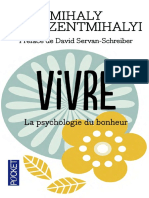Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Part Du Reste
La Part Du Reste
Transféré par
gertjanbisschopCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Part Du Reste
La Part Du Reste
Transféré par
gertjanbisschopDroits d'auteur :
Formats disponibles
La par t du reste : pour une conomie de la
contribution
Un entretien avec Bernard Stiegler
Anne Lardeux
Universit de Montral
et
Suzanne Beth
Universit de Montral
avec la collaboration de La Kalaora
Carleton University
Lide au fondement de ce numro Les paradoxes de la valeur tait de
faire un retour sur l'volution du dbat autour de la question de la valeur
telle qu'elle a t apprhende par les sciences sociales depuis la formulation
dfinitive, dfinitoire que Marx en a donn. Ce dbat ne nous semble gure
avoir volu depuis le XIXe sicle et continue de se dcliner entre deux ples :
d'une part un ple subjectif proche de Simmel selon lequel la valeur nest
jamais une proprit inhrente aux objets mais se constitue dans cet cart
entre sujet dsirant et objet dsir et d'autre part un ple objectif qui
rassemble des approches qui ne voient de formation de la valeur qu'
l'intrieur du processus objectif de la production marchande. Le travail de
Bernard Stiegler nous a interpelles en ce sens quil se situe au-del de ces
deux positions sans faire lconomie de leurs enjeux. Il dveloppe une
rflexion qui permet de rflchir la constitution du sujet en rapport avec la
consommation dans le contexte dune socit consumriste, tout en ouvrant
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
27
des pistes visant dpasser ce modle et de poser des bases pour une
nouvelle conomie politique.
Plus largement, ses ouvrages ont abord la question de la technique,
souvent mise de ct dans l'histoire de la philosophie occidentale au profit
d'une tradition de pense du savoir comme science. Sa rflexion sur les
implications de l'industrialisation de la production l'a conduit aborder de
nombreux aspects de notre monde contemporain, et particulirement les
effets des modifications techniques sur la transmission et l'acquisition des
connaissances.
Bernard Stiegler est philosophe, docteur de l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales. Il est prsident de lassociation Ars Industrialis; directeur
de l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Georges Pompidou;
professeur l'Universit de Londres (Goldsmiths College); professeur associ
l'Universit de Technologie de Compigne et visiting professor
lUniversit de Cambridge. Il a t directeur de programme au Collge
international de philosophie; directeur de l'unit de recherche Connaissances,
Organisations et Systmes Techniques de lUniversit de Compigne quil a
fonde en 1993; directeur gnral adjoint de l'Institut National de
l'Audiovisuel en 1996; directeur de l'IRCAM en 2001 et directeur du
dpartement du dveloppement culturel du Centre Georges Pompidou en
2006.
***
Notre premire question porte sur un extrait du quatrime chapitre de votre
livre Mcrance et discrdit, que nous reprenons in extenso :
Lconomie politique de la valeur esprit est celle de lconomie libidinale o
la valeur, en gnral, ne vaut que pour qui peut dsirer : elle ne vaut que
pour autant quelle est inscrite dans le circuit du dsir, qui ne dsire que ce
qui demeure irrductible la commensurabilit de toutes les valeurs.
Autrement dit, la valeur ne vaut que pour autant quelle value ce qui na
pas de prix. Elle ne peut donc pas tre intgralement calcule : elle
comporte toujours un reste, qui induit le mouvement dune diffrence, dans
laquelle seulement peut se produire la circulation des valeurs, cest--dire
leur change (Stiegler 2004).
Nous cherchons apprhender ce reste et ce qui en fait la valeur Selon
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
LA PART DU RESTE : POUR UNE CONOMIE DE LA CONTRIBUTION
UN ENTRETIEN AVEC BERNARD STIEGLER
28
vous, ce reste est-il quelque chose d'irrductible ou au contraire quelque
chose de fragile qu'il conviendrait de protger? Cette part du reste dont
vous parlez nous renvoie galement la part du sans-valeur
dont parle Nancy dans son livre Vrit et dmocratie, qui est la part de
l'incalculable, l'impartageable. C'est de l'attente d'un partage politique de
l'incalculable, nous dit Nancy, que provient la dception face la dmocratie.
L'individu dsaffect dont vous parlez est au-del de la dception, il est
atteint par cette forme de dsamour au point de commettre l'irrparable. De
cet anantissement, Nancy voit lever une commune poussire, celle
laquelle nous sommes promis. De votre ct, comment envisagez-vous la
question du commun dans cette dsaffectation?
Bernard Stiegler : Ce reste est en effet quelque chose dabsolument
fragile, ce quil y a de plus fragile pourrait-on dire. Je pense que pour
approcher cette question de la valeur, il faudrait repasser par Nietzsche et le
nihilisme qui est une question absolument cruciale. Nietzsche, et cest trs
connu, dfinit le nihilisme comme une dvalorisation ou une
dvaluation , comme une destruction de toutes les valeurs. Jessaie de
lire Nietzsche avec Freud dont je considre quil est un prcurseur.
Nietzsche parle de linconscient, du dsir : il est le premier finalement
parler de tout cela, presque la mme poque, dix ou quinze ans avant
Freud, mme si cest bien Freud qui identifie la question du dsir
proprement parler, comme on ne peut en parler que depuis Freud, et par un
saut bien au-del de la philosophie, Spinoza et Nietzsche compris. Ce nest
certes pas Freud qui nomme cela le dsir, ce nest que plus tard quon va
lappeler ainsi. Chez Freud, cela se nomme la libido telle quelle est
constitue par son conomie. Freud, petit petit, travers un long parcours
de plusieurs dcennies, puisquau dbut, cela nest pas identifi comme tel,
va faire merger ce que jappellerai, pour vous rpondre, le paradoxe de la
valeur.
La valeur est minemment paradoxale. Elle ne vaut, dune certaine manire,
que par comparaison avec dautres valeurs sinon il ne serait pas possible
de lvaluer. Lvaluation suppose la comparaison. Et pourtant, en mme
temps, ce qui possde de la valeur ne vaut que par rapport ce qui nest
pas valuable, par rapport ce qui chappe toute valuation ou pour le
dire dans un langage plus contemporain, plus moderne tout calcul. Que
ce soit minemment fragile, cest pour moi lvidence mme, et cette
fragilit renvoie une question qui nous concerne au premier chef notre
poque : savoir comment durer? Langoisse dans laquelle nous sommes
aujourdhui tient ce que tout le monde comme le disait Andy Warhol en
parlant des consommateurs de Coca Cola, du clodo du coin jusquau
prsident des tats-Unis en passant par Liz Taylor et lui-mme, tout le
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47
29
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
monde consomme du Coca-Cola disait-il. Eh bien aujourdhui, tout le monde
sait du clodo du coin Nicolas Sarkozy ou Barack Obama que rien
nest durable, que tout est absolument et foncirement menac et ce,
justement, par le paradoxe de la valeur. La valeur ne vaut que parce quelle
renvoie quelque chose qui na pas de prix, cest--dire qui est
incomparable. Cet incommensurable, la thologie a essay de le penser
pendant des sicles en rfrence au Dieu unique. Avant cela, on se rfrait
aux esprits, la surnature, aux mythes et leurs dieux, appelons cela
comme on veut.
Quoi quil en soit, depuis Freud, mais aussi avec Lacan qui place en son
centre la question du dsir, de lobjet du dsir, le problme se pose un peu
diffremment. Lobjet du dsir doit tre entretenu, doit tre cultiv : on
voue un culte lobjet du dsir; et cest ainsi le dsir lui-mme, travers le
culte quon voue son objet, qui doit tre entretenu. Contrairement ce
que croient beaucoup de freudistes (ces gens qui se revendiquent
dautant plus de Freud quils ne le lisent pas, comme tant de marxistes
lauront fait avec Marx), de deleuziens aussi, de spinozistes, le dsir nest
absolument pas une production spontane. Il y a des tres qui ne dsirent
pas : cela existe. Le dsir est quelque chose qui est produit, qui est produit
par une ducation, par un soin et je prends le mot soin au sens o lentend
Donald Winnicott. Le dsir, cest ce qui est constitu par une relation
daffection en particulier de la mre la mre pouvant videmment tre le
pre, ou la nourrice, etc. son enfant en lui vouant tout son dsir, dans
une relation o il est absolument vident que cet tre-l na pas de prix, quil
est incomparable tout autre, et que, bien entendu, je me sacrifierai pour
lui, je sacrifierai absolument nimporte quoi pour lui .
Cette structure relationnelle se trouve particulirement menace par le
nihilisme et par le capitalisme consumriste, et de nos jours, elle semble tre
en ruine. Mais elle est menace depuis toujours, et elle fut combattue de
tout temps.
Et elle est paradoxalement trs forte...
Bernard Stiegler : Oui, trs forte, condition dtre entretenue Si je ne
suis jamais all dans des socits de peuples premiers, comme on les appelle
aujourdhui en France, je suis all au Muse dethnographie de Leningrad,
aujourdhui Saint-Ptersbourg, qui est le plus grand muse ethnographique
du monde, un endroit fabuleux. Jai eu la chance de travailler, il y a fort
longtemps, sur les ides de Leroi-Gourhan qui tait un spcialiste des
Sibriens. Les Sibriens constituent un peuple extrmement intressant, ils
font le lien entre lEurope et lAmrique via les Indiens, puisque les Indiens
sont des Sibriens qui ont migr par le dtroit de Boering. Au muse
ethnographique de Saint-Ptersbourg donc, il y a un ensemble extraordinaire
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
LA PART DU RESTE : POUR UNE CONOMIE DE LA CONTRIBUTION
UN ENTRETIEN AVEC BERNARD STIEGLER
30
dobjets, des reconstitutions dhabitats sibriens et de scnes de la vie de
ces fameux chasseurs de phoques, de ces des socits chamaniques. Ces
peuples sont ce qui reste entre Europe et Asie, des socits formes autour
du chaman, que lon appelle dans les westerns lhomme-mdecine.
Or lhomme-mdecine est lhomme du pharmakon, au sens strict : cest
lhomme qui soccupe de ces substances qui ont le pouvoir de le mettre
dans des tats de transe, et de le faire passer sur un autre plan que la vie
ordinaire : prcisment le plan de lextra-ordinaire. Cest celui qui soigne et
qui empoisonne, cest--dire celui qui a accs ce qui est foncirement
ambigu, qui donne la valeur, mais qui peut lenlever aussi.
Ce qui est en jeu dans le savoir chamanique, cest ce qui joue dans lobjet
transitionnel de Donald Winnicott qui est la condition de constitution du
dsir. Si je nai pas de rapport un objet transitionnel, si je nai pas accs
travers cet objet transitionnel au dsir de ma mre, et si ma mre na pas
accs mon dsir en me faisant passer ou en maccompagnant, en nous
faisant passer par son accompagnement, et travers cet objet, sur un tout
autre plan eh bien je ne pourrais pas constituer mon dsir. Cela existe, il y
a des gens qui ne peuvent pas constituer leur dsir. On les appelle des fous,
des psychotiques. Cela ne veut pas dire quils ne peuvent rien signifier pour
nous, et gnralement, dans les socits anciennes, ce sont des tres
sacrs, qui sont tout fait ailleurs : qui sont dans le dlire.
Le travail du chaman qui est lui-mme un tre tabou le travail du chaman
dont la mre est une figure : la mre est une sorte de chaman pour son
enfant , cest de socialiser cela, et den faire du dsir qui va produire de la
valeur au sens de la chrmatistique dAristote, cest--dire, une valeur
calculable. Mais il est de la valeur qui na pas de prix et cette valeur qui na
pas de prix, se socialisant, produit finalement de la comparabilit, de
lgalit, de la solidarit, de la diffrence.
Quel rle joue ici la consommation?
Bernard Stiegler : La consommation et le consumrisme caractrisent une
socit trs rcente qui est apparue il y a exactement un sicle, et Joseph
Schumpeter commena en faire la thorie dans La thorie de lvolution
conomique, publi en 1911. Cest en analysant ce quest en train de faire
Henry Ford quil dveloppe cette thorie, de laquelle dcoule ce quil
appellera plus tard la destruction cratrice (dans Capitalisme, socialisme et
dmocratie). Cette socit consumriste repose sur une exploitation de
lobjet du dsir qui conduit sa destruction.
Mais quest-ce qui est dtruit exactement? Revenons en arrire Je
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47
31
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
soutiens, dans le livre auquel vous vous rfriez au dbut de cet entretien,
Mcrance et discrdit, que nous, nous cest--dire ceux que les Grecs
anciens appellent les mortels, ou ce quAristote appelle des mes notiques
cest--dire des tres capables daccder au nous, lesprit, mais
uniquement, dit Aristote, par intermittence nous, qui ne sommes ni dieux ni
btes, sommes perptuellement en train dosciller entre ces deux niveaux : la
btise et le dlire divin. Dans le langage de Freud, nous dirions que nous
sommes capables de dsirer, cest--dire de sublimer dans le dsir, cest-dire de devenir nous-mmes des tres sublimes. Dans le langage de Georges
Bataille, nous dirions que nous sommes capables de sacrifier. Mais il se
trouve aussi et cela, cest ce que Freud analyse cliniquement et dont il faut
une sorte de dcouverte scientifique que nous rgressons sans cesse, que
nous sommes mme condamns une constante rgression. Le
christianisme dcrit cela en nous assignant le statut de cratures : nous ne
sommes que des cratures, objets de misricorde. Jaccorde un sens plus
quhistorique ce discours : cest le sens de lOccident mme de lOccident
europen en tout cas.
Nous sommes ces tres-l en tant quils sont capables de dsirer, en tant
qutres mortels, en tant qutres notiques. Ces tres que nous sommes,
ou tentons dtre encore, vivent sur trois plans simultanment :
Le plan de la subsistance : nous devons subsister, nous devons chaque jour
accder tant de molcules deau, tant de molcules doxygne, tant de
protines, etc., sinon nous ne survivons pas. Nous sommes des animaux, et
en tant quanimaux, nous sommes soumis la loi de la vie et de la lutte pour
la vie. Nous devons satisfaire nos besoins organiques, mais nous avons
transform la lutte pour la vie en une socit qui, au lieu de tuer des
animaux, consomme des tranches de jambon achetes dans des
supermarchs, issues danimaux qui sont tus de manire industrielle dans
des abattoirs o nous ne voyons pas la mort. Cest ce que Rainer Maria Rilke
posait comme un immense problme de lhomme du XXe sicle qui a perdu
lexprience de la mort. Nous subsistons, nous devons subsister, mais une
vie ne vaut pas le coup dtre vcue si elle est uniquement rduite la
subsistance.
Le plan de la consistance : ce qui fait que la vie vaut la peine dtre vcue,
cest que nous puissions vivre sur un autre plan que la subsistance. Ce qui va
tre une grande question partir du XIXe sicle et qui va donner ce quon
appelle lexistentialisme o tout cela consiste mme si, et prcisment parce
que, la consistance, cela nexiste pas : ce qui consiste, cest ce qui na pas
de prix, nest pas comparable sachant que nexistent que des choses
comparables.
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
LA PART DU RESTE : POUR UNE CONOMIE DE LA CONTRIBUTION
UN ENTRETIEN AVEC BERNARD STIEGLER
32
Le plan de lexistence : lexistence, du moins telle quon en parle avec
lexistentialisme au XXe sicle, est une forme de la vie organique, mais une
forme de vie organique qui sorganise, si je puis dire, autour de quelque
chose dinorganique, qui est le ftiche. Ce que Freud appelle le ftiche en
1895, dont il reparle dans ses Trois thories de la sexualit en 1905, que
Winnicott appelle lobjet transitionnel, cest aussi ce que jappelle la
rtention tertiaire.
La rtention tertiaire est un objet de transaction conomique. Toutes les
rtentions tertiaires peuvent faire lobjet dchanges conomiques sur un
march, et donc tre des objets de calcul. En mme temps, ces rtentions
tertiaires, ces objets de calcul nont de valeur sur ce march que parce
quelles renvoient quelque chose qui est hors du march, et qui est le plan
de la consistance. travers les rtentions tertiaires, nous accdons aux
objets de nos dsirs Cest par exemple la bote aux trsors dans laquelle je
mets les cadeaux de mes enfants et petits-enfants, qui sont des objets qui
pour vous nont absolument aucune valeur et aucun sens, mais qui pour moi
sont sacrs. Ces objets sont chargs dun pouvoir symbolique qui procde
de ce que les Mlansiens appellent le mana et dont parle Marcel Mauss. Ils
donnent accs au plan de consistance qui est le plan qui nous renvoie ce
qui nexiste pas. Ce qui vaut ce qui veut toujours dire : ce qui vaut la peine
dtre vcu , cest ce qui nexiste pas.
Ce qui ne peut pas se partager?
Bernard Stiegler : Cela ne peut pas se partager parce que cela ne peut
pas tre lobjet dune division ni dune comparaison et en mme temps
cest la seule chose qui puisse tre partage, vraiment partage. Mais
comme un dfaut de communaut qui se rapporte toujours aussi et du
mme coup la communaut dun dfaut, et dont jai soutenu que cest
partir de ce faire dfaut (qui est aussi un faire signe, qui ouvre le flottement
du signifiant dont parlait Lvi-Strauss) quil faut penser das Ding aux sens de
Freud et de Lacan. Cest de cette Chose dont veut sans aucun doute
tmoigner leucharistie dans le christianisme et quelle prend pour (et qui
prend par) son Dieu.
Cette division infinie
Bernard Stiegler : Telle est la multiplication des petits pains, tel est le
miraculeux. Cest cet objet qui est la fois ce que le christianisme tardif dira
immortel, le Christ immortel, et ce que lon peut manger tous les dimanches,
ce que lon peut boire tous les jours, comme faisaient les sauvages du
corps et du sang de leurs ennemis quils mangeaient pour prendre leurs
mes et leur force.
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47
33
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
Et ce nest pas pour rien que cest du vin : cest aussi livresse, cest
Dionysos qui se cache l derrire, comme le dit le dernier Nietzsche lorsquil
fait du Christ et de Dionysos finalement la mme figure. Ma fille ane,
Barbara Stiegler, a crit l-dessus un livre formidable, Dionysos ou la critique
de la chair Pour rsumer ce que je viens de dire, si lon pose le problme
de la valeur, cest--dire de lconomie, il faut raisonner sur ces trois plans
en mme temps. Il y a la question de la valeur du point de vue de la
subsistance, par exemple : je suis dans le dsert, jai un milliard de dollars
dans ma poche, je peux donner un milliard de dollars pour un litre deau un
Bdouin qui passe . La loi de la subsistance est impose la valeur. Mais
elle ne suffit pas constituer une valeur, cest--dire un change. Il y faut
une autre loi, qui est celle de lexistence. Hegel appelle cela la
reconnaissance, et Kojve, le dsir de reconnaissance. Cest la dialectique du
matre et de lesclave, qui va faire que lesclave se soumet au matre, quil va
prfrer vivre, protger sa subsistance plutt que dtre libre, et qui va ainsi
diffrencier la socit : en faire une organisation sociale. Mais dans son
alination, dit Hegel, lesclave va se soumettre en travaillant, cest--dire en
existant dabord par la reconnaissance du matre, qui est la raison de sa
soumission, puis dans la dialectique historique de cette reconnaissance, en
sindividuant par le travail et en renversant la situation comme artisan
devenant un bourgeois. Lesclave, cependant, na pas accs au consistant
comme tel tant que la socit nest pas devenue celle des bourgeois qui
reverseront les restes monarchiques de la fodalit, renversement dont
Hegel est le tmoin subjugu. En attendant la rvolution, cest le matre qui
a accs lotium. Mais aprs la rvolution, otium et negotium
sindiffrencient : cest le dbut du nihilisme, et nous voici revenus la case
dpart et Prima della revoluzione, un film que je rve de revoir
(introuvable) o lon parle de tout cela dans mon souvenir trs lointain...
Une des questions fondamentales, quant la valeur, est en effet celle de
lotium et du negotium. Le matre a accs lotium et non lesclave, mais
dans la dialectique du matre et de lesclave, finalement, et par le travail,
lesclave va accder quelque chose qui est de lordre de lotium.
Est-ce que lesclave arrive au plan de lexistence par le biais de
lobjectivation?
Bernard Stiegler : Lesclave arrive en effet au plan de lexistence par
lobjectivation, cest ce que dit Hegel, mais cette objectivation devient ellemme une grammatisation machinique qui court-circuite lindividu (cest
ainsi que Simondon dcrit le machinisme industriel comme une
dsindividuation) o il ny a de travail, mais de lemploi ce que Marx appelle
du salariat. Cest bien de cela dont il est question chez Marx en particulier
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
LA PART DU RESTE : POUR UNE CONOMIE DE LA CONTRIBUTION
UN ENTRETIEN AVEC BERNARD STIEGLER
34
dans les Fondements de la critique de lconomie politique et cest
dailleurs un texte sur lequel je publie un livre au mois de janvier 2012.
Lobjectivation chez Marx ne signifie pas lobjectivation au sens de Descartes
ou de Newton, bien entendu : cela signifie lobjectivation au sens du devenir
objet, de lextriorisation. Le terme est dailleurs employ par Marx. Mais
cette extriorisation, que lon trouve dabord chez Hegel, comme le dbut
mme de sa phnomnologie de lesprit, qui ne sapparat lui-mme
quainsi, en se projetant hors de lui, cette extriorisation dans la dialectique
du matre et de lesclave rinterprte par Marx constitue un savoir parce
que finalement le travail, cest ce qui me donne accs un savoir et cest
ce que dit Hegel dj. En travaillant, lesclave va accder un savoir, et va
finalement acqurir une matrise, la matrise de celui qui travaille. Et cest
comme a quune dialectique va soprer. En fait ce que pense ici Hegel,
cest la bourgeoisie. Mais ce nest en aucun cas le proltariat.
Hegel analyse la faon dont la classe des bourgeois de ceux qui travaillent,
qui sont aussi ici ceux qui ngocient, les ngociants qui, la diffrence des
nobles qui sont dans lotium, sont contraints rester pris dans le negotium
vont accder une nouvelle forme, une forme rvolutionnaire de lotium.
Peu de lecteurs de Hegel ont compris cela parce quils ont lu Hegel partir
de Marx.
Or Marx va rfuter que lon pense ainsi le travail partir de la bourgeoisie,
partir de cet habitant du bourg quest lartisan, qui deviendra plus tard le
bourgeois au sens moderne. Marx va dplacer cette question du travail et de
sa dialectique de la reconnaissance en la projetant sur la classe ouvrire.
Quoi quil en soit, cest bien en passant par lobjectivation, par la mise en
extriorit du savoir que va se constituer une reconnaissance au sens de
Hegel, qui est une forme dexistence. Cest--dire que lesclave, dans la
dialectique du matre et de lesclave, va reconqurir une existence. Le
monde va devenir le monde de lesclave; autrement dit, le monde de la
bourgeoisie chez Hegel. Cette forme de lexistence, nanmoins, ne se
constitue quen donnant accs un autre plan, qui est celui de la
consistance, soit : le plan de ce qui na pas de prix.
Ce que je vous disais tout lheure concernant la subsistance dsigne le plan
o tout est rapportable la lutte pour la vie, tout est mis sur le mme plan,
tout est absolument comparable. Vivre ainsi, cest pour un tre notique
rgresser. Sur le plan de lexistence, il est possible de comparer, mais on ne
compare quen rfrence avec quelque chose qui na pas de prix : la
comparaison est le principe de ralit dun dsir de ce qui est incomparable,
et qui est le principe de tout plaisir. Cet inexistant est cependant symbolis
par ce qui est ce quil y a de plus cher comme, par exemple, ltalon or, qui
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47
35
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
lui-mme renvoie quelque chose dautre : cest ce qui saute aux yeux dans
lglise prs du quai de lor qui se trouve sur la rive du Guadalquivir Sville.
Lor des Espagnols, pour voir ce que a signifie, il faut aller Sville, il faut
aller dans cette glise dont jai oubli le nom, lglise de cet or qui revenait
dAmrique et au nom de quoi on a massacr tant de millions dIndiens, or
qui rachetait ces crimes, croyaient ces assassins, en tant vou Dieu sa
splendeur. Tout cela na de sens pour les Espagnols (sinon pour les bandits
quils envoyaient en Amrique latine commettre leurs basses uvres aux
cts des conquistadors) que dans une relation au Christ, et donc ce qui
renvoie quelque chose dautre.
Je crois et lon pourrait parler ici de Max Weber et de son analyse de la
transformation de la figure de Dieu par le protestantisme comme origine du
capitalisme quun systme de valeur, parce quon parle souvent dans ces
termes-l, et parce quen conomie on tudie des systmes de valeur, ne
fonctionne que pour autant quil est capable de maintenir quelque chose qui
est hors march, qui ne se ngocie pas, et qui va constituer ce que jappelle
avec Freud une conomie libidinale qui maintient des plans de consistance
en maintenant hors conomie des existences et des subsistances cest-dire hors conomie marchande, et au profit de quelque chose qui nest
pas ngociable (et qui est la Chose, das Ding).
Et qui donc se maintient en maintenant cet cart entre le sujet dsirant et
lobjet dsir dans lequel lchange se fait?
Bernard Stiegler : En effet : le sujet dsirant existe tandis que lobjet
dsir consiste cest--dire le dpasse. Et si on ne maintenait pas une
diffrence entre ce qui existe et ce qui consiste je parle l de choses qui
proccupent tout le monde tous les jours la justice nexisterait pas Les
sans-abris, les homeless sont dans linjustice pure. Nous en avons la preuve
chaque jour, en attendant que peut-tre nous en fassions lpreuve nousmmes ou nos proches un jour Mais mme sans parler de ces situations
terribles, ce que dit ladage populaire le bonheur des uns fait le malheur
des autres , lexprience quotidienne le valide et confirme quen effet,
nous vivons dans linjustice constante. Hraclite dit que pour avoir le
sentiment de la justice, il faut avoir le sentiment de linjustice cest--dire
savoir ce quest linjustice, cest--dire : tre injuste soi-mme, tre hant
par linjustice en soi-mme. Si on ne sent pas linjustice de la vie, on ne peut
pas savoir ce quest la justice. Ce qui revient dire que la justice nexiste
pas. La justice est strictement ce que Kant appelle une ide.
La question est ici celle de ce que jappelle les systmes de soin : cest la
question de ce qui prend soin de ce qui consiste en tant que dispositif social
formant une thrapeutique par o est faite lconomie de ce qui dans le
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
LA PART DU RESTE : POUR UNE CONOMIE DE LA CONTRIBUTION
UN ENTRETIEN AVEC BERNARD STIEGLER
36
pharmakon est le toxique par excellence : linjuste. Ces dispositifs quils
soient chamaniques, quils soient mythologiques au sens des Grecs, quils
soient chrtiens ou quils soient dsirants en gnral sont ce qui pose quil
y a des choses qui nexistent pas, mais que a nest pas parce quelles
nexistent pas quelles ne consistent pas. Toute lorganisation dune socit
doit tre base sur le culte de ce qui nexiste pas et qui est la condition de
lexistence. Si ces objets qui nexistent pas disparaissent, si nous ne sommes
plus capables de prendre soin deux, eh bien lexistence devient de la
subsistance, et tout le monde se met vivre sur un trottoir. Aujourdhui,
nous vivons tous sur des trottoirs. En disant cela, je ne veux pas dire
videmment que je suis dans la mme condition que les gens dont je parlais
tout lheure. Ce que je veux dire, cest que je me sens condamn tre
finalement sur une espce de trottoir de luxe et y faire le trottoir de
luxe.
Nous sommes face cette absence dhorizon collectif dont vous parlez dans
Mcrance et discrdit, nous vivons dans cette dsaffectation gnralise?
Bernard Stiegler : Oui nous sommes dsaffects en effet, nous vivons
dans ce que jai appel une misre symbolique qui frappe absolument tout le
monde et qui fait que les gens ont le sentiment que la vie ne vaut plus la
peine dtre vcue. Que le suicide est la premire cause de mortalit de la
jeunesse, que les conduites quon appelle risque, conduites addictives,
dintoxication volontaire se gnralisent. Ces conduites risque sont, de nos
jours en France, le premier problme que doivent affronter la psychiatrie et
la psychothrapie. Jrome Kerviel, cest une conduite risque; Nicolas
Sarkozy, cest une conduite risque; Papandreou1 cest peut-tre aussi une
conduite risque. Nous vivons sur un volcan, celui des conduites risques, y
compris des conduites risque de TEPCO qui exclut de son conseil
scientifique le sismologue qui souligne que la centrale nuclaire de
Fukushima pourrait ne pas tenir le coup au prochain sisme. Tout cela, ce
sont des conduites risque. Ce sont des comportements domins par la
pulsion de destruction. Nous avons dtruit la libido, la capacit de faire la
diffrence entre la subsistance, la consistance et lexistence; nous avons
dtruit lobjet du dsir, il ny a plus que des objets de pulsion.
Au milieu de cela, de cette absence dhorizon collectif, merge aussi du
mme trottoir sur lequel nous sommes condamns vivre, ce courant
doccupation qui, la suite dOccupy Wall Street, essaime partout en
Amrique du Nord, dans le monde, y compris ici Montral, et qui rappelle
les mouvements arabes et celui plus europen des indigns. Cette
1
Lentrevue sest droule le jour de lannonce du premier ministre grec George Papandreou
de la tenue dun rfrendum populaire sur le plan daide europen ngoci par Merkel et
Sarkozy.
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47
37
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
occupation peut se lire comme une attention collective rveille, un soin on
occupe pour soccuper de . On peut ainsi lire sur des pancartes au Zuccoti
Square de New York I take care of you . Bruno Latour crit quil faut
soccuper des affaires des autres, se mler de ce qui ne nous regarde pas,
comme dans un orchestre o, pour bien dire sa note, on se doit dtre
attentif celle des autres. Comment interprtez-vous ce mouvement?
Bernard Stiegler : La question est de savoir comment un apprentissage
peut natre de ce mouvement salutaire et terriblement dmuni. Et jessaie de
comprendre pourquoi on ne le trouve pas en France. La France, qui est soidisant le pays rvolutionnaire par excellence, est quasiment le seul pays au
monde o, en ce moment, il ne se passe peu prs rien pour autant que je
le sache. En France, il y a la tradition darticuler ce type de mouvement
social une analyse des causes, la construction dun discours, que ce soit
Montesquieu, Robespierre, Jaurs ou Debord. Or cette analyse est ici
absente. Cest la raison pour laquelle je crois que cela ne dmarre pas chez
nous. Mais cela va peut-tre dmarrer, et en gnral, quand cela prend, cela
prend vite de lampleur. Cela ne prend pas, puis cela ne prend toujours pas,
et quand, dun seul coup quand cela prend, a met le feu partout. Je crois
cependant que le climat social est tellement tendu en France que les gens
nosent pas bouger de peur que cela profite autant au Front National qu
Sarkozy, cest trop dangereux. Cest bien pire quen Italie, o les Italiens ont
compris, et ne veulent plus du berlusconisme. En France, derrire Sarkozy, il
y a Marine Le Pen qui arrive
Alors que l, cest une indignation seule qui sexprime...
Bernard Stiegler : Stphane Hessel, qui est un monsieur de 95 ans, a t
un grand rsistant et a t dport; il a utilis sa lgitimit historique en
publiant un petit texte, Indignez-vous!, qui sest vendu 3 millions
dexemplaires dans le monde. Je trouve ce livre absolument touchant, mais
si vous le lisez, il ny a rien, cest le vide! Stphane Hessel a publi depuis
avec trois grands rsistants, dont Edgar Morin, pour le plus connu dentre
eux, un texte qui propose de revenir au Conseil national de la rsistance Or
nous sommes en 2011. La lecture de ces propositions est assez
consternante. Il ny a pas un mot dans tout cela sur ce quil se passe en ce
moment. Je crois que ce mouvement des indigns surgit aprs 40 ans de
dmission politique, intellectuelle, artistique, dans la lutte conomique et
politique depuis la rvolution conservatrice avec Thatcher et Reagan. Cest
ce qui a pos quil ny avait pas dalternative au dveloppement illimit du
capitalisme, et cest finalement ce que les franais qui ont fait le
poststructuralisme ont accept. Quand vous regardez ce quils disent, il
ny a rien contre le discours de la rvolution conservatrice qui conduit la
crise actuelle. Que dit Lyotard dans La condition post-moderne? Il ny a pas
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
LA PART DU RESTE : POUR UNE CONOMIE DE LA CONTRIBUTION
UN ENTRETIEN AVEC BERNARD STIEGLER
38
dalternative. Arrtons de nous raconter des histoires sur le sujet historique
du proltariat, dit-il. Cela na pas march : Hegel, ce nest pas srieux, Marx
sest tromp. La modernit sest trompe nous sommes maintenant dans
la postmodernit, il ny a pas dalternative : telle est la fin des grands rcits.
Or je crois que les questions ne devaient pas tre poses en ces termes, et
que les poser ainsi, ctait en quelque sorte dy enfermer en ngatif.
Plus gnralement, pendant 40 ans, cette pense, qui a domin le monde
entier, na rien formul en termes dconomie politique rien sur le devenir
spculatif du capitalisme et sur limmense processus de dsinvestissement
gnralis qui a rendu possible ce devenir destructeur. Qua dit Foucault
dans les annes 1980? Il a dit que ltat tait caduc, ce en quoi il avait
certainement raison. Mais il na rien dit ni rien vu du marketing qui dtruisait
toute puissance publique. Si la figure de ltat est caduque, cela ne veut pas
dire que la puissance publique est caduque. Mais qua-t-il propos quant la
reconstruction dune puissance publique capable, capable de prendre soin de
ce qui nest pas valuable sur un march? Quont dit tous ces gens sur le
fait quil y a quelque chose qui nest pas rductible au march? Pas grand
chose. Cela ne veut pas dire quils nont rien dit. Derrida a essay de parler
de cela dans Spectre de Marx, mais mon avis, il a compltement chou.
Deleuze a sans doute essay de penser cela avec les machines dsirantes,
mais la manire dont il a trait le dsir, tout comme Lyotard dailleurs dans
Lconomie libidinale, a conduit ce quon ne puisse pas distinguer le dsir
de la pulsion.
Il y a eu deux grands malentendus dans la pense dite poststructuraliste
et qui concernent dune part le concept de proltariat, dautre part celui de
dsir. Le proltariat a t confondu avec la classe ouvrire et avec la
pauprisation, alors que le proltariat est le rsultat dun processus, la
proltarisation qui touche tout le monde en tant que perte de toutes les
formes de savoirs : savoir faire, savoir vivre et savoir penser. Le dsir a t
conu avec la thorie freudienne de la premire priode, mais les enjeux du
tournant de 1920, o Freud distingue trs nettement le dsir de la pulsion,
nont jamais t explors sous cet angle dune distinction entre dsir et
pulsion. Lenjeu en est lconomie du dtournement des buts pulsionnels en
puissance dinvestissement et cela a t largement ignor cependant que la
dsconomie libidinale consumriste se dveloppait en dtruisant le dsir.
Nous entrons dans une autre poque : nous ne sommes plus dans la postmodernit, nous sommes dans quelque chose de nouveau que je ne sais pas
nommer, mais dont lenjeu est pour moi le passage ce que jappelle la
pharmacologie positive cependant que la pharmacologie ngative est ce
qui indigne les indigns. Les indigns ne sont pas indigns seulement par ce
qui se produit sur les places boursires mondiales : ils le sont aussi par une
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47
39
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
socit qui na pas t capable de produire une critique de cette situation.
Et je ne suis pas du tout daccord avec Deleuze et avec Derrida quand ils
disent que lon doit dpasser la critique. L-dessus, je me suis toujours
affront avec Derrida : je crois au contraire quil faut engager une nouvelle
critique mais une critique pharmacologique, ce qui passe par une relecture
de Kant que jai tente dans Le temps du cinma, o le pharmakon constitue
ce que jy ai appel la quatrime synthse, qui est la condition du
schmatisme de limagination.
Ces positions sont reprises par Latour et Callon pour lesquels il ny a pas de
sol extrieur possible do formuler une critique. Ils proposent en revanche
dessayer de comprendre le calcul dun march particulier et den analyser la
formule
Bernard Stiegler : Je ne crois pas cela. Je pense que la formule du
march cest une formule magique cest--dire une tche aveugle qui
nest pas rductible au march, faute de quoi le march ne marche plus. Il
faut de la magie, enfin ce quon appelait autrefois de la magie, que lon a
ensuite appele de la transcendance partir du judasme, et que lon appelle
partir de Lacan du dsir cest--dire un objet du dsir qui renvoie ce
que Freud appelle das Ding, et dont jai tent de montrer (dans Ce qui fait
que la vie vaut la peine dtre vcue) que cest la question du dfaut, cest
dire l aussi du pharmakon, mais comme objet dinvestissement, par exemple
comme objet transitionnel qui constitue le dsir de lenfant comme celui de
sa mre. Or, le dsir, il faut le cultiver.
Cest dans ce sens-l quau sein dArs Industrialis2 nous soutenons quil faut
reconstruire une conomie du dsir que nous appelons lconomie de la
contribution. Une telle conomie se construit en ce moment, et cest une
conomie industrielle. Ce nest pas une utopie, comme le disent parfois
certains : cela existe. Je travaille avec des gens dans cette conomie, tous
ceux qui sont dans le modle du logiciel libre, de lopen source travaillent
dans cette conomie. Les gens qui travaillent dans mon institut qui ne
sont pas trs bien pays, qui gagneraient beaucoup mieux leur vie dans des
entreprises prives
restent avec nous parce quils ne sont pas
essentiellement motivs par leurs salaires, mais par les savoirs quils ne
peuvent cultiver que dans cette conomie et cette organisation
contributives. Ils veulent de largent pour tre capables de payer leur loyer
et dlever leurs enfants, mais ce quils veulent surtout, cest faire quelque
chose de bien.
Lassociation Ars Industrialis a t cre le 18 juin 2005 linitiative de Bernard Stiegler. Dans
le Manifeste rendu public cette occasion, elle se prsente comme une Association
internationale pour une politique industrielle de lesprit .
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
LA PART DU RESTE : POUR UNE CONOMIE DE LA CONTRIBUTION
UN ENTRETIEN AVEC BERNARD STIEGLER
40
Quelque chose qui vaille le coup...
Bernard Stiegler : Oui! Et a, cest ce qui fait fonctionner lopen source,
cest ce qui fait fonctionner lconomie de la contribution, que jappelle
lconomie libidinale.
Est-ce que cest pour vous une faon denvisager la technique comme
quelque chose qui ne soit pas seulement un moyen de production de la vie
humaine o lindividu se trouve arraisonn dans des rapports de force qui le
dpassent, dans un processus dobjectivation qui laline, mais comme
quelque chose qui fait retour sur le sujet en lui permettant de dvelopper
des formes de vie singulires?
Bernard Stiegler : La technique est ce que jappelle le pharmakon. Tout
objet technique est un poison. Seuls ces poisons peuvent devenir des
remdes. Cest ce que dit Winnicott propos de lobjet transitionnel. Une
mre ou un pre fragile, qui ne sen sort pas et cela peut arriver tout le
monde laisse lobjet transitionnel devenir un objet daddiction : un objet
qui va empcher lenfant de se socialiser et de devenir adulte. Mais cest ce
qui arrive aux adultes eux-mmes : ce qui arrive nous tous en permanence
lorsque lobjet de notre dsir devient un objet de notre addiction. Cette
addiction peut se dvelopper sous une forme douce, lobjet de notre
habitude, tout simplement, et on en a dailleurs absolument besoin, cest la
condition mme de lexistence. Il faut cependant tre capable den sortir, et
de la dpasser Cest lobjet du march, lhabitude : cest ce qui est
marchandable. Toutes les marchandises sont des choses qui ont ce que Marx
appelle une valeur dchange, rductibles lquivalent gnral quest
largent. Les marchandises ne peuvent faire un monde que pour autant
quelles soutiennent un commerce qui nest pas rductible un march,
cest--dire une simple valeur dchange. Je nappellerais pas pour autant
cela une valeur dusage. Je parlerais plutt dobjets de savoirs, cest--dire
de saveurs. La proltarisation (des producteurs, des consommateurs, de nos
jours des dcideurs et des concepteurs ), cest ce qui a dtruit ces
saveurs et les objets de savoir en gnral. Alors, le milieu semble se
dissoudre dans un environnement. Nous parlons quant nous de dissociation
des milieux en soutenant quun milieu est toujours associ au sens de
Simondon : ceux qui y vivent lindividuent en sy individuant. Dans les
environnements actuels, on survit en se dsindividuant et sans prendre part
en rien au devenir, au milieu qui est prcisment dissoci en ce sens sauf
lorsque le pharmakon numrique permet de faire merger de nouveaux
processus dindividuation.
Lconomie de la contribution dveloppe des processus de dproltarisation.
Lconomie libidinale capitaliste a conduit la destruction du dsir et de la
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47
41
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
valeur dans tous les domaines, chez les producteurs proltariss, puis chez
les consommateurs proltariss, enfin chez les concepteurs proltariss,
academics , dcideurs , ingnieurs, etc. des proltaires de haut
niveau qui ne font que servir les systmes techniques en y perdant
connaissances si jose dire ainsi dAlan Greenspan qui a lui-mme expliqu
cela la Chambre des reprsentants pour justifier son incurie face aux
systmes automatiss de titrisation et labsence totale de modle critique
de son ct. Tels sont les proltaires du thorique : ils ont perdu laccs la
thorie.
Les travailleurs de lconomie de la contribution conoivent des modles de
dproltarisation qui constituent une nouvelle organisation du travail et une
nouvelle conomie du travail. Jai lu dans Le Devoir3 un article dun
dmographe chinois qui soutenait quen Chine, des chercheurs rflchissent
des modles non consumristes. Je crois que cest le seul sujet despoir
rel quon puisse avoir que se dveloppent les modles de lconomie de la
contribution, que lont trouve dans de nombreux secteurs, lnergie, avec les
smart-grids contributifs, la construction mme : larchitecte Patrick Bouchain
est ainsi en train de mettre en place un modle dhabitat social construit en
partie par ses habitants. Pour en revenir aux indigns, il faut les armer avec
ces concepts-l pour quils ne restent pas dsarms, comme une puissance
nue manifestant contre sa destruction sans arme.
Agamben parlerait de singularits quelconques qui justement chappent la
reconnaissance...
Bernard Stiegler : Mais je ne suis pas daccord avec Agamben. Jai essay
de prciser pourquoi dans Prendre soin. Agamben est un foucaldien noncritique, qui ne lit Foucault que dans un certain sens, et qui oublie tout ce
qui, dans Foucault, ne va pas dans son sens en particulier en ce qui
concerne les dispositifs , dont il refuse ou dnie ce que je crois tre leur
dimension irrductiblement pharmacologique. Ctait sans doute un objet de
sa rupture avec Derrida. Cela dit, Derrida lui-mme napporte rien pour
penser une pharmacologie positive, mme si rien ne lempche non plus. Ce
que jappelle une pharmacologie positive, cest ce qui ouvre les perspectives
dune politique du pharmakon.
Vous participez mettre en place des collectifs qui rflchissent des
faons dexplorer des voies possibles cette transmission dissues dont vous
venez de parler mais vous posez nanmoins la question des critres
dvaluation dans le cadre de cette transmission. l'ge d'une
industrialisation trs avance des rtentions tertiaires, quelles exigences,
quels critres sont possibles aujourdhui au regard des critres
3
Dat du 31 octobre, dans le cahier spcial 7 milliards .
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
LA PART DU RESTE : POUR UNE CONOMIE DE LA CONTRIBUTION
UN ENTRETIEN AVEC BERNARD STIEGLER
42
traditionnels tels que la recherche documentaire (par rapport Wikipedia,
par exemple) dans une cole o la valeur fondamentale accorde l'criture
comme formalisation de la pense sest dplace? Comment une intelligence
peut-elle s'individuer dans ces conditions daccessibilit du savoir, comment
peut-elle se singulariser?
Bernard Stiegler : La question que vous posez l, et laquelle je
mintresse beaucoup, est celle des nouvelles socits savantes. Il se
dveloppe lpoque du numrique dextraordinaires comportements, des
cultures de consistance qui mergent spontanment, que personne na
prises en charge ni curs, ni professeurs, ni personne. Parce quil y a
encore, contrairement ce que croit Agamben, beaucoup de capacits
notiques, certaines personnes semparent de ce que le numrique rend
possible dans les champs du savoir et y crent des relations de consistance.
Compte tenu du caractre rtentionnel du savoir, du rle de la rtention
tertiaire dans le savoir, le numrique est une sorte de rvolution
rtentionnelle.
Le savoir tel que nous le pratiquons dans les universits du monde entier est
n Athnes, dans ce jardin quon appelait lAcadmie. Dans cette
Acadmie, partir de ce quAristote (qui y enseignait alors la rhtorique)
appelle les enseignements acroamatiques, cest--dire les enseignements
pour les initis, il sagissait aussi de produire des savoirs exotriques pour
tous les citoyens dAthnes. Ces enseignements devaient tre conformes
aux canons de l'exprience de laltheia, de la vrit, cest--dire de
l'exprience de la dmonstration en gomtrie, devenant de cette manire le
canon de la cit elle-mme, de ses critres dindividuation. Cest partir de
lexprience gomtrique de la dmonstration, en tant quelle est le point
dorigine de toute exprience de la vrit, que lon doit prendre soin de soi
et des autres, et vivre politiquement (cest--dire civilement).
Lon Robin montre que lorsque Platon cre lAcadmie, il entend instituer
une cole de formation des citoyens et de ceux qui doivent les encadrer. Or
cette cole est une institution dcriture : on narrte pas dy crire des
textes. Qua fait Platon? Il a produit un grand nombre de textes, dont
certains ont t perdus. Lui et ses lves ont transform le pharmakon
toxique, dont ils dnonaient lusage quen faisaient les sophistes, en un
pharmakon curatif qui a vu la multiplication des coles de philosophie qui ont
dailleurs structur toute lAntiquit bien aprs Jules Csar jusqu
Augustin.
Cest partir de cette matrice, combine aux institutions du monothisme,
quen 1088 Bologne une acadmie de clercs a t appele Universitas .
Cette machine socialiser la rtention tertiaire alphabtique et manuscrite
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47
43
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
qui, partir de 1165, jouit en principe dune autonomie sans limites, va
refonder lEurope occidentale. Cest partir de cette nouvelle matrice
acadmique que se dvelopperont les universits de la Sorbonne, dOxford,
de Cambridge et de Harvard. Au temps de Luther, le pharmakon littral
manuscrit devenu imprim rend possible la Rforme et un nouveau rapport
au savoir, qui est la condition du capitalisme. En passant par la Rpublique
des Lettres, ce nouveau rapport au savoir forme lhorizon de lUniversit de
Berlin telle que Humboldt la fonde sur la base des analyses de Kant. Cette
universit est une machine socialiser la rtention tertiaire alphabtique,
manuscrite puis imprime.
Au XXe sicle se dveloppent les industries des rtentions tertiaires
analogiques : photographie, phonographie, cinmatographie, radio-diffusion
et tlvision, que les industries de la rtention tertiaire numrique absorbent
finalement depuis 1992 cinq sicles aprs la conqute de lAmrique.
Internet gnralise et plantarise laccs la rtention tertiaire numrique.
Le tout le monde et le nimporte qui, dont parlent aussi bien Agamben que
Rancire, est de plus en plus constitu par ce rapport la rtention tertiaire
devenu commun.
Lenjeu de la gnralisation des rtentions tertiaires numriques, cest la
reconfiguration intgrale des conditions de formation des rtentions et des
protentions sous toutes leurs formes si ce que jai essay de montrer
depuis une vingtaine dannes est vrai, savoir que les rtentions primaires,
telles que Husserl les a dfinies, constituent ltoffe de ce que Kant nommait
le sens interne. En effet :
. Ces rtentions primaires sont des prlvements dans des flux dont les
critres de slection sont constitus par les rtentions secondaires
psychiques des individus, qui forment leur mmoire.
. Les rtentions tertiaires surdterminent les rapports entre ces rtentions
primaires et secondaires.
. Ces jeux rtentionnels produisent des protentions, cest--dire des
attentes.
. Rtentions et protentions constituent des formes attentionnelles :
lattention rsulte du jeu des rtentions et des protentions.
. La raison , et tout ce que lon enseigne dans le monde acadmique, est
constitu par la forme attentionnelle rationnelle dont la gomtrie est la
matrice et qui suppose elle-mme la rtention tertiaire littrale.
. La raison est ainsi la forme attentionnelle qui engendre des corps de
rtentions secondaires collectives rationnellement transindividues que lon
appelle les disciplines acadmiques.
Or je crois que la rtention numrique permet de nouvelles formes de
transindividiuation rationnelle au sein des disciplines acadmiques, entre les
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
LA PART DU RESTE : POUR UNE CONOMIE DE LA CONTRIBUTION
UN ENTRETIEN AVEC BERNARD STIEGLER
44
disciplines du monde acadmique et entre ce monde acadmique et ce que
je considre constituer de nouvelles socits savantes. Cette expression
(socits savantes) se rfre au texte Le conflit des facults, o Kant dit
quil faut que lUniversit travaille avec les socits savantes, qui ne sont
pas composes duniversitaires et de professeurs patents, quil nomme des
savants corporatifs , mais de savants indpendants , dit-il, des savants
formant des corporations libres , issues de la Rpublique des Lettres. Leur
origine est lhonnte homme, lui-mme lorigine de la science moderne.
lpoque du pharmakon numrique, et sil est vrai que celui-ci traverse
aussi bien les communauts acadmiques que les nouvelles socits
savantes qui mergent sur le rseau que forme le web, il nous faut inventer
et concevoir une nouvelle faon de faire de la recherche. Il s'agit d'une
recherche contributive, o la rtention numrique fait apparatre de
nouveaux processus publics et polmiques de transindividuation
controverses auxquelles participent des personnes qui nappartiennent pas
aux corps acadmiques mais qui savent beaucoup de choses, et parfois
beaucoup plus de choses que nous, les academics. Aujourdhui, nous, les
universitaires, devons tre capables de transmettre les mmoires et les
savoirs des rtentions tertiaires du pass ceux qui sont en train de mettre
en uvre les nouvelles rtentions tertiaires. En effet, les rtentions
tertiaires sont toujours pharmacologiques. Elles sont toxiques, en tant
qu'elles provoquent des courts-circuits dans les processus de
transindividuation. Elles ne deviennent curatives que si, relies les unes aux
autres, elles sont remises au service des circuits de transindividuation trs
longs et potentiellement infinis qui forment les disciplines dites rationnelles
ainsi la gomtrie qui est, comme tout savoir rationnel, apodictique ou non,
infiniment ouverte.
Lcriture alphabtique na pas supprim le rapport la mythologie, qui reste
inscrite au cur mme de la philosophie naissante, si complexe que puisse
tre cette inscription. Et le rapport la mythologie nous relie la socit
chamanique. Tout cela, qui est li des rgimes de rtentions tertiaires,
ftiches, churinga et objets investis desprit en tous genres. Ceci
comprend le livre, que Husserl analyse dans ses Recherches pour la
constitution, et dont le web constitue le nouveau dispositif de publication.
Tout cela se transmet et conditionne la formation de ce que Freud appelle
linconscient qui noublie rien et qui constitue la relation intergnrationnelle
laquelle est le principal sujet de la Bible : du Livre. La Bible est un discours
sur la faon de lier les gnrations entre elles sous lautorit dun unique
inengendr.
Aujourdhui, la grande question est le divorce intergnrationnel, combin
lexplosion dmographique, dont parlait lexcellent cahier du journal Le
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47
45
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
Devoir publi au Qubec en date du 31 octobre 2011. Cest dans ce
contexte que lUniversit doit repenser son rapport la rtention tertiaire,
doit la reconstituer de lintrieur, faute de quoi elle sera anantie. Mais elle
doit aussi la relier ce qui est hors delle. Je tente desquisser les principes
et les perspectives dun tel programme sous le nom de digital studies (et
non seulement de digital humanities) dans TATS DE CHOC. Btise et savoir au
XXIe sicle, un ouvrage paratre en janvier 2012 aux ditions Fayard.
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
Prendre soin de ce qui vaut.
Un entretien avec Bernard Stiegler
Rfrences
Derrida, Jacques
1997 Spectres de Marx. L'tat de la dette, le travail du deuil et la
nouvelle Internationale. Paris: Galile.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
1999 Phnomnologie de l'esprit. Paris: Aubier.
Husserl, Edmund
1996 Recherche phnomnologiques pour la constitution. Paris: PUF.
Jorion, Paul
2010 Le prix. Bellecombe-en-Bauges: ditions du Croquant.
Kant, Immanuel
1955 Le conflit des facults en trois sections. Paris: Vrin.
Lyotard, Jean-Franois
1979 La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris: ditions
de Minuit.
Marx, Karl
1963-1968 Le capital in uvres tomes 1 et 2. Paris: Gallimard.
Nancy, Jean-Luc
2008 Vrit de la dmocratie. Paris: Galile.
Schumpeter, Joseph Alois
1999 Thorie de l'volution conomique. Paris: Dalloz.
Stiegler, Barbara
2005 Nietzsche et la critique de la chair. Dionysos, Ariane, le Christ.
Paris: PUF.
Stiegler, Bernard
2004-2006 Mcrance et discrdit. 3 tomes. Paris: Galile.
2008 Prendre soin. Paris: Flammarion.
Anne Lardeux
Dpartement danthropologie, Universit de Montral
anne.lardeux@gmail.com
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
46
ANNE LARDEUX ET SUZANNE BETH
47
Suzanne Beth
Dpartement dhistoire de lart et dtudes cinmatographiques
Universit de Montral
suzannebeth@gmail.com
La Kalaora
Department of Anthropology, University of Carleton
leakalaora@gmail.com
Altrits, vol. 8, no 1, 2011 : 26-47.
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Principes Du SuccèsDocument6 pagesLes Principes Du SuccèssinokzePas encore d'évaluation
- Plus Malin Que Le DiableDocument32 pagesPlus Malin Que Le DiableRodrigue Malela94% (17)
- Lecons Sur La Volonte de Savoir Cours Au College de France 19701971 Suivi de Le Savoir DdipeDocument167 pagesLecons Sur La Volonte de Savoir Cours Au College de France 19701971 Suivi de Le Savoir Ddipelorenamf100% (1)
- Dissertation Corrigee - Niveau FacileDocument7 pagesDissertation Corrigee - Niveau FacileNa JouaPas encore d'évaluation
- Avatar KetoDocument50 pagesAvatar Ketosy.ladji94Pas encore d'évaluation
- Réflexions Sur Le Bon Usage Des Études Scolaires en Vue de L'amour de DieuDocument4 pagesRéflexions Sur Le Bon Usage Des Études Scolaires en Vue de L'amour de DieuAldorPas encore d'évaluation
- DefinitionDocument2 pagesDefinitionNestor GrahPas encore d'évaluation
- Ciel Dans La Foi, Elizabeth of The Trinity Carmelite SaintDocument17 pagesCiel Dans La Foi, Elizabeth of The Trinity Carmelite SaintMargaret ÆthelingPas encore d'évaluation
- 1896 Levi Catechisme de La PaixDocument248 pages1896 Levi Catechisme de La PaixDoru MarariuPas encore d'évaluation
- Chemin Spirituel FR v3.7 Chris IWENDocument149 pagesChemin Spirituel FR v3.7 Chris IWENWessunPas encore d'évaluation
- J.-B. BrenetDocument14 pagesJ.-B. BrenetbenyellesPas encore d'évaluation
- MéditerDocument24 pagesMéditerLaurent Ferry Siégni100% (1)
- LQ 743Document25 pagesLQ 743ThomyPas encore d'évaluation
- NO Éthique Du Désir Caroz-5Document8 pagesNO Éthique Du Désir Caroz-5euaggPas encore d'évaluation
- La Liberté Est-Elle Une IllusionDocument24 pagesLa Liberté Est-Elle Une IllusionMamadou Moustapha Sarr0% (1)
- Les Cinq Qualites D Un Vrai - Leader PDFDocument43 pagesLes Cinq Qualites D Un Vrai - Leader PDFSera Matotra100% (2)
- New Technology ImpactDocument94 pagesNew Technology ImpactaleksssiiiPas encore d'évaluation
- AmitiéDocument13 pagesAmitiéMaryuryGarciaPas encore d'évaluation
- Achat Impulsif AfmDocument25 pagesAchat Impulsif Afmleila benmansourPas encore d'évaluation
- Cours de Marketing 23Document137 pagesCours de Marketing 23Mohamed ibrahim KonéPas encore d'évaluation
- FrancaisDocument12 pagesFrancaisMahdi0% (1)
- Dissertation PhilosophieDocument3 pagesDissertation PhilosophieThe WolfcupcakePas encore d'évaluation
- Lintégrale Du Tronc Commun Tle GénéraleDocument393 pagesLintégrale Du Tronc Commun Tle GénéraleMãi Mãi Làbaoxa100% (2)
- Résumé de Généalogie de La Psychanalyse de Michel HenryDocument6 pagesRésumé de Généalogie de La Psychanalyse de Michel HenryTigiproutPas encore d'évaluation
- Marketing Chap 2 À 4Document32 pagesMarketing Chap 2 À 4etiennengaba44Pas encore d'évaluation
- MagieDocument9 pagesMagiemohamed TouréPas encore d'évaluation
- Vivre - La Psychologie Du Bonheur (PDFDrive) PDFDocument379 pagesVivre - La Psychologie Du Bonheur (PDFDrive) PDFSinda Saïdane100% (3)
- Réginald Blanchet - Transfert Et Contre-TransfertDocument13 pagesRéginald Blanchet - Transfert Et Contre-TransfertFengPas encore d'évaluation
- La Guérison Des Âmes (French Edition)Document77 pagesLa Guérison Des Âmes (French Edition)mickael.zaninelloPas encore d'évaluation
- Faire Les Bons Choix (Anna Gallotti, Maryvonne Lorenzen) (Z-Library)Document195 pagesFaire Les Bons Choix (Anna Gallotti, Maryvonne Lorenzen) (Z-Library)Adil IdrissiPas encore d'évaluation