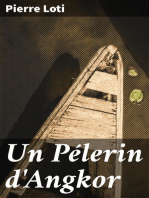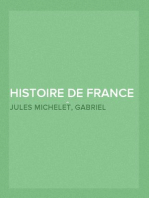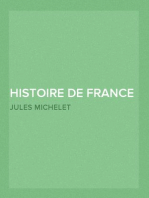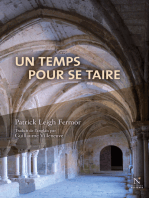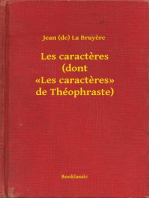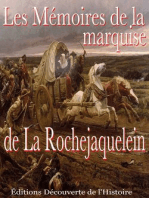Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bloch Societe Feodale
Bloch Societe Feodale
Transféré par
abounouwas6619Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bloch Societe Feodale
Bloch Societe Feodale
Transféré par
abounouwas6619Droits d'auteur :
Formats disponibles
@
Marc Bloch
(1886-1944)
La socit fodale
(1939, 1940)
Un document produit en version numrique par Pierre Palpant, bnvole,
Courriel : ppalpant@uqac.ca
Dans le cadre de la collection : Les classiques des sciences sociales
fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web : http : //www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul -mile Boulet de lUniversit du Qubec Chicoutimi
Site web : http : //bibliotheque.uqac.ca/
Marc BLOCH La socit fodale
Cette dition lectronique a t ralise par Pierre Palpant, bnvole, Paris.
Courriel : ppalpant@uqac.ca
partir de :
Marc Bloch (1886-1944)
La socit fodale
Collection Lvolution de lHumanit, tomes XXXIV et XXXIVbis,
Editions Albin Michel, Paris, 1982, 704 pages.
e
1 dition 1939, 1940.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte : Times New Roman, 12 points.
Pour les notes : Times New Roman, 10 points
dition numrique complte Chicoutimi le 31 juillet 2005.
Marc BLOCH La socit fodale
TABLE
DES
MATIRES
Notes Bibliographie Index
INTRODUCTION. Orientation gnrale de lenq ute.
TOME PREMIER : LA FORMATION DES LIENS DE DPENDANCE
PREMIRE PARTIE : LE MILIEU
Livre premier : Les dernires invasions
CHAPITRE PREMIER Musulmans et Hongrois : I. LEurope envahie et assige. II.
Les Musulmans. III. Lassaut hongrois. IV. Fin des invasions hongroises.
CHAPITRE II. Les Normands : I. Caractres gnraux des invasions scandinaves. II.
De la razzia ltablissement. III. Les tablissements scandinaves. lAnglet erre. IV. Les
tablissements scandinaves : la France. V. La christianisation du Nord. VI. A la
recherche des causes.
CHAPITRE III. Quelques consquences et quelques enseignements des invasions : I. Le
trouble. II. Lapport humain : le tmoignage de la langue et des noms. III. Lapport
humain : le tmoignage du droit et de la structure sociale. IV. Lapport humain : problmes
de provenance. V. Les enseignements.
Livre deuxime : Les conditions de vie et latmosphre mentale
CHAPITRE PREMIER. Conditions matrielles et tonalit conomique : I. Les deux ges
fodaux. II. Le premier ge fodal le peuplement. III. Le premier ge fodal ; la vie de
relations. IV. Le premier ge fodal : les changes. V. La rvolution conomique du
second ge fodal.
CHAPITRE II. Faons de sentir et de penser : I. Lhomme devant la nature et la dure.
II. Lexpression. III. Culture et classes sociales. IV. La mentalit religieuse.
CHAPITRE III. La mmoire collective : I. Lhistoriographie. II. Lpope.
CHAPITRE IV. La renaissance intellectuelle au deuxime ge fodal : I. Quelques
caractres de la culture nouvelle. II. La prise de conscience.
CHAPITRE V. Les fondements du droit : I. Lempire de la coutume. II. Les caractres
du droit coutumier. III. Le renouveau des droits crits.
Marc BLOCH La socit fodale
DEUXIME PARTIE : LES LIENS DHOMME HOMME
Livre premier : Les liens du sang.
CHAPITRE PREMIER La solidarit du lignage : I. Les amis charnels . II. La
vendetta. III. La solidarit conomique.
CHAPITRE II. Caractre et vicissitudes du lien de parent : I. Les ralits de la vie
familiale. II. La structure du lignage. III. Liens du sang et fodalit.
Livre deuxime : La vassalit et le fief.
CHAPITRE PREMIER Lhom mage vassalique : I. Lhomme dun autre homme. II.
Lhommage lre fodale. III. La gense des relations de dpendance personnelle. IV.
Les guerriers domestiques. V. La vassalit carolingienne. VI. Llaboration de la
vassalit classique.
CHAPITRE II. Le fief : I. Bienfait et fief : la tenure-salaire. II. Le chasement
des vassaux.
CHAPITRE III. Tour dhorizon europen : I. La diversit franaise Sud-Ouest et
Normandie. II. LItalie. III. LAllemagne. IV. Hors de lemprise carolingienne :
lAngleterre anglo -saxonne et lEspagne des royaumes asturo -lonais. V. Les fodalits
dim portation.
CHAPITRE IV. Comment le fief passa dans le patrimoine du vassal : I. Le problme de
lhrdit : honneurs et simples fiefs. II. Lvolution : le cas franais. III.
Lvolution : dans lEmpire. IV. Les transformations du fief vues travers son droit
successoral. V. La fidlit dans le commerce.
CHAPITRE V. Lhomme de plusieurs matres : I. La pluralit des hommages. II.
Grandeur et dcadence de lhommage lige.
CHAPITRE VI. Vassal et seigneur : I. Laide et la protection. II. La vassalit la place
du lignage. III. Rciprocit et ruptures.
CHAPITRE VII. Le paradoxe de la vassalit : I. Les contradictions des tmoignages. II.
Les liens de droit et le contact humain.
Livre troisime : Les liens de dpendance dans les classes infrieures
CHAPITRE PREMIER. La seigneurie : I. La terre seigneuriale. II. Les conqutes de la
seigneurie. III. Seigneur et tenanciers.
CHAPITRE II. Servitude et libert : I. Le point de dpart : les conditions personnelles
l poque franque. II. Le servage franais. III. Le cas allemand. IV. En Angleterre :
les vicissitudes du vilainage.
CHAPITRE III. Vers les nouvelles formes du rgime seigneurial : I. La stabilisation des
charges. II. La transformation des rapports humains.
Marc BLOCH La socit fodale
TOME II : LES CLASSES ET LE GOUVERNEMENT DES HOMMES.
Livre premier : Les classes.
CHAPITRE PREMIER. Les nobles comme classe de fait : I. La disparition des anciennes
aristocraties du sang. II. Des divers sens du mot noble , au premier ge fodal. III.
La classe des nobles, classe seigneuriale. IV. La vocation guerrire.
CHAPITRE II. La vie noble : I. La guerre. II. Le noble chez lui. III. Occupations et
distractions. IV. Les rgles de conduite.
CHAPITRE III. La chevalerie : I. L adoubement. II. Le code chevaleresque.
CHAPITRE IV. La transformation de la noblesse de fait en noblesse de droit : I. L hrdit
de l adoubement et l anoblissement. II. Constitution des descendants de chevaliers en
classe privilgie. III. Le droit des nobles. IV. L exception anglaise.
CHAPITRE V. Les distinctions de classes l intrieur de la noblesse : I. La hirarchie du
pouvoir et du rang. II. Sergents et chevaliers serfs.
CHAPITRE VI. Le clerg et les classes professionnelles : I. La socit ecclsiastique dans
la fodalit. II. Vilains et bourgeois.
Livre deuxime : Le gouvernement des hommes.
CHAPITRE PREMIER. Les justices : I. Caractres gnraux du rgime judiciaire. II.
Le morcellement des justices. III. Jugement par les pair, ou jugement par le matre ? IV.
En marge du morcellement : survivances et facteurs nouveaux.
CHAPITRE II. Les pouvoirs traditionnels : royauts et Empire : I. Gographie des
royauts. II. Traditions et nature du pouvoir royal. III. La transmission du pouvoir
royal ; problmes dynastiques. IV. L Empire.
CHAPITRE III. Des principauts territoriales aux chtellenies : I. Les principauts
territoriales. II. Comts et chtellenies. III. Les dominations ecclsiastiques.
CHAPITRE IV. Le dsordre et la lutte contre le dsordre : I. Les limites des pouvoirs.
II. La violence et l aspiration vers la paix. III. Paix et trve de Dieu.
CHAPITRE V. Vers la reconstitution des tats : les volutions nationales : I. Raisons du
regroupement des forces. II. Une monarchie neuve : les Captiens. III. Une monarchie
archasante : lAllemagne. IV. La monarchie anglo-normande faits de conqute et
survivances germaniques. V. Les nationalits.
Livre troisime : La fodalit comme type social et son action.
CHAPITRE PREMIER. La fodalit comme type social : I. Fodalit ou fodalits :
singulier ou pluriel ? II. Les caractres fondamentaux de la fodalit europenne. III.
Une coupe travers lhistoire compare.
CHAPITRE II. Les prolongements de la fodalit europenne : I. Survivances et
rviviscences. II. Lide guerrire et lide de contrat.
Marc BLOCH La socit fodale
A Ferdinand Lot,
Hommage de respectueuse
et reconnaissante affection.
Marc BLOCH La socit fodale
INTRODUCTION
Orientation gnrale de lenqute
p.11 Il ny a gure plus de deux sicles quen sintitulant La Socit
fodale, un livre peut esprer donner par avance une ide de son contenu. Non
que ladjectif, en lui -mme, ne soit fort ancien. Sous son vtement latin
feodalis , il date du moyen ge. Plus rcent, le substantif fodalit nen
remonte pas moins au XVIIe sicle, au plus tard. Mais lun et lautre mot
conservrent longtemps une valeur troitement juridique. Le fief tant, comme
on le verra, un mode de possession des biens rels, on entendait par fodal
ce qui concerne le fief ainsi sexprimait lAcadmie , par fodalit
tantt la qualit de fief , tantt les charges propres cette tenure. Ctaient,
dit, en 1630, le lexicographe Richelet, des termes de Palais . Non
dhistoire. Quand savisa -t-on den grandir le sens jusqu les employer
dsigner un tat de civilisation ? Gouvernement fodal et fodalit
figurent, avec cette acception, dans les Lettres Historiques sur les Parlemens,
qui parurent en 1727, cinq ans aprs la mort de leur auteur, le comte de
Boulainvilliers (1). Lexemple est le plus ancien quune enqute assez pousse
mait permis de dcouvrir. Peut -tre un autre chercheur sera-t-il, un jour, plus
heureux. Ce curieux homme de Boulainvilliers, pourtant, la fois ami de
Fnelon et traducteur de Spinoza, par-dessus tout virulent apologiste de la
noblesse, quil simaginait issue des chefs germains, avec p.12 moins de verve
et plus de science une sorte de Gobineau avant la lettre, on se laisse
volontiers tenter par lide de faire de lui, jusqu plus ample inform,
linventeur dune classification historique nouvelle. Car cest bien de cela, en
vrit, quil sagit, et n os tudes ont connu peu dtapes aussi dcisives que le
moment o Empires , dynasties, grands sicles placs chacun sous
linvocation dun hros ponyme, tous ces vieux dcoupages, en un mot, ns
dune tradition monarchique et oratoire, commencrent ain si de cder la place
un autre type de divisions, fondes sur lobservation des phnomnes
sociaux.
Il tait cependant rserv un plus illustre crivain de donner droit de
cit la notion et son tiquette. Montesquieu avait lu Boulainvilliers. Le
vocabulaire des juristes, par ailleurs, navait rien pour leffrayer ; davoir
pass par ses mains, la langue littraire ne devait-elle pas sortir toute enrichie
des dpouilles de la basoche ? Sil parat avoir vit fodalit , trop
abstrait, sans doute, son gr, ce fut lui, incontestablement, qui au public
cultiv de son sicle imposa la conviction que les lois fodales
caractrisrent un moment de lhistoire. De chez nous, les mots, avec lide,
rayonnrent sur les autres langues de lEurope, tan tt simplement calqus,
tantt, comme en allemand, traduits (Lehnwesen). Enfin la Rvolution, en
Marc BLOCH La socit fodale
slevant contre ce qui subsistait encore des institutions nagure baptises par
Boulainvilliers, acheva de populariser le nom que, dans un sentiment tout
oppos, il leur avait octroy. LAssemble Nationale , dit le fameux dcret
du 11 aot 1789, dtruit entirement le rgime fodal . Comment
dsormais mettre en doute la ralit dun systme social dont la ruine avait
cot tant de peines (2) ?
Ce mot, pourtant, promis une si belle fortune, tait, il faut lavouer,
un mot fort mal choisi. Sans doute les raisons qui, lorigine, dcidrent de
son adoption semblent assez claires. Contemporains de la monarchie absolue,
Boulainvilliers et Montesquieu tenaient le morcellement de la souverainet,
entre une multitude de petits princes ou mme de seigneurs de villages, pour
la plus frappante singularit du moyen ge. Ctait ce caractre quen
prononant le nom de p.13 fodalit ils croyaient exprimer. Car, lorsquils
parlaient de fiefs, ils pensaient tantt principauts territoriales, tantt
seigneuries. Mais ni toutes les seigneuries, en fait, ntaient des fiefs, ni tous
les fiefs des principauts ou des seigneuries. Surtout il est permis de douter
quun type dorganisation sociale trs complexe puisse tre heureusement
qualifi, soit par son aspect exclusivement politique, soit, si lon prend fief
dans toute la rigueur de son acception juridique, par une forme de droit rel,
entre beaucoup dautres. Les mots cependant sont comme des monnaies trs
uses, force de circuler de main en main ; ils perdent leur relief
tymologique. Dans lusage aujourdhui courant, fodalit et socit
fodale recouvrent un ensemble intriqu dimages o le fief proprement dit a
cess de figurer au premier plan. A condition de traiter ces expressions
simplement comme ltiquette, dsormais consacre, dun contenu qui reste
dfinir, lhistorien peut sen emparer sans plus de remords que le phys icien
nen prouve, lorsquau mpris du grec, il persiste dnommer atome une
ralit quil passe son temps dcouper.
Cest une grave question que de savoir si dautres socits, en dautres
temps ou sous dautres cieux, nont pas prsent une stru cture assez
semblable, dans ses traits fondamentaux, celle de notre fodalit occidentale
pour mriter, leur tour, dtre dites fodales . Nous la retrouverons au
terme de ce livre. Mais ce livre ne lui est pas consacr. La fodalit dont
lanalyse va tre tente est celle qui, la premire, reut ce nom. Comme cadre
chronologique, lenqute, sous rserve de quelques problmes dorigine ou de
prolongement, se bornera donc cette priode de notre histoire qui stendit,
peu prs, du milieu du IXe sicle aux premires dcennies du XIIIe ; comme
cadre gographique, lEurope de lOuest et du Centre. Or, si les dates nont
attendre leur justification que de ltude mme, les limites spatiales, par
contre, semblent exiger un bref commentaire.
*
La civilisation antique tait centre autour de la Mditerrane. De la
Terre , crivait Platon, nous nhabitons que cette partie qui stend depuis
Marc BLOCH La socit fodale
le Phase jusquaux Colonnes dHercule, rpandus autour de la mer comme des
fourmis ou des grenouilles autour dun tang. (3) En dpit des conqutes, ces
mmes eaux demeuraient, aprs bien des sicles couls, laxe de la Romania.
Un snateur aquitain pouvait faire carrire au bord du Bosphore, possder de
vastes domaines en Macdoine. Les grandes oscillations des prix secouaient
lconomie depuis lEuphrate jusqu la Gaule. Sans les bls dAfrique,
lexistence de la Rome impriale ne saurait pas plus se concevoir que, sans
lAfricain Augustin, la thologie catholique. Par contre, le Rhin aussitt
franchi, commenait, trange et hostile, limmense pays des Barbares.
Or, au seuil de la priode que nous appelons moyen ge, deux
profonds mouvements dans les masses humaines taient venus dtruire cet
quilibre dont nous navons pas r echercher ici dans quelle mesure il tait
dj branl par le dedans , pour lui substituer une constellation dun dessin
bien diffrent. Ce furent dabord les invasions des Germains. Puis les
conqutes musulmanes. A la plus grande partie des contres nagure
comprises dans la fraction occidentale de lEmpire, une mme domination
parfois, la communaut des habitudes mentales et sociales en tout cas,
unissent dsormais les terres doccupation germanique. Peu peu, on verra
sy joindre, plus ou moins assimil s, les petits groupes celtes des les.
LAfrique du Nord, au contraire, sapprte de tout autres destins. Le retour
offensif des Berbres avait prpar la rupture. LIslam la consomme. Par
ailleurs, sur les rives du Levant, les victoires arabes, cantonnant dans les
Balkans et dans lAnatolie lancien Empire dOrient, en avaient fait lEmpire
Grec. Des communications difficiles, une structure sociale et politique trs
particulire, une mentalit religieuse et une armature ecclsiastique fort
diffrentes de celles de la latinit lisolent dsormais, de plus en plus, des
chrtients de lOuest. Vers lEst du continent, enfin, si lOccident rayonne
largement sur les peuples slaves et propage, chez p.15 quelques-uns dentre eux,
avec sa forme religieuse propre, qui est le catholicisme, ses modes de pense
et mme certaines de ses institutions, les collectivits qui appartiennent ce
rameau linguistique nen poursuivent pas moins, pour la plupart, une
volution pleinement originale.
Born par ces trois blocs mahomtan, byzantin et slave , sans
cesse occup, dailleurs, depuis le X e sicle, pousser en avant ses mouvantes
frontires, le faisceau romano-germanique tait loin, assurment, de prsenter,
en lui-mme, une parfaite homognit. Sur les lments qui le composaient,
pesaient les contrastes de leur pass, trop vifs pour ne pas prolonger leurs
effets jusque dans le prsent. L mme o le point de dpart fut presque pareil,
certaines volutions, par la suite, bifurqurent. Cependant, si accentues
quai ent pu tre ces diversits, comment ne pas reconnatre, au-dessus delles,
une tonalit de civilisation commune : celle de lOccident ? Ce nest pas
seulement afin dpargner au lecteur lennui de lourds adjectifs que, dans les
pages qui vont suivre, l o on et pu attendre Europe Occidentale et
Centrale , il nous arrivera de dire Europe tout court. Quimporte, en effet,
lacception du terme et ses limites, dans la vieille gographie factice des cinq
Marc BLOCH La socit fodale
parties du monde ? Seule compte sa valeur humaine. Or, o donc a germ
et sest panouie, pour se rpandre ensuite sur le globe, la civilisation
europenne, sinon parmi les hommes qui vivaient entre la Tyrrhnienne,
lAdriatique, lElbe et lOcan ? Ainsi sentaient dj, plus ou moins
obscurment, ce chroniqueur espagnol qui, au VIIIe sicle, se plaisait
qualifier d Europens les Francs de Charles Martel, victorieux de lIslam,
ou, deux cents ans environ plus tard, le moine saxon Widukind, empress
vanter, dans Otton le Grand, qui avait repouss les Hongrois, le librateur de
l Europe (4). En ce sens, qui est le plus riche de contenu historique,
lEurope fut une cration du haut moyen ge. Elle existait dj quand
souvrirent, pour elle, les temps proprement f odaux.
*
p.16 Appliqu une phase de lhistoire europenne, dans les limites
ainsi fixes, le nom de fodalit a beau, nous le verrons, avoir t lobjet
dinterprtations parfois presque contradictoires ; son existence mme atteste
loriginalit insti nctivement reconnue la priode quil qualifie. Si bien quun
livre sur la socit fodale peut se dfinir comme un effort pour rpondre
une question pose par son titre mme : par quelles singularits ce fragment
du pass a-t-il mrit dtre mis par t de ses voisins ? En dautres termes,
cest lanalyse et lexplication dune structure sociale, avec ses liaisons, quon
se propose de tenter ici. Une pareille mthode, si elle savre, lexprience,
fconde, pourra trouver son emploi dans dautres cham ps dtudes, borns par
des frontires diffrentes, et ce que lentreprise a sans doute de neuf fera, je
lespre, pardonner les erreurs de lexcution.
Lampleur mme de lenqute, ainsi conue, a rendu ncessaire de
diviser la prsentation des rsultats. Un premier tome1 dcrira les conditions
gnrales du milieu social, puis la constitution de ces liens de dpendance,
dhomme homme, qui, avant toutes choses, ont donn la structure fodale
sa couleur propre. Le second sattachera au dveloppement des classes et
lorganisation des gouvernements. Il est toujours difficile de tailler dans le
vivant. Du moins, comme le moment qui vit la fois les classes anciennes
prciser leurs contours, une classe nouvelle, la bourgeoisie, affirmer son
originalit et les pouvoirs publics sortir de leur long affaiblissement, fut aussi
celui o commencrent seffacer, dans la civilisation occidentale, les traits
les plus spcifiquement fodaux, des deux tudes successivement offertes au
lecteur sans quentre elles u ne sparation strictement chronologique ait
paru possible la premire se trouvera tre surtout celle de la gense ; la
seconde celle du devenir final et des prolongements.
Mais lhistorien na rien dun homme libre. Du pass, il sait seulement
ce que ce pass mme veut bien lui confier. p.17 En outre, lorsque la matire
quil sefforce dembrasser est trop vaste pour lui permettre le dpouillement
1
[note css : les deux tomes sont ici en un seul volume]
10
Marc BLOCH La socit fodale
personnel de tous les tmoignages, il se sent incessamment limit, dans son
enqute, par ltat des recherch es. Certes, on ne trouvera ici lexpos daucune
de ces guerres de plumes dont lrudition a, plus dune fois, donn le
spectacle. Comment souffrir que lhistoire puisse seffacer devant les
historiens ? En revanche, je me suis attach ne jamais dissimuler, quelles
quen fussent les origines, les lacunes ou les incertitudes de nos
connaissances. Je nai pas cru courir, par l, le danger de rebuter le lecteur. Ce
serait au contraire dpeindre sous un aspect faussement sclros une science
toute de mouvement quon risquerait de rpandre sur elle lennui et la glace.
Un des hommes qui ont pouss le plus avant dans lintelligence des socits
mdivales, le grand juriste anglais Maitland, disait quun livre dhistoire doit
donner faim. Entendez : faim dappr endre et surtout de chercher. Ce livre-ci
na pas de vu plus cher que de mettre quelques travailleurs en apptit (5).
*
**
11
Marc BLOCH La socit fodale
TOME
PREMIER
LA FORMATION
DES LIENS DE DPENDANCE
12
Marc BLOCH La socit fodale
PREMIRE PARTIE
Le milieu
13
Marc BLOCH La socit fodale
LIVRE PREMIER : Les dernires invasions.
CHAPITRE PREMIER
Musulmans et Hongrois
I. LEurope envahie et assige
Vous voyez clater devant vous la colre du Seigneur... Ce ne
sont que villes dpeuples, monastres jets bas ou incendis, champs
rduits en solitudes... Partout le puissant opprime le faible et les hommes sont
pareils aux poissons de la mer qui ple-mle se dvorent entre eux. Ainsi
parlaient, en 909, les vques de la province de Reims, assembls Trosly. La
littrature des IXe et Xe sicles, les chartes, les dlibrations des conciles sont
pleines de ces lamentations. Faisons, tant quon voudra, la part de lemphase,
comme du pessimisme naturel aux orateurs sacrs. Dans ce thme sans cesse
orchestr et que dailleurs confirment tant de faits, force est bien de
reconnatre autre chose quun lieu commun. Certainement, en ce temps, les
personnes qui savaient voir et comparer, les clercs notamment, ont eu le
sentiment de vivre dans une odieuse atmosphre de dsordres et de violences.
La fodalit mdivale est ne au sein dune poque infiniment trouble. En
quelque mesure, elle est ne de ces troubles mmes. Or, parmi les causes qui
contriburent crer ou entretenir une si tumultueuse ambiance, il en tait
de tout fait trangres lvolution intrieure des socits europennes.
Forme, quelques sicles auparavant, dans le brlant creuset des invasions
germaniques, la nouvelle civilisation occidentale, son tour, faisait figure de
citadelle assige ou, pour mieux p.24 dire, plus qu demi envahie. Cela de
trois cts la fois : au midi, par les fidles de lIslam, Arabes ou Arabiss ;
lest, par les Hongrois ; au nord par les Scandinaves.
p.23
II. Les musulmans
Des ennemis qui viennent dtre numrs, lIslam tait certaine ment
le moins dangereux. Non quon doive se hter de prononcer, son propos, le
mot de dcadence. Longtemps, ni la Gaule, ni lItalie neurent rien offrir,
14
Marc BLOCH La socit fodale
parmi leurs pauvres villes, qui approcht la splendeur de Bagdad ou de
Cordoue. Sur lOccident, l e monde musulman, avec le monde byzantin, exera
jusquau XII e sicle, une vritable hgmonie conomique : les seules pices
dor qui circulassent encore dans nos contres sortaient des ateliers grecs ou
arabes ou bien comme plus dune monnaie dargent, galement en
imitaient les frappes. Et si les VIIIe et IXe sicles ont vu se rompre, pour
toujours, lunit du grand khalifat, les divers tats qui staient alors levs
dans ses dbris demeuraient des puissances redoutables. Mais il sagissait
beaucoup moins, dsormais, dinvasions proprement dites que de guerres de
frontires. Laissons lOrient, o les Basileis des dynasties amorienne et
macdonienne (828-1056), pniblement et vaillamment, procdrent la
reconqute de lAsie Mineure. Les socits oc cidentales ne se heurtaient aux
tats islamiques que sur deux fronts.
LItalie mridionale dabord. Elle tait comme le terrain de chasse des
souverains qui rgnaient sur lancienne province romaine dAfrique : mirs
aghlabites de Kairouan ; puis, partir du dbut du Xe sicle, khalifes
fatimides. Par les Aghlabites, la Sicile avait t peu peu arrache aux Grecs
qui la tenaient depuis Justinien et dont la dernire place forte, Taormine,
tomba en 902. En mme temps, les Arabes avaient pris pied dans la pninsule.
A travers les provinces byzantines du Midi, ils menaaient les villes, demi
indpendantes, du littoral tyrrhnien et les petites principauts lombardes de la
Campanie et du Bnventin, plus ou moins soumises au protectorat de
Constantinople. Au dbut du XIe sicle encore, ils poussrent leurs incursions
p.25 jusquaux montagnes de la Sabine. Une bande, qui avait fait son repaire
dans les hauteurs boises du Monte Argento, tout prs de Gate, ne put tre
dtruite, en 915, quaprs une vingtaine dannes de ravages. En 982, le jeune
empereur des Romains , Otton II, qui, de nation saxonne, ne sen
considrait pas moins, en Italie aussi bien quailleurs, comme lhritier des
Csars, partit la conqute du Sud. Il commit la surprenante folie, tant de fois
rpte au moyen ge, de faire choix de lt pour conduire vers ces terres
brlantes une arme habitue de tout autres climats et, stant heurt, le 25
juillet, sur la cte orientale de la Calabre, aux troupes mahomtanes, se vit
infliger par elles la plus humiliante dfaite. Le danger musulman continua de
peser sur ces contres jusquau moment o, au cours du XI e sicle, une
poigne daventuriers, venus de la Normandie franaise, bousculrent
indistinctement Byzantins et Arabes. Unissant la Sicile avec le Midi de la
pninsule, ltat vigoureux que finalement ils crrent devait la fois barrer
pour jamais la route aux envahisseurs et jouer, entre les civilisations de la
latinit et de lIslam, le rle dun brillant courtier. On le voit : sur le sol
italien, la lutte contre les Sarrasins, qui avait commenc au IXe sicle, stait
prolonge longtemps. Mais avec, dans les gains territoriaux, de part et dautre,
des oscillations dassez faible amplitude. Surtout elle nintressait gure, dans
la catholicit, quune terre extrme.
Lautre ligne de choc tait en Espagne. L, il ne sagissait plus, pour
lIslam, de razzias ou dphmres annexions ; des populations de foi
15
Marc BLOCH La socit fodale
mahomtane y vivaient en grand nombre et les tats fonds par les Arabes
avaient leurs centres dans le pays mme. Au dbut du Xe sicle, les bandes
sarrasines navaient pas encore tout fait oubli le chemin des Pyrnes. Mais
ces incursions lointaines se faisaient de plus en plus rares. Partie de lextrme
nord, la reconqute chrtienne, malgr bien des revers et des humiliations,
progressait lentement. En Galice et sur ces plateaux du nord-ouest que les
mirs ou khalifes de Cordoue, tablis trop loin dans le sud, navaient jamais
tenus dune main bien ferme, les petits royaumes ch rtiens, tantt morcels,
tantt runis sous un seul prince, savanaient ds le milieu du p.26 XIe sicle
jusqu la rgion du Douro ; le Tage fut atteint en 1085. Au pied des Pyrnes,
par contre, le cours de lbre, pourtant si proche, resta assez longt emps
musulman ; Saragosse ne tomba quen 1118. Les combats, qui dailleurs
nexcluaient nullement des relations plus pacifiques, ne connaissaient, dans
leur ensemble, que de courtes trves. Ils marqurent les socits espagnoles
dune empreinte originale. Quant lEurope dau del des cols , ils ne la
touchaient gure que dans la mesure o surtout partir de la seconde
moiti du XIe sicle ils fournirent sa chevalerie loccasion de brillantes,
fructueuses et pieuses aventures, en mme temps qu ses paysans la
possibilit de stablir sur les terres vides dhommes, o les attiraient les rois
ou les seigneurs espagnols. Mais, ct des guerres proprement dites, il
convient de placer les pirateries et les brigandages. Ce fut par l surtout que
les Sarrasins contriburent au dsordre gnral de lOccident.
De longue date, les Arabes staient faits marins. Depuis leurs repaires
dAfrique, dEspagne et surtout des Balares, leurs corsaires battaient la
Mditerrane occidentale. Cependant, sur ces eaux que ne parcouraient que
dassez rares navires, le mtier de pirate proprement dit tait de faible profit.
Dans la matrise de la mer, les Sarrasins, comme, au mme temps, les
Scandinaves, voyaient surtout le moyen datteindre les ctes et dy pratiquer
de fructueuses razzias. Ds 842 ils remontaient le Rhne jusquaux abords
dArles, pillant les deux rives sur leur passage. La Camargue leur servait alors
de base ordinaire. Mais bientt, un hasard devait leur procurer, avec un
tablissement plus sr, la possibilit dtendre singulirement leurs ravages.
A une date que lon ne saurait prciser, probablement aux environs de
890, une petite nef sarrasine, qui venait dEspagne, fut jete par les vents sur
la cte provenale, aux abords du bourg actuel de Saint-Tropez. Ses occupants
se terrrent, tant que le jour dura, puis, la nuit venue, massacrrent les
habitants dun village voisin. Montagneux et bois on lappelait alors le
pays des frnes, ou Freinet (6) ce coin de terre tait favorable la
dfense. Tout comme, vers le mme moment, en Campanie, leurs p.27
compatriotes du Monte Argento, nos gens sy fortifirent sur une hauteur, au
milieu des fourrs dpines, et appelrent eux des camarades. Ainsi se cra
le plus dangereux des nids de brigands. A lexception de Frjus, qui fut pille,
il ne semble pas que les villes, labri derrire leurs enceintes, aient eu
directement souffrir. Mais dans tout le voisinage du littoral, les campagnes
16
Marc BLOCH La socit fodale
furent abominablement dvastes. Les pillards du Freinet faisaient en outre de
nombreux captifs, quils vendaient sur les marchs espagnols.
Aussi bien ne tardrent-ils gure pousser leurs incursions bien audel de la cte. Trs peu nombreux assurment, ils ne semblent pas stre
volontiers risqus dans la valle du Rhne, relativement peuple et barre de
villes fortes ou de chteaux. Le massif alpestre, par contre, permettait de
petites bandes de se glisser trs avant, de chane en chane ou de hallier en
hallier : condition, bien entendu, davoir le pied montagnard. Or, venus de
lEspagne des Sierras ou du montueux Maghreb, ces Sarrasins, comme dit un
moine de Saint-Gall, taient de vraies chvres . Dautre part, les Alpes,
malgr les apparences, noffraient pas un mprisable terrain de razzias. Des
valles fertiles sy nichaient, sur lesquelles il tait ais de tomber
limproviste, du haut des monts environnants. Tel, le Graisivaudan. et l,
des abbayes slevaient, proies entre toutes attrayantes. Au -dessus de Suse, le
monastre de Novalaise, do la plupart des religieux avaient fui, fut pill et
brl, ds 906. Surtout, par les cols circulaient de petites troupes de
voyageurs, marchands ou bien romieux qui sen allaient prier sur les
tombeaux des aptres. Quoi de plus tentant que de les guetter au passage ?
Ds 920 ou 921, des plerins anglo-saxons furent crass coups de pierres,
dans un dfil. Ces attentats dornavant se rptrent. Les djichs arabes ne
craignaient pas de saventurer tonnamment loin vers le nor d. En 940, on les
signale aux environs de la haute valle du Rhin et dans le Valais o ils
incendirent lillustre monastre de Saint -Maurice dAgaune. Vers la mme
date, un de leurs dtachements cribla de flches les moines de Saint-Gall, en
train de processionner paisiblement autour de leur glise. Celui-l du moins
fut p.28 dispers par la petite troupe de dpendants qu la hte avait runie
labb ; quelques prisonniers, emmens dans le monastre, se laissrent
hroquement mourir de faim.
Faire la police des Alpes ou des campagnes provenales dpassait les
forces des tats du temps. Point dautre remde que de dtruire le repaire, au
pays du Freinet. Mais l un nouvel obstacle slevait. Il tait peu prs
impossible de cerner cette citadelle sans la couper de la mer, do lui venaient
ses renforts. Or ni les rois du pays louest les rois de Provence et de
Bourgogne, lest celui dItalie , ni leurs comtes ne disposaient de flottes.
Les seuls marins experts, parmi les chrtiens, taient les Grecs, qui dailleurs
en profitaient parfois, tout comme les Sarrasins, pour se faire corsaires. Des
pirates de leur nation navaient -ils pas, en 848, pill Marseille ? De fait,
deux reprises, en 931 et 942, la flotte byzantine parut devant la cte du
Freinet, appele, en 942, au moins et probablement dj onze ans plus tt, par
le roi dItalie, Hugue dArles, qui avait de grands intrts en Provence. Les
deux tentatives demeurrent sans rsultats. Aussi bien en 942, Hugue,
tournant casaque au cours mme de la lutte, navait -il pas imagin de prendre
les Sarrasins pour allis, afin de fermer, avec leur aide, les passages des Alpes
aux renforts quattendait un de ses comptiteurs la couronne lombarde ?
Puis le roi de France Orientale nous dirions aujourdhu i Allemagne ,
17
Marc BLOCH La socit fodale
Otton le Grand, en 951, se fit roi des Lombards. Ainsi il travaillait difier
dans lEurope centrale et jusquen Italie une puissance quil voulait, comme
celle des Carolingiens, chrtienne et gnratrice de paix. Se tenant pour
lhri tier de Charlemagne, dont il devait, en 962, ceindre la couronne
impriale, il crut de sa mission de faire cesser le scandale des pillages
sarrasins. Tentant dabord la voie diplomatique, il chercha obtenir du khalife
de Cordoue lordre dvacuer le Frei net. Puis il songea entreprendre luimme une expdition et ne laccomplit jamais.
Cependant, en 972, les pillards firent une trop illustre capture. Sur la
route du Grand Saint-Bernard, dans la valle de la Dranse, labb de Cluny,
Maeul, qui revenait dItalie, tomba dans une embuscade et fut emmen dans
un p.29 de ces refuges de la montagne dont les Sarrasins, incapables de
rejoindre chaque fois leur base dopration, usaient frquemment. Il ne fut
relch que moyennant une lourde ranon verse par ses moines. Or Maeul,
qui avait rform tant de monastres, tait lami vnr, le directeur de
conscience et, si lon ose dire, le saint familier de beaucoup de rois et de
barons. Notamment, du comte de Provence Guillaume. Celui-ci rejoignit sur
la route du retour la bande qui avait commis le sacrilge attentat et lui infligea
une rude dfaite ; puis, groupant sous son commandement plusieurs seigneurs
de la valle du Rhne auxquels devaient tre par la suite distribues les terres
regagnes la culture, il monta une attaque contre la forteresse du Freinet. La
citadelle, cette fois, succomba.
Ce fut pour les Sarrasins la fin des brigandages terrestres grande
envergure. Naturellement, le littoral de la Provence, comme celui de lItalie,
restait expos leurs insultes. Au XIe sicle encore, on voit les moines de
Lrins se proccuper activement de racheter des chrtiens que des pirates
arabes avaient ainsi enlevs et emmens en Espagne ; en 1178, un raid fit de
nombreux prisonniers, prs de Marseille. Mais la culture, dans les campagnes
de la Provence ctire et subalpine, put reprendre et les routes alpestres
redevinrent ni plus ni moins sres que toutes celles des montagnes
europennes. Aussi bien, dans la Mditerrane elle-mme, les cits
marchandes de lIt alie, Pise, Gnes et Amalfi, avaient-elles, depuis le dbut du
XIe sicle, pass loffensive. Chassant les Musulmans de la Sardaigne, allant
les chercher mme dans les ports du Maghreb (ds 1015) et de lEspagne (en
1092), elles commencrent alors le nettoyage de ces eaux, dont la scurit au
moins relative la Mditerrane nen devait jamais connatre dautre,
jusquau XII e sicle importait tant leur commerce.
III. Lassaut hongrois
Comme nagure les Huns, les Hongrois ou Magyars avaient surgi dans
lEurope presque limproviste, et dj les crivains du moyen ge, qui
navaient que trop bien p.30 appris les connatre, stonnaient navement que
les auteurs romains nen eussent point fait mention. Leur primitive histoire
18
Marc BLOCH La socit fodale
nous est dailleurs be aucoup plus obscure que celle des Huns. Car les sources
chinoises qui, bien avant la tradition occidentale, nous permettent de suivre les
Hioung-Nou la piste, sont ici muettes. Certainement ces nouveaux
envahisseurs appartenaient, eux aussi, au monde, si bien caractris, des
nomades de la steppe asiatique : peuples souvent trs divers de langage, mais
tonnamment semblables par le genre de vie quimposaient des conditions
dhabitat communes ; pasteurs de chevaux et guerriers, nourris du lait de leurs
juments ou des produits de leur chasse et de leur pche ; ennemis-ns, surtout,
des laboureurs du pourtour. Par ses traits fondamentaux, le magyar se rattache
au type linguistique dit finno-ougrien ; les idiomes dont il se rapproche
aujourdhui le plus so nt ceux de quelques peuplades de la Sibrie. Mais, au
cours de ses prgrinations, le stock ethnique primitif stait ml de
nombreux lments de langue turque et avait subi fortement lempreinte des
civilisations de ce groupe (7).
Ds 833, on voit les Hongrois, dont le nom apparat alors pour la premire
fois, inquiter les populations sdentaires khanat khasar et colonies
byzantines , aux environs de la mer dAzov. Bientt, ils menacent chaque
instant de couper la route du Dniepr, en ce temps voie commerciale
extrmement active par o, de portage en portage et de march en march, les
fourrures du Nord, le miel et la cire des forts russes, les esclaves achets de
toutes parts allaient schanger contre les marchandises ou lor fournis soit par
Constantinople, soit par lAsie. Mais de nouvelles hordes sorties, aprs eux,
de par del lOural, les Petchngues, les harclent sans cesse. Le chemin du
sud leur est barr, victorieusement, par lempire bulgare. Ainsi refouls et
cependant quune de leurs fractions prfrait senfoncer dans la steppe, plus
loin vers lest, la plupart dentre eux franchirent les Carpathes, vers 896, pour
se rpandre dans les plaines de la Tisza et du Danube moyen. Ces vastes
tendues, tant de fois ravages, depuis le IVe sicle, par les invasions,
faisaient alors dans la carte p.31 humaine de lEurope comme une norme tache
blanche. Solitudes , crit le chroniqueur Rginon de Prm. Il ne faudrait
pas prendre le mot trop la lettre. Les populations varies qui jadis avaient eu
l dimportants tablissements ou qui y avaient seulement pass avaient
vraisemblablement laiss aprs elles bien des petits groupes attards. Surtout,
des tribus slaves assez nombreuses sy taient peu peu infiltres. Mais
lhabitat demeurait, sans conteste, trs lche tmoin, le remaniement
presque complet de la nomenclature gographique, y compris celle des cours
deau, aprs larrive des Magyars. En outre, depuis que Charlemagne avait
abattu la puissance Avare, aucun tat solidement organis ntait plus capable
doffrir une srieuse rsistance aux envahisseurs. Seuls des chefs appartenant
au peuple des Moraves avaient, depuis peu, russi constituer, dans langle
nord-ouest, une principaut assez puissante et dj officiellement chrtienne :
le premier essai, en somme, dun vritable tat purement slave. Les attaques
hongroises la dtruisirent, dfinitivement, en 906.
A partir de ce moment, lhistoire des Hongrois prend un tour nouveau.
Il nest plus gure possible de les dire nomades, au sens fort du mot, puisquils
19
Marc BLOCH La socit fodale
ont, dans les plaines qui portent aujourdhui leur nom, un tablissement fixe.
Mais de l, ils se lancent, par bandes, sur les pays environnants. Ils ne
cherchent pas y conqurir des terres ; leur seul dessein est de piller, pour
revenir ensuite, chargs de butin, vers leur site permanent. La dcadence de
lempire bulgare, aprs la mort du tsar Simon (927), leur ouvrit le chemin de
la Thrace byzantine, quils saccagrent, plusieurs reprises. LOccident
surtout, beaucoup plus mal dfendu, les attirait.
Ils taient de bonne heure entrs en contact avec lui. Ds 862, avant
mme le passage des Carpathes, une de leurs expditions les avait conduits
jusquaux marches de la Germanie. Plus tard, quelques -uns dentre eux
avaient t engags, comme auxiliaires, par le roi de ce pays, Arnulf, dans une
de ses guerres contre les Moraves. En 899, leurs hordes sabattent sur la plaine
du P ; lanne suivante, sur la Bavire. Dornavant, il ne se passe gure
danne o , p.32 dans les monastres de lItalie, de la Germanie, bientt de la
Gaule, les annales ne notent, tantt dune province, tantt dune autre :
ravages des Hongrois . LItalie du nord, la Bavire et la Souabe eurent
surtout souffrir ; tout le pays sur la rive droite de lEnns, o les Carolingiens
avaient tabli des commandements de frontires et distribu des terres leurs
abbayes, dut tre abandonn. Mais les raids stendirent bien au -del de ces
confins. Lampleur du rayon parcouru confondrait li magination, si lon ne se
rendait compte que les longues courses pastorales, auxquelles les Hongrois
staient autrefois adonns sur dimmenses espaces et quils continuaient
pratiquer dans le cercle plus restreint de la puzta danubienne, avaient t pour
eux une merveilleuse cole ; le nomadisme du berger, dj, en mme temps
pirate de la steppe, avait prpar le nomadisme du bandit. Vers le nord-ouest,
la Saxe, cest --dire le vaste territoire qui stendait de lElbe au Rhin moyen,
fut atteinte ds 906 et, depuis lors, plusieurs fois mise mal. Dans lItalie, on
les vit pousser jusqu Otrante. En 917, ils se faufilrent, par la fort
vosgienne et le col de Saales, jusquaux riches abbayes qui se groupaient
autour de la Meurthe. Dsormais la Lorraine et la Gaule du nord devinrent un
de leurs terrains familiers. De l, ils se hasardrent jusquen Bourgogne et au
sud mme de la Loire. Hommes des plaines, ils ne craignaient point cependant
de franchir au besoin les Alpes. Ce fut par les dtours de ces monts que,
venant dItalie, ils tombrent, en 924, sur le pays nmois.
Ils ne fuyaient pas toujours les combats contre des forces organises.
Ils en livrrent un certain nombre, avec des succs variables. Cependant ils
prfraient lordinaire se glisser rapidement travers pays : vrais sauvages,
que leurs chefs menaient la bataille coups de fouet, mais soldats
redoutables, habiles, quand il fallait combattre, aux attaques de flanc, acharns
la poursuite et ingnieux se tirer des situations les plus difficiles. Fallait-il
traverser quelque fleuve ou la lagune vnitienne ? Ils fabriquaient la hte des
barques de peaux ou de bois. A larrt, ils plantaient leurs tentes de gens de la
steppe ; ou bien ils se p.33 retranchaient dans les btiments du ne abbaye
dserte par les moines et de l battaient les alentours. Russ comme des
primitifs, renseigns au besoin par les ambassadeurs quils envoyaient en
20
Marc BLOCH La socit fodale
avant, moins pour traiter que pour espionner, ils avaient bien vite pntr les
finesses, assez lourdes, de la politique occidentale. Ils se tenaient au courant
des interrgnes, particulirement favorables leurs incursions, et savaient
profiter des dissensions entre les princes chrtiens pour se mettre au service de
lun ou lautre des rivaux.
Quelquefois, selon lusage commun des bandits de tous les temps, ils
se faisaient payer une somme dargent par les populations quils promettaient
dpargner ; voire mme, ils exigeaient un tribut rgulier : la Bavire et la
Saxe durent, pendant quelques annes, se soumettre cette humiliation. Mais
ces procds dexploitation ntaient gure praticables que dans les provinces
limitrophes de la Hongrie propre. Ailleurs ils se contentaient de tuer et de
piller, abominablement. De mme que les Sarrasins, ils ne sattaquaient gure
aux villes fortes ; lorsquils sy risquaient, ils chouaient gnralement,
comme ils avaient fait, ds leurs premires courses autour du Dniepr, sous les
murs de Kiev. La seule cit importante quils enlevrent fut Pavie. Ils taient
surtout redoutables aux villages et aux monastres, frquemment isols dans
les campagnes ou situs dans les faubourgs des villes, en dehors de lenceinte.
Par-dessus tout, ils paraissent avoir tenu faire des captifs, choisissant avec
soin les meilleurs, parfois ne rservant, dans une population passe au fil de
lpe, que les jeunes femmes et les tout jeunes garons : pour leurs besoins et
leurs plaisirs, sans doute, et principalement pour la vente. A loccasion, ils ne
ddaignaient pas dcouler ce btai l humain sur les marchs mmes de
lOccident, o les acheteurs ntaient pas tous gens y regarder de prs ; en
954, une fille noble, prise aux environs de Worms, fut mise en vente dans la
ville (8). Plus souvent, ils tranaient les malheureux jusque dans les pays
danubiens, pour les offrir des trafiquants grecs.
IV. Fin des invasions hongroises
Cependant, le 10 aot 955, le roi de France Orientale, Otton le
Grand, alert la nouvelle dun raid sur lAllemagne du sud, r encontra, au
bord du Lech, la bande hongroise, sur son retour. Il fut vainqueur, aprs un
sanglant combat, et sut exploiter la poursuite. Lexpdition de pillage ainsi
chtie devait tre la dernire. Tout se borna dsormais, sur les limites de la
Bavire, une guerre de border . Bientt, conformment la tradition
carolingienne, Otton rorganisa les commandements de la frontire. Deux
marches furent cres, lune dans les Alpes, sur la Mur, lautre, plus au nord,
sur lEnns ; cette dernire, rapidement connue sous le nom de commandement
de lest Ostarrichi, dont nous avons fait Autriche , atteignit, ds la fin du
sicle, la fort de Vienne, vers le milieu du onzime, la Leitha et la Morava.
p.34
Si brillant quil ft et malgr tout son retentissement mo ral, un fait
darmes isol, comme la bataille du Lech, naurait videmment pas suffi
arrter net les razzias. Les Hongrois, dont le territoire propre navait pas t
atteint, taient loin davoir subi le mme crasement que jadis, sous
21
Marc BLOCH La socit fodale
Charlemagne, les Avars. La dfaite dune de leurs bandes, dont plusieurs
avaient dj t vaincues, et t impuissante changer leur mode de vie. La
vrit est que, depuis 926 environ, leurs courses, aussi furieuses que jamais,
nen taient pas moins alles sespaant. En Italie, sans bataille, elles prirent
fin galement aprs 954. Vers le sud-est, partir de 960, les incursions en
Thrace se rduisent de mdiocres petites entreprises de brigandage. Trs
certainement un faisceau de causes profondes avait fait lentement sentir son
action.
Prolongement dhabitudes anciennes, les longues randonnes travers
lOccident taient -elles toujours fructueuses et heureuses ? A tout prendre, on
en peut douter. Les hordes commettaient sur leur passage daffreux dgts.
Mais il ne leur tait gure possible de salourdir dnormes masses de butin.
Les esclaves, qui certainement suivaient pied, p.35 risquaient de ralentir les
mouvements ; ils taient, au surplus, de garde difficile. Les sources nous
parlent souvent de fugitifs, tel ce cur du pays rmois qui, entran jusquen
Berry, faussa compagnie, une nuit, ses envahisseurs, se blottit, plusieurs
jours durant, dans un marais et finalement, tout plein du rcit de ses aventures,
parvint regagner son village (9). Pour les objets prcieux, les chars, sur les
dplorables pistes du temps et au milieu de contres hostiles, noffraient quun
moyen de transport beaucoup plus encombrant et beaucoup moins sr quaux
Normands, sur les beaux fleuves de lEurope, le urs barques. Les chevaux,
dans des campagnes dvastes, ne trouvaient pas toujours se nourrir ; les
gnraux byzantins savaient bien que, le grand obstacle auquel se heurtent
les Hongrois dans leurs guerres vient du manque de pturages (10). En cours
de route, il fallait livrer plus dun combat ; mme victorieuses, les bandes
revenaient toutes dcimes par cette gurilla. Par la maladie aussi : terminant
dans ses annales, rdiges au jour le jour, le rcit de lanne 924, le clerc
Flodoard, Reims, y inscrivait avec joie la nouvelle, reue linstant, dune
peste dysentrique laquelle avaient succomb la plupart, disait-on, des
pillards du Nmois. A mesure, par ailleurs, que les annes passaient, les villes
fortes et les chteaux se multipliaient, restreignant les espaces ouverts, seuls
vritablement propices aux razzias. Enfin, depuis lanne 930 ou environ, le
continent tait peu prs affranchi du cauchemar normand ; rois et barons
avaient dsormais les mains plus libres pour se tourner contre les Hongrois et
organiser plus mthodiquement la rsistance. De ce point de vue, luvre
dcisive dOtton fut beaucoup moins la prouesse du Lechfeld que la
constitution des marches. Bien des motifs devaient donc travailler dtourner
le peuple magyar dun genre dentreprise qui, sans doute, rapportait de moins
en moins de richesses et cotait de plus en plus dhommes. Mais leur
influence ne sexera si fortement que parce que la socit magyare elle mme subissait, au mme moment, de graves transformations.
Ici, malheureusement, les sources nous font presque totalement dfaut.
Comme tant dautres nations, les p.36 Hongrois nont commenc avoir
dannales quaprs leur conversion au christianisme et la latinit. On
entrevoit cependant que lagriculture peu peu prenait place ct de
22
Marc BLOCH La socit fodale
llevage : mtamorphose trs lente, dailleurs, et qui comporta longtemps des
formes dhabitat intermdiaires entre le nomadisme vritable des peuples
bergers et la fixit absolue des communauts de purs laboureurs. En 1147,
lvque bavarois Otton de Freising, qui, stant crois, descendait le Danube,
put observer les Hongrois de son temps. Leurs huttes de roseaux, plus
rarement de bois, ne servaient dabris que durant la saison froide ; l t et
lautomne, ils vivent sous la tente . Cest lalternance mme quun peu plus
tt un gographe arabe notait chez les Bulgares de la Basse-Volga. Les
agglomrations, fort petites, taient mobiles. Bien aprs la christianisation,
entre 1012 et 1015, un synode interdit aux villages de sloigner lexcs de
leur glise. Sont-ils partis trop loin ? ils devront payer une amende et
revenir (11). Malgr tout, lhabitude des trs longues chevauches se
perdait. Surtout, sans doute, le souci des moissons sopposait dsormais aux
grandes migrations de brigandage, durant lt. Favorises peut -tre par
labsorption, dans la masse magyare, dlments trangers tribus slaves ds
longtemps peu prs sdentaires ; captifs originaires des vieilles civilisations
rurales de lOccident , ces modifications dans le genre de vie
sharmonisaient avec de profonds changements politiques.
Nous devinons vaguement, chez les anciens Hongrois, au-dessus des
petites socits consanguines ou censes telles, lexistence de groupements
plus vastes, dailleurs sans grande fixit : le combat une fois fini , crivait
lempereur Lon le Sage, on les voit se disperser dans leurs clans () et
leurs tribus () . Ctait une organisation assez analogue, en somme,
celle que nous prsente aujourdhui encore la Mongolie. Ds le sjour du
peuple au nord de la mer Noire, un effort avait t tent, cependant,
limitati on de ltat khasar, pour lever au -dessus de tous les chefs de hordes
un Grand Seigneur (tel est le nom quemploient, dun commun accord, les
sources grecques et latines). Llu fut un certain Arpad. Depuis lors, sans p.37
quil soit aucunement possib le de parler dun tat unifi, la dynastie
arpadienne se tint videmment pour destine lhgmonie. Dans la seconde
moiti du Xe sicle, elle russit, non sans luttes, tablir son pouvoir sur la
nation entire. Des populations stabilises ou qui, du moins, nerraient plus
qu lintrieur dun territoire faiblement tendu taient plus aises
soumettre que des nomades vous un ternel gaillement. Luvre parut
acheve lorsquen 1001 le prince descendant dArpad, Vak, prit le titre de
roi (12). Un groupement assez lche de hordes pillardes et vagabondes stait
mu en un tat solidement implant sur son morceau de sol, la manire des
royauts ou principauts de lOccident. A leur imitation aussi, dans une large
mesure. Comme si souvent, les luttes les plus atroces navaient pas empch
un contact des civilisations, dont la plus avance avait exerc son attrait sur la
plus primitive.
Linfluence des institutions politiques occidentales avait t dailleurs
accompagne par une pntration plus profonde, qui intressait la mentalit
entire ; lorsque Vak se proclama roi, il avait dj reu le baptme sous le
nom dtienne, que lglise lui a conserv, en le mettant au rang de ses saints.
23
Marc BLOCH La socit fodale
Comme tout le vaste no mans land religieux de lEurope orientale, depuis
la Moravie jusqu la Bulgarie et la Russie, la Hongrie paenne avait dabord
t dispute entre deux quipes de chasseurs dmes, dont chacune
reprsentait un des deux grands systmes, ds lors assez nettement distincts,
qui se partageaient la chrtient : celui de Byzance, celui de Rome. Des chefs
hongrois staient fait baptiser Constantinople ; des monastres de rite grec
subsistrent en Hongrie jusque trs avant dans le XIe sicle. Mais les missions
byzantines, qui partaient de trop loin, durent finalement seffacer devant leurs
rivales.
Prpare dans les maisons royales, par des mariages qui dj
attestaient une volont de rapprochement, luvre de conversion tait mene
activement par le clerg bavarois. Lv que Pilgrim, notamment, qui de 971
991 occupa le sige de Passau, en fit sa chose. Il rvait pour son glise, sur les
Hongrois, le mme rle de mtropole des missions qui incombait
Magdebourg, sur les Slaves au-del de p.38 lElbe, et que Brme revend iquait
sur les peuples scandinaves. Par malheur, la diffrence de Magdebourg
comme de Brme, Passau ntait quun simple vch, suffragant de
Salzbourg. Qu cela ne tint ! Les vques de Passau, dont le diocse avait t
fond, en ralit, au VIIIe sicle, se considraient comme les successeurs de
ceux qui, du temps des Romains, avaient sig dans le bourg fortifi de Lorch,
sur le Danube. Cdant la tentation laquelle succombaient, autour de lui,
tant dhommes de sa robe, Pilgrim fit fabriquer une s rie de fausses bulles, par
o Lorch tait reconnu comme la mtropole de la Pannonie . Il ne restait
plus qu reconstituer cette antique province ; autour de Passau, qui, tous liens
briss avec Salzbourg, reprendrait son rang prtendument ancien, viendraient
se grouper, en satellites, les nouveaux vchs dune Pannonie hongroise.
Cependant ni les papes, ni les empereurs ne se laissrent persuader.
Quant aux princes magyars, sils se sentaient prts au baptme, ils
tenaient beaucoup ne pas dpendre de prlats allemands. Comme
missionnaires, plus tard comme vques, ils appelaient, de prfrence, des
prtres tchques, voire vnitiens ; et lorsque, vers lan mille, tienne organisa
la hirarchie ecclsiastique de son tat, ce fut, daccord avec le p ape, sous
lautorit dun mtropolite propre. Aprs sa mort, les luttes dont sa succession
fut lenjeu, si elles rendirent, pour un temps, quelque prestige certains chefs
demeurs paens, en fin de compte natteignirent pas srieusement son uvre.
De plus en plus profondment gagn par le christianisme, pourvu dun roi
couronn et dun archevque, le dernier venu des peuples de la Scythie
comme dit Otton de Freising avait dfinitivement renonc aux
gigantesques razzias de jadis pour senfermer dan s lhorizon dsormais
immuable de ses champs et de ses ptures. Les guerres, avec les souverains de
lAllemagne proche, demeurrent frquentes. Mais ctaient les rois de deux
nations sdentaires qui, dornavant, saffrontaient (13).
*
**
24
Marc BLOCH La socit fodale
25
Marc BLOCH La socit fodale
CHAPITRE II
Les Normands
I. Caractres gnraux des invasions scandinaves
p.39 Depuis Charlemagne, toutes les populations de langue germanique
qui rsidaient au sud du Jutland, tant dsormais chrtiennes et incorpores
aux royaumes francs, se trouvaient places sous lemprise de la civilisation
occidentale. Plus loin, par contre, vers le Nord, dautres Germains vivaient,
qui avaient conserv, avec leur indpendance, leurs traditions particulires.
Leurs parlers, diffrents entre eux, mais beaucoup plus diffrents encore des
idiomes de la Germanie proprement dite, appartenaient un autre des rameaux
issus nagure du tronc linguistique commun ; nous lappelons aujourdhui le
rameau scandinave. Loriginalit de leur culture, par rapport cell e de leurs
voisins plus mridionaux, stait dfinitivement accuse la suite des grandes
migrations qui, aux IIe et IIIe sicles de notre re, vidant presque dhommes
les terres germaines, le long de la Baltique et autour de lestuaire de lElbe,
avaient fait disparatre beaucoup dlments de contact et de transition.
Ces habitants de lextrme Septentrion ne formaient ni une simple
poussire de tribus, ni une nation unique. On distinguait les Danois, dans la
Scanie, les les, et, un peu plus tard, la pninsule jutlandaise ; les Gtar dont
les provinces sudoises dster et de Vestergtland gardent aujourdhui le
souvenir (14) ; les Sudois, autour du lac Mlar ; enfin les peuplades diverses
qui, spares par de vastes p.40 tendues de forts, de landes demi enneiges
et de glaces, mais unies par la mer familire, occupaient les valles et les ctes
du pays que lon devait bientt appeler la Norvge. Cependant il y avait entre
ces groupes un air de famille trop prononc et, sans doute, de trop frquents
mlanges pour que leurs voisins neussent pas lide de leur appliquer une
tiquette commune. Rien ne paraissant plus caractristique de ltranger, tre,
par nature, mystrieux, que le point de lhorizon do il semble surgir, les
Germains den de de lElbe prirent lhabitude de dire simplement
hommes du Nord , Nordman. Chose curieuse : ce mot, malgr sa forme
exotique, fut adopt tel quel par les populations romanes de la Gaule : soit
quavant dapprendre connatre, di rectement, la sauvage nation des
Normands , son existence leur et t rvle par des rcits venus des
provinces limitrophes ; soit, plus probablement, que les gens du vulgaire
leussent dabord entendu nommer par leurs chefs, fonctionnaires royaux don t
la plupart, au dbut du IXe sicle, tant issus de familles austrasiennes,
parlaient ordinairement le francique. Aussi bien, le terme demeura-t-il
demploi strictement continental. Les Anglais, ou bien sefforaient de
26
Marc BLOCH La socit fodale
distinguer, de leur mieux, entre les diffrents peuples, ou bien les dsignaient,
collectivement, par le nom de lun deux, celui des Danois, avec lesquels ils se
trouvaient plus particulirement en contact (15).
Tels taient les paens du Nord , dont les incursions, brusquement
dclenches aux alentours de lan 800, devaient, pendant prs dun sicle et
demi, faire gmir lOccident. Mieux que les guetteurs qui, alors, sur nos ctes,
fouillant des yeux la haute mer, tremblaient dy dcouvrir les proues des
barques ennemies, ou que les moines, occups dans leurs scriptoria noter les
pillages, nous pouvons aujourdhui restituer aux raids normands leur
arrire-plan historique. Vus dans leur juste perspective, ils ne nous
apparaissent plus que comme un pisode, vrai dire particulirement sanglant,
dune grande aventure humaine : ces amples migrations scandinaves qui, vers
le mme temps, de lUkraine au Groenland, nourent tant de liens
commerciaux et culturels nouveaux. Mais cest un ouvrage p.41 diffrent,
consacr aux origines de lconomie europenne, quil faut rserver le soin de
montrer comment par ces popes, paysannes et marchandes aussi bien que
guerrires, lhorizon de la civilisation europenne sest trouv largi. Les
ravages et conqutes en Occident dont les dbuts seront dailleurs retracs
dans un autre volume de la collection nous intressent ici seulement
comme un des ferments de la socit fodale.
Grce aux rites funraires, nous pouvons nous reprsenter avec
prcision une flotte normande. Un navire, cach sous un tertre de terre
amoncele, telle tait en effet la tombe prfre des chefs. De notre temps, les
fouilles, en Norvge surtout, ont ramen au jour plusieurs de ces cercueils
marins : embarcations dapparat, vrai dire, destin es aux paisibles
dplacements, de fjord en fjord, plutt quaux voyages vers les terres
lointaines, capables pourtant au besoin de trs longs parcours, puisquun
vaisseau, copi exactement sur lune delles celle de Gokstad a pu, au
IXe sicle, traverser, de part en part, lAtlantique. Les longues nefs , qui
rpandirent la terreur en Occident, taient dun type sensiblement diffrent.
Non pas ce point, cependant, que, dment complt et corrig par les textes,
le tmoignage des spultures ne permette den restituer assez facilement
limage. Ctaient des barques non pontes, par lassemblage de leur
charpente chefs-duvre dun peuple de bcherons, par ladroite proportion
des lignes crations dun grand peuple de matelots. Longues, en gnral, dun
peu plus de vingt mtres, elles pouvaient se mouvoir soit la rame, soit la
voile, et portaient chacune, en moyenne, de quarante soixante hommes, sans
doute passablement entasss. Leur rapidit, si lon en juge par le modle
construit limitation d e la trouvaille de Gokstad, atteignait, sans peine, une
dizaine de nuds. Le tirant deau tait faible : peine plus dun mtre. Grand
avantage, lorsquil sagissait, quittant la haute mer, de saventurer dans les
estuaires, voire le long des fleuves.
Car, pour les Normands comme pour les Sarrasins, les eaux ntaient
quune route vers les proies terrestres. Bien quils ne ddaignassent point,
loccasion, les leons de p.42 chrtiens transfuges, ils possdaient, par eux-
27
Marc BLOCH La socit fodale
mmes, une sorte de science inne de la rivire, si rapidement familiers avec
la complexit de ses cheminements que, ds 830, quelques-uns dentre eux
avaient pu servir de guides, depuis Reims, larchevque Ebbon, fuyant son
empereur. Devant les proues de leurs barques, le rseau ramifi des affluents
ouvrait la multiplicit de ses dtours, propices aux surprises. Sur lEscaut, on
les vit jusqu Cambrai ; sur lYonne, jusqu Sens ; sur lEure, jusqu
Chartres ; sur la Loire, jusqu Fleury, bien en amont dOrlans. En Grande Bretagne mme, o les cours deau sont, au -del de la ligne des mares,
beaucoup moins favorables la navigation, lOuse les mena cependant
jusqu York, la Tamise et un de ses affluents jusqu Reading. Si les voiles
ou les rames ne suffisaient pas, on avait recours au halage. Souvent, pour ne
pas trop charger les nefs, un dtachement suivait par voie de terre. Fallait-il
gagner les bords, par des fonds trop bas ? ou se glisser, pour une razzia, dans
une rivire trop peu profonde ? les canots sortaient des barques. Tourner au
contraire lobstacle de fortifications qui barraient le fil de leau ? on
improvisait un portage ; ainsi, en 888 et 890, afin dviter Paris. L -bas, vers
lest, dans les plaines russes, les marchands scandinaves navaient -ils pas
acquis une longue pratique de ces alternances entre la navigation et le
convoiement des bateaux, dun fleuve lautre ou le long des rapides ?
Aussi bien ces merveilleux marins ne craignaient-ils nullement la terre,
ses chemins et ses combats. Ils nhsitaient pas quitter la rivire pour se
lancer, au besoin, la chasse du butin : tels ceux qui, en 870, suivirent la
piste, travers la fort dOrlans, le long des ornires laisses par les chariots,
les moines de Fleury fuyant leur abbaye du bord de Loire. De plus en plus, ils
shabiturent user, pour leurs dplacements plutt que pour le combat, de
chevaux, dont ils prenaient naturellement la plus grande part dans le pays
mme, au gr de leurs ravages. Cest ainsi quen 866 ils en firent une grande
rafle en Est-Anglie. Parfois, ils les transportaient dun terrain de razzia
lautre ; en 885, par exemple, de France en Angleterre (16). De la sorte, p.43 ils
pouvaient scarter de plus en plus de la rivire ; ne les vit-on pas, en 864,
abandonnant leurs nefs, sur la Charente, saventurer jusqu Clermont
dAuvergne, quils prirent ? En outre, allant plus vite, ils surprenaient mieux
leurs adversaires. Ils taient trs adroits lever des retranchements et sy
dfendre. Bien plus, suprieurs en cela aux cavaliers hongrois, ils savaient
attaquer les lieux fortifis. La liste tait dj longue, en 888, des villes qui, en
dpit de leurs murailles, avaient succomb lassaut des Normands : ainsi
Cologne, Rouen, Nantes, Orlans, Bordeaux, Londres, York, pour ne citer que
les plus illustres. A vrai dire, outre que la surprise avait parfois jou son rle,
comme Nantes, enleve un jour de fte, les vieilles enceintes romaines
taient loin dtre toujours bien entretenues, plus loin encore d tre toujours
dfendues avec beaucoup de courage. Lorsqu Paris, en 888, une poigne
dhommes nergiques sut mettre en tat les fortifications de la Cit et trouva
le cur de combattre, la ville qui, en 845, peu prs abandonne par les
habitants, avait t saccage et par la suite avait probablement subi, deux
reprises encore, le mme outrage, rsista cette fois victorieusement.
28
Marc BLOCH La socit fodale
Les pillages taient fructueux. La terreur que, par avance, ils
inspiraient ne ltait pas moins. Des collectivits, qui voya ient les pouvoirs
publics incapables de les dfendre tels, ds 810, certains groupes frisons
, des monastres isols avaient dabord commenc de se racheter. Puis les
souverains eux-mmes shabiturent cette pratique : prix dargent, ils
obtenaient des bandes la promesse de cesser, au moins provisoirement, leurs
ravages ou de se dtourner vers dautres proies. En France Occidentale,
Charles le Chauve avait donn lexemple, ds 845. Le roi de Lorraine,
Lothaire II, limita en 864. Dans la France Orien tale, ce fut, en 882, le tour de
Charles le Gros. Chez les Anglo-Saxons, le roi de Mercie fit de mme, peuttre, ds 862 ; celui du Wessex, certainement, en 872. Il tait dans la nature de
pareilles ranons quelles servissent dappt toujours renouvel e t, partant, se
rptassent presque sans fin. Comme ctait leurs sujets et, avant tout,
leurs glises que les princes devaient rclamer les sommes p.44 ncessaires,
tout un drainage stablissait finalement des conomies occidentales vers les
conomies scandinaves. Encore aujourdhui, parmi tant de souvenirs de ces
ges hroques, les muses du Nord conservent, dans leurs vitrines, de
surprenantes quantits dor et dargent : apports du commerce, assurment,
pour une large part ; mais aussi pour beaucoup, comme disait le prtre
allemand Adam de Brme, fruits du brigandage . Il est dailleurs frappant
que, drobs ou reus en tribut sous la forme tantt de pices de monnaie,
tantt de joyaux la mode de lOccident, ces mtaux prcieux aient t
gnralement refondus pour en faire des bijoux selon le got de leurs
acqureurs : preuve dune civilisation singulirement sre de ses traditions.
Des captifs taient aussi enlevs et, sauf rachat, emmens outre-mer.
Un peu aprs 860 on vit ainsi vendre, en Irlande, des prisonniers noirs qui
avaient t rafls au Maroc (17). Ajoutez enfin, chez ces guerriers du Nord, de
puissants et brutaux apptits sensuels, le got du sang et de la destruction,
avec, par moments, de grands dchanements, un peu fous, o la violence ne
connaissait plus de freins : telle la fameuse orgie durant laquelle, en 1012,
larchevque de Canterbury, que ses ravisseurs avaient jusque -l sagement
gard pour en tirer ranon, fut lapid avec les os des btes dvores au festin.
Dun Islandais, qui avait fait campagne en Occident, une saga nous dit quon
le surnommait lhomme aux enfants , parce quil se refusait embrocher
ceux-ci sur la pointe des lances, comme ctait la coutume parmi ses
compagnons (18). Cen est assez pour faire comprendre leffroi que partout
rpandaient devant eux les envahisseurs.
II. De la razzia ltablissement
Cependant, depuis le temps o, en 793, les Normands avaient pill leur
premier monastre, sur la cte de Northumbrie, et, durant lanne 800, forc
Charlemagne organiser en hte, sur la Manche, la dfense du littoral franc,
leurs entreprises avaient, peu peu, beaucoup chang de caractre comme
29
Marc BLOCH La socit fodale
denvergure. avaient t, au dbut, le long de p.45 rivages encore
septentrionaux Iles Britanniques, basses terres bordires de la grande
plaine du Nord, falaises neustriennes , des coups de main saisonniers qu
la faveur des beaux jours organisaient de petites troupes de Vikings .
Ltymologie du mot est conteste (19). Mais quil dsignt un coureur
daventures, profitables et guerrires, nest point douteux ; ni non plus que les
groupes ainsi forms ne se fussent gnralement constitus, en dehors des
liens de la famille ou du peuple, tout exprs pour laventure mme. Seuls les
rois de Danemark, placs la tte dun tat au moins rudimentairement
organis, sessayaient dj, sur leurs frontires du sud, de vritables
conqutes. Dailleurs, sans beaucoup de succs.
Puis, trs rapidement, le rayon slargit. Les nefs poussrent jusqu
lAtlantique et plus loin encore vers le Midi. Ds 844, certains ports de
lEspagne occidentale avaient reu la visite des pirates. En 859 et 860, ce fut
le tour de la Mditerrane. Les Balares, Pise, le Bas-Rhne furent atteints. La
valle de lArno fut remonte jusqu Fiesole. Cette incursion
mditerranenne tait dailleurs destine rester isole. Non que la distance
et rien pour effrayer les dcouvreurs de lIslande et du Groenlan d. Ne devaiton pas voir, par un mouvement inverse, au XIIIe sicle, les Barbaresques se
risquer jusquau large de la Saintonge, voire jusquaux bancs de Terre Neuve ? Mais sans doute les flottes arabes taient-elles de trop bonnes
gardiennes des mers.
Par contre les raids mordirent de plus en plus avant dans lpaisseur du
continent et de la Grande-Bretagne. Point de graphique plus parlant que,
reportes sur la carte, les prgrinations des moines de Saint-Philibert, avec
leurs reliques. Labbaye avait t fonde, au VIIe sicle, dans lle de
Noirmoutier : sjour bien fait pour des cnobites, tant que la mer tait peu
prs paisible, mais qui devint singulirement dangereux, lorsque parurent sur
le golfe les premires barques scandinaves. Un peu avant 819, les religieux se
firent construire un refuge de terre ferme, Des, au bord du lac de Grandlieu.
Bientt, ils prirent lhabitude de sy rendre chaque anne ds le dbut du
printemps ; lorsque la mauvaise saison, vers la fin de p.46 lautomne, semblait
interdire les flots aux ennemis, lglise de lle souvrait de nouveau aux
offices divins. Cependant, en 836, Noirmoutier, sans cesse dvaste et o
lapprovisionnement sans doute se heurtait des difficults croissantes, fut
juge dcidment intenable. Des, nagure abri temporaire, passa au rang
dtablissement permanent, tandis que, plus loin vers larrire, un petit
monastre rcemment acquis Cunauld, en amont de Saumur, servait
dornavant de position de repli. En 858, nouveau recul : Des, trop proche de
la cte, dut son tour tre abandonn et lon se fixa Cunauld.
Malheureusement le site, sur la Loire si aise remonter, avait t
mdiocrement choisi. Ds 862, il fallut se transporter en pleine terre,
Messay, dans le Poitou. Ce fut pour sy apercevoir, au bout dune dizaine
dannes, que la distance avec lOcan tait encore trop courte. Cette fois
toute ltendue du Massif Central, comme cran protecteur, ne parut pas de
30
Marc BLOCH La socit fodale
trop ; en 872 ou 873, nos gens senfuirent jusqu Saint -Pourain-sur-Sioule.
L mme, ils ne demeurrent pas longtemps. Plus loin encore vers lest, le
bourg fortifi de Tournus, sur la Sane, fut lasile o, depuis 875, le corps
saint, cahot sur tant de routes, trouva enfin le lieu de quitude dont parle
un diplme royal (20).
Naturellement ces expditions longue distance exigeaient une
organisation bien diffrente de celle dont staient accommodes les brusques
razzias de jadis. Dabord, des forces beaucoup plus nombreuses. Les petites
troupes, groupes chacune autour dun roi de mer , sunirent peu peu et
lon vit se constituer de vritables armes ; tel le Grand Ost (magnus
exercitus) qui, form sur la Tamise, puis, aprs son passage sur les rives de la
Flandre, accru par lappor t de plusieurs bandes isoles, ravagea
abominablement la Gaule, de 879 892, pour revenir enfin se dissoudre sur la
cte du Kent. Surtout il devenait impossible de regagner chaque anne le
Nord. Les Vikings prirent lhabitude dhiverner, entre deux campag nes, dans
le pays mme quils avaient lu comme terrain de chasse. Ainsi firent -ils,
partir de 835 ou environ, en Irlande ; dans la Gaule, pour la premire fois, en
843, Noirmoutier ; en 851, aux bouches de la p.47 Tamise, dans lle de
Thanet. Ils avaient dabord pris leurs quartiers sur la cte. Bientt ils ne
craignirent point de les pousser beaucoup plus avant dans lintrieur. Souvent
ils se retranchaient dans une le de rivire. Ou bien ils se contentaient de se
fixer porte dun cours deau. Po ur ces sjours prolongs, certains
emmenaient femmes et enfants ; les Parisiens, en 888, purent entendre, depuis
leurs remparts, des voix fminines entonner, dans le camp adverse, le vocero
des guerriers morts. Malgr la terreur qui entourait ces nids de brigands, do
partaient constamment de nouvelles sorties, quelques habitants du voisinage
saventuraient chez les hivernants, pour y vendre leurs denres. Le repaire, par
moment, se faisait march. Ainsi, flibustiers toujours, mais dsormais
flibustiers demi sdentaires, les Normands se prparaient devenir des
conqurants du sol.
Tout, la vrit, disposait les simples bandits de nagure une pareille
transformation. Ces Vikings, quattiraient les champs de pillage de lOccident,
appartenaient un peuple de paysans, de forgerons, de sculpteurs sur bois et
de marchands, autant que de guerriers. Entrans hors de chez eux par lamour
du gain ou des aventures, parfois contraints cet exil par des vendettas
familiales ou des rivalits entre chefs, ils nen sentaient pas moins derrire eux
les traditions dune socit qui avait ses cadres fixes. Aussi bien, ctait en
colons que les Scandinaves staient tablis, ds le VII e sicle, dans les
archipels de lOuest, depuis les Fr -r jusquaux Hbrides ; en colons
encore, vritables dfricheurs de terre vierge, qu partir de 870 ils
procdrent la grande prise de sol , la Landnma de lIslande. Habitus
mler le commerce la piraterie, ils avaient cr autour de la Baltique toute
une couronne de marchs fortifis et, des premires principauts que, durant le
IXe sicle, fondrent, aux deux bouts de lEurope, quelques -uns de leurs chefs
de guerre en Irlande, autour de Dublin, de Cork et de Limerick ; dans la
31
Marc BLOCH La socit fodale
Russie kivienne, le long des tapes de la grande route fluviale , le caractre
commun fut de se prsenter comme des tats essentiellement urbains qui,
depuis une ville prise pour centre, dominaient le bas pays environnant.
Force est de laisser ici de ct, si attachante soit-elle, p.48 lhis toire des
colonies formes dans les les occidentales : Shetland et Orcades qui,
rattaches, depuis le Xe sicle, au royaume de Norvge, ne devaient passer
lcosse quau terme mme du moyen ge (1468) ; Hbrides et Man,
constitues, jusquau milieu du X IIIe sicle, en une principaut scandinave
autonome ; royaumes de la cte irlandaise, lesquels, aprs avoir vu leur
expansion brise au dbut du XIe sicle, ne disparurent dfinitivement quun
sicle environ plus tard, devant la conqute anglaise. Dans ces terres places
la pointe extrme de lEurope, ctait aux socits celtiques que se heurtait la
civilisation scandinave. Seul doit tre retrac par nous avec quelque dtail
ltablissement des Normands dans les deux grands pays fodaux : ancien
tat franc et Grande-Bretagne anglo-saxonne. Bien que de lun lautre de
mme quavec les les voisines les changes humains aient t jusquau
bout frquents, que les bandes armes aient toujours aisment travers la
Manche ou la mer dIrlande, que les chefs, si quelque chec les avait
dsappoints sur lune des rives, aient eu pour habitude constante de sen aller
chercher fortune sur le littoral den face, il sera ncessaire, pour plus de clart,
dexaminer sparment les deux terrains de conqute.
III. Les tablissements scandinaves : lAngleterre
Les tentatives des Scandinaves pour sinstaller sur le sol britannique se
dessinrent ds leur premier hivernage : en 851, comme on la vu. Depuis lors,
les bandes, se relayant plus ou moins entre elles, ne lchent plus leur proie.
Parmi les tats anglo-saxons, les uns, leurs rois tus, disparurent : tels, le
Deira, sur la cte occidentale, entre le Humber et la Tees ; lEst -Anglie, entre
la Tamise et le Wash. Dautres, comme la Bernicie, dans lextrme nor d, et la
Mercie, au centre, subsistrent quelque temps, mais trs diminus dtendue et
placs sous une sorte de protectorat. Seul le Wessex, qui stendait alors sur
tout le sud, russit prserver son indpendance, non sans de dures guerres,
illustres, partir de 871, par lhrosme, avis et patient, du roi Alfred.
Produit accompli de cette civilisation anglo-saxonne p.49 qui, mieux quaucune
autre dans les royaumes barbares, avait su fondre en une synthse originale les
apports de traditions culturelles opposes, Alfred, roi savant, fut aussi un roi
soldat. Il parvint soumettre, vers 880, ce qui restait encore de la Mercie,
ainsi soustraite linfluence danoise. Par contre il fallut, au mme moment,
abandonner lenvahisseur, par un vritable trai t, toute la partie orientale de
lle. Non que cet immense territoire, limit approximativement, vers lEst, par
la voie romaine qui joignait Londres Chester, ait form alors, aux mains des
conqurants, un seul tat. Rois ou iarls scandinaves, avec et l, sans
doute, de petits chefs anglo-saxons, comme les successeurs des princes de
32
Marc BLOCH La socit fodale
Bernicie, se partageaient le pays, tantt unis entre eux par toutes sortes de
liens dalliance ou de subordination, tantt se querellant. Ailleurs de petites
rpubliques aristocratiques staient constitues, sur un type analogue celui
de lIslande. Des bourgs fortifis avaient t levs, qui servaient de points
dappui, en mme temps que de marchs, aux diverses armes , devenues
sdentaires. Et comme force tait de nourrir les troupes venues dau -del des
mers, des terres avaient t distribues aux guerriers. Cependant, sur les ctes,
dautres bandes de Vikings continuaient leurs pillages. Comment stonner si,
vers la fin de son rgne, la mmoire toute pleine encore de tant de scnes
dhorreur, Alfred, traduisant, dans la Consolation de Boce, le tableau de
lAge dOr, ne put se retenir dajouter son modle ce trait : alors on
nentendait point parler de vaisseaux arms en guerre (21) ?
Ltat danarchie o vivait ainsi la partie danoise de lle explique
qu partir de 899 , les rois du Wessex qui, seuls, dans la Grande-Bretagne
entire, disposaient dun pouvoir territorial tendu et de ressources
relativement considrables, aient pu, sappuyant sur un rseau de fortifications
peu peu construites, tenter et russir la reconqute. Depuis 954, aprs une
lutte trs rude, leur autorit suprme est reconnue sur tout le pays
prcdemment occup par lennemi. Non que les traces de l tablissement
scandinave aient t par l le moins du monde effaces. Quelques earls, il est
vrai, avec leurs groupes de suivants, avaient plus ou moins p.50 volontairement
repris la mer. Mais la plupart des envahisseurs de nagure demeurrent en
place : les chefs conservaient, sous lhgmonie royale, leurs droits de
commandement ; les gens du commun conservaient leurs terres.
Cependant, de profondes transformations politiques staient opres
en Scandinavie mme. Par-dessus le chaos des petits groupes tribaux, de
vritables tats se consolidaient ou se formaient : tats bien instables encore,
dchirs par dinnombrables luttes dynastiques et sans cesse occups se
combattre les uns les autres, capables cependant, au moins par sursauts, de
redoutables concentrations de forces. A ct du Danemark, o le pouvoir des
souverains saffermit considrablement la fin du X e sicle, ct du
royaume des Sudois, qui avait absorb celui des Gtar, vint alors se placer la
dernire-ne des monarchies septentrionales que cra, vers lan 900, une
famille de chefs locaux, tablis dabord dans les terres, relativement ouvertes
et fertiles, autour du fjord dOslo et du lac Mjsen. Ce fut le royaume du
chemin du Nord , ou, comme nous disons, de Norvge : le nom mme, de
simple orientation et sans aucune rsonance ethnique, voque un pouvoir de
commandement tardivement impos au particularisme de peuplades nagure
bien distinctes. Or aux princes, matres de ces plus puissantes units
politiques, la vie du Viking tait chose familire ; jeunes gens, avant leur
avnement, ils avaient couru les mers ; plus tard, si quelque revers les forait
de fuir, momentanment, devant un plus heureux rival, on les voyait repartir
pour la grande aventure. Comment, une fois capables dordo nner, sur un
territoire tendu, dimportantes leves dhommes et de navires, nauraient -ils
33
Marc BLOCH La socit fodale
point regard encore vers le rivage pour chercher, par-del lhorizon,
loccasion de nouvelles conqutes ?
Lorsque les incursions en Grande-Bretagne recommencrent
sintensifier, depuis 980, il est caractristique que nous trouvions bientt la
tte des principales bandes deux prtendants des royauts nordiques : lun
la couronne de Norvge, lautre celle de Danemark. Tous deux, par la suite,
furent rois. Le Norvgien, Olaf Trygvason, ne revint jamais dans lle. Le
Danois, par contre, Svein la Barbe Fourchue , p.51 nen oublia point le
chemin. A vrai dire, il semble y avoir t ramen tout dabord par une de ces
vendettas quun hros scandinave ne pouv ait, sans honte, renier. Comme,
entre-temps, les expditions de pillage avaient continu sous dautres chefs, le
roi dAngleterre, Aethelred, ne crut pouvoir mieux se dfendre contre les
brigands quen prenant quelques -uns dentre eux son service. Oppose r ainsi
les Vikings aux Vikings tait un jeu classique, plusieurs fois pratiqu par les
princes du continent et, presque toujours, avec un mdiocre succs. prouvant
son tour linfidlit de ses mercenaires danois , Aethelred sen vengea en
ordonnant, le 13 novembre 1002 jour de la Saint-Brice , le massacre de
ceux dentre eux quil fut possible datteindre. Une tradition postrieure,
quon ne peut contrler, raconte quau nombre des victimes figurait la propre
sur de Svein. Ds 1003, le roi de Dan emark brlait des villes anglaises.
Dsormais une guerre presque incessante dvora le pays. Elle ne devait
prendre fin quaprs la mort de Svein comme dAethelred. Dans les premiers
jours de lan 1017, les derniers reprsentants de la maison de Wessex st ant
rfugis en Gaule ou ayant t expdis par les Danois vainqueurs dans le
lointain pays des Slaves, les sages de la terre entendez lassemble des
grands barons et des vques reconnurent comme roi de tous les Anglais le
fils de Svein, Knut.
Il ne sagissait pas dun simple changement de dynastie. Knut, si au
moment de son avnement en Angleterre il ntait pas encore roi du
Danemark, o rgnait un de ses frres, le devint deux ans plus tard. Par la
suite, il conquit la Norvge. Il tenta au moins de stablir chez les Slaves et
Finnois dau -del de la Baltique, jusqu lEstonie. Aux expditions de pillage
dont la mer avait t le chemin succdait, tout naturellement, un essai
dempire maritime. LAngleterre ny figurait que comme la province la plus
occidentale. A la vrit, ce fut le sol anglais que Knut choisit pour y passer
toute la fin de sa vie. Ctait au clerg anglais quil faisait volontiers appel
pour organiser les glises de mission de ses tats scandinaves. Car, fils dun
roi paen, peut-tre tardivement converti, Knut lui-mme fut un dvot de
lglise p.52 romaine, fondateur de monastres, lgislateur pitiste et moralisant
la manire dun Charlemagne. Par l il se rapprochait de ses sujets de la
Grande-Bretagne. Lorsque, fidle lexemple de plusieurs de ses
prdcesseurs anglo-saxons, il fit en 1027, son plerinage Rome pour la
rdemption de son me et le salut de ses peuples , il y assista au
couronnement du plus grand souverain de lOccident, lEmpereur Conrad II,
roi dAl lemagne et dItalie, rencontra en outre le roi de Bourgogne et, en bon
34
Marc BLOCH La socit fodale
fils dun peuple qui avait toujours t commerant aussi bien que guerrier, sut
obtenir de ces portiers des Alpes, pour les marchands dAngleterre, de
fructueuses exemptions de pages. Mais ctait des pays scandinaves quil
tirait le principal des forces avec lesquelles il tenait la grande le. Aale sest
fait dresser cette pierre. Il a lev limpt pour le roi Knut en Angleterre. Dieu
ait son me. Telle est linscription en caract res runiques qui se lit encore
aujourdhui sur une stle funraire, prs dun village de la province sudoise
dUpland (22). Lgalement chrtien malgr la prsence, sur ses diverses terres,
de nombreux lments encore paens ou trs superficiellement christianiss,
ouvert, par le canal du christianisme, aux souvenirs des littratures antiques,
mlant enfin lhritage de la civilisation anglo -saxonne, elle-mme la fois
germanique et latine, les traditions propres des peuples scandinaves, cet tat,
centr autour de la mer du Nord, voyait sentrecroiser curieusement toutes
sortes de courants de civilisation. Peut-tre ft-ce vers ce temps ou
probablement un peu plus tt, dans la Northumbrie peuple danciens Vikings,
quun pote an glo-saxon, mettant en vers de vieilles lgendes du pays des
Gtar et des les danoises, composa le Lai de Beowulf, plein des chos dune
veine pique encore toute paenne ltrange et sombre lai aux monstres
fabuleux, que, par un nouveau tmoignage de ce jeu dinfluences contraires, le
manuscrit, auquel nous le devons, fait prcder dune lettre dAlexandre
Aristote et suivre dun fragment traduit du Livre de _Judith (23).
Mais cet tat singulier avait toujours t assez lche. Les
communications sur de si grandes distances et par des mers fort rudes
comportaient beaucoup dalas. Il y avait quelque p.53 chose dinquitant
entendre dire Knut, dans la proclamation quen 1027, faisant route de Rome
au Danemark, il adressait aux Anglais : Je me propose de venir vers vous,
mon royaume de lEst une fois pacifi... aussitt que cet t jaurai pu me
procurer une flotte. Les parties de lEmpire o le souverain ntait pas
prsent devaient tre remises des vice-rois, qui ne furent pas toujours fidles.
Aprs la mort de Knut, lunion, quil avait cre et maintenue par la force, se
brisa. LAngleterre fut dabord, comme royaume part, attribue un de ses
fils, puis, un court moment encore, runie au Danemark (la Norvge ayant
dcidment fait scession). En 1042 enfin, ce fut, de nouveau, un prince de la
maison de Wessex, douard, dit plus tard le Confesseur , qui y fut reconnu
roi.
Cependant, ni les incursions scandinaves sur les ctes navaient
compltement cess, ni les ambitions des chefs du Nord ne staient teintes.
Saign blanc par tant de guerres et de pillages, dsorganis dans son
armature politique et ecclsiastique, troubl par les rivalits des lignes de
barons, ltat anglais ntait visiblement plus capabl e que dune faible
rsistance. De deux cts, cette proie toute prte tait guette : au-del de la
Manche, par les ducs franais de Normandie, dont les sujets, pendant toute la
premire priode du rgne ddouard, lev lui -mme la cour ducale,
avaient peupl dj lentourage du prince et le haut clerg ; au-del de la mer
du Nord, par les rois scandinaves. Lorsquaprs la mort ddouard lun des
35
Marc BLOCH La socit fodale
principaux magnats du royaume, Harold, Scandinave lui-mme de nom,
demi Scandinave dorigine, eut t sacr roi, deux armes, peu de semaines
dintervalle, dbarqurent sur la cte anglaise. Lune, sur le Humber, tait
celle du roi de Norvge, un autre Harold ou Harald, le Harald au dur
conseil des Sagas : vrai Viking qui ntait parvenu la couronne qu aprs de
longues aventures errantes, ancien capitaine des gardes scandinaves la cour
de Constantinople, commandant des armes byzantines lances sur les Arabes
de Sicile, gendre dun prince de Novgorod, enfin hardi explorateur des mers
arctiques. Lautre , sur le littoral du Sussex, tait commande par le duc de
Normandie, Guillaume le Btard (24). Harald le p.54 Norvgien fut battu et tu
au pont de Stamford. Guillaume vainquit sur la colline de Hastings. Sans
doute les successeurs de Knut ne renoncrent pas dun coup leur rve
hrditaire : deux reprises sous le rgne de Guillaume, le Yorkshire vit
reparatre les Danois. Mais ces entreprises guerrires dgnraient en simples
brigandages : les expditions scandinaves, leur terme, revenaient au
caractre de leurs commencements. Soustraite lorbite nordique, laquelle
elle avait pu, un moment, sembler dfinitivement appartenir, lAngleterre fut,
pour prs dun sicle et demi, englobe dans un tat qui stendait sur les
deux rives de la Manche, pour toujours rattache aux intrts politiques et aux
courants de civilisation du proche Occident.
IV. Les tablissements scandinaves : la France
Mais ce duc de Normandie mme, conqurant de lAngleterre, tout
franais quil ft p ar la langue et par son genre de vie, ne sen rangeait pas
moins, lui aussi, parmi les authentiques descendants des Vikings. Car, sur le
continent comme dans lle, plus dun roi de mer stait finalement fait
seigneur ou prince de la terre.
Lvoluti on y avait commenc de trs bonne heure. Ds les environs
de 850, le delta du Rhin avait vu le premier essai de constitution dune
principaut scandinave, insre dans ldifice politique de ltat franc. Vers
cette date, deux membres de la maison royale de Danemark, exils de leur
pays, reurent en bienfait de lempereur Louis le Pieux le pays qui
stendait autour de Durstede, alors le principal port de lEmpire sur la mer du
Nord. Agrandi plus tard de divers autres morceaux de la Frise, le territoire
ainsi concd devait demeurer dune faon peu prs permanente aux mains
de personnages de cette famille, jusquau jour o le dernier dentre eux fut tu
par trahison, en 885, sur les ordres de Charles le Gros, son seigneur. Le peu
que nous entrevoyons de leur histoire suffit montrer que, les regards tourns
tantt vers le Danemark et ses querelles dynastiques, tantt vers les provinces
franques o ils ne craignaient pas, tout chrtiens quils taient devenus,
dentreprendre des p.55 raids fructueux, ils ne furent que des vassaux sans foi et
de mauvais gardiens de la terre. Mais cette Normandie nerlandaise, qui ne
vcut point, possde aux yeux de lhistorien toute la valeur dun symptme
36
Marc BLOCH La socit fodale
avant-coureur. Un peu plus tard, un groupe de Normands, encore paens,
semble avoir vcu assez longtemps Nantes ou autour de la ville en bonne
intelligence avec le comte breton. A plusieurs reprises les rois francs avaient
pris leur service des chefs de bande. Si ce Vlundr, par exemple, dont
Charles le Chauve avait, en 862, reu lhommage, navait pas t tu peu
aprs dans un duel judiciaire, nul doute quil net bientt t ncessaire de le
pourvoir de fiefs ni que cette invitable consquence ne ft accepte davance.
Visiblement, au dbut du Xe sicle, lide de pareils tablissements tait dans
lair.
Comment, en fin de compte, et sous quelle forme un de ces projets
prit-il corps ? Nous le savons trs mal. Le problme technique a ici trop de
gravit pour que lhistorien puisse sans malhonntet sabstenir den faire
confidence son lecteur. Entrouvrons donc, un instant, la porte du laboratoire.
Il y avait, en ce temps, dans diverses glises de la chrtient, des clercs
qui sappliquaient noter, anne par anne, les vnements. Ctait un vieil
usage, n jadis de lemploi des instruments du comput chronologique pour y
inscrire les faits saillants de lan coul ou en cours. Ainsi, au seuil du moyen
ge, alors que lon datait encore par consuls, avait -on procd pour les fastes
consulaires ; de mme, plus tard, pour les tables de Pques destines
indiquer, dans leur succession, les dates, si variables, de cette fte qui
commande lordre des liturgies presque tout entier. Puis, vers le dbut de la
priode carolingienne, le mmento historique stait dtach du calendrier,
tout en conservant sa coupe rigoureusement annuelle. Naturellement, la
perspective de ces mmorialistes diffrait beaucoup de la ntre. Ils
sintressaient aux chutes de grle, aux disettes de vin ou de bl, aux prodiges,
presque autant quaux guerres, aux morts des princes, aux rvolutions de
ltat ou de lglise. Ils taient en outre, non seulement dintelligence ingale,
mais aussi fort ingalement informs. La curiosit, lart p.56 dinterroger, le
zle variaient selon les individus. Surtout, le nombre et la valeur des
renseignements recueillis dpendaient de lemplacement de la maison
religieuse, de son importance, de ses liens plus ou moins troits avec la cour
ou les grands. A la fin du IXe sicle et au cours du Xe, les meilleurs annalistes
de la Gaule furent, sans conteste, un moine anonyme de la grande abbaye
Saint-Vaast dArras, et un prtre de Reims, Flodoard, qui, lavantage dun
esprit particulirement dli, joignait celui de vivre dans un incomparable
foyer dintrigues et de nouv elles. Malheureusement les Annales de SaintVaast sinterrompent tout net au milieu de lan 900 ; quant celles de
Flodoard, au moins telles quelles nous ont t conserves car il faut, bien
entendu, compter aussi avec les injures du temps , leur point de dpart se
place en 919. Or, par la plus fcheuse des aventures, le hiatus se trouve
correspondre prcisment ltablissement des Normands en France
Occidentale.
A dire vrai, ces agendas ne sont pas les seuls ouvrages historiques
laisss par une poque que le pass proccupait beaucoup. Moins dun sicle
aprs la fondation de la principaut normande de la Basse-Seine, le duc
37
Marc BLOCH La socit fodale
Richard Ier, petit-fils de son fondateur, dcida de faire retracer les exploits de
ses anctres et les siens propres. Il chargea de ce soin un chanoine de SaintQuentin, Doon. Luvre, excute avant 1026 , est pleine denseignements.
On y surprend la tche un crivain du XIe sicle occup compiler les
renseignements extraits dannales antrieures, quil ne cite jamais, avec
quelques communications orales, dont il fait grand tat, et avec les
embellissements que lui suggraient tantt ses souvenirs livresques, tantt,
plus simplement, son imagination. On y saisit au vif quels ornements un clerc
instruit tenait pour dignes de rehausser lclat dun rcit et un flatteur avis
pour propres chatouiller lorgueil de ses patrons. A laide des quelques
documents authentiques par o on la peut contrler, on y sonde la profondeur
doubli et de dformation dont, au bout de quelques gnr ations, la mmoire
historique des hommes de ce temps tait susceptible. En un mot cest sur la
mentalit dun milieu et dune poque un tmoignage infiniment prcieux ;
sur les faits p.57 mmes qui sy trouvent rapports, au moins en ce qui regarde
la primitive histoire du duch de Normandie, un tmoignage peu prs nul.
De ces vnements si obscurs, voici donc ce qu laide de quelques
mdiocres annales et dun tout petit nombre de documents darchives, on
arrive apercevoir.
Sans ngliger absolument les bouches du Rhin et de lEscaut, ctait
sur les valles de la Loire et de la Seine que, de plus en plus, stait port,
partir de 885 ou environ, leffort des Vikings. Autour de la Basse -Seine,
notamment, une de leurs bandes stait installe demeu re, en 896. De l elle
rayonnait, de toutes parts, la recherche du butin. Mais ces expditions
lointaines ntaient pas toujours heureuses. Les pillards furent battus en
Bourgogne, plusieurs reprises, sous les murs de Chartres, en 911. Dans le
Roumois et la rgion avoisinante, en revanche, ils taient matres et sans
doute, pour se nourrir durant les hivernages, avaient-ils dj d y cultiver ou
faire cultiver la terre : dautant que, cet tablissement formant foyer
dattraction, les premiers arrivs, q ui ntaient quen petit nombre, avaient t
rejoints par dautres vagues daventuriers. Si lexprience montrait quil
ntait pas impossible de brider leurs ravages, les dloger de leurs repaires
semblait, par contre, dpasser les forces du seul pouvoir intress, celui du roi.
Car de pouvoirs plus proches, il ntait plus question : dans ce pays
horriblement ravag et qui pour centre navait plus quune ville en ruine, les
cadres de commandement locaux avaient totalement disparu. Par ailleurs, le
nouveau roi de France Occidentale, Charles le Simple, sacr en 893 et partout
reconnu depuis la mort dEudes, son rival, parat avoir, ds son avnement,
entretenu le dessein dun accord avec lenvahisseur. Il y donna suite, durant
lanne 897 , en appelant prs de lui le chef qui commandait alors les
Normands de la Basse-Seine et en lui servant de parrain. Cette premire
tentative demeura sans rsultats. Mais comment stonner quil en ait,
quatorze ans plus tard, repris lide, sadressant cette fois Rollon qui , la
tte de la mme arme , avait succd au filleul de nagure ? Rollon, de
son ct, venait dtre vaincu devant Chartres ; cette dfaite p.58 navait pu
38
Marc BLOCH La socit fodale
manquer de lui ouvrir les yeux sur les difficults qui sopposaient la
poursuite des razzias. Il crut sage daccepter loffre du roi. Ctait, des deux
parts, reconnatre le fait accompli. Avec, par surcrot, aux regards de Charles
et de ses conseillers, lavantage de se rattacher, par les liens de lhommage
vassalique et, en consquence, loblig ation de laide militaire, une principaut,
dj, en ralit, toute forme et qui dsormais aurait les meilleures raisons du
monde de garder la cte contre les outrages de nouveaux pirates. Dans un
diplme du 14 mars 918, le roi mentionne les concessions consenties aux
Normands de la Seine, cest --dire Rollon et ses compagnons... pour la
dfense du royaume .
Laccord eut lieu une date que rien ne nous permet de fixer avec
exactitude : certainement aprs la bataille de Chartres (20 juillet 911) ;
probablement peu aprs. Rollon et beaucoup des siens reurent le baptme.
Quant aux territoires cds, sur lesquels Rollon devait dornavant exercer, en
gros, les pouvoirs, pratiquement hrditaires, du plus haut fonctionnaire local
de la hirarchie franque : le comte, ils comprenaient, nous dit la seule source
digne de foi Flodoard, dans son Histoire de lglise de Reims ,
quelques comts autour de Rouen : selon toute apparence, la partie du
diocse de Rouen qui stendait de lEpte la mer et une fraction de celui
dvreux. Mais les Normands ntaient pas hommes se contenter longtemps
dun espace aussi rduit. Aussi bien de nouveaux afflux dimmigrs les
poussaient-ils imprieusement sagrandir. La reprise des guerres
dynastiques, dans le royaume, ne tarda pas leur fournir loccasion de
monnayer leurs interventions. Ds 924, le roi Raoul remettait Rollon le
Bessin (25) ; en 933, au fils et successeur de Rollon, les diocses dAvranches
et de Coutances. Ainsi progressivement, la Normandie neustrienne avait
trouv ses contours dsormais presque immuables.
Restait cependant la Basse-Loire, avec ses Vikings : mme problme
que sur lautre estuaire, et pour commencer, mme solution. En 921, le duc et
marquis Robert qui, frre de lancien roi Eudes, dtenait dans lOuest un
grand p.59 commandement et se conduisait pratiquement en souverain
autonome, cda aux pirates du fleuve, dont quelques-uns seulement staient
fait baptiser, le comt de Nantes. La bande scandinave cependant semble avoir
t moins forte et lattraction exerce par les tablissements de Rollon,
rgulariss une dizaine dannes plus tt, lempchait de saccrotre. En outre
le Nantais ntait pas prcisment, comme les comts autour de Rouen, un
bien vacant, ni qui ft isol. Sans doute, dans le royaume ou duch des
Bretons Armoricains, o il avait t incorpor peu aprs 840, les luttes entre
les prtendants, les incursions scandinaves elles-mmes, avaient amen une
extrme anarchie. Les ducs, nanmoins, ou les prtendants la dignit ducale,
notamment les comtes du Vannetais tout proche, se considraient comme les
matres lgitimes de cette marche de langue romane ; pour la reconqurir, ils
avaient lappui des troupes quils pouvaient lever parmi leur s fidles de la
Bretagne propre. Lun deux, Alain Barbe Torte, revenu en 936 de
lAngleterre o il stait rfugi, chassa les envahisseurs. La Normandie de la
39
Marc BLOCH La socit fodale
Loire, la diffrence de celle de la Seine, navait eu quune existence
phmre (26).
Ltablissement des compagnons de Rollon sur la Manche ne mit pas
fin dun coup aux dvastations. et l des chefs isols, dautant plus pres
au pillage quils sirritaient de ne pas avoir reu eux aussi des terres (27),
coururent encore quelque temps la campagne. La Bourgogne fut de nouveau
mise sac en 924. Parfois des Normands de Rouen se joignaient ces
brigands. Les ducs eux-mmes navaient pas rompu dun coup avec les
habitudes anciennes. Le moine de Reims, Richer, qui crivait dans les
dernires annes du Xe sicle, manque rarement les traiter de ducs des
pirates . De fait, leurs expditions guerrires ne diffraient pas beaucoup des
razzias dautrefois. Dautant quils y employaient frquemment des troupes de
Vikings, tout frais arrivs du Nord : tels, en 1013, plus dun sicle par
consquent, aprs lhommage de Rollon, les aventuriers, haletant de dsir
vers le butin (28), que conduisait un prtendant la couronne de Norvge,
Olaf, alors paen, mais destin, aprs son baptme, devenir le saint national
de sa p.60 patrie. Dautres bandes opraient pour leur propre compte sur le
littoral. Lune delles, de 966 970, se hasarda jusque sur les ctes dEspagne
et prit Saint-Jacques de Compostelle. En 1018 encore on en vit paratre une
autre sur les ctes du Poitou. Peu peu, cependant, les barques scandinaves
dsapprirent le chemin des eaux lointaines. Par del les frontires de la
France, le delta du Rhin stait lui aussi peu prs libr. Vers 930, lvque
dUtrecht put regagner sa ville o son prdcesseur avait t incapable de
rsider dune faon durable, et la fit rebtir. Assurment les rives de la mer du
Nord restaient ouvertes bien des coups de mains. En 1006, le port de Tiel,
sur le Waal, fut pill, et Utrecht menac ; les habitants mirent eux-mmes le
feu aux installations des quais et du bourg marchand, que ne protgeait aucune
enceinte. Une loi frisonne, un peu plus tard, prvoit, comme un vnement
presque normal, le cas o un homme du pays, enlev par les Normands ,
aura t enrl de force, par eux, dans une de leurs bandes. Longtemps les
marins scandinaves continurent ainsi entretenir pour leur part, dans
lOccident, cet tat dinscurit si c aractristique dune certaine tonalit de
civilisation. Mais lpoque des courses lointaines, avec hivernage, et, depuis la
dfaite du Pont de Stamford, celle des conqutes, au-del des mers, taient
passes.
V. La christianisation du nord
Cependant le Nord lui-mme peu peu allait se christianisant. Une
civilisation qui, lentement, passe une autre foi : lhistorien ne connat gure
de phnomne qui prte de plus passionnantes observations, surtout lorsque,
comme cest ici le cas, les sources, malgr dirrmdiables lacunes,
permettent den suivre les vicissitudes dassez prs pour en faire une
exprience naturelle, capable dclairer dautres mouvements de mme ordre.
40
Marc BLOCH La socit fodale
Mais une tude dtaille dborderait le cadre de ce livre. Quelques points de
repre devront suffire.
Il ne serait gure exact de dire que le paganisme nordique ne fit pas
une srieuse rsistance, puisque trois sicles furent p.61 ncessaires pour le
mettre bas. On entrevoit pourtant quelques-unes des raisons internes qui
facilitrent la dfaite finale. Au clerg, fortement organis, des peuples
chrtiens, la Scandinavie nopposait aucun corps analogue. Les chefs de
groupes consanguins ou de peuples taient les seuls prtres. Sans doute les
rois, en particulier, pouvaient craindre, s ils perdaient leurs droits aux
sacrifices, de ruiner par l un lment essentiel de leur grandeur. Mais, comme
nous le dirons plus tard, le christianisme ne les forait pas tout abandonner
de leur caractre sacr. Quant aux chefs de familles ou de tribus, on peut
croire que les changements profonds de la structure sociale, corrlatifs la
fois aux migrations et la formation des tats, portrent un coup redoutable
leur prestige sacerdotal. Lancienne religion ne manquait pas seulement de
larmature d une glise ; il semble bien quau temps de la conversion elle ait
prsent, en elle-mme, les symptmes dune sorte de dcomposition
spontane. Les textes scandinaves mettent assez souvent en scne de
vritables incroyants. A la longue, ce grossier scepticisme devait conduire
moins labsence, presque inconcevable, de toute foi, qu ladoption dune
foi neuve. Enfin, le polythisme mme ouvrait au changement dobdience un
chemin ais. Des esprits auxquels toute critique du tmoignage est inconnue
nincli nent gure nier le surnaturel, do quil vienne. Lorsque les chrtiens
se refusaient prier les dieux des divers paganismes, ce ntait pas,
lordinaire, faute den admettre lexistence ; ils les tenaient pour de mchants
dmons, dangereux certes, plus faibles cependant que lunique Crateur. De
mme, des textes nombreux nous lattestent, lorsque les Normands apprirent
connatre le Christ et ses saints, ils shabiturent rapidement les traiter
comme des dits trangres, quon pouvait bien, avec laide de ses dieux
propres, combattre et railler, mais dont lobscure puissance tait trop
craindre pour que la sagesse, en dautres circonstances, ne ft point de se les
rendre propices et de respecter la mystrieuse magie de leur culte. Ne vit-on
pas, en 860, un Viking, malade, faire un vu saint Riquier ? Un peu plus
tard, un chef islandais, sincrement converti au christianisme, nen continuait
pas moins dinvoquer Thor, p.62 dans certains cas difficiles (29). De reconnatre
le Dieu des chrtiens comme une force redoutable laccepter comme le seul
Dieu, la distance se pouvait franchir par tapes presque insensibles.
Coupes de trves et de pourparlers, les expditions de pillage ellesmmes exeraient leur action. Plus dun marin du Nord, au retour de ses
courses guerrires, rapporta son foyer la religion nouvelle, comme un autre
butin. Les deux grands rois convertisseurs de la Norvge, Olaf, fils de Trygvi,
et Olaf, fils de Harald, avaient tous deux reu le baptme le premier sur le
sol anglais, en 994, le deuxime sur celui de la France, en 1014, au temps
o, sans royaumes encore, ils commandaient des bandes de Vikings. Ces
passages ou glissements la loi du Christ se multipliaient mesure que, le
41
Marc BLOCH La socit fodale
long de leur route, les aventuriers, venus doutre -mer, rencontraient un plus
grand nombre de leurs compatriotes tablis demeure sur des terres
anciennement chrtiennes et pour la plupart gagns aux croyances des
populations sujettes ou voisines. De leur ct, les relations commerciales,
antrieures aux grandes entreprises guerrires et que celles-ci ninterrompirent
jamais, favorisaient les conversions. En Sude, la plupart des premiers
chrtiens furent des marchands, qui avaient frquent le port de Durstede,
alors le principal nud des communications entre lempire franc et les mers
septentrionales. Une vieille chronique gotlandaise crit, des habitants de lle :
Ils voyageaient avec leurs marchandises vers toute contre... ; chez les
chrtiens, ils virent les coutumes chrtiennes ; quelques-uns furent baptiss et
ramenrent avec eux des prtres. De fait, les plus anciennes communauts
dont nous trouvions trace staient formes dans des bourgs de ngoce : Birka,
sur le lac Mlar, Ripen et Schleswig aux deux extrmits de la route qui, de
mer en mer, traversait listhme jutlandais. En Norvge, vers le dbut du XI e
sicle, selon la pntrante observation de lhistorien islandais Snorri
Sturluson, la plupart des hommes qui habitaient le long des ctes avaient
reu le baptme, alors que dans les hautes valles et sur les tendues
montagneuses, le peuple demeurait tout paen (30). Pendant longtemps, ces
contacts, p.63 dhommes hommes, au hasard des migrations temporaires,
furent pour la foi trangre des agents de propagation singulirement plus
efficaces que les missions lances par lglise.
Celles-ci, nanmoins, avaient commenc de bonne heure. Travailler
lextinction du paganisme apparaissait aux Carolingiens la fois comme un
devoir inhrent leur vocation de princes chrtiens et comme la voie la plus
sre pour tendre sur un monde, dsormais uni dans une mme prire, leur
propre hgmonie. De mme, aux grands empereurs allemands, hritiers de
leurs traditions. La Germanie proprement dite une fois convertie, comment
net -on pas song aux Germains du Nord ? Sur linitiative de Louis le Pieux,
des missionnaires sen furent annoncer le Christ aux Danois et aux Sudois.
Comme jadis Grgoire le Grand avait song le faire pour les Anglais, de
jeunes Scandinaves furent achets sur les marchs desclaves pour tre forms
la prtrise et lapostolat. Enfin, luvre de christianisation obtint un point
dappui permanent par ltablissement, Hambourg, dun archevch, dont le
moine picard Anschaire, son retour de Sude, fut le premier titulaire :
mtropole, pour linstant, dpourvue de suffragants, mais devant qui souvrait,
au-del des frontires scandinaves et slaves toutes proches, une immense
province conqurir. Cependant, les croyances ancestrales avaient encore de
trop fermes racines, les prtres francs en qui on voyait les serviteurs de princes
trangers soulevaient de trop vives suspicions, les quipes de prdicateurs
elles-mmes, en dpit de quelques mes de feu comme Anschaire, taient trop
difficiles recruter pour que ces grands rves pussent si promptement prendre
corps. Hambourg ayant t pill en 845 par des Vikings, lglise mre des
missions ne survcut que parce quon se dcida lui unir, en le dtachant de la
province de Cologne, le sige piscopal de Brme, plus ancien et moins
pauvre.
42
Marc BLOCH La socit fodale
Du moins tait-ce l une position de repli et dattente. De Brme Hambourg, en effet, repartit au Xe sicle un nouvel effort, qui fut plus
heureux. En mme temps, venus dun autre secteur de lhorizon chrtien, les
prtres anglais p.64 disputaient leurs frres dAllemagne lhonneur de baptiser
les paens de la Scandinavie. Habitus de longue date au mtier de pcheurs
dmes, servis par les communications constantes qui liaient l es ports de leur
le aux ctes den face, moins suspects surtout, leur moisson parat bien avoir
t plus abondante. Il est caractristique quen Sude, par exemple, le
vocabulaire du christianisme soit compos demprunts langlo -saxon plutt
qu lalle mand. Il ne lest pas moins que de nombreuses paroisses y aient pris
pour patrons des saints de la Grande-Bretagne. Bien que, selon les rgles
hirarchiques, les diocses plus ou moins phmres qui se fondaient dans les
pays scandinaves dussent dpendre de la province de Brme-Hambourg, les
rois, quand ils taient chrtiens, faisaient volontiers sacrer leurs vques en
Grande-Bretagne. A plus forte raison linfluence anglaise rayonna -t-elle
largement sur le Danemark et mme la Norvge au temps de Knut et de ses
premiers hritiers.
Car, la vrit, lattitude des rois et des principaux chefs tait
llment dcisif. Lglise le savait bien, qui toujours stait avant tout
attache les gagner. A mesure notamment que les groupes chrtiens se
multipliaient et, en raison mme de leur succs, trouvaient devant eux des
groupes paens plus conscients du danger et, par suite, mieux rsolus la lutte,
ctait dans le pouvoir de contrainte exerc par les souverains, souvent avec
une extrme duret, que les deux partis mettaient leur plus sr espoir. Aussi
bien, sans leur appui, comment jeter sur le pays ce rseau dvchs et
dabbayes, faute duquel le christianisme et t incapable de maintenir son
ordre spirituel et datteindre les couches profondes de la popula tion ?
Rciproquement, dans les guerres entre prtendants, qui sans cesse dchiraient
les tats scandinaves, les discordes religieuses ne manquaient pas dtre
exploites : plus dune rvolution dynastique vint ruiner, pour un temps, une
organisation ecclsiastique en voie dtablissement. Le triomphe put tre
reconnu comme assur le jour o, dans chacun des trois royaumes, tour tour,
on vit se succder sans interruption des rois chrtiens : en Danemark, dabord,
depuis Knut ; en Norvge, depuis p.65 Magnus le Bon (1035) ; et sensiblement
plus tard en Sude, depuis le roi Inge qui, vers la fin du XIe sicle, dtruisit
lantique sanctuaire dUpsal, o si souvent ses prdcesseurs avaient offert en
sacrifice la chair des btes et celle mme des hommes.
Comme en Hongrie, la conversion de ces pays du Nord, jaloux de leur
indpendance, devait forcment entraner la constitution dans chacun deux
dune hirarchie propre, directement soumise Rome. Il se trouva un jour, sur
le sige archipiscopal de Brme-Hambourg, un politique assez fin pour
sincliner devant linvitable et, faisant la part du feu, chercher du moins
sauver quelque chose de la suprmatie traditionnellement revendique par son
glise. Larchevque Adalbert depuis 1043 conut lide dun va ste
patriarcat nordique, au sein duquel, sous la tutelle des successeurs de saint
43
Marc BLOCH La socit fodale
Anschaire, se seraient cres les mtropoles nationales. Mais la Curie
romaine, mdiocrement amie des pouvoirs intermdiaires, se garda de
favoriser ce dessein, quau surplus les querelles des barons, en Allemagne
mme, ne permirent pas son auteur de pousser avec beaucoup desprit de
suite. En 1103 un archevch fut fond Lund, dans la Scanie danoise, avec
juridiction sur toutes les terres scandinaves. Puis la Norvge, en 1152, obtint
le sien propre, quelle tablit Nidaros (Trondhjem) auprs du tombeau,
vritable palladium de la nation, o reposait le roi martyr Olaf. La Sude
enfin, en 1164, fixa sa mtropole chrtienne tout prs du site o stait lev,
aux temps paens, le temple royal dUpsal. Ainsi lglise scandinave
chappait lglise allemande. Paralllement, dans le domaine politique, les
souverains de la France Orientale, malgr leurs innombrables interventions
dans les guerres dynastiques du Danemark, ne parvinrent jamais imposer
dune faon durable aux rois de ce pays le versement du tribut, signe de
sujtion ; ni mme avancer srieusement la frontire. Entre les deux grands
rameaux des peuples germaniques la sparation tait alle se marquant avec
une force croissante. LAllemagne ntait pas, ne devait jamais tre toute la
Germanie.
VI. A la recherche des causes
p.66 Fut-ce leur conversion qui persuada les Scandinaves de renoncer
leurs habitudes de pillages et de lointaines migrations ? Concevoir les courses
des Vikings sous les couleurs dune guerre de religion dclenche par lardeur
dun implacable fanatisme paen, lexplication, qui a parfois t au moins
esquisse, heurte par trop ce que nous savons dmes enclines respecter
toutes les magies. Ne peut-on, par contre, croire aux effets dun profond
changement de mentalit, sous laction du changement de foi ? Assurment,
lhistoire des navigations et invasions normandes serait inintelligible sans cet
amour passionn de la guerre et de laventur e qui, dans la vie morale du Nord,
coexistait avec la pratique darts plus tranquilles. Les mmes hommes quon
voyait hanter, en adroits commerants, les marchs de lEurope, depuis
Constantinople jusquaux ports du delta rhnan, ou qui, sous les frimas,
dfrichrent les solitudes de lIslande, ne connaissaient ni plus grand plaisir ni
plus haute source de renom que le cliquetis du fer et le choc des
boucliers : tmoins, tant de pomes et rcits mis par crit seulement au XIIe
sicle, mais o retentit encore le fidle cho de lge des Vikings ; tmoins
aussi, les stles, pierres funraires ou simples cnotaphes, qui, sur les tertres
du pays scandinave, le long des routes ou prs des lieux dassembles,
dressent aujourdhui encore leurs runes, grave s, en rouge vif, sur la roche
grise. Elles ne commmorent point, pour la plupart, comme un si grand
nombre de tombes grecques ou romaines, les morts paisiblement endormis au
foyer natal. Le souvenir quelles rappellent est, presque exclusivement, celui
de hros frapps au cours de quelque expdition sanglante. Il nest pas moins
44
Marc BLOCH La socit fodale
vident que cette tonalit de sentiment peut sembler incompatible avec la loi
du Christ, comprise comme un enseignement de douceur et de misricorde.
Mais, nous aurons par la suite maintes fois loccasion de le constater, chez les
peuples occidentaux, durant lre fodale, la foi la plus vive dans les mystres
du christianisme sassocia, sans difficults apparentes, avec le got de la
violence et du butin, voire avec la plus consciente exaltation de la guerre. p.67
Certes, les Scandinaves communirent dsormais avec les autres
membres de la catholicit dans un mme credo, se nourrirent des mmes
lgendes pieuses, suivirent les mmes routes de plerinages, lurent ou se firent
lire, pour peu quils eussent quelque dsir dinstruction, les mmes livres o
se refltait, plus ou moins dforme, la tradition romano-hellnique.
Cependant lunit foncire de la civilisation occidentale a -t-elle jamais
empch les guerres intestines ? Tout au plus admettra-t-on que lide dun
Dieu unique et omnipotent, jointe des conceptions toutes nouvelles sur
lautre monde, ait port, la longue, un coup fort rude cette mystique du
destin et de la gloire, si caractristique de la vieille posie du Nord et dans
laquelle plus dun Viking, sans doute, avait puis la justification de ses
passions. Qui estimera que cen tait assez pour ter aux chefs toute envie de
suivre les traces de Rollon et de Svein ou pour les empcher de recruter les
guerriers ncessaires leurs ambitions ?
A dire vrai, le problme, tel que nous lavons pos plus haut, souffre
dun nonc incomplet. Comment rechercher pourquoi un phnomne a pris
fin, sans se demander dabord pourquoi il stait produit ? Ce nest, peut -tre,
en le spce, que reculer la difficult : car le commencement des migrations
scandinaves nest gure moins obscur dans ses causes que leur arrt. Non
dailleurs, quil y ait lieu de sattarder scruter longuement les raisons de
lattirance exerce sur les socit s du Nord par les terres, gnralement plus
fertiles et plus anciennement civilises, qui stendaient leur midi. Lhistoire
des grandes invasions germaniques et des mouvements de peuples qui les
prcdrent navait -elle pas dj t celle dun long gli ssement vers le soleil ?
La tradition des pillages par voie de mer tait elle-mme ancienne. Par un
accord remarquable, Grgoire de Tours et le pome du Beowulf nous ont tous
deux conserv le souvenir de lexpdition que, vers 520, un roi des Gtar
entreprit sur les ctes de Frise ; dautres tentatives semblables ne nous
chappent sans doute que par la faute des textes. Il nen est pas moins certain
quassez brusquement, vers la fin du VIII e sicle, ces courses lointaines prirent
une ampleur jusque-l inconnue.
Faut-il donc croire que lOccident, mal dfendu, ft alors p.68 une proie
plus facile que par le pass ? Mais outre que cette explication ne saurait
sappliquer des faits exactement parallles dans le temps, comme le
peuplement de lIslande et la f ondation des royaumes vargues sur les fleuves
de la Russie, il y aurait un insupportable paradoxe prtendre que ltat
mrovingien, pendant sa priode de dcomposition, dt paratre plus
redoutable que la monarchie de Louis le Pieux, voire de ses fils. Visiblement
45
Marc BLOCH La socit fodale
cest ltude des pays du Nord eux -mmes quil convient de demander la
clef de leur destin.
La comparaison des nefs du IXe sicle avec quelques autres
trouvailles, qui se rapportent des dates plus anciennes, atteste que, pendant
la priode immdiatement antrieure lge des Vikings, les marins de la
Scandinavie avaient beaucoup perfectionn la construction de leurs barques.
Nul doute que sans ces progrs techniques les courses lointaines travers les
ocans eussent t impossibles. Mais fut-ce vraiment pour le plaisir dutiliser
des bateaux mieux conus que tant de Normands dcidrent daller chercher
aventure loin de leur pays ? On croira plutt quils se proccuprent
damliorer leur outillage naval afin, prcisment, de se lancer plus avant sur
la mer.
Une autre explication, enfin, a t propose, ds le XIe sicle, par
lhistorien mme des Normands de France, Doon de Saint -Quentin. La cause
des migrations, il la voyait dans le surpeuplement des pays scandinaves ;
lorigine de celui -ci, dans la pratique de la polygamie. Laissons cette dernire
interprtation : outre que les chefs seuls entretenaient de vrais harems, les
observations dmographiques nont jamais tabli loin de l que la
polygamie soit particulirement favorable la ccroissement de la population.
Lhypothse mme du surpeuplement peut paratre, au premier abord,
suspecte. Les peuples victimes dinvasions lont presque toujours mise en
avant, dans lespoir, assez naf, de justifier leurs dfaites par lafflux dun
nombre prodigieux dennemis : tels les Mditerranens, nagure, devant les
Celtes, les Romains devant les Germains. Ici cependant elle mrite davantage
considration : parce que Doon la tenait probablement, non de la tradition des
vaincus, mais de celle des p.69 vainqueurs ; surtout, en raison dune certaine
vraisemblance intrinsque. Du IIe au IVe sicle, les mouvements de peuples
qui devaient finalement amener la ruine de lEmpire romain avaient eu
certainement pour effet de laisser dans la pninsule scandinave, les les de la
Baltique, le Jutland, de grandes tendues vides dhommes. Les groupes
demeurs en place purent, plusieurs sicles durant, staler librement. Puis un
moment vint, vers le VIIIe sicle, o lespace sans doute commena de leur
faire dfaut : du moins, compte tenu de ltat de leur agriculture.
A dire vrai, les premires expditions des Vikings en Occident eurent
pour objet beaucoup moins la conqute dtablissements permanents que la
prise dun butin destin tre rapport au foyer. Mais ctait l encore un
moyen de parer au manque de terre. Grce aux dpouilles des civilisations
mridionales, le chef, quinquitait le resserrement de ses champs et de ses
ptures, pouvait maintenir son train de vie et continuer ses compagnons les
libralits ncessaires son prestige. Dans les classes plus humbles,
lmigration pargnait aux cadets la mdiocrit dun foyer trop encombr.
Probablement plus dune famille paysanne dut ressembler alors celle que
nous fait connatre une pierre funraire sudoise du dbut du XIe sicle : sur
cinq fils, lan et le plus jeune sont demeurs au pays ; les trois autres ont
succomb au loin, lun Bornholm, le second en cosse, le troisime
46
Marc BLOCH La socit fodale
Constantinople (31). Enfin une de ces querelles ou de ces vendettas, que la
structure sociale et les murs conspiraient multiplier, forait -elle un homme
abandonner le gaard ancestral ? La rarfaction des espaces vides lui rendait
plus difficile que par le pass la recherche, dans le pays mme, dune nouvelle
demeure ; traqu, il ne trouvait souvent dautre asile que la mer ou les
contres lointaines dont elle ouvrait laccs. A plus forte raison, si lennemi
quil fuyait tait un de ces rois auxquels lhabitat moins lche permettait
dtendre, sur des territoires plus vastes, un pouvoir de commandement plus
efficace. Lhabitude et le succs aidant, le got trs vite sajouta au besoin et
laventure, qui savrait gnralement fructueuse, devint la fois un mtier et
un sport.
Pas plus que le dbut des invasions normandes, leur terme ne
saurait sexpliquer par la situation des pouvoirs politiques dans les pays
envahis. Sans doute la monarchie ottonienne tait, mieux que celle des
derniers Carolingiens, capable de protger son littoral ; Guillaume le Btard et
ses successeurs eussent constitu, en Angleterre, des adversaires redoutables.
Cependant, il se trouva, prcisment, que ni les uns ni les autres, neurent, ou
peu sen faut, rien dfendre. Et lon croira difficilement que la France d epuis
le milieu du Xe sicle, que lAngleterre sous douard le Confesseur aient paru
des proies trop dures. Selon toute vraisemblance laffermissement mme des
royauts scandinaves, aprs avoir, dans ses origines, momentanment amplifi
les migrations, en jetant sur les routes de lOcan beaucoup de bannis et de
prtendants dus, aboutit en fin de compte en tarir la source. Dsormais les
leves dhommes et de navires taient monopolises par les tats, qui avaient,
notamment, organis avec un soin minutieux la rquisition des vaisseaux. Les
rois, dautre part, ne favorisaient gure les expditions isoles qui
entretenaient lesprit de turbulence et fournissaient aux hors -la-loi de trop
faciles refuges, ainsi quaux conspirateurs comme le montre la saga de
saint Olaf le moyen daccumuler les richesses ncessaires leurs noirs
projets. On racontait que Svein, une fois matre de la Norvge, les avait
interdites. Les chefs peu peu shabiturent aux cadres dune vie plus
rgulire, o les ambitions cherchaient leur assouvissement dans la mrepatrie elle-mme, auprs du souverain ou de ses rivaux. Pour se procurer des
terres nouvelles, on poussa plus activement le dfrichement intrieur.
Restaient les conqutes monarchiques, comme celles que fit Knut et
auxquelles sessaya Harald au Dur Conseil. Mais les armes royales taient de
lourdes machines, difficiles mettre en train dans des tats darmature si peu
stable. La dernire tentative dun roi de Danemark sur lAngleterre, au temps
de Guillaume le Btard, choua, avant mme que la flotte et lev lancre,
devant une rvolution de palais. Bientt les rois de Norvge bornrent leurs
desseins renforcer ou tablir leur domination, sur les les de lOuest, de
lIslande aux p.71 Hbrides ; les rois de Danemark et de Sude poursuivre
contre leurs voisins slaves, lettons et finnois de longues campagnes qui, la
fois entreprises de reprsailles car, par un juste retour, les pirateries de ces
peuples troublaient constamment la Baltique , guerres de conqute et
croisades, ne manquaient pas aussi de ressembler parfois, de fort prs, aux
p.70
47
Marc BLOCH La socit fodale
raids dont les bords de lEscaut, de la Tamise ou de la Loire avaient si
longtemps souffert.
*
**
48
Marc BLOCH La socit fodale
CHAPITRE III
Quelques consquences
et quelques enseignements des invasions
I. Le trouble
De la tourmente des dernires invasions, lOccident sortit tout
couvert de plaies. Les villes mmes navaient pas t pargnes, du moins par
les Scandinaves, et si beaucoup dentre elles, aprs le pillage ou labandon, se
relevrent tant bien que mal de leurs ruines, cette brche dans le cours rgulier
de leur vie les laissa pour longtemps affaiblies. Dautres furent moins
heureuses : les deux principaux ports de lempire carolingien sur les mers
septentrionales, Durstede sur le delta du Rhin, Quentovic lembouchure de
la Canche, tombrent dfinitivement au rang, le premier dun mdiocre
hameau, le second dun village de pcheurs. Le long des routes fluviales les
changes avaient perdu toute scurit : en 861, des marchands parisiens,
fuyant sur leur flottille, furent rejoints par les barques normandes et emmens
en captivit. Surtout les campagnes souffrirent affreusement, au point dtre
parfois rduites en vritables dserts. Dans le Toulonnais, aprs lexpulsion
des bandits du Freinet, le sol dut tre dfrich nouveau ; les anciennes
limites des proprits ayant cess dtre reconnaissables, chacun, dit une
charte, semparait de la terre selon ses forces (32). Dans la Touraine, si
souvent parcourue par les Vikings, un acte du 14 septembre 900 met en scne
une petite seigneurie Vontes, dans la valle de lIndre, et un village entier
Martigny, sur la Loire. A Vontes, cinq hommes de condition p.74 servile
pourraient tenir la terre sil y avait la paix . A Martigny, les redevances
sont dnombres soigneusement. Mais cest au pass ; car, si lon distingue
encore dix-sept units de tenure, ou manses, elles ne rapportent plus rien.
Seize chefs de famille seulement vivent sur cette glbe appauvrie : un de
moins que les manses, par consquent, alors que normalement une partie de
ceux-ci eussent d tre occups chacun par deux ou trois mnages. Parmi les
hommes, plusieurs nont ni femmes ni enfants . Et le mme tragique refrain
se fait entendre. Ces gens-l pourraient tenir la terre, sil y avait la
paix (33). Toutes les dvastations, dailleurs, ntaient pas luvre des
envahisseurs. Car, pour rduire lennemi merci, force tait souvent de
laffamer. En 894 , comme une bande de Vikings avait t contrainte de se
rfugier dans la vieille enceinte de Chester, lost anglais, dit la chronique,
enleva tout le btail autour de la place, et brla les moissons et fit manger
par ses chevaux tout le pays environnant .
p.73
49
Marc BLOCH La socit fodale
Naturellement, les paysans, plus quaucune autre classe, taient par l
acculs au dsespoir. Si bien quon les vit, plusieurs reprises, entre Seine et
Loire et prs de la Moselle, sunissant par serment dans un grand sursaut
dnergie, courir sus aux pillards. Leurs troupes, mal organises, se firent
chaque fois massacrer (34). Mais ils ntaient pas seuls ptir, durement, de la
dsolation des campagnes. Les villes, lors mme que leurs enceintes tenaient
bon, avaient faim. Les seigneurs, qui tiraient leurs revenus de la terre, taient
appauvris. En particulier, les seigneuries dglise ne vivaient plus quavec
peine. Do comme plus tard, aprs la guerre de Cent Ans une profonde
dcadence du monachisme et, par contrecoup, de la vie intellectuelle.
LAngleterre, principalement, fut touche. Dans la prface de la Rgle
Pastorale de Grgoire le Grand, traduite par ses soins, le roi Alfred voque
douloureusement le temps o avant que tout ne ft ravag ou brl, les
glises anglaises regorgeaient de trsors et de livres (35) . De fait, ce fut le
glas de cette culture ecclsiastique anglo-saxonne dont lclat nagure avait
rayonn sur lEurope. Mais sans doute leffet le plus durable, en tous lieux, se
rsuma-t-il dans une terrible p.75 dperdition de forces. Lorsquune scurit
relative eut t rtablie, les hommes, eux-mmes diminus en nombre, se
trouvrent devant de vastes tendues, jadis cultives, quavait recouvertes la
brousse. La conqute du sol vierge, encore si abondant, en fut retarde pour
plus dun sicle.
Aussi bien ces ravages matriels ntaient -ils pas tout. Il faudrait
galement pouvoir mesurer le choc mental. Celui-ci fut dautant plus profond
que la tempte, surtout dans lEmpire franc, su ccdait un calme au moins
relatif. Sans doute, la paix carolingienne ntait pas bien ancienne et on ne
lavait jamais vue bien complte. Mais la mmoire des hommes est courte et
leur capacit dillusions, insondable. Tmoin, lhistoire des fortification s de
Reims, qui se rpta, dailleurs, avec quelques variantes, dans plus dune autre
ville (36). Sous Louis le Pieux, larchevque avait sollicit de lempereur la
permission de prlever les pierres de lantique enceinte romaine, pour les
employer la reconstruction de sa cathdrale. Le monarque qui, crit
Flodoard, jouissait alors dune paix profonde et, fier de lillustre puissance
de son Empire, ne redoutait aucune invasion de barbares , donna son
consentement. A peine plus de cinquante ans staient couls que, les
barbares revenus, il fallut en toute hte btir de nouveaux remparts. Les
murs et les palissades, dont lEurope, alors, commena de se hrisser, furent
comme le symbole visible dune grande angoisse. Le pill age dsormais tait
devenu un vnement familier que les personnes prudentes prvoyaient dans
leurs contrats. Tels, ce bail rural des environs de Lucques qui, en 876, stipulait
la suspension du loyer si la nation paenne brle ou dvaste les maisons et
leur contenu ou le moulin (37) ; ou encore, dix-huit ans plus tt, le testament
dun roi de Wessex : les aumnes dont il charge ses biens seront payes
seulement si chaque terre ainsi greve reste peuple dhommes et de btail
et nest pas change en dsert (38). Diverses dapplication, pareilles par le
sentiment, de tremblantes prires, que nous ont conserves quelques livres
liturgiques, se rpondaient dun bout lautre de lOccident. En Provence :
50
Marc BLOCH La socit fodale
Trinit ternelle... dlivre ton peuple chrtien de loppression des paens
(ce sont ici, certainement, les p.76 Sarrasins). Dans la Gaule du Nord : de la
froce nation normande, qui dvaste nos royaumes, libre-nous, Dieu . A
Modne, o lon s adressait saint Gemignano : contre les flches des
Hongrois, sois notre protecteur (39). Quon veuille bien, une minute,
imaginer ltat desprit des fidles qui, chaque jour, sassociaient ces
implorations. Ce nest pas i mpunment quune socit vit en posture de
perptuelle alerte. Certes les incursions arabes, hongroises ou scandinaves ne
portaient pas toute la responsabilit de lombre qui pesait sur les mes. Mais
elles en portaient une large part.
La secousse cependant navait pas t que destructrice. Du trouble
mme naquirent certaines modifications, parfois profondes, dans les lignes de
force, lintrieur de la civilisation occidentale.
Des dplacements de population eurent lieu, en Gaule, qui, si nous
pouvions faire autrement que les deviner, nous paratraient sans doute de
grande consquence. Ds Charles le Chauve on voit le gouvernement se
proccuper, sans beaucoup de succs, de renvoyer, dans leurs foyers, les
paysans qui avaient fui devant lenvahisseur. Les gens du Bas-Limousin, qu
plusieurs reprises les textes nous montrent cherchant asile dans les montagnes,
croira-t-on que tous aient regagn, chaque fois, leur point de dpart ? Aussi
bien les plaines, en Bourgogne notamment, semblent-elles avoir t, plus que
les hautes terres, atteintes par le dpeuplement (40). Parmi les anciens villages
qui, de toutes parts, disparurent, tous navaient dailleurs pas t dtruits par le
fer ou le feu. Beaucoup furent simplement abandonns pour des refuges plus
srs : comme lordinaire, luniversel danger poussait la concentration de
lhabitat. Mieux que les prgrinations des laques, nous connaissons celles
des moines. Comme, le long des chemins de lexil, ils emportaient, avec leurs
chsses, leurs pieuses traditions, tout un brassage lgendaire sensuivit, fort
propre fortifier, en mme temps que le culte des saints, lunit catholique.
Notamment le grand exode des reliques bretonnes rpandit fort loin la
connaissance dune hagiographie originale, facilement accueillie par des mes
que flattait la singularit mme de ses miracles. p.77
Mais ce fut en Angleterre que, par suite dune occupation trangre
particulirement tendue et durable, la carte politique et culturelle subit les
altrations les plus sensibles. Leffondrement des royaumes, nagure
puissants, de la Northumbrie, dans le Nord-Est, et de la Mercie, dans le
Centre, favorisa lascension du Wessex, dj commence durant la priode
prcdente, et des rois issus de cette terre mridionale fit, au bout du compte,
comme dit une de leurs chartes, les empereurs de toute la Bretagne (41) :
hritage que Knut, puis Guillaume le Conqurant devaient en somme se
borner recueillir de leurs mains. Les villes du Sud, Winchester, puis
Londres, attirrent dsormais vers les trsors dont leurs chteaux avaient la
garde le produit des impts prlevs dans tout le pays. Les abbayes
northumbriennes avaient t dillustres foyers dtude. L avait vcu Bde, de
l tait parti Alcuin. Les pillages des Danois, auxquels vinrent sajouter les
51
Marc BLOCH La socit fodale
ravages systmatiques entrepris par Guillaume le Conqurant, afin de chtier
et prvenir les rvoltes, mirent fin cette hgmonie intellectuelle. Bien plus :
une partie de la zone septentrionale chappa pour toujours lAngleterre elle mme. Coupes des autres populations de mme langue par ltablissement
des Vikings dans le Yorkshire, les basses-terres de parler anglo-saxon, autour
de la citadelle northumbrienne ddimbourg, tombr ent sous la domination
des chefs celtes des montagnes. Ainsi le royaume dcosse, dans sa dualit
linguistique, fut, par un choc en retour, une cration de linvasion scandinave.
II. Lapport humain : le tmoignage de la langue et des noms
Ni les bandits sarrasins, ni, hors de la plaine danubienne, les coureurs
hongrois ne mlrent leur sang, en proportion apprciable, celui de la vieille
Europe. Les Scandinaves, par contre, ne se bornrent pas piller : dans leurs
tablissements de lAngleterre et de la Normandie neustrienne, ils
introduisirent, incontestablement, un lment humain nouveau. Comment
doser cet apport ? Les donnes anthropologiques sont, dans ltat actuel de la
science, incapables p.78 de rien fournir de certain. Force est de faire appel, en
les recoupant, divers ordres de tmoignages, de nature plus indirecte.
Chez les Normands de la Seine, ds 940 ou environ, la langue
nordique avait cess, autour de Rouen, dtre dun usage gnral. A cette date,
par contre, elle continuait dtre parle dans le Bessin, peut-tre peupl, plus
tardivement, par un nouvel arrivage dimmigrs ; et son importance dans la
principaut demeurait assez grande pour que le duc rgnant crt ncessaire de
la faire apprendre son hritier. Par une concidence frappante, cest vers le
mme temps que nous observons, pour la dernire fois, lexistence de groupes
paens assez puissants pour jouer un rle dans les troubles qui suivirent la
mort du duc Guillaume Longue-pe, assassin en 942. Jusque dans les
premires annes du onzime sicle, autour de ces iarls de Rouen
longtemps fidles, nous dit une saga, au souvenir de leur cousinage avec
les chefs du Nord (42) il faut bien que des hommes se soient encore trouvs qui,
sans doute bilingues, restaient capables duser des idiomes scandinaves.
Comment expliquer autrement que, vers lan mille, les proches de la
vicomtesse de Limoges, enleve, sur les ctes poitevines, par une bande de
Vikings et emmene par ses ravisseurs au-del des mers , aient eu recours,
pour obtenir sa libration, aux bons offices du duc Richard II ; que ce mme
prince, en 1013, ait pu prendre son service les hordes dOlaf ; que, lanne
suivante, quelques-uns de ses sujets aient peut-tre combattu dans larme du
roi danois de Dublin (43). Ds ce moment, cependant, favorise la fois par le
rapprochement religieux et par le ralentissement des apports humains qui,
dans la priode immdiatement postrieure au premier tablissement, sta ient
succd brefs intervalles, lassimilation linguistique devait tre peu prs
acheve ; Admar de Chabannes, qui crivait en 1028 ou peu avant, la tenait
pour accomplie (44). Au parler des compagnons de Rollon, le dialecte roman de
52
Marc BLOCH La socit fodale
la Normandie et, par son intermdiaire, le franais commun nont gure
emprunt que quelques termes techniques qui, presque tous si nous laissons
provisoirement part la vie agraire , se rapportent soit la p.79 navigation,
soit la topographie des ctes havre et crique , par exemple. Si les
mots de ce type restrent bien vivants, malgr la romanisation, ctait quil
avait t impossible den trouver les quivalents dans la langue dun peuple
terrien, inhabile construire les navires comme dcrire la physionomie dun
littoral.
Lvolution, en Angleterre, suivit de tout autres lignes. Pas plus, vrai
dire, que sur le continent, les Scandinaves ne sy obstinrent dans leur
isolement linguistique. Ils apprirent langlo -saxon. Mais ce fut pour le manier
dune faon bien singulire. Tout en se pliant tant bien que mal sa
grammaire et en adoptant une grande partie de son lexique, ils nen
persistrent pas moins y mler, en grand nombre, des mots de leur parler
originel. En contact troit avec les immigrs, les indignes, leur tour,
shabiturent user largement de ce vocabulaire tranger. Le nationalisme de
la parole et du style tait alors un sentiment inconnu. Mme chez les crivains
les plus attachs aux traditions de leur peuple : un des plus anciens exemples
demprunts la langue des Vikings ne nous est -il pas fourni par le chant de la
bataille de Maldon, qui clbre la gloire de guerriers de lEssex, tombs, en
991, dans un combat contre une bande de ces loups meurtriers ? Plus nest
besoin ici de feuilleter les dictionnaires techniques. Des noms parfaitement
usuels, tels que ciel (sky) ou compagnon (fellow) ; des adjectifs
demploi aussi courant que bas (low) ou malade (ill) ; des verbes que
tout homme a sans cesse la bouche appeler , par exemple, (to call) ou
prendre (to take) ; certains pronoms mme (ceux de la troisime
personne du pluriel) : autant de termes qui nous paraissent aujourdhui anglais
entre les anglais et qui pourtant, avec bien dautres, sont en ralit ns dans le
Nord. En sorte que les millions dhommes qui, au vingtime sicle, parlent, de
par le monde, le plus rpandu des langages europens sexprimeraient dans la
vie de chaque jour tout diffremment si les rivages de la Northumbrie
navaient jamais vu les barques des hommes de la mer .
Bien imprudent, cependant, serait lhistorien qui, cette richesse
comparant lindigence de la dette contracte par le franais envers les parlers
scandinaves, imaginerait entre p.80 les chiffres des populations immigres un
cart exactement proportionnel celui des emprunts linguistiques. Linfluence
dune langue qui meurt sur une concurrente qui survit est bien loin de se
mesurer exactement au nombre des individus auxquels la premire servait,
originellement, de moyen dexpression. Les conditions propres aux faits de
langage ne jouent pas un rle moins considrable. Spar par un vritable
abme des dialectes romans de la Gaule, le danois et le norrois, lpoque des
Vikings, se rapprochaient au contraire beaucoup du vieil anglais, n comme
eux du germanique commun. Certains mots taient pareils des deux parts,
pour la valeur smantique comme pour la forme. Dautres, qui avaient mme
sens, offraient des formes voisines entre lesquelles lhsitation tait aise. L
53
Marc BLOCH La socit fodale
mme o le terme scandinave a supplant un terme anglais, daspect tout
diffrent, lintroduction en a t souvent facilite par la prsence, dans la
langue indigne, dautres mots qui, de mme racine, se rattachaient un or dre
dides analogue. Il nen reste pas moins que la formation de cette sorte de
sabir demeurerait inexplicable si de nombreux Scandinaves ne staient
trouvs vivre sur le sol de lAngleterre et y entretenir des relations constantes
avec les anciens habitants.
Si beaucoup de ces emprunts finirent par sinfiltrer dans la langue
commune, ce fut dailleurs, presque toujours, par lintermdiaire des parlers
propres lAngleterre du Nord et du Nord -Est. Dautres demeurrent confins
dans les dialectes de ces rgions. L en effet notamment dans le Yorskhire,
le Cumberland, le Westmoreland, le nord du Lancashire et le pays des Cinq
Bourgs (Lincoln, Stamford, Leicester, Nottingham et Derby) les earls,
venus dau -del des mers, avaient taill leurs seigneuries les plus importantes
et les plus durables. L aussi et surtout avait eu lieu la grande prise de sol. En
876, racontent les chroniques anglo-saxonnes, le chef viking qui rsidait
York livra le pays de Deira ses compagnons et ceux-ci dsormais le
labourrent . Et plus loin, lanne 877 : aprs la moisson, larme danoise
vint dans la Mercie et sen partagea une partie. Sur cette occupation
paysanne, les indications de la linguistique, dont ce nest pas le moindre
intrt, confirment pleinement le p.81 tmoignage des narrateurs. Car la plupart
des mots emprunts dsignaient dhumbles objets ou des actions familires et
seuls des ruraux, frayant avec des ruraux, avaient pu apprendre leurs voisins,
pour le pain (bread), luf ( egg) ou la racine (root), des noms nouveaux.
Limportance, sur le sol anglais, de cet apport en profondeur ne ressort
pas avec une moindre nettet de ltude des noms de personnes. Les plus
instructifs ne sont pas ceux dont usaient les hautes classes. Car, chez elles, le
choix obissait avant tout aux prestiges dune mode hirarchique, dautant
plus volontiers suivie quaucun autre principe, aux X e et XIe sicles, nen
combattait bien efficacement lattrait : les rgles de la transmission familiale
avaient perdu toute vigueur ; les parrains navaient pas encore pris lhabitude
dimposer leurs noms leurs filleuls ni les pres ou mres, mme parmi les
plus pieuses gens, celle de ne donner leurs enfants que des saints pour
ponymes. De fait, aprs la Conqute de 1066, les noms dorigine scandinave,
jusque-l trs rpandus dans laristocratie anglaise, ne tardrent gure plus
dun sicle tre unanimement abandonns par tout ce qui prtendait une
certaine distinction sociale. Ils restrent, par contre, beaucoup plus longtemps
en usage dans les masses paysannes et mme bourgeoises, que ne talonnait
point limpossible dsir de sassimiler une caste victorieuse : en Est-Anglie
jusquau XIII e sicle ; dans les comts de Lincoln et dYork, jusquau sicle
suivant ; dans celui de Lancastre, jusqu lextrme fin du moyen ge. Certes
rien nautorise penser quils fussent alors ports exclusivement par les
descendants des Vikings. Comment ne pas croire, au contraire, que dans les
campagnes, au sein dune mme classe, limitati on comme les intermariages
avaient exerc leur action habituelle ? Mais ces influences ne purent jouer que
54
Marc BLOCH La socit fodale
parce que de nombreux immigrants taient venus stablir au milieu des
anciens habitants, pour vivre auprs deux de la mme humble vie.
Sur la Normandie neustrienne, le peu quen labsence,
malheureusement, de recherches drudition assez pousses, il soit possible
dentrevoir conduit imaginer une volution sensiblement parallle celle des
comts les plus scandinaviss p.82 de lAngleterre. Bien que lusage de
quelques noms de provenance nordique, comme Osbern, ait t conserv dans
la noblesse jusquau XIII e sicle au moins, les hautes classes, dans leur
ensemble, paraissent stre rallies de bonne heure aux modes franaises.
Rollon lui-mme na vait-il pas donn lexemple en faisant baptiser son fils, n
Rouen, sous le nom de Guillaume ? Aucun duc, depuis lors, ne revint sur ce
point aux traditions ancestrales ; visiblement ils ne dsiraient pas se distinguer
des autres grands barons du royaume. Ainsi quen Grande -Bretagne, dautre
part, les couches infrieures de la population se montrrent beaucoup plus
fidles la tradition : tmoin, lexistence, aujourdhui encore, en pays
normand, dun certain nombre de patronymes tirs danciens prnoms
scandinaves. Tout ce que nous savons de lonomastique familiale, en gnral,
nous interdit de penser quils aient pu se fixer, hrditairement, avant le XIII e
sicle au plus tt. Comme en Angleterre, ces faits voquent un certain
peuplement paysan ; moins nombreux quen Angleterre, ils suggrent un
peuplement moins serr.
Aussi bien, que, dans les contres o eux-mmes avaient creus tant de
vides, les Vikings aient, leur tour, fond plus dun tablissement nouveau, la
toponymie suffirait nous en assurer. En Normandie, vrai dire, il nest pas
toujours ais de faire le dpart entre les noms de lieux scandinaves et une
couche germanique plus ancienne, qui proviendrait dune colonisation
saxonne, clairement atteste, vers le temps mme des invasions barbares, dans
le Bessin au moins. Il semble cependant que, dans la plupart des cas, le litige
doive tre tranch en faveur de limmigration la plus rcente. Si lon dresse,
par exemple, comme il est loisible de le faire avec quelque exactitude, la liste
des terres possdes autour de la Basse-Seine, vers la fin de lpoque
mrovingienne, par les moines de Saint-Wandrille, deux enseignements
caractristiques sen dgagent : les noms sont tous gallo-romains ou dpoque
franque, sans confusion possible avec lappo rt nordique postrieur ; un trs
grand nombre se trouvent aujourdhui rebelles toute identification,
certainement parce quau temps de linvasion normande la plupart des
localits elles-mmes furent dtruites ou dbaptises (45). Seuls, p.83 dailleurs,
importent ici les phnomnes de masse, qui sont les moins sujets au doute.
Les villages consonance scandinave se pressent, trs proches les uns des
autres, dans le Roumois et le Caux. Au-del lordre en devient plus lche
avec, par endroits, de petites constellations encore relativement ramasses : tel
le groupe qui, entre Seine et Risle, aux abords de la fort de Londe dont le
nom lui-mme est nordique rappelle les dfrichements de colons
familiariss, ds la mre-patrie, avec la vie de coureurs des bois. Selon toute
apparence, les conqurants vitaient la fois de se disperser lexcs et de
55
Marc BLOCH La socit fodale
56
trop scarter de la mer. On ne relve, semble -t-il, aucune trace de leur
occupation dans le Vexin, lAlenonnais ou le pays dAvranc hes.
De lautre ct de la Manche, mmes contrastes, mais rpartis sur de
beaucoup plus vastes espaces. Extrmement serrs dans le grand comt
dYork et dans les rgions qui, au sud de la baie de Solway, bordent la mer
dIrlande, les noms caractristiques tout entiers scandinaves ou parfois
seulement scandinaviss vont sgaillant mesure que lon senfonce vers
le Midi ou le Centre : au point de se rduire quelques units lorsque, avec les
comts de Buckingham et de Bedford, on atteint le voisinage des collines qui
limitent, vers le nord-est, la plaine de la Tamise.
Certes, parmi les lieux ainsi baptiss la mode des Vikings, tous
ntaient pas forcment des agglomrations nouvelles ou dont le peuplement
et t, de fond en comble, renouvel. Il est, par exception, des faits
indiscutables. Les colons qui, se fixant sur les bords de la Seine, au dbouch
dun petit vallon, imaginrent dappeler cet tablissement, en leur langage,
le froid ruisseau cest aujourdhui Caudebec , comment croire quils
ne fussent pas tous, ou peu sen faut, de parler nordique ? Plusieurs localits,
dans le nord du Yorkshire, se dnomment village des Anglais , Ingleby (le
mot by par ailleurs tant incontestablement scandinave) : appellation qui, de
toute vidence, et t dpourvue de sens si, dans ce pays, un moment
donn, ce navait t pour un lieu habit une grande originalit que de
possder une population anglaise. L o, en mme temps que lagglomration
elle-mme, les diverses sections de son terroir revtirent des p.84 noms
galement imports, il est visible que lhumble toponymie des champs na pu
tre ainsi remanie que par des paysans. Le cas est frquent dans lAngleterre
du Nord-Est. En Normandie, une fois de plus, force est davouer linsuffisance
des recherches. Dautres tmoignages, malheureusement, offrent moins de
certitude. Un grand nombre de villages, dans la Grande-Bretagne comme
autour de la Seine, sont dsigns par un nom compos dont le premier terme
est un nom dhomme, dorigine scandinav e. Que ce personnage ponyme,
dans lequel on ne saurait gure voir quun chef, ft un immigr nimplique pas
ncessairement pour ses sujets une naissance semblable. Parmi les pauvres
hres dont le labeur nourrissait le seigneur Hastein, de Hattentot en Caux, ou
le seigneur Tofi, de Towthorpe en Yorkshire, qui nous dira combien, avant
larrive de ces matres, avaient dj, de pre en fils, vcu sur le sol quils
engraissaient de leurs peines ? A plus forte raison ces rserves simposent elles lorsque, dans le double nom, le second lment, qui, dans les exemples
prcdents, tait, comme le premier, de provenance trangre, appartient, au
contraire, la langue indigne : les hommes qui, parlant de la terre du
seigneur Hakon, lappelaient Hacquenville avaient assurment oubli la
langue des envahisseurs ou, plus probablement, ne sen taient jamais servi.
III. Lapport humain : le tmoignage du droit et de la structure sociale
Marc BLOCH La socit fodale
Dans le domaine juridique, non plus, tous les tmoignages ne sont pas
dgale po rte. Linfluence dune poigne de gouvernants trangers suffit
expliquer certains emprunts. Parce que les earls, dans lAngleterre conquise,
rendaient la justice, ils habiturent leurs sujets, mme anglais, invoquer la
loi sous le nom familier aux hommes dau -del des mers : lagu, law. Ils
dcouprent la zone occupe en circonscriptions la mode du Nord :
wapentakes, ridings. Sous laction des chefs immigrs, tout un droit nouveau
sintroduisit. Vers 962, aprs les victoires des rois de Wessex, lun d e ceux-ci,
Edgar, dclarait : Je veux que parmi les Danois le droit p.85 sculier demeure
rgl selon leurs bonnes coutumes (46). De fait, les comts que nagure
Alfred avait d abandonner aux Vikings restrent, pour la plupart, jusquau
XIe sicle, runis sous ltiquette commune de pays de loi danoise
(Danelaw). Mais la rgion ainsi dnomme stendait bien au -del des limites
lintrieur desquelles la toponymie rvle un peuplement scandinave intense.
Cest que, dans c haque territoire, les usages rgnants taient fixs par les
grandes assembles judiciaires locales, o les puissants, fussent-ils dune autre
origine que la masse, avaient voix prpondrante. En Normandie, si le fal
continua quelque temps dtre dsign p ar le terme import de dreng, si, par
ailleurs, la lgislation de paix conserva, jusquau bout, une empreinte
scandinave, ces survivances sont de celles qui ne permettent, sur lampleur de
limmigration, aucune conclusion certaine : car le vocabulaire du
compagnonnage intressait seulement un milieu assez restreint et lordre
public tait, par essence, chose du prince (47). Dans son ensemble et rserve
faite, comme nous le verrons plus tard, de certaines particularits relatives la
hirarchie des classes militaires, le droit normand perdit trs vite toute couleur
ethnique originale. Sans doute la concentration mme de lautorit aux mains
des ducs, qui, de bonne heure, se plurent adopter les murs du haut baronat
franais, tait-elle plus favorable lassimilation juridique que, dans le
Danelaw, le morcellement des pouvoirs.
Des deux parts, pour mesurer laction en profondeur de loccupation
scandinave, cest vers la structure de groupes infrieurs en dimension la
province ou au comt quil faut, de prfrence, regarder : vers les bourgs
anglais, dont plusieurs, comme Leicester et Stamford, gardrent une longue
fidlit aux traditions judiciaires des guerriers et des marchands qui sy taient
tablis, au moment de linvasion ; surtout, en Normandie aussi bien quen
Angleterre, vers les petites collectivits rurales.
Lensemble des terres dpendant de la maison paysanne sappelait,
dans le Danemark du moyen ge, bol. Le mot est pass en Normandie, o il
sest fix plus tard, da ns certains noms de lieux ou bien a gliss au sens
denclos, p.86 comprenant, avec le jardin ou le verger, les btiments
dexploitation. Dans la plaine de Caen et dans une grande partie du Danelaw,
un mme terme dsigne, au sein des terroirs, les faisceaux de parcelles
allonges cte cte suivant une orientation parallle : delle ici, dale lbas. Une si frappante concidence, entre deux zones sans rapports directs entre
57
Marc BLOCH La socit fodale
elles, ne saurait sexpliquer que par une influence ethnique commune. Le pays
de Caux se distingue des rgions franaises avoisinantes par la forme
particulire de ses champs, qui sont grossirement carrs et rpartis comme au
hasard ; cette originalit semble supposer un remaniement rural, postrieur au
peuplement des alentours. Dans lAngleterre danoise , le bouleversement
fut assez grave pour amener la disparition de lunit agraire primitive, la hide,
et son remplacement par un autre talon plus petit, la charrue (48).
Quelques chefs, satisfaits de prendre au-dessus de manants ns sur le sol
mme la place des anciens seigneurs, auraient-ils eu le dsir ou la force de
transformer ainsi le modeste lexique des champs et de toucher au dessin des
finages ?
Il y a plus. Entre la structure sociale du Danelaw et celle de la
Normandie, un trait commun se marque, qui dnonce une profonde parent
des institutions. Lattache servile, qui, dans le reste de la France du Nord,
nouait entre le seigneur et son homme un lien hrditaire si fort et si dur,
les campagnes normandes ne lont point connue ou si, peut -tre, elle avait
commenc de se former, avant Rollon, le dveloppement alors sen arrta net.
De mme, lAngleterre du Nord et du Nord -Est fut longtemps caractrise par
ltendue des franchises paysannes. Parmi les petits cultivateurs, beaucoup,
tout en tant gnralement justiciables de tribunaux seigneuriaux, avaient rang
dhommes pleinement libres ; ils pouvaient changer volont de domination ;
ils alinaient en tout cas leurs terres leur gr et, au total, subissaient des
charges moins lourdes et mieux fixes que celles dont le poids pesait soit sur
quelques-uns de leurs voisins moins favoriss, soit, en dehors du pays
danois , sur la plupart des manants.
Or il est sr qu lpoque des Vikings, l e rgime seigneurial tait
absolument tranger aux peuples scandinaves. Des p.87 conqurants, cependant,
qui, peu nombreux, se seraient borns vivre du travail des populations
vaincues, auraient-ils rpugn maintenir celles-ci dans la sujtion ancienne ?
Que les envahisseurs aient transport, dans leurs tablissements nouveaux,
leurs traditionnelles habitudes dindpendance paysanne suppose, de toute
vidence, un peuplement beaucoup plus massif ; ce ntait pas un
asservissement ignor de la mre-patrie que les guerriers du commun,
changeant, aprs le partage du sol, la lance contre la charrue ou la houe,
taient venus chercher si loin. Sans doute assez rapidement, la postrit des
premiers arrivants dut accepter quelques-uns des cadres de commandement
quimposaient les conditions ambiantes. Les chefs immigrs sefforcrent
dimiter le fructueux exemple de leurs pairs dautre race. Une fois rinstalle,
lglise, qui tirait des revenus seigneuriaux le meilleur de sa subsistance, agit
dans un sens analogue. Ni la Normandie, ni le Danelaw ne furent des pays
sans seigneurie. Mais, pour de longs sicles, la subordination y demeura
moins astreignante et moins gnrale quailleurs.
Ainsi tout ramne aux mmes conclusions. Point dimage plus fausse
que de se reprsenter, lexemple des compagnons franais de Guillaume
le Conqurant, les immigrs scandinaves sous laspect, uniquement, dune
58
Marc BLOCH La socit fodale
classe de chefs. Certainement, en Normandie, comme dans lAngleterre du
Nord et du Nord-Est, bien des guerriers paysans, pareils ceux que met en
scne la stle sudoise, dbarqurent des nefs du Nord. tablis tantt sur les
espaces enlevs aux anciens occupants ou quavaient abandonns les fuyards,
tantt dans les interstices de lhabitat primitif, ces colons furent asse z
nombreux pour crer ou dbaptiser des villages entiers, pour rpandre autour
deux leur vocabulaire et leur onomastique, pour modifier, sur quelques points
vitaux, larmature agraire et jusqu la structure mme des socits
campagnardes, dailleurs dj profondment bouleverses par linvasion.
Cependant, en France, linfluence scandinave fut, au total, moins forte
et, sauf dans la vie rurale, qui est, par nature, conservatrice, savra moins
durable que sur la p.88 terre anglaise. L-dessus le tmoignage de larchologie
confirme ceux qui ont t prcdemment invoqus. Malgr la lamentable
imperfection de nos inventaires, on ne saurait douter que les vestiges de lart
nordique ne soient en Normandie beaucoup plus rares quen Angleterre.
Plusieurs raisons expliquent ces contrastes. La moindre tendue de la rgion
scandinavise franaise la rendait plus permable aux actions extrieures.
Lantithse, beaucoup plus tranche, entre la civilisation autochtone et la
civilisation importe, par le fait mme qu elle ne favorisait pas les changes
de lune lautre, poussait lassimilation, pure et simple, de la moins
rsistante des deux. Le pays, vraisemblablement, avait toujours t plus
peupl ; par suite, sauf dans le Roumois et le Caux, abominablement ravags,
les groupes indignes, rests en place aprs linvasion, gardaient plus de
densit. Enfin arrivs en quelques vagues, durant une priode assez courte
alors quen Angleterre lafflux, par ondes successives, stait poursuivi
pendant plus de deux sicles les envahisseurs furent sans doute, mme
proportionnellement au terrain occup, en nombre sensiblement plus faible.
IV. Lapport humain : problmes de provenance
Peuplement, plus ou moins intensif, par les gens du Nord, soit. Mais de
quelles rgions du Nord exactement ? La discrimination, aux contemporains
mmes, ne paraissait pas toujours aise. Dun dialecte scandinave lautre on
se comprenait encore sans trop de peine et les premires bandes surtout,
composes daventuriers runis pour le pill age, taient vraisemblablement fort
mles. Cependant les divers peuples possdaient chacun leurs traditions
propres et, de tout temps vivace, le sentiment quils avaient de leur
individualit nationale semble bien, mesure que se constituaient dans la
mre-patrie les grands royaumes, stre fait de plus en plus aigu. Sur les
champs de conqute, dpres guerres mirent aux prises Danois et Norvgiens.
Tour tour on vit ces frres ennemis se disputer les Hbrides, les petits
royaumes de la cte irlandaise, celui dYork et, dans les Cinq Bourgs, les
garnisons danoises appeler, contre larme rivale, p.89 le roi anglais du
Wessex (49). Ce particularisme, qui reposait sur des diffrences parfois
59
Marc BLOCH La socit fodale
profondes entre les coutumes ethniques, ne fait que rendre plus souhaitable de
pouvoir dterminer, tablissement par tablissement, lorigine prcise des
envahisseurs.
Des Sudois figurrent, on la vu, parmi les conqurants de
lAngleterre, sous Knut. Dautres prirent part au pillage des tats francs : tel
ce Gudmar dont le cnotaphe, dans la province de Sdermanland, voque la
mort l-bas, vers lOuest, en Gaule (50). La plupart de leurs compatriotes,
cependant, prfrrent dautres chemins : les rives orientales ou mridionales
de la Baltique taient trop proches, les proies quoffraient les marchs des
fleuves russes trop tentantes pour ne pas les retenir avant tout. Familiers avec
la route de mer qui contournait la Grande-Bretagne par le nord, les
Norvgiens fournirent le plus gros contingent la colonisation des archipels
sems tout le long de ce priple, de mme qu celle de lIrlande. Ce fut de l,
plus encore que de la pninsule scandinave, quils partirent la conqute de
lAngleterre. Ainsi sexplique qu ils aient t presque les seuls envahisseurs
peupler les comts de la cte occidentale, depuis la baie de Solway jusqu la
Dee. Plus avant dans les terres, on relve encore leurs traces, relativement
nombreuses dans louest du Yorkshire, beaucoup plus rares dans le reste de ce
comt et autour des Cinq Bourgs. Mais, cette fois, partout mles aux
tablissements danois. Ceux-ci, dans toute la zone mixte, furent au total
infiniment plus denses. Visiblement la plupart des immigrants, fixs sur le sol
anglais, appartenaient au plus mridional des peuples scandinaves.
Sur la Normandie, les sources narratives sont dune dsesprante
pauvret. Qui pis est, elles se contredisent : alors que les ducs semblent stre
donns eux-mmes comme de souche danoise, une saga norroise fait de
Rollon un Norvgien. Resteraient les tmoignages de la toponymie et des
coutumes agraires ; les uns comme les autres ont t jusquici insuffisamment
scruts. La prsence dlments danois parat certaine ; de mme celle
dhommes de la Norvge du Sud. En quelles proportions ? et selon quelle
rpartition p.90 gographique ? Cest ce quil est, pour linstant, impossible de
dire ; et si jose indiquer que les contrastes si nets entre les terroirs cauchois,
dune part, ceux de la plaine de Caen de lautre, pourraient bien se ramener,
en fin de compte, une diffrence de peuplement les champs irrguliers du
Caux rappelant ceux de la Norvge, les champs allongs du Bessin ceux du
Danemark , je ne risque cette hypothse, encore bien fragile, que par
fidlit un dessein trs cher : la volont de ne jamais laisser oublier au
lecteur que lhistoire a encore tout le charme dune fouille inacheve.
V. Les enseignements
Quune poigne de bandits, juchs sur une colline provenale, ait pu,
prs dun sicle durant, rpandre linscurit tout le long dun immense massif
montagneux et barrer demi quelques-unes des routes vitales de la chrtient ;
que, plus longtemps encore, de petites hordes de cavaliers de la steppe aient
60
Marc BLOCH La socit fodale
t laisses libres de ravager en tous sens lOccident ; que danne en anne,
depuis Louis le Pieux jusquaux premiers Captiens, voire, en Angleterre,
jusqu Guillaume le Conqurant, les barques du Nord aient impunment jet
sur les ctes germaines, gauloises ou britanniques des bandes empresses au
pillage ; que, pour apaiser ces brigands, quels quils fussent, il ait fallu leur
verser de lourdes ranons et, aux plus redoutables dentre eux, cder
finalement des terres tendues : ces faits sont surprenants. De mme que les
progrs de la maladie rvlent au mdecin la vie secrte dun corps, de mme,
aux yeux de lhistorien, la marche victorieuse dune grande calamit prend,
envers la socit ainsi atteinte, toute la valeur dun symptme.
Ctait par la mer que les Sarrasin s du Freinet recevaient leurs
renforts ; ses flots portaient jusquaux terrains de chasse familiers les nefs des
Vikings. La barrer aux envahisseurs et t, sans nul doute, le plus sr moyen
de prvenir leurs ravages. Tmoins, les Arabes dEspagne interdi sant aux
pirates scandinaves les eaux mridionales ; plus tard, les victoires de la flotte
enfin cre par le roi Alfred ; au XIe sicle, le nettoyage de la Mditerrane
par les villes p.91 italiennes. Or, au dbut du moins, les pouvoirs de
commandement chrtiens manifestrent, cet gard, une incapacit presque
unanime. Ne vit-on pas les matres de cette cte provenale, o se nichent
aujourdhui tant de villages de pcheurs, implorer le secours de la lointaine
marine grecque ? Ne disons point que les princes manquaient de vaisseaux de
guerre. Dans ltat o se trouvait lart naval, il et suffi assurment de
rquisitionner des barques de pche et de commerce ou de rclamer, au
besoin, pour en avoir de plus perfectionns, les offices de quelques calfats ;
nimporte quelle population de matelots et fourni les quipages. Mais
lOccident semble avoir t alors presque totalement dshabitu des choses de
la mer et cette trange carence nest pas la moins curieuse rvlation que nous
offre lhistoire des invasi ons. Sur le littoral de la Provence, les bourgs, jadis,
sous les Romains, placs tout au bord des criques, staient enfoncs dans
lintrieur (51). Alcuin, dans la lettre quil crivit au roi et aux grands de
Northumbrie, aprs le premier pillage normand, celui de Lindisfarne, a un mot
qui fait rver : jamais, dit-il, on net cru la possibilit dune pareille
navigation (52). Il ne sagissait, pourtant, que de traverser la mer du Nord !
Lorsque, aprs un intervalle de prs dun sicle, Alfred se dcida combattre
les ennemis sur leur propre lment, il dut recruter une part de ses marins dans
la Frise, dont les habitants taient spcialiss, de longue date, dans le mtier,
peu prs abandonn par leurs voisins, de caboteurs le long des rivages
septentrionaux. Le service de mer indigne ne fut vritablement organis que
par son arrire-petit-fils Edgar (959-975) (53). La Gaule se montra encore
beaucoup plus lente savoir regarder au-del de ses falaises ou de ses dunes.
Il est significatif que, dans sa fraction la plus considrable, le vocabulaire
maritime franais, au moins sur le front ouest, soit de formation tardive et fait
demprunts tantt au scandinave, tantt langlais mme.
Une fois sur terre, les bandes sarrasines ou normandes, comme les
hordes hongroises, taient singulirement difficiles arrter. Il nest de police
61
Marc BLOCH La socit fodale
aise que l o les hommes vivent proches les uns des autres. Or, en ce temps,
mme p.92 dans les rgions les plus favorises, la population, au regard de nos
mesures actuelles, navait quune faible densit. Partout des espaces vides, des
landes, des forts offraient des cheminements propres aux surprises. Ces
fourrs marcageux, qui, un jour, drobrent la fuite du roi Alfred, pouvaient
aussi bien cacher la marche des envahisseurs. Lobstacle, en somme, tait
celui mme auquel nagure se heurtaient nos officiers lorsquils sefforaient
de maintenir la scurit sur les confins marocains ou en Maurtanie. Dcupl,
cela va de soi, par labsence de toute autorit suprieure capable de contrler
efficacement de vastes tendues.
Ni les Sarrasins, ni les Normands ne sarmaient mieux que leurs
adversaires. Dans les tombes des Vikings, les plus belles pes portent les
marques dune fabrication franque. Ce sont les glaives de Flandre dont
parlent si souvent les lgendes scandinaves. Les mmes textes coiffent
volontiers leurs hros de heaumes welches . Coureurs et chasseurs de la
steppe, les Hongrois probablement taient meilleurs cavaliers, meilleurs
archers surtout que les Occidentaux ; ils nen furent pas moins plusieurs
reprises vaincus en bataille range. Si les envahisseurs possdaient une
supriorit militaire, elle tait beaucoup moins de nature technique que
dorigine sociale. Comme plus tard les Mongols, les Hongrois taient forms
la guerre par leur genre de vie mme. Quand les deux partis sont gaux par
le nombre et par la force, le plus habitu la vie nomade remporte la
victoire. Lobservation est de lhistorien arabe Ibn -Khaldoun (54). Elle a eu
dans lancien monde une porte presque universelle : du moins jusquau jour
o les sdentaires purent appeler leur secours les ressources dune
organisation politique perfectionne et dun armement vraiment scientifique.
Cest que le nomade est un soldat-n , toujours prt partir en campagne
avec ses moyens ordinaires, son cheval, son quipement, ses provisions ; quil
est servi aussi par un instinct stratgique de lespace, fort tranger
gnralement aux sdentaires. Quant aux Sarrasins et surtout aux Vikings,
leurs dtachements taient ds le dpart constitus exprs pour la lutte. Que
pouvaient, en face de ces troupes mordantes, les leves improvises, runies
la hte depuis p.93 les quatre coins dun pays dj envahi ? Comparez, dans les
rcits des chroniques anglaises, lallant du here larme danoise avec la
gaucherie du fyrd anglo-saxon, lourde milice dont on nobtient une action tant
soit peu prolonge quen permettant, par un jeu de relves, le retour
priodique de chaque homme sa terre. Ces contrastes, vrai dire, furent vifs
surtout au dbut. A mesure que les Vikings se muaient en colons et les
Hongrois, autour du Danube, en paysans, de nouveaux soucis vinrent entraver
leurs mouvements. Par ailleurs, lOccident, avec le systme de la vassalit ou
du fief, ne stait -il pas donn, lui aussi, de bonne heure, une classe de
combattants professionnels ? Lincapacit o ce mcanisme, mont pou r la
guerre, fut jusquau bout, somme toute, de fournir les moyens dune
rsistance, vraiment efficace, en dit long sur ses dfauts internes.
62
Marc BLOCH La socit fodale
Mais ces soldats de mtier consentaient-ils rellement se battre ? Tout
le monde senfuit , crivait, ds 862 ou peu aprs, le moine Ermentaire (55).
De fait, jusque chez les hommes en apparence les mieux entrans, les
premiers envahisseurs semblent avoir produit une impression de terreur
panique dont les effets paralysants voquent irrsistiblement les rcits des
ethnographes sur la fuite perdue de certaines tribus primitives, pourtant fort
belliqueuses, devant tout tranger (56) : braves en face du danger familier, les
mes frustes sont lordinaire incapab les de supporter la surprise et le
mystre. Le moine de Saint-Germain-des-Prs qui, trs peu de temps aprs
lvnement, a racont la remonte de la Seine, en 845, par les barques
normandes, voyez avec quel accent troubl il observe quon navait jamais
ou parler dune chose semblable ni lu rien de pareil dans les livres (57).
Cette motivit tait entretenue par latmosphre de lgende et dapocalypse
qui baignait les cerveaux. Dans les Hongrois, rapporte Rmi dAuxerre,
d innombrables personnes croyaient reconnatre les peuples de Gog et
Magog, annonciateurs de lAntchrist (58). Lide mme, universellement
rpandue, que ces calamits taient un chtiment divin disposait courber la
tte. Les lettres quAlcuin expdia en Angleterre aprs le dsastre de
Lindisfarne ne sont quexhortations la vertu et au p.94 repentir ; de
lorganisation de la rsistance, pas un mot. L encore, cependant, cest de la
priode la plus ancienne que datent les exemples de couardise vraiment
avre. Plus tard, on reprit un peu plus de cur.
La vrit profonde est que les chefs taient beaucoup moins incapables
de combattre, si leur propre vie ou leurs biens se trouvaient en jeu, que
dorganiser mthodiquement la dfe nse et peu dexceptions prs de
comprendre les liens entre lintrt particulier et lintrt gnral. Ermentaire
navait point tort quand, parmi les causes des victoires scandinaves, il plaait,
ct de la poltronnerie et de la torpeur des chrtiens, leurs
dissensions . Que les affreux bandits du Freinet aient vu un roi dItalie
pactiser avec eux ; quun autre roi dItalie, Brenger I er, ait pris son service
des Hongrois, un roi dAquitaine, Ppin II, des Normands ; que les Parisiens
aient, en 885, lanc les Vikings sur la Bourgogne ; que la ville de Gate,
longtemps lallie des Sarrasins du Monte Argento, ait consenti seulement
contre des terres et de lor prter son appui la ligue forme pour chasser
ces brigands : ces pisodes, entre bien dautres, jettent un jour singulirement
cruel sur la mentalit commune. Les souverains sefforaient -ils, malgr tout,
de lutter ? Trop souvent lentreprise sachevait comme, en 881, celle de Louis
III qui, ayant construit, afin de barrer la route aux Normands, un chteau sur
lEscaut, ne put trouver personne pour le garder . Il nest gure dost royal
dont on net pu rpter, pour le moins, ce que, probablement non sans une
pointe doptimisme, un moine parisien disait de la leve de 845 : parmi les
guerriers convoqus beaucoup vinrent ; non pas tous (59). Mais, sans doute, le
cas le plus rvlateur est-il celui dun Otton le Grand, qui, puissant entre tous
les monarques de son temps, ne russit jamais faire runir la petite troupe
dont lassaut et mis un terme au scandale du Freinet. Si, en Angleterre, les
rois du Wessex, jusqu leffondrement final, menrent vaillamment et
63
Marc BLOCH La socit fodale
efficacement le bon combat contre les Danois, si en Allemagne Otton agit de
mme contre les Hongrois, dans lensemble du continent la seule rsistance
vraiment heureuse vint plutt des pouvoirs rgionaux qui, plus forts p.95 que les
royauts parce quils taient plus proches de la matire humaine et moins
proccups de trop vastes ambitions, se constituaient lentement au-dessus de
la poussire des petites seigneuries.
Quelque riche en enseignements que soit ltude des dernires invasions,
il ne faudrait pas cependant laisser ses leons nous masquer un fait plus
considrable encore : larrt des in vasions elles-mmes. Jusque-l ces ravages
par des hordes venues du dehors et ces grands remuements de peuples avaient
vritablement donn sa trame lhistoire de lOccident, comme celle du
reste du monde. Dornavant, lOccident en sera exempt. A la dif frence, ou
peu sen faut, du reste du monde. Ni les Mongols, ni les Turcs ne devaient
faire plus tard autre chose queffleurer ses frontires. Il aura certes ses
discordes ; mais en vase clos. Do la possibilit dune volution culturelle et
sociale beaucoup plus rgulire, sans la brisure daucune attaque extrieure ni
daucun afflux humain tranger. Voyez, par contraste, le destin de lIndo Chine o, au XIVe sicle, la splendeur des Chams et des Khmers seffondra
sous les coups des envahisseurs annamites ou siamois. Voyez surtout, plus
prs de nous, lEurope Orientale, foule, jusquaux temps modernes, par les
peuples de la steppe et les Turcs. Quon se demande, une minute, ce quet
t le sort de la Russie sans les Polovtsi et les Mongols. Il nest pas interdit de
penser que cette extraordinaire immunit, dont nous navons gure partag le
privilge quavec le Japon, fut un des facteurs fondamentaux de la civilisation
europenne, au sens profond, au sens juste du mot.
*
**
64
Marc BLOCH La socit fodale
LIVRE DEUXIEME :
Les conditions de vie et latmosphre mentale .
CHAPITRE PREMIER
Conditions matrielles et tonalit conomique
I. Les deux ges fodaux
Larmature dinstitutions qui rgit une socit ne saurait, en dernier
ressort, sexpliquer que par la connaissanc e du milieu humain tout entier. Car
la fiction de travail qui, dans ltre de chair et de sang, nous contraint de
dcouper ces fantmes : homo conomicus, philosophicus, juridicus, elle est
ncessaire sans doute ; mais supportable seulement si lon refuse den tre la
dupe. Cest pourquoi, malgr la prsence, dans la mme collection, dautres
volumes consacrs aux divers aspects de la civilisation mdivale, il na pas
sembl que les descriptions, ainsi entreprises sous des angles diffrents du
ntre, pussent dispenser de rappeler ici les caractres fondamentaux du climat
historique qui fut celui de la fodalit europenne. Est-il besoin de lajouter ?
En inscrivant cet expos presque en tte du livre, on ne songe nullement
postuler, en faveur des ordres de faits qui y seront brivement retracs, je ne
sais quelle illusoire primaut. Lorsquil sagit de confronter deux phnomnes
particuliers, appartenant des sries distinctes une certaine rpartition de
lhabitat, par exemple, avec certaines formes des groupes juridiques , le
problme dlicat de la cause et de leffet se pose assurment. Mettre face
face, en revanche, au long dune volution plusieurs fois sculaire, deux
chanes de phnomnes, par nature dissemblables, puis dire : voici de ce
ct toutes les causes ; de lautre, voil tous les effets , p.98 rien ne serait plus
vide de sens quune pareille dichotomie. Une socit, comme un esprit,
nest -elle pas tissue de perptuelles interactions ? Toute enqute cependant a
son axe propre. Points daboutissement au regard dautres recherches
autrement centres, lanalyse de lconomie ou de la mentalit sont, pour
lhistorien de la structure sociale, un point de dpart.
p.97
Dans ce tableau prliminaire, dobjet sciemment limit, force sera de ne
retenir que lessentiel et le moins sujet au doute. Une lacune volontaire mrite,
65
Marc BLOCH La socit fodale
entre toutes, un mot dexplication. Ladmirable floraison artistique de lre
fodale, au moins depuis le XIe sicle, ne demeure pas seulement, aux yeux de
la postrit, la plus durable gloire de cette poque de lhumanit. Elle servit
alors de langage aux formes les plus hautes de la sensibilit religieuse comme
cette interpntration, si caractristique, du sacr et du profane qui na pas
laiss de plus nafs tmoignages que certaines frises ou certains chapiteaux
dglises. Elle fut aussi, bien souvent, comme le refuge des valeurs qui
ailleurs ne parvenaient pas se manifester. La sobrit dont lpope tait si
incapable, cest dans les architectures romanes quil la faut che rcher. La
prcision desprit que les notaires, dans leurs chartes, ne savaient pas
atteindre, elle prsidait aux travaux des constructeurs de votes. Mais les
rapports qui aux autres aspects dune civilisation unissent lexpression
plastique sont encore trop mal connus, nous les entrevoyons trop complexes,
trop susceptibles de retardements ou de divergences pour quil nait pas fallu
se rsoudre ici laisser de ct les problmes poss par des liaisons si
dlicates et des contradictions, en apparence, si tonnantes.
Lerreur, dailleurs, serait lourde de traiter la civilisation fodale
comme constituant, dans le temps, un bloc dun seul tenant. Provoques sans
doute ou rendues possibles par larrt des dernires invasions, mais, dans la
mesure mme o elles taient le rsultat de ce grand fait, en retard sur lui de
quelques gnrations, une srie de transformations, trs profondes et trs
gnrales, sobservent vers le milieu du X Ie sicle. Non point brisure, certes,
mais changement dorientation, qui, malgr dinvitables dcalages, selon les
p.99 pays ou les phnomnes envisags, atteignit tour tour presque toutes les
courbes de lactivit sociale. Il y eut, en un mot, deux ges fodaux
successifs, de tonalits fort diffrentes. On sefforcera, dans ce qui suit, de
rendre justice, autant qu leurs traits communs, aux contrastes de ces deux
phases.
II. Le premier ge fodal : le peuplement
Il nous est et sera toujours impossible de chiffrer, ft-ce
approximativement, la population de nos contres, durant le premier ge
fodal. Aussi bien existait-il assurment de fortes variations rgionales,
constamment accentues par les -coups des troubles sociaux. En face du
vritable dsert qui, sur les plateaux ibriques, imprimait aux confins de la
chrtient et de lIslam toute la dsolation dun vaste no mans land , en
regard mme de lancienne Germanie, o se rparaient lentement les brches
creuses par les migrations de lge prcdent, les campagnes de la Flandre ou
de la Lombardie faisaient figure de zones relativement favorises.
Quelle que ft cependant limportance de ces contrastes, comme de leurs
retentissements sur toutes les nuances de la civilisation, le trait fondamental
66
Marc BLOCH La socit fodale
demeure luniversel et profond affaissement de la courbe dmogra phique.
Incomparablement moins nombreux, sur toute la surface de lEurope, que
nous ne les voyons, non seulement depuis le XVIIIe sicle mais mme depuis
le XIIe, les hommes taient aussi, selon toute apparence, dans les provinces
nagure soumises la domination romaine, sensiblement plus rares quaux
beaux temps de lEmpire. Jusque dans les villes, dont les plus notables ne
dpassaient pas quelques milliers dmes, terrains vagues, jardins, champs
mme et ptures se glissaient de toutes parts entre les maisons.
Cette absence de densit tait encore aggrave par une rpartition fort
ingale. Assurment, les conditions physiques, comme les habitudes sociales,
conspiraient maintenir, dans les campagnes, de profondes varits entre les
rgimes dhabitat. Tantt les familles ou, du moins, certaines dentre elles
staient tablies assez loin les unes des autres, p.100 chacune au milieu de son
exploitation propre : ainsi, en Limousin. Tantt, au contraire, comme dans
lIle -de-France, elles se massaient, presque toutes, en villages. Dans
lensemble, cependant, la pression des chefs, surtout le souci de la scurit
taient autant dobstacles une trop forte dispersion. Les dsordres du haut
moyen ge avaient entran de frquents rassemblements. Dans ces
agglomrations, les hommes vivaient au coude coude. Mais elles taient
spares par de multiples vides. La terre arable elle-mme, dont le village
tirait sa nourriture, il la fallait, proportionnellement au nombre des habitants,
beaucoup plus vaste que de nos jours. Car lagriculture tait alors une grande
dvoratrice despace. Sur les labours, incompltement dfoncs et privs,
presque toujours, dengrais suffisants, les pis ne croissaient ni bien lourds ni
bien serrs. Jamais, surtout, le finage entier ne se couvrait la fois de
moissons. Les systmes dassolement les plus perfectionns exigeaient que,
chaque anne, une moiti ou un tiers du sol cultiv demeurt en repos.
Souvent mme, jachres et rcoltes se succdaient en une alternance sans
fixit, qui la vgtation spontane accordait un temps toujours plus long
qu la priode de culture ; les champs, en ce cas, ntaient gure que de
provisoires et brves conqutes sur les friches. Ainsi, au sein mme des
terroirs, la nature sans cesse tendait reprendre le dessus. Au-del deux, les
enveloppant, les pntrant, se droulaient forts, broussailles et landes,
immenses zones sauvages, dont lhomme tait rarement tout fait absent,
mais que, charbonnier, ptre, ermite ou hors-la-loi, il hantait seulement au prix
dun long loignement de ses semblables.
III. Le premier ge fodal : la vie de relations
Entre les groupes humains ainsi gaills, les communications souffraient
bien des difficults. Lcroulement de lempire carolingien venait de ruiner le
dernier pouvoir assez intelligent pour se soucier de travaux publics, assez
puissant pour en faire excuter au moins quelques-uns. Mme les anciennes
67
Marc BLOCH La socit fodale
voies romaines, moins solidement p.101 construites quon ne la parfois
imagin, sabmaient, faute dent retien. Surtout les ponts, quon ne rparait
plus, manquaient un grand nombre de passages. Ajoutez linscurit, accrue
par la dpopulation quelle avait elle -mme en partie provoque. Quelle
surprise, en 841, la cour de Charles le Chauve, lorsque ce prince voit arriver
Troyes les messagers qui lui apportent dAquitaine les ornements royaux :
un si petit nombre dhommes, chargs de bagages si prcieux, traverser sans
encombres de si vastes tendues, infestes de toutes parts par les rapines (60) !
La chronique anglo-saxonne stonne beaucoup moins lorsquelle relate
comment en 1061, un des plus grands barons dAngleterre, le comte Tostig,
fut arrt et ranonn par une poigne de bandits, aux portes de Rome.
Compare ce que nous offre le monde contemporain, la rapidit des
dplacements humains, en ce temps, nous parat infime. Elle ntait point,
cependant, sensiblement plus faible quelle ne devait le rester jusqu la fin du
moyen ge, voire jusquau seuil du XVII Ie sicle. A la diffrence de ce que
nous observons aujourdhui, ctait sur mer quon la voyait la plus grande, de
beaucoup. De 100 150 kilomtres par jour ne constituaient pas, pour un
navire, un record exceptionnel : pour peu, cela va de soi, que les vents ne
fussent point trop dfavorables. Par voie de terre, le parcours journalier
normal atteignait, semble-t-il, en moyenne de trente quarante kilomtres.
Entendez pour un voyageur sans fivre : caravane de marchands, grand
seigneur circulant de chteau en chteau ou dabbaye en abbaye, arme avec
ses bagages. Un courrier, une poigne dhommes rsolus pouvaient, en
bandant leur effort, faire le double ou plus. Une lettre crite par Grgoire VII,
Rome, le 8 dcembre 1075, arriva Goslar, au pied du Harz, le Ier janvier
suivant ; son porteur avait abattu, vol doiseau, environ 47 kilomtres par
jour, dans la ralit, videmment, bien davantage. Pour voyager, sans trop de
fatigue ni de lenteur, il fallait tre mont ou en voiture : un cheval, un mulet
ne vont pas seulement plus vite quun homme ; ils saccommodent mieux des
fondrires. Do linterruption saisonnire de beaucoup de liaisons, moins en
raison du mauvais temps que par manque p.102 de fourrages : les missi
carolingiens dj sattachaient ne comme ncer leurs tournes que lherbe une
fois leve (61). Cependant, comme prsent en Afrique, un piton exerc
parvenait couvrir, en peu de jours, des distances tonnamment longues et,
sans doute, franchissait-il plus vite quun c avalier certains obstacles. Ctait,
en partie, par coureurs que Charles le Chauve, organisant sa deuxime
expdition dItalie, songeait assurer travers les Alpes ses liaisons avec la
Gaule (62).
Mauvaises et peu sres, ces routes ou ces pistes ntaient pas, pour cela,
dsertes. Bien au contraire. L o les transports sont difficiles, lhomme va
vers la chose plus aisment quil ne fait venir la chose lui. Surtout aucune
institution, aucune technique ne pouvaient suppler au contact personnel entre
les tres humains. Il et t impossible de gouverner ltat, du fond dun
palais : pour tenir un pays, point dautre moyen que dy chevaucher sans
68
Marc BLOCH La socit fodale
trve, en tous sens. Les rois du premier ge fodal se sont littralement tus de
voyage. Au cours, par exemple, dune anne qui na rien dexceptionnel en
1033 , on voit lempereur Conrad II passer successivement de la Bourgogne
la frontire polonaise et, de l, la Champagne, pour revenir enfin en
Lusace. Le baron, avec sa suite, circulait constamment dune de ses terres
lautre. Ce ntait pas seulement afin de les mieux surveiller. Force tait de
venir consommer sur place les denres, dont le charroi vers un centre commun
et t incommode autant que dispendieux. Sans correspondants, sur lesquels
il pt se dcharger du soin dacheter ou de vendre, peu prs certain dailleurs
de ne jamais trouver runie, en un mme lieu, une clientle suffisante pour
assurer ses gains, tout marchand tait un colporteur, un pied poudreux , qui
poursuivait la fortune par monts et par vaux. Assoiff de science ou dascse,
le clerc devait battre lEurope en qute du matre dsir : Gerbert dAurillac
apprit les mathmatiques en Espagne et la philosophie Reims ; lAnglais
tienne Harding, le parfait monachisme dans labbaye bourguignonne de
Molesmes. Avant lui, saint Eude, le futur abb de Cluny, avait parcouru la
France dans lespoir dy dcouvrir une maison o lon vct selon la rgle.
Aussi bien, en dpit de la vieille hostilit de la loi bndictine contre
les gyrovagues , les mauvais moines qui sans cesse vagabondent en
rond , tout, dans la vie clricale, favorisait ce nomadisme : le caractre
international de lglise ; entre prtres ou moines instruits, lusage du latin
comme langue commune ; les affiliations entre monastres ; la dispersion de
leurs patrimoines territoriaux ; les rformes enfin, qui, secouant
priodiquement ce grand corps ecclsiastique, faisaient des lieux touchs les
premiers par lesprit nouveau la fois des foyers dappel, o lon venait de
toutes parts chercher la bonne rgle, et des centres de dispersion do les
zlotes slanaient la conqute de la catholicit. Combien dtrangers furent
ainsi accueillis Cluny ! Combien de Clunisiens essaimrent vers les pays
trangers ! Sous Guillaume le Conqurant, presque tous les diocses, presque
toutes les grandes abbayes de la Normandie, que commenaient datteindre les
premires ondes du rveil grgorien , avaient leur tte des Italiens ou des
Lorrains ; larchevque de Rouen, Maurille, tait un Rmois qui, avant
doccuper son sige neustrien, avait tudi Lige, enseign en Saxe et
pratiqu en Toscane la vie rmitique.
p.103
Mais les humbles gens non plus ntaient point rares sur les chemins de
lOccident : fugitifs, chasss par la guerre ou la disette ; chercheurs
daventures, mi -soldats, mi-bandits ; paysans qui, avides dune existence
meilleure, espraient trouver, loin de leur premire patrie, quelques champs
dfricher ; plerins enfin. Car la mentalit religieuse elle-mme poussait aux
dplacements et plus dun bon chrtien, riche ou pauvre, clerc ou lai, pensait
ne pouvoir acheter le salut du corps ou de lme quau prix dun voyage
lointain.
On la souvent observ, le propre des bonnes ro utes est de faire le vide
autour delles, leur profit. A lpoque fodale, o toutes taient mauvaises, il
69
Marc BLOCH La socit fodale
nen tait gure qui ft capable daccaparer ainsi le trafic. Assurment les
contraintes du relief, la tradition, la prsence ici dun march, l d un
sanctuaire jouaient lavantage de certains tracs. Avec beaucoup moins de
fixit, cependant, que ne lont cru parfois les historiens des influences
littraires ou esthtiques. Un vnement fortuit accident matriel, exactions
dun p.104 seigneur en mal dargent suffisait dtourner le courant, parfois
durablement. La construction, sur lancienne voie romaine, dun chteau, aux
mains dune race de chevaliers pillards les sires de Mrville ,
ltablissement, quelques lieues de l, du prieur dionysien de Toury, o
marchands et plerins trouvaient au contraire bon accueil : en voil assez pour
dtourner dfinitivement vers lOuest le tronon beauceron de la route de
Paris Orlans, dornavant infidle aux dalles antiques. Surtout, du dpart
larrive, le voyageur avait presque toujours le choix entre plusieurs
itinraires, dont aucun ne simposait absolument. La circulation, en un mot, ne
se canalisait pas selon quelques grandes artres ; elle se rpandait,
capricieusement, en une multitude de petits vaisseaux. Point de chteau, de
bourg ou de monastre, si carts fussent-ils, qui ne pussent esprer recevoir
quelquefois la visite derrants, liens vivants avec le vaste monde. Rares, en
revanche, taient les sites o ces passages se produisaient avec rgularit.
Ainsi les obstacles et les dangers de la route nempchaient nullement les
dplacements. Mais de chacun deux, ils faisaient une expdition, presque une
aventure. Si donc les hommes, sous la pression du besoin, ne craignaient pas
dentr eprendre dassez longs voyages le craignaient moins, peut-tre, quils
ne devaient le faire en des sicles plus proches de nous , ils hsitaient
devant ces alles et venues rptes, court rayon, qui dans dautres
civilisations sont comme la trame de la vie quotidienne : surtout, lorsquil
sagissait de modestes gens, par mtier sdentaires. Do une structure, nos
yeux tonnante, du systme des liaisons. Il ntait gure de coin de terre qui
net quelques contacts, par intermittence, avec cette sor te de mouvement
brownien, la fois perptuel et inconstant, dont la socit tout entire tait
traverse. Par contre, entre deux agglomrations toutes proches, les relations
taient bien plus rares, lloignement humain, oserait -on dire, infiniment plus
considrable que de nos jours. Si, selon langle o on la considre, la
civilisation de lEurope fodale parat tantt merveilleusement universaliste,
tantt particulariste lextrme, cette antinomie avait avant tout sa source
dans un rgime de communications p.105 aussi favorable la lointaine
propagation de courants dinfluence trs gnraux que rebelle, dans le dtail,
laction uniformisatrice des rapports de voisinage.
Le seul service de transport de lettres peu prs rgulier qui ait fonctionn
durant lre fodale tout entire unissait Venise Constantinople. Il tait
pratiquement tranger lOccident. Les derniers essais pour maintenir au
service du prince un systme de relais, sur le modle lgu par le
gouvernement romain, staient vanouis avec lempire carolingien. Il est
significatif de la dsorganisation gnrale que les souverains allemands
70
Marc BLOCH La socit fodale
eux-mmes, hritiers authentiques de cet empire et de ses ambitions, aient
manqu soit de lautorit, soit de lintelligence ncessaires pour faire revivre
une institution pourtant si indispensable au commandement de vastes
territoires. Souverains, barons, prlats devaient confier leurs correspondances
des courriers expdis tout exprs. Ou bien principalement parmi les
personnes moins leves en dignit on sen remettait lobligeance de
passants : tels, les plerins qui cheminaient vers Saint-Jacques de Galice (63).
La lenteur relative des messagers, les msaventures qui chaque pas
menaaient de les arrter faisaient que seul le pouvoir sur place tait un
pouvoir efficace. Amen prendre constamment les plus graves initiatives
lhistoire des lgats pontificaux est, cet gard, riche denseignements ,
tout reprsentant local dun grand chef tendait, par un pencha nt trop naturel,
les prendre son propre profit et se muer, finalement, en dynaste
indpendant.
Quant savoir ce qui se passait au loin, force tait chacun, quel que ft
son rang, de se reposer pour cela sur le hasard des rencontres. Limage du
monde contemporain que portaient en eux les hommes le mieux informs
prsentait bien des lacunes ; on peut sen faire une ide par les omissions
auxquelles nchappent pas mme les meilleures parmi ces annales
monastiques qui sont comme les procs-verbaux de pcheurs de nouvelles. Et
elle marquait rarement lheure juste. Nest -il pas frappant, par exemple, de
voir un personnage aussi bien plac, pour se renseigner, que lvque Foubert
de Chartres stonner, lorsquil reoit pour son p.106 glise des cadeaux de Knut
le Grand : car, avoue-t-il, il croyait encore paen ce prince, baptis, en fait,
depuis lenfance (64). Fort convenablement inform des affaires allemandes, le
moine Lambert de Hersfeld, sil passe au rcit des graves vn ements qui se
droulrent, de son temps, dans la Flandre, limitrophe de lEmpire cependant
et, pour partie, fief imprial, voici quil accumule aussitt les bourdes les plus
tranges. Mdiocre base que des reprsentations aussi rudimentaires, pour
toute politique vastes desseins !
IV. Le premier ge fodal : les changes
LEurope du premier ge fodal ne vivait pas absolument replie sur
elle-mme. Delle aux civilisations avoisinantes, il existait plus dun courant
dchanges. Le plus actif probableme nt tait celui qui lunissait lEspagne
musulmane : tmoins les nombreuses monnaies dor arabes qui, par cette voie,
pntraient au nord des Pyrnes et y furent assez recherches pour devenir
lobjet de frquentes imitations. La Mditerrane Occidentale , par contre, ne
connaissait plus gure de navigation au long cours. Les principales lignes de
communication avec lOrient taient ailleurs. Lune, maritime, passait par
lAdriatique, au fond duquel Venise faisait figure dun fragment byzantin,
enchss dans un monde tranger. Par terre, la route du Danube, longtemps
71
Marc BLOCH La socit fodale
coupe par les Hongrois, tait presque dserte. Mais, plus au nord, sur les
pistes qui joignaient la Bavire au gros march de Prague et de l, par les
terrasses sur le flanc septentrional des Carpathes, se poursuivaient jusquau
Dniepr, des caravanes circulaient, charges, au retour, de quelques produits de
Constantinople ou de lAsie. A Kiev elles rencontraient la grande transversale
qui, travers les plaines et de cours deau en cours deau, mettait les pays
riverains de la Baltique en contact avec la mer Noire, la Caspienne ou les
oasis du Turkestan. Car le mtier de courtier entre le Nord ou le Nord-Est du
continent et la Mditerrane orientale chappait alors lOccident ; et sans
doute celui-ci navait -il rien danalogue offrir, sur son propre sol, au
puissant p.107 va-et-vient de marchandises qui fit la prosprit de la Russie
kivienne.
Ainsi concentr en un trs petit nombre de filets, ce commerce tait, en
outre, fort anmi. Qui pis est : la balance parat en avoir t nettement
dficitaire. Au moins avec lOrient. Des pays du Levant, lOccident recevait
peu prs exclusivement quelques marchandises de luxe, dont la valeur, trs
leve par rapport leur poids, permettait de passer outre aux frais et aux
risques du transport. En change il navait gure offrir que des esclaves.
Encore semble-t-il bien que, parmi le btail humain razzi dans les terres
slaves et lettones au-del de lElbe ou acquis des trafiquants de la
Grande-Bretagne, la plus grande partie prt le chemin de lEspagne islamique ;
la Mditerrane Orientale tait, par elle-mme, trop abondamment pourvue de
cette denre pour avoir besoin den importer des quantits fort considrables.
Les gains de la traite, au total assez faibles, ne suffisaient donc pas
compenser, sur les marchs du monde byzantin, de lgypte ou de la proche
Asie, les achats dobjets prcieux et dpices. Do, une lente saigne dargent
et surtout dor. Si quelques marchands, sans doute, devaien t leur fortune ce
lointain ngoce, la socit, dans son ensemble, nen tirait gure quune raison
de plus de manquer de numraire.
Assurment, la monnaie, dans lOccident fodal , ne fut jamais tout
fait absente des transactions, mme chez les classes paysannes. Surtout elle ne
cessa jamais dy jouer le rle dtalon des changes. Le dbiteur payait
souvent en denres ; mais en denres, ordinairement apprcies une une,
de faon que le total de ces valuations concidt avec un prix stipul en
livres, sous et deniers. vitons donc le mot, trop sommaire et trop vague,
d conomie nature . Mieux vaut parler simplement de famine montaire.
La pnurie despces tait encore aggrave par lanarchie des frappes, rsultat,
elle-mme, la fois du morcellement politique et de la difficult des
communications : car, chaque march important, il fallait, sous peine de
disette, son atelier local. Rserve faite de limitation des monnayages
exotiques et quelques infimes picettes mises part, on ne fabriquait plus que
des deniers, qui taient des pices p.108 dargent, de teneur assez faible. Lor ne
circulait que sous forme de monnaies arabes et byzantines ou de leurs copies.
La livre et le sou ntaient que des multiples arithmtiques du denier, sans
72
Marc BLOCH La socit fodale
support matriel qui leur ft propre. Mais les divers deniers, sous un mme
nom, avaient, selon leur provenance, une valeur mtallique diffrente. Pis
encore, en un mme lieu, chaque mission, ou peu sen faut, entranait des
variations dans le poids ou lalliage. A la fois rare, au total, et, en raison de ses
caprices, incommode, la monnaie circulait en outre trop lentement et trop
irrgulirement pour quon pt jamais se sentir assur de sen procurer, en cas
de besoin. Cela, faute dchanges suffisammen t frquents.
L encore, gardons-nous dune formule trop rapide : celle dconomie
ferme. Elle ne sappliquerait mme pas exacte ment aux petites exploitations
paysannes. Nous connaissons lexistence de marchs o les rustres
certainement vendaient quelques produits de leurs champs ou leurs
basses-cours : aux gens des villes, aux clercs, aux hommes darmes. Ctait
ainsi quils se procuraient les deniers des redevances. Et bien pauvre tait
celui qui jamais nachetait quelques onces de sel ou de fer. Quan t
l autarcie des grandes seigneuries, elle et suppos que leurs matres se
fussent passs darmes ou de bijoux, neussent jamais bu de vin, si daventure
leurs terres nen produisaient point, et se fussent contents, pour leurs
vtements, des grossires toffes tisses par les femmes de leurs tenanciers.
Ainsi donc, il ntait pas jusquaux insuffisances de la technique agricole, aux
troubles sociaux, aux intempries enfin qui ne contribuassent entretenir un
certain commerce intrieur : car, lorsque la rcolte venait manquer, si
beaucoup, littralement, mouraient de faim, la population entire nen tait
pas rduite cette extrmit et nous savons que, des pays plus favoriss vers
ceux que frappait la disette, un trafic de bl stablissait qui prtait beaucoup
de spculations. Les changes ntaient donc point absents ; ils taient par
contre, au suprme degr, irrguliers. La socit de ce temps nignorait certes
ni lachat ni la vente. Mais elle ne vivait pas, comme la ntre, dachat et de
vente.
Aussi bien le commerce, ft-ce sous la forme du troc, p.109 ntait pas le
seul, ni peut-tre mme le plus important des chenaux par o soprt alors,
travers les couches sociales, la circulation des biens. Ctait titre de
redevances, remises un chef comme rmunration de sa protection ou
simplement comme reconnaissance de son pouvoir, quun grand nombre de
produits passaient de main en main. De mme, pour cette autre marchandise
quest le travail humain : la corve fournissait plus de bras que le louage
douvrage. En un mot, lchange, au sens strict, tenait dans la vie conomique
moins de place, sans doute, que la prestation ; et parce que lchange ainsi
tait rare et que pourtant seuls les misreux pouvaient se rsigner ne
subsister que de leur propre production, la richesse et le bien-tre semblaient
insparables du commandement.
Cependant, la disposition des puissants eux-mmes une conomie ainsi
constitue ne mettait, en fin de compte, que des moyens dacquisition
73
Marc BLOCH La socit fodale
singulirement restreints. Qui dit monnaie dit possibilit de rserves, capacit
dattente, anticipation des valeurs futures : toutes choses que,
rciproquement, la pnurie de monnaie rendait singulirement difficiles. Sans
doute sefforait -on de thsauriser sous da utres formes. Les barons et les rois
accumulaient dans leurs coffres la vaisselle dor ou dargent et les joyaux ; les
glises amassaient les orfvreries liturgiques. Le besoin dun dboursement
imprvu se faisait-il jour ? on vendait ou engageait la couronne, le hanap ou le
crucifix ; ou bien on les envoyait fondre latelier montaire voisin. Mais
cette liquidation, en raison prcisment du ralentissement des changes,
ntait jamais aise ni dun profit sr ; et les trsors eux-mmes natteignaient
pas au total une somme bien considrable. Grands comme petits vivaient au
jour le jour, obligs de sen remettre aux ressources du moment et presque
contraints de dpenser celles-ci sur-le-champ.
Latonie des changes et de la circulation montaire avait une autre
consquence encore et des plus graves. Elle rduisait lextrme le rle social
du salaire. Celui-ci, en effet, suppose du ct du donneur douvrage un
numraire suffisamment abondant et dont la source ne risque pas de se tarir
chaque minute ; du ct du salari, la certitude de p.110 pouvoir employer la
monnaie ainsi reue se procurer les denres ncessaires la vie. Autant de
conditions qui manquaient au premier ge fodal. A tous les degrs de la
hirarchie, quil sagt pour le roi de sassu rer les services dun grand officier,
pour le hobereau de retenir ceux dun suivant darmes ou dun valet de ferme,
force tait de recourir un mode de rmunration qui ne ft point fond sur le
versement priodique dune somme dargent. Deux solutions s offraient :
prendre lhomme chez soi, ly nourrir et ly vtir, lui fournir, comme on disait,
la provende ; ou bien lui cder, en compensation de son travail, une terre
qui, par exploitation directe ou sous forme de redevances prleves sur les
cultivateurs du sol, lui permt de pourvoir lui-mme son propre entretien.
Or, lune et lautre mthode conspiraient, bien quen des sens opposs,
nouer des liens humains trs diffrents de ceux du salariat. Du provendier au
matre lombre duquel il vivait , comment lattache net -elle pas t
beaucoup plus intime quentre un patron et un salari, libre, une fois sa tche
termine, de sen aller avec ses sous dans sa poche ? On la voyait, au
contraire, presque ncessairement se relcher, aussitt le subordonn tabli sur
une terre que, peu peu, par un mouvement naturel, il tendait considrer
comme sienne, tout en sefforant de diminuer le poids des services. Ajoutez
quen un temps o lincommodit des communications et lanmie des
changes rendaient malais de maintenir dans une relative abondance de
vastes maisonnes, la provende tait, au total, susceptible dune extension
bien moindre que le systme des rmunrations foncires. Si la socit fodale
a perptuellement oscill entre ces deux ples : l troite relation dhomme
homme et le nud dtendu de la tenure terrienne, la responsabilit en revient,
pour une large part, au rgime conomique qui, lorigine du moins, lui
interdit le salariat.
74
Marc BLOCH La socit fodale
V. La rvolution conomique du second ge fodal
Nous nous efforcerons, dans la seconde partie de ce livre, de dcrire le
mouvement de peuplement qui, de 1050 p.111 1250, transforma la face de
lEurope : sur les confins du monde occidental, colonisation des plateaux
ibriques et de la grande plaine au-del de lElbe ; au cur mme du vieux
pays, les forts et les friches incessamment grignotes par la charrue ; dans les
clairires ouvertes parmi les arbres ou la brousse, des villages tout neufs
sagrippant au sol vierge ; ailleurs, autour des sites dhabit at sculaires,
llargissement des terroirs, sous lirrsistible pression des essarteurs. Il
conviendra alors de distinguer les tapes, de caractriser les varits
rgionales. Seuls, pour linstant, nous importent, avec le phnomne en lui mme, ses principaux effets.
Le plus immdiatement sensible fut sans doute de rapprocher les uns des
autres les groupes humains. Entre les divers tablissements, sauf dans
quelques contres particulirement dshrites, fini, dsormais, des vastes
espaces vides. Ce qui subsiste de distances est, par ailleurs, devenu plus ais
franchir. Car, favoriss, prcisment, dans leur ascension par le progrs
dmographique, des pouvoirs ont surgi ou se sont consolids auxquels leur
horizon agrandi impose de nouveaux soins : bourgeoisies urbaines, qui sans le
trafic ne seraient rien ; royauts et principauts, intresses elles aussi la
prosprit dun commerce dont elles tirent, par les impts et les pages, de
grosses sommes dargent, conscientes en outre, bien plus que par le pass, de
limportance vitale qui sattache pour elles la libre circulation des ordres et
des armes. Lactivit des Captiens, vers ce tournant dcisif que marque le
rgne de Louis VI, leur effort guerrier, leur politique domaniale, leur rle dans
lorg anisation du peuplement rpondirent, pour une large part, des soucis de
cette nature : conserver la matrise des communications entre les deux
capitales, Paris et Orlans ; par del la Loire ou la Seine, assurer la jonction
soit avec le Berry, soit avec les valles de lOise et de lAisne. A vrai dire, il
ne semble pas que les routes, si la police y tait devenue meilleure, aient t,
en elles-mmes, notablement amliores. Mais lquipement en travaux dart
fut port beaucoup plus loin. Que de ponts jets, au cours du XIIe sicle, sur
toutes les rivires de lEurope ! Enfin un heureux perfectionnement dans les
pratiques de lattelage vint augmenter, vers le mme moment, p.112 dans des
proportions trs fortes, le rendement des charrois.
Dans les liaisons avec les civilisations limitrophes : mme mtamorphose.
La Mditerrane sillonne par des vaisseaux de plus en plus nombreux ; ses
ports, du rocher dAmalfi la Catalogne, levs au rang de grandes places de
commerce ; le rayonnement du ngoce vnitien sans cesse accru ; la route des
plaines danubiennes elle-mme parcourue par les lourds chariots des
caravaniers : ces faits sont dj considrables. Mais les relations avec lOrient
75
Marc BLOCH La socit fodale
ntaient pas seulement devenues plus faciles et plus intenses. Le trait cap ital
est quelles avaient chang de nature. Hier presque uniquement importateur,
lOccident sest fait puissant fournisseur de produits ouvrs. Les marchandises
quil expdie ainsi par masses vers le monde byzantin, vers le Levant
islamique ou latin, voire, quoique dans une moindre mesure, vers le Maghreb,
appartiennent des catgories trs diverses. Lune delles, cependant, domine
de loin toutes les autres. Dans lexpansion de lconomie europenne, au
moyen ge, les draps jourent le mme rle directeur quau XI Ie sicle, dans
celle de lAngleterre, la mtallurgie et les cotonnades. Si en Flandre, en
Picardie, Bourges, dans le Languedoc, en Lombardie, ailleurs encore car
les centres drapiers sont presque partout rpandus , on entend bruire les
mtiers et battre les moulins foulon, cest au service des marchs exotiques
autant, ou peu sen faut, que de la consommation intrieure. Et sans doute
cette rvolution, qui vit nos pays commencer par lOrient la conqute
conomique du monde, il conviendrait, pour lexpliquer, dvoquer des causes
multiples, de regarder, si faire se peut vers lEst aussi bien que vers
lOuest. Il nen est pas moins vrai que seuls les phnomnes dmographiques,
qui viennent dtre rappels, lavaient rendue possible. Si la population navait
t plus quauparavant abondante et la surface cultive plus tendue ; si,
mieux mis en valeur par des bras plus nombreux, soumis notamment des
labours plus souvent rpts, les champs ntaient devenus capables de plus
paisses et plus frquentes moissons, comment et-on pu rassembler, dans les
villes, tant de tisserands, de teinturiers ou de tondeurs dtoffe et les nourrir ?
Le Nord est conquis, comme lOrient. Ds la fin du X Ie sicle, on
vendait Novgorod des draps de Flandre. Peu peu, la route des plaines
russes priclite et se ferme. Cest vers lOuest que dsormais se tournent la
Scandinavie et les pays baltes. Le changement qui samorce ainsi sachvera
lorsquau cours du XI Ie sicle, le commerce allemand sannexera la Baltique.
Ds lors les ports des Pays-Bas, Bruges surtout, vont tre le lieu o
schangent avec les produits septentrionaux, non seulement ceux de
lOccident lui -mme, mais aussi les marchandises quil fait venir de lOrient.
Un puissant courant de relations mondiales joint, par lAllemagne et surtout
par les foires de Champagne, les deux fronts de lEurope fodale.
p.113
Un commerce extrieur aussi favorablement quilibr ne pouvait manquer
de drainer vers lEurope monnaies et mtaux prcieux, dy accrotre p ar suite,
dans des proportions considrables, le volume des moyens de paiement. A
cette aisance montaire, au moins relative, sajoutait, pour en multiplier les
effets, le rythme acclr de la circulation. Car, lintrieur mme du pays,
les progrs du peuplement, la facilit plus grande des liaisons, larrt des
invasions qui avaient fait peser sur le monde occidental une telle atmosphre
de trouble et de panique, dautres causes encore, quil serait trop long de
scruter ici, avaient raviv les changes.
Gardons-nous cependant dexagrer. Le tableau demanderait tre
soigneusement nuanc, par rgions et par classes. Vivre du sien devait rester,
76
Marc BLOCH La socit fodale
pour de longs sicles, lidal rarement atteint, dailleurs de beaucoup de
paysans et de la plupart des villages. Dautre part, les transformations
profondes de lconomie obirent une cadence assez lente. Chose
significative : des deux symptmes essentiels dans lordre montaire, lun, la
frappe de grosses pices dargent, beaucoup plus lourdes que le denie r,
napparut quau dbut du XII Ie sicle et encore cette date en Italie
seulement , lautre, la reprise de la frappe de lor, sur type indigne, se fit
attendre jusqu la seconde moiti de ce mme sicle. A beaucoup dgards, le
second ge fodal vit moins leffacement des conditions antrieures que leur
attnuation. Lobservation vaut pour le rle de la distance comme pour le p.114
rgime des changes. Mais qualors les rois, les hauts barons, les seigneurs
aient pu recommencer de se constituer, coup dimpts, dimportants trsors,
que, parfois sous des formes juridiques gauchement inspires des pratiques
anciennes, le salariat ait repris, parmi les modes de rmunration des services,
une place peu peu prpondrante, ces signes dune conomie en v oie de
renouvellement agirent leur tour, ds le XIIe sicle, sur toute la contexture
des relations humaines.
Ce ntait pas tout. Lvolution de lconomie entranait une vritable
rvision des valeurs sociales. Il y avait toujours eu des artisans et des
marchands. Individuellement, ces derniers du moins avaient mme pu, et
l, jouer un rle important. Comme groupes, ni les uns ni les autres ne
comptaient gure. A partir de la fin du XIe sicle, classe artisane et classe
marchande, devenues beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus
indispensables la vie de tous, saffirmrent de plus en plus vigoureusement,
dans le cadre urbain. Avant tout, la classe marchande. Car lconomie
mdivale, depuis le grand renouveau de ces annes dcisives, fut toujours
domine, non par le producteur, mais par le commerant. Ce ntait pas pour
ces gens-l que, fonde sur un rgime conomique o ils ne tenaient quune
place mdiocre, stait constitue larmature juridique de lge prcdent.
Leurs exigences pratiques et leur mentalit devaient naturellement y introduire
un ferment nouveau. Ne dans une socit dun tissu trs lche, o les
changes taient peu de chose et largent rare, la fodalit europenne saltra
profondment aussitt que les mailles du rseau humain se furent resserres,
que la circulation des biens et du numraire se fut faite plus intense.
*
**
77
Marc BLOCH La socit fodale
CHAPITRE II
Faons de sentir et de penser
I. Lhomme devant la nature et la dure
Lhomme des deux ges fodaux tait, beaucoup plus que nous ,
proche dune nature, de son ct, beaucoup moins amnage et dulcore. Le
paysage rural, o les friches occupaient de si larges espaces, portait dune
faon moins sensible la marque humaine. Les btes froces, qui ne hantent
plus que nos contes de nourrices, les ours, les loups surtout, vaguaient dans
toutes les solitudes, voire parmi les campagnes cultives elles-mmes. Autant
quun sport, la chasse tait un moyen de dfense indispensable et fournissait
lalimentation un appoint presque galement nce ssaire. La cueillette des
fruits sauvages et celle du miel continuaient de se pratiquer comme aux
premiers temps de lhumanit. Dans loutillage, le bois tenait un rle
prpondrant. Les nuits, que lon savait mal clairer, taient plus obscures, les
froids, jusque dans les salles des chteaux, plus rigoureux. Il y avait, en un
mot, derrire toute vie sociale, un fond de primitivit, de soumission des
puissances indisciplinables, de contrastes physiques sans attnuation. Nul
instrument nexiste qui permet te de peser linfluence quun pareil entourage
pouvait exercer sur les mes. Comment ne pas supposer, cependant, quil
contribut leur rudesse ?
p.115
Une histoire plus digne de ce nom que les timides essais auxquels nous
rduisent aujourdhui nos moyens fera it leur place aux aventures du corps.
Cest une grande navet de p.116 prtendre comprendre des hommes sans
savoir comment ils se portaient. Mais ltat des textes, plus encore
linsuffisante acuit de nos mthodes de recherches bornent nos ambitions.
Incontestablement trs forte dans lEurope fodale, la mortalit infantile
ntait pas sans y endurcir quelque peu les sentiments vis --vis de deuils
presque normaux. Quant la vie des adultes, elle tait, indpendamment
mme des accidents de guerre, en moyenne relativement courte : du moins,
autant que lon en peut juger par les personnages princiers, auxquels se
rapportent les seules donnes tant soit peu prcises dont nous disposons.
Robert le Pieux mourut vers la soixantaine ; Henri Ier, 52 ans ; Philippe Ier et
Louis VI, 56. En Allemagne, les quatre premiers empereurs de la dynastie
saxonne atteignirent respectivement 60 ans ou environ, 28, 22 et 52 ans.
La vieillesse semblait commencer trs tt, ds notre ge mr. Ce monde qui,
nous le verrons, se croyait trs vieux, tait en fait dirig par des hommes
jeunes.
78
Marc BLOCH La socit fodale
Parmi tant de morts prmatures, beaucoup taient dues aux grandes
pidmies, qui sabattaient frquemment sur une humanit mal outille pour
les combattre ; chez les humbles, en outre, aux famines jointes aux violences
journalires, ces catastrophes donnaient lexistence comme un got de
perptuelle prcarit. L fut probablement une des raisons majeures de
linstabilit de sentiments, si caractristique de la mentalit de lre fodale,
surtout durant son premier ge. Une hygine certainement mdiocre
contribuait aussi cette nervosit. On sest donn, de nos jours, beaucoup de
peine pour dmontrer que la socit seigneuriale nignorait pas les bains. Il y a
quelque chose de puril oublier, en faveur de cette observation, tant de
fcheuses conditions de vie : notamment, la sous-alimentation chez les
pauvres ; chez les riches, les excs de table. Enfin, comment ngliger les effets
dune tonnante sensibilit aux manifestations prtendum ent surnaturelles ?
Elle rendait les esprits constamment et presque maladivement attentifs toute
espce de signes, de rves ou dhallucinations. Le trait, vrai dire, tait
surtout marqu dans les milieux monastiques, o les macrations et le
refoulement ajoutaient leur influence p.117 celle dune rflexion
professionnellement centre sur les problmes de linvisible. Nul
psychanalyste na jamais scrut ses songes avec plus dardeur que les moines
du Xe ou du XIe sicle. Cependant les laques aussi participaient lmotivit
dune civilisation o le code moral ou mondain nimposait pas encore aux
gens bien levs de rprimer leurs larmes et leurs pmoisons . Les
dsespoirs, les fureurs, les coups de tte, les brusques revirements proposent
de grandes difficults aux historiens ports, par instinct, reconstruire le pass
selon les lignes de lintelligence ; lments considrables de toute histoire
sans doute, ils ont exerc sur le droulement des vnements politiques, dans
lEurope fodale, une act ion qui ne saurait tre passe sous silence que par
une sorte de vaine pudeur.
Ces hommes, soumis autour deux et en eux -mmes tant de forces
spontanes, vivaient dans un monde dont lcoulement chappait dautant plus
leurs prises quils le savaient mal mesurer. Coteuses et encombrantes, les
horloges eau nexistaient qu un trs petit nombre dexemplaires. Les
sabliers semblent avoir t dusage mdiocrement courant. Limperfection des
cadrans solaires, surtout sous des ciels facilement brouills, tait flagrante.
Do lemploi de curieux artifices. Proccup de rgler le cours dune vie fort
nomade, le roi Alfred avait imagin de transporter partout avec lui des cierges
dgale longueur, quil faisait allumer tour tour (65). Ce souci duniformit,
dans le sectionnement de la journe, tait alors exceptionnel. Comptant
ordinairement, lexemple de lAntiquit, douze heures de jour et douze de
nuit, quelle que ft la saison, les personnes les plus instruites
saccommodaie nt de voir chacune de ces fractions, prise une une, crotre et
dcrotre sans trve, selon la rvolution annuelle du soleil. Il devait en tre
79
Marc BLOCH La socit fodale
ainsi jusquau moment o, vers le XI Ve sicle, les horloges contrepoids
entranrent, enfin, avec la mcanisation de linstrument, celle de la dure.
Une anecdote, rapporte par une chronique du Hainaut, met
admirablement en lumire cette sorte de perptuel flottement du temps. A
Mons, un duel judiciaire doit avoir lieu. Un seul champion se prsente, ds
laube ; une fois arrive p.118 la neuvime heure, qui marque le terme de
lattente prescrite par la coutume, il demande que soit constate la dfaillance
de son adversaire. Sur le point de droit, pas de doute. Mais est-il vraiment
lheure voulue ? Les juges du comt dlibrent, regardent le soleil, interrogent
les clercs que la pratique de la liturgie a plis une plus sre connaissance du
rythme horaire et dont les cloches le scandent, plus ou moins
approximativement, au profit du commun des hommes. Dcidment, prononce
la cour, lheure de none est passe (66). De notre civilisation, habitue ne
vivre que les yeux constamment fixs sur la montre, combien elle nous parat
loin, cette socit o un tribunal devait discuter et enquter pour savoir le
moment du jour !
Or limperfection de la mesure horaire ntait quun des symptmes, entre
beaucoup dautres, dune vaste indiffrence au temps. Rien net t plus ais
ni plus utile que de noter, avec prcision, des dates aussi importantes, en droit,
que celles des naissances princires ; en 1284 pourtant, il fallut toute une
enqute pour dterminer, tant bien que mal, lge dune des plus grandes
hritires du royaume captien, la jeune comtesse de Champagne (67). Aux Xe
et XIe sicles, dinnombrables chartes ou notices, dont la seule raison dtre
cependant tait de prserver un souvenir, ne portent aucune mention
chronologique. Dautres sont -elles, par exception, mieux pourvues ? Le
notaire, qui emploie simultanment plusieurs systmes de rfrences, souvent
na pas russi faire concorder ses divers calculs. Il y a plus : ce ntait pas la
notion de la dure seulement, ctait le domaine du nombre, en son entier, sur
qui pesaient ces brumes. Les chiffres insenss des chroniqueurs ne sont pas
quamplification littraire ; ils attestent labsence de toute sensibilit la
vraisemblance statistique. Alors que Guillaume le Conqurant navait
certainement pas tabli en Angleterre plus de cinq mille fiefs de chevaliers, les
historiens des sicles suivants, voire mme certains administrateurs, auxquels
il net pourtant pas t bien difficile de se renseigner, lui attribuaient
volontiers la cration de trente-deux soixante mille de ces tenures militaires.
Lpoque eut, surtout partir de la fin du XIe sicle, ses mathmaticiens, qui
ttonnaient p.119 vaillamment la suite des Grecs et des Arabes ; les architectes
et les sculpteurs savaient pratiquer une assez simple gomtrie. Mais, parmi
les comptes qui nous sont parvenus et cela jusqu la fin du moyen ge ,
il nen est gure o on ne relve des fautes tonnantes. Les incommodits de
la numrotation romaine, ingnieusement corriges dailleurs par lemploi de
labaque, ne suffisent pas expliquer ces erreurs . La vrit est que le got de
80
Marc BLOCH La socit fodale
lexactitude, avec son plus sr tai, le respect du chiffre, demeurait
profondment tranger aux esprits, mme des chefs.
II. Lexpression
Dune part, la langue de culture, qui tait, presque uniformment, le latin ;
de l autre, dans leur diversit, les parlers dusage quotidien : tel est le singulier
dualisme sous le signe duquel vcut lre fodale presque tout entire. Il tait
particulier la civilisation occidentale proprement dite et contribuait
lopposer vigoureus ement ses voisines : mondes celte et scandinave,
pourvus de riches littratures, potiques et didactiques, en langues nationales ;
Orient grec ; Islam, au moins dans les zones rellement arabises.
Dans lOccident mme, vrai dire, une socit pendant longtemps fit
exception : celle de la Grande-Bretagne anglo-saxonne. Non quon ny crivt
le latin et fort bien. Mais on ncrivait pas que lui, beaucoup prs. Le vieil
anglais stait lev de bonne heure la dignit de langue littraire et
juridique. Le roi Alfred voulait que les jeunes gens lapprissent dans les
coles, avant, pour les mieux dous, de passer au latin (68). Les potes
lemployaient en des chants que, non contents de les rciter, ils faisaient
transcrire. De mme, les rois, dans leurs lois ; les chancelleries, dans les actes
tablis pour les rois ou les grands ; et jusquaux moines, dans leurs
chroniques : cas vritablement unique, en ce temps, dune civilisation qui sut
maintenir le contact avec les moyens de xpression de la masse. La conqute
normande brisa net ce dveloppement. De la lettre adresse par Guillaume aux
gens de Londres, aussitt aprs la bataille de Hastings, jusqu quelques rares
mandements vers la fin p.120 du XIIe sicle, plus un acte royal qui ne soit rdig
en latin. A une seule rserve prs, les chroniques anglo-saxonnes se taisent
partir du milieu du XIe sicle. Quant aux uvres que lon peut, avec quelque
bonne volont, dire littraires, elles ne devaient rapparatre que peu avant
la n 1200 et seulement, au dbut, sous la forme de quelques opuscules
ddification.
Sur le continent, le bel effort culturel de la renaissance carolingienne
navait pas totalement nglig les langues nationales. A la vrit, il ne venait
alors personne l ide de considrer comme dignes de lcriture les parlers
romans qui faisaient leffet, simplement, dun latin affreusement corrompu.
Les dialectes de la Germanie, par contre, sollicitrent lattention dhommes
dont beaucoup, la cour et dans le haut-clerg, les avaient pour langue
maternelle. On copia de vieux pomes, jusque-l purement oraux ; on en
composa de nouveaux, principalement sur des thmes religieux ; des
manuscrits en langage thiois figuraient dans les bibliothques des magnats.
Mais ici encore les vnements politiques cette fois lcroulement de
lEmpire carolingien, avec les troubles qui suivirent marqurent une
81
Marc BLOCH La socit fodale
cassure. De la fin du Xe sicle la fin du XIe, quelques posies pieuses et
quelques traductions : voil le maigre butin que doivent se borner enregistrer
les historiens de la littrature allemande. En comparaison des crits latins
rdigs sur le mme sol et durant la mme priode, pour le nombre comme
pour la valeur intellectuelle, autant dire rien.
Gardons-nous, daille urs, de limaginer, ce latin de lre fodale, sous les
couleurs dune langue morte, avec ce que lpithte suggre la fois de
strotyp et duniforme. Malgr le got de correction et de purisme
rinstaur par la renaissance carolingienne, tout conspirait imposer, dans des
proportions trs variables selon les milieux ou les individus, tantt des mots,
tantt des tours nouveaux : la ncessit dexprimer des ralits inconnues aux
Anciens ou des penses qui, dans lordre religieux notamment, leur avaient t
trangres ; la contamination du mcanisme logique, trs diffrent de celui de
la traditionnelle grammaire auquel la pratique des langages populaires
habituait les p.121 esprits ; lignorance enfin ou la demi -science. Aussi bien, si
le livre favorise limmobilit, la parole nest -elle pas toujours facteur de
mouvement ? Or on ne se bornait pas crire le latin. On le chantait
tmoin, la posie, au moins sous ses formes les plus charges de sentiment
vrai, dlaissant la classique prosodie des longues et des brves pour se rallier
au rythme accentu, seule musique dsormais perceptible aux oreilles. On
le parlait aussi. Ce fut pour un solcisme commis dans la conversation quun
lettr italien, appel la cour dOtton Ier, se fit cruellement moquer par un
moinillon de Saint-Gall (69). Lorsque lvque Notker de Lige prchait, sil
sadressait des laques, il usait du wallon ; du latin, au contraire, sil avait
devant lui ses clercs. Assurment beaucoup decclsiastiques, s urtout parmi
les curs des paroisses, auraient t incapables de limiter, voire de le
comprendre. Mais pour les prtres et les moines instruits, la vieille 1 de
lglise conservait son rle dinstrument oral. Sans son aide, comment, la
Curie, dans les grands conciles ou au cours de leurs vagabondages dabbaye
en abbaye, ces hommes venus de patries diffrentes auraient-ils russi
communiquer entre eux ?
Certes, dans presque toute socit, les mots dexpression varient, parfois
trs sensiblement, daprs lemploi quon en dsire faire ou selon les classes.
Mais le contraste se borne ordinairement des nuances dans lexactitude
grammaticale ou la qualit du vocabulaire. Il tait ici incomparablement plus
profond. Dans une grande partie de lEurope, les langages usuels, qui se
rattachaient au groupe germanique, appartenaient une tout autre famille que
la langue de culture. Les parlers romans eux-mmes staient ce point
carts de leur souche commune que passer deux au latin supposait un long
apprentissage scolaire. Si bien que le schisme linguistique se ramenait, en fin
de compte, lopposition de deux groupes humains. Dune part, limmense
1
kon
82
Marc BLOCH La socit fodale
majorit des illettrs, murs, chacun, dans son dialecte rgional, rduits, pour
tout bagage littraire, quelques pomes profanes, qui se transmettaient
presque uniquement de vive voix, et ces pieuses cantilnes que des clercs
bien intentionns composaient en langues vulgaires, au profit des p.122 simples,
et dont parfois ils confiaient la mmoire au parchemin. Sur lautre rive, la
petite poigne des gens instruits, qui, oscillant sans cesse du parler journalier
et local la langue savante et universelle, taient proprement bilingues. A eux,
les uvres de thologie et dhistoire, uniformment crites en l atin ;
lintelligence de la liturgie ; celle mme des documents daffaire. Le latin ne
constituait pas seulement la langue vhiculaire de lenseignement ; il tait la
seule langue quon enseignt. Savoir lire, tout court, ctait savoir le lire. Se
laissait-on aller, par exception, user, dans une pice juridique, de la langue
nationale ? Dans cette anomalie, o quelle se produise, nhsitons pas
reconnatre un symptme dignorance. Si, ds le Xe sicle, certaines chartes de
lAquitaine mridionale appa raissent, au milieu dun latin plus ou moins
incorrect, toutes farcies de termes provenaux, cest que, placs lcart des
grands foyers de la renaissance carolingienne, les monastres du Rouergue ou
du Quercy ne comptaient que de rares religieux forms aux belles-lettres.
Parce que la Sardaigne tait un pauvre pays dont les populations, fuyant le
littoral ravag par les pirates, vivaient dans un quasi isolement, les premiers
documents crits du sarde dpassent de beaucoup en anciennet les plus vieux
textes italiens de la Pninsule.
De cette hirarchisation des langues, la consquence la plus
immdiatement apparente est sans doute davoir fcheusement brouill
limage que le premier ge fodal a laisse de lui -mme. Actes de vente ou de
donation, dasser vissement ou de libert, arrts de justice, privilges royaux,
procs-verbaux dhommage, les documents de la pratique sont la source la
plus prcieuse sur laquelle puisse se pencher lhistorien de la socit. Sils ne
sont pas toujours sincres, du moins, la diffrence des textes narratifs
destins la postrit, ont-ils le mrite de navoir voulu, au pis, tromper que
les contemporains, dont la crdulit avait dautres limites que la ntre. Or,
peu dexceptions prs, qui viennent dtre expliques, ils furent, jusquau
XIIIe sicle, constamment rdigs en latin. Mais ce ntait pas ainsi que
staient, dabord, exprimes les ralits dont ils sefforaient de conserver le
souvenir. Lorsque deux seigneurs dbattaient le prix dune p.123 terre ou les
clauses dune relation de dpendance, ils ne sentretenaient assurment point
dans la langue de Cicron. Affaire au notaire de dcouvrir ensuite, vaille que
vaille, un vtement classique leur accord. Toute charte ou notice latine, ou
peu sen faut, prsente donc le rsultat dun travail de transposition, que
lhistorien, aujourdhui, sil veut saisir la vrit sous -jacente, doit
recommencer, rebours.
Passe encore si llaboration avait toujours obi aux mmes rgles ! Il nen
tait rien. Du thme dcolier , gauchement calqu sur un schma mental en
langue vulgaire, jusquau discours latin, poli avec soin par un clerc instruit,
83
Marc BLOCH La socit fodale
tous les degrs se rencontrent. Parfois et cest incontestablement le cas le
plus favorable le mot courant est simplement dguis, tant bien que mal,
par ladjonction dune terminaison latine postiche : tel, hommage peine
masqu en homagium. Ailleurs, au contraire, on sefforait de nuser que des
termes les plus classiques : jusqu crire assimilant, par un jeu desprit
presque blasphmatoire, au prtre de Jupiter celui du Dieu Vivant
archiflamen pour archevque. Le pis tait que, dans la recherche des
paralllismes, les puristes ne craignaient pas de prendre volontiers pour guide
moins lanalogie des significations que celle des sons ; parce que comte
avait, en franais, pour cas sujet cuens, on le rendait par consul ; ou fief ,
daventure, par fiscus. Sans doute, des systmes gnraux de transcription
stablirent peu peu, dont certains participaient au caract re universaliste de
la langue savante : fief , qui se disait en allemand Lehn, avait, dans les
chartes latines de lAllemagne, pour quivalents rguliers, des mots forgs sur
le franais. Mais, jusque dans ses emplois les moins maladroits, le latin
notarial ne traduisait jamais sans dformer un peu.
Ainsi la langue technique du droit elle-mme ne disposait que dun
vocabulaire la fois trop archaque et trop flottant pour lui permettre de serrer
de prs la ralit. Quant au lexique des parlers usuels, il avait toute
limprcision et linstabilit dune nomenclature purement orale et populaire.
Or, en matire dinstitutions sociales, le dsordre des mots entrane presque
ncessairement celui des choses. Ne ft-ce quen raison de limperfection de
leur terminologie, une p.124 grande incertitude pesait donc sur le classement des
rapports humains. Mais lobservation doit tre encore largie. A quelque
usage quon lappliqut, le latin avait lavantage doffrir, aux intellectuels de
lpoque, un moyen de comm unication international. Il prsentait, par contre,
le redoutable inconvnient dtre, chez la plupart des hommes qui sen
servaient, radicalement spar de la parole intrieure ; de les contraindre, par
suite, dans lnonciation de leur pense, de perp tuels peu prs. Labsence
dexactitude mentale, qui fut, nous lavons vu, une des caractristiques de ce
temps, comment, parmi les causes multiples qui sans doute conspirent
lexpliquer, ne pas ranger ce va -et-vient incessant entre les deux plans du
langage ?
III. Culture et classes sociales
Langue de culture, dans quelle mesure le latin mdival tait-il la langue
dune aristocratie ? Jusqu quel point, en dautres termes, le groupe des
litterati se confondait-il avec celui des chefs ? Pour lglis e, point de doute.
Peu importe que le mauvais rgime des nominations ait, et l, pouss
jusquaux premiers postes des ignorants. Les cours piscopales, les grands
monastres, les chapelles des souverains, tous les tats-majors, en un mot, de
larme ecc lsiastique nont jamais manqu de clercs instruits, qui, souvent
84
Marc BLOCH La socit fodale
dailleurs, dorigine baronale ou chevaleresque, avaient t forms dans les
coles monastiques et surtout cathdrales. Ds quon touche au monde laque,
le problme devient plus dlicat.
Nimaginons pas, ft -ce aux plus sombres heures, une socit hostile de
parti pris toute nourriture intellectuelle. Que communment on estimt utile
un conducteur dhommes laccs du trsor de rflexions et de souvenirs dont
seul lcrit, cest --dire le latin, apportait la clef, le plus sr tmoignage en est
limportance attribue par beaucoup de souverains linstruction de leurs
hritiers. Robert le Pieux, roi savant en Dieu , avait t, Reims, llve de
lillustre Gerbert ; Guillaume le Conqurant donna son fils Robert p.125 un
clerc pour prcepteur. Parmi les grands de la terre, il se rencontrait de vrais
amis des livres : form, vrai dire, par sa mre qui, princesse byzantine, avait
apport de sa patrie les habitudes dune civilisation be aucoup plus affine,
Otton III parlait couramment le grec et le latin ; Guillaume III dAquitaine
avait runi une belle bibliothque, o on le voyait parfois lire fort avant dans
la nuit (70). Ajoutez le cas, nullement exceptionnel, de ces princes qui, destins
dabord lglise, avaient retenu de leur premier apprentissage certaines des
connaissances et certains des penchants propres au milieu clrical : tel, par
exemple, Baudoin de Boulogne, rude guerrier pourtant qui ceignit la couronne
de Jrusalem.
Mais ces ducations assez pousses il fallait latmosphre de hautes
lignes, dj solidement assises dans leur puissance hrditaire. Rien de plus
significatif quen Allemagne le contraste, presque rgulier, entre les
fondateurs de dynasties et leurs successeurs : Otton II, le troisime roi
saxon, Henri III, le second des Saliens, tous deux soigneusement instruits,
sopposent leurs pres : Otton le Grand, qui apprit lire 30 ans, Conrad II
dont son chapelain avoue quil ne savait pas ses lettres . Comme il arrivait
souvent, lun et lautre avaient t jets trop jeunes dans une vie daventure et
de dangers pour avoir eu le loisir de se former, autrement que par la pratique
ou la tradition orale, leur mtier de chefs. A plus forte raison en tait-il ainsi,
presque toujours, ds que lon descendait plus bas dans lchelle sociale. La
culture relativement brillante de quelques grandes familles royales ou
baronales ne doit pas faire illusion. Ni non plus lexceptionnelle fi dlit que
les classes chevaleresques de lItalie et de lEspagne conservrent des
traditions pdagogiques, elles-mmes, dailleurs, assez rudimentaires : le Cid
et Chimne, si leur science peut-tre nallait pas beaucoup plus loin, savaient
du moins signer leur nom (71). On ne saurait douter quau nord des Alpes et
des Pyrnes du moins, la majorit des petits et moyens seigneurs qui
dtenaient, en ce temps, les principaux pouvoirs humains, nait t compose
de vritables illettrs, au sens plein du terme : si bien que dans les monastres,
o certains dentre eux se p.126 jetaient, au soir de leur vie, on traitait comme
synonymes les mots de conversus, cest --dire de tard-venu la vocation
religieuse, et d idiota qui dsignait le moine incapable de lire les Livres
Saints.
85
Marc BLOCH La socit fodale
Par cette carence de linstruction, dans le sicle, sexplique le rle des
clercs la fois comme interprtes de la pense des grands et comme
dpositaires des traditions politiques. Force tait aux princes de demander
cette catgorie de leurs serviteurs ce que le reste de leur entourage et t
incapable de fournir. Vers le milieu du VIIIe sicle avaient disparu les derniers
rfrendaires laques des rois mrovingiens ; en avril 1298, Philippe le Bel
remit les sceaux au chevalier Pierre Flotte : entre ces deux dates, plus de cinq
sicles staient couls, durant lesquels les chancelleries des souverains qui
avaient rgn sur la France avaient eu leur tte uniquement des hommes
dglise. Il en fut de m me, en gros, ailleurs. Lon ne saurait considrer
comme un fait indiffrent que les dcisions des puissants de ce monde aient
t quelquefois suggres et toujours exprimes par des hommes qui, quels
que fussent leurs partis pris de classe ou de nation, nen appartenaient pas
moins, par toute leur ducation, une socit de nature universaliste et fonde
sur le spirituel. Nul doute quils naient contribu maintenir, par -dessus la
mle des petits conflits locaux, le souci de quelques horizons plus larges.
Dautre part, chargs de donner forme crite aux actes de la politique, ils se
trouvrent ncessairement amens les justifier officiellement par des motifs
tirs de leur propre code moral et rpandre ainsi, sur les documents de lre
fodale presque entire, ce vernis de considrants plus qu demi trompeurs
dont tmoignent en particulier les prambules de tant daffranchissements
prix dargent, dguiss en pures libralits, ou de tant de privilges royaux,
que voudrait paratre dicter, uniformment, la plus banale pit. Comme
pendant longtemps lhistoriographie, elle aussi, avec ses jugements de valeur,
fut aux mains des clercs, les conventions de pense, autant que les
conventions littraires, conspirrent tisser devant la cynique ralit des
motifs humains une sorte de voile qui ne devait gure tre dfinitivement
dchir, au seuil de temps p.127 nouveaux, que par la dure main dun
Commynes et dun Machiavel.
Les laques, nanmoins, demeuraient beaucoup dgards llment
agissant de la socit temporelle. Sans doute, les plus illettrs dentre eux
ntaient pas pour cela des ignorants. Outre quils ne manquaient pas, au
besoin, de se faire traduire ce quils ne lisaient pas eux -mmes, nous verrons
tout lheure combien les rcits en langu e vulgaire purent leur transmettre de
souvenirs et dides. Quon veuille bien cependant se reprsenter le cas de la
plupart des seigneurs et de beaucoup de hauts barons : administrateurs
incapables de consulter personnellement un rapport ou un compte ; juges dont
les arrts taient rdigs lorsquils ltaient dans un langage inconnu du
tribunal. Ces chefs, rduits ordinairement reconstituer de mmoire leurs
dcisions passes, comment stonner sils taient souvent totalement
dpourvus de lesprit d e suite que, bien tort, les historiens aujourdhui
peinent parfois leur prter ?
A peu prs trangers lcrit, il leur arrivait de lui tre indiffrents.
Lorsque Otton le Grand eut reu, en 967, la couronne impriale, il laissa
86
Marc BLOCH La socit fodale
tablir, sous son nom, un privilge qui, inspir par les pactes des
empereurs carolingiens et peut-tre par lhistoriographie, reconnaissait aux
papes, jusqu la fin des sicles , la possession dun immense territoire ;
se dpouiller ainsi, lempereur -roi et abandonn au patrimoine de saint Pierre
la plus grande partie de lItalie et jusqu la matrise de quelques -unes des
plus importantes voies alpestres. Certainement, jamais Otton navait song
une minute que ces dispositions, pourtant fort prcises, pussent tre suivies
deffet. On stonnerait moins sil sagissait dun de ces traits menteurs qui,
de tout temps, sous la pression des circonstances, ont t signs dans le ferme
dessein de ne les excuter point. Mais rien absolument, sinon une tradition
historique plus ou moins mal comprise, nobligeait le prince saxon un pareil
faux-semblant. Dune part, le parchemin et son encre ; de lautre, sans liens
avec lui, laction : tel tait lultime et, sous cette forme particulirement crue,
lexceptionnel aboutisseme nt dune scission beaucoup plus gnrale. La seule
langue qui p.128 part digne de fixer, avec les connaissances les plus utiles
lhomme et son salut, les rsultats mme de toute pratique sociale, un grand
nombre des personnages en situation de conduire les affaires humaines ne la
comprenaient point.
IV. La mentalit religieuse
Peuple de croyants, dit-on volontiers pour caractriser lattitude religieuse
de lEurope fodale. Si lon entend par l que toute conception du monde do
le surnaturel ft exclu demeurait profondment trangre aux esprits de ce
temps, que, plus prcisment, limage quils se faisaient des destines de
lhomme et de lUnivers sinscrivait peu prs unanimement dans le dessin
trac par la thologie et leschatologie chrtienn es, sous leurs formes
occidentales, rien de plus juste. Peu importe, et l, lexpression de quelques
doutes opposs aux fables de lcriture ; dpourvu de toute base
rationnelle, ce scepticisme rudimentaire, qui ntait pas ordinairement le
propre des personnes cultives, fondait, au jour du danger, comme neige au
soleil. Il est mme permis de dire que jamais foi ne mrita plus purement son
nom. Car, interrompu depuis lextinction de la philosophie chrtienne antique,
peine raviv, temporairement, durant la renaissance carolingienne, leffort
des doctes pour donner aux mystres ltai dune spculation logique ne
devait gure reprendre avant la fin du XIe sicle. A ces croyants, en revanche,
lerreur serait grave de prter un credo rigidement unifor me.
Non seulement, en effet, le catholicisme tait trs loin encore davoir
pleinement dfini sa dogmatique : si bien que lorthodoxie la plus stricte
disposait alors dun jeu beaucoup plus libre que ce ne devait tre le cas, plus
tard, aprs la thologie scolastique dabord, la Contre -Rforme ensuite. Non
seulement, sur la marge indcise o lhrsie chrtienne se dgradait en
religion oppose au christianisme, le vieux manichisme conservait, par
87
Marc BLOCH La socit fodale
endroits plus dun adepte, dont on ne sait au juste sils avaient hrit leur foi
de groupes demeurs obstinment fidles, depuis les premiers sicles du
moyen ge, cette secte perscute ou sils lavaient au p.129 contraire reue,
aprs une longue interruption, de lEurope Orientale. Le plus grave tait que l e
catholicisme navait quincompltement pntr les masses. Recrut sans
contrle suffisant et imparfaitement form le plus souvent au hasard des
leons donnes par quelque cur, lui-mme peut-tre mdiocrement instruit,
au garonnet qui, en servant la messe, se prparait aux ordres , le clerg
paroissial tait, dans son ensemble, intellectuellement comme moralement
infrieur sa tche. Seule capable douvrir efficacement au peuple laccs des
mystres enferms dans les Livres Saints, la prdication n tait
quirrgulirement pratique. En 1031, le Concile de Limoges ntait -il pas
contraint de slever contre lerreur qui prtendait la rserver aux vques,
bien empchs cependant eux seuls dvangliser tout leur diocse ?
La messe catholique se disait plus ou moins correctement parfois assez
incorrectement dans toutes les paroisses. Lettres de ceux qui ne savent
pas lire , les fresques et les bas-reliefs, sur les murs des principales glises ou
leurs chapiteaux, prodiguaient dmouvantes, ma is imprcises leons. Les
fidles, assurment, avaient peu prs tous une connaissance sommaire des
aspects les plus frappants pour limagination dans les reprsentations
chrtiennes sur le pass, le prsent et lavenir du monde. Mais, ct de cela,
leur vie religieuse se nourrissait dune multitude de croyances et de pratiques
qui, tantt lgues par des magies millnaires, tantt nes, une poque
relativement rcente, au sein dune civilisation anime encore dune grande
fcondit mythique, exeraient sur la doctrine officielle une constante
pression. Dans les ciels dorage, on navait pas cess de voir passer de
fantomatiques armes : celles des morts, disait la foule, celles de dmons
trompeurs, disaient les doctes, beaucoup moins enclins nier ces visions qu
leur trouver une interprtation peu prs orthodoxe (72). Dinnombrables rites
naturistes, parmi lesquels la posie nous a rendu particulirement familires
les ftes de larbre de mai, se clbraient dans les campa gnes. En un mot,
jamais la thologie ne se confondit moins avec la religion collective,
vritablement sentie et vcue.
Malgr dinfinies nuances selon les milieux et les traditions
rgionales, quelques caractres communs de la mentalit religieuse ainsi
comprise peuvent tre relevs. Quitte laisser chapper plus dun trait
profond ou touchant, plus dune interrogation passionne, charge, jamais,
de valeur humaine, on devra se borner retenir ici les orientations de pense
et de sentiment dont laction sur la conduite sociale semble avoir t
particulirement forte.
p.130
Aux yeux de toutes les personnes capables de rflexion, le monde sensible
ntait gure plus quune sorte de masque, derrire lequel se passaient toutes
les choses vraiment importantes, un langage aussi, charg dexprimer, par
signes, une ralit plus profonde. Comme un tissu dapparence noffre que
88
Marc BLOCH La socit fodale
peu dintrt, en soi, il rsultait de ce parti pris que lobservation tait
gnralement dlaisse au profit de linterprtation. Dans u n petit Trait de
lUnivers qui, crit au IXe sicle, jouit dune vogue trs longue, Raban Maur
expliquait comme il suit son dessein : il mest venu lesprit de composer
un opuscule... qui traitt, non seulement de la nature des choses et de la
proprit des mots.... mais encore de leur signification mystique (73). Par l
sexplique, pour une grande part, la mdiocre prise de la science sur une
nature qui, au fond, ne semblait pas mriter beaucoup quon soccupt delle.
La technique, jusque dans ses progrs parfois considrables, ntait
quempirisme.
Au surplus, cette nature dcrie, comment et-elle paru apte tirer
delle -mme sa propre interprtation ? Ntait -elle pas, dans linfini dtail de
son droulement illusoire, conue avant tout comme luvre de volonts
caches ? De volonts, au pluriel, du moins en croire les simples et mme
beaucoup de doctes. Car, au-dessous du Dieu Unique et subordonns sa
Toute-Puissance sans que dailleurs on se reprsentt, lord inaire, bien
clairement lexacte porte de cette sujtion , le commun des hommes
imaginait, en tat de perptuelle querelle, les vouloirs opposs dune foule
dtres bons ou mauvais. saints, anges, diables surtout. Qui ne sait , crivait
le prtre Helmold, que les guerres, les ouragans, les pestes, tous les maux,
en vrit qui sabattent sur le genre humain, arrivent par le ministre des
dmons (74) ? p.131 Les guerres, on le notera, sont cites ple-mle avec les
temptes ; les accidents sociaux, donc, sur le mme plan que ceux auxquels
nous donnerions aujourdhui le nom de naturels. Do, une attitude mentale
qua dj mise en lumire lhistoire des invasions : non pas, au sens prcis du
terme, renoncement ; refuge, plutt, vers des moyens daction censs plus
efficaces que leffort humain. Certes, les ractions instinctives dun vigoureux
ralisme ne manqurent jamais. Que, cependant, un Robert le Pieux, un Otton
III, aient pu accorder un plerinage autant dimportance q u une bataille ou
une loi, les historiens, qui tantt sen scandalisent, tantt sobstinent
dcouvrir derrire ces pieux voyages des fins politiques secrtes, attestent
simplement par l leur propre incapacit dpouiller les lunettes dhommes
des XIXe ou XXe sicles. Lgosme du salut personnel ninspirait pas seul ces
royaux plerins. Des saints protecteurs quils venaient solliciter, ils
attendaient, pour leurs sujets comme pour eux-mmes, avec les promesses
ternelles, les biens de la terre. Dans le sanctuaire, autant quau combat ou au
tribunal, ils pensaient faire leur mtier de conducteur de peuples.
Ce monde dapparences tait aussi un monde transitoire. Insparable en
elle-mme de toute reprsentation chrtienne de lUnivers, rarement lima ge
de la catastrophe finale adhra aussi fortement aux consciences. On mditait
sur elle ; on en supputait les symptmes avant-coureurs. Universelle entre
toutes les histoires universelles, la chronique de lvque Otton de Freising,
qui commence la Cration, sachve sur le tableau du Jugement Dernier.
Avec, cela va de soi, une invitable lacune : de 1146 date o lauteur cessa
89
Marc BLOCH La socit fodale
dcrire au jour du grand croulement. Otton, certainement, lestimait de
peu dtendue : nous qui avons t placs la fin des temps , dit-il
plusieurs reprises. Ainsi pensait-on couramment, autour de lui et avant lui. Ne
disons pas : ide de clercs. Ce serait oublier linterpntration profonde des
deux groupes, clrical et laque. Parmi ceux mmes qui nallaient pas, c omme
saint Norbert, jusqu donner la menace pour si proche que la gnration
prsente ne devait pas steindre sans la voir tomber, nul p.132 nen pouvait
ignorer limminence. Dans tout mauvais prince, les mes pieuses croyaient
apercevoir la griffe de l Antchrist, dont latroce empire prcdera
lavnement du Royaume de Dieu.
Mais cette heure toute voisine, quand donc lentendrait -on sonner ?
LApocalypse semblait fournir une rponse : Lorsque mille ans seront
consomms... Fallait-il entendre : depuis la mort du Christ ? Daucuns le
pensaient, reportant ainsi, selon le calcul ordinaire, jusqu 1033 la grande
chance. Ou bien : depuis sa naissance ? Cette dernire interprtation parat
avoir t la plus gnrale. Il est certain, en tout cas, qu la veille de lan mille,
un prdicateur, dans les glises de Paris, annonait pour cette date la Fin des
Temps. Si, nanmoins, on ne vit pas alors se rpandre sur les masses
luniverselle terreur que nos matres du romantisme ont eu le tort de
dpeindre, la raison en est, avant tout, quattentifs au droulement des saisons
et au rythme annuel de la liturgie, les hommes de cette poque ne pensaient
pas communment par chiffres danne ni, moins encore, par chiffres
clairement calculs daprs une base uniforme . Que de chartes, on la vu,
prives de toute mention chronologique ! Parmi les autres mme, que de
diversit dans les systmes de rfrence, pour la plupart sans liens avec la vie
du Sauveur : annes de rgne ou de pontificat, repres astronomiques de tout
genre, cycle quindcennal de lindiction, issu jadis des pratiques de la fiscalit
romaine ! Un pays entier, lEspagne, tout en usant, plus gnralement
quailleurs, dune re prcise, lui donnait, on ne sait trop pourquoi, une origine
absolument trangre lvangile : 38 avant J. -C. Se ralliait-on
exceptionnellement dans les actes, plus frquemment dans les chroniques, au
comput de lIncarnation ? Il fallait encore faire entrer en jeu les variations
dans le dbut de lanne. Car lglise frappait dos tracisme le premier janvier,
fte paenne. Selon les provinces ou les chancelleries, lan dnomm millime
se trouva ainsi commencer lune ou lautre de six ou sept dates diffrentes,
qui schelonnaient, daprs notre calendrier, du 25 mars 999 au 31 mars
1000. Qui pis est, fixs tel ou tel moment liturgique de la priode pascale,
quelques-uns de ces points de dpart taient, p.133 par essence mouvants, donc
imprvisibles en labsence de tables, rserves aux seuls savants, et fort
propres aussi brouiller dfinitivement les cervelles, puisquils condamnaient
les annes successives des dures fort ingales. Sous le mme numro dan,
ne voyait-on pas ainsi se produire assez souvent, par deux fois, le retour du
mme quantime, en mars ou avril, ou de la fte du mme saint ? En vrit,
pour la plupart des Occidentaux, ce mot dan mille, quon voudrait nous faire
90
Marc BLOCH La socit fodale
croire tout charg dangoisses, tait incapable dvoquer aucune tape
exactement situe dans la suite des jours.
Est-elle cependant si fausse, lide de lombre alors jete sur les mes par
lannonce du Jour de Colre ? Toute lEurope ne frmit pas vers la fin du
premier millnaire, pour se calmer brusquement aussitt passe cette date
prtendument fatidique. Mais, pis encore peut-tre, des ondes de craintes
couraient presque incessamment, tantt ici, tantt l, et ne sapaisaient sur un
point que pour renatre bientt un peu plus loin. Parfois une vision donnait le
branle, ou bien une grande tragdie de lhistoire, Comme, en 1009, la
destruction du Saint-Spulcre, ou encore, plus simplement, une violente
tempte. Un autre jour, ctait une supputation de liturgistes, qui des cercles
instruits descendait jusqu la foule. Le bruit stait rpandu dans le monde
presque entier que la Fin arriverait lorsque lAnnonciation conciderait avec le
Vendredi Saint , crivait, peu avant lan mille, Abbon de Fleury (75). A la
vrit, se remmorant que saint Paul a dit : le Seigneur surprendra les hommes
comme un voleur de nuit , beaucoup de thologiens blmaient ces
indiscrtes tentatives pour percer le mystre dont la Divinit se plat
envelopper ses foudres. A ignorer cependant quand frappera le coup, lattente
est-elle moins anxieuse ? Dans les dsordres ambiants, que nous qualifierions
volontiers de bouillonnements dadolescence, les contemporains,
unanimement, ne voyaient que la dcrpitude dune humanit vieillie .
Lirrsistible vie, malgr tout, fermentait dans les hommes. Mais ds quils
mditaient, nul sentiment ne leur tait davantage tranger que celui dun
avenir immense, ouvert devant des forces jeunes.
Si lhumanit entire semblait courir rapidement vers sa fin, plus
forte raison cette sensation d en route sappliquait -elle chaque vie, prise
isolment. Selon le mot cher tant dcrits religieux, le fidle ntait -il pas,
sur terre, comme un plerin , auquel le but du voyage importe
naturellement beaucoup plus que les hasards du trajet ? Certes, la majorit des
hommes ne pensaient pas constamment leur salut. Mais lorsquils y
pensaient, ctait avec force et surtout laide dimages trs concrtes. Ces
vives reprsentations leur venaient, volontiers, par -coups ; car leurs mes,
foncirement instables, taient sujettes de brusques revirements. Joint au
got de cendres dun monde penchant vers son dclin, le souci des
rmunrations ternelles interrompit, par la fuite vers le clotre, plus dune
destine de chef, voire arrta net la propagation de plus dune ligne
seigneuriale ; tels les six fils du sire de Fontaine-ls-Dijon, se jetant au
monastre sous la conduite du plus illustre dentre eux, Bernard de Clairvaux.
Ainsi la mentalit religieuse favorisait, sa faon, le brassage des couches
sociales.
p.134
Beaucoup de chrtiens, cependant, ne se sentaient pas le cur assez ferme
pour se plier ces dures pratiques. Ils sestimaient, dautre part, et non sans
raison peut-tre, incapables de gagner le ciel par leurs propres vertus. Ils
mettaient donc leur espoir dans les prires des mes pieuses, dans les mrites
91
Marc BLOCH La socit fodale
accumuls, au profit de tous les fidles, par quelques groupes dasctes, dans
lintercession des saints, matrialiss par leurs reliques et reprsents par les
moines, leurs serviteurs. Dans cette socit chrtienne, nulle fonction di ntrt
collectif ne paraissait plus indispensable que celle des organismes spirituels.
Ne nous y trompons point : en tant, prcisment, que spirituels. Le rle
charitable, culturel, conomique des grands chapitres cathdraux et des
monastres a bien pu tre, en fait, considrable. Aux yeux des contemporains,
il ntait quaccessoire. La notion dun monde terrestre tout pntr de
surnaturel conspirait ici avec la hantise de lau -del. Le bonheur du roi et du
royaume, dans le prsent ; le salut des anctres royaux et du roi lui-mme,
travers lternit : tel tait le p.135 double bnfice qutablissant
Saint-Victor-de-Paris une communaut de chanoines rguliers, Louis le Gros
dclarait attendre de sa fondation. Nous croyons , disait de mme Otton Ier,
qu la croissante prosprit du culte divin est attache la sauvegarde de
notre Empire (76). Des glises puissantes, riches, cratrices dinstitutions
juridiques originales ; soulevs par ladaptation dlicate de cette cit
religieuse la cit temporelle, une foule de problmes ardemment,
dbattus et qui devaient peser dun poids trs lourd sur lvolution gnrale de
lOccident : en prsence de ces traits, insparables de toute exacte image du
monde fodal, comment ne pas reconnatre, dans la peur de lenfer, un des
grands faits sociaux du temps ?
92
Marc BLOCH La socit fodale
CHAPITRE III
La mmoire collective
I. Lhistoriographie
Bien des influences sunissaient, dans la socit fodale, pour inspirer
le got du pass. La religion, pour livres sacrs, avait des livres dhistoire ; ses
ftes commmoraient des vnements ; sous ses formes les plus populaires,
elle se nourrissait des contes que lon faisait sur des saints trs antiques ;
enfin, en affirmant que lhumanit tait prs de s a perte, elle cartait lillusion
qui entrane les ges de grands espoirs ne sintresser qu leur prsent ou
leur avenir. Le droit canon se fondait sur les vieux textes ; le droit laque, sur
les prcdents. Les heures vides du clotre ou du chteau favorisaient les longs
rcits. Lhistoire, la vrit, ne senseignait pas ex professo dans les coles,
sinon par lintermdiaire de lectures tournes, en principe, vers dautres fins :
crits religieux, o lon cherchait une instruction thologique ou mora le ;
uvres de lAntiquit classique, destines, avant tout, fournir des modles
de bien dire. Dans le bagage intellectuel commun, elle nen occupait pas
moins une place presque prpondrante.
p.137
Avides de savoir ce qui les avait prcdes, quelles sources les personnes
instruites pouvaient-elles puiser ? Connus seulement par fragments, les
historiens de lAntiquit latine navaient rien perdu de leur prestige ; bien que
Tite-Live ne ft pas, beaucoup prs, le plus souvent feuillet, son nom figure
parmi les livres distribus, entre p.138 1039 et 1049, aux moines de Cluny, pour
leurs lectures de Carme (77). Les uvres narratives du haut moyen ge
ntaient pas davantage oublies : de Grgoire de Tours, par exemple, on
possde plusieurs manuscrits excuts entre le Xe et le XIIe sicle. Mais
linfluence la plus considrable appartenait, sans conteste, aux crivains qui,
vers le dcisif tournant des IVe et Ve sicles, staient donn pour tche de
faire la synthse des deux traditions historiques, jusque-l fort trangres lune
lautre, dont le double legs simposait au monde nouveau : celle de la Bible ;
celle de la Grce et de Rome. Pour mettre profit leffort de conciliation tent
alors par un Eusbe de Csare, un saint Jrme, un Paul Orose, point ntait
besoin, dailleurs, de se reporter directement ces initiateurs. La substance de
leurs ouvrages avait pass et continuait de passer sans cesse dans de nombreux
crits, de date plus rcente.
Car le souci de rendre sensible, derrire la minute prsente, la pousse du
grand fleuve des temps tait si vif que beaucoup dauteurs, parmi ceux mme
93
Marc BLOCH La socit fodale
dont lattention se portait avant tout sur les vnements les plus proches,
jugeaient nanmoins utile de procder, en guise de prambule, une sorte de
vue cavalire de lhistoire universelle. Aux Annales que rdigea, vers 1078,
dans sa cellule de Hersfeld, le moine Lambert, nous ne demandons plus que
de nous renseigner sur les dchirements de lEmpire, durant le rgne de Henri
IV ; elles ont cependant pour point de dpart la Cration. Parmi les chercheurs
qui consultent aujourdhui, sur les royaumes francs aprs lcroulement de la
puissance carolingienne, la chronique de Rginon de Prm, sur les socits
anglo-saxonnes, les chroniques de Worcester ou de Peterborough, sur les
menues particularits de lhistoire bourguignonne, les Annales de Bze,
combien ont occasion de sapercevoir que les destines de lhumanit y sont
esquisses depuis lIncarnation ? Lors mme que le rcit est pris de moins
haut, il est frquent de le voir dbuter une poque de beaucoup antrieure
aux souvenirs du mmorialiste. Construits coup de lectures, qui taient
souvent mal digres ou mal comprises, incapables, par suite, de rien nous
apprendre sur les faits trop lointains quils prtendent p.139 relater, ces
prolgomnes constituent, par contre, un prcieux tmoignage de mentalit ;
ils nous mettent sous les yeux limage que lEurope fodale se formait de son
pass ; ils attestent, avec force, que les fabricants de chroniques ou dannales
navaient pas lhorizon volontairement troit. Malheureusement, aussitt que,
quittant le sr abri de la littrature, lcrivain tait rduit sinformer lui mme, le morcellement de la socit venait borner ses connaissances ; si bien
que, frquemment, par un contraste singulier, la narration, mesure quelle
progresse, la fois senrichit de dtails et, dans lespace, restreint sa vision.
Ainsi la grande histoire des Franais, labore, dans un monastre angoumois,
par Admar de Chabannes, aboutit, dtape en tape, ntre gure plus
quune histoire dAquitaine.
La varit mme des genres pratiqus par les historiographes tmoigne,
dailleurs, de luniversel plaisir que lon prenait alors conter ou entendre
conter. Les histoires universelles ou censes telles, les histoires de peuples, les
histoires dglises ctoient les simples recueils de nouvelles, tablis danne
en anne. Ds que de grandes actions venaient frapper les mes, tout un cycle
narratif les prenait pour motifs : telle, la lutte des empereurs et des papes ;
telles, surtout, les croisades. Bien que les crivains, pas plus que les
sculpteurs, ne fussent habiles rendre les traits originaux qui de ltre humain
font un individu, la biographie tait la mode. Non point, seulement, sous la
forme des vies de saints. Guillaume le Conqurant, Henri IV dAllemagne,
Conrad II, qui navaient certes aucun titre figurer sur les autels, trouvrent
des clercs pour retracer leurs exploits. Un haut baron du XIe sicle, le comte
dAnjou Foulque le Rchin, alla plus loin : il rdigea lui-mme ou fit rdiger
sous son nom sa propre histoire et celle de sa ligne : tant les grands de ce
monde attachaient dimportance au souvenir ! Sans doute, certaines contres
apparaissent comme relativement dshrites. Ctait que, de toute faon, on y
crivait peu. Beaucoup plus pauvres en chroniques ou annales que les pays
entre Seine et Rhin, lAquitaine et la Provence ont galement produit
94
Marc BLOCH La socit fodale
beaucoup moins de travaux thologiques. p.140 Dans les proccupations de la
socit fodale, lhistoire tenait un rle assez considrable pour fournir, par sa
variable prosprit, un bon baromtre de la culture, en gnral.
Ne nous y trompons point, cependant : cet ge, qui se penchait si
volontiers vers le pass, nen possdait que des reprsentations plus
abondantes que vridiques. La difficult o lon tait de sinformer, mme sur
les vnements les plus rcents, comme linexactitude gnrale des esprits,
condamnaient la plupart des ouvrages historiques traner dtranges scories.
Toute une tradition narrative italienne, qui commence ds le milieu du IXe
sicle, oubliant denregistrer le couronnement de lan 800, faisait de Louis le
Pieux le premier empereur carolingien (78). A peu prs insparable de toute
rflexion, la critique du tmoignage ntait certes pas absolument inconnue, en
elle-mme ; preuve, le curieux trait de Guibert de Nogent sur les reliques.
Mais personne ne songeait lappliquer systmatiquemen t aux documents
anciens : du moins, avant Ablard ; encore fut-ce, chez ce grand homme
mme, dans un domaine assez restreint (79). Legs fcheux de lhistoriographie
classique, un parti pris oratoire et hroque pesait sur les crivains. Si certaines
chroniques de monastres sont bourres de documents darchives, cest que,
modestement, elles se proposaient pour dessein presque unique de justifier les
droits de la communaut sur son patrimoine. Un Gilles dOrval, par contre,
dans une uvre de ton plus soutenu, se voue -t-il retracer les hauts faits des
vques de Lige ? on le voit, rencontrant sur son chemin une des premires
chartes de liberts urbaines, celle dHuy, se refuser en donner lanalyse, de
peur dennuyer son lecteur. Une des forces de lcole islandaise, si
suprieure en intelligence historique aux chroniques du monde latin, fut
dchapper ces prtentions. De son ct, linterprtation symbolique,
quimposait un autre courant mental, brouillait lintelligence de s ralits.
Livres dhistoire, les Livres Saints ? Sans doute. Mais dans toute une partie au
moins de cette histoire, celle de lAncienne Alliance, lexgse commandait
de reconnatre, moins le tableau dvnements portant leur sens en eux mmes, que la prfiguration de ce qui devait les suivre : p.141 lombre du
futur , selon le mot de saint Augustin (80). Enfin et surtout limage souffrait
dune imparfaite perception des diffrences entre les plans successifs de la
perspective.
Ce ntait pas, comme Gaston Paris sest laiss aller le dire, quon crt
obstinment limmutabilit des choses. Un pareil penchant net gure
t compatible avec la notion dune humanit en marche, pas rapides, vers le
but fix davance. Du changement des temps : ainsi, daccord avec
lopinion commune, Otton de Freising intitulait sa chronique. Sans choquer
personne, cependant, les pomes en langues vulgaires dpeignaient
uniformment les paladins carolingiens, les Huns dAttila et les h ros antiques
sous les traits de chevaliers des XIe et XIIe sicles. Cet ternel changement,
qui ntait pas ni, on se trouvait, en pratique, absolument incapable den
saisir lampleur. Par ignorance, sans doute. Mais surtout parce que la
95
Marc BLOCH La socit fodale
solidarit entre lautrefois et laujourdhui, conue avec trop de force,
masquait les contrastes et cartait jusquau besoin de les apercevoir. Comment
et-on rsist la tentation dimaginer les empereurs de la vieille Rome tout
pareils aux souverains du jour, alors que lEmpire Romain passait pour durer
encore et les princes saxons ou saliens pour les successeurs, en droite ligne, de
Csar ou dAuguste ? Tout mouvement religieux se pensait lui-mme sous
laspect dune rforme, dans lacception propre du terme : entendez un retour
vers la puret originelle. Aussi bien lattitude traditionaliste, qui sans cesse
tire le prsent vers le pass et par l conduit naturellement confondre les
couleurs de lun et de lautre, nest -elle pas aux antipodes de lesprit
historique, domin par le sens de la diversit ?
Le plus souvent inconscient, le mirage quelquefois se faisait volontaire.
Sans doute les grands faux qui exercrent leur action sur la politique civile ou
religieuse de lre fodale lui sont lgrement antrieurs : la pseudo-Donation
de Constantin datait du VIIIe sicle finissant ; les fabrications de ltonnant
atelier auquel on doit, comme uvres principales, les fausses dcrtales mises
sous le nom dIsidore de Sville et les faux capitulaires du diacre Benot
furent p.142 un fruit de la renaissance carolingienne, en son panouissement.
Mais lexemple ainsi donn devait traverser les temps. Le recueil canonique
compil, entre 1008 et 1012, par le saint vque Burchard de Worms,
fourmille dattributions trompeuses et d e remaniements presque cyniques. Des
pices fausses ont t forges la cour impriale. Dautres, en quantit
innombrable, dans les scriptoria des glises, si mal fams cet gard que,
connues ou devines, les entorses la vrit qui y taient endmiques ne
contriburent pas mdiocrement discrditer le tmoignage crit : nimporte
quelle plume peut servir raconter nimporte quoi , disait, au cours dun
procs, un seigneur allemand (81). Assurment si lindustrie, en elle -mme
ternelle, des faussaires et des mythomanes connut, durant ces quelques
sicles, une exceptionnelle prosprit, la responsabilit en incombe, pour une
large part, la fois aux conditions de la vie juridique, qui reposait sur les
prcdents, et au dsordre ambiant : parmi les documents invents, plus dun
ne le fut que pour parer la destruction dun texte authentique. Cependant,
que tant de productions mensongres aient t alors excutes, que tant de
pieux personnages, dune lvation de caractre incontestable, aient tremp
dans ces machinations, pourtant expressment condamnes, de leur temps
mme, par le droit et la morale, il y a l un symptme psychologique bien
digne de rflexion : par un curieux paradoxe, force de respecter le pass, en
en arrivait le reconstruire tel quil et d tre.
Si nombreux dailleurs quils fussent, les crits historiques taient
accessibles seulement une lite assez restreinte. Car, sauf chez les
Anglo-Saxons, ils avaient pour langue le latin. Selon quun cond ucteur
dhommes appartenait ou non au petit cercle des litterati, le pass, authentique
ou dform, agissait donc sur lui avec plus ou moins de plnitude. Tmoins,
en Allemagne, aprs le ralisme dOtton Ier, la politique de rminiscences dun
96
Marc BLOCH La socit fodale
Otton III ; aprs lillettr Conrad II, volontiers enclin abandonner la Ville
ternelle aux luttes de ses factions aristocratiques et de ses pontifes fantoches,
le trs instruit Henri III, patrice des Romains et rformateur de la papaut.
p.143 Cependant mme les moins cultivs parmi les chefs ntaient pas sans
participer, en quelque mesure, ce trsor de souvenirs. Leurs clercs familiers
sans doute les y aidaient. Bien moins sensible assurment que ne devait ltre
son petit-fils aux prestiges de latmosphre romaine, Otton Ier avait pourtant
tenu ceindre, lui le premier de sa ligne, la couronne des Csars ; qui nous
dira jamais de quels matres, lui traduisant ou lui rsumant quels ouvrages, ce
roi, peu prs incapable de lectures, avait appris, avant de la restaurer, la
tradition impriale ?
Surtout, les rcits piques en langues vulgaires taient les livres dhistoire
des personnes qui ne savaient pas lire mais aimaient couter. Les problmes
de lpope comptent parmi les plus controverss des tudes mdivales.
Quelques pages ne sauraient suffire en scruter la complexit. Du moins
sied-il de les poser ici sous langle qui avant tout importe lhistoire de la
structure sociale et, plus gnralement, nest peut -tre pas le moins propre
ouvrir des perspectives fcondes celui de la mmoire collective.
II. Lpope
Lhistoire de lpope franaise, telle que nous la saisissons, commence
vers le milieu du XIe sicle, peut-tre un peu plus tt. Il est certain, en effet,
que ds ce moment circulaient, dans la France du Nord, des chansons
hroques en langue vulgaire. Sur ces compositions de date relativement
recule, nous ne disposons malheureusement que de renseignements
indirects : allusions dans des chroniques, fragment dune adaptation en lang ue
latine (le mystrieux fragment de La Haye ). Aucun manuscrit pique West
antrieur la seconde moiti du sicle suivant. Mais de lge dune copie, on
ne saurait conclure celui du texte copi. De clairs indices nous assurent que
trois pomes au moins existaient, ds les abords de lan 1100, au plus tard,
sous une forme trs voisine de celle o nous les lisons aujourdhui : la
Chanson de Roland ; la Chanson de Guillaume qui mentionne elle-mme,
en passant, plusieurs autres chants, dont p.144 nous ne possdons plus de
versions anciennes ; enfin, connu la fois par un dbut de manuscrit et par
des analyses dont la premire en date est de 1088, le rcit quon est convenu
dintituler Gormont et Isembart .
Lintrigue du Roland relve du folklore, plutt que de lhistoire : haine du
beau-fils et du partre, envie, trahison. Ce dernier motif rapparat dans
Gormont. De la Chanson de Guillaume, laffabulation nest que lgende. De
part et dautres, beaucoup des acteurs du drame, parmi les plus consid rables,
semblent de pure invention : ainsi Olivier, Isembart, Vivien. Cependant, sous
97
Marc BLOCH La socit fodale
les broderies du rcit, une trame historique partout subsiste. Il est vritable
que, le 15 aot 778, larrire -garde de Charlemagne fut surprise, au passage
des Pyrnes, par une bande ennemie des Basques, dit lhistoire, des
Sarrasins, dira la lgende et que, dans cette rude mle, un comte, nomm
Roland, prit, avec beaucoup dautres chefs. Les plaines du Vimeu, o se
droule laction de Gormont, avaient vu, en 881, un authentique roi Louis, qui
tait le Carolingien Louis III, triompher glorieusement dauthentiques paens :
des Normands, en fait, que la fiction, une fois de plus, mua en soldats de
lIslam. Le comte Guillaume, ainsi que sa femme Guibourc, avait vcu s ous
Charlemagne : vaillant pourfendeur de Musulmans, comme dans la Chanson,
parfois, comme dans celle-ci, vaincu par les Infidles, mais toujours
hroquement. Au second plan mme des trois uvres, voire dans le
grouillement des fonds de tableau, il nest pas malais de reconnatre, ct
dombres imaginaires, plus dun personnage qui, pour ne pas toujours se
trouver plac, par les potes, sa date exacte, nen avait pas moins rellement
exist : tels, larchevque Turpin, le roi paen Gormont, qui fut un clbre
Viking, et jusqu cet obscur comte de Bourges, Esturmi, dont la Chanson de
Guillaume ne dpeint la figure sous de si noires couleurs que par un
inconscient cho des mpris auxquels lavait, en son temps, expos une
naissance servile.
Dans les pomes, fort nombreux, qui furent mis par crits, sur des thmes
analogues, au cours des XIIe et XIIIe sicles : mme contraste. Les fables y
abondent, de plus en plus p.145 envahissantes mesure que le genre, en
senrichissant, ne russissait renouveler ses sujets qu coup de fictions.
Presque toujours, cependant, au moins dans les uvres dont le dessin gnral,
sinon la rdaction aujourdhui connue, remonte visiblement une poque
assez ancienne, on aperoit tantt, au centre mme de laction, un motif
indubitablement historique, tantt, parmi les dtails, tel ou tel souvenir dune
prcision inattendue : figure pisodique, chteau dont on et pu croire
lexistence depuis longtemps oublie. Ainsi simposent au chercheur deux
problmes indissolubles. Par quels ponts jets sur un abme plusieurs fois
sculaire la connaissance dun si lointain pass sest -elle transmise aux
potes ? Entre la tragdie du 15 aot 778, par exemple, et la Chanson des
dernires annes du XIe sicle, quelle tradition a tiss ses fils mystrieux ? Le
trouvre de Raoul de Cambrai, au XIIe sicle, de qui donc avait-il appris
lattaque lance, en 943, contre les fils de Herbert de Vermandois par Raoul,
fils de Raoul de Gouy, la mort de lenvahisseur et, avec ces vnements,
placs au nud du drame, les noms de plusieurs contemporains du hros :
Ybert, sire de Ribmont, Bernard de Rethel, Ernaut de Douai ? Voil pour la
premire nigme. Mais voici la seconde, qui nest pas moins grave : ces
donnes exactes, pourquoi les voit-on si trangement tortures ? ou plutt
car on ne saurait videmment tenir les derniers rdacteurs pour responsables,
eux seuls, de la dformation tout entire comment se fait-il que le bon
grain ne leur soit parvenu que ml tant derreurs ou dinventions ? Part de
lauthentique ; part de limaginaire : toute tentative dinterprtation qui
98
Marc BLOCH La socit fodale
manquerait rendre compte, avec une gale plnitude, de lun et lautre
lment serait par l mme condamne.
Les gestes piques ntaient pas, en principe, destines la lecture.
Elles taient faites pour tre dclames ou plutt psalmodies. De chteau en
chteau ou de place publique en place publique, on les voyait ainsi colportes
par des rcitants professionnels, quon appelait jongleurs . Les plus
humbles, en effet, subsistant des picettes de monnaie que chaque auditeur
tirait du pan de sa chemise (82), joignaient au mtier de conteurs ambulants
celui de p.146 baladins. Dautres, assez heureux pour avoir obtenu la protection
de quelque haut seigneur, qui les attachait sa cour, sassuraient par l un
moins prcaire gagne-pain. Ctait parmi ces excutants que se recrutaient
aussi les auteurs des pomes. Les jongleurs, en dautres termes, tantt
produisaient oralement les compositions dautrui, tantt avaient dabord
trouv eux-mmes les chants quils dbitaient. Dun extrme lautre, il
existait dailleurs une infinit de nuances. Rarement trouveur inventait
entirement sa matire ; rarement interprte sabstenait de tout remaniement.
Un public trs divers, en majorit illettr, incapable, presque toujours, de
peser lauthenticit des faits, beaucoup moins sensible dailleurs la vracit
qu lamusement et lexaltation de sentiments familiers ; comme crateurs,
des hommes habitus remodeler sans cesse la substance de leurs rcits,
vous dautre part un genre de vie mdiocrement favorable ltude, en
position cependant de frquenter de temps autre les grands et soucieux de
leur plaire tel fut larrire -plan humain de cette littrature. Rechercher
comment tant de souvenirs exacts sy sont infiltrs revient se demander par
quelles voies les jongleurs purent tre mis au courant des vnements ou des
noms.
Il est presque superflu de le rappeler : tout ce que les chansons, notre
connaissance, renferment de vridique se retrouvait, sous une forme
diffrente, dans les chroniques ou les chartes : sil en avait t autrement,
comment nous serait-il possible, aujourdhui, de faire le tri ? On ne saurait,
cependant, sans une criante invraisemblance, se reprsenter les jongleurs sous
laspect dautant de fouilleurs de bibliothques. Par contre, il est lgitime de
se demander sils nont pu avoir accs, indirectement, la matire dcrits
quils ntaient gure en mesur e de consulter eux-mmes. Comme
intermdiaires, on songera naturellement aux gardiens ordinaires de ces
documents : les clercs et spcialement les moines. Lide, en soi, na rien qui
rpugne aux conditions de la socit fodale. Cest bien tort, en effe t, que,
proccups dopposer en toutes choses le spontan au savant , les
historiens dinspiration romantique avaient imagin, entre les tenants de la
posie dite populaire et ces adeptes p.147 professionnels de la littrature latine
qutaient les clercs, je ne sais quelle infranchissable cloison. A dfaut
dautres tmoignages, lanalyse de la chanson de Gormont, dans la chronique
du moine Hariulf, le fragment de La Haye , qui est probablement un
exercice scolaire, le pome latin quun clerc fran ais du XIIe sicle composa
99
Marc BLOCH La socit fodale
100
sur la trahison de Ganelon suffiraient nous assurer qu lombre des clotres
lpope en langue vulgaire ntait ni ignore ni ddaigne. De mme, en
Allemagne, le Waltharius, dont les hexamtres virgiliens habillent si
curieusement une lgende germanique, naquit peut-tre dun devoir dlve et
lon nous rapporte que, plus tard, dans lAngleterre du XI Ie sicle, le
pathtique rcit des aventures dArthur tirait des larmes aux jeunes moines
comme aux laques (83). Ajoutez que, malgr les anathmes de quelques
rigoristes contre les histrions , les religieux, en gnral, naturellement
enclins rpandre la gloire de leurs maisons et des reliques qui en
constituaient les plus chers joyaux, ntaient pa s hommes mconnatre dans
les jongleurs, habitus passer, sur la place publique, des chants les plus
profanes aux contes pieux de lhagiographie, une force de propagande presque
sans gale.
De fait, comme Joseph Bdier la montr, en termes inoubliabl es, la
marque monacale est clairement inscrite sur plus dune lgende pique.
Linsistance des moines de Pothires et, plus encore, de Vzelay peut seule
expliquer le transfert, en Bourgogne, de laction de Grard de Roussillon, dont
tous les lments historiques se localisaient au bord du Rhne. Sans labbaye
de Saint-Denis-de-France, sa foire et ses corps saints, on ne saurait concevoir
ni le pome du Voyage de Charlemagne, humoristique broderie sur lhistoire
des reliques, lusage sans doute moins des plerins de lglise que des clients
du foirail, ni le Floovant, qui traite, avec plus de gravit et dennui, un sujet
voisin, ni, vraisemblablement, mainte autre chanson o paraissent, devant une
toile de fond sur laquelle se profile le monastre, les princes carolingiens dont
la mmoire y tait pieusement conserve. Sur la part de cette grande
communaut, allie et conseillre des rois captiens, dans llaboration du
thme de Charlemagne, le dernier mot, assurment, na pas encore t dit.
p.148 Il
est, cependant, beaucoup dautres uvres, notamment parmi les plus
anciennes, o on aurait peine dcouvrir la trace dune influence monastique,
au moins concerte et soutenue : telles la Chanson de Guillaume, Raoul de
Cambrai, le cycle des Lorrains tout entier. Dans le Roland mme, que lon a
voulu rattacher au plerinage de Compostelle, comment, si cette hypothse
devait tre vraie, ne pas stonner de ne voir citer ni, parmi tant de saints, le
nom de saint Jacques, ni, parmi tant de villes espagnoles, le grand sanctuaire
de la Galice ? Comment, dans un ouvrage prtendument inspir par des
moines, expliquer le virulent mpris que le pote affiche pour la vie du
clotre (84) ? Par ailleurs, sil est incontestable que toutes les donne s
authentiques exploites par les gestes auraient pu, en principe, tre puises
dans la consultation des chartriers et des bibliothques, les documents o elles
figurent ne les prsentent, lordinaire, qu ltat dispers, parmi beaucoup
dautres traits qui nont pas t retenus : si bien que pour les extraire de ces
textes et nextraire quelles seules, il et fallu tout un travail de rapprochement
et de triage, un travail drudition, en un mot, des moins familiers aux
habitudes intellectuelles du temps. Enfin et surtout, postuler lorigine de
Marc BLOCH La socit fodale
101
chaque chanson ce couple pdagogique : pour matre un clerc instruit, pour
lve un docile jongleur, cest, semble -t-il, renoncer expliquer, ct de la
vrit, lerreur. Car, si mdiocre que ft la littratu re annalistique, si
encombres de lgendes et de faux quon imagine juste titre les traditions
des communauts religieuses, si prompts broder ou oublier quon suppose
les jongleurs, le plus mauvais des rcits btis coup de chroniques ou de
chartes naurait gure pu commettre le quart des bourdes dont se rend
coupable la moins mensongre des chansons. Aussi bien avons-nous ici une
contre-preuve : vers le milieu du XIIe sicle, il se trouva successivement
deux clercs pour mettre en vers franais, dans un style peu prs calqu sur
lpope, une matire historique dont la plus grande partie au moins avait t
tire par eux des manuscrits. Or ni dans le Roman de Rou, de Wace, ni dans
l Histoire des ducs de Normandie, de Benot de Sainte-Maure, les lgendes ni
les confusions certes ne font dfaut ; p.149 mais, ct du Roland, ce sont des
chefs-duvre dexactitude.
Si donc lon doit tenir pour improbable quau moins dans la plupart des
cas, les trouvres du XIe sicle finissant et des premires annes du XIIe
aient, au moment prcis o ils composaient, tenu, mme indirectement, de
chroniques ou de pices darchives les lments de leurs gestes (85), force est
bien dadmettre la base de leurs rcits une tradition antrieu re. A dire vrai,
cette hypothse, longtemps classique, na t compromise que par les formes
dont on la vue trop souvent revtue. A lorigine, des chants trs courts,
contemporains des vnements ; nos chansons, telles que nous les
connaissons, tardivement et plus ou moins maladroitement confectionnes
laide de ces primitives cantilnes , cousues bout bout ; au point de
dpart, en un mot, la spontanit de lme populaire ; au terme, un travail de
littrateur : cette image, dont la simplicit de lignes a pu sduire, ne rsiste
gure lexamen. Certes toutes les chansons ne sont pas de la mme venue ; il
en est o ne manquent point les traces de grossires rajoutures. Qui donc,
cependant, lisant sans parti pris le Roland, refuserait dy voir une uvre dun
seul jet, luvre dun homme et dun grand homme dont lesthtique, dans la
mesure o elle ne lui tait pas personnelle, traduisait les conceptions de son
temps, non le ple reflet dhymnes perdus ? En ce sens il est bien vrai de dire
que les chansons de geste sont nes vers la fin du XIe sicle. Mais lors
mme quil a du gnie ce qui ntait assurment point le cas le plus
frquent : on oublie trop combien la beaut du Roland est exceptionnelle ,
un pote, le plus souvent, fait-il autre chose que dutiliser, selon son art, les
thmes dont lhritage collectif lui a t transmis par les gnrations ?
Aussi bien, quand on sait lintrt que les hommes de lpoque fodale
attachaient au pass et lagrment quils prenaient lentendre conter ,
comment stonner si une tradition narrative descendit le fil des ges ? Pour
foyers de prdilection, elle avait tous les lieux o se rencontraient les errants :
ces plerinages et ces champs de foire, ces routes de plerins et de marchands
dont le souvenir a marqu tant de p.150 pomes. Les commerants au long
Marc BLOCH La socit fodale
102
cours, dont nous savons, par le hasard dun texte, quallemands ils portrent
la connaissance du monde scandinave certaines lgendes allemandes (86),
hsiterons-nous croire que, franais, ils naient vhicul de mme, avec leurs
ballots de draps ou leurs sacs dpices, dun bout lautre des itinraires
familiers, bien des thmes hroques, voire de simples noms ? Ce furent
assurment, leurs rcits, avec ceux des plerins, qui apprirent aux jongleurs la
nomenclature gographique de lOrient et ces Potes du Nord firent
connatre la beaut de lolivier mditerranen, quavec un naf got de
lexotisme et un admirable mpris de la couleur locale, les chansons plantent
bravement sur les collines de la Bourgogne ou de la Picardie. Pour ne pas
avoir lordinaire dict les lgendes, les monastres aussi nen fournirent pas
moins un terrain minemment favorable leur dveloppement : parce quon y
voyait passer beaucoup de voyageurs ; parce que la mmoire sy accrochait
plus dun vieux monument ; parce quenfin les moines ont toujours aim
narrer beaucoup trop, au dire des puritains, comme Pierre Damien (87). Les
plus anciennes anecdotes sur Charlemagne furent mises par crit, ds le IXe
sicle, Saint-Gall : rdige au dbut du XIe sicle, la chronique du monastre
de Novalaise, sur le chemin du Mont-Cenis, fourmille de traits lgendaires.
Nimaginons pas, cependant, que tout soit sorti des s anctuaires. Les
lignes seigneuriales, de leur ct, avaient leurs traditions, par o a d venir
plus dun souvenir, exact ou dform ; et lon se plaisait parler des anctres
dans les salles des ferts comme sous les arcades du clotre. Nous nous
trouvons savoir que le duc Godefroy de Lorraine ne ddaignait pas de rgaler
ses htes dhistoriettes sur Charlemagne (88). Estimera-t-on que ce got
nappartnt qu lui ? Dans lpope, dailleurs, il nest gure malais de
dceler deux images du grand Carolingien, qui se contredisent violemment :
au noble souverain du Roland, quentoure une vnration quasi religieuse,
soppose le vieillard convoiteux et rassot de tant dautres chansons.
Le premier courant tait conforme la vulgate de lhistoriographie
ecclsiastique, comme aux besoins de la propagande p.151 captienne ; dans le
second, comment ne pas reconnatre lempreinte antimonarchique du
baronat ?
Des anecdotes peuvent fort bien se transmettre ainsi, de gnrations en
gnrations, sans pour cela prendre la forme de pomes. Mais ces pomes
enfin ont exist. Depuis quand ? le problme est presque insoluble. Car nous
avons affaire au franais, cest --dire une langue qui, passant pour une
simple corruption du latin, mit plusieurs sicles slever la dignit
littraire. Dans les chansons rustiques , cest --dire en parlers vulgaires,
que, ds la fin du IXe sicle, un vque dOrlans croyait devoir interdire ses
prtres, se glissait-il dj quelque lment hroque ? Nous nen saurons
jamais rien, parce que tout cela se passait dans une zone situe fort au-dessous
de lattention des gens de lettres. Cependant, sans vouloir tirer de largument a
silentio un parti excessif, force est de constater que les premires mentions
relatives aux chants piques surgissent seulement au XIe sicle ; la brusque
Marc BLOCH La socit fodale
103
apparition de ces tmoignages, aprs une longue nuit, semble bien suggrer
que les gestes versifies ne se dvelopprent pas beaucoup plus tt, au moins
avec quelque abondance. Il est fort remarquable, dautre part, que, dans la
plupart des pomes anciens, Laon figure comme la rsidence habituelle des
rois carolingiens ; le Roland lui-mme, qui rtablit Aix-la-Chapelle son vrai
rang, porte nanmoins, comme par inadvertance, quelques traces de la
tradition laonnaise. Or celle-ci ne saurait avoir pris naissance quau Xe sicle,
alors que le Mont-Loon jouait vritablement le rle qui lui est ainsi
assign. Plus tard, comme plus tt, elle serait inexplicable (89). Ce fut donc,
selon toute apparence, en ce sicle que se fixrent les principaux thmes de
lpope, sinon dj sous forme prosodique, du moins tout prts la recevoir.
Une des caractristiques essentielles des chansons fut dailleurs d e ne
vouloir retracer que des vnements anciens. A peu prs seules, les croisades
semblrent immdiatement dignes de lpope. Cest quelles avaient tout
pour secouer les imaginations ; sans doute aussi quelles transposaient dans le
prsent une forme d hrosme chrtien, familire, ds le XIe sicle, aux
pomes. Ces uvres dactualit p.152 fournissaient aux jongleurs loccasion
dexercer sur leurs mcnes une douce pression : pour avoir refus lun
dentre eux deux chausses dcarlate, Arnoul dArdres vit son nom ray de la
Chanson dAntioche (90). Quelque plaisir cependant que les barons dussent
ressentir entendre ainsi leurs exploits voler dans la bouche des hommes,
quelque profit que les potes pussent attendre de pareilles compositions, les
guerres du prsent, lorsquelles navaient pas pour thtre la Terre Sainte, ne
trouvrent gnralement personne pour les clbrer sur ce mode. Est-ce dire
que, comme la crit Gaston Paris, la fermentation pique sarrta au
moment o la nation franaise se fut dfinitivement constitue ? Cette thse,
en elle-mme mdiocrement vraisemblable, supposerait que les rcits relatifs
au IXe et au Xe sicle aient immdiatement revtu une forme potique : ce qui
nest rien moins que sr. La vrit est, sans doute, que, pntrs de respect
pour les temps couls, les hommes ne savaient alors chercher lexaltation que
dans des souvenirs dj chargs du prestige propre aux choses trs vieilles. Un
jongleur, en 1066, accompagna Hastings les guerriers normands. Que
chantait-il ? de Karlemaigne et de Rollant . Un autre, vers 1100, prcdait
une bande de pillards bourguignons, dans une petite guerre locale. Que
chantait-il ? les hauts faits des aeux (91). Lorsque les grands coups dpe
des XIe et XIIe sicles eurent, leur tour, recul dans le lointain des ges, le
got du pass subsistait toujours ; mais il se satisfaisait autrement. Lhistoire,
parfois encore versifie, mais appuye dsormais sur la transmission crite et
par suite beaucoup moins contamine par la lgende, avait remplac lpope.
Lamour des rcits historiques et lgendaires ne fut pas, durant lpoque
fodale, propre la France. Mais, commun toute lEurope, il sy satisfaisait
de diverses faons.
Marc BLOCH La socit fodale
104
Si haut que nous remontions dans lhistoire des peuples germaniques, nous
les voyons habitus clbrer en vers les exploits des hros. Chez les
Germains du continent et de la Bretagne, il semble dailleurs que, comme chez
les Scandinaves, deux genres de posies guerrires fussent pratiqus, cte
cte ; les unes consacres des personnages trs anciens, parfois mythiques ;
les autres qui disaient la p.153 gloire des chefs actuellement vivants ou morts
depuis peu. Puis, au Xe sicle, souvrit une priode o lon ncrivait gure et,
un bien petit nombre dexceptions prs, seulement en latin. Durant ces
sicles obscurs, la survie des vieilles lgendes, sur la terre allemande, est
atteste presque uniquement par une transposition latine le Waltharius et
par lmigration de certains thmes vers les pays du Nord, o la source de la
littrature populaire jaillissait toujours frache. Elles navaient pourtant pas
cess de vivre ni de sduire. A la lecture de saint Augustin ou de saint
Grgoire, lvque Gunther, qui, de 1057 1065, occupa le sige de Bamberg,
prfrait, si lon en croit un de ses chanoines, les rcits sur Attila et sur les
Amales, cest --dire lantique dynastie ostrogothique, teinte au V Ie sicle.
Peut-tre mme le texte est obscur potisait-il , de son propre cru, sur
ces sujets profanes (92). On continuait donc conter, autour de lui, les
aventures de rois ds longtemps disparus. Sans doute continuait-on aussi les
chanter, dans la langue de tout le monde ; mais de ce quon chantait, nous
navons rien. La vie de larchevque Anno, mise en vers allemands, peu aprs
1077, par un clerc du diocse de Cologne, appartient lhagiographie bien
plutt qu une littrature narrative lusage de larg es auditoires.
Le voile ne se lve nos yeux qu une date dun sicle environ
postrieure lapparition des gestes franaises et aprs que, prcisment,
limitation de ces gestes ou duvres plus rcentes, mais de mme
provenance, avait, depuis une gnration dj, accoutum le public allemand
apprcier les grandes fresques potiques en langue vulgaire. Les premiers
pomes hroques dinspiration indigne nont pas t composs sous une
forme proche de celle o nous les connaissons aujourdhui, avant la fin du
XIIe sicle. Abandonnant dsormais aux chroniqueurs ou la versification
latine les hauts faits des contemporains, cest, comme en France, des
aventures dj dcantes par une longue transmission quils demandent leurs
motifs. Le curieux est que ce pass de prdilection se trouve ici beaucoup plus
lointain. Un seul Lied celui du duc Ernst rapporte, dailleurs en le
dformant trangement, un vnement du dbut du XIe sicle. p.154 Les autres,
de pures lgendes et un merveilleux parfois encore tout paen, mlent de
vieux souvenirs du temps des Invasions, ordinairement rapetisss dailleurs de
leur dignit de catastrophes mondiales au mdiocre relief de banales vendettas
personnelles. Les vingt et un principaux hros, susceptibles didentif ication,
quon a pu dnombrer dans lensemble de cette littrature, schelonnent dun
roi goth, mort en 375, un roi lombard, mort en 575. Voit-on, par hasard,
apparatre, et l, un personnage de date plus rcente ? dans la Chanson des
Nibelungen, par exemple, un vque du Xe sicle se glisser parmi lassemble,
Marc BLOCH La socit fodale
105
dj singulirement disparate, qu ct dombres sans consistance historique,
comme Siegfried et Brnhilde, forment Attila, Thodoric le Grand et les rois
burgondes du Rhin ? Cet intrus ne figure jamais qu titre pisodique,
probablement par leffet dune influence locale ou clricale. Il nen et pas t
ainsi, assurment, si les potes avaient reu leurs sujets de clercs occups
compulser les documents crits : pour fondateurs, les monastres allemands
navaient pas des chefs barbares et si les chroniqueurs parlaient bien dAttila,
voire du tyran Thodoric, ctait sous des couleurs singulirement plus
noires que celles dont les pare lpope. Est -il cependant rien de plus frappant
que ce contraste ? la France, dont la civilisation avait t profondment
remanie dans le creuset du haut moyen ge, dont la langue, en tant quentit
linguistique vraiment diffrencie, tait relativement jeune, si elle se tournait
vers sa tradition la plus recule, dcouvrait les Carolingiens (la dynastie
mrovingienne ne parat, notre connaissance, que dans une seule chanson, le
Floovant, assez tardive et qui, on la vu, fait probablement partie dun groupe
duvres directement inspir par des moines sava nts, ceux de Saint-Denis) ;
lAllemagne, au contraire, disposait, pour en nourrir ses contes, dune
substance infiniment plus ancienne, parce que, longtemps cach, le courant
des rcits et peut-tre des chants ne stait jamais interrompu.
La Castille nous met sous les yeux une exprience galement instructive.
La soif de souvenirs ny tait pas moins vive quailleurs. Mais dans cette terre
de Reconqute, les plus p.155 vieux souvenirs nationaux taient tout neufs. Il en
rsulta que les jongleurs, dans la mesure o ils ne reproduisaient pas des
modles trangers, puisrent leurs inspirations dans des vnements peine
refroidis. La mort du Cid est du 10 juillet 1099 ; seul survivant de toute une
famille de cantares consacrs aux hros des guerres rcentes, le Pome du Cid
est des environs de 1150. Plus singulier est le cas de lItalie. Elle neut pas,
elle ne semble jamais avoir eu dpope autochtone. Pourquoi ? Il y aurait
bien de la tmrit prtendre trancher en deux mots un problme si
troublant. Une solution, nanmoins, mrite dtre suggre. A lpoque
fodale, lItalie fut un des rares pays o dans la classe seigneuriale, de mme
sans doute que chez les marchands, un grand nombre de personnes savaient
lire. Si le got du pass ny fit pas natre d es chants, ne serait-ce point parce
quil trouvait une satisfaction suffisante dans la lecture des chroniques
latines ?
Lpope, l o elle put se dvelopper, exerait sur les imaginations une
action dautant plus forte quau lieu, comme le livre, de sa dresser
exclusivement aux yeux, elle bnficiait de toute la chaleur de la parole
humaine et de cette espce de martelage intellectuel qui nat de la rptition,
par la voix, des mmes thmes, voire des mmes couplets. Aux
gouvernements de nos jours, demandez si la radio nest pas un moyen de
propagande plus efficace encore que le journal ? Sans doute fut-ce
principalement partir de la fin du XIIe sicle, dans des milieux dsormais
plus profondment cultivs, que lon vit les hautes classes se prendre v ivre
Marc BLOCH La socit fodale
106
vritablement leurs lgendes : un chevalier, par exemple, ne pas trouver pour
railler un lche de moquerie plus piquante ni plus claire quune allusion
emprunte un roman courtois ; plus tard tout un groupe de la noblesse
cypriote jouer personnifier les acteurs du cycle de Renard, comme plus prs
de nous, parat-il, certains cercles mondains pour les hros balzaciens (93). Les
gestes franaises, toutefois, taient peine nes que, ds avant 1100, des
seigneurs se plaisaient donner leurs fils les noms dOlivier et de Roland,
en mme temps que, frapp dune marque dinfamie, celui de Ganelon
disparaissait pour jamais de p.156 lonomastique (94). A ces contes, il arrivait
quon se reportt comme dauthentiques documents. Fils dune poque
pourtant dj beaucoup plus livresque, le clbre snchal de Henri II
Plantagent, Renoul de Glanville, quon interrogeait sur les raisons de la
longue faiblesse des rois de France vis--vis des ducs normands, rpondait en
invoquant les guerres qui jadis avaient presque dtruit la chevalerie
franaise : tmoins, disait-il, les rcits de Gormont et de Raoul de
Cambrai (95). Certainement, ctait avant tout dans de tels pomes que ce
grand politique avait appris rflchir sur lhistoire. A vrai dire, la conception
de la vie quexprimaient les gestes ne faisait, beaucoup dgards, que reflter
celle de leur public : dans toute littrature, une socit contemple toujours sa
propre image. Cependant, avec le souvenir, si mutil ft-il, des vnements
anciens, plus dune tradition rellement puise au pass avait filtr, dont,
maintes reprises, nous rencontrerons lempreinte.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
107
CHAPITRE IV
La renaissance intellectuelle au deuxime ge fodal
I. Quelques caractres de la culture nouvelle
Lapparition des grands pomes piques, dans la France du X Ie sicle
peut tre conue comme un des symptmes avant-coureurs par o sannonait
le puissant dveloppement culturel de la priode suivante. Renaissance du
XIIe sicle , dit-on souvent. Toutes rserves faites sur un mot qui, interprt
la lettre, voquerait, au lieu dun changement, une simple rsurrection, la
formule peut tre retenue : condition, cependant, de ne pas lui attacher une
signification chronologique trop prcise. Si le mouvement, en effet, ne prit
toute son ampleur quau cours du sicle dont on lui attribue ordinairement le
nom, ses premires manifestations, comme celles des mtamorphoses
dmographiques et conomiques concomitantes, datent de lpoque vraiment
dcisive que furent les deux ou trois dcennies immdiatement antrieures
lan 1100. A ce moment remontent, pour ne citer que quelques exemples,
luvre philosophique dAnselme de Canterbury, luvre juridique des plus
anciens romanistes italiens et des canonistes, leurs mules, le dbut de leffort
mathmatique dans les coles de Chartres. Pas plus dans lordre de
lintelligence que sur aucun autre terrain, la rvolution ne fut totale. Mais si
voisin que, par sa mentalit, le second ge fodal, beaucoup dgards,
demeure du premier, certains traits intellectuels nouveaux le marquent, dont il
faut chercher prciser laction.
p.157
Les progrs de la vie de relation, si apparents sur la carte conomique,
ne sinscrivent pas en traits moins nets sur la carte culturelle. Labondance des
traductions douvrages grecs et surtout arabes ces derniers, dailleurs,
ntant, pour la plupart, que les truchements de la pense hellnique ,
laction quelles ex ercrent sur la conscience et la philosophie de lOccident
attestent une civilisation dsormais mieux pourvue dantennes. Ce ne fut point
hasard si parmi les traducteurs se rencontrrent plusieurs membres des
colonies marchandes tablies Constantinople. Dans lintrieur mme de
lEurope, les vieilles lgendes celtiques, portes dOuest en Est, viennent
imprgner de leur trange magie limagination des conteurs franais. A leur
tour, les pomes composs en France gestes anciennes ou rcits dun got
plus neuf sont imits en Allemagne, en Italie, en Espagne. Les foyers de la
science nouvelle sont de grandes coles internationales : Bologne, Chartres,
Paris, chelle de Jacob dresse vers le Ciel (96). Lart roman, dans ce
qu au-dessus de ses innombrables varits rgionales il avait eu duniversel,
p.158
Marc BLOCH La socit fodale
108
exprimait avant tout une certaine communaut de civilisation ou linteraction
dune foule de petits nuds dinfluence. Lart gothique, par contre, va donner
lexemple de formes esth tiques dexportation qui, sujettes naturellement
toutes sortes de remaniements, ne sen propagent pas moins partir de centres
de rayonnement bien dtermins : la France dentre Seine et Aisne, les
monastres cisterciens de la Bourgogne.
Labb Guiber t de Nogent qui, n en 1053, crivait vers 1115 ses
Confessions, oppose en ces termes les deux extrmits de sa vie. Dans le
temps qui prcda immdiatement mon enfance et durant celle-ci mme, la
pnurie de matres dcole tait telle quil tait peu prs impossible den
trouver dans les bourgs : peine sil sen rencontrait dans les villes. En
dcouvrait-on par hasard ? Leur science tait si mince quelle ne saurait se
comparer mme celle des petits clercs vagabonds daujourdhui (97). Nul
doute quen effet linstruction, durant le XI Ie sicle, net accompli, en qualit
comme en extension travers les diverses couches sociales, dimmenses
progrs. Plus que jamais, elle se fondait p.159 sur limitation des modles
antiques, non pas davantage vnrs, peut-tre, mais mieux connus, mieux
compris, mieux sentis : au point davoir parfois, chez certains potes en marge
du monde clrical, comme le fameux Archipoeta rhnan, provoqu lclosion
dune sorte de paganisme moral, for t tranger la priode prcdente. Mais le
nouvel humanisme tait plus gnralement un humanisme chrtien. Nous
sommes des nains juchs sur les paules de gants : cette formule de
Bernard de Chartres, souvent rpte, illustre ltendue de la dette q ue les plus
graves esprits de lpoque se reconnaissaient envers la culture classique.
Le souffle nouveau avait atteint les milieux laques. Le cas, dsormais,
nest plus exceptionnel de ce comte de Champagne, Henri le Libral, qui lisait
dans le texte Vgce et Valre Maxime ; de ce comte dAnjou, Geoffroi le
Bel, qui, pour construire une forteresse, saidait de Vgce encore (98). Le plus
souvent, cependant, ces gots se heurtaient aux obstacles dune ducation
encore trop rudimentaire pour pntrer les arcanes douvrages crits dans la
langue de savants. Ils ne renonaient pas pour autant se satisfaire. Voyez
Baudoin II de Guines (mort en 1205). Chasseur, buveur et grand trousseur de
jupons, expert autant quun jongleur en cha nsons de gestes comme en
grossiers fabliaux, ce seigneur picard, pour illettr quil ft, ne se plaisait
pas quaux contes hroques ou gaillards. Il recherchait la conversation des
clercs quil payait de retour en paennes historiettes, trop bien instruit,
au gr dun prtre de son pays, par ces doctes entretiens : la science
thologique quil y avait puise, nen usait -il point pour disputer avec ses
matres ? Mais changer des propos ne lui suffisait point. Il fit traduire en
franais, pour lui tre lus haute voix, plus dun livre latin : avec le Cantique
des Cantiques, les vangiles et la Vie de Saint Antoine, une grande partie de la
Physique dAristote et la vieille Gographie du romain Solin (99). De ces
besoins nouveaux naquit ainsi, par presque toute lEurope, une littrature en
langue vulgaire, qui, destine aux gens du sicle, ne visait pas seulement les
Marc BLOCH La socit fodale
109
amuser. Peu importe quau dbut elle ait t faite presque exclusivement de
paraphrases. Elle nen ouvrait pas moins largement p.160 laccs de toute une
tradition. Celui, entre autres, dun pass peint de moins fictives couleurs.
Longtemps, vrai dire, les rcits historiques en langues nationales
demeurrent fidles au vtement prosodique et au ton des vieilles gestes. Pour
les voir consentir la prose, instrument naturel dune littrature de faits, il
faudra attendre, dans les premires dcennies du XIIIe sicle, lapparition,
tantt de mmoires composs par des personnages trangers au monde des
jongleurs comme celui des clercs un haut baron, Villehardouin, un
modeste chevalier, Robert de Clary , tantt de compilations expressment
destines renseigner un vaste public : les Faits des Romains, la somme qui,
sans fausse honte, sintitulait Tote lhistoire de France, la Chronique
Universelle saxonne. A peu prs autant dannes scouleront avant quen
France, puis dans les Pays-Bas et en Allemagne, quelques chartes, encore bien
rares, rdiges dans le langage de tous les jours, permettent enfin aux hommes
qui participaient un contrat den connatre directement la teneur. Entre
laction et son expression, labme se comblait lentement.
En mme temps, dans les cours lettres qui se groupaient autour des
grands chefs Plantagents de lempire angevin, co mtes de Champagne,
Welfs dAllemagne , toute une littrature de fables et de rves tissait ses
prestiges. Certes, plus ou moins remanies au got du jour et foisonnantes
dpisodes rajouts, les chansons de geste navaient pas cess de plaire. A
mesure, cependant, que la vritable histoire, peu peu, prenait, dans la
mmoire collective, la place de lpope, des formes potiques nouvelles
avaient jailli, provenales ou franaises par leur origine et, de l, bientt
rpandues dans lEurope entire. Ctaie nt des romans de pure fiction o les
prodigieux coups dpe, les grans borroflemens , toujours aims dune
socit demeure foncirement guerrire, avaient dornavant pour arrire-plan
familier un univers travers de mystrieux enchantements : par lab sence de
toutes prtentions historiques, comme par cette fuite vers le monde des fes,
expressions dun ge dsormais assez raffin pour sparer de la description du
rel la pure vasion littraire. Ctaient aussi de p.161 courts pomes lyriques,
dune an ciennet presque gale, par leurs premiers exemples, celle des
chants hroques eux-mmes, mais composs en nombre de plus en plus grand
et avec de plus en plus subtiles recherches. Car, un sens esthtique plus
aiguis attachait une valeur croissante aux trouvailles, voire aux prciosits de
la forme ; il est bien de ce temps le vers savoureux o, voquant le souvenir
de Chrtien de Troyes, en qui notre XIIe sicle reconnut son plus sduisant
conteur, un de ses mules ne savait trouver, pour le louer, de plus bel loge
que celui-ci : il prenait le franais pleines mains .
Surtout romans et pomes lyriques ne se bornent plus retracer des actes ;
ils sefforcent, non sans gaucherie, mais avec beaucoup dapplication,
analyser les sentiments. Jusque dans les pisodes guerriers, la joute de deux
combattants prend le pas sur les grands chocs darmes, chers aux anciens
Marc BLOCH La socit fodale
110
chants. De toutes faons, la nouvelle littrature tendait rintgrer lindividuel
et invitait les auditeurs mditer sur leur moi. Dans ce penchant vers
lintrospection, elle collaborait avec une influence dordre religieux : la
pratique de la confession auriculaire , de fidle prtre, qui, longtemps
renferme dans le monde monastique, se propagea, au cours du XIIe sicle,
chez les laques. Par bien des traits, lhomme des environs de lan 1200, dans
les classes suprieures de la socit, ressemble son anctre des gnrations
prcdentes : mme esprit de violence, mmes brusques sautes dhumeur,
mme proccupation du surnaturel, encore accrue peut-tre, quant
lobsession des prsences diaboliques par le dualisme que, jusque dans les
milieux orthodoxes, rpandait le voisinage des hrsies manichennes, alors si
prospres. Sur deux points pourtant, il en diffre profondment. Il est plus
instruit. Il est plus conscient.
II. La prise de conscience
Aussi bien cette prise de conscience dpassait-elle lhomme isol pour
stendre la socit elle -mme. Le branle ici avait t donn, dans la seconde
moiti du XIe sicle, par le p.162 grand rveil , religieux que, du nom du
pape Grgoire VII, qui en fut un des principaux acteurs, on a pris lhabitude
de nommer rforme grgorienne. Mouvement complexe, sil en fut, o aux
aspirations de clercs et surtout de moines, instruits dans les vieux textes, se
mlrent beaucoup de reprsentations jaillies du trfonds de lme populaire :
lide que le prtre dont la chair a t souille par lacte sexuel devient
incapable de clbrer efficacement les divins mystres, ce fut, autant que chez
les asctes du monachisme et beaucoup plus chez les thologiens, dans les
foules laques quelle trouvera ses plus virulents adeptes. Mouvement
extraordinairement puissant aussi, do il est permis, sans exagration, de
dater la formation dfinitive du catholicisme latin, alors prcisment, et non
par leffet dune concidence fortuite, dtach pour jamais du christianisme
oriental. Si varies quaient t les manifestations de cet esprit, plus nouveau
quil ne le savait lui -mme, lessence sen peut rsumer en quelques mots :
dans un monde o jusque-l on avait vu le sacr et le profane se mlanger
presque inextricablement, leffort grgorien tendit affirmer loriginalit
comme la suprmatie de la mission spirituelle dont lglise est dpositaire,
mettre le prtre part et au-dessus du simple fidle.
Assurment les plus rigoristes, parmi les rformateurs, ntaient gure des
amis de lintelligence. Ils se mfiaient de la philosophie. Ils mprisaient la
rhtorique, non sans succomber eux-mmes, assez souvent, ses prestiges
ma grammaire est le Christ , disait Pierre Damien, qui pourtant dclinait et
conjuguait fort correctement . Ils estimaient que le religieux tait fait pour
pleurer, plutt que pour ltude. En un mot, dans le grand drame de
conscience dont, depuis saint Jrme, avait t dchir plus dun cur
Marc BLOCH La socit fodale
111
chrtien, divis entre ladmiration de la pense ou de lart antiques et les
jalouses exigences dune religion dasctisme, ils se rangeaient rsolument du
parti des intransigeants, qui, loin de respecter, comme Ablard, dans les
philosophes du paganisme des hommes inspirs de Dieu , ne voulaient,
lexemple de Gerhoh de Reichersberg, voir en eux que des ennemis de la
croix du Christ . Mais, dans leur tentative p.163 de redressement, puis au cours
des combats que leur programme leur imposa de livrer contre les puissances
temporelles et notamment contre lEmpire, force leur fut de mettre en forme
intellectuelle leurs idaux, de raisonner, dinviter au raisonnement.
Brusquement des problmes qui, jusque-l, navaient t agits que par une
poigne de doctes prirent une valeur trs actuelle. Ne lisait-on pas, nous
dit-on, en Allemagne, ou du moins ne se faisait-on pas traduire, jusque sur les
places publiques et dans les choppes, les crits o des clercs, tout chauds
encore de la mle, dissertaient, en sens divers, des fins de ltat, des droits
des rois, de leurs peuples ou des papes (100) ? Les autres pays navaient pas t
touchs au mme degr. Nulle part, cependant, ces polmiques ne restrent
sans effet. Plus quavant, on considra dsormais les affaires humaines
comme sujettes la rflexion.
Une autre influence encore aida cette dcisive mtamorphose. Le
renouveau du droit savant, qui sera tudi plus loin, atteignait, en ce temps o
tout homme daction devait tre un peu juriste, des cercles tendus ; il amenait
lui aussi voir dans les ralits sociales quelque chose qui pouvait tre dcrit
mthodiquement et sciemment labor. Mais, sans doute, les effets les plus
certains de la nouvelle ducation juridique doivent-ils tre cherchs dans une
autre direction. Avant tout, quelle que ft la matire du raisonnement, elle
habituait les esprits raisonner en forme. Par l elle rejoignait les progrs de
la spculation philosophique, qui lui sont dailleurs troitement lis. Certes,
leffort logique dun saint Anselme, dun Ablard, dun Pierre Lombard ne
pouvait tre suivi que par un petit nombre dhommes, recruts presque
exclusivement parmi les clercs. Mais ces clercs mmes taient souvent mls
la vie la plus active : ancien lve des coles de Paris, Reinald de Dassel,
chancelier de lEmpire, puis archevque de Cologne, dirigea pendant de
longues annes la politique allemande ; prlat philosophe, tienne Langton
prit, sous Jean sans Terre, la tte du baronat anglais rvolt. Aussi bien, pour
subir lambiance dune pense, fut -il jamais ncessaire de participer ses plus
hautes crations ? Mettez cte cte p.164 deux chartes, lune des alentours de
lan mil le, lautre des dernires annes du XI Ie sicle : presque toujours la
seconde est plus explicite, plus prcise, moins mal ordonne. Non quau XI Ie
sicle mme, des contrastes fort sensibles ne subsistent entre les documents,
selon les milieux do ils tai ent issus : dictes par les bourgeoisies, plus
avises quinstruites, les chartes urbaines sont, lordinaire, pour le bon ordre
de leur rdaction, bien au-dessous, par exemple, des beaux tablissements
mans de la chancellerie savante dun Barberousse. Entre les deux poques,
lopposition, vue de haut, nen demeure pas moins trs nette. Or, lexpression,
Marc BLOCH La socit fodale
112
ici, tait insparable de son contenu. Que vers la fin du second ge fodal, les
hommes daction aient communment dispos dun instrument danalyse
mentale moins quautrefois malhabile, dans lhistoire, encore si mystrieuse,
des liens entre la rflexion et la pratique comment tenir ce fait pour
indiffrent ?
CHAPITRE V
Les fondements du droit
I. Lempire de la coutume
Un juge, dans lEurope pr -fodale du dbut du IXe sicle, avait-il
dire le droit ? Son premier devoir tait dinterroger les textes : compilations
romaines, si le procs devait tre tranch daprs les lois de Rome ; coutumes
des peuples germains, peu peu, dans leur quasi-totalit, fixes par lcriture ;
dits lgislatifs enfin, quavaient rendus en grand nombre les souverains des
royaumes barbares. L o parlaient ces monuments, il ny avait qu obir.
Mais la tche ne soffrait pas toujours aussi simple. Laissons mme le ca s, en
pratique sans doute assez frquent, o le manuscrit, soit se trouvant manquer,
soit comme les lourds recueils romains semblant de consultation
malaise, la disposition, bien quelle et son origine dans le livre, ntait en
fait connue que par l usage. Le plus grave tait quaucun livre ne suffisait
tout trancher. Des fractions entires de la vie sociale les relations
lintrieur de la seigneurie, les liens dhomme homme, o dj se prfigurait
la fodalit ntaient que bien imparfaitem ent rgles par les textes, voire
ne ltaient pas du tout. Ainsi, ct du droit crit, existait dj une zone de
tradition purement orale. Un des caractres les plus importants de la priode
qui suivit de lge, en dautres termes, o se constitua vr itablement le
rgime fodal fut que cette marge p.166 saccrut dmesurment, au point,
dans certains pays, denvahir le domaine juridique tout entier.
p.165
En Allemagne et en France, lvolution atteignit ses limites extrmes. Plus
de lgislation : en France le dernier capitulaire , fort peu original dailleurs,
est de 884 ; en Allemagne, la source semble stre tarie ds le dmembrement
de lEmpire, aprs Louis le Pieux. A peine si quelques princes territoriaux
un duc de Normandie, un duc de Bavire promulguent et l une ou deux
mesures dune porte un peu gnrale. Dans cette carence, on a parfois cru
reconnatre un effet de la faiblesse o tait tomb le pouvoir monarchique.
Mais lexplication quon pourrait tre tent dadmettre, sil ne sagissa it que
de la France, ne saurait videmment valoir pour les souverains beaucoup plus
puissants de lAllemagne. Aussi bien ces empereurs saxons ou saliens qui, au
Marc BLOCH La socit fodale
113
nord des Alpes, ne traitaient jamais dans leurs diplmes que de cas
individuels, ne les voyait-on pas se faire lgislateurs dans leurs tats dItalie,
o pourtant ils ne disposaient certes point dune force suprieure ? Si, au-del
des Monts, on nprouvait plus le besoin de rien ajouter aux rgles nagure
expressment formules, la vritable raison en tait que ces rgles mmes
avaient gliss loubli. Au cours du Xe sicle, les lois barbares comme les
ordonnances carolingiennes cessent peu peu dtre transcrites ou
mentionnes, autrement que par de fugitives allusions. Un notaire affecte-t-il
de citer encore les lois romaines ? la rfrence, les trois quarts du temps, nest
que banalit ou contresens. Comment nen et -il pas t ainsi ? Entendre le
latin langue commune, sur le continent, de tous les anciens documents
juridiques tait, peu de chose prs, le monopole des clercs. Or la socit
ecclsiastique stait donn son droit propre, de plus en plus exclusif. Fond
sur les textes si bien que les seuls capitulaires francs qui continuassent
dtre comments taient ceux qui concernaient l glise ce droit canon
senseignait dans les coles, toutes clricales. Le droit profane, au contraire,
ntait nulle part matire dinstruction. Sans doute la familiarit avec les vieux
recueils ne se ft-elle nanmoins pas compltement perdue, sil p.167 avait
exist une profession dhommes de loi. Mais la procdure ne comportait point
davocats et tout chef tait juge. Cest dire que la plupart des juges ne savaient
pas lire : mauvaise condition assurment pour le maintien dun droit crit.
Les rapports troits qui unissent ainsi, en France et en Allemagne, la
dcadence des anciens droits avec celle de linstruction, chez les laques,
ressortent dailleurs, avec clart, de quelques expriences de sens inverse. En
Italie, la liaison a t admirablement perue, ds le XIe sicle, par un
observateur tranger, le chapelain imprial Wipo ; dans ce pays o, dit-il, la
jeunesse tout entire entendez celle des classes dirigeantes tait
envoye aux coles pour y travailler la sueur des fronts (101), ni les lois
barbares, ni les capitulaires carolingiens, ni le droit romain ne cessrent dtre
tudis, rsums, glosss. De mme, une srie dactes, clairsems sans doute,
mais dont la continuit est visible, y attestent la persistance de lhabitude
lgislative. Dans lAngleterre anglo -saxonne, o la langue des lois tait celle
de tout le monde, o, par suite, comme le dcrit le biographe du roi Alfred, les
juges mmes qui ne savaient pas leurs lettres pouvaient se faire lire les
manuscrits et les comprendre (102) les princes, jusqu Knut, semployrent
tour tour codifier les coutumes ou les complter, voire les modifier
expressment par leurs dits. Aprs la conqute normande, il sembla
ncessaire de mettre la porte des vainqueurs ou, du moins, de leurs clercs la
substance de ces textes, dont le langage leur tait inintelligible. Si bien quon
vit alors se dvelopper dans lle, ds le dbut du XI Ie sicle, cette chose
inconnue, au mme moment, de lautre ct de la Manche : une littrature
juridique, qui, latine par lexpression, tait anglo -saxonne par lessentiel de
ses sources (103).
Marc BLOCH La socit fodale
114
Cependant, si considrable que ft la diffrence qui se marquait ainsi entre
les divers secteurs de lEurope fodale, elle natteignait point le fond mme du
dveloppement. L o le droit avait cess de se fonder sur lcrit, beaucoup de
rgles anciennes, de diverses provenances, avaient nanmoins t conserves
par transmission orale. p.168 Inversement, dans les contres qui continuaient de
connatre et de respecter les vieux textes, les besoins sociaux avaient fait
surgir, leur ct, tantt les compltant, tantt les supplantant, un grand
nombre dusages nouveaux. Partout, en un mo t, une mme autorit dcidait
finalement du sort rserv au patrimoine juridique de lge prcdent : la
coutume, alors la seule source vivante du droit et que les princes, lors mme
quils lgifraient, ne prtendaient gure quinterprter.
Les progrs de ce droit coutumier staient accompagns dun profond
remaniement de la structure juridique. Dans les provinces continentales de
lancienne Romania, occupe par les barbares, plus tard dans la Germanie,
conquise par les Francs, la prsence, coude coude, dhommes qui
appartenaient par leur naissance des peuples distincts avait dabord entran
la plus singulire bigarrure dont puisse, dans ses cauchemars, rver un
professeur de droit. En principe et toutes rserves faites sur les difficults
dapplicat ion qui ne manquaient pas de surgir entre deux plaideurs dorigine
oppose, lindividu, o quil habitt, demeurait soumis aux rgles qui avaient
gouvern ses anctres : si bien que, selon le mot clbre dun archevque de
Lyon, lorsque dans la Gaule franque, cinq personnages se trouvaient runis,
point navait -on lieu de stonner si Romain par exemple, Franc salien,
Franc ripuaire, Visigoth et Burgonde chacun deux obissait une loi
diffrente. Que, impos jadis par dimprieuses ncessits, un pare il rgime
ft devenu affreusement gnant, quil saccordt dailleurs de plus en plus mal
aux conditions dune socit o la fusion des lments ethniques tait peu
prs accomplie, aucun observateur rflchi, ds le IXe sicle, ne pouvait en
douter. Les Anglo-Saxons, qui navaient gure eu compter avec les
populations indignes, lavaient toujours ignor. La monarchie visigothique
lavait, ds 654 , consciemment limin. Mais tant que les droits particuliers
taient fixs par lcrit, leur force de rsis tance restait grande. Il est significatif
que le pays o lon vit se maintenir le plus longtemps jusquau seuil du
XIIe sicle cette multiplicit dobdiences juridiques p.169 fut la savante
Italie. Encore ntait -ce quau prix dune trange dformatio n. Car, les
filiations apparaissant de moins en moins faciles dterminer, lhabitude
sintroduisit de faire spcifier par chaque personne, au moment o elle prenait
part un acte, la loi dont elle se reconnaissait sujette et qui parfois variait
ainsi, au gr du contractant, selon la nature de laffaire. Dans le reste du
continent, loubli o, ds le Xe sicle, tombrent les textes de lge prcdent,
permit lavnement dun ordre tout nouveau. Rgime des coutumes
territoriales, dit-on quelquefois. Mieux vaudrait, sans doute, parler de
coutumes de groupes.
Marc BLOCH La socit fodale
115
Chaque collectivit humaine, en effet, grande ou menue, inscrite ou non
sur le sol en contours prcis, tend dvelopper sa tradition juridique propre :
si bien quon voit lhomme, selon les divers aspe cts de son activit, passer
successivement de lune lautre de ces zones de droit. Voici par exemple une
agglomration rurale. Le statut familial des paysans suit, ordinairement, des
normes peu prs semblables dans toute la contre environnante. Leur droit
agraire obit, par contre, aux usages particuliers leur communaut. Parmi les
charges qui psent sur eux, les unes, quils subissent en tant que tenanciers,
sont fixes par la coutume de la seigneurie, dont les limites sont loin de
concider toujours avec celles du terroir villageois ; dautres qui, sils sont de
condition servile, atteignent leurs personnes, se rglent sur la loi du groupe,
gnralement plus restreint, que composent les serfs du mme matre, habitant
le mme lieu. Le tout, cela va de soi, sans prjudice de divers contrats ou
prcdents, tantt strictement personnels, tantt capables de transmettre leurs
effets de pre en fils, tout le long dune ligne familiale. L mme o, dans
deux petites socits voisines et de contexture analogue, les systmes
coutumiers staient originellement constitus selon des lignes en gros
pareilles, il tait fatal que, ntant point cristalliss par lcriture, on les vt
progressivement diverger. Devant un pareil morcellement, quel historien ne
sest p arfois senti tent de reprendre son compte les propos dsabuss de
lauteur dun Trait des lois anglaises, rdig la cour de Henri II : mettre
par crit, dans leur universalit, les lois p.170 et droits du royaume serait de nos
jours tout fait impossible... tant est confuse leur foule (104) ?
La diversit, cependant, rsidait surtout dans le dtail et dans lexpression.
Entre les rgles pratiques lintrieur des diffrents groupes, dans une rgion
donne, rgnait ordinairement un grand air de famille. Souvent mme, la
ressemblance stendait plus loin. Tantt propres telle ou telle des socits
europennes, tantt communes lEurope entire, quelques ides collectives,
fortes et simples, dominrent le droit de lre fodale. Et sil est bien vrai que
la varit de leurs applications fut infinie, ce prisme, en dcomposant les
multiples facteurs de lvolution, que fait -il sinon fournir lhistoire un jeu
exceptionnellement riche dexpriences naturelles ?
II. Les caractres du droit coutumier
Foncirement traditionaliste, comme toute la civilisation du temps, le
systme juridique du premier ge fodal reposait donc sur lide que ce qui a
t a par l mme le droit dtre. Non, assurment, sans quelques rserves,
inspires par une morale plus haute. En face dune socit temporelle dont
lhritage tait loin de saccorder tout entier avec leurs idaux, les clercs,
notamment, avaient de bonnes raisons pour refuser de confondre toujours le
juste avec le dj vu. Le roi, dclarait dj Hincmar de Reims, ne jugera point
selon la coutume, si celle-ci se rvle plus cruelle que la rectitude
Marc BLOCH La socit fodale
116
chrtienne . Interprte de lesprit grgorien quanimait, chez les purs, un
souffle vraiment rvolutionnaire, sappropriant, daill eurs, comme un hritage
naturel, un propos de cet autre secoueur de traditions quavait t, en son
temps, le vieux Tertullien, le pape Urbain II crivait, en 1092, au comte de
Flandre Prtends-tu navoir fait jusquici que te conformer lusage trs
antique de la terre ? Tu dois le savoir pourtant, ton Crateur a dit : Mon nom
est Vrit. Il na pas dit : Mon nom est Usage (105). Il pouvait, en
consquence, y avoir de mauvaises coutumes . De fait, les documents de la
pratique prononcent assez souvent ces mots. Mais cest presque toujours pour
stigmatiser ainsi p.171 des rgles dintroduction rcente ou censes telles : ces
dtestables innovations , ces exactions jamais oues , que dnoncent tant
de textes monastiques. Une coutume, en dautres termes, semblait
condamnable surtout lorsquelle tait trop jeune. Quil sagt de la rforme de
lglise ou dun procs entre deux seigneurs voisins, le prestige du pass ne
pouvait gure tre contest quen lui opposant un pas s plus vnrable encore.
Le curieux est que ce droit, aux yeux duquel tout changement paraissait un
mal, loin de demeurer immuable, fut, en fait, un des plus plastiques quon vt
jamais. Faute, avant tout, dtre, dans les documents de la pratique, pas p lus
que sous forme de lois, stabilis par lcriture. La plupart des tribunaux se
contentaient darrts purement oraux. Dsirait -on en reconstituer la teneur ?
on procdait une enqute auprs des juges, sils vivaient encore. Dans les
contrats, les volonts se nouaient essentiellement au moyen de gestes et
parfois de mots consacrs, de tout un formalisme, en un mot, trs propre
frapper des imaginations peu sensibles labstrait. Voyait -on, en Italie, par
exception, lcrit jouer un rle dans lchange des accords. Ctait, lui -mme,
titre dlment du rituel : pour signifier la cession dune terre, on se passait
de mains en mains la charte, comme on et fait ailleurs dune motte ou dun
ftu. Au nord des Alpes, le parchemin, si daventure il intervena it, ne servait
gure que de mmento : dpourvue de toute valeur authentique, cette
notice avait pour principal objet denregistrer une liste de tmoins. Car
tout, en dernire analyse, reposait sur le tmoignage mme si lon avait us
de lencre noi re , plus forte raison dans les cas, certainement plus
nombreux, o lon sen tait dispens. Comme le souvenir promettait
videmment dtre dautant plus durable que ses porteurs devaient rester plus
longtemps sur cette terre, les contractants, souvent, amenaient avec eux des
enfants. Craignait-on ltourderie de cet ge ? Divers procds permettaient de
la prvenir par une opportune association dimages : une gifle, un menu
cadeau, voire un bain forc.
Quil sagit de transactions particulires ou des rgles gnrales de
lusage, la tradition navait donc gure dautres p.172 garants que la mmoire.
Or la mmoire humaine, la coulante, lescoulourjante mmoire, selon le
mot de Beaumanoir, est un merveilleux outil dlimination et de
transformation : surtout ce que nous appelons mmoire collective et qui,
ntant, au vrai, quune transmission de gnration gnration, ajoute, si elle
Marc BLOCH La socit fodale
117
est prive de lcrit, aux erreurs de lenregistrement par chaque cerveau
individuel, les malentendus de la parole. Passe encore, sil avait exist, dans
lEurope fodale, une de ces castes de professionnels mainteneurs des
souvenirs juridiques, comme dautres civilisations, chez les Scandinaves par
exemple, en ont connues. Mais, dans lEurope fodale et parmi les laque s, la
plupart des hommes qui avaient dire le droit ne le faisaient gure que par
occasion. Nayant pas subi dentranement mthodique, ils en taient rduits,
le plus souvent, comme sen plaignait lun deux, suivre leurs possibilits
ou leurs fantaisies (106). La jurisprudence, en un mot, exprimait moins une
connaissance que des besoins. Parce quil ne disposait, dans son effort pour
imiter le pass, que de miroirs infidles, le premier ge fodal changea trs
vite et trs profondment, en croyant durer.
En un sens, dailleurs, lautorit mme que lon reconnaissait la tradition
favorisait le changement. Car tout acte, une fois accompli ou, mieux, trois ou
quatre fois rpt, risquait de se muer en prcdent : mme sil a vait t,
lorigine, exceptionnel, voire franchement abusif. Les moines de Saint -Denis,
ds le Xe sicle, ont-ils t pris, un jour o le vin manquait dans les celliers
royaux, Ver, dy faire porter deux cents muids ? Cette prestation dsormais
leur sera rclame, titre obligatoire, tous les ans et il faudra, pour labolir, un
diplme imprial. Il y avait une fois, nous dit-on, Ardres, un ours, amen par
le seigneur du lieu. Les habitants, qui se plaisaient le voir combattre contre
des chiens, s offrirent le nourrir. Puis la bte mourut. Mais le seigneur
continua dexiger les pains (107). Lauthenticit de lanecdote est peut -tre
contestable ; sa valeur symbolique, en revanche, hors de doute. Beaucoup de
redevances naquirent ainsi de dons bnvoles et longtemps en conservrent le
nom. Inversement, une rente qui cessait dtre paye durant p.173 un certain
nombre dannes, un rite de soumission qui cessait dtre renouvel se
perdaient, presque fatalement, par prescription. Si bien que lhabitude
sintroduisit dtablir, en nombre croissant, ces curieux documents que les
diplomatistes nomment chartes de non prjudice . Un baron, un vque
demandent le gte un abb ; un roi, press dargent, fait appel la gnrosit
dun sujet. Daccord, rpond le personnage ainsi sollicit. A une condition,
toutefois quil soit spcifi, noir sur blanc, que ma complaisance ne crera
point, mes dpens, un droit. Ces prcautions, cependant, qui ntaient gure
permises qu des ho mmes dun rang un peu relev, navaient quelque
efficacit que lorsque la balance des forces ntait pas trop ingale. Une des
consquences de la conception coutumire fut, trop souvent, de lgitimer la
brutalit et, en la rendant profitable, den rpandre lemploi. Ntait -il pas
dusage, en Catalogne, lorsquune terre tait aline, de stipuler, en une
formule singulirement cynique, quelle tait cde avec tous les avantages
dont son possesseur avait eu la jouissance, gracieusement ou par
violence (108) ?
Ce respect du fait anciennement accompli agit avec une force particulire
sur le systme des droits rels. Il est, durant lre fodale tout entire, fort rare
Marc BLOCH La socit fodale
118
que lon parle de la proprit, soit dune terre, soit dun po uvoir de
commandement ; beaucoup plus rare encore si mme, hors de lItalie, le cas se
rencontre jamais quun procs roule sur cette proprit. Ce que revendiquent
les parties est, presque uniformment, la saisine (en allemand Gewere). Au
XIIIe sicle, mme le Parlement des rois captiens, docile aux influences
romaines, a beau prendre soin, dans tout arrt sur la saisine, de rserver le
ptitoire , cest --dire le dbat sur la proprit ; on ne voit point, quen fait,
la procdure ainsi prvue se soit jamais engage. Qutait -ce donc que cette
fameuse saisine ? Non pas, prcisment, une possession, quet suffi crer la
simple apprhension du sol ou du droit. Mais une possession rendue vnrable
par la dure. Deux plaideurs se disputent-ils un champ ou une justice ? Quel
que soit le dtenteur actuel, celui-l lemportera qui pourra prouver avoir
labour ou jug pendant les p.174 annes prcdentes ou, mieux encore,
dmontrera que ses pres lont fait comme lui, avant lui. Pour cela, dans la
mesure o lon ne sen remet pas aux ordalies ou au duel judiciaire, il
invoquera gnralement la mmoire des hommes, aussi loin quelle
stend . Produit-il des titres ? Ils ne sont gure l que pour aider au souvenir
ou sils attestent une transmission, cest dj celle dune saisine. Une fois la
preuve du long usage ainsi apporte, personne nestime quil soit utile de rien
justifier dautre.
Aussi bien, pour dautres raisons encore, le mot de proprit, appliqu un
immeuble, et-il t peu prs vide de sens. Ou du moins aurait-il fallu dire
comme on le fera volontiers plus tard, lorsquon disposera dun
vocabulaire juridique mieux labor proprit ou saisine de tel ou tel droit
sur le fonds. Sur presque toute terre, en effet, et sur beaucoup dhomme s,
pesaient, en ce temps, une multiplicit de droits, divers par leur nature, mais
dont chacun, dans sa sphre, paraissait galement respectable. Aucun ne
prsentait cette rigide exclusivit, caractristique de la proprit, du type
romain. Le tenancier qui de pre en fils gnralement laboure et
rcolte ; son seigneur direct, auquel il paie redevances et qui, en certains cas,
saura remettre la main sur la glbe ; le seigneur de ce seigneur et ainsi de
suite, tout le long de lchelle fodale : que de personnages qui, avec autant de
raison lun que lautre, peuvent dire mon champ ! Encore est-ce compter
trop peu. Car les ramifications stendaient horizontalement aussi bien que de
haut en bas et il conviendrait de faire place aussi la communaut villageoise,
qui ordinairement rcupre lusage de son terroir entier, aussitt celui -ci vide
de moissons ; la famille du tenancier, sans lassentiment de laquelle le bien
ne saurait tre alin ; aux familles des seigneurs successifs. Cet
enchevtrement hirarchis des liens entre lhomme et le sol sautorisait sans
doute dorigines trs lointaines. Dans une grande partie de la Romania
elle-mme, la proprit quiritaire avait-elle t autre chose quune faade ? Le
systme, cependant, spanouit aux temps fodaux avec une incomparable
vigueur. Une pareille compntration des saisines sur une mme chose
navait rien pour heurter des esprits p.175 assez peu sensibles la logique de la
Marc BLOCH La socit fodale
119
contradiction et, peut-tre, pour dfinir cet tat de droit et dopini on, le mieux
serait-il, empruntant la sociologie une formule clbre, de dire : mentalit de
participation juridique.
III. Le renouveau des droits crits
Ltude du droit romain navait, on la vu, jamais cess dtre pratique
dans les coles de lItalie. Mais, vers la fin du X Ie sicle, ce sont dsormais, au
tmoignage dun moine marseillais, de vritables foules quon voit se
presser aux leons donnes par des quipes de matres elles-mmes plus
nombreuses et mieux organises (109) ; Bologne surtout, quillustra le grand
Irnerius, flambeau du droit . Simultanment, la matire de lenseignement
subit de profondes transformations. Nagure trop souvent ngliges au profit
de mdiocres abrgs, les sources originales reprennent le premier rang ; le
Digeste, en particulier, qui tait presque tomb dans loubli, ouvre dornavant
laccs de la rflexion juridique latine, dans ce quelle avait de plus raffin.
Rien de plus apparent que les liens de ce renouveau avec les autres
mouvements intellectuels de lpoque. La crise de la rforme grgorienne
avait suscit, dans tous les partis, un effort de spculation juridique autant que
politique ; ce ne fut point hasard si la composition des grands recueils
canoniques quelle i nspira directement se trouva exactement contemporaine
des premiers travaux de lcole bolonaise. Dans ceux -ci, par ailleurs,
comment ne pas reconnatre les marques la fois de ce retour vers lAntique
et de ce got de lanalyse logique qui allaient span ouir dans la nouvelle
littrature en langue latine, comme dans la philosophie renaissante ?
Des besoins analogues staient, peu prs vers le mme moment, fait
jour dans le reste de lEurope. L aussi, notamment, les hauts barons
commenaient prouver le dsir de saider de lavis de juristes
professionnels : partir de 1096 environ, on voit apparatre, parmi les jugeurs
dont se compose la cour du comte de Blois, des personnages qui, non sans
orgueil, sintitulent doctes dans les lois (110). p.176 Peut-tre avaient-ils puis
leur instruction dans quelques-uns des textes de droit antique que conservaient
encore les bibliothques monacales doutre -monts. Mais ces lments taient
trop pauvres pour fournir eux seuls la matire dune renaissance indigne.
Limpulsion vint dItalie. Favorise par une vie de relations plus quautrefois
intense, laction du groupe bolonais se propagea par son enseignement, ouvert
aux auditeurs trangers, par lcrit, par lmigration enfin de pl usieurs de ses
matres. Souverain du royaume italien comme de la Germanie, Frdric
Barberousse accueillit, dans sa suite, durant ses expditions italiennes, des
lgistes lombards. Un ancien lve de Bologne, Placentin, stablit, peu aprs
1160, Montpellier ; un autre, Vaccarius, avait t appel, quelques annes
auparavant, Canterbury. Partout, au cours du XIIe sicle, le droit romain
Marc BLOCH La socit fodale
120
pntra dans les coles. Il senseignait, par exemple, vers 1170, cte cte
avec le droit canon, lombre de la cat hdrale de Sens (111).
Ce ne fut pas, la vrit, sans soulever de vives inimitis. Foncirement
sculier, il inquitait, par son paganisme latent, beaucoup dhommes dglise.
Les gardiens de la vertu monastique laccusaient de dtourner les religieux de
la prire. Les thologiens lui reprochaient de supplanter les seules
spculations qui leur parussent dignes des clercs. Les rois de France
eux-mmes ou leurs conseillers, au moins depuis Philippe-Auguste, semblent
avoir pris ombrage des justifications quil fournissait trop aisment aux
thoriciens de lhgmonie impriale. Loin cependant de russir enrayer le
mouvement, ces anathmes ne firent gure quen attester la puissance.
Dans la France du Midi, o la tradition coutumire avait conserv
fortement lempreinte romaine, les efforts des juristes, en permettant
dsormais le recours aux textes originaux, aboutirent lever le droit crit
au rang dune sorte de droit commun, qui sappliquait dfaut dusages
expressment contraires. De mme en Provence, o, ds le milieu du XIIe
sicle, la connaissance du Code Justinien paraissait si importante aux laques
eux-mmes quon prit soin de leur en fournir un rsum en langue vulgaire.
Ailleurs p.177 laction fut moins directe. A ussi bien, l mme o elle rencontrait
un terrain particulirement favorable, les rgles ancestrales taient trop
solidement enracines dans la mmoire des hommes , trop troitement lies
par ailleurs tout un systme de structure sociale, fort diffrent de celui de
lancienne Rome, pour souffrir dtre bouleverses par la seule volont de
quelques professeurs s lois. Certes, en tous lieux, lhostilit dsormais
tmoigne aux vieux modes de preuve, notamment au duel judiciaire,
llaboration, dans le d roit public, de la notion de lse-majest durent quelque
chose aux exemples du Corpus juris et de la glose. Encore limitation de
lAntique tait -elle, en lespce, puissamment aide par de tout autres
influences : lhorreur de lglise pour le sang, comme pour toute pratique qui
pouvait sembler destine tenter Dieu ; lattrait, auprs des marchands
surtout, de procdures plus commodes et plus rationnelles ; le renouveau du
prestige monarchique. Si lon voit, aux XI Ie et XIIIe sicles, certains notaires
peiner exprimer, dans le vocabulaire des Codes, les ralits de leur temps,
ces gauches tentatives ne touchaient gure au fond des relations humaines. Ce
fut par un autre biais que le droit savant agit alors vritablement sur le droit
vivant : en lui enseignant prendre une conscience plus claire de lui-mme.
Face face, en effet, avec les prceptes purement traditionnels qui avaient
jusque-l, tant bien que mal, gouvern la socit, lattitude dhommes forms
lcole du droit romain devait tre n cessairement de travailler en effacer
les contradictions et les incertitudes. Comme il est dans la nature de pareils
tats mentaux de faire tache dhuile, ces tendances, dailleurs, ne tardrent pas
dpasser les cercles relativement troits qui avaient une familiarit directe
avec les merveilleux instruments danalyse intellectuelle lgus par la doctrine
antique. Aussi bien saccordaient -elles, ici encore, avec plus dun courant
Marc BLOCH La socit fodale
121
spontan. Une civilisation moins ignorante avait soif de lcrit. Des
collectivits plus fortes avant tout, les groupes urbains rclamaient la
fixation de rgles dont le caractre flottant avait prt tant dabus. Le
regroupement des lments sociaux en grands tats ou en grandes
principauts favorisait non seulement p.178 la renaissance de la lgislation, mais
encore, sur de vastes territoires, lextension dune jurisprudence unificatrice.
Ce ntait pas sans raison qu la dcourageante multiplicit des usages
locaux, lauteur du Trait des lois anglaises, dans la suite du passage qui a t
cit plus haut, opposait la pratique, beaucoup mieux ordonne, de la cour
royale. Dans le royaume captien, il est caractristique quaux alentours de
lan 1200 on voit surgir, cte cte avec la vieille mention de la coutume du
lieu, au sens le plus troit, les noms daires coutumires plus amples ; France
autour de Paris, Normandie, Champagne. Par tous ces signes, une uvre de
cristallisation se prparait, dont le XIIe sicle finissant devait connatre, sinon
laccomplissement, du mo ins les prodromes.
En Italie, depuis la charte de Pise, en 1132, les statuts urbains vont se
multipliant. Au nord des Alpes, les actes de franchises octroys aux
bourgeoisies tendent de plus en plus se muer en exposs dtaills des
coutumes. Henri II, roi juriste savant dans ltablissement et la correction
des lois, subtil inventeur de jugements inusits (112), dploie, en Angleterre,
une activit lgislatrice dbordante. Sous le couvert du mouvement de paix, la
pratique de la lgislation se rintroduit jusquen Allemagne. En France,
Philippe-Auguste, port en toutes choses imiter ses rivaux anglais, rgle, par
ordonnances, diverses matires fodales (113). Enfin des crivains se
rencontrent qui, sans mission officielle et simplement pour la commodit des
praticiens, sappliquent mettre en tableaux les normes juridiques en vigueur
autour deux. Linitiative vint, comme il tait naturel, des milieux habitus, de
longue date, ne pas se contenter dune tradition purement orale : lItalie du
Nord o, vers 1150, un compilateur runit, en une sorte de corpus, les
consultations sur le droit des fiefs quavaient inspires aux juristes de son pays
les lois promulgues, sur ce sujet, par les Empereurs, dans leur royaume
lombard ; lAngleterre, qui vit tablir, vers 1187, dans lentourage du justicier
Renoul de Glanville, le Trait auquel nous avons dj fait plusieurs emprunts.
Puis ce furent, vers 1200, le plus ancien coutumier normand ; vers 1221, le
Miroir des Saxons qui, rdig, en p.179 langue vulgaire (114) par un chevalier,
attestait ainsi doublement les profondes conqutes de lesprit nouveau. Le
travail devait se poursuivre activement durant les gnrations suivantes : si
bien que, pour comprendre une structure sociale imparfaitement dcrite avant
le XIIIe sicle et dont, malgr de graves transformations, beaucoup de traits
subsistaient encore dans lEurope des grandes monarchies, force est de se
reporter souvent, avec toutes les prcautions ncessaires, ces uvres
relativement tardives, mais o se reflte la clart organisatrice propre lge
des cathdrales et des Sommes. Quel historien de la fodalit pourrait
Marc BLOCH La socit fodale
122
renoncer au secours du plus admirable analyste de la socit mdivale, le
chevalier pote et juriste, bailli des rois fils et petit-fils de saint Louis,
lauteur, en 1283, des Coutumes du Beauvaisis : Philippe de Beaumanoir ?
Or un droit qui, dornavant, tait fix, pour partie, par voie lgislative et,
en totalit, senseignait et scrivait, comment net -il pas perdu beaucoup de
sa plasticit, en mme temps que de sa diversit ? Certes, rien ne lempchait,
absolument, de continuer voluer : ce quil fit, en effet, Mais il se modifiait
moins inconsciemment, par suite plus rarement. Car rflchir sur un
changement, cest toujours risquer dy renoncer. A une priode singulirement
mouvante, un ge dobscure et profonde gestation, va donc succder, partir
de la seconde moiti du XIIe sicle, une re o la socit tendra dsormais
organiser les relations humaines avec plus de rigueur, tablir entre les
classes des limites plus nettes, effacer beaucoup de varits locales,
nadmettre enfin que de plus lentes transformations. De cette dcisive
mtamorphose des environs de lan 1200, les vicissitudes de la mentalit
juridique, troitement lies dailleurs aux autres chanes causales, ne furent
assurment pas seules responsables. Nul doute, cependant, quelles ny aient
largement contribu.
Marc BLOCH La socit fodale
DEUXIME PARTIE
Les liens dhomme homme
123
Marc BLOCH La socit fodale
124
LIVRE PREMIER : Les liens du sang
CHAPITRE PREMIER
La solidarit du lignage
I. Les amis charnels
Antrieurs de beaucoup et, par leur essence, trangers aux relations
humaines caractristiques de la fodalit, les liens fonds sur la communaut
du sang continurent de jouer, au sein mme de la structure nouvelle, un rle
trop considrable pour quil soit permis de les exclure de son image. Ltude,
malheureusement, en est difficile. Ce ntait pas sans raison que , dans
lancienne France, on dsignait couramment la communaut familiale des
campagnes sous le nom de communaut taisible . Entendez :
silencieuse . Il est de la nature mme des rapports entre proches de se
passer aisment dcrits. Y avait -on, par exception, recours ? tablies, peu
prs exclusivement, lusage des hautes classes, ces pices, pour la plupart,
ont pri. Du moins, avant le XIIIe sicle. Car, jusqu cette date, les seules
archives peu prs qui nous aient t conserves sont celles des glises. Mais
l nest pas le seul obstacle. Un tableau densemble des institutions fodales
peut tre lgitimement tent parce que, nes au moment mme o se
constituait vritablement une Europe, elles se sont tendues, sans diffrences
fondamentales, au monde europen tout entier. Les institutions de parent, au
contraire, taient, pour chacun des groupes dorigines diverses que leur destin
avait amens vivre cte cte, le legs singulirement tenace de son pass
particulier. Quon veuille bien pa r p.184 exemple comparer la quasi-uniformit
des rgles relatives lhritage du fief militaire avec linfinie varit de celles
qui fixaient la transmission des autres biens. Dans lexpos qui va suivre,
force sera, plus que jamais, de se contenter de mettre laccent sur quelques
grands courants.
p.183
Dans toute lEurope fodale, donc, existent des groupes consanguins. Les
termes qui servent les dsigner sont assez flottants : en France, le plus
ordinairement, parent ou lignage . Par contre, les liens ainsi nous
passent pour tre dune vigueur extrme. Un mot est caractristique. En
Marc BLOCH La socit fodale
125
France, pour parler des proches, on dit communment les amis , tout court,
et en Allemagne Freunde : ses amis , numre au XIe sicle un acte de
lIle -de-France, cest --dire sa mre, ses frres, ses surs et ses autres
proches par le sang ou par lalliance (115). Ce nest que par un souci
dexactitude assez rare que parfois lon prcise : amis charnels . Comme si,
en vrit, il ny avait damiti vritable quentre personnes unies par le sang !
Le hros le mieux servi est celui dont tous les guerriers lui sont joints soit
par la relation nouvelle et proprement fodale de la vassalit, soit par lantique
relation de la parent : deux attaches que lon met couramment sur le mme
plan, parce qugalement astreignantes, elles semblent primer toutes les
autres. Magen und mannen : lallitration , dans lpope allemande, a presque
rang de proverbe. Mais la posie nest pas l -dessus notre seul garant et le
sagace Joinville, au XIIIe sicle encore, sait bien que si la troupe de Guy de
Mauvoisin fit merveille, la Mansourah, ce fut pour avoir t compose
entirement ou dhommes liges du chef ou de chevaliers de son lignage. Le
dvouement atteint lultime ferveur, lorsque les deux solidarits se
confondent ; ainsi quil advint, selon la geste, au duc Bgue, dont les mille
vassaux taient trestous dune parent . Do un baron, quil soit de
Normandie ou de Flandre, tire-t-il, au tmoignage des chroniqueurs, sa
puissance ? de ses chteaux, sans doute, de ses beaux revenus sonnants, du
nombre de ses vassaux, mais aussi de celui de ses parents. Il en va de mme,
plus bas, tout le long de lchelle sociale. Ctaient des marchands que ces
bourgeois p.185 gantois dont un crivain, qui les connaissait bien, disait quils
disposaient de deux grandes forces : leurs tours tours patriciennes, dont
les murs de pierre, dans les villes, jetaient une ombre paisse sur les humbles
maisons de bois du populaire et leurs parents . Ctaient, pour une part
du moins, de simples hommes libres, caractriss par la modeste wergeld de
200 shillings, et probablement des paysans surtout, que les membres de ces
parentles, contre lesquelles, dans la seconde moiti du Xe sicle, les gens de
Londres se dclaraient prts partir en guerre, si elles nous empchent
dexercer nos droits, en se constituant les protectrices des larrons (116).
Traduit devant un tribunal, lhomme tro uvait, dans ses proches, ses aides
naturels. Les cojureurs , dont le serment collectif suffisait laver le
prvenu de toute accusation ou confirmer la plainte dun demandeur, ctait,
l o cette vieille procdure germanique demeurait en usage, parmi les amis
charnels que tantt la rgle et tantt les convenances commandaient de les
prendre : tels, Usagre, en Castille, les quatre parents appels jurer avec la
femme qui se dit victime dun viol (117). Prfrait-on, comme moyen de
preuve, le duel judiciaire ? En principe, expose Beaumanoir, il ne saurait tre
rclam que par une des parties. A deux exceptions prs, cependant : il est
loisible au vassal lige de demander le combat pour son seigneur et tout
homme le peut, si quelquun de son lignage est en cause. Une fois de plus, les
deux relations apparaissent au mme rang. Ainsi voit-on, dans le Roland, la
parentle de Ganelon dlguer un des siens pour entrer en lice contre
Marc BLOCH La socit fodale
126
laccusateur du tratre. Dans la Chanson, dail leurs, la solidarit stend
beaucoup plus loin encore. Aprs la dfaite de leur champion, les trente
lignagers, qui lont cautionn , seront pendus, en grappe, larbre du Bois
Maudit. Exagration de pote, sans nul doute. Lpope tait un verre
grossissant. Mais dont les inventions ne pouvaient esprer rencontrer quelque
complaisance que parce quelles flattaient le sentiment commun. Vers 1200, le
snchal de Normandie, reprsentant dun droit plus volu, avait peine
empcher ses agents de comprendre dans le chtiment, avec le criminel, p.186
toute sa parent (118). Tant lindividu et le groupe semblaient insparables.
Aussi bien quun appui, ce lignage tait, sa faon, un juge. Vers lui, si
nous en croyons les gestes , allait la pense du chevalier, au jour du pril.
A mon secours venez Afin que je ne fasse lchet Qui mon lignage
soit reproche : ainsi Guillaume dOrange, navement, implore Notre
Dame (119) ; et si Roland refuse dappeler son aide larme de Charlemagne,
cest de peur que ses parents, cause de lui, ne soient blms. Lhonneur ou le
dshonneur dun des membres rejaillissait sur la petite collectivit entire.
Cependant, ctait avant tout dans la vendetta que l es liens du sang
manifestaient toute leur force.
II. La vendetta
Le moyen ge, presque dun bout lautre, et particulirement lre
fodale ont vcu sous le signe de la vengeance prive. Celle-ci, bien entendu,
incombait avant tout, comme le plus sacr des devoirs, lindividu ls.
Ft-ce par del le trpas. N dans une de ces bourgeoisies auxquelles leur
indpendance mme, vis--vis des grands tats, permit une longue fidlit aux
points dhonneur traditionnels, un riche Florentin, Velluto di Buonch ristiano,
ayant t bless mort par un de ses ennemis, fit, en 1310, son testament.
Dans cet acte qui, uvre de pit autant que de sage administration, semblait,
en ce temps, destin, avant tout, assurer le salut de lme par de dvotes
libralits, il ne craignit point dinscrire un legs au bnfice de son vengeur,
sil sen trouvait un (120).
Lhomme isol, cependant, ne pouvait que peu de chose. Aussi bien
tait-ce, le plus souvent, une mort quil fallait faire expier. Alo rs entrait en
ligne le groupe familial et lon voyait natre la faide , selon le vieux mot
germanique qui se rpandit peu peu sur toute lEurope : la vengeance des
parents que nous nommons faide , dit un canoniste allemand (121). Nulle
obligation morale ne paraissait plus sacre que celle-l. En Flandre, vers la fin
du XIIe sicle, p.187 vivait une dame noble, dont le mari et les deux fils avaient
t tus par leurs ennemis ; depuis lors, la vendetta troublait le pays
environnant. Un saint homme, lvque de Soissons Arnoul, vint prcher la
rconciliation. Pour ne pas lentendre, la veuve fit hausser le pont -levis. Chez
Marc BLOCH La socit fodale
127
les Frisons, le cadavre mme criait vengeance ; il se desschait, suspendu dans
la maison, jusquau jour o les proches, la faide accomplie, recevaient enfin le
droit densevelir (122). En France, jusque dans les dernires dcennies du XIIIe
sicle, pourquoi le sage Beaumanoir, serviteur de rois entre tous bons gardiens
de la paix, estime-t-il dsirable que chacun sache calculer les degrs de
parent ? Afin, dit-il, que dans les guerres prives, lon puisse requrir laide
de son ami .
Tout le lignage, group lordinaire sous les ordres dun chevetaigne de
la guerre , prenait donc les armes pour punir le meurtre ou seulement linjure
dun des siens. Mais ce ntait pas uniquement contre lauteur mme du tort.
Car la solidarit active rpondait, galement forte, une solidarit passive. La
mort de lassassin ntait point nces saire, en Frise, pour que le cadavre
dsormais apais ft couch dans la tombe ; il suffisait de celle dun membre
de sa famille. Et si, vingt-quatre ans aprs son testament, Velluto, nous dit-on,
trouva enfin, dans un de ses proches, le vengeur souhait, lexpiation, son
tour, porta, non sur le coupable, mais sur un parent. Combien ces
reprsentations furent puissantes et durables, rien ne latteste mieux, sans
doute, quun arrt, relativement tardif, du Parlement de Paris. En 1260, un
chevalier, Louis Defeux, ayant t bless par un certain Thomas dOuzouer,
poursuivit son agresseur devant la Cour. Laccus ne nia point le fait. Mais il
exposa que lui-mme avait t attaqu, quelque temps auparavant, par un
neveu de sa victime. Que lui reprochait-on ? N avait-il pas, conformment aux
ordonnances royales, attendu quarante jours avant dexcuter sa vengeance ?
Ctait le temps quon estimait ncessaire afin que les lignages fussent
dment avertis du danger . Daccord, rpliqua le chevalier ; mais ce qua
fait mon neveu ne me concerne point. Largument ne valait rien ; lacte dun
individu engageait toute sa parent. Ainsi en dcidrent, du moins, p.188 les
juges du pieux et pacifique saint Louis. Le sang, de la sorte, appelant le sang,
dinterminables que relles, nes de causes souvent futiles, jetaient les unes
contre les autres les maisons ennemies. Au XIe sicle une dispute entre deux
maisons nobles de Bourgogne, commence un jour de vendanges, se
prolongea pendant une trentaine dannes ; ds les premiers combats un des
partis avait perdu plus de onze hommes (123).
Parmi ces faides, les chroniques ont surtout retenu les luttes des grandes
lignes chevaleresques : telle la pardurable haine , mle de tratrises
atroces, qui, dans la Normandie du XIIe sicle, mit aux prises les Giroie et les
Talvas (124). Dans les rcits psalmodis par les jongleurs, les seigneurs
retrouvaient lcho de leurs passions, grandies jusqu lpope. Les vendettas
des Lorrains contre les Bordelais , de la parent de Raoul de Cambrai
contre celle de Herbert de Vermandois remplissent quelques-unes des plus
belles parmi nos gestes. Le coup mortel quen un jour de fte un des infants de
Lara porta lun des proches de sa tante engendra la srie de meurtres qui,
lun lautre enchans, forment la trame dun illustre cantar espagnol. Mais
du haut en bas de la socit triomphent les mmes murs. Sans doute,
Marc BLOCH La socit fodale
128
lorsquau XII Ie sicle la noblesse se fut dfinitivement constitue en corps
hrditaire, elle tendit se rserver comme une marque dhonneur toutes les
formes du recours aux armes. Les pouvoirs publics telle, la cour comtale
du Hainaut en 1276 (125) et la doctrine juridique volontiers embotrent le
pas par sympathie pour les prjugs nobiliaires ; mais aussi parce que princes
ou juristes, proccups dtablir la paix, prouvaient, plus ou moins
obscurment, le besoin de faire la part du feu. Le renoncement toute
vengeance, quil ntait ni pratiquement possible ni mme moralement
concevable dimposer une caste guerrire, cet t du moins beaucoup que
de lobtenir du reste de la population. Ainsi la violence devenait un privilge
de classe. Du moins, en principe. Car les auteurs mmes qui, comme
Beaumanoir, estiment que dautres que gentilshommes ne peuvent
guerroyer ne nous laissent gure dillusions sur la porte relle de cette p.189
rgle. Arezzo ntait pas la seule ville do saint Franois, ainsi quon le voit
peint sur les murs de la basilique dAssise, et pu exorciser les dmons de la
discorde. Si les premires constitutions urbaines eurent la paix pour principal
souci, apparurent, foncirement, selon le nom mme quelles se donnaient
parfois, comme des actes de paix , ce fut, notamment, parce quentre
beaucoup dautres causes de troubles, les bourgeoisies naissantes taient
dchires, ainsi que le dit encore Beaumanoir, par les contens ou mautalens
qui muevent lun lignage contre lautre . Le peu que nous savons de la vie
cache des campagnes y rvle un tat de choses pareil.
Ces sentiments pourtant ne rgnaient pas absolument sans partage. Ils se
heurtaient dautres forces mentales : lhorreur du sang vers, quenseignait
lglise ; la notion traditionnelle de paix publique ; le besoin surtout de cette
paix. On trouvera plus loin lhistoire du douloureux effort vers la tranquillit
intrieure qui, travers toute lre fodale, fut un des symptmes les plus
clatants des maux mmes contre lesquels, avec plus ou moins de bonheur, il
tentait de ragir. Les haines mortelles lalliance de mots avait pris une
valeur presque technique que sans cesse engendraient les liens du lignage
se rangeaient incontestablement parmi les principales causes du trouble
ambiant. Mais, partie intgrante dun code moral auquel, dans le secret de
leurs curs, les plus ardents aptres de lordre restaient sans doute fidles,
seuls quelques utopistes pouvaient songer en poursuivre labolition radicale.
Tout en fixant des tarifs ou des lieux interdits lexercice de la violence,
quelle quelle ft, beaucoup des conventions de paix reconnaissent
expressment la lgitimit de la faide. Les pouvoirs publics, pour la plupart,
nagirent pas autrement. Ils sappliqurent protger les innoc ents contre les
plus criants abus de la solidarit collective et fixrent des dlais de mise en
garde. Ils sattachrent distinguer des reprsailles autorises les simples
brigandages, entrepris sous le couvert dune expiation (126). Ils essayrent
parfois de limiter le nombre et la nature des torts susceptibles dtre lavs
dans le sang : selon les ordonnances normandes de p.190 Guillaume le
Conqurant, seulement le meurtre dun pre ou dun fils. Ils osrent de plus en
Marc BLOCH La socit fodale
129
plus frquemment, mesure quils se sentaient plus forts, devancer la
vengeance prive dans la rpression, soit des flagrants dlits, soit des crimes
qui tombaient sous la rubrique de la violation de la paix. Surtout ils
travaillrent solliciter des groupes adverses, quelquefois leur imposer la
conclusion de traits darmistice ou de rconciliation, arbitrs par les
tribunaux. En un mot, sauf en Angleterre o, aprs la Conqute, la disparition
de tout droit lgal de vengeance fut un des aspects de la tyrannie royale, ils
se bornrent modrer les excs de pratiques quils ne pouvaient ni peut -tre
souhaitaient empcher. Aussi bien les procdures judiciaires elles-mmes,
lorsque daventure la partie lse les prfrait laction directe, ntaient
gure que des vendettas rgularises. Voyez, en cas dhomicide volontaire, le
significatif partage dattribution que prescrit, en 1232, la charte municipale
dArques, en Artois : au seigneur, les biens du coupable ; son corps, pour quil
soit tu, aux parents de la victime (127). La facult de porter plainte presque
toujours appartenait exclusivement aux proches (128) ; et au XIIIe sicle encore,
dans les villes et les principauts les mieux polices, en Flandre par exemple
ou en Normandie, le meurtrier ne pouvait recevoir sa grce du souverain ou
des juges que sil stait dabord accord avec la parentle.
Car, si respectables que parussent ces vieilles rancunes bien
conserves , dont parlent avec complaisance les potes espagnols, il ntait
gure possible de les esprer ternelles. Tt ou tard, il fallait bien quon en
vnt pardonner, comme il est dit dans Girart de Roussillon, la faide des
morts . Selon un usage trs antique la rconciliation soprait , ordinairement,
au moyen dune indemnit. La lance sur ta poitrine, achte-la si tu ne veux
recevoir le coup : le conseil de ce vieux dicton anglo-saxon navait point
cess dtre sage (129).
A vrai dire, les tarifs rguliers de composition, que nagure les lois
barbares avaient labors avec tant de minutie et, notamment, en cas de
meurtre, le savant chelonnement des prix de lhomme ne se maintenaient
plus, dailleurs considrablement remanis, que par places : p.191 en Frise, en
Flandre, sur quelques points de lEspagne. Dans la Saxe, pourtant
gnralement conservatrice, si le Miroir du dbut du XIIIe sicle connat
encore une construction de cette sorte, elle ny fait plus gure figure que
dassez vain archasme ; et le relief de lhomme , que, sous saint Louis,
certains textes de la valle de la Loire continuent fixer 100 sous,
sappliquait seulement dans des circonstances exceptionnelles (130). Comment
en et-il t autrement ? Aux vieux droits ethniques, des coutumes de groupe
staient substitues, communes dsormais des populations de traditions
pnales opposes. Les pouvoirs publics, autrefois intresss au strict paiement
des sommes prescrites, parce quils en percevaient une part, avaient, durant
lanarchie des Xe et XIe sicles, perdu la force de rien rclamer. Enfin et
surtout les distinctions de classes sur lesquelles reposaient les calculs anciens
staient profondment altres.
Marc BLOCH La socit fodale
130
Mais la disparition des barmes stables natteignait pas lusage du mme
rachat. Celui-ci persista, jusqu la fin du moyen ge, concurrencer les
peines afflictives, mises en honneur par le mouvement des paix, comme plus
propres pouvanter les criminels. Seulement, le prix de linjure ou du s ang,
auquel sajoutait parfois en faveur de lme dfunte, de pieuses fondations,
tait dornavant arrt, dans chaque cas particulier, par accord, arbitrage ou
dcision de justice. Ainsi pour ne citer que deux exemples, pris aux deux
extrmits de la hirarchie, on vit, vers 1160, lvque de Bayeux recevoir une
glise dun parent du seigneur qui avait occis sa nice et, en 1227, une
paysanne snonaise toucher du meurtrier de son mari une petite somme
dargent (131).
Comme la faide, le paiement qui y mettait fin intressait des groupes
entiers. A la vrit, lorsquil sagissait dun simple tort, lusage stait tabli,
semble-t-il, trs anciennement de borner la compensation lindividu ls.
Avait-on, au contraire, affaire un meurtre, parfois aussi une mutilation ?
Ctait la parentle de la victime qui, en tout ou partie, touchait le prix de
lhomme. Dans tous les cas, celle du coupable contribuait au versement : en
vertu p.192 dune obligation strictement lgale et selon de s normes traces
davance, l o les tarifs rguliers taient demeurs en vigueur ; ailleurs,
lhabitude dcidait, ou peut -tre la simple biensance, assez astreignantes,
cependant, lune et lautre, pour que les pouvoirs publics leur reconnussent
presque force de loi. De la finance des amis : ainsi, transcrivant sur leur
formulaire un mandement royal qui ordonnait la fixation, aprs enqute sur la
coutume, de la quote-part des divers amis charnels appels un pareil
rglement, les clercs de la chancellerie de Philippe le Bel intitulaient ce
modle dacte, dont ils estimaient, sans doute, avoir faire un frquent
emploi (132).
Aussi bien le versement dune indemnit ne suffisait -il pas, ordinairement,
sceller le trait. Il y fallait, en outre, un rite damende honorable ou plutt de
soumission, envers la victime ou les siens. Le plus souvent, au moins entre
personnes dun rang relativement distingu, il revtait la forme du geste de
subordination le plus lourd de sens que lon connt alors : celui de lhommage
de bouche et de mains . L encore, ctaient moins des individus que des
groupes qui saffrontaient. Lorsquen 1208, le maire des moines de
Saint-Denis, Argenteuil, conclut la paix avec celui du sire de Montmorency,
quil avait bless, il dut amener avec lui, pour lhommage expiatoire, vingt neuf de ses amis ; et, en mars 1134, aprs lassassinat du sous -doyen
dOrlans, on put voir tous les proches du mort runis afin de recevoir les
hommages, non seulement dun des meurtriers, de ses complices et de ses
vassaux, mais aussi des meilleurs de sa parent : au total, deux cent
quarante personnes (133). De toute manire, lacte de lhomme se propageait,
au sein de son lignage, en ondes collectives.
Marc BLOCH La socit fodale
131
III. La solidarit conomique
LOccident fodal reconnaissait, unanimement, la lgitimit de la
possession individuelle. Mais, dans la pratique, la solidarit du lignage se
prolongeait, frquemment, en socit de biens. Partout, dans les campagnes,
de nombreuses p.193 frrches groupaient, autour du mme feu et du
mme pot et sur les mmes champs indivis, plusieurs mnages apparents.
Le seigneur, souvent, encourageait ou imposait lusage de ces
compagnies : car il jugeait avantageux den tenir les membres pour
solidaires, bon gr mal gr, des redevances. Dans une grande partie de la
France, le rgime successoral du serf ne connaissait dautre systme de
dvolution que la continuation dune communaut dj existante. Lhri tier
naturel, fils ou parfois frre, avait-il, ds avant louverture de la succession,
abandonn le foyer collectif ? Alors, mais alors seulement, ses droits
seffaaient, totalement, devant ceux du matre. Sans doute, ces murs taient
moins gnrales dans les classes plus leves : parce que le fractionnement
devient ncessairement plus ais mesure que la richesse augmente ; surtout,
peut-tre, parce que les revenus seigneuriaux se distinguaient mal des
pouvoirs de commandement qui, par nature, se prtaient moins commodment
tre collectivement exercs. Beaucoup de petits seigneurs, cependant,
notamment dans le centre de la France et en Toscane, pratiquaient, tout
comme les paysans, lindivision, exploitant en commun le patrimoine, vivant
tous ensemble dans le chteau ancestral ou du moins se relevant sa garde.
Ctaient les paronniers la cape troue , dont lun deux, le troubadour
Bertrand de Born, fait le type mme des pauvres chevaliers. tels, en 1251
encore, les trente et un copossesseurs dune fert gvaudanaise (134). Un
tranger, daventure, obtenait -il de sadjoindre au groupe ? Quil sagt de
rustres ou de personnages plus haut placs, lacte dassociation revtait
volontiers la forme dune fictive fraternit : comme sil ny avait de
contrat de socit vraiment solide que celui qui, dfaut de sappuyer sur le
sang, du moins en imitait les liens. Les grands barons mmes nignoraient pas
toujours ces habitudes communautaires : ne vit-on pas, plusieurs gnrations
durant, les Bosonides, matres des comts provenaux, tout en rservant
chaque branche sa zone dinfluence particulire, considrer comme indivis le
gouvernement gnral du fief et se parer tous, uniformment, du mme titre de
comte ou prince de toute la Provence ?
p.194 Lors mme, dailleurs, que la possession tait franchement
individualise, elle nchappait point, pour cela, toute entrave familiale.
Entre deux termes que nous jugerions volontiers antinomiques, cet ge de
participation juridique ne voyait nulle contradiction. Feuilletons les actes
de vente ou de donation que nous ont, pour les Xe, XIe et XIIe sicles,
conservs les chartriers ecclsiastiques. Frquemment, dans un prambule
rdig par les clercs, lalinateur procl ame son droit disposer, en toute
Marc BLOCH La socit fodale
132
libert, de ses biens. Telle tait, en effet, la thorie de lglise : sans cesse
enrichie par les dons, gardienne, au surplus, du destin des mes, comment
et-elle admis quaucun obstacle ft oppos aux fidles dsireux dassurer,
par de pieuses gnrosits, leur salut ou celui dtres chers ? Les intrts de la
haute aristocratie, dont le patrimoine se grossissait des cessions de terres
consenties, plus ou moins volontairement, par les petits, allaient dans le mme
sens. Ce nest point hasard si, ds le I Xe sicle, la loi saxonne, numrant les
circonstances o lalination, dt -elle avoir pour effet de dshriter la parent,
est permise, y inscrit, ct des libralits envers les glises et le roi, le cas du
pauvre hre qui, press par la faim , aura mis pour condition dtre nourri
par le puissant auquel il a cd son lopin (135). Presque toujours, cependant,
chartes ou notices, si haut quelles fassent sonner les droits de lindividu, ne
manquent pas de mentionner, par la suite, le consentement des divers proches
du vendeur ou du donateur. Ces approbations paraissaient ce point
ncessaires que le plus souvent on nhsitait pas les rmunrer. Arrive -t-il
que quelque parent, nayant pas t consult sur le moment, prtende, parfois
aprs de longues annes, arguer la convention de nullit ? Les bnficiaires
crient linjustice ou limpit, quelquefois mme portent laffaire devant
un tribunal et en obtiennent gain de cause (136). Neuf fois sur dix, pourtant,
malgr protestations et jugements, force leur est, au bout du compte, de
composer. Entendons bien quil ne sagissait point, comme dans nos
lgislations, dune protection offerte aux hritiers, au sens rest reint du terme.
Sans quaucun principe fixe limite le cercle dont lassentiment semble requis,
il est p.195 constant que des collatraux interviennent, malgr la prsence de
descendants, ou que, dans une mme branche, les diverses gnrations soient
concurremment appeles approuver. Lidal tait, comme on voit sy
engager un sergent chartrain, de se procurer alors mme que femme,
enfants et surs avaient dj accept lavis favorable dautant de parents
et de proches quil sera possible (137). La parentle entire se sentait lse
lorsquun bien sortait de ses prises.
Cependant, depuis le XIIe sicle, des coutumes souvent incertaines, mais
soumises quelques grandes ides collectives, on vit se substituer peu peu
un droit plus pris de rigueur et de clart. Dautre part, les transformations de
lconomie rendaient de moins en moins supportables les gnes opposes aux
changes. Nagure les ventes immobilires avaient t assez rares ; leur
lgitimit mme, au regard de lopinion commune, semblait contestable, si
elles navaient, pour excuse, une grande pauvret . Lorsque lacheteur tait
une glise, elles se dguisaient volontiers sous le nom daumne. Ou, plus
exactement sans doute, de cette apparence, seulement demi trompeuse, le
vendeur attendait un double gain : dans ce monde, le prix, infrieur peut-tre
ce quil et t en labsence de toute autre rmunration ; dans lautre, le salut
obtenu par les prires des serviteurs de Dieu. Dsormais, la pure vente, au
contraire, va devenir une opration frquente et qui, franchement, savoue.
Assurment, pour la rendre absolument libre, il fallut, dans des socits de
type exceptionnel, lesprit commercial et laudace de quelques grandes
Marc BLOCH La socit fodale
133
bourgeoisies. En dehors de ces milieux, on se contenta de la doter dun droit
propre, nettement distinct de celui de la donation. Droit soumis encore plus
dune limitation, mais moins troites que par le pass et beaucoup mieux
dfinies. On tendit dabord exiger quavant toute ali nation titre onreux,
le bien ft lobjet, au profit de proches, dune offre pralable : Du moins sil
provenait lui-mme dun hritage : restriction dj grave et qui devait tre
durable (138). Puis, partir du dbut du XIIIe sicle environ, on se borna
reconnatre aux membres de la parent, dans un rayon et selon p.196 un ordre
donns, la facult, la vente une fois faite, de se substituer lacqureur,
moyennant reversement du prix dj pay. Il ny a gure eu, dans la soc it
mdivale, dinstitution plus universelle que ce retrait lignager . A la seule
exception de lAngleterre (139) et encore sous rserve de certaines de ses
coutumes urbaines , il triompha de la Sude lItalie. Ni, non p lus,
dinstitution plus solidement ancre : en France, il ne devait tre aboli que par
la Rvolution. Ainsi, travers les temps, se perptuait, sous des formes la
fois moins flottantes et plus attnues, lempire conomique du lignage.
Marc BLOCH La socit fodale
134
CHAPITRE II
Caractre et vicissitudes du lien de parent
I. Les ralits de la vie familiale
Ce lignage, pourtant, en dpit de sa force dappui et de contrainte,
lerreur serait lourde den concevoir la vie intrieure sous des couleurs
uniformment idylliques. Que les parents partissent volontiers en faides
les unes contre les autres nempchait pas toujours, dans leur sein mme, les
plus atroces querelles. Pour fcheuses que Beaumanoir estime les guerres
entre proches, il ne les considre visiblement pas comme exceptionnelles, ni
mme, sauf entre frres dun mme lit, comme rigoureusement interdites.
Aussi bien suffirait-il dinterroger l -dessus lhistoire des maisons princires ;
de suivre, par exemple, de gnrations en gnrations, le destin des Anjou,
vrais Atrides du moyen ge : la guerre plus que civile qui, sept annes
durant, prcipita contre le comte Foulque Nerra son fils, Geoffroi Martel ;
Foulque le Rchin, aprs avoir dpossd son frre, le jetant au cachot pour,
au bout de dix-huit ans, ne le relcher que fou ; sous Henri II, les haines
furieuses des fils contre le pre ; lassassinat dArthur, enfin, par le roi Jean,
son oncle. Au rang immdiatement infrieur, ce sont les sanglantes disputes
de tant de moyens et petits seigneurs, autour du chteau familial. Telle,
laventure de ce chevalier des Flandres qui, bout hors de sa demeure par ses
deux frres, vit sa jeune femme et son enfant massacrs par eux, puis tua de sa
main lun des meurtriers (140). Telle, surtout, la geste des p.198 vicomtes de
Comborn, un de ces rcits dodeur forte qui ne perdent rien nous avoir t
transmis par le placide organe dun crivain monastique (141).
p.197
A lorigine, voici le vicomte Archambaud qui, vengeur de sa mre
abandonne, tue un de ses frres du second lit, puis, bien des annes aprs,
achte le pardon de son pre par le meurtre dun chevalier qui, nagure, avait
inflig au vieux seigneur une incurable blessure. Il laisse, son tour, trois fils.
Lan, qui a hrit de la vicomt, meurt bientt, sans autre descendant quun
tout jeune garon. Se mfiant du second de ses frres, cest au dernier n,
Bernard, quil a confi, durant la minorit, la garde de ses terres. Arriv
lge de chevalerie, lenfan t Eble rclame en vain lhritage. Cependant,
grce damicales entremises, il obtient du moins, faute de mieux, le chteau
de Comborn. Il y vit, la rage au cur, jusquau moment o, un hasard lui
ayant livr sa tante, il la viole, publiquement, esprant forcer ainsi le mari
outrag la rpudier. Bernard reprend sa femme et prpare la revanche. Un
beau jour, il parat devant les murs avec une petite escorte, comme par
Marc BLOCH La socit fodale
135
bravade. Eble, qui sortait de table, le cerveau obscurci par les fumes de
livresse, follement se lance la poursuite. A quelque distance, les prtendus
fuyards se retournent, se saisissent de ladolescent et le blessent mortellement.
Cette fin tragique, les torts quavait subis la victime, sa jeunesse surtout
murent le peuple ; pendant plusieurs jours on fit des offrandes sur sa
spulture provisoire, au lieu mme o il tait tomb, comme sur la chsse dun
martyr. Mais loncle parjure et meurtrier et ses descendants, aprs lui,
conservrent paisiblement forteresse et vicomt.
Ne crions point la contradiction. En ces sicles de violence et de
nervosit, des liens sociaux pouvaient bien passer pour trs forts, voire se
manifester souvent comme tels et se trouver, nanmoins, la merci dun coup
de passion. Cependant, en dehors mme de ces brutales ruptures, provoques
par la cupidit autant que par la colre, le fait demeure que, dans les
circonstances les plus normales, un sens collectif trs vif saccommodait
aisment dune mdiocre tendresse envers les personnes. Ainsi quil tait
naturel peut-tre p.199 dans une socit o la parent tait surtout conue
comme un moyen dentraide, le groupe comptait beaucoup plus que ses
membres, pris un un. Cest lhistorien officiel, appoint par une grande
famille baronale, que nous devons le souvenir dun mot caractristique
prononc, un jour, par lanctre de la ligne. Comme Jean, marchal
dAngleterre, refusait, malgr ses engagements, de rendre au roi tienne une
de ses forteresses, ses ennemis le menacrent de faire excuter, sous ses yeux,
son jeune fils, quil avait nagure remis en otage : Que me chaut de
lenfant , rpondit le bon seigneur, nai -je pas encore les enclumes et les
marteaux dont jen forgerai de plus beaux (142) ? Quant au mariage, il ntai t
souvent, de la faon la plus nave, quune association dintrts et, pour les
femmes, une institution de protection. coutez, dans le Pome du Cid, les
filles du hros, auxquelles leur pre vient dannoncer quil les a promises aux
infants de Carrion. Les jouvencelles qui, cela va de soi, nont jamais vu leurs
fiancs, remercient : Quand vous nous aurez maries, nous serons de riches
dames. Ces conceptions taient si puissantes que, chez des peuples pourtant
profondment chrtiens, elles entranrent une trange et double antinomie
entre les murs et les lois religieuses.
Lglise tait mdiocrement sympathique aux secondes ou troisimes
noces, quand mme elle ne leur tait pas nettement hostile. Du haut en bas de
la socit, cependant, le remariage avait presque force de rgle. Par souci, sans
doute, de placer la satisfaction de la chair sous le signe du sacrement. Mais
aussi, lorsque lhomme avait disparu le premier, parce que lisolement
semblait pour la femme un trop grand pril et que le seigneur, dautre part,
dans toute terre tombe en quenouille voyait une menace au bon ordre des
services. Lorsquen 1119, aprs lcrasement de la chevalerie antiochienne au
Champ du Sang, le roi Baudoin II de Jrusalem se proccupa de rorganiser la
principaut, il se fit un devoir gal de conserver aux orphelins leur hritage et
de procurer aux veuves de nouveaux poux. Et, de six de ses chevaliers qui
Marc BLOCH La socit fodale
136
moururent en gypte, Joinville note avec simplicit : par quoi il convint que
leurs femmes se remariassent toutes les Six (143) . Parfois lautorit
seigneuriale elle-mme p.200 intervenait imprieusement pour que fussent
pourvues de maris les paysannes quun inopportun veuvage empchait de
bien cultiver leurs champs ou de fournir les corves prescrites.
Lglise, dautre part, proclamait lindissolubilit du lien conjugal. Cela
nempchait point, dans les hautes classes surtout, des rpudiations frquentes,
inspires souvent par les soucis les plus terre terre. Tmoins, entre mille, les
aventures matrimoniales de Jean le Marchal, narres, toujours du mme ton
gal, par le trouvre au service de ses petits-fils. Il avait pous une dame de
haut parage, doue, en croire le pote, de toutes les qualits du corps et de
lesprit : grande joie furent ensemble . Malheureusement, Jean avait aussi
un trop fort voisin , que la prudence commandait de se concilier. Il renvoya
sa charmante femme et sunit la sur de ce dangereux personnage.
Mais sans doute serait-ce dformer beaucoup les ralits de lre fodale
que de placer le mariage au centre du groupe familial. La femme nappartenait
qu demi au lignage o son destin lavait fait entrer, pour peu de temps
peut-tre. Taisez-vous , dit rudement Garin le Lorrain la veuve de son
frre assassin, qui, sur le corps, pleure et se lamente, un gentil chevalier
vous reprendra... cest moi quil convient de garder le grand deuil (144). Si
dans le pome, relativement tardif, des Nibelungen, Kriemhild venge sur ses
frres la mort de Siegfried, son premier poux sans que dailleurs la
lgitimit de cet acte paraisse le moins du monde certaine , il semble bien
quau contraire, dans la version primitive, on la vt poursuivre la faide de ses
frres contre Attila, son second mari et leur meurtrier. Par la tonalit
sentimentale de mme que par ltendue, la parentle tait tout autre chose
que la petite famille conjugale du type moderne. Comment donc se
dfinissaient, au juste, ses contours ?
II. LA STRUCTURE DU LIGNAGE
De vastes gentes, fortement cimentes par le sentiment, vrai ou faux,
dune descendance commune et, par l mme, p.201 dlimites avec beaucoup
de prcision, lOccident, lre fodale, nen connaissait plus gure que sur sa
frange extrme, en dehors des terres authentiquement fodalises : sur les
bords de la mer du Nord, Geschlechter de la Frise ou du Dithmarschen ; dans
lOuest, tribus ou clans celtiques. Selon toute apparence, des groupes de cette
nature avaient encore exist chez les Germains de lpoque des invasions
telles les farae lombardes et franques dont plus dun village, italien ou
franais, continue aujourdhui porter le nom ; telles aussi, les genealogiae
alamanes et bavaroises que certains textes montrent en possession du sol.
Mais ces units trop larges staient peu peu effrites.
Marc BLOCH La socit fodale
137
Aussi bien tait-ce labsolue primaut de la descendance en ligne
masculine que la gens romaine avait d lexceptionnelle rigueur de son destin.
Or rien de pareil ne se rencontrait lpo que fodale. Dj, dans lancienne
Germanie, nous voyons que chaque individu avait deux catgories de proches,
les uns du ct de lpe , les autres du ct de la quenouille , et se
trouvait solidaire, des degrs dailleurs diffrents, des seconds comme des
premiers comme si, chez les Germains, la victoire du principe agnatique
navait jamais t assez complte pour faire disparatre toute trace dun plus
ancien systme de filiation utrine. Nous ne savons malheureusement presque
rien sur les traditions familiales indignes des pays soumis par Rome. Mais,
quoi que lon doive penser de ces problmes dorigines, il est certain, en tout
cas, que dans lOccident mdival, la parent avait pris ou conserv un
caractre nettement bifide. Limportance se ntimentale que lpope attribue
aux relations doncle maternel neveu nest quune des expressions dun
rgime o les liens dalliance par les femmes comptaient peu prs autant que
ceux de la consanguinit paternelle (145). Ainsi que latteste, entre autres, le sr
tmoignage de lonomastique.
La plupart des noms de personne germaniques taient forms de deux
lments accols dont chacun possdait sa signification propre. Tant que la
conscience se maintint de la distinction entre les deux thmes, il fut, sinon de
rgle, au moins dusage frquent, de marquer la filiation par lemprunt dun
des composants. Cela mme en terre romane, o p.202 le prestige des
vainqueurs avait largement rpandu, dans les populations indignes,
limi tation de leur onomastique. Or ctait tantt au pre et tantt la mre
qu peu prs indiffremment on rattachait, par cet artifice verbal, leur
postrit. Dans le village de Palaiseau, par exemple, au dbut du Xe sicle, le
colon Teud-ricus et sa femme Ermenberta ont baptis un de leurs fils
Teut-hardus, un autre Ermentarius et le troisime, par un double rappel,
Teut-bertus (146). Puis lhabitude se prit de faire passer, de gnration en
gnration, le nom entier. Ce fut, de nouveau, en alternant les deux
ascendances. Ainsi des deux fils de Lisois, seigneur dAmboise, qui mourut
vers 1065, si lun reut le nom de son pre, lautre, qui tait lan, sappela
Sulpice, comme le grand-pre et le frre de sa mre. Plus tard encore,
lorsquon eut commenc dajouter aux prnoms un patronyme, on continua
longtemps dhsiter entre les deux modes de transmission. Fille de Jacques
dArc et dIsabelle Rome, on mappelle tantt Jeanne dArc et tantt
Jeanne Rome , disait ses juges celle que lhistoire connat seulement sous
le premier de ces noms ; et elle observait que, dans son pays, la coutume
inclinait attribuer aux filles le surnom de leur mre.
Cette dualit de relations entranait de graves consquences. Chaque
gnration ayant ainsi son cercle de proches qui ne se confondait point avec
celui de la gnration prcdente, la zone des obligations lignagres
perptuellement changeait de contours. Les devoirs taient rigoureux ; mais le
groupe, trop instable pour servir de base lorganisation sociale tout entire.
Marc BLOCH La socit fodale
138
Pis encore : quand deux lignages se heurtaient, il se pouvait fort bien quun
mme individu appartnt, ici du ct de son pre, l du ct de sa mre, aux
deux la fois. Comment choisir ? Sagement Beaumanoir conseille daller vers
le parent le plus rapproch et, degr gal, de sabstenir. Nul doute que dans
la pratique la dcision ne ft souvent dicte par les prfrences personnelles.
Nous retrouverons, propos des rapports proprement fodaux, ce
confusionnisme juridique, avec le cas du vassal de deux seigneurs ; il
caractrisait une mentalit ; la longue, il ne pouvait que dtendre le lien.
Quelle fragilit interne p.203 dans un systme familial qui contraignait, comme
on le faisait en Beauvaisis au XIIIe sicle, dadmettre pour lgitime la guerre
de deux frres, issus dun mme pre, si, tant de lits diffrents ils se
trouvaient pris dans une vendetta entre leurs parents maternelles !
Jusquo stendaient, le long des deux lignes, les devoirs envers les
amis charnels ? On nen trouve gure les frontires dlimites avec
quelque prcision que dans les collectivits demeures fidles aux tarifs
rguliers de composition. Encore les coutumes ny furent -elles mises par crit
qu une poque relativement tardiv e. Il nen est que plus significatif de les
voir fixer des zones de solidarit active et passive tonnamment larges : zones
dgrades, du reste, le taux des sommes reues ou verses variant selon la
proximit de la parent. A Sepulveda, en Castille, au XIIIe sicle, pour que la
vengeance exerce sur le meurtrier dun proche ne puisse tre impute
crime, il suffit davoir, avec la victime, un trisaeul commun. Le mme lien
habilite, selon la loi dAudenarde, toucher une part du prix du sang et,
Lille, impose de contribuer son paiement. A Saint-Omer, on va, dans ce
dernier cas, jusqu faire natre lobligation de lexistence, comme souche
commune, dun aeul de bisaeul (147). Ailleurs, le trac tait plus flottant.
Mais, comme il a dj t observ, la prudence commandait de requrir, pour
les alinations, le consentement dautant de collatraux quon en pouvait
atteindre. Quant aux communauts taisibles des campagnes, elles runirent
longtemps sous leur toit de nombreux individus : jusqu cinquante dans la
Bavire du XIe sicle, soixante-dix dans la Normandie du XVe (148).
A y regarder de prs, cependant, il semble qu partir du XII Ie sicle, une
sorte de rtraction se soit peu prs partout opre. Aux vastes parentles de
nagure, on voit lentement se substituer des groupes beaucoup plus voisins de
nos troites familles daujourdhui. Vers la fin du sicle, Beaumanoir a le
sentiment que le cercle des personnes lies par le devoir de vengeance est all
diminuant : jusqu ne plus comprendre, de son temps, la diffrence de
lpoque prcdente, que les cousins issus de germains, voire, comme p.204
rayon o lobligation demeurait ressentie avec beaucoup dintensit, les
simples cousins germains. Ds les dernires annes du XIIe, on note, dans les
chartes franaises, une tendance borner aux plus proches la recherche des
approbations familiales. Puis vint le systme du droit au rachat. Avec la
distinction quil tablissait entre les acquts et les biens familiaux, et, par
ceux-ci, entre les biens ouverts, selon leur provenance, aux revendications des
Marc BLOCH La socit fodale
139
lignes, soit paternelle, soit maternelle, il rpondait beaucoup moins que la
pratique ancienne la notion dun lignage quasi infini. Le rythme de
l volution fut naturellement trs variable selon les lieux. Il suffira ici
dindiquer, dun trait rapide, les causes les plus gnrales et les plus probables
dune transformation si lourde de consquences.
Certainement les pouvoirs publics, par leur action de gardiens de la paix,
contriburent user la solidarit familiale. De bien des faons et notamment,
comme le fit Guillaume le Conqurant, en limitant le cercle des vengeances
lgitimes ; surtout, peut-tre, en favorisant les renonciations toute
participation la vendetta. La sortie volontaire de la parentle tait une facult
ancienne et gnrale ; mais, si elle permettait dchapper beaucoup de
risques, elle privait, pour lavenir, dun appui, longtemps conu comme
indispensable. La protection de ltat, une fois devenue plus efficace, rendit
ces forjurements moins dangereux. Lautorit, parfois, nhsitait pas les
imposer : ainsi, en 1181, le comte de Hainaut, aprs un meurtre, brlant par
avance les maisons de tous les proches du coupable, afin de leur extorquer la
promesse de ne point secourir celui-ci. Cependant leffritement et
lamenuisement du lignage, unit conomique en mme temps que comme
organe de la faide, semble avoir t avant tout leffet de changements sociaux
plus profonds. Les progrs des changes conduisaient limiter les entraves
familiales, sur les biens ; ceux de la vie de relations entranaient la rupture de
collectivits trop vastes qui, en labsence de tout tat civil, ne pouvaient gure
conserver le sentiment de leur unit quen demeurant groupes en un mme
lieu. Ainsi dj les invasions avaient port un coup presque mortel aux
Geschlechter, beaucoup p.205 plus solidement constitus, de lancienne
Germanie. Les rudes secousses subies par lAngleterre incursions et
migrations scandinaves, conqute normande furent sans doute pour
beaucoup dans la ruine prcoce des vieux cadres lignagers. Dans lEurope
presque entire, lors des grands dfrichements, lattraction des centres urbains
nouveaux et des villages, fonds sur les essarts, brisa assurment mainte
communaut paysanne. Ce ne fut point hasard si, en France du moins, ces
frrches se maintinrent beaucoup plus longtemps dans les provinces les plus
pauvres.
Il est curieux, mais il nest pas inexplicable, que cette p riode o les
amples parentles des ges antrieurs commencrent ainsi de se morceler ait
vu, prcisment, lapparition des noms de familles, dailleurs sous une forme
encore trs rudimentaire. Comme les gentes romaines, les Geschlechter de la
Frise et du Dithmarschen possdaient chacun leur tiquette traditionnelle. De
mme, lpoque germanique, les dynasties de chefs, pourvues dun caractre
hrditairement sacr. Au contraire les lignages de lre fodale demeurrent
longtemps trangement anonymes : en raison, sans doute de lindcision de
leurs contours ; mais aussi parce que les gnalogies taient trop bien connues
pour quon prouvt le besoin dun aide -mmoire verbal. Puis, partir du XIIe
sicle surtout, lhabitude se prit de joindre, frquemment , au nom unique de
Marc BLOCH La socit fodale
140
nagure notre prnom daujourdhui un sobriquet ou parfois un second
prnom. La dsutude o taient tombs, peu peu, beaucoup de noms
anciens, laugmentation de la population aussi avaient eu pour effet de
multiplier, de la faon la plus gnante, les homonymes. En mme temps, les
transformations du droit, dsormais familier avec lacte crit, et celles de la
mentalit, beaucoup plus que par le pass avide de clart, rendaient de moins
en moins tolrables les confusions nes de cette pauvret du matriel
onomastique et poussaient rechercher des moyens de distinction. Mais ce
ntaient l encore que des marques individuelles. Le pas dcisif fut franchi
seulement lorsque le deuxime nom, quelle quen ft la forme, devenu
hrditaire, se transforma en patronyme. Il est caractristique que lusage des
dsignations vritablement p.206 familiales se soit fait jour, dabord, dans les
milieux de la haute aristocratie o lhomme tait la fois plus mobile et plus
dsireux, lorsquil sloig nait, de ne pas perdre lappui du groupe. Dans la
Normandie du XIIe sicle, on parlait dj couramment des Giroie et des
Talvas ; dans lOrient latin, vers 1230, de ceux du lignage qui ont surnom
dYbelin (149). Puis le mouvement gagna les bourgeoisies urbaines,
accoutumes elles aussi aux dplacements et portes, par les ncessits du
commerce, redouter tout risque derreur sur les personnes, voire sur les
familles, qui concidaient souvent avec des associations daffaires. Il se
propagea enfin dans lensemble de la socit.
Mais il faut bien entendre que les groupes dont ltiquette se prcisait ainsi
ntaient ni trs fixes ni dune tendue beaucoup prs comparable celle des
anciennes parentles. La transmission, qui parfois, on la vu, oscillait entre les
deux lignes, paternelle ou maternelle, souffrait bien des interruptions. Les
branches, en scartant, finissaient souvent par tre connues sous des noms
diffrents. Les serviteurs, par contre, ltaient volontiers sou s celui du matre.
En somme, bien plutt qu des gentilices, on avait affaire, conformment
lvolution gnrale des liens du sang, des sobriquets de maisonnes, dont la
continuit tait la merci du moindre accident survenu dans le destin du
groupe ou de lindividu. La stricte hrdit ne fut impose que beaucoup plus
tard, avec ltat civil, par les pouvoirs publics, soucieux de se faciliter ainsi
leur tche de police et dadministration. Si bien que, trs postrieur aux
dernires vicissitudes de la socit fodale, limmuable nom de famille, qui,
aujourdhui, runit sous un signe commun des hommes souvent trangers
tout vivant sentiment de solidarit, devait tre finalement, en Europe, la
cration, non de lesprit de lignage, mais de linstitution la plus foncirement
contraire cet esprit : ltat souverain.
III. Liens du sang et fodalit
Gardons-nous dailleurs dimaginer, depuis le lointain des temps tribaux,
une mancipation rgulire de p.207 lindividu. Sur le continent du moins, il
Marc BLOCH La socit fodale
141
semble bien qu lre des royaumes barbares les alinations aient t
beaucoup moins dpendantes de la bonne volont des proches quelles ne
devaient le devenir durant le premier ge fodal. De mme, pour les
dispositions cause de mort. Au VIIIe, au IXe sicle, tantt le testament
romain, tantt divers systmes dvelopps par les coutumes germaniques
permettaient lhomme de rgler lui -mme, avec une certaine libert, la
dvolution de ses biens. A partir du XIe sicle, sauf dans lItalie et lEspagne
lun e et lautre, on le sait, exceptionnellement fidles aux leons des vieux
droits crits , cette facult subit une vritable clipse ; fussent-elles
destines navoir deffets que posthumes, les libralits, dsormais,
revtaient, presque exclusivement, la forme de donations, soumises, par
nature, lassentiment du lignage. Cela ne faisait pas laffaire de lglise.
Sous son influence, le testament proprement dit ressuscita au XIIe sicle,
cantonn dabord dans de pieuses aumnes, puis, sous rserve de q uelques
restrictions au profit des hritiers naturels, peu peu tendu. Ctait le
moment o, de son ct, le rgime attnu du retrait se substituait celui des
approbations familiales. La faide elle-mme avait eu son champ daction
relativement limit par les lgislations des tats issus des invasions. Ces
barrires une fois tombes, elle prit ou reprit sa place au premier rang du droit
pnal, jusquau jour o elle fut de nouveau en butte aux assauts des pouvoirs
royaux ou princiers reconstitus. Le paralllisme, en un mot, apparat de tout
point complet. La priode qui vit lpanouissement des relations de protection
et subordination personnelles, caractristiques de ltat social que nous
nommons fodalit, fut marque galement par un vritable resserrement des
liens du sang : parce que les temps taient troubls et lautorit publique sans
vigueur, lhomme prenait une conscience plus vive de ses attaches avec les
petits groupes, quels quils fussent, dont il pouvait attendre un secours. Les
sicles qui, plus tard, assistrent la ruine ou la mtamorphose progressives
de la structure authentiquement fodale connurent aussi, avec lmiettement
des grandes parentles, les prodromes du lent effacement des solidarits
lignagres.
Cependant, lin dividu menac par les multiples dangers dune
atmosphre de violence, la parent, mme durant le premier ge fodal, ne
prsentait pas un abri qui part suffisant. Elle tait pour cela, sans doute, sous
la forme o elle se prsentait alors, trop vague et trop variable dans ses
contours, trop profondment mine, intrieurement, par la dualit des
descendances, masculine et fminine. Cest pourquoi les hommes durent
chercher ou subir dautres liens. L -dessus, nous avons une exprience
dcisive : les seules rgions o subsistrent de puissants groupes agnatiques
terres allemandes riveraines de la mer du Nord, pays celtes des les
ignorrent, du mme coup, la vassalit, le fief et la seigneurie rurale. La force
du lignage fut un des lments essentiels de la socit fodale ; sa faiblesse
relative explique quil y ait eu une fodalit.
p.208
Marc BLOCH La socit fodale
*
**
142
Marc BLOCH La socit fodale
143
LIVRE DEUXIME : La vassalit et le fief
CHAPITRE PREMIER
Lhommage vassalique
I. Lhomme dun autre homme
tre lhomme dun autre homme : dans le vocabulaire fodal, il
ntait point dalliance de mots plus rpandue que celle -l, ni dun sens plus
plein. Commune aux parlers romans et germaniques, elle servait y exprimer
la dpendance personnelle, en soi. Cela, quelle que ft, par ailleurs, la nature
juridique prcise du lien et sans que lon sembarrasst daucune distinction
de classe. Lecomte tait lhomme du roi, comme le serf celui de son
seigneur villageois. Parfois ctait jusque dans le mme texte qu quelques
lignes dintervalle des condi tions sociales radicalement diffrentes se
trouvaient ainsi tour tour voques : telle, vers la fin du XIe sicle, cette
requte de moniales normandes, se plaignant que leurs hommes
cest --dire leurs paysans fussent contraints, par un haut baron, de
travailler aux chteaux de ses hommes : entendez les chevaliers, ses
vassaux (150). Lquivoque ne choquait point, parce quen dpit de labme
entre les rangs, laccent portait sur llment fondamental commun : la
subordination dindividu individu.
p.209
Cependant, si le principe de cette attache humaine imprgnait la vie
sociale tout entire, les formes quelle revtait ne laissaient pas dtre
singulirement diverses. Avec, des plus leves aux plus humbles, des
transitions parfois quasi insensibles. Ajoutez, de pays pays, bien des
divergences. Il sera commode de prendre pour fil conducteur lun des p.210 plus
significatifs parmi ces rapports de dpendance : le lien vassalique ; de
ltudier dabord dans la zone la mie ux fodalise de lEurope : savoir,
le cur de lancien Empire carolingien, France du Nord, Allemagne rhnane
et souabe ; enfin de sefforcer, avant toute recherche embryologique, de
dcrire les traits au moins les plus apparents de linstitution, lpoque de son
plein panouissement cest --dire du Xe au XIIe sicle.
Marc BLOCH La socit fodale
144
II. Lhommage lre fodale
Voici, face face, deux hommes : lun qui veut servir lautre qui accepte
ou souhaite dtre chef. Le premier joint les mains et les place, ainsi unie s,
dans les mains du second : clair symbole de soumission, dont le sens, parfois,
tait encore accentu par un agenouillement. En mme temps, le personnage
aux mains offertes prononce quelques paroles, trs brves, par o il se
reconnat lhomme de son vis--vis. Puis chef et subordonn se baisent sur
la bouche : symbole daccord et damiti. Tels taient trs simples et, par l
mme, minemment propres frapper des esprits si sensibles aux choses vues
les gestes qui servaient nouer un des liens sociaux les plus forts quait
connus lre fodale. Cent fois dcrite ou mentionne dans les textes,
reproduite sur des sceaux, des miniatures, des bas-reliefs, la crmonie
sappelait hommage (en allemand, Mannschaft). Pour dsigner le
suprieur, que lle crait, point dautres termes que le nom, trs gnral, de
seigneur (151). Souvent le subordonn est dit de mme, sans plus,
lhomme de ce seigneur. Quelquefois, avec plus de prcision, son
homme de bouche et de mains . Mais on emploie aussi des mots mieux
spcialiss : vassal ou, jusquau dbut du XI Ie sicle au moins,
commend .
Ainsi conu, le rite tait dpourvu de toute empreinte chrtienne.
Explicable par les lointaines origines germaniques de son symbolisme, une
pareille lacune ne pouvait subsister dans une socit o lon nadmettait plus
gure quune promesse ft valable si elle navait Dieu pour garant.
Lhommage mme, dans sa forme, ne fut jamais modifi. Mais, p.211
vraisemblablement ds la priode carolingienne, un second rite, proprement
religieux, tait venu se superposer lui : la main tendue sur les vangiles ou
sur les reliques, le nouveau vassal jurait dtre fidle son matre. Ctait ce
quon appelait la foi (en allemand Treue, et, anciennement, Hulde). Le
crmonial tait donc deux temps. Ses deux phases, cependant, ne
possdaient pas, beaucoup prs, une valeur gale.
Car la foi navait rien de spcifique. Dans une socit trouble, o la
mfiance tait de rgle, en mme temps que lappel aux sanctions divines
semblait un des rares freins peu prs efficaces, le serment de fidlit avait
mille raisons dtre frquemment exig. Les officiers royaux ou seigneuriaux,
de tout rang, le prtaient leur entre en charge. Les prlats le demandaient
volontiers leurs clercs. Les seigneurs terriens, parfois, leurs paysans. A la
diffrence de lhommage qui, engageant, dun coup, lhomme tout entier,
passait, gnralement, pour incapable de renouvellement, cette promesse,
presque banale, pouvait tre plusieurs reprises rpte envers la mme
personne. Il y avait donc beaucoup dactes de foi sans hommages. Nous ne
connaissons pas dhommages sans foi. En outre, lorsque les deux rites taient
joints, la prminence de lhommage se traduisait par sa place mme dans la
Marc BLOCH La socit fodale
145
crmonie : il avait toujours lieu en premier. Il tait seul dailleurs faire
intervenir, en troite union, les deux hommes ; la foi du vassal constituait un
engagement unilatral, auquel ne rpondait que rarement, de la part du
seigneur, un serment parallle. Lhommage, en un mot, tait le vritable
crateur de la relation vassalique sous son double aspect de dpendance et de
protection.
Le nud ainsi form durait, en principe, autant que les deux vies quil
joignait. Aussitt, par contre, que la mort avait mis fin soit lune, soit
lautre, il se dfaisait de soi -mme. A dire vrai, nous verrons quen pratique la
vassalit se mua trs vite en une condition gnralement hrditaire. Mais cet
tat de fait laissa, jusquau bout, subsister, intacte, la rgle juridique. Peu
importait que le fils du vassal trpass portt ordinairement son hommage au
seigneur qui avait accueilli celui de son pre ; que lhritier du prcdent p.212
seigneur ret, presque toujours, les hommages des vassaux paternels : le rite
nen devait pas moins tre ritr, chaque fois que la composition du couple
venait se modifier. De mme, lhommage ne pouvait tre offert ni accept
par procuration : les exemples contraires datent tous dune poq ue trs tardive,
o le : sens des vieux gestes stait dj presque perdu. En France, vis --vis du
roi, cette facult ne devint lgale que sous Charles VII et non encore sans
beaucoup dhsitations (152). Tant il tait vrai que le lien social semblait
insparable du contact presque physique que lacte formaliste tablissait entre
les deux hommes.
Le devoir gnral daide et dobissance, qui simposait au vassal, lui tait
commun avec quiconque stait fait lhomme dun autre homme. Mais il
se nuanait ici dobligations particulires, sur le dtail desquelles nous aurons
revenir. Leur nature rpondait des conditions, assez troitement
dtermines, de rang et de genre de vie. Car, malgr de grandes diversits de
richesse et de prestige, les vassaux ne se recrutaient point indiffremment
parmi toutes les couches de la population. La vassalit tait la forme de
dpendance propre aux classes suprieures, que distinguaient avant tout, la
vocation guerrire et celle du commandement. Du moins, telle tait-elle
devenue. Pour en bien pntrer les caractres, il convient maintenant de
rechercher comment elle stait progressivement dgage de tout un complexe
de relations personnelles.
III. La gense des relations de dpendance personnelle
Se chercher un protecteur, se plaire protger : ces aspirations sont de
tous les temps. Mais on ne les voit gure donner naissance des institutions
juridiques originales que dans les civilisations o les autres cadres sociaux se
trouvent flchir. Tel fut le cas dans la Gaule, aprs lcroulement de lEmpire
romain.
Marc BLOCH La socit fodale
146
Imaginons, en effet, la socit de lpoque mrovingienne. Ni ltat, ni le
lignage noffraient plus dabri suffisant. La communaut villageoise navait de
force que pour sa police p.213 intrieure. La communaut urbaine existait
peine. Partout le faible prouvait le besoin de se rejeter vers un plus puissant
que lui. Le puissant, son tour, ne pouvait maintenir son prestige ou sa
fortune ni mme assurer sa scurit quen se procur ant, par persuasion ou par
contrainte, lappui dinfrieurs obligs laider. Il y avait, dune part, fuite
vers le chef ; de lautre, prises de commandement, souvent brutales. Et comme
les notions de faiblesse et de puissance ne sont jamais que relatives, on voyait,
en bien des cas, le mme homme se faire simultanment le dpendant dun
plus fort et le protecteur de plus humbles. Ainsi commena se construire un
vaste systme de relations personnelles, dont les fils entrecroiss couraient
dun tage l autre de ldifice social.
En se soumettant ainsi aux ncessits du moment, ces gnrations
navaient nullement le dsir ni le sentiment de crer des formes sociales
nouvelles. Dinstinct, chacun sefforait de tirer parti des ressources que lui
offrait larmature existante et, si lon finit, sans trop sen rendre compte, par
faire du neuf, ce fut en sefforant dadapter le vieux. Lhritage dinstitutions
ou de pratiques dont disposait la socit issue des invasions tait dailleurs
singulirement bigarr : au legs de Rome, celui aussi des peuples que Rome
avait conquis, sans jamais effacer tout fait leurs coutumes propres, les
traditions germaniques venaient se mler. Ne tombons pas ici dans lerreur de
chercher ni la vassalit, ni, plus gnralement, aux institutions fodales une
filiation ethnique particulire, de nous enfermer, une fois de plus, dans le
fameux dilemme : Rome ou les forts de la Germanie . Il faut laisser ces
jeux aux ges qui, moins instruits que nous de la puissance cratrice de
lvolution, ont pu croire, avec Boulainvilliers, que la noblesse du XVI Ie
sicle descendait, presque tout entire, des guerriers francs ou interprter, avec
le jeune Guizot, la Rvolution Franaise comme une revanche des
Gallo-Romains. Ainsi les vieux physiologistes imaginaient dans le sperme un
homunculus tout form. La leon du vocabulaire fodal est pourtant claire.
Cette nomenclature o se ctoyaient, nous le verrons, des lments de toute
origine les uns emprunts tantt la p.214 langue des vaincus, tantt celle
des vainqueurs, les autres, comme hommage mme, frapps de neuf ne
nous offre-t-elle pas le fidle miroir dun rgime social qui, pour avoir subi
fortement lempreinte dun pass, lui -mme singulirement composite, nen
fut pas moins, avant tout, le rsultat des conditions originales du moment ?
Les hommes , dit le proverbe arabe, ressemblent plus leur temps qu
leur pre.
Parmi les faibles qui se cherchaient un dfenseur, les plus misrables se
faisaient tout simplement esclaves, engageant par l, avec eux-mmes, leur
postrit. Beaucoup dautres cependant, mme parmi les humbles, tenaient
prserver leur condition dhomme libre. A un pareil dsir, les personnages qui
recevaient leur obissance navaient, le plus souve nt, gure de raisons de
Marc BLOCH La socit fodale
147
sopposer. En ce temps o les liens personnels navaient pas encore touff les
institutions publiques, jouir de ce quon appelait la libert , ctait
essentiellement appartenir, en qualit de membre de plein droit, au peuple rgi
par les souverains mrovingiens : au populus Francorum, disait-on
couramment, confondant sous le mme nom conqurants et vaincus. Ne de
cette quivalence, la synonymie des deux termes de libre et de franc
devait traverser les ges. Or, pour un chef, sentourer de dpendants pourvus
des privilges judiciaires et militaires qui caractrisaient lhomme libre tait,
beaucoup dgards, plus avantageux que de disposer seulement dune horde
servile.
Ces dpendances dordre ingnuile ainsi parle une formule
tourangelle sexprimaient laide de mots dont une grande partie venait du
plus pur stock latin. Car, travers toutes les vicissitudes dune histoire
mouvemente, les antiques usages du patronat navaient jamais disparu du
monde romain ou romanis. Dans la Gaule, en particulier, ils staient
implants dautant plus facilement quils saccordaient aux habitudes des
populations soumises. Point de chef gaulois qui, avant larrive des lgions, ne
vt graviter autour de lui un groupe de fidles, tantt paysans, tantt guerriers.
Nous savons trs mal ce qui, aprs la conqute et sous le vernis dune
civilisation cumnique, put subsister p.215 de ces anciennes coutumes
indignes. Tout conduit cependant penser que, plus ou moins profondment
modifies par la pression dun tat politique bien diffrent, elles ne
demeurrent point sans prolongements. Dans lEmpire entier, en tout cas, les
troubles des derniers temps avaient rendu plus ncessaire que jamais le
recours des autorits plus proches et plus efficaces que les institutions de
droit public. Du haut en bas de la socit, quiconque, au IVe ou au Ve sicle,
souhaitait se prmunir contre les dures exigences des agents du fisc, incliner
en sa faveur le bon vouloir des juges ou simplement sas surer une honorable
carrire ne croyait pouvoir mieux faire que de sattacher, lui libre pourtant et
dun rang parfois distingu, un personnage plus haut plac. Ignors, voire
proscrits par le droit officiel, ces liens navaient rien de lgal. Ils nen
constituaient pas moins un ciment social des plus puissants. En multipliant les
accords de protection et dobissance, les habitants de la Gaule, devenue
franque, avaient donc conscience de ne rien faire qui ne pt, dans la langue de
leurs anctres, aisment trouver un nom.
A la vrit, le vieux mot de clientle tait, rminiscences littraires part,
tomb en dsutude ds les derniers sicles de lEmpire. Mais dans la Gaule
mrovingienne, comme Rome, on continuait dire du chef quil prenait
en charge (suscipere) le subordonn, dont il se constituait par l le
patron ; du subordonn quil se commendait entendez se
remettait son dfenseur. Les obligations ainsi acceptes taient
couramment traites de service (servitium). Le mot et fait horreur,
nagure, un homme libre ; car le latin classique ne le connaissait que comme
synonyme de servitude ; les seuls devoirs qui fussent compatibles avec la
Marc BLOCH La socit fodale
148
libert taient des officia. Mais ds la fin du IVe sicle servitium avait perdu
cette tare originelle.
La Germanie, cependant, fournissait aussi son apport. La protection que le
puissant tendait sur le faible sappelait souvent mundium, mundeburdum
qui devait donner, en franais, maimbour ou encore mitium, ce dernier
terme traduisant plus particulirement le droit et la mission de reprsenter le
dpendant en justice autant de vocables p.216 germaniques, mal dguiss par
le vtement latin que leur imposaient les chartes.
A peu prs interchangeables, ces diverses expressions sappliquaient
indiffremment, quelle que ft lorigine, romaine ou barbare, des contractants.
Les rapports de subordination prive chappaient au principe des lois
ethniques, parce quils demeuraient encore en marge de tous les droits.
Ntant pas rgle ments, ils ne sen montraient que plus capables de
sadapter des situations infiniment diverses. Le roi lui -mme, qui, en tant
que chef du peuple, devait son appui tous ses sujets, indiffremment, et avait
droit leur fidlit, sanctionne par luniv ersel serment des hommes libres,
accordait nanmoins son maimbour particulier un certain nombre dentre
eux. Qui faisait tort ces personnes, places dans sa parole , semblait
loffenser directement et encourait, en consquence, un chtiment dun e
exceptionnelle svrit. Au sein de leur foule passablement bigarre, un
groupe plus restreint et plus distingu de faux royaux slevait, quon
appelait les leudes du prince, cest --dire ses gens , et qui, dans lanarchie
des derniers temps mrovingiens, disposrent plus dune fois de la couronne et
de ltat. Comme nagure Rome, le jeune homme de bonne famille qui
dsirait se pousser dans le monde se remettait un grand, moins que dj
son avenir net t ainsi assur, ds lenfance, par un pre prvoyant. En
dpit des conciles, beaucoup decclsiastiques de tout rang ne craignaient
point de rechercher le patronat de laques. Mais les couches infrieures de la
socit semblent bien avoir t celles o les relations de subordination furent
de bonne heure les plus rpandues, comme les plus astreignantes. La seule
formule de commendise que nous possdions met en scne un pauvre hre,
qui naccepte un matre que parce qu il na pas de quoi manger ni se
vtir . Point de distinction dailleu rs, ni de mots, ni mme, au moins, bien
nette, dides, entre ces divers aspects de la dpendance, si opposs, pourtant,
par leur tonalit sociale.
Quel que ft le commend, il prtait, semble-t-il, presque toujours serment
son matre. Lusage lui conse illait-il galement de se plier un acte
formaliste de soumission ? p.217 Nous le savons mal. Exclusivement attachs
aux vieux cadres du peuple et du lignage, les droits officiels sont l-dessus
muets. Quant aux accords particuliers, ils ne faisaient gure intervenir lcrit,
qui seul laisse des traces. A partir de la seconde moiti du VIIIe sicle,
cependant, les documents commencent mentionner le rite des mains dans les
Marc BLOCH La socit fodale
149
mains. Cest, vrai dire, pour nous le montrer employ, tout dabord,
seulement entre personnages du rang le plus relev : le protg est un prince
tranger ; le protecteur, le roi des Francs. Ne nous laissons point tromper par
ce parti pris dcrivains. La crmonie ne semblait mriter dtre dcrite que
lorsque associe des vnements de haute politique, elle figurait parmi les
pisodes dune entrevue princire. Dans le train ordinaire de la vie, elle passait
pour banale : donc, pour voue au silence. Certainement, elle avait t en
usage bien avant de surgir ainsi la lumire des textes. La concordance des
coutumes franques, anglo-saxonnes et scandinaves atteste son origine
germanique. Mais le symbole tait trop clair pour ne pas se faire aisment
adopter par la population entire. On le voit, en Angleterre et chez les
Scandinaves, exprimer, indiffremment, des formes trs diverses de
subordination : desclave matre, de libre compagnon chef de guerre. Tout
conduit penser quil en fut de mme, longtemps, dans la Gaule franque. Le
geste servait conclure des contrats de protection de nature variable et, tantt
accompli, tantt nglig, ne paraissait indispensable aucun. Une institution
exige une terminologie sans trop dambigut et un rituel relativement stable.
Mais, dans le monde mrovingien, les relations personnelles nt aient encore
quune pratique.
IV. Les guerriers domestiques
Un groupe de dpendants existait cependant, dores et dj distinct par ses
conditions de vie. Ctait celui que composaient, autour de chaque puissant et
du roi mme, leurs guerriers domestiques. Car le plus pressant des problmes
qui simposaient alors aux classes dirigeantes tait beaucoup moins
dadministrer, durant la paix, ltat ou p.218 les fortunes particulires que de se
procurer les moyens de combattre. Publique ou prive, entreprise de gaiet de
cur ou afin de dfendre les biens et la vie, la guerre devait, durant bien des
sicles, apparatre comme la trame quotidienne de toute carrire de chef et la
raison dtre profonde de tout pouvoir de commandement.
Lorsque les rois francs se furent rendus matres de la Gaule, ils se
trouvrent hriter de deux systmes qui, tous deux, pour former les armes,
faisaient appel aux masses : en Germanie tout homme libre tait un guerrier ;
Rome, dans la mesure o elle usait encore de troupes indignes, les recrutait,
principalement, parmi les cultivateurs du sol. Ltat franc, sous ses deux
dynasties successives, maintint le principe de la leve gnrale, qui, dailleurs,
devait traverser tout lge fodal et lui survivre. Les ordonnances royales ont
beau sefforcer de proportionner cette obligation aux fortunes, de runir les
plus pauvres en petits groupes dont chacun doit fournir un soldat. Variables
avec les exigences du moment, ces mesures dapplication pratique laissaient
intacte la rgle. De mme, les grands, dans leurs querelles, ne craignaient pas
dengager au combat leurs paysans.
Marc BLOCH La socit fodale
150
Dans les royaumes barbares, cependant, la machine du recrutement tait
lourde aux mains dune administration de moins en moins capable de suffire
sa tche bureaucratique. La conqute, dautre part, avait rompu les vieux
cadres que les socits germaniques staient donns pour le combat comme
pour la paix. Enfin, retenu par les soins dune agriculture dsormais mieux
stabilise, le Germain du commun, lpoque des migrations, guerrier plus
que paysan, devenait peu peu paysan plus que guerrier. Certes, le colon
romain de nagure, lorsque les camps lenlevaient la glbe, nen savait pas
davantage. Mais il se trouvait pris dans les rangs de lgions organises, qui le
formaient. Dans ltat franc, par contre, en dehors des gardes dont
sentouraient le roi et les grands, plus de troupes permanentes ; partant, plus
dinstruction rgulire des conscrits. Manque dempressement et inexprience
chez les recrues ; difficults darmement aussi il fallut, sous p.219
Charlemagne, interdire de se prsenter lost pourvu seulement dun bton
: ces dfauts pesrent sans doute de bonne heure sur le systme militaire de la
priode mrovingienne. Mais ils se firent de plus en plus apparents mesure
que la prpondrance, sur le champ de bataille, passa du fantassin au cavalier
pourvu dun important armement offensif et dfensif. Car, pour disposer dune
monture de guerre et squiper de pied en cap, il fallait jouir dune certai ne
aisance ou recevoir les subsides dun plus riche que soi. Selon la loi ripuaire,
un cheval valait six fois autant quun buf ; une broigne sorte de cuirasse
de peau, consolide par des plaques de mtal , le mme prix ; un heaume,
seulement moiti moins. Ne voit-on pas, en 761, un petit propritaire de
lAlmanie cder ses champs paternels et un esclave contre un cheval et une
pe ? (153). Un long apprentissage, dautre part, tait ncessaire pour savoir
manier efficacement son coursier au combat et pratiquer, sous un lourd
harnois, une difficile escrime. Dun garon lge de pubert, tu peux faire
un cavalier ; plus tard, jamais. La maxime tait, sous les premiers
Carolingiens, passe en proverbe (154).
Pourquoi, cependant, cette dcadence du fantassin, dont les rpercussions
sociales devaient tre si considrables ? On a parfois cru voir en elle un effet
des invasions arabes : afin de soutenir le choc des cavaliers sarrasins ou de les
poursuivre, Charles Martel et transform ses Francs en hommes de cheval.
Lexagration est manifeste. A supposer mme ce qui a t contest que
la cavalerie jout alors dans les armes de lIslam un rle si dcisif, les Francs,
qui de tout temps avaient possd des troupes montes, navaient pas attendu
Poitiers pour leur faire une place croissante. Lorsquen 755 la runion
annuelle des grands et de lost fut transporte, par Ppin, du mois de mars au
mois de mai, qui est le temps des premiers fourrages, cette mesure
significative marqua seulement le point daboutissement dune volution qui
se prolongeait depuis plusieurs sicles. Commune au plus grand nombre des
royaumes barbares et lEmpire dOrient mme, les raisons nen ont pas
toujours t trs bien comprises, dune part faute davoir p.220 suffisamment
pes certains facteurs techniques, de lautre parce que, sur le terrain propre de
Marc BLOCH La socit fodale
151
lart militaire, lattention sest trop exclusivement porte vers la tactique du
combat, au dtriment de ses approches et de ses suites.
Ignors des socits mditerranennes classiques, ltrier et le fer cheval
napparaissent pas, dans les documents figurs de lOccident, avant le I Xe
sicle. Mais il semble bien que limage ici ait t en retard sur la vie. Invent,
probablement, chez les Sarmates, ltrier fut, notre Europe, un cadeau des
nomades de la steppe eurasiatique et son emprunt un des effets du contact que
lpoque des invasions tablit, beaucoup plus troit quauparavant, entre les
sdentaires de lOuest et c es civilisations questres des grandes plaines : tantt
directement, grce aux migrations des Alains, fixs nagure au nord du
Caucase et dont plusieurs fractions, entranes par le flot germanique,
trouvrent asile au cur de la Gaule ou de lEspagne ; tantt et surtout par
lintermdiaire de ceux des peuples germaniques qui, comme les Goths,
avaient vcu quelque temps aux abords de la mer Noire. Le fer cheval, lui
aussi, vint vraisemblablement de lOrient. Or la ferrure facilitait
singulirement les chevauches et les charges, sur les plus mauvais terrains.
Ltrier, de son ct, npargnait pas seulement la fatigue du cavalier ; en lui
donnant une meilleure assiette, il accroissait lefficacit de son lan.
Quant au combat, la charge cheval en devint assurment un des modes
les plus frquents. Non le seul. Lorsque les conditions du terrain lexigeaient,
les cavaliers mettaient pied terre et se faisaient provisoirement, pour
lassaut, fantassins ; lhistoire militaire de lre fodale abonde en exemp les
de cette tactique. Mais, en labsence de routes convenables ou de troupes
dresses ces manuvres savamment coordonnes qui avaient fait la force
des lgions romaines, le cheval seul permettait de mener bien, tantt les
longues randonnes quimposai ent les guerres entre les princes, tantt les
brusques gurillas auxquelles se plaisait le commun des chefs ; darriver vite
et sans trop de fatigue, travers labours et fondrires, sur le champ de
bataille ; dy dconcerter ladversaire par des mouvement s inattendus ; p.221
voire, si la chance tournait mal, dchapper au massacre par une fuite
opportune. Lorsquen 1075, les Saxons furent dfaits par Henri IV
dAllemagne, la noblesse dut lagilit de ses montures de subir des pertes
bien moins lourdes que la pitaille paysanne, incapable de se drober assez
rapidement la boucherie.
Tout conspirait donc, dans la Gaule franque, rendre de plus en plus
ncessaire lappel des guerriers professionnels, instruits par une tradition de
groupe et qui fussent, avant tout, des cavaliers. Bien que le service de cheval,
au profit du roi, ait continu, presque jusquau terme du I Xe sicle, tre
exig, en principe, de tous les hommes libres assez riches pour pouvoir y tre
soumis, le noyau de ces troupes montes, exerces et bien quipes, qui
taient les seules dont on attendait une relle efficacit, fut naturellement
fourni par les suivants arms, depuis longtemps rassembls autour des princes
et des grands.
Marc BLOCH La socit fodale
152
Dans les anciennes socits germaniques, si les cadres des associations
consanguines et des peuples suffisaient au jeu normal de lexistence, lesprit
daventure ou dambition, par contre, navait jamais pu sen contenter. Les
chefs, les jeunes chefs surtout groupaient autour deux des compagnons
(en vieil allemand gisind, au propre : compagnon dexpdition ; Tacite a rendu
le mot, trs exactement, par le latin comes). Ils les conduisaient au combat et
au pillage ; durant les repos, ils leur donnaient lhospitalit dans les grands
halls de bois, propices aux longues beuveries. La petite troupe faisait la
force de son capitaine dans les guerres ou les vendettas ; elle assurait son
autorit dans les dlibrations des hommes libres ; les largesses de
nourriture, desclaves, danneaux dor quil rpan dait sur elle constituaient
un lment indispensable de son prestige. Tel, Tacite nous dpeint le
compagnonnage, dans la Germanie du Ier sicle ; tel, il revit encore, bien des
sicles plus tard, dans le pome de Beowulf, et, au prix de quelques variantes
invitables, dans les vieilles sagas scandinaves.
Une fois tablis dans les dbris de la Romania, les chefs barbares
renoncrent dautant moins ces pratiques que, dans le monde o ils venaient
de pntrer, lusage des soldats p.222 privs florissait depuis longtemps. Aux
derniers sicles de Rome, il ntait gure de membre de la haute aristocratie
qui net les siens. On les appelait souvent buccellarii, du nom du biscuit
(buccella) qui, meilleur que le pain de munition ordinaire, leur tait
gnralement distribu : soudoyers dailleurs beaucoup plutt que
compagnons, mais assez nombreux et assez loyaux pour que ces escortes
personnelles, autour de matres devenus gnraux de lEmpire, aient pu tenir
dans les forces en ligne une place qui souvent fut de premier plan.
Parmi les troubles de lpoque mrovingienne, lemploi de pareilles suites
armes devait plus que jamais simposer. Le roi avait sa garde, quon appelait
sa truste , et qui, de tout temps, avait t, en grande partie du moins,
monte. De mme, ses principaux sujets, quils fussent francs ou romains
dorigine. Il ntait pas jusquaux glises qui ne jugeassent ncessaires
dassurer ainsi leur scurit. Ces gladiateurs , comme dit Grgoire de
Tours, formaient des troupes assez mles, o ne manquaient point les
aventuriers de sac et de corde. Les matres ne craignaient pas dy enrler les
plus vigoureux de leurs esclaves. Les hommes libres, cependant, semblent
bien y avoir t les plus nombreux. Mais eux-mmes nappartenaient pas
toujours, par leur naissance, aux conditions les plus releves. Sans doute le
service comportait-il plus dun degr, dans la considration et dans la
rcompense. Il est nanmoins significatif quau VI Ie sicle, une mme formule
dacte ait pu servir indiffremment po ur la donation dune petite terre en
faveur dun esclave ou dun gasindus.
Dans ce dernier terme, on reconnat le vieux nom du compagnon de guerre
germain. Il parat en effet avoir couramment servi dsigner, dans la Gaule
mrovingienne, comme daill eurs dans lensemble du monde barbare,
lhomme darmes priv. Progressivement cependant, il cda la place un mot
Marc BLOCH La socit fodale
153
indigne : celui de vassal (vassus, vassallus), quattendait un si bel avenir. Ce
nouveau venu ntait pas n romain. Il tait celte, par ses origines (155). Mais il
avait assurment pntr dans le latin parl de la Gaule bien avant quon ne le
trouve crit, pour la premire fois, dans la Loi p.223 Salique : car lemprunt
navait pu se faire quau temps, fort loign de celui de Clovis, o sur notre
sol vivaient encore, ct de populations gagnes la langue de Rome, des
groupes importants qui taient demeurs fidles celle des anctres. Vnrons
donc en lui, si lon veut, un de ces fils authentiques des Gaules, d ont la vie se
prolonge dans les couches profondes du franais. Que ce soit, toutefois, en
nous gardant de conclure de son adoption par le lexique fodal je ne sais
quelle lointaine filiation de la vassalit militaire. Certes, la socit gauloise,
avant la Conqute, comme les socits celtes en gnral, avait pratiqu un
systme de compagnonnage , beaucoup dgards voisin de celui de
lancienne Germanie. Mais quelles quaient pu tre, sous la superstructure
romaine, les survivances de ces usages, un fait est certain : les noms du
client arm, tels que Csar nous les rvle ambacte ou, dans
lAquitaine, soldurius , disparurent sans laisser de traces (156). Le sens de
vassal, au moment de son passage dans le latin vulgaire, tait singulirement
plus humble : jeune garon cette signification devait se perptuer durant
tout le moyen ge dans le diminutif valet et aussi, par un glissement
smantique dont le latin puer avait connu lanalogue, esclave domestique.
Ceux que le matre a constamment autour de lui, ne les appelle-t-il pas
naturellement ses gars ? Cette seconde valeur est celle que continuent
donner au mot, dans la Gaule franque, divers textes chelonns du VIe au
VIIIe sicle. Puis, peu peu, une acception nouvelle se dgagea, quon voit, au
VIIIe sicle, concurrencer la prcdente, et au sicle suivant, sy substituer.
Plus dun esclave de la maisonne tait honor par son admission dans la
garde. Les autres membres de cette cohorte, sans tre esclaves, nen vivaient
pas moins dans la demeure du matre, vous le servir de mille manires et
recevoir directement ses ordres. Ils taient, eux aussi, ses gars . Ils furent
donc compris, avec leurs camarades de naissance servile, sous le nom de
vassaux, dsormais spcialis dans la signification de suivants darmes. Enfin
ltiquette nagure commune, voquant une estimable familiarit, fut rserve
aux seuls hommes libres de la troupe. p.224 Or cette histoire dun mot, sorti des
bas-fonds de la servitude pour se charger peu peu dhonneur, traduit la
courbe mme de linstitution. Si modeste que ft, lorigine, la condition de
beaucoup de sicaires entretenus par les grands et mme par le roi, elle nen
contenait pas moins, ds ce moment, de srieux lments de prestige. Les
liens qui unissaient ces compagnons de guerre leur chef taient un de ces
contrats de fidlit librement consentis qui saccordaient avec les situations
sociales les plus respectables. Le terme qui dsignait la garde royale est
pleinement significatif : truste, cest --dire foi. La nouvelle recrue admise
dans cette troupe jurait fidlit ; le roi, en retour, sengageait lui porter
secours . Ctaient les principes mmes de toute commendise . Sans doute
les puissants et leurs gasindi ou vassaux changeaient-ils des promesses
Marc BLOCH La socit fodale
154
analogues. Etre protg par un haut personnage offrait, dailleurs, une garantie
non seulement de scurit, mais encore de considration. A mesure que, dans
la dcomposition de ltat, tout gouv ernant devait chercher ses aides de plus
en plus exclusivement parmi les hommes qui lui taient directement attachs,
que dans la dcadence des vieilles murs militaires lappel au guerrier de
mtier devenait chaque jour plus ncessaire et plus admire la fonction de
quiconque portait les armes, il apparut, avec une force croissante, que, de
toutes les formes de la subordination dindividu individu, la plus leve
consistait servir de lpe, de la lance et du cheval, un matre dont on stait
solennellement dclar le fal.
Mais dj commenait se faire sentir une influence qui, en agissant
profondment sur linstitution vassalique, devait, dans une large mesure, la
faire dvier de son orientation premire. Ce fut lintervention, dans ces
rapports humains jusque-l trangers ltat, dun tat sinon nouveau, du
moins rnov : celui des Carolingiens.
V. La vassalit carolingienne
De la politique des Carolingiens par o il convient, comme
lordinaire, dentendre, ct des desseins personnels d e princes dont
quelques-uns dailleurs furent des p.225 hommes remarquables, les vues de
leurs tats-majors , on peut dire quelle fut domine la fois par des
habitudes acquises et par des principes. Issus de laristocratie, arrivs au
pouvoir la suite dun long effort contre la royaut traditionnelle, avait t
en groupant autour deux des troupes de dpendants arms et en imposant leur
maimbour dautres chefs que les premiers de la race staient peu peu
rendus les matres du peuple franc. Comment stonner si, une fois au pinacle,
ils continurent tenir pour normaux les liens de cette nature ? Dautre part
leur ambition, depuis Charles Martel, fut de reconstituer cette force publique
quils avaient dabord, avec leurs pairs, contribu dtru ire. Ils voulaient faire
rgner, dans leurs tats, lordre et la paix chrtienne. Ils voulaient des soldats
pour tendre au loin leur domination et mener contre les infidles la Guerre
Sainte, gnratrice de puissance et fructueuse pour les mes.
Or les anciennes institutions paraissaient insuffisantes cette tche. La
monarchie ne disposait que dun petit nombre dagents, dailleurs peu srs et
quelques hommes dglise mis part dpourvus de tradition et de
culture professionnelles. Aussi bien, les conditions conomiques
interdisaient-elles linstitution dun vaste systme de fonctionnariat salari.
Les communications taient longues, mal commodes, incertaines. La
principale difficult que rencontrait donc ladministration centrale tait
datteindre les individus, pour en exiger les services dus et exercer sur eux les
sanctions ncessaires. Do, lide dutiliser aux fins du gouvernement le
Marc BLOCH La socit fodale
155
rseau des rapports de subordination dj si fortement constitus ; le seigneur,
tous les degrs de la hirarchie, devenant le rpondant de son homme ,
serait charg de le maintenir dans le devoir. Les Carolingiens neurent point le
monopole de cette conception. Elle avait dj inspir la monarchie
visigothique dEspagne plusieurs prescriptions lgislatives ; nombreux la
cour franque, aprs linvasion arabe, les rfugis espagnols contriburent
peut-tre y faire connatre et apprcier ces principes. La mfiance trs vive
que les lois anglo-saxonnes devaient plus tard tmoigner lhomme sans
seigneur traduit des partis pris analogues. Mais rarement pareille politique
fut plus p.226 consciemment poursuivie, et serait-on tent dajouter
pareille illusion fut entretenue avec plus desprit de suite que dans le royaume
franc, aux alentours de lan 800. Que chaque chef exerce une action
coercitive sur ses infrieurs, afin que ceux-ci, de mieux en mieux, obissent,
dun cur consentant, aux mandements et prceptes impriaux (157) : cette
phrase dun capitulaire de 810 rsume, en un raccourci expressif, une des
maximes fondamentales de ldifice bti par Ppin et Charlemagne. Ainsi, en
Russie, au temps du servage, le tsar Nicolas Ier se vantait, dit-on, davoir en
ses pomiechtchiks, seigneurs des villages, cent mille commissaires de
police .
La plus urgente des mesures, dans cet ordre dide, tait videmment
dintgrer dans la loi les relations vassaliques et, du mme coup, de leur
confrer la stabilit qui seule pouvait en faire un ferme appui. De bonne heure,
les commends de rang infrieur avaient engag leur vie tel laffam de la
formule tourangelle. Mais si, depuis longtemps sans doute, soit quils
leussent expressment promis, soit que les murs ou leurs intrts leur en
fissent une obligation, on avait vu, en pratique, beaucoup de compagnons de
guerre servir, eux aussi jusqu la mort, rien ne prouve que sous les
Mrovingiens cette rgle et t le moins du monde gnrale. En Espagne, le
droit visigothique ne cessa jamais de reconnatre aux soldats privs la facult
de changer de matre car, disait la loi, lhomme libre garde toujours le
pouvoir de sa personne . Sous les Carolingiens, au contraire, divers dits
royaux ou impriaux se proccuprent de dterminer avec prcision les fautes
qui, commises par le seigneur, justifiaient, de la part du vassal, la rupture du
contrat. Ctait dcider que, ces cas excepts et sous rserve dune sparation
par consentement mutuel, le lien tait, la vie durant, indissoluble.
Le seigneur, dautre part, fut officiellement charg , sous sa responsabilit,
dassurer la comparution du vassal devant les tribunaux et larme. Prenait -il
part lui-mme lost ? Ses vassaux combattaient sous ses ordres. Ce ntait
quen son absence quils passaient sous le commandement direct du
reprsentant du roi : le comte.
A quoi bon cependant prtendre se servir ainsi des seigneurs pour
atteindre les vassaux, si ces seigneurs, leur tour, ne se trouvaient solidement
lis au souverain ? Ce fut en sefforant de raliser cette indispensable
condition de leur grand dessein que les Carolingiens contriburent tendre
p.227
Marc BLOCH La socit fodale
156
lextrme les applications sociales de la vassalit. Une fois au pouvoir, ils
avaient d rcompenser leurs hommes . Ils leur distriburent des terres,
selon des procds que nous aurons prciser plus tard. En outre, maires du
palais, puis rois, ils furent amens, pour se procurer les appuis ncessaires,
pour se constituer une arme surtout, attirer dans leur dpendance, souvent
l encore moyennant dons de terres, une foule de personnages, pour la plupart
dj relativement haut placs. Les anciens membres de la suite militaire,
tablis sur les biens concds par le prince, ne cessrent pas dtre tenus pour
ses vassaux. Le mme lien fut considr comme lui unissant ses nouveaux
fidles, qui navaient jamais t ses compagnons. Les uns et les autres le
servaient larme, suivis, sils en avaient, de leurs propres vassaux. Mais,
appels passer loin de lui la plus grande partie de leurs jours, leurs
conditions de vie taient profondment diffrentes de celles des guerriers
domestiques de nagure. En revanche, centre chacun dun groupe plus ou
moins tendu de dpendants, on attendait deux quils maintinssent ces
gens-l dans lordre ; au besoin mme quils exerassent sur leur s voisins une
surveillance analogue. Ainsi, parmi les populations de limmense Empire, se
distingua une classe, elle-mme proportionnellement fort nombreuse, de
vassaux du Seigneur entendez du Seigneur Roi (vassi dominici) ,
qui, jouissant de la protection particulire du souverain et chargs de lui
fournir une grande part de ses troupes, devaient former en outre, travers les
provinces, comme les mailles dun vaste rseau de loyaut. Lorsquen 871,
ayant triomph de son fils Carloman, Charles le Chauve voulut faire rentrer
dans le devoir les complices du jeune rebelle, il ne crut pouvoir mieux y
russir quen les obligeant se choisir chacun un seigneur, leur gr, parmi
les vassaux royaux.
Il y eut plus : ce lien de vassalit, dont lexprie nce p.228 semblait prouver
la force, les Carolingiens savisrent de lemployer sassurer la fidlit
ternellement chancelante de leurs fonctionnaires. Ceux-ci avaient toujours
t conus comme placs sous le maimbour spcial du souverain ; ils lui
avaient toujours prt serment ; ils taient, de plus en plus frquemment,
recruts parmi des hommes qui, avant de recevoir de lui cette mission,
lavaient servi comme vassaux. La pratique peu peu se gnralisa. Au moins
partir du rgne de Louis le Pieux, il nest plus de charge de cour ni de grand
commandement, plus de comt notamment, dont le titulaire nait d, au plus
tard son entre en dignit, se faire, jointes mains, le vassal du monarque. Des
princes trangers eux-mmes, sils reconnaissent l e protectorat franc, on
exige, ds le milieu du VIIIe sicle, quils se soumettent cette crmonie et
on les dit, leur tour, les vassaux du roi ou de lempereur. Certes, de tous ces
hauts personnages nul nattendait que, comme les suivants dautrefois, ils
montassent la garde dans la demeure du matre. A leur faon pourtant, ils
appartenaient sa maison militaire, puisquils lui devaient, avant tout, avec
leur foi, laide de guerre.
Marc BLOCH La socit fodale
157
Or les grands, de leur ct, staient depuis longtemps habitus vo ir dans
les bons compagnons qui formaient leurs bandes des hommes de confiance,
prts aux missions les plus diverses. Un emploi lointain, le don dune terre, un
hritage amenait-il un de ces loyaux garons abandonner le service
personnel ? Le chef nen c ontinuait pas moins le tenir pour son fal. L
encore, en un mot, la vassalit, par un mouvement spontan, tendait
chapper au cercle troit du foyer seigneurial. Lexemple des rois, linfluence
des rgles de droit quils avaient promulgues stabilisr ent ces mouvants
usages. Seigneurs comme subordonns ne pouvaient manquer daller
naturellement vers une forme de contrat qui, dsormais, tait pourvue de
sanctions lgales. Par les liens de la vassalit les comtes sattachrent les
fonctionnaires dordre infrieur ; lvque ou labb, les laques quils
chargeaient de les aider rendre la justice ou de conduire larme leurs
sujets. Les puissants, quels quils fussent, sefforaient dattirer ainsi dans leur
orbite des p.229 foules croissantes de petits seigneurs, qui leur tour agissaient
de mme envers de moins forts encore. Ces vassaux privs formaient une
socit mlange, qui comportait encore des lments assez humbles. Parmi
ceux que les comtes, les vques, les abbs et les abbesses sont autoriss
laisser au pays, lorsque lost est convoqu, il en est auxquels, comme des
vassi dominici au petit pied, sera remis le noble soin de maintenir la paix.
Dautres, en revanche, plus modestement, garderont la maison du matre,
prsidant aux moissons, surveillant la domesticit (158). Du moins taient-ce l
dj des fonctions de commandement, partant respectables. Autour des chefs
de tout rang, comme autour des rois, le service purement domestique
dautrefois avait fourni le mo ule o venait dsormais se couler toute sujtion
qui ne ft point sans honneur.
VI. Llaboration de la vassalit classique
Vint leffondrement de ltat carolingien : rapide et tragique dfaite dune
poigne dhommes qui, au prix de beaucoup darchasm es et de maladresses,
mais avec une immense bonne volont, staient efforcs de prserver
certaines valeurs dordre et de civilisation. Alors souvrit une longue priode
de troubles et en mme temps de gestation. La vassalit devait dfinitivement
y prciser ses traits.
Dans ltat de guerre permanent o dsormais vit lEurope invasions,
querelles intestines , plus que jamais lhomme cherche un chef, les chefs
cherchent des hommes. Mais lextension de ces rapports de protection a cess
de soprer au p rofit des rois. Ce sont les hommages privs qui dsormais vont
se multipliant. Autour des chteaux, notamment, qui, depuis les incursions
scandinaves ou hongroises, slvent de plus en plus nombreux dans les
campagnes, les seigneurs, qui, en leur propre nom ou au nom dun plus
puissant queux, commandent ces ferts, sefforcent de grouper des vassaux,
Marc BLOCH La socit fodale
158
chargs den assurer la garde. Le roi na plus du roi que le nom et la
couronne... il nest capable de dfendre contre les dangers qui les menacent ni
ses p.230 vques, ni ses autres sujets. Aussi voit-on les uns et les autres sen
aller, mains jointes, servir les grands. Par l ils obtiennent la paix. Tel est le
tableau que, vers 1016, un prlat allemand traait de lanarchie au royaume de
Bourgogne. En Artois, au sicle suivant, un moine explique pertinemment
comment, dans la noblesse , seuls un petit nombre dhommes ont pu,
vitant les liens des dominations seigneuriales, demeurer soumis
uniquement aux sanctions publiques . Encore convient-il visiblement
dentendre ici par ce dernier terme moins lautorit monarchique, beaucoup
trop lointaine, que celle du comte, dpositaire, la place du souverain, de ce
qui restait de puissance suprieure, par son essence, aux subordinations
personnelles (159).
Ctait, cela va de soi, du haut en bas de la socit et non pas seulement
parmi ces nobles dont parle notre moine, que se propageait ainsi la
dpendance. Mais entre ses diverses formes, caractrises par des atmosphres
sociales diffrentes, la ligne de dmarcation que lpoque carolingienne avait
commenc de tirer acheva de se creuser.
Certes le langage, les murs mmes conservrent longtemps bien des
vestiges de lancienne confusion. Quelques groupes de trs modestes sujet s
seigneuriaux, vous aux travaux mpriss de la terre et astreints des charges
que lon considrait dores et dj comme serviles, continurent jusquau XI Ie
sicle porter ce nom de commends que, non loin deux, la Chanson de
Roland appliquait aux plus hauts vassaux. Des serfs, parce quils taient les
hommes de leur seigneur, on disait frquemment quils vivaient dans son
hommage . Il ntait pas jusqu lacte formaliste par o un individu se
reconnaissait serf dun autre qui ne ft dsig n quelquefois par ce nom, voire
ne rappelt, et l, en son rituel, les gestes caractristiques de lhommage
de mains (160).
Cet hommage servile, cependant, l o il avait lieu, sopposait celui des
vassaux par un contraste dcisif ; il navait pas besoin dtre renouvel de
gnration en gnration. Car on en tait venu distinguer, de plus en plus
nettement, deux faons dtre attach un chef. Lune est hrditaire. Elle est
marque par toute espce dobligations p.231 qui sont tenues pour de nature
assez basse. Surtout, parce quelle exclut tout choix dans la sujtion, elle passe
pour contraire ce que maintenant on appelle libert . Cest le servage, o
ont gliss la plupart des commends dordre infrieur, en d pit du caractre
ingnuile dont, originellement, en un temps o les classifications sociales
rpondaient des principes diffrents, leur soumission avait t affecte.
Lautre attache, qui se nomme vassalit, ne dure en droit, sinon en fait, que
jusquau jour o prendra fin lune ou lautre des deux vies ainsi lies. Par ce
trait mme, qui lui pargne la choquante allure dune contrainte hrite avec le
sang, elle convient lhonorable service de lpe. La forme daide quelle
comporte est, en effet, essentiellement guerrire. Par une synonymie
Marc BLOCH La socit fodale
159
caractristique, les chartes latines, depuis la fin du IXe sicle, disent, peu
prs indiffremment, dun homme quil est le vassal ou le miles de son
seigneur. A la lettre, le second terme devrait se traduire par soldat . Mais
les textes franais, ds leur apparition, le rendront par chevalier et ctait
certainement cette expression de la langue non crite que dj les notaires
dautrefois avaient eue en tte. Le soldat par excellence tait celui qui servait
cheval, avec le grand harnois de guerre, et la fonction du vassal consistait
avant tout combattre, quip de la sorte, pour son matre. Si bien que, par un
autre avatar du vieux mot, nagure si humble, le langage usuel finira par
dnommer couramment vasselage la plus belle des vertus que pt
reconnatre une socit perptuellement sous les armes ; savoir, la bravoure.
La relation de dpendance ainsi dfinie se contracte par lhommage manuel,
dsormais spcialis, ou peu sen faut, dans ce rle. Mais ce rite de profonde
ddition sest, depuis le Xe sicle, semble-t-il, gnralement complt par
ladjonction du baiser, qui, mettant les deux individus sur un mme plan
damiti, confre la subordination du type vassalique plus de dignit. De
fait, elle nengage plus que des personnages dun rang distingu, parfois
mme trs lev. Issue, par une lente diffrenciation, de lantique et disparate
commendise, la vassalit militaire en reprsentait, dfinitivement, laspect le
plus haut.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
160
CHAPITRE II
Le fief
I. Bienfait et fief : la tenure-salaire
Parmi les commends de lpoque franque, la plupart nattendaient
pas seulement de leur nouveau matre sa protection. A ce puissant, qui tait en
mme temps un riche, ils demandaient aussi de les aider vivre. Depuis saint
Augustin, dcrivant, vers la fin de lEmpire, les pauvres la recherche dun
patron qui leur fournt de quoi manger , jusqu la formule mrovingienne
que nous avons plus dune fois cite, le mme obsdant appel s e fait
entendre : celui du ventre creux. Le seigneur, de son ct, navait point pour
unique ambition de dominer les personnes ; travers elles, ctaient les biens
que souvent il sefforait datteindre. Ds lorigine, en un mot, les relations de
dpendance eurent leur aspect conomique. La vassalit, comme les autres.
Les largesses du chef ses compagnons de guerre semblaient si essentielles au
lien que frquemment, lpoque carolingienne, la remise de quelques
prsents un cheval, des armes, des bijoux formait la contrepartie
presque rituelle du geste de ddition personnelle. Les capitulaires
interdisent-ils au vassal de rompre lattache ? Cest, aux termes de lun deux,
sous la rserve que lhomme ait dj reu de son seigneur la valeur dun sou
dor. Le seul vrai matre tait celui qui avait donn.
p.233
Or, au chef dun groupe de vassaux, comme tout employeur, les
conditions gnrales de lconomie ne p.234 laissaient gure le choix quentre
deux modes de rmunration. Il pouvait, retenant lhomme dans sa demeure,
le nourrir, le vtir, lquiper ses frais. Ou bien, lui attribuant une terre ou du
moins des revenus fixes tirs du sol, sen remettre lui du soin de pourvoir
son propre entretien : le chaser , disait-on, dans les pays de langue
franaise, mot mot le doter de sa maison particulire (casa). Reste savoir
selon quels modes, dans ce dernier cas, devait soprer la concession.
Le simple don, sans clause qui abolt ou limitt lhrdit, semble avoir
t, aux poques anciennes, assez largement pratiqu. Cest sous cette forme
que lon voit, dans une formule du VI Ie sicle, un chef remettre son
compagnon un petit domaine ; et, plus tard encore, les trois fils de Louis le
Pieux manifester, maintes reprises, leur gnrosit envers leurs vassaux,
dans le dessein avou de les maintenir dans le devoir et non sans se rserver
parfois la facult de rvoquer la donation, si cette attente devait tre trompe.
Cependant, les biens rgulirement distribus par le seigneur aux gens de sa
Marc BLOCH La socit fodale
161
suite ayant la nature dune solde, beaucoup plus que dune rcompense, il
importait quils lui fissent retour sans difficults, ds que le service cessait
dtre rendu : au plus tard, par consquent, quand la mort venait rompre le
lien. En dautres termes , la vassalit ne se transmettant point par le sang, la
rmunration du vassal ne pouvait non plus, sans paradoxe, revtir un
caractre hrditaire.
A de pareilles concessions foncires, par dfinition transitoires et qui,
originellement du moins, taient dpourvues de toute garantie, ni le droit
romain officiel, ni la coutume germanique, avec leurs rigides systmes de
contrats bilatraux, noffraient de prcdents. Par contre, la pratique, dans
lEmpire, avait dj, sous linfluence des puissants, largeme nt dvelopp ce
genre daccords, naturellement associs lusage du patronat, puisquils
faisaient dpendre du matre lentretien du protg. Leur terminologie, comme
il va presque de soi pour des institutions en marge de la lgalit, tait assez
flottante. On parlait de precarium cause de la prire (preces) qui manait
ou tait cense maner p.235 du donataire ou encore de bienfaits
(beneficium). Que la loi, ignorant ces conventions, ne fournt pas au bailleur le
moyen dexiger devant les tribun aux la prestation des charges auxquelles,
ordinairement, il soumettait le bien, peu lui importait, puisquil avait toujours
la facult de reprendre ce qui ntait, en principe, quun don de pure grce.
Lun et lautre mot continurent dtre employs dans la Gaule franque. Celui
de precarium, toutefois, au prix dun avatar grammatical, qui a beaucoup fait
rver les historiens. Du neutre, il passa au fminin : precaria. Simple cas
particulier, selon toute apparence, dun phnomne linguistique fort rpandu
dans le bas-latin ; celui qui, par une contamination ne de la dsinence en a
des pluriels neutres, a fait, entre autres, de folium notre feuille . La
transformation fut ici facilite par lattirance quexera le nom mme de la
requte adresse par le qumandeur : lettre de prire , [epistola] precaria.
Prcaire, bienfait ; les deux termes semblent avoir t dabord peu
prs indiffremment usits. Mais, mesure que la prcaire, incorporant des
lments emprunts au droit de louage, slaborait peu peu en un contrat de
contours assez stricts, on tendit en rserver le nom aux concessions
accordes moyennant redevance. Ltiquette de bienfait , au contraire, la
fois plus vague et plus honorable, puisquelle ne suggrait pas lide dune
supplication, fut affecte de prfrence aux libralits provisoires, consenties,
moyennant service, en faveur des personnes attaches aux maisons
seigneuriales et notamment des vassaux. Un vnement, dune importance
considrable, contribua fixer la distinction. Pour se procurer les terres
destines leur obtenir lappui de nombreux fidles, les Carolingiens
puisrent, sans vergogne, dans limmense fortune du clerg. La premire
spoliation, sous Charles Martel, avait t brutale. Ses successeurs ne
renoncrent point ces rquisitions ; mais, rgularisant du mme coup
lopration passe et celles du prsent comme de lavenir, ils se proccuprent
de rserver, en quelque mesure, les droits des lgitimes propritaires.
Marc BLOCH La socit fodale
162
Lvque ou le monastre, sur le sol do nt il leur tait impos de cder au
vassal p.236 royal la jouissance, en principe viagre, percevraient dsormais un
certain loyer ; au roi, allait le service. Le bien, au regard de lglise, tait donc,
juridiquement, une prcaire. Du roi, lhomme le tena it en bienfait .
Lusage de ce dernier mot, pour dsigner les terres concdes en change
dun service et notamment du service vassalique, devait se perptuer, dans le
latin des chancelleries et des chroniqueurs, jusquen plein XI Ie sicle. A la
diffrence cependant des termes juridiques vraiment vivants, tels que
commend, beneficium na donn aucun driv dans les langues romanes :
preuve quattard dans le vocabulaire, ptri de rminiscences, quaimaient les
clercs, il avait depuis longtemps, dans le langage parl, t relay par un autre
nom. Durant les ges fodaux, peut-tre ds le IXe sicle, lorsque les scribes
franais crivaient beneficium, ils pensaient fief .
Malgr quelques difficults dordre phontique qui, au reste, atteignent
moins les formes romanes que leurs transcriptions latines, lhistoire de ce
vocable fameux est claire (161). Les langues germaniques anciennes
possdaient toutes un mot qui, lointainement apparent au latin pecus, servait,
tour tour ou selon les parlers, dsigner tantt les biens mobiliers en
gnral, tantt la forme alors la plus rpandue comme la plus prcieuse de ces
biens : le btail. Lallemand, qui lui a fidlement gard la seconde de ces
significations, le possde encore de nos jours et lcrit : Vieh. Le gallo-roman,
lempruntant aux envahisseurs germains, en a fait fief (en provenal feu).
Ce fut dabord pour lui maintenir lun au moins de ses sens traditionnels : le
plus large, celui de biens meubles. Cette acception est encore atteste,
jusquau dbut du Xe sicle, par diverses chartes bourguignonnes. Un
personnage, nous dit-on, a acquis une terre. Le prix a t stipul selon ltalon
montaire ordinaire. Mais lacheteur ne dispose point, en numraire, de cette
somme. Il paye donc, conformment un usage alors courant, en objets de
valeur quivalente. Ce que les textes expriment ainsi : Nous avons reu de
toi le prix convenu, en feos apprcis la valeur de tant de livres, sous ou
deniers (162). La comparaison avec dautres documents p.237 prouve quil
sagissait habituellement darmes, de vtements, de chevaux, parfois de
vivres. Ctait peu prs la matire des distributions que touchaient les
suivants entretenus dans la maison du matre ou quips par ses soins. L
aussi, nen doutons pas, on parlait de feos.
Mais, issu de langues que dans la Gaule romane personne ne comprenait
plus, coup par suite de tous liens avec lensemble du vocabulaire qui lavait
primitivement paul, ce terme devait scarter aisment de son contenu
tymologique. Dans les maisonnes seigneuriales o il tait dusage quotidien,
on saccoutuma nen plus retenir que lide de la rmunration, en soi, sans
accorder dsormais dattention la nature, mobilire ou im mobilire, des
dons. Un compagnon, nourri jusque-l par le chef, recevait-il de lui une terre ?
Celle-ci, tait, son tour, dite le feus de lhomme. Puis, comme la terre tait
devenue peu peu le salaire normal du vassal, ce fut cette forme de
Marc BLOCH La socit fodale
163
rtribution, lexclusion de toute autre, que finalement le vieux nom, parti
dune signification exactement oppose, se trouva rserv. Ainsi quil est
arriv plus dune fois, lvolution smantique sachevait en contresens. De ces
fiefs, vassaliques et terriens, le plus ancien exemple qui ait perc dans les
documents crits appartient lextrme fin du I Xe sicle (163). Nous le devons
une de ces chartes mridionales qui, rdiges par des clercs ignorants,
faisaient au vocabulaire parl une place alors exceptionnellement large.
Suivent, au sicle suivant, quelques autres textes galement languedociens.
Plus soucieuses de purisme, les chancelleries de la Bretagne, de la France du
Nord et de la Bourgogne se rsignrent seulement un peu avant ou un peu
aprs lan mil cder, sur ce point, la pression de la langue commune.
Encore fut-ce souvent, dans les premiers temps, en rduisant le mot populaire
au rang dune glose, destine rendre clair tous le terme classique. Le
bienfait (beneficium), que lon appelle vulgairement fief , dit, en 1087, un
acte du Hainaut (164).
Dans les pays dexpression germanique, cependant, Vieh conservait son
sens de btail, exclusif de plus nobles acceptions. A la vrit, rien nempchait
la langue des p.238 chartes demprunter aux notaires de la Gaule lun ou lautre
des calques latins dont leur ingniosit avait pourvu le fief roman ; le plus
rpandu dentre eux, feodum, fut familier aux chancelleries allemandes
comme celles du royaume captien. Mais, pour rendre une ralit
quotidienne, la langue vulgaire avait besoin dun mot elle. Les distributions
de terre dont bnficiaient les hommes de service tant, en principe,
provisoires, lhabitude se prit de les dsigner par un substantif tir dun verbe
trs courant dont la signification tait : cder temps, prter. Le fief fut un
prt : Lehn (165). Toutefois, comme entre ce terme et sa racine verbale, dont
lemploi trs large continuait dtre bi en vivant, la liaison demeurait
constamment sensible, il natteignit jamais une spcialisation aussi parfaite
que son quivalent franais. Dans lusage populaire au moins, il ne cessa pas
de sappliquer toutes sortes de concessions terriennes. Tant il es t vrai que les
mots demprunt se plient plus aisment que tous autres une valeur technique
nouvelle et prcise.
Bienfait ; fief ; lehn : ce que ces divers synonymes cherchaient
exprimer tait une notion, en somme, trs claire. Ne nous y trompons point :
une notion, en son essence, dordre conomique. Qui disait fief disait bien
concd en change, fondamentalement, non dobligations de payer
lorsque celles-ci parfois intervenaient ctait seulement titre accessoire ,
mais dobligations de fair e. Plus prcisment, pour quil y ait fief, il ne suffit
point que les services constituent la charge principale du bien. Il faut encore
quils comportent un lment trs net de spcialisation professionnelle et aussi
dindividualisation. La censive rurale , laquelle dj les chartes du XIe sicle,
devanant les juristes du XIIIe, opposent expressment le fief, tait greve de
travaux, ct des redevances. Mais corves de culture, charrois, fourniture
mme de menus produits de lindustrie domestique, les tches auxquelles elle
Marc BLOCH La socit fodale
164
astreignait semblaient de celles que tout homme pouvait accomplir. Elles
taient, en outre, rgles par une coutume collective. Une terre, par contre,
avait-elle t octroye un sergent seigneurial, sous condition de
gouverner p.239 fidlement les autres tenanciers ? A un peintre, contre la
mission de dcorer lglise des religieux, ses matres ? A un charpentier ou
un orfvre, qui devaient dsormais mettre leur art la disposition du
seigneur ? Voire, un prtre, comme rtribution du soin des mes, dans la
paroisse ? A un vassal enfin, compagnon arm et guerrier de mtier ? La
tenure, ainsi oblige des services dune nature trs particulire, que fixait, en
chaque cas, une convention ou une tradition diffrentes, se dfinissait avant
tout par son caractre de rmunration : en un mot comme une tenure-salaire.
On lappelait fief (166). Cela, en dehors de toute considration de rang social et,
bien entendu, lorsquil sagissait dun modeste ouvrier, sans que ft demande
la prestation dhommage. Lofficier seigneurial tait frquemment un serf ; et
ni les cuisiniers des bndictins de Maillezais ou du comte de Poitou, ni le
manieur de lancette auquel incombait le devoir de saigner priodiquement les
moines de Trves, ne tiraient sans doute de leurs occupations habituelles un
bien grand prestige. Ce nen tait pas moins lgitimement quayant t, les uns
comme les autres, dots de tenures propres, au lieu de vivre simplement de la
provende distribue dans la maison du matre, ces serviteurs
professionnellement qualifis taient compts parmi les dpendants fieffs.
Certains historiens, relevant quelques exemples de ces humbles fiefs, ont cru
une dviation tardive. Bien tort. Les censiers du IXe sicle connaissent dj
des bienfaits aux mains de maires ruraux, dartisans, de palefreniers ;
Einhard, sous Louis le Pieux, mentionne le bienfait dun peintre ; lorsque
pour la premire fois, en pays rhnan, apparat, entre 1008 et 1016, le mot
mme de fief, dguis la latine, cest pour sappliquer la tenure dun
forgeron. Une institution, lorigine de porte trs gnrale, qui, peu peu, se
mua en institution de classe, telle fut la courbe du fief comme de la vassalit et
de beaucoup dautres formes juridiques, aux ges fodaux. Non le trac
inverse.
Car il y avait, cela va de soi, la longue, pour le sentiment commun,
quelque chose de gnant devoir dsigner ainsi, par un mme nom, des biens
qui, eux-mmes dtendue et de nature profondme nt diffrentes, taient
dtenus par des p.240 hommes de conditions aussi opposes quun petit maire
de village, un cuisinier, un guerrier, seigneur son tour de beaucoup de
paysans, un comte ou un duc. Jusque dans nos socits relativement
dmocratiques, nprouvons -nous pas le besoin dlever, par les mots, une
sorte de barrire de respectabilit entre le salaire de louvrier manuel, le
traitement du fonctionnaire, les honoraires des professions librales ?
Lambigut cependant subsista longtemps. La Fra nce du XIIIe sicle
continuait parler de fiefs dofficiers seigneuriaux et dartisans : si bien que,
proccups de mettre part les fiefs vassaliques, les juristes caractrisaient
volontiers ces derniers par lpithte de francs , entendez soumis seulement
Marc BLOCH La socit fodale
165
des obligations dignes dun homme parfaitement libre. Dautres langues, qui
avaient reu le mot de lusage franais, lui conservrent plus longtemps
encore le sens gnral de salaire, mme en dehors de tout don de terre : en
Italie, au XIIIe sicle, les traitements en argent de certains magistrats ou
fonctionnaires urbains taient appels fio ; lAngleterre aujourdhui persiste
nommer fee les honoraires du mdecin ou de lavocat. De plus en plus
cependant, lorsque le mot tait employ sans qualification particulire, on
tendait le comprendre comme sappliquant aux fiefs la fois les plus
nombreux et socialement les plus importants, autour desquels stait
dvelopp un droit proprement fodal : savoir, les tenures charges des
services de la vassalit, dans le sens lui-mme nettement spcialis que, de
meilleure heure encore, avait pris ce terme. Le fief (Lehn ), dira finalement,
au XIVe sicle, la Glose du Miroir des Saxons, est la solde du chevalier .
II. Le chasement des vassaux
Entre les deux modes de rmunration du vassal, par le fief et par la
provende, lincompatibilit ntait pas absolue. Une fois tabli sur son fonds,
le fidle ne renonait point, pour autant, aux autres marques de la libralit
seigneuriale : ces distributions, notamment, de chevaux, darmes, surtout de
robes, de manteaux, de vair et de gris , que p.241 beaucoup de coutumes
finirent par codifier et dont les plus hauts personnages mme tel un comte
de Hainaut, vassal de lvque de Lige se gardaient bien de faire fi.
Parfois, comme on le voit, en 1166, autour dun grand baron anglais, certains
chevaliers, dment pourvus de terres, nen vivaient pas moins avec le chef,
recevant de lui leur ncessaire (167). Cependant, rserve faite de quelques
situations exceptionnelles, vassaux provendiers et vassaux chass
reprsentaient vraiment deux varits bien tranches et, au regard du seigneur,
diversement utiles : en sorte que, ds Charlemagne, on considrait comme
anormal quun vassal du roi, servant dans le palais, tnt nanmoins un
bienfait. Quoi que lon pt, en effet, demander aux feudataires comme aide au
jour du danger ou du conseil, comme surveillance durant la paix, ctait
seulement des vassaux de la maisonne, capables dune prsence constante,
quil tait possible dattendre les mille offices de lescorte ou de la haute
domesticit. Parce que les deux catgories ntaient donc pas
interchangeables, lopposition, entre elles, ne fut pas, la lettre, celle de
stades successifs du dveloppement. Certes, le type du compagnon nourri dans
la maison du matre tait le plus ancien. Mais il continua longtemps de
coexister avec le type plus rcent du dpendant fieff. Lhomme, aprs un
stage dans la suite immdiate, obtenait-il un chasement ? Un autre un
adolescent, souvent, encore hors de son hritage, ou un cadet venait
occuper la table seigneuriale la place devenue vacante ; et la scurit du
vivre et du couvert, ainsi garantie, semblait si digne denvie qu e les moyennes
Marc BLOCH La socit fodale
166
familles chevaleresques en sollicitaient quelquefois la promesse, pour les plus
jeunes de leurs membres (168). Au dbut du rgne de Philippe Auguste, ces
vassaux sans fief taient encore assez nombreux pour que, dans son
ordonnance sur la dme de croisade, le roi, proccup de ne laisser chapper
aucun genre de contribuables, ait cru devoir leur rserver une place part.
Pourtant, on ne saurait douter que ds lpoque carolingienne ne se soit
marque, entre les deux groupes de vassaux et au profit du groupe des
dtenteurs de fief, une disproportion qui, par la suite, alla croissant. Sur ce p.242
mouvement et sur quelques-unes au moins de ses causes, nous possdons un
tmoignage exceptionnellement vivant dans un pisode qui, pour stre
droul hors de France, peut nanmoins tre lgitimement invoqu ici, en
raison de lorigine authentiquement franaise des institutions en jeu.
Quand Guillaume le Btard eut conquis lAngleterre, son premier soin fut
de transporter dans son nouveau royaume la remarquable organisation de
recrutement fodal dont son duch normand lui fournissait lexemple. Il
imposa donc ses principaux fidles lobligation de tenir constamment sa
disposition un nombre dtermin de chevaliers, dont le chiffre tait fix une
fois pour toutes, baronnie par baronnie. Ainsi chaque grand seigneur,
dpendant immdiatement du roi, tait contraint de sattacher, son tour, une
certaine quantit au moins de vassaux militaires. Mais il restait libre, bien
entendu, de dcider des procds employer pour assurer leur entretien.
Beaucoup dvques et dabbs prfrrent, au dbut, les loger et nourrir sur
le domaine , sans les chaser. Telle tait, naturellement, en tous pays, aux
yeux des chefs dglises, la so lution la plus sduisante, parce quelle semblait
prserver de toute atteinte linalinable patrimoine dont ils avaient reu le
dpt ; un sicle environ plus tard, le biographe de larchevque Conrad Ier de
Salzbourg devait encore fliciter son hros dav oir su mener ses guerres sans
gagner la bonne volont de ses chevaliers autrement que par des cadeaux de
biens meubles . A trs peu dexceptions prs, pourtant, les prlats anglais
durent assez vite renoncer un systme si conforme leurs vux, pour f aire
dsormais reposer la charge de lost royal sur des fiefs dcoups dans le sol
ecclsiastique (169). Le chroniqueur dEly raconte que les vassaux, au temps o
ils taient directement nourris par le monastre, staient rendus
insupportables par les tumultueuses rclamations dont ils assigeaient le
clerier. On croira, en effet, sans peine, quune bruyante troupe dhommes
darmes, aux apptits indiscrets, ft pour la paix du clotre un fcheux
voisinage ; sans doute, en Gaule mme, de pareils ennuis navaient -ils pas t
trangers la rapide et prcoce rarfaction de ces vassaux domestiques p.243
dglises, si nombreux encore, vers le dbut du I Xe sicle, autour des grandes
communauts religieuses, qu Corbie, par exemple, les moines leur
rservaient alors un pain spcial, plus fin que celui des autres provendiers.
Cependant cet inconvnient, propre des seigneuries dun genre particulier,
une difficult plus grave sajoutait qui, si elle ninterdisait pas absolument la
pratique de lentretien domicile, en limitait du moins singulirement
Marc BLOCH La socit fodale
167
lemploi. Ctait une grosse aventure, durant le premier ge fodal, que de
prtendre ravitailler rgulirement un groupe un peu tendu. Plus dun
annaliste monastique parle de famine au rfectoire. Le plus sr, en bien des
cas, pour le matre comme pour le suivant darmes, tait de laisser ce
dernier, avec les moyens ncessaires, la responsabilit de pourvoir sa propre
subsistance.
A plus forte raison, le rgime de la provende devenait-il inapplicable
lorsque les vassaux, dont il sagissait de payer la fidlit, taient dun rang
trop lev pour saccommoder dune existence passe tout entire lombre
du matre. A ceux-l, il fallait des revenus indpendants qui, lis lexercice
de pouvoirs de commandement, leur permissent de vivre dans des conditions
conformes leur prestige. Aussi bien le souci mme du service y obligeait-il
parfois. Le rle dun vassus dominicus carolingien supposait quil passt la
plus grande partie de ses jours dans sa province, occup la surveiller. De
fait, lpoque carolingienne, lextension des relations vassaliques, non
seulement en nombre, mais aussi, si lon peut dire, en hauteur, saccompagna
dune immense distribution de bienfaits .
Ce serait dailleurs se faire de la multiplication des rapports fodaux une
image singulirement imparfaite que de postuler, lorigine de tous les fiefs,
un vritable octroi du seigneur au vassal. Beaucoup au contraire, si paradoxal
que cela puisse paratre, naquirent, en ralit, dun don fait par le vassal au
seigneur. Lhomme qui cherchait un protecteur devait souvent acheter cette
protection. Le puissant qui forait un plus faible sattacher lui exigeait
volontiers que les choses lui fussent soumises comme les personnes. Les
infrieurs offraient donc, avec eux-mmes, leurs p.244 terres au chef. Celui-ci,
une fois contract le lien de subordination personnelle, restituait son
nouveau dpendant les biens ainsi provisoirement cds, mais non sans les
avoir, au passage, assujettis son droit suprieur, qui sexprimait par le poids
de charges diverses. Ce grand mouvement de ddition du sol se poursuivit,
durant lpoque franque et le premier ge fodal, du haut en bas de la socit.
Mais selon le rang du commend et son genre de vie, les formes en taient
bien diffrentes. Le fonds du rustre lui tait rendu grev de redevances en
nature ou argent et de corves agricoles. Le personnage dune condition plus
releve et dhabitudes guerrires, aprs avoir prt lho mmage, rcuprait son
ancien patrimoine en qualit dhonorable fief vassalique. Alors acheva de se
marquer lopposition de deux grandes classes de droits rels : dun ct, les
modestes tenures en villainage , qui obissaient aux coutumes collectives
des seigneuries, et les fiefs ; de lautre, rests exempts de toute dpendance,
les alleux .
Comme fief, mais avec une filiation tymologique beaucoup plus
rectiligne (od, bien , et peut tre al, total ), alleu , tait dorigine
germanique ; comme lui, adopt par les langues romanes, il ne devait vivre
que dans ce milieu demprunt. Lallemand disait, dans le mme sens, Eigen
( propre ). En dpit, et l, de quelques invitables gauchissements, la
Marc BLOCH La socit fodale
168
signification de ces mots synonymes demeura parfaitement stable, de lpoque
franque la fin des ges fodaux et plus tard encore. On la parfois dfinie :
pleine proprit . Ctait oublier que cette expression sapplique toujours
mal au droit mdival. Indpendamment mme des entraves lignagres,
partout prsentes, un possesseur dalleu, pour peu quil soit lui -mme un
seigneur, peut fort bien avoir, au-dessous de lui, des tenanciers, voire des
feudataires, dont les droits de jouissance sur le sol, en pratique le plus souvent
hrditaires, limitent imprieusement le sien. Lalleu, en dautres termes, nest
pas forcment vers le bas un droit absolu. Mais il lest vers le haut. Fief du
soleil entendez sans seigneur humain , diront de lui, joliment, les
juristes allemands de la fin du moyen ge.
Naturellement toute espce dimmeuble ou de revenu p.245 immobilier
pouvait jouir de ce privilge, quelle que ft la nature du bien depuis la
petite exploitation paysanne jusquau plus vaste complexe de redevances ou
de pouvoirs de commandement ; quel que ft aussi le rang social du
dtenteur. Il y avait donc une antithse alleu-censive aussi bien qualleu -fief.
Seule la seconde doit nous intresser pour linstant. A cet gard, lvolution
franaise et rhnane fut marque par un rythme deux temps, dingales
amplitudes.
Lanarchie qui accompagna et suivit leffritement de ltat carolingien
offrit dabord un bon nombre de feudataires loccasion de sapproprier,
purement et simplement, les chasements dont ils avaient reu le
conditionnel octroi. Cela, surtout quand le concdant tait une glise ou le roi.
Voici, par exemple, trente-huit ans de distance, deux chartes limousines.
876 : Charles le Chauve remet au fidle Aldebert, pour sa vie durant et celle
de ses fils, la terre de Cavaliacus titre usufructuaire, en bnfice . 914 :
Alger, fils dAldebert, fait don aux chanoines de Limoges de mon alleu
appel Cavaliacus, que je tiens de mes parents (170).
Cependant, moins dtre tombs, comme celui -l, entre les mains du
clerg, ni ces alleux dusurpation, ni ceux dancienne et authentique origine
ntaient destins, pour la plupart, conserver longtemps leur qualit. Il y
avait une fois, raconte un chroniqueur, deux frres, nomms Herroi et Hacket,
qui, aprs la mort de leur pre, riche seigneur Poperinghe, staient partag
ses alleux. Sans trve, le comte de Boulogne et le comte de Guines
sefforaient de les contraindre leur faire hommage, pour ces terres. Hacket,
craignant les hommes plus que Dieu , cda aux sommations du comte de
Guines. Herroi, par contre, ne voulant se soumettre aucun de ses deux
perscuteurs, porta sa part dhritage lvque de Throuanne et la reprit de
lui en fief (171). Tardivement relate et comme un simple on-dit, la tradition
nest pas trs sre dans les dtails. Pour le fond, elle fournit certainement une
juste image de ce que pouvait tre le sort de ces petits seigneurs alleutiers,
tenaills entre les ambitions rivales des hauts barons voisins. De mme
voit-on, dans lexacte chronique de Gilbert de Mons, les chteaux, levs p.246
sur les terres allodiales du pays hennuyer, peu peu rduits, par les comtes de
Marc BLOCH La socit fodale
169
Hainaut ou de Flandre, la condition de fiefs. Comme le rgime fodal, qui se
dfinit essentiellement sous les espces dun rseau de dpendances,
natteignit jamais, mme dans les contres qui lui avaient donn naissance,
ltat dun systme parfait, il subsista toujours des alleux. Mais, trs abondants
encore sous les premiers Carolingiens au point que la possession de lun
deux, qui ft situ dans le comt mme, tait alors la condition ncessaire
pour pouvoir tre dsign comme avou dune glise, cest --dire son
reprsentant laque , leur nombre, partir du Xe sicle, alla rapidement en
dcroissant, cependant que celui des fiefs augmentait sans trve. Le sol entrait
en sujtion avec les hommes.
Quelle que ft la provenance relle du fief vassalique prlvement
opr sur la fortune du chef ou fief de reprise , comme diront plus tard les
juristes, cest --dire ancien alleu abandonn, puis fodalement repris par
son dtenteur primitif , il se prsentait officiellement comme octroy par le
seigneur. Do, lintervention dun acte crmoniel, conu selon les formes
communes alors toutes les traditions de droits rels, quon appelait, en
franais, investitures . Au vassal, le seigneur remettait un objet qui
symbolisait le bien. Souvent on se contentait, pour cela, dun simple btonnet.
Il arrivait cependant que lo n prfrt une image plus parlante : motte de terre,
en rappel de la glbe concde ; lance qui voquait le service darmes ;
bannire, si le feudataire devait tre non seulement un guerrier, mais un chef
de guerre, groupant, son tour, sous son tendard, dautres chevaliers. Sur ce
canevas, originellement assez vague, la coutume et le gnie des juristes
brodrent peu peu une foule de distinctions, variables selon les pays.
Lorsque le don tait consenti un nouveau vassal, linvestiture avait lieu
immdiatement aprs lhommage et la foi, jamais avant (172). Le rite crateur
de la fidlit en prcdait ncessairement le salaire.
Nimporte quel bien, en principe, pouvait tre fief. En pratique,
nanmoins, la condition sociale des bnficiaires, lorsquil sagissait de fiefs
vassaliques, imposait certaines p.247 limites. Du moins depuis que stait
tablie, entre les diverses formes de la commendise, une distinction de classe
nettement tranche. La formule du don accord au compagnon , telle que
nous la conserve un document du VI Ie sicle, semble prvoir que des
corves agricoles pourront tre rclames. Mais le vassal des ges postrieurs
ne condescendait plus travailler de ses mains. Force lui tait donc de vivre
du travail dautrui. Lorsquil recevait une terre, il convenait quelle ft
peuple de tenanciers soumis, dune part, des redevances, de lautre, des
prestations de main-duvre, qui permettaient la culture de la fraction du sol
gnralement rserve lexploit ation directe par le matre. En un mot, la
plupart des fiefs vassaliques taient des seigneuries, grandes ou petites.
Dautres, cependant, consistaient en revenus qui, tout en laissant galement
leurs possesseurs le privilge dune noble oisivet, ne com portaient point, sauf
titre accessoire, de pouvoirs sur dautres dpendants. dmes, glises avec
leur casuel, marchs, pages.
Marc BLOCH La socit fodale
170
A vrai dire, mme les droits de ce dernier type, tant, en quelque mesure,
fixs au sol, se trouvaient, selon la classification mdivale, rangs parmi les
immeubles. Plus tard seulement, lorsque les progrs des changes comme de
lorganisation administrative eurent permis, dans les royaumes ou les grandes
principauts, laccumulation de stocks montaires relativement considrabl es,
les rois et les hauts barons se prirent distribuer en fiefs de simples rentes qui,
sans supports fonciers, nen entranaient pas moins la prestation dhommage.
Ces fiefs de chambre , cest --dire de trsor, avaient de multiples
avantages. Ils vitaient toute alination de terres. chappant, en gnral, la
dformation qui, nous le verrons, avait mtamorphos la plupart des fiefs
terriens en biens hrditaires, demeurs, par consquent, au plus viagers, ils
maintenaient beaucoup plus strictement le dtenteur dans la dpendance du
concdant. Aux chefs dtat, ils donnaient le moyen de sassurer des fidles
lointains, en dehors mme des territoires immdiatement soumis leur
domination. Les rois dAngleterre qui, riches de bonne heure, semblent avoir
t parmi les premiers user de ce procd, en firent lapplication, ds la fin
du XIe sicle, aux p.248 seigneurs flamands, comte en tte, dont ils
recherchaient lappui militaire. Puis Philippe Auguste, toujours prompt
imiter les Plantagents, ses rivaux, seffora de les concurrencer, par la mme
mthode et sur le mme terrain. Ainsi encore, au XIIIe sicle, les Staufen se
conciliaient les conseillers des Captiens, et les Captiens ceux des Staufen.
Ainsi saint Louis sattacha directement Joinville, qui navait t, jusque -l,
que son arrire-vassal (173). Sagissait -il, au contraire, de suivants darmes
domestiques ? La rtribution pcuniaire vitait les embarras du ravitaillement.
Si, au cours du XIIIe sicle, le nombre des vassaux provendiers diminua trs
vite, ce fut certainement, en plus dun cas, parce que la prise en subsistance,
pure et simple, avait t remplace par loctroi, sous forme de fief, dun
traitement fixe en argent.
tait-il bien sr, cependant, quun re venu exclusivement mobilier pt tre
lgitimement lobjet dune infodation ? Le problme ntait pas uniquement
verbal. Car il revenait se demander jusquo devaient stendre les rgles
juridiques, trs particulires, qui staient peu peu labores autour du
concept de fief vassalique. Cest pourquoi, en Italie et en Allemagne, o, dans
des conditions diverses, qui seront exposes plus loin, ce droit proprement
fodal russit le mieux se constituer en systme autonome, la doctrine et la
jurisprudence aboutirent dnier aux rentes en numraire la qualit de fief. En
France, par contre, la difficult ne parat gure avoir mu les juristes. Sous le
vieux nom de la tenure militaire, les grandes maisons baronales et princires y
purent passer, insensiblement, un rgime de quasi salariat, caractristique
dune conomie nouvelle qui se fondait sur la vente et lachat.
Solde dun commend, la concession en fief avait pour dure naturelle
celle du lien humain, qui tait sa raison dtre. Depuis le Xe sicle environ, la
vassalit passait pour unir deux vies. En consquence, le bienfait ou fief
fut dsormais considr comme devant tre dtenu par le vassal jusqu sa
Marc BLOCH La socit fodale
171
mort ou celle de son seigneur et jusque-l seulement. Telle fut jusquau bout
la rgle inscrite dans le formalisme du droit : de mme quentre le survivant
du couple primitif et le successeur de son partenaire la relation p.249 vassalique
ne persistait quau prix dune rptition de lhommage, le maintien du fief
lhritier du feudataire ou au feudataire par lhritier du concdant exigeait
que ft ritre linvestiture. Comment les faits, cependant, ne tardrent pas
donner aux principes un flagrant dmenti, cest ce quil nous faudra tout
lheure examiner. Mais lvolution ayant t, sur ce point, commune toute
lEurope fodale, il convient dabord de chercher retracer, dans les pays
demeurs jusquici en dehors de notre horizon, le dveloppement
dinstitutions ou semblables ou analogues celles qui viennent dtre dcrites.
Marc BLOCH La socit fodale
172
CHAPITRE III
Tour dhorizon europen
I. La diversit franaise : sud-ouest et Normandie
Que la France ait eu pour destin, ds le moyen ge, dassembler par le
lien de plus en plus vigoureux de lunit nationale comme, selon le beau mot
de Mistral, le Rhne accueille la Durance un faisceau de socits que
sparaient originellement, de puissants contrastes, chacun le sait ou le
pressent. Mais nulle tude nest aujourdhui moins avance que celle de cette
gographie sociale. Force sera donc ici de se borner proposer aux chercheurs
quelques jalons.
p.251
Voici dabord le Midi aquitain : Toulousain, Gascogne, Guyenne. Dans
ces contres, de structure tous gards fort originale et qui navaient t que
faiblement soumises laction des institutions franqu es, la propagation des
rapports de dpendance parat avoir rencontr beaucoup dobstacles. Les
alleux jusquau bout y demeurrent fort nombreux : tant petites exploitations
paysannes que seigneuries. La notion de fief elle-mme, malgr tout
introduite, perdit rapidement la nettet de ses contours. Ds le XIIe sicle, on
qualifiait ainsi, autour de Bordeaux ou de Toulouse, toute espce de tenures,
sans en excepter celles qui taient charges dhumbles redevances foncires
ou de corves agricoles. De mme pour le terme d honneur , devenu, dans
le Nord, la suite dune volution smantique qui sera retrace plus loin, le
quasi-synonyme de fief . Certainement les deux noms avaient t adopts,
dabord, avec leur sens p.252 ordinaire, bien spcialis. La dviation, que ne
connurent jamais les pays vraiment fodaliss, ne vint quaprs. Ctaient les
concepts juridiques eux-mmes quavait imparfaitement compris une socit
rgionale imbue de tout autres habitudes.
Accoutums un rgime de compagnonnage voisin des primitifs usages
francs, les Scandinaves de Rollon, lors de leur tablissement en Neustrie, ne
trouvaient, par contre, dans leurs traditions nationales rien qui ressemblt au
systme du fief et de la vassalit, tel quil stait ds lors dvelopp en Gaule.
Leurs chefs pourtant sy adaptrent, avec une tonnante souplesse. Nulle part
mieux que sur cette terre de conqute, les princes ne surent utiliser au profit de
leur autorit le rseau des relations fodales. Cependant, dans les couches
profondes de la socit, certains traits exotiques continurent de percer. En
Normandie, comme sur les rives de la Garonne, le mot de fief glissa
rapidement au sens gnral de tenure. Mais ce ne fut point pour des raisons
Marc BLOCH La socit fodale
173
exactement quivalentes. Car, ici, ce qui semble avoir manqu fut le
sentiment, ailleurs devenu si puissant, de la diffrenciation des classes et,
consquemment, des terres par le genre de vie. Tmoin, le droit spcial des
vavasseurs . Le mot en lui-mme navait rien dexceptionnel. A travers tout
le domaine roman, il dsignait, dans la chane des possesseurs de fiefs
militaires, les plus bas placs, ceux qui, par rapport aux rois ou aux grands
barons ntaient que des vassaux de vassaux ( vassus vassorum). Mais
loriginalit du vavasseur norman d rsidait dans le singulier imbroglio des
charges qui gnralement pesaient sur son bien. A ct dobligations de
service arm, tantt cheval, tantt pied, la vavassorerie supportait des
redevances, voire des corves : mi-fief en somme, mi-vilainage. Dans cette
anomalie, hsitera-t-on reconnatre un vestige du temps des Vikings ? Pour
lever tous les doutes, il suffira dun regard jet vers la Normandie anglaise :
entendez les comts du Nord et du Nord-Est, dits de coutume danoise . La
mme dualit de charges y grevait les terres de dpendants qui l taient
dnomms drengs, cest --dire originellement tout comme pour vassal
garons : terme, cette fois, franchement nordique et qui, p.253 dailleurs,
comme on la vu, semble avoir t auss i en usage, immdiatement aprs
linvasion, sur les bords de la Seine (174). Vavasseur et dreng, chacun de son
ct, devaient donner, au cours des sicles suivants, beaucoup de fil retordre
aux juristes, prisonniers de classifications progressivement cristallises. Dans
un monde qui au-dessus de toutes les autres activits sociales et part delles
mettait les armes, ils taient comme un persistant et gnant souvenir de lge
o chez les hommes du Nord , ainsi quil se voit e ncore si bien dans les
sagas islandaises, nul abme ne sparait la vie du paysan et celle du guerrier.
II. LItalie
LItalie des Lombards avait vu se dvelopper spontanment des pratiques
de relation personnelle presque de tous points analogues aux commendises des
Gaules : depuis la simple tradition de soi-mme en servitude jusquau
compagnonnage militaire. Les compagnons de guerre, au moins autour des
rois, des ducs, des principaux chefs, portaient le nom germanique commun de
gasindi. Beaucoup dentre e ux recevaient des terres. Quitte, dailleurs, le plus
souvent, devoir les restituer au chef, sils lui retiraient leur obdience. Car,
conformment aux habitudes que nous trouvons partout lorigine de ce genre
de rapports, le lien navait alors rien d indissoluble : au libre Lombard, pourvu
quil ne sortt point du royaume, la loi reconnaissait expressment le droit de
sen aller avec son lignage o il voudra . Cependant la notion dune
catgorie juridique de biens spcialiss dans la rmunration des services ne
parat pas stre dgage clairement avant labsorption de ltat lombard dans
ltat carolingien. Le bienfait fut en Italie une importation franque.
Bientt, au reste, comme dans la patrie mme de linstitution, on prfra dire
Marc BLOCH La socit fodale
174
fief . La langue lombarde possdait ce mot avec le sens ancien de bien
mobilier. Mais, ds la fin du IXe sicle, lacception nouvelle de tenure
militaire est atteste, aux environs de Lucques (175). En mme temps, le
gallo-franc vassal se substituait peu peu gasindus, refoul dans la
signification, plus troite, de suivant p.254 darmes non chas. Cest que la
domination trangre avait mis son empreinte sur les ralits elles-mmes.
Non seulement la crise sociale provoque par les guerres de conqute et sur
laquelle un capitulaire carolingien apporte un curieux tmoignage (176), non
seulement les ambitions de laristocratie immigre, matresse des hautes
charges, avaient entran la multiplication de patronages de tout ordre. Mais la
politique carolingienne, de ce ct des Alpes comme de lautre, rgularisa et
tendit la fois le systme primitivement assez lche des dpendances
personnelles et foncires. Si, de toute lEurope, lItalie du Nord fut sans doute
le pays o le rgime de la vassalit et du fief se rapprocha le plus de celui de
la France propre, la raison en fut que, des deux parts, les conditions premires
taient presque semblables : la base un substrat social de mme type, o les
habitudes de la clientle romaine se mlaient aux traditions de la Germanie ;
travaillant cette pte, luvre organisatrice des premiers Carolingiens.
Cependant, sur cette terre o ni lactivit lgislatrice, ni lenseignement
juridique ne sinterrompirent jamais, le droit fodal et vassalique devait, de
trs bonne heure, cesser dtre constitu seulement, comme il le fut si
longtemps en France, par un ensemble assez flottant de prceptes traditionnels
ou jurisprudentiels, presque purement oraux. Autour des ordonnances
promulgues, sur la matire, depuis 1037, par les souverains du royaume
dItalie lesquels taient, en fait, les rois allemands , toute une littrature
technique surgit qui, ct du commentaire de ces lois, sappliquait dcrire
les bonnes coutumes des cours . Les principaux morceaux en furent
rassembls, on le sait, dans la fameuse compilation des Libri Feudorum. Or le
droit de la vassalit, tel que lexposent ces textes, prsente une particularit
singulire : lhommage de bouche et de mains ny est jamais mentionn ; le
serment de foi semble suffire fonder la fidlit. Il y avait l, vrai dire, une
part de systmatisation et dartifice, conforme lesprit de presque toutes les
uvres doctrinales de ce temps. Les documents de la pratique attestent quen
Italie, aux ges fodaux, lhommage, selon le type franc, tait quelquefois
prt. Non pas toujours p.255 cependant, ni mme peut-tre le plus souvent. Il
ne paraissait pas ncessaire la cration du lien. Rite dimportation, il navait
sans doute jamais t compltement adopt par une opinion juridique
beaucoup plus aisment dispose quoutre -monts admettre des obligations
contractes en dehors de tout acte formaliste.
Un jour trs vif est jet sur la notion mme du fief vassalique par son
histoire dans une autre rgion de lItalie : le Patrimoine de saint Pierre. En
999, la faveur de lEmpereur Otton III poussa au pontificat un homme qui, n
dans le cur de lAquitaine, avait, au cours de sa carrire brillante et agite,
acquis lexpri ence des monarchies et des grandes principauts ecclsiastiques
Marc BLOCH La socit fodale
175
de lancien pays franc, comme de lItalie lombarde. Ctait Gerbert
dAurillac, de son nom de pape Silvestre II. Il constata que ses prdcesseurs
avaient ignor le fief. Certes lglise romai ne avait ses fidles. Elle ne
manquait pas de leur distribuer des terres. Mais elle usait encore pour cela des
vieilles formes romaines : lemphytose notamment. Adapts aux besoins de
socits dun tout autre type, ces contrats rpondaient mal aux ncessi ts du
prsent. Ils ne comportaient pas en eux-mmes de charges de services.
Temporaires, mais plusieurs vies, ils ne connaissaient pas lobligation
salutaire du retour au donateur, de gnration en gnration. Gerbert voulut
leur substituer de vritables infodations et dit pourquoi (177). Sil ne semble
pas avoir trs bien russi, en ce premier effort, fief et hommage nen
pntrrent pas moins, aprs lui, peu peu, dans la pratique du gouvernement
papal. Tant cette double institution paraissait dsormais indispensable toute
bonne organisation des dpendances dans la classe militaire.
III. LAllemagne
Aux provinces de la Meuse et du Rhin, parties intgrantes, ds le principe,
du royaume fond par Clovis et foyers de la puissance carolingienne, ltat
allemand, tel quil se constitua dfinitivement vers le dbut du Xe sicle,
unissait de vastes territoires qui taient demeurs lcart du grand brassage
dhommes et dinstitutions, caractristique de la p.256 socit gallo-franque.
Telle, avant tout, la plaine saxonne, du Rhin lElbe, occidentalise
seulement depuis Charlemagne. Les pratiques du fief et de la vassalit se
rpandirent nanmoins sur toute lAllemagne transrhnane. Mais sans jamais,
surtout dans le Nord, pntrer le corps social aussi fond que dans le vieux
pays franc. Nayant pas t adopt par les classes suprieures, aussi
compltement quen France, comme le rapport humain propre leur rang,
lhommage resta plus proche de sa nature primitive, qui faisait de lui un rite
de pure subordination : loffre des mains, le baiser damiti, qui mettait
presque niveau seigneur et vassal, ne vint que trs exceptionnellement
sajouter. Il est possible quau dbut les membres des grands lignages de chefs
aient prouv quelque rpugnance entrer dans des liens tenus encore pour
demi serviles. Au XIIe sicle, en racontait, dans lentourage des Welfs,
comment un des anctres de la race, ayant appris lhommage prt par son fils
au roi, avait conu de cet acte, o il voyait une atteinte la noblesse et la
libert de son sang, une irritation si vive que, se retirant dans un
monastre, il refusa, jusqu sa mort, de revoir le coupable. La tradition,
mle derreurs gnalogiques, nest pas, en soi, dune authe nticit certaine.
Elle nen est pas moins symptomatique ; dans le reste du monde fodal, on
nen aperoit point de semblable.
Dautre part, lopposition entre le service des armes et la culture du sol,
vritable fondement ailleurs du clivage des classes, mit ici plus longtemps
Marc BLOCH La socit fodale
176
stablir. Lorsque, dans les premires annes du Xe sicle, le roi Henri Ier,
Saxon lui-mme, pourvut de points dappui fortifis la frontire orientale de la
Saxe, sans cesse menace par les Slaves et les Hongrois, il en confia la
dfense des guerriers rpartis rgulirement, nous dit-on, par groupes de
neuf. Les huit premiers, tablis autour de la forteresse, venaient la garnir
seulement en cas dalerte. Le neuvime y vivait, en permanence, afin de
veiller sur les maisons et les provisions rserves ses compagnons. Le
systme, premire vue, nest point sans analogie avec les principes adopts,
au mme temps, pour la garde de divers chteaux franais. A y mieux regarder
cependant, une diffrence extrmement profonde p.257 se marque. Ces
garnisaires des confins saxons, au lieu de demander, comme les vassaux
estagiers de lOuest, leur subsistance tantt aux distributions faites par le
matre tantt, sous forme de redevances, des fiefs concds par celui-ci,
taient eux-mmes de vritables paysans, cultivant le sol de leurs mains :
agrarii milites.
Deux traits, jusqu la fin du moyen ge, continurent dattester cette
fodalisation moins avance de la socit allemande. Le nombre et ltendue
des alleux dabord, notamment d es alleux de chefs. Lorsque le Welf Henri le
Lion, duc de Bavire et de Saxe, eut t, en 1180, priv, par jugement, des
fiefs quil tenait de lEmpire, ses terres allodiales, demeures aux mains de ses
descendants, se trouvrent assez considrables pour leur constituer une
vritable principaut, qui, mue son tour, soixante-quinze ans plus tard, en
fief imprial, devait, sous le nom de duch de Brunswick et Lunebourg,
former la base, dans la future confdration germanique, des tats
brunswickois et hanovriens (178). En Allemagne, par ailleurs, le droit du fief et
de la vassalit, au lieu, comme en France, de se mler inextricablement tout
le rseau juridique, fut conu de bonne heure sous les espces dun systme
part, dont les rgles, applicables seulement certaines terres ou certaines
personnes, ressortissaient des tribunaux spciaux : peu prs comme chez
nous, actuellement, au droit civil droge celui des actes de commerce et des
commerants. Lehnrecht, droit des fiefs ; Landrecht, droit gnral du pays
les grands manuels du XIIe sicle sont tout entiers construits sur ce dualisme,
dont net jamais rv notre Beaumanoir. Il navait de sens que parce que,
mme dans les hautes classes, bien des liens juridiques manquaient rentrer
sous la rubrique fodale.
IV. Hors de lemprise carolingienne lAngleterre anglo -saxonne et
lEspagne des royaumes asturo -lonais
Au-del de la Manche, que mme aux pires heures les barques ne
cessrent jamais de traverser, les royaumes p.258 barbares de la
Grande-Bretagne ntaient pas labri des influences franques. Ladmiration
Marc BLOCH La socit fodale
177
que ltat carolingien notamment, inspira aux monarchies de lle semble tre
alle parfois jusqu de vritables tentatives dimitation. Tmoin, entre autr es,
dans quelques chartes et quelques textes narratifs, lapparition du mot de
vassal, visiblement emprunt. Mais ces actions trangres demeurrent toutes
de surface. LAngleterre anglo -saxonne offre lhistorien de la fodalit la
plus prcieuse des expriences naturelles : celle dune socit de contexture
germanique, qui poursuivit, jusqu la fin du X Ie sicle, une volution presque
entirement spontane.
Pas plus quaucuns de leurs contemporains, les Anglo -saxons ne
trouvaient dans les liens du peuple ou du sang de quoi satisfaire pleinement
chez les petits leur besoin de protection, chez les forts leurs instincts de
puissance. Depuis le moment o, au dbut du VIIe sicle, se lve nos yeux le
voile dune histoire jusque -l prive dcrits, nous voy ons se dessiner les
mailles dun systme de dpendances quachveront de dvelopper, deux
sicles plus tard, les grands troubles de linvasion danoise. Les lois, ds le
dbut, reconnurent et rglementrent ces relations, auxquelles on appliquait ici
aussi, lorsquil sagissait de marquer la soumission de linfrieur, le nom latin
de commendatio, si lon portait au contraire laccent sur la protection accorde
par le matre, le terme germain de mund. Les rois, partir du Xe sicle au
moins, les favorisrent. Ils les tenaient pour utiles lordre publie. Un homme,
prescrit, entre 925 et 935, Aethelstan, na -t-il point de seigneur ? Si on
constate que cette situation nuit lexercice des sanctions lgales, sa famille,
devant le plaid public, devra lui dsigner un lord. Ne le veut-elle ou ne le
peut-elle pas ? Il sera hors la loi et quiconque le rencontrera pourra le tuer,
comme un brigand. La rgle visiblement ne touchait point les personnages
assez haut placs pour se trouver soumis lautorit immdiate du souverain ;
ceux-l taient eux-mmes leurs propres rpondants. Mais telle quelle
sans que dailleurs lon sache jusqu quel point elle fut pratiquement suivie
deffet , elle allait, en intention du moins, plus loin que p.259 Charlemagne ou
ses successeurs nosrent jamais prtendre (179). Aussi bien, les rois ne se
privrent-ils point dutiliser, eux aussi, leur profit, ces liens. Leurs
dpendants militaires, que lon appelait leurs thegns , taient comme autant
de vassi dominici rpandus dans tout le royaume, protgs par des tarifs de
composition spciaux et chargs de vritables fonctions publiques. Si
nanmoins, par un de ces dcalages de courbe auxquels lhistoire se plat, les
rapports de dpendance ne dpassrent jamais, en Angleterre, avant la
conqute normande, ltat encore flottant qui avait t peu prs le stade de la
Gaule mrovingienne, la raison doit en tre cherche, moins encore dans la
faiblesse dune royaut profondment touche par les guerres danoi ses, que
dans la persistance dune structure sociale originale.
Dans la foule des dpendants staient distingus de bonne heure, l
comme ailleurs, les fidles arms dont sentouraient les grands et les rois.
Divers noms, qui navaient en commun quune r sonance assez humble et
mnagre, dsignrent, concurremment ou successivement, ces guerriers
Marc BLOCH La socit fodale
178
familiers : gesith, naturellement, dj tant de fois rencontr ; gesella,
cest --dire compagnon de salle ; geneat, compagnon de nourriture ; thegn,
qui, parent lointain du grec , avait, tout comme vassal, pour sens
primitif, jeune garon ; knight, lequel est le mme mot que lallemand
Knecht, serviteur ou esclave. Depuis Knut, on emprunta volontiers au
scandinave, pour lappliquer aux suivants darmes d u roi ou des grands, le
terme de housecarl, gars de la maison . Le seigneur du fal militaire
comme du plus mdiocre commend, voire de lesclave est dit hlaford
(do est venu le mot lord de langlais actuel) : au propre donneur de
miches ; de mme que les hommes, groups dans sa maison, sont ses
mangeurs de pain (hlafoetan). En mme temps quun dfenseur, ntait -il
pas un nourricier ? Un curieux pome met en scne la plainte dun de ces
compagnons de guerre, rduit, aprs la mort de son chef, courir les chemins
la recherche dun nouveau distributeur de trsors : poignant lamento
dune sorte disol social, priv la fois de protection, de tendresse p.260 et des
plaisirs les plus ncessaires la vie. Il rve par moments quil tr eint et
baise son seigneur, met les mains et la tte sur ses genoux, comme autrefois
prs du haut sige do venaient les dons ; puis lhomme sans amis sveille et
ne voit plus devant lui que les sombres vagues... O sont les joies de la grande
salle ? O, hlas, la brillante coupe ?
Alcuin, dcrivant, en 801, autour de larchevque dYork, une de ces
suites armes, y signalait la prsence cte cte de guerriers nobles , et de
guerriers sans noblesse : preuve, la fois, de la bigarrure propre
originellement toutes les troupes de cette sorte et des distinctions que
pourtant on inclinait dj marquer dans leurs rangs. Un des services que
nous rendent les documents anglo-saxons est de souligner, sur ce point, une
liaison causale que la dplorable pauvret des sources mrovingiennes ne
laisse gure apparatre la diffrenciation tait dans la nature des choses ;
mais, visiblement elle fut hte par lhabitude mme, qui se rpandit
progressivement, dtablir ces hommes darmes sur des terres. L tendue et la
nature de la concession, variant selon la qualit de lhomme, achevaient, en
effet, de prciser le contraste. Rien de plus rvlateur que les vicissitudes de la
terminologie. Parmi les mots qui ont t numrs tout lheure, certains
tombrent finalement hors dusage. Dautres se spcialisrent, soit vers le
haut, soit vers le bas. Le geneat est au dbut du VIIe sicle un vrai guerrier et
un assez grand personnage ; au XIe, un modeste tenancier, qui ne se spare
gure des autres paysans que parce quil est astreint monter la garde auprs
du matre et porter ses messages. Thegn, au contraire, demeura ltiquette
dune catgorie de dpendants militaires beaucoup plus considre. Mais,
comme la plupart des individus ainsi dnomms avaient t peu peu dots de
tenures, on prouva bientt le besoin duser dun terme nouveau pour dsigner
les hommes darmes domestiques qui taient venus les relayer dans le service
militaire de la maisonne. Ce fut knight, alors dbarrass de sa tare servile.
Cependant le mouvement qui poussait linstitution dun salaire foncier tait
Marc BLOCH La socit fodale
179
si irrsistible qu la p.261 veille de la conqute normande plus dun knight
son tour avait t pourvu dune terre.
A dire vrai, ce que ces distinctions verbales conservaient de mouvant
indique combien la discrimination, dans les faits, demeurait incomplte. Un
autre tmoignage nous en est fourni par le formalisme mme des actes de
soumission qui, jusquau bout, quelle que ft leur porte sociale, purent,
uniformment, soit comporter le rite doffrande des mains, soit sen passer.
Dans la Gaule franque, le grand principe de la scission qui finalement aboutit
sparer dun trait si net la vassalit et les formes infrieures de la
commendise avait t double : dune part, lincom patibilit entre deux genres
de vie et par suite dobligations celui du guerrier, celui du paysan ; de
lautre, la brche creuse entre un lien viager, en droit librement choisi, et les
attaches hrditaires. Or ni lun ni lautre facteur nagissaient au mme degr
dans la socit anglo-saxonne.
Agrarii milites, guerriers paysans cette alliance de mots, que nous
avons dj rencontre en Allemagne, un chroniqueur sen servait, son tour,
en 1159, pour caractriser certains lments traditionnels des forces militaires
que lAngleterre, dont la structure navait pas t compltement bouleverse
par la Conqute, continuait de mettre la disposition de son roi tranger (180).
Simples survivances ce moment, les ralits, auxquelles se rapportait
lallusion, avaient rpondu, un sicle plus tt, des pratiques trs gnrales.
Ntaient -ce pas en effet des hommes darmes et des rustres tout la fois que
ces geneat ou encore ces radmen dont les tenures, si nombreuses au Xe sicle,
taient greves de services descorte ou de message comme de redevances et
de corves agricoles ; que certains des thegns mmes, soumis, de par leurs
terres, dhumbles corves aussi ct du service de guerre ? Tout conspirait
maintenir ainsi une sorte de confusion des genres : labsence de ce substrat
social gallo-romain qui, sans quon puisse rendre un compte exact de son
action, semble bien en Gaule avoir contribu imposer lhabitude des
distinctions de classes ; linfluence des civilisatio ns nordiques : ctait dans
les comts du Nord, profondment scandinaviss, que se rencontraient surtout,
p.262 ct des drengs, que nous connaissons dj, les thegns paysans ; la
moindre importance enfin accorde au cheval. Non que beaucoup de faux
anglo-saxons ne fussent pourvus de montures. Mais au combat ils mettaient
rgulirement pied terre. La bataille de Hastings fut essentiellement la
dfaite dune infanterie par une troupe mixte o la cavalerie soutenait de ses
manuvres les fantassins. LA ngleterre, avant la Conqute, ignora toujours
lquivalence, familire au continent, de vassal avec chevalier et si
knight, aprs larrive des Normands, finit, dailleurs non sans hsitations, par
tre employ pour traduire le second de ces mots, ce fut sans doute parce que
les chevaliers dabord amens par les envahisseurs taient, pour la plupart,
comme la majorit des knights, des guerriers sans terres. Or lapprentissage et
les exercices constants que rendaient ncessaires la conduite dans la mle
Marc BLOCH La socit fodale
180
dun destrier et le maniement cheval de lourdes armes, quel paysan en avait
besoin pour chevaucher jusquau lieu de lengagement ?
Quant aux contrastes qui ailleurs dcoulaient de la plus ou moins longue
dure du lien, ils navaient gure la possib ilit de se manifester bien fortement
en Angleterre. Car lexception, cela va de soi, des asservissements purs et
simples les relations de dpendance, tous les degrs, demeuraient
susceptibles dune rupture assez aise. Les lois, il est vrai, inter disaient
lhomme dabandonner son seigneur, sans lassentiment de celui -ci. Mais
cette permission ne pouvait tre refuse si les biens remis en change des
services avaient t restitus et quaucune obligation portant sur le pass ne
restt due. La qute du lord , ternellement renouvelable, semblait un
imprescriptible privilge de lhomme libre. Quaucun seigneur , dit
Aethelstan, ny mette obstacle, du moment quil lui a t fait droit .
Assurment, le jeu des accords particuliers, des coutumes locales ou
familiales, des abus de force, enfin, tait parfois plus puissant que les rgles
lgales : plus dune subordination se muait pratiquement en attache viagre,
voire hrditaire. De nombreux dpendants, parfois de trs modeste condition,
nen ga rdaient pas moins la facult, comme dit le Domesday Book, de sen
aller vers un autre seigneur . Par p.263 ailleurs, aucune classification rigide des
rapports fonciers ne fournissait son armature au rgime des rapports
personnels. Sans doute, si, parmi les terres que les seigneurs octroyaient
leurs fidles, beaucoup, comme sur le continent, au temps de la premire
vassalit, taient cdes en plein droit, dautres, au contraire, devaient tre
conserves seulement pour autant que durerait la fidlit mme. Ces
concessions temporaires portaient frquemment, comme en Allemagne, le
nom de prt (laen, en latin praestitum). Mais lon ne voit point que la notion
dun bien -salaire, avec retour obligatoire au donateur, chaque mort, se ft
clairement labore. Lvque de Worcester procde -t-il, vers le dbut du XIe,
sicle, des distributions de cette nature, moyennant la fois devoir
dobissance, redevances et service de guerre ? Il adopte pour cela le vieux
mode, familier lglise, du bail trois gnra tions. Il arrivait que les deux
liens, de lhomme et du sol, fussent sans concidence : sous douard le
Confesseur, un personnage qui sest fait octroyer par un seigneur
ecclsiastique une terre, trois gnrations galement, reoit en mme temps
lautori sation daller durant ce terme, avec elle, vers le seigneur quil
voudra ; cest --dire de se commender, lui et le fonds, un autre matre que
le concdant : dualit qui, dans les hautes classes du moins, et t, en France,
la mme poque, proprement inconcevable.
Aussi bien, pour important que ft devenu, dans lAngleterre
anglo-saxonne, le rle de ciment social jou par les relations de protection, il
sen fallait de beaucoup quelles eussent touff tout autre lien. Le seigneur
rpondait publiquement de ses hommes. Mais ct de cette solidarit de
matre subordonn, subsistaient, trs vigoureuses et soigneusement
organises par la loi, les vieilles solidarits collectives, de lignages et de
Marc BLOCH La socit fodale
181
groupes de voisins. De mme, lobligation militaire de tous les membres du
peuple survivait, plus ou moins proportionne la richesse de chacun. Si bien
quici une contamination se produisit, infiniment instructive. Deux types de
guerriers servaient le roi avec armement complet : son thegn, quivalent peu
prs du vassal franc, et le simple homme libre, pourvu quil et une p.264
certaine fortune. Naturellement, les deux catgories se recouvraient
partiellement, le thegn ordinairement ntant point un pauvre. On shabitua
donc, vers le Xe sicle, dnommer thegns sous-entendu royaux et
considrer comme dots des privilges appartenant cette condition tous les
libres sujets du roi qui, mme sans stre placs sous sa commendise
particulire, possdaient des terres suffisamment tendues, voire mme
avaient exerc, avec profit, lhonorable commerce doutre -mer. Ainsi le mme
mot caractrisait, tour tour, tantt la situation cre par un acte de
soumission personnelle, tantt lappartenance une classe conomique :
quivoque qui, mme compte tenu, chez les esprits, dune remarquable
impermabilit au principe de contradiction, ne pouvait gure sadmettre que
parce que le lien dhomme homme ntait pas conu comme une force
tellement puissante que rien ne se pt comparer avec elle. Peut-tre ne serait-il
pas absolument inexact dinterprter leffondrement de la civilisation
anglo-saxonne comme la dbcle dune socit qui, ayant vu malgr tout
seffriter les vieux cadres sociaux, navait pas su leur substituer une armature
de dpendances bien dfinies et nettement hirarchises.
Ce nest pas vers lEspagne du Nord -Est que doit regarder lhistorien de la
fodalit, en qute, dans la pninsule ibrique, dun champ de comparaisons
vraiment particularis. Marche dtache de lEmpire carolingien, la Catalo gne
avait subi profondment lempreinte des institutions franques. De mme, plus
indirectement, lAragon voisin. Rien de plus original, au contraire, que la
structure des socits du groupe asturo-lonais : Asturies, Len, Castille,
Galice, plus tard Portugal. Malheureusement lexploration nen a gure t
pousse bien loin. Voici, en quelques mots, ce quon peut entrevoir (181).
Lhritage de la socit visigothique, transmis par les premiers rois et
laristocratie, les condition s de vie alors communes tout lOccident
favorisrent, l comme ailleurs, le dveloppement des dpendances
personnelles. Les chefs, notamment, avaient leurs guerriers familiers, quils
appelaient, lordinaire, leurs criados, cest --dire leurs p.265 nourris et que
les textes, parfois, traitent galement de vassaux . Mais ce dernier mot tait
demprunt ; et son emploi en somme fort rare, a pour principal intrt de
rappeler que mme ce secteur, entre tous autonome, du monde ibrique, subit
nanmoins, lui aussi, et avec une force, semble-t-il, croissante, linfluence des
fodalits doutre -Pyrnes. Comment en et-il t autrement, alors que tant
de chevaliers et de clercs franais passaient constamment les cols ? De mme,
le mot dhommage se rencont re quelquefois et, avec lui, le rite. Mais le geste
indigne de ddition tait autre : ctait le baisement des mains, dailleurs
entour dun formalisme beaucoup moins rigoureux et susceptible de se
Marc BLOCH La socit fodale
182
rpter assez frquemment, comme un acte de simple politesse. Bien que le
nom de criados paraisse voquer, avant tout, des fidles domestiques et que le
Pome du Cid appelle encore les suivants du hros ceux qui mangent son
pain , lvolution qui partout tendait substituer aux distributions daliments
et de cadeaux les dotations en terres ne laissa point de se faire sentir :
tempre pourtant, ici, par les ressources exceptionnelles que le butin, aprs
les razzias en territoire maure, mettait entre les mains des rois et des grands.
Une notion, assez nette, de la tenure greve de services et rvocable en cas de
manquement se dgagea. Quelques documents, inspirs par le vocabulaire
tranger, parfois rdigs par des clercs venus de France, la dnomment fief
(sous ses formes latines). La langue courante avait labor, en pleine
indpendance, un terme propre : prestamo, littralement par un curieux
paralllisme dides avec le lehn allemand ou anglo-saxon prt .
Jamais, cependant, ces pratiques ne donnrent naissance, comme en
France, un rseau, puissant, envahissant et bien ordonn, de dpendances
vassaliques et fodales. Cest que deux grands faits imprimrent, lhistoire
des socits asturo-lonaises, une tonalit particulire : la reconqute ; et le
repeuplement. Sur les vastes espaces arrachs aux Maures, des paysans furent
tablis, comme colons, qui, pour la plupart, chappaient aux formes au moins
les plus astreignantes de la sujtion seigneuriale ; qui, en outre, conservrent
ncessairement les aptitudes guerrires dune sorte p.266 de milice des confins.
Il en rsultait que beaucoup moins de vassaux quen France pouvaient tre
pourvus de revenus tirs du travail de tenanciers, payant redevances et devant
corves ; que, surtout, si le fidle arm tait le combattant par excellence, il
ntait pas le seul combattant ni mme le seul tre mont. A ct de la
chevalerie des criados, il existait une chevalerie vilaine , compose des
plus riches parmi les libres paysans. Dautre part, le pouvoir du roi, chef de la
guerre, restait beaucoup plus agissant quau nord des Pyrnes. Dautant que,
par surcrot, les royaumes tant beaucoup moins tendus, leurs souverains se
sentaient beaucoup moins en peine datteindre directement la masse de leurs
sujets. Donc point de confusion entre lhommage vassaliq ue et la
subordination du fonctionnaire, entre loffice et le fief. Point, non plus,
dchelonnement rgulier des hommages, montant de degr en degr sauf
interruption par lalleu du plus petit chevalier jusquau roi. Il y avait et
l des groupes de faux, souvent dots de terres qui rmunraient leurs
services. Imparfaitement lis entre eux, ils taient loin de constituer larmature
presque unique de la socit et de ltat. Tant il est vrai que deux facteurs
semblent avoir t indispensables tout rgime fodal achev : le quasimonopole professionnel du vassal-chevalier ; et leffacement, plus ou moins
volontaire, devant lattache vassalique, des autres moyens daction de
lautorit publique.
V. Les fodalits dimportation
Marc BLOCH La socit fodale
183
Avec ltablissement des ducs de Normandie en Angleterre, nous touchons
un remarquable phnomne de migration juridique : le transport, sur une
terre conquise, des institutions fodales franaises. On le vit se produire trois
reprises, durant le mme sicle. Au-del de la Manche, aprs 1066. Dans
lItalie du Sud o, depuis 1030 ou environ, des aventuriers, venus eux aussi de
Normandie, commencrent se tailler des principauts, destines finalement,
au bout dun sicle, constituer, par leur runion, le royaume dit de p.267
Sicile. En Syrie enfin, dans les tats fonds, depuis 1099, par les croiss. Sur
le sol anglais, la prsence chez les vaincus dhabitudes dj quasi vassaliques
facilita ladaptation du rgime tranger. Dans la Syrie latine, on travaillait sur
une table rase. Quant lItalie mridionale, elle avait t partage, avant
larrive des Normands, entre trois dominations. Dans les principauts
lombardes de Bnvent, Capoue et Salerne, la pratique des dpendances
personnelles tait fort rpandue, mais sans quelles se fussent labores en un
systme bien hirarchis. Dans les provinces byzantines, des oligarchies
terriennes, guerrires et souvent aussi marchandes dominaient la foule des
humbles, que leur attachait quelquefois une sorte de patronat. Enfin, l o
rgnaient les mirs arabes, il nexistait rien danalogue, mme de loin, la
vassalit. Mais, si puissants quaient t ces contrastes, la transplantation des
relations fodales et vassaliques fut partout rendue aise par leur caractre
dinstitutions d e classe. Au-dessus des plbes rurales et parfois des
bourgeoisies, les unes comme les autres de type ancestral, les groupes
dirigeants, composs essentiellement denvahisseurs, auxquels en Angleterre
et surtout en Italie staient joints quelques lments emprunts aux
aristocraties indignes, formaient autant de socits coloniales, rgies par des
usages, comme elles, exotiques.
Ces fodalits dimportation eurent pour caractre commun dtre
beaucoup mieux systmatises que l o le dveloppement avait t purement
spontan. A vrai dire, dans lItalie du Sud qui, conquise peu peu, la suite
daccords autant que de guerres, navait pas vu disparatre totalement ses
hautes classes ni leurs traditions, il subsista toujours des alleux. Beaucoup, par
un trait caractristique, taient entre les mains des vieilles aristocraties des
cits. Ni en Syrie par contre, ni en Angleterre si on laisse de ct, au dbut,
certaines oscillations de terminologie , lallodialit ne fut admise. Toute
terre est tenue dun seigneur et cette chane, qui nulle part ne sinterrompt,
aboutit de maillon en maillon au roi. Tout vassal, par suite, est attach au
souverain, non seulement comme son sujet, mais aussi par un lien qui monte
dhomme homme. Le vieux principe carolingien de la coercition par le
seigneur p.268 recevait ainsi, sur ces terres trangres au vieil Empire, son
application presque idalement parfaite.
Dans lAngleterre, gouverne par une royaut puissante, qui sur le sol
conquis avait apport les fortes habitudes administratives de son duch natal,
Marc BLOCH La socit fodale
184
les institutions ainsi introduites ne dessinrent pas seulement une armature
plus rigoureusement ordonne que nulle part ailleurs. Par leffet dune sorte de
contagion du haut en bas, elles pntrrent progressivement la socit presque
tout entire. En Normandie, comme lon sait, le mot de fief subit une
altration smantique profonde, au point den venir dsigner toute tenure. La
dviation probablement avait commenc ds avant 1066. Mais sans tre
encore, cette date, compltement acheve. Car, si elle se produisit
paralllement sur lune et lautre rive de la Manche, ce ne fut pas exactement
selon les mmes lignes. Le droit anglais, dans la seconde moiti du XIIe
sicle, se trouva conduit distinguer trs nettement deux grandes catgories
de tenures. Les unes, qui comprenaient la majorit, sans doute, des petites
exploitations paysannes, tant considres la fois comme de dure prcaire
et comme frappes de services dshonorants, furent qualifies de non-libres.
Les autres, dont la possession tait protge par les cours royales, formrent le
groupe des terres libres. Ce fut celles-ci, dans leur ensemble, que stendit le
nom de fief (fee). Les fiefs de chevaliers y voisinaient avec des censives
rurales ou bourgeoises. Or nimaginons point une assimilation purement
verbale. Dans toute lEurope des X Ie et XIIe sicles, le fief militaire, comme
on le verra bientt, stait mu en bien pratiquement hrditaire. Dans
beaucoup de pays, en outre, tant conu comme indivisible, il se transmettait
seulement dan en an. Tel tait le cas, notamment en Angleterre. Mais, ici,
la primogniture peu peu fit tache dhuile. Elle sappliqua toutes les terres
dnommes fees, et parfois plus bas encore. Ainsi ce privilge danesse, qui
devait devenir un des caractres les plus originaux des murs sociales
anglaises et lun des plus gros de consquences, exprima, en son principe, une
sorte de sublimation du fief au rang de droit rel, par excellence, des hommes
libres. En un sens, lAngleterre, dans lchelle des socits fodales, p.269 se
place aux antipodes de lAllemagne. Non contente, comme la France, de ne
point constituer la coutume des gens fieffs en corps juridique distinct, chez
elle toute une part considrable du Landrecht le chapitre des droits fonciers
fut Lehnrecht.
Marc BLOCH La socit fodale
185
Chapitre IV
Comment le fief passa dans le patrimoine du vassal
I. Le problme de lhrdit : honneurs et simples fiefs
Ltablissement de lhrdit des fiefs a t mis par Mont esquieu au
nombre des lments constitutifs du gouvernement fodal , oppos au
gouvernement politique des temps carolingiens. Non sans raison.
Entendons bien, cependant, que, pris la rigueur, le terme est inexact, jamais
la possession du fief ne se transmit automatiquement par la mort du prcdent
dtenteur. Mais, sauf motifs valables, troitement dtermins, le seigneur
perdit la facult de refuser lhritier naturel la rinvestiture, que prcdait un
nouvel hommage. Le triomphe de lhrdit ai nsi comprise fut celui des forces
sociales sur un droit prim. Pour en pntrer les raisons, il importe nous
bornant provisoirement au cas le plus simple : celui o le vassal laissait un fils
et nen laissait quun de chercher nous reprsenter, dans le concret,
lattitude des parties en cause.
p.271
Que, mme en labsence de toute concession de terre, la fidlit tendt
unir moins deux individus que deux lignes, voues lune commander,
lautre obir, comment en et -il t autrement, dans une socit o les liens
du sang avaient tant de force ? Le moyen ge tout entier a mis une grande
valeur sentimentale dans les mots de seigneur naturel : entendez, par
naissance. Mais, ds quil y avait chasement , lintrt du fils succder
son pre, dans la foi, devenait p.272 presque contraignant. Refuser lhommage
ou manquer le faire accepter, ctait du mme coup perdre avec le fief une
part considrable du patrimoine paternel, voire sa totalit. A plus forte raison,
la renonciation devait-elle sembler dure lorsque le fief tait de reprise ,
cest --dire reprsentait en ralit un ancien alleu familial. En fixant lattache
sur le sol, la pratique de la rmunration foncire amenait fatalement la fixer
dans la famille.
La position du seigneur tait moins franche. Il lui importait, au premier
chef, que le vassal parjure ft puni, que le fief, si les charges manquaient
tre rendues, devnt disponible pour un meilleur serviteur. Son intrt, en un
mot, le poussait insister vigoureusement sur le principe de rvocabilit.
Lhrdit, par contre, ne le trouvait pas hostile, de parti pris. Car il avait, sur
toutes choses, besoin dhommes. O les recruter mieux que parmi la postrit
de ceux qui lavaient dj servi ? Ajoutez quen refusant au fi ls le fief
paternel, il ne risquait pas seulement de dcourager les fidlits neuves. Il
Marc BLOCH La socit fodale
186
sexposait, chose plus grave encore, mcontenter ses autres vassaux,
justement inquiets du sort rserv leurs propres descendants. Selon le mot du
moine Richer, qui crivait sous Hugues Capet, dpouiller lenfant, ctait
pousser au dsespoir tous les braves gens . Mais il pouvait aussi, ce matre
qui stait provisoirement dessaisi dune part de son patrimoine, dsirer
imprieusement ramener lui la terre, le chteau, les pouvoirs de
commandement ; ou bien, lors mme quil se dcidait une nouvelle
infodation, prfrer lhritier du prcdent vassal un autre commend, jug
plus sr ou plus utile. Les glises, enfin, gardiennes dune fortune en principe
inalinable, rpugnaient particulirement reconnatre un caractre dfinitif
des infodations quelles navaient dj, le plus souvent, consenties qu
contrecur.
Jamais le jeu complexe de ces diverses tendances napparut avec plus de
clart que sous les premiers Carolingiens. Ds lors, les bienfaits se
transmettaient souvent aux descendants : telle cette terre de Folembray,
bienfait royal en mme temps que prcaire de lglise de Reims, que du
rgne de Charlemagne celui de Charles le Chauve quatre p.273 gnrations
successives se passrent de mains en mains (182). Il ntait pas jusqu la
considration due au fidle vivant qui, par un curieux dtour, ne contribut
parfois imposer lhrdit. Affaibli par lge ou la m aladie, un vassal, nous
dit larchevque Hincmar, devient -il incapable de remplir ses devoirs ? Sil
peut se substituer, dans le service, un fils, le seigneur ne sera point autoris
le dpossder (183). Ctait, peu de chose p rs, reconnatre davance cet
hritier une succession dont il avait, ds le vivant du dtenteur, assum les
charges. Dj mme on jugeait bien dur denlever lorphelin, si jeune ft -il
et par suite inapte aux armes, le bienfait paternel. Ne voyons-nous pas,
dans un cas de cette sorte, Louis le Pieux se laisser attendrir par les prires
dune mre ? Loup de Ferrires en appeler au bon cur dun prlat ? Quen
droit strict, cependant, le bienfait ft purement viager, nul nen doutait
encore. En 843, un certain Adalard donna au monastre de Saint-Gall des
biens tendus, dont une partie avait t distribue des vassaux. Ceux-ci,
passs sous la domination de lglise, devront conserver leurs bienfaits
leur vie durant ; de mme, leur suite, leurs fils, sils consentent servir.
Aprs quoi, labb disposera des terres son gr (184). De toute vidence, il et
paru contraire aux bonnes rgles de lui lier indfiniment les mains. Aussi bien
Adalard ne sintressait -il peut-tre quaux enfants quil avait pu connatre ;
proche encore de sa source, lhommage nengendrait que des sentiments
troitement personnels.
Sur ce fond premier de commodits et de convenances, lhrdit vritable
stablit peu peu, au cours de la p riode trouble et fertile en nouveauts qui
souvrit avec le morcellement de lempire carolingien. Partout lvolution
tendit vers cette fin. Mais le problme ne se posait pas dans les mmes termes
pour toutes les natures de fief. Une catgorie doit tre mise part : ces fiefs
Marc BLOCH La socit fodale
187
que plus tard les feudistes dnommeront de dignit . Entendez ceux qui
taient faits doffices publics, dlgus par le roi.
Ds les premiers Carolingiens, on la vu, le roi sattachait par les liens de
la vassalit les personnes auxquels il confiait les principales charges de ltat
et, notamment, les grands p.274 commandements territoriaux, comts, marches
ou duchs. Mais ces fonctions, qui conservaient le vieux nom latin
d honneurs , taient alors soigneusement distingues des bienfaits .
Elles en diffraient, en effet, par un trait, entre autres, particulirement
frappant : labsence de tout caractre viager. Leurs titulaires pouvaient
toujours tre rvoqus, mme sans fautes de leur part, voire pour leur
avantage. Car le changement de poste tait parfois un avancement ; ainsi pour
ce petit comte des bords de lElbe qui fut, en 817, mis la tte de limportante
marche du Frioul. Honneurs , bienfaits : numrant les faveurs dont le
souverain a gratifi tel ou tel de ses fidles, les textes de la premire moiti du
IXe sicle ne manquent jamais dy faire ces deux parts.
Cependant, en labsence de tout salaire en argent, quinterdisaient les
conditions conomiques, la fonction tait, elle-mme, son propre traitement.
Le comte ne percevait pas seulement, dans sa circonscription, le tiers des
amendes. La jouissance de certaines terres fiscales, spcialement affectes
son entretien, lui tait, entre autres, accorde. Il ntait pas jusquaux pouvoirs
exercs sur les habitants qui outre les gains illgaux dont ils fournissaient
trop souvent loccasion ne dussent sembler, par eux-mmes, un authentique
profit, en ce temps o la vritable fortune tait de tenir rang de matre. En plus
dun sens, loctroi dun comt ta it donc bien un don, parmi les plus beaux qui
pussent rcompenser un vassal. Quau surplus le donataire ft par l fait juge
et chef de guerre navait rien, en somme, qui le diffrencit, sinon par le
degr, de beaucoup de dtenteurs de simples bienfaits ; car ceux-ci
comportaient, pour la plupart, lexercice de droits seigneuriaux. Restait la
rvocabilit. A mesure que la royaut, partir de Louis le Pieux, alla
saffaiblissant, ce principe, sauvegarde de lautorit centrale, devint
dapplication de p lus en plus difficile. Car les comtes, renouvelant les
habitudes qui avaient t celles de laristocratie, au dclin de la dynastie
mrovingienne, travaillrent avec un succs croissant se transformer en
potentats territoriaux solidement enracins au soi. Ne voit-on pas, en 867,
Charles p.275 le Chauve sefforcer en vain darracher un serviteur rebelle le
comt de Bourges ? Rien dsormais ne sopposa plus une assimilation
prpare par dindiscutables ressemblances. Dj, aux beaux temps de
lEmpire ca rolingien, on avait commenc traiter volontiers dhonneurs
tous les bnfices des vassaux royaux, que leur rle dans ltat mettait si prs
des fonctionnaires proprement dits. Le mot finit par devenir un simple
synonyme de fief, sous cette rserve que, dans certains pays du moins tels
que lAngleterre normande , on tendit en limiter lemploi aux fiefs les
plus tendus, dots dimportants pouvoirs de commandement. Paralllement,
les terres affectes la rmunration de loffice, puis, par une dv iation
Marc BLOCH La socit fodale
188
beaucoup plus grave, celui-ci mme furent qualifis de bienfait , ou de fief.
En Allemagne, o les traditions de la politique carolingienne demeuraient
exceptionnellement vivantes, lvque -chroniqueur Thietmar, fidle au
premier de ces deux emplois, distingue encore trs nettement, vers 1015, le
comt de Mersebourg du bienfait attach ce comt. Mais depuis
longtemps le langage courant ne sembarrassait plus de ces subtilits : ce quil
dnommait bienfait ou fief tait bel et bien la charge tout entire, source
indivisible de puissance et de richesse. Ds 881, les Annales de Fulda
crivaient de Charles le Gros que cette anne-l il donna Hugues, son parent,
pour quil lui ft fidle, divers comts en bienfait .
Or ceux que les crivains dglise appelaient volontiers les nouveaux
satrapes des provinces avaient beau tirer de la dlgation royale lessentiel
des pouvoirs dont ils prtendaient dsormais user leur profit ; pour tenir
solidement le pays, il leur fallait davantage : acqurir et l des terres
nouvelles ; construire des chteaux aux nuds des routes ; sriger en
protecteurs intresss des principales glises ; avant tout, se recruter, sur
place, des fidles. Cette uvre de longue haleine exigeait le patient travail de
gnrations se succdant sur le mme sol. En un mot, leffort vers lhrdit
naissait naturellement des besoins de la puissance territoriale. Lerreur serait
donc lourde de le considrer simplement comme un effet de lassimilation p.276
des honneurs aux fiefs. Autant quaux comtes francs, il simposa aux earls
anglo-saxons, dont les vastes commandements ne furent jamais considrs
comme des tenures, aux gastaldes des principauts lombardes, qui
ntaient points des vassaux. Mais comme, dans les tat s issus de lEmpire
franc, les duchs, marches ou comts prirent place de bonne heure parmi les
concessions fodales, lhistoire de leur transformation en biens familiaux sy
trouva inextricablement mle celle de la patrimonialit des fiefs, en
gnral. Cela, dailleurs, sans avoir jamais cess de faire figure de cas
particulier. Le rythme de lvolution ne fut pas seulement partout diffrent
pour les fiefs ordinaires et pour les fiefs de dignit. Lorsquon passe dun tat
lautre, on voit lopposition changer de sens.
II. Lvolution : le cas franais
En France Occidentale et en Bourgogne, la prcoce faiblesse de la royaut
eut pour rsultat que les bienfaits constitus par des fonctions publiques
furent parmi les premiers conqurir lhrdit . Rien de plus instructif, cet
gard, que les dispositions prises par Charles le Chauve, en 877, dans le
fameux plaid de Quierzy. Sur le point de partir pour lItalie, il se proccupait
de rgler le gouvernement du royaume, durant son absence. Que faire, si,
pendant ce temps, un comte vient mourir ? Avant tout, aviser le souverain.
Celui-ci, en effet, se rserve toute nomination dfinitive. A son fils Louis,
charg de la rgence, il naccorde que la facult de dsigner des
Marc BLOCH La socit fodale
189
administrateurs provisoires. Sous cette forme gnrale, la prescription
rpondait lesprit de jalouse autorit dont le reste du capitulaire apporte tant
de preuves. Cependant, quelle sinspirt aussi, un degr au moins gal, du
souci de mnager les grands dans leurs ambitions familiales, la preuve en est
fournie par la mention dont sont expressment lobjet deux cas particuliers. Il
se peut que, le comte laissant aprs lui un fils, celui-ci ait suivi larme
outre-monts. En refusant au rgent la facult de pourvoir lui-mme au
remplacement, Charles, dans cette hypothse, entendait, avant tout, rassurer
p.277 ses compagnons darmes : fallait-il que leur fidlit les privt de lespoir
de recueillir une succession ds longtemps souhaite ? Il se peut aussi que le
fils, demeur en France, soit tout petit . Ce sera au nom de cet enfant que,
jusquau jour o la dcision suprme aura t connue, le comt devra tre gr
par les officiers de son pre. Ldit ne va pas plus loin. Visiblement, il
paraissait prfrable de ne pas inscrire en toutes lettres, dans une loi, le
principe de la dvolution hrditaire. Ces rticences, par contre, ne se
retrouvent plus dans la proclamation que lEmpereur fit lire, par son
chancelier, devant lassemble. L il promet sans ambages de remettre au fils
soldat dItalie ou en bas ge les honneurs paternels. Mesures de
circonstance, assurment, dictes par les ncessits dune politique de
magnificence. Elles nengageaient pas expressment lavenir. Mais, moins
encore, rompaient-elles avec le pass. Elles reconnaissaient officiellement,
pour un temps donn, un privilge dhabitude.
Aussi bien suffit-il de suivre, pas pas, l o cela est possible, les
principales sries comtales pour saisir, sur le vif, le glissement vers lhrdit.
Voici, par exemple, les anctres de la troisime dynastie de nos rois. En 864,
Charles le Chauve peut encore retirer Robert le Fort ses honneurs de
Neustrie, afin de lemployer ailleurs. Pour peu de temps. Lorsque Robert
tombe Brissarthe, en 866, cest de nouveau la t te de son commandement
dentre Seine -et-Loire. Mais, bien quil laisse deux fils, la vrit fort jeunes,
aucun deux nhrite de ses comts, dont le roi dispose en faveur dun autre
magnat. Il faudra attendre la disparition de cet intrus, en 886, pour que lan,
Eude, rcupre lAnjou, la Touraine, peut -tre le Blsois. Dsormais ces
territoires ne sortiront plus du patrimoine familial. Du moins, jusquau jour o
les Robertiens en seront chasss par leurs propres officiers, mtamorphoss,
leur tour, en potentats hrditaires. Dans la suite des comtes, tous de la mme
ligne, qui de 885 environ jusqu lextinction de la descendance, en 1137 , se
succdrent Poitiers, un seul intervalle fait brche : fort court dailleurs (de
890 902) et provoqu par une minorit, quaggravait un soupon de
btardise. Encore, par un trait doublement caractristique, p.278 cette
dpossession, dcide par le monarque, avait-elle profit, finalement, en dpit
de ses ordres, un personnage qui, fils dun plus ancien comte , pouvait lui
aussi invoquer les droits de la race. Par-del les sicles, un Charles Quint,
voire un Joseph II ne tiendront la Flandre que parce que, de mariage en
mariage, sera venu jusqu eux un peu du sang de ce Baudoin le Ferr, qui, en
Marc BLOCH La socit fodale
190
lan 862, avai t si gaillardement ravi la fille du roi des Francs. Tout nous
ramne, on le voit, aux mmes dates : sans conteste, ltape dcisive se plaa
vers la seconde moiti du IXe sicle.
Quadvenait -il, cependant, des fiefs ordinaires ? Les dispositions de
Quierzy sappliquaient expressment, en mme temps quaux comts, aux
bienfaits des vassaux royaux, honneurs , eux aussi, leur manire.
Mais dit et proclamation ne sen tiennent pas l. Les rgles auxquelles
Charles sengage en faveur de ses vassaux, i l exige que ceux-ci, leur tour, en
tende le profit leurs propres hommes. Prescription, dicte, cette fois encore,
de toute vidence, par les intrts de lexpdition italienne : ne convenait-il
pas de donner les apaisements ncessaires, autant qu qu elques grands chefs,
au gros des troupes, compos de vassaux de vassaux ? Pourtant nous touchons
ici quelque chose de plus profond quune simple mesure doccasion. Dans
une socit o tant dindividus taient la fois commends et matres, on
rpugnait admettre que lun deux, sil stait fait reconnatre, comme vassal,
quelque avantage, pt, comme seigneur, le refuser ceux quattachait sa
personne une semblable forme de dpendance. Du vieux capitulaire
carolingien la Grande Charte, fondement classique des liberts anglaises,
cette sorte dgalit dans le privilge, qui ainsi glissait de haut en bas, devait
demeurer un des principes les plus fconds de la coutume fodale.
Son action et plus encore le sentiment, trs puissant, dune manire d e
rversibilit familiale, qui, des services rendus par le pre, tirait un droit pour
sa postrit, gouvernaient lopinion publique. Or celle -ci, dans une civilisation
sans codes crits comme sans jurisprudence organise, tait bien prs de se
confondre avec le droit. Elle a trouv dans lpope franaise un fidle cho.
Non que le tableau que p.279 tracent les potes puisse tre accept sans
retouches. Le cadre historique que la tradition leur imposait les amenait ne
gure poser le problme qu propos d es grands fiefs royaux. En outre,
mettant en scne les premiers empereurs carolingiens, ils se les reprsentaient,
non sans raison, comme beaucoup plus puissants que les rois des XIe ou XIIe
sicles, par suite comme assez forts encore pour disposer librement des
honneurs du royaume, ft-ce aux dpens des hritiers naturels. Ce dont les
Captiens taient devenus bien incapables. L-dessus leur tmoignage na
donc dautre valeur que celle dune reconstitution, approximativement exacte,
dun pass ds longtemp s prim. Ce qui est bien de leur temps, en revanche,
cest le jugement que, ltendant sans nul doute toutes les natures de fiefs, ils
portent sur ces pratiques. Ils ne les donnent pas prcisment pour contraires au
droit. Mais ils les estiment moralement condamnables. Comme si le Ciel
mme se vengeait, elles engendrent les catastrophes : une double spoliation de
cette sorte nest -elle pas la racine des malheurs inous qui remplissent la
geste de Raoul de Cambrai ? Le bon matre est celui qui tient en mmoire
cette maxime, quune des chansons met au nombre des enseignements de
Charlemagne son successeur :
A enfant orphelin, garde-toi darracher son fief
(185).
Marc BLOCH La socit fodale
191
Mais combien y avait-il de bons matres, ou qui fussent contraints de
ltre ? crire lhistoire de lhrdit, ce devrait tre dresser, priode par
priode, la statistique des fiefs qui shritaient et de ceux qui ne shritaient
point : rve, en ltat des documents, jamais irralisable. Certainement, la
solution, dans chaque cas particulier, dpendit longtemps de la balance des
forces. Plus faibles, souvent mal administres, les glises semblent avoir, ds
le dbut du Xe sicle, gnralement cd la pression de leurs vassaux. Dans
les grandes principauts laques, par contre, on entrevoit, jusque vers le milieu
du sicle suivant, une coutume encore singulirement mouvante. Nous
pouvons suivre lhistoire dun fief angevin celui de Saint-Saturnin sous
les comtes Foulque Nerra et Geoffroi Martel (987-1060) (186). Le comte ne le
reprend pas seulement au p.280 premier signe dinfidlit, voire lorsque le
dpart du vassal pour une province voisine risque de mettre obstacle au
service. On naperoit point quil se croie le moins du monde a streint
respecter les droits familiaux. Parmi les cinq dtenteurs qui se relayent durant
une priode dune cinquantaine dannes, deux seulement deux frres
apparaissent lis par le sang. Encore, entre eux, un tranger tait-il venu se
glisser. Bien que deux chevaliers aient t jugs dignes de garder
Saint-Saturnin leur vie durant, la terre aprs eux sort de leur ligne. A vrai
dire, rien nindique expressment quils aient laiss des fils. Mais, supposer
mme labsence, dans les deux cas, de toute postrit masculine, rien ne
saurait tre plus significatif que le silence gard sur ce point par la notice trs
dtaille laquelle nous devons nos renseignements. Destine tablir les
droits des moines de Vendme, qui le bien finalement avait chu, si elle
nglige de justifier, par lextinction des diverses descendances, les transferts
successifs dont labbaye devait, au bout du compte, recueillir le profit, la
raison en est, de toute vidence, que la dpossession de lhritier ne paraissait
alors nullement illgitime.
Une telle mobilit cependant tait, ds ce moment, presque anormale. En
Anjou mme ce fut ds les alentours de lan mille que se fondrent les
principales dynasties de seigneurs chtelains. Il faut bien, par ailleurs, que le
fief normand, en 1066, ait t universellement estim transmissible aux
hritiers, puisque, dans lAngleterre o on le vit alors import, cette qualit ne
lui fut pratiquement jamais conteste. Au Xe sicle, lorsquun seigneur
acceptait, par aventure, de reconnatre la dvolution hrditaire dun fief, il
faisait inscrire cette concession, en termes exprs, dans lacte doctroi. Depuis
le milieu du XIIe sicle, la situation est retourne : les seules stipulations dont
dornavant on prouve le besoin sont celles qui, par une exception rare mais
toujours loisible, bornent la jouissance du fief la vie du premier bnficiaire.
La prsomption joue maintenant en faveur de lhrdit. En France, comme en
Angleterre, cette date, qui dit fief tout court dit bien qui shr ite et lorsque,
par exemple, les communauts ecclsiastiques, p.281 contrairement aux anciens
modes de langage, dclarent refuser ce titre aux charges de leurs officiers,
elles nentendent par l rien de plus que de repousser toute obligation
Marc BLOCH La socit fodale
192
daccepter le s services du fils aprs ceux du pre. Favorable aux descendants
ds lpoque carolingienne, confirme dans ce parti pris par lexistence des
nombreux fiefs de reprise auxquels leur origine mme confrait un
caractre presque inluctablement patrimonial, la pratique, au temps des
derniers Carolingiens et des premiers Captiens, imposait dj, peu prs
partout, linvestiture du fils aprs celle du pre. Durant le second ge fodal,
caractris de toute part par une sorte de prise de conscience juridique, elle se
fit droit.
III. Lvolution : dans lempire
Nulle part mieux que dans lItalie du Nord, le conflit des forces sociales,
sous-jacent lvolution du fief, napparat en plein relief. Reprsentons -nous,
dans son chelonnement, la socit fodale du royaume lombard : au sommet
le roi qui, depuis 951, avec de brves interruptions, est en mme temps roi de
Germanie et, lorsquil a t sacr des mains du pape, empereur ;
immdiatement au-dessous de lui, ses tenants en chef, hauts barons dglise
ou dpe ; plus bas encore, la modeste foule des vassaux de ces barons,
arrire-vassaux royaux par consquent et, pour cette raison, communment
appels vavasseurs . Une grave querelle divise au dbut du XIe sicle, les
deux derniers groupes. Les vavasseurs prtendent traiter leurs fiefs en biens
familiaux ; les tenants en chefs insistent au contraire sur le caractre viager de
la concession et sa constante rvocabilit. En 1035, ces heurts engendrent
enfin une vritable guerre de classes. Unis par serment, les vavasseurs de
Milan et des alentours infligent larme des magnats une clatante dfaite.
Arrive lempereur -roi Conrad II, que la nouvelle de ces troubles a alert dans
sa lointaine Allemagne. Rompant avec la politique des Ottons, ses
prdcesseurs, qui avaient t avant tout respectueux de linalinabilit du
domaine ecclsiastique, il prend parti pour les vassaux du degr infrieur et,
p.282 puisque lItalie est encore le pays des lois, quelle a, dit -il, faim de
lois , cest par une vritable ordonnance lgislative que, le 28 mai 1037, il va
fixer le droit en faveur de ses protgs. Dsormais, dcide-t-il, seront tenus
pour hrditaires, au profit du fils, du petit-fils ou du frre, tous les
bienfaits qui pour seigneur ont un tenant en chef laque, un vque, un
abb ou une abbesse ; de mme, les arrire-fiefs constitus sur ces
bienfaits mmes. Point nest fait mention des infodations consenties par
des alleutiers. Visiblement, Conrad estimait lgifrer moins en qualit de
souverain que comme chef de la hirarchie fodale. Il nen atteignait pas
moins ainsi limmense majorit des petits et moyens fiefs chevaleresques.
Quelque part quaient pu avoir, dans son attitude, certaines raisons de
circonstance, et notamment linimiti personnel le qui lopposait au principal
adversaire des vavasseurs, larchevque de Milan Aribert, il semble bien
cependant avoir vu plus loin que ses intrts momentans ou ses rancunes.
Marc BLOCH La socit fodale
193
Contre les grands feudataires, toujours redoutables aux monarchies, il
cherchait une sorte dalliance avec leurs propres troupes. La preuve en est
quen Allemagne o larme de la loi lui manquait, il seffora datteindre le
mme but par dautres moyens : probablement en inclinant, dans le sens
souhait, la jurisprudence du tribunal royal. L aussi, au tmoignage de son
chapelain, il gagna les curs des chevaliers en ne souffrant point que les
bienfaits octroys aux pres fussent enlevs leur descendance .
A dire vrai, cette intervention de la monarchie impriale, en faveur de
lhrdit, sinsrait dans la ligne dune volution dj plus qu demi
acheve. Navait -on pas vu, ds le dbut du XIe sicle, se multiplier en
Allemagne les accords privs qui reconnaissaient les droits de la descendance
sur tel ou tel fief particulier ? Si, en 1069, le duc Godefroy de Lorraine croyait
encore pouvoir disposer librement des tenures stipendiaires de ses
chevaliers pour les donner une glise, les murmures des fidles ainsi
lss se firent entendre si haut que son successeur, aprs sa mort, dut changer
ce cadeau contre un autre (187). Dans lItalie lgislatrice, dans lAllemagne
soumise des rois relativement puissants, dans la France sans lois et,
pratiquement, presque sans rois, p.283 le paralllisme des courbes dnonce
laction de forces plus profondes que les intrts politiques. Du moins, quant
aux fiefs ordinaires. Cest dans le sort fait aux fiefs de dignit quil faut
chercher la marque originale imprime lhistoire des fodalits allemande et
italienne par un pouvoir central plus quailleurs efficace.
Tenus directement de lEmpire, la loi de Conrad II, par dfinition, ne les
concernait point. Restait le prjug favorable qui sattachait, communment,
aux droits du sang. Il ne manquait pas de jouer ici aussi. Ds le IXe sicle, le
souverain ne se dcide quexceptionnellement rompre avec une tradition si
digne de respect. Sy rsout -il cependant ? lopinion, dont les chroniqueurs
nous apportent lcho, crie volontiers larbitraire. En fait, nan moins,
lorsquil sagit, soit de rcompenser un bon serviteur, soit dcarter un enfant
trop jeune ou un homme jug peu sr, le pas est souvent franchi. Quitte,
dailleurs, pour lhritier ainsi ls tre ensuite indemnis par loctroi de
quelque autre charge analogue. Car les comts, en particulier, ne passaient
gure de mains en mains qu lintrieur dun assez petit nombre de familles
et la vocation comtale, en soi, se trouva, de la sorte, hrditaire bien avant que
ne le fussent devenus les comts mmes, pris isolment. Les plus grands
commandements territoriaux, marches et duchs, furent aussi ceux qui
restrent le plus longtemps en butte ces actes dautorit. Par deux fois,
durant le Xe sicle, on vit le duch de Bavire, par exemple, chapper au fils
du prcdent titulaire. De mme, en 935, la marche de Misnie, en 1075, celle
de Lusace. Par un de ces archasmes dont lAllemagne du moyen ge tait
coutumire, la situation des principaux honneurs de lEmpire y demeura en
somme, jusqu la fin du X Ie sicle, peu prs telle quen France, sous
Charles le Chauve.
Marc BLOCH La socit fodale
194
Jusqu cette date seulement. Au cours du sicle dj le mouvement tait
all se prcipitant. De Conrad II lui-mme, on possde une concession de
comt titre hrditaire. Son petit-fils Henri IV, son arrire-petit-fils Henri V
reconnurent le mme caractre aux duchs de Carinthie et de Souabe, au
comt de Hollande. Au XIe sicle, le principe ne sera plus contest. L aussi
les droits du seigneur, ft-il le roi, p.284 avaient d cder le pas, peu peu,
ceux des lignages vassaliques.
IV. Les transformations du fief vues travers son droit successoral
Un fils, un seul fils et qui ft apte succder de suite : cette hypothse a
bien pu fournir notre analyse un commode point de dpart. La ralit
souvent tait moins simple. Du jour o lopinion tendit reconnatre les droits
du sang, elle se trouva en prsence de situations familiales varies, dont
chacune soulevait ses problmes propres. Ltude, au moins sommaire, des
solutions que les diverses socits donnrent ces difficults permettra de
saisir, au fil de la vie mme, les mtamorphoses du fief et du lien vassalique.
Le fils ou, son dfaut, le petit-fils semblait le continuateur naturel du
pre ou de laeul dans ces services qu e souvent, de son vivant mme, il lavait
aid rendre. Un frre, par contre, ou un cousin avaient ordinairement leur
carrire dj faite ailleurs. Cest pourquoi la reconnaissance de lhrdit
collatrale donne vraiment, ltat pur, la mesure de la tr ansformation de
lancien bienfait en patrimoine (188). Les rsistances furent vives, surtout en
Allemagne. En 1196, lempereur Henri VI, qui sollicitait de ses grands leur
assentiment une autre hrdit, celle de la couronne royale, pouvait encore
leur offrir, comme prix dun si beau don, la reconnaissance officielle de la
dvolution des fiefs aux collatraux. Le projet naboutit pas. A moins de
dispositions expresses insres dans la concession originelle ou de coutumes
particulires, comme celle qui, au XIIIe sicle, rgissait les fiefs des
ministriaux dEmpire, jamais, au moyen ge, les seigneurs allemands ne
furent tenus doctroyer linvestiture dautres hritiers que les descendants :
ce qui nempchait point quen fai t ils naccordassent, assez souvent, cette
grce. Ailleurs, il parut logique dintroduire une distinction : le fief se
transmettait en tous sens lintrieur de la postrit issue de son premier
bnficiaire. Non au del. Telle fut la solution du droit lombard. Elle inspira
galement, en France et en Angleterre, depuis le XIIe sicle, p.285 les clauses
dassez nombreuses constitutions de fiefs, nouvellement crs. Mais ctait ici
par drogation au droit commun. Car, dans les royaumes de lOuest, le
mouvement vers la patrimonialit avait t assez fort pour sexercer au profit
de la quasi-universalit des proches. Un seul parti pris continua dy rappeler
que la coutume fodale stait labore sous le signe du service : on rpugna
longtemps admettre, en Angleterre on naccepta jamais que le vassal mort
Marc BLOCH La socit fodale
195
et son pre pour successeur ; une tenure militaire ne pouvait, sans paradoxe,
passer dun jeune un vieux.
Rien ne semblait, en soi, plus contraire la nature du fief que den
permettre lhritage des femmes. Non que le moyen ge les ait jamais juges
incapables dexercer des pouvoirs de commandement. Nul ne se choquait de
voir la haute dame prsider la cour de la baronnie, la place de lpoux
absent. Mais elles ne portaient pas les armes. Il est caractristique que, dans la
Normandie du XIIe sicle finissant, lusage qui dj favorisait la vocation
hrditaire des filles ait t dlibrment aboli par Richard Cur de Lion,
aussitt quclata linexpiable guerre avec le Captien. Les droits qui
seffor aient de conserver le plus jalousement linstitution son caractre
originel la doctrine juridique lombarde, les coutumiers de la Syrie latine, la
juridiction de la cour royale allemande ne cessrent jamais de refuser, en
principe, lhritire ce q uils accordaient lhritier. Que Henri VI ait offert
ses grands vassaux la suppression de cette incapacit, comme de celle qui
frappait les collatraux, prouve combien en Allemagne la rgle demeurait
encore vivace. Mais lpisode en dit long galement sur les aspirations de
lopinion baronale : aussi bien, la faveur dont le Staufen proposait lappt
ses faux, les fondateurs de lEmpire latin de Constantinople devaient un peu
plus tard lexiger de leur futur souverain. En fait, l mme o lexclusion
subsistait en thorie, elle souffrit de bonne heure, dans la pratique, de
nombreuses exceptions. Outre que le seigneur avait toujours la facult de nen
point tenir compte, il arrivait quelle flcht devant telle ou telle coutume
particulire ou ft expressment leve par lacte de concession lui -mme :
ainsi, en 1156, pour le duch dAutriche. En p.286 France et dans lAngleterre
normande, il y avait longtemps, cette date, quon stait rsolu reconnatre
aux filles, dfaut de fils, voire mme de simples parentes, dfaut de
parents dun rang gal, les mmes droits sur les fiefs que sur les autres biens.
Cest quon stait avis trs vite que, si la femme tait incapable de servir,
son mari le pouvait sa place. Par un paralllisme caractristique, les plus
anciens exemples o la primitive coutume vassalique apparaisse ainsi dvie
au profit de la fille ou du gendre se rapportent tous ces grandes principauts
franaises qui furent galement les premires conqurir lhrdit tout court
et, dailleurs, ne comportaient gure plus de services personnels. poux de la
fille du principal comte de Bourgogne , le Robertien Otton dut cette
union, ds 956, la possession des comts, base matrielle de son futur titre
ducal. Ainsi les droits successoraux des descendants en ligne fminine
ayant t, par ailleurs, admis peu prs en mme temps que ceux des femmes
personnellement les lignes fodales, petites ou grandes, virent souvrir
devant elles la politique des mariages.
La prsence dun hri tier mineur posait le plus troublant, sans doute, des
problmes que, ds ses dbuts, eut rsoudre la coutume fodale. Ce ne fut
point sans raisons que la littrature de fiction envisagea toujours, de
prfrence, sous cet angle le grand dbat de lhrdit . Remettre un enfant
Marc BLOCH La socit fodale
196
une tenure militaire, quel illogisme ! Mais dpouiller le tout petit , quelle
cruaut ! La solution qui devait permettre de sortir de ce dilemme avait t
imagine ds le IXe sicle. Le sous-g est reconnu comme hritier ; mais,
jusquau jour o il sera en tat daccomplir ses devoirs de vassal, un
administrateur provisoire tiendra en son lieu le fief, prtera lhommage et
rendra les services. Ne disons pas : un tuteur. Car le baillistre , auquel
incombent ainsi les charges du fief, en recueille galement, son propre
profit, les revenus, sans autres obligations envers le mineur que dassurer son
entretien. Bien que la cration de cette sorte de vassal temporaire portt une
atteinte sensible la notion mme du lien vassalique, conu comme attach
lhomme jusqu la mort, linstitution conciliait trop heureusement avec le
p.287 sentiment familial les besoins du service pour ne pas avoir t adopte trs
largement partout o stendit le systme des fiefs issu de lEmpire franc.
LItalie seule, mdiocrement dispose multiplier en faveur des intrts
fodaux les rgimes dexception, prfra se contenter de la simple tutelle.
Cependant une curieuse dviation bientt se fit jour. Pour prendre la place
de lenfant la tte du fief, le plus naturel semblait de choisir un membre de
sa parent. Telle fut, selon toute apparence, lorigine, la rgle universelle ;
beaucoup de coutumes lui demeurrent jusquau bout fidles. Bien que le
seigneur et, lui aussi, envers lorphelin d es devoirs qui dcoulaient de la foi
nagure prte par le mort, lide que, durant la minorit, il pt chercher, aux
dpens des proches, se faire lui-mme le supplant de son propre vassal et
originellement pass pour absurde : ce matre avait besoin dun homme, non
dune terre. Mais la ralit dmentit trs vite les principes. Il est significatif
quun des plus anciens exemples de la substitution, au moins tente, du
seigneur au proche, comme baillistre , ait mis en prsence le roi de France,
Louis IV, et le jeune hritier dun des plus grands honneurs du royaume : la
Normandie. Mieux valait assurment commander en personne Bayeux ou
Rouen que de devoir compter sur laide incertaine dun rgent du duch.
Lintroduction, en divers pays, du bail seigneurial marque le moment o la
valeur du fief en tant que bien exploiter parut gnralement dpasser celle
des services quon en pouvait attendre.
Nulle part cet usage ne simplanta plus solidement quen Normandie et en
Angleterre o, de toutes faons, le rgime vassalique sorganisa au profit des
forces den haut. Les barons anglais en souffraient quand le seigneur tait le
roi. Ils en bnficiaient, par contre, lorsquils avaient eux -mmes exercer ce
droit envers leurs dpendants. Si bien quay ant obtenu, en 1100, le retour au
bail familial, ils ne surent ou ne voulurent empcher cette concession de
devenir lettre morte. En Angleterre dailleurs, linstitution scarta de bonne
heure ce point de sa signification primitive que lon vit les seig neurs le
roi en tout premier couramment p.288 cder ou vendre la garde de lenfant,
avec ladministration de ses fiefs. Un cadeau de cette nature tait la cour des
Plantagents une des rcompenses les plus envies. A la vrit, quelque belle
chose que ce ft de pouvoir, la faveur dune aussi honorable mission, tenir
Marc BLOCH La socit fodale
197
garnison dans les chteaux, percevoir les rentes, chasser dans les forts ou
vider les viviers, les terres ntaient gure, en pareil cas, que la moindre part
du don. La personne de lh ritier ou de lhritire valait plus encore. Car au
seigneur gardien ou son reprsentant revenait, comme nous le verrons, le
soin de marier leurs pupilles ; et de ce droit aussi ils ne manquaient pas de
faire commerce.
Que le fief, en son principe, dt tre indivisible, rien de plus clair.
Sagissait -il dune fonction publique ? A en souffrir le partage, lautorit
suprieure courait le danger la fois de laisser saffaiblir les pouvoirs de
commandement exercs en son nom et den rendre le contrle plus
incommode. Dun simple fief chevaleresque ? Le dmembrement jetait le
trouble dans la prestation des services, bien difficiles doser, efficacement,
entre les divers copartageants. En outre, la concession primitive ayant t
calcule pour subvenir la solde dun vassal unique, avec sa suite, les
fragments risquaient de ne plus suffire lentretien des nouveaux dtenteurs,
partant de les condamner soit mal sarmer, soit chercher fortune ailleurs. Il
convenait donc que, devenue hrditaire, la tenure, du moins, ne passt qu
un seul hritier. Mais, sur ce point, les exigences de lorganisation fodale
entraient en conflit avec les rgles ordinaires du droit successoral, favorables,
dans la plus grande partie de lEurope, lgalit des hritiers de m me rang.
Sous laction des forces antagonistes, ce grave dbat juridique reut des
solutions variables selon les lieux et les temps.
Une premire difficult se prsentait : entre des postulants galement
proches du dfunt, entre ses fils par exemple, da prs quel critre choisir
lhritier unique ? Des sicles de droit nobiliaire et de droit dynastique nous
ont accoutums attribuer une sorte dvidence au privilge de lanesse. En
ralit, il nest pas plus une chose de nature que tant dautres mythes sur
lesquels reposent aujourdhui nos p.289 socits : la fiction majoritaire, par
exemple, qui de la volont du plus grand nombre fait linterprte lgitime des
opposants eux-mmes. Jusque dans les maisons royales, lordre de
primogniture ne fut pas accept, au moyen ge, sans beaucoup de rsistances.
Dans certaines campagnes, des coutumes, qui remontaient au lointain des
ges, favorisaient bien un des garons ; mais ctait le plus jeune. Avait -on
affaire un fief ? Lusage primitif semble avoir reconnu au seigneur la facult
den investir celui des fils quil jugeait le plus apte. Telle tait encore, vers
1060, la rgle, en Catalogne. Parfois aussi, le pre lui-mme dsignait son
successeur au choix du chef, aprs se ltre plus ou moins associ, de son
vivant, dans le service. Ou bien encore, les hritiers restant dans lindivision,
linvestiture se faisait collective.
Nulle part ces procds archaques neurent la vie plus dure quen
Allemagne. Ils y demeuraient en vigueur en plein XIIe sicle. A ct deux, un
autre usage, en Saxe du moins, manifestait la profondeur du sentiment
familial : les fils eux-mmes lisaient celui dentre eux auquel devait revenir
lhritage. Naturellement, il pouvait arriver, il arrivait souvent que le choix,
Marc BLOCH La socit fodale
198
quelle que ft la mthode adopte, tombt sur lan. Cependant le droit
allemand rpugnait octroyer cette prfrence une force obligatoire. Ctait,
comme dit un pote, un usage welche , un tour tranger (189). Navait -on
pas vu, en 1169, lempereur lui -mme, Frdric Barberousse, disposer de la
couronne en faveur dun cadet ? Or labsence de tout principe de
discrimination nettement tabli entre les hritiers rendait en pratique
singulirement malaise lobservation de lindivisibil it. Aussi bien, en terre
dEmpire, les vieilles reprsentations collectives, hostiles lingalit entre
hommes du mme sang, ne trouvaient pas, dans la politique fodale des
pouvoirs royaux ou princiers, un contrepoids aussi puissant quailleurs. Moins
dpendants quen France des services de leurs vassaux, les rois et les chefs
territoriaux de lAllemagne, auxquels larmature lgue par ltat carolingien
parut longtemps suffire asseoir leurs droits de commandement, accordaient
naturellement une attention moins soutenue au p.290 systme des fiefs. Les rois,
en particulier, sattachrent peu prs exclusivement comme le fit, en
1158, Frdric Barberousse proscrire le dmembrement des comts,
marches et duchs . Encore, cette date, la fragmentation des comts au
moins avait-elle dj commenc. En 1255, un titre ducal, celui de Bavire, fut
pour la premire fois divis, avec le territoire mme du duch. Quant aux fiefs
ordinaires, la loi de 1158 avait d reconnatre que le partage en tait licite. Le
Landrecht, en somme, lavait finalement emport sur le Lehnrecht. La
raction ne vint que bien plus tard, vers la fin du moyen ge et sous laction de
forces diffrentes. Dans les grandes principauts, ce furent les princes
eux-mmes qui, par des lois successorales appropries, sefforcrent de
prvenir lmiettement dune puissance acquise au prix de tant de soins. Pour
les fiefs en gnral, lintroduction de lanesse, par le dtour du majorat, fut
conue comme un moyen de fortifier la proprit nobiliaire. Soucis
dynastiques et proccupations de classes accomplirent ainsi, tardivement, ce
que le droit fodal avait t incapable de raliser.
Dans la plus grande partie de la France, lvolution suivit des lignes bien
diffrentes. Des grandes principauts territoriales, formes par
lagglomration de plusieurs comts, les rois neurent intrt interdire le
fractionnement que tant quils purent employer ces groupements de forces la
dfense du pays. Mais, trs vite, les chefs provinciaux taient devenus pour la
royaut, des adversaires beaucoup plus que des serviteurs. Les comts, pris
isolment, furent rarement diviss ; dans leur total, par contre, les fils se
dcoupaient chacun leur part dhritage. Par l, le faisceau, chaque
gnration, menaait de sparpiller. Les maisons princires, assez
rapidement, prirent conscience du danger et, ici plus tt, l plus tard, y
remdirent par lanesse. Ctait, au XI Ie sicle, peu prs partout chose
faite. Comme en Allemagne, mais une date sensiblement antrieure, les
grands commandements de nagure taient revenus lindivisibilit, moins en
tant que fiefs que comme tats, dun type nouveau.
Marc BLOCH La socit fodale
199
Quant aux fiefs de moindre importance, les intrts du service, beaucoup
mieux respects sur cette terre dle ction de la fodalit, avaient de bonne
heure, aprs quelques p.291 ttonnements, amen les soumettre la loi prcise
et claire de la primogniture. Pourtant, mesure que la tenure de jadis se
muait en bien patrimonial, il semblait plus dur dexclure l es puns de la
succession. Seules quelques coutumes exceptionnelles, comme celle du pays
de Caux, sauvegardrent jusquau bout le principe dans toute sa rigueur.
Ailleurs on admit que lan, moralement oblig ne pas laisser ses frres sans
subsistance, pouvait, voire devait leur cder la jouissance de quelques
lambeaux de la terre paternelle. Ainsi stablit, en un grand nombre de
provinces, linstitution gnralement connue sous le nom de parage .
Lan seul faisait hommage au seigneur et, par cons quent, assumait, seul
galement, la responsabilit des charges. Ctait de lui que ses cadets tenaient
leurs portions. Tantt, comme dans lIle -de-France, ils lui prtaient, leur
tour, lhommage. Tantt, comme en Normandie et en Anjou, la force du lien
familial semblait rendre inutile, lintrieur de ce groupe de proches, toute
autre forme dattache : du moins jusquau jour o le fief principal et les fiefs
subordonns ayant pass de gnrations en gnrations, les relations de
parent entre les successeurs des paragers primitifs se trouvaient en fin de
compte atteindre des degrs trop loigns pour quil part sage de se reposer
uniquement sur la solidarit du sang.
Ce systme, malgr tout, tait loin de prvenir tous les inconvnients du
morcellement. Cest pourquoi, en Angleterre, o il avait t dabord introduit,
aprs la Conqute, il fut abandonn, vers le milieu du XIIe sicle, au profit de
la stricte primogniture. En Normandie mme, les ducs, qui, pour le
recrutement de leurs troupes, russirent tirer des obligations fodales un si
remarquable parti, navaient jamais admis le parage que lorsque la succession
comportait plusieurs fiefs de chevaliers, susceptibles dtre distribus, un par
un, entre les hritiers. Sil ne sen trouvait quun seu l, il passait intgralement
lan. Mais une pareille rigueur dans la dlimitation de lunit de service
ntait possible que sous laction dune autorit territoriale exceptionnellement
puissante et organisatrice. Dans le reste de la France, la thorie coutumire
avait beau affecter de soustraire au dmembrement au moins les fiefs les plus
considrables, p.292 qualifis couramment de baronnies, en fait, ctait presque
toujours la masse successorale entire que, sans distinguer entre ses lments,
les hritiers se partageaient. Seul lhommage prt lan et ses
descendants par ordre danesse prservait quelque chose de lindivisibilit
ancienne. Puis cette sauvegarde elle-mme finit par disparatre, dans des
conditions qui jettent un jour trs vif sur les derniers avatars de linstitution
fodale.
Lhrdit longtemps, avant dtre un droit, avait pass pour une faveur. Il
semblait donc convenable que le nouveau vassal marqut sa reconnaissance
envers le seigneur par un cadeau, dont lusage est atte st ds le IXe sicle. Or
dans cette socit, essentiellement coutumire, il tait de la destine de tout
Marc BLOCH La socit fodale
200
don bnvole, pour peu quil ft habituel, de se muer en obligation. La
pratique ici prit dautant plus aisment force de loi quelle trouvait, autour
delle, des prcdents. Depuis une poque sans doute fort ancienne, nul ne
pouvait entrer en possession dune terre paysanne, greve de redevances et de
services envers un seigneur, sans avoir au pralable obtenu de celui-ci une
investiture qui, ordinairement, ntait point gratuite. Or le fief militaire avait
beau tre une tenure dun genre trs particulier il nen venait pas moins
sinsrer dans ce systme de droits rels enchevtrs qui caractrisait le
monde mdival. Relief , rachat , parfois mainmorte , les mots, en
France, sont pareils, de part et dautre, que la taxe successorale pse sur le
bien dun vassal, dun manant, voire dun serf.
Le relief proprement fodal se distinguait pourtant par ses modalits.
Comme, jusquau XII Ie sicle, la plupart des redevances analogues, il tait le
plus souvent pay, au moins partiellement, en nature. Mais l o lhritier du
paysan livrait, par exemple, une tte de btail, celui du vassal militaire devait
un harnois de guerre, entendez soit un cheval, soit des armes, soit lun et
les autres la fois. Ainsi, tout naturellement, le seigneur adaptait ses
exigences la forme des services dont la terre tait charge (190). Tantt le
nouvel investi ntait redevable de rien de plus que ce harnois, quitte
dailleurs pouvoir sacquitter, dun commun accord, par le versement dune
somme de monnaies quivalente. p.293 Tantt, la fourniture du cheval de
bataille ou roncin , une taxe en numraire venait sajouter. Parfois mme,
les autres prestations tant tombes en dsutude, le rglement soprait tout
entier en argent. La varit, en un mot, tait, dans le dtail, quasiment infinie,
parce que le travail de la coutume avait abouti cristalliser, par rgion, par
groupe vassalique ou mme fief par fief, des habitudes nes souvent des plus
capricieux hasards. Seules, les divergences fondamentales ont une valeur de
symptmes.
LAllemagne, de trs bonne heure, restreignit lobligation du relief
presque exclusivement aux fiefs, d ordre infrieur, dtenus par des officiers
seigneuriaux, qui taient souvent dorigine servile. Sans doute fut -ce l une
des expressions de la hirarchisation des classes et des biens, si
caractristique, au moyen ge, de la structure allemande. Les retentissements
en devaient tre considrables. Du fief, lorsque, vers le XIIIe sicle, par suite
de la dcadence des services, il fut devenu peu prs impossible den tirer des
soldats, le seigneur allemand ne put plus rien tirer : carence grave surtout pour
les tats, car ctaient des princes et des rois que dpendaient naturellement
les fiefs les plus nombreux et les plus riches.
Les royaumes de lOuest, au contraire, connurent un stade intermdiaire,
o le fief, rduit presque rien comme source de services, demeurait lucratif
comme source de profits. Grce, avant tout, au relief, dont lapplication tait
ici trs gnrale. Les rois dAngleterre, au XI Ie sicle, en tirrent des sommes
normes. Ce fut ce titre quen France Philippe Auguste se fit cder la place
forte de Gien, qui lui ouvrait un passage sur la Loire. Dans la masse des petits
Marc BLOCH La socit fodale
201
fiefs, lopinion seigneuriale tout entire en arriva ne plus rien voir de digne
dintrt que ces taxes successorales. Ne finit -on pas, au XIVe sicle, dans la
rgion parisienne, par admettre officiellement que la prestation du roncin
dispensait le vassal de toute obligation personnelle autre que le devoir,
purement ngatif, de ne point nuire son seigneur ? Cependant, mesure que
les fiefs entraient de plus en plus avant dans les patrimoines, leurs
destinataires se rsignaient plus difficilement nobtenir quen ouvrant les
cordons de p.294 leur bourse une investiture qui dsormais semblait de droit.
Incapables dimposer labolition de la charge, ils obtinrent la longue quelle
ft sensiblement allge. Certaines coutumes ne la conservrent que pour les
collatraux, dont la vocation hrditaire semblait moins vidente. Surtout
conformment un mouvement qui se dveloppa, partir du XIIe sicle, du
haut en bas de lchelle sociale des paiements variables, dont le montant
tait dtermin en chaque cas par un acte darbitraire ou la suite dpineuses
ngociations, on tendit substituer la rgularit de tarifs immuablement
gradus. Passe encore lorsque selon un usage frquent en France on
adoptait pour norme la valeur du revenu annuel rapport par la terre : une
pareille base dvaluation tait soustraite aux fluctuations montaires. L o,
par contre, les taux furent tablis une fois pour toutes en numraire le plus
illustre exemple en est fourni par la Grande Charte anglaise , la redevance
se trouva finalement frappe de cet amenuisement progressif qui, du XIIe
sicle aux temps modernes, devait tre le sort fatal de toutes les crances
perptuellement fixes.
Entre-temps, cependant, lattention accorde ces droits casuels avait
modifi du tout au tout les termes du problme successoral. Le parage, sil
sauvegardait les services, rduisait les profits du relief, quil restreignait aux
mutations survenues dans la branche ane, seule lie directement au seigneur
du fief originel. Aisment accept tant que les services comptrent plus que
tout le reste, ce manque gagner parut insupportable ds quon cessa de leur
attacher beaucoup de prix. Si bien que rclame par les barons de France et
obtenue vraisemblablement sans peine dun souverain qui lui -mme tait le
plus grand seigneur du royaume, la premire loi quait promulgue un roi
captien, en matire fodale, eut prcisment pour objet, en 1209, la
suppression du parage. Point ntait question dabolir le morcellement,
dfinitivement entr dans les murs. Mais dsormais les lots devaient tous
dpendre, sans intermdiaire, du seigneur primitif. A la vrit,
ltablissement de Philippe Auguste ne semble pas avoir t bien
fidlement observ. Une fois de plus, les vieilles traditions du droit familial se
trouvaient p.295 en conflit avec les principes proprement fodaux : aprs avoir
impos le dmembrement du fief, elles travaillaient maintenant empcher
que les effets de cette fragmentation ne portassent atteinte la solidarit du
lignage. Le parage, en fait, ne disparut que lentement. Le changement de
front, son gard, de lopinion baronale franaise nen marque pas moins,
Marc BLOCH La socit fodale
202
avec une rare nettet, le moment o, chez nous, le fief, jadis salaire de la
fidlit arme, tomba au rang dune tenure avant tout rentable (191).
V. La fidlit dans le commerce
Sous les premiers Carolingiens, lide que le vassal pt aliner le f ief,
son gr, et paru doublement absurde : car le bien ne lui appartenait point et,
par surcrot, ne lui tait confi quen change de devoirs strictement
personnels. Cependant, mesure que la prcarit originelle de la concession
fut moins clairement ressentie, les vassaux, en mal dargent ou de gnrosit,
inclinrent plus volontiers disposer librement de ce que dsormais ils
tenaient pour leur chose. Ils y taient encourags par lglise qui, de toutes
faons, travailla si efficacement, durant le moyen ge, faire tomber les
entraves, seigneuriales comme familiales, dont les vieux droits avaient
garrott la possession individuelle : les aumnes eussent t rendues
impossibles, le feu de lenfer, quelles teignaient comme de leau , et
brl sans remde ; les communauts religieuses enfin eussent risqu de prir
dinanition si tant de seigneurs, qui ne possdaient gure que des fiefs,
staient trouvs empchs de rien dtacher de leur patrimoine, au profit de
Dieu et de ses saints. A vrai dire, lalination du fief revtait, selon les cas,
deux aspects fort diffrents.
Il arrivait quelle portt seulement sur une fraction du bien. Les charges
traditionnelles, qui nagure avaient grev le tout, se rassemblaient alors, en
quelque sorte, sur la partie qui seule demeurait aux mains du vassal. Sauf dans
les hypothses, de plus en plus exceptionnelles, dune confiscation ou dune
dshrence, le seigneur ne perdait donc rien dutile. Il pouvait craindre
toutefois que le fief, ainsi diminu p.296 ne sufft plus entretenir un dpendant
capable de sacquitter de ses devoirs. Lalination partielle, en un mot, rentrait
avec, par exemple, les exemptions de redevances octroyes aux habitants
de la terre sous la rubrique de ce que le droit franais appelait
labrgement du fief : entendez sa dvalorisation. Envers elle, comme
envers labrgement en gnral, les coutumes ragirent diffremment. Les
unes finirent par lautoriser, en la limitant. Dautres persistrent, jusquau
bout, la soumettre la pprobation du seigneur immdiat, voire des divers
seigneurs lun au -dessus de lautre tags. Naturellement cet assentiment,
lordinaire, sachetait et, parce quil tait une source de perceptions lucratives,
on conut de moins en moins aisment quil p t se refuser. Une fois de plus,
le souci du profit allait lencontre de celui du service.
Lalination intgrale tait plus oppose encore lesprit du lien. Non que
les charges, l non plus, fussent en principe menaces de disparatre,
puisquelles su ivaient la terre. Mais le servant changeait. Ctait pousser
lextrme le paradoxe qui rsultait dj de lhrdit. Car ce loyalisme inn,
Marc BLOCH La socit fodale
203
quavec un peu doptimisme on pouvait se promettre des gnrations
successives dun mme lignage, comment lattend re dun inconnu, qui la
vassalit dont il assumait ainsi les devoirs navait point dautre titre que de
stre trouv au bon moment lescarcelle pleine ? Le danger, vrai dire,
seffaait si le seigneur tait obligatoirement consult. Il le fut longtemp s. Plus
prcisment, il se faisait dabord restituer le fief ; puis, si telle tait sa volont,
il en rinvestissait lacqureur, aprs avoir reu son hommage. Presque
toujours, cela va de soi, un accord pralable permettait au vendeur ou donateur
de ne se dessaisir du bien quaprs avoir par avance vu agrer le remplaant
avec lequel il avait trait. Lopration ainsi comprise se produisit sans doute
presque ds quil y eut des fiefs ou des bienfaits . Comme pour lhrdit,
ltape dcisive fut franchi e lorsque le seigneur perdit, au regard de lopinion
dabord, puis du droit, la facult de refuser la nouvelle investiture.
Gardons-nous dailleurs dimaginer une courbe sans brisures. A la faveur
de lanarchie des Xe et XIe sicles, les droits p.297 des seigneurs de fiefs taient
souvent tombs dans loubli. Il leur arriva dtre remis en vigueur aux sicles
suivants, la fois par suite des progrs de la logique juridique et sous la
pression de certains tats, intresss une bonne organisation des rapports
fodaux. Ainsi, dans lAngleterre des Plantagents. Sur un point mme, ce
renforcement des prceptes anciens fut alors presque universel. Que le
seigneur pt sopposer absolument au transfert dun fief une glise, on
ladmettait, au XII Ie sicle, beaucoup plus gnralement et fermement que par
le pass. Leffort mme accompli par le clerg pour se dgager de la socit
fodale paraissait justifier plus que jamais une rgle qui se fondait sur
linaptitude des clercs au service des armes. Rois et princ es poussaient son
observation, parce quils voyaient en elle tantt une sauvegarde contre de
redoutables accaparements, tantt un moyen dextorsions fiscales.
Ce cas mis part, le consentement seigneurial ne tarda pas subir
lhabituelle dgradation ; il aboutit simplement lgitimer la leve dune taxe
de mutation. Une autre ressource, il est vrai, tait le plus souvent accorde au
seigneur : garder lui-mme le fief au passage, en indemnisant lacqureur.
Ainsi laffaiblissement de la suprmatie seig neuriale se traduisait exactement
par la mme institution que la dcadence du lignage : paralllisme dautant
plus frappant que l o le retrait lignager manqua, comme en Angleterre,
le retrait fodal fit dfaut galement. Rien dailleurs mieux que ce dernier
privilge reconnu aux seigneurs ne manifeste combien le fief tait dj
solidement ancr dans le patrimoine du vassal : puisque pour ravoir ce qui en
somme, lgalement, tait leur bien, il leur fallait dsormais verser le mme
prix quun autre acheteur. En fait, depuis le XIIe sicle au moins, les fiefs se
vendaient ou se cdaient presque librement. La fidlit tait entre dans le
commerce. Ce ntait pas pour la renforcer.
Marc BLOCH La socit fodale
*
**
204
Marc BLOCH La socit fodale
205
CHAPITRE V
Lhomme de plusieurs matres
I. La pluralit des hommages
Un samoura na pas deux matres : dans cette maxime du vieux
Japon, quen 1912 encore le marchal Nogi invoquait pour refuser de survivre
son empereur, sexprime linluctable loi de tout systme de fidlits,
vigoureusement conu. Telle avait t, nen pas douter, la rgle de la
vassalit franque, en ses dbuts. Les capitulaires carolingiens ont beau ne pas
la formuler en termes exprs, probablement parce quelle semblait aller de
soi ; toutes leurs dispositions la postulent. Le commend pouvait changer de
seigneur, si le personnage auquel il avait dabord port sa foi consentait la
lui rendre. Se vouer un second matre, en demeurant lhomme du premier,
tait strictement interdit. Rgulirement, on voit les partages de lempir e
prendre les mesures ncessaires pour viter tout chevauchement vassalique.
La mmoire de cette rigueur premire se conserva longtemps. Vers 1160, un
moine de Reichenau, ayant mis par crit le rglement du service dost, tel que
les empereurs de son temps lexigeaient pour leurs expditions romaines,
imagina de placer apocryphement ce texte sous le nom vnrable de
Charlemagne. Si par hasard , dit-il, en termes quil jugeait sans doute
conformes lesprit des murs antiques, il arrive quun mme chev alier se
soit attach plusieurs seigneurs, en raison de bienfaits diffrents, ce qu
Dieu ne plaise... (192).
p.299
Il y avait beau temps, cependant, cette date, quon stait accoutum
voir les membres de la classe chevaleresque se constituer les vassaux en
mme temps de deux, voire de plusieurs matres. Lexemple le plus ancien qui
ait jusquici t relev est de 895 et de provenance tourangelle (193). Les cas se
font partout de plus en plus nombreux aux sicles suivants : au point quau
XIe un pote bavarois, vers la fin du XIIe un juriste lombard, considrent
expressment cette situation comme normale. Les chiffres atteints par ces
hommages successifs taient parfois trs levs. Dans les dernires annes du
XIIIe sicle, un baron allemand se reconnaissait ainsi lhomme de fief de vingt
seigneurs divers, un autre de quarante-trois (194).
p.300
Quune pareille pluralit de soumissions ft la ngation mme de ce
dvouement de ltre tout entier dont le contrat vassalique, dans sa fracheur
premire, avait exig la promesse envers un chef librement choisi, les plus
rflchis parmi les contemporains sen sont aviss aussi bien que nous. De
Marc BLOCH La socit fodale
206
temps autre, un juriste, un chroniqueur, un roi mme, comme saint Louis,
rappellent mlancoliquement aux vassaux la parole du Christ : Nul ne peut
servir deux matres. Vers la fin du XIe sicle, un bon canoniste, lvque Ive
de Chartres, estimait devoir dlier un chevalier du serment de fidlit, selon
toute apparence vassalique, quil avait prt Guillaume le Conqurant ; car,
disait le prlat, de pareils engagements sont contraires ceux que cet
homme a auparavant contracts envers les seigneurs lgitimes, par droit de
naissance, desquels il a prcdemment reu ses bienfaits hrditaires .
Ltonnant est que cette clatante dviation se soit produite si tt et si
largement.
Les historiens, volontiers, en rendent responsable lhabitude qui se prit, de
trs bonne heure, de rmunrer les vassaux par des fiefs. On ne saurait douter,
en effet, que lappt de belles terres au soleil nait entran plus dun guerrier
multiplier les prestations dhommages. Voit -on, sous Hugues Capet, un
vassal direct du roi refuser de porter secours un comte, avant que celui-ci ne
lait, son tour, accept, jointes mains, pour son homme ? Cest, dit -il, quil
nest pas coutume chez les Francs de se battre autrement quen p.301 prsence
ou sur lordre de son seigneur . Le prtexte tait beau. La ralit ltait
moins. Car, nous le savons, un village de lIle -de-France fut le prix de cette
foi toute neuve (195). Reste nanmoins expliquer que les seigneurs aient si
aisment accueilli, voire sollicit, ces moitis, tiers ou quarts de dvouement,
que les vassaux aient pu, sans scandale, offrir tant de promesses
contradictoires. Faut-il, avec plus de prcision, invoquer, au lieu de
linstitution de la tenure militaire, en elle -mme, lvolution qui, de la
concession personnelle de jadis, fit un bien patrimonial et un objet de
commerce ? Assurment, le chevalier qui, ayant dj port sa foi un premier
matre, se trouvait, par hritage ou par achat, mis en possession dun fief,
plac sous la dpendance dun seigneur diffrent, on imaginera difficilement
quil nait pas, le plus souvent, prfr se plier une nouvelle soumission,
plutt que de renoncer cet heureux accroissement de sa fortune.
Prenons-y garde, cependant. Le double hommage ne fut pas, dans le
temps, la suite de lhrdit ; ses plus anciens exemples apparaissent, au
contraire comme peu prs exactement contemporains de celle-ci, encore
ltat de pratique naissante. Et pas davantage nen tait -il, logiquement, la
consquence ncessaire. Le Japon, qui na jamai s connu, sauf titre
dexceptionnel abus, les fidlits multiples, eut ses fiefs hrditaires, voire
alinables. Mais, comme chaque vassal nen tenait que dun seul seigneur,
leur passage de gnrations en gnrations aboutissait simplement fixer,
dans un lignage de servants, lattachement un lignage de chefs. Quant leur
cession, elle ntait permise qu lintrieur du groupe de faux, centr autour
dun commun matre. Rgles trs simples, dont la seconde, dailleurs, fut
frquemment impose, par notre moyen ge mme, des dpendants dun
degr infrieur : les tenanciers des seigneuries rurales. Il net pas t
inconcevable den tirer la loi tutlaire de la vassalit. Nul, toutefois, ne parat
Marc BLOCH La socit fodale
207
sen tre avis. En vrit, destin devenir, sans con teste, un des principaux
dissolvants de la socit vassalique, le foisonnement des hommages, dun seul
homme plusieurs seigneurs, navait t lui -mme, originellement, quun
symptme, entre autres, p.302 de la faiblesse presque congnitale dont, pour des
raisons que nous aurons scruter, souffrait un lien prsent, pourtant, comme
si astreignant.
En tout temps, cette diversit dattaches tait gnante. Dans les moments
de crise, le dilemme se faisait trop pressant pour que la doctrine ou les murs
pussent se dispenser de lui chercher une rponse. Lorsque deux de ses
seigneurs venaient se faire la guerre, o tait le devoir du bon vassal ?
Sabstenir et simplement abouti doubler la flonie. Il fallait donc choisir.
Comment ? Toute une casuistique s labora, dont les ouvrages des juristes
neurent pas le monopole. On la voit galement sexprimer, sous forme de
stipulations soigneusement balances, dans les chartes dont, partir du
moment o lcrit revendiqua ses droits, les serments de foi saccompag nrent
de plus en plus volontiers. Lopinion semble avoir oscill entre trois
principaux critres. On pouvait dabord classer les hommages par ordre de
date : le plus ancien primait le plus rcent ; souvent, dans la formule mme par
o il se reconnaissait lhomme dun nouveau seigneur, le vassal rservait
expressment la fidlit nagure promise un prcdent matre. Cependant
une autre ide soffrait, qui, dans sa navet, jette une lumire fort crue sur
larrire -plan de tant de protestations de dvouement : le plus respectable des
seigneurs tait celui qui avait donn le fief le plus riche. Dj, en 895, dans
une situation lgrement diffrente, on avait entendu le comte du Mans, que
les chanoines de Saint-Martin priaient de ramener lordre un de ses v assaux,
rpondre que ce personnage tait bien plutt le vassal du comte-abb
Robert, puisquil tenait de ce dernier un bienfait plus important . Telle
tait, encore la fin du XIe sicle, la rgle suivie, en cas de conflit
dhommages, par la cour c omtale de Catalogne (196). Enfin il arrivait que,
transportant sur lautre bord le nud du dbat, on prt pour pierre de touche la
raison dtre mme de la lutte : vis--vis du seigneur entr en lice pour
dfendre sa propre cause, lobligation paraissait plus imprieuse quenvers
celui qui se bornait se porter au secours damis .
Aucune de ces solutions, dailleurs, npuisait le problme. Quun homme
et combattre son seigneur tait dj bien p.303 grave ; pouvait-on accepter,
par surcrot, de le voir employer cette fin, les ressources des fiefs qui lui
avaient t confis dans un tout autre dessein ? On tourna la difficult en
autorisant le seigneur confisquer provisoirement, jusqu la paix, les biens
nagure infods au vassal, pour linstant lgitimement infidle. Ou bien, plus
paradoxalement, on admit quastreint servir de sa personne celui des deux
ennemis auquel allait avant tout sa foi, le vassal nen devait pas moins lever,
sur les terres quil tenait de laut re champion, des troupes, formes
notamment, sil en avait, de ses propres feudataires, afin de les mettre la
disposition de ce matre du second degr. Ainsi, par une sorte de
Marc BLOCH La socit fodale
208
prolongement de labus primitif, lhomme de deux chefs risquait, son tour,
de se heurter, sur le champ de bataille, ses sujets.
Pratiquement, ces subtilits, que compliquaient encore de frquents efforts
pour concilier les divers systmes, navaient gure dautres rsultats que
dabandonner larbitraire du vassal une dcision souvent longuement
marchande. Lorsque, en 1184, la guerre clata entre les comtes de Hainaut et
de Flandre, le sire dAvesnes, vassal des deux barons la fois, commena par
solliciter, de la cour du premier dentre eux, un jugement qui fixait savamment
ses obligations. Aprs quoi, il se jeta de toutes ses forces dans le parti
flamand. Une fidlit si flottante, tait-ce encore une fidlit ?
II. Grandeur et dcadence de lhommage lige
Cependant, dans cette socit, qui ni dans ltat ni mme dans la f amille
ne trouvait de ciments suffisants, le besoin dunir solidement les subordonns
au chef tait si vif que, lhommage ordinaire ayant notoirement failli sa
mission, un essai fut tent pour crer, par-dessus lui, une sorte de
super-hommage. Ce fut lh ommage lige .
En dpit de quelques difficults phontiques, communes, au moyen ge,
lhistoire de beaucoup de termes de droit probablement parce qu la fois
savants et populaires, ils passaient perptuellement dun registre de la langue
lautre , on ne saurait gure douter que ce fameux adjectif de lige ne
drivt dun vocable franc, dont le p.304 correspondant, dans lallemand
moderne, est ledig : libre, pur. Dj les scribes rhnans, qui, au XIIIe sicle,
transposaient homme lige en ledichman ont senti le paralllisme. Quoi
quil en soit, dailleurs, de ce problme dembryognie, aprs tout secondaire,
le sens mme de lpithte, telle que lemployait le franais mdival, na rien
dobscur. Les notaires du Rhin, de nouveau, voyaient ju ste, qui, en latin cette
fois, la rendaient par absolutus. Aujourdhui encore absolu fournirait la
traduction la moins inexacte. De la rsidence laquelle taient astreints
certains clercs, dans leurs glises, on disait, par exemple, quelle devait t re
personnelle et lige . Plus souvent, ctait lexercice dun droit que lon
qualifiait ainsi. Sur le march dAuxerre, le poids, monopole comtal, tait
lige du comte . Dgage par la mort de toute puissance maritale, la veuve,
sur ses biens propres, tendait sa lige viduit . En Hainaut, la rserve
directement exploite par le seigneur constituait, par opposition aux tenures,
ses liges terres . Deux monastres de lIle -de-France se partagent-ils une
seigneurie, jusque-l indivise ? chaque moiti passe dans la ligesse de
ltablissement qui en sera, dsormais, lunique possesseur. On ne sexprimait
pas diffremment quand ce pouvoir exclusif pesait, non sur des choses mais
sur des hommes. Sans autre suprieur canonique que son archevque, la bb
de Morigny se dclarait lige de Monseigneur de Sens . Dans beaucoup de
Marc BLOCH La socit fodale
209
rgions, le serf, attach son matre par les liens les plus rigoureux qui
fussent, tait dnomm son homme lige (lAllemagne employait
quelquefois, dans la mme acception, ledig) (197). Trs naturellement, lorsque,
parmi les hommages dun mme vassal plusieurs seigneurs, on savisa den
distinguer un dont loriginalit devait tre une fidlit assez absolue pour
passer avant toutes autres promesses, on shabitua parler d hommages
liges , de seigneurs liges , et aussi avec cet admirable mpris de
lquivoque que nous avons dj rencontr d hommes liges , vassaux
ici, non plus serfs.
A lorigine du dveloppement, se placent de s engagements encore
dpourvus de terminologie spcifique : le seigneur, recevant lhommage dun
vassal, lui faisait simplement jurer p.305 de prfrer tous autres devoirs la foi
ainsi contracte. Mais, lexception de quelques rgions o le vocabulaire de
la ligesse ne pntra que tardivement, cette phase danonyme gense se perd
nos yeux dans la brume des temps o les promesses mme les plus sacres ne
prenaient gure la forme crite. Car, dans un vaste domaine, lentre en scne
du nom de lige, comme de la chose, suivit de trs prs la gnralisation des
fidlits multiples. On voit les hommages ainsi qualifis surgir, au hasard des
textes, dans lAnjou ds 1046 ou environ, peine plus tard dans le Namurois,
puis, partir de la seconde moiti du sicle, en Normandie, en Picardie et dans
la comt de Bourgogne. La pratique en tait, en 1095, dj assez rpandue
pour attirer lattention du concile de Clermont. Vers le mme moment ils
avaient, sous une autre tiquette, fait leur apparition dans le comt de
Barcelone : au lieu dhomme lige, les Catalans disaient, en pure langue
romane, homme solide (soliu). Ds la fin du XIIe sicle, linstitution avait
atteint peu prs tout le rayonnement dont elle devait tre susceptible. Du
moins, dans la mesure o le mot de lige rpondit une ralit vivante. Plus
tard, son sens premier stant, nous le verrons, singulirement affaibli,
lemploi en devint, dans les chancelleries, presque une affaire de mode. A sen
tenir aux documents antrieurs 1750 environ, la carte, si indcis quen
labsence de relevs systmatiques en demeurent les contours, offre cependant
une leon assez claire. Avec la Catalogne sorte de marche coloniale
fortement fodalise , la Gaule dentre Meuse et Loire et la Bourgogne
furent la vritable patrie du nouvel hommage. De l il migra vers les
fodalits dimportation : Angleterre, Italie normande, Syrie. Autour de son
premier foyer, lusage sen propagea vers le midi, jusquau Languedoc, assez
sporadiquement, semble-t-il ; vers le nord-est, jusqu la valle du Rhin. Ni
lAllemagne transrhnane, ni lItalie du Nord, o le Livre des fiefs lombard
sen tient la classification par dates, ne lont jamais connu dans sa force
vritable. Cette seconde vague de la vassalit vague de renforcement,
oserait-on dire tait issue des mmes contres que la premire. Mais elle ne
dferla pas aussi loin.
Quel que soit le nombre de seigneurs que reconnaisse un homme ,
dit, vers 1115, un coutumier anglo-normand, cest celui dont il es t lige
p.306
Marc BLOCH La socit fodale
210
quil doit le plus . Et plus bas : On doit observer la foi envers tous ses
seigneurs, en sauvegardant toujours celle du seigneur prcdent. Cependant la
foi la plus forte appartient celui dont on est le lige. De mme en Catalogne,
les Usages de la cour comtale : Le seigneur dun homme soliu dispose
de son aide envers et contre tous ; nul nen doit disposer contre lui (198).
Lhommage lige prime donc tous les autres, sans distinction de dates. Il est
vritablement hors classe. De toutes faons, ce pur lien renouvelait, dans
son intgrit, lattache humaine primitive. Le vassal est -il tu ? parmi tous ses
seigneurs, cest le lige sire qui recueillera, sil y a lieu, le prix du sang.
Sagit -il, sous Philippe Auguste, de lever la dme de croisade ? Chaque
seigneur percevra la part due par les fiefs qui sont tenus de lui ; mais le
seigneur lige, la taxe sur les biens meubles, que le moyen ge a toujours
considrs comme particulirement proches de la personne. Dans
lintelligente analyse que le canoniste Guillaume Durand, peu aprs la mort de
saint Louis, donna des rapports vassaliques, laccent est mis, avec beaucoup
de raison, sur ce caractre principalement personnel de lhommage lige.
On ne saurait mieux exprimer le retour la source vive de la commendation
franque.
Mais prcisment parce que lhommage lige ntait gure que la
rsurrection de lhommage primitif, il ne pouvait manquer dtre atteint, son
tour, par les mmes causes de dclin. Il devait leur tre une proie dautant plus
aise que rien, sinon une fragile convention par paroles ou par crit, ne le
distinguait des hommages simples, dont il reproduisait, sans modifications, les
rites. Comme si, aprs le IXe sicle, la facult dinventer un symbolisme
nouveau stait brusquement tarie. Beaucoup dhommes liges, de bonne heure,
avaient reu linvestiture de terres, de pouvoirs de commandement, de
chteaux. Comment, en effet, priver de cette rcompense ou de ces
instruments ordinaires de la puissance les suivants sur la fidlit desquels on
entendait avant tout se reposer ? Lintervention du fief entrana donc, l aussi,
p.307 ses consquences habituelles : le subordonn loign de son chef ; les
charges peu peu dtaches de la personne pour se porter vers la terre, si bien
quon se prit parler de fief lige ; la ligesse hrditaire et, qui pis est,
devenue objet de commerce. Le cumul des soumissions, vritable lpre de la
vassalit, exera son tour ses ravages. Ctait pour le combattre que la
ligesse pourtant stait constitue. Mais ds les dernires annes du X Ie sicle,
les Usages barcelonais prvoient une inquitante exception. Nul ,
disent-ils, ne peut se faire le soliu que dun seul seigneur, moins que
lautorisation ne lui en soit accorde par celui auquel il a dabord prt cet
hommage. Un sicle environ plus tard, ltape tait presque partout franchie.
Il tait dsormais frquent quun seul homme reconnt deux ou plusieurs
seigneurs liges. Les promesses ainsi tiquetes continuaient passer avant les
autres. Entre elles, par contre, force tait de graduer les obligations au moyen
des mmes ractifs, dplorablement incertains, qui avaient dj servi
dpartager les hommages simples. Du moins, en thorie. Pratiquement, ctait
Marc BLOCH La socit fodale
211
de nouveau la porte ouverte la flonie presque ncessaire. On avait en
somme abouti crer deux tages de la vassalit. Rien de plus.
Aussi bien cette hirarchisation mme ne tarda-t-elle gure faire figure
de vain archasme. Car lhommag e lige tendit, trs vite, devenir le nom
normal de presque tout hommage. On avait imagin deux modalits dans
lattache vassalique : lune, plus forte ; lautre, plus faible. Quel seigneur tait
assez modeste pour se contenter de la seconde ? Vers 1260, sur quarante-huit
vassaux du comte de Forez, en Roannais, quatre au plus prtaient lhommage
simple (199). Exceptionnel, lengagement et peut -tre conserv quelque
efficacit ; banalis, il se vida de tout contenu spcifique. Rien de plus
significatif que le cas des Captiens. En persuadant les plus hauts barons du
royaume de se reconnatre leurs hommes liges, firent-ils autre chose
quobtenir de ces chefs territoriaux, dont la situation tait incompatible avec
lentier dvouement du suivant darmes, un trop facile acquiescement une
formule inluctablement creuse ? Ctait renouveler, au second degr,
lillusion des p.308 Carolingiens, croyant fonder sur lhommage, tout court, la
fidlit de leurs agents.
Dans deux fodalits d importation, cependant, ltat anglo -normand,
aprs la Conqute, et le royaume de Jrusalem, lvolution fut dvie par
laction de monarchies mieux armes. Estimant que la seule foi lige ,
cest --dire prfrable toute autre, tait celle qui leur tait due, les rois
travaillrent dabord, non sans succs, sattribuer le monopole de recevoir
les hommages ainsi qualifis. Mais ils entendaient bien ne pas limiter leur
autorit leurs propres vassaux. Quiconque tait leur sujet, mme sil ne
tenait pas sa terre directement de la Couronne, leur devait lobissance. Peu
peu, on saccoutuma donc, dans ces pays, rserver le nom de ligesse la
fidlit, souvent confirme par un serment, qui tait exige, envers le
souverain, de la totalit des hommes libres, quelle que ft leur place dans la
hirarchie fodale. Ainsi la notion de cette attache absolue ne conservait
un peu de sa valeur originelle que l o elle avait t dtache du systme des
rites vassaliques, pour contribuer, comme lacte de s oumission sui generis du
droit public, au regroupement des forces dans le cadre de ltat. Vis --vis du
vieux lien personnel, frapp dune fatale dcadence, linefficacit du remde
tait patente.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
212
CHAPITRE VI
Vassal et seigneur
I. Laide et la p rotection
Servir ou, comme on disait aussi aider protger : ctait en
ces termes trs simples que les plus anciens textes rsumaient les obligations
inverses du fidle arm et de son chef. Le lien ne fut jamais senti comme plus
fort qu au temps o les effets en taient ainsi exprims de la faon la plus
vague et, par suite, la plus comprhensive. Dfinir, nest -ce pas toujours
limiter ? Il tait fatal, cependant, que lon prouvt, avec une vivacit
croissante, le besoin de prciser les consquences juridiques du contrat
dhommage. Notamment, quant aux charges du subordonn. Une fois la
vassalit sortie de lhumble cercle de la loyaut domestique, quel vassal
dsormais et cru compatible avec sa dignit quon le dt candidement,
comme aux premiers temps, astreint servir le seigneur dans toutes les
besognes qui lui seront ordonnes (200) ? Au surplus, de personnages qui
dornavant, tablis pour la plupart sur des fiefs, vivaient loin du matre,
comment continuer attendre cette disponibilit toujours prte ?
p.309
Dans le travail de fixation qui sopra peu peu, les juristes professionnels
ne jourent quun rle tardif et, en somme, mdiocrement efficace. Sans doute
voit-on, ds les environs de 1020, lvque Fo ubert de Chartres, que le droit
canon avait form aux mthodes de la rflexion juridique, sessayer une
analyse de lhommage et de ses effets. p.310 Mais, intressante comme
symptme de la pntration du droit savant dans un domaine qui jusque-l lui
avait t bien tranger, cette tentative ne russissait gure slever au -dessus
dune assez creuse scolastique. Laction dcisive, ici comme ailleurs, appartint
la coutume, nourrie de prcdents et progressivement cristallise par la
jurisprudence de cours o sigeaient beaucoup de vassaux. Puis lhabitude se
prit, de plus en plus frquemment, de faire passer ces stipulations, nagure
purement traditionnelles, dans laccord mme. Mieux que les quelques mots
dont saccompagnait lhommage, le serment de foi , que lon pouvait allonger
volont, se prtait leur minutie. Ainsi un contrat prudemment dtaill
remplaa la soumission de lhomme tout entier. Par un surcrot de prcaution,
qui en dit long sur laffaiblissement du lien, le vassal, lordinaire, ne promit
plus seulement daider. Il dut encore sengager ne pas nuire. En Flandre, ds
le dbut du XIIe sicle, ces clauses ngatives avaient revtu assez
dimportance pour donner lieu un acte part : la sret qui, jure aprs la
foi, autorisait vraisemblablement le seigneur, en cas de manquement, la
Marc BLOCH La socit fodale
213
saisie de gages dtermins. Il va de soi que, longtemps, les obligations
positives nen continurent pas moins lemporter.
Le devoir primordial tait, par dfinition, laide de guerre. Lhomme de
bouche et de main doit, dabord et avant tout, servir en personne, cheval et
sous le plein harnois. Cependant, on ne le voit que rarement paratre seul.
Outre que ses propres vassaux, sil en possde, se grouperont naturellement
sous sa bannire, ses commodits, son prestige, la coutume, parfois, lui
commandent de se faire suivre au moins dun ou deux cuyers. Point de
fantassins, par contre, en rgle gnrale, dans son contingent. Leur rle, au
combat, est jug trop mdiocre, la difficult de nourrir des masses humaines
un peu considrables est trop grande pour que le chef darme puisse se
contenter de la pitaille paysanne que lui fournissent ses propres terres ou
celles des glises dont il sest, officiellement, constitu le protecteur.
Frquemment, le vassal est aussi astreint tenir garnison dans le chteau
seigneurial, soit durant les hostilits seulement, soit p.311 car une forteresse
ne saurait rester sans gardes en tout temps, par roulement avec ses pairs.
A-t-il lui-mme une maison forte ? il devra louvrir son seigneur.
Peu peu les diffrences de rang et de puissance, la formation de
traditions ncessairement divergentes, les accords particuliers et jusquaux
abus mus en droits introduisirent dans ces obligations dinnombrables
variantes. Ce fut, presque toujours, en fin de compte, pour en allger le poids.
Un grave problme naissait de la hirarchisation des hommages. A la fois
sujet et matre, plus dun vassal disposait, son tour, de vassaux. Le devoir,
qui lui commandait daider s on seigneur de toutes ses forces, et sembl lui
faire une loi de se prsenter lost seigneurial entour de la troupe entire de
ces dpendants. La coutume, cependant, lautorisa de bonne heure namener
avec lui quune quantit de servants fixe une fo is pour toutes et de beaucoup
infrieure au nombre de ceux quil pouvait employer ses propres guerres.
Voici, par exemple, vers la fin du XIe sicle, lvque de Bayeux. Plus dune
centaine de chevaliers lui doivent le service des armes. Mais il nest as treint
qu en fournir vingt au duc, son seigneur immdiat. Pis encore : si cest au
nom du roi, dont la Normandie est tenue en fief, que le duc rclame le secours
du prlat, le chiffre, cet chelon suprieur, sera rduit dix. Cet
amincissement, vers le haut, de lobligation militaire contre lequel la
monarchie des Plantagents, au XIIe sicle, seffora, sans beaucoup de
succs, de ragir fut, nen pas douter, une des principales causes de
linefficacit finale du systme vassalique, comme moyen de dfense ou de
conqute aux mains des pouvoirs publics (201).
Avant tout, les vassaux, grands et petits, aspiraient ne pas tre
indfiniment retenus au service. Pour borner la dure de celui-ci, ni les
traditions de ltat ca rolingien, ni les usages primitifs de la vassalit
noffraient de prcdents directs : le sujet, comme le guerrier domestique,
restaient sous les armes aussi longtemps que leur prsence semblait ncessaire
Marc BLOCH La socit fodale
214
au roi, ou au chef. Par contre, les vieux droits germaniques avaient largement
us dune sorte de dlai type, fix quarante jours ou, comme on disait plus
p.312 anciennement quarante nuits. Il ne rglait pas seulement de multiples
actes de procdure. La lgislation militaire franque elle-mme lavait ad opt,
comme la limite du temps de repos auquel les leves avaient droit, entre deux
convocations. Ce chiffre traditionnel, qui venait naturellement lesprit,
fournit, ds la fin du XIe sicle, la norme ordinaire de lobligation impose
aux vassaux. Une fois le terme coul, ils taient libres de retourner chez eux,
le plus souvent pour lanne durant. Sans doute arrivait -il, assez frquemment,
quon les vt nanmoins demeurer lost. Certaines coutumes mme
cherchaient leur faire de cette prolongation un devoir. Mais ce ne pouvait
plus tre, dornavant, quaux frais du seigneur et solds par lui, jadis salaire
du satellite arm, le fief avait si bien cess de remplir sa mission premire
quil fallait le suppler par une autre rmunration.
Ce nta it pas seulement pour le combat que le seigneur appelait lui ses
vassaux. Dans la paix, il en formait sa cour , qu des dates plus ou moins
rgulires, concidant lordinaire avec les principales ftes liturgiques, il
convoquait en grand arroi : tour tour tribunal, conseil dont la morale
politique du temps imposait au matre lavis dans toutes les circonstances
graves, service dhonneur aussi. Paratre aux yeux de tous environn dun
grand nombre de dpendants ; de ceux-ci, qui eux-mmes taient parfois dun
rang dj lev, obtenir laccomplissement public de quelques -uns de ces
gestes de dfrence offices dcuyer, dchanson, de valet de table
auxquels une poque sensible aux choses vues attachait une haute valeur de
symbole : pouvait-il y avoir, pour un chef, manifestation plus clatante de son
prestige ni moyen plus dlicieux den prendre soi -mme conscience ?
De ces cours plnires, merveilleuses et larges , les pomes piques,
dont elles sont un des dcors familiers, ont navement exagr la splendeur.
Mme pour celles o les rois figuraient, selon le rite, couronne en tte, le
tableau est trop flatteur. A plus forte raison, si lon voque les Modestes
rassemblements autour des petits ou moyens barons. Que dans ces runions,
cependant, beaucoup daffaires aient t traites ; que les plus brillantes
dentre elles aient prt p.313 tout un dploiement crmonial, attir, outre
leur assistance normale, un peuple ml daventuriers, de baladins, voire de
tire-bourses ; que le seigneur ft tenu, par lusage comme par son intrt bien
entendu, y distribuer ses hommes ces cadeaux de chevaux, darmes, de
vtements qui taient la fois le gage de leur fidlit et le signe de leur
subordination ; quenfin la prsence des vassaux chacun, comme le
prescrivait labb de Saint -Riquier, selon son pouvoir soigneusement par
nait jamais cess dy tre exactement exige : les textes les plus srieux ne
nous permettent pas den douter. Le comte, disent les Usages de Barcelone,
doit, lorsqu il tient sa cour : rendre la justice... ; prter secours aux
opprims... lheure des repas, les faire annoncer son de trompe pour que
nobles et non-nobles y viennent prendre part ; distribuer ses grands des
Marc BLOCH La socit fodale
215
manteaux ; rgler lost qui ira porter la dvastation dans les terres dEspagne ;
crer de nouveaux chevaliers . A un degr plus bas de la hirarchie sociale,
un petit chevalier picard, savouant en 1210 lhomme lige du vidame
dAmiens, lui promettait, dune mme haleine, laide de guerre pendan t six
semaines et de venir, lorsque jen serai requis, la fte que fera ledit
vidame, pour y demeurer mes frais, avec ma femme, huit jours durant (202).
Ce dernier exemple montre, avec beaucoup dautres, comment, au mme
titre que le service dost, le service de cour fut peu peu, rglement et limit.
Non cependant que lattitude des groupes vassaliques, vis --vis des deux
obligations, ait t de tous points semblable. Lost ntait gure quune
charge. Lassistance la cour comportait en revanche bien des avantages :
largesses seigneuriales, franches lippes, participation aussi au pouvoir de
commandement. Les vassaux cherchrent donc beaucoup moins sy
soustraire. Jusqu la fin de lre fodale, ces assembles, cont rebalanant en
quelque mesure lloignement n de la pratique du fief, travaillrent
maintenir entre le seigneur et ses hommes le contact personnel, sans lequel il
nest gure de lien humain.
Au vassal, sa foi imposait daider son seigneur en toutes choses. De
son pe ; de son conseil : cela allait de soi. Un p.314 moment vint o on
ajouta : de sa bourse aussi. Aucune institution mieux que celle de cet appui
pcuniaire ne rvle lunit profonde du systme de dpendances sur lequel
stait btie la socit fodale. Serf ; tenancier, dit libre , dune seigneurie ;
sujet, dans un royaume ; vassal enfin : quiconque obit doit son chef ou
matre de le secourir en ses ncessits. Or en est-il de plus grande que le mal
dargent ? De la contribution que le seigneur, en cas de besoin, tait ainsi
autoris requrir de ses hommes, les noms mmes, au moins dans le
domaine du droit fodal franais, furent du haut en bas de lchelle, pareils.
On disait aide tout court ; ou bien encore taille , expression image qui
se tirait du verbe tailler, mot mot prendre quelquun un morceau de sa
substance, et, par suite, le taxer (203). Naturellement, en dpit de cette
similitude de principe, lhistoire mme de lobligation suivit, selon les milieux
sociaux auxquels elle sappliquait, des lignes trs diffrentes. Seule, pour le
moment, nous intresse la taille des vassaux.
A ses dbuts, on entrevoit une simple pratique de cadeaux, exceptionnels
et plus ou moins bnvoles. LAllemag ne ni lItalie lombarde ne semblent
avoir jamais dpass ce stade : un passage significatif du Miroir des Saxons
met encore en scne le vassal lorsquil sert le seigneur de ses dons . Dans
ces pays, le lien vassalique navait pas assez de force pour que , les services
primordiaux une fois dment accomplis, le seigneur, dsireux dun secours
supplmentaire, pt une simple requte substituer un ordre. Il en fut
autrement dans le domaine franais. L, vers les dernires annes du XIe sicle
ou les premires du XIIe cest --dire vers le moment mme o, sur un autre
plan social, se rpandait galement la taille des humbles ; o, plus
gnralement, la circulation montaire, de toutes parts, se faisait plus intense
Marc BLOCH La socit fodale
216
et, par consquent, plus pressants les besoins des chefs et moins troites les
possibilits des contribuables , le travail de la coutume aboutit la fois
rendre obligatoires les versements et, par compensation, en fixer les
occasions. Ainsi, en 1111, sur un fief angevin pesaient dj les quatre
droites tailles : pour la ranon du seigneur, sil est pris ; quand son fils an
sera arm chevalier ; quand sa fille ane se mariera ; quand p.315 lui-mme
aura faire un achat [de terre] (204) . Le dernier cas, dapplica tion trop
arbitraire, disparut rapidement de la plupart des coutumes. Les trois premiers,
en revanche, furent peu prs partout reconnus. Dautres sy ajoutrent
parfois : laide de croisade notamment ou celle que le seigneur levait lorsque
ses suprieurs le taillaient lui-mme. Ainsi llment argent, dj aperu
sous la forme du relief, peu peu se glissait parmi les vieux rapports faits de
fidlit et dactions.
Il devait sy introduire par un autre biais encore. Forcment il advenait,
par moments, que le service de guerre manqut tre rendu. Le seigneur
rclamait alors une amende ou indemnit ; parfois, le vassal loffrait davance.
On lappelait service , conformment aux habitudes des langues
mdivales qui, au paiement de compensation, attribuaient volontiers le nom
mme de lobligation par lui efface ; ou bien, en France, taille de lost . A
dire vrai, la pratique de ces dispenses moyennant argent ne prit une grande
extension que vis--vis de deux catgories de fiefs : ceux qui taient tombs
entre les mains de communauts religieuses, inaptes porter les armes ; ceux
qui dpendaient directement des grandes monarchies, habiles tourner au
profit de leur fiscalit jusquaux insuffisances du systme de recrutement
vassalique. Sur le commun des tenures fodales, le devoir militaire, partir du
XIIIe sicle, se fit simplement de moins en moins astreignant, sans taxe de
remplacement. Mme les aides pcuniaires finirent souvent par tomber en
dsutude. Le fief avait cess de procurer de bons serviteurs sans russir, pour
cela, rester bien longtemps une fructueuse source de revenus.
Au seigneur, la coutume nimposait, ordinairement, aucun engagement
verbal ou crit qui rpondt au serment du vassal. Ces promesses den haut
napparurent que tardivement et demeurrent toujours exceptionnelles.
Loccasion manqua donc de dfinir les obligations du chef avec autant de
dtail que celles du subordonn. A de pareilles prcisions, dailleurs, un
devoir de protection se prtait moins bien que des services. Envers et contre
toute crature qui vive ou qui meurt , lhomme sera dfendu par son
seigneur. Dans p.316 son corps, dabord et surtout. Dans ses biens aussi et plus
particulirement dans ses fiefs. De ce protecteur, en outre, devenu, nous le
verrons, un juge, il attend bonne et prompte justice. Ajoutez les avantages,
impondrables et pourtant prcieux, que, dans une socit fort anarchique,
assurait, tort ou droit, le patronage dun puissant. Tout cela tait fort loin
de passer pour ngligeable. Il nen reste pas moins quau bout du compte, le
vassal, incontestablement, devait plus quil ne recevait. Salaire du service, le
fief primitivement avait rtabli la balance. A mesure que, transform
Marc BLOCH La socit fodale
217
pratiquement en bien patrimonial, sa fonction originelle tomba dans loubli,
lingalit des charges sembla plus flagrante ; et plus vif, par suite, chez ceux
quelle dfavorisait, fut le dsir de limiter leur fardeau.
II. La vassalit la place du lignage
Cependant, se borner ce bilan par doit et avoir, on nobtiendrait de la
nature profonde du lien quune image singulirement exsangue. Ctait
comme une sorte de succdan ou de complment de la solidarit lignagre,
devenue insuffisamment efficace, que les relations de dpendance personnelle
avaient fait leur entre dans lhistoire. Lhomme qui na pas de seigneur, si sa
parentle ne prend son sort en main, est, daprs le droit anglo -saxon du Xe
sicle, un hors-la-loi (205). Le vassal, vis--vis du seigneur, le seigneur
vis--vis du vassal demeura longtemps comme un parent supplmentaire,
volontiers assimil dans ses devoirs comme dans ses droits aux proches par le
sang. Lorsquun incendiaire, dit, dans une de ses constitutions de paix,
Frdric Barberousse, aura cherch asile dans un chteau, le matre de la
forteresse sera contraint, sil ne veut passer pour complice, de livrer le fugitif,
moins toutefois que celui-ci ne soit son seigneur, son vassal ou son
proche . Et ce ntait point hasard si le plus vieux coutumie r normand,
traitant du meurtre du vassal par le seigneur et du seigneur par le vassal,
classait ces crimes ple-mle dans un mme chapitre avec les plus horribles
homicides commis au sein de la p.317 parentle. De ce caractre quasi familial
de la vassalit devaient dcouler, dans les rgles juridiques comme dans les
murs, plusieurs traits durables.
Le premier devoir du lignager tait la vengeance. De mme, pour qui avait
prt ou reu lhommage. Une vieille glose germanique ne traduisait -elle pas
dj navement le latin ultor vengeur par le vieil haut-allemand
mundporo : patron (206) ? Cette galit de vocation entre la parentle et le lien
vassalique, commence dans la faide, se poursuivait devant le juge. Sil na
lui-mme assist au crime, nul, dit un coutumier anglais du XIIe sicle, ne
peut se porter accusateur, en cas de meurtre, moins quil ne soit le proche du
mort, son seigneur ou son homme par lhommage. Lobligation simposait
avec une force pareille au seigneur envers son vassal, au vassal envers son
seigneur. Une diffrence de degr pourtant se marquait, bien conforme
lesprit de ce rapport de soumission. A en croire le pome de Beowulf, les
compagnons du chef tu auraient eu, dans lancienne Germanie, part au prix
du sang. Il nen tait plus ainsi dans lAngleterre normande. Le seigneur
participait la compensation verse pour le meurtre du vassal ; sur celle qui
tait due pour le meurtre du seigneur, le vassal ne prlevait rien. La perte dun
serviteur se paye ; celle dun matre, non.
Marc BLOCH La socit fodale
218
Le fils du chevalier ntait que rarement lev dans la maison paternelle.
Lusage, qui fut respect tant que les murs de lre fodale eurent quelque
force, voulait que son pre le confit, tout jeune encore, son seigneur ou lun
de ses seigneurs. Auprs de ce chef, le garon, tout en faisant office de page,
sinstruisait dans les arts de la chasse et de la guerre, plus tard dans la vie
courtoise : tels, dans lhistoire, le jeune Arnould de Guines chez le comte
Philippe de Flandre, dans la lgende, le petit Garnier de Nanteuil, qui si bien
servit Charlemagne :
Quand le roi va au bois, lenfant ne le veut laisser ;
Tantt il porte son arc, tantt il lui tient ltrier.
Le roi va-t-il en rivire ? Garnier laccompagne.
Ou bien il porte lautour, ou le faucon qui sait chasser la grue.
Quand le roi veut dormir, Garnier est son coucher
Et, pour le distraire, dit chanson et musique.
Dautres socits, dans lEurope mdivale, ont connu des pratiques
analogues destines, l aussi, raviver, par les jeunes, des liens que
lloignement sans cesse menaait de dtendre. Mais le fosterage de
lIrlande semble avoir servi surtout resserrer lattache de lenfant avec le
clan maternel, parfois asseoir le prestige pdagogique dune corporation de
prtres lettrs. Chez les Scandinaves, ctait au fidle quincombait le devoir
dlever la postrit de son matre : si bien que, lorsque Harald de Norvge
voulut manifester aux yeux de tous la subordination o il prtendait tenir le roi
Aethelstan dAngleterre, il ne trouva pas pour cela de meilleur moyen, raconte
la saga, que de faire dposer par surprise, son fils sur les genoux de ce pre
nourricier malgr lui. Loriginalit du monde fodal est davoir conu la
relation de bas en haut. Les obligations de dfrence et de gratitude ainsi
contractes passaient pour trs fortes. Toute sa vie, le garonnet de jadis
devait se souvenir quil avait t le nourri du seigneur le mot, comme la
chose, date, en Gaule, de lpoque fra nque et se retrouve encore sous la plume
de Commynes (207). Assurment, ici comme ailleurs, la ralit dmentit
souvent les rgles de lhonneur. Comment refuser cependant toute efficacit
une coutume qui en mme temps quell e mettait aux mains du seigneur un
prcieux otage faisait revivre chaque gnration de vassaux un peu de
cette existence lombre du chef, do la premire vassalit avait tir le plus
sr de sa valeur humaine ?
p.318
Dans une socit o lindividu sappar tenait si peu, le mariage, qui, nous
le savons dj, mettait en jeu tant dintrts, tait trs loin de paratre un acte
de volont personnelle. La dcision, avant tout, reposait sur le pre. Il veut
voir de son vivant son fils prendre femme ; donc lui achte la fille dun
noble : ainsi sexprime, sans ambages, le vieux Pome de saint Alexis. A
ct du pre quelquefois, mais surtout l o il ntait plus, intervenaient les
proches. Mais aussi, lorsque lorphelin tait n dun vassal, le seigneur. Voire
mme, sil sagissait dun seigneur, ses vassaux. Dans ce dernier cas, dire
vrai, la rgle ne dpassa jamais la porte dun simple usage de biensance ; en
toute p.319 circonstance grave le baron devait consulter ses hommes ; dans
Marc BLOCH La socit fodale
219
celle-l, entre autres. De seigneur vassal, par contre, les droits se firent
beaucoup plus prcis. La tradition remontait aux plus lointaines origines de la
vassalit. Si le soldat priv (buccellarius) ne laisse quune fille , dit, au Ve
sicle, une loi visigothe, nous voulons quelle demeure sous la puissance du
patron, qui lui procurera un mari de condition gale. Que si, toutefois, elle se
choisit elle-mme un poux, contre le gr du patron, elle devra restituer
celui-ci tous les dons que son pre en avait reus (208). Lhrdit des fiefs
dj prsente dailleurs dans ce texte, sous une forme rudimentaire fournit
aux seigneurs un motif de plus, et trs puissant, pour surveiller des unions qui,
lorsque la terre tait tombe en quenouille, aboutissaient leur imposer un
fidle tranger la ligne primitive. Leurs pouvoirs matrimoniaux, pourtant,
ne se dvelopprent pleinement quen France et en Lotharingie, vritables
patries du systme vassalique, et dans les fodalits dimportation. S ans doute
les familles de condition chevaleresque ny furent pas les seules devoir subir
de pareilles ingrences ; car bien dautres se trouvaient, par dautres nuds,
soumises une autorit de nature seigneuriale, et les rois mmes, en tant que
tels, sestimaient parfois en droit de disposer de la main au moins de leur
sujettes. Mais envers les vassaux quelquefois envers les serfs, autres
dpendants personnels on considrait peu prs universellement comme
lgitime ce qui, vis--vis de subordonns de degrs diffrents, passait pour un
abus de force. Nous ne marierons pas les veuves et les filles contre leur
gr , promet Philippe Auguste aux gens de Falaise et de Caen, moins
quelles ne tiennent de nous, en tout ou en partie, un fief de hauber t
(entendez un fief militaire, caractris par le service avec cotte de mailles). La
bonne rgle voulait que le seigneur se mit daccord avec les lignagers :
collaboration quau XII Ie sicle, par exemple, une coutume orlanaise
sefforait dorganiser et que met en scne, sous Henri Ier dAngleterre, une
curieuse charte royale (209). Quand le seigneur, cependant, tait puissant, il
russissait vincer tous rivaux. Dans lAngleterre des Plantagents, cette
institution, issue de principes p.320 tutlaires, dgnra finalement en un
extravagant trafic. A qui mieux mieux, les rois et les barons les rois surtout
donnaient ou vendaient orphelins ou orphelines marier. Ou bien, menace
dun poux dplaisant, la veuve payait beau x deniers comptants la
permission de le refuser. Malgr le relchement progressif du lien, la vassalit,
comme on voit, nchappa point toujours cet autre danger dont lombre
guette presque tout rgime de protection personnelle : se muer en un
mcanisme dexploitation du faible par le fort.
III. Rciprocit et ruptures
Laccord vassalique liait deux hommes qui, par dfinition, ntaient pas de
niveau. Rien de plus loquent, cet gard, quune disposition du vieux droit
normand : si le seigneur qui a tu son vassal, le vassal qui a tu son seigneur
Marc BLOCH La socit fodale
220
sont lun et lautre punis de mort, le crime contre le chef est indubitablement
le plus noir, puisque seul il entrane linfamante pendaison (210). Pourtant, quel
que ft le dsquilibre entre les charges de part et dautre exiges, elles nen
formaient pas moins un tout indissoluble ; lobissance du vassal avait pour
condition lexactitude du seigneur tenir ses engagements. Mise en relief ds
le XIe sicle par Foubert de Chartres, jusquau bout trs fortement ressentie,
cette rciprocit dans des devoirs ingaux fut le trait vraiment distinctif de la
vassalit europenne. Par l, elle ne se sparait pas seulement de lantique
esclavage ; elle diffrait aussi, trs profondment, des formes de libre
dpendance propres dautres civilisations, comme celle du Japon, voire, plus
prs de nous, certaines socits limitrophes de la zone authentiquement
fodale. Les rites mmes expriment souhait lantithse : au salut frontal
des gens de service russes, au baisement de mains des guerriers castillans,
soppose notre hommage qui, par le geste des mains se fermant sur les mains
et par le baiser des deux bouches, faisait du seigneur moins un simple matre
appel uniquement recevoir que le participant dun vritable contrat.
Autant , crit Beaumanoir, lhomme doit son seigneur de foi et de
loyaut p.321 raison de son hommage, autant le seigneur en doit son
homme.
Cependant lacte solennel qui avait cr laccord semblait pos sder une
telle force que, mme devant les pires manquements, on imaginait mal la
possibilit den effacer les effets sans avoir recours une sorte de
contre-formalisme. Du moins, dans les vieux pays francs. En Lotharingie et
dans la France du Nord, un rite de rupture de lhommage sesquissa, o
revivait peut-tre le souvenir des gestes qui, dans des temps reculs, avaient
servi au Franc Salien renier sa parentle. Le seigneur, loccasion, le vassal
plus souvent, tout en dclarant son dessein de rejeter loin de soi le
partenaire flon , lanait violemment terre une brindille parfois aprs
lavoir brise ou un poil de son manteau. Seulement, pour que la crmonie
part aussi efficace que celle dont elle devait dtruire le pouvoir, il fallait qu
son exemple, elle mt en prsence les deux individus. Cela nallait pas sans
danger. Aussi, au jet du ftu , qui, avant mme davoir dpass le stade o
un usage devient rgle, tomba dans loubli, prfra -t-on de plus en plus un
simple dfi au sens tymologique du terme, cest --dire refus de foi , par
lettres ou par hraut. Les moins scrupuleux, qui ntaient pas les moins
nombreux, se contentaient naturellement dentamer les hostilits, sans
dclaration pralable.
Mais, dans limmense majorit des cas, le lien personnel se doublait dun
lien rel. La vassalit une fois brise, quel devait tre le sort du fief ? Lorsque
la faute incombait au vassal, point de difficult : le bien revenait au seigneur
ls. Ctait ce quon appelait la commise . Le dshritement du duc
Henri le Lion par Frdric Barberousse, celui de Jean sans Terre par Philippe
Auguste en sont les plus illustres exemples. Quand la responsabilit de la
rupture semblait au contraire appartenir au seigneur, le problme tait plus
Marc BLOCH La socit fodale
221
dlicat. Assurment le fief, rmunration de services qui cessaient dtre
rendus, perdait sa raison dtre. Comment cependant dpouiller un innocent ?
La hirarchisation des fidlits permit de sortir dembarras. Les droits du
seigneur indigne passaient son propre seigneur : tout comme si, p.322 un
maillon ayant saut, la chane se refermait par-dessus le vide. A dire vrai,
lorsque le fief avait t tenu directement du roi, maillon suprme, la solution
tait inoprante. Mais on admettait, semble-t-il, que vis--vis du roi, aucun
reniement dhommage ne pouvait tre durable. Seule lItalie fit bande part.
Victime dune flonie seigneuriale, le vassal y voyait simplement son fief se
muer en alleu : trait symptomatique, entre beaucoup dautres, du peu de
vigueur l-bas des conceptions les plus strictement fodales.
La lgislation carolingienne avait dfini les torts qui, ses yeux,
justifiaient labandon du seigneur par le vassal. Ses prceptes ne seffacrent
pas tous des mmoires. Dans le pome de Raoul de Cambrai, le nourri
Bernier, malgr tant de raisons de haine, ne renie Raoul quune fois frapp par
lui. Or le capitulaire carolingien avait dit : nul ne quittera son seigneur aprs
en avoir reu la valeur dun sou... sauf si ce seigneur la v oulu frir dun
bton. Invoqu aussi, un peu plus tard, par un roman courtois, au cours
dune curieuse discussion de casuistique fodale, ce motif de rupture tait
encore expressment retenu, au XIIIe sicle, par divers coutumiers franais, au
dbut du sicle suivant par le Parlement du premier Valois (211). Cependant les
plus solides mme parmi les rgles juridiques de jadis ne survivaient plus, aux
temps fodaux, quincorpores une flottante tradition. Larbitraire, qui
naissait de cette mtamorphose dun code de droit en un vague ensemble de
lois morales, et pu tre combattu par laction de tribunaux capables de fixer
et dimposer une jurisprudence. De fait, certaines juridictions souvraient, en
principe, de pareils dbats. Ctait dabord la cour seigneuriale, forme en
ralit des vassaux eux-mmes, que lon tenait pour les juges naturels des
procs entre le seigneur, leur matre, et son homme, leur pair ; puis,
lchelon suprieur, celle du chef, plus haut plac, auqu el le seigneur, son
tour, avait prt lhommage. Certaines coutumes, de bonne heure mises par
crit, comme celle de la Bigorre, se proccupaient de tracer une procdure
laquelle le vassal devait se plier, avant que son dpart ne ft lgitime (212).
Mais le grand vice de la fodalit fut prcisment son inaptitude construire
un systme judiciaire p.323 vraiment cohrent et efficace. Pratiquement
lindividu, victime de ce quil estimait ou affectait destimer une atteinte ses
droits, dcidait de rompre et lissue du conflit dpendait de la balance des
forces. Tel, un mariage qui comporterait le divorce, sans que les motifs en
fussent tablis davance ni quil y et des magistrats pour les appliquer.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
222
Marc BLOCH La socit fodale
223
CHAPITRE VII
Le paradoxe de la vassalit
I. Les contradictions des tmoignages
Par-del les problmes particuliers que soulve, si nombreux,
lhistoire de la vassalit europenne, un grand problme humain les domine
tous : de ce ciment social, quelle fut, dans les actions et dans les curs, la
force vritable ? Or la premire impression que donnent, l-dessus, les
documents est celle dune trange contradiction, devant laquelle il convient de
ne point biaiser.
p.325
Pas nest besoin de pressurer longtemps les textes pour en tirer une
mouvante anthologie la louange de linstitution vassalique.
En celle-ci, ils clbrent, dabord, un lien trs cher. Vassal a pour
synonyme courant ami et, plus souvent encore, le vieux nom,
probablement celtique, de dru , peu prs quivalent, mais dont le sens
comportait pourtant une nuance plus prcise de choix ; car sil sappliquait
parfois la dilection amoureuse, il ne semble jamais, la diffrence dami,
stre tendu aux relations de parent. Terme commun, daill eurs, au
gallo-romain et lallemand et dans lequel, travers les ges, se rpondent les
textes les plus pleins : lheure dernire , disent, ds 858, les vques de la
Gaule Louis le Germanique, il ny aura pour taider ni femme ni fils ; ni,
pour te porter secours, compagnonnage de drus et de vassaux . Laffection,
cela va de soi, comme elle monte de lhomme vers le seigneur, descend du
seigneur vers lhomme. p.326 Girart sest fait lhomme lige de
Charlemagne , dit un personnage de lpope franaise ; de lui il reut alors
amiti et seigneurie . Littrature, scrieront peut -tre les historiens qui nont
doreilles que pour la sche voix des chartes. Qu cela ne tienne ! De cette
terre je suis le seigneur, font dire un hobereau angevin les moines de
Saint-Serge ; car Geoffroy, qui la possdait leut de moi, comme fief, en
amiti . Aussi bien, comment rcuser ces vers de Doon de Mayence o
sexprime, avec une si franche simplicit, la vritable union des curs, celle
qui ne conoit point la vie lun sans lautre :
Si mon seigneur est occis, je veux tre tu.
Pendu ? Avec lui, me pendez.
Livr au feu ? Je veux tre brl
Et, sil est noy, avec lui me jetez. (213)
Marc BLOCH La socit fodale
224
Lien qui, par ailleurs, veut une dvotion sans faiblesse et que lhomme,
ainsi que dit la Chanson de Roland, pour lui, endure et le chaud et le froid .
Jaimerai ce que tu aimeras ; je dtesterai ce que tu dtesteras , jure le
commend anglo-saxon. Et voici, sur le continent, dautres texte s : Tes amis
seront mes amis ; tes ennemis, mes ennemis. Du bon vassal, le premier
devoir est, naturellement, de savoir mourir pour son chef, lpe la main :
sort, entre tous, digne denvie, car cest celui dun martyr et il ouvre le
paradis. Qui parle ainsi ? Les potes ? Sans doute. Mais lglise aussi. Un
chevalier, sous la menace, avait tu son seigneur. Tu aurais d accepter la
mort pour lui , dclare un vque, au nom du concile de Limoges, en 1031,
ta fidlit et fait de toi un martyr de Dieu (214).
Lien, enfin, tel que le mconnatre est le plus affreux des pchs. Lorsque
les peuples de lAngleterre furent devenus chrtiens, crit le roi Alfred, ils
fixrent, pour la plupart des fautes, de charitables tarifs de compensation,
hormis pour la trahison de lhomme envers son seigneur, nosant vis --vis
dun tel crime user de cette misricorde... pas plus que le Christ nen avait
accord ceux qui le livrrent la mort . Point de rdemption pour
lhomme qui a tu son seigneur , rpte, plus de deux sicles dintervalle,
dans lAngleterre p.327 dj fodalise sur le modle du continent, le coutumier
dit Lois de Henri Premier ; pour lui, la mort dans les plus atroces tortures.
On racontait, en Hainaut, quun chevalier, ayant occis, dans un combat, le
jeune comte de Flandre, son seigneur lige, tait all trouver le Pape, en
pnitent. Tel, le Tannhuser de la lgende. Le pontife commanda quon lui
trancht les mains. Cependant, comme celles-ci ne tremblaient point, il lui
remit sa peine. Mais condition de pleurer, sa vie durant, son forfait dans un
clotre. Il est mon seigneur , dira au XIIIe sicle, le sire dYbelin, qui lon
propose de faire assassiner lEmpereur, devenu son pire ennemi ; quoi qu il
fasse, nous lui garderons notre foi (215).
Cette attache tait sentie comme si puissante que son image se projetait sur
tous les autres liens humains, plus vieux quelle et qui auraient pu sembler
plus vnrables. La vassalit ainsi imprgna la famille. Dans les procs des
parents contre les fils ou des fils contre les parents , dcide la cour comtale
de Barcelone, il faudra traiter, dans le jugement, les parents comme sils
taient les seigneurs et les fils, leurs hommes, commends par les mains .
Lorsque la posie provenale inventa lamour courtois, ce fut sur le modle du
dvouement vassalique quelle conut la foi du parfait amant. Cela dautant
plus aisment, dailleurs, que ladorateur, en fait, tait souvent dun rang
moins lev que la dame de ses penses. Lassimilation fut pousse si loin
que, par un trange tour de langage, le nom ou le surnom de la bien-aime
tait volontiers dot du genre masculin, comme il convient un nom de chef :
Bel Senhor, mon beau seigneur , nous ne connaissons que sous ce
pseudonyme une de Celles qui Bertrand de Born porta son cur volage. Sur
son sceau, parfois, le chevalier se faisait graver les mains dans les mains
jointes de sa Dulcine. Aussi bien probablement ranim, au temps du
Marc BLOCH La socit fodale
225
premier romantisme, par une mode archologique le souvenir de ce
symbolisme, dune tendresse toute fodale, ne survit -il pas encore, de nos
jours, dans les rgles de civilit qui, du mot, bien pli, dhommages, nous
prescrivent un presque unilatral emploi ? Il ntait pas jusqu la mentalit
religieuse elle-mme qui ne se colort de ces teintes empruntes. Se donner au
diable, ctait se faire p.328 son vassal ; avec les sceaux amoureux, les scnes de
tradition de soi-mme au Mauvais comptent parmi les meilleures
reprsentations de lhommage que nous possdions. Pour lAnglo -Saxon
Cynewulf, les anges sont les thegns de Dieu ; pour lvque Eberhard de
Bamberg, le Christ, le vassal du Pre. Mais, sans doute, de lomniprsence du
sentiment vassalique nexiste -t-il pas de plus loquent tmoin que, dans ses
vicissitudes, le rituel mme de la dvotion : remplaant lattitude des antiques
orants, aux mains tendues, le geste des mains jointes, imit de la
commendise , devint, dans toute la catholicit, le geste de la prire, par
excellence (216). Devant Dieu, dans le secret de son me, le bon chrtien se
voyait comme un vassal, pliant les genoux devant son seigneur.
Il tait impossible, cependant, que lobligation vassal ique nentrt point
quelquefois en conflit avec dautres obligations : celle du sujet, par exemple,
ou du proche. Ctait, presque toujours, pour triompher de ces rivales. Non
seulement, en pratique ; mais aussi, selon le droit. Lorsque Hugues Capet, en
991, eut repris Melun, le vicomte, qui avait dfendu contre lui la forteresse,
fut pendu, avec sa femme : moins, sans doute, comme rebelle son roi que
parce quil avait, en mme temps, par un crime plus atroce, manqu la foi
envers le comte, son seigneur direct, prsent dans le camp royal. Par contre,
lentourage de Hugues exigea la grce des chevaliers du chteau : vassaux du
vicomte, en se rendant complices de sa rvolte, avaient-ils fait autre chose que
manifester, comme dit le chroniqueur, leur vertu ? Entendez leur fidlit
lhommage, laquelle primait donc la fidlit envers ltat (217). Les liens du
sang eux-mmes, qui paraissaient assurment beaucoup plus sacrs que ceux
du droit public, cdaient devant les devoirs de la dpendance personnelle.
On peut , prononcent en Angleterre les lois dAlfred, prendre les armes
pour son parent, injustement attaqu. Sauf, toutefois, contre son seigneur :
cela, nous ne le permettons pas. En un passage clbre, la chronique
anglo-saxonne met en scne les membres dun lignage que la vendetta des
deux seigneurs diffrents entre lesquels se rpartit leur obissance jette les uns
contre les autres. Ils acceptent ce destin : p.329 nul proche ne nous est plus
cher que notre lord , disent-ils. Grave parole, laquelle fait cho, en plein
XIIe sicle et dans lItalie respectueuse des lois, la phrase du Livre des fiefs :
Contre tous, les vassaux doivent aider le seigneur : contre leurs frres,
contre leurs fils, contre leurs pres (218).
Halte-l ! prend pourtant soin de prciser un coutumier anglo-normand :
Contre les commandements de Dieu et de la foi catholique, point dordre qui
soit valable. Ainsi pensaient les clercs. Lopinion chevaleresque exig eait un
plus achev renoncement. Raoul, mon seigneur, a beau tre plus flon que
Marc BLOCH La socit fodale
226
Judas ; il est mon seigneur : sur ce thme, les chansons ont orchestr
dinnombrables variantes. Les conventions de la pratique, parfois aussi. Si
labb a quelque proc s en cour du roi , dit un contrat de fief anglais, le
vassal prendra son parti, sauf contre le roi lui-mme. Laissons la rserve
finale : elle traduisait lexceptionnel respect que savait imposer une monarchie
ne de la conqute. Seule la premire partie de la clause, dans sa candeur
cynique, a une valeur gnrale : visiblement le devoir de fidlit parlait trop
haut pour quil ft loisible de se demander o tait le bon droit. Pourquoi
dailleurs sembarrasser de tant de scrupules ? Peu importe que mon seigneur
ait tort, pense Renaud de Montauban : sur lui, sera la faute . Qui se donne
tout entier fait, par l mme, abdication de sa responsabilit personnelle (219).
Dans ce dossier o force a t dinvoquer, cte cte, d es tmoignages
dordres et dges diffrents, craindra -t-on que les textes anciens, la littrature
juridique, la posie ne laient par trop emport sur des ralits plus vivantes ou
moins lointaines ? Pour apaiser ces doutes, il suffira den appeler, enfin ,
Joinville, observateur sans fivre, sil en fut, et qui crivait sous Philippe le
Bel. Jai dj cit le passage : un corps de troupe, au combat, sest
particulirement distingu ; comment sen tonner ? presque tous les guerriers
qui le composaient, lorsquils nappartenaient pas au lignage de son capitaine,
taient ses hommes liges.
Mais voici le revers. Cette pope mme, qui prise si haut a vertu
vassalique, nest gure quun long rcit des combats qui contre leurs seigneurs
lancent des vassaux. Parfois le p.330 pote blme. Plus souvent il se plat de
dlectables cas de conscience. Ce quil sait, nen pas douter, cest que de ces
rvoltes se nourrit le tragique quotidien de lexistence. En cela les chansons ne
faisaient que donner de la ralit un reflet presque pli. Luttes des grands
feudataires contre les rois ; rbellions, contre ces hauts barons, de leurs
propres hommes ; fuites devant le service ; faiblesse des armes vassaliques,
incapables, ds les premiers temps, darrter les envahisse urs : ces traits se
lisent chaque page de lhistoire fodale. Une charte de la fin du X Ie sicle
nous montre les moines de Saint-Martin-des-Champs occups fixer le sort
dune rente, assise sur un moulin, au cas o celui -ci viendrait tre pill
durant une guerre soutenue par les deux hobereaux auxquels la somme est
due. Ce que le texte exprime en ces mots : sil arrive quils fassent la guerre
leurs seigneurs ou dautres hommes (220). Ainsi, de toutes les occasions
de guerroyer, prendre les armes contre son seigneur tait la premire qui vnt
lesprit. Pour ces prtendus crimes, la vie tait singulirement plus indulgente
que la fiction. De Herbert de Vermandois, qui si vilainement trahit Charles le
Simple, son seigneur et son roi, la lgende racontait quil mourut pendu, de la
mort de Judas. Mais lhistoire nous apprend quil succomba, dans son vieil
ge, la plus naturelle des fins.
Il tait assurment invitable quil y et de mauvais comme de bons
vassaux ; que, surtout, lon vt beaucoup dentre eux, selon les intrts ou
lhumeur du moment, osciller du dvouement linfidlit. En face de tant de
Marc BLOCH La socit fodale
227
tmoignages qui paraissent se dmentir les uns les autres, suffira-t-il donc de
rpter, avec le pote du Couronnement de Louis ?
L, tous jurrent le serment.
Tel le jura, qui le tint bravement.
Tel aussi, qui ne le tint point du tout.
Certes, dans sa navet, lexplication nest pas entirement mprisable.
Foncirement attach la tradition, mais de murs violente s et de caractre
instable, lhomme des ges fodaux tait, de toutes faons, beaucoup plus
enclin p.331 vnrer les rgles qu sy plier avec constance. Navons -nous
pas dj not, propos des liens du sang, ces ractions contradictoires ?
Cependant il semble bien quici le nud de lantinomie doive tre cherch
plus loin : dans linstitution vassalique elle -mme, ses vicissitudes et ses
diversits.
II. Les liens de droit et le contact humain
Groupant autour du chef ses suivants arms, la premire vassalit avait,
dans son vocabulaire mme, comme une odeur de pain de mnage. Le matre
tait le vieux (senior, herr) ou le donneur de miches (lord). Les hommes,
ses compagnons (gasindi) ; ses gars (vassi, thegns, knights) ; ses mangeurs de
pain (buccellarii ; hlafoetan). La fidlit, en un mot, se fondait alors sur le
contact personnel et la sujtion se nuanait de camaraderie.
De ce lien, primitivement cantonn dans la maisonne, il arriva cependant
que le champ daction grandit dmesurment. Parce q uon continua de vouloir
en imposer le respect des hommes qui, aprs un stage dans la demeure du
matre, sen taient carts pour faire leur vie loin de lui, souvent sur les terres
mmes quil leur avait donnes. Parce que, surtout, devant lanarchie
croissante, les grands et plus encore les rois crurent trouver, dans cette attache
si forte ou dans son imitation, un remde aux fidlits dfaillantes et,
inversement, beaucoup de personnes menaces, le moyen de se procurer un
dfenseur. Quiconque, un certain rang social, voulait ou devait servir fut
assimil un suivant darmes.
Or prtendre ainsi soumettre une fidlit quasi domestique des
personnages qui ne partageaient plus ni la table du chef ni son destin, dont les
intrts frquemment sopposa ient aux siens, qui parfois mme, loin davoir
t enrichis de ses dons, avaient t contraints de lui cder, pour le reprendre
de ses mains, grev de charges nouvelles, leur propre patrimoine, cette foi tant
cherche finit par se vider de tout contenu vivant. La dpendance de lhomme
vis--vis de lhomme ne fut bientt plus que la rsultante de la dpendance
dune terre vis --vis dune autre.
Marc BLOCH La socit fodale
228
p.332 Lhrdit
mme, au lieu de sceller la solidarit de deux lignages, aida
au contraire au relchement du lien, parce quelle sappliqua, avant tout, aux
intrts terriens : lhritier ne prtait lhommage quafin de conserver le fief.
Le problme stait pos pour les humbles fiefs dartisans comme pour les
honorables fiefs de chevalerie. Il avait t rsolu, des deux parts, en des
termes dapparence semblable. Le fils du peintre ou du charpentier succdait
au bien du pre seulement sil avait aussi hrit de son art (221). De mme le
fils du chevalier ne recevait linvestiture que sil s engageait continuer les
services paternels. Mais lhabilet dun ouvrier qualifi tait une ralit de
constatation beaucoup plus sre que le dvouement dun guerrier, trop ais
promettre et ne garder point. Par une prcision bien significative, une
ordonnance de 1291, numrant les motifs de rcusation qui pouvaient tre
invoqus contre les juges de la cour royale franaise, considre comme
suspect de partialit le vassal de lun des plaideurs seulement si son fief est
viager : tant lattache qui s hritait paraissait alors de peu de force (222) !
Le sentiment du libre choix se perdit ce point que lon saccoutuma
voir le vassal aliner, avec le fief, les devoirs de la vassalit et le seigneur
donner ou vendre, avec ses champs, ses bois et ses chteaux, la loyaut de ses
hommes. Sans doute le fief ne pouvait-il, en principe, changer de mains sans
lautorisation du seigneur. Sans doute les vassaux, de leur ct, rclamaient -ils
volontiers de ntre cds que moyennant leu r consentement : si bien que la
reconnaissance officielle de ce droit fut, en 1037, une des faveurs accordes
par lempereur Conrad aux vavasseurs de lItalie. La pratique, pourtant, ne
tarda gure renverser ces fragiles barrires. Sauf dans lAllemagne, peu
prs prserve, nous le verrons, de cet abus par un exceptionnel sens
hirarchique, lentre des relations fodales dans le commerce eut, en outre,
labsurde effet que souvent un puissant se trouvait amen se faire lhomme
de bouche et de mains dun beaucoup plus faible que lui : le grand comte,
qui avait acquis un fief dans la mouvance dun petit chtelain, croira -t-on quil
ait jamais pris bien au srieux le rite de ddition auquel un vain usage le
condamnait se plier ? Enfin, p.333 malgr la tentative de sauvetage que fut la
ligesse, la pluralit des hommages, consquence elle-mme de
laffaiblissement du lien, acheva de lui retirer jusqu la possibilit dagir.
Dun compagnon darmes dont lattachement se nourrissait de cadeaux
constamment reus et de prsence humaine, le vassal tait devenu une sorte de
locataire, mdiocrement empress sacquitter de son loyer de services et
dobissance. Un frein demeurait pourtant : le respect du serment. Il ntait
pas sans force. Mais, quand les suggestions de lintrt personnel ou de la
passion parlaient trop haut, cette abstraite entrave rsistait mal.
Du moins en tait-il ainsi dans la mesure, prcisment, o la vassalit
stait tout fait loigne de son caractre primitif. Or, il y avait eu, dans ce
mouvement, bien des degrs. Lerreur serait grave dadopter pour gabarit du
sentiment vassalique les relations, si souvent troubles, des grands ou moyens
barons avec les rois ou les princes territoriaux, leurs seigneurs. Sans doute
Marc BLOCH La socit fodale
229
chroniques et chansons de geste semblent nous y inviter. Cest que, drames de
premier plan sur la scne politique, les clatantes infidlits de ces magnats
attiraient, avant tout, les regards de lhistoire comme de la fiction. Que
prouvent-elles cependant, sinon quen croyant sattacher efficacement leurs
principaux officiers par un lien emprunt une toute autre sphre, les
Carolingiens et leurs imitateurs staient lourdement blouss ?
Plus bas dans lchelle sociale, les textes laissent entrevoir des groupes
beaucoup mieux serrs autour de chefs mieux connus et mieux servis.
Ctaient dabord ces chevaliers non chass, ces bacheliers de la
mesnie autrement dit, la maisonne , dont la condition, durant de
longs sicles et dans tout lOccident, continua de reproduire, trait pour trait, la
vie des premiers vassaux (223). Lpope franaise ne sy est pas trompe. Ses
grands rvolts, un Ogier, un Girard, un Renaud, sont de puissants feudataires.
Sagit -il de dpeindre, au contraire, un bon vassal ? Nous aurons le Bernier de
Raoul de Cambrai Bernier, fidle malgr linjuste guerre que contre sa
parent mne son seigneur, fidle encore aprs avoir vu sa mre prir dans
p.334 lincendie allum par ce Judas et qui, une fois mme qu un atroce
affront la enfin dcid abandonner le plus dplorable des matres, ne parat,
pas plus que le pote, jamais savoir sil eut tort ou raison de rompre ainsi la
foi ; Bernier, simple valet darmes, dont le dvouement se fortifie du souvenir,
non dune terre reue, mais du cheval et des vtements libralement
distribus. Ils se recrutaient aussi, ces loyaux servants, dans la troupe, plus
nombreuse, des modestes vavasseurs , dont les petits fiefs souvent se
rassemblaient aux environs du chteau o, les uns aprs les autres, comme
estagiers , ils venaient monter la garde : trop pauvres, lordinaire, pour
tenir leurs terres moyennant plus dun hommage ou, du moins, plus dun
hommage lige (224) ; trop faibles pour ne pas accorder beaucoup de prix la
protection que seul pouvait leur assurer lexact accomplissement de leurs
devoirs ; trop peu mls aux grandes affaires du temps pour que leurs intrts
comme leurs sentiments ne prissent pas volontiers pour centre le seigneur qui
les convoquait rgulirement sa cour, par dopportuns cadeaux
supplmentait les minces revenus des champs ou des censives, accueillait
leurs enfants comme nourris , les conduisait enfin la guerre, joyeuse et
lucrative.
Tels furent les milieux o, en dpit dinvitables coups de passion, se
maintint longtemps, dans sa fracheur, la foi vassalique ; o aussi, lorsque ses
vieux rites se furent dfinitivement uss, dautres formes de dpendance
personnelle vinrent, nous le verrons, la relayer. Stre, lorigine, fonde sur
lamical compagnonnage du foyer et de laventure ; puis, une fois sortie de ce
cercle domestique, avoir conserv un peu de sa valeur humaine l seulement
o lcart tait le moins grand : dans ce destin, la vassalit europenne trouve
sa marque propre comme lexplication de ses apparents paradoxes.
Marc BLOCH La socit fodale
*
**
230
Marc BLOCH La socit fodale
231
LIVRE TROISIME :
Les liens de dpendance dans les classes infrieures
CHAPITRE PREMIER
La seigneurie
I. La terre seigneuriale
Les milieux sociaux relativement levs que caractrisait lhommage
militaire ntaient pas les seuls o il existt des hommes dautres hommes.
Mais, au degr infrieur, les relations de dpendance trouvrent leur cadre
naturel dans un groupement qui, beaucoup plus ancien que la vassalit, devait
survivre longtemps son dclin ; la seigneurie terrienne. Ni les origines du
rgime seigneurial, ni son rle dans lconomie ne nous appartiennent ici.
Seule nous importe sa place dans la socit fodale.
p.335
Alors que les droits de commandement, dont lhommage vassalique tait
la source, ne donnrent naissance des profits que tardivement et par une
incontestable dviation de leur sens premier, dans la seigneurie laspect
conomique tait primordial. Les pouvoirs du chef y eurent, ds le principe,
pour objet, sinon exclusif, du moins prpondrant, de lui assurer des revenus,
par prlvement sur les produits du sol. Une seigneurie est donc, avant tout,
une terre le franais parl ne lui connaissait gure dautre nom , mais
une terre habite et par des sujets. Normalement lespace ainsi dlimit se
divise, son tour, en deux fractions, quunit une troite interdpendance.
Dune part le domaine , appel aussi par les historiens rserve , dont le
seigneur recueille directement tous les fruits. De lautre, les tenures ,
petites ou moyennes exploitations paysannes, p.336 qui, en nombre plus ou
moins considrable, se groupent autour de la cour domaniale. Le droit rel
suprieur que le seigneur tend sur la chaumire, le labour, le pr du manant
se traduit par son intervention pour une nouvelle investiture, rarement gratuite,
chaque fois quon les voit changer de mains ; par la facult de se les
approprier, en cas de dshrence ou de lgitime confiscation ; enfin et surtout
par la perception de taxes et de services. Ceux-ci consistaient, pour la plupart,
en corves agricoles, excutes sur la rserve. Si bien que du moins au
Marc BLOCH La socit fodale
232
dbut de lre fodale, alors que ces prestations de travail taient
particulirement lourdes les tenures n ajoutaient pas seulement les gerbes
ou les deniers de leurs redevances aux revenus des champs mis en valeur, sans
intermdiaire, par le matre ; elles taient en outre comme un rservoir de
main-duvre, faute duquel ces champs eussent t condamns la f riche.
Toutes les seigneuries, cela va de soi, ntaient pas dgales dimensions.
Les plus grandes, dans les pays dhabitat agglomr, couvraient tout le terroir
dun village. Le cas, ds le I Xe sicle, ntait probablement pas le plus
frquent. En dpit, et l, de quelques heureux rassemblements, il devait, au
cours des temps, dans toute lEurope, se faire de plus en plus rare. Cela, par
leffet des partages successoraux, sans doute. Mais aussi, comme contrecoup
de la pratique des fiefs. Pour rmunrer ses vassaux, plus dun chef dut
morceler ses terres. Comme, en outre, il arrivait, assez souvent, que par don
ou vente ou la suite dun de ces actes de sujtion foncire, dont le
mcanisme sera dcrit plus loin, un puissant ft passer sous sa dpendance des
exploitations paysannes disperses dans un rayon assez tendu, bien des
seigneuries se trouvrent pousser leurs tentacules sur plusieurs terroirs la
fois, sans concider exactement avec aucun. Au XIIe sicle, les limites ne
concordaient plus gure que dans les zones de dfrichements rcents, o
seigneuries et villages avaient t fonds ensemble, sur table rase. La plupart
des paysans dpendaient donc la fois de deux groupes constamment
dcals : lun form des sujets dun mme matre ; lautre, de s membres dune
mme collectivit rurale. Car les cultivateurs dont les p.337 maisons slevaient
cte cte et dont les champs sentremlaient sur un mme finage taient
forcment unis, entre quelques dominations quon les vt se rpartir, par toutes
sortes de liens dintrt commun, voire par lobissance de communes
servitudes agricoles. Cette dualit devait tre, la longue, pour les pouvoirs de
commandement seigneuriaux, une srieuse raison de faiblesse. Quant aux
rgions o les familles, de type patriarcal, vivaient, soit isoles, soit runies,
au plus, par deux ou par trois, en menus hameaux, la seigneurie y comprenait,
lordinaire, un nombre plus ou moins lev de ces petits tablissements ; et
cet gaillement, nen pas douter, lui imposait u ne contexture sensiblement
plus lche.
II. Les conqutes de la seigneurie
Ces seigneuries, cependant, jusquo tendaient -elles leurs prises ? Et sil
est vrai quil subsista toujours des lots dindpendance, quelle en fut, selon
les temps ou les lieux, la variable proportion ? Problmes entre tous difficiles.
Car seules les seigneuries du moins dglise tenaient des archives et les
champs sans seigneurs sont aussi des champs sans histoire. Si tel ou tel dentre
eux apparat par hasard la lumire des textes, ce nest gure qu ltat, en
quelque sorte, dvanescence, au moment o un crit constate son absorption
Marc BLOCH La socit fodale
233
finale dans le complexe des droits seigneuriaux. En sorte que plus lexemption
fut durable, plus notre ignorance risque de demeurer sans remde. Pour
dbrouiller un peu cette obscurit, il conviendra, du moins, de distinguer avec
soin deux formes de sujtion : celle qui pesait sur lhomme, dans sa personne ;
celle qui ne latteignait que comme dtenteur dune certaine terre. Certes, il y
avait entre elles des rapports troits, au point que souvent elles sentranaient
lune lautre. Dans les classes infrieures pourtant la diffrence du monde
de lhommage et du fief elles taient loin de se confondre. Rservant pour
un prochain chapitre les conditions personnelles, commenons par la
dpendance de la terre ou travers la terre.
Dans les pays o les institutions romaines, elles-mmes p.338 superposes
dantiques traditions italiotes ou celtes, avaient profondment marqu la
socit rurale, la seigneurie, sous les premiers Carolingiens, prsentait dj
des contours trs nets. Encore nest -il point malais de dcouvrir, dans les
villae de la Gaule franque ou de lItalie, la trace des divers sdiments qui les
avaient formes. Parmi les tenures ou, comme on nommait les principales
dentre elles, caractrises par leur indivisibilit, parmi les manses , un
certain nombre taient qualifies de serviles : cette pithte, comme les
charges plus lourdes et plus arbitraires auxquelles elles taient soumises,
rappelait le temps o les matres les avaient constitues, en allotissant leurs
esclaves, quils transformaient en fermiers, de vastes portions de leurs anciens
latifundia, devenus, sous la forme du faire-valoir direct, mdiocrement
rentables. Cette opration de morcellement, ayant fait appel aussi des
cultivateurs libres, navait pas manqu de donner naissance, simultanment,
dautres types de concessions, destines entrer dans la catgorie gnrale des
manses ingnuiles , dont le nom voquait la condition, trangre toute
servitude, de leurs premiers dtenteurs. Mais, dans la masse, trs considrable,
des tenures dsignes par cet adjectif, la plupart avaient une origine bien
diffrente. Loin de remonter des octrois consentis aux dpens dun domaine
en voie damenuisement, ctaient des exploitations paysannes de toujours,
aussi vieilles que lagriculture mme. Les redevances et les corves qui les
grevaient navaient t primitivement que la marque de la dpendance o les
habitants staient trouvs envers un chef de village, de tribu ou de clan ou un
patron de clientle, peu peu mus en seigneurs vritables. Enfin de mme
quau Mexique on voyait rcemment voisiner avec les haciendas des
groupes de paysans propritaires il subsistait encore une quantit notable
dauthentiques alleux ruraux, exempts de toute suprmatie seigneuriale.
Quant aux rgions franchement germaniques dont le type le plus pur
tait incontestablement la plaine saxonne, entre Rhin et Elbe , il sy
rencontrait bien aussi des esclaves, des affranchis, voire mme, sans doute,
des fermiers p.339 libres, tablis, les uns comme les autres, sur les terres des
puissants, charge de taxes et de services. Mais, dans la masse paysanne, la
distinction entre dpendants des seigneuries et alleutiers tait beaucoup moins
tranche, parce que, de linstitution seigneuriale elle -mme, seuls les premiers
Marc BLOCH La socit fodale
234
prodromes avaient fait leur apparition. On navait encore qu peine dpass
le stade o un chef de village ou dune portion de village sapprte devenir
un seigneur ; o les cadeaux quil reoit traditionnellement ainsi que Tacite
lattestait du chef germain commencent glisser aux redevances.
Or, des deux parts, lvolution, durant le premier ge fod al, devait
sorienter dans le mme sens. Elle tendit, uniformment, vers une
seigneurialisation croissante. Fusion, plus ou moins complte, des diverses
sortes de tenures ; acquisition, par les seigneuries, de pouvoirs nouveaux ;
passage, surtout, de beaucoup dalleux sous lautorit dun puissant : ces faits
furent alors de partout, ou presque. Mais, en outre, l o il navait exist, au
point de dpart, que des relations de dpendance foncire encore assez lches
et confuses, on les vit, se rgularisant peu peu, donner naissance de
vritables seigneuries. Nimaginons point un surgissement uniquement
spontan. Le jeu des influences, favoris par limmigration et la conqute, y
tint son rle. Ainsi, en Allemagne, o, dans le Sud, ds avant lpoque
carolingienne, puis, sous les Carolingiens, en Saxe mme, les vques, les
abbs, les magnats, venus du royaume franc, contriburent rpandre les
habitudes sociales de leur patrie, aisment imites par laristocratie indigne.
Ainsi, plus nettement encore, en Angleterre. Tant que les traditions
anglo-saxonnes ou scandinaves y furent prpondrantes, le rseau des
sujtions terriennes demeura singulirement enchevtr et sans force durable ;
le domaine et les tenures ntaient quimparfaitement raccords. Lavn ement
dun rgime seigneurial exceptionnellement rigoureux sopra seulement,
aprs 1066, sous le brutal effort de matres trangers.
Nulle part, dailleurs, dans cette marche triomphante de la seigneurie,
labus de force navait t un lment p.340 ngligeable. A juste titre, les textes
officiels de lpoque carolingienne se lamentaient dj sur loppression des
pauvres par les puissants . Ceux-ci ne tenaient gure, en gnral,
dpouiller lhomme de sa terre ; car le sol sans bras valait peu de chose. Ce
quils souhaitaient, ctait se soumettre les petits avec leurs champs.
Pour y parvenir, beaucoup dentre eux trouvaient dans la structure
administrative de ltat franc une arme prcieuse. Quiconque chappait
encore toute autorit seigneuriale dpendait, en principe, directement du roi.
Ce qui, en pratique, voulait dire de ses fonctionnaires. Le comte ou ses
reprsentants conduisaient ces gens-l lost, prsidaient les tribunaux o ils
taient jugs, percevaient sur eux ce qui subsistait de charges publiques. Le
tout au nom du Prince, bien entendu. Cependant aux redevables eux-mmes la
distinction apparaissait-elle bien clairement ? Il est sr, en tout cas, que des
libres sujets, ainsi confis leur garde, les officiers royaux ne tardrent gure
exiger, pour leur propre compte, plus dune taxe ou dune prestation de
travail. Ctait, volontiers, sous lhonorable nom de cadeau ou service
bnvole. Mais bientt, comme le dit un capitulaire, labus devenait
coutume (225). En Allemagne, o le vieil difice carolingien mit longtemps
seffriter, du moins les droits nouveaux issus de cette usurpation
Marc BLOCH La socit fodale
235
demeurrent-ils, assez souvent, unis loffice ; le comte les exerait, en tant
que tel, sur des hommes dont les biens navaient pas t annexs ses terres
seigneuriales. Ailleurs, grce au fractionnement des pouvoirs comtaux
entre les hritiers du premier titulaire, les subordonns du comte ou ses
vassaux , lalleutier de nagure, dsormais astreint aux redevances et la
corve, finit par se confondre, purement et simplement, dans la masse des
sujets des seigneuries et ses champs passrent ltat de tenures.
Aussi bien ntait -il pas ncessaire de dtenir une fonction proprement dite
pour disposer, lgitimement, dune part de lautorit publique. Par le jeu de
limmunit franque , qui sera tudie plus loin, la plupart des seigneurs
dglise et un grand nombre de puissants laques avaient reu la dlgation
dune fraction au moins des pouvoirs judiciaires de p.341 ltat ; en outre, le
droit de lever leur profit certains de ses revenus. Cela, bien entendu, sur les
terres seulement qui taient dj ou devaient tre lavenir de leur
dpendance. Limmunit fortifiait le pouvoir seigneurial ; elle ne le crait pas.
Du moins, en principe. Mais les seigneuries ntaient que rarement dun seul
tenant. De petits alleux, souvent, sy trouvaient enclavs. Les atteindre
devenait, pour les officiers royaux, prodigieusement incommode. Parfois,
semble-t-il, ils taient, par dcision expresse du souverain, abandonns la
juridiction et la fiscalit de limmuniste. Beaucoup plus souvent et beaucoup
plus tt, ils succombrent deux -mmes cette invitable attraction.
Il y avait enfin, et non la moins frquente, la violence toute nue. Vers le
dbut du XIe sicle, une veuve vivait, en Lorraine, sur son alleu. Comme la
mort de son mari lavait laisse sans dfenseur, les sergents du seigneur voisin
prtendirent lui extorquer le paiement dun cens foncier, signe de sujtion
pour la terre. La tentative, ici, choua, parce que la femme se mit sous la
protection des moines (226). Combien dautres, qui ntaient pas plus
solidement fondes en droit, ne vit-on point obtenir meilleur succs ! Le
Domesday Book, qui nous offre, travers lhistoire du sol anglais, comme
deux coupes successives, lune immdiatement avant la conqute normande,
lautre huit dix ans aprs, montre comment, durant la priode intermdiaire,
beaucoup de petits biens indpendants furent, sans autre forme de procs,
ajouts aux seigneuries ou, pour parler la langue du droit anglo-normand,
aux manoirs limitrophes. Un Domesday Book allemand ou franais du Xe
sicle, sil en tait, mettrait assurment en lumire plus dune simple
addition de cette sorte.
Cependant les seigneuries stendirent aussi et peut -tre surtout par un
autre procd, qui tait, en apparence du moins, beaucoup plus irrprochable :
coup de contrats. Le petit alleutier cdait sa terre parfois, nous le verrons,
avec sa personne pour la reprendre ensuite titre de tenure : tout comme le
chevalier qui de son alleu faisait un fief et pour le mme motif avou, qui tait
de se trouver un dfenseur. Ces conventions se donnent, sans exception, p.342
comme entirement volontaires. Ltaient -elles vraiment, partout et toujours ?
Ladjectif ne saurait tre mani quavec beaucoup de prudence. Il est
Marc BLOCH La socit fodale
236
assurment bien des moyens dimposer sa protection un plus faible que soi :
ne serait-ce que de commencer par le perscuter. Ajoutez que laccord premier
ntait pas toujours respect. En prenant pour protecteur un hobereau du
voisinage, les gens de Wohlen, dans lAlmanie, navaient promis quun
cens ; ils furent bientt, par assimilation aux autres tenanciers du mme
potentat, contraints des corves et nuser de la fort proche que moyennant
redevances (227). Une fois le doigt mis dans lengrenage, le corps risquait dy
passer tout entier. Gardons-nous nanmoins dimaginer que la situatio n de
lhomme sans, matre part uniformment enviable. Ce paysan du Forez qui,
la date tardive de 1280, transformait son alleu en censive, sous condition
dtre dsormais gard, dfendu et garanti par les Hospitaliers de
Montbrison, ses nouveaux seigneurs, comme le sont les autres hommes de
cette maison , sans doute ne croyait-il pas faire une mauvaise affaire (228). Et
pourtant les temps taient alors bien moins troubls quau premier ge fodal.
Parfois, ctait un villa ge, en bloc, qui se plaait ainsi sous lautorit dun
puissant. Le cas fut surtout frquent en Allemagne, parce quil y subsistait
encore, au dbut de lvolution, un bon nombre de communauts rurales qui,
tout entires, chappaient au pouvoir seigneurial. En France et en Italie o,
ds le IXe sicle celui-ci avait pouss beaucoup plus avant ses prises, les actes
de tradition de terre revtirent gnralement un caractre individuel. Ils ne
furent pas moins abondants pour cela. Jusqu quatorze hommes libre s
avaient, de la sorte, vers lan 900, charg leurs biens propres de corves, en
faveur dune abbaye de Brescia (229).
En vrit, les brutalits les plus flagrantes comme les contrats les plus
sincrement spontans dnonaient l action dune mme cause profonde : la
faiblesse des paysans indpendants. Nvoquons pas ici une tragdie dordre
conomique. Ce serait oublier que les conqutes de la seigneurie ne furent pas
toutes rurales : jusque dans les anciennes cits romaines aussi ou, du moins,
dans un bon p.343 nombre dentre elles qui, sous la domination de Rome,
navaient assurment rien connu de pareil, ne vit -on pas sintroduire, linstar
des antiques villae campagnardes, le rgime de la tenure, avec ses charges
ordinaires ? Ce serait, surtout, prtendre tablir avec lantagonisme qui, dans
dautres civilisations, a pu opposer les mthodes de la petite et de la grande
proprit, une comparaison, en lespce, tout fait boiteuse. Car la seigneurie
tait, avant tout, une agglomration de petites fermes sujettes ; et lalleutier,
en se faisant tenancier, sil assumait des obligations nouvelles, ne changeait
rien aux conditions de son exploitation. Il ne cherchait ou subissait un matre
quen raison de linsuffisance des autres c adres sociaux, solidarits lignagres
ou pouvoirs dtat. Le cas est significatif des hommes de Wohlen qui,
victimes de la plus manifeste tyrannie, voulurent porter leur plainte au roi et,
pris dans la foule dune grande cour plnire, ne parvinrent mme p as faire
entendre leur rustique langage. Sans doute, dans la carence de lautorit
publique, latonie des changes et de la circulation montaire avait -elle sa
part. Sans doute aussi, en privant les cultivateurs de toute rserve
dinstruments de paiement , contribuait-elle anmier leur capacit de
Marc BLOCH La socit fodale
237
rsistance. Mais ce fut seulement par ces voies indirectes que les conditions
conomiques exercrent quelque action sur la crise sociale de la paysannerie.
Dans lhumble drame champtre, il convient de reconna tre un aspect du
mme mouvement qui, un chelon plus haut, prcipita tant dhommes dans
les nuds de la subordination vassalique.
Aussi bien suffirait-il de sen remettre, sur cette liaison, aux expriences
diverses que nous offre lEurope. Le moyen ge a connu, vrai dire, une
socit largement seigneurialise, non fodalise : la Sardaigne. Comment
stonner si, sur cette terre longtemps soustraite aux grands courants
dinfluence qui parcouraient le continent, un antique systme de chefferies
rurales, rgularis durant la priode romaine, put se maintenir, sans que la
puissance des aristocraties locales ait revtu la forme spcifique de la
commendise franque ? En revanche, point de pays sans seigneuries qui naient
t en mme temps des pays sans vassalit. Tmoin p.344 la plupart des socits
celtiques des les ; la pninsule scandinave ; enfin, en Germanie mme, les
basses terres bordires de la mer du Nord : Dithmarschen au-del de lestuaire
de lElbe ; Frise, de lElbe au Zuiderzee. Du moins en fu t-il ainsi, dans cette
dernire contre, jusquau moment o, vers le XI Ve et le XVe sicle, on y vit
slever, au -dessus de la foule des libres paysans, certains lignages de
chefs , (le mot franais rend exactement le frison hoveling). Forts de la
fortune foncire accumule de gnrations en gnrations, des bandes armes
quils entretenaient, de la mainmise par eux ralise sur certaines fonctions
judiciaires, ces tyranneaux de villages parvinrent tardivement se constituer
de vritables embryons de seigneuries. Ctait qualors les vieux cadres de la
socit frisonne, fonds essentiellement sur les liens du sang, commenaient
craquer. A lpoque o spanouissaient, ailleurs, les institutions fodales, ces
diverses civilisations, en marge de notre Occident, navaient assurment
ignor ni la dpendance du petit fermier, esclave, affranchi ou libre, vis--vis
dun plus riche que lui, ni le dvouement du compagnon envers le prince ou le
capitaine daventures ; rien, par contre, ny rappelait le vaste rs eau
hirarchis de sujtions paysannes et de fidlits militaires auquel nous
donnons le nom de fodalit.
De cette carence, tiendrons-nous pour seule responsable la commune
absence de toute solide empreinte franque (car, en Frise mme, lorganisation
administrative momentanment impose par les Carolingiens scroula de
bonne heure) ? Le trait est dimportance sans doute ; mais il intresse, avant
tout, limpuissance du compagnonnage se transformer en vassalit. Les faits
dominants dpassaient les problmes dinfluence. L o lhomme libre, quel
quil ft, resta un guerrier apte tre constamment appel au service et que
rien dessentiel, dans lquipement, ne distinguait des troupes dlite, le
paysan chappa aisment lemprise seigneuriale, cependan t que les
groupements de suivants darmes manquaient donner naissance une classe
chevaleresque nettement spcialise et pourvue dune armature juridique sui
generis. L o les hommes, tous les degrs, p.345 trouvaient sappuyer sur
Marc BLOCH La socit fodale
238
dautres pouvoir s et dautres solidarits que la protection personnelle
parentles surtout, chez les Frisons, les gens du Dithmarschen et les Celtes ;
parentles encore, mais aussi institutions de droit public, selon le type des
peuples germains, chez les Scandinaves , ni les rapports de subordination
propres la seigneurie terrienne, ni lhommage avec le fief nenvahirent toute
la vie sociale.
Il y a plus. Tout comme le systme proprement fodal, le rgime
seigneurial ne devait atteindre un tat dabsolue perfection que dans les pays
o il avait t import de toutes pices. LAngleterre des rois normands, pas
plus quelle nadmettait dalleux chevaleresques, ne connut dalleux paysans.
Sur le continent, ceux-ci eurent la vie beaucoup plus dure. A vrai dire, dans la
France dentre Meuse et Loire et la Bourgogne, ils taient devenus, aux XI Ie et
XIIIe sicles, extrmement rares ; sur de larges espaces ils y avaient,
semble-t-il, compltement disparu. Ils subsistaient, par contre, en nombre plus
ou moins important, mais toujours apprciable, dans la France du Sud-Ouest,
dans certaines provinces du Centre, comme le Forez, en Toscane et surtout en
Allemagne, o la Saxe fut leur terre dlection. Ctaient les rgions mmes
o, par un paralllisme frappant, se maintenaient les alleux de chefs,
agglomrations de tenures, de domaines et de pouvoirs de commandement
dont la possession nobligeait aucun hommage. La seigneurie rurale tait
une beaucoup plus vieille personne que les institutions vraiment
caractristiques du premier ge fodal. Mais ses victoires, durant cette
priode, comme ses checs partiels, sexpliquent tout conspire le prouver
par les mmes causes qui firent ou entravrent le succs de la vassalit et
du fief.
III. Seigneur et tenanciers
Rserve faite des contrats de sujtion individuelle, dont les clauses,
dailleurs, taient gnralement aussi imprcises que vite oublies, les
rapports du seigneur avec les tenanciers navaient dautre loi que la coutume
de la terre : au p.346 point quen franais le nom ordinaire des redevances tait
simplement coutumes et celui du redevable, homme coutumier . Depuis
quil existait un rgime seigneurial, ft -ce ltat encore embryonnaire ds
lEmpire romain, par exemple, ou lAngleterre anglo -saxonne cette
tradition particulire tait ce qui dfinissait vraiment chaque seigneurie,
comme groupe humain, en lopposant ses voisines. Les prcdents qui
dcidaient ainsi de la vie de la collectivit devaient tre, eux-mmes, de nature
collective. Peu importe quune taxe ait cess, depuis un temps presque
immmorial, dtre paye par une des tenures dit, en substance, sous saint
Louis, un arrt du Parlement ; si les autres exploitations lont, durant cet
intervalle, rgulirement acquitte, elle demeure obligatoire pour celle mme
qui sy tait, si longtemps, drobe (230). Du moins ainsi pensaient les juristes.
Marc BLOCH La socit fodale
239
La pratique, sans doute, fut souvent plus lche. Le respect de ces rgles
ancestrales simposait, en principe, tous : au matre comme aux
subordonns. Nul exemple, cependant, ne saurait mieux mettre en lumire ce
que cette prtendue fidlit au dj fait avait de trompeur. Car, relies,
travers les ges, par une coutume censment immuable, rien ne ressemblait
moins une seigneurie du IXe sicle quune seigneurie du XII Ie.
Ce nest point ici la transmission orale quil convient daccuser. Au temps
des Carolingiens, beaucoup de seigneurs, aprs enqute, avaient fait mettre
par crit les usages de leurs terres, sous forme de ces descriptions dtailles
que lon devait plus tard appeler censiers ou terriers . Mais la pression des
conditions sociales ambiantes tait plus imprieuse que la dfrence envers le
pass.
A la faveur des mille conflits de la vie quotidienne, la mmoire juridique
se gonflait sans cesse de prcdents nouveaux. Surtout une coutume ne saurait
tre vritablement astreignante que l o elle trouve comme gardienne une
autorit judiciaire impartiale et bien obie. Au IXe sicle, dans ltat franc, il
arrivait en effet que les tribunaux royaux assumassent ce rle ; et si nous ne
connaissons deux que des dcisions uniformment dfavorables aux
tenanciers, la raison en est peut-tre, simplement, que les p.347 archives
ecclsiastiques ne se souciaient gure de conserver les autres. Par la suite,
laccaparement des pouvoirs de juridiction par les seigneurs vint supprimer la
possibilit de pareils recours. Les plus scrupuleux dentre eux ne craignaient
pas toujours de bousculer la tradition, lorsquelle portai t atteinte leurs
intrts ou ceux qui leur taient confis : ne voit-on pas labb Suger, dans
ses mmoires, se fliciter davoir su imposer, dautorit, aux paysans dune de
ses terres le remplacement du cens en argent, que de mmoire dhomme ils
avaient constamment pay, par une redevance proportionnelle la rcolte,
dont on pouvait attendre plus de profit (231) ? Les abus de force des matres
navaient plus gure dautres contrepoids vrai dire souvent fort efficaces
que la merveilleuse capacit dinertie de la masse rurale et le dsordre de
leurs propres administrations.
Rien de plus variable, selon les lieux, sur chaque seigneurie, rien de plus
divers que les charges du tenancier, au premier ge fodal. A jours fixes, on le
voit porter au sergent seigneurial tantt quelques picettes dargent, tantt et
plus souvent des gerbes rcoltes sur ses champs, des poulets de sa
basse-cour, des gteaux de cire drobs ses ruches ou aux essaims de la fort
proche. A dautres moments, il peine sur les labours ou les prs du domaine.
Ou bien le voici qui charroie, au compte du matre, vers des rsidences plus
lointaines, pipes de vin ou sacs de bl. Cest la sueur de ses bras que sont
rpars les murs ou les fosss du chteau. Le matre reoit-il ? le paysan
dpouille sa propre couche pour fournir aux htes la literie ncessaire.
Viennent les grandes chasses : il nourrit la meute. La guerre clate-t-elle
enfin ? sous la bannire dploye par le maire du village, il simprovise
fantassin ou valet darme. Ltude dtaille de ces obligations appartient,
Marc BLOCH La socit fodale
240
avant tout, ltude de la seigneurie comme entreprise conomique et
source de revenus. On se bornera ici mettre laccent sur les faits dvolution
qui affectrent le plus profondment le lien proprement humain.
La dpendance des exploitations paysannes vis--vis dun matre commun
se traduisait par le versement dune p.348 sorte de loyer de la terre. Ici luvre
du premier ge fodal fut, avant tout, de simplification. Un assez grand
nombre de redevances qui, lpoque franque, taient dcomptes sparment
finirent par se fondre dans une rente foncire unique, quen France, lorsquelle
sacquittait en argent, on connaissait gnralement sous le nom de cens. Or,
parmi les taxes primitives, il sen trouvait qui, originellement, navaient t
leves, en principe, par les administrations seigneuriales que pour le compte
de ltat. Telles, les fournitures dues larme royale ou les paiements de
remplacement auxquels elles donnaient lieu. Leur runion une charge qui, ne
profitant quau seigneur, tait conue comme lexpression de ses droits
suprieurs sur le sol atteste, avec une particulire clart, la prpondrance
acquise par le pouvoir proche du petit chef de groupe, aux dpens de toute
attache plus haute.
Le problme de lhrdit, lun des plus brlants quait poss linstitution
du fief militaire, ne tint presque aucune place dans lhistoire des tenures
rurales. Du moins, durant lre fodale. A peu prs universellemen t, les
paysans se succdaient, de gnration en gnration, sur les mmes champs.
Parfois, vrai dire, comme il sera expliqu plus loin, les collatraux se
trouvaient exclus, quand le tenancier tait de condition servile. Toujours, par
contre, le droit des descendants devait tre respect, pourvu quils neussent
pas prmaturment abandonn le cercle familial. Les rgles successorales
taient fixes par les vieux usages rgionaux, sans autres interventions de la
part des seigneurs que leurs efforts, certaines poques et dans certains pays,
pour veiller lindivisibilit du bien, juge ncessaire lexacte perception
des charges. Au surplus, la vocation hrditaire des tenanciers semblait si bien
aller de soi que le plus souvent, les textes, supposant le principe tabli
davance, ne prenaient pas la peine de le mentionner, autrement que par
allusion. Parce que telle avait t, pour la plupart des exploitations paysannes,
avant que les chefferies villageoises ne se transformassent en seigneuries, la
coutume immmoriale, peu peu tendue aux manses plus rcemment
dcoups dans le domaine ? Sans doute. Mais aussi p.349 parce que les
seigneurs navaient aucun intrt rompre avec cette habitude. En ce temps
o la terre tait plus abondante que lhomme, o, p ar ailleurs, les conditions
conomiques interdisaient de mettre en valeur de trop vastes rserves laide
dune main -duvre salarie ou nourrie domicile, mieux valait, plutt que
de coudre parcelle parcelle, disposer, en permanence, des bras et de la force
contributive de dpendants, capables de sentretenir eux -mmes.
De toutes les exactions nouvelles imposes aux tenanciers, les plus
caractristiques furent sans doute les monopoles, trs varis, que le seigneur
sattribua leur dtriment. Tant t il se rservait, durant certaines priodes de
Marc BLOCH La socit fodale
241
lanne, la vente du vin ou de la bire. Tantt il revendiquait le droit exclusif
de fournir, moyennant paiement, le taureau ou le verrat ncessaire la
reproduction des troupeaux ou encore les chevaux qui, dans certaines rgions
du Midi, servaient au dpiquage des grains, sur laire. Plus souvent, il
contraignait les paysans de moudre son moulin, de cuire le pain son four,
de faire leur vin son pressoir. Le nom mme de ces charges tait significatif.
On les appelait, communment, banalits . Ignores de lpoque franque,
elles navaient dautre fondement que le pouvoir dordonner, reconnu au
seigneur, et dsign par le vieux mot germanique de ban . Pouvoir
insparable, cela va de soi, de toute autorit de chef, donc, en lui-mme,
comme part de lautorit seigneuriale, trs ancien, mais quavait
singulirement renforc, aux mains des petits potentats locaux, le
dveloppement de leur rle de juges. La rpartition de ces banalits, dans
lespace, no ffre pas une leon moins instructive. La France, o
laffaiblissement de la puissance publique et laccaparement des justices
avaient t pousss le plus loin, fut leur patrie dlection. Encore l mme
taient-elles surtout exerces par ceux des seigneurs qui dtenaient les droits
de justice les plus levs, dits de haute justice . En Allemagne, o
dailleurs elles ne stendaient pas un si grand nombre dactivits, elles
paraissent avoir t frquemment retenues par les hritiers directs des comtes,
ces juges par excellence de ltat franc. En Angleterre, elles ne furent p.350
introduites incompltement, du reste que par la conqute normande.
Visiblement le commandement seigneurial stait fait dautant plus
envahissant et lucratif quil rencontra it une concurrence moins efficace de la
part de cet autre ban : celui du roi ou de ses reprsentants.
Lglise paroissiale dpendait, presque partout, du seigneur ou, sil sen
trouvait plusieurs dans la mme paroisse, de lun deux. Le plus souvent, sans
doute, elle avait t nagure construite par un de ses prdcesseurs, sur le
domaine. Cela, pourtant, ntait pas ncessaire pour justifier une pareille
mainmise. Car on concevait alors le lieu de culte collectif comme la chose des
fidles. L o, ainsi quen Frise, il ny avait point de seigneurie, lglise
appartenait la communaut rurale elle-mme ; dans le reste de lEurope, le
groupe paysan, nayant point dexistence lgale, ne pouvait tre reprsent
que par son chef ou un de ses chefs. Ce droit de proprit disait-on avant la
rforme grgorienne, de patronat dit-on plus tard et plus
modestement consistait, avant tout, dans le pouvoir de nommer ou
prsenter le desservant. Mais les seigneurs prtendaient galement en dduire
la facult de percevoir, leur profit, une part au moins des revenus
paroissiaux. Parmi ceux-ci, le casuel, sans tre ngligeable, ne montait, en
somme, gure haut. La dme rapportait bien davantage. Aprs avoir longtemps
pass pour un devoir purement moral, le versement en avait t
rigoureusement impos tous les fidles, dans ltat franc par les premiers
Carolingiens, en Grande-Bretagne, vers le mme temps, par les rois
anglo-saxons, leurs imitateurs. Ctait, en principe, une taxe du dixime,
perue en nature et qui pesait sur tous les revenus, sans exception. Dans la
Marc BLOCH La socit fodale
242
ralit, elle en vint trs vite sappliquer, presque exclusivement, aux produits
agricoles. Lappropriation par les seigneurs ne fut point totale. LAngleterre
en fut peu prs protge par le tardif dveloppement de son rgime
seigneurial. Sur le continent mme, le cur, frquemment, lvque,
quelquefois, retenaient certaines fractions. En outre le rveil religieux n de la
rforme grgorienne aboutit rapidement faire restituer au clerg
cest --dire, pratiquement, dans la plupart des cas, aux p.351 monastres ,
avec un plus grand nombre encore dglises, beaucoup de dmes auparavant
tombes entre des mains laques. Laccaparement de cette redevance,
dorigine spirituelle, par des ma tres minemment temporels nen avait pas
moins t, au premier ge fodal, une des manifestations les plus frappantes,
comme les plus profitables, des conqutes dun pouvoir qui semblait,
dcidment, ne reconnatre nul autre le droit de rien demander ses sujets.
Laide pcuniaire ou taille des tenanciers ruraux naquit, comme la
taille des vassaux et vers le mme temps, du devoir gnral qui tout
subordonn faisait une loi de porter secours son chef. Comme elle, elle
adopta volontiers, au dbut, le masque dun cadeau, rappel, jusquau bout,
par certains des noms dont on la dsignait : en France, demande ou
queste , en Allemagne Bede, qui signifie prire. Mais on lappelait aussi,
plus sincrement, toulte , du verbe tolir, prendre . Son histoire, pour
avoir commenc plus tardivement, ne fut pas sans analogie avec celle des
monopoles seigneuriaux. Trs rpandue en France, importe en Angleterre par
les conqurants normands, elle demeura, en Allemagne, le privilge dun plus
petit nombre de seigneurs : ceux qui maniaient les pouvoirs de justice
suprieurs, l-bas moins morcels que chez nous. Tant il est vrai que le matre
parmi les matres fut toujours, lre fodale, le juge. Pas plus que la taille des
vassaux, la taille des rustres ne devait chapper laction rgulatrice de
lusage. Avec, toutefois, des rsultats sensiblement diffrents. Les
contribuables manquant ici, le plus souvent, de la force ncessaire pour
imposer une stricte dfinition des cas, limpt, qui dabord avai t t
exceptionnel, leur fut mesure que la circulation montaire devenait plus
intense rclam intervalles de plus en plus rapprochs. Cela nallait point,
dailleurs, sans de grandes varits, de seigneurie seigneurie. Dans
lIle -de-France, vers lan 1200, des terres o les leves taient annuelles, voire
bisannuelles, voisinaient avec dautres o elles navaient lieu que de loin en
loin. Le droit, presque partout, tait incertain. Car, pour sincorporer aisment
au rseau des bonnes coutumes , cette dernire venue parmi les charges
ntait pas seulement trop p.352 rcente. Sa priodicit mal fixe et, l mme o
le rythme stait stabilis, lirrgularit du montant chaque fois exig, lui
conservaient une couleur darbitraire. Dans les milieux dglise, de braves
gens , comme dit un texte parisien, en contestaient la lgitimit. Elle tait
particulirement odieuse aux paysans quelle poussa souvent de vives
rvoltes. A demi cristallise une poque dargent rare, la tradition de la
seigneurie ne se prtait pas sans heurts aux besoins dune conomie nouvelle.
Marc BLOCH La socit fodale
243
Ainsi le tenancier de la fin du XIIe sicle paye la dme, la taille, les
multiples droits des banalits : toutes choses que, mme dans les contres o
la seigneurie avait le plus long pass, son anctre du VIIIe sicle, par exemple,
navait pas connues. Incontestablement, les obligations de payer se sont faites
plus lourdes. Non du moins, en certains pays sans compensations du
ct des obligations de travail.
Car par une sorte de prolongation du dpcement dont le latifundium
romain avait t jadis la victime les seigneurs, dans une grande partie de
lEurope, staient pris allotir de vastes portions de leurs rserves : tantt
pour les distribuer, morceau par morceau, leurs anciens tenanciers ; tantt
pour y dcouper des tenures nouvelles, parfois mme pour en former de petits
fiefs vassaliques, bientt, leur tour, fragments en censives paysannes.
Provoqu par des causes dordre surtout conomique dont lexamen ne saurait
tre abord ici, le mouvement avait commenc ds le Xe et le XIe sicle,
semble-t-il, en France et en Lotharingie, comme en Italie ; il avait gagn, un
peu plus tard, lAllemagne transrhnane, plus lentement encore et non sans de
capricieux retours de courbe, lAngleterre , o le rgime seigneurial lui-mme
tait moins anciennement tabli. Or, qui disait domaine amoindri disait aussi,
forcment, corves abolies ou allges. L o le tenancier, sous Charlemagne,
devait plusieurs journes par semaine, on ne le voyait plus, dans la France de
Philippe Auguste ou de saint Louis, travailler sur les champs ou prs
domaniaux que quelques journes par an. Le dveloppement des exactions
neuves ne fut pas seulement, pays par pays, proportionnel p.353
laccapareme nt, plus ou moins pouss, du droit dordonner. Il sopra aussi en
raison directe de labandon, par le seigneur, du faire -valoir personnel.
Disposant la fois de plus de temps et de plus de terre, le paysan pouvait
payer davantage. Et le matre, naturellement, cherchait rattraper dun ct ce
quil perdait de lautre : priv des sacs de bl de la rserve, le moulin
seigneurial franais, sans le monopole du ban, net -il pas t contraint
darrter ses meules ? Cependant, cesser ainsi dexiger de ses su jets, tout le
long de lanne, un labeur dquipes ouvrires, les transformer
dfinitivement en producteurs, lourdement taxs certes, mais conomiquement
autonomes, se muer lui-mme en pur rentier du sol, le seigneur, l o cette
volution saccomplit dans toute sa plnitude, laissait invitablement se
relcher un peu du lien de domination humaine. Comme lhistoire du fief,
lhistoire de la tenure rurale fut, en fin de compte, celle du passage dune
structure sociale fonde sur le service un systme de rentes foncires.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
244
CHAPITRE II
Servitude et libert
I. Le point de dpart : les conditions personnelles
lpoque franque
Imaginons, dans ltat franc auquel, provisoirement, nous
bornerons nos regards et vers le dbut du IXe sicle, un personnage qui, en
prsence dune foule humaine, sefforce dy discerner les diverses conditions
juridiques : haut fonctionnaire du Palais en mission dans les provinces, prlat
dnombrant ses ouailles, seigneur occup recenser ses sujets. La scne na
rien de fictif. Nous connaissons plus dune tentative de cette sorte.
Limpression quelles donnent est celle de beaucoup dhsitations et de
divergences. Dans la mme rgion, des dates voisines, on ne voit presque
jamais deux censiers seigneuriaux user de critres semblables. Visiblement,
aux hommes mmes du temps, la structure de la socit o ils vivaient
napparaissait pas avec des lignes bien claires. Ctait que des systmes de
classification trs diffrents sentrecroisaient. Les uns, emprunt ant leur
terminologie aux traditions, elles-mmes discordantes, tantt de Rome, tantt
de la Germanie, ne sadaptaient plus que trs imparfaitement au prsent ; les
autres sessayaient de leur mieux exprimer la ralit et ne le faisaient pas
sans gaucherie.
p.355
A la vrit, une opposition primordiale soffrait, trs simple dans ses
termes : dun ct les hommes libres, de lautre les esclaves (en latin servi).
Sous rserve des p.356 attnuations apportes la duret des principes par ce
qui pouvait survivre encore de la lgislation humanitaire des empereurs
romains, par lesprit du christianisme et par les invitables transactions de la
vie quotidienne, les servi demeuraient, en droit, la chose dun matre, qui
disposait souverainement de son corps, de son travail et de ses biens. Par l,
dpourvu de personnalit propre, il fait, en marge du peuple, figure
dtranger -n. Il nest point convoqu lost royal. Il ne sige point aux
assembles judiciaires, ne peut y porter directement ses plaintes et nen est
justiciable quau cas o, ayant commis envers un tiers une faute grave, il se
voit livrer la vindicte publique par son matre. Que seuls les hommes libres,
indpendamment, dailleurs, de toute distinction ethnique, aient compos le
populus Francorum, la preuve en est la synonymie qui finalement stablit
entre le nom national et la qualit juridique : libre ou franc , les deux
mots devinrent interchangeables.
Marc BLOCH La socit fodale
245
A y regarder de prs cependant, cette antithse, en apparence si nette, ne
donnait de la vivante diversit des conditions quune image bien inexacte.
Parmi les esclaves mmes en nombre dailleurs relativement faible , les
modes dexistence avaient introduit des diffrences profondes. Un certain
nombre dentre eux, employs tantt aux bas ser vices domestiques, tantt aux
travaux des champs, taient nourris dans la maison du matre ou sur ses
fermes. Ceux-l demeuraient rduits au sort dun vritable cheptel humain,
officiellement rang parmi les biens meubles. Lesclave tenancier, par contre,
avait son chez soi ; il subsistait du produit de son propre labeur ; rien ne lui
interdisait, le cas chant, de vendre, son profit, le surplus de sa rcolte ; il
ne dpendait plus directement, pour son entretien, de son matre et la main de
celui-ci ne latteignait quoccasionnellement. Assurment il restait astreint,
envers le possesseur de la cour domaniale, des charges terriblement
lourdes. Du moins taient-elles limites, en droit quelquefois, en fait toujours.
Certains censiers, en effet, ont beau nous dire que lhomme doit servir toutes
les fois que lordre lui en sera donn ; en pratique, lintrt bien entendu du
matre lui commandait de laisser chaque petit exploitant la disposition des
p.357 journes de travail ncessaires la culture du manse : faute de quoi, la
matire mme des redevances se ft vanouie. Menant ainsi une vie fort
analogue celle des autres tenanciers, dits libres , aux familles desquelles
il sunissait assez souvent par mariage, le servus chas commenait dj
sen rapprocher galement par un trait, tout fait capital, de son statut
juridique. Les tribunaux royaux reconnaissaient que ses devoirs, lui aussi,
taient fixs par la coutume de la terre : stabilit absolument contraire la
notion mme desclavage, dont larbitraire est un lment essentiel. Certains
esclaves enfin, comme nous le savons, figuraient dans les troupes de fidles
arms dont sentou raient les grands. Le prestige des armes, la confiance dont
ils taient lobjet, en un mot, po ur parler comme un capitulaire, lhonneur du
vasselage leur assuraient dans la socit un rang et des possibilits daction
ce point au-dessus de toute tare servile que les rois jugrent bon de leur
rclamer, par exception, ce serment de fidlit auquel ne participaient, en
principe, que les vrais Francs .
Du ct des hommes libres, la bigarrure apparaissait plus forte encore. Les
distinctions de fortune, qui taient considrables, ne manquaient pas davoir
leur rpercussion sur les distinctions juridiques. Le personnage, si bien n
ft-il, qui, trop misreux pour squiper, ne pouvait tre convoqu larme
ou, du moins, ne pouvait sy rendre par ses propres moyens, devait -on le tenir
encore pour un membre authentique du peuple franc ? il nta it, au plus,
comme dit un capitulaire quun libre du second ordre ; une autre
ordonnance oppose, plus brutalement, aux libres les pauvres (232).
Surtout, en mme temps que sujets du roi, la plupart des hommes
thoriquement libres se trouvaient aussi les dpendants de tel ou tel chef
particulier et ctaient les nuances presque infinies de cette subordination qui
dterminaient principalement, dans chaque cas, la condition de lindividu.
Marc BLOCH La socit fodale
246
Les tenanciers des seigneuries, lorsquils ntaient point de statut servile,
portent en gnral, dans les documents officiels, rdigs en latin, le nom de
colons . Beaucoup, en effet, dans les parties de ltat franc qui jadis
avaient t p.358 romaines, descendaient certainement dan ctres soumis aux
lois du colonat. Mais lattache au sol, nagure la caractristique essentielle de
cette condition, tait peu prs tombe en dsutude. Plusieurs sicles
auparavant, le Bas-Empire avait conu le dessein de fixer tout homme, ou peu
sen f allait, sa tche hrditaire en mme temps qu sa cote dimpts : le
soldat larme, lartisan son mtier, le dcurion au snat municipal, le
fermier sa glbe, quil ne pouvait quitter et dont le propritaire minent du
sol ne pouvait larrach er. De ce rve, la puissance dune administration
souveraine sur dimmenses espaces avait alors permis de faire presque une
ralit. Les royaumes barbares, au contraire, pas plus que la plupart des tats
mdivaux qui leur succdrent, ne disposaient pas de lautorit ncessaire
pour poursuivre le paysan fugitif ou empcher quun nouveau matre ne
laccueillt. Au surplus, la dcadence de limpt foncier, entre les mains de
gouvernements inexperts, et enlev peu prs tout intrt de pareils efforts.
Il est significatif quau I Xe sicle, beaucoup de colons se soient trouvs tablis
sur des manses serviles , cest --dire qui avaient t jadis allotis des
esclaves, beaucoup desclaves sur des manses ingnuiles , originellement
attribus des colons. Ce dsaccord entre la qualit de lhomme et la qualit
de la terre dont les charges spcifiques continuaient rappeler le pass
najoutait pas seulement la confusion des classes. Il atteste combien la
perptuit de la succession, sur une mme motte , avait cess dtre
respecte.
Aussi bien labstraite notion du droit romain qui, du colon, homme libre
par son statut personnel, faisait lesclave de la terre o il est n , en un mot,
le dpendant non dun individu mais dune chose, quel sens pouvait-elle
conserver auprs dun ge trop raliste pour ne pas ramener tous les rapports
sociaux un change dobissance et de protection entre tres de chair et
dos ? Dj, l o une constitution impriale avait dit que le colon soit rendu
sa terre dorigine , le manuel de droit romain rdig, au dbut du VIe sicle,
pour les besoins de ltat visigoth, crivait : quil soit rendu son
matre (233). Assurment le colon du IXe sicle demeure, comme son lointain
prdcesseur, au p.359 regard de la loi, une personne libre. Il prte serment de
fidlit au souverain. Il parat quelquefois aux assembles judiciaires.
Cependant il na, avec les autorits publiques, que des contacts bien rares et
bien lointains. Va-t-il l ost ? Cest sous la bannire du chef dont il tient sa
tenure. Est-il cit en justice ? Le jeu des immunits et, plus encore, les usages
mme que ces privilges ordinairement se bornaient sanctionner lui
imposent de nouveau ce seigneur comme juge habituel. De plus en plus, en un
mot, sa place dans la socit se dfinit par sa sujtion envers un autre homme :
sujtion si troite, en vrit, quon estime naturel de limiter son statut familial
en lui interdisant de se marier en dehors de la seigneurie ; que son union avec
Marc BLOCH La socit fodale
247
une femme pleinement libre est traite de mariage ingal ; que le droit
canon tend lui refuser lentre des ordres sacrs, comme le droit sculier
lui infliger les chtiments corporels, anciennement rservs aux esclaves ;
quenfin, l orsque son seigneur lui fait remise de ses charges, cet acte est
volontiers qualifi daffranchissement. Ce ne fut pas sans raison qu la
diffrence de tant de termes du vocabulaire juridique latin, colonus finalement
resta sans postrit dans les parlers gallo-romans. La persistance dautres mots
dsignant, eux aussi, des conditions humaines, eut, cela va de soi, pour
ranon, beaucoup de glissements de sens ; elle nen atteste pas moins le
sentiment ou lillusion dune continuit. Ds lpoque carolingien ne, par
contre, le colon commenait se perdre dans la foule uniforme des
dpendants des seigneuries, que les chartes runissaient sous le nom de
mancipia (nagure, en latin classique, synonyme desclaves) et la langue
vulgaire sous celui, plus vague encore, d hommes du matre. Tout proche
des esclaves chass , dun ct, il se confondait presque, de lautre au
point que parfois, dans la terminologie, toute distinction sefface , avec les
protgs proprement dits, lorsque ceux-ci ntaient poin t des guerriers.
Car la pratique de la commendise ne se bornait point, nous le savons, aux
hautes classes. Beaucoup de modestes hommes libres se cherchaient un
dfenseur, sans pour cela accepter de se faire ses esclaves. En mme temps
quils lui p.360 livraient leur terre, pour la reprendre ensuite titre de tenure, on
voyait se nouer, entre les deux individus, une relation de caractre plus
personnel qui, pendant longtemps, dailleurs, resta mdiocrement dfinie.
Lorsquelle commena se prciser, ce fu t en empruntant plus dun trait une
autre forme de dpendance qui, trs rpandue, tait par l comme prdestine
servir de modle tous les liens dhumble sujtion : la condition de
laffranchi avec obissance .
Dinnombrables affranchissements d esclaves, dans les pays qui
composaient ltat franc, avaient eu lieu, depuis les derniers sicles de
lEmpire romain. Beaucoup dautres, au temps des Carolingiens, taient
octroys chaque anne. Aux matres, tout conseillait cette politique. Les
transformations de lconomie invitaient dissoudre les grandes quipes qui
avaient servi nagure cultiver les latifundia, aujourdhui morcels. De mme
que la richesse semblait ainsi devoir se fonder, dornavant, plutt sur la
perception de redevances et de services que sur lexploitation directe de vastes
domaines, la volont de puissance, son tour, trouvait dans la protection
tendue sur des hommes libres, membres du peuple, un instrument
singulirement plus efficace que ne pouvait le fournir la possession dun btail
humain, dpourvu de droits. Enfin, le souci du Salut, particulirement aigu
aux approches de la mort, inclinait couter la voix de lglise qui, si elle ne
slevait pas contre la servitude en elle -mme, nen faisait pas moins de la
libration de lesclave chrtien une uvre pie, par excellence. Aussi bien
laccession la libert avait -elle t de tout temps, Rome aussi bien que
dans la Germanie, laboutissement normal de beaucoup de destines serviles.
Marc BLOCH La socit fodale
248
Simplement, il parat probable que dans les royaumes barbares le rythme
stait peu peu acclr.
Mais les matres ne se montraient si gnreux, en apparence, que parce
quils taient loin de tout devoir cder. Rien de plus touffu, au premier abord,
que le rgime juridique des affranchissements, dans ltat franc du Xe sicle.
Les traditions du monde romain, dune part, des divers droits germaniques, de
lautre, fournissaient une multitude de p.361 moyens diffrents pour conclure
lopration et fixaient la condition de ses bnficiaires en d es termes dune
effarante varit. A sen tenir, cependant, aux rsultats pratiques, elles
concordaient offrir le choix entre deux grandes catgories dactes. Tantt
laffranchi chappait dsormais toute autorit prive, autre que celle dont il
pouvait plus tard, de son propre gr, rechercher lappui. Tantt, au contraire, il
demeurait astreint, dans son statut nouveau, certains devoirs de soumission,
soit envers son ancien matre, soit envers un patron nouveau une glise, par
exemple auquel ce matre consentait le cder. Ces obligations tant
gnralement conues comme destines se transmettre de gnration en
gnration, ctait la cration dune vritable clientle hrditaire quon les
voyait aboutir. Le premier type de manumission pour parler le langage
du temps tait rare. Le second, au contraire, trs frquent, parce que seul il
rpondait aux ncessits ambiantes. Le manumisseur , sil acceptait de
renoncer un esclave, tenait conserver un dpendant. Le manumis luimme, qui nosait gure vivre sans dfenseur, trouvait ainsi, demble, la
protection souhaite. La subordination par l contracte passait pour si forte
que lglise, porte exiger de ses prtres une pleine indpendance, rpugnait
accorder lordination ces nouveaux hommes libres, enserrs encore, en
dpit de leur nom, dans des liens son avis trop troits. Habituellement
laffranchi tait en mme temps le tenancier de son patron, soit quil et dj
t chas par lui avant de secouer la tare servile, soit que la libration se
ft accompagne dun don de terre. En outre, des charges dun caractre plus
personnel venaient souvent souligner la sujtion. Ctait parfois une part de
lhritage, perue, chaque mort, par le patron. Ctait, plus frquemm ent
encore, une taxe par tte, qui danne en anne frappait laffranchi, comme,
aprs lui, chaque individu de sa descendance. Tout en procurant un revenu
rgulier, dont le montant total ntait pas ngligeable, ce chevage , grce
la courte priodicit des leves, empchait que, par la mauvaise volont du
subordonn ou la ngligence du suprieur, le lien ne risqut de tomber dans
loubli. Le modle en avait t fourni par certains modes de
laffranchissement p.362 germanique. Il fut bientt imit dans presque toutes les
manumissions, pourvu quelles comportassent lobissance .
Part prleve sur la succession ; chevage : ces deux expressions de la
sujtion taient, dans les socits mdivales, promises un long avenir. La
seconde au moins avait de bonne heure cess dtre confine au petit monde
des personnes libres de la servitude. Comme le marquent, en termes exprs,
certains actes de manumission, les quelques deniers ou gteaux de cire,
Marc BLOCH La socit fodale
249
annuellement verss, passaient pour reprsenter le prix de la protection
tendue, sur son ancien esclave, par le matre transform en patron. Or les
affranchis ntaient pas les seuls hommes dits libres qui, de gr ou de force,
eussent t conduits se placer sous le maimbour dun puissant. Ds le
IXe sicle, le chevage, faisant tache dhuile, apparaissait dj comme le signe
spcifique de tout un groupe de dpendances personnelles qui, pour caractres
communs, suprieurs tous les caprices de la terminologie, avaient, de la part
du subordonn, une assez humble soumission, gnralement hrditaire, de la
part du protecteur, un vigoureux droit de commandement, gnrateur de
perceptions lucratives. Ainsi dans le chaos des relations dhomme homme,
encore bien enchevtres, commenaient se dessiner quelques lignes de
force, autour desquelles les institutions de lge suivant devaient peu peu se
cristalliser.
II. Le servage franais
Dans la France propre et la Bourgogne, une srie dactions convergentes
aboutirent, durant le premier ge fodal, un vritable dblayage de
lancienne nomenclature sociale. Les lois crites taient oublies. Parmi les
censiers de lpoque franque, un certain nombre avaient pri ; et les autres, par
suite des transformations du vocabulaire comme en raison des
bouleversements intervenus dans le dessin de beaucoup de terres, ne
pouvaient plus tre consults quavec peine. Les seigneurs, enfin, et les juges
taient gnralement trop ignorants pour sencombrer de souvenirs juridiques.
Dans le nouveau classement des conditions qui sopra alors, un rle
considrable revint, cependant, une notion familire, depuis p.363 un temps
immmorial, la conscience collective : lantithse de la libert avec la
servitude. Mais ce fut au prix dun profond changement de sens.
Que le contenu ancien de lopposition et cess de parler aux esprits,
comment sen tonner ? Car il ny avait, en France, presque plus desclaves
proprement dits. Bientt mme, il ny en eut plus du tout. Le genre de vie des
esclaves tenanciers navait rien de commun ave c lesclavage. Quant aux
petites troupes serviles qui nagure subsistaient de la provende du matre, les
vides quy creusait, constamment, le jeu combin de la mortalit et de
laffranchissement taient dsormais sans remdes. Le sentiment religieux, en
effet, interdisait dasservir les prisonniers de guerre chrtiens. Restait, il est
vrai, la traite, alimente par les razzias en terre de paennerie . Mais ses
grands courants ou bien natteignaient pas nos pays, ou bien faute sans
doute dy trouver da ssez riches acheteurs ne faisaient que les traverser,
pour se diriger vers lEspagne musulmane ou lOrient. Par ailleurs,
laffaiblissement de ltat privait de toute signification concrte lantique
distinction entre lhomme libre, sujet de plein droit, et lesclave, tranger au
fonctionnement des institutions publiques. On ne se dsaccoutuma point,
Marc BLOCH La socit fodale
250
pourtant, dimaginer la socit comme compose de personnes les unes libres,
les autres non libres ; en conserva ces dernires leur vieux nom latin de
servi, dont le franais fit serfs. Ce fut la ligne de clivage entre les deux
groupes qui, insensiblement, se dplaa.
Avoir un seigneur ne paraissait nullement contraire la libert. Qui nen
avait ? Mais on conut lide que cette qualit prenait fin l o cessait la
facult du choix, exerce une fois au moins dans la vie. En dautres termes,
toute attache hrditaire passa pour affecte dun caractre servile.
Linluctable lien, qui prenait lenfant ds le ventre de la mre , navait -il
pas t une des plus grandes durets de lesclavage traditionnel ? Le sentiment
de cette astreinte presque physique sexprime merveille dans lexpression
d homme de corps , forge par la langue populaire comme synonyme de
serf. Le vassal, dont lhommage ne shrita it point, tait, nous lavons vu,
essentiellement libre . Par contre, on se p.364 trouva conduit ranger sous
ltiquette dune commune servitude, avec les descendants, peu nombreux,
des esclaves tenanciers, la foule, beaucoup plus dense, des dpendants dont les
anctres avaient engag, avec leur propre personne, leur postrit : hritiers
daffranchis ou dhumbles commends. De mme, par un recoupement
significatif, pour les btards, les trangers ou aubains , quelquefois les
Juifs. Dpourvus de tout appui naturel dans la famille ou le peuple, ils avaient
t automatiquement confis, par les anciens droits, la garde du prince ou du
chef de leur rsidence ; lre fodale en fit des serfs, soumis, ce titre, au
seigneur de la terre sur laquelle ils vivaient ou, du moins, celui qui y dtenait
les pouvoirs de justice suprieurs. A lpoque carolingienne, un nombre
croissant de protgs avaient pay le chevage. Cela la condition, toutefois,
de conserver ou recevoir le statut dhommes libres. Car le sclavage avait un
matre qui pouvait tout lui prendre ; non un dfenseur, qui une compensation
ft due. Peu peu, cependant, on vit cette obligation, jadis considre comme
parfaitement honorable, se charger dune teinte de mpris ; puis, finalement,
tre compte, par les tribunaux, parmi les signes caractristiques du servage.
Elle continuait tre exige des mmes familles quautrefois et pour des
raisons fondamentalement les mmes. Seule avait chang la place quon
attribuait, dans la classification courante, au lien dont la redevance semblait
lexpression.
A peu prs imperceptible aux contemporains, comme toutes les mutations
smantiques, ce grand bouleversement de la table des valeurs sociales stait
annonc, ds la fin de lpoque franque, par un emploi trs lche du
vocabulaire de la servitude, qui ds lors commenait osciller entre les deux
acceptions du pass et de lavenir. Ces ttonnements se poursuivirent
longtemps. Selon les rgions, selon les clercs appels tablir les chartes, les
limites de la nomenclature variaient. Dans plusieurs provinces, certains
groupes, issus desclaves nagure librs moyennant obissance ,
conservrent, jusquau dbut du XI Ie sicle, comme une tiquette dorigine,
leur dsignation particulire de culverts , drive du latin collibertus,
Marc BLOCH La socit fodale
251
affranchi . Au mpris de la p.365 manumission dautrefois, on les tenait
dornavant pour privs de la libert , dans le sens nouveau du terme. Mais
on les considrait comme formant une classe suprieure aux simples serfs .
A dautres familles, et l, malgr une assimilation de fait toutes les
charges de la condition servile, les mots de commends ou de gens
davouerie (ce dernier substantif tant synonyme de protection) restrent
longtemps attachs. Un homme se plaait-il, avec sa postrit, sous la
dpendance dun matre, auquel il promettait, entre autres obligations, le
chevage ? Tantt lacte tait expressment trait dasservissement volontaire.
Tantt, au contraire, on y insrait, comme dans lan tique formule franque de
commendise , une clause de sauvegarde de la libert. Ou bien encore, on se
gardait prudemment, dans la rdaction, de toute expression compromettante.
Cependant, lorsquun dossier, comme celui de labbaye gantoise de
Saint-Pierre, stend sur plusieurs sicles, il nest pas malais dy observer,
mesure que le temps scoule, les progrs dune phrasologie de plus en plus
purement servile.
Quel quait t, dailleurs, le nombre de ces auto -traditions, dont la
proportion, remarquablement leve, par rapport la pauvret de nos
documents, en gnral, a de quoi surprendre et mouvoir ; il va de soi quelles
ne contriburent pas seules gonfler les rangs du servage. En dehors de toute
convention prcise, par le simple jeu de la prescription, de la violence et des
changements intervenus dans lopinion juridique, la masse des sujets des
seigneuries, anciens ou rcents, glissa lentement cette condition, dfinie par
un vieux nom et des critres presque tout neufs. Dans le village de Thiais en
Parisis qui, au dbut du IXe sicle, sur 146 chefs de famille comptait 11
esclaves seulement, en face de 130 colons, et dont dpendaient en outre 19
protgs payant chevage, la population presque entire, sous saint Louis, se
composait de personnes dont le statut tait qualifi de servile.
Jusquau bout, il subsista des individus, voire des collectivits entires
dont on ne savait au juste o les classer. Les paysans de Rosny-sous-Bois
taient-ils ou non serfs de Sainte-Genevive ? les gens de Lagny, serfs de leur
abbaye ? p.366 Ces problmes occuprent, du temps de Louis VII celui de
Philippe III, papes et rois. Astreints de pre en fils au chevage et plusieurs
autres coutumes que gnralement on estimait opposes la libert, les
membres de diverses bourgeoisies urbaines du Nord refusaient nanmoins, au
XIIIe sicle, de se laisser traiter de serfs. Hsitations et anomalies nenlevaient
cependant rien au fait essentiel. Au plus tard ds la premire moiti du XIIe
sicle les culverts ayant alors cess dexister en tant que classe et leur
nom tant devenu un pur synonyme de serf , une catgorie unique
dhumbles dpendants personnels sest constitue, lis un matre par leur
naissance, donc atteints par la macule servile.
Or, ce ntait pas l, beaucoup prs, une simple question de mot.
Certaines tares qui traditionnellement taient conues comme insparables de
la servitude se trouvrent presque ncessairement appliques ces non-libres
Marc BLOCH La socit fodale
252
dun genre en lui -mme nouveau, mais dont la nouveaut ntait pas bien
clairement ressentie. Telles, linterdiction dentrer dans les ordres ; la
privation du droit de porter tmoignage contre des hommes libres (cela,
toutefois, sauf privilge particulier, accord, par principe, aux serfs royaux et
tendu ceux de quelques glises) ; dune faon gnrale, une note trs
douloureuse dinfriorit et de ddain. Dautre part, un vritable statut stait
labor, dfini surtout par un faisceau de charges spcifiques. De modalits
infiniment variables, selon les coutumes de groupes, elles se retrouvaient,
dans les grandes lignes, partout peu prs semblables : contraste sans cesse
rpt dans cette socit la fois morcele et fondamentalement une. Ctait
le chevage. Ctait moins de permission spciale, qui sachetait
chrement la dfense de se formarier , entendez de contracter mariage
avec une personne qui ne ft pas de mme condition et ne dpendt pas du
mme seigneur. Ctait, enfin, une sorte dimpt sur lhritage. Dans les pays
picards et flamands, cette mainmorte prenait habituellement la forme
dune taxe successorale rgulire, le seigneur, chaque dcs, prlevant, soit
une petite somme, soit, plus souvent, le meilleur meuble ou la meilleure tte
de btail. Ailleurs, elle reposait sur la p.367 reconnaissance de la communaut
familiale : le dfunt laissait-il des fils (parfois des frres) ayant vcu avec lui
autour dun mme feu ? le seigneur ne recevait rien ; dans le cas contraire,
il confisquait tout.
Or, si lourdes que ces obligations pussent paratre, elles taient, en un
sens, aux antipodes de lesclavage, puisquelles supposaient, aux mains du
redevable, lexistence dun vritable patrimoine. En tant que tenancier, le serf
avait exactement les mmes devoirs et les mmes droits que nimporte quel
autre : sa possession ntait pas plus prcaire et son travail, les redevances et
services une fois rgls, nappartenait qu lui. Ne nous le figurons point, non
plus, limage du colon fix sa glbe . Certes les seigneurs cherchaient
retenir leurs paysans. Sans lhomme, que valait la terre ? Mais il tait difficile
dempcher les dparts, parce que le morcellement de lautorit sopposait,
plus que jamais, toute contrainte policire effective et que, dautre part, le
sol vierge tant encore trs abondant, il ne servait pas grand-chose de
menacer de confiscation le fugitif, toujours peu prs assur de trouver
ailleurs un nouvel tablissement. Aussi bien, ctait labandon de la tenure en
lui-mme quavec plus ou moins de succs on tchait de prvenir ; le statut
particulier de lexploitant importait peu. Voit -on deux personnages sentendre
pour refuser daccueillir chacun les sujets de lautre ? aucune distinction,
lordinaire, nest tente entre les conditions, servile ou libre, des individus
dont on convient ainsi dentraver les migrations.
Il ntait, dailleurs, nullement ncessaire que le champ et suivi, dans la
sujtion, le mme chemin que lhomme. Rien nempchait, en principe, que le
serf ne conservt par devers lui jusqu des alleux, soustraits toute
suprmatie foncire. A vrai dire, on admettait gnralement en pareil cas
nous en connaissons des exemples jusquau XII Ie sicle que, tout en
Marc BLOCH La socit fodale
253
demeurant tranger aux obligations caractristiques de la censive, le fonds ne
pouvait cependant tre alin sans lautorisation du matre de la personne : ce
qui, pratiquement, rendait assez imparfaite lallodialit. Il tait beaucoup plus
frquent que, possdant uniquement des tenures, le serf ne les tnt pas ou ne
les tint pas toutes du p.368 seigneur auquel lattachaient les liens propres sa
condition ; voire que, serf dun certain seigneur, il vct sur la terre dun
autre. Lre fodale rpugna -t-elle jamais aux enchevtrements de pouvoirs ?
Je donne Saint-Pierre de Cluny cette exploitation, avec ses
appartenances entendez je cde les droits minents sur le sol ,
except le vilain qui la cultive, sa femme, ses fils et ses filles, car ils ne sont
pas moi : ainsi sexprimait, vers la fin d u XIe sicle, une charte
bourguignonne (234). Ds lorigine, ce dualisme avait t inhrent la situation
de certains protgs. La mobilit de la population le rendit peu peu moins
exceptionnel. Il ne laissait naturellement pas de soulever de dlicats
problmes de partage et plus dun matre, tantt de la tenure, tantt de
lhomme, finalement y perdit son droit. Sur un point, toutefois, trs
significatif, on tait peu prs unanime reconnatre au nud dhomme
homme une sorte de primaut. On estimait que le serf, au moins en cas de
crime entranant une peine de sang , ne devait avoir dautre juge que son
seigneur de corps : cela, quels que fussent la fois les pouvoirs judiciaires
habituels de ce dernier et le domicile du justiciable. Le serf, en rsum, ne se
caractrisait nullement par un lien avec le sol. Sa marque propre tait, au
contraire, de dpendre si troitement dun autre tre humain que partout o il
se rendait, cette attache le suivait et collait sa postrit.
Ainsi, pas plus que les serfs, pour la plupart, ne descendaient danciens
esclaves, leur condition ne reprsentait-elle un simple avatar, plus ou moins
dulcor, de lancien esclavage ou du colonat romain. Sous de vieux mots,
avec des traits emprunts divers passs, linstitution refltait les besoins et
les reprsentations collectives du milieu mme qui lavait vue se former.
Assurment le sort du serf tait trs dur. Derrire la froideur des textes, il faut
restituer toute une atmosphre de rudesse, parfois tragique. Une gnalogie de
famille servile, dresse, dans lAnjou du X Ie sicle, pour les besoins dun
procs, se clt par cette mention : Nive, qui fut gorge par Vial, son
seigneur . Le matre volontiers prtendait, ft-ce au mpris de la coutume,
exercer un pouvoir arbitraire : il est mien de la plante des pieds au sommet
du crne , disait, dun de ses serfs, un abb de Vzelay. Plus p.369 dun
homme de corps, son tour, par la ruse ou par la fuite, sefforait dchapper
au joug. Tout cependant nest sans doute pas faux dans le propos de ce moine
dArras, qui nous dpeint les serfs de son abbaye galement empresss nier
le lien, quand leur vie tait paisible, le proclamer, au contraire, ds quun
danger pressant invitait chercher un dfenseur (235). Protection, oppression ;
entre ces deux ples tout rgime de clientle oscille presque ncessairement.
Et ctait bien en effet comme une des pices matresses dun systme de cet
ordre que le servage originellement stait constitu.
Marc BLOCH La socit fodale
254
Mais tous les paysans navaient pas pass la servitude mme lorsque leur
terre, elle, tait tombe dans la sujtion ou y tait demeure. Parmi les
tenanciers des seigneuries, des textes, qui se suivent sans interruption tout le
long de lre fodale, mettent en scne, coudoyant les serfs, des groupes
expressment qualifis de libres .
Surtout, nimaginons point de simples fermiers, ne soutenant avec le
matre suprme du sol que de froids rapports de dbiteurs cranciers.
Plongs dans une atmosphre sociale o toute relation dinfrieur suprieur
revt une couleur trs directement humaine, ces gens-l ne sont pas astreints
envers le seigneur seulement aux multiples redevances ou services qui psent
sur la maison et les champs. Ils lui doivent aide et obissance. Ils comptent sur
sa protection. La solidarit, qui stablit ainsi, est assez forte pour que le
seigneur ait droit une indemnit si son libre dpendant est bless, pour
que, rciproquement, dans lhypothse dune vendetta, voire de simples
reprsailles diriges contre lui, on juge lgitime de sen prendre au groupe
entier de ses sujets, sans distinction de statut. Elle parat assez respectable
aussi pour primer des devoirs en apparence plus hauts. Ils ntai ent pas serfs,
ces bourgeois dune villeneuve, indivise entre Louis VI et le sire de Montfort,
que leur charte autorisait garder la neutralit, en cas de guerre entre leurs
deux seigneurs, dont lun deux, pourtant, tait en mme temps leur roi (236).
Cependant ce lien, si prenant soit-il, demeure strictement fortuit. Aussi bien,
voyez les mots. Vilain , cest --dire habitant de la seigneurie, en latin
villa ; hte ; p.370 manant ; couchant et levant : ces termes, qui
suggraient simplement lide dune rsidence, sappliquaient tous les
tenanciers, en tant que tels, fussent-ils serfs. Mais le tenancier libre navait
pas dautre nom, parce quil tait un habitant ltat pur. Vend -il,
donne-t-il, abandonne-t-il sa terre, pour sen aller vivre ailleurs ? Rien ne
lattache plus au seigneur, dont mouvait ce morceau de sol. Cest pourquoi,
prcisment, ce vilain , ce manant passe pour dou de la libert et
rserves faites, et l, dune priode de g ense et dincertitudes pour
soustrait, en consquence, ces limitations du droit matrimonial et successoral
qui, sur lhomme de corps, au contraire, marquent la rigueur dune soumission
o la famille autant que lindividu est enserre.
Que de leons ne pourrait-on pas attendre dune carte de la libert et de la
servitude paysannes ! Seules, malheureusement, quelques grossires
approximations sont permises. Nous savons dj pour quelles raisons la
Normandie, remodele par les invasions scandinaves, ferait, sur ce croquis
suppos, une large tache blanche. et l, dautres espaces, galement vides
de servage, apparatraient, moins tendus et plus rebelles linterprtation :
tel, le Forez. Dans le reste du pays nous verrions une norme majorit de
serfs ; mais, ct deux, comme un semis de vilains libres, de densit trs
variable. Tantt on les aperoit troitement mls la population servile,
maison contre maison et sous la mme autorit seigneuriale. Tantt, au
contraire, ce sont des villages presque entiers qui semblent avoir ainsi chapp
Marc BLOCH La socit fodale
255
la servitude. Mme si nous tions mieux renseigns, dans le jeu des causes
qui ici prcipitrent une famille dans la sujtion hrditaire, ailleurs la
retinrent sur la pente, quelque chose assurment rsisterait toujours
lanalyse. Les conflits de forces infiniment dlicates peser, parfois le pur
hasard fixaient le dnouement, que souvent avaient prcd bien des
oscillations. Aussi bien cette bigarrure persistante des conditions
constitue-t-elle peut-tre le phnomne, tout prendre, le plus instructif. Dans
un rgime fodal parfait, de mme que toute terre et t fief ou tenure en
vilainage, tout homme se ft fait vassal ou serf. Mais il est bon que les faits
p.371 viennent nous le rappeler : une socit nest pas une figure de gomtrie.
III. Le cas allemand
Une tude complte de la seigneurie europenne lre fodale exigerait
que, passant maintenant au Midi de la France, nous y marquions lexistence,
concurremment avec le servage personnel, dune sorte de servage foncier, qui
passait de la terre lhomme et le fixait elle : institution dautant plus
mystrieuse que son apparition est extrmement difficile dater. Puis il
faudrait retracer, en Italie, le dveloppement dune notion de la servitud e,
troitement apparente la cration du droit franais, mais, semble-t-il, moins
rpandue et avec des contours plus mouvants. Enfin lEspagne offrirait le
contraste attendu qui, en face de la Catalogne, avec son servage la franaise,
dressait les terres de reconqute, Asturies, Len, Castille : pays, ainsi que
toute la pninsule, desclavage persistant, en raison des apports de la Guerre
Sainte, mais o, dans les populations indignes, les relations de dpendance
personnelle demeurrent, ce degr aussi de la socit, mdiocrement
astreignantes, par suite peu prs exemptes de tare servile. Plutt, cependant,
que de tenter cette revue, trop longue et encombre de trop dincertitudes,
mieux vaudra sattacher aux deux expriences, particulirement riche s, de
lAllemagne et de lAngleterre.
Parler des campagnes allemandes comme dune unit ne va pas sans
beaucoup dartifice. Ltude des terres de colonisation, lest de lElbe,
nappartient gure notre priode. Mais dans le cur mme de la vieille
Allemagne, une antithse massive opposait la Souabe, la Bavire, la
Franconie, la rive gauche du Rhin, o la seigneurialisation tait relativement
ancienne et profonde, la Saxe, qui par le nombre de ses libres paysans
libres de leurs terres, libres de leur personne semblait faire la transition
avec la Frise, sans seigneuries et, par suite, sans serfs. A sen tenir cependant
aux lignes fondamentales, certains caractres authentiquement nationaux
ressortent avec clart.
Comme en France, nous assistons et par les mmes p.372 moyens
une large gnralisation des rapports de soumission hrditaire. Les actes de
Marc BLOCH La socit fodale
256
donation de soi-mme sont dans les chartriers allemands aussi nombreux que
dans les ntres. Comme en France, entre la condition de ces protgs de
nouvelle origine et celle des anciens sujets des seigneuries, un rapprochement
tendit soprer et le modle du statut ainsi labor emprunta beaucoup de
traits la subordination type quavait t laffranchissement avec
obissance : filiation que le langage, ici, devait souligner dun trait
particulirement net. Sous le nom de Laten, dont ltymologie voque lide
dune libration, on avait dsign, nagure, en droit germanique, une classe
juridiquement bien dfinie qui, avec quelques rsidents trangers et, parfois,
les membres de populations vaincues, runissait les affranchis attachs encore
leurs anciens matres par les nuds dune sorte de patronat. Sous ce mme
nom, on comprenait, dans lAllemagne du Nord, au XI Ie sicle, de vastes
groupes de dpendants, o les fils des esclaves nagure transforms en clients
ne formaient assurment plus quune minorit. Le chevage, les taxes
successorales le plus souvent, sous laspect dun bien meuble prlev
chaque gnration taient devenus des charges caractristiques de la
subordination personnelle ; de mme linterdiction du formariage. Comme en
France enfin, dtournant de leur sens premier les notions de libert et de
non-libert, on tendait dsormais entacher de servitude tout lien dont
lemprise shritait avec la vie. Sur les terres de labbaye alsacienne de
Marmoutier, les tenures ingnuiles et serviles du IXe sicle sont, au XIIe,
fondues en une catgorie unique, que lon appelle servile. En dpit de leur
nom, les Laten de lre fod ale tout comme leurs frres de par del les
frontires, les culverts franais ont gnralement cess dtre tenus pour
des hommes libres : si bien que paradoxalement, le seigneur, sil renonce ses
droits sur eux, sera dit affranchir ces ex-affranchis. Par contre, la libert
est universellement reconnue aux Landsassen ( gens tablis sur la terre ),
appels aussi, par une dernire analogie avec la France, htes (Gste) et
qui sont de vritables manants, dgags de toute autre attache que les
obligations nes de la rsidence.
p.373 Cependant,
diverses conditions, spcifiquement allemandes, jetrent le
trouble dans ce dveloppement. La primitive conception de la libert navait
pu, en France, saltrer si profondment quen raison de leffacemen t de
ltat, notamment dans le domaine judiciaire. Or, en Allemagne et surtout
dans le Nord, durant toute lre fodale, il subsista, par places, en concurrence
avec les justices seigneuriales, des juridictions publiques conformes au type
ancien : comment lide naurait -elle pas survcu, plus ou moins obscurment,
de tenir pour libres tous les hommes et ceux-l seulement qui sigeaient ces
plaids et taient jugs par eux ? L o, comme en Saxe, les alleux paysans
taient nombreux, une autre cause de complication se produisait. Car, entre
lalleutier et le tenancier, lors mme que lun et lautre taient pareillement
exempts de tout lien personnel et hrditaire, la conscience commune ne
pouvait gure manquer de voir une diffrence de niveau. La libert de
lalleutier, parce quelle stendait aussi la terre, semblait plus complte.
Seul donc du moins lorsque son alleu atteignait une certaine dimension ,
Marc BLOCH La socit fodale
257
il avait le droit de figurer au tribunal comme juge, autrement dit, selon la
vieille terminologie franque, comme chevin ; il tait libre chevinable
(schffenbarfrei). Enfin des faits dordre conomique intervenaient galement.
Sans tre aussi ngligeable quen France car la proximit des pays slaves
alimentait perptuellement les razzias et la traite , lesclavage proprement
dit ne jouait cependant pas, dans lAllemagne fodale, un rle bien important.
Par contre, les anciens servi, domicilis sur la rserve, navaient pas t aussi
gnralement quen France transforms en tenanciers, parce que les rserves
elles-mmes conservaient, frquemment, une superficie plus considrable. La
plupart, il est vrai, avaient bien t, leur faon, chass , mais pour
recevoir seulement dinsignifiants lopins de terre. Astreints des corves
quotidiennes, ces valets la journe (Tagesschalken), vritables
manouvriers forcs, dont lespce tait tout fait inconnue en France, vivaient
dans un tat de sujtion profonde, quil ntait pas possible de ne pas ressentir
comme plus quun autre servile.
Pour avoir oubli quune classification sociale, en dernire analyse,
existe seulement par les ides que les hommes sen font et dont toute
contradiction nest pas ncessairement exclue, certains historiens se sont
laisss aller introduire, de force, dans le droit des personnes tel quil
fonctionnait dans lAllemagne fodale, une clart et une rgularit qui lui
taient fort trangres. Les juristes du moyen ge les avaient prcds dans cet
effort. Sans plus de succs. Il faut bien le reconnatre : les systmes que nous
proposent les grands auteurs de coutumiers, comme Eike von Repgow, dans
son Miroir des Saxons, ne sont pas seulement en eux-mmes assez mal lis ;
ils ne saccordent, par surcrot, que mdiocrement avec le langage des chartes.
Rien de pareil, ici, la simplicit relative du servage franais. Pratiquement,
lintrieur de chaque seigneurie, les dpendants titre hrditaire ntaient
presque jamais runis dans une classe unique, astreinte des devoirs
uniformes. En outre, de seigneurie seigneurie, les lignes de dmarcation
entre les groupes et leurs terminologies variaient lextrme. Un des critres
les plus usuels tait fourni par le chevage, auquel adhrait encore un peu de sa
valeur ancienne comme signe dune protection sans h onte. Si pauvres que
frquemment force avait t de les dispenser mme des taxes successorales,
les corvables la journe naturellement ne le devaient point. Mais il
manquait galement figurer dans le bagage traditionnel des charges, pourtant
fort lourdes, qui pesaient sur toute une partie des tenanciers de condition
servile. En sorte que tout en tant souvent, elles aussi, en raison de
lhrdit de lattache, considres comme prives de la libert les
familles dont cette redevance, vocatrice dune soumission jadis volontaire,
tait la marque propre passaient, du moins en rgle gnrale, pour suprieures
par le rang aux autres non-libres . Ailleurs les descendants des anciens
protgs continuaient tre qualifis par le vieux mot de Muntmen , issu
du terme germanique de Munt, qui, de toute antiquit, avait dsign lautorit
exerce par un dfenseur. Commends , et-on dit en pays roman. Mais
alors que, dans les campagnes franaises, les commends paysans du XIIe
p.374
Marc BLOCH La socit fodale
258
sicle, au reste trs peu p.375 nombreux, ne gardaient gure de leur origine
quun vain nom et staient en fait fondus dans la servaille , parmi leurs
confrres allemands, beaucoup avaient su maintenir leur existence comme
classe particulire, quelquefois mme leur libert de principe. Entre ces
diverses couches de la population sujette, la prohibition des intermariages ou,
du moins, labaissement de statut quentranait, en droit, toute union
contracte avec un conjoint moins haut plac contribuait maintenir de
fermes barrires.
Peut-tre, dailleurs, ft -ce en fin de compte, un dcalage dans le temps
que lvolution allemande dut le plus clair de son originalit. Avec ses tenures
indivisibles, rparties souvent en plusieurs catgories juridiques, avec les
multiples tiroirs o elle sefforait de classer les conditions humaines, la
seigneurie allemande, vers lan 1200, demeurait trs proche, en somme, du
type carolingien : beaucoup plus, assurment, que la seigneurie franaise du
mme temps. Mais elle devait, son tour, durant les deux sicles venir, sen
carter de plus en plus. En particulier, la fusion des dpendants hrditaires
sous une rubrique juridique commune samora vers la fin du XII Ie sicle :
deux ou trois cents ans plus tard quen France, par consq uent. L aussi, la
terminologie nouvelle procda par emprunts un vocabulaire qui sentait
lesclavage. Le qualificatif d homme propre (homo proprius, Eigen),
aprs avoir dsign lorigine, plus particulirement, les non -libres
entretenus, comme valets de ferme, sur la rserve, stendit peu peu
beaucoup de tenanciers, pour peu quils fussent attachs, de pre en fils, au
matre. Puis on shabitua complter lexpression par ladjonction dun autre
mot, qui exprimait vigoureusement la nature personnelle du lien : par un
curieux paralllisme avec un des noms les plus rpandus du serf franais, on
dira dsormais, de plus en plus volontiers : homme propre de son corps
eigen von dem Lipe Leibeigen. Naturellement, entre cette tardive
Leibeigenschaft, dont ltude nappartient point lre fodale, et le servage
franais du XIIe sicle, les diffrences de milieu et dpoque entranrent bien
des contrastes. Il nen est pas moins vrai quune fois de plus nous apparat ici
ce singulier caractre p.376 darchasme qui, travers presque toute lre
fodale, semble comme le signe distinctif de la socit allemande.
IV. En Angleterre : les vicissitudes du vilainage
Cest encore limage des vieux censiers carolingiens quvoque
invinciblement, deux sicles environ de distance, ltat des classes
paysannes dans lAngleterre du milieu du X Ie sicle : avec, il est vrai, une bien
moins ferme organisation de la seigneurie foncire ; mais, dans le systme des
liens de dpendance humaine, une complexit au moins gale. Ce chaos,
auquel ils ntaient point habitus, embarrassa beaucoup les clercs
continentaux chargs, par Guillaume le Conqurant, de cadastrer son nouveau
Marc BLOCH La socit fodale
259
royaume. Emprunte, ordinairement, la France de lOuest, leur terminologie
se plaque assez mal sur les faits. Quelques traits gnraux, nanmoins,
ressortent clairement. Il y a des esclaves authentiques (theows), dont
quelques-uns sont chass. Il y a des tenanciers chargs de redevances et de
services, mais qui passent pour libres. Il y a enfin des commends , soumis
un protecteur, lequel ne se confond point forcment avec le seigneur dont ils
tiennent leur tenure, sils en ont une. Tantt cette subordination dhomme
homme est encore assez lche pour pouvoir tre rompue au gr de linf rieur.
Tantt elle est au contraire indissoluble et hrditaire. Il y a enfin sans le
nom de vrais alleutiers paysans. En outre, deux autres principes de
distinction coexistaient avec les prcdents, sans se recouvrir ncessairement
avec eux : lun ti r de ltendue variable des exploitations ; lautre, de la
soumission telle ou telle des naissantes justices seigneuriales.
La conqute normande, qui renouvela presque totalement le personnel des
dtenteurs de seigneuries, bouleversa ce rgime et le simplifia. Sans doute
bien des traces de ltat ancien subsistrent : notamment dans le Nord, o nous
avons vu combien les paysans guerriers donnrent de tablature des juristes
accoutums un tout autre clivage des classes. Dans lensemble cependant, la
situation, un sicle p.377 environ aprs Hastings, tait devenue trs voisine de
celle de la France. En face des tenanciers qui dpendent dun seigneur
seulement parce quils tiennent de lui leur maison et leurs champs, on a vu se
constituer une classe d hommes lis (bondmen), d hommes par
naissance (nativi, niefs), sujets personnels et hrditaires que lon considre,
pour ce motif, comme privs de la libert . Sur eux psent des obligations
et incapacits, dont nous connaissons dj le dessein, quasiment invariable :
interdiction dentrer dans les ordres et de se formarier ; perception,
chaque mort, du meilleur meuble ; chevage (mais ce dernier, suivant un usage
dont on rencontre lanalogue sur certains points de lAllemagne, ntait
lordinaire peru que si lindividu vivait en dehors de la terre de son matre).
Ajoutez une charge curieusement protectrice des bonnes murs et dont
lquivalent tant cette socit fodale avait de profonde uniformit se
retrouve dans la lointaine Catalogne : la fille serve, si elle a faut, paye une
amende son seigneur. Beaucoup plus nombreux que les esclaves de jadis,
ces non-libres ne leur ressemblaient ni par le genre de vie, ni par le droit qui
les rgissait. Trait significatif : la diffrence du theow de lpoque
anglo-saxonne, leur famille, en cas de meurtre, participait, avec le seigneur, au
prix du sang. trangre lesclave, la solidarit du lignage ne le fut jamais au
serf des temps nouveaux.
Sur un point, pourtant, un contraste, vraiment profond, se marquait avec la
France. Beaucoup mieux que son voisin du continent, le seigneur anglais
russissait retenir sur sa terre ses serfs, voire ses simples tenanciers. Ctait
que, dans ce pays remarquablement unifi, lautorit royale avait as sez de
force pour faire rechercher les niefs fugitifs et chtier qui les avait
recueillis. Ctait aussi qu lintrieur mme de la seigneurie, le matre
Marc BLOCH La socit fodale
260
disposait, pour tenir en main ses sujets, dune institution dont les prcdents
taient sans doute anglo-saxons, mais que les premiers rois normands,
soucieux dune bonne police, avaient rgularise et dveloppe. On lappelait
frankpledge , ce qui veut dire cautionnement entendez cautionnement
mutuel , des hommes libres. Elle avait, en effet, pour objet dtablir, p.378 au
profit de la rpression, un vaste rseau de solidarit. Dans ce dessein, la
population, sur presque tout le sol anglais, se trouvait rpartie par sections de
dix. Chaque dizaine tait responsable, en son entier, de la comparution de
ses membres en justice. A intervalles dtermins, son chef devait prsenter les
coupables ou prvenus au dlgu des pouvoirs publics et celui-ci, en mme
temps, vrifiait que personne nchappt au filet ainsi tendu. Primitivement,
ctaient to us les hommes libres quon avait entendu grouper dans ce systme,
la seule exception des hautes classes, des serviteurs ou hommes darmes
nourris dans la maison et auxquels leur chef, par suite, servait de rpondant
naturel, des clercs enfin. Puis, trs rapidement, une grave transformation
sopra. On nastreignit plus au frankpledge que les dpendants des
seigneuries et on les y astreignit tous, sans distinction de statut. Par l, le nom
mme de linstitution devint menteur, puisque de ces dpendants beaucoup
ntaient plus tenus pour libres : preuve la fois paradoxale et loquente dun
changement de sens qui nous est dj bien souvent apparu. Dautre part, le
droit de procder ces sortes de revues judiciaires, tant impossible exercer
par des fonctionnaires trop peu nombreux, fut remis de plus en plus
frquemment aux seigneurs eux-mmes ou, du moins, beaucoup dentre eux.
Entre leurs mains, il devait tre un merveilleux instrument de contrainte.
Cependant la conqute, qui avait imprim aux seigneuries une si forte
structure,
avait
aussi
favoris
ltablissement
dune
royaut
exceptionnellement bien arme. Lespce daccord frontalier qui se conclut
entre les deux puissances explique le dernier avatar que subit, dans
lAngleterre mdivale, le classement des conditions et jusqu la notion
mme de libert. Ds le milieu du XIIe sicle, sous laction des dynasties
normande, puis angevine, les pouvoirs judiciaires de la monarchie avaient pris
un extraordinaire dveloppement. Cette rare prcocit pourtant eut sa ranon.
Contraints de respecter une barrire que, par la suite, les tats de formation
plus lente, comme la France, ne trouveront pas si difficile franchir, les juges
des Plantagents, p.379 aprs quelques hsitations, renoncrent sinte rposer
entre le lord du manoir et ses hommes. Non que ceux-ci fussent privs de
tout accs aux tribunaux royaux. Seuls les procs qui touchaient leurs relations
avec leur seigneur ne pouvaient tre ports que devant celui-ci ou sa cour.
Mais les causes ainsi dfinies atteignaient ces humbles gens dans leurs intrts
les plus chers : poids des charges, possession et transmission de la tenure. Par
ailleurs, le nombre de personnes intresses tait considrable : car on y
rangeait avec les bondmen, la plupart des simples tenanciers que, par un
emprunt au vocabulaire franais, on dsignait couramment sous le nom de
vilains . Ainsi une nouvelle faille, dont limportance pratique se manifestait
Marc BLOCH La socit fodale
261
tous les yeux, tait trace au travers de la socit anglaise : dun ct, les
vrais sujets du roi, sur lesquels stendait, en tout temps, lombre protectrice
de sa justice ; de lautre, la masse paysanne, plus qu demi abandonne
larbitraire seigneurial.
Or lide navait probablement jamais tout fait dispa ru qutre libre
ctait avant tout avoir droit la justice publique, lesclave ntant passible
que de la correction par le matre. Les juristes diront donc, subtilement, que,
par rapport son seigneur, mais celui-ci seulement (puisque contre des tiers
rien ninterdit le recours aux juridictions ordinaires), le vilain est un non -libre.
Lopinion commune, la jurisprudence mme virent plus gros et plus simple.
Ds le XIIIe sicle, on admet couramment la synonymie de ces deux mots,
jadis, comme en France, presque antithtiques : vilain et serf .
Assimilation trs grave, parce quelle ne se bornait point au langage. Celui -ci
ne faisait, en ralit, quexprimer de vivantes reprsentations collectives. Le
vilainage passa dsormais, lui aussi, pour hrditaire ; et, bien que dans la
foule des vilains, une certaine note dinfriorit continut ordinairement de
mettre part les descendants des anciens bondmen, dailleurs toujours moins
nombreux, semble-t-il, que les serfs franais, on tendit de plus en plus
lomnipotence des cours de manoirs aidant assujettir tous les membres de
la nouvelle classe servile aux charges et aux tares qui nagure navaient pes
que sur les hommes lis .
Cependant, dfinir le vilain comme lhomme qui, dans ses ra pports
avec son seigneur, ntait justiciable que de celui -ci ; puis mesure que,
grce la mobilit de la fortune foncire, le statut de lhomme et celui du sol
cessrent, de plus en plus frquemment, de concider dfinir, son tour, la
tenure en vilainage comme celle dont la possession manquait tre protge
par les cours royales : ctait, sans doute, poser les caractristiques dune
classe humaine ou dune catgorie dimmeubles. Ce ntait pas en fixer les
contours. Car encore fallait-il quun moyen se prsentt de dterminer, parmi
les personnes ou les terres, celles qui devaient tomber sous le coup de cette
incapacit, do dcoulait tout le reste. Ranger, sous une aussi mprisante
rubrique, tous les individus qui avaient un seigneur ou tous les biens-fonds
placs sous une mouvance, nul ny pouvait songer. Il ne suffisait mme pas
dexclure les fiefs chevaleresques. Parmi les possesseurs de censives
comprises dans un manoir , il se trouvait beaucoup de personnages dun
rang trop lev, voire beaucoup de paysans dont la libert tait trop
anciennement et trop solidement atteste pour quil ft possible de confondre
tout de go ces gens-l dans une masse servile. La jurisprudence eut donc
recours un critre que lui fournit, l aussi, lhritag e dides ou de prjugs
profondment enracins dans la conscience commune. Lesclave avait d tout
son travail son matre. Par suite, devoir un seigneur beaucoup de son temps
paraissait affecter srieusement la libert. Surtout quand les tches ainsi
exiges appartenaient ces besognes manuelles, juges assez basses, que lon
dsignait couramment, dans toute lEurope, sous le nom symptomatique
p.380
Marc BLOCH La socit fodale
262
duvres serviles . La tenure en vilainage fut donc celle qui obligeait
envers le seigneur de lourdes corves agricoles lourdes parfois au point
dtre quasiment arbitraires et dautres services considrs comme
mdiocrement honorables ; et les hommes qui, au XIIIe sicle, se trouvaient
dtenir ces terres formrent la souche de la chasse des vilains. Dans les cas
particuliers, la discrimination fut souvent capricieuse ; il y eut des rgions
presque pargnes. Mais le principe tait trouv.
Le problme concret quaux hommes de loi des p.381 Plantagents avait
pos la coexistence dune justice royale pr cocement dveloppe et dune
puissante aristocratie foncire tait, comme ces faits eux-mmes,
spcifiquement anglais. De mme, la distinction de classes qui permit de la
rsoudre et dont les consquences lointaines, par-del notre priode, devaient
tre singulirement graves. Par contre, les conceptions mmes que lopinion
juridique mit en uvre pour laborer la nouvelle notion de servitude
appartenaient au patrimoine commun de lEurope fodale. Que le vilain,
mme libre, ne dt avoir dautre juge que son seigneur, ctait ce que
soutenait encore, dans lentourage de Saint Louis, un juriste franais ; et lon
sait par ailleurs combien lquation libert -justice publique demeura vivante
en Allemagne. Que dautre part lobligation certains services jugs p eu
honorables ou trop rigoureux ft volontiers tenue pour une marque de servage,
ce sentiment, contraire au droit strict et que, par suite, combattaient les
tribunaux, nen alimentait pas moins, dans lIle -de-France, vers lan 1200,
certaines haines villageoises (237). Mais lvolution lente, insidieuse et sre de
ltat franais empcha quune frontire marque dun trait aussi net ne
stablt, finalement, entre les pouvoirs judiciaires du roi et ceux des
seigneurs. Quant la notion de travaux dshonorants, si elle eut son rle dans
la dlimitation, en France, de la classe nobiliaire, elle ny russit jamais
supplanter les anciens critres de la servitude, parce que rien ne vint imposer
le besoin dun nouveau classement des sta tuts. Ainsi le cas anglais montre,
avec une rare clart, comment au sein dune civilisation beaucoup dgards
trs une, certaines ides-forces, en se cristallisant sous laction dun milieu
donn, purent aboutir la cration dun systme juridique tout fait original,
alors quailleurs les conditions ambiantes les condamnaient un tat en
quelque sorte perptuellement embryonnaire. Par l il prend la valeur dune
vritable leon de mthode.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
263
CHAPITRE III
Vers les nouvelles formes du rgime seigneurial
I. La stabilisation des charges
Les profondes transformations qui, partir du XIIe sicle, commencrent
de mtamorphoser les rapports de sujet seigneur devaient stendre sur
plusieurs centaines dannes. Il suffira de marquer ici comment l institution
seigneuriale sortit de la fodalit.
Depuis quinapplicables en pratique et de plus en plus difficilement
intelligibles, les censiers carolingiens taient tombs en dsutude, la vie
intrieure des seigneuries, mme parmi les plus grandes et les moins mal
administres, menaait de ne plus connatre dautres rgles que purement
orales. Rien nempchait, vrai dire, dtablir, sur un modle analogue, des
tats des biens et des droits mieux adapts aux conditions du moment. Ainsi
agirent, en effet, dans les rgions o, comme en Lorraine, la tradition
carolingienne tait demeure particulirement vivace, certaines glises.
Lhabitude de ces inventaires ne devait jamais se perdre. De bonne heure,
cependant, lattention se porta sur un autre type d crit qui, ngligeant la
description du sol pour sattacher tablir les rapports humains, paraissait
rpondre plus exactement aux besoins dun temps o la seigneurie tait
devenue, par-dessus tout, un groupe de commandement. Le seigneur, par un
acte authentique, fixait les coutumes propres telle ou telle terre. En principe
octroyes par le matre, ces sortes de petites constitutions locales nen p.384
rsultaient pas moins, ordinairement, de tractations pralables avec les sujets.
Aussi bien un pareil accord semblait-il dautant plus ncessaire que le texte le
plus souvent ne se bornait point enregistrer la pratique ancienne ; il la
modifiait sur certains points. Telle la charte par laquelle, ds 967, labb de
Saint-Arnoul de Metz allgea les services des hommes de Morville-sur-Nied ;
tel encore, en sens inverse, le pacte dont, vers 1100, les moines de Bze,
en Bourgogne, avant de permettre la reconstruction dun village incendi,
imposrent aux habitants les clauses assez dures (238). Mais jusquau dbut du
XIIe sicle, ces documents demeurrent trs rares.
A partir de cette date, au contraire, diverses causes contriburent les
multiplier. Dans les milieux seigneuriaux, un got nouveau de nettet
juridique assurait la victoire de lcrit. Jusque chez les humbles, celui -ci, par
suite des progrs de linstruction, semblait plus quautrefois prcieux. Non
que, dans leur immense majorit, ils fussent capables de lire eux-mmes.
Mais, si tant de communauts rurales ont rclam des chartes et les ont
Marc BLOCH La socit fodale
264
conserves, cest assurment que, dans leur voisinage immdiat, il se trouvait
des hommes clercs, marchands, juristes tout prts leur interprter ces
documents.
Surtout les transformations de la vie sociale poussaient fixer les charges
et en attnuer le poids. Dans presque toute lEurope, un grand mouvement
de dfrichement se poursuivait. Qui voulait attirer les pionniers sur sa terre
devait leur promettre des conditions favorables ; le moins quils pussent
demander tait de se savoir soustraits, par avance, tout arbitraire. Puis, dans
les alentours, lexemple ainsi donn simposait bientt aux matres des vieux
vinages, sous peine de voir leurs sujets cder lappel dun sol moins
lourdement grev. Ce ne fut point hasard, sans doute, si les deux constitutions
coutumires qui devaient servir de modle tant dautres textes semblables, la
charte de Beaumont-en-Argonne et celle de Lorris, prs de la fort dOrlans,
octroyes, lune une agglomration de fondation rcent e, lautre, par contre,
un trs ancien tablissement, ont pour trait commun, tant nes pareillement
lore de grands p.385 massifs boiss, davoir t scandes, ds leur premire
lecture, par les cognes des essarteurs. Il nest pas moins significatif quen
Lorraine le mot de villeneuve ait fini par dsigner toute localit, ft-elle
millnaire, qui avait reu une charte. Le spectacle des groupes urbains agit
dans le mme sens. Soumis eux aussi au rgime seigneurial, beaucoup dentre
eux, ds la fin du XIe sicle, avaient russi conqurir de srieux avantages,
stipuls sur parchemin. Le rcit de leurs triomphes encourageait les masses
paysannes et lattrait que les villes privilgies risquaient dexercer faisait
rflchir les matres. Enfin lacclra tion des changes conomiques
ninclinait pas seulement les seigneurs souhaiter certaines modifications
dans la distribution des charges ; en faisant couler un peu de numraire jusque
dans les coffres des rustres, elle ouvrait devant ceux-ci de nouvelles
possibilits. Moins pauvres, partant moins impuissants et moins rsigns, ils
pouvaient dsormais tantt acheter ce qui ne leur et point t donn, tantt
lenlever de haute lutte : car il sen faut que toutes les concessions
seigneuriales aient t gratuites ou consenties de pure bonne volont. Ainsi
grandit, par monts et par vaux, le nombre de ces petits codes villageois. On les
appelait, en France, chartes de coutumes ou de franchises . Parfois les
deux mots taient accols. Le second, sans signifier ncessairement labolition
du servage, voquait les allgements varis apports la tradition.
La charte de coutumes fut, dans lEurope des derniers temps fodaux et de
la priode suivante, une institution trs gnrale. On la rencontre, de
multiples exemplaires, dans tout le royaume de France, dans la Lotharingie et
le royaume dArles, dans lAllemagne rhnane, dans lItalie presque entire,
royaume normand compris, sur toute ltendue enfin de la pninsule ibrique.
Assurment les poblaciones ou les fueros de lEspagne, les statuti italiens ne
diffrent pas seulement par le nom des chartes franaises et celles-ci, leur
tour, taient loin davoir t toutes jetes dans le mme moule. De grandes
diversits se marquent galement, selon les pays ou les provinces, dans la
Marc BLOCH La socit fodale
265
densit de la rpartition ; dautres, non moins accentues, dans les dates du
mouvement. Contemporaines des efforts des chrtiens pour p.386 repeupler les
terres conquises, les plus anciennes poblaciones de lEspagne remontent au Xe
sicle. Sur le Rhin moyen, les premires chartes de villages, imites,
semble-t-il, de modles plus occidentaux, ne sont pas antrieures aux
approches de lan 1300.
Cependant, si importantes que ces divergences puissent paratre, leurs
problmes sont peu de chose ct de celui que soulve la prsence, sur la
carte des franchises rurales, de deux normes blancs : lAngleterre, dune
part ; lAllemagne transrhnane, de lautre. Non que des deux parts, un assez
grand nombre de communauts naient reu de leurs seigneurs des chartes.
Mais ctaient, presque exclusivement, des groupes urbains. Sans doute, dans
presque toute ville mdivale, lexception des grandes mtropoles du
commerce, il subsista toujours quelque chose de campagnard : la collectivit
avait ses terrains de pture, les habitants avaient leurs champs, que les plus
humbles cultivaient eux-mmes. Simples bourgs plutt que villes, dirionsnous aujourdhui de la plupart des localits allemandes ou anglaises ainsi
privilgies. Il nen es t pas moins vrai que ce qui dcida, chaque fois, de
loctroi de pareilles faveurs, ce fut lexistence dun march, dune classe
marchande, dun artisanat. Ailleurs, au contraire, le mouvement avait touch
les purs villages.
Que lAngleterre nait pas conn u de chartes de coutumes rurales, la forte
armature du manoir et son volution dans un sens tout favorable larbitraire
seigneurial suffisent apparemment lexpliquer. Pour leur servir de mmoire
crite, les lords avaient leurs censiers et les rouleaux darrts de leurs cours de
justice ; pourquoi auraient-ils prouv le besoin de codifier autrement des
usages dont la mobilit mme devait leur permettre, peu peu, de rendre
singulirement prcaire la possession des tenures ? Ajoutez que, les
dfrichements paraissant avoir t, dans lle, relativement peu intensifs et les
seigneurs y disposant, dautre part, de moyens fort efficaces pour tenir leurs
sujets, une des causes qui, sur le continent, avait le plus puissamment pouss
aux concessions, ici ne joua gure.
Rien de pareil ne se voyait en Allemagne. Aussi la charte p.387 de coutumes
ny demeura -t-elle exceptionnelle quen raison de la prdilection dont un autre
procd de fixation des charges y fut lobjet : ce Weistum, que M.
Ch.-Edmond Perrin a ingnieusement propos de nommer, en franais,
rapport de droits . Lhabitude stant conserve, dans les seigneuries
allemandes, de runir les dpendants en assembles priodiques, hritires des
plaids judiciaires carolingiens, on trouva commode de leur donner lecture,
cette occasion, des dispositions traditionnelles qui devaient les rgir et
auxquelles, par leur assistance mme cette proclamation, ils semblaient
savouer soumis : sorte denqute coutumire qui perptuellement renouvele,
ressemblait fort, en son principe, celles dont les censiers dautrefois avaient
enregistr les rsultats. Des textes furent ainsi tablis, auxquels on ne se
Marc BLOCH La socit fodale
266
privait dailleurs pas dajouter, de temps autre, quelques complments. Le
rapport de droits eut l Allemagne au-del du Rhin pour domaine propre ;
sur la rive gauche et jusquen terre de langue franaise, une large zone de
transition stendit, quil se partagea avec la charte de coutumes.
Ordinairement plus minutieux que cette dernire, il prtait en revanche des
modifications plus aises. Mais le rsultat fondamental, des deux cts, tait le
mme. Bien quil y ait toujours eu, partout, de nombreux villages dpourvus
de Weistum ou de charte, bien que ni lun ni lautre mode de rglement, l o
ils existaient, naient possd lexorbitant pouvoir darrter la vie, ce fut
vraiment sous le signe dune stabilisation croissante des relations entre matres
et sujets que souvrit, dans lhistoire de la seigneurie europenne, une phase
nouvelle. Quaucun ce ns ne soit lev, sil nest crit : cette phrase dune
charte roussillonnaise tait comme le programme dune mentalit et dune
structure juridiques galement loignes des murs du premier ge
fodal (239).
II. La transformation des rapports humains
En mme temps que la vie interne de la seigneurie devenait moins
mouvante, elle se modifiait, sur certains points, presque du tout au tout.
Rduction gnrale des corves ; p.388 substitution, tantt celles-ci, tantt aux
redevances en nature, de paiements en argent ; limination progressive enfin
de ce qui, dans le systme des charges, demeurait frapp dun caractre
incertain et fortuit : ces faits sinscrivent dsormais toutes les pages des
cartulaires. La taille notamment, nagure arbitraire , fut en France trs
largement abonne : entendez transforme en une taxe de montant et de
priodicit galement immuables. De mme, aux fournitures dues au seigneur,
lors de sjours videmment variables, un impt forfaitaire souvent succda.
En dpit de multiples variations, rgionales ou locales, il tait clair que, de
plus en plus, le sujet tendait se muer en un contribuable dont la cote, danne
en anne, ne subissait que de faibles changements.
Dautre part, la forme de dp endance en qui la subordination dhomme
homme avait trouv son expression la plus pure tantt disparaissait, tantt
saltrait. Des affranchissements rpts, qui parfois sappliquaient des
villages entiers, diminurent considrablement, partir du XIIIe sicle, le
nombre des serfs franais et italiens. Dautres groupes glissrent la libert
par simple dsutude. Il y a plus : l o, en France, le servage subsistait
encore, on le vit progressivement scarter de lancien hommage de corps .
On le conut moins fortement comme une attache personnelle, davantage
comme une infriorit de classe qui pouvait, par une sorte de contagion,
passer de la terre lhomme. Il y eut dornavant des tenures serviles, dont la
possession faisait serf, dont labandon, parfois, affranchissait. Le faisceau
mme des obligations spcifiques, en plus dune province, se dissocia. Des
Marc BLOCH La socit fodale
267
critres nouveaux apparurent. Jadis dinnombrables tenanciers avaient subi la
taille arbitraire ; des serfs, rests serfs, avaient obtenu labo nnement.
Dsormais, payer la volont du seigneur fut pour le moins une prsomption
de servage. Nouveauts, alors, presque universelles. En dpit de ses
originalits si frappantes, le vilainage anglais tait-il autre chose quune
dfinition du statut par lincertitude des charges la corve tant ici prise
pour type et de charges essentiellement adhrentes un bien-fonds ? Alors
que jadis, au temps o il ny avait encore p.389 dautres non -libres que les
bondmen, le lien de lhomme avait pass pour une marque de servitude, ce
fut, lavenir, en qualit de manant, de vilain , que lon se trouva atteint
par cette tare ; et le vilain par excellence tait celui qui, soumis des services
sans fixit, ne savait le soir ce quil devrait faire le lendemain matin . En
Allemagne, o la classe des hommes propres de corps ne sunifia que trs
tard, lvolution fut plus lente ; elle ne sen opra pas moins, finalement, selon
des lignes peu prs semblables.
La seigneurie, en elle-mme, na aucun titre prendre place dans le
cortge des institutions que nous nommons fodales. Elle avait coexist,
comme elle le fera encore par la suite, avec un tat plus fort, des relations de
clientle plus rares et moins stables, une beaucoup plus large circulation de
largent. Cependant, aux conditions de vie nouvelles qui surgirent partir du
IXe sicle ou environ, cet antique mode de groupement ne dut pas seulement
dtendre ses prises une part beaucoup plus considrable de la population,
tout en consolidant singulirement sa propre armature interne. Comme le
lignage, il subit profondment laction de lambiance. La seigneurie des ges
o se dveloppa et vcut la vassalit fut, avant tout, une collectivit de
dpendants, tour tour protgs, commands et pressurs par leur chef et dont
beaucoup lui taient attachs par une sorte de vocation hrditaire, sans
rapport avec la possession du sol ou lhabitat. Quand les relations vraiment
caractristiques de la fodalit perdirent leur vigueur, la seigneurie subsista.
Mais avec des caractres diffrents, plus terriens, plus purement conomiques.
Ainsi un type dorganisation sociale, que marque une tonalit particulire dans
les rapports humains, ne se manifeste pas seulement par des crations neuves ;
il colore de ses teintes, comme au passage dun prisme, ce quil reoit du
pass, pour le transmettre aux poques suivantes.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
TOME
268
II
LES CLASSES
et le
GOUVERNEMENT DES HOMMES
Avis au lecteur
Un rseau de liens de dpendance, tissant ses fils du haut en bas de
lchelle humaine, donna la civilisation de la fodalit europenne son
empreinte la plus originale. Comment, sous laction de quelles circonstances
et de quelle ambiance mentale, laide aussi de quels emprunts, faits un plus
lointain pass, cette structure si particulire put-elle natre et voluer, cest ce
quon sest efforc de montrer dans le tome prcdent. Jamais, cependant,
dans les socits auxquelles sattache traditionnellement lpithte de
fodales , les destines individuelles navaient t rgles exclusivement
par ces rapports de proche sujtion ou dimmdiat commandement. Les
hommes sy rpartissaient aussi en groupes, lun au -dessus de lautre tags,
que distinguaient la vocation professionnelle, le degr de puissance ou de
prestige. En outre, par-dessus la poussire des innombrables petites chefferies,
de tout genre, il subsista toujours des pouvoirs de rayon plus tendu et de
nature diffrente. A partir du second ge fodal on vit la fois les classes
sordonner de plus en plus strictement et le rassemblement des forces, autour
de quelques grandes autorits et de quelques grandes aspirations, soprer
avec une vigueur croissante. Cest vers ltude de ce deuxime aspect de
lorganisation sociale quil nous faut maint enant nous tourner. Cela fait, il sera
enfin permis de chercher rpondre aux questions qui, ds les premiers pas de
lenqute, avaient paru la p.394 dominer : par quels traits fondamentaux, propres
ou non une phase de lvolution occidentale, ces quelq ues sicles ont-ils
mrit le nom qui les met ainsi part du reste de notre histoire ? De leur
hritage, quest -il demeur aux poques qui les devaient suivre ?
Marc BLOCH La socit fodale
269
LIVRE PREMIER : Les classes
CHAPITRE PREMIER
Les nobles comme classe de fait
I. La disparition des anciennes aristocraties du sang
Pour les crivains qui les premiers nommrent la fodalit, pour les
hommes de la Rvolution, qui travaillrent la dtruire, la notion de noblesse
en semblait insparable. Il nest gure cependant dassoci ation dides plus
franchement errone. Du moins, pour peu que lon tienne conserver au
vocabulaire historique quelque prcision. Assurment les socits de lre
fodale neurent rien dgalitaire. Mais toute classe dominante nest pas une
noblesse. Pour mriter ce nom, elle doit, semble-t-il, runir deux conditions :
dabord, la possession dun statut juridique propre, qui confirme et matrialise
la supriorit quoi elle prtend ; en second lieu, que ce statut se perptue par
le sang sauf, toutefois, admettre, en faveur de quelques familles
nouvelles, la possibilit de sen ouvrir laccs, mais en nombre restreint et
selon des normes rgulirement tablies. En dautres termes, ni la puissance
de fait ne saurait suffire, ni mme cette forme dhrdi t, en pratique pourtant
si efficace, qui, autant que de la transmission des fortunes, dcoule de laide
apporte lenfant par des parents bien placs ; il faut encore quavantages
sociaux comme hrdit soient reconnus en droit. Traitons-nous aujourdhu i,
sinon par ironie, nos grands bourgeois de noblesse capitaliste ? L mme o,
comme dans nos dmocraties, les privilges lgaux ont disparu, cest leur
souvenir qui nourrit la conscience de classe : point de noble p.396 authentique,
sil ne peut en prouv er lexercice par ses anctres. Or en ce sens, qui est le
seul lgitime, la noblesse ne fut, en Occident, quune apparition relativement
tardive. Les premiers linaments de linstitution ne commencrent pas se
dessiner avant le XIIe sicle. Elle se fixa seulement au sicle suivant, alors que
fief et vassalit taient dj sur leur dclin. Le premier ge fodal tout entier,
avec lpoque immdiatement antrieure, lavait ignore.
p.395
Par l, il sopposait aux civilisations dont il avait reu le legs lointain. Le
Bas-Empire avait eu lordre snatorial auquel, sous les premiers
Marc BLOCH La socit fodale
270
Mrovingiens, malgr leffacement des privilges juridiques dantan, les
principaux parmi les sujets romains du roi franc taient encore si fiers de
rattacher leur gnalogie. Chez beaucoup de peuples germains, il avait exist
certaines familles qualifies, officiellement, de nobles : en langue vulgaire
edelinge, que les textes latins rendent par nobiles et qui, en
franco-bourguignon, survcut longtemps sous la forme adelenc. Elles
jouissaient, ce titre, davantages prcis, notamment dun prix du sang plus
lev ; leurs membres, comme disent les documents anglo-saxons, taient
ns plus chers que les autres hommes. Issues, selon toute apparence,
danciennes lignes de chefs locaux les princes de cantons , dont parle
Tacite , la plupart dentre elles, l o ltat prit la forme monarchique,
avaient t peu peu dpossdes de leur pouvoir politique au profit de la
dynastie royale sortie, originellement, de leurs rangs. Elles nen gardaient pas
moins plus dune trace de leur primitif prestige de races sacres.
Mais ces distinctions ne survcurent pas lpoque des royaumes
barbares. Parmi les lignages d edelinge, beaucoup, sans doute, steignirent de
bonne heure. Leur grandeur mme en faisait la cible prfre des vengeances
prives, des proscriptions et des guerres. Saxe part, ils taient, ds la priode
qui suivit immdiatement les invasions, trs peu nombreux : quatre seulement,
par exemple, chez les Bavarois du VIIe sicle. Chez les Francs, supposer, ce
quon ne saurait prouver, que, l aussi, cette aristocratie du sang et t
reprsente une poque ancienne, elle avait disparu, avant nos premiers
monuments crits. De mme, lordre p.397 snatorial ne constituait qu une
oligarchie clairseme et fragile. Or ces castes, qui tiraient leur orgueil
dantiques rminiscences, ne se renouvelaient naturellement plus. Dans les
nouveaux royaumes, les motifs vivants dingalit parmi les hommes libres
taient dun tout autre type : la richesse avec son corollaire, la puissance ; et le
service du roi. Lun et lautre attribut, pour passer souvent, en pratique, du
pre au fils, nen laissaient pas moins la voie ouverte des ascensions ou des
dchances pareillement brusques. Par une restriction de sens hautement
significative, en Angleterre, depuis le IXe ou le Xe sicle, seuls les proches du
roi conservent le droit au nom d aetheling.
Aussi bien lhistoire des familles dominantes, au premier ge fodal, na
pas de caractre plus frappant que la brivet de leur gnalogie. Du moins si
lon saccorde rejeter, avec les fables imagines par le moyen ge lui -mme,
les conjectures ingnieuses, mais fragiles, que de nos jours divers rudits ont
chafaudes sur de trop hypothtiques rgles de transmission des noms
propres. Des Welfs, par exemple, qui, aprs avoir jou un rle considrable
dans la France Occidentale, portrent, de 888 1032, la couronne de
Bourgogne, le plus ancien anctre connu est un comte bavarois, dont Louis le
Pieux pousa la fille. La ligne des comtes de Toulouse surgit sous Louis le
Pieux ; celle des marquis dIvre, plus tard rois dItalie, sous Charles le
Chauve ; des Liudolfingiens, ducs de Saxe, puis rois de France Orientale et
empereurs, sous Louis le Germanique. Les Bourbons, issus des Captiens,
Marc BLOCH La socit fodale
271
sont probablement aujourdhui la plus vieille dynastie de lEurope ; des
origines de leur aeul, Robert le Fort, qui, tu en 866, comptait dj parmi les
magnats de la Gaule, que savons-nous cependant ? tout juste le nom de son
pre et que peut-tre il avait du sang saxon (240). Comme si, inluctablement,
une fois atteint ce fatal tournant de lan 800, lobscurit faisait loi. Encore
sont-ce l des maisons particulirement antiques et qui, de prs ou de loin, se
rattachaient ces lignages, issus pour la plupart de lAustrasie ou de
lOutre -Rhin, auxquels les premiers Carolingiens avaient confi les principaux
commandements, par tout lEmpire. Dans lItalie du Nord, au p.398 XIe sicle,
les Attonides tenaient, sur de larges espaces, monts et plaines ; ils
descendaient dun certain Siegfried, lequel, possesseur de biens importants
dans le comt de Lucques, tait mort peu avant 950 ; au-del, plus rien qui se
laisse saisir. Le milieu du Xe sicle est galement le moment o apparaissent
brusquement les Zhringen souabes, les Babenberg, vritables fondateurs de
lAutriche, les sires dAmboise... Que si nous passions de modestes lignes
seigneuriales, ce serait une poque bien plus basse encore que le fil se
romprait entre nos mains.
Or, il ne suffit point ici dincriminer le mauvais tat de nos sources.
Assurment, si les chartes des IXe et Xe sicles taient moins rares, nous
dcouvririons quelques filiations de plus. Mais ltonnant est que no us ayons
besoin de ces documents de hasard. Les Liudolfingiens, les Attonides, les sires
dAmboise, entre autres, ont eu, du temps de leur grandeur, leurs historiens.
Comment se fait-il que ces clercs naient rien su ou rien voulu nous dire des
aeux de leurs matres ? En vrit, transmises durant des sicles par une
tradition purement orale, les gnalogies des paysans de lIslande nous sont
beaucoup mieux connues que celles de nos barons mdivaux. Autour de
ceux-ci, visiblement, on ne sintressait la suite des gnrations que depuis
le moment, lordinaire relativement rcent, o lune delles stait pousse,
pour la premire fois, un rang vraiment lev. On avait sans doute quelques
bonnes raisons de penser que, par-del cette date lue, lhistoir e du lignage
net rien offert de bien reluisant : soit quil ft en effet parti dassez bas la
clbre maison normande des Bellme avait, semble-t-il, pour anctre un
simple arbaltrier de Louis dOutre -Mer (241) soit, plus souvent, quil ft
demeur longtemps demi cach dans la foule de ces petits possesseurs de
seigneuries, dont nous verrons plus loin quels problmes soulve leur origine,
en tant que groupe. Cependant la principale raison dun silence, en apparence,
si trange tait que ces puissants ne formaient pas une classe noble, au sens
plein du mot. Qui dit noblesse, dit quartiers. En lespce les quartiers
nimportaient point, parce quil ny avait pas de noblesse.
II. Des divers sens du mot noble , au premier ge fodal
Marc BLOCH La socit fodale
272
Ce nest pas dire, pourtant, que du Xe au XIe sicle, le mot de
noble (en latin nobilis) ne se rencontre assez souvent dans les documents.
Mais il se bornait marquer, en dehors de toute acception juridique prcise,
une prminence de fait ou dopinion, selon des critres presque chaque fois
variables. Il comporte, presque toujours, lide dune distinction de naissance ;
mais aussi celle dune certaine fortune. Voyez comment, glosant au VII Ie
sicle un passage de la Rgle de saint Benot, Paul Diacre, ordinairement plus
clair, hsite entre ces deux interprtations et sy embrouille (242). Trop
mouvants pour souffrir des dfinitions prcises, ces emplois, ds le dbut de
lre fodale, rpondaient du moins q uelques grandes orientations, dont les
vicissitudes mmes sont instructives.
p.399
En des jours o tant dhommes devaient accepter de tenir leurs terres dun
seigneur, le seul fait dchapper cette sujtion semblait un signe de
supriorit. On ne saurait donc stonner si la possession dun alleu celui-ci
net -il que la nature dun simple bien paysan fut considre parfois
comme un titre suffisant au nom de noble ou d edel. Il est remarquable,
dailleurs, que dans la plupart des textes o figurent, avec c e qualificatif, de
petits alleutiers, on ne les voit sen parer que pour labdiquer aussitt, en se
faisant tenanciers ou serfs dun puissant. Si lon ne rencontre plus gure,
depuis la fin du XIe sicle, de ces nobles -l, lesquels ntaient, en ralit ,
que dassez humbles gens, la cristallisation qui sopra alors, selon des lignes
toutes diffrentes, dans lide de noblesse nen fut pas la seule raison. La
catgorie sociale elle-mme, dans une grande partie de lOccident, avait
presque tout entire pri, par extinction.
Dinnombrables esclaves, lpoque franque, avaient reu leur libert.
Naturellement, ces intrus ntaient pas aisment accepts comme gaux par
les familles de tout temps exemptes de la tare servile. Au libre , qui pouvait
tre un ancien esclave affranchi ou le descendant, encore p.400 tout proche,
dun affranchi, les Romains nagure avaient oppos le pur ingnu ; mais
dans le latin de la dcadence, les deux mots taient devenus presque
synonymes. Une race sans macule, ntait -ce pas cependant une vritable
noblesse, au sens vague quavait ordinairement ce terme ? tre noble, cest
ne compter parmi ses anctres personne qui ait t soumis la servitude.
Ainsi sexprimait encore, vers le dbut du X Ie sicle, une glose italienne,
systmatisant un usage dont on trouve ailleurs plus dune trace (243). L non
plus, lemploi ne survcut pas aux transformations des classifications
sociales ; pour la plupart, les hritiers des anciens affranchis, comme on la
vu, ne tardrent pas redevenir tout simplement des serfs.
Cependant il se trouvait, mme parmi les petits, des individus qui, sujets
dun seigneur quant leur terre, nen avaient pas moins su conserver leur
libert personnelle. Invitablement, une qualit devenue si rare
sattachait le sentiment dune honorabilit particulire, quil ntait pas
contraire aux habitudes du temps de nommer noblesse . De fait, quelques
textes, et l, semblent incliner vers cette quivalence. Mais celle-ci ne
Marc BLOCH La socit fodale
273
pouvait tre absolue. Nobles, la masse des hommes dits libres, dont beaucoup
en tant que tenanciers, taient astreints de lourdes et humiliantes corves ?
Lide, pour simposer lopinion commune, rpugnait par trop limage que
celle-ci se faisait des valeurs sociales. La synonymie, fugitivement entrevue,
entre les mots de nobles et de libres ne devait laisser de traces durables
que dans le vocabulaire dune forme spciale de subordination, la vassalit
militaire. A la diffrence de beaucoup de dpendants, ruraux ou domestiques,
la fidlit des vassaux ne shritait point et leurs services taient minemment
compatibles avec la plus pointilleuse notion de la libert : parmi tous les
hommes du seigneur, ils furent ses francs hommes par excellence ;
au-dessus des autres fiefs, leurs tenures mritrent, nous le savons, le nom de
francs-fiefs . Et comme, dans la foule bigarre qui vivait lombre du chef,
leur rle de suivants darmes et de conseillers leur donnait figure
daristocrati e, on les vit aussi se distinguer de cette foule par le beau nom de
noblesse. La p.401 petite glise que les religieux de Saint-Riquier, vers le milieu
du IXe sicle, rservaient aux dvotions du personnel vassalique entretenu la
cour abbatiale, portait le nom de chapelle des nobles , par opposition
celle du peuple vulgaire o les artisans et les bas officiers, galement
groups autour du clotre, coutaient la messe. Dispensant de service dost les
tenanciers des moines de Kempten, Louis le Pieux spcifiait que cette
exemption ne sappliquait point aux plus nobles personnes , pourvues de
bienfaits par labbaye (244). De toutes les acceptions du terme, celle-ci, qui
tendait confondre les deux notions de vassalit et de noblesse, tait promise
au plus long avenir.
A un degr plus haut, enfin, il pouvait, ce mot passe-partout, servir
mettre part, dans le nombre des hommes qui ntaient ni de naissance servile
ni engags dans des liens dhumble dpendance, les f amilles les plus
puissantes, les plus anciennes, le mieux pourvues de prestige. Ny a -t-il plus
de nobles dans le royaume ? disaient, au tmoignage dun chroniqueur, les
magnats de la France Occidentale, lorsquils voyaient Charles le Simple se
guider en tout sur les conseils de son favori Haganon (245). Or ce parvenu, pour
mdiocre que ft son origine au regard des grands lignages comtaux, ntait
certainement pas dun rang moins lev que les guerriers domestiques
auxquels Saint-Riquier ouvrait sa capella nobilium. Mais lpithte alors
voquait-elle jamais autre chose quune supriorit relative ? Il est significatif
quon la trouve volontiers employe au comparatif nobilior, plus noble
que le voisin.
Cependant, au cours du premier ge fodal, ses usages les plus modestes
allrent peu peu seffaant ; et lon tendit de plus en plus la rserver ces
groupes de puissants auxquels les troubles des tats et la gnralisation des
liens de protection avaient permis de se hausser, dans la socit, une
prpondrance croissante. Ctait avec un sens bien lche encore, tranger
toute prcision de statut ou de caste. Mais non sans un sentiment trs fort de la
suprmatie du rang, ainsi qualifi. Certainement limage dun ordre
Marc BLOCH La socit fodale
274
hirarchique vigoureusement ressenti hantait les esprits de ces participants
un pacte de paix qui, en 1023, juraient de ne p.402 pas assaillir les nobles
femmes ; point ntait question des autres (246). En un mot, si la noblesse,
comme classe juridique, demeurait inconnue, il est, ds ce moment, au prix
dune lgre simplification de la terminologie, pleinement loisible de parler
dune classe sociale des nobles et, surtout peut -tre, dun genre de vie noble.
Car ctai t, principalement, par la nature des fortunes, lexercice du
commandement, les murs que cette collectivit se dfinissait.
III. La classe des nobles, classe seigneuriale
Classe terrienne, a-t-on dit parfois de cette classe dominante ? Si lon
entend par l que, pour lessentiel, ses membres tiraient leurs revenus dune
matrise exerce sur le sol, daccord. A quelle autre source, dailleurs,
eussent-ils pu les demander ? Encore faut-il ajouter que la perception de
pages, de droits de march, de redevances exiges dun groupe de mtiers ne
figuraient certes point, l o cela tait possible, parmi les biens les moins
recherchs. Le trait caractristique rsidait dans la forme de lexploitation. Si
les champs ou, beaucoup plus exceptionnellement, la boutique ou latelier
nourrissaient le noble, ctait toujours grce au travail dautres hommes. Il
tait, en dautres termes, avant tout un seigneur. Ou du moins, si tous les
personnages dont le genre de vie peut tre qualifi de nobiliaire navaient pas
la chance de possder des seigneuries quon songe aux vassaux entretenus
dans la maison du chef ou aux cadets, vous souvent un vritable
nomadisme guerrier , quiconque tait seigneur se classait, par l mme,
dans la couche suprieure de la socit.
Or un problme ici surgit, obscur entre tous ceux que pose la gense de
notre civilisation. Des lignages seigneuriaux, un certain nombre, sans doute,
descendaient daventuriers partis de rien, hommes darmes devenus, au
dpens de la fortune du chef, ses vassaux fieffs. Dautres, peut -tre, avaient
pour anctres quelques-uns de ces riches paysans dont la transformation en
rentiers de groupes de tenures sentrevoit travers certains documents du Xe
sicle. Tel ntait pourtant pas, assurment, le cas le plus gn ral. La p.403
seigneurie, dans une grande partie de lOccident, tait, avec des formes,
lorigine, plus ou moins rudimentaires, chose trs vieille. Brasse et rebrasse
tant quon voudra, il faut bien quen elle -mme la classe des seigneurs nait
pas eu une anciennet moindre. Parmi les personnages auxquels les manants
des temps fodaux devaient redevances et corves, qui nous dira jamais
combien auraient pu, sils lavaient su, inscrire dans leur arbre gnalogique
les mystrieux ponymes de tant de nos villages le Brennos de Bernay, le
Cornelius de Cornigliano, le Gundolf de Gundolfsheim, lAelfred
dAlversham ou bien quelques-uns de ces chefs locaux de la Germanie,
que Tacite nous dpeint enrichis par les cadeaux des rustres ? Le fil
Marc BLOCH La socit fodale
275
chappe tout fait. Mais il nest pas impossible quavec lopposition
fondamentale entre les matres des seigneuries et le peuple innombrable des
tenanciers, nous ne touchions une des plus antiques lignes de clivage de nos
socits.
IV. La vocation guerrire
Si la possession de seigneuries tait la marque dune dignit vraiment
nobiliaire et, avec les trsors de monnaies ou de bijoux, la seule forme de
fortune qui part compatible avec un rang lev, ctait dabord en raison des
pouvoirs de commandement quell e supposait sur dautres hommes. Fut -il
jamais plus sr motif de prestige que de pouvoir dire : je veux ? Mais
ctait aussi que la vocation mme du noble lui interdisait toute activit
conomique directe. Il se devait corps et me sa fonction propre : celle du
guerrier. Ce dernier trait, qui est capital, explique la part que tinrent les
vassaux militaires dans la formation de laristocratie mdivale. Ils ne la
constiturent pas tout entire. Comment en et-on exclu les matres des
seigneuries alleutires, promptement assimils, dailleurs, par les murs, aux
vassaux fieffs et parfois plus puissants queux ? Les groupes vassaliques,
cependant, y figurrent bien llment de base. Ici encore lvolution du
vocabulaire anglo-saxon illustre admirablement le passage de la vieille notion
de la noblesse comme race sacre la notion nouvelle de noblesse par genre
de vie. p.404 L o les lois anciennes opposaient eorl et ceorl noble, au sens
germanique du nom, et simple homme libre les plus rcentes, conservant le
second terme de lantithse, remplacent le premier par des mots tels que
thegn, thegnborn, gesithcund : compagnon ou vassal avant tout le vassal
royal ou bien n de vassaux.
Non certes que le vassal ft le seul pouvoir, devoir et mme aimer se
battre. Comment en et-il t ainsi durant ce premier ge fodal, tout color,
du haut en bas de la socit, par le got ou la peur de la violence ? Les lois qui
devaient sefforcer de restreindre ou dinterdire le port ds armes par les classes
infrieures napparurent pas avant la seconde moiti du XI Ie sicle ; elles
concidrent la fois avec les progrs de la hirarchisation juridique et avec
un apaisement relatif des troubles. Caravanier, le marchand circulait, ainsi que
le met en scne une constitution de Frdric Barberousse, lpe sur la
selle ; une fois rentr son comptoir, il conservait les habitudes contractes
au cours de cette vie daventures qutait alors le ngoce. De beaucoup de
bourgeois, aux temps de la turbulente renaissance urbaine, on pouvait dire,
comme Gilbert de Mons faisait de ceux de Saint-Trond, quils taient trs
puissants dans les armes . Dans la mesure o il nest pas purement
lgendaire, le type traditionnel du boutiquier ennemi des coups rpond
lpoque du commerce stable, oppos lantique nomadisme des pieds
poudreux : chose du XIIIe sicle, au plus tt. Si peu nombreuses, par
Marc BLOCH La socit fodale
276
ailleurs, que fussent les armes mdivales, leur recrutement ne se borna
jamais llment nobiliaire. Le seigneur levait se s fantassins parmi ses
manants. Et si, partir du XIIe sicle, on vit les obligations militaires de
ceux-ci se restreindre de plus en plus, si, en particulier, la limitation, trs
frquente, de la dure de prsence lespace dun jour eut pour effet de
cantonner lemploi des contingents ruraux dans de simples oprations de
police locale, cette transformation fut exactement contemporaine de
laffaiblissement du service mme des fiefs. Les piquiers ou archers paysans
ne cdrent pas alors la place aux vassaux. Ils furent rendus inutiles par
lappel aux mercenaires, qui, au mme moment, permettait de parer aux
insuffisances p.405 de la chevalerie fieffe. Mais vassal ou mme, l o il en
existait encore, seigneur alleutier, le noble des premiers temps fodaux, en
face de tant de soldats doccasion, avait pour caractristique propre dtre un
guerrier mieux arm et un guerrier professionnel.
Il combattait cheval ; ou du moins, si daventure, durant laction, on le
voyait mettre pied terre, il ne se dplaait que mont. En outre, il combattait
avec lquipement intgral. Offensif : la lance et lpe, quelquefois la masse
darmes. Dfensif : le heaume qui protgeait la tte ; puis, recouvrant le corps,
un vtement en tout ou partie mtallique ; au bras, enfin, le bouclier,
triangulaire ou rond. Ce ntait pas le cheval seul qui, proprement parler,
faisait le chevalier. Nen fallait -il pas aussi son plus humble compagnon,
lcuyer, charg de soigner les btes et de mener, le long de la route, les
montures de rechange ? Parfois mme, les armes comportaient, ct de la
pesante cavalerie chevaleresque, des cavaliers plus lgrement quips quon
nommait ordinairement sergents . Ce qui caractrisait la plus haute classe
des combattants tait lunion d u cheval et de larmement complet.
Les perfectionnements de ce dernier, depuis lpoque franque, en le
rendant la fois plus coteux et plus difficile manier, avaient ferm de plus
en plus rigoureusement laccs de cette faon de faire la guerre qui ntait
pas riche, ou fidle dun riche, et homme de mtier. Tirant de ladoption de
ltrier toutes ses consquences, on abandonna, vers le Xe sicle, la courte
haste de nagure, brandie bout de bras, comme un dard, pour lui substituer la
longue et lourde lance moderne, que le guerrier, dans le corps corps,
maintenait sous laisselle et, au repos, appuyait sur ltrier mme. Au heaume
sadjoignit le nasal, plus tard la visire. La brogne , enfin, sorte de
combinaison de cuir ou dtoffe, sur laquell e on cousait des anneaux ou des
plaques de fer, cda la place au haubert, peut-tre imit des Arabes ; tout
entier tissu de mailles mtalliques, il tait dune fabrication beaucoup plus
dlicate, lors mme quil ne fallait pas limporter. Peu peu, daill eurs, le
monopole de classe, qui avait dabord t impos par de simples ncessits
pratiques, commena passer dans le droit. Aux p.406 officiers seigneuriaux
quils sappliquaient maintenir dam une sage mdiocrit, les moines de
Beaulieu, peu aprs 970, interdisaient le port du bouclier et de lpe ; ceux de
Marc BLOCH La socit fodale
277
Saint-Gall, vers le mme moment, reprochaient leurs maires davoir de trop
belles armes (247).
Or reprsentons-nous, dans son essentielle dualit, une troupe de ce temps.
Dun ct, une pitaille mal outille pour attaquer comme pour se dfendre,
lente courir lassaut comme fuir, rapidement reinte par de longs
cheminements sur les mauvaises pistes ou travers champs. De lautre,
regardant du haut de leurs coursiers les pauvres diables, qui, vilainement
comme dit un roman courtois, tranent leurs pas dans la boue et la poussire,
de solides soldats, fiers de pouvoir se battre et manuvrer promptement,
savamment, efficacement : la seule force, en vrit, dont, nous dit le biographe
du Cid, il vaille la peine dtablir le compte, lorsquon dnombre une
arme (248). Dans une civilisation o la guerre tait chose de tous les jours,
point de contraste plus vivant que celui-l. Devenu quasi synonyme de vassal,
chevalier devint aussi lquivalent de noble. Plus dun texte,
rciproquement, lve la valeur dun terme presque juridique, pour
lappliquer aux petites gens, le nom mprisable de pedones, fantassins
oserons-nous traduire : pousse-cailloux ? Chez les Francs, dit lmir arabe
Ousma, toute prminence appartient aux cavaliers. Ceux-ci sont vraiment
les seuls hommes qui comptent. A eux, de donner des conseils ; eux, de
rendre la justice (249).
Or, au regard dune opinion qui avait de bonnes raisons pour estimer trs
haut la force, sous ses aspects les plus lmentaires, comment le combattant
par excellence net -il pas t le plus redout, recherch et respect des
hommes ? Une thorie alors trs rpandue reprsentait la communaut
humaine comme divise en trois ordres : ceux qui prient, ceux qui se
battent, ceux qui travaillent. Ctait, dun accord unanime, pour mettre le
second fort au-dessus du troisime. Mais le tmoignage de lpope v a plus
loin encore : le soldat nhsitait gure tenir sa mission pour suprieure
celle mme du spcialiste de la prire. Lorgueil est un des ingrdients
essentiels de toute conscience de classe. Celui des p.407 nobles de lre
fodale fut, avant tout, un orgueil guerrier.
Aussi bien la guerre, pour eux, ntait -elle pas seulement un devoir
occasionnel : envers le seigneur, le roi, la ligne. Elle reprsentait bien
davantage : une raison de vivre.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
278
CHAPITRE II
La vie noble
I. La guerre
p.409 Bien me plat le gai temps de Pques qui fait feuilles et fleurs venir ; et me
plat dour la joie des oiseaux qui font retentir leurs chants par le bocage. Mais me
plat aussi quand je vois, parmi les prs, tentes et pavillons dresss ; et jai grande
allgresse quand je vois, par la campagne rangs, chevaliers et chevaux arms ; et
me plat quand les coureurs font fuir les gens avec le btail ; et me plat quand je vois
leur suite une grande masse dhommes darmes ens emble venir ; et me plat en mon
cur quand je vois forts chteaux assigs et les palissades rompues et effondres et
larme, sur le rivage, toute entoure de fosss, avec une ligne de forts pieux tresss....
Masses darmes, pes, heaumes de couleur, cus, nous les verrons tranchs et en
pices ds lentre du combat et maints vassaux frapps ensemble, par o erreront
laventure les chevaux des morts et des blesss. Et quand au combat on sera entr,
que tout homme de bon lignage ne pense plus qu briser tte et bras ; car mieux vaut
mort que vivant vaincu. Je vous le dis, je ne trouve point autant de saveur dans le
manger, le boire, ni le dormir qu entendre le cri A eux ! slever des deux parts, le
hennissement des chevaux vides de cavaliers sous lombrage et les appels Au secours !
Au secours ! ; qu voir tomber, par -del les fosss, grands et petits sur lherbe ; qu
voir enfin les morts qui, dans leurs flancs, ont encore les tronons des lances, avec leurs
pennons.
Ainsi chantait, dans la seconde moiti du XIIe sicle, un troubadour, quil
faut probablement identifier avec le hobereau prigourdin Bertrand de
Born (250). La prcision visuelle et le bel lan, qui tranchent avec la fadeur
dune posie ordinairement plus convenue, sont la part dun p.410 talent
au-dessus du commun. Le sentiment, par contre, navait rien dexceptionnel :
tmoin mainte autre pice, issue du mme milieu, o il sexprime, avec moins
de brio sans doute, mais une spontanit gale. Dans la guerre frache et
joyeuse , comme devait dire, de nos jours, quelquun qui tait destin la
voir de moins prs, le noble aimait dabord le dploiement dune force
physique de bel animal, savamment entretenue par des exercices constants,
commencs ds lenfance. Rptant le vieux proverbe carolingien, qui, sans
monter cheval est, jusqu douze ans, rest lcole, nest plus bon qu
faire un prtre , dit un pote allemand (251). Les interminables rcits de
combats singuliers dont lpope est pleine sont dloquents documents
psychologiques. Le lecteur daujourdhui, que leur monotonie assomme, a
peine se persuader que lauditeur dantan y ait pu prendre, visiblement, ta nt
de plaisir ; attitude dhomme de cabinet vis --vis du rcit de comptitions
sportives ! Dans les uvres dimagination comme dans les chroniques, le
portrait du bon chevalier insiste avant tout sur ses qualits dathlte : il est
Marc BLOCH La socit fodale
279
ossu , membru , le corps bien taill et balafr dhonorables
cicatrices, les paules larges, large aussi ainsi quil convient un homme
de cheval lenfourchure . Et comme cette vigueur doit tre nourrie, il
nest pas jusqu un robuste apptit qui ne semble la m arque du preux. Dans la
vieille Chanson de Guillaume, aux rsonances si barbares, coutez Dame
Guibourc qui, aprs avoir servi la grande table du chteau le jeune Girart,
neveu de son poux, sadresse ce dernier :
Par Dieu ! beau sire ! celui-l est bien de votre ligne,
Qui mange ainsi un grand cuissot de porc
Et en deux traits boit un setier de vin ;
Bien dure guerre doit-il faire son voisin (252).
Un corps souple et muscl, il est presque superflu de le dire, ne suffit
pourtant pas faire le chevalier idal. Encore faut-il quil sy ajoute le
courage. Et cest aussi parce quelle fournit cette vertu loccasion de se
manifester que la guerre met tant dallgresse au cur dhommes pour qui
laudace et le mpris de la mort sont, en quelque sorte, des valeurs p.411
professionnelles. Assurment cette vaillance nexclut pas toujours les
paniques affoles on en a vu lexemple devant les Vikings , ni surtout
lappel des ruses de primitifs. Que cependant la classe cheval eresque ait su
se battre, lhistoire, l -dessus, est daccord avec la lgende. Son indiscutable
hrosme se nourrissait de bien des lments divers, tour tour alternant :
simple dtente physique dun tre sain ; rage dsespre le sage Olivier
lui-mme, lorsquil se sent navr mort , ne frappe de si terribles coups
quafin de se venger tout son saoul ; dvouement un chef ou, lorsquil
sagit de la Guerre Sainte, une cause ; passion de gloire, personnelle ou
collective ; vis--vis de linluctable destin, cette acceptation fataliste dont la
littrature noffre point de plus poignants exemples que quelques chants parmi
les derniers du Nibelungenlied ; espoir, enfin, des rcompenses de lautre
monde, assures, non seulement qui meurt pour son Dieu, mais aussi qui
meurt pour son matre.
Habitu ne pas redouter le danger, le chevalier trouvait dans la guerre un
autre charme encore : celui dun remde contre lennui. Car pour ces hommes
dont la culture longtemps demeura rudimentaire et qui quelques hauts
barons et leur entourage mis part ntaient gure occups par de bien
lourds soucis dadministration, la vie courante versait aisment dans une grise
monotonie. Ainsi naquit un apptit de diversions qui, lorsque le sol natal
manquait lui offrir une pture suffisante, cherchait se satisfaire dans les
terres lointaines. Attach exiger de ses vassaux un exact service, Guillaume
le Conqurant disait de lun deux, dont il venait de confisquer les fiefs pour
le punir davoir os, sans son autorisation, partir pour la croisade dEspagne :
Je ne crois pas quil se puisse rencontrer, sous les armes, un meilleur
chevalier ; mais il est inconstant, prodigue et passe son temps courir
travers pays (253). De combien dautres et -il pu rpter le mme mot ? Cette
humeur nomade fut, sans conteste, particulirement rpandue chez les
Marc BLOCH La socit fodale
280
Franais. Ctait que leur patrie ne leur offrait pas, comme lEspagne demi
musulmane, ou, un moindre degr, lAllemagne avec sa frontire slave, des
terrains de p.412 conqutes ou de razzias tout proches ; ni, comme lAllemagne
encore, les contraintes et les plaisirs des grandes expditions impriales.
Probablement aussi, la classe chevaleresque y tait plus quailleurs
nombreuse, partant ltroit. En France mme, on a souvent observ que la
Normandie fut, de toutes les provinces, la plus riche en hardis aventuriers.
Dj lAllemand Otton de Freising parlait de la gent trs inquite des
Normands . Hritage du sang des Vikings ? Peut-tre. Mais surtout effet de
la paix relative que, dans cette principaut remarquablement centralise, les
ducs firent rgner de bonne heure : force tait daller qurir au dehors
loccasion des coups dpe souhaits. La Flandre, o les condition s politiques
ntaient pas trs diffrentes, fournit aux prgrinations guerrires un
contingent presque gal.
Ces chevaliers errants le mot est du temps (254) aidrent en Espagne
les chrtiens indignes reconqurir sur lI slam le Nord de la pninsule ;
crrent, dans lItalie du Sud, les tats normands ; sengagrent, ds avant la
premire croisade, comme mercenaires au service de Byzance, sur les chemins
de lOrient ; trouvrent, enfin, dans la conqute et la dfense du Tombeau du
Christ leur champ daction prfr. Quelle ft dEspagne ou de Syrie, la
Guerre Sainte noffrait -elle pas lattrait dune aventure double dune uvre
pie ? Plus nest besoin de mener dure vie dans le plus svre des ordres... ,
chante un troubadour ; par des faits qui donnent lhonneur, chapper du
mme coup lenfer : que demander de mieux (255) ? Ces migrations
contriburent maintenir les liaisons entre des mondes que sparaient des
distances si longues et de si vifs contrastes : elles propagrent, en dehors de
ses limites propres, la culture occidentale et surtout franaise. Na -t-elle pas
de quoi faire rver, par exemple, la destine dun Herv le Francopoule ,
pris par un mir, en 1057, alors quil comma ndait sur les bords du lac de
Van ? En mme temps, les saignes ainsi pratiques dans les groupes les plus
turbulents de lOccident pargnaient sa civilisation de prir touffe dans les
gurillas. Les chroniqueurs le savaient bien que toujours, au dpart dune
croisade, les vieux pays, retrouvant un peu de paix, respiraient mieux (256).
Obligation juridique, quelquefois, plaisir, souvent, la guerre pouvait
aussi tre impose au chevalier par le point dhonneur. Ne vit -on pas, au XIIe
sicle, le Prigord ensanglant parce quun seigneur, qui trouvait un de ses
nobles voisins lallure dun forgeron, eut le mauvais got de ne le point celer ?
(257). Mais elle tait encore et peut-tre surtout une source de profit. En vrit,
lindustrie nobiliaire par excellence.
p.413
On a cit plus haut les effusions lyriques de Bertrand de Born. Or, luimme ne faisait nul mystre des raisons moins glorieuses qui, par-dessus tout,
linclinaient ne point trouver de plaisir la paix . Pourquoi, dit-il quelque
part, souhait-je que les riches hommes sentre -hassent ? Cest quun
riche homme est bien plus noble, gnreux et accueillant en guerre quen
Marc BLOCH La socit fodale
281
paix. Et plus crment, lannonce des hostilits : Nous allons rire. Car les
barons nous aimeront bien... et sils veulent que nous restions avec eux, ils
nous donneront des barbarins (ctait une monnaie de Limoges). Mais ce
grand amour des combats a un autre motif encore : Trompette, tambours,
enseignes et pennons et tendards et chevaux blancs et noirs, voil ce
que nous verrons sous peu. Et le temps sera bon ; car nous prendrons leurs
biens aux usuriers et par les routes niront plus btes de somme, le jour,
en toute scurit ; ni bourgeois sans rien redouter, ni le marchand qui
chemine vers la France ; mais celui-l sera riche qui prendra de bon
cur. Le pote appartenait cette classe de petits possesseurs de fiefs de
vavasseurs , comme il se nomme lui-mme dont la vie au manoir
ancestral ne manquait pas seulement de gaiet ; elle ntait pas toujours trs
facile. La guerre y parait, en procurant les gnrosits des grands chefs et les
bonnes prises.
Envers les vassaux mmes quappelaient auprs de lui les plus stricts
devoirs du service, le souci de son prestige comme de son intrt bien entendu
commandait au baron de ne pas pargner les largesses. Voulait-on retenir les
hommes de fief au-del du temps fix, les emmener plus loin ou les requrir
plus souvent que la coutume, devenue de plus en plus rigoureuse, ne semblait
le permettre ? Force tait de p.414 redoubler de libralits. Enfin, devant
linsuffisance croissante des contingents vassaliques, il ne fut bientt plus
darme qui pt se passer du concours de cette masse er rante de guerroyeurs
sur lesquels sexerait si fortement lattrait de laventure, pourvu qu lespoir
des grands coups dpe sajoutt celui du gain. Cyniquement notre Bertrand
soffrait au comte de Poitiers. Je puis vous aider. Jai dj lcu au col et le
heaume en tte... Sans argent, cependant, comment me mettre en
campagne (258) ?
Mais parmi les dons du chef, le plus beau semblait assurment la
permission de faire du butin. Tel tait aussi le principal profit que, dans les
petites guerres locales, le chevalier, combattant pour lui seul, escomptait des
combats. Double butin dailleurs : dhommes et de choses. Sans doute la loi
chrtienne ne permettait plus de rduire les captifs en esclavage : tout au plus,
transplantait-on parfois de force quelques paysans ou artisans. Par contre, la
ranon tait dusage courant. Bon pour un souverain dur et sage, comme
Guillaume le Conqurant, de ne jamais relcher jusqu leur mort ses
ennemis, lorsquils taient tombs entre ses mains. Le commun des guerriers
ne voyait pas si loin. Universellement rpandue, la pratique du rachat avait
parfois des consquences plus atroces que lantique asservissement. Au soir
de la bataille, raconte le pote, qui certainement sinspirait de choses vues,
Girard de Roussillon et les siens massacrent la foule obscure des prisonniers et
des blesss npargnant que les possesseurs de chteaux , seuls capables de
se rdimer contre deniers sonnants (259). Quant au pillage, ctait,
traditionnellement, une source de gain si rgulire quaux poques familires
avec lcrit, les textes juridiques le mentionnent calmement comme tel : lois
Marc BLOCH La socit fodale
282
barbares et contrats dengagement militaire du XII Ie sicle se font cho
l-dessus, dun bout lau tre du moyen ge. De lourds chariots, destins
entasser le produit des prises, suivaient les armes. Le plus grave tait quune
suite de transitions, quasiment insensibles des mes assez simples, menait
des formes presque lgitimes de ces violences rquisitions indispensables
des armes dpourvues dintendance, reprsailles exerces contre lennemi ou
ses sujets p.415 jusquau pur brigandage, brutal et mesquin : marchands
dtrousss le long des routes ; moutons, fromages, poulets vols dans les
bergeries ou les basses-cours, comme le faisait, au dbut du XIIIe sicle, un
hobereau catalan, obstin molester ses voisins de labbaye du Canigou. Les
meilleurs contractaient dtranges habitudes. Guillaume le Marchal tait
assurment un preux chevalier. Cependant, alors que, jeune et sans terre, il
parcourait la France de tournois en tournois, comme il avait rencontr sur sa
route un moine qui senfuyait avec une fille noble et, par surcrot, avouait
candidement le dessein de placer son argent usure, il ne se fit aucun scrupule
de sapproprier, titre de chtiment pour des desseins si noirs, les deniers du
pauvre hre. Encore un de ses compagnons lui reprocha-t-il de ne stre point
empar aussi du cheval (260).
De pareilles murs supposaient, cela va de soi, un grand mpris de la vie
et de la souffrance humaine. La guerre de lge fodal navait rien dune
guerre en dentelles. Elle saccompagnait dusages qui ne nous paraissent
aujourdhui rien moins que courtois : tels, frquemment, le massacre ou la
mutilation des garnisons qui avaient rsist trop longtemps . Cela, parfois,
au mpris mme du serment. Elle comportait, comme un accessoire naturel, la
dvastation des terres ennemies. et l, un pote, comme celui de Huon de
Bordeaux, plus tard un pieux roi, comme Saint Louis, peuvent bien protester
contre ce gast des campagnes, gnrateur pour les innocents de misres
affreuses. Fidle interprte de la ralit, lpope, allemande comme franaise,
est pleine des images de pays qui fument la ronde. Point de vraie
guerre sans feu ni sang , disait le sincre Bertrand de Born (261).
En deux passages, dun paralllisme saisissant, le pote de Girard de
Roussillon et le biographe anonyme de lempereur Henri IV nous montrent ce
que le retour de la paix signifiait pour les pauvres chevaliers : la crainte du
mpris o dsormais les tiendront les grands, qui nauront plus besoin deux ;
les exigences des usuriers ; le lourd cheval de labour substitu lcumant
destrier, les perons de fer aux perons dor en un mot une crise
conomique et une p.416 crise de prestige (262). Pour le commerant, au
contraire, et pour le paysan, ctait la possibilit revenue de tra vailler, de se
nourrir, en bref de vivre. Donnons la parole, une fois de plus, lintelligent
trouvre de Girard de Roussillon. Proscrit et repentant, Girard, avec sa femme,
erre travers pays. A des marchands quils rencontrent, la duchesse croit sage
de persuader que le banni, dont ils pensaient reconnatre les traits, nest plus :
Girard est mort ; je lai vu mettre en terre Dieu soit lou ! ,
rpondent les marchands, car il faisait toujours la guerre et par lui nous
Marc BLOCH La socit fodale
283
avons souffert bien des maux. A ces mots, Girard se rembrunit ; sil avait eu
son pe, il aurait frapp lun deux . pisode vcu, par o sillustre
lantithse qui dfinissait les classes. Elle tait double tranchant. Car le
chevalier, du haut de son courage et de son adresse, mprisait son tour le
peuple tranger aux armes, imbellis : vilains, qui, devant les armes, dtalaient
comme des cerfs ; plus tard bourgeois, dont la puissance conomique lui
paraissait dautant plus hassable quelle sobtenait par des moyen s la fois
mystrieux et directement opposs sa propre activit. Si le penchant aux
gestes de sang tait partout rpandu plus dun abb mme prit victime
dune haine de clotre , la conception de la guerre ncessaire, comme source
dhonneur et comme gagne-pain, tait bien ce qui mettait part la petite
socit des gens nobles .
II. Le noble chez lui
Elle avait cependant, cette guerre tant aime, ses mortes-saisons. Alors
mme, la classe chevaleresque se distinguait de ses voisines par un genre de
vie proprement nobiliaire.
A cette existence, nimaginons point forcment un cadre tout rustique.
Dans lItalie, la Provence, le Languedoc, subsistait lempreinte millnaire des
civilisations mditerranennes dont la structure avait t systmatise par
Rome. Traditionnellement, on y avait vu chaque petit peuple se grouper
autour dune ville ou bourgade, la fois chef -lieu, march et sanctuaire, par
suite demeure habituelle des puissants. Jamais plus, ceux-ci ne cessrent de
hanter les vieux p.417 centres urbains ; ils prirent part toutes leurs rvolutions.
Au XIIIe sicle, ce caractre citadin passait pour une des originalits des
noblesses mridionales. A la diffrence de lItalie, dit le Franciscain
Salimbene qui, n Parme, visita le royaume de Saint Louis, les villes de
France ne sont peuples que de bourgeois ; la chevalerie y habite sur ses
terres. Mais, vraie en gros du temps o crivait le bon frre, lantithse ne
let pas t au mme degr du premier ge fodal. Assurment, les villes
purement marchandes qui, surtout dans les Pays-Bas et lAllemagne
transrhnane, staient cres presque de toutes pices depuis le Xe ou le XIe
sicle Gand, Bruges, Soest, Lubeck et tant dautres ne comptaient gure
dans leurs murs, comme caste dominante, que des hommes enrichis par le
ngoce. Encore la prsence dun chtelain princier y entretenait -elle parfois un
petit personnel de vassaux non chass ou qui venaient accomplir
rgulirement leur tour de service. Par contre, dans les anciennes cits
romaines telles que Reims ou Tournai des groupes de chevaliers
semblent avoir longtemps vcu, dont beaucoup sans doute taient attachs aux
cours piscopales ou abbatiales. Ce fut seulement peu peu et par suite dune
diffrenciation plus pousse des classes que les milieux chevaleresques, en
dehors de lItalie ou de la France mridionale, devinrent presque entirement
Marc BLOCH La socit fodale
284
trangers la vie des populations proprement urbaines. Si le noble,
assurment, na pas renonc frquenter la ville, il ny parat plus g ure
quoccasionnellement, appel par son plaisir ou par lexercice de certaines
fonctions.
Tout contribuait dailleurs le rejeter vers la campagne : lhabitude, de
plus en plus rpandue, de rmunrer les vassaux au moyen de fiefs, constitus,
dans lim mense majorit des cas, par des seigneuries rurales ;
laffaiblissement des obligations fodales, qui favorisait, chez les suivants
darmes dsormais chass , la tendance vivre chacun chez soi, loin des
rois, des hauts barons et des vques, seigneurs des villes ; jusquau got,
enfin, du plein air, naturel ces sportifs. Nest -elle pas mouvante lhistoire,
raconte par un religieux allemand, de ce fils de comte qui, vou par les siens
ltat monastique et soumis, pour la premire fois, la p.418 dure rgle de la
clture, se hissa, ce jour-l, sur la plus haute tour du monastre, afin de
repatre du moins son me vagabonde du spectacle des monts et des champs
quil ne lui tait dsormais plus permis de parcourir (263) ? La pression des
bourgeoisies, fort peu dsireuses dadmettre dans leurs communauts des
lments indiffrents leurs activits et leurs intrts, prcipita le
mouvement.
Cependant, quelques correctifs quil faille ainsi apporter au tableau dune
noblesse, ds lorigine, exclusivement rurale, il nen est pas moins vrai que,
depuis quil existait des chevaliers, la plupart dentre eux et en nombre
croissant dans le Nord, beaucoup mme dans les pays riverains de la
Mditerrane avaient comme rsidence ordinaire un manoir champtre. La
maison seigneuriale slve le plus souvent dans une agglomration ou sa
proximit. Parfois, il en est plusieurs dans le mme village. Elle se distingue
nettement des chaumines environnantes comme dailleurs, dans le s villes,
des habitations des humbles non seulement parce quelle est mieux btie,
mais surtout parce quelle est, presque toujours, organise pour la dfense.
Le souci, chez les riches, de mettre leurs demeures labri dune attaque
tait naturellement aussi ancien que les troubles mmes. Tmoins, ces villae
fortifies dont lapparition, vers le I Ve sicle, dans les campagnes de la Gaule,
atteste le dclin de la paix romaine. La tradition sen peut suivre, et l,
lpoque franque. Cependant, la pl upart des cours , habites par les riches
propritaires, et jusquaux palais royaux eux -mmes restrent longtemps peu
prs dpourvus de moyens de dfense permanents. Ce furent les invasions
normandes ou hongroises qui, de lAdriatique aux plaines de l Angleterre
septentrionale, firent se lever, de tous cts, avec les remparts des villes,
rpars ou rebtis, les ferts rurales dont lombre ne devait plus cesser de
peser sur les champs de lEurope. Les guerres intestines ne tardrent pas les
multiplier. Le rle des grands pouvoirs, royaux ou princiers, dans ce
hrissement de chteaux, leurs efforts pour en contrler la construction nous
occuperont plus tard. Ils nont pas nous retenir pour linstant. Car, disperses
par monts et par vaux, les maisons fortes des petits p.419 seigneurs avaient t
Marc BLOCH La socit fodale
285
tablies, presque toujours, en dehors de toute autorisation venue den haut.
Elles rpondaient des besoins lmentaires, spontanment ressentis et
satisfaits. Un hagiographe en a rendu un compte fort exact, encore que dans
un esprit dpourvu de sympathie : pour ces hommes constamment occups
de querelles et de massacres, sabriter des ennemis, triompher de leurs gaux,
opprimer leurs infrieurs (264). En un mot, se protger et dominer. Ces
difices taient gnralement dun type trs simple. Le plus rpandu fut
longtemps, au moins hors des pays mditerranens, la tour de bois. Un curieux
passage des Miracles de saint Benot dcrit, vers la fin du XIe sicle, la
disposition, singulirement rudimentaire, de lune delles : au premier tage,
une salle o le puissant... avec sa mesnie, vivait, conversait, mangeait,
dormait ; au rez-de-chausse, le cellier provisions (265). Habituellement, un
foss se creusait au pied. Parfois une enceinte de palissades et de terre battue,
entoure son tour dun autre foss, courait quelque distance. Elle
permettait de mettre en scurit divers btiments dexploitation et la cuisine,
que le danger dincendie consei llait de placer lcart ; elle servait au besoin
de refuge aux dpendants ; elle vitait la tour un assaut immdiat et rendait
moins ais, vis--vis de ce rduit, lemploi du mode dattaque le plus efficace,
qui tait le feu. Mais il fallait, pour la garnir, disposer de plus de suivants
darmes que ne pouvait en entretenir le commun des chevaliers. Tour et
enceinte enfin se dressaient assez frquemment sur une motte, tantt naturelle,
tantt partiellement du moins leve de main dhomme. Nimportait -il
pas la fois dopposer lattaque lobstacle de la pente et de mieux surveiller
les environs ? Ce furent les magnats qui les premiers eurent recours la
pierre : ces riches hommes bastidors , que Bertrand de Born dpeint
prenant leur plaisir faire de chaux, de sable et de pierres de taille... portails
et tourelles, tours, votes et escaliers vis . Elle ne sintroduisit que
lentement, au cours du XIIe, voire du XIIIe sicle, dans les habitations des
petits et moyens chevaliers. Avant lachv ement des grands dfrichements, les
forts semblaient dexploitation plus facile et moins coteuse que les
carrires ; p.420 et, tandis que la maonnerie exigeait une main-duvre
spcialise, les tenanciers, corvables toujours prts, taient presque tous un
peu charpentiers en mme temps que bcherons.
Que, dans la petite forteresse seigneuriale, le paysan pt trouver
quelquefois une protection et un abri nest pas douteux. Lopinion des
contemporains avait cependant de bonnes raisons pour voir en elle, avant tout,
un dangereux repaire. Les institutions de paix, les villes soucieuses dtablir la
libert des communications, les rois ou les princes ne devaient pas avoir de
proccupations plus pressantes que dabattre les tours innombrables, dont tant
de tyranneaux locaux avaient couvert le plat pays. Et, quoi que lon en ait
dit, ce nest pas seulement dans les romans dAnne Radcliffe que, grands ou
petits, les chteaux avaient leurs oubliettes. Lambert dArdres, dcrivant la
tour de Tournehem, rebtie au XIIe sicle, na garde doublier les culs de
basse-fosse o les prisonniers, dans les tnbres, la vermine et lordure,
mangent le pain de douleur .
Marc BLOCH La socit fodale
286
Comme lindique la nature mme de sa demeure, le chevalier vit en tat de
perptuelle alerte. Personnage familier lpope comme la posie lyrique,
un guetteur, chaque nuit, veille sur la tour. Plus bas, dans les deux ou trois
pices de ltroite forteresse, cest tout un petit monde dhabitants permanents,
mls dhtes de passage, qui se coudoie en une constante promiscuit :
rsultat du manque de place, sans doute, mais aussi dhabitudes qui alors,
mme chez les plus grands, semblaient ncessaires toute existence de chef.
Le baron, littralement, ne respirait quentour de suivants qui hommes
darmes, valetaille, vassaux non chass, jeunes nobles remis comme
nourris ses soins le servaient, le gardaient, conversaient avec lui et,
lheure du sommeil enfin venue, continuaient le protger de leur prsence
jusquaux abords du lit conjugal. Il nest pas sant quun seigneur mange seul,
enseignait-on encore dans lAngleterre du XII Ie sicle (266). Dans la grande
salle, les tables taient longues et les siges avaient presque exclusivement la
forme de bancs, faits pour le cte cte. Sous lescalier les pauvres
tablissaient leur gte. L moururent p.421 deux pnitents illustres, saint Alexis,
dans la lgende, le comte Simon de Crpy, dans lhistoire. Ces murs,
contraires tout recueillement, taient, en ce temps, gnrales ; les moines
mmes avaient des dortoirs, non des cellules. Elles expliquent certaines fuites
vers les seules formes de vie qui permissent alors de goter la solitude : celles
de lermite, du reclus, de lerrant. Chez les nobles, elles se raccordaie nt une
culture o les connaissances taient transmises beaucoup moins par le livre et
par ltude que par la lecture haute voix, la rcitation rythme et les contacts
humains.
III. Occupations et distractions
Pour habituellement campagnard quil ft par le logis, le noble navait
pourtant rien dun agriculteur. Mettre la main la houe ou la charrue et t
pour lui un signe de dchance, comme il advint au pauvre chevalier dont
nous entretient un recueil danecdotes. Et si on le voyait parfois se plaire
contempler les travailleurs dans les champs ou, sur ses terres, les moissons
jaunissantes, il ne semble point qu lordinaire, il diriget de bien prs la
culture (267). Les manuels du bon gouvernement domanial, lorsquo n en crira,
seront destins, non au matre, mais ses officiers, et le type du gentilhomme
rural appartient un tout autre temps, aprs la rvolution des fortunes du XVIe
sicle. Bien que les droits de justice dont il dispose sur ses tenanciers soient
une des sources essentielles de son pouvoir, le potentat de village,
gnralement, les exerce beaucoup moins en personne quil ne les dlgue
des sergents, eux-mmes dextraction paysanne. Cependant la pratique de la
juridiction est, sans nul doute, une des rares occupations pacifiques familires
au chevalier. Mais il ne sy adonne, le plus souvent, que dans le cadre de sa
classe : soit quil dcide des procs de ses propres vassaux ou quil sige
Marc BLOCH La socit fodale
287
comme juge de ses pairs la cour o la convoqu son seign eur de fief ; soit
encore, l o subsistent, comme en Angleterre ou en Allemagne, des justices
publiques, quil prenne place au tribunal de comt ou de centaine. Cen tait
assez pour faire de lesprit p.422 juridique une des formes de culture le plus
prcocement rpandues dans les milieux chevaleresques.
Les distractions nobles par excellence portaient lempreinte dune humeur
guerrire.
La chasse dabord. On la dj dit, elle ntait pas quun jeu. Car lhomme
de nos climats ne vivait pas encore, comme nous, au sein dune nature
dfinitivement pacifie par lextermination des btes sauvages. La venaison,
dautre part, en un temps o le btail, insuffisamment nourri et mal
slectionn, ne fournissait que de tristes produits de boucherie, tenait dans
lal imentation carne, notamment chez les riches, une part prpondrante.
Parce quelle demeurait ainsi une activit presque ncessaire, la chasse ntait
pas non plus, strictement parler, un monopole de classe. Le cas de la Bigorre
semble exceptionnel o, ds le dbut du XIIe sicle, elle tait interdite aux
rustres (268). Partout cependant les rois, les princes et les seigneurs, chacun
dans les limites de ses pouvoirs, tendait dj accaparer la poursuite du gibier
dans certains territoires rservs : celle des grosses btes dans les forts (le
terme, originellement, dsignait toute tendue ainsi garde, quelle ft ou non
boise) ; des lapins et des livres, dans les garennes . Le fondement
juridique de ces prtentions est obscur ; selon toute apparence, elles nen
avaient souvent dautre que la loi du matre, et ce fut, trs naturellement, dans
un pays conquis lAngleterre des rois normands que la constitution des
forts royales, parfois aux dpens de la terre arable, et leur protection
portrent aux plus tranges excs. De pareils abus attestent la vivacit dun
got qui, lui, tait bien un trait de classe. De mme, les rquisitions imposes
aux tenanciers : obligation dhberger et de nourrir la meute seigneuriale ;
construction de loges dans les bois, la saison o avaient lieu les grandes
runions de chasseurs. A leurs maires, quils accusaient de vouloir se pousser
au rang des nobles, les moines de Saint-Gall ne faisaient-ils pas grief, avant
tout, dlever des chiens pour courir sus aux livres, et, pis encore, aux loups,
aux ours et aux sangliers ? Aussi bien, pour pratiquer le sport sous ses formes
les plus attrayantes chasse au lvrier courant, p.423 chasse au faucon surtout,
quavaient transmise lOccide nt, parmi tant dautres apports, les civilisations
questres des plaines asiatiques , il fallait de la fortune, des loisirs, des
dpendants. De plus dun chevalier, on et pu dire, comme, dun comte de
Guines, le chroniqueur de sa maison, que dun autou r frappant lair de son
aile il faisait plus de cas que de prtre prchant , ou rpter le propos naf et
charmant quun jongleur prte un de ses personnages, devant le hros
assassin autour duquel la meute hurle la mort : Gentilhomme fut ; moult
laimaient ses chiens (269). En rapprochant ces guerriers de la nature, la
chasse introduisit dans leur contexture mentale un lment qui, sans elle, en
et sans doute t absent. Sils navaient, par tradition de groupe, t le vs
Marc BLOCH La socit fodale
288
savoir de bois et de rivire , les potes de condition chevaleresque, qui
devaient donner tant deux -mmes au lyrisme franais et au Minnesang
allemand, auraient-ils trouv des notes si justes pour chanter laurore ou les
joies du mois de mai ?
Puis les tournois. On les croyait volontiers, au moyen ge, dinstitution
relativement rcente, et lon citait mme le nom de leur prtendu inventeur, un
certain Geoffroi de Preuilly, mort, disait-on, en 1066. En fait, lhabitude de
ces simulacres de combat remontait certainement au plus lointain des ges :
tmoins, les jeux paens , parfois mortels, que mentionne, en 895, le
concile de Tribur. Lusage sen maintint, dans le peuple, certaines ftes,
christianises plutt que chrtiennes : tels ces autres jeux paens le
retour du mot est significatif durant lesquels, en 1077, alors quil sy livrait
avec dautres jeunes gens, le fils dun cordonnier de Vendme fut bless
mort (270). Les luttes des jeunesses ne sont-elles pas un trait folklorique
presque universel ? Dans les armes, par ailleurs, limitation de la guerre
servit de tout temps entraner les troupes comme les amuser : durant la
clbre entrevue quillustrrent les Serments de Strasbourg , Charles le
Chauve et Louis le Germanique se donnrent lagrment dun spectacle de ce
genre et ne ddaignrent pas dy prendre part en personne. Loriginalit de
lre fodale fut de dgager de ces joutes ou militaires ou populaires un type
de bataille fictive p.424 relativement bien rgle, dote gnralement de prix et,
surtout, rserve des escrimeurs monts et pourvus darmes chevaleresques :
par suite un vrai plaisir de classe, tel en vrit que les milieux nobles nen
connurent gure de plus vif.
Comme ces runions, dont lorganisation nallait pas sans frais assez
levs, se clbraient ordinairement loccasion des grandes cours ,
tenues, de temps autre, par les rois ou les barons, on voyait les amateurs
courir le monde de tournois tournois. Ce ntai ent pas seulement des
chevaliers sans fortune, groups parfois en compagnies , mais aussi de trs
hauts seigneurs ; tels, le comte de Hainaut Baudoin IV ou, parmi les princes
anglais, le jeune roi Henri, qui pourtant ny brillait gure. De mme que
dans nos comptitions sportives, les chevaliers se groupaient ordinairement
par rgions : un grand scandale sleva le jour o les Hennuyers, prs de
Gournay, se mirent du camp des gens de la France propre, au lieu de se
joindre aux Flamands et aux habitants du Vermandois qui taient, sur ce
terrain du moins, leurs allis habituels. Nul doute que ces associations de jeux
naient contribu fixer les solidarits provinciales. Dautant quil ne
sagissait point toujours, tant sen faut, dune guerre pour rir e : les blessures,
voire lorsque, pour parler comme le pote de Raoul de Cambrai, la joute
tournait mal , les coups mortels ntaient point rares. Cest pourquoi les
souverains les mieux aviss ne favorisaient point ces bats o spuisait le
sang des vassaux. Henri II Plantagent les avait formellement interdits en
Angleterre. Pour le mme motif et aussi en raison de leurs rapports avec les
amusements des ftes populaires, qui fleuraient le paganisme , lglise
Marc BLOCH La socit fodale
289
les proscrivit rigoureusement, au point de refuser la spulture en terre
consacre au chevalier, mme pnitent, qui y avait trouv la mort. Quen dpit
des lois politiques ou religieuses, lusage se soit manifest, en fait,
indracinable, montre combien il rpondait un got profond.
A dire vrai, pas plus que dans la vraie guerre, la passion ntait toujours
dsintresse. Comme le vainqueur semparait frquemment de lquipement
et des chevaux du vaincu et quelquefois mme de sa personne, pour ne la
librer que p.425 contre ranon, l adresse ou la force avaient leurs profits. Plus
dun chevalier tournoyeur fit littralement de sa science des combats une
profession, et fort lucrative. Tant lamour du noble pour les armes unissait
inextricablement lallgresse et le besoin du gain (271).
IV. Les rgles de conduite
Il tait naturel quune classe aussi nettement dlimite par le genre de vie
et la suprmatie sociale aboutt se donner un code de conduite qui lui ft
propre. Mais ces normes ne se prcisrent, pour, en mme temps, saffiner,
que durant le second ge fodal, qui fut, de toutes faons, celui de la prise de
conscience.
Le terme qui, depuis les environs de lan 1100, sert couramment
dsigner le faisceau des qualits nobles par excellence est caractristique :
courtoisie , qui vient de cour (crit alors et prononc avec un t final). Ce
fut, en effet, dans les runions, temporaires ou permanentes, formes autour
des principaux barons et des rois, que ces lois russirent se dgager.
Lisol ement du chevalier dans sa tour ne let point permis. Il y fallait
lmulation et les changes humains. Et cest pourquoi ce progrs de la
sensibilit morale fut li la fois la consolidation des grandes principauts
ou monarchies et au retour dun e vie de relations plus intense. On disait aussi
et, mesure que, conformment ses origines, courtois glissait un sens
purement mondain, on dit de plus en plus volontiers, avec une signification
plus haute : prudhomme . Nom si grand et si bon que rien qu le
prononcer il emplit la bouche , affirmait Saint Louis, qui, en face des
vertus du moine, entendait par l revendiquer les droits de celles du sicle. Ici
encore lvolution smantique est singulirement instructive. Car
prudhomme ne st en ralit que le mme mot que preux , qui, parti de
lacception premire, assez vague, d utile ou d excellent , avait fini
par sappliquer avant tout la valeur guerrire. Les deux termes divergrent
preux gardant sa signification traditionnelle, quand on se prit penser
que la force et le courage ne p.426 suffisaient pas faire le parfait chevalier. Il
y a une grande diffrence entre un homme preux et un prudhomme , aurait
dit un jour Philippe-Auguste, qui tenait le second pour de beaucoup
Marc BLOCH La socit fodale
290
suprieur (272). Subtilit apparente ; aller au fond des choses, tmoignage
prcieux de lvolution subie par lidal chevaleresque.
Quil sagt de simples usages de biensance ou de prceptes proprement
moraux, de courtoisie , au sens troit, ou de prudhommie , le code
nouveau eut incontestablement pour patrie les cours de la France et du pays
mosan, ces dernires, dailleurs, toutes franaises par le langage et les murs.
Ds le XIe sicle, les modes venues de chez nous simitaient en Italie (273).
Aux deux sicles suivants, ces influences se marqurent avec plus de force
encore : tmoin, le vocabulaire chevaleresque allemand, tout plein de mots
welches noms darmes, de vtemen ts, de traits de murs , venus
ordinairement par le Hainaut, le Brabant ou la Flandre. Hflich mme nest
que le calque de courtois. Ces emprunts ntaient pas transmis que par la
littrature. Plus dun jeune noble thiois venait apprendre auprs des
princes franais, avec la langue, les rgles du bon ton. Le pote Wolfram
dEschenbach ne nomme -t-il pas la France la terre de la droite chevalerie ?
A vrai dire, ce rayonnement dune forme de culture aristocratique tait
seulement un des aspects de la ction exerce alors dans lEurope entire et
l encore, cela va de soi, principalement sur les hautes classes par la culture
franaise en son ensemble : propagation de styles dart et de littrature ;
prestige des coles chartraines, puis parisiennes ; emploi quasi international de
la langue. Et sans doute nest -il pas impossible den dcouvrir quelques
raisons : longues randonnes accomplies, travers lOccident, par la plus
aventureuse des chevaleries ; prosprit relative dun pays touch beaucoup
plus tt que lAllemagne (mais non, la vrit, avant lItalie) par les progrs
des changes ; distinction prcocement accentue entre la classe
chevaleresque et la tourbe des imbelles, inaptes aux armes ; malgr tant de
guerres locales, nul dchirement comparable celui que provoqua dans
lEmpire la grande querelle des empereurs et des papes. Mais, cela p.427 dit,
reste se demander si leffort nest pas vain de prtendre expliquer ce qui, en
ltat prsent de nos connaissances sur lhomme, semble bien d u domaine de
linexplicable : le tonus dune civilisation et ses capacits magntiques.
De cette journe , disait le comte de Soissons, la bataille de la
Mansourah, nous parlerons plus tard dans la chambre des dames (274) . Ce
mot, dont on chercherait vainement lquivalent dans les chansons de geste,
mais quet pu prononcer plus dun hros de roman, ds le XI Ie sicle, signale
une socit o la mondanit a fait son apparition et, avec elle, linfluence
fminine. La femme noble navait jamais t enferme au gynce. Si elle
gouvernait sa maison, entoure de servantes, il arrivait aussi quelle gouvernt
le fief, et parfois durement. Il tait rserv cependant au XIIe sicle de crer le
type de la grande dame lettre et qui tient salon. Profond changement, si lon
veut bien songer lextraordinaire grossiret de lattitude que les vieux
potes piques prtaient volontiers leurs hros vis--vis des femmes,
fussent-elles reines : jusquaux pires injures, que la mgre ren d par des
coups. On croit entendre les gros rires de lauditoire. Le public courtois ntait
Marc BLOCH La socit fodale
291
pas devenu insensible ces lourdes plaisanteries ; mais il ne les admettait
plus, comme dans les fabliaux, quaux dpens des paysannes ou des
bourgeoises. Car la courtoisie tait essentiellement affaire de classe. La
chambre des dames nobles et, plus gnralement, la cour est dsormais le
lieu o le chevalier cherche briller et clipser ses rivaux : par la rputation
de ses hauts faits ; par sa fidlit aux bons usages ; par son talent littraire
aussi.
Nous lavons vu, les milieux nobles navaient jamais t ni totalement
illettrs ni, moins encore, impermables linfluence de la littrature, coute
plutt que lue. Mais un grand pas fut accompli le jour o les chevaliers se
firent eux-mmes littrateurs. Il est significatif que le genre auquel, jusquau
XIIIe sicle, ils sadonnrent, peu prs lexclusion de tout autre, ait t la
posie lyrique. Le plus ancien des troubadours qui nous soit connu il
convient dajouter quil ntait certainement pas le premier comptait au
nombre des plus puissants princes du royaume de France : p.428 cest
Guillaume IX dAquitaine (mort en 1127). Dans la liste des chanteurs
provenaux qui vinrent aprs lui, de mme quun peu plus tard parmi les
potes lyriques du Nord, mules de ceux du Midi, les milieux de haute,
moyenne et petite chevalerie furent abondamment reprsents. A ct, cela va
de soi, des jongleurs professionnels, qui vivaient aux crochets des grands. Ces
pices courtes et gnralement dun art savant parfois jusqu lhermtisme
volontaire, le fameux trobar clus se prtaient admirablement tre
produites dans des runions aristocratiques. A savoir ainsi goter des
jouissances que leur raffinement mme interdisait aux vilains, la classe qui sy
complaisait prenait de sa supriorit une conscience dautant plus aigu que le
plaisir, en effet, tait souvent trs vif et trs sincre. troitement lie lattrait
du mot car les posies, ordinairement, saidaient du chant et dun
accompagnement , la sensibilit musicale nexerait pas un moindre
empire. Sur son lit de mort, nosant, quoiquil en et fort envie, se laisser aller
chanter lui-mme, Guillaume le Marchal, qui avait t un si rude batailleur,
ne dit du moins adieu ses filles quaprs quelles lui eurent fait entendre une
dernire fois le doux son de quelques rotrouenges . Et cest en coutant
la vielle de Volker, dans la nuit calme, que les hros burgondes du
Nibelungenlied sendor ment du dernier sommeil dont ils jouiront sur cette
terre.
Vis--vis des joies de la chair, lattitude gnrale de la classe
chevaleresque semble bien avoir t, en pratique, franchement raliste. Ctait
celle de lpoque, dans son ensemble. Lglise imp osait ses membres
lasctisme et aux laques ordonnait de limiter lunion sexuelle au mariage et
la gnration. Mais elle pratiquait assez mal ses propres enseignements,
surtout chez les clercs sculiers, o la rforme grgorienne mme npura
gure que lpiscopat. Ne rapportait -on pas, avec admiration, de pieux
personnages, prtres de paroisse, voire abbs, que, dit-on , ils taient morts
vierges ? Lexemple du clerg prouve combien la continence rpugnait au
Marc BLOCH La socit fodale
292
commun des hommes ; il ntait certaine ment pas particulirement propre
linspirer aux fidles. A la vrit une fois mis part tel pisode p.429
volontairement plaisant, comme, dans le Plerinage de Charlemagne, les
viriles vanteries dOlivier , lpope est assez chaste. Ctait quelle
nattachait pas grande importance dcrire des bats qui navaient, en effet,
rien dpique. Mme dans les rcits, moins rticents, de lge courtois, la
sensualit est volontiers prsente comme le fait de la femme plutt que des
hros. et l, cependant, un trait lve un coin du voile : ainsi, dans le vieux
pome de Girard de Roussillon, o lon voit un vassal, charg de donner
lhospitalit un messager, lui fournir pour la nuit une belle fille. Et tout, sans
doute, ntait pas fiction dans les dlitables rencontres dont, en croire les
romans, les chteaux fournissaient de si faciles occasions (275). Les
tmoignages de lhistoire sont plus nets encore. Le mariage du noble, on le
sait, tait souvent une simple affaire. Les maisons seigneuriales pullulaient de
btards. A ces murs, lavnement de la courtoisie ne semble point, au
premier abord, avoir chang grand-chose. Certaines des chansons de
Guillaume dAquitaine chantent la volupt en style de corps de garde et cette
veine, chez les potes qui le suivirent, devait trouver plus dun imitateur.
Pourtant, chez Guillaume dj, hritier vraisemblablement dune tradition
dont les dbuts nous chappent, une autre conception de lamour apparat : cet
amour courtois , qui fut une des crations assurment les plus curieuses du
code moral chevaleresque. Dulcine est-elle pour nous sparable de Don
Quichotte ?
Les traits caractristiques de lamour courtois peuvent se rsumer assez
simplement. Il na rien voir avec le mariage ou, pour mieux dire, il soppose
directement ses lois, puisque si laime est en gnral une femme marie,
lamant nest jamais le mari. Il sadresse frquemment une dame de rang
suprieur ; il comporte, en tout cas, constamment un vif accent de dvotion de
lhomme envers la femme. Il se donne pour une passion envahissante, sans
cesse traverse, volontiers jalouse et nourrie de ses troubles mmes, mais dont
le droulement strotyp nest pas sans comporter de bonne heure quelque
chose de rituel. Il ne hait point la casuistique. Enfin, comme le dit le
troubadour Jaufroi Rudel, dans une posie qui, interprte contresens, a fait
p.430 natre la fameuse lgende de la Princesse Lointaine, il est, avec
prdilection, un amour de loin . Non certes quil se refuse, par principe,
la jouissance charnelle ou que, si daventure selon le mot dAndr le
Chapelain qui le mit en thorie il doit renoncer lultime soulas , il
nambitionne du moins la menue monnaie des plaisirs dpiderme. Mais
labsence o u les obstacles, au lieu de le dtruire, ne font que lembellir dune
potique mlancolie. La possession, toujours dsirable, savre -t-elle
dcidment impossible ? Le sentiment nen subsiste pas moins comme un
excitant du cur et une poignante joie .
Telle est limage que nous tracent les potes. Car nous ne connaissons
lamour courtois que par la littrature et cest pourquoi nous sommes fort en
Marc BLOCH La socit fodale
293
peine dy dmler la part de la mode ou de la fiction. Il est sr que, tendant
dissocier, en une certaine mesure, le sentiment de la chair, il nempcha point,
tant sen faut, celle -ci de continuer se satisfaire, de son ct, assez
brutalement. Mais on sait de reste que chez la plupart des hommes la sincrit
affective est plusieurs plans. Incontestablement, en tout cas, une pareille
notion des rapports amoureux, o nous saluons aujourdhui au passage tant
dlments qui nous sont devenus familiers, reprsentait, lorsquelle fut
conue, une combinaison fort originale. Elle devait peu de chose aux arts
dai mer antiques, ni mme, bien quils soient peut -tre plus proches delle
aux traits, toujours un peu quivoques, que la civilisation grco-romaine a
consacrs lanalyse de lamiti masculine. La subordination de lamant tait,
en particulier, une attitude neuve. On a dj vu quelle sexprimait volontiers
en termes emprunts au vocabulaire de lhommage vassalique. La
transposition ntait pas seulement verbale. La confusion de ltre aim et du
chef rpondait une orientation de la morale collective tout fait
caractristique de la socit fodale.
Moins encore, quoi quon en ait dit parfois, tait -il, ce code amoureux,
tributaire de la pense religieuse (276) Si lon veut bien ngliger quelques
superficielles analogies de forme, qui ne sont, au plus, quune marque
dambiance, on devra mme reconnatre quil lui tait directement contraire,
p.431 sans dailleurs que ses tenants aient eu vraisemblablement une bien claire
conscience de cette antithse. Ne faisait-il point de lamour des cratures
presque une des premires vertus, assurment la joie par excellence ? Surtout,
alors mme quil renonait au plaisir physique, ne sublimait -il point, jusqu
prtendre en remplir lexistence, un lan du cur n, en son principe, de ces
apptits charnels dont le christianisme nadmet la lgitimit que pour les
brider par le mariage profondment ddaign par lamour cour tois , pour
leur assigner comme justification la propagation de lespce laquelle
lamour courtois ne songeait g ure , pour les cantonner enfin, de toute
faon, dans un registre secondaire de lexprience morale. Lauthentique cho
du sentiment chrtien de ce temps sur la vie sexuelle, ce nest pas dans le
lyrisme chevaleresque quon peut esprer le trouver. Il rs onne, pur de toute
compromission, dans ce texte de la pieuse et clricale Queste du Saint-Graal
o lon voit Adam et ve, avant de sunir, sous lArbre, pour conce voir
Abel le juste , supplier le Seigneur de faire tomber sur eux une grande nuit,
afin de comforter leur vergogne.
Aussi bien lopposition, sur ce point, des deux morales, nous donne -t-elle
peut-tre la clef de lnigme que pose, la gographie sociale, la gense de
ces ratiocinations amoureuses. Comme la posie lyrique qui nous en a
conserv lexpression, elles naquirent, ds la fin du X Ie sicle, dans les
milieux courtois de la France du Midi. Ce qui sen retrouve un peu plus tard
dans le Nord, sous forme lyrique encore ou par le truchement des romans, ce
qui en passa ensuite dans le Minnesang allemand ne fut que reflet. Or, on ne
saurait sans absurdit invoquer ce propos, en faveur de la civilisation de
Marc BLOCH La socit fodale
294
langue doc, je ne sais quelle couleur de supriorit. Que lattention se porte
sur lordre artistique, intellectuel ou conomique, la prtention serait
galement insoutenable. Autant vaudrait nier, dun bloc, lpope
dexpression franaise, lart gothique, les premiers efforts de la philosophie
dans les coles dentre Loire et Meuse, les foires de Champagne et les ruches
urbaines de la Flandre. Il nest point contestable, par contre, que, dans le Midi,
lglise, surtout durant le premier ge fodal, fut moins p.432 riche, moins
cultive, moins agissante que dans les provinces septentrionales. Aucune des
grandes uvres de la littratur e clricale, aucun des grands mouvements de
rforme monastique ne sont venus de l. Cette faiblesse relative des centres
religieux peut seule expliquer les succs exceptionnels remports, de la
Provence au Toulousain, par des hrsies, en elles-mmes internationales. Il
en rsulta sans doute aussi que, linfluence des clercs sur les hautes classes
laques tant moins forte, ces dernires dvelopprent plus librement une
morale plus purement mondaine. Que, dailleurs, ces prceptes de lamour
chevaleresque se soient, par la suite, si aisment propags atteste combien ils
rpondaient aux besoins nouveaux dune classe. Ils laidrent se percevoir
elle-mme. Ne pas aimer comme le commun, nest -ce pas se sentir autre ?
Que le chevalier suppute avec soin butin ou ranons, que, rentr chez lui,
il taille lourdement ses paysans ne choque point ou gure. Le gain est
lgitime. A une condition toutefois : quil soit promptement et libralement
dpens. je puis vous le garantir , dit un troubadour, auquel on reproche ses
brigandages, si jai pris, ce fut pour donner, non pour thsauriser (277). Sans
doute a-t-on le droit de juger un peu suspecte linsistance que les jongleurs,
parasites professionnels, mettaient prner, par-dessus tout autre devoir, la
largesse, dame et reine qui toutes vertus illumine . Sans doute aussi, parmi
les menus ou moyens seigneurs et, plus encore peut-tre, parmi les hauts
barons, ne manqua-t-il jamais davares ou, simplement, de prudents, plus
enclins amasser dans les coffres la monnaie rare ou les joyaux qu les
distribuer. Il nen est pas moins vrai qu laisser couler entre ses doigts la
fortune vite acquise, vite perdue, le noble croyait affirmer sa supriorit
envers des classes moins confiantes dans lavenir ou plus soucieuses de le
calculer. La gnrosit ni le luxe ntaient pas toujours les seules formes o
sarrtt cette louable prodigalit. Un chroniqueur nous a conserv le souvenir
de la singulire comptition de gaspillage dont fut, un jour, le thtre une
grande cour , tenue en Limousin. Un chevalier fait semer de picettes
dargent un terrain, pralablement labour ; un p.433 autre, pour sa cuisine,
brle des cierges ; un troisime, par jactance , ordonne de brler vifs trente
de ses chevaux (278). De cette joute de prestige, par la profusion, qui
invinciblement voque nos mmoires certains rcits dethnographes, quet
pens un marchand ? Ici encore, la nature du point dhonneur marquait la
ligne de sparation entre les groupes humains.
Distincte ainsi par sa puissance, son genre de fortune et de vie, sa morale
mme, la classe sociale des nobles tait, vers le milieu du XIIe sicle, toute
Marc BLOCH La socit fodale
295
prte se solidifier en classe juridique et hrditaire. Lusag e de plus en plus
frquent, semble-t-il, qui, pour en dsigner les membres, se fait ds lors du
mot de gentilhomme homme de bonne gent , cest --dire de bonne
race indique limportance croissante attribue aux qualits du sang. Ce fut
autour du n rite, ladoubement chevaleresque, que sopra la cristallisation.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
296
CHAPITRE III
La chevalerie
I. Ladoubemen t
A partir de la seconde moiti du XIe sicle, divers textes, qui bientt
vont se multipliant, commencent mentionner quici o u l une crmonie a eu
lieu, destine, disent-ils, faire un chevalier . Le rituel en est plusieurs
actes. Au postulant, gnralement peine sorti de ladolescence, un chevalier
plus ancien remet dabord les armes significatives de son futur tat.
Notamment, il le ceint de lpe. Puis vient, presque toujours, un grand coup
que, du plat de la main, ce parrain assne sur la nuque ou la joue du garon : la
paume ou cole des documents franais. preuve de force ? Ou bien,
comme le pensrent, ds le moyen ge, certains interprtes un peu tardifs,
mode de fixation du souvenir, qui, au jeune homme, devra, selon le mot de
Raimon Lull, rappeler, sa vie durant, la promesse ? De fait, les pomes
montrent volontiers le hros appliqu ne point plier sous cette rude gifle, la
seule, observe un chroniqueur, quun chevalier doive jamais recevoir, sans la
rendre (279). Nous le savons, dautre part, le soufflet tait, dans les murs
juridiques du temps, un des procds de commmoration le plus frquemment
infligs aux tmoins des actes de droit plutt, en vrit, qu leurs
participants. Mais de ce geste, originellement conu comme si essentiel la
crmonie que celle-ci, tout entire, en prit son nom habituel
d adoubement , (dun vieux verbe germanique qui voulait dire : frapper),
le sens premier p.436 tait, semble-t-il, bien diffrent et beaucoup moins
purement rationnel. Le contact ainsi tabli entre la main de ladoubeur et le
corps de ladoub transmettait de lun lautre une sorte dinflux : tout
comme cet autre soufflet, que lvque donne au clerc quil consacre prtre.
Une manifestation sportive, enfin, terminait souvent la fte. Le nouveau
chevalier slance cheval et va, dun coup de lance, transpercer ou abattre
une panoplie fixe un pieu : la quintaine .
p.435
Par ses origines et par sa nature, ladoubement se rattache visiblement
ces crmonies dinitiation dont les socits primitives, comme celles du
monde antique, fournissent tant dexemples pratiques qui, sous des formes
diverses, ont toutes pour objet commun de faire passer le jeune garon au rang
de membre parfait du groupe, dont jusque-l son ge lavait exclu. Chez les
Germains, elles taient limage dune civilisation guerrire. Sans prjud ice
peut-tre dautres traits tels que la coupe des cheveux, qui parfois se
retrouvera plus tard, en Angleterre, unie ladoubement chevaleresque ,
Marc BLOCH La socit fodale
297
elles consistaient essentiellement en une remise des armes, que Tacite a
dcrite et dont la persistance, lpoque des invasions, est atteste par
quelques textes. Entre le rituel germanique et le rituel de la chevalerie, la
continuit nest pas douteuse. Mais, en changeant dambiance, lacte avait
galement chang de sens humain.
Chez les Germains, tous les hommes libres taient des guerriers. Il ne sen
trouvait aucun, par suite, qui net droit linitiation par les armes : du moins,
l o la tradition du peuple imposait cette pratique, dont nous ignorons si elle
tait partout rpandue. Par contre, une des caractristiques de la socit
fodale fut, comme lon sait, la formation dun groupe de combattants
professionnels, constitu avant tout par les vassaux militaires et leurs chefs. A
ces soldats par excellence devait naturellement se restreindre lappl ication de
lantique crmonie. Celle -ci, vrai dire, risquait de perdre dans ce transfert
tout substrat social tant soit peu fixe. Elle avait servi de rite daccs au peuple.
Or le peuple, au sens ancien la petite cit des hommes libres nexistait
plus. Elle commenait servir de rite daccs une classe. Mais cette classe
manquait encore de p.437 tous contours prcis. Il arriva que, par endroits,
lusage disparut : tel semble avoir t le cas chez les Anglo-Saxons. Dans les
pays quavait marqus la coutume franque, il se maintint, au contraire ; mais
sans tre, pendant longtemps, dun emploi bien gnral, ni, aucun degr,
obligatoire.
Puis, mesure que les milieux chevaleresques prenaient une conscience
plus nette de ce qui les sparait de la masse sans armes et les levait
au-dessus delle, le besoin se fit sentir plus imprieusement de sanctionner, au
moyen dun acte formaliste, lentre dans la collectivit ainsi dfinie : soit que
le nouvel admis ft un jeune garon qui, n parmi les nobles , obtenait
dtre accept dans la socit des adultes ; soit quil sagit, beaucoup plus
rarement, de quelque heureux parvenu quune puissance rcemment acquise,
sa force ou son adresse semblaient galer aux membres des anciens lignages.
Ds la fin du XIe sicle, en Normandie, dire du fils dun grand vassal : il
nest pas chevalier quivalait le supposer encore enfant ou adolescent (280).
Assurment, le souci de signifier ainsi, par un geste sensible aux yeux, tout
changement dtat juridique comme tout contrat rpondait des tendances
caractristiques de la socit mdivale : tmoin, le rituel, souvent si
pittoresque, de laccession aux corps de mtier. Encore fallait -il, cependant,
pour imposer ce formalisme, que le changement dtat ft clairement peru
comme tel. Cest pourquoi la gnralisation de ladoubement se prsenta
vraiment comme le symptme dune modification profonde dans la notion de
chevalerie.
Durant le premier ge fodal, ce quon avait entendu par le terme de
chevalier tait, avant tout, tantt une situation de fait, tantt un lien de droit,
mais purement personnel. On se disait chevalier parce quon combattait
cheval, avec lquipement complet. On se disait le chevalier de quelquun
lorsquon tenai t de ce personnage un fief, qui obligeait le servir ainsi arm.
Marc BLOCH La socit fodale
298
Or, voici que, maintenant, ni la possession dun fief, ni le critre, forcment
un peu flottant, du genre de vie ne vont plus suffire mriter ce nom. Il y
faudra, en outre, une sorte de conscration. La transformation tait accomplie
vers le milieu du XIIe sicle. p.438 Un tour de langage usit ds avant 1100
aidera en saisir la porte. On ne fait pas seulement un chevalier. On
l ordonne tel. Ainsi sexprime, par exemple, en 109 8, le comte de
Ponthieu, qui sapprte armer le futur Louis VI (281). Lensemble des
chevaliers adoubs constitue un ordre : ordo. Mots savants, mots dglise,
mais que lon trouve, ds le dbut, dans des bouches laques. Il s ne
prtendaient nullement, du moins dans leur premier emploi, suggrer une
assimilation avec les ordres sacrs. Dans le vocabulaire que les crivains
chrtiens avaient emprunt lAntiquit romaine, un ordo tait une division
de la socit, temporelle aussi bien quecclsiastique. Mais une division
rgulire, nettement dlimite, conforme au plan divin. Une institution, en
vrit. Non plus seulement une ralit toute nue.
Comment, cependant, dans une socit habitue vivre sous le signe du
surnaturel, le rite, dabord purement profane, de la remise des armes,
naurait -il pas reu une empreinte sacre ? Deux usages, lun et lautre fort
anciens, servirent de point de dpart lintervention de lglise.
Dabord, la bndiction de lpe. Elle navait o riginellement rien eu de
particulier ladoubement. Tout ce qui tait au service de lhomme semblait
alors mriter dtre mis ainsi labri des piges du Dmon. Le paysan faisait
bnir ses rcoltes, son troupeau, son puits ; le nouveau mari, le lit nuptial ; le
plerin, son bton de voyage. Le guerrier, naturellement, agissait de mme
pour les outils propres sa profession. Le vieux droit lombard ne
connaissait-il pas dj le serment sur les armes consacres (282) ? Mais,
plus que toutes autres, celles dont le jeune guerrier se parait pour la premire
fois semblaient appeler une pareille sanctification. Un rite de contact en tait
le trait essentiel. Le futur chevalier dposait un moment son glaive sur lautel.
Des prires accompagnaient ou suivaient ce geste. Inspires du schma
gnral de la bndiction, on les voit cependant, de bonne heure, se produire
sous une forme spcialement approprie une premire vture. Telles, elles
apparaissent dj, peu aprs 950, dans un pontifical rdig dans labbaye de
Saint-Alban de Mayence. Fait sans doute, pour une bonne part, demprunts
des sources plus anciennes, ce p.439 recueil se propagea rapidement dans toute
lAllemagne, la France du Nord, lAngleterre et jusqu Rome mme, o il fut
impos par linfluence de la cour ottonienne. Il rpandit au loin le modle de
la bndiction de lpe nouvellement ceinte . Entendons bien, dailleurs,
que cette conscration ne constituait alors dans la solennit quune sorte de
prface. Lado ubement se droulait ensuite selon ses formes particulires.
La encore, pourtant, lglise pouvait tenir son rle. Le soin darmer
ladolescent navait pu appartenir, originellement, qu un chevalier dj
confirm dans ce titre : son pre, par exemple, ou son seigneur. Mais il arriva
aussi quon le confit un prlat. Ds 846, le pape Serge avait pass le
Marc BLOCH La socit fodale
299
baudrier au Carolingien Louis II. De mme, Guillaume le Conqurant fit plus
tard adouber un de ses fils par larchevque de Canterbury. Sans doute
lho nneur ainsi rendu allait-il moins au prtre quau prince de lglise, chef de
nombreux vassaux. Un pape ou un vque, cependant pouvaient-ils renoncer
sentourer dune pompe religieuse ? La liturgie, par l, tait comme invite
imprgner la crmonie tout entire.
Ctait chose faite au X Ie sicle. Un pontifical de Besanon, qui fut tabli
en ce temps, ne contient, il est vrai, que deux bndictions de lpe, lune et
lautre fort simples. Mais de la seconde il ressort clairement que lofficiant
tait suppos remettre lui-mme larme. Cependant, pour trouver un vritable
rituel religieux de ladoubement, cest plus au nord quil faut regarder, vers
ces pays dentre Seine et Meuse qui furent lauthentique berceau de la plupart
des institutions proprement fodales. Notre plus ancien tmoin est ici un
pontifical de la province de Reims, compil, vers le dbut du sicle, par un
clerc qui, tout en sinspirant du recueil mayenais, nen puisait pas moins
abondamment dans les usages locaux. La liturgie comporte, avec une
bndiction de lpe, qui reproduit celle de loriginal rhnan, des prires, de
mme sens, applicables aux autres armes ou insignes : bannire, lance,
bouclier, la seule exception des perons dont la remise sera jusquau bout
rserve des mains laques. Vient ensuite une bndiction du futur p.440
chevalier lui-mme. Enfin, la mention expresse que lpe sera ceinte par
lvque. Puis, aprs une lacune de prs de deux sicles, le crmonial
apparat pleinement dvelopp, en France encore, dans le Pontifical de
lvque de Mende, Guillaume Durant, rdig vers 1295, mais dont les
lments essentiels datent vraisemblablement du rgne de saint Louis. Ici le
rle conscrateur du prlat est pouss aux dernires limites. Il ne ceint plus
seulement le glaive ; il donne aussi la paume ; il marque , dit le texte, le
postulant du caractre chevaleresque . Pass au XIVe sicle dans le
Pontifical Romain, ce schma, dorigine franaise, devait devenir le rite
officiel de la chrtient. Quant aux pratiques accessoires le bain
purificateur, imit de celui des catchumnes, la veille des armes , elles ne
semblent pas stre introduites avant le XI Ie sicle ni avoir jamais t autre
chose quexceptionnelles. Aussi bien, la veille ntait -elle pas toujours voue
entirement de pieuses mditations. A en croire un pome de Beaumanoir, il
arrivait quelle se ft, profanement, au son des vielles (283).
Ne nous y trompons pas aucun de ces gestes religieux ne fut jamais
indispensable lacte. Les circonstances, dailleurs, en eussent assez souvent
empch laccomplissement. Ne fit -on pas, de tout temps, des chevaliers sur le
champ de bataille, avant ou aprs le combat ? Tmoin encore, aprs Marignan,
la cole que de lpe, selon lusage du moyen ge finissant Bayard
donna son roi. En 1213, Simon de Montfort avait entour dun pieux clat,
digne dun hros crois, ladoubement de son fils, que deux vques, au chant
du Veni Creator, armrent chevalier pour le service du Christ. Au moine
Pierre des Vaux-de-Cernay, qui y assista, cette solennit arrache un cri
Marc BLOCH La socit fodale
300
caractristique : O nouvelle mode de chevalerie ! Mode jusque-l inoue.
Plus modeste, la bndiction de lpe elle -mme, au tmoignage de Jean de
Salisbury (284), ntait pas gnrale vers le milieu du XI Ie sicle. Elle semble
cependant avoir t alors trs rpandue. Lglise, en un mot, avait cherch
transformer lantique remise des armes en un sacrement le mot, qui se
rencontre sous la plume de clercs, navait rien de choquant une poque o, la
thologie tant encore p.441 bien loin de la rigidit scolastique, on continuait
volontiers confondre sous ce nom toute espce dacte de conscration. Elle
ny avait pas russi pleinem ent. Mais elle stait du moins taill une part, ici
plus large, l plus restreinte. Ses efforts, en marquant limportance quelle
attachait au rite dordination, contriburent grandement aviver le sentiment
que la chevalerie tait une socit dinitis. Et, comme toute institution
chrtienne il fallait la sanction de fastes lgendaires, lhagiographie vint la
rescousse. Quand on lit, la messe, les ptres de saint Paul , dit un
liturgiste, les chevaliers restent debout, pour lhonorer, car il fut
chevalier (285).
II. Le code chevaleresque
Cependant, une fois entr en scne, llment religieux ne borna point ses
effets fortifier, dans le monde chevaleresque, lesprit de corps. Il exera
galement une puissante action sur la loi morale du groupe. Avant que le futur
chevalier ne reprt son pe sur lautel, un serment lui tait ordinairement
demand, qui prcisait ses obligations (286). Tous les adoubs ne le prtaient
point, puisquils ne faisaient pas tous bnir leurs armes. Mais, avec Jean de
Salisbury, les crivains dglise estimaient volontiers que, par une sorte de
quasi-contrat, ceux-l mme qui ne lavaient point prononc des lvres sy
taient tacitement soumis, par le seul fait davoir accept la chevalerie.
Peu peu les rgles ainsi formules pntrrent dans dautres textes : dabord,
dans les prires, souvent fort belles, qui scandaient le droulement de la
crmonie ; plus tard, avec dinvitables variantes, dans divers c rits en
langue profane. Tel, peu aprs 1180, un passage clbre du Perceval de
Chrtien de Troyes. Puis ce sont, au sicle suivant, quelques pages du roman
en prose de Lancelot ; dans le Minnesang allemand, une pice du
Meissner ; enfin et surtout, le petit pome didactique franais intitul
LOrdene de Chevalerie. Cet opuscule eut un vif succs. Bientt paraphras
en une couronne de sonnets italiens, imit, en Catalogne, par Raimon Lull,
il ouvrit la voie la foisonnante littrature qui, p.442 durant les derniers sicles
du moyen ge, devait puiser jusqu la lie lexgse symbolique de
ladoubement et, par ses outrances, dnoncer, avec la dcadence dune
institution passe du droit ltiquette, laffadissement de lidal mme quon
affectait de faire sonner si haut.
Marc BLOCH La socit fodale
301
Dans sa fracheur, pourtant, cet idal navait pas t sans vie. Il se
superposait aux rgles de conduite ds auparavant dgages par la spontanit
des consciences de classe : code de fidlit des vassaux la transition
apparat clairement, vers la fin du XIe sicle, dans le Livre de la Vie
Chrtienne de lvque Bonizon de Sutri, pour qui le chevalier, visiblement,
est encore, avant tout, un vassal fieff ; surtout code de classe des gens
nobles et courtois . A ces morales mondaines, le nouveau dcalogue
emprunta les principes les plus acceptables une pense religieuse : largesse,
poursuite de la gloire, le los ; mpris du repos, de la souffrance et de la
mort celui-l , dit le pote allemand Thomasin, ne veut pas faire
mtier de chevalier qui ne veut vivre que doucement (287). Mais ctait en
colorant ces normes mmes de teintes chrtiennes ; et, plus encore, en
nettoyant le bagage traditionnel des lments de nature trs profane qui y
avaient tenu et, en pratique, continuaient dy tenir une si large place : ces
scories qui, sur les lvres de tant de rigoristes, depuis saint Anselme jusqu
saint Bernard, avaient amen le vieux jeu de mots, tout gonfl du mpris du
clerc pour le sicle non militia, sed malitia (288). Chevalerie gale
mchancet aprs lannexion dfinitive, par lglise, des vertus
chevaleresques, quel crivain dsormais et os rpter cette quation ? Enfin
aux prceptes anciens, ainsi purs, dautres taient venus sajouter, qui
portaient lempreinte de proccupations exclusivement spirituelles.
Du chevalier, clercs et lais saccordent donc exiger cette pit, sans
laquelle Philippe Auguste lui-mme estimait quil ntait point de vrai
prudhomme . Il doit aller la messe, tous les jours ou, du moins,
volontiers ; il doit jener le vendredi. Cependant ce hros chrtien
demeure, par nature, un guerrier. De la bndiction des armes, nattendait -on
pas avant tout quelle les rend t efficaces ? Les prires expriment clairement
cette croyance. Mais lpe, p.443 ainsi consacre si nul ne songe interdire
de la tirer, au besoin, contre des ennemis personnels ou ceux dun matre le
chevalier la reue, avant tout, pour la mettre a u service des bonnes causes.
Dj les vieilles bndictions du Xe sicle finissant mettent laccent sur ce
thme, que dveloppent largement les liturgies postrieures. Ainsi une
discrimination, dintrt capital, sintroduisait dans le vieil idal de la gu erre
pour la guerre, ou, pour le gain. Avec ce glaive, ladoub dfendra la Sainte
glise, particulirement contre les paens. Il protgera la veuve, lorphelin, le
pauvre. Il poursuivra les malfaiteurs. A ces prceptes gnraux, les textes
laques joignent volontiers quelques recommandations plus spciales qui
touchent la conduite au combat : ne point tuer le vaincu sans dfense ; la
pratique des tribunaux et de la vie publique : ne point participer un faux
jugement ou une trahison ; si on ne peut les empcher, ajoute modestement
lOrdene de Chevalerie, quitter la place ; enfin les incidents de la vie
quotidienne : ne pas donner de mauvais conseils une dame ; aider, si lon
peut , son prochain dans lembarras.
Marc BLOCH La socit fodale
302
Que, tisse de beaucoup de ruses et de violences, la ralit ft loin de
rpondre toujours ces aspirations, comment sen tonner ? Inclinera-t-on,
dautre part, observer que du point de vue, soit dune morale dinspiration
sociale , soit dun code plus purement chrtien, une pareille table des
valeurs peut sembler un peu courte ? Ce serait se laisser aller juger, l o
lhistorien a pour seul devoir de comprendre. Il est plus important de noter
quen passant des thoriciens ou liturgistes dglise aux vulgarisateurs
laques, la liste des vertus chevaleresques parat bien avoir souvent subi un
assez inquitant amenuisement. Le plus haut ordre que Dieu ait fait et
command, cest lordre de chevalerie , dit, avec son ampleur coutumire,
Chrtien de Troyes. Mais il faut avouer quapr s ce prambule sonore les
enseignements que son prudhomme donne au jeune garon par lui arm
paraissent dune dconcertante maigreur. Peut -tre, vrai dire, Chrtien
reprsente-t-il plutt la courtoisie des grandes cours princires du XIIe
sicle que la prudhommie , pntre de souffles religieux, comme, au
sicle suivant, on lentendait autour de Louis IX. Ce p.444 nest pas hasard sans
doute si lpoque et le milieu mmes o vcut ce saint adoub ont donn
naissance la noble prire qui, recueillie dans le Pontifical de Guillaume
Durant, nous offre comme le commentaire liturgique des chevaliers de pierre,
dresss par les imagiers au portail de Chartres ou au revers de la faade de
Reims : Seigneur trs saint, Pre tout Puissant... toi qui as permis, sur terre,
lemploi du glaive pour rprimer la malice des mchants et dfendre la
justice ; qui, pour la protection du peuple as voulu instituer lordre de
chevalerie... fais, en disposant son cur au bien, que ton serviteur que voici
nuse jamais de ce glaive ou dun autre pour lser injustement personne ; mais
quil sen serve toujours pour dfendre le Juste et le Droit.
Ainsi lglise, en lui assignant une tche idale, achevait de lgitimer
lexistence de cet ordre des guerriers qui, conu comme une des divisions
ncessaires dune socit bien police, sidentifiait de plus en plus avec la
collectivit des chevaliers adoubs : O Dieu, qui aprs la chute, as constitu
dans la nature entire trois degrs parmi les hommes , lit-on dans une de ces
prires de la liturgie bisontine. Ctait en mme temps fournir cette classe la
justification dune suprmatie sociale, ds longtemps ressentie en fait. Des
chevaliers, le trs orthodoxe Ordene de Chevalerie ne dit-il pas quil convient
de les honorer par-dessus tous les autres hommes, prtre except ? Plus
crment, le roman de Lancelot, aprs avoir expos comment ils furent
institus pour garantir les faibles et les paisibles , ne poursuit-il pas,
conformment au got du signe, familier toute cette littrature, en montrant
dans les chevaux quils montent le propre symbole du peuple quils
tiennent en droite subjection ? Car dessus le peuple doit seoir le
chevalier. Et de mme quon point le cheval et que celui qui dessus sied le
mne o il veut, de mme le chevalier doit mener le peuple son vouloir.
Plus tard, Raimon Lull ne croira pas heurter le sentiment chrtien en dclarant
conforme au bon ordre que le chevalier tire son bien-tre des choses que
lui procurent la fatigue et la peine de ses hommes (289). tat desprit
Marc BLOCH La socit fodale
nobiliaire, sil en fut, minemment favorable lclosion de la noblesse la
plus stricte.
*
**
303
Marc BLOCH La socit fodale
304
CHAPITRE IV
La transformation de la noblesse de fait en noblesse de
droit
I. Lh rdit de ladoubement et lanoblissement
Fond, vers 1119, pour la dfense des colonies de Terre Sainte,
lOrdre du Temple groupait deux catgories de combattants, distinctes par le
costume, les armes et le rang : en haut, les chevaliers ; en bas, les simples
sergents manteaux blancs contre manteaux bruns. Nul doute que, ds le
principe, lopposition ne rpondt une diffrence dorigine sociale, parmi les
recrues. Cependant, rdige en 1130, la plus ancienne Rgle ne formule cet
gard aucune condition prcise. Un tat de fait, dtermin par une sorte
dopinion commune, dcidait videmment de ladmission dans lun ou lautre
grade. Postrieure dun peu plus dun sicle, la seconde Rgle procde, au
contraire, avec une rigueur toute juridique. Pour tre autoris revtir le blanc
manteau, il est dabord ncessaire que le postulant, ds avant son entre dans
lOrdre, ait t adoub. Mais cela mme ne suffit point. Il lui faut en outre tre
fils de chevalier ou extrait de chevaliers du ct de son pre ; en dautres
termes, comme il est dit dans un autre passage, tre gentilhomme . Car,
prcise encore le texte, cest cette condition seulement quun homme doit
et peut recevoir la chevalerie. Il y a plus. Arrive-t-il quun nouvea u venu,
taisant sa qualit chevaleresque, se soit gliss parmi les sergents ? La vrit
une fois connue, il sera mis aux fers (290). Mme chez des moines soldats, en
ce milieu du XIIIe sicle, p.446 lorgueil de caste, qui tient crime toute
dchance volontaire, parlait plus haut que lhumilit chrtienne. 1130 ; 1250
ou environ : entre ces deux dates, que stait -il donc pass ? Rien de moins
que la transformation du droit ladoubement en un privilge hrditaire.
p.445
Dans les pays o la tradition lgislative ne stait point perdue ou avait
repris vie, des textes rglementaires avaient prcis le droit nouveau. En 1152,
une constitution de paix de Frdric Barberousse la fois interdit aux
rustres le port de la lance et du glaive armes chevaleresques et
reconnat pour lgitime chevalier celui-l seulement dont les anctres lont
t avant lui ; une autre, en 1187, dfend expressment aux fils des paysans de
se faire adouber. Ds 1140, le roi Roger II de Sicile ; en 1234, le roi Jacques
Ier dAragon ; en 1294, le comte Charles II de Provence ordonnent de
nadmettre la chevalerie que les descendants de chevaliers. En France, il
ntait alors gure de lois. Mais la jurisprudence de la cour royale, sous Saint
Marc BLOCH La socit fodale
305
Louis, est formelle. De mme, les coutumiers. Sauf grce spciale du roi,
aucun adoubement ne saurait tre valable si le pre de ladoub ou son aeul,
en ligne masculine, nont dj t chevaliers (peut -tre ds ce temps, en tout
cas un peu plus tard, les coutumes provinciales dune partie au moins de la
Champagne accepteront cependant que cette noblesse puisse se
transmettre par le ventre maternel). La mme conception semble
galement la base dun passage, la vrit moins clair, du grand trait de
droit castillan, les Siete Partidas, que fit rdiger, vers 1260, le roi Alfonse le
Sage. Rien de plus remarquable que la quasi-concidence dans le temps et le
parfait accord de ces divers textes, la fois entre eux et avec la rgle du
Temple, ordre international. Du moins sur le continent car lAngleterre,
nous le verrons, doit tre mise part lvolution des hautes classes
obissait un rythme fondamentalement uniforme (291).
Sans doute, lorsquils levaient expressment cette b arrire, souverains et
tribunaux avaient-ils peine le sentiment dune innovation. De toujours, la
grande majorit des adoubs avaient t pris parmi les descendants de
chevaliers. Aux yeux dune opinion de groupe de plus en plus exclusive, p.447
seule la naissance, garante , comme devait dire Raimon Lull, de la
continuation de lhonneur ancien , paraissait habiliter lobservation du code
de vie auquel engageait la remise des armes. Ah Dieu ! quil est mal
rcompens le bon guerrier qui de fils de vilain fait chevalier ! scrie, vers
1160, le pote de Girard de Roussillon (292). Cependant, le blme mme dont
ces intrusions taient lobjet prouve quelles ntaient pas exceptionnelles.
Aucune loi, aucune coutume ne les rendaient caduques. Elles semblaient
dailleurs parfois presque ncessaires au recrutement des armes ; car, en
vertu du mme prjug de classe, on concevait mal que le droit de combattre
cheval et quip de pied en cap ft sparable de ladoubement. Ne vit-on pas
encore, en 1302, la veille de la bataille de Courtrai, les princes flamands,
dsireux de se faire une cavalerie, donner la cole quelques riches bourgeois,
auxquels leur richesse permettait de se procurer la monture et lquipement
ncessaires (293) ? Le jour o ce qui navait t longtemps quune vocation
hrditaire de fait, susceptible de beaucoup daccrocs, devint un privilge
lgal et rigoureux fut donc, mme si les contemporains nen eurent pas une
claire conscience, une trs grande date. Les profonds changements sociaux qui
sopraient alors sur les frontires du monde chevaleresque avaient
certainement beaucoup contribu inspirer des mesures aussi draconiennes.
Au XIIe sicle, une nouvelle puissance tait ne : celle du patriciat urbain.
En ces riches marchands qui, volontiers, se faisaient acqureurs de seigneuries
et dont beaucoup, pour eux-mmes ou pour leurs fils, neussent point
ddaign le baudrier de chevalerie , les guerriers dorigine ne pouvaien t
manquer de percevoir des lments beaucoup plus trangers leur mentalit et
leur genre de vie, beaucoup plus inquitants aussi, par leur nombre, que les
soldats de fortune ou les officiers seigneuriaux, parmi lesquels, jusque-l,
staient presque ex clusivement recruts, en dehors des personnes bien nes,
Marc BLOCH La socit fodale
306
les candidats linitiation par lpe et la cole. Aussi bien connaissons -nous,
par lvque Otton de Freising, les ractions des barons allemands devant les
adoubements quils jugeaient trop aism ent distribus, dans p.448 lItalie du
Nord, la gent mcanique ; et Beaumanoir, en France, a trs clairement
expos comment la pousse des nouvelles couches, empresses placer leurs
capitaux en terres, amena les rois prendre les prcautions ncessaires pour
que lachat dun fief ne ft pas de tout enrichi lgal dun descendant de
chevaliers. Cest quand une classe se sent menace quelle tend, surtout, se
clore.
Gardons-nous, toutefois, dimaginer un obstacle, par principe,
infranchissable. Une classe de puissants ne saurait se transformer, absolument,
en caste hrditaire sans se condamner exclure de ses rangs les puissances
nouvelles dont linvitable surgissement est la loi mme de la vie ; par suite,
sans se vouer, en tant que force sociale, un fatal tiolement. Lvolution de
lopinion juridique, au terme de lre fodale, tendit beaucoup moins, en
somme, interdire rigoureusement les admissions nouvelles qu les
soumettre un trs strict contrle. Tout chevalier nagure pouvait faire un
chevalier. Ainsi pensaient encore ces trois personnages que Beaumanoir met
en scne, vers la fin du XIIIe sicle. Pourvus eux-mmes de la chevalerie, ils
manquaient dun quatrime comparse, de mme dignit, dont la prsence tait
exige, par la coutume, pour un acte de procdure. Qu cela ne tnt ! Ils
happrent en chemin un paysan et lui donnrent la cole : Chevalier
soyez ! A cette date, cependant, ctait retarder sur la marche du droit ; et
une lourde amende fut le juste chtiment de cet anachronisme. Car, dsormais,
laptitude de lordonn confrer lordre ne subsistait plus, dans son
intgrit, que si le postulant appartenait dj un lignage chevaleresque.
Lorsque tel nest point le cas, ladoubement, en vrit, demeure encore
possible. Mais condition dtre spcialement autoris par lunique pouvoir
auquel les conceptions alors communment rpandues accordaient
lexorbitante facult de lever lapplication des rgles coutumires : celui du
roi, seul dispensateur, comme dit Beaumanoir, des novellets .
On la dj vu, telle tait, ds Saint Louis, la jurisprudence de la cour
royale franaise. Bientt lhabitude se prit, dans lentourage des Captiens, de
donner ces autorisations la forme de lettres de chancellerie dsignes,
presque ds le p.449 dbut, sous le nom de lettres danoblissement : car tre
admis recevoir la chevalerie, ntait -ce pas obtenir dtre assimil aux
nobles dorigine ? Les premiers exemples que nous possdions de ce genre
de documents, promis un si grand avenir, datent de Philippe III ou de
Philippe IV. Parfois, le roi usait de son droit pour rcompenser sur le champ
de bataille, selon lantique usage, quelque trait de bravoure : ainsi, Philippe le
Bel, en faveur dun boucher, le soir de Mons -en-Pevle (294). Le plus souvent,
cependant, ctait afin de reconnatre de longs services ou une situation
sociale prminente. Lacte ne permettait pas seulement de crer un nouveau
chevalier ; laptitude ladoubement se transmettant , par nature, de gnration
Marc BLOCH La socit fodale
307
en gnration, il faisait, du mme coup, surgir un nouveau lignage
chevaleresque. La lgislation et la pratique siciliennes sinspirrent de
principes tout pareils. De mme, en Espagne. Dans lEmpire, les constitutions
de Barberousse, vrai dire, ne prvoient rien de tel. Mais nous savons, par
ailleurs, que lEmpereur sestimait en droit darmer chevaliers de simples
soldats (295) ; il ne se considrait donc pas comme li, personnellement, par les
interdictions, en apparence absolues, de ses propres lois. Aussi bien, partir
du rgne suivant, lexemple sicilien ne manqua pas dexercer son action sur
des souverains qui, pour plus dun demi -sicle, devaient unir les deux
couronnes. Depuis Conrad IV, qui commena rgner indpendamment en
1250, nous voyons les souverains allemands concder, par lettres, des
personnages qui ny taient pas habilits de naissance, la permission de
recevoir le baudrier de chevalerie .
Assurment les monarchies ne parvinrent pas sans peine tablir ce
monopole. Roger II de Sicile, lui-mme, fit une exception en faveur de labb
della Cava. En France, les nobles et les prlats de la snchausse de
Beaucaire prtendaient encore, en 1298, avec quel succs ? nous ne savons
au droit de crer librement des chevaliers parmi les bourgeois (296). La
rsistance fut vive surtout du ct des hauts feudataires. Sous Philippe III, la
cour du roi dut entamer une procdure contre les comtes de Flandre et de
Nevers, coupables davoir, de leur propre gr, adoub des vilains p.450
qui, en ralit, taient de fort riches personnages. Plus tard, dans les dsordres
du temps des Valois, les grands princes apanags sarrogrent, avec moins de
difficult, ce privilge. Ce fut dans lEmpire, comme il tait naturel, que la
facult douvrir ainsi de nouveaux venus laccs de la chevalerie se divisa,
finalement, entre le plus grand nombre de mains : princes territoriaux, comme,
ds 1281, lvque de Strasbourg (297) ; voire, en Italie, communes urbaines,
comme, ds 1260, Florence. Mais sagissait -il l dautre chose que du
dpcement des attributs rgaliens ? Le principe qui au seul souverain
reconnaissait le droit dabaisser la barrire r estait sauf. Plus grave tait le cas
des intrus qui, en quantit certainement considrable, mettaient profit une
situation de fait pour se glisser indment dans les rangs chevaleresques. La
noblesse demeurant, dans une large mesure, une classe de puissance et de
genre de vie, lopinion commune, en dpit de la loi, ne refusait gure au
possesseur dun fief militaire, au matre dune seigneurie rurale, au guerrier
vieilli sous le harnois, quelle que ft son origine, le nom de noble et, par suite,
laptitude ladoubement. Puis, le titre naissant, comme lordinaire, du long
usage, au bout de quelques gnrations personne ne songeait plus le
contester la famille ; et le seul espoir qui, au bout du compte, restt permis
aux gouvernements tait, en soffr ant sanctionner cet abus, de tirer de ceux
qui en avaient bnfici un peu dargent. Il nen est pas moins vrai que,
prpare au cours dune longue gestation spontane, la transformation de
lhrdit de pratique en hrdit juridique navait t rendue possible que par
laffermissement des pouvoirs monarchiques ou princiers, seuls capables la
fois dimposer une police sociale plus rigoureuse et de rgulariser, en les
Marc BLOCH La socit fodale
308
sanctionnant, les invitables et salutaires passages dordre ordre. Si le
Parlement de Paris navait t l ou sil avait manqu de la force ncessaire
lexcution de ses sentences, on naurait vu, dans le royaume, si petit sire qui
net continu distribuer, sa volont, la cole.
Il ntait alors gure dinstitution qui, aux mains de gouvernements
ternellement besogneux, ne se transformt, peu ou prou, en machine faire
de largent. Les autorisations p.451 dadoubement nchapprent pas ce sort
commun. Pas plus que les autres expditions des chancelleries, les lettres
royales, de rares exceptions prs, ntaient gratuites. Parfois aussi on payait
pour ne pas avoir prouver son origine (298). Mais Philippe le Bel semble avoir
t le premier souverain mettre, ouvertement, la chevalerie dans le
commerce. En 1302, aprs la dfaite de Courtrai, des commissaires
parcoururent les provinces, chargs de solliciter les acheteurs
danoblissement, en mme temps que de vendre, aux serfs royaux, leur libert.
On ne voit pas, cependant, que cette pratique ait t ds ce moment, en Europe
ni en France mme, bien gnrale ou quelle ait beaucoup rapport. De la
savonnette vilains , les rois, plus tard, devaient apprendre faire une des
ressources rgulires de leur trsorerie et les riches contribuables un moyen
dchapper, par une somme une fois verse, aux impts dont la noblesse
exemptait. Mais, jusque vers le milieu du XIVe sicle, le privilge fiscal des
nobles demeura encore aussi mal dfini que limpt dtat lui -mme ; et
lesprit de corps, trs puissant dans les milieux chevaleresques auxquels les
princes eux-mmes avaient conscience dappartenir net gure permis,
sans doute, de multiplier des faveurs ressenties comme autant dinsultes la
puret du sang. Si le groupe des chevaliers titre hrditaire ne stait pas,
la rigueur, ferm, la porte ntait pourtant que faiblement entrouverte
beaucoup moins aise franchir certainement quelle ne lavait t auparavant
ou ne devait ltre, lavenir. Do, la violente raction antinobiliaire qui, en
France du moins, clata au XIVe sicle. De la forte constitution dune classe et
de son exclusivit peut-on rver symptme plus loquent que lardeur des
attaques dont elle est lobjet ? Sdition des non-nobles contre les nobles :
le mot, presque officiellement employ au temps de la jacquerie, est
rvlateur. Non moins, linventaire des combattants. Riche bourgeois, premier
magistrat de la premire des bonnes ville, tienne Marcel se posait,
expressment, en ennemi des nobles. Sous Louis XI ou Louis XIV, il et t,
lui-mme, lun deux. En vrit, la priode qui stend de 1250 1400 environ
fut, sur le p.452 continent, celle de la plus rigoureuse hirarchisation des
couches sociales.
II. Constitution des descendants de chevaliers en classe privilgie
A elle seule, pourtant, la restriction de ladoubement aux membres des
familles dj confirmes dans cette vocation ou aux bnficiaires de faveurs
Marc BLOCH La socit fodale
309
exceptionnelles net pas suffi constituer une vritable noblesse. Car ctait
encore faire dpendre dun rite, qui pouvait tre ou ntre pas accompli, les
privilges dont lide nobiliaire exigeait quils fussent attachs la pure
naissance. Il ne sagissait pas que de prestige. De plus en plus, la situation
prminente que lon saccordait recon natre aux chevaliers, la fois en tant
que guerriers ordonns et que vassaux, chargs des plus hautes missions
du combat et du conseil, tendait se concrtiser en un code juridique prcis.
Or, de la fin du XIe sicle aux premires annes du XIIIe, les mmes rgles se
font cho, travers lEurope fodale. Pour jouir de ces avantages, il faut
dabord que lhomme sacquitte effectivement de ses devoirs de vassal, quil
ait armes et chevaux, que, sauf sil est retenu par la vieillesse, il prenne part
lost et aux chevauches, aux plaids et aux cours , disent les Usages catalans.
Il faut aussi quil ait t adoub. Laffaiblissement gnral des services
vassaliques eut pour effet que, peu peu, on cessa dinsister sur la premire
condition ; les textes les plus rcents la passent sous silence. La seconde, par
contre, resta longtemps bien vivante. En 1238 encore, un rglement familial
priv, le statut des pariers qui possdaient en commun le chteau
gvaudanais, de La Garde-Gurin, donne la primaut au cadet sur lan, si
celui-l a reu la chevalerie et celui-ci non. Advient-il cependant, o que ce
soit, quun fils de chevalier ait omis de se plier cette crmonie ? Est-il
demeur trop tard simple cuyer , selon le terme que, par allusion au rle
traditionnel du jeune noble auprs de ceux qui lont prcd dans la carrire,
on sest habitu employer pour dsigner cette position dattente ? Une fois
pass lge partir duquel une pareille ngligence p.453 ne semble plus permise
vingt-cinq ans en Flandre et Hainaut, trente en Catalogne , il sera,
brutalement, rejet parmi les rustres (299).
Mais le sentiment de la dignit de la race tait devenu trop imprieux pour
que ces exigences pussent ternellement se maintenir. Leur effacement
sopra par tapes. Dans la Provence, en 1235 , dans la Normandie, vers le
mme moment, cest encore au fils seulement quen dehors de toute obligation
dadoubement, on reconnat les bienfaits de la condition paternelle. A -t-il,
son tour, un fils ? Celui-ci, prcise le texte provenal, devra, sil veut
participer ces privilges, recevoir, personnellement, la chevalerie. Plus
loquente encore, en Allemagne, la srie des chartes royales concdes aux
gens dOppenheim : les mmes droits sont octroys en 1226 aux chevaliers,
depuis 1269 aux chevaliers et fils de chevaliers, en 1275 aux, chevaliers,
leurs fils et leurs petits-fils (300) ? Comment cependant ne se ft-on pas
fatigu de compter les gnrations ? Assurment la rception solennelle des
armes continuait de passer pour un devoir de rang auquel le jeune noble ne
pouvait se drober, sans dchoir un peu. On stonnait de la singulire
superstition qui, dans la dynastie des comtes de Provence, de la maison de
Barcelone, faisait retarder le plus possible cette crmonie, comme un prsage
de mort prochaine (301). Parce quelle paraissait garantir la constitution de
lquipement complet, ncessaire un bon service, les rois de France, depuis
Philippe Auguste jusqu Philippe le Bel, sefforcrent den imposer
Marc BLOCH La socit fodale
310
laccomplissement leurs sujets de familles chevaleresques. Ils ny russirent
gure : si bien quimpuissante mme tirer de la perception des amendes ou
de la vente des dispenses un procd fiscal lucratif, ladministration royale dut
finalement se contenter de prescrire, ds quune guerre pointait lhorizon, la
simple possession de larmement.
Dans les dernires annes du XIIIe sicle, lvolution tait peu prs
partout acheve. Ce qui dsormais cre le noble, ce ne sont plus les vieux
gestes dinitiation, rduits ltat dune formalit de biensance, dautant plus
mal observe, du moins par la masse, quelle entrane ordinairement de p.454
grosses dpenses ; ces t, quon la mette ou non profit, la capacit hrditaire
de prtendre au bnfice de ce rite. On appelle gentilhomme, crit
Beaumanoir, quiconque est de ligne de chevaliers . Et, lgrement
postrieure 1284, la plus ancienne autorisation dadoubeme nt accorde, par
la chancellerie des rois de France, un personnage qui ne ft pas n dans un
de ces lignages, lve dun trait, sans poser la moindre condition, toute la
postrit du rcipiendaire aux privilges, droits et franchises dont ont
coutume de jouir les nobles selon les deux lignes dascendance (302).
III. Le droit des nobles
Commun, dans la mesure o le permettaient les diffrences de sexe, aux
gentilles femmes comme aux gentilshommes, le code nobiliaire ainsi
constitu variait sensiblement, dans les dtails, selon les pays. Il ne slabora,
dautre part, que lentement et subit, au cours des temps, dimportantes
modifications. On se bornera en indiquer ici les caractres les plus
universels, tels quils se dgagrent au cours du XIIIe sicle.
Traditionnellement, les liens du vasselage taient la forme de dpendance
propre aux hautes classes. Mais ici, comme ailleurs, un tat de fait se
substitua un monopole de droit. Nagure on avait pass pour noble parce
quon tait vassal. Dsormais, par un vritable renversement de lordre des
termes, il sera impossible, en principe, dtre vassal autrement dit. de
dtenir un fief militaire, ou fief franc si lon ne figure dj parmi les
nobles de naissance. C est chose communment admise, peu prs partout,
vers le milieu du XIIIe sicle. Cependant lascension de la fortune bourgeoise
comme les besoins dargent dont les vieilles familles taient si souvent
presses ne permettaient pas de maintenir la rgle dans toute sa rigueur. Non
seulement, en pratique, elle fut trs loin dtre constamment observe ce
qui ouvrit la porte beaucoup dusurpations de noblesse en droit mme,
force fut de prvoir des exemptions. Gnrales quelquefois : ainsi, en faveur
des personnes nes dune mre noble et dun pre non noble (303). p.455
Particulires, surtout. Ces dernires, une fois de plus, tournrent au profit des
Marc BLOCH La socit fodale
311
monarchies, qui, seules capables de lgitimer de pareils accrocs lordre
social, navaient point coutume de distribuer gratuitement leurs faveurs. Le
fief tant le plus souvent une seigneurie, les pouvoirs de commandement sur
les petites gens tendaient, par ces drogations, se dtacher de la qualit
nobiliaire. Comportait-il, par contre, la soumission darrire -vassaux ? Si
ceux-ci taient gentilshommes, on ne reconnaissait ordinairement pas
lacqureur non noble le droit de requrir leur hommage ; il devait, sans gestes
de fidlit, se contenter des taxes et services. Lon rpug nait mme admettre
quil pt, son tour, comme feudataire, accomplir ce rite envers le seigneur du
degr suprieur. On rduisait la crmonie un serment de foi ou, du moins,
on en liminait le baiser, trop galitaire, jusque dans la faon de solliciter ou
de contracter lobissance, il tait des formes interdites lhomme mal n.
Les vassaux militaires, de longue date, avaient t rgis par un droit
diffrent des rgles communes. Ils ntaient pas jugs par les mmes tribunaux
que les autres dpendants. Leurs fiefs ne shritaient pas comme les autres
biens. Leur statut familial mme portait la marque de leur condition. Quand
des possesseurs de fiefs militaires fut sortie la noblesse, ce qui avait t la
coutume attache lexercice dune fonction te ndit devenir celle dun
groupe de familles. Un changement de nom est, sur ce point, instructif : l o
on avait parl autrefois de bail fodal linstitution a t dfinie au dbut
de ce volume (304) , on se prit dsormais dire, en France, garde noble .
Comme il tait naturel pour une classe qui tirait son originalit du reflet
dinstitutions trs anciennes, le droit priv des nobles conserva un tour
volontiers archaque.
Une srie dautres traits marquaient, avec plu s de vigueur encore, la
suprmatie sociale de la classe en mme temps que son caractre dordre
combattant. Sagissait -il dassurer la puret du sang ? Pas de moyen plus
efficace, videmment, que dinterdire toute msalliance. On nen vint l,
pourtant, que dans une fodalit dimportation Chypre et dans p.456 la
hirarchique Allemagne. Encore, dans ce dernier pays, caractris, nous le
verrons, par un chelonnement trs pouss lintrieur mme de la noblesse,
fut-ce seulement la couche suprieure de celle-ci, lexclusion de la petite
chevalerie issue danciens officiers seigneuriaux, qui se ferma ainsi. Ailleurs,
le souvenir de lancienne galit des hommes libres continua dexercer ses
effets, en droit, sinon en pratique, sur le plan matrimonial. Partout, en
revanche, certaines grandes communauts religieuses, qui, jusqualors,
navaient manifest leur esprit aristocratique quen cartant les postulants
dorigine servile, dcidrent de nen plus admettre que venus de la
noblesse (305). Partout aussi, on peut constater, ici plus tt, l plus tard, que le
noble est spcialement protg dans sa personne contre le non-noble ; quil est
soumis un droit pnal exceptionnel, avec des amendes ordinairement plus
lourdes que celles des gens du commun ; que le recours la vengeance prive,
considre comme insparable du port des armes, tend lui tre rserv ; que
les lois somptuaires lui attribuent une place part. Limportance attache au
Marc BLOCH La socit fodale
312
lignage, comme porteur du privilge, s exprima dans la transformation qui des
anciens signes individuels de reconnaissance , peints sur le bouclier du
chevalier ou gravs sur son sceau, fit les armoiries, parfois transmises avec le
fief, plus souvent hrditaires, mme sans le bien, de gnration en
gnration. N dabord dans les dynasties royales et princires, o lorgueil de
la race tait particulirement fort, bientt adopt par beaucoup de plus
modestes maisons, lusage de ces symboles de continuit passa dsormais
pour le monopole des familles classes comme nobles. Enfin, sans que
lexemption fiscale et encore rien de rigoureusement dfini, lobligation
militaire, dancien devoir vassalique devenue le devoir nobiliaire par
excellence, avait dores et dj pour effet de mettre le genti lhomme labri
des charges pcuniaires communes, que remplaait, son gard, la vocation
de lpe.
Quelle que ft la force des droits acquis de naissance, elle ntait pas telle,
cependant, quils ne dussent se perdre par lexercice de certaines occupa tions
censes incompatibles avec la grandeur du rang. Certes la notion de
drogeance p.457 tait loin dtre encore pleinement labore. Linterdiction de
commercer parat alors avoir t impose aux nobles surtout par certains
statuts urbains, plus soucieux, par l, de protger le quasi monopole des
bourgeoisies marchandes que de servir lorgueil dune caste adverse. Mais,
unanimement, les travaux agricoles passaient pour contraires lhonneur des
armes. Ft-ce de son propre consentement, un chevalier, dcide le Parlement
de Paris, ne saurait, sil a acquis une tenure en vilainage, se soumettre aux
corves rurales. Labourer, piocher, transporter dos dne bois ou fumier :
autant de gestes qui, selon une ordonnance provenale, entranent,
automatiquement, la privation des privilges chevaleresques. En Provence
aussi, ne caractrisait-on pas la femme noble comme celle qui ne va ni au
four, ni au lavoir, ni au moulin (306) ? La noblesse avait cess de se dfinir
par lexerci ce dune fonction : celle du fidle arm. Elle ntait plus une classe
dinitis. Elle restait, par contre, et restera toujours une classe de genre de vie.
IV. Lexception anglaise
En Angleterre, o les institutions vassaliques et chevaleresques taient
toutes dimportation, lvolution de la noblesse de fait suivit dabord peu
prs les mmes lignes que sur le continent. Mais pour sinflchir, au XII Ie
sicle, dans un sens bien diffrent.
Matres trs puissants dun royaume insulaire quils concevaien t, avant
tout, comme destin leur fournir les moyens de poursuivre des ambitions
vritablement impriales, les rois normands, puis angevins sappliqurent y
tendre au maximum les ressorts de lobligation militaire. A cette fin, ils
utilisrent concurremment deux principes, dges divers : leve en masse de
Marc BLOCH La socit fodale
313
tous les hommes libres ; service spcialis rclam aux vassaux. Ds 1180 et
1181, on voit Henri II astreindre, dabord dans ses domaines continentaux,
puis en Angleterre, ses sujets se munir chacun des armes conformes sa
condition. L assise anglaise spcifie, entre autres, celles qui seront
exiges du dtenteur dun fief de chevalier. Elle ne fait point mention
dadoubement. p.458 Cependant on considrait, nous le savons, le rite comme
une sre garantie de lquipement. Aussi, en 1224 et 1234, Henri III jugea-t-il
sage, cette fois, dobliger tout possesseur dun tel fief se plier, sans retard,
cette initiation. Du moins ce fut la restriction introduite par la seconde
ordonnance , si l hommage tait rendu directement au roi.
Jusque-l, vrai dire, il ny avait, dans ces mesures, rien qui diffrt
sensiblement de la lgislation captienne du mme temps. Comment,
cependant, le gouvernement anglais, avec ses fortes traditions administratives,
ne se ft-il pas avis de linefficacit croissante laquelle le vieux systme du
service fieff tait dsormais condamn ? Beaucoup de fiefs avaient t
morcels. Dautres passaient travers les mailles de recensements sans cesse
ritrs et toujours imparfaits. Enfin leur nombre, au total, tait forcment
limit. Ntait -il pas plus raisonnable dasseoir, rsolument, le devoir de servir
et, par suite, de sarmer sur une ralit beaucoup plus tangible : la fortune
foncire, quelle quen ft la natur e ? Tel, dailleurs, avait dj t le principe
quen 1180 Henri II stait efforc dappliquer ses tats du continent, o
lorganisation fodale ntait pas, beaucoup prs, partout aussi rgulire
quen Angleterre ou dans le duch normand. On fit de m me dans lle,
partir de 1254, en usant de critres conomiques variables, dont le dtail ici
importe peu. Mais, l o Henri II stait born parler darmement, ce fut
ladoubement que, conformment aux habitudes prises, on exigea, dornavant,
de tous les libres possesseurs dune certaine quantit de terre libre. Cela
dautant plus volontiers, sans doute, que les dsobissances prvues
promettaient au trsor royal la perspective dagrables amendes.
Mme en Angleterre, pourtant, aucune machinerie dt at ntait alors
assez bien agence pour assurer le strict respect de pareilles mesures. Ds la
fin du sicle vraisemblablement, au sicle suivant, sans conteste, elles taient
devenues peu prs inoprantes. Il fallut y renoncer ; et, de moins en moins
rgulirement pratique, la crmonie chevaleresque, comme sur le continent,
fut finalement rejete parmi les p.459 accessoires dune tiquette archasante.
Mais de la politique royale laquelle stait ajoute, par un invitable
corollaire, labsence de toute tentative pour mettre une barrire au commerce
des fiefs une trs grave consquence avait dcoul. En Angleterre
ladoubement, mtamorphos en institution censitaire, ne put servir de centre
la formation dune classe fonde sur lhrdit.
Cette classe, en vrit, ne devait jamais y voir le jour. Au sens franais ou
allemand du mot, lAngleterre mdivale neut pas de noblesse. Entendez que,
parmi les hommes libres, aucun groupe dessence suprieure ne se constitua,
pourvu dun droit particulier qui se transmt par le sang. Structure, en
Marc BLOCH La socit fodale
314
apparence, tonnamment galitaire ! A aller au fond des choses, elle reposait
cependant sur lexistence dune frontire hirarchique singulirement dure,
encore que place plus bas. Au moment mme, en effet, o, partout ailleurs, la
caste des gens nobles slevait au -dessus de la masse de plus en plus
considrable dune population qualifie de libre , en Angleterre, au
contraire, la notion de servitude avait t tendue au point de frapper de cette
tare la majorit des paysans. Sur le sol anglais, le simple freeman, en droit, ne
se distingue gure du gentilhomme. Mais les freemen eux-mmes sont une
oligarchie.
Ce nest pas dire, dailleurs, quil nexistt point, au -del de la Manche,
une aristocratie aussi puissante que dans le reste de lEurope, plus puissante
peut-tre, parce que la terre paysanne tait davantage sa merci. Ctait une
classe de possesseurs de seigneuries, de guerriers ou de chefs de guerre,
dofficiers du roi et de reprsentants ordinaire s, auprs de la monarchie, des
cours de comt : tous gens dont les modes de vie diffraient grandement et
sciemment de ceux des hommes libres du commun. Avec, au sommet, le
cercle troit des comtes et barons . Au profit de ce groupe suprme, des
privilges assez prcis avaient, vrai dire, commenc de slaborer durant le
XIIIe sicle. Mais ils taient de nature presque exclusivement politique et
honorifique. Surtout, attachs au fief de dignit, lhonneur , ils ne
passaient qu lan. En un mot la classe des gentilshommes, dans son
ensemble, demeurait, en Angleterre, plus sociale p.460 que juridique ; et
bien que, naturellement, pouvoir et revenus le plus souvent shritassent, bien
que, comme sur le continent, le prestige du sang ft ressenti avec beaucoup de
force, cette collectivit tait trop mal dfinie pour ne pas rester largement
ouverte. La fortune foncire avait, au XIIIe sicle, suffi autoriser, voire
imposer ladoubement. Un sicle et demi plus tard, ou environ, elle devait
toujours limite, selon une norme caractristique, la libre tenure
officiellement habiliter au droit dlire, dans les comts, les dputs des
Communes de la Terre . Et si de ces dputs mmes, connus sous le nom
significatif de chevaliers des comts et qui, originellement, avaient d, en
effet, tre pris parmi les chevaliers adoubs, on continua dexiger, en principe,
jusqu la fin du moyen ge, quils pussent fournir la preuve darmoiries
hrditaires, il ne semble pas que, pratiquement, aucune famille, solidement
tablie en richesse et en distinction sociale, ait jamais rencontr beaucoup de
difficult se faire reconnatre lusage de pareils emblmes (307). Point de
lettres danoblissement chez les Anglais de ce temps (la cration des baronets,
par la monarchie besogneuse des Stuarts, ne sera quune imitation tardive des
murs franaises). Il nen tait pas besoin. Le fait suffisait en tenir lieu.
Et de stre ainsi maintenue tout prs des ralits qui font le vrai pouvoir
sur les hommes, davoir chapp lankylose qui guette les classes trop bien
dlimites et trop dpendantes de la naissance, laristocratie anglaise tira, sans
doute, le meilleur dune force qui devait traverser les ges.
Marc BLOCH La socit fodale
315
CHAPITRE V
Les distinctions de classes lintrieur de la noblesse
I. La hirarchie du pouvoir et du rang
Malgr les caractres communs de la vocation militaire et du genre de
vie, le groupe des nobles de fait, puis de droit, fut toujours trs loin de
constituer une socit dgaux. De profondes diffrences de fortune, de
puissance et par suite de prestige tablissaient entre eux une vritable
hirarchie, plus ou moins gauchement exprime par lopinion dabord, plus
tard par la coutume ou la loi.
p.461
Au temps o les obligations vassaliques conservaient encore toute leur
force, ce fut lchelonnement mme des hommages que lon demanda, de
prfrence, le principe de ce classement. Au plus bas des degrs, voici dabord
le vavasseur qui, vassal de beaucoup de vassaux (vassus vassorum), nest
lui-mme le seigneur daucun autre guerrier. Du moins quand le mot, commun
tout le domaine roman, tait pris dans son sens strict. Ne pas commander ou
ne commander qu des croquants : ctait navoir droit qu une mdiocre
considration. Pratiquement, cette situation juridique concidait presque
toujours avec une fortune des plus modestes, une vie besogneuse de petit
gentilhomme rural, vou laventure. Voyez, dans l Erec de Chrtien de
Troyes, le portrait du pre de lhro ne moult pauvre tait sa cour
ou, dans le pome de Gaydon, celui du vavasseur au grand cur et la
rustique armure ; hors de la fiction, lindigente maisonne do svada, la
poursuite p.462 des coups dpe et du butin, un Robert Guiscard ; les
mendicits dun Bertrand de Born ; ou encore ces chevaliers que diverses
chartes dun cartulaire provenal nous montrent pourvus, pour tout fief, dun
manse , cest --dire de lquivalent dune tenure paysanne. Parfois, on
disait aussi, peu prs dans le mme sens, bachelier , littralement jeune
homme . Car telle tait, naturellement, la condition normale de beaucoup de
jeunes, non encore chass ou encore insuffisamment dots. Mais il arrivait
quelle se prolonget fort tard (308).
Ds que le noble devenait le chef dautres nobles, on le voyait grandir en
dignit. Aprs avoir numr les diverses indemnits dues au chevalier,
frapp, fait prisonnier ou de toutes faons maltrait : mais sil a lui -mme
deux autres chevaliers tablis sur des terres de son honneur et en maintient un
autre dans sa mesnie , disent les Usages de Barcelone, la composition sera
double (309). Notre personnage groupe-t-il, sous son fanion, une troupe
Marc BLOCH La socit fodale
316
tendue de ces fidles arms ? Le voici banneret . Regardant vers le haut et
constatant quaucun autre chelon ne le spare du roi ou du prince territorial
auquel il prte directement hommage, on le dira aussi tenant en chef,
captal ou baron.
Emprunt aux langues germaniques, ce dernier mot avait dabord pass du
sens premier d homme celui de vassal : avoir remis sa foi un
seigneur, ntait -ce pas se reconnatre son homme ? Puis on prit lhabitude
de lappliquer, plus particulirement, aux pr incipaux vassaux des grands
chefs. Il nexprimait, dans cette acception, quune suprmatie toute relative,
par rapport aux autres fidles du mme groupe. Lvque de Chester ou le sire
de Bellme avaient leurs barons, tout comme les rois. Mais, puissants entre les
puissants, les plus importants feudataires des monarchies taient, pour le
langage usuel, les barons tout court.
Presque synonyme de baron de fait, employ par certains textes
comme son exact quivalent , pourvu, cependant, ds lorigi ne, dun
contenu juridique plus prcis, le terme de pair appartenait, en propre, au
vocabulaire des institutions judiciaires. Un des privilges les plus chers du p.463
vassal tait de ntre jug, la cour de son seigneur, que par les autres vassaux
de celui-ci. Lgalit rsultant de la similitude du lien, le pair ainsi dcidait
du sort du pair . Mais, parmi les personnages qui tenaient leurs fiefs
directement du mme matre, il sen trouvait de trs divers par la puissance et
la considration. Pouvait-on admettre que, tirant argument dune prtendue
conformit de soumission, le plus petit gentilhomme obliget le riche banneret
sincliner devant ses sentences ? Une fois de plus, les consquences dun
tat de droit se heurtaient au sentiment de ralits plus concrtes. De bonne
heure, donc, on saccoutuma, en beaucoup de lieux, rserver aux premiers
dentre les faux la facult de siger dans les procs qui concernaient leurs
vritables gaux en dignit ; celle aussi doffrir leurs conseils, d ans les affaires
graves. Le cercle des pairs , par excellence, se limita ainsi, souvent par
recours un chiffre traditionnel ou mystique : sept comme les chevins dans
les juridictions publiques de lpoque carolingienne ; douze, comme les
Aptres. Il en existait dans de moyennes seigneuries celle des moines du
Mont-Saint-Michel, par exemple aussi bien que dans de grandes
principauts, telles que la Flandre ; et lpope imaginait ceux de France
groups, en nombre apostolique, autour de Charlemagne.
Mais dautres noms aussi, qui se contentaient de mettre laccent sur le
pouvoir et la richesse, remplissaient la bouche des chroniqueurs ou des potes,
quand ils voquaient les figures des grands aristocrates. Magnats ,
poestatz , demeines leur semblaient dominer de trs haut la foule
chevaleresque. Car les antagonismes de rang taient, en vrit, trs abrupts,
lintrieur mme de la noblesse. Lorsquun chevalier a fait tort un autre
chevalier, exposent les Usages catalans, si le coupable est suprieur la
victime, on ne saurait exiger de lui, en personne, lhommage expiatoire (310).
Dans le Pome du Cid, les gendres du hros, issus dune ligne comtale,
Marc BLOCH La socit fodale
317
tiennent pour une msalliance leur mariage avec les filles dun simple fidle :
Nous ne devions pas les prendre mme pour concubines, moins den tre
pris. Pour dormir dans nos bras, elles ntaient pas nos gales. Inversement,
les mmoires du pauvre chevalier picard, p.464 Robert de Clary, sur la
quatrime croisade, nous ont conserv laigre cho des rancunes longuement
nourries par le commun de Post contre li hauts hommes , li rikes
hommes , li barons .
Au XIIIe sicle, ge de clart et de hirarchie, il tait rserv de chercher
faire de ces distinctions, jusque-l plus vivement ressenties que dfinies avec
prcision, un systme rigoureusement conu. Non, chez les juristes, sans un
certain excs desprit gomtrique, qui sadaptait mal des ralits demeures
beaucoup plus souples. Avec, aussi, entre les volutions nationales de fortes
dissemblances. On se bornera ici, comme dhabitude, aux exemples les plus
caractristiques.
En Angleterre, o du vieux devoir fodal de cour laristocratie avait su
tirer un instrument de gouvernement, le mot de baron continua de dsigner
les principaux feudataires du roi, appels son Grand Conseil en vertu
dun monopole de fait qui peu peu se mua en une vocation strictement
hrditaire. Ces personnages se plaisaient galement se parer du nom de
pairs de la terre et parvinrent, en fin de compte, en imposer
officiellement lusage (311).
En France, au contraire, les deux termes divergrent grandement. On ny
avait pas cess de parler de vavasseurs et de barons. Mais ctait,
couramment, pour exprimer une simple diffrence de fortune et de
considration. La dcadence du lien vassalique enlevait toute porte aux
critres tirs de la superposition des hommages. Afin de tracer, cependant, de
lune lautre cond ition une plus nette frontire, les techniciens imaginrent
den demander le principe la gradation des pouvoirs judiciaires : lexercice
de la haute justice distingua la baronnie ; le fief du vavasseur tait rduit la
basse ou la moyenne. En ce sens auquel le langage usuel, dailleurs, ne se
rallia jamais sans rserves , il y avait, dans le pays, une multitude de barons.
Trs peu de pairs de France, par contre. Car, linfluence de la lgende pique
favorisant le chiffre douze, les six plus importants vassaux du Captien
russirent, concurremment avec les six plus puissants vques ou archevques
dont les glises dpendaient directement du roi, sattribuer le bnfice p.465
exclusif de ce titre. Quitte, du reste, nobtenir quun beaucoup plus mdio cre
succs dans leurs efforts pour en dduire des privilges pratiques : leur droit
mme ntre jugs quentre eux dut accepter pour limite la prsence, au
tribunal, dofficiers de la couronne. Ils taient trop peu nombreux, leurs
intrts de grands princes territoriaux taient trop trangers ceux de la haute
noblesse, dans son ensemble, et trop extrieurs au royaume mme, pour quil
leur ft possible de faire passer dans le domaine des ralits politiques une
prminence condamne demeurer toute dt iquette. Aussi bien, trois sur six
des pairies laques primitives stant teintes au cours du sicle, par suite du
Marc BLOCH La socit fodale
318
retour au domaine royal des fiefs qui leur avaient servi de base, les rois
commencrent, partir de 1297, en crer, de leur propre autorit, de
nouvelles (312). A lge des formations nobiliaires spontanes succdait celui
o, du haut en bas de lchelle sociale, ltat dsormais allait dtenir le
pouvoir de fixer et de changer les rangs.
Telle est galement la leon quimpose, en France, lhistoire des titres de
dignit. De tout temps les comtes avec les ducs ou marquis, chefs chacun
de plusieurs comts avaient figur au premier rang des magnats. A ct
deux, les membres de leurs lignes, quon appelait, dans le Midi, comtors .
Mais, drivs de la nomenclature franque, ces termes, originellement,
exprimaient un genre de commandement bien dfini. Ils sappliquaient,
exclusivement, aux hritiers des grands honneurs de lpoque
carolingienne, nagure offices publics, fiefs maintenant. Si quelques
usurpations, pourtant, staient de bonne heure produites, elles avaient port,
en premier lieu, sur la nature du pouvoir lui-mme ; le mot, aprs coup, avait
suivi la chose. Peu peu, cependant, nous le verrons, le faisceau des droits
comtaux se fragmenta, au point de se vider de tout contenu spcifique. Les
dtenteurs des divers comts avaient beau continuer possder de nombreux
droits quils avaient, en fait, hrits de leurs anctres fonctionnaires ; comme
la liste en variait fortement, dun comt lautre, et que rarement les comtes
en avaient labsolu monopole, on nen ramenait plus lexercice la notion
dune autorit comtale, de p.466 caractre universel. Le nom subsistait
seulement, en somme, comme le signe, dans chaque cas particulier, de
beaucoup de puissance et de prestige. Il ny avait donc plus de raison valable
pour en limiter lemploi aux successeurs des gouverneurs provinciaux de
temps trs lointains. Depuis 1338 au plus tard, les rois se prirent faire des
comtes (313). Ainsi dbutait une classification dtiquette qui, archasante par
son langage, neuve dans son esprit, devait aller, par la suite, se compliquant de
plus en plus.
Entendons bien, dailleurs, que ces deg rs dans lhonneur et parfois, le
privilge nentamaient point trs profondment, dans la noblesse franaise,
lunit de la conscience de classe. Si, en face de lAngleterre, o il nexistait
point de droit des gentilshommes, distinct de celui des hommes libres, la
France du XIIIe sicle pouvait faire figure dune socit hirarchisante, du
moins y tait-il, ce droit spcifique, commun, dans ses lignes essentielles,
toutes les personnes habilites la chevalerie. Le dveloppement, en
Allemagne, sorienta dans un sens bien diffrent.
Au point de dpart, sinscrit une rgle particulire la fodalit allemande.
De bonne heure, semble-t-il, on considra que, sous peine de dchoir, un
personnage, dun niveau social dtermin, ne pouvait tenir un fief de qui tait
cens son infrieur. En dautres termes, alors quailleurs la gradation des
hommages fixait les rangs, ctait ici sur une distinction de classes
prexistante que devait se modeler leur chelonnement. Bien quil ne ft pas
toujours strictement respect par la pratique, ce rigoureux ordonnancement
Marc BLOCH La socit fodale
319
des boucliers chevaleresques exprimait, avec beaucoup de force, lesprit
dune socit qui, nayant accept quavec quelque rpugnance les liens
vassaliques, refusait du moins de les laisser venir la traverse dun sentiment
hirarchique, solidement enracin. Restait tablir les degrs. Au sommet de
laristocratie laque, on saccordait placer ceux quon appelait les
premiers , Frsten. Les textes latins traduisent par principes et lhabitude
ses t introduite de dire, en franais, princes . L encore, il est
caractristique que le critre nait pas t demand, originellement, aux
relations proprement fodales. Car lusage primitif fut de comprendre sous
p.467 ce nom tous les titulaires de pouvoirs comtaux, lors mme quayant reu
linvestiture dun duc ou dun vque, ils ne figuraient point parmi les vassaux
directs du roi. Dans cet Empire, o lempreinte carolingienne tait demeure
si vive, le comte, quel que ft le seigneur qui lui avait infod sa dignit,
passait toujours pour exercer son office au nom de la monarchie. Tous les
princes, ainsi dfinis, sigeaient aux grandes cours o les rois taient lus.
Cependant, vers le milieu du XIe sicle, la fois la puissance croissante
des grands chefs territoriaux et limprgnation, de plus en plus sensible, des
institutions allemandes par un esprit vritablement fodal amenrent un
dplacement trs marqu de la frontire des rangs. Par une restriction
doublement significative, on shabitua dorn avant borner le titre princier aux
feudataires directs du roi ; et, dans leur nombre mme, ceux qui tendaient
leur suprmatie sur plusieurs comts. Seuls, galement, ces magnats du
premier ordre furent, avec leurs confrres ecclsiastiques, admis lire le
souverain. Du moins jusquau jour o, trs vite, une seconde scission fit
surgir, au-dessus deux, un groupe, plus rduit encore, dlecteurs ns. La
nouvelle classe des princes laques, lecteurs compris, forma dfinitivement,
derrire le roi et les princes dglise qui taient les vques et les grands
abbs dpendant immdiatement de la monarchie , le troisime degr des
boucliers . L non plus, vrai dire, lingalit nallait pas si loin que,
notamment par la facult des intermariagcs, quelque chose ne subsistt
longtemps dune sorte dunit interne, dans la noblesse. Cela sous rserve,
toutefois, dun dernier chelon chevaleresque, qui, en tant que groupe
juridique, sinon comme couche sociale, fut hautement caractristique de
lempilement des rangs propre, alors, la socit allemande : la ministrialit
ou chevalerie servile.
II. Sergents et chevaliers serfs
Un puissant ne vit pas sans serviteurs, ne commande pas sans seconds. A
la plus modeste seigneurie rurale, il fallait un reprsentant du matre pour
diriger la culture du domaine, p.468 requrir les corves et en contrler
lexcution, lever les redevances, veiller au bon ordre parmi les sujets.
Souvent ce maire , ce bayle , ce Bauermeister, ce reeve disposait, son
Marc BLOCH La socit fodale
320
tour, d adjoints. A vrai dire, on pouvait concevoir que des fonctions aussi
simples fussent, tout bonnement, exerces par roulement entre les tenanciers,
voire que ceux-ci fussent appels en dsigner eux-mmes, dans leurs rangs,
les titulaires provisoires. Il en fut ainsi trs frquemment, en Angleterre. Sur le
continent, par contre, ces tches, remplies l aussi, comme il tait naturel, par
des paysans, nen constituaient pas moins, presque toujours, de vritables
charges, durables, rmunres et soumises, exclusivement, la nomination du
seigneur. Dans sa maison mme, dautre part, le hobereau, comme le baron,
groupait en nombre, cela va de soi, extrmement variable selon sa fortune ou
son rang, tout un petit monde de valets, douvriers attachs aux ateliers de la
cour , dofficiers qui aidaient gouverner les hommes ou le mnage. Entre
ces faons de servir, du moment quelles ne se classaient pas sous lhonorable
rubrique des obligations chevaleresques, le langage distinguait mal. Artisans,
membres de la menue domesticit, messagers, administrateurs des terres,
chefs du personnel, dans lentourage direct du chef : pour tous, les mots
taient les mmes. Langue internationale, le latin des chartes disait,
communment, ministeriales ; le franais, sergents lallemand,
Dienstmnner (314).
Comme lordinaire, deux procds soffraient pour rmunrer ces
diverses charges : lentretien par le matre ou la tenure qui, ici, tant greve de
tches professionnelles, sappelait fief. A la vrit, pour les sergents ruraux, la
question ne se posait gure. Paysans et, par leurs fonctions mmes, retenus
loin de leur beaucoup plus nomade seigneur, ils taient, par dfinition, des
tenanciers ; leurs fiefs , primitivement du moins, ne se distinguaient gure
des censives environnantes que par quelques exemptions de taxes et de
corves, contrepartie naturelle des obligations spciales qui pesaient sur
lhomme. Un certain pourcentage, prlev sur les redevances dont la
perception leur incombait, compltait leur salaire. Le rgime de la provende
sadaptait p.469 assurment beaucoup mieux aux conditions de vie, soit des
artisans domestiques, soit des officiers de la maisonne. Cependant
lvolution qui avait entran le chasement de tant de vassaux se
reproduisit au degr infrieur du service. Un grand nombre des ministriaux
de ce type furent de bonne heure, eux aussi, fieffs ; ce qui, dailleurs, ne les
empchait nullement de continuer demander une part apprciable de leurs
revenus aux distributions coutumires de vivres et de vtements.
Parmi les sergents, de toute catgorie, beaucoup taient de statut servile.
La tradition remontait trs haut : de tout temps, des esclaves staient vus
chargs, dans la maison du matre, de missions de confiance, et lon sait que
plus dun, lpoque franque, avait ainsi russi se glisser dans les rangs de
la primitive vassalit. Mais surtout, mesure que se dveloppaient les
relations de sujtion personnelle et hrditaire, dsormais qualifies de
servitude, ctait, trs naturellement, aux dpendants de cette nature que le
seigneur remettait, de prfrence, les offices dont il ne rservait pas le
monopole ses vassaux. Plus que lhomme libre, ne semblaient -ils point, par
Marc BLOCH La socit fodale
321
lhumilit de leur condition, par la rigueur de lattache, par limpossibilit o
ils taient, ds la naissance, de secouer le joug, offrir la garantie dune
prompte et stricte obissance ? Si la ministrialit servile ne fut jamais toute la
ministrialit une fois de plus constatons que cette socit navait rien dun
thorme , son importance croissante, au premier ge fodal, ne saurait faire
de doute.
Dun personnage qui, employ dabord comme pelletier par les moines de
Saint-Pre de Chartres, obtint ensuite dtre prpos la ga rde de leur cellier,
la notice contemporaine dit : il avait voulu monter plus haut . Mot, dans sa
navet, minemment symptomatique ! Unis par la notion dun genre de
service commun quexprimait la communaut du nom, frapps, en outre, pour
la plupart, de la mme macule servile, les sergents nen constituaient pas
moins un monde, non seulement bigarr, mais aussi et de plus en plus
hirarchis. Les fonctions taient trop diverses pour ne pas entraner de fortes
ingalits dans le genre de p.470 vie et la considration. Sans doute, charges
pareilles, le niveau atteint dpendait beaucoup, dans chaque cas, des usages
particuliers au groupe, des opportunits ou de ladresse de lhomme. Dune
faon gnrale, cependant, trois traits levrent le plus grand nombre des
maires ruraux, dune part, les principaux officiers de cour, de lautre, fort
au-dessus du menu fretin des titulaires de petites sergenteries rurales, des
serviteurs proprement dits et des artisans domestiques : la fortune, la
participation aux pouvoirs de commandement et le port des armes.
Paysan, le maire ? Oui certes, au dbut du moins et quelquefois jusquau
bout. Mais, ds le principe, un paysan riche et que ses fonctions enrichirent de
plus en plus. Car les profits licites taient dj apprciables et plus encore,
sans doute, ceux qui tenaient du simple abus. En ce temps o le seul pouvoir
efficace tait le pouvoir proche, comment les usurpations de droits qui de tant
de hauts fonctionnaires royaux firent, pratiquement, des souverains pour leur
propre compte, ne se seraient-elles pas rptes, au bas de lchelle, dans
lhumble cadre du village ? Dj Charlemagne manifestait envers les maires
de ses villae une juste mfiance : ne recommandait-il point dviter de les
prendre parmi des hommes trop puissants ? A vrai dire, si quelques
rapaces , et l, russirent substituer totalement leur autorit celle de
leur seigneur, des excs si clatants demeurrent toujours exceptionnels.
Combien, en revanche, de produits indment gards aux dpens des greniers
ou des coffres seigneuriaux ? Domaine abandonn aux sergents, domaine
perdu, enseigne le sage Suger. Combien, surtout de redevances ou de corves
qu son seul bnfice ce tyranneau rural extorque aux vilains ; de poules
prleves sur leurs basses-cours, de setiers de vin rclams leurs caves ou de
tranches de lard leurs celliers, de travaux de tissage imposs leurs
femmes ! Simples cadeaux, souvent, lorigine, que tout cela ; mais qui ne se
refusaient gure et que la coutume se chargeait bien vite, son ordinaire, de
transformer en devoirs. Il y a plus : ce rustre dorigine est, dans sa sphre, un
matre. Sans doute ordonne-t-il, en principe, au nom dun plus puissant que
Marc BLOCH La socit fodale
322
lui, Ce nen est pas moins p.471 ordonner. Mieux encore il est un juge. Il
prside, seul, les cours paysannes. Il sige, parfois, pour de plus graves procs,
au ct de labb ou du baron. Il possde, parmi ses attributions, celle de
tracer, entre les champs, les limites contestes ; des mes paysannes, quelle
fonction plus lourde de respect que celle-l ? Enfin, au jour du danger, le voici
qui chevauche en tte du contingent des manants. Auprs du duc Garin, navr
mort, le pote na su placer de meilleur serviteur quun maire fidle.
Assurment, lascen sion sociale eut ses degrs, infiniment variables.
Comment, cependant, mettre en doute les leons de tant de chartes, de tant de
chroniques monastiques, dont les lamentations se font cho, toutes pareilles,
depuis lAlmanie jusquau Limousin, et, avec ell es, le tmoignage des
fabliaux mmes ? Un portrait sen dgage, dont les vives couleurs neussent
pas t vraies partout, mais ltaient souvent : celui, si lon veut, du maire
heureux. Il ne jouit pas seulement dune large aisance. Sa fortune, en soi, na
plus rien de celle dun paysan. Il possde des dmes, des moulins. Il a tabli
sur ses propres terres des tenanciers, voire des vassaux. Sa demeure est une
maison forte. Il shabille comme un noble . Il entretient des chevaux de
guerre dans ses curies, et, dans son chenil, des chiens de chasse. Il porte
lpe, le bouclier et la lance.
Riches aussi par leurs fiefs et par les cadeaux constamment reus, les
principaux sergents qui formaient, autour des barons, comme ltat -major de
la ministrialit taient levs plus haut encore en dignit par la proximit o
ils se trouvaient du matre, par les importantes missions que celui-ci tait
conduit leur confier, par leur rle militaire de cavaliers descorte, voire de
commandants de petites troupes. Ils taient, auprs du sire de Talmont, par
exemple, ces chevaliers non nobles quune charte du X Ie sicle mentionne,
ct des chevaliers nobles . Ils sigeaient aux cours de justice et aux
conseils ; ils servaient de tmoins aux actes juridiques les plus graves. Tout
cela tait vrai, parfois, mme de personnages que la modestie de leurs
fonctions et sembl confiner, dcidment, dans la valetaille. Ne voit-on pas
les sergents de cuisine des moines dArras participer p.472 aux jugements ?
le serrurier des moines de Saint-Trond, qui tait, en mme temps, leur vitrier
et leur chirurgien, sefforcer de transformer sa tenure en libre fief
chevaleresque ? Cela tait cependant beaucoup plus vrai encore, et plus
gnralement, de ceux quon peut nommer le s chefs de service : le snchal,
charg en principe de lapprovisionnement, le marchal, qui incombait le
soin des curies, le bouteiller, le chambellan.
Originellement, la plupart de ses offices domestiques avaient t remplis
par des vassaux, le plus souvent non chass, jusquau bout la frontire entre
les attributions rserves aux vassaux et celles qui leur chappaient demeura
trs flottante. A mesure cependant que la vassalit, grandie en honneur,
scartait davantage de ses caractres primitifs, q uen outre la pratique du fief,
en se gnralisant, dispersait lancien groupe mnager des suivants darmes,
les seigneurs, de tout rang, shabiturent remettre, de prfrence, les charges
Marc BLOCH La socit fodale
323
de leur entourage des dpendants de plus basse naissance, plus proches et
jugs plus maniables. Que dsormais labb, cessant de distribuer des
bienfaits des hommes libres, nen concde plus quaux ministriaux de
lglise, prescrit, en 1135, un diplme de lempereur Lothaire pour
Saint-Michel de Lunebourg. Dans cette socit qui, ses premiers pas, avait
tant attendu de la fidlit vassalique, les progrs de la ministrialit de cour
furent un symptme de dsillusion. Entre les deux types de service et les deux
classes de serviteurs, une vritable concurrence stablit ainsi, dont la
littrature pique ou courtoise nous a conserv lcho. Il faut entendre en
quels termes le pote Wace flicite un de ses hros de navoir jamais donn
qu des gentilshommes les mtiers de sa maison . Mais voici, dans un
autre pome, un portrait, fait galement pour plaire au public des chteaux,
puisque lhomme finalement se rvlera un tratre, en lui-mme,
nanmoins, pris certainement une ralit familire : On voyait l un baron
que Girard tenait pour le plus fidle des siens. Il tait son serf et son snchal
pour maint chteau (315).
De ces premiers dentre les sergents, tout contribuait faire un groupe
social dlimit, vers le bas du moins, par de p.473 nets et stables contours.
Lh rdit dabord car, en dpit des efforts contraires, tents, notamment, par
les glises, la plupart des fiefs de sergenterie taient rapidement devenus, en
droit frquemment, en pratique presque toujours, transmissibles de gnration
en gnration : le fils succdait, simultanment, la terre et la fonction.
Lhabitude, ensuite, des intermariages, que lon suit trs aisment, ds le XI Ie
sicle, par les actes dchanges de serfs, conclus entre deux seigneurs
diffrents : le fils ou la fille du maire, ne trouvant pas, dans son village, de
conjoint de son rang, force lui tait den chercher dans la seigneurie voisine.
Ne vouloir se marier que dans son monde , saurait-il tre manifestation
plus loquente dune conscience de classe ?
Ce groupe, pourtant, en apparence si solidement constitu, souffrait dune
curieuse antinomie interne. Bien des traits le rapprochaient de la noblesse
des vassaux : les pouvoirs, les murs, le type de fortune, la vocation militaire.
Celle-ci, souvent, avait entran ses consquences naturelles dans le domaine
des gestes juridiques. Dune part, lusage de lhommage de bouche et de
mains : si les fiefs ministriaux taient loin de le comporter tous, beaucoup,
entre les plus importants, avaient paru imposer ce rite de la fidlit arme. De
lautre, linitiation chevaleresque : parmi les maires et les officiers de cour, il
se rencontrait plus dun chevalier adoub. Mais ces chevaliers, ces puissants,
ces adeptes de la vie noble taient, pour le plus grand nombre, en mme temps
des serfs : soumis, en tant que tels, la mainmorte et linterdiction du
formariage (sauf drogations, toujours coteuses) ; exclus, sauf
affranchissement, des ordres sacrs ; privs du droit de tmoigner en justice
contre les hommes libres ; frapps surtout de lhumiliante tare dune
subordination trangre tout choix. En un mot, les conditions de droit
Marc BLOCH La socit fodale
324
dmentaient brutalement les conditions de fait. Sur les solutions donnes, en
fin de compte, ce conflit les volutions nationales divergrent profondment.
La socit anglaise fut celle o, mme comme simple milieu social, la
ministrialit, de tout temps, joua le moindre rle. Les sergents villageois, on
la vu, ntaient pas, en p.474 rgle gnrale, des spcialistes. Les officiers de
cour ne se recrutaient ordinairement point parmi les trop humbles et trop rares
bondmen ; plus tard, soustraits, par dfinition, aux corves rurales, il ne put
tre question de les ranger parmi les vilains. Ils chappaient, en consquence,
pour la plupart, lanci enne forme de la servitude comme la nouvelle.
Hommes libres, ils jouirent simplement du droit commun des hommes libres ;
adoubs sils ltaient , de la considration particulire aux chevaliers.
La doctrine juridique se contenta dlaborer les rgles propres aux fiefs de
sergenteries, distingus des fiefs exclusivement militaires, et, surtout,
sattacha tablir, parmi les premiers, une ligne de dmarcation de plus en
plus nette entre les plus grands et les plus honorables, qui, par l-mme,
astreignaient lhommage, et les petits , peu prs assimils aux libres
tenures paysannes.
En France, une scission se produisit. Les moins puissants ou les moins
chanceux dentre les maires restrent simplement de riches paysans, parfois
transforms en fermiers du domaine et des droits seigneuriaux, parfois aussi
peu peu dtachs de tout rle administratif. Car, lorsque les conditions
conomiques eurent de nouveau permis le recours au salaire, beaucoup de
seigneurs rachetrent les charges, afin de confier dsormais la gestion de leurs
terres, moyennant traitement, de vrais fonctionnaires. Parmi les officiers des
cours baronales, un certain nombre, mls depuis longtemps au gouvernement
des seigneuries urbaines, prirent place, finalement, dans le patriciat bourgeois.
Beaucoup dautres, par contre, avec les plus favoriss des sergents ruraux,
pntrrent dans la noblesse au moment o celle-ci se constituait en classe
juridique. Les prludes de cette fusion staient esquisss de bonne heure,
notamment sous la forme de mariages, de plus en plus frquents, entre les
lignages de ministriaux et ceux de la vassalit chevaleresque. Dans les
msaventures du chevalier qui, dorigine servile, cherche faire oublier cette
tare, pour retomber, au bout du compte, sous la dure poigne de son matre, les
chroniqueurs, comme les anecdotiers, trouvrent, au XIIe sicle, un thme
familier.
p.475 Le servage, en effet, dressait la seule barrire qui pt sopposer
efficacement une assimilation prpare par tant de caractres communs. En
un sens, lobstacle pouvait sembler, depuis le XII Ie sicle, plus infranchissable
que jamais. Car, par une rupture significative avec un usage presque
immmorial, la jurisprudence, partir de cette date, dcida de considrer
ladoubeme nt comme incompatible avec la servitude : tant le sentiment
hirarchique avait pris de vivacit. Mais on tait aussi lpoque du grand
mouvement des affranchissements. Mieux pourvus dargent que le commun
des serfs, les sergents, partout, furent des premiers acheter leur libert. Rien
Marc BLOCH La socit fodale
325
nempchait donc, dornavant, que, le droit sadaptant au fait, ceux dentre
eux qui taient les plus proches de la vie chevaleresque et comptaient dj,
souvent, des anctres adoubs naccdassent de plain -pied lordre des
personnes habilites de naissance la chevalerie. Rien non plus, puisquils y
entraient dbarrasss de toute macule, ne les marquait, dans ses rangs, dune
note distinctive. Ils devaient former la souche dune bonne part de la petite
gentilhommerie campagnarde et ny restrent pas toujours confins. Les ducs
de Saulx-Tavannes, qui figuraient, vers la fin de lAncien Rgime, au plus
haut de laristocratie dpe, descendaient dun prvt du sire de Saulx,
affranchi par celui-ci en 1284 (316).
En Allemagne, le groupe des Dienstmnner de cour, avec quelques
sergents ruraux, prit de bonne heure une importance exceptionnelle. La
relation vassalique navait sans doute jamais tenu, dans la socit allemande,
une place aussi prpondrante que dans la France du Nord et en Lotharingie.
Quen tout cas la dcadence du lien y ait t prompte et quon ne se soit gure
proccup de lui chercher remde, labsence de leffort de redressement que
fut ailleurs lhommage lige en fournit la preuve manifeste. Plus que dans nul
autre pays, il y parut donc souhaitable de confier des dpendants non libres
les charges des maisons seigneuriales. Ds le dbut du XIe sicle, ces serfs
de vie chevaleresque , selon lexpression dun texte alaman, taient , autour
des principaux magnats, si nombreux, lesprit de solidarit qui animait leurs
turbulentes petites socits tait si vif p.476 quenregistrant et fixant leurs
privilges, toute une srie de coutumes de groupes staient cres, bientt
mises par crit et toutes prtes se confondre en une coutume de classe. Leur
sort paraissait ce point digne denvie quau sicle suivant on vit plus dun
homme libre, de rang honorable, entrer en servitude pour accder la
ministrialit. Ils jouaient un rle de premier plan dans les expditions
militaires. Ils peuplaient les tribunaux, admis, daprs une dcision de la dite
dEmpire, former les cours des princes, pourvu qu ct deux sigeassent
au moins deux nobles . Ils tenaient dans les conseils des grands une telle
place que la seule condition mise, par une sentence impriale de 1216,
lalination, par lempereur, de lhommage dune principaut tait, avec
lassentiment du prince lui -mme, celui de ses ministriaux. Ils prenaient part,
quelquefois, dans les seigneuries dglise, llection de lvque ou de
labb et, quand ce dernier sabsentait, tyrannisaient les moines.
Au premier rang se plaaient les Dienstmnner du souverain. Car les
grands offices de cour, que les Captiens confiaient aux membres de lignages
vassaliques, ctait de simples sergents, ns dans la servitude, que les
remettaient leurs voisins dAllemagne. Philippe Ier de France, sans doute, avait
pris un serf comme chambellan (317). Mais la charge tait relativement modeste
et le cas demeura, semble-t-il, exceptionnel. Pour snchal, le roi franais a
parfois un haut baron ; pour marchaux, rgulirement, de petits nobles
dentre Loire et Somme. En Allemagne o, au vrai dire, les changements
de dynastie et, comme nous le verrons, certaines particularits dans la
Marc BLOCH La socit fodale
326
structure de ltat empchrent les rois de se crer jamais une Ile -de-France,
rservoir dune fidle et stable gentilhommerie , il ntait normalement de
snchaux comme de marchaux dEmpi re que choisis dans la condition
servile. Assurment il y eut, chez laristocratie, des rsistances qui, refltes,
comme lordinaire, par la littrature des cours, semblent avoir t lorigine
de certaines rbellions. En dpit de tout, les ministriaux formrent, jusquau
bout, lentourage habituel des Saliens et des Staufen. A eux, lducation des
jeunes princes, la garde des plus importants chteaux, quelquefois, en Italie
p.477 du moins, les grands commandements ; eux, aussi, la plus pure tradition
de la politique impriale. Dans lhistoire de Barberousse et de ses premiers
successeurs, peu de figures slvent aussi haut que la rude silhouette du
snchal Markward dAnweiler, qui mourut rgent de Sicile : il navait t
affranchi quen 1197, le jo ur o son matre linvestit du duch de Ravenne et
du marquisat dAncne.
Il va de soi que nulle part le pouvoir et le genre de vie ne mettaient ces
parvenus plus prs du monde des vassaux. On ne les vit point cependant, ici,
sinsrer, presque insensible ment, dans la noblesse dorigine vassalique. Pour
cela, ils taient trop nombreux ; leur caractre de classe tait, de par les
coutumes propres qui les rgissaient, trop anciennement accentu ; trop
dimportance sattachait encore, en Allemagne, la vieil le notion de la libert
de droit public ; enfin lopinion juridique allemande avait trop le got des
distinctions hirarchiques. La chevalerie ne fut pas interdite aux serfs. Mais
les chevaliers-serfs quelquefois, par un surcrot de raffinement, diviss
eux-mmes en deux couches superposes formrent, dans la classe
gnrale des nobles, un chelon part : le plus bas. Et nul problme ne donna
aux thoriciens comme la jurisprudence plus de tablature que de dcider du
rang exact qu ces personnages, s i puissants et pourtant frapps dune telle
tare, il convenait dattribuer par rapport aux hommes libres du commun. Car,
trangers tant de raisons qui faisaient le prestige des ministriaux, bourgeois
et simples manants nen taient pas moins, aprs tout , leurs suprieurs par la
puret de la naissance. La difficult tait grave, notamment, quand il sagissait
de composer les tribunaux. Quaucun homme de condition servile ne soit,
lavenir, tabli pour vous juger : cette promesse se lit encore dans le
privilge que Rodolphe de Habsbourg accorda aux paysans de la primitive
Suisse (318).
Un jour vint toutefois o, comme en France, mais selon le dcalage
habituel entre les deux volutions avec un sicle ou un sicle et demi de
retard, linvitable sopra. Les moins heureuses parmi les familles de
Dienstmnner taient demeures dans la riche paysannerie ou staient
glisses dans la bourgeoisie des villes. Celles qui avaient eu p.478 accs la
dignit chevaleresque ne furent dsormais plus spares par aucune marque
propre, sinon de la plus haute noblesse car le droit nobiliaire allemand resta
jusquau bout fidle lesprit de caste , du moins de la chevalerie dorigine
libre. L encore et telle est, sans doute, la leon la plus importante
Marc BLOCH La socit fodale
327
quapporte lhistoire de la ministrialit la tradition juridique avait
finalement baiss pavillon devant les ralits.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
328
CHAPITRE VI
Le clerg et les classes professionnelles
I. La socit ecclsiastique dans la fodalit
Entre les clercs et les gens du sicle, la frontire ntait pas, lre
fodale, cette ligne nette et ferme que la rforme catholique, vers le temps du
Concile de Trente, devait sefforcer de tracer. Tout un peuple de tonsurs ,
dont la condition demeurait mal dfinie, formait sur les confins des deux
ordres, une marge de couleur indcise. Le clerg nen constituait pas moins,
minemment, une classe juridique. Car il se caractrisait, en son ensemble, par
un droit trs particulier et des privilges de juridiction jalousement dfendus.
Il navait, par contre, rien dune classe sociale. Dans ses rangs coexistaient des
types humains infiniment divers par les modes de vie, la puissance et le
prestige.
p.479
Voici dabord la foule des moines, tous fils de saint Benot , mais
soumis, en fait, des formes de plus en plus varies de la primitive loi
bndictine : monde divis et vibrant, sans cesse ballott entre la pure ascse
et les soucis plus terre terre quimposaient la gestion dune riche fortune,
voire lhumble hantise du pain quotidien. Ne limaginons point, dailleurs,
spar du peuple laque par dinfranchissables barrires. Les rgles mmes
quinspirait le plus intransigeant esprit de solitude durent toujours sincliner,
au bout du compte, devant les ncessits de laction. Des moines ont cure
dmes, dans des paroisses. Des monastres ouvrent leurs coles des lves
qui jamais ne revtiront p.480 la coule. Depuis la rforme grgorienne, surtout,
les clotres sont une ppinire dvques ou d e papes.
Tout au bas du clerg sculier, les desservants des paroisses rurales,
mdiocrement instruits et dots de maigres revenus, mnent une vie assez peu
diffrente, en somme, de celle de leurs ouailles. Avant Grgoire VII, ils
avaient t presque tous maris. Mme aprs le passage du grand souffle
asctique dchan comme le dit un texte monastique par ce
prcepteur de choses impossibles (319), la prtresse , compagne de fait et
parfois de droit, devait continuer longtemps figurer parmi les personnages
familiers du folklore villageois. Si bien quici le mot de classe ntait pas loin
de pouvoir tre pris dans son sens le plus prcis : les dynasties de prtres, dans
lAngleterre de Thomas Becket, ne semblent pas avo ir t beaucoup plus rares
que, de nos jours, dans les pays orthodoxes, les lignes de popes, ni,
dailleurs, en rgle gnrale, moins honorables (320). Puis, aux chelons
Marc BLOCH La socit fodale
329
suprieurs, cest le milieu plus ais et plus raffin des curs des villes, des
chanoines groups lombre de la cathdrale, des clercs ou dignitaires des
cours piscopales.
Enfin, au sommet, tablissant, en quelque sorte, la liaison entre les deux
hirarchies, rgulires et sculires, se dressent les prlats : abbs, vques,
archevques. Par la fortune, le pouvoir, la vocation du commandement, ces
grands seigneurs dglise taient au niveau des plus hauts barons dpe.
Or le seul problme qui ait ici lieu de nous occuper est dordre social.
Cette collectivit des serviteurs de Dieu, dont la mission, hrite dune
tradition dj ancienne, demeurait, en principe, trangre toute
proccupation temporelle, force lui fut bien, pourtant, de trouver sa place dans
la structure caractristique de la socit fodale. Jusqu quel point, tout en
ragissant, son tour, sur les institutions ambiantes, en subit-elle, elle-mme,
linfluence ? En dautres termes, puisque les historiens se sont habitus
parler de la fodalisation de lglise, quel sens concret convie nt-il
dattribuer cette formule ?
Retenus par les devoirs de la liturgie ou de lascse, par le gouvernement
des mes ou par ltude, il tait impossible aux clercs de demander leur
subsistance un travail p.481 directement productif. Les rnovateurs du
monachisme tentrent, diverses reprises, damener les religieux ne se
nourrir que des fruits de champs cultivs de leurs bras. Toujours lexprience
se heurta la mme difficult fondamentale : le temps donn ces besognes
trop matrielles tait du temps enlev la mditation ou au service divin.
Quant un rgime de salariat, on sait de reste quil ny fallait point penser.
Force tait donc que, pareils au chevalier dont parle Raimon Lull (321) le moine
et le prtre vcussent de la fatigue des autres hommes. Le cur de
campagne lui-mme, sil ne ddaignait sans doute pas de manier, loccasion,
la charrue ou la bche, ctait de la part de casuel ou de dme, dont le seigneur
du village avait bien voulu lui laisser la jouissance, quil tirait le plus clair de
ses pauvres rentes. Constitu par les aumnes accumules des fidles, accru
par des achats dans lesquels, dailleurs, le bnfice des prires promises
lme du vendeur figurait souvent comme un des lments du pr ix, le
patrimoine des grandes glises ou plutt car telle tait alors la notion
courante, bien loigne de ne reprsenter quune simple fiction juridique le
patrimoine des saints fut, par essence, de nature seigneuriale. Dimmenses
fortunes se construisirent ainsi aux mains des communauts ou des prlats,
allant, parfois, jusqu ces agglomrations quasi princires de terres et de
droits varis, dont nous verrons plus loin le rle dans ltablissement des
dominations territoriales. Or, qui disait seigneurie disait non seulement
redevances, mais aussi pouvoirs de commandement. Les chefs du clerg
eurent donc, sous leurs ordres, de nombreux dpendants laques de tout rang
depuis les vassaux militaires, indispensables la garde de si grands biens,
jusquaux manants et aux commends du degr infrieur.
Marc BLOCH La socit fodale
330
Ces derniers notamment vinrent en foule aux glises. tait-ce vraiment
que vivre sous la crosse , plutt que sous lpe, part un sort digne
denvie ? La polmique remonte loin : ds le XIIe sicle, labb de Cluny,
empress vanter la douceur de la domination monastique, elle opposait le
critique Ablard (322). Dans la mesure o il est loisible de faire abstraction du
facteur individuel, elle reviendrait, somme toute, se demander si un matre
exact, comme p.482 ltaient gnralement les clercs, vaut mieux quun matre
dsordonn : problme, en vrit, insoluble. Mais deux choses sont sres. La
prennit propre aux tablissements ecclsiastiques et le respect qui les
entourait faisaient deux, pour les humbles, des protecteurs particulirement
recherchs. Dautre part, qui se donnait un saint ne contractait pas seulement
une assurance contre les prils du sicle ; il se procurait, en outre, les
bnfices, non moins prcieux dune uvre pie. Double avantage que les
chartes, rdiges dans les clotres, exprimaient volontiers en affirmant que se
constituer le serf dune glise, ctait, en ralit, accder la vraie libert.
Entendez, sans que lon distingut toujours bien clairement entre les deux
notions, la fois participer, en ce monde, aux franchises dune corporation
privilgie et, dans lautre, sassurer la libert ternelle qui est en
Christ (323). Ne voyait-on pas des plerins reconnaissants solliciter, de leur
premier seigneur, lautorisation de se soumettre, avec leur postrit, aux
reprsentants du puissant intercesseur qui les avait guris (324) ? Ainsi, dans la
formation du rseau de sujtions personnelles, qui fut si caractristique de
lpoque, les maisons de prire comptrent parmi les plus efficaces des ples
dattraction.
Cependant, se transformer, de cette faon, en grande puissance humaine,
lglise de lre fodale sexposait deux danger s, dont les contemporains
eurent la claire conscience. Dabord un trop facile oubli de sa vocation
propre. Quelle belle chose ce serait dtre archevque de Reims, sil ne
fallait chanter la messe : le bruit public attribuait ce propos larchevque
Manass, dpos, en 1080, par les lgats pontificaux. Vridique ou
calomnieuse, lanecdote symbolise, dans lhistoire de lpiscopat franais,
lpoque du pire recrutement. Aprs la rforme grgorienne, son cynisme et
paru trop invraisemblable. Mais le type du prlat guerrier de ces bons
chevaliers du clerg dont parlait un vque allemand traversa les ges.
Dautre part, le spectacle de tant de richesses entasses par les clercs, les
rancunes que, dans le cur dhritiers appauvris , veillait le souvenir de
tant de bonnes terres au soleil, nagure abandonnes par leurs anctres des
moines habiles p.483 jouer de la terreur de lenfer : tels furent avec le
mpris de lhomme darmes pour une vie, son gr, trop abrite les
aliments dont se nourrit, dans laristocratie laque, lespce danticlricalisme
lmentaire qui a laiss, en maints passages de lpope, de si brutales
expressions (325). Pour se concilier fort bien avec les retours dune gnrosit
aumnire, aux heures du remords ou des ultimes angoisses, ces sentiments
Marc BLOCH La socit fodale
331
nen devaient pas moins sous -tendre la fois plus dune attitude politique et
plus dun mouvement proprement religieux.
Dans un monde qui inclinait concevoir tous les liens dhomme hom me
sous limage du plus prenant dentre eux, il tait presque fatal qu lintrieur
mme de la socit clricale, on vit les habitudes de la vassalit imprgner des
relations de subordination beaucoup plus anciennes et dune nature, en soi,
bien diffrente. Il arriva que lvque requt lhommage des dignitaires de son
chapitre ou des abbs de son diocse et les chanoines, pourvus des prbendes
les plus importantes, celui de leurs confrres moins bien partags ; que des
curs dussent le prter au chef de la communaut religieuse dont dpendaient
leurs paroisses (326). Lintroduction, dans la cit spirituelle, de murs aussi
visiblement empruntes au sicle ne pouvait manquer de soulever les
protestations des rigoristes. Mais le mal se faisait beaucoup plus grave lorsque
ctait dans des mains laques que venaient se placer, pour le rite de
soumission, les mains du prtre, sanctifies par lhuile bnite de lordination
et le contact de lEucharistie. Le problme ici est insparable d un autre
problme plus vaste, lun des plus angoissants, assurment, qui se soient
jamais dresss devant lglise : celui des nominations aux divers postes de la
hirarchie ecclsiastique.
Ce ne fut point lre fodale qui inventa de remettre aux pouvo irs
temporels le soin de choisir les pasteurs des mes. Pour les cures de villages,
dont les seigneurs disposaient peu prs librement, lhabitude remontait aux
origines mmes du systme paroissial. Sagissait -il dvques ou dabbs ? Le
seul procd conforme la rgle canonique tait incontestablement llection :
par le clerg et le peuple de la cit, p.484 pour les premiers ; par les moines,
pour les seconds. Mais, ds les derniers temps de la domination romaine, les
empereurs navaient pas craint di mposer leur volont aux lecteurs, dans les
cits, parfois mme de nommer directement des vques. Les souverains des
monarchies barbares imitrent ces deux exemples et surtout, beaucoup plus
largement quauparavant, le dernier. Quant aux monastres, ceux qui ne
dpendaient pas, eux aussi, immdiatement du roi recevaient frquemment
leurs abbs de la main du fondateur de la maison ou de ses hritiers. La vrit
tait quaucun gouvernement srieux ne pouvait tolrer de laisser en dehors de
son contrle latt ribution de charges qui, ct dune lourde responsabilit
religieuse dont nul chef, soucieux du bien de ses peuples, navait le droit de
se dsintresser , comportaient une si grande part de commandement
proprement humain. Confirme par la pratique carolingienne, lide quil
appartenait aux rois de dsigner les vques finit par passer ltat de
maxime. Au Xe sicle, au dbut du XIe, papes et prlats saccordent
lexprimer (327).
Cependant, l comme ailleurs, les institutions et les usages lgus par le
pass devaient subir laction dune atmosphre sociale nouvelle.
Marc BLOCH La socit fodale
332
Toute tradition, terre, droit ou charge, soprait, lre fodale, par la
transmission dun objet matriel qui, passant de main en main, tait cens
reprsenter la valeur concde. Le clerc appel par un laque au gouvernement
dune paroisse, dun diocse ou dun monastre reut donc, de ce collateur,
une investiture dans les formes ordinaires. Pour lvque, en particulier, le
symbole choisi fut, trs naturellement, ds les premiers Carolingiens, une
crosse (328) laquelle on joignit plus tard lanneau pastoral. Il va de soi que
cette remise dinsignes, par un chef temporel, ne dispensait nullement de la
conscration liturgique. En ce sens, elle tait impuissante crer un vque.
Mais on se tromperait lourdement en imaginant que son rle se bornt
marquer la cession, au prlat, des biens attachs sa nouvelle dignit. Ctait
la fois le droit la fonction et le droit son salaire qui sans que nul
prouvt le besoin de distinguer entre deux lments indissolubles taient
par l simultanment p.485 octroys. Aussi bien cette crmonie, si elle
soulignait, assez brutalement, la part prpondrante que sattribuaient , dans les
nominations, les puissances du sicle, najoutait en elle -mme peu prs rien
un fait ds longtemps patent. Il en fut diffremment dun autre geste, charg
de rsonances humaines beaucoup plus profondes.
Du clerc auquel il venait de confier une charge ecclsiastique, le potentat
local ou le souverain attendait, en rcompense, une sre fidlit. Or, depuis la
constitution de la vassalit carolingienne, aucun engagement de cette nature,
au moins dans les hautes classes, ne paraissait vritablement astreignant sil ne
se contractait selon les formes labores par la commendise franque. Les rois
et les princes shabiturent donc exiger des vques ou abbs de leur
nomination une prestation dhommage ; et les seigneurs de villages firent
parfois de mme pour leurs curs. Mais lhommage tait, au propre, un rite de
sujtion. En outre, un rite trs respect. Par l, la subordination des
reprsentants du pouvoir spirituel envers ceux du pouvoir laque ntait pas
seulement manifeste avec clat. Elle se trouvait aussi renforce. Dautant que
lunion des deux actes formalistes hommage et investiture favorisait une
dangereuse assimilation entre loffice du prlat et le fief du vassal.
Attribut essentiellement rgalien, le droit de nommer les vques et les
grands abbs ne pouvait gure chapper au morcellement des droits
monarchiques, en gnral, qui fut un des caractres des socits fodales.
Mais cette fragmentation neut pas lieu partout un degr gal. Do, sur le
recrutement du personnel ecclsiastique, des effets, leur tour, extrmement
variables. L o, comme en France, surtout dans le Midi et le Centre,
beaucoup dvchs tombrent sous lautorit des hauts et mme moyens
barons, les pires abus trouvrent leur terre dlection : depuis la succession
hrditaire du fils au pre jusqu la vente avoue. Observez, par contraste,
lAllemagne, o les rois ont su rester matres de presque tous les siges
piscopaux. Certes, ils ne sinspirent pas, dans leurs choix, de motifs
uniquement spirituels. Ne leur faut-il pas, avant tout, des prlats capables de
gouverner, voire de se battre ? Bruno de Toul, qui, sous le nom p.486 de Lon
Marc BLOCH La socit fodale
333
IX, devait devenir un trs saint pape, dut son sige piscopal, avant tout, aux
qualits dont il avait fait preuve comme officier de troupes. Aux glises
pauvres, le souverain donne, de prfrence, de riches vques. Il ne ddaigne
pas, pour lui-mme, les cadeaux dont lusage tend imposer lobligation aux
nouveaux investis, que lobjet de linvestiture soit un fief mil itaire ou une
dignit religieuse. Nul doute, cependant, que, dans lensemble, lpiscopat
imprial, sous les Saxons et les premiers Saliens, ne dpasst de beaucoup, par
linstruction et la tenue morale, celui des pays voisins. Du moment quil lui
fallait obir un pouvoir laque, mieux valait videmment, pour lglise,
dpendre dun pouvoir plus haut plac et, par l -mme, susceptible de vues
plus larges.
Vint llan grgorien. De cette tentative passionne pour arracher les
forces surnaturelles lempr ise du sicle et rduire les pouvoirs humains au
rle, discrtement subordonn, de simples auxiliaires, embrigads dans la
grande uvre du Salut, les pripties nont pas tre retraces ici. Quant au
bilan dernier, abstraction faite de beaucoup de nuances nationales, il peut se
rsumer en quelques mots.
Ce ntait pas du ct du systme paroissial que stait dirig le principal
effort des rformateurs. Au rgime juridique des paroisses, peu de choses, en
vrit, furent changes. Un nom plus dcent, celui de patronat, substitu
dfinitivement au terme brutal de proprit ; un contrle un peu plus exact des
choix, par lautorit piscopale : ces modestes innovations ne pesaient pas trs
lourd, en face du droit de nomination, pratiquement conserv par les
seigneurs. Le seul trait nouveau qui ft de quelque porte appartint au
domaine du fait, plutt que du droit : par don ou par achat, un grand nombre
dglises de villages avaient pass des mains de laques celles
dtablissements ecclsiastiques et, notam ment, de monastres. La domination
seigneuriale subsistait. Mais au profit, du moins, de matres qui comptaient
dans la milice des clercs. Il savrait une fois de plus que, dans larmature
sociale de la fodalit, la seigneurie rurale, plus ancienne en elle-mme que
les autres rouages, constituait une des pices les plus rsistantes.
p.487 En
ce qui concernait les hautes dignits de lglise, les formes les plus
choquantes de la sujtion au pouvoir temporel avaient t limines. Plus de
monastres ouvertement appropris par les dynastes locaux. Plus de
barons dpe srigeant eux -mmes en abbs ou archi-abbs de tant de
pieuses maisons. Plus dinvestitures par les propres insignes de la puissance
spirituelle : le sceptre remplace crosse et anneau et, les canonistes posent en
principe que la crmonie, ainsi comprise, a pour unique objet doctroyer la
jouissance des droits matriels attachs lexercice dune fonction religieuse
indpendamment confre. Llection est universellement reconnue co mme la
rgle et les laques, mme titre de simples lecteurs, sont dfinitivement
exclus de toute participation rgulire au choix de lvque, dsi gn
dornavant la suite dune volution qui occupe tout le XI Ie sicle par
un collge rduit aux chanoines de lglise cathdrale : trait nouveau,
Marc BLOCH La socit fodale
334
absolument contraire la loi primitive et qui, plus que tout autre, en disait
long sur le schisme croissant entre le sacerdoce et la foule profane.
Cependant le principe lectif jouait difficilement, parce quon se rsignait
mal compter simplement les voix. La dcision semblait appartenir, non la
majorit tout court, mais, selon la formule traditionnelle, la fraction la fois
la plus nombreuse et la plus saine . Quelle minorit rsistait la tentation
de dnier ses adversaires, victorieux selon la loi du nombre, la moins
pondrable de ces deux qualits ? Do la frquence des lections contestes.
Elles favorisaient lintervention des autorits plus haut places : celle des
papes assurment ; mais aussi celle des rois. Ajoutez que personne ne pouvait
nourrir dillusion sur les partis pris de collges lectoraux trs restreints,
souvent troitement soumis linfluence des intrts locaux les moins
avouables. Les canonistes les plus intelligents ne niaient gure quun contrle,
exerc dans un rayon plus large, ne dt tre bienfaisant. L encore le chef
suprme de lglise et les chefs dtat entraient en concurrence. En vrit, la
faveur du regroupement gnral des forces politiques, le menu fretin des
barons, dans la plus grande partie de lOccident, se vit peu peu limin au
profit des rois ou de quelques princes p.488 particulirement puissants. Mais les
souverains, qui demeuraient ainsi les seuls matres du terrain, nen taient que
plus capables de manier efficacement les divers moyens de pression dont ils
disposaient vis--vis des corps ecclsiastiques. Lun de ces procds
dintimidation, la prsence aux scrutins, navait -il pas t reconnu comme
lgal, en 1122, par le Concordat conclu entre le pape et lEmpereur ? Les
monarques les plus srs de leur force nhsitaient pas recourir parfois la
dsignation directe. Lhistoire du second ge fodal, comme des sicles qui
suivirent, retentit du bruit des innombrables querelles souleves, dun bout
lautre de la catholicit, par les nominations piscopales ou abbatiales. Tout
bien considr, pourtant, la rforme grgorienne avait montr son impuissance
arracher aux grands pouvoirs temporels ce levier de commande, en vrit
presque indispensable leur existence mme, qutait le droit de choisir les
principaux dignitaires de lglise ou, tout le moins, den surveiller le choix.
Dot de vastes seigneuries qui, leur possesseur imposaient, envers le roi
ou le prince, les charges ordinaires de tout haut baron, qui mme car le
domaine ecclsiastique, nous le verrons, tait conu comme attach au
domaine royal par un lien particulirement troit entranaient lobligation
de services plus que dautres importants, lvque ou labb des temp s
nouveaux demeurait astreint envers son souverain des devoirs de fidlit
dont nul ne pouvait nier la lgitime puissance. Les rformateurs se bornrent
leur rclamer une expression conforme lminente dignit du clerc. Que le
prlat prononce le serment de foi, rien de mieux. Mais, pour lui, point
dhommage. Telle fut la thorie, trs logique et trs claire, que, depuis la fin
du XIe sicle, dvelopprent lenvi conciles, papes et thologiens. Lusage
longtemps sen carta. Peu peu, cependant, ell e gagna du terrain. Vers le
milieu du XIIIe sicle, elle avait triomph presque partout. A une exception
Marc BLOCH La socit fodale
335
prs, toutefois et de taille. Terre de prdilection de la vassalit, la France tait
reste, sur ce point, obstinment respectueuse des pratiques traditionnelles.
Sous rserve de quelques privilges particuliers, elle devait leur demeurer
attache jusquau XV Ie sicle. Quun p.489 Saint Louis, rappelant lordre un
de ses vques, nait pas craint de lui dire vous tes mon homme, de vos
mains : il nest gure de tmoignage plus loquent de lextraordinaire
tnacit dont, jusque dans leur extension une socit dessence spirituelle,
firent preuve les reprsentations les plus caractristiques de la fodalit (329).
II. Vilains et bourgeois
Au-dessous du noble et du clerc, la littrature dinspiration chevaleresque
affectait de napercevoir quun peuple uniforme de rustres ou de
vilains . En ralit, cette foule immense tait traverse par un grand
nombre de lignes de clivage social, profondment marques. Cela tait vrai
des rustres eux-mmes, au sens exact et restreint du mot. Non seulement, dans
leurs rangs, les divers degrs de la sujtion envers le seigneur traaient
doscillantes frontires juridiques, peu peu ramenes lantithse entre la
servitude et la libert . Cte cte avec ces diffrences de statut et sans
se confondre avec elles, de graves ingalits conomiques divisaient aussi les
petites collectivits rurales. Pour ne citer que loppositio n la plus simple et le
plus tt formule, quel laboureur , fier de ses animaux de trait, et accept
comme ses pairs les brassiers de son village, qui, pour mettre en valeur
leurs maigres lopins, ne possdaient que leurs muscles ?
Surtout, lcar t de la population paysanne, comme des groupes vous
aux honorables tches du commandement, il avait toujours exist des noyaux
isols de marchands et dartisans. De ces germes, la rvolution conomique du
second ge fodal fit surgir, accrue dinnombrable s apports nouveaux, la
masse puissante, et bien diffrencie, des classes urbaines. Ltude de socits
dun caractre aussi nettement professionnel ne saurait tre entreprise en
dehors dun examen approfondi de leur conomie. Une rapide mise en place
suffira ici indiquer leur position sur la toile de fond de la fodalit.
Aucune des langues parles dans lEurope fodale ne disposait de termes
qui permissent de distinguer clairement, p.490 en tant que lieu habit, la ville du
village. Ville , town, Stadt sappliquaient indiffremment aux deux types
de groupement. Burg dsignait tout espace fortifi. Cit tait rserv aux
chefs-lieux de diocses ou, par extension, quelques autres centres dune
exceptionnelle importance. Ds le XIe sicle, par contre, aux mots de
chevalier, de clerc, de vilain, le nom de bourgeois, franais dorigine, mais
vite adopt par lusage international, soppose en un contraste sans ambigut.
Si lagglomration, en soi, demeure anonyme, les hommes qui y vivent ou, du
moins, dans cette population, les lments les plus agissants et, par leurs
Marc BLOCH La socit fodale
336
activits marchandes ou artisanes, les plus spcifiquement urbains possdent
donc, dsormais, dans la nomenclature sociale, une place bien eux. Un
instinct trs sr avait saisi que la ville se caractrisait, avant tout, comme le
site dune humanit particulire.
Certes, il ne serait que trop ais de forcer lantithse. Avec le chevalier, le
bourgeois de la premire poque urbaine partage lhumeur guerrire et le port
usuel des armes. On le vit longtemps, comme un paysan, tantt donner ses
soins la culture de champs dont les sillons parfois sallongeaient lintrieur
mme de lenceinte, tantt, hors des murs, envoyer ses troupeaux patre
lherbe de communaux jalousement gards. Deve nu riche, il se fera, son
tour, acqureur de seigneuries rurales. Rien de plus faux, par ailleurs, on le
sait, que dimaginer une classe chevaleresque idalement dtache de tout
souci de fortune. Mais, pour le bourgeois, les activits qui semblent ainsi le
rapprocher des autres classes ne sont en vrit quun accessoire et, le plus
souvent, comme les tmoins attards danciens modes dexistence, peu peu
secous.
Essentiellement il vit dchanges. Il tire sa subsistance de lcart entre le
prix dachat et le prix de vente ou entre le capital prt et la valeur du
remboursement. Et comme la lgitimit de ce profit intermdiaire, ds quil ne
sagit pas dun simple salaire douvrier ou de transporteur, est nie par les
thologiens et que les milieux chevaleresques en comprennent mal la nature,
son code de conduite se trouve ainsi en flagrant antagonisme avec les morales
p.491 ambiantes. Parce quil tient pouvoir spculer sur les terrains, les
entraves seigneuriales, sur ses biens-fonds, lui sont insupportables. Parce quil
a besoin de traiter rapidement ses affaires et que celles-ci, en se dveloppant,
ne cessent de poser des problmes juridiques nouveaux, les lenteurs, les
complications, larchasme des justices traditionnelles lexasprent. La
multiplicit des dominations qui se divisent la ville mme le choque comme
un obstacle la bonne police des transactions et comme une insulte la
solidarit de sa classe. Les immunits diverses dont jouissent ses voisins
dglise ou dpe lui paraissent autant d empchements la libert de ses
gains. Sur les routes quil hante sans trve, il abhorre dune haine gale les
exactions des pagers et les chteaux do fondent, sur les caravanes, les
seigneurs pillards. En un mot, dans les institutions cres par un monde o il
navait encore quune trs petite place, presque tout le heurte ou le gne.
Pourvue de franchises conquises par la violence ou obtenues contre deniers
sonnants, organise en groupe solidement arm pour lexpansion conomique
en mme temps que pour les ncessaires reprsailles, la ville quil rve de
construire sera, dans la socit fodale, comme un corps tranger.
Rarement, il est vrai, lindpendance collective, qui fut lidal de tant
dardentes communauts, devait dpasser, en fin de compte, les variables
degrs dune autonomie administrative dans lensemble assez modeste. Mais,
pour chapper aux inintelligentes contraintes des tyrannies locales, un autre
remde soffrait, qui, pour ne sembler peut -tre quun pis -aller, lexprience
Marc BLOCH La socit fodale
337
savra souvent le plus sr : le recours aux grands gouvernements
monarchiques ou territoriaux, gardiens de lordre sur de vastes espaces et, par
le souci mme de leurs finances, intresss comme ils surent de mieux en
mieux le comprendre la prosprit de riches contribuables. Par l encore
et peut-tre plus efficacement, lavnement de la force bourgeoise prit figure
dlment destructeur de larmature fodale, dans un de ses traits
caractristiques : le morcellement des pouvoirs.
Un acte, entre tous significatif, marquait gnralement lentre en scne de
la nouvelle communaut urbaine, pour p.492 la rvolte ou pour lorganisation :
le serment mutuel des bourgeois. Jusque-l, il ny avait eu que des individus
isols. Dsormais, un tre collectif tait n. Ctait lassociation jure ainsi
cre quau propre on nommait, en France, commune . Nul mot ne fut
jamais charg de plus de passions. Cri de ralliement des bourgeoisies, au jour
de la rbellion, cri dappel du bourgeois en danger, il veillait, dans l es classes
auparavant seules dirigeantes, de longs chos de haine. Pourquoi, envers ce
nom nouveau et dtestable , comme dit Guibert de Nogent, tant dhostilit ?
Bien des sentiments, sans doute, y contriburent : inquitudes de puissants,
directement menacs dans leur autorit, leurs revenus, leur prestige ; craintes
que, non sans raison, inspiraient aux chefs de lglise les ambitions de
groupes fort peu respectueux, lorsquelles les gnaient, des liberts
ecclsiastiques ; mpris ou rancunes du chevalier pour le trafiquant ;
vertueuses indignations souleves, dans le cur du clerc, par laudace de ces
usuriers , de ces profiteurs , dont les gains semblaient jaillir de sources
impures (330). Il y avait plus, pourtant, et plus profond.
Dans la socit fodale, le serment daide et damiti avait figur, ds
lorigine, comme une des pices matresses du systme. Mais ctait un
engagement de bas en haut, qui un suprieur attachait un sujet. Loriginalit
du serment communal fut dunir des gaux. Assurment, le trait ne saurait
passer pour absolument indit. Tels avaient dj t, nous le verrons, les
serments prts les uns aux autres par les confrres de ces guildes
populaires, quinterdit Charlemagne ; et, plus tard, par les membres des
associations de paix, dont, sous plus dun rapport, les communes urbaines
devaient recueillir lhritage. Tels encore, ceux par o se liaient les marchands
groups dans les petites socits, parfois, elles aussi, appeles guildes , qui,
formes simplement pour les besoins du commerce et de ses aventures, nen
avaient pas moins offert, avant les premiers efforts des villes vers
lautonomie, une des plus anciennes manifestations de la solidarit
bourgeoise. Jamais, cependant, avant le mouvement communal, la pratique de
ces fois rciproques navait pris une pareille ampleur ni rvl p.493 une
pareille puissance. Les conspirations , surgies de toute part, taient
vraiment, selon le mot dun sermonnaire, comme autant de fagots dpines
entrelaces . (331) L fut, dans la commune, le ferment proprement
rvolutionnaire, violemment antipathique un monde hirarchis. Certes, ces
primitifs groupes urbains navaient rien de dmocratique. Les hauts
Marc BLOCH La socit fodale
338
bourgeois , qui en furent les authentiques fondateurs et que, souvent les petits
ne suivirent pas sans peine, taient pour les pauvres gens des matres souvent
trs durs et dimpitoyables cranciers. Mais, en substituant la promesse
dobissance, rmun re par la protection, la promesse dentraide, ils
apportaient lEurope un lment de vie sociale nouveau, profondment
tranger lesprit quil est permis de dire fodal.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
339
LIVRE DEUXIME : Le gouvernement des
hommes
CHAPITRE PREMIER
Les justices
I. Caractres gnraux du rgime judiciaire
p.495 Comment
les hommes taient-ils jugs ? Pour un systme social, point
de meilleure pierre de touche que celle-l. Interrogeons donc, l-dessus,
lEurope des environs de lan mille. Ds le premier exa men, quelques traits,
qui dominent de haut le dtail juridique, ressortent en un vif relief. Cest
dabord le prodigieux morcellement des pouvoirs judiciaires. Cest aussi leur
enchevtrement. Enfin, leur mdiocre efficacit. Dinnombrables cours taient
appeles trancher, cte cte, les dbats les plus graves. Entre elles,
assurment, certaines rgles fixaient, en thorie, le partage des comptences.
Mais non sans laisser la porte ouverte de constantes incertitudes. Les
dossiers des seigneuries, tels quils nous sont parvenus, abondent en chartes
relatives aux contestations entre justices concurrentes. Dsesprant de savoir
devant quelle autorit porter leurs litiges, les plaideurs souvent sentendaient
pour constituer, de leur propre gr, des arbitres ou bien larrt prfraient un
accord amiable : quitte dailleurs, par la suite, ne le point respecter. Incertain
de son droit, incertain de sa force, le tribunal ne ddaignait pas toujours de
rclamer, par avance ou aprs coup, lacquiescement des p arties sa sentence.
Avait-on obtenu une dcision favorable ? Pour la faire excuter, il ntait, trop
frquemment, dautre ressource que de composer, avec un rcalcitrant
adversaire. En un mot, voici, p.496 ou jamais, le moment de se souvenir que le
dsordre peut tre, sa faon, un grand fait historique. Un fait, cependant, qui
doit tre expliqu. Visiblement il tenait, ici, pour une large part, la
coexistence de principes contradictoires, qui, issus de traditions diverses,
contraints, en outre, de s adapter, plus ou moins gauchement, aux besoins
dune socit minemment mouvante, allaient sans cesse se traversant. Mais il
avait galement sa source dans les conditions concrtes que le milieu humain
imposait lexercice de la justice.
Marc BLOCH La socit fodale
340
Dans cette socit qui avait multipli les rapports de dpendance, tout chef
et Dieu sait sils taient nombreux souhaitait dtre un juge. Parce que
le droit de juger permettait seul de maintenir efficacement dans le devoir les
subordonns et, en vitant de les laisser se plier aux arrts de tribunaux
trangers, fournissait le moyen le plus sr la fois de les protger et de les
dominer. Parce que ce droit, aussi, tait essentiellement lucratif. Non
seulement il comportait la perception damendes et de frais de justi ce, ainsi
que les fructueux revenus des confiscations ; plus que tout autre, en outre, il
favorisait cette transformation des usages en obligations dont les matres
tiraient tant de profits. Ce ne fut point hasard si le mot de justicia vit parfois
son acception stendre au point de dsigner lensemble des pouvoirs
seigneuriaux. A vrai dire, il y avait l, beaucoup dgards, lexpression
dune ncessit commune presque toute vie de groupe : de nos jours mme,
tout employeur, dans son entreprise, tout commandant de troupe nest -il pas,
sa faon, un juge ? Mais ses pouvoirs, ce titre, ont pour limite une sphre
dactivit bien dtermine. Il juge, il doit juger louvrier et le soldat seulement
en tant que tels. Le chef des temps fodaux visait plus loin, parce que les liens
de soumission tendaient alors treindre lhomme tout entier.
Rendre la justice ntait pas dailleurs, lpoque fodale, une besogne
bien complique. Sans doute y fallait-il quelque connaissance du droit. L o
subsistaient des codes crits, cette science revenait possder peu prs par
cur ou se faire lire leurs rgles souvent nombreuses et dtailles, mais trop
rigides pour ne pas dispenser, trs largement, de p.497 tout effort de pense
personnelle. La coutume orale, au contraire, avait-elle chass le texte ? Il
suffisait davoir quelque familiarit avec cette tradition diffuse. Enfin, de toute
faon, il convenait de savoir les gestes prescrits et les paroles ncessaires, qui
enserraient la procdure dans un corset de formalisme. Affaire de mmoire, en
somme, que tout cela, et de pratique. Les moyens de preuve taient
rudimentaires et dapplication aise. Mdiocrement frquent, lemploi du
tmoignage se bornait enregistrer les dires, plutt qu les scruter. Prendre
acte du contenu dun crit authentique le cas, du reste, fut longtemps assez
rare , recevoir le serment dune des parties ou celui des co -jureurs, constater
le rsultat dune ordalie ou dun duel judiciaire ce dernier de plus en plus
rpandu, aux dpens des autres formes du jugement de Dieu : de pareils
soins nexigeaient gure de prparation technique. Les procs mmes ne
portaient que sur des matires peu nombreuses et sans subtilit. Lanmie de
la vie commerciale rduisait lextrme le chapitre des contrats. Lorsque,
dans certains milieux particuliers, on vit se dvelopper nouveau une
conomie dchanges plus active, lincapacit dont le droit commun, comme
les tribunaux habituels, faisait preuve vis--vis de pareils dbats amena de
bonne heure les groupes marchands les trancher entre soi, dabord par
dinofficiels arbitrages, plus tard au moyen de juridictions propres. La saisine
cest --dire la possession sanctionne par le long usage , les pouvoirs sur
les choses et les hommes : tel tait lobjet constant de presque tous les litiges.
Avec, cela va de soi, les crimes et les dlits. Mais ici laction des tribunaux
Marc BLOCH La socit fodale
341
tait, dans la pratique, singulirement limite par la vengeance prive. Aucun
obstacle intellectuel, en somme, nempchait que qui conque disposait de la
puissance voulue ou en avait reu la dlgation ne sriget en juge.
Cte cte avec les tribunaux ordinaires existait cependant un systme de
cours spcialises : celles de lglise. Entendons : de lglise, dans lexercice
de sa mission propre. Car les pouvoirs judiciaires quvques et monastres
possdaient sur leurs dpendants, au mme titre que tant de seigneurs dpe,
ne se rangeaient naturellement pas sous la rubrique p.498 de la juridiction
authentiquement ecclsiastique. De celle-ci, le champ daction tait double,
Elle visait stendre sur toutes les personnes que marquait le signe sacr :
clercs et moines. Elle stait, en outre, plus ou moins compltement annex
certains dlits ou actes qui, mme accomplis par des gens du sicle, taient
conus comme de nature religieuse : depuis lhrsie jusquau serment ou au
mariage. Son dveloppement, durant lre fodale, ne rvle pas seulement la
faiblesse des grands pouvoirs temporels la monarchie carolingienne avait,
sur ce point, accord beaucoup moins dindpendance son clerg . Il
atteste aussi la tendance du monde clrical largir de plus en plus labme
entre la petite collectivit des serviteurs de Dieu et la foule profane. Ici
encore, le problme des comptences provoqua de vives querelles de bornage,
acharnes surtout, en vrit, partir du moment o, en face des empitements
du spirituel, se dressrent, nouveau, de vrais gouvernements dtat. Mais
prcisment parce que la justice comme le droit de lglise taient vraiment,
parmi les institutions propres la fodalit, comme un Empire dans un
Empire, il sera conforme la ralit, une fois rappels, dun mot, leur rle et
leur importance, den faire dsormais abstraction.
II. Le morcellement des justices
Comme le droit des personnes, le systme judiciaire avait t, dans
lEurope barbare, domin par lopposition traditionnelle entre les hommes
libres et les esclaves. Les premiers taient, en principe, jugs par des cours
composes, leur tour, dautres hom mes libres et dont les dbats taient
dirigs par un reprsentant du roi. Sur les seconds, le matre exerait un
pouvoir de dcision dans leurs diffrends entre eux et de correction, trop
exclusivement rgl par son bon plaisir pour pouvoir tre proprement qualifi
de justice. Il arrivait, vrai dire, par exception, que des esclaves fussent
traduits devant le tribunal public, soit que le propritaire et spontanment
choisi ce moyen de mettre sa responsabilit couvert, soit mme que, dans un
intrt de bonne police, la loi, en certains cas, lui en ft une obligation. Mais
ctait, p.499 alors mme, pour voir leur sort remis entre les mains de
suprieurs, non dgaux. Rien de plus clair quune pareille antithse. De
bonne heure, cependant, elle dut cder devant lirrsistible pression de la vie.
Marc BLOCH La socit fodale
342
Dans la pratique, en effet, la brche entre les deux catgories juridiques
tendait, on le sait, de plus en plus se combler. Beaucoup desclaves taient
devenus tenanciers, au mme titre que, tant dhommes lib res. Beaucoup
dhommes libres vivaient sous lautorit dun seigneur et de lui tenaient leurs
champs. Sur ce petit peuple ml, quunissaient les liens dune commune
soumission, comment le matre net -il pas t amen tendre,
uniformment, son droit de correction ? comment ne se ft-il par rig en juge
des litiges survenus dans le groupe ? Ds la fin de lpoque romaine, on voit
poindre, en marge de la loi, ces justices prives des puissants , parfois avec
leurs prisons. Le biographe de saint Csaire dArles qui mourut en 542
loue-t-il son hros de navoir jamais fait distribuer, du moins la fois, plus de
trente-neuf coups de bton aucun de ses dpendants ? cest pour prciser
quil usait de cette mansutude, non seulement envers ses esclaves , mais aussi
envers les ingnus de son obissance . Il tait rserv aux royauts barbares
de reconnatre, en droit, cette situation de fait.
Tel fut notamment un des objets principaux, ds lorigine, et bientt la
vritable raison dtre de l immunit franque, qui, trs ancienne en Gaule,
devait se rpandre par les soins des Carolingiens sur tout leur vaste empire. Le
mot dsignait lunion de deux privilges : dispense de certaines perceptions du
fisc ; interdiction aux officiers royaux de pntrer, pour quelque motif que ce
ft, sur le territoire immune . Il en rsultait, presque ncessairement, la
dlgation au seigneur, sur les habitants, de certains pouvoirs judiciaires.
A vrai dire, loctroi, par diplme exprs, de ces immunits parat avoi r t
strictement limit aux glises. Les rares exemples contraires que lon puisse
tre tent dinvoquer ne sont pas seulement tardifs ; ils se justifiaient
visiblement par des circonstances tout exceptionnelles. Aussi bien, plus que le
silence, toujours suspect, des chartriers, celui des formulaires employs par la
chancellerie franque p.500 mrite-t-il demporter la conviction : on y chercherait
en vain un modle dacte de ce type en faveur de laques. En pratique,
cependant, un trs grand nombre de ceux-ci avaient, par un autre biais, accd
aux mmes avantages. Traditionnellement, les biens royaux taient eux aussi
classs comme immunes . Entendez quexploits directement au profit du
prince et administrs par un corps spcial dagents, ils chappaie nt lautorit
des fonctionnaires du cadre normal. Au comte et ses subordonns, il tait
dfendu dy rien percevoir et mme dy entrer. Or, lorsquen rcompense de
services rendus ou rendre, le roi cdait une de ses terres, ctait,
ordinairement, en lui conservant lexemption ancienne. Accord titre
provisoire, le bienfait ne continuait-il pas faire partie, en thorie, du
domaine de la monarchie ? Les puissants, dont la fortune, pour une trs large
part, tirait son origine de ces libralits, se trouvrent donc, sur beaucoup de
leurs seigneuries, jouir de privilges lgaux exactement semblables ceux des
immunistes dglise. Nul doute, dailleurs, quils naient souvent russi en
tendre, moins lgitimement, le profit leurs possessions patrimoniales, sur
lesquelles ils staient, de si longue date, habitus commander en matres.
Marc BLOCH La socit fodale
343
A ces concessions, qui devaient se poursuivre durant tout le premier ge
fodal et dont les chancelleries continurent beaucoup plus tard encore se
transmettre les formules devenues alors assez vaines, les souverains taient
amens par des raisons diverses, mais galement imprieuses. Sagis sait-il
dglises ? Les combler de faveurs tait un devoir de pit, qui tait bien prs
de se confondre avec un devoir de bon gouvernement : par l, le prince
appelait sur ses peuples la rose des bndictions clestes. Quant aux magnats
et aux vassaux, ces largesses semblaient, envers eux, le prix ncessaire de leur
fragile loyaut. Y avait-il, par ailleurs, un inconvnient bien grave
restreindre le champ daction des officiers royaux ? Durs aux populations souvent mdiocrement dociles leur matre, leur conduite ne donnait que trop de
prises la mfiance. Autant que sur eux, ctait sur les chefs des petits
groupes entre lesquels se rpartissait la masse des sujets que la monarchie p.501
dsormais faisait reposer le soin dassurer lordre et lobissance ; en fortifiant
lautorit de ces responsables, elle pensait consolider son propre systme de
police. Longtemps, enfin, les juridictions prives staient montres dautant
plus envahissantes que, nes du simple exercice de la force, celle-ci dcidait
seule de leurs limites. Les lgaliser devait permettre de les ramener, du mme
coup, dans de justes bornes. Trs sensible dans limmunit carolingienne,
cette dernire proccupation se rattachait la rforme gnrale du rgime
judiciaire, qui, entreprise par Charlemagne, tait destine peser dun poids
trs lourd sur toute lvolution suivante.
Dans ltat mrovingien, la circonscription judiciaire fondamentale avait
t un territoire dtendue assez mdiocre : comme ordre de grandeur
rserve faite, cela va de soi, dinnombrables variations locales peu prs
lquivalent des plus petits arrondissements napoloniens . On lappelait
gnralement de noms romans ou germaniques qui signifiaient centaine :
dsignation dorigine passablement mystrieuse, qui remontait aux vieilles
institutions des peuples germains et peut-tre un systme de numration
diffrent du ntre (le sens premier du mot que nous crivons en allemand
moderne hundert ayant t probablement : cent vingt). On disait aussi, en pays
de langue romane, voirie ou viguerie (latin : vicaria). Le comte, au
cours de ses tournes dans les diverses centaines places sous son autorit,
convoquait tous les hommes libres au lieu de son tribunal. L, les sentences
taient rendues par un petit groupe de jugeurs pris dans lassemble ; le rle
de lofficier royal se bornait dabord prsider les dlibration s, puis faire
excuter les arrts.
A lexprience, cependant, ce systme parut entach dun double
inconvnient : aux habitants il imposait de trop frquentes convocations ; au
comte, une charge trop lourde pour tre correctement remplie. Charlemagne
lui substitua donc ltagement de deux juridictions, matresses chacune dans
sa sphre. Le comte continue de se rendre rgulirement dans la centaine pour
y tenir sa cour ; celle-ci, comme par le pass, la population tout entire doit,
en principe, se prsenter. Mais ces assises comtales et plnires nont plus p.502
Marc BLOCH La socit fodale
344
lieu que trois fois par an : priodicit rduite, qua rendue possible une
limitation de comptence. Car seuls seront ports, dsormais, devant ces
plaids gnraux , les procs qui roulent sur les matires les plus
importantes : les causes majeures . Quant aux causes mineures , elles
seront rserves des sessions, la fois moins rares et plus restreintes, o les
jugeurs seulement sont obligs de venir et dont la prsidence est confie un
simple subordonn du comte : son reprsentant dans la circonscription, le
centenier ou voyer .
Or, quelle que soit lhorrible imprcision de nos documents, on ne saurait
gure douter que, sous Charlemagne et ses successeurs immdiats, lten due
de la juridiction reconnue aux immunistes sur les hommes libres de leurs
terres nait concid gnralement avec les causes mineures . En dautres
termes, le seigneur, ainsi privilgi, fait fonction chez lui, de centenier.
Sagit -il, au contraire, dune cause majeure ? Limmunit soppose toute
tentative du comte pour saisir, lui-mme, le prvenu, le dfendeur ou les
co-jureurs sur le sol exempt. Mais le seigneur devra, sous sa propre
responsabilit, prsenter les personnes requises au tribunal comtal. Ainsi,
faisant la part du feu, le souverain esprait du moins conserver aux cours de
droit public les dcisions les plus graves.
La distinction des causes majeures et mineures devait avoir de longs
retentissements. Cest elle, en effet, que, dur ant toute lre fodale et bien plus
tard encore, on voit se poursuivre, sous les noms nouveaux de haute et
basse justices. Cette antithse fondamentale, commune tous les pays qui
avaient subi linfluence carolingienne et ceux -l seulement, continuait
dopposer deux degrs de comptence qui, sur un mme territoire, ntaient
pas forcment runis dans la mme main. Mais ni les limites des attributions
ainsi superposes, ni leur rpartition ne demeurrent, beaucoup prs, telles
quelles avaient t primitivement tablies.
Au criminel, lpoque carolingienne, aprs quelques hsitations, avait fix
aux causes majeures un critre tir de la nature du chtiment : seul le
tribunal comtal p.503 pouvait condamner mort ou prononcer la rduction en
esclavage. Ce principe, trs clair, traversa les ges. A dire vrai, les
transformations de la notion de libert firent rapidement disparatre
lasservissement proprement pnal (les cas o lon voit le meurtrier dun serf
contracter les mmes liens envers le seigneur de la victime rentrent sous une
tout autre rubrique : celle de lindemnit). Le haut justicier, en revanche, resta
toujours le juge normal des crimes de sang : entendez ceux qui
entranaient le dernier supplice. Le fait nouveau fut que ces plaids de
lpe , comme dit le droit normand, cessrent dtre le privilge de quelques
grandes cours. Point de trait plus frappant, durant le premier ge fodal, que la
multitude des petits chefs, ainsi pourvus du droit de mort ; ni non plus bien
quil ait t, sans doute, particulirement accentu en France de trait plus
universel et, pour le destin des communauts humaines, plus dcisif. Que
stait -il donc pass ? De toute vidence, ni la fragmentation de certains
Marc BLOCH La socit fodale
345
pouvoirs comtaux, par hritage ou par don, ni mme les usurpations pures et
simples ne sauraient suffire donner la clef dun pareil foisonnement. Aussi
bien, divers indices attestent-ils clairement un vritable dplacement des
valeurs juridiques. Toutes les grandes glises dsormais exercent, par
elles-mmes ou par leurs reprsentants, la justice de sang : cest donc que
celle-ci est devenue, au mpris des rgles anciennes, une suite naturelle de
limmunit. On la nomme parfois centaine ou voirie : ctait constater,
en quelque sorte officiellement, quelle tait dornavant considre comme du
ressort des cours du second degr. En dautres termes, la barrire, nagure
leve par les Carolingiens, avait, sur ce point, cd. Et sans doute lvolution
nest -elle pas inexplicable.
Ne nous y trompons point, en effet : ces sentences capitales, jadis
rserves aux plaids comtaux ainsi que, plus haut encore, au tribunal royal
ou aux assises convoques par les missi , elles navaient jamais t,
lpoque franque, bien nombreuses. Se uls les crimes quon tenait pour
particulirement odieux la paix publique taient alors frapps de pareils
chtiments. Beaucoup plus souvent, le rle des juges se bornait proposer ou
imposer un accord, puis p.504 prescrire le versement dune indemnit
conforme au tarif lgal et dont lautorit, dote des pouvoirs judiciaires,
percevait une part. Mais vint, au moment de la grande carence des tats, une
priode de vendettas et de violences presque constantes. Contre le vieux
systme de rpression, dont les faits eux-mmes semblaient ainsi dnoncer la
redoutable inefficacit, une raction ne tarda pas se produire, troitement
lie au mouvement des ligues de paix. Elle trouva son expression la plus
caractristique dans lattitude toute nouvelle adopte p ar les milieux les plus
influents de lglise. Nagure, par horreur du sang, et des longues rancunes,
ils avaient favoris la pratique des compositions pcuniaires. Dsormais,
on les vit ardents rclamer, au contraire, qu ces rachats trop faciles f ussent
substitues des peines afflictives, seules capables, pensaient-ils, deffrayer les
mchants. Ce fut en ce temps vers le Xe sicle que le code pnal de
lEurope commena revtir cet aspect dextrme duret, dont il tait appel
conserver lem preinte jusqu leffort humanitaire de jours beaucoup plus
proches de nous : farouche mtamorphose qui, si elle devait, la longue,
entretenir lindiffrence la souffrance humaine, avait t, en son principe,
inspire par le dsir dpargner cette souf france mme.
Or, dans toutes les causes criminelles, si graves fussent-elles, o le
bourreau nintervenait pas, les juridictions infrieures, plaids de centaines ou
dimmunit, avaient toujours t comptentes. Quand le prix en argent peu
peu recula devant la sanction, les juges restrent les mmes ; la nature des
arrts seule changea et les comtes cessrent davoir le monopole des
condamnations mort. La transition fut dailleurs rendue aise par deux traits
du rgime antrieur. Toujours les tribunaux des centeniers avaient possd le
droit de punir du dernier supplice les coupables surpris en flagrant dlit. Ainsi
avait paru lexiger le souci de lordre public. Cette mme proccupation
Marc BLOCH La socit fodale
346
conseilla ces cours de ne plus sarrter la limite prcdemment fixe.
Toujours les immunistes avaient dispos de la vie de leurs esclaves. Parmi les
dpendants o tait, dornavant, la frontire de la servitude ?
p.505 Crimes
part, les plaids du comte avaient eu dans leur ressort exclusif
deux catgories de procs : ceux qui mettaient en jeu le statut, servile ou libre,
dune des parties ou concernaient la possession des esclaves ; ceux qui
portaient sur la possession des alleux. Ce double hritage ne devait pas passer
intact aux beaucoup plus nombreux hauts justiciers de lpoque postrieure.
Les litiges relatifs aux alleux dailleurs de plus en plus rares
demeurrent souvent le monopole des vritables hritiers des droits comtaux :
ainsi, jusquau XI Ie sicle, Laon, o le comte tait lvque (332). Quant aux
questions relatives la servitude ou aux esclaves, la quasi-disparition de
lesclavage domestique, de mme que lapparition dune nouvelle conception
de la libert, amenrent les confondre dans la masse des dbats sur le
patrimoine en gnral ou sur la dpendance de lhomme : genre de
contestations qui navaient jamais fait partie des causes majeures .
Dpouille, de la sorte, vers le bas comme vers le haut, on et pu croire la
haute justice condamne au rle dune juridict ion purement pnale. Le
civil au sens moderne du mot y opra pourtant sa rentre par
lintermdiaire de la procdure. A lre fodale, un trs grand nombre de
diffrends, de toute nature, taient tranchs par le duel. Or, par une association
dide naturelle, on admit non point toujours, sans doute, mais trs
frquemment que ce mode de preuve sanglant ne pouvait se drouler que
devant les justices de sang .
Tout haut justicier, aux temps fodaux, possde galement sur les terres de
son obdience directe la basse justice. Mais linverse ntait point vrai ou du
moins ne devait le devenir que dans certains pays tel, en croire
Beaumanoir, le Beauvaisis du XIIIe sicle et seulement au terme de
lvolution. Autrement dit, le cas, durant long temps, ne fut point exceptionnel
dhommes qui, pour les procs du degr infrieur justiciables du seigneur sur
le sol duquel ils vivaient, portaient, par contre, devant une cour voisine, leurs
causes les plus graves. Quelle quet t la dispersion des pou voirs judiciaires,
elle navait pas supprim ltagement des comptences entre des mains
distinctes. Mais avec, sur toute la ligne, un abaissement dun chelon. De p.506
mme, en effet, que les successeurs des voyers ou centeniers et les
immunistes, comme, certainement, en dehors de tout privilge, un grand
nombre de simples puissants, ont enlev au comte affaires dalleux part
le monopole des causes majeures et se sont ainsi faits hauts justiciers, de
mme on les a vus perdre, leur tour, au profit de la masse des seigneurs,
celui des causes mineures. Quiconque se trouve la tte dun petit groupe
dhumbles dpendants, quiconque peroit les charges dun petit groupe de
tenures rurales dispose, dsormais, au minimum, de la basse justice. Dans
celle-ci, dailleurs, bien des lments de date et de nature diffrentes taient
venus se mler.
Marc BLOCH La socit fodale
347
Elle comprenait dabord le jugement de toutes les contestations qui
mettaient face face le seigneur lui-mme et ses tenanciers. Notamment,
quant aux charges qui pesaient sur ces derniers. Inutile dvoquer ici lhritage
de systmes judiciaires officiels. La vritable source de ce droit tait dans
limage la fois trs ancienne et de plus en plus vivement conue quon se
faisait des pouvoirs propres au chef. Disons mieux : au personnage, quel quil
ft, qui se trouvait en possession dexiger dun autre homme lacquittement
dune obligation nuance dinfriorit. Ne voit -on pas, en France, au XIIe
sicle, le dtenteur dune modeste tenure en vilainage, qu son tour, il a
accense un exploitant, se faire reconnatre par son propre seigneur, sur ce
censitaire, au cas o la somme manquerait tre paye, lexercice de la
justice pour cela seulement et pour rien dautre (333) ? De la juridiction
proprement dite lexcution personnelle par le crancier si frquemment
pratique alors et souvent lgalement reconnue les transitions ntaient pas
toujours bien sensibles et entre les deux notions la conscience commune, sans
doute, distinguait assez mal. Cette justice sur les redevances la justice
foncire des juristes dge postrieur ne constituait cependant pas toute la
basse justice. Dans le bas-justicier, les hommes qui vivaient sur sa terre
trouvaient aussi le juge normal d pe u prs tous les procs civils quils
pouvaient avoir entre eux sous rserve du recours au duel judiciaire ,
ainsi que de tous leurs menus et moyens dlits : rle o se confondaient le legs
des causes mineures p.507 et celui des droits de dcision et de correction
depuis si longtemps manis, en fait, par les matres.
Hautes et basses justices taient, les unes comme les autres, attaches au
sol. Qui rsidait dans leurs frontires leur tait soumis. Qui vivait en dehors
leur chappait. Mais, dans cette socit o les liens dhomme homme taient
si forts, ce principe territorial subissait perptuellement la concurrence dun
principe personnel. A quiconque tendait son maimbour sur un plus faible
que lui, on faisait, lpoque franque, la fois u n droit et un devoir
daccompagner son protg au tribunal, de ly dfendre, de sen porter garant.
De l revendiquer le pouvoir de prononcer la sentence, le pas devait tre
aisment franchi. Il le fut, en effet, tous les degrs de la hirarchie.
Parmi les dpendants personnels, les plus humbles et les plus strictement
soumis taient ceux quen raison du caractre hrditaire de lattache on avait
pris lhabitude de dire non -libres. Ils furent, en rgle gnrale, considrs
comme ne pouvant avoir, sinon dautres juges, du moins dautres juges de
sang que leurs seigneurs de corps . Cela lors mme quils nhabitaient point
sur sa terre ou que ce seigneur, sur ses autres tenanciers, nexerait pas de
haute justice. Souvent on tenta dappliquer des princ ipes analogues dautres
types de modestes subordonns qui, pour ntre pas lis de pre en fils au
matre, nen semblaient pas moins trs proches de sa personne : aux serviteurs
et servantes, par exemple, ou encore aux marchands que, dans les villes, les
barons dglise chargeaient de leurs achats et de leurs ventes. Difficiles faire
Marc BLOCH La socit fodale
348
passer dans la pratique, ces revendications taient une source constante
dincertitude et de conflits.
A dire vrai, dans la mesure o la nouvelle servitude avait conserv
lempreinte de lancienne, lexclusive justice du seigneur sur ses serfs pouvait
passer pour la suite naturelle du vieux droit de correction : telle est bien,
dailleurs, lide que semble exprimer encore un texte allemand du XI Ie
sicle (334). Les vassaux militaires, au contraire, tant des hommes libres,
relevaient, lpoque carolingienne, seulement du tribunal public. Du moins,
en droit. Comment douter quen fait le seigneur ne seffort de rgler lui mme les p.508 difficults qui risquaient de mettre aux prises ses fidles ? ou
que les personnes lses par les satellites dun puissant naient
ordinairement estim plus sr de chercher auprs de celui-ci le redressement
du tort ? A partir du Xe sicle, ces pratiques donnrent naissance une
vritable justice. La mtamorphose, dailleurs, avait t favorise et parfois
rendue presque insensible par le sort que lvolution gnrale des pouvoirs
avait fait aux juridictions publiques. Honneurs , puis fiefs patrimoniaux,
celles-ci taient, pour la plupart, tombes aux mains des magnats. Ils les
peuplaient de leurs faux ; et lon peut suivre clairement, dans certaines
principauts, comment le plaid du comte, ainsi compos, se transforma peu
peu en une cour vraiment fodale, o le vassal, avant tout, tranchait les procs
des autres vassaux.
III. Jugement par les pairs ou jugement par le matre ?
Lhomme libre jug par une runion dhommes libres, lesclave corrig
par son matre, seul : ce partage ne pouvait gure survivre aux
bouleversements de la classification sociale et, notamment, lentre en
servitude de tant dhommes anciennement libres qui, dans ces liens nouveaux,
conservaient bien des traits de leur primitif statut. Le droit dtre jugs par
leurs pairs ne fut jamais contest aux personnes dun rang tant soit peu
relev. Cela, dailleurs, moyennant lintroduction de distinctions hirarchiques
qui, on la vu, ntaient pas sans porter de rudes atteintes au vieux principe de
lgalit judiciaire, ne, simpleme nt, dune commune libert. En outre, dans
beaucoup de lieux, la coutume tendit lensemble des dpendants et
jusquaux serfs la pratique du jugement, sinon toujours par dexacts gaux, du
moins par des collges composs de sujets du mme matre. Dans les pays
dentre Seine et Loire, la haute justice continuait ordinairement de se rendre
dans des plaids gnraux , o toute la population de la terre devait assister.
Quant aux jugeurs, on les voyait souvent encore, conformment la plus pure
tradition carolingienne, nomms vie par le dtenteur des pouvoirs judiciaires
ctaient p.509 les chevins ; ou bien, la fodalisation des fonctions
tant ici aussi intervenue, lobligation de siger au tribunal avait fini par se
fixer hrditairement sur certaines tenures. Ailleurs, le seigneur ou son
Marc BLOCH La socit fodale
349
reprsentant semblent stre contents de sentourer, un peu au hasard, des
principaux notables, les bons hommes de lendroit. Au -dessus de ces
divergences, un fait central demeure. Parler de justice royale, baronale,
seigneuriale peut tre commode. Mais lgitime seulement condition de ne
pas oublier que, presque jamais le roi ni le haut baron ne jugeaient en
personne et quil en tait ainsi mme de beaucoup de seigneurs ou de maires
de villages. Runie par le chef, place frquemment sous sa prsidence, ctait
sa cour qui disait ou trouvait le droit : entendez, se remmorant les
rgles, les incorporait dans sa sentence. La cour fait le jugement ; non le
seigneur , affirme, en propres termes, un texte anglais (335). Et sans doute
serait-il aussi imprudent dexagrer que de nier absolument les garanties par l
offertes aux justiciables. Vite, vite, dpchez-vous de me faire un
jugement : ainsi parlait limpatient Henr i Plantagent, rclamant ses
fidles la condamnation de Thomas Becket (336). Le mot rsume assez bien et
les limites infiniment variables selon les cas que la puissance du chef
mettait limpartialit des juges et limpossi bilit o le plus imprieux des
tyrans tait, cependant, de se passer dun jugement collectif.
Mais que les non-libres et, par une assimilation naturelle, les plus humbles
dpendants dussent ne connatre dautre juge que leur matre, cette ide tait
trop anciennement ancre dans les consciences pour soblitrer aisment.
Dans les pays autrefois romaniss, elle trouvait, en outre, un appui dans ce qui
pouvait rester de lempreinte ou des souvenirs de lorganisation romaine ; les
magistrats y avaient t les suprieurs, non les pairs, de leurs justiciables. Une
fois de plus, lopposition de principes contraires, entre lesquels il fallait bien
opter, se traduisit par la diversit des coutumes. Selon les rgions, voire les
villages, les paysans taient jugs tantt par des cours collgiales, tantt par le
seigneur ou son sergent, tout seul. Ce dernier systme ne semble pas avoir t
dabord le plus frquent. Mais, durant p.510 le second ge fodal, lvolution
pencha nettement en sa faveur. Cour baron , compose de libres tenanciers
qui dcident du sort dautres libres tenanciers ; cour coutumire , o le
vilain, dsormais considr comme priv de la libert, courbe la tte sous les
arrts du snchal : telle est la distinction, lourde de consquences, qu au XIIIe
sicle les juristes anglais sefforcent dintroduire dans la structure judiciaire,
jusque-l beaucoup plus simple, des manoirs anglais. De mme, en France, au
mpris dune pratique encore trs rpandue, la doctrine, dont Beaumanoir est
linterprt e, veut, dans le jugement par les pairs, voir le monopole des
gentilshommes. La hirarchisation, qui tait une des marques de lpoque,
pliait ses fins jusquau rgime des tribunaux.
IV. En marge du morcellement : survivances et facteurs nouveaux
Si morcele, si seigneurialise que ft la justice, lerreur serait grave,
cependant, dimaginer que dans le monde fodal rien ne survct des
Marc BLOCH La socit fodale
350
anciennes juridictions de droit populaire ou public. Mais leur force de
rsistance, qui nulle part ne fut ngligeable, varia grandement selon les pays.
Le moment est donc venu de mettre laccent, avec plus de nettet quil na pu
tre fait jusquici, sur les contrastes nationaux.
En dpit dincontestables originalits, lvolution anglaise ne fut pas sans
prsenter, avec celle de ltat franc, dvidentes analogies. L encore, la
base de lorganisation judiciaire, nous trouvons la centaine, avec sa cour de
libres jugeurs. Puis, vers le Xe sicle, commencrent stablir, au -dessus des
centaines, les comts, en langue indigne shires. Dans le Sud, ils rpondaient
de vivantes divisions ethniques, anciens royaumes peu peu absorbs dans
des monarchies plus vastes tels le Kent ou le Sussex , ou bien groupes
spontanment forms au sein dun peuple en voie dtablissem ent : ainsi le
Suffolk et le Norfolk, gens du Sud et gens du Nord , qui reprsentaient
les deux p.511 moitis de la primitive Est-Anglie. Dans le Centre et le Nord, au
contraire, ils ne furent, ds lorigine, que des circonscriptions administratives
et militaires, plus tardivement et plus arbitrairement cres, au moment de la
lutte contre les Danois, avec une citadelle pour centre : ce pourquoi, dans cette
partie du pays, on les voit, pour la plupart, porter simplement le nom de leur
chef-lieu. Le shire lui aussi eut dsormais sa cour dhommes libres. Mais le
partage des comptences fut ici beaucoup moins nettement tranch que dans
lEmpire carolingien. Malgr quelques efforts pour rserver au tribunal du
comt le jugement de certains crimes particulirement odieux la paix
publique, il semble tre intervenu surtout dans les cas o la juridiction
infrieure stait montre impuissante. Par l sexplique que la distinction des
haute et basse justices soit toujours reste trangre au systme anglais.
Comme sur le continent, ces juridictions de nature publique rencontrrent
la concurrence des justices de chefs. De bonne heure, nous entendons parler
dassises tenues par le seigneur dans sa maison, son hall . Puis les rois
lgalisrent cet tat de fait. A partir du Xe sicle, on les voit distribuer des
permissions de juger, quon appelait droit de sake and soke (sake, qui
correspond au substantif allemand Sache, signifiait cause ou procs ;
soke, quil faut rapprocher du verbe allemand suchen, dsignait la
recherche du juge, cest --dire le recours ses arrts). Applicables tantt
une terre donne, tantt un groupe de personnes, les pouvoirs ainsi octroys
concidaient peu prs avec la comptence, trs large, on le sait, de la
centaine anglo-saxonne : ce qui leur confra, ds le dbut, un rayon suprieur
la capacit daction que comportait, en principe, limmunit carolingienne,
approximativement gal, par contre, aux droits quau Xe sicle, les immunistes
taient parvenus sapprop rier. Leur rpercussion sur les liens sociaux
paraissait si grave que le libre tenancier tira de sa soumission au tribunal du
matre son nom ordinaire : sokeman, au propre le justiciable . Parfois
mme certaines glises ou certains magnats reurent, titre de don perptuel,
le droit de tenir une cour de centaine ; et lon alla p.512 jusqu reconnatre
Marc BLOCH La socit fodale
351
quelques monastres, vrai dire en trs petit nombre, la facult de juger tous
les crimes, le jugement en ft-il habituellement rserv au roi.
Cependant ces concessions, si importantes fussent-elles, ne ruinrent
jamais compltement les vieilles juridictions collgiales de droit populaire. L
mme o la cour de centaine tait aux mains dun baron, elle continuait de se
runir, comme au temps o elle avait t prside par un dlgu du roi. Quant
aux cours de comt, leur fonctionnement, selon le schma ancien, ne fut
jamais interrompu. Sans doute les grands personnages, trop haut placs pour
se soumettre ses arrts, les paysans, mme libres, quavaie nt happs les
justices seigneuriales, cessrent gnralement de paratre ces assembles :
sauf, dailleurs, pour le menu peuple des villages, devoir, en principe, sy
faire reprsenter par le prtre, lofficier seigneurial et quatre hommes. Tout ce
qu il y avait, par contre, de moyen dans la puissance et la libert restait
astreint les frquenter. touffes entre les tribunaux seigneuriaux et
depuis la conqute normande lenvahissante juridiction royale, leur rle
judiciaire se rduisit, progressivement, assez peu de chose. Il ntait pas
absolument ngligeable, pourtant. Surtout ctait l dans le cadre du comt,
principalement, mais aussi dans celui, plus restreint, de la centaine que les
lments vraiment vivants de la nation gardaient lh abitude de se rencontrer
pour fixer la coutume du groupe territorial, rpondre, en son nom, toutes
sortes denqutes, voire porter, si besoin tait, la responsabilit de ses fautes
collectives : jusquau jour o, convoqus tous ensemble, les dputs des cours
de comt formrent le premier noyau de ce qui devait tre plus tard, la
Chambre des Communes. Certes le rgime parlementaire anglais neut point
son berceau dans les forts de la Germanie . Il reut profondment
lempreinte du milieu fodal dont i l tait sorti. Sa tonalit propre, cependant,
qui le mit si nettement part des systmes d tats du continent, et, plus
gnralement, cette collaboration des classes aises au pouvoir, si
caractristique, ds le moyen ge, de la structure politique anglaise, comment
ne pas en reconnatre lorigine dans le solide enracinement, sur le sol
insulaire, p.513 de larmature des plaids dhommes libres, conformes lantique
usage des temps barbares ?
Au-dessus de linfinie varit des coutumes locales ou r gionales, deux
grands faits dominrent lvolution du rgime judiciaire allemand. Le droit
des fiefs demeurant distinct du droit de la terre , ce fut cte cte avec
les anciennes juridictions et sans les absorber que se dvelopprent les
tribunaux vassaliques. Dautre part, le maintien dune hirarchie sociale plus
tage, la longue survivance, surtout, de lide que jouir de la libert ctait
dpendre, sans intermdiaire, de la puissance publique conservrent aux
anciens plaids de comt et de centaine avec des comptences, entre elles,
assez imparfaitement dlimites un rayon daction encore fort tendu. Tel
fut le cas surtout dans le Jura de Souabe et en Saxe, pays dalleux nombreux et
dincomplte seigneurialisation. Des jugeurs ou chevins on shabitua
cependant exiger, en rgle gnrale, une certaine fortune foncire. Parfois
Marc BLOCH La socit fodale
352
mme on en vint, selon la tendance alors presque universelle, considrer
leurs charges comme hrditaires. Si bien que le respect du vieux principe, qui
soumettait lhomme libre au jugement de cours dhommes libres, aboutit
souvent, en fin de compte, une composition des tribunaux plus quailleurs
oligarchique.
La France avec, sans doute, lItalie septentrionale fut, par
excellence, le pays de la justice seigneurialise. Certes, les traces du systme
carolingien y demeurrent profondment marques, surtout vers le Nord. Mais
elles nintressaient gure que la hirarchisation des justices seigneuriales
en hautes et basses et leur organisation interne. Les plaids de centaine ou
voirie disparurent trs vite et trs compltement. Il est caractristique que
le ressort du haut justicier ait pris, ordinairement, le nom de chtellenie :
comme si la conscience collective ne reconnaissait plus la source du droit de
juger que dans la possession dune maison forte, la fois origine et symbole
dune puissance de fait. Ce nest pas dire, cependant, que rien ne subsistt
des anciennes justices comtales. Dans les grandes principauts territoriales, le
prince, parfois, sut se rserver p.514 le monopole des causes de sang, au moins
sur de vastes tendues : ainsi en Flandre, en Normandie, en Barn.
Frquemment, on la vu, le comte juge des alleux ; il tranche les procs o les
glises, imparfaitement insres dans la hirarchie fodale, figurent comme
parties ; sauf concessions ou usurpations, il dtient, en principe, la justice des
marchs et des voies publiques. Il y avait l, dj, au moins en germe, un
puissant antidote la dispersion des pouvoirs judiciaires.
Ce ntait pas le seul. Dans toute lEurope, deux grandes forces
travaillaient limiter ou contrecarrer le morcellement des justices : lune
comme lautre longtemps mdiocrement efficaces, mais galement riches
davenir.
Dabord, les royauts. Que le roi ft, par essence, le suprme justicier de
ses peuples, l-dessus tout le monde tombait daccord. Restait tirer de ce
principe ses consquences pratiques. Ici le problme passait sur le plan de
laction et de la puissance de fait. Au X Ie sicle, le tribunal du Captien ne
fonctionne gure que pour juger les dpendants immdiats du prince et ses
glises ou bien, plus exceptionnellement et beaucoup moins efficacement,
comme cour vassalique, laquelle ressortissent les grands feudataires de la
Couronne. Celui du roi allemand, par contre, conu sur le modle carolingien,
attire encore lui un bon nombre de causes importantes. Mais, fussent-elles
relativement agissantes, ces cours attaches la personne du souverain
demeuraient, de toute vidence, incapables datteindre la masse des sujets. Il
ne suffisait mme point que, comme en Allemagne, l o passait le roi, au
cours de ses tournes de bon gouvernement, toute autre justice seffat
devant la sienne. Le pouvoir de la monarchie ne pouvait devenir un lment
dcisif du systme juridictionnel qu condition de pousser ses tentacules
travers le royaume entier, grce tout un rseau de juges missionnaires ou de
dlgus permanents. Telle fut luvre accomplie, au moment du
Marc BLOCH La socit fodale
353
regroupement gnral des forces qui marqua le terme du second ge fodal,
par les souverains anglo-normands et anglo-angevins dabord, plus tard et
beaucoup plus lentement par les p.515 Captiens. Ils devaient, les uns comme
les autres, mais les derniers surtout, trouver un point dappui p rcieux dans le
systme vassalique lui-mme. Car la fodalit, qui avait abouti diviser entre
tant de mains le droit de juger, fournissait cependant, par le jeu des appels, un
remde contre ce fractionnement.
On ne concevait pas, cette poque, quun p rocs, une fois tranch, pt
recommencer, entre les mmes adversaires, devant dautres magistrats. En
dautres termes, lerreur proprement dite, honntement commise, ne semblait
pas susceptible de redressement. Un des plaideurs, par contre, estimait-il que
le tribunal avait volontairement mal jug ? ou bien lui reprochait-il davoir,
plus brutalement encore refus tout jugement ? Rien nempchait quil nen
poursuivt les membres devant une autorit suprieure. Si, dans cette action,
absolument distincte de la prcdente, il obtenait gain de cause, les mauvais
juges, gnralement, subissaient un chtiment et leur sentence, de toute faon,
tait rforme. Lappel ainsi entendu nous le nommerions, aujourdhui,
prise partie du juge existait ds le temps des royaumes barbares. Mais il
ne pouvait tre port, alors, que devant la seule juridiction qui slevt
au-dessus des plaids dhommes libres : savoir la cour royale. Cest dire que
la pratique en tait rare et difficile. Le rgime vassalique ouvrit des
possibilits nouvelles. Tout vassal, dsormais, avait son seigneur de fief pour
juge ordinaire. Or le dni de justice tait un crime comme les autres. On lui
appliqua donc, tout naturellement, la rgle commune et les appels montrent
ainsi, dchelon en c helon, le long de la filire des hommages. La procdure
demeurait dlicate manier ; elle tait surtout dangereuse : car la preuve sy
faisait habituellement par le duel. Du moins la cour fodale, laquelle il
convenait dornavant de sadresser, se trouv ait-elle singulirement plus
accessible que celle dun roi trop lointain ; lorsquon en arrivait finalement au
souverain, ctait de proche en proche. En fait les appels, dans la pratique des
classes suprieures, devinrent de moins en moins exceptionnels. Parce quil
comportait une hirarchie des dpendances et, entre les chefs lun au -dessus
de lautre tags, tablissait une srie p.516 de contacts directs, le systme de la
vassalit et du fief permettait de rintroduire, dans lorganisation judiciaire, u n
lment dunit que les monarchies du type ancien, hors de porte de la
majeure partie des populations censes sujettes, staient montres
impuissantes sauvegarder.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
354
CHAPITRE II
Les pouvoirs traditionnels : royauts et Empire
I. Gographie des royauts
Au-dessus de la poussire des seigneuries, des communauts
familiales ou villageoises, des groupes vassaliques, slevaient, dans lEurope
fodale, divers pouvoirs dont lhorizon plus tendu eut longtemps pour ranon
une action beaucoup moins efficace, dont le destin cependant fut de maintenir,
dans cette socit morcele, certains principes dordre et dunit. Au sommet,
royauts et Empire tenaient leur force ou leurs ambitions dun long pass. Plus
bas, des dominations plus jeunes s tageaient, par une gradation presque
insensible, de la principaut territoriale la simple baronnie ou chtellenie. Il
convient de regarder dabord du ct des puissances les plus charges
dhistoire.
p.517
LOccident, aprs la chute de lEmpire romain, avait t dcoup en
royaumes gouverns par des dynasties germaniques. Ctait de ces monarchies
barbares que, par une succession plus ou moins directe, descendaient
presque toutes celles de lEurope fodale. La filiation tait particulirement
nette dans l Angleterre anglo-saxonne qui, vers la premire moiti du IXe
sicle, se divisait encore en cinq ou six tats, hritiers authentiques
quoique en beaucoup moins grand nombre des dominations nagure
fondes par les envahisseurs. On a vu comment les incursions scandinaves ne
laissrent finalement subsister que le Wessex, agrandi des dpouilles de ses
voisins. Son souverain prit, au p.518 Xe sicle, lhabitude de sintituler, soit roi
de toute la Bretagne, soit, plus souvent et plus durablement, roi des Angles ou
Anglais. Sur les frontires de ce regnum Anglorum subsistait cependant,
lpoque de la conqute normande, une marge celtique. Les Bretons du Pays
de Galles se rpartissaient entre plusieurs petites principauts. Vers le Nord,
une famille de chefs scots, cest --dire irlandais, soumettant, tour tour, les
autres tribus celtes des hautes terres et les populations germaniques ou
germanises du Lothian, avait, pice pice, constitu un vaste royaume, qui
emprunta aux vainqueurs leur nom national : l cosse.
Dans la pninsule ibrique, quelques nobles goths, rfugis dans les
Asturies aprs linvasion musulmane, sy taient donn un roi. Divis
plusieurs reprises entre les hritiers du fondateur, mais considrablement
accru par la Reconqute, ltat ainsi form eut sa capitale transporte, vers le
dbut du Xe sicle, Len, sur le plateau au sud des monts. Au cours de ce
Marc BLOCH La socit fodale
355
mme sicle, un commandement militaire tabli, vers lest, en Castille et qui
dabord avait dpendu des royaumes asturo -lonais, se rendit peu peu
autonome et son chef, en 1035, prit le titre de roi. Puis, une centaine dannes
plus tard, une scission analogue donna naissance, dans lOuest, au Portugal.
Cependant, les Basques des Pyrnes Centrales, que lon appelait les
Navarrais, vivaient part dans leurs valles. Eux aussi finirent par se
constituer en un royaume, qui apparat clairement aux environs de lan 900 et
dont se dtacha, en 1037, une autre menue monarchie, dnomme, daprs le
torrent qui en baignait le territoire, Aragon . Ajoutez, au nord du bas cours
de lbre, une marche cre par les Francs et qui, sous le nom de comt de
Barcelone, fut considre en droit, jusqu Saint Louis, comme un fief du roi
de France. Telles furent avec des frontires extrmement mouvantes et
soumises toutes les vicissitudes des partages, des conqutes et de la politique
matrimoniale les formations politiques do naquirent les Espagnes .
Au nord des Pyrnes, un des royaumes barbares, celui des Francs, avait
t dmesurment agrandi par les Carolingiens. La dposition de Charles le
Gros, en novembre 887 p.519 que suivit bientt sa mort, le 13 janvier de lanne
suivante, marqua lchec du dernier effort dunit. Ce ne fut point caprice si le
nouveau roi de lEst, Arnulf, ne tmoigna daucun empressement accepter
galement la domination sur lOuest, que lui offrait larchevque de Reims.
Visiblement, lhritage de Charlemagne semblait trop lourd. La division
sopra, en gros, selon les lignes quavait fixes le premier part age, celui de
Verdun, en 843. Constitu, cette date, par lunion de trois diocses de la rive
gauche du Rhin Mayence, Worms et Spire avec les vastes contres
germaniques nagure soumises, lest du fleuve, par les deux dynasties
franques, le royaume de Louis le Germanique fut, en 888, rtabli au profit du
seul survivant de ses descendants Arnulf de Carinthie. Ce fut la France
Orientale , que, par un anachronisme sans danger, sil est conscient, nous
pouvons dores et dj nommer Allemagne .
Dans lancien royaume de Charles le Chauve, la France Occidentale
notre France tout court , deux grands seigneurs furent peu prs
simultanment proclams rois : un duc italien, mais de famille franque, Gui de
Spolte ; un comte neustrien, dorigin e probablement saxonne, Eude. Le
second, qui disposait dune clientle beaucoup plus tendue et quavait illustr
la guerre contre les Normands, lemporta sans peine. La frontire fut
approximativement, ici aussi, celle de Verdun. Faite dune juxtaposition de
limites entre comts, elle coupait et recoupait plusieurs fois lEscaut et venait
toucher la Meuse un peu en aval de son confluent avec la Semois ; aprs quoi,
elle courait peu prs paralllement au fleuve et quelques lieues de lui, sur
la rive gauche. Elle atteignait ensuite la Sane, en aval de Port-sur-Sane, et
se confondait, sur une assez longue distance, avec son cours, ne sen cartant
gure quen face de Chalon, pour un crochet vers lest. Enfin, au sud du
Mconnais, elle abandonnait la ligne Sane-Rhne, de faon laisser la
puissance voisine tous les comts bordiers de la rive occidentale, et ne
Marc BLOCH La socit fodale
356
rattrapait le fil de leau que sur le delta, pour longer, jusqu la mer, le Petit
Rhne.
Restait la bande intermdiaire, qui, sinsrant, au n ord des Alpes, entre les
tats de Louis le Germanique et ceux p.520 de Charles le Chauve, puis se
prolongeant sur la pninsule italienne jusque vers Rome, avait, en 843, form
le disparate royaume de Lothaire. De ce prince, aucun descendant, en ligne
masculine, nexistait plus. Son hritage devait tre finalement tout entier
annex la France Orientale. Mais ce fut fragment par fragment.
Successeur de lancien tat lombard, le royaume dItalie couvrait le Nord
et le Centre de la pninsule, moins Venise la byzantine. Il connut, pendant
prs dun sicle, le plus orageux destin. Plusieurs lignes sy disputrent la
couronne : ducs de Spolte, dans le Sud, et surtout, vers le nord, les matres de
ces cols alpestres do il tait si facile et si tentant de fonc er sur la plaine :
marquis de Frioul ou dIvre, rois de Bourgogne, qui tenaient les passages des
Alpes Pennines, rois ou comtes de Provence, ducs de Bavire. Plusieurs
dentre ces prtendants se firent, en outre, sacrer empereurs par le pape ; car,
depuis le premier partage de lEmpire sous Louis le Pieux, la possession de
lItalie, en raison des droits de protection et de domination quelle entranait
sur Rome et sur lglise romaine, semblait la fois la condition ncessaire de
cette prestigieuse dignit et le meilleur des titres la briguer. Cependant
la diffrence des rois de la France Occidentale que leur loignement mme
prservait de nourrir des ambitions italiennes ou impriales les souverains
de la France Orientale comptaient, eux aussi, parmi les proches voisins du
beau royaume labandon. Dj, en 894 et 896, Arnulf, fort de son origine
carolingienne, y tait descendu, sy tait fait reconnatre roi et y avait reu
lonction impriale. En 951, un de ses successeurs, Otton Ier, un Saxon, dont le
grand-pre peut-tre avait nagure accompagn Arnulf au-del des monts,
reprit le mme chemin. Il fut acclam roi des Lombards dans la vieille
capitale, Pavie, puis ayant d, dans lintervalle, se donner dautres
tches revint dix ans aprs, soumit mieux le pays et poussa enfin jusqu
Rome, o le pape fit de lui un auguste empereur (2 fvrier 962).
Dsormais, sauf pour de courtes priodes de crises, lItalie, ainsi entendue,
naura, jusquau cur des temps modernes dautre monarque de dr oit que
celui de lAllemagne.
En 888, un trs haut personnage, de race bavaroise, le Welf Rodolphe,
se trouvait la tte du grand gouvernement militaire que les Carolingiens, au
cours des annes prcdentes, avaient tabli entre le Jura et les Alpes et que
lon nommait ordinairement duch de Transjurane : position capitale,
puisquelle commandait quelques -uns des principaux passages intrieurs de
lEmpire. Rodolphe chercha, lui aussi, pcher en eau trouble une couronne
et fit choix, pour cela, de cette espce de no mans land que constituait,
dans lintervalle entre les Frances de lOuest et de lEst, les pays que plus
tard on devait dire, si justement, dEntre Deux . Quil se soit fait sacrer
Toul indique suffisamment lorientation de ses esprances. Cependant, si loin
p.521
Marc BLOCH La socit fodale
357
de son duch propre, il manquait de fidles. Battu par Arnulf, il dut tout en
gardant le titre royal se contenter de joindre la Transjurane la plus grande
partie de la province ecclsiastique de Besanon.
Au nord de celle-ci, tout un morceau de lhritage de Lothaire restait donc
vacant. Ctait la rgion que, faute dun terme gographique appropri, on
appelait volontiers, du nom dun prince qui, fils et homonyme de ce premier
Lothaire, y avait rgn quelque temps, la Lotharingie : vaste territoire
bord louest par les limites de la France Occidentale, telles quelles ont t
prcdemment dfinies, lest par le cours du Rhin, que la frontire
nabandonnait que sur 200 kilomtres environ, pour remettre la France
Orientale ses trois diocses de la rive gauche ; pays de grosses abbayes et de
riches vchs, de beaux fleuves sillonns par les barques marchandes ;
contre vnrable aussi, puisquelle avait t le berceau de la maison
carolingienne et le cur m me du grand Empire. Les vivaces souvenirs que la
dynastie lgitime y avait laisss furent probablement lobstacle qui empcha
aucune royaut indigne de sy lever. Comme, nanmoins, l pas plus
quailleurs les ambitieux ne manquaient, leur jeu fut doppo ser lune lautre
les monarchies limitrophes. Dabord soumise de nom Arnulf, qui tait en
888 le seul des descendants de Charlemagne porter la couronne, fort indocile
ensuite envers le roi particulier quen la personne dun de ses btards Arnulf
p.522 bientt lui avait donn, la Lotharingie, aprs quen 911 la branche
carolingienne dAllemagne eut pri, fut longtemps dispute entre les princes
voisins. Bien quun sang diffrent coult dans leurs veines, les rois de France
Orientale se considraient comme les hritiers dArnulf. Quant aux souverains
de la France Occidentale du moins lorsquils appartenaient la ligne
carolingienne, ce qui fut le cas de 898 923, puis de 936 jusqu 987
comment ne les et-on pas vus revendiquer, sur la Meuse et le Rhin, la
succession de leurs aeux ? Cependant, la France Orientale, visiblement, tait
la plus forte : si bien que lorsquen 987, les Captiens eurent pris, leur tour,
dans le royaume adverse, la place de lancienne race, ils renoncrent tout
naturellement poursuivre un dessein tranger leurs propres traditions
familiales et pour lequel, dailleurs, il neussent plus trouv, sur les lieux
mmes, lappui dune clientle toute prte. Pour de longs sicles voire pour
toujours, en ce qui concerne sa partie nord-est, Aix-la-Chapelle et Cologne,
Trves et Coblence , la Lotharingie tait incorpore la constellation
politique allemande.
Aux abords de la Transjurane, le Lyonnais, le Viennois, la Provence, les
diocses alpestres taient rests prs de deux ans sans reconnatre aucun roi.
Dans ces rgions pourtant subsistaient le souvenir et les fidles dun
ambitieux personnage, nomm Boson, qui, au mpris de la lgitimit
carolingienne, avait, ds avant 887, su sy tailler un royaume indpendant.
Son fils, Louis descendant, en outre, par sa mre, de lempereur Lothaire
russit finalement se faire sacrer Valence, vers la fin de 890. Mais la
royaut ainsi fonde devait tre phmre. Ni Louis qui, ds 905, eut les yeux
Marc BLOCH La socit fodale
358
crevs, dans Vrone, ni son parent Hugues dArles, qui aprs cette tragdie
commanda longtemps au nom du malheureux aveugle, ne semblent jamais
avoir vu dans leurs terres dentre Rhne et monts autre chose quun point de
dpart commode pour la sduisante conqute de lItalie. En sorte quaprs la
mort de Louis, en 928, Hugues, proclam roi en Lombardie, laissa peu prs
librement les Welfs pousser leur domination jusqu la mer. A partir du milieu
du Xe sicle environ, le royaume de Bourgogne p.523 ainsi appelait-on
gnralement, l tat fond par Rodolphe stend donc de Ble la
Mditerrane. Ds ce moment, cependant, ses faibles monarques faisaient,
vis--vis des rois ou empereurs allemands, figure dassez modestes protgs.
Finalement non sans beaucoup de rpugnances dailleur s et de
tergiversations le dernier de la race, qui mourut en 1032, reconnut le
souverain de lAllemagne pour son successeur. A la diffrence de la
Lotharingie, mais comme lItalie, la Bourgogne ainsi entendue, que
lon connatra, de prfrence, dep uis le XIIIe sicle, sous le nom de royaume
dArles ne fut, dailleurs, pas prcisment absorbe dans lancienne France
Orientale. On concevait lunion plutt comme celle de trois royaumes
distincts, rassembls, indissolublement, dans la mme main.
Ainsi lre fodale vit se dessiner les premiers linaments dune carte
politique europenne, dont certains traits percent encore sous la ntre, et
dbattre des problmes de zones frontires destins, jusqu nos jours, faire
verser tantt de lencre, tantt du sang. Mais peut-tre, tout bien considr, le
trait le plus caractristique de cette gographie des royauts fut-il, avec des
marges si mouvantes entre leurs territoires, ltonnante stabilit du nombre
des royauts elles-mmes. Si, dans lancien Empir e carolingien, une foule de
dominations, en fait quasi indpendantes, slevrent, pour se dtruire sans
cesse, aucun de ces tyrans locaux, parmi les plus puissants, nosa
depuis Rodolphe et Louis lAveugle sattribuer le titre royal ni nier quil ne
ft, en droit, le sujet ou le vassal dun roi. Preuve, entre toutes loquente, de
ce que conservait de vigueur la tradition monarchique, beaucoup plus vieille
que la fodalit et destine lui survivre longtemps.
II. Traditions et nature du pouvoir royal
Les rois de lancienne Germanie faisaient volontiers remonter leur
gnalogie aux dieux. Semblables eux-mmes, comme dit Jordans, des
Ases ou demi-dieux , ctait de la vertu mystique dont leurs personnes
taient hrditairement imprgnes que leurs peuples attendaient la p.524
victoire au combat, et, pendant la paix, la fcondit des champs. Les
empereurs romains, de leur ct, avaient vcu entours dun nimbe divin. De
ce double hritage et, surtout, du premier, les royauts de lge fodal ti rrent
leur caractre sacr. Le christianisme lavait sanctionn, en empruntant la
Bible un vieux rite davnement, hbraque ou syriaque. Dans les tats
Marc BLOCH La socit fodale
359
successeurs de lEmpire carolingien, en Angleterre, en Asturies, les rois,
leur accession, ne reoivent pas seulement de la main des prlats les insignes
traditionnels de leur dignit et, notamment, cette couronne dont ils se pareront
dsormais, solennellement, durant les cours tenues aux grandes ftes, les
cours couronnes quvoque une charte de Louis VI de France (337). Un
vque encore, nouveau Samuel, oint ces nouveaux Davids, sur diverses
parties de leurs corps, avec une huile bnite : geste dont le sens universel, dans
la liturgie catholique, est de faire passer un homme ou un objet, de la catgorie
du profane celle du sacr. Larme, vrai dire, tait double tranchant.
Celui qui bnit est suprieur celui qui est bni : ainsi avait parl saint
Paul. De la conscration du roi par les prtres, ne fallait-il donc point conclure
la suprmatie du spirituel ? Tel fut en effet, presque ds lorigine, le
sentiment de plus dun crivain dglise. La conscience des menaces dont une
pareille interprtation tait lourde explique sans doute que, parmi les premiers
souverains de la France Orientale, plusieurs aient nglig ou refus de se faire
oindre. Leurs successeurs, cependant, ne tardrent gure venir
rsipiscence. Comment eussent-ils souffert dabandonner leurs rivaux de
lOuest le privilge de ce prestigieux charisme ? La crmonie ecclsiastique
de la remise des insignes anneau, glaive, tendard, couronne mme eut
ses imitateurs, plus ou moins tardivement, dans diverses principauts :
Aquitaine, Normandie, duchs de Bourgogne ou de Bretagne. Il est
caractristique que, par contre, aucun grand feudataire, si puissant ft-il, nait
jamais os lever ses prtentions jusquau sacre, dans le sens propre du mot,
cest --dire lonction. En dehors des prtres, on ne voyait de Christs du
Seigneur que parmi les rois.
De cette empreinte surnaturelle, dont lonction tait la p.525 confirmation
plutt que lorigine, la valeur ne pouvait manquer dtre vivement ressentie
par un ge habitu mler sans cesse la vie quotidienne les influences de
lau -del. Assurment une royaut vritablement sacerdotale et t
incompatible avec la religion partout rgnante. Les pouvoirs du prtre
catholique sont quelque chose de parfaitement dfini du pain et du vin, il
peut et peut seul faire le corps et le sang du Christ. Incapables, nayant pas
reu lordination, de clbrer le saint sacrifice, les rois ntaient donc pas, au
sens strict, des prtres. Mais, moins encore, de purs laques. Il est difficile
dexprimer clairement des reprsentations rebelles, en elles -mmes, la
logique. On en donnera cependant une ide approche en disant que, sans tre
revtus du sacerdoce, les rois, selon le mot dun crivain du X Ie sicle,
participaient son ministre. Do cette consquence, infiniment grave,
que, dans leurs efforts pour gouverner lglise, cest comme membres de
celle-ci quils croiront et quon les croira agir. Du moins, telle tait lopinion
commune. Dans les milieux ecclsiastiques, elle navait jamais rgn sans
partage. Au XIe sicle, les Grgoriens lattaqurent avec la plus rude et la plus
clairvoyante vigueur. Ils plaidaient pour cette distinction du spirituel et du
temporel, o Rousseau et Renan nous ont appris voir une des grandes
innovations du christianisme. Ils ne sparaient dailleurs si bien les deux
Marc BLOCH La socit fodale
360
pouvoirs quafin dhumilier les matres des corps devant les matre des mes :
la lune , qui nest que reflet, devant le soleil , source de toute lumire.
Mais leur succs, sur ce point, fut mince. Bien des sicles devaient scouler
avant quaux yeux des peuples, les royauts ne fussent ramenes leur rle de
puissances modestement humaines.
Dans lesprit des masses, ce caractre sacr ne se traduisait pas seulement
par la notion, trop abstraite, dun droit de direction ecclsiastique. Autour de
la royaut, en gnral, ou des diverses royauts particulires, tout un cycle de
lgendes et de superstitions slabora. Il natteignit, dire vrai, son plein
panouissement qu partir du moment o saffermirent, en fait, la plupart des
pouvoirs monarchiques : vers les XIIe et XIIIe sicles. Mais ses origines
remontaient p.526 au premier ge fodal. Depuis la fin du IXe sicle, les
archevques de Reims prtendent conserver le dpt dune huile miraculeuse,
jadis apporte Clovis, par une colombe, du haut du firmament : admirable
privilge qui permettra, du mme coup, ces prlats de revendiquer, en
France, le monopole du sacre, et leurs rois de se dire et se croire consacrs
par le Ciel mme. Les rois de France, depuis Philippe Ier au moins,
probablement depuis Robert le Pieux, les rois dAngleterre, depuis Henri Ier,
passent pour gurir certaines maladies par le contact de leurs mains.
Lorsquen 1081 lempereur Henri IV excommuni pourtant traversa la
Toscane, les paysans, accourus sur sa route, seffo raient de toucher ses
vtements, persuads de sassurer, par l, dheureuses moissons (338).
A l aura merveilleuse qui entourait ainsi les personnes royales,
opposerons-nous, pour mettre en doute lefficacit de cette image, le peu de
respect que trop souvent obtenait lautorit monarchique ? Ce serait mal poser
le problme. Car regardons-y de prs : de rois imparfaitement obis,
combattus et bafous par leurs feudataires, voire prisonniers de ceux-ci, les
exemples, en effet, sont sans nombre. Mais de rois qui aient pri de mort
violente, de la main de leurs sujets, jen vois, lpoque qui nous occupe, sauf
erreur, exactement trois : en Angleterre, douard le Martyr, victime dune
rvolution de palais fomente au profit de son propre frre ; en France, Robert
Ier, usurpateur tu au combat par un partisan du roi lgitime ; dans lItalie,
traverse de tant de luttes dynastiques, Brenger Ier. A ct des hcatombes de
lIslam, en regard de ce quoffrirait, dans lOccident mme, la l iste des
meurtres commis sur les grands vassaux des diverses couronnes, compte tenu,
enfin, des murs familires une poque de violences, on avouera que cest
peu.
Ces reprsentations, ainsi tages du religieux au magique, ntaient, sur le
plan des forces surnaturelles, que lexpression de la mission politique
reconnue comme propre aux rois : celle de chef du peuple , thiudans, selon
le vieux mot germanique. Dans le pullulement des dominations, qui
caractrisait le monde fodal, les royauts, comme la p.527 justement crit
Guizot, constituaient des pouvoirs sui generis : non seulement suprieurs,
en principe, tous les autres, mais encore dun ordre vritablement diffrent.
Marc BLOCH La socit fodale
361
Trait significatif : alors que les autres puissances taient, pour la plupart, de
simples agglomrats de droits divers, dont lenchevtrement voue lerreur
toute tentative pour figurer sur la carte ltendue daucun de ces fiefs ,
grands ou petits, au moyen de contours linaires, il existait au contraire, entre
les tats monarchiques, ce quon peut lgitimement appeler des frontires.
Non certes, l non plus, sous laspect de lignes exactement tires au cordeau.
Loccupation du sol, encore trs lche, nen imposait pas le besoin. Pour
sparer la France de lEmpire, dans l es marches mosanes, ne suffisait-il point
des halliers dserts de lArgonne ? Mais, du moins, une ville ou un village, si
dispute quen ft parfois lappartenance, semblait ne devoir jamais dpendre,
en droit, que dun seul des royaumes affronts, tandis quon pouvait fort bien
voir un quelconque potentat y exercer, par exemple, la haute justice, un autre
y possder des serfs, un troisime des cens avec leur juridiction, un quatrime
la dme. En dautres termes, pour une terre comme pour un homme, avoir
plusieurs seigneurs tait presque normal ; plusieurs rois, impossible.
Loin de lEurope, au Japon, il advint quun systme de subordinations
personnelles et terriennes, fort analogue notre rgime fodal, se constitua
peu peu en face dune monarchie, com me en Occident, beaucoup plus
ancienne. Mais l les deux institutions coexistrent, sans se pntrer.
Personnage sacr, comme nos rois, et beaucoup plus queux proche de la
divinit, lempereur, au pays du Soleil Levant, demeura, en droit, le souverain
du peuple entier. Au-dessous de lui, la hirarchie des vassaux sarrtait au
shogoun, leur chef suprme. Le rsultat fut que, pour de longs sicles le
shogoun accapara tout le pouvoir rel. En Europe, au contraire, les royauts,
antrieures par leur date et, par leur nature, trangres au rseau vassalique,
nen prirent pas moins place son sommet. Elles surent viter dtre elles mmes enveloppes dans le filet des dpendances. Arrivait-il que, par le jeu
de la patrimonialit des fiefs, une terre, p.528 auparavant soumise la
mouvance dun seigneur particulier ou dune glise, entrt dans le domaine
royal ? La rgle, universellement admise, tait que le roi, sil succdait
certaines des charges, se trouvait, cependant, dispens de tout hommage : car
il ne pouvait savouer le fidle dun de ses sujets. Par contre, rien navait
jamais empch que, parmi ceux-ci, qui tous taient, en tant que tels, ses
protgs, il ne ft choix de certains privilgis pour tendre sur eux, selon le
rite de lhommage, une prote ction particulire.
Or, dans le nombre de ces commends royaux figuraient, comme on
la vu, depuis le I Xe sicle, ct dune foule de petits satellites , tous les
magnats, hauts fonctionnaires bientt mus en princes rgionaux. Si bien que,
recteur du peuple, en son ensemble, le monarque est, en outre, degr par
degr, larrire -seigneur dune quantit prodigieuse de vassaux, voire mme,
travers eux, dune multitude, plus nombreuse encore, dhumbles dpendants.
Dans les pays dont la structure fodale exceptionnellement rigoureuse exclut
lalleu telle, lAngleterre aprs la conqute normande , il nest pauvre
hre si bas plac dans lchelle des sujtions qui, en levant les yeux,
Marc BLOCH La socit fodale
362
naperoive, au dernier barreau, le roi. Ailleurs, la chane, ava nt datteindre si
haut, parfois se rompt. Cependant, en tous lieux, cette fodalisation des
royauts fut certainement pour elles un lment de salut. L o il ne parvenait
plus commander comme chef de ltat, le roi, du moins, pouvait utiliser
son profit les armes du droit vassalique, nourri du sentiment de la plus vivante
alors parmi les attaches humaines. Dans la Chanson, est-ce pour son
souverain, est-ce pour le seigneur, auquel il a prt hommage, que Roland
combat ? Sans doute ne le sait-il pas lui-mme. Mais il ne combat avec tant
dabngation pour son souverain que parce que celui -ci est en mme temps
son seigneur. Plus tard, lorsque Philippe Auguste contestera au pape la facult
de disposer des biens dun comte hrtique, il dira encore, tout nat urellement :
ce comt est tenu de moi en fief ; non : il est de mon royaume . En ce
sens, la politique des Carolingiens, qui avaient rv de construire leur
gouvernement sur la vassalit, ne devait peut-tre pas, longue chance, se
montrer aussi vaine que ses p.529 premiers checs volontiers ne le feraient
croire. Bien des raisons nous lavons dj observ et nous aurons y
revenir conspirrent, durant le premier ge fodal, rduire peu de chose
laction vraiment efficace du pouvoir royal . Du moins disposait-il de deux
grandes forces latentes, toutes prtes spanouir sous linfluence de
conditions plus favorables : lintact hritage de son prestige ancien ; le regain
de jeunesse quil puisait dans son adaptation au systme social nouvea u.
III. La transmission du pouvoir royal ; problmes dynastiques
Cette dignit monarchique, cependant, lourde de traditions mles,
comment se transmettait-elle ? Hrdit ? lection ? Volontiers, nous tenons
aujourdhui les deux termes pour incompatibl es. Quils ne parussent point tels,
au mme degr, durant lre fodale, dinnombrables textes saccordent nous
lapprendre. Nous avons obtenu llection unanime des peuples et des
princes et la succession hrditaire du royaume indivis , ainsi sexp rime, en
1003, le roi dAllemagne Henri II. Et, en France, lexcellent canoniste qutait
Ive de Chartres : A juste titre celui-l a t sacr roi, auquel la royaut
revenait par droit hrditaire et qua dsign lunanime consentement des
vques et des grands (339). Ctait quon ne concevait aucun des deux
principes sous sa forme absolue. Conue moins comme lexercice dun libre
arbitre que sous laspect de lobissance une sorte de rvlation intime, qui
faisait dcouvrir le juste chef, la pure lection trouva, vrai dire, ses
dfenseurs chez les clercs. Hostiles lide, quasi paenne, dune vertu sacre
de la race, ils inclinaient, en outre, voir la source lgitime de tout pouvoir
dans un mode de nomination que lgl ise revendiquait, pour elle-mme,
comme seul conforme sa loi : labb ne devait -il pas tre choisi par ses
moines, lvque, par le clerg et le peuple de la cit ? Ces thologiens se
rencontraient l-dessus avec les ambitions des grands feudataires, qui ne
Marc BLOCH La socit fodale
363
souhaitaient rien tant que de voir la monarchie tomber dans leur dpendance.
Mais, impose par tout un p.530 monde de reprsentations que le moyen ge
avait reu, principalement de la Germanie, lopinion gnralement rpandue
tait toute diffrente. On croyait la vocation hrditaire, non dun individu,
mais dune ligne, seule cense capable de donner des chefs efficaces.
La conclusion logique et sans doute t lexercice de lautorit, en
commun, par tous les fils du roi dfunt ou le partage du royaume, entre eux.
Interprtes parfois, bien tort, comme prouvant la prtendue assimilation de
la royaut un patrimoine, alors quelles exprimaient, au contraire, la
participation de tous les descendants un mme privilge dynastique, ces
pratiques, on le sait, avaient t familires au monde barbare. Les tats
anglo-saxons et espagnols les perpturent, longtemps, lre fodale.
Cependant elles semblaient dangereuses pour le bien des peuples. Elles se
heurtaient cette notion dune monarchie indivi sible, sur laquelle un Henri II
mettait, trs consciemment, laccent et qui rpondait la survivance, parmi
tous les troubles, dun sentiment, encore vigoureux, de ltat. Une autre
solution, qui, dailleurs, avait toujours plus ou moins jou paralllemen t avec
la premire, prvalut donc. Dans cette famille prdestine, et dans elle seule
parfois, si la ligne masculine stait teinte, dans les familles allies les
principaux personnages du royaume, reprsentants-ns de lensemble des
sujets, nomment le nouveau roi. Lusage des Francs , crit, trs
pertinemment, en 893, larchevque de Reims, Foulque, fut toujours, leur roi
mort, den lire un autre dans la race royale (340) .
Lhrdit collective, ainsi comprise, devai t dailleurs presque
ncessairement tendre entraner lhrdit individuelle en ligne directe. Les
fils du dernier roi ne participaient-ils pas minemment aux vertus de son
sang ? Mais ici le facteur dcisif fut un autre usage, que lglise aussi
acceptait, chez elle, comme un utile antidote au hasard des lections.
Frquemment labb, de son vivant, faisait reconnatre par ses moines le
personnage quil dsignait lui -mme pour son successeur. Ainsi procdrent,
notamment, les premiers chefs du grand monastre de Cluny. De mme, le roi
ou le prince obtenait de ses fidles que, de son vivant, p.531 lun de ses fils ft
associ sa dignit, voire sil sagissait dun roi sacr incontinent :
pratique vraiment universelle, durant lre fodale, et dans la quelle on vit les
doges de Venise ou les consuls de Gate communier avec toutes les
monarchies de lOccident. Encore pouvait -il y avoir plusieurs fils. Parmi eux,
comment choisir lheureux bnficiaire de cette lection anticipe ? Pas plus
que le droit des fiefs, le droit monarchique ne se rallia demble lanesse.
Volontiers, en opposait celle-ci les droits de lenfant n dans la pourpre ,
cest --dire alors que son pre tait dj roi ; ou bien des raisons plus
personnelles faisaient pencher la balance. Pourtant, fiction commode et
dailleurs peu peu impose par lexemple mme du fief, le privilge de
primogniture, en dpit de quelques tentatives contraires, simposa presque
ds lorigine en France. LAllemagne, plus fidle lesprit des v ieilles
Marc BLOCH La socit fodale
364
coutumes germaniques, ne ladmit jamais sans rserves. En plein XI Ie sicle,
Frdric Barberousse devait encore se donner, pour continuateur, son second
fils.
Ce ntait l, dailleurs, que le signe de divergences plus profondes. Car,
parties des mmes notions dans lesquelles sunissaient le principe lectif et le
droit de la race, les coutumes monarchiques volurent, dans les diffrents
tats europens, en des sens singulirement variables. Il suffira ici de retenir
deux expriences particulirement typiques : celles que nous offrent la France,
dune part, lAllemagne, de lautre.
Lhistoire de la France Occidentale souvrit, en 888, par une clatante
rupture avec la tradition dynastique. En la personne du roi Eude les grands
avaient fait choix, dans toute la force du terme, dun homme nouveau. Ctait
que de la descendance de Charles le Chauve il ne restait alors quun enfant de
huit ans, qui, en raison de sa jeunesse, avait dj t, par deux fois, cart du
trne. A peine, nanmoins, ce garonnet appel, lui aussi, Charles et
quune historiographie sans indulgence devait surnommer le Simple
avait-il dpass cet ge de douze ans auquel le droit des Francs Saliens fixait
la majorit, quon le vit, le 28 janvier 893, sacr Reims. La guerr e entre les
deux rois dura p.532 longtemps. Mais, peu avant sa mort, qui survint le 1er
janvier 898, Eude, conformment, semble-t-il, un accord conclu quelques
mois plus tt, invita ses partisans se rallier, lui disparu, au Carolingien. Ce
fut seulement au bout de vingt-quatre ans que celui-ci retrouva un rival. Irrits
par la faveur que Charles tmoignait un petit chevalier, naturellement
enclins, dailleurs, lindocilit, quelques -uns des plus hauts personnages du
pays se mirent en qute dun autr e roi. Eude nayant pas laiss de fils, son
frre, Robert, avait hrit de ses honneurs patrimoniaux et de sa clientle. Il
fut llu des rebelles (29 juin 922). Pour avoir dj touch la couronne, cette
famille semblait demi consacre. Puis, lorsque Robert, lanne suivante, eut
t tu sur le champ de bataille, son gendre, le duc de Bourgogne Raoul, reut
son tour lonction ; et le guet-apens qui, peu aprs, fit de Charles, pour sa vie
entire, le prisonnier dun des principaux rvolts, assura la v ictoire de
lusurpateur. Pourtant, la mort de Raoul, lui aussi sans postrit masculine,
devait donner le signal dune vritable restauration. Le fils de Charles le
Simple, Louis IV, fut rappel dAngleterre o il stait rfugi (juin 936) . Son
propre fils, son petit-fils ensuite, lui succdrent sans difficults. Si bien que,
vers la fin du Xe sicle, tout paraissait conduire tenir pour dfinitif le
rtablissement de la lgitimit.
Il fallut, pour la remettre en question, le hasard dun accident de cha sse,
auquel succomba le jeune roi Louis V. Ce fut le petit-fils du roi Robert,
Hugues Capet, que, le 1er juin 987, proclama lassemble de Noyon.
Cependant il existait encore un fils de Louis IV, Charles, dont lempereur
allemand avait fait un duc de Basse-Lorraine. Il ne tarda pas revendiquer par
les armes son hritage et bien des gens, sans doute, ne voyaient dans Hugues,
selon le mot de Gerbert, quun roi intrimaire . Un heureux coup de main
Marc BLOCH La socit fodale
365
en dcida autrement. Tratreusement abus par lvque de Laon, Charles fut
pris, le jour des Rameaux de lanne 991, dans cette ville. Comme son
grand-pre, Charles le Simple, il devait mourir en captivit. Jusquau jour o
elle ne reconnatra plus de roi, la France dsormais nen aura que de race
captienne.
De cette longue tragdie, dnoue par la chance, il ressort assurment
que le sentiment de la lgitimit garda longtemps quelque force. Plus que les
chartes aquitaines qui, sous Raoul, puis sous Hugues Capet, marquent, par
leurs formules de datation, la volont de ne pas reconnatre les usurpateurs
les pays au sud de la Loire avaient toujours men une vie part et le baronat y
tait naturellement hostile des chefs issus de la Bourgogne ou de la France
propre , plus que lindignation convenue ou intresse de certaines
chroniques, les faits ici parlent haut. Il fallait bien que lexprience dEude, de
Robert et de Raoul part mdiocrement tentante pour quelle ait mis tant
dannes tre renouvele. Aucun scrupule nempcha le fils de Robert,
Hugues le Grand, de tenir, durant prs dun an, Louis IV prisonnier. Le
curieux est quil nait pas os mettre profit cette circonstance si favorable
pour se faire lui-mme roi. Amen par la plus inopine des morts, lvnement
de 987 ne fut pas, quoi quon en ait dit, avant tout un fait ecclsiastique . Si
larchevque de Reims, Adalbron, en fut incontestablement le principal
artisan, lglise entire ne se rangeait pas derrire lui. Selon toute apparence,
les fils de lintrigue remontaient la cour im priale de Germanie, laquelle le
prlat et son conseiller Gerbert taient lis la fois par lintrt personnel et
par les convictions politiques. Car, aux yeux de ces prtres instruits, Empire
tait synonyme dunit chrtienne. Dans les Carolingiens de France, les
Saxons, qui rgnaient alors sur lAllemagne et lItalie, redoutaient le sang de
Charlemagne, dont eux-mmes, sans en descendre, avaient recueilli lauguste
hritage. Plus particulirement, dun changement de dynastie ils attendaient,
juste titre, la paisible possession de cette Lorraine que les Carolingiens, qui
sy sentaient chez eux, navaient jamais renonc leur disputer. Le succs fut
facilit par la balance des forces, en France mme. Non seulement, conduit
chercher fortune hors de son pays natal, Charles de Lorraine ny avait gure
de faux. Dune faon plus gnrale, la cause carolingienne fut victime de
lincapacit o les derniers rois staient trouvs de conserver sous leur
domination directe assez de terres ou dglises pour s assurer lappui p.534
hrditaire dune vaste clientle vassalique, constamment tenue en haleine par
la promesse de nouvelles rmunrations. En ce sens, le triomphe des
Captiens reprsenta bien la victoire dun pouvoir jeune celui dun prince
territorial seigneur et distributeur de nombreux fiefs sur la puissance
traditionnelle dune royaut presque pure.
p.533
Ltonnant est dailleurs moins leur premire russite que lapaisement,
ds 991, de toute querelle dynastique. La ligne carolingienne ne stait p as
teinte avec Charles de Lorraine. Il laissait des fils, qui les uns plus tt, un
autre plus tard chapprent la captivit. On ne voit point quils aient
Marc BLOCH La socit fodale
366
jamais rien tent. Ni, non plus, malgr leur turbulence, les comtes de
Vermandois, dont la maison, issue dun fils de Charlemagne, ne devait
prendre fin que dans la seconde moiti du XIe sicle. Peut-tre, par une sorte
de rtrcissement du loyalisme, hsitait-on tendre les droits du sang jusqu
ces collatraux qui, sil stait agi dun fief, eussent t alors gnralement
considrs comme exclus de la succession. Largument semble avoir t
utilis en 987, contre Charles. A cette date et dans la bouche dadversaires, il
est suspect. Ne rend-il pas compte pourtant, en quelque mesure, de
labste ntion de la branche de Vermandois, ds 888 ? Et qui sait quel et t le
sort des Captiens, sans le merveilleux hasard qui, de 987 1316, fit que
chaque pre trouva, pour le continuer, un fils ? Surtout, obnubil chez les
grands par leurs ambitions, priv, dautre part, de lappui quet t capable
de lui fournir un groupe important de faux personnels, le respect de la
lgitimit carolingienne net gure pu tre entretenu que dans ces milieux
clricaux qui, seuls ou presque seuls, avaient alors lhabit ude dhorizons
intellectuels assez larges pour voir au del des petites intrigues quotidiennes.
Que les plus actifs et les plus intelligents des chefs de lglise, un Adalbron,
un Gerbert, en raison mme de leur attachement lide impriale, aient cru
devoir sacrifier aux porteurs actuels de cette ide la dynastie de Charlemagne,
tel fut, sans doute, dans lquilibre des forces, non plus matrielles, mais
morales, llment dcisif.
Comment expliquer cependant quen dehors mme des p.535 derniers
rejetons des Carolingiens, les Captiens naient vu se lever contre eux, jamais,
aucun concurrent ? Llection ne disparut pas, de longtemps. Voyez, tel quil
a t cit plus haut, le tmoignage dIve de Chartres ; il se rapporte Louis
VI, qui fut sacr en 1108. Une cour solennelle se runissait et proclamait un
roi. Puis, le jour du sacre, le prlat, avant de procder lonction, demandait
encore aux assistants leur consentement. Seulement, ce choix prtendu
tombait invariablement sur le fils du prcdent souverain, le plus souvent du
vivant de celui-ci, grce la pratique de lassociation. Il arrivait que tel ou tel
grand feudataire mt peu dempressement prter lhommage. Les rbellions
taient frquentes. Mais danti -roi, point. Il est significatif que la nouvelle
dynastie comme Ppin et ses successeurs lavaient dj fait pour les
Mrovingiens ait demble manifest sa volont de se rattacher la
tradition de la ligne quelle avait supplante. Les rois parlent des
Carolingiens comme de leurs prdcesseurs. De bonne heure, ils semblent
stre fait gloire de descendre deux par les femmes : ce quon peut croire
exact, un peu du sang de Charlemagne ayant probablement coul dans les
veines de lpouse de Hugues Capet. Puis, ds le temps de Louis VI, au plus
tard, on voit lentourage de la famille rgnante chercher utiliser, au profit de
celle-ci, la lgende du grand Empereur, qui, porte par lpope,
spanouissait alors en France, voire, peut -tre, collaborer son rayonnement.
Dans cet hritage, les Captiens puisaient, avant tout, les prcieux prestiges de
la royaut sacre. Ils ne tardrent point y ajouter, de leur propre cru, un
miracle particulirement mouvant : celui de la gurison. Le respect de
Marc BLOCH La socit fodale
367
lonction, qui nempchait pas les rvoltes, p rvenait les usurpations. En un
mot, peu prs tranger au monde romain, mais venu lOccident, par la
Germanie, du lointain dges primitifs, le sentiment du mystrieux privilge
qui semblait sattacher une race prdestine avait tant de vigueur tenac e que,
du jour o il fut servi la fois par le hasard des naissances masculines et par la
prsence, autour de la maison royale, de fidles nombreux, on vit une
lgitimit toute frache se reconstruire trs vite sur les ruines de lancienne.
En Allemagne, lhistoire des successions royales offrit, ses dbuts,
des lignes beaucoup plus simples. Lorsque la dynastie carolingienne, dans sa
branche germanique, se fut teinte, en 911, le choix des magnats tomba sur un
grand seigneur franc, alli la race disparue, Conrad Ier. Mal obi, mais sans
que jamais se ft lev contre lui un autre prtendant, ce prince dsigna luimme, pour rgner aprs sa mort, le duc de Saxe, Henri, qui, malgr la
concurrence du duc de Bavire, fut lu et reconnu sans beaucoup de
difficults. Ds lors cependant que le royaume de lOuest se dbattait dans
une longue querelle dynastique les souverains de cette famille saxonne
vont se suivre, durant plus dune centaine dannes (919 -1024), de pre en
fils, voire de cousin en cousin. Llection, qui continuait rgulirement avoir
lieu, ne semblait que confirmer lhrdit. Or, faisons maintenant, travers les
temps, un bond dun sicle et demi environ. Entre les deux nations, le
contraste subsiste. Mais il sest invers. En Eur ope, ce sera dsormais un des
lieux communs de la spculation politique que dopposer la France, royaume
hrditaire, lAllemagne, o la monarchie, dit -on, est lective.
p.536
Trois grandes causes, qui agirent dans le mme sens, avaient ainsi dvi
lvolutio n allemande. Le hasard physiologique, qui fut si favorable aux
Captiens, tourna ici au dtriment de la continuit dynastique :
successivement, on vit succomber, sans postrit masculine ni agnats, le
cinquime des rois saxons, puis le quatrime roi issu de la ligne salienne ,
cest --dire franque, qui avait pris leur place. Dautre part, la royaut
allemande, depuis Otton Ier, paraissait lie la dignit impriale. Or, si les
royauts de tradition foncirement germanique reposaient sur lide dune
vocation hrditaire, sinon de lindividu, du moins du lignage, la tradition
romaine, qui tait lorigine de lEmpire et quentretenait une littrature,
historique ou pseudo-historique, de mieux en mieux connue depuis la fin du
XIe sicle, navait au contr aire jamais pleinement accept ces privilges du
sang. Cest larme qui fait lEmpereur , rptait-on volontiers ; et les hauts
barons, naturellement, taient tout prts assumer le rle de ces lgions ou
encore, p.537 comme ils se plaisaient aussi le dire, du Snat . Enfin, la lutte
violente qui, au temps du mouvement grgorien, clata entre les souverains de
lAllemagne et la papaut, nagure rforme par leurs soins, amena les papes
dresser, contre le monarque ennemi, quils souhaitaient fair e dposer, le
principe de llection, si conforme, par ailleurs, au sentiment de lglise. Le
premier anti-roi quait connu lAllemagne depuis 888 fut lu contre le Salien
Henri IV, le 15 mars 1077, en prsence des lgats pontificaux. Il ne devait pas
Marc BLOCH La socit fodale
368
demeurer, beaucoup prs, le dernier ; et sil est sans doute inexact que cette
assemble se soit expressment prononce en faveur du caractre jamais
lectif de la monarchie, le bruit qui, sur le moment, en courut dans les
monastres tmoignait, tout le moins, dune juste prescience de lavenir.
Mais lpret mme de la querelle qui divisait ainsi les rois allemands et la
Curie ne sexplique, son tour, que parce que ces rois taient aussi empereurs.
Alors quaux autres souverains les papes ne pouvaient reprocher que
loppression dglises particulires, dans les successeurs dAuguste et de
Charlemagne ils trouvaient des rivaux la domination de Rome, du Sige
Apostolique et de la Chrtient.
IV. Lempire
Leffondrement de ltat carolingien avait eu pour effet de livrer des
factions locales les deux dignits pan-chrtiennes : la papaut, aux clans de
laristocratie romaine ; lEmpire, aux partis qui se formaient et se dfaisaient
sans cesse dans le baronat italien. Car, on la dj vu, le titre imp rial semblait
attach la possession du royaume dItalie. Il ne reprit quelque sens que
lorsquil eut t, depuis 962, appropri par les souverains allemands, dont les
prtentions pouvaient sappuyer sur une force, pour le temps, considrable.
Non, dail leurs, que les deux titres, royal et imprial, se soient jamais
confondus. Durant la priode qui stait coule entre Louis le Pieux et Otton
Ier, on avait vu dfinitivement saffirmer le double caractre, la fois romain
et pontifical, de lEmpire dOcc ident. Pour se dire empereur, il p.538 ne saurait
donc suffire davoir t reconnu et sacr en Allemagne. Il faut, de toute
ncessit, avoir reu, Rome mme, des mains du pape une conscration
spcifique, par une seconde onction et la remise des insignes proprement
impriaux. Le fait nouveau est que dsormais llu des magnats allemands
passe pour le seul candidat lgitime cet auguste rite. Comme devait lcrire,
vers la fin du XIIe sicle, un moine alsacien : quel que soit le prince que la
Germanie a choisi comme chef, devant lui lopulente Rome courbe la tte et
ladopte pour son matre. Bientt mme on considrera que, ds son
avnement comme roi dAllemagne, ce monarque accde, par l -mme et
demble, au gouvernement, non seulement de la France Orientale et de la
Lotharingie, mais aussi de tous les territoires impriaux : Italie, plus tard
royaume de Bourgogne. En dautres termes, tant, selon le mot de Grgoire
VII, le futur Empereur , il commande dj dans lEmpire : situation
dattente expr ime, depuis la fin du XIe sicle, par le nom de roi des Romains,
que le souverain allemand porte, dornavant, ds son lection au voisinage du
Rhin, pour lchanger contre un nom plus beau seulement le jour o, ayant
enfin entrepris la classique expdition romaine , le Rmerzug traditionnel,
il aura pu coiffer, sur les bords du Tibre, la couronne des Csars. A moins que
les circonstances, mettant obstacle ce long et difficile voyage, ne le
Marc BLOCH La socit fodale
369
condamnent se contenter, toute sa vie durant, de ntre que le roi dun
Empire.
Supposons-le, cependant, assez heureux pour avoir t, vraiment, fait
empereur : comme ce sera, dailleurs, jusqu Conrad III exclusivement
(1138-1152), le sort, tt ou tard, de tous les monarques appels rgner sur
lAllemagne. De ce titre envi, quel tait donc le contenu ? Nul doute quil ne
semblt exprimer une supriorit sur le commun des rois : les roitelets
(reguli), comme on se plaira le dire, dans lentourage du matre, au XI Ie
sicle. Ainsi sexplique quon ait vu pa rfois sen parer, hors des limites de
lancien Empire carolingien, divers souverains qui, par l, prtendaient la
fois marquer leur indpendance vis--vis de toute monarchie censment
universelle et leur propre hgmonie sur les royaumes ou anciens royaumes
voisins : tels, en Angleterre, p.539 certains rois de Mercie ou de Wessex et, plus
souvent, en Espagne, ceux de Len. Simples plagiats, la vrit ! Il ntait en
Occident dempereur authentique que lempereur des Romains , selon la
formule que, ds 982, la chancellerie ottonienne avait reprise, face Byzance.
La mmoire des Csars fournissait en effet laliment dont se nourrissait le
mythe de lEmpire. De prfrence, les souvenirs des Csars chrtiens. Rome
ntait -elle point, en mme temps que la tte du Monde , la cit
apostolique, rnove par le prcieux sang des martyrs ? Aux
rminiscences de luniversalit romaine, limage de Charlemagne, lui aussi,
selon le mot dun vque imprialiste, conqurant du Monde (341) venait se
mler, pour les fortifier dvocations moins lointaines. Otton III, qui sur son
sceau inscrivit la devise Renouvellement de lEmpire Romain dj,
dailleurs, employe par Charlemagne lui -mme fit, dautre part,
rechercher Aix la tombe du grand Carolingien, quavaient nglige des
gnrations plus indiffrentes lhistoire et, tout en procurant ces glorieux
ossements un spulcre cette fois digne de leur renomme, prleva, pour son
propre usage, comme autant de reliques, un bijou et quelques fragments de
vtements pris au cadavre : gestes parallles, par o sexprimait loquemment
la fidlit une double et indissoluble tradition.
Assurment ctaient l, avant tout, des ides des clercs. Du moins, par
lorigine. Il nest pas bi en sr que des guerriers passablement incultes, comme
un Otton Ier ou un Conrad II, leur aient jamais t parfaitement permables.
Mais les clercs qui environnaient et conseillaient les rois et parfois avaient fait
leur ducation ne restaient pas sans influence sur leurs actes. Parce quil tait
jeune, instruit, de temprament mystique, quil tait n dans la pourpre et quil
avait reu les leons dune princesse byzantine, sa mre, Otton III puisa les
ivresses du rve imprial. Romain, triomphateur des Saxons, triomphateur
des Italiens, esclave des Aptres, par le don de Dieu auguste empereur du
Monde : le notaire qui, en tte dun de ses diplmes, droulait ainsi sa
titulature, croira-t-on quil ne ft point, par avance, sr de lassentiment du
matre ? Comme un refrain, p.540 les expressions de recteur du Monde , de
Marc BLOCH La socit fodale
370
seigneur des seigneurs du Monde reviennent, un peu plus d un sicle plus
tard, sous la plume de l historiographe officiel du premier des Saliens (342).
Seulement, cette idologie, y regarder de prs, tait un tissu de
contradictions. Rien de plus sduisant, au premier abord, que de se laisser,
comme Otton Ier, traiter de successeur du grand Constantin. Mais la fausse
Donation, que la Curie avait mise sous le nom de l auteur de la Paix de
l glise et par laquelle il tait cens avoir cd au pape l Italie, voire
l Occident tout entier, tait, pour le pouvoir imprial, si gnante, que, dans
l entourage d Otton III, on se prit en mettre en question l authenticit ;
l esprit de parti avait veill le sens critique. En se faisant, depuis Otton Ier,
sacrer, de prfrence, Aix-la-Chapelle, les rois allemands signifiaient qu ils
se tenaient pour les lgitimes hritiers de Charlemagne. Pourtant dans cette
Saxe, d o la dynastie rgnante tait issue, le souvenir de la guerre atroce qu y
avait mene le conqurant avait laiss nous le savons par l historiographie
de longues rancu rs. L Empire romain vivait-il vraiment encore ? On
l affirmait volontiers chez les clercs, puisque aussi bien l interprtation
ordinairement donne l Apocalypse forait voir en lui le dernier des quatre
Empires, avant la Fin du Monde. D autres crivains, cependant, doutaient de
cette prennit ; leur gr le partage de Verdun avait, marqu dans l histoire,
un tout nouveau commencement. Enfin, ces Saxons, Francs, Bavarois ou
Souabes empereurs ou grands seigneurs de l Empire , qui voulaient
marcher dans les pas des Romains de nagure, se sentaient, en ralit,
vis--vis des Romains de leurs jours, des mes d trangers et de vainqueurs.
Ils ne les aimaient ni ne les estimaient et ils en taient ardemment dtests.
Des deux parts, jusqu aux pires violences. Le cas d Otton III, vraiment
Romain de cu r, fut exceptionnel et son rgne se termina dans la tragdie
d un songe du. Il mourut loin de Rome d o l avait chass l meute, tandis
que, parmi les Allemands, on l accusait d avoir nglig, pour l Italie, la terre
de sa naissance, la dlectable Germanie .
Quant aux prtentions la monarchie universelle, elles p.541 manquaient
videmment de tout soutien matriel de la part de souverains que pour ne
pas parler de difficults plus graves une rvolte des Romains ou des gens
de Tivoli, un chteau tenu, un point de passage, par un seigneur rebelle,
voire la mauvaise volont de leurs propres troupes empchaient trop souvent
de gouverner efficacement leurs propres tats. En fait, jusqu Frdric
Barberousse (dont l avnement se place en 1152), elles ne semblent pas avoir
dpass le domaine des formules de chancellerie. On ne voit point qu au cours
des nombreuses interventions des premiers empereurs saxons en France
Occidentale, elles aient jamais t mises en avant. Ou du moins ces immenses
ambitions ne cherchaient gure alors se manifester que par un biais. Matre
suprme de Rome, partant avou de saint Pierre, c est--dire son
dfenseur, hritier surtout des droits traditionnels que les empereurs romains
et les premiers Carolingiens avaient exercs sur la papaut, gardien enfin de la
foi chrtienne partout o s tendait sa domination, relle ou prtendue,
Marc BLOCH La socit fodale
371
l empereur saxon ou salien n avait pas, ses propres yeux, de mission plus
haute ni plus troitement adhrente sa dignit que de protger, rformer et
diriger l glise romaine. Comme le dit un vque de Verceil, c est l abri
de la puissance de Csar que le pape lave les sicles de leurs pchs (343).
Plus prcisment il s estime, ce Csar , en droit de nommer le souverain
pontife ou, tout le moins, d exiger qu il ne soit dsign qu avec son assentiment. Par amour de saint Pierre nous avons choisi comme pape notre
prcepteur le seigneur Silvestre et, avec la volont de Dieu, nous l avons
ordonn et tabli pape : ainsi parle Otton III, dans un de ses diplmes. Par
l, puisque le pape n tait pas seulement vque de Rome, mais aussi et
surtout le chef de l glise universelle universalis papa, rpte deux
reprises le privilge accord par Otton le Grand au Saint-Sige , l Empereur
se rservait sur la chrtient tout entire une sorte de droit de contrle qui,
ralis, et fait de lui beaucoup plus qu un roi. Par l, aussi, un germe d invitable discorde entre le spirituel et le temporel tait introduit dans l Empire :
germe de mort, la vrit.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
372
Chapitre III
Des principauts territoriales aux chtellenies
I. Les principauts territoriales
En soi, la tendance qui poussait les grands tats se fragmenter en
formations politiques de plus faible rayon tait, dans lOccident, chose trs
vieille. Presque au mme degr que les ambitions des commandants darmes,
lindocilit des aristocraties de cits, parfois groupes en ligues rgionales,
avait menac lunit de lEmpire romain finissant. Dans certains secteurs de
lEurope fodale survivaient encore, comme les tmoins dges en dautres
lieux rvolus, quelques-unes de ces petites Romaniae oligarchiques. Telle, la
communaut des Vntiens , association de bourgades fondes dans les
lagunes par les fugitifs de la Terre Ferme et dont le nom collectif, emprunt
la province dorigine, ne devait que tardivement se fixer sur la butte du Rialto
notre Venise , peu peu promue au rang de capitale. Telles aussi, dans
lItalie du Sud, Naples et Gate. En Sardaigne, des d ynasties de chefs
indignes avaient dcoup lle en judicatures . Ailleurs, ltablissement
des royauts barbares entrava ce fractionnement. Non, cependant, sans que
plus dune concession ne dt tre consentie lirrsistible pression des forces
locales. Navait -on pas vu les rois mrovingiens obligs de reconnatre, tantt
laristocratie de tel ou tel comt le droit dlire le comte, tantt aux grands
de la Bourgogne celui de se donner eux-mmes leur maire du palais
particulier ? Si bien que la constitution de pouvoirs p.544 provinciaux, qui
sopra sur tout le continent lors de leffondrement de lEmpire carolingien et
dont lanalogue se retrouve, un peu plus tard, chez les Anglo -Saxons, put
sembler, en un sens, un simple retour en arrire. Mais li nfluence des
institutions publiques, trs fortes, de lpoque immdiatement antrieure,
imprima alors au phnomne un tour original.
p.543
Dans tout lEmpire franc, la base des principauts territoriales, nous
trouvons rgulirement des agglomrations de comts. En dautres termes
puisque le comte carolingien tait un vrai fonctionnaire les bnficiaires
des pouvoirs nouveaux peuvent, sans trop danachronisme, tre compars
des sortes de sur-prfets, dont chacun, en mme temps commandant darmes,
aurait runi plusieurs dpartements sous son administration. Charlemagne,
dit-on, stait fait une loi de ne jamais confier un mme comte plusieurs
circonscriptions la fois. On ne saurait assurer, cependant, que, de son vivant
mme, cette sage prcaution ait toujours t observe. Il est sr que, sous ses
successeurs et notamment aprs la mort de Louis le Pieux, elle cessa tout fait
Marc BLOCH La socit fodale
373
de ltre. Elle ne se heurtait pas seulement la voracit des magnats. Les
circonstances mme la rendaient difficilement applicable. Les invasions,
comme les querelles des rois rivaux, ayant port la guerre jusquau cur du
monde franc, ltablissement de vastes commandements militaires, pareils
ceux qui de tout temps avaient exist sur ses limites, simposait un peu
partout. Parfois, ils prenaient leur origine dans une de ces tournes de contrle
que Charlemagne avait institues ; linspecteur temporaire, le missus, se
transformait en gouverneur permanent. Ainsi, entre Seine et Loire, Robert le
Fort, ou, plus au Sud, lanctre des comtes de Toulouse.
A ces concessions de comts sajoutait ordinairement celle des principaux
monastres royaux du pays. Devenu leur protecteur, voire leur abb
laque, le grand chef en tirait dimportantes ressources en biens et en hommes.
Souvent possessionn dj, par lui-mme, dans la province, il y acqurait de
nouveaux fiefs ou de nouveaux alleux ; il sy constituait notamment en
usurpant lhommage des p.545 vassaux royaux une importante clientle.
Incapable dexercer directement son auto rit sur tous les territoires qui lui
taient lgalement soumis, oblig, par suite, dinstaller ou daccepter, dans
quelques-uns dentre eux, soit des comtes de rang infrieur, soit de simples
vicomtes (mot mot dlgus du comte), il sunissait du moins ces
subordonns par les liens de lhommage. Pour dsigner les rassembleurs de
comts, lusage ancien ne fournissait aucune tiquette prcise. On les intitulait
et ils sintitulaient eux -mmes, peu prs indiffremment, archicomtes ,
comtes principaux , marquis cest --dire commandants dune
marche, par analogie avec les gouvernements des frontires qui avaient fourni
le modle de ceux de lintrieur , ducs enfin, ce qui tait un emprunt la
terminologie mrovingienne et romaine. Mais ce dernier mot ne semployait
gure que l o une unit provinciale ou ethnique ancienne servait de support
la puissance nouvelle. La mode lentement fit triompher ici lun, l un autre
des titres concurrents, voire finalement, comme Toulouse ou en Flandre, le
simple nom de comte.
Ces constellations de pouvoirs nacquirent, cela va de soi, une vritable
stabilit qu partir du moment o trs tt comme lon sait, en France
Occidentale, sensiblement plus tard dans lEmpire lhrdit des
honneurs en gnral se fut introduite. Jusque-l une mort inopportune, les
changeants desseins dun roi, par aventure capable de faire sentir efficacement
son autorit, lhostilit de puissants ou habiles voisins pouvaient, chaque
instant, venir ruiner ldifice. Da ns le Nord de la France, deux tentatives, au
moins, de runions de comts, par deux lignes diffrentes, prcdrent
luvre que les marquis de Flandre , depuis leur citadelle de Bruges,
devaient mener bonne fin. En un mot, dans le succs ou lchec, le hasard
eut certainement une grande part. Ses jeux, cependant, nexpliquent pas tout.
Les fondateurs des principauts ntaient sans doute pas de bien subtils
gographes. Mais ils ne firent gure besogne utile que l o la gographie ne
contrecarrait point leurs ambitions : l o ils surent coudre les uns aux autres
Marc BLOCH La socit fodale
374
des territoires entre lesquels les communications taient p.546 suffisamment
aises et traditionnellement frquentes ; l, surtout, o il leur fut donn de se
rendre matres de ces points de passage dont dj ltude des monarchies nous
a montr limportance, la fois positions militaires dcisives et, par les
pages, sources de beaux revenus. Menac par beaucoup de circonstances
dfavorables, le principat bourguignon et-il russi vivre et prosprer si,
dAutun la valle de lOuche, les ducs navaient tenu les routes qui, travers
les pres solitudes du haut pays, joignaient la France propre au bassin
rhodanien ? Il brlait de possder la citadelle de Dijon dit, dun
prtendant, le moine Richer , pensant bien que, du jour o il disposerait
de cette place, il pourrait soumettre ses lois la meilleure part de la
Bourgogne. Seigneurs des Apennins, les sires de Canossa ne tardrent pas
tendre, du haut des monts, leur pouvoir sur les basses terres voisines, vers
lArno comme vers le P.
Souvent aussi, la tche tait prpare par danciennes habitudes de vie
commune. Ce ne fut pas sans raison que, sous la titulature de beaucoup de
chefs nouveaux, on vit rapparatre de vieux noms nationaux. A dire vrai, l
o le groupe ainsi dsign tait trop tendu, il nen subsista, au bout du
compte, rien de plus quune tiquette, assez arbitrairement applique un
fragment du tout.
Parmi les grandes subdivisions traditionnelles de ltat franc, qui plus
dune fois avaient constitu des royauts spares, lAustrasie avait t
presque tout entire absorbe dans la Lorraine. Des trois autres, par contre
Aquitaine, Bourgogne, Neustrie, enfin, que lon stait peu peu accoutum
nommer France, tout court le souvenir, aux environs de lan 900, ne stait
pas encore effac de la mmoire des hommes. Placs la tte de vastes
commandements rgionaux, divers personnages sintitulrent donc ducs des
Aquitains, des Bourguignons ou des Francs. La runion de ces trois
principauts semblait si bien recouvrir le royaume entier que le roi lui-mme
se disait parfois roi des Francs, des Aquitains et des Bourguignons et
quaspirant tout dominer, le Robertien Hugues le Grand ne crut pas trouver,
pour cela, de moyen plus sr que de joindre au duch de France, dans lequel il
avait succd son pre, linvestiture p.547 des deux autres : concentration trop
grandiose, dailleurs, pour avoir pu durer plus quun moment (344).
Mais, en fait, les ducs de France, devenus plus tard les rois Captiens,
nexercrent jamais dautorit relle que sur les comts quils tenaient
directement en main et qui ceux de la basse Loire ayant t usurps par
leurs propres vicomtes se rduisaient, vers 987, six ou huit
circonscriptions environ, autour de Paris et dOrlans. De lantique terre des
Burgondes, le nom fut finalement partag, lpoque fodale, entre le
royaume des Rodolphiens, un grand fief tenu de ces rois ( la comt de
Bourgogne, notre Franche-Comt) et un duch franais. Encore, ce dernier,
tal de la Sane lAutunois et lAvallonnais, tait -il bien loin de
comprendre tous les pays ceux de Sens et de Troyes, par exemple qui,
Marc BLOCH La socit fodale
375
dans la France Occidentale mme, continuaient tre dits en Bourgogne .
Le royaume dAquitaine stait tendu au nord jusqu la Loire et longtemps
le centre de gravit du duch, qui lui succda, demeura proche du fleuve. Ce
fut de Bourges que le duc Guillaume le Pieux data, en 910, la charte de
fondation de Cluny. Cependant, le titre ayant t disput entre plusieurs
maisons rivales, celle qui le conserva se trouva dabord ne plus possder de
droits effectifs que sur les plaines poitevines et lOuest du Massif Central.
Puis, vers 1060, un hritage heureux lui permit de joindre son premier
patrimoine la principaut fonde, entre Bordeaux et les Pyrnes, par une
famille de dynastes indignes, qui cette rgion ayant t nagure en partie
occupe par des envahisseurs de langue euskarienne staient appels ducs
des Basques ou Gascons. Ltat fodal issu de cette fusion tait certes
considrable. Il nen laissait pas moins hors de ses prises de larges tranches de
lAquitaine primitive.
Ailleurs la base ethnique tait plus nette. Entendons, abstraction faite de
toutes considrations prtendument raciales, la prsence, comme substrat,
dun groupe pourvu dune certaine unit traditionnelle de civilisation. Parmi
bien des traverses, le duch breton fut lhritier du royaume qu la faveur
des troubles de lEmpire carolingien, des chefs celtes de lArmorique avaient
cr, en runissant p.548 tout comme les rois scots au loin, dans le Nord
aux terres de peuplement celtique leurs confins dautre langue : ici, les vieilles
marches romanes de Rennes et de Nantes. La Normandie devait sa naissance
aux pirates scandinaves. En Angleterre, les anciennes divisions de lle,
traces par ltablissement des diffrents peuples germaniques, servirent
approximativement de cadres aux grands gouvernements que les rois, partir
du Xe sicle, prirent lhabitude de constituer au profit de quelques magnats.
Mais nulle part ce caractre ne devait tre plus accentu que dans les duchs
allemands.
A leur origine, nous retrouvons les mmes faits quen France O ccidentale
ou en Italie : runion de plusieurs comts en commandements militaires ;
indtermination primitive de la titulature. Celle-ci, cependant, se fixa ici
beaucoup plus vite et avec beaucoup plus duniformit. Dans un intervalle de
temps remarquablement court de 905 915 environ , on vit surgir les
duchs dAlmanie ou Souabe, de Bavire, de Saxe, de Franconie (diocses
ripuaires de la rive gauche du Rhin et terres de colonisation franque, sur le
Bas-Main), sans compter celui de Lorraine, o le duc ntait que le successeur
amoindri dun roi. Ces noms sont significatifs. Dans la France de lEst , qui
navait pas subi, comme lancienne Romania, le grand brassage des invasions,
persistaient, sous lunit de principe dun tat trs rcent, les anci ennes
divisions en nations germaniques. Ntait -ce pas groups selon ces affinits
ethniques que lon voyait llection royale les magnats paratre ou
sabstenir ? Entretenu par lusage de coutumes codifies, propres chaque
peuple et, pratiquement, son territoire, le sentiment particulariste se
nourrissait des souvenirs emprunts un proche pass. LAlmanie, la
Marc BLOCH La socit fodale
376
Bavire, la Saxe navaient t annexes, tour tour, ltat carolingien que
dans la seconde moiti du VIIIe sicle et le titre mme de duc, relev par les
princes fodaux, reproduisait celui quavaient longtemps port, sous une
intermittente hgmonie franque, les souverains hrditaires des deux
premiers pays. Observez, par contraste, la parfaite exprience ngative
quoffre la Thuringe. Dpourvue p.549 dexistence nationale indpendante,
depuis que la royaut indigne avait succomb, ds 534, aucun pouvoir ducal
durable ne russit sy tablir. Le duc passait si bien pour le chef dun peuple,
plutt que pour le simple administrateur du ne circonscription provinciale, que
laristocratie du duch volontiers prtendait llire et, en Bavire, se fit parfois
reconnatre par les rois le droit de participer, du moins par son assentiment,
la dsignation. Pourtant la tradition de ltat caroli ngien tait, en Allemagne,
encore trop vivante pour que les rois pussent renoncer traiter les personnages
pourvus de ces grands gouvernements comme tant, avant tout, leurs
dlgus. Longtemps, on la vu, ils se refusrent leur reconnatre lhrdit.
Or, le caractre de fonction publique, ainsi conserv par le pouvoir ducal,
se joignit au sentiment persistant de la nationalit ethnique pour faire du duch
allemand du Xe sicle quelque chose de trs diffrent des principauts
franaises : quelque chose, si lon veut, de beaucoup moins fodal, de trs
symptomatique, par consquent, dun pays qui nen tait pas arriv, au mme
degr que la France, ne gure connatre, parmi les puissants, dautre forme
efficace du commandement et de lobissance que la r elation vassalique. Au
lieu quen France, malgr les efforts des premiers ducs des Francs, des
Aquitains ou des Bourguignons, le duc, le marquis, larchicomte en vinrent
trs rapidement nexercer de pouvoir rel que sur les comts dont ils taient
personnellement pourvus ou qui taient tenus deux en fief, le duc allemand,
tout en tirant videmment une grande part de sa puissance de ses honneurs
propres, demeura cependant le chef suprme dun territoire beaucoup plus
vaste que ceux-ci. Il se pouvait fort bien que, parmi les comtes dont les
circonscriptions se trouvaient comprises dans les frontires de la province
ducale, certains dussent directement lhommage au roi. Ils nen taient pas
moins, en quelque mesure, subordonns au duc : un peu si jose employer,
une fois de plus, une comparaison trop manifestement anachronique
comme, chez nous, un sous-prfet, nomm par le pouvoir central, reste,
malgr cela, le subordonn du prfet. Le duc convoque ses cours p.550
solennelles tous les grands du duch, en commande lost et, charg dy
maintenir la paix, tend sur lui un droit de justice, qui, de contours assez
imprcis, nest pourtant pas sans force.
Cependant, ces grands duchs ethniques les Stammesherzogtmer
des historiens allemands taient menacs vers le haut par la royaut, dont
ils limitaient singulirement la puissance, vers le bas par toutes les forces de
morcellement, de plus en plus actives dans une socit qui, scartant de ses
origines, comme du souvenir des peuples anciens, allait vers une fodalisation
progressive. Parfois supprims purement et simplement ce fut le cas de la
Marc BLOCH La socit fodale
377
Franconie, ds 939 , le plus souvent fragments par les rois, privs de toute
autorit sur les principales glises et sur les comts qui avaient t rattachs
celles-ci, ils perdirent progressivement leurs caractres primitifs. Aprs que le
titre ducal de Basse-Lorraine ou Lothier eut pass, en 1106, la maison de
Louvain, il arriva que, quatre-vingt-cinq ans plus tard, le dtenteur de cette
dignit prtendit faire valoir ses droits dans tout lespace ancien. Il lui fut
rpondu par la cour impriale que, selon lusage dment constat, il navait
de duch que dans les comts quil tenait lui -mme ou qui taient tenus de
lui . Ce quun chroniqueur contemporain traduit en disant que les ducs de
cette ligne navaient jamais exerc la justice hors des limites de leurs
propres terres (345). Impossible de mieux exprimer lorientation nouvelle de
lvolution. Des duchs de l espce premire, il subsista quelques titres et
parfois davantage quun titre. Mais les quelques principauts ainsi qualifies
ne se distinguaient plus gure de la foule des puissances territoriales qui,
mettant profit la faiblesse croissante de la monarchie, se constiturent si
fortement dans lAllemagne du XI Ie sicle finissant, et surtout du XIIIe, pour
donner naissance, finalement, aux tats fdrs dont nous avons encore connu
les derniers : organismes politiques beaucoup plus proches du type franais,
puisquils ntaient, en somme, eux aussi, que des conglomrats de droits
comtaux et dautres pouvoirs dessence varie. Par un de ces dcalages
dvolution qui nous sont dj familiers, lAllemagne sengageait, deux p.551
sicles environ dinter valle, dans la voie mme dont sa voisine de lOuest
semblait dj sortir.
II. Comts et chtellenies
Devenus tt ou tard hrditaires, les comts, dans les tats issus de
lEmpire carolingien, navaient pas tous t absorbs par les grandes
principauts. Certains continurent longtemps mener une existence
indpendante : tel, bien que perptuellement sous la menace de ses voisins
angevins ou normands, le Maine, jusquen 1110. Mais le jeu des partages,
linstitution de nombreuses immunits, les usurpatio ns, enfin, aboutirent au
morcellement des droits comtaux. Si bien quentre les hritiers lgitimes des
fonctionnaires francs et les simples puissants , assez heureux ou assez
habiles pour avoir rassembl dans leurs mains un grand nombre de seigneuries
et de justices, la diffrence, de plus en plus, tendit se rduire lemploi ou
labsence dun nom lui-mme, dailleurs, parfois usurp par certains
reprsentants laques des glises (ainsi les avous de Saint-Riquier,
devenus comtes de Ponthieu), voire, en Allemagne, par quelques riches
alleutiers. Tant lide de loffice public seffaait devant la constatation, toute
nue, du pouvoir de fait.
Dans ltablissement ou laffermissement de ces dominations, de titre et de
rayon variables, un trait commun se marque : le rle jou, comme point de
Marc BLOCH La socit fodale
378
cristallisation, par les chteaux. Il tait puissant , dit Orderic Vital du sire
de Montfort, comme un homme qui disposait de forts chteaux, gards par
de fortes garnisons. Nvoquons plus ici limage d e simples maisons
fortifies, comme sen contentait, on la vu, la masse des chevaliers. Les
bastilles des magnats taient de vrais petits camps retranchs. La tour
subsistait, la fois demeure du matre et dernier rduit de la dfense. Mais,
autour dell e, une ou plusieurs enceintes circonscrivaient un espace assez
vaste o se groupaient les btiments rservs soit au logement des troupes, des
serviteurs, des artisans, soit lengrangement des redevances ou des
provisions. Tel nous apparat, ds le Xe sicle, le p.552 castrum comtal de
Warcq-sur-Meuse ; tels encore, aprs deux sicles couls, ceux de Bruges ou
dArdres, dune construction assurment beaucoup plus perfectionne, mais,
dans les lignes fondamentales de leur plan, presque pareils. Les premires de
ces citadelles avaient t leves, au temps des invasions normandes et
hongroises, par les rois ou les chefs des grands commandements militaires ; et
jamais, par la suite, lide que le droit de fortification tait, en son essence, un
attribut de la puissance publique ne seffaa tout fait. Dge en ge, on
qualifiera
dillgitimes
ou,
selon
lexpression
anglo -normande,
dadultrins , les chteaux construits sans la permission du roi ou du
prince. La rgle, cependant, navait dautre force rel le que celle de lautorit
intresse la faire appliquer et seule la consolidation des pouvoirs
monarchiques ou territoriaux, partir du XIIe sicle, devait lui restituer un
contenu concret. Chose plus grave encore : impuissants empcher lrection
de forteresses nouvelles, les rois et les princes ne russirent pas beaucoup
mieux conserver le contrle de celles quaprs les avoir bties eux -mmes,
ils avaient remises la garde de fidles, titre de fiefs. Contre les ducs ou les
grands comtes, on vit se dresser leurs propres chtelains, eux aussi dofficiers
ou de vassaux prompts se muer en dynastes.
Or ces chteaux ntaient pas seulement, pour le matre et parfois pour ses
sujets, un abri sr. Ils constituaient aussi, pour tout le pays environnant, un
chef-lieu administratif et le centre dun rseau de dpendances. Les paysans y
excutaient les corves de fortification et y venaient porter leurs redevances ;
les vassaux des alentours y montaient la garde et ctait souvent de la
forteresse elle-mme ainsi, en Berry, de la grosse tour dIssoudun
que leurs fiefs taient dits tre tenus. L se rendait la justice ; de l partaient
toutes les manifestations sensibles de lautorit. Si bien quen Allemagne,
partir de la fin du XIe sicle, beaucoup de comtes, incapables dsormais
dexercer leurs droits de commandement sur la totalit dune circonscription
irrmdiablement morcele, shabiturent substituer, dans leur titulature, au
nom du district, du Gau, celui de leur principale forteresse patrimoniale.
Lusage de cette p.553 dsignation stendit parfois jusqu des personnages
plus levs encore en dignit : Frdric Ier ne traitait-il pas le duc de Souabe
de duc de Staufen (346) ? En France, ce fut approximativement vers le mme
temps que lon saccoutuma qualifier de chtellenie le territoire dune haute
Marc BLOCH La socit fodale
379
justice. Mais plus rare encore devait tre la fortune dun chteau aquitain,
celui de Bourbon-lArchambault : bien que ses possesseurs ne fussent pas de
rang comtal, il donna naissance, finalement, une vritable principaut
territoriale, dont le nom survit dans celui dune de nos provinces le
Bourbonnais , comme dans le patronyme dune illustre famille. Les tours et
les murs qui taient la source visible du pouvoir lui servaient dtiquette,
comme de justification.
III. Les dominations ecclsiastiques
Suivant la tradition mrovingienne et romaine, les Carolingiens avaient
toujours tenu pour normale et souhaitable la participation de lvque
ladministra tion temporelle de son diocse. Mais ctait titre de
collaborateur ou, parfois, de surveillant du dlgu royal : autrement dit, du
comte. Les monarchies du premier ge fodal allrent plus loin : de lvque,
il arriva quelles firent en mme temps le comte.
Lvolution eut lieu en deux phases. Plus encore que le reste du diocse, la
ville o slevait lglise cathdrale semblait place sous la protection et
lautorit particulires de son pasteur. Alors que le comte avait mille
occasions de courir les campagnes, lvque rsidait, de prfrence, dans sa
cit . Au jour du danger, cependant que ses hommes aidaient garnir les
remparts, souvent construits ou rpars ses frais, et que ses greniers
souvraient pour nourrir les assigs, il tait lui -mme souvent amen
assumer le commandement. En lui reconnaissant sur cette forteresse urbaine et
ses premiers glacis les pouvoirs comtaux, joints ordinairement dautres
droits, tels que la monnaie ou la possession mme de lenceinte, les rois
sanctionnaient un tat de fait, jug favorable la dfense. Tel fut le cas
Langres, ds 887 ; Bergame, sans doute, en 904 ; Toul, en p.554 927 ;
Spire, en 946 pour ne citer, pays par pays, que le plus ancien exemple
accessible. Le comte conservait le gouvernement des terres environnantes. Ce
partage quelquefois devait tre durable. Pendant des sicles, la ville de
Tournai eut son vque ou son chapitre cathdral pour comte ; le comte de
Flandre fut comte du Tournaisis. Ailleurs on prfra, finalement, octroyer
lvque tout le territoire. La concession du comt de Langres suivit ainsi,
soixante ans dintervalle, celle du comt dans Langres. Puis, une fois introduit
lusage de ces dons de comts entiers, on saccoutuma brler les tapes :
sans avoir jamais t, semble-t-il, comtes de Reims seul, les archevques
devinrent, en 940, comtes de Reims et du Rmois.
Les raisons qui poussaient les rois ces concessions sont videntes. Ils
misaient sur deux tableaux : le Ciel et la Terre. L-haut, les saints
certainement sapplaudissaient de voir leurs serviteurs la fois pourvus de
lucratifs revenus et dbarrasss dincommodes voisins. Ici -bas, donner le
Marc BLOCH La socit fodale
380
comt lvque, ctait remettre le commandement entre des mains juges
plus sres. Car le prlat, qui ne risquait gure de transformer sa charge en
patrimoine hrditaire, dont la nomination tait soumise lassentiment du roi
quand mme elle ntait pas simplement prononce par celui -ci ,
quenfin sa culture et ses intrts volontiers rejetaient vers le parti
monarchique, ne trouvait-on pas en lui, tout prendre, dans le dsordre des
tats fodaux, le moins indocile des fonctionnaires ? Il est significatif que les
premiers comts confis par les rois allemands lpiscopat aient t, loin des
villes cathdrales, certaines circonscriptions alpestres, dont la perte, en
fermant les passages des monts, et gravement compromis la politique
impriale.
Cependant, partie de besoins partout pareils, linstitution volua, selon les
pays, dans des sens bien diffrents.
Dans le royaume franais, beaucoup dvchs taient tombs, ds le Xe
sicle, sous la dpendance des princes territoriaux, voire de simples comtes.
Le rsultat fut quun assez petit nombre dvques, groups surtout dans la
France propre et la Bourgogne, obtinrent eux-mmes les pouvoirs comtaux.
Deux dentre eux, au moins, Reims et Langres, p.555 parurent un moment
sur le point de constituer des principauts vritables, en runissant autour de la
circonscription centrale, quils gouvernaient eux-mmes, une constellation de
comts vassaux. Dans les guerres du Xe sicle, point de force militaire plus
souvent cite, ni avec plus de respect, que les chevaliers de lglise de
Reims . Mais, serres entre les principauts laques voisines, victimes
dailleurs de linfidlit de leurs propres feudataires, ces vastes dominations
ecclsiastiques semblent stre rapidement tioles. A partir du X Ie sicle, les
vques-comtes, de toute catgorie, nont, contre les forces ennemies, dautre
recours que de se rattacher de plus en plus troitement la royaut.
Fidles la tradition franque, les souverains allemands semblent avoir
hsit assez longtemps toucher lancienne organisation comtale.
Cependant, vers la fin du Xe sicle, on vit se multiplier rapidement, au profit
des vques, les octrois de comts entiers, voire mme de groupes de comts :
si bien que, les privilges dimmunits et toutes sortes de concessions diverses
sajoutant ces dons, dimportantes puissances territoriales dglise se
crrent en peu dannes. Visiblement, les rois staient, quoique regret,
rallis lide que, pour lutter contre laccaparement des pouvoirs locaux par
dindociles magnats et notamment par les ducs, il ntait pas de meilleure
arme que le pouvoir temporel des prlats. Il est frappant que ces territoires
ecclsiastiques aient t surtout nombreux et forts l o les duchs avaient t,
soit rays de la carte comme en Franconie , soit, comme dans lancienne
Lorraine Rhnane ou la Saxe Occidentale, privs de toute domination efficace
sur une partie de leur ancien rayon. Lvnement devait, cependant, au bout
du compte, donner tort ces calculs. La longue querelle des papes et des
empereurs et le triomphe, au moins partiel, de la rforme ecclsiastique firent
que les vques allemands, depuis le XIIe sicle, se considrrent de moins en
Marc BLOCH La socit fodale
381
moins comme des fonctionnaires de la monarchie et, tout au plus, comme ses
vassaux. Ici le principat ecclsiastique finit par prendre place, tout
simplement, parmi les lments de dsunion de ltat national.
Dans lItalie lombarde et bien qu un moindre degr p.556 en
Toscane, la politique impriale suivit dabord les mmes lignes quen
Allemagne. Toutefois, les agglomrations de comts, entre les mains dune
mme glise, y furent beaucoup plus rares et lvolution aboutit des rsultats
bien diffrents. Derrire lvque -comte un nouveau pouvoir surgit, trs vite :
celui de la commune urbaine. Pouvoir rival, beaucoup dgards, mais qui
sut, finalement, utiliser, au profit de ses ambitions propres, les armes
prpares par les anciens seigneurs de la cit. Ce fut souvent titre
dhritires de lvque ou en sabritant derrire son nom quon vit, depuis le
XIIe sicle, les grandes rpubliques oligarchiques des villes lombardes
affirmer leur indpendance et faire rayonner leur domination sur le plat pays.
Il y aurait dailleurs un excs de raffinement juridique vouloir, en aucun
pays, tablir une distinction trop rigoureuse entre lglise pourvue de comts
et celle qui, prive de toute concession de cette espce, nen possde pas
moins assez de seigneuries immunistes, assez de vassaux, de manants, de
justiciables pour faire figure, presque au mme titre, de vraie puissance
territoriale. De toutes parts, le sol de lOc cident tait sillonn par les frontires
de ces grandes liberts ecclsiastiques. Souvent des lignes de croix en
jalonnaient les contours, pareilles, selon le mot de Suger, autant de
colonnes dHercule , infranchissables aux profanes (347). Infranchissables,
du moins, en principe. Il en fut, en pratique, assez diffremment. Dans le
patrimoine des saints et des pauvres laristocratie laque sut trouver un des
aliments prfrs de son apptit de richesse et de pouvoir au moyen
dinfodations, arraches sous la menace ou obtenues de la complaisance de
trop faciles amis ; quelquefois, par la spoliation la plus simplement brutale ;
enfin du moins dans les limites de lancien tat carolingien par le biais
de lavouerie (348).
Lorsque la premire lgislation carolingienne rgularisa le fonctionnement
des immunits, la ncessit parut simposer de pourvoir chaque glise
immuniste dun reprsentant laque, charg la fois de tenir, dans la
seigneurie mme, les plaids autoriss et de traduire, devant le tribunal comtal,
les sujets qui, requis dy comparatre, ne pouvaient plus tre p.557 directement
recherchs, sur la terre dsormais exempte, par les propres officiers du roi.
Cette cration rpondait un double dessein, conforme, dans sa dualit mme,
aux orientations fondamentales dune politique trs consciente de ses fins :
viter de dtourner, par de profanes obligations, les clercs et notamment les
moines des devoirs de leur tat ; comme prix de la reconnaissance officielle
accorde aux juridictions seigneuriales, les insrer dans un systme, rgulier et
contrl, de justices bien dfinies. Non seulement donc, toute glise, dote de
limmunit, dut possder son avou (advocatus) ou ses avous. Mais le
choix mme de cet agent fut surveill de prs par lautorit publique. Lavou
Marc BLOCH La socit fodale
382
carolingien, en un mot, sil tait au service de lvque ou du monastre, nen
jouait pas moins auprs deux, le rle dune sorte de dlgu de la monarchie.
Leffondr ement de ldifice administratif bti par Charlemagne nentrana
pas la disparition de linstitution. Mais celle -ci saltra profondment. Ds
lorigine, sans doute, lavou avait t rmunr par loctroi dun bienfait ,
prlev sur le patrimoine de l glise. Lorsque la notion de fonction publique
sobscurcit devant le triomphe des liens de dpendance personnelle, on cessa
gnralement de le considrer comme attach au roi, auquel il ne prtait pas
lhommage, pour ne plus apercevoir en lui que le vassal de lvque ou des
moines. Leur choix dsormais dcida librement de sa nomination. Du moins
jusquau moment o, trs vite, malgr quelques rserves de droit, son fief,
comme les autres, avec loffice, devint pratiquement hrditaire.
En mme temps, le rle de lavou avait singulirement grandi. Comme
juge, dabord. Les immunits ayant accapar les causes de sang, on le vit,
dornavant, au lieu de conduire les criminels au plaid comtal, manier luimme larme redoutable de la haute justice. Surtout, il n tait plus uniquement
un juge. Dans les troubles ambiants, il fallait aux glises des chefs de guerre
pour conduire leurs hommes au combat sous le gonfanon du saint. Ltat
ayant cess dtre un protecteur efficace, il leur fallait des dfenseurs plus
proches pour assurer la sauvegarde de biens constamment menacs. Elles
crurent trouver les uns et les autres dans les p.558 reprsentants laques dont les
avait dotes la lgislation du grand Empereur ; et ces guerriers professionnels
eux-mmes sempressrent vraisemblablement doffrir, voire dimposer leurs
services pour des tches qui promettaient dtre riches dhonneur et de profits.
Do un vritable dplacement du centre de gravit de la charge. De plus en
plus, lorsque les textes sefforcent de dfinir l a nature de lavouerie ou de
justifier les rmunrations rclames par lavou, cest sur lide de protection
quils mettent laccent. Paralllement, le recrutement se modifia. Lavou
carolingien avait t, en somme, un assez modeste officier. Au Xe sicle, les
premiers parmi les puissants , les membres mmes des lignes comtales ne
ddaignent plus de rechercher un titre qui nagure leur aurait paru bien
au-dessous deux.
Cependant lmiettement, qui fut alors le sort commun de tant de droits,
nparg na pas non plus celui-ci. La lgislation carolingienne semble avoir
prvu, pour les tablissements possessionns sur de larges espaces, la prsence
dun avou par comt. Mais bientt leur nombre se multiplia. A vrai dire, en
Allemagne et en Lotharingie o, de toutes faons, linstitution scarta le
moins de son caractre originel, ces avous locaux, frquemment appels
sous-avous, demeurrent en principe les dlgus et, lordinaire, les
vassaux soit de lavou gnral de lglise, soit de lun ou laut re des deux ou
trois avous gnraux entre lesquels celle-ci avait rparti ses biens. En France,
comme on pouvait sy attendre, le morcellement fut pouss plus loin : si bien
quil ny eut gure, au bout du compte, de terre ou de groupe de terres un peu
important qui ne dispost de son dfenseur particulier, recrut parmi les
Marc BLOCH La socit fodale
383
moyens potentats du voisinage. L encore, pourtant, le personnage,
habituellement plus haut plac, auquel revenait la garde de lvch ou du
monastre, en tant que tels, dpassait de beaucoup, par les revenus et la
puissance, la poussire des petits protecteurs locaux. Il arrivait dailleurs que
ce magnat, en mme temps que lavou de la communaut religieuse, en ft le
propritaire entendez, avant tout, quil en dsignt la bb, voire
quil et revtu lui -mme, quoique laque, le titre abbatial : confusion de
notions bien caractristique dun ge qui, plus p.559 quaux subtilits juridiques,
tait sensible la force du fait.
Lavou ne disposait pas seulement de fiefs sou vent trs importants,
attachs sa fonction. Celle-ci mme lui permettait dtendre jusque sur les
terres de lglise ses droits de commandement et dy percevoir de fructueuses
redevances. En Allemagne, plus quailleurs, tout en devenant protecteur, il
tait rest un juge. Arguant du vieux principe qui aux clercs interdisait de
verser le sang, maint Vogt allemand russit monopoliser presque
entirement, sur les seigneuries monastiques, lexercice de la haute justice. La
force relative de la monarchie et sa fidlit la tradition carolingienne
contriburent faciliter cette mainmise. Car si, l aussi, les rois avaient d
renoncer dsigner les avous, du moins continuaient-ils leur donner, en
principe, linvestiture du ban , cest --dire du droit de contraindre. Privs
de cette dlgation de pouvoir, qui passait ainsi, directement du souverain
leur vassal, quel titre les religieux se seraient-ils rigs en hauts-justiciers ?
A peine sils parvenaient conserver la facult de chtier les dpenda nts qui
leur taient unis par les nuds les plus troits, leurs domestiques ou leurs
serfs. En France, o tous liens avaient t coups entre lautorit royale et les
avous, le partage des juridictions sopra selon des lignes plus variables ; et
ce dsordre, mieux sans doute que lordre allemand, servit les intrts
ecclsiastiques. Que d exactions , en revanche pour parler comme les
chartes , partout imposes aux manants des glises par leurs dfenseurs ,
rels ou prtendus ! A vrai dire, mme en France, o lavouerie tait tombe
aux mains dinnombrables tyranneaux campagnards, particulirement pres
la cure, cette protection ne fut peut-tre pas toujours aussi vaine que
lhistoriographie clricale voudrait le faire croire. Un diplme de Lo uis VI,
pourtant rdig selon toute apparence, dans une abbaye, ne la confesse-t-il pas
extrmement ncessaire et tout fait utile (349) ? Mais elle sachetait
incontestablement trs cher. Service daide, sous toutes ses form es, de la
corve rurale au gte, de lost aux travaux de fortification ; rentes en avoine,
en vin, en poules, en deniers, leves sur les champs et plus souvent p.560 encore
(car ctait le village avant tout quil fallait dfendre) sur les chaumires : la
liste serait presque infinie de tout ce que lingniosit des avous sut tirer de
paysans dont ils ntaient pas les seigneurs directs. En vrit, comme crit
Suger, ils les dvoraient pleine bouche (350).
Le Xe sicle, la premire moiti du XIe furent lge dor des avoueries : sur
le continent sentend, car lAngleterre, trangre lexemple carolingien, ne
Marc BLOCH La socit fodale
384
connut jamais linstitution. Puis, lglise, revivifie par leffort grgorien,
passa loffensive. Par accords, pa r dcisions de justice, par rachats, grce
aussi aux concessions gratuitement obtenues du repentir ou de la pit, elle
parvint peu peu cantonner les avous dans lexercice de droits strictement
dfinis et progressivement rduits. Sans doute lui avait-il fallu leur
abandonner de larges tranches de son patrimoine ancien. Sans doute
continuaient-ils dtendre, sur plus dune de ses terres, leurs pouvoirs de
justice et dy lever quelques redevances, dont lorigine tait de moins en
moins bien comprise. Les paysans, dautre part, navaient pas toujours tir
grand profit de luvre patiente de leurs matres. Car la rente rachete ne
cessait point, pour autant, dtre perue ; simplement elle tait dsormais
paye au seigneur vque ou aux seigneurs moines, au lieu daller enrichir
quelque hobereau voisin. Mais, les sacrifices invitables une fois consentis, la
puissance seigneuriale de lglise chappait un des plus insidieux dangers
qui leussent menace.
Cependant, contraints de renoncer lexploitation de ressources nagure
presque indfiniment ouvertes et sans lesquelles plus dune ligne
chevaleresque du pass net jamais russi sortir de sa mdiocrit premire,
les petits et moyens dynastes faisaient avant tout les frais de la rforme. Les
avous locaux, vers la fin du second ge fodal, avaient t rendus peu prs
inoffensifs. Les avoueries gnrales subsistaient. Les rois et les trs hauts
barons en avaient t, de tout temps, les principaux titulaires. Et dj on voyait
les monarchies commencer de revendiquer, sur toutes les glises de leurs
tats, une garde universelle. Aussi bien, si vques, chapitres ou
monastres avaient os rejeter les onreux services de tant de menus
dfenseurs, p.561 ctait parce que, pour assurer leur scurit, il s pouvaient
dsormais se contenter de lappui, redevenu efficace, des grands
gouvernements monarchiques ou princiers. Or cette protection aussi, de
quelque nom quelle se couvrt, elle avait toujours d sacheter, par des
services fort lourds et des contributions en argent dont le poids alla sans cesse
salourdissant. Il convient que les glises soient riches , faisait dire,
navement, Henri II dAllemagne, un faussaire du XI Ie sicle ; car plus il
est confi, plus il est exig (351). Inalinables, en principe, prserves par leur
nature mme de lternel danger des partages successoraux, les dominations
ecclsiastiques avaient t, ds lorigine, dans un monde mouvant, un lment
remarquablement stable. Elles nen devaient constituer quun instrument plus
prcieux aux mains des grands pouvoirs, lors du regroupement gnral des
forces.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
385
CHAPITRE IV
Le dsordre et la lutte contre le dsordre
I. Les limites des pouvoirs
p.563 Nous
parlons volontiers dtats fodaux . Assurment, la notion ntait
pas trangre au bagage mental des doctes ; les textes prononcent quelquefois
le vieux mot de respublica. A ct des devoirs envers le matre proche, la
morale politique reconnaissait ceux qui simposaient. vis --vis de cette
autorit plus haute. Le chevalier, dit Bonizon de Sutri, doit ne pas pargner
sa vie pour dfendre celle de son seigneur et pour ltat de la chose publique
combattre jusqu la mort (352). Mais limage ainsi voque tait t rs
diffrente de ce quelle serait aujourdhui. Elle avait surtout un contenu
beaucoup plus mince.
La liste serait longue des activits qui nous apparaissent insparables de
lide dtat et que les tats fodaux, pourtant, ont radicalement ignores.
Le nseignement appartenait lglise. De mme, lassistance, qui se
confondait avec la charit. Les travaux publics taient abandonns
linitiative des usagers ou des petites puissances locales : rupture entre toutes
sensible avec la tradition romaine, voire avec celle de Charlemagne. Les
gouvernants ne recommencrent gure nourrir de pareils soucis avant le XIIe
sicle, et moins encore, cette date, dans les monarchies que dans certaines
principauts dvolution prcoce : lAnjou de Henri Plantagent, b tisseur des
leves de la Loire ; la Flandre qui son comte Philippe dAlsace dut p.564
quelques canaux. Il fallut attendre le sicle suivant pour voir rois ou princes
intervenir, comme lavaient fait les Carolingiens, dans la fixation des prix et
esquisser, timidement, une politique conomique. A dire vrai, depuis le
second ge fodal, les vritables mainteneurs dune lgislation de bien -tre
avaient t peu prs exclusivement des pouvoirs de beaucoup plus faible
rayon et, par leur nature, tout fait trangers la fodalit proprement dite :
les villes, proccupes, presque ds leur constitution en communauts
autonomes, dcoles, dhpitaux et de rglements sur lconomie.
En fait, le roi ou le haut baron a trois devoirs fondamentaux et na gure
que ceux-l : par de pieuses fondations et par la protection accorde la vraie
foi, assurer le salut spirituel de son peuple ; dfendre celui-ci contre les
ennemis du dehors fonction tutlaire laquelle sajoute, quand faire se
peut, la conqute, inspire par le point dhonneur autant que par le dsir de
puissance ; faire rgner enfin la justice et la paix intrieure. Donc, sa
Marc BLOCH La socit fodale
386
mission lui imposant avant tout de pourfendre les envahisseurs ou les
mchants, il guerroie, punit, rprime plutt quil nadmin istre. Aussi bien, la
tche ainsi comprise tait-elle dj assez lourde.
Car un des traits communs de tous les pouvoirs est, sinon prcisment leur
faiblesse, du moins le caractre toujours intermittent de leur efficacit ; et
cette tare napparat jamais avec plus dclat que l o les ambitions sont plus
grandes et plus vaste le rayon daction prtendu. Un duc de Bretagne, en 1127,
savoue -t-il incapable de protger un de ses monastres contre ses propres
chevaliers ? il ne dnonce par l que la dbilit dune mdiocre principaut
territoriale. Mais, parmi les souverains dont les chroniqueurs font sonner le
plus haut la puissance, on nen trouverait pas un seul qui nait d passer de
longues annes mater les rvoltes. Le moindre grain de sable suffit parfois
enrayer la machine. Un petit comte rebelle qui se fortifie dans son repaire, et
voici lempereur Henri II arrt trois mois durant (353). Nous avons dj
rencontr les principales raisons de ce manque de souffle : lenteur et
difficults des liaisons ; absence de rserves en numraire ; ncessit, pour
exercer p.565 une autorit vritable, dun contact direct avec les hommes. En
1157, dit Otton de Freising, qui, par l, croit navement vanter son hros,
Frdric Barberousse : regagna le Nord des Alpes : par sa prsence la paix
fut rendue aux Francs entendez aux Allemands ; par son absence,
te aux Italiens . Ajoutez, naturellement, la tenace concurrence des liens
personnels. En plein XIIIe sicle, un coutumier franais reconnat encore quil
est des cas o le vassal lige dun baron peut lgitimement faire la guerre au
roi, en embrassant la cause de son seigneur (354).
Les meilleurs esprits concevaient nettement la permanence de ltat. A
Conrad II dAllemagne son chapelain prte ce mot : Quand le roi prit, le
royaume demeure, comme le navire dont le capitaine a succomb. Mais les
gens de Pavie, auxquels sadressait cette semonce, taient sans doute
beaucoup plus prs de lopinion comm une, lorsquils niaient quon pt leur
imputer crime la destruction du palais imprial. Car, disaient-ils, elle avait
eu lieu durant linterrgne. Nous avons servi notre empereur tant quil a
vcu ; lui mort, nous navions plus de roi. Les personnes prudentes ne
manquaient pas de se faire confirmer par le nouveau souverain les privilges
quavait octroys son prdcesseur et, en plein XI Ie sicle, des moines anglais
ne craignaient pas de soutenir devant la cour royale quun dit, drogeant
une vieille coutume, ne devait avoir de force que durant la vie de son
auteur (355). En dautres termes, de lide abstraite du pouvoir on sparait mal
limage concrte du chef. Les rois mmes avaient peine slever au -dessus
dun sentim ent familial troitement limit. Voyez en quels termes Philippe
Auguste, partant pour la croisade, rgle lemploi qui, sil meurt durant le
voyage de Terre Sainte, devra tre fait de son trsor, base indispensable de
toute puissance monarchique. Si son fils lui survit, la moiti seulement sera
distribue en aumnes ; le tout, au contraire, si lenfant succombe avant le
pre.
Marc BLOCH La socit fodale
387
Nimaginons point cependant, en droit pas plus quen fait, un rgime
dabsolutisme personnel. Selon le code de bon gouvernement alors
universellement admis, aucun chef, quel quil ft, ne pouvait rien dcider de
grave sans avoir p.566 pris conseil. Non point du peuple, assurment. Nul ne
pensait quil dt tre interrog directement ou dans ses lus. Pour
reprsentants naturels, navait -il point, selon le plan divin, les puissants ou les
riches ? Ce sera donc de ses principaux sujets et fidles particuliers que le roi
ou le prince sollicitera lavis : de sa cour, en un mot, au sens vassalique du
terme. Les plus fiers monarques ne manquent jamais de rappeler dans leurs
diplmes cette ncessaire consultation. Lempereur Otton I er navoue -t-il point
quune loi, dont la promulgation tait prvue pour une assemble dtermine,
na pu y tre publie, en raison de labsence de quelques grands (356) ?
Lapplication plus ou moins stricte de la rgle dpendait de la balance des
forces. Mais il net jamais t prudent de la violer trop ouvertement. Car les
seuls ordres que les sujets dun rang un peu lev se crussent o bligs de
respecter vraiment taient ceux qui avaient t donns, sinon toujours avec
leur assentiment, du moins en leur prsence. Dans cette incapacit concevoir
le lien politique autrement que sous laspect du face face, reconnaissons, une
fois de plus, une des causes profondes du morcellement fodal.
II. La violence et laspiration vers la paix
Un tableau de la socit fodale, surtout durant son premier ge, se
condamnerait ne donner de la ralit quune image bien infidle si, soucieux
seulement dinstitutions juridiques, il laissait oublier que lhomme vivait alors
en tat de perptuelle et douloureuse inscurit. Ce ntait pas, comme
aujourdhui, langoisse du danger atroce, mais collectif, mais intermittent, que
recle un monde de nations en armes. Ni non plus ou du moins ce ntait
pas surtout lapprhension des forces conomiques qui broient le petit ou le
malchanceux. La menace, qui tait de tous les jours, pesait sur chaque destin
individuel. Elle atteignait, comme les biens, la chair mme. Au reste, la
guerre, le meurtre, labus de la force, il nest gure de page de notre analyse
sur lesquelles nous nayons dj vu se profiler leurs ombres. Quelques mots
suffiront maintenant pour rassembler p.567 les causes qui de la violence firent
vritablement la marque dune poque et dun systme social.
Quand, lEmpire romain des Francs ayant pri, divers rois prendront
place sur le trne auguste, chaque homme ne se fiera plus qu lpe : ainsi,
sous couleur de prophtie, parlait, vers le milieu du IXe sicle, un clerc
ravennate, qui avait vu et dplor lvanouissement du grand rve imprial
carolingien (357). Les contemporains en eurent donc nettement conscience :
effet elle-mme, dans une large mesure, dirrp ressibles habitudes de
dsordre, la carence des tats avait, son tour, favoris le dchanement du
mal. De mme, les invasions qui, faisant pntrer partout lhomicide et le
Marc BLOCH La socit fodale
388
pillage, travaillrent en outre, si efficacement, rompre les vieux cadres des
pouvoirs. Mais la violence tenait aussi au plus profond de la structure sociale
et de la mentalit.
Elle tait dans lconomie ; en un temps dchanges rares et difficiles,
pour devenir riche, quel moyen plus sr que tantt le butin et tantt
loppression ? Toute une classe dominatrice et guerrire vivait surtout de cela
et un moine, froidement, pouvait faire dire un petit seigneur, dans une
charte : je donne cette terre libre de toute redevance, de toute exaction ou
taille, de toute corve et de toutes ces choses que par violence les
chevaliers ont coutume dextorquer aux pauvres (358).
Elle tait dans le droit : en raison du principe coutumier qui, la longue,
aboutissait lgitimer presque toute usurpation ; par suite aussi de la tradition
solidement enracine qui lindividu ou au petit groupe reconnaissait la
facult ou mme imposait le devoir de se faire justice soi-mme.
Responsable dune infinit de drames sanglants, la faide familiale ntait
pas la seule forme dexcution personnelle qui mt constamment en danger
lordre public. Lorsqu la victime dun tort matriel, rel ou fictif, les
assembles de paix interdisaient de sindemniser directement en saisissant un
des biens de lauteur du dommage, elles sa vaient bien atteindre par l une des
plus frquentes occasions de trouble.
La violence, enfin, tait dans les murs, parce que, mdiocrement
capables de rprimer leur premier mouvement, p.568 peu sensibles,
nerveusement, au spectacle de la douleur, peu respectueux de la vie, o ils ne
voyaient quun tat transitoire avant lternit, les hommes taient, par
surcrot, trs ports mettre leur point dhonneur dans le dploiement quasi
animal de la force physique. Tous les jours , crit vers 1024, lvqu e
Burchard de Worms, des meurtres, la faon des btes sauvages, se
commettent parmi les dpendants de Saint-Pierre. On se court sus par ivresse,
par orgueil ou pour rien du tout. Dans le courant dune anne, trente -cinq serfs
de Saint-Pierre, parfaitement innocents, ont t tus par dautres serfs de
lglise ; et les meurtriers, loin de se repentir, se glorifient de leur crime.
Prs dun sicle plus tard, une chronique anglaise, louant la grande paix que
Guillaume le Conqurant avait tablie dans son royaume, ne croyait pouvoir
mieux en exprimer la plnitude que par ces deux traits : dsormais nul homme
ne peut en mettre un autre mort, quelque tort quil ait reu de lui ; chacun
peut parcourir lAngleterre, sa ceinture pleine dor, sans danger (359). Ctait
dcouvrir navement la double racine des maux les plus ordinaires : la
vengeance qui, selon les ides du temps, pouvait arguer dune justification
morale mais aussi le brigandage, dans sa nudit.
Cependant, de ces brutalits tout le monde, en fin de compte, souffrait et
les chefs, plus que quiconque, avaient conscience des dsastres quelles
entranaient. Si bien que des profondeurs de cette poque trouble slve,
avec toute la force dune aspiration vers le plus prci eux et le plus
Marc BLOCH La socit fodale
389
inaccessible des dons de Dieu , un long cri de paix. Entendez, avant tout, la
paix intrieure. Pour un roi, pour un prince, point dloge plus beau que le
titre de Pacifique. Le mot doit tre pris dans son sens plein : non qui accepte la
paix, mais qui limpose. Que la paix soit dans le royaume : ainsi prie-t-on
au jour des sacres. Bnis soient les apaiseurs scriera saint Louis.
Commun tous les pouvoirs, ce souci sexprime parfois en termes dune
candeur touchante. Ce mme roi Knut, dont un pote de cour avait dit : tu
tais bien jeune, Prince, que dj, mesure que tu avanais, on voyait brler
les demeures des hommes , coutez-le, dans ses sages lois. Nous voulons ,
dit-il, que tout homme, p.569 au-dessus de douze ans, jure de ne jamais voler
ni se faire complice dun voleur (360). Mais comme, prcisment, les grands
pouvoirs temporels taient inefficaces, on vit se dvelopper, en marge des
autorits rgulires et sous limpulsion de lgl ise, un effort spontan pour
lorganisation de cet ordre tant dsir.
III. Paix et trve de dieu (361)
Ce fut dans des runions dvques que prirent naissance les associations
de paix. Chez les clercs, le sentiment de la solidarit humaine se nourrissait de
limage de la chrtient, conue comme le corps mystique du Sauveur.
Quaucun chrtien ne tue un autre chrtien , disent, en 1054, les vques de
la province de Narbonne ; car tuer un chrtien, nul doute que ce ne soit
rpandre le sang du Christ. Dans la pratique, lglise se savait
particulirement vulnrable. Enfin elle tenait pour son devoir particulier de
protger, avec ses propres membres, tous les faibles, ces miserabiles personae
dont le droit canon lui confiait la tutelle.
Cependant, malgr le caractre cumnique de linstitution mre et
rserve faite de lappui tardivement accord par la papaut rforme, le
mouvement, dans ses origines, fut trs spcifiquement franais et, plus
particulirement, aquitain. N, semble-t-il, vers 989, prs de Poitiers, au
concile de Charroux que, depuis la Marche dEspagne jusquau Berry ou au
Rhne, de nombreux synodes bientt devaient suivre, ce fut seulement dans la
deuxime dcennie du XIe sicle quon le vit se propager en Bourgogne et
dans le nord du royaume. Quelques prlats du royaume dArles et labb de
Cluny se firent, en 1040 et 1041, ses propagandistes auprs des vques
dItalie. Sans grand succs, semble -t-il (362). La Lorraine et lAllema gne ne
furent srieusement touches que vers la fin du sicle ; lAngleterre, jamais.
Les diffrences de la structure politique expliquent aisment les particularits
de ce dveloppement. Lorsquen 1023 les vques de Soissons et de Beauvais,
ayant form une association de paix, engagrent leur confrre de Cambrai
sy joindre, ce prlat, comme eux suffragant de la mtropole de Reims, qui
tait p.570 situe en France, mais sujet de lEmpire, refusa : il serait
inconvenant , dit-il, quun vque se mlt de ce qui appartient aux rois.
Marc BLOCH La socit fodale
390
Dans lEmpire, notamment chez lpiscopat imprial, lide de ltat tait
encore bien vivante et ltat lui -mme ny paraissait pas compltement
incapable de remplir sa tche. De mme, dans la Castille et le Len, il fallut,
en 1124, une crise de succession, qui avait considrablement affaibli la
monarchie, pour permettre lintroduction, par le grand archevque de
Compostelle, Diego Gelmirez, de dcisions conciliaires prises limitation
des Romains et des Francs . En France, au contraire, limpuissance de la
monarchie frappait partout les yeux. Mais nulle part davantage que dans ces
anarchiques pays du Sud et du Centre, habitus de longue date une existence
quasi indpendante. L, en outre, aucune principaut aussi solidement
constitue que la Flandre ou la Normandie, par exemple, navait russi
stablir. Force tait donc de saider soi -mme ou de prir dans le dsordre.
Supprimer toutes les violences, il ny fallait pas songer. Du moins
pouvait-on esprer leur fixer des bornes. On y tcha dabord et ce fut ce qui
se nomma en propre Paix de Dieu en plaant sous une sauvegarde
spciale certaines personnes ou certains objets. La liste du concile de
Charroux est encore trs rudimentaire : interdiction de pntrer par force dans
les glises ou de les piller, denlever aux paysans leur btail, de frapper un
clerc, condition quil ne porte pas darmes. Puis on dveloppa et prcisa. On
comprit les marchands parmi les protgs par nature : pour la premire fois,
semble-t-il, au synode du Puy, en 990. On labora, sous une forme de plus en
plus dtaille, linventaire des actes dfendus : par exemple dtruire un
moulin, arracher des vignes, attaquer un homme qui va lglise ou en
revient. Encore certaines exceptions demeuraient-elles prvues. Les unes
semblaient imposes par les ncessits de la guerre : le serment de Beauvais,
en 1023, autorise tuer les bestiaux des paysans si cest pour sen nourrir ou
nourrir son escorte. Dautres sexpliquaient par le respect de s contraintes,
voire des violences, alors conues comme lgitimement insparables de tout
exercice du commandement : je ne dpouillerai p.571 pas les vilains ,
promettent, en 1025, les seigneurs runis Anse, sur la Sane, je ne tuerai
pas leurs btes, sauf sur mes propres terres. Dautres, enfin, taient rendues
invitables par des traditions juridiques ou morales universellement obies.
Expressment ou par prtrition, presque toujours le droit la faide , aprs
un meurtre, est rserv. Empcher que les innocents et les petits ne fussent
entrans dans les querelles des puissants ; prvenir la vengeance, lorsquelle
navait dautre justification, comme dit le concile de Narbonne, quun dbat
sur une terre ou sur une dette ; surtout, mettre un frein au brigandage : ces
ambitions dj paraissaient assez hautes.
Mais sil y avait des tres et des choses particulirement respectables,
ntait -il pas aussi des jours ferms la violence ? Dj un capitulaire
carolingien interdisait que la faide ft poursuivie le dimanche. Reprise
pour la premire fois, semble-t-il, en 1027, par un modeste synode diocsain
runi en Roussillon, au pr de Toulonges , non sans doute que lobscur
capitulaire ft directement connu, mais lide tait vivace cette
Marc BLOCH La socit fodale
391
prescription, quon joignait gnralement celles de lautre type, eut un
rapide succs. De bonne heure, dailleurs, on refusa de se contenter dune
seule journe de rpit. Dj, paralllement au tabou dominical, celui de
Pques avait, dans le Nord cette fois, fait son apparition ( Beauvais, en
1023). La trve de Dieu ainsi appelait-on cet armistice priodique
fut peu peu tendue, en mme temps quaux grandes ftes, aux trois jours de
semaine (depuis le mercredi soir) qui prcdent le dimanche et semblaient y
prparer. Si bien quau bout du compte, la guerre disposait de moins de temps
que la paix. Comme ici peu prs aucune exception ntait, en principe,
admise, nulle loi net t plus salutaire, si, pour avoir trop demand, la rgle
ntait demeure, le plus souvent, lettre morte.
Les tout premiers conciles, comme celui de Charroux, staient borns
lgifrer, de la faon la plus banale, sous la sanction de peines religieuses.
Mais, vers 990, lvque du Puy, Guy, ayant runi ses diocsai ns, chevaliers
et vilains, dans un pr, les pria de sengager par serment observer la paix,
ne pas opprimer les glises ni les pauvres dans p.572 leurs biens, restituer ce
quils auraient enlev... Ils refusrent . Sur ce, le prlat fit venir, la faveur
de la nuit, des troupes, quil avait secrtement concentres. Au matin, il
entreprit de contraindre les rcalcitrants jurer la paix et donner des otages ;
ce qui, Dieu aidant, fut fait (363). Telle fut, selon la tradition locale, lorigine,
quon ne saurait dire purement volontaire, du premier pacte de paix .
Dautres suivirent, et bientt il ny eut plus gure dassemble, occupe
limiter les violences, qui ne se prolonget ainsi par un grand serment collectif
de rconciliation et de bonne conduite. En mme temps, la promesse, inspire
des dcisions conciliaires, se faisait de plus en plus prcise. Parfois elle
saccompagnait de remises dotages. Dans ces unions jures, qui luvre
pacificatrice sefforaien t dassocier le peuple entier, reprsent
naturellement, avant tout, par ses chefs, petits ou grands, rsida loriginalit
vritable du mouvement des paix.
Restait tantt contraindre et tantt punir ceux qui navaient pas jur ou,
layant fait, avaien t manqu leurs engagements. Car des peines spirituelles,
il ny avait, de toute vidence, attendre quune efficacit fort intermittente.
Quant aux chtiments temporels que les assembles sefforaient aussi
dtablir notamment sous forme dindemnits aux victimes et damendes
, ils ne pouvaient eux-mmes avoir quelque poids que sil se trouvait une
autorit capable de les imposer.
On semble sen tre dabord remis aux pouvoirs existants. La violation de
la paix demeurait justiciable du seigneur du pays , dment oblig par son
serment et dont la responsabilit, elle aussi, comme on le voit au concile de
Poitiers, en lan mille, pouvait tre tenue en haleine par des otages. Ntait -ce
point cependant revenir au systme mme qui stait avr impuiss ant ? Par
une volution presque fatale, les associations jures, dont lobjet premier
navait t que de lier les hommes par une vaste promesse de vertu, tendirent
se transformer en organes dexcution. Peut -tre se donnrent-elles
Marc BLOCH La socit fodale
392
quelquefois, du moins en Languedoc, des juges particuliers, chargs, en marge
des juridictions ordinaires, de chtier les dlits contre le bon ordre. Il est sr,
en tout cas, que beaucoup dentre elles constiturent de vritables milices :
p.573 simple rgularisation, en somme, du vieux principe qui, la communaut
menace, reconnaissait le droit de courir sus aux brigands. Ce fut,
originellement, ici encore, avec le visible souci de respecter les autorits
tablies : les forces auxquelles le concile de Poitiers confie la mission de
rduire rsipiscense le coupable, si son seigneur propre na pas russi en
venir bout, sont celles dautres seigneurs participants au commun serment.
Mais des ligues dun type nouveau bientt se crrent, qui dbordaient
rsolument les cadres traditionnels. Le hasard dun texte nous a conserv le
souvenir de la confdration quen 1038 institua larchevque de Bourges,
Aimon. Le serment tait exig de tous les diocsains de plus de quinze ans,
par lintermdiaire de leurs curs. Ceux -ci, dployant les bannires de leurs
glises, marchaient en tte des leves paroissiales. Plus dun chteau fut
dtruit et brl par cette arme populaire, jusquau jour o, mal arme et
rduite, dit-on, monter sa cavalerie dos dnes, elle se fit massacrer, par le
sire de Dols, sur les bords du Cher.
Aussi bien, des unions de cette sorte devaient-elles ncessairement
soulever de vives hostilits, qui ne se bornaient pas aux cercles les plus
directement intresss la prolongation du dsordre. Car il y avait en elles,
incontestablement, un lment antithtique la hirarchie : non seulement
parce quaux seigneurs pillards elles opposaient des vilains ; mais aussi et
peut-tre surtout parce quelles engageaient les hommes se dfendre
eux-mmes, au lieu datten dre leur protection des pouvoirs rguliers. Le temps
ntait pas si loin o, aux beaux jours des Carolingiens, Charlemagne avait
proscrit les guildes ou confrries , mme lorsquelles avaient pour objet
de rprimer le brigandage. Ce qui, dans ces associations survivait, sans doute,
de pratiques hrites du paganisme germain, navait pas t alors le seul motif
de linterdiction. Un tat qui cherchait se construire la fois sur lide de
fonction publique et sur les rapports de subordination personnelle, employs
au profit de lordre monarchique, ne pouvait souffrir que la police ft prise en
main par des groupes sans mandat, que les capitulaires nous reprsentent dj
comme composs gnralement de paysans. Les p.574 barons et les seigneurs de
lr e fodale ntaient pas moins jaloux de leurs droits. Leurs ractions se
manifestrent, avec un relief singulier, dans un pisode qui fut, en Aquitaine,
comme le dernier sursaut dun mouvement dj prs de deux fois sculaire.
En 1182, un charpentier du Puy, instruit par des visions, fonda une
confrrie de paix, qui se rpandit rapidement dans tous les pays de Languedoc,
en Berry et jusquen Auxerrois. Lemblme en tait un chaperon blanc, avec
une sorte dcharpe, dont la bande antrieure, pendant sur la poitrine, portait
autour de limage de la Vierge Mre, linscription : Agneau de Dieu, qui
tes les pchs du monde, donne-nous la paix. On racontait que Notre Dame
elle-mme, apparaissant lartisan, lui avait remis linsigne avec la devise.
Marc BLOCH La socit fodale
393
Toute faide tait expressment proscrite du groupe. Un de ses membres
a-t-il commis un meurtre ? le frre du mort, sil appartient lui -mme aux
Capuchonns, donnera au meurtrier le baiser de paix, et, le conduisant dans sa
propre maison, ly fera manger, en t moignage doubli. Ces Pacifiques,
dailleurs, ainsi aimaient-ils se nommer navaient rien de Tolstosants.
Ils menrent contre les routiers une dure guerre, et victorieuse. Mais ces
excutions spontanes ne tardrent pas susciter les inquitudes des milieux
seigneuriaux. Par un revirement significatif, on voit le mme moine,
Auxerre, en 1183, accabler dloges ces bons serviteurs de lordre, puis,
lanne suivante, couvrir de boue leur secte indocile. Selon le mot dun
autre chroniqueur, on les accusait de poursuivre la ruine des institutions qui
nous rgissent par la volont de Dieu et le ministre des puissants de ce
monde . Ajoutez que les inspirations sans contrle dun illumin laque et,
par suite, prsum ignorant quil sagt du ch arpentier Durand ou de Jeanne
dArc ont toujours, et non sans motifs, paru aux gardiens de la foi grosses
de menaces pour lorthodoxie. crass par les armes conjugues des barons,
des vques et des routiers, les Jurs du Puy et leurs allis finirent aussi
misrablement quau sicle prcdent les milices berrichonnes.
Ces catastrophes ntaient que le symptme, particulirement loquent,
dun chec de porte plus gnrale. p.575 Incapables de crer, de toutes pices,
la bonne police et la droite justice sans lesquelles il ntait point de paix
possible, les conciles ni les ligues ne parvinrent jamais rprimer durablement
les troubles. Le genre humain , crit Raoul le Glabre, ft pareil au chien
qui retourne son vomissement. La promesse avait t faite. Elle ne fut pas
tenue. Mais dans dautres milieux et sous des formes diverses le grand rve
vanoui devait laisser des traces profondes.
Ce fut par des expditions punitives diriges, les bannires des glises au
vent, contre les chteaux des seigneurs pillards que dbuta au Mans, en 1070,
le mouvement communal franais. Il nest pas jusquau mot de saintes
institutions , par o la jeune collectivit mancelle dsignait ses dcrets, qui
lhistorien des paix ne rende un son familier. Certes bien dautres besoins,
dune nature trs diffrente, engageaient les bourgeois sunir. Comment
oublier, cependant, que de l amiti urbaine, selon le beau nom que
certains groupes aimaient se donner, la rpression ou lapaisement des
vendettas, parmi les associs, la lutte, au dehors, contre le brigandage furent,
ds lorigine, une des principales justifications ? Comment ne pas rappeler,
surtout, du pacte de paix au pacte communal, la filiation tablie par ce trait,
des deux parts prsent et dont nous avons dj vu laccent rvolutionnaire : le
serment des gaux ? Mais, la diffrence des grandes confdrations cres
sous les auspices des conciles et des prlats, la commune se bornait
rassembler, dans une seule ville, des hommes lis par une vigoureuse
solidarit de classe et dj accoutums au coude coude. Ce resserrement fut
une des grandes raisons de sa force.
Marc BLOCH La socit fodale
394
Cependant, les rois et les princes, eux aussi, par vocation ou par intrt,
recherchaient lordre intrieur. Ce mouvement, qu i avait surgi en dehors
deux, pouvaient -ils hsiter longtemps le mettre profit, en se constituant,
leur tour, chacun dans sa sphre, selon le titre que devait se donner
expressment en 1226, un comte de Provence, grands paciaires (364) ? Dj
il semble bien que des fameuses milices du Berry larchevque Aimon avait
rv de faire, son bnfice, linstrument dune vritable souverainet
provinciale. En Catalogne, on vit les comtes, qui dabord staient borns p.576
participer aux synodes, en incorporer bientt les dcisions dans leurs propres
ordonnances, non sans donner ces emprunts un tour par o la paix dglise
se transformait peu peu en paix du prince. Dans le Languedoc et,
notamment, dans les diocses du Massif Central, les progrs, au XIIe sicle, de
la circulation montaire avaient permis de constituer aux associations de paix
des finances rgulires : sous le nom de commun de paix ou pezade ,
un subside tait lev, qui avait pour objet, la fois, d indemniser les victimes
des troubles et de solder les expditions. Les cadres paroissiaux servaient la
perception. Lvque grait la caisse. Mais, trs rapidement, cette contribution
fut dtourne de sa nature premire. Les magnats les comtes de Toulouse
surtout, matres ou seigneurs fodaux de nombreux comts forcrent les
vques en partager avec eux les revenus ; les vques mmes en oublirent
la premire destination. Si bien quen fin de compte le grand effort de dfense
spontane eut ici pour rsultat le plus durable car la pezade devait vivre
autant que lAncien Rgime de favoriser la cration, remarquablement
prcoce, dun impt territorial.
A lexception de Robert le Pieux, qui runit de grandes assembles pour y
faire jurer la paix, les Captiens ne semblent gure stre soucis dinstitutions
quils tenaient peut -tre pour attentoires leur propre mission de justiciers. Ce
fut au service direct du roi que, sous Louis VI, on vit les contingents des
paroisses monter lassaut des ferts seigneuriales. Quant la paix solennelle
quen 1155 son successeur promulgua pour dix ans, si sensible quy soit
linfluence des dcisions conciliaires usuelles, elle portait, en elle -mme, tous
les caractres dun acte dautorit monarchique. Par contre, dans les
principauts les plus vigoureuses de la France du Nord, en Normandie et en
Flandre, les princes estimrent dabord utile de sassocier luvre des paix
jures. Ds 1030, Baudoin IV de Flandre sunit lvque de Noyon -Tournai
pour provoquer une vaste promesse collective. En 1047, un concile, Caen,
peut-tre sous linfluence de textes flamands, proclama la Trve de Dieu.
Mais point de ligues armes. Elles neussent pas t tolres et auraient paru
sans objet. Puis, trs vite, le comte ou le duc p.577 ce dernier aid, en
Normandie, par certaines traditions propres au droit scandinave se
substiturent lglise comme lgislateurs, juges et gendarmes du bon ordre.
Ce fut dans lEmpire que le mouvement des paix la fois eut les plus
longs effets et subit les plus curieuses dviations. Nous connaissons dj les
rpugnances quil y avait dabord rencontres. Certes, l aussi on vit, depuis le
Marc BLOCH La socit fodale
395
dbut du XIe sicle, les peuples, au cours de grandes assembles, invits la
rconciliation gnrale et labstention de toute violence. Mais ctait dans
les dites royales et par des dcrets royaux. Du moins, les choses demeurrent
en cet tat jusqu la grande querelle de Henri IV et de Grgoire VII. Puis,
pour la premire fois, en 1082, une Trve de Dieu fut proclame, Lige, par
lvque, assist des barons du diocse. Le lieu et la date mritent galement
lattention. Plus que lAllemagne propre, la Lotharingie souvrait aux
influences venues de lOuest. Cinq ans peine, dautre part, s taient couls
depuis que stait lev, contre Henri IV, le premier anti -roi. D linitiative
dun vque imprialiste, lacte navait dailleurs nullement sa pointe dirige
contre la monarchie. Henri le confirma. Mais du fond de lItalie. Vers le
mme temps, dans les parties de lAllemagne o lautorit impriale ntait
plus reconnue, les barons sentaient la ncessit de sunir pour lutter contre le
dsordre. Lglise et les pouvoirs locaux visiblement tendaient prendre en
main la tche des rois.
Pourtant, la monarchie impriale tait encore trop forte pour abandonner
cette arme. Ds son retour dItalie, Henri IV se prit lgifrer son tour
contre les violences et, dsormais, pendant plusieurs sicles, on put voir les
empereurs ou les rois promulguer, de temps autre, de vastes constitutions de
paix applicables tantt telle ou telle province particulire, tantt et plus
souvent lEmpire tout entier. Ce ntait pas l le retour, pur et simple, aux
pratiques antrieures. Transmise par la Lorraine, linfluence des paix
franaises avait appris substituer, aux ordres trs gnraux de nagure, un
grand luxe de rgles de plus en plus minutieuses. A ce point que lhabitude
sintroduisit, progressivement, de glisser dans ces textes toutes sortes de
prescriptions, qui p.578 avec leur objet primitif navaient plus quun rapport
lointain. Les Friedesbriefe , dit justement une chronique souabe du dbut
du XIIIe sicle, sont les seules lois dont usent les Allemands (365). Parmi les
consquences du grand effort tent par les conciles et les associations jures,
la moins paradoxale ne fut pas, ayant en Languedoc aid natre limpt
princier, de favoriser, en Allemagne, la rsurrection de la lgislation
monarchique.
LAngleter re des Xe et XIe sicles eut aussi, sa faon, ses ligues, ses
guildes de paix. Mis par crit entre 930 et 940, les statuts de celle de
Londres sont un extraordinaire document dinscurit et de violence : justice
expditive, poursuivants lancs sur la piste des voleurs de btail, ne se
croirait-on point parmi les pionniers du Far West, aux temps hroques de la
Frontire ? Mais ctait ici la police toute laque dune rude communaut,
un code pnal populaire dont la sanglante rigueur une addition au texte en
tmoigne nallait pas sans choquer le roi et les vques. Sous le nom de
guildes, le droit germanique avait entendu des associations dhommes libres
formes en dehors des liens de parent et destines, en quelque mesure, en
tenir lieu : un serment, des beuveries priodiques quavaient accompagnes
aux temps paens des libations religieuses, parfois une caisse commune,
Marc BLOCH La socit fodale
396
surtout une obligation dentraide en taient les caractres principaux : pour
lamiti comme pour la vengeance, nous rest erons unis quoi quil advienne ,
disent les ordonnances londoniennes. En Angleterre, o les rapports de
dpendance personnelle tardrent, beaucoup plus que sur le continent, tout
envahir, ces groupements, loin dtre frapps dinterdiction, comme dans
ltat carolingien, furent volontiers reconnus par les rois, qui espraient
sappuyer sur eux pour le maintien de lordre. La responsabilit du lignage ou
celle du lord manquaient-elles jouer ? La responsabilit de la guilde pour ses
membres les remplaait. Aprs la conqute normande, lorsquune royaut trs
forte se fut instaure, elle reprit la tradition anglo-saxonne ces pratiques de
caution mutuelle. Mais ce fut pour en faire, finalement sous le nom de ce
frankpledge dont nous avons dj esquiss lhistoire (366) un des rouages du
nouveau systme p.579 seigneurial. Dans loriginale volution de la socit
anglaise qui, dun rgime o laction collective de lhomme libre navait pas
t compltement abaisse devant le pouvoir du chef, passa, directement,
une dure monarchie, les institutions de paix du type franais navaient pas
trouv sinsrer.
Sur le continent mme, ctait aux royauts et aux principauts
territoriales qutait rserv, en oprant lindispensable r egroupement des
forces, de donner corps, enfin, aux aspirations dont conciles et pactes avaient
du moins manifest lintense ferveur.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
397
Chapitre V
Vers la reconstitution des tats : Les volutions nationales
I. Raisons du regroupement des forces
Au cours du second ge fodal, on vit, de toutes parts, le pouvoir sur
les hommes, jusque-l divis lextrme, commencer de se concentrer dans
des organismes plus vastes : non point neufs assurment, mais dans leur
capacit daction vritablement rnovs. Les exceptions apparentes, comme
lAllemagne, svanouissent ds lors quon veut bien cesser denvisager ltat
uniquement sous les couleurs de la royaut. Un phnomne aussi gnral ne
saurait avoir t command que par des causes galement communes tout
lOccident. Pour les numrer, il suffirait presque de reprendre rebours le
tableau de celles qui prcdemment avaient conduit au morcellement.
p.581
Larrt des invasions avait libr les pouvoirs royaux et princiers dune
tche o susaient leurs forces. En mme temps, il permettait le prodigieux
essor dmographique que dnonce, partir du milieu du XIe sicle, la pousse
des dfrichements. La densit accrue de la population ne rendait pas
seulement le maintien de lordre plus ais. Elle favorisa it aussi le renouveau
des villes, de lartisanat et des changes. Grce une circulation montaire
devenue plus abondante et plus active, limpt rapparaissait. Avec lui, le
fonctionnariat salari et, substitues linefficace rgime de services
hrditairement contractuels, les armes soldes. Assurment le petit ou
moyen seigneur ne manquait pas de tirer profit, lui p.582 aussi, des
transformations de lconomie ; il eut, comme on la vu, ses tailles . Mais
le roi ou le prince possdait, presque toujours, plus de terres et plus de vassaux
que quiconque. En outre, la nature propre de son autorit lui fournissait de
multiples occasions de lever des taxes, notamment sur les glises et sur les
villes. Le revenu quotidien de Philippe Auguste, sa mort, galait, comme
ordre de grandeur, environ la moiti du revenu annuel accus, un peu plus
tard, par une seigneurie monastique qui, sans compter parmi les plus riches,
disposait cependant de biens fort tendus, dans une province particulirement
prospre (367). Ainsi ltat avait, ds lors, commenc dacqurir cet lment
essentiel de sa suprmatie : une fortune incomparablement plus considrable
que celle de nimporte quelle personne ou collectivit prives.
Les modifications de la mentalit allaient dans le mme sens. La
renaissance culturelle, depuis la fin du XIe sicle, avait rendu les esprits
plus aptes concevoir le lien social, toujours un peu abstrait de nature, quest
Marc BLOCH La socit fodale
398
la subordination de lindividu la puissance publiq ue. Elle avait rveill aussi
le souvenir des grands tats polics et monarchiques du pass lEmpire
romain, dont les Codes, comme les livres dhistoire, disaient, sous des princes
absolus, la majestueuse grandeur ; lEmpire carolingien, embelli par le c ulte
de la lgende. Sans doute les hommes assez instruits pour que de pareilles
influences pussent sexercer sur eux demeuraient, proportionnellement la
masse, une poigne. Mais, en elle-mme, cette lite tait devenue beaucoup
plus nombreuse. Surtout l instruction avait gagn, dans les milieux laques,
ct de la haute aristocratie, jusqu la classe chevaleresque. Plus utiles que
les clercs, en un temps o tout administrateur devait tre en mme temps chef
de guerre, moins queux sujets lattraction dintrts trangers aux
puissances temporelles, rompus enfin, de longue date, la pratique du droit,
ces gentilshommes de mdiocre fortune devaient former, bien avant la
bourgeoisie, ltat -major des monarchies renouveles : lAngleterre de Henri
Plantagent, la France de Philippe Auguste et de Saint Louis. Lusage, le got,
la possibilit de lcrit permirent aux tats de se constituer ces p.583 archives
administratives sans lesquelles il ne saurait tre de pouvoir vraiment continu.
Tableaux des services dus par les fiefs, comptabilit priodique, registres des
actes expdis ou reus : autant d aide-mmoire quon voit surgir, ds le
milieu du XIIe sicle, dans ltat anglo -normand et le royaume, normand
aussi, de Sicile ; vers la fin de ce mme sicle ou au cours du sicle suivant,
dans le royaume de France et la plupart de ses grandes principauts. Leur
apparition fut comme le signe avertisseur que se levait lhorizon une
puissance nouvelle ou du moins rserve jusque-l aux grandes glises et la
cour pontificale : la bureaucratie.
Pour quasi universel quait t, dans ses traits fondamentaux, ce
dveloppement, il nen suivit pas moins, selon les pays, des lignes bien
diffrentes. On se bornera ici considrer rapidement, titre en quelque sorte
exprimental, trois types dtat.
II. Une monarchie neuve : les Captiens
La monarchie carolingienne de la grande poque avait tir sa force,
dailleurs toute relative, de lapplication de quelques principes gnraux :
service militaire exig de tous les sujets ; prminence du tribunal royal ;
subordination des comtes, alors vritables fonctionnaires ; rseau de vassaux
royaux, partout rpandus ; pouvoir sur lglise. De tout cela, que restait -il la
royaut franaise, vers la fin du Xe sicle ? Presque rien, en vrit.
Assurment, surtout depuis quen accdant la couronne les ducs
robertiens lui ont fait apport de leurs fidles un assez grand nombre de
moyens et de petits chevaliers continuent de prter lhommage directement au
roi. Mais on les rencontre dsormais, presque exclusivement, dans cet espace
assez restreint de la France du nord o la dynastie jouit elle-mme de droits
Marc BLOCH La socit fodale
399
comtaux. Ailleurs, elle na plus gure hauts barons part que des
arrire-vassaux : inconvnient terrible en un temps o le seigneur proche est le
seul auquel on se sente moralement attach. Les comtes ou rassembleurs de
comts, qui sont ainsi devenus le maillon intermdiaire de tant de chanes
vassaliques, ne nient point tenir leurs dignits du roi. p.584 Mais loffic e est
devenu un patrimoine, que chargent des obligations dun type particulier. Je
nai point agi contre le roi , fait dire un contemporain Eude de Blois, qui
avait cherch enlever un autre vassal de Hugues Capet le chteau comtal
de Melun ; il ne lui importe pas quun homme ou un autre tienne le
fief (368). Entendez : du moment que la relation vassalique subsiste. On
croirait un fermier : ma personne est indiffrente, pourvu que le loyer soit
acquitt . Encore ce loyer de fidlit et de service tait-il en lespce souvent
bien mal pay.
Pour toute arme, le roi en est, dans la pratique courante, rduit ses petits
vassaux, aux chevaliers des glises sur lesquelles il na pas perdu tout
pouvoir, la pitaille leve dans ses propres villages et sur les terres de ces
mmes glises. Parfois, quelques ducs ou grands comtes lui amnent leur
contingent. Comme allis, plutt que comme sujets. Parmi les plaideurs qui
persistent porter leurs causes devant son tribunal, ce sont encore les mmes
cercles que nous trouvons peu prs exclusivement reprsents : petits
seigneurs lis par lhommage direct, glises royales. Si, en 1023, un magnat,
le comte de Blois, affecte de se soumettre au jugement de la cour, cest en
posant comme condition que lui soient dabord concds les fiefs qui
formaient prcisment lobjet du litige. Passs sous la domination des
dynasties territoriales, plus des deux tiers des vchs avec quatre
provinces ecclsiastiques entires : Rouen, Dol, Bordeaux et Narbonne
chappent totalement la royaut. A vrai dire, ceux qui lui restent
immdiatement soumis sont encore nombreux. Grce certains dentre eux,
elle demeure, en quelque mesure, prsente jusquau cur de lAquitaine
avec Le Puy ou, avec Noyon-Tournai, au milieu mme des pays de
domination flamande. Mais la plupart de ces vchs royaux sont eux aussi
concentrs entre la Loire et la frontire de lEmpire. Tel est galement le cas
des abbayes royales , dont beaucoup proviennent de lhritage des
Robertiens, en leur temps ducal cyniques accapareurs de monastres. Ces
glises devaient tre une des meilleures rserves de force de la monarchie. Les
premiers Captiens, toutefois, semblaient trop faibles pour quaux privilges
dont ils pouvaient distribuer p.585 la manne leur propre clerg attacht un grand
prix. De Hugues Capet, on connat, en dix ans de rgne, une douzaine de
diplmes ; de son contemporain Otton III dAllemagne, en moins de vingt
annes dont les premires furent occupes par une minorit plus de
quatre cents.
Cette opposition entre la dfaillance de la royaut, en France Occidentale,
et son clat relatif, dans le grand tat voisin, ne manqua point de frapper les
contemporains. On parlait volontiers, en Lotharingie, des murs
Marc BLOCH La socit fodale
400
indisciplines des Kerlinger, cest --dire des habitants de lancien royaume
de Charles le Chauve (369). Il est plus ais de constater le contraste que den
rendre compte. Les institutions carolingiennes navaient pa s eu, lorigine,
moins de force dun ct que de lautre. Probablement lexplication doit -elle
tre cherche dans des faits profonds de structure sociale. Le grand principe
moteur du morcellement fodal fut toujours le pouvoir du chef local ou
personnel sur de petits groupes, soustraits ainsi toute autorit plus large. Or,
une fois laisse de ct lAquitaine, traditionnellement indocile, les rgions
qui formaient proprement le cur de la monarchie franaise taient
prcisment ces pays dentre Loire et Meuse o la seigneurie rurale remontait
au plus lointain des ges et dans lesquels la commendise dhomme
homme avait trouv sa terre dlection. Dans une contre o limmense
majorit des biens-fonds taient soit tenure, soit fief, et o on en arriva, de
bonne heure, dire libre , non lhomme sans seigneur, mais celui auquel
restait encore, pour tout privilge, le droit de choisir son matre, il ny avait
plus gure de place pour un vritable tat.
Cependant cette ruine mme du droit public ancien devait finalement
servir le destin de la monarchie captienne. Non certes que la dynastie
nouvelle se soit jamais propos de rompre avec la tradition carolingienne, dont
elle tirait le meilleur de sa force morale. Mais aux vieux organes vermoulus de
l tat franc, elle fut, par ncessit, contrainte de substituer dautres
instruments de puissance. Tenant les comtes pour leurs dlgus, les rois de
nagure navaient pas imagin pouvoir gouverner aucun territoire important
autrement que par lintermdiaire de ces officiers. On nobserve point p.586
quaucun comt, plac directement sous la main royale, ait t trouv par
Hugues Capet dans lhritage des derniers Carolingiens. Au contraire, issus
dune famille dont la grandeur tait ne dune accumulation dhonneurs
comtaux, les Captiens, tout naturellement, continurent sur le trne la mme
politique.
Ce ne fut pas, vrai dire, sans incertitudes. On a quelquefois compar nos
rois des paysans, cousant patiemment le champ au champ. Limage est
doublement trompeuse. Elle exprime fort mal la mentalit doints du Seigneur,
au surplus grands donneurs de coups dpe et, de tout temps comme la
classe chevaleresque laquelle les rattachaient leurs faons de sentir ,
dangereusement soumis aux prestiges de laventure. Elle suppose, dans leurs
desseins, une continuit que lhistorien, pour peu quil y regarde de prs,
constate rarement. Si ce Bouchard de Vendme, que Hugues Capet avait fait
comte de Paris, de Corbeil et de Melun ne stait trouv dpourvu de tout
autre hritier direct quun fils ds longtemps entr dans les ordres, on et vu
se constituer, au cur mme de lIle -de-France, la plus redoutablement situe
des principauts territoriales. Henri Ier encore envisagera, dans un diplme,
linfodation d e Paris, comme une ventualit nullement invraisemblable (370).
Visiblement, on avait peine se dgager des pratiques carolingiennes.
Marc BLOCH La socit fodale
401
Cependant, depuis le dbut du XIe sicle, une srie de comts sont
successivement acquis par les rois sans que ceux-ci y tablissent aucun comte
nouveau. Les souverains, en dautres termes, ayant cess, bon droit, de
considrer ces magnats comme des fonctionnaires, hsitent de moins en moins
se faire eux-mmes leurs propres comtes. Sur les terres, hrites des anctres
ou rcemment annexes, do est ainsi limin lcran dune puissance
interpose, les seuls reprsentants de lautorit royale sont dassez petits
personnages, placs chacun la tte dune assez petite circonscription ; et si,
lorigine, quelques -uns de ces prvts , que leur mdiocrit mme rendait
peu menaants, semblent stre succd de pre en fils dans leurs charges,
leurs matres neurent pas grand -peine, durant le XIIe sicle, p.587 les
transformer presque tous en fermiers temps. Puis, partir de Philippe
Auguste, ce sera, un degr suprieur de la hirarchie administrative,
lapparition dauthentiques fonctionnaires salaris : les baillis ou snchaux.
Parce que, sadaptant aux conditions sociales nouvelles, la royaut franaise
avait fait modestement reposer son pouvoir sur le commandement direct de
groupes dhommes peu tendus, elle put, lorsque les circonstances
favorisrent le regroupement des forces, en tirer, au profit des ides et des
sentiments trs antiques quelle continuait dincorporer, le principal profit.
Elle ne fut pas cependant la seule en bnficier. Car le mme phnomne
se produisit galement au sein des grandes principauts territoriales, encore
subsistantes. Entre la mosaque des comts que, de Troyes Meaux et
Provins, Eude de Blois, vers 1022, grce des liens familiaux astucieusement
exploits, avait russi sapproprier et ltat champenois du dbut du XII Ie
sicle, avec son droit successoral qui, fond sur la primogniture, excluait
dsormais le partage, avec ses circonscriptions administratives bien traces,
ses fonctionnaires, ses archives, il ny avait pas moins de diffrence quentre
le royaume de Robert le Pieux et celui de Louis VIII. Les cadres ainsi
constitus furent si forts que mme labsorption finale par la monarchie ne
parvint pas les rompre. De toutes faons, les rois rassemblrent la France
bien plutt quils ne lunifirent. En Angleterre, la Grande Charte ; dans la
France de 1314-1315, les Chartes aux Normands, aux Languedociens, aux
Bretons, aux Bourguignons, aux Picards, aux Champenois, aux Auvergnats,
aux gens des Basses-Marches de lOuest, aux Berrichons, aux Nivernais ;
en Angleterre le Parlement ; en France les tats provinciaux, toujours
beaucoup plus frquents et, en somme, plus actifs que les tats Gnraux
en Angleterre la common law, peine teinte dexceptions rgionales ; en
France, linfinie bigarrure des coutumes rgionales : autant de contrastes qui
devaient peser dun poids trs lourd s ur notre volution nationale. En vrit,
davoir tir sa force premire, trs fodalement , dune agglomration de
comts de chtellenies, de droits sur les glises, p.588 il semble que la royaut
franaise, mme ltat une fois ressuscit, soit reste pour toujours marque.
Marc BLOCH La socit fodale
402
III. Une monarchie archasante : lAllemagne
Constatant que la perptuit des fiefs stablit en France plus tt quen
Allemagne , Montesquieu mettait en cause lhumeur flegmatique et, si
jose dire, limmutabilit de lespri t de la nation allemande (371). Psychologie
assurment aventureuse, mme en la nuanant, comme Montesquieu, dun
peut-tre . Mais lintuition subsiste, singulirement pntrante. Au lieu
dhumeur flegmatique , disons modestement archasme : le mot sera
celui quimpose toute tude de la socit mdivale allemande, compare,
date pour date, avec la socit franaise. Or, vraie, comme on la vu, de la
vassalit et du fief, du rgime seigneurial, de lpope si vritablement
archaque par ses thmes lgendaires et latmosphre paenne de son
merveilleux , non moins exacte dans le domaine de lconomie (la
renaissance urbaine , en Allemagne, retarda dun sicle ou deux sur lItalie,
la France et la Flandre), lobservat ion conserve toute sa valeur, lorsquon
passe lvolution de ltat. Point dexprience plus dcisive que cette
concordance, une fois de plus retrouve, entre la structure sociale et la
structure politique. Dans lAllemagne beaucoup moins profondment et moins
uniformment fodalise et seigneurialise que la France, la
monarchie, beaucoup plus longtemps quen France, demeura fidle au type
carolingien.
Le roi gouverne laide de comtes qui ne virent leur hrdit se confirmer
que lentement et, mme celle-ci une fois tablie, restrent conus comme les
titulaires moins dun fief que dune fonction. Lors mme quils ne sont pas
directement les vassaux du souverain, cest de lui, quen principe, comme les
avous des glises immunistes, ils tiennent, par une concession spciale,
leur pouvoir dordonner et de punir, leur ban . Certes, la monarchie, ici
aussi, se heurta la rivalit des principauts territoriales, sous la forme surtout
de ces duchs dont nous avons dit loriginale structure. En dpit des
suppressions ou des divisions opres par p.589 les Ottoniens, les ducs ne
cessrent dtre dangereusement puissants et indociles. Mais, contre eux, les
rois ont su utiliser lglise. Car, la diffrence des Captiens, lhritier
allemand de Charlemagne a russi rester le matre d peu prs tous les
vchs du royaume. Labandon des vchs bavarois que Henri I er dut
consentir au duc de Bavire ne fut quune mesure de circonstance, bientt
retire ; la tardive concession des siges doutre -Elbe, octroye par Frdric
Barberousse au duc de Saxe, nintressait quun pays de missions et ne se
trouva dailleurs gure plus durable ; le cas des petits vchs alpestres, remis
linvestiture de leur mtropolitain de Salzbourg, constituait une except ion
sans porte. La chapelle royale est le sminaire des prlats dEmpire et cest
ce personnel de clercs, instruits, ambitieux, rompus aux affaires, qui, avant
tout, maintient la continuit de lide monarchique. vchs et monastres
royaux, de lElbe la Meuse, des Alpes la mer du Nord, mettent la
disposition du souverain leurs services : prestations en argent ou en
Marc BLOCH La socit fodale
403
nature ; gte offert au Prince ou ses gens ; devoir militaire surtout. Les
contingents des glises forment la part la plus considrable et la plus stable de
larme royale. Non la seule. Car le roi persiste revendiquer laide de tous
ses sujets et, si la leve en masse proprement dite, lappel au pays (clamor
patriae), na dapplication relle que sur les frontires, en cas de raids
barbares, lobligation de servir avec leur chevalerie incombe aux ducs et
comtes du royaume entier et ne laisse pas dtre, en fait, assez efficacement
accomplie.
Ce systme traditionnel, cependant, ne joua jamais parfaitement.
Assurment, il permit les grands desseins des expditions romaines . Par l
mme, favorisant de trop vastes ambitions, elles-mmes anachroniques, il tait
dj dangereux. Car, lintrieur du pays, larmature ntait pas, en ralit,
assez forte pour soutenir un pareil poids. Ce gouvernement sans impt autre
que les quelques services financiers des glises, sans fonctionnaires
salaris, sans arme permanente, ce gouvernement nomade, qui ne disposait
pas de moyens de communication convenables et que les hommes sentaient
physiquement et moralement trs loin, p.590 comment et-il russi obtenir une
constante obissance ? Point de rgne sans rbellions.
Aussi bien, avec quelque retard et bien des diffrences, lvolution vers le
morcellement des pouvoirs publics en petits groupes de commandement
personnel emportait-elle lAllemagne comme la France. La dissolution des
comts, entre autres, retirait peu peu ldifice sa base ncessaire. Or, les
rois allemands, tant beaucoup plus que des princes territoriaux, ne staie nt,
dautre part, rien donn qui ressemblt au domaine restreint, mais bien centr,
des ducs robertiens, devenus les rois de France. Mme le duch de Saxe, que
Henri Ier avait dtenu avant son avnement, se trouva finalement bien
quavec une tendue moin dre chapper la royaut. Ce fut un des premiers
exemples dun usage qui progressivement prit force de loi. Point de fief de
dignit qui, provisoirement acquis la Couronne, par confiscation ou par
vacance, ne doive presque aussitt tre rinfod : cette rgle, caractristique
de la monarchie impriale, fut entre toutes fatale ses progrs. Applique la
France, elle et empch Philippe Auguste de conserver la Normandie,
comme, en Allemagne, une trentaine dannes plus tt, elle stait oppose, en
fait, lannexion, par Frdric Barberousse, des duchs enlevs Henri le
Lion. Assurment, il tait rserv au XIIe sicle de la formuler dans toute sa
rigueur, sous la pression du baronat. Mais elle tirait sans nul doute ses origines
du caractre de fonction publique tenacement attach, l-bas, aux
honneurs comtaux et ducaux. Un souverain saurait-il, sans paradoxe, se
constituer son propre dlgu ? Certes, le roi allemand tait le seigneur direct
de nombreux villages ; il avait ses vassaux particuliers, ses ministriaux, ses
chteaux. Tout cela, cependant, dispers sur dimmenses espaces.
Tardivement, Henri IV comprit le pril. On le vit, partir de 1070, sefforcer
de se crer, en Saxe, une vritable Ile-de-France, toute hrisse de forteresses.
Marc BLOCH La socit fodale
404
Il choua : car dj se prparait la grande crise de la lutte avec les papes, qui
devait mettre au jour tant de germes de faiblesse.
Ici encore, il faut oser le mot danachronisme. Si, du conflit dapparence
banale, qui, depuis quelques annes, p.591 dressait lun contre lautre Henri IV
dAllemagne et Grgoire VII, sortit brusquement, en 1076, une inexpiable
guerre, le coup de thtre de Worms en fut la cause : cette dposition du pape,
prononce, aprs consultation dun concile allemand, par un roi qui n tait
mme pas encore excommuni. Or, ce geste ntait que rminiscences.
Otton Ier avait fait casser un pape ; le propre pre et prdcesseur dHenri IV :
trois, dun coup. Seulement, depuis lors, le monde avait chang. Rforme par
les empereurs mmes, la papaut avait reconquis son prestige moral et un
grand mouvement de rveil religieux faisait delle le plus haut symbole des
valeurs spirituelles.
Nous avons dj vu comment cette longue querelle ruina dfinitivement,
en Allemagne, le principe hrditaire. Elle acheva de jeter les souverains dans
le gupier italien, sans cesse renaissant. Elle servit de point de cristallisation
toutes les rvoltes. Surtout elle atteignit profondment les pouvoirs sur
lglise. Non, beaucoup prs, que jusquau XII Ie sicle, les rois aient cess
dexercer sur les nominations piscopales ou abbatiales une influence qui,
pour varier extrmement selon les rgnes ou les moments, nen demeurait pas
moins dans lensemble fort considrable. Mais, investis dsormais par le
sceptre, symbole du fief, les prlats, cessant de passer pour les dtenteurs
dune fonction publique, paratront, lavenir, de simples feudataires. En
outre, lvolution de la conscience religieuse, branlant lide de la valeur
sacre jusque-l attache la dignit royale, rendait le clerg
incontestablement moins docile des tentatives de domination qui heurtaient,
chez lui, un sens plus aiguis de la prminence du surnaturel. Paralllement,
les transformations de la socit muaient dfinitivement les anciens
reprsentants de la royaut, dans les provinces, en seigneurs hrditaires de
domaines morcels, diminuaient le nombre des hommes libres, au sens
premier du mot, retiraient enfin beaucoup de leur caractre public des
tribunaux progressivement seigneurialiss. Assurment, au XIe sicle,
Frdric Barberousse fait encore figure de monarque trs puissant. Jamais
lide impriale, nourrie par une culture plus riche et plus consciente, ne
sexprimera plus fortement que sous son rgne et p.592 dans son entourage.
Mais ldifice, mal tay, mal adapt aux forces du prsent, est dj la merci
de tout choc un peu rude.
Cependant dautres pouvoirs sapprtent natre sur les ruines la fois de
la monarchie et des vieux duchs ethniques. De principauts territoriales,
jusque-l assez lchement assembles, on verra, depuis le tournant de la fin du
XIIe sicle, se dgager peu peu des tats fonctionnariss, relativement
polics, soumis limpt, pourvus dassembles reprsentatives. Ce qui
subsiste de lorga nisation vassalique y est tourn au profit du prince et lglise
mme y obit. Plus gure dAllemagne, politiquement parlant ; mais, comme
Marc BLOCH La socit fodale
405
on disait chez nous, les Allemagnes . Dune part le retard, spcifiquement
allemand, de lvolution sociale ; de lautre, lavnement, commun presque
toute lEurope, des conditions propres une concentration de la puissance
publique : la rencontre de ces deux chanes causales fit que le regroupement,
en Allemagne, ne sopra quau prix dune longue fragmentation de lancien
tat.
IV. La monarchie anglo-normande :
faits de conqute et survivances germaniques
Ltat anglo -normand tait issu dune double conqute de la Neustrie
occidentale par Rollon, de lAngleterre par Guillaume le Btard. Il dut cette
origine une structure beaucoup plus rgulire que celle des principauts
difies par pices et morceaux ou des monarchies charges dune longue et
parfois confuse tradition. Ajoutez que la seconde conqute, celle de
lAngleterre, stait produite au moment mme o le changement des
conditions conomiques et mentales, dans tout lOccident, commenait
favoriser la lutte contre le morcellement. Il est significatif que, presque ds le
dbut, cette monarchie, ne dune guerre heureuse, nous apparaisse fonde sur
lc rit ; trs tt aussi, pourvue dun personnel instruit et dhabitudes
bureaucratiques.
LAngleterre anglo -saxonne des derniers temps avait vu se constituer, aux
mains de ses earls, de vritables principauts territoriales, formes, selon le
type classique, par des p.593 agglomrations de comts. La guerre de conqute
et les rvoltes postrieures, rudement mates, ayant fait disparatre de la scne
les grands chefs indignes, tout pril, de ce ct-l, put sembler cart pour
lunit de ltat. Cependant, l ide quil ft possible pour un roi de gouverner
directement son royaume entier tait alors si trangre aux esprits que
Guillaume crut devoir crer, son tour, des commandements de type
analogue. Heureusement pour la monarchie, linfidlit mme de ces h auts
barons amena trs vite la seule exception du comt de Chester, sur les
marches galloises, et de la principaut ecclsiastique de Durham, sur les
marches cossaises la suppression des redoutables formations politiques
auxquelles les rebelles avaient t prposs. Les rois persistent crer parfois
des comtes ; mais dans les comts dont ils portaient le titre, ces personnages
se bornaient dsormais recevoir une part des produits de la justice.
Lexercice mme des pouvoirs judiciaires, la leve d es troupes, la perception
des revenus fiscaux appartenaient des reprsentants directs du roi,
dnomms, en anglais, sheriffs. Fonctionnaires ? Pas tout fait. Dabord parce
quils affermaient leur charge, moyennant une somme fixe verse au Trsor :
en un temps o les conditions conomiques ne permettaient pas encore le
salariat, ce systme de fermage tait la seule solution qui soffrt, quand on ne
voulait pas de linfodation. Ensuite parce quau dbut un assez grand nombre
Marc BLOCH La socit fodale
406
dentre eux parvinrent se rendre hrditaires. Mais cette volution
menaante fut brusquement arrte par la forte main des souverains angevins.
Le jour o, en 1170, on vit Henri II, dun coup, destituer tous les sheriffs du
royaume, soumettre leur gestion une enqute et nen rep lacer que
quelques-uns, il fut sensible tous les yeux que dans lAngleterre entire le
roi tait matre de ceux qui commandaient en son nom. Parce que la fonction
publique ne sy tait point pleinement confondue avec le fief, lAngleterre fut
beaucoup plus tt quaucun royaume du continent, un tat vraiment un.
Fodal, cependant, nul tat, certains gards, ne le fut plus parfaitement.
Mais de telle faon que le pouvoir royal en tirait, finalement, un surcrot de
prestige. Dans ce pays p.594 o toute terre tait une tenure, le roi ntait -il pas
littralement le seigneur de tous les seigneurs ? Nulle part, surtout, le systme
des fiefs militaires ne fut plus mthodiquement appliqu. Dans les armes
ainsi recrutes, le problme essentiel tait, on le sait, dobtenir que les vassaux
directs du roi ou du prince se fissent accompagner, lost, dun nombre
suffisant de ces arrire-vassaux dont, ncessairement, le gros des troupes se
trouvait compos. Or, au lieu dtre livr, comme ce fut ailleurs si souvent le
cas, larbitraire dune variable coutume ou des conventions individuelles
plus ou moins mal respectes, ce chiffre, dans le duch normand dj, puis,
sur une chelle beaucoup plus vaste, en Angleterre, fut pour chaque baronnie
fix dfinitivement au moins titre de minimum par le pouvoir central.
Et, comme il tait de principe que presque toute obligation de faire pouvait
tre remplace par son quivalent en numraire, les rois, ds les premires
annes du XIIe sicle, prirent lhabitude dexige r parfois de leurs tenants en
chef, au lieu de soldats, un impt, peru au prorata du nombre de chevaliers
ou, selon lexpression courante, dcus , quils eussent d fournir.
Mais cette organisation fodale admirablement concerte salliait des
traditions empruntes un plus lointain pass. La forte paix tablie, ds
loccupation des comts neustriens, par les ducs des pirates , comment ne
pas reconnatre en elle le code dune arme au cantonnement, pareil ces lois
que lhistorien danois Saxo G rammaticus attribue au roi Frod, conqurant de
lgende ? Surtout, gardons-nous de diminuer lexcs la part de lhritage
anglo-saxon. Le serment de fidlit quen 1086 Guillaume requit de tous ceux
qui avaient autorit en Angleterre, de quelque seigneur quils fussent les
hommes , et que par la suite ses deux premiers successeurs firent renouveler
cette promesse transcendante tous les liens vassaliques et qui les primait
, tait-ce autre chose, aprs tout, que lantique serment des sujets, famili er
toutes les royauts barbares et que les souverains de la dynastie du Wessex,
comme les Carolingiens, avaient pratiqu ? Si faible quappart, en ses
derniers temps, la monarchie anglo-saxonne, elle nen avait pas moins su
maintenir, seule entre toutes ses contemporaines, un impt p.595 qui, davoir
servi dabord payer ranon aux envahisseurs danois, puis les combattre,
avait tir son nom de Danegeld. Dans cette tonnante survivance, qui semble
bien supposer dans lle une circulation montaire moin s quailleurs anmie,
Marc BLOCH La socit fodale
407
les rois normands devaient trouver un instrument singulirement efficace.
Enfin, la persistance, en Angleterre, des anciennes cours dhommes libres,
associes, de tant de faons, au maintien de lordre public institution
germanique, sil en fut favorisa grandement le maintien, puis lextension
de la justice et de la puissance administrative royales.
La force de cette monarchie complexe ntait dailleurs que toute relative.
L aussi, les lments de dissociation demeuraient l uvre. Le service des
fiefs fut de plus en plus difficilement obtenu parce que, capable dexercer
quelque contrainte sur ses tenants en chef, le gouvernement royal ltait
beaucoup moins datteindre, travers eux, la masse des petits feudataires,
souvent rcalcitrants. Le baronnage fut presque constamment indocile. De
1135 1154, durant les longs troubles dynastiques du rgne dtienne,
ldification dinnombrables chteaux adultrins , lhrdit reconnue des
sheriffs, qui runissaient parfois plusieurs comts sous leur domination et
portaient eux-mmes le titre de comte, semblaient annoncer lirrsistible
pousse du morcellement. Cependant, aprs le redressement qui marqua le
rgne dHenri II, on verra les magnats, dans leurs rbellions, chercher
dsormais beaucoup moins dchirer le royaume qu le dominer. La classe
chevaleresque, de son ct, trouvait, dans les cours de comts, loccasion de
se grouper et de se donner des dlgus. La puissante royaut des conqurants
navait pas ananti tous les autres pouvoirs. Mais elle les avait forcs nagir,
ft-ce contre elle, que dans les cadres de ltat.
V. Les nationalits
Dans quelle mesure ces tats taient-ils aussi ou devinrent-ils des
nations ? Comme tout problme de psychologie collective, celui-ci exige que
lon distingue avec soin, non seulement les temps, mais aussi les milieux.
Ce ne fut point parmi les hommes les plus instruits que put natre le
sentiment national. Tout ce qui subsistait de culture un peu profonde se
rfugia, jusqu au XIIe sicle, dans une fraction du clerg. Or bien des raisons
dtournaient cette intelligentsia de partis pris quelle et volontiers traits de
prjugs : lusage du latin, langue internationale, avec les facilits de
communication intellectuelle qui en dcoulaient ; le culte, surtout, des grands
idaux de paix, de pit et dunit qui, humainement, semblaient se
concrtiser dans les images jumeles de Chrtient et dEmpire. Aquitain et
ancien dignitaire de lglise de Reims, ce double titre sujet du roi de France,
Gerbert ne croyait assurment trahir aucun devoir essentiel en se faisant, au
temps o lhritier de Charlemagne tait un Saxon, soldat dans le camp de
Csar (372). Pour dcouvrir les obscurs prludes de la nationalit, il faut se
tourner vers des milieux plus frustes et plus ports vivre dans le prsent ;
moins sans doute vers les masses populaires, dont aucun document dailleurs
p.596
Marc BLOCH La socit fodale
408
ne nous permet de deviner les tats dme, que du ct la fois des classes
chevaleresques et de cette partie du monde clrical qui, dinstruction
mdiocre, se bornait reflter, dans ses crits, avec plus de nettet daccent,
les opinions ambiantes.
Par raction contre lhistoriographie romantique, il a t de mode, chez
certains historiens plus rcents, de refuser aux premiers sicles du moyen ge
toute conscience de groupe, national ou ethnique. Ctait oublier que, sous la
forme navement brutale de lantagonisme contre ltranger, le horsin , de
pareils sentiments nexigent pas un bien grand raffinement desprit. Nous
savons aujourdhui quils se sont manifests, lpoque des invasions
germaniques, avec beaucoup plus de force que ne le croyait, par exemple,
Fustel de Coulanges. Dans la seule grande exprience de conqute que nous
offre lre fodale celle de lAngleterre normande , on les voit
clairement luvre. Lorsque le dernier fils de Guillaume, Henri Ier, eut, par
un geste en lui-mme caractristique, jug adroit dpouser une princesse
issue de lantique dynastie du Wessex de la droite ligne dAngleterre ,
disait un moine de Canterbury , les chevaliers normands, par drision, se
p.597 plurent affubler le couple royal de sobriquets saxons. Mais, clbrant ce
mme mariage, un demi-sicle environ plus tard, sous le rgne du petit-fils de
Henri et dEdith, un hagiographe crivait : Maintenant lAngleterre a un roi
de race anglaise ; elle trouve dans la mme race des vques, des abbs, des
barons, de braves chevaliers, issus de lune et lautre semence (373).
Lhistoire de cette assimilation, qui est celle mme de la nationalit anglaise,
ne saurait tre mme esquisse ici, dans un cadre trop restreint. Cest, en
dehors de tout fait de conqute, dans les limites de lancien Empire franc, au
nord des Alpes, quil faudra nous contenter de scruter la formation des entits
nationales la naissance, si lon veut, du couple France -Allemagne (374).
La tradition ici tait, bien entendu, lunit : tradition, vrai dire,
relativement rcente et quelque peu artificielle, dans son application
lEmpire carolingien tout entier ; plusieurs fois sculaire, par contre, et
appuye sur une relle communaut de civilisation, ds lors quil sagissait
seulement du vieux regnum Francorum. Quelque sensibles que pussent tre,
une fois atteintes les couches profondes de la population, les contrastes de
murs ou de langues, une mme aristocratie et un mme clerg avaient aid
les Carolingiens gouverner, depuis lElbe jusqu l Ocan, limmense tat.
Ces grandes familles encore, apparentes entre elles, avaient fourni, aprs 888,
aux royauts ou aux principauts issues du dmembrement, leurs chefs,
nationaux seulement en apparence. Des Francs se disputaient la couronne
dItalie ; un Bavarois avait ceint celle de Bourgogne ; un Saxon dorigine
peut-tre avec Eude , celle de France Occidentale. Comme, dans les
vagabondages que leur imposaient tantt la politique des rois, distributeurs
dhonneurs, tantt leurs propres ambitions, les magnats entranaient, leur
suite, toute une clientle, la classe des vassaux elle-mme participait ce
Marc BLOCH La socit fodale
409
caractre, si lon ose dire, supra -provincial. A juste titre, le dchirement de
840-843 avait donn aux contemporains le sentiment dune guerre ci vile.
Cependant, sous cette unit, subsistait le souvenir de groupements plus
anciens. Ce furent ceux-ci que, dans lEurope divise, on vit dabord se
raffirmer, dans une rciprocit de p.598 mpris ou de haine. Neustriens, du
haut de lorgueil que leur inspire la plus noble rgion du monde ,
empresss traiter les Aquitains de perfides et les Bourguignons de
poltrons ; la perversit des Francs son tour dnonce par les
Aquitains et la fraude souabe, par les Mosans ; bross par les Saxons, tous
beaux et qui jamais ne fuient, le noir tableau de la couardise thuringienne, des
rapineries alamanes et de lavarice bavaroise : il ne serait pas malais de
grossir dexemples, emprunts des crivains qui schelonnent de la fin du
IXe au dbut du XIe sicle, cette injurieuse anthologie (375). Pour des raisons
que lon connat dj, les oppositions de ce type furent, en Allemagne,
particulirement tenaces. Loin de servir les tats monarchiques, elles
menaaient leur intgrit. Le patriotisme du moine chroniqueur Widukind,
sous Otton Ier, ne manquait certes ni de ferveur, ni dintransigeance. Mais
ctait un patriotisme saxon, non allemand. De l, comment sopra le passage
la conscience de nationalits adaptes aux cadres politiques nouveaux ?
On ne saurait gure penser clairement une patrie anonyme. Or rien nest
plus instructif que la difficult o les hommes se trouvrent, longtemps, de
nommer les deux principaux tats que les partages avaient dcoups dans le
regnum Francorum. Tous deux taient des Frances . Mais les adjectifs
dOrientale et Occidentale, par o on se contenta longtemps de les distinguer,
ne constituaient pas pour une conscience nationale un support bien vocateur.
Quant aux tiquettes de Gaule et de Germanie que quelques crivains, de
bonne heure, cherchrent faire revivre, elles ne parlaient qu lesprit des
doctes. En outre, elles sappliquaient fort mal aux frontires nouvelles. Se
rappelant que Csar avait arrt la Gaule au Rhin, les chroniqueurs allemands
dsignaient volontiers de ce nom leurs propres provinces de la rive gauche.
Parfois, soulignant inconsciemment ce que les dlimitations avaient eu
originellement dartificiel, on saccrochait au souvenir du premier souverain
au profit duquel le royaume avait t taill pour leurs voisins, Lorrains ou
gens de par del, les Francs de lOuest restaient les hommes de Charles le
Chauve (Kerlinger, Carlenses), tout comme les Lorrains eux-mmes ceux de
lobscur Lothaire II. p.599 Longtemps la littrature allemande devait demeurer
fidle cette terminologie, probablement parce quil lui rpugnait de
reconnatre au peuple occidental le monopole du titre de Francs tout court ou
de Franais la Chanson de Roland emploie encore indiffremment les deux
termes , auquel tous les tats successeurs semblaient avoir un droit lgal.
Que cette restriction de sens pourtant se soit finalement produite, chacun
le sait. Au temps mme du Roland, le chroniqueur lorrain Sigebert de
Gembloux la tenait pour gnralement admise (376). Comment eut-elle lieu ?
Cest, encore beaucoup trop mal tudie, la grande nigme de notre nom
Marc BLOCH La socit fodale
410
national. Lhabitude semble stre implante au temps o, en face du royaume
de lEst gouvern par des Saxon s, celui de lOuest tait revenu lauthentique
dynastie franque, la race carolingienne. Elle trouva un appui dans la titulature
royale elle-mme. Par contraste avec ses rivaux qui, dans leurs diplmes, ne
se dnommaient que rois, sans plus, et afin, prcisment, de signifier avec
clat sa dignit dhritier de Charlemagne, Charles le Simple, aprs avoir
conquis la Lorraine, avait relev le vieux titre de rex Francorum. Ses
successeurs, bien quils ne rgnassent plus que sur notre France et lors mme
quil s avaient cess dappartenir lancienne ligne, continurent, de plus en
plus gnralement, sen parer. Ajoutez quen Allemagne le mot de Francs,
face aux autres groupes ethniques, conservait presque forcment un caractre
particulariste : il y servait, en effet, couramment dsigner les gens des
diocses ripuaires et de la valle du Main nous disons, aujourdhui,
Franconie et un Saxon, par exemple, net gure accept de se laisser
qualifier ainsi. De lautre ct de la frontire, au contraire, il sappliquait sans
difficults, sinon toutes les populations du royaume, du moins aux habitants
de ce pays dentre Loire et Meuse dont les coutumes et les institutions
demeuraient si profondment marques de lempreinte franque. Enfin la
France de lOues t sen vit dautant plus aisment rserver lemploi que lautre
France tait en voie de se donner, issu dune ralit entre toutes sensible, un
nom bien diffrent.
Entre les hommes de Charles et ceux du royaume de lEst, un
contraste trs frappant se marquait. Ctait en dpit des diffrences
dialectales, lintrieur de chaque groupe une antithse linguistique. Dune
part, les Francs romans ; de lautre, les Francs thiois . Par ce dernier
mot, conformment lusage mdival, je trad uis ladjectif dont est issu
lallemand actuel deutsch et qualors les clercs, en leur latin bourr de
rminiscences classiques, rendaient volontiers, au mpris de toute tymologie,
par teuton . Lorigine nen souffre point de doute. La theotisca lingua, dont
parlaient les missionnaires de lpoque carolingienne, ntait rien dautre, au
sens propre, que la langue du peuple (thiuda), oppose au latin dglise ;
peut-tre aussi la langue des paens, des gentils . Or, le terme de
Germain, plus savant que populaire, ayant, par ailleurs, toujours t dpourvu,
dans la conscience commune, de racines profondes ltiquette, ainsi cre
pour dsigner un mode dexpression, passa trs rapidement la dignit dun
nom ethnique : le peuple parlant thiois , dit dj, sous Louis le Pieux, le
prologue dun des plus anciens pomes rdigs en ce langage. De l dsigner
une formation politique, le pas tait ais franchir. Lusage, probablement,
sy dcida bien avant que les crivains nosassent accorder droit de cit un
tour si peu conforme lhistoriographie traditionnelle. Ds 920, pourtant, des
annales salzbourgeoises mentionnent le royaume des Thiois (ou Teutons) (377).
p.600
Peut-tre cette aventure smantique ne laissera-t-elle point dtonner les
personnes qui, dans lattachement aux faits de langue, inclinent voir une
effervescence rcente de la conscience nationale. Largument linguistique,
Marc BLOCH La socit fodale
411
cependant, aux mains des politiques, nest pas daujourdhui. Au X e sicle un
vque lombard, sindignant des prtentions historiquement trs fondes
des Byzantins sur lApulie, ncrivait -il pas : que ce pays appartienne au
royaume dItalie, la langue de ses habitants en est la preuve (378) ? Non
seulement lusage de moyens dexpression communs rend toujours les
hommes plus proches les uns des autres et manifeste, en mme temps quil en
cre de nouvelles, les similitudes des traditions mentales. Chose plus sensible
encore des mes p.601 encore rudes : lopp osition des langages entretenait le
sentiment des diffrences, source elle-mme dantagonismes. Un moine
souabe, au IXe sicle, notait dj que les Latins tournaient en drision les
mots germaniques, et ce fut de moqueries sur leurs idiomes respectifs que
naquit, en 920, entre les escortes de Charles le Simple et de Henri Ier, une rixe
assez sanglante pour avoir mis fin lentrevue des deux souverains (379). Aussi
bien, lintrieur mme du royaume de lOuest, la curieuse vo lution, encore
mal explique, qui dans le gallo-roman avait provoqu la formation de deux
groupes de parlers distincts, fit que pendant de longs sicles les
Provenaux ou gens de Languedoc, sans possder, le moins du monde,
lunit politique, eurent ne ttement le sentiment de constituer une collectivit
bien part. De mme, lors de la seconde croisade, on vit les chevaliers
lorrains, sujets de lEmpire, se rapprocher des Franais, dont ils entendaient et
parlaient le langage (380). Rien de plus absurde que de confondre la langue
avec la nationalit. Mais il ne le serait pas moins de nier son rle dans la
cristallisation des consciences nationales.
Que celles-ci sagissant de la France et de lAllemagne apparaissent
dj trs clairement formes vers les alentours de lan 1100, les textes ne
permettent pas den douter. Durant la premire croisade, Godefroi de
Bouillon, qui, grand seigneur lotharingien, parlait, heureusement pour lui, les
deux langues, eut fort faire pour apaiser lhostilit, dj, nous dit -on,
traditionnelle, des chevaleries franaise et thioise(381). La douce France de
la Chanson de Roland est prsente toutes les mmoires : France encore un
peu incertaine dans ses limites, aisment confondue avec le gigantesque
Empire dun Charlemagne de lgende, mais dont le cur se plaait
nanmoins, de toute vidence, dans le royaume captien. Aussi bien dtre
ainsi comme dor par le souvenir carolingien lemploi du nom de France
favorisant lassimilation, et la lgende, son tour, aidant fixer le nom ,
lorgueil national, chez des hommes volontiers enivrs de conqutes, recevait
une vigueur plus grande. Les Allemands, dautre part, tiraient une grande
fiert dtre demeurs le peuple imprial. La loyaut monarchique p.602
contribuait entretenir ces sentiments. Il est significatif que leur expression
fasse peu prs compltement dfaut dans les pomes piques dinspiration
purement baronale, comme le cycle des Lorrains. Nimaginons p oint
cependant une confusion totale. Patriote fervent, le moine Guibert, qui, sous
Louis VI, donna son rcit de la croisade le titre fameux de Gesta Dei per
Francos, ntait quun bien tide admirateur des Captiens. La nationalit se
Marc BLOCH La socit fodale
412
nourrissait dappor ts plus complexes : communaut de langue, de tradition, de
souvenirs historiques plus ou moins bien compris ; sens du destin commun
quimposaient des cadres politiques dlimits fort au hasard, mais dont chacun
rpondait pourtant, en son ensemble, des affinits profondes et dj vieilles.
Tout cela, le patriotisme ne lavait pas cr. Mais au cours de ce second
ge fodal, caractris la fois par le besoin que les hommes prouvaient de
se grouper en collectivits plus larges et par la plus claire conscience que, de
toutes faons, la socit prenait delle -mme, il fut de ces ralits latentes
comme la manifestation enfin explicite et, par l, son tour cratrice de
ralits nouvelles. Dj, dans un pome un peu postrieur au Roland, nul
Franais ne vaut mieux que lui , dit-on pour vanter un chevalier
particulirement digne destime (382). Lpoque dont nous cherchons retracer
lhistoire profonde ne vit pas seulement se former les tats. Elle vit aussi se
confirmer ou se constituer voues encore bien des vicissitudes les
patries.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
413
LIVRE TROISIME :
La fodalit comme type social et son action
CHAPITRE PREMIER
La fodalit comme type social
I. Fodalit ou fodalits : singulier ou pluriel ?
Aux yeux de Montesquieu, ltablissement des lois fodales en
Europe tait un phnomne unique en son genre, un vnement arriv une
fois dans le monde et qui narrivera peut -tre jamais . Moins rompu, sans
doute, la prcision des dfinitions juridiques, mais curieux dhorizons plus
larges, Voltaire protesta : La fodalit nest point un vnement ; cest une
forme trs ancienne qui subsiste dans les trois quarts de notre hmisphre,
avec des administrations diffrentes (383). La science, de nos jours, sest
gnralement rallie au parti de Voltaire. Fodalits gyptienne, achenne,
chinoise, japonaise : autant dalliances de mots et jen passe dsormais
familires. Aux historiens de lOccident elles ne laissent pas dins pirer parfois
de discrtes inquitudes. Car ils ne sauraient ignorer la diversit des
dfinitions dont ce fameux nom, sur son sol natal mme, a t lobjet. La base
de la socit fodale, a dit Benjamin Gurard, est la terre. Cest le groupe
personnel, rplique Jacques Flach. Les fodalits exotiques, dont lhistoire
universelle apparat aujourdhui toute parseme, le sont -elles selon Gurard ?
ou selon Flach ? A ces quivoques, point dautre remde que de reprendre le
problme ses prmices. Puisque, de toute vidence, tant de socits, spares
par le temps et par lespace, nont reu le nom de fodales quen raison de
leurs similitudes, vritables ou p.604 supposes, avec notre fodalit nous, les
caractres de ce cas type, plac ainsi comme au centre dun vaste systme de
rfrences, sont ce quil importe avant tout de dgager. Non, toutefois, sans
quaient t pralablement carts quelques emplois, manifestement abusifs,
dune expression trop sonore pour ne pas avoir subi bien des dviations.
p.603
Marc BLOCH La socit fodale
414
Dans le rgime quils baptisrent fodalit, ses premiers parrains, nous le
savons, percevaient avant tout ce quil eut dantithtique la notion dun tat
centralis. De l qualifier ainsi tout morcellement des pouvoirs sur les
hommes, la distance tait courte. Dautant qu la simple constatation dun
fait un jugement de valeur venait, ordinairement, se mler. La souverainet
dun tat assez vaste tant conue comme la rgle, toute atteinte ce principe
paraissait se classer dans lanormal. Cela seul suffir ait condamner un usage
qui, dailleurs, ne saurait quengendrer un insupportable chaos. Parfois, la
vrit, une notation plus prcise sentrevoit. Ds 1783, un modeste agent
municipal, le hallier de Valenciennes, dnonait comme responsable du
renchrissement des denres une fodalit de gros propritaires
campagnards (384). Que de polmistes, depuis lors, ont vou aux gmonies
les fodalits bancaires ou industrielles ! Charg de rminiscences
historiques plus ou moins vagues, le mot semble, sous certaines plumes,
nvoquer rien de plus que la brutalit du commandement ; mais souvent
aussi, dune faon moins lmentaire, lide dun empitement des puissances
conomiques sur la vie publique. Or il est bien vrai, en effet, que la confusion
de la richesse alors principalement terrienne avec lautorit fut un des
traits marquants de la fodalit mdivale. Mais ctait moins en raison des
caractres proprement fodaux de cette socit que parce quelle tait, en
mme temps, fonde sur la seigneurie.
Fodalit, rgime seigneurial la confusion, cette fois, remonte
beaucoup plus haut. Elle stait produite dabord dans lemploi du mot de
vassal . Lempreinte aristocratique que ce terme avait reue dune
volution en somme secondaire ntait pas si forte quon ne lait vu, ds le
moyen ge, appliqu parfois, soit des serfs, primitivement bien p.605
proches des vassaux proprement dits par la nature personnelle de leur
dpendance , soit mme de simples tenanciers. Ce qui ntait alors quune
sorte daberration smantique, frquente surtout dans des rgions assez
incompltement fodalises comme la Gascogne ou le Len, devint, mesure
que seffaait la conscience du lien authentiquement vassalique, un usage de
plus en plus gnralement rpandu. Il est connu de tout le monde , crit, en
1786, Perreciot, que les sujets des seigneurs sont communment appels en
France leurs vassaux (385). Paralllement, on prit lhabitude de dsigner, en
dpit de ltymologie, sous le nom de droits fodaux les charges qui
pesaient sur les tenures paysannes : si bien quen annonant leur intention de
dtruire la fodalit, ctait, avant tout, la seigneurie rurale que les hommes
de la Rvolution entendaient sattaquer. Mais ici encore lhistorien doit ragir.
lment essentiel de la socit fodale, la seigneurie, en elle-mme, tait plus
ancienne ; et elle devait tre beaucoup plus durable. Il importe une saine
nomenclature que les deux notions demeurent clairement distinctes.
De la fodalit europenne, au sens juste, cherchons donc rassembler,
grands traits, ce que nous a appris son histoire.
Marc BLOCH La socit fodale
415
II. Les caractres fondamentaux de la fodalit europenne
Le plus simple sera sans doute de commencer par dire ce que cette socit
ntait pas. Bien que les obligations nes de la parent y fussent conues
comme trs vigoureuses, elle ne se fondait pas tout entire sur le lignage. Plus
prcisment, les liens proprement fodaux navaient de raison d tre que parce
que ceux du sang ne suffisaient pas. Dautre part, malgr la persistance de la
notion dune autorit publique superpose la foule des petits pouvoirs, la
fodalit concida avec un profond affaiblissement de ltat, notamment dans
sa fonction protectrice. Mais la socit fodale ntait pas seulement diffrente
et dune socit de parentles et dune socit domine par la force de ltat.
Elle venait aprs des socits ainsi constitues et portait leur empreinte. Les
rapports de dpendance personnelle qui la p.606 caractrisaient gardaient
quelque chose de la parent artificielle quavait t, beaucoup dgards, le
primitif compagnonnage et, parmi les droits de commandement exercs par
tant de menus chefs, une bonne part faisaient figure de dpouilles arraches
des puissances rgaliennes .
Cest donc comme le rsultat de la brutale dissolution de socits plus
anciennes que se prsente la fodalit europenne. Elle serait, en effet,
inintelligible sans le grand bouleversement des invasions germaniques qui,
forant se fusionner deux socits originellement places des stades trs
diffrents de lvolution, rompit les cadres de lune comme de lautre et fit
revenir la surface tant de modes de pense et dhabitudes sociales dun
caractre singulirement primitif. Elle se constitua dfinitivement dans
latmosphre des dernires rues barbares. Elle supposait un profond
ralentissement de la vie de relations, une circulation montaire trop atrophie
pour permettre un fonctionnariat salari, une mentalit attache au sensible et
au proche. Quand ces conditions commencrent changer, son heure
commena de passer.
Elle fut une socit ingale, plutt que hirarchise : de chefs, plutt que
de nobles ; de serfs, non desclaves. Si lesclav age ny avait pas jou un rle
aussi faible, les formes de dpendance authentiquement fodales, dans leur
application aux classes infrieures, nauraient pas eu lieu dexister. Dans le
dsordre gnral, la place de laventurier tait trop grande, la mmoir e des
hommes trop courte, la rgularit du classement social trop mal assure pour
permettre la stricte constitution de castes rgulires.
Pourtant, le rgime fodal supposait ltroite sujtion conomique dune
foule dhumbles gens envers quelques puissa nts. Ayant reu des ges
antrieurs la villa dj seigneuriale du monde romain, la chefferie de village
germanique, il tendit et consolida ces modes dexploitation de lhomme par
lhomme et, joignant en un inextricable faisceau le droit la rente du sol avec
le droit au commandement, fit de tout cela vritablement la seigneurie. Au
profit dune oligarchie de prlats ou de moines, chargs de rendre le Ciel
Marc BLOCH La socit fodale
416
propice. Au profit, surtout, dune oligarchie de guerriers. p.607 Quen effet,
parmi les caractres distinctifs des socits fodales, on doive ranger la quasiconcidence tablie entre la classe des chefs et une classe de guerriers
professionnels, servant de la seule faon qui alors part efficace, cest --dire
en cavaliers lourdement arms, la plus rapide des enqutes comparatives suffit
le montrer. Nous lavons vu : les socits o subsista une paysannerie
arme, tantt ignorrent larmature vassalique, comme celle de la seigneurie,
tantt de lune et lautre ne connurent que des formes trs imparfait es : ainsi
en Scandinavie, par exemple, ou dans les royaumes du groupe asturo-lonais.
Le cas de lEmpire byzantin est peut -tre plus significatif encore, parce que
les institutions y portrent la marque dune pense directrice beaucoup plus
consciente. L, depuis la raction anti-aristocratique du VIIe sicle, un
gouvernement, qui avait conserv les grandes traditions administratives de
lpoque romaine et que proccupait, dautre part, le besoin de se donner une
arme solide, cra des tenures charges, envers ltat, dobligations
militaires : vrais fiefs en un sens, mais la diffrence de lOccident, fiefs de
paysans, constitus chacun par une modeste exploitation rurale. Les
souverains, dsormais, nauront pas de souci plus cher que de protger ces
biens de soldats , comme dailleurs les petits possesseurs en gnral, contre
laccaparement par les riches et les puissants. Vint cependant, vers la fin du
XIe sicle, le moment o lEmpire, dbord par les conditions conomiques
qui des paysans constamment endetts rendaient lautonomie de plus en plus
difficile, affaibli aussi par des dissensions intrieures, cessa dtendre sur les
libres exploitants aucune protection utile. Il ny perdit pas seulement de
prcieuses ressources fiscales. Il tomba, du mme coup, la merci des
magnats, seuls capables, dsormais, de lever, parmi leurs dpendants, les
troupes ncessaires.
Dans la socit fodale, le lien humain caractristique fut lattache du
subordonn un chef tout proche. Dchelon en chelon, les nu ds ainsi
forms joignaient, comme par autant de chanes indfiniment ramifies, les
plus petits aux plus grands. La terre mme ne semblait une richesse si
prcieuse que parce quelle permettait de se procurer des p.608 hommes , en
les rmunrant. Nous voulons des terres, disent, en substance, les seigneurs
normands, qui refusent les cadeaux de bijoux, darmes, de chevaux offerts par
leur duc. Et ils ajoutent entre eux : il nous sera ainsi possible dentretenir de
nombreux chevaliers et le duc ne le pourra plus (386).
Restait crer une modalit de droits fonciers approprie la rcompense
des services et dont la dure se modelt sur celle mme du dvouement. De la
solution quelle sut trouver ce problme, la fodalit occ identale tira un de
ses traits les plus originaux. Alors que les gens de service groups autour des
princes slaves continuaient recevoir de lui leurs domaines en pur don, le
vassal franc, aprs quelques ttonnements, ne se vit plus octroyer que des
fiefs, en principe viagers. Car, dans les classes les plus leves, distingues
par lhonorable devoir des armes, les relations de dpendance avaient revtu,
Marc BLOCH La socit fodale
417
lorigine, la forme de contrats librement consentis, entre deux vivants, placs
face face. De la ncessit de ce contact personnel, elles tirrent toujours le
meilleur de leur valeur morale. De bonne heure, cependant, divers lments
taient venus ternir la puret de lobligation : lhrdit, naturelle dans une
socit o la famille demeurait si vigoureusement constitue ; la pratique du
chasement qui, impose par les conditions conomiques, aboutissait
charger la terre de services plutt que lhomme de fidlit ; la pluralit des
hommages, enfin et surtout. La loyaut du commend restait, dans beaucoup
de cas, une grande force. Mais comme ciment social par excellence, appel
unir, de haut en bas, les divers groupes, prvenir le morcellement et
enrayer le dsordre, elle se manifesta dcidment inefficace.
A dire vrai, dans limmense porte d onne ces liens, il y avait eu, ds le
principe, une part dartificiel. Leur gnralisation fut aux temps fodaux le
legs dun tat moribond celui des Carolingiens , qui leffritement
social avait imagin dopposer une des institutions nes de cet e ffritement
mme. Par lui-mme, ltagement des dpendances ntait sans doute pas
incapable de servir, en effet, la cohsion de ltat. Tmoin, la monarchie
anglo-normande. Mais il y p.609 fallait une autorit centrale seconde, comme
en Angleterre, moins encore par la conqute seule que par la concidence,
avec celle-ci, de conditions matrielles et morales nouvelles. Au IXe sicle, la
pousse vers la dispersion tait trop forte.
Dans laire de la civilisation occidentale, la carte de la fodalit offre
quelques larges vides : pninsule scandinave, Frise, Irlande. Peut-tre est-il
plus important encore de constater que lEurope fodale ne fut pas tout entire
fodalise au mme degr ni selon le mme rythme et, surtout, quelle ne le
fut nulle part compltement. En aucun pays, la population rurale ne tomba,
totalement, dans les liens dune dpendance personnelle et hrditaire.
Presque partout bien quen nombre extrmement variable selon les rgions
, il subsista des alleux, grands ou petits. La notion de ltat ne disparut
jamais absolument et, l o elle conserva le plus de force, des hommes
persistrent sappeler libres , au sens ancien du mot, parce quils ne
dpendaient que du chef du peuple ou de ses reprsentants. Des groupes de
paysans guerriers se maintinrent en Normandie, dans lAngleterre danoise, en
Espagne. Le serment mutuel, antithtique aux serments de subordination,
vcut dans les institutions de paix et triompha dans les communes. Sans doute
est-il dans la destine de tout systme di nstitutions humaines de ne jamais se
raliser quimparfaitement. Dans lconomie europenne du dbut du X Ie
sicle, place incontestablement sous le signe du capitalisme, plus dune
entreprise ne continuait-elle pas dchapper ce schma ?
Entre Loire et Rhin et dans la Bourgogne des deux rives de la Sane, un
espace fortement ombr, quau X Ie sicle les conqutes normandes largiront
brusquement vers lAngleterre et lItalie du Sud ; tout autour de ce noyau
central des teintes presque rgulirement dgrades, jusqu atteindre en Saxe
et, surtout, en Len et Castille un extrme espacement des traits : voil, peu
Marc BLOCH La socit fodale
418
prs, sous quel aspect se prsenterait, cercle de ses blancs, la carte fodale
que nous commencions tout lheure dimaginer. Dans la zone la plus
nettement marque, il nest pas difficile de reconnatre les contres o
linfluence de la rgularisation carolingienne avait t la plus profonde, o
aussi le mlange, plus pouss p.610 quailleurs, des lments romaniss et des
lments germains avait, sans doute, le plus compltement disloqu larmature
des deux socits et permis le dveloppement de germes particulirement
anciens de seigneurie terrienne et de dpendance personnelle.
III. Une coupe travers lhistoire compare
Sujtion paysanne ; la place du salaire, gnralement impossible, large
emploi de la tenure-service, qui est, au sens prcis, le fief ; suprmatie dune
classe de guerriers spcialiss ; liens dobissance et de protection qui
attachent lhomme lhomme et, dans cette classe guerrire, revtent la forme
particulirement pure de la vassalit ; fractionnement des pouvoirs, gnrateur
de dsordre ; au milieu de tout cela, cependant, la survivance dautres modes
de groupement, parentle et tat, dont le dernier devait, durant le second ge
fodal, reprendre une vigueur nouvelle : tels semblent donc tre les traits
fondamentaux de la fodalit europenne. Comme tous les phnomnes
dcels par cette science de lternel changement quest lhistoire, la structure
sociale ainsi caractrise porta certainement lempreinte originale dun temps
et dun milieu. De mme, cependant, que le clan filiation fminine ou
agnatique ou encore que certaines formes dentreprises conomiques se
retrouvent peu prs semblables dans des civilisations fort diverses, il nest
pas impossible, en soi, que des civilisations diffrentes de la ntre naient
travers un stade approximativement analogue celui qui vient dtre dfini.
Si cela est, elles mriteront, durant cette phase, le nom de fodales. Mais le
travail de comparaison ainsi compris excde visiblement les forces dun seul
homme. Je me bornerai donc un exemple, capable de suggrer, au moins,
lide de ce que, conduite par des mains plus sres, pourrait donner une
pareille recherche. La tche sera facilite par dexcellentes tudes, marques
dj au coin de la plus saine mthode comparative.
Dans les lointains de lhistoire du Japon, ce quon entrevoit, cest une
socit de groupes consanguins, ou censs tels. Puis vient, vers la fin du VIIe
sicle de notre re, sous p.611 linfluence chinoise, linstauration dun rgime
dtat qui, tout comme nos Carolingiens, sefforce une sorte de patronat
moral des sujets. Enfin souvre partir du XIe sicle ou environ la
priode que lon a pris lhabitude dappeler fodale et dont lavnement
semble bien, selon un schma que nous connaissons dj, avoir concid avec
un certain ralentissement des changes conomiques. Ici donc, comme en
Europe, la fodalit aurait t prcde par deux structures sociales trs
diffrentes. Comme chez nous galement, elle conserva profondment
Marc BLOCH La socit fodale
419
lempreinte de lune et de lautre. Plus trangre, on la vu, quen Europe
ldifice proprement fodal puisque les filires dhommages sarrtaient
avant datteindr e lEmpereur , la monarchie subsista, en droit, comme la
source thorique de toute puissance ; et, l aussi, le morcellement des droits de
commandement, qui se nourrissait dhabitudes trs anciennes, se prsenta
officiellement comme une suite dempitemen ts sur ltat.
Au-dessus de la paysannerie, une classe de guerriers professionnels stait
leve. Ce fut dans ce milieu que, sur le modle donn par les rapports du
suivant darmes avec son chef, se dvelopprent les dpendances
personnelles, affectes ainsi, semble-t-il, ds lorigine, dun caractre de
classe beaucoup plus accentu que la commendise europenne. Elles
taient, de mme quen Europe, hirarchises. Mais la vassalit japonaise fut,
beaucoup plus que la ntre, un acte de soumission et beaucoup moins un
contrat. Elle fut beaucoup plus rigoureuse aussi, puisquelle nadmettait pas la
pluralit des seigneurs. Comme il fallait entretenir ces guerriers, des tenures,
qui ressemblaient beaucoup nos fiefs, leur furent distribues. Parfois, mme,
linstar de nos fiefs de reprise , loctroi, purement fictif, portait en ralit
sur des terres qui avaient originellement appartenu au patrimoine du prtendu
donataire. Ces combattants consentirent naturellement de moins en moins
volontiers cultiver le sol. A quelques exceptions prs, toutefois. Car au
Japon, aussi, il y eut jusquau bout des cas aberrants de vavasseurs
paysans. Les vassaux vcurent donc surtout des rentes de leurs propres
tenanciers. Leur masse cependant tait trop nombreuse beaucoup plus,
apparemment, quen Europe p.612 pour permettre la constitution, leur
profit, de vraies seigneuries, avec de forts pouvoirs sur les sujets. Il ne sen
forma gure quaux mains du baronat et des temples. Encore, passablement
disperses et dpourvues de rserves dexploitation directe, rappelaient -elles
plutt les seigneuries embryonnaires de lAngleterre anglo -saxonne que celles
des rgions vraiment seigneurialises de lOccident. Aussi bien, sur ce sol o
les rizires irrigues reprsentaient la culture dominante, les conditions
techniques taient-elles trop diffrentes des pratiques europennes pour que la
sujtion paysanne ne revtt pas, elle aussi, des formes originales.
Bien trop sommaire, assurment, et, dans lapprciation des con trastes
entre les deux socits, insuffisamment nuance, cette esquisse nen permet
pas moins, semble-t-il, une conclusion assez ferme. La fodalit na pas t
un vnement arriv une fois dans le monde . Comme lEurope bien
quavec dinvitables et profondes diffrences le Japon traversa cette
phase. Dautres socits ont -elles galement pass par elle ? Et, sil en a t
ainsi, sous laction de quelles causes, peut -tre communes ? Cest le secret des
travaux futurs. On serait heureux si ce livre, en proposant aux chercheurs un
questionnaire, pouvait prparer les voies une enqute qui le dpassera de
beaucoup.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
420
CHAPITRE II
Les prolongements de la fodalit europenne
I. Survivances et rviviscences
Depuis le milieu du XIIIe sicle les socits europennes scartrent
dfinitivement du type fodal. Cependant, simple moment dune volution
continue au sein de groupements dous de mmoire, un systme social ne
saurait mourir tout entier ni dun coup. La fodalit eut ses prolongements.
p.613
Longtemps le rgime seigneurial, quelle avait marqu de son empreinte,
lui survcut. Parmi bien des vicissitudes, dailleurs, qui ne nous appartiennent
pas ici. Comment cependant ne pas observer que, cessant dtre insr dans
tout un rseau dinstituti ons de commandement qui lui taient troitement
apparentes, il ne pouvait manquer, aux yeux des populations sujettes, de
paratre de plus en plus inintelligible et, par suite, plus odieux ? De toutes les
formes de la dpendance lintrieur de la seigneu rie, la plus authentiquement
fodale avait t le servage. Profondment transform, devenu plus terrien que
personnel, il subsista, nanmoins, en France, jusqu la veille de la
Rvolution. Qui se souvenait alors que, parmi les mainmortables, il sen
trouvait assurment dont les anctres staient commends eux-mmes
un dfenseur ? Et ce lointain souvenir, sil avait t connu, aurait -il rendu plus
lgre une condition anachronique ?
A lexception de lAngleterre, o la premire Rvolution du X IIe
sicle abolit toute distinction entre les fiefs de chevaliers et les autres tenures,
les obligations vassaliques et fodales, inscrites dans le sol, durrent soit,
comme en France, aussi longtemps que le rgime seigneurial, soit, comme
dans la Prusse qui, au XVIIIe sicle, procda lallodification gnrale des
fiefs, peine moins longtemps. Seuls capables, dornavant, dutiliser la
hirarchie des dpendances, les tats ne renoncrent que trs lentement tirer
parti de linstrument militaire que lle semblait leur mettre en main. Louis XIV
encore convoqua, plusieurs reprises, larrire -ban vassalique. Mais ce
ntait plus, de la part de gouvernements en mal de soldats, quune entreprise
dsespre, voire mme, par le jeu des amendes et des exemptions, un simple
expdient fiscal. Parmi les caractres du fief, seules les charges pcuniaires
qui pesaient sur lui et les rgles particulires sa succession conservaient
rellement, depuis la fin du moyen ge, une valeur pratique. Comme il ny
avait plus de vassaux domestiques, lhommage tait dsormais uniformment
attach la possession dune terre. Son aspect crmoniel, si vain quil pt
p.614
Marc BLOCH La socit fodale
421
sembler aux yeux de juristes forms par le rationalisme des temps
nouveaux (387), ne laissait pas indiffrente une classe nobiliaire naturellement
soucieuse dtiquette. Le rite mme, pourtant, charg jadis dun sens humain
si profond, ne servait plus gure outre les perceptions auquel parfois il
donnait lieu qu constater la mo uvance du bien, source de droits, selon les
coutumes, plus ou moins lucratifs. Essentiellement contentieuses, les
matires fodales occupaient la jurisprudence. Elles approvisionnrent de
beaux thmes de dissertations une foisonnante littrature de doctrinaires et de
praticiens. Que ldifice cependant ft bien vermoulu et les profits, quen
attendaient ses bnficiaires, de rapport en somme assez faible, rien ne le
montre mieux, en France, que son facile croulement. La disparition du
rgime seigneurial ne sopra quau prix de bien des rsistances et non sans
troubler gravement la rpartition des fortunes. Celle du fief et de la vassalit
parut linvitable et presque insignifiant aboutissement dune longue agonie.
Pourtant, dans une socit qui demeurait sujette bien des troubles,
les besoins qui avaient suscit les anciennes pratiques du compagnonnage,
puis du vasselage navaient point cess de faire sentir leurs effets. Parmi les
raisons diverses qui provoqurent la cration des ordres de chevalerie, fonds,
en si grand nombre, aux XIVe et XVe sicles, une des plus dcisives, sans
doute, fut le dsir que les princes prouvaient de sattacher, par un lien
particulirement astreignant, un groupe de fidles haut placs. Les chevaliers
de Saint-Michel, selon les statuts donns par Louis XI, promettaient au roi
bonne et vraye amour et de le servir loyalement dans ses justes guerres.
Tentative, dailleurs, aussi vaine que, jadis, celle des Carolingiens : sur la plus
ancienne liste des personnages honors du fameux collier, la troisime place
tait occupe par le conntable de Saint-Pol, qui si bassement devait trahir son
matre.
p.615
Plus efficace et plus dangereuse fut, durant les dsordres du moyen
ge finissant, la reconstitution de troupes de guerriers privs, fort proches des
vassaux satellites dont les crivains de lre mrovingienne avaient
dnonc les brigandages. Frquemment, leur dpendance sexprimait par le
port dun costume aux couleurs de leur seigneur de guerre ou ses armes.
Condamn en Flandre par Philippe le Hardi (388), cet usage semble avoir t
particulirement rpandu dans lAngleterre des derniers Plantagents, des
Lancastre et des York : si bien que les groupements ainsi forms autour des
hauts barons y reurent le nom de livres . Pas plus que la vassalit non
chase dautrefois, ils ne comprenaient uniquement des aventuriers de basse
naissance. La gentry leur fournit la plus grosse part sans doute de leurs
contingents. Lhomme avai t-il un procs ? Le lord le couvrait de son autorit,
devant le tribunal. Illgale, mais singulirement tenace, ainsi quen
tmoignent les interdictions rptes par les Parlements, cette pratique de la
maintenance ou soutien en justice reproduisait, presque trait pour trait,
lantique mithium que, dans la Gaule franque, le puissant avait tendu sur
son fidle. Et comme les souverains aussi trouvaient profit utiliser, sous sa
Marc BLOCH La socit fodale
422
forme neuve, lattache personnelle, on vit Richard II sefforcer de p.616
rpandre, travers le royaume, pareils autant de vassi dominici, ses suivants,
reconnaissables au blanc cur dont leur uniforme tait blasonn (389).
Dans la France mme des premiers Bourbons, le gentilhomme qui, pour se
pousser dans le monde, se faisait le domestique dun grand, noffrait -il pas
limage dune condition singulirement voisine de la primitive vassalit ?
Avec une force digne du vieux langage fodal, on disait de tel ou tel quil
tait M. le Prince ou au Cardinal. A dire vrai, le rite manquait. Mais
remplac souvent par un engagement crit. Car, depuis la fin du moyen ge, la
promesse damiti stait substitue lhommage dfaillant. Lisez ce
billet que, le 2 juin 1658, souscrivit Fouquet un certain capitaine
Deslandes. Je promets et donne ma foy Monseigneur le Procureur
Gnral... de nestre jamais autre personne qu luy, auquel je me donne et
mattache du dernier attachement que je puis avoir ; et je luy promets de le
servir gnralement contre toute personne sans exception et de nobir
personne qu luy, ni mesme davoir aucun commerce avec ceux quil me
dfendra... Je luy promets de sacrifier ma vie contre tous ceux quil luy
plaira... sans en excepter dans le monde un seul... (390). Ne croirait-on pas
entendre, travers les ges, lcho des plus pleines parmi les formules de
commendise : tes amis seront mes amis, tes ennemis seront mes ennemis ?
Sans mme la rserve au profit du roi !
En un mot, la vassalit authentique avait beau ne plus se survivre que
comme un assemblage de gestes vainement crmoniels et dinstitutions
juridiques jamais sclroses, lesprit qui lavait anime renaissait sans cesse
de ses cendres. Et sans doute ne serait-il gure malais de retrouver dans des
socits encore plus proches de nous les manifestations de sentiments et de
ncessits presque semblables. Mais ce ntaient plus l que des pratiques
sporadiques, particulires certains milieux, proscrites dailleurs par ltat
aussitt quelles semblaient le menacer, incapables, au total, de sunir en un
systme bien li et dimposer la structure sociale tout entire leur tonalit.
II. Lide guerrire et lide de contrat
Aux socits qui la suivirent, l re fodale avait lgu la chevalerie,
cristallise en noblesse. De cette origine, la classe dominante garda lorgueil
de sa vocation militaire, que symbolisait le droit au port de lpe. Elle sy
attacha avec une force particulire l o, comme en France, elle en tirait la
justification de prcieux avantages fiscaux. Les nobles ne doivent pas payer la
taille, exposent, vers 1380, deux cuyers de Varennes-en-Argonne ; car par
la noblesse, les nobles sont astreints dexposer leurs corps et chevances s
guerres (391). Sous lAncien Rgime, la noblesse de vieille extraction, par
opposition laristocratie des offices, persistait se dire dpe . Jusque
p.617
Marc BLOCH La socit fodale
423
dans nos socits o se faire tuer pour son pays a totalement cess dtre le
monopole dune classe ou dun mtier, le tenace sentiment dune sorte de
suprmatie morale lie la fonction du guerrier professionnel parti pris si
tranger dautres civilisations, telle que la chinoise demeure comme un
souvenir du partage opr, vers le dbut des temps fodaux, entre le rustre et
le chevalier.
Lhommage vassalique tait un vrai contrat, et bilatral. Le seigneur, sil
manquait ses engagements, perdait ses droits. Transporte, comme il tait
invitable, dans le domaine politique puisque les principaux sujets du roi
taient en mme temps ses vassaux , rejointe dailleurs sur ce terrain par les
trs antiques reprsentations qui, tenant le chef du peuple pour mystiquement
responsable du bien-tre de ses sujets, le vouaient au chtiment en cas de
malheur public, cette ide devait exercer une influence profonde. Dautant que
ces vieux courants se trouvrent ici sunir une autre source de pense, ne,
dans lglise, de la protestation grgorienne contre le mythe de la royaut
surnaturelle et sacre. Ce furent les crivains de ce groupe essentiellement
religieux qui exprimrent les premiers, avec une force longtemps ingale, la
notion dun contrat liant le souverain son peuple, comme le porcher au
matre qui lemploie , p.618 crivait, vers 1080, un moine alsacien. Propos
dont le sens apparat encore plus plein, une fois mis en regard du cri indign
dun partisan cependant assez modr de la monarchie : un oint du Seigneur
ne saurait pourtant tre rvoqu comme un maire de village ! Mais ces
doctrinaires du clerg eux-mmes ne manquaient pas dinvoquer, parmi les
justifications de la dchance laquelle ils condamnaient le mauvais prince, le
droit universellement reconnu au vassal dabandonner le mauvais
seigneur (392).
Surtout le passage laction vint des milieux de vassaux, sous linfluence
des institutions qui avaient form leur mentalit. En ce sens, il y avait, dans
tant de rvoltes qui, au premier abord, ne paraissent que dsordre, un principe
fcond : Lhomme peut rsister son roi et son juge, quand celui -ci agit
contre le droit et mme aider lui faire la guerre... Par l, il ne viole pas le
devoir de fidlit. Ainsi parle le Miroir des Saxons (393). Dj en germe dans
les Serments de Strasbourg de 843 et dans le pacte conclu, en 856, par Charles
le Chauve avec ses grands, ce fameux droit de rsistance retentit, aux XIIIe
et XIVe sicles, dun bout lautre du monde occidental, dans une foule de
textes issus, pour la plupart, tantt de la raction nobiliaire, tantt de
lgosme des bourgeoisies, et pourtant gros davenir : Grande Charte anglaise
de 1215 ; Bulle dor hongroise de 1222 ; coutumier du royaume de
Jrusalem ; privilge de la noblesse brandebourgeoise ; Acte dUnion
aragonais de 1287 ; charte brabanonne de Cortenberg ; statut delphinal de
1341 ; dclaration, en 1356, des communes du Languedoc. Ce ne fut point
hasard, assurment, si le rgime reprsentatif, sous la forme, trs
aristocratique, du Parlement anglais, des tats franais, des Stnde de
lAllemagne et des Corts espagnols, naquit dans des tats qui se dgageaient
Marc BLOCH La socit fodale
424
peine du stade fodal et en subissaient encore lempreinte ; si, par ailleurs,
dans le Japon, o la soumission vassalique tait beaucoup plus unilatrale et
qui, du reste, laissait le divin pouvoir de lEmpereur en dehors de ldifice des
hommages, rien de pareil ne sortit dun rgime pourtant, tant dgards, trs
voisin de notre fodalit. Dans cet accent, mis sur lide dune convention,
capable de lier les pouvoirs, p.619 rside loriginalit de notre fodalit nous.
Par l, si dur aux petits quait t ce rgime, il a vritablement lgu nos
civilisations quelque chose dont nous souhaitons vivre encore.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
425
NOTES
(1) Histoire de lancien gouvernement de la France avec XIV Lettres Historiques sur les
Parlemens ou tats-Gnraux. La Haye, 1727. La quatrime lettre a pour titre Dtail du
gouvernement fodal et de ltablissement des Fiefs (t. I, p. 286) et on y lit (p. 300) cette
phrase : Je me suis tendu dans lextrait de cette ordonnance, la croyant propre donner une
ide exacte de lancienne fodalit.
(2) Parmi les Franais dont la boutonnire se fleurit aujourdhui dun ruban ou dune rosette
rouges, combien savent quun des devoirs imposs leur ordre par sa constitution premire du
19 mai 1802 tait de combattre... toute entreprise tendant rtablir le rgime fodal ?
(3) Phdon, 109 b.
(4) Auctores Antiquissimi (Mon. Germ. ), t. XI, p. 362 ; WIDUKIND, I, 19.
(5) Tout ouvrage dhistoire, pour peu quil sadresse un public relativement tendu, po se
son auteur un problme pratique des plus troublants : celui des rfrences. Lquit et voulu,
peut-tre, que fussent multiplis, dans les notes, les noms des savants travaux sans lesquels ce
livre nexisterait pas. Quitte, cependant, encourir le d sobligeant reproche dingratitude, jai
cru pouvoir laisser la bibliographie, que lon trouvera la fin du volume, le soin de guider le
lecteur dans les chemins de la littrature rudite. Par contre je me suis fait une loi de ne jamais
citer un document sans donner tout travailleur un peu expriment le moyen de retrouver le
passage vis et den vrifier linterprtation. Si le renvoi manque, cest que les
renseignements fournis par lexpos lui -mme et, dans la publication dont le tmoignage est
tir, la prsence de tables bien conues suffisent rendre la recherche aise. Dans le cas
contraire, une note sert de flche indicatrice. A un tribunal, aprs tout, ltat civil des tmoins
importe beaucoup plus que celui des avocats.
(6) Cest le nom dont le village actuel de La Garde -Freinet conserve le souvenir. Mais, situe
au bord de la mer, la citadelle des Sarrasins ntait pas La Garde, qui se trouve dans
lintrieur.
(7) Le nom mme de Hongrois est probablement turc. De mme peut-tre, au moins dans un
de ses lments, celui de Magyar, qui semble dailleurs ne stre appliqu, originellement,
qu une tribu.
(8) LANTBERTUS, Vita Heriberti, c. I, dans SS. t. IV, p. 741.
(9) FLODOARD, Annales, 937.
(10) LON, Tactica, XVIII, 62.
(11) K. SCHNEMANN, Die Entstehung des Stdte wesens in Sdosteuropa, Breslau, s. d.,
p. 18-19.
(12) Sur les conditions, assez obscures, de lrection de la Hongrie en royaume, cf. P. E.
SCHRAMM, Kaiser, Rom und Renovatio, t. I, 1929, p. 153 et s.
(13) Lhistoire de la carte ethnique, dans lEurope extra-fodale , ne nous intresse pas
directement ici. Notons cependant que ltablissement hongrois, dans la plaine danubienne,
aboutit couper en deux le bloc slave.
(14) Les rapports de ces Gtar scandinaves avec les Goths, dont le rle fut si considrable
dans lhistoire des invasions germaniques, posent un problme dlicat et sur lequel laccord
est loin dtre fait entre les spcialistes.
Marc BLOCH La socit fodale
426
(15) Les Normands que les sources de provenance anglo-saxonne mettent parfois en scne
sont selon lusage mme des textes scandinaves les Norvgiens, opposs aux Danois
stricto sensu.
(16) ASSER, Life of king Alfred, d. W. H. Stevenson, 1904, c. 66.
(17) SHETELIG, Les origines des invasions des Normands (Bergens Museums Arbog,
Historisk-antikvarisk rekke, n 1), p. 10.
(18) Landnamabk, c. 303, 334, 344, 379.
(19) Deux interprtations, principalement, ont t proposes. Certains rudits font venir le mot
du scandinave vik, baie ; dautres voient en lui un driv du germanique commun wik,
dsignant un bourg ou un march. (Cf. le bas allemand Weichbild, droit urbain, et un grand
nombre de noms de lieux, tels que Norwich, en Angleterre, ou Brunswick Braunschweig
en Allemagne.) Dans le premier cas, le Viking et tir son nom des baies o il
sembusquait ; dans le second, des bourgs que tantt il frquentait en paisible commerant,
tantt il pillait. Aucun argument absolument dcisif na pu jusquici tre fourni, dans lun ou
lautre sens.
(20) R. POUPARDIN, Monuments de lhistoire des abbayes de Saint -Philibert, 1905, avec
l Introduction, et G. TESSIER, Bibliothque de lc. des Chartes , 1932, p. 203.
(21) King Alfreds old English version of Boethius , d. W. J. Sedgetield, XV.
(22) MONTELIUS, Sverige och Vikingafderna vsternt (La Sude et les expditions des
Vikings vers lOuest) dans Antikvarisk Tidskrift , t. XXI, 2, page 14 (plusieurs autres
exemples).
(23) Sur lnorme littrature relative au pome, ldition KLAEBER, 1928, suffira orienter.
La date est conteste, les critres linguistiques savrant dinterprtation singulirement
difficile. Lopinion avance dans le texte semble rpondre aux vraisemblances historiques :
Cf. SCHKING, Wann entstand der Beowulf ? dans Beitrge zur Gesch. der deutschen
Sprache t. XLII, 1917. Rcemment, M. RITCHIE GIRVAN (Beowulf and the seventh
century, 1935) sest efforc de reculer la rdaction jusquaux environs de 700. Mais il
nexplique pas lempreinte scandinave, si sensible dans le sujet lui -mme.
(24) M. PETIT-DUTAILLIS, La monarchie fodale, p. 63, considre comme vraisemblable
une entente entre les deux envahisseurs, qui auraient envisag un trait de partage.
Lhypothse est ingnieuse, mais elle nest gure susceptible de preuves.
(25) En mme temps, semble-t-il, que le Maine, dont la cession fut plus tard rvoque.
(26) Plus tard, sur divers points de la France, plusieurs familles seigneuriales prtendirent
avoir pour anctres des chefs normands : tels les seigneurs de Vignory et de la Fert-sur-Aube
(M. CHAUME, Les origines du duch de Bourgogne, t. I, p. 400 n. 4). Un rudit, M.
MORANVILL, a attribu la mme origine la maison de Roucy (Bibl. c. Chartes, 1922).
Mais les preuves certaines manquent.
(27) FLODOARD, Annales, 924 ( propos de Rgnvaid).
(28) GUILLAUME DE JUMIGES, Gesta, d. Marx, V, 12, p. 86.
(29) MABILLON, AA. SS. ord. S. Bened., saec. II, d. de 1733, t. II, p. 214. Landnamabk,
III, 14, 3.
(30) Saga dOlaf le Saint , c. LX. Cf. traduction SAUTREAU, 1930, p. 56.
(31) NORDENSTRENG, Die Zge der Wikinger, trad. L. MEYN, Leipzig, 1925, p. 19.
(32) Cartulaire de labbaye de Saint -Victor de Marseille, d. Gurard, n LXXVII.
Marc BLOCH La socit fodale
427
(33) Bibl. Nat., Baluze 76, fol. 99 (900, 14 sept. ).
(34) Ann. Bertiniani, 859 (avec la correction propose par F. LOT, Bibl. c. Chartes, 1908, p.
32, n. 2). REGINO DE PRM, 882. DUDON DE SAINT-QUENTIN, II, 22.
(35) King Alfreds West Saxon Version of Gregorys Pastoral Care , d. Sweet (E. E. S., 45),
p. 4.
(36) Cf. VERCAUTEREN, tude sur les cits de la Belgique seconde, Bruxelles, 1934, p.
371, n. 1 ; cf. pour Tournai, V. S. Amandi, III, 2 (Poetae aevi carol., t. III, p. 589).
(37) Memorie e documenti per servir allistoria del ducato di Lucca , t. V, 2, n 855.
(38) Testament du roi Aethelwulf, dans Assers Life of King Alfred , d. W. H. Stevenson, c.
16.
(39) R. POUPARDIN. Le royaume de Provence sous les Carolingiens, 1901 (Bibl. c. Hautes
tudes, Sc. histor., 131). L. DELISLE, Instructions adresses par le Comit des travaux
historiques... Littrature latine, 1890, p. 17. MURATORI, Antiquitates, 1738, t. I, col. 22.
(40) Capitularia, t. II, n 273, c. 31. F. LOT, dans Bibl. c. Chartes, 1915, p. 486.
CHAUME, Les origines du duch de Bourgogne, t. H, 2, pp. 468-469.
(41) JOLLIFFE, The constitutional history of medieval England, Londres, 1937, p. 102.
(42) Saga dOlaf le Saint , c. XX (trad. SAUTREAU, p. 24).
(43) ADMAR DE CHABANNES, Chronique, d. Chavanon, III, c. 44 (pour laventure de la
vicomtesse). SHETELIG, Vikingeminner i Vest Europa (Les souvenirs archologiques des
Vikings dans lEurope Occidentale), Oslo, 1933 (Instituttet for sammenlignende
kulturforksning, A, XVI), p. 242 (pour la prsence de contingents normands la bataille de
Clontarf).
(44) Ibid., III, c. 27.
(45) Cf. F. LOT, tudes critiques sur labbaye de Saint -Wandrille, 1913 (Bibl. c. Hautes
tudes, Sc. histor., fasc. 204), p. XIII et s. et p. L, n. 2.
(46) Lois dEdgar, IV, 2, 1.
(47) Pour le mot dreng STEENSTRUP, Normandiets Historie under de syv frste
Hertuger 911-1066 (avec un rsum en franais) dans Mmoires de lAcadmie royale des
sciences et des lettres de Danemark , 7e srie, Sect. des Lettres, t. V, n 1, 1925, p. 268. Pour
la lgislation de paix, YVER, Linterdiction de la guerre prive dans le trs ancien droit
normand (Extrait des travaux de la semaine dhistoire du droit normand), Caen, 1928. Il y a
encore profit lire larticle de K. AMIRA ( propos de STEENSTRUP, Normannerne, t. I) :
Die Anfnge des normannischen Rechts, dans Hist. Zeitschrift, t. XXXIX, 1878.
(48) Cest tort, je crois, que contrairement lopinion gnrale des rudits anglais, M.
JOLLIFFE se refuse reconnatre dans la charrue de lAngleterre du Nord -Est un effet
du bouleversement caus par linvasion scandi nave ; voir notamment The era of the folk, dans
Oxford Essays in medieval history presented to H. E. Salter, 1934.
(49) Cf. ALLEN MAWER, The redemption of the five boroughs, dans Engl. Hist. Rev., t.
XXXVIII, 1923.
(50) MONTELIUS, Sverige Och Vikingafderna vsternt (La Sude et les expditions des
Vikings vers lOuest), p. 20.
(51) E.-H. DUPRAT, A propos de litinraire maritime : I, Citharista, La Ciotat, dans Mm.
de lInstitut Historique de Provence, t. IX, 1932.
(52) Ep. 16, (Monum. Germ., E. E., t. IV), p. 42.
Marc BLOCH La socit fodale
428
(53) Sur cette lenteur du dveloppement maritime de lAngleterre, cf. F. LIEBERMANN,
Matrosenstellung aus Landgtern der Kirche London um 1000 dans Archiv fr das Studium
der neueren Sprachen, t. CIV, 1900. La bataille navale livre, en 851, par les gens du Kent est
un fait isol ; aussi bien sur ce secteur du littoral les relations avec les ports, tout proches, de
la Gaule, avaient sans doute entretenu une vie maritime moins ralentie quailleurs.
(54) Prolgomnes, trad. SLANE, t. I, p. 291. Sur les Mongols, voir les fines observations de
GRENARD, dans Annales dhist. conom ., 1931, p. 564 ; je lui emprunte quelques
expressions.
(55) Monuments de lhistoire des abbayes de Saint -Philibert, d. Poupardin, p. 62.
(56) Cf., par exemple, L. LVY-BRUHL, La mentalit primitive, p. 377.
(57) Analecta Bollandiana, 1883, p. 71.
(58) MIGNE, P. L., t. CXXXI, col. 966.
(59) Analecta Bollandiana, 1883, p. 78.
(60) NITHARD, Histoire des fils de Louis le Pieux, d. Lauer, II, c. 8.
(61) LOUP DE FERRIRES, Correspondance, d. Levillain, t. I, n 41.
(62) Capitularia, t. II, n. 281, c. 25.
(63) Cf. E. FARAL, dans Revue critique, 1933, p. 454.
(64) Ep., n. 69, dans MIGNE, P. L., t. CXLI, col. 235.
(65) ASSER, Life of King Alfred, d. Stevenson, c. 104. Un systme semblable, en croire L.
REVERCHON, Petite histoire de lhorlogerie , p. 55, aurait encore t employ par Charles
V.
(66) GISLEBERT DE MONS, d. Pertz, pp. 188-189 (1188).
(67) P. VIOLLET, Les tablissements de Saint Louis, 1881-1886 (Soc. de lHist. de France),
t. III, p. 165, n. 8.
(68) Pastoral Care, d. Sweet, p. 6.
(69) GUNZO NOVARIENSIS dans MIGNE, P. L., t. CXXXVI, col. 1286.
(70) ADMAR DE CHABANNES, Chronique, d. Chavanon, III, c. 54. Lempereur Henri
III, dont il sera question plus bas, se faisait copier des manuscrits par les moines : Codex
epistolarum Tegernseenstum (Mon. Germ., Ep. selectae, t. III), n 122.
(71) MENENDEZ PIDAL, La Espaa del Cid, Madrid, 1929, pp. 590 et 619.
(72) Cf. O. HFLER, Kultische Geheimbnde der Germanen, t. I, 1934, p. 160.
(73) RABAN MAUR, De Universo libri XXII, dans MIGNE, P. L., t. CXI, col. 12.
(74) HELMOLD, Chronica Slavorum, I, 55.
(75) Apologeticus, dans MIGNE, P. L., t. CXXXIX, col. 472.
(76) TARDIF, Cartons des rois, n 357. Diplom. regam et imperatorum Germaniae, t. I,
Otton Ier, n 366.
(77) WILMART, dans Revue Mabillon, t. XI, 1921.
(78) Cf. E. PERELS, Das Kaisertum Karls des Grossen in mittelalterlichen Geschichtsquellen
dans Sitzungsberichte der preussischen Akademie, phil-hist. Klasse, 1931.
(79) P. FOURNIER et G. Le BRAS, Histoire des collections canoniques, t. II, 1932. p. 338.
Marc BLOCH La socit fodale
429
(80) De civ. Dei, XVII, 1.
(81) Ch. E. PERRIN, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine daprs les plus
anciens censiers, p. 684.
(82) Huon de Bordeaux, d. Guessard et Grandmaison, p. 148.
(83) AIRELD DE RIEVAULX, Speculum charitatis, II, 17, dans MIGNE, P. L., t. CXCV,
col. 565.
(84) V. 1880-1882. Ces propos sont dautant plus frappants que la Chanson les met dans la
bouche dun archevque. Vi siblement la rforme grgorienne navait pas encore pass par l.
(85) Il nest pas impossible que dans le Couronnement de Louis on ne trouve, par exceptions,
quelques traces dutilisation de chroniques : Cf. SCHLADKO, dans Zeitschrift fr die
franzsische Sprache, 1931, p. 428.
(86) Prologue de la Thidreksaga ; cf. H. J. SEEGER, Westfalens Handel, 1926, p. 4.
(87) De perfectione monachorum, dans MIGNE, P. L., t. CXLV, col. 324.
(88) PIERRE DAMIEN, De elemosina, c. 7 dans MIGNE, P. L., t. CXLV, col. 220.
(89) Cf. F. LOT, dans Romania, 1928, p. 375 ; et, sur tout ce qui prcde, la srie darticles
publis par ce savant.
(90) LAMBERT DARDRE, Chronique de Guines et dArdre , c. CXXX, d. Mnilglaise, p.
311.
(91) Miracles de Saint Benot, d. Certain, VIII, 36.
(92) C. ERDMANN, dans Zeitschrift fr deutsches Altertum, 1936, p. 88 et 1937, p. 116.
(93) Histoire de Guillaume le Marchal, d. P. Meyer, t. I, v. 8444 et s. PHILIPPE DE
NOVARE, Mmoires, d. Ch. Kohler. C. LXXII ; cf. C. CL et s.
(94) Disparition dont, soit dit en passant, ltude qui ne semble pas avoir t jusquici
entreprise fournirait un bon moyen de dater la popularit de la lgende de Roland.
(95) GIRALDUS CAMBRENSIS, De principis instructione, dist. III, c. XII (Opera, Rolls
Series, t. VIII, p. 258).
(96) JEAN DE SALISBURY dans H. DENIFLE et E. CHATELAIN, Chartularium
universitatis Parisiensis, t. I, p. 18-19.
(97) Histoire de sa vie, I, 4 ; d. G. Bourgin, pp. 12-13.
(98) DARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et comtes de Champagne, t. III, p.
189 et s. Chroniques des comtes dAnjou , d. Halphen et Poupardin, pp. 217-219.
(99) LAMBERT DARDRE, Chronique, c. LXXX, LXXXI, LXXXVIII, LXXXIX.
(100) MANEGOLD DE LAUTENBACH, Ad Gebehardum liber dans Monum. Germ., Libelli
de lite, t. I, pp. 311 et 420.
(101) Tetralogus, d. Bresslau, v. 197 et s.
(102) ASSER, Life of King Alfred, d. Stevenson, c. 106.
(103) De mme en Espagne, o, comme on la vu, une certaine instruction subsistait chez les
laques, la codification visigothique continua dtre copie et tudie.
(104) GLANVILL, De legibus et consuetudinibus regni Angliae, d. G. E. Woodbine, New
Haven (USA), 1932 (Yale Historical Publications, Manuscripts, XIII), p. 24.
Marc BLOCH La socit fodale
430
(105) HINCMAR, De ordine palatii, c. 21. MIGNE, P. L., t. CLI, col. 356 (1092, 2 dc. ).
Cf. TERTULLIEN, De virginibus velandis, c. 1.
(106) Chron. Ebersp., dans SS., t. XX, p. 14 ; tout le passage est extrmement curieux.
(107) Histor. de Fr., t. VI, p. 541. LAMBERT DARDRE, Chronique, CXXVIII.
(108) HINOJOSA, El regimen seorial y la cuestion agraria en Catalua, pp. 250-251.
(109) MARTENE et DURAND, Ampl. Collectio, t. I, col. 470 (1065).
(110) E. MABILLE, Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, 1874, n CLVI et LXXVIII.
(111) Rev. hist. du Droit, 1922, p. 301.
(112) WALTER MAP, De nugis curialium, d. M. R. James, p. 237.
(113) Parmi les trs anciennes lgislations royales figure aussi celle des rois de Jrusalem. Cf.
H. MITTEIS dans Beitrge zur Wirtschaftsrecht, t. I, Marbourg, 1931 et GRANDCLAUDE
dans Mlanges Paul Fournier, 1929. galement, celle des rois normands de Sicile. Mais
celle-ci, pour une part, prenait la suite de traditions trangres lOccident.
(114) Au moins dans la seule version que nous possdions. Elle avait probablement t
prcde par une rdaction latine, qui est aujourdhui perdue.
(115) Cartulaire de Sainte-Madeleine de Davron : Bibl. Nat., ms. latin 5288, fol. 77 v. Cette
quivalence des mots : ami et parent se retrouve dans les textes juridiques gallois et
irlandais ; cf. R. THURNEYSSEN, dans Zeilschr. der Savigny-Stiftung, G.A., 1935, pp.
100-101.
(116) JOINVILLE, d. de Wailly (Soc. de lhistoire de France ), p. 88. Garin le Lorrain,
d. P. Paris, t. I, p. 103. ROBERT DE TORIGNY, d. L. Delisle, pp. 224-225.
GISLEBERT DE MONS, d. Pertz, p. 235 et p. 258. AETHELSTAN, Lois, VI, c. VIII, 2.
(117) HINOJOSA, Das germanische Element im spanische Rechte dans Zeitschrift der
Savigny-Stiftung, G.A., 19 10.
(118) J. TARDIF, Coutumiers de Normandie, t. I, p. 52, c. LXI.
(119) Le couronnement de Louis, d. E. Langlois, v. 787-789.
(120) DAVIDSON, Geschichte von Florenz, t. IV, 3, 1927, pp. 370 et 384-385.
(121) REGINO DE PRM, De synodalibus causis, d. Wasserschleben, II, 5.
(122) HARIULF, Vita Arnulfi episcopi, dans SS., t. XV, p. 889. THOMAS DE
CANTIMPR, Bonum universale de apibus, II, 1, 15.
(123) Raoul GLABER, d. Prou, II, c. X.
(124) On en trouvera, dans le livre du vicomte du MOTEY, Origines de la Normandie et du
duch dAlenon , 1920, un rcit quanime une candide partialit en faveur des Talvas.
(125) F. CATTIER, La guerre prive dans le comt de Hainaut, dans Annales de la Facult
de philosophie de Bruxelles , t. I, (1889-90), pp. 221-223. Cf. pour la Bavire :
SCHNELBGL, Die innere Entwicklung des bayer. Landfriedens, 1932, p. 312.
(126) Par exemple, en Flandre, WALTERUS, Vita Karoli, c. 19, dans SS., t. XII, p. 547.
(127) G. ESPINAS, Recueil de documents relatifs lhistoire du droit municipal , Artois, t. I,
p. 236, c. XXVIII. Il est significatif que cette prescription ait disparu de la Keure de 1469,
p. 251, c. IV j.
Marc BLOCH La socit fodale
431
(128) Et aussi, comme on le verra plus loin, au seigneur de la victime ou son vassal ; mais
cela, par une vritable assimilation du lieu de protection et de dpendance personnelles avec
le rapport de parent.
(129) GIRART DE ROUSSILLON, traduction P. MEYER, p. 104, n 787. Leges Edwardi
Confessoris, XII, 6.
(130) tablissements de Saint Louis, d. P. Viollet, la table.
(131) L. DELISLE et E. BERGER, Recueil des actes de Henri II, n CLXII ; Cf. CXCIV.
M. QUANTIN, Recueil de pices pour faire suite au cartulaire gnral de lYonne , n 349.
(132) Bibl. nat., ms. latin 4763, fol. 47 r.
(133) FELIBIEN, Histoire de labbaye royale de Saint Denys , p. just., n CLV. A.
LUCHAIRE, Louis VI, n 531.
(134) B. de BORN, d. Appel, 19, v. 16-17. PORE, Les statuts de la communaut des
seigneurs pariers de La Garde-Gurin (1238-1313) dans Bibliothque de lcole des Chartes,
1907 et tudes historiques sur le Gvaudan, 1919.
(135) Lex Saxonum, c. LXII.
(136) Voir un exemple (arrt de la cour de Blois), Ch. MTAIS, Cartulaire de Notre-Dame
de Josaphat, t. I, n CIII ; cf. n CII.
(137) B. GURARD, Cartulaire de labbaye de Saint -Pre de Chartres, t. II, p. 278, n XIX.
(138) Cette restriction apparat ds 1055-1070, dans une notice du Livre Noir de Saint-Florent
de Saumur. Bibl. nat., nouv. acquis. lat. 1930, fol. 113 v.
(139) Ds lpoque anglo -saxonne, dailleurs, on avait vu se crer, en Angleterre, une
catgorie de terres, vrai dire mdiocrement nombreuses, qui, sous le nom de book-land,
chappaient aux restrictions coutumires et pouvaient saliner librement.
(140) Miracula S. Ursmari, c. 6, dans SS., t. XV, 2, p. 839.
(141) GEOFFROI DE VIGEOIS I, 25, dans LABB, Bibliotheca nova, t. II, p. 291.
(142) Lhistoire de Guillaume le Marchal , d. P. Meyer, t. I, v. 339 et s.
(143) GUILLAUME DE TYR, XII, 12. JOINVILLE, d. de Wailly (Soc. de lHist. de
France), pp. 105-106.
(144) Garin le Lorrain, d. P. Paris, t. II, p. 268.
(145) W. O. FARNSWORTH, Uncle and nephew in the old French chansons de geste : a
study in the survival of matriarchy, New York, 1913 (Columbia University : Studies in
romance philology and literature) ; CI. H. BELL, The sisters son in the medieval german
pic : a study in the survival of matriliny, 1922 (University of California : Publications in
modern philology, vol. X, n 2).
(146) Polyptyque de labb Irminon , d. A. Longnon, II, 87. Il arrivait que le dsir de marquer
ainsi la double filiation entrant dtranges non -sens ; tel, le nom anglo-saxon Wigfrith :
mot mot paix de la guerre .
(147) Livre Roisin, d. R. Monier, 1932, 143-144. A. GIRY, Histoire de la ville de
Saint-Omer, t. II, p. 578, c. 791. Ainsisexplique que le droit canon ait pu, sans trop de
prsomption, tendre jusquau septime degr linterdiction des mariages consanguins.
(148) Annales Altahenses maiores, 1037, dans SS., t. XX, p. 792. JEHAN MASSELIN,
Journal des tats Gnraux, d. A. BERNIER, pp. 582-584.
(149) PHILIPPE DE NOVARE, Mmoires, d. Kohler, pp. 17 et 56.
Marc BLOCH La socit fodale
432
(150) HASKINS, Norman institutions, Cambridge (USA), 1918, Harvard Historical Studies,
XXIV, p. 63.
(151) Cest par un vritable contresens que suzerain a quelquefois t employ dans cette
acception, depuis les feudistes de lAncien Rgime. La signification vritable en tait bien
diffrente. Soit Paul, qui a prt hommage Pierre, qui lui-mme la prt Jacques. Jacques
et non Pierre sera le seigneur suzerain ou, en bref, le suzerain de Paul : entendez le
seigneur suprieur (le mot semble driv de ladverbe sus, par analogie avec souverain). En
dautres termes, mon suzerain est le seigneur de mon seigneur, non mon seigneur direct.
Lexpression parat dailleurs tardive (XVII sicle ? ).
(152) MIROT, Les ordonnances de Charles VII relatives la prestation des hommages dans
Mmoires de la Socit pour lHistoire du droit et des institutions des anciens pays
bourguignons, fasc. 2, 1935 ; G. DUPONT-FERRIER, Les origines et le premier sicle de la
Cour du Trsor, 1936, p. 108 ; P. DOGNON, Les institutions politiques et administratives du
pays de Languedoc, 1895 p. 576 (1530).
(153) H. WARTMANN, Urkundenbuch der Abtei Sanct-Gallen, t. I, n 31.
(154) RABAN MAUR, dans Zeitschrift fr deutsches Altertum, t. XV, 1872, p. 444.
(155) G. DOTTIN, La langue gauloise, 1920, p. 296.
(156) Au moins dans ce sens. Car cest ambacte que remo nte par des dtours qui
nimportent pas ici notre mot ambassade .
(157) Capitularia, t. I, n 64, c. 17.
(158) Ibid., t. I, n 141, c. 27.
(159) THIETMAR DE MERSEBOURG, Chronique, VII, 30. Miracula S. Bertini, II, 8,
dans MABILLON AA. SS. ord. S. Benedicti, III, I, pp. 133-134.
(160) Lutilisation de lhommage comme acte expiatoire, qui a t signale plus haut (p. 192),
rentre dans son rle comme geste de soumission, propre aux classes relativement leves. Des
tmoignages mis jour par Platon, dans un article dailleurs insuffisamment critique
(Lhommage comme moyen de contracter des obligations prives , dans Revue gnrale du
droit, t. XXVI, 1902.), montrent, en outre, dans ce rite, un moyen de contracter diverses
obligations de droit priv. Il sagit dune pratique aberrante, limite un petit nombre de
rgions (Catalogne ; peut-tre Castille) et de date tardive.
(161) Le meilleur expos, du point de vue linguistique, dans WARTBURG, Franzsisches
etymologisches Wrterbuch, 1928 et suiv. t. III (mais la charte de Charles le Gros, de 884, est
un faux).
(162) Recueil des chartes de labbay e de Cluny, d. Bruel et Bernard, t. I, n 24 ; 39 ; 50 ; 54 ;
68 ; 84 ; 103 ; 236 ; 243.
(163) Cartulaire de Maguelonne, d. J. Rouquette et A. Villemagne, n III (texte diffrent
dans Histoire de Languedoc, t. V, n 48). Date : 893, 23 janvier 894, 27 janvier, ou (plus
probablement), 898, 1er janv. 31 dc. Pour les exemples postrieurs, il mest impossible ici
de citer mes rfrences. La forme provenale feuz est atteste ds le 9 juin 956 (Hist. de
Languedoc, t. V. n 100).
(164) A. MIRAEUS, Donationes belgicae, II, XXVII.
(165) Dans le pome de l Heliand (822-840), les deux thmes auxquels se rattachent notre fief
et lallemand Lehn se trouvent curieusement associs dans lexpression lehni feho = bien
emprunt (v. 1548).
(166) Les exemples de fiefs de sergenterie (le feuum sirventale du Midi : cf. Hist. de
Languedoc, t. V. n 1037) sont bien connus. De mme pour le feudum presbyterale. Sur les
Marc BLOCH La socit fodale
433
fiefs dartisans, voir M. BLOCH, Un problme dhistoire compare : la ministrialit en
France et en Allemagne dans Revue historique du droit, 1928, pp. 54-55.
(167) GISLEBERT DE MONS, d. Pertz, p. 35. Red Book of the Exchequer, d. H. Hall, t.
I, p. 283.
(168) Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, d. Douais, n 155.
(169) H. ROUND, Feudal England, Londres, 1907 ; H. M. CHEW, The English ecclesiastical
tenants-in-chief and knight-service, especially in the thirteenth and fourteenth century. Pour
Salzbourg, SS., t. XI, c. 25, p. 46.
(170) S. Stephani. Lemovic Cartul., d. Font-Raulx, n XCI et XVIII.
(171) LAMBERT DARDRE, Chronique de Guines, d. Mnilglaise, c. CI.
(172) Du moins dans les pays profondment fodaIiss, comme la majeure partie de la
France. En Italie, il en fut autrement.
(173) G.-G. DEPT, Les influences anglaise et franaise dans le comt de Flandre, 1928 ;
KIENAST, Die deutschen Frsten im Dienste der Westmchte, t. I, 1924, p. 159 ; t. II, p. 76,
n. 2 ; 105, n 2 ; 112 ; H.-F. DELABORDE, Jean de Joinville, n 341.
(174) Sur les drengs anglais, le meilleur expos par LAPSLEY, dans Victoria County
Histories Durham, t. I, p. 284 ; cf. JOLLIFFE, Northumbrian institutions dans English
Historical Review, t. XLI, 1926.
(175) P. GUIDI et E. PELLEGRINETTI, Inventari del vescovato, della cattedrale e di altre
chiese di Lucca dans Studi e Testipubblicati per cura degli scrittori della Biblioteca Vaticana,
t. XXXIV, 1921, n 1.
(176) Capitularia, t. I, n 88.
(177) Dans la bulle relative Terracine, 1000, dcembre 26. Cf. JORDAN, Das Eindringen
des Lehnwesens in das Rechtsleben der rmischen Kurie dans Archiv. fr
Urkundenforschung, 1931.
(178) Cf. L. HTTEBRAUKER, Das Erbe Heinrichs der Lwen dans Studien und
Vorarbeiten zum historischen Atlas Niedersachsens, H. 9, Gttingen, 1927.
(179) AETHELSTAN, II, 2. Parmi les conventions conclues Mersen, en 847, par les trois
fils de Louis le Pieux figure, dans la proclamation de Charles le Chauve, la phrase suivante :
Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem, qualem voluerit, in
nobis et in nostris fidelibus accipiat. Mais le xamen des dispositions analogues contenues
dans les divers partages de lEmpire montre que volumus signifie ici nous permettons ,
non point nous ordonnons .
(180) ROBERT DE TORIGNY, d. L. Delisle, t. I, p. 320.
(181) Sur les institutions asturo-lonaises, je dois dutiles indications lamabilit de M. P.
Bernard, archiviste de la Savoie.
(182) E. LESNE, Histoire de la proprit ecclsiastique en France, t. II, 2, pp. 251-252.
(183) Pro ecclesiae libertatum dfensione, dans MIGNE, P. L., t. CXXV, col. 1050.
(184) Mon. Germ., EE, t. V, p. 290, n 20 ; LOUP DE FERRIRES, d. Levillain, t. II, n
122. WARTMANN, Urkundenbuch der Abtei Sanct-Gallen, t. II, n 386.
(185) Le Couronnement de Louis, d. E. Langlois, v. 83.
(186) MTAIS, Cartulaire de labbaye cardinale de La Trinit de Vendme , t. I, n LXVI et
LXVII.
Marc BLOCH La socit fodale
434
(187) Cantatorium S. Huberti, dans SS., t. VII, pp. 581-582.
(188) Les frres, toutefois, furent de bonne heure lobjet de privilges spciaux voyez la loi
de Conrad II qui, parfois, conformment aux partis pris de certains droits populaires en
faveur de la gnration la plus ge, allrent jusqu leur donner le pas sur les fils : cf. G.
GARAUD, dans Bullet. Soc. Antiquaires Ouest, 1921.
(189) WOLFRAM VON ESCHENBACH, Parzival, I, str. 4-5.
(190) Certains historiens expliquent cette prestation par lhabitude quauraient eue
primitivement les seigneurs dquiper eux -mmes leurs vassaux ; le harnois ainsi fourni
devait, dit-on, tre rendu aprs la mort de lhomme. Mais du moment que le fils tait son
tour accept pour vassal, quoi bon une pareille restitution ? Linterprtation propose ici a
lavantage de tenir compte de lvidente ressemblance entre le relief fodal et les autres
redevances de nature voisine : par exemple les droits dentre dans certains mtiers,
galement verss au seigneur sous forme dobjets qui rpondaient la profession du
redevable.
(191) Les mmes proccupations imposrent dans lAngleterre, en 1290, linterdiction de
pratiquer la vente du fief sous la forme de la sous-infodation. Lacheteur dut dsormais tenir
le bien directement du seigneur de son vendeur.
(192) Mon. Germ. Constitutiones, t. I, n 447, c. 5.
(193) H. MITTEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt p. 103 et W. KIENAST, dans Historische
Zeitschrift, t. CXLI, 1929-1930, croient avoir relev des exemples plus anciens. Mais le seul
o lon voit vritablement sexprimer une double fidlit a trait au partage de lautorit,
Rome, entre le pape et lempereur : dualisme de souverainet, non de relation entre seigneur
et commend. La charte de Saint-Gall, que ni M. Ganshof, ni M. Mitteis nont pu retrouver et
qui porte en ralit dans l Urkundenbuch le n 440, se rapporte une cession de terre
moyennant un cens.
(194) Ruodlieb, d. F. Seiler, I, v. 3. K. LEHMANN, Das Langobardische Lehnrecht, II, 2,
3. W. LIPPERT, Die deutschen Lehnsbcher, p. 2.
(195) Vita Burchardi, d. de la Roncire, p. 19 ; cf. p. XVII.
(196) GANSHOF, Depuis quand a-t-on pu en France tre vassal de plusieurs seigneurs ?
dans Mlanges Paul FOURNIER , 1929. Us. Barc., c. 25.
(197) Pour les rfrences, voir les travaux cits la bibliographie. Y ajouter : pour les deux
monastres, Arch. Nat., LL 1450 A, fol. 68, r et v (1200-1209) ; pour Morigny, Bibl. Nat.,
lat. 5648, foi. 110 r (1224, dc. ), pour les serfs, Marc BLOCH, Rois et Serfs, 1920, p. 23, n
2.
(198) Leges Henrici, 43, 6 et 82, 5 ; 55, 2 et 3 ; Us. Barcin., c. 36.
(199) Chartes du Forez, n 467.
(200) Mon. Germ., EE., t. V, p. 127, n 34.
(201) HASKINS, Norman institutions, p. 15. ROUND, Family Origins, 1930, p. 208 ;
CHEW, The English ecclesiastical tenants-in-chief and knight-service, especially in the
thirteenth and fourteenth century. GLEASON, An ecclesiastical barony of the middle ages,
1936. H. NAVEL, Lenqute de 1133 , 1935, p. 71.
(202) HARIULF, Chronique, III, 3, d. Lot, p. 97. Us. Barc., c. CXXIV. DU CANGE,
Dissertations sur lhist. de Saint Louis , V, d. Henschel, t. VII, p. 23.
(203) En Angleterre, toutefois, les termes finirent par se hirarchiser, celui d aide tant
rserv aux vassaux et taille aux plus modestes dpendants.
Marc BLOCH La socit fodale
435
(204) Premier cartulaire de Saint-Serge, restitution de Marchegay. Arch. Maine-et-Loire, H.
fol. 293. Naturellement les cas diffraient sur les fiefs dglise ; sur ceux qui dpendaient de
lvque de Bayeux, par exemple, ctaient le voyage de lvque Rome, une rparation la
cathdrale, lincendie du palais piscopal (GLEASON, An ecclesiastical barony, p. 50).
(205) Cf. ci-dessus, p. 258.
(206) STEINMEYER et SIEVERS, Althochdeutschen Glossen, I, pp. 268 et 23.
(207) FLODOARD, Hist. Remensis eccl., III, 26, dans SS., t. XIII, p. 540 ; cf. dj Actus
pontificum Cenomannensium, pp. 134 et 135 (616 : nutritura ), COMMYNES, VI, 6
(d. Mandrot, t. II, p. 50).
(208) Codex Euricianus, c. 310. Par contre, le vassal, mari par ses deux matres successifs,
que met en scne le synode de Compigne de 757, est, conformment au sens premier du mot,
un simple esclave et ne nous intresse pas ici.
(209) Ordonnances, t. XII, p. 295. t. de Saint Louis, I, c. 67.
century of English feudalism (1066-1166), pp. 33-34.
STENTON, The first
(210) Trs ancien Coutumier, XXXV, 5.
(211) Le Roman de Thbes, d. L. Constans, t. I, v. 8041 et s., et 8165 et s. Arch. Nat., X
IA, 6, fol. 185 ; cf. O. MARTIN, Histoire de la coutume de la prvt et vicomt de Paris, t. I,
p. 257, n. 7.
(212) FOURGOUS et BEZIN, Les Fors de Bigorre ( Travaux sur lhistoire du droit
mridional fasc. 1, 1901), c. 6.
(213) Girart de Roussillon, trad. P. MEYER, p. 100 (d. Foerster, Romanische Studien, t. V,
v. 3054). Prem. cartul. de Saint Serge, restitution Marchegay, Arch. Maine-et-Loire, H,
fol. 88. Doon de Maience, d. Guessard, p. 276.
(214) Par exemple Girart de Roussillon, trad. P. MEYER, p. 83 ; Garin le Lorrain, d. P.
Paris, t. II, p. 88. Concile : MIGNE, P. L., t. CXLII, col. 400.
(215) Alfred, dans LIBBERMANN, Die Gesetze der Angelsachsen, t. I, p. 47 (49, 7) ; Leges
Henrici, 75, 1. GISLEBERT DE MONS, d. Pertz, p. 30. PHILIPPE DE NOVARE, d.
Kohler, p. 20.
(216) The Christ of Cynewulf, d. A. S. Cook, v. 457. MIGNE, P. L., t. CXCIII, col. 523 et
524. L. GOUGAUD, Dvotions et pratiques du moyen ge, 1925, p. 20 et s.
(217) RICHER, IV, 78. Autres exemples (jusquau XIIIe sicle), JOLLIFFE , The
constitutional history of medieval England, p. 164.
(218) Alfred, XLII, 6. Two of the Saxon chronicles, d. Plummer, t. I, pp. 48-49 (755).
K. LEHMANN, Das Langobardische Lehnrecht : Vulgata, II, 28, 4.
(219) Leges Henrici, 55, 3. Raoul de Cambrai, v. 1381. Chron. mon. de Abingdon (R.
S.), t. II, p. 133 (1100-1135). Renaud de Montauban, d. Michelant, p. 373, v. 16.
(220) J. DEPOIN, Recueil de Chartes et documents de Saint-Martin-des-Champs, t. I, n 47,
et Liber Testamentorian S. Martini, n XVIII.
(221) Par exemple, fief du peintre, B. de BROUSSILLON, Cartulaire de labbaye de
Saint-Aubin dAngers , t. II, n CCCCVIII.
(222) Ch.-V. LANGLOIS, Textes relatifs lhistoire du Parlement , n CXI, c. 5 bis.
(223) Aux exemples franais ajouter, par exemple, CHALANDON, Histoire de la domination
normande en Italie et en Sicile, t. II, p. 565 ; HOMEYER, System des Lehnrechts der
schsischen Rechtsbcher dans Sachsenspiegel (t. II, 2, Berlin, p. 273) ; KIENAST, Die
Marc BLOCH La socit fodale
436
deutschen Frsten im Dienste der Westmchte bis zum Tode Philipps des Schnen von
Frankreich, t. II, p. 44.
(224) On ne la peut -tre pas assez remarqu : voquant limage de ces petits vassaux,
lordonnance franaise de 1188, sur la dme de croisade, postule, en effet, quils ont un seul
seigneur lige.
(225) Cap., t. I, n 132, c. 5.
(226) A. LESORT, Chronique et chartes... de Saint-Mihel, n 33.
(227) Acta Murensia, dans Quellen zur schweizer Geschichte, t. III, 2, p. 68, c. 22.
(228) Chartes du Forez antrieures au XIVe sicle, n 500 (t. IV).
(229) Monumenta Historiae Patriae, t. XIII, col. 711.
(230) Olim, t. I, p. 661, n III.
(231) SUGER, De rebus, d. Lecoy de La Marche, c. X, p. 167.
(232) Cap., I, n 162, c. 3 ; n 50 c. 2.
(233) Lex Romana Visigothorum, d. Haenel, Cod. Theod., V, 10, 1 et Interpretatio.
(234) A. BERNARD et A. BRUEL, Rec. des chartes de... Cluny, t. IV, n 3024.
(235) Bibl. de Tours, ms. 2041, feuillet de garde. Histor. de France, t. XII, p. 340.
Cartulaire de Saint-Vaast, p. 177.
(236) Coutumes de Montchauvet (concdes primitivement vers 1101-1137) dans Mm. Soc.
archol. Rambouillet, t. XXI, 1910, p. 301. Cf. aussi Ordonn., t. XI, p. 286
(Saint-Germain-des-Bois).
(237) PIERRE DE FONTAINES, Le Conseil de Pierre de Fontaines, d. A. J. Marnier,
XXI, 8, p. 225. Marc BLOCH, Les transformations du servage dans Mlanges dhistoire
du Moyen Age offerts M. F. Lot , 1925, p. 55 et s.
(238) PERRIN, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine daprs les p lus anciens
censiers, p. 225 et s. ; Chronique de labbaye de Saint -Bnigne..., d. E. Bougaud et J.
Garnier, pp. 396-397 (1088-1119).
(239) Charte de Codalet en Conflent, 1142, dans B. ALART, Privilges et titres relatifs aux
franchises... de Roussillon, t. I, p. 40.
(240) Le dernier expos du problme par J. CALMETTE, dans Annales du Midi, 1928.
(241) H. PRENTOUT, Les origines de la maison de Bellme, dans tudes sur quelques
points dhistoire de Normandie , 1926.
(242) Bibliotheca Casinensis, t. IV, p. 151.
(243) Mon. Germ. LL., t. IV, p. 557, col. 2, l. 6.
(244) HARIULF, Chronique, d. Lot, p. 308 ; cf. p. 300. Monumenta boica t. XXVIII, 2, p.
27, n XVII.
(245) RICHER, Histoires, I, c. 15.
(246) Serment de paix de Beauvais, dans PFISTER, tudes sur le rgne de Robert le Pieux,
1885, p. LXI.
(247) DELOCHE, Cartulaire de labbaye de Beaulieu , n L. Casus S. Galli, c. 48.
(248) Fritz MEYER, Die Stnde... dargestellt nach den altfr. Artusund Abenteuerromanen,
1892, p. 114. Poema del mio Cid, d. Menendez Pidal, v. 918.
Marc BLOCH La socit fodale
437
(249) H. DERENBOUPG, Ousma Ibn Mounkidh, t. I (Publications Ec. Langues Orientales,
2e srie, t. XII, 1), p. 476.
(250) Ed. Appel, n 40 ; comparez, par exemple, Girart de Vienne, d. Yeandle, v. 2108 et s.
(251) HARTMANN von AUE, Gregorius, v. 1547-1553.
(252) La chanun de Guillelme, d. Suchier, v. 1055 et s.
(253) ORDERIC VIDAL, Histoire ecclsiastique, d. Le Prevost, t. III, p. 248.
(254) Guillaume le Marchal, d. P. Meyer, v. 2777 et 2782 (il sagit daileurs de chevaliers
qui courent les tournois).
(255) PONS DE CAPDEUIL, dans RAYNOUARD, Choix, IV, pp. 89 et 92.
(256) ERDMANN, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, 1935 ( Forschungen zur
Kirchen- und Geistesgeschichte , VI), pp. 312-313.
(257) GEOFFROI DE VIGEOIS, I, 6 dans LABBE, Bibliotheca, t. II, p. 281.
(258) BERTRAND DE B., d. Appel, 10, 2 ; 35, 2 ; 37, 3 ; 28, 3.
(259) GUIBERT DE NOGENT, De vita, d. Bourgin, I, c. 13, p. 43. Girart de Roussillon,
trad. P. MEYER, p. 42.
(260) Pour le butin, par exemple, Codex Euricianus, c. 323 ; MARLOT, Histoire de lglise
de Reims, t. III, P. just. N LXVII (J 127) ; Les chariots : Garin le Lorrain, d. P. Paris, t.
I, pp. 195 et 197. Les plaintes des moines du Canigou : LUCHAIRE, La socit franaise
au temps de Philippe Auguste, 1909, p. 265.
(261) Huon, d. F. Guessard, p. 41, v. 1353-54. Louis IX, Enseignemens, c. 23, dans Ch.
V. LANGLOIS, La vie spirituelle, p. 40. B. DE BORN, 26, v. 15.
(262) Girart de Roussillon, trad. P. MEYER, 633 et 637. Vita Heinrici, d. W. Eberhard,
c. 8.
(263) Casus S. Galli, c. 43.
(264) Vita Johannis ep. Teruanensis, c. 12, dans SS., t XIV, 2, p. 1146.
(265) Miracula S. Benedicti, d. Certain, VIII, c. 16.
(266) Rgles de Robert GROSSETTE dans WALTER OF HENLEYS, Husbandry, d. E.
Lamond.
(267) Marc BLOCH, Les caractres originaux de lhistoire rurale franaise , 1931, p. 148.
(268) Fors de Bigorre, c. XIII.
(269) LAMBERT DARDRES, Chronique, c. LXXXVIII. Garin le Lorrain, d. P. Paris, t.
II, p. 244.
(270) Ch. MTAIS, Cartulaire de labbaye... de la Trinit de Vendme , t. I, n CCLXI.
(271) Sur les tournois, outre les travaux signals la Bibliographie, voir WAITZ, Deutsche
Verfassungsgeschichte, t. V, 2e d., p. 456. Guillaume le Marchal, d. P. Meyer, t. III, p.
XXXVI et s. Chronique de GISLEBERT DE MONS, d. Pertz, pp. 92-93 ; 96 ; 102 ;
109-110 ; 128-130 ; 144. Raoul de Cambrai, v. 547.
(272) Joinville, c, CIX.
(273) RANGERIUS, Vita Anselmi dans SS., XXX, 2, p. 1252, v. 1451.
(274) Joinville, c. CLIX.
Marc BLOCH La socit fodale
438
(275) Girart de Roussillon, trad. P. MEYER, S. 257 et 299. Cf. La Mort de Garin, d. E. du
Mril, p. XL. Et voyez, entre autres, la scne dlicatement voluptueuse du Lancelot, d.
Sommer, The vulgate version of the Arthurian romances, t. III, p. 383.
(276) On a parfois aussi, propos de lamour courtois et de la posie lyrique qui lui servit
dexepression, soulev le problme dune influence arabe. Il ne semble pas que jusquici
aucune preuve concluante ait t apporte. Cf., outre Al. JEANROY, La posie lyrique des
troubadours, t. II, p. 366, un compte rendu de C. APPEL dans Zeitschrift fr romanische
Philologie, t. LII, 1932, p. 770 (sur A. R. Nykl).
(277) ALBERT DE MALASPINA, dans C. APPEL, Provenzalische Chrestomathie, 3e d., n
90, v. 19 et s.
(278) GEOFFROI DE VIGEOIS, I, 69 dans LABBE, Bibliotheca, t. II, p. 322.
(279) RAIMON LULL, Libro de la orden de Caballeria, d. J. R. de Luanco. Trad. fr. dans P.
ALLUT, tude biographique et historique sur Symphorien Champier , Lyon, 1859, IV, 11.
LAMBERT DARDRES, Chronique, c. XCI.
(280) HASKINS, Norman institutions, 1918, p. 282, c. 5.
(281) Rec. des Histor. de France, t. XV, p. 187.
(282) Ed. Rothari, c. 359. La liturgie de ladoubement na fait jusquici lobjet que de
recherches insuffisantes. On trouvera, la bibliographie, lindication des ouvrages et des
recueils auxquels jai eu recours. Ce premier essai de cla ssement, si rudimentaire soit-il, ma
t rendu possible seulement grce laide qua bien voulu me prter mon collgue de
Strasbourg, M. labb Michel Andrieu.
(283) Jehan et Blonde, d. H. Suchier (uvres potiques de Ph. de Rmi, t. II, v. 5916 et s. ).
(284) Policraticus, VI, 10 (d. Webb, t. II, p. 25).
(285) GUILLAUME DURANT, Rationale, IV, 16.
(286) PIERRE DE BLOIS, p. XCIV.
(287) Der Welsche Gast, d. Rckert. v. 7791-92.
(288) ANSELME, Ep. I, (P. L., t. CLVIII, col. 1147). S. BERNARD, De lande novae
militiae. 77, c. 2.
(289) RAIMON LULL, op. cit., I, 9. Tout le passage est dune saveur singulire.
(290) Ancienne rgle : G. SCHNRER, Die ursprngliche Templerregel, 1903. Rgle en
franais H. de CURZON, La rgle du Temple (Soc. de lhist. de France ), c. 431 ; 445 ;
446 ; 448. Dispositions analogues chez les Hospitaliers, au chapitre gnral de 1262, 19
sept. : DELAVILLE LE ROULX, Cartulaire gnral, t. III, p. 47, c. 19
(291) Constitutiones, t. I, p. 197, c. 10 ; p. 451, c. 20. H. NIFSE, Die Gesetzgebung der
norm. Dynastie, p. 67. MARCA, Marca Hisp., col. 1430, c. 12. PAPON, Histoire
gnrale de Provence, t. III, p. 423. Siete Partidas, Part. II, t. XXI, I, 2. Cf. pour le
Portugal, PRESTAGE, Chivalry : a series of studies to illustrate its historical significance
and civilizing influence, by members of Kingss College , London, Londres, 1928, p. 143.
Pour la France, rfrences trop nombreuses pour tre cites ; Cf., PETIT-DUTAILLIS,
Lessor des tats dOccident , p. 22 et s.
(292) RAIMON LULL, op. cit., III, 8. Girart de Roussillon, trad. P. MEYER, p. 28 (cf. d.
Foerster, Roman. Studien, t. V, v. 940 et s.
(293) P. THOMAS, Textes historiques sur Lille, t. II, 1936, p. 237.
(294) Rec. des Hist. de France, t. XXII, p. 19.
Marc BLOCH La socit fodale
439
(295) OTTON DE FREISING, Gesta, II, 23.
(296) Hist. de Languedoc, 2e d., t. VIII, col. 1747.
(297) Annal. Colmar. dans SS., t. XVII, p. 208, l. 15 ; cf. p. 224, l. 31.
(298) BARTHLEMY, De la qualification de chevalier dans Revue nobiliaire 1868, p.
123 et ID., tude sur les lettres danoblissement , dans Revue nobiliaire , 1869, p. 205.
(299) Usatici Barcin., c. 9 et 8. Ch. PORE, tudes historiques sur le Gvaudan, 1919 (et
Bibl. Ec. Chartes, 1907), p. 62, c. 1. Charte de paix du Hainaut (1200), dans SS., XXI, p.
619.
(300) Summa de legibus, dans TARDIF, t. II, XIV, 2. F. BENOIT, Recueil des actes des
comtes de Provence, t. II, n 246, c ; IX a, 275, c ; V a, 277, 278 (1235-1238).
GUILHIERMOZ, Essai sur les origines de la noblesse en France au moyen ge, 1902, p.
481, n. 5.
(301) Annales Colonienses max. dans SS., t. XVII, p. 845.
(302) BARTHLEMY, tude sur les lettres danoblissement , p. 198.
(303) BEAUMANOIR, t. II 1434.
(304) Voir plus haut, p. 287.
(305) Les travaux de A. SCHULTE, Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter, 2e d.,
Stuttgart, et de dom URSMER BERLIRE, Le recrutement dans les monastres bndictins
aux XIIIe et XIVe sicles (Mm. Acad. royale Belgique, in-8, 2e srie, t. XVIII) fournissent
cet gard un grand nombre de renseignements. Mais avec des prcisions chronologiques et
critiques insuffisantes. Quoi quen pense Schulte, il ressort des textes cits que rserve
faite de lemploi trs lche fait anciennement des mots de nobiles ou ignobiles le monopole
des nobles, au sens exact du terme, fut partout un phnomne relativement rcent. Quant
ladmission des non -libres, accepte ou non, elle posait un tout autre problme.
(306) Olim, t. I, p. 427, n XVII (Chandeleur, 1255). F. BENOIT, Recueil des actes,
passages cits ci-dessus, p. 453, n. 300. M. Z. ISNARD, Livre des privilges de Manosque,
1894, n. XLVII, p. 154.
(307) Cf. E. et A. G. PORRITT, The unreformed House of Commons, 2e d. 1909, t. I, p. 122.
(308) Pour la Provence, KIENER, Verfassungsgeschichte der Provence seit der
Ostgothenherrschaft bis zur Errichtung der Konsulate (510-1200), Leipzig, p. 107. Sur les
bacheliers , cf. E. F. JACOB, Studies in the period of baronial Reform, 1925, (Oxford
Studies in social and legal history, VIII), p. 127 et s.
(309) Usatici., c. 6.
(310) Ibid., c. 6.
(311) Cf. F. TOUT, Chapters in administrative history, t. III, p. 136 et s.
(312) En faveur du duc de Bretagne : DOM MORICE, Histoire de Bretagne Pr., t. I, col.
1122. Sur les revendications des pairs, cf. PETIT-DUTAILLIS, Lessor des tats
dOccident , pp. 266-267.
(313) BORRELLI DE SERPES, Recherches sur divers services Publics, t. III, 1909, p. 276.
(314) Les rfrences, pour ce paragraphe, tant aises trouver dans les divers travaux
indiqus la bibliographie (p. 667), sous le titre : Sergents et sergenterie (auxquels il faut
ajouter ROTH VON SCHRECKENSTEIN, Die Ritterwrde und der Ritterstand.), on
comprendra que jaie rduit les notes au strict minimum.
(315) Girart de Roussillon, trad. P. MEYER, 620 (d. Foerster, v. 9139).
Marc BLOCH La socit fodale
440
(316) Sur les routes de lmigration. Mmoires de la duchesse de Saulx-Tavannes, d. de
Valous, 1934, Introduction, p. 10.
(317) La condition servile de ce personnage comme la bien vu W. M. NEWMAN ( Le
domaine royal sous les premiers Captiens, 1937, p. 24, n 7) ressort du fait que le roi
recueillit, aprs sa mort, sa mainmorte.
(318) Quellenwerk zur Entstehung der schweizerischen Eidgenossenschaft, n 1650.
(319) K. ROST, Die Historia pontificum Romanorum aus Zwettl, Greifswald, 1932, p. 177, n
4.
(320) Voir, notamment, Z. N. BROCKE, dans Cambridge Historical Journal, t. II, p. 222.
(321) Ci-dessus, p. 444.
(322) Jacques P. MIONS, P. L., t. CLXXXIX, col. 146. P. ABELARDI, Opera, d. V.
COUSIN. t. I, p. 572.
(323) A. WAUTERS, Les liberts communales. Preuves, Bruxelles, 1869, p. 83 (1221, avril).
Cf. Marc BLOCH, dans Anuario de historia del derecho espaol, 1933, p. 79 et s.
(324) L. RAYNAL, Histoire du Berry, t. I, 1845, p. 477, n XI (1071, 23 avril 1093, 22
avril. Saint-Silvain de Levroux).
(325) GUIBERT DE NOGENT, Histoire de sa vie, I, 11 (d. Bourgin, p. 31). THIETMAR
DE MERSEBOURG, Chronicon, II, 27 (d. Holtzmann, pp. 72-73). Texte pique
caractristique : Garin le Lorrain, d. P. Paris, t. I, p. 2.
(326) On a parfois prt aux papes de la grande poque grgorienne le dessein de se constituer
en seigneurs fodaux de certains rois. Il semble bien, en fait, quils se soient borns rclamer
et parfois obtenir un serment de fidlit et un tribut : formes de sujtion, assurment, mais
qui navaient rien de proprement fodal. Lhommage ne fut alors demand q u de simples
princes territoriaux (chefs normands de lItalie du Sud ; comte languedocien de Substantion).
Jean sans Terre, il est vrai, le prta, mais beaucoup plus tard (1213).
(327) JAFF-WATTENBACH, Regesta pontificum, t. I, n 3564. RATHIER DE
VRONE, dans MIGNE, P. L., t. CXXXVI, col. 249. THIETMAR, Chronicon, I, 26 (p.
34-35).
(328) Lun des plus anciens exemples souvent omis : G. BUSSON et LEDRU, Actus
Pontificum Cenomannensium, p. 299 (832).
(329) JOINVILLE, c. CXXXVI.
(330) Cf. le synode de Paris, 1212 : MANSI, Concilia, t. XXII, col. 851, c. 8 (feneratoribus et
exactoribus).
(331) A. GIRY, Documents sur les relations de la royaut avec les villes, 1885, n XX, p. 58.
(332) Institution de paix de Laon (1128, 26 aot) dans WARNKNIG et STEIN,
Franzsische Staats und Rechtsgeschichte, t. I, Urkundenbuch, p. 31, c. 2.
(333) Cartulaire du prieur de N.-D. de Longpont, d. MARION, n 25.
(334) ORTLIEB DE ZWIEFALTEN, Chronicon, I, c. 9 dans SS., t. X, p. 78.
(335) Monumenta Gildhallae Londoniensis (Rolls Series), t. I, p. 66.
(336) ROGER DE HOVEDEN, Chronica (Rolls Series), t. I, 228.
(337) WARNKNIG et STEIN, op. cit., p. 34, c. 22.
(338) RANGERIUS, Vita Anselmi, dans SS., XXX, 2, p. 1256, v. 4777 et s.
Marc BLOCH La socit fodale
441
(339) Diplom. regum et imp., t. III, n 34. Histor. de France, t. XV, p. 144, n CXIV.
(340) FLODOARD, Historia Remensis ecclesiae, t. IV, 5, dans SS., t XIII, p. 563.
(341) LIUDPRAND, Antapodosis, II, c. 26.
(342) WIPONIS, Opera, d. BRESSLAU, pp. 3 et 106.
(343) Hermann BLOCH, dans Neues Archiv, 1897, p. 115.
(344) On a quelquefois soutenu que le titre de duc de France, port, depuis Robert Ier, par les
Robertiens, exprimait une sorte de vice-royaut sur le royaume entier. Il est possible que
certains contemporains aient eu ce sentiment encore que je nen voie nulle ar t dexpression
bien nette dans les textes (le terme de dux Galliarum employ par Richer, II, 2, nest quune
traduction pdante de dux Franciae ; II, 39, omnium Galliarum ducem constituit fait allusion
linvestiture Hugues le Grand du duch de Bourgogn e, ct du duch de France). Mais
que le sens premier ft territorial ne semble point douteux. Dans lhypothse con traire,
comment comprendre la runion des trois duchs, tente par Hugues ? Peut-tre la dignit de
comte du palais (royal) avait-elle galement t divise, comme en Allemagne, selon les
mmes lignes, chaque duch ayant dsormais son comte du palais particulier : ainsi
sexpliquerait le titre de comte palatin paralllement revendiqu, en France par le comte
de Flandre, en Bourgogne par le comte de Troyes (dit, plus tard, de Champagne ), en
Aquitaine par le comte de Toulouse. Pour le titre royal tripartite, Rec. des Hist. de France, t.
IX, pp. 578 et 580 (933 et 935).
(345) GISLEBERT DE MONS, d. Pertz, pp. 223-224 et 58.
(346) Monumenta Boica, t. XXIX, 1, n CCCCXCI ; Wrttemberger Urkundenbuch, t. II, n
CCCLXXXIII.
(347) SUGER, Vie de Louis VI, d. Waquet, p. 228.
(348) Aucune tude dtaille sur lavouerie post -carolingienne en France ; cest une des
lacunes les plus graves des recherches sur le moyen ge et une des plus aises combler. En
Allemagne linstitution a surtout t examine non sans un certain abus de la thorie
dans ses rapports avec le systme judiciaire.
(349) Mm. Soc. archol. Eure-et-Loir, t. X, p. 36, et Gallia christ., t. VIII, instr., col. 323.
(350) De rebus, d. Lecoy de La Marche, p. 168.
(351) Diplom. regum et imperatorum, t. III, n 509.
(352) BONIZO, Liber de vita christiana, d. Perels, 1930 (Texte zur Geschichte des
rmischen und kanonischen Rechts), VII, 248.
(353) Cartulaire de Redon, d. de Courson, p. 298, n CCCXLVII ; cf. p. 449. Siegfried
Hirsch, Jahrbcher des Deutschen Reiches unter Heinrich II, t. III, p. 174.
(354) Et. de Saint Louis, I, 53.
(355) BIGELOW, Placita Anglo-Normannica, p. 145.
(356) Constitutiones regum et imp., t. I, N XIII, pp. 28-29.
(357) SS. rer., Langob. Saec. VI-IX (Mon. Germ. ), p. 385, c. 166.
(358) Cartulaire de Saint-Aubin dAngers , d. B. de BroussilIon, t. II, n DCCX, 1138, 17
sept.)
(359) Constitutiones, t. I, p. 643, c. 30. Two of the Saxon Chronicles, d. Plummer, t. I, p.
220. Impossible daccumuler les anecdo tes. Il en faudrait cependant, pour faire saisir la
vraie couleur de lpoque. Henri II dAngleterre, par exemple, na pas laiss la rputation
dune bte sauvage. Voyez, pourtant, dans Orderic Vital, comment le mari dune de ses
Marc BLOCH La socit fodale
442
btardes ayant fait arracher les yeux au jeune fils dun chtelain royal, il ordonna son tour
que fussent aveugles et mutiles ses propres petites-filles.
(360) M. ASHDOWN, English and Norse documents relating to the reign of Ethelred the
Unready, 1930, p. 137. KNUT, Lois, II, 21.
(361) Les ouvrages relatifs lhistoire des paix de Dieu (notamment HUBERTI, Studien zur
Rechtsgeschichte der Gottesfrieden und Landesfrieden : I, Die Friedensordnungen in
Frankreich, Ansbach, 1892 ; GRRIS, De denkbeelden over oorlog en de bemoeeiingen voor
vrede in de effide eeuw (Les ides sur la guerre et les efforts en faveur de la paix au XIe
sicle), Nimgue, 1912 (Diss. Leyde), contenant de nombreuses rfrences, faciles
retrouver, on voudra bien ne pas stonner de trouver dans ce qui va suivre un grand nombre
de citations sans renvois.
(362) Dans le sud de la pninsule, la trve de Dieu fut introduite par un pape franais (Urbain
II) et les barons normands : JAMISON, dans Papers of the British School at Rome, 1913, p.
240.
(363) Histoire de Languedoc, t. V, col. 15.
(364) R. BUSQUET, dans Les Bouches-du-Rhne. Encyclopdie dpartementale. Premire
partie, t. II. Antiquit et moyen ge, 1924, p. 563.
(365) SS., t. XXIII, p. 361. Cf. FRENSDORFF dans Nachr. von der Kgl. Gesellsch. zu
Gttingen. Phil.-hist. Kl., 1894. La mme transformation eut lieu en Catalogne et Aragon.
(366) Voir plus haut p. 377 et s.
(367) Revenu quotidien la mort de Philippe Auguste, daprs le tmoignage de Conon de
Lausanne : 1200 livres parisis (SS., t. XXIV, p. 782). Revenu annuel de labbaye
Sainte-Genevive de Paris, daprs une estimation pour les dcimes, en 1246 : 1810 livres
par. ; Biblioth. Sainte-Genevive, ms. 356, p. 271. Le premier chiffre probablement trop haut,
le second trop bas. Ajoutez, cependant, pour rtablir lcart, quune hausse des pri x, entre les
deux dates, est vraisemblable. De toutes faons le contraste est saisissant.
(368) RICHER, IV, 80.
(369) Gesta ep. Cameracensium, III, 2, dans SS., XVII, p. 466 ; Cf. III, 40, p. 481.
(370) TARDIF, Cartons des rois, n 264.
(371) Esprit des Lois, XXXI, 30.
(372) Lettres, d. Havet, n 12 et 37.
(373) Marc BLOCH, La vie de S. Edouard le Confesseur par Osbert, dans Analecta
Bollandiana, t. XLI, 1923, pp. 22 et 38.
(374) Outre la Bibliographie, (p. 673, sous-titre : Les Nationalits ) voir LOT, Les derniers
carolingiens, p. 308 et s. LAPOTRE, LEurope et le Saint-Sige, 1895, p. 330 et s. F.
KERN, Die Anfnge der franzsischen Ausdehnungspolitik, 1910, p. 124 et s. M. L.
BULSTTHIELE, Kaiserin Agnes, 1933, p. 3, n 3.
(375) ABBO, De bello Parisiaco, d. Pertz, I, v. 618 ; II, v. 344 et 452. ADMAR DE
CHABANNES, Chronique, d. Chabanon, p. 151. Gesta ep. Leodensium, II, 26 dans SS., t.
VII, p. 204. WIDUKIND, d. P. Hirsch, I, 9 et 11 ; II, 3. THIETMAR DE
MERSEBOURG, d. R. Holtzmann, V, 12 et 19.
(376) SS., t. VI, p. 339 et 41-42.
(377) Prologue du Heliand, d. E. Sievers, p. 3. La distinction des vassaux royaux Teutisci
quam et Langobardi est faite dans un acte italien de 845 (MURATORI, Ant., t. II, col. 971).
Annales Juvavenses maximi, dans SS., t. XXX, 2, p. 738.
Marc BLOCH La socit fodale
443
(378) LIUDPRAND, Legatio, c. 7.
(379) WALAFRID STRABO, De exordiis, c. 7, dans Capitularia reg. Francorum, t. II, p.
481. RICHER, I, 20.
(380) EUDES DE DEUIL, dans SS., t. XXVI, p. 65.
(381) EKKEHARD DAURA, dans SS., t. VI, p. 218.
(382) Girart de Roussillon, trad. P. MEYER, 631 ; d. Foerster, (Romanische Studien, V) v.
9324.
(383) Esprit des Lois, XXX, I. VOLTAIRE, Fragments sur quelques rvolutions dans
lInde , II (d. Garnier, t. XXIX, p. 91).
(384) G. LEFEBVRE, Les paysans du Nord, 1924, p. 309.
(385) Par exemple, E. LODGE, Serfdom in the Pyrenees, dans Vierteljahrschr. fr Soz. und
WG., 1905, p. 31. SANCHEZ-ALBORNOZ, Estampas de la vida en Len, 2e d., p. 86,
N 37. PERRECIOT, De ltat civil des personnes , t. II, 1786, p. 193, n 9.
(386) DUDON DE SAINT-QUENTIN, d. Lair, Mm. Soc. Antiquaires Normandie, t. XXIII,
III, 43-44 (1933).
(387) P. HVIN, Consultations et observations sur la coutume de Bretagne, 1724, p. 343.
(388) P. THOMAS, Textes historiques sur Lille et le Nord, t. II, 1936, p. 285 (1385 et 1397) ;
cf. p. 218 (n 68).
(389) T. F. TOOT, Chapters in the administrative history, t. IV, 1928, p. 62.
(390) COLBERT, Lettres, d. P. Clment, t. II, p. XXX. Pour un exemple ancien de promesse
damiti, voir J. QUICHERAT, Rodrigue de Villandrando, 1879, p. just., n XIX.
(391) Ch. AIMOND, Histoire de la ville de Varennes, 1925, p. 50.
(392) MANEGOLD DE LAUTENBACH, dans Libelli de lite (Mon. Germ. ), t. I, p. 365.
WENRICH, Ibid., p. 289. Paul DE BERNRIED, Vita Gregorii, c. 97 dans WATTERICH,
Romanorum pontificum vitae, t. I, p. 532.
(393) Landr. III, 78, 2. Sens contest par ZEUNIER dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung,
G.A., 1914, pp. 68-75 ; bien rtabli par KERN, Gottesgnadentum and Widerstandsrecht im
frheren Mittelalter, 1914.
Marc BLOCH La socit fodale
444
BIBLIOGRAPHIE
TOME I.
LA FORMATION DES LIENS DE DPENDANCE
NOTE POUR LUSAGE DE LA BIBLIOGRAPHIE
p.638 Une bibliographie de la socit fodale, telle que ltude du sujet a t comprise ici,
exigerait une place dmesure ; et elle doublerait inutilement, en nen donnant quune
reproduction rduite, dautres listes. Pour les sources, je me suis donc born indiquer les
grands inventaires quen ont dresss les rudits. Seuls ont t recenss part, dans ce volume,
les principaux documents de la littrature juridique. Quant aux travaux des historiens, il a
sembl que sur les aspects sociaux qui nont t ci -dessus abords que de biais mentalit,
vie religieuse, modes dexpression littraire , il suffisait de prier, une fois pour toutes, le
lecteur de se reporter aux autres volumes de l volution de lHumanit, o ces problmes sont
ou seront traits pour eux-mmes. Exception a t faite, seulement, pour quelques questions
qui ont t lobjet dune attention particulire et ne seront sans doute pas reprises ailleurs :
telles, les terreurs de lan mille. Je me suis, par contre, attach fournir des bibliographies
de travail beaucoup plus compltes sur les dernires invasions dune part, les faits de structure
sociale de lautre. Bibliographies choisies, cela va de soi. Parmi les lacunes que pourront y
relever les spcialistes, il en est assurment dinvolontaires. Mais aussi de pleinement
conscientes : soit quayant t dans limpossibilit de me procurer louvrage, je me sois refus
le citer sur la parole dautrui ; soit que layant c onsult, il ne mait pas paru devoir tre
retenu.
Il convient dajouter que, dans le tome qui suit celui -ci et est consacr ltude des
classes et du gouvernement des hommes, durant lre fodale, une autre bibliographie trouve
place, rserve aux questions traites dans ce second ouvrage. On prend la libert dy
renvoyer, par avance (p. 663), pour les problmes qui, destins tre alors examins plus
fond, ont d cependant tre dj en quelque mesure effleurs dans le prsent expos.
Un classement a t tent. Comme tous les classements, il est imparfait. Tel quel, il a
sembl plus pratique quune numration tout dun trait.
p.639 Le plan des principales divisions est donn ci-dessous. A lintrieur de chaque
rubrique, lordre suivi, selon les cas mthodique, gographique ou simplement alphabtique,
ne prsentera, esprons-nous, gure de difficults lusager. Les ouvrages sans indication de
lieu ont t publis Paris.
[css a soulign une vingtaine darticles publis dans diffrentes revues
disponibles sur le site Gallica de la Bibliothque Nationale de France.]
PLAN DE LA BIBLIOGRAPHIE
I. Les tmoignages. 1. Principaux inventaires des documents. 2. Smantique
historique et emploi des diverses langues. 3. Lhistoriographie. 4. Dpouillements des
tmoignages littraires.
Marc BLOCH La socit fodale
445
II. Les attitudes mentales. 1. Faons de sentir et de penser ; murs ; instruction. 2.
Les terreurs de lan mille.
III. Principales histoires gnrales. 1. LEurope. 2. Histoires nationales ou par
rgnes.
IV. Structure juridique et politique. 1. Principales sources juridiques. 2. Principaux
ouvrages sur lhistoire des institutions et du droit. 3. La mentalit juridique et
lenseignement du droit. 4. Les ides politiques.
V. Les dernires invasions. 1. Gnralits. 2. Les Sarrasins dans les Alpes et lItalie
pninsulaire. 3. Les Hongrois. 4. Les Scandinaves en gnral et leurs invasions. 5.
La conversion du Nord. 6. Traces et effets des invasions scandinaves.
VI. Les liens du sang. 1. Gnralits ; solidarit criminelle. 2. Le lignage comme
socit conomique.
VII. Les institutions proprement fodale. 1. Gnralits ; origines de la fodalit
franque. 2. tudes par pays ou par rgions. 3. Compagnonnage, vassalit, hommage.
4. Prcaire, bienfait , fief et alleu. 5. Le droit du fief. La pluralit des seigneurs et
lhommage lige.
VIII. Le rgime fodal comme institution militaire. 1. Ouvrages gnraux sur lart
militaire et les armes. 2. Les problmes de la cavalerie et de larmement. 3.
Lobligation militaire et les armes soldes. 4. Le chteau.
IX. Les liens de dpendance dans les classes infrieures.
X. Quelques pays sans fodalit. 1. La Sardaigne. 2. Les socits allemandes des
rives de la mer du Nord.
I. LES TMOIGNAGES
1. Principaux inventaires de documents 1.
POTTHAST (August), Bibliotheca historica medii aevi, 2 vol., Berlin, 1875-96.
MANMUS (Max. ), Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 3 vol. Munich,
1911-1931 (Handbuch der Klassischen Altertumswissenschaft, herausgg. von I. MLLER.
UEBERWEG (Friedrich), Grundriss der Geschichte der Philosophie, t. II, 11e d., Berlin,
1928.
Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, 2 vol. et 1 vol. de supplment,
Bruxelles, 1898-1911.
DAHLMANN-WAITZ, Quellenkunde der deutschen Geschichte, 9e d., Leipzig, 2 vol.,
1931-32. p.641
JACOB (Karl), Quellenkunde der deutschen Geschichte im Mittelalter, Berlin, 1917
(Sammlung Gschen).
JANSEN (M.), et SCHMITZ-KALLENBERG (L. ), Historiographie und Quellen der
deutschen Geschichte bis 1500, 2e dit., Leipzig, 1914 (A. MEISTER, Grundriss, I, 7).
A lexception des sources littraires en langue vulgaire.
Marc BLOCH La socit fodale
446
VILDHAUT (H. ), Handbuch der Quellenkunde zur deutschen Geschichte bis zum
Ausgange der Staufer, 2e d., 2 vol., Werl, 1906-09.
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen in Mittelalter bis zur Mitte des
dreizehnten Jahrhunderts, t. I, 7e d., Berlin, 1904, t. II, 6e d., Berlin, 1874.
WATTENBACH (W.) et HOLTZMANN (R.), Deutschlands Geschichtsquellen im
Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, t. 1, fasc. 1, Berlin, 1938.
GROSS (Charles), The sourcesand literature of English history from the earliest times to
about 1485, 2e d., Londres, 1915.
PIRENNE (Henri), Bibliographie de lhistoire de Belgique, 3e d., Bruxelles, 1931.
BALLESTER (Rafael), Fuentes narrativas de la historia de Espaa durante la Edad
Media, Palma, 1912.
BALLESTER (Rafael), Bibliografia de la historia de Espaa, Grone, 1921.
MOLINIER (Auguste), Les sources de lhistoire de France des orig ines aux guerres
dItalie, 6 vol., 1901-1906.
EGIDI (Pietro), La storia medievale, Rome, 1922.
OESTERLEY (H.), Wegweiser durch die Literatur der Urkunden-Sammlung, 2 vol.,
Berlin, 1886.
STEIN (Henri), Bibliographie gnrale des cartulaires franais ou relatifs lhistoire de
France, 1907.
2. Smantique historique et emploi des diverses langues.
ARNALDI (Fr.), Latinitatis Italicae medii aevi inde ab A. CDLXXVI usque ad A. MDXXII
lexicon imperfectum dans Archivum latinitatis medii aevi, t. X, 1936.
BAXTER (J.-H.), etc. Medieval latin word-list from British and Irish sources, Oxford,
1934.
DIEFENBACH (L.), Glossarium latino-germanicum mediae et infimae latinitatis,
Francfort, 1857. Novum Glossarium, Francfort, 1867.
Du CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, d. HENSCHEL, 7 vol., 1830-50.
Rimpression, Niort, 1883-1887.
HABEL (E.), Mittellateinisches Glossar, Paderborn, 1931.
MEYER-LBKE (W.), Romanisches Etymologisches Wrterbuch, 3e d., Heidelberg,
1935.
KLUGE (Friedrich), Etymologisches Wrterbuch der deutschen Sprache, 11e d., Berlin,
1934.
MURRAY (J. A. H.), The Oxford English dictionary, Oxford, 1888-1928.
BLOCH (Oscar) avec la collaboration de W. von WARTBURG, Dictionnaire
tymologique de la langue franaise, 1932.
GAMILLSCHEG (E.), Etymologisches Wrterbuch der franzsischen Sprache,
Heidelberg, 1928.
WARTBURG (W. von), Franzsisches etymologisches Wrterbuch, 1928 et suiv.
Marc BLOCH La socit fodale
447
BRUNEL (Cl.), Le latin des chartes dans Revue des tudes latines, 1925.
HECK (Philippe), Uebersetzungsprobleme im frheren Mittelalter, Tubingue, 1931.
HEGEL (Karl), Lateinische Wrter und deutsche Begriffe dans Neues Archiv der
Geselischaft fr ltere deutsche Geschichtskunde, 1893. p.642
OGLE (M.-B.), Some aspects of mediaeval latin style dans Speculum, 1926.
STRECKER (Karl), Introduction ltude du latin mdival, traduction P. VAN DE
WOESTIJNE, Gand, 1933.
TRAUBE (L.), Die lateinische Sprache des Mittelalters dans TRAUBE, Vorlesungen und
Abhandlungen, t. II, Munich, 1911.
BRUNEL (Cl.), Les premiers exemples de lemploi du provenal dans Romania, 1922.
MERKEL (Felix), Das Aufkommen der deutschen Sprache in den stdtischen Kanzleien
des ausgehenden Mittelalters, Leipzig, 1930 (Beitrge zur Kulturgeschichte des Mittelalters,
45).
NLIS (H.), Les plus anciennes chartes en flamand dans Mlanges dhistoire offerts H.
Pirenne, Bruxelles, 1926, t. I.
OBREEN (H.), Introduction de la langue vulgaire dans les documents diplomatiques en
Belgique et dans les Pays-Bas dans Revue belge de philologie, 1935.
VANCSA (Max), Das erste Auftreten der deutschen Sprache in den Urkunden, Leipzig,
1895 (Preisschriften gekrnt... von der frstlich Jablonowskischen Gesellschaft,
histor-nationalkonom. Section XXX).
3. Lhistoriographie
BALZANI (Ugo), Le cronache italiane nel medio evo, 2e d., Milan, 1900.
GILSON (E.), Le moyen ge et lhistoire dans GILSON, Lesprit de la philosophie
mdivale, t. II, 1932.
HEISIG (Karl), Die Geschichtsmetaphysik des Rolandliedes und ihre Vorgeschichte dans
Zeitschift fr romanische Philologie, t. LV, 1935.
LEHMANN (Paul), Das literarische Bild Karls des Grossen, vornehmlich im lateinischen
Schrifttum des Mittelalters dans Sitzungsber. der bayerischen Akad., Phil.-hist. Kl., 1934.
POOLE (R.-L.), Chronicles and annals : a brief outline of their origin and growth,
Oxford, 1926.
SCHMIDLIN (Joseph), Die geschichtsphilosophische und kirchenpolitische
Weltanschauung Ottos von Freising. Ein Beitrag zur mittelalterlichen Geistesgeschichte.
Fribourg-en-Brisgau, 1906 (Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte, hgg.
von H. GRAUERT, IV, 2-3).
SPRL (Johannes), Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung, Munich,
1935.
4. Dpouillements des tmoignages littraires
Marc BLOCH La socit fodale
448
ACHER (Jean), Les archasmes apparents dans la Chanson de Raoul de Cambrai dans
Revue des langues romanes, 1907. [pp. 237 sqq].
FALK (J.), tude sociale sur les chansons de geste, Nykping, 1879.
KALBELFISCH Die Realien im altfranzsischen Epo Raoul de. Cambrai , Giessen,
1897 (Wissenchaftliche Beilage zum Jahresbericht des Grh. Realgymnasiums).
MEYER (Fritz), Die Stnde, ihr Leben und Treiben dargestellt nach den altfr. Artus- und
Abenteuerromanen, Marbourg, 1892 (Ausg. und Abh. aus dem Gebiete der roman. Philologie,
89).
TAMASSIA (G.), Il diritto nell epica francese dei secoli XII e XIII dans Revist italiana
per le scienze giuridiche, t. I, 1886.
II. LES ATTITUDES MENTALES p.643
1. Faons de sentir et de penser ; murs ; instruction 1.
BESZARD (L.), Les larmes dans lpope, Halle, 1903.
BILFINGER, Die mittelalterlichen Horen und die modernen Stunde, Stuttgart, 1892.
DOBIACHE-RODJESVENSKY, Les posies des Goliards, 1931.
DRESDNER (Albert), Kultur- und Sittengeschichte der italienischen Geistlichkeit im 10.
und 11. Jahrhundert, Breslau, 1910.
EICKEN (Heinrich v.), Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung,
Stuttgart, 1887.
GALBRAITH (V. H.), The literacy of the medieval English kings, dans Proceedings of the
British Academy, 1935.
GHELLINCK (J. de), Le mouvement thologique du XIIe sicle, 1914.
GLORY (A.) et UNGERER (Th.), Ladolescent au cadran solaire de la cathdrale de
Strasbourg, dans Archives alsaciennes dhistoire de lart, 1932.
HASKINS (Ch. H.), The renaissance of the twelfth century, Cambridge (Mass.), 1927.
HOFMEISTER (Ad.), Puer, iuvenis, senex : zum Verstndnis der mittelalterlichen
Altersbezeichnungen dans Papstum und Kaisertum... Forsch. P. Kehr dargebr., 1926.
IRSAY (St. d), Histoire des universits franaises et trangres, t. I, 1933
JACOBIUS (Helene), Die Erziehung des Edelfraleins im alten Frankreich nach
Dichtungen des XII., XIII. und XIV. Jahrhunderts, Halle, 1908 (Beihefte zr Zeitschr. fr
romanische Philologie, XVI).
LIMMER (Rod.), Bildungszustnde und Bildungsideen des 13. Jahrhunderts, Munich,
1928.
PAR (G.) BRUNET (A.) TREMBLAY (P.), La renaissance du XIIe sicle : les coles et
lenseignement, 1933 (Publications de lInstitut dtudes mdivales dOttawa, 3).
Bibliographie trs sommaire, notamment pour linstruction ; les ouvrages cits renverront
aux autres tudes, plus anciennes ou plus dtailles.
Marc BLOCH La socit fodale
449
RASHDALL (H.), The Universities of Europe in the middle ages, 2e d. par F. M.
POWICKE et A. B. EMDEN, 3 vol., Oxford, 1936.
SASS (Johann), Zur Kultur- und Sittengeschichte der schsischen Kaiserzeit, Berlin, 1892.
SSSMILCH (Hans), Die Lateinische Vagantenpoesie des 12. und 13. Jahrhunderts als
Kulturerscheinung, Leipzig, 1917 (Beitrge zur Kulturgesch. des Mittelalters und der
Renaissance, 25).
2. Les terreurs de lan mille
BURR (G. L.), The year 1000 dans American Histor. Review, 1900-01.
EICKEN (H. von), Die Legende von der Erwartung des Weltuntergangs und der
Wiederkehr Christi im Jahre 1000 dans Forschungen zur deutschen Gesch., t. XXIII, 1883.
ERMINI (Filippo), La fine del mondo nellanno mille e il pensiero di Odone di Cluny dans
Studien zur lateinischen Dichtung des Mittelalters, Ehrengabe fr K. Strecker, Dresde, 1931
(Schriftenreihe der Histor. Vierteljahrschrift, 1).
GRUND (Karl), Die Anschauungen des Radulfus Glaber in seinen Historien, Greifswald,
1910. p.644
ORSI (P.), Lanno mille dans Rivista storica italiana, IV, 1887.
PLAINE (dom Franois), Les prtendues terreurs de lan mille dans Revue des questions
historiques, t. XIII, 1873.
WADSTEIN (Ernst), Die eschatologische Ideengruppe : Antichrist- Weltsabbat-Weltende
und Weltgericht, Leipzig, 1896.
III. PRINCIPALES HISTOIRES GNRALES
1. LEurope
BARBAGALLO (Corrado), Il medio evo, Turin, 1935.
CALMETTE (Joseph), Le monde fodal, S. d. (Clio, 4).
The Cambridge Medieval history, 8 vol., Cambridge, 1911-1936.
CARTELLIERI (Alexander), Weltgeschichte als Machtgeschichte : 382 911. Die Zeit der
Reichsgrndungen. Die Weltstellung des deutschen Reiches, 911-1047, 2 vol., Munich,
1927 et 1932.
EAST (Gordon), An historical geography of Europe, Londres, 1935.
GLOTZ (G.), Histoire gnrale : Histoire du moyen ge, t. I, Les destines de lEmpire en
Occident, par F. LOT, Chr. PFISTER, F. L. GANSHOF, 1928-1935 t. II LEurope
occidentale de 888 1125, par A. FLICHE, 1930. t. IV, 2, Lessor des tats dOccident,
par Ch. PETIT-DUTAILLIS et P. GUINARD, 1937.
HASKINS (Ch. H.), The Normans in European history, Boston, 1915.
PIRENNE (Henri), Histoire de lEurope, des invasions au X VI sicle, 1936.
Marc BLOCH La socit fodale
450
VOLPE (G.), Il medio evo, Florence [1926].
2. Histoires nationales ou par rgnes 1
GEBHARDT (Bruno), Handbuch der deutschen Geschichte, t. I, 7e d., Stuttgart, 1930.
Jahrbcher der deutschen Geschichte, Berlin, depuis 1862 (Pour le dtail, voir
DAHLMANN-WAITZ, p. 640).
HAMPE (Karl), Herrschergestalten des deutschen Mittelalters, Leipzig [1927].
LAMPRECHT (Karl), Deutsche Geschichte, t. II et III, Berlin, 1892-93.
BHLER (Johannes), Deutsche Geschichte. Urzeit, Bauerntum und Aristocratie bis um
1100, Berlin, 1934.
MANITIUS (Max.), Deutsche Geschichte unter den schsischen und salischen Kaisern,
Stuttgart, 1889.
CARTELLIERI (AI.), Kaiser Otto II dans Beitrge zur thringischen und schsischen
Geschichte, Festschrift fr O. Dobenecker, 1929.
CARTELLIERI (AI.), Otto III, Kaiser der Rmer dans Judeich-Festschrift, 1929.
TER BRAAK (Menno), Kaiser Otto III, Amsterdam, 1928.
HAMPE (Karl), Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer, 3e d.,
Leipzig.
HUNT (W.) et POOLE (R. L.), The political history of England, t. I, To 1066, par Th.
HODGKIN, Londres, 1920 ; t. II, 1066-1216, par G. B. ADAMS, 1905 ; t. III, 1216-1377, par
T. F. TOUT, 1905. p.645
OMAN (C.-W. C), A history of England, t. I, Before the Norman Conquest, par C. W.
OMAN, Londres, 1910 ; t. II, Under the Normans and Angevins, par H. W. C. DAVIS, 1905.
RAMSAY (J. H.), The foundations of England C. B. C. 55, A. D. 1154, 2 vol., Londres,
1890. The Angevin Empire, 1154-1216, 1903. The dawn of the constitution, 1908.
HODGKIN (R. H.), A history of the Anglo-Saxons, 2 vol., Oxford, 1935.
LEES (B. A.), Alfred the Great, Londres, 1915.
PLUMMER (Charles), The life and time of Alfred the Great, Oxford, 1902.
LARSON (L. M.), Canute the Great, New York, 1912.
STENTON (F. M.), William the Conqueror and the rule of the Normans, Londres, 1908.
NORGATE (K.), Richard the Lion Heart, Londres, 1924.
PIRENNE (Henri), Histoire de Belgique, t. I, 3e d., Bruxelles, 1929.
POUPARDIN (Ren), Le royaume de Bourgogne (888-1038), 1907 (Biblioth. c. Hautes
tudes, Sc. histor. 163).
Les ouvrages relatifs aux provinces seront groups, dans la bibliographie du tome suivant,
avec les travaux concernant lhistoire des principauts territoriales (cf. p. 671).
Marc BLOCH La socit fodale
451
ALTAMIRA (R.), Historia de Espaa y de la civilizacin espaola, t. I et II, 4e d.,
Barcelone, 1928-29.
BALLESTEROS Y BERETTA (Antonio), Historia de Espaa y su influencia en la
historia universal, t. II, Barcelone, 1920.
ANGLS, FOLCH I TORRS, LAUER (Ph.), DOLWER (Nicolau), PUIG I
CADAFALCH, La Catalogne lpoque romane, Paris, 1932 (Universit de Paris,
Bibliothque dart catalan, II) .
LAVISSE (E.), Histoire de France, t. II, 1 (C. BAYET, C. PFISTER, A.
KLEINCLAUSZ), t. II, 2 et III, 1 (A. LUCHAIRE) ; t. III, 2 (Ch.-V. LANGLOIS),
1901-1903.
KALCKSTEIN (K. von), Geschichte des Franzsischen Knigtums unter den ersten
Kapetingern, I. Der Kampf der Robertinern und Karolingern, Leipzig, 1877.
FAVRE (E.), Eudes, comte de Paris et roi de France, 1893 (Bibliothque c. Hautes
tudes, Sc. histor., 99).
ECKEL (A.), Charles le Simple, 1899 (Bibliothque Ec. Hautes Etudes, Sc. histor., 124).
LAUER (Ph.), Robert Ier et Raoul de Bourgogne, 1910.
LAVER (Ph.), Le rgne de Louis IV dOutre -Mer, 1900 (Bibliothque c. Hautes tudes,
Sc. histor., 127).
LOT (Ferdinand), Les derniers Carolingiens, 1891 (Bibliothque c. Hautes tudes, Sc.
histor., 87).
LOT (Ferdinand), tudes sur le rgne de Hugues Capet, 1903 (Bibliothque c. Hautes
tudes, Sc. histor., 147).
PFISTER (C.), tudes sur le rgne de Robert le Pieux, 1885 (Bibliothque c. Hautes
tudes, Sc. histor., 64).
FLICHE (Augustin), Le rgne de Philippe Ier, 1912.
LUCHAIRE (Achille), Louis VI le Gros. 1890.
CARTELLIERI (Al.), Philipp II August, Leipzig, 1899-1922.
PETIT-DUTAILLIS (Ch.), Etude sur la vie et le rgne de Louis VIII, 1894.
CASPAR (Erich), Roger II (1101-1151) und die Grndung der normannischsicilischen
Monarchie, Innsbruck, 1904.
CHALANDON (F.), Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, 2 vol.,
1907.
MONTI (G. M.), Il mezzogiorno dIt alia nel medio evo, Bari, 1930.
PONTIERI (E.), LEICHT (P. S.) etc., Il regno normanno, Milan, 1932.
POUPARDIN (R.), Le royaume de Provence sous les Carolingiens, 1901 (Biblioth. c.
Hautes tudes, Sc. histor., 131).
PARISOT (R.), Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843-923), 1899.
IV. STRUCTURE JURIDIQUE ET POLITIQUE p.646
1. Principales sources juridiques
Marc BLOCH La socit fodale
452
Capitularia regum Francorum, d. A. BORETIUS et V. KRAUSE, Hanovre, 1883-1897
(Mon. Germ., in-4).
Formulae merowingici et Karolini aevi, d. K. ZEUMER, Hanovre, 1886 (Mon. Germ.,
in-4).
Sachsenspiegel, d. K. A. ECKHARDT, Hanovre, 1933 (Mon. Germ., Fontes iuris
germanici, Nova series).
ATTENBOROUGH (F. L.), The laws of the earliest English Kings, Cambridge, 1922.
LIEBERMANN (F.), Die Gesetze der Angelsachsen, 3 vol., Halle, 1903-1916 (comprend
galement les coutumiers de lpoque normande et un prcieux index historique) 1.
ROBERTSON (A. J.), The laws of the kings of England from Edmund to Henry I,
Cambridge, 1925.
BRACTON, De legibus et consuetudinibus Angliae, d. G.-E. WOODBINE, 2 vol.,
New-Haven (U.S.) 1915-1932 (Yale Hist. Publ. Ms. III) ; d. Twiss, 6. vol., Londres, 1878-83
(Rolls Series).
GLANVILL, De legibus et consuetudinibus regni Angliae, d. G. E. WOODBINE,
New-Haven (U. S.), 1932 (Yale Historical Publications, Manuscripts, XIII).
Le Conseil de Pierre de Fontaines, d. A.-J. MARNIER, 1886.
Les tablissements de Saint Louis, d. P. VIOLLET, 4 vol., 1881-1886 (Soc. de lHist. de
France).
FOURGOUS (J.), et BEZIN (G. de), Les Fors de Bigorre, Bagnres, 1901 (Travaux sur
lhistoire du droit mridional, fasc. 1).
PHILIPPE DE BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, d. A. SALMON, 2 vol.,
1899-1900 (Coll. de textes pour servir ltude... de lhi st.).
TARDIF (Joseph), Coutumiers de Normandie, 2 vol., Rouen, 1881-1903.
MUOZ ROMERO (T.), Coleccin de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de
Castilla, Len, Corona de Aragon y Navarra, t. I, Madrid, 1847.
Usatges de Barcelona, editats amb una introduccio per R. dABADAL I VINYALS i F.
VALLS TABERNER, Barcelone, 1913 (Textes de dret catala I).
ACHER (Jean), Notes sur le droit savant au moyen ge dans Nouvelle Revue historique du
droit, 1906 [pp. 125 sqq] (trait des hommages de J. de Blanot).
GUILLAUME DURAND. Speculum judiciale. (Le texte, compos entre 1271 et 1276, a
t plusieurs fois imprim).
LEHMANN (Karl), Das Langobardische Lehnrecht (Handschriften, Textentwicklung,
ltester Text und Vulgattext nebst den capitula extraordinaria), Gttingen, 1896.
SECKEL (Em.), Ueber neuere Editionen juristischer Schriften des Mittelalters dans
Zeitschrift der Savigny Stiftung, G. A, 1900 (sur les Summae feudorum du XIIIe sicle).
2. Principaux ouvrages sur lhistoire des institutions et du droit
Les rfrences aux lois anglo-saxonnes ont t donnes ci-dessus, par noms de rois ; celles
aux coutumiers, par leurs titres.
Marc BLOCH La socit fodale
453
MAYER (Ernst), Mittelalterliche Verfassunsgsgeschichte : deutsche und franzsische
Geschichte vom 9. bis zum 14. Jahrhundert, 2 vol., Leipzig, 1899. p.647
BELOW (Georg. v.), Der deutsche Staat des Mittelalters, t. I, Leipzig, 1914.
BELOW (Georg v.), Vom Mittelalter zur Neuzeit, Leipzig, 1924 (Wissenschaft und
Bildung, 198).
BRUNNER (Heinrich), Deutsche Rechtsgeschichte, 2 vol., 2e d., Leipzig, 1906 et 1928.
KEUTGEN (F.), Der deutsche Staat des Mittelalters, Ina, 1918.
MEYER (Walter), Das Werk des Kanzlers Gislebert von Mons besonders als
verfassungsgeschichtliche Quelle betrachtet, Knigsberg, 1888.
SCHRDER (R.), Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 6e d., Leipzig, 1919-1922.
WAITZ (G.), Deutsche Verfasungsgeschichte, t. I VI en 2e d., Berlin, 1880-1896 ; t. VII
et VIII, Kiel, 1876-78.
CHADWICK (H.M.), The origin of the English nation, Cambridge, 1924.
CHADWICK (H.M.), Studies in Anglo-Saxon Institutions, Cambridge, 1905.
HOLDSWORTH (W. S.), A history of English law, t. I, II et III, 3e d., Londres, 1923.
JOLLIFFE (J. E. A.), The constitutional history of medieval England, Londres, 1937.
MAITLAND (F. W.), Domesday Book and Beyond, Cambridge, 1921.
POLLOCK (Frederick) et MAITLAND (F. W.), The history of English law before the time
of Edward I, 2 vol., Cambridge, 1898.
POLLOCK (F.), The land laws, 3e d., Londres, 1896.
STUBBS (William), Histoire constitutionnelle de lAnglete rre, trad. par Ch.
PETIT-DUTAILLIS et G. LEFEBVRE, 3 vol., 1907-1927 (avec notes additionnelles par les
traducteurs).
VINOGRADOFF (P.), English society in the eleventh century. Oxford, 1908.
GAMA-BARROS (H. da), Historia da administraao publica em Portugal nos seculos XII
a XV, 2 vol., Lisbonne, 1885-96 (beaucoup de renseignements aussi sur le Len et la Castille).
MAYER (Ernst), Historia de las instituciones sociales y politicas de Espaa y Portugal
durante los siglos V a XIV, 2 vol., Madrid, 1925-26.
RIAZA (Romn) et GALLO (Alfonso Garcia), Manual de historia del derecho espanol,
Madrid, 1935.
SANCHEZ-ALBORNOZ (Cl.), Confirencias en la Argentina dans Anuario de historia
del derecho espaol, 1933.
SANCHEZ-ALBORNOZ (Cl.), La potestad real y los seorios en Asturias, Len y
Castilla dans Revista de Archivos, 3e srie, XXXI, 1914.
BESNIER (Robert), La coutume de Normandie. Histoire externe, 1935.
CHNON (mile), Histoire gnrale du droit franais public et priv, 2 vol., 1926-1929.
ESMEIN (A.), Cours lmentaire dhistoire du droit franais, 14e d., 1921.
FLACH (J.), Les origines de lancienne France, 4 vol., 1886-1917.
FUSTEL DE COULANGES, Histoire des institutions politiques de lancienne France, 6
vol., 1888-1892.
Marc BLOCH La socit fodale
454
HASKINS (Ch. H.), Norman institutions, Cambridge (Mass.), 1918 (Harvard Historical
Studies, XXIV).
KIENER (Fritz), Verfassungsgeschichte der Provence seit der Ostgothenherrschaft bis zur
Errichtung der Konsulate (510-1200), Leipzig, 1900.
LUCHAIRE (Achille), Manuel des institutions franaises. Priode des Captiens directs,
1892.
OLIVIER-MARTIN, Histoire de la coutume de la prvt et vicomt de Paris, 3 vol.,
1922-1930.
ROG (Pierre), Les anciens fors de Barn, Toulouse, 1907. p.648
VIOLLET (Paul). Histoire des institutions politiques et administratives de la France, 3
vol. 1890-1903.
BESTA (E.), Fonti, legislazione e scienza giuridicha della caduta dellimpero romano al
sec. XV, Milan, 1923 (Storia del diritto italiano, di P. GIUDICE).
FICKER (Q.), Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens, 4 vol., Innsbruck,
1868-74.
LEICHT (P.S.), Ricerche sul diritto privato nei documenti preirneriani, 2 vol., Rome,
1914-1922.
MAYER (Ernst), Italienische
Zunftherrschaft, 2 vol., Leipzig, 1900.
Verfassungsgeschichte
von
der Gothenzeit zur
SALVIOLI (G.), Storia del diritto italiano, 8e d., Turin, 1921.
SOLMI (A.), Storia del diritto italiano, 3e d., Milan, 1930.
JAMISON (E.), The Norman administration of Apulia and Capua dans Papers of the
British School at Rome, VI, 1913.
NIESE (Hans), Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im regnum Siciliae, Halle,
1910.
3. La mentalit juridique et lenseignement du droit
CHNON (E.), Le droit romain la Curia regis dans Mlanges Fitting, t. I, Montpellier,
1907 (Compte rendu par J. ACHER, Rev. gnrale de droit, XXXII, 1908).
BESTA (E.), Lopera dIrnerio, Turin, 1910.
BRIE (S.), Die Lehre vom Gewohnheitsrecht, I. Geschichtliche Grundlegung, Breslau,
1899.
CHIAPPELLI (L.), Recherches sur ltat des tudes de droit romain en Toscane au XIIe
sicle dans Nouv. Revue historique de droit, 1896. [pp. 243 sqq].
CONRAT (Max), Die Quellen und Literatur des Rmischen Rechts lm frheren
Mittelalter, Leipzig, 1891.
FLACH (J.), tudes critiques sur lhistoire du droit romain au moyen ge, 1890.
FOURNIER (P.), Lglise et le droit romain au XIIIe sicle dans Nouv. Revue historique
de droit, 1890. [pp. 80 sqq].
Marc BLOCH La socit fodale
455
GARAUD (Marcel), Le droit romain dans les chartes poitevines du IXe au XIe sicle dans
Bull. de la Soc. des Antiquaires de lOuest, 1925.
GOETZ (W.), Das Wiederaufleben des rmischen Rechts im 12. Jahrhundert dans Archiv.
fr Kulturgeschichte, 1912.
MEYNIAL (E.), Note sur la formation de la thorie du domaine divis... du XIIe au XIVe
sicle dans Mlanges Fitting, t. II, Montpellier, 1908.
MEYNIAL (E.), Remarques sur la raction populaire contre linvasion du droit romain en
France aux XIIe et XIIIe sicles dans Mlanges Chabaneau, Erlangen, 1907.
OLIVIER-MARTIN (Fr.), Le roi de France et les mauvaises coutumes dans Zeitschrift der
Savigny Stifiung, G.A., 1938.
VINOGRADOFF (P.), Roman Law in medieval Europe, 2e d., Oxford, 1929.
WEHPL (R.), De la coutume dans le droit canonique, 1928.
4. Les ides politiques
CARLYLE (R.W. et A.J.), A history of medieval politicaltheory in the West., t. I III,
Londres, 1903-1915.
DEMPF (Alois), Sacrum imperium : Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters
und der politischen Renaissance, Mnich, 1929.
HERN (Fritz), Recht und Yerfassung in Mittelaiter dans Historische Zeitschrift, 1919.
V. LES DERNIRES INVASIONS p.649
1. Gnralits
LOT (Ferdinand), Les invasions barbares et le peuplement de lEurope : introduction
lintelligence des derniers traits de paix, 2 vol., 1937.
2. Les Sarrasins dans les Alpes et lIta lie pninsulaire
(voir aussi POUPARDIN, p. 645)
DUPRAT (Eug.), Les Sarrasins en Provence dans Les Bouches-du-Rhne. Encyclopdie
dpartementale, 1924.
LATOUCHE (R.), Les ides actuelles sur les Sarrasins dans les Alpes dans Revue de
gographie alpine, 1931.
PATRUCCO (Carlo E.), I Sarraceni nelle Alpi Occidentali dans Biblioteca della Societa
storica subalpina, t. XXXII, 1908.
VEHSE (0.), Das Bndnis gegen die Sarazenen vont Jahre 915 dans Quellen und Forsch.
aus italienischen Archiven, t. XIX, 1927.
Marc BLOCH La socit fodale
456
3. Les Hongrois
BDINGER (Max), (sterreischische Geschichte bis zum Ausgange des dreizehnten
Jahrhunderts, t. I, Leipzig, 1858.
CARO (G.), Der Ungarntribut unier Heinrich I. dans Mitteilungen des Instituts fr sterr.
Geschichtsforschung, t. XX, 1899.
DARKO (E.), Influences touraniennes sur lvolution de lart militaire des Grecs, des
Romains et des Byzantins dans Byzantion, 1935 et 1937.
JOKAY (Z.), Die
Ortsnamenforschung, 1935.
ungarische
Ortsnamenforschung
dans
Zeitschrift
fr
KAINDL (R. F.), Beitrge zur lteren ungarischen Geschichte, Vienne, 1893.
LTTICH (Rudolph), Ungarnzge in Europa im 10. Jahrhundert, Berlin, 1910 (Eberings
Histor. Studien, 74).
MACARTNEY (C.A.), The Magyars in the ninth century, Cambridge, 1930 (Compte
rendu par G. MORAVSIK, dans Byzantinische Zeitschrift, 1933).
MARCZALI (Heinrich), Ungarns Geschichtsquellen im Zeitalter der Arpaden, Berlin,
1882.
MARQUART (J.), Osteuropische und ostasiatische Strelfzge, Leipzig, 1903.
SAUVAGEOT (A.), Lorigine du peuple hongrois dans Revue des tudes hongroises, t. II,
1924.
SCHNEBAUM (Herbert), Die Kenntnis der byzantinischen Geschichstsschreiber von
der ltesten Geschichte der Ungarn vorderLandnahme, Berlin, 1922.
SEBESTYEN (Charles C. S.), La rc et la flche des Hongrois dans Nouvelle Revue de
Hongrie, t. LI, 1934.
STEINACKER (Harold), Ueber Stand und Aufgabe der ungarischen
Verfassungsgeschichte dans Mitteilungen des Instituts fr sterr. Geschichtsforschung, t.
XVIII, 1907.
SZINNYEI, Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur, 2e d., Berlin, 1923.
ZICHY (tienne), Lorigine du peuple hongrois dans Revue des tudes hongroises, t. I,
1923.
4. Les Scandinaves en gnral et leurs invasions p.650
ARBMAN (Holger) et STENBERGER (Marten), Vikingar i Vsterled (Les Vikings sur les
routes de lOuest ), Stockholm, 1935.
BUGGE (Alexander), The Norse settlements in the British Islands dans Transactions of the
Royal Historical Society, 1921.
BUGGE (Alexander), Die Wikinger : Bilder aus der nordischen Vergangenheit, Halle,
1906.
CLAPHAM (H. J.), The horsing of the Danes dans English HistoricalReview, 1910.
COLLINGWOOD (W. G.), Scandinavian Britain, Londres, 1908.
Marc BLOCH La socit fodale
457
CURTIS (E.), The English and Ostmen in Ireland dans English Historical Review, 1908.
DARLINGTON (R. R.), The last phase of Anglo-Saxon history dans History, 1937.
FALK (H.), Altnordisches Seewesen dans Wrter und Sachen, t. IV, 1912.
GARAUD (Marcel), Les invasions des Normands en Poitou et leurs consquences dans
Rev. historique, t. CLXXX, 1937.
GOSSES (I. H.), Deensche Heerschappijen in Friesland gedurende den Noormannentijd
dans Mededeelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Deel
56, Srie B, 1923.
HOFMEISTER (A.), Ein angeblicher Normannenzug ins Mittelmeer um 825 dans
Historische Aufstze K. Zeumer dargebracht, Weimar, 1909.
JACOBSFN (Lis), Les Vikings suivant les inscriptions runiques du Danemark dans Revue
Historique, t. CLVIII, 1938.
JORANSON (Einar), The Danegeld in France, Rock-Island, 1923 (Augustana Library
Publ., 10).
KENDRICK (T. D.), A history of the Vikings, Londres, 1930.
LOT (F.), La grande invasion normande de 856-862, dans Bibliothque de lEcole des
Chartes, 1908.
LOT (F.), La Loire, lAq uitaine et la Seine de 862 866, dans Bibliothque de lcole des
Chartes, 1915.
LOT (F.), Le monastre inconnu pill par les Normands en 845, dans Bibliothque de
lcole des Chartes, 1909.
MONTELIUS (Oskar), Kulturgeschichte Schwedens von den ltesten Zeiten bis zum elften
Jahrhundert, Leipzig, 1906.
MONTELIUS (Oskar), Sverige och Vikingafderna vsternt (La Sude et les expditions
des Vikings vers lOuest) dans Antikvarisk Tidskrift, t. XXI, 2.
NORDENSTRENG (Rolf), Die Zge der Wikinger, trad. L. MEYN, Leipzig, 1925.
OMAN (Charles W. C.), The danish kingdom of York dans The Archaeological Journal, t.
XCI, 1934.
OLRIK (Axel), Viking Civilization, Londres, 1930.
PAULSEN (P.), Studien zur Wikingerkultur, Neurnnster, 1933.
PRENTOUT (Henri), tude critique sur Dudon de Saint-Quentin, 1916.
PRENTOUT (Henri), Essai sur les origines et la formation du duch de Normandie, Caen,
1911.
SHETELIG (Haakon), Les origines des invasions des Normands (Bergens Museums
Arbog, Historisk-antikvarisk rekke, n 1).
SHETELIG (Haakon), Prhistoire de la Norvge, Oslo, 1926 (Instituttet for
sammenlignende Kulturforskning, Srie A, t. V).
STEENSTRIUP (J.), Normandiets Historie under de syv frste Hertuger 911-1066 (avec
un rsum en franais) dans Mmoires de lAcadmie royale des sciences et des lettres de
Danemark, 7e Srie, Sections des Lettres, t. V, n 1, 1925. p.651
Marc BLOCH La socit fodale
458
STEENSTRUP (J.), Normannerne, 4 vol., Copenhague, 1876-1882 (Le tome 1
partiellement traduit sous le titre d tudes prliminaires pour servir lhistoire des
Normands, dans Bullet. Soc. Antiquaires Normandie, t. V et part, 1881).
VAN DER LINDEN, Les Normands Louvain dans Revue historique, t. CXXIV, 1917.
[pp. 64 sqq].
VOGEL (Walther), Die Normannen und das frnkische Reich bis zur Grndung der
Normandie (799-911), Heidelberg, 1906.
VOGEL (Walther), Handelsverkehr, Stdtewesen und Staatenbildung in Nordeuropa
imfrheren Mittelalter dans Zeitschrift der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin, 1931.
VOGEL (Walther), Wik-Orte und Wikinger : eine Studie zu den Anfngen des
germanischen Stdtewesens dans Hansische Geschichtsbltter, 1935.
WADSTEIN, Le moi viking, dans Mlanges de philologie offerts M. Johan Vising, 1925.
5. La conversion du Nord
JOHNSON (E. N.), Adalbert of Hamburg-Bremen dans Speculum, 1934.
MAURER (Konrad), Die Bekehrung des norwegischen Stammes zum Christentum, 2 vol.,
Munich, 1855-1856.
MOREAU (E. de), Saint Anschaire, Louvain, 1930.
SCHMEIDLER (B.), Hamburg-Bremen und Nordwest-Europa von 9. bis 11. Jahrh.,
Leipzig, 1918.
6. Traces et effets des tablissements scandinaves
ANDERSON (Olaf S.), The English hundred-names, Lund, 1934.
BRNDAL (Viggo), Le normand et la langue des Vikings dans Normannia, 1930.
EKWALL (E.), How long did the Scandinavian language survive in England dans A
grammatical miscellany offered to O. Jespersen, Copenhague, 1930.
EKWALL (E.), Scandinavians and Celts in the North-West of England, Lund, 1918 (Lunds
Universitets rsskrift, n F, Afd. 1, Bd. 14).
EKWALL (E.), The scandinavian element dans A. MAWER et F. W. STENTON,
Introduction to the survey of English Place-Names, Part. I, Cambridge, 1929.
EKWALL (E.), The scandinavian element dans H. C. DARBY, An historical geography of
England, Cambridge, 1936.
EMANUELLI, La colonisation normande dans le dpartement de la Manche dans Revue
de Cherbourg, 1907 et suiv.
JESPERSEN (O.), Growth and structure of the English language, 7e d., Leipzig, 1933.
JORET (Ch.), Les noms de lieu dorigine non romane et la colonisation germanique et
scandinave en Normandie dans Congrs du millnaire de la Normandie, Rouen, 1912, t. II et
(developp) part, 1913.
LINDKVIST, Middle English Place-Names of Scandinavian origin, Upsal, 1912.
Marc BLOCH La socit fodale
459
LOT (Ferdinand), De lorigine et de la signification historique des noms de lieux en ville et
en court dans Romania 1933 (Cf. MARC BLOCH, Rflexions dun his torien sur quelques
travaux de toponymie dans Annales dhistoire conomique, t. VI, 1934).
MAWER (A.), Problems of Place-Name study, Cambridge, 1929.
MAWER (A.), The scandinavian settlements in England as reflected in English
Place-Names dans Acta Philologica Scandinavica, t. VII, 1932-33. p.652
PRENTOUT (H.), Le rle de la Normandie dans lhistoire dans Rev. historique, t. CLX,
1929.
SHETELIG (H.), Vikingeminner i Vest Europa (Les souvenirs archologiques des Vikings
dans lEurope Ocidentale) , Oslo, 1933 (Instittutet for sammenlignende kulturforksning, A,
XVI.)
SION (Jules), Les paysans de la Normandie orientale, 1908.
SJGREN (A.), Le genre des mots demprunt norrois en normand, dans Romania, 1928.
STENTON (F. M.), The Dunes in England dans History, 1920-21.
STENTON (F. M.), The Dunes in England dans Proceedings ofthe British Academy, t.
XIII, 1927.
VI. LES LIENS DU SANG
1. Gnralits ; solidarit criminelle
ROFDER (Fritz), Die Familie bei den Angelsachsen, tome I, Halle, 1899 (Studien zur
englischen Philologie, IV).
BRUNNER (Heinrich), Sippe und Wergeld in den niederdeutschen Rechten dans
BRUNNER, Abhandlungen zur Rechtsgeschichte, t. I, Weimar, 1931 (prcdemment
Zeitschr. der Savigny-St., G.A., III).
CATTIER (F.), La guerre prive dans le comt de Hainaut dans Annales de la Facult de
philosophie de Bruxelles, t. I, 1889-90.
DUBOIS (Pierre), Les asseurements au XIIIe sicle dans nos villes du Nord, 1900.
ESPINAS (G.), Les guerres familiales dans la commune de Douai aux XIIe et XIIIe sicles
dans Nouv. Revue historique de droit, 1901. [pp. 161].
FRAUENSTDT (Paul), Blutrache und Todtschlagshne int deutschen Mittelalter,
Leipzig, 1881.
HINOJOSA (Eduardo de), Das germanische Element im spanischen Rechte dans
Zeitschrifi der Savigny-Stiftung, G.A., 1910.
HIS (R.), Gelobter und gebotener Friede im deutschen Alittelalter dans Zeitschrifi der
Savigny-Stiftung, G.A., 1912.
PETIT-DUTAILLIS (Ch.), Documents nouveaux sur les murs populaires et le droit de
vengeance dans les Pays-Bas au XVe sicle, 1908 (avec bibliographie).
PHILLPOTTS (Bertha Surtees), Kindred and clan in the middle ages and after : a study in
the sociology of the Teutonic races, Cambridge, 1913 (Cambridge Archaeological and
Ethnological Series).
Marc BLOCH La socit fodale
460
VALAT (G.), Poursuite prive et composition pcuniaire dans lancienne Bourgogne,
Dijon, 1907.
VAN KEMPEN (Georges) De la composition pour homicide daprs l a Loi Salique. Son
maintien dans les Coutumes de Saint-Omer jusqu la fin du XVe, sicle, Saint-Omer, 1902.
WILKE (Car]), Das Friedegebot : ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Strafrechts,
Heidelberg, 1911 (Deutschrechtliche Beitrge, VI, 4).
YVER (J.), Linterdiction de la guerre prive dans le trs ancien droit normand (Extrait
des travaux de la semaine dhistoire du droit normand ), Caen, 1928.
2. Le lignage comme socit conomique
BRUNNER (H.), Der Totenteil in germanischen Rechten dans BRUNNER, Abhandlungen
zur Rechtsgeschichte, t. II, Weimar, 1937 (prcdemment dans Zeitschrift der Savigny-St.,
G.A., XIX). p.653
CAILLEMER (Robert), Les ides coutumires et la renaissance du droit romain dans le
Sud-Est de la France : I Laudatio des hritiers dans Essays in legal history ed. by P.
Vinogradoff, Oxford, 1913.
CAILLEMER (Robert), Le retrait lignager dans le droit provenal dans Studi giuridici in
onore di Carlo Fadda, t. IV, Naples, 1906.
FALLETTI (Louis), Le retrait lignager en droit coutumier franais, Paris, 1923.
FORMENTINI (Ubaldo), Sulle origini e sulla costituzione dun grande gentilizio feodale
dans Atti della Societ ligure di storia patria, t. LIII, 1926.
GNESTAL (Robert), Le retrait lignager en droit normand dans Travaux de la semaine
dhistoire du droit normand, 1923, Caen, 1925.
LAPLANCHE (Jean de), La rserve coutumire dans lancien droit franais, 1925.
PLUCKNETT (Thodore F. T.), Bookland and Folkland dans The Economic history
Review, t. VI, 1935-1936 (avec bibliographie).
PORE (Charles), Les statuts de la communaut des seigneurs pariers de La
Garde-Gurin (1238-1313) dans Bibliothque de lcole des Chartes, 1907 et tudes
historiques sur le Gvaudan, 1919.
SCHULTZE (Alf.), Augustin und der Seelteil des germanischen Erbrechts dans Abh. der
schs. Akad. der Wiss., Phil. hist. Kl. 28.
TAMASSIO (G.), Il diritto di prelazione e lespropriazione forzata negli statuti dei
comuni italiani dans Archivio giuridico, 1885.
VII. LES INSTITUTIONS PROPREMENT FODALES
1. Gnralits ; origines de la fodalit franque 1
Voir aussi ci-dessous, VIII, 2.
Marc BLOCH La socit fodale
461
BLOCH (Marc), Feudalism (European) dans Encyclopaedia of the social sciences, VI,
1931.
BOURGEOIS (Em.), Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise : tude sur ltat et le rgime
politique de la socit carolingienne la fin du IXe sicle daprs la lgislation de Charles le
Chauve, 1885.
CALMETTE (J.), La Socit fodale, 1923 (Collection A. Colin).
DOPSCH (A.), Benefizialwesen und Feudalitt dans Mitteilungen des sterreichischen
Instituts fr Geschichtsforschung, 1932.
DOPSCH (A.), Die Leudes und das Lehnwesen dans Mitteilungen des sterr. Instituts fr
Geschichtsforschung, 1926.
DOPSCH (A.), Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit, 2e d., Vienne, 1921-1922.
DUMAS (Auguste), Le serment de fidlit et la conception du pouvoir du Ier au IXe sicle
dans Revue historique de droit, 1931 [pp. 30 sqq] (Cf. LOT (F.), Le serment de fidlit
lpoque franque dans Revue belge de philologie, 1933 ; DUMAS (A.), Le serment de fidlit
lpoque franque, ibid., 1935.)
GANSHOF (F. L.), Note sur les origines de lunion du bnfice avec la vassalit dans
tudes dhistoire ddies la mmoire de Henri Pirenne, Bruxelles, 1937.
GUILHIERMOZ (A.), Essai sur les origines de la noblesse en France au moyen ge,
1902.
HALPHEN (L.), A propos du capitulaire de Quierzy dans Revue historique, t. CVI, 1911.
[pp. 286 sqq].
KIENAST (W.), Die deutschen Frsten im Dienste der Westmchte bis zum Tode Philipps
des Schnen von Frankreich, 2 vol., Utrecht, 1924-1931. p.654
KIENAST (W.), Lehnrecht und Staatsgewalt int Mittelalter dans Histor. Zeitschrift, t.
CLVIII, 1938.
KRAWINKEL (H.), Zur Entstehung des Lehnwesens, Weimar, 1936.
LESNE (Em.), Histoire de la proprit ecclsiastique en France, 4 vol., Lille, 1910-1936
MENZEL (Viktor) Die Entstehung des Lehnwesens, Berlin, 1890.
MAYER (Ernst), Die Entstehung der Vasallitt und des Lehnwesens dans Festgbe fr R.
Sohm., Munich, 1914.
MITTEIS (H.), Lehnrecht und Staatsgewalt, Weimar, 1933.
MITTEIS (H.), Politische Prozesse des frheren Mittelalters in Deutschland und
Frankreich dans Sitzungsher. der Heidelberger Akad. der Wissenschaften, 1926.
ROTH (P.), Feudalitt und nterthanenverband, Weimar, 1863.
SOCIT JEAN BODIN, Les liens de vassalit et les immunits, Bruxelles, 1936 (et
Revue de lInstitut de Sociologie, 1936).
VINOGRADOFF (P.), Foundations of Society et Feudalism dans Cambridge Medieval
History, t. II et III.
WAITZ (G.), Die Anfnge des Lehnivesens dans WAITZ, Gesammelte Abhandlungen, t. I,
Gttingen, 1896.
2. tudes par pays ou par rgions
Marc BLOCH La socit fodale
462
BESELER (Georg), System des genieinen deutschen Privatrechts, t. II, Berlin, 1885.
HOMEYER (C.G.), System des Lehnrechts der schsischen Rechtsbcher dans
Sachsenspiegel, d. Homeyer, t. II, 2, Berlin, 1844.
LIPPERT (Woldemar), Die deutschen Lehnsbcher, Leipzig, 1903.
ADAMS (G.B.), Anglo-saxon feudalism dans American Historical Review, t. VII, 1901-02.
CHEW (H. M.), The English ecclesiastical tenants-in-chief and knight-service, especially
in the thirteenth and fourteenth century, Oxford, 1932.
DOUGLAS (D. C.), Feudal documents from the abbey of Bury St-Edmunds, Londres, 1932
(Records of the Soc. and Ec. Hist. of England, VIII) : importante introduction.
JOLLIFFE (J.E.A.), Northumbrian institutions dans English Historical Review, t. XLI,
1926.
MAC KECHNIE, (W. S.), Magna Carta : a commentary, 2e d., Glascow, 1914.
ROUND (H.), Feudal England, Londres, 1907.
ROUND (H.), Military tenure before the Conquest dans English historical Review, t. XII,
1897.
STENTON (F. M.), The changing feudalism of the middle ages dans History, t. XIX,
1934-35.
STENTON (F. M.), The first century of English feudalism (1066-1166), Oxford, 1932.
MENENDEZ PIDAL, La Espaa del Cid, 2 vol., Madrid, 1929. Traduction anglaise
abrge The Cid and his Spain, 1934 ; allemande Das Spanien des Cid, 2 vol., Munich,
1936-37.
MUNOZ-ROMERO (T.), Del estado de las personas en los reinos de Asturias y Leon dans
Revista de Archivos, 1883.
PAZ (Ramon), Un nuevo feudo castellano dans Anuario de historia del derecho espaol,
1928.
SANCHEZ-ALBORNOZ (Cl.), Las behetrias et Muchas paginas mas sobre las behetrias
dans Anuario de historia del derecho espaol, 1924 et 1927.
SANCHEZ-ALBORNOZ (Cl.), Un feudo castellano del XIII dans Anuario de historia del
derecho espaol, 1926. p.655
SECRTAN (E.), De la fodalit en Espagne dans Rev. historique du droit, 1863.
ESPINAY (G. d), La fodalit et le droit civil franais, Saumur, 1862 (Rec. de
lAcadmie de Lgislation de Toulouse. Livraison supplmentaire).
DILLAY (Madeleine), Le service annuel en deniers des fiefs de la rgion angevine
dans Mlanges Paul Fournier, 1919.
BRUTAILS Les fiefs du roi et les alleux en Guienne dans Annales du Midi, 1917.
LAGOUELLE (Henri), Essai sur la conception fodale de la proprit foncire dans le
trs ancien droit normand, 1902.
RABASSE (Maurice), Du rgime des fiefs en Normandie au moyen ge, 1905.
RICHARDOT (Hubert), Le fief roturier Toulouse aux XIIe et XIIIe sicles dans Rev.
histor. de droit franais, 1935.
Marc BLOCH La socit fodale
463
STRAYER (J. R.), Knight-Service in Normandy dans Anniversary essays by studens of Ch.
H. Haskins, 1929.
YVER (Jean), Les contrats dans le trs ancien droit normand, 1926.
DEL GIUDICE (P.) et CALISSE (C.), Feudo dans Il Digesto italiano, t. XI, 2, 1892-1898.
SCHNEIDER (F.), Die Entstehung von Burg- und Landgemeinde in Italien. Berlin, 1924
(Abhandt. zur mittleren und neueren Gesch., 68).
WUNDERLICH (Erich), Aribert von Antemiano, Erzbischof von Mailand, Halle, 1914.
BROOKE (Z. N.), Pope Gregory VIIs demand of fealty from William the Conqueror dans
English Historical Review, t. XXVI, 1911.
ERDMANN (Karl), Das Papsttum und Portugal im ersten Jahrhunderte der
portugiesischen Geschichte dans Abh. der preussischen Akademie, Phil.-hist. Kl., 1938.
JORDAN (Karl), Das Eindringen des Lehnwesens in das Rechtsleben der rmischen Kurie
dans Archiv. fr Urkundenforschung, 1931.
KEHR (P.), Die Belehnungen der sditalienischen Normimnenfrsten durch die Ppste
dans Abhandl. der preussischen Akademie, Phil.-hist. Kl., 1934.
KEHR (P.), Das Papsttum und der katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon
dans Abhandl. der preussischen Akademie, Phil.-hist. Kl., 1926.
KEHR (P.), Das Papsttum und die Knigreiche Navarra und Aragon bis zur Mitte des XII.
Jahrhunderts dans Abh. der pr. Akademie, Phil.-hist. Kl., 1928.
KEHR (P.), Wie und wann wurdedos Reich Aragon einLehen der rmischen Kirche, dans
Sitzungsber. der preussischen Akademie, Phil.-hist. Kl., 1928.
KLMEL (W.), Rom und der Kirchenstaat im 10. und 11. Jahrhundert bis in die Anfnge
der Reform, Berlin, 1935 (Abh. zur mittleren und neueren Gesch., 78).
TOMASSETTI (G.), Feudalismo roinano dans Rivista internazionale di scienze sociale, t.
V, 1894.
CAPASSO (B.), Sul catalogo dei jeudi e dei feudatari delle provincie napoletane sotto la
dominazione normanna dans Atti della r. Accademia di archeologia, t. IV (1868-69).
CECI (C.), Normanni di Inghilterra e Normanni dItalia dans Archivio Scientifico del R.
Istituto Sup. di Sc. Economiche... di Bari, t. VII, 1932-33.
MONTI (G.-M.), Ancora sulla feudalit e i grandi domani feudali del regno di Sicilia dans
Rivist di storia del diritto ital., t. IV, 1921.
LA MONTE (J. L.), Feudal monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, Cambridge (U.
S.), 1932 (Monographs of the Mediaeval Acad., 4).
3. Compagnonnage, vassalit, hommage p.656
BLOCH (Marc), Les formes de la rupture de lhommage dans lancien droit fodal, dans
Nouvelle Revue historique de droit, 1912. [pp. 141 sqq].
BRUNNER (H.), Zur Geschichte des frnkischen Gefolgswesens dans Forschungen zur
Geschichte des d. und fr. Rechtes, Stuttgart, 1894 (prcdemment Zeitschr. der Savigny St.,
G.A., IX).
Marc BLOCH La socit fodale
464
CARMETTE (Joseph), Le comitatus germanique et la vassalit dans Nouvelle Revue
historique de droit, 1904. [pp. 501 sqq].
CHNON (E.), Le rle juridique de losculum dans lancien droit franais dans Mm. Sac.
nationale des Antiquaires, 8e Srie, t. VI, 1919-1923.
DOUBLIER (Othmar), Formalakte beim Eintritt in die altnorwegische Gefolgschaft dans
Mitteilungen des Instituts fr sterr. Geschichtsforschung, Ergnzungsband VI, 1901.
EHRENBERG (V.), Commendation und Huldigung nach frnkischem Recht, 1877.
EHRISMANN (G.), Die Wrter fr Herr im Althochdeutschen dans Zeitschrift fr
deutsche Wortforschung, t. VII, 1905-06.
GROSSE (Robert), Rmische Militrgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der
byzantinischen Themenverfassung, Berlin, III, 20.
HIS (Rudolf), Todschlagshne und Mannschaft dans Festgabe fr K. Gterbock, Berlin,
1910.
JUD (J.), Zur Geschichte und Herkunft von frz. dru dans Archivum romanicum, 1926.
LARSON (L. M.), The Kings Household in England before th e Conquest, Madison, 1904.
LCRIVAIN (Ch.), Les soldats privs au Bas-Empire dans Mlanges darchologie et
dhistoire, 1890.
LEICHT (P S.), Gasindi e vassalli dans Rendiconti della r. Accademia naz. dei Lincei, Sc.
morali, 6e Srie, t. III, 1927.
LITTLE (A. G.), Gesiths and thegns dans English historical Review, t. IV, 1887.
MEYER-LBKE (W.), Senyor, Herr dans Wrter und Sachen, t. VIII, 1923.
MIROT (Lon), Les ordonnances de Charles VII relatives la prestation des hommages,
dans Mmoires de la Socit pour lHistoire du droit et des institutions des anciens pays
bourguignons, fasc. 2, 1935.
MLLER (Martin), Minne und Dienst in der altfranzsichen Lyrik, Marbourg, 1907.
MYRICK (Arthur B.), Feudal terminology in medieval religious poetry dans The romanic
review, t. XI, 1920.
PETOT (Pierre), La capacit testimoniale du vassal dans Revue historique du droit, 1931.
[pp. 691-698].
PLATON (G.), Lhommage fodal comme moyen de contracter des obligations prives,
dans Revue gnrale de droit, t. XXVI, 1902.
RAMOS Y LOSCERTALES, La devotio iberica dans Anuario de Historia del derecho
espaol, 1924.
RICHTER (Elise), Senior, Sire dans Wrter und Sachen, t. XII, 1929.
SCHUBERT (Carl), Der Pflegesohn (nourri) im franzsischen Heldenepos, Marbourg,
1906.
SEECK (Otto), Buccellarii dans PAULY WISSOWA, Real-Encyclopdie der classischen
Altertumswissenschaft, t. III, 1899.
SEECK (Otto), Das deutsche Gefolgswesen auf rmischem Boden dans Zeitschrift der
Savigny Stiftung, G.A., 1896. p.657
WAITZ (G.), Ueber die Anfnge der Vasallitt dans WAITZ, Gesammelte Abhandl., t. I,
Gttingen, 1896.
Marc BLOCH La socit fodale
465
WECHSSLFR (Eduard), Frauendienst und Vasallitt dans Zeitschrift fr franzsische
Sprache, t. XXIV, 1902.
WECHSSLER (E.), Das Kulturproblem des Minnesangs, t. I, Halle, 1907.
WINDISCH, Vassus und vassallus dans Berichte ber die Verhandl. der k. schs.
Gesellschaft der Wissenschaften, 1892.
4. Prcaire, bienfait , fief et alleu
BLOCH (Marc), Un problme dhistoire compare : la ministrialit en France et en
Allemagne dans Revue historique du droit, 1928. [pp.46-91]
BONDROIT, Les precariae verbo regis devant le concile de Leptinnes dans Revue
dhistoire ecclsiastique, 1900.
BRUNNER (H.), Die Landschenkungen der Merowinger und Agilolfinger dans
Forschungen zur Geschichte des d. und fr, Rechtes, Stuttgart, 1877 (prcdemment
Sitzungsber. der pr. Akad., Phil.-hist. Kl., 1885).
CHNON (E.), Etude sur lhistoire des alleux, 1888.
CLOTET (L.), Le bnfice sous les deux premires races dans Comptes rendus du
Congrs scientifique international des catholiques, 1891.
GIERKE (O.), Allod dans Beitrge zum Wrterbuch der deutschen Rechtssprache,
Weimar, 1908.
GLADISS (D. v.), Die Schenkungen der deutschen Knige zu privatem Eigen dans
Deutsches Archiv fr Geschichte des Mittelalters, 1937.
KERN (H.), Feodum, fief dans Mmoires Soc. Linguistique Paris, t. II, 1872.
KRAWINKEL (H.), Feudum, Weimar, 1938 (Forschungen zum d. Recht, III, 2).
KRAWINKEL (H.), Untersuchungen zum frnkischen Benefizialrecht, Weimar, 1936
(Forschungen zum d. Recht, 11, 2).
JOLLIFFE (J. E. A.), Alod and fee dans Cambridge historical journal, 1937.
LESNE (Em.), Les bnficiers de Saint-Germain-des-Prs au temps de labb Irminon
dans Revue Mabillon, 1922.
LESNE (Em.), Les diverses acceptions du mot beneficium du VIIIe au IXe sicle dans
Revue historique du droit, 1921.
LOT (Ferdinand), Origine et nature du bnfice dans Anuario de historia del derecho
espaol, 1933.
PSCHL (A.), Die Entstehung des geistlichen Benefiziums dans Archiv. fr Kathol.
Kirchenrecht, 1926.
ROTH (P.), Geschichte des Benefizialwesens von den ltesten Zeiten bis ins zehnte
Jahrhundert, Erlangen, 1850.
SCHFER (D.), Honor... im mittelatterlichen Latein dans Sitzungsber. der pr. Akad., Phil.
hist. Kl., 1921.
STUTZ (U.), Lehen und Pfrnde dans Zeitschrift der Savigny Stiftung, G.A., 1899.
WIART (Ren), Le rgime des terres du fisc sous le Bas-Empire. Essai sur la precaria,
1894.
Marc BLOCH La socit fodale
466
5 Le droit du fief.
(voir aussi ACHER, p. 642)
ARBOIS DE JUBAINVILLE (d), Recherches sur la minorit et ses effets dans le droit
fodal franais dans Bibliothque de lc. des Chartes, 1851 et 1852.
BELLETTE (Ern.), La succession aux fiefs dans les coutumes flamandes, 1927. p.658
BLUM (Edgard), La commise fodale dans Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, IV,
1922-23.
ERMOLAEF, Die Sondertstellung der Frau im franzsischen Lehnrecht, Ostermundingen,
1930.
GNESTAL (R.), La formation du droit danesse dans la coutume de Normandie dans
Normannia, 1928.
GNESTAL (R.), Le parage normand, Caen, 1911 (Biblioth. dhist. du droit normand, 2e
Srie, I, 2.)
GNESTAL (R.), tudes de droit priv normand. I, La tutelle, 1930, (Biblioth. dhist. du
droit normand, 2e srie, III).
KLATT (Kurt), Das Heergewte, Heidelberg, 1908 (Deutschrechtliche Beitrge, t. II, fasc.
2).
MEYNIAL (E.), Les particularits des successions fodales dans les Assises de Jrusalem
dans Nouvelle Revue histor. de droit, 1892. [pp. 408-426]
MRRREIS (Heinrich), Zur Geschichte der Lehnsvormundschaft dans Alfred Schulze
Festschrift, Weimar, 1934.
SCHULZE (H. J. F.), Das Recht der Erstgeburt in den deutschen Frstenhusern und
seine Bedeutung fr die deutsche Staatsentwicklung, Leipzig, 1851.
STUTZ (U.), Rmerwergeld und Herrenfall dans Abhandlungen der pr. Akademie,
Phil.-hist. Kl., 1934.
6. La pluralit des seigneurs et lhommage lige
BAIST (G.), Lige, liege dans Zeitschrift fr rmanische Philologie, t. XXVIII, 1904, p.
112.
BEAUDOIN (Ad.), Homme lige dans Nouvelle Revue historique de droit, t. VII,
1883.[pp.659-668]
BLOOMFIELD, Salie Litus dans Studies in honor of H. Collitz, Baltimore, 1930.
BRCH (Joseph), Zur Meyer-Lbkes Etymologischem Wrterbuch dans Zeitschrift fr
rmanische Philologie, t. XXXVIII, 1917, p. 701-702.
GANSHOF (F. L.), Depuis quand a-t-on pu en France tre vassal de plusieurs seigneurs ?
dans Mlanges Paul Fournier, 1929 (Compte rendu W. KIENAST, Historische Zeitschrift, t.
CXLI, 1929-1930).
PIRENNE (Henri), Quest -ce quun homme lige ? dans Acadmie royale de Belgique,
Bulletin de la classe des lettres, 1909.
Marc BLOCH La socit fodale
467
PHLMANN (Carl), Das ligische Lehensverhlinis, Heidelberg, 1931.
ZEGLIN (Dorothea), Der homo ligius und die franzsische Ministerialitt, Leipzig,
1917 (Leipziger Historische Abhandlungen, XXXIX).
VIII. LE RGIME FODAL COMME INSTITUTION MILITAIRE
1. Ouvrages gnraux sur lart militaire et les armes
BALTZER (Martin), Zur Geschichte des deutschen Kriegswesens in der Zeit von den
letzten Karolingern bis auf Kaiser Friedrich IL Leipzig, 1877.
BOUTARIC (Edgar), Institutions militaires de la France, 1863.
DELBRCK (Hans), Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte,
t. III, Berlin, 1907.
DELPECH (H.), La tactique au XIIIe sicle, 2 vol., 1886.
FRAUENHOLZ (Eugen v.), Entwicklungsgeschichte des deutschen Heerwesens, t. I, Das
Heerwesen der germanischen Frhzeit, des Frankenreiches und des ritterlichen Zeitalters,
Munich, 1935. p.659
KHLER (G.), Entwicklung des Kriegswesens und der Kriegsfhrung in der Ritterzeit, 3
vol., Breslau, 1886-1893.
OMAN (Ch.), A history of the art of war. The middle ages from the fourth to the fourteenth
century, 2e d., Londres, 1924.
2. Les problmes de la cavalerie et de larmement
BACH (Volkmar), Die Verteidigungswaffen in den altfranzsischen Artusund
Abenteuerromanen, Marbourg, 1887 (Ausg. und Abh. ans dem Gebiete der roman. Philologie
70).
BRUNNER (Heinrich), Der Reilerdienst und die Anfnge des Lehnwesens dans
Forschungen zum d. und fr. Recht, Stuttgart, 1874 (prcdemment Zeitschrift der
Savigny-Stift., G.A., VIII)
DEMAY (G.), Le costume au moyen ge daprs les sceaux, Paris, 1880.
GESSLER (E. A.), Die Trutzwaffen der Karolingerzeit vom VIII. bis zum XI. Jahrhundert,
Ble, 1908.
GIESSE (W.), Waffen nach den provenzalischen Epen und Chroniken des XII. und XIII.
Jahrhunderts dans Zeitschr. fr roman. Philologie, t. LII, 1932.
LEFEBVRE DES NOTTES, Lattelage et le cheval de selle travers les ges, 2 vol.,
1931 (Cf. MARC BLOCH, Les inventions mdivales, dans Annales dhist. conomique,
1935).
MANGOLDT-GAUDLITZ (Hans von), Die Reiterei in den germanischen und frnkischen
Heeren bis zum Ausgang der deutschen Karolinger, Berlin, 1922 (Arbeiten zur d. Rechts und
Verfassungsgeschichte, IV)
Marc BLOCH La socit fodale
468
ROLOFF (Gustav), Die Umwandlung desfrnkischen Heeres von Chlodwig bis Karl den
Grossen dans Neue Jahrbcherfr das klassische Altertum, t. IX, 1902.
SANCHEZ-ALBORNOZ (Cl.), Los Arabes y los origines del feudalismo dans Anuario de
historia del derecho espaol, 1929 ; Les Arabes et les origines de la fodalit dans Revue
historique de droit, 1933.
SANCHEZ-ALBORNOZ (Cl.), La caballeria visigoda dans Wirtschaft und Kultur :
Festschrift zum 70. Geburtstag von A. Dopsch, Vienne, 1938.
SCHIRLING (V.), Die Verteidigungsgwaffen im altfranzsischen Epos, Marbourg, 1887
(Ausg. und Abh. aus dern Gebiete der roman. Philologie, 69).
SCHWIETERING (Julius), Zur Geschichte vom Speer und Schwert im 12. Jahrhundert
dans Mitteilungen aus dem Museum fr Hamburgische Geschichte, n 3 (8. Beiheft, 2. Teil
zum Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten, XXIX, 1911).
STERNBERG (A.), Die Angriffswaffen im altfranzsischen Epos, Marbourg, 1886 (Ausg.
und Abh. aus dem Gebiete der roman. Philologie, 48).
3. Lobligation militaire et les armes soldes
FEHR (Hans), Landfolge und Gerichstfolge im frnkischen Recht dans Festgabe fr R.
Sohm, Munich, 1914.
NOYES (A. Ci.), The military obligation in mediaeval England, Columbus (Ohio), 1931.
ROSENIIAGEN (Gustav), Zur Geschichte der Reichsheerfahrt von Heinrich VI. bis
Rudolf von Habsburg, Meissen, 1885.
SCHMITTHENNER (Paul), Lehnkriegswesen und Sldnertum im abendlndischen
Imperium des Mittelalters dans Histor. Zeitschrift, 1934.
WEILAND (L.), Die Reichsheerfahrt von Heinrich V. bis Heinrich VI. nach ihrer
staatsrechtlichen Seite dans Forschungen zur d. Geschichte, t. VII, 1867.
4. Le chteau p.660
ARMITAGE (E. S.), Early Norman Castles of the British Isles, Londres, 1913 (cf.
ROUND, English Historical Review, 1912, p. 544).
COULIN (Alexander), Befestigungshoheit und Befestigungsrecht, Leipzig, 1911.
DESMAREZ (G.), Fortifications de la frontire du Hainaut et du Brabant au XIIe sicle
dans Annales de la Soc. royale darchologie de Bruxelles, 1914.
ENLART (C.), Manuel darchologie franaise. Deuxime partie. t. II, Architecture
militaire et navale, 1932.
PAINTER (Sidney), English castles in the middle-ages dans Speculum, 1935.
ROUND (J. H.), Castle-guard dans The archaeological journal, LIX, 1902.
SCHRADER (Erich), Das Befestigungsrecht in Deutschland, Gttingen, 1909.
SCHUCHARDT (C.), Die Burg im Wandel der Geschichte, Potsdam, 1931.
Marc BLOCH La socit fodale
469
THOMPSON (A. Hamilton), Military architecture in England during the middle-ages,
Oxford, 1912.
IX. LES LIENS DE DPENDANCE DANS LES CLASSES INFRIEURES 1
(Cf. Cl. SANCHEZ-ALBORNOZ, p. 654)
BELOW (G. v.), Geschichte der deutschen Landwirtschaft des Mittelalters, Ina, 1937.
BLOCH (Marc), Les caractres originaux de lhistoire rurale franaise, 1931.
BLOCH (Marc), Les coliberti , tude sur la formation de la classe servile dans Revue
historique, t. CLVII, 1928. [pp. 1 sqq].
BLOCH (Marc), De la cour royale la cour de Rome : le procs des serfs de
Rosny-sous-Bois dans Studi di storia e diritto in onoe di E. Besta, Milan, 1938.
BLOCH (Marc), Libert et servitude personnelles au moyen ge dans Anuario de historia
del derecho espaol, 1933.
BLOCH (Marc), Les transformations du servage dans Mlanges dhistoire du moyen ge
offerts M. F. Lot, 1925.
BOEREN (P.-C.), tude sur les tributaires dglise dans le comt de Flandre du IXe au
XIVe sicle, Amsterdam, 1936 (Uitgaven van het Instituut voor middeleuwsche Geschiedenis
der... Universitet te Nijmegen, 3).
CARO (G.), Beitrge zur lteren deutschen Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte,
Leipzig, 1905.
CARO (G.), Neue Beitrge zur deutschen Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte,
Leipzig, 1911.
COULTON (G. G.), The medieval village, Cambridge, 1925.
HINOJOSA (E. de), El regimen seorial y la cuestion agraria en Catalua, Madrid, 1905.
p.661
KELLER (Robert v.), Freiheitsgarantien fr Person und Eigentum im Mitelalter,
Heidelberg, 1933 (Deutschrechtliche Beitrge, XIV, 1).
KIELMEYER (O. A.), Die Dorfbefreiung auf deutschem Sprachgebiet, Bonn, 1931.
LUZZATO (G.), I servi nelle grande propriet ecclesiastiche italiane nei secoli IX e X,
Pise, 1910.
MINNIGERODE (H.V.),
Wirtschaftsgeschichte, 1916.
Wachzinsrecht
dans
Vierteljahrschrift
fr
Sozialund
Bibliographie sommaire, limite par principe aux plus importants travaux relatifs aux
dpendances personnelles La bibliographie gnrale de la seigneurie rurale et des populations
paysannes sera donne dans un autre volume de la collection : les travaux qui traitent de la
division des classes, en gnral, sont indiqus dans la bibliographie du deuxime tome (p.
663).
Marc BLOCH La socit fodale
470
PERRIN (Ch.-Edmond), Essai sur la fortune immobilire de labbaye alsacienne de
Marmoutier, Strasbourg, 1935.
PERRIN (Ch.-Edmond), Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine daprs les plus
anciens censiers, Strasbourg.
PETIT (A.), Coliberti ou culverts : essai dinterprtation des textes qui les concernent
(Xe-XIII sicles), Limoges, 1926.
PETIT (A.), Coliberti ou culverts : rponse diverses objections, Limoges, 1930.
PETOT (P.), Lhommage servile dans Revue historique du droit, 1927 (cf. la contribution
du mme auteur Le Servage, ci-dessous.
PETOT (P.), La commendise personnelle dans Mlanges Paul Fournier, 1929 (cf. MARC
BLOCH, Ann. dhi st. conom., 1931, p. 254 et suiv.).
PIRENNE (Henri), Libert et proprit en Flandre du VIIIe au IXe sicle dans Bulletin
Acadmie royale de Belgique, Cl. Lettres, 1911.
PUIGARNAU (Jaime M. Mans), Las clases serviles bajo la nionarquia visigoda y en los
estados cristianos de la reconquista espaola, Barcelone, 1928.
SE (Henri), Les classes rurales et le rgime domanial en France au moyen ge, 1901.
SEELIGER (G.), Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im frheren
Mittelalter dans Abhandlungen der schsischen Gesellschaft der Wissensch., t. XX, 1903.
SOCIT JEAN BODIN, Le servage, Bruxelles, 1937 (et Revue de linstitut de
Sociologie, 1937).
SOCIT JEAN BODIN, La tenure, Bruxelles, 1938.
THIBAULT (Fabien), La condition des personnes en France au IXe sicle au mouvement
communal dans Revue historique de droit, 1933. [pp. 424 sqq ; pp. 696 sqq].
VACCARI (P.), Laffrancazione dei servi della gleba nell Emilia e nella Toscana,
Bologne, 1925 (R. Accademia dei Lincei. Cominissione per gli atti delle assemblee
costituzionali).
VANDERKINDERE, Libert et proprit en Flandre du IXe au XIIe sicle dans Bulletin
Acadmie royale de Belgique, Cl. des Lettres, 1906.
VERRIEST (L.), Le servage dans le comt de Hainaut dans Acadmie royale de Belgique,
Cl. des Lettres. Mmoires in-8, 2e Srie, t. VI, 1910.
VINOGRADOFF (P.), Villainage in England, Oxford, 1892.
WELLER (K.), Die freien Bauern in Schwaben dans Zeitschrift der Savigny Stift., G.A.,
1934.
WITTICH (W.), Die Frage der Freibauern dans Zeitschrift der Savigny Stift., G.A., 1934.
X. QUELQUES PAYS SANS FODALIT
1. La Sardaigne
BESTA (E.), La Sardegna medievale, 2 vol., Palerme, 1909.
RASPI (R.-C.), Le classi sociali nella Sardegna medioevale, Cagliari, 1938.
Marc BLOCH La socit fodale
471
SOLMI (A.), Studi siorici sulle istutizione della Sardegna nel media evo, Cagliari, 1917.
p.662
2. Les socits allemandes des rives de la mer du Nord
GOSSE (J.H.), De Friesche Hoefdeling dans Mededeelingen der Kl. Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterk., 1933.
KHLER (Johannes), Die Struktur der Dithmarscher Gechlechte, Heide, 1915.
MARTEN (G.) et MCKELMANN (K.) Dithmarschen, Heide, 1927.
SIFBS (B.E.). Grundlagen und Aufban der altfriesichen Verfassung, Breslau, 1933
(Untersuchungen zur deutschen Staats und Rechtsgeschichte, 144).
Marc BLOCH La socit fodale
472
TOME II.
LES CLASSES ET LE GOUVERNEMENT DES HOMMES
NOTE POUR L USAGE DE LA BIBLIOGRAPHIE
Les principes gnraux qui ont prsid l tablissement de cette bibliographie ont t
exposs en tte de l instrument de travail, de mme nature, qui figure au tome prcdent (p.
639) sous le titre : La formation des liens de dpendance. On a vit, trs peu d exceptions
prs, de rpter ici les titres des ouvrages dj recenss dans l inventaire prcdent, auquel le
lecteur est pri de se reporter, notamment, pour toutes les tudes gnrales sur la socit
fodale. La liste a t arrte, comme la rdaction mme, au mois de fvrier 1939.
p.663
PLAN DE LA BIBLIOGRAPHIE
I. LES CLASSES EN GNRAL ET LA NOBLESSE. 1. Gnralits sur l histoire des
classes et de la noblesse. 2. L adoubement : les textes liturgiques. 3. Les traits de la
chevalerie. 4. Travaux sur la chevalerie et l adoubement. 5. Les anoblissements. 6.
La vie noble et chevaleresque. 7. Les armoiries. 8. Sergents et sergenteries.
II. L GLISE DANS LA SOCIT FODALE ; L AVOUERIE.
III. LES JUSTICES.
IV. LE MOUVEMENT DES PAIX.
V. L INSTITUTION MONARCHIQUE.
VI. LES POUVOIRS TERRITORIAUX.
VII. LES NATIONALITS.
VIII. LA FODALIT DANS L HISTOIRE COMPARE.
I. LES CLASSES EN GNRAL ET LA NOBLESSE
1. Gnralits sur l histoire des classes et de la noblesse
BLOCH (Marc), Sur le pass de la noblesse franaise : quelques jalons de recherche dans
Annales d histoire conomique et sociale, 1936. p.664
DENHOLM-YOUNG (N.), En remontant le pass de l aristocratie anglaise, le moyen ge
dans Annales d histoire conomique et sociale, 1937.
DESBROUSSES (X), Condition personnelle de la noblesse au moyen ge, Bordeaux,
1901.
Du CANGE, Des chevaliers bannerets. Des gentilshommes de nom et d armes
(Dissertations sur l histoire de saint Louis, IX et X) dans Glossarium, d. Henschel, t. VII.
DUNGERN (O.v.), Comes, liber, nobilis in Urkunden des 11. bis 13. Jahrhundert dans
Archiv fr Urkundenforschung, 1932.
Marc BLOCH La socit fodale
473
DUNGERN (O.v.), Der Herrenstand im Mittelalter, t. I. PapiermhIe, 1908.
DUNGERN (O.v.), Die Entstehung der Landeshoheit in sterreich, Vienne, 1930.
ERNST (Viktor), Die Entstehung des niederen Adels, Stuttgart, 1916.
ERNST (Viktor), Mittelfreie, ein Beitrag zur schwbischen Standesgeschichte, 1920.
FEHR (Hans), Das Waffenrecht der Bamern im Mittelalter dans Zeitschrift der Savigny
Stiftung, G.A., 1914 et 1917.
FICKER (JUliUS), Vom Heerschilde, Innsbruck, 1862.
FORST-13ATTAGLIA (0.), Vom Herrenstande, Leipzig, 1916.
FRENSDORIFF (F.), Die Lehnsfhigkeit der Brger dans Nachrichten der K.
Gessellschaft der Wissensch. zu Gttingen, Phil.-hist. Kl., 1894.
GARCIA RIVES (A.), Clases sociales en Len y Castilla (Siglos X-XIII) dans Revista de
Archivos, t. XLI et XLII, 1921 et 1922.
GUILHIERMOZ (A.), Essai sur les origines de la noblesse en France au moyen ge,
1902.
HECK (Philipp), Beitrge zur Geschichte der Stnde im Mittelalter, 2 vol., Halle,
1900-1905.
HECK (Ph.), Die Standesgliederung der Sachsen im frhen Mittelalter, Tubingue, 1927.
HECK (Ph.), Uebersetzungsprobleme im frheren Mittelaiter, Tubingue, 1931.
LANGLOIS (Ch.-V.), Les origines de la noblesse en France dans Revue de Paris, 1904, V
( propos de GUILHIERMOZ, ci-dessus).
LA ROQUE (de), Trait de la noblesse, 1761.
LINTZEL (M.), Die stndigen Ehehindernisse in Sachsen dans Zeitschr. der
Savigny-Stiftung, G.A., 1932.
MARSAY (de), De l ge des privilges au temps des vanits, 1934 et Supplment, 1933.
MINNIGERODE (H. v.), Ebenburt und Echtheit- Untersuchungen zur Lehre von der
adeligen Heiratsebenburt vor dem 13. Jahrhundert Heidelberg, 1932 (Deutschrechtliche
Beitrge, VIII, 1).
NECKEL (Gustav.), Adel und Gefolgschaft dans Beitrge zur Gesch. der deutschen
Sprache, t. XVLI, 1916.
NEUFBOURG (de), Les origines de la noblesse dans MARSAY, Supplment.
OTTO (Eberhard F.), Adel und Frelheit im deutschen Staat des frhen Mittelalters, Berlin,
1937 1.
PLOTHO (V.), Die Stnde des deutschen Reiches im 12. Jahrhundert und ihre
Fortentwicklung dans Vierteljahrschrift fr Wappen-Siegel und Familienkunde, t. XLV, 1917.
REID (R. R.), Barony and Thanage dans English Historical Review, t. XXXV, 1920. p.665
ROUND (J. A.), Barons and knights in the Great Charter dans Magna Carta :
Commemoration essays, Londres, 1917.
Je n ai pu prendre connaissance de cet ouvrage, dans certaines de ses thses sans doute
contestable, mais trs riche de faits et d ides, qu aprs avoir remis l impression les
chapitres relatifs la noblesse.
Marc BLOCH La socit fodale
474
ROUND (J. A.), Barons and peers dans English historical Review, 1918.
SANTIFALLER (Leo), Ueber die Nobiles dans SANTIFALLER, Das Brixner Domkapitel
in seiner persnlichen Zusammensetzung, t. I, p. 59-64, Innsbruck, 1924 (Schleiern-Schriften,
7).
SCHNETTLER (Otto), Westfaiens Adel und seine Fiihrerrolle in der Geschichte,
Dortmund, 1926.
SCHNETTLER (Otto), Westfaiens alter Adel, Dortmund, 1928.
SCHULTE (Aloys), Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter, 2e d., Stuttgart.
VOGT (Friedrich), Der Bedeutungswandel des Wortes edel, Marbourg, 1909 (Marburger
Akademische Reden, n 20).
WERMINGHOFF (Albert), Stndische Probleme in der Geschichte der deutschen Kirche
des Mittelalters dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung, G.A., 1911.
WESTERBLAD (C. A.), Baro et ses drivs dans les langues romanes, Upsal, 1910.
2. L adoubement. Les textes liturgiques
ANDRIEU (Michel), Les ordines romani du haut moyen ge : I, Les manuscrits. Louvain,
1931 (Spicilegium sacrum lovaniense, 11).
FRANZ (Ad.), Die kirchlichen Benediktionen des Mittelalters, 2 vol. Fribourg en B., 1909.
Benedictio ensis noviter succincti, Pontifical mayenais : ms. et d. cf. Andrieu, p. 178 et
grafico, t. II, n 73.
table mot ensis, fac-simil MONACI, Archivio paleo
Bndiction de l pe : Pontifical de Besanon : cf. Andrieu, p. 445. d : Martne, De
antiquis eccl. ritibus, t. II, 1788, p. 239 ; FRANZ, t. II, p. 294.
Liturgie de l adoubement : Pontifical rmois ; cf. ANDRIEU, p. 112.
d. Hittorp, De divinis catholicae ecclesiae officils, 1719, col. 178 ; FRANZ, t. II, p. 295.
Liturgie de l adoubement : Pontifical de Guill. Durant. d. J. Catalani, Pontificale
romanum, t. I, 1738, p. 424.
Liturgie de l adoubement : Pontifical romain. d. (entre autres) Catalani, t. I, p. 419.
3. Les traits de la chevalerie
BONIZO, Liber de vita christiana, d. Perels, 1930 (Texte zur Geschichte des rmischen
und kanonischen Rechts I), VII, 28.
CHRTIEN DE TROYES, Perceval le Gallois, d. Potvin, t. II, v. 2831 suiv.
Lancelot dans H. O. SOMMER, The vulgate version of the Arthurian romances, t. III, 1, p.
113-115.
DER MEISSNER, Swer ritters name wil empfan... , dans F. H. von DER HAGEN,
Minnesinger, t. III, p. 107, n 10.
NAVONE (G.), Le rime di Folgore da San Gemignano, Bologne, 1880, p. 45-49 (Scelta di
curiosit letterarie, CLXXII).
Marc BLOCH La socit fodale
475
L Ordene de Chevalerie dans BARBAZAN, Fabliaux, 2e d. par MON, t. I, 1808, pp.
59-79.
RAIMON LULL, Libro de la orden de Caballeria, d. J. R. de Luanco, Barcelone, R.
Academia de Buenos Letras, 1901. Traduction franaise dans P. ALLUT, tude biographique
et historique sur Symphorien p.666 Champier, Lyon, 1859, p. 266 et suiv. Traduction anglaise,
The book of the ordre of chivalry, translated and printed by W. Caxton, d. Byles, 1926
(Early English Texts Soc., t. CLXVIII).
4. Travaux sur la chevalerie et l adoubement
BARTHLEMY (Anatole de), De la qualification de chevalier dans Revue nobiliaire,
1868.
ERBEN (Wilhelm), Schwertleite und Ritterschlag : Beitrge zu einer Rechtsgeschichte der
Waffen dans Zeitschrift fr historische Waffenkunde, t. VIII, 1918-1920.
GAUTIER (Lon), La chevalerie, 3e d., S. d.
MASSMANN (Ernst Heinrich), Schwerileite und Ritterschlag, dargestellt auf Grund der
mittelhochdeutschen literarischen Quellen, Hambourg, 1932.
PIVANO (Silvio), Lineamenti storici e giuridici della cavalleria medioevale dans Memorie
della r. Accad. delle scienze di Torino, Srie II, t. LV, 1905, Scienze Morali.
PRESTAGE (Edgar), Chivalry : a series of studies to illustrate its historical significance
and civilizing influence, by members of Kings College, London, Londres, 1928.
ROTH VON SCHRECKENSTEIN (K. H.), Die Ritterwrde und der Ritterstand.
Historisch-politische Studien ber deutsch-mittelalterliche Standesverhltnisse auf dem
Lande und in der Stadt, Fribourg-en-Brisgau, 1886.
SALVEMINI (Gactano), La dignita cavalleresca net Comune di Firenze, Florence, 1896.
TREIS (K.), Die Formalitten des Ritterschlags in der altfranzsischen Epik, Berlin, 1887.
5. Les anoblissements
ARBAUMONT (J.), Des anoblissements en Bourgogne dans Revue nobiliaire, 1866.
BARTHLEMY (Anatole de), tude sur les lettres d anoblissement dans Revue
nobiliaire, 1869.
KLBER (Q. L.), De nobilitate codicillari dans KLBER, Kleine uristische Bibliothek, t.
VII, Erlangen, 1793.
THOMAS (Paul), Comment Guy de Dampierre, comte de Flandre, anoblissait les
roturiers dans Commission histor. du Nord, 1933 ; cf. P. THOMAS, Textes historiques sur
Lille et le Nord, t. II, 1936, p. 229.
6. La vie noble et chevaleresque
APPEL (Carl), Bertran von Born, Halle, 1931.
Marc BLOCH La socit fodale
476
BORMANN (Ernst), Die Jogd in den altfranzsischen Artus-und Abenteuerromanen,
Marbourg, 1887 (Ausg. und Abh. aus dem Gebiete der roman. Philologie, 68).
Du CANGE, De l origine et de l usage des tournois. Des armes outrance, des joustes, de
la Table Ronde, des behourds et de la quintaine (Dissertations sur l histoire de saint Louis,
VI et VII) dans Glossarium, d. Henschel, t. VII.
DUPIN (Henri), La courtoisie au moyen ge (d aprs les textes du XIIe et du XIIIe sicle)
[1931].
EHRISMANN (G.), Die Grundlagen des ritterlichen Tugendsystems dans Zeitschrift fr
deutsches Altertum, t. LVI, 1919. p.667
ERDMANN (Carl), Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935
(Forschungen zur Kirchen-und Geistesgeschichte, VI).
GEORGE (Robert H.), The contribution of Flanders to the Conquest of England dans
Revue Belge de philologie, 1926.
GILSON (tienne), Lamour courtois, dans GILSON, La Thologie Mystique de saint
Bernard, 1934, p. 192-215.
JANIN (R.), Les Francs au service des Byzantins dans chos dOrient, t. XXXIX,
1930.
JEANROY, Alfred, La posie lyrique des troubadours. 2 vol., 1934.
CH.-V. LANGLOIS, Un mmoire indit de Pierre du Bois, 1313 : De torneamentis et
justis dans Revue Historique, t. XLI, 1889. [pp. 84 sqq].
NAUMANN (Hans), Ritterliche Standeskultur um 1200 dans NAUMANN (H.) et
MLLER (GUNTHER), Hfische Kultur, Halle, 1929 (Deutsche Vierteljahrschrift fr
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Buchreihe, t. XVII).
NAUMANN (Hans), Der staufische Ritter, Leipzig, 1936.
NIEDNER (Felix), Das deutsche Turnier im XII. und XIII. Jahrhundert, Berlin, 1881.
PAINTER (Sidney), William Marshal, knight-errant, baron and regent of England,
Baltimore, 1933 (The Johns Hopkins Historical Publications).
RUST (Ernst), Die Erziehung des Ritters in der altfranzsischen Epik, Berlin, 1888.
SCHRADER (Werner), Studien ber das Wort hfisch in der mittelhochdeutschen
Dichtung, Bonn, 1935.
SCHULTE (Aloys), Die Standesverhltnisse der Minnesnger, dans Zeitchrift fr
deutsches Altertum, t. XXXIX, 1895.
SCHULTZ (Alwin), Das hfische Leben zur Zeit der Minnesinger, 2e d., 2 vol., 1889.
SEILER (Friedrich), Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen
Lehnworts, II. Von der Einfhrung des Christentums bis zum Beginn der neueren Zeit, 2e d.,
Halle, 1907.
WHITNEY (Maria P.), Queen of medieval virtues : largesse dans Vassar Mediaeval
Studies... edited by, C. F. Fiske, New Haven, 1923.
7. Les armoiries
Marc BLOCH La socit fodale
477
BARTHLEMY (A. de), Essai sur lorigine des armoiries fodales dans Mm. soc.
antiquaires de lOuest, t. XXXV, 1870-71.
ILGEN (Th.), Zur Entstehung und Entwicklungsgeschichte der Wappen dans
Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der d. Geschichts- und Altertumsvereine, t. LXIX,
1921.
ULMENSTEIN (Chr. U. v.), Ueber Ursprung und Entstehung des Wappenwesens,
Weimar, 1935 (Forsch. zum deutschen Recht, I. 2.).
8. Sergents et sergenteries
(Pour la bibliographie allemande et franaise antrieure 1925, voir GANSHOF, ci-dessous.)
BLOCH (Marc), Un problme dhistoire compare : la ministrialit en France et en
Angleterre, dans Revue historique du droit, 1928. [pp. 46 sqq].
BLUM (E.), De la patrimonialit des sergenteries fieffes dans lancienne Normandie,
dans Revue gnrale de droit, 1926.
GANSHOF (F.L.), tude sur les ministeriales en Flandre et en p.668 Lotharingie, dans
Mm. Acad. royale Belgique, Cl. Lettres, in-8, 2e srie, XX, 1926.
GLADISS (D. v.), Beitrge zur Geschichte der staufischen Ministerialitt., Berlin, 1934
(Eberings Histor. Studien, 249).
HAENDLE (Otto), Die Dienstmannen Heinrichs des Lwen, Stuttgart, 1930 (Arbeiten zur
d. Rechts- and Verfassungsgeschichte, 8).
KIMBALL (E. G.), Serjeanty tenure in mediaeval England, New York, 1936 (Yale
Historical Publications, Miscellany, XXX).
LE FOYER (Jean), Loffice hrditaire de Focarius regis Angliae, 1931 (Biblioth.
dhistoire du droit normand, 2e srie, 4).
STENGEL (Edmund E.), Ueber den Ursprung der Ministerialitt dans Papsttum und
Kaisertum : Forsch... P. Kehr dargebracht, Munich, 1925.
II. LGLISE DANS LA SOCIT FODALE : LAVOUERIE
On na pas cru devoir numrer ci -dessous les histoires gnrales de lglise, dans son
ensemble ou par pays, non plus que les travaux relatifs aux divers problmes de lhistoire
ecclsiastique proprement dite. On se bornera rappeler tout le profit que lhistorien de la
socit fodale trouve consulter le grand ouvrage dA. HAUCK, Kirchengeschichte
Deutschlands, 5 vol., Leipzig, 1914-1920 et le beau livre de P. FOURNIER et G. LE BRAS,
Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses Dcrtales jusquau
Dcret de Gratien, 2 vol., 1931-1932.
Pour lavouerie, voir aussi beaucoup de travaux allemands, en particulier, distinguant mal
les problmes, dailleurs troitement lis, de lavouerie dune part, des justices, en gnral, de
lautre la section III de la prsente bibliographie.
GNESTAL (R.), La patrimonialit de larchidiaconat dans la province ecclsiastique de
Rouen dans Mlanges Paul Fournier, 1929.
Marc BLOCH La socit fodale
478
LAPRAT (R.), Avou dans Dictionnaire dhistoire et de gographie eccl siastique, t. V,
1931.
LESNE (Em.), Histoire de la proprit ecclsiastique en France, 4 vol., Lille, 1910-1938.
MERK (C.J.), Anschauungen ber die Lehre und das Leben der Kirche im
altfranzsischen Heldenepos, Halle, 1914 (Zeitschrift fr romanische Philologie, Beiheft, 41).
OTTO (Ebehard F.), Die Entwicklung der deutschen Kirchenvogtei im 10. Jahrhundert,
Berlin, 1933 (Abhandl. zur mittleren und neueren Geschichte, 72).
PERGAMENI (Ch.), Lavouerie ecclsiastique belge. Gand, 1907. Cf. BONENFANT (P.),
Notice sur le faux diplme dOtton II, dans Bulletin Commission royale histoire, 1936.
SENN (Flix), Linstitution des avoueries ecclsiastiques en France, 1903. Cf. compte
rendu par W. SICKEL, Gttingische Gelehrte Anzeigen, t. CLVI, 1904.
SENN (Flix), Linstitution des vidamies en France, 1907.
WAAS (Ad.), Vogtei und Bede in der deutschen Kaiserzeit, 2 vol., Berlin, 1919-1923.
III. LES JUSTICES
AULT (W.O.), Private Juridiction in England. New Haven, 1923 (Yale Historical
Publications. Miscellany, X).
BEAUDOIN (Ad.), tude sur les origines du rgime fodal : la p.669 recommandation et la
justice seigneuriale dans Annales de lenseignement suprieur de Grenoble, I, 1889.
BEAUTEMPS-BEAUPR, Recherches sur les juridictions de lAnjou et du Maine, 1890.
CAM (Helen M.), Suitors and Scabini dans Speculum, 1935.
CHAMPEAUX (Ernest), Nouvelles thories sur les justices du moyen ge dans Revue
historique du droit, 1935, p. 101-111.
ESMEIN (Ad.), Quelques renseignements sur lorigine des juridictions prives dans
Mlanges darcholo gie et dhistoire, 1886.
FERRAND (N.), Origines des justices fodales dans Le Moyen Age, 1921.
FRVILLE (R. de), Lorganisation judiciaire en Normandie aux XIIe et XIIIe sicles dans
Nouv. Revue historique de droit, 1912. [pp. 681 sqq].
GANSHOF (Franois L.), Notes sur la comptence des cours fodales en France dans
Mlanges dhistoire offerts Henri Pirenne, 1926.
GANSHOF (Franois L.), Contribution ltude des origines des cours fod ales en
France dans Revue historique de droit, 1928. [pp. 644 sqq].
GANSHOF (Franois L.), La juridiction du seigneur sur son vassal lpoque
carolingienne dans Revue de lUniversit de Bruxell es, t. XXVIII, 1921-22.
GANSHOF (Franois L.), Recherches sur les tribunaux de chtellenie en Flandre, avant le
milieu du XIIIe sicle, 1932 (Universiteit te Gent, Werken uitgg. door de Faculteit der
Wijsbegeerte en Letteren, 68).
GANSHOF (Franois L.), Die Rechtssprechung des grflichen Hofgerichtes in Flandern
dans Zeitschrift der Savigny Stiftung, G.A., 1938.
GARAUD (Marcel), Essai sur les institutions judiciaires du Poitou sous le gouvernement
des comtes indpendants : 902-1137, Poitiers, 1910.
Marc BLOCH La socit fodale
479
GARCIA DE DIEGO (Vicente), Historia judicial de Aragon en los siglos VIII al XII dans
Anuario de historia del derecho espaol, t. XI, 1934.
GLITSCH (Heinrich), Der alamannische Zentenar und sein Gericht dans Berichte ber die
Verhandlungen der k. schsischen Ges. der Wissenschaften, Phil-histor. Kl., t. LXIX, 1917.
GLITSCH (H.), Unterstichungen zur mittelalterlichen Vogtgerichtsbarkeit, Bonn, 1912.
HALPHEN (L.), Les institutions judiciaires en France au XIIe sicle : rgion angevine
dans Revue historique, t. LXXVII, 1901. [pp. 279 sqq].
HALPHEN (L.), Prvts et voyers au XII Sicle : rgion angevine dans Le Moyen Age,
1902.
HIRSCH (Hans), Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter, Prague, 1922.
HIRSCH (Hans), Die Klosterimmunitt seit dem Investiturstreit, Weimar, 1913.
KROELL (Maurice), Limmunit franque, 1910.
LOT (Ferdinand), La vicaria et le vicarius dans Nouvelle Revue historique de droit,
1893. [p. 281 sqq].
MASSIET Du BIEST (J.), A propos des plaids gnraux dans Revue du Nord, 1923.
MORRIS (W.-A.), The frankpledge system, New York, 1910, Harvard Historical Studies,
XIV).
PERRIN (Ch.-Edmond), Sur le sens du mot centena dans les chartes lorraines du
moyen ge dans Bulletin Du Cange, t. V, 1929-30.
SALVIOLI (Giuseppe), Limmunit et le giustizie delle chiese in Italia dans Atti e
memorie delle R. R. Deputazioni di Storia Patria per le provincie Modenesi e Parmesi, Srie
III, vol. V et VI, 1888-1890.
SALVIOLI (G.), Storia della procedura civile e criminale, Milan, 1925 (Storia del diritto
italiano pubblicata sotto la direzione di PASQUALE DEL GIUDICE, Vol. III, Parte prima).
p.670
STENGEL (Edmund E.), Die Immunitt in Deutschland bis zum Ende des 11.
Jahrhunderts. Teil I, Diplomatik der deutschen Immunitts-Privilegien, Innsbruck, 1910.
THIRION (Paul), Les chevinages ruraux aux XIIe et XIIIe Sicles dans les possessions
des glises de Reims dans tudes dhistoire du moyen ge ddies G. Monod, 1896.
IV. LE MOUVEMENT DES PAIX
ERDMANN (C.), Zur Ueberlieferung der Gottesfrieden-Konzilien dans ERDMANN, op.
cit. (p. 667)
GRRIS (G.-C.-W.), De denkbeelden over oorlog en de bemoeeiingen voor vrede in de
elfde eeuw (Les ides sur la guerre et les efforts en faveur de la paix au XIe sicle). Nimgue,
1912 (Diss. Leyde).
HERTZBERG-FRANKEL (S.), Die ltesten Land-und Gottesfrieden in Deutschland dans
Forschungen zur deutschen Geschichte, t. XXIII, 1883.
HUBERTI (Ludwig), Studien zur Rechtsgeschichte der Gottesfrieden und Landesfrieden :
1, Die Friedensordnungen in Frankreich, Ansbach, 1892.
KLUCKHOHN (A.), Geschichte des Gottesfriedens, Leipzig, 1857.
Marc BLOCH La socit fodale
480
MANTEYER (G. de), Les origines de la maison de Savoie... La paix en Viennois (Anse,
17 ? juin 1025) dans Bulletin de la Soc. de statistique de lIsre, 4e srie, t. VII, 1904.
MOLINI (Georges), Lorganisation judiciaire, militaire et financire des associations de
la paix : tude sur la Paix et la Trve de Dieu dans le Midi et le Centre de la France,
Toulouse, 1912.
PRENTOUT (H.), La trve de Dieu en Normandie dans Mmoires de lAcad. de Caen,
Nouv. Srie, t. VI, 1931.
QUIDDE (L.), Histoire de la paix publique en Allemagne au moyen ge, 1929.
SCHNELBGL (Wolfgang), Die innere Entwicklung des bayerischen Landfriedens des
13. Jahrhunderts, Heidelberg, 1932 (Deutschrechtliche Beitrge, XIII, 2).
SMICHON (E.), La Paix et la Trve de Dieu, 2e d., 2 vol. 1869.
YVER (J.), Linterdiction de la guerre prive dans le trs ancien droit normand (Ewrait
des travaux de la semaine dhistoire du droit normand mai 1927) 1928.
WOHLHAUPTER (Eugen), Studien zur Rechtsgeschichte der Gottes-und Landfrieden in
Spanien, Heidelberg, 1933 (Deutschrechtliche Beitrge XIV, 2).
V. LINSTITUTION MONARCHIQUE 1
BECKER (Franz), Das Knigtum des Nachfolgers im deutschen Reich des Mittelalters,
1913 (Quellen und Studien zur Verfassung des d. Reiches, V, 3).
BLOCH (Marc), LEmpire et lide dEmpire sous les Hohenstaufen, dans Revue des
Cours et Confrences, t. XXX, 2, 1928-1929.
BLOCH (Marc), Les rois thaumaturges : tude sur le caractre surnaturel p.671 attribu
la puissance royale, particulirement en France et en Angleterre, Strasbourg, 1924 (Biblioth.
de la Facult des Lettres de lUniv. de Strasbourg, XIX).
EULER (A.), Das Knigtum im altfranzsischen Karls-Epos. Marbourg, 1886 (Ausgaben
und Abhandl. aus dem Gebiete der romanischen Philologie, 65).
KAMPERS (Fr.), Rex und sacerdos dans Histor. Jahrbuch, 1925.
KAMPERS, Vom Werdegang der abendlndischen Kaisermystik, Leipzig, 1924.
KERN (Fritz), Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im frheren Mittelalter, Leipzig,
1914.
HALPHEN (Louis), La place de la royaut dans le systme fodal dans Revue historique,
t. CLXXII, 1933. [pp. 249 sqq].
MITTEIS (Heinrich), Die deutsche Knigswahl : ihre Rechtsgrundlagen bis zur Goldenen
Bulle, Baden bei Wien [1938].
NAUMANN (Hans), Die magische Seite des altgermanischen Knigtums und ihr
Fortwirken dans Wirtschaft und Kultur. Festschrift zum 70. Geburtstag von A. Dopsch,
Vienne, 1938.
1
Les bibliographies relatives aux institutions politiques des divers tats ayant t donnes ou
devant ltre d ans dautres volumes de la collection, on a cru pouvoir se borner ici aux travaux
relatifs la conception de la monarchie, en gnral, ou aux plus importants problmes du droit
monarchique.
Marc BLOCH La socit fodale
481
PERELS (Ernst), Der Erbreichsplan Heinrichs VI. Berlin, 1927.
ROSENSTOCK (Eugen), Knigshaus und Stmme in Deutschland zwischen 911 und 950,
Leipzig, 1914.
SCHRAMM (P. E.), Die deutschen Kaiser und Knige in Bildern ihrer Zeit, I, 751-1152, 2
vol., Leipzig, 1928 (Verffentlichungen der Forschungsinstitute an der Univ. Leipzig, Institut
fr Kultur-und Universalgesch., 1).
SCHRAMM (P. E.), Geschichte des englischen Knigtums im Lichte der Krnung,
Weimar, 1937. Traduction anglaise : A history of the English coronation (avec bibliographie
gnrale du sacre, en Europe).
SCHRAMM (P. E.), Kaiser, Rom und Renovatio, 2 vol. Leipzig, 1929 (Studien der
Bibliothek Warburg, XVII).
SCHULTE (Aloys), Anlufe zu einer festen Residenz der deutschen Knige im Mittelalter
dans Historisches Jahrbuch, 1935.
SCHULTZE (Albert), Kaiserpolitik und Einheitsgedanken in den Karolingischen
Nachfolgestaaten (876-962), Berlin, 1926.
VIOLLET (Paul), La question de la lgitimit lavnement de Hugues Capet dans Mm.
Acadmie Inscriptions, t. XXXIV, 1, 1892.
VI. LES POUVOIRS TERRITORIAUX
VACCARI (Pietro), Dall unit romana al particolarismo giuridco del Medio evo, Pavie,
1936.
FICKER (J.) et PUNTSCHART (P.), Vom Reichsfrstenstande, 4 vol. Innsbruck, Graz et
Leipzig, 1861-1923.
HALBEDEL (A.), Die Pfalzgrafen und ihr Amt : ein Ueberblick dans HALBEDEL,
Frnkische Studien, Berlin, 1915 (Eberings Histor. Studien. 132).
LWEN (Gerhard), Stammesherzog und Stammesherzogtum. Berlin, 1935.
LINTZEL (Martin), Der Ursprung der deutschen Pfalzgrafschaften dans Zeitschriff der
Savigny Stiftung, G.A., 1929.
PARISOT (Robert), Les origines de la Haute-Lorraine et sa premire maison ducale,1908.
Herzogsgeivalt
und
Friedensschutz :
deutsche
ROSENSTOCK
(Eugen),
Provinzialversammlungen des 9-12. Jahrhunderts, Breslau, 1910 (Untersuchungen zur
deutschen Staats-und Rechtsgeschichte, H., 104). p.672
SCHMIDT (Gnther), Das wrzburgische Herzogtum und die Grafen und Herren von
Ostfranken vain 11. bis zum 17. Jahrhumiert, Weimar, 1913 (Quellen und Studien zur
Verfassungsgeschichte des deutschen Reiches, V, 2).
WERNEBURG (Rudolf), Gau, Grafschaft und Herrschaftt in Sachsen bis zum Uebergang
in das Landesfrstentum Hannover, 1910 (Forschungen zur Geschichte Niedersachsens, III,
1).
LAPSLEY (G. Th.), The county palatine of Durham, Cambridge, Mass., 1924 (Harvard
Historical Studies, VIII).
ARBOIS DE JUDAINVILLE (d), Histoire des ducs et comtes de Champagne, 7 vol.,
1859-1866.
Marc BLOCH La socit fodale
482
AUZIAS (Lorice), LAquitai ne carolingienne (778-897), 1937.
BARTHLEMY (Anatole de), Les origines de la maison de France, dans Revue des
questions historiques, t. XIII, 1873.
BOUSSARD (J.) Le comt dAnjou sous Henri Plantagenet et ses fils (1151-1204), 1938
(Biblioth. c. Hautes-tudes, Sc. histor. 271).
CHARTROU (Josphe), LAnjou de 1109 1151, 1928.
CHAUME (M.), Les origines du duch de Bourbogne, 2 vol., Dijon, 1925-31.
FAZY (Max.), Les origines du Bourbonnais, 2 vol., Moulins, 1924.
GROSDIDIER DE MATONS (M.), Le comt de Bar des origines au trait de Bruges (vers
750-1301), Bar-le-Duc, 1922.
HALPHEN (Louis), Le comt dAnjou au XIe sicle, 1906.
JAURGAIN (J. de), La Vasconie, 2 vol., Pau, 1898.
JEULIN (Paul), Lhommage de le Bretagne en droit et dans les faits dans Annales de
Bretagne, 1934.
LA BORDERIE (A. LE MOYNE de), Histoire de Bretagne, t. II et III, 1898-9.
LATOUCHE (Robert), Histoire du comt du Maine, 1910 (Biblioth. Ec. Hautes tudes,
Sc. histor., 183).
LEX (Lonce), Eudes, comte de Blois... (995-1007) et Thibaud, son frre (995-1004),
Troyes, 1892.
LOT (Ferdinand), Fidles ou vassaux ?, 1904.
POWICKE (F. M.), The loss of Normandy (1189-1204), 1913 (Publications of the
University of Manchester, Historical Series, XVI).
SPROEMBERG (Heinrich), Die Entstehung der Grafschaft Flandern. Teil I : die
ursprngliche Grafschaft Flandern (864-892), Berlin, 1935, Cf. F. L. GANSHOF, Les
origines du comt de Flandre, dans Revue belge de philologie, 1937.
VALIN (L.), Le duc de Normandie et sa cour, 1909.
VALLS-TABERNER (F.), La cour comtale barcelonaise, dans Revue historique du droit,
1935.
Les Bouches du Rhne, Encyclopdie dpartementale. Premire partie, t. II Antiquit et
moyen ge, 1924.
KiENER (Fritz), Verfassungsgeschichte der Provence seit der Ostgothenherrschaf bis zur
Errichtung der Konsulate (510-1200), Leipzig, 1900.
MANTEYER (G.), La Provence du IIIe au XIIe sicle, 1908.
PREVIT-ORTON (C.W.), The early history of the House of Savoy (1000-1223),
Cambridge, 1912.
TOURNADRE (Guy de), Histoire du comt de Forcalquier (XIIe sicle), [1930].
GRIMALDI (Natale), La contessa Matilde e la sua stirpe feudale, Florence, [1928].
HOFMEISTER (Adolf), Markgrafen und Markgrafschaften im italienischen Knigreich in
der Zeit von Karl dem Grossen bis auf Otto den Grossen (774-962) dans Mitteilungen des
Instituts fr sterreichische Geschichtsforschung, VII, Ergnzungsband, 1906.
Marc BLOCH La socit fodale
483
VII. LES NATIONALITS p.673
CHAUME (M.), Le sentiment national bourguignon de Gondebaud Charles le
Tmraire dans Mm. Acad. Sciences Dijon, 1922.
COULTON (G. G.), Nationalism in the middle ages dans The Cambridge Historical
Journal, 1935.
HUGELMANN (K. G.), Die deutsche Nation und der deutsche Nationalstaat ! in
Mittelalter dans Histor. Jahrbuch, 1931.
KURTH (G.), Francia et Francus dans tudes franques, 1919, t. I.
MONOD (G.), Du rle de lopposition des races et des nationalits dans la dissolution de
lEmpire carolingien dans Annuaire de lc. des Hautes tudes, 1896.,
REMPPIS (Max), Die Vorstellungen von Deutschland im altfranzsischen Heldenepos und
Roman und ihre Quellen, Halle, 1911 (Beihefte zur Zeitschrift fr roman. Philologie, 234).
SCHULTHEISS (Franz Guntram), Geschichte des deutschen Nationalgefhls, t. I, Munich,
1893.
VIGEINER (Fritz), Bezeichnungen fr Volk und Land der Deutschen vom 10. bis zum 13.
Jahrhundert, Heidelberg, 1901.
ZIMMERMAN (K. L.), Die Beurteilung der Deutschen in der franzsischen Literatur des
Mittelalters mit besonderer Bercksichtigung der Chansons de geste dans Romanische
Forschungen, t. XIX, 1911.
VIII. LA FODALIT DANS LHISTOIRE COMPARE
HINTZE (0.), Wesen und Verbreitung des Feudalismus dans Sitzungsber. der preussischen
Akad., Phil.-histor. Kl., 1929.
DLGER (F.), Die Frage des Grandeigentums in Byzanz dans Bulletin of the international
commission of historical sciences, t. V, 1933.
OSTROGORSKY (Georg), Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsgrundlagen des
byzantinischen Reiches dans Vierteljahrschrift fr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1929.
STEIN (Ernst), Untersuchungen zur sptbyzantinischen VerfassungsWirtschaftsgeschichte dans Miffeilungen zur osmanischen Geschichte, t. II, 1923-25.
und
THURNEYSSEN (R.). Das unfreie Lehen dans Zeitschrift fr keltische Philologie, 1923 ;
Das freie Lehen, ibid., 1924.
FRANKE (0.), Feudalism : Chinese dans Encyclopaedia of the social sciences, t. VI, 1931.
FRANKE (0.), Zur Beurteilung des chinesischen Lehnwesens dans Sitzungsber. der
preussischen Akad., Phil.-histor. Kl., 1927.
ERSLEV (Kr.), Europaeisk Feudalisme og dansk Lensvaesen dans Historisk Tidsskrift,
Copenhague, 7e srie, t. II, 1899.
BECKER (C. H.), Steuerpacht und Lehnwesen, eine historische Studie ber die Enstehung
des islamischen Lehnwesens dans Islam, t. V, 1914.
BELIN, Du rgime des fiefs militaires dans lIslamisme et principalement en Turquie dans
Journal Asiatique, 6e srie, t. XV, 1870. [pp. 187 sqq].
Marc BLOCH La socit fodale
484
LYBYER (A. H.), Feudalism : Sarracen and Ottoman dans Encyclopaedia of the social
sciences, t. VI, 1931.
ASAKAWA (K.), The documents of Iriki illustrative of the development of the feudal
institutions of Japan, New Haven, 1929 (Yale Historical Publ., Manuscripts and edited texts,
X). Avec une importante introduction.
ASAKAWA (K.), The origin of feudal land-tenure in Japan dans American Historical
Review, XXX, 1915. p.674
ASAKAWA (K.), The early sho and the early manor : a comparative study dans Journal
of economic and business history, t. I, 1929.
FUKUDA (Tokusa), Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwickelung in Japon,
Stuttgart, 1900 (Mnchner volkswirtschaftliche Studien, 42).
RUFFINI AVONDO (Ed.), Il feudalismo giapponese visto da un giurista europeo dans
Rivista di storia del diritto italiano, t. III, 1930.
SANSOM (J. B.), Le Japon : histoire de la civilisation japonaise, 1938.
UYEHARA (Senroku), Gefolgschaft und Vasallitt im frnkischen Reiche und in Japan
dans Wirtschaft und Kultur. Festschrift zum 70. Geburstag von A. Dopsch, Vienne, 1938.
LVI (Sylvain), Le Npal, 2 vol., 1905 (Annales du Muse Guimet, Bibliothque, t. XVII
et XVIII).
HTZCH (C. V.), Adel und Lehnwesen in Russland und Polen dans Historische
Zeitschrift, 1912.
WOJCIECHOWSKI (Z.), La condition des nobles et le problme de la fodalit en
Pologne au moyen ge dans Revue historique du droit, 1936 et 1937 (avec bibliographie).
ECK (Al.), Le moyen ge russe, 1933.
*
**
Marc BLOCH La socit fodale
485
INDEX
A
ABBON de Fleury, 133.
ABEL (fils d Adam), 431.
ABLARD, 140, 162, 163, 481.
Abonnement, 388.
ADALARD, 273.
ADALBRON, archevque de Reims, 533, 534.
ADALBERT, archevque de Hainbourg- Brme, 65.
ADAM (le premier homme), 431.
ADAM de Brme (chroniqueur), 44.
Adelenc : voir Noble.
ADMAR de Chabannes, 78, 139.
Adoubement (sens du mot), 435 et s. ; note n 282.
Adriatique, 15, 106, 418.
Aelfred, 403.
Aelversham, 403.
Aetheling : voir Noble.
AETHELRED, roi dAngleterre, 51.
AETHELSTAN, roi d Angleterre, 258, 262, 318 ; note n 179.
AETHELWULF, roi dAngleterre, note n 38.
Affranchissement, 360 et s., 364, 372, 388.
Afrique, 14, 102.
Aghlabites, 24.
Aide, 309, 313, 351, 369 ; note n 203.
AIMON, archevque de Bourges, 573, 575.
Anesse, 531.
AIRELD de Rievaulx, note n 83.
Aisne, 111.
Aix-la-Chapelle, 151, 522, 539, 540.
ALAIN Barbe Torte, 59.
Alains, 220.
ALCUIN, 77, 91, 93, 260.
ALDEBERT, 245.
Almanie, 219, 342, 471, 548. Voir aussi Souabe.
Alenonnais, 83.
ALEXANDRE le Grand, 52.
ALEXIS (saint), 42 1 ; voir aussi le Pome de saint Alexis, 318.
ALFRED le Grand, roi des Anglo-Saxons, 48, 49, 74, 85, 90, 91, 92, 117, 119, 167, 326, 328.
Voir aussi Lois d Alfred.
ALGER (fils dAldebert), 245.
Allemagne, 38, 65, 94, 113, 168, 209 et s., 255-57, 275, 281-83, 286, 289 et s., 293, 314, 332,
339, 371-76, 558 et s., arme, guerriers : 218, 256 et s., 261 ; chartes : 123,
160, 385, 386, 453, 468 ; compagnonnage : 221, 223 ; chevalerie et noblesse :
340, 345, 351, 389, 422, 426, 438 et s., 447, 453, 456, 466, 468, 475-77 ; dialectes
germains : 120 ; duchs et principauts territoriales : 257, 289, 290, 548 et s., 555
et s., 589, 590, 592 ; glise : 63, 65, 339, 472, 485, 553-55, 561, 589-92 ;
empereurs ou rois : 116, 139, 142, 166, 176, 289, 472, 485, 548, 553, 561, 589, 590
et s., fodalit : 99, 210, 248, 256, 257, 289, 293, 304, 305, 314, 332, 345, 455,
456, 466, 550, 588 ; France Orientale : 28 ; Germanie : 65, 99, 168, 176, 186,
Marc BLOCH La socit fodale
486
201, 204 et s., 213, 215, 218, 221, 223, 254, 317, 344, 355, 360 ; chefs germains :
32 ; justice, lgislation ; 165 et s. 176, 178, 248, 257, 263, 268 et s., 289, 290,
314, 340 et s., 349, 381, 421, 513, 559 ; langue nationale, littrature : 120 et s.,
142 et s., 147, 158, 160, 162 et s., 317 ; monarchie : 519, 521 et s., 533, 536, et s.,
564, 581, 588-92 ; nationalit : 167 et s., 597602 ; paix (institutions de), 569,
577 ; parent : 184, 201, 204 et s., Stnde : 618 ; villes : 417, 588. Voir aussi
Empire romain germanique.
Alleu, alleutier, 244, 267, 373.
Alpes, 27, 28, 32, 52, 102, 125, 166, 519, 520.
ALPHONSE le Sage, roi de Castille, 446.
Amales (dynastie ostrogothique), 153.
Amalfi, 29, 112.
Ambacte, 223 ; note n 156.
Amboise (Sires d ), 202, 398
Amiens (Vidame d ), 313.
Amis charnels, 183-86, 203.
Amour courtois, 327, 331, 428-32 ; note n 276.
Anatolie : voir Asie Mineure.
Ancne (Marquisat d ), 477.
ANDR le Chapelain, 430.
Angers, 326 ; voir Saint-Serge et Anjou.
Angleterre, 41, 42 et s., 45, 48-54, 59, 64, 70, 74-95, 107 ; anglo-saxonne : 396, 397, 436
et s., 517, 518, 530, 532, 538 et s., 543 et s., 578 et s., 612, chasse : 42, 422 ;
chteaux : 418 ; conomie : 112 ; glise : 63, 480 560 ; fodalit : 196, 217,
240, 242, 247, 257-64, 266-69, 280, 285 et 287, 297, 306, 308, 317, 318, 326 et s.,
376-81, 596, 609, 614, 615 ; chevalerie, noblesse : 101, 339, 345, 346, 350, 351,
376-81, 420, 436, 438 et s., 446, 457-60, 464, 466, 468 ; enseignement,
littrature : 119, 147 ; justice, lgislation : 167-69, 178, 190, 196, 280, 285 et s.,
291, 319, 328, 339, 345, 346, 350, 351, 386, 421 ; notes n 191, 203 ; langue 147 ;
nationalit : 596-97 ; paix (institutions de), 569, 578 et s., royaut : 247, 293,
524, 526, 528, 568, 582, 587, 592-597, 618 ; tournois : 424.
Anjou, 277, 280, 291, 305, 563 ; dynastie : 160, 197 ; comtes, voir Foulque Nerra,
Foulque le Rchin, Geoffroi le Bel et Geoffroi Martel.
Annales de Bze, 138.
Annales de Fulda, 275.
Annales de Saint-Vaast, 56.
Anneau (pastoral), 484, 487.
Anne (dtermination de l ), 118, 132 et s.
ANNO (ou HANNO), archevque de Cologne, 153.
ANSCHAIRE (saint), moine picard puis archevque de Hambourg, 63, 65, 442.
Anse-sur-Sane, 571.
ANSELME, (saint), archevque de Canterbury, 157, 163.
Antioche, 199.
Antioche (Chanson d ), 152,
Apennins (Seigneurs des), 546.
Appel en justice, 515 et s.
Apulie, 600.
Aquitaine, Aquitains, 101, 122, 139, 223, 255, 524, 546, 547, 584, 585, 598 ; ducs, voir
Guillaume le Pieux, Guillaume IX ; roi, voir Ppin II.
Arabes : voir Musulmans.
Aragon, 264, 518, 618 ; roi, voir Jacques III.
ARCHAMBAUD de Comborn, 198.
ARCHIPOETA, pseudonyme d un pote d expression latine, 159.
Ardres, 172, 552.
Marc BLOCH La socit fodale
Arezzo, 189.
Argenteuil, Moines de Saint-Denis : 192.
Argonne, 527.
ARIBERT, archevque de Milan, 282.
ARISTOTE, 52 ; sa Physique : 159.
Arles, 26 ; royaume : 385, 523, 538, 569.
Armement, 405 et s.
Armoiries, 456, 460.
Armorique, 547 ; voir aussi Bretagne (duch).
Arno, 45, 546.
ARNOUL, vque de Soissons, 187.
ARNOUL d Ardres, 152.
ARNOUL de Guines, 317.
ARNULF de Carinthie, roi de Germanie, 31, 519, 520, 521, 522.
ARPAD, 36 ; dynastie arpadienne, 37.
Arques-en-Artois, 190.
Arras : voir Saint-Vaast.
ARTHUR (Le roi), 147.
ARTHUR de Bretagne, 197.
Artois, 230.
Ases (demi-dieux), 523.
Asie, 30, 106, 107 ; Asie Mineure : 14, 24.
Assise, 189.
Asturies, 264, 371, 518, 524, 605.
Atlantique (ocan), 15, 41, 45, 46, 70.
ATTILA, 141, 153, 154 ; personnage des Nibelungen, 200.
Attonides, 398 ; voir aussi Canossa,
Audenarde, 203.
AUGUSTE (empereur romain), 141, 537.
AUGUSTIN (saint), 14, 141, 153.
Austrasie, 397, 546.
Autriche, 34, 285.
Autun, Autunois, 546, 547.
Auvergne, 587.
Auxerre, Auxerrois, 304, 574.
Avallonais, 547.
Avars, 31, 34.
Avesnes (Sire d ), 303.
Avou (advocatus), 246, 559, 588.
Avouerie, 365, note n 348.
Avranches, 83 ; diocse : 58.
Azov (mer d ), 30.
B
Babenberg, 398.
Bachelier, 462 ; note n 308.
Bagdad, 24.
Bail fodal, baillistre, 286, 287.
Baillis royaux, 587.
Ble, 523.
Balares, 26, 45.
Balkans, 14.
Baltique (mer), 39, 47, 51, 69, 71, 106 ; pays baltes, 113.
487
Marc BLOCH La socit fodale
488
BALZAC (H. de), 155.
Bamberg, vques : voir Eberhard et Gunther.
Ban, banalits, 349, 350, 559.
Baneret, 462.
Barbaresques, 26, 45.
Barbarin (monnaie), 413.
Barcelone, comt : 305, 327, 518 ; dynastie 453. Usages de Barcelone 306, 307, 313,
462, 463. Voir aussi Catalogne.
Baron, Baronet, 459 et s., 460, 462 et s.
Basques, 144 ; Duc des Basques : 547. Langue euskarienne : 547.
BAUDOIN II, roi de Jrusalem, 125.
BAUDOIN II, roi de Jrusalem 199.
BAUDOIN le Ferr, comte de Flandre, 278.
BAUDOIN IV de Flandre, 576.
BAUDOIN II de Guines, 159.
BAUDOIN IV de Hainaut, 424.
Bauermeister (maire), 468.
Bavire, 31, 32, 33, 106, 203, 283, 290, 371, 396 ; ducs : 166, 520, 536, 548, 549 ;
vchs : 589. Voir Henri le Lion.
BAYARD (le Chevalier), 440.
Bayeux, 287 ; vque : 191, 311 note n 204.
Bayle (maire), 468.
Barn, 514.
Beaucaire, 449.
Beauce, 104.
Beaulieu (moines de), 406.
BEAUMANOIR (Philippe de), 172, 179, 185, 187, 188, 189, 203, 257, 320, 440, 448, 454,
505, 510. Voir ses Coutumes du Beauvaisis.
Beaumont en Argonne (charte de), 384.
Beauvais, 505, 570, 571 ; vque : 569 ; voir Coutumes du Beauvaisis.
BDE le Vnrable (saint), 77.
Bede (prire, demande), 351.
Bedfordshire, 83.
BDIER (J.), 147.
BGUE (duc), 184.
Bellme (famille), 398 ; sire de B. : 463.
Bnvent, Bnventin, 24, 267.
BENOT (saint), 479. Voir Miracles de saint Benot : et aussi Rgle de saint Benot.
BENOT le Diacre, 141.
BENOT de Sainte-Maure, 148.
Beowulf (Lai de), 52, 67, 221, 317 ; note n 23.
Berbres, 14,
BRENGER 1 11, roi d Italie, 94, 526.
Bergame, 553.
BERNARD (saint) de Clairvaux, 134, 442.
BERNARD de Chartres, 159.
BERNARD de Comborn, 198.
BERNARD de Rethel, 145.
Bernay, 403.
Bernicie, 48, 49.
Bernier (personnage de la Chanson de Raoul de Cambrai), 322, 333.
Berry, 35, III, 552, 569, 574, 575.
BERTRAND de BORN, 193, 327, 409, 413, 414, 415, 419, 462.
Besanon, province ecclsiastique, 521 ; Pontifical de B. : 439.
Marc BLOCH La socit fodale
489
Bessin, 58, 78, 82, 90.
Bze, Annales : 138 ; moines 384.
Bienfait (sens du mot), 236-240, 243.
Bigorre, 322, 422.
Birka (sur le lac Mlar), 62.
Blois, Blsois, 277 ; comte : 175, 584. Voir aussi Eudes de Blois.
BOCE (auteur de la Consolation), 49.
Bol (ensemble de terres danoises), 85.
Bologne, 158, 175, 176.
Bondmen (hommes lis), 379, 389, 474.
BONIZON, vque de Sutri, 442, 563 ; note n 352.
Bordeaux, 251, 547, 584 ; voir aussi Lorrains (Cycle des).
Bornholm, 69.
BOSON, roi de Provence, Bosonides, 193, 522.
Bosphore, 14.
BOUCHARD de Vendme, 586.
Boucliers (Ordre des), 466 et s.
BOULAINVILLIERS (H. de), 11, 12, 213.
Boulogne (comte de), 245.
Bourbon l Archambault (chteau), 553.
Bourbonnais (province), 553.
Bourbons (famille), 397, 553, 616.
Bourgeoisie, 178, 447, 489-93 ; voir aussi Marchands.
Bourges, 112 ; comt : 275, 547 ; archevque, voir Aimon ; comte, voir Esturmi.
Bourgogne, 57, 59, 76, 94, 102, 188, 230, 276, 305, 345, 362, 533, 546, 569.
Bourguignons : 598 ; comt, voir Franche Comt ; duch : 524 ; note n 344 ;
ducs, voir Philippe le Hardi et Raoul ; monastres 158 ; parler
bourguignon : 396 ; royaume : 28, 52, 397, 522 et s. Voir aussi Arles (royaume).
Brabant, 426, 618.
Brandebourg (noblesse), 618.
Brme, 63 ; archevque, voir Adalbert. Archevch de Brme-Hambourg : 64, 65.
Brennos, 403.
Brescia (abbaye), 342.
Bretagne, 518 ; duch : 59, 77, 524 ; duc : 564.
Brissarthe (Bataille de), 277.
Bruges, 113, 417, 545, 553.
Brnhilde (personnage lgendaire), 154.
BRUNO, vque de Toul, puis pape, 485.
Brunswick (duch), 257 ; note n 19.
Buccelarius (soldat priv), 222, 319, 331.
Buckinghamshire, 83.
Bulgarie, 30, 37 ; Bulgares de la Volga : 36.
BURCHARD, vque de Worms, 142, 568.
Burg, 490.
Burgondes (hros), 428 ; terre : 547.
Byzance, Empire byzantin, 107, 112, 267, 412, 539, 600, 607 ; arme : 35, 53 ;
provinces, 267. flotte : 28.
C
Caen, 86, 90, 319 ; concile : 576. Calabre, 25.
Camargue, 26.
Cambrai, 42 ; vque : 569.
Campanie, 24, 26.
Marc BLOCH La socit fodale
490
Canche, 73.
Canigou (abbaye du), 415, note n 260.
Canossa (sires de), 546.
Canterbury, 176 ; archevques : 44, 439. Voir Anselme et tienne Langton.
Cantique des Cantiques (Le), 159.
Captiens, 90, 111, 248, 279, 281, 307, 397, 448, 464, 476, 514, 515, 533, 534, 535, 536, 547,
576, 584. Voir aussi Robert le Fort (Robertiens).
Capoue, 267.
Captal ou baron, 462.
Capuchonns du Puy (Les), 574.
Carinthie, duch : 283 ; voir Arnulf de Carinthie, roi de Germanie.
Carlenses : voir Kerlinger.
CARLOMAN (fils de Charles le Chauve), 227.
Carolingiens, poque carolingienne, 28, 32, 63, 70, 73, 100, 210, 229, 273, 295, 308, 311,
484, 533-535, 586, 611 ; dynastie : 531, 533-537, 585 et s., 599 ; effort
culturel : 120 ; glise : 484 et s., 497, 498, 533, 556-60 ; influence sur la
fodalit : 227 et s., 246, 254, 281, 608 et s., 610, 614 ; juridictions : 462, 463,
499-503, 508, 509, 511, 513 et s., monarchie : 397, 398, 465, 519, 521, 528, 544,
547, 549, 551, 564, 573, 578 et s., 582, 595, 597 ; service de cheval : 410 ;
tradition : 219, 224 et s., 467, 521, 522, 524, 539, 541, 582, 588, 589, 601 et s.
Carpathes, 30, 31, 106.
Carrion (Les infants de), personnages du Pome du Cid, 199.
Caspienne (mer), 106.
Castille, 154, 203, 264, 371, 518, 570, 609 ; note n 160. voir Alphonse le Sage.
Catalogne, Catalans, 112, 173, 264, 289, 302, 305, 306, 371, 377, 441, 453, 575 ; note n 160.
Voir aussi Barcelone et Espagne (Marches d).
Caucase, 220.
Caudebec, 83.
Caux (Pays de), 83, 86, 88, 90, 291.
Cava (abb de Santa Trinit della), 449
Cavalerie, 219-222, 262, 406.
Cavaliacus (domaine de), 245.
Celtes, 68, 345 ; traditions celtes 338.
Censiers, 346, 362.
Centaine, centenier, 501, 502, 505, 510 et s.
Ceorl (homme libre), 404.
CSAIRE dArles (saint), 499.
CSAR (Jules), 141, 223.
Chalon-sur-Sane, 519.
Champagne, 102, 113, 178, 431, 446 ; comtes : 160 ; note n 344 ; comtesse : 118 ;
voir aussi Henri le Libral.
Chams (peuple asiatique), 95.
Chanson de Guillaume, 143, 144, 148, 410.
Chanson de Roland : Voir Roland.
Charente, 43.
CHARLES MARTEL, 15, 219, 225, 235.
CHARLEMAGNE, 52, 144, 186, 219, 226, 241, 256, 259, 272, 279, 352, 558 ;
descendance : 28, 259, 279, 521, 533, 534, 535 ; lgende et tradition : 150, 152,
279, 299, 317, 463, 519, 537, 539 et s., 563, 589, 596, 600, 601 ; politique : 470,
492, 50 1, 502, 544, 557, 558, 573. Voir aussi le Voyage de Charlemagne
(pome).
CHARLES II le Chauve, roi de France et empereur dOccident, 43, 55, 76, 101, 102, 227,
245, 272, 276-78, 283, 397, 519, 520, 531, 532, 585, 598, 618.
CHARLES III le Simple, roi de France, 57, 58, 330, 401, 531, 599, 601.
Marc BLOCH La socit fodale
491
CHARLES III le GROS, empereur, 43, 54, 275, 423, 518.
CHARLES VII, 212 ; note n 152.
CHARLES QUINT, 278.
CHARLES, duc de Lorraine, 533, 534.
CHARLES II, comte de Provence, 446.
Charroux (Concile de), 569, 570, 571.
Charte (La Grande), 278, 294, 587, 618.
Chartres, 42, 57, 58, 157, 195 ; cathdrale : 444 ; abbaye de Saint-Pre : 469.
vques, voir Foubert et Ive.
Chasement, chaser, 241, 242, 245, 271, 469, 608.
Chasse, 422 et s.
Chteaux, 418 et s., 551 et s., 595.
Chtellenie, 513, 551-53.
Cher, 573.
Chester, 49, 74 ; comt : 593 ; vque : 462.
Chevage (taxe), 361, 362, 366, 372, 374, 377.
Chevalerie, 435-444, 449, 450-454.
Chevaliers errants, 411.
CHIMNE, 125.
Chine, 603.
CHRTIEN de Troyes, 161, 441, 443, 461.
Chronique Universelle Saxonne, 160.
Chypre, 155, 455.
CID (Le), 125, 155, 406.
Cid (Pome du), 155, 265, 463.
Cinq Bourgs (Les), 80, 88, 89.
CLARY (Robert de), 160, 463 et s.
Clermont-Ferrand, 43 ; concile. 305.
Clientle, 215.
Clontarf (bataille de), note n 43.
CLOVIS, 223, 255, 526.
Cluny (abbaye de), 103, 138, 368, 481, 547, 569 ; note n 162. Abbs : 530. Voir aussi
Eudes et Maeul.
Coblence, 552.
Codalet-en-Conflent (Charte de), 387 ; note n 239.
Collatraux (droit des), 534.
Collibertus : voir Culvert.
Cologne, 43, 63, 522 ; archevques, voir Anno et Reinald de Dassel.
Colonnes dHercule, 14.
Colons, 357, 367.
COMBORN (Vicomt de), 198.
Commend, commendise, commendatio, 210, 215, 216, 224, 230, 231, 233, 244, 258, 299,
374 et s., 376, 485, 528, 611.
Communes de la Terre, 460.
Communes (Chambre des), 512.
COMMYNES (Ph. de), 127, 318.
Compigne (synode de), note n 208.
Compostelle, archevque, voir Diego Gelmirez.
Comte palatin, note n 344.
Comtes, juridiction, pouvoirs et titre : 465 et s., 502-505, 543, 544, 549 et s., 583, 586-88.
Comts anglais : voir Shires.
Comtors (comtes provenaux), 465.
Confessions de Guibert de Nogent, 158.
CONON de Lausanne, note n 367.
Marc BLOCH La socit fodale
CONRAD Ier, 536.
CONRAD II, 52, 102, 125, 139, 142, 281, 282, 283, 332, 537, 539.
CONRAD III, 538, 565.
CONRAD IV, 449.
CONRAD, archevque de Salzbourg, 242.
Consolation (La), de Boce, 49.
CONSTANTIN ler le Grand, 540 ; sa Pseudo Donation : 141, 540.
Constantinople, 24, 30, 53, 66, 105, 106, 158. Voir aussi Byzantin (Empire).
Contrat, 617 et s.
Contre-Rforme, 128.
Conversus, 125 et s.
Corbeil, 586.
Corbie (monastre), 243.
Cordoue (Khalifat), 24, 25, 28.
Cork, 47.
Cornelius, 403.
Cornigliano, 403.
Cortenberg (Charte), 618.
Corts espagnols, 618.
Cour baron, 510.
Cour coutumire, 510.
Cour royale franaise, voir Parlement.
Couronnement de Louis (geste), note n 85.
Courtoisie (sens du mot), 425, 427 ; 429 ; gens courtois : 442. Voir aussi Amour courtois.
Courtrai (bataille de), 447, 451. Coutances (diocse), 58.
Coutumes du Beauvaisis, de Ph. de Beaumanoir, 179, 203.
Coutumes (charte de), 385.
Criados, 264 et s., 266.
Croisades, 411 et s., 565.
Crosse, 481, 484, 487.
Culvert, collibertus (affranchi), 364, 366, 372.
Cumberland, 80.
Cunauld, prs Saumur, 46.
Cycle des Lorrains (pome pique), 148, 602.
CYNEWULF, 328 ; note n 216.
D
Danegeld, 595.
Danelaw, 85, 86, 87.
Danemark, 39, 40, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 77, 85, 88.
Danube, plaine danubienne, 30, 32, 33, 36, 77, 93, 106, 112 ; note n 13.
Dauphin, 618.
DAVID (Le roi), 524.
Dee (rivire), 89.
Des, au lac de Grandlieu, 45, 46.
DEFEUX (L.), 187.
Dfi = refus de foi, 321.
Deira (pays anglo-saxon), 48, 80.
Delle (dale), 86.
Demeines = magnats, 463.
Dols (sire de), 573.
Derby, 80.
Drogeance, 456 et s.
492
Marc BLOCH La socit fodale
DESLANDES (capitaine), 616.
Deutsch, origine du nom, 600.
Dvotion, voir Prire (rite de la).
DIEGO GELMIREZ, archevque de Compostelle, 570.
Dienstmann, 468, 475, 476, 477 ; voir aussi Sergent.
Dijon, 546.
Dime de croisade, note n 224.
Dithmarschen, 201, 205, 344, 345.
Dniepr, 30, 33, 106.
Dol-de-Bretagne, 584.
Domesday Book, 262, 341.
DOON, chanoine de Saint-Quentin, 56, 68 et s.
Doon de Mayence (pome) 326.
Douro, 26.
Dranse (Valais), 28.
Dreng, 252 et s., 262.
Dublin, 47 ; roi danois de D., 78.
Ducs de Normandie (Histoire des), de Benot de Sainte-Maure, 148.
Duel judiciaire, 505.
Dulcine (personnage de Cervants), 327, 429.
DURAND, vque de Mende, voir Guillaume Durand.
DURAND (charpentier), 574.
Durham (principaut ecclsiastique), 593.
Durstede, 54, 62, 73.
E
Earl ou iarl, 49, 78, 80, 84, 276, 592.
EBBON, archevque de Reims, 42.
EBERHARD, vque de Bamberg, 328.
EBLE de Comborn, 198.
Ebre 26, 518.
chevins, 509.
Ecosse, 48, 77, 518.
Ecuyer, 452.
Edel, Edeling : voir Noble.
EDGAR, roi du Wessex, 84, 91.
Edimbourg, 77.
DITH, reine du Wessex, 597.
DOUARD le Confesseur, 53, 70, 263.
DOUARD le Martyr, roi dAngleterre, 526.
gypte, 107, 199.
EIKE von REPGOW, 374. Voir aussi son Miroir des Saxons.
EINHARD ou EGINHART, 239.
Elbe, 15, 32, 39 40, 107, 111, 256, 274, 344, 371, 589.
lection royale, 467, 529-537.
ly (Chroniqueur d), 242.
Empereur (titre hors dAllemagne), 538.
Empire romain germanique, 450, 537.
Enns, 32.
Eorl, 404.
pidmies, 35, 116.
pope, 143-156, 160, 185, 188, 278, 279, 286, 325-334, 464.
Epte, 58.
493
Marc BLOCH La socit fodale
494
Erec, de Chrtien de Troyes, 461.
ERMENTAIRE (moine), 93, 94.
ERNAUT de Douai, 145.
Ernst (Lied du duc), 153.
Escaut, 42, 57, 71, 94 519.
Espagne, 24-26, 29, 45, 60, 90, 99, 102, 106, 107, III, 125, 132, 158, 173, 190 et s., 207, 210,
220, 225, 226, 264-6, 313, 363, 371, 411, 412, note n 103 ; croisade : 411 ;
marches : 264, 518, 569. Voir aussi Visigothique (Monarchie). Note n 103.
Essex, 79.
Est-Anglie, 42, 81, 511.
Esthonie, 51.
ESTURMI, comte de Bourges, personnage de la Chanson de Guillaume, 144.
tats gnraux et provinciaux, 587.
TIENNE, roi dAngleterre, 199, 595.
TIENNE Ier, (saint), roi de Hongrie (VAK), 37, 38.
TIENNE HARDING (saint), 102.
TIENNE LANGTON, archevque de Canterbury, 163.
TIENNE MARCEL, 451.
trier, 220, 405.
EUDES, roi de France, 57, 277, 519, 531, 532, 533.
EUDES (saint), abb de Cluny, 102.
EUDES de Blois, 584, 587.
Euphrate, 14.
Eure, 42.
Europe (sens du mot), 15.
EUSBE de Csare, 138.
VE (la premire femme), 431.
vques, genre de vie : 439, 480 et s., 482, 484, 48 5, 48 8 ; nomination : 483-489 ;
comme princes territoriaux : 553-56.
Evreux, 58.
F
Faide (vengeance), 186, 188, 189, 191, 207, 574.
Faits des Romains (Les), 160.
Falaise, 319.
Famines, 116.
Farae (gentes), 201.
Fr r, 47.
Fatimides, 24.
Flonie, 321.
FNELON, 11.
Feodum : voir Fief.
Fos : voir Fief.
Fer cheval, 220.
Fert-sur-Aube (Sires de La), note n 26.
Feu (mot provenal), voir Fief.
Fief (sens du mot), 236-39, 251, 252, 268 et s. ; transcriptions latines : 123. Voir aussi
Reprise (fief de).
Fiesole, 45.
Finlande, Finnois, 51, 71.
FLACH (J.), 603.
Marc BLOCH La socit fodale
495
Flandre, 46, 92, 99, 106, 112, 113, 170, 184, 186 et s., 190, 197, 246, 278, 303, 310, 327, 412,
424, 426, 431, 449, 453, 463, 514, 545, 554, 563, 570, 576 ; chevalerie : 424 ;
note n 253 ; comtes, voir Baudoin IV et Philippe dAlsace.
Fleury-sur-Loire, 42. Voir aussi Abbon de Fleury.
FLODOARD, (chroniqueur), 3, 56, 75. Voir son Histoire de lglise de Reims .
Floovant (chanson), 154.
Florence, 450.
Folembray, 272.
Fontaine-ls-Dijon (sire de), 134.
Forez (comtes du), 307, 342, 345, 370.
Forjurement, 204.
Formariage, 366, 372, 377.
Fosterage, 318.
FOUBERT, vque de Chartres, 105, 309, 320.
FOULQUE, archevque de Reims, 530.
FOULQUE NERRA (comte), 196, 279.
FOULQUE le Rchin, comte dAnjou, 139, 197.
FOUQUET (Nicolas), 616.
Franc libre, 214, 240, 356, 357.
France (duch), 547, 549 ; note n 344.
France (origine du nom national), 598, 599.
Franche-Comt ou Comt de Bourgogne, 305, 547.
Franchises (Charte de) : voir Couturnes.
FRANOIS dAssise (saint), 189.
FRANOIS Ier, 440.
Franconie, France Orientale, 34, 65, 371, 397, 522, 548, 550, 555, 599.
Francs (noblesse chez les), 396 et s.
Frankpledge (cautionnement), 377, 378, 578.
FRDRIC BARBEROUSSE, 164, 176, 289, 290, 316, 321, 446, 449, 477, 531, 541, 553,
565, 589, 590, 591.
Freeman, 459.
Freinet (Le), 26, 27, 28, 29, 73, 90, 94 ; note n 6.
Freising, vque : voir Otton.
Frjus, 27.
Frrches, 192 et s.
Frioul, 274 ; marquis : 520.
Frise, Frisons, 43, 54, 67, 91, 187, 191, 201, 205, 344, 345, 350, 371, 609 ; loi frisonne :
60.
Frod ou Frothi, roi lgendaire, 594.
Fueros, 385.
Fulda, voir Annales.
Frsten, voir Princes, (en Allemagne).
FUSTEL DE COULANGES, 596.
G
Gate, 25, 94, 531, 543.
Galice, 25, 105, 148, 264.
Galles (Pays de), 518.
Gand, 184 et s., 417 ; abbaye de Saint-Pierre : 365.
GANELON, 147, 155, 185.
Garde-Freinet (La), voir Freinet.
Garde-Gurin (La), 452.
Garde noble, 455.
Marc BLOCH La socit fodale
496
Garin le Lorrain (personnage dpope), 200, 471.
Garnier de Nanteuil (personnage lgendaire), 317.
Garonne, 252.
Gascogne, Gascons, 251, 547, 605.
Gasindus, gesith, gisind (compagnon), 221, 222, 253, 259, 331.
Gast (dvastation), 415.
Gau (district), 552.
Gaule, 56, 76, 102, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 252, 261, 305 ; dialectes
romans : 79 ; sens du mot : 598.
Gaydon (pome), 461.
Gembloux, voir Sigebert.
GEMIGNANO (saint), 76.
Genealogiae alamanes et bavaroises, 201.
Geneat (compagnon de nourriture), 260, 261.
Gnes, 29.
Gentilhomme, 433, 445, 454, 455, 456, 463, 466, 472.
GEOFFROI le Bel, comte dAnjou, 159.
GEOFFROI MARTEL, 197, 279.
GEOFFR. oi de Preuilly, 423.
GERBERT dAurillac, futur pape Silvestre II, 102, 124, 255, 532, 533, 534, 541.
GERHOH von Reichersberg, 162.
Germanie, 31, 39, 63, 99, 168, 201, 205, 215, 218, 221, 254, 281, 530 ;
Germains : 14, 40, 68, 152 ; dialectes : 120.
Gesitheund (vassal), 259, 404.
Gesta Dei per Francos, 602 ; voir Guibert de Nogent.
Gvaudan, 452.
Gien, 293.
GILBERT ou GISLEBERT de Mons, 245, 404 ; note n 66, 167.
GILLES dOrval, 140.
Girard de Roussillon (chanson de), 190, 333, 414, 415, 416, 429, 447, 472, 602 ; notes n
213, 214, 382.
Girart (personnage de la Chanson de Guillaume), 410.
Giroie (famille), 188, 206.
GLANVILLE : voir Renoul de.
GOBINEAU (A. de), 12.
GODEFROI de Bouillon, 601.
GODEFROY de Lorraine (duc), 150, 282.
Gog et Magog (Ancien Testament), 93.
Gokstad, 41.
GORMONT, roi Viking, 144.
Gormont et Isembart (chanson), 144, 147, 156.
Goslar, 101.
Gtar (pays des), 39 ; roi : 67 ; note n 14.
Gothique (art), 158.
Goths, 220.
Gotland, 62.
Gournay, 424.
Graal : voir Queste du SaintGraal.
Grande Bretagne, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 64, 82, 107, 119, 258.
Grande Charte anglaise : voir Charte.
Grandlieu (Lac de), 45.
Grec (empire) : voir Byzantin (empire).
Grce, Grecs, 28, 33, 119 ; marine grecque : 81.
GRGOIRE le Grand (saint), 63, 74, 153 ; voir aussi Rgle pastorale.
Marc BLOCH La socit fodale
497
GRGOIRE VII, pape, 101, 161 et s., 480, 538, 577, 591 voir Rforme grgorienne.
GRGOIRE de Tours, 67, 138, 222.
Grsivaudan, 27.
Groenland, 40, 45.
GUDMAR (conqurant sudois), 89.
GURARD (B.), 603.
Gurison des maladies par les rois, 526, 535.
Guerre Sainte : voir Croisades.
GUIBERT de Nogent, abb : 140, 158, 483, 492, 602 ; note n 325.
GUIBOURG (Darne), 144 ; personnage de la Chanson de Guillaume : 410.
Guildes, 492, 573, 578.
GUILLAUME le Conqurant, ou Guillaume le Btard, 53, 54, 70, 77 87 90, 103, 118, 119,
124, 13, 190, 204, 242, 300, 376, 411, 414, 439, 568, 592, 593, 594.
GUILLAUME le Pieux, duc dAquitaine, 547.
GUILLAUME III, duc dAquitaine, 125.
GUILLAUME IX, duc dAquitaine, 428, 429.
GUILLAUME Longue-pe, duc de Normandie, 78.
GUILLAUME, comte de Provence, 29, 144.
GUILLAUME dOrange, 186.
GUILLAUME DURAND, vque de Mende, 306, 440, 444
GUILLAUME le Marchal (chevalier), 415, 428.
Guillaume (personnage dpope), voir Chanson de Guillaume.
Guines (comte de), 245, 423.
GUIZOT (F.), 213, 527.
Gundolf, 403.
Gundolfsheim, 403.
GUNTHER, vque de Bamberg, 153.
GUNZO de Novare, note n 69.
Guy de Mauvoisin, 184.
Guy de Spolte, roi dItalie, 519.
Guy, vque du Puy, 571.
Guyenne, 251.
H
HACKET, sire de Poperinghe, 245.
Hacquenville, terre du sire Hakon, 84.
HAGANON, conseiller de Charles le Simple, 401.
Hainaut, 117, 188, 237, 246, 304, 327, 426, 453 ; comtes : 204, 241, 303. Voir aussi
Baudoin IV.
HAKON, 84.
Hambourg, 63, archevque, voir Adalbert.
Hanovre, 257.
HARALD au Dur Conseil, roi de Norvge, 53, 70, 318.
HARDING : voir tienne Harding (saint), 102.
HARIULF (chroniqueur), 147.
HAROLD, roi dAngl eterre, 53.
HAROLD, roi de Norvge. voir Harald.
HARTMANN von AUE, 410 ; note n 251.
Harz, 101.
HASTEIN, 84.
Hastings (bataille de), 54, 119, 152, 262, 377.
Hattentot-en-Caux, 84.
Haye (La), Fragment de (pope), 143, 147.
Marc BLOCH La socit fodale
Hbrides (Iles), 47, 71, 88.
Hliand (pome vieux-saxon), notes n 165, 377.
HELMOLD (auteur de la Chronica Slavorum), 130 et note n 74.
HENRI Ier, lOiseleur, roi de Germanie, 256, 589, 590, 601.
HENRI II, empereur, 169, 178, 457, 458, 529, 530, 561, 564, 595.
HENRI III, empereur, 125, 142, 457 ; note n 70.
HENRI IV, empereur, 138, 139, 221, 283, 415, 524, 537, 577, 590, 591.
HENRI V, empereur, 283.
HENRI VI, empereur, 284, 285.
HENRI Ier, roi dAngleterre, 319, 509, 526, 582 ; note n 359. Voir aussi Lois de Henri Ier.
HENRI II, roi dAngleterre, 156, 169, 197, 424, 593.
HENRI, roi, fils du prcdent, 424.
HENRI III, roi dAngleterre, 458.
HENRI Ier, roi de France, 116, 586.
HENRI le Libral, comte de Champagne, 159.
HENRI le Lion, duc de Bavire et de Saxe, 257, 321, 536, 590.
HERBERT de Vermandois, 145, 188, 330.
Herr (matre), 331.
HERROI, sire de Poperinghe, 245.
HERV le Francopoule , 412.
Heure (calcul de l), 117 et s.
Hide (unit agraire), 86.
HINCMAR, archevque de Reims, 170, 273.
Histoire de lglise de Reims , de Flodoard, 58.
Hlaford. voir Lord.
Hlafoetan (mangeur de pain), 259, 331.
Hflich (courtois), 426.
Hohenstaufen : voir Staufen (ou Staufer).
Hollande, 160, 283.
Hommage (sens du mot), 210, 211, 212, 254, 256 ; note n 160.
Hongrie, Hongrois, 15, 24, 29-38, 43, 65, 77, 92, 93, 94, 106, 256, 418 ; note n 7.
Honneur (sens du mot), 251, 274 et s., 459 et s., 508, 549.
Housecarl (gars de la maison), 259.
HUGUES CAPET, 272, 300, 328, 532, 533, 535, 584, 585, 586.
HUGUES dArles, ro i de Provence puis dItalie, 28, 522.
HUGUES le Grand, 533, 546 ; note 11, 344.
HUGUES, fils de Lothaire 11, 275.
Hulde (foi), 211.
Humber (rivire), 48, 53.
Hundert (sens du mot), 501.
Huns, 29, 30, 141.
Huon de Bordeaux (pome), 415.
Huy (charte), 140.
I
IBN KHALDOUN, 92.
Idiota, 126.
Ile de France, 100, 184, 291, 301, 304, 351, 381, 476, 586.
Immuniste, immunit, 499 et s., 506, 588.
Indochine, 95.
Indre, 73.
INGE, roi de Sude, 65.
Investiture, 246, 296, 467, 484, 485.
498
Marc BLOCH La socit fodale
499
Irlande, 44, 46, 47, 89, 318, 609.
IRNERIUS, 175.
Isembart (personnage de la Chanson de Guillaume), 144.
ISIDORE de Sville, 141.
Islam, 14, 15, 25, 99, 119, 219, 412, 526. Voir aussi Musulmans.
Islande, Islandais, 44, 45, 47, 49, 61, 66, 68, 70 et s., 398 ; cole islandaise : 140.
Issoudun, 552.
Italie, 24, 28, 32, 34, 102, 103, 113, 127, 253-55, 276, 565 ; chevalerie, noblesse : 125,
155, 338, 371, 400, 416, 417, 426, 447, 448, 450 ; conomie, monnaie : 240, 342,
352 ; enseignement : 167, 176 ; fodalit : 155, 207, 248, 266 et s., 281 et s.,
287, 305, 314, 322, 329, 332, 588, 609 ; justice, lgislation : 166, 171, 175, 178,
196, 385, 513 ; posie : 158, 441 ; principauts : 397, 398, 546, 548 ;
royaume : 254, 397, 476 et s., 519, 520, 522, 523, 526, 533, 538, 540, 569, 577, 591,
597, 600 ; villes : 416, 417, 543, 588. Voir aussi Lombardie (rois) et Normands
(tats).
IVE, vque de Chartres, 300, 529, 535.
Ivre, marquis dIvre puis rois dItalie, 397, 520.
J
Jacquerie, 451.
JACQUES (saint), 148.
JACQUES II, dAragon 446.
Japon, 95, 299, 301, 320, 527, 610-612, 618.
JAUFROI RUDEL, 430.
JEAN de Salisbury, 440, 441.
JEAN sans Terre, 163, 321 ; note C 326.
JEAN, marchal dAngleterre, 199, 200.
JEANNE DARC, 202, 574.
JRME (saint), 138, 162.
Jrusalem (royaume de), coutumier : 618 ; rois : voir Baudoin Ier et Baudoin II.
JOINVILLE (Jean de), 184, 199, 248, 329.
Jongleurs, 145-150.
JORDANS, 523.
JOSEPH II, empereur, 278.
Judith (Le Livre de), de lAncien Testament, 52.
Jura, 521 ; de Souabe : 513.
Justice foncire, 506.
Justicia, 496.
JUSTINIEN (empereur dOrient), 24 ; code Justinien : 176.
Jutland, 39, 62, 69.
K
Kairouan, 24.
Kempten (moines de), 401.
Kent, 46, 510 ; note n 53.
Kerlinger ou Carlenses (habitants du royaume de Charles le Chauve), 585, 598, 600.
Khasar (tat), 30, 36.
Khmers, 95.
Kiev, 33, 47, 106, 107.
Knight (anglais), 259, 260, 262 ; = Knecht (allemand), 259.
KNUT, roi Anglo-Saxon, 51, 52, 53, 54, 64, 70, 77, 89, 106, 167, 259, 331, 568.
Kriemhild (personnage des Nibelungen), 200.
Marc BLOCH La socit fodale
500
L
Laen (prt), 263.
Lagny, 365.
LAMBERT (moine de Hersfeld), 106, 138.
LAMBERT dArdres, 420.
Lancashire, 80, 81.
Lancastre (dynastie), 615.
Lancelot (roman), 441, 444-, note n 275.
Landrecht (droit gnral du pays), 257, 269, 290.
Langres, 553, 554.
Languedoc, 112, 305, 416, 572, 574, 576, 578, 601, 618.
Laon, 151 ; comte et vque : 505, 532.
Largesse, 432.
Laten (affranchis), 372.
Latifundia, 338, 352, 3W.
Lech, 34.
Lechfeld (bataille du, 35.
Lehn (fief), sens du mot, 238, 240, 265 ; note n 165.
Lehnrecht (droit des fiefs), 257, 269, 290.
Lehnwesen, 12.
Leibeigen, 375.
Leicester, 80, 85.
Leitha, 34.
Len (Espagne), 264, 371, 518, 539, 570, 605, 607, 609.
LON IX, pape : voir Bruno.
LON le Sage, empereur, 36.
Lrins (moines de), 29.
Lettonie, Lettons, 71.
Levant (Pays du), 107, 112.
Libert (notion de la), 498 et s., 508 et s. ; en Allemagne : 477 ; en Angleterre : 459,
473 et s.
Libert ecclsiastique, 481 et s.
Libri Feudorum (livres des fiefs), 254, 305, 329.
Lige, 103, 241, 577 ; histoire des vques : 140 ; Voir aussi Notker.
Lige (sens du mot), 303-307 ; ligesse : 304, 308.
Lille, 203.
Limerick, 47.
Limoges, chanoines. 245 ; concile : 129, 326 ; vicomtesse : 78 ; monnaie de L., voir
Barbarin.
Limousin, 76, 100, 432 ; charte : 471.
Lincoln, Lincolnshire, 80, 81.
Lindisfarne, 91, 83.
Lisois (sire dAmboise), 202.
Liudolfingiens (ducs de Saxe), 397, 398.
Liutprand, vque de Crmone, 539 ; note el 341.
Livres (troupes de guerriers privs), 615.
Livres des fiefs, voir Libri Feudorum.
Loire, 32, 42, 46, 57, 58, 59, 71, 74, 111, 191, 293, 345, 547, 585.
Lois dAlfred (coutumier anglo-saxon), 328.
Lois de Henri Ier (coutumier anglais), 327.
Lombardie, 99, 112, 555, 556 ; droit : 253 vque : 600 ; rois : 520, 522. Voir aussi
Italie.
Marc BLOCH La socit fodale
501
Londe (fort de), 83.
Londres, 43, 49, 77, 180, 578.
Lorch, 38.
Lord (sens du mot), 259, 331.
Lorraine, 32, 341, 383, 385, 533, 546, 548, 555, 569, 577, 599 ; duc de Basse-Lorraine.
532, 550 ; ducs : voir Charles et Godefroy II ; roi : Lothaire II. Voir aussi
Lotharingie.
Lorrains, vendettas contre les Bordelais : 188 ; voir aussi Cycle des Lorrains (pome pique).
Lorris (charte de), 384.
LOTHAIRE III, empereur, 520, 521, 522.
LOTHAIRE III, empereur, 472.
LOTHAIRE II, roi de Lorraine, 43, 598.
Lotharingie, 319, 321, 352, 385, 475, 521, 522, 523, 538, 558, 557, 585. Voir aussi Lorraine.
Lothian, 518.
Lothier (titre ducal de Basse-Lorraine), 550.
Louis le Pieux, empereur, 54, 63, 68, 75, 90, 140, 166, 228, 234, 239, 273, 274, 275, 397, 401,
520, 537, 544.
Louis le Germanique, 325, 397, 423, 519.
Louis II, empereur, 439.
Louis II le Bgue, roi de France, 276.
Louis III, 94, 144.
Louis IV dOu tremer, 287, 398, 532, 533.
Louis V, 532.
Louis VI le Gros, 111, 116, 135, 369, 438, 524, 525, 535, 559, 576, 602.
Louis VII le Jeune, 366.
Louis VIII, 587.
Louis IX ou Saint Louis, 179, 188, 191, 248, 300, 306, 346, 352, 365, 415, 417, 425, 440,
443, 446, 448, 489, 518, 568, 582.
Voir aussi le Couronnement de Louis, note n 85.
Louis XI, 451, 615.
Louis XIV, 451, 614.
Louis lAveugle, roi de Provence, 522, 523.
Loup de Ferrires, 273 ; note n 184.
Louvain, 550.
Lubeck, 417.
Lucques, 75, 253, 398.
LULL ou LULLE (Raimon), 435, 441, 444, 447, 481.
Lund, 65.
Lunebourg (duch) 257 ; abbaye de Saint-Michel : 472.
Lusace, 102, 283.
Lyon, 522.
M
Macdoine, 14 ; dynastie macdonienne : 24.
MACHIAVEL, 127.
Mconnais, 519.
Magdebourg, 37, 38.
Maghreb, 27, 29, 112.
Magnats, 120, 333, 339, 419, 463, 465, 467, 508.
MAGNUS le Bon, roi de Norvge. 64 et s.
Magog, voir Gog.
MAEUL (saint), abb de Cluny, 28, 29.
Maillezais, 239.
Marc BLOCH La socit fodale
Maimbour, 216, 228, 507.
Main, 548, 599.
Maine (comt du Mans), 551 ; note n 25.
Mainmorte, 292, 366.
Maintenance, 615.
Maires, 468-78, 509, 618.
MAITLAND, (F. W.), 17.
Maladies : voir Gurison.
Mlar (Lac), 62.
Maldon (bataille de), 79.
Man (Ile de), 48.
MANASS, archevque de Reims, 482.
Manche, 44, 48, 53, 58, 59, 83.
Mancipia, 359.
Manichisme, 128, 161.
Mans (Le), 575 ; comt : 302 ; voir aussi Maine.
Mansourah (bataille de), 184, 427.
Manumission, 361.
Marchands, 403, 413, 416 et s., 457. Voir aussi Bourgeoisie.
Marchal, 472, 476.
Marignan (bataille de), 440.
MARKWARD dAnweiler (sn chal), 477.
Marmoutier (abbaye), 372.
Maroc, 44, 92.
Marseille, 28, 29.
Martigny-sur-Loire, 73 et s.
Massif Central, 46, 547, 576.
Maures : voir Musulmans.
Maurtanie, 92.
MAURILLE, archevque de Rouen, 103.
Mayence, 519 ; abbaye de SaintAlban : 438.
Meaux, 587.
Mditerrane, Mditerranens, 26, 29, 45, 68, 90 et s., 106, 107, 112.
MEISSNER, Le (Ileinrich von Meissen, dit), 441.
Melun, 328, 584.
Mende, vque : voir Guillaume Durand.
Mer dIrlande, 48, 83.
Mer Noire, 36, 106, 220.
Mer du Nord, 52, 53, 54, 60, 91, 201, 208.
Mer Tyrrhnienne, 15, 24.
Mercie, pays : 48, 49, 77, 80 ; roi : 43, 539.
Mrville (sires de), 104.
Mrovingiens, 154, 212, 214, 215, 222, 226, 259, 396, 501, 535, 543, 553, 615 ; tat : 68.
Mersebourg (comt), 275 ; vque, voir Thietmar.
Mersen (Conventions de) note n 179.
Messay-en-Poitou, 46.
Metz, voir Saint-Arnoul.
Meurthe, 32.
Meuse, 255, 345, 519 ; marches mosanes, 527 ; pays mosan : 426, 522, 585, 598.
Mexique, 338.
Mille (Lan), 132, 133.
Milan, 281 ; archevque : Voir Aribert.
Miles (soldat), 231 ; agrarii milites : 257, 261.
Ministriaux : voir Sergents.
502
Marc BLOCH La socit fodale
503
Minnesang, 423, 431, 441.
Miracles de saint Benot (Les), 419.
Miroir des Saxons (Le) coutumier de Eike von Repgow, 178, 191, 240, 314, 374, 618.
Misnie (Marche de), 283.
MISTRAL (Fr.), 251.
Mjsen (Lac), 50.
Modne, 76.
Molesmes (abbaye), 102.
Monachisme, 162 ; rnovation 481,
Mongolie, Mongols, 36, 92, 95.
Mons (Hainaut), 117.
Mons-en-Pevle (bataille de), 449.
Montbrison (Hospitaliers), 342.
Mont-Cenis (Col du), 150.
Montchauvet (Coutumes de), note III 236.
Monte Argento, 25, 27, 94.
MONTESQUIEU, 11, l2, 271, 588, 603.
Montfort lAmaury (sire de), 369, 551.
Mont-Loon : voir Laon.
Montmorency (sire de), 192.
Montpellier, 176.
Mont Saint-Michel (abbaye du), 463.
Morava, 34.
Moravie, Moraves, 31, 37.
Morigny (abb de), 304 ; note n 197.
Morville-sur-Nied, 384.
Moselle, 74.
Muntmen (commends), 374.
Mur (La), rivire, 34.
Musulmans, 14, 15, 24-29, 41, 53, 75 et s., 77, 90, 92, 94, 99, 107, 119, 265, 267, 405, 411,
526. Littrature arabe : 158. Flotte arabe : 45. Monnaies dor arabes : 106, 108.
N
Namurois, 305.
Nantes, Nantais, 43, 55, 58, 59, 548.
Naples, 543.
Narbonne, 569, 584 ; concile : 571 ; note n 276.
Nativi : voir Niefs.
Navarre, 518.
Neustrie, Neustriens, 45, 252, 277, 546, 592, 598.
Nevers (comtes de), 449 ;
Nivernais : 587.
Nibelungen (Chanson des), 154, 200, 411, 428.
NICOLAS Ier, tsar, 226.
Nidaros : voir Trondhjem.
Niefs (nativi), 377.
Nmois (Pays), 32, 35.
NIVE (Dame), 368.
Nobiles, ignobiles, note n 305.
Noble adelenc (franco-bourguignon), aetheling (anglais), edeling(vieil-allemand) : 396,
397, 399-402.
NOGI (marchal japonais), 299.
Noirmoutier : voir Saint-Philibert.
Marc BLOCH La socit fodale
504
NORBERT (saint), 131.
Norfolk, 510.
Normand (sens du mot), 40.
Normandie, Normands, 25, 39-71, 77, 78, 81-87, 178, 188, 203, 206, 252, 266, 287, 291, 305,
311, 370, 412, 453, 514, 524, 548, 570, 576, 577 ; dialecte roman : 78 ; ducs :
57, 166, 266, 267 ; voir Rollon (Ier duc de Normandie) Invasions normandes : 35,
44, 56, 59, 60, 68, 90, 93, 95, 144, 262, 418. Voir aussi Vikings.
Normands (tats) de lItalie du Sud, 25, 412. Voir auss i Sicile. Notes n 113, 326.
Northumberland, Northumbrie, 44, 52, 77, 79, 91.
Norvge, Norvgiens, 40, 41, 48, 50, 53, 59, 62, 64, 65, 70, 88, 89, 90.
NOTKER, vque de Lige, 121.
Nottingham, 80.
Novalaise (monastre de), 27, 150.
Novgorod, 113 ; prince : 53.
Noyon (assemble de), 532 ; vch de Noyon-Tournai : 576, 584.
O
Ogier, hros dpope, 333.
Oise, III.
OLAF (saint), 59, 65 ; lgende : 70.
OLAF TRYGVASON, roi de Norvge, 62, 78.
Olivier (personnage de la Chanson de Guillaume), 144, 411, 429.
Onction, 524, 525.
Oppenheim (chartes d), 453.
Orcades (Iles), 48.
Ordene de Chevalerie (L ), pome, 441, 443, 444.
ORDERIC VITAL, 551 ; notes n 253, 359.
Ordo (ordre), 438.
Orient (Empire latin d) 219, 285, 607.
Orlans, 43, 111, 192, 319, 547 ; vque : 151 ; fort dOrlans ; 42.
Orval : voir Gilles.
Oslo (fjord), 50.
stergtland, 39.
Ostrogothique (dynastie), 153.
Otrante, 32.
OTTON Ier le Grand 15, 28, 34, 35, 94, 112, 125, 127, 135, 142, 143, 281, 520, 536, 537,
539, 540, 541, 566, 591, 598.
OTTON II, 25, 125, 281.
OTTON III, 125, 131, 142, 255, 281, 539 ; 540, 541, 585.
OTTON, duc de Bourgogne, 286.
OTTON, vque de Freising, 36, 38, 131, 141, 412, 447, 565.
Ottonienne (Cour), 438, 439 ; dynastie : voir Saxe ; chancellerie : 539 ; politique :
281.
Ouche (valle de l), 546.
Ouest (Basses Marches de l), 587.
Oural, 30.
OUSAMA IBN MOUNKIDH, 406 ; note n 249.
Ouse (rivire), 42.
P
Pacifiques (les), 574.
Pair, pairie, 462 et s., 464 et 9.
Marc BLOCH La socit fodale
505
Palaiseau, 202.
Pannonie, 38 ; voir aussi Hongrie.
Pques (fte de), 55, 571.
Parage, parager, 291 et s., 294, 295.
Paris, 42, 43, 111, 132, 158, 163, 178, 547.
PARIS (Gaston), 141, 152.
Parlement anglais, 587, 615, 618 ; voir aussi Communes (Chambre des).
Parlement franais, 346 ; des rois captiens : 173 ; de Paris : 187, 450, 457.
Parme, 417.
Paroissiales (glises), 479 et s., 483, 486.
Partage du royaume, 530.
Passau, 38 ; vque, voir Pilgrim.
PAUL (saint), 133, 524 ; ptres 441.
PAUL DIACRE, 399.
PAUL OROSE, 138.
Pavie, 33, 520, 565.
Pays-Bas, 113, 417.
Pedones (fantassins), 406.
Plerinage de Charlemagne (Chanson du), 429.
PPIN le Bref, 219, 226, 535.
PPIN II, roi dAquitaine, 94.
Perceval (pome), 441.
Prigord, 409, 413.
PERRECIOT, 605.
PERRIN (Ch. E.), 387.
Petchngues, 30.
Petersborough, 138.
Phase (fleuve du Caucase), 14.
PHILIPPE II, 116, 476, 526.
PHILIPPE AUGUSTE, 176, 178, 241, 248, 285, 293, 294, 306, 319, 321, 352, 426, 442, 453,
528, 565, 582, 587, 590.
PHILIPPE III le Hardi, 366, 449, 615.
PHILIPPE IV le Bel, 126, 192, 329, 449, 451, 453.
PHILIPPE VI de Valois, 322.
PHILIPPE dAlsace, comte de Flandre, 317, 563.
Physique (La), dAristote, 159.
Picardie, 112, 305.
PIERRE (saint), avou de. 541 ; Patrimoine : 127, 255.
PIERRE DAMIEN (saint), 150, 162 ; note n 88.
PIERRE FLOTTE, 126.
PIERRE de FONTAINES, note n 237.
PIERRE LOMBARD, 163.
PIERRE des Vaux de Cernay (moine), 440.
PILGRIM, vque de Passau, 37, 38.
Pise, 29, 45 ; Charte : 178.
PLACENTIN, 176.
Plaids gnraux, 502, 508. Plaid de lpe, 503.
PLANTAGENT (Henri), 509, 563.
Plantagents, 160, 248, 288, 297, 319, 378 et s., 380 et s., 615.
PLATON, 14.
P, 31, 546.
Poblaciones, 385, 386.
Pome de saint Alexis, 318.
Poitiers, 219, 277, 569 ; comte 414 ; concile : 572, 573.
Marc BLOCH La socit fodale
506
Poitou, 60, 547 ; comte : 239.
Pologne, 102.
Polovtsi, 95.
Ponthieu (comtes de), 551.
Ponts, 101, 111.
Poperinghe : voir Hacket et Herroi.
Port-sur-Sane, 519.
Portugal, 264, 518.
Pothires (moines de), 147.
Prague, 106.
Precaria, precarium, 234 et s.
Prestamo (prt), 265.
Preux, 425.
Prvots royaux, 586.
Prire (rite de la), 328.
Princes (en Allemagne), 466 ; latin : principes.
Princesse Lointaine (Lgende de la), 430.
Promesse damiti, 616 ; note n 390.
Proprit, 173 et s.
Provence, 75, 91, 139, 176, 193, 416, 432, 453, 457, 522, 601. comtes : 453, 520, 575 ;
voir Charles II et Guillaume ; langue des Provenaux (gens du Languedoc) :
601 ; posie 427 et s. ; rois : 28. Voir aussi Hugues dArles et Louis lAveugle.
Provende, 241-43.
Provins, 587.
Prudhomme, prudhominie, 425, 426.
Prm, voir Rginon.
Prusse, 614.
Puy (Le), 574, 584 ; synode 570 ; vque, voir Guy.
Pyrnes, 26, 106, 125, 144, 547.
Q
Quentovic (aujourdhui taples), 73.
Quercy (monastres du), 122.
Queste du Saint Graal (pome), 431.
Quichotte (Don), personnage de Cervantes, 429.
Quierzy (plaid de), 276, 278.
Quintaine (panoplie), 436.
R
RABAN MAUR, 130 ; voir son Universo Libri (De).
RADCLIFFE (Anne), 420.
RAOUL, duc de Bourgogne puis roi de France, 58, 532, 533.
Raoul de Cambrai (Chanson de), 145, 148, 156, 188, 279, 322, 333, 424.
RAOUL le Glabre, 575.
RAOUL de Gouy, 145.
Rapport de droits (Weistum), 387.
Ravenne (duch), 477.
Reading, 42.
Reeve (maire), 468.
Rforme grgorienne, 103, 161 et s., 170, 175, 350, 428, 480, 482, 486, 488, 525, 537, 560 ;
notes n 84, 326.
RGINON, ou REGINO de Prm, 31, 138.
Marc BLOCH La socit fodale
507
Rgle pastorale de Grgoire le Grand, 74.
Rgle de saint Benot, 399.
Reichenau (abbaye de), 299.
Reims, 42, 75, 102, 124, 272, 417, 439, 482 ; cathdrale : 444, 531, 554, 569 ;
archevques : 519, 526 ; voir aussi Adalbron, Ebbon, Foulque, Hincrnar,
Manass et Turpin ; Histoire de lglise de Reims voir Flodoard.
REINALD von DASSEL (chancelier de lEmpire, puis archevque de Cologne), 163.
RMI dAuxerre, 93.
Rmois (pays), 35.
RENAN (Ernest), 525.
Renard (Cycle de), 155.
Renaud de Montauban (hros dpope), 329, 333.
Rennes, 548.
RENOUL de Glanville, 156, 169, 178.
Reprise (fief de), 246, 254 et s., 272, 280, 281, 332, 611.
Retrait fodal, 297.
Retrait lignager, 297.
Rvolution franaise, 12, 196, 213, 395, 605, 613.
Rhin, 14, 27, 32, 54, 57, 60, 66, 210, 255, 256, 304, 305, 371, 385, 386, 521, 538.
Rhne, 27, 29, 45, 519, 569.
Rialto, 543.
RICHARD Cur de Lion, roi dAngleterre, 285.
RICHARD II, roi dAngleterre, 615 et s.
RICHARD Ier, duc de Normandie, 56.
RICHARD II, duc de Normandie, 78.
RICHELET, 11.
RICHER (moine de Reims), 59, 272, 546 ; note n 344.
Riding (circonscription), 84.
Ripen, 62.
Ripuaires (Francs), 168 ; loi ripuaire : 219.
RIQUIER (saint), 61.
Risle, 83.
Roannais (pays), 307.
ROBERT le Fort, Comte dAnjou, duc de France, 277, 397, 544.
ROBERT Ier, roi de France, 58, 302, 526, 532, 533 ; note n 344.
ROBERT II le Pieux, roi de France, 116, 124, 131, 526, 576, 587.
ROBERT Courteheuse, 124, 125.
Robertiens, 286, 546, 583, 584, 590 ; note n 344.
ROBERT Guiscart, 462.
RODOLPHE de HABSBOURG, 477.
RODOLPHE Ier le Welf, roi de Bourgogne, 521, 523 ; Rodolphiens : 547.
ROGER II, roi de Sicile, 446, 449.
ROLAND, comte des Marches de Bretagne, 144, 152, 155, 186 ; note n 94.
Roland (La Chanson de), 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 185, 230, 326, 528, 599,
601, 602 ; note n 84.
ROLLON, 57, 58, 59, 67, 78, 82, 86, 89, 252, 592.
Roman (art), 98, 158.
Romania, 14, 168, 174, 221, 543, 548.
Romantisme, 132, 327.
Rome, Romains, 52, 53, 65, 101 ; antiquit : 14, 69, 91, 177, 201, 212, 213, 216, 218, 222,
342, 343, 396, 399, 400, 416, 438, 539, 544, 553, 570, 582 ; re fodale : 165,
215, 438, 439, 520, 537-39, 540, 541 ; Pontifical : 440. Voir aussi Empire romain
germanique.
Rmerzug, 538.
Marc BLOCH La socit fodale
508
Rosny-sous-Bois, 365.
Rou (Roman de), 148, 472.
Roucy (sires de), note n 26.
Rouen, 43, 58, 59, 78, 287, 584, archevque, voir Maurille.
Rouergue (monastres du), 122.
Roumois, 57, 83, 88.
Routes, 111.
ROUSSEAU (Jean-Jacques), 525.
Roussillon, 387, 571 ; voir aussi Codalet-en-Conflent.
Russie, 42, 68, 95, 107, 113, 226, 320 ; fleuves russes. 68, 89.
S
Saales (col de), 32.
Sabine (mont de la), 25.
Saint-Arnoul (Metz), 384.
Saint-Bernard (Col du Grand), 28.
Saint-Denis, 147, 154, 172 ; voir aussi Argenteuil.
Saint-Gall, 27, 28, 150, 273, 406, 422.
Saint-Germain-des-Prs (moine de), 93.
Saint-Jacques-de-Compostelle (ou de Galice), 60, 105, 148.
Saint-Martin (Le Mans), 302.
Saint-Martin-des-Champs (Paris), 330.
Saint-Maurice dAgaune (Valais), 27.
Saint-Michel (Ordre de), 615.
Saint-Omer, 203.
Saint-Philibert (abbaye), Noirmoutier : 45 ; Tournus : 46 ; note n 20.
SAINT-POL (Conntable de), 615.
Saint-Pourain-sur-Sioule, 46.
Saint-Quentin (chanoine de), voir Doon.
Saint-Riquier (abb), 313, 401 ; avous : 551.
Saint-Saturnin-en-Anjou, 279, 280.
Saint-Serge (Angers), 326.
Saint-Trond, 404, 472.
Saint-Tropez, 26.
Saint-Vaast (Arras), 56, 369, 471.
Saint-Victor (abbaye), 135.
Saint-Wandrille, 82.
Sainte-Genevive, 365.
Saintonge, 45.
Saisine, 173, 174, 497.
Sake and soke (permission de juger), 511.
Salerne, 267.
Saliens (Francs), 476, 531, 536, 540 ; droit salien : 321 ; dynastie : 486 ; empereurs :
166.
SALIMBENE, 417.
Salique (loi), 223.
Salzbourg, 38 ; annales : 600 ; archevque : 589. Voir aussi Conrad.
SAMUEL (personnage biblique), 524.
Sane, 519, 547.
Saragosse, 26.
Sardaigne, Sardes, 29, 122, 343, 543.
Sarmates (peuplade), 220.
Sarrasins : voir Musulmans.
Marc BLOCH La socit fodale
509
SAULX-TAVANNES (Duc de), 475.
Saumur, 46.
Saxe, 32, 33, 70, 103, 191, 221, 256, 257, 289, 338, 339, 345, 371, 373, 513, 540, 548, 555,
589, 590, 598, 609 ; empereurs saxons : 116, 166, 281, 486, 533. Ducs : voir
Henri Ier dAllemagne et Henri le Lion.
Saxons (Miroir des) : voir Miroir.
SAXO GRAMMATICUS, 594.
Scandinavie, Scandinaves, 26, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68,
73, 77, 79, 80, 113, 152, 172, 217, 252, 318, 344, 345, 607, 609.
Scanie, 39.
Schleswig, 62.
Scots (Irlandais), 518.
Scythie, 38.
Seigneur (sens du mot), 210 et s., 331.
Seigneurie, 337, 338, 403, 604, 605, 608 et s., 611, 612.
Seine, 57, 59, 74, 82, 83, 84, 93, 111.
Seine, (Basse), 57 ; principaut normande : 56-58.
Semois (rivire), 519.
Snchal, 472, 476, 587.
Sens, Senonais, 42, 176, 547 ; archevque : 304.
Sepulveda, 203.
SERGE II, pape, 439.
Sergents, 238, 467, 468, 469, 471 ; note n 314.
Serments de Strasbourg, 423, 618.
Servage, 363-371, 374, 467 et s., 507, 508, 612.
Servitium (service), 215.
Sheriff, 593, 595.
Shetland (Iles), 48.
Shire (comt), 511.
Sibrie, 30.
Sicile, 24, 25, 53, 266 et s., 449, 583 ; rgent : 477. Rois : voir Roger II. Note n 113.
Siegfried (personnage lgendaire), 154, 200.
SIEGFRIED (anctre des Attonides), 398.
Siete Partidas (trait de droit castillan), 446.
SIGEBERT de Gembloux, (chroniqueur), 599.
SILVESTRE II, voir. Gerbert dAurillac.
SIMON, tsar des Bulgares, 31.
SIMON de Crpy, 421.
SIMON de Montfort, 440.
Slaves, 15, 31, 36, 37, 51, 71, 256, 608.
SNORRI-STURLUSON, 62.
Sdermanland, 89.
Soest, 417.
Soissons (comte de), 427 ; vque : 569.
Sokeman (justiciable), 511.
SOLIN (La Gographie de), 159.
Soliu (homme solide = lige), 305, 306, 307.
Solway (Baie de), 83, 89.
Somme, 476.
Souabe, 210, 283, 371, 548 ; duc : 553 ; Jura : 513.
SPINOZA, 11.
Spire, 519, 554.
Spolte, ducs : 520. Voir aussi Guy.
Stadt, 490.
Marc BLOCH La socit fodale
Stamford, 80, 85 ; Bataille du Pont de Stamford : 54, 60.
Stnde, 618.
Statuti, 385.
Staufen (Hohenstaufen), 248, 285, 476, 553.
Strasbourg, vque : 450 ; Serments : 423, 618.
Stuarts, 460.
Sude, Sudois, 50, 62, 63, 64, 65.
Suffolk, 510.
SUGER (abb), 347, 470, 556, 560.
Suisse, 477.
Suse, 27.
Sussex, 53, 510.
Suzerain (sens du mot), 210 ; note n 151.
SVEIN la Barbe Fourchue , roi de Danemark, 50, 51, 67, 70.
Sylvestre, prnom : voir Silvestre.
Syrie latine, 267, 285, 305, 412.
T
TACITE, 221, 396, 403, 436.
Tage, 26.
Taille, 314, 315, 351, 387 et s., 432, 617 ; note n 203.
Talmont (sire de), 471.
Talvas (famille), 188, 206 ; note n 124.
Tamise, 42, 46, 47, 48, 71, 83.
Tannhuser (personnage lgendaire), 327.
Taormine, 24.
Tchques, 38.
Tees (rivire), 48.
Temple (Ordre du), 445, 446.
Tenant en chef, 462.
Terre-Neuve, 45.
TERTULLIEN, 170.
Teutons : voir Thiois.
Thanet (Ile de), 47.
Thegn (dpendant militaire), 259, 260, 261, 262, 263, 264, 328, 331, 404.
Thegnborn, 404.
THODORIC le GRAND, roi des Ostrogoths, personnage des Nibelungen, 154.
Theow (esclave), 376, 377.
Throuanne (vque de), 245.
Thiais-en-Parisis, 365.
THIETMAR, vque de Mersebourg, 275 ; notes n 325, 375.
Thiois, 120, 426, 600. Voir aussi Deutsch.
Thiudans (chef du peuple), 526.
THOMAS BECKET, 480, 509.
THOMAS dOuzouer, 187.
THOMASIN von ZIRKLRE, 442.
Thor (dieu scandinave), 61 et s.
Thrace byzantine, 31, 34.
Thuringe, Thuringiens, 548, 598
Tibre, 538.
Tiel-sur-le-Waal, 60.
Tisza (rivire), 30.
TITE-LIVE, 137.
510
Marc BLOCH La socit fodale
Tivoli, 541.
TOFI (seigneur), 84.
Toscane, 103, 193, 345, 526, 556.
TOSTIG (Comte), 101.
Tote lHistoire de France , 160.
Toul, 521, 553 ; vque, voir Bruno.
Toulonges-en-Roussillon, 571.
Toulonnais, 73.
Toulouse, Toulousain, 251, 397, 432, 545 ; comtes : 544, 576.
Toulte (demande, queste), 351.
Tournai, Tournaisis, 417, 554 ; vch : voir Noyon.
Tournehem (Tour de), 420.
Tournois, 423-425.
Tournus, voir Saint-Philibert.
Tours, Touraine, 73, 277, 300.
Toury (prieur), 104.
Town, 490.
Towthorpe-en-Yorkshire, 84.
Trait des lois anglaises de Raoul de Glanville, 169, 178.
Transjurane (duch de), 521, 522.
Trente (concile de), 479.
Treue (foi), 211.
Trves, 522 ; moines : 239.
Tribur (aujourdhui Trebur), concile : 423.
Trobar clus (pome), 428.
Trondhjem, 65.
Trosly, 23.
Troyes, 101, 547, 587 ; comte de T., dit comte de Champagne note n 344.
Turcs, 95 ; langue turque : 30.
Turkestan, 106.
TURPIN, archevque de Reims, 144.
U
Ukraine, 40.
Universo Libri (De), de Raban Maur, 130 ; note n 73.
Upland, 52.
Upsal, 65.
URBAIN II, pape, 170.
Usages de la cour comtale en Catalogne : voir Barcelone.
Usagre, 185.
Utrecht, vque : 60.
V
Vaccarius, 176.
VAIK : voir tienne Ier.
Valais, 27.
Valence, 522.
Valenciennes, 604.
VALRE MAXIME, 159.
Valet (sens du mot), 223.
Valois (dynastie), 322, 450.
Van (Lac de), 412.
511
Marc BLOCH La socit fodale
512
Vannetais (comtes du), 59.
Vargues (royaumes), 68.
Varennes-en-Argonne, 617.
Vassal (sens et emplois du mot), 222, 223, 253 et s., 258, 264 et s., 325 ; institution
vassalique : 331.
Vassus Dominici (vassal du seigneur-roi), 227, 229, 243, 259, 616.
Vavasseur, 252, 253, 281, 332, 334.
VGCE, 159.
VELLUTO di BUONCHRISTIANO, 186, 187.
Vendme (moines de), 280 ; comte : voir Bouchard.
Venise, Vnitiens, 38, 105, 106, 112, 520, 543 ; doges, 531.
Ver, 172.
Verceil (vque de), 541.
Verdun (trait de), 519, 540.
Vermandois, 424 ; comtes 5 34.
Vrone, 522.
Vestergtland, 39.
Vexin, 83.
Vzelay (abb de), 368.
VIAL (sire), 368.
Vicaria : voir voirie.
Vie chrtienne (Livre de la), voir Bonizon de Sutri.
Vienne (Autriche) : Wienerwald, 34.
Viennois (France), 522.
VIGNORY (sires de), note n 26.
Viguerie : voir voirie.
Vikings, sens du mot : 45 ; 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 73,
74, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 93, 94, 252, 411 ; langue : 79. Voir aussi
Scandinaves ; note n 19.
Ville (sens du mot), 489, 490.
VILLEHARDOUIN, 160.
Visigoths, 168, 287, 319, 358 ; dEspagne : 225, 226, 264 ; note n 103.
Vivien (personnage de la Chanson de Guillaume), 144.
Voirie ou viguerie, 501, 503, 505 et s.
Volga, 36.
VOLKER von ALZEY, 428.
VOLTAIRE, 603.
VOLNDR ou WIELAND, 55.
Vontes, 73.
Voyage de Charlemagne (pome), 147.
W
Waal, 60.
WACE, auteur du Roman de Rou, 148, 472.
Waltharius (pome), 147, 153.
Wapentake (circonscription), 84.
Warcq-sur-Meuse (castrum comtal de), 552.
Wash (rivire), 48.
Weistum (rapport de droits), 387.
Welfs, 160, 256, 397, 521, 522. Voir Rodolphe Ier.
Wergeld, 185.
Wessex, pays 48, 51, 53, 77, 94 ; dynastie 594 ; rois : 43, 49, 75, 84, 89, 539.
Westmoreland, 80.
Marc BLOCH La socit fodale
513
WIDUKIND (chroniqueur), 15, 598.
WIELAND ; voir Volndr.
Winchester, 77.
WIPO (chapelain imprial), 167.
Wolen, 342, 343.
WOLFRAM dESCHENBACH, 426 ; note n 189.
Worcester, 138 ; vque : 263.
Worms, 33, 519, 591 ; vque, voir Burchard.
Y
Ybelins (famille), 206, 327.
YBERT DE RIBMONT, 145.
Yonne, 42.
York, Yorkshire, 42, 43, 54, 77, 80, 81, 83, 88, 89 ; archevque : 260 ; dynastie : 615.
Yves, prnom : voir Ive.
Z
Zhringen (famille), 398.
Zuiderzee, 344.
*
**
Nom du document : bloch_societe_feodale.doc
Dossier :
C:\CSS\Bloch
Modle :
C:\WINDOWS\Application
Data\Microsoft\Modles\Normal.dot
Titre :
La socit fodale
Sujet :
Histoire du Moyen Age
Auteur :
Marc Bloch
Mots cls :
Moyen Age, Histoire de France, fodalit, vassalit,
vassal, homme lige, hommage vassalique, fief, Normands, seigneurie,
alleu, prcaire, bienfait, chevalerie, adoubement, noblesse, vilain,
bourgeois, serf, avouerie,
Commentaires :
http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/
Date de cration :
15/06/05 17:06
N de rvision :
128
Dernier enregistr. le : 30/07/05 12:59
Dernier enregistrement par : Pierre Palpant
Temps total d'dition:2 790 Minutes
Dernire impression sur :
30/07/05 15:26
Tel qu' la dernire impression
Nombre de pages :
513
Nombre de mots : 215 700 (approx.)
Nombre de caractres : 1 229 492 (approx.)
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Templiers Et La GuerreDocument26 pagesLes Templiers Et La GuerreTemplarium éditions100% (3)
- Que Sais-Je - Histoire Du Droit - Carbasse Jean-MarieDocument61 pagesQue Sais-Je - Histoire Du Droit - Carbasse Jean-MarieSamir EssghaierPas encore d'évaluation
- AdB - René Girard, Auteur SurfaitDocument12 pagesAdB - René Girard, Auteur SurfaitIo Pan100% (1)
- Gilbert Keith Chesterton, L'homme ÉternelDocument300 pagesGilbert Keith Chesterton, L'homme ÉternelJacques RipperPas encore d'évaluation
- Du Contrat Social (Jean-Jacques Rousseau) (Z-Library)Document338 pagesDu Contrat Social (Jean-Jacques Rousseau) (Z-Library)Ebonga100% (1)
- La réforme grégorienne: De la lutte pour le sacré à la sécularisation du mondeD'EverandLa réforme grégorienne: De la lutte pour le sacré à la sécularisation du mondePas encore d'évaluation
- COSANDEY, Fanny. L'absolutisme Un Concept Irremplacé.Document20 pagesCOSANDEY, Fanny. L'absolutisme Un Concept Irremplacé.Daniel FerreiraPas encore d'évaluation
- J. Lacarriére, Les Hommes Ivres de Dieu J. Décarreaux, Les Moines Et La Civilisation Y. Bottineau, Les Chemins de Saint-JacquesDocument4 pagesJ. Lacarriére, Les Hommes Ivres de Dieu J. Décarreaux, Les Moines Et La Civilisation Y. Bottineau, Les Chemins de Saint-JacquesJoop-le-philosophe0% (1)
- Les Origines de La France ContemporaineDocument442 pagesLes Origines de La France Contemporaineianbc2Pas encore d'évaluation
- Bloch Capetiens PDFDocument141 pagesBloch Capetiens PDFtoopee1Pas encore d'évaluation
- Saint Louis: Un roi chrétien à la base de la justice moderneD'EverandSaint Louis: Un roi chrétien à la base de la justice modernePas encore d'évaluation
- Michel Houellebecq - Lecteur D'auguste ComteDocument18 pagesMichel Houellebecq - Lecteur D'auguste ComteTiago SouzaPas encore d'évaluation
- J. Rancière - Les Noms de L'histoireDocument223 pagesJ. Rancière - Les Noms de L'histoireSajjad LohiPas encore d'évaluation
- Joseph de Maistre Mémoire Au Duc de BrunswickDocument24 pagesJoseph de Maistre Mémoire Au Duc de BrunswickMarco CodiciniPas encore d'évaluation
- Histoire Des Idées Politiques, 2ème Semestre.Document41 pagesHistoire Des Idées Politiques, 2ème Semestre.Marina LozovoiPas encore d'évaluation
- Moeurs intimes du passé: Usages et coutumes disparus - Série ID'EverandMoeurs intimes du passé: Usages et coutumes disparus - Série IPas encore d'évaluation
- Le Concile de Clermont en 1095 Et La Première CroisadeDocument310 pagesLe Concile de Clermont en 1095 Et La Première CroisadeMario BagascioPas encore d'évaluation
- Roger Caillois Et Les Approches de Limaginaire.Document16 pagesRoger Caillois Et Les Approches de Limaginaire.alexPas encore d'évaluation
- Histoire Des Rois de France - Robert II - Ivan GobryDocument75 pagesHistoire Des Rois de France - Robert II - Ivan GobryÉric TonkaPas encore d'évaluation
- Marcel de Corte Crise - de - La - Societe - Et - Crise - de - L - 220913 - 134106Document11 pagesMarcel de Corte Crise - de - La - Societe - Et - Crise - de - L - 220913 - 134106Alexis de ButlerPas encore d'évaluation
- Michel de Certeau - L'Étranger Ou L'union Dans La Différence (1991, Desclée de Brouwer) PDFDocument108 pagesMichel de Certeau - L'Étranger Ou L'union Dans La Différence (1991, Desclée de Brouwer) PDFhenriquemelatiPas encore d'évaluation
- Martigues Claire - Le Pacte de Reims Et La Vocation de La FranceDocument100 pagesMartigues Claire - Le Pacte de Reims Et La Vocation de La FranceNunussePas encore d'évaluation
- Bloch, Marc - Caracteres - t1 PDFDocument303 pagesBloch, Marc - Caracteres - t1 PDFpablo.montserrathPas encore d'évaluation
- Histoire socialiste de la France contemporaine 1789-1900: Tome 3 La Convention I 1792D'EverandHistoire socialiste de la France contemporaine 1789-1900: Tome 3 La Convention I 1792Pas encore d'évaluation
- Marie Heurtin 1904 PDFDocument71 pagesMarie Heurtin 1904 PDFAlbocicade100% (2)
- FEBVRE, Lucien. La Société Féodale - Une Synthèse Critique (Compte Rendu)Document7 pagesFEBVRE, Lucien. La Société Féodale - Une Synthèse Critique (Compte Rendu)Edilson MenezesPas encore d'évaluation
- GOFF, Jacques Le Saint Louis A-T-Il ExistéDocument15 pagesGOFF, Jacques Le Saint Louis A-T-Il ExistéMauro BaladiPas encore d'évaluation
- Déclin Du Droit RomainDocument2 pagesDéclin Du Droit RomainnghiPas encore d'évaluation
- Clovis IerDocument26 pagesClovis IerfhgrzhzrPas encore d'évaluation
- Hippolyte TaineDocument6 pagesHippolyte Tainedemetrios2017Pas encore d'évaluation
- Yourcenar Hadrien Margot PLDocument6 pagesYourcenar Hadrien Margot PLAnonymous KWqsRLPas encore d'évaluation
- Un temps pour se taire: Voyage au cœur de la vie monastiqueD'EverandUn temps pour se taire: Voyage au cœur de la vie monastiquePas encore d'évaluation
- Les Usages de La Biographie - Giovanni LeviDocument13 pagesLes Usages de La Biographie - Giovanni LeviIsabele MelloPas encore d'évaluation
- (15 - 16) LÉVINAS Emmanuel (La Compréhension de La Spiritualité Dans Les Cultures Française Et Allemande)Document13 pages(15 - 16) LÉVINAS Emmanuel (La Compréhension de La Spiritualité Dans Les Cultures Française Et Allemande)johncarlouy2945Pas encore d'évaluation
- Carolingiens: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandCarolingiens: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Imaginaire Et Orientalisme Chez Les Ecrivains Du Xix EmeDocument11 pagesImaginaire Et Orientalisme Chez Les Ecrivains Du Xix EmeltasanPas encore d'évaluation
- Crétineau-Joly Jacques - L'église Romaine en Face de La Révolution - Tome 2 PDFDocument552 pagesCrétineau-Joly Jacques - L'église Romaine en Face de La Révolution - Tome 2 PDFluciola123100% (1)
- Pedro Álvares Cabral, sur les pas de Vasco de Gama: Le Brésil au hasard des alizésD'EverandPedro Álvares Cabral, sur les pas de Vasco de Gama: Le Brésil au hasard des alizésPas encore d'évaluation
- Mémoires du duc de Saint-Simon: Siècle de Louis XIV, la régence, Louis XVD'EverandMémoires du duc de Saint-Simon: Siècle de Louis XIV, la régence, Louis XVPas encore d'évaluation
- Les caracteres (dont «Les caracteres» de Théophraste)D'EverandLes caracteres (dont «Les caracteres» de Théophraste)Pas encore d'évaluation
- Yvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementDocument24 pagesYvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementALBERTO PAULO NETOPas encore d'évaluation
- 1886 Jean Moréas - Le SymbolismeDocument12 pages1886 Jean Moréas - Le SymbolismeGabriel Costa JalotoPas encore d'évaluation
- Les moines en Gaule sous les premiers mérovingiensD'EverandLes moines en Gaule sous les premiers mérovingiensPas encore d'évaluation
- Jean Guiraud - L'Inquisition MedievaleDocument262 pagesJean Guiraud - L'Inquisition MedievaleJosé Carlos ZamboniPas encore d'évaluation
- Les mystères de la police. La police française depuis Louis XIV jusqu'à la révolution de 1789D'EverandLes mystères de la police. La police française depuis Louis XIV jusqu'à la révolution de 1789Pas encore d'évaluation
- Entretien Avec Jérôme Rousse-Lacordaire (Novembre 2009)Document19 pagesEntretien Avec Jérôme Rousse-Lacordaire (Novembre 2009)highrangePas encore d'évaluation
- Les Mémoires de la marquise de la RochejaqueleinD'EverandLes Mémoires de la marquise de la RochejaqueleinPas encore d'évaluation
- Citation Des Grands Hommes Parrapport À L'islamDocument18 pagesCitation Des Grands Hommes Parrapport À L'islamYouchahou PoutougnigniPas encore d'évaluation
- Abrégé de L'histoire Ecclésiastique de M. L'abbé Fleury (1750) - Volume 10.Document644 pagesAbrégé de L'histoire Ecclésiastique de M. L'abbé Fleury (1750) - Volume 10.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation