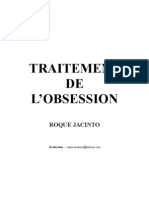Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Franz Kafka, La Métamorphose (1915) Philo-Lettres
Transféré par
carinebecharaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Franz Kafka, La Métamorphose (1915) Philo-Lettres
Transféré par
carinebecharaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Par
Michèle Tillard
Ouvrir le menu
Franz Kafka, « La
Métamorphose » (1915)
Franz Kafka en 1917
Tableau Métamorphoses, Un curieux
synoptique : d’Ovide à Kafka insecte
Kafka et son
époque
Gregor : un une famille et Le comique
esprit humain une société dans la
dans un corps animales Métamorphose
animal
Les processus Conclusion : Texte de
de la le sens du récit Deleuze et
déshumanisation Gattari sur
: Kafka et Primo Kafka
Levi
Kafka (1883-1924).
Il n’est pas utile de reprendre ici la
chronologie qui se trouve dans le
l’édition Garnier-Flammarion, p. 181-
183. L’on constate que Kafka a vécu à
l’extrême fin du XIX siècle et au tout
ème
début du XX , dans un milieu très
ème
particulier : celui de la communauté
juive germanophone de Prague (c’est
à dire dans un pays majoritairement
orthodoxe et de langue tchèque).
L’appartenance à une communauté
restreinte a pu influencer le sentiment
d’étrangeté qui parcourt l’ensemble de
son oeuvre ; il était ainsi pris dans un
triangle impossible : juif et tchèque,
sa famille avait abandonné la langue
tchèque de ses origines paysannes
pour la langue allemande de la ville ;
mais il était ainsi rejeté de la
communauté allemande parce que
juif, et de la communauté juive
tchèque… parce que germanophone !
La Métamorphose n’est pas un récit
isolé ; elle s’inscrit au cœur d’une
oeuvre qui mérite toute entière d’être
connue :
1903 : Description d’un combat,
première œuvre publiée ; Kafka semble
avoir auparavant beaucoup écrit… et
beaucoup détruit de manuscrits.
A partir de 1910, Kafka tient un Journal
1912 : rédaction du Verdict et de la
Métamorphose
1914 : La Colonie pénitentiaire
1915 : publication de la Métamorphose,
et d’un fragment du Procès
1916 : publication du Verdict
1917 : Un médecin de campagne
1922 : rédaction du Château – une
réécriture du mythe de Perceval
Événements Événements Événements Beaux-arts
Dates littéraires en littéraires hors politiques
Allemagne d’Allemagne
1883 Naissance Mort de Mort de Manet
de Kafka ; mort Tourgueniev ; Zola, et Rossetti ;
de Marx et de Au Bonheur des impressionnisme
Wagner dames et pointillisme
1884 Huysmans : A France : chute Bruckner :
Rebours de Jules 7ème
Ferry, ministre Symphonie
de la IIIème
République
1886 Rimbaud, Les Van Gogh,
Illuminations Renoir, Brahms
(4ème
symphonie)
1890 Wedekind, Claudel, Tête d’Or ; Démission de Mort de Van
L’Éveil du O. Wilde, Le Portrait Bismarck Gogh ; Cézanne
Printemps de Dorian Gray : Joueurs de
cartes
1892 Hofmannstahl : Publications de Mort de
Mort du Mallarmé et Tchaïkovski
Titien J-M de Heredia
1894 Affaire Dreyfus Rodin : Les
en France ; Bourgeois de
en Russie, Calais
avènement de
Nicolas II
1895 T. Fontane, Effi Création de la
Briest CGT en
France
1896 Mort de Verlaine Mort de
Bruckner ;
Puccini, La
Bohème, R.
Strauss :
Zarathoustra
1898 Mort de
Bismarck
1900 Mort de Exposition Puccini, La Tosca
Nietzsche Universelle à
Paris
1901 Hofmannstahl, Mort de la Mort de
Lettre de Lord Reine Victoria Toulouse-
Chandos ; T. en Angleterre Lautrec et de
Mann : Les Verdi
Buddenbrooks
1902 Mort de Zola Debussy, Pelléas
et Mélisande
1904 Rodin, Le
Penseur ;
Debussy, La Mer
; Picasso,
période bleue
1907 peintures de Bergson, L’Évolution Triple Entente Picasso, Les
Kokoschka et créatrice Demoiselles
poèmes de Rilke d’Avignon
1909 Kafka, Matisse,
Description Delaunay ;
d’un combat début des
Ballets Russes
de Diaghilev à
Paris
1910 Rilke, Cahiers de Matisse,
Malte Laurids Kandinsky, F.
Brigge Léger, Chirico ;
Stravinsky,
L’Oiseau de feu
1911 Mort de G.
Mahler ; Blaue
Reiter ;
Schönberg
1912 Kafka : rédaction Claudel, L’Annonce Ravel, Daphnis
de faite à Marie et Chloé
la Métamorphose
et du Verdict ;
Rilke,
Élégies ; Mort
de Georg Heym
1913 Kafka, Amerika ; Apollinaire, Alcools Stravinsky, Le
Thomas Mann, ; Alain-Fournier, Le Sacre du
Mort à Venise ; Grand Meaulnes ; Printemps
poèmes de G. Proust, début de la
Trakl ; Husserl, Recherche du
Phénoménologie temps perdu
1914 PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
1915 Kafka, Premiers films
publication de la de Charlie
Métamorphose Chaplin
1916 Freud : Barbusse, Le Feu Verdun ; mort
Introduction à de
la psychanalyse François-
; Kafka, Joseph
publication du
Verdict
1917 Kafka, Un Pirandello, Chacun RÉVOLUTION Mort de Rodin,
médecin de sa RUSSE de Degas
campagne vérité ;
1918 mort de Armistice, Miro, Stravinsky
Wedekind assassinat de ; mort de
Nicolas II, Debussy
abdication de
Guillaume II,
dissolution de
l’empire
Austro-
hongrois
1919 Hofmannstahl, Exécution de Mort de Renoir ;
La Femme sans Rosa fondation du
ombre Luxemburg Bauhaus à
; République Weimar
de Weimar ;
traité de
Versailles ;
naissance du
parti
nazi
1920 Jünger, Sur les Fauré, Ravel
Falaises de
marbre
1921 Claudel, Le Soulier Max Ernst
de satin
1922 Rilke, Sonnets à Mort de Proust ; Prise du
Orphée ; Kafka, Joyce, Ulysse pouvoir en
Le Château ; Italie par
Mussolini
1923 Mort de Barrès, Loti Occupation de
; la Ruhr ;
Jules Romain, putsch de
Knock Hitler à Munich
; Lénine
abandonne le
pouvoir
1924 Mort Manifeste du Mort de Lénine Mort de Puccini,
de Kafka ; Th. Surréalisme Fauré ;
Mann, La Honegger,
Montagne Pacific 231
magique
Métamorphoses, d’Ovide à
Kafka
Dans l’imaginaire populaire, la
métamorphose animale représente l’un des
motifs privilégiés du fantastique, voire de
l’horreur.
Métamorphoses
réversibles
La métamorphose réversible est en général
une histoire qui se termine bien : un prince
ou une princesse changés en bête (fauve ou
grenouille, suscitant horreur ou dégoût), qui
retrouvera son aspect initial au terme d’une
série d’épreuves. L’archétype de ce genre de
récit est La Belle et la Bête, récit et film de
Jean Cocteau.
Autre exemple, de l’Antiquité celui-là, de
métamorphose réversible : L’Âne d’or,
d’Apulée. Un jeune homme est victime d’une
erreur de manipulation de sa petite amie,
sorcière maladroite, et il se retrouve changé
en âne ! Au terme de toute une série de
mésaventures, il trouvera enfin le moyen de
reprendre sa forme initiale, en mangeant des
roses… Il y aura gagné une initiation
philosophique !
On peut penser que de telles
métamorphoses sont le reflet populaire de la
croyance en la métempsycose, ou plus
exactement la métemsomatose, croyance
dont le philosophe et mathématicien
Pythagore a été le plus célèbre représentant,
mais dont on trouve également des traces
chez Platon (voir Phèdre, par exemple) :
après la mort, l’âme qui n’a pas su trouver le
chemin du Bien ne peut se libérer du cycle de
l’éternelle répétition ; elle est condamnée à
un nouveau passage sur terre, sous une
forme qui correspond à sa nature et à ses
actes ; elle peut ainsi se réincarner dans un
animal (moins noble que l’homme) ou un
végétal… L’âme ne sortira du cercle infernal
des réincarnations qu’en trouvant le chemin
du Bien.
Métamorphoses
irréversibles
Les métamorphoses réversibles donnent une
chance de retrouver sa forme initiale, voire
de progresser. Mais il est une autre sorte de
métamorphose, plus tragique : celle qui ne
connaît pas de retour.
C’est le cas d’un texte qui a enthousiasmé
toute l’époque classique : les
Métamorphoses d’Ovide, texte extrêmement
connu qui a entre autres influencé La
Fontaine. Ovide a collationné et réuni tous
les récits de l’antiquité racontant une
transformation. Certaines sont heureuses :
Philémon et Baucis changés en arbres pour
ne pas être séparés par la mort. La plupart
sont tragiques, et résultent de la colère,
parfois injuste, toujours dévastatrice, des
Dieux
contre des mortels…
Ovide nous présente, avec une précision
baroque, le moment où l’être humain se
transforme progressivement, tout en
gardant sa sensibilité humaine ; son récit
s’achève au moment où la métamorphose est
complètement terminée.
Voici par exemple la transformation de Niobé
en pierre, après la perte de tous ses enfants :
Veuve de son époux, ayant perdu tous ses
enfants, Niobé s’assied au milieu d’eux. Tant
de malheurs ont épuisé sa sensibilité. Déjà le
vent n’agite plus ses longs cheveux. Son sang
s’est arrêté, et son visage a perdu sa couleur.
Son œil est immobile. Tout cesse de vivre en
elle. Sa langue se glace dans sa bouche durcie.
Le mouvement s’arrête dans ses veines. Sa
tête n’a plus rien de flexible; ses bras et ses
pieds ne peuvent se mouvoir. Ses entrailles
sont du marbre. Cependant ses yeux versent
des pleurs. Un tourbillon l’emporte dans sa
patrie. Là, placée sur le sommet d’une
montagne, elle pleure encore, et les larmes
coulent sans cesse de son rocher. »
Ovide, Métamorphoses, livre VI, v. 301-
312.
Plus tragique encore, l’histoire de Callisto : si
Niobé avait défié les Dieux, la nymphe, elle,
est pleinement innocente. Violée par Jupiter
malgré sa résistance, elle est chassée par
Diane ; enceinte, elle accouche d’un petit
Arcas, qui suscite la colère de Junon, épouse
de Jupiter…
[466] Depuis longtemps l’épouse du dieu qui
lance la foudre connaissait l’aventure de
Callisto; mais elle avait renvoyé sa vengeance
à des temps plus favorables; maintenant ils
étaient arrivés. Arcas était déjà né de la
nymphe sa rivale. Elle n’eut pas plutôt jeté ses
regards sur cet enfant, que, transportée de
colère, elle s’écria : « Malheureuse adultère,
fallait-il donc que ta fécondité rendît plus
manifestes et le crime de Jupiter et la honte
de sa compagne ! Mais je serai vengée, et je te
ravirai cette beauté fatale dont tu es si fière,
et qui plut trop à mon époux. »[476] Elle dit,
et saisissant la nymphe par les cheveux qui
couronnent son front, elle la jette et la
renverse à terre. Callisto suppliante lui
tendait les bras, et ses bras se couvrent d’un
poil noir et hérissé. Ses mains se recourbent,
s’arment d’ongles aigus, et lui servent de
pieds; sa bouche, qui reçut les caresses de
Jupiter, s’élargit hideuse et menaçante. Et
voulant que ses discours et ses prières ne
puissent jamais attendrir sur ses malheurs,
Junon lui ravit le don de la parole. Il ne sort,
en grondant, de son gosier, qu’une voix
rauque, colère, et semant la terreur. Callisto
devient ourse; mais, sous cette forme
nouvelle, elle conserve sa raison. Des
gémissements continuels attestent sa
douleur; et levant, vers le ciel, les deux pieds
qui furent ses deux mains, elle sent
l’ingratitude de Jupiter, et ne peut l’exprimer.
Combien de fois, n’osant demeurer seule dans
les forêts, erra-t-elle autour de sa maison et
dans les champs qui naguère étaient son
héritage ! combien de fois fut-elle poussée,
par les cris des chiens, à travers les
montagnes ! Celle dont la chasse avait été
l’exercice habituel, fuyait épouvantée devant
les chasseurs. Souvent l’infortunée, oubliant
ce qu’elle était elle-même, se cacha
tremblante à la vue des bêtes féroces; ourse,
dans les montagnes, elle craignait les ours;
elle évitait les loups, et Lycaon son père était
au milieu d’eux.
Ovide, Métamorphoses, Livre II, v. 466-495
En somme, le récit de Kafka commence au
moment précis où s’achève celui d’Ovide : il
nous raconte non la métamorphose – qui
nous est présentée comme un fait naturel,
presque anodin, qui étonne à peine Gregor
qui en est la victime – mais ce qui la suit : la
transformation progressive des relations
familiales autour de Gregor, et sa mise à
l’écart du monde humain, jusqu’à sa mort.
Une curieuse
bestiole
Gregor Samsa se réveille donc un matin,
« après des rêves agités », dans la carapace
d’un insecte non identifié, et dont Kafka
refusera toujours qu’elle soit représentée sur
la couverture de la nouvelle. Peut-on
néanmoins en avoir quelque idée ?
« un dos aussi dur qu’une carapace » et un
abdomen « bombé, brun, cloisonné par des arceaux
plus rigides », telle est la description que Kafka
nous en donne dès la 1ère page. Et il ajoute que
« ses nombreuses pattes, lamentablement grêles
[…] grouillaient désespérément sous ses yeux ».
Cette description peut nous faire penser à un
scarabée, un cafard ou encore une blatte, insectes
assez répugnants qui hantent les logements mal
entretenus. Les « nombreuses pattes » peuvent,
elles, faire plutôt songer à un mille-pattes… encore
que se retrouver avec les six pattes réglementaires
d’un insecte peut sembler pléthorique à un bipède
!…
p. 8, on apprend qu’il est démesurément gros, et
que ses petites pattes semblent avoir une vie à
part.
p. 40-41,Grégor parvient encore à parler, mais
avec « une voix d’animal » (p. 36) : il n’est donc pas
encore complètement métamorphosé.
Au terme de la première partie, Gregor garde
encore les réflexes, les sentiments et même
un peu la voix d’un être humain ; mais sa
transformation physique est achevée. Sa
carapace, ses petites pattes en font un
insecte assez répugnant.
p. 47, il « commence à apprécier ses antennes » :
l’animalisation se poursuit. De même, son odorat
semble se développer (p. 48) : il est attiré par une
écuelle de lait sucré. Ses goût aussi se modifient : le
lait qu’il aimait tant le dégoûte – mais il ignore
quels sont ses nouvelles prédilections. De même, il
se cache sous le canapé comme dans un terrier (p.
49)
p. 50 nous avons une idée des proportions de
Gregor : dans la première partie, sa tête atteignait
la poignée de la porte ; ici, son corps « est trop
large pour tenir entièrement sous le canapé ». On
peut donc imaginer un corps d’1,0 m de long sur 1
m de large environ… Un insecte énorme,
surdimensionné, monstrueux, mais plus petit qu’un
homme.
p. 51, nous découvrons son nouveau régime
alimentaire : »Il y avait là des restes de légumes à
moitié avariés ; des os du dîner de la veille,
entourés de sauce blanche solidifiée ; quelques
raisins secs, quelques amandes ; un fromage que
Gregor eût déclaré immangeable deux jours plus
tôt ; une tranche de pain sec, une autre tartinée de
beurre, une troisième beurrée et salée. De plus,
elle joignit encore à tout cela l’écuelle,
vraisemblablement destinée à Gregor une fois
pour toutes, et où elle avait mis de l’eau. »
Que retenir de cet étrange régime ?
Tout d’abord, sa sœur manifeste encore un
minimum d’attention pour Gregor, du moins
celui-ci le perçoit-il ainsi ;
Ensuite, elle est perplexe quant à la nature de
Gregor, et sur son régime alimentaire ; que
mange au juste un insecte ? D’où des
« expériences », comme celle des trois tartines ;
En revanche, pour elle la métamorphose
animale ne fait aucun doute, pas plus que son
caractère irréversible : elle lui dédie « une fois
pour toutes » une écuelle (et non une assiette ou
un plat), et la plus grosse part de ses
propositions relèvent de détritus que l’on
donnerait à peine à un
chien… l’attitude de Grete est, elle aussi, en train
de changer.
Gregor découvre alors ses propres goûts :
fromage avarié, légumes. Il rejette les denrées
fraîches. Sa nature de cafard ou de blatte semble
se confirmer.
Des habitudes nouvelles se créent : attirance
vers la lumière (p. 57)… et myopie croissante. Il
« évolue en tous sens sur les murs et le plafond » et
aime rester « suspendu au plafond ». On apprend
également qu’il secrète un liquide visqueux, qui lui
permet ces évolutions (mais ne le rend que plus
répugnant !) (p. 61). Il commence aussi à « oublier
sa condition d’être humain », au point de souhaiter
que l’on vide sa chambre !
La seconde partie a fait de lui un insecte à
part entière ; toute communication lui est
désormais impossible avec sa famille – il a
perdu la voix – et celle-ci lui manifeste avec
violence son hostilité (son père le bombarde
de pommes).
Gregor, blessé par son père, reste désormais
cloué au sol (p. 73) ; la troisième partie n’est que le
récit de sa lente agonie.
Délaissé par sa famille, laissé par sa sœur dans
une saleté repoussante(sa chambre sert à présent
de débarras), Gregor perd peu à peu tout
sentiment humain. Ses souvenirs se brouillent,
sous l’effet de la colère il « siffle comme un
serpent ». (p. 79). La nouvelle femme de ménage, la
seule à ne pas lui manifester de répugnance,
l’appelle « vieux cafard » (p. 79). Il dépérit – et il est
fait allusion à sa « mâchoire sans dents » ; mais ce
n’est pas pour cela qu’il cesse de s’alimenter ! (p. 8).
C’est pourtant un dernier réflexe humain,
l’attirance pour la musique, qui provoque la
catastrophe finale, la fuite des trois sous-
locataires, et la mort de Gregor.
La métamorphose de Gregor s’apparente
donc à un récit fantastique : il se transforme
en un animal qui évoque des animaux réels,
mais sans toutefois pouvoir leur être
complètement assimilé : ses proportions sont
monstrueuses, sa forme réelle reste floue
(nombre de ses pattes, forme très ronde de
son corps). En revanche, ses habitudes, goûts
alimentaires, attirance vers la fenêtre,
promenades sur les murs et le plafond) sont
bien celles d’un insecte.
Toute la tragédie de Gregor tient au fait que,
comme chez Ovide, la métamorphose reste
incomplète. Gregor conserve jusqu’à la fin le
souvenir de sa vie antérieure (même si ses
souvenirs deviennent flous), le souci de sa
famille, son amour pour sa mère et sa sœur,
sa crainte de son père. Il assiste impuissant à
leur peur, à leur dégradation sociale et
morale, et s’en estime responsable. Il se sent
coupable à leur égard, et son acceptation
finale de la mort s’apparente à un suicide.
Cette métamorphose inachevée se traduit
par le monologue intérieur : la plus grande
partie du récit est relatée du point de vue de
Gregor.
Gregor : un esprit humain
dans un corps animal
Si La Métamorphose est le récit de la
déshumanisation progressive de Gregor,
transformé d’abord en insecte,
progressivement privé de tout contact avec
les humains, et finalement changé en cadavre
« plat et sec » que la dernière bonne désigne
comme « la chose d’à côté » (p. 95), en
revanche, il garde seul un esprit humain.
Avant la métamorphose : nous apprenons que
Gregor est représentant de commerce ; il vit
l’existence banale d’un employé toujours en
mouvement (sa grande distraction, durant ses
jours de congé, consiste à étudier les horaires des
trains !), harassé, souffrant de la « maladie
professionnelle » des représentants : le rhume ; au
départ, il identifie sa métamorphose à un tel
malaise, habituel et bénin. C’est un solitaire : la
seule femme de sa vie semble celle, purement
fantasmatique, représentée dans le sous-verre de
sa chambre : une femme nue sous sa fourrure.
Pour le reste, il s’est entièrement dévoué à sa
famille, se substituant au père défaillant pour
subvenir à ses besoins. S’il redoute son père, il
voue une grande tendresse à sa mère, et à sa soeur
un amour exclusif. Là encore il se substitue au père,
lorsqu’il envisage de la faire entrer au
conservatoire de musique.
La première partie montre un Gregor en pleine
transformation, qui se raccroche comme il peut à
son humanité ; il garde une voix, une faible
capacité à communiquer avec les autres – il tient
par exemple un long discours au fondé de pouvoir,
mais celui-ci ne semble même pas l’entendre, pas
plus que son père. L’on voit déjà le fossé qui se
creuse : Gregor ne pense qu’à sauver son emploi,
un emploi qu’il déteste mais qui lui permet de
nourrir sa famille, alors que celle-ci ne voit plus en
lui qu’un monstre, qu’il faut chasser. Tout le monde
semble n’avoir que des réactions mécaniques (fuir,
s’évanouir, chasser l’intrus), alors que lui s’efforce
désespérément de communiquer et garde une
conscience humaine.
La seconde partie nous présente un Gregor qui
s’accommode peu à peu de sa vie animale, tout en
conservant le souvenir et la conscience de son
existence antérieure. Toute son attitude révèle son
abnégation et son amour de sa famille : il se cache
pour ne pas effrayer sa sœur ; il éprouve de la
culpabilité de ne plus pouvoir aider sa famille (p. 57
: « il était tout brûlant de honte et de chagrin »). Il
souhaite voir sa mère, mais c’est surtout pour
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Type ArgumentatifDocument3 pagesLe Type ArgumentatifcarinebecharaPas encore d'évaluation
- La BioéthiqueDocument1 pageLa BioéthiquecarinebecharaPas encore d'évaluation
- Dissertation - Raphaël, Un Homme Responsable de Ses ÉchecsDocument5 pagesDissertation - Raphaël, Un Homme Responsable de Ses ÉchecscarinebecharaPas encore d'évaluation
- Le Texte Argumentatif-2 - Correction)Document11 pagesLe Texte Argumentatif-2 - Correction)carinebecharaPas encore d'évaluation
- Lengagement Test TexteDocument4 pagesLengagement Test TextecarinebecharaPas encore d'évaluation
- 29589-Raymond QueneauDocument2 pages29589-Raymond QueneaucarinebecharaPas encore d'évaluation
- 2e SessionDocument8 pages2e Sessioncarinebechara100% (1)
- Le Role de L Enseignant Dans L Enseignement de La Langue OraleDocument11 pagesLe Role de L Enseignant Dans L Enseignement de La Langue OralecarinebecharaPas encore d'évaluation
- Le Monde Diplomatique 2020 01 PDFDocument28 pagesLe Monde Diplomatique 2020 01 PDFcarinebecharaPas encore d'évaluation
- Principaux Arguments Contre La Peine de MortDocument3 pagesPrincipaux Arguments Contre La Peine de MortcarinebecharaPas encore d'évaluation
- Vocabulaire Alter Ego+ A1Document39 pagesVocabulaire Alter Ego+ A1carinebecharaPas encore d'évaluation
- Belle 1Document1 pageBelle 1carinebecharaPas encore d'évaluation
- Mourad, Kenizé - de La Part de Le Princesse MorteDocument454 pagesMourad, Kenizé - de La Part de Le Princesse Mortecarinebechara100% (1)
- QCM La ParureDocument2 pagesQCM La Parurecarinebechara0% (1)
- La Religion Balinaise Dans Le Miroir de L'hindouisme.Document25 pagesLa Religion Balinaise Dans Le Miroir de L'hindouisme.Tiffany BrooksPas encore d'évaluation
- L'islam Et Le KarmaDocument39 pagesL'islam Et Le KarmaROJ100% (2)
- Spirit Is Me FR Traitement de L'obsession Roque JacintoDocument42 pagesSpirit Is Me FR Traitement de L'obsession Roque Jacintoyannick67% (3)
- Vaquie-Occultisme Et Foi Catholique PDFDocument43 pagesVaquie-Occultisme Et Foi Catholique PDFGarry DeroyPas encore d'évaluation
- PhilippeGuillemant - La Route Du Temps..Wawacity - Ec..Document342 pagesPhilippeGuillemant - La Route Du Temps..Wawacity - Ec..Ange Basile Diawara Tshivumda100% (1)
- Peirce Penney - FréquenceDocument392 pagesPeirce Penney - FréquenceAurélien Haddad100% (2)
- Après La MortDocument170 pagesAprès La MortdepascouPas encore d'évaluation
- 03 56a77 ResurrectionDocument24 pages03 56a77 ResurrectionPierre-Alexandre NicolasPas encore d'évaluation
- 40 Reponses de Kryeon 55a7564e6c63e PDFDocument50 pages40 Reponses de Kryeon 55a7564e6c63e PDFTIMITE DallaPas encore d'évaluation
- Philippe GuillemantDocument24 pagesPhilippe GuillemantEric Jean100% (1)
- ReincarnationDocument19 pagesReincarnationJean-Loïc BauchetPas encore d'évaluation
- (Etudes Traditionnelles) - La Science Occulte Egyptienne Jean-Louis BernardDocument30 pages(Etudes Traditionnelles) - La Science Occulte Egyptienne Jean-Louis BernardRoger Mayen100% (3)
- ProclamationDocument15 pagesProclamationRegy MoundéPas encore d'évaluation
- Le Spiritisme Rationnel de RedemptorDocument122 pagesLe Spiritisme Rationnel de RedemptorMarcelo Dos PeixesPas encore d'évaluation
- Principe Divin n4 Chp5Document10 pagesPrincipe Divin n4 Chp5Robert AgbogbaPas encore d'évaluation
- Les 3 Vagues de Volontaires - Dolores Cannon by Dolores CannonDocument475 pagesLes 3 Vagues de Volontaires - Dolores Cannon by Dolores Cannonsylvie100% (8)
- Au Royaume de La VieDocument71 pagesAu Royaume de La VieMichel Mangin100% (3)
- Alpha ManuelDocument21 pagesAlpha Manuelara804875% (8)
- Cellules BlanchesDocument16 pagesCellules BlanchesadriananastasiuPas encore d'évaluation
- Le Culte Des Ancêtres en Pays Evhé - 1655938999234Document16 pagesLe Culte Des Ancêtres en Pays Evhé - 1655938999234Justin zogli100% (1)
- Avortement Vu SpirituellementDocument174 pagesAvortement Vu Spirituellement15091965Pas encore d'évaluation
- Le Karma IV - Rudolf SteinerDocument63 pagesLe Karma IV - Rudolf SteinerDaniel Guimarães100% (3)
- E-Book Histoire & Philosophie - ĀYUDocument35 pagesE-Book Histoire & Philosophie - ĀYUshzqmsxzqgPas encore d'évaluation
- Pouvoirs InterieursDocument38 pagesPouvoirs Interieurs1neo28100% (2)
- Revivre Nos Vies Antérieures. Témoignages de La RéincarnationDocument62 pagesRevivre Nos Vies Antérieures. Témoignages de La RéincarnationAmoul Toure0% (1)
- Dossier de L Ame Dans La KabbaleDocument67 pagesDossier de L Ame Dans La KabbaleRichard VerboomenPas encore d'évaluation