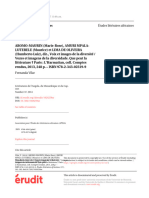Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
BIYAOULA Daniel, L'impasse, Paris, Présence Africaine, 1996, 327 Pages MABANCKOU Alain, Bleu Blanc Rouge, Paris, Présence Africaine, 1998, 222 Pages
BIYAOULA Daniel, L'impasse, Paris, Présence Africaine, 1996, 327 Pages MABANCKOU Alain, Bleu Blanc Rouge, Paris, Présence Africaine, 1998, 222 Pages
Transféré par
cadrick noutchaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- AnalyseDocument9 pagesAnalyseKamal ElamraouiPas encore d'évaluation
- Le Choix de Sophie, de William Styron, Traduit de L'américainDocument5 pagesLe Choix de Sophie, de William Styron, Traduit de L'américainAbdal ArtPas encore d'évaluation
- Roman Parabolique Sur L'immigration Féminine Marocaine en France: Les Yeux Baissés de Tahar Ben JellounDocument7 pagesRoman Parabolique Sur L'immigration Féminine Marocaine en France: Les Yeux Baissés de Tahar Ben JellounTiti SuruPas encore d'évaluation
- Asimov, Isaac (Robots) (1950) Les Robots (I, Robot)Document259 pagesAsimov, Isaac (Robots) (1950) Les Robots (I, Robot)Sourigo100% (3)
- Dictionnaire: DES HiéroglyphesDocument23 pagesDictionnaire: DES HiéroglyphesJuan Carlos MPPas encore d'évaluation
- COUCHORO (Félix), Oeuvres Complètes. Tome 1: Romans.: Études Littéraires AfricainesDocument4 pagesCOUCHORO (Félix), Oeuvres Complètes. Tome 1: Romans.: Études Littéraires Africainesmoonjack229Pas encore d'évaluation
- KEITA Fatou, Rebelle, Paris, Présence Africaine/abidjan, NEI, 1998, 232 PDocument3 pagesKEITA Fatou, Rebelle, Paris, Présence Africaine/abidjan, NEI, 1998, 232 PAboubacar TraoréPas encore d'évaluation
- KOUROUMA Ahmadou, Allah N'est Pas Obligé, Paris, Seuil, 2000, 233 PDocument4 pagesKOUROUMA Ahmadou, Allah N'est Pas Obligé, Paris, Seuil, 2000, 233 PMohamed FofanaPas encore d'évaluation
- Contes de La Savane: Contes Choisis Et Présentés Par HélèneDocument4 pagesContes de La Savane: Contes Choisis Et Présentés Par HélèneMalikaro DoumbiaPas encore d'évaluation
- Les "Fictions Critiques"Document3 pagesLes "Fictions Critiques"Paula RostanPas encore d'évaluation
- L'aventure Ambeguë, Cheikh Hamidou KaneDocument9 pagesL'aventure Ambeguë, Cheikh Hamidou Kanearchangel94% (17)
- Images et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophoneD'EverandImages et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophonePas encore d'évaluation
- DOSSIER 5 Patrick Chamoiseau Nov 2014 - La Tortue VerteDocument130 pagesDOSSIER 5 Patrick Chamoiseau Nov 2014 - La Tortue VerteGabriel González CastroPas encore d'évaluation
- 77 1222 1 PB PDFDocument18 pages77 1222 1 PB PDFMounir OussikoumPas encore d'évaluation
- Hommesmigrations 3937Document3 pagesHommesmigrations 3937Yasmine DaboussiPas encore d'évaluation
- À Propos Du Cinquantenaire: Chroniques D'une Indépendance AmbiguëDocument14 pagesÀ Propos Du Cinquantenaire: Chroniques D'une Indépendance AmbiguëEsther TiaPas encore d'évaluation
- De L'intermédiaire Colonial Au Mémorialiste Postcolonial. Les Fonctions Du Déplacement Géographique Dans Les Mémoires D'amadou Hampâté BâDocument14 pagesDe L'intermédiaire Colonial Au Mémorialiste Postcolonial. Les Fonctions Du Déplacement Géographique Dans Les Mémoires D'amadou Hampâté BâAdama NdiayePas encore d'évaluation
- Jean Genet Arabes, Noirs Et Palestiniens Dans Son OeuvreDocument26 pagesJean Genet Arabes, Noirs Et Palestiniens Dans Son OeuvreSirine HadakPas encore d'évaluation
- LENFANT NOIR DE CAMARA LAYE Litterature PDFDocument22 pagesLENFANT NOIR DE CAMARA LAYE Litterature PDFEmna Braham100% (3)
- Sup Livres 060309Document12 pagesSup Livres 060309tinderpaperPas encore d'évaluation
- Les Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo GodinDocument11 pagesLes Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo GodinMorlaye soumahPas encore d'évaluation
- Gascar (Curatolo Pierre Gascar) PDFDocument5 pagesGascar (Curatolo Pierre Gascar) PDFAnonymous EcAltIedNPas encore d'évaluation
- Les Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo GodinDocument11 pagesLes Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo Godinbenjamin ananouPas encore d'évaluation
- Hommesmigrations 3946Document3 pagesHommesmigrations 3946MarioPas encore d'évaluation
- Satire Et Humanisme de Bernard Dadié Dans Un Nègre À Paris: Louis-Marie OngoumDocument16 pagesSatire Et Humanisme de Bernard Dadié Dans Un Nègre À Paris: Louis-Marie OngoumDiallo SouleymanePas encore d'évaluation
- Études Littéraires AfricainesDocument3 pagesÉtudes Littéraires Africainesfernanda.vilarsPas encore d'évaluation
- Alain Mabanckou - Lettres Noires - Des Ténèbres À La Lumière - Lettres Noires - Des Ténèbres À La Lumière - Collège de FranceDocument30 pagesAlain Mabanckou - Lettres Noires - Des Ténèbres À La Lumière - Lettres Noires - Des Ténèbres À La Lumière - Collège de FranceIêda VasconcelosPas encore d'évaluation
- AfriquesDocument17 pagesAfriquesELO HELLOPas encore d'évaluation
- Bibliographie Doumbi FakolyDocument7 pagesBibliographie Doumbi FakolyFélix BangouraPas encore d'évaluation
- Le Pays Des Merveilles À L'enversDocument3 pagesLe Pays Des Merveilles À L'enversfojajof208Pas encore d'évaluation
- Retour D'afrique: Claude RoussinDocument8 pagesRetour D'afrique: Claude Roussin9643171Pas encore d'évaluation
- Les Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo GodinDocument11 pagesLes Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo Godinodiankha351Pas encore d'évaluation
- Terminale ProDocument32 pagesTerminale ProAnonymous V3AcBqo8gY100% (1)
- Négritude Et Responsabilité: Ville Cruelle de Mongo BetiDocument15 pagesNégritude Et Responsabilité: Ville Cruelle de Mongo Betimobina torkianPas encore d'évaluation
- 9782307201205Document27 pages9782307201205seydina omar thiam100% (1)
- Sillage Trace Empreinte - La Migrance Ambulatoire de Fatou DiomeDocument25 pagesSillage Trace Empreinte - La Migrance Ambulatoire de Fatou DiomeYoussef El HabachiPas encore d'évaluation
- Ni Françaises Ni Maghrébines-Stratégies de Déplacement Et de DépartenanceDocument23 pagesNi Françaises Ni Maghrébines-Stratégies de Déplacement Et de DépartenanceElazzouzi KhiraPas encore d'évaluation
- Resumes Des Œuvres LitterairesDocument11 pagesResumes Des Œuvres Litterairesn'dri100% (5)
- Benoît DuteurtreDocument13 pagesBenoît DuteurtreAgnes MonadePas encore d'évaluation
- ArDocument32 pagesArNeelKamal89Pas encore d'évaluation
- Retour D'afrique: Claude RoussinDocument8 pagesRetour D'afrique: Claude RoussingorguyPas encore d'évaluation
- Liberation Du Samedi 4 Et Dimanche 5 Fevrier 2012Document48 pagesLiberation Du Samedi 4 Et Dimanche 5 Fevrier 2012Christophe PrunierPas encore d'évaluation
- N° 4 C R I: EditorialDocument72 pagesN° 4 C R I: EditorialAdrian IancuPas encore d'évaluation
- Dramaturge Ivoirien. Paris: L'Harmattan, Coll. EspacesDocument4 pagesDramaturge Ivoirien. Paris: L'Harmattan, Coll. EspacesjoaobilkoskyPas encore d'évaluation
- Mémoire Saket RFDocument54 pagesMémoire Saket RFIlies chrPas encore d'évaluation
- La Boite A MerveillesDocument0 pageLa Boite A MerveillesAnas OuallaPas encore d'évaluation
- Tant D'errances de Mambi MDocument12 pagesTant D'errances de Mambi MSeidina kadra KanePas encore d'évaluation
- MABANCKOU, Alain (2005) Verre Cassé, Paris, Le Seuil, 202 PPDocument2 pagesMABANCKOU, Alain (2005) Verre Cassé, Paris, Le Seuil, 202 PPstevejerry93Pas encore d'évaluation
- L'engagement Des Romanciers Québécois: Gilles DorionDocument5 pagesL'engagement Des Romanciers Québécois: Gilles Doriondoumbouyaa433Pas encore d'évaluation
- Dossier Grand Calao-NoracDocument17 pagesDossier Grand Calao-NoracKomenan CyriaquePas encore d'évaluation
- (Im) Possible Autobiographie: Vers Une Lecture Derridienne de L'amour, La Fantasia D'assia DjebarDocument23 pages(Im) Possible Autobiographie: Vers Une Lecture Derridienne de L'amour, La Fantasia D'assia DjebarJean-Paul Friedrich NgabuPas encore d'évaluation
- Marcel CabonDocument21 pagesMarcel CabonWaheed JoolfooPas encore d'évaluation
- D'expression Française, Collection Thema/Anthologie, ParisDocument4 pagesD'expression Française, Collection Thema/Anthologie, ParisBenbar 007Pas encore d'évaluation
- Tierno MoninemboDocument392 pagesTierno MoninemboARGYOU100% (1)
- Ni Noires Ni BlanchesDocument4 pagesNi Noires Ni BlanchesCoraline KaPas encore d'évaluation
- 7ième CoursDocument16 pages7ième CoursDennys Silva-ReisPas encore d'évaluation
- Petit Chaperon RougeDocument13 pagesPetit Chaperon RougeMatthew ParsonsPas encore d'évaluation
- Litt Magh Expr FrancDocument20 pagesLitt Magh Expr FranckantikorsPas encore d'évaluation
- D'une Île À L'autre Enjeux de La Créolité Au FémininDocument11 pagesD'une Île À L'autre Enjeux de La Créolité Au Fémininpaula roaPas encore d'évaluation
- Théâtres Africains: Jean Cléo GodinDocument6 pagesThéâtres Africains: Jean Cléo GodinAsse SeckPas encore d'évaluation
- Salammbo de Gustave Flaubert: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandSalammbo de Gustave Flaubert: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- On Affame Bien Les RatsDocument32 pagesOn Affame Bien Les RatsNarimane BenabbouPas encore d'évaluation
- Plan de Redaction Du Schema Directeur TICDocument3 pagesPlan de Redaction Du Schema Directeur TICMathy TuringPas encore d'évaluation
- le crapaudDocument6 pagesle crapaudchirineghostine0112Pas encore d'évaluation
- Examen AnalyseDocument3 pagesExamen AnalyseMouna Bz100% (1)
- Notice Ucemine PP 50 ComprimesDocument4 pagesNotice Ucemine PP 50 ComprimesFrancisPas encore d'évaluation
- Memento SQL PDFDocument8 pagesMemento SQL PDFKawtar L Azaar100% (1)
- La Forme Active Et La Forme Passive PDFDocument9 pagesLa Forme Active Et La Forme Passive PDFAnuradha SharmaPas encore d'évaluation
- Introduction À L'analyse MacroéconomiqueDocument65 pagesIntroduction À L'analyse MacroéconomiqueWillihomesYahooPas encore d'évaluation
- Tchad Breve Histoire Politique Jusqu A 1990Document7 pagesTchad Breve Histoire Politique Jusqu A 1990Arnaud RAOUMBAPas encore d'évaluation
- Code de Deontologie Edition 2017 Secure InteractiveDocument64 pagesCode de Deontologie Edition 2017 Secure InteractivePauloPas encore d'évaluation
- TD 05 - Effet Des UV Sur Les LevuresDocument3 pagesTD 05 - Effet Des UV Sur Les LevuresLoïcPas encore d'évaluation
- Audit Légal Dev1Document4 pagesAudit Légal Dev1Marc-Rémy N'driPas encore d'évaluation
- ArquivoDocument16 pagesArquivoGabrielly NatanielPas encore d'évaluation
- Effets de BordureDocument1 pageEffets de BordureYoucef BenferdiPas encore d'évaluation
- PharmacovigilanceDocument2 pagesPharmacovigilancemohamaed abbasPas encore d'évaluation
- Grammaire MementoDocument4 pagesGrammaire MementoosoksPas encore d'évaluation
- Dominique Maingueneau-Auteur Et Image D'auteur en Analyse Du DiscoursDocument18 pagesDominique Maingueneau-Auteur Et Image D'auteur en Analyse Du DiscoursAnonymous gyBlO7oxp100% (1)
- Annabelle Marquis Ma-SignedDocument6 pagesAnnabelle Marquis Ma-Signedapi-240985696Pas encore d'évaluation
- Atelier Climat Scolaire 2Document26 pagesAtelier Climat Scolaire 2Olsen MalagaPas encore d'évaluation
- Rapport Electronique NumeriqueDocument4 pagesRapport Electronique NumeriqueBIENVENU KANGNI100% (1)
- Peau Du PorcDocument4 pagesPeau Du PorcMohPas encore d'évaluation
- Litterature Et Langue Francaises Scolaria ExcellenceDocument32 pagesLitterature Et Langue Francaises Scolaria ExcellenceEcoleprivee ScolariaexcellencePas encore d'évaluation
- Intro PKIDocument26 pagesIntro PKIKabb kenkenPas encore d'évaluation
- Progression DicteesDocument2 pagesProgression Dicteeschautan.marionPas encore d'évaluation
- Catalogue NihelDocument62 pagesCatalogue NihelRafik GhaouiPas encore d'évaluation
- 14 Mars 2006 - L'esprit D'équipeDocument2 pages14 Mars 2006 - L'esprit D'équipeJuJutsuMeyrin100% (1)
- P Rebetez Le-CoachingprofessionnelDocument31 pagesP Rebetez Le-CoachingprofessionnelHichamElIbrahimiPas encore d'évaluation
BIYAOULA Daniel, L'impasse, Paris, Présence Africaine, 1996, 327 Pages MABANCKOU Alain, Bleu Blanc Rouge, Paris, Présence Africaine, 1998, 222 Pages
BIYAOULA Daniel, L'impasse, Paris, Présence Africaine, 1996, 327 Pages MABANCKOU Alain, Bleu Blanc Rouge, Paris, Présence Africaine, 1998, 222 Pages
Transféré par
cadrick noutchaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
BIYAOULA Daniel, L'impasse, Paris, Présence Africaine, 1996, 327 Pages MABANCKOU Alain, Bleu Blanc Rouge, Paris, Présence Africaine, 1998, 222 Pages
BIYAOULA Daniel, L'impasse, Paris, Présence Africaine, 1996, 327 Pages MABANCKOU Alain, Bleu Blanc Rouge, Paris, Présence Africaine, 1998, 222 Pages
Transféré par
cadrick noutchaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Document généré le 8 mai 2024 05:49
Études littéraires africaines
BIYAOULA Daniel, L’impasse, Paris, Présence africaine, 1996,
327 pages
MABANCKOU Alain, Bleu Blanc Rouge, Paris, Présence
africaine, 1998, 222 pages
Nicolas Martin-Granel
Numéro 8, 1999
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1042034ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1042034ar
Aller au sommaire du numéro
Éditeur(s)
Association pour l'Étude des Littératures africaines (APELA)
ISSN
0769-4563 (imprimé)
2270-0374 (numérique)
Découvrir la revue
Citer ce compte rendu
Martin-Granel, N. (1999). Compte rendu de [BIYAOULA Daniel, L’impasse, Paris,
Présence africaine, 1996, 327 pages / MABANCKOU Alain, Bleu Blanc Rouge,
Paris, Présence africaine, 1998, 222 pages]. Études littéraires africaines, (8),
53–56. https://doi.org/10.7202/1042034ar
Tous droits réservés © Association pour l'Étude des Littératures africaines Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
(APELA), 1999 services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/
COM PT E S REN DU S AFR I QUE NOIRE FRANCOPHO N E (53
CONGO
• BIYAOULA DANIEL, L'IMPASSE, PARIS, PRÉSENCE AFRICAINE, 1996, 327
PAGES .
• MABANCKQU ALAIN, BLEU BLANC RoUGE, PARIS, PRÉSENCE AFRICAINE,
1998, 222 PAGES.
Difficile d'évirer le rapprochement entre ces deux romans. Non qu'ils
ne se puissent, bien sûr, lire er s'apprécier diversement, pour eux-mêmes.
Et il est vrai qu'à s'en tenir à une première approche formelle, les traits
différentiels sont de taille : écriture serrée, hachée et presque sèche, chez
Mabanckou, comme pour coller aux faits bruts tels que le personnage
focal les a perçus, tels que le narrateur essaie de se les rappeler avec objec-
tivité, et au contraire, chez Biyaoula, lente, sinueuse, répétitive, avec de
longues digressions que le temps présent apparente à du monologue inté-
rieur et le style "oral", disloqué, émotif et éminemment subjectif, au ton
célinien. Ce que pourraient montrer, respectivement, les deux exemples
suivants (pris au hasard) : "Mon père était réapparu avec deux ensembles.
Il avait choisi pour ma mère. Le soir, chacun essaya son ensemble devant
le miroir." et "Ah! ça m'éperonne, ça me saisit! C'est comme si c'était de
moi qu'elles causent, ces bonnes femmes, de mon enveloppe à moi qui est
aussi la leur, qu'elles ne souffrent plus." Il se pourrait certes trouver des
contre-exemples qui assouplissent la rigueur constative du premier récit et
qui, à l'inverse, disciplinent le verbe et balisent la dérive exclamative du
second, il n'empêche que dans l'ensemble ils contrastent et même se
repoussent dans leur phrasé, dans la musique singulière qu'ils nous don-
nent à entendre.
Cependant leurs paroles s'aimantent et le discours qu'ils tiennent sur
l'expérience de leur narrateur personnage se complète de manière tour à
fait étonnante. Il y a vraiment de l'écho entre ces deux romans, et la coïn-
cidence de leur sujet leur vaut d'être traité ici ensemble, ou du moins en
contrepoint, et ce en dépit de leur foncière originalité, de leur singulière
littérarité, de tout ce qu'ils ne partagent évidemment pas.
Voici deux auteurs congolais, originaires du Congo (Brazzaville) et
vivant en France, et dont les premiers romans, à peu près contemporains
et tous deux écrits "à la première personne", tous deux divisés en parties
symétriques ("Au pays/Paris" et "première/deuxième constriction"),
racontent un double échec. Celui d'abord (Mabanckou) du "rêve bleu-
blanc-rouge" pour Massala-Massala, le jeune et naïf immigré clandestin
qui se retrouve floué, en prison ; il n'y a pas d'aller vraiment simple
Brazzaville-Paris, car le retour "à la case de départ" est programmé dès
"l'ouverture". Il se fera, à la fin du roman dite "fermeture", en avion char-
ter. Le "fiasco" de l'éphémère aventure parisienne se soldera au pays face
à "la grande famille" qui, attendant le fils prodigue sous la figure
mythique du Parisien, n'aura que les débris du rêve brisé net. Lui, face à
ce cauchemar du retour et dans le charter de la honte, ne saurait rêver que
de repartir.
54)
Selon un parcours inversé, le second échec (Biyaoula) commence, pour
Joseph, l'émigré de longue date apparemment bien intégré en France, par
un catasuophique retour au pays d'origine (c'est la "première constric-
tion") suivi d'un non moins calamiteux retour en France ("deuxième
constriction"). Étranger à lui-même, il ne se reconnaît pas dans l'image
prestigieuse du Congolais Parisien qu'il rejette mais que sa famille lui ren-
voie: il est "devenu Blanc", si profondément qu'il n'a pas à le jouer, à en
exhiber les signes attendus par sa famille ; pour elle, il est resté Kala, un
surnom infamant ("charbon") qu'il n'a pas su effacer : il fait honte, il en
a honte. Revenu en France, il se découvre peu à peu noir et seul, exposé
au racisme blanc qu'il s'imagine découvrir jusque dans sa plus chère amie.
La séparation entérine sa division intestine, accélère la dérive vers la folie.
Pour se mettre en accord avec lui-même, se libérer du "monstre" intérieur
et obsédant, il ne lui reste plus qu'à faire sa "mue", c'est-à-dire se confor-
mer enfin au modèle canonique (paraître avec le ventre idoine, bien sapé,
"maquillé", courant les filles ... ). Le voilà fin prêt à retourner au pays, à s'y
re-présenter en bonne et due forme pour être accueilli en vrai Parisien ...
Or c'est bien ainsi que se présente, chez Mabanckou, le personnage de
Moki dont la figure mythique déclenche et nourrit les rêves de départ en
France chez les jeunes garçons (et filles) du pays, ce Moki qui sert de men-
tor au jeune Massala-Massala.
Aussi est-ce en ce point que les romans se recroisent en une sorte d'al-
litération perpétuelle, au point qu'il est loisible de les imaginer comme la
suite l'un de l'autre. De même que Moki serait le résultat achevé de la
métamorphose du dernier Joseph cherchant encore à la fin du roman
"une méthode plus rapide, plus efficace, plus radicale pour m'effacer la
mémoire et me donner de bons souvenirs ... " (derniers mots de L'impasse),
de même Joseph pourrait figurer à son tour le double fictif et postérieur
de Massala-Massala, lequel, à l'ultime page de la "fermeture" de Bleu
blanc rouge, atteste lui aussi d'une mutation ouvrant sur une autre vie :
"Tout est possible dans notre monde à nous. Sans le savoir, je ne suis plus
le même. ( ... ) Mentalement je me prépare. Je ne peux écarter l'éventuali-
té de ce retour en France."
Cette mise en série des deux romans est évidemment surdéterminée par
le genre "roman de formation" qu'ils ont en commun. L'apprentissage de
leur héros respectif ne mène à aucune vérité positive. Au contraire, la
révélation de leur être aliéné tourne, comme dans un cercle vicieux, vers
toujours plus d'aliénation. Dans cette voie négative, par rapport à son
cadet de Bleu blanc rouge, le héros de L'impasse semble tout de même en
être à un stade plus avancé, c'est-à-dire plus régressif. Car la troisième
position qu 'il adopte ("'a mue") n'est pas une (im)posture de synthèse, un
quelconque métissage dans le sryle classique de la "Noiritude" dont
Joseph, alias Kala, ne cesse de se moquer. Stade de l'ironie et du gro-
tesque, elle s'opère sous la pression conjointe de son psychiatre africano-
lâtre et de son entourage "blanchi" sous le harnais parisien, elle décons-
COMPTES RENDUS AFRI QUE NOI RE FRANCO PHONE (55
truit les séquelles manichéennes d'une trop simple "aventure ambiguë".
Ce dernier tour de vis (sans fin) dans la souffrance est le véritable tour de
force du roman. C'est aussi un bon tour joué au lecteur, car il réussit à le
désorienter, à le semer entre ici et là-bas, quelque part entre l'analyse clas-
sique mais toujours actuelle de "Peau noire, masques blancs" et des fic-
tions schizoïdes telles L'écart de Mudimbe ou Giambatista Viko de N'Gal:
on ne sait jamais trop de quel côté l'auteur se situe ni même s'il existe
encore un (bon ou mauvais) "côté", tant la béance identitaire paraît auto-
riser toutes sortes de fixations, de détours et de retournements. Au fond,
dans ce trajet Paris-Brazzaville-Paris, il n 'y aurait que des "retours" - y
compris celui du refoulé. Mais quoi faire d 'autre, face à "l'impasse" luci-
dement aperçue au bout de toutes les nuits, sinon (se) retourner ?
Ladite trajectoire est scandée par l'alternance blanc noir blanc, en fait
moins des couleurs que des valeurs internes dont le contraste violent
accentue le côté roman noir. Tandis que sur le trajet Brazza-Paris-Brazza
emprunté par Bleu Blanc Rouge, les trois couleurs éponymes mettent au
centre la France et en exergue sa grande tradition naturaliste-réaliste (cf
la mention de Maupassant en quatrième de couverture). Tout s'y passe
donc dans la plus complète transparence, avec un souci de l'exactitude
documentaire qui va jusqu'à dévoiler les petits trafics des Parisiens et en
général la réalité sordide de leurs conditions de (sur)vie, en opposition
avec leurs discours de gloire à Brazzaville.
Sur le phénomène de la diaspora congolaise en France, déjà abondam-
ment étudié par les sociologues, Mabanckou écrit le roman de l'honneur
perdu, de l'amour déçu, sur le plan des signes extérieurs, sociologiques et
économiques, tandis que Biyaoula en explore le versant souterrain, psy-
chologique et même physiologique. De fait, L'impasse est un roman de la
honte, de la haine, de la nausée - sans doute celle de Sartre à cause de sa
teneur existentielle, d 'un certain regard intellectuel, de la mauvaise foi
aussi (cf le psychiatre Malfoi, si justement dénommé), mais, en fin de
compte, domine surtout cette "nausée de Céline" si bien analysée par
Jean-Pierre Richard : à travers le personnage focal elle se transmet par le
corps, par des sensations très physiques, viscérales - estomac retourné,
angoisse nouée, migraines pour traduire la crispation, J'abjection identi-
taire- peut-être pour en finir avec l'identité.
On aurait là deux versions du roman "postidentitaire", comme on dit
outre-Atlantique. Le double échec de la pulsion d'exil qu'il diagnostique
peut se lire, par le biais d'une sorte d'hypertexte anthropologique, comme
le double bind de l'émigré/immigré qui n'a pas le choix: impossibilité de
trancher les racines, de tracer "le chemin d'Europe" (" roots" /"routes"
selon le jeu de mots qui revient dans le dernier livre de James Clifford),
impossibilité aussi de choisir entre "nationalists and nomads" (titre du der-
nier livre de Christopher L. Miller). En tenant, chacun à leur manière, un
bout de cette chaîne aporétique, ces deux romans ont pour dénominateur
commun de nous la rendre extrêmement sensible et vivante, et, à défaut
56)
de la briser, de lui donner quand même, à force de la tendre et de la tordre
dans rous les sens, un peu de jeu. Grâce au choix de l'écriture qui dans
l'engrenage sociologique et psychologique introduit nuances et diffé-
rences.
• Nicolas MARTIN-GRANEL
• EFQUI KOSSI, LA POL KA, ROMAN, PARIS, EDITIONS DU SEUIL, 1998, 157 P.
Prévu pour paraître sous le titre de Rumba chronique, le premier roman
de Kossi Efoui porte finalement le nom d'une danse polonaise à deux
temps, à l'allure très vive et très rythmée : La Polka. Mais contrairement
à ce que laisse présager ce titre, le récit est une profonde allégorie qui se
joue dans la tête d'un narrateur-conteur. La polka, c'est le nom de guerre
de Nahéma, cette jeune fille d'une vingtaine d'années, dont la mère est
décédée lors de l'accouchement, dont le père reste inconnu, énigme qui
alimente les commentaires et les discussions au Bar M., carrefour de ce
petit monde en permanente quête de délassement. Nahéma do
Nacimento, dite la Polka, décide un jour de partir pour Sr-Dallas, ville
mystérieuse sans géographie ni histoire, terre d'où "personne n'a jamais
été natif' (106), mais qui a la réputation d'être le tombeau de tout le
monde. La Polka est partie et un jour, Pape Solo, l'instituteur, grand ani ..
mateur des funérailles, laisse tomber lourdement la nouvelle comme dans
un rêve : la Polka est morte ; son corps retrouvé pendu est bien identifié
et rendu à sa famille. La douleur prend tout le monde à la gorge. Ne reste
plus que la vaste maison de la grand-mère Marne Sale- vieillie par les évé-
nements - où se déroulent les funérailles dans une atmosphère morose.
Le vide soudain vécu transforme la mémoire du narrateur en une vaste
hallucination qui nourrit le récit d'un permanent chevauchement entre
réel et fiction. Le mot événement revient fréquemment dans les propos
des personnages mais l'écriture, elle, rêveuse, n'en propose véritablement
pas un seul. Tout tourne en spirale, le temps comme l'espace. Les mots se
compilent et se vident de sens, renvoyant secrètement au non-sens de la
vie. Finalement, ils se placent en situation de produire l'événement dans
leurs déferlements tantôt sentencieux, tantôt macabres avec des allusions
répétées à certains événements qui ont marqué la vie de Kossi Efoui, lui-
même arrêté en 1990 au Togo pour distribution de tracts et jeté en pri-
son avant de prendre le chemin de l'Europe. Efoui fait clairement allusion
aux événements de la journée du 11 avril 1991 au Togo où la population
qui manifestait dans les rues de la capital e Lomé pour réclamer un Etat
de droit fut chargée par les forces de l'ordre dans les abords de la Lagune
de Bè. Dans le sauve-qui-peur, certains se sont jetés dans la lagune pour
une noyade prévisible.
Mais Efoui ne s'attarde pas sur ces quelques intrusions du réel dans le
fictif. La trame romanesque cherche à rester entièrement fidèl e au souve-
Vous aimerez peut-être aussi
- AnalyseDocument9 pagesAnalyseKamal ElamraouiPas encore d'évaluation
- Le Choix de Sophie, de William Styron, Traduit de L'américainDocument5 pagesLe Choix de Sophie, de William Styron, Traduit de L'américainAbdal ArtPas encore d'évaluation
- Roman Parabolique Sur L'immigration Féminine Marocaine en France: Les Yeux Baissés de Tahar Ben JellounDocument7 pagesRoman Parabolique Sur L'immigration Féminine Marocaine en France: Les Yeux Baissés de Tahar Ben JellounTiti SuruPas encore d'évaluation
- Asimov, Isaac (Robots) (1950) Les Robots (I, Robot)Document259 pagesAsimov, Isaac (Robots) (1950) Les Robots (I, Robot)Sourigo100% (3)
- Dictionnaire: DES HiéroglyphesDocument23 pagesDictionnaire: DES HiéroglyphesJuan Carlos MPPas encore d'évaluation
- COUCHORO (Félix), Oeuvres Complètes. Tome 1: Romans.: Études Littéraires AfricainesDocument4 pagesCOUCHORO (Félix), Oeuvres Complètes. Tome 1: Romans.: Études Littéraires Africainesmoonjack229Pas encore d'évaluation
- KEITA Fatou, Rebelle, Paris, Présence Africaine/abidjan, NEI, 1998, 232 PDocument3 pagesKEITA Fatou, Rebelle, Paris, Présence Africaine/abidjan, NEI, 1998, 232 PAboubacar TraoréPas encore d'évaluation
- KOUROUMA Ahmadou, Allah N'est Pas Obligé, Paris, Seuil, 2000, 233 PDocument4 pagesKOUROUMA Ahmadou, Allah N'est Pas Obligé, Paris, Seuil, 2000, 233 PMohamed FofanaPas encore d'évaluation
- Contes de La Savane: Contes Choisis Et Présentés Par HélèneDocument4 pagesContes de La Savane: Contes Choisis Et Présentés Par HélèneMalikaro DoumbiaPas encore d'évaluation
- Les "Fictions Critiques"Document3 pagesLes "Fictions Critiques"Paula RostanPas encore d'évaluation
- L'aventure Ambeguë, Cheikh Hamidou KaneDocument9 pagesL'aventure Ambeguë, Cheikh Hamidou Kanearchangel94% (17)
- Images et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophoneD'EverandImages et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophonePas encore d'évaluation
- DOSSIER 5 Patrick Chamoiseau Nov 2014 - La Tortue VerteDocument130 pagesDOSSIER 5 Patrick Chamoiseau Nov 2014 - La Tortue VerteGabriel González CastroPas encore d'évaluation
- 77 1222 1 PB PDFDocument18 pages77 1222 1 PB PDFMounir OussikoumPas encore d'évaluation
- Hommesmigrations 3937Document3 pagesHommesmigrations 3937Yasmine DaboussiPas encore d'évaluation
- À Propos Du Cinquantenaire: Chroniques D'une Indépendance AmbiguëDocument14 pagesÀ Propos Du Cinquantenaire: Chroniques D'une Indépendance AmbiguëEsther TiaPas encore d'évaluation
- De L'intermédiaire Colonial Au Mémorialiste Postcolonial. Les Fonctions Du Déplacement Géographique Dans Les Mémoires D'amadou Hampâté BâDocument14 pagesDe L'intermédiaire Colonial Au Mémorialiste Postcolonial. Les Fonctions Du Déplacement Géographique Dans Les Mémoires D'amadou Hampâté BâAdama NdiayePas encore d'évaluation
- Jean Genet Arabes, Noirs Et Palestiniens Dans Son OeuvreDocument26 pagesJean Genet Arabes, Noirs Et Palestiniens Dans Son OeuvreSirine HadakPas encore d'évaluation
- LENFANT NOIR DE CAMARA LAYE Litterature PDFDocument22 pagesLENFANT NOIR DE CAMARA LAYE Litterature PDFEmna Braham100% (3)
- Sup Livres 060309Document12 pagesSup Livres 060309tinderpaperPas encore d'évaluation
- Les Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo GodinDocument11 pagesLes Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo GodinMorlaye soumahPas encore d'évaluation
- Gascar (Curatolo Pierre Gascar) PDFDocument5 pagesGascar (Curatolo Pierre Gascar) PDFAnonymous EcAltIedNPas encore d'évaluation
- Les Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo GodinDocument11 pagesLes Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo Godinbenjamin ananouPas encore d'évaluation
- Hommesmigrations 3946Document3 pagesHommesmigrations 3946MarioPas encore d'évaluation
- Satire Et Humanisme de Bernard Dadié Dans Un Nègre À Paris: Louis-Marie OngoumDocument16 pagesSatire Et Humanisme de Bernard Dadié Dans Un Nègre À Paris: Louis-Marie OngoumDiallo SouleymanePas encore d'évaluation
- Études Littéraires AfricainesDocument3 pagesÉtudes Littéraires Africainesfernanda.vilarsPas encore d'évaluation
- Alain Mabanckou - Lettres Noires - Des Ténèbres À La Lumière - Lettres Noires - Des Ténèbres À La Lumière - Collège de FranceDocument30 pagesAlain Mabanckou - Lettres Noires - Des Ténèbres À La Lumière - Lettres Noires - Des Ténèbres À La Lumière - Collège de FranceIêda VasconcelosPas encore d'évaluation
- AfriquesDocument17 pagesAfriquesELO HELLOPas encore d'évaluation
- Bibliographie Doumbi FakolyDocument7 pagesBibliographie Doumbi FakolyFélix BangouraPas encore d'évaluation
- Le Pays Des Merveilles À L'enversDocument3 pagesLe Pays Des Merveilles À L'enversfojajof208Pas encore d'évaluation
- Retour D'afrique: Claude RoussinDocument8 pagesRetour D'afrique: Claude Roussin9643171Pas encore d'évaluation
- Les Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo GodinDocument11 pagesLes Soleils Des Indépendances : Jean-Cléo Godinodiankha351Pas encore d'évaluation
- Terminale ProDocument32 pagesTerminale ProAnonymous V3AcBqo8gY100% (1)
- Négritude Et Responsabilité: Ville Cruelle de Mongo BetiDocument15 pagesNégritude Et Responsabilité: Ville Cruelle de Mongo Betimobina torkianPas encore d'évaluation
- 9782307201205Document27 pages9782307201205seydina omar thiam100% (1)
- Sillage Trace Empreinte - La Migrance Ambulatoire de Fatou DiomeDocument25 pagesSillage Trace Empreinte - La Migrance Ambulatoire de Fatou DiomeYoussef El HabachiPas encore d'évaluation
- Ni Françaises Ni Maghrébines-Stratégies de Déplacement Et de DépartenanceDocument23 pagesNi Françaises Ni Maghrébines-Stratégies de Déplacement Et de DépartenanceElazzouzi KhiraPas encore d'évaluation
- Resumes Des Œuvres LitterairesDocument11 pagesResumes Des Œuvres Litterairesn'dri100% (5)
- Benoît DuteurtreDocument13 pagesBenoît DuteurtreAgnes MonadePas encore d'évaluation
- ArDocument32 pagesArNeelKamal89Pas encore d'évaluation
- Retour D'afrique: Claude RoussinDocument8 pagesRetour D'afrique: Claude RoussingorguyPas encore d'évaluation
- Liberation Du Samedi 4 Et Dimanche 5 Fevrier 2012Document48 pagesLiberation Du Samedi 4 Et Dimanche 5 Fevrier 2012Christophe PrunierPas encore d'évaluation
- N° 4 C R I: EditorialDocument72 pagesN° 4 C R I: EditorialAdrian IancuPas encore d'évaluation
- Dramaturge Ivoirien. Paris: L'Harmattan, Coll. EspacesDocument4 pagesDramaturge Ivoirien. Paris: L'Harmattan, Coll. EspacesjoaobilkoskyPas encore d'évaluation
- Mémoire Saket RFDocument54 pagesMémoire Saket RFIlies chrPas encore d'évaluation
- La Boite A MerveillesDocument0 pageLa Boite A MerveillesAnas OuallaPas encore d'évaluation
- Tant D'errances de Mambi MDocument12 pagesTant D'errances de Mambi MSeidina kadra KanePas encore d'évaluation
- MABANCKOU, Alain (2005) Verre Cassé, Paris, Le Seuil, 202 PPDocument2 pagesMABANCKOU, Alain (2005) Verre Cassé, Paris, Le Seuil, 202 PPstevejerry93Pas encore d'évaluation
- L'engagement Des Romanciers Québécois: Gilles DorionDocument5 pagesL'engagement Des Romanciers Québécois: Gilles Doriondoumbouyaa433Pas encore d'évaluation
- Dossier Grand Calao-NoracDocument17 pagesDossier Grand Calao-NoracKomenan CyriaquePas encore d'évaluation
- (Im) Possible Autobiographie: Vers Une Lecture Derridienne de L'amour, La Fantasia D'assia DjebarDocument23 pages(Im) Possible Autobiographie: Vers Une Lecture Derridienne de L'amour, La Fantasia D'assia DjebarJean-Paul Friedrich NgabuPas encore d'évaluation
- Marcel CabonDocument21 pagesMarcel CabonWaheed JoolfooPas encore d'évaluation
- D'expression Française, Collection Thema/Anthologie, ParisDocument4 pagesD'expression Française, Collection Thema/Anthologie, ParisBenbar 007Pas encore d'évaluation
- Tierno MoninemboDocument392 pagesTierno MoninemboARGYOU100% (1)
- Ni Noires Ni BlanchesDocument4 pagesNi Noires Ni BlanchesCoraline KaPas encore d'évaluation
- 7ième CoursDocument16 pages7ième CoursDennys Silva-ReisPas encore d'évaluation
- Petit Chaperon RougeDocument13 pagesPetit Chaperon RougeMatthew ParsonsPas encore d'évaluation
- Litt Magh Expr FrancDocument20 pagesLitt Magh Expr FranckantikorsPas encore d'évaluation
- D'une Île À L'autre Enjeux de La Créolité Au FémininDocument11 pagesD'une Île À L'autre Enjeux de La Créolité Au Fémininpaula roaPas encore d'évaluation
- Théâtres Africains: Jean Cléo GodinDocument6 pagesThéâtres Africains: Jean Cléo GodinAsse SeckPas encore d'évaluation
- Salammbo de Gustave Flaubert: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandSalammbo de Gustave Flaubert: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- On Affame Bien Les RatsDocument32 pagesOn Affame Bien Les RatsNarimane BenabbouPas encore d'évaluation
- Plan de Redaction Du Schema Directeur TICDocument3 pagesPlan de Redaction Du Schema Directeur TICMathy TuringPas encore d'évaluation
- le crapaudDocument6 pagesle crapaudchirineghostine0112Pas encore d'évaluation
- Examen AnalyseDocument3 pagesExamen AnalyseMouna Bz100% (1)
- Notice Ucemine PP 50 ComprimesDocument4 pagesNotice Ucemine PP 50 ComprimesFrancisPas encore d'évaluation
- Memento SQL PDFDocument8 pagesMemento SQL PDFKawtar L Azaar100% (1)
- La Forme Active Et La Forme Passive PDFDocument9 pagesLa Forme Active Et La Forme Passive PDFAnuradha SharmaPas encore d'évaluation
- Introduction À L'analyse MacroéconomiqueDocument65 pagesIntroduction À L'analyse MacroéconomiqueWillihomesYahooPas encore d'évaluation
- Tchad Breve Histoire Politique Jusqu A 1990Document7 pagesTchad Breve Histoire Politique Jusqu A 1990Arnaud RAOUMBAPas encore d'évaluation
- Code de Deontologie Edition 2017 Secure InteractiveDocument64 pagesCode de Deontologie Edition 2017 Secure InteractivePauloPas encore d'évaluation
- TD 05 - Effet Des UV Sur Les LevuresDocument3 pagesTD 05 - Effet Des UV Sur Les LevuresLoïcPas encore d'évaluation
- Audit Légal Dev1Document4 pagesAudit Légal Dev1Marc-Rémy N'driPas encore d'évaluation
- ArquivoDocument16 pagesArquivoGabrielly NatanielPas encore d'évaluation
- Effets de BordureDocument1 pageEffets de BordureYoucef BenferdiPas encore d'évaluation
- PharmacovigilanceDocument2 pagesPharmacovigilancemohamaed abbasPas encore d'évaluation
- Grammaire MementoDocument4 pagesGrammaire MementoosoksPas encore d'évaluation
- Dominique Maingueneau-Auteur Et Image D'auteur en Analyse Du DiscoursDocument18 pagesDominique Maingueneau-Auteur Et Image D'auteur en Analyse Du DiscoursAnonymous gyBlO7oxp100% (1)
- Annabelle Marquis Ma-SignedDocument6 pagesAnnabelle Marquis Ma-Signedapi-240985696Pas encore d'évaluation
- Atelier Climat Scolaire 2Document26 pagesAtelier Climat Scolaire 2Olsen MalagaPas encore d'évaluation
- Rapport Electronique NumeriqueDocument4 pagesRapport Electronique NumeriqueBIENVENU KANGNI100% (1)
- Peau Du PorcDocument4 pagesPeau Du PorcMohPas encore d'évaluation
- Litterature Et Langue Francaises Scolaria ExcellenceDocument32 pagesLitterature Et Langue Francaises Scolaria ExcellenceEcoleprivee ScolariaexcellencePas encore d'évaluation
- Intro PKIDocument26 pagesIntro PKIKabb kenkenPas encore d'évaluation
- Progression DicteesDocument2 pagesProgression Dicteeschautan.marionPas encore d'évaluation
- Catalogue NihelDocument62 pagesCatalogue NihelRafik GhaouiPas encore d'évaluation
- 14 Mars 2006 - L'esprit D'équipeDocument2 pages14 Mars 2006 - L'esprit D'équipeJuJutsuMeyrin100% (1)
- P Rebetez Le-CoachingprofessionnelDocument31 pagesP Rebetez Le-CoachingprofessionnelHichamElIbrahimiPas encore d'évaluation