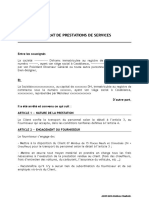Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Epfl TH2294
Epfl TH2294
Transféré par
Thomas SahliTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Epfl TH2294
Epfl TH2294
Transféré par
Thomas SahliDroits d'auteur :
Formats disponibles
CHOIX DE VARIANTES D'INFRASTRUCTURES ROUTIRES: MTHODES MULTICRITRES
THSE NO 2294 (2000)
PRSENTE AU DPARTEMENT DE GNIE CIVIL
COLE POLYTECHNIQUE FDRALE DE LAUSANNE
POUR L'OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR S SCIENCES TECHNIQUES
PAR
Mical TILLE
Ingnieur civil diplm EPF de nationalits franaise et suisse et originaire d'Ormont-Dessus (VD)
accepte sur proposition du jury: Prof. A.-G. Dumont, directeur de thse Prof. M. Bassand, rapporteur Prof. Ph. Bovy, rapporteur M. O. Michaud, rapporteur Prof. A. Schrlig, rapporteur
Lausanne, EPFL 2001
Page A
RESUME
La prsente tude fournit au projeteur routier, qui est gnralement un ingnieur civil, des outils de travail lui permettant de raliser une infrastructure routire de qualit, durable et qui est accepte par tous. Ces diffrents lments facilitateurs des activits du projeteur sont runis au sein dune mthodologie dlaboration du projet routier actualise et qualifie de mthodologie concertative. Aprs avoir analys la typologie des problmes rencontrs dans les projets dinfrastructures routires, (chapitre 1) lauteur sest intress hirarchiser les principales causes de cette problmatique. Il en ressort de multiples facteurs de causalit qui peuvent tre lis la structure du projet, son environnement ou aux diffrents acteurs. Lactualisation de la mthodologie de travail du projeteur routier est un thme minemment pratique qui se base sur des tudes de cas. (chapitre 2) Le cas de base de cette tude est la Comparaison de variantes 1999 mene sur la A 144 entre les localits de Villeneuve et du Bouveret. A partir de quatre variantes initiales, qui taient la source de nombreux conflits entre les diffrents acteurs, la Comparaison de variantes 1999 a permis de dgager, aprs sept mois de travaux, une solution optimale et consensuelle appele Solution COPIL . Le choix de cette variante sest bas sur une mthode daide multicritre la dcision de type agrgation complte. Celle-ci utilisait les pondrations effectues par lensemble des acteurs politiques de ltude. Lauteur a pu participer en tant quauditeur prs dune quinzaine de sances de travail du Groupe technique et du Comit de Pilotage, qui runit les acteurs politiques de cette tude. Lexamen de ce cas de base a fourni lauteur de nombreux et prcieux renseignements sur le processus dlaboration dun projet routier. Les besoins et les objectifs des infrastructures routires ont t analyss par lauteur. (chapitre 3) Celui-ci sest intress dfinir les besoins individuels et collectifs ainsi que lvolution des attentes sociales du public. La mise en uvre des politiques publiques est ensuite tudie. Un accent particulier est mis sur les principales politiques publiques incidence spatiale lies au projet routier : amnagement du territoire, transport et environnement. Une rflexion finale portant sur la mobilit, ses valeurs, ses caractristiques et ses perspectives dvolution est effectue. La diffrence existant entre le standard dune infrastructure routire et la norme est finalement explicite. Les diffrentes tapes du processus dlaboration du projet routier (chapitre 4) sont analyses en profondeur par lauteur. Un accent particulier est port sur les tapes initiales de limpulsion llaboration du projet et de lidentification des besoins, car celles-ci dterminent fortement la qualit et lacceptation du projet. Lauteur propose ensuite de prsenter les diffrentes tapes dune infrastructure routire sous la forme dun cycle de vie, la prsente tude ne concernant que quelques aspects de celui-ci. Diffrentes procdures particulires ont ensuite t analyses et critiques, de manire tablir diverses propositions intgrer dans la mthodologie concertative.
Page B
La typologie des acteurs du projet routier (chapitre 5) ainsi que les caractristiques des relations entre ceux-ci ont t dveloppes par lauteur. Ce dernier, qui dispose lensemble des pondrations des membres du COPIL dans le cas de base, analyse ensuite les rapports existants entre les diffrents acteurs de la Comparaison de variantes 1999 et analyse les profils de pondration des diffrents acteurs de manire. Ceci permet de dfinir des profils dacteurs reprsentatifs . Le dveloppement durable (chapitre 6) est ensuite prsent par lauteur. Aprs un rappel des dfinitions et des raisons qui ont amen tablir cette nouvelle notion, lauteur dfinit les principes dune mobilit durable. Les aspects pratiques pour le projeteur de ce nouveau paradigme socital sont ensuite dfinis et prsents. Ils concernent la prise en compte du cycle de vie dans lanalyse des effets dun projet, la pese des intrts selon les trois ples de lconomie, du social et de lenvironnement, la participation publique et lusage de la concertation, ce ds le dbut de ltude. La participation publique (chapitre 7) est un lment important de llaboration du projet routier permettant de sassurer de lacceptation de celui-ci par le public. Elle est mme susceptible de dvelopper le phnomne de lappropriation du projet par les acteurs priphriques. Aprs avoir analys lvolution de la participation publique dans les projets dinfrastructures routires, lauteur rappelle quelques notions de la communication. Les diffrentes formes de participation publique sont ensuite prsentes par lauteur qui a tabli un tableau rcapitulant prs de soixante-dix mthodes de participation publique. Certaines de ces mthodes sont dtailles en annexe dans des fiches descriptives. Des rgles dapplication de la mthodologie concertative sont ensuite prsentes puis les avantages et les limites de cette mthode sont dcrits. Les mthodes daide multicritre la dcision (chapitre 8) sont prsentes par lauteur. Tout dabord, une rflexion approfondie est mene sur le processus de la dcision ainsi que sur ses acteurs. Les aspects subjectifs et objectifs ainsi que la possible ainsi que les diffrents facteurs influenant la dcision sont dtaills. Lauteur prsente ensuite les mthodes daide multicritre la dcision. La terminologie des diffrents lments utiliss est dfinie puis une prsentation des principaux types de mthodes daide multicritre la dcision est ralise. Lauteur a privilgi dans cette tude lapplication des mthodes dagrgation partielle au projet dinfrastructure routire. Ces mthodes peuvent tre classes en trois catgories selon quelles sappliquent une problmatique de choix, de tri ou de rangement. Lauteur procde ensuite une prsentation complte des principes et de la dmarche dutilisation des diffrentes mthodes dagrgation partielle de la famille Electre (I, II, III, IV, IS et Tri). Lauteur recommande lutilisation de la mthode dagrgation partielle Electre III dans le cadre du projet routier. Cette mthode utilise la notion de critres flous, dfinis par des seuils de prfrence, dindiffrence ou de veto. Elle peut tre utilise avec un logiciel simplifiant fortement le travail du projeteur Pour illustrer lutilisation de cette mthode, lauteur la applique sur le cas de la Comparaison de variantes 1999 . La mthode Electre III a t utilise avec lensemble des pondrations effectues par les acteurs du Comit de pilotage. Lusage du logiciel spcifique montre une grande souplesse et facilit dutilisation, permettant lauteur de le recommander au projeteur routier.
Page C
Lauteur prsente ensuite les systmes rfrence spatiale et leur utilisation au sein de projets routiers pour tablir des couloirs prfrentiels ou comme support lutilisation dune mthode aide multicritre la dcision. La mthodologie concertative du projet routier est prsente en dtail (chapitre 9) sous la forme de diffrents diagrammes de flux successifs reprenant les tapes de llaboration du projet routier. Ces diagrammes de flux, bass sur une dmarche dtude mene en plusieurs itrations, sont la base de la mthodologie concertative et sont destins au projeteur routier qui le parcourt en rpondant aux diffrentes questions poses dans le but dorienter son projet. En conclusion de cette tude, (chapitre 10) lauteur indique les diffrentes perspectives dutilisation de la mthodologie actualise proposes ainsi que les axes des recherches futures mener partir des rflexion et des propositions tablies dans cette tude. MOTS CLES projet routier, mthodologie de travail, processus dlaboration, dmarche itrative, procdure, acteurs, dveloppement durable, transparence, information, consultation, concertation, participation publique, aide multicritre la dcision, agrgation partielle, Electre
Page E
SUMMARY
This study provides a tool by means of which a road planner, usually a civil engineer, can achieve a durable infrastructure of high quality, acceptable to all parties concerned. The various elements which facilitate the work of planning are united into a modernized methodology for the elaboration of road projects, called a methodology of concert. After analysing the sort of problems encountered in the planning of road infrastructure (Chapter 1), the author classifies the main causes of these into a hierarchy. This brings to light many factors which may stem from the structure of the project, the environment or from the various participants. The modernization of the working methods of road planners is a highly practical idea based on case studies (Chapter 2). The particular study on which this work is based is the Comparaison de variantes 1999 , made on the A 144 road between the cities of Villeneuve and Le Bouveret. From an initial group of four variants, which were a source of much contention between the interested parties, an optimal and consensual solution, called Solution COPIL , was evolved in seven months, by means of this study. The choice of this solution was based on a method of multicriteria decision analysis of a completely aggregational form. This used the weightings defined by all the political partners in the study. The present author was allowed to sit in on about fifteen working sessions of the Technical Group and of the Guiding Committee, which consists of the political partners. The examination of this particular case provided him with much valuable information about the process of elaboration of a road plan. The requirements and aims of road infrastructure are analysed (Chapter 3). Here, the focus is on the definition of individual and collective needs and the evolution of social expectation of the general public. The implementation of public policy is then examined. Particular emphasis is laid on the principal public policies whose spatial incidence affects the road plan : land distribution, transport and environment. Some attention is paid to the consideration of mobility, its value, characteristics and future developments. The difference between the standard and the norm of road infrastructure is described explicitly. The various stages of the process of elaboration of a road plan are analysed in depth. (Chapter 4) Particular attention is paid to the initial stages of impulsion for the elaboration of the project and of the identification of needs, since these influence strongly the quality and the acceptability of the project. The author then proposes that the various stages of road infrastructure be presented in the form of a life cycle of which the present study only concerns some aspects. Various special procedures are then analysed critically in order to extract propositions to be integrated into the methodology of concert.
Page F
The type of partners in the road project and the characteristics of the relationships between them are discussed. (Chapter 5) The set of weightings made by the political partners in the case study Comparaison de variantes 1999 are used to analyze the relations between the various participants in this study. A representative profile of a participant is defined from the examination of their individual weighting profiles. The notion of sustainability is presented (Chapter 6). After a recapitulation of definitions and of the reasons for this new idea, the principles of a durable mobility are presented. The practical aspects of this new paradigm of society for the planner are defined and discussed. They concern the inclusion of the life cycle in the analysis of the effects of a project, the weighing of interests from the three points of view of economy, social utility and the environment, public participation and the use of consultation right from the start of the study. Public participation (Chapter 7) is an important element in the elaboration of a road plan as it ensures its acceptation by the public. It may even allow the phenomenon of appropriation of a project by peripheral partners to develop. The various forms of public participation are presented in a table showing almost seventy which can affect a road project. The detailed description of some of these methods are given in appendix. Rules for applying the methodology of concert are then presented and the advantages and limits of this are discussed. After in-depth consideration of the decision procedure and its participants, with details of the various subjective and objective factors which may influence it, the study describes the methods of multicriteria decision analysis. (Chapter 8) Terminology is defined and the main types of these methods are presented. In this study, partial aggregation methods have been applied to the road infrastructure projects. These methods may be divided into three categories according to whether they are applicable to a situation of choice, of sorting or of order. A complete presentation is then given of the principles and ways of using the various methods of partial aggregation of the Electre family (I, II, III, IV, IS and Tri). For projects of road infrastructure, the method of partial aggregation Electre III is suggested. This method is based on the idea of fuzzy criteria, defined by thresholds of preference, indifference or of veto. It can be used with computer software which greatly simplifies the work of the planner. To illustrate the use of this method, Electre III have been applied to the case of Comparaison de variantes 1999 . The method was used on the set of weightings defined by the members of the Guiding Committee. The specific software is convivial and intuitively simple to use, so that the author was able to recommend it to the road planner. Information systems of spatial reference are described and their relevance for road projects in the establishment of optimal corridors or as a support for a method of multicriteria decision analysis. The methodology of concert for the elaboration of road plans is presented in detail (Chapter 9) in the form of successive flow diagrams illustrating the various stages of the procedure. These diagrams, based on an iterative process of study, provide the basis of the methodology of concert. They are intended for the road planner who follows them through and orients his planning according to his answers to the various questions contained there.
Page G
In conclusion (Chapter 10), various prospects for the utilization of the proposed modernized methodology are indicated, together with the lines of possible future research suggested by the results and ideas contained in this study. KEY WORDS Road planning, working methodology, process of elaboration, iterative process, procedure, partners, sustainability, transparency, information, consultation, concert, public participation, multicriteria decision analysis, partial aggregation, Electre
Page I
TABLE DES MATIERES
RESUME SUMMARY TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 1.
1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3
A E I 1 5
5 6 7 8 10 12 13 14 17 20 23
PROBLEMATIQUE
Intervenants Remerciements tendue du domaine concern par ltude Description des chapitres Principe des postulats Risques viter Conditions de pertinence de l'tude Prambule Typologie des problmes rencontrs Facteurs de la problmatique Conclusion
CADRE DE LA THESE .................................................................................................... 5
1.2
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
STRUCTURE DE L'ETUDE .............................................................................................. 8
1.3
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
LA PROBLEMATIQUE DES PROJETS ROUTIERS .......................................................... 14
2.
2.1 2.2 2.3
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6
LES ETUDES DE CAS
25
PREAMBULE ............................................................................................................... 25 CAS DE BASE : ROUTE PRINCIPALE SUISSE A 144 VILLENEUVE LE BOUVERET ................................................................................................................. 26 CONTEXTE DETUDE ET PROBLEMATIQUE ................................................................ 28
Contexte gographique Contexte politique Contexte des transports conomie Environnement Problmatique 28 29 31 33 33 33
2.4 2.5
HISTORIQUE DES PROJETS ......................................................................................... 34 LES VARIANTES INITIALES ......................................................................................... 36
Page J
2.6
2.6.1
LORGANISATION DU PROJET .................................................................................... 39
Groupes de travail
2.6.1.1 2.6.1.2 2.6.1.3 Comit de Pilotage Groupe Technique Mandataire externe
39
39 40 40
2.6.2 2.6.3
Droulement de ltude La mthode danalyse des valeurs d'utilit
2.6.3.1 2.6.3.2 2.6.3.3 2.6.3.4 Dmarche adopte Systme des objectifs Principe de notation Description des indicateurs
41 41
42 43 43 45
2.7
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18
DEROULEMENT DE LA COMPARAISON DE VARIANTES 1999 ............................... 47
Sance dinformation publique Premire sance du Comit de Pilotage Deuxime sance du Comit de Pilotage Troisime sance du Comit de Pilotage Runion de coordination OFROU - OFEFP Troisime sance du Groupe Technique Quatrime sance du Comit de Pilotage Quatrime sance du Groupe Technique Cinquime sance du Groupe Technique Cinquime sance du Comit de Pilotage Ractions mdiatiques Organisation de la suite de loptimisation Sixime sance du Groupe Technique Septime sance du Groupe Technique Sixime sance du Comit de Pilotage Confrence de presse finale Parution du rapport technique Projet de dcret pour un crdit dtude Phases principales de ltude Variantes Analyse des besoins et dtermination du standard Procdure Organisation du travail Acteurs Analyse des valeurs dutilit Conclusions de la Comparaison de variantes 1999 48 48 50 52 54 54 58 62 63 65 67 69 70 72 74 78 78 81 83 85 87 90 91 92 95 101
2.8
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8
ANALYSE DU DEROULEMENT DE LA COMPARAISON DE VARIANTES 1999 ......... 82
2.9
AUTRES CAS ............................................................................................................. 102
3.
3.1 3.2
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
107
INTRODUCTION ........................................................................................................ 107 LES BESOINS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS ............................................................. 109
Les besoins individuels Les socits humaines Les besoins collectifs Les volutions des attentes sociales Mise en uvre dune politique publique 109 111 112 113 115
3.3
3.3.1
LES POLITIQUES PUBLIQUES .................................................................................... 115
Page K
3.3.2
Les politiques publiques incidence spatiale
3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.2.3 Amnagement du territoire Transport Environnement
118
118 120 122
3.4
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4
LA MOBILITE ............................................................................................................ 123
volution des rseaux dinfrastructures routires volution de la mobilit Consquences de la mobilit
3.4.3.1 3.4.3.2 Avantages de la mobilit Inconvnients de la mobilit
124 125 127
127 128
Perspectives Typologie des infrastructures de transport
3.5.1.1 3.5.1.2 3.5.1.3 3.5.1.4 Les fonctions principales dune infrastructure de transport Modes de classification Classification fonctionnelle Rseau de transport fonctionnel Le standard et la norme Standards pour lusager Standards pour le dcideur
129 130
130 130 131 131
3.5
3.5.1
LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ........................................................................ 130
3.5.2
Les standards
3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3
132
132 133 133
3.5.3
Conclusions
134
4.
4.1
4.1.1 4.1.2
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
Avant-propos Terminologie Principales phases du cycle de vie tendue de ltude Paramtres distinctifs Tableau de synthse Les diffrentes tapes Impulsion llaboration du projet Dfinir le cadre de ltude Fixer la participation des intervenants Identifier les besoins Formuler des objectifs Analyser les contraintes Proposer des solutions Apprcier les consquences Proposer une solution Prendre une dcision Principes de llaboration squentielle Prsentation des diffrentes tapes tude de planification Avant-projet Projet dfinitif
135
135 136 138 139 140 141 142 144 146 147 147 150 150 151 151 151 152 152 154 156 156 157
PREAMBULE ............................................................................................................. 135
4.2
4.2.1 4.2.2
LE CYCLE DE VIE DUNE INFRASTRUCTURE ROUTIERE........................................... 137
4.3
4.3.1 4.3.2
TYPOLOGIE DES PROJETS ROUTIERS ....................................................................... 140
4.4
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.11 4.4.12
PROCESSUS DELABORATION DU PROJET ROUTIER ................................................ 142
4.5
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
LABORATION DU PROJET SELON LES NORMES SUISSES ........................................ 154
4.6
EXEMPLES DE PROCEDURES PARTICULIERES ......................................................... 157
Page L
4.6.1 4.6.2 4.6.3
Routes nationales suisses Grands projets dinfrastructures en France Autoroutes concdes en France
157 160 161
4.7 4.8
ANALYSE CRITIQUE DES METHODOLOGIES EXISTANTES ........................................ 163 PROPOSITIONS ......................................................................................................... 165
5.
5.1
5.1.1 5.1.2
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
Les diffrents acteurs du projet routier Intervention des acteurs
5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.2.4 Groupe dcideur et groupe dtude Reprsentativit des acteurs Composition du groupe dcideur Composition du groupe dtude
167
168 169
169 170 171 171
IDENTIFICATION DES ACTEURS................................................................................ 168
5.1.3 5.1.4 5.1.5
Le dcideur Le groupe dtude Le public
5.1.5.1 5.1.5.2 5.1.5.3 5.1.5.4 Prambule Intrts dfendus dans l'espace et le temps La perception du risque par le public Contraintes et motivations de laction Origines du mouvement cologique Modes daction des organisations non-gouvernementales Droit de recours des organisations environnementales
171 172 173
173 174 176 177
5.1.6
Les organisations non-gouvernementales
5.1.6.1 5.1.6.2 5.1.6.3
178
178 179 179
5.1.7 5.1.8 5.1.9
Les acteurs politiques Les acteurs administratifs Les utilisateurs de la route Conflits et coalitions Objectifs, moyens et rsum Analyse de situation Analyse des pondrations
5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4 5.3.2.5 5.3.2.6 5.3.2.7 5.3.2.8 5.3.2.9 Groupe dacteurs lus valaisans Groupe dacteurs lus vaudois Groupe dacteurs Associations de dveloppement conomique Groupe dacteurs Associations de protection de lenvironnement Groupe dacteurs Administration publique Environnement et amnagement du territoire Groupe dacteurs Administration publique Service des routes Analyse rcapitulative Corrlation avec les profils dacteurs reprsentatifs Commentaires
182 182 183 185 186 189 191
192 193 195 196 197 198 199 201 205
5.2
5.2.1 5.2.2
LES RAPPORTS ENTRE LES ACTEURS ....................................................................... 184
5.3
5.3.1 5.3.2
ANALYSE DE LA COMPARAISON DE VARIANTES 1999 ....................................... 188
6.
6.1 6.2 6.3 6.4
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
207
HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE.......................................................... 207 PRESENTATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ..................................................... 211 POLITIQUE DES TRANSPORTS ET MOBILITE DURABLE ............................................ 215 LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LES PROJETS DINFRASTRUCTURES ROUTIERES ............................................................................................................... 217
Page M
6.5
COMMENTAIRES ...................................................................................................... 220
7.
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13
LA CONCERTATION
221
PREAMBULE ............................................................................................................. 223 LA COMMUNICATION ............................................................................................... 226 FORMES DE PARTICIPATION DU PUBLIC .................................................................. 229 OBJECTIFS DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE ......................................................... 230 DESCRIPTION DES METHODES DE PARTICIPATION DU PUBLIC................................ 231 CHOIX DE LA METHODE DE PARTICIPATION PUBLIQUE .......................................... 235 REGLES SPECIFIQUES A LA METHODOLOGIE DETUDE CONCERTATIVE ................ 236 LA RESOLUTION DES CONFLITS ............................................................................... 241 LA CONDUITE DE REUNION ...................................................................................... 243 LES AVANTAGES DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE................................................. 246 LES LIMITES DE LA CONCERTATION........................................................................ 247 LES ENSEIGNEMENTS DE LA COMPARAISON DE VARIANTES 1999 .................... 249 REFLEXIONS............................................................................................................. 250
8.
8.1 8.2
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
251
PREAMBULE ............................................................................................................. 251 LAIDE A LA DECISION ............................................................................................. 254
Le processus de la dcision Une dfinition de laide la dcision Acteurs de laide la dcision Subjectivit et objectivit Facteurs dinfluence dune dcision Labsence doptimum Caractristiques de laide la dcision pour les projets dinfrastructures routires Processus dtude Terminologie
8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3 8.3.2.4 8.3.2.5 8.3.2.6 Variante Critre Relation de surclassement Relations entre les variantes Poids Critres francs et critres flous Agrgation complte Agrgation partielle Agrgation locale itrative
254 255 256 258 259 263 265 267 268
268 268 269 270 271 271
8.3
8.3.1 8.3.2
LES METHODES DAIDE MULTICRITERE A LA DECISION ......................................... 267
8.3.3
Typologie des mthodes daide multicritre la dcision
8.3.3.1 8.3.3.1 8.3.3.2
275
275 276 277
8.3.4 8.3.5
Problmatique de dcision Electre I
8.3.5.1 8.3.5.2 Prambule Dmarche dutilisation
278 279
279 280
Page N
8.3.6 8.3.7
Electre II
8.3.6.1 8.3.6.2 8.3.7.1 8.3.7.2 8.3.7.3 Prambule Dmarche dutilisation Prambule Dmarche dutilisation Prsentation des rsultats Prambule Dmarche dutilisation Prambule Dmarche dutilisation Prambule Variantes de rfrence Dmarche dutilisation
283
283 283
Electre III
286
286 287 289
8.3.8 8.3.9 8.3.10
Electre IV
8.3.8.1 8.3.8.2 8.3.9.1 8.3.9.2 8.3.10.1 8.3.10.2 8.3.10.3
290
290 291
Electre IS Electre Tri
293
293 293
294
294 295 296
8.3.11
Rcapitulation
297
8.4
8.4.1
UNE METHODE DAIDE MULTICRITERE A LA DECISION ADAPTEE AU PROJET ROUTIER ................................................................................................................... 299
Le choix dune mthode daide multicritre la dcision
8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 Quoi ? Qui ? Quand ? Performances des variantes Famille de critres Mthode daide multicritre la dcision
299
299 300 300
8.4.2
Choix raliss dans le cadre de ltude
8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3
301
301 302 303
8.5
8.5.1 8.5.2
APPLICATION A LA COMPARAISON DE VARIANTES 1999 .................................. 304
Dtermination du tableau des performances Application de Electre III Composantes dun systme d'information rfrence spatiale
8.6.1.1 8.6.1.2 Composantes structurelles Composantes informatiques
304 307 315
316 316
8.6
8.6.1 8.6.2 8.6.3
LES SYSTEMES DINFORMATION A REFERENCE SPATIALE ...................................... 315
Modes de reprsentation des donnes Fonctions principales dun systme dinformation rfrence spatiale
8.6.3.1 8.6.3.2 8.6.3.3 8.6.3.4 8.6.3.5 Saisie Manipulations Gestion Interrogation et analyses Visualisation Association des systmes dinformation rfrence spatiale et des mthodes daide multicritre la dcision Problmatique des infrastructures linaires Intgration au sein de la mthodologie concertative Conclusion
318 319
319 319 320 320 321
8.6.4
Utilisation des systmes dinformation rfrence spatiale au sein du projet routier
8.6.4.1 8.6.4.2 8.6.4.3 8.6.4.4
322
322 323 324 326
9.
9.1 9.2 9.3
9.3.1 9.3.2 9.3.3
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
327
INTRODUCTION ........................................................................................................ 327 RECAPITULATIF DES POSTULATS ............................................................................ 330 INTEGRATION DE LELABORATION DU PROJET AU SEIN DU CYCLE DE VIE............. 336
tapes du cycle de vie Lexamen dopportunit du projet Llaboration du projet routier 336 336 340
Page O
9.3.4
Le projet dfinitif tapes du processus Dfinir le cadre de ltude
9.4.1.1 9.4.1.2 9.4.1.3 Dlimitation du domaine dtude Description de la mthodologie de travail Fixer la participation des intervenants Identification et analyse des besoins Formulation des objectifs Collecte et analyse des contraintes Pondration des critres
340 342 344
344 345 346
9.4
9.4.1 9.4.1
PROCESSUS DELABORATION DU PROJET ROUTIER ................................................ 342
9.4.2
Dcrire la problmatique
9.4.2.1 9.4.2.2 9.4.2.3 9.4.2.4
347
348 348 348 351
9.4.3 9.4.4
Proposer des solutions Apprcier les consquences
9.4.4.1 9.4.4.2 9.4.4.3 9.4.4.4 Dtermination des indicateurs valuation des performances Utilisation dune mthode daide multicritre la dcision Proposition de variante satisfaisante
351 354
354 354 357 359
9.4.5
Prendre une dcision
359
10. 11. 12.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES BIBLIOGRAPHIE ANNEXES
361 365 377
Figures
Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 6 Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10 Figure 11 Figure 12 Figure 13 Figure 14 Figure 15 Diffrentes sources des postulats ....................................................................................11 Extrait dun article paru le 9 avril 1997 dans le quotidien rgional La Presse Riviera-Chablais (Wichser F., 1997)............................................................................14 Ptition de protestation contre la politique autoroutire franaise publie sur le site du Comit contre la frnsie autoroutire (CCFA, 2000).........................................15 Catgories principales des facteurs gnrateurs de conflits dans les projets routiers.............................................................................................................................22 Vue de la plaine du Rhne en amont du Lac Lman. La localit du Bouveret se situe en bas droite de limage (Swissair, 1995) ............................................................28 Extrait de la carte topographique au 1 : 100000 (OFT, 1999) .......................................29 Rseau routier actuel autour du lac Lman (Microsoft, 1998)........................................31 Rseau routier actuel dans la zone dtude (OFT, 1999) ................................................31 Martin-pcheur dans la rserve des Grangettes (Aubort D., 1999).................................33 Variantes initiales tudies dans la Comparaison de variantes 1999 (Infraconsult, 2000).........................................................................................................38 Exemple de profil dapprciation permettant de comparer deux variantes (Infraconsult, 2000).........................................................................................................55 Trac des variantes tudies dans la premire phase doptimisation de la Comparaison de variantes 1999 (Infraconsult, 2000) ...............................................65 Combinaisons de variantes Clos et Golf utilises lors de la Comparaison de variantes 1999 (Infraconsult, 2000) .............................................................................71 Trac de la Solution COPIL propose la suite de la Comparaison de variantes 1999 (Infraconsult, 2000) .............................................................................76 Prsentation synthtique des principales phases dtude de la Comparaison de variantes 1999 ..............................................................................................................85
Page P
Figure 16 Figure 17 Figure 18 Figure 19 Figure 20 Figure 21 Figure 22 Figure 23 Figure 24 Figure 25 Figure 26 Figure 27 Figure 28 Figure 29 Figure 30 Figure 31 Figure 32 Figure 33 Figure 34 Figure 35 Figure 36 Figure 37 Figure 38 Figure 39 Figure 40 Figure 41 Figure 42 Figure 43 Figure 44 Figure 45 Figure 46 Figure 47 Figure 48 Figure 49 Figure 50 Figure 51 Figure 52 Figure 53 Figure 54 Figure 55 Figure 56 Figure 57 Figure 58
Ampleur des choix de standard et de trac pour la Comparaison de variantes 1999 ..............................................................................................................................89 Possibilits de pondration en fonction du nombre de critres dans le cas de la Comparaison de variantes 1999 ................................................................................97 Possibilits de pondration en considrant le nombre de critres dans la dtermination de la pondration minimale ......................................................................98 La pyramide de Maslow................................................................................................109 Gense de la mise en uvre dune politique publique (Knoepfel P., 1997a) ...............116 Le triangle de fer dune politique publique (Knoepfel P., 1993)............................117 Les politiques publiques lies au projet routier.............................................................118 Rseau des routes nationales suisses (tat : fin aot 1997) (ODT, 2000a)....................125 volution de plusieurs paramtres lis la mobilit en Suisse (OFS et OFEFP, 1997) .............................................................................................................................125 Modification du champ des dplacements potentiels (Bridel L., 1998)........................126 Perspectives dvolution du trafic voyageurs et marchandises (SET, 2000) ................129 La mthodologie, agrgation de deux notions distinctes ..............................................137 Cycle de vie dune infrastructure routire (VSS, SN 640 026).....................................138 tendue de ltude par rapport au cycle de vie dune route ..........................................139 Processus dlaboration du projet routier......................................................................143 Dimension optimale du domaine dtude......................................................................146 Bilan didentification des besoins .................................................................................149 tapes de la planification des routes nationales (CGCN, 1997) .......................................158 Procdure dlaboration des grands projets dinfrastructures en France.......................161 laboration du trac et ralisation dune autoroute concde en France ......................162 Positionnement des acteurs en fonction de lespace et du temps considr (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) ..........................................................................................174 Le cycle des proccupations par rapport une infrastructure routire (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) ...............................................................................................175 Diagramme ternaire des idologies (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) .....................178 Rapports existants entre les diffrents acteurs du projet routier (Tille M., 1999a) .......185 Exemple dun triangle de fer avec formation de deux coalitions (Tille M., 1999a) .....186 Schma de principe rsumant lanalyse de situation de la Comparaison de variantes 1999 ............................................................................................................190 Profils de pondration des familles de critres pour les acteurs du groupe Elus vaudois .......................................................................................................................194 Profils de pondration des familles de critres pour les six groupes dacteurs .............200 Profils de pondration des familles de critres pour les quatre acteurs reprsentatifs .................................................................................................................201 Couplage de la croissance conomique et de la charge environnementale (Knoepfel P., 1997a) .....................................................................................................208 Les trois dimensions de la durabilit (CI-Rio, 1997; Knoepfel P., 1997a) ...................212 Les diffrentes notions de dveloppement ....................................................................213 Le dveloppement durable et les transports ..................................................................217 Modle gnral de la communication (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)..................226 La dformation de linformation ...................................................................................228 Types de participants une runion selon Orgogozo (Audtat M.C., Robert F. et al., 1998)........................................................................................................................244 Les six mauvaises raisons de chercher viter la participation publique (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) ..........................................................................................250 Facteurs dinfluence de la dcision ...............................................................................261 Dimension dcisionnelle en fonction de ltendue spatiale de ltude..........................262 Valeurs des indices de concordance spcifique et de discordance dans le cas des critres francs ................................................................................................................272 Valeurs des indices de concordance spcifique et de discordance dans le cas des critres flous ..................................................................................................................274 Situations relatives entre deux variantes vi et vk dans le cadre de critres flous............274 Problmatique de choix .............................................................................................278
Page Q
Figure 59 Figure 60 Figure 61 Figure 62 Figure 63 Figure 64 Figure 65 Figure 66 Figure 67 Figure 68 Figure 69 Figure 70 Figure 71 Figure 72 Figure 73 Figure 74 Figure 75 Figure 76 Figure 77 Figure 78 Figure 79 Figure 80 Figure 81 Figure 82 Figure 83 Figure 84 Figure 85 Figure 86 Figure 87 Figure 88 Figure 89 Figure 90
Problmatique de tri ...................................................................................................279 Problmatique de rangement ......................................................................................279 Dmarche dutilisation dElectre I (tir de Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)..........280 Dmarche dutilisation de la mthode Electre III (LAMSADE, 1994) ..............................289 Saisie dcran des rsultats des distillations et du graphe final selon ELECTRE III-IV .............................................................................................................................289 Exemple de reprsentation des rsultats obtenus avec Electre III selon Simos et Maystre (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) ........................................................................290 Procdure daffectation des variantes dans Electre Tri (tir de Schrlig A., 1985, 1996) .............................................................................................................................297 Rsultats des profils de pondration P1 P12 ..............................................................308 Rsultats des profils de pondration P13 P24 ............................................................309 Rsultats des profils de pondration P25 P28 ............................................................310 Relations de prfrences entre les variantes de la Comparaison de variantes 1999 ............................................................................................................................313 Rpartition des donnes dans des couches thmatiques (Esrifrance, 2000) ......................317 Modes de reprsentation de donnes gorfrences (Esrifrance, 2000)...........................319 Exemple danalyse de proximit (Esrifrance, 2000)..........................................................320 Exemple danalyse spatiale (Esrifrance, 2000)..................................................................321 Carte de sensibilit environnementale (Molines N., 1997) ................................................324 Proposition de fuseaux de trac (Molines N., 1997) ..........................................................325 Proposition de fuseaux de trac raliss sur un prototype de SMA (Ferrand N., 1998) .............................................................................................................................326 Structure de la description de la mthodologie concertative dans le chapitre 9............329 Intgration de llaboration du projet au sein du cycle de vie de linfrastructure routire ..........................................................................................................................337 Examen dopportunit du projet....................................................................................339 laboration du projet routier par application dune dmarche itrative........................341 Processus dlaboration du projet routier......................................................................343 Dlimitation du domaine dtude ..................................................................................345 Fixer la participation des intervenants ..........................................................................347 Identification des besoins ..............................................................................................349 Collecte et analyse des contraintes................................................................................350 Pondration des critres ................................................................................................352 Gnration des variantes ...............................................................................................354 Dtermination des indicateurs .......................................................................................355 valuation des performances ........................................................................................356 Utilisation dune mthode daide multicritre la dcision..........................................358
Page R
Tableaux
Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 Tableau 4 Tableau 5 Tableau 6 Tableau 7 Tableau 8 Tableau 9 Tableau 10 Tableau 11 Tableau 12 Tableau 13 Tableau 14 Tableau 15 Tableau 16 Tableau 17 Tableau 18 Tableau 19 Tableau 20 Tableau 21 Tableau 22 Tableau 23 Tableau 24 Tableau 25 Tableau 26 Tableau 27 Tableau 28 Tableau 29 Tableau 30 Tableau 31 Tableau 32 Tableau 33 Tableau 34 Structure du rapport de thse.............................................................................................9 Charges de trafic au droit de la traverse du Rhne par la A 144 (Infraconsult, 2000) ...............................................................................................................................32 Principales caractristiques des variantes initiales (Infraconsult, 2000) et (DINF, 2000a)..............................................................................................................................37 chelle des notes d'apprciation (Infraconsult, 2000).....................................................43 Systme des objectifs retenu pour la Comparaison de variantes 1999 (Infraconsult, 2000).........................................................................................................44 Description des indicateurs utiliss pour apprcier la satisfaction des besoins de transport (Infraconsult, 2000)..........................................................................................45 Description des indicateurs utiliss pour apprcier lutilisation conomique des moyens financiers (Infraconsult, 2000)...........................................................................45 Description des indicateurs utiliss pour apprcier le respect des objectifs de lamnagement du territoire (Infraconsult, 2000) ...........................................................46 Description des indicateurs utiliss pour apprcier la rduction des nuisances sur lenvironnement (Infraconsult, 2000) .............................................................................46 Description des indicateurs utiliss pour apprcier le dveloppement conomique (Infraconsult, 2000).........................................................................................................47 Description des indicateurs utiliss pour apprcier la limitation des nuisances dues aux travaux (Infraconsult, 2000).............................................................................47 Rsultats de lanalyse des valeurs dutilit (Infraconsult, 2000).....................................60 Classement des valeurs dutilit dtermin selon les pondrations individuelles des membres du COPIL (Infraconsult, 2000) .................................................................61 Rsultats de lanalyse des valeurs dutilit avec les corrections du COPIL (Infraconsult, 2000).........................................................................................................63 Apprciations des diffrentes variantes tudies lors de la Comparaison de variantes 1999 (Tille M., 1999b) et (Infraconsult, 2000).............................................79 Rsultats de lanalyse des valeurs dutilit avec la variante Solution COPIL (Infraconsult, 2000).........................................................................................................79 Typologie des projets routiers .......................................................................................141 Matrice dexemples dimpulsions .................................................................................145 Contenus principaux des tapes de projet (Selon tab. 1, VSS, SN 640 026) ................155 Contraintes et motivations laction (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)...................177 Rpertoire dinterventions des groupes structurs (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) .............................................................................................................................179 Acteurs politiques susceptibles dinfluencer le projet...................................................182 Exemples de quelques confrontations ou coalitions envisageables dans les projets dinfrastructures routires (Tille M., 1999a) .................................................................187 Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs lus valaisans ...........192 Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs lus vaudois .............193 Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs Associations de dveloppement conomique .......................................................................................195 Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs Associations de protection de lenvironnement ...................................................................................196 Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs Administration publique Environnement et amnagement du territoire ..........................................197 Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs Administration publique Service des routes .....................................................................................198 Analyse des pondrations moyennes de chaque groupe dacteurs................................199 Pondrations des acteurs reprsentatifs de la Comparaison de variantes 1999 .......200 Corrlation des acteurs avec les acteurs reprsentatifs..................................................203 Rcapitulatif de la catgorisation des acteurs selon les acteurs reprsentatifs ..............204 Prsentation des diverses mthodes de participation du public.....................................234
Page S
Tableau 35 Tableau 36 Tableau 37 Tableau 38 Tableau 39 Tableau 40 Tableau 41 Tableau 42 Tableau 43
Typologie des mthodes dagrgation partielle selon la problmatique de dcision (Roy B., 1985; Schrlig A., 1985) ................................................................................278 Caractristiques principales des mthodes Electre (tir de Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)....................................................................................................................298 Performances values suite une pondration technique............................................305 Tableau des performances .............................................................................................306 Rangs obtenus en appliquant Electre III 28 profils de pondration ...........................310 Comparaison des rangs entre les variantes pour les 56 distillations effectues ............311 Relations de prfrences entre les variantes de la Comparaison de variantes 1999 ............................................................................................................................312 Ecarts des rangs obtenus en appliquant Electre III 28 profils de pondration............314 Tableau rcapitulatif des postulats mis tout au long de ltude...................................335
Postulats
Postulat 00 ..............................................................................................................................................10 Postulat 01 ..............................................................................................................................................17 Postulat 02 ..............................................................................................................................................17 Postulat 03 ..............................................................................................................................................18 Postulat 04 ..............................................................................................................................................19 Postulat 05 ..............................................................................................................................................20 Postulat 06 ..............................................................................................................................................21 Postulat 07 ..............................................................................................................................................22 Postulat 08 ..............................................................................................................................................37 Postulat 09 ..............................................................................................................................................49 Postulat 10 ..............................................................................................................................................51 Postulat 11 ..............................................................................................................................................53 Postulat 12 ..............................................................................................................................................54 Postulat 13 ..............................................................................................................................................73 Postulat 14 ..............................................................................................................................................86 Postulat 15 ..............................................................................................................................................86 Postulat 16 ..............................................................................................................................................90 Postulat 17 ..............................................................................................................................................93 Postulat 18 ..............................................................................................................................................93 Postulat 19 ..............................................................................................................................................95 Postulat 20 ..............................................................................................................................................98 Postulat 21 ............................................................................................................................................100 Postulat 22 ............................................................................................................................................103 Postulat 23 ............................................................................................................................................103 Postulat 24 ............................................................................................................................................107 Postulat 25 ............................................................................................................................................108 Postulat 26 ............................................................................................................................................110 Postulat 27 ............................................................................................................................................117 Postulat 28 ............................................................................................................................................123 Postulat 29 ............................................................................................................................................132 Postulat 30 ............................................................................................................................................132 Postulat 31 ............................................................................................................................................133 Postulat 32 ............................................................................................................................................137 Postulat 33 ............................................................................................................................................139 Postulat 34 ............................................................................................................................................141 Postulat 35 ............................................................................................................................................142 Postulat 36 ............................................................................................................................................144 Postulat 37 ............................................................................................................................................148 Postulat 38 ............................................................................................................................................148
Page T
Postulat 39 ............................................................................................................................................152 Postulat 40 ............................................................................................................................................165 Postulat 41 ............................................................................................................................................166 Postulat 42 ............................................................................................................................................170 Postulat 43 ............................................................................................................................................170 Postulat 44 ............................................................................................................................................173 Postulat 45 ............................................................................................................................................176 Postulat 46 ............................................................................................................................................205 Postulat 47 ............................................................................................................................................224 Postulat 48 ............................................................................................................................................225 Postulat 49 ............................................................................................................................................235 Postulat 50 ............................................................................................................................................236 Postulat 51 ............................................................................................................................................236 Postulat 52 ............................................................................................................................................237 Postulat 53 ............................................................................................................................................238 Postulat 54 ............................................................................................................................................238 Postulat 55 ............................................................................................................................................239 Postulat 56 ............................................................................................................................................240 Postulat 57 ............................................................................................................................................241 Postulat 58 ............................................................................................................................................255 Postulat 59 ............................................................................................................................................257 Postulat 60 ............................................................................................................................................258 Postulat 61 ............................................................................................................................................258 Postulat 62 ............................................................................................................................................264 Postulat 63 ............................................................................................................................................300 Postulat 64 ............................................................................................................................................300
Pour Marie-Hlne et Gabriel
AVANT-PROPOS
Une route est, par essence, un lment linaire1 reliant deux points, lorigine et la destination. Cette dfinition dun simple ruban bitumineux, ouvrage artificiel sinsrant plus ou moins harmonieusement dans le paysage, est cependant insuffisante. En effet, une route nest finalement rien dautre quun simple lment dune organisation dense et beaucoup plus complexe, le rseau routier. Ce dernier est une vritable toile daraigne stendant sur lensemble du territoire et garantissant en tout temps la circulation aise de moyens de locomotion htrognes. Plus que tout autre rseau de transport, le rseau routier assure une diffusion maximale dans lespace des effets bnfiques ou nfastes lis la motorisation. Ce qui caractrise fortement la route, cest quelle prsente, tel le dieu Janus de la mythologie romaine, deux faces opposes, ce qui fait dire F.B. Huyghe quelle est un vritable mdium ambigu . (Huyghe F.-B., 1997) La face lumineuse de la route, cest quelle agit comme un formidable vecteur dchanges et de dcouvertes au service de lHomme. Elle lui permet de faire clater de manire extraordinaire les limites de son cadre de vie. Grce la route, lensemble de la collectivit peut exercer de manire confortable et conomique de multiples activits : changer des marchandises, vivre dans un endroit et travailler dans un autre, acheter des produits volumineux et encombrants loin de son domicile, accder des services loigns, etc. La route est aussi un important lment de lpanouissement personnel par les multiples possibilits de rencontres et de dtente offertes tous : voir ses proches ou ses amis, se divertir, dcouvrir de nouveaux territoires, svader au sein de nouveaux paysages, etc. Laccessibilit une mobilit performante, sre, conomique, confortable et librement choisie est dsormais un lment important et indissociable de notre civilisation occidentale. Le rseau routier est de loin le premier systme de transport permettant dassurer cette mobilit, que cela soit par son ampleur ou par le nombre de personnes et de biens qui lempruntent. Comme le dit J. Billard : Nous sommes
habitus aux routes. Leur importance ne nous apparat que par leur absence, soit qu'elles manquent pour accder un lieu () qui est alors qualifi d'inaccessible; soit encore lorsqu'elles sont momentanment coupes () . (Billard J., 1998)
La face sombre de la route, ce sont les impacts sur lenvironnement humain et naturel quelle gnre, comme le bruit, la pollution atmosphrique ou les atteintes au paysage, et qui sont mises par les vhicules qui lempruntent ou par linfrastructure proprement dite. La fragmentation du territoire ralise par le maillage parfois dense du rseau routier entrane une forte diffusion de ces nuisances qui stendent bien au-del du domaine propre de linfrastructure. Le fantastique accroissement de la mobilit et de la motorisation que lon observe depuis prs dun demi-sicle amplifie encore plus lintensit de ces effets ngatifs.
1
Dans le sens la continuit dun lment gomtrique plutt que dun trac en ligne droite
AVANT-PROPOS
Les nouvelles technologies de linformation et de la communication permettent de saffranchir des contraintes de dplacement afin de communiquer, travailler, se divertir ou se ravitailler depuis son domicile. Elle ne semblent cependant pas pouvoir, contrairement aux esprances places tort en elles, diminuer, ou simplement freiner, cette volution de la mobilit. La transformation de notre socit en une socit de plus en plus base sur les loisirs et les pratiques hdonistes favorise aussi la croissance de la mobilit.2 Mdium ambigu finalement, car les avantages et les inconvnients lis aux routes sont indissociables et ne concernent pratiquement jamais les mmes populations (le riverain supportant les inconvnients dune route la peroit dune manire totalement oppose quun usager qui en bnficie). De plus, il est difficile et souvent coteux dliminer les inconvnients lis la route sans en affecter les avantages. Ainsi, la route porte en son sein autant de facteurs qui tendront la plbisciter que de germes qui tendront la rejeter : cest dans cette bivalence et cette sorte de concomitance du Bien et du Mal que rsident toutes les difficults de lactivit du projeteur routier ! Laspect de Janus varie radicalement selon langle de vue duquel on lobserve, la route prsente aussi cette caractristique de lidole romaine. Dveloppement durable Longtemps accepts comme corollaire du dveloppement conomique et du progrs, et souvent fortement dsirs, les projets techniques denvergure, et les infrastructures routires en particulier, sont de moins en moins tolrs par la population. (Besnanou R., 1999) Conduire un projet dinfrastructures routires est dsormais un exercice difficile et complexe bien diffrent de la procdure pratique il y a quelques dcennies. (Galland J.-P., 1999) La prise de conscience des limites du dveloppement conomique et de la ncessit de bnficier dun environnement naturel prserv et diversifi, gage dun cadre de vie de qualit, voir de la vie tout simplement, ont amen depuis prs de quatre dcennies un fort dveloppement des proccupations environnementales au sein de la socit. Le modle de dveloppement de la socit occidentale depuis la rvolution industrielle du XIXme sicle est bas principalement sur la croissance conomique, lexploitation sans retenue des matires premires, notamment celles qui ne sont pas renouvelables, et le pangyrique des innovations technologiques mises au service du bien-tre de lHomme. La ncessit de modifier ce mode dvolution de la collectivit, qui entrane une forte pression sur les milieux naturels et le cadre de vie, est reconnue depuis prs de trois dcennies. Un nouveau modle de dveloppement harmonieux et quilibr entre ltre humain, lenvironnement et lconomie sest concrtis par la notion du dveloppement durable dfinie en 1992 au sommet de la Terre Rio de Janeiro. La responsabilit de nos actes envers les gnrations futures, qui lon se doit de laisser des ressources suffisantes afin de ne pas prtriter leur mode de vie, est aussi prsente dans ce nouveau concept.
En 1994, la moiti de la distance journalire moyenne parcourue en Suisse tait due un motif li aux loisirs. (OFS et OFEFP, 1997) Entre 1984 et 1994, la distance parcourue pour les loisirs a doubl et tout semble indiquer que cette croissance va aller en sintensifiant (OFAT, 1998a)
Ainsi, le dveloppement durable est dsormais un lment important considrer dans llaboration dune route : il est ncessaire, dune part, de mettre en balance des intrts et des besoins contradictoires afin de nen pnaliser aucun, et, dautre part, davoir une rflexion sur les effets long terme des amnagements proposs. et participation citoyenne En parallle cette remise en question du progrs et de sa finalit, la crise de confiance envers ses serviteurs, les scientifiques, est patente. Le citoyen, de plus en plus et de mieux en mieux inform, est sensible aux drives de la science et de la technologie justifies parfois au nom du progrs. Il tend ainsi de plus en plus se mfier, voire mme rejeter sans distinction, des ralisations techniques. La mise en doute de la parole des techniciens, autrefois inconteste, nest aujourdhui plus saugrenue. Le respect du citoyen envers ses reprsentants politiques est aussi modifi dans un sens de dfiance, de perte de crdit et de contestation. Des mouvements, parfois spontans, plus ou moins organiss et prennes, prennent de plus en plus le relais du systme politique dmocratique classique pour transmettre et catalyser les aspirations et les craintes de la population, qui veut tre partie intgrante des projets la concernant. La population, souvent dsigne sous le terme gnral d opinion publique , nhsite plus utiliser les mdias, dont elle matrise de mieux en mieux les particularits de fonctionnement, pour faire part de ses proccupations directement auprs des dcideurs. On assiste aussi une remise en cause de lintrt gnral au profit dun meilleur respect des intrts individuels. La lgislation tient compte de cette volution en offrant dsormais la population et aux organisations non-gouvernementales des moyens dintervention au sein de la procdure dlaboration des projets denvergure. Le citoyen ne veut plus simplement subir un projet, il veut aussi participer pleinement sa conception. Cette crise de confiance se remarque ainsi par des projets routiers fortement contests et parfois bloqus, voir mme dfinitivement abandonns. Ces conflits proviennent souvent dincomprhensions sur le projet, quant sa finalit, son mode dlaboration ou sa prsentation. La procdure et les outils de travail utiliss par les projeteurs apparaissent parfois dsuets et peuvent tre en dcalage avec les aspirations de la population, renforant ainsi le malaise et les conflits potentiels. Cest l le second lment considrer dans llaboration dune route : il faut dsormais encore plus convaincre le citoyen et linciter participer llaboration des projets techniques denvergure qui le concernent plus ou moins directement. Apport de l'tude Remise en question de ses capacits tenir compte de la complexit du territoire, volution des aspirations de la population, nouveaux paradigmes socitaux, dveloppement de nouveaux outils de travail, etc. Le projeteur se doit dadapter ses mthodes de travail un contexte changeant en permanence. Les solutions traditionnelles ne sont plus garantes de succs et il sagit de les actualiser. Cette adaptation, dj en cours, nest cependant pas aise, car les solutions proposes sont multiples, ce qui laisse souvent le projeteur dans le dsarroi tant il est difficile de se faire rapidement une ide sur la mthode idale retenir. Ce sera l le principal objectif de cette tude : analyser les effets des modifications socitales sur la procdure du projet routier et les dveloppements raliss dans des domaines connexes afin de proposer lingnieur civil des mthodes de travail lui permettant de sadapter au mieux cette socit en changement.
Cadre de la thse
1.
PROBLEMATIQUE
Ce chapitre initial est scind en trois parties possdant les caractristiques suivantes : Cadre de la thse
(Qui ? - Combien ?)
Il sagit ici de prsenter les diffrents intervenants ainsi que ltendue du domaine dtude concern par cette tude Structure du rapport de thse
(Comment ?)
Les diffrents thmes traits dans les chapitres du document, ou rapport de thse,3 y sont prsents. Ensuite, le principe et les objectifs des postulats y sont dcrits. Une courte rflexion est aussi mene sur les prcautions prendre lors de llaboration de cette tude et les attentes avoir sur les rsultats qui y seront obtenus Problmatique
(Pourquoi ?)
et futurs lis ralise. Cette sommaire. Ceci plus synthtique
Dans ce chapitre, une description des problmes actuels llaboration des projets dinfrastructures routires est problmatique est volontairement prsente dune manire permet daborder rapidement ce vaste sujet de la faon la possible.
Cependant, certains des aspects conflictuels prsents ici seront repris et traits plus en profondeur dans la suite de ltude au sein de chapitres spcifiques
1.1
C ADRE DE LA THESE
1.1.1
Intervenants
Cette thse est prsente par Mical Tille, ingnieur-civil diplm EPF-ETS, sous la direction du professeur Andr-Gilles Dumont, directeur du Laboratoire des Voies de circulation (LAVOC) au Dpartement de Gnie Civil (DGC) de lEcole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL).
Par la suite, ce document sera dsign par le terme unique de Rapport de thse
PROBLEMATIQUE
Le jury charg de juger cette thse est compos des personnes suivantes : Prsident Walter-H. Graf , professeur au Dpartement de Gnie Civil de lEPFL, directeur du Laboratoire de Recherches Hydrauliques (LRH), prsident de la Commission de recherche du Dpartement de Gnie Civil Directeur de thse Andr-Gilles Dumont, professeur au Dpartement de Gnie Civil de lEPFL, directeur du Laboratoire des Voies de circulation (LAVOC) Rapporteurs internes Michel Bassand, professeur au Dpartement dArchitecture de lEPFL, directeur de lInstitut de recherche sur lenvironnement construit (IREC) Philippe Bovy, professeur au Dpartement de Gnie Civil de lEPFL, directeur de lunit Transport Environnement Amnagement (TEA) Rapporteurs externes Olivier Michaud, directeur de lOffice Fdral des Routes (OFROU), intgr au Dpartement Fdral de l'Environnement, des Transports, de lnergie et de la Communication (DETEC) Alain Schrlig, professeur lcole des Hautes tudes Commerciales (HEC) de lUniversit de Lausanne (UNIL) Cette tude a t finance par le biais dune bourse dtude de 37 mois accorde par la direction de lEPFL en avril 1997. La dfense orale sest droule le vendredi 27 octobre 2000.
1.1.2
Remerciements
Je tiens ici fortement remercier lensemble des personnes qui ont contribu de manire directe ou indirecte au succs de ce vritable challenge que constitue la rdaction dun rapport de thse. Cet exercice final qui consiste citer de nombreux noms est souvent difficile : comment ne pas oublier quelquun ? Que ceux qui ne seront pas cits ici me pardonnent, ils ne sont pas oublis ! En tout premier remerciement, je pense notamment mon pouse Marie-Hlne qui par ses encouragements multiples et sa patience jamais mise en dfaut a toujours rallum la petite flamme de la motivation qui vacillait parfois en moi et qui a accept de sacrifier trois longues annes de plus pour me permettre de poursuivre mes tudes. Merci aussi aux personnes contactes qui ont mont accords un peu de leur prcieux temps. Je pense notamment aux professeurs M. Bassand, A. Schrlig, F.-L. Perret, Golay et P. Bovy, J.-J. Hertig, B. Daucher, G. Roth, H. Hauck, F. Joerin, etc. Remerciements adresss aussi mes collgues de travail et mon directeur de thse, le professeur A-G. Dumont.
Cadre de la thse
1.1.3
tendue du domaine concern par ltude
Cette thse de doctorat traite du domaine des projets dinfrastructures routires en site banal,4 termes que lon peut dfinir ainsi : Projet Planification et conception5 de la construction, de lamnagement ou de la correction dun lment, dune partie ou de la totalit dun rseau routier. Cette dfinition exclut les parties purement constructives (ralisation) et dexploitation (maintenance et entretien) du cadre de cette tude Infrastructure routire Ensemble des amnagements linaires permettant dassurer le dplacements des personnes et des marchandises par le biais de vhicules motoriss deux degrs de libert de mouvement. Cette dfinition exclut de ltude lensemble des infrastructures routires ponctuelles comme les ouvrages dart (ponts, tunnels, etc.), les lments dexploitation et de maintenance (postes de gestion du trafic, centres dentretien, etc.), les infrastructures daccompagnement (aires de ravitaillement, etc.), etc. Les infrastructures de transport destines dautres modes (cyclistes, bateaux, trolleybus, etc.) sont aussi exclues de cette tude Site banal Voirie amnage pour la circulation concomitante ou alterne de plusieurs modes de transports. Cette dfinition exclut ainsi de cette tude les sites propres relatifs un seul mode de transport (mtro, chemin de fer, etc..) Par extension, de nombreux domaines voisins des infrastructures routires, tels que les infrastructures de transports en site propre denvergure, comme les lignes de chemins de fer grande vitesse, ou les projets damnagement forte incidence spatiale sur le territoire, notamment lensemble des projets damnagements linaires (canaux, ligne lectriques, etc.), peuvent tre concerns par la thmatique dveloppe dans ce travail de doctorat. La problmatique de la voirie urbaine, compose certes dlments dinfrastructures routires linaires (rues) mais comportant de nombreux amnagements ponctuels (nuds routiers, places, etc.) nentre pas directement dans le cadre de ltude. Mme si les projets dinfrastructures routires en site banal ne constituent dsormais quune minorit des projets routiers, du moins en Suisse, les principes dvelopps dans cette thse intressent lensemble des projeteurs routiers car ils traitent des rapports entre les acteurs et de la problmatique de laide multicritre la dcision.
Pour cette tude, les infrastructures autoroutires sont considres comme faisant partie de cette catgorie dinfrastructures routires. Cette prcision est ncessaire, certains auteurs classant les autoroutes dans le domaine des infrastructures de transport en site propre, car elles sont rserves uniquement la circulation des vhicules motoriss pouvant atteindre une vitesse de 60 km/h La planification a un sens plus gnral que la conception. Il sagit des bases ncessaires llaboration de plans directeurs, de politiques de transport, etc. tandis que la conception concerne plus un projet dfini
PROBLEMATIQUE
1.2
S TRUCTURE DE L ' ETUDE
1.2.1
Description des chapitres
Le prsent document est organis en 10 chapitres, comme prsent dans le tableau suivant : N
Rsum Table des matires et index Avant-propos
Titre
Franais / Anglais
Thmes traits
Problmatique
Cadre et structure de la thse Typologie des problmes rencontrs Description et analyse de la problmatique
Les tudes de cas
La comparaison de variantes ralise en 1999 pour la route principale suisse A 144 reliant les localits de Villeneuve et du Bouveret, dans le secteur Rennaz Les Evouettes, a t tudie en profondeur Prsentation du cadre de ltude et du contexte historique Description fouille du droulement de la Comparaison de variantes 1999 : sances de travail, ractions mdiatiques, rsultats et travaux futurs Analyse de la Comparaison de variantes 1999 et commentaires Description plus sommaire de quelques autres cas
Les besoins et les objectifs des infrastructures routires
Typologie des besoins sociaux (individuels et collectifs), environnementaux et conomiques Mise en uvre dune politique publique Les politiques publiques spcifiques aux infrastructures amnagement du territoire, transport et environnement routires :
La mobilit : faits, volution, avantages et inconvnients, perspectives Description des besoins spcifiques lis aux infrastructures routires : classification conventionnelle, hirarchisation du rseau, standard et norme
Llaboration du projet routier
Distinction entre la mthodologie et la procdure du projet routier Cycle de vie dune infrastructure routire Typologie des projets routiers Description complte des tapes du processus dlaboration du projet Prsentation de la procdure selon les normes suisses et de quelques procdures particulires en France et en Suisse Analyse critique et propositions de lutilisation de la procdure existante modifications : amlioration de
Les acteurs du projet routier
Classification et description des diffrents acteurs du projet routier Relations et rapports de forces : triangle de fer, coalition ou confrontation Projeteur et dcideur : composition, mthode de travail, reprsentativit Analyse des acteurs de la Comparaison de variantes 1999 : analyse de situation et analyse des pondrations avec profils dacteurs reprsentatifs
Structure de l'tude
N 6
Titre
Le dveloppement durable
Thmes traits
Le dveloppement durable : rappel historique, dfinitions La mobilit durable Le dveloppement durable dans le domaine des infrastructures routires : laboration dune stratgie de transport durable Le dveloppement durable dans le projet routier : concertation en amont, considrations multicritres et prise en compte du long terme Critre dveloppement durable : transversal ou spcifique ?
La concertation
La participation du public au sein du processus dtude Dfinitions : information, consultation et concertation Typologie de lensemble des mthodes de concertation : dfinitions, principes et domaines dutilisation, avantages et inconvnients, propositions Cette typologie est synthtise sous forme de fiches pratiques places en annexe Rgles dapplication de la concertation Avantages et limites de la concertation
Laide multicritre la dcision
Dfinition des outils de travail du projeteur routier Laide la dcision : objectifs, principe, subjectivit et objectivit, absence doptimum Le dcision et le dcideur : principes, facteurs dinfluence Mthodes dagrgation complte et agrgation partielle Synthse des mthodes dagrgation partielle existantes : Electre I, II, III, IV, IS et Tri Dfinitions : indicateurs, notes, pondration Les mthodes daide multicritre la dcision et le projet routier : proposition dutilisation dune mthode Electre III, sparation des oprations dvaluation et de pondration Application au cas de la Comparaison de variantes 1999 Les systmes dinformation rfrence spatiale (SIRS) : dfinitions et principes Utilisation des SIRS dans les projets routiers : principes, avantages et inconvnients Gnration de variantes : plan de contraintes, couloirs de moindre valeur, automatisation de tracs prfrentiels valuation de variantes : lien avec les mthodes daide multicritre la dcision
Une mthodologie actualise
Rcapitulation des postulats Description de la mthodologie concertative du projet routier sous la forme de diagrammes de flux Prospective Mise en application pratique Conclusion finale du travail de thse
10
Conclusion et perspectives
11 12
Bibliographie Annexes C.V. de lauteur
180 rfrences sont prsentes ici Quelques exemples de fiches pratiques dcrivant des mthodes de participation publique sont prsents en annexe
Tableau 1
Structure du rapport de thse
10
PROBLEMATIQUE
1.2.2
Principe des postulats
La ralisation de cette tude est base sur de multiples lments provenant de sources diverses comme lanalyse de cas, des entrevues, la synthse de documents, des rflexions personnelles, etc. Au fur et mesure de la rdaction de ce document, certains de ces lments vont apparatre comme tant des notions primordiales de la ralisation dun projet routier acceptable et de qualit. Il sagira par consquent de souligner leur importance au sein du texte. Cette mise en vidence des ides fortes et des rgles respecter imprativement dans un projet routier pour en assurer les conditions de succs se fera par le biais de ltablissement de postulats. Dans cette tude, un postulat est entendu comme tant un principe premier, dmontr ou admis comme tel, et non comme la dfinition parlementaire helvtique !6 Les postulats seront mis en vidence dans le rapport de thse par une prsentation particulire de leurs noncs. Ils seront placs dans un encadr, la suite des paragraphes contenant la rflexion et lanalyse qui ont mens les tablir. Un exemple de cette mise en forme distincte des postulats est prsente ci-dessous : Postulat 00
Ceci est un exemple de postulat
Les postulats seront finalement regroups et comments dans le chapitre 9.2. Ceci permet de poser un regard synthtique sur la totalit des postulats ainsi agrgs. Ltablissement des postulats se ralise de la manire suivante : rdaction initiale du texte de l'tude premire lecture et analyse des notions dveloppes mise en vidence des notions importantes tablissement et mise en forme des postulats au sein du texte complment rdactionnel seconde lecture du texte agrment des postulats synthse et commentaires des postulats la fin du rapport de thse au sein dun chapitre rcapitulatif et spcifique
Vu qu'un parlementaire transmet au pouvoir excutif aprs qu'il a t approuv par la majorit de l'assemble
Structure de l'tude
11
Les postulats sont des ides qui peuvent tre de nature diffrente. En effet, on y rencontre des notions : existantes : il sagit de notions qui sont rappeles et raffirmes, soit parce quelles sont dune importance capitale pour le projet routier, soit parce quelles ne sont pas forcment toujours respectes dans la procdure malgr la connaissance de leur importance synthtiques : il sagit de notions voisines qui sont agrges dans un souci de clart et de comprhension innovantes : il sagit cette fois de notions nouvelles dans le domaine des projets routiers. Elles peuvent tre totalement innovatrices ou elles peuvent provenir de notions existantes dj considres dans dautres domaines dactivit mais qui ne sont pas ou trop peu appliques dans le domaine concernant ltude
Ltablissement des postulats se base sur de nombreuses sources qui peuvent tre : des rflexions, de lauteur ou de tiers, bases sur la synthse et lanalyse du matriau de rfrence de l'tude, savoir : documentation, entrevue, tude de cas, etc. des expriences menes avec succs ou non dans le domaine du projet routier ou dans dautres domaines
Ces postulats concernent le domaine des projets dinfrastructures routires, mais comme il a t dit auparavant, ils peuvent aussi provenir de domaines connexes.7 La figure suivante prsente les diffrentes sources possibles pour ltablissement des postulats.
Projet routier Expriences RflExions
domaine connexe Expriences RflExions
Existantes
Notions ...
Figure 1
7
Synthtiques
Innovantes
Diffrentes sources des postulats
Domaine qui a des rapports de similitude ou de dpendance avec quelque chose, le projet routier en loccurrence
12
PROBLEMATIQUE
1.2.3
Risques viter
Cette tude traite dune problmatique particulire (les projets dinfrastructures routires) sinsrant dans un domaine vaste (le territoire et la mobilit), complexe (multiples acteurs et domaines concerns) et changeant. Il sagit ici de prciser les limites et les attentes du travail effectuer pour mieux cerner la problmatique. Pourquoi un tel titre qui semble exprimer finalement une certaine prudence, voir de la crainte ? Ceci vient essentiellement du fait que ltendue de la problmatique traite reprsente un grand risque de dispersion si le domaine dtude (thmes traits et niveau de dtail de lanalyse) est mal cadr. Dans cette tude, il sagit dviter les risques suivants : il faut se garder dtudier peu de sujets en profondeur (risque dune tude de dtail oubliant de traiter la globalit), sans pour autant raliser des tudes sommaires sur beaucoup de sujets (risque de superficialit) il ne faut pas avoir peur de rater quelque chose, cest dire que lexhaustivit est impossible ici. Dans une premire phase, le maximum dinformations sera rassembl mais il est impossible de vrifier tout ce qui concerne ce sujet dans le monde. Ceci serait une tche norme et finalement impossible raliser de nombreux spcialistes des diffrents domaines abords auront une plus grande connaissance de certains sujets et il ne faut pas tomber dans la tentation de tenter dacqurir leur niveau de connaissances. Le but dune telle tude est de synthtiser, pas de se multi-spcialiser faut-il tre Suisse, Europen ou International ? Les projets routiers sont diffrents selon les cadres administratifs dans les limites des quelles ils voluent. Si lon restreint ltude au seul au cadre helvtique, il y a un risque dtre trop local et lon nglige les expriences trangres intressantes. Si lon veut traiter de nombreux projets dans le monde, lon se heurte des pratiques et des rgles inconnues, ce qui reprsente un risque de mconnaissance des problmatiques de par son tendue, ce sujet comporte de nombreux domaines o il y a eu, il y a et il y aura des recherches et des thses effectues. Il faut viter la redondance des tudes et tre suffisamment prcis sur le thme de la prsente recherche pour pouvoir en exprimer la spcificit il ne faut pas procder uniquement un travail dinventaire et de synthse de lexistant mais proposer des nouveauts et des synthses novatrices il ne faut pas tomber dans la tentation de la normalisation. Les projets dinfrastructure routires ont des spcificits propres chacun et il ne sagit pas dtablir un catalogue o lingnieur cherche de prime abord situer son projet il sagit aussi dviter de tout remettre en question, rinventer la roue en quelque sorte, mais de tirer le meilleur de ce qui existe et damliorer ce qui peut ltre il ne sagit pas se focaliser sur des tudes de cas mais de gnraliser. Les tudes cas sont conserver comme exemples et pour vrifier laspect pratique de ltude : elles sont au service de la thse et non le contraire ! une grande tche est de vaincre les habitudes. Lexprience est parfois un atout, mais peut parfois se rvler castratrice de limagination et de la rflexion
Structure de l'tude
13
1.2.4
Conditions de pertinence de l'tude
Ce chapitre a pour objectif de justifier la pertinence du thme trait.8 A mes yeux, la problmatique la base de cette thse de doctorat se doit de remplir un certain nombre de conditions, savoir : Thmatique actuelle Les solutions proposes doivent permettre de rsoudre des problmes existant actuellement et qui ont une perspective dvolution court ou moyen terme ne montrant que peu de changements et damlioration possibles. Il ne sagit donc pas ici de raliser un travail dhistorien analysant des procdures passes mais plutt de procder une mise en pratique actualise de diverses notions thoriques ou pratiques et doprer une rflexion prospective Nombreux acteurs concerns Il est ncessaire de proposer des solutions adaptes aux multiples acteurs concerns par cette problmatique, mme si laccent sera plus particulirement port sur quelques uns comme le projeteur routier. Il ne sagit pas dune tude cible sur un crneau dacteurs trs troit mais dune tude sadressant au plus large public9 possible Intgration de plusieurs disciplines scientifiques La prsente tude se doit dintgrer plusieurs disciplines scientifiques dans ses rflexions et analyses, afin de proposer des solutions globales et non sectorielles. Seul cette optique assure une prise en compte optimale de la complexit de la problmatique Frquence Il est ncessaire de proposer des solutions une problmatique qui apparaisse rgulirement dans le temps ou dans lespace pour viter de traiter un cas isol Variabilit Il sagit dviter de rdiger une thse qui ne soit valable que pour des conditions bien dfinies, voir unique ou mme pire, non-reproductible lenvi Aspects pratiques et thoriques Les rponses la problmatique apportes par la thse ne doivent pas tre uniquement dessence thorique mais doivent donner des solutions utilisables par le praticien. Laspect pdagogique des propositions dveloppes dans cette tude sera aussi important afin de pouvoir les intgrer au mieux au sein de lenseignement dispens lEcole Polytechnique Fdrale de Lausanne
Cette pertinence a t dj t reconnue, vu que le sujet propos a fait lobjet dune acceptation par un jury de lEPFL Ensemble de la clientle vise ou atteinte par un mdia ou qui s'adresse un crit
14
PROBLEMATIQUE
1.3
L A PROBLEMATIQUE DES PROJETS ROUTIERS
Ce chapitre 1.3 traite globalement, et de manire relativement sommaire, de la problmatique lie aux projets dinfrastructures routires. Celle-ci est en effet la base de la ralisation de cette thse, ce travail de doctorat nayant finalement quun unique objectif : proposer des solutions permettant de rsoudre les problmes inhrents au projet routier. Certains aspects plus intressants de cette problmatique seront repris et dvelopps dans des chapitres spcifiques de cette tude.
1.3.1
Prambule
Les deux exemples suivants illustrent, de faon parfois caricaturale, certains aspects de la problmatique des projets routiers.
Autoroute du Sud-Lman A400 et route Villeneuve - Le Bouveret A144
TOUT LE MONDE COUCHE SUR SES POSITIONS !
Dix ans de perdus! Sur ce point, cologistes et lus locaux sont d'accord. Mais les premiers rclament l'abandon du second projet aprs le veto parisien au premier. Rien voir, ripostent les lus suisses: la A144 est d'abord une ncessit locale. Et leurs homologues franais s'apprtent remonter au crneau. <> Il faut raccorder l'extrme Bas-Valais au Chablais vaudois, rapprocher et consolider le Chablais par une liaison directe au rseau des routes nationales. nonce par le conseiller d'Etat valaisan Bernard Bornet, c'est la conclusion d'une rencontre, le 26 mai 1993 Villeneuve, des Gouvernements vaudois et valaisan. Une conclusion derrire laquelle lus et dlgus conomiques du Chablais vaudois et valaisan serrent aujourd'hui les rangs. La A144 a 30 ans de retard, martle le dlgu conomique du district d'Aigle Ren Perret. La liaison actuelle est obsolte, inefficace, dangereuse et polluante. Elle ne suffit plus dbiter le trafic <> J'invite les opposants sjourner avec leur famille quelque temps Noville ou aux Evouettes! <> HALTE A UNE A144 PHARAONIQUE ! Tout autre son de cloche ct cologiste! Le 28 mars au soir, le Conseil lmanique pour l'environnement, qui regroupe sept associations, demandait de renoncer aux projets pharaoniques ct valaisan et vaudois. <> RETARD : A QUI LA FAUTE ? Les cologistes couchent sur leurs positions? Le dput lausannois Pierre Santschi n'en disconvient pas: Aprs la partie de ping-pong des btonneurs suisses et franais, le bon sens a triomph. Que le Conseil d'Etat vaudois arrte de jeter de l'argent par la fentre pour des variantes pharaoniques! Nous sommes les seuls avoir eu une politique raisonnable ds le dbut, il n'y a pas de raison de changer son fusil d'paule! L'A 400 et la A144 ne sont pas lis? C'est de la mauvaise foi et du double langage! Et de dnoncer l'norme irresponsabilit des notables vaudois vouloir s'acharner sur une variante pharaonique. A vouloir couler du bton au lieu de rsoudre les problmes, ils ont pris dix ans de retard! <>
Figure 2
Extrait dun article paru le 9 avril 1997 dans le quotidien rgional La Presse Riviera-Chablais (Wichser F., 1997)
La problmatique des projets routiers
15
ASSEZ DE BITUME, DE BETON, DE FERRAILLE... !
Massacre des paysages, bruit infernal, habitats invivables, pollution, dvalorisation des biens, expropriations... trop longue est la liste des dsastres provoqus par la croissance dlirante des transports routiers qui rclame des routes toujours plus larges, toujours plus de dviations, toujours plus dautoroutes. Les grandes infrastructures de transport routires et autoroutires sont des incitations laugmentation infinie du trafic. Il faut les combattre en elles-mmes, en refusant les manuvres de concertation et de manipulation proposes par les btonneurs sur tel ou tel projet. Face ce dferlement, nous exigeons que ceux qui dtiennent le pouvoir tatique mettent fin leur collusion avec les groupes de pression de la route. Jean-Claude Gayssot, ministre des transports, na rien refuser aux transporteurs routiers. Ils surexploitent leur personnel ? On les laisse violer impunment la lgislation du travail et les rglements de scurit. Ils polluent ? On leur fait payer le gasoil moins cher quaux autres usagers, ce qui encourage le trafic, alors quil faudrait au contraire satteler le faire diminuer. Il serait lgitime de mettre sur la paille des milliers de salaris pour dvelopper les profits des firmes capitalistes, et il serait impensable de briser les reins de certains marchands et industriels ? Cest bien justement ce que nous exigeons : que nos dirigeants mettent au pas transporteurs et btonneurs. Ces choix gouvernementaux, qui se refusent dans les faits tenter de matriser les flux, et les rquilibrer au profit du rail, sont aussi ceux du renoncement toute organisation urbaine rationnelle. Sous lempire de la spculation, on laisse prolifrer le chaos des banlieues, leur dferlante de hangars commerciaux agressifs et de mares pavillonnaires. Cest pourquoi nous exigeons aussi une politique damnagement du territoire libre des diktats des intrts marchands et mafieux qui imposent aujourdhui leur loi dans tous les domaines de la vie sociale.
POUR LARRET IMMEDIAT DU PROGRAMME AUTOROUTIER ! POUR UNE POLITIQUE DES TRANSPORTS SOUCIEUSE DE LINTERET PUBLIC ! POUR UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE QUI CESSE DE DETRUIRE LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE !
Figure 3 Ptition de protestation contre la politique autoroutire franaise publie sur le site du Comit contre la frnsie autoroutire (CCFA, 2000)
Ces deux exemples, prsents ici pour illustrer la thmatique traite, nont pas la prtention dtre reprsentatifs de lensemble de la problmatique. Ils sont cependant assez typiques du climat de travail que lon peut rencontrer parfois dans des projets dinfrastructures routires. Comme le montrent ces deux exemples, les projets dinfrastructures routires peuvent entraner de vives polmiques, susciter quelquefois de violents rejets et entraner la proclamation danathmes particulirement vindicatifs. Lobservation des mdias crits ou audiovisuels permet de constater quil nest pas rare dy voir apparatre des articles et des sujets traitant de projets dtude dinfrastructures routires. Souvent, mais pas de manire unique heureusement, ceux-ci sont abords par leurs aspects problmatiques :10 blocages, conflits, polmiques, etc. On peut, la lecture de la plupart de ces projets problmes , y dceler une analogie avec les feuilletons tlviss si populaires : les acteurs sont multiples, les positions de chacun sont parfois connues davance ou clairement identifiables, il y a la possibilit de rater plusieurs pisodes sans forcment perdre le fil
10
Comme le dit ladage les gens heureux nont pas dhistoires et ne font donc que peu ou pas lobjet dun traitement mdiatique, pour des raisons plus ou moins louables et comprhensibles. Ainsi, il est clair quune analyse de la problmatique des projets routiers base uniquement sur une approche mdiatique est quelque peu biaise, car il en ressortirait surtout les aspects ngatifs et problmatiques de ces projets.
16
PROBLEMATIQUE
de lhistoire, les rebondissements du scnario sont multiples et maintiennent les intresss en haleine, la fin semble parfois insaisissable, etc. Et, contrairement certains de ces divertissements tlvisuels, il ny a pas toujours un happy end ! Les projets routiers sont-ils si problmatiques que leur destin est de devenir systmatiquement une source de conflits ? Nassiste t-on pas plutt la lumire de ces traitements mdiatiques une certaine surestimation ou une exagration des problmes ? La rponse nest pas vidente, mais il ne sert rien de se voiler la face et dembellir la situation : les projeteurs rencontrent de nombreux obstacles dans ltude des projets routiers. (Tille M., 1999a) Et finalement, les mdias ne font que reflter cet tat problmatique, certes parfois en lexagrant ou en occultant certains aspects positifs. Ce constat des problmes lis au projet routier, bas sur quelques articles pris au hasard sans une dmarche de recherche rationnelle et sur des impressions personnelles, ne peut bien entendu pas servir de fondement scientifique une analyse de la problmatique. Lobjectif des deux chapitres suivants sera de classifier et danalyser de manire rigoureuse les diverses facettes de celle-ci. Il est noter que cette problmatique du projet routier, qui tend allonger les dlais de planification et faire augmenter les cots de ralisation, dpasse les simples soucis des acteurs directement lis au projet (ingnieurs civils, spcialistes techniques, etc.) ou concerns par ses effets (riverains, usagers, etc.)11 pour devenir un dbat de socit suscitant de plus en plus lintrt du monde politique. Cet tat de fait est illustr par exemple par le rapport de 1997 de la Commission de Gestion du Conseil national qui sest inquite de laugmentation des cots de construction des routes nationales et de lallongement de la dure des tudes. (CGCN, 1997) En raison de la varit des contextes environnementaux, sociaux ou procduraux, les projets dinfrastructures routires possdent des caractristiques trs diffrentes. Il serait ainsi tentant de dcrter lunicit de chaque projet mais on peut nanmoins remarquer que certaines difficults sont rcurrentes dans plusieurs cas. Lanalyse de la problmatique se basera sur une catgorisation des principaux problmes rgulirement rencontrs par les projeteurs routiers. Cette analyse seffectue en deux phases distinctes : Tout dabord, dans le chapitre 1.3.2, on ralise un relev descriptif des catgories de problmes observs dans les projets routiers. On ne recherche nullement lexhaustivit, tout en tant le plus large possible, et il ny a pas ici une volont dtablir une hirarchisation quelconque des complications rencontres par le projeteur. Il sagit l dune description des effets de la problmatique. Ensuite, dans le chapitre 1.3.3, une analyse des sources de la problmatique est ralise. Ici, par contre, ltude tente de hirarchiser les origines des difficults lies ltablissement des projets dinfrastructures routires et elle les analyse sommairement. Il sagit l dune description des causes de la problmatique.
11
Le chapitre 5 Les acteurs du projet routier dcrit lensemble de ces diffrents acteurs
La problmatique des projets routiers
17
1.3.2
Typologie des problmes rencontrs
Par le terme de typologie, on entend ltude des traits caractristiques dans un ensemble de donnes, en vue d'y dterminer des types ou des systmes. Voici quelques-uns12 des principaux problmes rencontrs dans llaboration des projets dinfrastructures routires : Allongement des dures dtude Ltude dun projet dinfrastructure routire est un travail de longue haleine qui stend depuis la prise de conscience de la ncessit de raliser une route jusquau dbut de lexcution des travaux, excluant ainsi la dure de ralisation. Il sagit en effet de tenir compte de multiples lments, de faire intervenir de nombreuses personnes dans la dmarche dtude et de procder par itrations successives. Cependant, de plus en plus, la dure de ce genre dtude prend parfois des proportions inquitantes. (Hayoz N. et Urio P., 1993) Quand la dure dtude dun projet commence sexprimer en dcennies, et non plus en annes, il apparat de plus en plus difficile de raliser une infrastructure tenant compte au mieux du contexte, alors que celui-ci se modifie plus rapidement que ltude. Par exemple, on risque alors de baser ltude sur des informations obsoltes ou de proposer des solutions une problmatique qui nont plus dintrts car cette dernire a disparu. Postulat 01
La dure dtude dun projet routier doit tre en relation avec le rythme des changements du contexte dtude
Fractionnement des tudes Lallongement des dlais dtude des projets naboutit pas forcment de meilleurs projets. En effet, le temps supplmentaire ainsi consacr ne sert pas ncessairement amliorer lensemble du projet mais est plus souvent consacr la rsolution de conflits portants sur des lments particuliers de celui-ci. On observe par consquent une tendance donner de limportance des tudes de dtails, parfois menes isolment, tandis que la globalit du projet nest plus considre comme une base de rflexion. Il est aussi relever que lagrgation doptimums localiss obtenus par la ralisation dtudes sectorielles indpendantes les unes des autres namne pas forcment un optimum global. Postulat 02
Des tudes fractionnes et menes indpendamment permettent que difficilement daboutir un optimum global ne
12
Comme dcrit auparavant, on ne tente pas au chapitre 1.3.2. dtablir une liste exhaustive des problmes rencontrs
18
PROBLEMATIQUE
Prdominance des intrts particuliers La notion de lintrt public, qui permet de restreindre certaines liberts individuelles quand celles-ci pnalisent la ralisation dun bien profitant la collectivit, est de plus en plus remise en cause au profit de la dfense des intrts particuliers. Si la protection de lindividu, qui est souvent isol face une administration publique ou une entreprise disposant de moyens financiers et techniques suprieurs, est louable, les excs qui en dcoulent sont manifestes. Une pese des intrts entre dune part les individus et dautre part la socit semble priori quitable, mais ceci cache souvent en fait un dsquilibre car le nombre de bnficiaires nest de loin pas identique de part et dautre. Il sagit donc de sassurer de la proportionnalit des effets des mesures, comme dfini dans larticle 17 de la LPE, (LPE, 1983) en tenant compte de leur efficacit (taux dobjectifs atteint) et de leur efficience (rapport entre le cot de la mesure et le bnfice obtenu). (Egger M., Roth G. et al., 1998) Postulat 03
Le respect du principe de proportionnalit (LPE, art.17) dune mesure propose est vrifi par son efficacit et son efficience
Rapports conflictuels entre les acteurs du projet Le climat dtude rgnant entre les diffrents protagonistes du projet routier nest parfois pas serein : rapports tendus, mauvaise foi manifeste de certains acteurs, liens de confiance rompus, dfense des intrts particuliers ou sectoriels au dtriment du bien collectif, refus de la concertation, (CCFA, 2000) etc. Il parat difficile alors darriver concevoir un projet accept par tous quand initialement les diffrentes composantes du groupe dtude ne sentendent pas entre elles. Faute dentente entre les acteurs du projet, les diffrends doivent se rsoudre parfois devant la justice. On assiste aussi trop souvent des querelles entre des services administratifs censs dfendre le mme intrt commun. (CGCN, 1997)
Intervention du pouvoir judiciaire Le dcideur, qui est gnralement un acteur politique, base sa dcision sur des lments dapprciations apports par le projeteur. Parfois, cause du mauvais climat dtude qui rgne, la pese des intrts contradictoires quil ralise lui chappe pour tomber dans le domaine judiciaire. (CGCN, 1997) Ceci tend rallonger la dure de ltude, qui dpend alors dlments extrieurs, et engorger fortement les tribunaux avec des procdures qui auraient pu tre rsolues, et qui auraient d ltre, dans un autre cadre. Le dveloppement de larsenal lgislatif destin protger lenvironnement (LPE, 1983) et assurer au citoyen une meilleure prise en compte de ses intrts particuliers complexifie fortement la procdure dtude et participe aussi nettement lapparition des aspects juridiques dans un domaine priori technique.
La problmatique des projets routiers
19
Augmentation des cots de ralisation A lanalyse des diffrents cas tudis par la Commission de gestion du Conseil National, on remarque une tendance laugmentation des cots unitaires des ralisations routires actuelles par rapport celles ralises il y a deux ou trois dcennies, en valeur actualise bien entendu. (CGCN, 1997) Cette diffrence peut tre impute de nombreux paramtres comme les conditions topographiques diffrentes,13 la progression de lurbanisation,14 aux nouvelles lois de protection de lenvironnement, etc. Cependant, lallongement de la procdure, consquence gnralement dun manque de concertation, est un facteur important daugmentation de ces cots. Comme le dclare le conseiller national P. Tschopp, qui tait alors prsident de la CGCN, le consensus ncessaire lapprobation des projets routiers est souvent achet coups de milliards . (Miville D. S., 1997) Ces considrations conomiques ne sont pas ngliger, dautant plus dans une priode o lquilibre des finances publiques est difficile atteindre.
Issue des projets incertaine Quand le projet a une gestation si difficile, quil est bloqu dans dinterminables procdures juridiques, il arrive parfois que ses initiateurs doivent labandonner, soit de manire dfinitive ou en le renvoyant aux calendes grecques, ou fortement le modifier, quand bien mme leur projet rpondait un besoin public avr.
Solution insatisfaisante Quand une solution est trouve, elle est toujours le fruit dun compromis, cest dire quelle reflte le rapport de force des acteurs. Il sagit dune notion qui est trs diffrente de la recherche de loptimum et qui naboutit pas forcment une solution idale . De plus, souvent la solution est viable court terme mais le bilan long terme, lhritage laiss aux gnrations futures, nest pas considr (cot et facilit dentretien par exemple). Postulat 04
Lobtention dun compromis, reflet prsent des rapports de force entre les diffrents acteurs du projet, nest pas garant de lobtention dune solution optimale, tenant compte notamment des principes du dveloppement durable
13 14
Le rseau autoroutier suisse a par exemple dabord t ralis dans les zones topographie douce La demande de zones constructibles tend rarfier les terrains bons marchs et la progression des surfaces habites diminue fortement les zones situes distance des habitations, qui sont gnralement des zones prfrentielles pour implanter des routes diminuant les nuisances sur lenvironnement humain
20
PROBLEMATIQUE
1.3.3
Facteurs de la problmatique
On peut lgitimement se poser la question de savoir si les projets dinfrastructures routires, qui prsentent un important potentiel de difficults, sont systmatiquement gnrateurs de conflits. Assurment, la rponse est ngative, mais force est de constater que cela nest pas forcment le cas, pour de multiples causes qui restent identifier. On peut alors se poser la question suivante : Quels sont les principaux facteurs qui reviennent le plus souvent comme source du problme, sachant que chaque projet a finalement ses propres caractristiques ? . Rpondre cette question, cest dj poser les jalons des solutions. Cette analyse des principales causes, ou facteurs, de la problmatique a dj t ralise par de nombreuses personnes, comme notamment (Molines N., en prparation) ou (Tille M., 1999a). Il est souligner aussi que ces conflits relatifs la ralisation des infrastructures routires sont souvent amplifis en raison de la conjonction de plusieurs de ces facteurs, qui ne sont rarement dcisifs quand on les considre sparment. Lanalyse de la problmatique des projets dinfrastructures routires fait ressortir les principaux facteurs de causalit suivants : Nombreux domaines affects Les projets dinfrastructures routires de part leurs influences directes (emprise au sol notamment) et surtout indirectes (atteinte au paysage, fragmentation du territoire, bruit, etc.) sur lenvironnement naturel et humain affectent, positivement ou ngativement, de nombreux domaines, o interviennent autant dacteurs diffrents. Ces diffrents domaines ont des objectifs divergents et parfois opposs, qui, combins, peuvent tre trs contraignant pour le projeteur. Il lui est alors difficile, voir impossible, de proposer un projet qui soit optimum pour chacun deux, do la ncessit d'avoir une vision multicritre et globale pour llaboration du projet. Postulat 05
Une vision multicritre est indispensable pour tenir compte de la complexit de la problmatique des milieux affects par le projet routier
Multiples acteurs On entend par le terme de acteur du projet ou main participant , (Knoepfel P., 1993) lensemble des individus et des personnes morales qui participent llaboration du projet ou qui gravitent autour de celui-ci, mme avec un degr de participation nul. En fait, tout acteur du projet a une influence relle ou potentielle sur celui-ci, quelle soit reconnue ou non. Les multiples acteurs ont des cultures techniques, des fonctions et des objectifs diffrents. Il est donc difficile de faire communiquer et se comprendre des acteurs qui voluent dans des schmas de penses, ou systmes de valeurs, distincts ou mme opposs. (Molines N., en prparation)
La problmatique des projets routiers
21
Une autre problmatique lie aux acteurs du projet routier est que les personnes bnficiant dune route ne sont gnralement pas les mme que celles qui en subissent les inconvnients. Ainsi, si au niveau de la collectivit, les avantages dune route lemportent15 sur ses inconvnients, cette analyse risque souvent de ntre pas partage par certains acteurs, comme les riverains par exemple. Postulat 06
Les bnficiaires et les victimes dune route ne sont pas les mmes acteurs
Socit en volution La socit actuelle est en pleine mtamorphose et le sens des valeurs, les attentes sociales des individus, se modifie. (Besnanou R., 1999) Ainsi, le rapport hirarchique du citoyen, qui smancipe et devient plus versatile, par rapport lautorit nest plus aussi fort. Cest ce que N. Molines dsigne par le terme de crise du systme dcisionnel . La volont de transparence des dcisions et le besoin dinformation sont devenus importants pour lacceptabilit de tout projet denvergure. (Molines N., en prparation) De ce fait, lorganisation de la socit se modifie et le relais des dsirs et des besoins des citoyens ne passe plus forcment travers le systme politique traditionnel (lus locaux) mais plutt par le biais de rseaux dorganisations ou dassociations. Ces rseaux sont plus ou moins bien structurs et ils peuvent tre permanents (associations de protection de lenvironnement) ou nexister que pour un seul projet particulier (association de riverains).
Nouveaux paradigmes Le dveloppement conomique continu de la socit librale, et notamment la forte augmentation de la mobilit qui lui est lie, accentue les impacts sur lenvironnement naturel et humain. La constatation des limites de cette croissance associ limprieuse ncessit de modifier nos comportements entranent une prise de conscience environnementale de plus en plus gnralise au sein de la population. Ce phnomne favorise lapparition de nouveaux paradigmes socitaux, comme celui du dveloppement durable, o la croissance conomique est associe un niveau de vie de qualit et un environnement naturel prserv. La participation des citoyens aux projets dinfrastructures, par le biais de la concertation, est clairement lun des lments de ce nouveau paradigme. Lhomme dtude se doit dintgrer dans son projet lensemble des acteurs concerns et la transparence des dcisions est indispensable. La mise en balance des intrts contradictoires, qui est base sur un examen multicritre de la problmatique, est aussi une partie intgrante du dveloppement durable. Ceci limite les excs constats dans le pass pour certains projets routiers o seul un aspect, conomique ou environnemental, tait considr aux dpens dautres intrts. Laspect multidisciplinaire amne aussi intgrer diffrents acteurs.
15
Si ce nest pas le cas (plus dinconvnients que davantages), la ralisation de cette route nest pas opportune et ne devrait pas tre envisage
22
PROBLEMATIQUE
Mthodes de travail inadaptes Les mthodes de travail utilises dans ltude des projets routiers n'ont pas forcment suivi l'volution des attentes des acteurs. Le manque de transparence de certaines dcisions lors de llaboration du projet donnant aux acteurs extrieurs le sentiment dune tude mene en secret sans eux et surtout contre eux, la mauvaise volont ou la difficult des hommes dtudes communiquer avec des acteurs non techniques, lutilisation de technologies dinformation dpasses, sont autant dlments favorisant lchec dun projet. Postulat 07
Lacceptation dun projet auprs dune population fortement de la politique de communication adopte dpend
Procdure rigoureuse Les projeteurs doivent voluer dans un cadre de procdure lgislative trs rigoureux, au risque sinon de voir leur opration tre annule pour vice de forme. (Cabioch F., 1997) Ainsi, la procdure, qui ne sadapte que peu aux cas et qui na aucune souplesse, correspond de moins en moins aux attentes des acteurs, do source de multiples incomprhensions. Parfois seule la mise lenqute publique, qui intervient vers la fin du projet, est disposition des acteurs pour que ceux-ci puissent exprimer leurs objectifs et leurs craintes.
En rsum, on peut remarquer quil existe trois grandes catgories de facteurs gnrateurs de problmes. Il y a en effet des facteurs qui sont lis la structure du projet : procdures, mthodes de travail, etc. lenvironnement du projet : multiples domaines contraignants, etc. aux acteurs du projet : multiplicit des points de vues, travail du groupe dtude, crise du systme dcisionnel, etc.
Environnement
Acteurs
Projet
Figure 4
Catgories principales des facteurs gnrateurs de conflits dans les projets routiers
La problmatique des projets routiers
23
1.3.4
Conclusion
Lanalyse de la problmatique du projet routier dmontre bien quil est ncessaire de proposer une actualisation des mthodologies dtude. Il sagira de tenir compte des principaux points suivants dans llaboration de cette nouvelle mthode, que lon dsignera par le terme de mthodologie concertative du projet routier , terme dj propos par lauteur dans (Tille M., 1999a) : respecter les principes du nouveau paradigme du dveloppement durable favoriser la transparence des tudes par la concertation avec les acteurs adopter une dmarche de projet multicritre repenser la procdure du projet pour disposer de mthodes de travail souples et volutives utiliser les dveloppements mthodologiques rcents et innovants
Le projeteur routier na pas attendu la ralisation de cette tude pour modifier ses mthodes de travail. Il est cependant intressant de profiter de ce travail de doctorat pour, laune dexpriences intressantes menes dans le domaine routier ou des domaines connexes et de dveloppements mthodologique innovateurs, les repenser en profondeur. Dsormais, linitiative et linnovation doivent tre entre les mains du projeteur et il ne doit plus tre un acteur passif et passiste.
Prambule
25
2.
LES ETUDES DE CAS
2.1
P REAMBULE
Cette thse de doctorat a pour objectif principal dactualiser les mthodes de travail et les procdures utilises pour les projets dtude des infrastructures routires. Elle se base en consquence sur un thme minemment pratique. Le matriau de base de cette recherche sera donc fortement compos, mais pas uniquement, danalyses tires de divers exemples de projets routiers. La prsentation des tudes de cas a volontairement t place au dbut du rapport de thse. En effet, ces exemples sont ensuite voqus de multiples reprises dans les chapitres spcifiques de la problmatique, o ils font parfois loffice dun sous-chapitre propre. Comme il a t prcis la page 12, le nombre et la varit des projets routiers existants sont tels quil est impossible, voire utopique, de prtendre une parfaite exhaustivit. Il est donc ncessaire de procder un choix de certains cas intressants, choix qui se base sur les principes gnraux suivants : pertinence : il sagit de cas qui amnent quelque chose dintressant la thse (un postulat par exemple) actualit : il sagit de traiter de problmatiques actuelles, comme prcis au chapitre 1.2.4, page 13 cas positifs et ngatifs : il est important danalyser des checs, pour analyser les causes dinsuccs, mais aussi de traiter des russites, pour en retenir les lments susceptibles damliorer la procdure du projet documentation disponible : il est ncessaire de disposer de suffisamment de documentation pour analyser le cas, ce qui vite un jugement bas sur des prjugs ou des inexactitudes
Ainsi, plusieurs cas pratiques ont t tudis avec divers degrs dinvestigation. Le principal cas, que lon dsignera par la suite par le terme de cas de base est celui de la route principale suisse A 144 reliant les localits de Villeneuve et du Bouveret.16 Seul ce cas sera prsent en dtail dans cette thse. Les autres projets de rfrence seront simplement prsents de manire sommaire la fin de ce chapitre 2. De plus, le cas de base sert aussi une mise en application des principes dactualisation de la mthodologie du projet routier dfinis dans cette recherche, notamment en ce qui concerne les mthodes daide multicritre la dcision.
16
Il est expliqu au chapitre 2.2 lintrt particulier dtudier ce projet de la A 144 Villeneuve Le Bouveret
26
LES ETUDES DE CAS
On peut donc, en rsum, dire que pour cette thse, ltude des cas pratiques a privilgi laspect qualitatif, car les enseignements tirs des analyses effectues sont nombreux, de qualit et pertinents, laspect quantitatif, ce qui nvite pas le risque dun certain biais statistique vu le peu d chantillons analyss. Les divers projets dtude routier ont t analyss de diverses manires, savoir : cas de base : lauteur a pu participer pleinement au processus dtude, comme il sera prsent ensuite lecture de livres et entrevues : pour des projets dont la problmatique est plus importante et/ou situe en Suisse (proximit gographique des participants) lecture darticles (presse ou livres) : quand il sagit par exemple de projets situs dans des pays lointains ou que laspect qui est intressant pour la thse ne reprsente quune petite partie de celui-ci
2.2
C AS DE BASE : ROUTE PRINCIPALE SUISSE A 144 V ILLENEUVE L E B OUVERET
La liaison routire entre les localits de Villeneuve (canton de Vaud) et du Bouveret (canton du Valais) occupe les lus locaux ainsi que les services cantonaux et fdraux depuis de nombreuses annes17 sans qu'une solution consensuelle ait pu tre trouve. (Infraconsult, 2000) Cette voie de communication fait partie du rseau routier principal suisse et est dsigne par le terme de A 144.18 Le choix dun trac optimal pour cette route, notamment pour le secteur compris entre les villages de Rennaz (Vaud) et des Evouettes (Valais), tait impossible obtenir par le biais de la procdure de projet adopte, que lon peut classifier de procdure classique . Pour dbloquer la situation de quasi-blocage (Wichser F., 1997) dans laquelle se trouvait cette tude, une analyse multicritre comparative rassemblant lensemble des acteurs concerns a t mene sous la direction de lOffice Fdral des Routes (OFROU) durant lanne 1999. Elle a permis daboutir en septembre 1999 une proposition dun trac consensuel appel Solution COPIL .19 Jai eu le privilge dassister en tant quauditeur neutre aux diverses sances des groupes de travail chargs de mener bien cette tude. Je tiens tout particulirement ici remercier Messieurs Philippe Biler, conseiller dEtat en charge du Dpartement des Infrastructures (DINF) du canton de Vaud, et Bernard Daucher, ingnieur en chef du Service des Routes (SR) du DINF, pour avoir rpondu favorablement ma demande et de mavoir permis de participer cette tude. Comme on le verra par
17 18
La construction de cette route est prvue au niveau fdral depuis 1961 ! (Busslinger L., 2000) et (DINF, 2000a) Le terme A 144 est tir de lancienne dnomination des routes principales suisses (A : Alpes ; T : Plateau ( Tal en allemand); J : Jura) utilise par lOffice Fdral des Routes (OFROU). Depuis le 1er Janvier 2000, la lettre H (pour le terme allemand de Hauptstrasse signifiant route principale ) remplace lensemble de ces anciennes lettres. (DINF, 2000a) Cependant, dans un esprit de correspondance avec les documents utiliss pour la thse et les sances de travail suivies par lauteur en 1999, qui sont tous des lments antrieurs lanne 2000, la dsignation A144 sera prfre dans ce document au terme officiel de H144
19
COPIL : comit de pilotage
Cas de base : route principale suisse A 144 Villeneuve Le Bouveret
27
aprs, les renseignements tirs de ces nombreuses sances et des divers documents de travail ont fourni de nombreux lments utiles pour illustrer et tayer la thse. Dentente avec le directeur de thse, il a t dcid que cette analyse multicritre comparative mene sur la route A 14420 servirait de cas de base fournissant le matriau pratique principal ncessaire llaboration de cette thse. Les raisons qui ont amen ce choix sont les suivantes : possibilit offerte lauteur de participer sans aucune restriction, mis part un devoir de confidentialit, toutes les sances des groupes de travail politiques et techniques o taient prsents lensemble des acteurs potentiels dun projet routier tude mene relativement rapidement (fvrier septembre 1999) et aboutissant un rsultat concret (choix dune variante optimale et consensuelle), tout ceci durant le droulement de la thse de doctorat passage du climat de travail par plusieurs stades antagonistes : enthousiasme initial, conflit larv, conflit ouvert, tensions, entente finale, etc. position de totale neutralit en tant quauditeur, ce qui autorise la rcolte des avis et des opinions des diffrents acteurs sans a priori de leur part de par la position de lauteur au cur du processus, accs direct aux diffrents lments techniques de ltude, notamment les pondrations individuelles problmatique intressante dun projet tudi depuis de nombreuses annes sans aboutir une solution consensuelle et qui a pu tre finalement dbloqu cas actuel, la mise lEnqute publique ntant mme pas encore intervenue ampleur du projet intressante : ni trop petite, ce qui risque damener une problmatique trop particulire, ni trop grande, ce qui prsente le risque dtre trop superficiel ou alors de ncessiter une tude de longue dure
De nombreux lments tirs de cette Comparaison de variantes 1999 vont rapparatre transversalement tout au long de ce rapport de thse. Dans ce chapitre 2, cette tude sera dcrite dans sa globalit. Les points appels tre dtaills, car ils concernent des aspects particuliers de la problmatique, seront analyss dans les chapitres spcifiques. Il sagit notamment de la procdure, des acteurs, de lanalyse multicritre et de la concertation. Ce choix dun chapitre 2 assez gnral permet davoir une prsentation homogne du cas tudi. Lanalyse de la Comparaison de variantes 1999 est base sur diverses sources : rapport technique du comit de pilotage paru en 2000. (Infraconsult, 2000) Il sagit de la principale source et de nombreux lments seront tirs de ce document sans forcment tre systmatiquement rfrencs documents distribus aux sances de travail en 1999 : pr-rapport, procsverbaux des sances, plans, etc. notes manuscrites des sances tablies par lauteur (Tille M., 1999b) communiqus de presse du Dpartement des Infrastructures du Canton de Vaud (DINF, 1998, 1999b, 1999c, 1999d, 2000a, 2000b, 2000c) articles de presses
20
Dans la suite de la thse, cette tude sera dsigne par un terme plus succinct : Comparaison de variantes 1999
28
LES ETUDES DE CAS
2.3
C ONTEXTE D ETUDE ET PROBLEMATIQUE
Les caractristiques principales du contexte dtude et de la problmatique de la Comparaison de variantes 1999 sont dcrites succinctement dans ce chapitre 2.3. Cette courte prsentation est ncessaire pour mieux comprendre le cadre du cas tudi, mme si dans cette thse on sintresse plus laspect procdural de celui-ci (Comment ltude de la Comparaison de variantes 1999 a t-elle t mene ?) qu ses aspects techniques (Quel est le rsultat obtenu ?). Le lecteur intress par plus de dtails pourra toujours se rfrer au rapport technique publi. (Infraconsult, 2000)
2.3.1
Contexte gographique
La route principale suisse A 144 se situe au dbouch de la plaine du Rhne sur la rive sud du Lac Lman. Cette zone est au cur du Chablais Suisse qui stend sur les cantons de Vaud et du Valais. Il sagit dune rgion faisant partie du massif alpin, mais qui prsente cependant cet endroit des caractristiques topographiques fortement contrastes :21 une plaine alluviale, dune altitude variant de 370 380 m et dune largeur de 4 5 km, oriente perpendiculairement la rive des versants montagneux fortement escarps situs lest et louest de la plaine
Figure 5 Vue de la plaine du Rhne en amont du Lac Lman. La localit du Bouveret se situe en bas droite de limage (Swissair, 1995)
Le Rhne coule louest de la valle, proximit des parois rocheuses, comme au resserrement de la Porte du Scex.22 A lest de son embouchure, le delta du Rhne est une zone marcageuse prserve abritant une flore et une faune de qualit. Il sagit de la rserve naturelle des Grangettes.
Sur le versant est de la Plaine du Rhne se situe lautoroute A 9 qui est laxe routier principal entre le Valais et le Plateau Suisse. Ce canton prsente de nombreux ples gnrateurs de trafic : bassin de population de 275000 habitants fortement motoriss (2me taux de motorisation suisse), de nombreuses stations touristiques, des cols alpins transfrontaliers (Simplon et Grand Saint-Bernard) ainsi que des sites industriels (Lonza Vige, Novartis Monthey, etc.).
21 22
Lextrait de la carte topographique au 1 : 100'000 de la page suivante prsente cette zone dtude Lorthographe de ce lieu est parfois diffrent selon les cartes utilises. Nous utiliserons ici le terme Porte du Scex
Contexte dtude et problmatique
29
La A 144 est une liaison routire qui traversera la plaine du Rhne douest en est, ceci au sud de la rserve naturelle des Grangettes. Les limites extrmes de cet amnagement sont indiques sur la figure suivante : (Infraconsult, 2000) lest : le long de la route cantonale Villeneuve Aigle, au sud de la jonction autoroutire de Villeneuve (A 9) louest : portail Sud du futur tunnel servant contourner les Evouettes
Figure 6
Extrait de la carte topographique au 1 : 100000 (OFT, 1999)
2.3.2
Contexte politique
La zone dtude stend sur plusieurs entits politico-administratives et la route planifie en intresse beaucoup dautres,23 savoir, par ordre dcroissant dimportance : Pays Deux pays sont concerns : la Suisse, o se trouve la A 144, et la France qui doit amnager la liaison routire sur la rive sud du lac Lman entre Evian et SaintGingolph, ceci en prolongement de la A 144
23
Une route A 144 de qualit peut par exemple amener un report de trafic depuis la A 9 au nord du Lman (axe Genve - Lausanne) vers le sud (axe Genve - Evian) pour le cas des genevois allant en Valais (stations de ski)
30
LES ETUDES DE CAS
Rgion La A 144 se trouve dans la rgion du Chablais suisse qui est la partie de la valle du Rhne stendant entre le lac Lman (Villeneuve) et le goulet dtranglement de Saint-Maurice. Cette rgion nest pas une entit politique proprement parler mais des collaborations intercantonales existent dj ou sont en voie dlaboration, notamment dans les domaines de la sant publique (hpitaux dAigle et de Monthey), des transports publics (Chemins de fer du Chablais) ou du tourisme. Deux associations conomiques rgionales soccupent de dvelopper ces synergies intercantonales : lAssociation rgionale Monthey - Saint-Maurice (ARMS, 2000) et lAssociation rgionale pour le dveloppement du district d'Aigle. (ARDA, 2000) Le Chablais franais est une rgion qui est aussi concerne par les effets du futur amnagement routier. Il stend entre Genve et le Valais sur la rive franaise du lac Lman. (CLD, 2000)
Cantons Ceux-ci sont au nombre de 2 : le canton de Vaud qui comprend la partie Est de la zone dtude et le canton du Valais qui stend sur la partie Ouest. Il est noter que la presque totalit du trac de la A 144 se trouve dans le canton de Vaud
Districts Il y a deux districts concerns, un dans chaque canton : district dAigle (Vaud) et district de Monthey (Valais)
Communes Les communes ont une forte influence sur la procdure du projet, comme on le verra par aprs. Il y a huit communes concernes directement par la A 144 :
-
5 sont dans le canton de Vaud : Villeneuve, Rennaz, Noville, Roche, et Chessel. Il sagit de communes de tailles modestes reprsentant pour lensemble des quatre dernires de la liste prcdente moins de 2'500 habitants 3 sont dans le canton du Valais : Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph
Les communes qui sont hors de la zone dtude et qui peuvent tre concernes par les effets de la nouvelle route sont nettement plus nombreuses et ne seront pas cites ici. On remarque donc quil existe cinq niveaux de dcisions politiques possibles,24 avec en plus des interlocuteurs diffrents chaque niveau.
24
Dans les cantons du Valais et de Vaud, le niveau politique du district na pas beaucoup de poids comparativement au niveau communal ou cantonal. Cependant, il est indiqu ici car les deux prfets taient prsents dans la Comparaison de variantes 1999 et quils jouent un rle de fdrateur des communes et dintermdiaire entre le canton et les communes
Contexte dtude et problmatique
31
2.3.3
Contexte des transports
Le rseau routier actuel autour du lac Lman et dans la zone dtude est le suivant :
Figure 7
Rseau routier actuel autour du lac Lman (Microsoft, 1998)
A9
Jonction A 9 RC 725 RC 726
RC 302 (A 21)
RC 780
Pont de la Porte du Scex
Figure 8 Rseau routier actuel dans la zone dtude (OFT, 1999)
32
LES ETUDES DE CAS
Le rseau routier actuel dans la zone dtude comporte les axes suivants : Autoroute A 9 : jonctions Aigle et Villeneuve, standard 2 x 2 voies Routes cantonales vaudoises
-
RC 780 Villeneuve Jonction autoroutire sur la A 9 - Roche - Aigle Route cantonale RC 725 Villeneuve Noville Crebelley Chessel Porte du Scex : elle sert au trafic allant de Villeneuve en direction du Valais RC 726 Crebelley Rennaz : elle sert au trafic venant du Valais et allant en direction de Villeneuve
La RC 725 et la RC 726 sont sinueuses et traversent les localits de Noville et de Rennaz. Elles ont une largeur maximale de 6 m, ce qui constitue un standard nettement insuffisant pour assurer un croisement sr des vhicules. Route cantonale valaisanne : RC 302 Vouvry Les Evouettes Saint-Gingolph (correspond la route principale suisse A 21) de bonne qualit Le projet dvitement du village des Evouettes est dj planifi et ne sera pas remis en question par la Comparaison de variantes 1999 . (Tille M., 1999b) Traverse du Rhne : Le Rhne constitue, outre la frontire cantonale, un obstacle physique important. Le premier pont le franchissant se situe 5 km en amont de son embouchure dans le lac Lman. On peut traverser le fleuve aux endroits suivants :
-
Porte du Scex : pont une seule voie et avec une limitation de charge 18 tonnes. Cet ouvrage dart ne rpond plus au standard dune route cantonale, car il ncessite une circulation alterne des vhicules, source de longues files dattente, et interdit le passage de la plupart des poids lourds Axe Vionnaz Jonction A 9 dAigle : premier pont sur le Rhne en amont du lac Lman autorisant le passage des poids lourds suprieurs 18 tonnes, ce qui entrane un dtour de 10 km pour ceux qui se dplacent entre la France et le Plateau Suisse par rapport au passage direct par la Porte du Scex
On remarque que le rseau routier est surtout dvelopp selon une orientation parallle aux versants de la valle. Les charges de trafic journalier moyen (TJM) releves ou estimes pour la traverse du Rhne par la A 144 sont les suivantes :
Anne
1995 2005 Sans amnagement A 144 en site propre Rseau actuel amlior
TJM (vhicules/jour)
7000 8100 7500 8900 2015
Anne
A 144 en site propre Rseau actuel amlior
TJM (vhicules/jour)
10200 11800
2035
A 144 en site propre Rseau actuel amlior
12200 14100
Tableau 2
Charges de trafic au droit de la traverse du Rhne par la A 144 (Infraconsult, 2000)
40 % de ce trafic est un trafic de transit transfrontalier. Le taux de poids lourds sur le tronon entre Vionnaz et Aigle25 est actuellement de 10 %. Ceci laisse augurer un taux de 5 % sur la future A 144 en raison du report de trafic et de la libralisation des
25
Le taux de poids lourds la Porte du Scex est seulement de 2 %, mais il nest pas significatif en raison de la limitation de 18 tonnes impose sur le pont traversant le Rhne
Contexte dtude et problmatique
33
contingents de 40 tonnes autoriss circuler sur le rseau routier suisse la suite de la conclusion des accords bilatraux entre lUnion Europenne et la Suisse. La desserte de cette rgion peu dense par les transports collectifs est assez faible. Un chemin de fer se trouve sur la rive gauche du Rhne, la ligne du Tonkin . Celui-ci, sarrte en cul-de-sac Saint-Gingolph. Les dplacements non-motoriss (cyclistes et pitons) sont peu dvelopps et concernent surtout des dplacements de loisirs.
2.3.4
conomie
La plaine est une zone dagriculture intensive de part sa planit, la qualit des sols rencontrs et les bonnes conditions hydrologiques. Le tourisme est dvelopp dans les villages situs sur les rives lmaniques, notamment au Bouveret qui a un ple touristique important form par divers parcs dattractions existants et projets. Le nouveau parc de loisirs dAquaparc ouvert en novembre 1999 gnrera par exemple un trafic journalier moyen estim prs de 1250 vhicules.
2.3.5
Environnement
La rserve des Grangettes est lune des neuf rserves doiseaux deau et de migrateurs dimportance internationale26 que compte la Suisse (Annexe 1 de (OROEM, 1991) en application de (Convention Ramsar, 1971)). Les chteaux de la Porte du Scex (1678) et du Grand Clos Rennaz (1763) sont classs linventaire des monuments historiques. (Annet D. et Cassina G., 1980) Sinon, le paysage de la plaine est banal et mis part quelques forts il est fortement marqu par lexploitation agricole intensive.
Figure 9
Martin-pcheur dans la rserve des Grangettes (Aubort D., 1999)
2.3.6
Problmatique
La liaison routire actuelle entre Villeneuve et le Bouveret ne rpond plus aux attentes que lon peut avoir envers une infrastructure de transport moderne : linscurit et les nuisances pour la population des villages de la plaine sont intolrables la traverse des localits, les sinuosits du trac et ltroitesse de la chausse ne rpondent plus aux exigences du trafic motoris le pont sur le Rhne la Porte du Scex est un goulet d'tranglement pour le trafic motoris et oblige les poids lourds effectuer un important dtour
26
Les rserves doiseaux deau et de migrateurs dimportance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux deau vivant toute lanne en Suisse (Article 1 de (OROEM, 1991))
34
LES ETUDES DE CAS
Dautres problmes sadditionnent cet tat insuffisant des infrastructures routires dans la Plaine du Rhne : le volume du trafic frontalier va saccrotre en raison de la mise en application des accord bilatraux entre lUnion Europenne et la Suisse la limitation maximale de la charge des poids lourds circulant en Suisse va passer de 28 40 tonnes en raison de ces mmes accords le ple touristique du Bouveret, qui est une importante source de trafic motoris, est appel se dvelopper le projet d'amlioration de l'axe routier projet lhorizon 2005 sur la rive franaise du Lman (construction dune voie rapide 2 x 2 voies entre Annemasse et Thonon et ralisation des contournements des villages entre Thonon et SaintGingolph) rend ncessaire, du ct suisse, lamnagement dune liaison routire avec l'autoroute A 9 qui puisse, dune part, supporter la charge de trafic supplmentaire engendre et qui possde, dautre part, un standard quivalent
Pour toutes ces raisons, lamnagement dune liaison routire de qualit entre Villeneuve et le Bouveret est ncessaire.
2.4
H ISTORIQUE DES PROJETS
La liaison routire entre les localits de Villeneuve (canton de Vaud) et du Bouveret (canton du Valais) occupe les lus locaux ainsi que les services cantonaux et fdraux depuis de nombreuses annes, sans qu'une solution consensuelle ait pu tre trouve. La Comparaison de variantes 1999 a donc un pass charg par de multiples tudes de projets, ce qui nest pas sans influence sur son droulement comme on le verra par aprs. Le rsum de cet historique des diffrentes variantes tudies est tir des documents (Infraconsult, 2000) et (DINF, 2000a). Les tracs des diffrentes variantes tudies dans la Comparaison de variantes 1999 sont prsents sur les cartes des pages 38, 65 et 71. Elles ne seront pas dcrites en profondeur ici, cette thse ne sintressant pas directement leurs caractristiques techniques. La construction de la route nationale suisse A 144 est prvue dans l'arrt du Conseil fdral du 17 mars 1961. (Busslinger L., 2000) Depuis cette date, de nombreux projets ont t tudis, dont notamment les variantes suivantes : Variante des Grangettes Cette variante consistait en une liaison directe entre la jonction autoroutire de Villeneuve sur la A 9 et le Bouveret, ce qui permet de se raccorder le plus rapidement possible avec la future Transchablaisienne ralise en France le long de la rive sud du lac Lman. Le standard choisi est celui d'une semiautoroute. Le trac passait au nord du village de Noville et traversait en partie la rserve naturelle des Grangettes en la surplombant par un viaduc de 3 km. Longtemps dfendue par le Service des Routes du canton de Vaud, cette variante a toutefois t abandonne en 1987 en raison des impacts jugs intolrables sur des biotopes de grande valeur hbergeant une flore et faune riches et diversifies. (Busslinger L., 2000) et (DINF, 2000a)
Historique des projets
35
Variante des Communes En juin 1992, cette variante a t propose au Conseil dEtat du canton de Vaud par les cinq communes vaudoises situes dans la zone dtude. Elle est le fruit dun consensus obtenu entre ces diffrents entits politiques et elle vite le site protg des Grangettes. Elle prvoit une route entirement nouvelle deux pistes, sans accs latraux et avec une sparation du trafic. Elle comporte dimportants ouvrages dart : traverse du Rhne et du grand Canal par un viaduc de 1'340 m et tranche couverte proximit du hameau de Crebelley, qui est situ entre les villages de Noville et de Chessel. En fvrier 1993, la Communaut d'tudes Espace Chablais remettait au Service des routes et des autoroutes (SRA) une tude dvaluation concluant que la variante des communes est la plus favorable mais qu'elle est encore perfectible . Cette variante a obtenu, en 1993, l'accord des administrations routires cantonales valaisannes et vaudoises. Une optimisation a ensuite t ralise par le Service des Routes vaudois (suppression dune jonction sur la A 9, rduction des dimensions de certains ouvrages dart, etc.) pour tre prsente sous forme dun avant-projet sommaire (APS) aux syndics des communes vaudoises en juillet 1997, puis aux services cantonaux vaudois concerns pour quils donnent leur avis. Le 24 mars 1998, le dossier de cette variante, appele Variante des Communes Rvise a t transmis aux autorits fdrales comptentes (OFROU et OFEFP) pour examen.
Variante 0 + La variante 0+ a t propose par les milieux de la protection de l'environnement. Elle consiste ramnager les routes existantes afin d'viter ou de protger les localits. Elle prsente un gabarit infrieur la Variante des Communes, prvoit des accs latraux et autorise un trafic mixte. La variante 0+ t revue principalement dans le sens d'une rduction maximale des cots.27 Ds son arrive au Dpartement vaudois des infrastructures, le 21 avril 1998, le conseiller d'tat Philippe Biler a demand d'tudier plus prcisment la variante 0+ afin de pouvoir la comparer la Variante des Communes Rvise. Cette nouvelle variante est dsigne par le terme de Variante 0 + Rvise .
27
Linterpellation du dput cologiste Luc Recordon ce sujet est loquente : considrant que largent de la Confdration navait pas tre gaspill , la variante 0+ est beaucoup plus raisonnable et doit tre prfre la variante des Communes qualifie de variante lourde (DINF, 2000b)
36
LES ETUDES DE CAS
2.5
L ES VARIANTES INITIALES
En raison de limpossibilit darriver obtenir un choix consensuel entre la variante des Communes, qui a reu un pravis ngatif de la part de lOFEFP, et la variante 0+, l'OFROU a propos en novembre 1998 de former un groupe de travail afin de raliser une analyse multicritre comparative. Le 3 dcembre 1998, les Chefs des dpartements valaisan des transports, de l'quipement et de l'environnement (DTEE) et vaudois des infrastructures (DINF) annonaient le lancement de cette analyse multicritre ayant pour objectifs de : (DINF, 1998) examiner les diffrentes variantes selon des critres aussi objectifs et neutres que possible soumettre les variantes une analyse de leurs valeurs d'utilit tablir, sur cette base, une recommandation permettant de choisir la variante optimale
Les 4 variantes initiales28 retenues pour la Comparaison de variantes 1999 sont les suivantes :29 Variante 0+ Rvise telle qutudie en 1998 Variante 0+ Adapte qui correspond la proposition initiale, simplifie par des tudes complmentaires menes au dbut de 1999 Variante des Communes Rvise qui correspond aux tudes doptimisation menes en 1997 Variante des Communes Adapte qui correspond la proposition de juin 1992, avec la suppression de la nouvelle jonction autoroutire sur la A 9
28
Ces variantes sont qualifies d initiales car dautres variantes ont t gnres lors de la Comparaison de variantes 1999 Les tracs de ces 4 variantes sont prsents sur la carte de la page 38
29
Les variantes initiales
37
Les principales caractristiques de ces variantes sont les suivantes : Nom
Variante 0+ Rvise
) simplification de la variante originelle
Version
Aot 1998
Caractristiques principales
Trafic : mixte, desserte locale, trafic agricole Carrefours : en T, nombreux accs latraux Jonction VD : PS Rennaz Jonction VS : Porte du Scex, niveau avec CFF Traverse du Rhne : pont de 80 m (pont actuel amlior)
Cot
28 mios
Variante 0+ Adapte
) conforme la variante originelle, lgrement amliore
Mars 1999
Trafic : mixte, desserte locale Carrefours : giratoires, nombreux accs latraux Jonction VD : PS Rennaz Jonction VS : giratoire sur la RC 302 Traverse du Rhne : pont de 380 m vers la Porte du Scex 40 mios
Variante des Communes Rvise
) correspond lavantprojet sommaire
Mars 1997
Trafic : spar, rserv au transit, trafic agricole exclu Carrefours : aucun (site propre) Jonction VD : viaduc A 9 et giratoire sur la RC 780 Jonction VS : giratoire sur la RC 302 au portail Sud Traverse du Rhne : pont de 485 m 68 mios
Variante des Communes Adapte ) conforme la variante de juin 1992 avec des adaptations techniques (plus de jonction sur la A 9)
Mars 1999
Trafic : spar, rserv au transit, trafic agricole exclu Carrefours : aucun (site propre) Tranche couverte de 850 m vers Crebelley Jonction VD : viaduc A 9 et giratoire sur la RC 780 Jonction VS : giratoire sur la RC 302 au portail Sud Traverse du Rhne : viaduc de 1'340 m 98 mios
Tableau 3
Principales caractristiques des variantes initiales (Infraconsult, 2000) et (DINF, 2000a)
Ltat de rfrence, dsign par le terme ER(1), correspond la situation actuelle du rseau routier transpose l'an 2005 (nouvelles charges de trafic). Pour des raisons mthodologiques, il est aussi considr dans ltude, mme sil ne constitue pas une stratgie d'action envisageable.30 En outre, le rseau actuel en 1995, dsign par le terme ER(0), sert dtat de rfrence l'apprciation des variantes.31 Postulat 08
Une comparaison de variantes doit intgrer un tat de rfrence, mme si celui-ci nest pas envisageable comme tant une solution retenir
On peut remarquer que les diffrentes appellations des variantes sont parfois si semblables quelles peuvent prter confusion. Cependant, lors des premires sances de travail de la Comparaison de variantes 1999 , il a t dcid de conserver ces termes pour viter de devoir procder envers le public de complexes explications de correspondance entre des noms diffrents servant prsenter un trac identique. (Tille M., 1999b)
30 31
Il est intressant de comparer pour chaque critre leffet dune variante vis--vis dune stratgie ne rien faire Il sagit donc dune apprciation relative : une variante est qualifie par rapport un rfrentiel dfini qui est ER(0). Trois cas sont alors possibles :1. Amlioration / 2. Dgradation / 3. Aucune modification
38
LES ETUDES DE CAS
Variante 0+ Rvise Variante 0+ Adapte Variante des Communes Rvise Variante des Communes Adapte
Figure 10
Variantes initiales tudies dans la Comparaison de variantes 1999 (Infraconsult, 2000)
Lorganisation du projet
39
2.6
L ORGANISATION DU PROJET
2.6.1
Groupes de travail
Comme prsent dans les documents (DINF, 1998) et (Infraconsult, 2000), une organisation comportant trois groupes de travail a t mise en place pour la Comparaison de variantes 1999 , savoir : comit de pilotage, groupe technique et mandataire externe. Mis part le mandataire externe, le reprsentant de lOFROU prsidant le comit de pilotage et un auditeur, le comit de pilotage et le groupe technique sont composs dacteurs distincts. Ceci est du au fait que les objectifs et les mthodes de travail de ces deux groupes de travail sont diffrents et quil y a aussi la ncessit davoir une totale indpendance entre eux.
2.6.1.1
Comit de Pilotage
Le Comit de Pilotage, que lon va dsormais dsigner par le terme de COPIL, est responsable de l'orientation de l'tude et il en valide les rsultats. Il est donc l'organe de ngociation et de dcision. Il sagit du groupe de travail politique qui effectuera la pondration des objectifs de lanalyse multicritre. Le COPIL comporte 32 membres, qui ont t rpartis dans six groupes dacteurs :32 Groupe 1
-
lus valaisans
Ce groupe est constitu de cinq acteurs, savoir : Conseiller dEtat responsable du DTEE Prfet du district de Monthey Prsidents des communes valaisannes de la zone dtude lus vaudois 1 personne 1 personne 3 personnes
Groupe 2
-
Ce groupe est constitu de sept acteurs, savoir : Conseiller dEtat responsable du DINF Prfet du district dAigle Syndics des communes vaudoises de la zone dtude 1 personne 1 personne 5 personnes
Groupe 3
-
Associations de dveloppement conomique
Ce groupe est constitu de quatre acteurs, savoir : Association Rgionale pour le Dveloppement du district dAigle (ARDA, 2000) Association Rgionale Monthey - Saint-Maurice (ARMS, 2000) Conseil Du Lman (CDL), association franco-suisse Chablais Lman Dveloppement, France (CLD, 2000) 1 personne 1 personne 1 personne 1 personne
32
Cette rpartition en six groupes dacteurs effectue par lauteur sera reprise dans les chapitres 5 et 8 pour analyser les pondrations effectues. Chaque groupe reprsente des points de vues plus ou moins identiques
40
LES ETUDES DE CAS
Groupe 4
-
Associations de protection de lenvironnement
Ce groupe est constitu de cinq acteurs, savoir : Pro Natura, sections vaudoises et valaisannes Association Transport et Environnement (ATE), section Vaud Conseil Lmanique pour lEnvironnement (CLE) World Wide Fund for Nature (WWF), section Valais Administration publique - Environnement et Amnagement du territoire 2 personnes 1 personne 1 personne 1 personne
Groupe 5
Ce groupe est constitu de cinq acteurs, savoir :
-
Reprsentante de lOffice Fdral lEnvironnement et du Paysage (OFEFP)
des
Forts,
de 1 personne 2 personnes 2 personnes
Service de lEnvironnement, cantons de Vaud et du Valais Service de lAmnagement du Territoire, Vaud et Valais Administration publique - Service des routes
Groupe 6
-
Ce groupe est constitu de quatre acteurs, savoir : Reprsentant de lOffice Fdral des Routes (OFROU) Ingnieurs cantonaux, Vaud et Valais Reprsentant de la Direction Dpartementale de lquipement de la Haute-Savoie (DDE 74) 1 personne 2 personnes 1 personne
Deux acteurs externes font partie intgrante de ce COPIL : le mandataire externe (bureau IC Infraconsult SA) et un auditeur externe (auteur de la thse). Le COPIL est prsid par J. Bguin, reprsentant de lOFROU.
2.6.1.2
Groupe Technique
Le Groupe Technique, que lon va dsormais dsigner par le terme de GT, est charg de fournir les informations requises en collaboration directe avec le mandataire externe. Il sagit du groupe de travail technique qui effectuera la quantification des indicateurs avec le mandataire extrieur puis la notation des variantes de lanalyse multicritre. Ses rsultats seront approuvs par le COPIL. Le GT comprend un nombre variable de membres selon les sances (une dizaine en gnral). Il sagit de reprsentants des administrations cantonales vaudoises et valaisannes responsables des routes, des transports, de lenvironnement et de lamnagement du territoire ainsi que des collaborateurs de bureaux dtudes spcialiss en ingnierie (SD ingnierie Lausanne), environnement et trafic.
2.6.1.3
Mandataire externe
Le mandataire externe est charg de la coordination de l'tude, de l'excution de l'tude multicritre l'aide de l'analyse des valeurs d'utilit et d'agir comme secrtariat du Comit de Pilotage et du Groupe Technique. Le bureau IC Infraconsult SA (Berne) a t choisi parmi plusieurs candidats pour raliser cette tche.
Lorganisation du projet
41
2.6.2
Droulement de ltude
L'laboration de la Comparaison de variantes 1999 comporte trois phases principales de travail : (Infraconsult, 2000) Phase A 1. 2. 3. 4. Prparation des bases de l'analyse des valeurs d'utilit
Introduire l'organisation du projet et dfinir les rles de chaque acteur Dfinir les variantes tudier laborer le systme des objectifs Dfinir les indicateurs Ralisation de l'analyse des valeurs d'utilit
Phase B 5. 6. 7.
Pondrer les objectifs partiels et gnraux Complter les donnes de base concernant les variantes; laborer une proposition de l'apprciation des variantes base sur des indicateurs Calculer les valeurs d'utilit, laborer l'analyse de sensibilit pour vrifier la stabilit des rsultats de l'analyse des valeurs dutilit Optimisation des variantes
Phase C 8. 9.
Optimiser les variantes laborer l'analyse des valeurs d'utilits pour les variantes optimises
10. Choisir la variante optimale
2.6.3
La mthode danalyse des valeurs d'utilit
La mthode daide multicritre la dcision choisie par le mandataire externe est la mthode danalyse des valeurs d'utilit, que lon dsigne par le terme AVU. Comme il le prcise, lutilisation de cette mthode se justifie par le fait que : Cette
mthode permet de tenir compte d'objectifs multiples, de nature diverse, en particulier contrairement l'analyse cots - avantages - d'objectifs non quantifiables en termes montaires, et que (elle)reste la principale mthode d'aide la dcision en prsence de problmes multidimensionnels comportant des objectifs concourants. La mthode de l'AVU a dj souvent t utilise en Suisse, . (Infraconsult, 2000)
La mthode danalyse des valeurs d'utilit comprend quatre phases de travail bien distinctes : on dtermine diffrents indicateurs mesurant ou apprciant dans quelle mesure chaque variante atteint chacun des objectifs partiels poursuivis chaque variante se voit attribuer ensuite des notes d'apprciation dtermines sur la base de lanalyse de diffrents indicateurs la pondration des objectifs est tablie de manire assurer une prise en compte de lensemble des points de vue envisageables les moyennes pondres des notes, dsignes par le terme de valeurs d'utilit, permettent de comparer les variantes entre elles et par rapport un tat de rfrence dfini pralablement
42
LES ETUDES DE CAS
Les deux premires tapes de travail sont ralises par le mandataire externe qui fait valider ses rsultats par le GT. Le COPIL dispose aussi en fait dun droit de regard sur cette partie de ltude, notamment sur les indicateurs. Ces deux phases de travail sont interdpendantes car la notation des variantes se base sur les valeurs des indicateurs. La phase de pondration, ralise uniquement par le COPIL, est mene indpendamment de ces deux phases initiales. La dernire opration consiste quant elle en une simple multiplication des notes et des pondrations. Les deux premires tapes de travail sont des oprations ralises le plus objectivement possible, tandis que la pondration est une opration qui prsente un caractre nettement plus subjectif.
2.6.3.1
Dmarche adopte
La dmarche adopte pour la mthode AVU est la suivante : (Infraconsult, 2000) 1. Dfinition des variantes Toutes les informations relatives aux variantes et ltat de rfrence doivent tre connues afin que leurs effets positifs ou ngatifs puissent tre dtermins 2. Dfinition du systme des objectifs La conception d'un systme d'objectifs consiste prsenter un catalogue des objectifs dterminants pour la prise de dcision 3. Dfinition des indicateurs Les indicateurs dcrivent les effets des variantes, sur une base dapprciation clairement dfinie 4. Apprciation des effets Une valeur est attribue chaque indicateur au moyen d'une chelle de mesure objective. Afin que ces valeurs puissent ensuite tre compares entre elles, on ralise une conversion en une valeur d'objectif adimensionnelle par le biais dune fonction dite d'utilit. En prsence de plusieurs indicateurs pour un objectif partiel donn, une pondration technique est ralise par le GT 5. Pondration du systme des objectifs Les dcideurs classent chaque objectif et lui attribuent un poids selon l'importance relative qu'ils lui accordent (prfrence). Chaque membre du COPIL procde anonymement et librement, dans le respect de certaines rgles, sa propre pondration qui est communique ensuite au mandataire extrieur 6. Synthse Sur la base des valeurs de l'objectif et de la pondration, la valeur d'utilit gnrale de chaque variante est calcule 7. Analyse de sensibilit Des tests de sensibilit sont raliss afin de vrifier la stabilit des rsultats 8. Interprtation des rsultats Sur la base des rsultats de la synthse et de l'analyse de sensibilit, le consensus sur le choix dfinitif de la variante peut tre labor
Lorganisation du projet
43
2.6.3.2
Systme des objectifs
Le systme des objectifs retenu pour la Comparaison de variantes 1999 comporte trois niveaux successifs : une finalit qui concerne tous les objectifs de l'action entreprendre. Elle est dfinie comme tant une contribution la qualit de la vie par un systme de transports judicieux six objectifs gnraux qui recouvrent les grands domaines d'objectifs : transports, moyens financiers, amnagement du territoire, environnement, dveloppement conomique et travaux seize objectifs partiels qui refltent la dcomposition sectorielle des objectifs gnraux. Il sont bass sur lapprciation de diffrents indicateurs
La valeur dutilit dune variante est base sur une double pondration des notes : tout dabord, la multiplication des notes dapprciation des objectifs partiels par les poids correspondants aux objectifs partiels donne une valeur dutilit partielle dans une deuxime phase, les valeurs dutilit partielles sont multiplies par les poids correspondants aux objectifs gnraux afin de dterminer la valeur dutilit de la variante
Un tableau rcapitulant les seize objectifs partiels retenus pour la Comparaison de variantes 1999 se trouve la page suivante.33
2.6.3.3
Principe de notation
Les effets mesurs au moyen des indicateurs sont ensuite transforms en notes. La note 0 est attribue ltat de rfrence en 1995 ER(0). Ainsi, ltat de rfrence en 2005 peut tre diffrent de cette valeur nulle. Lchelle de notation utilise est homogne et valable pour tous les objectifs partiels. Elle peut prendre sept valeurs : Note
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Tableau 4
Dfinition
Dgradation trs importante par rapport la situation actuelle Dgradation importante par rapport la situation actuelle Lgre dgradation par rapport la situation actuelle Pas de changement notable par rapport la situation actuelle Lgre amlioration par rapport la situation actuelle Amlioration importante par rapport la situation actuelle Amlioration trs importante par rapport la situation actuelle chelle des notes d'apprciation (Infraconsult, 2000)
Une variante ayant des effets extrmes par rapport ceux observs pour l'tat de rfrence dfinit les valeurs extrmes de l'chelle des notes. Ainsi on obtient l'tendue dans laquelle l'attribution des notes pour les autres variantes peut avoir lieu.
33
Les objectifs gnraux et partiels ont t dfinis par le COPIL, sur la base de propositions mises par le mandataire externe. Les indicateurs sont par contre proposs par le mandataire externe et ils sont ensuite valids par le GT et le COPIL
44
LES ETUDES DE CAS
Objectif gnral
1. Satisfaire les besoins de transport 1.1 1.2 1.3
Objectifs partiels
Besoins du transport motoris Besoins du trafic piton et deuxroues Besoins des transports collectifs
Indicateurs
Confort, scurit, efficacit Performance du systme et standard Effet de coupure pour pitons Confort et scurit utilisateurs 2-roues Attrait du rseau pour le trafic motoris individuel Potentiel dveloppement lignes Liaisons directes, confort et scurit Cots des infrastructures conomies par la ralisation en tapes Cots d'entretien et d'exploitation fixes Cots d'entretien et d'exploitation dpendants du trafic Besoins de terrains Nuisances zones rsidentielles, artisanales et de rcration Flexibilit de ractions au dveloppement futur Buts et principes de la loi fdrale Plans sectoriels de la Confdration Plans Directeurs cantonaux Plans d'affectation Impact sonore Pollution atmosphrique Risques d'accidents majeurs dans l'espace habit Impact visuel au paysage et au patrimoine construit Surfaces dvalorises et dtruites Coupure de liaisons importantes et pertes d'espace vital pour la faune Consommation d'nergie Surfaces impermabilises Atteintes aux eaux de surface et eaux souterraines provoques par des accidents majeurs Eaux de surfaces et souterraines Effets sur l'emploi (par la construction et l'entretien/exploitation) Contribution du systme de transport au dveloppement de l'conomie rgionale Nuisances sur l'homme proche des chantiers Dure et importance de l'entrave la circulation Transports de matriaux (dblaisremblais)
1.4 2. Utilisation conomique des moyens financiers 2.1 2.2
Besoins du transport agricole Maintenir au plus bas les cots d'investissement Maintenir au plus bas les cots d'entretien et d'exploitation Favoriser une utilisation mesure du sol
3. Remplir au mieux les objectifs de lamnagement du territoire
3.1
3.2
Favoriser la compatibilit avec les buts et plans de l'amnagement du territoire Rduire les atteintes l'environnement humain
4. Rduire les nuisances sur lenvironnement
4.1
4.2
Rduire les atteintes l'environnement naturel Rduire les autres nuisances
4.3
5. Favoriser le dveloppement conomique
5.1 5.2
Contribuer au dveloppement de l'conomie micro-rgionale Contribuer au dveloppement de l'conomie macro-rgionale Limiter les nuisances locales Limiter les nuisances sur la circulation Limiter les nuisances gnrales
6. Limiter les nuisances
dues aux travaux
6.1 6.2 6.3
Tableau 5
Systme des objectifs retenu pour la Comparaison de variantes 1999 (Infraconsult, 2000)
Des commentaires et des apprciations sur la mthode daide multicritre la dcision retenue pour la Comparaison de variantes 1999 sont raliss au chapitre 8.
Lorganisation du projet
45
2.6.3.4
Description des indicateurs
Il sagit ici de dcrire sommairement, dans des tableaux rcapitulant les objectifs gnraux, les diffrents indicateurs retenus pour chaque objectif partiel. Objectifs partiels
Besoins du transport motoris Confort Scurit du trafic Performance du systme de transport Homognit du standard Besoins du trafic piton et deuxroues Effet de coupure pour les pitons en localit Confort et scurit pour les pitons et les deux-roues Attrait du rseau pour le trafic motoris individuel Potentiel de dveloppement des lignes Liaisons directes Confort et scurit Dtours imposs au trafic agricole Nombre de points risques (entres et sorties)
Indicateurs
Description de lindicateur
Niveau de service : % de route principale avec ou sans trafic mixte et en localit Nombre daccidents, de blesss et de morts Gains de vitesse moyenne (VL) et de taxe RPLP (PL) Correspondance avec laxe projet entre Annemasse et Saint-Gingolph (rive sud du Lman) Volume du flux de trafic travers une localit (coupure prjudiciable au del de 500 vhicules/heure) Volume du trafic motoris, cause dentraves Amlioration du rseau pour les vhicules individuels Situation concurrentielle
Besoins des transports collectifs
Besoins du transport agricole
Tableau 6
Description des indicateurs utiliss pour apprcier la satisfaction des besoins de transport (Infraconsult, 2000)
Objectifs partiels
Maintenir au plus bas les cots d'investissement Maintenir au plus bas les cots d'entretien et d'exploitation
Indicateurs
Cots des infrastructures conomies par la ralisation en tapes Cots d'entretien et d'exploitation fixes Cots d'entretien et d'exploitation dpendants du trafic
Description de lindicateur
Cot selon devis estimatif avec situation actuelle 0 Potentiel dconomie du des investissements initiaux rduits Cots dentretien lis aux dimensions de la route Cots dentretien lis au volume de trafic (poids lourds)
Tableau 7
Description des indicateurs utiliss pour apprcier lutilisation conomique des moyens financiers (Infraconsult, 2000)
46
LES ETUDES DE CAS
Objectifs partiels
Favoriser une utilisation mesure du sol
Indicateurs
Besoins de terrains Nuisances zones rsidentielles, artisanales et de rcration Flexibilit de ractions au dveloppement futur
Description de lindicateur
Influence de la ralisation de la A 144 sur lutilisation mesure du sol, objectif principal de LAT (article 1) Consommation de terrain agricole, rsidentiel, artisanal et de rcration Nuisances sur ces mmes terrains Degr de respect des buts et des plans en matire damnagement du territoire
Favoriser la compatibilit avec les buts et plans de l'amnagement du territoire
Buts et principes de la loi fdrale Plans sectoriels de la Confdration Plans Directeurs cantonaux Plans d'affectation
Tableau 8
Description des indicateurs utiliss pour apprcier le respect des objectifs de lamnagement du territoire (Infraconsult, 2000)
Objectifs partiels
Rduire les atteintes l'environnement humain
Indicateurs
Impact sonore Pollution atmosphrique Risques d'accidents majeurs dans l'espace habit Impact visuel au paysage et au patrimoine construit
Description de lindicateur
Respect des valeurs limites dimmission dans les villages missions de NOx Nombres de camions transportant des substances dangereuses valuation qualitative des impacts paysagers Surfaces riches en flore dtruites ou dvalorises pondres par la valeur des milieux concerns Nombre et importance des coupures sur les dplacements de la faune nergie de construction, dentretien, dexploitation et du trafic exprime en GJ/an Surface directe de la chausse Probabilit dun accident de camion transportant des substances dangereuses Atteintes saisonnires et chroniques aux eaux dapprovisionnement
Rduire les atteintes l'environnement naturel
Surfaces dvalorises et dtruites Coupure de liaisons importantes et perte d'espace vital pour la faune Consommation d'nergie Surfaces impermabilises Atteintes aux eaux de surface et eaux souterraines provoques par des accidents majeurs Eaux de surfaces et souterraines
Rduire les autres nuisances
Tableau 9
Description des indicateurs utiliss pour apprcier la rduction des nuisances sur lenvironnement (Infraconsult, 2000)
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
47
Objectifs partiels
Dveloppement de lconomie micro-rgionale Dveloppement de lconomie macro-rgionale
Indicateurs
Effets sur lemploi (par la construction et lentretien/exploitation) Contribution du systme de transport au dveloppement de lconomie rgionale
Description de lindicateur
Crations demplois induits par la construction et lexploitation dans la zone dtude Effets sur lconomie rgionale du Chablais
Tableau 10
Description des indicateurs utiliss pour dveloppement conomique (Infraconsult, 2000)
apprcier
le
Objectifs partiels
Limiter les nuisances locales Limiter les nuisances sur la circulation Limiter les nuisances gnrales
Indicateurs
Nuisances sur l'homme proche des chantiers Dure et importance de l'entrave la circulation Transports de matriaux (dblais- remblais)
Description de lindicateur
Bruit, vibrations et pollution atmosphrique occasionns par les machines de chantier Perturbations dues lorganisation du chantier
Mouvements des matriaux entre le chantier et les zones dapport ou de dcharge
Tableau 11
Description des indicateurs utiliss pour apprcier la limitation des nuisances dues aux travaux (Infraconsult, 2000)
2.7
D EROULEMENT DE LA C OMPARAISON DE VARIANTES 1999
Si les pages prcdentes, qui ont servi prsenter le contexte, la problmatique et la mthodologie de travail utilise pour la Comparaison de variantes 1999 , sont inspires principalement du rapport technique (Infraconsult, 2000), les lments prsents dans le chapitre 2.7 seront essentiellement tirs des procs-verbaux des runions, des notes manuscrites effectues tout au long de lanne 1999 par lauteur lors des diverses sances de travail du COPIL et du GT (Tille M., 1999b) ainsi que de ses rflexions personnelles. La description du droulement de la Comparaison de variantes 1999 est ralise dans un ordre chronologique dcoup principalement selon lordonnancement des diverses sances du Comit de Pilotage (COPIL) et du groupe technique (GT) suivies par lauteur en 1999. Ce descriptif, qui reprend la trame des discussions ralises lors de ces sances, nest pas une simple concatnation des diffrents procs-verbaux mais constitue plutt en une mise en exergue des lments intressants la thse. Le travail de synthse slective ainsi effectu permet de prsenter lvolution du climat dtude rgnant au sein des deux groupes de travail soccupant de la Comparaison de variantes 1999 ainsi que la maturation des ides ayant permis, partir des quatre variantes initiales, daboutir une solution consensuelle dsigne sous le nom de Solution COPIL .
48
LES ETUDES DE CAS
2.7.1
Sance dinformation publique
Lors dune sance dinformation publique qui se tient le 3 dcembre 1998 Villeneuve, les conseillers dEtat P. Biler (Vaud) et J.-J. Rey-Bellet (Valais) annoncent le lancement dune analyse multicritre. (DINF, 1998) Les rsultats de cette tude de variantes qui permettra de trouver une solution ngocie et accepte par un maximum de partenaires sont annoncs pour la fin juin 1999. Lorganisation de ltude en trois groupes de travail (COPIL, GT et mandataire externe) est aussi prsente. Dans un article de la presse rgionale du lendemain, la mthode AVU est qualifie, en des termes dithyrambiques, de mthode qui a fait merveille pour les contournements de Vige et de Bulle .34 (Wichser F., 1998)
2.7.2
Premire sance du Comit de Pilotage
La sance inaugurale du Comit de Pilotage se tient le 5 fvrier 1999 Villeneuve. Il sagit dune sance de prise de contact entre les diffrents acteurs, de prsentation de la problmatique et de description de la mthodologie dtude retenue. La rtrospective des diffrents projets tudis pour la liaison routire A 144 dans la plaine du Rhne, du projet de la RC 302 entre Vouvry et Saint-Gingolph et des variantes initiales retenues pour la Comparaison de variantes 1999 est effectue par les deux ingnieurs cantonaux. Suite cette prsentation, des ractions apparaissent dans lassemble au sujet du trac de la RC 302. En effet, celui-ci est quasiment dfini, notamment le tunnel de 900 m de longueur servant contourner le village des Evouettes. Seule limplantation exacte du portail Sud de cet ouvrage souterrain, qui servira de point daccrochage la future A 144, est susceptible de modifications. Celles-ci sont cependant mineures et dpendent du choix du trac de la route A 144 sur le territoire vaudois. La Comparaison de variantes 1999 ne concerne donc que trs peu le Valais, mais les autorits de ce canton y participent dans un souci de cohrence entre les deux projets et pour tre inform des tenants et aboutissants de ltude. Le fait de ne pas considrer le contournement des Evouettes et la route entre cette localit et Saint-Gingolph dans la Comparaison de variantes 1999 est contest par la reprsentante de lOFEFP et le reprsentant du Service de lamnagement du territoire du canton de Vaud qui demandent que ltude seffectue globalement entre la frontire franaise et lautoroute A 9 et non pas uniquement dans la traverse de la plaine entre Villeneuve et le sud des Evouettes. Les deux conseillers dEtat dfendent le choix effectu en prcisant que le trac de la route sur la rive gauche du Rhne na que peu dincidences sur ltude qui est mener pour choisir le trac de la A 144 travers la valle. Ceci justifie donc amplement son exclusion de la zone dtude.
34
Laccueil rserv cette tude, qui nest finalement quune tude de plus dans un projet qui en compte dj beaucoup, est trs favorable. Les deux conseillers dEtat insistent sur le fait quil ny aucun risque denlisement du dossier et que cette tude ne va pas ralentir le processus mais peut au contraire faire gagner beaucoup de temps en liminant les divergences avant la mise lEnqute publique
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
49
La question de la possibilit de panacher ou non les variantes initiales35 est aussi voque. Il est dcid que cette opration sera effectue, si elle se rvle intressante, uniquement lors de loptimisation des variantes. Lopportunit de limiter ltude quatre variantes pour des raisons de dlais fait cependant craindre quelques acteurs le risque dcarter doffice une solution intressante.36 Le programme dtude propos par le mandataire externe prvoit initialement de comparer uniquement les deux variantes rvises. Cependant, afin de disposer dun choix plus tendu, de nombreux acteurs demandent et obtiennent, aprs une pre discussion, que lon prenne aussi en considration les variantes adaptes. Un complment dtude sera men avant la prochaine sance du COPIL afin de disposer de donnes identiques pour les quatre variantes initiales ainsi considres. Le mandataire externe dcrit les objectifs de cette Comparaison de variantes 1999 qui doit tre mene de faon transparente et doit servir aux autorits concernes de base de dcision . Il expose ensuite les diffrentes phases de la dmarche adopte pour lanalyse des valeurs dutilit (idem chapitre 2.6.3.1) et prsente le systme des objectifs.37 Quelques questions lies au droulement de la mthode AVU, notamment sur les tches des diffrents acteurs, sont poses par lassemble. Pour expliquer ces problmes de comprhension quant la mthode de travail ou la procdure retenue, il est noter que le mandataire externe nest pas de langue maternelle franaise et que, mme sil sexprime correctement dans la langue de Molire, la subtilit de certains termes spcialiss lui chappe parfois. Ceci peut sembler ntre finalement quun point de dtail, mais comme le souligne J.-E. Klimpt, Un acteur de mauvaise qualit (linguistique dans le cas de la A 144) peut, sans le vouloir, amener lchec dun projet . (Klimpt J.-E., 1999) Dans un projet aussi sensible que la Comparaison de variantes 1999 o des conflits potentiels sont importants, cest un aspect qui nest pas ngliger, le dtail pouvant sans raisons apparentes lemporter sur le global . Postulat 09
Des dtails anodins peuvent entraner lchec dun important processus concertatif
Le nouveau projet de la liaison A 400 entre Annemasse et Thonon est prsent par le reprsentant de la DDE de Haute-Savoie. Il remplace le projet dautoroute page dont la Dclaration dUtilit Publique (DUP) a t annule en mars 1997 par le Conseil dEtat38 suite une recours dorganisations cologistes. (Nouvelliste, 1997) Ce pro-
35 36
Par exemple, en combinant un tronon Est dune variante avec un tronon Ouest dune autre variante On verra par aprs que ces craintes taient fondes car si la solution retenue par le COPIL prsente un trac identique la variante des Communes rvise sur sa partie Est, son trac est bien diffrent des quatre variantes initiales dans le secteur de la fort de Vuillerez Il est remarquer que lors de cette sance, le mandataire externe prsente le systme des objectifs sous la forme dun tableau rcapitulatif identique celui prsent la page 44. Cependant, ce tableau est une adaptation du systme des objectifs utilis dans un projet semblable que le mandataire a ralis prcdemment. Ce projet est celui du pont de la Poya qui surplombe la Sarine dans la ville de Fribourg. (Infraconsult, 1999) Les quelques modifications apportes savrant insuffisantes (len-tte du document prsent contient par exemple le titre de la prcdente tude) pour passer dun systme dobjectifs adapts un contexte urbain un autre systme propre au contexte de la Comparaison de variantes 1999 , le mandataire externe prcise, en sexcusant auprs de lassemble, que certains des objectifs sont encore modifier Il sagit de la plus haute autorit judiciaire franaise ayant, dans ce cas, le rle du Tribunal Fdral en Suisse
37
38
50
LES ETUDES DE CAS
jet est intressant car il est bas sur une large concertation mene en 1998 afin de recueillir la majorit des participants.39 Il apparat que lamnagement routier prvu entre Evian et Saint-Gingolph est class en 3me priorit (ralisation long terme prvue en 2020) et sera surtout constitu de contournements de localits. Cette sance initiale namne que peu de contestations au sujet de la procdure choisie pour le droulement de la Comparaison de variantes 1999 . La bonne volont de lensemble des acteurs vouloir obtenir un consensus aprs tant dannes de conflit et la nouveaut apparente de la dmarche40 expliquent cet accueil favorable. Le chef du Service de lamnagement du territoire du canton du Valais fait remarquer que le systme des objectifs gnraux tel quil est prsent par le mandataire externe apporte une certaine confusion entre les aspects environnementaux, socioconomiques et ceux lis lamnagement du territoire. Il demande donc ce quun objectif gnral spcifique lamnagement du territoire soit rajout. La rponse du mandataire externe sa demande est ngative et assez surprenante car il lgitime ainsi son refus daugmenter le nombre dobjectifs gnraux : Le nombre de critres influence la pondration . Cependant le COPIL accepte cette demande, quil trouve justifie.
2.7.3
Deuxime sance du Comit de Pilotage
La deuxime sance du COPIL a lieu le 29 mars 1999 Villeneuve. Elle est consacre la description des quatre variantes initiales retenues pour la Comparaison de variantes 1999 , la dfinition du systme dobjectifs et expliquer le principe de la pondration raliser par les membres du COPIL. La procdure de modification du rapport technique propose par le mandataire externe consiste, lors des sances, passer en revue les unes aprs les autres les pages du rapport distribu aux membres du COPIL pour que chacun puisse, devant lassemble, proposer des modifications quil reste ensuite faire approuver par tous. Il sagit dun processus assez long mais qui prsente lavantage de structurer le travail lors des runions et dviter de longues discussions pouvant se perdre dans un dbat interminable.41 De nombreuses questions concernent ltendue du primtre dtude.42 Tout dabord, le reprsentant de lOFROU rappelle que le but de la Comparaison de variantes 1999 est dtudier le trac de la A 144 entre la A 9 et la RC 302. Par consquent, la problmatique du tunnel des Evouettes na pas tre traite ici. Par contre, les effets lis la A 144 qui sont ressentis hors du primtre dtude
39 40
Prs de 150 personnes ont particip cette concertation Les dclarations du reprsentant de lATE La proposition (de changement de mthode de travail) est nouvelle et intressante, car elle associe les dfenseurs de lenvironnement ou du reprsentant de lARMS Aprs plus de 30 ans de dmarches parallles, je suis du en bien illustrent bien laccueil favorable qui est rserv cette mthode de lAVU ralise par deux groupes de travail composs dun large panel dacteurs reprsentatifs. (Wichser F., 1998) On constatera dans la suite de cette thse que cette mthode nest pas si novatrice quelle en a lair aux yeux de ces acteurs et quelle est plutt classique vis--vis dautres mthodes daide la dcision multicritre. Par contre, elle tranche nettement avec la mthodologie retenue alors (tudes menes en parallle notamment)
41 42
Malheureusement, cela ne sera pas forcment toujours le cas ! Il sagit dun souci rcurrent, vu quil a dj bien occup le COPIL durant la sance prcdente
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
51
(dveloppement macro-rgional par exemple) seront considrs, notamment lors de lapprciation des variantes. Cependant, malgr toutes ces prcisions, le dbat revient rapidement sur le trac de la RC 302 aux alentours des Evouettes. Le reprsentant vaudois de Pro Natura se demande si louvrage souterrain de contournement projet est vraiment ncessaire, son cot de ralisation tant lev. Dautres reprsentants des associations de protection de lenvironnement lui embotent le pas et reposent le problme des dimensions du primtre de ltude. Il est aussi fait mention que le tronon routier entre Evian et la Suisse est prvu trs long terme, sans tre encore certain, et quil ne sert rien de prcipiter les choses en Suisse.43 Ce bouillonnement dides commenant loigner le dbat de la finalit de la Comparaison de variantes 1999 , le conseiller dEtat vaudois rpond ces dtracteurs que ces questions, mme si elles sont lgitimes, ne rentrent pas du tout dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 et quil ne sagit pas ici dtudier lensemble des rseaux de transport du Chablais suisse et franais. Ceci montre bien quil est important de prciser rapidement les limites dune tude et les attentes quon peut en avoir. Sans ces prcisions, les dbats risquent vite de se disperser ou de sterniser. Postulat 10
Les limites et les attentes de ltude doivent tre clairement dfinies avant de dbuter le projet
Le mandataire externe prsente le dtail du systme des objectifs retenu pour la Comparaison de variantes 1999 . Il prcise que les cinq premiers objectifs gnraux (voir page 44) concernent la phase dexploitation (environ 100 ans) tandis que le sixime objectif gnral soccupe de la phase de ralisation (2 3 ans). Il prcise aussi que les indicateurs prsents constituent uniquement une proposition. Il peut y avoir des ajouts ou des suppressions en cours dtude.44 La pertinence de la mesure de certains indicateurs est ensuite discute par le COPIL. Il sensuit des discussions plutt techniques (demandes de prciser certaines valeurs, ncessit de sparer des indicateurs, problmes de dialectique, etc.) qui ne suscitent pas de franches polmiques mais consistent plutt en lajout de certaines descriptions ou en des corrections mineures. Le mandataire externe prsente ensuite le questionnaire sur la pondration qui est distribu lensemble des membres du COPIL. Celui-ci doit tre complt dici la miavril 1999 en respectant certains principes admis par lensemble de lassemble : chaque membre du COPIL effectue sa propre pondration en toute indpendance si chacun a sa propre sensibilit, il sagit toutefois de tenter dtre le plus objectif possible en effectuant, comme le prcise le conseiller dEtat valaisan, honntement sa propre pese dintrts
43 44
Peut-on parler de prcipitation au sujet dun projet tudi depuis si longtemps ? Cette proposition faite au COPIL est curieuse. En effet, ces indicateurs sont purement objectifs et ne devraient normalement tre discuts uniquement que dans le cadre du GT
52
LES ETUDES DE CAS
chacun est invit, sans que cela soit une obligation, justifier sa pondration auprs du mandataire externe les poids des objectifs sont attribus en %. La somme des divers poids dune catgorie dobjectifs identiques dans le systme dobjectifs vaut 100 %45 en prsence de plus de deux objectifs dans une catgorie donne, le poids maximal pour un objectif est fix 50 % le poids minimal attribu un objectif est de 10 %46 on peut attribuer le mme poids deux objectifs diffrents on se doit deffectuer la pondration de tous les objectifs gnraux et partiels sans en omettre aucun47
Le mandataire externe traite confidentiellement les documents reus de la part des membres du COPIL. Ainsi, les valeurs des pondrations tablies ne sont pas rendues publiques.48 Il est prcis aussi que les rsultats de la pondration des objectifs seront prsents lors de la prochaine sance du COPIL. Un communiqu de presse est publi. (DINF, 1999b) Intitul Quatre variantes sous la loupe de lanalyse multicritres , il rappelle le lancement de la Comparaison de variantes 1999 et annonce que Le comit de pilotage a dmarr lanalyse multicritres et a dcid dexaminer quatre variantes. Il est prcis que chaque membre du COPIL se prononcera sur les pondrations et pourra ainsi contribuer au choix dune variante optimale .
2.7.4
Troisime sance du Comit de Pilotage
La troisime sance de travail du COPIL a lieu le 21 mai 1999 Villeneuve. Lors de la lecture du procs-verbal de la sance prcdente pour approbation, le reprsentant vaudois de Pro Natura prcise que Le tunnel des Evouettes nest pas le
seul trac possible pour contourner cette localit. Il existe une tude dune route grand trafic longeant la ligne du Tonkin et permettant lvitement du village des Evouettes .49
45
Ce choix de fixer la somme des diffrents poids dobjectifs au sein dune catgorie dfinie une valeur finie de 100 % nest pas strictement ncessaire. Il permet cependant lensemble des acteurs de se rendre compte aisment et rapidement de limportance relative dun de ces objectifs par rapport la catgorie laquelle il appartient. Cette problmatique fera lobjet dun dveloppement particulier aux pages 96ss Ces prcautions instituant des pondrations maximales et minimales sont ncessaires pour viter toute tentation un acteur de vouloir raliser une analyse monocritre (un critre 100 %, les autres 0 %) Cette remarque sexplique par le fait quun participant souhaitait ne pondrer que les objectifs partiels Lauteur a pu disposer des diverses pondrations ralises par les membres du COPIL. Je profite au passage de remercier M. G. Roth du bureau IC Infraconsult pour avoir rpondu favorablement ma demande et mavoir gracieusement mis disposition, et sous une forme adquate, toutes ces sources. Toutefois, une certaine confidentialit a t respecte lors de la transmission de ces documents. Seule lappartenance des acteurs aux diffrents catgories dacteurs du COPIL dfinies au chapitre 2.6.1.1 (pages 39ss) est connue de lauteur On peut remarquer ici que labsence de variantes sur le sol valaisan pose de nombreux problmes. Comme les documents mis disposition du COPIL nindiquent quun seul trac, certains membres de lassemble, notamment les associations de protection de lenvironnement, ont tendance croire que le projet retenu pour le tunnel dvitement des Evouettes na pas fait lobjet dtudes de variantes. Une tude comparative et une tude dimpact ont pourtant t ralises comme le relve lors de la sance le conseiller dEtat valaisan. On voit donc toute limportance quil y a ne pas se contenter dindiquer uniquement les rsultats dune tude mais de bien prsenter lensemble des variantes tudies et de prciser la mthode utilise pour arriver au rsultat final
46
47 48
49
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
53
Cette remarque amne la reprsentante de lOFEFP, qui tait absente lors du dbat de la prcdente sance du COPIL au sujet du primtre dtude, demander que ce dernier soit tendu. Selon lOFEFP, il sagit dintgrer lensemble de la liaison routire entre lautoroute A 9 (jonction de Villeneuve) et la frontire franco-suisse Saint-Gingolph dans la Comparaison de variantes 1999 . De plus, elle demande quune tude dopportunit de la A 144 et du tunnel des Evouettes soit ralise.50 Comme on peut sen douter, ces propositions lectrisent lassemble et la discussion commence driver hors des points de lordre du jour. Tout dabord le dbat senvenime sur le tunnel des Evouettes. Si pour certains, on ne doit pas vacuer ce problme de la Comparaison de variantes 1999 , pour dautres la A 144 va des Evouettes Villeneuve et il ne sagit pas dtudier dautres routes. Lexamen dopportunit demand par la reprsentante de lOFEFP est fortement contest, notamment de la part des syndics prsents. Il est rappel que lOrdonnance Fdrale de 1961 indique clairement que la A 144 est une route principale suisse et que la mission du COPIL est uniquement de raliser la comparaison de variantes et de rechercher une solution consensuelle pour le tronon entre Villeneuve et les Evouettes. La justification de la A 144 est purement politique et demeure du ressort de la Confdration, pas du COPIL. Cet avis est partag par de nombreux acteurs et la discussion est ensuite close par les deux conseillers dEtat qui estiment que le mandat du COPIL est clair ce sujet.51 Ils dsirent aller de lavant et ne pas se perdre dans de longs dbats. Cette phase de confusion dans le dbat montre quil est ncessaire que celui-ci soit dirig et que des limites soient fixes, non pas pour rduire les arguments, mais pour viter la dispersion. Postulat 11
Le dbat dans un groupe de travail comprenant de multiples acteurs doit tre fermement dirig pour respecter une certaine progression dans la maturation des ides
Le refus du COPIL de procder une nouvelle tude dopportunit de la A 144 et de modifier les dimensions du primtre dtude fait dire la reprsentante de lOFEFP que son office se rserve un avis libre . Ce discours, qui signifie que lOFEFP ne tiendra pas compte des rsultats consensuels de la Comparaison de variantes 1999 , entrane une vive raction de la part du conseiller dEtat valaisan qui refuse que chaque acteur naccepte les rsultats dune tude concertative que sils lui sont favorables. Il en va de la crdibilit de la Comparaison de variantes 1999 qui doit aboutir un rsultat consensuel sans risque dun veto impos par un des acteurs. Ceci montre limportance de lexplication mener auprs des acteurs de lensemble des rgles du jeu concertatif et des objectifs de celui-ci. Il est ncessaire que chaque membre du groupe dtude soit conscient que le rsultat ne peut pas forcment convenir tout le monde et quil sera le fruit dun consensus.
50
Il est demand au COPIL de montrer dune manire transparente et solide si la ncessit dune liaison existe et de
prciser son standard
51
Ils prcisent aussi que ltat de rfrence nest en aucune manire une stratgie envisageable
54
LES ETUDES DE CAS
Lacceptation de la mthodologie choisie doit tre ralise au dbut de ltude et non pas la fin quand le rsultat va dans la direction souhaite.52 Postulat 12
Un acteur participant un processus concertatif doit en accepter les rsultats mme sils ne les partagent pas
La suite de la sance consiste en des modifications mineures portant sur la description des variantes et le contexte des transports. Il est prcis que les variantes 0+ qui ont un trac identique la route actuelle seront en fait de nouvelles ralisations car le profil gomtrique doit tre entirement modifi. Il est aussi dcid que la publication dun communiqu de presse nest pas opportune ce niveau de ltude, car seul le rsultat de ltude intresse le public.
2.7.5
Runion de coordination OFROU - OFEFP
Afin de rgler dfinitivement les polmiques au sujet de ltendue du primtre dtude adopter pour la Comparaison de variantes 1999 , une runion de coordination a lieu le 4 juin 1999 entre lOFEFP et lOFROU pour dterminer le primtre dtude et lamnagement de la A 21. Ces deux offices tombent daccord sur les points suivants : le primtre de ltude tel que retenu initialement par le COPIL est confirm : liaison routire A 144 entre la jonction autoroutire de Villeneuve et le portail Sud du tunnel des Evouettes le projet de lamnagement de la A 21 entre les Evouettes et Saint-Gingolph sera tudi sparment de la Comparaison de variantes 1999
2.7.6
Troisime sance du Groupe Technique
La troisime sance de travail du GT a lieu le 15 juin 1999 Villeneuve.53 Cette sance est principalement consacre lapprciation des variantes qui est ralise en deux tapes :54 description des effets des variantes attribution des notes aux effets selon lchelle prtablie (notes relatives par rapport ltat de rfrence en 1995 et allant de -3 + 3 par pas de 0,5)
Les notes ainsi obtenues seront ensuite proposes au COPIL.55
52
En utilisant une mtaphore sportive, on peut formuler ceci de la manire suivante : il est ncessaire, pour que le rsultat soit admis par tous, que les rgles du jeu soient connues et adoptes par tous les joueurs au dbut du match et quelles ne soient plus contestes ensuite. La contestation peut par contre concerner leur mise en application, la qualit de larbitrage par exemple Lauteur na pas particip aux deux premires sances de travail du Groupe Technique. Cest partir du moment o slaborait lapprciation des variantes, aspect intressant directement la thse, quil a t jug opportun dy participer Cette apprciation est une opration objective consistant simplement transformer des valeurs dindicateurs, exprimes par de multiples units, en des valeurs comparables sur une chelle donne. Ces apprciations sont plus communment dsignes par le terme de notes
53
54
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
55
Afin davancer rapidement lors de la runion, il est dcid didentifier initialement les effets pour lesquels il y a un consensus et de revoir ensuite les effets pour lesquels lapprciation pose un problme et ncessite une discussion approfondie. Les apprciations suscitent surtout des dbats techniques56 ou des demandes de modifications mineures. Il est relever que le climat de travail est moins passionnel que lors de la dernire sance du COPIL. Le mandataire externe prsente ensuite les premiers rsultats de lapprciation au moyen de diffrents profils comparatifs.57 Il sagit de profils dapprciation, semblables des courbes de fivre , qui indiquent simultanment les rsultats de deux variantes, ce qui permet de les comparer rapidement entre elles. Ces profils prsentent graphiquement deux informations : les notes dapprciations des variantes dune part et les carts entre les deux variantes dautre part. Un exemple dun tel profil comparatif est prsent ci-dessous : Objectif gnral
1. Transport
Objectifs partiels
-3 Transport motoris Trafic piton et deux-roues Transports collectifs Transport agricole
Notes dapprciation
-2 -1 0 +1 +2 +3
2. Moyens financiers
Investissement Entretien et exploitation
3. Remplir au mieux les objectifs de lamnagement du territoire 4. Rduire les nuisances sur lenvironnement
Utilisation mesure du sol Compatibilit buts et plans Environnement humain Environnement naturel Autres nuisances
5. Favoriser le dveloppement conomique
conomie micro-rgionale conomie macro-rgionale Nuisances locales Nuisances sur la circulation Nuisances gnrales
6. Limiter les nuisances dues
aux travaux
Variante 0+ rvise Avantages relatifs de la variantes Communes rvise
Variante Communes rvise Dsavantages relatifs de la variantes Communes rvise
Figure 11
Exemple de profil dapprciation permettant de comparer deux variantes (Infraconsult, 2000)
55
Dans le cas dune stricte sparation des tches entre un COPIL ralisant une pondration de manire subjective et un GT attribuant des notes objectivement, cette opration ne devrait pas avoir lieu La transformation des indicateurs en notes a t sommairement prsente au chapitre 2.6.3.4. Certaines de ces fonctions dutilit seront dveloppes dans le chapitre 8 consacr laide multicritre la dcision Les apprciations ont t ralises par le mandataire externe et le GT a simplement le rle den discuter afin de les accepter ou de proposer des modifications. Il est cependant surprenant que ces profils comparatifs soient prsents lassemble et surtout comments car les apprciations des diffrentes variantes ne sont pas encore dfinitives. On risque ainsi de tirer des conclusions htives et prcoces par cet exercice danalyse
56
57
56
LES ETUDES DE CAS
Ces graphes sont jugs peu clairs par les membres du GT et ils namnent que peu damliorations dans les jugements. Il faut souligner aussi que ce mode de reprsentation peut tre trompeur, car il donne limpression que tous les critres ont un poids identique. Quatre profils comparatifs ont t raliss et amnent les commentaires suivants : Comparaison entre ltat de rfrence en 1995 et ltat de rfrence en 2005 Comme on pouvait sen douter, il y a une dgradation, voir une stagnation, pour lensemble des critres.58 La note minimale pour ER(1) est de -1, correspondant une lgre dgradation par rapport la situation actuelle Comparaison entre les deux variantes 0+ Les deux variantes ont des profils trs semblables (cart de notation maximal de 1,5). Elles prsentent peu dinconvnients majeurs, mis part les nuisances dues aux travaux, mais elles ont aussi peu davantages importants (note maximale de +1,5), ce qui fait que leur profil serpente autour de la note 0. On peut remarquer que pour le trafic, la variante adapte est la meilleure Comparaison entre les deux variantes des Communes Ici aussi ces deux variantes ont des profils trs semblables avec un cart de notation maximal de 1. La variante rvise prsente plus de critres favorables que la variante adapte.59 Par contre, le profil est plus accentu passant de la note maximale pour le transport la note minimale pour linvestissement Comparaison entre les deux variantes rvises En regard des comparaisons prcdentes qui prsentaient des profils plus ou moins semblables, ce qui est comprhensible car on analysait des variantes poursuivant les mmes objectifs, la comparaison entre la variante des Communes rvises et la variante 0+, qui sont la concrtisation de deux stratgies opposes,60 montre des profils trs diffrents. Lcart de notation maximal est de 2 points lavantage de lune ou de lautre variante. Il est cependant intressant de remarquer quil ny a aucun objectif partiel o les notes des deux variantes sont de signe contraire. La variante des Communes est nettement suprieure la variante 0+ pour le transport,61 lamnagement du territoire, le dveloppement conomique et les nuisances dues au chantier. Par contre, la variante 0+ lui est suprieure pour les moyens financiers et lenvironnement. Cest pour lanalyse de ce profil comparatif entre des variantes fortement diffrencies quune mthode daide multicritre la dcision se rvle tre indispensable pour tablir un jugement. Il est en effet impossible de porter immdiatement un jugement sur la qualit globale dune variante par rapport une autre.
58 59
On peut se demander quel est le rel intrt de cette comparaison tant le rsultat est vident Cette rflexion est cependant considrer avec prudence en regard des dfauts du mode de reprsentation utilis, les critres les plus favorables pouvant tre ceux qui ont la plus faible pondration ! Variantes des Communes : standard dune route rserve au trafic motoris (site propre) et nouvelle infrastructure / Variantes 0+ : trafic mixte et rutilisation des routes existantes Il sagit mme l dun cart significatif pour cet objectif gnral qui traduit la diffrence de standard de circulation attribu la variante
60
61
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
57
Les principales apprciations controverses lors de la discussion qui sensuit sont les suivantes : les effets sur le dveloppement conomique sont difficiles estimer, notamment au niveau macro-rgional o lon se base sur des impressions lobjectif partiel de lenvironnement humain mlange plusieurs indicateurs comme le bruit et le paysage, ce qui amne une certaine confusion. Ceux-ci pouvant se compenser,62 il est demand soit dindiquer clairement leur pondration technique ou alors de sparer cet objectif en plusieurs objectifs partiels63 pour les notes concernant la faune et la flore, le fait que celles qui sont attribues aux variantes des Communes, qui traversent la fort de Vuillerez, soient toutes notes avec la note la plus basse (-3) entrane une vive discussion. En effet, la zone des Grangettes a une valeur naturelle bien plus grande que cette fort de Vuillerez. Ainsi, une atteinte la zone des Grangettes devrait tre bien plus pnalise (-3) quune atteinte cette fort de Vuillerez (-1,5). Aprs une vive discussion, le GT dcide nanmoins de conserver cette notation. On voit donc apparatre dans ce dbat toute la problmatique de la correspondance adopter entre les notes extrmes et les valeurs des indicateurs, telle que prsente par exemple par (Dumont A.-G. et Tille M., 1997) la problmatique de la fonction dutilit liant les indicateurs aux notes est voque aussi pour les cots de ralisation et dentretien car les carts entres les valeurs des indicateurs ne sont pas en proportion avec les carts entre les notes
Les participants relvent aussi que lchelle des notes adopte64 pose certains problmes de diffrenciation entre des variantes prsentant des carts minimes dapprciation. Les limites de la notation des mthodes AVU pour des variantes prsentant des diffrences faibles, mais perceptibles, apparaissent ainsi aux yeux des acteurs. Les quelques modifications de notes adoptes par le GT sont mineures et ne changent que peu les profils dapprciation. Les commentaires tablis auparavant restent donc identiques.
62
Par exemple, une paroi de protection contre le bruit amliore la note nuisances sonores mais minore la note qualit paysagre Le mandataire externe ralisera un tableau dans le rapport technique (Infraconsult, 2000) qui rcapitule les points positifs ou ngatifs de chaque variante vis--vis des indicateurs. Lattribution dune apprciation partir dun tel tableau est cependant un exercice prilleux car il est trs difficile destimer limportance relative de chaque indicateur Il existe 13 possibilits de notes (carts de 0,5 points entre 3 et +3). Cependant, pour de nombreux critres, les valeurs dapprciation des variantes sont souvent dun signe identique, ce qui restreint le nombre de notes possibles. Cest le cas par exemple du critre du cot de construction o toutes les notes sont ngatives, car elles demandent un investissement qui nest pas raliser si lon ne fait rien (tat de rfrence)
63
64
58
LES ETUDES DE CAS
2.7.7
Quatrime sance du Comit de Pilotage
La quatrime sance de travail du COPIL a lieu le 2 juillet 1999 Villeneuve. En raison de labsence du reprsentant de lOFROU, cest le directeur de cet Office fdral, Monsieur Olivier Michaud,65 qui prside cette runion. Lannonce des dcisions prises lors de la runion de coordination entre lOFEFP et lOFROU tenue le 4 juin66 dsamorce les tensions qui commenaient se faire jour au sein du COPIL et dissipe bien des malentendus. Cette sance est principalement consacre la prsentation par le mandataire externe des rsultats de lapprciation des variantes, ceci au moyen des profils dapprciations comparant les variantes deux par deux.67 La discussion se droule ensuite en passant successivement en revue les apprciations de chaque objectif partiel ralises par le GT. Il en ressort les remarques principales suivantes : Besoins en transport La question du standard de la future A 144 est souleve car lhtrognit de celui-ci entre Villeneuve et Evian va subsister durant quelques annes. Il est dcid toutefois de raliser une infrastructure routire en considrant un horizon de planification long terme, voir trs long terme, cest dire en adaptant ses caractristiques ce que lon veut obtenir pour lensemble de la liaison Annemasse - Villeneuve et non pas en fonction de ce qui existe actuellement. Un intervenant souligne tout de mme quil serait judicieux de dfinir quel est le standard adquat pour la A 144, car il est clair quentre les variantes 0+ et les variantes des Communes, on ne compare pas seulement des tracs diffrents mais aussi des standards distincts (trafic mixte ou uniquement motoris).68 Les effets sur les pitons, les deux-roues ou le trafic agricole sont aussi sujets quelques discussions. Il est rpondu que ces aspects seront mieux dtaills et pris en considration dans loptimisation des variantes. Moyens financiers La demande du mandataire externe de tenir compte des subventions fdrales pour apprcier les cots dentretien est considre par le conseiller dEtat valaisan comme ntant pas une question pertinente :
-
le taux de subventionnement peut varier, notamment avec la nouvelle rpartition des tches entre la Confdration et les Cantons seul le cot total pour la socit doit entrer en ligne de compte. Considrer uniquement le cot support par les cantons est une vision trique
Ces remarques sont appuyes par le prsident de la sance qui propose une modification de cet objectif partiel, ce qui est accept par le COPIL.
65 66
Dsign par le terme de remplaant de luxe par certains participants Les deux offices fdraux se sont mis daccord sur les limites donner au primtre dtude de la Comparaison de variantes 1999 : jonction autoroutire de Villeneuve et portail Sud du tunnel des Evouettes Il sagit des mmes profils que ceux dcrits aux pages 55ss Cette question na pas t franchement rgle et est souvent source dpres discussions. On reviendra plus en avant dans ce rapport de thse sur le problmes lis ce mixage ralis avec deux standards diffrents et deux tracs diffrents
67 68
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
59
Amnagement du territoire La notation de cet objectif gnral est source de multiples incomprhensions de la part du COPIL. De nombreux intervenants proposent de prciser mieux certains indicateurs et de modifier des notes. Il est demand au GT de revoir les notes des deux objectifs partiels et raliser une synthse de meilleure qualit.
Environnement La pondration technique ralise pour lobjectif partiel concernant lenvironnement humain suscite beaucoup dinterrogation. Limportance attribue limpact visuel, qui est nettement surestim par rapport aux nuisances sonores ne semble pas tre justifie.69 L aussi, il est demand au GT de revoir cette pondration technique.70 Le fait que toutes les notes concernant lenvironnement humain soient ngatives surprend de nombreux membres du COPIL car le but de la A 144 est justement de rduire les nuisances pour les riverains, voire de les liminer. Comme lors de la dernire sance du GT, il y a des interrogations au sujet du calibrage de lapprciation de lobjectif partiel concernant la faune et la flore. Le fait que la variante des Communes qui vite la zone de haute sensibilit des Grangettes soit avec une note minimale de -3 amne beaucoup de commentaires. Il est aussi demand au GT de revoir ce calibrage.
conomie Ici aussi, il apparat des problmes de calibrage. Des intervenants demandent ce que les variantes des Communes se voient attribuer la note maximale de +3 vu que elles rpondent 100 % aux besoins macro-conomiques . Le GT reoit aussi, pour cet objectif gnral, la mission de revoir le calibrage et de mieux dvelopper largumentation qui semble tenir, selon le reprsentant de lATE, dun acte de foi vu labsence de toute tude prouvant clairement lapport conomique de la A 144
Ainsi, le COPIL demande au GT de rexaminer les notes de huit objectifs partiels.
69
Les acteurs la base de cette constatation sont surtout les syndics des communes dont les habitants subissent directement dimportantes nuisances sonores. Le mandataire externe semble apporter beaucoup dimportance au site paysager de la Porte-du-Scex qui, mme sil est protg par le canton du Valais, nest cependant quun site relativement banal en comparaison dautres sites paysagers de valeur situs proximit (chteaux de Chillon ou dAigle, rives du lac Lman, etc.). Ceci est lillustration parfaite de la diffrence de perception dun paysage selon le point de vue dun habitant de la zone dtude (paysage vcu) et la perception plus collective de la valeur culturelle du patrimoine paysager (Tille M. et Dumont A.-G., 2000)
70
Lagrgation de diffrents indicateurs trs diffrents (atteinte au paysage naturel ou construit, nuisances sonores, accidents majeurs et pollution atmosphrique) ralise pour cet objectif partiel est la base de ces remarques. Il aurait t srement prfrable, tout comme demand la sance du GT du 15 juin, de sparer cet objectif partiel en plusieurs parties indpendantes
60
LES ETUDES DE CAS
Les rsultats de la pondration du systme des objectifs sont ensuite dcrits par le mandataire externe. Il y a 36 pondrations disposition : 28 proviennent du COPIL71 et 8 du GT.72 Il en ressort certaines remarques, qui sont peu discutes par le COPIL, et qui seront reprises dans les chapitres 5 et 8. Les rsultats provisoires73 de lanalyse des valeurs dutilit sont ensuite prsents au COPIL. Deux modes danalyse de ces rsultats ont t utiliss : la dtermination dune valeur dutilit base sur une moyenne des pondrations qui ont t ralises par les membres du COPIL et les membres du GT74 un classement du nombre de fois quune variante est prfre en calculant les valeurs dutilit pour chaque pondration individuelle
La moyenne des pondrations qui ont t ralises par les membres du COPIL et les membres du GT donne les rsultats suivants :
Rang Variante Valeur dutilit
COPIL 1 2 3 4 5 Communes rvise Communes adapte 0 adapte 0 rvise tat de rfrence 2005
+ +
GT 0,73 0,67 0,24 0,21 - 0,55
0,40 0,32 0,10 0,10 - 0,49
Tableau 12
Rsultats de lanalyse des valeurs dutilit (Infraconsult, 2000)
On remarque que toutes les variantes initiales amnent globalement une amlioration vis--vis de ltat de rfrence en 1995 et que le choix de ne rien faire , qui correspond ltat de rfrence en 2005, prsente des rsultats globaux nettement infrieurs ces variantes. Par contre, cette amlioration donne au maximum une apprciation globale infrieure la note +1, ce qui correspond selon
71
Sur les 32 membres du COPIL (voir le chapitre 2.6.1.1 la page 39), 2 ne sont pas comptabiliss car ils ne sont pas reprsentatifs des intrts en jeu autour de la A 144 (le mandataire externe et lauditeur) et 2 membres du COPIL, faisant tous les deux parties du groupe dacteurs N3 Associations de dveloppement conomique , nont pas rpondu au questionnaire pour des raisons inconnues Normalement, dans une comparaison de variantes ralisant une totale indpendance entre la phase de pondration et la phase de notation, les membres du GT, qui ont attribu les notes dapprciation, ne devraient pas participer la pondration des objectifs. Lors de lanalyse des diffrentes pondrations selon les profils dacteurs qui sera ralise dans les chapitres spcifiques 5 et 8, les pondrations des membres du GT ne seront pas pris en compte pour cette raison Ils sont en effet provisoires car ils sont prsents sous rserve des modifications des notes proposes lors de la prsente sance. Ce procd est un peu cavalier de la part du mandataire externe, car il suppose que les modifications apportes par le COPIL sont sans influence sur le rsultat final. Cela sera effectivement le cas, car les variantes ont des rsultats bien diffrencis. Mais si ceux-ci avaient t proches, il y aurait pu avoir un basculement des prfrences avec une faible modification des apprciations. Dans ce rapport de thse, seules les notes dfinitives attribues chaque variantes sont indiques, lauteur ne jugeant pas ncessaire de donner le dtail de lvolution de ces apprciations. Les diffrentes valeurs dutilit obtenues au cours de la Comparaison de variantes 1999 sont par contre exposes. Les notes dapprciation dfinitives sont prsentes dans le Tableau 15 la page 79
72
73
74
Ce genre de moyenne na de sens que si le nombre dacteurs reprsentant certains avis est plus ou moins quilibr, ce qui nest de loin pas le cas dans la Comparaison de variantes 1999
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
61
les dfinitions du Tableau 4 de la page 43 une lgre amlioration par rapport la situation actuelle . On peut donc en conclure que ces variantes prsentent encore un grand potentiel damlioration. Les valeurs dutilit dtermines selon la pondration individuelle de chaque membre du COPIL ont t calcules. Le classement du nombre de fois quune variante arrive en tte est prsent dans le tableau suivant :
Variante
Communes rvise Communes adapte 0 adapte 0 rvise tat de rfrence 2005
+ +
Prfre
19 fois 5 fois 3 fois 1 fois
Tableau 13
Classement des valeurs dutilit dtermin selon les pondrations individuelles des membres du COPIL (Infraconsult, 2000)
On arrive aux mmes conclusions quavec la mthode prcdente avec 86 % de prfrence pour une des variantes des Communes.75 Il est noter que le classement des valeurs dutilit dtermin selon les diffrentes pondrations individuelles du GT donne lunanimit la variante des Communes rvise classe en tte. Ces rsultats provisoires montrent clairement que globalement les deux variantes des Communes prcdent nettement les variantes 0+ et que ltat de rfrence en 2005 est insuffisant. Le mandataire externe en tire le constat suivant, prsent la page 93 de (Infraconsult, 2000) : les rsultats dmontrent linfluence prdominante du choix de la stratgie ( standard) pour le rang dune variante ; lintrieur de chacune de ces
stratgies, les diffrences entre la variante adapte et la variante rvise sont peu importantes (influence du trac) . A la page prcdente du mme document, il
affirme que les critres lis aux tracs (moyens financiers, environnement et travaux) ont fait lobjet dune grande unanimit au sein du GT tandis que pour les objectifs lis aux standards (amnagement du territoire, trafic et conomie) les apprciations sont diffrentes. Ces propos corroborent les commentaires apports la page 56 pour la Comparaison entre les deux variantes rvises. Cependant, lauteur ne partage pas entirement les conclusions du mandataire externe comme expliqu dans le chapitre 2.8 la page 82. Comme conclusion de ltude, le mandataire externe demande ce que le GT soit charg doptimiser les variantes afin damliorer leurs performances. Le COPIL confirme cette suite des tudes et donne mandat au GT dliminer les points faibles des variantes.
75
Il est cependant intressant de remarquer quune pondration individuelle donne ltat de rfrence en 2005 comme variante prfre. Comme on le verra dans le chapitre 8, il sagit dune pondration extrme donnant 50 % de pondration pour lobjectif gnral Utilisation des moyens financiers
62
LES ETUDES DE CAS
Un communiqu de presse est ensuite prsent aux membres du COPIL, qui approuvent sa publication. (DINF, 1999c) Il comporte les points principaux suivants : rcapitulation des travaux effectus depuis le mois de fvrier 1999 par le COPIL et le GT avantages et inconvnients principaux relevs pour les quatre variantes initiales ncessit de proposer un nouveau trac : Le COPIL reconnat que la situation actuelle dans la rgion est insatisfaisante et quil faut dsenclaver le Chablais suite des tudes : optimisation des variantes qui seront prsentes la prochaine sance
2.7.8
Quatrime sance du Groupe Technique
La quatrime sance de travail du GT a lieu le 6 juillet 1999 Villeneuve. Cette sance est principalement consacre au rexamen des notes dapprciation des variantes selon les diverses remarques effectues par le COPIL lors de la sance du 2 juillet. Lorganisation de ltude doptimisation des variantes est aussi discute. Une rflexion initiale est effectue sur le calibrage et le mandataire externe insiste sur la correspondance entre les notes et ltat descriptif de celle-ci telle quelle est prsente dans le Tableau 4 de la page 43. Dans un souci de cohrence entre les diffrents objectifs, il est dcid aussi que les variantes extrmes ne doivent pas forcment correspondre la note +3 ou -3. Une discussion trs intressante, amene par le chef du service de lamnagement du territoire du Valais, concerne les rles donner au COPIL et au GT, car il semble que certains membres du COPIL ne matrisent pas encore la mthodologie de ltude . Le fait que les notes du GT soient discutes par le COPIL ne semble pas tre cohrent pour de nombreux participants. Les discussions portent ensuite sur ladaptation de certaines notations, la redfinition de quelques calibrages et des modifications sur des indicateurs. Cette discussion essentiellement technique ne sera pas entirement commente ici. On peut remarquer, pour lamnagement du territoire, une diffrence de conception entre les deux cantons concerns par la Comparaison de variantes 1999 . Si pour le Valais, le but est de raliser un dveloppement des localits, pour Vaud, le but est de maintenir le caractre rural des villages de la plaine. Pour lattribution des notes de cet objectif gnral, la discussion est vive et le consensus est difficile obtenir au sein du GT car ces deux visions cantonales saffrontent. La pondration technique de lobjectif partiel Environnement humain doit tre modifie, selon les propositions du COPIL, en donnant la priorit aux nuisances sonores vis--vis de limpact visuel. Il est dcid de mettre ces deux indicateurs au mme niveau dimportance.76
76
Limpact visuel est jug long terme (un paysage dgrad est perdu) mais ayant des effets sur une faible population (visiteurs) comparativement aux nuisances sonores juges court terme (une paroi antibruit peut les attnuer) mais ayant des effets sur une importante population (riverains)
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
63
Loptimisation des quatre variantes suscite un dbat sur sa ncessit car le mandat initial prcisait que seule la meilleure variante la suite de lanalyse des valeurs dutilit tait optimiser. Un groupe de travail restreint77 est charg par le GT dlaborer un plan de contraintes complet, un tel document, pourtant indispensable dans tout projet dtude dune nouvelle infrastructure routire, tant absent.78 Des donnes complmentaires sont aussi rcolter pour cette phase doptimisation. Ce groupe de travail restreint proposera ensuite des changements tudier pour chaque variante.
2.7.9
Cinquime sance du Groupe Technique
La cinquime sance de travail du GT a lieu le 18 aot 1999 Villeneuve. Lauteur na pas pu participer cette runion, mais il dispose du procs-verbal de celle-ci. Lanalyse des valeurs dutilit effectue avec les notes corriges lors la sance du GT du 6 juillet 1999 donne les mmes rsultats que pour la premire analyse effectue en juin. Les variantes des Communes sont toujours nettement en tte du classement avec un cart encore plus significatif par rapport aux variantes 0+. Par contre, la valeur dutilit maximale volue peu et reste infrieure la note +1.
Rang Variante Valeur dutilit
COPIL 1 2 3 4 5 Communes rvise Communes adapte 0 rvise 0 adapte tat de rfrence 2005
+ +
GT 0,93 0,88 0,28 0,27 - 0,55
0,63 0,55 0,17 0,13 - 0,49
Tableau 14
Rsultats de lanalyse des valeurs dutilit avec les corrections du COPIL (Infraconsult, 2000)
Le plan des contraintes est prsent par le mandataire spcialis en environnement. Il est bas sur les zones lgalises79 des communes de Noville, Chessel et Vouvry,80 les valeurs naturelles des forts, linventaire des monuments naturels et des sites du canton de Vaud et des contraintes ponctuelles (habitation isoles par exemple). La fort de Vuillerez est une fort humide de grande valeur naturelle (zone inondable et site de reproduction de batraciens). Le reprsentant du Service des Routes du canton du Valais signale au GT que la paroi rocheuse en aval de la Porte du Scex est une zone dinstabilit et dombre qui risque de crer dimportants problmes pour lentretien des variantes ncessitant un dplacement de la RC 302 vers louest (variante 0+ rvise par exemple).
77
Il est compos de trois membres du GT (mandataire externe, reprsentant du Services des Routes du Canton de Vaud et mandataire spcialis en environnement) et dun bureau dingnieur civil (SD ingnierie Lausanne) Un participant remarque que faute de donnes suffisantes, le GT navigue vue Il y a notamment des zones de camping (Grand Bois entre Chessel et Crebelley), de golf (sur la rive droite du Rhne, entre les Iles Ferrandes et Chessel), de protection de la nature, de protection du paysage (cordons boiss le long du Rhne en aval de la Porte du Scex), de village, etc. Le plan de contraintes est incomplet car il ne comprend pas le communes de Rennaz et de Roche qui sont pourtant situes dans le primtre dtude
78 79
80
64
LES ETUDES DE CAS
Les potentiels doptimisation suivants sont retenus par le GT : pour les variantes des Communes, le trac doit viter la fort de Vuillerez afin de diminuer les impacts ngatifs lis la traverse actuelle (dfrichement) pour les variantes 0+, il sagit de garantir un standard de route sans trafic mixte et damliorer la jonction avec la RC 302 au droit de la Porte du Scex
Au Verney, proximit du hameau de Crebelley, les quatre variantes initiales se croisent et sparent ainsi ces variantes en deux tronons est et ouest. Le GT dcide que la combinaison de ces tronons81 sont envisageables. Les premiers rsultats des tudes doptimisation menes depuis la dernire sance du GT par le groupe de travail restreint amnent les constations suivantes : Optimisation des variantes des Communes
-
le contournement de la fort de Vuillerez est techniquement ralisable et permet ainsi de prserver ce milieu naturel de grande qualit un giratoire plac Crebelley offre une bonne accessibilit aux villages vaudois de la plaine et a un effet de modration du trafic sur la A 144 (diminution de la vitesse pratique) les cots de ralisation ont pu sensiblement tre diminus la variante des Communes optimise aura srement une meilleure valeur dutilit que la variante des Communes rvise82
Optimisation des variantes 0 + Deux nouvelles variantes, prsentes sur la Figure 12 de la page suivante, ont t examines par le groupe de travail :
-
Variante X, qui est une combinaison de la variante des Communes rvise (tronon est) et de la variante 0+ (tronon ouest) Variante Y,83 qui par rapport la variante X franchit le Rhne plus en aval, au Sud du Golf de Chessel, ceci pour limiter les impacts dus au passage niveau de la Porte du Scex
Ces tracs ne consistent pas exactement en une optimisation des variantes 0+ mais plutt en une combinaison de plusieurs variantes. Malgr ces modifications, il ne faut pas sattendre ce que les valeurs dutilit des variantes 0+ soient comparables celles des variantes des Communes, ceci en raison de la diffrence de standard.84 Comme en plus le cot augmente, ce qui va lencontre du but recherch par les variantes 0+, il apparat donc que les variantes 0+ nont pas suffisamment de potentiel doptimisation pour justifier des tudes complmentaires.
81 82
Un tronon ouest Variante des Communes avec un tronon est Variante 0+ par exemple Il sagit simplement dune impression qui nest cependant pas vrifie. Il serait intressant de savoir, outre le fait quil y a une amlioration de la valeur dutilit, quelle est lampleur de la modification de cette valeur dutilit On remarque que les dsignations des variantes sont toujours susceptibles de provoquer la confusion Les mmes remarques qu la note de bas de page N82 sappliquent ici
83 84
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
65
Variante X Variante Y Variante des Communes avec le contournement de la fort de Vuillerez Variante K Golf de Chessel
Fort de Vuillerez
Camping de Grand Bois
Figure 12
Trac des variantes doptimisation de la (Infraconsult, 2000)
tudies dans la Comparaison de
premire variantes
phase 1999
Le GT propose lunanimit dabandonner les variantes 0+ et de terminer les tudes techniques de loptimisation de la variante des Communes avec le contournement de la fort de Vuillerez pour permettre son introduction dans la Comparaison de variantes 1999 . Sur proposition du chef du Service des Transports du Canton de Vaud, ltude dune variante Sud, dsigne par la suite par le terme de Variante K , sera propose au COPIL. Son trac part depuis la RC 780 la hauteur de Roche et reprend le trac de la variante Y la hauteur de Chessel. Il sagit dune route traversant le plus directement possible la plaine du Rhne et vitant au maximum les surfaces boises.
2.7.10
Cinquime sance du Comit de Pilotage
La cinquime sance de travail du COPIL a lieu le 23 aot 1999 Villeneuve. Elle est consacre lexamen des propositions du GT concernant loptimisation des variantes. Le mandataire spcialis en environnement prsente le plan de contraintes en insistant sur le fait que loptimisation de la variante des Communes (contournement de fort de Vuillerez) diminue les impacts environnementaux (moins demprise et deffet de coupure). Le bureau dingnieur civil prsente ensuite les variantes X et Y ainsi que le nouveau trac des variantes des Communes. Dans la discussion qui sensuit, la question de la ncessit du giratoire de Crebelley prsent dans la nouvelle mouture de la variante des Communes est pose.85
85
Si ce giratoire est ncessaire, pourquoi ntait-il pas prsent dans les variantes prcdentes ? Tout comme pour le standard donner la nouvelle A 144 qui na pas t dfini au dbut de la Comparaison de variantes 1999 , la ncessit ou non des jonctions intermdiaires na jamais t tudie ce qui entrane invitablement ce genre de question
66
LES ETUDES DE CAS
Le mandataire externe expose ensuite les propositions du GT pour la suite de ltude.86 Certains membres du COPIL sont davis dtudier la variante K, mais le chef du Service des Routes du canton de Vaud stonne de cette proposition car il sagit dun trac qui a dj t tudi il y a quelques annes.87 Il se demande si le mandat du COPIL nest pas en train de driver en passant du choix la gnration de variantes et il estime que le COPIL est en train de perdre son temps. Lassemble dcide finalement dabandonner cette ventualit, car cette variante est nettement situe hors du primtre dtude dfini avec peine aux sances prcdentes. La sance se perd ensuite dans de longues et confuses discussions tel point quun participant demande plus de mthode, car il faut avancer dans ltude et ne pas perdre le fil . Les principaux points soulevs dans le dbat qui sensuit sont les suivants : le standard de la future A 144 devrait tre fix dfinitivement avant de poursuivre ltude. Le reprsentant du Service vaudois de lamnagement du territoire repose nouveau la question de lutilit de disposer dune A 144 en site propre au regard de la situation actuelle entre Evian et les Evouettes le conseiller dEtat vaudois est davis que laspect financier nest pas assez pris en compte dans la Comparaison de variantes 1999 .88 Il propose de raliser un phasage des tracs entre lest et louest et dtudier la possibilit de procder une ralisation par tapes. Ceci permettrait dtaler les investissements financiers la charge du canton de Vaud89 lest, la variante 0+ devrait tre mieux optimise tandis qu louest il parat vident que la variante des Communes est la meilleure solution certains participants demandent dviter de multiplier les variantes et de plutt doptimiser celles qui existent, ce qui nest pas lavis dautres membres du COPIL qui ne veulent pas renoncer de nouveaux tracs mme en les loignant de la Porte du Scex, les variantes 0+ ne sont pas acceptables pour des raisons dintgration paysagre et de qualit de la jonction avec la RC 302. Elles doivent donc tre abandonnes
86
Abandon des variantes 0+, variante des Communes avec le contournement de la fort de Vuillerez et proposition dtudier une nouvelle variante sud, appele variante K La forte consommation de surfaces dassolement, lloignement de la jonction autoroutire de Villeneuve et le manque de consensus entre les diverses communes vaudoises avaient alors provoqus labandon de ce trac Cette remarque de la part dun des principaux acteurs du COPIL est en dcalage vis--vis de la procdure dtude adopte pour la Comparaison de variantes 1999 . En effet, limportance donner aux moyens financiers nest pas dcider par le COPIL mais par chacun de ses acteurs qui dcide individuellement de limportance accorder ceux-ci par le biais de la pondration. De plus, cette rflexion arrive lors de la phase doptimisation o il nest plus sens se drouler des discussions au sujet de la pondration. Sa rflexion est justifie par le fait que , mme si 85 % des membres (du COPIL) sont en faveur de la variante des communes, lobjectif de trouver lunanimit nest pas atteint
87
88
89
Selon larticle 27, chiffre 2 bis de la Constitution vaudoise, adopt par 53 % des votants le 29 novembre1998, (Etat de Vaud, 2000) toute dcision du Grand Conseil vaudois entranant une dpense suprieure 20 millions de francs doit obligatoirement tre soumise au peuple par ce que lon appelle communment le rfrendum financier . (Constitution VD, 1885) et (Busslinger L., 2000) Le Service des Routes du canton de Vaud prfre visiblement viter cette votation qui nest pas gagne davance, la A 144, qui est un objet rgional assez restreint, risquant de ne pas obtenir la majorit auprs du corps lectoral vaudois. On remarque ici lillustration de la vritable pe de Damocls quest un rfrendum obligatoire pour un projet, les solutions consensuelles obtenues par un groupe dtude pouvant tre purement et simplement balayes par un vote populaire
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
67
Le conseiller dEtat valaisan, soutenu par de nombreux acteurs, notamment les acteurs conomiques, demande darrter ce stade les discussions90 et de procder un choix. Il apparat clairement que seule lamlioration du standard permet damliorer la valeur dutilit des variantes. De plus, la solution doit tre recherche dans le primtre dtude dfini auparavant et il faut cesser de proposer de nouvelles variantes en amont du Rhne. Les discussions qui sensuivent entre les diffrents acteurs sont vives. Il semble impossible dobtenir un consensus sur la suite donner aux tudes menes par le GT tant les diffrends sont importants.91 Sur proposition du conseiller dEtat vaudois, qui rtorque aux propos de son homologue valaisan il ne sert rien de brusquer les choses et la solution doit tre mrie , le COPIL dcide daffiner encore davantage loptimisation des variantes en procdant ainsi : louest : trouver la solution dune traverse du Rhne sans trafic mixte lest : en plus de la variante des Communes, chercher une optimisation du trac pour la variante 0+ avec ventuellement un trafic mixte
Ces deux parties feront ensuite lobjet dune combinaison qui pourra tre intgre dans lanalyse des valeurs dutilit. Cette solution semble ramener le calme dans lassemble, mais comme on va le constater, les esprits des diffrents acteurs sont toujours chauffs et la polmique va trs rapidement clater au grand jour.
2.7.11
Ractions mdiatiques
Lors de lassemble gnrale de lAssociation routire vaudoise qui se droule le 26 aot 1999, soit trois jours aprs la sance du COPIL, le syndic de Roche invit sexprimer sur le dossier de la A 144 ne mche pas ses mots en dclarant que : Alors que la majorit des membres du comit de pilotage ont plbiscit la va-
riante des Communes rvise, voil que M. Philippe Biler impose le silence et veut revenir dix ans en arrire. En ralit, cette variante ne plat pas M. Biler et aux reprsentants des mouvements cologistes. Cest pourquoi en se cachant derrire le cot et des considrations cologistes, le conseiller dEtat vaudois ne veut pas accepter ce choix et demande ltude de nouvelles variantes
(Rausis O., 1999)
90 91
Il est demand de cesser ces combats darrire garde et de ne pas tre mauvais perdant On remarque ici la prsence de deux camps. Il y a, dune part, les partisans dune fin rapide de la Comparaison de variantes 1999 qui indique que la variante des Communes rvise est nettement en tte. Il suffit doptimiser cette variante, notamment en contournant la fort de Vuillerez et en affinant les dtails des jonctions. Dautre part, il y a les partisans dune solution qui reste encore mrir et qui ne doit pas exclure douvrir le champ dtude des variantes. En simplifiant lextrme, on peut remarquer que les acteurs du premier groupe sont plutt des partisans de la variante des Communes qui sont satisfaits du rsultat de lanalyse des valeurs dutilit. Ils ne voient pas lutilit davancer plus en avant dans ltude. Les acteurs du second groupe sont plutt des partisans de la variante 0+ qui sont dus du fait que le standard trafic mixte ne soit pas si intressant. Ils souhaitent tre vraiment certain quil nexiste pas dautre solution que la traverse du Rhne par la variante des Communes, ce qui ncessite bien entendu de prolonger les tudes pour affiner encore plus les diffrents tracs. On trouve plus de dtails ce sujet au chapitre 5 consacr aux relations entre les acteurs du projet routier
68
LES ETUDES DE CAS
Ses propos sont relays dans diffrents journaux locaux et nationaux. Les titres sont loquents : Ras-le-bol des communes , (24 Heures, 1999) Roche appelle une mobilisation de la rgion , (Wichser F., 1999a) ou Vaud bloque le trac choisi . (Rausis O., 1999) Rompant avec les consignes de confidentialit demandes aux membres du COPIL au dbut de la Comparaison de variantes 1999 , ceci pour pouvoir avancer dans ltude avec un climat de travail serein, le syndic de Roche lance un vritable bombe mdiatique. Il justifie cette position car il estime que la population qui subit tous les jours un trafic considrable doit savoir pourquoi le dossier navance pas . (Rausis O., 1999) Lamertume du syndic de Roche se base sur le fait que, satisfait des rsultats de lanalyse des valeurs dutilit, qui a clairement montr que les variantes des Communes taient largement positionnes en tte de classement, il pensait que la Comparaison de variantes 1999 arrivait sa fin.92 Il a la sensation que Le Conseil dEtat93 na encore aucune politique dfinie et quil a dcid de faire tudier de nouvelles variantes afin de faire traner les choses . Le conseiller dEtat vaudois en charge des Infrastructures est mme accus davoir publi un communiqu trompeur 94 car celui-ci parlait du fait que lanalyse multicritre navait pas permis de dgager une solution satisfaisante alors quen ralit, le COPIL a bel et bien exprim une large prfrence pour la variantes des Communes . (Rausis O., 1999) Le syndic de Roche souligne que ce projet est important pour les villages de la plaine et quil faut certes affiner le trac, mais surtout aller de lavant ! car sinon les riverains vont vivre le chaos ! On peut, sans vraiment beaucoup se tromper, affirmer que le syndic de Roche nagit pas isolment et que ses propos sont rvlateurs des opinions des autres syndics tant ceux-ci ont lair daccord entre eux depuis le dbut de la Comparaison de variantes 1999 . Ce nest rien dautre que ce souligne M. Bernier en crivant que Cette raction est le reflet dune srieuse grogne dans les communes concernes du Chablais . (Bernier M., 1999) On peut aussi noter la lecture de cet article quil y a une opposition de vue complte entre les syndics qui veulent acclrer le rythme du projet afin de commencer au plus tt les travaux et le conseiller dEtat qui estime, comme le confirme son collaborateur personnel, que Nous ne sommes pas tenus de nous dpcher de construire la route car il y a eu prcipitation autour de ce projet . Etant vigoureusement mis en cause, le conseiller dEtat vaudois, chef du Dpartement des Infrastructures, se doit de ragir, ce quil fait le lendemain regret car nous
nous sommes donns pour rgle au sein du COPIL de ne pas nous exprimer titre personnel . (Wichser F., 1999b)
Le conseiller dEtat souligne le fait que le syndic de Roche na pas compris entirement le sens de la dmarche car aprs lanalyse des variantes initiales, qui sest acheve dbut juillet, le GT avait pour tche doptimiser ces variantes. Il dclare que Il est faux et contraire la dmarche de dire que lune des variantes est la meilleure et quil faut sortir du cycle des oppositions. Il souligne aussi que le COPIL ne cherche
pas la variante qui a le plus de voix, mais le consensus qui recueillera plus ou moins ladhsion de tous les partenaires .
92
Il nest pas inutile de rappeler quen dcembre 1998, les rsultats de cette Comparaison de variantes 1999 taient annoncs pour juin 1999 (DINF, 1998) On peut remarquer que celui-ci est attaqu in corpore alors que seul un de ses membres fait partie du COPIL Il sagit du communiqu de presse publi le 2 juillet 1999 (DINF, 1999c)
93 94
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
69
Il conteste vigoureusement le fait que le dossier trane, car la recherche de la meilleure solution, si elle prend un peu plus de temps, permet dviter quelle ne soit refuse lors de la mise lEnqute . (Bernier M., 1999) Pour rsumer, le conseiller dEtat estime que la divergence dopinion rside dans le fait que le syndic de Roche considre que lanalyse multicritre est un processus dmocratique, ce qui nest pas le cas car si chaque partie concerne est reprsente dans le groupe, sa composition nest pas proportionnelle aux forces en prsence .95 Ce que veut finalement le conseiller dEtat, cest trouver la solution qui prsente globalement le moins dinconvnients et le plus davantages . Comme on le constate, le climat entourant la Comparaison de variantes 1999 est trs tendu. Aprs des annes de tergiversations, les syndics des communes vaudoises de la plaine veulent obtenir rapidement des rsultats concrets. Du reste, dans le dpartement de la Haute-Savoie, la grogne monte aussi envers le Gouvernement franais que lon accuse de lenteur dans le dossier damlioration des liaisons routires entre Annemasse, Evian et Saint-Gingolph. Une opration spectaculaire mais non violente symbolisant lenclavement du Chablais est mene par les lus locaux franais et suisses un samedi de septembre 1999 la douane de SaintGingolph. Un mur de briques est difi travers la chausse, bloquant totalement la circulation. La route transfrontalire au sud du lac Lman reste ainsi ferme durant toute la matine.
2.7.12
Organisation de la suite de loptimisation
Le 26 aot 1999, une sance tripartite runit le conseiller dEtat vaudois, le reprsentant de lOFROU et le mandataire externe afin de prparer lorganisation de la suite de loptimisation. Au cours de cette sance, il est dcid que : chaque membre du COPIL recevra le rsultat de lanalyse des valeurs dutilit effectue avec sa pondration individuelle la variante K96 est abandonne car elle amne plus de problmes quelle nen rsout. De plus, elle sort du primtre de ltude dfini loption de la traverse du Rhne la Porte du Scex en trafic mixte (variantes 0+) est abandonne. Le franchissement du fleuve est envisager uniquement de part et dautre du Golf de Chessel avec un standard en site propre (standard des variantes des Communes) il faut viter de traverser la fort de Vuillerez en la contournant par le Sud, sans toutefois trop sapprocher du camping du Grand Bois sur la partie est de ltude, entre Crebelley et Rennaz, il faut envisager la possibilit de conserver un trafic mixte pour toutes les variantes
95
Ces propos rejoignent les commentaires de lauteur propos de la pondration moyenne (note de bas de page N74, page 60 Elle est aussi appele Variante Blanc , du nom du Conseiller dEtat vaudois responsable du Service des routes en exercice lors de son laboration
96
70
LES ETUDES DE CAS
2.7.13
Sixime sance du Groupe Technique
La sixime sance de travail du GT a lieu le 31 aot 1999 Villeneuve. Cette sance est consacre laffinage de loptimisation des variantes tel que demand par le COPIL lors de la sance du 23 aot. Aprs la prsentation des rsultats de la prcdente sance du COPIL et de la sance tripartite qui sest tenue depuis, la discussion au sein du GT est entame. Plusieurs dcisions concernant les directions donner loptimisation des variantes sont prises : la variante des Communes et la route cantonale valaisanne RC 302 peuvent tre raccordes par un giratoire et non par un passage suprieur accdant la route actuelle par une bretelle97 le contournement de la fort de Vuillerez empite sur la lisire sud, car le trac consiste en un compromis entre dune part lemprise forestire et dautre part les nuisances amenes au camping du Grand Bois. Il est dcid de chercher optimiser encore ce trac afin de diminuer, voire dliminer totalement, lemprise sur cette fort de grande valeur lemplacement du giratoire de Crebelley doit tre affin en le rapprochant de la RC 725 et de son croisement avec la RC 726, afin de diminuer lemprise sur les terres agricoles il est ncessaire de rduire les cots dinvestissement de la variante des Communes, en diminuant les dimensions des diffrents ouvrages dart au sud-est du village de Rennaz, on tentera dans la mesure du possible dutiliser le pont qui franchit actuellement lautoroute A 998 la ralisation par tapes de linfrastructure projete nest pas opportune car louverture de la A 144 aux poids lourds de 40 tonnes ncessite, pour des raisons structurelles et de dimensions de la chausse, la reconstruction de deux importants ouvrages dart (traverses du Rhne et de la A 9) qui constituent la majeure partie des investissements
Pour loptimisation des variantes, le GT dcide dtudier la combinaison de quatre tronons est et ouest, rebaptiss ainsi : 99 Clos Nord : tronon est correspondant au trac est de la variante 0+ rvise Clos Sud : tronon est correspondant au trac est de la variante des Communes rvise Golf Nord : tronon ouest correspondant au trac ouest de la variante des Communes rvise avec contournement de la fort de Vuillerez Golf Sud : tronon ouest correspondant au trac amlior de la variante Y
Ces variantes sont prsentes sur la figure de la page suivante.
97
Cette dcision va lencontre des desiderata du Service des Routes du canton du Valais qui souhaite assurer un trac direct en continuation de la A 144 Dun point de vue dimensionnel et statique, cet ouvrage dart ne pourra pas tre rutilis tel quel, mais le nouveau pont raliser sera construit au mme emplacement De nouveaux noms sont ainsi attribus des tronons de variantes existantes, qui ont simplement t corrigs. La confusion est quasi totale et naide pas la discussion
98
99
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
71
Variante Clos Nord Variante Clos Sud Variante Golf Nord Variante Golf Sud
Figure 13
Combinaisons de variantes Clos et Golf utilises lors de la Comparaison de variantes 1999 (Infraconsult, 2000)
On remarque que deux contraintes sont considres comme importantes pour ces variantes : le Golf, situ le long du Rhne, et le camping de Grand Bois. La cheffe de lamnagement du territoire du canton de Vaud se demande si limportance de ces contraintes nest pas un peu exagre par le mandataire externe, les tracs proposs les vitant soigneusement.100 Au fur et mesure de lavance de la discussion, il apparat plein de propositions de trac. Le nombre de variantes imagines explose et chacun amne une bonne ide. Il sagit l typiquement dune phase de gnrations de variantes et non plus dune optimisation. Le mandataire externe tente de remettre de lordre dans la sance afin dviter une dispersion totale des travaux et des discussions. En outre, le fait denvisager un panachage des standards entre les tronons est et ouest de la future A144 suscite un dbat passionn. Pour de nombreuses personnes, il sagit l dune initiative btarde. Le dsquilibre ainsi cr ne serait pas trs heureux, car il cumulerait les inconvnients des deux standards possibles plutt que leurs avantages. Un participant relve aussi que le Service de lamnagement du territoire du canton de Vaud avait dj propos le phasage actuellement tudi, ceci ds 1997. Le reprsentant du Service des Routes du canton de Vaud est davis que le dveloppement de nouvelles variantes nest pas ncessaire car cela retarde encore la dcision et augmente le cot de ltude qui dpasse dj le budget fix. Le GT est cependant davis de continuer les tudes pour permettre au COPIL de prendre une dcision dans les meilleures conditions possibles.
100
Limportance relative des diffrentes contraintes nest pas reprsente sur le plan des contraintes. On ne sait ainsi pas si une contrainte est de faible gravit ou si au contraire, elle est plutt rdhibitoire
72
LES ETUDES DE CAS
2.7.14
Septime sance du Groupe Technique
La septime sance de travail du GT a lieu le 22 septembre 1999 Villeneuve. Elle est consacre lexamen des rsultats des tudes menes sur les quatre variantes analyses lors de la sance prcdente et sur la prparation de la prochaine sance du COPIL. Le mandataire externe rappelle le climat mdiatique polmique qui sest dvelopp depuis la dernire sance du COPIL et prsente les travaux mens par le bureau dingnieur civil sur le trac des variantes. Une information provenant des services cantonaux responsables des monuments historiques, concernant les chteaux de la Porte du Scex et de Rennaz, est distribue aux participants.101 Les deux lments critiques sont la Porte du Scex et Rennaz. Le mandataire spcialis annonce que par consquent le plan de contraintes a t agrandi.102 Loptimisation des variantes a concern les quatre combinaisons possibles et donne les rsultats suivants : Variante Clos Sud et Golf Nord avec un cot de ralisation estim 60 millions. La lisire de la fort de Vuillerez est moins touche et la tranche couverte de Crebelley, o se situe un giratoire sur la RC 725, est supprime. Il sagit dun trac se rapprochant fortement de la variante des Communes rvise. Il est rserv un trafic motoris Variante Clos Nord et Golf Sud avec un cot de ralisation estim 50 millions. Elle est parallle la route cantonale entre Chessel et le camping du Grand Bois, qui est contourn par le sud. Sur le tronon est, elle est identique la variante 0+ rvise. Le mlange de deux standards entre lest (trafic mixte) et louest (site propre) est problmatique et la coupure de la zone agricole au nord de Chessel est importante. A lexamen des nouveaux documents provenant des services des monuments historiques, il apparat que le trac Clos Nord est trop proche du village de Rennaz et du chteau du Grand Clos et quil coupe de bonnes terres agricoles. Cependant comme ces services nont pas fourni de rponse officielle, le doute subsiste sur latteinte provoque au paysage du sud de Rennaz103 Variante Golf Nord et Clos Nord avec un cot de ralisation estim 43 millions. Elle prsente des caractristiques gomtriques trs diffrentes Variante Golf Sud et Clos Sud avec un cot de ralisation estim 65 millions. Le trac est trs tourment lest de la fort de Vuillerez et il y a une forte emprise agricole vers Chessel. Les jonctions Crebelley sont implantes sur des terrains agricoles de qualit. La question de lutilit de ce carrefour intermdiaire se pose nouveau. Il parat ncessaire de revoir le trac dans ce secteur de manire mieux coller au trac actuel de la RC 725
101
Alors que la Comparaison de variantes 1999 arrive sa fin en analysant les rsultats des optimisations, le fait de distribuer des documents dcrivant une contrainte essentielle seulement ce moment de ltude est rvlateur de la procdure utilise. Les phases de travail ne sont pas succdes logiquement, ce qui explique bien des problmes rencontrs Lors de la sance prcdente, celui-ci ne montrait que le secteur ouest du primtre dtude. Il parat inconcevable quun tel document, qui na pas t ralis temps, car il aurait du tre fourni avant lapprciation des variantes, soit incomplet et ncessite ainsi un complment dinformation Il sagit dun lment de rponse primordial qui ne peut pas tre confirm ou infirm dfinitivement par les membres du GT prsents. On peut donc noter labsence dun acteur important dans ce groupe de travail
102
103
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
73
Une valuation des contraintes Nature mene par le mandataire spcialis en environnement montre que les problmes poss par la variante Golf Nord, qui vite la fort de Vuillerez, peuvent trouver des solutions techniques peu contraignantes . Par contre, pour la variante Golf Sud, les effets sur la faune sur la rive valaisanne du Rhne104 sont plus dfavorables quavec la variante Nord et des mesures relativement lourdes seront peut-tre ncessaires . A la suite de ces prsentations, le reprsentant du Service des Routes du canton du Valais attire lattention du GT sur le fait que le tronon valaisan entre le portail Sud du tunnel des Evouettes105 et la traverse du Rhne par la variante Golf Sud doit tre tudi de manire rsoudre le problme de la mixit avec la route cantonale actuelle. Il est ncessaire de disposer dun trac en site propre car le Valais veut une route A 144 qui soit rserve au seul trafic motoris tandis que la RC 302 serait dclasse pour le trafic mixte. Cette intervention, mene assez nergiquement, tend dmontrer que le trac Golf Sud est impossible raliser et que la solution dun giratoire la jonction sur la RC 302 nest pas acceptable. Des intervenants se demandent si la suppression de la tranche couverte de Crebelley sur le tronon Clos Sud est judicieuse vu que cet ouvrage amliorait lintgration paysagre du trac et diminuait fortement les nuisances sonores Crebelley. Le reprsentant du bureau dingnieur civil rpond que le bruit ne pose
pas de problmes et que limpact sur le paysage est acceptable et est en tout cas moins grave que celui occasionn par la variante Golf Sud 106
Comme il a t relev par des participants, la qualit de prsentation de certains plans par le bureau dingnieur civil est nettement insuffisante de la part de professionnels du domaine : les fonds topographiques manquent au sud des Evouettes, certaines variantes sont grossirement esquisses au feutre tandis que dautres sont plus labores, des carrefours ne sont pas indiqus, etc. Si la forme nest pas tout dans une tude, loin sen faut, cette mauvaise qualit des plans exposs entran quelques confusions et quiproquos dans la discussion au sein du GT. De plus, lhtrognit de la reprsentation des diffrents tracs tendait faire croire que certains taient plus tudis que dautre, alors quils taient tous au mme niveau dapprofondissement. Postulat 13
La forme des supports utiliss pour la discussion doit tre de parfaite qualit et homogne
A la suite de la prsentation des quatre variantes Clos et Golf, le mandataire externe propose de manire unilatrale dabandonner ltude de la variante Golf Sud puis de calculer la valeur dutilit de la variante Golf Nord et Clos Sud qui sera introduite comme cinquime variante dans lanalyse des valeurs dutilit dj ralise et prsente dans le Tableau 14 la page 63.
104
Prsence dun cordon alluvial de rive, emprise importante sur la fort en pied de paroi et coupure dun couloir faune Il prcise aussi que laxe du tunnel des Evouettes est fix de manire dfinitive et que seule la conception de la jonction du contournement avec la route cantonale RC 302 (jonction dnivele ou en giratoire) peut tre discute, son service prfrant nettement une jonction dnivele entre la A 144 et la RC 302 Au vu de ces arguments, on peut se demander si la ncessit ou non dun ouvrage enterr cet endroit a rellement t tudie en profondeur
105
106
74
LES ETUDES DE CAS
Un participant relve que dun point de vue mthodologique, on devrait tout de mme considrer les quatre variantes dans cette analyse des valeurs dutilit.107 Il est mme demand de refaire la totalit des apprciations de variantes en raison des modifications intervenues depuis : affinage des tracs, nouvelles donnes sur les contraintes, etc. Il sagit certes dune opration de longue haleine, mais ltude a t longue et il serait dommage de la bcler ainsi ! comme relve un membre du GT.108 Il est dcid ensuite de prsenter les quatre variantes au COPIL puis de commenter la rflexion ayant amen choisir de ne dterminer que la valeur dutilit de la variante Golf Nord et Clos Sud, ce qui permet dliminer les autres tracs.
2.7.15
Sixime sance du Comit de Pilotage
La sixime sance de travail du COPIL a lieu le 30 septembre 1999 Villeneuve. Durant cette runion, qui est la dernire tenue par le COPIL, les rsultats de loptimisation des variantes ralise par le GT sont analyss et une solution consensuelle, qui est dsigne par le terme de Solution COPIL , est propose. Le mandataire externe prsente les quatre variantes avec leurs caractristiques, leurs avantages et leurs inconvnients comme prsent la page 72. Il conclut son intervention en annonant que le GT opte pour la variante Golf Nord et Clos Sud et propose au COPIL dabandonner les autres variantes qui ont trop dinconvnients. Les discussions du COPIL portent ensuite sur les diffrents points suivants : labandon de la mixit du trafic sur le tronon ouest est largement accept le syndic de Chessel demande sil nest pas possible de repousser le trac de la variante Golf Nord plus dans la fort. Vu quil sagit dun compromis entre les atteintes lagriculture et la fort, ce trac ne sera que peu modifi le reprsentant de Pro Natura Vaud demande si le cot du tunnel des Evouettes est compris dans les cots de ralisation. Ce nest videmment pas le cas, car cet ouvrage est en dehors de la zone dtude comme il la dj t voqu le syndic de Rennaz se flicite du fait que la variante des Communes, qui tait le fruit dun consensus109 entre les communes vaudoises de la plaine du Rhne, correspond pratiquement au trac qui sera retenu. Selon lui, toutes ces tudes ont t inutiles et lon redevient raisonnable 110 le chef du Service de lamnagement du territoire du canton du Valais remarque que le consensus se fait sur un standard non-mixte et sur une ralisation en une seule tape loigne des habitations111
107
De plus, il parat inutile de vouloir comparer des variantes 0+, dont les inconvnients sont manifestement trop importants pour quelles entrent en ligne de compte, avec des variantes provenant de loptimisation des Communes rvise qui tait dj en tte. La seule conclusion qui serait tirer de cet exercice est que lcart entre les deux variantes augmente, ce qui est tout simplement logique car il serait difficile quil en soit autrement Le fait que la procdure de notation soit longue effectuer et incite le mandataire externe ne pas vouloir la recommencer montre bien que lAVU est une opration peu souple lutilisation Il souligne le fait que sa commune fait preuve de bonne volont car elle consent ce compromis malgr le lourd tribut quelle doit payer, cette variante : sacrifice de prs de 3 hectares de terrain agricole en plus des surfaces dj concdes lautoroute A 9 et la RC 780 Cette remarque sadresse tout particulirement aux tenants dune prolongation des tudes La ralisation par tapes a plutt tendance augmenter le cot dinvestissement final
108
109
110 111
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
75
Le reprsentant valaisan de Pro Natura demande que le respect des 80 km/h soit assur pour des raisons de protection contre le bruit notamment. Pour cette raison, le trac Golf Nord et Clos Sud est trop direct et il est ncessaire de lui prfrer un trac plus sinueux comme la combinaison Golf Sud et Clos Nord. Ces propos provoquent une vive colre de la part des syndics des communes vaudoises. Le chef du Service des Routes du canton de Vaud rpond quil ne faut pas revenir sur les dcisions prcdentes (profil gomtrique type) avec des personnes qui sont prsentes pour la premire fois aux sances du COPIL.112 Un autre reprsentant des associations de protection de lenvironnement participe encore plus faire monter la tension en demandant que seul le trac Golf Sud soit retenu car la fort de Vuillerez est trop proche du trac Nord. Latteinte lagriculture par les deux variantes Clos est aussi lobjet dpres discussions. Le dbat se dplace ensuite sur de nombreux points de dtail (nombre de voies ncessaire, montant exact des travaux la charge du canton de Vaud,113 charges de trafic, etc..). Le climat devient tendu et une pause bienvenue dans la sance permet chacun de reprendre ses esprits afin de tenter darriver un consensus. A la reprise de la sance, le prsident du COPIL passe en revue les diffrents tronons afin dobtenir une variante consensuelle. Pour le tronon ouest, le tronon Golf Nord est prfr par les reprsentants des services administratifs chargs de lenvironnement et par certaines associations de protection de lenvironnement qui demandent que la fort de Vuillerez soit mieux pargne et que des mesures de compensation soient envisages. Le conseiller dEtat vaudois synthtise les opinions en dclarant que la variante Golf Nord est la meilleure solution pour le tronon ouest. Il est contredit par le reprsentant de lATE qui estime que le consensus nest pas encore l.114 Des avis sur le tronon Golf Nord sont ensuite mis par de nombreux membres du COPIL qui expriment leur acceptation ou leur refus de cette solution en commentant leur choix. Pour le tronon est, le syndic de Rennaz ne veut pas de Clos Nord qui ne verra jamais le jour . Son avis est partag par de nombreux participants. Le reprsentant du WWF sinquite toutefois du devenir de la RC 726 en cas de ralisation de Clos Sud. Cette route cantonale sera dclasse pour viter davoir deux routes cantonales en parallle. Tout comme pour le tronon Golf Nord, plusieurs membres du COPIL expriment ensuite leur avis positif ou ngatif sur le tronon Clos Sud propos par le GT. Finalement, le conseiller dEtat vaudois synthtise les discussions qui semblent amener un consensus sur la variante Clos Sud.115
112 113
Il sagit en effet du remplaant du titulaire de cette charge auprs du COPIL Avec la Solution COPIL dont le cot de ralisation est devis 60 millions de francs, la part de la Confdration slve 39,5 millions, celle du canton de Vaud 17 millions et celle du canton du Valais 3,5 millions. (Wichser F., 1999c) Avec cette variante, le canton de Vaud chappe ainsi de justesse au rfrendum financier (limite de 20 millions), ce qui ntait pas le cas avec les variantes des Communes dont les cots de ralisation taient bien plus levs. Comme lcrit L. Busslinger Vaud pourrait se retrouver au-dessous de la barre fatidique (Busslinger L., 2000) Il est intressant de remarquer quau cours de la discussion qui sensuit, les reprsentants de lATE et de Pro Natura affirment que la variante Golf Sud est prfrable au trac Golf Nord pour laspect environnemental. Le biologiste du GT leur rtorque que cest pourtant exactement le contraire Aprs les vives discussions qui semblaient en cours de sance amener un conflit dimportance, le Conseiller dEtat vaudois a calm le jeu, laiss sexprimer lensemble des avis et propos des variantes acceptes par la majorit des membres du COPIL, la ncessit de convaincre lensemble du COPIL savrant de toute manire impossible. Son rle stabilisateur et rassembleur sest avr crucial pour le succs de cette runion
114
115
76
LES ETUDES DE CAS
5 4
2 1
Figure 14
Trac de la Solution COPIL propose la suite de la Comparaison de variantes 1999 (Infraconsult, 2000)
Les limites des diffrentes entits administratives concernes par la Comparaison de variantes 1999 (communes et cantons) sont reprsentes en pointills (communes) ou traitills (cantons) sur cette carte.
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
77
Le conseiller dEtat vaudois souligne cependant que laspect financier nest pas ngliger. Cependant son homologue valaisan fait remarquer lassemble que cet aspect est dj bien prsent dans le processus dtude, le cot de ralisation de la tant pass de 100 millions pour la variante des Communes 60 millions pour la variante Golf Nord et Clos Sud. La discussion revient sur lventualit dune ralisation par tapes, qui pourrait tre envisage pour des raisons financires. Cette solution est nettement refuse par les syndics qui craignent de ne voir se raliser quun seul tronon court terme116 et de perdre ensuite la solidarit existant actuellement entre les communes pour obtenir la ralisation du second tronon moyen terme. Le fait que cette ralisation par tapes amnerait des poids lourd de 40 tonnes et le trafic de transit circuler lintrieur des villages et croiser du trafic agricole ne savre pas judicieux. Le consensus se dveloppe rapidement sur la ncessit dune ralisation en entier de la A 144 et lOFROU est invite par le conseiller dEtat vaudois tout mettre en uvre pour raliser rapidement cette liaison routire. Le conseiller dEtat vaudois insiste aussi sur la ncessit de raliser des mesures daccompagnement sur le rseau routier actuel pour favoriser le report de trafic sur la future A 144. Un groupe dtude de ces mesures daccompagnement sera cr pour proposer un concept global dans la plaine du Rhne et le conseil dtat insiste sur le fait que la part du canton doit rester en dessous de 20 millions de francs .117 En rsum, le COPIL dcide sans opposition 118 de proposer une variante constitue de la combinaison de la variante Golf Nord et Clos Sud. Cette variante est dsigne par le terme de Solution COPIL dont le trac est indiqu la page prcdente. Cette variante a permis de rduire sensiblement deux inconvnients majeurs lis aux variantes des Communes : important cot de ralisation et forte atteinte la fort de Vuillerez. (DINF, 2000a) Pour la suite de ltude, il est dcid que le COPIL na plus la ncessit de se runir et que ses travaux sont donc termins. Le mandataire externe rdigera le rapport technique en tablissant lanalyse de la valeur dutilit pour la solution COPIL119 et en y indiquant les conclusions et remarques du COPIL. Les services cantonaux et lOFROU sont chargs dlaborer le projet dfinitif de la Solution COPIL et ils prsenteront les rsultats devant le Comit de Pilotage avant la mise lEnqute publique.
116
Ceci explique les craintes des syndics envers un giratoire Crebelley. Ceux-ci apprhendent en effet que le terminus provisoire dune ralisation dun seul tronon de la A 144 se rvle long terme tre dfinitif Ces propos illustrent bien la crainte quinspire le rfrendum financier au Dpartement des Infrastructures (DINF) Au vu des discussion animes qui se sont droules lors de cette sance, cette phrase est trs optimiste, certains participants la runion ne partageant visiblement pas cet enthousiasme Ainsi, la Comparaison de variantes 1999 se termine par ltablissement dun consensus entre les diffrents acteurs du COPIL sur une solution de trac. Lanalyse multicritre qui doit servir de base cette dcision, en tablissant des recommandations au COPIL qui prend ensuite une dcision, est finalise aprs lobtention de ce consensus, ce qui est pour le moins troublant, mme sil semble, lanalyse des arguments dveloppes lors des diverses sances de septembre 1999, que la valeur dutilit de cette solution sera la plus leve de toutes les variantes dj analyses
117 118
119
78
LES ETUDES DE CAS
2.7.16
Confrence de presse finale
Une confrence de presse120 runissant plusieurs membres du COPIL, dont les deux conseillers dEtat, a lieu Villeneuve le 30 septembre 1999 aprs la sance du COPIL. (Wichser F., 1999c) Le communiqu de presse distribu alors prsente dans le dtail les caractristiques de la solution retenue par le COPIL en dcrivant les amliorations par rapport la variante des Communes rvise. (DINF, 1999d) Il est prcis que si le COPIL a trouv un accord sur une variante , le processus dtude nest nanmoins pas termin. Il est encore ncessaire de procder des tudes techniques pour affiner les dtails du trac, prvoir des mesures de compensations cologiques121 et ramnager le rseau routier existant pour dissuader le trafic de transit dutiliser un raccourci . (Wichser F., 1999c) Mme sil met quelques rserves sur les effets concrets du consensus ainsi obtenu, en crivant que Seul lavenir dira sil a t dcisif, , le quotidien rgional rserve un accueil favorable cette solution qui est inespre aprs les remous mdiatiques rencontrs la fin du mois daot 1999.122
2.7.17
Parution du rapport technique
Le 25 fvrier 2000, la rdaction du rapport technique est termine par le mandataire externe. Ce document est ensuite envoy le 3 mai 2000 aux membres du COPIL. (Infraconsult, 2000) Lapprciation de la variante Solution COPIL a t effectue ainsi que le calcul de la valeur de sa valeur dutilit.123 A la page suivante, un tableau rcapitule les diffrentes apprciations attribues aux variantes aprs les diffrentes remarques mises par le Comit de Pilotage et le Groupe Technique. Les modifications apportes ont souvent t minimes (1 point au maximum). Ces diffrentes notes seront reprises dans le chapitre 8 consacr laide multicritre la dcision.
120
Cette confrence de presse a t prpare (convocation des journalistes et des orateurs) sans connatre les rsultats de lultime sance du COPIL Il sagit dune formulation tendant insister sur le caractre consensuel du COPIL, en montrant que celui-ci sintresse lenvironnement. Cependant, ceci na rien dextraordinaire car tout projeteur dune infrastructure provoquant des atteintes lenvironnement est oblig lgalement de raliser de telles mesures Les sous-titres Sur la bonne voie ! ou Retour loptimisme sont loquents Il est noter que ces rsultats nont jamais t comments lors dune sance du COPIL
121
122 123
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
79
Objectifs gnraux
Objectifs partiels
1.1 Transport motoris 1.2 Trafic piton et deux-roues 1.3 Transports collectifs 1.3 Transport agricole 2.1 Cots d'investissement 2.2 Cots d'entretien et d'exploitation 3.1 Utilisation mesure du sol 3.2 Buts et plans de lA.T. 4.1 Environnement humain 4.2 Environnement naturel 4.3 Autres nuisances 5.1 conomie micro-rgionale 5.2 conomie macro-rgionale 6.1 Nuisances locales 6.2 Nuisances sur la circulation 6.3 Nuisances gnrales
Variantes
ER (1) -1,0 -1,0 -0,5 -1,0 0,0 Communes Communes + 0 adapte adapte rvise 3,0 3,0 -0,5 2,0 -3,0 3,0 3,0 -0,5 2,0 -2,0 1,5 1,5 -0,5 0,5 -1,0 0+ rvise 1,0 1,0 -0,5 0,5 -1,0 Solution COPIL 3,0 3,0 -0,5 2,0 -2,0
Moyens financiers
2.
Besoins de transport
1.
0,0
-1,0
-0,5
0,0
0,0
-0,5
Objectifs de lA.T.
-1,0 -1,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0
1,5 1,5 -1,5 -2,0 0,0 3,0 1,5 -1,0 -0,5 -2,0
1,5 1,5 -1,0 -2,5 0,0 2,0 1,5 -0,5 -0,5 -1,5
0,0 0,5 -1,5 -1,0 0,0 1,0 1,0 -1,0 -2,0 -1,0
0,5 0,5 0,0 -0,5 0,0 1,0 0,5 -1,0 -2,5 -0,5
1,5 1,5 -1,0 -1,5 0,0 2,0 1,5 -0,5 -0,5 -1,5
3. 4. 5. 6.
Nuisances dues aux travaux
Dveloppement de lconomie
Nuisances sur lenvironnement
Tableau 15
Apprciations des diffrentes variantes tudies lors de la Comparaison de variantes 1999 (Tille M., 1999b) et (Infraconsult, 2000) Rang Variante Valeur dutilit
COPIL 1 2 3 4 5 6 Solution COPIL Communes rvise Communes adapte 0+ rvise 0+ adapte tat de rfrence 2005 0,69 0,63 0,55 0,17 0,13 - 0,49 GT 0,98 0,93 0,88 0,28 0,27 - 0,55
Tableau 16
Rsultats de lanalyse des valeurs dutilit avec la variante Solution COPIL (Infraconsult, 2000)
80
LES ETUDES DE CAS
On constate que loptimisation amne une amlioration de la valeur dutilit qui est cependant relativement minime et qui reste toujours proche de la note +1 sur une chelle variant de 3 +3. Ceci correspond, selon le Tableau 4 de la page 43, une lgre amlioration par rapport la situation actuelle . Cependant, le mandataire externe fait remarquer que ce faible gain de la valeur dutilit est mettre en corollaire avec la diminution des cots dinvestissement :124 Tout en rduisant les cots de cette variante, on russit encore en amliorer le score des points dutilit . Le Comit de Pilotage adresse les conclusions et les recommandations suivantes, admises par lensemble des parties reprsentes en son sein, aux services cantonaux et lOFROU : sur la base de lanalyse multicritre ralise, il apparat que la Solution COPIL est la meilleure variante de trac possible pour la A 144125 les lments suivants sont optimiser :126 (Infraconsult, 2000) et (DINF, 2000a) 1. 2. 3. raccordement la RC 780 ainsi que le passage au-dessus de la route cantonale et de l'autoroute A 9 giratoire Crebelley : emplacement et rgime de trafic affinage du trac entre Crebelley et le Rhne : amnagement des surfaces entre la nouvelle route et les forts, notamment en prservant les lisires, et de celles entre cette mme route et le camping du Grand Bois traverse du Rhne : rduire la longueur et le cot du viaduc, les surfaces dfricher et l'effet de coupure raccordement la RC 302 : sauvegarder les surfaces et l'aspect visuel du vignoble des Evouettes
4. 5.
les mesures d'accompagnement destines assurer un report optimal du trafic de transit sur la A 144 afin de garantir un dlestage maximal des villages et des routes locales dans la plaine du Rhne font partie intgrante du projet mis l'enqute127 une ralisation par tapes n'est pas opportune et la Solution COPIL doit donc tre ralise d'un seul tenant
124
On est pass dun cot de 68 millions pour la variantes des Communes rvise un cot estim 60 millions. Compar aux 98 millions de la variante des Communes adapte, le gain est de prs de 40 % La Solution COPIL est meilleure que les variantes 0+ et la route actuelle grce aux points suivants : (DINF, 2000a)
125
126 127
report du trafic de transit sur un axe en dehors des localits amlioration de la qualit de vie des villageois grce la forte rduction des nuisances dues la circulation amlioration de la scurit et du confort des transports individuels grce au rgime de trafic spar objectifs de l'amnagement du territoire mieux remplis meilleur dveloppement conomique macro et micro - rgional moins de nuisances locales et de gne la circulation pendant les travaux
Ces lments sont identifis par leurs numros sur la figure de la page 76 Il est demand que Tous les milieux concerns devront tre intgrs dans le processus de planification participatif afin de gagner l'appui de la population
Droulement de la Comparaison de variantes 1999
81
2.7.18
Projet de dcret pour un crdit dtude
Le 3 juillet 2000, un projet de dcret sollicitant le Grand Conseil vaudois pour un crdit dtude complmentaire de 1,1 millions destin la route A 144 Villeneuve Bouveret, section Rennaz - Les Evouettes est publi par le Conseil dEtat du canton de Vaud. (DINF, 2000a) Ce document rappelle les diffrentes tapes de la Comparaison de variantes 1999 et commente les principaux rsultats obtenus. La structure gnrale suivante est retenue pour ltude du projet sur la partie vaudoise : Organes excutifs Le Service des routes assure la direction gnrale du projet et coordonne les activits des mandataires, sous la responsabilit politique du Chef du Dpartement des Infrastructures Instances de coordination, de conseil et de soutien Elles sont au nombre de cinq :
-
le Comit de pilotage de l'tude multicritre dont le rle est limit une sance, pour valider le projet dfinitif de la Solution COPIL, y compris les tudes d'optimisation de certains points du trac, les mesures d'accompagnement et celles de compensations cologiques la Commission de coordination qui se runit environ deux fois par an pour suivre l'avancement du projet et comprend les membres vaudois du COPIL la Commission de construction qui assure la coordination au niveau technique durant ltude du projet. Elle comprend les reprsentants des services cantonaux concerns, le responsable pour le dveloppement et les mandataires spcialiss la Commission pour les mesures d'accompagnement qui propose toutes les mesures principales et annexes dans le but d'assurer au mieux le report du trafic de transit sur la A 144, les accs aux villages et la gestion des trafics agricole, deux-roues, publics et pitons. Elle comprend les reprsentants spcialiss des pouvoirs publics, ceux des communes et des associations uvrant dans le domaine des transports la Commission pour les mesures de compensations cologiques qui propose les mesures prvues par les recommandations de l'OFEFP et le rapport d'impact sur l'environnement. Elle est compose principalement par des reprsentants des associations de protection de lenvironnement et des services cantonaux concerns
Le calendrier de l'tude complmentaire prvu est le suivant : 3me trimestre 2000 et jusquen t 2001 : prparation du projet dfinitif avec les mesures d'accompagnement, de compensations cologiques et d'acquisition des terrains automne 2001 : consultation des services fin 2001 - dbut 2002 : enqutes publiques (travaux et expropriations) 2me trimestre 2002 : demande de crdit d'ouvrage au Grand Conseil vaudois
82
LES ETUDES DE CAS
2.8
A NALYSE DU DEROULEMENT DE LA C OMPARAISON DE VARIANTES 1999
Le suivi de la Comparaison de variantes 1999 en tant quauditeur neutre, rle qui a permis lauteur dtre totalement immerg dans le processus dtude, sest rvl tre fort instructif par la multiplicit et la qualit des renseignements obtenus, limportante documentation rcolte, la possibilit de voir voluer ltude en temps rel et le rsultat consensuel obtenu. Cet exercice a permis en quelque sorte dobserver lenvers du dcor et les coulisses du projet. Les leons que lon peut en tirer sur la procdure ou la mthodologie dune tude routire sont trs nombreuses et intressantes. Le droulement de la Comparaison de variantes 1999 a t dcrit dans le chapitre prcdent de manire complte et prcise avec un souci permanent dobjectivit. Cette fidle transcription des diffrentes tapes de ltude a pour but de permettre au lecteur de comprendre les tenants et les aboutissants de la Comparaison de variantes 1999 . On y trouve de nombreux lments dcrivant lvolution du climat de travail entre les multiples intervenants, les diffrentes tudes ralises, lorganisation des groupes de travail et les principaux rsultats obtenus. Certains thmes plus spcifiques de la Comparaison de variantes 1999 seront dcrits et analyss plus en profondeur dans les chapitres suivants du rapport de thse. Ce chapitre 2.8 dbute par un rcapitulatif des principales tapes de la procdure dtude suivie dans la Comparaison de variantes 1999 . Ensuite, la majeure partie de ce chapitre est consacre aux nombreux commentaires et remarques tablis par lauteur au sujet du droulement de la Comparaison de variantes 1999 . Certaines de ces remarques prsentes ici taient tablies prcdemment, notamment sous la forme de notes de bas de page qui sont simplement regroupes et compltes. Ces commentaires sont numrs et regroups par thmes spcifiques. En plus de ces remarques, une analyse sommaire est parfois effectue sur les aspects intressants plus directement la thse, quils soient positifs ou ngatifs. Des postulats sont parfois tablis. On peut aussi prciser que dans le chapitre prcdent, lauteur a eu la volont de retranscrire le plus objectivement possible les faits, afin de laisser au lecteur la possibilit de se forger son propre avis. Par contre, dans ce chapitre 2.8, les remarques et les commentaires sont plus subjectifs, lauteur conservant tout de mme une certaine impartialit, et refltent les opinions que celui-ci sest forg sur le droulement de cette Comparaison de variantes 1999 .
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
83
2.8.1
Phases principales de ltude
Les six sances du Comit de Pilotage et les sept sances du Groupe Technique chargs de ltude de la A 144 se sont droules sur prs de huit mois entre le 5 fvrier et le 30 septembre 1999. On peut dcouper le droulement de ltude de la Comparaison de variantes 1999 en cinq phases principales, qualifies surtout par leur climat de travail : Premire phase fvrier et mars 1999
Une Comparaison de variantes 1999 attendue par tous
Il sagit dune phase dinitialisation de ltude. En premier lieu, une mise niveau des connaissances de la rgion dtude et de la problmatique est effectue pour lensemble des intervenants. La procdure et lorganisation de ltude de la Comparaison de variantes 1999 est ensuite dcrite, notamment les diffrentes tapes de lanalyse des valeurs dutilit. Comme prcis la page 50, cette phase namne que peu de contestation. Les acteurs sont satisfaits de constater que la procdure dtude est modifie dans le but daboutir enfin un consensus.128 On assiste plutt de leur part une recherche de comprhension de ce processus diffrent de ce qui a t utilis auparavant. Deuxime phase avril dbut juillet 1999
Une Comparaison de variantes 1999 se droulant telle que prvu
Il sagit dune phase se droulant dans le respect de la procdure dfinie au dbut de la Comparaison de variantes 1999 et comportant les tapes successives suivantes : (DINF, 1998)
-
complments dtude afin dhomogniser et dactualiser les donnes permettant danalyser les quatre variantes initialement retenues pour ltude dtermination du systme des objectifs choix des indicateurs et des fonctions dutilit tablissement des apprciations de chaque objectif partiel pondration des objectifs ralise individuellement par chaque membre du Comit de Pilotage dtermination des valeurs dutilit de chaque variante recommandations doptimisation de la part du Groupe Technique
Cette procdure est admise par tous les acteurs prsents. Les dbats les plus vifs portent sur la dimension donner au primtre dtude jug trop restreint par les acteurs sensibilit environnementale. Lanalyse des valeurs dutilit de ces quatre variantes aboutit la fin du mois de juin 1999. On peut alors constater que les variantes des Communes apparaissent nettement en tte de lanalyse, que ltat de rfrence (rseau routier actuel) est clairement insuffisant, ce qui justifie la ralisation dune nouvelle route, et que les diffrences entre les variantes de standard identiques sont faibles.
128
Comme indiqu dans la note de bas de page N40 la page 50
84
LES ETUDES DE CAS
Troisime phase
juillet et aot 1999
Une optimisation qui nen est pas une
La phase doptimisation des variantes dbute par la constatation que laffinage de lanalyse doit se baser sur des documents complmentaires, ceux qui sont disposition tant insuffisants. Un plan de contraintes est ainsi ralis. Ensuite, ltude doptimisation dborde largement de son cadre et plutt que de proposer des variantes initiales avec des caractristiques et des tracs affins, on procde la gnration de nouvelles variantes. Des variantes inspires des variantes 0+ sont proposes puis rapidement abandonnes (variantes X et Y). Finalement, lexamen dune variante K, qui sort du primtre dtude, est envisag. On remarque ainsi que ltude diverge fortement dune phase doptimisation. Pour la sance du COPIL prvue le 23 aot 1999, le GT ne propose pas celui-ci une optimisation de variantes initiales, mais plutt ltude de nouvelles variantes. Quatrime phase fin aot et septembre 1999
A deux doigts de la rupture
Pour de nombreux membres du COPIL, la sance du 23 aot devait reprsenter une sance de clture o le trac de la variante des Communes rvise, qui apparaissait nettement en tte de la Comparaison de variantes 1999 , serait finalis aprs y avoir apport les correctifs ncessaires.129 Il est noter que cette attente est comprhensible, le dlai de clture de ltude la fin du mois de juin 1999, tel quannonc la sance dinformation initiale, tant dj dpass. La proposition du GT de prolonger les travaux de la Comparaison de variantes 1999 en demandant dtudier de nouvelles variantes entrane la confusion dans lassemble. Si certains acteurs accueillent avec intrt ces propositions, ne voulant pas exclure doffice des solutions, dautres ont le sentiment que les partisans des variantes 0+ tentent denliser la procdure. Comme indiqu la note de bas de page N91, ces deux camps sont assez facilement identifiables. Les ractions mdiatiques qui sensuivent sont vives et lon peut craindre alors une rupture du consensus autour du processus, celui-ci apparaissant par exemple comme tant vici aux yeux des syndics vaudois. Cinquime phase septembre 1999
Consensus final sur une Solution COPIL
Ltude ayant failli chouer, une nouvelle optimisation, qui nest en fait quune gnration de variantes supplmentaires, est ralise. Elle consiste en ltude de quatre combinaisons possibles entre des tronons est (Clos) et ouest (Golf). Lors de la sance du COPIL du 30 septembre 1999, un consensus est adopt lissue de vifs dbats faisant craindre lauteur que ltude ne senlise nouveau. Ce consensus aboutit une variante appele Solution COPIL . Le mandataire externe finalisera ensuite lanalyse de valeurs dutilit en y introduisant cette variante consensuelle. Le rapport technique dfinitif est fourni en mai 2000 et le projet de dcret auprs du Grand Conseil vaudois est dpos en juillet 2000.
129
Il sagit de rduire les atteintes lenvironnement naturel la fort de Vuillerez et de rduire les cots de ralisation en diminuant les dimensions des ouvrages dart
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
85
Ltendue de chacune de ces diffrentes phases dtude de la Comparaison de variantes 1999 est reprsente graphiquement sur la figure suivante :
3 dcembre 1998
Sance d'information
29 mars 1999
COPIL 2
Phase 1 Phase 2 Phase 3
5 fvrier 1999
COPIL 1
21 mai 1999 15 juin 1999 2 juillet 1999 6 juillet 1999 18 aot 1999 31 aot 1999
COPIL 3 GT 3 COPIL 4 GT 4 GT 5 COPIL 5 GT 6 GT 7 COPIL 6
Phase 4
23 aot 1999
22 septembre 1999
Figure 15
Prsentation synthtique des principales phases dtude de la Comparaison de variantes 1999
2.8.2
Variantes
Au cours de la phase doptimisation ralise durant lt 1999, de nombreuses variantes ont t proposes par le Groupe Technique afin dtre intgres dans lanalyse des valeurs dutilit, ceci en plus des quatre variantes initiales (variantes des Communes et 0+, adaptes ou rvises). Il sagit des variantes X et Y, drives des variantes 0+, de la variante K ou Blanc , des combinaisons entre les variantes Golf et Clos (Nord et Sud) et finalement la Solution COPIL. Dautres propositions de tracs ont aussi t voques par de nombreux participants au cours de ces sances de travail du GT, mais elles ne sont pas cites ici, leur existence ayant t assez phmre. Il sagit l clairement dune phase de gnration de variantes, car les tracs proposs sont parfois trs loigns de ceux des variantes initiales. Sil peut sembler intressant de ne pas limiter ltude quatre options et de tenter de trouver de nouvelles solutions, cette opration a cependant t trs mal prsente au Comit de Pilotage et elle sest droule au mauvais moment du processus dtude.
Phase 5
86
LES ETUDES DE CAS
En effet, ce nest pas aprs avoir ralis une analyse des valeurs dutilit trs restrictive130 que lon doit ouvrir la bote de Pandore et laisser libre cours aux diverses propositions. Il faut plutt procder de manire inverse : ne pas brider les rflexions initiales, qui peuvent amener une profusion de variantes, puis petit petit resserrer le cadre de la rflexion, en triant et en liminant des options, ceci pour aboutir des solutions de plus en plus labores. Postulat 14
La profusion dides initiale doit progressivement tre canalise afin daboutir une rflexion approfondie sur des sujets prcis
Lexamen des quatre variantes initiales tudies dans la Comparaison de variantes 1999 amne les constations suivantes : Chacune de ces variantes souffre dun fort handicap, que cela soit la traverse de la fort de Vuillerez pour les variantes des Communes, la prsence douvrages dart importants pour la variantes des Communes adapte131 ou un faible standard de circulation assur par les variantes 0+ Ces variantes sont peu finalises car, comme on la constat lors de leur optimisation, certains inconvnients majeurs quelles prsentaient ont pu rapidement et aisment tre rduits, voir limins132 La diffrentiation entre les variantes rvises et les variantes adaptes nest pas pertinente. En effet, ladaptation des variantes consiste en quelques lgres modifications donnant une solution qui est trs proche des propositions initiales des groupes dintrt. La rvision des variantes est par contre une tentative, certes encore incomplte, dliminer certains des dfauts de ces propositions, sans pour autant modifier fortement leur trac. On peut ainsi prtendre que les deux variantes rvises sont le fruit dune premire optimisation et non dune gnration de nouvelles variantes. Les faibles diffrences de notation observes entre elles le dmontre bien dailleurs Postulat 15
Les diffrentes variantes gnres doivent prsenter des diffrences sensibles pour tre retenues dans la phase de choix
Le choix de conserver dans lanalyse des valeurs dutilit des variantes prsentant dimportants dfauts a une raison historique et politique. Il sagit en effet de montrer chaque groupe dintrt que leur variante est considre et nest pas exclue doffice, ce qui amliore lacceptation du processus dtude propos.
130 131
Les variantes initiales nont subi aucune modification avant juillet 1999, mme si certains dfauts taient flagrants Il est remarquer quun projet de semestre ralis par un tudiant qui proposerait un ouvrage dune telle dimension pour franchir le Rhne sans une argumentation solide ne serait pas garant dune note suffisante de la part de lauteur. Le trac ouest des variantes des Communes semble avoir en effet t ralis sans tenir compte de la contrainte Environnement naturel Ainsi, un simple dcalage du trac des variantes des Communes de moins de cent mtres vers le Sud permet dviter la fort de Vuillerez et de nettement amliorer leur note dapprciation concernant lenvironnement naturel
132
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
87
Cependant, cette mthode peut avoir un effet pervers, car en comparant ensuite une variante de qualit moyenne avec une variante de mauvaise qualit, on a tendance surestimer les qualits de la variante moyenne.133 De plus, llimination des dfauts de la variante de mauvaise qualit peut tre prsente comme tant une amlioration des ses performances, alors quen fait il sagit dune opration qui aurait d tre intgre dans son processus de conception Ces variantes ont t labores en parallle par diffrents groupes dintrt.134 Ceux-ci sont trangers au Service des Routes du canton de Vaud, qui na finalement eu que peu dinitiative dans ces tudes. Ceci se ressent dans la dissimilitude des paramtres de base retenus et les objectifs qui sont trs divergents (cas du standard affect la future A 144 par exemple) Ces variantes ont fait lobjet dun tri prliminaire limitant la rflexion quatre solutions possibles. Ceci permet de diriger lanalyse sans se disperser. Cependant, cette opration rsulte dun choix politique, ce qui explique ses caractristiques, et non pas dune premire analyse de choix base, par exemple, sur des mthodes daide multicritre la dcision permettant de classifier rapidement des variantes dans des catgories prdfinies135 (Roy B., 1985; Schrlig A., 1985)
Il est relever aussi que les noms attribus aux diverses variantes tudies dans la Comparaison de variantes 1999 sont compliqus, ce qui namliore pas forcment la comprhension.
2.8.3
Analyse des besoins et dtermination du standard
Les rponses aux questions de justification du projet poses par les membres du COPIL sont parfois vasives ou fortement lgalistes.136 La rflexion mene par la reprsentante de lOFEFP137 montre combien lanalyse des besoins, notamment du standard donner la A 144, na pas t ralise correctement en dbut dtude. De nombreuses remarques mises par les membres du COPIL138 corroborent cet avis. Ainsi, une demande formelle de fixer dfinitivement le standard de la future A 144 avant de poursuivre ltude a t ralise lors de la sance du 23 aot 1999,139 ce qui est bien tardif. Le fait que le standard, qui est lun des objectifs atteindre par la nouvelle route (Quelle scurit et quel confort veut-on offrir aux usagers de la route ?), naie pas t clairement dfini au dbut de la Comparaison de variantes 1999 a fortement influ sur le droulement de cette tude. On assiste ainsi un mlange entre des
133 134 135 136
Citons par exemple le proverbe Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois pour illustrer cette problmatique Le conseiller dEtat vaudois parle mme de dmarche autistique ! (Wichser F., 1998) Par exemple en classant les variantes en trois familles : retenir / approfondir / rejeter Largument avanc parfois LOrdonnance du Conseil Fdral de 1961 prcise que la A 144 est une route principale suisse (page 53) pour justifier le standard de cet axe nest pas convaincant tant les conditions se sont modifies depuis quatre dcennies Note de bas de page N50 la page 53 Note de bas de page N68 la page 58 Voir le commentaire ce sujet situ la page 66
137 138 139
88
LES ETUDES DE CAS
variantes en site propre et dautres trafic mixte. Le mandataire externe voque ce problme lors de linterprtation des rsultats de lanalyse des valeurs dutilit, en crivant la page 92 du rapport technique que , la comparaison des variantes de la
A 144 a ceci de particulier que ces variantes reprsentent la fois des variantes de trac et des variantes de standard (trafic mixte, trafic spar) . (Infraconsult, 2000)
A la lecture des rsultats de lanalyse de la valeur dutilit, qui classe les variantes des Communes largement en tte devant les variantes 0+, le mandataire externe en tire le constat suivant, prsent la page 93 du rapport technique : les rsultats
dmontrent linfluence prdominante du choix de la stratgie (du standard) pour le rang dune variante ; lintrieur de chacune de ces stratgies, les diffrences entre la variante adapte et la variante rvise sont peu importantes (influence du trac) .
(Infraconsult, 2000) Il semblerait la lecture de cette phrase que finalement seul le standard influence le classement dune variante et que le trac ne soit finalement que secondaire. En fait, il nen est rien et lauteur ne partage pas ces conclusions, qui pousses lextrme peuvent se rvler errones. En effet, en appliquant la lettre cette recommandation, comme seul le standard influence le choix dune variante, le trac ntant finalement quun affinage, il suffirait donc de fixer un standard de qualit leve140 pour arriver une valeur dutilit suffisante. Ainsi, le trac de la variante travers la zone dtude naurait aucune influence sur le choix final, ce qui bien sr est absurde. En fait, ce genre de raisonnement comporte un double problme dchelle danalyse qui est occult dans le rapport technique. La premire chelle danalyse consiste choisir le standard donnant la meilleure valeur dutilit. Cest ce qui prcisment na pas t ralis au dbut de la Comparaison de variantes 1999 , les variantes prsentant des standards diffrents. On admet que ce standard est choisi sur la base dcarts dune ampleur dsigne par le terme . Dans lanalyse des valeurs dutilit ralise la fin de la Comparaison de variantes 1999 et qui est prsente au Tableau 16 la page 79, cet cart considr pour la pondration du COPIL entre les moyennes des variantes Communes (standard lev) dune part et les variantes 0+ (standard moyen) dautre part vaut : = 0,58 0,14 = 0,44 La seconde chelle danalyse consiste choisir un trac qui donne la meilleure valeur dutilit avec un standard fix par les rsultats de lanalyse prcdente. On admet que ce trac est choisi sur la base dcarts dune ampleur dsigne par le terme . Dans lanalyse des valeurs dutilit ralise la fin de la Comparaison de variantes 1999 et qui est prsente au Tableau 16 la page 79, cet cart considr pour la pondration du COPIL vaut :
= 0,63 0,55 = 0,08 pour les variantes des Communes = 0,17 0,13 = 0,04 pour les variantes 0+
On constate donc que pour la Comparaison de variantes 1999 , 5 et que les deux valeurs de sont du mme ordre de grandeur.
140
Ceci car le standard appliqu la variante des Communes, qui arrive en tte de lanalyse des valeurs dutilit, est un standard de qualit leve
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
89
Variantes ORDRE DE GRANDEUR DES APPRECIATIONS
Ampleur pour le choix du standard
Ampleur pour le choix du trac
Figure 16
Ampleur des choix de standard et de trac pour la Comparaison de variantes 1999
Ainsi, on peut affirmer en premire approche, tout comme le mandataire externe, que lampleur du choix du standard est nettement suprieure lampleur du choix du trac . Il sagit donc bien de deux problmatiques exprimes des chelles diffrentes, comme le montre la figure prcdente. La Comparaison de variantes 1999 ralise un mlange de ces deux niveaux danalyse en se basant sur une problmatique grande chelle, qui est celle du choix du standard, ce qui fait que logiquement les chelles du deuxime chelon, qui est celui du trac, apparaissent insignifiantes. Cette erreur dapprciation na pas t dcele dans la Comparaison de variantes 1999 car le standard na pas t fix avant de dbuter ltude. La Comparaison de variantes 1999 aurait d procder au choix de variantes de la manire suivante pour viter de tirer de tels enseignements : tout dabord procder au choix du standard donner linfrastructure routire. Si ce standard nest pas dfini de manire stricte ou rglementaire,141 ce choix peut tre effectu laide dune premire analyse multicritre qui peut tre ralise sommairement142 sans ncessairement mobiliser tous les acteurs du COPIL fixer ensuite le standard qui constitue alors un objectif commun toutes les variantes : raliser une route assurant la circulation dun type de trafic donn avec des conditions de scurit et de confort donnes gnrer les variantes choisir une variante en procdant une analyse des valeurs dutilit telle que ralise dans la Comparaison de variantes 1999 raliser loptimisation du ou des trac(s) plac(s) en tte du classement
141
Le standard dune autoroute doit par exemple respecter certains critres tandis que pour un type de route infrieur, une plus grande libert est laisse pour le choix du standard On pourrait par exemple considrer dans le cas de la A 144 des critres lis directement au standard comme : effets sur le dveloppement conomique, impacts sur lamnagement du territoire, confort et scurit de circulation du trafic motoris, pitons et agricole, cots de ralisation, cots dentretien, etc.
142
90
LES ETUDES DE CAS
2.8.4
Procdure
Le primtre de ltude na pas t clairement dfini au dbut de la procdure, ce qui a engendr de nombreuses discussions. Cest en effet seulement aprs la troisime sance du COPIL, suite une sance de coordination entre lOFROU et lOFEFP, que cette opration a t ralise. La procdure classique du projet routier143 na de loin pas t respecte dans ce projet. La Comparaison de variantes 1999 a en effet directement dbut la phase 5 (prparation des lments amenant au choix dune variante).144 Loptimisation finale qui a suivi (phase 7) lanalyse des valeurs dutilit ayant montr des lacunes dans les lments descriptifs (contraintes environnementales notamment) disposition du GT, ceci a ncessit un retour la phase 3 (tablissement et synthse des contraintes). Ensuite, la constatation des dfauts inhrents aux variantes initiales a amen le GT raliser un travail de gnration des variantes (phase 4). Ainsi, on peut constater que le fait de dbuter la Comparaison de variantes 1999 par une phase avance de la procdure na pas permis de saffranchir de certaines tapes initiales dont les rsultats sont ncessaires pour les tapes suivantes. Cette faon de faire a plutt embrouill le dbat alors quelle avait pour but de lclaircir. Cest cette confusion qui a t la base des nombreuses ractions ngatives rencontres la fin aot et en septembre 1999.145 On peut en tirer la leon que lanalyse des contraintes et la dtermination du cadre de ltude et des objectifs sont des oprations qui semblent anodines mais qui ont dimportantes consquences sur le droulement des travaux dtude. Elles ne sont pas raliser en cours dtude mais au dbut de celle-ci. Postulat 16
Une tude routire doit slaborer sur des bases de qualit, soit une dfinition claire des objectifs, un cadre dtude correctement dfini et une synthse complte des contraintes
Au vu des nombreuses rtroactions qui ont t ncessaires, des conflits ainsi engendrs et de la qualit du rsultat obtenu,146 il aurait srement t prfrable daffirmer plus nettement une volont de saffranchir des variantes initiales.147 Ainsi, la Comparaison de variantes 1999 aurait pu dmarrer la procdure dtude classique cite prcdemment en tant vierge de tout examen prliminaire.
143
On peut simplifier celle-ci en sept phases principales : 1) Dfinition du cadre de ltude ; 2) Dfinition des objectifs ; 3) Rcolte et synthse des contraintes ; 4) Gnration de variantes ; 5) tablissement des lments et des principes du choix de variantes ; 6) Choix de la variante ; 7) Optimisation du trac retenu Le chapitre 3 qui concerne la procdure dtude dun projet routier donne plus de renseignements ce sujet Comme expliqu auparavant, ceci sexplique par les nombreuses variantes existantes dj avant le lancement de la Comparaison de variantes 1999 et aussi par le peu de temps disposition (moins de six mois initialement) Certains acteurs ont eu le sentiment de tourner en rond Celui-ci est bien plus quune optimisation dune variante initiale et consiste plutt en une nouvelle variante Ce choix aurait srement engendr de vives rcriminations de la part des acteurs qui ont gnr les variantes initiales. Cependant, une argumentation solide peut faire comprendre ceux-ci lintrt de procder ainsi
144
145 146 147
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
91
Ce procd rallonge srement la dure de ltude, mais le fait de faire table rase du pass prsente plusieurs avantages : le primtre de ltude et les objectifs attribus la A 144 (le standard notamment) sont clairement dfinis ds le dbut du processus et ne sont plus rediscuts ensuite les contraintes sont tablies avant de procder lanalyse des variantes, contrairement ce qui a t observ dans la Comparaison de variantes 1999 148 il y a lassurance dune totale libert dans la gnration de variantes, les participants tant invits alors prsenter leurs propositions sans retenue, propositions qui peuvent rejoindre des tudes antrieures mais qui surtout tiennent compte des objectifs et des contraintes actualises149 en liminant des projets antrieurs potentiellement conflictuels, on dcrispe les acteurs prsents en les dbarrassant de la tentation de dbuter ltude par une attitude dopposition envers lune des variantes proposes par la partie adverse. Cest le cas par exemple de lattitude des syndics vis--vis des variantes 0+ ou des associations de protection de lenvironnement vis--vis des variantes des Communes. Ltude peut ainsi dbuter sur des bases plus saines
2.8.5
Organisation du travail
Lanalyse de lorganisation du travail de la Comparaison de variantes 1999 amne les commentaire suivants : Les rsultats de certaines tapes sont parfois anticips. On pense ici par exemple la premire analyse des valeurs dutilit qui a t ralise avant que les apprciations ne soient corriges par le GT ou le COPIL. Il y a aussi le cas de la confrence de presse du 30 septembre qui a t organise sans que les rsultats de la dernire sance du COPIL soient formellement connus. Cette faon de faire laisse parfois une dsagrable impression de forcer la main des participants On peut noter limportance de linfluence politique du conseiller dEtat vaudois sur le choix des variantes initiales et sur lorganisation de la procdure. En effet, alors que lOFROU finance les 2/3 de la future route et que son reprsentant dirige le COPIL, les impulsions quant aux orientations donner ltude sont manifestement ralises par le conseiller dtat. Dans ce cas, lOFROU laisse plutt limpression davoir un rle de suiveur que de meneur de ltude Lors de la dernire sance du COPIL, ce nest pas lexamen des rsultats de lanalyse des valeurs dutilit qui a permis daboutir une solution mais plutt la recherche dun consensus, ou plutt dun compromis, au sein de lassemble. Les membres du COPIL se sont en effet plutt bass sur leurs impressions et leurs avis personnels sur les nouvelles variantes que sur les rsultats de lAVU, qui
148
Le fait de ne disposer de certaines contraintes qu la fin du mois de septembre 1999 (cas des sites protgs par les monuments historiques par exemple) nest pas un gage de qualit pour lapprciation des variantes. Un participant relve mme lors dune sance que pour cette raison le GT navigue vue Ceci nest vraiment pas le cas dans la Comparaison de variantes 1999 , la variante des Communes ne respectant pas la contrainte de la fort de Vuillerez par exemple
149
92
LES ETUDES DE CAS
taient de toute manire absents,150 pour prendre cette dcision consensuelle. La dernire sance du COPIL a en quelque sorte court-circuit lAVU, dont les rsultats ont t publis aprs ladoption de la solution COPIL. On remarque dans la conclusion de cette tude quil persiste une certaine confusion entre une solution consensuelle, qui sous-entend une variante adopte par les membres du COPIL aprs des changes dides et des discussions acharnes, et une solution optimale, qui est la variante la plus favorable sur la globalit des critres danalyse. Ces deux solutions ne sont pas forcment identiques, un consensus pouvant tre adopt sur une variante prsentant dimportants dfauts Il y a une forte ambigut sur le rle des diffrents groupes de travail. La stricte sparation qui doit exister entre le Comit de Pilotage, qui correspond au dcideur tel que le dcrit B. Roy, (Roy B., 1985) et le Groupe Technique, qui ici correspond lhomme dtude de B. Roy, nest en effet pas assure dans la Comparaison de variantes 1999 comme on la remarqu de multiples reprises. Ceci est mme relev par certains participants qui se demandent parfois quel est le rle et la fonction exacte de chacun
On peut aussi relever que la Comparaison de variantes 1999 a engendr un dpassement du crdit dtude denviron 150'000.- Les tudes complmentaires ncessaires dici la mise lEnqute publique sont devises environ 1 million de francs. (DINF, 2000a) De plus, le dlai annonc en dcembre 1998 (fin des tudes en juin 1999) na pas pu tre tenu et est dpass de 3 mois.
2.8.6
Acteurs
On peut relever les commentaires suivants propos des acteurs composant les diffrents groupes de travail de la Comparaison de variantes 1999 : Pour le canton de Vaud, la diffrence dapprciation de la problmatique entre les lus locaux (syndics et prfets) et cantonaux (conseiller dEtat) est manifeste. En effet, si les premiers dsirent aboutir au plus vite une solution permettant de dbuter rapidement les travaux, le conseiller dEtat dsire quant lui mettre le maximum datouts dans sa manche. Il argumente sa position sur le fait que le temps perdu lors de la Comparaison de variantes 1999 pourra tre rapidement rattrap si la mise lEnqute publique ne dbouche sur aucune opposition. Il est dsireux de nliminer aucune alternative et de consolider le dossier dtudes en obtenant le plus large consensus possible auprs de lensemble des acteurs reprsentatifs. Cette faon de faire est plus prudente, car elle permet dliminer les difficults au dbut de ltude afin de prvenir au maximum les mauvaises surprises.
150
En effet celle-ci est termine par le mandataire externe aprs cette dernire sance du COPIL. Il est intressant de constater limportance que celui-ci accorde cette deuxime AVU. En effet, dans le rapport technique, si lattribution des valeurs dapprciation des quatre variantes initiales reprsente prs de 45 pages fortement dtailles, lapprciation de la Solution COPIL est limite 7 pages peu commentes ! On peut srieusement se demander quest ce quil se serait pass si lAVU finale montrait que la Solution COPIL napportait pas une importante amlioration aux Variantes des Communes, voir mme si elle prsentait une valeur dutilit infrieure celles-ci. Il sagit dun procd qui ne respecte pas la succession logique des oprations dune aide la dcision multicritre o les dcisions sont prises sur la base des rsultats de lAVU et non pas avant
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
93
Postulat 17
Une perte de temps engendre par une tude initiale approfondie peut permettre dviter des blocages ultrieurs, diminuant ainsi la dure globale du projet
Les acteurs reprsentant lenvironnement ont profit au dbut de la Comparaison de variantes 1999 du fait que le primtre dtude ntait pas clairement dfini pour demander de lagrandir au del du secteur entre Les Evouettes et Rennaz. Ceci avait pour objectif de considrer au sein de ltude un ouvrage source de conflits, le tunnel des Evouettes. Cette tentative dlargissement de ltude a cependant t rejete, car elle naurait eu pour but que de ralentir la procdure et quelle sortait compltement du mandat du COPIL. Si il ne faut pas se fixer obstinment sur un primtre dtude initial, au risque doublier danalyser un lment important, le projeteur doit nanmoins tre conscient que les acteurs prsents dans le processus dtude veulent souvent y intgrer le maximum dlments les intressant. Cest lui dviter une drive de ltude en veillant conserver au maximum le cadre de ltude en relation avec les dimensions spatiales ou temporelles du projet. Postulat 18
Le cadre de ltude ne doit pas stendre de manire dmesure au gr des demandes des acteurs
On peut remarquer que certains acteurs ont eu la tentation du hold-up , comportement qui sera dcrit plus en profondeur dans le chapitre 7 concernant la concertation. Cest le cas notamment de la reprsentante de lOFEFP qui a lissue de la troisime sance du COPIL dclare que son office se rserve un avis libre (page 53). Cette remarque rejoint le commentaire effectu par la Commission de Gestion du Conseil National au sujet de la manire dont lOFEFP utilise les autorisations de dfrichement : des exigences formules par lOFEFP, (), qui nont pas t retenues
par le canton, sont rintroduites dans des conditions dapprobation de dfrichement. Pour la commission, cette procdure est intolrable. Il nest pas normal que des travaux () puissent tre retards par () un office fdral qui cherche par tous les moyens faire passer ses exigences . (CGCN, 1997)
On est ici dans un fait similaire, un acteur dimportance151 tentant dimposer son point de vue aux autres participants. Comme le prcise le rapport technique, la composition du COPIL prend en
compte les diffrents intrts et responsabilits, tant politiques que techniques, au niveau rgional, cantonal, voir international . (Infraconsult, 2000) Cependant, comme on le
constatera dans la suite du rapport de thse, il apparat que certains acteurs manquent dans la composition du Comit de Pilotage de la Comparaison de variantes 1999 .
151
Si cet acteur nest pas important, il sera plus difficile pour lui dimposer son point de vue. Cette qualification de lOFEFP vient du fait quelle bnficie doutils lgislatifs pouvant bloquer la totalit du projet
94
LES ETUDES DE CAS
Les acteurs quil aurait t ncessaire dintgrer au COPIL sont les suivants :
-
usagers individuels motoriss152 avec des associations comme le Touring Club Suisse (TCS) ou lAutomobile Club Suisse (ACS) transporteurs routiers153 avec une association lAssociation suisse des transports routiers (ASTAG) professionnelle comme
transports collectifs routiers ou ferroviaires de la plaine du Rhne acteurs conomiques privs dimportance du Chablais : industrie chimique de Monthey, etc.154 reprsentants de lconomie touristique du Chablais comme les parcs dattractions du Bouveret,155 le camping du Grand Bois ou le Golf situ au nord de Chessel agriculteurs de la plaine du Rhne156 population des villages du primtre dtude157 etc.
On remarque aussi que la composition du COPIL favorise deux catgories dacteurs :
-
les riverains158 de la A 144, ceci au dtriment des usagers qui sont reprsents indirectement par des acteurs institutionnels159 les acteurs institutionnels,160 ceci au dtriment des acteurs privs, les milieux associatifs tant correctement reprsents
Il ne semble pas par contre que des acteurs usurpent leur place au sein du COPIL La composition du GT nest pas clairement dfinie et elle sera trs variable tout au long de la Comparaison de variantes 1999 . Il est prciser aussi quau dbut de ltude, un acteur se trouvait tre membre des deux groupes de travail, ce qui tait prjudiciable lindpendance ncessaire entre ceux-ci. Cette situation ambigu a cependant t rapidement rgle. On peut noter labsence de quelques acteurs dans ce Groupe technique, comme un reprsentant des services des monuments historiques
152 153
Il sagit des principaux utilisateurs de la future A 144 qui sont directement intresss par le standard propos Des lments concernant le trafic des poids lourds (volume, desiderata, etc.) sont prsents dans la Comparaison de variantes 1999 . Il aurait t intressant de disposer de lavis des professionnels du domaine Pour laccs leurs entreprises, soit pour les poids lourds, soit pour leurs employs frontaliers La qualit de la liaison routire depuis la A 9 est un aspect important de leur offre touristique Il sagit aussi dusagers importants de la future A 144, si celle-ci est en trafic mixte, ou du rseau secondaire de la plaine modifi par une A 144 en site propre Celle-ci est reprsente de manire indirecte par les syndics et les prsidents de communes qui semblent exprimer le sentiment des riverains de la liaison routire actuelle Dans une dfinition largie comprenant lensemble des acteurs concerns par les milieux naturels ou humains affects par la route (associations de protection de lenvironnement, syndics, etc.) Cette affirmations se base sur le fait qu la question de la raison de labsence dassociations dusagers dans le COPIL, le chef du Service des Routes du canton de Vaud a rpondu que son service reprsente en fait les usagers, position que ne partage pas lauteur Sur les 28 membres du COPIL, on compte 12 lus (2 conseillers dEtat, 2 prfets et 8 syndics ou prsidents de communes), ceci sans compter les reprsentants dassociations disposant de mandats politiques, et 9 reprsentants dadministrations publiques
154 155 156
157
158
159
160
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
95
Les acteurs provenant du dpartement franais de la Haute-Savoie sont surtout intervenus lors des premires sances de la Comparaison de variantes 1999 . Quand le standard a t admis pour un trafic motoris en site propre, ceux-ci sont rests discrets, le trac exact de la A 144 travers la plaine du Rhne les concernant moins directement La sparation en deux groupes de travail (GT et COPIL) aux spcificits clairement dfinies initialement, mme si la pratique montre des diffrences, est relever comme tant une organisation intressante pour mener lanalyse des valeurs dutilit Dans la Comparaison de variantes 1999 , il est intressant de constater que les principaux acteurs reprsentatifs ont pleinement particip la discussion. Les dbats ont parfois t vifs ou passionns et les ractions virulentes ont occup le devant de la scne mdiatique. Mais au moins les acteurs sont sortis du bois et ont affirms leurs positions divergentes et dfendus leurs points de vue contradictoires. Ces conflits nont nullement empch la Comparaison de variantes 1999 daboutir finalement un consensus. Il sagit dune situation qui est prfrable un dbat o les participants naffichent pas leurs opinions ou saffrontent sur des sujets mineurs. Dans ce genre de cas, le compromis qui est tabli ensuite peut souvent tre qualifi de faade car les avis divergents ne se sont pas exprims. Postulat 19
Il ne faut pas craindre un dbat passionn car il sagit de la meilleure manire de faire apparatre au grand jour les positions divergentes des diffrents acteurs de ltude
2.8.7
Analyse des valeurs dutilit
On peut relever les commentaires suivants propos de lanalyse des valeurs dutilit effectue lors de la Comparaison de variantes 1999 : Le systme des objectifs prsent par le mandataire externe a suscit peu de discussions,161 mis part lajout dun objectif gnral li lamnagement du territoire Les indicateurs utiliss sont parfois ambigus et complexes, ce qui namliore pas leur comprhension pour les membres du COPIL. Cest le cas par exemple pour lamnagement du territoire qui est dcrit par des indicateurs comme Influence de la ralisation de la A 144 sur lutilisation mesure du sol, objectif principal de LAT (article 1) ou Degr de respect des buts et des plans en matire damnagement du territoire Le principe de la double pondration effectuer individuellement par chaque membre du COPIL a t bien accepte et comprise par les participants. Seules deux personnes sur trente nont pas remis leur pondration au mandataire externe
161
Cet aspect a fortement surpris lauteur. Cette acceptation est-elle due au fait que la procdure tant novatrice pour la plupart des acteurs, ils ladmettent comme tant de qualit, surtout quil a t annonc que lAVU avait t utilise auparavant avec succs ? Ou alors, les acteurs ne comprenant pas encore entirement le fonctionnement de cette AVU, ils sabstiennent de la commenter ?
96
LES ETUDES DE CAS
On peut remarquer quun syndrome du rverbre 162 est prsent dans cette tude. En effet, on insiste beaucoup dans cette tude sur lexamen de certains critres facilement quantifiables comme le trafic ou les cots de ralisation tandis que dautres critres plus difficilement valuables, comme les effets sur le dveloppement conomique au niveau macro-rgional, sont traits superficiellement163 Comme prsent la page 52, la pondration dun objectif par un acteur du COPIL ou du GT dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 est organise de la manire suivante :
-
les poids sont attribus en % la somme des diffrentes pondrations au sein dune catgorie donne vaut 100 % en prsence de plus de deux objectifs dans une catgorie donne, le poids maximal pour un objectif est fix 50 % le poids minimal attribu un objectif est de 10 %.
Cette limite infrieure de 10 % attribue la pondration dun critre,164 quand on dispose de plus de deux critres diffrents dans une mme catgorie, peut tre trs restrictive si le nombre de critres considrs n augmente. On peut analyser la libert ou marge de manuvre laisse lacteur effectuant une pondration en fonction du nombre de critres prsents dans la catgorie analyse en tenant compte de trois valeurs reprsentes dans la Figure 17 :
-
la somme reprsente par le fait de pondrer tous les critres, sauf un, avec la pondration minimale de 10 % la libert de manuvre, qui est en quelque sorte la quantit de pondration restant disposition de cet acteur une fois quil a appliqu la pondration minimale tous les critres la pondration maximale qui est de 50 % mais qui diminue si n > 6, ceci pour respecter la valeur totale fixe 100 %165
162
Il sagit du fameux exemple o un individu ayant perdu ses clefs par terre dans une rue obscure commence sa recherche sous le rverbre, non pas parce quil pense quelles sy trouvent, mais parce que cest lendroit o la prospection est la plus facile en raison de la prsence de la lumire (Roy B., 1985) Par exemple, le trafic fait lobjet dun chapitre fouill dans le rapport technique alors que le dveloppement conomique est trait en quelques paragraphes remplis dassertions gratuites et non dmontres. Un participant relve mme que lexamen des effets du dveloppement conomique induit par la A 144 tient plus de la profession de foi que dune tude fouille On parlera dsormais dans le texte de critres plutt que dobjectifs En effet, le systme deux inquations ( (n-1) 10 % + maximum 100 % ) et ( maximum = 50 % ) ne fonctionne pas si n est suprieur 6
163
164 165
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
97
Pondration P
100 %
Remarque : les diffrentes valeurs sont reprsentes sous forme d'une fonction continue pour amliorer la reprsentation. En fait, il s'agit de valeurs discrtes
Libert de manoeuvre
75 %
des (n-1) critres avec
la valeur minimale
50 %
Valeur de pondration maximale
25 %
10 % 0% 2
Figure 17
Nombre de critres n 3 4 5 6 7 8
Possibilits de pondration en fonction du nombre de critres dans le cas de la Comparaison de variantes 1999
On remarque que la libert de manuvre diminue quand le nombre de critres augmente.166 Une telle difficult apparat dans le cas des objectifs gnraux qui sont au nombre de six. Ces problmes ont t contourns par certains acteurs du COPIL qui nont pas systmatiquement respect la limite infrieure de 10 %, certains attribuant mme une valeur nulle des objectifs gnraux ! Il serait prfrable cependant de laisser une libert de manuvre suffisante qui soit indpendante du nombre de critres considrs. En prenant toujours comme limite maximale la valeur de 50 %,167 on peut fixer une valeur minimale de pondration qui est lie au nombre de critres de la manire suivante :
Pmin =
Avec :
2 n
Pi
100 2 n
Pmin
Pi
pondration minimale attribuable un critre donn somme des pondrations des diffrents critres au sein dune catgorie donne (100 % dans le cas de la Comparaison de variantes 1999 ) nombre de critres au sein dune catgorie donne
166
On peut aussi remarquer quavec la limite dun minimum de 10 %, il est impossible de disposer de plus de dix critres Un critre ne pse pas plus que tous les autres critres runis ensemble ou au pire, il les gale
167
98
LES ETUDES DE CAS
On obtient ainsi le schma suivant :
Pondration P
100 %
Remarque : les diffrentes valeurs sont reprsentes sous forme d'une fonction continue pour amliorer la reprsentation. En fait, il s'agit de valeurs discrtes
75 %
Libert de manoeuvre
50 %
Valeur de pondration maximale
des (n-1) critres avec
la valeur minimale
25 %
10 % 0% 2
min = 25 %
Nombre de critres n 3
min = 16,7 %
4
min = 12,5 %
5
min = 10 %
6
min = 8,3 %
7
min =7,1 %
8
min = 6,25 %
Figure 18
Possibilits de pondration en considrant le nombre de critres dans la dtermination de la pondration minimale
Avec ce principe, la libert de manuvre disposition du projeteur reste toujours fixe 50 % ce qui est moins restrictif quauparavant. On peut cependant postuler que le nombre de critres au sein dune catgorie ne devrait pas en gnral tre suprieur sept. Ceci facilite lattribution de la pondration de la part du dcideur. En effet, au del de cette valeur, les distinctions entre les critres (leur importance relative) tendent samenuiser et contribuent rendre la pondration homogne, cest dire que lon arrive obtenir des critres de mme poids ou faible diffrence relative.
Postulat 20
Afin de faciliter lattribution de la pondration de la part du dcideur, il ne devrait en gnral pas avoir plus de sept critres considrer simultanment
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
99
Comme la fait remarquer A. Schrlig lauteur, on peut facilement saffranchir de ces difficults de fixation des valeurs minimales et maximales des diffrents poids, comme prsent auparavant. Il suffit simplement de ne pas imposer une valeur la somme des poids des critres au sein dune catgorie et dutiliser des nombres entiers, plutt que des pourcentages, pour les poids. Lauteur partage cette analyse en remarquant toutefois que ceci suppose certaines limitations ltablissement des pondrations par les acteurs du projet. Il est indispensable en effet que certaines conditions soient remplies :
-
il ne faut pas quun critre soit trop faible par rapport lensemble de la catgorie, sous peine que son influence soit insignifiante. On peut qualifier cette condition de valeur minimale relative loppos de la remarque prcdente, il ne faut pas quun critre aie un poids trop important, reprsentant par exemple une importance suprieure la somme des poids de tous les autres critres. On peut qualifier cette condition de valeur maximale relative il est ncessaire dviter une homognisation des diffrents poids qui ne prsenteraient alors que de faibles diffrences relatives
Il sagit donc dun exercice qui peut tre difficile raliser en prsence de nombreux critres, rejoignant ainsi la rflexion du postulat prcdent sur la limitation sept du nombre de critres au sein dune catgorie donne. En outre, la difficult de fixer des rgles simples saffranchissant des pourcentages, pour le respect du minima et du maxima des poids, est manifeste. On peut en conclure que lusage de poids en nombre entiers sans somme fixe nest donc pas forcment plus ais et comprhensible pour les acteurs que celui des poids en pourcentage avec une somme fixe 100 %. Lobjectif partiel concernant lenvironnement agrgation que lon peut qualifier dimparfaite :
-
humain
consiste
en
une
lapprciation de cet objectif partiel est base sur une combinaison de quatre indicateurs trs diffrents : impact sonore, pollution atmosphrique, risques d'accidents majeurs dans l'espace habit et impact visuel au paysage et au patrimoine construit lagrgation dindicateurs fortement htrognes168 est rsolue par une pondration qualifie de technique . Celle-ci est prsente de manire vague la page 71 du rapport technique : En raison de leur irrversibilit,
limpact sonore et limpact visuel, () sont deux indicateurs dominant pour lattribution des notes. Les autres indicateurs montrent peu de diffrences entre les variantes (Infraconsult, 2000)
Cette dfinition montre que le principe de lindpendance entre la pondration et la notation dun critre nest pas considre. En effet, on ne doit en aucun cas justifier la pondration dun indicateur par le fait que les valeurs de cet indicateur pour les diffrentes variantes sont similaires. Cest seulement son importance relative dans lchelle des valeurs vis--vis des autres indicateurs qui entre en considration. La pondration est identique que les notes des variantes soient semblables ou quelles soient trs diffrentes. Cest pour cela quil est ncessaire de clairement sparer ces deux oprations.
168
Le rapport technique parle de grande htrognit (Infraconsult, 2000)
100
LES ETUDES DE CAS
Postulat 21
La pondration dun critre doit tre ralise de manire strictement indpendante de sa notation -
alors que lun des objectifs de la nouvelle infrastructure est de diminuer les nuisances lenvironnement humain, le fait que la note de cet objectif partiel soit ngative surprend de nombreux acteurs (page 59)
Cet objectif partiel aurait d tre spar en deux objectifs partiels : un concernant les nuisances sonores et un autre concernant latteinte au paysage169 Une analyse des valeurs dutilit base sur une moyenne arithmtique des pondrations de tous les acteurs, telle que le propose le mandataire externe, na aucun sens. Mme le conseiller dEtat vaudois en convient, en dclarant que le processus de lAVU nest pas dmocratique, car si chaque partie concerne est
reprsente dans le groupe, sa composition nest pas proportionnelle aux forces en prsence 170 (Wichser F., 1999b)
La pondration ralise par le GT ne doit pas tre considre dans laide la dcision. Au sens tel que dfini par B. Roy, (Roy B., 1985) le GT est un homme dtude qui ne participe en aucune manire cette opration plus politique que technique Lchelle des notes nest parfois pas clairement indique et lon ne sait pas forcment quel tat de lindicateur correspondent les notes extrmes de 3 ou de +3. De plus, de faibles carts dans les valeurs des indicateurs entranent des carts de notation parfois importants171 Les fonctions dutilit permettant de transformer les valeurs dindicateurs en notes dapprciation sont parfois trs vagues ou fortement subjectives Le terme danalyse des valeurs dutilit est un peu pompeux, car il sagit simplement de notes pondres. (Dumont A.-G. et Tille M., 1997) Le principal argument en faveur de cette mthode est sa simplicit dutilisation et de comprhension Lanalyse de sensibilit effectue dans le rapport technique est assez sommaire. Des membres du COPIL la critiquent, car elle se base sur un postulat, assez maladroit dans son expression, remettant en cause lapprciation avantageuse des variantes des Communes . (Infraconsult, 2000) De plus, la pertinence des informations nest pas considre dans cette analyse de sensibilit172
169
Au regard de lobjectif gnral concernant les nuisances dues aux travaux, pondr au maximum de 10 % et spar en trois objectifs partiels, cette sparation est amplement justifie. En outre, on remarque que dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 , ces deux objectifs partiels bruit et paysage sont souvent contradictoires. Le fait de les avoir combin tend liminer ces diffrences La recherche dune telle proportionnalit nest pas envisager, comme on le dmontrera plus tard. Il sagit dune opration complexe namenant quun rsultat critiquable et il est prfrable denvisager lanalyse multicritre sous la forme de profils dacteurs reprsentatifs de certaines tendances Les discussions quant lattribution des notes au sein du GT sont loquentes. Il apparat parfois le cas o deux variantes sont diffrentes pour un objectif partiel, mais que cette diffrence est si faible quelle ne justifie pas une diffrence de note de 0,5. Cependant, pour ne pas donner la mme note aux deux variantes, on dcide dimposer tout de mme cet cart. On voit l lintrt de disposer dune mthode daide la dcision multicritre tenant compte de diffrences fortes ou faibles, ce qui nest pas le cas de lAVU Par un traitement probabiliste entre la qualit des valeurs provenant dinformations sres, vrifies et mesurables ou des informations vagues prsentant une forte variabilit
170
171
172
Analyse du droulement de la Comparaison de variantes 1999
101
2.8.8
Conclusions de la Comparaison de variantes 1999
Ltude assez complte de ce cas de la liaison routire A 144 entre les localits de Villeneuve et des Evouettes est un apport trs important pour cette thse. On peut dire en conclusion que :
A la suite de nombreuses sances de travail, la Comparaison de variantes 1999 a permis daboutir en moins dune anne dbloquer une situation fortement conflictuelle considrer les avis dacteurs reprsentatifs prendre en compte prs de seize critres dapprciation diminuer les cots dinvestissement de prs de moiti proposer un standard de conduite alliant confort et scurit rduire les atteintes environnementales provoques par les projets initiaux aboutir une solution consensuelle accepte par la plupart des participants prciser le cadre de ltude actualiser les standards .. dcrire le cahier des charges de ltude complmentaire Ceci malgr quelques dfauts relevs par lauteur comme une procdure hsitante et se cherchant une prise en compte de variantes initiales imparfaites labsence de certains acteurs une mthode daide la dcision simple et dun usage ais mais prsentant des dfauts de violents conflits entre les acteurs
102
LES ETUDES DE CAS
2.9
A UTRES CAS
Comme il a t prcis la page 25, la Comparaison de variantes 1999 est le cas de base de cette thse qui a t tudi de manire approfondie. Pour la suite de ltude, lauteur a choisi de concentrer ses analyses sur ce seul cas qui fournit de nombreux et prcieux renseignements sur llaboration dun projet routier. Dautres exemples ont toutefois aussi servis pour appuyer les rflexions menes sur les projets dinfrastructures routires. Quelques uns de ceux-ci sont cits ici, sans quils soient pour autant dcrits avec le mme dtail que pour la A 144.
Autoroute A 1b : contournement de Genve
Louvrage de D. Hiler dcrit lhistorique du projet de cette autoroute contournant la ville de Genve. Son titre Et pourtant elle contourne est vocateur du climat politique rgnant autour de ce projet et ayant plusieurs fois mis en pril sa ralisation. On peut tirer de ce cas les rflexions suivantes : (Hiler D. et Frei A., 1993) depuis les annes 1950, la ralisation dune infrastructure routire dun standard lev contournant lagglomration genevoise a t au cur des joutes politiques de ce canton. A Genve, les combats politiques lis lurbanisme ont lieu dans un climat particulier et sont souvent le lieu de froces luttes bouleversant parfois les traditionnels clivages entre la gauche et la droite. Le cas de lamnagement de la Place Neuve est une parfaite illustration du climat politique genevois relatif aux projets durbanisme (Bassand M., 1998) cette route a t projete au dbut des annes 1980 lors dune priode de croissance conomique et de bonne sant des finances publiques. Il sagit de linfrastructure autoroutire la plus chre de Suisse relativement au kilomtrage. Elle est souvent qualifie dautoroute de prestige quant son important niveau dquipement et aux nombreux ouvrages dart raliss. Certains de ces ouvrages ont t construits ou modifis pour satisfaire aux demandes des opposants faisant dire, comme nous lavons vu auparavant, que lon a achet lopposition coups de milliards ce projet est aussi un symbole de la faiblesse de la qualification du projeteur routier face aux demandes des spcialistes techniques, ce qui amne une certaine fuite en avant dans lquipement. La profusion des quipements lectromcaniques assure un haut niveau de scurit mais du point de vue de la technique routire, ceci n'est pas forcment significatif dune bonne qualit, la prsence de nombreux panneaux et tlpanneaux entranant une importante saturation visuelle pour les usagers. Le projeteur routier na pas eu disposition les outils adquats pour la discussion avec les spcialistes techniques afin de comprendre leurs problmes, accepter leurs propositions mais aussi pour pouvoir en refuser dautres infondes la ralisation dune autoroute dun standard trs lev et comportant de nombreux ouvrages dart enterrs est contraire au principe du dveloppement durable. Les problmes dentretien des quipements sophistiqus (installations de dverglaage automatique, parois paraphones aux portails des tunnels) sont manifestes et il apparat clairement que les projeteurs des annes 1980 nont pas pens aux responsables de lentretien des annes 2000. La consommation dnergie sur le cycle de vie de cette autoroute (les ouvrages enterrs doivent tre clairs et ventils) est considrable et nest pas une solution durable
Autres cas
103
On peut en tirer de ce cas les deux postulats suivants :
Postulat 22
Lingnieur civil doit pouvoir communiquer avec les autres spcialistes par le biais dun langage commun, ceci pour pouvoir aussi mettre des interdits
Postulat 23
Llimination des oppositions par labandon de la confrontation namne pas une solution durable
Autoroute A 1 : Morat Yverdon
Ce cas est bien connu de lauteur qui a exerc une activit de projeteur routier au sein du Bureau des autoroutes de Fribourg durant ltude de dtail de cette infrastructure routire. Prs de trois dcennies ont t ncessaires pour aboutir au trac actuel de cette autoroute qui sera inaugure au printemps 2001. Lhistoire des nombreuses tudes entreprises montre bien lvolution des procdures suisses depuis les annes 1970, ainsi que la monte en puissance des proccupations environnementales auprs de la population, mais aussi auprs des projeteurs. (Infraconsult, 1979) Ce tronon a aussi fait lobjet dune initiative populaire au niveau fdral, intitule Pour une rgion sans autoroute entre Morat et Yverdon . Cette initiative a t rejete le 1er avril 1990 par 67,3 % des votants et par tous les cantons. Les deux cantons concerns (Vaud et Fribourg) ont rejets cette initiative plus de 80 %. Le contexte social autour du projet routier a fortement volu et ce cas en est une bonne illustration. Le trac initialement propos au dbut des annes 1970 prvoyait de traverser le marais de la Grande Cariaie sur la rive sud du lac de Neuchtel. Les marais taient alors vu comme une zone improductive et inintressante pour lhomme, donc idale pour venir y implanter une infrastructure routire dimportance. A lheure actuelle, une telle variante ne serait pas tudie, les marais tant strictement protgs par la loi (Art. 23, LPN, 1966) car ils sont essentiels au cadre de vie.
Problmatique des mesures de protection faunistiques
En participant activement la recherche Interactions entre la faune et les trafics , lauteur a eu loccasion de procder lanalyse de diffrents projets routiers problmatiques. Cette recherche, qui se terminera lautomne 2000, montre que pour aboutir une solution durable, il est ncessaire que les projets de mesures de protection spcifiques la faune se ralisent de manire concerte entre le projeteur routier et lcologue. La mthodologie dtude dun projet comportant des aspects faunistiques doit ainsi tre revue dans le sens dune intgration plus rapide des acteurs spcifiques la faune et du dveloppement dun langage commun entre tous ces acteurs, chacun devant comprendre les proccupations de lautre.
104
LES ETUDES DE CAS
La problmatique de la perte dinformations entre la conception du projet, lexcution des travaux puis lexploitation de louvrage a aussi t souleve dans cette recherche. Il est ncessaire de procder la mise en place de structures assurant le suivi des informations et vrifiant la conformit de lexcution des mesures.
Chantiers dentretien sur le rseau autoroutier suisse
La problmatique de lordonnancement des chantiers dentretien sur le rseau autoroutier suisse est rcurrente. Le systme fdraliste helvtique contribue ltablissement de plans dentretien au niveau cantonal qui nont quune faible cohrence entre eux. Ceci aboutit parfois des situations qui ne sont pas optimales sur le plan national, les chantiers pouvant tre concentrs dans le temps ou lespace. Lauteur sintresse ici non pas aux techniques dentretien ou lorganisation de ces travaux, qui sont ncessaires, mais plutt la politique dinformation des usagers. Ceux-ci sont invitablement gns dans leurs dplacements par la prsence de chantiers dentretien et il sagit de les informer des raisons menant raliser ces travaux ainsi que de prciser leur localisation dans lespace et dans le temps de manire ce quils puissent planifier leurs trajets en connaissance de cause. En Suisse, la politique de linformation des usagers de la part de ladministration routire est lacunaire voire inexistante. Le constat est dautant plus frappant en comparaison avec lexemple dautoroutes concdes franaises o lusager, considr comme un client que lon doit satisfaire car sinon il risque de ne plus revenir sur lautoroute, est inform des mesures dentretien planifies pour les six mois venir. Cette information a lieu notamment par le biais de plaquettes distribues aux pages ou dans les aires de ravitaillement. Ces documents prsentent en plus de la liste des travaux dentretien planifis, les raisons menant les raliser. (AREA, 1999) Il existe aussi un service tlphonique dinformation et de rcoltes de plaintes. Des enqutes intitules Content ? Pas content ? sont aussi rgulirement organises sur le terrain ou par sondages tlphoniques afin de connatre lopinion des usagers sur le rseau quils empruntent ainsi que leurs dsirs. En Suisse, labsence dinformation et le peu de transparence de ladministration routire fdrale fait que seuls les mdias considrent les rcriminations des usagers. Il nexiste pas de structure intermdiaire entre ces derniers et ladministration. Cette dernire ne tient donc que peu de lavis des utilisateurs de la route.
TGV Mditerrane dans la Drme
Louvrage de H. Lannoy traite de la participation du public un grand projet dinfrastructure ferroviaire, la nouvelle ligne du TGV173 Mditerrane entre Lyon et Marseille. Lappropriation par le public de ce projet dimportance qui a dmarr avec de vives contestations, en raison du manque de transparence affich par le projeteur et le dcideur, est intressante analyser. Les riverains ont t informs par la presse le 13 janvier 1990 du trac du TGV dans la plaine de Marsanne, lest de Montlimar, sans aucune consultation des communes concernes de la part de la SNCF (Socit Nationale des Chemins de fer Franais). Ce manque de transparence a dclench de multiples manifestations qui ont
173
Train grande vitesse
Autres cas
105
culmin par le blocage des voies ferres du Vaucluse et de la route Nationale 7 Saulce-sur-Rhne lors de la nuit infernale du 18 aot 1990. Les manifestants ne rclamaient rien dautre que dtre entendus par la SNCF. Durant les cinq annes qui ont suivi, des tudes complmentaires ont t menes afin de prciser le trac exact de la ligne TGV en intgrant cette fois les riverains et les associations dans le processus dtude, amenant ainsi un fort sentiment dappropriation du projet, ce que H. Lannoy dsigne par une citoyennet renouvele . (Lannoy H., 1997)
Introduction
107
3.
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
3.1
I NTRODUCTION
Une infrastructure routire nest pas planifie et ralise pour elle-mme mais pour rpondre certains besoins collectifs, voir individuels.174 Une socit humaine dispose de nombreux instruments techniques ou politiques pour assurer les multiples besoins de ses diverses composantes, la route tant un de ces outils. Les besoins de la socit sont gnralement dfinis au sein de diffrentes politiques publiques qui peuvent tre trs gnrales (politique des transports) ou sectorielles (politique routire). En Suisse, les politiques publiques, tablies au niveau national,175 sont gnralement appliques par les acteurs administratifs cantonaux176 ou communaux. Les politiques publiques sont ainsi dfinies bien en amont du projet routier qui est la concrtisation de celles-ci.
Postulat 24
Une infrastructure routire est ralise pour rpondre des objectifs parfaitement dfinis
Au fur et mesure de lavancement du projet, quand les dtails saffinent, le domaine de ltude se restreint et les acteurs de ltude peuvent tre diffrents. On peut ainsi parfois perdre de vue les objectifs gnraux qui sont atteindre par la future route ainsi que les raisons qui ont donn limpulsion aux diverses tudes. Ceci prsente des risques majeurs pour le projet : on risque de proposer une solution rsolvant parfaitement une problmatique locale mais qui ne rpond que partiellement, voir mme pas du tout, aux objectifs initiaux et globaux lis linfrastructure routire lors de la dfense du projet vis--vis de ses dtracteurs, si le projeteur nest pas conscient de tous les enjeux lorigine de ltude, il y a un risque de ne pas pouvoir le justifier suffisamment, au point de mettre en pril sa ralisation
Ainsi, les objectifs attendus dune route, qui sont la satisfaction de certains besoins, doivent tre clairement dfinis, ou tout du moins rappels, au dbut du projet, ceci pour pouvoir justifier sa ralisation.
174
La problmatique de lidentification des besoins satisfaire par une infrastructure routire est aborde au chapitre 4.4.5 Les politiques publiques nationales sont influences par des notions situes au niveau international, comme le dveloppement durable ou le respect de la biodiversit En Suisse, prs de 80 % des lois dfinies au niveau de la Confdration sont appliques par les cantons dans ce que lon dsigne par le terme de fdralisme dexcution (Knoepfel P., 1997b)
175
176
108
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Ce chapitre, qui traite plus daspects politiques ou sociaux que daspects techniques, est prsent dans cette tude car le projeteur doit tre conscient des politiques publiques et des besoins qui sont lorigine des infrastructures routires quil tudie. Seule une bonne connaissance de ces enjeux politiques et sociaux lui permet de bien raliser son projet ainsi que de le dfendre correctement. De plus, de nombreuses politiques publiques sont affectes par les infrastructures routires et peuvent directement influencer leurs caractristiques lors de llaboration des tudes de conception. Ce chapitre a ainsi plusieurs objectifs : dfinir les besoins individuels et collectifs, notamment ceux qui amnent raliser des routes analyser les politiques publiques qui sont lorigine de la ralisation des infrastructures routires ou qui sont affectes par ces ouvrages. Il sagit en fait de lensemble des politiques publiques incidence spatiale ou lies au territoire dfinir les besoins spcifiques des infrastructures routires en distinguant notamment les notions de norme et de standard
Lors dun examen initial, que lon appelle aussi examen dopportunit, prcdant llaboration du projet routier, lintrt de la ralisation de linfrastructure routire doit tre prouv. La proposition N10 de la Conception Global Suisse des Transports abonde dans ce sens en dclarant que : Avant tout investissement dune certaine im-
portance dans linfrastructure des transports, on examinera comment il se justifie au regard des objectifs de la politique des transports. On tiendra compte des cots et bnfices conomiques globaux, quils soient mesurables ou non . (DFTCE, 1980)
Souvent, lors du processus dtude, le bien-fond des infrastructures routires est remis en cause. Cette contestation tient autant du choix de socit, que lon naccepte pas (dbat sur la mobilit individuelle par exemple) ou que lon souhaite modifier, que des impacts engendrs par la future route que lon dsire liminer ou fortement rduire. Comme on le verra aux chapitres 4 et 9, lexamen initial concerne le dcideur, les acteurs politiques et le public. Cest donc ces acteurs de justifier le projet si celui-ci est contest. Le projeteur routier est un acteur technique excutant qui na pas influencer la socit dans ses objectifs. Toutefois, on assiste de plus en plus un report de cette tche de justification des acteurs politiques vers les acteurs techniques. Ce transfert peut tre difficile assumer pour le projeteur et il est parfois insatisfaisant car celui-ci nest que peu form cet exercice. Il sagit donc de donner au projeteur des notions de communication lui permettant de justifier son projet auprs du public. Ainsi, cet acteur technique doit intgrer dans ses activits des lments politiques de manire pouvoir rpondre aux questions qui se posent invitablement en cours dtude. Il est clair quun solide examen dopportunit prcdant la phase dtude est un lment prcieux au service du projeteur qui peut ainsi faire rfrence un lment indiscutable lors des dbats mens en cours dtude.
Postulat 25
Lingnieur civil doit tre form justifier son projet
Les besoins individuels et collectifs
109
3.2
L ES BESOINS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
3.2.1
Les besoins individuels
Abraham Maslow177 a dvelopp la thorie de la motivation dcrivant le processus par lequel un individu progresse partir des besoins de base jusqu'aux plus levs. Cette structure des besoins est gnralement prsente sous la forme dune pyramide comprenant cinq niveaux de satisfaction successifs : besoins physiologiques besoins de scurit et de protection besoins dappartenance estime de soi accomplissement de soi
BESOINS D'ACCOMPLISSEMENT
BESOINS D'ESTIME
BESOINS D'APPARTENANCE
BESOINS SECURITAIRES
BESOINS PHYSIOLOGIQUES
Figure 19
La pyramide de Maslow
Un individu ne tend satisfaire un besoin dun degr suprieur que quand le besoin de degr infrieur est rempli. On peut conclure ainsi que la satisfaction dun besoin entrane toujours la ncessit den satisfaire dautres. Lhomme est en dfinitive toujours la recherche dun besoin combler, dun sens donner sa vie. Ainsi, par exemple, quand un individu a assur ses besoins scuritaires en disposant dun logement, il cherche assouvir son besoin dappartenance en nouant des relations sociales avec dautres individus. Un individu rationnel et logique ne se soucie pas de laccomplissement de soi sans avoir rpondu son besoin dappartenance.
177
Abraham Maslow (1908-70) est un psychologue amricain, reprsentant principal de la psychologie humaniste
110
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
partir de cette thorie de la motivation des individus, on peut effectuer les remarques suivantes au sujet des acteurs des projets routiers : Les acteurs priphriques les plus susceptibles dintervenir178 dans un projet dinfrastructure routire sont ceux qui dveloppent leur besoin dappartenance ou destime de soi. Ces acteurs sont la recherche dun sens donner leur vie et peuvent considrer ce projet comme tant un prtexte daction, mme sils ne sont pas fortement ou directement affects par celui-ci. Par opposition, un acteur cherchant satisfaire ses besoins physiologiques ou scuritaires est moins enclin ragir un projet, mme si celui laffecte directement ou fortement, car il se soucie de son emploi, de son logement, de sa subsistance, etc. Il est vident que la premire catgorie dacteurs est gnralement plus aise, mieux qualifie, a plus de temps libre et bnficie dun meilleur niveau dducation que la seconde catgorie. On peut aussi remarquer que dans une dmarche de projet classique, les riverains les mieux informs sont les propritaires qui sont avertis par le biais de la mise lEnqute publique. Or, ce sont aussi les individus qui sont les plus aiss, les autres individus ayant moins de moyens financiers pour devenir propritaire.179 Ainsi, les minorits, les personnes faible revenu, les personnes avec une faible ducation sont potentiellement les individus qui sont les moins intresss par les projets et ceux vers qui traditionnellement on ne porte pas leffort dinformation. Il y a l une double injustice quil sagit dviter par la mise en place dune information adresse de manire adapte tous et en attribuant un droit la parole tous les individus, quels que soient leur rle ou leur fonction
Postulat 26
Linformation de la part du projeteur et du dcideur doit tre adapte la structure de la population concerne. Un effort particulier est fournir envers les minorits et les dfavoriss
Quand le besoin dun acteur priphrique est satisfait, ceci ne signifie pas que tous les problmes sont rsolus. Par exemple, si lon peut rsoudre un problme de nuisances sonores auprs des riverains dune infrastructure routire, ce qui consiste satisfaire leur besoin physiologique dun sommeil de qualit, des besoins supplmentaires peuvent apparatre, lis lesthtique des parois paraphones ainsi installes. Par dfinition, la satisfaction des besoins dun individu est inextinguible
Sans vouloir dvelopper dans le cadre de cette tude une thorie de la socit, on peut, partir des besoins individuels dfinis par Maslow, procder une analyse sommaire des besoins collectifs dfinis comme tant les besoins dun ensemble dindividus rassembls dans un systme dfini pour tablir un destin commun.
178
Gnralement les acteurs qui interviennent dans un projet dinfrastructure routire le font car ils ne sont pas satisfaits de certains aspects de celui-ci. Ils souhaitent modifier certains points du projet voir mme, dans un cas extrme, sy opposer dans sa globalit. Pour faire entendre leur voix, ces acteurs utilisent parfois des pressions mdiatiques, surtout sils ne sont pas directement intgrs au processus dlaboration du projet. Par contre, les acteurs satisfaits par un projet sexpriment plus rarement sur celui-ci. On peut ainsi avoir une minorit bruyante dopposants au projet face une majorit silencieuse en accord avec le projet (Bourdier J.P., 1999) et (ENPC, 1999)
179
Cette remarque est dautant plus pertinente en Suisse o seulement 31 % des logements occups en permanence le sont par leur propritaire. Il s'agit l du pourcentage de loin le plus faible en Europe (OFS, 2000)
Les besoins individuels et collectifs
111
3.2.2
Les socits humaines
Une socit dmocratique est un ensemble d'individus organiss en vue de la satisfaction dun intrt gnral. Elle est caractrise par des institutions, des lois, des rgles et des codes sociaux. (AIPCR, 1999) Cette dfinition amne les rflexions suivantes : La socit est organise selon des rgles, qui sont des lois, des coutumes, des traditions, etc. Il ny a pas dorganisation collective sans un minimum de rgles organisationnelles limitant les prrogatives individuelles quand celles-ci peuvent porter prjudice la libert dun autre individu ou lintrt de la collectivit Les individus exercent leurs liberts individuelles dtablissement, dopinion, de croyance ou dactivit au sein de ce cadre collectif. Ils peuvent influencer les conditions de cette socit par le biais de la dmocratie qui leur permet ainsi dexprimer leur avis ou de sopposer certaines dcisions collectives restreignant leur libert La socit existe dans un but prcis : rpondre des besoins communs de nombreux individus, lintrt gnral, et participer ainsi la cration dun bonheur collectif . Le but ultime dune collectivit est de maximiser la somme des besoins individuels raliss et non pas de maximiser chaque besoin individuel. Il sagit dune optique diffrente de la volont de vouloir considrer quune socit nest idale que quand lindividu qui est le moins satisfait lest suffisamment, voir totalement. Seule la satisfaction de la majeure partie des besoins individuels de lensemble de la socit compte La socit sorganise de manire assurer librement chacun de ses membres la satisfaction de ses besoins lmentaires. Cependant, les liberts individuelles peuvent tre limites quand elles sopposent celles des autres individus ou lintrt collectif (cas de la libert de proprit restreinte si elle soppose la ralisation dun infrastructure routire reconnue dintrt public). Ces remarques sont aussi valables pour les personnes morales (entreprises, associations, etc.). Dans un systme dmocratique, ces limitations sous-entendent lexistence dune autorit reconnue par lensemble des citoyens. Il sagit du systme politique des trois pouvoirs (lgislatif, excutif et judiciaire). Ceux-ci doivent jouir dune parfaite indpendance dans la ralisation de leurs tches. R.E. Miles propose de distinguer les diffrents systmes180 civils selon limportance du but social recherch, ceci dans un ordre croissant dorganisation et dtendue spatiale : sciences de base technologie systme technique systme civil systme social ou socit
180
Un systme est un ensemble organis de diffrents lments en interactions dynamiques assembls conformment un plan en vue datteindre un objectif gnral
112
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
3.2.3
Les besoins collectifs
Lidentification, la classification et la hirarchisation des besoins dune collectivit dpassent le cadre de cette tude. Nanmoins, lauteur procde ici une rflexion sommaire sur les besoins de la collectivit car cette phase didentification et de classification est ncessaire pour placer la problmatique des infrastructures routires dans le contexte gnral de la socit. Une socit dfinit ses orientations et son organisation sous la forme de politiques publiques (voir le chapitre 3.3, page 115). Les besoins dune collectivit peuvent se ranger dans les catgories suivantes :
conomie
La collectivit doit investir dans la ralisation de diverses infrastructures techniques afin doffrir aux individus et aux entreprises un contexte favorable la ralisation dactivits conomiques prives. Il sagit pour la socit dassurer le financement de ces investissements par le biais dimpts directs et de taxes prleves sur le produit du travail ou la consommation de biens et de services. En Suisse, le financement de la construction, de lentretien et de lexploitation des routes nationales et de certaines routes principales est assur par plusieurs impts spcifiques qui sont les suivants : (OFT, 2000)
-
moiti du produit net de limpt sur les huiles minrales supplment du droit de douane sur les carburants redevance poids lourds proportionnelle aux prestations (ds le 1er janvier 2001) produit de la vente de la vignette autoroutire
De prime abord, les investissements routiers ne sont pas productifs, mise part la prsence de pages. Les apports de ces investissements sont indirects, par le biais dune amlioration des communications permettant le dveloppement conomique, donc de nouvelles ressources financires.
Environnement
La gestion des ressources naturelles est ncessaire pour assurer la prennit des espces animales et vgtales, ainsi que pour protger le cadre de vie humain. La socit assure cette gestion par le biais doutils lgislatifs incitatifs ou coercitifs, par la ralisation douvrages de protection vis--vis des catastrophes naturelles et par lintgration de la problmatique environnementale au sein de ses diverses activits
Sociale
La socit se doit dassurer chacun un cadre de vie agrable et une protection vis--vis des vicissitudes de la vie. Elle doit aussi quilibrer les avantages et les inconvnients du dveloppement sur lensemble de ses composantes afin dassurer une quit sociale Ces trois dimensions des besoins de la socit ne sont rien dautre que les composantes du dveloppement durable. En plus de la notion de satisfaction des besoins immdiats ou court terme, la socit doit avoir une vision long terme qui permette dassurer aux gnrations futures une satisfaction optimale de ces besoins. Ces aspects seront traits plus en profondeur dans le chapitre 6.
Les besoins individuels et collectifs
113
Par analogie avec les besoins individuels, la socit tablit aussi une pyramide de ses besoins, qui peut sordonner dans lordre hirarchique suivant : besoins de subsistance : nourrir la population, etc. besoins de scurit et de protection : assurer tous un toit, un emploi, une protection face aux menaces naturelles et humaines, etc. besoins dappartenance : codifier les comportements, dicter les lois, etc. protection sociale : assurer tous des soins en cas de maladie, dinvalidit ou daccident, assurer tous une retraite convenable, etc. accomplissement de la collectivit : se soucier des lments externes la collectivit comme lenvironnement naturel et les autres socits qui nont pas atteint le mme degr de satisfaction des besoins (aide aux pays en voie de dveloppement), etc.
La dfinition dune socit comme tant un ensemble dindividus se regroupant afin de mieux rpondre des besoins qui dpassent le strict cadre des besoins individuels est un schma un peu simplificateur. La socit est en effet complexe et comporte de multiples composantes qui ont des objectifs propres. Ces derniers sont contradictoires ou antagonistes, ce qui rend dautant plus difficile la recherche dun intrt gnral commun et accept par tous. J.M. Fourniau cite ce propos cette intervention de Dominique Voynet, ministre de lEnvironnement : Lintrt gnral est
devenu plus complexe et plus difficile cerner. Les intrts gnraux se multiplient et entrent parfois en conflit . (Fourniau J.-M., 1999)181
Cette forte htrognit de la socit qui se divise en des multiples composantes correspondant de moins en moins aux schmas dorganisation habituels fait de la gouvernance une activit de plus en plus difficile exercer. La recherche dun consensus semble parfois ne plus avoir de sens, car il y aura toujours des individus qui ne seront pas satisfaits. Ceci est alors une problmatique relevant du respect de la minorit en comparaison de lintrt collectif, les choix de la majorit ne devant pas prtriter la satisfaction des besoins des minoritaires. Ainsi, dfinir des besoins pour une socit, en entendant par l une organisation collective sur un territoire donn, cest agrger plusieurs catgories sociales aux desseins diffrents dans un projet socitaire commun.
3.2.4
Les volutions des attentes sociales
Les attentes des individus se modifient et lon peroit bien que des processus autrefois efficaces ont perdu aujourdhui de leur pouvoir opratoire. En Europe occidentale, les tendances lourdes du changement socioculturel sont les suivantes : (Besnanou R., 1999) Autonomie Lindividu smancipe des systmes hirarchiques et dtermine lui mme son mode de vie. Il est plus versatile, moins fidle un produit ou un systme de valeurs et peut rapidement changer de choix de vie
181
En plus de ces divers intrts gnraux en conflit, de multiples intrts privs viennent sadditionner et complexifient encore plus la problmatique. Ces intrts privs peuvent maner dindividus ou de personnes morales (entreprises, associations, etc.)
114
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Vitalit Les codifications sociales qui inhibaient les sensations et les motions ont vols en clat. Les individus sont moins tolrants envers leur environnement et la moindre entrave, mme minime, leur vitalit est perue comme une frustration, amenant ainsi des ractions pidermiques par rapport aux dtails qui tuent , rejoignant en cela la rflexion mene au postulat 9, page 49
Tissu social organique La morphologie de la socit est en pleine mtamorphose. Dun modle de socit de masse dvelopp dans les annes 1950, nous sommes passs une socit dstructure compose de rseaux et de systmes sociaux auto-rguls
Besoin de sens Dans un monde o les sources de sens traditionnelles sont en dclin, lindividu cultive une qute individuelle du sens donner son vcu quotidien et non plus forcment un grand projet technique, culturel ou idologique
Le dclin du tropisme hirarchique de lautorit ainsi que la dfiance vis--vis de la technique et de la science sont deux aspects trs importants pour qualifier les attentes des individus par rapport un projet dinfrastructure routire. Si dans les annes 1950, les projets techniques taient dsirs par les individus et taient jugs indispensables, les mdias fustigeant les opposants comme tant des citoyens opposs au progrs, depuis les annes 1970, les projets sont de plus en plus vus comme tant une atteinte la qualit de vie, les mdias relayant dsormais le message des opposants. (Bourdier J.-P., 1999) Veuve dcrit cette modification de limage des projets dinfrastructures techniques auprs de la population par le fait que la rationalit de substance, base sur la valeur dusage, lemporte dsormais sur la rationalit fonctionnelle propre chaque discipline : la route est bonne pour le projeteur et le dcideur, bonne pour lenvironnement, etc. mais est-elle bonne pour la socit dans son ensemble ? (Veuve L., 1994) On peut remarquer aussi que les aspirations des citoyens changent plus vite que lorganisation et la structure de la socit. Ceci engendre un phnomne de courtcircuitage des rseaux politiques traditionnels par la mise en place dorganisations non-gouvernementales prennes ou phmres. Celles-ci sont mieux adaptes aux attentes des acteurs car elles soccupent de problmes spcifiques (protection de lenvironnement, assistance aux dmunis, etc.) et prsentent parfois des positions plus tranches. Elles attirent ainsi de nombreuses personnes dues du jeu politique traditionnel. Une autre consquence de cette volution rapide des attentes citoyennes rside dans la difficult pour le projeteur et le dcideur de cerner les caractristiques du public qui linformation ou la concertation est destine. Besnanou compare cette difficult celle du responsable du marketing doffre qui se doit de cerner au mieux le consommateur afin de lui offrir le produit que celui-ci attend. (Besnanou R., 1999) La structure de la socit ainsi que la reprsentativit des autorits politiques est remise en question en raison de son inadaptation aux attentes citoyennes. Ce phnomne de dsenchantement se manifeste par les forts taux dabstention observs lors des votations ou des lections ou par la perte du civisme et de lintrt pour le dbat public.
Les politiques publiques
115
3.3
L ES POLITIQUES PUBLIQUES
3.3.1
Mise en uvre dune politique publique
Une politique publique est le moyen par lequel une socit sorganise afin de satisfaire aux besoins de ses diverses composantes. Ltat tente de modifier le comportement de certains acteurs par le biais de programmes administratifs contraignants ou incitatifs. La modification du comportement des ces acteurs cibles a des impacts positifs sur des groupes concerns par la politique publique ainsi dfinie. La politique publique est labore au niveau le plus lev dun pays, la Confdration par exemple, et est applique au niveau administratif le plus bas possible (principe de subsidiarit). La politique gnrale dun pays est dfinie par sa Constitution et des programmes gnraux, tel que le programme de lgislature du Conseil Fdral pour la Suisse. (Conseil Fdral, 2000) Cette politique gnrale est un conglomrat de diffrentes politiques sectorielles qui peuvent tre contradictoires voir antagonistes. Pour assurer la cohrence de la politique gnrale, il sagit de rsoudre les conflits potentiels entre diffrentes politiques publiques par une coopration et une coordination transversale entre celles-ci, ce que P. Knoepfel dsigne par le terme de interpolicy design . (Knoepfel P., 1997a) Un exemple de coordination entre deux politiques sectorielles est le cas en Suisse de la politique de lenvironnement et celle de la circulation routire.182 Les deux offices administratifs responsables de ces politiques au niveau national sont intgrs dans le mme dpartement (DETEC : Dpartement fdral de l'environnement, des transports, de l'nergie et de la communication) de lexcutif fdral. Ainsi, la stratgie de ce dpartement a pour but de dfinir plus long terme les objectifs et les
lignes directrices du DETEC, qui devront tre intgrs dans les programmes d'activit des diffrents offices en vue de leur ralisation. Il s'agit donc bel et bien d'un instrument de gestion dterminant pour l'ensemble du dpartement. Elle doit garantir la corrlation entre les diffrentes activits du DETEC, notamment entre les politiques menes dans les domaines de l'environnement et des infrastructures . (DETEC, 2000)
182
Ceci na pas toujours t le cas. En 1997, la Commission de gestion du Conseil National (CGCN) notait la page 17 de son rapport que Il nest pas rare de voir () deux offices fdraux (lOFEFP et lOFROU dans ce cas) se
quereller devant le Tribunal Fdral. La commission trouve inacceptable () quun litige soit tranch par la justice qui est ainsi amene intervenir, en endossant un rle politique, dans la pese des intrts collectifs (CGCN, 1997)
Lindpendance qui doit rgner entre les trois composantes du pouvoir dmocratique est ainsi remise en question par le recours la justice pour rgler les diffrends entre deux services administratifs. Sur proposition de la CGCN, qui a t accepte par le Conseil Fdral, une commission de recours indpendante de l'administration (CORE) a t mise en place au sein du DETEC depuis le 1er janvier 2000. Larticle 18, alina 5 de la LRN indique que Un recours peut tre form devant la commission de recours du DETEC contre la dcision d'approbation des plans et les autres dcisions rendues par le dpartement (LRN, 1960) La CORE agit en premire instance contre des dcisions en matire de procdures d'octroi des concessions et d'approbation des plans pour les ouvrages qui relvent de la comptence du DETEC. Elle a pour but de dcharger quelque peu le Tribunal Fdral. (DETEC, 1999) Par contre, pour les litiges opposant les intrts publics et privs, le rle de la justice est toujours justifi et nest pas contest
116
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Le droulement de la mise en uvre dune politique publique est prsent cidessous :
Conception de la politique publique
Formulation du programme Politique incitative ou restrictive Hypothse de causalit Dfinition des groupes cibles Dfinition des objectifs
Programme administratif
Mise en place d'une structure de mise en oeuvre (cantonale ou communale)
Cohrences des diffrents programmes administratifs (lgislation)
Arrangement politico-administratif pour la Dfinitions des diverses mise en oeuvre de la politique publique comptences d'application
Etablissement de plans d'action stratgiques pour la mise en oeuvre
Plans d'actions pour la mise en oeuvre
Formulation de produits (outputs)
Planification
Produits (outputs)
Dcisions des groupes cibles de modifier leur comportement conformment aux produits administratifs
Adquation et efficience des produits administratifs
Impacts
Effets des nouveaux comportements des groupes cibles sur la problmatique concerne
Changements de comportement des groupes cibles
Rsultats (outcomes)
Evaluation de la politique publique (monitoring scientifique)
S'il y a un impact, mais pas de rsultats, l'hypothse de causalit est mal pose
Effets de l'valuation de la politique publique
Figure 20
Gense de la mise en uvre dune politique publique (Knoepfel P., 1997a)
La conception dun politique publique se base sur une hypothse de causalit dfinie par les autorits politiques (problmatique haut bas ou top down ) ou provenant de la demande dacteurs concerns ou du public (problmatique bas haut ou bottom up ). Cette hypothse de causalit nest pas pose quen termes politiques mais sappuie aussi sur une analyse scientifique des faits et une identification des acteurs en cause. La difficult de cette identification provient du fait que la politique publique peut concerner un domaine o les avantages sont diffus tandis que les inconvnients sont concentrs.
Les politiques publiques
117
La problmatique de la concentration des nuisances et de la diffusion des avantages est propre chaque infrastructure de transport. Cest le cas par exemple de la A 144 : les avantages dune route de bonne qualit entre Villeneuve et le Bouveret concernent un large bassin de population dans la rgion lmanique tandis que les inconvnients ne concernent que les riverains du projet.
Postulat 27
Les impacts engendrs par une infrastructure routire sont concentrs tandis que ses avantages sont diffus
Les acteurs impliqus dans la mise en uvre dune politique publique peuvent tre rpartis en trois catgories : les acteurs administratifs qui gnrent des produits (outputs) comme des lois, des rglements, des valeurs limites respecter, des incitations, etc. le groupe cible qui change son comportement conformment aux produits gnrs par ladministration. Ce changement peut tre ralis sous la contrainte ou tre stimul par des mesures incitatives le groupe concern qui ressent les rsultats (outcomes) bnfiques ou non d au changement de comportement des acteurs cibles183
Pour lexemple de la pollution atmosphrique, lacteur administratif produit des restrictions dmissions polluantes, les acteurs cibles sont les vhicules et le groupe concern est la qualit de lair et les populations qui le respire. Les relations entre ces trois groupes forment un triangle de fer. Les cts de celui-ci symbolisent les relations entre les diffrents acteurs. (Knoepfel P., 1993)
Mise en application de la politique publique Surveillance
Pression sur les acteurs administratifs
Acteurs administratifs
Pression sur les acteurs administratifs
Volont de modifier le comportement du groupe cible par l'incitation ou l'obligation
Politique publique
Evaluation de la politique publique
Groupe cible
Modification de comportement
Groupe concern
Impacts des nouveaux comportements des groupes cibles
Figure 21
Le triangle de fer dune politique publique (Knoepfel P., 1993)
183
Si ce nest pas le cas, cest que lhypothse de causalit a t mal pose. Il se peut toutefois que des rsultats soient observs sur un autre groupe que celui qui tait initialement vis. Cest le cas par exemple des conomies ralises par des entreprises devant repenser leur processus de fabrication pour satisfaire des normes environnementales nouvelles. Le but recherch est de limiter les missions de lusine et en complment, on peut arriver un nouveau processus de fabrication moins nergivore et plus conomique, mme si ce ntait pas le but initial
118
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
3.3.2
Les politiques publiques incidence spatiale
Comme prsent la figure suivante, de nombreuses politiques incidence spatiale influencent le projet routier ou sont affectes par celui-ci.
Politique des transports
Politique routire Disparit rgionale Dsenclavement Accessibilit Programmes LIM PROJET ROUTIER Sant publique Chasse et pche Agriculture Sylviculture Economie Conditions cadres Zones d'activits
Amnagement du territoire
Loisirs
Politique de protection de l'environnement
Politique de l'emploi March du travail Nature et paysage Politique nergtique
Finances publiques
Figure 22
Les politiques publiques lies au projet routier
Par dfinition, les politiques publiques incidence spatiale font lobjet de plans sectoriels de la Confdration. Cependant, on constate la multiplication de politiques fdrales ayant une incidence spatiale directe ou indirecte dans lespace (Benninghoff M., Terribilini S. et al., 1997) Seules trois politiques publiques seront traites ici pour limportance de leur rle dans le projet routier : lamnagement du territoire, la politique des transports et la politique de protection de lenvironnement.
3.3.2.1
Amnagement du territoire
Le territoire est un patrimoine qui appartient la fois la collectivit et des propritaires privs. Il a de multiples fonctions et est le sige de nombreuses activits parfois contradictoires. Il subit ainsi une forte pression anthropique : consommation de sol, dgradation de la qualit des terrains, fractionnement et morcellement des espaces naturels, etc. Lamnagement du territoire a pour objectif dassurer une utilisation mesure du sol184 et une occupation rationnelle du territoire. Ainsi, le cadre de vie est prserv tout en garantissant la coexistence harmonieuse et le dveloppement des diverses utilisations du territoire. En Suisse, la loi sur lamnagement du territoire est entre en vigueur en Suisse le 1er janvier 1980. (LAT, 1979) Dans son article premier, cette loi dfinit clairement lobjectif principal de lamnagement du territoire et prcise que celui-ci est une tche dont la ralisation revient ltat.
184
Rappelons quen moyenne en Suisse prs de 1 m2 de sol est construit chaque seconde (ODT, 2000a)
Les politiques publiques
119
La Confdration, les cantons et les communes veillent assurer une utilisation mesure du sol. Ils coordonnent celles de leurs activits qui ont des effets sur lorganisation du territoire et ils semploient raliser une occupation du territoire propre garantir un dveloppement harmonieux de lensemble du pays. Dans laccomplissement de leurs tches, ils tiennent compte des donnes naturelles ainsi que des besoins de la population et de lconomie.
(Article 1, LAT, 1979) Les instruments disposition de lamnagement du territoire sont les suivants : conception et plans sectoriels185 de la Confdration qui ont pour but de coordonner ses propres tches susceptibles davoir un effet sur lorganisation du territoire et de les intgrer dans une politique cohrente. (Article 13, LAT, 1979; ODT, 2000a) Il sagit des grandes lignes de lorganisation du territoire suisse plans directeurs cantonaux prcisant les principales zones dintrt du territoire et dfinissant ltat et le dveloppement souhait, notamment dans le domaine des transports (Article 6, LAT, 1979) 186 plans d'affectation communaux dfinissant les diffrentes zones dactivit et dutilisation du sol. (Article 14, LAT, 1979) Ils comprennent les plans de zones et les rglements de construction
Ces trois instruments prvus par la LAT sont interdpendants, cest--dire que par exemple llaboration dun plan directeur cantonal tient compte des plans daffectation existants et intgre les conceptions et les plans sectoriels de la Confdration. (OFAT, 1998b) La LAT insiste pour que linformation et la participation du public soient parties prenantes de llaboration de ces divers instruments. Cette planification de lamnagement du territoire concerne dune part, les autorits politiques tous les chelons (Confdration, cantons et communes) et dautre part, tous les domaines sectoriels des activits incidence spatiale. Lamnagement du territoire est donc une tche interdisciplinaire qui concerne plusieurs niveaux de dcisions. (ODT, 2000a) Les diffrents acteurs de lamnagement du territoire ont des visions diffrentes de lutilisation du sol et de lorganisation du territoire. La rarfaction de la ressource sol accentue la potentialit de conflits car les objectifs de chacun187 deviennent plus difficiles raliser dans un territoire exigu comme la Suisse. De plus, ces objectifs sont souvent interdpendants, la satisfaction dun besoin engendrant des impacts dans un autre domaine. Le but de lamnagement du territoire est donc de coordonner au mieux les diffrentes activits afin de parvenir une occupation rationnelle du territoire et d'assurer une utilisation mesure du sol disponible. La politique des transports est une politique qui a de fortes interactions avec la politique de lamnagement du territoire. Les infrastructures routires jouent un rle structurant sur le territoire et un amnagement mal planifi en accompagnement
185
Il est intressant de remarquer que la Confdration ne dispose pas de plan sectoriel concernant spcifiquement les transports routiers malgr limportance du rseau des infrastructures routires sur lorganisation du territoire suisse (OFAT, 1998b) On peut citer par exemple le plan cantonal des transports du canton de Vaud qui a pour objectif de fixer les termes dune politique globale cohrente et raliste, traduite en options et objectifs-cibles prcis, propres guider les multiples actions qui conduiront progressivement un systme des transports plus performant et plus conome (DINF,
1999a)
186
187
Raliser une infrastructure routire, maintenir un paysage de qualit, dvelopper les activits conomiques, maintenir une agriculture de subsistance, etc.
120
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
de la ralisation dune nouvelle infrastructure routire peut avoir des consquences graves sur lamnagement de certaines zones (dveloppement anarchique de zones dactivits commerciales ou artisanales proximit de jonctions dautoroutes par exemple). A loppos, la planification de lamnagement de certaines zones du territoire sans adaptation de linfrastructure routire peut avoir des consquences sur la qualit dutilisation dun rseau de transport (exemple dune zone commerciale drainant un important trafic sur un rseau de routes dune capacit insuffisante et destines un usage rsidentiel). Pour limiter ces inconvnients, on peut citer la dmarche franaise du 1 % Paysage et Dveloppement qui vise inciter les collectivits locales dont le territoire est travers par une grande infrastructure routire mettre en uvre une politique de gestion matrise des espaces proches de lamnagement routier et rendre compatible le dveloppement conomique et la valorisation du paysage. Les efforts des collectivits locales pour prserver ou mettre en valeur le paysage sont finances par lEtat qui accorde une subvention de 50 % au maximum et valant 1 % de linvestissement autoroutier. (Elbaz-Benchetrit V., 1997; Jarlier P., 1997) Les effets des infrastructures routires sur le dveloppement conomique188 dune rgion ne sont pas faciles qualifier et quantifier.189 Sil semble vident quune activit conomique dimportance se doit de bnficier dune desserte routire de qualit,190 linverse nest pas systmatiquement vrifi, la ralisation dune infrastructure routire dans une zone conomiquement sinistre pouvant mme au contraire acclrer le processus de modification structurelle de lconomie rgionale. Il faut se mfier de ce que la Cellule de prospective et de stratgie du Ministre de lEnvironnement appelle le mythe du dveloppement par la multiplication des infrastructures . (Dron D. et M. Cohen de Lara, 1996)
3.3.2.2
Transport
Le transport est une activit qui na pas dexistence propre mais qui est au service dautres activits humaines. Mis part les voyages de pur agrment, on se dplace toujours dans le but de raliser une activit en un autre endroit. Le principal objectif de la politique des transports est dassurer laccessibilit des voyageurs et des marchandises sur lensemble du territoire. Il sagit pour cela de raliser un rseau de transport trs dense, sr, confortable et conomique lusage. Larticle 2, alina 3a de la LAT prcise cet objectif en indiquant que les lieux dhabitation et les lieux de travail doivent tres dots dun rseau de transports suffisant . (LAT, 1979) Lquilibre entre les diffrents modes de transport (structure modale) est aussi au cur de cette politique. Les infrastructures de transport occupent dimportantes surfaces, morcellent le territoire et transforment le paysage en occupant un rle structurant dans l'organisation spatiale du territoire. Il sagit donc de les planifier avec soin de manire assurer une rpartition quitable des avantages et des inconvnients lis la mobilit.
188
Les activits conomiques de la socit ne font pas lobjet dun sous-chapitre spcifique car elles sont traites ici uniquement sous langle de lorganisation du territoire quelles induisent V. Elbaz-Benchetrit en convient aussi en crivant que Les effets induits et indirects de lautoroute sur le dveloppement conomique ne sont pas certains ni systmatiques et varient selon les secteurs dactivit et les caractristiques de la rgion traverse (Elbaz-Benchetrit V., 1997) V. Elbaz-Benchetrit conclut la fin de son ouvrage consacr lexamen des impacts des autoroutes sur lconomie que Lautoroute diminue le cot du transport dans les cots de production, () Cependant, cet impact est faible car le transport reprsente en moyenne 5 7 % du prix de revient
189
190
Les politiques publiques
121
En Suisse, les principes de la politique des transports sont dfinis dans le document Stratgie du DETEC . Les objectifs de cette politique sont les suivants : (DETEC, 2000) garantir une mobilit durable191, ce qui implique que :
-
les dplacements ne seffectuent pas au dtriment de l'environnement les besoins en matire de mobilit soient satisfaits de la manire la plus rentable possible pour l'conomie nationale tous les groupes de population et toutes les rgions aient accs aux infrastructures de transport
les diffrents modes de transport devront tre utiliss en fonction de leurs avantages respectifs et relis judicieusement les uns aux autres les politiques d'amnagement du territoire et des transports seront harmonises tous les moyens techniques soient mis en uvre pour optimiser les infrastructures, les vhicules et les carburants l'utilisation optimale des installations existantes (gestion des capacits) aura la priorit sur la construction de nouveaux quipements la politique des transport suisse doit tre harmonise avec celle de l'Europe les diffrents modes de transport doivent couvrir eux-mmes leurs frais d'exploitation et les cots externes occasionns la part des transports publics et des dplacements pied et bicyclette doit s'accrotre, notamment pour les loisirs un niveau de scurit lev doit tre assur lors des dplacements
En Suisse, la seule politique routire existant au niveau fdral concerne les autoroutes de 1re et de 2me classe ainsi que les routes principales ayant un intrt national.192 Ces routes sont dsignes par le terme de routes nationales . La majeure partie des 71'000 km du rseau routier helvtique ne dpend donc pas de la Confdration. Il est intressant de constater aussi que la gense de la politique publique des routes nationales provient dun processus bas haut ou bottom up . En effet la Loi sur les routes nationales (LRN, 1960) est un contre-projet linitiative populaire pour lamlioration du rseau routier qui a t accept le 6 juillet 1958 par prs de 85 % des votants. Une des caractristiques de la politique des routes nationales suisses consiste aussi dans le fait que la Confdration assure la cration dun rseau de routes nationales, mais ce sont les cantons qui construisent et qui entretiennent ces routes. Le rseau des routes nationales devait tre achev en 1987. En raison de multiples retards, cet achvement naura lieu au mieux quen 2012, ce qui fait une dure double de ce qui avait t prvu. (CGCN, 1997) Dans le mme ordre dides, on peut relever aussi le fait que le cot de la construction de ce rseau a littralement explos passant de 6 milliards prvu en 1960 15 milliards lors du programme de construction long terme de 1967. Actuellement prs de 35 milliards de francs ont t dpenss et 25 milliards devraient encore ltre, soit dix fois plus que prvu !
191 192
Les caractristiques dune mobilit durable seront dtailles au chapitre 6 La Suisse ne dispose dune politique nationale pour les grandes infrastructures routires que depuis 1960. Auparavant, les seules routes qui taient subventionnes par la Confdration taient les routes des cols alpins, autant pour des raisons militaires que pour soutenir le dveloppement des valles recules. La premire autoroute de Suisse, ralise en 1954 au sud de Lucerne, tait une route cantonale lorigine
122
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
3.3.2.3
Environnement
Historiquement, la prise en compte de lenvironnement comporte quatre tats de considrations successifs :
Mesures sur les effets
Il sagit de mesures de sant publique protgeant les tres vivants des effets des immissions polluantes. Ces mesures nagissent que sur le dernier maillon de la chane193 et nont quune porte ponctuelle : pose de fentres isolantes pour se protger du bruit, etc. Il sagit en quelque sorte dagir comme un pompier
Mesures sur les immisions
Il sagit dinterventions temporaires utilises en priode dalerte (restriction de circulation en cas de pollution excessive, oxygnation des lacs, etc.) ou en cas de difficults agir sur les missions (diminution des immissions de bruit par pose de parois paraphones, etc.). A ce stade, on ne rsout pas encore les causes
Mesures sur les missions
Il sagit du principe du pollueur-payeur ou de causalit. A ce niveau, on agit la source de la pollution, cause des immissions et des effets : filtre catalyseur sur les vhicules, dpollution des poussires industrielles, etc. La loi suisse sur la protection de lenvironnement (LPE, 1983) insiste sur la ncessit dintervenir sur les missions, indpendamment de ltat de lenvironnement (niveaux dimmissions)
Gestion durable des ressources naturelles
Cette notion nouvelle insiste sur le fait de grer durablement des biens caractriss par leur raret : air de qualit, eau, maintien de la biodiversit, etc.. Il sagit du dfi futur auquel se doivent de rpondre les activits humaines La plupart des pays occidentaux se situent actuellement entre le troisime et le quatrime tat de considration de lenvironnement. En Suisse, la majeure partie des lois concernant la protection de lenvironnement sont apparues en nombre au cours des annes 1980 (LPN (1966), LPE (1983), OPAIR (1985), OPB (1986), OEIE (1987), etc.) rendant la tche du projeteur routier de plus en plus complexe, celui-ci voluant dans un cadre lgislatif touffu. Comme le souligne la CGCN dans son rapport, les annes 80 marquent un tournant dans llaboration des projets routiers. Les valeurs limites (immission ou mission) fait souvent lobjet dun dbat et leur dtermination est fortement conteste et juge parfois arbitraire. La CGCN les jugent trop absolues et trop rigides alors quil faudrait des valeurs flexibles adaptes au lieu et la situation . (CGCN, 1997) De plus, comparativement ltranger, les valeurs limites suisses sont plus contraignantes.194 LOFEFP est aussi accus de formuler ses
directives de manire isole sans prendre contact avec les techniciens comptents et sans effectuer de pese des intrts .
193
Dans le domaine des nuisances environnementales, cette chane comporte trois maillons : mission la source, transmission dans le milieu ambiant et immission au rcepteur La CGCN cite le cas des valeurs limites dimmission pour le dioxyde dazote NO2 qui vaut 30 g/m3 en Suisse, 50 g/m3 en Allemagne et 80 g/m3 en France (CGCN, 1997)
194
La mobilit
123
De part la forte densit du rseau de transport sur le territoire, les effets des infrastructures routires sur lenvironnement naturel ou humain sont nombreux et consquents : morcellement du paysage en lots naturels pouvant atteindre une taille critique pour assurer la survie de certains espces animales coupure (effet de barrire) des rseaux de dplacement de la faune amenant un blocage du brassage gntique, des migrations et une mortalit par collision avec le trafic emprise directe environnemental de linfrastructure routire sur des zones dintrt
effets sur les riverains des infrastructures routires : bruit, vibrations, etc. effets diffus sur le cadre de vie humain : pollution atmosphrique (sant publique), transformation du paysage, etc. effets sur le patrimoine : pollution, vibrations, atteintes au paysage, etc.
3.4
L A MOBILITE
La civilisation occidentale de la fin du 20me sicle a pris comme choix de socit, dune manire plus ou moins volontaire, le fait dassurer sur lensemble du territoire la mobilit des personnes et des marchandises. La mobilit est dfinie comme tant non seulement le fait de se dplacer de manire performante et conomique, mais aussi comme tant le potentiel de dplacement, potentiel servant rpondre la demande mais aussi gnratrice de celle-ci. 195 Lorganisation actuelle de notre socit, base sur le dveloppement conomique et social, lquit et le respect des liberts individuelles fondamentales, permet de satisfaire la majeure partie des besoins particuliers et collectifs. On peut affirmer que le maintien et la croissance de la qualit de vie dont nous profitons quotidiennement sont indissociables de rseaux de transports performants, srs, rentables et accessibles tous et partout ainsi que dune mobilit librement choisie et conomiquement supportable. En effet, un rseau de transport mal organis, inefficace, inquitable ou en voie de dtrioration a de graves rpercussions sur le dveloppement durable dune socit.
Postulat 28
Assurer tous et sur lensemble du territoire une mobilit performante et conomique, condition indispensable au maintien de la qualit de vie actuelle, ne peut se faire quau prix de lexistence dun rseau dinfrastructures de transport de qualit prenne et dans le respect des liberts individuelles
195
On retrouve ainsi tout le problme de la relation entre loffre et la demande de transport, deux notions qui sont fortement interdpendantes. En effet, une amlioration de loffre peut entraner une augmentation de la demande. Au contraire, une augmentation de la demande (par exemple, plus de charge sur une infrastructure) peut entraner une diminution de loffre, car le niveau de service diminue (loffre de transport nest pas quune valeur de trafic, mais comporte aussi des notions de confort, de scurit, etc..)
124
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Lorganisation du territoire est fortement influence par ce choix dassurer lensemble de la population laccessibilit une mobilit de qualit et librement choisie. Ceci engendre de nombreuses atteintes au cadre de vie, la sant humaine et lenvironnement. La mise en vidence de ces inconvnients et des limites du dveloppement conomique ds les annes 1960 ont amen un fort dveloppement de la prise de conscience environnementale. Les transports ne sont pas les seuls responsables de cette dernire, mais leurs impacts diffus sur le territoire y contribuent grandement. Il apparat dsormais ncessaire dvoluer vers une diminution des impacts induits par lorganisation territoriale base sur la mobilit, tout en conservant les avantages de celle-ci. La dfinition dune mobilit durable sera prcise au chapitre 6.
3.4.1
volution des rseaux dinfrastructures routires
La Suisse dispose dun rseau de voies de communication trs dense desservant toutes ses rgions et la reliant avec ltranger. Le rseau de transport le plus important en Suisse est le rseau routier qui compte 71000 km de routes rparties de la manire suivante : (Tille M., 2000) Routes nationales Routes cantonales Routes communales 1'540 km 18'200 km 51'200 km
196
Ce rseau est lun des plus denses au monde, rapport la population ou la superficie du pays. La figure de la page suivante prsente le rseau des routes nationales qui sont les infrastructures routires subventionnes par la Confdration pour leur ralisation, leur entretien et leur exploitation. 197 (Art. 2, ORN, 1995) Le taux de participation de la Confdration au financement des routes nationales varie selon les cantons : (ORN,
1995)
construction : 58 % (Zrich-Ville) 97 % (Uri et Obwald) entretien : 80 % (Genve, Zoug et Zrich) 97 % (Uri et Obwald) exploitation : 40 % (Ble-Ville et Genve) 95 % (Jura, Uri et Obwald)
Pour chaque canton, le taux de participation de la Confdration est dtermin en fonction des charges imposes par les routes nationales, leur intrt ces routes et leur capacit financire. (CGCN, 1997; LRN, 1960) La CGCN souligne que ce principe du subventionnement est gnrateur de risques , les cantons fortement subventionns ntant pas forcment intresss trouver des conomies dans le domaines des routes nationales. La CGCN recommande de pratiquer par consquence le principe de lenveloppe budgtaire, les ventuels dpassements tant pris en charge par les cantons.
196 197
Valeurs la fin 1995 Construction : ralisation d'une nouvelle route et amnagement d'une route existante Entretien : gros entretien et renouvellement, soit lensemble des mesures qui servent maintenir en bon tat la route et ses installations techniques en tant qu'ouvrage construit Exploitation : entretien courant et services de protection, soit toutes les mesures qui servent assurer la scurit ainsi que le bon fonctionnement de la route et de ses installations techniques
La mobilit
125
Figure 23
Rseau des routes nationales suisses (tat : fin aot 1997) (ODT, 2000a)
3.4.2
volution de la mobilit
Le graphique suivant prsente lvolution de plusieurs paramtres lis la mobilit terrestre198 en Suisse, ceci entre 1960 et 1995 :
Motorisation (100 = 509'000 voitures de tourisme)
700
Transports de marchandises par la route (100 = 2,15 mrd to-km) Transports de personnes par la route (100 = 18,6 mrd voy-km) Produit national brut rl (100 = 120 mrd de francs - Valeur 1993) Transports de marchandises par le rail (100 = 4,32 mrd to-km) Transports de personnes par le rail (100 = 7.97 mrd voy-km) Population (100 = 5,36 mios habitants) Longueur des rseaux de transport (100 = 61'000 km)
600
Indice (1960 = 100)
500
400
300
200
100 1960
1970
1980
1990
1995
2000
Figure 24
volution de plusieurs paramtres lis la mobilit en Suisse (OFS et OFEFP, 1997)
198
Les transports par air, par eau, par cbles et par conduites (oloduc, etc.) sont exclus de cette comparaison. En Suisse, ils reprsentent 3 % des prestations de transport de personnes et 10 % de celles de marchandises. Seul le transport arien de personnes connat un dveloppement fulgurant (+ 900 % entre 1960 et 1995)
126
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
On constate les faits suivants, que lon peut mettre en relation avec la croissance de lindicateur de la richesse quest le produit national brut rel (+ 207 %) : formidable accroissement ininterrompu des prestations de transport de personnes (+ 344 %) ou de marchandises (+ 498 %) par route accroissement moindre et fluctuant des prestations de transport de personnes (+ 68 %) ou de marchandises (+ 101 %) par rail. Ceci explique la rpartition modale actuelle en faveur de la route, celle-ci assurant prs de 86 % des dplacements de personnes et 63 % des dplacements de marchandises faible augmentation de la population (+ 32 %) et des rseaux de transport (+ 25 %) amlioration du niveau de vie illustre par limportante augmentation de la motorisation (+ 534 %), qui est un indicateur important du pouvoir dachat.
Ces diffrentes valeurs permettent daffirmer quen Suisse, depuis quatre dcennies, lvolution de la mobilit est en majeure partie due aux transports individuels. Une des principales consquence de lvolution de la mobilit individuelle est lclatement du champ des dplacements potentiels. (Bridel L., 1998) Lamlioration des performances des rseaux de transport, notamment laugmentation de la vitesse commerciale, nentrane pas une diminution du temps consacr aux dplacements mais provoque plutt une augmentation de la distance parcourue. Le budget temps reste ainsi constant et cest la dimension de lespace-temps parcouru qui saccrot. Ce phnomne engendre une forte priurbanisation au dtriment des centres villes ainsi quune diminution de la densit doccupation du territoire construit, allant au dtriment de la volont de densifier celui-ci. Les nuisances sont ainsi disperses, augmentant la pression sur le territoire. (ODT, 2000b)
Espace
Espace-temps initial Espace-temps budget temps constant Espace-temps budget espace constant
Domicile
Lieu d'activits
<
Domicile
Lieu d'activits
Temps
Figure 25
Modification du champ des dplacements potentiels (Bridel L., 1998)
La mobilit
127
3.4.3
Consquences de la mobilit
La mobilit dont nous bnficions actuellement assure le dveloppement conomique, social et culturel de la civilisation occidentale et bouleverse nos habitudes et nos comportements. Cependant, elle entrane dimportantes consquences ngatives sur notre environnement, consquences qui sont en partie responsables de la prise de conscience environnementale des trente dernires annes. Compars aux installations industrielles, les rseaux de transport gnrent des nuisances diffuses sur le territoire. Ils comptent pour une part importante de plusieurs impacts environnementaux, comme la pollution atmosphrique, les nuisances sonores ou la consommation de ressources non-renouvelables. Au nom des inconvnients ainsi engendrs, le principe de la mobilit actuelle, base sur le choix individuel du mode de transport, est fortement remis en question, que cela soit par des spcialistes des transports, par des acteurs politiques mais aussi par la population et des groupes dintrts. Cette remise en question passe par une volont de stabiliser, voire de diminuer la mobilit, den modifier la structure modale199 et de changer la politique des transports. Ce changement de paradigme pour une mobilit diffrente nest pas partag par tous.200 Lauteur ne rentre pas ici dans le dbat passionn, et passionnant, de la dfinition de la politique des transports pour les annes futures. Seule une mise en balance rigoureuse des diffrents intrts en jeux permettra de dfinir les objectifs futurs de la mobilit. Il faut garder un dbat serein201 et obtenir un consensus pragmatique et raliste.
3.4.3.1
Avantages de la mobilit
La mobilit assure actuellement en Europe Occidentale prsente les principaux avantages suivants : libert individuelle du choix modal, du trajet et de la priode de dplacement flexibilit des dplacements assurant une flexibilit des activits de loisirs, de travail et dachats faible cot des dplacements relativement au pouvoir dachat, ceci en comparaison de la mobilit assure pour les gnrations prcdentes indpendance des individus vis--vis des contraintes horaires ou administratives accessibilit de nombreuses zones permettant dassurer une qualit de vie identique sur la majeure partie du territoire et dagrandir les aires des marchs des entreprises qualit de vie amliore par une meilleure accessibilit aux loisirs
199
En Europe, prs de 80% de la mobilit des personnes et de 70% de la mobilit des marchandises est assure par la route (transports individuels ou collectifs). La tche du report modal risque dtre herculenne, surtout si lon veut limiter lusage de moyens coercitifs ! Rappelons par exemple que linitiative populaire Rduction de moiti du trafic routier motoris afin de maintenir et d'amliorer des espaces vitaux a t massivement rejete par 78,7 % des votants le 12 mars 2000 Un intitul de rapport comme celui de la dlgation suisse la confrence de la CEMAT en 1988 Les transports privs : liberts individuelles et flau social nest sans doute pas significatif dune volont de consensus tant lanathme jet sur la mobilit individuelle est violent (CEMAT, 1988)
200
201
128
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
rencontres et ouverture du champ de dcouvertes amliores par lclatement des distances diminution des cots de transport des biens et des marchandises202 permettant de rorganiser la logistique des entreprises (politique du just in time ), ce qui rejaillit sur les prix la consommation etc.
3.4.3.2
Inconvnients de la mobilit
La mobilit assure actuellement en Europe Occidentale prsente les principaux inconvnients suivants : forte saturation des rseaux de transport en raison de la structure sociale du travail ou des loisirs (horaires de travail, horaires scolaires, jours fris, etc.) nuisances aux riverains (bruit, vibrations, pollution atmosphrique, etc.) nuisances lenvironnement et au paysage consommation despace dans un territoire parfois exigu et limit (cas du Plateau Suisse) fragmentation du territoire naturel par la multiplication des effets de barrire des infrastructures de transport (autoroutes cltures, ouvrages dart, etc.) perte dattractivit de certaines zones, notamment urbaines, en raison de la densit du trafic cots sociaux des accidents (tus et blesss) fragilisation de la socit par ladoption du flux tendu forte consommation dnergies non-renouvelables (ptrole, gaz) dissmination des fonctions urbaines sur le territoire au dtriment des centresvilles denses (phnomne de priurbanisation) dveloppement de zones monofonctionnelles203 etc.
202
Selon J.-P. Orus, cette diminution des cots de transport est due aux gains de temps et aux conomies dans les frais de fonctionnement des vhicules. La concurrence entre les entreprises agrandissant leurs aires de march participe aussi cette baisse des cots de transport (Orus J.-P., 1997) Le dveloppement de ces zones monofonctionnelles est-il la consquence de la motorisation et de la ralisation de nouvelles infrastructures routires permettant daccder plus rapidement de nouveaux espaces ou en est-il plutt la cause ? Dans un cas, on se trouve dans une problmatique oriente vers la demande (rponse une mobilit existante) et dans lautre cas, on se trouve dans une problmatique oriente vers loffre (attirer les individus vers de nouveaux espaces)
203
La mobilit
129
3.4.4
Perspectives
Il est difficile et trs alatoire de prvoir lvolution de la mobilit pour les annes venir.204 Pour la Suisse, le Service dtude des transports (SET) prvoit les perspectives dvolution suivantes jusque en 2015 : (SET, 2000)
Figure 26
Perspectives dvolution du trafic voyageurs et marchandises (SET, 2000)
Il sagit de rduire les inconvnients lis la mobilit par ladoption de mesures de plusieurs types, comme notamment : mesures de gestion de linfrastructure : rduction du volume de trafic, amlioration de la fluidit, modification de la rpartition modale, etc. mesures techniques : la source (qualit des vhicules et des infrastructures, augmentation des rendements nergtiques, etc.), la propagation de la nuisance (parois anti-bruits, etc.) et limmision mesures dorganisation des activits humaines : dveloppement des tlcommunications pour amliorer laccessibilit certaines prestations (tltravail, achats, ducation, etc.), favoriser un comportement durable par la formation et la sensibilisation (Journe Sans ma voiture en ville , etc.) des individus, etc. mesures sur lamnagement du territoire : densifier les centre-villes, regrouper les zones dactivits, etc.
Il y a cependant des limites lefficacit de ces mesures, car il est impossible de les appliquer dune manire coercitive, de part le ncessaire respect des liberts individuelles, et seul lincitation peut tre pratique. La Suisse est fortement engage dans un tel processus (redevance poids lourd lie aux prestations, taxe incitative sur le CO2, dveloppement des transports publics, incitation du ferroutage, etc.).
204
Par exemple, les perspectives dvolution du trafic effectues la fin des annes 1950 pour la planification du rseau des routes nationales prvoyaient que le parc automobile suisse compterait environ un million de vhicules en 1985, alors quen fait cette date on recensait prs de trois millions de vhicules en Suisse !
130
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Il faut aussi se mfier des solutions miracles parfois proposes205 car les effets des actions sur la mobilit sont souvent difficiles estimer. De plus, ces mesures ne sont parfois que partielles et elles peuvent souvent engendrer de nouveaux besoins insouponns. Par exemple, prs de la moiti des distances parcourues quotidiennement en Suisse le sont pour un dplacement de loisirs. Le dveloppement du tltravail rduira srement les dplacements pendulaires mais serait totalement inefficace pour la mobilit des loisirs, en tendant mme laugmenter ! On mesure l toute la difficult du contrle de la mobilit.
3.5
L ES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Il ne sagit pas exactement de dfinir ici les besoins dune route, qui nen a pas en soi, mais ceux des usagers qui lutilisent et des propritaires de celle-ci.
3.5.1
3.5.1.1
Typologie des infrastructures de transport
Les fonctions transport principales dune infrastructure de
Une infrastructure de transport est caractrise par la multiplicit des rles quelle est amene jouer, savoir : Transport : capacit dcoulement dun flux de personnes ou de marchandises Accessibilit : desserte territoriale Social : amlioration des conditions de vie par une diffusion sur le territoire Structurant : organisation du territoire, dveloppement des activits
Les fonctions daccessibilit et de transport sont indissociables et inversement proportionnelles : une forte capacit de transport, caractristique dune infrastructure en site propre, se fait au dtriment de laccessibilit. Ces diffrentes fonctions antinomiques sont combines des proportions diverses, ce qui engendre une grande varit des types dinfrastructures.
3.5.1.2
Modes de classification
La classification des infrastructures de transport vise les distinguer selon les fonctions quelles remplissent, les standards applicables dpendant directement des besoins
205
Prenons le cas de lInternet par exemple. Certes, on nest par exemple plus oblig de se dplacer pour acheter des marchandises, celles-ci pouvant tre observes, dtailles et commandes depuis son domicile, puis livres directement. Cependant, le transport physique de la marchandise est toujours ncessaire. Il y a moins de dplacements (visites de plusieurs magasins par exemple) et le livreur peut optimiser ses dplacements, mais on ne passe pas de 100 0, mais plutt de 100 50 Le cas de nouvelles technologies senses rsoudre tout les problmes, comme Swissmetro, sont aussi envisager avec circonspection. Elles ont srement leur intrt, mais il parat prtentieux de leur attribuer, tel le mdicament miraculeux qui gurit de tous les maux possibles, des effets si importants
Les infrastructures routires
131
satisfaire. Cette hirarchisation du rseau de transport est ncessaire pour les besoins de planification, dentretien et pour des questions administratives lies la surveillance ou au financement. Il existe de multiples manires de classifier une infrastructure de transport selon : la situation : urbaine, de contournement, hors localit ou en rase campagne, de montagne le type de trafic : international, national, rgional, urbain et priurbain touristique, agricole ou d'exploitation forestire, etc.. la structure du trafic : composition, particularits, rgles de circulation qui y sont appliques (circulation autorise, conditions d'accs, etc..), rpartition modale, etc.. la classification juridique ou administrative, qui indique lexploitant de linfrastructure. Celui peut tre une entit publique (pays, canton, commune) ou prive. Pour les routes nationales suisses, une distinction supplmentaire est effectue en 3 classes, savoir : 1re classe (autoroutes 4 voies et plus), 2me classe (autoroutes rduites et semi-autoroutes) et 3me classe (routes principales 2 voies) lexploitation : signalisation, qualit de service, etc..
3.5.1.3
Classification fonctionnelle
La classification conventionnelle est base essentiellement sur la diffrenciation des fonctions antagonistes de transport et d accessibilit . Par exemple, dans le cas des routes, on distingue 5 types : (VSS, SN 640 040b) route grand dbit (RGD ) avec une fonction de transport primordiale : assurer un dbit de trafic important grande vitesse et avec un niveau de scurit lev route principale (RP ) avec une fonction de transport : relier les localits et les rgions en assurant un trafic important route de liaison (RL ) avec une fonction de transport - accessibilit : assurer des liaisons secondaires et relier entre elles des agglomrations et des zones d'une mme rgion route collectrice (RC ) avec une fonction d accessibilit - transport : collecter le trafic des parcelles et des quartiers route de desserte (RD ) avec une fonction d accessibilit : desservir les parcelles
Chacun de ces types se diffrencie encore selon sa situation : urbain ou rural.
3.5.1.4
Rseau de transport fonctionnel
La classification conventionnelle des infrastructures de transport entrane une hirarchie selon le niveau de standard offert lusager. Par exemple, pour les routes, le niveau de qualit est dcroissant depuis les RGD, qui reprsentent le niveau hirarchique suprieur, jusquaux RD.
132
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
La constitution d'un rseau de transport fonctionnel se doit dtre structur de faon canaliser les flux de transports dune manire rationnelle et adapter le standard la fonction attribue la voie de circulation.
Postulat 29
La classification conventionnelle dune infrastructure routire dtermine ses caractristiques au sein dun rseau de transport fonctionnel
3.5.2
Les standards
Ce chapitre sur les standards est bas sur le rapport de commission effectu par lOFR pour le compte de la Commission de gestion du Conseil National. (OFR, 1996)
3.5.2.1
Le standard et la norme
Le standard se dfinit comme tant lensemble des exigences et attentes de la socit vis--vis dune infrastructure de transport, qui est ralise pour rpondre un besoin de mobilit. Le standard est une notion souvent imprcise, parfois fixe par la loi, qui nest pas dessence technique mais plutt politique. Il varie selon limportance accorde une infrastructure de transport au sein dun rseau structur, les revendications diverses, lexprience acquise et les attentes propre chaque poque. Le standard peut concerner divers stades de la vie dune infrastructure de transport (conception, ralisation, exploitation ou entretien) ainsi que divers acteurs (projeteur, riverain, usager, etc.). Il ne sera trait ici que des standards du dcideur et de lusager. Le standard est diffrencier de la norme, qui qualifie les rgles techniques de conception et dexcution des infrastructures de transport, avec pour principal objectif dassurer la scurit des usagers. Elle est tablie par les professionnels du domaine. Le souci de rentabilit est aussi au cur des normes qui ont pour but damliorer et duniformiser les mthodologies de travail.
Postulat 30
Le standard prcise ce qui doit tre fait (Quoi ?) en fonction dun certain besoin, tandis que la norme prcise la manire de le raliser (Comment ?). Il varie selon limportance de linfrastructure au sein du rseau de transport
Les infrastructures routires
133
3.5.2.2
Standards pour lusager
Lusager attend dune infrastructure de transport, en change dune prestation montaire directe (page routier, billet de train, etc.) ou indirecte (impts spcifiques, subventions publiques, etc.), un standard assurant sa mobilit dune manire : sre : pas de trac accidentogne, revtement adhrence leve, etc. assurant un temps de dplacement court et stable : stabilit dhoraire des transports collectifs, peu de gne due lexploitation, fluidit dcoulement du trafic, vitesse commerciale leve, etc. conomique : faible consommation nergtique, maintien des fonctionnalits du vhicule, etc. confortable : trac fluide, revtement uniforme, signalisation, guidage optique, paysage agrable, installations annexes, etc. accessible : couverture territoriale, accs rguliers linfrastructure, etc.
Ces diffrents critres ne dpendent pas que de linfrastructure proprement dite (la scurit dpend aussi du comportement des usagers, le temps de dplacement dpend de la charge de trafic, etc.), mais la qualit de celle-ci a une influence prpondrante. Le standard se doit dtre le plus homogne possible sur une infrastructure donne pour permettre lusager didentifier la qualit de celle-ci et de disposer dune mobilit de qualit constante.
Postulat 31
Une infrastructure de transport doit possder un standard assurant lusager un dplacement sr, rapide, conomique et confortable
3.5.2.3
Standards pour le dcideur
Le dcideur ou matre duvre est essentiellement intress par les aspects conomiques lis aux exigences de standard dune infrastructure de transport et qui concernent : ralisation : faible cot de construction, taux de subventionnement, mesures environnementales ncessaires, etc. exploitation : taux de rentabilit, subventions, maintien du trafic, services aux usagers, permanence et niveau de qualit dusage de linfrastructure, mesures de scurit, etc. maintenance : durabilit des ouvrages, seuil de qualit, scurit, etc.
134
LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
3.5.3
Conclusions
Le projeteur routier doit adapter son tude une population aux caractristiques de plus en plus mouvantes. Lvolution des attentes sociales tend en effet depuis prs de trois dcennies une mancipation des individus, une remise en question de lautorit, une dfiance vis--vis de la technique ainsi qu une recherche de sens, dans une socit occidentale o la satisfaction des besoins de base, tels que dfinis par Maslow, de la majeure partie de la population est dsormais assure. De plus, le projeteur doit analyser de la structure sociale prsente dans le contexte du projet, ceci afin de faire participer au mieux lensemble des acteurs et notamment ceux qui sont traditionnellement les moins intgrs dans les processus dtudes classiques. Les politiques publiques, qui sont le moyen par lequel une socit humaine sorganise afin de satisfaire au mieux les besoins de ses diverses composantes, ne concernent pas directement les activits du projeteur routier. Cependant, vu les fortes interactions quelles ont sur le produit que celui-ci doit raliser, une infrastructure routire, il est ncessaire quil soit conscient des enjeux qui leurs sont lis. On peut relever que la satisfaction de ces besoins tend un optimum global qui nest en aucun cas la somme des optimums de chaque composante de la socit. Trois principales politiques publiques sont plus directement concernes par le projet routier en raison des incidences spatiales de celui-ci. Il sagit de la politique de lamnagement du territoire, qui dfinit les principes directeurs des rseaux de transport, vritables pines dorsales des activits spatiales humaines, la politique des transports, qui dfinit les caractristiques et la hirarchie des rseaux de transport ncessaires lassurance dune mobilit sre, conomique, quitable et de qualit, et la politique environnementale qui subit de nombreuses nuisances de la part des activits de transport. Ces trois politiques ne sont pas appliquer sparment mais sont en forte interaction et il sagit souvent pour le projeteur dtablir un quilibre quant aux respect de leurs objectifs spcifiques parfois contradictoires. Lassurance dune mobilit sre, conomique et diffuse sur le territoire est dsormais indispensable lorganisation de notre socit occidentale. Le principal rseau de transport permettant dassurer cette mobilit est le rseau routier. Les perspectives dvolution montrent que la part relative de la mobilit individuelle lies ce rseau restera pour longtemps encore importante, notamment dans une socit o les loisirs occupent une part de plus en plus importante. La ralisation dun rseau de transport routier, qui est le principal rseau de transport en Suisse, rpond certaines exigences que se doit de respecter le projeteur et que lon dsigne par le terme de standard. Le standard prcise ce qui doit tre fait (Quoi ?) en fonction dun certain besoin, tandis que la norme prcise la manire de le raliser (Comment ?). Il varie selon limportance de linfrastructure au sein du rseau de transport Ainsi, sans prtendre avoir fourni une tude sociologique approfondie, lauteur montre dans ce chapitre que les besoins des individus, et de la socit par extension, influencent les caractristiques des projets routiers par la dfinition des politiques publiques qui linfluencent ou qui sont influences par celui-ci. Le projeteur routier est en quelque sorte au bout de cette chane et il nest quun excutant, qui ninfluence pas le processus, mais qui doit en tre conscient afin de raliser au mieux une infrastructure routire rpondant aux attentes des citoyens.
Prambule
135
4.
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
4.1
P REAMBULE
4.1.1
Avant-propos
Le projeteur routier labore une infrastructure qui assure le respect des objectifs atteindre, tout en tenant compte de multiples contraintes lies lenvironnement humain et naturel, la technique, lconomie ou aspects sociaux. Pour assurer un rsultat optimal, il ralise son tude de manire rationnelle en respectant une certaine mthodologie de travail squentielle. Le contexte administratif et juridique influence notablement les caractristiques des diffrentes tapes de son activit. Celui-ci dfinit, ou impose mme dans certains cas, le cahier des charges du projeteur ainsi que les phases de son travail, notamment les phases dinformation et de consultation des autorits et du public. Ces dispositions sont ncessaires dans une socit dmocratique pour aviser le public et ladministration concerne de la teneur des lments du projet. En effet, au contraire dune socit autoritaire ou dun processus purement technocratique, les remarques et dsaccords des acteurs priphriques sur des aspects du projet peuvent linfluencer par le biais de moyens lgaux. Lensemble de ces aspects administratifs et juridiques est appel la procdure. Elle varie selon la typologie du projet, celle-ci tant fonction de son tendue spatiale, du matre duvre concern et de la position dans le temps. Ce chapitre est articul autour de plusieurs thmes concernant llaboration du projet routier, savoir : notion du cycle de vie dune infrastructure routire typologie des projets routiers processus dlaboration du projet routier tapes de la procdure gnrale des projets routiers raliss en Suisse procdures particulires concernant des infrastructures routires importantes analyse critique des procdures et des mthodologies existantes
Ce chapitre est orient sur la description et lanalyse des procdures et des mthodologies dtude existantes. Les diverses notions abordes seront reprises dans le chapitre 9 o elles seront adaptes en fonction des enseignements tirs des diffrents postulats, rflexions, commentaires ou constatations effectus dans les divers chapitres de cette tude.
136
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
4.1.2
Terminologie
Les principales notions utilises dans cette tude sont les suivantes :
Infrastructure routire
Ensemble des installations linaires destines la circulation des vhicules motoriss uniquement (site propre) ou en trafic mixte (site banal)
Projet routier
tude des dimensions et de lemplacement dune infrastructure routire comprenant lensemble des lments (calculs, plans, etc.) ncessaires sa ralisation dans le respect de la technique, de lhomme et du milieu naturel. Outre ltude de linfrastructure routire proprement dite, le projet routier comprend aussi ltude des mesures daccompagnement lies la ralisation de la nouvelle route (mesures environnementales, de trafic, de rorganisation des rseaux existants, etc.)
Mthodologie
Ensemble des mthodes et des techniques d'un domaine particulier. Semploie parfois abusivement pour dsigner la manire de faire ou de procder
Procdure
Marche suivre et ensemble des rgles respecter pour obtenir un rsultat
Mthode de travail
Moyens utiliss pour raliser les diffrentes tapes de la procdure
Processus
Enchanement ordonn de faits ou de phnomnes, rpondant un certain schma et aboutissant un rsultat dtermin
laboration
Action d'laborer quelque chose par un travail de rflexion, de prparation ou de cration
Dcideur
Personne physique ou morale habilite prendre des dcisions. Dans le cas des projets dinfrastructures routires publiques, ce dcideur est gnralement un acteur politique. On dsigne aussi ce dcideur par le terme de Matre duvre
Projeteur
Homme dtude ralisant le projet routier. Il sagit gnralement dun ingnieur civil
Groupe dtude
Ensemble des spcialistes techniques et des acteurs reprsentatifs entourant le projeteur, et dirigs par celui-ci, pour raliser ltude du projet routier. On peut aussi, par extension, parler du Groupe dtude comme tant, dans son ensemble, le projeteur
Le cycle de vie dune infrastructure routire
137
On peut remarquer la lecture de ces diffrentes dfinitions que la notion de mthodologie est une agrgation de deux notions distinctes : la procdure (Que faire ?), qui sera traite aux chapitres 4 et 9 et les mthodes de travail (Comment le faire ?) qui seront traites aux chapitres 7, 8 et 9.
METHODOLOGIE
PROCEDURE
- Dcideur - Typologie du projet - Cadre lgal et administratif - Normes et directives - Etapes de travail - Documents fournir - Points d'arrt obligatoires - Modes participatifs - Dlais - Etc.
METHODES DE TRAVAIL
- Rapports entre les acteurs - Participation publique - Information - Concertation - Dmarche itrative - Aide multicritre la dcision - Systmes d'information rfrence spatiale - Durabilit - Etc.
Figure 27
La mthodologie, agrgation de deux notions distinctes
Dans la suite de cette tude, la mthodologie du projet est dfinie comme tant le regroupement des procdures dorganisation dun travail, le projet routier dans ce cas, men laide doutils adquats permettant dobtenir un projet de qualit.
4.2
L E CYCLE DE VIE D UNE INFRASTRUCTURE
ROUTIERE
La dmarche dtude dun projet routier propose par les normes suisses206 postule nettement quun ouvrage, i.e. une infrastructure routire, est soumise un cycle de vie. (Art. 3, VSS, SN 640 026) Une route est planifie, conue, construite, utilise et exploite, entretenue et ventuellement dmolie.
Postulat 32
Une route doit tre considre sur un cycle de vie : elle est planifie, conue, construite, utilise et exploite, entretenue, ramnage et ventuellement dmolie
206
Il sagit des normes SN 640 026 640 029. Ces normes sont dites par l Union des professionnels suisses de la route , plus communment dsigne par son abrviation allemande VSS (Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute). Pour la suite de ltude, on utilisera ce terme de VSS pour dsigner cette association professionnelle
138
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
Ltude de planification et de conception du projet routier ne comporte que quelques lments de ce cycle de vie. Le volume de travail que ncessite le projet est important mais sa dure est faible par rapport lensemble du cycle. Il est nanmoins un rouage important de celui-ci car il dicte son fonctionnement.
ETUDE : planification et
conception
Impulsion l'laboration du projet
ENTREE DANS LE CYCLE
Examen de l'opportunit du projet
Etude de planification
Avant-projet Correction Amnagement
Projet dfinitif
Dmolition
Maintenance Surveillance
Appel d'offres Exploitation Excution
SORTIE DU CYCLE
EXPLOITATION REALISATION
Figure 28
Cycle de vie dune infrastructure routire (VSS, SN 640 026)
4.2.1
Principales phases du cycle de vie
Les diffrentes tapes du cycle de vie dune infrastructure routire dcrit prcdemment peuvent se catgoriser en trois phases principales : (VSS, SN 640 026)
tude
Aprs avoir examin lopportunit du projet, il sagit de planifier et de concevoir linfrastructure routire. La norme SN 640 026 parle de cette phase comme tant une phase de dveloppement dides. Cette phase dtude est le principal sujet de la thse
Ralisation
II sagit de concrtiser la route dans le terrain, cet ouvrage nexistant auparavant que virtuellement dans lesprit du projeteur et du dcideur
Exploitation
La route est maintenant aux mains de lexploitant qui la gre de manire assurer une utilisation rgulire, sre et conomique pour les usagers
Le cycle de vie dune infrastructure routire
139
Cette vision du cycle de vie dune infrastructure routire nest pas celle qui est utilise habituellement pour illustrer la procdure du projet. On se base plutt sur la linarit du projet. Certes, des retours en arrire (rtroactions) sont souvent indiques, mais la notion circulaire est absente. Cette linarit nest pas une vision pertinente, car limpulsion du projet semble sloigner de plus en plus des tapes dexcution et de maintenance. En considrant un cycle, on peut au contraire montrer que toutes les actions sont prcdes mais aussi devancent dautres actions et surtout quelles ne sont pas dfinitives.
Postulat 33
Les tapes du projet ne sont pas dfinitives car elles sont un des rouages du cycle de vie de linfrastructure routire
Comme il sera expliqu par aprs, cette rflexion sur la circularit du projet, oppose son actuelle linarit , permet de proposer un fil conducteur, form dun groupe de spcialistes. Ce groupe est garant de la prennit des ides et des tudes du projet tout au long de la vie de la route.
4.2.2
tendue de ltude
Comme indiqu dans la figure suivante, cette tude ne sapplique qu certaines phases du cycle de vie de linfrastructure routire, savoir celles qui sont dans la phase principale de ltude du projet routier.
Impulsion l'laboration du projet
ENTREE DANS LE CYCLE
Examen de l'opportunit du projet
Etude de planification
Avant-projet Correction Amnagement
Projet dfinitif
Dmolition
Maintenance Surveillance
Appel d'offres Exploitation SORTIE DU CYCLE Excution
Figure 29
tendue de ltude par rapport au cycle de vie dune route
140
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
La principale tape du processus dtude dun projet routier est la phase de ltude de planification. Le travail de thse portera donc essentiellement sur cette tape du cycle de vie dune route.207 Les phases dexcution, dexploitation et dentretien ne concernent pas directement cette tude, car elles sont plus constructives et il y intervient moins dacteurs. Elles sont nanmoins prsentes dans lesprit du projeteur, qui doit tenir compte des possibilits et impossibilits techniques (phase de ralisation) ainsi que des effets long terme de ses choix (phase dexploitation et dentretien). Cette considration des impacts de linfrastructure routire analys sur la totalit du cycle de vie, qui est une des composantes du dveloppement durable, sera reprise dans la comparaison des variantes.
4.3
T YPOLOGIE DES PROJETS ROUTIERS
4.3.1
Paramtres distinctifs
Il existe de multiples types de projets routiers. On peut distinguer un projet selon : Son emplacement dans le cycle de vie de linfrastructure Il peut sagir dune construction dun nouvel amnagement, de la correction dune infrastructure existante ou dun entretien La dimension spatiale de ltude Le projet peut se situer au niveau dun rseau routier, il peut sagir dun amnagement linaire ou mme dun tronon partiel trs localis La dimension temporelle de ltude Le projet peut tre une base dune conception de planification ou concerner la phase de ralisation Le Matre duvre concern Celui-ci est dans la majeure partie des cas une collectivit publique (Etat, Canton ou Commune) mais il peut tre aussi priv La position gographique Celle-ci engendre surtout des contraintes diffrentes au niveau des lois applicables et des procdures utilises208 ainsi que des normes ou des directives applicables. Les rgles de lart sont aussi variables selon les endroits considrs Le milieu environnant On peut aussi distinguer les projets urbains des projets hors-localits
207
Comme on le constatera par aprs, la distinction entre ltape de ltude de planification et celle de lavant projet nest pas pertinente. Ces deux tapes seront donc considres en commun sous lappellation laboration du projet routier On pourrait ainsi plutt parler du cadre lgislatif et du cadre administratif, mais ceux-ci dpendent des paramtres prcdents, savoir le Matre duvre concern combin avec la position gographique du projet
208
Typologie des projets routiers
141
Comme le prcise la norme SN 640 026 la dmarche du projet tient compte de limportance et de la grandeur de celui-ci.
Postulat 34
Lampleur et le principe de la mthodologie du projet dpendent directement de la typologie de celui-ci
4.3.2
Tableau de synthse
Les nombreux paramtres permettant de distinguer les projets engendrent une multitude de catgories de projets routiers. En considrant par exemple uniquement trois paramtres209 parmi la liste prsente la page prcdente, on obtient prs de 80 possibilits, comme prsent dans la matrice de synthse suivante :
Position dans le cycle de vie de linfrastructure routire Planification Matre duvre Etendue spatiale PL Rseau R PAYS P Linaire L Tronon T Nud routier NO Rseau R CANTON / REGION CR Linaire L Tronon T Nud routier NR Rseau R COMMUNAUTE URBAINE CU Linaire L Tronon T Nud routier NR Rseau R COMMUNE C Linaire L Tronon T Nud routier NR Rseau R PRIVE P Linaire L Tronon T Nud routier NR
P R - PL P L - PL P T - PL P NO - PL CR R - PL CR L - PL CR T - PL CR NO - PL CU R - PL CU L - PL CU T - PL CU NO - PL C R - PL C L - PL C T - PL C NO - PL P R - PL P L - PL P T - PL P NO - PL
Nouvelle route NR
P R - NR P L - NR P T - NR P NO - NR CR R - NR CR L - NR CR T - NR CR NO - NR CU R - NR CU L - NR CU T - NR CU NO - NR C R - NR C L - NR C T - NR C NO - NR P R - NR P L - NR P T - NR P NO - NR
Correction / amnagement CA
P R - CA P L - CA P T - CA P NO - CA CR R - CA CR L - CA CR T - CA CR NO - CA CU R - CA CU L - CA CU T - CA CU NO - CA C R - CA C L - CA C T - CA C NO - CA P R - CA P L - CA P T - CA P NO - CA
Entretien E
P R E PLE PTE P NO E CR R E CR L E CR T E CR NO E CU R E CU L E CU T E CU NO E C R E CLE CTE C NO E P R E PLE PTE P NO E
Tableau 17
Typologie des projets routiers
209
Il sagit de lemplacement dans le cycle de vie de la route, du matre duvre concern et de la dimension spatiale de la route
142
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
A la lecture de cet exemple, deux possibilits soffrent alors lauteur pour la poursuite de ltude : proposer des mthodologies spcifiques qui sont adaptes aux diffrentes catgories de projets routiers que lon peut rencontrer en Suisse210 proposer une mthodologie gnrale du projet routier qui soit indpendante de la procdure
La prfrence de lauteur va la deuxime possibilit car elle est beaucoup plus souple et gnrale que la premire. Il est en effet impossible de procder dans la prsente tude ltablissement de mthodologies spcifiques pour chaque type de projets, de par ltendue des possibilits offertes.211 De plus, les caractristiques des projets voluent selon la procdure mais les principes mthodologiques eux restent identiques. Lauteur prfre formuler une rflexion portant sur la procdure gnrale du projet, qui est en quelque sorte la dmarche intellectuelle que doivent mener tous les projeteurs et les dcideurs afin dobtenir partir dun contexte et dune problmatique quelconque une infrastructure routire durable, de qualit et accepte par tous. La mthodologie concertative ainsi propose ne sera pas spcifique une typologie prcise mais sera applicable sur la majeure partie des projets routiers.
Postulat 35
La mthodologie concertative sapplique, moyennant quelques adaptations mineures, lensemble des projets routiers
4.4
P ROCESSUS D ELABORATION DU PROJET
ROUTIER
4.4.1
Les diffrentes tapes
Indpendamment du contexte administratif et juridique, et des termes y rfrents, le projeteur, i.e. le groupe dtude, laborant un projet dinfrastructure routire respecte le processus dcrit par aprs et illustr par la figure de la page suivante. (Dumont A.-G. et Tille M., 1997) et (fig. 1, VSS, SN 640 027) La norme SN 640 026 insiste aussi sur le fait de dfinir clairement le mandat dtude avant de dbuter le projet, ceci afin de rgler toutes les questions organisationnelles de celui-ci. Il est intressant de remarquer que Veuve promeut exactement le contraire ! (Veuve L., 1994) Ces aspects traitant de la forme des relations juridiques entre le projeteur et le dcideur ne seront pas considrs dans cette tude.
210 211
Ou tout du moins aux principales catgories Songeons par exemple au cas des routes cantonales o dans un pays morcel comme la Suisse, 26 cantons correspondent 26 procdures diffrentes, 26 pratiques administratives diffrentes, 26 terminologies diffrentes
Processus dlaboration du projet routier
143
Impulsion l'laboration du projet
1. Dfinir le cadre de l'tude
2. Fixer la participation des intervenants
Dfinition du problme
3. Identifier les besoins
4. Formuler les objectifs
5. Analyser les contraintes
Proposition de solutions
6. Proposer des solutions
7. Apprcier les consquences
Apprciation
8. Proposer une solution
9. Prendre une dcision
Modif ier
le projet
Poursuivre le projet
Renoncer au projet
Figure 30
Processus dlaboration du projet routier
144
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
4.4.2
Impulsion llaboration du projet
Ltape de limpulsion llaboration du projet routier est une tape qui prcde le projet. Elle nen fait donc pas partie et nest pas traite par le projeteur. Cependant, elle est considre dans cette thse, car son effet de dtonateur du projet influence nettement les caractristiques de celui-ci. Une infrastructure routire ne se ralise pas pour elle-mme mais pour rsoudre une situation problmatique ou rpondre un besoin insatisfait ou nouveau. Comme on la vu au chapitre 3, une infrastructure routire est la concrtisation dune expression politique de satisfaction de certains besoins collectifs, comme laccessibilit ou la mobilit. Le dcideur, qui est gnralement une administration publique soccupant des infrastructures routires, donne limpulsion llaboration du projet. Ce dcideur nagit pas isolment mais est influenc par le contexte du projet et surtout par les diffrents acteurs priphriques qui lui font part de leurs proccupations vis--vis dune problmatique donne ou de leurs dsirs dtudier un projet routier. Le projeteur na aucune influence en ce qui concerne cette impulsion, qui est daspect purement politique. Le dcideur nest toutefois pas une simple courroie de transmission entre les attentes des acteurs priphriques et le projeteur. Il analyse, en examinant aussi le contexte, si les demandes qui lui sont formules sont vraiment pertinentes et justifies. On peut aussi relever que limpulsion llaboration du projet peut aussi provenir directement du dcideur qui en analysant le contexte lors dun suivi effectu par ses soins et de manire rgulire peut dceler des besoins insatisfaits (cas dune administration routire qui en analysant les accidents sur une route existante dcide de corriger les tronons dangereux par exemple).
Postulat 36
Limpulsion llaboration du projet est le fait du dcideur qui peut prendre cette dcision sous linfluence de divers acteurs priphriques
Limpulsion peut ainsi avoir plusieurs sources dinfluence : Un besoin collectif est satisfaire Un besoin collectif est insatisfait, il va ltre prochainement ou un nouveau va apparatre. Ce genre de besoin est signifi auprs du dcideur par les autorits politiques, dautres services administratifs ou des associations. Il peut aussi tre mis en vidence directement par le dcideur Des besoins individuels sont satisfaire Ces besoins se manifestent auprs du dcideur par le biais des autorits politiques (transmission traditionnel des rcriminations du public), des associations (rapport lautorit modifi) ou les mdias pour autant que ces acteurs jugent cette demande individuelle pertinente. Si ce nest pas le cas, un besoin individuel peut tre signifi directement au dcideur si celui organise un systme dcoute du public (centre de plaintes, etc.). Mme si, comme on la vu au chapitre 3, il sagit dassurer les besoins collectifs en priorit par rapport aux besoins individuels, ce genre dinfluence nest pas ngliger
Processus dlaboration du projet routier
145
Le contexte du projet volue Lenvironnement se dgrade, le paysage volue, les finances publiques ont des priorits diffrentes, etc. ce qui modifie les conditions du contexte du projet
Le contexte lgislatif ou administratif volue Une nouvelle loi oblige tenir compte de nouvelles contraintes
Pour que le projet dinfrastructure routire aie des chances de succs, il est ncessaire que le projet rponde des besoins collectifs, ceci au dtriment de besoins strictement individuels. Les besoins doivent aussi tre durables, cest dire tre quilibrs entre les besoins sociaux, environnementaux et conomiques et il sagit de considrer le long terme dans la satisfaction des besoins (ne pas se contenter de satisfaire un besoin court terme). Ainsi, tout comme il existe de nombreux projets, il existe aussi de multiples impulsions llaboration du projet. Lexemple ci-dessous montre diverses impulsions en fonction de la position du projet au sein du cycle de vie et du type de besoins :
Social Construction Correction
Rendre une zone habite accessible au rseau routier principal Amnager les tronons risque sur un trac accidentogne Amliorer la qualit dune chausse afin de rduire les accidents
conomie
Nouvel accs zone industrielle une
Environnement
Transfrer le trafic hors dune zone urbaine Amnager des passages faunes pour rduire la mortalit animale Limiter les risques majeurs en amnageant des dshuileurs
Amliorer la fluidit du trac pour diminuer les temps de parcours En cas de saturation, augmenter la capacit en modifiant les profils en travers
Amnagement
Tableau 18
Matrice dexemples dimpulsions
Limpulsion du projet dpend donc de la ncessit de rpondre un ou plusieurs besoins. Cette ncessit peut cependant revtir des formes diverses et le besoin peut tre clairement dfini ou simplement tre bauch : (VSS, SN 640 026) le besoin peut rsulter dun climat passionnel, dun intrt particulier, ne pas tre dfini et quantifi et finalement savrer inexistant, ou supportable, aprs examen. Cest le cas par exemple dune pression populaire exprime par les mdias, par des manifestations et reprise ventuellement par des autorits politiques dans un but lectoraliste et amenant le dcideur entreprendre une tude de faisabilit. La situation est ressentie comme tant problmatique mais les faits dmentent sa gravit le besoin nest pas quantifi, mais une tude peut en montrer limportance. Cest le cas par exemple o des signes rvlateurs avrs (impacts par exemple) dmontrent la ncessit dune modification de lexistant, sans que lon puisse dj qualifier la gravit de la problmatique le besoin est dfini avec prcision car il rsulte dune tude antrieure ou voisine ou bien dun suivi. Cest le cas par exemple dune tude voisine la zone dtude ou antrieure qui a pu, dune part, tablir la ncessit du besoin et, dautre part, le quantifier, ou au moins le qualifier avec prcision le besoin peut tre dfini par une approche globale, tel un plan directeur ou une conception directrice (VSS, SN 640 026)
146
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
4.4.3
Dfinir le cadre de ltude
Ltendue spatiale212 et temporelle du domaine dtude doit tre proportionnelle aux dimensions du projet. (Dumont A.-G. et Tille M., 1997) Ses limites doivent tre dfinies de faon ce que linfrastructure routire tudie ninfluence pas ou peu son environnement, en tenant compte des lments suivants : (Tzieropoulos P., 1995) lments gographiques structurants : rivires, crtes, lacs, etc. projets routiers antrieurs ou adjacents la rgion tudie limites administratives et juridiques dure de vie (exploitation notamment) de linfrastructure
Ainsi le domaine dtude doit tre suffisamment tendu pour circonscrire lensemble de lespace o se produisent des effets dus linfrastructure routire. Il doit cependant aussi tre le plus rduit possible pour que les changements induits par la route soient significatifs. (Infraconsult, 2000) La dimension optimale du domaine dtude peut tre illustre par la figure cidessous o est reprsent, dune part, le cot des tudes permettant damliorer la connaissance du territoire o se situe la route et, dautre part, le cot engendr par linadquation du projet son environnement, qui est fonction de la qualit des informations disposition. On remarque ainsi que le choix dun domaine dtude sur-dimensionn augmente le cot des tudes, sans avoir un effet intressant sur les dimensions du projet. Par contre, le choix dun domaine dtude sousdimensionn permet certes de raliser une conomie sur ltude, mais le cot des erreurs entran par la forte inadquation du projet, en raison de limprcision des informations, est prohibitif.
Cots
Dimension optimale du domaine d'tude
Cots des investigations et des tudes
Cots de la modification du projet Dimension du domaine d'tude
Figure 31
Dimension optimale du domaine dtude
La dlimitation du domaine dtude est contrler rgulirement et doit tre adapte le cas chant. (Art. 8, VSS, SN 640 027)
212
Appele aussi zone dtude
Processus dlaboration du projet routier
147
4.4.4
Fixer la participation des intervenants
Dans cette tape, il sagit de dterminer le niveau de participation des diffrents acteurs du projet, notamment celui du public. Plusieurs formes dintgration de ces acteurs sont possibles : information, consultation ou concertation intgration au plus tt du processus dtude, en cours dtude ou la fin de celle-ci
Ces diffrents lments de participation publique seront traits plus en profondeur dans le chapitre 7. Il est cependant prfrable de procder la participation publique au plus tt du projet, ceci permettant de dceler rapidement les problmes et de dtecter au mieux les diffrents besoins. Lappropriation du projet par le public ainsi que son acceptation est ainsi facilite. Il sagit aussi dans cette tape de dfinir la structure dorganisation des acteurs principaux de ltude. Ceux-ci sont au nombre de deux au minimum : le dcideur, qui est lautorit politique responsable de ladministration routire le projeteur, qui peut tre un ingnieur civil ou rural
Selon limportance du projet, la complexit de ltude et le degr dapprofondissement dsir, dautres acteurs sont associs ce binme de base : intermdiaires, spcialistes, associations, public, etc.
4.4.5
Identifier les besoins
Linfrastructure routire sert satisfaire des besoins collectifs qui peuvent tre de nature trs diffrente. Limpulsion llaboration du projet intervient gnralement quand un ou plusieurs de ces besoins sont insatisfaits. Cependant, ceux-ci sont rarement clairement identifis ou quantifis. Ltape didentification des besoins consiste mettre en vidence ceux qui sont insuffisamment satisfaits, ou qui vont prochainement le devenir, et qualifier, voir mme quantifier, cette insuffisance. On procde alors un bilan qui est une comparaison entre deux valeurs et qui a pour but didentifier les besoins auxquels doit rpondre linfrastructure routire : une valeur de demande de la socit qui est lattente de la collectivit auprs du besoin tudi. Il peut sagir dun standard, dune valeur limite ou alors dune valeur beaucoup plus subjective une valeur caractrisant ltat prsent et futur213 du besoin considr. Par une analogie conomique avec le terme de demande, on peut qualifier cette valeur comme tant loffre
213
Il y a gnralement deux tats futurs qui sont dtermins : un tat futur sans projet ralis et un autre avec le projet ralis. Ceci permet de vrifier limpact ou lapport du projet. Quant il sagit simplement de vrifier si le besoin est justifi, ltat futur sans projet est suffisant. La dtermination de ltat futur permet de qualifier lvolution dynamique du besoin. (Hertig J.-A., Fallot J.-M., et al., 1999) La priode considrer pour ltat futur dpend du projet. On peut considrer cet tat lissue de la dure de planification qui est de 20 ans en gnral en Suisse (Dumont A.-G. et Tille M., 1997)
148
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
Le bilan est tabli pour chaque besoin collectif. En cas dinadquation de loffre la demande (loffre est infrieure la demande, rvlant ainsi une insuffisance), la ncessit de raliser une infrastructure routire est tablie. Cette insuffisance, qui est dsigne par le terme de besoin, est ainsi mise en vidence et peut tre quantifie, ou tout du moins qualifie. Dans le sens de la dfinition donne par le dictionnaire, le besoin peut tre dfini comme tant un tat dinsatisfaction mais aussi ce qui est ncessaire . On procde ici un lger abus de langage en dsignant linsatisfaction dun besoin, qui est le dclencheur du projet, par le terme seul de besoin. Ce raccourci, qui simplifie la comprhension de la suite de ltude, na pas de graves consquences car il arrive souvent quun besoin qui initialement tait satisfait ne le soit plus en raison de la ralisation dune nouvelle infrastructure routire. On se doit donc aussi de le considrer dans cette tape de ltude. La diffrence par rapport un besoin initialement satisfait rside dans le fait que lun est class comme objectif (le besoin qui doit tre satisfait) et lautre comme contrainte (le besoin qui risque de ntre plus satisfait).
Postulat 37
Un objectif est un besoin collectif qui doit tre satisfait par linfrastructure routire de manire rpondre aux attentes de la socit
Postulat 38
Une contrainte est un besoin collectif qui ne doit pas tre dgrad par la future infrastructure routire de manire ne plus rpondre aux attentes de la socit
On procde cette estimation des besoins pour lensemble des besoins supposs ou potentiels. Ces besoins nont pas forcment tous la mme importance, mais il ne sagit pas dans cette tape de procder leur pondration. Les besoins satisfaire par une infrastructure routire sont multiples et peuvent tre par exemple : qualit de circulation : niveau de service (demande) et coulement du trafic lheure de pointe (tat du besoin) nuisances sonores : valeurs limites dimmision (demande) et niveau dimmission sonore (tat du besoin) paysage : qualit paysagre (demande) et atteintes paysagres (tat du besoin) scurit : pas daccidents (demande) et accidents (tat du besoin) etc.
Illustrons cette notion de bilan par un exemple : le niveau dimmission sonore des riverains situs proximit dune infrastructure routire. La demande, ou standard,
Processus dlaboration du projet routier
149
est illustre par la valeur limite dimmission sonore (VLI) (OPB, 1986) quil sagit de ne pas dpasser. Cette demande est gnralement constante au cours du temps.214
Cas 3 : un besoin est prsent ds la Valeur
mise en service (voire mme au dbut de l'tude)
Standard : peut tre variable
Cas 2 : un besoin apparat
aprs la mise en service
Cas 1 : les besoins sont
satisfaits pendant la dure de vie
Dure de l'tude et de ralisation Dbut de l'tude Mise en service de la route
Dure de vie de l'infrastructure
Temps
Figure 32
Bilan didentification des besoins
Loffre, ou plutt dans ce cas les effets, est illustre par les immissions sonores perues au rcepteur. Il y a alors 3 cas possibles : Cas 1 : les immissions sonores sont infrieures VLI sur lensemble du domaine dtude. Il ny a pas de besoin dintervention particulire Cas 2 : les immissions sonores sont actuellement infrieures VLI mais dans un futur proche, qui a lieu durant la dure de vie de la route, elles seront suprieures. Un besoin de correction apparatra (ralisation dune paroi paraphone par exemple) Cas 3 : le standard nest pas assur actuellement ou lors de la mise en service de la route. Le besoin correctif est imminent
Lexemple illustratif prsent a des effets qui sont en volution constante au cours du temps. Ce nest pas forcment toujours le cas215 et il peut apparatre un quatrime cas, identique aux cas 2 ou 3 lors de la mise en service de linfrastructure et semblable au cas 1 la fin de sa dure de vie. Dans ce cas intermdiaire, un besoin ncessaire au dbut du cycle de vie de linfrastructure projete disparat au cours du temps. La question de la ncessit de rpondre (linadquation de loffre et de la demande est prjudiciable, mme dans un court laps de temps) ou non (linsatisfaction temporaire est tolrable) court terme ce besoin est traiter ponctuellement. Elle peut cependant dpendre dune obligation lgislative imprative.
214
Cependant, elle peut varier. On peut, par exemple, admettre que dans 10 ans le standard soit augment (diminution de VLI) ou diminu (augmentation de VLI) Les immissions sonores peuvent diminuer en raison de lapparition de nouvelles technologies, dune diminution du volume de trafic, dun changement du revtement routier, etc.
215
150
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
Cette question de la ncessit ou non de la satisfaction dun besoin peut se poser aussi si celui-ci napparat de manire fugace la fin du cycle de vie prvu,216 cest dire trs long terme. De mme si les seuls besoins mis en vidence sont des besoins de faible importance, la ncessit de les satisfaire ou non doit aussi tre discute par le dcideur. Il est noter que si aucun besoin napparat lors de cette phase dtude, cas plutt rare il faut en convenir, la ncessit de linfrastructure routire est discutable car la problmatique est non fonde. La conclusion peut tre alors de dcider dabandonner le projet, ou tout au moins de reporter la ralisation de la route. Les tudes dimpact sur lenvironnement (EIE) ont pour but de considrer les aspects environnementaux au dbut de la procdure de planification afin de rvler immdiatement les problmes environnementaux auquel peut tre confront le projeteur. Il sagit donc typiquement l dune mesure didentifications des besoins.
4.4.6
Formuler des objectifs
Sur la base des besoins tablis par le biais du bilan ralis prcdemment, les objectifs, cest dire les buts atteindre, lis linfrastructure routire projete sont tablis. Si la phase de bilan est plutt une tape technique, ralise par le groupe dtude, la phase de formulation des objectifs est plutt une dcision politique, base sur de nombreux lments techniques. Cest en quelque sorte le rsultat dun dialogue entre le dcideur et le groupe dtude. Parfois ces objectifs sont fixs par la loi (valeur atteindre, standard de linfrastructure routire, etc.), par des projets voisins ou par des dcisions prises dans dautres projets.
4.4.7
Analyser les contraintes
La ralisation des objectifs est limite par des contraintes, qui sont en quelque sorte des entraves la libert d'action du projeteur. Celui-ci se doit donc de disposer dun ensemble complet de donnes de base pour pouvoir connatre au mieux le domaine dtude. La qualit du projet dpend fortement de celle des donnes de base. Aprs avoir dtermin quelles sont les contraintes affectant le projet, la ralisation de la phase de collecte des informations peut dbuter. Celle-ci demande un important volume de travail. Elle doit imprativement tre suivie dune phase danalyse et de reprsentation synthtique des contraintes.
216
Il sagit alors du cas 2 pouss lextrme
Processus dlaboration du projet routier
151
4.4.8
Proposer des solutions
Des solutions permettant de rsoudre le problme sont proposes par le projeteur. Celui-ci va donc procder une gnration de variantes217 avec le souci datteindre les objectifs lis linfrastructure routire, tout en respectant les contraintes. Il est important dassocier ces diffrentes variantes une variante, dite variante zro , qui reprsente ltat actuel, appel aussi tat de rfrence. Ceci permet de comparer les propositions avec ltat existant afin de voir quelles sont les amliorations ou dgradations apportes par le nouveau projet. Selon le degr de participation du public dans le processus du projet, des variantes proposes par des groupes dintrt sont intgres dans les diffrentes solutions proposes au dcideur. Les variantes considres dans cette tude sont des variantes de tracs routiers comportant ventuellement des mesures annexes, comme des mesures de modration de trafic sur le rseau annexe, de compensation cologique, etc. Les variantes multimodales ne sont pas traites dans cette tude. Cest une phase purement technique qui concerne essentiellement le groupe dtude.
4.4.9
Apprcier les consquences
Le projeteur doit examiner et apprcier les effets des diffrentes variantes gnres. Les objectifs et les contraintes tant souvent contradictoires et les acteurs du projet ayant souvent des chelles de valeur diffrente, il sagit l dune tche typiquement multicritre. Cest pour cela que le projeteur se doit dutiliser une mthode daide multicritre la dcision.
4.4.10
Proposer une solution
Sur la base des rsultats de laide multicritre la dcision, le projeteur propose au dcideur une, voire plusieurs si les diffrences sont insignifiantes, variante optimale. Loptimum peut tre dfini comme tant le rsultat le plus favorable au regard de circonstances donnes , les diffrents critres en loccurrence. Il est important que le projeteur vrifie que la variante optimale atteigne un niveau de satisfaction suffisant vis--vis des objectifs et des contraintes dtermins au dbut de llaboration du projet. En effet, la variante optimale est un maximum local qui natteint pas forcment un seuil dfini dans un domaine global.
217
On parle aussi parfois dalternatives ou de mesures. Dans cette tude, le terme de variantes sera retenu
152
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
4.4.11
Prendre une dcision
Sur la base de la variante optimale propose par le projeteur, le dcideur doit prendre une dcision politique fonde sur des lments dapprciation techniques. Trois options soffrent alors au dcideur : Poursuivre le projet Il sagit daffiner les dtails, de procder des modifications mineures, ceci de manire arriver un projet prt tre ralis Modifier le projet Les modifications ncessaires lacceptabilit de la variante choisie peuvent tre majeures, mais toutefois ralisables. Il sagit alors de raliser des rtroactions dans le processus du projet, afin de modifier des tapes de travail antrieures en tenant compte des rsultats obtenus Renoncer au projet Si les impacts de la variante optimale sont trop importants, si des contraintes rdhibitoires apparaissent ou si les objectifs sont manifestement impossibles raisonnablement tre atteints, il faut alors renoncer au projet Le renoncement au projet, ou son abandon, ne signifie pas que celui-ci ne verra jamais le jour. Le contexte nest tout simplement pas favorable sa ralisation. Il est tout fait possible que cet environnement du projet puisse voluer de manire lente ou brusque et devenir ainsi propice la ralisation de linfrastructure routire.
Postulat 39
Labandon du projet est une mesure qui est lie lvolution de son contexte et nest par consquent jamais dfinitive
4.4.12
Principes de llaboration squentielle
La subdivision du projet dtude dune infrastructure routire en tapes, ou par laboration squentielle, a pour but de progresser dans le dveloppement intellectuel de manire rationnelle et logique tout en traitant les informations exhaustives des moments opportuns. Les caractristiques de la future route sont affines progressivement et le travail du projeteur peut tre utilis de manire efficace. Une laboration squentielle dun projet routier rationnelle et logique doit respecter certains principes gnraux, noncs ci-aprs : (VSS, SN 640 026) chaque tape comprend des itrations (dmarche itrative) avec des rtroactions possibles quand il est ncessaire de revenir en arrire les tapes ou phases de travail sont successives chronologiquement, llaboration du projet se ralisant en srie et non en parallle. Cependant, lors de llaboration dune tape de projet, il est souvent ncessaire de considrer les tapes suivantes dans la rflexion (par exemple, la maintenance dsire pour
Processus dlaboration du projet routier
153
la route a une influence sur les principes constructifs de celle-ci), sans pour autant les tudier en dtail certaines tapes sont ludes ou regroupes selon la typologie du projet. Cest le cas, par exemple, des projets de petite dimension. Si lon procde par itrations successives, cest dire que lon effectue plusieurs fois la dmarche dlaboration du projet routier, certaines tapes peuvent simplement tre vites si entre deux itrations successives il ny a pas de changement significatif des lments les prcdant Llaboration du projet routier part dune vision globale du domaine dtude pour sachever par les dtails. Il sagit dun effet de zooms successifs ou par tapes lchelle dtude sagrandit. Cette faon de faire est rationnelle, car il ny a pas de logique tudier des dtails prcis (les dimensions dun ouvrage dart par exemple) si des lments plus importants (la position exacte de cet ouvrage dart) ne sont pas encore dfinis les tapes dlaboration du projet routier sont lies entre elles. En manquer une, ou en ngliger une, peut fortement dstabiliser lensemble et altrer le rsultat final il doit y avoir une certaine maturation des diffrentes ides. Cette maturation ncessite un temps de dveloppement et une gradation dans le niveau de concrtisation de lide. Ceci ne signifie pas que les dcisions prises rapidement sont exclure. Cependant, dans un domaine o typiquement de nombreux aspects contradictoires sont considrer et o de nombreux acteurs interviennent, le dveloppement des ides est un processus assez long et volutif. Il est rare que lide initiale ne subisse lexamen des modifications. chaque tape du projet se base sur la prcdente. Ceci prsente deux avantages :
-
on assure la prennit des informations entre deux tapes successives, celleci pouvant tre mise en pril autrement par un changement dacteurs (pas de transmission dinformations) ou en raison dun laps de temps important (oubli des actions prcdentes) la remise en question des phases initiales du projet est limite
chaque tape porte les rsultats des rflexions de lauteur sous forme de plans, de rapports ou dautres documents, ceci pour assurer la prennit des rflexions pour les professionnels, mais aussi pour les autorits et le public. Une attention particulire sera porte la qualit de ces documents qui dans certaines tapes servent de moyen de communication entre le groupe dtude du projet et le public la marge de manuvre diminue avec lvolution du projet, tandis que les effets conomiques et la porte des changements augmentent
154
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
4.5
LABORATION DU PROJET SELON LES
NORMES SUISSES
Les normes suisses (VSS, SN 640 026, SN 640 027) dcrivent les phases dlaboration du projet routier pour la construction, la correction et lamnagement des infrastructures routires. Elles sadressent par consquent lensemble des projets traits dans le Tableau 17 la page 141. Les termes utiliss dans les chapitres 4.2 et 4.4 sont tirs de la terminologie utilise par les normes suisses. Par consquent, les notions prsentes dans le chapitre 4.5 se rfreront parfois ces deux sous-chapitres prcdents.
4.5.1
Prsentation des diffrentes tapes
Les normes suisses distinguent les tapes suivantes : (Art. 2, VSS, SN 640 026) Impulsion llaboration du projet,218 qui est lentre dans le cycle Etude de planification (VSS, SN 640 027) Avant-projet (VSS, SN 640 028) Projet dfinitif219 (VSS, SN 640 029) Appel doffres Excution Exploitation : travaux permettant d'assurer la scurit de fonctionnement de toutes les parties de la route, sans en modifier les caractristiques (Dumont A.-G., Tille M. et al., 2000) Maintenance : ensemble des travaux dentretien visant assurer la conservation de la surface de circulation ainsi quau maintien de la scurit du trafic et de la valeur dusage. (Dumont A.-G., Tille M. et al., 2000) Amnagement, correction, source dune nouvelle impulsion Dmolition, qui est la sortie du cycle
Comme il a t dit auparavant, seules les quatre premire tapes concernent le thme de la prsente tude.
218 219
Cette tape a t prsente au chapitre 4.4.2. Elle ne sera pas reprise ici Cette tape est aussi appele projet de mise lenqute publique
laboration du projet selon les normes suisses
155
Voici les dtails principaux des tapes dlaboration du projet selon les normes suisses :
Etape de projet Contenu Objectifs
- Examen de lopportunit du projet (preuve du besoin et de la faisabilit) - Compatibilit avec la lgislation sur la protection de lenvironnement - Respect de la planification selon la loi sur lamnagement du territoire - Dtermination des zones rserves - Inscription dans les programmes pluriannuels
Bases
- Expos sommaire du problme - Examens pralables ventuels - Planifications gnrales - Concepts et inventaires existants - Plans et prescriptions en vigueur relatifs loccupation du sol - Objectifs et contraintes
Prestations
- Collecte des donnes et analyse de la situation, des objectifs et des contraintes - Type douvrage et rgime de circulation - Gnration de variantes - Choix de variantes - Evaluation sommaire des cots - Information de la population en cas de participation publique - Analyse de la situation - Liste des objectifs et des contraintes
Etude de planification
- Choix dfinitif des variantes - Coordination - Consultation et examens pralables
- Etude de planification - Complments relatifs la problmatique, aux objectifs et aux contraintes
- Etablissement de lavantprojet des variantes retenues - Examen approfondi des variantes restantes - Rapport dimpact prliminaire - Devis estimatif
Avant-projet
- Compatibilit avec la lgislation sur la protection de lenvironnement - Respect de la planification selon la loi sur lamnagement du territoire - Acquisition des terrains de gr gr - Inscription dans les plans financiers et excution de travaux prliminaires - Mise lenqute publique - Rsultats des tapes de projet prcdentes, en particulier de lavant-projet
Projet dfinitif
- Information et participation de la population concerne - Approbation du projet - Octroi dautorisations spciales et du financement - Concordance avec les plans daffectation - Examen de la compatibilit environnementale - Dtermination des alignements
- Approfondissement de la variante retenue - Plans dutilisation et plans de scurits spcifiques louvrage - EIE (si ncessaire) - Planification de lamnagement paysager daccompagnement - Devis gnral
Tableau 19
Contenus principaux des tapes de projet (Selon tab. 1, VSS, SN 640 026)
La norme SN 640 026 indique pour chaque tape les objectifs et les activits du projeteur, avec leur degr dlaboration. Elle se soucie aussi de comment y associer les dcideurs et la population concerne.
156
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
4.5.2
tude de planification
Ltude de planification a pour objectifs de : (Art. 3, VSS, SN 640 027) Examiner lopportunit du projet Il sagit de fournir la preuve du besoin, qui est la source de limpulsion du projet, et de la faisabilit. La pertinence du projet vis vis des besoins en circulation, des possibilits de financement, de lenvironnement, de lamnagement du territoire et de la faisabilit technique doit tre analyse. Les objectifs atteindre sont fixs dans cette tape Prparer les bases pour le choix des variantes Les critres qui interviendront dans lanalyse des variantes sont dfinir, en fonction des objectifs et des contraintes Inscrire le projet dans les programmes pluriannuels contrler la compatibilit avec les lgislations sur lenvironnement et la planification de lamnagement du territoire
Informer la population concerne par le projet
La norme prcise le cas chant , mais comme il sera montr plus en avant dans cette thse, cette tche est essentielle et doit sappliquer lors de ltude de planification Le rsultat de ltude de planification est en gnral le choix dune variante optimale avec la preuve correspondante de la justification du besoin et de la faisabilit . (VSS, SN 640 027) Cette phase est donc essentielle, car elle dtermine les dimensions principales du projet routier. Les phases suivantes (avant-projet et projet dfinitif) ne sont en fait quun approfondissement des rsultats obtenus dans cette tude de planification.
4.5.3
Avant-projet
Lavant-projet a pour objectifs de : choisir dfinitivement un trac si cela na pas t ralis auparavant assurer la coordination entre la construction, lexploitation et la maintenance consulter les autorits et informer le public si ceci est prvu contrler la compatibilit du projet avec les lois environnementales ou les plans directeurs de lamnagement du territoire dterminer les cots du projet afin de pouvoir linscrire dans les plans financiers
Ltude de planification telle quelle prsente par les normes suisses est assez pousse : on y tablit les variantes et on les choisit. La diffrence entre cette tape et lavant projet nest pas vidente tablir, lavancement de ltude de planification pouvant tre variable (choix dune variante optimale ou de plusieurs variantes traiter).
Exemples de procdures particulires
157
4.5.4
Projet dfinitif
Dans le projet dfinitif, la variante retenue lissue de lavant-projet est labore en profondeur avec les dimensions des ouvrages dart ainsi que toutes les caractristiques des lments ncessaires sa ralisation. Le projet dfinitif a pour objectifs de : servir de base la mise lenqute publique. Selon le degr de participation publique adopt auparavant, le public nest parfois inform des caractristiques du projet que lors de cette tape. Son intervention est aussi faible, seule une partie de ce public ayant la capacit de modifier le projet en formulant une opposition faire approuver le projet par les diffrents services administratifs et le public obtenir les crdits de construction de linfrastructure routire prparer lappel doffres tablir le devis gnral avec un cot de ralisation estim 10 % prs tablir les plans dutilisation et de scurit du futur ouvrage
4.6
E XEMPLES DE PROCEDURES PARTICULIERES
Trois procdures particulires concernant des infrastructures dimportance en Suisse et en France sont prsentes ici afin dillustrer plus concrtement les aspects procduraux des projets routiers.
4.6.1
Routes nationales suisses
Comme prcis dans larticle 1 de la Loi sur les Routes nationales, (LRN, 1960) Les voies de communication les plus importantes prsentant un intrt pour la Suisse en gnral seront dclares routes nationales . La procdure de planification des routes nationales suisses est prsente la page suivante. (CGCN, 1997) Les remarques suivantes peuvent tre tablies au sujet de cette procdure particulire : Le dbat sur lintrt gnral du projet a t ralis par lAssemble Fdrale la fin des annes 1950. Un plan directeur (PD) a alors t tabli en parallle de la mise en vigueur de la LRN et adopt en juin 1960. Ce plan directeur, qui a maintenant prs de 40 ans, sert de point de dpart aux diffrents projets autoroutiers raliss en Suisse. Il na t que lgrement modifi (travaux de la Commission Biel qui concernaient quelques tronons)220 depuis son tablissement, malgr le fait quen prs de quatre dcennies la mobilit et les attentes de la population aient fortement volus.
220
Les travaux de cette Commission Biel sont aussi prsents au chapitre 7.1, page 223
158
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
Collaboration des services fdraux concerns
Plan directeur
Collaboration des services cantonaux concerns
Ralis par l'ancien Service des routes et des digues (actuel OFROU)
Approuv par le Parlement sur proposition du CF Collaboration des services fdraux concerns : - OFAT (prise de position) - OFEFP (prise de position sur EIE, degr 2) - AFF (prise de position)
Projet gnral
Collaboration des services cantonaux concerns :
- ponts et chausses - amnagement du territoire - protection de l'environnement - protection des eaux et des forts - tourisme - transports et nergie - circulation et navigation - amliorations foncires - monuments historiques et archologie
Ralis par les cantons et soumis l'OFROU (inverse de la LRN)
Soumis aux communes et propritaires fonciers (consultation) Soumis l'approbation du CF
(EIE, degr 2)
Collaboration des services fdraux concerns
Projet dfinitif
Collaboration des services cantonaux concerns :
- ponts et chausses - amnagement du territoire - protection de l'environnement - protection des eaux et des forts - tourisme - transports et nergie - circulation et navigation - amliorations foncires - monuments historiques et archologie
Prise de position de l'OFEFP sur EIE, degr 3
Ralis par les cantons
Soumis l'OFROU Autorisation de dfrichement de l'OFEFP
(EIE, degr 3)
Mise l'enqute publique
Dcision du gouvernement cantonal (selon droit cantonal)
Soumis l'approbation du DETEC
Projet de dtail (soumission)
Soumis l'approbation du DETEC
Ralisation
Figure 33
tapes de la planification des routes nationales (CGCN, 1997)
Exemples de procdures particulires
159
Ainsi, pour les routes nationales suisses, le projet est justifi sur la base dun plan directeur qui est fig, malgr lvolution de la socit. De plus, il nest men aucun examen dopportunit du projet avant llaboration des projets gnraux, ce qui ne donne que peu darguments solides pour justifier de lintrt du projet vis--vis de ses dtracteurs. Le principal argument avanc est gnralement le fait que le plan directeur a t approuv par les Chambres fdrales,221 ce que Bassand dsigne par le terme de lgitimation verticale Louvrage de Bassand et de Veuve qui traite de la mise en uvre de la politique des routes nationales suisses, sujet abord au chapitre 3.3.2.2, donne des prcisions sur la ralisation de ce plan directeur. Il a tabli par une Commission de planification compose dune trentaine de techniciens et de hauts fonctionnaires. Le rapport final de cette commission qui a travaill de 1954 1959 dfinissait un rseau routier national qui, quelques dtails prs, est exactement le mme que celui du plan directeur. Pour la ralisation du plan directeur des routes nationales, le pouvoir politique, qui na que trs peu modifi le rapport final de la commission,222 a donc perdu de son importance face aux experts et aux techniciens largement majoritaires dans celle-ci. De plus, Bassand souligne le fait que la dmarche dtude adopte par la Commission de planification ne fut pas celle de louverture et de la transparence . Les aspects de la technique routire et du trafic ont ainsi t largement dterminant dans llaboration du plan directeur, ceci au dtriment de lamnagement du territoire, de lenvironnement et des conditions locales. Ce plan directeur dessence technique portait ainsi en lui les germes des contestations du rseau autoroutier observes en Suisse partir de la fin des annes 1960 (Bassand M., Veuve L. et al., 1986) Les travaux de la CGCN mens entre 1994 et 1997223 ont mis en vidence diffrents facteurs de blocage de cette procdure. Il a notamment t soulign le fait que lorsque deux intrts publics taient en contradiction, le dsaccord entre les services fdraux concerns se rglait devant la justice. Dsormais, la pese des intrts est ralise au sein de ladministration dans un dlai dun mois et laccord ainsi obtenu lie les parties. (Art. 62b, LF, 1999)224 La problmatique de lautorisation de dfrichement accorde par lOFEFP aprs la mise lenqute publique et qui servait de support des recommandations dpassant le simple cadre des forts est ainsi rgle
221 222
Celui-ci na cependant pas t accept par le peuple (Bassand M., Veuve L., et al., 1986) Au dbut des annes 1960, il apparat urgent de commencer raliser le rseau des routes nationales suisses en raison de laugmentation des charges de trafic et du retard pris sur les rseaux autoroutiers des pays voisins. Les autoroutes deviennent ainsi une tche prioritaire et dimportance nationale qui nest que peu conteste. Ceci explique les faible modifications apportes par les Chambres fdrales aux propositions de la Commission de planification (Bassand M., Veuve L., et al., 1986)
223
Cette commission ralis une inspection en relation avec la mise en uvre de la politique des routes nationales pour rpondre trois questions : - pourquoi le rseau des routes nationales nest pas ralis dans les dlais et pour les cots prvus ? - pourquoi le cot des constructions des routes nationales sont plus levs en Suisse qu ltranger ? - quels sont les effets socio-conomiques des retards de la construction des routes nationales sur le dveloppement des rgions desservies ? Les travaux de la CGCN se sont finalement essentiellement concentrs sur la premire question. (CGCN, 1997) On peut se rfrer aussi au chapitre 3.3.1, page 115 qui parle de la CORE (commission de recours indpendante de l'administration)
224
160
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
La procdure comporte deux dcideurs : le Canton qui ralise le projet gnral et le projet dfinitif et la Confdration qui les approuve. Ceci ncessite la coordination de nombreuses administrations (amnagement du territoire, environnement, transports, etc.) situes au niveau fdral et cantonale, ce qui complique et allonge fortement la dure du processus (Bassand M., Veuve L. et al., 1986) Le projet gnral, qui correspond ltude de planification, revt une grande limportance au sein du processus dlaboration du projet. Ceci est soulign par la CGCN qui recommande :
Le Conseil Fdral est invit prendre des mesures visant revaloriser le projet gnral pour en faire un vritable instrument de planification et doptimalisation. Tous les partenaires associs au projet seront appels participer son laboration, si possible sous la tutelle dun organe de coordination (page 27, CGCN, 1997)
4.6.2
Grands projets dinfrastructures en France
La procdure dlaboration des grands projets dinfrastructures (autoroutes, routes nationales dimportance) raliss en France est prsente la page suivante. (Ministre de l'Equipement, 2000) Les remarques suivantes peuvent tre tablies au sujet de cette procdure particulire :
Un dbat ouvert prcde le projet routier proprement dit. Ce dbat associe les responsables politiques, sociaux, conomiques et associatifs et il est dirig par un prfet coordonnateur. Mme si ce dbat reste un peu formel, il est intressant car il permet chaque partie de se prononcer avant le dbut de ltude. De plus, ce dbat permet de mieux justifier lintrt du projet Un cahier des charges rsumant le dbat initial est tabli par le gouvernement. Ce document prcise les objectifs attendus pour la future infrastructure routire Une commission de suivi des dbats est charge dassurer la continuit entre le dbat initial et les tapes suivantes, notamment ltude dlaboration du trac Les dmarches dlaboration du trac sont identiques celles observes en Suisse Le dcret dutilit publique est un puissant outil au service du dcideur car aprs sa publication, il ny a plus de contestation possible. Il est cependant soumis lapprobation du Conseil dEtat qui peut le refuse, comme cela a t le cas pour la A 400 Annemasse Thonon Une publication des engagements de lEtat est ralise la fin des travaux. Le respect de ces engagements est ensuite vrifi par la commission de suivi en cours de ralisation
Exemples de procdures particulires
161
1. Dbat sur l'intrt conomique et social du projet
Grandes fonctions de l'infrastructure Approche intermodale
Dbat entre M.O. et acteurs politiques, sociaux, conomiques et associatifs Commission de suivi du dbat, expertises externes Cahier des charges publi par le gouvernement
Comparaison des variantes
2. Elaboration du trac
Publication des tudes
Choix d'une variante de trac
Perspectives d'amnagement local lies au nouveau trac en partenariat avec les collectivits territoriales
Commission de suivi du dbat, expertises externes
Dbat entre M.O. et acteurs politiques, sociaux, conomiques et associatifs
Avis de la population concerne, sous la responsabilit des commissaires enquteurs
Avis des commissaires enquteurs et publication des conclusions de l'enqute publique
3. Utilit publique
Publication des engagements de l'Etat Dcret d'utilit publique D.U.P. Avis du Conseil d'Etat
Recueil des avis avant la ralisation de la route
Suivi de la mise en oeuvre des engagements de l'Etat (prfets et comit de suivi)
4. Ralisation des travaux
Rapports priodiques du M.O. au comit de suivi
5. Bilan aprs la mise en service
Evaluation des rsultats obtenus au regard du cahier des charges et des engagements de l'Etat
Evaluation des effets socio-conomiques et des impacts sur l'environnement Comparaison avec les perspectives labores lors de la D.U.P.
Publication du rapport du comit de suivi
Figure 34
Procdure dlaboration des grands projets dinfrastructures en France
4.6.3
Autoroutes concdes en France
La procdure dlaboration des autoroutes concdes en France est prsente la page suivante. (Ministre de lquipement, 2000) Les remarques suivantes peuvent tre tablies au sujet de cette procdure particulire : Elle comporte deux dcideurs (tat central et le concessionnaire). Cependant, compar aux routes nationales suisses, ces deux dcideurs interviennent successivement et non pas contradictoirement Les diffrentes phases dtude sont prcises par la largeur des fuseaux successifs Il existe aussi une publication des engagements de lEtat et un dbat initial entre les diffrents acteurs
162
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
1. Etudes prliminaires
Zone d'tude large de 10 20 km
Recueil des donnes techniques, conomiques et environnementales Choix d'un fuseau de 1 km (dcision ministrielle)
Synthse des perspectives d'amnagement local en partenariat avec les collectivits territoriales Dbat entre M.O. et acteurs politiques, sociaux, conomiques et associatifs Comparaison des variantes de fuseau de 1 km
2. Avant-projet sommaire A.P.S.
Fuseau de 1 km
Recueil des donnes techniques, conomiques et environnementales Approbation ministrielle du dossier d'A.P.S.
Gnration de variantes de bandes de trac de 300 m de large (collaboration avec experts indpendants) Etude plus prcise de la bande choisie et des impacts Synthse des perspectives Choix d'une bande de 300 m + changeurs
Enqute pralable la dclaration d'utilit publique Etude d'impact sur l'environnement Etude des effets socio-conomiques
Sur la bande de 300 m de largeur
4. Dclaration d'utilit publique D.U.P.
Sur la bande de 300 m de largeur
Dcret du Premier Ministre aprs avis du Conseil d'Etat
5. Concession de l'autoroute
Publication des engagements de l'Etat
Procdure dconcentre : socits d'autoroutes
6. Avant-projet autoroutier A.P.A
Etude du trac prcis de l'autoroute Dfinition gomtrique de l'emprise, des ouvrages d'art, des changeurs, etc.
7. Ralisation de l'autoroute
Acquisitions foncires Attribution des travaux Excution des travaux Suivi des engagements de l'Etat
8. Mise en service de l'autoroute
Avec valuation des rsultats
Figure 35
laboration du trac et ralisation dune autoroute concde en France
Procdure mene l'chelon central : Etat - Direction des routes
3. Enqute publique
Analyse critique des mthodologies existantes
163
4.7
A NALYSE CRITIQUE DES METHODOLOGIES
EXISTANTES
A la lecture des procdures prsentes auparavant, on peut effectuer les remarques suivantes :
Examen de lopportunit
Compar la procdure pour les routes nationales suisses, la procdure franaise accorde plus dimportance cette phase, en la liant avec une tude des effets prvus. Ceci sexplique par le fait que le besoin nest pas directement prouver en Suisse, vu que le plan directeur a t approuv par les Chambres Fdrales. Le fait de ne pas raliser un examen dopportunit au dbut du projet peut fortement perturber son droulement. En effet, en cours dtude, il arrive frquemment que la question de la justification ou non de linfrastructure routire soit pose par lun des acteurs prsents. Si un examen dopportunit a t ralis auparavant, le dbat est vite tranch car les rponses aux questions adresses sont prsentes. Si, par contre, ce nest pas le cas, les rponses apporter cet acteur sont dterminer dans lurgence et en dcalage avec la procdure. Ainsi, faire lconomie dun examen dopportunit nest finalement pas un bon choix car si celui-ci peut tre limin en dbut de procdure, il risque fortement de rapparatre ensuite. En voulant ainsi le cacher, on ne le fait que mieux surgir par aprs. Cest typiquement ce qui a t observ dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 , la justification de la A 144 tant lobjet de dbats rcurrents en cours dtude. Si un examen dopportunit solide avait t ralis auparavant, ces questions ne se seraient pas poses ou tout du moins auraient eu une rponse rapide et indiscutable
Complexit
Les procdures sont parfois trs complexes, utilisent des termes abscons et certaines tapes se recoupent. Il est par exemple trs difficile de nettement sparer ltude de planification de ltape de lavant-projet au sein de la procdure dlaboration des projets propose par les normes suisses. Cette complexit peut drouter le public car il est parfois difficile de traiter un projet intervalles successives. Pour les routes nationales suisses, la procdure est trop lourde, trop lente et manque totalement de transparence (CGCN, 1997)
Dmarche politique
La complexit de certaines procdures tend multiplier les expertises, les rapports, les tudes complmentaires, etc. (Veuve L., 1994) Cet accroissement de la technicit du projet a pour effet dvacuer les aspects subjectifs de ltude et de rduire la dimension politique lie au projet. Cet tat de fait nest pas imputable quaux techniciens dsireux daccrotre leur participation dans ltude du projet mais aussi aux autorits politiques voulant liminer la part de la subjectivit dans leurs actes, de manire assumer au minimum les risques inhrents toute prise de dcision
164
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
Libert du projeteur
Les procdures sont assez strictes quant au droulement de certaines tapes. Ceci peut tre prjudiciable au projeteur qui doit adapter son projet un contexte socio-conomique voluant parfois plus vite que ladaptation de la loi
Dmarche linaire
Mme si des rtroactions sont envisageables dans les procdures, force est dadmettre quelles adoptent une dmarche fortement linaire o chaque tape conditionne la suivante jusquau rsultat final. Cette dmarche postule que le problme peut tre dfini clairement au dbut de ltude puis la solution peut alors tre recherche. Cependant, comme le dit Veuve, la dfinition du problme et la recherche de solutions sont des actions concomitantes et non successives. (Veuve L., 1994)
Ressemblance
Des termes se retrouvent dans de nombreuses procdures, comme avant-projet. Ceux-ci ne concernent pas forcment les mmes travaux dtude.
Projet dfinitif et projet gnral
La procdure dlaboration des projets de routes nationales suisses comporte une phase dite dfinitive qui nen nest pas une. En effet, cette phase se clt par la mise lenqute publique, lment pouvant apporter dimportants changements dans le projet. Le corollaire de cet tat de fait est que le projet gnral est dvaloris. Il est ncessaire de lui redonner de limportance pour en faire un vritable outil de planification. Lensemble de acteurs concerns est associer la ralisation du projet gnral, ce ds le dbut de ltude. Un organe de coordination est aussi organise en parallle (CGCN, 1997)
Participation des acteurs
Certaines procdures ne prvoient leur intervention qu la fin du processus, ou que dune manire rgule. (Bassand M., Veuve L. et al., 1986) On parle, dans le cas des routes nationales, dune procdure peu participative . La norme SN 640 026 ne prvoit quune faible participation du public lors de phases dtude bien particulires. Cette intgration apparat bien tardive et seule une information, voire une consultation, est prconise. La concertation nest que peu traite Les remarques concernant la procdure utilise dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 ont t effectues au chapitre 2.8.4. On peut prciser par rapport aux remarques prcdentes que les tudes menes en 1999 au sujet de la A 144 correspondent aux tapes dtude de la planification et davant-projet. Il reste dsormais tablir le projet dfinitif de cette infrastructure.
Propositions
165
4.8
P ROPOSITIONS
Lexamen de la procdure utilise en Suisse et des procdures franaises montre que des amliorations du processus sont possibles. Une question se pose alors : Est-
il ncessaire de proposer une autre procdure pour llaboration du projet routier telle que nous la connaissons en Suisse actuellement ? La rponse cette question nest pas
vidente et peut tre double : on peut proposer une procdure dtude du projet routier qui soit nouvelle et ceci sans tenir compte de ce qui existe on peut partir des procdures existantes que lon amliore par des apports ponctuels destins certaines tapes de celles-ci
Lauteur a opt pour la seconde rponse, car proposer de grandes modifications de la procdure consiste en fait proposer des modifications lgislatives importantes. Ceci est une tche qui concerne plutt le domaine juridique et dpasse le cadre de cette thse. Par consquent, le cadre lgislatif et procdural ne fera pas lobjet de propositions. Par contre, la faon dvoluer au sein de ce cadre225 (les outils et mthodes de travail) fera lobjet de propositions, rsume en une mthodologie concertative.
Postulat 40
La thse ne propose non pas un nouveau cadre dlaboration du projet mais plutt une manire optimale dutiliser la procdure existante
La mthodologie concertative propose se basera sur une dmarche itrative qui a les caractristiques suivantes : les diffrentes tapes dlaboration sont ralises successivement tel que dfini auparavant au chapitre 4.4. la fin dun processus dlaboration par tapes, il y a une discussion qui porte sur la ncessit de raliser une nouvelle itration, labandon du projet ou lacceptation des rsultats obtenus les itrations successives vont de plus en plus dans le dtail. Si dans une premire itration, le projet est dgrossi et les solutions esquisses afin davoir une ide gnrale sur le projet, dans une seconde itration, le projet analysera par exemple quelques variantes pour finalement ne comparer plus que deux variantes dans une itration finale. La dfinition du cadre de ltude est typiquement une tape qui se modifie au fur et mesure des itrations en se restreignant de plus en plus226
225
Il sagit dadjoindre une huile de qualit pour dgripper le mcanisme du projet et le rendre plus efficace (CGCN, 1997) La rdaction du prsent rapport de thse est aussi un lment de dmarche itrative directement exerc par lauteur. A des rflexions initiales poses sur une simple feuille, lon passe une deuxime itration o la structure
226
166
LELABORATION DU PROJET ROUTIER
quand une tape est clairement dfinie dans une itration (la formulation des objectifs par exemple), elle peut tre affine, modifie ou simplement lude dans litration suivante. Les rsultats quelle a obtenu ne sont pas ignors mais ils ne sont pas intangibles
La dmarche itrative permet de considrer ds le dbut du projet une multitude dlments ou dopinions en ouvrant la dmarche. On peut alors parler de dmarche concertative ouverte ou de planification ouverte. Dans cette tude, le terme de mthodologie concertative sous-entendra une ouverture du processus. Des premiers lments de rponse sont ainsi rapidement disponibles et permettent ensuite doptimiser les tudes sur les points vraiment intressants analyser. Cette dmarche demande un rel changement de paradigme pour le projeteur et le dcideur qui doivent accepter de discuter sur des lments non aboutis ou des tudes inacheves. De plus, la contestation de leurs travaux peut arriver rapidement au dbut de ltude, ce qui nest pas forcment ngatif car une remise en question saccompagne parfois de propositions dautres solutions.
Postulat 41
Llaboration dun projet stablit par itrations successives
Les principes de la dmarche itrative et de la mthodologie concertative actualise seront prsents dans le chapitre 9. Base sur le processus dlaboration du projet routier, la dmarche concertative reprendra les principes suivants : conserver la procdure gnrale pour llaboration dun projet routier telle quelle est prsente dans les normes suisses y ajouter les tapes intressantes des procdures particulires approfondir les tapes qui restent sommaires dans leur droulement prciser les outils adquats certaines phases cruciales indiquer les acteurs intgrer, et comment les intgrer, dans chaque tape modifier le droulement des tapes qui sont insatisfaisantes laune des cas tudis, des dveloppements techniques relevs et des rflexions personnelles
est prsente sur quelques feuillets pars, puis une troisime itration pose les mots cls autour de cette structure. La quatrime itration habille le squelette par des priphrases, puis des phrases compltes pour finir par des paragraphes entiers. Les nombreuses impressions suivies de lectures et relectures ralises personnellement et par des tiers (je profite de loccasion pour les remercier davoir pass autant de temps lire, comprendre le sens, corriger ou proposer des modifications du texte, qui est un peu le leur en fait) sont autant ditrations successives o le texte est corrig et volue. Ainsi, tel le tamis du chercheur dor, la dmarche itrative permet partir de la gangue dobtenir les ppites du prcieux minerai. Et quand la dernire itration, la dernire tape consiste prendre la dcision de limprimatur, le projet a fortement mri et sest adapt aux multiples changements de cap raliss en cours de route. Tel sujet semblait pertinent au dbut de ltude, celui-ci ne ltait pas et au milieu de ltude, ils ont t considrs ensemble puis la fin, celui qui tait pertinent ne ltait plus tout fait, tandis que celui qui tait ignor rvl sa valeur Cette analogie entre un projet routier et la rdaction dun rapport de thse peut tre ralise avec de nombreuses activits humaines o il est ncessaire de laisser mrir les ides, daffiner progressivement ltude. Dans ces cas, une dmarche linaire progressant tapes par tapes, avec un niveau de ralisation de chacune qui est abouti, nest pas pertinente. La dmarche linaire nest cependant pas totalement exclue des activits humaines. Les essais de laboratoire, les relevs in situ, une lection sont autant de processus o elle se rvle indispensable car l le temps disposition est compt et quil est ncessaire dobtenir rapidement un rsultat, qui est cependant obtenu dans un contexte moins complexe que celui considr par la dmarche itrative
167
5.
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
Comme prcis au postulat 40 la page 165, le principal objectif de cette tude est dtablir une mthodologie de travail actualise qui est surtout destine au projeteur routier.227 Toutefois, il ne faut pas ngliger les autres acteurs du projet routier car leur influence est de plus en plus importante dans llaboration de celui-ci. Lpoque du projeteur routier clair , pouvant valuer et synthtiser isolment lensemble des objectifs et des contraintes relatifs une infrastructure routire, et ainsi rsoudre une problmatique en tenant compte des multiples avis divergents, est dsormais rvolue. On ne peut plus travailler, si lon prtend raliser un ouvrage pour le bien de la collectivit, dune manire individuelle, quelques soient nos qualits. Cette remarque est valable pour lensemble des acteurs, car trop souvent certains prtendent apporter une solution dfinitive une problmatique complexe. Nul ne peut avoir la prtention de matriser lensemble des multiples aspects dun projet, tant la complexit de ceux-ci est grande. On entend par le terme de acteur du projet ,228 ou main participant , (Knoepfel P., 1993) lensemble des individus, des collectivits, des associations et des personnes morales prives ou publiques qui participent llaboration du projet ou qui gravitent229 autour de celui-ci, mme avec un degr de participation nul. En fait, tout acteur du projet a une influence relle ou potentielle sur celui-ci, quelle soit reconnue ou non. Les multiples acteurs ont des cultures techniques, des fonctions et des objectifs diffrents. Il est donc difficile de faire communiquer et se comprendre des acteurs qui voluent dans des schmas de penses distincts ou mme opposs. Dans ce chapitre, lauteur traite deux thmes relatifs aux acteurs du projet routier : classification des acteurs du projet routier identification et caractrisation des rapports existants entre ces acteurs
A la fin du chapitre, les caractristiques (classification et rapports entre les acteurs) des participants (COPIL et GT) du cas de base de la Comparaison de variantes 1999 sont analyses. Cette analyse est effectue de deux manires : tout dabord, une analyse de situation est mene sur la base des rflexions tablies au chapitre 2.8.6 les rsultats des pondrations des membres du COPIL sont ensuite analyss puis catgoriss selon plusieurs profils dacteurs reprsentatifs
227
Dans la littrature, ce projeteur prend parfois le nom de homme dtude . Il sagit du principal acteur qui labore et tudie le projet de manire continue et centrale. Cest gnralement un ingnieur civil Ce terme dacteur du projet fait penser au thtre. Par analogie, on pourrait en effet reprsenter le projet dtude dune infrastructure routire comme tant un spectacle. La procdure est en quelque sorte le scnario type de celui-ci, lenvironnement du projet, cest lhistoire que lon veut faire raconter par les acteurs, les personnes impliques dans le projet On peut aussi parler dans ce cas d acteurs priphriques car ils se trouvent la priphrie de ltude. Ils nen font pas officiellement partie mais ils nen sont pas trs loigns et peuvent donc clairement influencer le projet
228
229
168
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
5.1
I DENTIFICATION DES ACTEURS
5.1.1
Les diffrents acteurs du projet routier
On peut classer les acteurs intervenant dans ltude dun projet dinfrastructure routire dans les catgories suivantes : le dcideur est lautorit politique qui finance la ralisation de linfrastructure et qui en sera le futur propritaire. On le dsigne parfois par le terme dexploitant de la route. Il sagit de lacteur pour lequel est principalement destin le projet. Le dcideur est gnralement un acteur politique du domaine excutif, responsable de ladministration routire. Comme indiqu au chapitre 4.4.2, limpulsion llaboration du projet routier est le fait du dcideur le groupe dtude comprend les acteurs techniques qui laborent le projet routier et prparent des lments daide la dcision pour le dcideur. Son principal acteur est le projeteur routier,230 qui est un ingnieur civil. Celui-ci sentoure de diffrents spcialistes quand apparaissent des problmes quil ne peut pas rsoudre les acteurs administratifs proviennent de diffrents services de ladministration publique. Ils ont pour but de vrifier la conformit du projet dinfrastructure routire avec les lois, les ordonnances, les plans directeurs, etc. Lacteur administratif routier (service des routes, dpartement des ponts et chausses, etc.) est classer dans la catgorie du dcideur le public comprend lensemble des acteurs affects par la future infrastructure routire : riverains, agriculteurs, exploitants forestiers, etc. Une distinction est tablie dans cette tude entre le public qui est affect par les consquences de linfrastructure routire (modifications du cadre de vie, nuisances, emprise, etc.) et le public qui utilise linfrastructure routire et qui en bnficie. Pour la suite de ltude, le terme public dsigne uniquement les acteurs priphriques affects par linfrastructure routire, les bnficiaires tant dsigns par le terme d utilisateurs de linfrastructure les groupes spontans regroupent des acteurs appartenant la catgorie du public affect par une infrastructure routire. Ces acteurs estiment que certaines de leurs proccupations ne sont pas suffisamment prises en compte ou sont ngliges par les institutions politiques, qui sont traditionnellement les relais des aspirations citoyennes. Gnralement, ces regroupements sont phmres et ne survivent que rarement au projet, qui est en quelque sorte leur raison de vivre. Pour la suite de ltude, les groupes spontans seront associs au public affect par linfrastructure routire les utilisateurs de linfrastructure sont les bnficiaires directs ou indirects de la future infrastructure routire : usagers, acteurs conomiques, etc.
230
Dans le cadre de projets de faible envergure ou davant-projets trs sommaires, le projeteur routier peut tre le seul membre du groupe dtude
Identification des acteurs
169
les organisations non-gouvernementales, abrges O.N.G., sont des groupes structurs prennes qui interviennent pour dfendre certaines valeurs environnementales, sociales ou conomiques. Dans cette tude, seules les O.N.G. dfendant des valeurs environnementales seront traites, car ce sont celles qui influencent le plus le projet routier les acteurs politiques sont les membres des pouvoirs excutifs ou lgislatifs qui ne sont pas dans le mme rle que celui du dcideur. Ils peuvent se trouver plusieurs niveaux politiques diffrents (Confdration, canton, district, commune, etc.) situs un degr hirarchique autre que celui du dcideur
Lacteur judiciaire influence fortement le projet routier en intervenant dans les conflits entre les acteurs qui nont pu tre rgls au sein de la procdure. Il ne sera cependant pas trait dans cette tude, car la proposition dune mthodologie concertative et actualise a pour ambition de proposer une procdure dlaboration du projet routier qui permette tous les acteurs dintervenir et daboutir un rsultat de qualit, durable et accept par tous. Dans ce cas, lacteur judiciaire na alors plus de raisons dintervenir.231 Les acteurs techniques chargs spcifiquement des phases de ralisation (entrepreneur, direction des travaux, etc.) et dexploitation de linfrastructure routire (services dentretien, service dexploitation, police, etc.)232 sont aussi des acteurs du projet routier. Cependant, comme indiqu la page 140, ces deux phases du cycle de vie dune infrastructure routire ne sont pas considres dans cette thse de doctorat. Toutefois, on peut postuler que ces acteurs spcifiques ces deux tapes du cycle de vie de la route sont prsents dans la classification tablie ici, soit comme dcideur (futur exploitant, etc.), soit comme acteur administratif (office de police, etc.) ou alors comme spcialiste technique au sein du groupe dtude (service dentretien, entrepreneur, etc.).
5.1.2
5.1.2.1
Intervention des acteurs
Groupe dcideur et groupe dtude
Les diffrents acteurs interviennent dans le processus dlaboration du projet routier sous deux formes possibles, dfinies aux chapitres 8.2.3 (page 256) ou au chapitre 9.4.1.3 (page 346) : soit en appartenant un groupe dcideur qui est un groupe politique, effectuant par exemple la pondration des critres lors de lutilisation dune mthode daide multicritre la dcision soit en appartenant au groupe dtude qui est le groupe technique effectuant, par exemple, la notation desdits critres
Comme il sera prsent au chapitre 8, le travail du groupe dcideur est bas sur des lments subjectifs tandis que celui du groupe dtude est purement objectif. Pour cette raison, une parfaite indpendance doit tre assure entre le groupe dtude
231
Cette affirmation pourrait tre infirme dans le cas o un consensus serait obtenu sans que le respect de certaines lgislations soit ralis (dpassement de valeurs limites admis par lensemble des acteurs prsents par exemple). Cependant, la prsence de lacteur administratif, charg de veiller au bon respect des lois, parmi le groupe dcideur minimise fortement ce risque On peut se rfrer au chapitre 4.2.1, page 138, pour ces deux phases succdant ltude du projet routier
232
170
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
et le groupe dcideur : aucun acteur ne peut tre prsent simultanment dans les deux. La seule exception est constitue par le projeteur ou un spcialiste venant exposer au groupe dcideur des aspects particuliers des travaux raliss par le groupe dtude. Dans des projets de faible envergure ou lors dune phase initiale de llaboration du projet, seul deux acteurs peuvent tre prsents : le dcideur et le projeteur routier. Ensuite, au fur et mesure de lavancement du projet, de nombreux acteurs viendront se greffer autour de ce binme de base.
5.1.2.2
Reprsentativit des acteurs
Le dcideur et le projeteur doivent identifier et dbusquer les acteurs du projet au dbut de ltude. (Bassand M., 1998). En oublier un peut tre prjudiciable, car dans ce cas il subsiste un risque de ne pas traiter correctement certains aspects du projet. La principale difficult de cette tche didentification des acteurs rside dans le fait que parfois des acteurs influents veulent rester dans lombre afin de mieux pouvoir tirer les ficelles du projet et ne pas avoir sexposer la critique ou expliquer leurs objectifs. Il est donc ncessaire dviter dutiliser des acteurs paravents ou marionnettes au sein du projet. Les acteurs influents, les leaders dopinion, doivent tre prsents. Si ce nest pas le cas, les rsultats obtenus par le groupe dcideur risquent de ne pas tre valids par les composantes du public.
Postulat 42
Les acteurs influents doivent tre intgrs dans le projet afin de valider les rsultats obtenus
Il est ncessaire dintgrer dans le processus dlaboration du projet routier des acteurs reprsentatifs. Un acteur participant au processus dtude doit tre lgitim par les intrts ou le groupe quil reprsente. Ceci permet de sassurer de la conformit de ses positions avec les idologies du groupe qui le dlgue. Cette lgitimation est obtenue par la fonction occupe au sein dun groupe ou dune collectivit (porte-parole, prsident, etc.), par le vote de confiance obtenu auprs de ses pairs ou par les qualits professionnelles reconnues de cet acteur. Cependant, selon lhomognit des positions au sein des associations reprsentes et du leadership de cet acteur, sa reprsentativit peut tre difficile assurer.
Postulat 43
Il est ncessaire dinclure dans le processus dlaboration du projet routier des acteurs reprsentatifs et lgitims
Il faut viter que les acteurs napparaissent qu la fin du processus. Ceci leur laisse une sensation dtre un acteur alibi devant donner un avis sur un projet prendre ou laisser. De plus, une modification de projet amene par des remarques pertinentes de la part dun acteur est moins coteuse lamont de celui-ci. Mais chaque acteur doit tre conscient quil ne lui sera peut tre pas demand dintervenir pour chaque phase du projet, soit quil ne sagisse pas dune phase o son intervention est ncessaire, soit que le domaine trait ne le concerne pas.
Identification des acteurs
171
5.1.2.3
Composition du groupe dcideur
Pour que les rsultats de ltude soient ralistes et accepts par tous, il est indispensable que lensemble des acteurs politiques concerns par le projet soient intgrs dans le groupe dcideur. La composition dun groupe dcideur fonctionne selon un principe itratif. Une premire liste de participants est ralise par le dcideur, qui peut se baser sur une liste dacteurs types intgrer doffice dans le processus. Lors de la premire sance de travail du groupe dcideur, il est demand aux acteurs prsents sils estiment ncessaire dintgrer dautres acteurs. Aprs dbat, le groupe dcide des modifications apporter sa composition. Ces nouveaux acteurs amnent aussi leurs propositions qui sont rediscutes, ceci jusqu obtenir une liste dfinitive des participants. Il est ncessaire de disposer de suffisamment dacteurs reprsentatifs, mais il faut toutefois veiller ne pas intgrer un nombre si important dacteurs que les travaux du groupe dcideur en viennent limiter le temps de parole de chacun. Les acteurs doublons, inutiles ou alibis sont viter car ils alourdissent inutilement les travaux du groupe. Les acteurs politiques doivent tre prsents tout au long du processus dtude pour pouvoir correctement analyser les rsultats techniques.
5.1.2.4
Composition du groupe dtude
La composition du groupe dtude est par contre dcide par le projeteur et ne fait pas lobjet dun dbat. Un spcialiste est mis contribution quand un problme que le projeteur ne peut rsoudre apparat. Ces spcialistes peuvent tre prsents durant toute llaboration du projet routier ou napparatre qu certains moments de celuici.
5.1.3
Le dcideur
Le dcideur est lautorit politique qui revient principalement la prise de dcision en regard dun projet. (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) Cest lui qui donne limpulsion llaboration du projet. Il finance la ralisation de linfrastructure233 et en est le futur propritaire. II ne faut pas confondre le dcideur avec le groupe dcideur tel que dfini au chapitre 9.4.1.3, page 346. Ce dernier comprend le dcideur proprement dit mais aussi lensemble des acteurs susceptibles de jouer un rle politique au sein du projet routier. Gnralement, le dcideur est lacteur politique dirigeant ladministration publique en charge de la politique publique routire. La problmatique de laide la dcision, qui est spcifiquement destine au dcideur, est approfondie dans le chapitre 8, notamment aux chapitres 8.2.3 (acteurs de laide la dcision) et 8.2.5 (facteurs dinfluence dune dcision).
233
Comme il a t montr auparavant, dans certains cas le dcideur ne finance que trs partiellement linfrastructure routire (cas des routes nationales suisses o le dcideur cantonal ne paye que 3 20 % du cot de ralisation, le reste tant pay par la Confdration). Ceci comporte des risques, car le dcideur est ainsi moins enclin trouver des conomies dans son projet. Dans le cas de la A144, trois acteurs constituaient le dcideur : le reprsentant de lOffice fdral des routes (OFROU) et les deux conseillers dEtat responsables du DINF et du DTEE
172
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
5.1.4
Le groupe dtude
Le dcideur doit appuyer sa dcision sur des lments fournis par des spcialistes du domaine. Ceux-ci sont runis dans le groupe dtude qui constitue la cheville ouvrire du projet et qui comprend des acteurs techniques de deux types :
Projeteur routier
Le projeteur routier est un ingnieur civil qui a un rle central dans ce groupe dtude quil dirige et manage. Il doit tre capable dintgrer au mieux les multiples aspects des infrastructures routires et doit possder un excellent esprit de synthse. De plus, il se doit de possder une large culture technique afin de pouvoir communiquer avec lensemble des acteurs, quils soient dessence technique (dans ce cas, le projeteur doit possder une bonne culture gnrale technique) ou non (dans ce cas, le projeteur doit tre un bon vulgarisateur). Il est mandat par le dcideur et possde donc avec cet acteur une relation diffrente, car contractuelle, davec les autres acteurs du projet routier
Spcialistes techniques
Quand le projeteur routier ne peut rsoudre certains problmes spcifiques, il fait appel des spcialistes techniques. Contrairement au projeteur qui est prsent tout au long du processus dlaboration du projet routier, les spcialistes techniques peuvent napparatre que lors de certaines phases spcifiques. Le lien entre les diffrents acteurs techniques est assur par le projeteur routier. De nombreux spcialistes techniques peuvent intervenir dans le projet routier, comme :
-
cologue ou biologiste : problmatique de la faune ou de la flore gologue ou hydrogologue : connaissance du sous-sol ingnieur rural, pdologue, forestier sylviculture ou agronome : agriculture, sols,
ingnieur en ventilation ou lectricit en cas douvrage souterrain ingnieur en lectromcanique ingnieur de trafic amnagiste, paysagiste ou urbaniste architecte exploitant de la future infrastructure routire entrepreneur etc.
Des acteurs non techniques peuvent tre intgrs dans le groupe dtude selon les conditions de participation publique dsire pour le projet :
-
spcialiste de la communication mdiateur sociologue etc.
Identification des acteurs
173
5.1.5
5.1.5.1
Le public
Prambule
Ce chapitre est inspir de louvrage de P. Andr qui traite des acteurs dans les tudes dimpact sur lenvironnement. (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) Celui-ci ne sera donc pas systmatiquement rfrenc ici. Le public dun projet dinfrastructure routire se compose des acteurs suivants : les acteurs bnficiaires appuyant le projet ou en tirant indirectement un bnfice. Ils sont aussi dsigns par le terme dusagers les acteurs affects qui subissent les inconvnients directement lis sa ralisation. Il sagit par exemple des riverains dune route. Les acteurs qui ne subissent pas directement les effets du projet mais qui pourraient subir des consquences indirectes font aussi partie de cette catgorie les acteurs intresss qui ne sont pas affects par le projet mais qui dfendent des valeurs en conflit avec celui-ci les acteurs passifs qui ne sont pas affects par le projet et qui ne se sentent pas concerns par celui-ci234
Vis--vis dune problmatique donne, le public peut adopter plusieurs attitudes : il peut tre latent et se composer des individus concerns par un problme commun il peut tre averti et regrouper les individus concerns par un mme problme et conscients de la situation il peut tre actif et se composer des individus concerns par un mme problme, conscients de la situation et qui agissent de manire le rsoudre
Le public peut passer dune catgorie lautre ou modifier son attitude vis--vis du projet de manire trs rapide. Comme prcis auparavant, dans cette tude, le public sera class en deux catgories : le public, qui comporte les acteurs affects par linfrastructure routire de manire positive ou ngative, les groupes spontans, les acteurs intresss et les acteurs passifs les utilisateurs de linfrastructure qui sont les acteurs bnficiaires de la route
Postulat 44
On distingue deux types de public dans le cadre dun projet dinfrastructure routire : le public, qui peut tre affect, intress ou passif, et les utilisateurs de linfrastructure qui en tirent un bnfice
234
Dans de nombreux cas, il sagit de la catgorie de population la plus nombreuse
174
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
Les organisations non-gouvernementales peuvent tre intgres dans le public235 car elles dfendent souvent les mmes intrts et partagent les mmes proccupations que de nombreux citoyens ou groupes spontans. Lauteur prfre cependant les traiter comme un acteur diffrent, notamment dans la partie de ltude consacre aux mthodes de participation publique, une diffrenciation doit souvent tre ralise selon que lon sadresse des individus ou des associations.
5.1.5.2
Intrts dfendus dans l'espace et le temps
Les acteurs affects ou intresss adoptent une position dans un plan espace-temps en relation troite avec les intrts qu'ils dfendent. Lespace dsigne l'aire d'influence, le rayon d'action de chacun. On peut le dcomposer en couches successives telles que les limites du corps (1 m), une pice (3 7 m), la proprit (10 m), la rue (100 m), le voisinage (1000 m), la rgion, la nation, voire l'espace international. Le temps se dfinit plutt comme tant l'intervalle temporel dont les personnes et les groupes tiennent compte lors de leurs interventions. Il peut tre court terme (quelques annes), moyen terme (une dcennie) et long terme (une gnration).
Espace
(m)
1 000 000 100 000 10 000 1 000 100 10 1 0,1 Type A Type B Type C
INTresss
Affects
Temps (terme)
court moyen long
Type A : individus et groupes spontans Type B : groupes structurs locaux et internationaux Type C : groupes rgionaux, nationaux, et internationaux
Figure 36
Positionnement des acteurs en fonction de lespace et du temps considr (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
Les proccupations du public ne sont pas constantes au cours du cycle de vie dune infrastructure routire. Elles voluent en fonction de la connaissance du problme, de la confiance envers le dcideur et des rsultats obtenus. P. Andr a dfini ainsi un cycle de proccupation (awareness cycle) en cinq phases. (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
235
P. Andr classe les O.N.G. dans la catgorie public
Identification des acteurs
175
Les cinq phases de ce cycle des proccupations sont les suivantes : la phase de prdveloppement de l'intrt et de l'attention du public dbute ds qu'on entend les premires rumeurs concernant la ralisation potentielle dune nouvelle infrastructure routire la phase de construction concide avec la ralisation de linfrastructure routire suite l'obtention des autorisations. En gnral, durant cette phase, les proccupations du public s'avrent relativement faibles, celui-ci semblant se rsoudre accepter la dcision le dbut de la phase de croissance des proccupations concorde avec la reconnaissance d'impacts ngatifs ou de conflits potentiels lors de lexploitation de la route. Elle peut survenir immdiatement aprs la phase de construction ou de dveloppement du projet ou un peu plus tard, selon le degr d'acceptation du projet par le public lors de la phase de rsolution de conflit, un dialogue sinstalle entre les autorits et le public. Il peut se conclure par la ncessit de corriger linfrastructure routire ou par la constatation quil nest pas ncessaire dintervenir quand survient l'acceptation de la solution, on observe gnralement une diminution de l'intrt manifest par les personnes affectes
Ce cycle de proccupation est un processus itratif car les trois dernires phases peuvent revenir rgulirement si le contexte volue ou que la correction de linfrastructure routire ralise est insatisfaisante.
Proccupations
Prdveloppement Rsolution des conflits Construction du projet Croissance des proccupations
Acceptation de la solution
Temps
Figure 37 Le cycle des proccupations par rapport une infrastructure routire (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
Le public est un acteur essentiel du projet routier car il est dtenteur d'une connaissance spcifique son milieu de vie comparativement aux acteurs techniques qui affichent une connaissance scientifique objective. De plus, il est directement concern par linfrastructure routire car son cadre de vie peut tre fortement affect par la ralisation de celle-ci. Il est donc lgitime et quitable quil puisse participer llaboration du projet routier qui modifiera ses conditions de vie.
176
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
Postulat 45
Le public possde un droit lgitime participer llaboration du projet dune infrastructure routire affectant son cadre de vie
Une des caractristique des groupes spontans est quils ont des actions ractives. Ces groupes ne se forment et nagissent que lorsque les problmes mergent et qu'ils gnrent une insatisfaction. Ils ont donc des limites dans leurs actions et dans leur potentiel d'influence envers le dcideur : manque dexprience, manque de moyens, image dopposition plutt que de construction, etc.
5.1.5.3
La perception du risque par le public
La proposition de raliser une nouvelle infrastructure routire contribue modifier l'image du cadre de vie auprs du public. Pour chaque individu, les lments dinformation fournis par le dcideur et le projeteur se combinent avec ses propres lments de perception de son environnement. On assiste ainsi la formation de trois images mentales : (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) une image mentale dinterprtation de lenvironnement actuel (ce paysage est de qualit et reposant) une image mentale de lavenir sans projet, forge par ses expriences, son sentiment dappartenance et ses objectifs (ce paysage fait partie du patrimoine que je veut lguer mes descendants) une image mentale de lavenir concernant lenvironnement modifi par le nouveau projet (ce paysage sera dvaloris et naura plus dattrait)
Lindividu, alors en possession de ces trois images mentales value et analyse les changements apports par le nouveau projet. Ce jugement de valeur dpend de la proximit du projet, de sa dure de vie et des valeurs de lindividu. Trois situations sont alors possibles : ltat actuel est affect : lindividu agira pour que le projet ne se ralise pas car il y a une divergence avec ses valeurs ltat actuel est prserv (statu quo) ou amlior : lindividu sera indiffrent au projet ou il agira pour que le projet prenne forme car il y a une convergence avec ses valeurs lindividu ne se fait pas davis par manque dinformations : il tentera dacqurir des informations complmentaires pour mieux asseoir son analyse
Ce genre de construction mentale requiert que l'individu ait la capacit de conceptualiser et visualiser le projet en question. Cette dmarche peut poser des difficults en l'absence de rfrence. Dans le cas o lindividu ne peut construire cette image du projet implant dans son cadre de vie, il arrive quil s'oppose la ralisation du projet par crainte (Je ne sais pas ce qui mattend, mais je prfre tre prudent). Il sagit dun principe de prcaution systmatique engendr par lincomprhension du projet) ou par principe (Tout projet est potentiellement nfaste pour mon cadre de vie).
Identification des acteurs
177
5.1.5.4
Contraintes et motivations de laction
Un individu dont les valeurs sont en divergence avec les consquences du projet ne passe pas forcment laction. Certaines motivations tendent le faire passer laction, mais des contraintes et des limites laction peuvent rfrner ses dsirs. On peut relever les contraintes et les motivations laction suivantes :
Contraintes et limites laction
Manque de temps Dure du processus Cot Sentiment dimpuissance face au pouvoir Non-influence sur le processus dcisionnel Craintes de rtorsions ou de poursuites Pressions sociales
Motivations laction
Sant et scurit de l'individu, des siens, de ses biens et de son quartier Solidarit envers une cause Souci de justice et dquit Risque de pertes conomiques Maintien de la qualit de vie Bien des gnrations futures Souci de respect de la lgislation Pressions sociales
Tableau 20
Contraintes et motivations laction (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
Les actions qu'un individu peut entreprendre sont multiples. Il peut sagir de : (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) se regrouper avec dautres individus (groupes spontans) rencontrer le dcideur ou le projeteur faire pression sur une autorit, le dcideur ou le projeteur faire signer une ptition ameuter les mdias organiser une manifestation participer une soire d'information demander une audience publique et s'y prsenter intenter une action lgale
Le potentiel d'action des individus augmente quand ceux-ci se rassemblent en groupes spontans partageant les mmes intrts ou adoptant les mmes positions face au projet, soit en un groupe structur.236 Mme si une procdure est organise de manire rendre les actions de contestation plus accessibles aux individus, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit avoir une forte personnalit et une rsistance toute preuve face l'intimidation.
236
Comme le disait Jean de La Fontaine : Lunion fait la force. (Fables, le Vieillard et ses Enfants)
178
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
5.1.6
Les organisations non-gouvernementales
Les organisations non-gouvernementales sont des groupes structurs qui englobent une diversit d'organisations diffrencies par les valeurs quelles dfendent237 et par l'chelle spatiale sur laquelle elles interviennent. Comme le dcrit P. Andr, les organisations non-gouvernementales peuvent avoir des idologies extrmistes tandis que dautres sont plus enclin admettre des compromis. De plus, ces groupes structurs sont aussi traverss par plusieurs courants de penses et des nuances diffrentes.
Ple conomique
Espace de compromis
Ple social
Figure 38
Ple environnemental
Diagramme ternaire des idologies (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
5.1.6.1
Origines du mouvement cologique
Les origines du militantisme et du mouvement cologique sont diverses et expliquent le choix du groupe auquel les militants adhrent. On peut observer plusieurs catgories dorigine du mouvement cologique : (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) Origines lies la conservation : protection des sites naturels, des espces, stratgie de conservation Origines scientifiques : cologie, biologie, nergie, dmographie Origines de lalternative politique : socialisme, courant autogestionnaire, anarchisme, tiers-mondisme Origines contre-culturelles : retour la terre, modes de vie alternatifs
Dans son ensemble, le mouvement cologique est tiraill entre le dsir d'autonomie, qui le coupe du monde des dcisions, et le dsir de participer aux dcisions politiques et conomiques, avec tous les risques de rcupration que comporte un tel choix.
237
Comme prcis auparavant, dans cette tude lauteur sintresse uniquement aux organisations nongouvernementales dfendant des valeurs environnementales
Identification des acteurs
179
5.1.6.2
Modes daction gouvernementales
des
organisations
non-
Les groupes structurs peuvent compter sur un rpertoire dactions beaucoup plus large et puissant que celui des groupes spontans ou des individus. Il peut sagir des actions suivantes :
Types dintervention
Action populaire (recherche de compromis, andragogie active, sensibilisation, image de marque)
Exemples dactions
Coalition de groupes Rencontre avec des personnalits Campagne de presse Campagne dopposition : ptitions, boycottage, manifestations Engagement dans la participation publique Publication de magazines et de revues Publications scientifiques Pose de panneaux dinformation Recours individuels ou collectif (class action) Droit de recours Poursuite Entrave aux travaux Dsobissance civile Occupation de locaux ou blocage des voies de communication Sabotage dquipements Menaces physiques Altration des ressources
Action judiciaire (efficacit, respect des lois environnementales) Dsobissance civile (illgalit)
Ecoterrorisme (menaces sur la socit, effets mdiatiques, radicalisation)
Tableau 21
Rpertoire dinterventions des groupes structurs (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
5.1.6.3
Droit de recours des organisations environnementales
En Suisse, certaines organisations non-gouvernementales dont le but est la protection de lenvironnement peuvent recourir contre des dcisions des autorits cantonales ou fdrales. Ce droit de recours des organisations de protection de lenvironnement a t progressivement introduit depuis 1966 dans les diffrentes lois sur la protection de lenvironnement. Il sagit notamment de la loi sur la protection de lenvironnement et de la loi sur la protection de la nature et du paysage :
Les organisations nationales dont le but est la protection de l'environnement ont galement le droit de recourir dans la mesure o le recours administratif au Conseil fdral ou le recours de droit administratif au Tribunal fdral est admis contre des dcisions des autorits cantonales ou fdrales relatives la planification, la construction ou la modification d'installations fixes soumises l'tude de l'impact sur l'environnement selon l'article 9, et pour autant qu'elles aient t fondes dix ans avant l'introduction du recours
(Article 55, LPE, 1983)
Les communes et les organisations d'importance nationale but non lucratif qui existent depuis dix ans au moins et se vouent la protection de la nature, la protection du paysage, la conservation
180
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
des monuments historiques ou des tches semblables ont qualit pour recourir contre les dcisions du canton ou des autorits fdrales si ces dcisions peuvent, en dernire instance, faire l'objet d'un recours au Conseil fdral ou d'un recours de droit administratif au Tribunal fdral (Article 12, LPN, 1966)
Ce droit de recours est doublement limit : seules les organisations de protection de lenvironnement dimportance nationale existant depuis dix ans au moins y ont accs238 il ne peut tre utilis que pour les projets soumis ltude dimpact sur lenvironnement et pour les projets qui relvent dune tche fdrale. Les projets dinfrastructure routire font partie de cette catgorie de projet
Pour viter tout abus, la LPE prvoit aussi que les organisations nongouvernementales qui nont pas formul de recours dans une phase dtude initiale ne peuvent intervenir dans la suite de la procdure que si la dcision est modifie en faveur dune autre partie ou quelle leur porte atteinte. (CGCN, 1997) La liste des organisations non-gouvernementales habilites recourir est tablie dans lOrdonnance relative la dsignation des organisations habilites recourir dans les domaines de la protection de lenvironnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage. (ODO, 1990) Actuellement, 29 associations se trouvent sur cette liste, savoir : Rheinaubund (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fr Natur und Heimat) Association suisse pour lamnagement national (ASPAN) World Wildlife Fund (WWF) Suisse Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO) Ligue suisse du patrimoine national (LSP) Pro Natura Club alpin suisse (CAS) Socit suisse pour la protection de lenvironnement (SPE) Helvetia Nostra Association suisse de technique pour lenvironnement (ASTE) Ligue suisse contre le bruit Ligue suisse pour la protection des eaux et de lair (LSPEA) Fondation suisse pour la protection et lamnagement du paysage (FSPAP) Fondation suisse pour lnergie (FSE) Fdration suisse des amis de la nature (FSAN) Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) Aqua Viva (Communaut nationale daction pour la protection des cours deau et des lacs) Fdration suisse de pche et de pisciculture (FSPP)
238
Cette condition exclut doffice les groupements spontans ou les associations locales
Identification des acteurs
181
Fondation suisse des transports (FST) Association transports et environnement (ATE) Fdration suisse de tourisme pdestre Socit suisse de prhistoire et darchologie (SSPA) Greenpeace Suisse Pro Campagna, Association pour la sauvegarde de lhabitat rural suisse Fondation suisse de la Greina (FSG) Fdration des associations suisses de chasseurs (FACH) Socit suisse de splologie (SSS) Socit dhistoire de lart en Suisse (SHAS) Mdecins en faveur de lenvironnement
Une association dsireuse de faire partie de cette liste a la possibilit de le demander au Conseil fdral (Article 3, ODO, 1990). Elle doit cependant prsenter sa demande au moins 18 mois avant la date laquelle elle dsire se voir confrer ce droit de recours. Le droit de recours des organisations de protection de lenvironnement est rgulirement la cible de critiques et de nombreuses initiatives parlementaires au niveau des Chambres fdrales ont demand sa suppression. Une tude ralise en 1999 par lOFEFP pour amener des lments scientifiques dans le dbat public (OFEFP, 2000) montre cependant que ce droit de recours nest pas utilis abusivement. Entre 1996 et 1998, seul 1,4 % des jugements du Tribunal fdral concernaient des recours de droit administratif impliquant les organisations de protection de lenvironnement. De plus, le taux de succs des recours des organisations de protection de lenvironnement est nettement suprieur la moyenne. Les auteurs de cette tude concluent donc que La thse dun usage abusif gnralis du droit de recours des organisations de protection de lenvironnement est infonde . (OFEFP, 2000) Ce droit de recours des organisations de protection de lenvironnement a engendr au cours des annes, des effets positifs en favorisant le consensus, en encourageant lintgration des organisations de protection de lenvironnement dans les processus de dcision et initiant un dialogue prcoce avec les projeteurs et les dcideurs. Il sagit donc dun instrument efficace pour amliorer la mise en uvre de la rglementation environnementale . (OFEFP, 2000) Les auteurs de ce rapport remarquent que Une partie des critiques formules lors des entretiens concerne moins le droit de recours () que les exigences du droit environnemental (..) juges trop leves. () le droit de recours endosse ainsi le rle du bouc missaire . Les lenteurs des procdures dues la surcharge des tribunaux ainsi que les exigences du droit environnemental sont les vritables raisons du blocage des projets. La CGCN relativise aussi les oppositions et le rle des organisations nongouvernementales dans les blocages des projets en remarquant que les oppositions sont aussi le fait de riverains, dagriculteurs, de communes, etc. (CGCN, 1997)
182
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
5.1.7
Les acteurs politiques
Les acteurs politiques sont les membres des pouvoirs excutifs ou lgislatifs qui ne sont pas dans le mme rle que celui du dcideur. Ils peuvent se trouver plusieurs niveaux politiques diffrents (Confdration, canton, district, commune, etc.) situs un degr hirarchique diffrent de celui du dcideur. Dans le cas de la A144, le dcideur est lOffice fdral des routes appartenant au Dpartement fdral de lEnvironnement, des Transports, de lEnergie et de la Communication (DETEC).239 Les diffrents acteurs politiques de cette tude sont les suivants :
Niveau politique
Confdration : Suisse
Pouvoir lgislatif
Conseiller national Conseiller aux tats
Pouvoir excutif
Conseiller fdral en charge des routes : DECIDEUR Autre Conseiller fdral
Canton : Vaud ou Valais
Dput au Grand Conseil
Conseiller dEtat en charge des routes : DECIDEUR Autre Conseiller dEtat
District : Monthey ou Aigle Commune : 8 communes
Assemble de commune Conseil communal
Prfet Syndic ou prsident de commune Municipal
Tableau 22
Acteurs politiques susceptibles dinfluencer le projet
Par exemple, un conseiller national vaudois pourrait intervenir auprs des Chambres fdrales ou du Conseiller fdral responsable du DETEC pour dfendre un point de vue relatif la A 144.
5.1.8
Les acteurs administratifs
Les acteurs administratifs sont chargs de la mise en place dune politique publique dfinie. Ils participent au processus dlaboration du projet routier240 et vrifient la conformit des projets routiers avec lensemble des produits administratifs (outputs) gnrs par ladministration : lois, ordonnances dapplication, conceptions gnrales, plans directeurs, directives, etc. Il sagit gnralement des acteurs administratifs responsables des politiques publiques lies au projet routier (voir la figure 22 la page 116). Il peut sagir des services administratifs suivants : amnagement du territoire environnement : faune, forts, paysage, eaux transports conomie
239 240
Ceci en raison du financement de la A 144 par la Confdration et les cantons concerns (Vaud et Valais) Il est important dintgrer ces acteurs dans le processus dlaboration du projet routier. Un projet ralis indpendamment de ladministration publique peut donner un rle de censeur aux acteurs administratifs qui doivent juger de lacceptabilit dun projet dj bien avanc. Si leurs propositions sont apportes suffisamment tt dans ltude, bien des conflits seraient vits
Identification des acteurs
183
agriculture finances circulation et police etc.
Les services administratifs concerns peuvent tre au niveau communal, cantonal ou fdral selon limportance de linfrastructure routire projete. Gnralement, la procdure dfinit les services administratifs qui interviennent dans llaboration du projet routier. Le principal reproche adress aux acteurs administratifs chargs de vrifier la conformit du projet est leur rigidit et leur manque de souplesse.241 Par exemple, la CGCN parle ainsi de lOFEFP : Cet office fdral remplit son rle de manire
consciencieuse et engage. Il serait tout de mme souhaitable quil fasse preuve de souplesse. Il nest malheureusement plus possible aujourdhui, au vu de la situation financire des collectivits publiques, de tout financer et nimporte quel prix. Il faut () que les mesures prises justifient leurs cots .(CGCN, 1997)
5.1.9
Les utilisateurs de la route
Les utilisateurs de la route sont les bnficiaires de linfrastructure routire projete. Ils sont la raison mme de son existence. Ils assurent une partie du financement des infrastructures quils utilisent (principe de causalit) travers diverses taxes indirectes sur les huiles minrales ou lies aux prestations. Cependant, une partie de linfrastructure routire est finance par la collectivit car ses bienfaits (mobilit, accessibilit, etc.) rejaillissent sur lensemble de la socit. Les utilisateurs de linfrastructure routire sont souvent les parents pauvres de la procdure dlaboration du projet routier, comme il a t relev lors de lanalyse de la Comparaison de variantes 1999 mene au chapitre 2.8. Les associations dusagers doivent tre intgres dans ltude du projet afin dapporter un autre point de vue sur celui-ci. Il peut sagir des associations suivantes : associations dautomobilistes (TCS, ACS, etc.) reprsentant les usagers individuels motoriss associations soccupant de la scurit routire (BPA, etc.) associations de professionnels de la route (ASTAG, FRS, etc.) reprsentant les acteurs vivant directement du transport 242 associations dusagers des transports collectifs (ATE) associations dentreprises concessionnaires de transports collectifs associations de cyclistes (ATE, etc.) associations conomiques, intresses disposer dun rseau dinfrastructures routires de qualit etc.
241 242
On pourrait toutefois citer cette locution latine : Dura lex, sed lex (la loi est dure, mais c'est la loi) Il existe prs de 8'000 entreprises de transport en Suisse (ASTAG, 2000)
184
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
5.2
L ES RAPPORTS ENTRE LES ACTEURS
Les rapports de forces existants entre les acteurs du projet routier peuvent tre rsums en utilisant la notion du triangle de fer dfinie par P. Knoepfel. (Knoepfel P., 1993) Celui-ci a dfini le triangle de fer pour illustrer les rapports entre les acteurs des problmatiques environnementales qui peuvent tre tendus aux projets dinfrastructures routires. Les sommets du triangle reprsentent les acteurs et les cts, les rapports de force entre ceux-ci. Selon les cas, ce schma peut clater en plus de trois acteurs, ou plutt groupes dacteurs. Dans le cas des projets dinfrastructures routires, on peut identifier sept principales catgories dacteurs, bases sur le chapitre 5.1.1, page 168 : Dcideur : administration routire Groupe dtude : projeteur routier et spcialistes techniques Acteurs administratifs : services de ladministration chargs de la vrification de la conformit de linfrastructure routire Acteurs politiques : lgislatif ou excutif au niveau communal, cantonal ou national Utilisateurs de linfrastructure : bnficiaires, usagers, acteurs conomiques Public : groupes spontans, acteurs affects, concerns ou passifs Organisations non-gouvernementales : groupes structurs, associations de protection de lenvironnement
Les rapports existants entre ces diffrentes catgories sont reprsents la page suivante. On peut remarquer que cette figure est plutt un hexagone quun heptagone, le groupe dtude tant plac au milieu. Dans ce schma, les flches extrmits noires reprsentent des relations techniques entre le groupe dtude et les acteurs du projet. Les flches extrmits blanches reprsentent les relations politiques entre les diffrents acteurs du projet. La relation entre le groupe dtude et le dcideur est particulire car il existe une relation de mandat243 attribu par le dcideur au groupe dtude. La position de ce dernier est centrale dans llaboration dun projet routier, car cest lui qui dirige la manuvre et centralise les informations. Cest pour cela quil a t plac au cur du schma. Le groupe dtude ralise un travail objectif244 et il ne doit pas prtriter un acteur ou en favoriser un autre. Pour assurer cette objectivit, lensemble des tendances devraient tre prsentes dans le groupe dtude pour raliser ce que M. Tille dfinit par un mini-systme semblable au systme gnral des acteurs. (Tille M., 1999a)
243
La question de lindpendance du mandataire qui dpend financirement de son mandant a t traite au chapitre 2. Un mandant peut-il conseiller au dcideur de ne pas raliser le projet pour lequel il a t mandat ? Une rflexion sur lobjectivit et la subjectivit est ralise au chapitre 8.2.4.
244
Les rapports entre les acteurs
185
Dcideur
Acteur tatique routier
Amnagement du territoire Transport Environnement Agriculture Forts etc.
GROUPE D'ETUDE
Projeteur routier Spcialistes
Groupes structurs et prennes Valeurs environnementales
Acteurs administratifs
Organisations non-gouvernementales
Acteurs politiques
Public
Lgislatif ou excutif Pays, canton ou commune
Utilisateurs de l'infrastructure
Acteurs bnficiaires Usagers Acteurs conomiques
Acteurs affects, intresss ou passifs Riverains Groupes spontans
Figure 39
Rapports existants entre les diffrents acteurs du projet routier (Tille M., 1999a)
5.2.1
Conflits et coalitions
La nature des rapports entre les diffrentes catgories dacteurs peut tre de deux types :
conflit quand les intrts sont antagonistes coalition quand les intrts convergent (coalition dintrt) ou quand il sagit de sallier pour faire plier un acteur tiers (coalition de circonstance)
Dans le cas de la coalition de certains acteurs, lheptagone de base peut par exemple se rtrcir un schma triangulaire. A la page suivante, une exemple dun triangle de fer form par deux coalitions est reprsent : les utilisateurs de linfrastructure routire et les acteurs politiques sont allis pour favoriser la construction de la route le public, les organisations non-gouvernementales et les acteurs administratifs en charge de lenvironnement sont opposs ce projet le dcideur na pas dappuis
Ce triangle peut tre fortement dsquilibr, excluant ainsi les proccupations dun groupe dacteurs de lanalyse.
186
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
Dcideur
GROUPE D'ETUDE
Utilisateurs de l'infrastructure Acteurs politiques
Organisations non-gouvernementales Acteurs administratifs Public
Figure 40
Exemple dun triangle de fer avec formation de deux coalitions (Tille M., 1999a)
Il peut y avoir aussi en cas de conflits, des conflits internes certaines catgories dacteurs (acteurs politiques dfendant des options diffrentes, services administratifs soccupant de politiques publiques contradictoires, etc.).
5.2.2
Objectifs, moyens et rsum
Le tableau de la page suivante rsume pour ces catgories dacteurs, leurs objectifs, les moyens quils ont disposition ainsi que les conflits et les coalitions qui peuvent apparatre, avec des exemples. Les moyens influencent directement les rapports entre acteurs : par exemple, si les riverains habitent dans un quartier de propritaires de villas dun standing lev ou bien sil sagit de locataires dun quartier populaire, lorganisation, les moyens financiers, les appuis politiques sont diffrents.
Les rapports entre les acteurs
187
Acteurs
1. Dcideur Administration routire (service des routes) Groupe dtude
Objectifs
Amnager une infrastructure de transport sre et conomique la construction et lexploitation
Moyens
Financiers Techniques
Conflit possible avec
2. Rglement politique impossible, politiques publiques fortement incompatibles 3. Reprsentativit des cologues du groupe dtude mise en doute 4. Infrastructure routire impose une rgion 5. Cot de construction excessif 6. Administration dun niveau suprieur lacteur politique (Canton vs commune)
Coalition possible avec
2. tat puissant et dterministe, rglement interne des conflits (DETEC actuel) 3. Groupe dtude htrogne, besoin dun consensus, pragmatisme 4. et 5. Besoin vital dune nouvelle route 6. lectoralisme
2. Acteur administratif Services de ladministration publique Amnagement du territoire, environnement, transport (sauf service des routes) 3. Organisations non-gouvernementales Groupes structurs et prennes
Assurer le respect des lois Mise en uvre de diffrentes politiques publiques
Comptences scientifiques et techniques Lgislation
3. Efficacit et volont de ladministration mise en doute, politique publique en conflit avec lenvironnement 4. Difficults dapplication des politiques top to down 5. Conflit avec les intrts de lconomie
1. et 6. Arrangement politico- administratif pour la mise en uvre de la politique publique 3. Protection efficace de lenvironnement 4. et 5. coute des attentes
Sauver et grer la faune Limiter les impacts de la mobilit
Droit de recours Enthousiasme des membres
Manifestations mdiatiChanger les parases digmes socitaux et les comportements Sensibiliser la population
4. Acteurs locaux vs ac- 2. apport du haut teurs externes : vision niveau dexpertise diffrente du milieu naturel et de son utilisation 4. Les O.N.G. servent de porte-voix 5. Vision de la socit aux revendications diffrente : nature vs du public mobilit 5. Favoriser un re6. Mise en question de la lgitimit des acteurs port modal politiques 6. lectoralisme
4. Public Individus affects, concerns ou passifs Groupes spontans
Limiter les impacts sur la vie sociale Maintenir ou amliorer le cadre de vie
Procdure lgislative des propritaires Manifestation Battage mdiatique Mobilisation Groupements spontans
5. Refus dune route 3. Structurer le mdans un environnement contentement vis-prserv vis dune situation existante 2. Connaissance du terrain face aux connaissances thoriques 5. Nuisances associes un trac de mauvaise qualit 6. lectoralisme
5. Utilisateurs de linfrastructure Bnficiaires Usagers et acteurs conomiques 6. Acteurs politiques Lgislatif ou excutif Commune, canton ou pays
Utiliser une infrastructure de transport conomique, sre et confortable
Associations dusagers Associations conomiques Lobbying
1. Manque dengagement de la part du service des routes 4. Infrastructure impose une rgion
1. Besoins clairement compris 2. Dfinition dune technologie adquate
Rpondre aux attentes citoyennes Dfinir les politiques publiques de la socit Echances lectorales
Lgitimit populaire Proche du dcideur Pression sur le dcideur
1. Conflits de personnes 1. et 4. Dvelopentre deux acteurs pement de dun mme excutif laccessibilit 4. Privilgie une solution long terme sans attrait court terme 3. ou 4. Pragmatisme
Tableau 23
Exemples de quelques confrontations ou coalitions envisageables dans les projets dinfrastructures routires (Tille M., 1999a)
188
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
5.3
A NALYSE DE LA C OMPARAISON DE VARIANTES 1999
Comme prsent la page 39, les diffrents acteurs du COPIL sont rpartis en six groupes dacteurs. Ceci doit permettre de faciliter lanalyse des acteurs en restreignant le nombre de cas tudier. Chacun de ces groupes reprsente des points de vue plus ou moins identiques.245 On peut remarquer quaucun acteur nappartient deux groupes et quaucun acteur du COPIL est absent dun groupe dacteurs. De plus, pour bnficier dune analyse base sur un chantillonnage reprsentatif,246 le groupe le moins fourni compte quatre acteurs, le groupe le plus fourni comptant quant lui sept acteurs. Lauteur a tabli les six groupes dacteurs puis a rparti les membres du COPIL au sein de ces groupes en posant les hypothses suivantes : lus valaisans : il sagit des acteurs politiques et du dcideur du canton du Valais qui auront cur de satisfaire les besoins de transport lus vaudois : il sagit des acteurs politiques et du dcideur du canton de Vaud qui auront aussi cur de satisfaire les besoins de transport mais seront aussi dsireux de raliser une nouvelle route hors des localits Une sparation entre les lus des deux cantons a t ralise afin de vrifier si la situation cantonale influence sur le rsultat. Il aurait t envisageable de sparer diffremment ces lus selon leur niveau politique (canton, district ou communes), mais cest une option que lauteur na pas retenu Associations de dveloppement conomique : il sagit dacteurs bnficiaires de la future A 144 qui seront intresss satisfaire le dveloppement de lconomie et obtenir des conditions de transport de qualit Associations de protection de lenvironnement : il sagit dorganisations nongouvernementales qui auront comme objectif la protection de lenvironnement, le transport et les finances tant secondaires Administration publique - environnement et amnagement du territoire : il sagit dacteurs qui favoriseront lamnagement du territoire et lenvironnement Administration publique - service des routes : il sagit dacteurs qui vont favoriser le transport et les finances
Lanalyse de situation et lexamen des pondrations permettront de vrifier la justesse des hypothses ainsi poses par lauteur. La dtermination de profils dacteurs reprsentatifs doit notamment tre possible pour chaque catgorie.
245
Cette rpartition fonctionnelle a t ralise avant que lauteur dispose des diffrentes pondrations. Comme on le verra par aprs, certains acteurs ne correspondent pas au profil de pondration de la classe fonctionnelle laquelle ils appartiennent La volont de respecter lanonymat des acteurs est aussi prsente dans ce choix du nombre minimum dacteurs par groupe
246
Analyse de la Comparaison de variantes 1999
189
5.3.1
Analyse de situation
Lanalyse de situation des acteurs de la Comparaison de variantes 1999 a dj grandement t ralise au chapitre 2.8.6., page 92. Un bref complment danalyse est toutefois tabli ici en se basant sur ces rflexions et sur les lments dvelopps au chapitre 5.2. On peut effectuer les remarques suivantes quant aux relations entre les diffrents acteurs de la Comparaison de variantes 1999 : certaines catgories dacteurs sont absentes de la Comparaison de variantes 1999 : public affect, concern ou passif, usagers, etc. Elles sont reprsentes indirectement au sein du COPIL : syndics pour le public affect, service des routes pour les usagers, etc. le dcideur comprend trois acteurs : le reprsentant de lOFROU ainsi que les deux conseillers dtat responsables du DINF et du DTEE. On peut cependant affirmer que le conseiller dEtat vaudois est le moteur parmi ces dcideurs. Le fait que la majeure partie de lamnagement routier projet se trouve sur le sol vaudois nest pas tranger ce comportement. Ces trois acteurs sont disperss dans diffrents groupes dacteurs247 les lus locaux du groupe lus vaudois sont solidaires et dfendent un point de vue commun. Les communes veulent obtenir rapidement la ralisation de linfrastructure routire travers la plaine du Rhne on peut signaler une coalition entre les lus locaux vaudois, les lus valaisans, lacteur administratif routier, certains acteurs valaisans du groupe administration publique - environnement et amnagement du territoire et les acteurs conomiques. Cette coalition a pour objectif darriver rapidement proposer un trac pour une route possdant un standard de bonne qualit et situe hors des localits une deuxime coalition apparat entre les organisations non-gouvernementales et les acteurs vaudois et fdraux du groupe administration publique environnement et amnagement du territoire . Cette coalition a pour objectif de prserver lenvironnement, de favoriser la mixit du trafic et damliorer la route actuelle en modifiant ponctuellement certains tronons de part labsence de certains acteurs et la prsence de deux coalitions, le triangle de fer entre le dcideur, la coalition routire et la coalition environnementale est fortement dsquilibr. La relation qui prdomine est la confrontation entre les deux coalitions, le dcideur jouant en quelque sorte le rle darbitre entre les deux au sein des groupes dfinis par lauteur il existe des diffrences dapprciation de la problmatique, voir des tensions (cas de lamnagement du territoire qui est envisag de manire trs diffrente entre les deux cantons concerns)
247
Il aurait t possible de crer un groupe dacteurs dcideurs mais lauteur prfre privilgier les rles et lappartenance gographique dans la dtermination des groupes dacteurs
190
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
Le schma suivant synthtise les rapports entre les diffrents acteurs de la Comparaison de variantes 1999 (conflits ou coalitions) relevs ou supposs par lauteur. Les acteurs de mme sensibilit ou de mme typologie sont placs proximit les uns des autres. Les acteurs qui auraient dus tre intgrs cette tude sont aussi reprsents dans cette figure.
DETEC Confdration Finances Confdration Contrle financier OFROU Confdration Financement Volont d'aboutir un consensus Chambres fdrales
Conseiller d'tat VD
Conseiller d'tat VS
Financement
Service des routes VD
Service des routes VS
DDE 74 Haute-Savoie
Mandat Mandataire externe INFRACONSULT Conflit mdiatis en aot 1999
NOYAU DU GROUPE D'ETUDE
POPULATION
Communes VD et VS
Ingnieur civil SD Lausanne
Ecologue
Coalition "routire"
Acteurs conomiques du Chablais
OFEFP Confdration
Service de la Faune VD
Service de la Faune VS Associations de dveloppement conomiques
Perception diffrente du territoire Amnagement du territoire VD Amnagement du territoire VS
Dpartement de l'agriculture Agriculteurs de la Plaine du Rhne
Coalition "environnementale"
Protection du patrimoine Organisations nongouvernementales
Tourisme Aquaparc, camping Usagers TCS, ASTAG Transports collectifs CFF, bus AUDITEUR
LEGENDE
DETEC Confdration Finances Confdration
Acteur de la "Comparaison de Variantes 1999" Acteur absent mais dont la prsence aurait t souhaitable Lien hirarchique Coalition d'intrts Conflit relev
Figure 41
Schma de principe rsumant lanalyse de situation de la Comparaison de variantes 1999
Analyse de la Comparaison de variantes 1999
191
5.3.2
Analyse des pondrations
Cette analyse a t mene pour les pondrations des 28 acteurs du COPIL248 rpartis en six groupes dacteurs (rappel des pages 39 et 40) : Groupe 1 : lus valaisans, compos de cinq acteurs. Pondrations P1 P5 Groupe 2 : lus vaudois, compos de sept acteurs. Pondrations P6 P12 Groupe 3 : Associations de dveloppement conomique, compos de deux acteurs.249 Pondrations P13 et P14 Groupe 4 : Associations de protection de lenvironnement, compos de cinq acteurs. Pondrations P15 P19 Groupe 5 : Administration publique - Environnement et Amnagement du territoire, compos de cinq acteurs. Pondrations P20 P24 Groupe 6 : Administration publique - Service des routes, compos de quatre acteurs. Pondrations P25 P28
Pour chaque groupe dacteurs, un tableau rcapitulatif prsente les valeurs suivantes : pondrations individuelles de chaque acteur. La valeur indique est le produit de la pondration du critre (16 critres en tout) au sein de la famille par la pondration de la famille (6 familles en tout). La sommes des seize pondrations vaut 100 % moyenne des pondrations individuelles pour chaque critre et chaque famille valeur maximale pour chaque critre et chaque famille250 valeur minimale pour chaque critre et chaque famille cart maximum, en valeur absolue, par rapport la moyenne pour chaque critre et chaque famille cart-type des pondrations individuelles pour chaque critre et chaque famille les valeurs des pondrations individuelles qui sont suprieures la valeur de la moyenne additionne de lcart-type sont mises en vidence en bleu et en italique. Les valeurs des pondrations individuelles qui sont infrieures la valeur de la moyenne soustraite de lcart-type sont mises en vidence en rouge et en italique. Il sagit des valeurs sloignant fortement de la tendance du groupe pour chaque acteur, un coefficient de dtermination R2 d'une rgression linaire est dtermine par rapport aux valeurs moyennes du groupe. Il indique la correspondance du profil de cet acteur par rapport son groupe de rfrence. Si cette valeur dpasse 0,75, elle est mise en vidence en gras
248
Comme il a t prcis au chapitre 2, les huit pondrations effectues par les membres du GT, la pondration du mandataire externe et celle de lauditeur ne sont pas considres dans cette analyse car elles ne sont pas juges reprsentatives des enjeux de la A 144 Pour le groupe 3, seuls deux acteurs sur quatre ont fourni une pondration (voir les remarques de la page 60 ce sujet) Pour le groupe Acteurs conomiques qui ne comprend que deux valeurs, seule la moyenne est dtermine
249
250
192
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
5.3.2.1
Groupe dacteurs lus valaisans
Lanalyse des cinq pondrations individuelles de ce groupe est prsente dans le tableau suivant :
P1 P5 : 5 acteurs
Elus Valaisans
Critres P1 P2 P3 P4 P5
Acteur reprsentatif 20.0 2.0 10.0 3.0 35.0 5.0 5.0 10.0 5.0 10.0 15.0 8.0 3.5 3.5 15.0 8.0 12.0 20.0 1.5 2.0 1.5 5.0 maximum Ecart-type 6.42 1.10 3.03 1.67 10.95 2.01 1.27 2.24 2.62 4.73 6.54 5.66 1.56 1.56 8.67 3.36 10.36 13.54 0.55 1.46 1.34 2.95 Maximum 24.00 4.00 12.00 6.00 40.00 6.00 7.10 10.00 10.00 14.30 20.00 18.00 6.00 6.00 30.00 12.00 28.00 40.00 3.00 5.00 4.00 10.00 Moyenne Minimum 10.00 2.00 6.00 2.00 20.00 1.00 4.00 5.00 3.00 2.00 5.00 5.00 2.00 2.00 10.00 5.00 4.00 10.00 1.60 1.50 0.80 4.00
Famille de critres
Besoins de transport
Transport motoris Trafic piton et deux-roues Transports collectifs Transport agricole
10.00 2.00 6.00 2.00 20.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 20.00 5.00 2.50 2.50 10.00 12.00 18.00 30.00 3.00 3.00 4.00 10.00 100.00
2
10.00 2.00 6.00 2.00 20.00 1.00 4.00 5.00 8.00 12.00 20.00 5.00 3.00 2.00 10.00 12.00 28.00 40.00 1.75 2.00 1.25 5.00 100.00 0.54
24.00 2.00 8.00 6.00 40.00 6.00 4.00 10.00 6.30 11.70 18.00 7.00 3.50 3.50 14.00 7.00 7.00 14.00 1.60 1.60 0.80 4.00 100.00 0.80
20.00 4.00 12.00 4.00 40.00 5.00 5.00 10.00 3.00 2.00 5.00 18.00 6.00 6.00 30.00 6.00 4.00 10.00 2.00 1.50 1.50 5.00 100.00 0.40
20.00 4.00 12.00 4.00 40.00 2.90 7.10 10.00 5.70 14.30 20.00 5.00 2.00 3.00 10.00 5.00 5.00 10.00 2.00 5.00 3.00 10.00 100.00 0.65
16.80 2.80 8.80 3.60 32.00 3.98 5.02 9.00 6.60 10.00 16.60 8.00 3.40 3.40 14.80 8.40 12.40 20.80 2.07 2.62 2.11 6.80
7.20 1.20 3.20 2.40 12.00 2.98 2.08 4.00 3.60 8.00 11.60 10.00 2.60 2.60 15.20 3.60 15.60 19.20 0.93 2.38 1.89 3.20
TOTAL BESOINS DE TRANSPORT Moyens financiers Cots d'investissement Cots d'entretien et d'exploitation TOTAL MOYENS FINANCIERS Objectifs de l'A.T.
(amnagement du territoire)
Utilisation mesure du sol Buts et plans de l'A.T.
TOTAL OBJECTIFS DE L'A.T. Nuisances sur l'environnement Environnement humain Environnement naturel Autres nuisances TOTAL NUISANCES SUR L'ENVIRONNEMENT Dveloppement de l'conomie Economie micro-rgionale Economie macro-rgionale
TOTAL DVELOPPEMENT DE L'CONOMIE Nuisances dues aux travaux Nuisances locales Nuisances sur la circulation Nuisances gnrales TOTAL NUISANCES DUES AUX TRAVAUX
TOTAL GENERAL
Coefficient de dtermination R
0.60
Tableau 24
Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs lus valaisans
Cette analyse amne les remarques suivantes : le transport est privilgi et reprsente prs du tiers du poids total le dveloppement de lconomie reprsente 1/5me du poids total, juste devant lamnagement du territoire avec une valeur infrieure 10 %, les moyens financiers sont ngligs. Le fait que seul 6 % du cot de la ralisation de la A144 soit la charge du canton du Valais explique sans doute ce choix mis part lacteur P4, lenvironnement a une faible importance. On peut relever que cet acteur accorde 70 % de la pondration aux deux premires familles ! seul lacteur P3 prsente un coefficient de dtermination lev, signe dune forte dispersion des valeurs des acteurs de ce groupe on remarque trois types de profils de pondration au sein de ce groupe : P1 et P2 qui ont des valeurs de transport infrieures la moyenne mais qui accordent plus dimportance lconomie, P3 qui est isol, mais qui est le plus proche de la moyenne du groupe, et P4 avec P5
Lacteur reprsentatif dfini ici sera dsign sous le terme de Acteur Transport + conomie . 35 % de la pondration est attribue aux transports et 20 % lconomie.
Analyse de la Comparaison de variantes 1999
193
5.3.2.2
Groupe dacteurs lus vaudois
Lanalyse des sept pondrations individuelles de ce groupe est prsente dans le tableau suivant :
P6 P12 : 7 acteurs
Elus Vaudois
Critres P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Acteur reprsentatif 13.0 4.0 7.0 4.0 28.0 4.0 8.0 12.0 7.0 5.0 12.0 8.0 3.0 3.0 14.0 10.0 17.0 27.0 2.0 3.0 2.0 7.0 maximum Ecart-type 3.93 1.93 1.13 1.74 4.88 2.23 2.03 2.67 2.82 3.56 6.25 2.18 2.06 2.00 5.35 3.75 7.64 11.07 1.11 2.61 1.59 2.67 Maximum 17.50 7.00 7.50 7.50 35.00 9.00 10.50 15.00 12.50 12.50 25.00 10.50 7.50 7.50 25.00 14.00 26.00 40.00 4.00 7.00 5.00 10.00 Moyenne Minimum 5.00 2.30 4.50 2.50 20.00 2.00 6.00 10.00 3.30 1.80 5.10 5.00 1.50 1.00 10.00 2.50 2.50 5.00 1.00 0.50 0.50 5.00
Famille de critres
Besoins de transport
Transport motoris Trafic piton et deux-roues Transports collectifs Transport agricole
12.50 2.50 7.50 2.50 25.00 4.50 10.50 15.00 7.00 3.00 10.00 9.00 3.00 3.00 15.00 9.00 21.00 30.00 1.50 0.50 3.00 5.00 100.00
2
17.50 7.00 7.00 3.50 35.00 3.00 7.00 10.00 6.00 4.00 10.00 10.50 1.50 3.00 15.00 8.00 12.00 20.00 3.00 6.00 1.00 10.00 100.00 0.73
5.00 5.00 7.00 3.00 20.00 9.00 6.00 15.00 12.50 12.50 25.00 10.00 7.50 7.50 25.00 2.50 2.50 5.00 4.00 1.00 5.00 10.00 100.00 0.03
12.50 2.50 5.00 5.00 25.00 4.50 10.50 15.00 6.00 4.00 10.00 9.00 3.00 3.00 15.00 9.00 21.00 30.00 1.50 3.00 0.50 5.00 100.00 0.96
12.50 2.30 6.80 3.40 25.00 4.50 10.50 15.00 3.30 1.80 5.10 5.50 2.00 2.50 10.00 14.00 26.00 40.00 1.50 2.50 1.00 5.00 100.10 0.89
15.00 6.00 6.00 3.00 30.00 3.50 6.50 10.00 5.50 4.50 10.00 5.00 2.00 3.00 10.00 12.00 18.00 30.00 3.00 6.00 1.00 10.00 100.00 0.89
15.00 3.00 4.50 7.50 30.00 2.00 8.00 10.00 7.00 3.00 10.00 7.00 2.00 1.00 10.00 12.00 18.00 30.00 1.00 7.00 2.00 10.00 100.00 0.87
12.86 4.04 6.26 3.99 27.14 4.43 8.43 12.86 6.76 4.69 11.44 8.00 3.00 3.29 14.29 9.50 16.93 26.43 2.21 3.71 1.93 7.86
7.86 2.96 1.76 3.51 7.86 4.57 2.43 2.86 5.74 7.81 13.56 3.00 4.50 4.21 10.71 7.00 14.43 21.43 1.79 3.29 3.07 2.86
TOTAL BESOINS DE TRANSPORT Moyens financiers Cots d'investissement Cots d'entretien et d'exploitation TOTAL MOYENS FINANCIERS Objectifs de l'A.T.
(amnagement du territoire)
Utilisation mesure du sol Buts et plans de l'A.T.
TOTAL OBJECTIFS DE L'A.T. Nuisances sur l'environnement Environnement humain Environnement naturel Autres nuisances TOTAL NUISANCES SUR L'ENVIRONNEMENT Dveloppement de l'conomie Economie micro-rgionale Economie macro-rgionale
TOTAL DVELOPPEMENT DE L'CONOMIE Nuisances dues aux travaux Nuisances locales Nuisances sur la circulation Nuisances gnrales TOTAL NUISANCES DUES AUX TRAVAUX
TOTAL GENERAL
Coefficient de dtermination R
0.93
Tableau 25
Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs lus vaudois
Cette analyse amne les remarques suivantes : les deux principales proccupations des lus vaudois rsident dans le dveloppement de lconomie (27 %) et le transport (28 %) il est surprenant de constater que lenvironnement nobtient que 10 15 % du poids total251 alors que la raison principale qui fait que les lus des villages vaudois traverss par la route actuelle dsirent rapidement une nouvelle route est le fait des nuisances sonores, qui font partie de la famille nuisances sur lenvironnement . Le fait que des acteurs riverains ne fassent pas partie du COPIL expliquent peut tre cette pondration. On peut aussi arguer que le terme denvironnement peut avoir t confondu avec celui denvironnement naturel alors quil comporte aussi une part denvironnement humain les valeurs des pondrations des acteurs P6 et P9 sont si proches que ceci semble difficilement tre le fruit du hasard. En comparant les pondrations de ces deux acteurs avec celles de P10, P11 et P12, on observe aussi le mme phnomne. On peut se demander si ces acteurs ne sont pas concerts avant dtablir cette pondration. La solidarit rgnant entre les diffrents syndics nexclut pas cette ventualit, mais lauteur ne dispose pas de plus dlments pour tayer cette hypothse
251
Mis part lacteur P3 qui lui affecte 25 %, mais cet acteur nest pas reprsentatif de ce groupe
194
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
le cot de lentretien a une pondration valant prs du double de celle du cot de ralisation les coefficients de dtermination sont trs levs sauf pour lacteur P8 qui a un R2 presque nul. Cet acteur possde un profil de pondration totalement loppos de la moyenne du groupe, comme prsent dans la figure suivante :
Figure 42
Profils de pondration des familles de critres pour les acteurs du groupe Elus vaudois
Cette comparaison mene sur les familles de critres montre que pour lamnagement du territoire, lenvironnement et le dveloppement de lconomie, lacteur P8 est totalement loppos du groupe. On peut aussi relever graphiquement la concidence des profils dacteurs P6 P12, hormis P8 Au vu de la composition de ce groupe dacteurs, lauteur pense que la pondration P8 correspond celle du conseiller dEtat, les pondrations identiques tant le fruit des communes. Ceci sexplique par sa fonction un niveau politique suprieur lui demandant davoir une vision plus globale que celle des communes. Cette hypothse est avance par lauteur mais na nullement t vrifie auprs de lintress
Lacteur reprsentatif dfini ici sera dsign sous le terme de Acteur Transport + conomie . 30 % de la pondration est attribue aux transports et 30 % lconomie.
Analyse de la Comparaison de variantes 1999
195
5.3.2.3
Groupe dacteurs conomique
Associations
de
dveloppement
Lanalyse des deux pondrations individuelles de ce groupe est prsente dans le tableau suivant :
P13 P14 : 2 acteurs
Economie
Critres P13 P14
Acteur reprsentatif 19.0 3.0 4.0 4.0 30.0 3.0 3.0 9.0 5.0 3.0 8.0 7.0 4.0 4.0 15.0 8.0 24.0 32.0 2.0 3.0 1.0 6.0 Moyenne 18.50 3.00 4.25 4.25 30.00 2.85 6.15 9.00 4.75 2.75 7.50 7.00 4.00 4.00 15.00 8.25 24.25 32.50 2.00 3.30 0.70 6.00
Famille de critres
Besoins de transport
Transport motoris Trafic piton et deux-roues Transports collectifs Transport agricole
12.50 2.50 5.00 5.00 25.00 2.50 7.50 10.00 6.00 4.00 10.00 6.00 2.00 2.00 10.00 10.50 24.50 35.00 3.00 6.00 1.00 10.00 100.00
2
24.50 3.50 3.50 3.50 35.00 3.20 4.80 8.00 3.50 1.50 5.00 8.00 6.00 6.00 20.00 6.00 24.00 30.00 1.00 0.60 0.40 2.00 100.00 0.93
TOTAL BESOINS DE TRANSPORT Moyens financiers Cots d'investissement Cots d'entretien et d'exploitation TOTAL MOYENS FINANCIERS Objectifs de l'A.T.
(amnagement du territoire)
Utilisation mesure du sol Buts et plans de l'A.T.
TOTAL OBJECTIFS DE L'A.T. Nuisances sur l'environnement Environnement humain Environnement naturel Autres nuisances TOTAL NUISANCES SUR L'ENVIRONNEMENT Dveloppement de l'conomie Economie micro-rgionale Economie macro-rgionale
TOTAL DVELOPPEMENT DE L'CONOMIE Nuisances dues aux travaux Nuisances locales Nuisances sur la circulation Nuisances gnrales TOTAL NUISANCES DUES AUX TRAVAUX
TOTAL GENERAL
Coefficient de dtermination R
0.89
Tableau 26
Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs Associations de dveloppement conomique
Vu le faible chantillonnage disposition, lanalyse de ce groupe est assez sommaire. Elle amne les remarques suivantes : le dveloppement de lconomie et les transports sont galit, avec une lgre prfrence apporte lconomie, et reprsentent les 2/3 du poids total. Il sagit l dune pondration typique dun acteur conomique futur bnficiaire de la route : il dsire avoir de bonnes conditions de circulation favorables son activit, quelque soit latteinte sur lenvironnement ou le cot de ralisation les moyens financiers ne sont pas trs importants (moins de 10 %) lamnagement du territoire a une importance minime, comparable celle des nuisances des travaux
Lacteur reprsentatif dfini ici sera dsign sous le terme de Acteur conomie + Transport . 35 % de la pondration est attribue lconomie et 30 % aux transports.
196
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
5.3.2.4
Groupe dacteurs lenvironnement
Associations
de
protection
de
Lanalyse des cinq pondrations individuelles de ce groupe est prsente dans le tableau suivant :
P15 P19 : 5 acteurs
Associations de protection de lenvironnement
Critres P15 P16 P17 P18 P19
Acteur reprsentatif 6.0 3.0 4.0 2.0 15.0 16.0 7.0 23.0 9.0 8.0 17.0 9.0 13.0 8.0 30.0 6.0 3.0 9.0 2.5 1.5 2.0 6.0
maximum
Famille de critres
Besoins de transport
Transport motoris Trafic piton et deux-roues Transports collectifs Transport agricole
16.25 3.75 2.50 2.50
7.00 3.00 7.00 3.00 20.00 7.50 7.50
1.30 3.90 3.90 3.90 13.00 13.30 5.70 19.00 4.80 1.20
3.00 3.00 3.00 1.00 10.00 22.50 7.50
0.50 1.50 2.50 0.50
5.61 3.03 3.78 2.18 14.60 15.66 7.14 22.80 8.86 8.34 17.20 9.83 13.38 7.83 31.04 5.08 3.12 8.20 2.65 1.53 2.00 6.18
0.50 1.50 2.50 0.50 5.00 7.50 2.50 15.00 0.00 1.20 6.00 3.75 5.00 3.75 20.10 2.00 0.60 5.00 1.25 0.60 1.00 5.00
16.25 3.90 7.00 3.90 25.00 22.50 12.50 30.00 20.00 20.00 25.00 16.70 21.00 16.70 50.10 7.50 8.00 10.00 4.20 3.30 3.30 9.90
10.64 1.53 3.22 1.72 10.40 8.16 5.36 7.80 11.14 11.66 11.20 6.87 8.38 8.87 19.06 3.08 4.88 3.20 1.55 1.77 1.30 3.72
TOTAL BESOINS DE TRANSPORT Moyens financiers Cots d'investissement Cots d'entretien et d'exploitation TOTAL MOYENS FINANCIERS Objectifs de l'A.T.
(amnagement du territoire)
25.00
22.50 2.50 25.00 7.00 3.00 10.00 3.75 17.50 3.75 25.00 7.00 3.00 10.00 1.25 1.25 2.50 5.00 100.00
5.00
12.50 12.50 25.00 12.50 12.50 25.00 7.00 21.00 7.00 35.00 3.50 1.50
15.00
20.00 5.00 25.00 15.00 5.00 5.00 25.00 2.00 8.00 10.00 2.50 1.50 1.00 5.00 100.00 0.21
30.00
0.00 20.00 20.00 6.70 6.70 6.70 20.10 7.50 2.50 10.00 3.30 3.30 3.30
Utilisation mesure du sol Buts et plans de l'A.T.
TOTAL OBJECTIFS DE L'A.T. Nuisances sur l'environnement Environnement humain Environnement naturel Autres nuisances TOTAL NUISANCES SUR L'ENVIRONNEMENT Dveloppement de l'conomie Economie micro-rgionale Economie macro-rgionale
6.00
16.70 16.70 16.70
50.10
5.40 0.60 6.00 4.20 0.60 1.20 6.00 100.10 0.55
11.95 2.33 2.88 2.49 1.14 1.04 0.95 2.12
TOTAL DVELOPPEMENT DE L'CONOMIE Nuisances dues aux travaux Nuisances locales Nuisances sur la circulation Nuisances gnrales TOTAL NUISANCES DUES AUX TRAVAUX
5.00
2.00 1.00 2.00 5.00 100.00 0.72
9.90
100.00 0.43
TOTAL GENERAL
Coefficient de dtermination R
2
0.55
Tableau 27
Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs Associations de protection de lenvironnement
Cette analyse amne les remarques suivantes : comme on pouvait sy attendre, lenvironnement arrive en tte pour ce groupe avec 30 % du poids total. Seul un acteur a mis la valeur de 50 % pour lenvironnement, les autres tant compris entre 20 % et 35 %. On peut relever ainsi une certaine maturit de ces acteurs, conscients que les enjeux environnementaux ne sont pas les seuls entrer en ligne de compte la deuxime famille en importance sont les moyens financiers. Cette priorit donne ces deux axes souvent prsents comme antagonistes ( lenvironnement renchrit les cots , etc.) peut paratre surprenante mais elle sexplique aisment par le fait que la variante la plus chre est aussi celle qui est la moins bonne pour lenvironnement naturel. Comme les acteurs connaissaient les caractristiques des variantes avant de raliser la pondration, ils ont pu en tenir compte lors de cette tape de travail les profils dacteurs sont plus varis et aucun coefficient de dtermination ne dpasse 0,75
Lacteur reprsentatif dfini ici sera dsign sous le terme de Acteur Environnement + Finances . 30 % de la pondration est attribue lenvironnement et 23 % aux moyens financiers.
Ecart-type 6.45 0.95 1.89 1.41 7.96 6.63 3.63 5.85 7.68 7.81 8.76 5.67 7.09 5.13
Maximum
Moyenne
Minimum
Analyse de la Comparaison de variantes 1999
197
5.3.2.5
Groupe dacteurs Administration publique Environnement et amnagement du territoire
Lanalyse des cinq pondrations individuelles de ce groupe est prsente dans le tableau suivant :
P20 P24 : 5 acteurs
Administration - Environnement et A.T.
Critres P20 P21 P22 P23 P24
Acteur reprsentatif 10.00 3.00 3.00 4.00 20.00 13.00 12.00 25.00 9.00 6.00 15.00 10.00 10.00 5.00 25.00 5.00 5.00 10.00 2.00 1.00 2.00 5.00 maximum Ecart-type 8.93 1.57 1.53 3.03 14.76 11.11 5.94 16.39 2.69 3.81 5.63 2.59 4.80 2.03 6.83 3.76 3.95 7.42 0.48 0.41 1.02 0.45 Maximum 24.80 5.90 5.40 9.00 45.10 30.00 20.00 50.00 12.60 12.65 23.00 11.70 15.00 7.50 26.00 9.00 11.00 20.00 2.50 1.75 3.60 6.00 Moyenne Minimum 1.20 1.80 2.10 0.90 6.00 2.80 4.20 7.00 6.00 3.00 10.00 5.50 2.50 2.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.90 1.00 5.00
Famille de critres
Besoins de transport
Transport motoris Trafic piton et deux-roues Transports collectifs Transport agricole
1.20 1.80 2.10 0.90 6.00 30.00 20.00 50.00 7.80 5.20 13.00 6.30 15.00 3.70 25.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.90 3.60 6.00 100.00 0.60
12.50 3.75 5.00 3.75 25.00 6.00 9.00 15.00 7.00 3.00 10.00 10.00 7.50 7.50 25.00 9.00 11.00 20.00 1.25 1.75 2.00 5.00 100.00 0.42
6.00 3.00 2.25 3.75 15.00 19.50 10.50 30.00 6.00 4.00 10.00 7.50 12.50 5.00 25.00 8.25 6.75 15.00 1.75 1.00 2.25 5.00 100.00 0.73
8.50 2.55 3.40 2.55 17.00 9.60 14.40 24.00 12.60 5.40 18.00 11.70 9.10 5.20 26.00 3.00 7.00 10.00 2.00 1.75 1.25 5.00 100.00 0.77
24.80 5.90 5.40 9.00 45.10 2.80 4.20 7.00 10.35 12.65 23.00 5.50 2.50 2.00 10.00 4.00 6.00 10.00 2.50 1.50 1.00 5.00 100.10 0.11
10.60 3.40 3.63 3.99 21.62 13.58 11.62 25.20 8.75 6.05 14.80 8.20 9.32 4.68 22.20 4.85 6.15 11.00 1.80 1.38 2.02 5.20
14.20 2.50 1.77 5.01 23.48 16.42 8.38 24.80 3.85 6.60 8.20 3.50 6.82 2.82 12.20 4.85 6.15 11.00 0.70 0.48 1.58 0.80
TOTAL BESOINS DE TRANSPORT Moyens financiers Cots d'investissement Cots d'entretien et d'exploitation TOTAL MOYENS FINANCIERS Objectifs de l'A.T.
(amnagement du territoire)
Utilisation mesure du sol Buts et plans de l'A.T.
TOTAL OBJECTIFS DE L'A.T. Nuisances sur l'environnement Environnement humain Environnement naturel Autres nuisances TOTAL NUISANCES SUR L'ENVIRONNEMENT Dveloppement de l'conomie Economie micro-rgionale Economie macro-rgionale
TOTAL DVELOPPEMENT DE L'CONOMIE Nuisances dues aux travaux Nuisances locales Nuisances sur la circulation Nuisances gnrales TOTAL NUISANCES DUES AUX TRAVAUX
TOTAL GENERAL
Coefficient de dtermination R2
Tableau 28
Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs Administration publique Environnement et amnagement du territoire
Cette analyse amne les remarques suivantes : comme pour le groupe dacteurs des associations de protection de lenvironnement, lenvironnement et les moyens financiers arrivent en tte pour ce groupe avec 1/4 du poids total pour chaque famille la variabilit des pondrations est trs leve. Pour le transport, les valeurs varient de 6 45 % avec un cart-type de 15 %. Pour les moyens financiers, les carts sont encore plus marqus : 7 50 % avec 16 % dcart-type. On peut aussi remarquer quun seul acteur (P23) a un coefficient de corrlation lev les besoins en transport sont privilgis par rapport lacteur O.N.G. (22 % au lieu de 15 %) malgr le fait que lamnagement du territoire soit une des activits spcifiques de certains des acteurs de ce groupe, cette famille reste en dessous de 20 % lacteur P24 a un trs faible coefficient de dtermination
Lacteur reprsentatif dfini ici sera dsign sous le terme de Acteur Environnement + Finances . Lenvironnement et les moyens financiers se voient attribuer 25 % chacun.
198
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
5.3.2.6
Groupe dacteurs Administration publique Service des routes
Lanalyse des quatre pondrations individuelles de ce groupe est prsente dans le tableau suivant :
P25 P28 : 4 acteurs
Administration publique Service des routes
Critres P25 P26 P27 P28
Acteur reprsentatif 30.00 5.00 5.00 5.00 45.00 7.50 5.00 12.50 5.00 7.50 12.50 7.00 3.00 2.50 12.50 5.50 7.00 12.50 2.00 2.00 1.00 5.00 maximum Ecart-type 5.62 0.63 2.22 0.63 4.79 0.50 3.00 2.50 1.50 4.35 5.00 5.44 3.21 3.18 11.70 3.39 3.57 6.27 0.88 0.65 0.45 1.50 Maximum 35.00 6.00 9.00 6.00 50.00 7.00 9.00 15.00 6.00 14.00 20.00 15.00 7.50 7.50 30.00 9.00 12.00 20.00 2.50 2.50 1.50 5.00 Moyenne Minimum 24.00 4.50 4.00 4.50 40.00 6.00 3.00 10.00 3.00 4.00 10.00 3.50 0.50 1.00 5.00 1.50 3.50 5.00 0.60 1.00 0.40 2.00
Famille de critres
Besoins de transport
Transport motoris Trafic piton et deux-roues Transports collectifs Transport agricole
27.00 4.50 9.00 4.50 45.00 6.00 9.00 15.00 4.00 6.00 10.00 6.00 3.00 1.00 10.00 9.00 6.00 15.00 2.00 2.00 1.00 5.00 100.00 0.91
35.00 5.00 5.00 5.00 50.00 7.00 3.00 10.00 3.00 7.00 10.00 3.50 0.50 1.00 5.00 8.00 12.00 20.00 1.00 2.50 1.50 5.00 100.00 0.95
35.00 5.00 5.00 5.00 50.00 7.00 3.00 10.00 6.00 14.00 20.00 3.60 0.90 1.50 6.00 4.80 7.20 12.00 0.60 1.00 0.40 2.00 100.00 0.95
24.00 6.00 4.00 6.00 40.00 7.00 3.00 10.00 6.00 4.00 10.00 15.00 7.50 7.50 30.00 1.50 3.50 5.00 2.50 1.50 1.00 5.00 100.00 0.71
30.25 5.13 5.75 5.13 46.25 6.75 4.50 11.25 4.75 7.75 12.50 7.03 2.98 2.75 12.75 5.83 7.18 13.00 1.53 1.75 0.98 4.25
6.25 0.88 3.25 0.88 6.25 0.75 4.50 3.75 1.75 6.25 7.50 7.98 4.53 4.75 17.25 4.33 4.83 8.00 0.98 0.75 0.58 2.25
TOTAL BESOINS DE TRANSPORT Moyens financiers Cots d'investissement Cots d'entretien et d'exploitation TOTAL MOYENS FINANCIERS Objectifs de l'A.T.
(amnagement du territoire)
Utilisation mesure du sol Buts et plans de l'A.T.
TOTAL OBJECTIFS DE L'A.T. Nuisances sur l'environnement Environnement humain Environnement naturel Autres nuisances TOTAL NUISANCES SUR L'ENVIRONNEMENT Dveloppement de l'conomie Economie micro-rgionale Economie macro-rgionale
TOTAL DVELOPPEMENT DE L'CONOMIE Nuisances dues aux travaux Nuisances locales Nuisances sur la circulation Nuisances gnrales TOTAL NUISANCES DUES AUX TRAVAUX
TOTAL GENERAL
Coefficient de dtermination R2
Tableau 29
Analyse des pondrations individuelles Groupe dacteurs Administration publique Service des routes
Cette analyse amne les remarques suivantes : la fonction de transport est primordiale pour ce groupe avec une pondration proche de 50 % les quatre profils de pondration sont trs semblables (coefficients de dtermination proches de lunit) montrant une forte cohrence de ces acteurs les nuisances lenvironnement, les moyens financiers, le dveloppement conomique et lamnagement du territoire sont mis au mme niveau de proccupation (entre 11 et 13 %) dans labsolu, le critre transport motoris reprsente le tiers de la pondration totale. Il sagit dune valeur trs importante, valant prs du double de celle attribue lenvironnement ! ces profils de pondration semblent correspondre des acteurs possdant un systme de valeurs trs technique, que lon peut qualifier de systme de valeurs du pass (priorit au transport, faible considration de lenvironnement ou de lamnagement du territoire)
Lacteur reprsentatif dfini ici sera dsign sous le terme de Acteur Transport . Les transports se voient attribuer un poids de 45 %.
Analyse de la Comparaison de variantes 1999
199
5.3.2.7
Analyse rcapitulative
Une analyse rcapitulative est mene sur la base des pondrations moyennes des six groupes dacteurs :252
28 acteurs - 6 groupes
Rcapitulation par groupes d'acteurs
Administration env. + A.T. Adminsitration routire
Famille de critres
Critres
Besoins de transport
Transport motoris Trafic piton et deux-roues Transports collectifs Transport agricole
16.80 2.80 8.80 3.60 32.00 3.98 5.02 9.00 6.60 10.00 16.60 8.00 3.40 3.40 14.80 8.40 12.40 20.80 2.07 2.62 2.11 6.80 100.00 0.79
12.86 4.04 6.26 3.99 27.14 4.43 8.43 12.86 6.76 4.69 11.44 8.00 3.00 3.29 14.29 9.50 16.93 26.43 2.21 3.71 1.93 7.86 100.01 0.71
18.50 3.00 4.25 4.25 30.00 2.85 6.15 9.00 4.75 2.75 7.50 7.00 4.00 4.00 15.00 8.25 24.25 32.50 2.00 3.30 0.70 6.00 100.00 0.69
5.61 3.03 3.78 2.18 14.60 15.66 7.14 22.80 8.86 8.34 17.20 9.83 13.38 7.83 31.04 5.08 3.12 8.20 2.65 1.53 2.00 6.18 100.02 0.09
10.60 3.40 3.63 3.99 21.62 13.58 11.62 25.20 8.75 6.05 14.80 8.20 9.32 4.68 22.20 4.85 6.15 11.00 1.80 1.38 2.02 5.20 100.02 0.45
30.25 5.13 5.75 5.13 46.25 6.75 4.50 11.25 4.75 7.75 12.50 7.03 2.98 2.75 12.75 5.83 7.18 13.00 1.53 1.75 0.98 4.25 100.00 0.70
15.77 3.57 5.41 3.86 28.60 7.87 7.14 15.02 6.74 6.60 13.34 8.01 6.01 4.32 18.35 6.98 11.67 18.65 2.04 2.38 1.62 6.05
5.61 2.80 3.63 2.18 14.60 2.85 4.50 9.00 4.75 2.75 7.50 7.00 2.98 2.75 12.75 4.85 3.12 8.20 1.53 1.38 0.70 4.25
30.25 5.13 8.80 5.13 46.25 15.66 11.62 25.20 8.86 10.00 17.20 9.83 13.38 7.83 31.04 9.50 24.25 32.50 2.65 3.71 2.11 7.86
14.48 1.56 3.39 1.68 17.65 7.79 4.48 10.18 2.12 3.85 5.84 1.82 7.37 3.51 12.69 2.52 12.58 13.85 0.61 1.33 0.92 1.81
8.45 0.88 1.97 0.97 10.69 5.42 2.61 7.15 1.82 2.63 3.64 1.03 4.35 1.84 7.04 1.97 7.88 9.56 0.38 0.98 0.62 1.25
0.50 1.50 2.10 0.50 5.00 1.00 2.50 5.00 0.00 1.20 5.00 3.50 0.50 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 0.40 2.00
TOTAL BESOINS DE TRANSPORT Moyens financiers Cots d'investissement Cots d'entretien et d'exploitation TOTAL MOYENS FINANCIERS Objectifs de l'A.T.
(amnagement du territoire)
Utilisation mesure du sol Buts et plans de l'A.T.
TOTAL OBJECTIFS DE L'A.T. Nuisances sur l'environnement Environnement humain Environnement naturel Autres nuisances TOTAL NUISANCES SUR L'ENVIRONNEMENT Dveloppement de l'conomie Economie micro-rgionale Economie macro-rgionale
TOTAL DVELOPPEMENT DE L'CONOMIE Nuisances dues aux travaux Nuisances locales Nuisances sur la circulation Nuisances gnrales TOTAL NUISANCES DUES AUX TRAVAUX
TOTAL GENERAL
Coefficient de dtermination R2
Tableau 30
Analyse des pondrations moyennes de chaque groupe dacteurs
Par rapport aux tableaux prcdents, deux valeurs sont ajoutes : le minimum et le maximum absolus sur lensemble des 28 pondrations individuelles. Cette analyse amne les remarques suivantes : par rapport la moyenne gnrale de six groupes, les valeurs des coefficients de dtermination sont trs varies. Ceci montre quun profil dacteur moyen na pas de sens dans le cas de la Comparaison de variantes 1999 .253 Les profils de pondration des familles de critres pour les six groupes dacteurs prsents la page suivante illustrent bien cette diversit des pondrations le dveloppement conomique et les transports prsentent de fortes variations avec des carts-types valant 10 % le groupe dacteur des O.N.G. prsente un coefficient de dtermination trs faible. Ceci signifie que ce groupe prsente un profil fortement oppos celui de la moyenne ou des autres acteurs
252
Ce procd a lavantage de ne pas prtriter les groupes composs de moins dacteurs que dautres. Il faut toutefois relativiser cet exercice au vu du dcalage existant parfois entre le profil de pondration de certains acteurs par rapport leur groupe de rfrence (R2 trs faible) Par extension, pour tous les projets routiers
253
Maximum des maximums 35.00 7.00 12.00 9.00 50.00 30.00 20.00 50.00 20.00 20.00 25.00 18.00 21.00 16.70 50.10 14.00 28.00 40.00 4.20 7.00 5.00 10.00
Minimum des minimums
maximum
MOYENNE
Ecart-type
Economie
Maximum
Minimum
Elus VD
Elus VS
O.N.G.
200
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
Elus VS Elus VD Economie O.N.G. A.T. + Etat env. Services routes
15.00
10.00
5.00
0.00 Besoins de transport Moyens financiers Objectifs de l'A.T. Nuisances sur l'environnement Dveloppement de Nuisances dues aux l'conomie travaux
Figure 43
Profils de pondration des familles de critres pour les six groupes dacteurs
la seule famille o tous les groupes saccordent est celle des nuisances dues aux travaux. Aucun acteur ne lui accorde plus de 10 % la famille de lamnagement du territoire ne dpasse pas 25 % chez tous les acteurs
Sur la base de cette analyse, quatre profils dacteurs reprsentatifs peuvent tre dfinis :254
Acteur A
Famille de critres
Acteur B
Acteur C
Environnement + Finance
Acteur D
Transport
Transport + conomie conomie + Transport
Besoins de transport Moyens financiers Objectifs de l'A.T. Nuisances sur l'environnement Dveloppement de l'conomie Nuisances dues aux travaux
30 10 15 15 25 5
25 10 10 15 35 5
15 25 15 30 10 5
45 12.5 12.5 12.5 12.5 5
Tableau 31
Pondrations des acteurs reprsentatifs de la Comparaison de variantes 1999
254
Seules les valeurs des familles des critres seront dfinies pour ces acteurs reprsentatifs
Analyse de la Comparaison de variantes 1999
201
Les profils de pondration des familles de critres pour ces quatre acteurs reprsentatifs sont prsents ci-dessous :
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0 Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0 Besoins de transport Moyens financiers Objectifs de l'A.T. Nuisances sur l'environnement Dveloppement de l'conomie Nuisances dues aux travaux
Figure 44
Profils de pondration des familles de critres pour les quatre acteurs reprsentatifs
5.3.2.8
Corrlation avec les profils dacteurs reprsentatifs
Une corrlation des pondrations individuelles avec les profils dacteur reprsentatifs dtermins est ralise ici. La raison qui pousse lauteur effectuer cet exercice vient du fait quil apparat que certains acteurs ne sont pas reprsentatifs du groupe dans lequel ils sont placs. Il peut tre intressant alors de classer les acteurs selon les quatre catgories dacteurs reprsentatifs plutt que selon les rles ou les fonctions. Cette analyse se droule de la manire suivante : le profil de pondration des acteurs reprsentatifs dfinis auparavant sont rappels ici. Pour limiter le volume danalyse, seuls les pondrations des six familles de critres seront considres dans lanalyse pour chaque acteur, un coefficient de dtermination R2 d'une rgression linaire est dtermine par rapport aux valeurs moyennes des quatre acteurs reprsentatifs trois indices de confiance IC1 sont dtermins en fonction de la valeur de R2 :
-
R2 > 0,75
IC1 = 0 IC1 = 1 IC1 = 2
0,75 > R2 > 0,50
R2 0,50255
255
Ces valeurs ont t fixes par lauteur. Lexercice peut tre ralis aussi avec dautres valeurs
202
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
pour chaque acteur, on dtermine la somme S des deux familles dterminantes correspondantes chaque acteur reprsentatif256 trois indices de confiance IC2 sont ensuite dtermins en fonction de la valeur de cette somme :
-
S > 60 %
IC2 = 0 IC2 = 1 IC2 = 2
60 % > S > 40 %
S 40 %
un indice de confiance agrg IC est obtenu par la multiplication257 des indices IC1 et IC2 Si IC = 0, la confiance de lhypothse lacteur a un profil correspondant avec lacteur reprsentatif est totale. Si IC a une valeur maximale de 4, on ne peut pas faire confiance cette hypothse
pour chaque acteur, on obtient autant dindices de confiance agrg IC quil y a dacteurs reprsentatifs pour chaque acteur, on dtermine ensuite, si cest possible, la meilleure correspondance, cest dire la plus faible valeur dindice, avec un acteur reprsentatif. Cette correspondance est admise vrifie quand IC vaut 0 ou 1. Un acteur peut correspondre plusieurs acteurs reprsentatifs. Si cette correspondance est observe simultanment pour trois acteurs reprsentatifs, une analyse est ralise pour retenir les deux meilleures correspondances, ceci en donnant la priorit IC1 Il est aussi possible quaucun acteur reprsentatif ne corresponde au profil de lacteur considr
Les rsultats de cette analyse de corrlation sont prsents la page suivante.
256
Pour le cas de lacteur reprsentatif D, seule la famille transport est considre. Pour les acteurs A et B, cette somme est identique Lintrt de choisir une moyenne gomtrique est que si une seule condition de confiance est ralise car elle vaut 0, alors lindice global vaut aussi 0 indpendamment de la valeur de lautre indice
257
Analyse de la Comparaison de variantes 1999
203
Acteur A Transport
Acteur B Economie
Famille de critres
Besoins de transport Moyens financiers Objectifs de l'A.T. Nuisances sur l'environnement Dveloppement de l'conomie Nuisances dues aux travaux
20 10 20 10 30 10 100
20 5 20 10 40 5 100
40 10 18 14 14 4 100
40 10 5 30 10 5 100
40 10 20 10 10 10 100
25 15 10 15 30 5 100
35 10 10 15 20 10 100
20 15 25 25 5 10 100
25 15 10 15 30 5 100
25 15 5 10 40 5 100
30 10 10 10 30 10 100
30 10 10 10 30 10 100
25 10 10 10 35 10 100
35 8 5 20 30 2 100
29.29 10.93 12.72 14.57 25.29 7.21 100
30.0 10.0 15.0 15.0 25.0 5.0 100
25.0 10.0 10.0 15.0 35.0 5.0 100
15.0 25.0 15.0 30.0 10.0 5.0 100
Environnement + Finances
Elus valaisans
Elus vaudois
Economie
MOYENNE
45.0 12.5 12.5 12.5 12.5 5.0 100
TOTAL GENERAL
Coefficient de dtermination R2 Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D
0.56 0.70 0.19 0.07
0.55 0.77 0.12 0.04
0.70 0.23 0.00 0.94
0.40 0.14 0.17 0.65
0.46 0.07 0.01 0.88
0.78 0.94 0.00 0.29
0.80 0.48 0.01 0.86
0.00 0.13 0.38 0.07
0.78 0.94 0.00 0.29
0.58 0.91 0.03 0.14
0.81 0.84 0.12 0.43
0.81 0.84 0.12 0.43
0.66 0.92 0.15 0.18
0.87 0.81 0.00 0.52
Somme des familles dterminantes Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D Indices de confiance agrgs IC Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D 1 1 4 4 1 0 4 4 1 2 4 0 2 2 4 2 2 2 4 0 0 0 4 4 0 2 4 0 4 4 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 1 0 4 4 0 0 4 2 50.00 60.00 54.00 50.00 50.00 55.00 55.00 25.00 55.00 65.00 60.00 60.00 60.00 65.00 50.00 60.00 54.00 50.00 50.00 55.00 55.00 25.00 55.00 65.00 60.00 60.00 60.00 65.00 20.00 15.00 24.00 40.00 20.00 30.00 25.00 40.00 30.00 25.00 20.00 20.00 20.00 28.00 20.00 20.00 40.00 40.00 40.00 25.00 35.00 20.00 25.00 25.00 30.00 30.00 25.00 35.00
Classification
A- B
A-B A-D
A-B
A-B
A- B
A- B
A-B
Acteur A Transport
Acteur B Economie
Famille de critres
Besoins de transport Moyens financiers Objectifs de l'A.T. Nuisances sur l'environnement Dveloppement de l'conomie Nuisances dues aux travaux
25 25 10 25 10 5 100
20 15 25 25 10 5 100
13 19 6 50 6 6 100
10 30 20 20 10 10 100
5 25 25 35 5 5 100
6 50 13 25 0 6 100
25 15 10 25 20 5 100
15 30 10 25 15 5 100
17 24 18 26 10 5 100
45 7 23 10 10 5 100
45 15 10 10 15 5 100
50 10 10 5 20 5 100
50 10 20 6 12 2 100
40 10 10 30 5 5 100
26.15 20.36 15.00 22.66 10.57 5.28 100
30.0 10.0 15.0 15.0 25.0 5.0 100
25.0 10.0 10.0 15.0 35.0 5.0 100
15.0 25.0 15.0 30.0 10.0 5.0 100
Environnement + Finances
Service des routes
MOYENNE
45.0 12.5 12.5 12.5 12.5 5.0 100
TOTAL GENERAL
Coefficient de dtermination R2 Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D
0.09 0.01 0.68 0.29
0.08 0.00 0.46 0.11
0.01 0.01 0.73 0.00
0.19 0.22 0.56 0.08
0.12 0.18 0.74 0.10
0.20 0.22 0.57 0.04
0.56 0.45 0.30 0.38
0.00 0.00 0.78 0.00
0.00 0.02 0.94 0.03
0.54 0.11 0.00 0.87
0.64 0.25 0.00 0.98
0.73 0.36 0.03 0.92
0.61 0.17 0.00 0.93
0.31 0.05 0.20 0.65
Somme des familles dterminantes Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D 35.00 30.00 19.00 20.00 10.00 35.00 30.00 19.00 20.00 10.00 25.00 20.00 13.00 10.00 5.00 6.00 6.00 6.00 45.00 30.00 27.00 55.10 60.00 70.00 62.00 45.00 45.00 30.00 27.00 55.10 60.00 70.00 62.00 45.00 25.00 15.00 17.00 45.10 45.00 50.00 50.00 40.00
50.00 40.00 69.10 50.10 60.00 75.00 40.00 55.00 50.00 17.00 25.00 15.00 16.00 40.00
Indices de confiance Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 0 4 1 2 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 1 2 4 0 1 2 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 2 4 2
Classification
A-D A-D
Tableau 32
Corrlation des acteurs avec les acteurs reprsentatifs
Acteur D Transport
28 acteurs - 6 groupes - 4 profils d'acteur reprsentatif
Corrlation avec un profil d'acteur reprsentatif
Associations de protection de l'environnement
+ Economie + Transport
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
Acteur C
Administration environnement et A.T.
Acteur D Transport
28 acteurs - 6 groupes - 4 profils d'acteur reprsentatif
Corrlation avec un profil d'acteur reprsentatif
+ Economie
Acteur C
+ Transport
P10
P11
P12
P13
P14
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
204
LES ACTEURS DU PROJET ROUTIER
On obtient les correspondances suivantes :
Acteurs P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 TOTAL 11 9 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Acteur A 9 Acteur B 9 9 9 9 Acteur C Acteur D Impossible se prononcer
Tableau 33
Rcapitulatif de la catgorisation des acteurs selon les acteurs reprsentatifs
On peut effectuer les commentaires suivants : lhtrognit du groupe Elus valaisans est confirme car pour quatre acteurs correspond quatre situations diffrentes. Deux acteurs (P3 et P5) ont mme un profil de pondration qui correspond un reprsentant de ladministration routire lhomognit du groupe Elus vaudois , hormis lacteur P8, est confirme. Sur les six acteurs restants de ce groupe, la combinaison A B apparat cinq fois cette remarque est aussi valable pour les acteurs conomiques
Analyse de la Comparaison de variantes 1999
205
mis part un acteur, les acteurs du groupe Associations de protection de lenvironnement correspondent tous avec lacteur C le groupe Administration publique Amnagement du territoire et environnement est trs contrast, comme son intitul dailleurs. On trouve trois fois lacteur C Environnement et deux fois un acteur Transport . On peut affirmer que ce groupe dacteur comprend donc deux sous-groupes distincts : un sous-groupe orient environnement et un autre orient transport mis part lacteur P28, le groupe de ladministration des routes correspond bien avec le profil dacteur D les acteurs reprsentatifs A et B sont trs semblables et il apparat sept fois la combinaison A B. On peut se demander sil est bien pertinent de les conserver sparment seuls quatre acteurs sur 28 (15 %) ne peuvent tre catgoriss
5.3.2.9
Commentaires
Dans la globalit, les hypothse de dpart sont vrifies. Seuls quelques acteurs ne sont pas reprsentatifs de la catgorie dans laquelle ils ont t classs, comme P3 et P5 qui devraient tre classs dans le groupe Service des routes ou P8 qui possde un profil inclassable . Cet exercice ralis sur la Comparaison de variantes 1999 peut se rvler tre intressant pour le projeteur routier. En effet, si celui-ci tudie un projet de faible envergure ou un avant-projet trs sommaire, il peut lors de lutilisation de la mthode daide multicritre la dcision utiliser des profils dacteurs reprsentatifs des diffrents points de vues. Ces profils reprsentatifs peuvent aussi lui tre utile pour catgoriser les acteurs.
Postulat 46
Lors dune phase dtude prliminaire ou dans le cas dun projet de faible envergure, le projeteur routier peut considrer les diffrents points de vues en utilisant des profils dacteurs reprsentatifs
Il est clair que si le projeteur dispose dun ensemble de pondrations individuelles comme dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 , ces profils dacteurs reprsentatifs ne sont plus utiliser.
Historique du dveloppement durable
207
6.
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le dveloppement durable est un enjeu important qui doit tre considr pour toutes les activits humaines actuelles et futures. Il consiste fournir tous les tres humains et leurs socits les moyens de vivre et de se dvelopper sans puiser les ressources de notre Plante et sans compromettre la capacit des gnrations futures rpondre leurs besoins. (Faucon M., 1997) En raison de la couverture territoriale importante des rseaux dinfrastructures routires et de leurs effets, de la multiplicit des acteurs concerns et des nombreux domaines affects, les projets routiers sont directement concerns par ce nouveau paradigme socital.
6.1
H ISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Depuis la rvolution industrielle, le modle conomique de la socit occidentale considre lenvironnement comme tant une source de matires premires que lon peut exploiter et dgrader, cette dgradation tant compense par la cration de capital. (Delacrtaz Y., 1998) Ds les annes 1960, les limites dun dveloppement conomique continu et extensible l infini , dans un monde o les ressources environnementales possdent des limites finies, sont devenues perceptibles. Les atteintes environnementales lchelle plantaire causes par les activits anthropiques (smog de Londres, Minimata, Seveso, Tchernobyl, pluies acides, trou dans la couche dozone, etc.), la dgradation du cadre de vie (accroissement des zones urbaines, btonnage et destruction des paysages, eutrophisation des lacs, destruction des forts tropicales, dsertification, etc.), la forte dpendance de la socit vis--vis de ressources non-renouvelables (crises ptrolires de 1973, 1980 ou celle de lan 2000), les ingalits sociales dans la distribution des richesses258 sont autant dlments qui ont montr que ce modle de dveloppement ne pouvait pas tre conserv tel quel sans mener le Monde une proche catastrophe. A la fin du 20me sicle, lhumanit se trouve un tournant crucial de son existence. Les flaux sociaux (famine, guerre, etc.) ne cessent de saggraver, les cosystmes se dgradent fortement et les ingalits perdurent et saccroissent. Pour assurer un avenir plus sr et prospre pour tous, une prise de conscience lchelle plantaire est ncessaire. Les rponses aux problmes poss aux hommes doivent tre labores conjointement et harmonieusement, cest dire en respectant les diffrents intrts en jeu. En raison de la complexit des problmes environnementaux et des multiples interactions entre les activits humaines, les problmes doivent tre rsolus au niveau du village mondial , aucune nation ne pouvant satisfaire ses besoins par ses seuls moyens.259 (Agenda 21, 1993)
258 259
Rappelons que 20 % de la population mondiale possde 83 % du revenu mondial (Agenda 21, 1993) La pollution ne connat pas de frontires et doit tre traite au niveau international
208
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Plusieurs modes dutilisation des ressources environnementales sont envisageables dans une situation de dveloppement conomique. Ces diverses possibilits dutilisation des ressources environnementales sont reprsentes la figure suivante dans un diagramme o lvolution positive260 de la richesse dun pays, reprsente par son produit national brut (PNB), est compare lvolution des charges environnementales (consommation de ressources non-renouvelables, pollution, emprises, etc.) y relatives. On peut relever quatre possibilits de couplage suivantes entre ces deux valeurs : (Knoepfel P., 1997a)
croissance quantitative : la charge environnementale crot dans les mmes proportions que le PNB (environnement PNB). Le dveloppement conomique saccompagne ainsi dune dgradation progressive de lenvironnement. Il sagit en quelque sorte dune solution sans avenir, laccomplissement de la socit humaine saccompagnant de la destruction de son environnement dcouplage (1970) : la charge environnementale crot moins vite que le PNB (0 < environnement < PNB). Le problme de cette option rside dans le fait que le taux de croissance des charges environnementales reste toujours positif croissance qualitative (1980) : la charge environnementale se stabilise (environnement 0). Par contre, la qualit de lenvironnement ne samliore pas et peut rester nettement insuffisante si cette mesure est prise trop tardivement dveloppement durable (1992) : lutilisation des ressources environnementales dcrot (environnement < 0) et lon peut ainsi atteindre une qualit environnementale satisfaisante. Il sagit de la seule solution permettant dassurer un environnement de qualit sans tre en contradiction avec le dveloppement de la socit humaine
Produit national brut (PNB) Charge environnementale
Croissance quantitative Dcouplage
Croissance qualitative
Dveloppement durable
Temps
Figure 45
Couplage de la croissance conomique et de la charge environnementale (Knoepfel P., 1997a)
260
On peut supposer que cet objectif de croissance de la richesse est le but de toute socit humaine. Cette analyse aurait pu aussi se baser sur des valeurs autres que montaires, en utilisant par exemple des valeurs tenant compte du dveloppement humain (ducation, sant, esprance de vie, etc.), telles que retenues par les Nations Unies. Ceci ne change cependant pas les conclusions mises par aprs
Historique du dveloppement durable
209
La dcroissance de la charge environnementale permettant dassurer un dveloppement durable peut tre obtenue de manire coercitive ou incitative par lapparition de nouveaux procds industriels et le progrs technologique permettant daugmenter la production de richesse par unit environnementale consomme. Le professeur P. Knoepfel cite dans son cours (Knoepfel P., 1997a) lexemple de lintensit nergtique ncessaire pour produire 1'000 $ de PIB (produit intrieur brut). Si en Suisse, 0,11 Tep (Tonnes-quivalent ptrole) sont ncessaires, aux tats-Unis cette valeur monte 0,45 et atteint 2,53 en Chine. Mme sil est ncessaire de relativiser ces valeurs, notamment par rapport la structure conomique de ces diffrents pays,261 on peut toutefois relever quune importante marge de manuvre existe pour diminuer la pression sur les ressources non-renouvelables en amliorant lefficacit des processus de production et de consommation de ces ressources. Les diffrentes tapes marquantes du dveloppement de la conscientisation environnementale au niveau mondial, qui a amen tablir la notion de dveloppement durable, sont les suivantes : (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) En 1972, le Club de Rome publie le clbre rapport Halte la croissance ? . Ce rapport tait le premier tenter de prvoir l'tat futur de la plante. Ses conclusions sont catastrophiques : si les tendances dvolution de la dmographie, de la consommation nergtique et de la pression sur lenvironnement continuent ce rythme sans bouleversement technologique, la socit conomique scroulera dans la premire moiti du 21me sicle En 1972, la Confrence des Nations Unies sur l'environnement humain de Stockholm constitue la premire runion mondiale sur l'Homme et son milieu. La Dclaration issue de cette confrence insiste sur l'importance de prendre en compte les questions environnementales dans la planification et duvrer de faon protger et amliorer la qualit de l'environnement Le 28 octobre 1982, lAssemble gnrale des Nations Unies adopta par rsolution la Charte mondiale de la nature. Celle-ci stipulait que les activits pouvant
avoir un impact sur la nature seront contrles et les meilleures techniques disponibles, susceptibles de diminuer l'importance des risques ou d'autres effets nuisibles sur la nature, seront employes
En 1982, la Confrence de Nairobi fut un chec. Les pressions des pays du Sud amenrent les Nations Unies crer en 1983 la Commission mondiale sur l'environnement et le dveloppement. Cette commission, prside par Mme Gro Harlem Brundtland avait pour mandat de proposer en termes clairs des
stratgies en vue d'apporter une solution durable quant la faon de satisfaire les besoins et les aspirations de l'humanit actuelle sans compromettre la capacit des gnrations futures .
Le rapport final de la Commission, intitul Notre avenir tous (Our commun Future), fut publi en 1987. Il sagissait dune mise en garde pour lhumanit qui soulignait que, sans rvision de nos modes de vie et de dveloppement, nous nous exposions des souffrances humaines inacceptables et une dgradation dramatique de lenvironnement. La Commission Brundtland dfinit aussi le concept de dveloppement durable comme tant un dveloppement qui rpond
aux besoins du prsent sans compromettre la possibilit pour les gnrations venir de satisfaire les leurs
261
Pour la production dune richesse quivalente, une activit de services est nettement moins nergivore quune industrie lourde par exemple. La Suisses, qui a une conomie fortement tertiaire, est ainsi avantage dans cette analyse
210
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
En 1992, le Sommet de la Terre sest tenu Rio de Janeiro afin de concrtiser les engagements internationaux envers le dveloppement durable. Il a rassembl les reprsentants officiels de 179 pays, de multiples organisations non-gouvernementales et des reprsentants de la socit civile. Le sommet de la Terre a produit les documents suivants, qui depuis prs de huit ans influencent les politiques publiques de nombreux pays, dont la Suisse :
-
la Dclaration de Rio sur lenvironnement et le dveloppement durable comportant 27 principes trs gnraux la Convention des Nations Unies sur le changement climatique visant stabiliser les missions de gaz effet de serre la Convention sur la diversit biologique visant prserver la biodiversit les Principes cadres sur la protection des forts un Agenda 21 qui est un vaste programme daction pour le 21me sicle. Il consiste en un catalogue de recommandations de quarante mesures non contraignantes dans les domaines du dveloppement durable, de la lutte contre la pauvret et l'exclusion, de la production et de la consommation, de l'agriculture durable, de la gouvernance et des processus de dcision et de la protection de l'environnement. LAgenda 21 est destin toutes les composantes de la socit : gouvernements nationaux, organisations nongouvernementales, entreprises, collectivits locales, etc. (Agenda 21, 1993; ODT, 2000a) Il propose aussi la mise en place d'indicateurs du dveloppement durable et la ralisation d'Agendas 21 locaux (AIPCR, 1999)
Le 11 dcembre 1997, le Protocole concernant la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est tabli Kyoto. Ce document fixe des valeurs limites dmissions de gaz effet de serre, notamment le CO2. 38 pays industrialiss se sont vus attribus une valeur de diminution respecter pour 2010. Lobjectif reste nanmoins modeste, la rduction tant en moyenne de 5,2 % par rapport aux missions de 1990 La confrence mondiale sur le rchauffement climatique qui doit se tenir du 20 au 24 novembre 2000 La Haye, a pour but de prciser les modalits dapplication du Protocole de Kyoto : limitation de lusage des combustibles metteurs de CO2, contrle du respect des engagements, aides financires et techniques, etc. Deux profondes divergences subsistent cependant entre les tats-Unis, lEurope et les Pays en voie de dveloppement :
-
mcanismes de flexibilit ou droits de polluer . Chaque pays industrialis reoit des permis dmissions ngociables, cest dire quil peut vendre ou acheter un droit dmission de CO2. Dans le mme ordre dides, le transfert de technologies propres vers les pays en voie de dveloppement, les Pays de lEurope de lEst ou les pays mergents contribue attribuer un crdit dmission de CO2. Le principe de ces droits polluer, dfendu par les tatsUnis, est de recourir au march afin de diriger leffort l o il est le moins coteux la dfinition exacte des puits de carbone que sont les forts (la croissance des arbres consomme du CO2) et les ocans. Ces puits de carbone absorbent 50 % des rejets annuels de CO2
Ces dsaccords font craindre un chec programm davance pour cette runion pourtant cruciale pour lavenir de la Plante.
Prsentation du dveloppement durable
211
6.2
P RESENTATION DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
La dfinition du dveloppement durable (sustainable development en anglais) couramment utilise est celle inspire des travaux de la Commission Brundtland : (AIPCR, 1999)
Le dveloppement durable est un processus de dveloppement qui rpond aux besoins sociaux, environnementaux et conomiques du prsent sans compromettre la capacit des gnrations futures de rpondre aux leurs
Ce concept exclut les positions radicales tant cologistes qu'conomiques. Il sagit dun compromis acceptable pour tous, bien que sa mise en application s'avre extrmement difficile. Il montre aussi que lon ne peut plus rsoudre les problmes sectoriellement mais que lon doit les traiter globalement. On peut remarquer que cette dfinition du dveloppement durable place lhomme et ses besoins au cur du processus. Il sagit l dune vision qualifie danthropocentre. (Knoepfel P., 1997a) Le dveloppement durable est li un certain nombre de principes lis lenvironnement, lconomie et la socit : Principe de prcaution Le principe de prcaution met l'accent sur le risque de dommages graves l'environnement qu'il est ncessaire de prvenir dans une situation d'incertitude et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment Principe de rversibilit La rversibilit se traduit par des mesures conservatoires rservant la faisabilit et des dcisions par tapes lies au progrs des connaissances, permettant de ne pas sengager dans des impasses et de pouvoir revenir sur des dcisions Principe de subsidiarit La subsidiarit est un principe selon lequel les pouvoirs sont dlgus diffrents niveaux. (AIPCR, 1999) Ce principe souligne qu'aucune rponse ne peut tre trouve un seul niveau et que c'est l'articulation des comptences entre les niveaux qui est la cl de vote de la gouvernance de demain. Elle fonde l'action sur des obligations de pertinence et non sur des obligations de moyens. En Suisse, le fdralisme dexcution (loi fdrale applique par les cantons) est une forme de subsidiarit dans la mise en uvre dune politique publique. Lavantage du principe de subsidiarit rside dans le fait que lon tient compte des particularits locales small is beautiful . Par contre, lapplication du dveloppement durable risque dtre fortement diffrencie et de subir des atteintes de la part dacteurs puissants au niveau local (Knoepfel P., 1997a)
212
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Comme prsent dans la figure suivante, trois dimensions sont associes au dveloppement durable : dimension environnementale dimension sociale dimension conomique
Cette figure prsente les objectifs de chaque dimension ainsi que les conflits potentiels existants entre elles. Par exemple, les migrations des habitants des pays pauvres et surpeupls vers les pays industrialiss la recherche de travailleurs peu qualifis, qui est une dimension conomique, peut entraner de fortes tensions sur le plan social du pays daccueil (intgration de diverses cultures, structure de la population fortement modifie, etc.).
COMPATIBILITE ECOLOGIQUE
Protection de la biosphre
- capacit d'absorption - utilisation mesure des ressources - maintien de la biodiversit
Environnement
Crises ptrolires Spculations
Dveloppement durable
COMPATIBILITE ECONOMIQUE
Forts tropicales Brevets vivants O.G.M.
Economie
Migrations Dlocalisations Mondialisation
Social
Distribution quitable des chances
- entre individus - Nord-Sud - Est - Ouest - entre gnrations
COMPATIBILITE SOCIALE
Dveloppement conomique stable
- meileure qualit de vie - plein emploi - stabilit des prix - quilibres des finances publiques
Figure 46
Les trois dimensions de la durabilit (CI-Rio, 1997; Knoepfel P., 1997a)
Ces trois dimensions doivent tre quilibres, la satisfaction dun besoin ne devant pas se faire au dtriment dun autre. Ainsi, en appliquant de principe au cas dune infrastructure routire, si la rponse un besoin conomique daccessibilit dune zone artisanale (dimension conomique) consiste en la ralisation dune route daccs dtruisant un cosystme rare (dimension environnementale) ou traversant des zones habites (dimension sociale), les principes du dveloppement durable ne sont pas assurs car les besoins sont fortement dsquilibrs. Le dveloppement durable est un quelque sorte un plateau triangulaire quilatral charg sur ses trois sommets et reposant sur son barycentre. Pour assurer lquilibre de lensemble, les charges appliques sur les sommets du triangle doivent tre identiques, sinon lensemble bascule. Ainsi, la notion de dveloppement durable se base une stratgie de triple dividende, cest dire que les avantages amens par lapplication dune stratgie de dveloppement sont quitablement rpartis sur les domaines conomiques, environnementaux et sociaux. Un besoin ne doit pas tre satisfait aux dpens des autres. Cette stratgie est aussi appele gagnant gagnant ou win win . Si les
Prsentation du dveloppement durable
213
avantages ne concernent que deux dimensions (double dividende) du dveloppement durable, on peut avoir les trois cas suivants : (AIPCR, 1999)
dveloppement vivable dont les stratgies sont orientes la fois vers le progrs social et le respect de l'environnement dveloppement viable dont les stratgies sont orientes la fois vers l'efficacit conomique et le respect de l'environnement dveloppement quitable dont les stratgies sont orientes la fois vers le progrs social et lefficacit conomique
La figure suivante prsente ces diffrentes notions de dveloppement selon le nombre de domaines bnficiaires dune stratgie donne.
Respect de l'environnement
Dveloppement viable Dveloppement vivable
Dveloppement durable Dveloppement quitable
Efficacit conomique
Progrs social
Figure 47
Les diffrentes notions de dveloppement
Le document explicatif de la stratgie du DETEC explicite les diffrentes dimensions du dveloppement durable. (Agenda 21, 1993; DETEC, 2000) Pour la dimension cologique, le dveloppement est durable lorsqu'il permet de : assurer l'panouissement des tres humains et des cosystmes maintenir l'utilisation des ressources renouvelables stabiliser ou rduire la consommation des ressources non-renouvelables maintenir long terme les diverses missions polluantes un niveau minimum rduire le risque ainsi que les effets des catastrophes cologiques
214
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Pour la dimension conomique, le dveloppement est durable lorsque : le rendement conomique et la richesse de la socit peuvent tre sauvegards long terme et tre amliors sur le plan qualitatif plutt que quantitatif l'conomie est comptitive, qu'elle permet la cration d'emplois et l'amlioration du bien-tre gnral les prix assument l'essentiel de la gestion sur les marchs et qu'ils refltent les cots externes ainsi que la pnurie de ressources, de facteurs de production, de biens et de services
S'agissant de la dimension sociale, le dveloppement est durable lorsque : les droits de l'homme sont respects et les droits dmocratiques garantis l'esprance de vie est prolonge dans les pays pauvres l'panouissement culturel est assur la protection sociale est garantie et que la rpartition quitable des revenus et des richesses ainsi que l'galit entre l'homme et la femme sont encourages la sant des individus est non seulement protge mais encore amliore
La prise en compte des effets long terme des ralisations techniques est assure par la prise en compte des intrts des enfants natre (gnrations futures). (AIPCR, 1999) Cette considration nest pas vidente raliser et pose de nombreuses difficults dintgration dans les mthodes de gouvernance et de processus participatifs. Il sagit en effet dassurer la reprsentation des intrts de tiers qui par dfinition sont absents. N. Georgescu-Roegen, cite par Y. Delacrtaz, ne croit pas ltre humain capable de consentir des sacrifices immdiats au profit de gnrations futures :
A cause de sa nature biologique, lhomme a le souci de ses descendants immdiats, mais gnralement point au del de ses arrire-petits-enfants. Il ny a aucun cynisme ni pessimisme croire que () lhumanit nabandonnerait pas volontiers ses fastes actuels en vue de faciliter la vie des humains qui natront dans dix ou vingt gnrations. () Tout se passe comme si lespce humaine avait choisi de mener une vie brve mais excitante, laissant aux espces moins ambitieuses une existence longue mais monotone. (Delacrtaz
Y., 1998)
Lhomme adopte par nature plus un comportement de cigale que de fourmi, la satisfaction de ses besoins court ou moyen terme lemportant largement sur celle de ses besoins long terme.
Politique des transports et mobilit durable
215
6.3
P OLITIQUE DES TRANSPORTS ET MOBILITE
DURABLE
La dfinition du transport durable propose par le Centre pour un Transport durable du Canada, qui est cite par lAIPCR, (AIPCR, 1999) est la suivante :
Un transport durable sentend dun systme qui permet aux particuliers et aux socits de satisfaire leurs principaux besoins daccs dune manire consistante et compatible avec la sant des humains et des cosystmes, sous le signe de lquit au cur des gnrations et entre celles-ci; est abordable, fonctionne efficacement, offre un choix de modes de transports et appuie une conomie dynamique ; limite les missions et les dchets de manire ce que ceux-ci ne dpassent pas la capacit de la plante de les absorber, rduit au minimum la consommation de ressources non renouvelables, rutilise et recycle ses composantes et rduit au minimum le bruit et lutilisation des terrains
Le document de lAIPCR (AIPCR, 1999) relatif la mise en uvre dune politique des transports durable rappelle que celle-ci ncessite une prise en compte des transports dans une approche globale intgrant planification, ressources, environnement et dveloppement locaux. Ainsi, les effets dune politique des transports doivent tre valus dans de nombreux domaines, notamment ceux abords au chapitre 3.3.2, page 118. La politique publique des transports en Suisse est base sur la durabilit. Les objectifs qui dcoulent de ce choix sont les suivants : (DETEC, 2000)
Viabilit cologique
rduire long terme les atteintes l'environnement imputables aux transports (polluants atmosphriques, nuisances sonores, occupation des sols, dgradation du paysage et du cadre de vie, etc.) rduire la consommation d'nergie, en particulier celle des agents non renouvelables
Efficacit conomique
crer une infrastructure performante amliorer l'efficacit des prestations et promouvoir la comptitivit internaliser les cots externes utiliser de manire optimale l'infrastructure existante favoriser la comptitivit des entreprises de transport
216
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Justice sociale
garantir un approvisionnement de base sur l'ensemble du territoire prendre en considration les personnes qui n'ont pas facilement accs aux infrastructures de transport assurer le bien-tre des personnes et rduire au minimum les risques pour la sant ainsi que le nombre des accidents
En Suisse, la politique des transports se donne pour objectif de garantir une mobilit durable, ce qui implique que : (DETEC, 2000) les dplacements soient grs compte tenu des impratifs cologiques afin que, grce l'internalisation des cots externes, ils n'augmentent pas de manire dmesure au dtriment de l'environnement (aspect cologique) les besoins en matire de mobilit soient satisfaits de la manire la plus rentable possible pour l'conomie nationale, de sorte que les cots financiers restent supportables pour l'Etat (aspect conomique) tous les groupes de population et toutes les rgions aient accs aux infrastructures de transport (aspect social)262
La figure de la page suivante prsente des exemples spcifiques aux infrastructures de transport illustrant le dveloppement durable dans ce domaine dactivits.
262
Il sagit de laccessibilit dfinie ainsi : mesure, gnralement en termes de temps, de l'aptitude d'un rseau routier permettre la pntration vers une zone d'activit afin de garantir l'obtention d'un service ou de la mise en relation avec une activit ou un rseau de comptences permettant une intgration dans la socit. Il est actuellement considr qu'une bonne accessibilit est celle qui permet d'obtenir un service quotidien dans un dlai infrieur 20 minutes et un service hebdomadaire dans un dlai infrieur une heure (AIPCR, 1999)
Le dveloppement durable et les projets dinfrastructures routires
217
Prservation du cadre de vie Gestion des ressources naturelles Biodiversit
Environnement
des mesures d'conomie ne doivent pas prtriter l'environnement l'accessibilit quitable la mobilit ne doit pas accentuer la pression anthropique
une mesure environnementale doit tre conomique long terme
Dveloppement durable
l'accessibilit doit tre rentable
une mesure environnementale doit gnrer des contraintes quitables
Economie
Finances publiques Cots de l'usager Cots externes
Figure 48
les gnrations futures ne doivent pas supporter les conomies court terme
Social
Scurit des usagers Qualit de vie des riverains Accessibilit la mobilit
Le dveloppement durable et les transports
6.4
L E DEVELOPPEMENT DURABLE ET LES PROJETS D INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Le comit C14 (Environnement) de lAIPCR indique dans les conclusions du XXme congrs mondial de la route de Montral que Tant qu'il n'est pas dmontr que les
projets routiers sont compatibles avec les exigences du dveloppement durable, ils ne doivent pas tre mis en uvre . Le but de cette tude est de fournir au projeteur routier des
lments lui permettant dintgrer cette durabilit dans ses travaux. Lintgration des principes du dveloppement durable au sein de la procdure dlaboration des projets dinfrastructures routires amne les principes suivants :
Transdisciplinarit
Lanalyse dune problmatique doit se baser sur une approche globale et non sectorielle. LAIPCR dfinit la transdisciplinarit ou interdisciplinarit comme tant une approche globale par un projeteur connaissant plusieurs disciplines, et faisant approfondir certains aspects par des spcialistes en fonction des ncessits. (AIPCR, 1999) Il sagit exactement des principes voqus pour la composition du groupe dtude prsente la page 172.
218
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les comptences professionnelles que doivent possder les excutants de la mise en uvre du dveloppement durable sont dfinies par le "Workforce 2020" de l'Hudson Institute comme tant les suivantes : (AIPCR, 1999)
-
esprit critique aptitude rsoudre les problmes aisance communiquer culture conomique et sociale confiance en soi transdisciplinarit
Intgration
Afin que la population puisse faire partie intgrante du processus dtude des projets qui laffectent, la participation publique doit tre ralise ds le dbut du projet. De plus, la transparence des dcisions et des tudes est assurer
Analyse du cycle de vie
Afin destimer les effets long terme des infrastructures routires, il est ncessaire de considrer leur cycle de vie, tel que prsent la Figure 28 de la page 138, dans lvaluation des performances des variantes. Cette prise en compte du long terme seffectue ds le dbut du projet : on pense lentretien de la route lors de sa planification. Toutes les tapes de celui-ci doivent tre intgres dans les analyses menes au niveau de llaboration du projet routier. On peut ainsi viter le cas dune variante qui serait choisie car elle plus favorable quune autre court terme, mais qui pourrait se rvler comme tant plus dfavorable sur le long terme. Ces diffrents aspects seront repris dans le chapitre 9 relatif la mise en application de la mthodologie concertative. A. Pereira et al. ont prsent une mthodologie dvaluation de ce cycle de vie appliques aux infrastructures routires. (Pereira A., Blanc I. et al., 1999) Une analyse du cycle de vie, appel aussi cobilan, comprend gnralement quatre tapes : (Jolliet O. et Crettaz P., 1998)
-
dfinition des objectifs et du champ de ltude permettant de poser le problme et ses limites inventaire des missions et des ressources utilises valuation de limpact sur lenvironnement des diverses missions rpertories auparavant interprtation des rsultats : pondrations, incertitudes, tude de sensibilit
Le champ de ltude dune infrastructure routire considre les rejets ayant lieu depuis lextraction des matires premires (granulats et ptrole) jusqu leur limination (recyclage ou mise en dcharge). Le systme considrer pour une infrastructure routire comprend trois grands domaines : ralisation, exploitation et entretien. Linventaire des missions et des ressources utilises donne les rsultats suivants :
-
ralisation : extraction, traitement, transport et mise en uvre des matriaux exploitation : clairage et ventilation, consommation dnergie des vhicules entretien : entretien hivernal, lavage des tunnels, entretien courant, etc.
Le dveloppement durable et les projets dinfrastructures routires
219
Le projet nentre pas en ligne de compte dans le cycle de vie, sa consommation en ressources environnementales tant ngligeable. Cependant, les dcisions qui sont prises durant cette tape influencent considrablement les valeurs des rejets dans les tapes suivantes. En appliquant cette analyse du Cycle de vie (ACV) la comparaison de trois variantes dun tronon autoroutier, A. Pereira et al. montrent que prs de 93 % de la consommation nergtique sur 50 ans tait due lexploitation. Les auteurs concluent cette analyse en relevant sa pertinence pour lvaluation de variantes. Elle permet en effet de considrer la dure de vie dans lanalyse, de procder un vaste inventaire des impacts et elle considre des impacts globaux tels leffet de serre ou le rchauffement climatique. Par contre, les donnes relatives aux consommations nergtiques des processus dexploitation ou concernant les matriaux sont encore trs lacunaires et parfois peu prcises. Ceci peut se rvler tre un lourd handicap pour les projets de faible envergure o le projeteur doit disposer immdiatement de telles informations. Lanalyse du cycle de vie reste donc encore rserve des projets dinfrastructures routires dimportance.263 A la connaissance de lauteur, il nexiste pas de tels analyses ralises en Suisse sur des infrastructures routires
Mise en balance des intrts
Les intrts sociaux, environnementaux et conomiques doivent tre quilibrs. Lanalyse des diffrentes variantes vrifie cet quilibre en procdant une analyse globale des avantages et des inconvnients selon plusieurs points de vues. Lutilisation dune mthode daide multicritre la dcision permet de raliser cette analyse de manire aise en y intgrant un critre dveloppement durable . Lintgration de ce critre peut se faire de deux manires :
-
par le biais dun critre spcifique durabilit du projet . Il sagit dune prise en compte partielle et localise par la considration de la durabilit de chaque critre : considration globale par dissolution et absorption du dveloppement durable
Il est prfrable dopter pour la seconde possibilit, car il parat difficile de considrer le dveloppement durable en tant quentit propre. Chaque critre a un aspect de durabilit considrer
Acteurs du dveloppement durable
Le lien entre la concertation et le dveloppement durable est direct. En effet, la durabilit sociale passe par la citoyennet, la participation et la transparence des dcisions. Lquilibre social demande la participation de tous. Les organisations non-gouvernementales doivent tre associes au projet. LAgenda 21, qui leur reconnat un rle vital dans le processus dmocratique recommande de les considrer comme des partenaires part entire dans llaboration des projets. De plus, elles doivent pouvoir sassocier au sein de groupes consultatifs. Finalement, lAgenda 21 indique que Les Etats doivent
promouvoir des lois qui permettent aux organisations non-gouvernementales de prendre des mesures juridiques pour dfendre lintrt public (Agenda 21, 1993)
263
Dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 , une telle analyse na pas t effectue par lauteur car trop dlments taient manquants pour quelle aie vritablement un sens. On peut toutefois convenir que la variante des Communes prsentant un ouvrage enterr aurait sans aucun doute t bien plus nergivore que les autres variantes ciel ouvert
220
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
6.5
C OMMENTAIRES
Le dveloppement durable est dsormais inscrit dans la Constitution suisse : La
Confdration et les cantons uvrent ltablissement dun quilibre durable entre la nature, en particulier sa capacit de renouvellement, et son utilisation par ltre humain .
(Article 73, Constitution Fdrale, 1999) Ce nouveau paradigme socital est au cur des politiques publiques. Cependant, au niveau de la ralisation et de lintgration du dveloppement durable dans les diffrentes lois, la rcession des annes 1990 a reprsent un frein supplmentaire, lenvironnement devenant secondaire dans les proccupations de la population. (CI-Rio, 1997) Une tude de lINRETS montre dailleurs quen cas de conflit entre deux politiques publiques, la priorit est souvent donne aux objectifs court terme, pnalisant ainsi le dveloppement durable par rapport des politiques plus conjoncturelles. Il faut aussi noter que la mise en oeuvre du dveloppement durable ncessite parfois des mesures drastiques impopulaires vis--vis des citoyens, ce qui peut retenir les acteurs politiques. (AIPCR, 1999) Ainsi, le passage des rsolutions et des concepts gnraux la mise en application concrte du dveloppement durable nest encore que peu satisfaisante et peu visible. De plus, lorganisation de notre socit ne favorise toujours pas les comportements durables : la vision court terme du gaspillage des ressources dans un but denrichissement est encore profitable, les effets de la mondialisation suscitent de forts mouvements sociaux, les ingalits continuent saggraver depuis 1992, comme il a t prsent au rcent Sommet du Millnaire New-York. Il semble que le concept du dveloppement durable est bien accept par la population (le vritable sens de ce message, qui implique une rvolution dans nos comportements, est-il cependant vraiment saisi ?) mais que le passage lacte est encore difficile raliser (je suis pour protger mon cadre de vie mais je ne veut pas modifier mes comportements, payer mon nergie plus cher, etc.). Il sagit l de la problmatique typique de lacceptabilit de tout concept agrable quand il est abstrait mais dsagrable quand il se concrtise. Pour le projet routier, le dveloppement durable est une chance quil sagit de saisir car cest un facteur damlioration de la qualit des projets permettant damliorer lacceptabilit auprs du public. De plus, la mise en balance de plusieurs intrts contradictoires vite les excs constats dans certains projets des annes 1960 (tout pour lconomie) ou des annes 1980 (tout pour lenvironnement : voir page 101 sur le cas de lautoroute de contournement de Genve). Ce nest pas une contrainte supplmentaire pour le projeteur et le dcideur mais une chance qui leur est offerte. Pour terminer, on peut citer la conclusion du rapport de lAIPCR sur le dveloppement durable : le dveloppement durable constitue un dfi majeur pour nos gouvernements et pour l'avenir de nos enfants l'ore de ce nouveau millnaire .
Commentaires
221
7.
LA CONCERTATION
Ce chapitre 7 est consacr la participation du public la prise de dcision et lapplication de la concertation dans la mthodologie dtude dun projet dinfrastructure routire. Il a fait lobjet dune prsentation de la part de lauteur lors de la Confrence Faune et Trafics - Voies de circulation et rseaux de la faune : ncessit d'une nouvelle approche qui sest droule en octobre 1999 lEcole Polytechnique Fdrale de Lausanne. (Tille M., 1999a)
Nous devons apprendre vivre ensemble comme des frres, ou nous mourrons ensemble comme des idiots
Martin Luther King Prix Nobel de la Paix 1964
Pourquoi cette illustration ?
Cette figure ne semble pas au premier abord concerner le sujet dvelopp dans cette thse et pourtant, en sattardant quelques instants pour entamer une rflexion, on peut constater quelle rsume parfaitement la problmatique traite, savoir finalement la rponse la question Quelle est la meilleure manire de procder dans
toute entreprise humaine, ou dans un projet dinfrastructure routire par extension, pour arriver au succs ?
Au pied de cet escalier grimpant vers les sommets, ceux de la russite il se doit, et dont la dynamique davancement est symbolise par une flche dirige vers le haut, le duo prsent peut se poser la question de la faon idale de progresser. Les marches sont hautes et semblent difficiles franchir, la charge porter est lourde et le chemin parcourir est bien long. Parvenir au fate de lescalier ne sera visiblement pas une partie de plaisir !
Sentendre et russir
Les deux hommes peuvent sentendre sur un objectif commun : arriver ensemble au sommet en minimisant leffort fournir. Ils peuvent saider mutuellement gravir chaque tape difficile dans un mme lan et progresser vers un but identique, par-
222
LA CONCERTATION
fois avec lenteur tant lobstacle est important, parfois avec rapidit tant leur collaboration est efficace. La monte rapide des marches est possible grce cet esprit de coopration o chacun aide lautre pour atteindre un objectif commun. Il ny a ni vainqueur, ni vaincu, mais simplement une quipe gagnante. Cette progression efficace mene en commun dans un objectif partag par tous est en quelque sorte une image idale de lentreprise humaine.
Se dsunir et chouer
Au contraire de lexemple vu prcdemment, au pied de cette difficult le duo peut sentre-dchirer sur lobjectif atteindre, refuser de saider franchir les cueils, voire se gner mutuellement. Le but de lun peut tre de gagner, darriver avant son adversaire, au lieu de son partenaire, ou mme, dans le pire des cas, de participer la dfaite de lautre. Le cynisme et lgosme sont malheureusement des traits de caractre si humains ! Ce processus de conflits et de comptition entrane une formidable dbauche dnergie et les efforts fournir sont plus importants. La tension est son comble et lambiance se dgrade rapidement. Qui plus est, la ralisation de lobjectif Arriver au sommet peut devenir impossible concrtiser tant la discorde prend le dessus sur lesprit de concorde.
Rflexion
Quelle parabole peut-on dvelopper avec la thmatique de cette thse en gnral et de la concertation en particulier ? Tout simplement, celle du bien de la collectivit et de la recherche de la collaboration franche et sincre mis en chec par les individualismes et lesprit de confrontation. Et tout ceci, source dun formidable gaspillage de ressources humaines. On peut ainsi conclure, sur la base de la rflexion engendre par cette petite illustration, quil sera toujours plus facile de progresser deux, ou plusieurs par extension, en dfinissant un objectif commun et en surmontant ENSEMBLE les diffrents cueils qui jalonnent la conception et llaboration de toute entreprise humaine. Il peut y avoir ainsi plusieurs gagnants, ce que lon dsigne par le terme anglophone de win-win ! La politique de laffrontement, de lgosme et de la satisfaction de son propre besoin peut tre strile et nest mme pas gage datteinte de lobjectif. Tout comme le duo de lillustration prcdente, qui est oblig de dialoguer afin de pouvoir amener cette lourde charge au sommet de lescalier, les diffrents acteurs du projet routier doivent passer dune politique de confrontation une optique de partenariat. Il est donc ncessaire quils communiquent entre eux pour aboutir un projet acceptable et de qualit. Le but de ce chapitre est de dcrire les diffrentes manires dobtenir la participation de la population, que lon dsignera aussi par le terme de public , dans le processus dtude des projets dinfrastructures routires. Il y a plusieurs degrs dimplication de ce public au sein du projet, la concertation tant le cas o cette intgration est maximale. Le public devient alors un acteur intervenant directement dans ltude, dialoguant avec le projeteur et le dcideur et prenant part la dcision. Un clairage plus particulier sera donc port sur la concertation qui doit devenir la rgle gnrale dans tout projet routier.
Prambule
223
7.1
P REAMBULE
Lpoque o le projeteur ralisait pratiquement seul la planification, la conception et la ralisation dune infrastructure routire est dsormais rvolue. Le dcideur ne peut plus ignorer les riverains et les opposants au projet, mme sil est persuad de lintrt que reprsente son projet pour la collectivit et si celui-ci est de qualit. Intgrer le public dans le processus dtude dune infrastructure routire est dsormais pour le dcideur et le projeteur un dfi majeur quils se doivent de relever avec brio. Il faut bien reconnatre que cette proccupation est cependant assez rcente. Lintervention suivante ralise par R. Ruckli lors dune confrence pour la VSS en 1962, et cite par M. Bassand, est assez rvlatrice du climat rgnant parmi les projeteurs et les dcideurs de cette poque. Lorateur sexprimait au sujet des propositions de modifications du trac des routes nationales suisses tablies par des acteurs priphriques du projet.
Entrer en matire sur des contre-propositions ne conduit pas seulement des retards dsagrables, mais paralyse aussi les organes techniques excutants, ce qui signifie une mise contribution inapproprie dune force de travail dj limite. Nous aimerions par consquent prier les chefs de dpartements des travaux publics de ne pas entrer en matire, ni mme dtudier des alternatives () seulement pour tranquilliser les opposants. () lexcution dun tel travail surcharge inutilement les organes techniques et les empche de se consacrer des travaux plus importants. La grande majorit des personnes () est certainement daccord avec nous ; on a suffisamment discut et on doit srieusement dmarrer avec la construction. (Bassand M., Veuve L. et al., 1986)
Ainsi, un projeteur demande expressment aux dcideurs de ne pas considrer le public dans le processus dtude, les attentes de celui-ci tant, ses yeux, dj considres et ceci engendrant un surplus de travail inutile. Vers la fin des annes 1960, ce refus de la participation publique a eu pour consquence, pour les routes nationales mais aussi par extension pour les routes dun niveau hirarchique infrieur, le dveloppement des oppositions. Le 22 juillet 1974, une initiative populaire au titre loquent de Pour plus de dmocratie dans la construction des routes nationales est dpose la Chancellerie Fdrale. Cette initiative est rejete par le peuple et les cantons le 26 fvrier 1978. Malgr lhostilit de tous les partis politiques, elle est tout de mme accepte par prs de 39 % des votants, signe dun malaise certain. Aucun contre-projet nest oppos cette initiative, mais lacceptation dune motion parlementaire en fvrier 1977 demandant le rexamen de six tronons de routes nationales constitue en quelque sorte un contre-projet indirect. Le 8 novembre 1978, suite cette motion, le Conseil Fdral donne mandat une commission, la Commission Biel , de procder ce rexamen. Les travaux de cette commission sont encore trs techniques, mais il sagit de la premire manifestation en Suisse de lintervention du public tendant modifier un processus dtude dune infrastructure routire de grande envergure. En 1979, le rexamen du trac de lautoroute A 9 dans la valle du Rhne par un groupe
224
LA CONCERTATION
dexperts multidisciplinaires, dirig par le professeur Bovy, donne loccasion de raliser un vritable processus dintgration du public dans la procdure dtude. Ainsi, la prise de conscience environnementale et la perte de confiance envers ladministration et les autorits politiques, souvent juges non reprsentatives, amnent la population dsirer de plus en plus tre partie intgrante du processus dtude des projets routiers. Le public ne se contente plus dinfluencer un projet de manire indirecte, en dlguant son pouvoir des reprsentants politiques, et veut dsormais participer la prise de dcision concernant les infrastructures routires. Cette volont des citoyens de participer pleinement llaboration des projets, qui conditionnent fortement et durablement leur environnement et leur cadre de vie, constitue aussi un enrichissement de la dmocratie et du dbat public.
Postulat 47
La population dsire pourvoir participer directement au processus dtude et de dcision dune infrastructure routire
La participation publique est obligatoire dans certaines procdures, qui reconnaissent ainsi la lgitimit de ce dsir provenant de la population. Lapplication de la concertation au sein du projet peut aussi provenir dune volont du dcideur ou du projeteur dimpliquer davantage les acteurs affects par la future infrastructure routire dans le projet de manire amliorer celui-ci et de favoriser le phnomne dappropriation par le public, ce qui facilite son acceptation. Lintgration de la participation publique et de la concertation dans la procdure de projet, que lon dsignera dsormais par le terme de mthodologie concertative, engendre des cots dtude supplmentaires, prend plus de temps et ncessite plus de disponibilit et douverture desprit de la part du dcideur et du projeteur. Cependant, ces inconvnients reste marginaux par rapport aux avantages significatifs qui peuvent tre lis une concertation bien planifie et correctement mene : transparence du processus dtude, dtection rapide des besoins des acteurs et des potentialits de conflits, appropriation du projet par le public, climat de travail serein, etc.264 Ainsi, les bnfices engendrs par la participation du public dpassent largement les inconvnients inhrents cette dmarche. La concertation est dfinie comme tant un change dides en vue de sentendre sur une attitude commune . Il sagit par consquent dune dmarche positive o les participants nont pas pour objectif dimposer leurs exigences en faisant cder les autres mais tendent plutt changer leurs points de vue pour prendre une dcision acceptable par la majorit. Pour les projets routiers, la concertation est ainsi devenue ncessaire. Cette intgration de la population dans les prises de dcisions des projets dinfrastructures est plus quun simple effet de mode, cest dsormais un besoin de la socit. La participation du public amne un changement des mentalits et des comportements qui se rvle bnfique. Par consquence, la concertation nest pas une tape supplmentaire du processus dtude ou un but en soi mais elle est un lment essentiel dun projet dinfrastructure routire, totalement intgr dans toutes ses tapes.
264
Les diffrents avantages lis la participation publique, tout comme les limites de cet exercice, sont abords plus en profondeur la fin de ce chapitre 7
Prambule
225
Postulat 48
La concertation fait partie intgrante de toutes les tapes du projet routier
Ce postulat est de plus en plus partag par les projeteurs routiers. Le comit C4 de lAssociation mondiale de la route (AIPCR) recommande dailleurs en ces termes dintgrer le public au sein du processus dlaboration des projets routiers :
Ds le dbut, les principaux objectifs de la planification routire doivent consister dans la qualit du service pour les usagers ainsi que la protection de lenvironnement. Ceci ncessite une connaissance des besoins des usagers et une connaissance des proccupations environnementales et sociales des collectivits et des populations affectes par le projet routier. Ces proccupations doivent tre identifies grce un processus soigneusement labor de participation et dengagement du public dans le processus damnagement routier. En consultant le public ds le dbut (), on pourra aborder et rsoudre les questions difficiles en vitant ainsi ultrieurement les confrontation inutiles et les majorations de cot, ou peut-tre mme lannulation du projet routier (Comit C4, 1998)
Cependant, comme le constate la Commission de gestion du Conseil national dans son rapport de 1997, la participation des diffrents intervenants nest pas encore parfaitement intgre dans les procdures de ralisation des projets dinfrastructures routires, notamment les routes nationales qui font lobjet de ce rapport :
La situation actuelle nest pas suffisante. Les planificateurs de la route planifient de manire isole (). LAdministration fdrale des finances se plaint dtre consult trop tard, de ne pas pouvoir intervenir un stade antrieur de la procdure de planification, de ne pas avoir suffisamment accs linformation. Chaque office consult fait sa cuisine de son ct en prenant le temps qui lui convient. Il serait prfrable que tous les partenaires se retrouvent la mme table pour argumenter, dialoguer, ngocier (...). (CGCN, 1997)
Sur la base du rapport de commission de lOFR,265 une des recommandations266 quadresse cette commission au Conseil Fdral consiste revaloriser le projet gnral en favorisant la participation des diffrents acteurs :
Tous les partenaires associs au projet sont appels participer son laboration, (). Un vritable travail de partenariat entre les parties concernes doit sengager (CGCN, 1997)
Ces recommandations tablies pour les routes nationales suisses sont aussi valables pour lensemble des projets routiers.
265
Celui-ci conclut que Lusager de la route est confront aux projets les plus varis, quil est souvent incapable de comprendre quand on ne lui fournit pas les explications ncessaires. Au lieu de demander la population daller chercher linformation, il conviendrait de la lui apporter, de sorte que toute le monde soit inform correctement (OFR,
1996) On peut remarquer quici une confusion est effectue entre les usagers de la route et la population !
266
Il sagit de la proposition N602, page 27 de (CGCN, 1997)
226
LA CONCERTATION
7.2
L A COMMUNICATION
La participation du public et la concertation passent par une communication efficace entre les diffrents acteurs du projet routier. Le processus de la communication va tre dcrit sommairement ici, en sinspirant du chapitre 7.3 de (Andr P., Delisle C E. et al., 1999). La communication est le mcanisme qui est la base de lexistence et du dveloppement des relations humaines. Elle comprend de nombreux moyens de transmission travers lespace et le temps et inclut divers modes de conversation et dexpression. Le modle gnral du processus de la communication dun message, qui est prsent la figure suivante, comprend trois composantes principales : lmetteur qui est la personne qui dsire, structure et met le message le mdium, ou canal de communication, qui dsigne la faon dont le message est transmis le rcepteur qui est la personne qui reoit le message
Lmetteur et le rcepteur subissent linfluence dun ensemble de facteurs qui modifient et complexifient la qualit du message. Ces deux composantes de la communication utilisent aussi des systmes de codage et de dcodage du message qui sont rarement identiques, ce qui, combin avec la perception simultane au rcepteur dautres messages, que lon dsigne parfois par le terme de bruit , accentue la dformation et la perte de qualit de linformation.
Autres mdiums Autres messages
Canal de communication
Filtre(s) de communication et codage
Filtre(s) de perception et dcodage
Emetteur
Cadre de rfrence Attitude envers autrui Rle au sein du projet But de la communication
Rcepteur
Cadre de rfrence Attitude envers autrui Bagage culturel But de la communication Etat de prparation
Figure 49
Modle gnral de la communication (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
Bruit
Mdium
La communication
227
Lmetteur est influenc par les facteurs suivants : cadre de rfrence : systme des opinions, des ides ou du savoir, normes, valeurs, etc. On peut avoir un cadre de rfrence qui est scientifique, traditionnel, technique, utopique, pragmatique, etc. langage propre : courant, technique, juridique, scientifique, conomique, etc. attitude gnrale de lmetteur envers autrui : attitude sociale, conception des rapports humains, degr de socialisation, personnalit de lmetteur, etc. attitude envers le destinataire du message : strotypes, prjugs, connaissance des ractions du rcepteur, mpris, arrogance, complaisance, ouverture desprit, etc. rle de lmetteur au sein du projet : dcideur ou projeteur, dirigeant, subalterne, etc. statut social de lmetteur : rgles de communication du milieu social, diffrence de milieu avec le rcepteur, etc. situation gnrale de la communication : information, dialogue, consultation, participation, concertation, etc. reprsentation du but de la communication : acception de la concertation comme partie intgrante du projet ou refus de la concertation, qui est vue comme une exigence contraignante
Comme il est expliqu au chapitre 7.5, un message peut emprunter de multiples canaux lors de ltude dune infrastructure routire. Ces canaux sont gnralement de trois classes : canaux oraux, crits ou visuels. Ils ne sont pas forcment exclusifs, un message pouvant tre envoy au rcepteur par des canaux diffrents. Par exemple, une visite de chantier peut tre combine avec de la distribution de brochures et la projection dun film. La perception dun message par le rcepteur est influence par les mmes facteurs que son mission par lmetteur. Toutefois, ltat de prparation du rcepteur est un lment important qui se greffe ces diffrents facteurs. Il sagit de la disposition et de lattitude du rcepteur recevoir un message dun metteur donn. Cet tat de prparation dpend des lments suivants : (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) information pralable : perception des informations prcdentes de la part du mme metteur, consignes reues, ides prconues, etc. perception de la personnalit de lmetteur : sincrit, crdibilit, charisme, etc. usage que le rcepteur compte faire de linformation
228
LA CONCERTATION
La transmission dun message passe travers un ensemble de filtres propres lmetteur (codage de linformation) et au rcepteur (dcodage de linformation) mais aussi de nombreux intermdiaires. La perte de linformation et les dformations potentielles du message, qui peuvent dautant plus tre importantes quelles sont brouilles par un bruit provenant dautres messages ou dautres canaux, peuvent totalement en modifier sa substance.267
Filtres intermdiaires
Emetteur
Rcepteur
Information 1 = Information n
Figure 50 La dformation de linformation
Le dcideur se doit de renseigner rapidement et le plus directement possible le public afin dviter la circulation de rumeurs ou dinformations errones. Ceci est dautant plus vrai quavec les moyens de communications modernes, les informations peuvent circuler trs rapidement et se rpandre comme une trane de poudre. Comme il est alors trs difficile, pour ne pas dire parfois impossible, et coteux de modifier lopinion dun public stant dj fait un avis dfavorable sur le projet et demeurant mfiant vis--vis de lmetteur, le dcideur se doit dadopter une politique de communication prventive plutt que ractive. Cest uniquement en appliquant une transparence totale que le dcideur parviendra raliser cette politique de communication qui permet de dsamorcer de futurs conflits. Lensemble des lments dapprciation, des discussions ainsi que les tenants et aboutissants du processus de dcision des diffrentes tapes dtude doivent tre disposition du public intress. Cet exercice est difficile et trs contraignant, car il ncessite un important effort de vulgarisation, mais il est ncessaire pour obtenir un climat de confiance durable entre le public et le dcideur.
267
Par exemple, le projeteur met le message suivant : Les risques de pollution accidentelles des nappes phratiques sont minimiss et considrs dans ltude du projet . On peut avoir un filtre intermdiaire, comme un journaliste, transformant le message en Il y a moins de pollution des nappes phratiques due au projet , un bruit comme Leau potable coupe en raison de la pollution dune nappe phratique par un camion qui sest renvers et finalement un rcepteur interprtant un message comme Le projet entrane un risque de pollution de la nappe phratique . Ce genre de transformation du sens de linformation est frquent et ne doit pas tre nglig par un metteur qui dsire fournir au rcepteur une information qui soit la plus exacte et prcise possible
Formes de participation du public
229
7.3
F ORMES DE PARTICIPATION DU PUBLIC
Il existe diverses formes de participation du public qui sont trs proches et sont souvent confondues. Ces notions sont distingues ci-aprs selon le niveau croissant dengagement du public dans le processus dtude : (Andr P., Delisle C E. et al., 1999; Tille M., 1999a)
Absence dinformations
Il sagit dun cas qui nest pas considr dans cette tude. Il est uniquement prsent ici pour des raisons historiques268 et afin de le comparer aux autres formes de participation publique. Le dcideur ninforme pas le public au sujet du projet quil tudie et quil va raliser. La seule information rside dans des processus obligatoires qui sont formels et restrictifs, comme la mise lenqute publique
Image de marque
Il sagit doprations qui ont pour but damliorer limage de marque du projet routier auprs de la population sans pour autant raliser une information de celui-ci
Information
Le public reoit des informations, dtenues par le dcideur et le projeteur, sur un projet qui est dfini et qui ne sera quasiment plus modifi. Lavis du public nest pas pris en compte, car il ny a pas dcoute de celui-ci qui est prvue. Il sagit l dune participation passive du public269
Collecte dinformations
Les participants sont invits contribuer lacquisition des donnes, par le biais denqutes par exemple. Le public ninfluence pas le projet et les rsultats ne font pas lobjet dune diffusion
Consultation
Le public donne son avis, qui sera plus ou moins considr, sur plusieurs variantes de projet dj dfinies. Le public na quun pouvoir dcisionnel indirect sur des aspects partiels du projet. En effet, il peut influer le dcideur qui lcoute mais qui dcide seul de tenir compte ou non de ses propositions
Concertation
Le public participe conjointement avec le projeteur et le dcideur llaboration dun projet qui nest pas encore ralis. Le public dispose ici dun vritable pouvoir dcisionnel quil exerce de plusieurs manires : (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
-
par dcision partage : le public sexprime, vote et a autorit dans la dcision
268
Cette forme tait en effet forte frquente il y a quelques dcennies, dans un climat conomique, social et environnemental bien diffrent toutefois P. Andr parle de participation unidirectionnelle (Andr P., Delisle C E., et al., 1999)
269
230
LA CONCERTATION
par autorit dlgue : il y a l un transfert des responsabilits du dcideur vers le public par autodtermination : le public prend le processus directement en main et le dcideur sengage respecter le rsultat obtenu
Dans le cas des projets dinfrastructures routires, la concertation avec un pouvoir dcisionnel par dcision partage est le cas privilgier. Le public participe ainsi au Groupe dtude mais le dcideur y exerce toujours un rle important
Automobilisation
le public prend lui mme linitiative de simpliquer dans un projet, en dehors de des institutions ou de toute organisation de la participation publique tablie par le dcideur. Il sagit en quelque sorte dune participation spontane ractive Tout au long du cycle de vie de linfrastructure routire, la participation peut voluer entre diverses formes. On peut, par exemple, dbuter par une phase de collecte dinformations au niveau de ltude de planification puis raliser une consultation au niveau de lavant-projet pour finalement pratiquer de linformation lors de lexcution des travaux. Comme il a t prcis auparavant, dans cette thse la participation publique est traite dans son ensemble mais un accent particulier est apport la concertation qui est la forme la plus aboutie dintgration du public au sein de la procdure du projet routier.
7.4
O BJECTIFS DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE
La participation du public est ralise de manire obligatoire, quand la loi le prvoit, ou volontaire, quand le dcideur ou le projeteur dsire amliorer le processus dtude. Les objectifs dune participation du public sont : (Comit C10, 1999)
informer les riverains directement affects par une infrastructure routire ou les futurs usagers qui en bnficient dissiper les malentendus et les craintes infondes attnuer les craintes justifies affirmer la position du dcideur et des acteurs affects par le projet recueillir des informations concernant la zone dtude rechercher des propositions de variantes parmi un large chantillon dacteurs reprsentatifs. La multiplicit des ides ne peut tre quenrichissante identifier les intrts en jeu et les besoins valuer les ractions favorables ou ngatives vis--vis des variantes proposes dvelopper le sentiment dappropriation du projet par le public270 mettre au point des solutions communes manipuler lopinion publique, soit en obtenant son soutien au projet, soit en lutilisant pour contrer un ventuel opposant ou alors pour faire croire que les
270
Le comit C10 parle de accrotre le sentiment de paternit
Description des mthodes de participation du public
231
populations affectes acceptent le projet. Cette manipulation peut se passer de manire coercitive ou persuasive
dcider de plusieurs manires : de manire partage et commune entre le projeteur et le public, en dlguant un partie de la dcision du dcideur vers le public ou par dsengagement total du dcideur envers le public
7.5
D ESCRIPTION DES METHODES DE PARTICI PATION DU PUBLIC
Les multiples possibilits offertes au dcideur et au projeteur pour faire participer le public au processus dtude sont dcrites ici. Lauteur a dcid de prsenter ici un large ventail de mthodes de participation publique rencontres ou envisageables dans le cadre dun projet dinfrastructure routire. Ceci na toutefois pas la prtention de lexhaustivit car linventivit des acteurs dans ce domaine est immense et lvolution des techniques de communication est quasi-permanente. Les caractristiques et les principes des mthodes de participation du public sont prsentes sous la forme de fiches descriptives. Celles-ci contiennent les informations principales suivantes : description de la mthode et prsentation des objectifs et des rsultats attendus combinaison ventuelle avec dautres mthodes de participation support de communication priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route rgles essentielles respecter pour assurer le succs dutilisation de la mthode engagement et activits des diffrents acteurs concerns : public-cible, dcideur, projeteur, spcialiste de la communication intgrer dans le groupe dtude, etc. intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur avantages, inconvnients, risques et limites de la mthode de participation publique exemples dapplication et sources remarques diverses
Quelques exemples de fiches descriptives sont prsentes en annexe de ce rapport de thse. Dans le chapitre 7.5, un tableau rcapitulatif indique pour chaque mthode quelle est la forme, ou les formes, de participation publique la, ou les, plus adquate(s). Les nombreuses mthodes prsentes sont numres dans un ordre croissant dengagement du public. Il est prciser que les mthodes spcifiques lautomobilisation du public ne sont pas proprement parler des mthodes qui sont appliques par le dcideur ou le projeteur. Elles sont toutefois prsentes ici car on les rencontre frquemment dans des projets routiers et que leur influence sur le processus dtude peut tre prpondrante.
232
LA CONCERTATION
Les fiches descriptives synthtisent les informations afin de raliser un guide pratique permettant dobtenir rapidement les principales caractristiques de ces diffrentes mthodes. Elles sont disposition du dcideur et du projeteur afin de leur permettre de choisir une mthode de participation en adquation avec le projet concern et les objectifs recherchs. Ces fiches sont principalement inspires des rflexions menes par les comits C4 et C10 de lAssociation mondiale de la route (AIPCR) (Comit C4, 1998; Comit C10, 1999) sur ce sujet. Il sagit de propositions dapplication pouvant tre nuances selon les cas. Les diverses mthodes de participation du public au sein du processus dtude des projets routiers sont les suivantes :
Forme de participation publique Collecte dinformations Automobilisation Concertation Consultation Information N de fiche
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Manifestation populaire Support publicitaire sur des objets courants Marchandisage Mcnat Concours Communiqu de presse Confrence de presse Pochette de presse Djeuner de presse Article dans la presse spcialise Reportage tlvis mission radiophonique Affichage publicitaire Publi-reportage Publicit tlvise
Image de marque
Mthodes de participation publique
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
(9 )
9 9
Description des mthodes de participation du public
233
Forme de participation publique Collecte dinformations Automobilisation Concertation Consultation Information N de fiche
Image de marque
Mthodes de participation publique
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Publicit radiophonique Plaquette ou brochure de prsentation Bulletin dinformation Brochure Tout mnage Opration portes ouvertes Pavillon dinformation Panneau dinformation Visite de chantier Maquette Visualisation informatique Photomontage Film vido ou court mtrage Publipostage traditionnel Publipostage lectronique Base de donnes documentaire (registre public) Sance dinformation Runion avec des personnages cls Prsentation aux groupes organiss Confrence Bureau dinformation Ligne tlphonique directe dinformation Forum Sminaire Retraite Expos avec ou sans questions Exposition itinrante Enqute publique Site Internet Service de consultation sur place Livre de travail
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
(9 )
(9 ) (9 )
(9 ) (9 )
(9 ) (9 )
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
(9 )
9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
234
LA CONCERTATION
Forme de participation publique Collecte dinformations Automobilisation Concertation Consultation Information N de fiche
Image de marque
Mthodes de participation publique
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Table ronde Centre de plainte Livre de dolances Enqute auprs du public Sondage dopinions Comit consultatif de citoyens Citoyens sigeant des commissions Enqute avec questionnaire Document de discussion Runion publique Audience publique Rfrendum Initiative Consultation populaire Ptition valuation par un tiers Groupe de travail collaboratif Comit de suivi Comit de surveillance Comit de liaison Action devant les tribunaux Mdiation Ngociation Manifestation de mcontentement symbolique Action de blocage indirect du projet Action de blocage direct du projet Action de perturbation
9 9
9 9 9 9 9 9 9
9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9
Tableau 34
Prsentation des diverses mthodes de participation du public
Choix de la mthode de participation publique
235
7.6
C HOIX DE LA METHODE DE PARTICIPATION
PUBLIQUE
Comme le prcise le Comit C4 de lAIPCR, la question que se pose le projeteur dsirant pratiquer la concertation est la suivante : Comment peut-on formuler un proces-
sus de participation du public tel quil suscitera lintrt des habitants et les convaincra quils auront une influence directe et significative sur les dcisions ? (Comit C4, 1998)
Cette question ne possde pas de solution vidente et il existe de nombreux moyens pour y rpondre. La principale proccupation du projeteur et du dcideur est de choisir une mthode adquate parmi les multiples possibilits prsentes auparavant. Si le tableau prcdent synthtise au maximum les informations et diminue ce choix, il laisse toutefois le dcideur dans lexpectative en proposant au minimum une dizaine de mthodes utilisables pour la forme de participation publique prvue. Aider plus ce dcideur nest cependant pas possible, car il nest pas raisonnable de vouloir obtenir une mthode qui soit spcifiquement adapte un type de projet dfini. En effet, on peut affirmer que chaque projet routier est unique, vu la variabilit du contexte, de lenvironnement travers ou des acteurs rencontrs. Certains projets aux enjeux complexes ncessiteront de fournir un important travail de la part du projeteur et lutilisation de nombreuses mthodes de participation publique tandis que des projets plus simples pourront se contenter de mthodes de participation publique ncessitant des efforts minimaux de la part du projeteur. De plus, une mthode couronne de succs dans un projet routier dfini peut se rvler comme tant totalement inoprante dans un autre projet. Il apparat aussi que tout au long du cycle de vie de la route, la mthode de participation du public qui est la plus adquate peut voluer. Il semble ainsi difficile et utopique de vouloir raliser un catalogue des mthodes de participation applicables des situations prcises. Dans cette tude, lauteur a dcid quil tait plus logique de laisser la libert de choix au projeteur et au dcideur. Cest eux dopter pour la mthode quils jugent la plus adquate en tenant compte des caractristiques de celle-ci et du contexte du projet. Ce choix se base sur plusieurs paramtres dvaluation du projet qui sont prsents par aprs.
Postulat 49
Le choix de la mthode de participation publique adquate pour un projet donn est effectuer par le dcideur et le projeteur
Le principal paramtre du choix de la mthode de participation publique est la forme envisage pour celle-ci :271 information, consultation, concertation, etc. Cependant, la mthode de participation publique utiliser tient aussi compte dautres lments comme la phase du cycle de vie du projet (tude de
271
Le comit C10 utilise le terme de stratgie de la consultation envisage
236
LA CONCERTATION
planification, avant-projet, excution, etc.) ou les caractristiques du rcepteur (type, nombre dacteurs, niveau social, contexte socio-conomique, etc.). Une seule mthode de participation publique, aussi complte soit-elle, ne peut prtendre rpondre toutes les attentes. Il est prfrable de procder lapplication de plusieurs mthodes de participation, de manire concomitante ou successive. En effet, la combinaison de plusieurs mthodes permet souvent datteindre des publics diffrents272 et de toucher un auditoire semblable avec des moyens moins importants.
Postulat 50
Il est prfrable dappliquer simultanment plusieurs types de mthodes de participation publique, chacune delles ayant des caractristiques et des objectifs diffrents qui mis en commun amliorent lefficacit de la participation publique
7.7
R EGLES SPECIFIQUES A LA METHODOLOGIE D ETUDE CONCERTATIVE
Pour que la concertation273 soit un exercice couronn de succs et afin quelle puisse totalement dployer ses effets bnfiques, il est ncessaire de bien la planifier et de respecter un certain nombre de rgles spcifiques qui sont dcrites ici. Cellesci sont prsentes dans un ordre qui ne prfigure en rien leur importance dans la procdure dtude. Ces rgles ne garantissent pas lobtention de rsultats satisfaisants mais elles augmentent sensiblement les chances de succs de lexercice si elles sont appliques correctement. La concertation commence au dbut du projet La dmarche de concertation doit commencer ds lors qu'un projet est envisag. Il ne sera jamais trop tt pour dbuter la concertation, mais toujours trop tard. Des propositions et des arguments nouveaux arrivant rapidement dans ltude ne peuvent quenrichir le projet. De plus, il faut tre conscient quune modification du projet lamont sera nettement moins prjudiciable et coteuse que si elle est effectue lors de la mise lenqute publique.
Postulat 51
La participation publique sapplique ds le dbut du projet
272
Prenons le cas dune information diffuse par plusieurs mdias (tlvision, journaux, radios et Internet) qui touchera un plus large public que si elle utilisait un seul de ces canaux de diffusion Comme nous lavons vu auparavant, la concertation est le plus important engagement du public au sein du processus dtude. Cest cette parfaite intgration de la population au sein du projet qui est retenue comme forme de participation publique pour les tudes dinfrastructures routires. Nous traiterons dsormais de la concertation applique par dcision partage, le public tant alors considr comme tant intgr dans un Groupe dtude o ?u demeure le projeteur et les acteurs spcialiss
273
Rgles spcifiques la mthodologie dtude concertative
237
En rendant public rapidement le projet, on peut ainsi favoriser le phnomne de lappropriation du projet par les diffrents acteurs. Ceux-ci le dfendront mieux sils ont le sentiment que cest finalement leur projet qui sera ralis, mme si ce nest que partiellement vrai, et non un projet qui leur est impos et o ils nont que peu dinfluence. Cependant, comme il a t vu la Figure 37, page 175, le niveau dengagement du public au sein du processus dtude peut tre trs variable tout au long du droulement du projet. Par exemple, durant la phase de gnration de variantes, on peut procder une consultation ouverte un large public qui apporte de nombreuses informations ou qui propose des variantes. Ensuite, durant la ralisation des travaux, on peut par contre restreindre, sans toutefois la supprimer, la participation publique et simplement informer la population ou enregistrer ses dolances La concertation doit tre pratique durant tout le projet Il nest pas judicieux de ne pratiquer la concertation que durant quelques phases dtude du projet. Si, par exemple, au dbut du processus une large concertation a t mene et quelle est suivie dune phase o peu dinformations filtrent depuis le dcideur, il y a un fort risque dincomprhension de la part du public. Un sentiment de concertation alibi ou de tromperie peut mme survenir en cas darrt plus ou moins prolong de la participation publique.
Postulat 52
Un processus dtude concertatif lest intgralement ou ne lest pas du tout
Le comit C10 de lAIPCR partage aussi ce point de vue en dclarant que lidal est de mener la consultation en continu . (Comit C10, 1999) La concertation doit prendre des formes multiples Comme il a t dit auparavant, il est prfrable dappliquer plusieurs mthodes de concertation plutt quune seule, la complmentarit des mesures tant un gage defficacit et non un frein la participation publique La concertation doit impliquer lensemble des acteurs La concertation doit tre mene de manire associer lensemble des acteurs concerns directement ou indirectement par le projet. Comme nous lavons vu auparavant, la principale difficult consiste dbusquer les acteurs cachs : ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas participer la concertation. Si les acteurs qui tirent les ficelles ne sont pas l, il existe aussi le risque dune concertation alibi . Les acteurs doivent tre lgitimes, reprsentatifs et leur nombre doit tre quilibr : il faut viter de favoriser un groupe dintrts au dtriment dun autre, mme si le processus de dcision nest pas un processus dmocratique ( une personne participant au processus de participation publique ne correspond pas forcment une voix reprsentative dans un vote dcisionnel) proprement parler.
238
LA CONCERTATION
Cest au dcideur et au projeteur274 danalyser le contexte du projet afin dtablir la liste des acteurs concerns par le projet et, par extension, par la concertation. En effet, la mthode de participation publique adopte sadapte lauditoire laquelle elle est destine. Les acteurs ainsi dbusqus sont ensuite invits par le dcideur participer ltude concertative. Si un acteur sannonce spontanment et que sa lgitimit est avre, il doit aussi tre accept par le dcideur
Postulat 53
La dmarche concertative doit rassembler de manire quilibre et complte les acteurs reprsentatifs pouvant influencer le projet
La concertation doit tre mise en uvre par un acteur incontestable La dmarche concertative implique parfois des arbitrages entre des intrts contradictoires ainsi que la prsence dune autorit de conduite. Cette autorit doit tre le dcideur, qui peut dlguer son rle lacteur qui dirige le Groupe dtude. Elle doit tre accepte au dbut du processus concertatif par lensemble des acteurs, pour que ses arbitrages soient reconnues par tous. Ceci est ncessaire pour aboutir des dcisions valides et pertinentes. Si chaque partie opte pour une autorit darbitrage qui nest pas reconnue par lautre, il est quasiment impossible dobtenir un consensus, chaque dcision pouvant tre conteste. On risque ainsi dassister en une querelle dexperts ou dcole de penses
Le processus dcisionnel doit tre admis par tous Les rgles de fonctionnement de la concertation doivent tre clairement dfinies et acceptes par tous. Il en va de la crdibilit du rsultat de la concertation qui pourra ainsi tre difficilement contestable. Il est trs important de dfinir les diffrentes tapes du processus dcisionnel au dbut de la concertation pour que les acteurs sachent quel moment et par qui les dcisions sont prises. Les limites de la concertation doivent aussi tre clairement exposes afin que les participants soient conscients des attentes que lon peut raisonnablement lier ce processus.275 Les objectifs de la dmarche concertative doivent tre clairement dfinis et lon doit insister sur les aspects objectifs et subjectifs prsents dans la dcision
Postulat 54
Ds le dbut du projet, les tapes de la dmarche concertative doivent tre prsentes aux acteurs de la concertation. Ceux-ci la valideront avant de dbuter leurs travaux
274 275
M. Bassand propose dintgrer un sociologue dans ce processus danalyse (Bassand M., 1998) Par exemple, lavis dun acteur est considr avec les autres avis et non isolment, ce qui peut parfois le dcevoir
Rgles spcifiques la mthodologie dtude concertative
239
La concertation doit aboutir des dcisions Le dbat dides sous forme de remue-mninges est une importante source dides et dinspiration. Cependant, les discussions ne doivent pas sombrer dans lanarchie et il est ncessaire davancer en prenant rgulirement des dcisions. Ainsi, il peut tre utile au commencement du projet de fixer un chancier des dcisions importantes prendre, et le respecter, ceci pour viter un enlisement du projet. Pour faire avancer le projet, il faut une autorit forte qui donne le tempo et montre la voie suivre et non un dcideur qui avance au coup par coup selon les humeurs des participants au projet
Postulat 55
Le dbat doit tre dirig de manire aboutir la prise de dcisions
Le dcideur doit comprendre que les attentes du public sont lgitimes Tout projet affectant le cadre de vie de ltre humain entrane une inquitude de sa part qui est lgitime. Le dcideur et le projeteur ne doivent pas ngliger cet aspect et doivent signifier au public quils comprennent leurs inquitudes. Les acteurs ne doivent pas tre exclus du processus pour ce prtexte. Il faut aussi que le projeteur vite la tentation de se mettre penser la place du public de ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui276
Lesprit du dcideur vis--vis du processus doit tre positif Le dcideur ne doit pas considrer la concertation comme tant une contrainte ou les dsirs du public de participer ltude comme tant infonds. Sil considre les craintes des riverains comme exagres ou mprise leur incomprhension, la concertation peut chouer. Comme le dit Besnanou, il faut tirer parti des motivations plutt que chercher les modifier en orientant les rponses, en anticipant les volutions. (Besnanou R., 1999) Le dcideur doit sadapter aux acteurs et leur environnement et non tenter de les forcer rentrer dans un moule quil aurait dfini par avance
La concertation exige la transparence Toutes les informations doivent tre disponibles pour les partenaires de la concertation. Une concertation efficace ncessite une information complte, accessible aux non-spcialistes, permanente et contradictoire. Les acteurs doivent pouvoir sexprimer librement et selon le mode dexpression quils dsirent. Les dcisions doivent tre clairement valides par lensemble des acteurs. Il sagit aussi de les dcrire compltement : variantes tudies, motivation et justification du choix. Une dcision justifie est en effet plus difficilement contestable. Cet exercice de justification peut sembler demander plus de travail de la part du projeteur, ce qui est le cas, mais cest un exercice qui rvle vite ses avantages en cas de controverse au sujet de la dcision prise.
276
Lexemple prsent au chapitre 7.1 est assez reprsentatif de ce genre de comportement
240
LA CONCERTATION
Pour les administrations publiques et les autorits politiques lexercice de la transparence est un changement de paradigme accept parfois avec rticence.277 Une paralysie du fonctionnement de lEtat est souvent craint ainsi que des manquements au respect de la sphre prive et des relations daffaires entre administrs et collectivits publiques, faisant mme dire certains que un peu dopacit ne fait pas de mal . (Bernet C., 2000) La transparence peut parfois se rvler tre un exercice risqu. Il se peut en effet que des acteurs nosent pas sexprimer visage dcouvert, de peur de reprsailles sociales ou conomiques. Ceci est surtout valable pour les projets de petite envergure o la plupart des acteurs se connaissent fortement Le dcideur doit tre disponible et ouvert Louverture desprit, lacceptation de la remise en question des dcisions par des tiers, la disponibilit auprs du public et des mdias sont autant dattitudes que doit possder un dcideur voulant russir sa concertation. A ces qualits, on peut aussi rajouter lhumilit : un dcideur ou un projeteur admettant leurs limites278 seront mieux perus aux yeux du public que des hommes dtudes bourrs de certitudes Le dcideur doit tre actif Il ne faut pas que le dcideur attende que les ractions du public apparaissent. Son attitude doit tre de mener une communication active en prvoyant les attentes du public, en anticipant les problmes et en coupant court toute rumeur ou en dmentant toute information infonde. Ceci nest possible que si le dcideur considre la participation publique comme tant partie intgrante du projet La concertation doit tre souple, volutive et adaptative Les dcisions des diffrentes phases doivent tre valides par tous. Il est impratif dviter la remise en question de dcisions acquises en amont. Cette remise en question peut tre effectue par un acteur qui voulant viter de se prononcer sur une tape dcide de contester le choix dune tape prcdente, choix qui aboutissait ltape actuelle. Le processus dcisionnel doit avoir des bases solides. Cependant, le procd doit tre volutif pour sadapter aux modifications du contexte du projet pouvant intervenir durant ltude. Il y a l comme une contradiction ! Le seul cas o lon revient en arrire dans le processus doit tre quand le contexte dtude change de manire notable : une nouvelle variante apparat, des valeurs mesures changent, etc.. Le dsir dun acteur de contester un rsultat acquis dans un environnement de projet stable doit tre vit, sous peine de tourner en rond dans le processus dtude
Postulat 56
Si la concertation sadapte aux modifications du contexte de ltude, elle ne doit cependant pas tre source de perptuelles remises en question des dcisions prcdentes
277
Aujourdhui, tout est secret, sauf exception. Il sagit de renverser la logique, dinstaurer la rgle de la transparence, avec des restrictions (Bernet C., 2000) Il ne faut toutefois pas crer un sentiment dinscurit auprs de la population qui attend du projeteur des rponses de la part dun professionnel
278
La rsolution des conflits
241
Le langage de la concertation doit tre adapt au public Les acteurs ne sont pas tous des techniciens. Il faut que chacun comprenne de quoi il sagit. On vitera de tomber dans le jargon scientifique et lavalanche de rsultats, qui donnent au nophyte une impression de rabaissement et dincomprhension. Un acteur mal laise participe peu au dbat et il sagit donc de le rassurer, de le tranquilliser et de lui montrer que son avis compte et quil peut influencer la dcision. Un important effort de vulgarisation et de prsentation doit tre fourni pour que les acteurs communiquent par le biais dun langage commun univoque, clair, simple et destin des nophytes. Il sagit aussi dadapter la communication aux acteurs les plus dfavoriss parmi le public affect par le projet : minorits ethniques, faibles revenus, acteurs faiblement scolaris, personnes ges, etc. De plus, la communication non verbale a une forte incidence sur la qualit de rception du message destin au public. Comme le dit P. Andr, cest souvent pendant les premires secondes que lon fait bonne ou mauvaise impression . (Andr P., Delisle C E. et al., 1999) Il sagit donc de soigner les points suivants :
-
prsentation personnelle : habillement, posture, sincrit du regard, attitude vis--vis du public, qualit dcoute, langage clair, ponctualit, discours simple, etc. prsentation des documents : clart et structure du propos, lisibilit du document, prsentation de qualit, figures et graphiques simples, etc.
Postulat 57
La qualit de prsentation de lorateur et du document est un lment dimportance du processus concertatif
Les moyens de communication modernes doivent tre utiliss au mieux, cest dire sans tomber dans la dmonstration technologique, pour animer le dbat : cartes, photos montage, infographie, etc.
7.8
L A RESOLUTION DES CONFLITS
Lors de certaines tapes de la dmarche concertative, il sagit de rsoudre les conflits qui apparaissent entre plusieurs acteurs aux objectifs contradictoires. Lobtention du consensus entre les diffrentes parties est dautant plus facile obtenir si certaines conditions sont remplies, savoir : les acteurs sont reprsentatifs le nombre dacteurs est faible : il est plus facile de trouver un accord deux qu dix une chance est proche : par exemple, la date de clture de la procdure est dans une semaine lordre du jour est restreint et ax sur les dcisions
242
LA CONCERTATION
il y a une volont daboutissement de la ngociation de la part des acteurs et non pas une volont de faire traner la procdure afin de lenterrer dfinitivement les acteurs sont prts obtenir un gain pour la socit et non pour eux-mmes : les intrts globaux lemportent sur les intrts sectoriels il y a plusieurs variantes disposition les enjeux du conflit sont ngligeables et non fondamentaux lautorit dirigeant la ngociation et les donnes ne sont pas contestes le consensus obtenu sera officialis par un acte crit sign et respect par les parties prsentes il y a une volont de maintenir de bonnes relations entre les diffrents acteurs
Deux attitudes de blocage peuvent cependant arriver durant la ngociation :
Paradoxe du prisonnier et du gardien
Un acteur peut avoir deux attitudes diffrentes vis--vis dune dcision, attitudes que lon peut illustrer par cet exemple tir de la thorie conomique des jeux. Il sagit du paradoxe du prisonnier, qui cherche svader, et du gardien, qui cherche le brimer car tel est son bonheur. Quelle peut tre lattitude de ces deus acteurs dans cette situation ?
-
une attitude de collaboration : le gain du prisonnier est moindre (il reste en prison, limitant ainsi sa libert), celui du gardien aussi (il ne peut pas brimer le dtenu son envi), mais le gain collectif est optimal (pas de tensions dans la prison) une attitude de refus : le gain du prisonnier est meilleur (il svade de la prison, recouvrant sa libert), celui du gardien aussi (il peut brimer le dtenu), mais le gain collectif est minimal (tensions dans la prison)
Ainsi, selon la volont de disposer dun gain collectif ou dun gain individuel, lattitude dun acteur au sein de la ngociation peut tre trs diffrente
Tentation du hold-up
Quand un accord est sur le point daboutir entre plusieurs acteurs, il peut tre tentant de profiter de cet tat de fait pour soudainement augmenter ses exigences, en esprant ainsi faire cder plus facilement les autres parties presses den finir. Le fait dtre le dernier parler permet ainsi de plus facilement simposer
La conduite de runion
243
7.9
L A CONDUITE DE REUNION
Une runion conduite efficacement par un animateur apporte de nombreux avantages : La runion est un lieu dchange entre les participants. Rondement mene, elle permet une substantielle conomie de temps . (Audtat M.C., Robert F. et al., 1998) Pour obtenir une efficacit maximale du travail en groupe, il est ncessaire de respecter un minimum de rgles organisationnelles comme : se runir sur un objectif clair et prcis : le temps des participants est toujours prcieux, indiquer lavance le but de la sance ne runir que les gens concerns : un participant prsent doit tre concern, ne pas se fier aux titres mais aux comptences se runir que si cest le moyen le plus efficace : un change tlphonique, la circulation de notes crites, les contacts individuels peuvent tre suffisants fixer lobjectif lavance avec laccord des participants liminer tout contact avec lextrieur : ne pas dilapider le temps de runion avec des appels extrieurs, ne pas casser le rythme des changes conscience dun minimum de rigueur : lexactitude est un facteur defficacit, prparation des dossiers, concentration des participants, lordre du jour doit tre respect, un participant doit pouvoir tre rappel lordre sil perturbe le droulement de la sance, mme si son rang hirarchique est lev choisir une mthode approprie : utiliser les outils de travail adapts au thme de la sance et aux participants dmasquer les obstacles cachs : modifier le cours de la runion en cas de blocages, emmagasiner de lexprience pour les runions suivantes choisir un animateur de qualit : le rang hirarchique lev nest pas garant dune comptence danimation dune runion dsigner un rapporteur de qualit : bonne expression crite, dsignation lavance tenir compte des horaires fixs : dbuter et terminer lheure, la courbe dintensit au travail est plus faible la mi-journe, prfrer des sances courtes et intensives de longues sances monotones
Lorganisation matrielle (choix de la salle de runion, quipement, etc.) ainsi que le style de lanimateur (directif, autoritaire, consensuel, bon orateur, etc.) sont aussi des lments matriser afin dobtenir des runions de qualit. Comme prsent la page suivante, Orgogozo propose huit types principaux de participants partag par deux axes actif ou passif et avec ou contre le projet . (Audtat M.C., Robert F. et al., 1998)
244
LA CONCERTATION
Contre Le comptitif
Avec
Le chef
L'agressif
Actif Passif
Le protecteur
L'adhrent
Le contestataire
Le repli
Le dpendant
Figure 51
Types de participants une runion selon Orgogozo (Audtat M.C., Robert F. et al., 1998)
M.-C. Audtat et al. distinguent aussi une trentaine de comportements possibles de la part des participants une runion :279 (Audtat M.C., Robert F. et al., 1998) le mfiant qui craint que lanimateur lui impose des ides qui ne lui conviennent pas le drang dont les habitudes sont troubles par la runion et qui ne voit pas en quoi celle-ci a de lintrt lergoteur ou pinailleur qui veut montrer son niveau dintelligence et sa supriorit linsatisfait ou rleur qui critique le but de la runion, les autres participants, les rsultats, etc. celui qui ne comprend rien car la runion dpasse son niveau de comprhension le courtisan qui intervient souvent, qui flatte lanimateur et qui napporte rien de nouveau dans la discussion celui qui veut prendre le pouvoir et exprime un sentiment de supriorit et entre en concurrence avec lanimateur
279
Ils proposent aussi des manires de ragir en prsence de ces comportements, lments que lauteur ne reprend pas ici (Audtat M.C., Robert F., et al., 1998)
La conduite de runion
245
le sceptique qui naccorde pas de crdit aux autres participants et lanimateur le dtach qui ne simplique pas et reste en retrait car le sujet ne lintresse pas le calme qui est timide ou qui sennuie et qui ne parle pas beaucoup, sauf aux moments quil juge ncessaire le frimeur qui scoute parler et indispose les autres participants le pitre qui peut par quelques interventions dbloquer des situations conflictuelles mais qui peut aussi nerver les autres participants par une frquence trop importante de ses interventions humoristiques le primaire qui a des opinions carres, rigides, dfinitives et sans nuance lintermittent qui ne mobilise pas perptuellement son attention et qui est parfois absent, parfois prsent le bavard qui prouve une irrsistible envie de sexprimer et qui risque de monopoliser la parole le timide qui parle peu et se rallie souvent lavis de la majorit lesprit lent qui est souvent en retard ou dcal par rapport la discussion en cours lobstin qui poursuit une ide fixe jusqu faire chouer la runion le contradicteur qui rgit mais nagit pas celui qui veut tre reconnu et qui a besoin de se mettre en avant lhistorien qui met en avant ses expriences passes sans se rendre compte que le contexte sest modifi le blas qui est revenu de tout et qui a un avis sur tout, cette runion lennuie le super-efficace qui perd son temps dans cette runion car plein de dcisions importantes nattendent que lui lobjecteur qui pratique la langue de bois et qui martle inlassablement les mmes affirmations au nome de valeurs quil dfend le puits de science qui sait tout sur tout, qui dtient la Vrit et qui manifeste sa supriorit auprs des autres participants le raseur dont les apports ne sont pas vivants et attractifs le divagateur qui parle de tout et sort rgulirement de son sujet en faisant perdre du temps aux autres participants le dcal qui est en retard ou en avance sur le thme qui se discute le mou qui na pas dopinion et qui approuve tout le monde le mandarin dont la fonction interdit toute critique le passionnel qui vit se interventions et les exprime avec fougue le rserv qui ne se sent pas sa place dans la runion en raison de sa comptence suppose infrieure le dbutant qui fait de la figuration dans la runion
246
LA CONCERTATION
7.10
L ES AVANTAGES DE LA PARTICIPATION
PUBLIQUE
Lutilisation dune mthodologie concertative dans llaboration dun projet routier prsente les avantages suivants : le dbat entre les diffrents acteurs peut sinstaurer dans un climat de confiance et non de dfiance lchange des arguments et des diffrents points de vue permet de traiter lensemble des points litigieux du projet, sans devoir attendre la mise lenqute pour assister une remise en question de certains principes les conflits sont dsamorcs et lon passe un processus interactif et un climat de confiance entre le dcideur et le projeteur dune part et le public dautre part les acteurs sapproprient le projet et en deviennent les meilleurs dfenseurs les projets sont amliors par lapport de multiples points de vue : une intelligence collective est toujours suprieure la meilleure intelligence individuelle tous les acteurs peuvent exprimer leur point de vue on peut assister lmergence de nouvelles propositions novatrices qui taient insouponnes et qui auraient pu tre ngliges. On considre des propositions alternatives280 qui peuvent mieux tre refuses, ou acceptes, par aprs car elles sont tudies de manire plus fouille linformation est recueillie auprs plus de sources les groupes dinfluences doivent clairement exprimer leurs objectifs et ne doivent plus se contenter doppositions striles on assiste un enrichissement du processus dmocratique les ventuels conflits sont identifis plus rapidement largumentation servant la prise de dcision politique est plus solide et mieux fonde on peut informer les opposants des raisons pour lesquelles on ne retient pas leur point de vue les principes du dveloppement durable sont appliqus : transparence de ltude, prise en compte des intrts contradictoires, intgration de la population dans les processus affectant son cadre de vie, etc.
280
Qui ne sont pas proposes par le projeteur ou le Groupe dtude traditionnel
Les limites de la concertation
247
7.11
L ES LIMITES DE LA CONCERTATION
La dmarche concertative a pour objectif dviter que le climat dtude entre un dcideur et les personnes affectes par une infrastructure routire, qui habituellement est tendu, ne dgnre. Le succs nest cependant pas garanti. Il faut bien tre conscient que la concertation la mieux organise, la plus transparente et la plus ouverte possible peut nanmoins tre couronne dinsuccs. Il y a ainsi des limites la concertation, qui sont dcrites ici. Engagement des acteurs La volont de participation des acteurs peut tre nulle. On le voit par exemple dans des sances dinformation la population o seulement quelques dizaines de citoyens se dplacent malgr dimportants efforts dploys pour attirer le public (annonces, affiches, etc.). (Bassand M., 1998) De plus, ce genre de sances attire un public convaincu aux positions bien tranches : soit il est totalement favorable au projet, et il vient se rassurer sur son opinion, soit il est faroucheusement oppos celui-ci, et il vient se convaincre aussi de son opinion. Le ventre mou du public, hsitant dans son avis, participe moins aux sances. Cest pourtant sur ces personnes que lon doit porter le plus laccent de la communication si lon veut emporter ladhsion de la population. Ce problme est identique celui des abstentionnistes lors dune lection ou dune votation, ceux-ci constituent souvent la majorit du corps lectoral, en Suisse du moins, mais ils ne sexpriment pas pour de multiples raisons. Peut-on alors mettre en pratique le proverbe Qui ne dit mot, consent ? Assurment, non ! Les acteurs peuvent ne pas sinvestir dans le projet, tre peu reprsentatifs, ne pas tre conscient de la multiplicit des objectifs ou tre notoirement incomptents. La mauvaise qualit des acteurs peut ainsi dteindre sur la qualit de la concertation. Sil y a des acteurs qui veulent avoir droit au chapitre, et qui ne sont actuellement pas couts, il y a aussi des acteurs que lon voudrait entendre et qui ne veulent pas parler. Pour quun dialogue sinstaure, il faut que les deux interlocuteurs dcident de communiquer ! Il y aussi des groupes qui nont pas intrt pratiquer la concertation, leur raison dtre rsidant dans le conflit et non dans le dialogue. (CCFA, 2000) Le cot augmente ainsi que la disponibilit du projeteur et du dcideur Lapplication dune dmarche concertative ncessite de la part du projeteur plus de travail, de prparation et un effort de vulgarisation ainsi quune parfaite disponibilit. Louverture desprit est ncessaire car il faut admettre que lon remette en question les choix raliss ou son travail. Ceci peut parfois tre difficile imposer des projeteurs ou des dcideurs qui nont pas lhabitude de voir leurs prrogatives remises en question. Cest une vritable rvolution des mentalits qui est longue imposer
248
LA CONCERTATION
Un enrichissement dmocratique contradictoire Il peut paratre contradictoire de promouvoir la concertation comme tant un enrichissement dmocratique au vu de la diminution lente et rgulire de lesprit civique dans les socits occidentales : participation lectorale en baisse, perte dinfluence des partis politiques, individualisation des comportements, etc. Cependant, comme le montre bien Besnanou, ceci nest pas contradictoire. Si le sens collectif ou le civisme perdent de leur importance, cest au profit dune volution sociale base plutt sur un besoin de sens .281 (Besnanou R., 1999) Ainsi, le combat contre un projet peut devenir la raison de vivre dacteurs directement affects dans leur cadre de vie et qui ne sinvestissent pas autrement dans la vie politique. Cette personnalisation des engagements politiques complique dautant plus la concertation, car ces acteurs sont moins intresss par le bien tre de la population que par le leur
Procdures et lois rigides Une procdure ou un cadre lgislatif trop rigide peuvent entrer en conflit avec la souplesse et lvolutivit ncessaire la dmarche concertative
Concertation russie mais rsultat dcevant Il arrive aussi que lon puisse aboutir une mthodologie concertative approuve par lensemble des acteurs, mais dont le rsultat est dcevant ou nest pas optimal. Un accord parfait ne donne pas automatiquement une solution parfaite !
Les enjeux risquent de dborder du cadre du projet La concertation risque de mettre en vidence de nouveaux problmes qui dpassent parfois le cadre du projet. Ctait le cas dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 o les conflits se sont longtemps focaliss sur un ouvrage dart (le tunnel des Evouettes) situ hors du primtre dtude
Les tensions peuvent tre accentues Les dbats lis au processus concertatif peuvent avoir de fcheuses influences sur le climat de travail :
-
les critiques du projet peuvent se transformer en des attaques en rgle des autres acteurs ou du dcideur selon les chances lectorales, le projet risque dtre rcupr comme enjeu politique des acteurs voulant amliorer leur leadership vis--vis dacteurs reprsentant la mme sensibilit (dirigeant dune association de protection de lenvironnement par exemple) peuvent tre tents de surenchrir dans les ngociations
281
Certains auteurs parlent de la monte des gosmes face la perte des valeurs collectives
Les enseignements de la Comparaison de variantes 1999
249
7.12
L ES ENSEIGNEMENTS DE LA C OMPARAISON DE VARIANTES 1999
Lexamen de la participation publique dans le processus dtude de la Comparaison de variantes 1999 amne les constations suivantes : la nouveaut de la mthode (acteurs aux diffrents points de vues runis pour la prise de dcision) reoit un accueil favorable de la part des diffrents acteurs. le processus de dcision a t dcrit au dpart, ce qui ntait pas inutile vu sa nouveaut les acteurs du COPIL sexpriment franchement lors des dbats, ce qui amne parfois des tensions mais permet de se rendre compte des diffrents points de vues lautorit dirigeant les dbats est parfois ambigu entre un reprsentant de lOFROU qui est dpass par la volont de leadership affiche par le conseiller dEtat vaudois la seule source dinformation pour le public provient des mdias traditionnels (journaux rgionaux) il ny a pas eu de consultation du public, ni denqute mene auprs de celui-ci pour connatre ses dsirs : la dmarche reste encore rserve une lite professionnelle ou politique. Cette remarque est valable autant pour les riverains que pour les usagers la tentation du projeteur connaissant les attentes du public est prsente dans les propos du chef du service des routes vaudois certains documents techniques sont parfois difficilement accessibles aux membres du COPIL. Ceci rside moins dans la volont dlibre de ne pas tenir les acteurs informs que dans labsence de disponibilit du mandataire externe le conflit mdiatique de la fin aot 1999 a pour lgitimation de la part de son dclencheur une volont de transparence des dbats auprs des riverains on peut noter un phnomne dautomobilisation li aux attentes de la population : blocage dun axe routier Saint-Gingolph mais surtout dclenchement dun conflit mdiatique de la part dun acteur du COPIL on peut noter la prsence certaines sance du COPIL de la dlgue linformation du conseiller dtat vaudois. La volont dintgrer la communication directement au sein du processus dtude est ainsi bien vidente dans la poursuite des tudes, la participation du public est encourage afin damliorer lacceptation du projet : Tous les milieux concerns devront tre
intgrs dans le processus de planification participatif afin de gagner l'appui de la population (DINF, 2000a)
250
LA CONCERTATION
7.13
R EFLEXIONS
P. Andr prsente un encadr numrant les raisons de ne pas faire participer le public ltude, raisons qui sont plus des prtextes que des arguments solides.
1. 2. 3. 4. 5.
6.
Cest trop tt, nous navons pas encore de proposition ferme a prend trop de temps et a cote trop cher Nous allons stimuler lopposition et le processus va tre pris en charge par des activistes a ne permet de nentendre que des personnes bien organises Nous allons soulever des attentes que nous ne pourrons pas satisfaire La communaut locale ne comprendra rien des enjeux impliqus
Figure 52
Les six mauvaises raisons de chercher viter la participation publique (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
Au vu de ce qui a t rdig dans le chapitre 7, il est vident que lauteur ne partage pas ces six raisons qui sont autant darguments de mauvaise foi voqus pour viter de pratiquer la concertation, exercice difficile mais riche en apports pour le projet. La ncessit de raliser une dmarche concertative pour tout les projets routiers est clairement admise : le public a un droit lgitime a tre intgr dans le processus dtude des projets affectant son cadre de vie et celui de ses descendants. Les cots supplmentaires lis lapplication de la concertation sont ngligeables vis-vis des avantages importants procurs, mme si le succs nest pas forcment garanti. Si la participation publique est la meilleure chance daboutir un rsultat satisfaisant tous les acteurs, labsence de participation publique augmente le risque dannulation du projet. Devant cette incertitude du rsultat, certaines voix, heureusement minoritaires, slvent contre la ncessit de mener bien une telle concertation, qui demande des efforts importants, notamment dans la vulgarisation : Pourquoi dpenser une telle nergie trouver un consensus alors que le rsultat nest pas garanti ? mettre une telle opinion est un faux dbat et il sagit dune erreur, dune incomprhension flagrante de lvolution de la socit. Cest finalement mpriser les autres acteurs en ne reconnaissant pas la richesse de leurs apports. Les paradigmes changent, on peut certes ne pas les approuver, mais on ne peut les liminer. Cest une mauvaise solution que lhomme dtude se doit dcarter.
Prambule
251
8.
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.1
P REAMBULE
Le prsent chapitre tait initialement intitul Les outils de travail du projeteur routier . Ce terme dsigne lensemble des mthodes et des procds qui sont disposition du projeteur pour que celui-ci ralise son tude de manire rationnelle, globale, complte et efficace, ceci tout en respectant les diffrentes tapes de la procdure dfinie au chapitre 4. Cependant, comme il est prsent par aprs, laide multicritre la dcision, par limportance quelle revt au sein de lapplication dune mthodologie concertative du projet routier et par son aspect novateur dans ce domaine particulier des projets dinfrastructures routires, sest impose auprs de lauteur comme tant le principal outil de travail traiter282 Certains autres de ces outils au service de lingnieur civil sont traits plus sommairement ou ont t abords dans dautres chapitres de la prsente tude. La dfinition des outils de travail est trs large et elle englobe un vaste domaine comprenant de nombreux lments fortement htrognes et provenant de multiples disciplines scientifiques, techniques, sociales ou conomiques. On peut en effet inclure dans cette description, de nombreuses mthodes qui : synthtisent les contraintes limitant la ralisation des objectifs de manire faire ressortir les lments importants considrer par le projeteur gnrent des variantes, en automatisant certaines tapes de cette phase dtude, en tenant compte au mieux de lensemble des contraintes spatiales prsentes dans le domaine dtude aident le projeteur et le dcideur prendre des dcisions en simplifiant la complexit des informations quils ont disposition permettent de reprsenter clairement le projet et ses incidences sur le milieu, ceci court ou long terme, afin de mieux lexposer aux non-spcialistes formalisent sous forme de modles la complexit du domaine dtude afin den amliorer la comprhension pour le projeteur permettent deffectuer de multiples traitements mathmatiques des donnes du domaine dtude, soit pour tablir des zones dimplantations prfrentielles, soit pour apprcier les consquences des dcisions du projeteur assurent une communication de qualit et comprhensible entre tous les acteurs, notamment entre le projeteur et le dcideur, ainsi quavec le public intgrent la dmarche de projet lensemble des acteurs pour tenir compte de leurs besoins et de leurs objectifs
282
On peut aussi remarquer que laide multicritre la dcision prend une place importante dans lintitul de cette thse de doctorat
252
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
permettent de prvenir et de grer les conflits pour quils deviennent plus un aiguillon de la rflexion quun lment de blocage intgrent la notion de durabilit dans ltude du projet en considrant le cycle de vie de linfrastructure routire assurent un suivi et une gestion du processus dtude etc.
Comme nous lavons vu au dbut de l'tude, les projets dinfrastructures routires voluent dans un environnement de plus en plus complexe. Les acteurs potentiels du projet se multiplient et leurs attentes voluent vers plus dintgration dans le processus dtude. De plus, le cadre lgislatif est de plus en plus rigoureux et touffu. Les mthodologies utilises actuellement pour concevoir et raliser le projet dtude dune infrastructure routire ne sont plus satisfaisantes et montrent rgulirement leurs limites et leur inadquation pouvoir sadapter ce monde en changement. Cest pour ces raisons que cette thse a pour objectif de proposer une mthodologie concertative du projet routier qui est base sur des outils novateurs pour le domaine routier et des mthodes actualises. Elle doit en plus tre adaptative vu la difficult dassurer une certaine continuit dans un contexte mouvant et la formidable htrognit de la typologie des projets. Il a t dcid dans cette thse de doctorat de ne traiter que des outils de travail qui sont essentiels pour assurer un droulement du projet routier dans le sens dune meilleure acceptation de celui-ci et de ladoption dune solution optimale et durable. Les modus operandi de ces diffrents outils seront dfinis dans l'tude. Les principaux outils prsents concernent les thmes suivants : Analyse des rapports entre les acteurs (chapitre 5) Il sagit pour le projeteur routier de pouvoir, dune part, dtecter les acteurs susceptibles dinfluer sur son projet et, dautre part, danalyser les rapports existants entre les divers acteurs intervenants dans le processus dtude. (Bassand M., 1998) Ceci permet dintgrer dans le processus dtude un ensemble exhaustif dacteurs reprsentatifs et dliminer les blocages du projet, ou au moins de dtecter les facteurs de ceux-ci au plus vite afin dadapter ltude Prise en compte du dveloppement durable (chapitre 6) Afin de rpondre aux nouvelles attentes socitales, un projet dinfrastructure routire doit incorporer le paradigme du dveloppement durable tous les chelons de ltude. Ceci consiste notamment intgrer le public dans le processus dtude, de considrer les effets long terme des dcisions prises et de mettre en balances les impacts environnementaux, sociaux et conomiques des infrastructures routires Concertation, consultation et information des acteurs (chapitre 7) Le projeteur doit raliser une tude de manire dvelopper le phnomne dappropriation du projet par les diffrents acteurs. Il sagit aussi dassurer la transparence du processus dtude dont les tenants et les aboutissants doivent tre disposition du public. Dans cette tude, il sera prsent un ensemble assez complet de mthodes intgrant directement dans le processus de ltude les attentes des acteurs et facilitant lacceptation du projet
Prambule
253
Mthodes daide la dcision (chapitre 8) Le projeteur doit fournir au dcideur des lments objectifs apprciant compltement les effets des variantes gnres afin de laider prendre des dcisions, qui sont par dfinition subjectives
Prise en compte de la complexit de lenvironnement du projet (chapitre 8) Le projet dune infrastructure routire se droule dans un cadre complexe : nombreux domaines affects, socit en mutation, multiples acteurs, objectifs divers, etc.. Il sagit dautant de points de vues diffrents qui sont considrer et quil sagit dintgrer dans le processus dtude, notamment lors de lapprciation des effets, par ce que lon appelle des mthodes daide multicritre la dcision
Systmatisation de la reprsentation des contraintes spatiales (chapitre 8) Un projet dinfrastructure routire concerne un vaste territoire comprenant de multiples contraintes spatiales. Il sagit de les reprsenter de manire systmatique et de faon faciliter le traitement des multiples donnes rcoltes. On utilise pour ceci des systmes dinformation rfrence spatiale
Aide la gnration de variantes (chapitre 8) Lintgration des systmes dinformation rfrence spatiale et des mthodes daide multicritre la dcision fournit une assistance prcieuse pour la gnration et lapprciation des variantes de trac
Comme prsent auparavant, le prsent chapitre traitera des quatre dernires mthodes de cette liste. Cette manire de procder peut sembler tre quelque peu restrictive, mais lauteur a prfr concentrer ses efforts sur quelques mthodes qui seront approfondies plutt que de chercher tre exhaustif sur de nombreuses mthodes qui seraient simplement voques. Initialement, lauteur avait prvu de consacrer deux chapitres spcifiques aux mthodes daide multicritre la dcision dune part et aux systmes dinformation rfrence spatiale dautre part. Comme on le verra par aprs, pour les projets dinfrastructures routires, ces deux mthodes connaissent des dveloppements montrant quelle peuvent tre intimement lies pour lanalyse des projets dinfrastructures linaires forte incidence spatiale. Cest pour cela quil a t dcid de les regrouper dans un chapitre unique.283 Lobjectif de cette thse nest pas de proposer de nouvelles mthodes daide multicritre la dcision ou de dvelopper des applications spcifiques aux systmes dinformation rfrence spatiale. Il sagit plutt de synthtiser les nombreux dveloppements existants ou en cours dlaboration dans ces nouvelles disciplines scientifiques284 et de proposer au projeteur routier, outre une prsentation synthtise des diverses mthodes, des recommandations dutilisation au sein de la mthodologie concertative. Ce chapitre est donc typiquement orient vers une option Choix dun outil et Utilisation dun outil plutt que Dveloppement dun outil .
283
Dans cette thse, laccent est toutefois essentiellement port sur les mthodes daide multicritre la dcision, les systmes dinformation rfrence spatiale ntant que sommairement prsents la fin du chapitre 8. On sintressera prsenter leurs composantes ainsi que les combinaisons avec laide multicritre la dcision Les premires mthodes dagrgation partielle proposes par B. Roy ne datent que du milieu des annes 60 et les systmes dinformation rfrence spatiale sont fortement lis linformatisation de la socit datant de moins de trois dcennies
284
254
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.2
L AIDE A LA DECISION
8.2.1
Le processus de la dcision
La majeure partie des activits humaines ncessitent de prendre quotidiennement des dcisions, que cela soit au niveau dun pays, dune rgion, dune administration, dune collectivit locale, dune entreprise, au sein de la cellule familiale ou tout simplement lchelle de lindividu. (Roy B., 1985) La dcision est avant tout un choix que lon doit raliser devant diffrentes possibilits qui sont offertes et qui ne sont pas directement comparables ou qui prsentent des aspects contradictoires.285 Si le choix se base sur un seul critre dapprciation ou sur un ensemble de diffrentes informations convergentes, il ny a pas proprement parler de dcision mais il sagit plutt dune simple dtermination.286 (Joerin F., 1998) Dans un systme dmocratique tel que nous le connaissons dans notre socit occidentale actuelle, les dcisions ne sont que rarement le fait dun individu isol, quil soit prsident, chef du gouvernement, haut fonctionnaire de ladministration publique, directeur dentreprise, directeur technique, financier ou commercial, etc. Mme si la responsabilit de la dcision incombe un acteur clairement identifi, que lon dsigne par le terme de dcideur,287 cette dcision est gnralement le fruit dune interaction entre ses prfrences et celles dautrui. B. Roy distingue trois catgories dacteurs, appels intervenants, qui ont de linfluence dans le processus de dcision : les individus, les corps constitus (associations dindividus dfinies et organises : assemble lue, commission, jury, etc.) et les collectivits (associations aux contours mal dfinis : groupes de pression, opinion publique, etc.). Les acteurs qui subissent de manire passive les consquences de la dcision sont dsigns par le terme dagis.288 (Roy B., 1985) Le processus de dcision est dfini par B. Roy comme tant le droulement des confrontations et interactions, rgules par diffrents processus compensatoires, apparaissant successivement entre les diffrents acteurs. Ce processus est jalonn de temps forts, o sont prises des dcisions intermdiaires ou partielles,289 et qui ne sont pas ncessairement prdfinis ou disposs logiquement. Ainsi, la dcision globale290 slabore progressivement, tel point que la dcision finale peut ntre quun acte de ratification des dcisions antrieures ou une synthse dun faisceau de dcisions .
285 286
Ces aspects sont alors en conflit (Schrlig A., 1985) Dans ce cas l, comme le dit F. Joerin la page 42 de sa thse, on se trouve dans le cas dun problme monocritre et le terme de dcision est incorrect. (Joerin F., 1998) En effet, si le choix dune voiture (cas pris par F. Joerin) se base uniquement sur son prix, il suffit simplement de dterminer quel est le vhicule qui est le moins cher sans aucune autre considration. Le choix ne dpend pas alors du dcideur, mais simplement de loffre prsente et ce sans quivoque possible, pour autant que la solution soit unique, deux voitures remplissant les conditions voques auparavant pouvant avoir un prix identique
287 288 289
Les diffrents termes spcifiques laide multicritre la dcision sont dcrits dans le chapitre 8.3.2 Ces diffrents acteurs ont t dcrits auparavant dans le chapitre 5 et seront prciss au chapitre 8.2.3 B. Roy prcise quil ne sagit pas de confondre ces fragments de la dcision avec lensemble des rflexions, des tudes ou des phases de concertation et de ngociation qui peuvent faire lobjet dune dcision unique de la part du dcideur B. Roy la dsigne ainsi pour viter toute confusion avec les fragments de cette dcision globale
290
Laide la dcision
255
Cette problmatique de lvolution chaotique du processus de dcision jusqu la dcision finale est bien illustre par lexemple rapport par B. Roy du choix de la voiture familiale qui est sans cesse report en raison de nouveauts apportes par les membres de la famille, lapparition de nouveaux critres de choix ou de nouveaux modles de vhicules. On peut en tirer lenseignement que, en supposant que son comportement soit rationnel, chaque intervenant dans un processus de dcision tente dinfluencer la dcision. Il peut proposer le plus grand nombre de possibilits offertes au choix du dcideur, procder une analyse complte de leurs consquences afin den apprcier les avantages et les inconvnients et faire partager ses conclusions dautres intervenants de faon imposer son systme de valeurs. (Roy B., 1985)
8.2.2
Une dfinition de laide la dcision
La dfinition que B. Roy propose pour laide la dcision est la suivante : Laide la dcision est lactivit de celui qui, prenant appui sur des modles291
clairement explicits mais non ncessairement compltement formaliss, aide obtenir des lments de rponses aux questions que se pose un intervenant dans un processus de dcision, lments concourant clairer la dcision et normalement prescrire, ou simplement favoriser, un comportement de nature accrotre la cohrence entre lvolution dun processus dune part, les objectifs et le systme de valeurs au service desquels cet intervenant se trouve plac dautre part (Roy B., 1985)
Laide la dcision ne consiste que partiellement en une recherche de la vrit mais est plus souvent utilise comme une aide la rflexion et la communication destine au dcideur. Elle laide construire et faire partager ses convictions. Les caractristiques de laide la dcision ainsi que la conduite du processus dpendant fortement des objectifs fixs292 par le dcideur pour qui elle est ralise, il est ncessaire didentifier clairement et rapidement celui-ci avant de dbuter une tude.
Postulat 58
Le dcideur doit tre clairement identifi au dbut du projet afin de raliser une aide la dcision qui soit adapte ses besoins
Cependant, le dcideur narrive parfois pas fixer aussi clairement les objectifs de laide la dcision car il est parfois conscient de lexistence dun problme, sans que celui-ci soit clairement formalis, et il ne sait pas forcment comment le rsoudre. (Veuve L., 1994)
291
Le modle est pris ici au sens dune description mentale reprsentant une classe de phnomnes et qui est considre par un observateur afin de servir de support linvestigation et la communication (Roy B., 1985) Dans le cas du projet dune infrastructure routire, cet objectif peut tre par exemple Trouver une variante de trac optimale ou Dterminer le standard adquat pour une route donne
292
256
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.2.3
Acteurs de laide la dcision
La dfinition que B. Roy propose pour les acteurs de laide la dcision est la suivante : Un individu ou un groupe dindividus est acteur dun processus de dcision si,
par son systme de valeurs, que ce soit au premier degr du fait des intentions de cet individu ou groupe dindividus ou au second degr par la manire dont il fait intervenir ceux dautres individus, il influence directement ou indirectement la dcision (Roy B., 1985)
Pour quun groupe dindividus soit identifi comme un acteur unique, il faut que relativement ce processus, les systmes de valeurs des membres de ce groupe soient identiques . (Roy B., 1985) Les deux principaux acteurs de laide la dcision sont le dcideur et lhomme dtude : le dcideur est la personne qui sadresse laide la dcision, comme nous lavons vu prcdemment. Il occupe une place centrale dans le processus dtude dont les caractristiques dpendent de ses attentes. Il sagit parfois dune entit un peu floue, mais son identification est primordiale. Dans le cadre des projets dinfrastructures routires, ce dcideur est souvent un acteur politique du domaine excutif, responsable de ladministration routire. Il peut donc sagir des acteurs suivants, selon lentit politique qui est concerne, ceci en partant du local jusquau global :293
-
Commune : responsable excutif (municipal, conseiller communal, etc.) charg du dicastre des infrastructures294 Agglomration ou district : on ne peut pas parler en Suisse de dcideurs appartenant ce cadre rgional intermdiaire entre le Canton et les Communes. La loi dagglomration fribourgeoise de 1995 semble cependant tre un premier pas dans cette direction en prvoyant que lagglomration se substitue aux communes et que les dcisions prises par les organes de lagglomration () obligent les communes membres (LAgg, 1995) La ralisation dun plan rgional des transports de lagglomration de Fribourg est la premire ralisation de cette entit politique novatrice au niveau de la Suisse Canton : conseiller dEtat charg du dpartement des infrastructures295 Pays : conseiller Fdral responsable du dpartement des transports (DETEC) International : ce niveau ne concerne pas les projets routiers suisses. Par contre, pour les pays en voie de dveloppement des organisations comme la Banque Mondiale ont souvent un rle de dcideur qui est d au fait quelles sont les financiers du projet
En Suisse, le dcideur dans le cadre dun projet routier nest que trs rarement un acteur priv ou semi-priv. Il en est de mme en France o, malgr le fait que
293 294
Nous reprenons ici les entits politiques de la Suisse Ce dicastre peut prendre plusieurs appellations : travaux publics (Lausanne, Sion, Neuchtel, Delmont), voirie (Genve), dilit (Fribourg), etc. Ce dpartement peut prendre plusieurs appellations : infrastructures (VD), travaux publics (FR), quipement (GE, VS, JU), gestion du territoire (NE), etc.
295
Laide la dcision
257
certaines autoroutes sont concdes des entreprises semi-prives, les principales dcisions sur le trac de linfrastructure sont du ressort des acteurs tatiques et prcdent lattribution de la concession. Cette procdure a t prsente au chapitre 4. Dans le cas des projets dinfrastructures routires o la dcision dune administration routire peut tre entrave par les recours ou les oppositions dautres acteurs, il parat difficile de parler du dcideur comme tant un acteur indpendant.296 Ainsi, la concertation entre les dcideurs et dautres acteurs dilue en quelque sorte la responsabilit de la dcision dans un ensemble complexe de dcideurs.297 lhomme dtude298 est un individu ou un groupe dindividus, dsign dans le chapitre 5 par le terme groupe dtude , qui a pour rle dtablir un systme de prfrences, de dfinir le modle daide la dcision, de lexploiter afin dobtenir des rponses et dtablir des recommandations pour conseiller le dcideur sur les solutions envisageables. (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) B. Roy insiste aussi sur le fait que cet homme dtude se doit de rendre ses rsultats comprhensibles lensemble des intervenants. Lhomme dtude est distinguer du ngociateur, qui est mandat par le dcideur afin de faire valoir sa position dans la recherche dune variante consensuelle, et du mdiateur, qui est un arbitre aidant les dcideurs aboutir un compromis. En labsence de communication directe entre le dcideur et lhomme dtude, une tierce personne peut solliciter ltude et allouer les moyens. Il sagit du demandeur. Par exemple, dans le cas dun trac routier dune route communale o le dcideur peut tre le municipal responsable des travaux et lhomme dtude un ingnieur civil indpendant, ce rle du demandeur peut tre endoss par un reprsentant des services techniques communaux. Cette dlgation de la ralisation de laide la dcision de la part des autorits politiques, qui ont le pouvoir de la dcision finale, des responsables administratifs est assez frquente dans le domaine des projets routiers. Il est remarquer que ce nest pas exactement le cas dans la Comparaison de variantes 1999 o les deux conseillers dEtat taient prsents (autorits politiques cantonales) mais o il ny avait quun dlgu de la Confdration (OFROU), qui est le matre duvre principal.
Postulat 59
Le dcideur peut tre une entit complexe et floue aux comptences mal dfinies
296
Cet aspect de la non indpendance du dcideur est trait plus en profondeur dans le chapitre 8.2.5 intitul Facteurs dinfluence dune dcision Cette complexit est accrue aussi par le fait que les possibilits de dcisions des acteurs ne portent pas toutes sur les mmes aspects du projet routier. Par exemple, un acteur Administration environnementale peut influencer la dcision uniquement sur les aspects cologiques du projet tandis quun acteur Administration des transports peut influencer la dcision uniquement sur des aspects modaux. Par contre, un dcideur politique pourra influencer la dcision sur les deux aspects Maystre le dsigne aussi par le terme de facilitateur (Maystre L. Y. et Bollinger D., 1999)
297
298
258
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Dans un souci de parfaite indpendance, il est ncessaire que le dcideur soit distinct de lhomme dtude. En effet, les tches que doivent raliser chacun de ces acteurs sont diffrentes et ne doivent pas sinfluencer.
Postulat 60
Dans le cadre de laide la dcision, le dcideur et lhomme dtude doivent tre deux acteurs clairement distincts
8.2.4
Subjectivit et objectivit
Comme le dfinit F. Joerin, la dcision est de nature subjective,299 ce qui peut tre parfois difficile admettre par un ingnieur. De par sa formation technique et son mode de pense scientifique et rationnel, celui-ci est en effet plus enclin prfrer des jugements bass sur des modles approuvs qui apportent la dmonstration que la solution propose est indiscutable. On peut noter que cette tendance vouloir minimiser la part de la subjectivit inhrente toute dcision nest pas lapanage des scientifiques. Par exemple, pour embaucher un collaborateur, ny a t-il pas de plus en plus une tendance de la part des responsables des ressources humaines vouloir multiplier les examens divers pour augmenter la part de lobjectivit dans leurs dcisions ? La subjectivit nest pas considrer comme tant un dfaut ou une imprcision de la dcision, mais plutt comme tant le reflet de laspect humain qui lui est intimement li. A. Schrlig parle mme de la comdie de la dcision qui est finalement un processus anarchique et trs rarement un procd rationnel. Il cite une phrase vocatrice de R. Howard decision making is what you do when you dont know what to do (llaboration dune dcision, cest ce que lon fait quand on ne sait pas quoi faire). (Schrlig A., 1985) Cette subjectivit reflte les systmes de valeurs du dcideur et des intervenants qui conditionnent la dcision. Les aspects subjectifs et objectifs sont intimement lis dans tout le processus de dcision. Il est donc important de les distinguer et de les identifier clairement tout au long de ltude.300
Postulat 61
Il est important de distinguer et dindiquer clairement au sein dune tude les aspects objectifs des aspects subjectifs
B. Roy insiste sur le fait que lhomme dtude se doit de respecter une parfaite neutralit301 envers le processus dtude, mme sil apparat invitablement intgr comme un acteur, certes secondaire, du processus de dcision. On peut aussi remarquer, comme le souligne le professeur Knoepfel dans son cours, (Knoepfel P.,
299 300
Cette dfinition semble tre un peu excessive, certaines dcisions comportant aussi des lments objectifs Les diffrentes remarques concernant le droulement de ltude de la Comparaison de variantes 1999 apparaissent ainsi justifies, cette distinction nayant parfois pas t assez claire Il ne doit pas tre tent dimposer son propre systme de valeurs et se doit de garder une parfaite objectivit dans la tenue de ltude
301
Laide la dcision
259
1997c) quil existe une relation de mandat entre le dcideur, ventuellement le
demandeur, et lhomme dtude, ce qui peut parfois biaiser laide la dcision, lindpendance de ce dernier ntant pas toujours parfaitement garantie.302 Le choix du modle dans le domaine de laide la dcision est dj en soi un choix qui est difficilement objectif. (Joerin F., 1998) B. Roy dfinit lobjectivit dun modle par le fait quil soit accept par lensemble des acteurs et quil ne biaise pas lapprciation des possibilits analyses. Le biais instrumental, qui est en quelque sorte limprcision amene par le modle, doit tre minimis en utilisant de bons instrument objectifs. Il faut viter une prcision inutile dans un contexte parfois complexe ou dapprofondir ce que lon connat dj objectivement et de ngliger ce qui est plus difficilement apprciable (cas du rverbre dcrit auparavant la note de bas de page N162). On reviendra plus en avant dans cette thse sur le choix dun modle daide la dcision adapt aux projets routiers. Avant la recherche dune objectivit parfaite qui nest finalement quillusoire, lhomme dtude ayant son propre systme de valeurs dont il ne pourra pas sans autre saffranchir, cest plutt sur lhonntet intellectuelle de cet acteur, sur une rgle de bonne conduite, que doit se baser laide la dcision afin de faire reconnatre la validit des rsultats.
8.2.5
Facteurs dinfluence dune dcision
Comme il a t dit auparavant, la subjectivit des dcisions est le fidle reflet du systme de valeurs propre au dcideur. Cependant, cette grille dvaluation interne sur laquelle se base la dcision, de manire consciente ou non, ne dpend pas intrinsquement des caractristiques du dcideur. Celui-ci est en effet fortement conditionn par de nombreux facteurs extrieurs. Lensemble de ces influences sera dsign par le terme denvironnement dcisionnel du dcideur. Les diffrents facteurs influenant la dcision dans le cadre des projets dinfrastructures routires sont les suivants : (tir de Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
Contraintes institutionnelles
Le cadre rglementaire des institutions politiques, la structure de rpartition du pouvoir et les traditions et coutumes des autorits politiques crent un modle de comportement qui conditionne le dcideur
Contraintes lgales
Lensemble des textes lgislatifs doivent tre respects par le dcideur. Labondance des aspects juridiques amene par les diffrents domaines concerns et les juridictions parfois enchevtres peut se rvler trs contraignant quant la libert daction du dcideur. Outre ce respect strict des lois, il sagit pour le dcideur de suivre aussi lesprit de celles-ci, de tenir compte des proccupations qui ont amen les rdiger
302
Comme ses intrts sont en jeu, car ses ressources financires dpendent du dcideur, lhomme dtude peut tre tent, mme de manire involontaire, daller dans la direction souhaite par un mandant voulant influencer une tude
260
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Contraintes organisationnelles
La rpartition des comptences et les relations (rapports de force) entre les diffrents services de ladministration sont aussi considrs dans la prise de dcision. Il sagit dviter les conflits internes au sein de ladministration en amliorant la concertation entre les diffrents services, de manire tendre vers une politique cohrente et non des politiques antagonistes. Le dcideur peut toutefois adopter deux comportements contradictoires : soit il assure une parfaite transparence au sein de ladministration pour obtenir un consensus entre ses services, soit il bloque totalement la communication interne pour tre le seul acteur administratif dcider
Dimension scientifique
Les experts scientifiques peuvent avoir des avis contradictoires sur les effets dun projet routier, divergences qui peuvent tre dautant plus marques que les informations disposition sont lacunaires. Ce dsaccord entre les experts peut entraner le dcideur retarder sa dcision pour disposer de plus dlments danalyse
Dimension politique
Divers groupes de pressions peuvent influencer directement ou indirectement la dcision : entits politiques autres que celle du dcideur, partis politiques, acteurs privs, associations, etc. Les instruments politiques disposition des ces groupes de pressions (rfrendums, initiatives, etc.) sont aussi considrs dans la prise de dcision.303 Les valeurs idologiques (conservatisme, libralisme, cologie, socialisme, etc.) dfendues par le dcideur, qui est gnralement un politicien lu sur la base dun programme dfini, influencent aussi sa dcision.304 Un collge gouvernemental peut aussi tenter dinfluencer la dcision dun dcideur minoritaire
Dimension technologique
La confiance, ou au contraire une certaine rticence, dans les effets de la technologie pour diminuer les impacts des routes est un lment dapprciation important. La fiabilit de la technologie propose, sa faisabilit et ses apports conomiques sont aussi des lments influenant la dcision
Dimension sociale
Les effets sur la population, laccessibilit une mobilit de qualit, les principes dgalit des chances ainsi que les valeurs et les croyances dfendues par le dcideur sont aussi des lments de la dcision
Dimension conomique
Ltat des finances publiques305 et les effets directs et indirects dun projet routier sur les activits conomiques influencent aussi la dcision
303
Lexamen de la Comparaison de variantes 1999 a bien montr linfluence du rfrendum financier dans les proccupations du conseiller dEtat vaudois On peut relever que les sept conseillers dEtat des cantons romands chargs des infrastructures routires appartiennent aux formations politiques suivantes : Parti dmocrate chrtien (3 : FR, JU, VS), Parti socialiste (2 : GE, BE), Parti libral (1 : NE) et cologiste (1 : VD). Etat en aot 2000 selon (IDHEAP, 2000)
304
Laide la dcision
261
Dimension environnementale
Tout comme les deux dimensions prcdentes, la dimension environnementale qui est la troisime composante du dveloppement durable entre en ligne de compte dans la dcision
Opinion publique
La dmocratie consiste dlguer au dcideur un pouvoir qui peut tre important mais qui est limit dans le temps. La satisfaction de lopinion publique, par extension des lecteurs, est essentielle pour un acteur politique qui veut remporter une nouvelle lection. Cet lment peut par exemple amener le dcideur anticiper ou au contraire retarder une dcision en fonction des chances lectorales prvues
Pression mdiatique
Dans le cadre de projet fortement contests ou au contraire fortement esprs, les dcisions peuvent bnficier dune couverture mdiatique importante
Image de soi et leadership
Prendre une dcision est en soi un acte de pouvoir. Dcider dans un contexte compliqu ou affirmer une position sujette la contestation montre, soi mme mais aussi vis--vis des autres, que lon est un dcideur, un homme politique courageux. Limage qui est amene par ces prises de dcision faonnent ainsi clairement une image de leadership du dcideur. On peut remarquer quau contraire dun acteur politique fonceur , un acteur politique tentant de trouver en permanence un consensus peut aussi bnficier dune image forte Les diffrents facteurs qui influencent la dcision dans le cadre des projets dinfrastructures routires sont les suivants : (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
Contraintes institutionnelles Contraintes lgales Contraintes organisationnelles
Pression mdiatique
Dimension scientifique
Opinion publique
Dcision
Dimension politique
Image de soi Leadership
Dimension technologique
Dimension environnementale
Dimension conomique
Dimension sociale
Dveloppement durable
Figure 53 Facteurs dinfluence de la dcision
305
Les demandes ritres du conseiller dEtat vaudois de tenir compte des aspects financiers dans ltude de la Comparaison de variantes 1999 montre bien limportance de cette dimension
262
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Comme prsent dans la figure ci-dessous, lenvironnement dcisionnel tend se dvelopper quand la dimension spatiale de ltude augmente, le nombre dacteurs et de contraintes considrer croissant aussi. (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
Dimension de l'environnement dcisionnel
Nationale
Rgionale
Locale Etendue spatiale de l'tude Nombre d'acteurs concerns
Nombre de contraintes considrer
Figure 54
Dimension dcisionnelle en fonction de ltendue spatiale de ltude
Un acteur politique prenant une dcision subjective qui est influence par plusieurs facteurs dvelopps auparavant. Sa dcision est aussi oriente par certains principes thiques :306 (Andr P., Delisle C E. et al., 1999)
Equit
Les avantages et les inconvnients lis la ralisation dune nouvelle infrastructure routire doivent tre rpartis de manire telle quaucun acteur naie raison de croire, tort ou raison, quun autre acteur a pris un avantage inquitable
Participation
Chaque acteur concern le droit dtre intgr dans le processus de dcision concernant des projets affectant ses conditions de vie
Equit intergnrationnelle
Les gnrations futures ne doivent pas subir des prjudices de la part des dcisions prises par les gnrations actuelles
306
Ces principes thiques sont inspirs des proccupations environnementales mais peuvent tre appliqus lensemble des dcisions
Laide la dcision
263
Subsidiarit
Les dcisions doivent tre prises au plus faible niveau politique possible
Bien commun
Le bien de la socit dans son ensemble est rechercher plutt que des avantages particuliers. Cependant, celui qui subit un prjudice de part ces dcisions doit bnficier dun ddommagement quivalent
Prcaution
En cas de doute sur des impacts dommageables lis un projet, il est prfrable de sabstenir ou dapprofondir les connaissances du phnomne
Rversibilit
La socit ne doit pas engager dans une impasse et il doit tre possible de revenir sur les dcisions prises
8.2.6
Labsence doptimum
Dans le cadre des projets dtude des infrastructures routires, le dcideur attend souvent du projeteur quil lui fournisse une rponse qui soit clairement dfinie et justifie. Gnralement cette aide la dcision intervient en cours dtude et aboutit par exemple au choix dune variante de trac. Il sagit ensuite daffiner la solution ainsi propose pour en liminer les dfauts et amliorer les qualits. Le cas de la Comparaison de variantes 1999 montre clairement ce que les dcideurs politiques307 attendent de lhomme dtude : Trouver la solution qui prsente globalement le moins dinconvnients et le plus davantages . (Wichser F., 1999c) Cependant, comme le montre bien B. Roy et surtout A. Schrlig, la recherche dun optimum est parfois dnue de sens car elle suppose que trois contraintes soient remplies simultanment : (Roy B., 1985; Schrlig A., 1985) stabilit : lensemble des actions analyses est stable tout au long de ltude unicit : il nexiste quune seule action parmi lensemble des actions tudies qui soit la solution optimale transitivit : en comparant deux actions diffrentes, seules deux relations transitives sont possibles, savoir la prfrence stricte de lune par rapport lautre ou lindiffrence entre les deux
Dans la majeure partie des problmes daide la dcision, ces conditions ne sont que rarement remplies de manire concomitante. La condition la plus contraignante de loptimisation concerne la transitivit de lindiffrence. Cette indiffrence est en fait une relation intransitive.308 Ainsi, il est tout fait plausible que dans le cas
307
Pour la suite de la thse, le Comit de Pilotage dans son intgralit sera considr comme tant le dcideur de la Comparaison de variantes 1999 , car cest lui qui fournit les pondrations qui sont le reflet des valeurs propres ses membres. Lhomme dtude de cette tude est compos du mandataire externe et du Groupe Technique Lindiffrence nest pas confondre avec lgalit. Elle dpend de la sensibilit de la mesure comme le dcrit A. Schrlig avec lexemple de diffrents sandwiches au fromage diffrencis chaque fois par lajout dune tranche de fromage. Entre deux sandwichs successifs, la diffrence dune seule tranche de fromage entrane une relation dindiffrence entre ceux-ci. Par contre, aprs avoir ajout plusieurs tranches de fromage, la diffrence entre le sandwich final et le sandwich initial est telle que lindiffrence ne sapplique pas et on est alors dans le cas dune prfrence de lun par rapport lautre (Schrlig A., 1985)
308
264
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
de trois variantes a, b et c, le fait que a soit indiffrent vis--vis de c et que b soit indiffrent vis vis de c ne signifie pas que a soit indiffrent c. La relation de prfrence est aussi intransitive. Un dcideur peut en effet prfrer a b, b c mais ne pas prfrer a c. Rechercher un optimum apparat ainsi parfois dnu de sens ou trop rducteur et il faut donc, comme le dit A. Schrlig, oser lincomparabilit ! , raliser sa propre rvolution copernicienne et admettre quil nexiste pas forcment une solution unique pour une problmatique donne. Ainsi, dans son dialogue avec le dcideur, le projeteur routier doit passer dun discours La solution optimale est la suivante un discours Ces solutions ne sont pas valables et entre ces autres solutions, il ny a pas de critres qui objectivement permettent de suffisamment les distinguer .
Postulat 62
A une problmatique donne peut correspondre une ou plusieurs solutions
Pourquoi cherche-t-on tout prix obtenir un optimum, au risque de se fourvoyer en tentant de forcer lenvironnement du problme se conformer un modle thorique, plutt que dadapter ce modle la ralit ? Cest en quelque sorte lhritage dune longue tradition rationaliste marquant fortement notre pense occidentale depuis Aristote, prolong notamment par les travaux de Descartes et de Kant, ce dernier crivant dans la Critique de la raison pure que On ne connat bien que ce que lon peut exprimer par les mathmatiques . Si ce mode de pense nest pas rejeter, et dans son ouvrage A. Schrlig ne tombe pas dans ce pige facile, il est nanmoins considrer comme tant un des lments danalyse possible et non comme le seul ! Il sagit donc de saffranchir du rationalisme, de larithmomorphisme comme le qualifie A. Schrlig, (Schrlig A., 1996) dans le domaine de laide la dcision, mais pas de la rationalit. Veuve abonde dans ce sens en dclarant que dsormais les problmes se posent de plus en plus en termes de valeurs non quantifiables et non de prix . (Veuve L., 1994) Une justification de loptimisation est quelle simplifie la complexit de la ralit, ceci en amenant cependant une important perte dinformation. Sil est plus facile de porter un jugement sur un modle simple, mais parfois dtach du contexte de la problmatique, il est parfois tentant de vouloir ensuite limposer comme la seule possibilit dapprciation. Cette opration frquemment pratique est la source de nombreux malentendus et namne souvent que de la confusion. Ainsi que le dit A. Schrlig, la ralit est critres multiples - elle est donc impossible optimiser - et la voie suivre est celle des mthodes multicritres . (Schrlig A., 1985) Comme un dcideur ne peut intgrer simultanment quun nombre limit dinformations pour porter son jugement, lhomme dtude va organiser et synthtiser les informations par le biais des mthodes daide multicritre la dcision. Il ne cherchera pas cependant obtenir une seule information, la solution optimale, qui est une opration trop rductrice et loigne de la ralit. Cest cette voie qui est choisie et dfendue dans cette thse de doctorat.
Laide la dcision
265
8.2.7
Caractristiques de laide la dcision pour les projets dinfrastructures routires
En quoi les mthodes daide multicritre la dcision sont-elles utiles au projeteur routier ? Comme nous lavons vu dans les chapitres prcdents, les projets dinfrastructures routires affectent directement ou indirectement de nombreux domaines comme la mobilit, lenvironnement, les activits conomiques, lamnagement du territoire, les activits sociales, etc. Cette multiplicit des domaines affects va aussi de pair avec la varit des acteurs intervenant dans le projet, ceux-ci ayant souvent des systmes de valeurs diffrents, voir antagonistes. De plus, la prise en compte du dveloppement durable ncessite danalyser le projet court, moyen et long terme. Et finalement, le projet peut avoir au cours de lanalyse des dimensions du primtre dtude qui varient. Lenvironnement de ltude du projet prsente ainsi des limites floues et variables et lon est dans une problmatique complexe prsentant de multiples dimensions : critres multiples selon les contraintes prises en compte dans llaboration du projet. De plus, ces critres sont parfois difficilement quantifiables, notamment les critres concernant laspect environnemental systmes de valeurs diffrents selon les acteurs intervenant dans le projet plusieurs priodes danalyse, notamment pour considrer le cycle de vie du projet dimensions du primtre dtude variables. Ce problme est rsolu par la dfinition stricte de la dimension spatiale du champ de ltude prsences de plusieurs dcideurs. Cest le cas par exemple des routes nationales suisses qui sont finances par la Confdration et les Cantons. Le dcideur peut aussi tre une entit compose de plusieurs acteurs, comme dans le cas de la Comparaison de variantes 1999 309
On constate donc que la problmatique des projets dinfrastructures routires est fortement multicritre. Elle est donc intresse au plus haut point par les diffrentes mthodes daide multicritre la dcision qui sont prsentes dans cette tude.310 On peut aussi remarquer que les trois contraintes de loptimisation prsentes auparavant ne se rencontrent pas dans le domaine des projets routiers. Il apparat souvent quune solution se dveloppe en cours dtude311 et les solutions envisageables sont multiples.312
309
Dans ce cas l, on peut cependant parler dun seul dcideur qui est le COPIL en tant quentit. Cependant, si lon ralise les 28 oprations de classement tel que la ralis le mandataire externe, on peut alors parler de 28 dcideurs diffrents Si ce ntait pas le cas, lauteur nen aurait pas parl dans cette thse Le cas de la Comparaison de variantes 1999 o la Solution COPIL a t dveloppe en cours dtude est loquent ce sujet Des variantes peuvent par dfinition avoir des tracs trs semblables avec des options quasiment infinies. Pour un trac en situation identique, de nombreux profils en long sont envisageables, des ouvrages dart peuvent avoir des dimensions variables, etc. Il est ainsi impossible dtre exhaustif dans la gnration de variantes de tracs routiers et sans cette exhaustivit, la prsence de loptimum parmi les solutions tudies nest pas assure
310 311
312
266
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Le projeteur routier na pas attendu le dveloppement de ces mthodes pour intgrer la complexit de lenvironnement dune infrastructure routire dans ses tudes. Cependant, les mthodes daide multicritre la dcision utilises dans les projets routiers, quand elles existent, sont parfois assez sommaires et souvent fortement rductrices. Elles consistent souvent en lutilisation de notes pondres, la notation tant lapanage de lhomme dtude, la dtermination des poids ltant aussi parfois. Des tentatives damlioration de la procdure existent, comme on la vu dans la Comparaison de variantes 1999 o la phase de pondration et de notation taient spares, quoique quimparfaitement. Cependant, les dveloppements des mthodes daide multicritre la dcision raliss depuis trois dcennies par lcole europenne313 sont encore peu ou pas intgres dans la mthodologie du projet routier. Cest lobjectif de cette thse que de raliser cette opration. Ces remarques rejoignent aussi les rflexions menes sur la concertation o le besoin de la transparence des tudes est ncessaire pour lacceptation du projet de la part du public. Pour justifier ou dfendre un choix de variantes, il est ncessaire de proposer une mthode daide la dcision qui comporte des lments objectifs, sans pour autant exclure les lments subjectifs. Ainsi, dans cette thse de doctorat aprs avoir prsent les principes gnraux314 des mthodes daide multicritre la dcision, notamment celles se basant sur une agrgation partielle des performances, les mthodes novatrices intressant directement le projet routier seront dcrites. Un accent particulier sera mis sur les modalits de leur mise en application dans le cadre de la problmatique des projets routiers. Ces conseils dapplication seront mis en pratique sur le cas de la Comparaison de variantes 1999 .
313
On verra par aprs ce qui distingue lcole europenne de lcole nord-amricaine dans le domaine des mthodes daide multicritre la dcision Cette thse nest pas conue dans lesprit dtre un manuel dcrivant la mise en application de lensemble des mthodes daide la dcision multicritre. Le lecteur intress par des dtails pratiques et des cas dapplication des mthodes Electre peut se rfrer lexcellent ouvrage de Maystre destin aux praticiens (Maystre L. Y., Pictet J., et al., 1994)
314
Les mthodes daide multicritre la dcision
267
8.3
L ES METHODES D AIDE MULTICRITERE A LA
DECISION
Il existe de nombreuses mthodes daide multicritre la dcision315 permettant de rpondre une problmatique prcise. Leur typologie sera dcrite ici ainsi que les caractristiques des principales mthodes qui seront utilises dans la suite de la thse. Il sagit dune description assez sommaire base sur la littrature spcialise et qui constitue un rappel pour le connaisseur mais qui est une prsentation synthtique pour le praticien les dcouvrant.316 Le lecteur dsireux dapprofondir ses connaissances dans ce domaine passionnant peut consulter la littrature cite.
8.3.1
Processus dtude
Le processus dtude dune aide multicritre la dcision se droule en cinq tapes successives et indpendantes :317 (Schrlig A., 1985)
Inventorier des variantes
Il sagit de procder linventaire des variantes318 valuer. Cette liste n'est pas exhaustive et dfinitive. Elle peut voluer tout au long de l'tude (suppression ou ajout de variantes)
Lister les critres
Il sagit dlaborer la liste de critres prendre en considration. Ces critres doivent tre en relation avec les contraintes et les objectifs utiliss dans la gnration des variantes
Pondrer les critres
Un critre peut tre plus important quun autre. Cette importance relative est exprime par un nombre appel poids, terme qui a plus un sens imag que physique
Juger les actions
Il sagit de juger chaque variante par rapport chacun des critres. Les critres ne sont pas toujours directement mesurables et dans ce cas un indicateur leur est associ. L'ensemble des valuations est prsent dans un tableau double entre, appel tableau des performances ou matrice des valuations, dans laquelle chaque ligne reprsente une variante et chaque colonne un critre
315
Il existe dautre termes comme mthodes daide la dcision multicritre . Cependant, ce nest pas la dcision qui est multicritre en soi mais la faon de poser le problme (Schrlig A., 1996) Comme certaines de ces mthodes daide la dcision multicritre sont peu utilises dans le domaine des projets dinfrastructures routires, on peut raisonnablement poser le postulat que les praticiens ne les connaissent que peu ou pas du tout Ces tapes ne sont pas ncessairement successives et peuvent faire l'objet de rtroactions (Molines N., 1997) Comme on le verra par aprs, on dsigne aussi les variantes par le terme dactions potentielles
316
317 318
268
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Agrger les jugements
Il sagit ensuite dagrger les jugements pour dfinir quelle solution jouit globalement des meilleures valuations Les quatre premires tapes sont pratiquement communes toutes les mthodes daide multicritre la dcision. Par contre, la cinquime tape, qui est une tape technique, est propre chaque mthode. (Molines N., 1997)
8.3.2
Terminologie
Plusieurs termes sont rcurrents dans le domaine de laide multicritre la dcision. Ils sont prsents ici dans le cadre de ladaptation des ces mthodes aux projets dinfrastructures routires. Certaines dfinitions plus spcifiques la mthode daide multicritre la dcision choisie seront approfondies plus en avant dans le rapport.
8.3.2.1
Variante
Il sagit des lments qui font lobjet de lanalyse multicritre. Les ouvrages de rfrence de cette discipline parlent plutt dactions potentielles. Dans cette thse, le terme de variantes sera prfr, car il est plus spcifique aux projets dinfrastructures routires. Dans le cadre du tri des variantes, il est ncessaire de proposer des limites aux diffrentes catgories daffectation. On parle alors de variantes de rfrence par rapport auxquelles les variantes sont values. Lensemble des variantes V comprend n variantes (v1 vn) et quand il sagira de dsigner deux variantes particulires de cet ensemble (cas des mthodes dagrgation partielle), les termes de variante vi et de variante vk seront utiliss.319
8.3.2.2
Critre
Un critre est dfini comme tant une expression qualitative ou quantitative permettant de juger la consquence, dsigne aussi par le terme de performance, dune variante vis vis dun objectif ou dune contrainte, tous deux relatifs au projet considr.320 Lensemble des critres C comprend m critres (c1 cm). La performance, ou valuation, de la variante vi pour un critre cj donn est dfinie par le terme gj(vi). Un critre se doit dtre utile et fiable.321 Il est associ une chelle ordinale (excellent, bon, moyen ou mauvais) ou cardinale (francs, notes, etc.) et dispose dun sens de prfrence (minimisation ou maximisation).
319
La majeure partie des termes utiliss ici sont repris de (Maystre L. Y., Pictet J., et al., 1994). La principale modification consiste parler de variantes vi au lieu dactions potentielles ai Un critre Cot de ralisation value le montant dinvestissement qui sera la charge de la collectivit, un critre Paysage value les atteintes paysagres provoques par la route, etc. Afin de tenir compte des principes du dveloppement durable, il est important de considrer ces performances long terme, sur lensemble du cycle de vie de linfrastructure routire Par exemple, dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 un critre Traverse des couloirs davalanches na pas de sens contrairement un projet qui serait situ dans une valle alpine troite
320
321
Les mthodes daide multicritre la dcision
269
Dans le domaine des projets dinfrastructures routires, les critres peuvent tre nombreux322 et il est ncessaire de les regrouper en familles de critres afin de faciliter notamment lapprciation de leur importance relative par le dcideur. Il est en effet plus facile de procder une pondration sur six ou sept critres que sur une vingtaine de critres. Cest cette procdure en deux tapes (pondration des familles de critres puis des critres au sein des familles) qui a t adopte pour la pondration des critres de la Comparaison de variantes 1999 . Le choix des critres doit tre cohrent323 et il doit permettre de faire le tour de la question . (Schrlig A., 1985) Cette cohrence est vrifie si les trois conditions suivantes sont respectes :
exhaustivit
Il sagit de ne pas oublier un critre. Le test d'exhaustivit propos B. Roy et D. Bouyssou est trs simple : quand les consquences de deux variantes sont identiques pour lensemble des critres en prsence, il doit exister une relation dindiffrence entre ces deux variantes (Roy B. et Bouyssou D., 1993)
cohrence
Il doit y avoir une cohrence entre les prfrences locales de chaque critre et les prfrences globales. C'est--dire que si une variante a est gale une variante b pour tous les critres sauf un o elle lui est suprieure, ceci signifie que la variante a est globalement suprieure la variante b
indpendance
Il ne doit pas y avoir de redondance entre les critres. Leur nombre doit tre tel que la suppression d'un des critres ne permet plus de satisfaire les deux conditions prcdentes (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) Les critres ne sont pas toujours directement mesurables. On utilise parfois un indicateur qui est une variable mesurable servant quantifier une situation ou la tendance du critre en question.
8.3.2.3
Relation de surclassement
Une variante vi surclasse une variante vk, not viSvk, si elle est au moins aussi bonne que vk relativement une majorit de critres, sans tre trop nettement plus mauvaise que vk relativement aux autres critres. (Schrlig A., 1985) Il est donc ncessaire de vrifier critre aprs critre lensemble des paires ordonnes,324 ou couples, de variantes possibles. Les mthodes dagrgation partielle vrifient le degr de crdibilit de cette hypothse de surclassement viSvk en se basant sur une notion de concordance (Y at-il suffisamment darguments pour admettre cette hypothse ?) et une notion de discordance (Y a-t-il une raison importante pour refuser cette hypothse ?).
322
Dans le cas de la Comparaison de variantes 1999 , les critres, dsigns par le terme objectifs partiels sont au nombre de seize, rpartis en six familles de critres, dsignes par le terme objectifs gnraux Dans sa thse de doctorat, V. Mousseau parle dune famille cohrente de critres pour dsigner lensemble de ceux-ci. (Mousseau V., 1993) Cette dfinition est diffrente de celle adopte dans cette thse o il y a un chelon intermdiaire, appel par ce terme de famille, dans la liste des critres Il sagit de paires ordonnes car la vrification de viSvk ne dispense pas de vrifier le surclassement vkSvi
323
324
270
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.3.2.4
Relations entre les variantes
Dans le cadre des mthodes daide multicritre la dcision comparant deux variantes vi et vk (mthodes dagrgation partielle), on analyse les relations entre les variantes pour un critre ou globalement pour lensemble des critres. En procdant une comparaison entre deux variantes vi et vk sur un critre cj, il existe trois situations relatives325 qui sont dtermines partir de la diffrence entre les performances des variantes : gj(vi) - gj(vk),326 qui est note j(vi, vk).
j(vi, vk) > 0 j(vi, vk) = 0 j(vi, vk) < 0
la variante vi est prfre la variante vk pour le critre cj, ce que lon note viPvk la variante vi est quivalente la variante vk pour le critre cj, ce que lon note viIvk la variante vk est prfre la variante vi pour le critre cj, ce que lon note vkPvi
Pour un critre cj donn, on dtermine deux indices qualifiant les relations entre les variantes vi et vk :327 un indice de concordance,328 qui qualifie le degr de crdibilit de la relation vi surclasse vk . Cet indice est dsign par le terme cj(vi, vk) un indice de discordance, qui indique pour les critres o viPvk nest pas vrifi, si le non respect de lhypothse de surclassement viSvk nest pas trop important. Cet indice est dsign par le terme dj(vi, vk)
En procdant une comparaison globale sur lensemble C des critres, on cherche vrifier la concordance de lhypothse de surclassement vi surclasse vk, note viSvk. Quatre situations relatives sont alors possibles :
viSvk v iI v k
la variante vi surclasse la variante vk : il y a suffisamment de critres vrifiant lhypothse de surclassement viSvk la variante vi et la variante vk sont indiffrentes : on ne peut pas les dpartager car il y a autant darguments en faveur de viSvk que darguments en faveur de vkSvi la variante vk surclasse la variante vi : il y a suffisamment de critres vrifiant lhypothse de surclassement vkSvi la variante vi et la variante vk sont incomparables : les deux hypothses de surclassement viSvk et vkSvi ne sont pas vrifies
vkSvi viRvk
Toutes ces relations sont intransitives : viSvk et vkSvi sont parfaitement compatibles (voir note de bas de page N324 la page prcdente).
325 326
On verra dans la dfinition des seuils quil est possible davoir parfois cinq situations relatives Ceci signifie que cj est un critre prsentant une structure de maximisation, cest dire que lon cherche atteindre la performance maximale. Cest ce type de prfrence qui est conserve dans les pages suivantes Ces indices de concordance et discordance ne sont pas utiliss dans toutes les mthodes comme on le verra par aprs On appelle aussi cet indice degr de crdibilit ou indice de concordance pour le critre
327
328
Les mthodes daide multicritre la dcision
271
Les relations globales, cest dire analyses sur lensemble des critres, entre les deux variantes vi et vk sont qualifies par deux indices synthtiques : un indice de concordance globale, dtermin partir des indices de concordance cj(vi, vk) de chaque critre. Il est dsign par le terme Cik et il qualifie le degr de crdibilit de la relation de surclassement viSvk un indice de discordance globale, dsign par le terme Dik. Il est dtermin daprs les indices de discordance dj(vi, vk) et il qualifie le non respect de lhypothse de surclassement viSvk
Ces deux indices peuvent tre compars un systme politique o pour quun objet soit accept en votation, il faut dune part obtenir la majorit des votants (indice de concordance globale) et dautre part que la minorit qui s'y oppose ne soit pas gravement contrarie (indice de discordance globale). (Schrlig A., 1985)
8.3.2.5
Poids
Un poids Pj qualifie limportance relative dun critre cj donn vis vis des autres critres. Il sagit dun paramtre intercritre. On abordera plus en avant dans cette tude les diffrentes manires qui peuvent tre envisages pour fixer ces poids. Cette opration est appele pondration des critres et est gnralement ralise par le dcideur.
8.3.2.6
Critres francs et critres flous
Les mthodes dagrgation partielle comparent les variantes deux deux pour chaque critre. Cette comparaison sur un critre cj donn se base sur la diffrence entre les performances de deux variantes j(vi, vk). Ceci permet de vrifier les relations de prfrence (viPvk et vkPvi) et dindiffrence (viIvk) entre les deux variantes pour un critre cj donn. Il existe deux possibilits de critres possdant des caractristiques de seuils diffrents : les critres francs et les critres flous, dsigns aussi par le terme de pseudo-critres. (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) Ces seuils sont des paramtres intracritres. Avec les critres francs, dans le cas dune comparaison de deux variantes sur un critre cj donn, il existe trois situations relatives entre les variantes, prsentes avec les valeurs des indices de concordance spcifiques cj(vi, vk) et cj(vk, vi) :
j(vi, vk) > 0 j(ai, vk) = 0 j(vi, vk) < 0
viPvk v iI v k vkPvi
cj(vi, vk) = 1 cj(vi, vk) = 0 ou 1330 cj(vi, vk) = 0
cj(vk, vi) = 0329 cj(vk, vi) = 1
On est ici dans le cas dune prfrence ou dune indiffrence stricte, la moindre diffrence entre deux variantes tant significative.
329 330
La rponse la question vi surclasse t-elle vk ? est oui si cj(vi, vk) vaut 1 et non si cj(vi, vk) vaut 0 Ceci varie si lon veut calculer lindice de concordance global Cik en tenant compte des critres indiffrents (cj(vi, vk) = 1) ou non (cj(vi, vk) = 0)
272
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Un seuil de veto Svj spcifique un critre cj donn peut tre dfini.331 Il signifie que si pour un seul critre cj donn, il existe un j(vi, vk) < 0 tel que j(vi, vk) + Svj 0, alors lhypothse viSvk nest pas vrifie quelles que soient les comparaisons ralises sur les autres critres. Ce seuil de veto est une donne volontariste marquant la limite au del de laquelle le non-respect de lhypothse de surclassement est trop important. Ce seuil de veto constitue ainsi une limite la compensation entre les critres. Les valeurs des indices de discordance sont fixes par rapport ce seuil de veto et prennent les valeurs suivantes :
j(vi, vk) Svj
-Svj < j(vi, vk) < Svj
dj(vi, vk) = 0 dj(vi, vk) = 0 dj(vi, vk) = 1
dj(vk, vi) = 1 dj(vk, vi) = 0 dj(vk, vi) = 0
j(vi, vk) -Svj
La figure suivante prsente ces diffrents cas pour la vrification des deux hypothses de surclassement viSvk et vkSvi :
Indice de concordance spcifique
cj
cj(vi, vk) : viSvk cj(vk, vi) : vkSvi
+Svj
-Svj
j(vi, vk)
1
Indice de discordance
dj(vi, vk) : viSvk dj dj(vk, vi) : vkSvi
Figure 55
Valeurs des indices de concordance spcifique et de discordance dans le cas des critres francs
Les critres flous, consistent en une transition progressive entre lindiffrence et la prfrence. Deux seuils supplmentaires, lis un critre cj donn, sont introduits : seuil dindiffrence Sij : il sagit de la plus petite diffrence qui est significative. En dessous de ce seuil, il est impossible de dpartager les deux variantes. On est alors en dessous de la sensibilit de lanalyse332 seuil de prfrence Spj : il sagit du seuil partir duquel la diffrence entre les deux variantes est perceptible et fait prfrer lune lautre333
331
On verra par aprs lintrt de ne pas systmatiquement utiliser ce veto dans le cadre des projets routiers, celui-ci pouvant savrer parfois trop restrictif Par exemple, pour le cas de la Comparaison de variantes 1999 , pour le critre concernant le cot de ralisation, ce seuil dindiffrence peut tre fix 2 millions de francs. Ainsi, une diffrence de 100'000 entre deux variantes aboutit la conclusion de lindiffrence dapprciation entre ces deux variantes vis--vis de ce critre et cj(vi, vk) = 1
332
Les mthodes daide multicritre la dcision
273
Par dfinition, on a : Svj Spj Sij Il est remarquer que le cas o Spj = Sij est tout fait envisageable. Il sagit l dun simple dcalage des deux courbes de la figure prcdente vers lextrieur du graphique. Auparavant les valeurs de lindice de concordance spcifique cj(vi, vk) prenaient les deux valeurs numriques 0 ou 1. Elles ont maintenant des valeurs continues entre 0 et 1 si j(vi, vk) est compris entre Sij et Spj. Ceci signifie que la rponse lhypothse de surclassement est plus ou moins respecte (prfrence floue). On parle dans ce cas de prfrence faible note viQvk. La relation viPvk est alors dsigne par le terme de prfrence stricte. Il existe alors cinq situations relatives entre les variantes, prsentes avec les valeurs des indices de concordance spcifiques cj(vi, vk) et cj(vk, vi) :
j(vi, vk) Spj
Spj j(vi, vk) Sij Sij j(vi, vk) - Sij
- Sij j(vi, vk) - Spj
viPvk viQvk v iI v k vkQvi vkPvi
cj(vi, vk) = 1 cj(vi, vk) = 1 cj(vi, vk) = 1 cj(vi, vk) = 1 0 cj(vi, vk) = 0
cj(vk, vi) = 0 cj(vk, vi) = 0 1334 cj(vk, vi) = 1 cj(vk, vi) = 1 cj(vk, vi) = 1
- Spj j(vi, vk)
La discordance floue est aussi prsente dans le cadre des critres flous, les valeurs des indices de discordance dj(vi, vk) et dj(vk, vi) prenant les valeurs suivantes :
j(vi, vk) Svj
Svj j(vi, vk) Sij Sij j(vi, vk) - Sij
- Sij j(vi, vk) - Svj
dj(vi, vk) = 0 dj(vi, vk) = 0 dj(vi, vk) = 0 dj(vi, vk) = 0 1 dj(vi, vk) = 1
dj(vk, vi) = 1 dj(vk, vi) = 1 0 dj(vk, vi) = 0 dj(vk, vi) = 0 dj(vk, vi) = 0
- Svj j(vi, vk)
La figure ci-aprs prsente ces diffrents cas pour la vrification des deux hypothses de surclassement entre deux variantes vi et vk.
333
Reprenons le cas du critre concernant le cot de ralisation avec un seuil de prfrence fix 10 millions de francs. Si j(vi, vk) vaut 15 millions de francs, alors cj(vi, vk) vaut 0. Si j(vi, vk) vaut 6 millions de francs, alors cj(vi, vk) vaut 0,5 Pour la comprhension de cet exemple, il est prciser que pour le critre du cot de ralisation, lon cherche minimiser les performances
334
La variation des indices de concordance cj(vi, vk) et cj(vk, vi) est linaire entre les deux bornes 0 et 1
274
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Indice de concordance spcifique
cj
cj(vi, vk) : viSvk cj(vk, vi) : vkSvi
+Spj
1
Indice de discordance
+Svj
-Spj
-Svj
+Sij
-Sij
j(vi, vk)
dj(vi, vk) : viSvk dj dj(vk, vi) : vkSvi
Figure 56
Valeurs des indices de concordance spcifique et de discordance dans le cas des critres flous
Les cinq situations relatives entre les variantes dcrites auparavant se prsentent de la manire suivante :
vkPvi
-Spj
vkQvi
-Sij
viIvk
viQvk
+Spj +Sij
viPvk j(vi, vk)
Figure 57
Situations relatives entre deux variantes critres flous
vi et vk dans le cadre de
Il est prciser aussi que les seuils dindiffrence, de prfrence et de veto dfinis pour un critre cj donn ne sont pas forcment dtermins par une valeur fixe comme prsent auparavant. Ils peuvent avoir, avec certaines mthodes daide multicritre la dcision, des valeurs qui dpendent de la performance de la variante. On a alors dans ce cas des seuils dtermins par des formules de ce type :
Sj = j gj(vi) + j335
Si gj(vi) > gj(vk), on a un seuil inverse Si gj(vi) < gj(vk), on a un seuil direct
Les explications relatives aux diffrents seuils ont t ralises avec un cas de critres cherchant maximiser la performance. Dans le cas de la minimisation, les valeurs j(vi, vk) sont considrer comme tant simplement inverses, mais la dmarche de comparaison entre les variantes et la dfinition des seuils restent identiques. Cest pour cela que les formules relatives un problme de minimisation des performances ne seront pas prsentes ici.
335
Il suffit de poser j = 0 pour revenir aux seuils fixes dfinis auparavant
Les mthodes daide multicritre la dcision
275
8.3.3
Typologie des mthodes daide multicritre la dcision
Trois problmatiques dagrgation des jugements sont distinguer dans le domaine des mthodes daide multicritre la dcision : agrgation complte, agrgation partielle ou agrgation locale itrative.
8.3.3.1
Agrgation complte
Ces mthodes sont dveloppes par les tenants de l cole nord-amricaine . Elles consistent attribuer une fonction dutilit partielle, qui est parfois trs complexe, chaque critre. Ensuite, pour chaque variante, une fonction mathmatique agrge les diffrentes utilits partielles propres chaque critre. On obtient ainsi une rponse synthtique qui est unique (critre unique de synthse). Celui-ci est parfois appel valeur d'utilit globale de la variante. Ces mthodes autorisent la compensation des jugements, qui sont transitifs,336 entre les diffrents critres. Un autre dfaut de ces mthodes provient du fait que la dtermination de la fonction dutilit est parfois trs complexe. Le reproche que lon peut faire lgard de ces mthodes, cest quelles sont des
moulinettes, qui donnent limpression dextraire tout le suc des informations dune manire arbitraire, et en gnral peu transparente . Ainsi, aprs avoir adopt une logique multicritre, on revient finalement un problme monocritre en mollissant sur
labsence de commensurabilit des critres. (Schrlig A., 1985) Ainsi les critres qualitatifs doivent tre retranscrits sous forme de notes. Les principales mthodes dagrgation compltes existantes sont : (Maystre L. Y.,
Pictet J. et al., 1994; Schrlig A., 1985)
addition de notes pondres (cas des notes scolaires) : gj(vi) Pj produit de ratios pondrs : gj(vi)
Pj
goal-programming : minimiser des variables dcart Maut : thorie de lutilit multi-attribut (trs utilise dans les pays anglo-saxons) Uta : utilits additives Ahp : analytic hierarchy process analyse cots - bnfices dclassement compar dictature : critre rdhibitoire dmocratie : majorit des votants hirarchie : analyse des critres successifs dans lordre dcroissant dimportance montarisation337
336 337
Cest pour cela que lon parle parfois dagrgation complte transitive Dans le domaine des transports, les mthodes dveloppes actuellement pour choisir des variantes de stratgie dentretien des chausses ou pour comparer les effets sur la socit de diffrents modes de transport (externalisation des cots) sont des mthodes dagrgation complte. Elles consistent ramener un ensemble
276
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
La mthode danalyse des valeurs dutilit utilise dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 est une mthode dagrgation complte qui consiste en une addition de notes pondres.338 Son principe a t prsent au chapitre 2. Il sagit de la mme mthode que celle qui est prsente, sous un autre nom, dans le cours de Conception des voies de circulation du LAVOC. (Dumont A.-G. et Tille M., 1997) Les autres mthodes dagrgation complte ne sont pas dveloppes ici. Le lecteur intress peut se rfrer aux chapitres 4 7 du livre de A. Schrlig. (Schrlig A., 1985)
8.3.3.1
Agrgation partielle
Ces mthodes sont dveloppes par les tenants de l cole europenne. Lagrgation partielle consiste tout dabord comparer les variantes deux par deux, critre par critre. Ceci permet dtablir les relations de surclassement qui existent entre elles (prfrence forte ou faible, indiffrence ou incomparabilit). Ensuite, une synthse de ces relations entre les diffrentes variantes est effectue, sous forme gnralement dun graphe des relations, afin de raliser un tri, de procder un rangement ou de faire sortir la meilleure variante du lot. Ces mthodes admettent les postulats dincomparabilit et d'intransitivit. Elles autorisent une plus grande richesse dans les relations entre les variantes. Comme les critres sont considrs sparment et quil ny a pas de fonctions dutilit dfinir, ceux-ci peuvent tre qualitatifs ou quantitatifs et de nature trs diffrentes. En comparaison des mthodes dagrgation complte, les rsultats des mthodes dagrgation partielles sont parfois peu clairs car ils sont bass sur une analyse du graphe des relations qui est difficile et complexe. Le fait de mollir sur la clart du rsultat peut tre perturbant pour le dcideur qui sattend recevoir une rponse nette et dfinitive.339 (Schrlig A., 1985) De plus, le nombre doprations de comparaisons raliser sur chaque paires de variantes (pour n variantes, on a n (n-1) comparaisons raliser) peut se rvler considrable en prsence de nombreuses variantes. Les principales mthodes dagrgation partielles existantes sont : (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994; Schrlig A., 1985)
Electre (limination et choix traduisant la ralit) : Electre I, Electre II, Electre III, Electre IV, Electre Tri, Electre IS
Qualiflex Oreste Regime
de critres htroclites, concernant parfois lenvironnement ou le comportement social, une seule unit montaire, passant ainsi dune problmatique multicritre une problmatique monocritre. Les dfauts de ce genre de mthodes sont pourtant dcrit depuis longtemps. (Maystre L. Y., Pictet J., et al., 1994)
338
Comme on le verra par aprs, il sera propos une mthode dagrgation partielle pour le projet routier. Cependant, il ne sagit pas de jeter le bb avec leau du bain et il faut retenir de la mthode daide la dcision multicritre retenue pour la Comparaison de variantes 1999 la manire de procder quant la pondration des critres et lvaluation des variantes Cependant cette attitude du constat de limpossibilit de pouvoir nettement trancher en faveur dune variante est plus honnte vis--vis du dcideur que de faire dire quelque chose des lments danalyse non significatifs
339
Les mthodes daide multicritre la dcision
277
Promthe (preference ranking organisation methode for enrichment evaluations) : Promthe I, Promthe II Pragma / Maccap N-Tomic Macbeth Gaia : geometric analysis for interactive assistance
Dans cette tude, seules les mthodes Electre seront prsentes. Il sagit des principales mthodes dagrgation partielle et elles ont t dveloppes par B. Roy et ses collaborateurs du LAMSADE et ont fait lobjet de nombreux ouvrages de vulgarisation, de mise en application et de conseils pratiques, comme (Roy B., 1985), (Schrlig A., 1985), (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) ou (Maystre L. Y. et Bollinger D., 1999).
8.3.3.2
Agrgation locale itrative
Les deux mthodes prcdentes peuvent se rvler lourdes utiliser en prsence dun grand nombre de variantes, voir dun nombre de variantes quasi infini si lon est en prsence dun ensemble V continu. Il sagit alors de procder une exploration locale en fixant tout dabord une solution de dpart correspondant une variante initiale qui est aussi bonne que possible. Ensuite, on regarde dans lensemble des variantes proches de la variante initiale sil nexiste pas une variante qui soit meilleure. Si cest le cas, cette variante devient la variante initiale dun nouveau processus de recherche. On procde ainsi par itrations. Ces jugements locaux mettent en jeu un petit nombre de variantes en renonant une vision globale du problme pos. Il est ainsi tentant de vouloir augmenter le nombre ditrations raliser de manire limiter le risque d oublier une variante qui pourrait savrer intressante. Ces mthodes sont aussi dun contenu thorique ardu ce qui fait que le dcideur doit avoir une totale confiance envers lhomme dtude. F. Joerin souligne aussi que ce genre de mthode nest pas conseiller si le dcideur est un groupe dacteurs, car cette approche ne favorise pas la ngociation, les nombreuses itrations et la complexit des oprations tant autant doccasions de remise en question de la procdure. (Joerin F., 1998) Les principales mthodes dagrgation locale itrative existantes sont : (Maystre L. Y.,
Pictet J. et al., 1994; Schrlig A., 1985)
Plm : programmation linaire multicritre Stem (Pop) Uta interactive Prefcalc
Ces diffrentes mthodes ne seront pas reprises dans cette thse de doctorat.
278
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.3.4
Problmatique de dcision
Comme prsent dans le tableau suivant, les mthodes dagrgation partielles sont rparties en trois catgories de problmatique selon la dcision attendue.
Problmatique Objectif
clairer la dcision par le choix dun sous-ensemble de V aussi restreint que possible (ventuellement rduit une seule variante) en vue dun choix final dune seule variante, ce sous-ensemble contenant les meilleures variantes ou dfauts des variantes satisfaisantes. Il sagit de procder une sorte doptimisation en proposant plusieurs variantes dont une est la meilleure
Rsultat
Un choix ou une procdure de slection
Mthode
Electre I Electre IS
choisir slectionner
trier segmenter
clairer la dcision par un tri rsultant dune affectation de chaque variante des catgories prdfinies en fonction de normes ayant trait la suite donner aux variantes quelles sont destines recevoir. Les variantes ne sont pas compares entre elles mais par rapport des variantes de rfrence. Il sagit de sparer les variantes des moins bonnes bonnes
Un tri ou une procdure daffectation
Electre Tri
ranger classer
clairer la dcision par un rangement obtenu en regroupant tout ou partie des variantes en classes dquivalence qui sont ordonnes, de faon complte ou partielle, conformment aux prfrences. Il sagit de classer les variantes de la moins bonne la meilleure
Un rangement ou une procdure de classement
Electre II Electre III Electre IV
Tableau 35
Typologie des mthodes dagrgation partielle selon problmatique de dcision (Roy B., 1985; Schrlig A., 1985)
la
Les figures prsentes la suite illustrent ces diffrentes problmatiques de dcision.
v2 v4 v1 ... vi ... vk ... vn v1 v3 ... vi ... vn
Noyau : meilleure variante et variantes satisfaisantes
Variantes insatisfaisantes
Figure 58
Problmatique de choix
Les mthodes daide multicritre la dcision
279
v2 v4
Bonnes variantes
v1 ... vi ... vk ... vn
v1 v6
Variantes analyser plus en profondeur
v3 v5
Mauvaises variantes
Figure 59
Problmatique de tri
v2 v4 v6 v1 ... vi ... vk ... vn vi
Meilleure variante
vn
Figure 60 Problmatique de rangement
Plus mauvaise variante
8.3.5
8.3.5.1
Electre I
Prambule
Il sagit de la plus ancienne mthode dagrgation partielle. Elle a t prsente par B. Roy en 1968. La mthode Electre I relve de la problmatique de choix . La mthode Electre I ne sera pas utilise dans cette thse. Elle est cependant dcrite en profondeur en raison de sa simplicit, ce qui permet au lecteur de comprendre rapidement les principes gnraux dune mthode dagrgation partielle. De plus, certains des principes quelle utilise (concordance, discordance, etc.) sont utiliss, dune manire plus complte, mais aussi plus complexe, dans les autres mthodes Electre. Son principal avantage rside dans sa simplicit dutilisation. Cette mthode propose de dgager un sous-ensemble, appel noyau N, comprenant des variantes satisfaisantes renfermant la meilleure variante.
280
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Les critres utiliss dans la mthode Electre I sont francs et il ny a pas de seuil de veto. Ceci nautorise que trois types de relations entre deux variantes pour un critre cj donn : viPvk ou viIvk ou vkPvi. Le principal inconvnient de cette mthode, outre la rigidit de ses jugements, est quelle ne propose que rarement une seule meilleure variante, ce qui peut tre parfois gnant car le rsultat nest pas net. On sait que la meilleure variante se trouve dans le noyau, mais on ne peut pas dire que les autres variantes du noyau sont les variantes places en deuxime ou troisime position. Il sagit plutt des variantes qui sont difficilement comparables avec cette meilleure variante.
8.3.5.2
Dmarche dutilisation
La dmarche dutilisation dElectre I est prsente la figure suivante :
Tableau des performances
gj(vi)
Poids des critres Pj
Comparaison par paires de variantes
Echelle des notes
j(vi, vk)
Tableau des indices de concordance spcifiques
Indices de discordance
cj(vi, vk)
dj(vi, vk) = j(vi, vk)
Indice de concordance globale Cik
Indice de discordance globale Dik
Seuil de concordance
Seuil de discordance
Sc
Sd
Test de concordance
Cik Sc
NON
OUI
Test de non-discordance
Dik Sd
NON
OUI
Hypothse viSvk rejete
Hypothse viSvk accepte
Relation et graphe de surclassement
Recherche du noyau N
Figure 61
Dmarche dutilisation dElectre I (tir de Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)
Les mthodes daide multicritre la dcision
281
Cette dmarche comporte quatre phases successives. (Schrlig A., 1985)
Phase 1 Raliser le tableau des performance
Il sagit dvaluer les performances des variantes auprs de chaque critre. Il est ncessaire de transformer ensuite ces valeurs en notes selon une chelle propre chaque critre. Ces notes sont ensuite disposes dans le tableau des performances, appel aussi matrice des jugements. La difficult de cette opration dans Electre I rside dans le fait que cette valuation doit se baser sur une chelle de jugement chiffre dont la longueur est proportionnelle au poids du critre analys.
Phase 2 Indices de concordance et de discordance
Lhypothse de surclassement viSvk est vrifie pour chaque paire de variantes en calculant deux indices, dont les valeurs sont compris entre 0 et 1 : un indice de concordance global Cik qui se base sur les indices de concordance spcifique cj(vi, vk) et les poids des critres Pj La valeur de Cik se dtermine ainsi :
j=m j =1
c j (vi , vk ) Pj
j=m j =1
Remarques :
Cik =
Pj
cj(vi,vk) = 1 si j(vi, vk) 0 cj(vi,vk) = 0 si j(vi, vk) < 0
un indice de discordance global Dik qui est calcul en considrant les critres cj o j(vi, vk) < 0. Cette opration, qui est un peu arbitraire, consiste chercher parmi ces critres, le minimum de j(vi, vk)340 ou plutt le maximum de j(vk, vi). La valeur de Dik se dtermine ainsi :
Dik =
minimum j ( vi , vk ) ou maximum j ( vk , vi ) amplitude de la plus grande chelle
341
On voit donc toute limportance de la dimension attribuer lchelle chiffre adopte pour lvaluation des performances, celle-ci influenant directement la discordance Des auteurs comme Duckstein (1982), Rochat (1980) ou Vansnick (1979) ont proposs des mthodes de simplification dElectre I utilisant des indices de concordance tenant compte dune certaine discordance en reliant directement ces deux notions. (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994; Schrlig A., 1985)
340 341
On peut alors dire que dj(vi, vk) = j(vi, vk) On peut relever une contradiction (ou une erreur ?) dans la dtermination de cet indice de discordance Dik entre Maystre et Schrlig. En effet, si le premier propose (page 49 de (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)) de diviser le maximum de la diffrence j(vk, vi) (ou le minimum de j(vi, vk) ce qui revient au mme) par lamplitude de lchelle du critre cj correspondant, le second propose de diviser cette diffrence par lamplitude de la plus grande chelle (page 144 de (Schrlig A., 1985))
282
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
On peut aussi attnuer la discordance en ne prenant pas la valeur minimale de j(vi, vk), qui est le premier critre discordant, mais en prenant la valeur du deuxime ou du troisime critre discordant. On parle alors de niveaux de svrit de lanalyse, nots s =1, s = 2, etc.
Phase 3 Seuils de surclassement
On vrifie ensuite si lhypothse de surclassement viSvk est respecte en fixant deux seuils de surclassement : un seuil de concordance Sc qui exprime le minimum de concordance requis un seuil de discordance Sd qui exprime le maximum de discordance tolr
On peut prendre en premire approche les valeurs suivantes : Sc = 0,7 et Sd = 0,2. On analyse ensuite les relations entre les variantes. Si les deux test suivants sont satisfaits, alors on peut affirmer que viSvk : test de concordance : test de non-discordance :
Phase 4 Synthse
Cik Sc Dik Sd
Un graphe de surclassement reprsentant les diffrentes relations de surclassements viSvk entre les variantes est tabli. Ceci permet de dgager le noyau N qui est dfini comme suit : toute variante nappartenant pas au noyau est surclasse par au moins une variante appartenant au noyau les variantes appartenant au noyau sont incomparables entre elles
L'appartenance d'une variante au noyau ne signifie pas ncessairement quil sagit dune bonne solution, le noyau reprsentant simplement l'ensemble des variantes parmi lesquelles se trouve la meilleure et des variantes qui lui sont difficilement comparables. En raison de lintransitivit des surclassements, on peut aussi avoir des circuits (viSvk, vkSvl et vlSvi) ce qui peut fortement gner linterprtation des rsultats. Il sagit ensuite de procder analyse de robustesse en faisant varier les valeurs des seuils de concordance et discordance de manire observer le comportement de ce graphe, notamment la stabilit du rsultat. Si les seuils sont exigeants (Sc = 0,8 et Sd = 0,1 par exemple), il y a un certain appauvrissement du graphe de surclassement mais les relations de surclassement sont trs solides. En prenant par contre des seuils peu exigeants (Sc = 0,5 et Sd = 0,3 par exemple), on peut mieux dpartager les variantes, en faisant apparatre de nouvelles relations de surclassements, qui sont cependant moins solides.
Les mthodes daide multicritre la dcision
283
8.3.6
8.3.6.1
Electre II
Prambule
La mthode Electre II, qui date de 1972, relve de la problmatique de rangement ou de classement . Les rsultats obtenus avec Electre II sont plus tranchs que dans la prcdente mthode, car il y a presque toujours une meilleure variante qui se dgage du classement obtenu. Electre II a pour objectif, en utilisant les relations d'ordre sur chacun des critres, de classer les variantes depuis les meilleures jusqu'aux moins bonnes , ceci en tolrant les ex quo. (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) Les variantes ne sont pas qualifies en fonction de leur valeur propre mais en valeur relative par rapport aux autres variantes. Cette mthode utilise, tout comme la mthode Electre I, une vrification de la concordance et de la non-discordance avec lhypothse de surclassement viSvk. Une distinction est nanmoins ralise, afin de mieux respecter les nuances du rel, en introduisant une notion de respect de cette hypothse de surclassement qui est plus floue, entre la rigidit de Electre I et le flou total dElectre III. On trouve ainsi un surclassement fort viSFvk, qui repose sur des bases solides (certitude forte sur lhypothse), et un surclassement faible viSfvk, qui est plus sujet caution (certitude faible sur lhypothse). Les critres utiliss dans la mthode Electre II sont francs et ne comportent pas de seuil de veto.
8.3.6.2
Dmarche dutilisation
La mthode Electre II se base sur les phases dtudes successives suivantes :
Phase 1 Raliser le tableau des performance
Il sagit dvaluer les performances des variantes auprs de chaque critre en les disposant dans le tableau des performances. Contrairement Electre I, il ny a ici aucune contrainte quant lampleur des chelles dvaluation des critres.
Phase 2 Vrification de la concordance
La concordance avec lhypothse de surclassement viSvk est vrifie pour chaque paire de variantes de la manire suivante : dtermination dun indice de concordance globale Cik identique Electre I
j=m j =1
c j (vi , vk ) Pj
j=m j =1
Remarques :
Cik =
Pj
cj(vi,vk) = 1 si j(vi, vk) 0 cj(vi,vk) = 0 si j(vi, vk) < 0
284
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
dtermination dun indice de vrification du noyau Nik permettant dliminer les circuits lintrieur de celui-ci (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)
j=m
Nik =
j =1 j=m j =1
c+ j (vi , vk ) Pj c- j (vi , vk ) Pj
Trois cas sont possibles :
j(vi, vk) > 0 j(vi, vk) = 0 j(vi, vk) < 0
c+j(vi,vk) = 1 c+j(vi,vk) = 0 c+j(vi,vk) = 0
cj(vi,vk) = 0 cj(vi,vk) = 0 cj(vi,vk) = 1
Remarque : on peut avoir Nik > 1
+ 0 -
trois seuils de concordance sont proposs dans lordre suivant : Sc Sc Sc . Il sagit de seuils de concordance fort, moyen ou faible le test de concordance consiste vrifier si les conditions suivantes sont satisfaites :
Cik (Sc+ ou Sc0 ou Sc-)
Phase 3
et
Nik 1
Vrification de la discordance
La discordance avec lhypothse de surclassement viSvk est vrifie pour chaque critre de la manire suivante : deux seuils de discordance342 Sd1 (discordance faible) et Sd2 (discordance forte) tels que Sd1 Sd2 sont fixs pour chaque critre le test de non-discordance consiste vrifier pour chaque critre que :
-
si j(vk, vi) Sd2, il y a une certitude forte que le critre cj ne soppose pas lhypothse de surclassement viSvk si Sd2 j(vk, vi) Sd1, il y a une certitude faible que le critre cj ne soppose pas lhypothse de surclassement viSvk
tablissement des relations de surclassement
Phase 4
Un graphe de surclassement reprsentant les relations de surclassements forts viSFvk et faibles viSfvk entre les variantes est tabli. Tout comme avec la mthode Electre I, les tests de concordance et de non-discordance doivent tre satisfaits pour tablir une relation de surclassement. Une procdure complexe, prsente la page 67 de (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994), permet de procder ensuite la vrification du surclassement (faible ou fort) en combinant les diffrents tests et indices pralablement dcrits. Elle ne sera pas reprise ici.
Phase 5 Exploitation des relations de surclassement
Pour procder la classification des variantes depuis la moins bonne jusqu la meilleure , Electre II analyse le graphe de surclassement afin dtablir trois prordres : deux prordres complets, ou totaux, qui permettent dobtenir un prordre partiel final.
342
Lopposition des critres discordants lhypothse de surclassement doit tre suffisamment faible pour celle-ci soit acceptable
Les mthodes daide multicritre la dcision
285
On tablit initialement les deux prordres complets suivants :
classement direct, bas sur la longueur des chemins343 arrivant la variante, appel aussi procdure des chemins aboutissant (Schrlig A., 1985) classement inverse, bas sur la longueur des chemins partant de la variante, appel aussi procdure des chemins issus
Les variantes sont ainsi ranges par classes distingues par leur rang.344 Les deux classements s'oprent partir du graphe de surclassement fort, le graphe de surclassement faible n'tant utilis que pour dpartager les ex quo. En effet, dans ces prordres complets, lincomparabilit des variantes nest pas admise. Un prordre partiel final, qui est constitu par lintersection345 des deux prordres complets, est ensuite tabli. Ici, lincomparabilit entre les variantes est autorise. Les rgles suivantes doivent tre respectes pour ltablissement du prordre partiel final : (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) si viPvk dans les deux prordres complets, alors viPvk dans le prordre final si viPvk dans un prordre complet et viIvk dans lautre, alors viPvk dans le prordre final si viPvk dans un prordre complet et vkPvi dans lautre, alors viRvk dans le prordre final
Cette procdure offre la possibilit de se faire une ide de la solidit des rsultats : une variante qui change normment de rang entre les classements direct et inverse, est une action qui peut difficilement se comparer aux autres. Au contraire, une action se classant en tte dans les deux types de classement est srement une variante retenir. On vite aussi les risques lis un classement mdian (moyenne des rangs obtenus dans les deux prordres complets) qui peut indique le mme rsultat pour deux situations diffrentes. La manire de reprsenter le prodre partiel final est dtaille au chapitre 8.3.7.3 la page 289
343 344
Cette notion de chemin est emprunte la thorie des graphes Le rang est une notion qui ne doit pas tre confondue avec la position dans le classement. Si par exemple, pour quatre variantes, les deux premires sont dans une classe quivalente, on a le 1er rang qui compte deux variantes, le 2me rang comptant une variante qui arrive en troisime position du classement et le 3me rang comprenant la variante qui arrive en dernire position Il sagit de lintersection au sens mathmatique du terme (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)
345
286
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.3.7
8.3.7.1
Electre III
Prambule
La mthode Electre III, qui date de 1977, relve aussi de la problmatique de rangement ou de classement . Elle suit les grands principes dj nonc dans la mthode Electre II en constituant sa prolongation naturelle. Il y a toujours, comme dans les deux prcdentes mthodes, une hypothse de surclassement et des notions de concordance et de discordance. Le changement le plus important par rapport Electre II rside dans le fait que Electre III comporte une part de flou dans la relation de surclassement. La rflexion porte dsormais sur la crdibilit accorder cette hypothse de surclassement viSvk. Ceci est traduit par la mesure du degr de crdibilit de l'hypothse de surclassement, qui varie de 0 (surclassement certainement inexistant) 1 (surclassement existant). On travaille ainsi avec des valeurs continues et non plus bivalentes. Electre III utilise la notion de critres flous qui a t dcrite auparavant et qui comporte trois seuils lis chaque critre : seuil d'indiffrence, de prfrence stricte pour la concordance et de veto pour mieux exprimer la discordance.346 Ceci permet de dfinir une relation supplmentaire entre deux variantes, la prfrence faible note viQvk. Electre III continue sur les traces d'Electre II, mais cette volution se traduit par deux effets contradictoires : (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) une information qui est de plus en plus nuance et qui se rapproche de la complexit de la ralit, ce qui donne un rsultat plus net et des conclusions bien fondes une complexit croissante du processus, donnant un peu une impression de bote noire et donc une difficult de comprhension grandissante de la part du dcideur
La ralisation des diffrentes phases dtude dElectre III est fastidieuse et complexe. Cependant, le logiciel ELECTRE III-IV dvelopp par le LAMSADE permet de rapidement tablir les classements des diffrentes variantes partir du tableau des performances et de la dfinition des diffrents seuils.347 Son faible cot, sa facilit dinstallation et dutilisation ainsi que sa convivialit en font un excellent outil daide la dcision au service du praticien, pargnant celui-ci lexamen des procdures complexes de classement. (LAMSADE, 1994)
346
Le seuil de veto nest pas obligatoire dans Electre III, ce qui peut se rvler intressant dans le cadre des projets dinfrastructures routires B. Roy et D. Bouyssou affirment que le recours un logiciel est absolument ncessaire (Roy B. et Bouyssou D., 1993)
347
Les mthodes daide multicritre la dcision
287
Comme les descriptions des diffrentes mthodes dagrgation partielle sont destines au praticien,348 la prsentation de la mthode Electre III dans cette thse de doctorat sera donc volontairement porte sur les lments principaux de celle-ci. On ne dveloppera pas ici les algorithmes de classement. Le lecteur intress peut toujours se rfrer aux descriptions trs compltes situes dans louvrage de L.-Y. Maystre. (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)
8.3.7.2
Dmarche dutilisation
La mthode Electre III se base sur les phases dtudes successives suivantes :
Phase 1 Raliser le tableau des performance
Il sagit dvaluer les performances des variantes auprs de chaque critre en les disposant dans le tableau des performances, tout comme dans Electre II.
Phase 2 Indices de concordance
La dtermination dun indice de concordance globale Cik avec lhypothse de surclassement viSvk est identique Electre I ou II :
j=m j =1
c j (vi , vk ) Pj
j=m j =1
Cik =
Dans ce cas, les valeurs de lindice de concordance cj(vi, vk) sont continues entre 0 et 1 et non plus bivalentes (0 ou 1) comme pour Electre I ou Electre II
Pj
Aprs avoir ralis des matrices de concordance pour chaque critre (m matrices n n comprenant les indices de concordance cj(vi, vk)), une matrice de concordance globale est ensuite ralise (matrice n n comprenant les indices de concordance globale Cik).
Phase 3 Indices de discordance
La discordance avec lhypothse de surclassement viSvk se dtermine pour chaque critre par le calcul de lindice de discordance dj(vi, vk). Des matrices de discordance sont ensuite ralises pour chaque critre (m matrices n n comprenant les indices de discordance dj(vi, vk)).
348
Le praticien intress par lutilisation de la mthode Electre III effectuera son tude laide du logiciel ELECTRE IIIIV du LAMSADE. Comme il a t dit prcdemment, cette thse sintresse plus cet aspect dutilisation qu un aspect de dveloppement de la mthode
288
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Phase 4
Relation de surclassement floue
Le degr de crdibilit du surclassement ik est dtermin ainsi :
ik = Cik
j =1
j=m
1 - d j (vi , vk ) 1 - Cik
Seuls les critres cj o dj(vi, vk) > Cik349 sont pris en considration dans le calcul du degr de crdibilit (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)
On peut faire les remarques suivantes en fonction de la valeur du seuil de veto : (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) si -Svj j(vi, vk) (ou Svj j(vk, vi)) pour un seul critre, alors dj(vi, vk) = 1, ce qui signifie que le degr de crdibilit du surclassement ik vaut alors 0 si il ny a pas de seuil de veto sur lensemble des critres (Svj quel que soit le critre cj considr), alors dj(vi, vk) = 0, ce qui signifie que le degr de crdibilit vaut lindice de concordance globale : ik = Cik
Une matrice des degrs de crdibilit est ensuite ralise (matrice n n comprenant les degr de crdibilit ik). Compar Electre II, il n'y a plus deux types de surclassement (fort ou faible) mais une multitude de surclassements caractriss par leur degr de crdibilit, ce qui permet de mieux saisir la complexit de la problmatique tudie.
Phase 5 Exploitation de la relation de surclassement floue
Un classement des variantes et tabli sur la base des degrs de crdibilit des relations de surclassement entre chaque paire de variantes. La procdure, qui est complexe, et lalgorithme permettant darriver ce classement sont prsents aux pages 93ss de (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994). Par analogie avec le classement inverse et le classement direct utilis dans Electre II, la mthode Electre III procde deux classements antagonistes, qui sont des prordres complets : une distillation ascendante et une distillation descendante. Le classement final est un prordre partiel, autorisant les ex quo, qui est tir de la comparaison des rangs obtenus par les variantes dans ces deux distillations. Il est tabli de la mme manire que dans Electre II. La dmarche dutilisation de la mthode Electre III est rsume dans le schma de la page suivante.
349
Pour calculer le degr de crdibilit, on ne considre que les critres cj o lindice de discordance est suprieur lindice de concordance globale (Maystre L. Y., Pictet J., et al., 1994)
Les mthodes daide multicritre la dcision
289
Ensemble des critres flous
cj
Tableau des performances Double pondration : critres et familles de critres
Ensemble des variantes
gj(vi)
vi
Seuils de prfrence Spj Seuils d'indiffrence Sij
Poids des critres Pj
Comparaison par paires de variantes
j(vi, vk)
Tableau des indices de concordance spcifiques
cj(vi, vk)
Indices de discordance par critres dj(vi, vk)
Seuils de veto Svj
Indice de concordance globale Cik
Degr de crdibilit du surclassement ik
Relation de surclassement floue
Algorithme de classement Seuil de distillation
2 prordres complets
Distillation ascendante Distillation descendante
Graphique Simos-Maystre
1 prodre partiel
Figure 62
Dmarche dutilisation de la mthode Electre III (LAMSADE, 1994)
8.3.7.3
Prsentation des rsultats
Le logiciel ELECTRE III-IV dvelopp par le LAMSADE propose les rsultats des deux distillations comme prsent dans la figure ci-contre. (LAMSADE, 1994) Cette faon de procder peut compliquer lanalyse, surtout si lon se trouve en prsence de variantes prsentant de grands carts de rang entre les deux prordres complets. Si le nombre de variantes est important, lanalyse est aussi plus difficile tablir.
Figure 63 Saisie dcran des rsultats des distillations et du graphe final selon ELECTRE III-IV
290
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Simos et Maystre proposent de prsenter les rsultats des deux distillations ralises dans Electre III (rang des variantes) sous la forme dun graphique trs simple raliser et dune grande lisibilit. (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) Labscisse est constitue par les rangs en sens inverse de la distillation descendante. Lordonne est constitue par les rangs en sens inverse de la distillation ascendante.350 Un exemple dun tel graphique est prsent ci-dessous :
Distillation ascendante
Distillation ascendante Variantes Rang 1 2 3 4 5
Distillation descendante Variantes Rang 1 2 3 4 5 6
v3 v1 v2 v5, v7 v4 v6
v3 v2 v4 v1 v5 v7 v6
v3 v1 v2 v5 v7 v4 v6
Distillation descendante
Figure 64
Exemple de reprsentation des rsultats obtenus avec Electre III selon Simos et Maystre (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)
Ce mode de reprsentation des rsultats se base sur lhypothse que les carts de rangs sont considrs comme gaux, ce qui peut tre un peu formel car rien ne justifie la ralit de ce postulat. Son intrt rside aussi dans le fait que le classement final ou mdian, qui entrane une perte dinformation, nest pas raliser. Les meilleures variantes sont proches du coin suprieur gauche. Les variante situes le long de la diagonale reliant les coins infrieur gauche et suprieur droit peuvent faire lobjet dun jugement solide car leur rang est constant dans les deux distillations. Les variantes se trouvant vers les coins suprieur gauche et infrieur droit sont les plus incomparables, les plus baladeuses . (Schrlig A., 1996)
8.3.8
8.3.8.1
Electre IV
Prambule
La mthode Electre IV, qui date de 1982, relve aussi de la problmatique de rangement ou de classement . Sa dmarche dutilisation constitue en une simplification de la mthode Electre III par labandon de la pondration des critres. Son originalit rside dans le fait quil n'y a plus de poids attribus aux critres, seul une hypothse de disparit limite tant fixe. Ce changement fondamental est accompagn dune modification de l'hypothse de surclassement, labsence de
350
Le rang est dfini comme tant la classe dans laquelle est place la variante. Deux variantes ex aequo sont de mme rang.
Les mthodes daide multicritre la dcision
291
poids ne permettant plus en effet de calculer une concordance globale telle que vue auparavant. Lhypothse de disparit limite est nonce de la manire suivante : Aucun
critre na, lui tout seul, une importance suprieure ou gale celle dune coalition rassemblant au moins la moiti des critres . (Roy B. et Bouyssou D., 1993) Cette
prcaution permet dviter quun critre ne soit trop prpondrant ou au contraire ngligeable. Electre IV utilise, comme Electre III, des critres flous associs un seuil de prfrence stricte et un seuil d'indiffrence. La mthode admet plusieurs versions des types de surclassement entre deux variantes. Electre IV se base sur les nuances dveloppes dans Electre III mais simplifie fortement le processus dtude qui sensuit. Comme pour la mthode Electre III, lusage du logiciel ELECTRE III-IV assure au praticien un usage efficace et rapide de cette mthode. Cette mthode est trs utile quand des jeux de pondration totalement antagonistes sont en prsence ou quand il apparat extrmement difficile dlaborer une pondration, cette opration tant sans fondement ou nayant pas de sens. Cependant en procdant ainsi, on enlve, par rapport Electre III, un certain pouvoir au dcideur, qui dans le cadre du projet routier, est lacteur qui effectue la pondration.
8.3.8.2
Dmarche dutilisation
La mthode Electre IV se base sur les phases dtudes successives suivantes :
Phase 1 Raliser le tableau des performance
Il sagit dvaluer les performances des variantes auprs de chaque critre en les disposant dans le tableau des performances, comme dans Electre II ou Electre III.
Phase 2 Comparaison des variantes deux deux
On dtermine pour chaque paire de variantes vi et vk351 les indices suivants :
mp(vi, vk) mq(vi, vk) min(vi, vk) m0(vi, vk) min(vk, vi) mq(vk, vi) mp(vk, vi)
nombre de critres o viPvk (prfrence stricte) nombre de critres o viQvk (prfrence faible) nombre de critres o viIvk et j(vi, vk) > 0352 nombre de critres o viIvk et j(vi, vk) = 0 (indiffrence) nombre de critres o vkIvi et j(vi, vk) < 0 nombre de critres o vkQvi nombre de critres o vkPvi
La somme de ces sept indices vaut m, qui est le nombre de critres.
351
Il est remarquer que celles-ci nont plus tre ordonnes car on cherche qualifier directement la relation de surclassement qui existe entre ces deux variantes On dit dans ce cas que vi est peine prfre que vk
352
292
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Phase 3
Construction de la relation de surclassement
Electre IV distingue quatre niveaux de crdibilit de la relation de surclassement : Quasi-dominance
viSqvk
si les deux conditions suivantes sont respectes :
-
mp(vi, vk) = mp(vk, vi) = 0 min(vk, vi) 1 + min(vi, vk) + mq(vi, vk) + mp(vi, vk)
viScvk
Dominance canonique
si les trois conditions suivantes sont respectes :
-
mp(vk, vi) = 0 mq(vk, vi) mp(vi, vk) min(vk, vi) + mq(vk, vi) 1 + min(vi, vk) + mq(vi, vk) + mp(vi, vk)
viSpvk
Pseudo-dominance
si les deux conditions suivantes sont respectes :
-
mp(vk, vi) = 0 mq(vk, vi) mq(vi, vk) + mp(vi, vk)
viSvvk
Veto-dominance
si les trois conditions suivantes sont respectes :
-
mp(vk, vi) = 0 mq(vk, vi) = 1 mq(vi, vk) 0,5 m
Exploitation de la relation de surclassement
Phase 4
Tout comme dans Electre III, Electre IV procde deux classements antagonistes : une distillation ascendante et une distillation descendante. Le classement final est un prordre partiel, autorisant les ex quo, qui est tir de la comparaison des rangs obtenus par les variantes dans ces deux distillations. La procdure, qui est complexe, et lalgorithme permettant darriver ce classement sont prsents aux pages 112ss de (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994).
Les mthodes daide multicritre la dcision
293
8.3.9
8.3.9.1
Electre IS
Prambule
La mthode Electre IS,353 qui date de 1985, relve de la problmatique de choix . Cette mthode est une adaptation dElectre I permettant dutiliser des critres flous, ce qui amliore la prise en compote des nuances. Comme dans Electre III, Electre IS utilise les seuils dindiffrence Si, de prfrence Sp et de veto Sv. Comme dans Electre I, c'est dans le noyau N que se trouve la meilleure variante. Toutefois les inconvnients lis au fait que les autres variantes du noyau sont surtout celles qui sont incomparables avec cette meilleure solution subsistent. La mthode Electre IS permet par contre de mieux cerner le problme des circuits du graphe de surclassement. Elle permet de connatre, pour chaque circuit maximal, son taux de cohsion interne (relations entre les variantes le composant) et son taux de liaison externe (relations avec les autres lments du graphe, variantes ou circuit). Electre IS se base sur les degrs de crdibilit provenant de lutilisation de la mthode Electre III. Cependant, la transformation de la relation de surclassement floue en une relation nette est pnalisante car elle limine les nuances.
8.3.9.2
Dmarche dutilisation
La mthode Electre IS comporte les mmes phases initiales dtude quElectre III : ralisation du tableau des performances dtermination des indices de concordance par critre cj(vi, vk) et des indices de concordance globale Cik reprsents dans une matrice de concordance globale dtermination des indices de discordance dj(vi, vk) reprsents dans des matrices de discordance dtermination des degrs de crdibilit ik qui sont indiqus dans une matrice des degrs de crdibilit. Celle-ci est identique que lon soit en train danalyser une problmatique par une mthode Electre III ou Electre IS.
Les phases dtude qui suivent sont :
Phase 1 Relation de surclassement
Afin de simplifier le graphe de surclassement, un seuil de coupe s est fix. (Joerin F., 1998) Il permet dliminer les relations de surclassement viSvk si s > ik . Un seuil de coupe lev (s = 0,8 par exemple) clarifie ainsi les relation de surclassement. Pour augmenter les relations de surclassement, il suffit daffaiblir progressivement la valeur du seuil de coupe.
353
Le terme S signifie seuils
294
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Phase 2
Recherche du noyau
La dfinition du noyau N est identique celle utilise dans Electre I : toute variante nappartenant pas au noyau est surclasse par au moins une variante appartenant au noyau les variantes appartenant au noyau sont incomparables entre elles
Si lon observe des circuits, il sagit de dgager le ou les circuits maximaux.354 Quand ces circuits maximaux sont identifis, ils sont remplacs par une variante fictive qui a pour but de rduire les circuits afin de dgager le noyau. Deux indicateurs de rsultat sont dfinis pour analyser les rsultats obtenus :
taux de cohsion interne dun circuit qui est le rapport entre le nombre darcs existant entre les variantes dun circuit et le nombre darcs potentiels de ce mme circuit. Si ce taux se rapproche de 1, la plupart des variantes du circuit sont incomparables entre elles taux de liaison externe dun circuit qui est le rapport entre, dune part, le nombre darcs existant entre les variantes dun circuit et les autres lments du graphe de surclassement et, dautre part, le nombre darcs potentiels entre le circuit et les autres lments du graphe de surclassement. Plus ce taux est lev, plus le rsultat est stable
8.3.10
8.3.10.1
Electre Tri
Prambule
Les mthodes Electre Tri relvent de la problmatique de tri ou daffectation . Il sagit dattribuer chaque variante une catgorie, ou classe daffectation, prdfinie. Par rapport aux autres mthodes Electre, la mthode Electre Tri permet de sensiblement rduire le nombre de variantes comparer. Des variantes de rfrence355 sont utilises pour segmenter l'espace des variantes en classes daffectation. Chaque variante de rfrence sert de limite deux catgories, l'une suprieure et l'autre infrieure. Il y a deux familles de mthodes Electre permettant des trier les variantes : la mthode Electre Tri dveloppe par W. Yu en 1992 ne considre quune seule variante de rfrence pour dlimiter deux classes daffectation. Le nombre de ces classes nest par contre pas limit la mthode dveloppe par B. Roy et J. Moscarola en 1981 permet de considrer plusieurs variantes de rfrence pour dlimiter deux classes daffectation. Par contre, le nombre de classes daffectation est limit trois (bon, incertain, mauvais)
354 355
Un circuit maximal est un circuit qui nest compris dans aucun autre circuit A. Schrlig les dsigne par le terme de action-talon (Schrlig A., 1996)
Les mthodes daide multicritre la dcision
295
Tout comme F. Joerin la fait dans sa thse de doctorat, le choix de la mthode Electre Tri adopt par lauteur se porte sur la deuxime famille. (Joerin F., 1998) Le fait de ne disposer que de trois classes daffectation (bon, incertain, mauvais) pour trier des variantes de tracs dinfrastructures routires est jug comme tant amplement suffisant. La mthode Electre Tri est intressante pour les raisons suivantes : elle permet de juger chaque variante sur sa valeur relative vis--vis des variantes de rfrences et ceci indpendamment des autres variantes. On peut ainsi rajouter une variante dans lanalyse et rapidement ltudier sans modifier les rsultats dj obtenus on peut fixer des valeurs de rfrence comme des normes lgales ou des rsultats minimaux ncessaires pour l'acceptation ou le refus dune variante on peut considrer un nombre de variantes plus important que dans les autres mthodes Electre, car le volume de calculs raliser est nettement infrieur le tri permet de rapidement rduire le nombre de variantes tudier pour pouvoir ensuite concentrer ltude sur les variantes intressantes, ceci en appliquant une autre mthode dagrgation partielle, Electre III par exemple comme les variantes de rfrence sont stables tout au long de ltude, la mthode Electre Tri est moins sensible la prsence de clones qui sont des variantes proches lune de lautre et qui ont tendance fausser les rsultats obtenus avec une mthode comme Electre III (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994)
8.3.10.2
Variantes de rfrence
Deux types de variantes de rfrence sont dfinir au dbut de lanalyse :
vBi : variante de rfrence bonne sparant les classes daffectation variante bonne et variante incertaine 356 vMi : variante de rfrence mauvaise sparant les classes daffectation variante incertaine et variante mauvaise
Il est vident que la condition de surclassement vBiSvMi doit tre vrifie pour toutes les variantes de rfrence. De plus, la situation dincomparabilit vBiRvMi ne doit pas tre prsente. On distingue deux types de variantes de rfrence selon leur mode de dtermination : (Joerin F., 1998) les variantes de rfrence relles qui sont des variantes faisant partie de lensemble des variantes analyser. Aux yeux du dcideur, ces variantes apparaissent comme tant caractristique des bornes des classes daffectation357
356
Le qualificatif dincertain signifie que ltude de ces variantes est approfondir car elles se situent entre les variantes certainement bonnes et celles qui sont certainement mauvaises . Un doute subsiste sur leur qualit Par exemple, dans le cadre de la Comparaison de variantes 1999 la variante dtat de rfrence ER(0) peut servir de variante de rfrence mauvaise, son inadquation aux standards dsirs pour la A 144 tant manifeste. Ainsi, toute variante qui sera moins bien classe que ER(0) sera affecte la classe variante mauvaise
357
296
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
les variantes de rfrence artificielles o les valeurs des critres sont fixes par le dcideur sur la base de normes, de rglements ou de lois ou sur la base de son propre systme de valeurs
Le nombre de ces variantes de rfrence nest pas limit. Ces variantes de rfrence sont tablies avec le dcideur. On peut avoir, par exemple, pour le cas des variantes de rfrence bonnes, une variante o lconomie est suffisante tandis que lenvironnement est bon et une autre variante o ces aspects sont inverss.
8.3.10.3
Dmarche dutilisation
La mthode Electre Tri dmarre comme Electre III. On retrouve les phases dtudes suivantes, qui peuvent tre ralises laide du logiciel ELECTRE III-IV :358 ralisation du tableau des performances en y intgrant vB et vM dtermination des indices de concordance par critre cj(vi, vk) et des indices de concordance globale Cik reprsents dans une matrice de concordance globale dtermination des indices de discordance dj(vi, vk) reprsents dans des matrices de discordance dtermination des degrs de crdibilit ik qui sont indiqus dans une matrice des degrs de crdibilit
Les phases dtude spcifiques Electre Tri qui suivent sont les suivantes :
Phase 1 Seuils de crdibilit
Il sagit de fixer quatre seuils S1, S2, S3, et S4 tels que : 1 > S1 > S2 et S3 > S4. On doit prendre des valeurs leves pour ces quatre seuils, comme par exemple les valeurs suivantes : S1 = 0,9, S2 = 0,8, S3 = 0,8 et S4 = 0,7 (Schrlig A., 1996)
Phase 2 Indices de crdibilit maximaux
En se basant sur la matrice des degrs de crdibilit, il sagit de dterminer, pour chaque variante vi qui doit tre affecte, les indices de crdibilit maximaux :
M1
maximum i,Bi : indice de crdibilit maximal de lhypothse de surclassement viSvBi Ensuite, la variante de rfrence bonne vBi amenant M1 est exclure de la recherche de M2 maximum Bi,i : indice de crdibilit maximal de lhypothse de surclassement vBiSvi maximum Mi,i : indice de crdibilit maximal de lhypothse de surclassement vMiSvi Ensuite, la variante de rfrence mauvaise vMi amenant M3 est exclure de la recherche de M4 maximum i,Mi : indice de crdibilit maximal de lhypothse de surclassement viSvMi
M2 M3
M4
358
Un logiciel spcifique est aussi disponible pour lutilisation dELECTRE Tri (LAMSADE, 1998b)
Les mthodes daide multicritre la dcision
297
Phase 3
Affectation des variantes
La procdure de tri des variantes se base sur les indices de crdibilit dtermins auparavant, comme indiqu dans la figure suivante :
OUI
M1 S1
NON
OUI
M2 < S2
NON
M3 S 3
OUI
NON NON
M4 < S4
OUI
Variante bonne
Variante incertaine
Variante mauvaise
Figure 65
Procdure daffectation des variantes dans Electre Tri (tir de Schrlig A., 1985, 1996)
La lecture du schma prcdent peut se dcrire ainsi : Une variante vi est affecte la classes des variantes bonnes si les deux conditions suivantes sont respectes :
M1 S1 M2 < S2
vi surclasse fortement une variante de rfrence bonne vBi
aucune variante de rfrence bonne vBi, lexclusion de celle qui a donn M1, ne surclasse fortement vi
Une variante vi est affecte la classes des variantes mauvaises si les trois conditions suivantes sont respectes :
M1 < S1 M3 S3 M4 < S4
vi ne surclasse pas fortement une variante de rfrence bonne vBi
une variante de rfrence mauvaise vMi surclasse fortement vi
vi ne surclasse pas fortement une variante de rfrence mauvaise vMi
Si les deux vrifications prcdentes ne sont pas remplies, la variante vi est affecte la classes des variantes incertaines .
8.3.11
Rcapitulation
Les principales caractristiques des mthodes Electre prsentes dans cette thse de doctorat sont rcapitules dans le tableau de la page suivante.
298
Critres
Poids flous francs veto Sv
Seuils
Exploitation du surclassement
Problmatique
Avantages
globale Cik
globale Dik
Mthode Electre
Inconvnients
prfrence Sp
indiffrence Si
discordance Sd
concordance Sc
par critre cj(vi, vk)
par critre dj(vi, vk)
Indice de discordance
Indice de concordance
Degr de crdibilit ik
classement direct et inverse
recherche du noyau
distillation ascendante et descendante
Tableau 36
rigidit des jugements
rsultat difficile interprter
simplicit dutilisation
chelle des notes poids
noyau : le brillant second est hors du noyau et circuits possibles
comprhension aise du processus
solution intermdiaire entre Electre I et Electre III
II
critres francs
apparition de la nuance par surclassement faible ou fort
entre les deux prordres totaux, risque de variante baladeuse
rsultat plus tranch
complexit du processus
algorithme complexe
logique floue dcrite par le degr de crdibilit du surclassement
III
ncessite un logiciel spcifique
3 seuils
information totalement nuance
comprhension plus difficile pour le dcideur (bote noire)
logiciel LAMSADE convivial
complexit du processus
absence de poids
algorithme complexe
hypothse de disparit limite
IV
labsence de pondration peut tre perturbante
critres flous
utile en cas de pondrations antagonistes
solution un peu btarde entre Electre I et Electre III car elle a les inconvnients lis au noyau
plus de nuances quElectre I par utilisation de critres flous
IS
niveau du seuil de coupe ?
taux de cohsion des circuits qualifiant la stabilit des rsultats
variantes de rfrence
Caractristiques principales des mthodes Electre (tir de Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) 9 9 9 9 9 9 9 9
difficult de dfinir des variantes de rfrence
moins de calculs
Tri
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
que faire des variantes incertaines ?
variantes juges isolment des autres : permet dajouter des variantes
Une mthode daide multicritre la dcision adapte au projet routier
299
8.4
U NE METHODE D AIDE MULTICRITERE A LA
DECISION ADAPTEE AU PROJET ROUTIER
8.4.1
Le choix dune mthode daide multicritre la dcision
Quoi ?
8.4.1.1
Il nexiste pas de mthodes daide multicritre la dcision qui soit parfaite et idale pour chaque cas donn. Le choix de la mthode utiliser est en soi une problmatique qui dpend du dcideur, de lhomme dtude, des caractristiques du projet, de son environnement, des variantes considres, du rsultat attendu, des objectifs fixs laide la dcision, etc. Les mthodes dagrgation complte ne seront pas considres ici car elles sont dj connue des praticiens utilisant des mthodes daide multicritre la dcision dans le cadre du projet routier. Lanalyse de la valeur dutilit (AVU)359 traite dans le chapitre 2 rsume bien le principe des ces mthodes. Cette thse de doctorat va sintresser maintenant dterminer quelle est la mthode dagrgation partielle qui est la mieux adapte aux projets dinfrastructures routires. Il sagit pour cela de proposer une mthode daide multicritre la dcision rpondant de multiples contraintes : utilisation facilite pour le praticien : volume de travail raisonnable, bagage technique ncessaire courant, comprhension du processus rsultats clairs pour le dcideur, le public et les acteurs non techniques aspects pdagogiques : comprhension du processus par ltudiant ralisation rapide de ltude multicritre apport supplmentaire comparativement aux mthodes daide multicritre la dcision utilises actuellement dans des projets routiers360 souplesse dadaptation au projet
Le tableau de la page prcdente constitue une synthse claire des caractristiques principales des diffrentes mthodes dagrgation partielle. Il constitue une aide prcieuse pour le dcideur voulant choisir une mthode adapte ltude. Cependant, comme on le verra par aprs, lauteur va proposer une mthode qui est la mieux adapte aux projets routiers. Ce choix nest pas le seul applicable bien entendu et il peut tre discut sans que cela remette en cause lintrt des mthodes Electre.
359
Il sagit en fait tout simplement dune mthode daide multicritre la dcision de type agrgation complte utilisant des notes pondres Il sagit de vaincre le puissant obstacle culturel du rationalisme, vaincre la peur comme le dit A. Schrlig, et pour cela il faut tre convaincant car la proposition dune mthode dagrgation partielle est attendue au contour
360
300
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.4.1.2
Qui ?
F. Joerin affirme que cette opration doit gnralement revenir au dcideur . (Joerin F., 1998) Vu la complexit des notions et des algorithmes dvelopps dans certaines mthodes, cette affirmation semble un peu premptoire. Il nest pas vident que le dcideur, qui nest pas par dfinition un acteur technique mais plutt un acteur politique, connaisse les caractristiques des diffrentes mthodes dagrgation partielle qui sont sa disposition. Dans cette thse de doctorat, lauteur prfre postuler que ce choix doit faire partie des prrogatives de lhomme dtude qui a la connaissance des tenants et des aboutissants de ces diffrentes mthodes.361 Cependant, il ne ralise pas ce choix sans concertation avec le dcideur.362 Il sagit pour lhomme dtude dexpliquer au dcideur les raisons de sa prfrence utiliser telle ou telle mthode, en lui prsentant franchement les avantages et les inconvnients qui leurs sont inhrentes. Le choix de la mthode dagrgation partielle qui a t ralis par lhomme dtude est ensuite avaliser par le dcideur. Il va de soit que si le dcideur connat les mthodes daide multicritre la dcision, cette dmarche nest pas ncessaire.
Postulat 63
En exposant clairement les avantages et les inconvnients, lhomme dtude doit proposer au dcideur une mthode daide multicritre la dcision base sur les caractristiques du projet et de son contexte. Ensuite, celui-ci doit avaliser ou non ce choix
8.4.1.3
Quand ?
Il est prfrable de raliser le choix de la mthode dagrgation partielle au dbut de ltude car ceci permet de raliser ensuite le processus dtude dune manire claire et plus efficace.
Postulat 64
La mthode daide multicritre la dcision sera choisie ds lengagement du processus dtude
Cependant, il peut tre intressant de parfois diffrer ce choix de cette mthode : (Maystre L. Y., Pictet J. et al., 1994) au dbut de ltude, les rsultats qui sont attendus ne sont pas forcment trs clairs pour le dcideur et lhomme dtude : veut-on trier les variantes, en choisir une, etc. ? Au cours du processus dtude, il devient plus facile de choisir la problmatique adquate le dcideur nest pas forcment enclin raliser ce choix au dbut de ltude car il ne voit pas concrtement quelles sont les consquences quil amne
361
Sil ne lest pas, cette thse a pour but de le mettre au courant des caractristiques principales des mthodes dagrgation partielle Si le dcideur est une entit comprenant de nombreux acteurs, ce choix de la mthode daide multicritre la dcision est raliser entre lhomme dtude et lacteur principal du groupe de dcideurs
362
Une mthode daide multicritre la dcision adapte au projet routier
301
8.4.2
Choix raliss dans le cadre de ltude
Aprs avoir analys la mthode daide multicritre la dcision utilise dans la Comparaison de variantes 1999 et dcrit les caractristiques des diffrentes mthodes dagrgation partielles, lauteur procde ici une synthse de diverses propositions qui seront partie intgrante de la mthodologie concertative du projet routier propose au chapitre 9.
8.4.2.1
Performances des variantes
La dtermination des performances des variantes pour un critre donn se base sur un indicateur qui est une variable mesurable servant quantifier une situation ou la tendance du critre en question. Si plusieurs indicateurs servent qualifier le critre,363 il sagit de procder alors une pondration technique entre ces indicateurs partiels de manire disposer dun indicateur agrg unique pour le critre. Cette pondration technique est une agrgation complte ralise entre ces diffrents indicateurs partiels.364 Pour r indicateurs partiels IPp relatifs au critre cj, on peut qualifier ltat dune variante vi relativement au critre cj avec un indicateur agrg Ij(vi) en procdant de la manire suivante :
p=r
Ij(vi) =
p=1
Avec les lments suivants :
IPp (vi ) PTp
Ij(vi)
indicateur agrg qualifiant ltat du critre cj pour la variante vi
IP p (vi) indicateur partiel qualifiant partiellement (pour le domaine p) ltat du critre cj pour la variante vi PTp
pondration technique de lindicateur partiel IPp(vi)
On peut remarquer que la somme des pondrations techniques PTp pour un critre cj donn vaut 100 % :
p =r
p =1
PTp = 100 %
La pondration technique des diffrents indicateurs partiels est ralise uniquement par le projeteur ou par le groupe dtude. Elle doit cependant tre clairement dfinie et taye dans le rapport technique.
363
Cest le cas par exemple du critre Environnement humain de la Comparaison de variantes 1999 o quatre indicateurs sont utiliss (A tort selon lauteur) Pour des raison de cohrence, il est ncessaire de ramener lensemble des units de ces indicateurs partiels en une unit commune (cot, note, etc.)
364
302
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.4.2.2
Famille de critres
En prsence de nombreux critres, comme cest souvent le cas dans le domaine des infrastructures routires qui affectent de multiples domaines, il est ncessaire de procder une agrgation des critres en famille de critres. La pondration seffectue ainsi en deux niveaux sur un nombre de critres qui idalement ne devrait pas dpasser sept par catgorie (voir le postulat 20). Cependant, on ne procde pas deux niveaux dapplication dune mthode daide multicritre la dcision mais un seul en attribuant une pondration croise chaque critre. Cette pondration croise est obtenue en multipliant le poids du critre au sein de sa famille par le poids de sa famille. Cest ce procd qui a t retenu dans la Comparaison de variantes 1999 . Ainsi, lensemble des critres C comprend m critres cj rpartis en f familles de critres Fi. Le poids Pj dun critre se dtermine ainsi de la manire suivante :
Pj = Pj,i Pi
Avec les lments suivants :
Pj Pj,i Pi
poids du critre cj relativement lensemble des autres critres de lensemble C poids du critre cj relativement lensemble des autres critres de la famille de critres Fi laquelle appartient le critre cj poids de la famille de critre Fi laquelle appartient le critre cj relativement lensemble des autres familles de critres
On peut remarquer que pour t critres cj 365 dune famille de critres Fi dfinie, on a :
j =t
j =1
Pj,i = 100 %
i =f
De mme, pour lensemble des poids Pi des f familles de critres, on a :
i =1
Pi = 100 %
365
On peut postuler que t << j et que t 7 et f 7
Une mthode daide multicritre la dcision adapte au projet routier
303
8.4.2.3
Mthode daide multicritre la dcision
Sur la base des rflexions menes prcdemment, lauteur propose dutiliser la mthode daide multicritre la dcision Electre III dans la mthodologie concertative du projet routier. Il est clair que selon la sensibilit du projeteur ou du dcideur et le contexte dtude, dautres mthodes peuvent tre choisies selon les principes dfinis au chapitre 8.4.1. Les nuances apportes par cette mthode (critres flous) permettent de mieux se rapprocher de la complexit de lenvironnement dun projet dinfrastructure routire. Lutilisation de cette mthode ncessite toutefois lemploi dun logiciel tel ELECTRE III-IV. Avec cet outil, qui est dune taille et dun cot relativement modestes, Electre III devient ainsi une mthode facile utiliser par le projeteur routier et est par consquent facilement intgrable dans le processus dtude. Une restriction est apporter dans lutilisation dElectre III au sujet des seuils de veto pour certains critres. En effet, si lon considre dans lanalyse de variantes la variante tat actuel , dans le cadre dun critre concernant le cot de ralisation lapplication dun seuil de veto peut signifier que toutes les variantes ne peuvent surclasser ltat actuel, la non-ralisation dune infrastructure routire tant par dfinition nettement moins coteuse que sa ralisation. Ces seuils de veto sont donc utiliser avec circonspection dans le cadre des projets dinfrastructures routires. Si le nombre de variantes gnres est trs important, il pourrait sembler intressant dutiliser la mthode dagrgation partielle Electre Tri qui permet de trier les actions en trois catgories prdfinies. Cependant, aprs une discussion mene avec le professeur A. Schrlig, lauteur est arriv la conclusion que le nombre de variantes gnres gnralement dans un projet routier ne justifiait pas lusage de cette mthode. Il est rare en effet que lon aie plus dune dizaine de variantes comparer simultanment et le logiciel Electre III-IV permet de raliser cette opration sans difficults. Dans ces cas, lusage de cette mthode nest pas justifi car il est plus susceptible damener des conflits que den rsoudre, la dfinition des variantes de rfrence se rvlant tre un exercice complexe. Par contre, Electre Tri est justifie dans les situations o des centaines de variantes seraient valuer et trier, comme la ralise F. Joerin dans le cadre de sa thse de doctorat. (Joerin F., 1998)
304
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.5
A PPLICATION A LA C OMPARAISON DE VARIANTES 1999
Dans le chapitre 5, lauteur sest intress analyser les diffrents pondrations des acteurs du COPIL. Ici, il va tre procd deux analyses bases sur lutilisation de la mthode Electre III telle que propose la page prcdente : Dtermination du tableau des performances Lors de lanalyse de la Comparaison de variantes 1999 , il est apparu que certaines notes taient insatisfaisantes et que les pondrations techniques taient sujettes discussion. Dans le but de prsenter le principe de la pondration technique, dutiliser des critres avec des units variables et des sens de prfrence croissant ou dcroissant, le tableau des performances de la Comparaison de variantes 1999 va tre tabli nouveau. Les critres dtermins auparavant sont conservs.366 Les variantes tudies sont les quatre variantes initiales, la solution COPIL et la variante de rfrence ER(1) Procder lapplication de Electre III avec les 28 pondrations La mthode Electre III est ralise avec les pondrations des 28 membres du COPIL. Les rangs des variantes dans les 56 distillations ascendantes et descendantes obtenues sont ensuite analyses. Comme les diffrences de performances sont parfois trs importantes entre les variantes, il a t postul que la mthode Electre III sera utilise dans cette application sans seuil de veto, ceci pour lensemble des critres Ces analyses nont pas pour but de dmontrer si la Comparaison de variantes 1999 prsente des rsultats crdibles ou non. Elles constituent plutt en une application des principes mthodologiques dcrits auparavant. Certains choix ont t arbitrairement raliss par lauteur367 afin de procder cette analyse qui na pas la prtention dtre la solution qui aurait du tre utilise pour la Comparaison de variantes 1999 . Dailleurs, comme on le constatera par aprs, les rsultats sont trs semblables ceux obtenus en pratique.
8.5.1
Dtermination du tableau des performances
Sur 16 critres, 7 ont conservs des valeurs sous forme de note comme lors de la Comparaison de variantes 1999 . La seule diffrence rside dans le fait quune chelle de notation de 0 6, avec prfrence croissante, a t choisie prfrentiellement une chelle allant de -3 +3. Il est clair que ces notes sont admises comme tant valables, le but de cette analyse tant de comparer deux mthodes et non pas de vrifier la qualit des rsultats obtenus.
366 367
Plutt que dobjectifs partiels ou gnraux, on utilisera dsormais le terme de critres et de famille de critres Il aurait t intressant de pouvoir mettre en application les principes dfinis ici dans un cas semblable celui de la Comparaison de variantes 1999
Application la Comparaison de variantes 1999
305
Ces critres sont les suivants : transport collectif les deux critres de lamnagement du territoire conomie macro-rgionale les trois critres des nuisances dues aux travaux
Comme indiqu dans le tableau suivant, les performances de 6 critres ont t dtermines par une pondration technique sous une forme autre que les notes attribues par le Groupe Technique de la Comparaison de variantes 1999 :
Transport motoris
Indicateurs
Confort Scurit Performance Homoginit Agrgation de 4 indicateurs
Units
% de site propre Nombre d'accidents Vitesse en km/h Oui (1) ou Non (0) 0 100
Sens de prfrence
Maximum Minimum Maximum Maximum Maximum
Pondration technique
30 30 20 20 100
Limites
0 100 50 0 50 80 01
ER(0) 32.0 41 59 0 21.0
ER(1) 32.0 47 59 0 17.4
Communes adapte 62.5 33 70 1 62.3
Communes rvise 62.5 33 70 1 62.3
0+ adapte 34.5 41 65 0 25.8
Trafic piton et deux-roues
Indicateurs
Effet de coupure Scurit et confort Agrgation de 2 indicateurs
Units
Note Note 0 100
Sens de prfrence
Minimum Maximum Maximum
Pondration technique
50 50 100
Limites
10 01
ER(0) 0.8 0.2 20.0
ER(1) 1.0 0.0 0.0
Communes adapte 0.0 1.0 100.0
Communes rvise 0.0 1.0 100.0
0+ adapte 0.5 0.5 50.0
Trafic agricole
Indicateurs
Dtours Points risques Agrgation de 2 indicateurs
Units
Kilomtrage des dtours Nombre de points risques 100 0
Sens de prfrence
Minimum Minimum Minimum
Pondration technique
33 67 100
Limites
20 25 0
ER(0) 0.0 21 56.3
ER(1) 0.0 21 56.3
Communes adapte 0.5 3 16.3
Communes rvise 1.2 3 27.8
0+ adapte 0.0 12 32.2
Environnement humain
Indicateurs
Bruit Pollution Accidents majeurs Paysage Agrgation de 4 indicateurs
-6
Units
Note Tonnes de Nox par an 10 accidents par jour Note 0 100
Sens de prfrence
Maximum Minimum Minimum Maximum Maximum
Pondration technique
35 20 20 25 100
Limites
0 100 200 100 200 0 0 100
ER(0) 20 166.6 117 75 40.7
ER(1) 10 128.8 153 75 41.2
Communes adapte 95 124.4 81 15 64.0
Communes rvise 85 124.4 81 30 64.3
0+ adapte 50 123.4 117 45 52.4
Autres nuisances
Indicateurs
Energie Impermabilise Accidents majeurs surf. Accidents majeurs sout. Agrgation de 4 indicateurs
Units
TJ /an Hectares 10-6 accidents par jour 10-6 accidents par jour 100 0
Sens de prfrence
Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
Pondration technique
25 25 25 25 100
Limites
200 100 3.5 0 100 0 400 100
ER(0) 140 0.0 53 291 39.2
ER(1) 163 0.0 83 305 53.6
Communes adapte 157 2.1 46 184 47.8
Communes rvise 153 3.2 46 190 55.1
0+ adapte 152 1.6 77 251 56.3
Tableau 37
Performances values suite une pondration technique
Finalement, trois critres prennent simplement les valeurs des indicateurs les qualifiant : les deux critres des moyens financiers, avec un sens de prfrence dcroissant lconomie macro-rgionale
Le tableau des performances dtaill est prsent la page suivante. Les seuils dindiffrence et de prfrence y sont aussi dfinis.
306
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Tableau 38
Tableau des performances
Application la Comparaison de variantes 1999
307
8.5.2
Application de Electre III
Le logiciel LINAM (Wieser P., 1993) et le logiciel ELECTRE III-IV (LAMSADE, 1994) ont t utiliss pour effectuer cette application. A lusage, malgr sa disponibilit, le logiciel LINAM a t cart pour trois raisons : il est nettement moins convivial il y a certaines erreurs qui ont retrouves dans les matrices des degrs de crdibilit par rapport des exemples prsents dans la littrature spcialise il est impossible de sabstenir dun seuil de veto
Le logiciel ELECTRE III-IV a t utilis 28 fois avec les nouvelles notes et en considrant six variantes (ER(1) ; Communes adapte ; Communes rvise ; 0+ adapte ; 0+ rvise ; Solution COPIL). Les rsultats des distillations ascendantes et descendantes obtenus par lapplication dElectre III aux 28 profils de pondrations sont prsents aux pages suivantes sous la forme de graphiques tels que dfinis par Simos et Maystre.
308
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Pondration P1
Distillation ascendante Distillation ascendante
1
Pondration P2
Distillation ascendante
Pondration P3
SC CR CA 0R 0A
1
SC CR CA 0R 0A E1
SC CR CA 0R 0A E1
E1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Distillation descendante
Distillation descendante
Pondration P4
Distillation ascendante Distillation ascendante
1
Pondration P5
Distillation ascendante
Pondration P6
SC CR CA 0R 0A
1
SC CR CA 0R 0A E1
SC CR CA 0A E1 0R
E1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Distillation descendante
Distillation descendante
Pondration P7
Distillation ascendante Distillation ascendante
1
Pondration P8
Distillation ascendante
Pondration P9
0R SC CR CA
1
SC CR CA 0R 0A E1
SC CR CA 0R 0A E1
0A
E1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Distillation descendante
Distillation descendante
Pondration P10
Distillation ascendante Distillation ascendante
1
Pondration P11
Distillation ascendante
Pondration P12
SC CR CA 0R 0A
1
SC CR CA 0R 0A E1
CA SC CR 0R 0A E1
E1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Distillation descendante
Distillation descendante
Figure 66
Rsultats des profils de pondration P1 P12
Application la Comparaison de variantes 1999
309
Pondration P13
Distillation ascendante Distillation ascendante
1
Pondration P14
Distillation ascendante
Pondration P15
SC CR CA 0R 0A
1
SC CR CA 0R 0A E1
SC 0R CR 0A E1 CA
E1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Distillation descendante
Distillation descendante
Pondration P16
Distillation ascendante Distillation ascendante
1
Pondration P17
Distillation ascendante
Pondration P18
0R SC CR E1 0A
1
SC CA CR 0R E1
0A
0R SC E1 CR CA
0A
CA
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Distillation descendante
Distillation descendante
Pondration P19
Distillation ascendante Distillation ascendante
1
Pondration P20
Distillation ascendante
Pondration P21
SC 0R E1
1
0R SC CR E1 0A
SC CA CR 0A E1 0R
CA
0A CR CA
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Distillation descendante
Distillation descendante
Pondration P22
Distillation ascendante Distillation ascendante
1
Pondration P23
Distillation ascendante
Pondration P24
0R SC CA 0A E1 CR
1
0R 0A E1 CR SC CA
SC CR CA 0R 0A E1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Distillation descendante
Distillation descendante
Figure 67
Rsultats des profils de pondration P13 P24
310
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Pondration P25
Distillation ascendante Distillation ascendante
1
Pondration P26
Distillation ascendante
Pondration P27
SC CR CA 0R 0A
1
SC CR CA 0R 0A E1
SC CR CA 0R 0A E1
E1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Distillation descendante
Distillation descendante
Pondration P28
Distillation ascendante
1
CA CR SC 0R 0A E1
6 6 5 4 3 2 1
Distillation descendante
Figure 68
Rsultats des profils de pondration P25 P28
Les rsultats des 56 distillations calcules avec le logiciel ELECTRE III-IV sont rsums dans le tableau suivant :368
Variantes
1 ER (1) Communes adapte Communes rvise 0+ adapte O+ rvise Solution COPIL Tableau 39 5 2 6 8 9
Rangs des variantes369
3 4 12 2 1 4 5 1 1 1 1 6
32
2 4 16 11
43 41
2 14
33 31
8
48
Rangs obtenus en appliquant Electre III 28 profils de pondration
En examinant ce tableau de rsultats, on peut remarquer quil ny a aucune distillation o le classement permet de totalement dpartager les variantes, le rang maximum obtenu tant en effet un cinquime rang alors quil y a six variantes analyses.
368 369
Le rang le plus frquemment rencontr par la variante est mis en vidence dans le tableau Comme prcis la note de base de page N344, le rang dune variante dans un classement effectu par Electre III est une notion qui ne doit pas tre confondue avec la position dans le classement
Application la Comparaison de variantes 1999
311
Lanalyse de ce tableau montre que toutes les variantes apparaissent au premier rang. Il existe donc des profils de pondration particuliers qui permettent de faire ressortir dans le premier rang chacune des six variantes analyses. On remarque cependant que ces apparitions dans le 1er rang sont ingalement rparties : la Solution COPIL apparat 48 fois au premier rang, soit dans 85 % des cas. On peut aussi remarquer que cette variante napparat jamais au-del du deuxime rang les variantes des Communes apparaissent 43 et 41 fois au premier rang, soit dans 75 % des cas les variantes 0+ napparaissent que 2 et 14 fois au premier rang, soit au maximum dans 25 % des cas. Dans 60 % des cas, ces variantes sont au deuxime rang la variante ER(1) apparat 5 fois au premier rang, soit dans 10 % des cas. Dans 60 % des cas, cette variante apparat au troisime rang
Le tableau suivant rsume les comparaisons des rangs entre chaque variante pour les 56 distillations effectues :
Variantes
0+ adapte O+ rvise Communes rvise Communes adapte ER(1)
0A > ER(1) : 38 0A = ER(1) : 11 0A < ER(1) : 7 0R > ER(1) : 49 0R = ER(1) : 6 0R < ER(1) : 1
O+ rvise
0R > 0A : 19 0R = 0A : 36 0R < 0A : 1
CR > ER(1) : 43 CR > 0A : 44 CR = ER(1) : 10 CR = 0A : 10 CR < ER(1) : 3 CR < 0A : 2 CA > ER(1) : 46 CA = ER(1) : 8 CA < ER(1) : 2 CA > 0A : 48 CA = 0A : 6 CA < 0A : 2
CR > 0R : 41 CR = 0R : 4 CR < 0R : 11 CA > 0R : 41 CA = 0R : 7 CA < 0R : 8 SC > 0R : 42 SC = 0R : SC < 0R : 6
CA > CR : 8 CA = CR : 42 CA < CR : 6
Solution COPIL
SC > ER(1) : 50 SC > 0A : 11 SC = ER(1) : 5 SC = 0A : 43 SC < ER(1) : 1 SC < 0A : 2
SC > CR : 11 SC = CR : 43 SC < CR : 2
SC > CA : 12 SC = CA : 44 SC < CA : -
Tableau 40
Comparaison des rangs entre les variantes pour les 56 distillations effectues
En considrant le tableau prcdent, on peut analyser les relations de prfrence existant entre les diffrentes variantes. On distingue alors trois possibilits : Prfrence stricte, note P Dans ce cas, il y a une bonne concordance de lhypothse de surclassement dune variante par rapport une autre. Ceci signifie que le nombre de fois o, dans le tableau prcdent, cette variante est dans un meilleur rang que lautre variante est important.370 Il sagit de la vrification de la concordance. De plus, le nombre de fois o elle est dans un moins bon rang doit tre faible.371 Il sagit cette fois de la vrification de la discordance
370 371
Ce nombre est admis 28 ici (50 % des classements effectus) Ce nombre est admis 6 ici (10 % des classements effectus)
Communes adapte
0+ adapte
Communes rvise
312
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Prfrence faible, note Q Il sagit dun cas o la concordance de lhypothse de surclassement dune variante par rapport une autre est moins nette que dans le cas prcdent. Soit lgalit entre les deux variantes lemporte, avec toutefois une majorit de cas o lhypothse de concordance est vrifie. La discordance doit aussi rester faible. Soit alors la discordance est forte quand lhypothse de concordance est vrifie.
Indiffrence, note I Il sagit du cas o on ne peut pas dpartager les variantes entre elles
En rsum, on effectue les vrifications successives suivantes dans le cas de la Comparaison de variantes 1999 :
N1 = nombre de fois o vi > vk
2 cas sont possibles :
-
Cas 1 : N1 28 viPvk ou viQvk Cas 2 : N1 < 28 viQvk ou viIvk
N3 = nombre de fois o vi < vk
4 cas sont possibles :
-
Cas 3 : cas 1 et N3 < 6 viPvk Cas 4 : cas 1 et N3 6 viQvk Cas 5 : cas 2 et N3 < 6 viQvk 372 Cas 6 : cas 2 et N3 6 viIvk
Les diffrentes relations que lon peut observer entre les six variantes analyses pour la Comparaison de variantes 1999 sont prsentes dans le tableau suivant :373
Communes rvise O+ rvise
Variantes
0+ adapte O+ rvise Communes rvise Communes adapte Solution COPIL Tableau 41
ER(1) Q P P P P
Q P P Q
Q Q Q
I Q Q
Relations de prfrences entre les variantes de la Comparaison de variantes 1999
372
Dans ce cas, N2, qui est le nombre de fois o vi = vk, vaut au minimum 22 (56 N1,max (cas 2) N2,max (cas 5) = 56 27 7 = 22) Ce tableau se lit de gauche droite. Par exemple, pour la premire case en haut gauche, il faut lire La
373
variante 0+ adapte est prfre faiblement la variante ER(1)
Communes adapte
0+ adapte
Application la Comparaison de variantes 1999
313
On peut reprsenter graphiquement ces relations de prfrence entre les diffrentes variantes de la Comparaison de variantes 1999 :
SC
0R
CA
?
LEGENDE
Prfrence stricte
0A
CR
Prfrence faible
E1
Figure 69
Indiffrence
Relations de prfrences entre les variantes de la Comparaison de variantes 1999
On peut relever les faits suivants : toutes les variantes surclassent la variante ER(1) mis part la variante ER(1), la variante 0+ adapte est surclasse par toutes les autres variantes mis part les variantes ER(1) et 0+ adapte, la variante 0+ rvise est surclasse par toutes les autres variantes
Ainsi les trois dernires variantes du classement sont 0+ rvise qui surclasse 0+ adapte, qui elle mme surclasse ER(1). Les rflexions pour les trois solutions qui dominent les variantes 0+ et ER(1) sont les suivantes : on ne peut pas distinguer la variante Communes adapte de la variante Communes rvise la Solution COPIL nest pas surclasse par une autre variante la Solution COPIL a une prfrence faible par rapport aux variantes Communes
314
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
La mthode ELECTRE III ainsi utilise374 montre que la solution se trouve parmi le trio compos de la Solution COPIL et des variantes des Communes. Au sein ce groupe, la solution semble se dgager faiblement pour la solution COPIL, mais trs lgrement. Le flou du rsultat amen par Electre III montre bien que les diffrences entre les notes obtenues dans la Comparaison de variantes 1999 sont trs faibles (voir le tableau 16 la page 79 : les notes des trois variantes varient entre 0,55 et 0,69 pour les 28 pondrations du COPIL). En utilisant une mthode dagrgation complte, ce flou a t limin. Les carts relevs entre le rang obtenu par une variante avec la distillation ascendante par rapport celui-ci obtenu dans la distillation descendante sont les suivants :
Variantes
0 ER (1) Communes adapte Communes rvise 0+ adapte O+ rvise Solution COPIL Tableau 42 1 12 9 6 13 11 6
Ecarts entre les deux rangs
2 3 2 2 1 3 4 5
13 16 20 15 17 22
Ecarts des rangs obtenus en appliquant Electre III 28 profils de pondration
On remarque que les classements sont gnralement assez semblables quant leur conclusion. En effet, sur 168 carts relevs (28 pondrations multiplies par 6 variantes analyses), il y a seulement 8 cas o lcart est suprieur une diffrence de 1 rang. On peut donc conclure une certaine stabilit des classements, 103 classements (61 % des carts relevs) donnant le mme rang dans les deux classements. En remarque finale, on constate que les rsultats obtenus avec Electre III ou Electre Tri sont du mme ordre que ceux obtenus dans la Comparaison de variantes 1999 : Solution COPIL en tte, devant les variantes des Communes puis les variantes 0+.
374
Cette application se base sur un postulat qui nest pas forcment vrifi : chaque pondration dacteurs, qui permet de raliser deux classements diffrents, prsente la mme valeur relative, ce qui permet deffectuer des analyses statistiques sur les 56 classements effectus. Ceci suppose que la composition du COPIL est quitablement rpartie selon les diffrentes sensibilits des acteurs, ce qui nest pas forcment le cas comme il a t dmontr auparavant
Les systmes dinformation rfrence spatiale
315
8.6
L ES SYSTEMES D INFORMATION A
REFERENCE SPATIALE
L'avnement des technologies de l'information a permis le dveloppement d'outils informatiques destins mmoriser une grande quantit dinformations, changer et exploiter les donnes spatialises relatives au territoire. C'est ainsi que sont apparus les Systmes dInformation Rfrence Spatiale (SIRS), dsigns aussi sous le terme de Systmes dInformation Gographique (SIG). Il sagit dune rponse avant tout technologique aux problmes de gestion d'un territoire. La cration de cartes et lanalyse gographique ne sont pas des procds nouveaux, mais les SIRS procurent une plus grande vitesse et proposent des informations drives qui sont souvent des lments utiles dans lanalyse, la comprhension et la rsolution des problmes. Il existe de multiples dfinitions des systmes d'information rfrence spatiale.375 Nous retiendrons ici celle fournie par M. Thriault : (Thriault M., 1996)
Un systme dinformation rfrence spatiale est un ensemble de principes, de mthodes, dinstruments et de donnes rfrence spatiale utiliss pour saisir, conserver, transformer, analyser, modliser, simuler et cartographier les phnomnes et les processus distribus dans lespace gographique. Les donnes sont analyses afin de produire linformation ncessaire pour aider les dcideurs
Les systmes d'information rfrence spatiale offrent toutes les possibilits des bases de donnes telles que requtes et analyses statistiques. Lintrt de ce systme est quil assure une visualisation et une analyse gographique propres aux cartes. Ces capacits spcifiques font du systme d'information rfrence spatiale un outil unique, sadressant un public trs large et destin une trs grande varit dapplications. (Esrifrance, 2000)
8.6.1
Composantes dun systme d'information rfrence spatiale
La dfinition dun systme d'information rfrence spatiale de Thriault intgre les acteurs utilisant les systme d'information rfrence spatiale dans un systme multiples composantes.
375
F. Joerin souligne dans sa thse de doctorat la grande diversit qui existe dans les dfinitions des SIRS selon que lon parle du systme ou uniquement de loutil informatique qui lui est associ. (Joerin F., 1998)
316
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.6.1.1
Composantes structurelles
Un systme d'information rfrence spatiale comporte quatre composantes structurelles fondamentales : (Thriault M., 1996) les utilisateurs du systme d'information rfrence spatiale, qui sont gnralement des hommes dtude tel que dfini auparavant, et qui laborent des variantes et valuent les performances de celles-ci les projets ou variantes proposes par les utilisateurs du systme d'information rfrence spatiale le systme informatique qui mmorise les donnes et effectue les traitements danalyse, de modlisation et de simulation afin de produire des valuations quantitatives, qualitatives ou cartographiques les dcisions prises par les dcideurs sur la base des rsultats fournis par le systme d'information rfrence spatiale et sur des facteurs complmentaires
8.6.1.2
Composantes informatiques
Un systme d'information rfrence spatiale comporte huit composantes informatiques, regroupes en deux composantes fondamentales : (Thriault M., 1996)
Donnes
On y trouve les composantes suivantes :
-
la gobase est une base de donnes spcialise qui comprend lensemble des informations gomtriques relatives la description des entits spatiales naturelles (lacs, rivires, forts, etc.) et anthropiques (infrastructures de transport, btiments, etc.) qui composent le territoire les donnes thmatiques concernent les phnomnes et les vnements distribus sur le territoire. Ces donnes sont reprsentes sous formes de tableaux spcialiss relis aux entits spatiales par un lien relationnel
Les donnes sont identifies par rapport une rfrence gographique explicite (latitude et longitude, coordonnes nationales, etc.) ou une rfrence gographique implicite (adresse, numro de parcelle, numro de route, entit politique, etc.). Le processus automatique du gocodage est utilis pour transformer les rfrences implicites en rfrences explicites et permettre ainsi de localiser les objets et les vnements sur le territoire. On parle alors de donnes gorfrences . (Esrifrance, 2000) Les donnes sont rparties dans des couches thmatiques, comme illustr la page suivante, afin de faciliter ldition et le traitement des entits spatiales dun thme donn.
Les systmes dinformation rfrence spatiale
317
Figure 70
Rpartition des donnes dans des couches thmatiques (Esrifrance,
2000)
Traitements
Il y a deux composantes destines la gestion et lextraction des donnes et qui servent alimenter le systme :
-
le systme de gestion de base de donnes (SGBD) permet de saisir et dditer les tableaux des donnes thmatiques intgrs dans le systme d'information rfrence spatiale. Il comporte des fonctions permettant dextraire des ensemble de donnes afin de les utiliser dans un systme informatique danalyse ou de reprsentation. le systme de gestion de donnes localises (SGDL) accomplit la mme tche que le SGBD avec la gobase. Il comporte des lments complexes permettant de numriser des cartes analogiques, de grer des systmes de coordonnes et dditer des cartes numrises
Un systme d'information rfrence spatiale ne comportant quun SGBD et un SGDL na quun but de reprsentation des donnes. Afin dobtenir des rsultats analytiques complmentaires, il est ncessaire de disposer doutils permettant de transformer et dinterprter les donnes. Il sagit des composantes suivantes :
-
une fonction danalyse et de traitement dimages satellitaires ou ariennes des outils danalyse statistique pour effectuer de synthses de distribution gographiques sur les donnes thmatiques ou pour tablir des relations entre lespace et les thmes des modules danalyse spatiale permettant de simuler ou de modliser des processus naturels ou anthropiques et leur comportement spatial des fonctions de communication permettant de produire des cartes assurant la diffusion de linformation
318
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.6.2
Modes de reprsentation des donnes
Il existe deux modes de reprsentation des donnes gorfrences permettant de reprsenter la ralit gographique du territoire sous la forme dun modle simplifi.
Mode matriciel
Dans le mode de reprsentation matriciel, appel aussi modle pixel ou modle raster, le territoire est reprsent par une image numrique dont la rsolution spatiale varie selon la taille dunits lmentaires appeles pixels.376 Le territoire est ainsi maill dans une grille rgulire de cellules possdant chacune une seule valeur (couleur du pixel). Il est donc ncessaire de disposer dune image par thme, ce qui requiert beaucoup despace pour le stockage des informations. Ce mode sadapte parfaitement la reprsentation de donnes variables continues telles que les donnes relatives lenvironnement et lanalyse spatiale de proximit. Les systmes dinformation rfrence spatiale utiliss dans les projets dinfrastructures routires font essentiellement appel ce type de donnes. On obtient une image raster par scannage de donnes existantes (plan papier, photographies, films, cartes, etc.) ou par traitement numris dune prise de vue arienne ou satellitaire (CETE de Lyon, 1993)
Modle vectoriel
Dans le modle vectoriel, les objets spatiaux sont dcrits par leur forme gomtrique. On trouve les types dobjets suivants dans ce mode de reprsentation :
-
les objets ponctuels qui sont dans ce cas reprsents par un simple point les objets linaires (infrastructures de transport, lignes lectriques, fleuves, etc.) qui sont eux reprsents par une succession de coordonnes x-y les objets zonaux ou polygonaux (limites territoriales, parcelles, lacs, etc.) qui sont reprsents par une succession de coordonnes dlimitant une surface ferme
Le modle vectoriel prsente une structure discontinue de linformation et est particulirement utilis pour reprsenter des donnes discrtes. Compar au modle matriciel qui informe de ce qui se passe en tout point du territoire, le modle vectoriel concentre lattention sur les endroits o il se passe quelque chose. (Thriault M., 1996) On obtient un fichier vecteur par digitalisation de donnes existantes (plan papier, photographies, orthophotos, films, cartes, etc.) ou par vectorisation dun fichier raster. Une illustration de ces deux modes de gorfrences se trouve la page suivante. reprsentation des donnes
376
Le pixel est le plus petit lment de teinte homogne d'une image numrique
Les systmes dinformation rfrence spatiale
319
Figure 71
Modes de reprsentation de donnes gorfrences (Esrifrance,
2000)
8.6.3
Fonctions principales dun systme dinformation rfrence spatiale
Les principales fonctions dun systme d'information rfrence spatiale sont les suivantes : (Esrifrance, 2000)
8.6.3.1
Saisie
Avant dutiliser des donnes dans un systme d'information rfrence spatiale, il est ncessaire de les convertir dans un format informatique. Cette tape essentielle de transfert depuis le papier vers lordinateur sappelle digitalisation. Elle est ralise de manire automatique par scannage. De plus, aujourdhui de nombreuses donnes gographiques sont disponibles auprs de producteurs de donnes et peuvent tre directement intgres un systme d'information rfrence spatiale.
8.6.3.2
Manipulations
Les sources dinformations peuvent tre dorigines trs diverses. Il est donc ncessaire de les harmoniser afin de pouvoir les exploiter conjointement. Les systmes d'information rfrence spatiale intgrent de nombreux outils permettant de manipuler toutes les donnes pour les rendre cohrentes et ne garder que celles qui sont essentielles au projet. Ces manipulations peuvent, suivant les cas ntre que temporaires afin de se coordonner au moment de laffichage ou bien tre permanentes pour assurer alors une cohrence dfinitive des diffrentes sources de donnes.
320
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.6.3.3
Gestion
Si pour les petits projets il est envisageable de stocker les informations gographiques comme de simples fichiers, il en est tout autrement quand le volume de donnes grandit et que le nombre dutilisateurs de ces mmes informations devient important. Dans ce cas, lutilisation dun SGBD facilite le stockage, lorganisation et la gestion des donnes. Le modle de SGBD le plus utilis est le systme de gestion de bases de donnes relationnelles. Les donnes y sont reprsentes sous la forme de tables utilisant certains champs comme lien. Cette approche offre une grande souplesse et une totale flexibilit dutilisation.
8.6.3.4
Interrogation et analyses
Les systme d'information rfrence spatiale disposent de nombreux et puissants outils danalyse, comme par exemple lanalyse de proximit ou lanalyse spatiale :
Lanalyse de proximit
Combien existe-t-il de maisons dans une zone de 100 mtres de part et dautre de cette autoroute ? Quel est le nombre total de client dans un rayon de 10 km autour de ce magasin ? Pour rpondre ces questions, les systme d'information rfrence spatiale disposent dalgorithmes de calcul appels buffering afin de dterminer les relations de proximit entre les objets.
Figure 72
Exemple danalyse de proximit (Esrifrance, 2000)
Analyse spatiale
Lintgration de donnes au travers des diffrentes couches dinformation permet deffectuer une analyse spatiale rigoureuse. Cette analyse par croisement dinformations, si elle peut seffectuer visuellement ( lidentique de calques superposs les uns aux autres) ncessite souvent le croisement avec des informations alphanumriques. Croiser la nature dun sol, sa dclivit, la vgtation prsente avec les propritaires et les taxes payes est un exemple danalyse sophistique que permet lusage dun systme d'information rfrence spatiale.
Les systmes dinformation rfrence spatiale
321
Figure 73
Exemple danalyse spatiale (Esrifrance, 2000)
Thriault identifie plusieurs types de traitements des donnes spatiales : (Thriault M., 1996)
localisation, utilise pour un inventaire localis : quy a t-il tel endroit ? distribution, pour une analyse thmatique : o trouve t-on ce genre de phnomne ? volution pour une analyse temporelle : quest ce qui a chang depuis ? rpartition afin de raliser une analyse spatiale : quel est le nombre de surfaces affectes ? modlisation afin de simuler des processus : que se produit t-il si ? optimisation pour une aide la dcision : quelle est la meilleure faon de ?
8.6.3.5
Visualisation
Pour de nombreuses oprations gographiques, la finalit consiste bien visualiser des cartes et des graphes. La carte est en effet un formidable outil de synthse et de prsentation de linformation. Les systmes d'information rfrence spatiale offrent la cartographie moderne de nouveaux modes dexpression permettant daccrotre de faon significative son rle pdagogique. Ils sont ainsi de prcieux outils au service du projeteur pour que celui-ci communique de nombreuses informations dune manire claire et comprhensible des intervenants non-techniques. Lutilisation des systmes d'information rfrence spatiale est donc clairement recommande comme outil au service de la concertation et du dialogue entre les diffrents acteurs intervenant dans le projet routier.
322
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
8.6.4
Utilisation des systmes dinformation rfrence spatiale au sein du projet routier
Association des systmes dinformation rfrence spatiale et des mthodes daide multicritre la dcision
8.6.4.1
Comme nous lavons vu auparavant, les systmes dinformation rfrence spatiale permettent de grer et de traiter dimportantes quantits dinformations spatialises. De plus, de nombreuses fonctions danalyses spatiales sont dveloppes pour ces outils, qui peuvent ainsi dcrire, analyser et simuler au mieux le contexte de ltude et les phnomnes lis au territoire. Par contre, les systmes d'information rfrence spatiale ne permettent pas de hirarchiser les solutions tudies. (Molines N., en prparation) De mme, nous avons vu que les mthodes daide multicritre la dcision permettent de hirarchiser les variantes dveloppes par le projeteur routier afin daider le dcideur dans son choix. De plus, elles tiennent compte des dimensions objectives et subjectives lies au phnomne de la dcision, ceci par le biais de lvaluation des performances et de la pondration des critres. Les phnomnes spatiaux ainsi que lvolution dans le temps du contexte environnant le projet sont par contre difficiles analyser laide de ces mthodes. En procdant lassociation des mthodes daide multicritre la dcision et des systmes d'information rfrence spatiale, on peut intgrer conjointement les avantages lis chaque mthode. Ceci permet de faire voluer les systmes d'information rfrence spatiale vers de vritables systmes daide la dcision pour la localisation dinfrastructures dans le territoire, largissant ainsi les capacits danalyse des mthodes daide multicritre la dcision. Les tudes relatives cette association des deux mthodes prcites, comme celles menes par N. Molines (Molines N., 1997) ou F. Joerin, (Joerin F., 1998) sont relativement rcentes377 et les perspectives dvolution sont encourageantes. Il existe trois niveaux dintgrations envisageables : Aucune intgration Les rsultats fournis par lutilisation dune analyse spatiale au sein du systme dinformation rfrence spatiale sont exports dans un logiciel utilisant un algorithme multicritre. Les rsultats de lanalyse sont ensuite exports dans le systme dinformation rfrence spatiale Importation et exportation interactives Les changes entre le systme dinformation rfrence spatiale et le logiciel utilisant un algorithme multicritre sont automatiss au sein dune interface SIRS. Il sagit du principal dveloppement ralis lheure actuelle
377
N. Molines tablit un inventaire intressant des expriences menes dans ce domaine (Molines N., 1997)
Les systmes dinformation rfrence spatiale
323
Intgration complte Il ne subsiste plus quun seul logiciel contenant les donnes rfrence spatiale et un algorithme multicritre, utilisable comme toutes les autres fonctions danalyse spatiale dudit logiciel
Les tudes et les recherches entreprises dans cette optique de lintgration des deux mthodes prcites ont pour objectif dautomatiser une partie des activits du projeteur routier dans le domaine de la gnration et du choix de variantes. Les analyses spatiales, synthtises graphiquement sur des cartes descriptives du territoire, deviennent ainsi de prcieux outils daide aux activits du projeteur. Elles nont pas la prtention de remplacer totalement ses activits mais elles simplifient fortement les analyses quil doit mener ou les scnarios quil doit tudier. Un autre aspect intressant de lintgration de ces deux mthodes en un outil commun est de faciliter la visualisation des dcisions prises, afin damliorer la concertation et le dialogue entre les acteurs du projet, notamment ceux qui ne sont pas des acteurs techniques.
8.6.4.2
Problmatique des infrastructures linaires
Si de nombreux auteurs se sont penchs sur la problmatique du choix dun site localis ou ponctuel dans un territoire dfini, la problmatique du choix de variantes dinfrastructures linaires na t que peu abord. N. Molines a men une tude trs intressante et prometteuse ce sujet. (Molines N., 1997) Les propositions effectues dans la prsente thse sont fortement inspires de ce document. La principale difficult danalyse dune infrastructure linaire dans un systme d'information rfrence spatiale bas sur un modle raster378 rside dans la dimension de lobjet analyser : Pour un site ponctuel, qui lextrme possde une dimension valant celle du pixel de base, le nombre de solutions est fini. On a en effet au maximum le nombre de mailles de base, ou de mailles de dimension du site recherch, prsents dans le domaine de ltude danalyse. Ce nombre de solutions envisageables peut tre important, mais il existe des procdures permettant de rduire rapidement le volume de lanalyse. (Joerin F., 1998) De plus, le site recherch est un point uniquement li au territoire En comparaison, la recherche dune infrastructure linaire dveloppe dans le territoire ncessite la recherche dune polyligne compose dun ensemble de point pixels contigus. Ainsi, la condition doptimisation est modifie, la polyligne optimale ntant pas compose uniquement de pixels de valeur maximale, mais dun ensemble de pixels proches de loptimum et formant une entit gomtrique continue qui elle est optimale. On remarque donc que les possibilits de variantes sont nettement plus importantes que dans le cadre de la recherche dun site ponctuel. Les pixels sont non seulement lis au territoire mais aussi entre eux de manire obtenir une continuit gomtrique. Il faut aussi que cette polyligne soit la plus directe possible si lon cherche relier un point A un point B, comme cest souvent le cas dans les projets dinfrastructures routires
378
Comme prcis auparavant, lintgration des mthodes daide multicritre la dcision au sein de systmes d'information rfrence spatiale se fait sur des modles de reprsentation raster
324
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
On peut aussi relever le fait que dans les systmes d'information rfrence spatiale lanalyse se mne gnralement en deux dimensions alors quune route est un lment gomtrique tridimensionnel. Ainsi, en un endroit donn du territoire, une route peut avoir des effets totalement opposs selon sa position relativement au terrain naturel : sous le niveau du terrain (ouvrage enterr), au niveau du sol ou alors dans un ouvrage dart arien. Les systmes d'information rfrence spatiale ne tiennent pas encore compte de cette problmatique dans les diffrents cas dintgration des mthodes daide multicritre la dcision analyss.
8.6.4.3
Intgration au sein de la mthodologie concertative
Dans le cadre des projets infrastructures routires linaires, les systmes d'information rfrence spatiale, associs avec des mthodes daide multicritre la dcision, doivent sutiliser aux tapes suivantes379 :
Analyse des contraintes
Dans sa forme la plus sommaire, le systme d'information rfrence spatiale peut tre utilis comme tant un outil de reprsentation des contraintes spatiales. Il remplit alors uniquement un rle de forme numrique dun plan de contraintes traditionnel. Lutilisation doutils danalyse permet de dresser des cartes de sensibilit du territoire. Dans le cadre de son tude, N. Molines a dvelopp un exemple dune carte de sensibilit environnementale globale, prsent ci-dessous. Cette carte prsente en vert fonc les zones les plus sensibles limplantation dune infrastructure routire tandis quen vert clair se trouve les zones les moins sensibles. En gris se trouvent les zones urbaines qui sont strictement interdites (on parle dans ce cas de contraintes rdhibitoires). (Molines N., 1997)
Figure 74
Carte de sensibilit environnementale (Molines N., 1997)
Une telle carte est obtenue en agrgeant chaque endroit la sensibilit de la zone vis--vis de diffrentes contraintes retenues pour ltude. Pour une contrainte donne, cette sensibilit peut tre dfinie comme tant limpact
379
Il sagit des tapes du processus dlaboration du projet routier prsentes la figure 30, page 143
Les systmes dinformation rfrence spatiale
325
prvisible380 aprs limplantation dune infrastructure linaire en cet endroit prcis. N. Molines dtermine cette sensibilit globale en procdant une agrgation complte des diffrentes sensibilits dtermines pour chaque contrainte considre. Lintrt de lanalyse spatiale est que lon peut considrer les effets directs des infrastructures routires (emprise) et les effets lis une proximit de celle-ci (diffusion des impacts). Les contraintes spatialises peuvent concerner de multiples domaines lis au territoire. Gnralement il sagit de donnes relatives lenvironnement naturel (occupation du sol, qualit de la vgtation, zones protges, etc.) ou humain (zones de protection, patrimoine, etc.). Des indications relatives aux activits anthropiques (agriculture, transport, etc.) peuvent aussi tre prsentes.
Gnration de variantes
Lintgration dune mthode daide multicritre la dcision dans un systme d'information rfrence spatiale permet ensuite de dterminer des couloirs de moindre valeur, ou couloirs de moindre contrainte. A partir de la carte de sensibilit environnementale globale, N. Molines a dfini une mthode permettant de proposer au projeteur routier des fuseaux ou couloirs reliant les deux extrmits dfinies. Ces fuseaux ne respectent que la condition de la continuit gomtrique et la qualit de la gomtrie des tracs routiers proposs nest pas vrifie. Le projeteur peut ensuite, sur la base des fuseaux proposs, procder la gnration de variantes tout en respectant les contraintes techniques (gomtrie routire, ouvrages dart, etc.). (Molines N., 1997)
Figure 75
Proposition de fuseaux de trac (Molines N., 1997)
Lintrt de ce procd est quil laisse une totale libert lactivit du projeteur. Celui-ci peut gnrer des variantes de trac respectant au mieux les contraintes spatiales, cest dire des tracs sinsrant dans les fuseaux proposs. Il peut aussi proposer des tracs moins optimaux, cest dire des tracs sloignant parfois des fuseaux mais qui permettent de contourner certaines contraintes techniques ou conomiques majeures. Loutil propos par N. Molines est ainsi un vritable outil daide pour le projeteur mais en aucun un outil se substituant ses activits.
380
Ces impacts sont vrifis en admettant que les ouvrages complmentaires ncessaires sont raliss
326
LAIDE MULTICRITERE A LA DECISION
Dans le mme ordre dides, N. Ferrand a dvelopp des systmes experts dits multiagents (SMA) proposant des tracs prfrentiels au projeteur routier.
Figure 76 Proposition de fuseaux de trac raliss sur un prototype de SMA (Ferrand N., 1998)
Apprciation des variantes
Aprs avoir gnr ses variantes, le projeteur routier les introduit dans le logiciel du systme d'information rfrence spatiale afin de procder lvaluation de celles-ci. Lanalyse spatiale permet en effet de dterminer rapidement les performances des variantes vis--vis des contraintes diffuses sur le territoire. Cest une opration qui mene manuellement est fastidieuse et complexe. Lutilisation dune mthode daide multicritre la dcision de type agrgation partielle permet finalement de procder au choix de la variante optimale. N. Molines a dans son tude procd lanalyse de 4 fuseaux sur la base de la mthode dagrgation partielle Electre III, ce qui a permis dtablir ainsi une hirarchie des variantes.
8.6.4.4
Conclusion
Lintgration des mthodes daide multicritre la dcision aux systmes d'information rfrence spatiale est une aide prcieuse pour le projeteur routier. Elle sutilise principalement selon deux procds : du systme d'information rfrence spatiale vers le projeteur : proposer au projeteur des solutions optimales vis--vis des contraintes spatialises du projeteur vers le systme d'information rfrence spatiale : valuer les performances sur les contraintes spatialiss des tracs gnrs par le projeteur afin de procder au choix dune variante optimale
Lintrt de ces mthodes est quelles facilitent le travail du projeteur tout en lui laissant une large marge de manuvre quant ses activits. Son rle central au cur du processus du projet routier est renforc par la possibilit de procder rapidement lanalyse dune importante quantit dinformations spatiales et par lutilisation doutils de communication performants. Le systme d'information rfrence spatiale est ainsi au service du projeteur et non le contraire. Linconvnient de ce procd est quil peut difficilement intgrer des contraintes lies la gomtrie du trac, la technique du trafic ou lconomie. Dans les exemples abords auparavant, les contraintes environnementales semblent ainsi tre souvent favorises, laissant parfois poindre un sentiment de moindre considration des autres contraintes moins lies au territoire. La problmatique du cot de lacquisition des donnes spatiales reste aussi importante, ce qui semble favoriser lutilisation de ces mthodes dans le cadre de projets denvergure.
Introduction
327
9.
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
9.1
I NTRODUCTION
Cette recherche aboutit la proposition dune mthodologie dtude des projets dinfrastructures routires qui est itrative et qui tient compte des nouveaux paradigmes socitaux comme le dveloppement durable ou la participation publique. Cette mthodologie dtude sera dsigne par le terme de mthodologie concertative du projet routier .381 Lattention porte par lauteur au dveloppement du processus dtude des projets dinfrastructures routires nest pas sans raison. Veuve souligne bien limportance du processus du projet quand il crit que quand le problme se pose en terme de valeur, le processus par lequel le projet est dfini est aussi important que le projet lui mme . (Veuve L., 1994) Cette mthodologie a pour but dintgrer en son sein tous les acteurs affects par le projet dinfrastructure routire. Elle consiste adopter une attitude dynamique de prvention des problmes, en incorporant rapidement ces acteurs dans le processus dtude de manire raliser un projet durable et accept par toutes les parties. Ceci est une attitude qui est prfrable une dmarche dfensive et statique tentant dattnuer les impacts lis toute infrastructure routire. Il sagit en quelque sorte de prvenir plutt que gurir . Ce chapitre est une pr-conclusion de la thse et la mthode propose intgre lensemble des rflexions et des propositions effectues tout au long de cette tude. Il en constitue une synthse pratique, o le lecteur pourra directement venir y trouver des lments applicables au sein de llaboration du projet routier. Les tapes qui ont fait lobjet dune description complte dans les chapitres antrieurs, comme lapplication de la participation publique ou lutilisation dune mthode daide multicritre la dcision, sont simplement cites dans ce chapitre 9 avec un renvoi adquat. Comme expliqu auparavant, une mthodologie actualise, se basant sur lexistant, est une solution prfrable au dveloppement dune nouvelle mthodologie, ceci pour plusieurs raisons diverses et complmentaires : il ny a pas que des tapes problmatiques dans la procdure actuelle. Il ne sagit donc de ne pas tout liminer, mais plutt de retenir ce qui est bon, damliorer ce qui est passable et de changer ce qui est franchement mauvais une volution douce est prfrable une rvolution de la mthodologie dtude des projets routiers, ceci pour des raisons administratives, politiques ou culturelles et pour tenir compte de lexprience des projeteurs. La rsistance au
381
Dautres termes peuvent aussi tre utiliss : mthodologie participative ouverte, mthodologie intgre, etc.
328
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
changement est parfois fortement ancre dans lesprit des individus et une modification trop brutale des habitudes peut engendrer une forte raction de rejet,382 mme si les propositions sont bnfiques certaines des propositions avances existent dj en tant que telles. Elles sont prcises ici ou utilises diffremment dautres tapes de la procdure
Lauteur sest affranchi le plus possible des procdures spcifiques, qui sont trop dpendantes des contextes considrs, pour mieux se concentrer sur la problmatique gnrale du processus dtude, applicable tout type de projet routier. Les propositions tablies ici se basent sur les rflexions et les remarques tablies dans les diffrents chapitres du rapport de thse, savoir notamment : processus dlaboration du projet routier (chapitres 4.4) qui sert de trame la mthodologie concertative du projet routier notion de cycle de vie de linfrastructure routire (chapitre 4.2) procdures particulires (chapitre 4.5) acteurs du projet routier et dfinitions de profils reprsentatifs (chapitre 5) implications du dveloppement durable dans la procdure du projet routier (chapitre 6) les mthodes daide multicritre la dcision adaptes au projet routier (chapitre 8) rcapitulatif des postulats mis tout au long de l'tude (chapitre 9.2)
La mthodologie concertative du projet routier se base sur un processus qui reprend la structure circulaire du cycle de vie dune route tel que dcrit au chapitre 4.2. Comme le processus qui intresse la prsente tude ne constitue que quelques tapes de ce cycle de vie, celui-ci ne sera prsent que sous la forme traditionnelle dun schma de flux linaire, muni certes de rtroactions, et orient de haut en bas. La description de la mthodologie concertative du projet routier est surtout ralise sous la forme de diffrents diagrammes de flux successifs, imbriqus tels des poupes russes. Dun diagramme de flux gnral, lon soriente vers un ensemble de diagrammes de flux secondaires dtaillant de plus en plus les diffrentes tapes des flux prcdents. Ces diagrammes sont reprsents sous la forme du cheminement intellectuel du dcideur et du projeteur, effectuant des tapes avec des points de passage obligs et dautres qui dpendent des rsultats obtenus dans des tapes antrieures. Une srie de questions et de rponses orientent la dmarche de ces acteurs. Des commentaires succincts accompagnent ces diagrammes. Ils peuvent porter notamment sur lintgration des acteurs dans le processus dlaboration ainsi que sur les formes de la participation publique. La structure des diffrents diagrammes utiliss dans ce chapitre 9 est prsente la page suivante. Il est remarquer quil ny a pas un diagramme de flux pour chaque tape du processus dlaboration du projet routier.383 En effet, ce mode de reprsentation ntait pas forcment adapt chacune de ces phases.
382 383
Noublions pas aussi que cette mthodologie est dveloppe en Suisse ! Les tapes comportant un tel diagramme sont reprsents la page suivante par un rectangle jaune
Introduction
329
9.3.1
Etapes du cycle de vie
Figure 78
9.3.2
Examen d'opportunit du projet
9.3.3
L'laboration du projet
9.3.4
Le projet dfinitif
Figure 79
Figure 80
9.4 9.4.1.1
Dlimitation du domaine d'tude Le processus d'laboration du projet routier
Il s'agit de la partie centrale de la mthodologie concertative du projet routier
Figure 81 Figure 82 9.4.1.2
Fixer la participation des intervenants
9.4.2.3
Collecte et analyse des contraintes
9.4.4.2
Evaluation des consquences
Figure 83 9.4.1.3
Description de la mthodologie de travail
Figure 85 9.4.2.4
Pondration des critres
Figure 89 9.4.4.3
Utilisation d'une mthode d'aide la dcision multicritre
Figure 86 9.4.2.1
Identification et analyse des besoins
Figure 90 9.4.4.4
Proposition de solutions
9.4.3
Gnration de variantes
Figure 84 9.4.2.2
Formulation des objectifs
Figure 87 9.4.4.1
Dtermination des indicateurs
9.4.5
Prise de dcision
Figure 88
Figure 77
Structure de la description de la mthodologie concertative dans le chapitre 9
330
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
9.2
R ECAPITULATIF DES POSTULATS
Lensemble des postulats mis tout au long du rapport de thse sont rcapituls ici. Le tableau synthtique ainsi ralis permet de se rendre compte dun seul coup dil de lensemble des rflexions tablies tout au long de ce document. Ce tableau comporte aussi des commentaires prsentant les postulats ou compltant leur description et mettant en vidence les liens qui existent parfois entre eux. Les postulats innovants, dfinis la page 11, sont mis en vidence par un fond gris. Ces postulats impliquent un changement dapproche de la procdure du projet telle que ralise dans le contexte helvtique.
N
1
nonc du postulat
La dure dtude dun projet routier doit tre en relation avec le rythme des changements du contexte dtude
Commentaires
Il sagit l du rappel dune problmatique souvent rencontre dans les projets dinfrastructure routire. Le contexte du projet est en effet en perptuelle volution, ce qui fait quune tude ralise en un temps donn peut rapidement devenir obsolte et se retrouver ainsi en dcalage par rapport aux attentes des acteurs ou aux exigences de la socit Le projeteur routier doit raliser une tude qui soit la plus globale possible, soit dans lespace, soit dans le temps, soit dans les domaines traits, afin de tenir compte au mieux des nombreux domaines affects par une infrastructure routire Ce rappel dun article de la Loi sur la Protection de lEnvironnement souligne le fait que les efforts entrepris dans la ralisation dun projet doivent tre proportionnels aux effets attendus Ce postulat premier stipule que le consensus et le compromis sont deux notions voisines mais diffrentes. Le projeteur se doit de chercher obtenir un optimum rsultant dune pese des intrts divergents en prsence. Ceci est la seule solution garante dune viabilit long terme. Le compromis est par contre viter car il dpend trop du rapport de force entre les diffrents acteurs Seule lutilisation dune mthode daide multicritre la dcision permet au projeteur de tenir compte au mieux dintrts contradictoires et de la complexit de la ralit, comme prsent au postulat 4 Ce postulat semble trivial mais il explicite bien les divergences que lon peut rencontrer dans les objectifs des diffrents acteurs affects par le projet. Si pour la socit, le bilan dune infrastructure routire est globalement positif, il nen est pas de mme pour certaines catgories de citoyens qui sont victimes de la route tandis que dautres sont uniquement bnficiaires de celle-ci Le choix des mthodes de participation publique pour un projet donn est trs important, car il conditionne fortement le succs de lopration. Il faut adapter la mthode de communication au public vis et non le contraire Afin de comparer les variantes vis--vis dune valeur connue, il est intressant de placer comme variante de rfrence, la variante reprsentant ltat actuel. Ainsi, on peut mieux se rendre compte de lapport de la nouvelle route pour des thmes spcifiques ou globalement Il sagit ici de rappeler que parfois des petits dtails semblant anodins peuvent avoir une grande importance sur le droulement du projet routier. Il sagit donc de soigner les dtails du processus dtude
Des tudes fractionnes et menes indpendamment ne permettent que difficilement daboutir un optimum global Le respect du principe de proportionnalit (LPE, art.17) dune mesure propose est vrifi par son efficacit et son efficience Lobtention dun compromis, reflet prsent des rapports de force entre les diffrents acteurs du projet, nest pas garant de lobtention dune solution optimale, tenant compte notamment des principes du dveloppement durable Une vision multicritre est indispensable pour tenir compte de la complexit de la problmatique des milieux affects par le projet routier Les bnficiaires et les victimes dune route ne sont pas les mmes acteurs
Lacceptation dun projet auprs dune population dpend fortement de la politique de communication adopte Une comparaison de variantes doit intgrer un tat de rfrence, mme si celui-ci nest pas envisageable comme tant une solution retenir Des dtails anodins peuvent entraner lchec dun important processus concertatif
Rcapitulatif des postulats
331
N
10
nonc du postulat
Les limites et les attentes de ltude doivent tre clairement dfinies avant de dbuter le projet
Commentaires
Le projeteur doit faire prendre conscience aux acteurs que ltude laquelle ils participent se concentre sur un domaine parfois restreint. Cet avertissement doit tre fait au dbut du projet pour viter des frustrations ultrieures ou une incomprhension quant aux rsultats que lon peut attendre de ltude Chaque acteur doit pouvoir sexprimer sans contraintes au sein du groupe dtude. Cependant, il est ncessaire davancer dans le processus dtude et il faut viter de remettre perptuellement en question les dcisions prises prcdemment. Dans ce but, le dbat doit tre fermement dirig afin que ltude du projet routier progresse rgulirement et rationnellement. Les efforts du projeteur peuvent ainsi se concentrer du global vers le dtail Ce postulat rejoint le postulat 10 en prcisant que les acteurs doivent accepter les rgles du jeu concertatif pour que celui-ci soit de qualit. Un acteur doit donc admettre que le rsultat du processus auquel il est intgr ne lui sera pas forcment favorable. Cependant, comme ce rsultat aura tenu compte de son avis, il lui sera srement moins dfavorable quun processus lignorant totalement Cette vidence nest pas forcment respecte, comme il a t montr dans la Comparaison de variantes 1999 . Ce postulat rejoint lide du postulat 9 qui est de soigner les dtails, notamment ceux lis la forme de la prsentation des documents utiliss Ce postulat complte le postulat 11 en indiquant que la maturation des ides na de sens que si elle dirige vers le dtail, qui est approfondi, ceci en partant du global, qui peut tre plus sommairement analys au sein dune large rflexion Ce postulat souligne lvidence dune gnration de variantes qui doit se baser sur des objectifs clairement prciss au dbut de ltude
11
Le dbat dans un groupe de travail comprenant de multiples acteurs doit tre fermement dirig pour respecter une certaine progression dans la maturation des ides
12
Un acteur participant un processus concertatif doit en accepter les rsultats mme sils ne les partagent pas
13
La forme des supports utiliss pour la discussion doit tre de parfaite qualit et homogne La profusion dides initiale doit progressivement tre canalise afin daboutir une rflexion approfondie sur des sujets prcis Les diffrentes variantes gnres doivent prsenter des diffrences sensibles pour tre retenues dans la phase de choix Une tude routire doit slaborer sur des bases de qualit, soit une dfinition claire des objectifs, un cadre dtude correctement dfini et une synthse complte des contraintes Une perte de temps engendre par une tude initiale approfondie peut permettre dviter des blocages ultrieurs, diminuant ainsi la dure globale du projet
14
15
16
Ce postulat semble tre une vidence car il rappelle que la qualit et la clart des lments prliminaires influence nettement la qualit du rsultat obtenu. Il est nanmoins rappel ici car lanalyse de la Comparaison de variantes 1999 montre quil nest pas forcment respect Le principal reproche fait au processus concertatif est quil est plus coteux et plus long quun processus dtude classique. Cette critique, qui peut sembler justifie car le travail du projeteur est accru, savre infonde. Un perte de temps initiale permettant dtablir au mieux les donnes prliminaires du projet, de tenir compte rapidement de certaines contraintes et dintgrer lensemble des points de vue a plus de chances de russite quun projet classique. Ainsi, le temps perdu au dpart du projet est amplement rattrap au cours du processus dtude Il est ncessaire de bien dfinir les rgles de fonctionnement du projet au dbut de celui-ci. Ainsi, le cadre de ltude dans lespace et le temps doit tre clairement dfinie et ne doit tre modifi quen cas de stricte ncessit. Ceci rejoint le sens du postulat 10 sur les limites de ltude Il ne faut pas avoir de crainte procder un large dbat contradictoire au dbut de ltude. Ceci a pour but de permettre didentifier rapidement et clairement les objectifs des diffrents acteurs, objectifs qui peuvent tre divergents. Aprs ce grand dballage , les positions des diffrents acteurs sont ainsi bien connues et que lon peut procder alors la recherche dun consensus en toute connaissance de cause En analysant au maximum sept critres simultanment, le dcideur peut facilement identifier limportance relative de chacun. Ce postulat est pertinent dans le domaine des infrastructures routires o lon peut avoir facilement 20 critres dvaluation
17
18
Le cadre de ltude ne doit pas stendre de manire dmesure au gr des demandes des acteurs Il ne faut pas craindre un dbat passionn car il sagit de la meilleure manire de faire apparatre au grand jour les positions divergentes des diffrents acteurs de ltude Afin de faciliter lattribution de la pondration de la part du dcideur, il ne devrait en gnral pas avoir plus de sept critres considrer simultanment
19
20
332
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
N
21
nonc du postulat
La pondration dun critre doit tre ralise de manire strictement indpendante de sa notation
Commentaires
Il sagit dun postulat innovant de ce thse de doctorat. La pondration dun critre, qui est lestimation de son poids relativement dautres critres, est une opration subjective, ralise par le dcideur, tandis que la notation, ou valuation de la performance, dune variante relativement un critre est une opration objective, ralise par le projeteur La concertation entre les diffrents acteurs du projet routier demande une communication qui soit comprhensible et sans quivoque. Lingnieur civil doit donc tre un communicateur et un vulgarisateur de qualit afin que son message soit clairement interprt par tous Cder un opposant au projet peut se rvler tre une solution intressante court terme, car lon a ainsi stopp le blocage du projet, qui peut tre par contre nettement dfavorable long terme. Tout comme lanalyse a lieu dans un espace global, le temps considr doit aussi tre pris long terme Il est important de rappeler cette vidence et de dfinir parfaitement les objectifs du projet au dbut du projet afin de mieux le justifier envers ses contradicteurs Comme indiqu au postulat 22, le projeteur routier a de plus en plus un rle de communicateur et il doit parfois prendre la place du dcideur pour justifier le projet auprs de ses contradicteurs Comme prcis au postulat 7, il sagit dadapter la mthode de communication au public vis. Le projeteur doit aussi porter leffort de la communication vers les acteurs dfavoriss ou minoritaires qui traditionnellement sont moins concerns par la participation publique, mais qui subissent gnralement plus les impacts des infrastructures routires Comme prcis au postulat 6, les acteurs affects par une infrastructure routire sont les riverains, qui sont gnralement situs dans une zone restreinte, tandis que les bnficiaires dune route sont les usagers gnralement diffuss dans le territoire Ce postulat rappelle que la qualit de la vie dont nous disposons actuellement dans notre socit est indissociable dun rseau dinfrastructures routires assurant sur le long terme une mobilit individuelle de qualit et librement choisie
22
Lingnieur civil doit pouvoir communiquer avec les autres acteurs par le biais dun langage commun, ceci pour pouvoir aussi mieux les comprendre Llimination des oppositions par labandon de la confrontation namne pas une solution durable
23
24
Une infrastructure routire est ralise pour rpondre des objectifs parfaitement dfinis Lingnieur civil doit tre form justifier son projet Linformation de la part du projeteur et du dcideur doit tre adapte la structure de la population concerne. Un effort particulier est fournir envers les minorits et les dfavoriss Les impacts engendrs par une infrastructure routire sont concentrs tandis que ses avantages sont diffus Assurer tous et sur lensemble du territoire une mobilit performante et conomique, condition indispensable au maintien de la qualit de vie actuelle, ne peut se faire quau prix de lexistence dun rseau dinfrastructures de transport de qualit prenne et dans le respect des liberts individuelles La classification conventionnelle dune infrastructure routire dtermine ses caractristiques au sein dun rseau de transport fonctionnel Le standard prcise ce qui doit tre fait (Quoi ?) en fonction dun certain besoin, tandis que la norme prcise la manire de le raliser (Comment ?). Il varie selon limportance de linfrastructure au sein du rseau de transport Une infrastructure de transport doit possder un standard assurant lusager un dplacement sr, rapide, conomique et confortable Une route doit tre considre sur un cycle de vie : elle est planifie, conue, construite, utilise et exploite, entretenue, ramnage et ventuellement dmolie
25
26
27
28
29
Ce postulat rappelle que les objectifs de qualit dune route sont tablis selon une vision globale dun rseau de transport organis de manire fonctionnelle Ce postulat rappelle la diffrence existante entre le standard, qui est une valeur subjective de qualit dfinie par la socit, et la norme, qui est une valeur prcisant la manire de raliser une infrastructure routire en assurant la scurit des usagers et en prservant la qualit de vie des riverains. Ce standard est diffrent selon limportance de la route dans le rseau de transport, rejoignant en ce sens le postulat 29 Rejoignant les ides mises aux postulats 28 et 30, ce postulat rappelle la notion du standard qui est appliqu une infrastructure routire afin dassurer une mobilit de qualit, cest dire sre, rapide, conomique et confortable La considration du cycle de vie rejoint un des principes du dveloppement durable bas sur le respect des besoins des gnrations futures. Le projeteur doit analyser les variantes court terme mais aussi moyen et long terme. Cette notion du cycle de vie montre aussi que les tapes du projet sont en interdpendance. Elle introduit ainsi une vision diffrente de la structure linaire gnralement adopte dans la reprsentation de la procdure dtude des infrastructures routires
30
31
32
Rcapitulatif des postulats
333
N
33
nonc du postulat
Les tapes du projet ne sont pas dfinitives car elles sont un des rouages du cycle de vie de linfrastructure routire
Commentaires
Ce postulat rejoint les remarques du postulat prcdent quant linterdpendance des tapes du projet. Une dcision prise lors de la conception de linfrastructure routire peut avoir des effets trs long terme, sur lexploitation par exemple. Le projeteur doit tre conscient de ce fait et doit en tenir compte dans ses dcisions Le choix dune mthode dlaboration du projet routier est directement bas sur la typologie de celui-ci. La mthodologie concertative du projet routier dveloppe ici sadresse lensemble des projets routiers La mthodologie concertative du projet routier dveloppe dans cette tude est trs complte car elle a pour ambition dtre applique la majeure partie des projets dinfrastructures routires. Le projeteur se doit dadapter certaines de ces tapes la typologie du projet tudi, en agrgeant notamment certaines des tapes proposes. Ce postulat rejoint ainsi le postulat 34 Ce postulat rappelle le rle exact du projeteur routier qui ralise une infrastructure routire sur la base de la volont du dcideur. Ce dernier nagit cependant pas isolment et subit de nombreuses influences endognes ou exognes Ce postulat montre quune route nest pas construite pour elle mme mais dans le but de rpondre un besoin socital. Ce besoin qui doit tre satisfait par linfrastructure routire tudie par le projeteur est dsign sous le terme d objectif Contrairement un objectif, qui est le but que doit atteindre le projeteur, une contrainte est gnralement dfinie comme tant une limite son champ daction. Elle est dfinie dans ce postulat comme tant un besoin socital actuellement satisfait mais qui ne doit pas tre diminu par la nouvelle infrastructure routire de manire ne plus tre satisfait. Les dfinitions des objectifs et des contraintes dveloppes dans les postulats 37 et 38 lient ces termes la notion de satisfaction ou dinsatisfaction des besoins socitaux. Il sagit l dune ide novatrice de cette tude
34
Lampleur et le principe de la mthodologie du projet dpendent directement de la typologie de celui-ci La mthodologie concertative sapplique, moyennant quelques adaptations mineures, lensemble des projets routiers
35
36
Limpulsion llaboration du projet est le fait du dcideur qui peut prendre cette dcision sous linfluence de divers acteurs priphriques Un objectif est un besoin collectif qui doit tre satisfait par linfrastructure routire de manire rpondre aux attentes de la socit Une contrainte est un besoin collectif qui ne doit pas tre dgrad par la future infrastructure routire de manire ne plus rpondre aux attentes de la socit
37
38
39
Labandon du projet est une mesure qui est lie lvolution de son contexte et nest par consquent jamais dfinitive La thse ne propose non pas un nouveau cadre dlaboration du projet mais plutt une manire optimale dutiliser la procdure existante
Le projeteur ne doit pas hsiter proposer au dcideur labandon du projet si celui-ci savre irralisable dans le contexte actuel ou sil ne correspond pas un besoin socital. Cet abandon nest cependant pas dfinitif et le projet peut simplement tre report en attendant que lvolution du contexte justifie alors sa ncessit La procdure du projet routier est gnralement dfinie par un cadre lgislatif rigoureux. Cette tude postule de non pas modifier ce cadre dans lequel doit voluer le projet routier mais plutt de dvelopper une manire optimale de lutiliser. Il sagit ainsi de procder une volution du processus dlaboration du projet routier prfrablement une rvolution Llaboration dun projet routier comporte de nombreuses itrations permettant daffiner progressivement le niveau de dtail des tudes. Les rsultats dune itration ne sont pas ignors dans la suite du projet mais peuvent tre prciss ou modifis dans des itrations suivantes. Ainsi, la succession des itrations nest pas confondre avec la ralisation de projets successifs indpendants
40
41
Llaboration dun projet stablit par itrations successives
42
Les acteurs influents doivent tre intgrs dans le projet afin de valider les rsultats obtenus
Il faut viter de procder une concertation alibi ignorant volontairement ou par ignorance les acteurs influents, sous peine de voir lensemble du projet chouer faute dtre adapt au contexte ou de ne pas possder de lgitimit suffisante. Un acteur influent est un acteur qui dispose dune influence suffisante sur dautre acteurs ou de moyens importants lui permettant de remettre en cause certains aspects du projet, voir mme lintgralit de celui-ci, ne le satisfaisant pas. Le rle du projeteur est de clairement identifier ces acteurs influents, qui peuvent parfois tre dissimuls par certains acteurs. Il doit ensuite les intgrer dans le processus dtude afin de pouvoir considrer leur avis
334
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
N
43
nonc du postulat
Il est ncessaire dinclure dans le processus dlaboration du projet routier des acteurs reprsentatifs et lgitims
Commentaires
Le postulat rejoint les conclusions du postulat 42 sur la lgitimit des acteurs intgrs dans le processus dtude. Un acteur doit avoir suffisamment de pouvoir auprs du groupe de population ou de lassociation quil reprsente afin de faire respecter les rsultats du projet auprs de ceux-ci et que son avis puisse tre considr comme tant reprsentatif de lavis de ceux quil reprsente Ce postulat rejoint le postulat N6 en identifiant les diffrentes attitudes du public vis--vis du projet. Le rle du projeteur est de fournir une communication active permettant datteindre le public passif, qui reprsente gnralement la majorit de la population, afin de lui prsenter les tenants et les aboutissants du projet et damliorer lacceptabilit de celui-ci La participation publique nest pas un effet de mode mais est dsormais une ncessit de tout les projets dinfrastructures routires. Le projeteur doit tre conscient de cette lgitimit du public pouvoir intervenir dans ses activits. Cette vidence est rappele ici, car elle nest pas forcment admise par tous les professionnels du domaine Si le projet ne permet pas de runir de nombreux acteurs reprsentatifs de sensibilits diffrentes, le projeteur peut toutefois raliser lexercice de se mettre dans la peau de ceux-ci en dfinissant des profils dacteurs reprsentatifs. Ceci permet de tenir compte davis divergents.
44
On distingue deux types de public dans le cadre dun projet dinfrastructure routire : le public, qui peut tre affect, intress ou passif, et les utilisateurs de linfrastructure qui en tirent un bnfice Le public possde un droit lgitime participer llaboration du projet dune infrastructure routire affectant son cadre de vie Lors dune phase dtude prliminaire ou dans le cas dun projet de faible envergure, le projeteur routier peut considrer les diffrents points de vues en utilisant des profils dacteurs reprsentatifs La population dsire pourvoir participer directement au processus dtude et de dcision dune infrastructure routire
45
46
47
La lgitimit de lintgration de la population au sein du processus dtude du projet routier est aussi voque ici, tout comme dans le postulat 45. Le projeteur et le dcideur doivent agir de concert de manire satisfaire cette envie et non de manire la contrer. Reconnatre le bien-fond de cette volont de participation citoyenne est dj un gage de meilleure acceptabilit du projet auprs de la population Ce postulat est trs important dans le cadre de cette thse de doctorat. La concertation nest pas considre comme tant une fin en soi ou comme tant une tape particulire du projet. Elle est au contraire intgre dans chaque action du projeteur et du dcideur et elle est distribue tout au long du processus dlaboration du projet routier Ce choix est le rsultat dun dialogue entre ces deux acteurs et dune pese dintrt entre la volont de transparence, de vulgarisation, les moyens disposition et la volont davancer dans lesprit du dveloppement durable. Il nexiste pas de mthodes de participation publique dfinie pour un type de projet dfini et cest ces deux acteurs de dcider quelle sera la mthode la mieux adapte au contexte du projet On peut illustrer ce postulat par le proverbe les petits ruisseaux forment les grandes rivires . Chaque mthode de participation publique prsente dans cette tude a un public-cible et des caractristiques bien dfinies. La combinaison de plusieurs mthodes de participation publique tend augmenter le nombre de personnes atteintes par le message dlivr par le projeteur, ce qui amliore ainsi la qualit de la participation publique Lintgration de la participation publique au sens du postulat 48 se ralise immdiatement afin de profiter au mieux des apports de la population dans le projet. Un concertation tardive na pas de sens et dintrt pour le projeteur et le dcideur. Elle tend plus tre de linformation ou alors un concertation alibi Comme dcrit aux postulats 48 et 51, lintgration de la participation publique dans le projet routier doit tre totale pour prsenter de lintrt pour le projet Lintgration de diffrents acteurs dans le processus dlaboration du projet routier ncessite un important effort dquilibrage entre ceux-ci. Mme si le processus du projet nest pas proprement parler un processus dmocratique, lquilibre des avis est important au sein dun groupe afin dassurer un dbat ouvert et non partisan
48
La concertation fait partie intgrante de toutes les tapes du projet routier
49
Le choix de la mthode de participation publique adquate pour un projet donn est effectuer par le dcideur et le projeteur
50
Il est prfrable dappliquer simultanment plusieurs types de mthodes de participation publique, chacune delles ayant des caractristiques et des objectifs diffrents qui mis en commun amliorent lefficacit de la participation publique La participation publique sapplique ds le dbut du projet
51
52
Un processus dtude concertatif lest intgralement ou ne lest pas du tout La dmarche concertative doit rassembler de manire quilibre et complte les acteurs reprsentatifs pouvant influencer le projet
53
Rcapitulatif des postulats
335
N
54
nonc du postulat
Ds le dbut du projet, les tapes de la dmarche concertative doivent tre prsentes aux acteurs de la concertation. Ceux-ci la valideront avant de dbuter leurs travaux Le dbat doit tre dirig de manire aboutir la prise de dcisions Si la concertation sadapte aux modifications du contexte de ltude, elle ne doit cependant pas tre source de perptuelles remises en question des dcisions prcdentes La qualit de prsentation de lorateur et du document est un lment dimportance du processus concertatif Le dcideur doit tre clairement identifi au dbut du projet afin de raliser une aide la dcision qui soit adapte ses besoins Le dcideur peut tre une entit complexe et floue aux comptences mal dfinies
Commentaires
La transparence de la mthodologie utilise doit tre totale envers les acteurs du projet routier. Aprs avoir t inform sur les caractristiques des diffrentes tapes de la mthodologie de projet retenue, ceux-ci doivent la valider. Ces propositions rejoignent les propositions des postulats 10 et 12 La participation publique nest pas uniquement un dbat dides mais elle doit aussi permettre de faire avancer le processus dlaboration du projet routier, notamment par la prise de dcisions La concertation doit tre souple et volutive afin de pouvoir sadapter rapidement aux modifications du contexte du projet, notamment lors de lidentification de nouveaux acteurs. Cependant, comme prcis dans les postulats 11 et 55, cette volution en doit pas tre loccasion de perptuelles remises en question des tapes prcdentes de ltude Ce postulat rejoint les postulats 9 et 13 qui traitent de la qualit de la forme, celle-ci pouvant occulter le fond si elle est de mauvaise qualit Une mthode daide multicritre la dcision est destine un acteur qui doit tre connu car ses besoins dterminent les rsultats attendus. Cette identification du dcideur doit se faire au dbut de ltude Le terme de dcideur peut recouvrir une individualit ou une collectivit dacteurs. Gnralement, il sagit du futur propritaire de la route, mais il y a parfois certains acteurs qui ont un rle de dcideur mais qui ne sont que partiellement intgrs au projet. Dans le cadre dune intgration dans le processus de pondration dacteurs reprsentatifs dintrts ou de points de vues diffrents, lensemble de ces acteurs peut tre considr comme tant le groupe dcideur Rejoignant lesprit du postulat 21, qui stipule une stricte sparation des oprations dvaluation des variantes et de la pondration des critres, ce postulat rappelle que ces deux acteurs ont un rle bien diffrent. Si le projeteur traite essentiellement des aspects objectifs du projet, le dcideur quant lui un rle nettement plus subjectif li son systme de valeurs. Une stricte indpendance entre ces deux acteurs, quil sagit de dfinir ds le dbut du projet, doit tre assure Ce postulat rejoint le postulat prcdent ainsi que le postulat 21. Cette distinction est aussi prsenter aux acteurs du projet au dbut de ltude, rejoignant ainsi le postulat 10 quant la ncessaire information prliminaires des acteurs sur les attentes et les limites de ltude Labsence doptimum qui peut rsulter de lutilisation dune mthode daide multicritre la dcision de type agrgation partielle doit tre clairement prcis aux diffrents acteurs, car il peut tre perturbant pour ceux-ci La mthode daide multicritre la dcision propose par lauteur est la mthode dagrgation partielle Electre III, mais dautre choix sont possibles selon le contexte du projet. Ce genre de choix doit toujours tre avalis par lensemble des acteurs au dbut du projet, afin dliminer toute contestation quant au rsultat final. La prsente tude prconise labandon de lutilisation de mthodes dagrgation complte car elles sadaptent mal au flou ncessaire la description de la complexit de la ralit Tout comme la participation publique commence au dbut du projet, la mthode daide multicritre la dcision retenue doit tre prcise au dbut du projet
55
56
57
58
59
60
Dans le cadre de laide la dcision, le dcideur et lhomme dtude doivent tre deux acteurs clairement distincts
61
Il est important de distinguer et dindiquer clairement au sein dune tude les aspects objectifs des aspects subjectifs A une problmatique donne peut correspondre une ou plusieurs solutions
62
63
En exposant clairement les avantages et les inconvnients, lhomme dtude doit proposer au dcideur une mthode daide multicritre la dcision base sur les caractristiques du projet et de son contexte. Ensuite, celui-ci doit avaliser ou non ce choix La mthode daide multicritre la dcision sera choisie ds lengagement du processus dtude
64
Tableau 43
Tableau rcapitulatif des postulats mis tout au long de ltude
Les postulats prsents et comments dans le tableau prcdent seront intgrs dans la mthodologie concertative du projet routier dveloppe et prsente au chapitre 9.3 Ils apparaissent parfois directement comme un lment de cette mthodologie ou ils sous-tendent parfois certains autres.
336
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
9.3
I NTEGRATION DE L ELABORATION DU
PROJET AU SEIN DU CYCLE DE VIE
9.3.1
tapes du cycle de vie
Comme prsent dans la figure de la page suivante, qui est tire directement de la Figure 28, page 138, le projet dtude dune infrastructure routire sinscrit dans le cycle de vie de celle-ci. Les tapes dtude de planification et davant projet sont rassembles dans une tape dsigne par le terme laboration du projet routier . La mthodologie concertative sapplique surtout cette tape, mais on traitera aussi de lexamen dopportunit du projet qui a des effets sur le projet. Limpulsion llaboration du projet ne sera pas reprise ici, car elle a t traite au chapitre 4 et quelle nimplique pas le projeteur. On peut remarquer que lors de lexamen de lopportunit du projet ou lors de la ralisation de llaboration du projet routier, ce dernier peut tre abandonn si lon constate quil ne prsente aucun intrt ou que sa faisabilit nest pas dmontre.
9.3.2
Lexamen dopportunit du projet
Lexamen dopportunit du projet consiste vrifier si limpulsion llaboration du projet est fonde. Le dbat qui est ainsi ouvert a pour but de donner au dcideur une vue d'ensemble des consquences de la ralisation dune infrastructure routire. La faisabilit ou les aspects financiers du projet ne sont pas traits dans cette tape car ils sont admis ce stade comme ntant pas dterminants.384 Plutt que de raliser une tude complte et fouille, qui est une entreprise difficile vu la complexit du contexte du projet, cette tape consiste en un dbat portant sur lintrt conomique, social et environnemental de la future infrastructure routire. Des objectifs prcis peuvent tre fixs lors de cette tape, mais ceci nest pas la rgle gnrale. Le dbat a pour but principal de permettre toutes les parties affectes par le projet de sexprimer librement. Il doit tre le plus large et le plus ouvert possible et toutes les ides ou propositions sont retenir. Il ne sagit donc pas dune tude fouille de la problmatique, celle-ci tant ralise au dbut de llaboration du projet routier. Afin de baser la discussion sur des arguments fonds, des tudes sommaires peuvent tre ralises avant dentamer le dbat. Elles ne doivent cependant que procder une analyse de lexistant et ne proposer que des bauches de solutions, de manire ne pas orienter le dbat. Les participants ce dernier ne doivent pas subir dinfluences extrieures de manire pouvoir exprimer librement leur avis.
384
Comme le prcise Veuve, si ce ntait le pas cas, lexamen dopportunit naurait aucune raison dtre ! (Veuve
L., 1994)
Intgration de llaboration du projet au sein du cycle de vie
337
CONTEXTE
Impulsion l'laboration du projet
Nouveaux besoins individuels ou collectifs satisfaire Nouveaux paradigmes socitaux Evolution du cadre administratif Nouveau cadre lgal Environnement en volution
Le projet n'est pas opportun
Examen d'opportunit du projet
Dbat ouvert sur l'intrt de raliser une infrastructure routire Justification politique, sociale, administrative et technique
Projet abandonn
Le projet est opportun
Les besoins sont clairement dmontrs Les besoins sont prciser
Aucune variante n'est intressante
Elaboration du projet routier
Dmarche concertative Du global au local Affinage par itrations successives Gnration puis choix de variantes
Projet accept
Une variante est retenue
Prparation de la ralisation
Projet dfinitif Soumission Appel d'offres
Ralisation
EXPLOITATION DE LA ROUTE
Figure 78
Intgration de llaboration du projet au sein du cycle de vie de linfrastructure routire
338
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
A la fin de lexamen de lopportunit du projet, plusieurs degrs de dfinition du problme sont possibles : Le problme est bien dfini et le type de solution est connue La problmatique est mise en vidence, voire mme quantifie, et la faon de la rsoudre est connue (Pour liminer le trafic qui congestionne le cur du village, il faut raliser une route de contournement car les 3/4 de ce trafic est de transit) Le problme est bien dfini mais la solution nest pas connue La problmatique est mise en vidence, voire mme quantifie. Cependant, il subsiste un doute sur la faon de la rsoudre (Le centre du village est engorg par le trafic. Faut-il raliser une route de contournement, favoriser le transfert modal, modrer le trafic, etc. ?) Le problme est mal dfini mais pressenti Une situation problmatique est ressentie, la volont politique de la rsoudre existe, mais il ne semble pas possible de la dfinir avec prcision. Cest au cours de ltude du projet que la problmatique pourra tre dfinie plus prcisment (Il semble y avoir trop de trafic au cur du village, mais quelle est la provenance de celui-ci et observe t-on souvent des embouteillages ?) Le problme est inexistant Lexamen dopportunit montre que le problme a t surestim ou mal valu et quil ny a pas dintrt laborer un projet dinfrastructure routire (Le centre du village nest engorg que 10 heures par an, ce qui est tolrable) La solution se rvle tre pire que le problme Les impacts engendrs par les solutions envisages ne permettent pas de rsoudre la problmatique, voire mme laggrave (Les nuisances de la route de contournement affectent plus de riverains quactuellement) Le projet routier peut tre justifi de deux manires : (Veuve L., 1994) Par la concrtisation dune politique publique (justification problmatique haut bas, appel aussi processus top down politique) :
Projet ralis afin de satisfaire des exigences lgales sans que le public naie manifest un dsir particulier de ralisation : cas dune paroi antibruit ralise sur la base de ltablissement dun cadastre de bruit montrant un dpassement des valeurs limites, etc. Par la concrtisation dun dsir de la population (justification sociale) : problmatique bas haut, appel aussi processus bottom up Projet ralis afin de satisfaire une demande du public : cas dune paroi antibruit exige par les riverains mais non ralise auparavant car les valeurs limites ntaient pas dpasses, etc. Lexamen de lopportunit du projet constitue en une intgration de ces deux problmatiques qui peuvent parfois avoir des intrts divergents. Par exemple, en reprenant le cas de la paroi antibruit ralise pour satisfaire des exigences lgales (justification politique), si la justification sociale nest pas prsente (les riverains nont pas la sensation de subir de fortes nuisances sonores), lacceptation de cet ouvrage impos la population peut tre difficile, par exemple en raison de lintgration paysagre.
Intgration de llaboration du projet au sein du cycle de vie
339
Les rsultats obtenus aprs lexamen de lopportunit du projet sont les suivants : tablissement dun cahier des charges du projet. Dans ce document, les objectifs du projet sont fixs ainsi que les contraintes lgales et le primtre de ltude. Le cahier des charges engage le dcideur et celui-ci a la responsabilit de le faire respecter par le projeteur. Si le contexte du projet se modifie trs rapidement, ce mandat peut toutefois tre modifi organisation dune commission de suivi des dbats. Cet organe indpendant sassure tout au long de llaboration du projet, puis dans les tapes suivantes du cycle de vie de la route, que le cahier des charges et lesprit du dbat initial soient respects
Le principe dun examen dopportunit dun projet routier est prsent ci-dessous :
Etape prcdente
Impulsion l'laboration du projet
Ces donnes caractrisent la dynamique d'volution de l'environnement et du contexte du projet - relevs - bilan actuel - prospective
Vrification de l'intrt du projet
HYPOTHESE. la faisabilit technique et conomique n'est pas dterminante SOURCES. impulsion du projet acteurs requrants analyse de l'existant (suivi rgulier)
Les donnes disposition peuvent tres sommaires et inabouties
OUI Les donnes disposition sont-elles suffisantes pour clairer le dbat ? NON
Enqute Enqutes sommaires complmentaires
Autorits politiques Lgislation Administration
Problmatique haut vers le bas Justification politique
Conception gnrale Plans directeurs
DE BAT PUBLIC
Ouvert tous Porte sur l'intrt conomique, environnemental et social du projet Chaque partie donne librement son avis Pas de finalisation de tous les thmes
Public
Dolances organises ou spontanes
Associations Acteurs conomiques
Problmatique bas vers le haut Justification sociale
Observe
Commission de suivi des dbats
Acteurs indpendants Fonction de surveillance
Prend note OUI OUI
Synthse du dbat public
Le problme est-il bien dfini ? NON
En cas de profonds dsaccords, ceux-ci sont indiqus dans le rapport de synthse Le problme est inexistant L'intrt du projet n'est pas prouv
La solution est- NON elle connue ?
Projet abandonn
On ressent la ncessit d'un projet sans connatre avec prcision la problmatique
L'information est suffisante et pertinente pour justifier la ralisation d'un projet
Il subsiste un doute sur la faon de rsoudre le problme
La commission de suivi des dbats s'organise pour s'assurer du respect du cahier des charges durant l'laboration du projet routier
Informe
Cahier des charges de l'tude
Ce document qui rsume les dbats engage le dcideur et doit tre respect par le projeteur
Etape suivante
Elaboration du projet routier
Contenu - objectifs raliser - contraintes principales considrer - primtre d'tude - textes lgaux considrer - standard de la future route Si un dsaccord persiste, le dcideur doit trancher ! Si un doute demeure, l'identification des besoins, qui est ralise en aval, fixera ces lments
Figure 79
Examen dopportunit du projet
340
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
9.3.3
Llaboration du projet routier
Llaboration du projet routier se droule par lapplication dune dmarche itrative respectant les principes suivants mis au chapitre 4.8 : ralisation successive des diffrentes tapes dlaboration du projet routier qui sont prsentes dans la figure de la page 343 la fin dun processus dlaboration par tapes, 3 possibilits de dcision sont possibles : raliser une nouvelle itration, abandonner le projet ou accepter les rsultats obtenus les itrations successives vont de plus en plus dans le dtail en procdant un affinage successif quand une tape est clairement dfinie dans une itration, elle peut tre affine, modifie ou simplement lude dans litration suivante. Les rsultats obtenus auparavant sont considrs mais ils ne sont pas intangibles
Llaboration du projet par lapplication dune dmarche itrative est dcrite la page 341.
9.3.4
Le projet dfinitif
Le projet dfinitif consiste en un affinage des dimensions du projet choisi lors de ltape prcdente. Si dans cette phase antrieure, la ppite a t sortie de sa gangue, dans ltape du projet dfinitif, le mtal prcieux est travaill et poli pour en faire un joyau parfait. Cette tape ne fera pas lobjet dun dveloppement particulier dans cette tude car son processus est essentiellement technique : modifications mineures du trac et des dimensions des ouvrages dart, affinage des caractristiques des mesures tablies dans lavant-projet, etc. Il ny a plus de choix subjectif raliser et seul le Groupe dtude et le dcideur principal sont concerns. Pour viter toute drive lors de cette tape, notamment dimportantes modifications de la variante retenue, la conformit du projet dfinitif avec le cahier des charges est vrifie par la Commission de suivi des dbats avant lEnqute publique.
Intgration de llaboration du projet au sein du cycle de vie
341
Etape prcdente
Examen de l'opportunit du projet
2me Itration
2. Dcrire la problmatique
2. Dcrire la problmatique
nme Itration
Nouvelle itration
1re Itration
1. Dfinir le cadre de l'tude
1. Dfinir le cadre de l'tude
1. Dfinir le cadre de l'tude
2. Dcrire la problmatique
3. Proposer des solutions
3. Proposer des solutions
3. Proposer des solutions
4. Apprcier les consquences
4. Apprcier les consquences
4. Apprcier les consquences
5. Prendre une dcision
Nouvelle itration
5. Prendre une dcision
5. Prendre une dcision
Projet abandonn
Projet accept
Etape suivante
Projet dfinitif
Figure 80
laboration du projet routier par application dune dmarche itrative
342
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
9.4
P ROCESSUS D ELABORATION DU PROJET
ROUTIER
9.4.1
tapes du processus
Le processus dlaboration du projet routier est illustr par la figure prsente la page suivante. Cette figure centrale de la mthodologie concertative du projet routier sert de base aux autres diagrammes du chapitre 9.4. Toutes les tapes du processus dlaboration du projet routier ont leur raison dtre et sont lies. Certaines tapes sont rapidement tudies, dautres demandent un travail important, mais elles doivent toutes tre analyses au cours des diffrentes itrations, sans quoi le projet risque dtre dsquilibr ou incomplet. Compar au processus prsent au chapitre 4.4.1, page 142, les modifications suivantes ont t apportes : simplification du nombre de phases de neuf cinq en attribuant des tapes intermdiaires au nombre de douze la mthodologie de travail est adopter clairement par les acteurs du projet au dbut du processus dtude afin de respecter la transparence des dcisions et lacceptabilit du projet la phase de pondration des critres est avance au dbut du processus, lors de la description de la problmatique. Ceci permet dassurer au mieux lindpendance entre les deux tapes de la pondration et lvaluation des performances.385 Ces deux tapes ne sont pas ralises en continu lors de lapprciation des variantes car il est postul que le systme des valeurs dun dcideur, qui se transcrit sous la forme dune pondration, ne dpend pas des variantes gnres mais uniquement de la problmatique et du contexte du domaine dtude. Sa pondration doit tre attribue en toute indpendance. Il est donc ncessaire de raliser la pondration avant de proposer des solutions. Si ce nest pas le cas, le biais des pondrations en raison des rsultats obtenus est possible386 une tape spcifique lie aux mthodes daide multicritre la dcision est ajoute au processus
385 386
Si lon dsire transformer les performances en valeurs semblables, on peut alors parler l dune tape de notation On peut avoir ainsi un dcideur qui ne veut pas dune variante prcise car son valuation pour un critre qui lui tient cur est mauvaise. Ce dcideur risque alors de fortement pondrer les critres pour lesquels cette variantes est mauvaise afin de lliminer. On peut observer ce cas dans la Comparaison de variantes 1999 o les variantes des Communes sont mauvaises dun point de vue environnemental et conomique. Les associations de protection de lenvironnement ont alors fortement pondr les critres milieu naturel et cot de ralisation pour les liminer
Processus dlaboration du projet routier
343
Etape prcdente
Examen d'opportunit du projet
Adaptation du domaine d'tude Rvision de la mthode de travail
Dlimitation du domaine d'tude
1. Dfinir le cadre de l'tude
Fixer la participation des intervenants
Description de la mthodologie de travail
Modification des besoins Objectifs trop ambitieux Nouvelles contraintes
2. Dcrire la problmatique
Identification et analyse des besoins
Formulation des objectifs
Pondration des critres
Collecte et analyse des contraintes
Atteindre les objectifs fixs Amlioration ou modification majeure des variantes
3. Proposer des solutions
Gnration des variantes Respecter les contraintes releves
Autre mthode d'aide la dcision Nouveaux critres Affiner l'valuatiom
Dtermination des indicateurs
Evaluation des performances
4. Apprcier les consquences
Proposition de(s) variante(s) satisfaisante(s)
Utilisation d'une mthode d'aide multicritre la dcision
Rtroactions possibilits ...
5. Prendre une dcision
Modif ier
le projet
Poursuivre le projet
Modifications mineures Cadrer l'tude Affiner les dtails
Renoncer au projet
Impossibilit d'atteindre les objectifs Contraintes rdhibitoires
Modifications majeures, mais possibles Nouvelle itration
Etape suivante
Projet dfinitif
Figure 81
Processus dlaboration du projet routier
344
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
9.4.1
Dfinir le cadre de ltude
Cette phase initiale consiste dfinir le contexte, i.e. le cadre, dans lequel se droulera la future tude. Elle comporte trois tapes : dlimitation du domaine dtude description de la mthodologie de travail fixer la participation des intervenants
9.4.1.1
Dlimitation du domaine dtude
La dlimitation du domaine dtude est dtermine selon les principes mis au chapitre 4.4.3, page 146. Un diagramme de flux situ la page suivante prsente le droulement de cette tape. Comme montr prcdemment, la dimension du domaine dtude est un quilibre quil sagit de raliser entre les cots dinvestigation et les cots dus aux modifications du projet. Il sagit donc de choisir une chelle raliste, sans trop restreindre le domaine de ltude mais aussi sans se disperser. Trois dimensions du domaine dtude sont dterminer : dimension spatiale dimension temporelle niveau dapprofondissement de ltude
Ltendue spatiale du domaine dtude comporte deux zones distinctes : la zone dintervention, qui est le territoire o sont gnres les diverses variantes la zone dinfluence, qui est le territoire o les effets de linfrastructure routire sont ressentis de manire significative. Cette zone dinfluence peut tre diffrente selon les critres considrs
Il est bien vident que la zone dinfluence englobe la zone dintervention. Ces deux zones peuvent, dans certains cas exceptionnels, tre confondues. Les limites de la zone dinfluence sont moins prcises que celles de la zone dintervention. Au fur et mesure des itrations successives, les dimensions du domaine dtude sont rvalues. Gnralement, la zone dintervention se restreint tandis que la zone dinfluence se modifie peu.387 Comme lauteur lexplique dans le cours de Conception des voies de circulation (Dumont A.-G. et Tille M., 1997), il est parfaitement envisageable de scinder la zone dintervention en plusieurs sous-domaines dtude afin de mener localement les tudes du projet. Dans ce cas, la structure du projet devient spare au cours de litration et les tudes sont menes en parallle. On veille toutefois conserver une certaine cohrence entre ces tudes en adoptant des paramtres identiques : critres considrs, principe de choix des variantes, etc. A la fin de litration les diffrentes variantes optimales localement sont agrges en une variante finale.
387
Les caractristiques du trac des variantes saffinent et se prcisent, mais les effets engendrs sappliquent toujours sur le mme domaine
Processus dlaboration du projet routier
345
Etape prcdente
Examen de l'opportunit du projet
Cadre de l'tude
Le projet en est sa premire itration ? OUI Limites administratives et juridiques Elments gostructurants Projets voisins et antrieurs Contraintes rdhibitoires Dtermination spatiale de la zone d'intervention Le projet en est sa premire itration ? NON
SOURCES. impulsion l'laboration du projet cahier des charges dcideur
NON NON
OUI
Le contexte s'est modifi ? OUI
Dtermination de l'tendue spatiale
Ces deux zones peuvent tre identique !
Dsire t-on approfondir NON le dtail de l'tude ?
Territoire o les variantes sont gnres OUI
Dtermination spatiale de la zone d'influence
Territoire o les effets des variantes sont perceptibles
NON j sous-domaines Le domaine d'tude a t-il dj t scind ? OUI
A dterminer pour chaque critre Si on est la premire itration, il s'agit d'estimer les principaux critres retenir
Points de passage obligs Striction de la zone d'tude
Est-il ncessaire de scinder le domaine d'tude en plusieurs sous-domaines ? NON OUI NON
Rgle importante : les sous-domaines ne se recoupent pas !
Faut-il agrger des sous-domaines ?
OUI m sous-domaines j>m>1
NON
Faut-il conserver le dcoupage antrieur ?
j sous-domaines j>1 L'tape de dlimitation de la zone d'tude peut tre lude Cartes topographiques Document crit Systmes d'information rfrence spatiale Seuil de planification : 10, 20, 50 ans ? Court, moyen et long terme ? Planification, avant-projet ? Dpend de l'itration prcdente Document crit OUI
1 domaine d'tude
n sous-domaines n>1
Si plusieurs sous-domaines d'tudes sont dfinis, les tapes suivantes de l'laboration du projet sont menes en parallle. A la fin de l'itration, la variante propose est constitue par la concatnation des diffrentes variantes retenues dans chaque sous-domaine Dure du cycle de vie de l'infrastructure routire Contraintes lgales et directives Projets antrieurs Dbat dcideur et public
Report sur documents
Dtermination de l'tendue temporelle
Dtermination du niveau d'approfondissement de l'tude
Prparation pour ... Collecte et analyse des contraintes Gnration des variantes Evaluation des performances
Report sur documents
Etape suivante
Description de la mthodologie de travail
Figure 82
Dlimitation du domaine dtude
9.4.1.2
Description de la mthodologie de travail
Il sagit de dterminer et de prsenter aux diffrents acteurs la mthodologie de travail qui sera utilise tout au long de llaboration du projet routier : procdure, participation publique, principe des tapes de travail, mthode daide multicritre la dcision utilise, dlais, etc. Dans cette tude certains choix mthodologiques ont t raliss : dmarche itrative, mise en pratique de la concertation, mthode daide multicritre la dcision (Electre III ou autre), etc. Ce choix nest quune proposition et il est clair quil peut varier pour chaque projet selon le choix du dcideur et du projeteur. La mthodologie de travail est adapte la typologie du projet et son importance. Elle doit tre accepte par lensemble des acteurs prsents et lon veillera ne pas trop la modifier au cours de llaboration du projet.
346
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
9.4.1.3
Fixer la participation des intervenants
Cette tape consiste dterminer quels sont les acteurs intgrer au processus dtude ainsi que leur niveau de participation au projet, notamment celui du public. Les acteurs intervenants388 dans ltude sont rpartis en deux groupes indpendants : le groupe dcideur, qui est le groupe politique. Il comprend le dcideur proprement dit (autorit responsable de ladministration routire), le public, des autorits politiques, des reprsentants des groupes dintrts, des usagers, des riverains, des associations non-gouvernementales, etc. le groupe dtude, qui est le groupe technique. Il comprend le projeteur, qui est gnralement un ingnieur civil, des spcialistes des domaines concerns par le projet routier (environnement, trafic, conomie, etc.), des reprsentants des administrations concernes, etc.
Une description de ces diffrents types dacteurs est ralise au chapitre 5. Les principes de la participation publique ont t dcrits dans le chapitre 7. La composition dun groupe dcideur fonctionne selon un principe itratif. Une premire liste de participants est ralise par le dcideur, qui peut se baser sur une liste dacteurs types intgrer doffice dans le processus. Lors de la premire sance du groupe dcideur, il est demand aux acteurs prsents sils estiment ncessaire dintgrer dautres acteurs. Aprs dbat, le groupe dcide des modifications apporter sa composition. Ces nouveaux acteurs amnent aussi leurs propositions qui sont rediscutes, ceci jusqu obtenir une liste dfinitive des participants. Il est ncessaire de disposer de suffisamment dacteurs reprsentatifs, mais il faut toutefois veiller ne pas intgrer un nombre si important dacteurs que les travaux du groupe dcideur en viennent limiter le temps de parole de chacun. Les acteurs doublons, inutiles ou alibis sont viter car ils alourdissent inutilement les travaux du groupe. Les acteurs politiques doivent tre prsents tout au long du processus dtude pour pouvoir correctement analyser les rsultats techniques. La composition du groupe dtude est par contre dcide par le projeteur et ne fait pas lobjet dun dbat. Un spcialiste est mis contribution quand un problme que le projeteur ne peut rsoudre apparat. Ces spcialistes peuvent tre prsents durant toute llaboration du projet routier ou napparatre qu certains moments de celuici. Une parfaite indpendance doit tre assure entre le groupe dtude et le groupe dcideur : aucun acteur ne peut tre prsent simultanment dans les deux. La seule exception est constitue par le projeteur ou un spcialiste venant exposer au groupe dcideur des aspects particuliers des travaux raliss par le groupe dtude. Les travaux spcifiques chaque groupe sont considrs pas lautre mais ne sont pas discuts et renvoys pour modification. Il ne sagit pas en effet au sein du projet routier de travailler tel un systme parlementaire bicamral o un texte lgislatif fait la navette entre les deux groupes avant dtre dfinitivement accept.
388
Les acteurs qui ninterviennent pas dans le projet ont aussi une influence sur celui-ci. Il sagit cependant dans cette tape de les identifier de faon les intgrer dans le projet. Dun statut dacteur priphrique, ils doivent ainsi passer un statut dintervenant
Processus dlaboration du projet routier
347
Dans une itration initiale, seul deux acteurs peuvent tre prsents : le dcideur et le projeteur. Ensuite, au fur et mesure de lavancement du projet, de nombreux acteurs viennent se greffer autour de ce binme de base.
Etape prcdente
Description de la mthodologie de travail
Dterminer quels sont les modes d'intervention des acteurs du projet
Le projet en est sa premire itration ? OUI
Acteurs initiaux : dcideur - projeteur - (public) Le projeteur est choisi par le dcideur. Il apparat dans le processus la fin de l'examen d'opportunit, quand celui-ci tablit l'intrt d'tudier le projet
NON NON
Les itrations prcdentes montrent-elles des lacunes dans la composition des groupes ? OUI
Dtermination des acteurs intgrer
Projeteur (choisi par le dcideur) Spcialistes intgrs dans le groupe selon les objectifs et les critres (dbat avec le dcideur) ou selon les avis des spcialistes prsents Administrations concernes
Groupe d'tude
Les deux groupes doivent tre indpendants !
Groupe dcideur
Technique
Objectivit
Politique
Subjectivit
Dcideur : autorit politique routire Acteurs reprsentatifs : usagers, riverains, O.N.G., administration Selon avis des acteurs prsents Liste des acteurs types
Tous les acteurs doivent pouvoir apporter leur opinion au sujet de la composition du groupe dcideur
En premire itration, le dcideur et le projeteur peuvent tre seuls et utiliser des profils d'acteurs reprsentatifs
Liste des acteurs intervenants dans le projet Dtermination des conditions de la participation publique
Quelle forme de participation ?
Distinction acteurs intervenants / acteurs non-intervenants
Intgration du public au sein du processus d'tude Rtroaction sur la composition des acteurs intervenants
OUI Automobilisation du
public observe ?
NON
Image de marque
Pas d'information Avis
Information
Faut-il "rcuprer" le mouvement ? OUI
NON
Concertation Mode de participation privilgier
Collecte d'informations
Consultation Dbat dcideur - projeteur Selon les fiches descriptives prsentes en annexe Utiliser plusieurs mthodes plutt qu'une seule
Spcialiste de la communication
Choix de mthodes de participation publique adapte au contexte
Le plus tt Le plus transparent Tout le temps
Plan d'action pour appliquer la participation publique
Etape suivante
Dcrire la problmatique
Figure 83
Fixer la participation des intervenants
9.4.2
Dcrire la problmatique
Cette phase consiste dcrire les diffrents lments du problme rsoudre. On y trouve quatre tapes , savoir : identification et analyse des besoins formulation des objectifs collecte et analyse des contraintes pondration des critres
348
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
9.4.2.1
Identification et analyse des besoins
Cette tape consiste raliser lanamnse du contexte du projet afin de dterminer quels sont les besoins qui doivent tre satisfaits par linfrastructure routire projete. Cette identification tient compte de ses aspects dynamiques antrieurs et futurs. Elle est base sur une comparaison de loffre et de la demande. Cette tape a t dcrite en dtail au chapitre 4.4.5, page 147. Le droulement de cette tape, qui sert de base la formulation des objectifs et lanalyse des contraintes, est prsent la page suivante.
9.4.2.2
Formulation des objectifs
Sur la base des besoins tablis prcdemment, les objectifs, cest dire les buts atteindre par la future infrastructure routire projete sont dfinis ici. Si la phase didentification des besoins est une tape trs technique, ralise pour lessentiel par le groupe dtude, la phase de formulation des objectifs est plutt une dcision politique, base sur de nombreux lments techniques. Cest en quelque sorte le rsultat dun dialogue entre le dcideur et le groupe dtude. Les objectifs doivent tre clairement dfinis lors de cette tape car les tapes suivantes en dpendent fortement. Il est frquent que les objectifs ne soient pas clairs aux yeux du dcideur lors de la premire itration. Dans ce cas, le fait davoir identifi les besoins avant de procder la formulation des objectifs permet de mieux mettre en vidence la problmatique. Les rsultats de cette tape sont utiliss ensuite pour lanalyse des contraintes, la gnration de variantes et lvaluation des performances.
9.4.2.3
Collecte et analyse des contraintes
La ralisation des objectifs est limite par des contraintes, qui sont en quelque sorte des entraves la libert d'action du projeteur. Celui-ci se doit donc de disposer dun ensemble complet de donnes de base pour pouvoir connatre au mieux le domaine dtude. La qualit du projet dpend fortement de celle des donnes de base. La phase de collecte des informations demande un important volume de travail et doit imprativement tre suivie dune phase danalyse et de reprsentation synthtique des contraintes. Le droulement de cette tape est dcrit la page 350.
Processus dlaboration du projet routier
349
Etape prcdente
Dfinition du cadre de l'tude
Besoins collectifs
OUI Le projet en est sa premire itration ? NON Les besoins sont clairement dfinis ? NON
SOURCES. impulsion l'laboration du projet cahier des charges dcideur
OUI NON L'tape d'identification des besoins peut tre lude
Le contexte s'est modifi ? OUI
Pour chaque besoin OUI NON Le besoin est affect par le projet ? OUI
Le besoin Ne sait pas est satisfait ? NON
Etablissement d'un bilan
OFFRE
OUI Les informations disposition sont suffisantes et pertinentes ? NON
DEMANDE
Les attentes de la socit sont OUI clairement dfinies ? NON
Etudes complmentaires
Enqutes Dcideur Public Relevs Rcolte de donnes Actuel Futur sans projet Futur avec projet
Discussion et dbat
Lois Normes Standards
Etat du besoin
Demande de la socit
Comparaison
NON
La demande est sup- OUI rieure l'offre ? Quantification du besoin OUI
Ceci depuis depuis la mise en service ? OUI
NON
Discussion sur la considration du besoin NON Le besoin n'est pas pertinent
Dcideur
NON
Tous les besoins ont t analyss ? OUI
Le dbat sur l'intrt rl NON du projet est mener
Prparation pour ... Formulation des objectifs Collecte et analyse des contraintes Evaluation des performances
Des besoins ont t identifis ? OUI
Synthse des besoins identifis
Etape suivante
Formulation des objectifs
Figure 84
Identification des besoins
350
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
Etape prcdente
Formulation des objectifs
Elments limitant la libert d'action du projeteur
Le projet en est sa premire itration ? OUI
SOURCES. Identification et analyse des besoins Cahier des charges Environnement du domaine d'tude Apports des acteurs
NON NON
OUI
Autorits politiques Lgislation Administration
Influence
Le contexte s'est modifi ? OUI
Lacunes releves
Etablissement de la liste des contraintes considrer
Dsire t-on considrer des contraintes supplmentaires ? NON
Vrification de l'exhaustivit Manque t-il des contraintes ? Dbat entre spcialistes des contraintes
Liste des critres
Liste des contraintes Relev des donnes existantes
DOCUMENTS Plans directeurs, d'occupation des sols, etc. Services administratifs comptents : environnement, conomie, transport, agriculture, amnagement du territoire, etc. Etudes antrieures ou voisines
ACTEURS Apports individuels ou collectifs Dbat avec le public
Volume de travail consquent
Le domaine d'tude a t-il une dimension adquate ? OUI Qualit de l'information : format,recoupement, actualisation, quantit, prcision, viabilit, etc. Les donnes disposition sont-elles pertinentes pour la dure de vie de la route ? OUI OUI
Il est possible de dmarrer l'tude avant d'avoir disposition l'ensemble des donnes (risque d'erreur faible, risque prenable)
NON
Trop tendu : volume de travail consquent Trop restreint : manque d'informations
NON
Domaine d'tude redfinir
Rtroaction Les informations sont-elles pertinentes la mise en service ? NON
La rcolte de donnes complmentaires doit dbuter au plus vite, avant l'tude du projet
Etudes et enqutes complmentaires
Enqutes, comptages, relevs, etc. Etudes complmentaires Elargissement de la consultation des acteurs
Synthse des contraintes
Objectifs Aide la gnration de variantes Evaluation des performances
Retenir ce qui est pertinent Eliminer ce qui n'a pas d'intrt
Reprsentation des contraintes
Plans topographiques Systmes d'information rfrence spatiale
Etape suivante
Proposer des solutions
Figure 85
Collecte et analyse des contraintes
Processus dlaboration du projet routier
351
9.4.2.4
Pondration des critres
Cette tape est ralise en deux temps : Tout dabord, il sagit didentifier et de ranger les critres retenus pour lanalyse. Ces critres sont directement tirs des objectifs et des contraintes relevs prcdemment. Des tests dexhaustivit, de cohrence et de non-redondance sont effectuer. Si de nombreux critres sont prsents, ce qui est souvent le cas dans les projets dinfrastructure routire, un regroupement des critres par familles est ralis. On doit ainsi procder une pondration par deux niveaux : familles puis critres au sein des familles. Cette tape est ralise principalement par le projeteur Dans une deuxime phase, chaque acteur du groupe dcideur tablit sa pondration, qui est la prfrence relative accorde un critre vis--vis des critres de sa propre catgorie, pour chacun des critres et des familles dtermines auparavant (pondration individuelle double niveau). Le projeteur nintervient pas ici Le chapitre 8 dcrit plus en profondeur les principes respecter pour la pondration individuelle. Un diagramme de flux situ la page suivante prsente le droulement de cette tape.
9.4.3
Proposer des solutions
Dans cette tape, il est propos des variantes permettant de rsoudre les problmes. Cette tape se droule en deux temps : En premier lieu, le projeteur et le groupe dcideur dbattent pour dterminer quelles variantes seront gnres Ensuite, le groupe dtude procde aux tudes techniques pour chaque variante gnre. Il sagit dun travail technique dimportance o toutes les dimensions des variantes sont dtermines
La dmarche utilise pour la gnration des variantes est prsente la page 354. Lors de cette gnration de variantes, certaines rgles sont respecter : le dbat sur la liste des variantes tudier doit tre le plus ouvert possible. Il est ncessaire dviter dexclure doffice des variantes, sans procder un examen sommaire de celles-ci. Les variantes dfinies lors ditrations prcdentes ainsi que celles proposes par dautres acteurs doivent tre intgres dans ltude la dtermination des couloirs de moindre valeur est une aide prcieuse la gnration de variantes chaque variante est gnre pour rpondre un but prcis quil sagit dindiquer le niveau dtude de toutes les variantes doit tre quivalent pour pouvoir ensuite effectuer une comparaison entre elles qui soit la plus objective possible
352
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
Etape prcdente
Collecte et analyse des contraintes
Identifier et ranger les critres
Le projet en est sa premire itration ? OUI
SOURCES. Formulation des objectifs Analyse des contraintes
NON OUI
Les critres considrs dans l'itration prcdente taient pertinents ? NON OUI Les objectifs et les contraintes sont modifis ? NON
Liste des objectifs et des contraintes
Ajouter Enlever Regrouper
Test de qualit des critres
Dcrit au chapitre 8.3.2.2 - exhaustivit - cohrence - non- redondance
Modification de la liste des critres
NON
Les tests sont-ils concluants ? OUI
La liste des critres est approuve
Discussion
Regroupement par ralisation, activits socio-conomiques (exemple) familles de critres 6 7 critres au maximum par famille Systme de rangement en familles de critres Pondration des critres
Ralises individuellement par chaque membre du groupe dcideur OUI
4 5 familles : trafic, environnement, cot de
Les pondrations individuelles sont ralises selon les instruction tablies lors de l'tape de description de la mthodologie de travail : % minimum, % maximum, etc.
Les pondrations individuelles ont-elles et effectues par tous les acteurs ?
OUI NON
Prsence d'un nouvel acteur Nouveau systme de critres (la seconde possibilit est viter au maximum !)
L'tape d'identification des critres peut tre lude
Liste des critres considrer
NON
Le projet comporte t-il un nombre d'acteurs limit ?
Le dcideur accepte-il de considrer un nombre d'acteurs limit ?
OUI
NON
Pondrations individuelles ralises par chaque dcideur Pour chaque famille Pondration des critres de la famille
Systme de valeurs Subjectivit
Pour toutes les familles Pondration de la famille
NON
Profils d'acteurs reprsentatifs
Cas d'un itration initiale
NON
Toutes les critres de la famille sont pondrs ?
OUI NON
Toutes les familles sont pondres ?
OUI
Tous les critres sont pondrs ?
OUI
Transmission des rsultats individuels au projeteur
Il faut viter de procder plusieurs fois des pondrations individuelles
Ensemble des pondrations individuelles ralises par chaque dcideur
Prparation pour l'utilisation d'une mthode d'aide multicritre la dcision
Etape suivante
Proposer des solutions
Figure 86
Pondration des critres
Processus dlaboration du projet routier
353
Etape prcdente
Dcrire la problmatique
Gnration de variantes
Le projet en est sa premire itration ? OUI
Zones o l'on affecte le moins de contraintes
SOURCES. Dbat initial Objectifs atteindre Contraintes respecter Dlimitation du domaine d'tude
NON
Le dbat se base sur des lments techniques et politiques NON
Les variantes retenues prcdemment sont-elles pertinentes ? NON OUI OUI Cette modification est-elle importante ?
On ne va tout rtudier si les modifcations du contexte sont mineures
OUI
Uniquement un dbat d'ides
Dtermination de couloirs de moindre valeur
OUI Dtermination traditionnelle ? OUI
Le contexte s'est modifi ? NON
Il n'y a pas de nouvelles variantes gnrer : le contexte ne s'est pas modifi et il n'y a pas de propositions de la part des acteurs
NON
NON
Utilisation d'un outil automatis Intgration des SIRS et d'Electre III Systmes multi-agents Propositions techniques
Plans de contraintes Mise en valeur des contraintes Plans de superposition
Intgrer les variantes suivantes : - variante zro (tat de rfrence) - variante de rfrence (bonne ou mauvaise) si on utilise Electre Tri
Inclure les variantes dfinies dans les itrations prcdentes !
Dbat ouvert
Large dbat d'ides Ne pas exclure d'office une variante ! Dterminer les buts de chaque variante
Propositions politiques Propositions verbales formaliser Variantes pr-existantes
Acteurs politiques Public
Liste des variantes gnres
NON Doit-on combiner des variantes ou tablir des sous-variantes ? OUI Faut-il redfinir le domaine d'tude ? NON OUI Rtroaction vers l'tape de dlimitation du domaine d'tude
Volume de travail consquent
Etudes techniques
Toutes les variantes doivent avoir la mme qualit d'tude
Etape traditionnelle des projets routiers Conception de la route dans l'espace 2 principes : - atteindre les objectifs - respecter les contraintes Travail technique du projeteur routier et des spcialistes Dfinition des tracs respectant la technique routire : scurit et confort des usagers Dimensions des ouvrages d'art
OUI
Des nouvelles variantes apparaissent sont dcles ? Rapport technique Dossier de plans
Prparation pour ... Evaluation des performances
Etape suivante
Apprcier les consquences
L'tude des variantes doit tre affine
354
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
Figure 87
Gnration des variantes
9.4.4
Apprcier les consquences
Le projeteur doit examiner et apprcier les effets des diffrentes variantes gnres. Cette phase comporte quatre tapes principales : dtermination des indicateurs valuation des performances utilisation dune mthode daide multicritre la dcision proposition de variantes satisfaisantes
9.4.4.1
Dtermination des indicateurs
Les critres sont dcrits par des indicateurs qui peuvent tre quantitatifs ou qualitatifs. Lintrt dutiliser une mthode dagrgation partielle dans ce processus dlaboration du projet routier est quil nest pas ncessaire, lors de lvaluation des performances, de ramener les valeurs des indicateurs une valeur norme. On peut ainsi conserver toutes les units rencontres ainsi que les diffrents sens de prfrence. Il est clair que si le dcideur et le projeteur dcident dadopter une mthode dagrgation complte pour effectuer le choix dune variante, les principes prsents dans les diffrents diagrammes de flux du chapitre 9.4.4. ne sont pas pertinents. Ltape de dtermination des indicateurs est essentiellement ralise par le groupe dtude. Elle se doit dtre le plus objective possible. Si pour un critre donn, il y a plusieurs indicateurs qui permettent de le qualifier, il sagit de procder alors une pondration technique entre ceux-ci de manire disposer dun nombre identique dindicateurs et de critres. Cette pondration technique permet de raliser ensuite une agrgation complte entre ces diffrents indicateurs et ne fait intervenir que le projeteur. Elle doit cependant tre clairement dfinie dans le rapport technique. Le droulement de cette tape est illustr la page suivante.
9.4.4.2
valuation des performances
Cette tape est une tape purement technique qui est ralise par le projeteur et les spcialistes. Elle consiste procder diffrents examens des effets de linfrastructure routire, ceci pour lensemble des indicateurs dfinis auparavant. Ces examens peuvent tre plus ou moins approfondis. Il faut toutefois viter de multiplier les analyses sur des critres faciles tudier, tout comme les sujets les moins motivants ou les plus complexes ne doivent pas tre ngligs. Il ne doit pas subsister dimportantes diffrences dinvestigation entre les critres. Les diffrentes valuations des performances ralises pour tous les critres et pour lensemble des variantes gnres sont rassembles dans le tableau des performances, qui est le point de dpart de ltape de lutilisation dune mthode daide multicritre la dcision. Le droulement de cette tape est illustr la page 356.
Processus dlaboration du projet routier
355
Etape prcdente
Proposer des solutions
PHASE TECHNIQUE. Projeteur routier Spcialistes Le groupe dcideur n'a pas intervenir ! (sauf pour la dtermination des seuils)
Identifier les indicateurs propres chaque critre
Le projet en est sa premire itration ? NON Des nouveaux critres sont-ils prsents ? OUI
SOURCES. Formulation des objectifs Collecte et analyse des contraintes Dtermination des critres
OUI
NON NON OUI
Le contexte s'est modifi ? OUI
Pour chaque critre
Les indicateurs utiliss NON taient-ils pertinents ?
Proposition de 1 ou Les indicateurs peuvent avoir plusieurs indicateurs des units diffrentes NON 1 seul indicateur suffit qualifier le critre ? OUI Indicateur qualifiant l'tat du critre Caractristiques de l'indicateur NON Des seuils sont-ils ncessaires ? OUI Veut-on considrer un seuil de veto ? OUI Dtermination des seuils suivants : Si : indiffrence Sp : prfrence Sv : veto Tous les critres ont t analyss ? NON Prparation pour ... Evaluation des performances Utilisation d'une mthode d'aide multicritre la dcision OUI NON NON Peut-on procder une agrgation complte directe ?
Units semblables
Transformation des indicateurs en notes
OUI Agrgation complte des notes
Pondration technique Units Maximisation ou minimisation Sources de l'valuation Evt., valeurs de rfrence En cas d'utilisation d'Electre III
Dbat entre le dcideur et le projeteur
Dtermination de : Si : indiffrence Sp : prfrence
Seuls phases o intervient le dcideur !
Listes des indicateurs pour tous les critres
Etape suivante
Evaluation des performances
Figure 88
Dtermination des indicateurs
L'tape de dtermination des indicateurs peut tre lude
356
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
Etape prcdente
Dtermination des indicateurs
SOURCES. Dtermination des indicateurs Gnration de variantes
Quantifer les indicateurs
Le projet en est sa NON premire itration ? OUI OUI
Ou si elles sont modifies, ces changements ont-ils un effet sur les performances ?
Les variantes sontelles identiques ? NON La liste des critres est-elle identique ?
OUI
La liste des critres est-elle identique ? OUI Le contexte est-il identique ? NON
NON
NON
OUI
Analyser uniquement les nouvelles variantes Dtermination des valeurs du tableau des performances Procder une nouvelle analyse complte Analyser uniquement les nouveaux critres
Pour chaque variante
Pour chaque critre Y a t-il plus qu'un indicateur pour le critre considr ? OUI Pour chaque indicateur Examen des effets de l'infrastructure routire pour l'indicateur donn Tous les indicateurs ont t tudis ? OUI Pondration technique Performance du critre pour la variante donne NON Tous les critres ont t tudis ? OUI NON Tous les variantes ont t tudies ? OUI Tableau des performances
Ce tableau sert de base l'application de la mthode d'aide la dcision multicritre
NON
Si ce cas survient, la pertinence de l'itration peut tre discute car le tableau des performances est identique
Examen des effets de l'infrastructure routire pour l'indicateur donn
NON
Etape suivante
Utilisation d'une mthode d'aide la dcision multicritre
Figure 89
valuation des performances
Processus dlaboration du projet routier
357
9.4.4.3
Utilisation dcision
dune
mthode
daide
multicritre
la
Dans cette tape, les rsultats de deux tapes antrieures sont mlangs dans la moulinette de la mthode daide multicritre la dcision choisie. Il sagit des rsultats suivants : les pondrations individuelles des critres ralises lors de la description de la problmatique. Cette tape est essentiellement politique et les rsultats sont subjectifs lvaluation des performances qui est ralise ltape prcdente. Il sagit ici dune tape purement technique dont les rsultats sont objectifs
Cette intgration de notions objectives avec des notions subjectives nest possible quen utilisant une mthode daide multicritre la dcision. Le rsultat de cette tape est une proposition de rangement des variantes dtermine par le biais de lutilisation de la mthode dagrgation partielle Electre III. Le chapitre 8 prsente les caractristiques de cette mthodes daide multicritre la dcision. Cette mthode daide multicritre la dcision est utilise pour lensemble des pondrations individuelles, en regroupant les rsultats obtenus par catgories dacteurs. Une analyse de ces rsultats est ensuite effectue. Lutilisation dun logiciel adquat, comme ELECTRE III-IV du LAMSADE, permet de rapidement raliser ces oprations. Lauteur na pas insist ici sur la ncessit deffectuer des analyses de sensibilit des rsultats. Cette opration o lon peut faire varier les valeurs des indicateurs et des pondrations est en fait une itration supplmentaire du processus dlaboration du projet routier. Dans cette itration de vrification de la stabilit des rsultats obtenus, il sagit de faire varier les pondrations des critres et les valuations des performances puis dobserver les effets sur les rsultats. On peut postuler quun groupe dcideur comportant de nombreux acteurs, donc de nombreuses pondrations individuelles est un gage de vrification de la stabilit des rsultats en fonction des pondrations. Ainsi, seule une analyse des effets provoqus par des changements des diffrentes valuations est raliser. Le droulement de cette tape, qui est entirement ralise par le groupe dtude, est prsent la page suivante.
358
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
Etape prcdente
Evaluation des performances
Intgration de la subejctivit et de l'objectivit comme aide la prise de dcision Choix de la mthode d'aide la dcision adapte
SOURCES. Mthodologie de travail Pondration des critres Evaluation des performances
Veut-on utiliser une mthode NON d'agrgation partielle ? Mthode recommande pour la mthodologie concertative du projet routier OUI Mthode d'agrgation complte Mthode traditionnellement applique dans les tudes multicritres des projets routiers (N'est pas concerne par l'tude)
Electre III
Rangement des variantes
Dmarche complte dcrite au chapitre 8.3.7 Utilisation du logiciel ELECTRE III-IVdvelopp par le LAMSADE Usage simple et ais pour le projeteur Rapide d'utilisation Permet de traiter la plupart des projets routiers
Phase d'dition Etablissement du tableau des critres Liste des critres et pondration : figure 86
Phase de calcul
Analyse des rsultats Distillations Matrice Graphes Distillation descendante Distillation ascendante Concordance Degrs de crdibilit Graphe final Graphique Simos - Maystre
Dfinition des Liste des variantes actions (= variantes) gnres : figure 87 Edition du tableau des performances Dfinition des seuils Indicateurs : figure 88 Performances : figure 89 Dfinition des seuils : figure 88
Rsultats obtenus avec chaque pondration individuelle
n dcideurs = n rsultats Est surtout ralise lors de la dernire itration
Il ne s'agit pas ici de raliser une moyenne des pondrations mais une moyenne des rsultats
Analyse de sensibilit
Stabilit des rsultats Analyse des classes d'acteurs
Est dj ralise en Variation des considrant les pond- pondrations rations individuelles
Variation des valuations
Deux possibilits : 1. vrifier quel est l'effet sur les rsultats d'une variation donne 2. vrifier quelle est la variation qu'il faut avoir pour une modification donne des rsultats
Synthse des rsultats obtenus
Etape suivante
Proposition d'une variante satisfaisante
Figure 90
Utilisation dune mthode daide multicritre la dcision
Processus dlaboration du projet routier
359
9.4.4.4
Proposition de variante satisfaisante
Sur la base des rsultats de ltape prcdente, le projeteur effectue une proposition au dcideur en lui recommandant de choisir la variante qui est ressortie en tte de lanalyse multicritre. Selon les cas, cette proposition peut tre de deux ou trois variantes satisfaisantes qui sont ressorties du lot mais quil est plus difficile de dpartager. Il accompagne cette proposition de diffrentes recommandations servant orienter le choix du dcideur. Le projeteur propose aussi au dcideur la marche suivre : poursuivre ltude avec une nouvelle itration, abandonner car il est impossible datteindre les objectifs fixs ou alors passer au projet dfinitif, les rsultats obtenus tant satisfaisants. Il est important que le projeteur analyse la variante retenue lissue de lutilisation dune mthode daide multicritre la dcision. Il sagit notamment pour lui de vrifier les degrs datteinte des objectifs et de respect des contraintes. Cette vrification est ncessaire avec lutilisation dune mthode dagrgation partielle o les rsultats sont bass sur des comparaisons relatives entre diffrentes variantes et non par rapport un rfrentiel absolu. Ainsi, la meilleure variante peut ne pas tre suffisante.
9.4.5
Prendre une dcision
Sur la base de la proposition de variante effectue par le projeteur et le groupe dtude, trois options soffrent alors au dcideur : Poursuivre le projet Il sagit daffiner les dtails, de procder des modifications mineures, ceci de manire arriver un projet prt tre ralis. On passe ainsi au projet dfinitif qui prpare lEnqute publique Modifier le projet Les modifications ncessaires lacceptabilit de la variante choisie peuvent tre majeures, mais toutefois ralisables. Il sagit alors de raliser une nouvelle itration dans le processus du projet, afin de modifier des tapes de travail antrieures en tenant compte des rsultats obtenus Renoncer au projet Si les impacts de la variante propose sont trop importants, si des contraintes rdhibitoires apparaissent ou si les objectifs sont manifestement impossibles raisonnablement tre atteints, il faut alors renoncer au projet ou le reporter Cette tape est purement subjective. Le projeteur na que le pouvoir de proposer une solution mais seul le dcideur tranche. Il existe alors un risque que le dcideur ne tienne pas du tout compte des propositions du projeteur. Cependant, un dcideur prenant de telles liberts, en court-circuitant ainsi la phase dlaboration du projet routier, sexpose de graves problmes dacceptation du projet. La commission de suivi des dbats est informe des dcisions prises par le dcideur. Elle labore avec un lui un document rcapitulant les principales recommandations mises par le projeteur et les dcisions prises. Ce document rsume les engagements pris par le dcideur lissue de ltude du projet routier, principes quil appliquera lors de la ralisation et de lexploitation de linfrastructure routire. Lors dun suivi
360
UNE METHODOLOGIE ACTUALISEE
rgulier de la route, on peut ainsi comparer les rsultats obtenus avec ce dossier qui est en quelque sorte la mmoire du projet . Ce document prennisant les rflexions de la phase dlaboration du projet routier est un exemple concret dapplication du dveloppement durable.
9.4.6
Conclusion
La mthodologie concertative du projet routier propose dans ce chapitre 9 est trs complte, pour ne pas dire complexe. Ceci peut drouter le projeteur dsirant lappliquer. Nanmoins, lauteur a fait le choix de proposer une mthodologie tendant lexhaustivit dans le but de proposer une solution la majeure partie des projets dinfrastructures routires que lon puisse rencontrer. Au del des diagrammes de flux et des nombreuses tapes de ltude proposs par lauteur, le projeteur se doit surtout de retenir le cheminement intellectuel et les principes qui ont servi les tablir. Selon limportance du projet, le projeteur simplifiera les diagrammes proposs, en se basant toutefois sur le diagramme de base de la Figure 77, page 329. Ainsi, certaines tapes de la mthodologie seront raccourcies ou fusionnes, ceci toutefois dans le respect des principes mis dans le diagramme central de la Figure 81, page 343, qui dcrit le processus dlaboration du projet routier.
361
10.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Llaboration dun projet dinfrastructure routire est une activit qui est de plus en complexe et ardue raliser. Les difficults prouves par le projeteur routier, qui est gnralement un ingnieur civil, dans lexercice de ses activits sont multiples. Elles peuvent consister en un allongement de la dure de ltude, en des rapports conflictuels avec les diffrents acteurs intervenant dans le projet ou en une augmentation des cots de ralisation de linfrastructure routire. Dans cette thse, lauteur a tabli une typologie des problmes rencontrs puis il a procd lidentification des facteurs lorigine de cette problmatique. Ceux-ci peuvent tre de nature endogne au projet, comme la procdure du projet qui est souvent rigoureuse ou les mthodes de travail qui sont inadaptes, ou de nature exogne au projet, comme lapparition de nouveaux paradigmes socitaux, tel le dveloppement durable, la multiplicit des domaines affects et des acteurs concerns par une infrastructure routire ou lvolution des attentes sociales. Mme si le projeteur routier, conscient des problmes engendrs par la mise en uvre de ses ralisations, adapte ses activits en consquence, il apparat ncessaire, laune des analyses de cas menes par lauteur, de procder une modification de la mthodologie de travail utilise. Le cas de base de cette thse est la Comparaison de variantes 1999 traitant de la A 144 dans le Chablais Suisse, entre Villeneuve et les Evouettes. En tant intgr au cur du processus dtude, lauteur a pu tirer de prcieux renseignements alimentant la rflexion mene dans cette thse. Aprs avoir analys de nombreux thmes lis la procdure du projet dune infrastructure routire, aux acteurs intervenants dans celui-ci et aux dveloppements mthodologiques rcents, lauteur relve tout un ensemble dlments facilitateurs des activits du projeteur. Dans un but de synthse, il propose de les intgrer au sein dune mthodologie dlaboration du projet routier qui est actualise et quil qualifie de mthodologie concertative du projet routier. Cette mthodologie est dtermine en fonction de son utilisation par le praticien. Elle traite la problmatique de manire globale, afin dtre applicable pour la majeure partie des projets routiers. Elle consiste plus en un cheminement intellectuel adopter par le projeteur quen une mthode strictement dfinie pour un type de projet donn. La mthodologie concertative du projet routier comporte de nombreuses volutions ou modifications par rapport la pratique actuelle de llaboration des projets dinfrastructures routires en Suisse. Elle postule que le cadre procdural existant nest pas modifier, mme sil nest pas parfait, cette tche relevant plus du lgislateur que de lingnieur civil. Il sagit plutt de se concentrer sur la manire dvoluer au mieux au sein de cette procdure afin datteindre une meilleure efficacit. Lauteur dmontre dans son tude limportance quil faut accorder aux tapes initiales de la procdure, comme lexamen de lopportunit du projet et lidentification des besoins. Ces deux tapes sont indispensables pour aboutir un rsultat durable, de qualit et accept par tous. De plus, une bonne dfinition du
362
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
problme permet de raliser une tude dans un climat de travail serein et productif. Lauteur propose dinstituer une Commission de suivi des dbats qui a pour but de sassurer tout au long de llaboration du projet que le cahier des charges et lesprit du dbat initial soient respects. La participation publique telle quelle est propose par lauteur consiste en une intgration du public au sein de la procdure du projet ds le dbut de ltude et une pratique accrue de la concertation toutes les tapes du processus. La concertation, que lon peut dfinir comme tant une participation du public llaboration dun projet conjointement avec le projeteur et le dcideur, est actuellement peu pratique en Suisse. La transparence quelle ncessite ainsi que leffort de vulgarisation fournir suscitent de nombreuses rticences auprs des administrations, des dcideurs et des projeteurs qui ne voient pas dun il favorable limmixtion du public dans leurs activits. Il est ncessaire dagir continuellement pour modifier cet tat desprit et de dmontrer les avantages de la concertation, qui lemportent sur ses inconvnients. Cest une vritable rvolution copernicienne quil sagit ainsi de raliser afin de pouvoir favoriser pleinement lmergence du phnomne dappropriation du projet par le public. Lauteur sintresse lapplication des mthodes daide multicritre la dcision au sein de llaboration du projet routier en portant son attention sur les mthodes dagrgation partielle qui sont encore peu utilises dans ce domaine particulier. Aprs avoir prsent les caractristiques des principales mthode daide multicritre la dcision, lauteur recommande dutiliser au sein du projet routier la mthode dagrgation partielle Electre III. Cette mthode permet de mieux respecter la complexit du contexte du projet et de la dcision par ladoption de critres flous, de seuils dincomparabilit, de prfrence et de veto ainsi que par la possibilit dvaluer les variantes dune manire libre. Cette proposition est taye par une tude mene sur les rsultats de la Comparaison de variantes 1999 . Celle-ci montre que cette mthode est dun usage ais pour le projeteur routier, notamment grce lutilisation dun logiciel de qualit et dune grande souplesse dutilisation. La comprhension de cette mthode est peut tre plus difficile pour le dcideur, car elle peut ne pas aboutir un rsultat clair, labsence dun optimum tant tout fait possible. Lauteur souligne aussi limportance de la sparation de la phase de pondration et dvaluation des variantes qui concernent deux types dacteurs diffrents. On peut identifier dans le cadre du projet routier deux acteurs principaux, mais pas uniques : un qui est de nature politique, le dcideur, et un qui est dessence technique, le projeteur. Ces deux acteurs doivent tre strictement diffrencis et doivent travailler de manire indpendante lun de lautre. La pondration des critres est effectue de manire subjective par le dcideur, qui se base sur son systme de valeurs. Elle ne doit pas tre tablie avant que le projeteur procde lvaluation des performances des variantes, qui se ralise de manire objective. Lauteur prconise donc de strictement sparer ces deux phases de travail dans la mthodologie concertative du projet routier. Cette thse montre aussi que le projeteur routier, par extension lingnieur civil, se doit dtre plus quun simple technicien muni dun bagage technique et scientifique de qualit. Il doit possder des notions de communication, tre conscient des enjeux politiques et tre un bon vulgarisateur. De plus, il doit accepter les critiques et les remarques sur son travail provenant dacteurs priphriques non-techniques.
363
Cependant, son rle reste primordial dans le projet routier car il est la cheville ouvrire du groupe qui procde aux diffrentes tudes. En analysant les principes de bases du dveloppement durable, lauteur remarque que ceux-ci sont encore trs abstraits. Ils peuvent nanmoins aisment tre transcrits au niveau du projeteur par des principes trs simples, mis en application au sein de la mthodologie concertative du projet routier dveloppe ici. Ainsi, la mise en balance des intrts divergents se ralise par lapplication des mthodes daide multicritre la dcision, la transparence des dcisions et la participation publique est rendue possible par ladoption de la concertation tous les niveaux de ltude et lanalyse du cycle de vie dans lvaluation des variantes est un lment de prise en compte des besoins des gnrations futures. La problmatique des projets dinfrastructures routires est un vaste sujet que lauteur a trait de la manire la plus complte possible, ceci en proposant une solution globale sadaptant la majeur partie des projets dinfrastructures routires. Les dveloppements permanents et prometteurs des moyens technologiques ou scientifiques disposition du projeteur, que cela soit dans le domaine des systmes d'information rfrence spatiale, des mthodes daide multicritre la dcision ou des moyens de communication, ainsi que la modification continue du contexte environnemental, conomique, social ou lgal du projet font que la prsente tude est loin dtre une solution dfinitive. Elle consiste plutt en une rflexion sur la problmatique actuelle des projets dinfrastructures routires, rflexion qui amne proposer des solutions aux praticiens et aux dcideurs, mais rflexion qui doit tre aussi une impulsion llaboration de nouvelles propositions. Suite cette thse, les perspectives peuvent senvisager selon plusieurs directions, savoir la mise en application pratique des principes dfinis dans la mthodologie concertative du projet routier, lapprofondissement des notions dveloppes, la vulgarisation auprs du public concern par cette tude ou limpulsion de nouvelles recherches. Une mise en application court terme des principes dvelopps au sein de la mthodologie concertative du projet routier propose par lauteur plusieurs cas pratiques permettrait dvaluer cette mthode et de ladapter si ncessaire en pratiquant un monitorage approfondi. Cette mise en application peut se faire auprs de projeteurs ou au sein dadministrations publiques routires nationales, rgionales ou locales, qui ont un rle de dcideur. Il peut tre aussi envisag de procder des analyses comparatives dapplication entre les mthodes dagrgation complte et partielle dans le cadre de certains projets routiers. Lapprofondissement de certaines notions dveloppes dans la thse peut senvisager sur plusieurs thmes. Ceci peut tre loccasion dtablir des recherches scientifiques ou doctorales complmentaires prcisant certains aspects relatifs la mthodologie concertative du projet routier. Leffort de vulgarisation auprs des praticiens a toujours t un axe privilgi par lauteur qui veut donner un sens pratique la mthodologie concertative du projet routier. Cet effort est porter dans plusieurs directions, soit auprs des praticiens, soit auprs des tudiants, qui sont les praticiens de demain, soit finalement auprs des dcideurs
364
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Dans ce but, de multiples activits sont envisageables pour faire passer le message ou une partie de celui-ci. Cette transmission des principes dvelopps dans cette tude peut prendre la forme de sminaires, de confrences, de cours de formation continue ou alors consister en la rdaction de directives, de guides ou de manuels pratiques. La ralisation dun Guide de la concertation en Suisse reprenant le principe des fiches descriptives ralises aurait un aspect minemment pratique et serait disposition du projeteur et du dcideur afin de les guider dans le choix de la meilleure mthode appliquer. Il devrait tre ralis en procdant une large consultation des expriences pratiques dj menes en Suisse et ltranger. Afin de promouvoir lutilisation des mthodes daide multicritre la dcision de type agrgation partielle, la ralisation dun manuel pratique dcrivant lusage de ces mthodes comme Electre III au sein du projet routier serait un prcieux atout. Les diffrentes notions dveloppes dans cette thse sont introduire dans les cours relatifs aux infrastructures de transport enseigns au Dpartement de Gnie Civil. Ceci permettra de sensibiliser les futurs praticiens aux subtilits de laide la dcision, aux aspects politiques et sociaux et aux effets pratiques du dveloppement durable sur ltude dun projet dune infrastructure de transport Ainsi, en rsum, les solutions proposes par lauteur sont nombreuses mais ne sauraient tre exhaustives tant le domaine des infrastructures routires est vaste, multiple et complexe. La mthodologie concertative du projet routier propose pour le projeteur et le dcideur ne garantit pas systmatiquement le succs mais elle est un puissant outil de travail permettant de franchir les obstacles de manire efficace et assurant un projet de qualit, durable et accept par tous.
365
11.
(1)
BIBLIOGRAPHIE
24 Heures (1999) - Transchablaisienne A144 - Ras-le-bol des communes. Article paru dans 24 Heures, Lausanne, 27 aot 1999 Abraham C. (1999) - Le Tunnel Prado Carnage, une exprience russie de page en zone urbaine prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 Agenda 21 (1993) - Sommet de la Terre 1992 - Un programme d'action Version pour le grand public de l'Agenda 21 et des autres accords de Rio. Centre pour notre Avenir Tous, Genve, avril 1993 AIPCR (1999). Processus de dcision pour un transport durable - Rapport introductif. Association mondiale de la route, Kuala Lumpur, 1999 AIPCR (2000) - Routes/Roads. Routes/Roads, N305, Paris, Association mondiale de la Route (AIPCR), janvier 2000 Andr P., Delisle C E., et al. (1999) - L'valuation des impacts sur l'Environnement Processus, acteurs et pratique. Presses Internationales Polytechnique, Montral, 1er trimestre 1999 Annales (1999) - Dbat public et projets d'infrastructures. Annales des Ponts et Chausses - Ingnieur, Science et Socit, N92, Paris, Lavoisier, dcembre 1999 Annet D. et Cassina G. (1980) - Chteau de la porte du Scex. Monthey, 1980 ARDA (2000) - Association rgionale pour le dveloppement du district d'Aigle (ARDA). Site internet. ARDA, Aigle, consult en juillet 2000, http://www.chablais.com/arda/ AREA (1999). Une autoroute ne peut s'entretenir par magie ! AREA, Lyon, 1999 ARMS (2000) - Association rgionale Monthey - Saint-Maurice (ARMS). Site internet. ARMS, Monthey, consult en juillet 2000, http://www.chablais.com/arms/ ASTAG (2000) - Association suisse des transports routiers (ASTAG). Site internet. ASTAG, Berne, consult en septembre 2000, www.astag.ch ATEC (1997) - Mobilit dans un environnement durable - Congrs international francophone de Versailles. Presses de l'cole nationale des Ponts et Chausses, Paris, 28 au 30 janvier 1997 Aubort D. (1999) - Port-folio. Site internet. Photographis, Montreux, consult en juillet 2000, http://www.digimage.ch/Portfolio/Aubort/Welcome.html Audtat M.C., Robert F., et al. (1998) - Une application concrte : la conduite de runions. Sminaire l'EPFL, Psynergie, Lausanne, mars 1998 BAR Fribourg (1996) - Pavillon d'information de l'A1. Site internet. Bureau des Autoroutes du Canton de Fribourg, Mussillens (FR), consult en Aot 2000, http://www.barfr.ch/A1/MUSS.HTM
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) (9)
(10) (11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
366
BIBLIOGRAPHIE
(17) (18)
Bassand M. (1998) - Entrevue ralise Lausanne le 20 juillet 1998 Bassand M., Veuve L., et al. (1986) - Politiques des routes nationales - Acteurs et mise en oeuvre. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, 1986 Benninghoff M., Terribilini S., et al. (1997) - Le fdralisme d'excution en matire de politiques publiques incidence spatiale. IDHEAP, Rapport de recherche N1 pour Fonds national suisse de la recherche scientifique suisse, Institut de hautes tudes en administration publique (IDHEAP), Chavannes-prs-Renens, dcembre 1997 Bergougnoux R. (1999) - Le dbat "Port 2000" prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 Bernet C. (2000) - Transparence de l'Etat: le projet fait des vagues. Article paru dans La Tribune de Genve, Genve, 13 septembre 2000 Bernier M. (1999) - Bras de fer la Porte-du-Scex. Article paru dans 24 Heures, Lausanne, 1er septembre 1999 Besnanou R. (1999) - Les volutions des attentes sociales prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 Billard J. (1998) - Abrg d'histoire des routes. Site internet. Laboratoire Central des Ponts et Chausses (LCPC), Paris, consult en juin 2000, http://www.lcpc.fr/LCPC/Service/Images/Hist_routes/Hist_routes_0_sommaire.html Bourdier J.-P. (1999) - Les oppositions la construction d'ouvrages prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 Bovy P.-H. (1995) - Social acceptance of traffic management projects : the role of social agreement prsent Urban traffic management conference. Evora (Portugal), Bridel L. (1998) - Manuel d'amnagement du territoire - Volume 2. Georg Editeur, Genve, 1998 Brodhag (1997) - Comment intgrer les concepts du dveloppement durable dans les politiques de transport ? prsent Les 5mes Rencontres de Clermont-Ferrand - La qualit environnementale des projets routiers : de la politique d'amnagement la ralisation de la route. Semaine des Arts Techniques et Culture de l'Automobile et de la Route (SATCAR), Clermont-Ferrand, 5 et 6 juin 1997 Busslinger L. (2000) - Pour viter tout blocage, Vaud scrute la loupe le trac de sa Transchablaisienne. Article paru dans Le Temps, Genve, 5 juillet 2000 Cabioch F. (1997) - La concertation des acteurs et du public : une exprience de la DDE du Lot prsent Les 5mes Rencontres de Clermont-Ferrand - La qualit environnementale des projets routiers : de la politique d'amnagement la ralisation de la route. Semaine des Arts Techniques et Culture de l'Automobile et de la Route (SATCAR), ClermontFerrand, 5 et 6 juin 1997 Carrasco J., Figueras J.R., et al. (-) - Strategic multicriteria evaluation for the redesigning of freight railway networks. Madrid, Cartier G. (1999) - Le cas du TGV Mditerrane prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
367
(33)
CCFA (2000) - Halte au saccage de notre pays. Site internet. Comit contre la frnsie autoroutire (CCFA), Esvres-sur-Indre, consult en juin 2000, http://assoc.wanadoo.fr/c.c.f.a/index.htm CEMAT (1988) - L'utilisation judicieuse du sol. Rapport ralis par la dlgation suisse pour CEMAT la 8me Confrence europenne des ministres responsables de l'Amnagement du Territoire, Lausanne, Berne, octobre 1988 CETE de Lyon (1993) - Les images satellitales dans les tudes d'environnement - Le cas du projet autoroutier Ambrieu - Grenoble. Vido, Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) et CETE de Lyon, Lyon, mars 1993 CGCN (1997) - Construction des routes nationales. Rapport ralis par Commission de gestion du Conseil National pour Berne, 14 mai 1997 Chanard P. (1997) - La charte de la concertation prsent Les 5mes Rencontres de Clermont-Ferrand - La qualit environnementale des projets routiers : de la politique d'amnagement la ralisation de la route. Semaine des Arts Techniques et Culture de l'Automobile et de la Route (SATCAR), Clermont-Ferrand, 5 et 6 juin 1997 CI-Rio (1997) - Le dveloppement durable en Suisse - Etat des ralisations. Comit interdpartemental de Rio (CI-Rio), Berne, 1997 CLD (2000) - Chablais Lman Dveloppement (CLD). Site internet. CLD, Thonon-les-bains (France), consult en juillet 2000, http://www.sudleman.com/ Comit C4 (1998) - Mthodes pour obtenir la participation du public l'laboration des projets routiers. Groupe de travail C 4.5 du Comit C4 (Routes, Transport et Amnagement du rgional) de l'AIPCR, Rapport de recherche pour Association mondiale de la route (AIPCR), 15 dcembre 1998 Comit C10 (1999) - Environnement et participation du public. Comit C10 (Ville) de l'AIPCR, Rapport de recherche pour Association mondiale de la route (AIPCR), 1999 Conseil Fdral (1997) - Le dveloppement durable en Suisse - Stratgie. Service de documentation, OFEFP - Office de l'environnement, des forts et du paysage, Berne, 1997 Conseil Fdral (2000). Le Programme de la lgislature 19992003 Conseil Fdral, Berne, mai 2000 Constitution VD (1885) - Constitution du Canton de Vaud. R 1885, 1er mars 1885 (tat le 1er janvier 2000), entre en vigueur le 27 mars 1885 Convention Ramsar (1971) - Convention relative aux zones humides dimportance internationale particulirement comme habitats des oiseaux deau (Convention Ramsar). RS 0.451.45, 2 fvrier 1971 (tat le entre en vigueur le 16 mai 1976 Delacrtaz Y. (1998) - Mobilit urbaine et politiques de dplacements - Le cas de trois agglomrations suisses : Berne, Genve et Lausanne. Thse de doctorat. Dpartement de Gnie Civil, Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL), Lausanne, mars 1998 Delaygue M. (1997) - Les dbats "Bianco" : exemple de la nouvelle liaison autoroutire Lyon - Saint-tienne (A45) prsent Les 5mes Rencontres de Clermont-Ferrand - La qualit environnementale des projets routiers : de la politique d'amnagement la ralisation de la route. Semaine des Arts Techniques et Culture de l'Automobile et de la Route (SATCAR), Clermont-Ferrand, 5 et 6 juin 1997
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
368
BIBLIOGRAPHIE
(48)
DETEC (1999) - Une nouvelle commission de recours du DETEC permet de simplifier davantage les procdures d'octroi des concessions et d'approbation des plans. Communiqu de presse, Dpartement fdral de lEnvironnement, des Transports, de lEnergie et de la Communication (DETEC), Berne, 1er juillet 1999 DETEC (2000). Stratgie du DETEC. DETEC, Berne, 6 janvier 2000 DFTCE (1980) - CGST - Conception globale suisse des transports - Rsum du rapport final. DFTCE - Dpartement fdral des transports, des communications et de l'nergie, Berne, dcembre 1980 DINF (1998) - Route A 144 Villeneuve Le Bouveret - Vaudois et Valaisans lancent une analyse "multicritres" pour trouver une solution de consensus. Communiqu de presse, Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud (BIC) - Dpartement des Infrastructures (DINF), Lausanne, 3 dcembre 1998 DINF (1999a) - Transports 2015 - Politique cantonale Projet mis en consultation par le Dpartement des Infrastructures. DINF - Dpartement des Infrastructures, Lausanne, Janvier 1999 DINF (1999b) - Route A 144 Villeneuve - Les Evouettes - Quatre variantes sous la loupe de l'analyse multicritres. Communiqu de presse, Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud (BIC) - Dpartement des Infrastructures (DINF), Lausanne, 30 mars 1999 DINF (1999c) - Route A 144 Villeneuve - Les Evouettes - Quatre variantes optimiser. Communiqu de presse, Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud (BIC) - Dpartement des Infrastructures (DINF), Lausanne, 2 juillet 1999 DINF (1999d) - Route A 144 Villeneuve - Les Evouettes - Le comit de pilotage est arriv au terme de ses travaux. Communiqu de presse, Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud (BIC) - Dpartement des Infrastructures (DINF), Lausanne, 30 septembre 1999 DINF (2000a) - Expos des motifs et projet de dcret accordant un crdit d'tude complmentaire de la route H 144 Villeneuve -Bouveret, section Rennaz - Les Evouettes. Projet de dcret, Dpartement des Infrastructures (DINF), Lausanne, 3 juillet 2000 DINF (2000b) - Rponse l'interpellation de Luc Recordon concernant la Transchablaisienne - Interpellation devant le Grand Conseil en date du 20 mai 1997. Rponse une interpellation, Dpartement des Infrastructures (DINF), Lausanne, 3 juillet 2000 DINF (2000c) - 1,1 million pour mener terme les tudes du projet dfinitif de la route Villeneuve - Les Evouettes. Communiqu de presse, Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud (BIC) - Dpartement des Infrastructures (DINF), Lausanne, 4 juillet 2000 Dron D. et M. Cohen de Lara (1996) - Pour une politique soutenable des transports. Rapport de recherche pour la Cellule de prospective et de stratgie, Ministre de l'Environnement, Paris, 12 novembre 1996 DTEE (2000) - Confrence de presse " Autoroute A9 - Route cantonale T9 - Ligne du Simplon. Dpartement des transports, de l'quipement et de l'environnement du canton du Valais (DTEE), Sion, 3 juillet 2000 Inauguration d'un pavillon d'information ". Communiqu de presse, Dpartement des transports, de l'quipement et de l'environnement du canton du Valais (DTEE), Sion, 3 juillet 2000
(49) (50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
369
(62)
Dumont A.-G. et Tille M. (1997) - Voies de Circulation 1 - Conception et ralisation du projet. Support du cours enseign l'Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL), Dpartement de Gnie Civil, Lausanne, octobre 1997 Dumont A.-G., Tille M., et al. (2000) - Gestion de la maintenance des infrastructures de transport. Support du cours enseign l'Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL), Dpartement de Gnie Civil, Lausanne, juin 2000 Ecoscan (1999) - Directives pour la surveillance et le suivi environnemental des projets soumis EIE en Suisse - Aide la dfinition et l'application des mesures de protection de l'environnement. Ecoscan SA, Rapport de recherche pour l'Office Fdral de l'Environnement, des Forts et du Paysage (OFEFP) - Groupe EIE de Suisse occidentale et du Tessin (GREISOT), Ecoscan, Lausanne, 30 mars 1999 Egger M., Roth G., et al. (1998) - Bruit - Caractre conomiquement supportable et proportionnalit des mesures de protection contre le bruit Cahier de l'environnement N301. Office Fdral de l'Environnement, des forts et du paysage (OFEFP), Berne, 1998 Elbaz-Benchetrit V. (1997) - Autoroutes : impacts sur l'conomie et l'environnement. Presses de l'cole nationale des Ponts et Chausses, Paris, 1997 ENPC (1999) - Dbat de clture - Confrence "Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure", Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 Erkman S. (1998) - Vers une cologie industrielle. Editions Charles Lopold Meyer, Lausanne et Paris, 1998 Esrifrance (2000) - Site officiel de Esrifrance. Site internet. Esrifrance, Paris, consult en septembre 2000, www.esrifrance.fr Etat de Vaud (2000) - Site officiel de l'Etat de Vaud. Site internet. Etat de Vaud, Lausanne, consult en juillet 2000, www.vd.ch Faucon M. (1997) - Dveloppement durable. Lyon, 1997 Ferrand N. et G. Deffuant (1998) - Trois apports potentiels des approches "multi-agents" pour l'aide la dcision publique prsent Gestion de territoires ruraux - Connaissances et mthodes pour l'aide la dcision publique Anthony (France). Cemagref, LISC, avril 1998 Fourniau J.-M. (1999) - Processus, acteurs et circuits de dcision prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 Galland J.-P. (1999) - Editorial tir de Dbat public et projets d'infrastructures. Annales des Ponts et Chausses - Ingnieur, Science et Socit, N92, Paris, Lavoisier, dcembre 1999 Gerondeau C. (1996) - Les transports en Europe. EDS Editeur, Paris, 1996 Girard N. et Knoepfel P. (1997) - Cleuson-Dixence : Tout est bien qui finit bien ? Etude de cas de l'IDHEAP (8/1996). Institut de hautes tudes en administration publique (IDHEAP), Chavannes-prs-Renens, avril 1997 Goumaz C. (2000) - Chablais: route H144 Villeneuve - Les Evouettes - Les dfenseurs de l'environnement refusent de se faire rouler. Article paru dans 24 Heures, Lausanne, 5 aot 2000
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71) (72)
(73)
(74)
(75) (76)
(77)
370
BIBLIOGRAPHIE
(78)
Hamon D. (1999) - Gestion des Aroports de Paris prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 Hayoz N. et Urio P. (1993) - Routes nationales et Opposition - Aspects de la construction problmatique du rseau des routes nationales. Universit de Genve, Dpartement de Science Politique, Rapport de recherche N51/87 pour l'Union Suisse des professionnels de la route (VSS), Dpartement Fdral des transports, des communications et de l'nergie, Genve, dcembre 1993 Hertig J.-A., Fallot J.-M., et al. (1999) - Etudes d'impact sur l'environnement Volume 23 du Trait de Gnie Civil de l'Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), Lausanne, 1999 Hiler D. et Frei A. (1993) - Elle pourtant elle contourne - Le rseau autoroutier genevois l'preuve de la dmocratie. Dpartement des Travaux publics du canton de Genve, Genve, 1993 Huyghe F.-B. (1997) - Le mdium ambigu tir de Qu'est-ce qu'une route ? Les Cahiers de mdiologie, N2, Paris, Gallimard, 1997 IDHEAP (2000) - BADAC - Banque de donnes sur les administrations cantonales et communales suisses. Site internet. IDHEAP - Institut des hautes tudes en administration publique, Chavannes-prs-Renens, consult en Aot 2000, http://www.badac.ch/accueil.html Infraconsult (1979) - tronon Cheyres - Estavayer-le-Lac Route nationale N1, Bases cologiques pour une recherche de variantes. Rapport ralis par Infraconsult pour le Bureau des Autoroutes du Canton de Fribourg, Berne, septembre 1979 Infraconsult (1999) - Pont de la Poya - Dossier d'tude de variante. Site internet. Infraconsult SA, Berne, consult en juillet 2000, http://www.pontpoya.ch/archives/totale.htm Infraconsult (2000) - Routes principales suisses A 144 Villeneuve - les Evouettes Comparaison de variantes 1999, Rapport technique du Comit de Pilotage. Rapport ralis par Infraconsult SA pour le Service des routes et autoroutes (Canton de Vaud) et le Service des routes et des cours d'eau (Canton du Valais), Berne, 25 fvrier 2000 Jarlier P. (1997) - Saint-Flour - Cit mdivale : porte sud de l'Auvergne sur la A 75 prsent Les 5mes Rencontres de Clermont-Ferrand - La qualit environnementale des projets routiers : de la politique d'amnagement la ralisation de la route. Semaine des Arts Techniques et Culture de l'Automobile et de la Route (SATCAR), ClermontFerrand, 5 et 6 juin 1997 Joerin F. (1995) - Mthode multicritre d'aide la dcision et SIG pour la recherche d'un site tir de Volume 5. Revue internationale de gomatique, N5, Lausanne, Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne, 1995 Joerin F. (1998) - Dcider sur le territoire : Proposition d'une approche par utilisation de SIG et de mthodes d'analyse multicritre. Thse de doctorat N1755. Dpartement de Gnie Rural, Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne, Lausanne, 1998 Klimpt J.-E. (1999) - Projet de lignes haute tension au Qubec prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
371
(91)
Knoepfel P. (1993) - Approaches to an effective framework for environmental management tir de Politiques de l'environnement - Introduction. Institut de hautes tudes en administration publique (IDHEAP), Chavannes-prs-Renens, septembre 1997 Knoepfel P. (1997a) - Les politiques de l'environnement et la durabilit : du contrle des missions vers la gestion des ressources. Support du cours enseign Institut de hautes tudes en administration publique (IDHEAP), Cours postgrade, Chavannesprs-Renens, septembre 1997 Knoepfel P. (1997b) - Politiques de l'environnement - Introduction - Volume 1. Support du cours enseign Institut de hautes tudes en administration publique (IDHEAP), Politiques de l'environnement, Chavannes-prs-Renens, septembre 1997 Knoepfel P. (1997c) - Politiques de l'environnement - Les instruments - Volume 2. Support du cours enseign Institut de hautes tudes en administration publique (IDHEAP), Politiques de l'environnement, Chavannes-prs-Renens, septembre 1997 Knoepfel P. (1997d) - Politiques de l'environnement - La mise en oeuvre - Volume 3. Support du cours enseign Institut de hautes tudes en administration publique (IDHEAP), Politiques de l'environnement, Chavannes-prs-Renens, septembre 1997 Knoepfel P. (1997e) - Politiques de l'environnement - Transformations institutionnelles Volume 4. Support du cours enseign Institut de hautes tudes en administration publique (IDHEAP), Politiques de l'environnement, Chavannes-prs-Renens, septembre 1997 LAgg (1995) - Loi fribourgeoise sur les agglomrations. RF 140.2, 19 septembre 1995 (tat le 1er janvier 1997), entre en vigueur le 1er janvier 1997 LAMSADE (1994) - ELECTRE III-IV - Version 3.1b, version 3.1 b. Logiciel, LAMSADE Universit Paris Dauphine, Paris LAMSADE (1998a) - Instruments d'aide la dcision et dynamique des organisations. Site internet. LAMSADE, Paris, consult en juillet 1998, www.lamsade.dauphine.fr/negociations/welcome.htm LAMSADE (1998b) - ELECTRE TRI version 2.0. Logiciel, LAMSADE - Universit Paris Dauphine, Paris Lannoy H. (1997) - Raison d'Etat au pays du nougat - Le TGV Mditerrane en question. Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE), Lyon, mars 1997 LAT (1979) - Loi fdrale sur l'amnagement du territoire. RS 700, 22 juin 1979 (tat le 22 aot 2000), entre en vigueur le 1er avril 1980 Le Pors A. (1999) - Les volutions de la rglementation de oprations d'amnagement prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 LF (1999) - Loi fdrale sur la coordination et la simplification des procdures de dcision. RO 1999 3071, 18 juin 1999 (tat le 18 juin 1999), entre en vigueur le 1er janvier 2000 LMP (1994) - Loi fdrale sur les marchs publics. RS 172.056.1, 16 dcembre 1994 (tat le 28 dcembre 1999), entre en vigueur le 1er janvier 1996 LPE (1983) - Loi sur la protection de l'environnement. RS 814.01, 7 octobre 1983 (tat le 21 dcembre 1999), entre en vigueur le 1er janvier 1985
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
372
BIBLIOGRAPHIE
(107)
LPN (1966) - Loi fdrale sur la protection de la nature et du paysage. RS 451, 1er juillet 1966 (tat le 21 dcembre 1999), entre en vigueur le 1er janvier 1967 LRN (1960) - Loi fdrale sur les routes nationales. RS 725.11, 8 mars 1960 (tat le 21 dcembre 1999), entre en vigueur le 21 juin 1960 Malczewski J. (1999) - GIS and Multicriteria decision analysis. John Wiley & Sons, NewYork, 1999 Marschal B. (2000) - Mthode d'aide la dcision. Site internet. Universit libre de Bruxelles, Nivelles (Belgique), consult en juillet 2000, www.ulb.ac.be/students/ceish/tuyaux/mad.html Maystre L. Y. et Bollinger D. (1999) - Aide la ngociation multicritre : Pratique et conseils - Collection Grer l'Environnement. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), Lausanne, 1999 Maystre L. Y., Pictet J., et al. (1994) - Mthodes multicritres ELECTRE - Description, conseils pratiques et cas d'application la gestion environnementale. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), Lausanne, 1994 Microsoft (1998) - Autoroute Express. Cdrom, Microsoft Corporation, 1998 Miville D. S. (1997) - Tout le monde rclame des autoroutes, mais personne ne veut les voir ni les entendre. Article paru dans Le Nouveau Quotidien, Lausanne, 20 mai 1997 Ministre de l'Equipement (2000) - Site officiel du Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement - Les tapes des projets routiers. Site internet. Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, Paris, consult en aot 2000, http://www.route.equipement.gouv.fr/RoutesEnFrance/etapes/SOM2.HTM Molines N. (1997) - Systmes d'information Gographique et Mthodes d'analyse multicritre. - Perspectives d'utilisation pour la conception d'infrastructures linaires, Rapport de recherche pour le CETE de Lyon, Lyon, Aot 1997 Molines N. (en prparation) - Optimisation du processus d'valuation environnementale des grandes infrastructures linaires - Intgration de l'analyse multicritre dans les systmes d'information gographique. Thse de doctorat en cours. CRENAM (Centre de recherche sur l'Environnement et l'Amnagement), Universit Jean Monnet, SaintEtienne, en prparation Mousseau V. (1993) - Problmes lis l'valuation des critres en aide multicritre la dcision - Rflexions thoriques, exprimentations et implmentations informatiques. Thse de doctorat. LAMSADE - Laboratoire d'Analyse et de Modlisation de Systmes pour l'Aide la Dcision, Paris, Universit de Paris Dauphine Nahon C. (1999) - Le dbat public "Boutre-Carros" prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 Narath S., Rosenkranz D., et al. (1998) - Les rgimes de chasse en Suisse, outils de gestion de la faune et de protection de la biodiversit Travail de semestre ralis au sein du cours "Les politiques de l'environnement et la durabilit : du contrle des missions vers la gestion des ressources", Institut de hautes tudes en administration publique (IDHEAP), Chavannes-prs-Renens, fvrier 1998 Nouvelliste (1997) - L'autoroute sud-lmanique tue dans l'oeuf. Article paru dans Le Nouvelliste, Sion, 29 mars 1997
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113) (114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
373
(122)
ODO (1990) - Ordonnance relative la dsignation des organisations habilites recourir dans les domaines de la protection de lenvironnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage. RS 814.076, 27 juin 1990 (tat le 30 juin 1998), entre en vigueur le 1er aot 1990 ODT (2000a) - Office fdral du dveloppement territorial. Site internet. ODT, Berne, consult en septembre 2000, http://www.developpement-territorial.admin.ch/ ODT (2000b). Le cot des infrastructures augmente avec la dispersion des constructions Office fdral du dveloppement territorial, Berne, 8 septembre 2000 OFAT (1998a) - Le problme du trafic de loisirs Suggestions pour l amnagement du territoire. Observation du territoire, Berne, OFAT - Office fdral de l'amnagement du territoire, 30 juillet 1998 OFAT (1998b) - Vade-mecum - Amnagement du territoire suisse. OFAT - Office fdral de l'amnagement du territoire, Berne, janvier 1998 OFEFP (2000) - Droit de recours des organisations de protection de l'environnement - Un instrument efficace pour la mise en oeuvre des lois environnementales. Communiqu de presse, Office Fdral de l'Environnement, des Forts et du Paysage (OFEFP), Berne, 3 mars 2000 OFR (1996) - Examen des normes et des standards dans le domaine des routes nationales. Rapport de recherche pour la Commission de gestion du Conseil National, Office fdral des routes, Berne, 6 mars 1996 OFS (2000) - Office fdral de la statistique. Site internet. OFS - Office fdral de la statistique, Neuchtel, consult en septembre 2000, http://www.statistik.admin.ch/findex.htm OFS et OFEFP (1997) - L'environnement en Suisse 1997 - Chiffres, faits, perspectives. OFS (Office fdral de la statistique) et OFEFP (Office fdral de l'environnement, des forts et du paysage), Berne, 1997 OFT (1998) - Pixelkarte 1 : 25'000 - CD N2. Cdrom, Office Fdral de la Topographie (OFT), Wabern, 30 octobre 1998 OFT (1999) - Swiss Map 100 - Version 2.0. Cdrom, Office Fdral de la Topographie (OFT), Wabern, 1999 OFT (2000) - Office fdral des transports. Site internet. OFT - Office fdral des transports, Berne, consult en septembre 2000, http://www.bav.admin.ch/index_f.cfm OPB (1986) - Ordonnance sur la protection contre le bruit. RS 814.41, 15 dcembre 1986 (tat le 6 juin 2000), entre en vigueur le 1er avril 1987 ORN (1995) - Ordonnance sur les routes nationales. RS 725.111, 18 dcembre 1995 (tat le 28 mars 2000), entre en vigueur le 1er janvier 1996 OROEM (1991) - Ordonnance sur les rserves doiseaux deau et de migrateurs dimportance internationale et nationale. RS 922.32, 21 janvier 1991 (tat le 28 mars 2000), entre en vigueur le 1er fvrier 1991 Orus J.-P. (1997) - Impacts conomiques des grandes infrastructures autoroutires tir de Routes - Roads. Revue de l'AIPCR, N293, Paris, Association mondiale de la route (AIPCR), janvier 1997
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
374
BIBLIOGRAPHIE
(138)
Ouzilou O. (1994) - Aide la dcision pour la planification nergtique qu'un quartier - Cas Martinet - Morche ville de Nyon. Projet de matrise ralis au sein du Cycle d'tudes postgrades en nergie, Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne, Lausanne, 1994 Paulik L. et Papillon J.-P. (1999) - Les grands projets autoroutiers prsent Amnager pour demain : de l'utilit l'acceptabilit d'une infrastructure, Journe d'tude ENPC. Ecole Nationale des Ponts et chausses (ENPC), Paris, 16 mars 1999 Pesch R. (1997) - Le plan objectif environnement prsent Les 5mes Rencontres de Clermont-Ferrand - La qualit environnementale des projets routiers : de la politique d'amnagement la ralisation de la route. Semaine des Arts Techniques et Culture de l'Automobile et de la Route (SATCAR), Clermont-Ferrand, 5 et 6 juin 1997 Peyronnet J.-P. et Pinoteau B. (1997) - L'information au niveau des projets : les centres d'information des autoroutes Paris-Rhin-Rhne prsent Les 5mes Rencontres de Clermont-Ferrand - La qualit environnementale des projets routiers : de la politique d'amnagement la ralisation de la route. Semaine des Arts Techniques et Culture de l'Automobile et de la Route (SATCAR), Clermont-Ferrand, 5 et 6 juin 1997 Pictet J. (1996) - Dpasser l'valuation environnementale - Procdures d'tude et insertion dans la dcision globale. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), Lausanne, 1996 Pictet J. et Bollinger D. (1999) - Aide multicritre la dcision - Aspects mathmatiques du droit suisse sur les marchs publics tir de Droit de la construction. Droit de la construction, Fribourg, Universit de Fribourg, 16 dcembre 1999 Pigois M. (1987) - Comparaison de variantes. Laboratoire des voies de circulation (LAVOC), Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL), Rapport de recherche N24/79 pour Dpartement Fdral des transports, des communications et de l'nergie, Lausanne, septembre 1987 Quinet E. (2000) - Effets externes du transport prsent Sminaires du 3e Cycle Romand en Gestion d'Entreprise - Mthodes et instruments d'aide la dcision et la gestion dans le domaine des transports. DGC-ITEP-LEM, Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL), EPFL, 21 mars 2000 Rausis O. (1999) - A 144 : Vaud bloque le trac choisi ! - Un syndic parle de scandale et accuse le conseiller d'Etat Biler. Article paru dans Le Nouvelliste, Sion, 27 aot 1999 Roy B. (1985) - Mthodologie Multicritre d'Aide la Dcision Collection Gestion, Srie "Production et techniques quantitatives appliques la gestion". Economica, Paris, 1985 Roy B. et Bouyssou D. (1993) - Aide Multicritre la Dcision : Mthodes et cas Collection Gestion, Srie "Production et techniques quantitatives appliques la gestion". Economica, Paris, 1993 SAT-VD (1998) - Les nouveaux instruments d'amnagement du territoire - Sminaire. SATService de l'amnagement du territoire du canton de Vaud, Lausanne, 24 novembre et 9 dcembre 1998 Schrlig A. (1985) - Dcider sur plusieurs critres : Panorama de l'aide la dcision multicritre - Collection Diriger l'entreprise, Volume 1. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), Lausanne, 1985 Schrlig A. (1995) - The case of the vanishing optimum. Lausanne, 6 mars 1995
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
375
(152)
Schrlig A. (1996) - Pratiquer Electre et Promthe - Collection Diriger l'entreprise, Volume 11. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), Lausanne, 1996 Schrlig A. (1998a) - La complexit en gestion : loge de l'aide multicritre prsent Colloque ARAE - Complexit, intelligence et dcision. Universit jean-Moulin Lyon 3, Lyon, 1998 Schrlig A. (1998b) - Entrevue ralise Bernex le 11 juillet 1998 SET (2000) - Service d'tude des transports. Site internet. SET - Service d'tude des transports, Berne, consult en septembre 2000, http://www.admin.ch/gvf/index_f.html Simos J. (1990) - Evaluer l'impact sur l'environnement - Une approche originale par l'analyse multicritre et la ngociation. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), Lausanne, 1990 Swissair (1995) - Aerials views of Switzerland - Volume 2. Cdrom, Multimdia Application Center AG, Zrich, 1995 Thriault M. (1996) - Systmes d'information gographique - Concepts fondamentaux. Support du cours enseign Universit Laval, Dpartement de gographie, SainteFoy (Qubec), Janvier 1996 Tille M. (1999a) - La mthodologie concertative du projet routier prsent Confrence Faune et Trafics - Voies de circulation et rseaux de la faune : ncessit d'une nouvelle approche. Laboratoire des Voies de Circulation (LAVOC), Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL), 18 au 20 octobre 1999 Tille M. (1999b) - Relevs des sances du COPIL et du GT pour l'tude comparative de la A 144. Notes manuscrites, M. Tille, Lausanne, 1999 Tille M. (2000) - Cours de "Transport et route". Support du cours enseign Ecole d'Ingnieurs et d'Architecte de Fribourg, Dpartement de Gnie Civil, Lausanne, juin 2000 Tille M. et Dumont A.-G. (2000) - Esthtique des ouvrages, Intervention sur le thme " Voies de circulation ". Support du cours enseign l'Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL), Dpartement de Gnie Civil, Lausanne, 15 mai 2000 Tschannen O. et Lambelet C. (1998) - Environnement, Science et Communication. Editions Seismo, Sciences sociales et problmes de socit, Zrich, 1998 Tzieropoulos P. (1995) - Introduction la demande de transport - Systmes de transport 1. Support du cours enseign l'Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL), Dpartement de Gnie Civil, Lausanne, janvier 1995 Urman V. (1998) - La A 86 taille sa route en terrain min. Article paru dans Le Parisien, Paris, 20 juillet 1998 Venables W.N. et Ripley B.D. (1997) - Modern Applied Statistics with S-PLUS, Second Edition. Springer-Verlag, New-York, 1997 Veuve L. (1994) - Urbanisme et gnie-civil. Support du cours enseign Ecole Polytechnique de Lausanne, Dpartement de gnie-civil, Lausanne, Semestre d'hiver 1994-1995 Vincke P. (1989) - L'aide multicritre la dcision. Editions de l'Universit de Bruxelles, Bruxelles, 1989
(153)
(154) (155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
(167)
(168)
376
BIBLIOGRAPHIE
(169)
Norme SN 640 026 (1998) - Elaboration des projets - Etapes de projet. VSS - Union Suisse des professionnels de la route, Zrich, avril 1998 Norme SN 640 027 (1998) - Elaboration des projets - Etude de planification. VSS - Union Suisse des professionnels de la route, Zrich, avril 1998 Norme SN 640 028 (en prparation) - Elaboration des projets - Avant-projet. VSS - Union Suisse des professionnels de la route, Zrich, en prparation Norme SN 640 029 (en prparation) - Elaboration des projets - Projet dfinitif. VSS Union Suisse des professionnels de la route, Zrich, en prparation Norme SN 640 030 (en prparation) - Elaboration des projets - Excution. VSS - Union Suisse des professionnels de la route, Zrich, en prparation Norme SN 640 040b (1992) - Projets, bases - Types de route. VSS - Union Suisse des professionnels de la route, Zrich, avril 1992 Wichser F. (1997) - Tout le monde couche sur ses positions ! Article paru dans La Presse Riviera/Chablais, Villeneuve, 9 avril 1997 Wichser F. (1998) - A la recherche de la variante " Consensus ". Article paru dans La Presse Riviera/Chablais, Villeneuve, 4 dcembre 1998 Wichser F. (1999a) - A144 : la variante des communes est la meilleure mais Lausanne tergiverse - Roche appelle une mobilisation de la rgion. Article paru dans La Presse Riviera/Chablais, Villeneuve, 26 aot 1999 Wichser F. (1999b) - Analyse multicritres de la A144 Villeneuve - Les Evouettes : Ph, Biler "Optimiser n'est pas opposer". Article paru dans La Presse Riviera/Chablais, Villeneuve, 28 aot 1999 Wichser F. (1999c) - Route transchablaisienne Villeneuve - les Evouettes - La voie du consensus pour l'A144. Article paru dans La Presse Riviera/Chablais, Villeneuve, 1er octobre 1999 Wieser P. (1993) - LINAM - Logiciel Interactif d'Analyse Multicritre, version 1.2. Logiciel, DGC/ITEP-LEM, Ecole polytechnique Fdrale de Lausanne, Lausanne
(170)
(171)
(172)
(173)
(174)
(175)
(176)
(177)
(178)
(179)
(180)
377
12.
ANNEXES
N1
Manifestation populaire
A loccasion dune tape particulire du chantier de ralisation de linfrastructure routire (percement dun tunnel, inauguration de linfrastructure routire, etc.), une fte populaire est organise par le matre duvre. Cette fte a lieu gnralement en utilisant linfrastructure routire de manire inhabituelle. On peut organiser des activits sportives sur linfrastructure routire (course pied, ballade cyclotouriste), des dmonstrations, des bals, etc.
Fiche descriptive
Titre(s) Description
Objectifs et rsultats attendus
Dcouverte de la route sous un angle diffrent : image de marque La population prend possession de louvrage Eventuellement, information du public Oprations portes ouvertes Concours
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes Support de communication Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter
Activits festives qui peuvent tre varies Durant les travaux Avant linauguration Gratuit des activits Priorit la dtente et au confort des visiteurs Animations adapte tous les types de visiteurs
Public-cible Engagement du public Rle du dcideur Activits du projeteur Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E. Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur Avantages Inconvnients
Riverains et futurs utilisateurs Participation libre Doit tre prsent pour renforcer le lien autorits - population Prparation des panneaux dinformation Organisateur dvnements Animateurs musicaux et festifs Permet de montrer la route sous un visage agrable Il sagit dune opration de relation publique, voir de charme, qui na pour seul but que damliorer limage de la route et na aucune influence sur le projet Peut servir de support des manifestations dopposants Na aucune influence sur le projet Course pied lors de linauguration du contournement autoroutier de Genve
Risques et limites
Remarques diverses Exemples Sources
378
ANNEXES
Fiche descriptive
Titre(s) Description
N2
Support publicitaire
Il sagit de prsenter le projet sur des supports publicitaires disposs sur des objets dusage courant : stylos, crayons, sets de table, sachets de sucre, crme caf, etc. Amliorer limage de marque du projet Donner au projet une image courante quotidiennement ancre dans lesprit de la population Varier la prsentation pour prsenter diffrents aspects du projet Concours Manifestation populaire Petits objets divers dusage courant A la fin des tudes et durant lexcution des travaux tre court et identifiable immdiatement Message attrayant Confrence de presse initiale pour annoncer le lancement de la campagne publicitaire
Objectifs et rsultats attendus
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes Support de communication Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter
Public-cible Engagement du public Rle du dcideur Activits du projeteur Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E.
Population en gnral Approuve la campagne publicitaire Publicitaire Graphiste Distributeur dobjets publicitaires Publicitaire Vendeur de lobjet Permet de toucher un large public Messages rpts quotidiennement Messages brefs et percutants
Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur Avantages
Inconvnients Risques et limites
Surtout utiliser pour limage de marque car en raison de la brivet des messages, il y a peu dinformations Raccourci dans la dlivrance du message Usure et lassitude du public en cas de prsence trop marque dans lespace et le temps Peut sembler tre de la propagande
Remarques diverses Exemples Sources
379
Fiche descriptive
Titre(s) Description Objectifs et rsultats attendus
N6
Communiqu de presse
Rdaction dun communiqu envoy ensuite aux agences de presses et aux rdactions des journaux, radios ou tlvisions Informer le public de lavancement du projet Confrence de presse Djeuner de presse Journaux (quotidiens ou hebdomadaires), radios, tlvisions et sites Internet Tout au long du cycle de vie, quand une tape de celui-ci est franchie (frquence irrgulire) ou une frquence dfinie (tous les mois par exemple) Porter une grande attention la vulgarisation car le communiqu de presse est destin au grand public nophyte dans le domaine du projet routier Mise en avant de lavancement du projet : il faut un lment novateur, sinon ne pas communiquer Etre court et concis, sous peine de voir les arguments tronqus avant la publication ou le public ne pas lire larticle Pochette de presse
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes Support de communication Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter
Public-cible Engagement du public Rle du dcideur Activits du projeteur Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E. Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur Avantages
Large public : zone dtude et au-del Passif Signer le communiqu Synthtiser les informations pour le rdacteur du communiqu Apporter certains clairages si ncessaire Journaliste mandat par le groupe dtude pour rdiger le communiqu ou responsable de linformation du dcideur Agences de presse Journalistes et rdactions Diffusion large, bien au del de la zone dtude Peut faire lobjet dun reportage plus consquent de la part dun mdia intress, le communiqu servant de prtexte de dpart
Inconvnients
Pas de retour auprs du groupe dtude Pas dobligation de parution de la part des mdias Parution invisible si lactualit est charge Arguments tronqus par un intermdiaire Peut ne pas arriver au public si le mdia se dsintresse du sujet
Risques et limites
Remarques diverses
2 stratgies sont possibles : choisir une srie de journaux et dagences de presse afin de bien diriger linformation vers un type de lectorat ou dauditeurs spcifique tablir une diffusion la plus large possible sans soucier du type de mdias atteint
Exemples Sources
Communiqus de presse de la Comparaison de variantes 1999 Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud (BIC)
380
ANNEXES
Fiche descriptive
Titre(s) Description
N10
Article dans la presse spcialise
Rdaction dun article envoy ensuite aux rdactions des journaux spcialiss : revue des associations professionnelles de la route, de lenvironnement, de lingnierie, etc. Amliorer limage de marque du projet auprs de la profession Informer les spcialistes de lavancement du projet Partager les expriences avec les confrres Confrence de presse Djeuner de presse Journaux spcialiss : frquence mensuelle au maximum Tout au long du cycle de vie, quand une tape de celui-ci est franchie (frquence irrgulire) ou une frquence dfinie, mais infrieure celle des communiqus de presse La vulgarisation est moins importante car on sadresse un public averti Mise en avant de lavancement du projet ou de la procdure utilise : il faut un lment novateur, sinon ne pas communiquer Le communiqu peut procduraux complexes sattarder sur des lments techniques ou Pochette de presse
Objectifs et rsultats attendus
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes Support de communication Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter
Public-cible Engagement du public Rle du dcideur Activits du projeteur Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E. Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur
Public trs restreint et souvent convaincu Aucun Aucun Rdiger larticle qui est souvent publi tel quel dans la revue Apporter certains clairages si ncessaire Aucun Article non modifi et plac isolment dans la revue : pas dintermdiaires Article non modifi mais prcd dun article interne de la revue le prsentant et le commentant : intermdiaire objectif Article modifi par la revue spcialise : intermdiaire subjectif Diffusion au sein de la communaut scientifique dexpriences pouvant tre utilises par dautres professionnels Peut faire lobjet dun reportage plus consquent de la part du journal spcialis intress par la thmatique
Avantages
Inconvnients
Demande une grande prparation Ne concerne pas le public affect Faible diffusion Demande un grand travail (si par exemple la revue dispose dun comit de relecture) pour un faible rsultat Nest pas utiliser comme une mthode de participation du public mais plutt comme une information de la profession Article dans les revues professionnelles comme Routes te trafic
Risques et limites Remarques diverses Exemples Sources
381
Fiche descriptive
Titre(s) Description Objectifs et rsultats attendus
N20
Opration portes ouvertes
Les services du dcideur et du projeteur permettent au public de visiter leurs installations, en organisant une exposition dinformation Information du public Discussion entre le public et les professionnels Exposition Concours Fte populaire Pavillon dinformation Livre de dolances
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes
Support de communication Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter
Divers : oral (questions au personnel), visuel (visite des installations) Lors de lexcution des travaux Le public est libre de dambuler au sein de lexposition Lambiance doit tre tendue : prvoir des animations (concours, stands de boissons et de nourriture, etc.) et penser au confort du public (chaises, abris, etc.) Il doit y avoir du personnel rpondant aux questions ventuelles Faire une publicit suffisante pour inviter le plus large public possible Le projet doit tre suffisamment visible (ne pas faire une journe portes ouvertes pour un tunnel si on ne peut pas le visiter) Penser la scurit du public
Public-cible Engagement du public Rle du dcideur Activits du projeteur Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E. Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur Avantages
Public intress Passif, doit dcider lui-mme ce quil dsire visiter Organisation de la journe portes ouvertes Prparation et prsence lors de la journe portes ouvertes pour rpondre au public Prsence lors de la journe portes ouvertes pour rpondre au public Aucun Permet douvrir les installations et de dmystifier le chantier Le personnel est directement atteignable dans un cadre propice la discussion
Inconvnients Risques et limites
Pas de consultation organise Risque de nattirer quun public de convaincu Le personnel prsent doit connatre suffisamment le projet pour rpondre au public Laccent est mis sur laspect Ralisation
Remarques diverses Exemples Sources
Mthode de participation publique frquemment utilise
382
ANNEXES
Fiche descriptive
Titre(s)
N21
Pavillon dinformation
Kiosque dinformation Centre dinformation
Description
Une exposition est installe dans un btiment provisoire (pavillon prfabriqu par exemple) ou existant (habitation riveraine achete par le matre duvre) situ proximit de la future infrastructure routire Information du public Recueil des dolances des visiteurs (peut servir de base de consultation) Panneaux dinformations Visite de chantier Vidos Panneaux dinformation Dialogue avec le responsable du pavillon Vue du site Livre de travail Plaquette dinformation
Objectifs et rsultats attendus
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes
Support de communication
Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter
Vers la fin du projet et durant la ralisation des travaux Important effort de vulgarisation Actualiser en permanence les expositions pour coller au mieux lvolution du projet Heures douverture favorisant la dcouverte, notamment prvoir la possibilit de visiter le pavillon le week-end tre disponible pour rpondre aux questions Public affect par le projet Large public dintresss prt se dplacer pour visiter le pavillon Courses dcole ou sorties de socit
Public-cible
Engagement du public Rle du dcideur Activits du projeteur Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E.
Aucun, si ce nest lintrt de se dplacer Dlguer un responsable du pavillon Prparer le texte des panneaux Aide la rdaction dans les domaines spcifiques Graphiste pour la ralisation des panneaux ventuellement un animateur comme responsable du pavillon, mais il est prfrable de choisir un technicien matrisant les diffrents aspects relatifs au projet Crateur des panneaux ventuellement le responsable du pavillon si celui-ci dcrit les panneaux (visites guides) Guide dirigeant un groupe de visiteurs Information de qualit et fouille Se situe proximit du chantier
Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur
Avantages
Inconvnients Risques et limites Remarques diverses Exemples
Peu dinteractions avec le dcideur Le public peut bouder le pavillon ou alors seuls les gens convaincus viennent visiter l'exposition Ce procd est dsormais couramment utilis dans de nombreux projets A1 : Mussillens et Yverdon A9 : Finges
Sources
(BAR Fribourg, 1996; Peyronnet J.-P. et Pinoteau B., 1997)
383
Fiche descriptive
Titre(s) Description
N37
Forum
Le forum est une audience publique au sens large qui comporte certains lments dune opration portes ouvertes. En plus de lexposition, les participants au forum peuvent transcrire leurs dolances dans le dossier officiel Information Collecte dinformations Opration portes ouvertes Dialogue verbal entre le public et le projeteur ou le dcideur Tout au long du cycle de vie Assurer un climat dtendu et amical Laccent est mettre sur les problmes plutt que sur les avis
Objectifs et rsultats attendus
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes Support de communication Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter
Public-cible Engagement du public Rle du dcideur Activits du projeteur Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E. Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur Avantages Inconvnients Risques et limites Remarques diverses Exemples Sources
Public intress Transmission de dolances au projeteur ou au dcideur Organisation et gestion du forum Aucun Le personnel est disponible pour rpondre aux attentes du public
384
ANNEXES
Fiche descriptive
Titre(s)
N43
Site Internet
Site WEB Site Internet ralis par le dcideur ou le projeteur et prsentant le projet Il peut contenir des informations simples ou fouilles, un forum de discussion, une bote lettre lectronique et des rfrences pour linformation
Description
Objectifs et rsultats attendus
Faciliter laccs des informations volumineuses, fouilles ou actualises Permettre un dialogue entre le public et le dcideur Bureau dinformation Plaquette ou brochure dinformation Site Internet, ordinateur Tout au long du cycle de vie Actualisation frquente Accessibilit rapide Recherche dinformations aise Rponses aux questions ou aux messages Exposition itinrante
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes
Support de communication Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter
Public-cible Engagement du public Rle du dcideur
Ensemble du public, mais surtout internautes Variable : de passif actif, mais sans prise de dcision Rpondre aux questions Entretenir le site et lactualiser
Activits du projeteur
Entretenir le site Informer le webmestre
Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E. Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur Avantages
Interventions de spcialistes Concepteur du site Internet Webmestre Webmestre Fournisseur daccs Permet dactualiser rapidement les informations Important volume dinformations disposition Faible couverture de la population, notamment auprs des personnes ges Risque de piratage de la part dopposants
Inconvnients
Risques et limites
Il y a un risque de ne sadresser qu une certaine catgorie de la poulation Ne pas cder la tentation du gadget technologique en vitant de consacrer plus dnergie au site Internet plutt quau projet
Remarques diverses Exemples Sources
385
Fiche descriptive
Titre(s)
N51
Comit consultatif de citoyens
Comit consultatif civique Groupe reprsentatif dintresss qui se runissent rgulirement pour discuter de question dintrt commun. Les avis des participants sont enregistrs. Il ny a pas de recherche de consensus de la part du dcideur Lieu permanent dapport des ides de la part du public Recueillir des informations et consultation du public
Description
Objectifs et rsultats attendus
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes Support de communication Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter Dialogue, procs-verbaux Tout au long du cycle de vie Sances rgulires et frquentes Prsence du dcideur ou dun reprsentant du dcideur Runions rgulires Public-cible Engagement du public Rle du dcideur Activits du projeteur Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E. Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur Avantages Riverains concerns et intresss Public Un reprsentant du dcideur doit tre membre du comit consultatif Prsence dans le comit consultatif Selon le type de questions dbattues, leur prsence peut tre ncessaire Aucun Aucun Permanence du lieu dcoute Information fournies par des riverains Connaissance des proccupations du public Inconvnients Seules les personnes intresss participent Pas de recherche de consensus Risques et limites Remarques diverses Exemples Sources (Comit C4, 1998) Image biaise des proccupations du public car lchantillonnage des participants nest peut tre pas reprsentatif
386
ANNEXES
Fiche descriptive
Titre(s) Description Objectifs et rsultats attendus
N63
Comit de suivi
Un comit compos dlus, de reprsentants administratifs et dassociations concernes par le projet reoit rgulirement des informations du G.E. Dbat technique Transparence des tudes Objectivit Recueil dinformations Communiqus de presse Rapport davancement / intermdiaire Dialogue verbal
Combinaison ventuelle avec dautres mthodes Support de communication
Priode dutilisation au sein du cycle de vie de la route Rgles essentielles respecter
Tout au long du cycle de vie Assurer la transparence Ne pas embellir la situation en tant objectif
Public-cible Engagement du public Rle du dcideur Activits du projeteur Activits des autres acteurs du groupe dtude (G.E.) Spcialiste de la communication intgrer dans le G.E. Intermdiaires entre lmetteur et le rcepteur Avantages
Reprsentants administratifs, lus, ONG concerns par le projet Aucun Rapport davancement Aide llaboration du rapport par tudes thmatiques On peut avoir des comits de suivi sectoriels : trafic, environnement, Avis scientifique dexpert
Inconvnients Risques et limites Remarques diverses Exemples Sources
Un peu tranger au public, ce qui peut donner un sentiment de groupe dtude largi mais encore loign du public Ne sapplique pas forcment au local Procdure POE (plan objectif environnement) dveloppe par la SANE (Pesch R., 1997)
Curriculum vitae
387
Curriculum vitae
Mical Tille
3 aot 1968 Mari, 1 enfant Nationalits franaise et suisse
Formation
cole primaire Vex et Sion, Suisse cole primaire (systme scolaire franais) Korogho, Cte dIvoire cole primaire (systme scolaire franais) Abidjan, Cte dIvoire cole secondaire (systme scolaire franais) Yaound, Cameroun cole secondaire Savise, Suisse Collge Sion, Suisse Apprentissage de dessinateur en gnie civil et bton arm Sion, Suisse
1974 - 1976 1976 - 1977 1977 - 1980 1980 - 1982 1982 1983 1983 - 1984 1984 - 1988 1985 - 1988 1988 - 1991
Prix de la meilleure moyenne finale
Ecole professionnelle suprieure de Sion, section technique
Prix de la meilleure moyenne finale
Ecole d'Ingnieurs de Fribourg, Suisse, dpartement de Gnie Civil
Prix SIA-Fribourg pour le meilleur travail pratique de diplme
Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne, Suisse, dpartement de Gnie Civil 1991 - 1996
Prix UPIAV pour la meilleure moyenne pratique de 4me anne
Activits professionnelles
Apprenti dessinateur en gnie civil et bton arm Ingnieur civil ETS indpendant Assistant doctorant au Laboratoire des voies de circulation, Dpartement de Gnie-Civil de lcole Polytechnique Fdrale de Lausanne Charg de cours Transport et route lEcole dIngnieurs de Fribourg
1984 - 1988 1991 - 1995 ds 1996 ds 1998
388
ANNEXES
Activits actuelles
Assistant doctorant chez le Professeur A.-G. Dumont au Laboratoire des Voies de Circulation (LAVOC) depuis le 1er juillet 1997 Collaboration lenseignement et la rdaction des supports de cours de Histoire des constructions , Gestion de la maintenance , Esthtique des ouvrages et de Conception des voies de circulation Rdaction du fascicule Le bruit enseign aux tudiants du Gnie Rural Refonte du polycopi Conception des voies de circulation Prparation et assistanat pour les projets de semestre et de diplme destins aux tudiants du gnie civil , y compris les applications informatiques Suivi de 3 candidats au diplme depuis 1996, tous accepts Conseiller au plan dtudes pour les tudiants du Dpartement de Gnie Civil Participation la recherche Interactions entre les voies de circulation et les rseaux de la faune , mandat de lOffice Fdral Suisse des Routes Collaboration diverses recherches et mandats Enseignement du cours de Transport et routes lcole dIngnieurs de Fribourg partir doctobre 1998. rdaction dun document de cours complet
Vous aimerez peut-être aussi
- 1 Chabi PDFDocument6 pages1 Chabi PDFben benPas encore d'évaluation
- QUALIMO - Plaquette de Présentation CERTIVEADocument2 pagesQUALIMO - Plaquette de Présentation CERTIVEAsusCitiesPas encore d'évaluation
- PUR-G-DAE-010 IR02 Signée FRDocument23 pagesPUR-G-DAE-010 IR02 Signée FRkabil boualiPas encore d'évaluation
- DR CGM Mam 2019 Partie CopieDocument11 pagesDR CGM Mam 2019 Partie Copiekeltoma.boutaPas encore d'évaluation
- Ajouter Des Indicateurs Graphique Dans ProjectDocument6 pagesAjouter Des Indicateurs Graphique Dans Projectgueyetapha77Pas encore d'évaluation
- Contrat TypeDocument5 pagesContrat TypeYoussef choukriPas encore d'évaluation
- Machine À Laver FAUREDocument8 pagesMachine À Laver FAUREDavid BevilacquaPas encore d'évaluation
- Correction de La Question de Synthèse 2b I OstDocument4 pagesCorrection de La Question de Synthèse 2b I OstMme et Mr Lafon0% (1)
- METALARMDocument2 pagesMETALARMImad AznagPas encore d'évaluation
- Chap3 La Maintenance Corrective Prof PDFDocument6 pagesChap3 La Maintenance Corrective Prof PDFQudýmãt ÁhmèdPas encore d'évaluation
- Projet RecyclageDocument17 pagesProjet Recyclageiraoui jamal (Ebay)100% (1)
- Kaschke Components Tunisie: Stage de PerfectionnementDocument19 pagesKaschke Components Tunisie: Stage de PerfectionnementAzizPas encore d'évaluation
- RTA Renault Laguna Contacteurs Lève Vitres ÉlectriquesDocument12 pagesRTA Renault Laguna Contacteurs Lève Vitres ÉlectriquesAnonymous fufQrPPKHPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage A Groupe OCPDocument38 pagesRapport de Stage A Groupe OCPIbtissam ChakriPas encore d'évaluation
- Classification Simplifiée Des Moteurs DieselDocument13 pagesClassification Simplifiée Des Moteurs DieselAhmed Web100% (2)
- Cour 1 Typologie de Production (Typologie Des Produits Et Des Procedes) (Gpl-s1)Document7 pagesCour 1 Typologie de Production (Typologie Des Produits Et Des Procedes) (Gpl-s1)zin1eedinePas encore d'évaluation
- Capacité PortanteDocument5 pagesCapacité PortanteSel BenPas encore d'évaluation
- Ha15i - Ha43eDocument226 pagesHa15i - Ha43eFrancisco barba lópezPas encore d'évaluation
- Notice D'utilisation de L'indicateur TrendFrance Pour ProrealtimeDocument2 pagesNotice D'utilisation de L'indicateur TrendFrance Pour ProrealtimeAnonymous hAtBRfvWSJ100% (1)
- Ift-2007 A16 91229Document11 pagesIft-2007 A16 91229Jorge D. NontolPas encore d'évaluation
- DéversDocument3 pagesDéversYoussef HouggaaliPas encore d'évaluation
- ESP TechDocument57 pagesESP Techdid85Pas encore d'évaluation
- BEC4841-défauts Dentures PDFDocument136 pagesBEC4841-défauts Dentures PDFytupidPas encore d'évaluation
- 16 MARENO 6 Fornuizen Gas-15Document1 page16 MARENO 6 Fornuizen Gas-15Pablo CappelliniPas encore d'évaluation
- Amdec 1Document6 pagesAmdec 1Jihane AbdessPas encore d'évaluation
- Bosch-Rexroth Profiles-Fonction-Integree R999001519 2020-03 FIP 1.0 FR MediaDocument40 pagesBosch-Rexroth Profiles-Fonction-Integree R999001519 2020-03 FIP 1.0 FR MediaXavierPas encore d'évaluation
- PDF 07 Plan de Controle-2 PDFDocument98 pagesPDF 07 Plan de Controle-2 PDFmuselhakPas encore d'évaluation
- Le Lean ManagementDocument15 pagesLe Lean ManagementIsmail TiGuintPas encore d'évaluation
- Article 7p Longepe-MethodeDocument7 pagesArticle 7p Longepe-MethodeElkanouni MohamedPas encore d'évaluation
- BAC Etude Des Constructions 2005 STIELECTECH 1Document23 pagesBAC Etude Des Constructions 2005 STIELECTECH 1lamiabejaouiPas encore d'évaluation