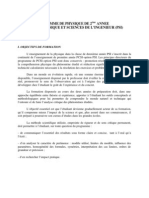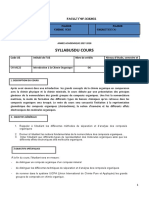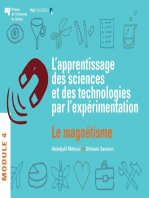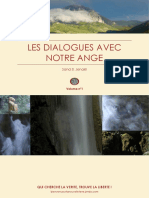Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ressources 3eme PDF
Ressources 3eme PDF
Transféré par
Elodie De AlmeidaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ressources 3eme PDF
Ressources 3eme PDF
Transféré par
Elodie De AlmeidaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Physique-chimie
Collge
Classe de troisime
Ressources
en
- Physique-chimie -
Ce document peut tre utilis librement dans le cadre des enseignements , et de la
formation des enseignants.
Toute reproduction, mme partielle, dautres fins ou dans une nou!elle
publication, est soumise lautorisation du directeur gnral de l"nseignement
scolaire.
Aot 2008
8 eduscol.education.fr/D0017
SOMMAIRE
INTRODUCTION
LES PRATIQUES PDAGOGIQUES
1. La dmarche dinvestigation
2. L histoire des sciences
3. Les TC et le B2i
4. La liaison collge-lyce
5. Les liens avec lenseignement dispens dans les autres disciplines
6. Lvaluation
7. Rflexions autour de lnergie
PARTIE TMATIQUE ! c"#sse $e %roisi&me
A - La chimie, science de la transformation de la matire
A1 - Mtaux, lectrons et ions
A1.1 Des mtaux au quotidien
A1.2 Conduction lectrique et structure de la matire
A1.3 Quelques tests de reconnaissance dions
A1.4 Raction entre le fer et lacide chlorhydrique ; interprtation
A1.5 Pile lectrochimique et nergie chimique
A1.5.1 Principe
A1.5.2 Entres historiques
A' - Synthse despces chimiques
B - nergie lectrique et circuits lectriques en alternatif
B1 - De la centrale lectrique lutilisateur
B1.1 Des possibilits de production de llectricit
B1.2 Lalternateur
B1.3 Tension continue et tension alternative priodique
B2 - Puissance et nergie lectriques
B2.1 La puissance lectrique
B2.2 La mesure de lnergie lectrique
C - De la gravitation . lnergie mcanique
C1 - nteraction gravitationnelle
C2 - nergie cintique et scurit routire
ANNE(ES
ANNEXE A : la dmarche dinvestigation
Quelques exemples (diaporama)
ANNEXE B : lhistoire des sciences
1. ons et lectrons (voir ANNEXE B1)
2. Brve histoire des phnomnes lectromagntiques (voir ANNEXE B2)
3. Utilisation de lalternateur pour la production industrielle dlectricit (voir
ANNEXE B3)
4. Lalimentation lectrique des trains (voir ANNEXE B4)
2
ANNEXE C : les TC et le B2i
1. Contributions de la physique-chimie au B2i domaine 3 (voir ANNEXE C1)
2. Recherche documentaire : propos de Volta (voir ANNEXE C2)
3. SDTCE : des ressources numriques et des usa ges des TC pour
lenseignement des sciences physiques et chimiques fondamentales et
appliques
(voir ANNEXE C3)
ANNEXE D : la liaison collge-lyce
Continuit des apprentissages en physique-chimie
I NTRODUCTI ON
Le )r*sen% $ocumen% es% re"#%i+ #u )ro,r#mme $e )hysique-chimie en -i,ueur
)our "# c"#sse $e TROISI.ME/
Ce document permet de mettre en ouvre les programmes selon lesprit dvelopp dans
lintroduction commune lensemble des disciplines scientifiques
l constitue la suite du document rdig pour le cycle central et disponible sur duSCOL :
http://eduscol.education.fr/D0017/SPC_DOC_DAC_CC.pdf
Nest pas repris, mais sadresse aussi la classe de troisime, tout ce qui concerne les
pratiques pdagogiques en gnral (la dmarche dinvestigation, louverture lhistoire des
sciences, les TC et la contribution la validation du B2i, les liens avec lenseignement
dispens lcole primaire et dans les autres disciplines), et certains thmes comme
lvaluation et le travail personnel des lves, les mesures et incertitudes, la scurit...
Le choix des activits illustres est guid par le souci dapporter aux enseignants des
informations en lien avec les pratiques pdagogiques et avec les thmes rfrencs ci-
dessus sans prtendre les dvelopper sur la totalit du programme. Limportance relative
dans le document de certaines rubriques nest pas en rapport avec la dure quil faut leur
consacrer.
Un certain nombre d'activits sont proposes, toutefois la libert pdagogique de
l'enseignant reste entire quant leur choix. La colonne connaissances du programme
recense et prcise les champs de connaissances de llve, la colonne capacits
explicite ce que llve doit savoir faire : il est indispensable de traiter les contenus de ces
deux colonnes dans le strict respect des commentaires.
l est souhaitable de faire acqurir les comptences transversales en relation avec les autres
disciplines y compris travers les thmes de convergence.
Des liens conduisent des ressources acadmiques slectionnes pour leur pertinence en
rapport avec le programme. Toutefois, pour respecter les droits dauteurs, ces documents
nont pas t modifis et il convient ponctuellement de les adapter afin de rester dans le
cadre du programme.
Ce document est complt par des annexes. Les liens pointant vers des pages de sites
internet peuvent ne plus tre actifs au moment de la lecture de ce document ; il faut alors
utiliser ladresse du site et/ou un moteur de recherche pour les actualiser.
3
LES PRATI QUES PDAGOGI QUES
0/ LA DMARCE D1IN2ESTIGATION
Quelques exemples sont proposs en ANNEXE A1.
L annexe A propose des adresses de sites nternet o une telle dmarche est prsente
en classe de troisime.
'/ L1ISTOIRE DES SCIENCES
Lannexe B de ce document complte celle du document du cycle central.
On y trouve des exemples dactivits intitules :
- ions et lectrons (voir ANNEXE B1) ;
- brve histoire des phnomnes lectromagntiques (voir ANNEXE B2) ;
- lutilisation de lalternateur pour la production industrielle dlectricit (voir ANNEXE
B3) ;
- lalimentation lectrique des trains (voir ANNEXE B4) ;
La visite (relle ou virtuelle) de muses ou de centres de culture scientifique, technique
et industrielle (CCST) permet de faire prendre conscience des effets de lvolution des
matriels techniques sur les progrs de la science. Le muse des Arts et Mtiers de
Paris propose de nombreuses pistes (voir le site du muse http://www.arts-et-metiers.net
ainsi que celui de lacadmie de Paris http://physique.scola.ac-paris.fr/ qui offrent une
slection et une prsentation de documents utilisables).
3/ LES TIC ET LE 4'i
L'annexe C' de ce document complte celle du document du cycle central. Elle propose des
pistes d'utilisation du tableur-grapheur en cours de formation et des exemples d'valuation
formative ou de validation de comptences du B2i-collge.
3/0/ CONTRI4UTIONS DE LA P5SIQUE-CIMIE AU 4'I 6 DOMAINE 3
Des exemples utilisant un tableur concernent diffrentes parties du programme : distance de
freinage et distance darrt, vitesse dune goutte, poids et masse, tension aux bornes dun
GBF. ls peuvent tre utiliss en formation ou en valuation et contribuer la matrise de
comptence du B2i-collge (voir ANNEXE C1).
3/'/ SDTICE
Des ressources numriques et des usages des TC pour lenseignement des sciences
physiques et chimiques fondamentales et appliques sont prsents dans le document
daccompagnement du cycle central (voir ANNEXE C5) et sont complts par lANNEXE
C3.
7/ LA LIAISON COLL.GE - L5CE
Un tableau synoptique prsentant lensemble des entres des programmes de
physique-chimie du collge se trouve dans "1ANNE(E D1.
4
De nombreux documents sont disponibles sur le site de lacadmie de Versailles
(http://www.phychim.ac-versailles.fr/donnees/college_lycee/intro.htm). ls prsentent
des outils de russite au collge et au lyce sous forme :
- de pistes dactivits ayant pour objectifs de motiver les lves ;
- des supports dvaluation et de remdiation diversifies.
l est conseill aux enseignants de prendre connaissance des )ro,r#mmes de
sciences physiques et chimiques du lyce denseignement gnral et technologique :
- classe de seconde : B.O. hors srie n2 du 30 aot 2001 annexe 1
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs2/seconde1.htm#page10,
- classe de premire S : B.O. hors srie n 7 du 31 aot 2000
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs7/vol5phys.htm,
- classe de premire L : B.O. hors srie n 7 du 31 aot 2000
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs7/vol5scientlitt.htm,
- classe de terminale S : B.O. hors srie n 4, volume 9 du 30 aot 2001
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs4/sciences.htm#physchim
En ce qui concerne la transformation chimique, la raction chimique et lquation de
raction, des informations sont donnes sur le site de lacadmie de Montpellier :
http://pedagogie.ac-
montpellier.fr:8080/disciplines/scphysiques/academie/college/quatrieme/doc/Transfor
mationchimiquecollege.doc
8/ LES LIENS A2EC L1ENSEIGNEMENT DISPENS DANS LES AUTRES DISCIPLINES
8/0/ LIEN A2EC LA TECNOLOGIE ET L1ISTOIRE-GOGRAPIE
Techno"o,ie
La technologie, la physique et la chimie sont des disciplines complmentaires. En
technologie, de la sixime la troisime, les lves analysent des objets techniques existant
dans leur environnement et en ralisent dautres sous forme de maquettes ou de prototypes
destins illustrer des principes techniques, des principes physiques ou rpondre un
cahier des charges. Au del des approches fonctionnelle et historique des objets techniques,
lanalyse des matriaux qui les constituent et les nergies quils utilisent, quils produisent ou
quils transforment, apporte du sens aux dfinitions donnes en physique-chimie et suscite la
curiosit sur les notions venir. Cet aspect constitue un largissement, un enrichissement et
une complmentarit avec les connaissances tudies en physique-chimie.
Les activits menes dans les deux disciplines doivent montrer que les sciences physiques
et la technologie ont volu en parallle au cours du temps. Loin dtre uniquement une
thorie matrialise, la technologie a bien souvent prcd la thorisation dun problme.
Ainsi au cours des sicles, on peut relever des exemples qui illustrent lantriorit dune
innovation technique sur son analyse scientifique :
- les outils primitifs tels que la roue ou le levier ont prcd les lois de la statique ou de la
dynamique ;
- invents vers la fin de la priode romane, les arcs-boutant ont t utiliss bien avant que
la mcanique des structures ne permette de comprendre leur efficacit ;
- la conception et la construction du premier tlescope par Galile a permis la dcouverte
dune multitude de lois et de modles astronomiques ;
Cependant, cet ordre dapparition historique ninduit aucun lien de subordination dune
discipline sur lautre. Ainsi, ce nest pas lapproche empirique qui peut expliquer lapparition
de modles thoriques et de dmonstrations propres aux sciences : on peut donc bien parler
de complmentarit. Cest lvolution des techniques associe au progrs des
connaissances scientifiques qui a permis de structurer la technologie.
5
i s% oi re- ,*o,r#)hi e- *$uc#% i on ci -i que
Du )oin% $e -ue $es ensei,n#n%s
Au cours de leur formation initiale, les enseignants dhistoire gographie sont amens
acqurir une connaissance minimale de lhistoire des sciences et des techniques et
approchent ainsi les noms de ceux qui ont marqu lvolution de ces domaines.
Ainsi, lHistoire permet de montrer le caractre volutif des connaissances scientifiques du
monde et aide prendre conscience quil a fallu beaucoup de temps et de ttonnements
avant que les hommes ne parviennent crer des techniques qui nous sont familires
aujourdhui (la roue, le passage de la machine vapeur au moteur par exemple). Elle
permet galement de mettre en vidence le lien troit entre les sciences et les techniques ;
le sicle des Lumires, lEncyclopdie, la rvolution industrielle sont notamment loccasion
den parler.
La relation entre les sciences et techniques et le contexte socioculturel est galement
souligner (culte religieux et astronomie ; frein des religions sur les connaissances : mdecine
du Moyen-Age ; Galile ; les savants franais et la rvolution ; socits esclavagistes ;
socits industrielles et colonialisme).
Comme dans toutes les matires, le professeur pourra corriger loccasion les
reprsentations intuitives ou culturelles des lves.
Du )oin% $e -ue $es *"&-es
Les lves de collge montrent un vritable intrt pour lhistoire des sciences et des
techniques. LHistoire et la Gographie permettent de les y conduire par le biais de
documents iconographiques : photos, textes, biographies, cartes, diagrammes, tableaux
tudis tout au long de la scolarit mais plus spcialement revus en classe de troisime
dans le cadre des grands repres historiques.
Ainsi, les grands inventeurs auxquels fait rfrence le programme de physique-chimie
peuvent donner lieu de nombreuses activits ; parmi eux citons notamment Franklin
(associ lindpendance amricaine et la rvolution franaise), Bessemer et les hauts
fourneaux ; Watt ; Pascal, Volta ou Branly. Lvolution dun objet ou dune technique peut
galement se prter une tude diachronique.
Les multiples sources dont dispose lenseignant lui permettent de contextualiser linvention
et linventeur en faisant rfrence lenvironnement historique, gographique, culturel et
social, ou en rapportant les ractions de lpoque ces dcouvertes (contre lautomobile ou
le train, inventions du diable par exemple).
Le travail interdisciplinaire et les thmes de convergence permettent de donner plus de sens
au travail de chacun. Ainsi, les enseignants de chaque discipline se doivent de connatre les
programmes des matires avec lesquelles ils comptent travailler.
Rappelons "es )ro,r#mmes $1his%oire du collge :
classe de 6
me
: "es mon$es #nciens : lOrient ancien ; la civilisation grecque : dans
cette partie, il est propos de parler des savants grecs qui dchiffrent le monde en
sappuyant sur la raison (Hippocrate de Cos ; Aristote ; Archimde de Syracuse ;
Eratosthne de Cyrne) ; Rome ; les mondes lointains (au choix la Chine des Han et
lnde des Gupta) ; les dbuts des trois monothismes.
classe de 5
me
: "e Moyen-9,e e% "1ou-er%ure #u mon$e ! lEurope et ses voisins
vers 800 ; lOccident fodal Xe XVe sicle ; un autre monde : lAfrique du Moyen-
ge au XVe sicle ; vers la modernit, XVe XVe sicle : il est demand aux
enseignants de parler de lvolution de la pense scientifique travers la vie et
louvre dun savant et de raconter un pisode significatif des progrs ou dbats
scientifiques des XVe et XVe sicles ; lmergence du roi absolu.
6
classe de 4
me
: $u si&c"e $es "umi&res : "1;,e in$us%rie" ! lEurope et le monde au
XVe sicle avec, pour dmarche une tude mene partir de la vie et de louvre
dun philosophe des Lumires ou dun savant au choix ; la rvolution et lempire ; le
XXe sicle avec comme capacit requise de dcrire un exemple de mutations lies
lindustrialisation.
classe de 3
me
: "e mon$e $e)uis 0<07 ! un sicle de transformations scientifiques,
technologiques, conomiques et sociales partir des volutions scientifiques
majeures depuis 1914 et de ltude de deux exemples : une mdecine de plus en
plus scientifique et technique et son impact sur la vie humaine et les rvolutions de
linformation et de la communication ; guerres et totalitarismes (1914-1945) ; une
gopolitique mondiale (depuis 1945) ; la vie politique en France.
En ce qui concerne les )ro,r#mmes $e ,*o,r#)hie :
classe de 6
me
: "# Terre )"#n&%e h#=i%*e ! mon espace proche : paysages et
territoire ; o sont les Hommes sur la Terre ? ; habiter la ville ; habiter le monde
rural ; habiter les littoraux ; habiter les espaces fortes contraintes.
classe de 5
me
: hum#ni%* e% $*-e"o))emen% $ur#="e ! la question du
dveloppement durable ; des socits ingalement dveloppes ; des hommes et
des ressources.
classe de 4
me
: #))roches $e "# mon$i#"is#%ion ! des changes la dimension du
monde ; les territoires dans la mondialisation.
classe de 3
me
: "# >r#nce e% "1Euro)e $#ns "e mon$e $1#u?our$1hui ! habiter la
France ; amnagement et dveloppement du territoire franais ; la France et lUnion
europenne ; le rle mondial de la France et de lUnion europenne.
Tout au long des programmes, mais plus encore en 5
me
et en 4
me
, des liens peuvent tre
tablis entre le dveloppement des socits et laugmentation des puissances mises la
disposition des hommes dans ces diffrentes socits, et conduire ainsi expliquer les
grandes disparits conomiques et sociales du monde.
De mme, les facteurs de puissance et de fragilit des pays du Nord ou du Sud
trouvent en partie une explication dans lutilisation ou la production de ressources
nergtiques, dont ltude peut tre effectue en comparant des ordres de grandeurs et en
utilisant pour ce faire des units et un vocabulaire appropris. A cet gard, il est important
que les enseignants de physique-chimie et ceux dhistoire-gographie usent de mots
identiques pour dsigner ou analyser des phnomnes identiques.
Le travail interdisciplinaire peut revtir des formes diverses : recherches (notamment
informatiques) permettant de replacer le chercheur ou le savant dans le contexte de lpoque
et de sinterroger sur ce qui est fait sur le mme sujet dans les autres pays au mme
moment ; laboration de textes ou dexpositions relatifs lhistoire des sciences une
poque dtermine sur un thme donn.
8/'/ LIEN A2EC LE >RAN@AIS
Les programmes de franais au collge contribuent lacquisition de plusieurs grandes
comptences dfinies par le socle commun de connaissances et de comptences,
notamment dans le pilier 1 La matrise de la langue franaise et le pilier 5 La culture
humaniste , mais aussi dans le pilier 4 Les technologies de linformation et de la
communication pour lenseignement , le pilier 6 Les comptences sociales et civiques
et le pilier 7 Lautonomie et linitiative .
Lorganisation des programmes de franais vise la fois satisfaire les exigences du socle,
tablir des correspondances avec dautres disciplines et articuler les diffrents domaines
de lenseignement du franais que sont ltude de la langue, la lecture, lexpression crite et
7
orale. Cette articulation ou dcloisonnement permet aux lves de percevoir clairement ce
qui relie la diversit des exercices quils ralisent.
Les programmes de franais traitent expl i citement de ltude de textes documentaires,
notamment scientifiques (rubrique B 2 c - Textes documentaires) : on conduit llve une
plus grande autonomie dans le choi x et le maniement des documents. On poursuit la
pratique des dictionnaires usuels et des ouvrages de rfrence. On initie les lves
lutilisation des manuels dhistoire l i ttraire ou des ouvrages de vulgari sation scientifique.
On apprend consulter et on util i se dans toute la mesure du possible les banques de
donnes informatiques et tlmatiques. Dans ltude de la presse, on distingue linformation
du commentaire et on dgage les spcificits du discours journal i stique, notamment en
comparant le traitement dun mme sujet dans plusieurs journaux.
La voie dun travail interdisciplinaire est ici toute trace.
8/3/ DANS LE CADRE DES T.MES DE CON2ERGENCE
Les ressources spcifiques chacun des thmes de convergence apportent des
informations qui enrichissent les entres strictement disciplinaires. l convient en particulier
de se rapporter celui qui concerne lnergie.
A/ L12ALUATION
Diffrents sites acadmiques proposent des valuations
http://pedagogie.ac-amiens.fr/spc/
http://artic.ac-besancon.fr/sciences_physiques/ressources/liste_ressources.php?
tri=themes&chp=theme&ord=id_theme# 9
valuation des capacits exprimentales :
http://www4b.ac-lille.fr/~physiquechimie/college/capaexp/capaexp.htm
valuation formative :
http://www.phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article78
valuation sommative :
http://pedagogie.ac-
montpellier.fr:8080/disciplines/scphysiques/academie/college/evaluation3.php
http://physique.scola.ac-paris.fr/
Le socle commun de connaissances et de comptence (Dcret du 11 juillet
2006 ;
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-
de-competences.html) permet de renouveler les pratiques et les modes
dvaluation.
Lenseignant doit veiller en particulier valuer les capacits qui se rattachent aux
activits exprimentales qui constituent le fondement mme de la physique et de la
chimie (observation des lves en train de manipuler, sollicitation des lves pour
participer la conception dun protocole et/ou sa mise en ouvre, analyse de
comptes rendus dexpriences.).
B/ R>LE(IONS AUTOUR DE L1NERGIE
8
B/0 RESSOURCES POUR LE T.ME DE CON2ERGENCE # $%"&'(" ) :
Ce document est disponible sur le site de lacadmie de Paris http://physique.scola.ac-
paris.fr/ et sur le site de lacadmie de Versailles http://www.phychim.ac-
versailles.fr/MG/pdf/accompagnement_energie_.pdf
B/'/ DCAPR.S LA COLLECTION LI4RES PARCOURSD ED/ ACETTE E0<FGH, avec
laimable autorisation de l'Association Tour 123.
B/'/0 In%ro$uc%ion $e "# no%ion $1*ner,ie
Dans la vie courante, en labsence de la lumire du jour, on a souvent besoin dclairage
adapt chaque situation. Aussi, utilise-t-on des moyens diffrents :
- pour aller de nuit en un lieu loign de toute installation lectrique, on peut
employer une lampe de poche compose dune ampoule relie une pile ;
- pour clairer un bureau, un atelier ou un appartement, on branche des lampes sur
une prise lectrique : cette prise est relie par des lignes une centrale lectrique
compose dun alternateur solidaire dune turbine actionne par exemple par la chute
deau dun barrage ;
- pour sclairer de nuit lors dune promenade vlo, on peut utiliser un petit
alternateur dont le galet est entran par les roues, lesquelles sont mises en mou-
vement par les muscles.
Ainsi, dans chaque situation, on peut obtenir le mme rsultat - allumage dune lampe -
partir de systmes de dpart trs diffrents : une pile, une chute deau, les muscles etc.
En mme temps que la lampe brille, une modification se produit dans le systme de dpart :
par exemple, le zinc est transform en ions zinc () dans la pile ordinaire du commerce. On
dit que ltat du systme est modifi.
Au bout dun certain temps, on observe aussi que les systmes de dpart deviennent
incapables dallumer une lampe ; dans le langage quotidien, on dit que la pile suse, le
muscle se fatigue, etc.
Pour traduire lensemble de ces observations, le physicien a propos lide suivante :
Quelque chose est con%enu dans la pile, leau du barrage, le muscle ; ce quelque
chose est le mme dans chacun de ces rservoirs ; on ne peut pas le voir, on ne peut
pas le toucher, ce nest pas de la matire, mais on en observe les effets ici, lallumage dune
lampe. Ce quelque chose , nous lappelons NERGE. l peut y avoir beaucoup ou peu
dnergie dans les systmes de dpart puisque la lampe peut briller longtemps ou pas, mais
elle finit toujours par steindre ; ces rservoirs (appels aussi sources dnergie
voire ressources nergtiques ) donnent (ou transfrent) donc leur nergie en mme
temps que la lampe brille. Certains rservoirs sont considrs comme des sources
dnergies renouvelables parce que leur stock dnergie se renouvelle.
Lnergie est une grandeur physique qui se mesure. On a choisi pour cela une unit : "e
?ou"e (symbole : J).
B/'/' >ormes $1*ner,ie - con-ersion $e "1*ner,ie
Les rservoirs dnergie sont trs diffrents les uns des autres et, pour y puiser de lnergie,
on utilise des techniques trs varies, adaptes chaque situation.
Quels que soient ces rservoirs, il sagit toujours de cette mme grandeur physique
nergie ; pour bien marquer quil sagit dun contenu, on parle $1*ner,ie in%erne/
9
On peut considrer diffrentes formes dnergie.
Une pile, sige dune transformation chimique lors de son fonctionnement, possde une
nergie interne dont une partie est utilisable sous forme chimique ; on dit par abus de
langage quelle contient de "1*ner,ie chimique/
De mme, de luranium possde de lnergie. Dans un racteur nuclaire, on recueille
lnergie fournie par la fission des noyaux duranium. On dit que luranium possde de
lnergie interne (utilisable) sous forme nuclaire ; on dit par abus de langage quil contient
de "1*ner,ie nuc"*#ire.
On peut prciser les formes dnergie qui varient dans chaque rservoir.
Dans un barrage, le systme eau-Terre possde de lnergie. Lorsque leau tombe, elle peut
faire tourner lensemble turbine-alternateur. On dit que le systme eau-Terre possde de
lnergie interne utilisable en faisant varier la hauteur de leau par rapport la Terre ; on dit
par abus de langage que le systme eau-Terre possde de "1*ner,ie $e )osi%ion (ou de
niveau).
De mme le vent possde de lnergie parce quil est de lair en mouvement : il peut mme
en possder suffisamment pour actionner une turbine ; mais, dans ce cas, sa vitesse
diminue en mme temps. On dit que lair possde de lnergie interne utilisable du fait de
son mouvement ; on dit par abus de langage que lair possde de "1*ner,ie cin*%ique.
De leau chaude, par exemple celle dune installation de chauffage central, possde de
lnergie : elle peut chauffer lair dune maison tout en se refroidissant. l y a variation de
temprature. On dit que leau chaude possde de "1*ner,ie in%erne utilisable en faisant
varier sa temprature.
On voit que le vocabulaire utilis propos des formes dnergie peut apporter une
information supplmentaire sur les phnomnes mis en ouvre ou sur les grandeurs qui vont
varier pendant le transfert dnergie.
Parfois, le qualificatif associ lnergie caractrise lobjet qui fournit cette nergie : il en est
ainsi pour lnergie solaire. Lnergie solaire dsigne lnergie contenue dans le Soleil ; en
fait, cest de lnergie nuclaire qui est transfre en partie la Terre, principalement sous
forme de rayonnement.
B/'/3 Mo$es $e %r#ns+er% $1*ner,ie
De lnergie peut tre transfre dun systme un autre de trois faons diffrentesD sous la
forme de transfert thermique (chaleur), de travail et de rayonnement.
- Le transfert thermique (ou chaleur) :
Une opration de chauffage par combustion illustre ce mode de transfert par exemple
le chauffage de leau dans une casserole au moyen dun rchaud gaz. Le systme
air-gaz brle en se transformant et perd une partie de son nergie interne : il y a eu
un transfert dnergie sous forme de chaleur au systme eau-casserole dont lnergie
interne augmente. Ce qui se traduit soit par une lvation de temprature, soit par
lbullition de leau (changement dtat) temprature constante.
l y a transfert thermique ou transfert dnergie sous forme de (ou par) chaleur
chaque fois quil y a contact entre deux corps des tempratures diffrentes.
Un exemple simple de la vie courante peut tre donn par le manche mtallique
chaud dune cuillre dans un bol contenant un liquide chaud : de lnergie est
transfre sous forme de chaleur du liquide chaud au manche mtallique froid de la
cuillre.
De mme, un radiateur chaud de chauffage central transfre de lnergie lair moins
chaud de la pice sous forme de (ou par) chaleur (contact air-radiateur).
10
Le transfert dnergie par chaleur ne peut jamais avoir lieu dans le vide.
- Le rayonnement
De lnergie peut aussi tre transfre sous forme de (ou par) rayonnement ; on dit
encore : sous forme dnergie rayonnante.
Chacun sait quil fait plus chaud au soleil qu lombre. Si, par une journe chaude
dt, on laisse une bouteille deau frache lombre, sa temprature augmente peu
peu. Son nergie interne crot. Si on laisse la bouteille au soleil, sa temprature
augmente beaucoup plus. Son nergie interne augmente donc beaucoup plus.
Place au soleil, leau reoit, par rapport sa place lombre, un supplment
dnergie sous forme de rayonnement.
Ce mode de transfert intervient chaque fois que lon est en prsence de lumire et,
plus gnralement, dondes lectromagntiques : ondes radio et de tlvision, ondes
radar, rayonnement infrarouge, lumire visible, rayonnement ultraviolet, micro-ondes,
rayonnement X, rayonnement y.
Le transfert dnergie sous forme de (ou par) rayonnement peut se faire sur de trs
grandes distances et mme dans le vide I cest ainsi que nous recevons lnergie
rayonnante du Soleil.
La quantit dnergie transfre du Soleil la Terre sous forme de rayonnement est
trs importante : la puissance correspondante est, au mieux, de 1 kW.m
-2
. Ceci
explique lintrt des capteurs solaires qui permettent dobtenir de leau chaude et de
chauffer, au moins en partie, une maison. De l aussi lintrt des cellules solaires :
elles transforment directement lnergie rayonnante en nergie lectrique mais leur
rendement est faible.
En fait, tous les systmes perdent de lnergie par rayonnement, mais plus ou
moins : tous les corps rayonnent. Ainsi, le corps humain perd 50% de son nergie par
rayonnement : la puissance correspondante est de quelques dizaines de watts par
mtre carr.
l faut souligner que, dans un grand nombre de cas, ce nest pas la quantit dnergie
transfre par rayonnement qui est intressante ; le rayonnement, en effet, sert
essentiellement transmettre de linformation : forme et couleur des objets perus
par loeil, messages transmis par les ondes radio, de tlvision, de tlphone, etc.
- Le travail
1
Par exemple, une grue fonctionne laide dun moteur combustion interne. Elle
peut lever des charges. Une certaine quantit de mlange gasoil-air brle pendant le
dplacement de la charge. Le mlange est capable de transfrer de lnergie au
systme charge-Terre dont lnergie de position augmente.
On dit que le transfert dnergie du systme gasoil-air, moteur de la grue au
systme charge-Terre se fait sous forme de travail : cest le travail de la force
exerce par le cble sur la charge, et ce, pendant le dplacement de cette charge.
Les transferts dnergie se font sous forme de travail, par exemple, lorsquune force
(ou des forces) agit (agissent) sur un systme qui se dplace.
- Remarque
l serait imprudent de vouloir prciser la forme dun transfert dnergie en examinant
seulement leffet quil produit. Leffet produit peut tre le mme dans les trois cas de
transfert: par chaleur, travail ou rayonnement. l faut aussi examiner la faon dont
leffet est produit.
Leffet produit peut tre, par exemple, une lvation trs forte de la temprature de la
1
e mode de transfert de l!ner"ie est #ors pro"ramme.
11
peau, cest--dire une brlure. l peut y avoir eu brlure :
- par transfert sous forme de chaleur (par exemple par contact de la main avec
un morceau de mtal chaud) ;
- par transfert sous forme de travail (par exemple, glissade rapide des mains
serres sur une corde) ;
- par transfert sous forme de rayonnement (par exemple, exposition prolonge
des mains au rayonnement solaire concentr, laide dune loupe/
B/'/7 Puiss#nce ! $*=i% $1*ner,ie
Un rservoir dnergie est ncessaire; il peut ne pas tre suffisant.
On ne peut pas faire bouillir un litre deau en faisant brler en permanence une seule bougie,
mme si on en a tout un stock et si on remplace chaque bougie consume par une neuve.
On ne peut pas, non plus, chauffer convenablement une grande salle, salle de thtre ou de
cinma par exemple, avec un seul radiateur, mme si on le laisse en service en
permanence.
Tous ces exemples montrent que les effets produits par une chane nergtique ne
dpendent pas uniquement de la quantit dnergie dont on dispose.
La vitesse des transferts dnergie intervient aussi.
En effet, on pourrait faire bouillir un litre deau laide de bougies mais une seule ne suffirait
pas, il faudrait en utiliser plusieurs en mme temps. De mme, avec plusieurs radiateurs
fonctionnant en mme temps, on pourrait chauffer raisonnablement une grande salle.
Deux voitures, de caractristiques identiques, peuvent faire un mme parcours des
vitesses diffrentes. On constate que la plus rapide utilise un dbit dessence plus grand.
Pour obtenir des effets instantans plus importants ou plus rapides, il faut donc que lnergie
soit fournie plus rapidement ou, autrement dit, que le transfert dnergie se fasse plus vite.
On peut encore dire quil faut que le dbit dnergie (appel puissance) soit plus grand.
Le lien mathmatique entre la quantit dnergie transfre E, la puissance P et la dure du
transfert dnergie t est par dfinition E = P. t.
La puissance est une grandeur physique que lon mesure. Lunit de puissance est le J#%%
(symbole W).
B/'/8 Conser-#%ion $e "1*ner,ie
On peut faire une maquette dune centrale hydrolectrique (chute deau, turbine, alternateur,
alimentant une lampe).
Si lon calculait
2
dune part lnergie de position de leau et dautre part lnergie lectrique
transfre de lalternateur la lampe, en faisant la comparaison, on sapercevrait que
lnergie lectrique transfre de lalternateur la lampe serait nettement infrieure
lnergie de niveau, stocke par le systme eau-Terre/
l en est ainsi pour toute chane dnergie. La mesure des transferts dnergie du rservoir
initial au systme final, pour lequel la chane a t construite, fait apparatre un manque ,
un dfaut dnergie.
Mais lnergie ne disparat pas/
En fait, il ny a pas de manque dnergie. Le physicien affirme que, en cherchant bien, on
retrouvera ailleurs toute lnergie qui tait auparavant dans leau du barrage.
Dans lexemple de la centrale hydrolectriqueD il y a des frottements dans la turbine, dans
lalternateur, de lchauffement dans les fils lectriques etc. Tous ces transferts dnergie
non souhaits sont souvent appels pertes dnergie ; en fait lnergie est bien conserve.
2
$out calcul concernant l!ner"ie de position est #ors pro"ramme.
12
Un nonc du principe de conservation de lnergie
Plus gnralement, toute chane dnergie comporte :
- un systme de dpart (cest le rservoir dnergie) ;
- un ou plusieurs systmes darrive en fin de chane ;
- des systmes intermdiaires, mais on peut, en gnral, les ignorer avant et aprs les
transferts dnergie, car leur nergie na pas vari (ils taient et sont revenus au
repos, par exemple).
Le principe de conservation de lnergie peut alors snoncer ainsi :
La diminution dnergie contenue dans le systme de dpart est gale laugmentation
dnergie contenue dans le systme darrive, quelles que soient les formes dnergie
contenues dans les systmes.
B/'/A D*,r#$#%ion $e "C*ner,ie
Les machines thermiques
3
(moteurs explosion, rfrigrateur, pompe chaleur) sont les
seules machines pouvoir transformer la chaleur en travail. Ltude des machines
thermiques montre que lnergie reue par celles-ci sous forme de (ou par) chaleur (de la
part dun mlange combustible-air, par exemple) ne peut pas tre entirement transfre par
travail. Comme dans le cas des centrales lectriques, une part importante de lnergie est
transfre sous forme de chaleur lair ambiant ou leau des mers et des rivires.
Lnergie perd alors sa qualit dtre convertible en une autre forme dnergie : on dit que
lnergie se dgrade.
B/3 UN E(EMPLE RCENT DE TRANS>ORMATION DE LCNERGIE MCANIQUE EN
NERGIE LECTRIQUE
par Philippe ABBO
Un exemple qui illustre assez bien la conversion de l'nergie cintique en nergie lectrique
est le fonctionnement des voitures dites hybrides (association de deux sources d'nergie :
essence et lectrique). Elles prsentent des caractristiques intressantes :
- au dmarrage le vhicule est m exclusivement par le moteur lectrique aliment par des
batteries loges dans la voiture ;
- en conduite normale le moteur essence fonctionne et sa puissance se divise en deux
flux :
l'un entrane un gnrateur (ce gnrateur est appel communment alternateur ;
il sagit en fait dune machine synchrone qui fonctionne en gnrateur de tension
alternative) qui fournit de l'lectricit au moteur lectrique qui participe la
traction du vhicule ;
l'autre actionne directement les roues par l'intermdiaire du moteur thermique.
La rpartition des flux est contrle pour assurer les meilleures performances.
- lors d'une dclration ou d'un freinage, l'nergie cintique lie la vitesse du vhicule est
transforme en nergie lectrique par l'intermdiaire du moteur lectrique, qui fonctionne
alors en gnrateur. Cette phase permet de recharger les batteries d'alimentation du moteur
lectrique (au dmarrage, les batteries fournissent de l'nergie ; au freinage, elles en
reoivent).
Ce fonctionnement porte la puissance globale du vhicule de 33 kW (sans un tel dispositif)
50 kW soit un gain de 50%.
Une animation simplifie des phases de fonctionnement, est disponible cette adresse:
http://www.hybridsynergydrive.com/fr/quick_guide.html
3
%es mac#ines t#ermiques sont #ors pro"ramme.
13
B/7 AUTRES DOCUMENTS
Des articles concernant lnergie apparaissent la rubrique documentation scientifique
sur le site de L# m#in : "# );%e : http://www.inrp.fr/lamap/
14
PARTI E THMATI QUE
CLASSE DE TROISI.ME
Lune des entres importantes du programme de troisime est une structuration des notions
relatives lnergie. Ces sujets apparaissent dans approches de lnergie chimique : une
pile lectrochimique et sont dveloppes dans nergie lectrique et circuits lectriques
en alternatif et dans de la gravitation lnergie mcanique .
A/ LA CIMIED SCIENCE DE LA TRANS>ORMATION
DE LA MATI.RE
A0/ MTAU(D LECTRONS ET IONS
A0/0 Des m*%#uK #u quo%i$ien
On )eu% qu#"i%#%i-emen% $i++*rencier cer%#ins m*%#uK comme "e +erD "e cui-reD
"1#"uminiumD "e LincD "1#r,en% e% "1or/
Lorganigramme (ou clef de dtermination) ci-dessous permet une reconnaissance
exprimentale mthodique de quelques mtaux :
Les mat ri aux conduct eurs et i sol ant s sont util i ss dans les installations lectriques
domest i ques et dans les apparei l s lectriques
15
- Le cuivre est trs utilis en lectricit pour trois proprits :
excellente conductibilit lectrique ;
rsistance la corrosion;
grande ductilit (possibilit dtirage en fils). Pour des pices conductrices
demandant une rsistance mcanique et un usinage, les laitons (alliages de cuivre
et de zinc) sont alors prfrs ; mais, si la rsistance mcanique et la duret
samliorent lorsque la teneur en zinc augmente, la temprature de fusion et la
conductibilit lectrique diminuent.
- Deux autres mtaux sont aussi prsents en trs faible quantit dans lappareillage
lectrique domestique : largent, sous forme de pastilles aux points de contact de rupture
(interrupteurs) et laluminium (petits moteurs lectriques). Lamiante est un isolant minral
(silicate de chaux et de magnsie) qui rsiste aux hautes tempratures ; il a t utilis
comme support de rsistances chauffantes lectriques (anciens fers repasser) mais a d
tre abandonn car linhalation rgulire de fibres damiante prsente long terme un grave
danger pour la sant.
- La plupart des matires plastiques utilises comme isolants en lectricit sont des
thermoplastiques. Leurs transformations utilisent essentiellement deux procds :
lextrusion qui permet le revtement et le gainage des fils lectriques ;
linjection qui permet la ralisation des pices dans un moule (botiers des interrup-
teurs, prises de courant, etc.).
Ins%#""#%ions
*"ec%riques +iKes
M#%*ri#u
con$uc%eur
M#%*ri#u iso"#n%
Lignes cuivre polychlorure de
vinyle (PVC)
thylne-
propylne
polythylne
rticul (PE)
nterrupteurs
Prises de courant
laiton
argent (contacts
dans les
interrupteurs)
porcelaine
(anciens
modles)
polycarbonate
(PC)
polypropylne(P
P)
polybutylne
trphtalate
(PBT)
polythylne
trphtalate
(PET)
Cartouches
fusibles
Alliage
d'aluminium,
cuivre, zinc,
argent pour le fil
fusible
statite pour le
tube
16
A))#rei""#,e
*"ec%rique
M#%*ri#u
con$uc%eur
M#%*ri#u iso"#n%
Cordons cuivre polychlorure de
vinyle (PVC)
caoutchouc
polychloroprne
(Noprne)
Appareils
domestiques
laiton
aluminium
cuivre
tungstne
(filaments des
lampes
incandescence)
acrylonitrile-
butadine-
styrne (ABS)
polystyrne (PS)
polypropylne(P
P)
phnoplastes
(PF ou
Baklite)
verre silicium-
sodium-calcium
(lampes)
Des in+orm#%ions sur "es m*%#uK sont accessibles aux adresses suivantes :
- Centre dinformations du cui-re, laitons et alliages :
http://www.cuivre.org/index-3310.htm
Cuivre : historique
http://www.cuivre.org/index-3110.htm
Cuivre : extraction et mtallurgie
http://www.cuivre.org/index-3210.htm
http://www.sfc.fr/donnees/mine/nh3/texnh3.htm
- Une riche documentation sur les mtaux et les alliages, notamment sur "1#"uminium
"1#r,en%D "e +erD "e cui-reD "e Linc (diaporama), "1or e% "1#cier, labore par Jean-
Louis VGNES du Laboratoire d'ngnierie des Matriaux et des Hautes Pressions
(LMHP-CNRS (UPR 1311) - Universit Paris 13) est accessible sur le site :
http://www.sfc.fr/donnees/acc.htm
& Les tapes de fabrication dune canette mettent en vidence des proprits
physiques et chimiques de l#"uminium : voir les sites
de lcole nationale suprieure de Grenoble
http://www.presentation.enseeg.inpg.fr/Objets/boiteboisson7.html
de la Cit des sciences et de lindustrie de Paris :
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/aluminium/histoire/index.html
& Des informations sur lor sont disponibles sur le site du CNRS :
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/dossier.pdf
& Des informations peuvent aussi se trouver sur les sites des industries
mtallurgiques.
M*%#uK e% en-i ronnemen%
17
Lutilisation des mtaux dans la vie quotidienne est loccasion daborder les questions de
production, de tri et de recyclage en lien avec lducation au dveloppement durable et le
thme de convergence environnement et dveloppement durable .
Dans la vie quotidienne, nombreux sont les objets qui renferment des mtaux. Ainsi, le fer,
le cuivre, le zinc et laluminium se retrouvent-ils dans nos dchets. l faut savoir, quune fois
jets dans la nature, plusieurs dentre eux, et dautres bien prsents mais moins cits
(plomb, mercure.) sont des sources de pollution de la terre, de leau et mme de lair
(lorsque les objets qui les contiennent sont brls et que les gaz dincinration sont librs
sans tre filtrs). La rcupration des mtaux est pour cela un enjeu important pour le
respect de lenvironnement et de la sant. Bien sr, elle prsente aussi des avantages
conomiques tant donn leur valeur marchande. Le tri et le recyclage des mtaux,
prsents par exemple dans les D3E (dchets dquipement lectrique lectronique) et dans
les piles, sont en lente progression.
A0/' Con$uc%ion *"ec%rique e% s%ruc%ure $e "# m#%i&re
Con$uc%ion $#ns "es m*%#uK
Des animations peuvent tre consultes :
A%omeD *"ec%rons e% ions
Cette partie peut donner lieu des tudes de documents en lien avec lhistoire des
sciences. : voir par exemple le texte de "1ANNE(E 410 ! Ions e% *"ec%rons
Lenseignant peut aussi consulter la partie thmatique - classe de quatrime du document
daccompagnement du cycle central ( A5.1 Les modles de latome).
De plus, les sites suivants proposent des documents intressants :
- Acadmie de Rouen : Histoire de latome
http://lycees.ac-rouen.fr/galilee/iesp27/atome/histoire%20de%20l'atome.htm
- Acadmie de Nantes : La dcouverte de l'atome : une vieille histoire
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1165240897625/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHY
N#%ure $u cour#n% *"ec%rique
- Une animation, sur le courant lectrique dans les mtaux et dans un lectrolyte, est
propose sur le site de lacadmie de Dijon :
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/Flash/nature_courant/nature_courant.htm
& Une dmarche dinvestigation sur le courant lectrique dans les solutions aqueuses
est propose sur le site de lacadmie de Clermont-Ferrand :
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/physique/investigation/spip.php?article26
- Une exprience de migration dions, ralisable par les lves, est propose sur le
site de lacadmie dOrlans-Tours :
http://www.ac-orleans-tours.fr/physique/phototek/Dossiers/SUREAU/chimie.htm
Une exprience ralisable par lenseignant est galement propose sur ce site. Mais, dans
les deux cas, lenseignant $oi% M%re %r&s -i,i"#n% sil est conduit manipuler du dichromate
de potassium solide pour fabriquer la solution aqueuse correspondante.
- Une vido voir en ligne ou tlcharger est disponible sur le site de l'acadmie
d'Aix-Marseille :
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/menus/pc/video_diverses.htm
avec prsentation ladresse :
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/labospc/spip.php?article54
A0/3 Que"ques %es%s $e reconn#iss#nce $1ions
Lactivit habituelle consiste rechercher exprimentalement la prsence de diffrents ions
par les tests au nitrate dargent en solution aqueuse et la soude.
18
Cette partie du programme donne loccasion de prsenter les pictogrammes de scurit qui
figurent sur les flacons de produits chimiques.
Acadmie de Nancy-Metz : Symboles utiliss sur les tiquettes
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/Securite/Symboles.htm
Pour les risques prsents par les acides et les bases, il convient de consulter les fiches
relatives la scurit de lNRS (http://www.inrs.fr), lannexe F scurit du document
daccompagnement du cycle central ainsi que le site de lacadmie de Nancy-Metz :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/sc_index.htm
La question des pluies acides et de leur origine peut tre aborde dans le cadre de
lducation au dveloppement durable.
Une solution aqueuse est acide si son pH est infrieur 7 mais une pluie est dite acide si
son pH est infrieur 5,6. Certains gaz dissous dans leau, tels que le dioxyde de carbone et
le dioxyde de soufre, confrent la solution un caractre acide.
Toutefois, le dioxyde de carbone nest pas responsable de lacidit des pluies : la mesure du
pH dune solution sature de dioxyde de carbone (par exemple, une eau de Perrier) donne
un pH suprieur 5,6. Les pluies acides rsultent de la dissolution de certains gaz ou de la
dilution darosols (un arosol est au sens strict, une gouttelette en suspension dans lair ;
par extension, il dsigne aussi toute suspension de particules collodales solides ou
liquides). Les principaux gaz responsables des pluies acides sont le dioxyde de soufre (SO2)
et les oxydes dazote (NO et NO2 nots en rsum NOx).
A0/7 R*#c%ion en%re "e +er e% "1#ci$e ch"orhy$rique I in%er)r*%#%ion
La colonne capacits prcise : crire! avec le nom des espces en toutes lettres! le
bilan de la raction chimique entre le fer et lacide chlorhydrique . Cette criture remplace
lquation de la raction qui nest pas exigible ce niveau. En effet, lquation est une
criture symbolique de la raction chimique qui utilise les symboles des espces dont
certaines sont ici ioniques, ce qui reprsente une difficult supplmentaire. Lenseignant se
limite ce bilan qualitatif et naborde pas le bilan quantitatif de matire tudi au lyce
pour les transformations chimiques.
A0/8 Pi"e *"ec%rochimique e% *ner,ie chimique
A1.5.1 Principe et utilisation
Une pile lectrochimique est constitue de deux demi-piles relies par un pont salin (ou par
lintermdiaire dun vase poreux) ;
- chaque demi-pile correspond un couple oxydo-rducteur ; par exemple pour le
couple Zn
2+
/Zn, la demi-pile peut-tre constitue d'une lame de zinc plongeant dans une
solution contenant des ions zinc.
- le pont salin (ou le vase poreux) permet d'assurer la conduction lectrique quand la pile
dbite et de maintenir la neutralit lectrique dans chaque demi-pile pendant que
disparaissent ou apparaissent des espces ioniques aux lectrodes.
On peut, par exemple, raliser une pile en plongeant :
" dans un bcher une lame de zinc dans une solution aqueuse contenant les ions
zinc ;
" dans un autre bcher une lame de cuivre dans une solution aqueuse contenant les
ions cuivre () ;
" en reliant les deux bchers par un pont salin contentant une solution concentre de
chlorure de potassium ou de nitrate dammonium (de faon lmentaire par un
papier filtre imbib de solution aqueuse dun de ces lectrolytes).
19
Le voltmtre affiche 1,038 V
mais il faut tenir compte des
incertitudes de mesures.
Lampremtre affiche 0,557 mA
mais il faut tenir compte des
incertitudes de mesures.
Chaque lame joue le rle d'une borne pour la pile (lame de cuivre : ple + et lame de zinc :
ple -).
Dans le cadre du programme de troisime, on se contente dintroduire une lame de zinc et
une lame de cuivre dans une solution conductrice, de sulfate de cuivre par exemple. Grce
la prsence, sous forme dimpurets dans la solution, de traces dions zinc (), la pile est
initialement ralise. De plus, il se forme des ions zinc par raction directe entre le zinc et
les ions cuivre ().
Si on nutilise pas de solution aqueuse de sulfate de cuivre comme lectrolyte, mais une
solution acide ou ionique particulire (citron, oignon, pomme de terre, pomme, fromage,
acide sulfurique comme dans la pile de Volta -.) (voir pile historique de Volta)....,) les
impurets ioniques, formes ou existantes, assurent la prsence de deux couples avec
les deux lames mtalliques diffrentes utilises.
De telles piles peuvent alimenter un circuit lectronique comme celui dune carte
musicale par exemple :
20
" Ou bien comme une horloge cristaux liquides (Lcd #iquid cristal display)
Exemples de piles (constitues les mtaux cuivre et zinc) en fonctionnement
Ci-dessus : fonctionnement d'une
horloge LCD. Les lames de cuivre et de
zinc plongent dans une solution
aqueuse de sulfate de cuivre.
Ci-contre : fonctionnement d'une horloge LCD et
dune DEL. Les lames de cuivre et de zinc sont
plantes dans un citron. La DEL ncessite deux
piles de ce type en srie pour briller.
A1.5.2 Entres historiques
Les travaux de Volta : une entre historique relative ces travaux figure dans
LANNEXE B 5 du document daccompagnement du cycle central.
Dautres documents sont disponibles
- sur le site du CNRS :
http://www.ampere.cnrs.fr
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/chimieaulycee/THEMES/piles/prezpil.htm
- sur le site de lacadmie de Bordeaux
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e02histo.htm
- sur le site de lAcadmie des sciences :
http://www.academie-sciences.fr/Membres/in_memoriam/Volta/Volta_oeuvre.htm
Le site de lacadmie de Paris propose une recherche documentaire ce
sujet http://physique.scola.ac-paris.fr/ .
voir $olta et la dcouverte de la pile en ANNEXE C2.
Elle exploite une ressource disponible sur le site :
http:// www.academie-sciences.fr/membres/in_memoriam/Volta/Volta_oeuvre.htm
La squence sonore extraite de la chronique Bien choisir prsente par Fabienne
Chauvire et diffuse sur l'antenne de France nfo, le samedi 3 mai 2008 15h52,
21
intitule choisir ses piles et les recycler , peut constituer une entre en matire.
En fonction de son modle et de son tat dusure, une pile est capable de fournir plus ou
moins dnergie, ce qui conditionne les appareils quelle peut faire fonctionner.
Lvocation des matriaux utiliss et la ncessit du recyclage des piles peuvent tre un
autre sujet de rflexion.
couter : en ligne %mission de &rance 'nfo du ( )*' +,
ou tlcharger
4
: le fichier piles *rance (nfo +,-(./.mp+
Un document concernant la pile de Bagdad : une pile lectrique il y a deux mille
ans ? rdig par Marie-Hlne Wronecki, Christine Blondel et Bertrand Wolff, peut
servir de support pour dvelopper lesprit critique des lves au cours dune rflexion
argumente (comptence 6 du socle : les comptences sociales et civiques - faire
preuve desprit critique) en commun avec lenseignant de franais. Ce document est
accessible ladresse :
http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/zoom/mythesetlegendes/bagdad/index.php
Une controverse est prsente autour de la dcouverte dun objet mystrieux quil
est possible de faire fonctionner comme une pile. Les auteurs du document
exposent habilement la fois des arguments en faveur et des arguments contre la
thse de linvention de la pile lectrique par le peuple parthe au dbut du premier
millnaire, donc bien avant le XVme sicle et Alessandro Volta notamment.
Lenseignant de Sciences Physiques peut mener plusieurs tudes avec les lves :
- la comparaison entre la constitution dune pile et celle de lobjet mystrieux,
- les proprits de lor (diffrence entre les atomes dor du solide mtallique et les
ions or Au
3+
dune solution de sels dor. dorure par dpt de feuilles mtalliques
trs fines ou par lectrolyse).
Par exemple, il peut donner lexercice suivant :
#gende- le schma de la figure .
reproduite daprs le site 'nternet en vous
aidant des informations prsentes dans
le/trait :
'l s0agit d0un petit vase de terre cuite! haut
d0une quin-aine de centimtres et ferm
d0un bouchon de bitume! contenant un tube
de cuivre l0intrieur duquel se trouvait une
tige de fer! l0un et l0autre trs corrods1
Aprs la lecture de la partie du document intitule 2n mystrieu/ objet
archologique, lenseignant de franais peut demander aux lves sils
pensent personnellement que lobjet est une pile (les arguments pour et
contre la thse dans le document). La partie du document intitule #e
dveloppement de linterprtation lectrique se prte plutt une
activit autour de la neutralit des auteurs du texte du site internet (les
modalisateurs employs, les implicites, lironie dans le document.).
4
'n attente des droits de diffusion
22
A' - S5NT.SE D1ESP.CES CIMIQUES
Cette tude est loccasion de montrer "# r*#"i%* $e "1in$us%rie chimique $e syn%h&se
en projetant une squence et/ou en visitant une usine chimique.
Le site du CNRS propose un dossier sur le thme chimie et beaut dans la
collection Sagascience ladresse http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/accueil.html
Les *%u$es eK)*rimen%#"es
& Les expriences sont ralises, chaque fois que possible par les lves, sur des faibles
quantits de ractifs, en respectant les rgles de scurit (petites quantits, fentres
ouvertes), avec des protocoles simples.
De plus, il est souhaitable que lenseignant prsente au bureau un dispositif labor de
synthse utilisant le matriel habituel du laboratoire de chimie.
& Ces synthses sont loccasion dattirer lattention des lves sur les rgles de scurit
observer dans la manipulation des ractifs, en respectant les pictogrammes de scurit :
www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/sc_index.htm
Ces pictogrammes peuvent tre prsents sous forme dactivit comme celle propose
sur le site de lacadmie de Lille :
http://www4b.ac-
lille.fr/~physiquechimie/lycee/seconde/pci/chimie/obligatoire/la_securite_en_salle_de_tp/devri
es/activite_pictogramme_de_securite.pdf
Voir aussi lANNEXE F scurit du document daccompagnement du cycle central.
S ynthse dune espce chimique existant dans la nature
EXPRENCE DE SYNTHSE DUN ARNME DE 4ANANE*
PROTOCOLE SMPLF
(*) #c*%#%e $1iso#my"e ou actate de 3-
mthylbutyle
Verser 0,5 mL de 3-mthylbutan-1-ol dans
un tube essai. Ajouter 10 mL dacide
thanoque environ 1 mol/L. Agiter
dlicatement. Complter le tube avec 5 mL
dacide sulfurique environ 1 mol/L. Agiter
nouveau.
Plonger le tube dans un bain-marie deau en
bullition pendant 15 min environ (+i,ures 0
e% ').
Laisser refroidir le tube hors du bain-marie.
Verser le contenu du tube tide dans un
bcher de 100 mL rempli moiti deau
sale sature. Lodeur de larme de banane
est perceptible ds le retrait du tube
rfrigrant.
Figure 1
23
Figure 2 Figure 3 Figure 4
Le protocole prcdent est prvu pour tre ralis par les lves lors dactivits
exprimentales. Les produits corrosifs ont volontairement une concentration molaire qui ne
dpasse pas 1 mol/L. Lenseignant ne manquera pas de revenir sur les consignes de
scurit qui simposent lors de lutilisation dun systme de chauffage (notamment support
lvateur), de la manipulation deau trs chaude, de liquides inflammables et corrosifs
(notamment port de lunettes et de gants).
Le tube essai choisi est de grande taille (40 mL) pour que le mlange ne dpasse pas la
moiti de la contenance du tube. Le ballon sert pour le bain-marie. Au moment de son
remplissage avec de leau, lenseignant sensibilisera les lves sur le fait que le niveau
deau ne doit pas dpasser la moiti du ballon lorsque le tube est plong lintrieur. l est
possible dutiliser un bain-marie lectrique (+i,ure 3) mais la temprature reste voisine de
80C ce qui peut ncessiter une dure de chauffage plus leve. Si le nombre de dispositifs
de chauffage est limit, il est possible de rpartir les lves, par exemple, sur quatre postes
seulement.
Le volume dester form (actate disoamyle) est faible. Pour rassembler les gouttes dester,
il est possible de tourner doucement un bton de verre dans le bcher ; lester sagglomre
alors en une goutte de 2 cm de diamtre environ (+i,ure 7).
Le site de lacadmie dOrlans-Tours propose un autre protocole qui ncessite moins de
matriel ladresse
http://www.ac-orleans-tours.fr/physique/phyel/quatr/chimie-4eme/AR/SYNTH.HTM
Cration dune espce chimique nexistant pas dans la nature
Synthse du ny"on
O
A-A
Dans un verre de montre, verser quelques gouttes dune solution de chlorure
dhexanedioyle ClOC-(CH2)4-COCl en solution 5 % en masse dans le dichloromthane.
Verser trs lentement, le long dun agitateur, quelques gouttes dune solution aqueuse 5
% en masse dhexane-1,6-diamine H2N-(CH2)6-NH2 additionne de quelques gouttes de
phnolphtaline.
Observer linterface des deux solutions ; laide dune pince, tirer un fil de linterface des
deux solutions et lenrouler sur un agitateur : cest du nylon
O
6-6.
Synthse du ny"on 00.
24
Dans une capsule en porcelaine placer un peu dacide amino-11-undcanoque H2N-
(CH2)10-CO2H et chauffer doucement.
Aprs fusion du solide, poursuivre le chauffage ; la viscosit du solide crot alors que de la
vapeur deau se dgage. Tirer un fil avec une pince : cest du nylon 11 ou rilsan
O
.
Synthse du ny"on
O
A-0G.
Prparer une tige de fil de fer munie dune extrmit en forme de crochet.
Dposer 4 5 gouttes de chlorure de dcanedioyle (appel aussi chlorure de sba3oyle) au
centre dun verre de montre.
Verser ensuite 4 5 gouttes
de 1,6-diaminohexane
(appel aussi
he/amthylnediamine) sur le
ct du verre du montre.
Pousser le 1,6-
diaminohexane vers le
chlorure de sbaoyle
laide de la tige. On aperoit
la formation dun film blanc
la limite entre les deux
liquides : il sagit du nylon
6-10 et il est possible de
ltirer laide du crochet de
la tige.
Le chlorure de dcanedioyle ClCO(CH2)8COCl doit tre dilu 5% en masse dans du
cyclohexane. Le 1,6-diaminohexane NH2(CH2)6NH2 doit tre dilu 5% en masse dans de
leau distille.
Plus faciles dutilisation que les pipettes ordinaires, les bouchons compte-gouttes permettent
de respecter les faibles quantits de produits verser dans le verre de montre.
25
Synthse dun s#-on
Avant de se lancer dans la fabrication, i" es% im)*r#%i+ que "es *"&-es )or%en% "une%%esD ,#n%s
e% ="ouse/
Les espces chimiques : huile dolive, thanol 90, soude 3 mol/L, chlorure de sodium.
Le matriel ncessaire : prouvette gaz, bcher, agitateur, bec lectrique, papier filtre, verre
pied.
Dans lprouvette gaz, verser 20 mL
dthanol, 10 mL dhuile dolive et 20 mL
de soude.
Munir lprouvette gaz dun rfrigrant
air (long tube fin) et la laisser au bain-
marie pendant 20 min environ.
Durant le chauffage, prparer
de leau sature en chlorure
de sodium dans un grand
bcher (dissoudre 10g de
gros sel dans 100 mL deau).
Laisser refroidir le mlange dans lprouvette gaz quelques instants.
Re"#r,#,e >i"%r#%ion
Verser le mlange
ractionnel dans le
bcher deau sale.
Recueillir le prcipit form en
ralisant une filtration.
Filtrer le mlange tout en rinant avec
de leau.
Mettre le savon obtenu dans une
soucoupe et le laisser scher.
Remarques :
il ne faut pas utiliser le savon ainsi obtenu car il contient encore beaucoup de
soude ;
il est possible de montrer le caractre moussant de ce savon en lintroduisant
dans un tube essai contenant de leau et en agitant.
Des expriences peuvent tre ralises en sinspirant des fiches disponibles sur
les sites dHerv This, en lien avec la chimie dans la cuisine :
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/gastronomie_moleculaire
http://www.academie-sciences.fr/fondations/FSCA.htm
Certaines fiches, conues au niveau cole, ont t amendes et compltes
26
pour tre utilises au collge. l est possible de les trouver sur le site du CRDP
de lacadmie de Paris, sur celui de la Dlgation Acadmique aux Arts et la
Culture ainsi que sur celui de physique-chimie de lacadmie de Paris
(http://physique.scola.ac-paris.fr/).
4/ NERGIE LECTRIQUE ET CIRCUITS LECTRIQUES
EN P ALTERNATI> Q
40/ DE LA CENTRALE LECTRIQUE R L1UTILISATEUR
40/0 Des )ossi=i"i%*s $e )ro$uc%ion $e "1*"ec%rici%*
Activits exprimentales
Exemple de dispositif pour lobservation de la vitesse de rotation
dune turbine anime par une chute deau
Des animations ou des squences vido sur le fonctionnement des cen%r#"es
*"ec%riques sont disponibles sur :
& Le site tv :
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0435.0098.00&motclef=centrales,lectriques
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&d=171&n=123&p=507&ne=2&cl=PTCLE_NB_PTCLE_LK
(centrales lectriques et oliennes).
ATTENTON : les consultations ncessitent un abonnement.
& Le site dEDF :
http://www.edf.com/html/panorama/production/intro.html
http://www.edf.com/html/panorama/transversal/media_eol/eol_anim_01.html# (centrale
olienne)
& Le site de lADEME Pays de la Loire : animation centrale hydro-lectrique et olienne
http://www.ademe.fr/paysdelaloire/inf/dis.asp#
- Le site de lacadmie dAmiens :
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/spc/phydoc/college/document/cd_begore/Elec_3_alternatif.htm
27
Diaporama sur le courant alternatif : http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/spc/phydoc/college/document/cd_begore/3%B0%20tension
%20alternative/diaporama%20%20alternatif%20version%202.ppt
- Un nouveau type de centrale, lhydrolienne, exploite les courants marins en Manche
depuis avril 2008 (voir http://generationsfutures.chez-alice.fr/energie/hydrolienne.htm)
Un logiciel RP du MEN est disponible sur un cdrom auprs de la mdiathque de
lADEME : Les problmatiques de lnergie et de lenvironnement qui comporte cinq
chapitres : diffrentes sources dnergie, impacts environnementaux, lois et conventions
internationales, politiques nergtiques, prospectives.
40/' L1#"%ern#%eur
Le principe de lalternateur sappuie sur le phnomne dinduction lectromagntique dont
ltude est hors programme. Llve retient que ce phnomne est obtenu par le
mouvement relatif dun aimant au voisinage dune bobine.
Diffrents documents sont utilisables :
& Lacadmie de Dijon propose une animation sur un aimant tournant devant une bobine :
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/Flash/induction/aimant_tournant.htm
& Lacadmie dAmiens propose un diaporama sur le courant alternatif :
http://pedagogie.ac-amiens.fr/spc/phydoc/nouveau/nouveautescollege.php
& Lutilisation de lalternateur pour la production i ndust r i el l e dlectricit peut tre tudie
laide dun document support historique (voir ANNEXE B3).
& Exemples de sources documentaires et iconographiques au sujet de Tes"# !
site du CNRS : ampere.cnrs.fr
Tesla, la passion dinventer par Margaret Cheney diteur Belin 1987
Les sources dnergie renouvelables ou non sont traites dans le cadre de lducation au
dveloppement durable en lien avec les thmes de convergence nergie et
environnement et dveloppement durable .
Pour le vocabulaire et les ordres de grandeur, lenseignant se reporte au document li
des mises en ouvre du thme de convergence nergie (lANNEXE 2 :
harmonisation du vocabulaire, les units, ordres de grandeur).
Cette tude est loccasion de valider certains items du B2i-collge (voir ANNEXE C1).
40/3 Tension con%inue e% %ension #"%ern#%i-e )*rio$ique
B1.3.1 Tension alternative trs basse frquence : tude assi st e par or di nat eur
ntroduction
Ce type dactivit vient complter celle faisant intervenir le relev manuel. Llve doit
dabord tre initi ce dernier et aux tracs graphiques sur papier.
l faut notamment que ces activits prparatoires aient amen les lves comprendre que,
sur les graphiques obtenus, lcoulement du temps est reprsent sur laxe horizontal et une
autre grandeur physique sur laxe vertical.
Quand on utilise lordinateur, il est essentiel de comprendre que cet outil nintervient que
pour lacquisition et le traitement, la mesure proprement dite restant faite par un organe, dit
capteur, externe lordinateur.
28
Dans tous les cas, il faut prendre le temps ncessaire pour que llve ait bien compris que
ce qui est reprsent sur lcran rsulte dune srie de mesures et non dune simulation.
Objectifs de la manipulation
Lemploi de lordinateur devient particulirement intressant par rapport deux aspects de la
manipulation :
- Un premier est de montrer lvolution de la tension : en effet, le nombre lev dacquisitions
permet de faire prendre conscience aux lves de cet aspect du phnomne (un autre
moyen de lillustrer est de saider de lobservation loscilloscope de lvolution au cours du
temps de cette tension trs basse frquence).
- Le deuxime aspect intressant apparat quand on est amen comparer des acquisitions
faites dans des conditions diffrentes (valeur maximale, priode, frquence). Par
comparaison de graphiques, ceci permettra de mettre en vidence des proprits
caractristiques que sont la priode et la tension maximale de la tension alternative.
Schma du montage pour le relev dune tension alternative trs basse
frquence
l ny a pas de difficult particulire dans la ralisation de lexprience, elle dure le temps de
lacquisition, environ deux trois minutes dans ces conditions.
Rsultats et exploitations
Re"e-* nS0 $1une %ension #"%ern#%i-e u0
$e %r&s =#sse +r*quence +0
Re"e-* nS' $1une %ension #"%ern#%i-e u' $e
%r&s =#sse +r*quence +' su)*rieure : +0
Re"e-* nS 3 ! su)er)osi%ion $e $euK
%ensions #"%ern#%i-es $e +r*quence e%
$e -#"eur m#Kim#"e $i++*ren%es
Sur les graphiques ci-dessus, on pourra observer trois enregistrements de signaux diffrents.
Les deux premiers relevs ne comportent chacun quun signal not u
1
pour le premier et u
2
pour le deuxime. Le troisime relev comporte deux signaux nots u
3
et u
4
, ces derniers
ont t enregistrs successivement par le dispositif dacquisition avec des rglages
diffrents du gnrateur trs basse frquence. Le systme dexploitation employ permet de
visualiser deux signaux sur le mme graphique.
On peut faire observer, en comparant aux relevs manuels, la plus grande souplesse de
29
lacquisition informatique, qui va permettre de faire progresser plus loin ltude dune tension
alternative. En observant les similitudes et les diffrences entre plusieurs relevs, on pourra
dgager quelques caractristiques supplmentaires de ces tensions.
En modifiant le nombre de points dacquisition, on fera observer lvolution des tensions
dans les trois relevs (ce qui justifie a posteriori la contrainte de lissage impose par le
professeur lors du trac du graphique des relevs manuels).
En observant les relevs n1 et 2, on fera noter la diffrence du nombre de motifs
lmentaires correspondants une mme dure pour les tensions u1 et u2. Ceci fait
apparatre la priode comme une caractristique pouvant diffrencier deux tensions
alternatives.
En observant le relev n3, on fera noter non seulement la diffrence de priode de u3 et u4,
mais aussi celle de leur tension maximale. Cette grandeur est une deuxime caractristique
pouvant distinguer deux tensions alternatives.
On fera dterminer les valeurs de la tension maximale et celles de la priode. Par exemple
sur le relev n3, on trouvera des valeurs de la priode pour u3 proche de 120 s, et pour u4
de 90 s. Pour la tension maximale, on aura de mme pour u3 une valeur proche de 2,8 V et
pour u4 de 3,6 V.
On pourra signaler que la forme de cette tension alternative est la mme sur chacun des
trois relevs et donner son nom titre indicatif : tension sinusodale.
B1.3.2 Animations et simulations sur les tensions alternatives
Diffrents sites acadmiques proposent des ressources :
- Animation flash avec questions pour llve :
http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/animations_flash/ualternative.swf
- Diaporama sur le courant alternatif (attention, le redressement nest pas au
programme) : http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/spc/phydoc/college/document/cd_begore/Elec_3_alternatif.htm
- Diaporama : http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/spc/phydoc/college/document/cd_begore/3%B0%20tension
%20alternative/diaporama%20%20alternatif%20version%202.ppt
Des exercices pour distinguer diffrents types de tensions sont galement proposs
sur :
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/42217875/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1161013006328
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1165947198046/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1161013006328
B1.3.3 Loscilloscope, instrument de mesures
- Exercices interactifs portant sur l'analyse d'oscillogrammes varis :
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/phch/college/troisieme/exos_interactifs/C12-
Oscillogramme/menuoscillogrammes.htm
4'/ PUISSANCE ET NERGIE LECTRIQUES
4'/0 L# )uiss#nce *"ec%rique
B2.1.1 Diffrents documents ont t labors par le muse des Arts et Mtiers de Paris :
ls sont disponibles sur les sites du Muse des Arts et Mtiers (http://www.arts-et-
metiers.net/) et sur celui de lacadmie de Paris (http://physique.scola.ac-paris.fr/).
B2.1.2 La puissance lectrique
Concernant le risque *"ec%rique $omes%ique "i* #uK surin%ensi%*s, on peut proposer
aux lves un petit exercice de rflexion, un diaporama accompagn dun texte
30
conserver aprs discussion en classe ou une dmarche dinvestigation. Un exemple de
cette dmarche est disponible sur le site de lacadmie de Dijon :
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/college/Prises/fichprof.htm
Le tableau qui suit prsente des cas de surintensits possibles. Ces exemples ne
prtendent pas tre exhaustifs ni avoir de valeur rglementaire ou juridique.
Si%u#%ions Risque Pr*-en%ion Com)or%emen%
L'utilisation de
rcepteurs
lectriques sur les
prises de courant.
-Echauffement des
conducteurs
traverss par une
intensit trop forte.
Un conducteur
mtallique s'chauffe
lorsqu'il est travers
par un courant. Cet
chauffement
augmente avec
l'intensit du courant
qui le traverse.
- L'intensit que peut
supporter un
conducteur de section
donne ne doit pas
dpasser une valeur
limite, sinon on risque
de dtruire les
isolants, de
provoquer un
incendie.
- A partir du circuit
principal d'une
alimentation, des
lignes (neutre +
phase) sont montes
en drivation. On
obtient ainsi une
sparation des
circuits.
Les sections de
conducteurs de
chaque ligne sont
adaptes la
puissance donc
l'intensit.
- Au dpart de
chaque ligne, un
coupe-circuit
maximum d'intensit
adapt la section
des conducteurs.
- Prises spcifiques
selon l'intensit
qu'elles peuvent
supporter.
N'utiliser que des
fusibles adapts
chaque ligne (coupant
si l'intensit maximale
que peut supporter la
ligne est atteinte).
Branchement d'un
grand nombre
d'appareils
lectriques sur des
prises.
Coupure de
l'alimentation
lectrique.
Cartouche fusible
adapte la section
des conducteurs de la
ligne.
Ne brancher en
mme temps que les
appareils ne faisant
pas dpasser
l'intensit maximale
admissible.
Appareils mnagers
anciens, cbles
d'alimentation usags
(isolants qui
vieillissent et se
fendillent, fortes
contraintes
mcaniques). Contact
accidentel entre la
phase et le neutre.
- Courts-circuits.
- Sans protection de
l'installation, les
courts-circuits
provoqueraient une
augmentation brutale
de l'intensit dans les
conducteurs, leur
chauffement, la
destruction des
isolants et seraient
ainsi l'origine
d'incendies.
- L'isolement des
cbles doit tre
vrifi.
- Sur chaque ligne, le
coupe-circuit
(cartouche fusible ou
coupure
lectromagntique)
doit intervenir si
l'intensit maximale
que peuvent
supporter les
conducteurs de cette
ligne est atteinte.
l conviendra de ne
plus utiliser l'appareil
l'origine du court-
circuit (rparation
ventuelle par un
spcialiste).
Alimentation avec des Echauffement du La somme des
31
botiers multiprises. cordon si l'on branche
beaucoup d'appareils.
puissances des
diffrents appareils
branchs ne doit pas
dpasser la
puissance indique
sur le botier.
Cou)e-circui% !
Quelques clarifications de vocabulaire concernant le fusible et le coupe circuit :
- La protection de base pour se protger de l'lectricit est l'isolement lectrique. On ralise
cet isolement par une couche de matriaux isolants sur les fils, cbles. et un confinement
de tout circuit lectrique ou lectronique dans une enveloppe rigide et dilectrique.
- Pour viter qu'un dfaut d'isolation ou un court-circuit dans un appareil ne dclenche un
incident grave (lectrocution ou un incendie), un circuit lectrique est obligatoirement muni
d'un coupe-circuit manuel plus un automatique :
- fusible ;
- disjoncteur ;
- sectionneur (manuel).
Un fusible est un organe de scurit, utilis en lectricit et lectronique. Son rle est
d'interrompre le courant lectrique dans le circuit lectrique qu'il protge en cas de dfaut.
Son nom vient du fait qu'il fonctionne par fusion d'un filament .
Un disjoncteur est un organe lectromcanique, voire lectronique, de protection, dont la
fonction est d'interrompre le courant lectrique en cas d'incident sur un circuit lectrique. l
est capable d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une
installation. Suivant sa conception, il peut surveiller un ou plusieurs paramtres d'une ligne
lectrique. Sa principale caractristique par rapport au fusible est qu'il est rarmable.
Un sectionneur est un appareil lectromcanique permettant de sparer un circuit
lectrique aval de son alimentation et qui assure en position ouverte une distance de
sectionnement satisfaisante lectriquement, gnralement visible par l'intervenant. l ne
figure pas dans les installations domestiques.
32
4'/' L# mesure $e "1*ner,ie *"ec%rique
Diffrents si%es #c#$*miques proposent des ressources :
- nergie consomme par une installation lectrique :
http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Simulation/Tableur_consommation_electrique/consommation_ele
ctrique.htm
- Facture dnergie lectrique interactive :
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Simulation/Facture_electricite/Facture.htm
http://missiontice.ac-besancon.fr/sciences_physiques/ressources/liste_ressources.php
- Formation et validation du B2i : http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/physchim/colleg
e/troisieme/tp_etude_de_la_puiss/view
- Puissance et nergie lectrique :
http://www.ac-orleans-tours.fr/physique/phyel/trois/pagpui/puiss.htm
- Historique de lclairage :
http://www.ac-orleans-tours.fr/physique/4eme/p2.htm
- clairage
http://www.ac-orleans-tours.fr/physique/docly/curious/c3.htm
- prsentation anime : http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/telechargement/
TZR/Hydrau1.ppt
Sur le site de lacadmie de Paris, un texte sur lalimentation lectrique des trains de
J. Jandaly propose une tude documentaire entre historique. Ce document relie
diffrentes notions tudies dans cette partie de programme. l permet galement un
lien avec lenseignement dhistoire-gographie et de technologie. (voir ANNEXE B4)
C. DE LA GRAVTATON . LNERGE MCANQUE
C0/ INTERACTION GRA2ITATIONNELLE
Dans cette partie de programme, la notion de conservation de lnergie est aborde lors de
ltude dune chute. Le principe de conservation de lnergie nest pas tudier en tant que
tel mais lenseignant garde lesprit que ce principe est sous-jacent dans toutes les tudes
relatives lnergie.
C0/0 Une #))roche eK)*rimen%#"e
Les questions Pourquoi les plantes gra!itent-elles autour du 0oleil 1 et Pourquoi
les satellites tournent-ils autour de la Terre 1 ont pour rponse la gravitation. Une
interaction attractive a lieu entre le corps central et celui qui tourne autour. On comprend
alors pourquoi les corps en interaction ne peuvent pas sloigner lun de lautre mais la
raison pour laquelle ils ne viennent pas la rencontre lun de lautre est moins vidente.
Lenseignant peut utiliser une analogie avec linteraction magntique en commenant par
considrer linteraction entre deux aimants car ce sont deux corps qui ont une proprit
commune de la mme faon que linteraction gravitationnelle est due une proprit
commune des corps (leur masse).
Comme linteraction magntique nest pas un point du programme dvelopper,
lenseignant se contente de comparer les deux phnomnes et il est intressant quil
voque les limites de lanalogie.
33
Points communs Diffrences
l y a interaction : les deux corps
agissent mutuellement lun sur
lautre.
Gravitation : uniquement attraction
Magntisme : attraction et
rpulsion
Linteraction se fait distance.
Linteraction diminue lorsque la
distance augmente entre les deux
corps.
Lenseignant garde en mmoire que dans le cas du magntisme, linteraction se manifeste
par lexistence dun couple.
Pour illustrer lvolution de linteraction avec la distance, il est possible de raliser une srie
de passages dune bille en acier devant un aimant en changeant la position de laimant.
Les squences filmes correspondantes se trouvent dans le FCHER COMPLMENTARE
4ille5aimant5distance1s6f. Quelques photographies ci-dessous en sont extraites.
La bille descend une rampe incline et arrive chaque fois avec la mme vitesse
proximit de laimant. Avec le matriel utilis ci-dessous (plan inclin de faible pente de
lordre de 5 %), on constate que lorsque le centre de la bille arrive sur une ligne situe 1,5
cm de laimant, elle est attire au point de venir se coller sur lui ; lorsque son centre
arrive sur une ligne situe 3,0 cm de laimant, elle nest presque pas dvie.
34
Le dispositif avec la rampe, la bille dacier et laimant permet daider les lves
comprendre pourquoi deux corps qui sattirent ne se rejoignent pas toujours.
Si la bille va trs vite lorsquelle passe
proximit de laimant, elle est peu dvie sous
leffet de lattraction. En revanche, elle est
dautant plus dvie que sa vitesse est plus
faible. Elle rejoint laimant et sy colle
lorsquelle passe trop lentement. Avec le
matriel utilis, on fait varier la vitesse de la
bille en la lchant depuis une position plus ou
moins loigne sur la rampe (par exemple sur
la photographie ci-contre, la bille est lche la
bille est lche 70 cm du bord).
Les squences filmes correspondantes se
trouvent dans le FCHER COMPLMENTARE
4ille5aimant5vitesse178&.
Les photographies ci-contre et ci-dessous en
sont extraites.
La vitesse est donc un facteur ajuster pour
permettre la rvolution dun satellite autour
dune plante sans quil ne scrase sa
surface.
35
Le parallle entre le mouvement dun satellite et celui dune fronde peut, lui aussi, aider
llve comprendre quun lien - certes invisible - existe entre la plante et le satellite car,
sans lui, le satellite en mouvement rapide sloignerait comme le ferait la fronde si la corde
venait se rompre. La notion de force ntant pas au programme, il nest pas utile
dvoquer la force exerce par la corde sur la fronde en mouvement circulaire.
Le fait quil faille une vitesse minimale pour obtenir (et maintenir) la rvolution de la fronde
peut servir expliquer le domaine spcifique de vitesses dun satellite pour quil se
maintienne en orbite autour dune plante donne.
On pourra galement voir sur le site de lacadmie de Nancy-Metz une vido sur la
trajectoire dune bille passant devant un aimant :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/video/exemples/bille_aimant.avi
Pourquoi un corps a-t-il un poids ? Quelle relation y a-t-il entre le poids et la masse ?
L encore, il nest pas question de parler de la notion de force : le poids correspond, en
premire approximation, laction attractive de la Terre ; il est une manifestation de la
gravitation au voisinage de la surface de la plante. Lenseignant naborde pas le fait que le
poids est une grandeur vectorielle tandis que la masse est une grandeur scalaire.
Le lien mathmatique entre les deux grandeurs poids et masse est donn. Sagissant dun
simple lien de proportionnalit, llve peut se demander alors pourquoi il est ncessaire de
faire une distinction entre les deux grandeurs. En plus daborder le fait que lintensit de la
pesanteur g est diffrente dun astre lautre, il est possible aussi dvoquer son volution
avec laltitude du lieu : lattraction dun corps par la Terre diminue trs lgrement si lon
monte en altitude.
souligner que la masse affiche par une balance lectronique repose sur une dformation
associe une force lie la pesanteur. Seules les balances fonctionnant sur le principe du
levier (type Roberval par exemple) permettent laccs direct (sans utiliser la relation P = m .
g) la mesure de la masse.
C0/' Que"ques r*+*rences
Une squence audiovisuelle sur NeJ%on e% "# ,r#-i%#%ion est disponible sur le site de la
Ci%* $es Sciences et de lndustrie de Paris.
http://www.cite-sciences.fr/cs/Satellite?
c=Page&cid=1195216550963&packedargs=pdpa=2&pagename=Portail/GRU/Po
rtailLayout&pid=1195216502897
Le si%e $e "1A,ence s)#%i#"e euro)*enne, dans sa partie jeunesse, http://www.esa.int/
esaKDSfr/index.html propose des documents en anglais et en franais, notamment :
Partie Les plantes et les lunes : le systme solaire et ses plantes
http://www.esa.int/esaKDSfr/SEM7ZK0VRHE_OurUniverse_0.html
36
Partie histoire de lUnivers : une histoire de la science spatiale en Europe
http://www.esa.int/esaKDSfr/SEMDEH808BE_OurUniverse_0.html
Partie les orbites : vitesse dans lespace
http://www.esa.int/esaKDSfr/Orbits.html
Partie les lanceurs : propulsion ionique contre propulsion chimique
Vitesses : comparaison entre deux propulsions diffrentes
http://www.esa.int/esaKDSfr/SEMEE00DU8E_Liftoff_0.html
Sur le site educnet on trouvera des informations sur : Apesanteur, impesanteur
http://www.educnet.education.fr/orbito/pedago/zerog/zerog1.htm
mesures de la variation de pesanteur
http://www.educnet.education.fr/orbito/pedago/zerog/zerog32.htm
un lve en impesanteur ; ses impressions
http://www.educnet.education.fr/orbito/pedago/zerog/zerog4.htm
la gravitation
http://www.educnet.education.fr/orbito/pedago/inertie/inert2.htm
notion de rfrentiel
http://www.educnet.education.fr/orbito/pedago/inertie/inert1.htm
Certaines brochures de la revue espace information dite par le CNES,
notamment le n 25 avec le dossier intitul de la pesanteur la gravitation et le n 26
(octobre 1983) avec le phnomne dimpesanteur ont t rdites en mai 86 et
restent utilisables par les enseignants avec laccord du CNES. Elles sont accessibles sur
le site de lacadmie de Paris http://physique.scola.ac-paris.fr/
Louvrage intitul #a gravitation de Madeleine SONNEVLLE et Danielle FAUQUE -
CNDP 1997 - SBN : 2-240-00411-8 runit des textes varis (extrait de BD page 152,
on a march sur la Lune , ouvre littraire page 96 lptre de Voltaire la
marquise du Chastelet , etc.) permettant une tude critique avec les lves. l runit
galement des textes fondateurs.
On pourra galement consulter :
& le site du CNES (mini encyclopdie spatiale)
http://www.cnes.fr/web/107-mini-encyclopedie-spatiale.php
- le site de lESA : http://www.esa.int/esaCP/France.html
C'/ NERGIE CINTIQUE ET SCURIT ROUTI.RE
l est possible dexploiter des chronotachygraphes, ou des produits quivalents, qui
enregistrent les vitesses en temps rel sur les vhicules de transports de personnes et
de marchandises poids lourds .
Diffrents documents sont exploitables sur certains sites :
- le site de lacadmie de Dijon propose une animation tlchargeable sur la
distance d'arrt :
37
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/college/SecuriteRoutiere/DistanceArret.swf
- le site de lAssociation pour la prvention routire :
http://www.preventionroutiere.asso.fr/acteur_education_interactif_lycee.aspx
Consulter notamment le dossier moduloroute .
Le dossier freinage peut contribuer la validation de certaines comptences du B2i-
collge :
http://artic.ac-besancon.fr/sciences_physiques/physique_chimie/college/b2i/index.php
>in $e "# )#r%ie %h*m#%ique >in $e "# )#r%ie %h*m#%ique
38
A N N E ( E S A N N E ( E S
ANNE(E A1 ! "# $*m#rche $1in-es%i,#%ion
Diffrents sites acadmiques proposent des pistes :
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/college/Chimie/explosion/fichprof.htm
http://artic.ac-besancon.fr/sciences_physiques/ressources/fiches_college.php?niveau=3&theme=9&cadre=28
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/physique/investigation/spip.php?article26
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/college/Chimie/PamelaRose/enqeleve.htm
Par ailleurs, lacadmie de Paris donne quelques exemples dans le diaporama de cette annexe A.
ANNE(E 41 ! his%oire $es sciences
ANNE(E 41 0/ Ions e% *"ec%rons
DOCUMENT POUR LE PRO>ESSEUR
lectron et atome : survol historique
D#ni&"e >AUQUE
Le document qui suit retrace les grandes tapes de la dcouverte de la structure de latome. l
sappuie uniquement sur lexprience et naborde pas laspect thorique. Les informations quil
propose permettront au professeur de prparer le document propos aux lves en leur apportant
un certain nombre dinformations sur le contexte des dcouvertes. Les dcouvertes se font un peu
partout dans le monde occidental, en Allemagne, en France, aux tats-Unis, et surtout en
Angleterre, au Cavendish Laboratory de Cambridge.
Aprs les travaux pionniers de William Crookes, J. J. Thomson, et les dcouvertes de W. C.
Roentgen, dHenri Becquerel et de Marie Curie, une gnration de jeunes chercheurs va imaginer
des dispositifs performants mettant en application leurs intuitions. Ce sont Ernest Rutherford,
Robert Millikan, Frederick Soddy, Francis Aston, sans oublier Jean Perrin en France. Les
dcouvertes exprimentales saccumulant, les interprtations thoriques suivent. Au dbut du XX
e
sicle, une nouvelle physique nat, fonde sur les ides de Max Planck (Allemagne), dAlbert
Einstein (Suisse), de Niels Bohr (Danemark).
La thorie atomique qui laissait sceptique un grand nombre de chimistes franais de la fin du XX
e
sicle ne peut tre rejete au prtexte quelle tait fonde sur une spculation : lexistence de
particules indivisibles ultimes de la matire, organises en molcules dfinissant les corps connus.
La preuve est apporte par lexprience, non seulement de la structure discontinue de la matire,
mais aussi de la divisibilit de latome.
Nous proposons ici quelques extraits dun ouvrage de diffusion (datant du premier quart du XX
e
sicle) de la nouvelle conception que lon se fait de la matire, diffusion base sur les rcits des
expriences, seuls critres considrs comme objectifs par la communaut internationale, car
reproductibles par tous dans les mmes conditions. Le vocabulaire nest pas tout fait le ntre.
Par exemple, lorsque Millikan parle dlectron positif, nous devons avoir en tte quil sagit
probablement du futur proton. Le neutron nest pas encore connu. Lorsque llectron est identifi,
et que la structure lacunaire de latome ne fait plus de doute, on ne conoit pas encore lexistence
des isotopes. Lorsque ceux-ci entrent dans le champ des connaissances, la notion dlment doit
tre redfinie. La structure lacunaire de latome induit un modle datome incompatible avec les
thories physiques connues, dont la thorie lectromagntique. l faut lintuition de Bohr pour
thoriser la stabilit de latome. l sensuit une explication trs simple des spectres lumineux.
Nous arrterons notre texte la dcouverte de la radioactivit artificielle en 1934.
L1*"ec%ron
Dfinition : " particule lmentaire, pouvant exister ltat libre ; elle est lie dans les atomes et les
molcules. Sa masse au repos est me = 9, 109534. 10
-31
kg. Elle porte une charge lmentaire
39
e = 1, 602 18 . 10
-19
C (do son nom de ngaton, lantiparticule de charge +e tant le positon) .
(J.-P. Mathieu, A. Kastler, P. Fleury, 9ictionnaire de physique (Paris, Masson, Eyrolles), 3
e
d.,
1991.
Le nom $e "1*"ec%ron
Nous allons trouver dans l'ouvrage, #0lectron, de Robert Andrews Millikan (1917, revu en 1924,
traduction franaise en 1926), une premire information.
" :n .,;.! le 9r <1 =ohnstone 7toney proposa pour la premire fois! le mot > lectron ?! pour
dsigner lunit naturelle dlectricit @ cest""dire la quantit dlectricit quil faut faire passer
dans une solution pour librer lune des lectrodes un atome dhydrogne ou un atome dun
lment monovalent quelconque1 ? (p. 30).
Lauteur rappelle ensuite les travaux quantitatifs de Michal Faraday sur llectrolyse. Ce dernier
avait montr qu un gramme dhydrogne mis en jeu, il y avait toujours passage de la mme
quantit dlectricit. Et, en 1874, il avait pu mettre en vidence quune charge de 10
-19
C tait
associe un seul atome. Cette charge tait neutralise par une charge positive quivalente dans
latome neutre.
Millikan poursuit : " #e mot > lectron ? est introduit simplement pour dsigner une quantit
dlectricit lmentaire bien dfinie! sans quil soit aucunement question de la masse ou inertie
qui pourrait y Atre associe BC1 'l y a! en fait! aujourdhui toute raison de croire que latome
dhydrogne contient effectivement un seul lectron positif et un seul lectron ngatif ? (p. 31).
Le proton na pas encore t dfini, et lexpression utilise par Millikan " lectron positif doit tre
entendue comme dsignant cette entit.
" 'l est regrettable que tous les auteurs qui ont crit sur ce sujet aient attach si peu de pri/ la
signification primitive du mot propos par le professeur 7toney @ il est! en effet! vident que nous
avons besoin dun mot pour dsigner lunit lmentaire dlectricit sans que ce mot doive
prciser quelle est lorigine de cette unit! ce quoi elle est attache! quelle inertie lui est
associe! ni mAme dsigner son signe positif ou ngatif @ il apparaDt ainsi que le mot > lectron ?
est le terme logique quon doive associer cette notion1 9e plus! il ny a aucune difficult
conserver la signification originelle et drive du mot > lectron ? et autoriser en mAme temps
lusage ordinaire quon en fait de/pression abrge et commode pour dsigner > llectron ngatif
libre ?1 :n dautres termes! tant donn la prsence universelle de llectron ngatif en physique
e/primentale et le/trAme raret de llectron positif isol! on peut admettre quil sagit de
llectron ngatif! moins que lon ne spcifie que cest du positif dont on parle1 Ce cas
grammatical est! en tout point! identique celui de lusage du mot > homme ? qui dsigne
admirablement le genre > homo ? ainsi que son reprsentant masculin! le reprsentant fminin se
trouvant alors diffrenci par lemploi dun prfi/e Ben anglais : man et 6omanC1 #es e/pressions
> lectron ? et > lectron positif ? seraient alors employes e/actement avec la mAme prcision que
les mots Eman et E6oman1 #es principales autorits en la matire F Ghomson! Hutherford!
Campbell! Hichardson F ont! en fait! conserv au mot > lectron ? son sens originel! au lieu de
lemployer pour signifier uniquement llectron ngatif libre! dont la masse est de .I.,JK de celle
de latome dhydrogne ? (p. 30-33).
D*%ermin#%ion $e e2m
Les expriences de Faraday ne donnent pas de valeur prcise de la charge dun lectron.
" )ais si les e/priences de &araday ne nous renseignaient pas sur la quantit dlectricit e que
reprsente un lectron! elles nous permettaient de connaDtre e/actement le rapport de la charge
ionique : la masse de latome laquelle elle se trouve associe dans une solution donne (p.
35).
" 2n accord international a dfini dans le systme lectromagntique des units! lunit absolue
dlectricit comme la quantit dlectricit ncessaire pour obtenir dans une solution dargent un
dpLt de +!+..., g de ce mtal .
Ainsi pour largent : eIm = 89,44 .10
5
C/kg pour 0,01118 g dargent (aujourdhui 89,3). Pour
lhydrogne, cela donne eIm = 9,573.10
5
C/kg (aujourdhui 9,64).
D*%ermin#%ion $e %e
" *insi! dans l0lectrolyse! le rapport :Im varie dun ion lautre @ pour les ions monovalents :
tant gal un lectron e! ce rapport est inversement proportionnel au poids atomique de lion1
40
Mour les ions polyvalents! : peut Atre gal N! (! J! ou K lectrons @ mais puisque lhydrogne est
au moins sept fois plus lger que tout autre ion qui puisse se rencontrer dans une solution! et que
sa charge nest que dun lectron! nous voyons que la plus grande valeur que puisse prendre :Im
dans llectrolyse est celle qui correspond lhydrogne BC1 Ouoique :Im varie avec la nature de
lion! on en dduit cependant une quantit qui est une constante universelle1
#on reprsente cette quantit par Pe! e reprsente toujours llectron! P est la constante
d*vogadro (p. 35-36).
#a question de la nature des ions ou particules charges se pose trs tLt au Q'Q
e
sicle! mais la
question de la conductibilit lectrique des ga- napparaDt vraiment qu partir de .,;K! avec la
dcouverte des rayons Q par 81 C1 Hoentgen1
" Cest =1 =1 Ghomson et ses lves du Cavendish #aboratory! de Cambridge! que nous devons
les e/priences dcisives ce sujet1 #e nouveau travail naquit pour ainsi dire et driva simplement
et naturellement du fait que les rayons Q et! un an ou deu/ plus tard! les rayons du radium!
dchargeaient llectroscope et! par consquent! rendaient les ga- conducteurs1 =usque"l! on ne
possdait aucun moyen pour dceler et contrLler volont la conductibilit lectrique des ga-
BC1 #a nature lectrolytique de la conductibilit ga-euse sest trouve ainsi clairement tablie
vers .,;R1 )ais quelle tait donc la nature des ions ainsi forms S (p. 39-40).
cet effet, J. J. Thomson et son quipe dfinirent de nouvelles grandeurs : la mobilit des ions
gazeux et le coefficient de diffusion des ions, et imaginrent de nouvelles mthodes pour mesurer
ces constantes. Celles-ci furent appliques ensuite par plusieurs savants partir de 1897. En
1900, John S. E. Townsend, Oxford, trouva quun ion positif avait un coefficient de diffusion
infrieur un ion ngatif, donc il tait plus lent dans lair sec quun ion ngatif. l a aussi t tabli
que les ions se dplaaient plus lentement que les molcules des gaz dans lair. Dautres
considrations de mobilit conduisirent supposer que " lion serait simplement une molcule
lectrise (p. 45).
Enfin, on montra au dbut du XX
e
sicle, que Tla valeur ne pour les ions ngatifs produits dans les
ga- par les rayons Q! les rayons du radium et la lumire ultraviolette! est la mAme que pour les
ions monovalents dans les solutions (p. 46).
" 'l apparut clairement! alors! que les constituants dun atome neutre! mAme celui dune substance
monoatomique devaient Atre de minuscules charges lectriques1 Pous avions ainsi la premire
preuve directe de la structure comple/e de latome et du fait que des charges lectriques entraient
dans sa constitution1 Cette dcouverte drive directement de lemploi dun agent nouveau! les
rayons Q! discrditait jamais la thorie de linscabilit de latome! et inaugurait lre de ltude
des constituants de latome1 Ce fut! dailleurs! avec une e/traordinaire rapidit que les proprits
du monde intra"atomique nous furent rvles au cours des vingt"cinq dernires annes . Nous
sommes en 1924 (p. 48-49).
Les physiciens formulrent plusieurs questions portant sur la valeur de la masse et de la charge
des constituants arrachs latome, la nature et le nombre des constituants de latome, leurs
rapports avec lmission et labsorption des ondes lumineuses.
Millikan contribua apporter une rponse partielle ces questions.
EK)*riences $e Mi""iT#n
Cest Townsend qui entreprit le premier la dtermination directe de e partir de ltude dun
brouillard charg, et publia ses rsultats en 1897. Dans le mme temps, C. T. R. Wilson, toujours
au laboratoire Cavendish, travaillait aussi sur les brouillards lectriss. J. J. Thomson mit profit
les dcouvertes de Wilson, et employa la mthode de Townsend, cest--dire en provoquant la
condensation de gouttelettes deau sur les ions, et en pesant ensuite le brouillard ainsi form. Mais
les progrs notables sont apports par Wilson en 1903. l utilise une chambre brouillard o les
gouttelettes les plus charges sont entranes plus rapidement par le champ lectrique que les
gouttelettes les moins charges. Cest sur ces dernires quil fait toutes ses mesures. Millikan met
alors au point une mthode o la goutte charge atteint un tat dquilibre, dans un champ
lectrostatique, en 1909, et obtient des valeurs plus prcises.
L# s%ruc%ure $e "1#%ome
*insi! au cours de la premire dcennie du QQ
e
sicle! on sait que latome nest pas le composant
ultime de la matire! mais quil se subdivise en particules plus petites charges lectriquement!
dont une! llectron ngatif est maintenant bien connu1 #atome tant neutre! il contient
41
ncessairement des > lectrons positifs ?! mais qui diffrent considrablement de leur
complmentaire ngatif1
" Pous avons vu que ces lectrons! qu laide des rayons Q! on peut e/traire de toute espce
datomes neutres! doivent Atre des constituants de tous les atomes1 BC1 Pous avons tudi ces
lectrons en eu/"mAmes! et nous avons trouv quil en e/iste de deu/ sortes : des lectrons
positifs et des lectrons ngatifs! dont les charges lectriques sont e/actement identiques! mais
qui diffrent totalement par leur inertie ou masse! celle de llectron ngatif tant gnralement la
.I.,JK
e
partie de la masse de latome dhydrogne! le plus lger des atomes connus! alors que la
masse de llectron positif nest jamais infrieure! semble"t"il! celle de latome dhydrogne (p.
217).
En utilisant les rayons d et , William H. Bragg (1904) puis Ernest Rutherford (1911) vont dcouvrir
la structure lacunaire de latome.
Ltude des trajectoires de ces particules dans un gaz montre Tque la particule traverse! en
moyenne! .+ +++ atomes avant de pouvoir approcher suffisamment prs de lun des constituants
lectroniques dun de ces atomes pour le dtacher de son propre systme et former un ion1 Ceci
montre clairement que les constituants lectroniques et autres des atomes ne peuvent occuper
quune fraction e/trAmement petite de lespace compris lintrieur du systme atomique1
Mratiquement! tout se passe! pour llectron de haute vitesse! comme si lintrieur de latome tait
compltement vide (p. 228). " )ais ltude des trajectoires des particules d nous renseigne mieu/
encore sur la structure de latome1 :n effet! un lectron ngatif dans un atome ne peut pas
davantage dvier une particule d! ou atome dhlium! mille fois plus gros que lui! quun pois
pourrait faire dvier un obus1 Cependant lon remarque! vers la fin du parcours de la particule d!
plusieurs coudes brusques qui ne peuvent Atre dus qu la prsence! lintrieur de latome! dun
centre de force e/traordinairement puissant! dont la masse est! pour le moins comparable la
masse de latome dhlium1 Ces brusques carts qui! e/ceptionnellement! atteignent .K+U .,+U!
constituent une preuve des plus fortes lappui de cette hypothse que latome se compose dun
noyau positif fortement charg! autour duquel se groupent des lectrons ngatifs en nombre
suffisant pour rendre latome lectriquement neutre dans son ensemble (p. 230-231).
Les savants vont ensuite chercher dcouvrir la structure du noyau. l doit contenir des lectrons
positifs en nombre suffisant pour assurer la neutralit de latome, mais aussi des associations
dlectrons ngatifs et positifs pour donner lessentiel de la masse du noyau.
En 1911, les expriences de Charles G. Barkla montrrent que le nombre dlectrons ngatifs tait
gal la moiti environ du poids atomique de latome. Or ce nombre devait galer ncessairement
le nombre dlectrons positifs libres dans le noyau.
Cest un jeune et brillant savant anglais, Henry G. J. Moseley, dj clbre vingt-sept ans pour
des recherches parmi les plus importantes du demi-sicle coul, qui devait apporter une rponse
en 1913. l fut lune des premires victimes de la Grande Guerre en t 1915. l tudia les
longueurs donde des faisceaux dondes lectromagntiques X excits par les chocs des rayons
cathodiques sur des anticathodes constitues de mtaux connus. l arriva la conclusion que leurs
frquences taient lies par une relation simple entre elles, une progression arithmtique simple
dont on obtient chaque terme en ajoutant au prcdent une quantit constante. Cette relation
suggre que la charge du noyau rsulte, pour chaque atome, de laddition dune certaine charge
invariable au noyau de latome le prcdant dans le tableau dress par Moseley. La srie de
Moseley concide galement avec la suite des masses atomiques croissantes. On en arrive
concevoir que les termes successifs du tableau priodique, allant de un quatre-vingt-douze,
correspondent chacun laddition dune nouvelle charge positive au noyau. Ce qui suggre que
lunit de charge positive est elle-mme un lment primordial (p. 248). Cet lectron positif se
rvle par exprience tre identique au noyau de latome dhydrogne.
la date laquelle est crit cet ouvrage de Millikan, 1917, et a fortiori, la date de sa traduction,
1926, latome dhlium est expliqu ainsi :
" #e poids de latome dhlium est quatre! alors que son nombre atomique! cest""dire la charge
positive libre de son noyau! nest que deu/1 #atome dhlium doit! en consquence! contenir dans
son noyau! deu/ lectrons ngatifs! qui neutralisent deu/ des quatre lectrons positifs! et servent
maintenir ceu/"ci runis! car! autrement! ils se spareraient violemment sous linfluence de leurs
rpulsions mutuelles (p. 249).
42
Nous navons pas ici abord la question de la stabilit de latome. Nous navons prsent que
quelques notions retraant la succession des dcouvertes exprimentales conduisant peu peu
la connaissance de la constitution de latome. En 1913, Rutherford fut en mesure de donner une
limite suprieure au rayon dun noyau, au moins dix mille fois plus petit que latome, soit de lordre
de 10
-12
cm. Mais il contient 99,95% de la masse de latome. En 1911, Frederick Soddy prsenta
une nouvelle dcouverte, celle des isotopes du radium, du thorium et du plomb. Aprs la premire
Guerre mondiale, Francis Aston construisit un spectromtre de masse qui lui permit de sparer les
isotopes. l publia un ouvrage sur le sujet en 1922.
Le lecteur aura reconnu dans llectron positif de Millikan, le proton. Ce nom a t donn en 1920
par Rutherford, lors dune runion de la British Association for the Advancement of Science,
Cardiff (Rutherford avait galement propos prouton en lhonneur de William Prout qui, au sicle
prcdent, tait persuad que chaque lment tait fabriqu partir dun lment primordial
apparent lhydrogne. Mais cest le mot proton qui sest impos avec le temps.
Rutherford essayait de comprendre comment des lectrons ngatifs pouvaient tre associs des
lectrons positifs dans le noyau. l postula lexistence dune particule neutre, quil nomma neutron,
au Conseil Solvay davril 1921, Bruxelles. Ctait un objet trange hautement spculatif, une
sorte datome neutre sans lectron priphrique et dont lunique lectron serait emprisonn dans
le noyau (Fernandez, p. 204).
l faut attendre 1932 pour que James Chadwick, au Cavendish Laboratory, dcouvre cette
particule imagine par Rutherford dix ans plus tt, et que son quipe ne cessait de rechercher.
Chadwick dcouvrit le neutron en refaisant les expriences rcemment publies drne et Frdric
Joliot-Curie (le 17 janvier). Ceux-ci avaient dtect un rayonnement supplmentaire lors dune
tude du bombardement du bryllium par des particules . ls supposrent que ce rayonnement
tait constitu dhydrogne, sans lanalyser. Quand Chadwick lut leur mmoire, il sursauta, et en
parla avec Rutherford : " Naturellement, Rutherford pensait quil fallait accorder crdit aux
observations ; linterprtation tait une tout autre affaire , crit-il (Fernandez, p. 272). En effet,
pour Chadwick, le rayonnement observ par les Joliot-Curie ne pouvait tre constitu que de
neutrons, particules tant attendues dans son laboratoire. Chadwick se mit au travail nuit et jour, et
refit les expriences. Le 17 fvrier, il envoya la revue Pature une lettre intitule " Existence
possible dun neutron . l y confirme les rsultats des Joliot-Curie, mais propose une autre
interprtation. Les Joliot-Curie, entre autres, montrrent que la masse de cette nouvelle particule
est peu ou prou gale la somme des masses dun lectron et dun proton, confortant lhypothse
de sa nature.
Aprs la dcouverte du neutron, une nouvelle thorie du noyau devenait ncessaire.
Quid de llectron positif ? l est dcouvert par C. D. Anderson, en Californie, au laboratoire de
Millikan, le 2 aot 1932. et nomm positon (en franais) ou positron (en anglais). Les Joliot-Curie,
poursuivant leurs recherches, dcouvrent la radioactivit artificielle avec mission de positons, le
11 janvier 1934.
Danile Fauque
Sources =i="io,r#)hiques
Millikan, Robert Andrews, #lectron, traduction dAdolphe Lepape (Paris, F. Alcan, 1926).
Fernandez, Bernard, 9e latome au noyau! une approche historique de la physique atomique et de
la physique nuclaire (Paris, Ellipses, 2006).
Radvanyi, Pierre, et Bordry, Monique, #a radioactivit artificielle et son histoire (Paris, Seuil, 1984),
coll. Points Sciences, nS42.
DOCUMENT POUR L1L.2E
Ce texte est extrait du livre clbre de Jean Perrin, #es atomes, publi la premire fois en 1913. l
a t de nombreuses fois rdit depuis. En 1970, dans la prsentation de louvrage, son fils,
Francis, lui aussi physicien rput, rappelle le contexte scientifique de cette publication.
Dans ce livre, Jean Perrin, montre laccord de mthodes profondment diffrentes dveloppes
vers la mme poque pour atteindre les grandeurs atomiques absolues. l apporte ainsi la preuve
43
de la ralit des atomes et des molcules, ralit qui tait alors conteste par dminents hommes
de science, qui, invoquant un positivisme rigoureux, estimaient quil fallait rejeter hors de la
science la notion mme des structures inaccessibles notre perception.
Les ions : hypothse dArrhnius E%eK%e "e )"us #ccessi="e )our "es *"&-esH
l sagissait de comprendre pourquoi une solution aqueuse, une eau sale par exemple, conduit le
courant (elle est un exemple de solution anormale* , puisqu'une eau sucre ne conduit pas le
courant, ou trs trs faiblement). l fallait admettre la dissociation totale de NaCl en > atomes libres
Pa et Cl ?1 > :t cest bien ce quosa soutenir avec une hardiesse gniale! un jeune homme de
vingt"cinq ans! *rrhnius B.,,VC1 Cette ide parut draisonnable beaucoup de chimistes! et cela
est bien curieu/! car! ainsi quWs6ald le remarqua aussitLt! elle tait en ralit profondment
conforme au/ connaissances qui leur taient le plus familires! et la nomenclature binaire
employe pour les sels : que tous les chlorures dissous aient en commun certaines ractions quel
que soit le mtal associ au chlore! cela se comprend trs bien si dans toutes les solutions e/iste
une mAme sorte de > molcules! ? qui ne peut Atre que > latome ? de chlore1 BC1 7ans se
proccuper de cet argument! les adversaires d*rrhnius trouvaient absurde quon pXt supposer
des atomes de sodium libres dans leau1 BC1 *rrhnius rpondait ces objections en sappuyant
sur le fait que les solutions > anormalesY ? conduisent llectricit1 Cette conductibilit se/plique si
les > atomes ? Pa et Cl que donne par dissociation une > molcule ? de sel sont charges
dlectricits contraires1 Mlus gnralement! toute molcule dun lectrolyte peut de mAme se
dissocier en atomes Bou groupes datomesC chargs lectriquement! que lon appelle des ions @
Wn admet que tous les ions dune mAme sorte! tous les ions Pa par e/emple dune solution de
PaCl! portent e/actement la mAme charge Bforcment gale celle que porte lun des ions Cl de
lautre signe! sans quoi leau sale se serait pas dans son ensemble lectriquement neutre!
comme elle lestC1 BC1 7i lon plonge dans leau sale une lectrode positive et une lectrode
ngative! les ions positifs seront attirs vers llectrode ngative ou cathode! les ions ngatifs
chemineront de mAme vers llectrode positive ou anode1 2n double courant de matire en deu/
sens opposs accompagnera donc le passage de llectricit1 *u contact des lectrodes! les ions
pourront perdre leur charge! et prendre du mAme coup dautres proprits chimiques1 Car un ion
qui diffre par sa charge de latome Bou du groupe datomesC correspondant! peut ne pas avoir du
tout les mAmes proprits chimiques1 (p. 73-75).
* remarque pour lenseignant : anormales : l s'agit de solutions qui ont un effet osmotique
lev et sont dans le mme temps de bons conducteurs d'lectricit (solutions d'lectrolytes forts).
Or les solutions aqueuses des lectrolytes (particulirement, les lectrolytes forts, et nous savons
pourquoi aujourd'hui) chappent aux lois de Raoult (abaissement du point de conglation de l'eau
beaucoup plus important que pour des solutions de molcules organiques ou d'lectrolytes
faibles), par exemple, voir cet effet la diffrence de comportement entre une eau sucre et une
eau sale). En ce sens elles sont "anormales".
L'observation d'Arrhnius impliquait qu'il y avait plus de particules charges que de "molcules" de
sel en solution. Les "anomalies" s'expliquent par le fait que toutes les particules (molcules et ions)
se comportent comme des molcules entires et interviennent dans les lois des solutions (Raoult,
1883-1885). Ces particules ne pouvaient venir que de la dissociation en solution des "molcules"
de sel, phnomne existant mme hors du circuit lectrique d'lectrolyse (on pensait
gnralement que les ions se formaient uniquement au moment de l'lectrolyse). Pour les lves,
on peut supprimer le mot "anormales", car je suppose qu'ils ignorent ce qu'est la pression
osmotique, ou leur dire que l'on considrait alors les solutions lectrolytiques comme semblables
l'eau sucre, c'est--dire o les molcules ont seulement t spares par l'action de l'eau. Que
justement cette anormalit n'en sera plus une quand on aura compris que le cristal en l'occurrence
NaCl ici aura t dissoci ds sa mise dans l'eau. En quelque sorte, la conclusion de l'extrait
propos permet l'explication de ce mot "anormales". On pourrait d'ailleurs en faire l'objet d'une
question.
44
"Premire ide dune charge lmentaire minimum"
"Pous venons dadmettre que tous les ions Cl de leau sale ont la mAme charge! et nous avons
attribu le/istence de cette charge la diffrence des proprits chimiques entre latome et lion1
Considrons maintenant! au lieu dune solution de chlorure de sodium! une solution de chlorure de
potassium1 #es proprits chimiques dues au/ ions chlore Bprcipitation par le nitrate dargentC!
se retrouvent les mAmes1 #es ions chlore du chlorure de potassium sont donc probablement
identiques ceu/ du chlorure de sodium et ont donc la mAme charge1 Comme les solutions sont
neutres! les ions sodium et potassium ont aussi la mAme charge prise avec un signe contraire1 Wn
serait ainsi conduit de proche en proche penser que tous les atomes ou groupes monovalents
datomes BC portent quand ils deviennent libres sous forme dions la mAme charge lmentaire e!
positive ou ngative1 BC Mar l! se trouve mise en vidence une relation importante entre la
valence et la charge des ions : chaque valence brise dans un lectrolyte correspond lapparition
dune charge toujours la mAme sur les atomes que reliait cette valence1 9u mAme coup! la charge
dun ion doit toujours Atre un multiple e/act de cette charge lmentaire invariable! vritable
atome d3lectricit1
Ces prsomptions sont en complet accord avec les connaissances que nous donne ltude prcise
de llectrolyseT1 (p. 76-77)
" #es proprits des lectrolytes suggrent le/istence dune charge lectrique indivisible!
ncessairement porte un nombre entier de fois par chaque ion".
Les corpuscules de J. J. Thomson daprs Jean Perrin (1913)
J.J. Thomson tudie les projectiles lectriss produits dans un tube de Crookes. l suppose que
ces projectiles provenant de la cathode, et dits cathodiques " sont toujours identiques et que
chacun deu/ porte un seul atome dlectricit ngative! et par suite est environ .,++ fois plus
lger que le plus lger de tous les atomes1 9e plus! puisquon peut les produire au/ dpens de
nimporte quelle matire! cest""dire au/ dpens de nimporte quel atome! ces lments matriels
forment un constituant universel commun tous les atomes @ Ghomson a propos de les appeler
corpuscules1 Wn ne peut considrer un corpuscule indpendamment de la charge ngative quil
transporte : il est insparable de cette charge! il est constitu par cette charge1 'ncidemment! la
haute conductibilit des mtau/ se/plique bien simplement! si lon admet que certains au moins
des corpuscules prsents dans leurs atomes peuvent se dplacer sous laction du plus faible
champ lectrique! passant dun atome lautre! ou mAme sagitant dans la masse mtallique aussi
librement que des molcules dans un ga-1 7i nous nous rappelons quel point la matire est vide
et caverneuse cette hypothse ne nous tonnera pas trop. (p. 241-242).
Extraits de Jean Perrin, #es atomes, 1
re
d. 1913, rd. 1970 (Paris, PUF).
Pr*)#r#%ion $u %eK%e
Le professeur pourra utiliser un des extraits, ou lensemble, proposs dans une dmarche
progressive de dcouverte de la structure ionique et de lexistence de llectron. Pour chaque
extrait, il faudra expliquer simplement aux lves le contexte scientifique de lpoque : lignorance
o lon tait de la vritable structure de la matire, la ncessit dinventer des procdures et de
monter des expriences pour vrifier les hypothses proposes. En tenant compte des
dcouvertes, faire sentir aux lves la ncessit dinventer aussi un vocabulaire adapt qui dcrit
bien les objets scientifiques tudis ou dcouverts. ci, le mot lectron nest pas mis en avant.
Perrin prfre lexpression " atome dlectricit tant que lon na pas mis en vidence lexistence
dabord puis la singularit ensuite de la particule. l rappelle galement la proposition smantique
de Thomson qui parle de corpuscule. Cest seulement quelques annes aprs que le mot lectron
tel que le dfinit Stoney est appliqu au corpuscule de Thomson.
De mme lacceptation de lexistence des particules charges dans un lectrolyte demande
plusieurs annes. Perrin le montre bien en ne nommant pas a priori les particules libres lors de
la dissociation dun sel dans leau. Ce nest quaprs avoir expliqu son lecteur et lavoir amen
comprendre ce qui se passe dans la solution quil propose le mot dion (Le mot avait t propos
par Faraday pour caractriser les particules charges qui intervenaient au moment de
45
l'lectrolyse ; il a galement propos les mots : cathode, anode, cation et anion, vers 1833-34).
Lcriture ionique avec le signe de la charge en haut droite est encore loin dtre propose, do
lcriture qui apparat drangeante ici, mais qui sera lobjet dune explication, ou dune proposition
du professeur. Ce dernier amnera llve proposer une criture pour diffrencier latome tout
court de latome charg quil appellera alors ion.
Danile Fauque
46
ANNE(E 41 '/ 4r&-e his%oire $es )h*nom&nes *"ec%rom#,n*%iques
E0F'G-0F30H
Sur ce thme, Danile FAUQUE propose un document destin aux professeurs. Ce
document se trouve sur le site de lacadmie de Paris (http://physique.scola.ac-paris.fr/).
ANNE(E 41 3/ L1u%i"is#%ion $e "1#"%ern#%eur
)our "# )ro$uc%ion i n$us% ri e" " e $1*"ec%rici%*
tude de document support historique - J. Jandaly
TeK%e $es%in* #uK )ro+esseurs
En 1831, lAnglais Michael Faraday dcouvre le phnomne dinduction en dplaant un
aimant par rapport un circuit. Ds lors, on sait convertir lnergie mcanique en nergie
lectrique. Ds 1832, Ampre fait construire par son compatriote Hippolyte Pixii une machine
manivelle faisant tourner un aimant en U (inducteur) devant deux bobines (induit),
produisant ainsi un courant alternatif. Adjoignant ensuite sa machine un commutateur
dAmpre , Pi xii produit un courant continu.
Diffrents perfectionnements sont apports par la suite aux gnrateurs lectri ques. Ainsi
lAnglais Edward Clarke construit une machine induit mobile (laimant est fixe). En 1864,
ltalien Antonio Pacinotti conoit un induit mobile en forme danneau dot dun collecteur. En
1866, LAllemand Werner von Siemens construit une dynamo dans laquelle les aimants
inducteurs sont remplacs par des lectroaimants aliments par la machine elle-mme, et
linduit est constitu denroulements sur un tambour, disposition toujours adopte
actuellement. En 1871, le Belge Znobe Gramme fait construire une machine entrane par
un moteur vapeur, dont on peut dire quelle est la premire pouvoir produire industriel-
lement de llectricit.
On voit que, ds les annes 1870, on est capable de )ro$uire industriellement aussi bien du
courant continu que du courant alternatif
( cette poque cependant, la prfrence va trs
nettement au courant continu : la machine de Gramme, par exemple, est courant
continu). Mais la difficult se situe au niveau du %r#ns)or%! la tension chute rapidement
mesure que la longueur de la ligne augmente.
La fin du XX
e
sicle va voir se l i vrer une lutte svre entre tenants du courant continu et
tenants du courant alternatif pour la production industriel l e.
En 1881, une grande exposition est organise Paris pour prsenter les diffrents appareils
capables de produire, de transporter et dutiliser llectricit. Elle accueille prs dun million de
visiteurs.
Le Franais Marcel Deprez est un partisan du courant continu. Les expriences quil mne
successivement (liaison La Chapelle-Le Bourget en 1883, puis La Chapelle-Creil en 1885 par
exemple) ne donnent pas les rsultats escompts. Pendant ce temps, son compatriote
Lucien Gaulard dfend le courant alternatif. En 1883, il dpose avec lAnglais John Dixon
Gibbs le brevet dun appareil qui sera appel plus tard transformateur ; le rendement
annonc est de 90 %. Face aux critiques des tenants du courant continu, Gaulard installe
avec succs en 1884, loccasion de lexposition dlectricit de Turin, une ligne de 80 km
entre Turin et Lanzo. Le cour#n% #"%ern#%i+ lemporte, en France du moins, car, aux tats-
Unis, le courant continu possde un solide dfenseur en la personne dEdison !
En 1885, ltalien Galileo Ferraris montre que des courants alternatifs polyphass peuvent
crer un champ magntique tournant. En 1888, le Croate Nikola Tesla construit sur ce
principe un moteur triphas.
Dans toute lEurope et aux tats-Unis, de nombreux constructeurs se livrent une
47
concurrence svre dans le domaine de la construction dappareils lectriques, et en
particulier de gnrateurs.
En 1913, le rseau franais de distribution est encore trs morcel : la production est faite
par un grand nombre de petites usines, et le courant distribu sur des distances assez
faibles ; cette date, seules 6000 communes, sur 36000 environ, sont quipes.
Aprs la Premire Guerre mondiale, commence linterconnexion des rseaux. En 1920 sont
construites les premires lignes reliant la Suisse, ltalie, lAllemagne avec la France.
En 1936, la plupart des communes de France reoivent llectricit.
En avril 1946, une grande part des usines de production et des rseaux de distribution sont
regroups dans la socit nationale lectricit de France.
TeK%e $es%in* #uK *"&-es
Remarque : en mme temps que ce texte, on peut prsenter aux lves diffrentes
illustrations de machines dpoque [voir le site du muse des Arts et mtiers de
Paris (http://www.arts-et-metiers.net/) et le site du muse de llectricit de Mulhouse
(http://www.electropolis.tm.fr/)].
En 1831, lAnglais Michael Faraday dcouvre le phnomne dinduction, cest--dire la
cration dun courant par un aimant mobile. Ds lors on sait convertir lnergie mcanique en
nergie lectrique. Ds 1832, Ampre fait construire par son compatriote Hippolyte Pixii une
machine manivelle faisant tourner un aimant en U (inducteur) devant deux bobines (induit),
produisant ainsi un courant alternatif. Adjoignant ensuite sa machine un commutateur
dAmpre , Pixii produit un courant continu.
Ensuite, les physiciens amliorent la qualit et la puissance des gnrateurs lectriques. Par
exemple, ils remplacent les aimants par des lectroaimants : ce sont des bobines
parcourues par un courant lectrique qui se comportent comme des aimants, mais avec un
champ magntique qui peut tre trs fort si la bobine comporte beaucoup de spires et si
lintensit du courant est leve.
En 1871, le Belge Znobe Gramme fait construire une machine entrane par un moteur
vapeur, dont on peut dire quelle est la premire pouvoir produire industriellement de
llectricit.
En 1881, une grande exposition est organise Paris pour prsenter les diffrents appareils
capables de produire, de transporter et dutiliser llectricit. Elle accueille prs dun million de
visiteurs. On y voit aussi bien des gnrateurs de courant alternatif que des gnrateurs de
courant continu, mme si ces derniers ont la faveur des utilisateurs de lpoque (la machine
de Gramme, par exemple, est courant continu). Cependant, tous les constructeurs
rencontrent des difficults importantes pour transporter lnergie lectrique : en effet la
tension chute rapidement mesure que la longueur de la ligne augmente, cause des
pertes par effet Joule.
Cest entre les annes 1880 et 1890 quest dcouvert un appareil appel transformateur .
Cet appareil, qui ne fonctionne quen courant alternatif, permet volont dlever ou
dabaisser la tension lectrique. Cela est trs intressant car, pour une nergie transporte
donne, plus la tension est leve, plus les pertes par effet Joule sont rduites. Le
transformateur assure le succs du courant alternatif face au courant continu.
Le domaine de la construction dappareils lectriques, et en particulier de gnrateurs, est
devenu un enjeu conomique majeur : dans toute lEurope et aux tats-Unis, de nombreux
constructeurs se livrent une concurrence svre. Cest au dbut du XX
e
sicle
quapparaissent sur le march la plupart des appareils lectriques mnagers : grille-pain, fer
repasser, machine coudre, ventilateur, sonnette, etc.
En 1913, le rseau franais de distribution est encore trs morcel: la production est faite par
un grand nombre de petites usines, et le courant distribu sur des distances assez faibles ;
cette date, seules 6000 communes, sur 36000 environ, sont quipes.
En 1936, la plupart des communes de France reoivent llectricit.
48
En avril 1946, un grande part des usines de production et des rseaux de distribution sont
regroups dans la socit nationale lectricit de France.
Ques%ions ni-e#u 0 Er*)onses $#ns "e %eK%eH
Quel est lavantage des lectroaimants sur les aimants ?
Pourquoi le transformateur* assure-t-il le succs du courant alternatif face au courant
continu ?
lpoque de la Premire Guerre mondiale, llectricit tait-elle distribue dans toute la
France ?
Ques%ions ni-e#u '
Er*)onses : chercher $#ns une encyc"o)*$ieH
Combien de temps sest-il coul entre la dcouverte de la pile par Volta et la mise au point
de la machine de Pixii ? (Rponse : pile de Volta en 1800, donc environ trente ans.)
On nous dit que les gnrateurs transforment lnergie mcanique en nergie lectrique.
Do peut provenir cette nergie mcanique ?
(Rponse: des chutes deau des barrages, ou de la vapeur deau dans les centrales
thermiques.)
Quels sont les appareils cits dans le texte qui transforment lnergie lectrique en nergie
mcanique ?
(Rponse: les appareils comportant un moteur, tels les machines coudre, les ventilateurs.)
Parmi les appareils lectriques mnagers cits dans le texte, quels sont ceux dans lesquels
leffet Joule est mis profit ?
(Rponse: grille-pain, fer repasser.)
Parmi les appareils lectriques mnagers cits dans le texte, quels sont ceux dans lesquels
leffet magntique est mis profit ?
(Rponse: les appareils moteur dj cits, les transformateurs, les sonnettes.)
* rappel : ltude du transformateur nest pas au programme mais ce texte permet de
rpondre dventuelles questions dlves.
49
ANNE(E 41 7/ L1#"imen%#%ion *"ec%rique $es %r#ins
Voir le site de lacadmie de Paris
50
ANNE(E C1 ! "es TIC e% "e 4'i
ANNE(E C10/ Con%ri=u%ions $e "# )hysique-chimie #u 4'i 6 $om#ine 3
Des exemples (-oir "e +ichier # contributions de la physique-chimie au 45i 6 domaine +.7ls )),
labors par G. Denis de lacadmie de Paris, utilisent le tableur-grapheur. ls concernent :
& poids et masse dun objet ;
& vitesse dune goutte ;
& distance darrt dun vhicule ;
& tension aux bornes dun GBF.
ANNE(E C1'/ Recherche $ocumen%#ire ! : )ro)os $e 2o"%#
Une recherche documentaire, propos de Volta et la dcouverte de la pile, est propose sur le site de
lacadmie de Paris (http://physique.scola.ac-paris.fr/). Elle exploite une ressource disponible sur le site
http:// www.academie-sciences.fr/membres/in_memoriam/Volta/Volta_oeuvre.htm
51
ANNE(E C13/ SDTICE
Des ressources num*riques e% $es us#,es $es TIC )our "Censei,nemen%
$es sciences )hysiques e% chimiques +on$#men%#"es e% #))"iqu*es
par Christine TRABADO
Sous - direction des technologies de l'information et de la communication pour l'ducation
On trouvera ci-aprs :
- des ressources numriques (des produits reconnus dintrt pdagogique, des logiciels
libres sur le SALLE, des ressources audiovisuelles) ;
& des usages des TC (indexs dans la banque de pratiques acadmiques EDUBases physique-
chimie) ;
& des pistes dactivits pour le B2i ;
- une lettre d'information professionnelle TCEdu.
I/ Des ressources num*riques
0H L# m#rque UReconnu $CIn%*rM% )*$#,o,iqueU ERIPH
La marque RP, destine guider les enseignants dans le monde du multimdia pdagogique, est
prsente sur le site Educnet :
http://www2.educnet.education.fr/sections/contenus/rip/
On y trouve aussi la liste des produits RP en sciences physiques
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/ressources/rip/
ainsi que des tutoriels permettant une prise en main rapide de quelques logiciels :
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/ressources/assistance/
'H SIALLE (Service dnformation et dAnalyse des Logiciels Libres ducatifs)
Le SALLE propose une slection de logiciels libres destins la communaut ducative, tlcharger et
valuer.
http://www.sialle.education.fr/accueil.php
3H Ressources #u$io-isue""es
Quelques adresses
Pour dcouvrir et suivre l'actualit des ressources audiovisuelles libres de droits pour une utilisation en
classe le site Educnet propose ladresse de quelques sites
http://www2.educnet.education.fr/contenus/avmm?affdoc=1
Le site.tv
Le site.tv, rserv aux tablissements scolaires, propose aux enseignants, documentalistes et lves
d'accder la demande et d'utiliser, en classe ou au CD, des squences audiovisuelles ducatives
courtes.
Pour tre utilisateur du service, un tablissement scolaire ou sa collectivit locale de tutelle (ville,
dpartement ou rgion) doit souscrire un abonnement.
Ladresse du site est : http://www.lesite.tv/
Des extraits des vidos sont accessibles hors abonnement.
Par exemple Energie : centrale lectrique
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&ne=2&d=171&n=123&p=507&f=0435.0098.00
52
Curiosphere.tv
Curiosphere, TV ducative en libre accs sur le Web, met les ressources vidos de France 5 et de ses
partenaires au centre de son offre.
http://www.curiosphere.tv/
II/ Des us#,es $es TIC
EDUbases
Des activits pdagogiques impliquant lusage des TC sur diffrents thmes du programme ont t
conues, exprimentes en classe, et mises en ligne sur des sites acadmiques puis indexes dans la
banque nationale EDUbases Physique-Chimie
Comment effectuer une recherche dans EDUbases Physique-Chimie ?
Soit par une recherche prformate en cliquant partir dun niveau denseignement sur lun des
intituls des diffrentes parties du programme :
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/pratiques/college/troisieme
Soit par une recherche gnrale. Voir :
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/pratiques/edubasepc/
III/ Des )is%es $1#c%i-i%*s )our me%%re en Vu-re "e 4'i ((Brevet informatique et
nternet)
Un formulaire de recherche permet d'accder des fiches d'activits mettant en oeuvre des
comptences du B2i au cours dactivits pdagogiques en sciences physiques.
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/b2i
On trouvera aussi des pistes dactivits classes :
par domaine du B2i
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/b2i/pistes-domaine
par niveau denseignement
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/b2i/pistes-niveau
2I/ Une "e%%re $1in+orm#%ion )ro+essionne""e TIC1E$u
TIC1E$u
En collaboration avec l'GEN (nspection gnrale de l'ducation nationale), la SDTCE propose une lettre
d'information TCE spcifique chaque discipline.
Les lettres TCEdu physique-chimie sont consultables ladresse suivante :
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/communication/ticedu/
53
ANNE(E D1 ! "# "i#ison co""&,e-"yc*e
C
h
i
m
i
e
- Leau dans notre
environnement.
- Mlanges aqueux :
homognes et htrognes.
- Mlanges homognes et corps
purs.
- Les tats physiques de leau.
- Proprits spcifiques de
chaque tat.
- Cycle de leau.
- Mesures de masse et de
volume.
- Changements dtat de leau.
- Leau est un solvant.
-L1#u,men%#%ion $e "#
%em)*r#%ure $1un cor)s )ur
n*cessi%e un #))or%
$1*ner,ie/
- L# +usion e% "# -#)oris#%ion
$1un cor)s )ur n*cessi%en% un
#))or% $1*ner,ie/
- Composition de lair.
- Volume et masse de lair.
- Compressibilit de lair.
- Une description molculaire pour comprendre.
- Combustions du carbone, du mthane ou du butane.
- Les com=us%ions $u c#r=one e% $u m*%h#ne Eou
$u =u%#neH "i=&ren% $e "1*ner,ie.
- Ractifs et produits.
- Danger des combustions incompltes.
- Les atomes et la transformation chimique.
- Symboles de quelques atomes et formules de
quelques molcules.
- Ecriture des quations de raction.
- Conservation des atomes et de la masse au cours
dune transformation chimique.
Utilisation des mtaux dans la vie quotidienne.
- Llectron et la conduction lectrique dans les mtaux.
- Lion et la conduction lectrique dans les solutions
aqueuses.
- Constituants de latome : noyau et lectrons.
- Test de reconnaissance de quelques ions.
- Acidit et pH des solutions aqueuses.
- Raction entre lacide chlorhydrique et le fer.
- Une pile lectrochimique : raction entre les ions cuivre
et le zinc.
-"es es)&ces chimiques )r*sen%es $#ns une )i"e
con%iennen% $e "1*ner,ie chimique $on% une )#r%ie es%
%r#ns+*r*e sous $1#u%res +ormes $1*ner,ie "orsqu1e""e
+onc%ionne/
- L1*ner,ie mise en ?eu $#ns une )i"e )ro-ien% $1une
r*#c%ion chimique/
-Synthses de larme de banane (espce chimique
existant dans la nature) et du nylon ou dun savon
(espce chimique nexistant pas dans la nature).
M
*
c
#
n
i
q
u
e
- Prsentation succincte du systme solaire.
- Action attractive distance exerce par le Soleil sur les
plantes .
- Notion de gravitation.
- Poids et masse dun corps : units et relation P =
m.g
- Energies mcanique, de position, de mouvement
appele nergie cintique.
- Un o=?e% )oss&$e !
& une *ner,ie $e )osi%ion #u -oisin#,e $e "#
Terre I
& une *ner,ie $e mou-emen% #))e"*e
*ner,ie cin*%ique/
- L# somme $e ses *ner,ies $e )osi%ion e% cin*%ique
cons%i%ue son *ner,ie m*c#nique/
- L# re"#%ion $onn#n% "1*ner,ie cin*%ique $1un so"i$e
en %r#ns"#%ion es% ! E
c
W X m/-
'
- Conser-#%ion $e "1*ner,ie #u cours $1une chu%e/
- Ener,ie cin*%ique e% s*curi%* rou%i&re/
L
u
m
i
&
r
e
- Sources de lumire.
- Entre de la lumire dans
loil.
- Diffusion de la lumire.
- Propagation rectiligne.
- Modle du rayon de lumire et
du faisceau de lumire.
- Ombre propre, ombre porte
et cne dombre.
- Systme Soleil Terre
Lune.
- Phases de la Lune, clipses.
- Dcomposition de la lumire blanche.
- Utilisation de filtres colores.
- Synthse additive des couleurs.
- Couleur des objets en lumires colores.
- Obtention dune image laide dune lentille mince
convergente.
- En #=sor=#n% $e "# "umi&reD "# m#%i&re reYoi% $e
"1*ner,ie/
- Une "en%i""e mince con-er,en%e concen%reD )our
une source *"oi,n*eD "1*ner,ie "umineuse en son
+oyer/
- Foyer et distance focale.
- Loil : la vision, la correction des dfauts de loil.
- Vitesse de la lumire.
- Ordres de grandeur de distances et de dures de
propagation de la lumire dans lUnivers.
"
e
c
%
r
i
c
i
%
*
- Circuits lectriques simples :
ralisation et schmatisation.
- Sens conventionnel du
courant.
- Conducteurs et isolants.
- Circuit lectrique en boucle
simple (en srie)
- Circuit lectrique comportant
des drivations. - Court-circuit.
- Un gnrateur transfre de
lnergie lectrique chacun
des diples placs en srie.
- Une photopile convertit de
lnergie lumineuse en nergie
lectrique.
- ntensit et tension : deux grandeurs lectriques
issues de la mesure.
- Units de mesures de lintensit et de la tension.
- Utilisation dun ampremtre et dun voltmtre.
- Lois dunicit de lintensit dans un circuit en srie et
dadditivit de lintensit dans un circuit comportant des
drivations.
- Lois dadditivit des tensions dans un circuit en srie
et dgalit des tensions aux bornes de deux diples
en drivation.
- nfluence dune rsistance dans un circuit lectrique
en srie.
- Le ,*n*r#%eur +ourni% $e "1*ner,ie : une
r*sis%#nce qui "# %r#ns+&re sous +orme $e ch#"eur/
- Loi dOhm.
- Production dnergie lectrique : lalternateur.
- Tension continue et tension alternative priodique.
- Valeur maximale, priode et frquence.
- Oscilloscope ou interface dacquisition : instrument de
mesures de tension et de dure.
- Voltmtre en tension sinusodale : valeur efficace.
- Puissance et nergie lectriques : units, relations
P = U. et E = P.t
- L1*ner,ie reYue )#r "1#"%ern#%eur es% con-er%ie en
*ner,ie *"ec%rique/
- Dis%inc%ion en%re "es sources $1*ner,ie
renou-e"#="es ou non/
- L1*ner,ie *"ec%rique E %r#ns+*r*e )en$#n% une $ur*e
% : un #))#rei" $e )uiss#nce nomin#"e P es% $onn*e
)#r "# re"#%ion ! E W P/%
C"#sse $e cinqui&me C"#sse $e qu#%ri&me C"#sse $e %roisi&me
En caractre gras les acquis relatifs lnergie
54
Vous aimerez peut-être aussi
- Repere FormationDocument33 pagesRepere FormationkrommPas encore d'évaluation
- ContinueDocument3 pagesContinueMed yahya100% (1)
- Jurys - CESS Technique Et Artistique de Transition - Programmes (Ressource 14059)Document1 pageJurys - CESS Technique Et Artistique de Transition - Programmes (Ressource 14059)dfhohfeicxhPas encore d'évaluation
- DauphineDocument32 pagesDauphinefran22_laloma100% (1)
- Boursorama - Formulaire-Ouverture CompteDocument5 pagesBoursorama - Formulaire-Ouverture CompteNaima BenadaPas encore d'évaluation
- Physique Chimie College Classe de TroisiemeDocument55 pagesPhysique Chimie College Classe de TroisiemeASMA AHARTAFPas encore d'évaluation
- Cours 2020 Lphys1345Document3 pagesCours 2020 Lphys1345SabaPas encore d'évaluation
- Animations Gep Juin 2005 Version23maiDocument15 pagesAnimations Gep Juin 2005 Version23mainisrine sellaiPas encore d'évaluation
- Microreacteurs cfm2015 PDFDocument7 pagesMicroreacteurs cfm2015 PDFDoha assadPas encore d'évaluation
- PolyTD EDP PDFDocument15 pagesPolyTD EDP PDFChiheb MamriPas encore d'évaluation
- Cours 2017 Lgbio2030aDocument3 pagesCours 2017 Lgbio2030aghodbanePas encore d'évaluation
- 1e STI2D Physique-Chimie Et Mathematiques 1025407Document25 pages1e STI2D Physique-Chimie Et Mathematiques 1025407shoot 93tPas encore d'évaluation
- Cours 2017 LBIR1122Document3 pagesCours 2017 LBIR1122PrincePas encore d'évaluation
- ST308MF Mecanique Des FluidesDocument3 pagesST308MF Mecanique Des FluidesMouadBtkPas encore d'évaluation
- Physique Pour ConstructeursDocument33 pagesPhysique Pour Constructeursgamalielmalaba903Pas encore d'évaluation
- CHM 131 PDocument4 pagesCHM 131 PAbdelhadi KarbalPas encore d'évaluation
- Les Sciences Physiques Et Chimiques Et Leur Valuation Dans Les B T S 67437Document23 pagesLes Sciences Physiques Et Chimiques Et Leur Valuation Dans Les B T S 67437serkan gunduzPas encore d'évaluation
- Licence en Physique GeneraleDocument42 pagesLicence en Physique GeneraleKimou HakimPas encore d'évaluation
- CURRICULUMVITAEBENYOUCEFFvrier2017 PDFDocument99 pagesCURRICULUMVITAEBENYOUCEFFvrier2017 PDFBACHIRI WahibaPas encore d'évaluation
- Draft Programme Physique Terminale EDocument16 pagesDraft Programme Physique Terminale EjosephPas encore d'évaluation
- Cycle Central Prog Phychim 54Document21 pagesCycle Central Prog Phychim 54Basheer AbouzizouPas encore d'évaluation
- p2017 Agreg Ext Spe Phys Chimie 609798Document5 pagesp2017 Agreg Ext Spe Phys Chimie 609798mikletPas encore d'évaluation
- Les Activités Expérimentales Dans L'enseignement Des Sciences Physiques: Cas Des Collèges MarocainsDocument23 pagesLes Activités Expérimentales Dans L'enseignement Des Sciences Physiques: Cas Des Collèges MarocainszahrabenghPas encore d'évaluation
- Master Physique EnergetiquehDocument50 pagesMaster Physique Energetiquehsamer menPas encore d'évaluation
- Cours 2017 lchm1341 PDFDocument2 pagesCours 2017 lchm1341 PDFعادل الحمديPas encore d'évaluation
- Guide 2008-2009 Chimie PDFDocument178 pagesGuide 2008-2009 Chimie PDFⵎⵓⵍⵓⴷ ⵃⴰⴷⵉⴷPas encore d'évaluation
- L'Enseignement - Physique - ChimieDocument61 pagesL'Enseignement - Physique - ChimieAbaay2013100% (1)
- HDRPresentation PDFDocument48 pagesHDRPresentation PDFAli FguiriPas encore d'évaluation
- Physique PsiDocument20 pagesPhysique PsiarnaudmarielPas encore d'évaluation
- Cours 2017 Lbrna2103Document3 pagesCours 2017 Lbrna2103kattyPas encore d'évaluation
- PGMW 001 JDocument3 pagesPGMW 001 JAntoine lazarus MaomyPas encore d'évaluation
- Phy Chim 3Document36 pagesPhy Chim 3Sa LoudPas encore d'évaluation
- AérodynamiqueDocument90 pagesAérodynamiqueSalim CheikhPas encore d'évaluation
- Hydrologie Et ProbabilitésDocument265 pagesHydrologie Et Probabilitésscribdandfloatreader100% (1)
- Electric It eDocument53 pagesElectric It edjeph matokoPas encore d'évaluation
- Cours 2017 lchm1331Document2 pagesCours 2017 lchm1331FaouziSediriPas encore d'évaluation
- Programme de Chimie 1TSI 02-08-2023 MarocDocument20 pagesProgramme de Chimie 1TSI 02-08-2023 Maroclahcen elamraouiPas encore d'évaluation
- Syllabus-i2c-2020-2021-Fr-Vfinale Syllabus de Genie Mecanique Quebec BanzaDocument141 pagesSyllabus-i2c-2020-2021-Fr-Vfinale Syllabus de Genie Mecanique Quebec Banzacarlos matondoPas encore d'évaluation
- Projet de Programme de Physique 2nde C - FinalDocument14 pagesProjet de Programme de Physique 2nde C - Finalbenjamin itoePas encore d'évaluation
- RA034Document211 pagesRA034Ivan NGOMO NANGPas encore d'évaluation
- BUPhistoireetmodlisationDocument25 pagesBUPhistoireetmodlisationZakari YaePas encore d'évaluation
- Notice Explicative Erbd en LigneDocument6 pagesNotice Explicative Erbd en LigneAmadou SouleyPas encore d'évaluation
- Fopc 53170Document4 pagesFopc 53170Imen JabariPas encore d'évaluation
- Program Licence Chimie Parcours Physique Chimie l1 l2 l3 2Document7 pagesProgram Licence Chimie Parcours Physique Chimie l1 l2 l3 2Awa BeyePas encore d'évaluation
- Chapitre I Nomenclature Esb 132 Et 152 Annee 2022-2023 Groupe A B MCHPDocument57 pagesChapitre I Nomenclature Esb 132 Et 152 Annee 2022-2023 Groupe A B MCHPZack LapPas encore d'évaluation
- FS Bachelor Syst-NaturelsDocument2 pagesFS Bachelor Syst-NaturelsGANGAK JacquesPas encore d'évaluation
- Réviser Et Préparer Les Concours - Nov 2020Document3 pagesRéviser Et Préparer Les Concours - Nov 2020thieri khanPas encore d'évaluation
- Maths Pour Le Physicien Tome 1Document272 pagesMaths Pour Le Physicien Tome 1coulibalyzakaria898Pas encore d'évaluation
- Chimie CHM122Document4 pagesChimie CHM122Djoumessi SylvianePas encore d'évaluation
- These Ramsey Herrera DavidDocument156 pagesThese Ramsey Herrera DavidNajoua ZergaouiPas encore d'évaluation
- Cours 2021 Wdent1204Document2 pagesCours 2021 Wdent1204GANGAK JacquesPas encore d'évaluation
- 15 - Dgesip - Arrete Tipe en CpgeDocument5 pages15 - Dgesip - Arrete Tipe en CpgePolat WalidPas encore d'évaluation
- Mpsi 2014Document8 pagesMpsi 2014N'solé YAMONTCHEPas encore d'évaluation
- Brochure L1 L2 Physique 2020-2021Document65 pagesBrochure L1 L2 Physique 2020-2021maomoulaurentmory6824Pas encore d'évaluation
- Cours - 11C121 Chimie Générale Pour Étudiant-E-S en MédecineDocument2 pagesCours - 11C121 Chimie Générale Pour Étudiant-E-S en MédecineZo CorPas encore d'évaluation
- Chimie Minerali I PDFDocument179 pagesChimie Minerali I PDFIkrăm La Bèlle Flēur100% (1)
- Reg 3Document112 pagesReg 3Wolf Bensley SAINSURINPas encore d'évaluation
- Educ ProgrammDocument35 pagesEduc ProgrammSuper arabienPas encore d'évaluation
- Mecanique Des Fluides ECN 2008Document223 pagesMecanique Des Fluides ECN 2008sylvain koudadje67% (3)
- L' Injection électronique: Tutoriel et GuideD'EverandL' Injection électronique: Tutoriel et GuideÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- L'apprentissage des sciences et des technologies par l'expérimentation – Module 4: Le magnétismeD'EverandL'apprentissage des sciences et des technologies par l'expérimentation – Module 4: Le magnétismePas encore d'évaluation
- L' enseignement explicite dans la francophonie: Fondements théoriques, recherches actuelles et données probantesD'EverandL' enseignement explicite dans la francophonie: Fondements théoriques, recherches actuelles et données probantesPas encore d'évaluation
- Ressources Internet Nouv Prog 3emeDocument1 pageRessources Internet Nouv Prog 3emeheneman100% (7)
- Histoire de L'électricitéDocument2 pagesHistoire de L'électricitéheneman100% (3)
- Pluies AcidesDocument44 pagesPluies AcideshenemanPas encore d'évaluation
- Les Pluies AcidesDocument7 pagesLes Pluies Acidesheneman100% (5)
- Le Système HACCPDocument3 pagesLe Système HACCPInga JurjuPas encore d'évaluation
- Formule Irg PcpaieDocument3 pagesFormule Irg PcpaiebroadspacePas encore d'évaluation
- Creyssensac Catalogue Tarif 2021Document92 pagesCreyssensac Catalogue Tarif 2021daliPas encore d'évaluation
- 3-Section de La RegulationDocument9 pages3-Section de La Regulationtaibaoui MohamedPas encore d'évaluation
- Lave LingeDocument11 pagesLave LingeEsquille WinsouPas encore d'évaluation
- Analyse Du Limiteur de Pression PDFDocument8 pagesAnalyse Du Limiteur de Pression PDFfoufouaPas encore d'évaluation
- Gds KD 5 H OFd 8 MV0 BP 7 P 22 LWDocument2 pagesGds KD 5 H OFd 8 MV0 BP 7 P 22 LWLOBRI BERNARD OKOUPas encore d'évaluation
- Confirmation 2330564559 PDFDocument2 pagesConfirmation 2330564559 PDFMohammed MejdoubPas encore d'évaluation
- La Gestion Des Ressources Humaines: Réalisé ParDocument33 pagesLa Gestion Des Ressources Humaines: Réalisé ParKassid MohammedPas encore d'évaluation
- 2 Musica ItalianaDocument56 pages2 Musica ItalianaIgor100% (1)
- Despiece Haulotte 3510Document694 pagesDespiece Haulotte 3510KRALICEK OBRAS CIVILESPas encore d'évaluation
- GrafcetDocument109 pagesGrafcetTko ToolPas encore d'évaluation
- Catalogo STM Linea Standard - UMI - WMIDocument238 pagesCatalogo STM Linea Standard - UMI - WMIManuel vasquezPas encore d'évaluation
- CCTP Lot 12 Chauffage - Ventilation - PlomberieDocument34 pagesCCTP Lot 12 Chauffage - Ventilation - PlomberieB. ABDELLAHPas encore d'évaluation
- Atelier Qualité Et MaintenanceDocument41 pagesAtelier Qualité Et MaintenanceGhofrane GhofranePas encore d'évaluation
- Quand Twitter S'invite À L'écoleDocument3 pagesQuand Twitter S'invite À L'écoleSebastien FantiPas encore d'évaluation
- Série de Révision N 6 Bac Info Tech Filtre 2022Document5 pagesSérie de Révision N 6 Bac Info Tech Filtre 2022B0RHEN DH100% (1)
- MikielaDocument50 pagesMikielaandokouassiarmelPas encore d'évaluation
- Certificat de Vie Fedris - Levensbewijs - in - 6 - Talen - FR - 0Document2 pagesCertificat de Vie Fedris - Levensbewijs - in - 6 - Talen - FR - 0musta05Pas encore d'évaluation
- Budget de ProductionDocument7 pagesBudget de ProductionBahaj YoussefPas encore d'évaluation
- Des Méthodes ActivesDocument42 pagesDes Méthodes ActivesElhadi MebarkiPas encore d'évaluation
- Brochure Serame 2019 FRDocument11 pagesBrochure Serame 2019 FRsoul BeloPas encore d'évaluation
- Les Dialogues Avec Notre Ange Sand & JenaëlDocument1 042 pagesLes Dialogues Avec Notre Ange Sand & JenaëlMimidbe Bibi100% (1)
- Easy UPS 3S - E3SUPS20KHB1Document3 pagesEasy UPS 3S - E3SUPS20KHB1Okba GhodbaniPas encore d'évaluation
- Commande Des Convertisseurs DC-DC Par Mode de GlissementDocument360 pagesCommande Des Convertisseurs DC-DC Par Mode de GlissementSouhaib Louda100% (1)
- AeroDocument87 pagesAeroRana HnaPas encore d'évaluation
- Nature en Fête 2019 - Saint-Avertin - 13 Et 14 AvrilDocument2 pagesNature en Fête 2019 - Saint-Avertin - 13 Et 14 AvrilAnonymous dLgx6znPas encore d'évaluation
- Initiation Aux Réseaux SociauxDocument18 pagesInitiation Aux Réseaux SociauxCaroline BaillezPas encore d'évaluation