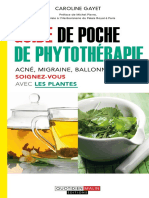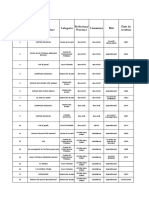Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
A Famille LE Complexe Facteur Concret DE LA Psychologie Familiale ES Complexes Familiaux EN Pathologie
A Famille LE Complexe Facteur Concret DE LA Psychologie Familiale ES Complexes Familiaux EN Pathologie
Transféré par
FjcqTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
A Famille LE Complexe Facteur Concret DE LA Psychologie Familiale ES Complexes Familiaux EN Pathologie
A Famille LE Complexe Facteur Concret DE LA Psychologie Familiale ES Complexes Familiaux EN Pathologie
Transféré par
FjcqDroits d'auteur :
Formats disponibles
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE.
LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Cet article de Lacan, crit la demande de Wallon est publi dans lEncyclopdie Franaise, tome VIII,
en mars 1938. On trouvera ci-dessous le plan de cet article reproduit peu prs tel quil figure dans
ldition originale : les intertitres furent imposs Lacan par Lucien Febvre (responsable de
lEncyclopdie Franaise) et Henri Wallon (responsable du Tome VIII, intitul : La vie mentale ). Ce
travail hors du commun a son histoire : se rapporter au memorandum de Lucien Febvre dont il est
question dans Jacques Lacan de Elisabeth Roudinesco1.
DEUXIME PARTIE
CIRCONSTANCES ET OBJETS DE LACTIVIT PSYCHIQUE
SECTION A : LA FAMILLE
INTRODUCTION : LINSTITUTION FAMILIALE Jacques-M. LACAN 8.40- 3
STRUCTURE CULTURELLE DE LA FAMILLE HUMAINE
La famille primitive : une institution
Chapitre I
LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE Jacques-M. LACAN
840- 5
Dfinition gnrale du complexe Le complexe et linstinct Le complexe freudien et
limago
1. Le complexe du sevrage 8.40- 6
Le sevrage, en tant quablactation
Le sevrage, crise du psychisme
Limago du sein maternel
Le sevrage : prmaturation spcifique de la naissance
Le sentiment de la maternit Lapptit de la mort Le lien domestique La nostalgie
du Tout
2. Le complexe de lintrusion 8.40- 8
LA JALOUSIE, ARCHETYPE DES SENTIMENTS SOCIAUX 8.40- 8
Identification mentale Limago du semblable Le sens de lagressivit primordiale
Le stade du miroir
Puissance seconde de limage spculaire Structure narcissique du moi
LE DRAME DE LA JALOUSIE : LE MOI ET LAUTRUI 8.40-10
3. Le complexe ddipe 8.40Schma du complexe Valeur objective du complexe
La FAMILLE SELON Freud
Le complexe de castration
LES FONCTIONS DU COMPLEXE : REVISION PSYCHOLOGIQUE
Maturation de la sexualit
Constitution de la ralit
Rpression de LA SEXUALIT
Sublimation DE LA RALIT
Originalit de lidentification dipienne Limago du pre
LE COMPLEXE ET LA RELATIVIT SOCIOLOGIQUE
Matriarcat et PATRIARCAT
Lhomme MODERNE ET LA FAMILLE CONJUGALE
Rle de la formation familiale Dclin de limago paternelle
CHAPITRE II
LES COMPLEXES FAMILIAUX EN PATHOLOGIE Jacques-M. LACAN 8.421. Les psychoses thme familial
Fonction DES COMPLEXES DANS LES DLIRES
Ractions familiales Thmes familiaux
1
Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, Fayard, Paris, 1993.
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Dterminisme DE LA PSYCHOSE
Facteurs familiaux
2. Les nvroses familiales 8.42- 3
Symptme nvrotique et drame individuel De lexpression du refoul la
dfense contre langoisse Dformations spcifiques de la ralit humaine
Le drame existentiel de lindividu La forme dgrade de ldipe
Nvroses DE TRANSFERT
Lhystrie La nvrose obsessionnelle
Nvroses DE CARACTRE
La nvrose dautopunition Introversion de la personnalit et schizonoa
Inversion de la sexualit Prvalence du principe mle
SECTION B : LCOLE
SECTION C : LA PROFESSION
SECTION D : VIE QUOTIDIENNE ET VIE PUBLIQUE
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
(8.40-3)
SECTION A : LA FAMILLE
INTRODUCTION : LINSTITUTION FAMILIALE
La famille parat dabord comme un groupe naturel dindividus unis par une double
relation biologique : la gnration, qui donne les composants du groupe ; les conditions
de milieu que postule le dveloppement des jeunes et qui maintiennent le groupe pour
autant que les adultes gnrateurs en assurent la fonction. Dans les espces animales,
cette fonction donne lieu des comportements instinctifs, souvent trs complexes. On a
d renoncer faire driver des relations familiales ainsi dfinies les autres phnomnes
sociaux observs chez les animaux. Ces derniers apparaissent au contraire si distincts
des instincts familiaux que les chercheurs les plus rcents les rapportent un instinct
original, dit dinterattraction.
STRUCTURE CULTURELLE DE LA FAMILLE HUMAINE
Lespce humaine se caractrise par un dveloppement singulier des relations
sociales, que soutiennent des capacits exceptionnelles de communication mentale, et
corrlativement par une conomie paradoxale des instincts qui sy montrent
essentiellement susceptibles de conversion et dinversion et nont plus deffet isolable
que de faon sporadique. Des comportements adaptatifs dune varit infinie sont ainsi
permis. Leur conservation et leur progrs, pour dpendre de leur communication, sont
avant tout uvre collective et constituent la culture ; celle-ci introduit une nouvelle
dimension dans la ralit sociale et dans la vie psychique. Cette dimension spcifie la
famille humaine comme, du reste, tous les phnomnes sociaux chez lhomme.
Si, en effet, la famille humaine permet dobserver, dans les toutes premires phases
des fonctions maternelles, par exemple, quelques traits de comportement instinctif,
identifiables ceux de la famille biologique, il suffit de rflchir ce que le sentiment
de la paternit doit aux postulats spirituels qui ont marqu son dveloppement, pour
comprendre quen ce domaine les instances culturelles dominent les naturelles, au point
quon ne peut tenir pour paradoxaux les cas o, comme dans ladoption, elles sy
substituent.
Cette structure culturelle de la famille humaine est-elle entirement accessible aux
mthodes de la psychologie concrte : observation et analyse ? Sans doute, ces
mthodes suffisent-elles mettre en vidence des traits essentiels, comme la structure
hirarchique de la famille, et reconnatre en elle lorgane privilgi de cette contrainte
de ladulte sur lenfant, contrainte laquelle lhomme doit une tape originale et les
bases archaques de sa formation morale.
Mais dautres traits objectifs : les modes dorganisation de cette autorit familiale, les
lois de sa transmission, les concepts de la descendance et de la parent qui lui sont
joints, les lois de lhritage et de la succession qui sy combinent, enfin ses rapports
intimes avec les lois du mariage obscurcissent en les enchevtrant les relations
psychologiques. Leur interprtation devra alors sclairer des donnes compares de
lethnographie, de lhistoire, du droit et de la statistique sociale. Coordonnes par la
mthode sociologique, ces donnes tablissent que la famille humaine est une
institution. Lanalyse psychologique doit sadapter cette structure complexe et na que
faire des tentatives philosophiques qui ont pour objet de rduire la famille humaine soit
un fait biologique, soit un lment thorique de la socit.
Ces tentatives ont pourtant leur principe dans certaines apparences du phnomne
familial ; pour illusoires que soient ces apparences, elles mritent quon sy arrte, car
elles reposent sur des convergences relles entre des causes htrognes. Nous en
dcrirons le mcanisme sur deux points toujours litigieux pour le psychologue.
3
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Hrdit psychologique. Entre tous les groupes humains, la famille joue un rle
primordial dans la transmission de la culture. Si les traditions spirituelles, la garde des
rites et des coutumes, la conservation des techniques et du patrimoine lui sont disputes
par dautres groupes sociaux, la famille prvaut dans la premire ducation, la
rpression des instincts, lacquisition de la langue justement nomme maternelle. Par l
elle prside aux processus fondamentaux du dveloppement psychique, cette
organisation des motions selon des types conditionns par lambiance, qui est la base
des sentiments selon Shand ; plus largement, elle transmet des structures de
comportement et de reprsentation dont le jeu dborde les limites de la conscience.
Elle tablit ainsi entre les gnrations une continuit psychique dont la causalit est
dordre mental. Cette continuit, si elle rvle lartifice de ses fondements dans les
concepts mmes qui dfinissent lunit de ligne, depuis le totem jusquau nom
patronymique, ne se manifeste pas moins par la transmission la descendance de
dispositions psychiques qui confinent linn ; Conn a cr pour ces effets le terme
dhrdit sociale. Ce terme, assez impropre en son ambigut, a du moins le mrite de
signaler combien il est difficile au psychologue de ne pas majorer limportance du
biologique dans les faits dits dhrdit psychologique.
(8.40-4)
Parent biologique. Une autre similitude, toute contingente, se voit dans le fait
que les composants normaux de la famille telle quon lobserve de nos jours en
Occident : le pre, la mre et les enfants, sont les mmes que ceux de la famille
biologique. Cette identit nest rien de plus quune galit numrique. Mais lesprit est
tent dy reconnatre une communaut de structure directement fonde sur la constance
des instincts, constance quil lui faut alors retrouver dans les formes primitives de la
famille. Cest sur ces prmisses quont t fondes des thories purement hypothtiques
de la famille primitive, tantt limage de la promiscuit observable chez les animaux,
par des critiques subversifs de lordre familial existant ; tantt sur le modle du couple
stable, non moins observable dans lanimalit, par des dfenseurs de linstitution
considre comme cellule sociale.
La famille primitive : une institution.
Les thories dont nous venons de parler ne sont appuyes sur aucun fait connu. La
promiscuit prsume ne peut tre affirme nulle part, mme pas dans les cas dits de
mariage de groupe : ds lorigine existent interdictions et lois. Les formes primitives de
la famille ont les traits essentiels de ses formes acheves : autorit sinon concentre
dans le type patriarcal, du moins reprsente par un conseil, par un matriarcat ou ses
dlgus mles ; mode de parent, hritage, succession, transmis, parfois distinctement
(Rivers), selon une ligne paternelle ou maternelle. Il sagit bien l de familles
humaines dment constitues. Mais loin quelles nous montrent la prtendue cellule
sociale, on voit dans ces familles, mesure quelles sont plus primitives, non seulement
un agrgat plus vaste de couples biologiques, mais surtout une parent moins conforme
aux liens naturels de consanguinit.
Le premier point est dmontr par Durkheim et par Fauconnet aprs lui, sur
lexemple historique de la famille romaine ; lexamen des noms de famille et du droit
successoral, on dcouvre que trois groupes sont apparus successivement, du plus vaste
au plus troit : la gens, agrgat trs vaste de souches paternelles ; la famille agnatique,
plus troite mais indivise ; enfin la famille qui soumet la patria potestas de laeul les
couples conjugaux de tous ses fils et petits-fils.
Pour le second point, la famille primitive mconnat les liens biologiques de la
parent : mconnaissance seulement juridique dans la partialit unilinale de la
filiation ; mais aussi ignorance positive ou peut-tre mconnaissance systmatique (au
sens de paradoxe de la croyance que la psychiatrie donne ce terme), exclusion totale
de ces liens qui, pour ne pouvoir sexercer qu lgard de la paternit, sobserverait
4
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
dans certaines cultures matriarcales (Rivers et Malinovski). En outre la parent nest
reconnue que par le moyen de rites qui lgitiment les liens du sang et au besoin en
crent de fictifs : faits du totmisme, adoption, constitution artificielle dun groupement
agnatique comme la zadruga slave. De mme, daprs notre code, la filiation est
dmontre par le mariage.
mesure quon dcouvre des formes plus primitives de la famille humaine, elles
slargissent en groupements qui, comme le clan, peuvent tre aussi considrs comme
politiques. Que si lon transfre dans linconnu de la prhistoire la forme drive de la
famille biologique pour en faire natre par association ni naturelle ou artificielle ces
groupements, cest l une hypothse contre laquelle choue la preuve, mais qui est
dautant moins probable que les zoologistes refusent nous lavons vu daccepter une
telle gense pour les socits animales elles-mmes.
Dautre part, si lextension et la structure des groupements familiaux primitifs
nexcluent pas lexistence en leur sein de familles limites leurs membres
biologiques le fait est aussi incontestable que celui de la reproduction bisexue , la
forme ainsi arbitrairement isole ne peut rien nous apprendre de sa psychologie et on ne
peut lassimiler la forme familiale actuellement existante.
Le groupe rduit que compose la famille moderne ne parait pas, en effet, lexamen,
comme une simplification mais plutt comme une contraction de linstitution familiale.
Il montre une structure profondment complexe, dont plus dun point sclaire bien
mieux par les institutions positivement connues de la famille ancienne que par
lhypothse dune famille lmentaire quon ne saisit nulle part. Ce nest pas dire quil
soit trop ambitieux de chercher dans cette forme complexe un sens qui lunifie et peuttre dirige son volution. Ce sens se livre prcisment quand, la lumire de cet
examen comparatif, on saisit le remaniement profond qui a conduit linstitution
familiale sa forme actuelle ; on reconnat du mme coup quil faut lattribuer
linfluence prvalente que prend ici le mariage, institution quon doit distinguer de la
famille. Do lexcellence du terme famille conjugale , par lequel Durkheim la
dsigne.
(8.40.-5)
CHAPITRE I
LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET
DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE
Cest dans lordre original de ralit que constituent les relations sociales quil faut
comprendre la famille humaine. Si, pour asseoir ce principe, nous avons eu recours aux
conclusions de la sociologie, bien que la somme des faits dont elle lillustre dborde
notre sujet, cest que lordre de ralit en question est lobjet propre de cette science. Le
principe est ainsi pos sur un plan o il a sa plnitude objective. Comme tel, il permettra
de juger selon leur vraie porte les rsultats actuels de la recherche psychologique. Pour
autant, en effet, quelle rompt avec les abstractions acadmiques et vise, soit dans
lobservation du behaviour soit par lexprience de la psychanalyse, rendre compte du
concret, cette recherche, spcialement quand elle sexerce sur les faits de la famille
comme objet et circonstance psychique , nobjective jamais des instincts, mais toujours
des complexes.
Ce rsultat nest pas le fait contingent dune tape rductible de la thorie ; il faut y
reconnatre, traduit en termes psychologiques mais conforme au principe
prliminairement pos, ce caractre essentiel de lobjet tudi : son conditionnement par
des facteurs culturels, aux dpens des facteurs naturels.
5
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Dfinition gnrale du complexe. Le complexe, en effet, lie sous une forme fixe
un ensemble de ractions qui peut intresser toutes les fonctions organiques depuis
lmotion jusqu la conduite adapte lobjet. Ce qui dfinit le complexe, cest quil
reproduit une certaine ralit de lambiance, et doublement. 1 Sa forme reprsente cette
ralit en ce quelle a dobjectivement distinct une tape donne du dveloppement
psychique ; cette tape spcifie sa gense. 2 Son activit rpte dans le vcu la ralit
ainsi fixe, chaque fois que se produisent certaines expriences qui exigeraient une
objectivation suprieure de cette ralit ; ces expriences spcifient le conditionnement
du complexe.
Cette dfinition elle seule implique que le complexe est domin par des facteurs
culturels : dans son contenu, reprsentatif dun objet ; dans sa forme, lie une tape
vcue de lobjectivation ; enfin dans sa manifestation de carence objective lgard
dune situation actuelle, cest--dire sous son triple aspect de relation de connaissance,
de forme dorganisation affective et dpreuve au choc du rel, le complexe se
comprend par sa rfrence lobjet. Or, toute identification objective exige dtre
communicable, cest--dire repose sur un critre culturel ; cest aussi par des voies
culturelles quelle est le plus souvent communique. Quant lintgration individuelle
des formes dobjectivation, elle est luvre dun procs dialectique qui fait surgir
chaque forme nouvelle des conflits de la prcdente avec le rel. Dans ce procs il faut
reconnatre le caractre qui spcifie lordre humain, savoir cette subversion de toute
fixit instinctive, do surgissent les formes fondamentales, grosses de variations
infinies, de la culture.
Le complexe et linstinct. Si le complexe dans son plein exercice est du ressort de
la culture, et si cest l une considration essentielle pour qui veut rendre compte des
faits psychiques de la famille humaine, ce nest pas dire quil ny ait pas de rapport
entre le complexe et linstinct. Mais, fait curieux, en raison des obscurits quoppose
la critique de la biologie contemporaine le concept de linstinct, le concept du
complexe, bien que rcemment introduit, savre mieux adapt des objets plus riches ;
cest pourquoi, rpudiant lappui que linventeur du complexe croyait devoir chercher
dans le concept classique de linstinct, nous croyons que, par un renversement
thorique, cest linstinct quon pourrait clairer actuellement par sa rfrence au
complexe.
Ainsi pourrait-on confronter point par point : 1 la relation de connaissance
quimplique le complexe, cette connaturalit de lorganisme lambiance o sont
suspendues les nigmes de linstinct ; 2 la typicit gnrale du complexe en rapport
avec les lois dun groupe social, la typicit gnrique de linstinct en rapport avec la
fixit de lespce ; 3 le protisme des manifestations du complexe qui, sous des formes
quivalentes dinhibition, de compensation, de mconnaissance, de rationalisation,
exprime la stagnation devant un mme objet, la strotypie des phnomnes de
linstinct, dont lactivation, soumise la loi du tout ou rien , reste rigide aux
variations de la situation vitale. Cette stagnation dans le complexe tout autant que cette
rigidit dans linstinct tant quon les rfre aux seuls postulats de ladaptation vitale,
dguisement mcaniste du finalisme, on se condamne en faire des nigmes ; leur
problme exige lemploi des concepts plus riches quimpose ltude de la vie psychique.
Le complexe Freudien et limago. Nous avons dfini le complexe dans un sens trs
large qui nexclut pas que le sujet ait conscience de ce quil reprsente. Mais cest
comme facteur essentiellement inconscient quil fut dabord dfini par Freud. Son unit
est en effet frappante sous cette forme, o elle se rvle comme la cause deffets
psychiques non dirigs par la conscience, actes manqus, rves, symptmes. Ces effets
6
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
ont des caractres tellement distincts et contingents quils forcent dadmettre comme
lment fondamental du complexe cette entit paradoxale : une reprsentation
inconsciente, dsigne sous le nom dimago. Complexes et imago ont rvolutionn la
psychologie et spcialement celle de la famille qui sest rvle comme le lieu
dlection des complexes les plus (8.406)stables et les plus typiques : de simple sujet de
paraphrases moralisantes, la famille est devenue lobjet dune analyse concrte.
Cependant les complexes se sont dmontrs comme jouant un rle d organiseurs
dans le dveloppement psychique ; ainsi dominent-ils les phnomnes qui, dans la
conscience, semblent les mieux intgrs la personnalit ; ainsi sont motives dans
linconscient non seulement des justifications passionnelles, mais dobjectivables
rationalisations. La porte de la famille comme objet et circonstance psychique sen est
du mme coup trouve accrue.
Ce progrs thorique nous a incit donner du complexe une formule gnralise,
qui permette dy inclure les phnomnes conscients de structure semblable. Tels les
sentiments o il faut voir des complexes motionnels conscients, les sentiments
familiaux spcialement tant souvent limage inverse de complexes inconscients.
Telles aussi les croyances dlirantes, o le sujet affirme un complexe comme une ralit
objective ; ce que nous montrerons particulirement dans les psychoses familiales.
Complexes, imagos, sentiments et croyances vont tre tudis dans leur rapport avec la
famille et en fonction du dveloppement psychique quils organisent depuis lenfant
lev dans la famille jusqu ladulte qui la reproduit.
1. Le complexe du sevrage
Le complexe du sevrage fixe dans le psychisme la relation du nourrissage, sous le
mode parasitaire quexigent les besoins du premier ge de lhomme ; il reprsente la
forme primordiale de limago maternelle. Partant, il fonde les sentiments les plus
archaques et les plus stables qui unissent lindividu la famille. Nous touchons ici au
complexe le plus primitif du dveloppement psychique, celui qui se compose avec
tous les complexes ultrieurs ; il nest que plus frappant de le voir entirement domin
par des facteurs culturels et ainsi, ds ce stade primitif, radicalement diffrent de
linstinct.
Le sevrage en tant quablactation. Il sen rapproche pourtant par deux caractres :
le complexe du sevrage, dune part, se produit avec des traits si gnraux dans toute
ltendue de lespce quon peut le tenir pour gnrique ; dautre part, il reprsente dans
le psychisme une fonction biologique, exerce par un appareil anatomiquement
diffrenci : la lactation. Aussi comprend-on quon ait voulu rapporter un instinct,
mme chez lhomme, les comportements fondamentaux, qui lient la mre lenfant.
Mais cest ngliger un caractre essentiel de linstinct : sa rgulation physiologique
manifeste dans le fait que linstinct maternel cesse dagir chez lanimal quand la fin du
nourrissage est accomplie.
Chez lhomme, au contraire, cest une rgulation culturelle qui conditionne le
sevrage. Elle y apparat comme dominante, mme si on le limite au cycle de
lablactation proprement dite, auquel rpond pourtant la priode physiologique de la
glande commune la classe des Mammifres. Si la rgulation quon observe en ralit
napparat comme nettement contre nature que dans des pratiques arrires qui ne sont
pas toutes en voie de dsutude ce serait cder une illusion grossire que de chercher
dans la physiologie la base instinctive de ces rgles, plus conformes la nature,
quimpose au sevrage comme lensemble des murs lidal des cultures les plus
avances. En fait, le sevrage, par lune quelconque des contingences opratoires quil
7
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
comporte, est souvent un traumatisme psychique dont les effets individuels, anorexies
dites mentales, toxicomanies par la bouche, nvroses gastriques, rvlent leurs causes
la psychanalyse.
Le sevrage, crise du psychisme. Traumatisant ou non, le sevrage laisse dans le
psychisme humain la trace permanente de la relation biologique quil interrompt. Cette
crise vitale se double en effet dune crise du psychisme, la premire sans doute dont la
solution ait une structure dialectique. Pour la premire fois, semble-t-il, une tension
vitale se rsout en intention mentale. Par cette intention, le sevrage est accept ou
refus ; lintention certes est fort lmentaire, puisquelle ne peut pas mme tre
attribue un moi encore ltat de rudiments ; lacceptation ou le refus ne peuvent tre
conus comme un choix, puisquen labsence dun moi qui affirme ou nie ils ne sont pas
contradictoires ; mais, ples coexistants et contraires, ils dterminent une attitude
ambivalente par essence, quoique lun deux y prvale. Cette ambivalence primordiale,
lors des crises qui assurent la suite du dveloppement, se rsoudra en diffrenciations
psychiques dun niveau dialectique de plus en plus lev et dune irrversibilit
croissante. La prvalence originelle y changera plusieurs fois de sens et pourra de ce fait
y subir des destines trs diverses ; elle sy retrouvera pourtant et dans le temps et dans
le ton, elle propres, quelle imposera et ces crises et aux catgories nouvelles dont
chacune dotera le vcu.
LIMAGO DU SEIN MATERNEL
Cest le refus du sevrage qui fonde le positif du complexe, savoir limago de la
relation nourricire quil tend rtablir. Cette imago est donne dans son contenu par
les sensations propres au premier ge, mais na de forme qu mesure quelles
sorganisent mentalement. Or, ce stade tant antrieur lavnement de la forme de
lobjet, il ne semble pas que ces contenus puissent se reprsenter dans la conscience. Ils
sy reproduisent pourtant dans les structures mentales qui modlent, avons-nous dit, les
expriences psychiques ultrieures. Ils seront rvoqus par association loccasion de
celles-ci, mais insparables des contenus objectifs quils auront informs. Analysons ces
contenus et ces formes.
Ltude du comportement de la prime enfance permet daffirmer que les sensations
extro-, proprio- et introceptives ne sont pas encore, aprs le douzime mois,
suffisamment coordonnes pour que soit acheve la reconnaissance du corps propre, ni
corrlativement la notion de ce qui lui est extrieur.
Forme extroceptive : la prsence humaine. Trs tt pourtant, certaines sensations
extroceptives sisolent sporadiquement en units de perception. Ces lments dobjets
rpondent, comme il est prvoir, aux premiers intrts affectifs. En tmoignent la
prcocit et llectivit des ractions de lenfant lapproche et au dpart des personnes
qui prennent soin de lui. Il faut pourtant mentionner part, comme un fait de (8407)
structure, la raction dintrt que lenfant manifeste devant le visage humain : elle est
extrmement prcoce, sobservant ds les premiers jours et avant mme que les
coordinations motrices des yeux soient acheves. Ce fait ne peut tre dtach du progrs
par lequel le visage humain prendra toute sa valeur dexpression psychique. Cette
valeur, pour tre sociale, ne peut tre tenue pour conventionnelle. La puissance
ractive, souvent sous un mode ineffable, que prend le masque humain dans les
contenus mentaux des psychoses, parait tmoigner de larchasme de sa signification.
Quoi quil en soit, ces ractions lectives permettent de concevoir chez lenfant une
certaine connaissance trs prcoce de la prsence qui remplit la fonction maternelle, et
8
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
le rle de traumatisme causal, que dans certaines nvroses et certains troubles du
caractre, peut jouer une substitution de cette prsence. Cette connaissance, trs
archaque et pour laquelle semble fait le calembour claudlien de co-naissance , se
distingue peine de ladaptation affective. Elle reste tout engage dans la satisfaction
des besoins propres au premier ge et dans lambivalence typique des relations mentales
qui sy bauchent. Cette satisfaction apparat avec les signes de la plus grande plnitude
dont puisse tre combl le dsir humain, pour peu quon considre lenfant attach la
mamelle.
Satisfaction proprioceptive : la fusion orale. Les sensations proprioceptives de la
succion et de la prhension font videmment la base de cette ambivalence du vcu, qui
ressort de la situation mme : ltre qui absorbe est tout absorb et le complexe
archaque lui rpond dans lembrassement maternel. Nous ne parlerons pas ici avec
FREUD dauto-rotisme, puisque le moi nest pas constitu, ni de narcissisme, puisquil
ny a pas dimage du moi ; bien moins encore drotisme oral, puisque la nostalgie du
sein nourricier, sur laquelle a quivoqu lcole psychanalytique, ne relve du complexe
du sevrage qu travers son remaniement par le complexe ddipe. Cannibalisme ,
mais cannibalisme fusionnel, ineffable, la fois actif et passif, toujours survivant dans
les jeux et mots symboliques, qui, dans lamour le plus volu, rappellent le dsir de la
larve, nous reconnatrons en ces termes le rapport la ralit sur lequel repose limago
maternelle.
Malaise introceptif : limago prnatale. Cette base elle-mme ne peut tre
dtache du chaos des sensations introceptives dont elle merge. Langoisse, dont le
prototype apparat dans lasphyxie de la naissance, le froid, li la nudit du tgument,
et le malaise labyrinthique auquel rpond la satisfaction du bercement, organisent par
leur triade le ton pnible de la vie organique qui, pour les meilleurs observateurs,
domine les six premiers mois de lhomme. Ces malaises primordiaux ont tous la mme
cause : une insuffisante adaptation la rupture des conditions dambiance et de nutrition
qui font lquilibre parasitaire de la vie intra-utrine.
Cette conception saccorde avec ce que, lexprience, la psychanalyse trouve
comme fonds dernier de limago du sein maternel : sous les fantasmes du rve comme
sous les obsessions de la veille se dessinent avec une impressionnante prcision les
images de lhabitat intra-utrin et du seuil anatomique de la vie extra-utrine. En
prsence des donnes de la physiologie et du fait anatomique de la non-mylinisation
des centres nerveux suprieurs chez le nouveau-n, il est pourtant impossible de faire de
la naissance, avec certains psychanalystes, un traumatisme psychique. Ds lors cette
forme de limago resterait une nigme si ltat postnatal de lhomme ne manifestait, par
son malaise mme, que lorganisation posturale, tonique, quilibratoire, propre la vie
intra-utrine, survit celle-ci.
LE SEVRAGE : PRMATURATION SPCIFIQUE DE LA NAISSANCE
Il faut remarquer que le retard de la dentition et de la marche, un retard corrlatif de
la plupart des appareils et des fonctions, dterminent chez lenfant une impuissance
vitale totale qui dure au del des deux premires annes. Ce fait doit-il tre tenu pour
solidaire de ceux qui donnent au dveloppement somatique ultrieur de lhomme son
caractre dexception par rapport aux animaux de sa classe : la dure de la priode
denfance et le retard de la pubert ? Quoi quil en soit, il ne faut pas hsiter
reconnatre au premier ge une dficience biologique positive, et considrer lhomme
comme un animal naissance prmature. Cette conception explique la gnralit du
9
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
complexe, et quil soit indpendant des accidents de lablactation. Celle-ci sevrage au
sens troit donne son expression psychique, la premire et aussi la plus adquate,
limago plus obscure dun sevrage plus ancien, plus pnible et dune plus grande
ampleur vitale : celui qui, la naissance, spare lenfant de la matrice, sparation
prmature do provient un malaise que nul soin maternel ne peut compenser.
Rappelons en cet endroit un fait pdiatrique connu, larriration affective trs spciale
quon observe chez les enfants ns avant terme.
Le sentiment de la maternit. Ainsi constitue, limago du sein maternel domine
toute la vie de lhomme. De par son ambivalence pourtant, elle peut trouver se saturer
dans le renversement de la situation quelle reprsente, ce qui nest ralis strictement
qu la seule occasion de la maternit. Dans lallaitement, ltreinte et la contemplation
de lenfant, la mre, en mme temps, reoit et satisfait le plus primitif de tous les dsirs.
Il nest pas jusqu la tolrance de la douleur de laccouchement quon ne puisse
comprendre comme le fait dune compensation reprsentative du premier apparu des
phnomnes affectifs : langoisse, ne avec la vie. Seule limago qui imprime au plus
profond du psychisme le sevrage congnital de lhomme, peut expliquer la puissance, la
richesse et la dure du sentiment maternel. La ralisation de cette imago dans la
conscience assure la femme une satisfaction psychique privilgie, cependant que ses
effets dans la conduite de la mre prservent lenfant de labandon qui lui serait fatal.
En opposant le complexe linstinct, nous ne dnions pas au complexe tout
fondement biologique, et en le dfinissant par certains rapports idaux, nous le relions
pourtant sa base matrielle. Cette base, cest la fonction quil assure dans le groupe
social ; et ce fondement biologique, on le voit dans la dpendance vitale de lindividu
par rapport au groupe. Alors que linstinct a un support organique et nest rien dautre
que la rgulation de celui-ci dans une fonction vitale, le complexe na qu loccasion
un rapport organique, quand il supple une insuffisance vitale par la rgulation dune
fonction sociale. Tel est le cas du complexe du sevrage. Ce rapport organique explique
que limago de la mre tienne aux profondeurs du psychisme et que sa sublimation soit
particulirement difficile, comme il est manifeste dans lattachement de lenfant aux
jupes de sa mre et dans la dure parfois anachronique de ce lien.
Limago pourtant doit tre sublime pour que de nouveaux rapports sintroduisent
avec le groupe social, pour que de nouveaux complexes les intgrent au psychisme.
Dans la mesure o elle rsiste ces exigences nouvelles, qui sont celles du progrs de la
personnalit, limago, salutaire lorigine, devient facteur de mort.
Lapptit de la mort. Que la tendance la mort soit vcue par lhomme comme
objet dun apptit, cest l une ralit que lanalyse fait apparatre tous les niveaux du
psychisme ; cette ralit, il appartenait linventeur de la psychanalyse den reconnatre
le caractre irrductible, mais lexplication quil en a donne par un instinct de mort,
pour blouissante (8*40 8)quelle soit, nen reste pas moins contradictoire dans les termes ;
tellement il est vrai que le gnie mme, chez Freud, cde au prjug du biologiste qui
exige que toute tendance se rapporte un instinct. Or, la tendance la mort, qui spcifie
le psychisme de lhomme, sexplique de faon satisfaisante par la conception que nous
dveloppons ici, savoir que le complexe, unit fonctionnelle de ce psychisme, ne
rpond pas des fonctions vitales mais linsuffisance congnitale de ces fonctions.
Cette tendance psychique la mort, sous la forme originelle que lui donne le sevrage,
se rvle dans des suicides trs spciaux qui se caractrisent comme non violents , en
mme temps quy apparat la forme orale du complexe : grve de la faim de lanorexie
mentale, empoisonnement lent de certaines toxicomanies par la bouche, rgime de
10
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
famine des nvroses gastriques. Lanalyse de ces cas montre que, dans son abandon la
mort, le sujet cherche retrouver limago de la mre. Cette association mentale nest
pas seulement morbide. Elle est gnrique, comme il se voit dans la pratique de la
spulture, dont certains modes manifestent clairement le sens psychologique de retour
au sein de la mre ; comme le rvlent encore les connexions tablies entre la mre et la
mort, tant par les techniques magiques que par les conceptions des thologies antiques ;
comme on lobserve enfin dans toute exprience psychanalytique assez pousse.
Le lien domestique. Mme sublime, limago du sein maternel continue jouer un
rle psychique important pour notre sujet. Sa forme la plus soustraite la conscience,
celle de lhabitat prnatal, trouve dans lhabitation et dans son seuil, surtout dans leurs
formes primitives, la caverne, la hutte, un symbole adquat.
Par l, tout ce qui constitue lunit domestique du groupe familial devient pour
lindividu, mesure quil est plus capable de labstraire, lobjet dune affection distincte
de celles qui lunissent chaque membre de ce groupe. Par l encore, labandon des
scurits que comporte lconomie familiale a la porte dune rptition du sevrage et
ce nest, le plus souvent, qu cette occasion que le complexe est suffisamment liquid.
Tout retour, fut-il partiel, ces scurits, peut dclencher dans le psychisme des ruines
sans proportion avec le bnfice pratique de ce retour.
Tout achvement de la personnalit exige ce nouveau sevrage. Hegel formule que
lindividu qui ne lutte pas pour tre reconnu hors du groupe familial, natteint jamais
la personnalit avant la mort. Le sens psychologique de cette thse apparatra dans la
suite de notre tude. En fait de dignit personnelle, ce nest qu celle des entits
nominales que la famille promeut lindividu et elle ne le peut qu lheure de la
spulture.
La nostalgie du Tout. La saturation du complexe fonde le sentiment maternel ; sa
sublimation contribue au sentiment familial ; sa liquidation laisse des traces o on peut
la reconnatre : cest cette structure de limago qui reste la base des progrs mentaux
qui lont remanie. Sil fallait dfinir la forme la plus abstraite o on la retrouve, nous la
caractriserions ainsi : une assimilation parfaite de la totalit ltre. Sous cette formule
daspect un peu philosophique, on reconnatra ces nostalgies de lhumanit : mirage
mtaphysique de lharmonie universelle, abme mystique de la fusion affective, utopie
sociale dune tutelle totalitaire, toutes sorties de la hantise du paradis perdu davant la
naissance et de la plus obscure aspiration la mort.
11
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
2. Le complexe de lintrusion
La JALOUSIE, ARCHTYPE DES SENTIMENTS SOCIAUX
Le complexe de lintrusion reprsente lexprience que ralise le sujet primitif, le
plus souvent quand il voit un ou plusieurs de ses semblables participer avec lui la
relation domestique, autrement dit, lorsquil se connat des frres. Les conditions en
seront donc trs variables, dune part selon les cultures et lextension quelles donnent
au groupe domestique, dautre part selon les contingences individuelles, et dabord
selon la place que le sort donne au sujet dans lordre des naissances, selon la position
dynastique, peut-on dire, quil occupe ainsi avant tout conflit : celle de nanti ou celle
dusurpateur.
La jalousie infantile a ds longtemps frapp les observateurs : Jai vu de mes yeux,
dit Saint Augustin, et bien observ un tout-petit en proie la jalousie : il ne parlait pas
encore et il ne pouvait sans plir arrter son regard au spectacle amer de son frre de
lait (Confessions, I, VII). Le fait ici rvl ltonnement du moraliste resta
longtemps rduit la valeur dun thme de rhtorique, utilisable toutes fins
apologtiques.
Lobservation exprimentale de lenfant et les investigations psychanalytiques, en
dmontrant la structure de la jalousie infantile, ont mis au jour son rle dans la gense
de la sociabilit et, par l, de la connaissance elle-mme en tant quhumaine. Disons que
le point critique rvl par ces recherches est que la jalousie, dans son fonds, reprsente
non pas une rivalit vitale mais une identification mentale.
Identification mentale. Des enfants entre 6 mois et 2 ans tant confronts par
couple et sans tiers et laisss leur spontanit ludique, on peut constater le fait
suivant : entre les enfants ainsi mis en prsence apparaissent des ractions diverses o
semble se manifester une communication. Parmi ces ractions un type se distingue, du
fait quon peut y reconnatre une rivalit objectivement dfinissable : il comporte en
effet entre les sujets une certaine adaptation des postures et des gestes, savoir une
conformit dans leur alternance, une convergence dans leur srie, qui les ordonnent en
provocations et ripostes et permettent daffirmer, sans prjuger de la conscience des
sujets, quils ralisent la situation comme double issue, comme une alternative. Dans
la mesure mme de cette adaptation, on peut admettre que ds ce stade sbauche la
reconnaissance dun rival, cest--dire dun autre comme objet. Or, si une telle
raction peut tre trs prcoce, elle se montre dtermine par une condition si dominante
quelle en apparat comme univoque : savoir une limite qui ne peut tre dpasse dans
lcart dge entre les sujets. Cette limite se restreint deux mois et demi dans la
premire anne de la priode envisage et reste aussi stricte en slargissant.
(840 9)
Si cette condition nest pas remplie, les ractions que lon observe entre les
enfants confronts ont une valeur toute diffrente. Examinons les plus frquentes :
celles de la parade, de la sduction, du despotisme. Bien que deux partenaires y figurent,
le rapport qui caractrise chacune delles se rvle lobservation, non pas comme un
conflit entre deux individus, mais dans chaque sujet, comme un conflit entre deux
attitudes opposes et complmentaires, et cette participation bipolaire est constitutive de
la situation elle-mme. Pour comprendre cette structure, quon sarrte un instant
lenfant qui se donne en spectacle et celui qui le suit du regard : quel est le plus
spectateur ? Ou bien quon observe lenfant qui prodigue envers un autre ses tentatives
de sduction : o est le sducteur ? Enfin, de lenfant qui jouit des preuves de la
domination quil exerce et de celui qui se complat sy soumettre, quon se demande
12
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
quel est le plus asservi ? Ici se ralise ce paradoxe : que chaque partenaire confond la
partie de lautre avec la sienne propre et sidentifie lui ; mais quil peut soutenir ce
rapport sur une participation proprement insignifiante de cet autre et vivre alors toute la
situation lui seul, comme le manifeste la discordance parfois totale entre leurs
conduites. Cest dire que lidentification, spcifique des conduites sociales, ce stade,
se fonde sur un sentiment de lautre, que lon ne peut que mconnatre sans une
conception correcte de sa valeur tout imaginaire.
Limago du semblable. Quelle est donc la structure de cette imago ? Une premire
indication nous est donne par la condition reconnue plus haut pour ncessaire une
adaptation relle entre partenaires, savoir un cart dge trs troitement limit. Si lon
se rfre au fait que ce stade est caractris par des transformations de la structure
nerveuse assez rapides et profondes pour dominer les diffrenciations individuelles, on
comprendra que cette condition quivaut lexigence dune similitude entre les sujets.
Il apparat que limago de lautre est lie la structure du corps propre et plus
spcialement de ses fonctions de relation, par une certaine similitude objective.
La doctrine de la psychanalyse permet de serrer davantage le problme. Elle nous
montre dans le frre, au sens neutre, lobjet lectif des exigences de la libido qui, au
stade que nous tudions, sont homosexuelles. Mais aussi elle insiste sur la confusion en
cet objet de deux relations affectives, amour et identification, dont lopposition sera
fondamentale aux stades ultrieurs.
Cette ambigut originelle se retrouve chez ladulte, dans la passion de la jalousie
amoureuse et cest l quon peut le mieux la saisir. On doit la reconnatre, en effet, dans
le puissant intrt que le sujet porte limage du rival : intrt qui, bien quil saffirme
comme haine, cest--dire comme ngatif, et bien quil se motive par lobjet prtendu de
lamour, nen parat pas moins entretenu par le sujet de la faon la plus gratuite et la
plus coteuse et souvent domine tel point le sentiment amoureux lui-mme, quil doit
tre interprt comme lintrt essentiel et positif de la passion. Cet intrt confond en
lui lidentification et lamour et, pour napparatre que masqu dans le registre de la
pense de ladulte, nen confre pas moins la passion quil soutient cette irrfutabilit
qui lapparente lobsession. Lagressivit maximum quon rencontre dans les formes
psychotiques de la passion est constitue bien plus par la ngation de cet intrt
singulier que par la rivalit qui parat la justifier.
Le sens de lagressivit primordiale. Mais cest tout spcialement dans la situation
fraternelle primitive que lagressivit se dmontre pour secondaire lidentification. La
doctrine Freudienne reste incertaine sur ce point ; lide darwinienne que la lutte est aux
origines mmes de la vie garde en effet un grand crdit auprs du biologiste ; mais sans
doute faut-il reconnatre ici le prestige moins critiqu dune emphase moralisante, qui se
transmet en des poncifs tels que : homo homini lupus. Il est vident, au contraire, que le
nourrissage constitue prcisment pour les jeunes une neutralisation temporaire des
conditions de la lutte pour la nourriture. Cette signification est plus vidente encore chez
lhomme. Lapparition de la jalousie en rapport avec le nourrissage, selon le thme
classique illustr plus haut par une citation de Saint Augustin, doit donc tre interprte
prudemment. En fait, la jalousie peut se manifester dans des cas o le sujet, depuis
longtemps sevr, nest pas en situation de concurrence vitale lgard de son frre. Le
phnomne semble donc exiger comme pralable une certaine identification ltat du
frre. Au reste, la doctrine analytique, en caractrisant comme sadomasochiste la
tendance typique de la libido ce mme stade, souligne certes que lagressivit domine
alors lconomie affective, mais aussi quelle est toujours la fois subie et agie, cest-dire sous-tendue par une identification lautre, objet de la violence.
13
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Rappelons que ce rle de doublure intime que joue le masochisme dans le sadisme, a
t mis en relief par la psychanalyse et que cest lnigme que constitue le masochisme
dans lconomie des instincts vitaux qui a conduit Freud affirmer un instinct de mort.
Si lon veut suivre lide que nous avons indique plus haut, et dsigner avec nous
dans le malaise du sevrage humain la source du dsir de la mort, on reconnatra dans le
masochisme primaire le moment dialectique o le sujet assume par ses premiers actes
de jeu la reproduction de ce malaise mme et, par l, le sublime et le surmonte. Cest
bien ainsi que sont apparus les jeux primitifs de lenfant lil connaisseur de Freud :
cette joie de la premire enfance de rejeter un objet du champ de son regard, puis,
lobjet retrouv, den renouveler inpuisablement lexclusion, signifie bien que cest le
pathtique du sevrage que le sujet sinflige nouveau, tel quil la subi, mais dont il
triomphe maintenant quil est actif dans sa reproduction.
Le ddoublement ainsi bauch dans le sujet, cest lidentification au frre qui lui
permet de sachever : elle fournit limage qui fixe lun des ples du masochisme
primaire. Ainsi la non-violence du suicide primordial engendre la violence du meurtre
imaginaire du frre. Mais cette violence na pas de rapport avec la lutte pour la vie.
Lobjet que choisit lagressivit dans les primitifs jeux de la mort est, en effet, hochet ou
dchet, biologiquement indiffrent ; le sujet labolit gratuitement, en quelque sorte pour
le plaisir, il ne fait que consommer ainsi la perte de lobjet maternel. Limage du frre
non sevr nattire une agression spciale que parce quelle rpte dans le sujet limago
de la situation maternelle et avec elle le dsir de la mort. Ce phnomne est secondaire
lidentification.
LE STADE DU MIROIR
Lidentification affective est une fonction psychique dont la psychanalyse a tabli
loriginalit, spcialement dans le complexe ddipe, comme nous le verrons. Mais
lemploi de ce terme au stade que nous tudions reste mal dfini dans la doctrine ; cest
quoi nous avons tent de suppler par une thorie de cette identification dont nous
dsignons le moment gntique sous le terme de stade du miroir.
Le stade ainsi considr rpond au dclin du sevrage, cest--dire la fin de ces six
mois dont la dominante psychique de malaise, rpondant au retard de la croissance
physique, traduit cette prmaturation de la naissance qui est, comme nous lavons dit, le
fond spcifique du sevrage chez lhomme. Or, la reconnaissance par le sujet de son
image dans le miroir est un phnomne (8*40 10)qui, pour lanalyse de ce stade, est deux
fois significatif : le phnomne apparat aprs six mois et son tude ce moment rvle
de faon dmonstrative les tendances qui constituent alors la ralit du sujet ; limage
spculaire, en raison mme de ces affinits, donne un bon symbole de cette ralit : de
sa valeur affective, illusoire comme limage, et de sa structure, comme elle reflet de la
forme humaine.
La perception de la forme du semblable en tant quunit mentale est lie chez ltre
vivant un niveau corrlatif dintelligence et de sociabilit. Limitation au signal la
montre, rduite, chez lanimal de troupeau ; les structures chomimiques, chopraxiques
en manifestent linfinie richesse chez le Singe et chez lhomme. Cest le sens primaire
de lintrt que lun et lautre manifestent leur image spculaire. Mais si leurs
comportements lgard de cette image, sous la forme de tentatives dapprhension
manuelle, paraissent se ressembler, ces jeux ne dominent chez lhomme que pendant un
moment, la fin de la premire anne, ge dnomm par Bhler ge du Chimpanz
parce que lhomme y passe un pareil niveau dintelligence instrumentale.
14
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Puissance seconde de limage spculaire. Or le phnomne de perception qui se
produit chez lhomme ds le sixime mois, est apparu ds ce moment sous une forme
toute diffrente, caractristique dune intuition illuminative, savoir, sur le fonds dune
inhibition attentive, rvlation soudaine du comportement adapt (ici geste de rfrence
quelque partie du corps propre) ; puis ce gaspillage jubilatoire dnergie qui signale
objectivement le triomphe ; cette double raction laissant entrevoir le sentiment de
comprhension sous sa forme ineffable. Ces caractres traduisent selon nous le sens
secondaire que le phnomne reoit des conditions libidinales qui entourent son
apparition. Ces conditions ne sont que les tensions psychiques issues des mois de
prmaturation et qui paraissent traduire une double rupture vitale : rupture de cette
immdiate adaptation au milieu qui dfinit le monde de lanimal par sa connaturalit ;
rupture de cette unit du fonctionnement du vivant qui asservit chez lanimal la
perception la pulsion.
La discordance, ce stade chez lhomme, tant des pulsions que des fonctions, nest
que la suite de lincoordination prolonge des appareils. Il en rsulte un stade
affectivement et mentalement constitu sur la base dune proprioceptivit qui donne le
corps comme morcel : dune part, lintrt psychique se trouve dplac sur des
tendances visant quelque recollement du corps propre ; dautre part, la ralit, soumise
dabord un morcellement perceptif, dont le chaos atteint jusqu ses catgories,
espaces , par exemple, aussi disparates que les statiques successives de lenfant,
sordonne en refltant les formes du corps, qui donnent en quelque sorte le modle de
tous les objets.
Cest ici une structure archaque du monde humain dont lanalyse de linconscient a
montr les profonds vestiges : fantasmes de dmembrement, de dislocation du corps,
dont ceux de la castration ne sont quune image mise en valeur par un complexe
particulier ; limago du double, dont les objectivations fantastiques, telles que des
causes diverses les ralisent divers ges de la vie, rvlent au psychiatre quelle volue
avec la croissance du sujet ; enfin, ce symbolisme anthropomorphique et organique des
objets dont la psychanalyse, dans les rves et dans les symptmes, a fait la prodigieuse
dcouverte.
La tendance par o le sujet restaure lunit perdue de soi-mme prend place ds
lorigine au centre de la conscience. Elle est la source dnergie de son progrs mental,
progrs dont la structure est dtermine par la prdominance des fonctions visuelles. Si
la recherche de son unit affective promeut chez le sujet les formes o il se reprsente
son identit, la forme la plus intuitive en est donne, cette phase, par limage
spculaire. Ce que le sujet salue en elle, cest lunit mentale qui lui est inhrente. Ce
quil y reconnat, cest lidal de limago du double. Ce quil y acclame, cest le
triomphe de la tendance salutaire.
Structure narcissique du moi. Le monde propre cette phase est donc un monde
narcissique. En le dsignant ainsi nous nvoquons pas seulement sa structure libidinale
par le terme mme auquel Freud et Abraham, ds 1908 ont assign le sens purement
nergtique dinvestissement de la libido sur le corps propre ; nous voulons aussi
pntrer sa structure mentale avec le plein sens du mythe de Narcisse ; que ce sens
indique la mort : linsuffisance vitale dont ce monde est issu ; ou la rflexion
spculaire : limago du double qui lui est centrale ; ou lillusion de limage : ce monde,
nous lallons voir, ne contient pas dautrui.
La perception de lactivit dautrui ne suffit pas en effet rompre lisolement affectif
du sujet. Tant que limage du semblable ne joue que son rle primaire, limit la
15
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
fonction dexpressivit, elle dclenche chez le sujet motions et postures similaires, du
moins dans la mesure o le permet la structure actuelle de ses appareils. Mais tandis
quil subit cette suggestion motionnelle ou motrice, le sujet ne se distingue pas de
limage elle-mme. Bien plus, dans la discordance caractristique de cette phase,
limage ne fait quajouter lintrusion temporaire dune tendance trangre. Appelons-la
intrusion narcissique : lunit quelle introduit dans les tendances contribuera pourtant
la formation du moi. Mais, avant que le moi affirme son identit, il se confond avec
cette image qui le forme, mais laline primordialement.
Disons que le moi gardera de cette origine la structure ambigu du spectacle qui,
manifeste dans les situations plus haut dcrites du despotisme, de la sduction, de la
parade, donne leur forme des pulsions, sado-masochiste et scoptophilique (dsir de
voir et dtre vu), destructrices de lautrui dans leur essence. Notons aussi que cette
intrusion primordiale fait comprendre toute projection du moi constitu, quelle se
manifeste comme mythomaniaque chez lenfant dont lidentification personnelle vacille
encore, comme transitiviste chez le paranoaque dont le moi rgresse un stade
archaque, ou comme comprhensive quand elle est intgre dans un moi normal.
LE DRAME DE LA JALOUSIE : LE MOI ET LAUTRUI
Le moi se constitue en mme temps que lautrui dans le drame de la jalousie. Pour le
sujet, cest une discordance qui intervient dans la satisfaction spectaculaire, du fait de la
tendance que celle-ci suggre. Elle implique lintroduction dun tiers objet qui, la
confusion affective, comme lambigut spectaculaire, substitue la concurrence dune
situation triangulaire. Ainsi le sujet, engag dans la jalousie par identification, dbouche
(8*40 11)
sur une alternative nouvelle o se joue le sort de la ralit : ou bien il retrouve
lobjet maternel et va saccrocher au refus du rel et la destruction de lautre ; ou bien,
conduit quelque autre objet, il le reoit sous la forme caractristique de la
connaissance humaine, comme objet communicable, puisque concurrence implique la
fois rivalit et accord ; mais en mme temps il reconnat lautre avec lequel sengage la
lutte ou le contrat, bref il trouve la fois lautrui et lobjet socialis. Ici encore la
jalousie humaine se distingue donc de la rivalit vitale immdiate, puisquelle forme son
objet plus quil ne la dtermine ; elle se rvle comme larchtype des sentiments
sociaux.
Le moi ainsi conu ne trouve pas avant lge de trois ans sa constitution essentielle ;
cest celle mme, on le voit, de lobjectivit fondamentale de la connaissance humaine.
Point remarquable, celle-ci tire sa richesse et sa puissance de linsuffisance vitale de
lhomme ses origines. Le symbolisme primordial de lobjet favorise tant son extension
hors des limites des instincts vitaux que sa perception comme instrument. Sa
socialisation par la sympathie jalouse fonde sa permanence et sa substantialit.
Tels sont les traits essentiels du rle psychique du complexe fraternel. En voici
quelques applications.
Conditions et effets de la fraternit. Le rle traumatisant du frre au sens neutre est
donc constitu par son intrusion. Le fait et lpoque de son apparition dterminent sa
signification pour le sujet. Lintrusion part du nouveau venu pour infester loccupant ;
dans la famille, cest en rgle gnrale le fait dune naissance et cest lan qui en
principe joue le rle de patient.
La raction du patient au traumatisme dpend de son dveloppement psychique.
Surpris par lintrus dans le dsarroi du sevrage, il le ractive sans cesse son spectacle :
il fait alors une rgression qui se rvlera, selon les destins du moi, comme psychose
schizophrnique ou comme nvrose hypochondriaque ; ou bien il ragit par la
16
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
destruction imaginaire du monstre, qui donnera de mme soit des impulsions perverses,
soit une culpabilit obsessionnelle.
Que lintrus ne survienne au contraire quaprs le complexe de ldipe, il est adopt
le plus souvent sur le plan des identifications parentales, plus denses affectivement et
plus riches de structure, on va le voir. Il nest plus pour le sujet lobstacle ou le reflet,
mais une personne digne damour ou de haine. Les pulsions agressives se subliment en
tendresse ou en svrit.
Mais le frre donne aussi le modle archaque du moi. Ici le rle dagent revient
lan comme au plus achev. Plus conforme sera ce modle lensemble des pulsions
du sujet, plus heureuse sera la synthse du moi et plus relles les formes de lobjectivit.
Cette formule est-elle confirme par ltude des jumeaux ? On sait que de nombreux
mythes leur imputent la puissance du hros, par quoi est restaure dans la ralit
lharmonie du sein maternel, mais cest au prix dun fratricide. Quoi quil en soit, cest
par le semblable que lobjet comme le moi se ralise : plus il peut assimiler de son
partenaire, plus le sujet conforte la fois sa personnalit et son objectivit, garantes de
sa future efficacit.
Mais le groupe de la fratrie familiale, divers dge et de sexe, est favorable aux
identifications les plus discordantes du moi. Limago primordiale du double sur laquelle
le moi se modle semble dabord domine par les fantaisies de la forme, comme il
apparat dans le fantasme commun aux deux sexes, de la mre phallique ou dans le
double phallique de la femme nvrose. Dautant plus facilement se fixera-t-elle en des
formes atypiques, o des appartenances accessoires pourront jouer un aussi grand rle
que des diffrences organiques ; et lon verra, selon la pousse, suffisante ou non, de
linstinct sexuel, cette identification de la phase narcissique, soit engendrer les
exigences formelles dune homosexualit ou de quelque ftichisme sexuel, soit, dans le
systme dun moi paranoaque, sobjectiver dans le type du perscuteur, extrieur ou
intime.
Les connexions de la paranoa avec le complexe fraternel se manifestent par la
frquence des thmes de filiation, dusurpation, de spoliation, comme sa structure
narcissique se rvle dans les thmes plus paranodes de lintrusion, de linfluence, du
ddoublement, du double et de toutes les transmutations dlirantes du corps.
Ces connexions sexpliquent en ce que le groupe familial, rduit la mre et la
fratrie, dessine un complexe psychique o la ralit tend rester imaginaire ou tout au
plus abstraite. La clinique montre queffectivement le groupe ainsi dcomplt est trs
favorable lclosion des psychoses et quon y trouve la plupart des cas de dlires
deux.
3. Le complexe ddipe
Cest en dcouvrant dans lanalyse des nvroses les faits dipiens que Freud mit au
jour le concept du complexe. Le complexe ddipe, expos, vu le nombre des relations
psychiques quil intresse, en plus dun point de cet ouvrage, simpose ici et notre
tude, puisquil dfinit plus particulirement les relations psychiques dans la famille
humaine et notre critique, pour autant que Freud donne cet lment psychologique
pour la forme spcifique de la famille humaine et lui subordonne toutes les variations
sociales de la famille. Lordre mthodique ici propos, tant dans la considration des
structures mentales que des faits sociaux, conduira une rvision du complexe qui
permettra de situer dans lhistoire la famille paternaliste et dclairer plus avant la
nvrose contemporaine.
17
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Schma du complexe. La psychanalyse a rvl chez lenfant des pulsions gnitales
dont lapoge se situe dans la 4me anne. Sans nous tendre ici sur leur structure, disons
quelles constituent une sorte de pubert psychologique, fort prmature, on le voit, par
rapport la pubert physiologique. En fixant lenfant par un dsir sexuel lobjet le
plus proche que lui offrent normalement la prsence et lintrt, savoir le parent de
sexe oppos, ces pulsions donnent sa base au complexe ; leur frustration en forme le
nud. Bien quinhrente la prmaturation essentielle de ces pulsions, cette frustration
est rapporte par lenfant au tiers objet que les mmes conditions de prsence et
dintrt lui dsignent normalement comme lobstacle leur satisfaction : savoir au
parent du mme sexe.
La frustration quil subit saccompagne, en effet, communment dune rpression
ducative qui a pour but dempcher tout aboutissement de ces pulsions et spcialement
leur aboutissement masturbatoire. Dautre part, lenfant acquiert une certaine intuition
de la situation qui lui est interdite, tant par les signes discrets et diffus qui trahissent sa
sensibilit les relations parentales que par les hasards intempestifs qui les lui dvoilent.
Par ce double procs, le parent de mme sexe apparat lenfant la fois comme lagent
de linterdiction sexuelle et lexemple de sa transgression.
(8*40 12)
La tension ainsi constitue se rsout, dune part, par un refoulement de la
tendance sexuelle qui, ds lors, restera latente laissant place des intrts neutres,
minemment favorables aux acquisitions ducatives jusqu la pubert ; dautre part,
par la sublimation de limage parentale qui perptuera dans la conscience un idal
reprsentatif, garantie de la concidence future des attitudes psychiques et des attitudes
physiologiques au moment de la pubert. Ce double procs a une importance gntique
fondamentale, car il reste inscrit dans le psychisme en deux instances permanentes :
celle qui refoule sappelle le surmoi, celle qui sublime, lidal du moi. Elles reprsentent
lachvement de la crise dipienne.
Valeur objective du complexe. Ce schma essentiel du complexe rpond un grand
nombre de donnes de lexprience. Lexistence de la sexualit infantile est dsormais
inconteste ; au reste, pour stre rvle historiquement par ces squelles de son
volution qui constituent les nvroses, elle est accessible lobservation la plus
immdiate, et sa mconnaissance sculaire est une preuve frappante de la relativit
sociale du savoir humain. Les instances psychiques qui, sous le nom du surmoi et
didal du moi, ont t isoles dans une analyse concrte des symptmes des nvroses,
ont manifest leur valeur scientifique dans la dfinition et lexplication des phnomnes
de la personnalit ; il y a l un ordre de dtermination positive qui rend compte dune
foule danomalies du comportement humain et, du mme coup, rend caduques, pour ces
troubles, les rfrences lordre organique qui, encore que de pur principe ou
simplement mythiques, tiennent lieu de mthode exprimentale toute une tradition
mdicale.
vrai dire, ce prjug qui attribue lordre psychique un caractre piphnomnal,
cest--dire inoprant, tait favoris par une analyse insuffisante des facteurs de cet
ordre et cest prcisment la lumire de la situation dfinie comme dipienne que tels
accidents de lhistoire du sujet prennent la signification et limportance qui permettent
de leur rapporter tel trait individuel de sa personnalit ; on peut mme prciser que
lorsque ces accidents affectent la situation dipienne comme traumatismes dans son
volution, ils se rptent plutt dans les effets du surmoi ; sils laffectent comme
atypies dans sa constitution, cest plutt dans les formes de lidal du moi quils se
refltent. Ainsi, comme inhibitions de lactivit cratrice ou comme inversions de
limagination sexuelle, un grand nombre de troubles, dont beaucoup apparaissent au
18
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
niveau des fonctions somatiques lmentaires, ont trouv leur rduction thorique et
thrapeutique.
LA FAMILLE SELON FREUD
Dcouvrir que des dveloppements aussi importants pour lhomme que ceux de la
rpression sexuelle et du sexe psychique taient soumis la rgulation et aux accidents
dun drame psychique de la famille, ctait fournir la plus prcieuse contribution
lanthropologie du groupement familial, spcialement ltude des interdictions que ce
groupement formule universellement et qui ont pour objet le commerce sexuel entre
certains de ses membres. Aussi bien, Freud en vint-il vite formuler une thorie de la
famille. Elle tait fonde sur une dissymtrie, apparue ds les premires recherches,
dans la situation des deux sexes par rapport ldipe. Le procs qui va du dsir
dipien sa rpression napparat aussi simple que nous lavons expos dabord, que
chez lenfant mle. Aussi est-ce ce dernier qui est pris constamment pour sujet dans les
exposs didactiques du complexe.
Le dsir dipien apparat, en effet, beaucoup plus intense chez le garon et donc
pour la mre. Dautre part, la rpression rvle, dans son mcanisme, des traits qui ne
paraissent dabord justifiables que si, dans sa forme typique, elle sexerce du pre au
fils. Cest l le fait du complexe de castration.
Le complexe de castration. Cette rpression sopre par un double mouvement
affectif du sujet : agressivit contre le parent lgard duquel son dsir sexuel le met en
posture de rival ; crainte secondaire, prouve en retour, dune agression semblable. Or
un fantasme soutient ces deux mouvements, si remarquable quil a t individualis
avec eux en un complexe dit de castration. Si ce terme se justifie par les fins agressives
et rpressives qui apparaissent ce moment de ldipe, il est pourtant peu conforme au
fantasme qui en constitue le fait original.
Ce fantasme consiste essentiellement dans la mutilation dun membre, cest--dire
dans un svice qui ne peut servir qu chtrer un mle. Mais la ralit apparente de ce
danger, jointe au fait que la menace en est rellement formule par une tradition
ducative, devait entraner Freud le concevoir comme ressenti dabord pour sa valeur
relle et reconnatre dans une crainte inspire de mle mle, en fait par le pre, le
prototype de la rpression dipienne.
Dans cette voie, Freud recevait un appui dune donne sociologique : non seulement
linterdiction de linceste avec la mre a un caractre universel, travers les relations de
parent infiniment diverses et souvent paradoxales que les cultures primitives frappent
du tabou de linceste, mais encore, quel que soit dans une culture le niveau de la
conscience morale, cette interdiction est toujours expressment formule et la
transgression en est frappe dune rprobation constante. Cest pourquoi Frazer
reconnat dans le tabou de la mre la loi primordiale de lhumanit.
Le mythe du parricide originel. Cest ainsi que Freud fait le saut thorique dont
nous avons marqu labus dans notre introduction : de la famille conjugale quil
observait chez ses sujets, une hypothtique famille primitive conue comme une horde
quun mle domine par sa supriorit biologique en accaparant les femelles nubiles.
Freud se fonde sur le lien que lon constate entre les tabous et les observances lgard
du totem, tour tour objet dinviolabilit et dorgie sacrificielle. Il imagine un drame de
meurtre du pre par les fils, suivi dune conscration posthume de sa puissance sur les
femmes par les meurtriers prisonniers dune insoluble rivalit : vnement primordial,
do, avec le tabou de la mre, serait sortie toute tradition morale et culturelle.
19
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Mme si cette construction ntait ruine par les seules ptitions de principe quelle
comporte attribuer un groupe biologique la possibilit, quil sagit justement de
fonder, de la reconnaissance dune loi ses prmisses prtendues biologiques ellesmmes, savoir la tyrannie permanente exerce par le chef de la horde, se rduiraient
un fantme de plus en plus incertain mesure quavance notre connaissance des
Anthropodes. Mais surtout les traces universellement prsentes et la survivance tendue
dune structure matriarcale de la famille, lexistence dans son aire de toutes les formes
fondamentales de la culture, et spcialement dune rpression souvent trs rigoureuse de
la sexualit manifestent que lordre de la famille humaine a des fondements soustraits
la force du mle.
Il nous semble pourtant que limmense moisson des faits que le complexe ddipe a
permis dobjectiver depuis quelque cinquante ans, peut clairer la structure
psychologique de la famille, plus avant que les intuitions trop htives que nous venons
dexposer.
(8*40 13)
LES FONCTIONS DU COMPLEXE : RVISION PSYCHOLOGIQUE
Le complexe ddipe marque tous les niveaux du psychisme ; mais les thoriciens
de la psychanalyse nont pas dfini sans ambigut les fonctions quil y remplit ; cest
faute davoir distingu suffisamment les plans de dveloppement sur lesquels ils
lexpliquent. Si le complexe leur apparat en effet comme laxe selon lequel lvolution
de la sexualit se projette dans la constitution de la ralit, ces deux plans divergent
chez lhomme dune incidence spcifique, qui est certes reconnue par eux comme
rpression de la sexualit et sublimation de la ralit, mais doit tre intgre dans une
conception plus rigoureuse de ces rapports de structure : le rle de maturation que joue
le complexe dans lun et lautre de ces plans ne pouvant tre tenu pour parallle
quapproximativement.
MATURATION DE LA SEXUALIT
Lappareil psychique de la sexualit se rvle dabord chez lenfant sous les formes
les plus aberrantes par rapport ses fins biologiques, et la succession de ces formes
tmoigne que cest par une maturation progressive quil se conforme lorganisation
gnitale. Cette maturation de la sexualit conditionne le complexe ddipe, en formant
ses tendances fondamentales, mais, inversement, le complexe la favorise en la dirigeant
vers ses objets.
Le mouvement de ldipe sopre, en effet, par un conflit triangulaire dans le sujet ;
dj, nous avons vu le jeu des tendances issues du sevrage produire une formation de
cette sorte ; cest aussi la mre, objet premier de ces tendances, comme nourriture
absorber et mme comme sein o se rsorber, qui se propose dabord au dsir dipien.
On comprend ainsi que ce dsir se caractrise mieux chez le mle, mais aussi quil y
prte une occasion singulire la ractivation des tendances du sevrage, cest--dire
une rgression sexuelle. Ces tendances ne constituent pas seulement, en effet, une
impasse psychologique ; elles sopposent en outre particulirement ici lattitude
dextriorisation, conforme lactivit du mle.
Tout au contraire, dans lautre sexe, o ces tendances ont une issue possible dans la
destine biologique du sujet, lobjet maternel, en dtournant une part du dsir dipien,
tend certes neutraliser le potentiel du complexe et, par l, ses effets de sexualisation,
mais, en imposant un changement dobjet, la tendance gnitale se dtache mieux des
tendances primitives et dautant plus facilement quelle na pas renverser lattitude
20
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
dintriorisation hrite de ces tendances, qui sont narcissiques. Ainsi en arrive-t-on
cette conclusion ambigu que, dun sexe lautre, plus la formation du complexe est
accuse, plus alatoire parat tre son rle dans ladaptation sexuelle.
CONSTITUTION DE LA RALIT
On voit ici linfluence du complexe psychologique sur une relation vitale et cest par
l quil contribue la constitution de la ralit. Ce quil y apporte se drobe aux termes
dune psychogense intellectualiste : cest une certaine profondeur affective de lobjet.
Dimension qui, pour faire le fond de toute comprhension subjective, ne sen
distinguerait pas comme phnomne, si la clinique des maladies mentales ne nous la
faisait saisir comme telle en proposant toute une srie de ses dgradations aux limites de
la comprhension.
Pour constituer en effet une norme du vcu, cette dimension ne peut qutre
reconstruite par des intuitions mtaphoriques : densit qui confre lexistence lobjet,
perspective qui nous donne le sentiment de sa distance et nous inspire le respect de
lobjet. Mais elle se dmontre dans ces vacillements de la ralit qui fcondent le
dlire : quand lobjet tend se confondre avec le moi en mme temps qu se rsorber
en fantasme, quand il apparat dcompos selon lun de ces sentiments qui forment le
spectre de lirralit, depuis les sentiments dtranget, de dj vu, de jamais-vu, en
passant par les fausses reconnaissances, les illusions de sosie, les sentiments de
devinement, de participation, dinfluence, les intuitions de signification, pour aboutir au
crpuscule du monde et cette abolition affective quon dsigne formellement en
allemand comme perte de lobjet (Objektverlust).
Ces qualits si diverses du vcu, la psychanalyse les explique par les variations de la
quantit dnergie vitale que le dsir investit dans lobjet. La formule, toute verbale
quelle puisse paratre, rpond, pour les psychanalystes, une donne de leur pratique ;
ils comptent avec cet investissement dans les transferts opratoires de leurs cures ;
cest sur les ressources quil offre quils doivent fonder lindication du traitement. Ainsi
ont-ils reconnu dans les symptmes cits plus haut les indices dun investissement trop
narcissique de la libido, cependant que la formation de ldipe apparaissait comme le
moment et la preuve dun investissement suffisant pour le transfert .
Ce rle de ldipe serait corrlatif de la maturation de la sexualit. Lattitude
instaure par la tendance gnitale cristalliserait selon son type normal le rapport vital
la ralit. On caractrise cette attitude par les termes de don et de sacrifice, termes
grandioses, mais dont le sens reste ambigu et hsite entre la dfense et le renoncement.
Par eux une conception audacieuse retrouve le confort secret dun thme moralisant :
dans le passage de la captativit loblativit, on confond plaisir lpreuve vitale et
lpreuve morale.
Cette conception peut se dfinir une psychogense analogique ; elle est conforme au
dfaut le plus marquant de la doctrine analytique : ngliger la structure au profit du
dynamisme. Pourtant lexprience analytique elle-mme apporte une contribution
ltude des formes mentales en dmontrant leur rapport soit de conditions, soit de
solutions avec les crises affectives. Cest en diffrenciant le jeu formel du complexe
quon peut tablir, entre sa fonction et la structure du drame qui lui est essentielle, un
rapport plus arrt.
RPRESSION DE LA SEXUALIT
Le complexe ddipe, sil marque le sommet de la sexualit infantile, est aussi le
ressort de la rpression qui en rduit les images ltat de latence jusqu la pubert ;
21
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
sil dtermine une condensation de la ralit dans le sens de la vie, il est aussi le
moment de la sublimation qui chez lhomme ouvre cette ralit son extension
dsintresse.
Les formes sous lesquelles se perptuent ces effets sont dsignes comme surmoi ou
idal du moi, selon quelles sont pour le sujet inconscientes ou conscientes. Elles
reproduisent, dit-on, limago du parent du mme sexe, lidal du moi contribuant ainsi
au conformisme sexuel du psychisme. Mais limago du pre aurait, selon la doctrine,
dans ces deux fonctions, un rle prototypique en raison de la domination du mle.
Pour la rpression de la sexualit, cette conception repose, nous lavons indiqu, sur
le fantasme de castration. Si la doctrine le rapporte une menace relle, cest avant tout
que, gnialement dynamiste pour reconnatre les tendances, Freud reste ferm par
latomisme traditionnel la notion de lautonomie des formes ; cest ainsi qu observer
lexistence du mme fantasme chez la petite fille ou dune image phallique de la mre
dans les deux sexes, il est contraint dexpliquer ces faits par de prcoces rvlations de
la domination du mle, rvlations qui conduiraient la petite fille la nostalgie de la
virilit, lenfant concevoir sa mre comme virile. Gense qui, pour trouver un
fondement dans lidentification, requiert lusage une telle surcharge de mcanismes
quelle parat errone.
Les fantasmes de morcellement. Or, le matriel de lexprience analytique suggre
une interprtation diffrente ; le fantasme de castration est en effet prcd par toute une
srie de fantasmes de morcellement du corps qui vont en rgression (8*40 14)de la
dislocation et du dmembrement, par lviration, lventrement, jusqu la dvoration et
lensevelissement.
Lexamen de ces fantasmes rvle que leur srie sinscrit dans une forme de
pntration sens destructeur et investigateur la fois, qui vise le secret du sein
maternel, cependant que ce rapport est vcu par le sujet sous un mode plus ambivalent
proportion de leur archasme. Mais les chercheurs qui ont le mieux compris lorigine
maternelle de ces fantasmes (Mlanie Klein), ne sattachent qu la symtrie et
lextension quils apportent la formation de ldipe, en rvlant par exemple la
nostalgie de la maternit chez le garon. Leur intrt tient nos yeux dans lirralit
vidente de leur structure : lexamen de ces fantasmes quon trouve dans les rves et
dans certaines impulsions permet daffirmer quils ne se rapportent aucun corps rel,
mais un mannequin htroclite, une poupe baroque, un trophe de membres o il
faut reconnatre lobjet narcissique dont nous avons plus haut voqu la gense :
conditionne par la prcession, chez lhomme, de formes imaginaires du corps sur la
matrise du corps propre, par la valeur de dfense que le sujet donne ces formes,
contre langoisse du dchirement vital, fait de la prmaturation.
Origine maternelle du surmoi archaque. Le fantasme de castration se rapporte ce
mme objet : sa forme, ne avant tout reprage du corps propre, avant toute distinction
dune menace de ladulte, ne dpend pas du sexe du sujet et dtermine plutt quelle ne
subit les formules de la tradition ducative. Il reprsente la dfense que le moi
narcissique, identifi son double spculaire, oppose au renouveau dangoisse qui, au
premier moment de ldipe, tend lbranler : crise que ne cause pas tant lirruption du
dsir gnital dans le sujet que lobjet quil ractualise, savoir la mre. langoisse
rveille par cet objet, le sujet rpond en reproduisant le rejet masochique par o il a
surmont sa perte primordiale, mais il lopre selon la structure quil a acquise, cest-dire dans une localisation imaginaire de la tendance.
Une telle gense de la rpression sexuelle nest pas sans rfrence sociologique : elle
sexprime dans les rites par lesquels les primitifs manifestent que cette rpression tient
22
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
aux racines du lien social : rites de fte qui, pour librer la sexualit, y dsignent par
leur forme orgiaque le moment de la rintgration affective dans le Tout ; rites de
circoncision qui, pour sanctionner la maturit sexuelle, manifestent que la personne ny
accde quau prix dune mutilation corporelle.
Pour dfinir sur le plan psychologique cette gense de la rpression, on doit
reconnatre dans le fantasme de castration le jeu imaginaire qui la conditionne, dans la
mre lobjet qui la dtermine. Cest la forme radicale des contrepulsions qui se rvlent
lexprience analytique pour constituer le noyau le plus archaque du surmoi et pour
reprsenter la rpression la plus massive. Cette force se rpartit avec la diffrenciation
de cette forme, cest--dire avec le progrs par o le sujet ralise linstance rpressive
dans lautorit de ladulte ; on ne saurait autrement comprendre ce fait, apparemment
contraire la thorie, que la rigueur avec laquelle le surmoi inhibe les fonctions du sujet
tende stablir en raison inverse des svrits relles de lducation. Bien que le
surmoi reoive dj de la seule rpression maternelle (disciplines du sevrage et des
sphincters) des traces de la ralit, cest dans le complexe ddipe quil dpasse sa
forme narcissique.
SUBLIMATION DE LA RALIT
Ici sintroduit le rle de ce complexe dans la sublimation de la ralit. On doit partir,
pour le comprendre, du moment o la doctrine montre la solution du drame, savoir de
la forme quelle y a dcouverte, de lidentification. Cest, en effet, en raison dune
identification du sujet limago du parent de mme sexe que le surmoi et lidal du moi
peuvent rvler lexprience des traits conformes aux particularits de cette imago.
La doctrine y voit le fait dun narcissisme secondaire ; elle ne distingue pas cette
identification de lidentification narcissique : il y a galement assimilation du sujet
lobjet ; elle ny voit dautre diffrence que la constitution, avec le dsir dipien, dun
objet de plus de ralit, sopposant un moi mieux form ; de la frustration de ce dsir
rsulterait, selon les constantes de lhdonisme, le retour du sujet sa primordiale
voracit dassimilation et, de la formation du moi, une imparfaite introjection de
lobjet : limago, pour simposer au sujet, se juxtapose seulement au moi dans les deux
exclusions de linconscient et de lidal.
Originalit de lidentification dipienne. Une analyse plus structurale de
lidentification dipienne permet pourtant de lui reconnatre une forme plus distinctive.
Ce qui apparat dabord, cest lantinomie des fonctions que joue dans le sujet limago
parentale : dune part, elle inhibe la fonction sexuelle, mais sous une forme
inconsciente, car lexprience montre que laction du surmoi contre les rptitions de la
tendance reste aussi inconsciente que la tendance reste refoule. Dautre part, limago
prserve cette fonction, mais labri de sa mconnaissance, car cest bien la prparation
des voies de son retour futur que reprsente dans la conscience lidal du moi. Ainsi, si
la tendance se rsout sous les deux formes majeures, inconscience, mconnaissance, o
lanalyse a appris la reconnatre, limago apparat elle-mme sous deux structures dont
lcart dfinit la premire sublimation de la ralit.
On ne souligne pourtant pas assez que lobjet de lidentification nest pas ici lobjet
du dsir, mais celui qui sy oppose dans le triangle dipien. Lidentification de
mimtique est devenue propitiatoire ; lobjet de la participation sado-masochique se
dgage du sujet, prend distance de lui dans la nouvelle ambigut de la crainte et de
lamour. Mais, dans ce pas vers la ralit, lobjet primitif du dsir parat escamot.
23
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Ce fait dfinit pour nous loriginalit de lidentification dipienne : il nous parat
indiquer que, dans le complexe ddipe, ce nest pas le moment du dsir qui rige
lobjet dans sa ralit nouvelle, mais celui de la dfense narcissique du sujet.
Ce moment, en faisant surgir lobjet que sa position situe comme obstacle au dsir, le
montre aurol de la transgression sentie comme dangereuse ; il apparat au moi la
fois comme lappui de sa dfense et lexemple de son triomphe. Cest pourquoi cet objet
vient normalement remplir le cadre du double o le moi sest identifi dabord et par
lequel il peut encore se confondre avec lautrui ; il apporte au moi une scurit, en
renforant ce cadre, mais du mme coup il le lui oppose comme un idal qui,
alternativement, lexalte et le dprime.
Ce moment de ldipe donne le prototype de la sublimation autant par le rle de
prsence masque quy joue la tendance, que par la forme dont il revt lobjet. La mme
forme est sensible en effet chaque crise o se produit, pour la ralit humaine, cette
condensation dont nous avons pos plus haut lnigme : cest cette lumire de
ltonnement qui transfigure un objet en dissolvant ses quivalences dans le sujet et le
propose non plus comme moyen la satisfaction du dsir, mais comme ple aux
crations de la passion. Cest en rduisant nouveau un tel objet que lexprience
ralise tout approfondissement.
Une srie de fonctions antinomiques se constitue ainsi dans le sujet par les crises
majeures de la ralit humaine, pour contenir les virtualits indfinies de son progrs ; si
la fonction de la conscience semble exprimer langoisse primordiale et celle de
lquivalence reflter le conflit narcissique, celle de lexemple parat lapport original
du complexe ddipe.
Limago du pre. Or, la structure mme du drame dipien dsigne le pre pour
donner la fonction de sublimation sa forme la plus minente, parce que la plus pure.
Limago de la mre dans lidentification (8*40 15)dipienne trahit, en effet, linterfrence
des identifications primordiales ; elle marque de leurs formes et de leur ambivalence
autant lidal du moi que le surmoi : chez la fille, de mme que la rpression de la
sexualit impose plus volontiers aux fonctions corporelles ce morcelage mental o lon
peut dfinir lhystrie, de mme la sublimation de limago maternelle tend tourner en
sentiment de rpulsion pour sa dchance et en souci systmatique de limage
spculaire.
Limago du pre, mesure quelle domine, polarise dans les deux sexes les formes
les plus parfaites de lidal du moi, dont il suffit dindiquer quelles ralisent lidal viril
chez le garon, chez la fille lidal virginal. Par contre, dans les formes diminues de
cette imago nous pouvons souligner les lsions physiques, spcialement celles qui la
prsentent comme estropie ou aveugle, pour dvier lnergie de sublimation de sa
direction cratrice et favoriser sa rclusion dans quelque idal dintgrit narcissique. La
mort du pre, quelque tape du dveloppement quelle se produise et selon le degr
dachvement de ldipe, tend, de mme, tarir en le figeant le progrs de la ralit.
Lexprience, en rapportant de telles causes un grand nombre de nvroses et leur
gravit, contredit donc lorientation thorique qui en dsigne lagent majeur dans la
menace de la force paternelle.
LE COMPLEXE ET LA RELATIVIT SOCIOLOGIQUE
Sil est apparu dans lanalyse psychologique de ldipe quil doit se comprendre en
fonction de ses antcdents narcissiques, ce nest pas dire quil se fonde hors de la
relativit sociologique. Le ressort le plus dcisif de ses effets psychiques tient, en effet,
ce que limago du pre concentre en elle la fonction de rpression avec celle de
24
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
sublimation ; mais cest l le fait dune dtermination sociale, celle de la famille
paternaliste.
MATRIARCAT ET PATRIARCAT
Lautorit familiale nest pas, dans les cultures matriarcales, reprsente par le pre,
mais ordinairement par loncle maternel. Un ethnologue qua guid sa connaissance de
la psychanalyse, Malinowski, a su pntrer les incidences psychiques de ce fait : si
loncle maternel exerce ce parrainage social de gardien des tabous familiaux et
dinitiateur aux rites tribaux, le pre, dcharg de toute fonction rpressive, joue un rle
de patronage plus familier, de matre en techniques et de tuteur de laudace aux
entreprises.
Cette sparation de fonctions entrane un quilibre diffrent du psychisme, quatteste
lauteur par labsence de nvrose dans les groupes quil a observs aux les du nordouest de la Mlansie. Cet quilibre dmontre heureusement que le complexe ddipe
est relatif une structure sociale, mais il nautorise en rien le mirage paradisiaque,
contre lequel le sociologue doit toujours se dfendre : lharmonie quil comporte
soppose en effet la strotypie qui marque les crations de la personnalit, de lart la
morale, dans de semblables cultures, et lon doit reconnatre dans ce revers,
conformment la prsente thorie de ldipe, combien llan de la sublimation est
domin par la rpression sociale, quand ces deux fonctions sont spares.
Cest au contraire parce quelle est investie de la rpression que limago paternelle en
projette la force originelle dans les sublimations mmes qui doivent la surmonter ; cest
de nouer en une telle antinomie le progrs de ces fonctions, que le complexe ddipe
tient sa fcondit. Cette antinomie joue dans le drame individuel, nous la verrons sy
confirmer par des effets de dcomposition ; mais ses effets de progrs dpassent de
beaucoup ce drame, intgrs quils sont dans un immense patrimoine culturel : idaux
normaux, statuts juridiques, inspirations cratrices. Le psychologue ne peut ngliger ces
formes qui, en concentrant dans la famille conjugale les conditions du conflit
fonctionnel de ldipe, rintgrent dans le progrs psychologique la dialectique sociale
engendre par ce conflit.
Que ltude de ces formes se rfre lhistoire, cest l dj une donne pour notre
analyse ; cest en effet un problme de structure quil faut rapporter ce fait que la
lumire de la tradition historique ne frappe en plein que les annales des patriarcats,
tandis quelle nclaire quen frange celle mme o se maintient linvestigation dun
Bachofen les matriarcats, partout sous-jacents la culture antique.
Ouverture du lien social. Nous rapprocherons de ce fait le moment critique que
Bergson a dfini dans les fondements de la morale ; on sait quil ramne sa fonction
de dfense vitale ce tout de lobligation par quoi il dsigne le lien qui clt le groupe
humain sur sa cohrence, et quil reconnat loppos un lan transcendant de la vie
dans tout mouvement qui ouvre ce groupe en universalisant ce lien ; double source que
dcouvre une analyse abstraite, sans doute retourne contre ses illusions formalistes,
mais qui reste limite la porte de labstraction. Or si, par lexprience, le
psychanalyste comme le sociologue peuvent reconnatre dans linterdiction de la mre
la forme concrte de lobligation primordiale, de mme peuvent-ils dmontrer un procs
rel de l ouverture du lien social dans lautorit paternaliste et dire que, par le conflit
fonctionnel de ldipe, elle introduit dans la rpression un idal de promesse.
Sils se rfrent aux rites de sacrifice par o les cultures primitives, mme parvenues
une concentration sociale leve, ralisent avec la rigueur la plus cruelle victimes
25
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
humaines dmembres ou ensevelies vivantes les fantasmes de la relation primordiale
la mre, ils liront, dans plus dun mythe, qu lavnement de lautorit paternelle
rpond un temprament de la primitive rpression sociale. Lisible dans lambigut
mythique du sacrifice dAbraham, qui au reste le lie formellement lexpression dune
promesse, ce sens napparat pas moins dans le mythe de ldipe, pour peu quon ne
nglige pas lpisode du Sphinx, reprsentation non moins ambigu de lmancipation
des tyrannies matriarcales, et du dclin du rite du meurtre royal. Quelle que soit leur
forme, tous ces mythes se situent lore de lhistoire, bien loin de la naissance de
lhumanit dont les sparent la dure immmoriale des cultures matriarcales et la
stagnation des groupes primitifs.
Selon cette rfrence sociologique, le fait du prophtisme par lequel Bergson recourt
lhistoire en tant quil sest produit minemment dans le peuple juif, se comprend par
la situation lue qui fut cre ce peuple dtre le tenant du patriarcat parmi des groupes
adonns des cultes maternels, par sa lutte convulsive pour maintenir lidal patriarcal
contre la sduction irrpressible de ces cultures. travers lhistoire des peuples
patriarcaux, on voit ainsi saffirmer dialectiquement dans la socit les exigences de la
personne et luniversalisation des idaux : tmoin ce progrs des formes juridiques qui
ternise la mission que la Rome antique a vcue tant en puissance quen conscience, et
qui sest ralise par lextension dj rvolutionnaire des privilges moraux dun
patriarcat une plbe immense et tous les peuples.
LHOMME MODERNE ET LA FAMILLE CONJUGALE
Deux fonctions dans ce procs se rflchissent sur la structure de la famille ellemme : la tradition, dans les idaux patriciens, de formes privilgies du mariage ;
lexaltation apothotique que le christianisme apporte aux exigences de la personne.
Lglise a intgr cette tradition dans la morale du christianisme, en mettant au premier
plan dans le lien du mariage le libre choix de la personne, faisant ainsi franchir
linstitution familiale le pas dcisif vers sa structure moderne, savoir le secret
renversement de sa prpondrance (8*40 16)sociale au profit du mariage. Renversement
qui se ralise au XVme sicle avec la rvolution conomique do sont sorties la
socit bourgeoise et la psychologie de lhomme moderne.
Ce sont en effet les rapports de la psychologie de lhomme moderne avec la famille
conjugale qui se proposent ltude du psychanalyste ; cet homme est le seul objet quil
ait vraiment soumis son exprience, et si le psychanalyste retrouve en lui le reflet
psychique des conditions les plus originelles de lhomme, peut-il prtendre le gurir
de ses dfaillances psychiques sans le comprendre dans la culture qui lui impose les plus
hautes exigences, sans comprendre de mme sa propre position en face de cet homme
au point extrme de lattitude scientifique ?
Or, en notre temps, moins que jamais, lhomme de la culture occidentale ne saurait se
comprendre hors des antinomies qui constituent ses rapports avec la nature et avec la
socit : comment, hors delles, comprendre et langoisse quil exprime dans le
sentiment dune transgression promthenne envers les conditions de sa vie, et les
conceptions les plus leves o il surmonte cette angoisse en reconnaissant que cest par
crises dialectiques quil se cre, lui-mme et ses objets.
Rle de la formation familiale. Ce mouvement subversif et critique o se ralise
lhomme trouve son germe le plus actif dans trois conditions de la famille conjugale.
Pour incarner lautorit dans la gnration la plus voisine et sous une figure
familire, la famille conjugale met cette autorit la porte immdiate de la subversion
cratrice. Ce que traduisent dj pour lobservation la plus commune les inversions
26
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
quimagine lenfant dans lordre des gnrations, o il se substitue lui-mme au parent
ou au grand-parent.
Dautre part, le psychisme ny est pas moins form par limage de ladulte que contre
sa contrainte : cet effet sopre par la transmission de lidal du moi, et le plus
purement, nous lavons dit, du pre au fils ; il comporte une slection positive des
tendances et des dons, une progressive ralisation de lidal dans le caractre. Cest ce
procs psychologique quest d le fait des familles dhommes minents, et non la
prtendue hrdit quil faudrait reconnatre des capacits essentiellement
relationnelles.
Enfin et surtout, lvidence de la vie sexuelle chez les reprsentants des contraintes
morales, lexemple singulirement transgressif de limago du pre quant linterdiction
primordiale exaltent au plus haut degr la tension de la libido et la porte de la
sublimation.
Cest pour raliser le plus humainement le conflit de lhomme avec son angoisse la
plus archaque, cest pour lui offrir le champ clos le plus loyal o il puisse se mesurer
avec les figures les plus profondes de son destin, cest pour mettre porte de son
existence individuelle le triomphe le plus complet contre sa servitude originelle, que le
complexe de la famille conjugale cre les russites suprieures du caractre, du bonheur
et de la cration.
En donnant la plus grande diffrenciation la personnalit avant la priode de
latence, le complexe apporte aux confrontations sociales de cette priode leur maximum
defficacit pour la formation rationnelle de lindividu. On peut en effet considrer que
laction ducative dans cette priode reproduit dans une ralit plus leste et sous les
sublimations suprieures de la logique et de la justice, le jeu des quivalences
narcissiques o a pris naissance le monde des objets. Plus diverses et plus riches seront
les ralits inconsciemment intgres dans lexprience familiale, plus formateur sera
pour la raison le travail de leur rduction.
Ainsi donc, si la psychanalyse manifeste dans les conditions morales de la cration
un ferment rvolutionnaire quon ne peut saisir que dans une analyse concrte, elle
reconnat, pour le produire, la structure familiale une puissance qui dpasse toute
rationalisation ducative. Ce fait mrite dtre propos aux thoriciens quelque bord
quils appartiennent dune ducation sociale prtentions totalitaires, afin que chacun
en conclue selon ses dsirs.
Dclin de limago paternelle. Le rle de limago du pre se laisse apercevoir de
faon saisissante dans la formation de la plupart des grands hommes. Son rayonnement
littraire et moral dans lre classique du progrs, de Corneille Proudhon, vaut dtre
not ; et les idologues qui, au XIXme sicle, ont port contre la famille paternaliste
les critiques les plus subversives ne sont pas ceux qui en portent le moins lempreinte.
Nous ne sommes pas de ceux qui saffligent dun prtendu relchement du lien
familial. Nest-il pas significatif que la famille se soit rduite son groupement
biologique mesure quelle intgrait les plus hauts progrs culturels ? Mais un grand
nombre deffets psychologiques nous semblent relever dun dclin social de limago
paternelle. Dclin conditionn par le retour sur lindividu deffets extrmes du progrs
social, dclin qui se marque surtout de nos jours dans les collectivits les plus prouves
par ces effets : concentration conomique, catastrophes politiques. Le fait na-t-il pas t
formul par le chef dun tat totalitaire comme argument contre lducation
traditionnelle ? Dclin plus intimement li la dialectique de la famille conjugale,
puisquil sopre par la croissance relative, trs sensible par exemple dans la vie
amricaine, des exigences matrimoniales.
27
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Quel quen soit lavenir, ce dclin constitue une crise psychologique. Peut-tre est-ce
cette crise quil faut rapporter lapparition de la psychanalyse elle-mme. Le sublime
hasard du gnie nexplique peut-tre pas seul que ce soit Vienne alors centre dun
tat qui tait le melting-pot des formes familiales les plus diverses, des plus archaques
aux plus volues, des derniers groupements agnatiques des paysans slaves aux formes
les plus rduites du foyer petit-bourgeois et aux formes les plus dcadentes du mnage
instable, en passant par les paternalismes fodaux et mercantiles quun fils du
patriarcat juif ait imagin le complexe ddipe. Quoi quil en soit, ce sont les formes de
nvroses dominantes la fin du sicle dernier qui ont rvl quelles taient intimement
dpendantes des conditions de la famille.
Ces nvroses, depuis le temps des premires divinations Freudiennes, semblent avoir
volu dans le sens dun complexe caractriel o, tant pour la spcificit de sa forme
que pour sa gnralisation il est le noyau du plus grand nombre des nvroses on peut
reconnatre la grande nvrose contemporaine. Notre exprience nous porte en dsigner
la dtermination principale dans la personnalit du pre, toujours carente en quelque
faon, absente, humilie, divise ou postiche. Cest cette carence qui, conformment
notre conception de ldipe, vient tarir llan instinctif comme tarer la dialectique
des sublimations. Marraines sinistres installes au berceau du nvros, limpuissance et
lutopie enferment son ambition, soit quil touffe en lui les crations quattend le
monde o il vient, soit que, dans lobjet quil propose sa rvolte, il mconnaisse son
propre mouvement.
Jacques M. LACAN,
Ancien chef de clinique
la Facult de Mdecine.
28
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
(8*421)
CHAPITRE II
LES COMPLEXES FAMILIAUX EN PATHOLOGIE
Les complexes familiaux remplissent dans les psychoses une fonction formelle :
thmes familiaux qui prvalent dans les dlires pour leur conformit avec larrt que les
psychoses constituent dans le moi et dans la ralit ; dans les nvroses, les complexes
remplissent une fonction causale : incidences et constellations familiales qui
dterminent les symptmes et les structures, selon lesquels les nvroses divisent,
introvertissent ou invertissent la personnalit. Telles sont, en quelques mots, les thses
que dveloppe ce chapitre. Il va de soi quen qualifiant de familiales la forme dune
psychose ou la source dune nvrose, nous entendons ce terme au sens strict de relation
sociale que cette tude semploie dfinir en mme temps qu le justifier par sa
fcondit objective : ainsi ce qui relve de la seule transmission biologique doit-il tre
dsign comme hrditaire et non pas comme familial , au sens strict de ce terme,
mme sil sagit dune affection psychique, et cela malgr lusage courant dans le
vocabulaire neurologique.
1. Les psychoses thme familial
Cest dans un tel souci de lobjectivit psychologique que nous avons tudi les
psychoses quand, parmi les premiers en France, nous nous sommes attach les
comprendre dans leur rapport avec la personnalit : point de vue auquel nous amenait la
notion, ds lors de plus en plus reconnue, que le tout du psychisme est intress par la
lsion ou le dficit de quelque lment de ses appareils ou de ses fonctions. Cette
notion, que dmontraient les troubles psychiques causs par des lsions localisables, ne
nous en paraissait que plus applicable aux productions mentales et aux ractions
sociales des psychoses, savoir ces dlires et ces pulsions qui, pour tre prtendus
partiels, voquaient pourtant par leur typicit la cohrence dun moi archaque, et dans
leur discordance mme devaient en trahir la loi interne.
Que lon se rappelle seulement que ces affections rpondent au cadre vulgaire de la
folie et lon concevra quil ne pouvait sagir pour nous dy dfinir une vritable
personnalit, qui implique la communication de la pense et la responsabilit de la
conduite. Une psychose, certes, que nous avons isole sous le nom de paranoa
dautopunition, nexclut pas lexistence dune semblable personnalit, qui est constitue
non seulement par les rapports du moi, mais du surmoi et de lidal du moi, mais le
surmoi lui impose ses effets punitifs les plus extrmes, et lidal du moi sy affirme
dans une objectivation ambigu, propice aux projections ritres ; davoir montr
loriginalit de cette forme, en mme temps que dfini par sa position une frontire
nosologique, est un rsultat, qui, pour limit quil soit, reste lacquis du point de vue
qui dirigeait notre effort.
Formes dlirantes de la connaissance. Le progrs de notre recherche devait nous
faire reconnatre, dans les formes mentales que constituent les psychoses, la
reconstitution de stades du moi, antrieurs la personnalit ; si lon caractrise en effet
chacun de ces stades par le stade de lobjet qui lui est corrlatif, toute la gense normale
de lobjet dans la relation spculaire du sujet lautrui, ou comme appartenance
subjective du corps morcel, se retrouve, en une srie de formes darrt, dans les objets
du dlire.
29
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Il est remarquable que ces objets manifestent les caractres constitutifs primordiaux
de la connaissance humaine : identit formelle, quivalence affective, reproduction
itrative et symbolisme anthropomorphique, sous des formes figes, certes, mais
accentues par labsence ou leffacement des intgrations secondaires, que sont pour
lobjet sa mouvance et son individualit, sa relativit et sa ralit.
La limite de la ralit de lobjet dans la psychose, le point de rebroussement de la
sublimation nous parat prcisment donn par ce moment, qui marque pour nous laura
de la ralisation dipienne, savoir cette rection de lobjet qui se produit, selon notre
formule, dans la lumire de ltonnement. Cest ce moment que reproduit cette phase,
que nous tenons pour constante et dsignons comme phase fconde du dlire : phase o
les objets, transforms par une tranget ineffable, se rvlent comme chocs, nigmes,
significations. Cest dans cette reproduction que seffondre le conformisme,
superficiellement assum, au moyen duquel le sujet masquait jusque l le narcissisme de
sa relation la ralit.
Ce narcissisme se traduit dans la forme de lobjet. Celle-ci peut se produire en
progrs sur la crise rvlatrice, comme lobjet dipien se rduit en une structure de
narcissisme secondaire mais ici lobjet reste irrductible aucune quivalence et le
prix de sa possession, sa vertu de prjudice prvaudront sur toute possibilit de
compensation ou de compromis : cest le dlire de revendication. Ou bien la forme de
lobjet peut rester suspendue lacm de la crise, comme si limago de lidal dipien
se fixait au moment de sa transfiguration mais ici limago ne se subjective pas par
identification au double, et lidal du moi se projette itrativement en objets dexemple,
certes, mais dont laction est tout externe, plutt reproches vivants dont la censure tend
la surveillance omniprsente : cest le dlire sensitif de relations. Enfin, lobjet peut
retrouver en de de la crise la structure de narcissisme primaire o sa formation sest
arrte.
(8*422)
On peut voir dans ce dernier cas le surmoi, qui na pas subi le refoulement, non
seulement se traduire dans le sujet en intention rpressive, mais encore y surgir comme
objet apprhend par le moi, rflchi sous les traits dcomposs de ses incidences
formatrices, et, au gr des menaces relles ou des intrusions imaginaires, reprsent par
ladulte castrateur ou le frre pntrateur : cest le syndrome de la perscution
interprtative, avec son objet sens homosexuel latent.
un degr de plus, le moi archaque manifeste sa dsagrgation dans le sentiment
dtre pi, devin, dvoil, sentiment fondamental de la psychose hallucinatoire, et le
double o il sidentifiait soppose au sujet, soit comme cho de la pense et des actes
dans les formes auditives verbales de lhallucination, dont les contenus autodiffamateurs
marquent laffinit volutive avec la rpression morale, soit comme fantme spculaire
du corps dans certaines formes dhallucination visuelle, dont les ractions-suicides
rvlent la cohrence archaque avec le masochisme primordial. Enfin, cest la structure
foncirement anthropomorphique et organomorphique de lobjet qui vient au jour dans
la participation mgalomaniaque, o le sujet, dans la paraphrnie, incorpore son moi le
monde, affirmant quil inclut le Tout, que son corps se compose des matires les plus
prcieuses, que sa vie et ses fonctions soutiennent lordre et lexistence de lUnivers.
FONCTION DES COMPLEXES DANS LES DLIRES
Les complexes familiaux jouent dans le moi, ces divers stades o larrte la
psychose, un rle remarquable, soit comme motifs des ractions du sujet, soit comme
thmes de son dlire. On peut mme ordonner sous ces deux registres lintgration de
30
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
ces complexes au moi selon la srie rgressive que nous venons dtablir pour les
formes de lobjet dans les psychoses.
Ractions familiales. Les ractions morbides, dans les psychoses, sont provoques
par les objets familiaux en fonction dcroissante de la ralit de ces objets au profit de
leur porte imaginaire : on le mesure, si lon part des conflits qui mettent aux prises
lectivement le revendicateur avec le cercle de sa famille ou avec son conjoint en
passant par la signification de substituts du pre, du frre ou de la sur que
lobservateur reconnat aux perscuteurs du paranoaque pour aboutir ces filiations
secrtes de roman, ces gnalogies de Trinits ou dOlympes fantastiques, o jouent
les mythes du paraphrnique. Lobjet constitu par la relation familiale montre ainsi une
altration progressive : dans sa valeur affective, quand il se rduit ntre que prtexte
lexaltation passionnelle, puis dans son individualit quand il est mconnu dans sa
ritration dlirante, enfin dans son identit elle-mme, quand on ne le reconnat plus
dans le sujet que comme une entit qui chappe au principe de contradiction.
Thmes familiaux. Pour le thme familial, sa porte expressive de la conscience
dlirante se montre fonction, dans la srie des psychoses, dune croissante identification
du moi un objet familial, aux dpens de la distance que le sujet maintient entre lui et
sa conviction dlirante : on le mesure, si lon part de la contingence relative, dans le
monde du revendicateur, des griefs quil allgue contre les siens en passant par la
porte de plus en plus existentielle que prennent les thmes de spoliation, dusurpation,
de filiation, dans la conception qua de soi le paranoaque pour aboutir ces
identifications quelque hritier arrach de son berceau, lpouse secrte de quelque
prince, aux personnages mythiques de Pre tout-puissant, de Victime filiale, de Mre
universelle, de Vierge primordiale, o saffirme le moi du paraphrnique.
Cette affirmation du moi devient au reste plus incertaine mesure quainsi elle
sintgre plus au thme dlirant : dune sthnie remarquablement communicative dans
la revendication, elle se rduit de faon tout fait frappante une intention
dmonstrative dans les ractions et les interprtations du paranoaque, pour se perdre
chez le paraphrnique dans une discordance dconcertante entre la croyance et la
conduite.
Ainsi, selon que les ractions sont plus relatives aux fantasmes et que sobjective
plus le thme du dlire, le moi tend se confondre avec lexpression du complexe et le
complexe sexprimer dans lintentionnalit du moi. Les psychanalystes disent donc
communment que dans les psychoses les complexes sont conscients, tandis quils sont
inconscients dans les nvroses. Ceci nest pas rigoureux, car, par exemple, le sens
homosexuel des tendances dans la psychose est mconnu par le sujet, encore que traduit
en intention perscutive. Mais la formule approximative permet de stonner que ce soit
dans les nvroses o ils sont latents, que les complexes aient t dcouverts, avant dtre
reconnus dans les psychoses, o ils sont patents. Cest que les thmes familiaux que
nous isolons dans les psychoses ne sont que des effets virtuels et statiques de leur
structure, des reprsentations o se stabilise le moi ; ils ne prsentent donc que la
morphologie du complexe sans rvler son organisation, ni par consquent la hirarchie
de ses caractres.
Do lvident artifice qui marquait la classification des psychoses par les thmes
dlirants, et le discrdit o tait tombe ltude de ces thmes, avant que les psychiatres
y fussent ramens par cette impulsion vers le concret donne par la psychanalyse. Cest
ainsi que daucuns, qui ont pu se croire les moins affects par cette influence,
rnovrent la porte clinique de certains thmes, comme lrotomanie ou le dlire de
filiation, en reportant lattention de lensemble sur les dtails de leur romancement, pour
31
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
y dcouvrir les caractres dune structure. Mais seule la connaissance des complexes
peut apporter une telle recherche, avec une direction systmatique, une sret et une
avance qui dpasse de beaucoup les moyens de lobservation pure.
Prenons par exemple la structure du thme des interprtateurs filiaux, telle que
Srieux et Capgras lont dfinie en entit nosologique. En la caractrisant par le ressort
de la privation affective, manifeste dans lillgitimit frquente du sujet, et par une
formation mentale du type du roman de grandeur dapparition normale entre 8 et 13
ans, les auteurs runiront la fable, mrie depuis cet ge, de substitution denfant, fable
par laquelle telle vieille fille de village sidentifie quelque doublure plus favorise, et
les prtentions, dont la justification parat quivalente, de quelque faux dauphin .
Mais que celui-ci pense appuyer ses droits par la description minutieuse dune machine
dapparence animale, dans le ventre de laquelle il aurait fallu le cacher pour raliser
lenlvement initial (histoire de Richemont et de son cheval extraordinaire , cite par
ces auteurs), nous croyons pour nous que cette fantaisie, quon peut certes tenir pour
superftatoire et mettre au compte de la dbilit mentale, rvle, autant par son
symbolisme de gestation que par la place que lui donne le sujet dans son dlire, une
structure plus archaque de sa psychose.
DTERMINISME DE LA PSYCHOSE
Il reste tablir si les complexes qui jouent ces rles de motivation et de thme dans
les symptmes de la psychose, ont aussi un rle de cause dans son dterminisme ; et
cette question est obscure.
Pour nous, si nous avons voulu comprendre ces symptmes par une psychogense,
nous sommes loin davoir pens y rduire le dterminisme de la maladie. Bien au
contraire, en dmontrant dans la paranoa que sa phase fconde comporte un tat
hyponoque : confusionnel, onirique, ou crpusculaire, (8*423)nous avons soulign la
ncessit de quelque ressort organique pour la subduction mentale o le sujet sinitie au
dlire.
Ailleurs encore, nous avons indiqu que cest dans quelque tare biologique de la
libido quil fallait chercher la cause de cette stagnation de la sublimation o nous
voyons lessence de la psychose. Cest dire que nous croyons un dterminisme
endogne de la psychose et que nous avons voulu seulement faire justice de ces pitres
pathognies qui ne sauraient plus mme passer actuellement pour reprsenter quelque
gense organique : dune part la rduction de la maladie quelque phnomne
mental, prtendu automatique, qui comme tel ne saurait rpondre lorganisation
perceptive, nous voulons dire au niveau de croyance, que lon relve dans les
symptmes rellement lmentaires de linterprtation et de lhallucination ; dautre part
la prformation de la maladie dans des traits prtendus constitutionnels du caractre, qui
svanouissent, quand on soumet lenqute sur les antcdents aux exigences de la
dfinition des termes et de la critique du tmoignage.
Si quelque tare est dcelable dans le psychisme avant la psychose, cest aux sources
mmes de la vitalit du sujet, au plus radical, mais aussi au plus secret de ses lans et de
ses aversions, quon doit la pressentir, et nous croyons en reconnatre un signe singulier
dans le dchirement ineffable que ces sujets accusent spontanment pour avoir marqu
leurs premires effusions gnitales la pubert.
Quon rapproche cette tare hypothtique des faits anciennement groups sous la
rubrique de la dgnrescence ou des notions plus rcentes sur les perversions
biologiques de la sexualit, cest rentrer dans les problmes de lhrdit psychologique.
Nous nous limitons ici lexamen des facteurs proprement familiaux.
32
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Facteurs familiaux. La simple clinique montre dans beaucoup de cas la corrlation
dune anomalie de la situation familiale. La psychanalyse, dautre part, soit par
linterprtation des donnes cliniques, soit par une exploration du sujet qui, pour ne
savoir tre ici curative, doit rester prudente, montre que lidal du moi sest form,
souvent en raison de cette situation, daprs lobjet du frre. Cet objet, en virant la libido
destine ldipe sur limago de lhomosexualit primitive, donne un idal trop
narcissique pour ne pas abtardir la structure de la sublimation. En outre, une
disposition en vase clos du groupe familial tend intensifier les effets de
sommation, caractristiques de la transmission de lidal du moi, comme nous lavons
indiqu dans notre analyse de ldipe ; mais alors quil sexerce l normalement dans
un sens slectif, ces effets jouent ici dans un sens dgnratif.
Si lavortement de la ralit dans les psychoses tient en dernier ressort une
dficience biologique de la libido, il rvle aussi une drivation de la sublimation o le
rle du complexe familial est corrobor par le concours de nombreux faits cliniques.
Il faut noter en effet ces anomalies de la personnalit dont la constance dans la
parent du paranoaque est sanctionne par lappellation familire de nids de
paranoaques que les psychiatres appliquent ces milieux ; la frquence de la
transmission de la paranoa en ligne familiale directe, avec souvent aggravation de sa
forme vers la paraphrnie et prcession temporelle, relative ou mme absolue, de son
apparition chez le descendant ; enfin llectivit presque exclusivement familiale des
cas de dlires deux, bien mise en vidence dans des collections anciennes, comme
celle de Legrand du Saulle dans son ouvrage sur le dlire des perscutions , o
lampleur du choix compense le dfaut de la systmatisation par labsence de partialit.
Pour nous, cest dans les dlires deux que nous croyons le mieux saisir les
conditions psychologiques qui peuvent jouer un rle dterminant dans la psychose.
Hormis les cas o le dlire mane dun parent atteint de quelque trouble mental qui le
mette en posture de tyran domestique, nous avons rencontr constamment ces dlires
dans un groupe familial que nous appelons dcomplt, l o lisolement social auquel
il est propice porte son effet maximum, savoir dans le couple psychologique form
dune mre et dune fille ou de deux surs (voir notre tude sur les Papin), plus
rarement dune mre et dun fils.
2. Les nvroses familiales
Les complexes familiaux se rvlent dans les nvroses par un abord tout diffrent :
cest quici les symptmes ne manifestent aucun rapport, sinon contingent, quelque
objet familial. Les complexes y remplissent pourtant une fonction causale, dont la
ralit et le dynamisme sopposent diamtralement au rle que jouent les thmes
familiaux dans les psychoses.
Symptme nvrotique et drame individuel. Si Freud, par la dcouverte des
complexes, fit uvre rvolutionnaire, cest quen thrapeute, plus soucieux du malade
que de la maladie, il chercha le comprendre pour le gurir, et quil sattacha ce quon
ngligeait sous le titre de contenu des symptmes, et qui est le plus concret de leur
ralit : savoir lobjet qui provoque une phobie, lappareil ou la fonction
somatique intresss dans une hystrie, la reprsentation ou laffect qui occupent le
sujet dans une obsession.
Cest de cette manire quil vint dchiffrer dans ce contenu mme les causes de ces
symptmes : quoique ces causes, avec les progrs de lexprience, soient apparues plus
complexes, il importe de ne point les rduire labstraction, mais dapprofondir ce sens
33
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
dramatique, qui, dans leur premire formule, saisissait comme une rponse
linspiration de leur recherche.
Freud accusa dabord, lorigine des symptmes, soit une sduction sexuelle que le
sujet a prcocement subie par des manuvres plus ou moins perverses, soit une scne
qui, dans sa petite enfance, la initi par le spectacle ou par laudition aux relations
sexuelles des adultes. Or si dune part ces faits se rvlaient comme traumatiques pour
dvier la sexualit en tendances anormales, ils dmontraient du mme coup comme
propres la petite enfance une volution rgulire de ces diverses tendances et leur
normale satisfaction par voie auto-rotique. Cest pourquoi, si dautre part ces
traumatismes se montraient tre le fait le plus commun soit de linitiative dun frre, soit
de linadvertance des parents, la participation de lenfant sy avra toujours plus active,
mesure que saffirmaient la sexualit infantile et ses motifs de plaisir ou
dinvestigation. Ds lors, ces tendances apparaissent formes en complexes typiques par
la structure normale de la famille qui leur offrait leurs premiers objets. Cest ainsi que
nul fait plus que la naissance dun frre ne prcipite une telle formation, en exaltant par
son nigme la curiosit de lenfant, en ractivant les mois primordiaux de son
attachement la mre par les signes de sa grossesse et par le spectacle des soins quelle
donne au nouveau-n, en cristallisant enfin, dans la prsence du pre auprs delle, ce
que lenfant devine du mystre de la sexualit, ce quil ressent de ses lans prcoces et
ce quil redoute des menaces qui lui en interdisent la satisfaction masturbatoire. Telle
est du moins, dfinie par son groupe et par son moment, la constellation familiale qui,
pour Freud, forme le (8*424)complexe nodal des nvroses. Il en a dgag le complexe
ddipe, et nous verrons mieux plus loin comment cette origine commande la
conception quil sest forme de ce complexe.
Concluons ici quune double instance de causes se dfinit par le complexe : les
traumatismes prcits qui reoivent leur porte de leur incidence dans son volution, les
relations du groupe familial qui peuvent dterminer des atypies dans sa constitution. Si
la pratique des nvroses manifeste en effet la frquence des anomalies de la situation
familiale, il nous faut, pour dfinir leur effet, revenir sur la production du symptme.
De lexpression du refoul la dfense contre langoisse. Les impressions issues
du traumatisme semblrent une premire approche dterminer le symptme par une
relation simple : une part diverse de leur souvenir, sinon sa forme reprsentative, au
moins ses corrlations affectives, a t non pas oublie, mais refoule dans
linconscient, et le symptme, encore que sa production prenne des voies non moins
diverses, se laissait ramener une fonction dexpression du refoul, lequel manifestait
ainsi sa permanence dans le psychisme. Non seulement en effet lorigine du symptme
se comprenait par une interprtation selon une clef qui, parmi dautres, symbolisme,
dplacement, etc., convnt sa forme, mais le symptme cdait mesure que cette
comprhension tait communique au sujet. Que la cure du symptme tnt au fait que
ft ramene la conscience limpression de son origine, en mme temps que se
dmontrt au sujet lirrationalit de sa forme une telle induction retrouvait dans
lesprit les voies frayes par lide socratique que lhomme se dlivre se connatre par
les intuitions de la raison. Mais il a fallu apporter la simplicit comme loptimisme
de cette conception des corrections toujours plus lourdes, depuis que lexprience a
montr quune rsistance est oppose par le sujet llucidation du symptme et quun
transfert affectif qui a lanalyste pour objet, est la force qui dans la cure vient
prvaloir.
Il reste pourtant de cette tape la notion que le symptme nvrotique reprsente dans
le sujet un moment de son exprience o il ne sait pas se reconnatre, une forme de
division de la personnalit. Mais mesure que lanalyse a serr de plus prs la
34
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
production du symptme, sa comprhension a recul de la claire fonction dexpression
de linconscient une plus obscure fonction de dfense contre langoisse. Cette
angoisse, Freud, dans ses vues les plus rcentes, la considre comme le signal qui, pour
tre dtach dune situation primordiale de sparation, se rveille la similitude dun
danger de castration. La dfense du sujet, sil est vrai que le symptme fragmente la
personnalit, consisterait donc faire sa part ce danger en sinterdisant tel accs la
ralit, sous une forme symbolique ou sublime. La forme que lon reconnat dans cette
conception du symptme ne laisse en principe pas plus de rsidu que son contenu tre
comprise par une dynamique des tendances, mais elle tend transformer en termes de
structure la rfrence du symptme au sujet en dplaant lintrt sur la fonction du
symptme quant aux rapports la ralit.
Dformations spcifiques de la ralit humaine. Les effets dinterdiction dont il
sagit constituent des relations qui, pour tre inaccessibles au contrle conscient et ne se
manifester quen ngatif dans le comportement, rvlent clairement leur forme
intentionnelle la lumire de la psychanalyse ; montrant lunit dune organisation
depuis lapparent hasard des achoppements des fonctions et la fatalit des sorts qui
font chouer laction jusqu la contrainte, propre lespce, du sentiment de
culpabilit. La psychologie classique se trompait donc en croyant que le moi, savoir
cet objet o le sujet se rflchit comme coordonn la ralit quil reconnat pour
extrieure soi, comprend la totalit des relations qui dterminent le psychisme du
sujet. Erreur corrlative une impasse dans la thorie de la connaissance et lchec
plus haut voqu dune conception morale.
Freud conoit le moi, en conformit avec cette psychologie quil qualifie de
rationaliste, comme le systme des relations psychiques selon lequel le sujet subordonne
la ralit la perception consciente ; cause de quoi il doit lui opposer dabord sous le
terme de surmoi le systme, dfini linstant, des interdictions inconscientes. Mais il
nous parat important dquilibrer thoriquement ce systme en lui conjoignant celui des
projections idales qui, des images de grandeur de la folle du logis aux fantasmes
qui polarisent le dsir sexuel et lillusion individuelle de la volont de puissance,
manifeste dans les formes imaginaires du moi une condition non moins structurale de la
ralit humaine. Si ce systme est assez mal dfini par un usage du terme d idal du
moi quon confond encore avec le surmoi, il suffit pourtant pour en saisir loriginalit
dindiquer quil constitue comme secret de la conscience la prise mme qua lanalyste
sur le mystre de linconscient ; mais cest prcisment pour tre trop immanent a
lexprience quil doit tre isol en dernier lieu par la doctrine : cest quoi cet expos
contribue.
Le drame existentiel de lindividu. Si les instances psychiques qui chappent au
moi apparaissent dabord comme leffet du refoulement de la sexualit dans lenfance,
leur formation se rvle, lexprience, toujours plus voisine, quant au temps et la
structure, de la situation de sparation que lanalyse de langoisse fait reconnatre pour
primordiale et qui est celle de la naissance.
La rfrence de tels effets psychiques une situation si originelle ne va pas sans
obscurit. Il nous semble que notre conception du stade du miroir peut contribuer
lclairer : elle tend le traumatisme suppos de cette situation tout un stade de
morcelage fonctionnel, dtermin par le spcial inachvement du systme nerveux ; elle
reconnat ds ce stade lintentionalisation de cette situation dans deux manifestations
psychiques du sujet : lassomption du dchirement originel sous le jeu qui consiste
rejeter lobjet, et laffirmation de lunit du corps propre sous lidentification limage
spculaire. Il y a l un nud phnomnologique qui, en manifestant sous leur forme
originelle ces proprits inhrentes au sujet humain de mimer sa mutilation et de se voir
35
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
autre quil nest, laisse saisir aussi leur raison essentielle dans les servitudes, propres
la vie de lhomme, de surmonter une menace spcifique et de devoir son salut lintrt
de son congnre.
Cest en effet partir dune identification ambivalente son semblable que, par la
participation jalouse et la concurrence sympathique, le moi se diffrencie dans un
commun progrs de lautrui et de lobjet. La ralit quinaugure ce jeu dialectique
gardera la dformation structurale du drame existentiel qui la conditionne et quon peut
appeler le drame de lindividu, avec laccent que reoit ce terme de lide de la
prmaturation spcifique.
Mais cette structure ne se diffrencie pleinement que l o on la reconnue tout
dabord, dans le conflit de la sexualit infantile, ce qui se conoit pour ce quelle
naccomplit qualors sa fonction quant lespce : en (8*42 5)assurant la correction
psychique de la prmaturation sexuelle, le surmoi, par le refoulement de lobjet
biologiquement inadquat que propose au dsir sa premire maturation, lidal du moi
par lidentification imaginaire qui orientera le choix sur lobjet biologiquement adquat
la maturation pubrale.
Moment que sanctionne lachvement conscutif de la synthse spcifique du moi
lge dit de raison ; comme personnalit, par lavnement des caractres de
comprhensibilit et de responsabilit, comme conscience individuelle par un certain
virage quopre le sujet de la nostalgie de la mre laffirmation mentale de son
autonomie. Moment que marque surtout ce pas affectif dans la ralit, qui est li
lintgration de la sexualit dans le sujet. Il y a l un second nud du drame existentiel
que le complexe ddipe amorce en mme temps quil rsout le premier. Les socits
primitives, qui apportent une rgulation plus positive la sexualit de lindividu,
manifestent le sens de cette intgration irrationnelle dans la fonction initiatique du
totem, pour autant que lindividu y identifie son essence vitale et se lassimile
rituellement : le sens du totem, rduit par Freud celui de ldipe, nous parat plutt
quivaloir lune de ses fonctions : celle de lidal du moi.
La forme dgrade de ldipe. Ayant ainsi tenu notre propos de rapporter leur
porte concrte cest--dire existentielle les termes les plus abstraits qua labors
lanalyse des nvroses, nous pouvons mieux dfinir maintenant le rle de la famille dans
la gense de ces affections. Il tient la double charge du complexe ddipe : par son
incidence occasionnelle dans le progrs narcissique, il intresse lachvement structural
du moi ; par les images quil introduit dans cette structure, il dtermine une certaine
animation affective de la ralit. La rgulation de ces effets se concentre dans le
complexe, mesure que se rationalisent les formes de communion sociale dans notre
culture, rationalisation quil dtermine rciproquement en humanisant lidal du moi.
Dautre part, le drglement de ces effets apparat en raison des exigences croissantes
quimpose au moi cette culture mme quant la cohrence et llan crateur.
Or les alas et les caprices de cette rgulation saccroissent mesure que le mme
progrs social, en faisant voluer la famille vers la forme conjugale, la soumet plus aux
variations individuelles. De cette anomie qui a favoris la dcouverte du complexe,
dpend la forme de dgradation sous laquelle le connaissent les analystes : forme que
nous dfinirons par un refoulement incomplet du dsir pour la mre, avec ractivation
de langoisse et de linvestigation, inhrentes la relation de la naissance ; par un
abtardissement narcissique de lidalisation du pre, qui fait ressortir dans
lidentification dipienne lambivalence agressive immanente la primordiale relation
au semblable. Cette forme est leffet commun tant des incidences traumatiques du
complexe que de lanomalie des rapports entre ses objets. Mais ces deux ordres de
36
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
causes rpondent respectivement deux ordres de nvroses, celles dites de transfert et
celles dites de caractre.
NVROSES DE TRANSFERT
Il faut mettre part la plus simple de ces nvroses, cest--dire la phobie sous la
forme o on lobserve le plus frquemment chez lenfant : celle qui a pour objet
lanimal.
Elle nest quune forme substitutive de la dgradation de ldipe, pour autant que
lanimal grand y reprsente immdiatement la mre comme gestatrice, le pre comme
menaant, le petit-frre comme intrus. Mais elle mrite une remarque, parce que
lindividu y retrouve, pour sa dfense contre langoisse, la forme mme de lidal du
moi, que nous reconnaissons dans le totem et par laquelle les socits primitives
assurent la formation sexuelle du sujet un confort moins fragile. Le nvros ne suit
pourtant la trace daucun souvenir hrditaire , mais seulement le sentiment
immdiat, et non sans profonde raison, que lhomme a de lanimal comme du modle de
la relation naturelle.
Ce sont les incidences occasionnelles du complexe ddipe dans le progrs
narcissique, qui dterminent les autres nvroses de transfert : lhystrie et la nvrose
obsessionnelle. Il faut en voir le type dans les accidents que Freud a demble et
magistralement prciss comme lorigine de ces nvroses. Leur action manifeste que la
sexualit, comme tout le dveloppement psychique de lhomme, est assujettie la loi de
communication qui le spcifie. Sduction ou rvlation, ces accidents jouent leur rle,
en tant que le sujet, comme surpris prcocement par eux en quelque processus de son
recollement narcissique, les y compose par lidentification. Ce processus, tendance
ou forme, selon le versant de lactivit existentielle du sujet quil intresse assomption
de la sparation ou affirmation de son identit sera rotis en sadomasochisme ou en
scoptophilie (dsir de voir ou dtre vu). Comme tel, il tendra subir le refoulement
corrlatif de la maturation normale de la sexualit, et il y entranera une part de la
structure narcissique. Cette structure fera dfaut la synthse du moi et le retour du
refoul rpond leffort constitutif du moi pour sunifier. Le symptme exprime la
fois ce dfaut et cet effort, ou plutt leur composition dans la ncessit primordiale de
fuir langoisse.
En montrant ainsi la gense de la division qui introduit le symptme dans la
personnalit, aprs avoir rvl les tendances quil reprsente, linterprtation
FREUDienne, rejoignant lanalyse clinique de Janet, la dpasse en une comprhension
dramatique de la nvrose, comme lutte spcifique contre langoisse.
Lhystrie. Le symptme hystrique, qui est une dsintgration dune fonction
somatiquement localise : paralysie, anesthsie, algie, inhibition, scotomisation, prend
son sens du symbolisme organomorphique structure fondamentale du psychisme
humain selon Freud, manifestant par une sorte de mutilation le refoulement de la
satisfaction gnitale.
Ce symbolisme, pour tre cette structure mentale par o lobjet participe aux formes
du corps propre, doit tre conu comme la forme spcifique des donnes psychiques du
stade du corps morcel ; par ailleurs certains phnomnes moteurs caractristiques du
stade du dveloppement que nous dsignons ainsi, se rapprochent trop de certains
symptmes hystriques, pour quon ne cherche pas ce stade lorigine de la fameuse
complaisance somatique quil faut admettre comme condition constitutionnelle de
lhystrie. Cest par un sacrifice mutilateur que langoisse est ici occulte ; et leffort de
restauration du moi se marque dans la destine de lhystrique par une reproduction
37
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
rptitive du refoul. On comprend ainsi que ces sujets montrent dans leurs personnes
les images pathtiques du drame existentiel de lhomme.
(8*426)
La nvrose obsessionnelle. Pour le symptme obsessionnel, o Janet a bien
reconnu la dissociation des conduites organisatrices du moi apprhension obsdante,
obsession-impulsion, crmoniaux, conduites coercitives, obsession ruminatrice,
scrupuleuse, ou doute obsessionnel il prend son sens du dplacement de laffect dans
la reprsentation ; processus dont la dcouverte est due aussi Freud.
Freud montre en outre par quels dtours, dans la rpression mme, que le symptme
manifeste ici sous la forme la plus frquente de la culpabilit, vient se composer la
tendance agressive qui a subi le dplacement. Cette composition ressemble trop aux
effets de la sublimation, et les formes que lanalyse dmontre dans la pense
obsessionnelle isolement de lobjet, dconnexion causale du fait, annulation
rtrospective de lvnement se manifestent trop comme la caricature des formes
mmes de la connaissance, pour quon ne cherche pas lorigine de cette nvrose dans les
premires activits didentification du moi, ce que beaucoup danalystes reconnaissent
en insistant sur un dploiement prcoce du moi chez ces sujets ; au reste les symptmes
en viennent tre si peu dsintgrs du moi que Freud a introduit pour les dsigner le
terme de pense compulsionnelle. Ce sont donc les superstructures de la personnalit
qui sont utilises ici pour mystifier langoisse. Leffort de restauration du moi se traduit
dans le destin de lobsd par une poursuite tantalisante du sentiment de son unit. Et
lon comprend la raison pour laquelle ces sujets, que distinguent frquemment des
facults spculatives, montrent dans beaucoup de leurs symptmes le reflet naf des
problmes existentiels de lhomme.
Incidence individuelle des causes familiales. On voit donc que cest lincidence du
traumatisme dans le progrs narcissique qui dtermine la forme du symptme avec son
contenu. Certes, dtre exogne, le traumatisme intressera au moins passagrement le
versant passif avant le versant actif de ce progrs, et toute division de lidentification
consciente du moi parat impliquer la base dun morcelage fonctionnel : ce que
confirme en effet le soubassement hystrique que lanalyse rencontre chaque fois quon
peut reconstituer lvolution archaque dune nvrose obsessionnelle. Mais une fois que
les premiers effets du traumatisme ont creus leur lit selon lun des versants du drame
existentiel : assomption de la sparation ou identification du moi, le type de la nvrose
va en saccusant.
Cette conception na pas seulement lavantage dinciter saisir de plus haut le
dveloppement de la nvrose, en reculant quelque peu le recours aux donnes de la
constitution o lon se repose toujours trop vite : elle rend compte du caractre
essentiellement individuel des dterminations de laffection. Si les nvroses montrent,
en effet, par la nature des complications quy apporte le sujet lge adulte (par
adaptation secondaire sa forme et aussi par dfense secondaire contre le symptme
lui-mme, en tant que porteur du refoul), une varit de formes telle que le catalogue
en est encore faire aprs plus dun tiers de sicle danalyse la mme varit
sobserve dans ses causes. Il faut lire les comptes rendus de cures analytiques et
spcialement les admirables cas publis par Freud pour comprendre quelle gamme
infinie dvnements peuvent inscrire leurs effets dans une nvrose, comme
traumatisme initial ou comme occasions de sa ractivation avec quelle subtilit les
dtours du complexe dipien sont utiliss par lincidence sexuelle : la tendresse
excessive dun parent ou une svrit inopportune peuvent jouer le rle de sduction
comme la crainte veille de la perte de lobjet parental, une chute de prestige frappant
son image peuvent tre des expriences rvlatrices. Aucune atypie du complexe ne
38
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
peut tre dfinie par des effets constants. Tout au plus peut-on noter globalement une
composante homosexuelle dans les tendances refoules par lhystrie, et la marque
gnrale de lambivalence agressive lgard du pre dans la nvrose obsessionnelle ;
ce sont au reste l des formes manifestes de la subversion narcissique qui caractrise les
tendances dterminantes des nvroses.
Cest aussi en fonction du progrs narcissique quil faut concevoir limportance si
constante de la naissance dun frre : si le mouvement comprhensif de lanalyse en
exprime le retentissement dans le sujet sous quelque motif : investigation, rivalit,
agressivit, culpabilit, il convient de ne pas prendre ces motifs pour homognes ce
quils reprsentent chez ladulte, mais den corriger la teneur en se souvenant de
lhtrognit de la structure du moi au premier ge ; ainsi limportance de cet
vnement se mesure-t-elle ses effets dans le processus didentification : il prcipite
souvent la formation du moi et fixe sa structure une dfense susceptible de se
manifester en traits de caractre, avaricieux ou autoscopique. Et cest de mme comme
une menace, intimement ressentie dans lidentification lautre, que peut tre vcue la
mort dun frre.
On constatera aprs cet examen que si la somme des cas ainsi publis peut tre
verse au dossier des causes familiales de ces nvroses, il est impossible de rapporter
chaque entit quelque anomalie constante des instances familiales. Ceci du moins est
vrai des nvroses de transfert ; le silence leur sujet dun rapport prsent au Congrs
des psychanalystes franais en 1936 sur les causes familiales des nvroses est dcisif. Il
nest point pour diminuer limportance du complexe familial dans la gense de ces
nvroses, mais pour faire reconnatre leur porte dexpressions existentielles du drame
de lindividu.
NVROSES DE CARACTRE
Les nvroses dites de caractre, au contraire, laissent voir certains rapports constants
entre leurs formes typiques et la structure de la famille o a grandi le sujet. Cest la
recherche psychanalytique qui a permis de reconnatre comme nvrose des troubles du
comportement et de lintrt quon ne savait rapporter qu lidiosyncrasie du caractre ;
elle y a retrouv le mme effet paradoxal dintentions inconscientes et dobjets
imaginaires qui sest rvl dans les symptmes des nvroses classiques ; et elle a
constat la mme action de la cure psychanalytique, substituant pour la thorie comme
pour la pratique une conception dynamique la notion inerte de constitution.
Le surmoi et lidal du moi sont, en effet, des conditions de structure du sujet. Sils
manifestent dans des symptmes la dsintgration produite par leur interfrence dans la
gense du moi, ils peuvent aussi se traduire par un dsquilibre de leur instance propre
dans la personnalit : par une variation de ce quon pourrait appeler la formule
personnelle du sujet. Cette conception peut stendre toute ltude du caractre, o,
pour tre relationnelle, elle apporte une base psychologique pure la classification de
ses varits, cest--dire un autre avantage sur lincertitude des donnes auxquelles se
rfrent les conceptions constitutionnelles en ce champ prdestin leur
panouissement.
La nvrose de caractre se traduit donc par des entraves diffuses dans les activits de
la personne, par des impasses imaginaires dans les rapports avec la ralit. Elle est
dautant plus pure quentraves et impasses sont subjectivement plus intgres au
sentiment de lautonomie personnelle. Ce nest pas dire quelle soit exclusive des
symptmes de dsintgration, puisquon la rencontre de plus en plus comme fonds dans
les nvroses de transfert. Les rapports de la nvrose de caractre la structure familiale
tiennent au rle des objets parentaux dans la formation du surmoi et de lidal du moi.
39
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
Tout le dveloppement de cette tude est pour dmontrer que le complexe ddipe
suppose une certaine typicit dans les relations psychologiques entre les parents, et nous
avons spcialement insist sur le double rle que joue le pre, en tant quil reprsente
lautorit et quil est le centre de la rvlation sexuelle ; cest lambigut mme de
son imago, incarnation de la rpression et catalyseur dun accs essentiel la ralit,
que nous avons rapport le double progrs, typique dune culture, dun certain
temprament (8*427)du surmoi et dune orientation minemment volutive de la
personnalit.
Or, il savre lexprience que le sujet forme son surmoi et son idal du moi, non
pas tant daprs le moi du parent, que daprs les instances homologues de sa
personnalit : ce qui veut dire que dans le processus didentification qui rsout le
complexe dipien, lenfant est bien plus sensible aux intentions, qui lui sont
affectivement communiques de la personne parentale, qu ce quon peut objectiver de
son comportement.
Cest l ce qui met au premier rang des causes de nvrose la nvrose parentale et,
encore que nos remarques prcdentes sur la contingence essentielle au dterminisme
psychologique de la nvrose impliquent une grande diversit dans la forme de la
nvrose induite, la transmission tendra tre similaire, en raison de la pntration
affective qui ouvre le psychisme enfantin au sens le plus cach du comportement
parental.
Rduite la forme globale du dsquilibre, cette transmission est patente
cliniquement, mais on ne peut la distinguer de la donne anthropologique brute de la
dgnrescence. Seule lanalyse en discerne le mcanisme psychologique, tout en
rapportant certains effets constants une atypie de la situation familiale.
La nvrose dautopunition. Une premire atypie se dfinit ainsi en raison du conflit
quimplique le complexe ddipe spcialement dans les rapports du fils au pre. La
fcondit de ce conflit tient la slection psychologique quil assure en faisant de
lopposition de chaque gnration la prcdente la condition dialectique mme de la
tradition du type paternaliste. Mais toute rupture de cette tension, une gnration
donne, soit en raison de quelque dbilit individuelle, soit par quelque excs de la
domination paternelle, lindividu dont le moi flchit recevra en outre le faix dun surmoi
excessif. On sest livr des considrations divergentes sur la notion dun surmoi
familial ; assurment elle rpond une intuition de la ralit. Pour nous, le renforcement
pathogne du surmoi dans lindividu se fait en fonction double : et de la rigueur de la
domination patriarcale, et de la forme tyrannique des interdictions qui resurgissent avec
la structure matriarcale de toute stagnation dans les liens domestiques. Les idaux
religieux et leurs quivalents sociaux jouent ici facilement le rle de vhicules de cette
oppression psychologique, en tant quils sont utiliss des fins exclusivistes par le
corps familial et rduits signifier les exigences du nom ou de la race.
Cest dans ces conjonctures que se produisent les cas les plus frappants de ces
nvroses, quon appelle dautopunition pour la prpondrance souvent univoque quy
prend le mcanisme psychique de ce nom ; ces nvroses, quen raison de lextension
trs gnrale de ce mcanisme, on diffrencierait mieux comme nvroses de destine, se
manifestent par toute la gamme des conduites dchec, dinhibition, de dchance, o
les psychanalystes ont su reconnatre une intention inconsciente ; lexprience
analytique suggre dtendre toujours plus loin, et jusqu la dtermination de maladies
organiques, les effets de lautopunition. Ils clairent la reproduction de certains
accidents vitaux plus ou moins graves au mme ge o ils sont apparus chez un parent,
certains virages de lactivit et du caractre, pass le cap dchances analogues, lge
de la mort du pre par exemple, et toutes sortes de comportements didentification, y
40
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
compris sans doute beaucoup de ces cas de suicide, qui posent un problme singulier
dhrdit psychologique.
Introversion de la personnalit et schizonoa. Une seconde atypie de la situation
familiale se dfinit dans la dimension des effets psychiques quassure ldipe en tant
quil prside la sublimation de la sexualit : effets que nous nous sommes efforcs de
faire saisir comme dune animation imaginative de la ralit. Tout un ordre danomalies
des intrts sy rfre, qui justifie pour lintuition immdiate lusage systmatis dans la
psychanalyse du terme de libido. Nulle autre en effet que lternelle entit du dsir ne
parat convenir pour dsigner les variations que la clinique manifeste dans lintrt que
porte le sujet la ralit, dans llan qui soutient sa conqute ou sa cration. Il nest pas
moins frappant dobserver qu mesure que cet lan samortit, lintrt que le sujet
rflchit sur sa propre personne se traduit en un jeu plus imaginaire, quil se rapporte
son intgrit physique, sa valeur morale ou sa reprsentation sociale.
Cette structure dinvolution intra-psychique, que nous dsignons comme introversion
de la personnalit, en soulignant quon use de ce terme dans des sens un peu diffrents,
rpond la relation du narcissisme, telle que nous lavons dfinie gntiquement
comme la forme psychique o se compense linsuffisance spcifique de la vitalit
humaine. Ainsi un rythme biologique rgle-t-il sans doute certains troubles affectifs,
dits cyclothymiques, sans que leur manifestation soit sparable dune inhrente
expressivit de dfaite et de triomphe. Aussi bien toutes les intgrations du dsir humain
se font-elles en des formes drives du narcissisme primordial.
Nous avons pourtant montr que deux formes se distinguaient par leur fonction
critique dans ce dveloppement : celle du double et celle de lidal du moi, la seconde
reprsentant lachvement et la mtamorphose de la premire. Lidal du moi en effet
substitue au double cest--dire limage anticipatrice de lunit du moi, au moment o
celle-ci sachve, la nouvelle anticipation de la maturit libidinale du sujet. Cest
pourquoi toute carence de limago formatrice de lidal du moi tendra produire une
certaine introversion de la personnalit par subduction narcissique de la libido.
Introversion qui sexprime encore comme une stagnation plus ou moins rgressive dans
les relations psychiques formes par le complexe du sevrage ce que dfinit
essentiellement la conception analytique de la schizonoa.
Dysharmonie du couple parental. Les analystes ont insist sur les causes de
nvroses que constituent les troubles de la libido chez la mre, et la moindre exprience
rvle en effet dans de nombreux cas de nvrose une mre frigide, dont on saisit que la
sexualit, en se drivant dans les relations lenfant, en ait subvertit la nature : mre qui
couve et choie, par une tendresse excessive o sexprime plus ou moins consciemment
un lan refoul ; ou mre dune scheresse paradoxale aux rigueurs muettes, par une
cruaut inconsciente o se traduit une fixation bien plus profonde de la libido.
Une juste apprciation de ces cas ne peut viter de tenir compte dune anomalie
corrlative chez le pre. Cest dans le cercle vicieux de dsquilibres libidinaux, que
constitue en ces cas le cercle de famille, quil faut comprendre la frigidit maternelle
pour mesurer ses effets. Nous pensons que le sort psychologique de lenfant dpend
avant tout du rapport que montrent entre elles les images parentales. Cest par l que la
msentente des parents est toujours nuisible lenfant, et que, si nul souvenir ne
demeure plus sensible en sa mmoire que laveu formul du caractre mal assorti de
leur union, les formes les plus secrtes de cette msentente ne sont pas moins
pernicieuses. Nulle conjoncture nest en effet plus favorable lidentification plus haut
invoque comme nvrosante, que la (8428)perception, trs sre chez lenfant, dans les
relations des parents entre eux, du sens nvrotique des barrires qui les sparent, et tout
41
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
spcialement chez le pre en raison de la fonction rvlatrice de son image dans le
processus de sublimation sexuelle.
Prvalence du complexe du sevrage. Cest donc la dysharmonie sexuelle entre les
parents quil faut rapporter la prvalence que gardera le complexe du sevrage dans un
dveloppement quil pourra marquer sous plusieurs modes nvrotiques.
Le sujet sera condamn rpter indfiniment leffort du dtachement de la mre
et cest l quon trouve le sens de toutes sortes de conduites forces, allant de telles
fugues de lenfant aux impulsions vagabondes et aux ruptures chaotiques qui
singularisent la conduite dun ge plus avanc ; ou bien, le sujet reste prisonnier des
images du complexe, et soumis tant leur instance lthale qu leur forme narcissique
cest le cas de la consomption plus ou moins intentionnalise o, sous le terme de
suicide non violent, nous avons marqu le sens de certaines nvroses orales ou
digestives ; cest le cas galement de cet investissement libidinal que trahissent dans
lhypocondrie les endoscopies les plus singulires, comme le souci, plus
comprhensible mais non moins curieux, de lquilibre imaginaire des gains
alimentaires et des pertes excrtoires. Aussi bien cette stagnation psychique peut-elle
manifester son corollaire social dans une stagnation des liens domestiques, les membres
du groupe familial restant agglutins par leurs maladies imaginaires en un noyau
isol dans la socit, nous voulons dire aussi strile pour son commerce quinutile son
architecture.
Inversion de la sexualit. Il faut distinguer enfin une troisime atypie de la situation
familiale, qui, intressant aussi la sublimation sexuelle, atteint lectivement sa fonction
la plus dlicate, qui est dassurer la sexualisation psychique, cest--dire un certain
rapport de conformit entre la personnalit imaginaire du sujet et son sexe biologique :
ce rapport se trouve invers des niveaux divers de la structure psychique, y compris la
dtermination psychologique dune patente homosexualit.
Les analystes nont pas eu besoin de creuser bien loin les donnes videntes de la
clinique pour incriminer ici encore le rle de la mre, savoir tant les excs de sa
tendresse lendroit de lenfant que les traits de virilit de son propre caractre. Cest
par un triple mcanisme que, au moins pour le sujet mle, se ralise linversion : parfois
fleur de conscience, presque toujours fleur dobservation, une fixation affective la
mre, fixation dont on conoit quelle entrane lexclusion dune autre femme ; plus
profonde, mais encore pntrable, ft-ce la seule intuition potique, lambivalence
narcissique selon laquelle le sujet sidentifie sa mre et identifie lobjet damour sa
propre image spculaire, la relation de sa mre lui-mme donnant la forme o
sencastrent jamais le mode de son dsir et le choix de son objet, dsir motiv de
tendresse et dducation, objet qui reproduit un moment de son double ; enfin, au fond
du psychisme, lintervention trs proprement castrative par o la mre a donn issue
sa propre revendication virile.
Ici savre bien plus clairement le rle essentiel de la relation entre les parents ; et les
analystes soulignent comment le caractre de la mre sexprime aussi sur le plan
conjugal par une tyrannie domestique, dont les formes larves ou patentes, de la
revendication sentimentale la confiscation de lautorit familiale, trahissent toutes leur
sens foncier de protestation virile, celle-ci trouvant une expression minente, la fois
symbolique, morale et matrielle, dans la satisfaction de tenir les cordons de la
bourse . Les dispositions qui, chez le mari, assurent rgulirement une sorte
dharmonie ce couple, ne font que rendre manifestes les harmonies plus obscures qui
font de la carrire du mariage le lieu lu de la culture des nvroses, aprs avoir guid
lun des conjoints ou les deux dans un choix divinatoire de son complmentaire, les
42
1938-03-00 LA FAMILLE : LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE. LES COMPLEXES
FAMILIAUX EN PATHOLOGIE.
avertissements de linconscient chez un sujet rpondant sans relais aux signes par o se
trahit linconscient de lautre.
Prvalence du principe mle. L encore une considration supplmentaire nous
semble simposer, qui rapporte cette fois le processus familial ses conditions
culturelles. On peut voir dans le fait de la protestation virile de la femme la consquence
ultime du complexe ddipe. Dans la hirarchie des valeurs qui, intgres aux formes
mmes de la ralit, constituent une culture, cest une des plus caractristiques que
lharmonie quelle dfinit entre les principes mle et femelle de la vie. Les origines de
notre culture sont trop lies ce que nous appellerions volontiers laventure de la
famille paternaliste, pour quelle nimpose pas, dans toutes les formes dont elle a enrichi
le dveloppement psychique, une prvalence du principe mle, dont la porte morale
confre au terme de virilit suffit mesurer la partialit.
Il tombe sous le sens de lquilibre, qui est le fondement de toute pense, que cette
prfrence a un envers : fondamentalement cest loccultation du principe fminin sous
lidal masculin, dont la vierge, par son mystre, est travers les ges de cette culture le
signe vivant. Mais cest le propre de lesprit, quil dveloppe en mystification les
antinomies de ltre qui le constituent, et le poids mme de ces superstructures peut
venir en renverser la base. Il nest pas de lien plus clair au moraliste que celui qui unit
le progrs social de linversion psychique un virage utopique des idaux dune culture.
Ce lien, lanalyste en saisit la dtermination individuelle dans les formes de sublimit
morale, sous lesquelles la mre de linverti exerce son action la plus catgoriquement
masculante.
Ce nest pas par hasard que nous achevons sur linversion psychique cet essai de
systmatisation des nvroses familiales. Si en effet la psychanalyse est partie des formes
patentes de lhomosexualit pour reconnatre les discordances psychiques plus subtiles
de linversion, cest en fonction dune antinomie sociale quil faut comprendre cette
impasse imaginaire de la polarisation sexuelle, quand sy engagent invisiblement les
formes dune culture, les murs et les arts, la lutte et la pense.
Jacques M. LACAN,
Ancien chef de clinique
la Facult de Mdecine.
43
Vous aimerez peut-être aussi
- Guide de Poche de PhytotherapieDocument35 pagesGuide de Poche de PhytotherapieAHF ALGPas encore d'évaluation
- Les Procédés de Fabrication Des CéréalesDocument57 pagesLes Procédés de Fabrication Des CéréalesMjaied Sawsen100% (6)
- 7 Dokument Dok PDF 43542 3 PDFDocument104 pages7 Dokument Dok PDF 43542 3 PDFcourtoiPas encore d'évaluation
- 06 Malnutrition Proteino-Calorique SemDocument45 pages06 Malnutrition Proteino-Calorique SemSafaa Med100% (1)
- Dossier de Presse La Source Dorée 2019Document17 pagesDossier de Presse La Source Dorée 2019lasourcedoreePas encore d'évaluation
- Projet Pilote de Développement de La Filière Dihé Au Tchad - RAPPORT NARRATIF FINAL (20 Mars 2007 Au 20 Septembre 2010)Document23 pagesProjet Pilote de Développement de La Filière Dihé Au Tchad - RAPPORT NARRATIF FINAL (20 Mars 2007 Au 20 Septembre 2010)Kendra MasseyPas encore d'évaluation
- Serie 4Document3 pagesSerie 4Fouad Dimane100% (3)
- Societe FR Au Xvii SiecleDocument3 pagesSociete FR Au Xvii SiecleDai AriasPas encore d'évaluation
- Photographie Dentaire Numerique PDFDocument3 pagesPhotographie Dentaire Numerique PDFAya JelaidiPas encore d'évaluation
- Catalogue - Climatisations PAC - Daikin-Air-Air-2021Document114 pagesCatalogue - Climatisations PAC - Daikin-Air-Air-2021Yassine Yahia BerrouiguetPas encore d'évaluation
- Ch11 Carte MentaleDocument1 pageCh11 Carte MentalePalisse BrunoPas encore d'évaluation
- CATALOGUE DES MATIERES PREMIERES 2-Fi15997396 PDFDocument44 pagesCATALOGUE DES MATIERES PREMIERES 2-Fi15997396 PDFmagloire amivaPas encore d'évaluation
- PRO-HDS-LAB004-V1 Procédure de Gestion Des Déchets BiomédicauxDocument6 pagesPRO-HDS-LAB004-V1 Procédure de Gestion Des Déchets Biomédicauxfroppy froppyPas encore d'évaluation
- Acova Cotona LCDDocument1 pageAcova Cotona LCDPierrot KadangaPas encore d'évaluation
- Le Groupe OCP SDocument5 pagesLe Groupe OCP SMouaad El MeslouhiPas encore d'évaluation
- AssainissementDocument14 pagesAssainissementAbdelilah ElmahsaniPas encore d'évaluation
- Bac C - 2014 1Document8 pagesBac C - 2014 1Heureux BanzoulouPas encore d'évaluation
- Mapping Jeunesse Culture Casa SettatDocument42 pagesMapping Jeunesse Culture Casa SettatHICHAM FADLIPas encore d'évaluation
- La Terre Marocaine 1947-1958Document61 pagesLa Terre Marocaine 1947-1958Ahmed KabilPas encore d'évaluation
- 1S5 DS1Document4 pages1S5 DS1galaxiPas encore d'évaluation
- Caracterestiques Des Supports de TransmissionDocument9 pagesCaracterestiques Des Supports de TransmissionFarid HouariPas encore d'évaluation
- Échafaudage de PiedDocument10 pagesÉchafaudage de PiedBarbouche MohamedYassinePas encore d'évaluation
- Chapitre VI Transformation GénétiqueDocument3 pagesChapitre VI Transformation Génétiqueihcene aouesPas encore d'évaluation
- Cœur Et SportDocument16 pagesCœur Et SportdrlauriPas encore d'évaluation
- Conclusions en ConserveDocument2 pagesConclusions en ConserveScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Vins Saint Emilion Guide Tarif 2013Document15 pagesVins Saint Emilion Guide Tarif 2013MrFeraillePas encore d'évaluation
- 1ères CD - CH REVISION N°02Document2 pages1ères CD - CH REVISION N°02NDE50% (2)
- Spells Dungeons & Dragons - D&D 5eDocument4 pagesSpells Dungeons & Dragons - D&D 5ejulienPas encore d'évaluation
- Les Causes Et ConsequencesDocument3 pagesLes Causes Et ConsequencesRawan KarimPas encore d'évaluation
- Rapport Final PDE Imprimante 3D - Martí PujolDocument38 pagesRapport Final PDE Imprimante 3D - Martí PujolANAS ANASPas encore d'évaluation