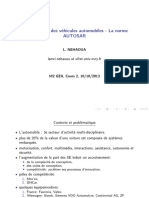Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Multiplex
Multiplex
Transféré par
donsallus0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
8 vues24 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
8 vues24 pagesMultiplex
Multiplex
Transféré par
donsallusDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 24
Le multiplexage
di t avec l e concour s de l ducat i on Nat i onal e
Cr avec l a col l aborati on du GAMA et du GNFA :
Les Dossiers
Techniques
L E C T R I C I T - L E C T R O N I Q U E
G.A.M.A.
(Groupement Amical d'enseignants des Matriels Automobiles)
Son but est d'apporter aux enseignants des mtiers de l'automobile :
des aides pdagogiques et techniques ;
de renforcer les liens entre collgues ;
d'tablir et faciliter les relations avec les professionnels ;
d'tre l'interlocuteur privilgi des responsables dcisionnels.
Contact : Henri NOIREL : 03 83 26 31 73 ou 06 89 37 78 19
E.mail : HNoirel@ac-nancy-metz.fr ou h.noirel@infonie.fr
S
ommaire
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
1 Historique .......................................................................................................................................................................... page 5
2 Intrt du multiplexage .................................................................................................................................... page 7
3 volution : lectronique/cblage ....................................................................................................... page 10
4 Conversion : analogique/numrique .............................................................................................. page 12
5 Architecture ................................................................................................................................................................. page 15
6 Dialogue .......................................................................................................................................................................... page 17
7 Recommandations ............................................................................................................................................... page 23
8 Conclusion .................................................................................................................................................................... page 24
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
A. INTRODUCTION
Depuis le dbut des annes quatre-vingt, de nombreux
systmes lectroniques ont fait leur apparition dans le
domaine de l'automobile, selon trois grandes tapes
successives :
l'poque o chaque systme tait totalement
indpendant des autres ;
la seconde priode, pendant laquelle quelques
systmes commenaient communiquer entre
eux ;
enfin, la dernire poque o tout le monde doit
communiquer avec tout le monde, et ce en
temps rel.
Dbut 1981, quelques grandes socits automobiles
s'intressrent des systmes de communication
fonctionnant en temps rel entre diffrents microcon-
trleurs, concernant notamment le contrle moteur, la
transmission automatique et l'anti-patinage.
En 1983, le leader allemand d'quipements automobile
Robert Bosch Gmbh pris la dcision de dvelopper un
protocole de communication orient vers des systmes
distribus fonctionnant en temps rel et satisfaisant
toutes ses propres exigences.
En 1985, le gant amricain Intel, puis Philips et Siemens
se lancent dans la fabrication de circuits intgrs.
Depuis, d'autres fabricants leur ont embot le pas
(Motorola, National Semiconductors, Texas Instruments,
MHS, etc.)
Au printemps 1986, la premire communication con-
cernant le bus CAN ft ralise.
Enfin, au milieu de l'anne 1987, la ralit prit la forme
des premiers siliciums fonctionnels ; puis, en 1991, une
premire voiture (allemande) haut de gamme quipe
de cinq Electronic Central Units (ECU) et d'un bus CAN
fonctionnant 500 kb/s sortit des chanes de produc-
tion.
Ce fut alors l'arrive de nombreux bus de mme type,
soit aux USA, soit au japon, soit en France (bus VAN -
support par un GIE compos principalement de PSA
et Renault).
partir de 1994, le constructeur Citron commercialise
des vhicules multiplexs (XM) comportant 24 nuds
et mettant en uvre le protocole VAN.
5
1
Le multiplexage
Historique
1
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
B. QUELQUES DATES SUR LES VHICULES
MULTIPLEXS
1980 Naissance du CAN (Robert Bosch Gmbh).
1985 Naissance du VAN.
1986 Sorti e de l a BMW 850 CSI (l e rseau
multiplex permet aux deux calculateurs
des deux moteurs 6 cylindres en ligne relis
mcaniquement de communiquer).
1989 Mercedes ( apparition du multiplexage sur
la SL 500).
1991 CAN Low Speed devient norme ISO 1519-2
standard.
1992 Mercedes utilise le multiplexage CAN sur
une classe S.
1993 CAN High Speed devient norme ISO 11898
(CAN 2.0).
1994 Fabri cati on en sri e l i mi te vhi cul es
(Citron XM), l'Audi A4 sort avec la gestion
moteur multiplexe.
1995 C'est le tour du Ford Galaxy d'avoir un
rseau.
1997 Sur l a Vol kswagen Passat, l e confort du
vhicule est multiplex.
1998 Fabrication en srie sur la Peugeot 206.
1999 Fabrication en srie sur la Peugeot 406 et la
Citron Xsara Picasso.
2001 Sortie de la Renault Laguna II avec un
rseau multiplex vhicule qui relie douze
calculateurs, deux rseaux privatifs (un pour
le contrle de trajectoire, un autre pour la
fonction lve-vitre impulsionnel avec sige
mmoris), un rseau multimdia.
2002 Auj ourd' hui , quel ques vhi cul es comme
l'Audi A8 ou la Mercedes Classe E sont tota-
l ement mul ti pl exs. Leurs rseaux rel i ent
entre eux une trentaine de calculateurs
avec de la fibre optique.
Historique (suite)
6
Les Dossiers
Techniques
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
7
2
Le multiplexage
A. POURQUOI LE MULTIPLEXAGE
Les normes antipollution, la scurit ainsi que le
confort des utilisateurs entranent une augmentation
constante des foncti ons l ectroni ques prsentes
dans nos vhicules : climatisation, navigation, ABS,
radar, EOBD
1
Ainsi que bon nombre dinformations
qui peuvent tre utilises par les systmes.
Points communs entre les capteurs et les calculateurs
Un vhicule haut de gamme ncessite environ 40 kg
de faisceau pour une longueur de plus de deux kilo-
mtres et 1 800 interconnections.
Ceci gnre :
1. Une volution majeure du cblage :
complexit des faisceaux ;
augmentation en masse et en volume de ces
faisceaux ;
augmentation du nombre d'intercon-
nections.
2. Des problmes de :
conception et fabrication ;
cot et encombrement ;
fiabilit ;
recherche de pannes et diagnostics.
1
EOBD : European On Board Diagnostic.
Intrt du multiplexage
CAPTEURS
CALCULATEURS
2000
1960 2000
1960 2000
1960 2000
1500
1000
500
0
Points de connexion
2000
2500
1500
1000
500
0
Longueur de cble en m
80
60
40
20
0
Nombre de fusibles
2
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
Intrt du multiplexage (suite)
8
Les Dossiers
Techniques
B. INTRT DU MULTIPLEXAGE
Le multiplexage permet la mise en commun et lchange dinformations entre les systmes.
Mise en commun de linformation
Systme classique
Systme multiplex
Calculateur
Gestion moteur
(CGM)
Charge
moteur
Rgime
moteur
T eau
Vitesse
vhicule
Autres
info.
BVA
Charge
moteur
Vitesse
entre
Vitesse
vhicule
T eau Autres
info.
Afficheur
tableau de
bord
T eau
Niveau
d'huile
Vitesse
vhicule
Autres
info.
Afficheur
vitesse vhicule
(BVA)
T eau (CGM)
Niveau
d'huile
BVA
T eau
charge
moteur
}
CGM
Autres
info.
Vitesse
entre
Vitesse
vhicule
Calculateur
CGM
vitesse vhicule
(BVA)
Charge
moteur
Rgime
moteur
T eau
Bus
(1 ou 2 fils)
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
9
2
Le multiplexage
Rduction du nombre de fils
Systme classique
Systme multiplex
Intrt du multiplexage (suite)
M M
M
M
MM
M
M
Porte passager Porte conducteur
14 fils
M M
M
M
M
o
d
u
l
e
c
o
n
d
u
c
t
e
u
r
MM
M
M
M
o
d
u
l
e
p
a
s
s
a
g
e
r
Botier
centralisateur
informations
Prise diag.
Bus (1 ou 2 fils)
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
10
Les Dossiers
Techniques
A. DVELOPPEMENT DE LLECTRONIQUE
Un circuit lectronique dispose, comme pour un
relais, dun circuit de commande et de puissance.
Le dveloppement de llectronique a permis :
linterrogation du systme par des outils de diag-
nostic (paramtres entres/sorties, activation
sortie, lecture/effacement des dfauts ) ;
la possibilit dactiver/dsactiver des fonctions
initialement prvues par le constructeur ;
deffectuer un diagnostic distance.
B. VOLUTION DU CBLAGE
Solution classique Solution BSH (Botier Servitude Habitacle)
Solution BSH, BSM (Botier Servitude Moteur) Solution multiplexe
3
volution :
lectronique/cblage
Commande
Prise
diag
Puissance
C
o
m
m
a
n
d
e
P
u
i
s
s
a
n
c
e
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
11
Le multiplexage
3
Le multiplexage consiste faire circuler plusieurs
informations entre divers quipements lectriques
avec le moins de fils possible. Ceci implique que les
informations soient :
numrises (constitues de bits) ;
rapides (62 000 bits/seconde) ;
identifies (trame : destinataire, information,
commande) ;
classes par priorit.
On appelle Bus le circuit lectrique vhiculant les
informations multiplexes. Sur la majorit des vhi-
cules multiplexs, le bus est constitu de deux fils.
Chaque fil porte une appellation diffrente suivant le
type de multiplexage :
- DATA ou (data barre) : codage VAN
1
;
- CAN H ou CAN L : codage CAN
2
.
Dans l es deux cas, ces deux i nfor mati ons sont
complmentaires : quand lun est un niveau haut,
lautre est un niveau bas.
Exemple :
Cette stratgie de cblage permet dliminer une
partie des parasites (entrants et sortants de la paire).
1
VAN : Vehicule Area Network.
2
CAN : Controller Area Network.
DATA
volution :
lectronique/cblage (suite)
DATA
DATA
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
12
Les Dossiers
Techniques
A. SIGNAL ANALOGIQUE/NUMRIQUE
Un signal lectrique peut tre sous deux formes :
analogique ou numrique.
Signal analogique
Un signal analogique est un signal dont lamplitude
volue dans le temps. Il provient souvent dun cap-
teur, comme par exemple le potentiomtre papillon.
Le signal fourni par le potentiomtre est un signal
analogique. On peut dire quil ressemble ce quil
mesure.
Signal numrique
Un signal numrique est un signal dont lamplitude ne
prend que deux valeurs : tension, pas tension.
Il reprsente souvent ltat lectrique dun interrup-
teur : ferm, ouvert.
volution de ltat lectrique dans le temps
4
Conversion :
analogique/numrique
+
Inter. ouvert
Pas de tension
tat logique 0
+
Inter. ferm
Tension
tat logique 1
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
13
Le multiplexage
4
B. SYSTME DCIMAL/BINAIRE
La numration binaire (base deux) a pour base le
nombre deux. Elle n'a que deux chiffres, le zro et
l'unit.
La numration dcimale (base dix) a pour base le
nombre dix. Elle utilise dix chiffres, de zro neuf.
Quel l e que soi t l a base uti l i se, un nombre se
compose d'un ou plusieurs chiffres. Chaque chiffre
d'un nombre occupe un rang dans ce nombre (on
appelle souvent ce rang le poids du chiffre). En base
dix , le rang = 0 de poids faible (celui qui se
trouve droite du nombre) est l'unit, le rang suivant
reprsente les dizaines, le troisime les centaines, et
ainsi de suite. Le chiffre ayant le poids le plus fort
se trouve compltement gauche du nombre.
La valeur du nombre est la somme des valeurs des
diffrents chiffres affects de leur poids.
(chiffre de rang 1 x base
poids
) + (chiffre de rang 0 x base
poids
)
Conversion binaire /dcimale
Le nombre binaire 10010011 correspond au nombre dcimal 147.
Conversion dcimale/binaire
Le nombre dcimal 84 correspond au nombre binaire 01010100.
Conversion :
analogique/numrique (suite)
RANG pds 7 6 5 4 3 2 1 0
BASE
pds
2
7
2
6
2
5
2
4
2
3
2
2
2
1
2
0
VALEUR DCIMALE 128 64 32 16 8 4 2 1
NOMBRE DCIMAL 84
CONVERSION
DCIMALE/BINAIRE 0 1 0 1 0 1 0 0
RANG pds 7 6 5 4 3 2 1 0
BASE
pds
2
7
2
6
2
5
2
4
2
3
2
2
2
1
2
0
VALEUR DCIMALE 128 64 32 16 8 4 2 1
NOMBRE BINAIRE 1 0 0 1 0 0 1 1
CONVERSION
BINAIRE/DCIMALE 128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 147
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
14
Les Dossiers
Techniques
C. LA CONVERSION ANALOGIQUE/NUMRIQUE
Influence des parasites
Pour transmettre une i nfor mati on l ectri que
distance sans tre altre (perte par conduction,
parasite, effet magntique), cette information doit
tre numrise. Car un signal numris est moins
sensi bl e aux perturbati ons tant que cel l es-ci ne
dpassent pas un certain niveau.
Un parasite modifie principalement lamplitude dun
si gnal . Dans l e cas dun si gnal anal ogi que o
chaque valeur de tension est interprte par le
calculateur comme un angle (potentiomtre), on
voi t i ci que pour une mme val eur de tensi on
parasite correspondent deux angles douverture
(perturbation).
Principe de numrisation du signal
analogique : potentiomtre papillon
Un tat lectrique ne prenant que deux valeurs 0 ou 1 sappelle un Bit (Binary digit). Pour
numriser un signal analogique il faut le dcouper (chantillonnage) et pour toute valeur de tension
correspondante, la coder en bits.
Ces cinq valeurs de tension peuvent tre codes sur trois bits.
Dans la majorit des cas, le codage se ralise sur huit bits (un octet).
4
Conversion :
analogique/numrique (suite)
Dcimal
0 Volts
1 Volts
2 Volts
3 Volts
4 Volts
5 Volts
Binaire
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
15
Le multiplexage
5
A. ORGANISATION DUN RSEAU MULTIPLEX
Un rseau multiplex peut tre organis avec des
dispositifs matres ou esclaves. Cela dpend sils
peuvent prendre linitiative dune communication
(matre) ou seulement rpondre un matre (escla-
ve).
Rseaux matre-esclave/matre-matre (multi-
matre)
Ce rseau permet un matre de piloter plusieurs
esclaves , chacun ayant une tche prcise ex-
cuter. Les matres pourront dialoguer entre eux et
mettre en commun des informations (matre-matres).
Synoptique :
Les cal cul ateurs changeant rgul i rement des
informations entre eux sont connects sur un bus.
Pour faciliter les changes et ne pas surcharger le
bus, un vhicule multiplex peut disposer de plusieurs
bus en fonction des quipements et accessoires.
B. NORMES CAN-VAN
CAN : Controller Area Networks
Naissance en 1980.
Dvelopp par R. Bosch.
Premire application en 1982 sur Mercedes 500 SL.
Vitesse maximale de transmission : 1Mbit/s.
Temps de rponse : 50 ms.
Architecture
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
16
Les Dossiers
Techniques
VAN : Vehicule Area Networks
Naissance en 1985/86.
Dvelopp par PSA/Renault.
Premire application en 1994 sur Citron XM.
Vitesse maximale de transmission : 250 kbit/s.
Temps de rponse : 200 ms.
C. LE CODAGE VAN/CAN
le bus utilis en format VAN est constitu de deux
fils dsigns par DATA et .
Sur chacun de ces fils, le signal ne peut prendre
que deux niveaux 0 ou 1 , les signaux tant
complmentaires lun de lautre.
Les valeurs de tension sont comprises, pour DATA
et entre 0,5 V et 4,5 V.
le bus utilis en format CAN est constitu de deux
fils dsigns par CAN-H (High : haut) et CAN-L
(Low : bas) ; les signaux sont complmentaires
lun de lautre mais les niveaux logiques 0 et
1 sont des potentiels diffrents.
Les tensions sont comprises :
2,5 < CAN-H < 3,5 V ;
1,5 < CAN-L < 2,5 V.
DATA
DATA
5
Architecture (suite)
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
17
Le multiplexage
6
A. CONSTITUTION DUNE TRAME
Sur les rseaux VAN et CAN, les signaux sont transmis sous forme de trame.
1. Dbut de trame : signale aux diffrents quipements quune trame va tre mise.
2. Identificateur : dsigne le/les metteur(s) de la trame et indique les priorits.
3. Commande : indique la nature du message (transmission dune information, dun ordre ou dune com-
mande).
4. Donnes : fournit le contenu du ou des messages (valeurs, consignes).
5. Contrle : permet de vrifier que les donnes transmises ou reues sont correctes. Le rcepteur
effectue un calcul (algorithme) avec les donnes, le rsultat est compar avec le contrle.
6. Acquittement : indique la bonne rception des donnes (message envoy par le rcepteur).
7. Fin de trame : signale aux diffrents quipements que la trame est termine (une nouvelle trame peut
tre mise).
B. LES DIFFRENTES TRAMES
Sur les rseaux CAN ou VAN, les trames sont envoyes des moments prcis selon les besoins de
fonctionnement des systmes.
On distingue diffrents types de trames, dont voici les principales :
Trame priodique : elle est envoye priodiquement sur le rseau par les botiers (intervalles rguliers).
Ex : pour PSA, toutes les 50 ms, le BSI transmet sur le champ de donnes les valeurs suivantes : rgime
moteur, vitesse vhicule, distance parcourue.
Trame vnementielle : elle est envoye chaque fois que surgit un vnement. Ex : demande de mise
en route de lautoradio, de la climatisation, etc.
Dialogue
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
18
Les Dossiers
Techniques
C. OSCILLOGRAMMES
Trace loscilloscope de la trame VAN
Trace loscilloscope de la trame CAN
6
Dialogue (suite)
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
19
Le multiplexage
6
D. DIALOGUE SUR LE RSEAU POUR LA FONCTION RFRIGRATION SIMPLE
Synoptique
Phases 1. Demande de rfrigration au BSH (Botier Servitude Habitacle) par le bouton.
2. Le BSH demande au calculateur dinjection lautorisation denclencher le compresseur, qui
dpendra de :
la vitesse de rotation du moteur < 6 250 tr/min ;
linformation temprature deau moteur ;
linformation pression circuit rfrigration (> 3 bars et < 27 bars).
3. Le calculateur dinjection donnera une rponse positive en prenant en compte le rapport
de bote automatique (estompage de couple).
4. Le BSH mesure la temprature fournie par la sonde de lvaporateur (non givr).
5. Le BSH enclenche alors :
le compresseur ;
lallumage du voyant dans le bouton et signale au calculateur dinjection la mise en
action du compresseur.
6. Le calculateur dinjection commande alors le motoventilateur.
Dialogue (suite)
Flche simple : liaison filaire
Flche triple : liaison multiplexe
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
20
Les Dossiers
Techniques
6
Dialogue (suite)
E. TRANSMISSION DE DONNES PAR FIBRE OPTIQUE
La lumire
Le spectre lumineux
La lumire visible stend de linfrarouge
lultraviolet, bornes non comprises.
1 nanomtre = 10
-9
mtre = 1/1 000 000 de
millimtre, soit en frquence la lumire stendant
de 4 x 10
14
8 x 10
14
Hz (400 000 800 000 GHz).
Vitesse et propagation
La lumire se propage 300 000 km/s dans un
milieu homogne et isotrope.
Que fai t l a l umi re l orsquel l e rencontre un
obstacle ?
Un rayon de lumire qui vient de lair vers une
pl aque de verre sel on un angl e di nci dence
donn va :
se rflchir et retourner dans lair, cest le
rayon rflchi ;
pntrer dans le verre en subissant une
dvi ati on de traj ectoi re, cest l e rayon
rfract ;
perdre un peu dnergie.
Le rapport entre lnergie rflchie et lnergie
transmise varie en fonction de langle dinciden-
ce. Il existe un angle critique.
Sil est mesur comme indiqu sur le schma,
l orsque cet angl e devi ent i nfri eur l angl e
critique, il ny a plus de rayon rfract et aux
pertes par absorption prs, la totalit du rayon
incident est rflchie.
Infrarouges Lumire visible Ultraviolets
800 nm 400 nm
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
21
Le multiplexage
6
La fibre optique
Constitution
Une fibre optique est constitue de :
un cur ;
une gaine optique ;
un revtement.
Propagation de la lumire dans la fibre optique
En regardant le schma ci-dessus, on comprend bien que plus le diamtre du cur de la fibre sera
petit, plus on minimisera les risques dun angle dincidence trop grand.
La fibre gradient dindice
Ici, deux amliorations sont apportes :
le diamtre du cur est plus petit ;
le cur est constitu de deux couches successives, indice de rfraction de plus en plus grand. Ainsi,
un rayon lumineux qui ne suit pas laxe central de la fibre est ramen en douceur dans le droit
chemin.
La source lumineuse
Lmetteur est le plus souvent une diode lectro-
luminescente ou une diode laser.
Le rcepteur est une photodiode (diode sensible
la lumire) ou un phototransistor.
Lmetteur convertit les impulsions lectriques en
signaux optiques (5 nanosecondes) ; le rcepteur
convertit les signaux optiques en impulsions lec-
triques (5 nanosecondes).
Dialogue (suite)
ou
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
22
Les Dossiers
Techniques
La fibre optique cote-t-elle cher ?
Non. Par rapport au cble en cuivre, elle aurait
mme tendance coter moins cher. En revanche,
l a connecti que et l es converti sseurs dnergi e
lectrique/lumineuse placer aux extrmits sont
trs coteux en fonction des technologies mises en
uvre.
Quels sont les principaux avantages de la fibre
optique ?
1. La fibre optique est totalement insensible aux
rayonnements lectromagntiques.
2. Lattnuation du signal est infrieure celle dun
conducteur lectrique et les distances couvertes
sans ncessit dinstaller des amplificateurs sont
bien plus grandes.
3. La bande passante est gnralement bien
suprieure celle que lon peut obtenir avec un
cble lectrique.
4. Les performances atteintes sont de plusieurs
centaines de mgabits par seconde.
La fibre optique est-elle fragile ?
Pas particulirement, cest la connectique qui peut
ltre. La seule difficult est le rayon de courbure
minimum qui la rend assez peu souple demploi pour
les installations volantes .
6
Dialogue (suite)
A.N.F.A. / dition 2002
Les Dossiers
Techniques
Lemploi de lampe tmoin, led ou voltmtre
analogique pour contrler une liaison multi-
plexe est proscrire (gnrateur de dfauts
par consommation de courant).
Les liaisons multiplexes peuvent tre
rpares avec des manchons Raychem .
Respecter en cas de rparation la structure
du faisceau (torsad, passage dorigine)
pour conserver limmunit au parasite .
Le multiplexage permet de relier des calcu-
lateurs (rseau de calculateur) ; il faut res-
pecter des rgles avant de dbrancher un
calculateur ou une batterie car les communi-
cations vont tre interrompues ( dfaut de
communication ).
Les interventions doivent seffectuer suivant
les recommandations constructeurs (pose,
dpose, paramtrage, apprentissage, rinitia-
lisation, ).
23
7
Le multiplexage
Recommandations
8
Le multiplexage
A.N.F.A. / dition 2002
Les vhicules daujourdhui sont :
de plus en plus confortables (climatisation, rgu-
lation de vitesse, siges mmoire, ordinateur de
bord, aide la navigation...) ;
de plus en plus srs (direction variable, suspen-
sion pilote, antiblocage de roue, contrle
dynamique de stabilit, radar anticollision) ;
de moins en moins polluants (contrle du pot
catalytique, recyclage des gaz dchappement,
injection dair lchappement, filtres parti-
cules, gestion des fonctions intervenant sur
lmission des polluants).
Or toutes ces fonctions font appel llectronique et
seul le multiplexage permet ces systmes de com-
muniquer entre eux et de les connecter leur envi-
ronnement, mais aussi de relier le vhicule au monde
extrieur (tlmatique) pour que :
lutilisateur puisse envoyer et recevoir des
informations ;
le rparateur puisse distance (tlassistance)
interroger et paramtrer les calculateurs.
conclusion
24
Les Dossiers
Techniques
Vous aimerez peut-être aussi
- CHAPITRE 3 MULTIPLEXAGE - Bus-CANDocument30 pagesCHAPITRE 3 MULTIPLEXAGE - Bus-CANabdo taouriri100% (1)
- L'autodiagnostic Des Calculateurs - InnovautoDocument8 pagesL'autodiagnostic Des Calculateurs - InnovautoTraore100% (1)
- Can EBSDocument52 pagesCan EBSyassine chakir100% (2)
- Bsi PDFDocument98 pagesBsi PDFwidespirit50% (2)
- Bus CAN - Qu'Est-ce Que C'est Et À Quoi Sert-Il Dans Une Voiture - Décodage de La Désignation. Mesure Et Diagnostic Du Bus CAN Comment Trouver Le Bus CAN Dans La VoitureDocument25 pagesBus CAN - Qu'Est-ce Que C'est Et À Quoi Sert-Il Dans Une Voiture - Décodage de La Désignation. Mesure Et Diagnostic Du Bus CAN Comment Trouver Le Bus CAN Dans La Voiturejunior kengni100% (1)
- Guide Maxiecu 2 - ObdautoDocument27 pagesGuide Maxiecu 2 - ObdautojossePas encore d'évaluation
- SSP 193 Système ConfortDocument48 pagesSSP 193 Système ConfortYassine LakhalPas encore d'évaluation
- 286 Dossier MultiplexageDocument27 pages286 Dossier MultiplexageSCORSAM1Pas encore d'évaluation
- P0243 SYMPTÔMES ET SOLUTIONS CORRECTES Code DDocument6 pagesP0243 SYMPTÔMES ET SOLUTIONS CORRECTES Code DAdonis KokoraPas encore d'évaluation
- Le Freinage Travaux Pratiques Freins À TamboursDocument9 pagesLe Freinage Travaux Pratiques Freins À TamboursJero MilPas encore d'évaluation
- Fonctionnement Du Calculateur ESPDocument2 pagesFonctionnement Du Calculateur ESPdoudzo100% (1)
- Nouveau Document Microsoft WordDocument9 pagesNouveau Document Microsoft WordYass561Pas encore d'évaluation
- Electronique - Le Multiplexage 2Document7 pagesElectronique - Le Multiplexage 2koukihamedPas encore d'évaluation
- Cours Multiplexage M1Document46 pagesCours Multiplexage M1sam100% (1)
- MaxiECU NoticeDocument16 pagesMaxiECU NoticejossePas encore d'évaluation
- Identification Des Fils MultiplexesDocument32 pagesIdentification Des Fils MultiplexesMohammed alami100% (1)
- Calage Distribution Methode 87Document2 pagesCalage Distribution Methode 87Gill100% (1)
- Calculateur Moteur Bosch EDC16C34-4.11 Peugeot Citroen 1.6HDI PSA Référence-9664617480-0281012980-9653958980Document4 pagesCalculateur Moteur Bosch EDC16C34-4.11 Peugeot Citroen 1.6HDI PSA Référence-9664617480-0281012980-9653958980Lakbir100% (1)
- Ressource Multiplexage PrincipesDocument16 pagesRessource Multiplexage Principesmilerk100% (1)
- 1 BusCAN TrameDocument16 pages1 BusCAN Trameabdousewager100% (1)
- Multiplex AgeDocument60 pagesMultiplex AgeMoncef Lazaar100% (1)
- LAGUNA 2 - 0 - Généralités 3Document17 pagesLAGUNA 2 - 0 - Généralités 3Benoit F. Andriantody100% (2)
- Le Multiplexage PDFDocument27 pagesLe Multiplexage PDFDjëugä Möudjeu EGPas encore d'évaluation
- Mux PDFDocument9 pagesMux PDFkalombo100% (1)
- Flyer Car Train Motronic 2.8 - FRDocument4 pagesFlyer Car Train Motronic 2.8 - FRabdelwahab mahdhi100% (1)
- Abs C5Document5 pagesAbs C5Marcadal100% (1)
- Simulation D'Injection c5 Steep7Document115 pagesSimulation D'Injection c5 Steep7Mohamed El Mountassir100% (1)
- Programme Electronique Du Comportement Dynamique ESP Disposition Des Composants ElectriquesDocument1 pageProgramme Electronique Du Comportement Dynamique ESP Disposition Des Composants Electriqueskalamj100% (1)
- Vel Satis - 3Document89 pagesVel Satis - 3aymendabPas encore d'évaluation
- 8627 Dossier Corrige CopieDocument49 pages8627 Dossier Corrige Copierbii100% (1)
- CHAP 1 ARCHITECTURE CALCULATEUR - EtudiantDocument13 pagesCHAP 1 ARCHITECTURE CALCULATEUR - EtudiantMbotchack Mbotchack100% (2)
- BP MV VTR NC 2019 DC CopieDocument10 pagesBP MV VTR NC 2019 DC CopiePape Faye100% (1)
- 8627 Dossier Travail CopieDocument49 pages8627 Dossier Travail CopieJALID ABD100% (1)
- SSP 024 Octavia, Bus CanDocument25 pagesSSP 024 Octavia, Bus CanbrahimPas encore d'évaluation
- Systeme Electronique Industriel Embarque Pour Vehicules PDFDocument8 pagesSysteme Electronique Industriel Embarque Pour Vehicules PDFWilly tsaty100% (1)
- LE BUS CAN - ElDocument12 pagesLE BUS CAN - ElSCORSAM1Pas encore d'évaluation
- TP Maquette Exotest Abs-EspDocument16 pagesTP Maquette Exotest Abs-EspBonickelPas encore d'évaluation
- Gestion Des Interconnecxtion CitroenDocument5 pagesGestion Des Interconnecxtion CitroenB medPas encore d'évaluation
- Lexia36 FR FRDocument8 pagesLexia36 FR FRMacloutPas encore d'évaluation
- 7-1-18 COURS Initiation Au MultiplexageDocument12 pages7-1-18 COURS Initiation Au Multiplexagejuvénal metoulou me ondoPas encore d'évaluation
- Intro CAN Color PDFDocument42 pagesIntro CAN Color PDFKaddouri KaddaPas encore d'évaluation
- Procedure Install Diagbox ComplèteDocument2 pagesProcedure Install Diagbox ComplèteABDEDDAIM EL HAFIDI100% (1)
- Cours de Diagnostic Electronique Automobile5Document21 pagesCours de Diagnostic Electronique Automobile5Diarrassoub BrahimaPas encore d'évaluation
- Code de Defaut UDocument13 pagesCode de Defaut UTokynyaina ANDRIANASOLO100% (1)
- Plan MultiplexageDocument3 pagesPlan MultiplexageTyler TwiixPas encore d'évaluation
- IndIDocument96 pagesIndIAdemir MarimPas encore d'évaluation
- C5 BrochureDocument22 pagesC5 Brochurekris_inorPas encore d'évaluation
- Bus CanDocument17 pagesBus CanTL05Pas encore d'évaluation
- MR346CLIO1Document364 pagesMR346CLIO1bogdanxp2000Pas encore d'évaluation
- Débitmètre D'airDocument3 pagesDébitmètre D'airLucas Sieuw100% (1)
- Gestion de L'information Par Bus-CanDocument17 pagesGestion de L'information Par Bus-Cankalico67Pas encore d'évaluation
- MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES Véhicules Particuliers SESSION 2016 DOSSIER RESSOURCES SUJET PREMIÈRE PARTIE ÉPREUVE ÉCRITE D ADMISSIBILITÉDocument39 pagesMAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES Véhicules Particuliers SESSION 2016 DOSSIER RESSOURCES SUJET PREMIÈRE PARTIE ÉPREUVE ÉCRITE D ADMISSIBILITÉmokzgalaxiePas encore d'évaluation
- Chapitre - 2 - Le Bus CANDocument59 pagesChapitre - 2 - Le Bus CANsid ali saidjPas encore d'évaluation
- Bus CanDocument12 pagesBus CanØûssæmã SâmsøümPas encore d'évaluation
- Diag BoxDocument20 pagesDiag BoxmaitrefouPas encore d'évaluation
- Verrouillage Des Ouvrants Infodiag159Document22 pagesVerrouillage Des Ouvrants Infodiag159mnawarPas encore d'évaluation
- 23le MultiplexageDocument9 pages23le MultiplexageNoureddine HafidPas encore d'évaluation
- Bus CANDocument4 pagesBus CANYOUSSEF EL MERABETPas encore d'évaluation
- Info IndustrielDocument79 pagesInfo Industrielhoussin unusPas encore d'évaluation
- Cours 2Document20 pagesCours 2يونس سليميPas encore d'évaluation