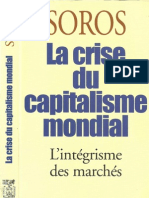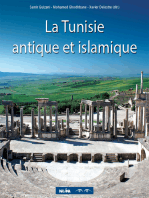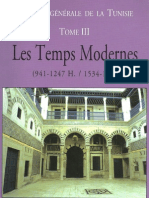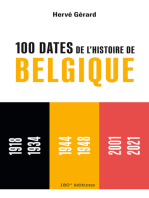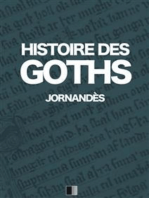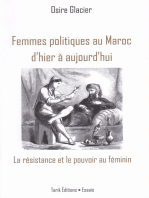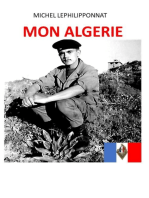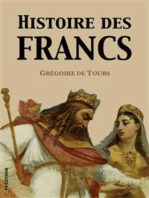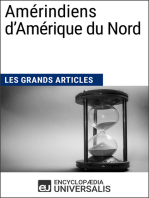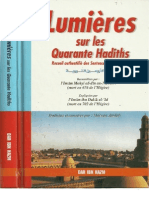Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Historia General de Tunez
Historia General de Tunez
Transféré par
RagagaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Historia General de Tunez
Historia General de Tunez
Transféré par
RagagaDroits d'auteur :
Formats disponibles
HISTOIRE GNRALE DE LA TUNISIE
TOME I
Hdi Slim Ammar Mahjoubi
K
hale
d Belkhoja Abdelmajid Ennabli
HISTOIRE GNRALE DE LA TUNISIE
TOME I
L ' a n t i q u i t
CHEZ LE MME DITEUR
MEZGHANI Ali, Lieux et non-lieu de l'identit, Tunis 1998.
MANSTEIN-CHIRINSKY Anastasia, La dernire escale, le sicle d'une
exile russe Bi^erte, Tunis 2000.
SMIDA Mongi , /lux origines du commerce franais en Tunisie, Tunis
2001.
JABI Fadhel, Les amoureux du Caf dsert (thtre), Tunis 1977.
FONTAINE Jean , Propos sur la littrature tunisienne, Tunis 1998.
KHAYAT Geroges, Sfax, ma jeunesse, Tunis 1997.
KARIM Houda, Lzardes (roman), Tunis 1999.
RAMDOM Michel, Maivlana, le Soufisme et la Danse, Postface :
Maurice Bjart, Tunis 1980.
CHEMKHI Sonia, Cinma tunisien nouveau, parcours autres, Tunis 2002
KRIDIS Noureddine, Communication etfamille, Tunis 2002
GHARBI Jalel, Le pote que je cherche lire, Lissai sur l'uvre de Michel
Deguj, Tunis 2002
Demandez le catalogue de nos publications en arabe
et en franais l'adresse suivante :
Sud ditions, service commercial
e-mail : sud.edition@planet.tn
HISTOIRE GNRALE DE LA TUNISIE
TOME I
L' ant i qui t
Hdi SLIM Ammar MAHJOUBI
Directeur de recherche Professeur Emerite des Universits
Ancien Conservateur du site de Thysdrus Ancien Directeur de l'Ecol e Normal e Suprieure
Kl j em de Tunis
Khaled BELKHODJA
Anci en Pr of es s eur l ' Uni versi t de Tuni s
Anci en Pr of e s s e ur l ' Uni versi t de Mo n c t o n - Canada
106 illustrations - 24 cartes et plans
runis et comments par
Abdelmajid ENNABLI
Directeur de recherche
Ancien Conservateur du site de Carthage
Sud di t i ons - Tunis
Sud Editions - Tunis Mars 2010
sud ,edition@planet .tn
Tous droits de reproduction, de traduction
et d'adaptation sont rservs
pour toutes les langues et tous les pays
Avant-propos de l'diteur
Il y a plus d'une trentaine d'annes un groupe de jeunes his-
toriens et archologues tunisiens, stimuls par l'Autorit nationale,
avaient publi une Histoire de la Tunisie en quatre volumes.
L'ouvrage fut bien accueilli, car il rpondait une attente ; l'en-
semble tait bien document, rigoureux, clair et bien rdig. Ce livre
aurait d faire une longue carrire mais il ne fut pas rdit et dis-
parut des librairies.
Convaincus de l'utilit d'une rdition, nous nous sommes
adresss aux auteurs, devenus pour la plupart les grands matres de
l'Histoire et de l'Archologie en Tunisie aujourd'hui. Ils accueillirent
favorablement l'ide et beaucoup acceptrent d'apporter leur
contribution ce projet.
Il est certain que, trente ans aprs sa premire publication,
l'ouvrage ne pouvait tre rdit sans les mises jour rendues nces-
saires en raison des progrs de la recherche historique. Pour ce pre-
mier volume, consacr l'Antiquit, les fouilles, notamment la cam-
pagne internationale de fouille de Carthage parraine par
l' UNESCO et les moissons annuelles de textes pigraphiques ont
clair, et parfois corrig, nos connaissances.
Notre vision du site de Carthage par exemple a chang fon-
damentalement. Aussi les auteurs ont-ils t amens autant que
ncessaire corriger et complter leurs textes.
C'est ainsi que dans ce volume les professeurs Hdi Slim
pour l'poque punique et Ammar Mahjoubi pour l'poque romaine
ont rcrit plus d' un chapitre, et ralis une vritable synthse des
travaux les plus rcents, dans les domaines de l'archologie et de
l'histoire ancienne de la Tunisie. Le professeur Khaled Belkhodja a
apport son texte initial des retouches de forme. Il a prfr, pour
cette nouvelle dition prsenter un tat de la question dans
lequel il a consign (voir p. 421) les principaux apports de la
recherche relatifs l'Antiquit tardive. Il invite ainsi le lecteur
prendre en considration les lumires nouvelles que les chercheurs
ont apportes ces dernires annes sur la situation particulire, en
Afrique, des villes du Bas-Empire.
La prsente dition se distingue aussi de l'ancienne par la
documentation illustre qu'elle propose au lecteur. Cette tche t
confie Abdelmajid Ennabli, ancien conservateur du site de
Carthage. Cent six documents photographiques, ds au talent de
Nicolas Fauqu, et relatifs la vie conomique, sociale, culturelle et
artistique, vingt-quatre cartes et plans, tous accompagns de
lgendes appropries, enrichissent le texte. Ils compltent les expo-
ss des historiens et permettent au lecteur ce contact privilgi avec
le document, matriau essentiel de la connaissance historique.
C'est donc un livre nouveau destin un large public ; il est
aussi, par ses apports indits, par sa riche iconographie et par ses
annexes un outil de travail apprciable pour les chercheurs.
M. Masmoudi
Le cadre naturel
Les conditions naturelles sont parmi les facteurs essentiels qui
dterminent les pripties de l'histoire de tout pays. Cela est parti-
culirement vident pour la Tunisie.
Ce pays occupe la partie orientale de l'Afrique du Nord et se
situe presque gale distance du dtroit de Gibraltar et de Suez. Sa
faade nord - ouverte sur le bassin occidental de la Mditerrane -
et sa faade sud - qui s'ouvre sur le bassin oriental - dveloppent
plus de 1200 km de ctes offrant des plages et des criques appr-
cies, depuis les temps les plus reculs, par les navigateurs. Si la mer
dlimite au nord et l'est les frontires du pays, on chercherait en
vain, l'ouest et au sud, quelque lment naturel qui marquerait la
limite entre le territoire tunisien et celui des pays voisins.
L e reli ef
La Tunisie est partie intgrante de l'Afrique du Nord : on y
retrouve en effet les lments du relief qui structurent celle-ci. C'est
ainsi que les deux grandes chanes de l'Atlas tellien et de l'Atlas
saharien viennent ici se rencontrer.
L'Atlas tellien s'achve au nord de la Mejerda par les Monts de
Khroumirie et les Mogods. L'Atlas saharien occupe un espace beau-
coup plus important. Depuis la valle de la Mejerda au nord et la
dpression des chotts au sud, il dveloppe une srie de massifs
10. L'ANTIQUIT
montagneux qui forment la Dorsale. Ces massifs sont dirigs sud-
ouest, nord-est et vont s'achever dans la rgion de Tunis et au Cap
Bon. Ils ne sont pas trs levs (le point culmunant, le Chambi
atteint peine 1544 m) et ne sont nulle part impntrables.
Depuis cette Dorsale on passe progressivement des terres
moins leves (hautes steppes) et une succession de plaines qui
commencent dans la rgion de Tunis et de Grombalia et occupent
tout le centre et le sud du pays. Ces vastes plaines qui s'ouvrent sur
la mer sont de temps en temps interrompues par des systmes col-
linaires, comme le Sahel, et plus souvent pas des dpressions dans
lesquelles l'coulement endogne des eaux a form au cours des
sicles des lacs sals ou sebkhas (Kelbia, Sidi Hni...)
Au niveau de Matmata au sud, affleure le vieux socle continental
africain, il prend sous l'effet de l'rosion l'aspect d'une chane de
montagne dnude et sauvage malgr sa faible altitude.
C'est son relief que la Tunisie doit cette particularit d'tre
permable aux influences extrieures, climatiques et historiques.
L e cli ma t :
Situe entre la Mditerrane et le Sahara, la Tunisie subit l'in-
fluence des masses d'air frais et humide de la premire et celle des
masses d'air chaud et sec du second. Les variations des tempra-
tures, de la pluviomtrie, de l'hydrographie et de la vgtation natu-
relle s'expliquent par cette double influence. D' autres facteurs inter-
viennent aussi, comme l'altitude et l'loignement par rapport la
mer.
Fondamentalement, ce climat est caractris par des ts chauds
et sans pluies et par des hivers froids et pluvieux. Mais dans ce
tableau trop gnral, il faut introduire beaucoup de nuances.
C'est ainsi que la moyenne des tempratures annuelles les plus
basse n'est pas dans l'extrme nord, elle est Maktar (14,2) et la
LE CADRE NATUREL 11
moyenne des tempratures les plus leves est Tozeur (21,3) au
sud mais loin de la cte. Il faut aussi corriger ces moyennes, somme
toute abstraites, en signalant que la thermomtre peut descendre
trs bas l'hiver (-9 Thala) et monter trs haut l't (+54 Kbili).
Ni Thala, ni Kbili ne profitent de l'effet modrateur de la mer, et
d'une faon gnrale la faade orientale du pays jouit, malgr des
contrastes vidents, d' un climat plutt doux.
On constate les mmes contrastes pour la pluviomtrie. Ici les
reliefs jouent un rle plus net. Les rgions les plus arroses se
situent au nord de la Mejerda (An Drahem == 1500 mm/ an
Tabarka = 1000 mm/ an).
Dans leur ensemble, les rgions situes au nord de la Dorsale
reoivent entre 400 et 600 mm par an. Nous sommes ici dans le
Tell, rgion dont les hauteurs sont couvertes de belles futaies de
chnes lige et chnes zen. De mme les cultures annuelles sont
plus rgulires et gnralement assures et l'arboriculture est pros-
pre.
Les cours d'eau oueds coulent toute l'anne avec des tiages
trs faibles certes, mais arrivent jusqu' la mer. La Mejerda, princi-
pal cours d'eau du pays (460 km de longueur), prend sa source en
Algrie 1200 m d'altitude. Elle reoit des affluents qui descendent
de l'Adas tellien et du versant nord de l'Adas saharien, et termine
son cours dans la plaine ctire de la rgion de Tunis, charriant
chaque anne des matriaux qui au cours des sicles ont modifi le
dessin de la cte. Utique qui aux poques punique et romaine tait
un port actif se trouve aujourd'hui 12 km de la mer.
Entre Le Dorsale et la dpression des chotts , la Tunisie centra-
le (haute et basse steppe) reoit entre 200 et 400 mm an. Ici la vg-
tation est moins dense ; nous sommes davantage dans le domaine
de l'alfa que dans celui de l'arbre. Les oueds qui descendent des ver-
sants sud de la Dorsale, dversent leurs eaux en priode de crues
qui peuvent tre trs fortes dans la sebhka (Kelbia et Sidi Hni).
12
L'ANTIQUIT
Exceptionnellement ces eaux atteignent la mer par Oued El Menfes
qui joint la Kelbia la mer.
Ici on cultive davantage l'orge que le bl ; l'olivier et l'amandier
sont aussi cultivs en raison de leur rsistance la scheresse.
Au sud de la dpression des chotts, la Tunisie saharienne a un cli-
mat beaucoup plus sec (100 200 mm par an) et les chaleurs de
l't, loin des ctes sont trs leves. Kbili la moyenne du mois
le plus chaud atteint 32,4 degrs alors qu' Gabs qui est sensible-
ment la mme latitude, mais situ au bord de la mer, cette moyen-
ne tombe 27,5 degrs.
C'est du reste dans cette partie orientale de la Tunisie subdser-
tique que la culture de l'olivier reste possible (Zarzis). Ailleurs seules
les sources artsiennes ont permis depuis une antiquit recule
l'existence d'oasis rputes par leurs cultures tages : le palmier
dattier, l'ombre duquel pousse l'arbre fruitier, qui son tour pro-
tge les cultures potagres.
Ces caractristiques du relief et du climat, voqus ici grands
traits semblent avoir t sensiblement les mmes au cours des
temps historiques. Il est vrai que l'arme carthaginoise utilisait les
lphants, que la Carthage romaine approvisionnait Rome en bl et
en animaux sauvages pour les jeux du cirque ; il est vrai aussi que le
dernier lion aurait t tu en Tunisie au milieu du sicle dernier. Les
forts ont du tre s'il faut croire les gographes arabes plus ten-
dues et plus denses. Mais toutes ces volutions semblent tre le fait
de l' homme plus que le fait d' un changement climatique.
C'est donc dans un cadre naturel sensiblement comparable
au ntre qu' ont vcu les hommes des poques antiques.
t
PREMIRE PARTIE
L' POQUE PUNIQUE
CHAPITRE PREMIER
Les temps prhistoriques
L es con di t i on s g n ra les
Lorsque vers le milieu du XIX
e
s., Jacques Boucher de Perthes
dcouvrit, au milieu d'ossements d'animaux appartenant des
espces disparues depuis fort longtemps, des pierres dont les
formes trop rgulires ne pouvaient avoir t faonnes par la natu-
re, il mit l'hypothse que l' homme existait depuis des centaines de
millnaires. Le monde savant se montra trs sceptique : il tait gn-
ralement admis que les premiers hommes ne remontaient pas plus
haut que les premires civilisations connues comme celles de Sumer
et de l'Egypte.
La dcouverte de Boucher de Perthes allait marquer la nais-
sance d'une science qui donnera l'histoire de l'humanit une nou-
velle dimension.
Cependant, de cette longue et obscure priode qui prcda
l'histoire, seules de rares traces subsistrent, permettant de projeter
de vagues lueurs sur l'humanit primitive. Quelques squelettes, des
ossements d'animaux ayant servi de nourriture nos premiers
anctres, des outils grossirement taills dans le silex et des gravures
16. L'ANTIQUIT
rupestres laissent quelqu peu entrevoir certains genres de vie et
certaines croyances. L'absence totale de documents crits ne permet
pas d'atteindre une plus grande prcision. Il est vident que dans ces
conditions la seule approche qu' on peut esprer concernera les
genres de vie essentiellement conditionns, d'ailleurs, par les don-
nes gographiques et climatiques. Certaines rgions dotes d' un
climat plus doux que d'autres, semblent avoir t plus tt habites.
Dans l'tat actuel de nos connaissances, l'Afrique est considre
comme le berceau de l'humanit : c'est en effet prs de Dar Es-
Salem (Soudan) que le squelette le plus ancien - vieux de deux mil-
lions d'annes parait-il - a t dcouvert. Le bassin de la Mditerra-
ne a galement fourni, de trs bonne heure, un cadre propice au
dveloppement de l'homme. La Tunisie, qui est incontestablement
un domaine privilgi de la recherche en matire d'archologie clas-
sique, offre un aussi vaste champ de prospection aux prhistoriens.
Tour tour, Giuseppe Bellucci (1875), G. Schweinfurth (1906), Col-
lignon Couillault, Paul Boudy, Jacques de Morgan, Marcel Solignac,
Etienne Dumon, Gruet, Schoumovitch, Diard, Harson, Bardin,
explorent les stations prhistoriques tunisiennes. Mais le grand
homme de la recherche prhistorique sur la Tunisie demeure le
Docteur E. Gobert qui entreprit ses premiers travaux Rdeyef
vers 1920 et dont l'inlassable activit se poursuivit sans relche clai-
rant chaque jour davantage un domaine des plus complexes.
D'autres grands savants, tels R. Vaufrey ou L. Balout, travaillant
chacun dans son secteur, contriburent leur tour nous faire
mieux connatre notre prhistoire. Depuis, la relve a t assure par
une quipe tunisienne, trs active, comprenant notamment Mouni-
ra Harbi-Riahi, Abderrazek Gragueb, Ali Mtimet et Jamel Zoughla-
mi.
Cependant, en dpit des efforts conjugus de ces minents
savants, beaucoup reste encore faire dans le domaine de la fouille
et de la recherche avant de prtendre voir clair dans la prhistoire
du pays. Car c'est peine si quelques lumires commencent suc-
cder une nuit presque totale. D' autre part, une plus grande explo-
POQUE CARTHAGINOISE
17
ration du sol nous rservera sans doute de nouvelles dcouvertes
qui, chaque instant, pourront remettre en cause plus d'une hypo-
thse. Le prhistorien, comme l'a si bien dit Charles-Andr Julien,
btit son fragile difice sur un sol mouvant. Aussi les vrits d'au-
jourd'hui ne peuvent-elles tre considres comme immuables, et
on ne peut prtendre faire davantage qu'une mise au point assez
provisoire.
Ceci dit, le premier fait frappant auquel des savants apparte-
nant diverses disciplines aboutirent aprs de longues recherches,
est que les donnes climatiques et gographiques de l'ensemble de
l'Afrique du Nord ont considrablement chang et ce, plusieurs
reprises au cours des temps prhistoriques. Il est par exemple admis
que nos premiers anctres vcurent dans une Tunisie bien diffren-
te de la ntre. Non pas que l'aspect gnral du relief ait beaucoup
chang depuis, les fluctuations de paysages n'ayant affect que des
aspects secondaires et souvent limites aux ctes, mais c'est le cli-
mat qui, tantt trs sec et tantt humide, a conditionn les zones
d'occupation humaine et les genres de vie. Au gr de ces variations,
la vie se concentrait autour des sources et points d'eau ou se dis-
persait sur de plus vastes zones. Paysages et genres de vie subis-
saient d'ailleurs largement l'influence du Sahara qui de son ct
connut de notables changements climatiques tout au long des mil-
lnaires de la Prhistoire. Il est surtout noter qu' certaines
poques, il y fit moins chaud et plus humide qu'aujourd'hui. Par-
couru par de grands oueds, le Sahara offrait l'aspect d'une vaste
steppe.
C'est dans ce contexte prcis que vcurent les chasseurs d'au-
truches et de girafes que nous reprsente l'art rupestre qui voque
galement des guerriers, des pasteurs, des agriculteurs et divers ani-
maux, comme les lphants, les hippopotames, les rhinocros, les
girafes et les autruches. Ces diverses reprsentations attestent des
conditions de vie rvolues et une grande humidit dans des rgions
aujourd'hui totalement sches. Les conditions actuelles ne se sont
en effet que progressivement tablies, partir du X
e
millnaire au
plus tt.
18.
L'ANTIQUIT
Ainsi, il n'y a rien d' tonnant ce que la Tunisie prhistorique,
subissant diverses influences, connt certaines priodes un climat
plus humide, de plus grandes prcipitations et une rosion plus acti-
ve. Tout cela se rpercutait sur la flore et au cours de multiples
investigations, on n'a pas manqu de relever des traces de vgtaux
disparus depuis longtemps (le lac Ichkeul en fournit bien des
preuves.) La faune tait galement bien plus riche que celle d'au-
jourd'hui. Le Sahara, ne jouant pas le rle de barrire qu' on lui
connut par la suite, favorisait les changes zoologiques entre
l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique. Ce n'est qu'avec le dess-
chement du Sahara que ces changes cessrent et que certaines
espces animales coupes de l'Afrique tropicale prirent l'aspect
d' une faune rsiduelle et isole. Conditions climatiques et histo-
riques se conjugurent par la suite pour en hter la disparition.
Quant aux premiers hommes, ils connurent, comme partout
ailleurs, des conditions de vie fort pnibles. Exposs toutes les
intempries, vivant dans l'inscurit la plus totale, n'obissant qu'
leur instinct de survivre, condamns de perptuels dplacements,
ils erraient, la recherche d' une nourriture incertaine et semblaient
presque perdus au milieu d'immensits vides. Ils taient trop peu
nombreux et trop isols pour entretenir des rapports fconds et
profitables. Cela explique l'extrme lenteur des progrs qui caract-
risrent leur volution au cours des ges. Il suffit de savoir, pour
s'en convaincre, qu'il fallut plus d' un million d'annes l' homme
pour passer de la technique de la pierre taille celle de la pierre
polie.
Les principales phases de la prhistoire
La prhistoire se divise en plusieurs priodes de dure fort
variable, mais de moins en moins longues au fur et mesure qu' on
se rapproche de l'histoire. C'est l'image mme du rythme des pro-
grs raliss par l' homme. L'ge le plus recul, caractris par la
fabrication d'outils en pierre taille, s'appelle le palolithique. Il
Hermaon d'El Guettar
II s'agit d'un amoncellent d'objets prhistoriques remontant plus de 40 000 ans
et constitu de pierres sphriques, de silex taills,
de dents et d'ossements d'animaux qui ont t rassembls
intentionnellement auprs d'une source. Cet amas est considr
comme l'une des premires manifestations religieuses de l'homme.
Il a t trouv dans le gisement d'El Guettar situ 20 km l'est de
Gafsa. Ce site est rput en raison de la longue occupation qu 'il a connu
travers le temps, du palolithique au nolithique.
Pierre sculpte
(civilisation capsienne)
Elle provient du gisement capsien
d'El Mekta situ proximit de Gafsa.
En calcaire tendre, de forme conique,
cette sculpture reprsente une figure
humaine. Les traits du visage ne sont
pas indiqus, mais la face porte
quelques incisions. En revanche la
chevelure, qui est longue, est
particulirement bien traite :
une frange paisse, soigneusement
coupe au-dessus du front est
associe deux lourdes masses
de cheveux descendant de chaque
ct en cachant les oreilles.
20. L'ANTIQUIT
semble que les premires traces de ce palolithique ancien soient ces
galets taills qui ont t trouvs mls des ossements de tigres et
d'lphants gants dans l'extrme sud tunisien, aux environs de
Kbili. D'autres traces aussi anciennes auraient t repres en
Tunisie centrale.
L'Acheulen (vers 300 000 100 000 avant J.-C.)
L'Acheulen qui est la dernire phase du palolithique inf-
rieur ou ancien se trouve en gnral la base des reliefs. L'industrie
de cette priode produite par l'espce dite pithcanthrope (homme-
singe) est caractrise par ces bifaces aux patines rougetres trouvs
au pied de la colline d' El Mekta, mais aussi par ceux recueillis
Rdeyef et Gafsa. On a remarqu que ces industries se trouvent
en gnral localises vers le parallle de Gafsa. Les seuls vestiges de
cette poque, trouvs ailleurs, l'ont t dans un gisement prs du
Kef, Sidi Zin, o on a pu dterminer la prsence d'animaux comme
l'lphant, le rhinocros, le zbre, la gazelle et l'antilope, ce qui
dnote un climat chaud et humide.
Le Moustrien (100 000 35 000 avant J.-C.)
Le Moustrien, civilisation du palolithique moyen, se trouve
trs troitement circonscrit au contact immdiat des sources, ce qui
laisse supposer que la Tunisie traversait alors une phase d'aridit tel-
le que les hommes cherchrent refuge prs des seuls points d'eau.
Cinq gisements sont signaler : Oued Akarit prs de Gabs ; El
Guettar prs de Gafsa ; Ain Metherchem au Nord-Ouest du Cham-
bi ; An Mrhotta prs de Kairouan et enfin Sidi-Zin.
L'outillage moustrien, essentiellement constitu de pointes et
de racloirs, forme une industrie clats qui diffre, par la technique
de la taille, de l'industrie acheulenne. Mais le gisement le plus int-
ressant provient d' El Guettar o on a trouv, prs d'une source fos-
sile, un amoncellement conique form de boules, de plus de 4000
silex et d'ossements d'animaux, rsultant de dpts successifs d' of-
POQUE CARTHAGINOISE 21
frandes au gnie de la source. Cet hermaon , datant d' environ
40 000 ans avant J.-C. est considr comme le plus vieil difice
religieux du monde.
L'Atrien (35 000 25 000 avant J.-C.)
Bir El Ater, au Nord-Est de Constantine, a donn son nom
une industrie caractristique du palolithique rcent dont les traces
couvrent toute l'Afrique du Nord depuis l'Atlantique jusqu' la val-
le du Nil. L'Atrien drive de la tradition moustrienne enrichie
d'apports nouveaux ; sa large diffusion travers toute la Tunisie tra-
duit un climat beaucoup plus clment que celui du Moustrien. En
effet, l'Atrien affleure partout, sur les croupes dnudes, sur les
dunes, sur les rivages et plus exactement dans les rgions de Tozeur,
Gafsa, Gabs, Monastir, Hergla, Bizerte etc... L'industrie atrienne
se caractrise en gros par la forme pdoncule de ses outils dont
l'auteur est l'homo-sapiens, proche de l' homme actuel.
L'Ibromaurusien (25 000 8 000 avant J.-C.)
Antrieure au IX
e
millnaire, la civilisation ibromaurusienne
se caractrise par un outillage riche en lamelles, pauvre en silex go-
mtriques. Avec le Capsien qu'il prcde, l'Ibromaurusien appar-
tient l'pipalolithique du Maghreb.
Le Capsien (7 000 4 500 avant J.-C.)
C'est ensuite le Capsien qui retient l'attention, tant il a t plus
marquant que d'autres phases comme l'Ibromaurusien. Ce Capsien
a suscit un engouement tel parmi les savants que le Docteur
Gobert n'a pas hsit parler de mirage du Capsien . C'est de
Gafsa, autrefois Capsa, qu'il tire son nom, et c'est Jean de Morgan
qui le signala le premier. La civilisation capsienne semble pourtant
venue de loin : on en a trouv des traces dans une grotte de Cyr-
naque. Il n'est pas possible, dans l'tat actuel des connaissances, de
22.
L'ANTIQUIT
prciser ses origines exactes. On pense cependant qu'elle a gagn la
Tunisie par l'est ; son aire d'expansion est assez tendue et le peu-
plement qu'elle a suscit a t particulirement dense dans la rgion
de Gafsa-Tbessa o elle a laiss de trs nombreuses traces prser-
ves de l'usure par l'asschement du climat. Il semble bien, en effet,
que la civilisation capsienne se soit droule dans un paysage trs
proche du ntre. On a galement pens que le Capsien a envahi
l'Afrique puis l' Europe et sa vogue fut telle qu' on a voulu le voir
partout, aussi bien en Espagne qu'en Egypte et mme dans l'Inde.
Il semble aujourd'hui plus raisonnable d' abandonner ces points de
vue.
Des charbons capsiens provenant d' El Mekta soumis des
analyses de laboratoire se rvlrent vieux de quelque 8 000 ans.
C'est grce au carbone 14, dont la destruction s'effectue suivant un
processus rgulier, qu' on a pu dater, avec une relative prcision, ces
tmoins de la civilisation capsienne.
Le Capsien est essentiellement caractris par les escargotires
ou rammadyat, sorte de monticules artificiels de 10 mtres de haut
et dont les dimensions fort variables atteignent parfois jusqu' 50
mtres de large et 150 mtres de long.
Ces monticules se sont forms sur l'emplacement des campe-
ments d'autrefois et par suite de l'accumulation de cendres, d'outils
divers, d'ossements humains et animaux et surtout de coquilles d'es-
cargots dont l' homme du Capsien semble avoir fait une abondante
consommation. Il y aurait peut-tre un rapport entre l'existence des
escargotires et des noms de lieux tels que : Ramada, An Babouch
etc...
On distingue sur le plan de l'outillage deux formes de Capsien :
le Capsien typique caractris par des burins et des lames bord
rabattu et le Capsien suprieur riche en formes gomtriques et
d'une manire plus particulire remarquable par la prsence de
grandes quantits de microburins qu' on a ramasss dans les cen-
taines d'escargotires qui jalonnent l'Afrique du Nord. Les
hommes, vivant exclusivement de chasse et de cueillette, en taient
encore au stade de l'conomie destructive mais on note chez eux
Outillage prhistorique
Divers types d'outils prhistoriques : a) biface du Palolithique ;
b) flches pdoncules de l'Atrien et
c) pierres tailles du Capsien. Ces derniers ont t recueillis
sur le site de El Mekta, gisement princeps de cette
priode de la prhistoire en Tunisie. Ce sont des grattoirs,
burins, grosses lames et petites lamelles tailles finement dans le silex.
Ce matriel est extrait des gisements capsiens dnomms
ramadya ou escargotires en raison de la
prsence de cendres et de coquilles d'escargots, dbris
des foyers d'occupation de ces hommes du Capsien qui ont vcu dans
la rgion de Gafsa Tbessa, proximit de points d'eau.
Haouanet
(pluriel de hanout)
C'est le nom donn des tombes
ayant la forme de chambres cubiques
creuses dans le roc et s'ouvrant sur
les parois de certaines collines. Leur
datation est encore mal assure,
s'tendant de la protohistoire la
priode punique. Leur localisation,
surtout dans le nord-est de la
Tunisie, montre une influence
venue des les mditerranennes,
en particulier de la Sicile.
24. L'ANTIQUIT
l'veil de la sensibilit artistique comme le montre, en particulier
une figurine fminine dont la chevelure encadre le front et les deux
cts du visage mais dont les traits n' ont pas t fixs.
Nolithique (4500 2000 environ avant J.-C.)
Le Nolithique ou ge de la pierre polie commence assez
tard pour la Tunisie. Traditions locales et apports extrieurs se
conjuguent pour donner au pays un nouveau visage et, ct des
formes volues du Capsien, on trouve des outils en pierre polie et
des poteries. Ce Nolithique se prolongera jusqu' l'arrive des Ph-
niciens et mme au-del puisqu'on continuera pendant longtemps
utiliser des flches en pierre et des modes de spulture nolithiques
et proto-historiques comme les mgalithes, les dolmens et les
haouanets creuss aux flancs des rocs et particulirement abondants
dans le Cap Bon. Le plus grand changement l'poque nolithique
c'est le desschement du climat qui devient peu prs ce qu'il est
aujourd'hui. Certaines espces animales comme l'hippopotame et le
rhinocros disparaissent, par contre les animaux domestiques com-
me le chien et le cheval font leur apparition.
Bien que notre connaissance des temps nolithiques demeure
incomplte, il ne semble pas que l'on puisse dater de cette poque
l'apparition d'une vraie agriculture. St. Gsell se contente, pour sa
part, d'affirmer prudemment que les indignes de l'Afrique du
Nord n' ont pas attendu la venue des Phniciens pour pratiquer l'le-
vage et l'agriculture. D'autres savants, comme G. Camps, tout en
admettant que l'agriculture nord-africaine est ancienne, hsitent la
faire remonter au Nolithique. Ils fondent leur doute sur l'absence
de graines et de plantes cultives dans les gisements nolithiques. Ils
considrent que certaines scnes de vannage ou de broyage repr-
sentes sur des peintures rupestres peuvent tout aussi bien se rap-
porter au traitement de graines sauvages que de graines de crales.
Les documents archologiques et historiques permettent unique-
ment d'affirmer, que l'agriculture apparat et commence s'organi-
ser entre la fin du Nolithique et l'poque punique. C'est une agri-
POQUE CARTHAGINOISE 25
culture protohistorique qui ne doit rien aux Carthaginois. Le pro-
blme est complexe et seules de nouvelles dcouvertes et une
meilleure connaissance du Nolithique permettront de le rsoudre.
Contentons nous donc, en attendant, d'affirmer ce qui parat acquis :
aucune certitude absolue en ce qui concerne l'existence d'une agri-
culture rellement Nolithique mais des donnes incontestables,
confirmes notamment par l'archologie et la linguistique, et mon-
trant que les autochtones de la protohistoire pratiquaient des cul-
tures antrieurement la pntration phnicienne.
Parmi les cultures les plus anciennement connues en Afrique
du Nord, on peut citer le bl dur auquel les Berbres donnent le
nom de irden. E. Laoust a montr que ce mme mot est employ
par tous les Berbres depuis l'oasis Siouah ( l'est de l'Egypte) jus-
qu'aux les Canaries. Cela prouverait l'anciennet de l'appartenance
du bl l'conomie nord-africaine. Les botanistes pensent que ce
bl tait venu d'Abyssinie, ce qui confirmerait quelque peu le point
de vue des anthropologistes qui tendent rattacher l'origine des
Berbres l'Afrique orientale. Des arguments du mme genre peu-
vent montrer que l'orge, les crales secondaires et certains fruits ou
lgumes prexistaient la conqute phnicienne. Ainsi on peut
affirmer que les fves, l'ail, les pois chiches, les melons, les courges
et les navets sont trs anciennement connus.
Les Berbres de la protohistoire ne cultivaient peut tre pas
l'olivier, mais les anciens habitants de Djerba savaient dj tirer
l'huile de l'olivier sauvage et le vin des fruits du jujubier. L'amandier,
le figuier, la vigne et le palmier sont aussi trs anciens. De mme
l'utilisation de la houe, de l'araire et de certains autres instruments
de travail de la terre ne semble pas tre due une quelconque
influence trangre.
Parmi les vestiges les plus intressants du Nolithique et de la
protohistoire nous trouvons les gravures rupestres, tantt creuses
au silex et reprsentant des sujets aux traits rguliers, tantt gros-
sirement pointilles et trs schmatiques. Certains animaux aux-
quels on semble avoir vou un culte ont t plus volontiers repr-
sents que d'autres. Les quelques portraits humains qu' on y trouve
26.
L'ANTIQUIT
sont gnralement ceux de personnages vtus de peaux de btes et
portant l'tui phallique. Dans certains cas, ils ont la tte couverte
d' une couronne de plumes, ou bien ils portent des colliers et des
bracelets ou sont arms d'arcs, de flches et de boomerangs.
Les ufs d' autruche furent utiliss comme bouteilles, coupes
et parures depuis le Capsien. Souvent ils prsentent aussi un dcor
grav ou peint fait de motifs gomtriques et parfois, comme
Redeyef, de motifs figuratifs.
De cette mme poque semblent dater des poteries de factu-
re certes mdiocre mais tmoignant d' un certain souci esthtique et
quelques statuettes d'aspect primitif.
Au total nos connaissances sur les modes de vie, les croyances,
les gots et la production de cette poque demeurent bien vagues.
Les Berbres
On dispose de ressources plus faibles encore quand il s'agit
d'tudier les hommes qui habitrent notre pays avant l'arrive des
Phniciens. Quelle que soit la priode de la prhistoire laquelle
nous tentons de nous placer pour dgager des donnes prcises
nous nous heurtons de srieux obstacles. On a beaucoup de pei-
ne tirer la moindre conclusion claire de toutes les tudes,
anciennes ou rcentes, consacres ce difficile problme. Il est
cependant admis que les Berbres ne sont, l'origine, que des tran-
gers venus, vers le Nolithique, se fixer dans un pays jusqu'alors
peupl d' hommes sur lesquels nous ne possdons presque pas de
renseignements sinon qu'ils ont t mtisss d'lments plus ou
moins ngrodes vers l' poque capsienne. L' hypothse la plus vrai-
semblable, dans l'tat actuel des tudes, considre les Berbres com-
me une race d' hommes proto-mditerranens analogues aux popu-
lations mditerranennes actuelles d' Orient ou d' Europe. Apparus
au VIII
e
millnaire, ils sont les auteurs de la civilisation capsienne.
Toutefois c'est l' Orient qui semble avoir jou le rle principal pour
ces Berbres dont la langue se rattache au groupe chamito-smi-
tique du Proche-Orient. Leur nom de Berbres (ou Barbares), leur
POQUE CARTHAGINOISE 27
a t donn par les Grecs et les Romains qui avaient l'habitude de
qualifier ainsi tous les trangers leur civilisation.
Les peuples anciens les appelaient aussi les Libyens. Ce nom
semble driver du mot gyptien Lebu utilis ds le XIII
e
s. avant
J.-C. pour dsigner un peuple africain, puis tendu par les Grecs
tous les Berbres.
Plus tard, seuls les habitants de l'Afrique du Nord-Est conser-
vrent ce nom avant de devenir les Afri des Latins, et leur pays
l'Africa. Cependant, comme l'a not G. Camps, il se peut que le vri-
table nom du peuple berbre provienne de la racine MZG ou MZK
qui se retrouve dans les noms des Mazices, Mazaces, Mazazeces des
Romains, Maxyes d' Hrodote, Mazyes d'Hecate, et Meshwesh des
gyptiens. Il semble ainsi que les Imuzagh de l'ouest du Fezzan, les
Imagighen de l'Air, les Imazighen de l'Aurs, du Rif et du Haut
Atlas ne soient que des survivances d' un mme nom ancien donn
aux Berbres.
Avec la formation de peuples, puis de royaumes berbres, les
distinctions et les nuances se multiplient chez les auteurs anciens.
C'est ainsi que les Berbres, sujets de Carthage, conservrent le
nom de Libyens ; ceux du Maghreb central furent appels Numides,
et ceux du Maroc Maures. Dans le Sud de ces pays vivaient des Ber-
bres appels Gtules. Cependant certains auteurs parlent de Pha-
rusiens au Sud du Maroc, de Garamantes au Fezzan.
Les uns et les autres semblent avoir parl une langue commu-
ne qui est probablement l'origine des dialectes berbres modernes
et qui semble tre de la mme famille que l'gyptien ancien.
D'ailleurs l'Afrique du Nord de cette poque a subi l'influence de
l'Egypte pharaonique qui fut un des premiers berceaux de la civili-
sation. Ce fait peut tre mis en rapport avec les multiples tentatives
de pntration libyenne en gypte commences ds 3300 avant
J.-C. et qui aboutirent la conqute du Delta vers 950.
Il semble enfin que notre pays fut, au lendemain du Noli-
thique, en relation avec la Sicile, la Sardaigne et mme le Sud de
l'Italie. C'est par ces relations que l'on explique la diffusion au Cap
Bon de ces haouanets qui taient connus en Sicile et en Sardaigne
28.
L'ANTIQUIT
depuis l'ge du bronze. De mme les dolmens de la rgion de l'En-
fida et du Cap Bon seraient venus d'Italie et d' Orient avec un relais
Malte. On a not galement certaines similitudes entre la cra-
mique et la poterie peinte de ce pays et celles de l'Italie de l'ge du
bronze et du fer.
En dfinitive malgr ces contacts, ces influences et certains
progrs rels, la Tunisie, la veille de l'histoire, demeure par son
conomie et sa civilisation un pays modeste et quelque peu attard.
L'arrive des Phniciens vers la fin du second millnaire va incon-
testablement hter son volution. Il faut d'ailleurs prciser que seuls
de rares endroits privilgis favorisrent, au dbut de l'histoire, le
dveloppement de brillantes civilisations. Il s'agit essentiellement
des valles des grands fleuves subtropicaux qui, grce leur fertili-
t exceptionnelle, avaient procur aux hommes, en plus de leur
nourriture indispensable, une marge de confort assez large stimu-
lant toutes sortes de progrs.
CHAPITRE II
Les Phniciens et la fondation
de Carthage
Les chelles phniciennes
La Tunisie tait encore dans sa phase protohistorique et vivait
donc l'cart des grands courants de la civilisation mditerranen-
ne, lorsque vers la fin du XII
e
s. avant l're chrtienne, les premiers
Phniciens vinrent s'y installer.
Si les nouveaux venus sont relativement bien connus, les condi-
tions et les tapes de leur installation demeurent, par contre, obscures.
Ils paraissent avoir fond leur plus ancienne colonie, Utique, vers
1101 avant J.-C. L'absence de donnes chronologiques prcises nous
empche d'avancer des dates pour leurs divers autres tablissements.
On peut cependant admettre que, ds cette poque lointaine, les Ph-
niciens avaient tabli un rseau de stations et d'escales le long des
rivages tunisiens afin de pouvoir relcher chaque soir aprs une ta-
pe de quarante kilomtres environ. Ces abris concidaient sou-
vent avec des points d'eau o ils pouvaient se ravitailler et en mme
temps rparer leur navire, ou se rfugier en cas de tempte.
Pour ces grands navigateurs doubls de commerants habiles,
la Tunisie ne constituait pas une fin en soi. Rien de prime abord, ne
pouvait les y attirer. Le sous-sol n'tait dot d' aucun mtal prcieux,
et si le sol tait riche de possibilits, il tait exploit d' une manire
si rudimentaire qu'il ne livrait encore aucun produit agricole sus-
30. L'ANTIQUIT
ceptible de les intresser au point de les faire venir d'aussi loin. En
fait, l' Espagne tait le but ultime de cette aventure phnicienne en
Mditerrane occidentale. Le pays de Tartessos, vritable Eldorado
du monde antique, fournissait, en abondance, l'tain et le cuivre
dont le transfert en Orient constituait une des bases de la richesse
phnicienne. Les rivages de l'Afrique du Nord taient providentiels,
parce que, d' une part ils rendaient l'accs l' Espagne singulire-
ment facile en supprimant les alas de la navigation en haute mer,
une poque o on ne pratiquait que le cabotage, et d'autre part, ils
permettaient de surveiller et de contrler la route du mtal prcieux.
Le site d'Utique, se trouvant mi-chemin entre le point de
dpart et le point d'arrive de ce long parcours eut le privilge de
susciter le premier grand tablissement phnicien en Tunisie. Cette
grande cit antique ne cessera de jouer un rle important que le jour
o la Medjerda aura entirement combl ses ports de nombreuses
alluvions qui modifieront le paysage ctier de toute la rgion.
Elissa et la fondation de Carthage
Carthage ne devait voir le jour que de nombreuses annes
aprs Utique. Plus jeune galement qu' Hadrumte, semble-t-il, elle
est plus vieille que Rome, puisque divers textes indiquent qu'elle a
t fonde en 814 avant J.-C.
Son site est trs avantageux, car il se trouve dans un golfe
ouvert sur le dtroit qui unit les deux bassins, occidental et orien-
tal, de la Mditerrane. D' autre part, des lagunes sparent la zone
de Carthage du continent et lui assurent une certaine scurit
contre les attaques pouvant venir de l'intrieur. La tradition place,
d'ailleurs, un premier tablissement, phnicien, antrieur Cartha-
ge et sur son emplacement mme. Dans l'tat actuel des fouilles
archologiques ce fait ne peut tre confirm. Pendant longtemps
on s'est fond sur l'archologie qui n'avait pas fourni de documents
antrieurs la deuxime moiti du VIII
e
s., pour avancer la date de
la fondation de la cit la deuxime moiti du VIII
e
s. ou au dbut
du VIP s. Mais les dcouvertes rcentes tendent confirmer la date
de 814 avant J.-C.
POQUE CARTHAGINOISE
31
En ce qui concerne les origines et les circonstances de la fon-
dation de Carthage, nous disposons de plusieurs textes anciens,
mais la ralit s'y mle troitement la lgende. Les rcits les plus
circonstancis nous rapportent que le roi de Tyr avait institu com-
me hritiers son fils Pygmalion et sa fille Elissa. Celle-ci, carte du
trne au profit de son frre, pousa Acherbas, prtre de Melquart
et, de ce fait, second personnage du royaume aprs le souverain.
Acherbas tait de surcrot immensment riche. Ses richesses ne tar-
drent pas veiller la convoitise du jeune roi Pygmalion qui, dans
l'espoir de s'en emparer, se dbarrassa d'Acherbas en le tuant. La
belle Elissa conut contre son frre une haine implacable. Elle dci-
da de fuir en compagnie de quelques puissants citoyens qui avaient
accumul contre Pygmalion autant de haine que sa propre sur.
Celle-ci dcida d'agir avec prudence : elle informa son frre de son
dsir de s'installer chez lui et de quitter la maison de son mari qui
lui rappelait trop son triste deuil. Pygmalion s'empressa d'accepter
dans l'espoir de voir arriver en mme temps que sa sur l'or pour
lequel il n'avait pas hsit tuer son beau-frre. Il mit la disposi-
tion d'Elissa de fidles serviteurs, chargs de l'aider transporter ses
biens. Le soir, Elissa fit embarquer ses biens, gagna la haute mer et
l elle obligea les serviteurs du roi jeter dans les flots des sacs
pleins de sable leur faisant croire qu'ils renfermaient la fortune
d'Acherbas. Elle manuvra ensuite si habilement que les serviteurs
se crurent menacs des plus cruels supplices s'ils retombaient sous
la main de leur redoutable matre qui n'avait pas hsit tuer un
proche parent pour s'emparer de ces mmes richesses qu'ils
venaient de jeter la mer. Ils n'eurent alors rien de plus press que
d'accompagner Elissa dans sa fuite. Ils ne tardrent pas tre
rejoints par tous ceux qui dsiraient fuir et qui taient au courant du
projet d'Elissa. Aprs un sacrifice Melqart, le convoi se dirigea
vers Chypre. Dans cette le, les fugitifs embarqurent avec eux le
grand prtre de Junon-Astart ainsi que quatre-vingts jeunes filles,
enleves au moment o elles venaient sur le rivage pour offrir leur
virginit Vnus et se constituer une dot, comme c'tait la coutu-
32. L'ANTIQUIT
me Chypre. Cette opration tait destine procurer des femmes
aux jeunes gens parmi les fugitifs phniciens et une abondante pro-
gniture leur future ville.
Aprs un long priple, les Phniciens dbarqurent sur le site
de Carthage o ils ne tardrent pas tablir de bonnes relations avec
les autochtones. Les coutumes locales interdisaient l'acquisition par
les trangers de terrains plus vastes qu'une peau de buf. Elissa
dcoupa la peau en lanires si minces qu'elles suffirent cerner les
plus vastes espaces. Elle russit, grce cette ruse, tourner la loi
et avoir autant de terrain qu'elle voulait.
Il ne restait plus alors qu' fonder la ville pour laquelle ces
Phniciens taient venus de si loin. C'tait l'acte le plus important
que l'on pt accomplir dans un monde antique domin par la super-
stition. Les origines de Rome ou d'Athnes ont, selon les Anciens,
continuellement pes sur le destin de ces grandes mtropoles, et le
premier acte dans la fondation d'une ville est toujours considr
comme un prsage.
Les premiers travaux de fondation de la nouvelle colonie
mirent au jour une tte de buf, symbole d'une vie de labeur et de
servitude que ne souhaitaient ni Elissa ni ses compagnons. Ils creu-
srent le sol plus loin et dterrrent une tte de cheval, prsage d' un
destin belliqueux et puissant qui correspondait aux vux des fon-
dateurs. Le choix se fixa donc sur ce deuxime emplacement.
Cependant Hiarbas, roi autochtone, bloui par l'clatante
beaut et la vive intelligence d'Elissa, voulut l'pouser et dclara aux
Carthaginois qu'il leur ferait la guerre si l'illustre princesse lui refu-
sait sa main. Prvenue des intentions d'Hiarbas, Elissa se trouva fort
embarrasse, partage qu'elle tait entre le dsir de demeurer fidle
la mmoire de son premier mari et le souci d'pargner sa jeune
patrie les dures preuves d'une guerre qui pourrait lui tre fatale.
Elle dcida nanmoins d'accepter la proposition d'Hiarbas et
ordonna ses hommes d'entamer les prparatifs de la crmonie de
mariage. Quand tout fut prt, elle fit dresser un bcher pour effacer
par un dernier sacrifice le souvenir de son ancien mari ; puis, aprs
avoir immol de nombreuses victimes, elle monta sur le bcher et
se jeta dans le feu aprs avoir dclar qu'elle allait rejoindre son
POQUE CARTHAGINOISE 33
poux comme le voulaient ses compatriotes. Ce geste lui valut
d'tre, par la suite, honore comme une divinit.
Plus tard, le pote latin Virgile l'associant Ene, en fit une
hrone de l' Enide sous le nom de Didon. Ce nom semble d aux
Libyens pour les nombreuses prgrinations d'Elissa. Il semble
signifier en langue punique femme virile , voire meurtrire de
Bal , gnie protecteur du bien , ou celle qui donne .
Virgile situe ainsi son histoire longtemps avant la date tradi-
tionnelle de la fondation de Carthage et ceci, dans le but de rendre
possible la rencontre entre les deux personnages, impliqus dans la
fondation des deux villes destines se disputer l'hgmonie du
monde mditerranen.
Lgende et ralit
En tout cas, le premier rcit de la fondation de Carthage
semble s'tre constitu dans un milieu culturel grec ou carthaginois
hellnis. Ce rcit, en dpit de son caractre lgendaire, contient un
certain nombre de donnes historiques telles que l' importance du
culte vou Melqart Tyr, l'existence d' une aristocratie carthagi-
noise originaire de Tyr et la mention du lieu appel Byrsa.
Cependant le recours la ruse de la peau de buf semble
reposer sur un jeu de mots : Byrsa , signifiant peau de buf en
grec, existait en phnicien mais avait un sens tout fait diffrent
(forteresse ?).
De mme, l'pisode de la tte de cheval dterre lors des tra-
vaux de fondation et considre comme un bon prsage semble
avoir t invent aprs coup et inspir par la prsence sur les mon-
naies carthaginoises d' une tte de cheval. En tout cas, on peut pen-
ser que, malgr la lgende, qui entoure sa fondation, Carthage est
due l'initiative de Phniciens venus de Tyr. Plusieurs facteurs se
conjugurent pour les pousser raliser cette fondation : attrait des
mtaux prcieux d' Espagne sur des commerants ; pression dmo-
graphique Tyr ; pression tyrannique des Assyriens ; avantage du
site...
34.
L'ANTIQUIT
Aucun lment ne permet de confirmer qu'Elissa, la sur de
Pygmalion, ait particip la fondation de Carthage. Cette ville au
nom prestigieux (Qart Hadasht signifie capitale nouvelle) connut
des dbuts assez modestes.
Longtemps, tout comme Utique et les autres comptoirs ph-
niciens, elle vcut sous la dpendance de Tyr, lui payant des dmes
et faisant des offrandes au temple d'Hrakles (Melqart). L'archolo-
gie, pour sa part, confirme des liens troits avec l'Orient et l'Egyp-
te (poteries d' Orient et divers bijoux et amulettes d'Egypte).
Mdaillon en terre cuite.
Muse de Carthage
Ce mdaillon trouv dans la ncropole punique de Carthage,
reprsente un cavalier arm d'une lance et d'un
bouclier. Sont reprsents galement un
chien, une fleur de lys ainsi que le disque solaire
et le croissant lunaire.
VI
e
s. av. J.-C.
CHAPITRE III
Formation de l'empire carthaginois
et conflit avec les Grecs
L'empire carthaginois
Grce sa position avantageuse et l'esprit d'entreprise de sa
puissante aristocratie reprsente par la famille des Magons, Car-
thage ne tarda pas se dvelopper.
Favorise par sa position, aurole de ses prestigieuses ori-
gines, servie par des hommes politiques de grande valeur comme
Malchus et les Magonides, Carthage, demeure l'cart des grands
cataclysmes qui secourent l' Orient et les cits phniciennes, profi-
ta du dclin de Tyr (qui n'chappa aux Babyloniens que pour
retomber sous la coupe des Perses) et recueillit l'hritage impres-
sionnant de la malheureuse mtropole. Non seulement elle se tailla
un immense empire maritime en Mditerrane occidentale, en
regroupant sous son hgmonie toutes les cits phniciennes d' Oc-
cident, chose que Tyr n'a jamais russi raliser en Orient, mais elle
s'assura l'exclusivit du transit vers l' Orient. En mme temps, elle
amora un mouvement d' expansion appuy par une inlassable
action militaire et diplomatique en vue d' occuper des positions stra-
tgiques un peu partout en Mditerrane occidentale, ce qui tait de
nature favoriser le dveloppement de son commerce.
36.
L'ANTIQUIT
Elle prit pied d'abord en Sicile : en croire Thucydide, l'ins-
tallation des Phniciens dans cette le aurait t antrieure celle des
Grecs. Ceux-ci, arrivs plus tard, n'avaient fait que refouler les Ph-
niciens vers l'ouest de l'le o ils auraient conserv simplement une
mince frange ctire. Si l'archologie confirme la prsence des Ph-
niciens ds le VIP s. Moty et dans d'autres endroits de l'ouest de
l'le, aucune trace, par contre, n'a t trouve dans l'est ou dans le
sud-est de la Sicile qui soit de nature prouver que les Phniciens
s'y taient installs avant les Grecs. On est donc oblig de douter de
l'affirmation de Thucydide tant que les fouilles n'auraient pas mis au
jour un niveau phnicien au-dessous du niveau grec.
A la fin du VI
e
s., Carthage s'installa en Sardaigne. Les dcou-
vertes archologiques le prouvent bien ; et il serait prudent de rete-
nir cette date plutt que celle plus lointaine de 654 avant J.-C. que
nous donne la tradition mais que rien ne confirme.
C'est vers la mme poque, galement, qu'elle s'installe aux
Balares (Ibiza) et au sud-est de l'Espagne. Les Phocens qui avaient
fond Massalia (Marseille) vers 600 avant J.-C. et qui connurent la
plus rapide des ascensions, se prsentaient comme de srieux rivaux
des Carthaginois. Puissants militairement et conomiquement grce
un commerce florissant, ils s'installrent en Corse et tentrent
d'essaimer en Mditerrane. Ils se heurtrent Carthage qui stoppa
brutalement leur expansion la suite de la fameuse bataille d'Alalia
(535). Chasss de Corse, ils furent aussi limins d'Espagne et se
confinrent au seul golfe du Lion.
Ainsi, la fin du VI
e
s. avant J.-C., la puissance carthaginoise
s'tendait sur toutes les colonies phniciennes d'Afrique, depuis la
Tripolitaine jusqu' l'Atlantique, et avait des points stratgiques en
Sicile, en Sardaigne, en Corse, aux Balares et en Espagne. Sa posi-
tion tait renforce par un trait d'alliance qu'elle avait sign avec les
trusques, une autre puissance de l'poque.
Cependant, dans cette politique d'expansion militaire et co-
nomique, tendant lui assurer l'exclusivit du commerce en Occi-
38.
L'ANTIQUIT
dent, Carthage finit par se trouver face face avec son premier
grand rival mditerranen : les Grecs.
La bataille d'Himre et ses consquences
L'expansion carthaginoise se heurte donc aux Grecs et un
long conflit se dveloppa pendant plusieurs annes avant de dg-
nrer en choc sanglant qui mit aux prises les deux puissances en
Sicile, le jour mme, semble-t-il, o la marine grecque affrontait cel-
le des Perses Salamine.
Les Grecs parlrent d' une arme carthaginoise de 300 000
hommes, habitus qu'ils taient parler de hordes barbares .
Pour la critique moderne, les effectifs carthaginois, composs essen-
tiellement de Libyens, de Corses, d'Ibres et de Sardes et comman-
ds par le Magonide Amilcar, ne dpassaient gure 30 000 hommes.
en croire les sources grecques cette expdition se solda par une
vritable catastrophe militaire, l'arme et la flotte carthaginoises
ayant t quasiment ananties par Glon prs d' Himre en 480
avant J.-C.
Dans le mme temps, les Grecs triomphaient Salamine et les
deux vnements furent lis et interprts comme le symbole du
triomphe des lumires sur les forces de la barbarie. Les Grecs,
imbus de la supriorit de leur civilisation et griss par l' importan-
ce de leurs succs en Occident et en Orient, exagrrent, bien
entendu, leur triomphe et eurent l'impression de vivre un moment
exaltant. Mais, mme si la dfaite d' Himre n' eut pas sur Carthage
les consquences catastrophiques qu' on s'est plu mettre en relief,
elle n' en constitua pas moins un tournant dans son histoire.
La main mise de plus en plus grande des Grecs sur les deux
bassins de la Mditerrane qui eurent tendance se fermer au com-
merce punique, entrana des changements affectant un grand
nombre de secteurs. La transformation la plus importante semble
tre une austrit draconienne qui caractrisa le mode de vie des
Carthaginois cette poque. Les archologues ont t frapps par
Sarcophage du Prtre
Muse de Carthage
Sarcophage statue dit du Prtre
trouv dans un caveau de la ncropole punique de Carthage.
Le couvercle, double pente, est sculpt en haut-relief
le personnage reprsente probablement un prtre appartenant
l'aristocratie carthaginoise.
Vtu d'une longue tunique sacerdotale, son visage, encadr d'une
chevelure et d'une barbe, dgage une expression de srnit
majestueuse. La main gauche, qu 'on ne voit pas sur la photographie,
tient une boite encens.
La main droite est leve en signe de bndiction. Ce sarcophage
en marbre blanc, trouv en compagnie d'un autre sarcophage (voir p. 84)
reprsentant une prtresse, illustre travers l'art, les changes fructueux que
Carthage entretenait avec le monde grec.
L'uvre est probablement grecque, mais le destinataire est bien carthaginois.
(Fin du IV' - dbut du III
e
s. av. J.-C.)
40. L'ANTIQUIT
la pauvret relative des tombes carthaginoises du V
e
s. o les objets
imports comme les cramiques corinthiennes ou attiques et autres
objets gyptiens deviennent assez rares.
Le got du luxe semble avoir t banni et les riches donnrent
mme l'exemple : des lois somptuaires limitrent le faste des noces
et on rglementa les dpenses des funrailles. Mme les bijoux fabri-
qus sur place sont rares dans les tombes de cette poque. Cet effort
d'austrit n'pargna pas le domaine religieux, et on constate que
monuments et offrandes perdent de leur faste et de leur richesse.
D' autre part, son isolement et le tarissement de son commer-
ce posaient Carthage de graves problmes de ravitaillement : elle
ne recevait plus certaines denres indispensables sa vie. Pour se
procurer tout cela et, en mme temps, rorganiser ses forces et
ventuellement faire face de probables assauts grecs, Carthage se
mit en devoir de conqurir un arrire-pays qui correspond en gros
au territoire tunisien actuel.
Cette conqute se fit au prix de durs combats avec les autoch-
tones, mais dota l'aristocratie carthaginoise de vastes domaines agri-
coles. Dion Chrysostome, voquant plus tard ce phnomne, parla
de transformation des Carthaginois, de Tyriens qu'ils taient, en Africains .
Ces multiples difficults avec les Grecs et l'isolement qui en
rsulta poussrent Carthage chercher de nouveaux dbouchs et
intensifier son commerce avec les populations primitives dans le
temps mme o ses importations de produits grecs ou gyptiens se
rarfiaient. Elle entendait consacrer les profits tirs de ce nouveau
commerce refaire les bases de sa puissance. En effet, les Cartha-
ginois changrent avec les peuples primitifs des objets fabriqus
sans grande valeur contre d'importantes quantits de mtal prcieux
ou de l'ivoire. Hrodote nous a dcrit le procd pittoresque que les
Carthaginois utilisaient dans ce commerce fort lucratif : ils descen-
dent leurs marchandises et les rangent le long du rivage puis, aprs
avoir fait beaucoup de fume, ils remontent sur leurs vaisseaux ; les
autochtones avertis par la fume viennent apprcier la marchandise,
dposent la quantit d'or qui leur parat correspondre la valeur de
POQUE CARTHAGINOISE 41
/
la marchandise propose, puis s'en vont. Si cette quantit d' or parat
satisfaisante aux Carthaginois, ils l' emportent et s'en vont aprs
avoir laiss la marchandise aux autochtones, sinon ils attendent de
nouvelles offres. Personne ne touche rien avant l'accord total des
deux parties. La plus grande loyaut semble avoir prsid ce pro-
cd de troc muet qui s'est d'ailleurs prolong sur la cte africaine
jusqu'au XIX
e
s. L' enjeu tait si considrable que nul n'eut song
tricher.
Les priples de Hannon et de Himilcon
C'est la recherche de tels profits, la fois considrables et
faciles, que Hannon entreprit vers le milieu du V
e
s. un fameux
priple dont il a dcrit les tapes et dont les Grecs nous ont conser-
v une traduction.
Relation de Hannon, roi des Carthaginois, sur les contres libjques au
del des colonnes d'Hracls, qu'il a ddie dans le temple de Kronos et dont voi-
ci le texte :
1-11 a paru bon aux Carthaginois qu 'Hannon navigut en dehors des
Colonnes d'Hracls et fondt des villes liby-phniciennes. Il navigua donc,
emmenant 60 vaisseaux 50 rames, une multitude d'hommes et de femmes, au
nombre d'environ 30 000, des vivres et d'autres objets ncessaires.
2- Aprs avoir pass le long des Colonnes et avoir navigu au del pen-
dant deux jours, nous fondmes une premire ville que nous appelmes Thj-
miatrion ; au-dessous d'elle tait une grande plaine.
3- Unsuite, nous dirigeant vers l'Occident, nous parvnmes au lieu dit
Soloeis, promontoire libyque couvert d'arbres.
4- A\yant tabli l un sanctuaire de Posidon, nous navigumes dans la
direction du soleil levant pendant une demi-journe aprs laquelle nous arri-
vmes une lagune situe non loin de la mer, couverte de roseaux abondants et
levs ; des lphants et d'autres animaux, trs nombreux y paissaient.
42. L'ANTIQUIT
5- Aprs avoir dpass cette lagune et navigu pendant unejourne, nous
fondmes sur la mer des colonies (,nouvelles?) appeles le Mur Carien, Gytt,
Ara, Melita et Arambys.
6- tant partis de l, nous arrivmes au grandfleuve Lixos qui vient de
la Libye. Sur ses rives, des nomades, les Lixites faisaient patre des troupeaux.
Nous restmes quelque temps avec ces gens, dont nous devnmes les amis.
7- Au-dessus d'eux, vivaient des Ethiopiens inhospitaliers, habitant une
terre pleine de btes froces, traverse par des grandes montagnes, d'o sort, dit-
on, le Lixos. On dit aussi qu'autour de ces montagnes vivent des hommes d'un
aspectparticulier, les Troglodytes ; les Lixites prtendent qu'ils sontplus rapides
la course que des chevaux.
8- Ayant pris des interprtes chez les Lixites, nous longemes le dsert,
dans la direction du Midi, pendant un jour. Alors nous trouvmes, dans l'en-
foncement d'un golfe, une petite le, ayant une circonfrence de cinq stades ; nous
l'appelmes Cern et nous y laissmes des colons.
D'aprs notre voyage, nous jugemes qu'elle tait situe 1'opposite de
Carthage. Car il fallait naviguer autant pour aller de Carthage aux Colonnes
que pour aller des Colonnes Cern.
9- De l, passant par un grand fleuve, le Chrts, nous arrivmes un
lac qui renfermait trois les plus grandes que Cern. Variant de ces les, nous
fmes un jour de navigation et arrivmes au fond du lac que dominaient de trs
grandes montagnes pleines d'hommes sauvages, vtus de peaux de btes qui, nous
lanant des pierres, nous empchrent de dbarquer.
10- De l, nous entrmes dans un autre fleuve, grand et large, rempli de
crocodiles et d'hippopotames. Puis nous rebroussmes chemin et nous retour-
nmes Cern.
11- Nous navigumes de l vers le Midi, pendant douze jours, en lon-
geant la cte toute entire occupe par des Ethiopiens qui fuyaient notre
approche. Ils parlaient une langue incomprhensible, mme pour les Lixites qui
taient avec nous.
12- Le dernier jour nous abordmes des montagnes leves couvertes
d'arbres dont les bois taient odorifrants et de diverses couleurs.
13- Ayant contourn ces montagnes pendant deuxjours, nous arrivmes
dans un golfe immense, de l'autre cte duquel il y avait une plaine ; l nous
vmes, la nuit, des feux s'levant de tous cts par intervalles avec plus ou moins
d'intensit.
POQUE CARTHAGINOISE 43
17- A partir de l, nous longemes, pendant trois jours, des flammes, et
nous arrivmes au golfe nomm la Corne du Sud. Dans l'enfoncement tait une
le, semblable la premire, contenant un lac, l'intrieur duquel, il y avait une
autre le, pleine d'hommes sauvages. Les femmes taient de beaucoup les plus
nombreuses. Elles avaient le corps velu et les interprtes les appelaient gorilles.
Nous poursuivmes des mles, sans pouvoir en prendre aucun, car ils taient
bons grimpeurs et se dfendaient. Mais nous nous emparmes de trois femmes
mordant et gratignant ceux qui les entranaient ; elles ne voulaient pas les
suivre. Nous les tumes et nous enlevmes leur peau que nous apportmes
Carthage. Car nous ne navigumes pas plus avant, faute de vivres.
Ce texte a t diversement comment par les nombreux
savants qui ont eu l'examiner. Il semble acquis qu'il ait t origi-
nellement falsifi par Hannon lui-mme qui ne voulait communi-
quer aucune donne prcise sur la fameuse route de l'or.
Il n'a probablement publi que ce qui tait de nature flatter
l'immense orgueil qu'avaient retir les Carthaginois de cette lointai-
ne expdition sans toutefois compromettre l'exclusivit de l'accs
une zone prodigieusement enrichissante. Dans ces conditions, de
nombreuses identifications de lieux demeurent hasardeuses et les
chiffres de navires ou de passagers sont fortement sujets caution.
D' autre part, si certains historiens admettent que Hannon par-
vint jusqu'au Golfe de Guine en vue du volcan Cameroun, beau-
coup tendent limiter dans l'espace la porte de cette expdition.
Les prochaines annes pourraient nous apporter de nouvelles
lumires concernant ce fameux priple.
A la mme poque, rpondant aux mmes proccupations
conomiques, un autre Carthaginois, Himilcon, a explor la cte
atlantique de l' Europe de l'Ouest la recherche de l'tain et de l'ar-
gent. Il semble que ce deuxime priple ait conduit les Carthaginois
jusqu'aux les britanniques.
Ces efforts gigantesques entrepris dans les divers domaines de
l'conomie carthaginoise et les changements survenus dans la vie
sociale, religieuse et politique donnrent Carthage un aspect nou-
veau et la hissrent au rang de grande puissance mditerranenne.
44. L'ANTIQUIT
14- Aprs avoir fait provision d'eau, nous continumes notre navigation
le long de la terre pendant cinq jours, au bout desquels nous arrivmes un
grand golfe que les interprtes nous disent s'appeler la Corne de l'Occident.
Dans ce golfe se trouvait une grande le et, dans l'le, une lagune, qui renfermait
une autre le. Y tant descendus, nous ne vmes, le jour, qu'une fort, mais, la
nuit, beaucoup de feux nous apparurent et nous entendmes des sons de fltes,
un vacarme de cymbales et de tambourins et un trs grand bruit, la peur nous
prit et les devins nous ordonnrent de quitter l'le.
15- Nous partmes donc en hte de ce lieu, et nous longemes une contre
embrase pleine de parfums ; des ruisseaux de flammes sortaient et venaient se
jeter dans la mer. Tm. terre tait inaccessible cause de la chaleur.
16- Saisis de crainte, nous nous loignmes rapidement. Pendant quatre
journes de navigation, nous vmes, la nuit, la terre couverte de flammes ; au
milieu tait un feu lev, plus grand que les autres et qui paraissait toucher les
astres. Mais le jour, on reconnaissait que c'tait une trs grande montagne appe-
le le char des dieux.
Priples d'Hannon et d'Himilcon
CHAPITRE IV
L'apoge de Carthage
et le premier conflit avec Rome
Battue par les Grecs, carte de la Mditerrane orientale, Car-
thage avait russi rtablir une situation chancelante et, grce la
nouvelle orientation de son empire et de son conomie, elle revint,
peu peu, en surface et commena de nouveau faire figure de
grande puissance sur l'chiquier de la politique mditerranenne.
Exploitant les querelles entre les cits grecques, elle essaya de recon-
qurir les positions qu'elle avait perdues en Sicile et parvint
contrler une bonne partie de l'le malgr l'hostilit de Denys de
Syracuse et de ses successeurs qui tentrent plusieurs reprises de
mettre un frein son expansion.
L'essor de Carthage
La fin du IV
e
s. voit Carthage reprendre pied dans le bassin
oriental de la Mditerrane en nouant des relations commerciales
intenses avec les nouveaux Etats d' Orient issus de la conqute
d'Alexandre et, en particulier, avec le royaume des Ptolmes d' E-
gypte qui fondait sa nouvelle monnaie sur l'talon phnicien, le
mme donc que celui adopt par Carthage o l'apparition des mis-
sions montaires proprement carthaginoises n'est gure antrieure
au milieu du IV
e
s. Sa puissance conomique s'en trouva singulire-
46. L'ANTIQUIT
ment renforce. Au cours de la dernire dcennie du IV
e
s. Cartha-
ge connut une brve mais srieuse alerte due un nouveau tyran
syracusian, Agathocle, qu'elle contribua, au dbut, installer solide-
ment au pouvoir. Ds qu'il se sentit fort, Agathocle s'empressa
d'empiter sur le territoire sicilien de Carthage. Au prix d'un grand
effort militaire celle-ci russit refouler Agathocle vers Syracuse et
l'y assigea. Mais le tyran syracusain tenta une diversion hardie qui
sera plus tard reprise par les Romains : trompant le blocus carthagi-
nois, il russit, la tte de 14 000 hommes, s'chapper de Syracu-
se et dbarqua dans le sud du Cap Bon en 310. Il brla sa flotte vrai-
semblablement pour enlever ses soldats tout espoir de retour,
puis, grce ses talents militaires, il parvint se maintenir pendant
trois ans dans le pays o il s'empara de plusieurs cits ; mais n'ayant
pas russi inquiter Carthage, bien en scurit l'abri de ses rem-
parts, il vit bientt sa tentative tourner court. Agathocle eut l'intel-
ligence de ne pas s'enfermer trop longtemps dans cette conqute
sans issue et prfra traiter avec les Carthaginois aprs avoir regagn
discrtement la Sicile. Carthage put ainsi conserver sa province sici-
lienne. L'entreprise d'Agathocle, mme si elle s'tait solde par un
chec, avait eu le mrite de relcher quelque peu la pression punique
sur Syracuse sans compter qu'elle constitua un dangereux prcdent
que les Romains n'hsitrent pas suivre lors de la premire, puis
de la deuxime guerre punique. Agathocle avait peut-tre l'intention
de reprendre la lutte contre Carthage, mais sa mort en 289 l'emp-
cha de raliser ses projets. Les Carthaginois en profitrent pour
consolider leur position d'autant plus que les dissensions entre cits
grecques de Sicile favorisrent leurs interventions et ils s'imposrent
souvent en arbitres de la situation. En 278, ils bloqurent Syracuse
qui ne fut dlivre que grce l'intervention de Pyrrhus, roi d'pi-
re et champion d' un hellnisme occidental en pleine dcadence.
Pyrrhus russit nanmoins reconqurir toutes les posses-
sions carthaginoises de Sicile sauf Lilybe. Cependant les cits
grecques commencrent se mfier de Pyrrhus, voyant en lui un
tyran en puissance, et certaines d'entre elles se rallirent Carthage.
Devant cette hostilit dclare, Pyrrhus abandonna en 276 l'le, et
Monnaie punique
Sur la face est reprsente une
tte de femme pouvant tre celle de
Cor, desse des moissons. Deux
pis de bl dcorent ses cheveux,
elle est pare d'un collier et de
boucles d'oreilles. Au revers sont
reprsents un cheval et un globe
rayonnant flanqu de deux cobras.
Cette pice est date du milieu
du III
e
s. av. J.-C. Elle est en lectrum,
alliage d'or et d'argent dans les
proportions d'un tiers et deux tiers.
Les motifs reproduits sont des
emblmes de Carthage.
Collier punique
Muse de Carthage
Dcouvert dans une tombe de
Carthage. Il est constitu de
nombreux lments de
matires et de formes
diverses : or et pierres
prcieuses tels que lapis,
turquoise, hyacinthe et
perles. Notez en particulier
deux pendentifs l'un circulaire,
l'autre rectangulaire. Tous
ces lments jouent le
rle d'amulettes protectrices.
Datable du VIT s. av. J.-C.
48. L'ANTIQUIT
les Carthaginois purent reprendre leurs positions. Puis profitant
nouveau des rivalits, jamais teintes entre les diverses cits
grecques de Sicile, ils ne tardrent pas tendre leur influence dans
le reste de l'le. Un effort militaire vigoureux aurait permis aux Car-
thaginois l'occupation rapide de l'le bien avant le dbut du III
e
s.
Carthage ne le fit pas et, lorsqu' en 269 elle s'installa Messine, elle
se trouva face face avec la nouvelle force mditerranenne :
Rome.
La premire guerre punique
La cause directe de la guerre qui va se dclencher a t l'appel
lanc Rome par les Mamertins. Ceux-ci, bloqus Messine par le
syracusain Hiron, demandent d' abord du secours aux Puniques qui
accdent leur sollicitation mais pour occuper aussitt la ville ; un
deuxime parti mamertin, mcontent de cette occupation punique,
fait appel aux Romains.
Rome avait, cette poque-l, russi imposer son hgmo-
nie toute l'Italie et venait galement de s'installer Rhgion, de
l'autre ct du dtroit.
Beaucoup d'historiens, repensant l'histoire aprs coup, en
conclurent que cette situation mettant deux imprialismes face
face, devait fatalement dgnrer en choc qui aboutirait ncessaire-
ment la disparition d' une des deux forces en prsence. C'est une
vue trs sduisante, coup sr, mais qui ne tient pas assez compte
de la complexit de la situation car le dclenchement du conflit avait
quelque chose de paradoxal : les deux puissances qui n'allaient pas
tarder se transformer en forces hostiles, avaient eu jusque-l des
rapports pacifiques et amicaux. La puissance maritime et commer-
ciale de Carthage ne pouvait gner la puissance terrestre et agricole
de Rome. Les deux tats semblaient s'tre engags dans deux voies
parallles sinon complmentaires.
Plusieurs traits dont le premier remonterait 509 avant J.-C.
avaient dj concrtis une volont assez nette de coexistence fon-
POQUE CARTHAGINOISE 49
de sur une limitation raisonnable des ambitions et la ncessit de
lutter contre l'ennemi commun : les Grecs, la veille de la premi-
re guerre punique, la dcadence de l'hellnisme occidental suppri-
mait certes un facteur important d'entente mais ne rendait nulle-
ment le conflit invitable, car un clivage de la Mditerrane en deux
domaines suffisamment distincts aurait bien pu rsoudre le probl-
me. Carthage en tout cas ne pouvait, cette poque, engager une
politique vritablement imprialiste. C'tait incompatible avec son
rgime politique et son organisation militaire. Tout ceci explique
l'extrme lenteur qui marquera le dbut de la guerre. De mme,
Rome on hsita longuement avant de se rsoudre engager les hos-
tilits : deux partis, l'un pacifiste, l'autre belliqueux, le premier repr-
sent par la puissante famille des Claudii, le second par celle des
Fabii s'affrontrent sur la scne politique. Les snateurs ne parve-
naient pas se mettre d'accord, et l'affaire, d'aprs Polybe, fut por-
te devant le peuple qui vota en faveur d'une intervention en Sicile.
En fait, conformment des usages tablis, il appartenait au Snat
et non au peuple de dcider. Mais mme si le peuple n'a pas dcid
seul, en l'occurrence, il a d faire pression sur le Snat pour le pous-
ser ratifier l'expdition de Sicile. Les Fabii agitaient devant l'opi-
nion populaire la menace d' un imprialisme punique envahissant et
apptaient les foules par l'vocation des trsors fabuleux que dte-
naient les cits siciliennes ; enfin, ils avaient russi convaincre les
Romains que la guerre serait rapide et limite. Il faut aussi tenir
compte du fait que les grandes familles romaines d'origine campa-
nienne taient pour la guerre, car la fermeture du dtroit de Messi-
ne par les Puniques aurait t nfaste pour l'industrie et le commer-
ce capouan ; or le consul Appius Claudius Caudex, champion du par-
ti de la guerre, tait entirement li l'aristocratie capouane par des
intrts et par certaines parents. En 264, il tint garnison Messine.
Jusque-l il n'y avait eu aucune dclaration de guerre, mais celle-ci
paraissait difficilement vitable, en dpit des hsitations de Cartha-
ge qui semblait vouloir viter le conflit et qui ragissait mollement
devant les initiatives romaines.
50. L'ANTIQUIT
C'est ainsi, par exemple, que l'amiral punique Hannon, crai-
gnant d'aggraver la tension entre les deux tats punique et romain
et n'ayant pas reu d'instructions prcises de la part de son gouver-
nement, vacua Messine. Cette attitude fut juge trop conciliante
par Carthage qui crucifia son amiral puis s'entendit avec Hiron de
Syracuse pour bloquer le dtroit et isoler les Romains dans la cita-
delle de Messine. Une premire ngociation entre les deux bellig-
rants choua et fut suivie par une tentative romaine de forcer le blo-
cus. Les Carthaginois, dcidment trop conciliants et voulant garder
pour eux le bon droit, se contentrent de repousser le convoi
romain et allrent jusqu' rendre leurs ennemis les navires pris au
cours de l'engagement. De nouveau, ils prfrrent la ngociation
la guerre et ils eurent beau avertir les Romains qu'en cas de rupture
ils ne pourraient mme plus se laver les mains dans la mer , ils ne purent
viter la guerre. Celle-ci dura 23 ans (264-241). Elle peut se diviser,
dans ses grandes lignes, en quatre phases assez distinctes.
La premire se situe entre 264 et 260. Peu de faits saillants
hormis le passage de Hiron de Syracuse dans le camp romain, ce
qui eut pour effet d'isoler les Puniques, la prise d'Agrigente par les
troupes romaines, et enfin la dcision que s'imposa le Snat romain
de construire une flotte. Jusque-l, les Romains n'avaient eu qu'une
marine tout fait rudimentaire. Grce au concours de nombreux
allis aguerris dans le domaine de la navigation, tels les Syracusains,
et une quinqurme punique prise en 264 qui servit de modle, les
Romains purent improviser une flotte de cent quinqurmes et
vingt trirmes.
Avec la construction d'une flotte romaine, la guerre entra dans
sa seconde phase et fut rapidement marque par l'important avan-
tage pris par les Romains sur leurs adversaires. En effet, la flotte
romaine improvise va s'attaquer une des flottes les plus rputes
du monde antique, et, grce un stratagme qui consista pourvoir
les navires de grappins et de passerelles de manire pouvoir mon-
ter l'abordage des bateaux ennemis, le consul Duilius surprit les
Carthaginois et russit les battre prs de Mylae (Milazzo), en 260.
Stle punique votive
Muse de Carthage
Cette stle provient du tophet
de Carthage.
Dans le fronton, est grav le signe
dit de Tanit. Dans le premier registre,
reprsentation d'une proue de
navire anne d'un peron en trident.
Dans le registre infrieur, est
grave la ddicace votive.
de 35 36 m et large de 5 5,50 m, le navire tait manuvr par
170 rameurs rpartis sur trois rangs superposs par bord.
L'ensemble de l'quipage, rameurs et matelots, atteignait les 200 hommes.
C'tait un vritable cuirass, arm d'un peron trilame destin
enfoncer la coque des navires adverses. La trirme sera supplante
partir du III
e
s. par la quinqurme ou pentre qui sera le navire
de la premire guerre punique. Longue de 37 m, large de 7 m,
elle comporte cinq rangs de rameurs superposs et ncessite
300 hommes rpartis par deux pour chaque aviron.
Elle embarque aussi 120 soldats. L'abordage du navire
adverse tait prfr 1 'peronnage.
La trire (ou trirme) tait le navire de guerre
par excellence du V au III' s. av. J.-C. Long
Restitution d'une galre antique
52. L'ANTIQUIT
Ce fut une cruelle dsillusion pour les Puniques qui perdirent
quarante cinq navires sans que toutefois leur potentiel guerrier soit
srieusement entam. Du ct romain, l' effet moral de la victoire
fut considrable mais l'opration a t fort coteuse sur le plan
financier, et les Romains montraient malgr tout une certaine rpu-
gnance pour les expditions maritimes. Aussi une certaine accalmie
succda-t-elle cette premire grande offensive maritime et il fallut
attendre l'anne 256 pour voir les Romains mrir puis excuter un
projet de dbarquement en Afrique destin surtout pousser les
Carthaginois relcher leur effort en Sicile en branlant les bases
quelque peu fragiles de leur empire africain. Suivant la voie dj tra-
ce par Agathocle, les lgions romaines, diriges par Regulus, dbar-
qurent prs de Clupea (Klibia). Le Cap Bon fut razzi, les Ber-
bres commencrent se soulever et Carthage connut des difficul-
ts de ravitaillement. Mais un officier Spartiate la solde de Cartha-
ge, Xanthippe, rorganisa l'arme punique et parvint presque
craser les 15 000 romains dont 2 000 seulement russirent
s'chapper. L'expdition d' Afrique dirige par Ikegulus tourna court
et Rome se rsolut concentrer ses efforts en Sicile.
La guerre entra alors dans sa troisime phase qui devait durer
de 255 247 et qui fut marque par une nouvelle tactique romaine
tendant arracher aux Puniques leurs places fortes siciliennes.
Panorme commena par succomber aux Romains qui purent alors
porter leurs efforts sur Lilybe qu'ils bloqurent. Mais, au cours de
l'anne 249, les Romains allaient subir coup sur coup, une srie de
dsastres qui les affaiblirent tant sur le plan matriel que moral.
Voulant attaquer la flotte punique Drepane, les Romains subirent
un premier dsastre auquel vingt sept navires seulement chapp-
rent ; les Puniques s' emparrent quelque temps aprs d' un convoi
de transport romain se dirigeant vers Lilybe. Une tempte fit ensui-
te le reste, et la flotte romaine se retrouva en 249 avec vingt navires
seulement. Carthage venait de rtablir une incontestable supriorit
sur mer et dtenait une chance exceptionnelle sinon de forcer la vic-
toire, du moins d' obtenir une paix avantageuse. Mais pour des rai-
sons de politique intrieure, Carthage ne fit pas l' effort qui s'impo-
sait, permettant ainsi son ennemi de reconstituer ses forces.
POQUE CARTHAGINOISE
53
L'anne 247 inaugura la dernire phase de la premire guerre
punique marque par l'entre en scne d'Amilcar Barca qui mena
contre les Romains une habile guerre de harclements, les inqui-
tant srieusement plusieurs reprises, mais qui, faute de moyens et
de renforts, ne put emporter la dcision. Les oprations tranrent
en longueur. Rome russit imposer ses riches un lourd sacrifice
financier qui lui permit d'accrotre ses forces et de porter aux
Puniques, puiss par une guerre trop longue, le coup dcisif au lar-
ge des les Aegates en 241. Carthage n'eut plus d'autre alternative
que la paix et Amilcar reut les pleins pouvoirs pour la ngocier.
Au terme de cette guerre, Carthage dut vacuer la Sicile, aban-
donner les les Aegates et Lipari, accepter de payer une indemnit
de 3 200 talents en trois ans et s'engager ne plus recruter de mer-
cenaires en Italie et chez les allis de Rome.
Il est remarquable de noter que Rome n'avait pas cherch
ruiner irrmdiablement un rival gnant son imprialisme puis-
qu'elle n'exigea pas de Carthage de dtruire ou de livrer sa flotte et
qu'elle ne toucha pas son empire, mise part la Sicile que les
Romains voulaient contrler.
Il serait galement intressant d'analyser les causes de l'chec
carthaginois dans cette guerre qui tait presque exclusivement mari-
time alors mme que les Puniques passaient pour les matres de la
mer.
Beaucoup d'historiens qui se sont penchs sur la question ont
attribu la victoire finale des Romains sur les Puniques aux qualits
morales dont les premiers ont fait preuve ; suivant en cela la tradi-
tion ancienne, ils n' ont pas dout de la supriorit d'une arme de
citoyens anime de patriotisme sur une arme de mercenaires dilet-
tantes. Mais on peut penser aussi l'attrait du butin et des primes
qui constituait un extraordinaire stimulant pour des soldats de
mtier, des professionnels de la guerre, suprieurement exprimen-
ts et ayant au plus haut point le got du risque et de l'aventure. Au
cours des oprations et en dpit de leur courage indniable, les sol-
dats romains n' ont fait preuve d'aucune qualit guerrire exception-
54.
L'ANTIQUIT
nelle. Xanthippe qui avait du talent et des moyens n'a pas eu beau-
coup de peine tailler en pices l'arme de Regulus. Certes les ami-
raux romains purent remporter quelques victoires sur la flotte
punique en la surprenant par des procds insolites, mais les mmes
amiraux prouvrent leur inexprience des choses de la mer en lais-
sant la tempte dtruire leur flotte trois reprises et, d'une manire
gnrale, la supriorit des cadres carthaginois sur ceux de Rome
parut vidente. En ralit ce qui a caus la perte de Carthage, c'est
en premier lieu un dfaut de coordination flagrant entre l'appareil
gouvernemental et le commandement militaire. Si l'on excepte
Amilcar, tous les chefs de l'arme punique semblrent timors et se
cantonnrent souvent dans une attitude dfensive laissant toute
l'initiative des oprations leurs adversaires. Ils taient vraisembla-
blement paralyss par la crainte d'un tribunal extraordinaire qui,
Carthage, jugeait impitoyablement toute dfaillance dans la condui-
te de la guerre. C'est ainsi qu'ils ratrent de multiples occasions de
pousser plus loin certains avantages acquis sur le terrain de la lutte
et qu'ils perdirent de prcieux allis comme Hiron de Syracuse.
D' autre part, ces mmes gnraux manqurent de renforts et de
soutiens dans les moments les plus dcisifs ; et les raisons d'une tel-
le faille sont rechercher dans la structure mme du systme poli-
tique carthaginois o une caste de nobles dominant la situation s'est
toujours mfie des gnraux vainqueurs et, de ce fait, prestigieux et
susceptibles de tenter de s'appuyer sur les mercenaires pour s'em-
parer du pouvoir. Ce sont donc les contradictions mmes du rgi-
me carthaginois qui expliquent, en grande partie, la carence des
Puniques. Cette longue guerre branla srieusement l'conomie de
Carthage. Le commerce fut paralys et les ressources manqurent
quand il fallut payer les mercenaires. Le paiement de ces merce-
naires crait de vritables hmorragies budgtaires occasionnant
Carthage de multiples difficults de trsorerie qui eurent leur poids
dans l'volution de la guerre. Rome, n'ayant pas eu affronter de
tels obstacles, eut beaucoup plus de souffle.
POQUE CARTHAGINOISE
55
La rvolte des mercenaires et l'entre-deux-guerres
Certaines difficults rapidement entrevues au cours de la guer-
re prirent une acuit tout fait dramatique pour Carthage au lende-
main de sa dfaite. Ces difficults vont dgnrer en crise qui, en
mme temps qu'elle rvlera tous les vices de l'tat carthaginois,
branla terriblement les fondements de la puissance punique.
En effet, Carthage qui avait payer les indemnits de guerre
dut, en plus, faire face une situation gnrale pouvantable. La
guerre, en entravant le trafic et le commerce, avait tari les sources
mmes de la prosprit. L'expdition de Regulus avait ravag le plus
riche des territoires puniques, le Cap Bon. La rvolte grondait par-
mi les paysans berbres durement exploits par Carthage qui, de
surcrot, n'avait pas pu payer la solde de ses mercenaires. Ceux-ci au
nombre de 20 000 taient concentrs Lilybe et attendaient le
rglement de leurs arrirs. En 241, ils furent ramens en Afrique
en vue d'tre pays puis dmobiliss. Normalement, on aurait d
payer les contingents au fur et mesure de leur arrive puis les
licencier. Mais le trsor de Carthage tant vide, le gouvernement les
concentra tous prs de Sicca (Le Kef) et voulut ngocier avec eux
pour obtenir une rduction de solde ou quelque arrangement qui lui
aurait accord un certain rpit. Mais des contestations s'levrent,
accentues par la diversit des origines, des ethnies et des langues.
Cela ne tarda pas dgnrer en mouvement de masses qui prit, de
jour en jour, de plus en plus d'ampleur. Carthage comptait prcis-
ment sur les diversits ethniques qui empchaient les contingents de
s' entendre et sur les cadres subalternes forms d'officiers indignes,
souvent conciliants, pour maintenir la discipline et imposer son
point de vue. Or tous ses calculs s'avrrent faux, et elle ne tarda pas
raliser l' imprudence commise en oprant le rassemblement de
plus de 20 000 hommes qui avaient de srieuses raisons de lui en
vouloir et qui, le cas chant, n'prouveraient aucun scrupule fai-
re valoir leur droit par la force.
56. L'ANTIQUIT
Le mercenaire qui vit en marge de la socit, est tout naturel-
lement port se rvolter contre une autorit qui n'a pas respect
les engagements pris son gard. D' autre part l'arme punique
comprenait un grand nombre d'esclaves et d'affranchis fugitifs ou
de dserteurs qui taient des rvolts en puissance contre l'ordre
social rgnant. Tout cela se place dans un contexte de guerres ser-
viles qui ne cessent d'clater en Orient et qui commencent gagner
l'Occident. Aussi la diversit ethnique n'empcha pas les merce-
naires conscients de leurs intrts et de leur force de se rvolter. Ils
furent d'ailleurs presque tout aussitt rejoints par la masse des pay-
sans berbres, toujours l' afft de la moindre possibilit de secouer
le joug carthaginois, et d'autant plus mcontents qu'ils avaient d
livrer la moiti de leur rcolte en guise de tribut Carthage pendant
la guerre. Ainsi, d' un simple conflit de salaires on passe un vri-
table conflit de classes, mettant aux prises un double proltariat
militaire et agricole uni par l'exploitation commune dont il est vic-
time et une aristocratie exploitante qui est, de surcrot, immigre.
Les rvolts quittrent le Kef, marchrent sur Tunis et s'y ins-
tallrent. Carthage se tourna alors vers les cadres subalternes de l'ar-
me mercenaire, essayant de trouver avec eux un arrangement qui
lui aurait permis d'avoir les mains libres et de mater aussitt les Ber-
bres. Le carthaginois Giscon tint une srie de runions avec ces
officiers, parvint trouver un accord avec eux et commena mme
payer leur solde. Ds que la nouvelle se rpandit un mouvement
de masse se dclencha, aboutissant rapidement l'limination des
cadres moyens jugs trop conciliants et qui furent dbords par des
lments absolument intransigeants. Deux chefs nouveaux, surgis
de la masse et lus par elle, se dressrent devant Carthage et prirent
la direction de la rvolte : Spendios, ancien esclave romain, qui
redoutait d'tre rendu son matre en cas d'arrangement et Math,
un libyen qui savait que tout rglement de l'affaire des mercenaires
entranera l'crasement des Berbres ; l'un et l'autre taient dcids
aller jusqu'au bout. Ils montrrent leur intransigeance en faisant
massacrer tous les officiers qui avaient accept de ngocier avec
Carthage et en jetant en prison Giscon et sa suite.
POQUE CARTHAGINOISE 57
La guerre entra alors dans sa phase active : 70 000 Libyens
rpondirent l'appel de Mtho pour mettre fin tous les abus de
Carthage et venger l'acte sanglant qu'elle venait d'accomplir en ex-
cutant 3000 dserteurs berbres rendus par Rome. Les femmes ber-
bres firent don de leurs bijoux, ce qui permit de rgler l'arrir de
solde des mercenaires. On sollicita l'appui de toutes les cits hostiles
Carthage dont le commerce souffrait de la concurrence punique.
Carthage, ruine, sans arme et sans allis, se trouva dans une
situation alarmante. Au prix d' un extraordinaire effort, elle mobili-
sa ses citoyens, enrla de nouveaux mercenaires, les plaa sous le
commandement de Hannon et les dirigea vers Utique et Hippo
Diarrhytus (Bizerte) que les rvolts venaient d'assiger. Hannon ne
s'tant pas montr la hauteur de la tche, ce fut Amilcar que l'on
confia une seconde arme et le soin de diriger les oprations contre
les rebelles. Celui-ci russit surprendre Spendios et le battre gr-
ce une manuvre qui annonce la tactique d'Hannibal. Ce succs
valut Carthage le ralliement d' un chef berbre, Naravas, et permit
aux Carthaginois de remporter une nouvelle victoire sur Spendios.
Amilcar voulut exploiter ce nouveau succs pour obtenir de nou-
veaux ralliements parmi ses anciens soldats. Il traita les prisonniers
avec beaucoup de mansutude, leur proposant soit de s'enrler dans
l'arme carthaginoise, soit de rentrer dans leur pays. Cette indul-
gence inquita fort les chefs de l'arme rebelle qui ripostrent en
massacrant Giscon et 700 prisonniers carthaginois, creusant ainsi
un foss de sang entre les deux adversaires et rendant toute rcon-
ciliation impossible. Les Carthaginois, exasprs, dcidrent que les
rebelles prisonniers seraient crass par les lphants et la guerre
prit la tournure inexpiable qui devait dsormais la caractriser.
Cependant, les rebelles mirent profit certaines msententes
entre Hannon et Amilcar et russirent reprendre l'avantage.
Utique et Bizerte passrent de leur ct. Carthage fut de nouveau
dans une position critique. Elle eut beau limoger Hannon et donner
tous les pouvoirs Amilcar, elle ne se retrouva pas moins en proie
la famine, et c'est de Rome et de Syracuse que le secours vint. Ces
deux cits interdirent leurs marchands d'approvisionner les rvol-
58.
L'ANTIQUIT
ts et les invitrent vendre des vivres Carthage. Ainsi les enne-
mis de la veille, oubliant leur querelle, dcidrent de ne considrer
que leur intrt commun qui tait de lutter sans merci contre un
soulvement qui prenait, leurs yeux de dfenseurs de l'ordre ta-
bli, des allures subversives et qui menaait de faire tche d'huile en
cas de succs. Les mercenaires se rendirent compte de la vanit de
leurs efforts et abandonnrent le sige de Carthage. Pendant ce
temps-l, Amilcar parvint enfermer l'arme de Spendios dans le
Dfil de la Scie (situ vraisemblablement entre Zaghouan et
Grombalia), s'empara de ses chefs, au cours de pourparlers, rem-
porta sur elle une grande victoire et d'aprs Polybe fit craser les
40 000 survivants par ses lphants. La cause semblait entendue
malgr la victoire que remporta Math sur les Puniques, quand
ceux-ci tentrent de reprendre Tunis. Mais Math fut battu, quelque
temps aprs, prs de Lemta (Lepti Minus), pris et atrocement sup-
plici. Bizerte et Utique se rendirent et Carthage rtablit toute son
autorit sur les Libyens.
Cette guerre inexpiable dont certains pisodes furent dcrits
et romancs par Flaubert dans Salammb , faillit sonner le glas
pour Carthage. Elle en sortit puise. Rome avait exploit sa fai-
blesse pour la dpossder de la Sardaigne, mais la conqute de l'Es-
pagne allait inaugurer pour elle une re nouvelle qui la conduira
grands pas vers une nouvelle prosprit.
CHAPITRE V
Hannibal et la deuxime
guerre punique
Les Barcides en Espagne
et le dclenchement de la guerre
La premire guerre punique et la rvolte des mercenaires ont
fait apparatre Amilcar Barca comme un grand stratge doubl d' un
habile politicien, c'est--dire comme l' homme providentiel indis-
pensable au rtablissement de la puissance carthaginoise. Ayant
beaucoup rflchi aux diverses causes de la dfaite de sa patrie,
celui-ci va essayer de remdier aux deux dfauts qui lui ont paru
caractriser le rgime carthaginois, savoir la faiblesse du comman-
dement militaire et l'instabilit conomique.
Des exemples de solution s' offraient lui chez les rois hell-
nistiques dont le pouvoir tait intimement li l'autorit militaire.
Les rois hellnistiques s'assuraient un indiscutable ascendant sur
leurs troupes de mercenaires grce une mystique tendant les fai-
re passer pour dtenteurs de dons divins et surnaturels leur conf-
rant l'invincibilit militaire. La leon hellnistique a t bien retenue
par Amilcar auquel il ne restait plus qu' adapter ces ides la ra-
lit punique tant sur le plan politique qu'idologique. Or les condi-
tions de ralisation se trouvaient facilites par la grande crise de la
60. L'ANTIQUIT
guerre des mercenaires et par la victoire d'Amilcar sur les rvolts.
Sorti aurol de prestige et de gloire, il aurait pu imposer Cartha-
ge une espce de tyrannie. Il ne le fit pas, car il avait galement tir
la leon de prcdentes tentatives malheureuses de dictature Car-
thage et, de plus, il voyait loin et sentait que les besoins en res-
sources conomiques et militaires primaient tout pour l'immdiat.
Tout ce qu'il fit Carthage c'est, peut-tre, une modification de la
constitution dans un sens plus dmocratique en diminuant la toute-
puissance de l'oligarchie. Les Barcides utilisrent, au sein de Car-
thage, le parti dmocratique qui commena se manifester ds la fin
du IV
e
s., pour assurer la liaison entre leur pouvoir militaire et le
gouvernement intrieur de Carthage.
Cependant, ce n'est pas dans sa patrie qu'Amilcar va fonder
son pouvoir mais en Espagne, province suffisamment loigne de
Rome et de Carthage, et suffisamment riche pour pallier l'touffe-
ment de l'conomie punique en cas de guerre.
Carthage avait dj des intrts en Espagne dont Amilcar
connaissait la richesse et la valeur militaire. Il comprit qu'il trouve-
rait l les bases du pouvoir monarchique et militaire et les ressources
conomiques et en hommes dont il avait besoin. Il partit donc pour
l'Espagne et parvint soumettre une grande partie du pays et l'or-
ganiser en s'inspirant dans son action des grands fondateurs d'em-
pire comme Alexandre. Il fonda son pouvoir politique sur l'arme
et dveloppa la mystique de la victoire due au chef inspir et invin-
cible. Il pratiqua une politique d'assimilation des indignes par l'en-
rlement des soldats vaincus et de nombreux mariages mixtes.
Les Barcides s'orientent nettement vers le pouvoir monar-
chique en Espagne comme le prouvent l'volution montaire et le
comportement d'Hasdrubal, gendre et successeur d'Amilcar qui
fonde une seconde Carthage, appele par les Romains Carthagne :
c'est Qart Hadasht , la ville nouvelle mais aussi la capitale, donc
une nouvelle Tyr , ce qui enlve Carthage le privilge d'tre la
seule nouvelle Tyr . Le mme Hasdrubal construit un palais et se
fait saluer du titre de roi. Il faut bien noter que ce pouvoir royal, les
Barcides ne l'exercent qu'en Espagne et non Carthage. Un autre
POQUE CARTHAGINOISE 61
trait mrite galement d'tre soulign, c'est l'indpendance de plus
en plus grande que les Barcides prennent par rapport Carthage.
D' habitude les gnraux taient dsigns par le Snat ou l'assemble
populaire de Carthage, avec les Barcides c'est dsormais l'arme qui
dsigne son chef, puis le Snat ratifie. Ainsi Hannibal jouit d'une
libert complte au point de vue diplomatique : il ngocie avec les
diffrents peuples, traite avec le roi de Macdoine et semble ainsi
diriger la politique extrieure et militaire ; le gouvernement intrieur
restant entre les mains des anciens organes du pouvoir. C'est une
politique qui s'apparente bien plus avec les rgimes monarchiques
qu'avec les institutions traditionnelles de Carthage.
La position personnelle des Barcides se renforait donc de
jour en jour et les bienfaits de la conqute de l'Espagne ne tardrent
pas se faire sentir dans tout le monde carthaginois. Les progrs de
la conqute et la prosprit qui en rsulta finirent par inquiter
Rome qui, sous la pression de son allie, Marseille, dont les intrts
en Mditerrane et en Espagne taient de plus en plus menacs,
obtint, en 226, d'Hasdrubal l'engagement de ne pas dpasser l' Ebre
dans ses conqutes.
la mort d'Hasdrubal, l'arme dsigna Hannibal, alors g de
26 ans, pour lui succder. Celui-ci montra un talent exceptionnel
dans la poursuite de l'action de ses prdcesseurs. En moins de
vingt ans, les Barcides avaient russi alimenter abondamment le
trsor de Carthage et rnover sa puissance conomique et militai-
re. De vastes horizons s'ouvraient dsormais devant elle. Mais en
219, un incident clata qui allait plonger Rome et Carthage dans les
affres d'une nouvelle guerre. L'affaire de Sagonte fut l'origine des
hostilits. Rome et Marseille intervinrent dans les affaires intrieures
de la petite cit pour intriguer et pousser au pouvoir une faction
hostile aux Carthaginois. Le plan russit et les amis de Carthage qui
gouvernaient la ville furent massacrs. Les Sagontais ne tardrent
pas entrer en conflit avec un peuple voisin alli de Carthage dont
Hannibal prit le parti, ce qui le poussa s'emparer de Sagonte. Sous
la pression de Marseille et d' un groupe politique activiste, prdomi-
nant au Snat et partisan d'une intervention immdiate contre Car-
62. L'ANTIQUIT
thage dont la puissance, grce ses nouvelles bases d' Espagne,
devenait menaante, Rome dcida d'exploiter l'affaire de Sagonte et
de ragir. Elle somma le Snat carthaginois de svir contre Hanni-
bal qui ses yeux, venait de violer le trait de 226 en portant attein-
te une allie de Rome. Le Snat carthaginois fit valoir que Sagon-
te se trouvait au sud de l' Ebre et qu' en 226 elle n'tait pas l'allie de
Rome et accepta la dclaration de guerre romaine. La responsabili-
t du dclenchement de ce conflit a aliment d' abondantes discus-
sions entre les historiens. La tradition historique favorable Rome
rejette toute la responsabilit sur Carthage. En fait, il semble bien
qu les Carthaginois envisagrent, long terme, la revanche, mais en
219 ils ne s'estimaient pas prts la tenter. En attaquant Sagonte,
ils pensaient tre forts de leur bon droit et, agissant au sud de l' Ebre,
ils ne violaient d' aucune manire le trait de 226, sauf si on suppo-
se que l' Ebre en question n'est en fait que le Jucar d' aujourd' hui,
comme on a pu le prtendre sans toutefois le prouver.
En tout cas, du ct punique il restait encore beaucoup fai-
re pour consolider l'uvre de conqute de l' Espagne et achever de
forger une force militaire capable de battre Rome. Carthage n'avait
presque pas de flotte. Elle ne souhaitait donc nullement la guerre,
mais elle ne pouvait pas non plus ignorer le dfi que lui lanait
Rome sans compromettre son prestige aux yeux des Espagnols.
Les victoires d'Hannibal et ses checs
Les Romains semblaient croire qu' une rapide campagne sur
deux fronts, en Espagne et en Afrique, les dbarrasserait de la puis-
sance carthaginoise. Rome comptait sur l'incontestable supriorit
de ses forces navales pour oprer des dbarquements en Afrique et
en Espagne et assurer des liaisons continuelles avec les troupes en
guerre. Les Carthaginois, dus par le comportement de leur flotte
lors de la premire guerre, l'avaient quelque peu dlaisse pour
reporter tous leurs efforts sur l'arme de terre. Aussi, Hannibal qui
prit l'initiative d' imposer la guerre en Italie, fut-il oblig d' emprun-
Buste en bronze
Dcouvert Volubilis en 1944.
Conserv au muse de Rabat, au Maroc.
C'est le portrait prsum d'Hannibal jeune. Il est reprsent la mode
hellnistique sur le modle d'Alexandre le Grand, au moment o il est proclam
chef de l'tat barcide d'Espagne : jeune homme imberbe, aux traits gracieux et
nergiques la fois, la tte ceinte du diadme royal. Certains attribuent toutefois
ce bronze Juba II, dernier roi de Maurtanie.
64.
L'ANTIQUIT
ter la voie terrestre malgr les nombreux problmes que cela posait
et les risques de perte de temps et d' hommes que cela comportait.
Aprs avoir assur ses arrires en faisant venir d'Afrique des troupes
destines protger l'Espagne contre une ventuelle attaque romai-
ne, il envoya de nombreux missaires dans le monde celtique en
plein veil et prit ses dispositions pour utiliser les forces vives de ce
monde contre les Romains.
Au printemps de l'anne 218, il s'branla vers l'Italie la tte
d'une arme compose de 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers et 37
lphants. Aprs de longs mois d'une marche pnible et pleine d'em-
bches, il dboucha dans la valle du P en septembre 218. Son
arme ne comptait plus que 20 000 fantassins, 6 000 cavaliers et 21
lphants. L'ampleur des pertes dispense de tout commentaire sur
les difficults auxquelles se heurta le grand gnral carthaginois. La
traverse des Alpes eut probablement lieu dans une zone comprise
entre le col du petit Saint Bernard et celui du mont Genvre et frap-
pa les esprits depuis l'antiquit. En fait, ce ne fut pas un exploit hors
srie et plusieurs reprises des bandes celtiques avaient russi fran-
chir cette montagne. La principale difficult de l'entreprise rsidait
dans le double fait qu'il s'agissait cette fois-ci de faire traverser les
Alpes une arme flanque de cavalerie et de train d'quipages au
moment o les premires chutes de neige rendaient la marche par-
ticulirement meurtrire et de faire face l'hostilit des tribus mon-
tagnardes qui ne cessrent de harceler les troupes d'Hannibal. Mais
celui-ci avait accept tous les risques en vue de raliser son plan qui
tait d'viter de se heurter aux armes romaines avant d'avoir atteint
l'Italie du Nord o Rome n'avait pas encore bien affermi son instal-
lation et o il tait susceptible de trouver de nombreux allis contre
ses adversaires. Ds que les Romains ralisrent la gravit de la situa-
tion, ils annulrent leur expdition en Afrique et se contentrent
d'envoyer une arme en Espagne afin de couper Hannibal de ses
rserves en hommes et en richesses puis ils essayrent d'arrter la
progression d'Hannibal en Italie du Nord. Ils subirent un premier
chec l'ouest du Tessin, en dcembre, puis se firent craser sur la
Trbie, perdant les trois quarts des forces qu'ils avaient engages
dans la bataille.
POQUE CARTHAGINOISE
65
Cet clatant succs et l'exploitation qu'il en fit par une habile
propagande valurent Hannibal le ralliement de nombreux Gaulois
de la Cisalpine. Les Romains abandonnrent leurs rivaux la plaine
du P tout en dcidant de leur dfendre l'accs de l'Italie centrale
l'abri de l'Apennin. Hannibal franchit pniblement cette chane, y
laissant bon nombre de ses soldats et la presque totalit de ses l-
phants puis, laissant sur sa gauche l'arme romaine, il se dirigea vers
Prouse. Bientt, les lgions adverses commandes par Elaminius se
lancrent ses trousses, le poursuivant sans relche et surveillant de
trs prs ses mouvements. Hannibal finit par s'engager dans un
troit dfil sparant le lac de Trasimne et les collines dominant ce
lac. Il campa la sortie de ce passage alors que les Romains cam-
paient son entre pour passer la nuit. Mais le lendemain de ce jour,
au petit matin du 21 juin 217, alors qu'un pais brouillard recouvrait
le paysage, Hannibal, qui avait auparavant embusqu ses hommes
sur les hauteurs et laiss les Romains s'engager largement dans l'in-
sidieux couloir, fit soudainement barrage avec ses cavaliers en avant
et en arrire des colonnes romaines en marche pendant que ses
autres troupes, dvalant des hauteurs se prcipitaient sur l'ennemi
l'attaquant de toutes parts. En deux ou trois heures, 15 000 Romains
et leur chef Elaminius furent massacrs et noys dans le lac o, affo-
ls, ils avaient cherch refuge ; 15 000 autres furent faits prisonniers.
Presque toute l'arme romaine a t mise hors de combat alors
qu'Hannibal avait perdu peine deux milliers de Gaulois. Les
Romains s'taient laisss prendre dans cette souricire qu'avait
conue un Hannibal suprieurement dou sur le plan de la stratgie
et de la tactique militaire et dot d'un sens aigu de l'utilisation des
lments topographiques et naturels dans l'accomplissement de ses
plans. Au reste, il n'allait pas tarder donner un nouvel aperu de
l'immensit de son talent guerrier et de l'tonnante varit de ses
ressources mentales en matire de conception et de conduite des
oprations militaires.
Au lendemain de Trasimne, le plan d'Hannibal n'tait pas de
tenter d'assiger Rome bien en scurit l'abri de ses fortifications
mais de s'engager dans l'Italie afin de susciter, parmi les peuples
66.
L'ANTIQUIT
allis ou soumis Rome, des rvoltes qui renforceraient singulire-
ment sa position et feraient du mme coup le vide autour de sa riva-
le qu'il avait dcid d'touffer. D'ailleurs, la suite de chaque
bataille, il avait pris l'habitude de librer les prisonniers italiens sans
ranon afin de les dtacher de la cause romaine.
En aot 216, Hannibal avait russi gagner l'Apulie et se trou-
vait prs de Cannes, au sud de l'Italie, lorsqu'une imposante arme
romaine compose de 80 000 hommes et 6 000 cavaliers l'y rejoi-
gnit. Menant une vritable guerre de nerfs contre ses ennemis, il
finit par les exasprer et les amener se battre au jour et l'endroit
choisis par lui. Le 2 aot 216, lorsque la bataille s'engagea dans la
valle de l'Aufide sur de vastes espaces unis et propices aux volu-
tions de la cavalerie, Hannibal eut soin de mettre de son ct tous
les lments naturels : le soleil dardant ses rayons sur les lgion-
naires et gnant considrablement leur vue et le vent qui leur fouet-
tait le visage et les aveuglait de ses nuages de poussires.
La bataille, bien dcrite par les historiens anciens et modernes,
se droula selon une manuvre gniale devenue un sujet de mdi-
tation classique pour les stratges de tous les temps. Hannibal tint
compte, dans la disposition de ses troupes en rang de bataille, aussi
bien des diversits ethniques que des diffrences de valeur guerri-
re. Les frondeurs balares placs l'avant-garde face aux premires
lignes du chef romain Varron devaient rapidement se replier sur les
ailes aprs avoir multipli les escarmouches. Derrire cette premi-
re ligne d'infanterie lgre taient disposs des cavaliers gaulois et
espagnols appels attaquer l'aile droite romaine. Aux extrmits
tait masse l'lite africaine reprsente par les escadrons numides.
Trs rapidement, toute l'arme apparut dispose sur une seule ligne,
prsentant en son milieu une saillie en arc dont la convexit regar-
dait l'ennemi comme pour le narguer et en provoquer les coups. Le
plan d'Hannibal tait de pousser le fougueux et impulsif Varron
se jeter de toutes ses forces sur cet insolite front en saillie de l'arme
punique compos essentiellement d'lments gaulois dont il pr-
voyait tout le comportement : aprs s'tre dfendus rageusement, ils
finiraient par se dcourager et reculer devant l'ennemi, transfor-
68.
L'ANTIQUIT
mant petit petit le dispositif convexe initialement mis en place en
une sorte de poche o se prcipiteraient les Romains avec l'illusion
d'tre les plus forts et o ils seraient rapidement envelopps par la
cavalerie numide dont Hannibal dirigeait personnellement les mou-
vements.
Toute la bataille se droula comme s'il ne s'agissait que d'un
simple exercice de rptition thtrale et J. Carcopino crit dans Profils
de conqurants : Le rsultatfut exactement celui qu'Hannibal avait prvu : en
s'acharnant sur les Gaulois, les Romains s'taient laisss envelopper par les
Africains. Coincs entre les volets de la trappe que le Carthaginois leur avait insi-
dieusement prpare, les lgionnaires, incapables de maintenir leur ordre de
bataille, ne pouvaient plus lutter que par groupes incohrents et disloqus
d'avance contre des attaques prononces de tous les cts la fois, en tte, en
qimte et sur flancs. La bataille de Cannes tait gagne et pour transformer la
dfaite romaine en un dsastre sans prcdent, Hannibal sonna la charge ses
Numides qui, par une conversion de l'aile droite, accoururent sabrer dans le dos
un adversaire dsempar .
Le bilan de la bataille est trs loquent et permet d'apprcier-
le talent militaire et l'exceptionnelle virtuosit d'un homme qui,
Cannes, alignait peine 40 000 soldats, ce qui reprsente la moiti
du chiffre des effectifs dont disposaient ses adversaires. Au terme
des hostilits de cette journe du 2 aot, 67 000 Romains avaient
mordu la poussire et ceux qui, chappant au carnage, avaient rus-
si regagner Cannes ou ses environs la faveur de la nuit furent
leur tour cueillis par la cavalerie numide. Seuls quelques dizaines de
fuyards devaient russir avec Varron rejoindre Rome. Les pertes
d'Hannibal s'levrent 4 800 tus : 3000 Gaulois, 300 Numides et
1 500 Espagnols ou Africains. Commentant cette bataille, J. Carco-
pino crit : Jamais encore les principes de l'conomie des forces n 'avaient t
appliqus avec autant de prcision et de bonheur. Jamais non plus on n 'avait
assist une boucherie o l'arme victorieuse avait ce point pargn son sang,
tandis que l'hmorragie de l'arme vaincue l'avait, pour ainsi dire, saign
blanc... l'admiration de Cannes, chef d'uvre des conceptions d'Hannibal, est
aujourd'hui celle de l'histoire. Il y a soixante ans, en Allemagne, cette bataille
Stle punique l'lphant.
Calcaire. 41,5 cm x 14 cm, III-IP s. av. J.-C.,
Muse de Carthage.
Il s'agit d'un exemplaire parmi plus
de 6000 stles votives recueillies dans
le tophet ou travers le site de Carthage.
Toutes sont consacres aux deux divinits
suprmes de Carthage : Bal Hammon et Tanit
qui forment un couple divin. L'inscription
rituelle commence par la formule :
"A la Dame, Tanit, Face de Bal et au
seigneur Bal Hammon, c'est ce qu' a vou,
suivent les noms du ddicant et sa filiation
avec parfois l'indication de son titre
et de son mtier. La formule finale
est habituellement rdige comme suit :
Parce qu'il (le dieu) a entendu ma voix,
c'est--dire qu'il a exauc mon vu.
Il m' a bni (ou qu'il me bnisse).
En dehors de l'inscription, la stle
comporte des dcors sculpts ou gravs.
Ici c'est un lphant, animal clbre dans
l'histoire de Carthage en raison de son usage
comme tank au cours de la deuxime guerre
punique mene par Hannibal.
Cuirasse en bronze dor
Muse de Bardo
Dcouverte dans un
t o mb e a u pu n i q u e , prs de
Ksour Essaf, en 1909.
H. 30 cm.
Elle comprend un plastron
et une dossire presque
identiques, orns d'un dcor
similaire, remarquable par la
tte de Minerve casque.
De fabrication campanienne,
cette armure aurait appartenu
unsoldat de l'arme
carthaginoise de la
fin du III
e
s. av. J.-C.
70.
L'ANTIQUIT
tait considre comme le modle encore ingal de la victoire intgrale, celle qui
par l'encerclement complet de l'ennemi, non seulement le bat mais le supprime .
En 1914 encore, prcise J. Carcopino, les Allemands devaient
essayer la mme tactique d'enveloppement inspir du modle de
Cannes.
C'est au lendemain de Cannes que Maharbal, un des officiers
carthaginois suggra la marche sur Rome. Hannibal, refusant l'op-
ration, se vit adresser la fameuse rplique : Les dieux n'ont pas tout
donn au mme homme Hannibal ! tu sais vaincre mais tu ne sais pas profiter
de la victoire . En fait Hannibal avait de srieuses raisons de rejeter
le projet. Il n'tait pas arm pour une guerre de sige qui risquait
d'tre longue, peu rentable pour ses mercenaires et de se drouler
au sein d'une rgion tout fait hostile. Rome tait solidement forti-
fie et ses habitants clbres pour leur farouche rsistance tout
envahisseur. N'tait-il pas prfrable, dans ces conditions, d'exploi-
ter militairement et politiquement les succs obtenus puis, de
conqute en conqute, de procder l'isolement total puis la
rduction de Rome. Les premiers lendemains de Cannes confirm-
rent nettement la faon de voir d'Hannibal : impressionns par
l'ampleur de sa victoire, de nombreux allis firent dfection Rome
et rallirent ses rangs. Capoue, la deuxime grande ville d'Italie,
ouvrit ses portes pour accueillir le triomphateur. Fort de cet appui
et de celui des peuples de l'Apulie, du Samnium, de la Lucanie et du
Bruttium, Hannibal n'attendait plus que l'arrive des renforts pour
forcer le destin. Grce son habilet diplomatique, il fit de Philip-
pe V de Macdoine un prcieux alli dispos lui apporter son
concours. Mme en Sicile, l'influence de Carthage se dveloppa
considrablement aprs la mort de Hiron. La situation tait en tous
points favorable, mais seule l'arrive rapide des renforts pouvait
permettre Hannibal d'en tirer des avantages dcisifs.
Cependant deux facteurs importants allaient peser lourde-
ment dans la balance de la guerre et ruiner les plans d'Hannibal.
L'infriorit de la flotte punique et l'incapacit notoire de son ami-
POQUE CARTHAGINOISE
71
ral Bomilcar empchrent Carthage et Philippe V d'envoyer des
renforts en Italie et mirent fin l'influence carthaginoise en Sicile.
Deux diversions hardies opres par les Romains quelques annes
d'intervalle, allaient s'avrer efficaces : la conqute de l'Espagne par
P. Cornlius Scipion et la dfaite et la mort d'Hasdrubal qui volait au
secours de son frre, achevrent presque de sonner le glas pour
Hannibal qui ne pouvait plus compter sur aucun secours extrieur.
Sur un autre plan, les Romains avaient peu peu russi rtablir une
situation lourdement compromise aprs Cannes. Au lendemain de
la dfaite, le Snat romain soucieux de relever le moral des citoyens,
n'hsita pas accueillir Varron, vaincu et fugitif, en le flicitant de
n'avoir pas dsespr de la Rpublique. S'appuyant sur des allis
fidles en Italie centrale, les Romains s'imposrent d'immenses
sacrifices et inaugurrent une nouvelle tactique de guerre personni-
fie par la temporisation de Fabius dit Cunctator (le temporisateur)
qui dsormais refusait tout engagement rang avec Hannibal et
s'vertuait harceler les troupes puniques, tenter des coups de
main contre ceux qui s'taient rallis aux Carthaginois. Hannibal
n'avait pas suffisamment de troupes pour dfendre toutes ses nou-
velles positions la fois. Capoue, tombe entre les mains de ses
adversaires, fut chtie de sa dfection avec la dernire cruaut, et
cela constitua un exemple qui ne manqua pas d'impressionner tous
les allis italiens d'Hannibal. Bientt l'expdition carthaginoise
commena tourner l'aventure ; et, pour prcipiter le cours des
vnements, les Romains oprrent une deuxime diversion : sous
l'impulsion de Scipion, surnomm l'Africain aprs sa victoire, on
dcida de porter la guerre en Afrique afin d'obliger Hannibal quit-
ter l'Italie et d'liminer Carthage comme grande puissance mditer-
ranenne.
Scipion avait dj tabli des contacts en Espagne avec des
princes numides qui lui avaient promis leur concours. Mais Syphax,
roi des Massyles, pousa entre temps une fille de l'aristocratie car-
thaginoise et du mme coup devint l'alli de Carthage. Quant
Massinissa, roi des Massyles, il demeurait bien fidle Scipion, mais
72. L'ANTIQUIT
il avait t chass de son royaume par Syphax et menait une vie de
proscrit tenant le maquis et nourrissant l'espoir que l'invasion
romaine lui permettrait de recouvrer son royaume. Il sera d' un
concours fort prcieux pour Scipion. Celui-ci dbarqua en Afrique
en 204. Les Carthaginois et Syphax ratrent l'occasion de le cueillir
son dbarquement et ne profitrent pas de ses premires difficul-
ts, lui laissant le temps de s'installer dans le pays et d'y fortifier ses
positions. Bientt, avec le concours de Massinissa, il russit infli-
ger de cuisante dfaites ses adversaires. Hannibal fut rappel de
toute urgence d'Italie. Aprs avoir franchi la mer sans encombre, il
dbarqua epti Minus (Lemta). Il leva quelques recrues la hte
puis livra bataille Scipion prs de Zama, dont l'emplacement pr-
cis vient d'tre connu. Scipion, grce Massinissa, disposait d' une
cavalerie numide dont l'absence se fit cruellement sentir dans les
rangs d' Hannibal qui ne put viter la dfaite. Celui-ci conseilla sa
patrie de faire la paix.
L'effacement de Carthage et la fin d'Hannibal
Au printemps 201, la paix fut signe. Carthage devait payer
une indemnit de 10 000 talents chelonns sur 50 ans et livrer ses
lphants et sa flotte l'exception d' une dizaine de navires. Elle
conservait son territoire africain mais laisserait Massinissa les ter-
ritoires qui lui appartenaient ou avaient appartenu ses anctres.
Carthage en outre ne devait plus faire la guerre hors d' Afrique et, en
Afrique mme, elle ne pouvait la faire qu'avec l'accord de Rome. Ce
trait sonnait le glas de Carthage en tant que puissance mditerra-
nenne ; elle perdait sa place sur le plan international, ses moyens et
sa libert d'action tant sur le plan extrieur qu'intrieur. C'est pei-
ne si elle disposait d' une certaine autonomie pour la conduite de ses
affaires intrieures.
Le premier problme srieux qui se posa Carthage au lende-
main de la paix tait le payement de l'indemnit de guerre. Or le
gouvernement aristocratique multiplia les pratiques de corruption,
Paysage de la rgion de Zama
Vaste plaine autour de Zama, en Tunisie centrale. C'est dans cette rgion qu'eut lieu
la bataille dcisive entre Rome et Carthage, entre Scipion et Hannibal, deux grands
capitaines la tte de deux grandes armes. 80 000 fantassins et 10 000 cavaliers
s'y affrontrent. La dfaite de Carthage en 202 av. J.-C. marque la fin de la deuxi-
me guerre punique.
Croquis de la bataille de Zama
Dispositif des armes avant les combats (croquis par S. Lance l
d'aprs H. H. Scullard)
74.
L'ANTIQUIT
allant jusqu' dtourner au profit de ses membres l'argent destin
tre vers Rome. Mcontentes, les masses populaires tirrent Han-
nibal de la retraite o il s'tait confin ds l'anne 200 et le port-
rent au pouvoir en l'lisant suffte en 196. Hannibal frappa dure-
ment les concussionnaires, mit fin aux malversations et assainit les
finances publiques. Il tenta en mme temps de rorganiser la consti-
tution carthaginoise par des rformes tendant briser l'omnipoten-
ce de l'aristocratie et introduire plus de dmocratie dans la vie
politique de la cit. Soutenus par le peuple, ses efforts faillirent tre
couronns de succs, mais l'aristocratie plus soucieuse de ses privi-
lges que des intrts rels de l'tat, dnona Rome son action
rvolutionnaire, l'accusant de surcrot de prparer une nouvelle
guerre de revanche. Hannibal, conscient de la versatilit des foules
qui le soutenaient et dsireux, semble-t-il, d'viter son pays de
nouvelles preuves, prfra s'enfuir.
Pendant plusieurs annes il parcourut l'Orient, cherchant
pousser la guerre contre Rome, les souverains de divers pays. Mais
la haine implacable des Romains le poursuivit partout et, en 181, il
prfra se suicider en Bithynie plutt que de tomber entre les mains
de ses adversaires.
Ce fut incontestablement l'un des plus grands hommes de
l'antiquit. Les Romains, ses pires ennemis, ne purent s'empcher
d'exprimer leur admiration devant certaines de ses qualits. Ses
dons de chef et d'entraneur d' hommes constituent un sujet d'ton-
nement pour tout le monde. Tite-Live crivait : Hannibal, pendant
16 ans qu'il lutta contre les Romains en Italie, n'accorda aucun cong ses
troupes... Il les garda constamment sous sa main sans que le moindre trouble
clatt entre elles ou contre lui. Pourtant son arme tait compose de gens qui
appartenaient, non seulement des peuplades, mais des races trs diverses. Il
avait avec lui des Libyens, des Ibres, des Ugures, des Phniciens, des Italiens,
des Grecs entre lesquels n'existaient aucune communaut de lois, de murs, de
langues, aucun lien naturel. Il eut l'habilet de plier la mme pense des
hommes si diffrents malgr les vicissitudes de la guerre et les caprices de la for-
tune... Jamais il ne fut en butte un complot. Jamais il ne fut trahi par ses com-
pagnons d'armes .
Dessin de J. Martin, ralis en 1986, pour le 28"" centenaire de la fondation de
Carthage, proposant, partir de la disposition des vestiges en place, une restitution
imaginaire de la rue principale du quartier punique de Byrsa,
76.
L'ANTIQUIT
Il y a en histoire peu de noms aussi prestigieux que celui
d'Hannibal qui devint rapidement un hros d'pope, chant depuis
l'antiquit. Hommes politiques, historiens, philosophes parlent de
lui en termes trs admiratifs. Montesquieu l'appelle le colosse de
l'antiquit ; Thiers l' homme qui Dieu dispensa tous les dons
de l'intelligence ; Michelet la plus formidable machine de guerre
de l'antiquit ; Napolon le plus grand capitaine du monde .
Gsell crivait : aucun homme de guerre, sauf Napolon, n'a
t plus favoris de dons qui s'excluent : l'imagination, le jugement
et la volont . Enfin, Dodge l'appelle le pre de la stratgie .
CHAPITRE VI
La civilisation carthaginoise :
les bases de la puissance
Les guerres puniques ont donc abouti la dfaite des Cartha-
ginois. Cependant, les revers subis ne doivent pas masquer toute la
vitalit dont Carthage fit preuve au cours de son histoire mouve-
mente. Elle se hissa au rang de puissance non seulement capable
de jouer les premiers rles politiques mais mme d'influer sur le
destin du monde antique. L'insuffisance, voire parfois l'absence de
documents relatifs la civilisation punique a entran certains his-
toriens imaginer Carthage comme une nation fige, uniquement
proccupe de ses intrts matriels et presque sans civilisation. De
nos jours, on tend de plus en plus montrer qu'elle ne fut pas seu-
lement une ppinire de guerriers valeureux comme Amilcar, Has-
drubal ou Hannibal mais aussi le foyer d' une civilisation originale,
brillante par certains aspects, qui a rayonn en Afrique et qui s'est
mme propage dans certains pays d' Europe.
L'empire et le commerce
Au dbut du III
e
s. avant J.-C., les Carthaginois taient certai-
nement la plus forte puissance maritime et commerciale du bassin
occidental de la Mditerrane.
78. L'ANTIQUIT
Cette puissance reposait, en premier lieu, sur un vaste empi-
re : les Carthaginois possdaient en effet toutes les ctes d'Afrique
du Nord depuis la grande Syrte jusqu'au dtroit de Gibraltar, une
zone territoriale tendue comprenant peu prs toute la Tunisie, le
rivage atlantique du Maroc, les rivages de l'Algrie et de l'Espagne
mridionale, les Balares, Malte, la Sicile occidentale et centrale, la
Sardaigne, les ctes de la Corse.
Plusieurs cits jalonnent cet immense empire. Les principales
sont:
- En Tripolitaine : Lepcis, Oea et Sabratha.
- Sur la cte est de la Tunisie : Acholla, Sullectum, Thapsus,
Leptis, Hadrumetum, Neapolis, Clupea, Gigthis.
- Sur la cte nord de la Tunisie : XJtica, Hippo Diarrhjtus
(Bizerte).
- En Algrie : Icosium (Alger), Tipasa, loi (Cherchel).
- Au Maroc : Tingi (Tanger), Lixus.
- En Espagne : Gads.
La puissance carthaginoise entretenait des relations commer-
ciales tendues, tant en Mditerrane que dans l'Atlantique.
C'taient de vritables rouliers des mers qui vivaient essentielle-
ment du commerce.
Au dbut, l'conomie carthaginoise reposait essentiellement
sur un commerce exclusivement tourn vers la concentration, l'en-
trept et la redistribution, puis, grce la conqute du territoire
tunisien, ce commerce s'enrichit considrablement par les produits
d'une agriculture savamment mise au point et mthodiquement
exploite et d' un artisanat trs riche et trs diversifi.
Il y avait deux grands courants commerciaux. Carthage dte-
nait presque le monopole du commerce atlantique qu'elle pratiquait
dans deux directions essentielles.
Les rivages de l'Afrique Noire : ce commerce tait trs lucra-
tif car il semble que Carthage changeait des produits brillants mais
sans grande valeur, de la pacotille, contre de l'or, des peaux, de
l'ivoire et des esclaves. Le fameux priple de Hannon n'tait vi-
demment pas tranger ce type d'changes. Ce mme type de com-
Carthage au dbut du II
e
sicle av. J.-C.
Reconstitution par J.-C. Golvin
La reconstitution, prsente partir du fond du golfe,
montre la ville installe dans la partie sud-est de la presqu'le,
la colline de Byrsa, les deux ports. Les ncropoles sont tales au nord sur
les versants des collines formant un arc autour du centre. Au-del, c'est la zone
rurale, Mgara, faubourg de Carthage. Celle-ci est intgre dans l'enceinte
de la ville constitue par la muraille maritime le long de la cte avec, comme
avant-poste renforc, les bassins portuaires et la muraille intrieure
barrant l'isthme qui rattache la presqu'le au continent.
Carte du Golfe de Carthage l'poque punique
On observe que la presqu'le de Carthage se dtache plus nettement
qu 'aujourd'hui.
80. L'ANTIQUIT
merce avec l'Afrique tropicale se faisait galement par caravanes
qui, partant des ports de Tripolitaine, empruntaient une voie ter-
restre passant par le Fezzan.
Les rivages europens : essentiellement ceux d' Armorique,
d'Angleterre et d'Irlande. C'tait surtout la recherche de l'tain qui
avait pouss Himilcon et les commerants carthaginois vers ces
lointains rivages.
Carthage avaient des relations beaucoup plus soutenues avec
les pays mditerranens et en particulier avec le monde grec. Mal-
gr une coupure assez longue au V
e
s., marque par la raret relati-
ve de la cramique attique figures rouges dans les vestiges
puniques, le commerce avec les Grecs reprit son cours le plus actif
aprs la conqute d'Alexandre. De nombreux objets alexandrins et
des amphores rhodiennes trouvs dans les ncropoles puniques de
Ca rt ha ge prou ven t la prosprit de ce commerce a vec l' Egypte lagi-
de ou Rhodes. Les changes taient aussi nombreux avec bien
d'autres rgions mditerranennes telles la Campanie, l'trurie,
l'Espagne, la Sicile, Dlos etc... Avec ces divers clients ou fournis-
seurs mditerranens, Carthage changeait matires premires, pro-
duits fabriqus et produits agricoles. Grce leur remarquable esprit
d'entreprise et leur recherche constante d' ouvertures sur le mon-
de extrieur, mis au service des richesses de l'agriculture et de l'ar-
tisanat, les Carthaginois ont fait de leur mtropole, la plaque tour-
nante du commerce mditerranen.
Il faut cependant signaler le fait, quelque peu insolite, que Car-
thage, grande puissance commerante, n'ait commenc utiliser la
monnaie que vers la seconde moiti du IV
e
s. Jusqu' cette date le
troc semble avoir t la base de ses changes.
L'agriculture
Depuis la conqute puis l'exploitation du territoire tunisien,
Carthage tait devenue un des plus grands producteurs agricoles de la
Mditerrane. Deux zones essentielles sont distinguer en matire
d'agriculture.
POQUE CARTHAGINOISE
81
La chora : comprenant la campagne de Carthage, le Cap
Bon et une partie du Sahel (appele alors Bj^adum). C'tait une zone
d'agriculture spculative exploite directement par les grands pro-
pritaires puniques selon une technique savamment mise au point
par des agronomes dont le plus clbre tait Magon. Les Carthagi-
nois y pratiquaient l'levage, l' ol i cu lt u re, la vi t i cu lt u re sans ou bl i er
la culture des arbres fruitiers tels les figuiers, les amandiers et sur-
tout les grenadiers qui, transplants des jardins de Tyr et inconnus
des Romains, reurent de ceux-ci le nom de pommes puniques .
Les soldats d'Agathocle et de Regu/us furent blouis par la richesse
des campagnes du Cap Bon en btail et en arbres fruitiers. Nul dou-
te que l'extension des fouilles dans la cit punique de Kerkouane
apporteront de nouvelles lumires sur cette richesse dont parlent les
textes.
L'hinterland : c'est une zone s'tendant l'ouest et au sud
de la chora , habite et cultive par des sujets libyens, elle tait
consacre la craliculture. Ces paysans indignes y vivaient mis-
rablement, astreints au servage, exploits et livrant une large pro-
portion de leurs rcoltes Carthage au titre de tribut. Ils taient tou-
jours prts la rvolte. La production cralire de cette rgion
contribuait largement alimenter les exportations carthaginoises
vers certains pays mditerranens.
Les hautes performances de l'agriculture carthaginoise sont
en grande partie des l'uvre magistrale de Magon (IV
e
s. avant
J.-C.), considr juste titre comme le pre de l'agronomie , par
le spcialiste romain Columelle (I
er
s. aprs J.-C.). Ses ouvrages for-
ment une vritable encyclopdie en vingt huit volumes largement
diffuse dans tout le monde antique grce des traductions int-
grales grecques et latines et grce la mise en circulation de versions
abrges. Sa doctrine, trs technique et trs dtaille, touche tous
les domaines de l'agriculture, de l'levage et de la gestion rurale
d'une faon gnrale. Il a mis au point des procds de culture par-
ticulirement adapts aux conditions gographiques et climatiques
de la Tunisie antique. Ses recommandations et ses recettes sont
82. L'ANTIQUIT
riches en indications prcises sur la culture de l'olivier et de la vigne
et notamment sur la production des vins, et en particulier d' un vin
liquoreux partir des raisins schs au soleil et qui s' apparente au
passum des Romains. En tout cas de nombreuses amphores
puniques ont t trouves sur de multiples sites mditerranens et
surtout sur les ctes d' Afrique du Nord, d'Andalousie, de Catalogne
et de Corse ainsi qu' Marseille, Vintimille, Rome et Athnes.
Ces amphores, ayant servi sans doute l'exportation de l'huile et du
vin, tmoignent des succs de l'agriculture punique.
L'artisanat
Les Carthaginois s'taient surtout spcialiss dans les
constructions navales et l'outillage des ports. Mais ils se livraient
galement d'autres activits fort varies. Les verriers fabriquaient
des perles, des masques minuscules, des flacons parfum multico-
lores.
Les produits tisss, brods ou teints en pourpre surtout jouis-
saient d' une grande rputation sur les marchs mditerranens. Le
travail du cuir, des mtaux, du bois compltait cette production de
valeur qui tait destine l'exportation ou la consommation d' une
aristocratie restreinte. La masse de la population s'adressait des
artisans mdiocres qui, souvent, imitaient maladroitement les
modles emprunts la Grce ou l'Egypte.
Les textes anciens et surtout l'pigraphie tmoignent d' une
intense activit artisanale qui a t confirme par les fouilles et
notamment par la mise au jour Carthage de nombreux vestiges
d'installations artisanales s'chelonnant du VIII
e
au II
e
s. avant J.-C.
Les traces d'industries mtallurgiques sont cet gard considrables
comme le montrent plusieurs dcouvertes et surtout celle d' une
importante aire d'ateliers de traitement du fer et du cuivre dans le
secteur sud de la colline de Byrsa. De son ct, la cramique, por-
tant la fois la marque de ses racines phniciennes et orientales et
Vases puniques en terre
cuite
Four pain punique.
Muse de Carthage. H. 19 cm.
Cette terre cuite miniature reproduisant
un four pain rustique a t
trouve dans une ncropole punique
de Carthage. Le four, dform
tronconique prsente une ouverture
au-dessus de laquelle une mnagre
est penche pour plaquer la galette
contre la paroi intrieure pralablement
chauffe. Il s'agit d'une technique de
cuisson simple remontant la nuit des
temps et qui n 'a pas totalement disparu
en Afrique du Nord. C'est la tabouna
de la campagne tunisienne.
Les vases en poterie taient
d'un usage courant et multiple
rpondant tous les besoins
de la vie quotidienne. Aussi
leurs formes et leurs volumes
taient-ils trs diversifis :
amphores pour contenir l'eau,
pour transporter le vin et
l'huile, pour conserver les
produits agricoles ou ceux de
la pche. La vaisselle commu-
ne comme les lampes, les
plats, les coupes, les cruches
tait trs diversifie et son
usage tait trs rpandu.
La plasticit de l'argile et le savoir faire des
potiers ont permis de satisfaire tous les besoins
de la vie quotidienne. On en retrouve quantit
d'exemplaires dans le mobilier funraire
accompagnant les morts dans leur tombe.
84.
L'ANTIQUIT
subissant l'influence de divers modles mditerranens, est aussi
riche que varie. On peut mentionner galement la tabletterie, dj
en vogue ds le VIP s., et donnant lieu une riche production d'ob-
jets en os et en ivoire : pingles cheveux, peignes, jetons, stylets,
charnires, rondelles, garnitures de meubles et autres objets de
dcoration.
Sarcophage dit de la prtresse
Muse de Carthage
Il a t trouv dans le mme caveau que le sarcophage
dit du prtre reproduit p. 39
CHAPITRE VII
La civilisation carthaginoise :
les instruments de la puissance
La flotte et l'arme
Carthage possdait une flotte de premier plan. Hritire de la
clbre flotte tyrienne, elle comptait plusieurs milliers de navires
construits par des artisans expriments et habiles. Les arsenaux de
Carthage furent parmi les plus clbres de toute l'Antiquit ; les
marins eux-mmes avaient une profonde connaissance de la mer et
quoique ignorant la boussole, ils arrivaient se guider d'aprs la
grande Ourse. En temps de guerre, l' tat rquisitionnait les navires
de commerce et leurs quipages pour le transport des troupes et du
matriel. Il semble bien, qu' en temps de paix, la marine officielle ne
ft jamais trs nombreuse, servant simplement protger les
convois contre les pirates ou garder les abords des zones d'exclu-
sivit carthaginoise en matire de commerce. Mais, en temps de
guerre, l' tat peut mettre en circulation jusqu' 350 navires la fois.
L' tat carthaginois tait d'ailleurs plein d'initiatives et donnait
un appui sans rserve tous les efforts d' expansion conomique ou
de crations de monopoles. Ainsi, il n'hsita pas organiser les
audacieux priples d' Hannon et d'Himilcon, s'ingniant dpister
les suiveurs et les effrayer en rpandant des bruits terrifiants sur
les routes maritimes menant aux zones d' influence carthaginoises,
86.
L'ANTIQUIT
veillant ainsi jalousement ce que ces expditions soient envelop-
pes du secret et du mystre les plus totaux. Enfin il intervenait sou-
vent par la diplomatie ou par la force pour protger les intrts de
ses ressortissants.
Lorsque l'intrt l'exigeait, l'tat intervenait donc, soutenant
sa politique d'expansion par l'arme. Celle-ci tait essentiellement
constitue de mercenaires. Certes, il y avait au dbut des corps d'li-
te composs de citoyens, tels les 2 500 jeunes aristocrates du
bataillon sacr qui se firent tuer jusqu'au dernier en Sicile. Mais sou-
cieuse de mnager le sang de ses citoyens, Carthage ne voulut plus
les mobiliser qu'en cas de danger imminent menaant l'existence
mme de la ville.
Pendant les guerres puniques, par exemple, le gros de l'arme
tait constitu par des mercenaires, des contingents composs de
sujets qui tait impose une sorte de service militaire et des
troupes auxiliaires fournies par les rois vassaux de Carthage. Le
concours des cavaliers numides tait particulirement prcieux pour
cette arme qui posait de nombreux problmes d'organisation et de
maniement. En effet, en son sein se groupaient les reprsentants
des races, des langues, des religions et des traditions les plus
diverses. Le grand mrite d'Hannibal, ce fut d'avoir russi donner
une me cette mosaque de soldats qu'tait l'arme carthaginoise.
Il groupa ses hommes en corps nationaux encadrs par des officiers
de leur race, mais commands l'chelon suprieur par des chefs
carthaginois et affects des tches spcialises selon leur arme-
ment et leurs traditions nationales.
Les Carthaginois firent, d'autre part, progresser l'art des siges
et des fortifications. Les remparts de leur ville, longs de 34 km,
hauts de 13 m, larges de 8 m et comportant une tour tous les 60 m
avec de multiples casernes et des curies pour 300 lphants et 4000
chevaux plongrent tous les contemporains dans l'admiration.
De mme, les Carthaginois firent figure originale en transpor-
tant en Occident cette pratique de guerre qui n'existait qu'en Orient
et qui consistait utiliser les lphants comme chars d'assaut
dans les affrontements.
POQUE CARTHAGINOISE 87
Cependant cette arme carthaginoise posait deux problmes :
- Un problme financier : elle tait d' un entretien fort coteux.
- Un problme politique : celui des chefs, de leur place dans
l' tat ou de leurs rapports avec les civils.
Le recours des mercenaires confrait une gravit particuli-
re ces deux problmes car, d' une part les mercenaires pouvaient
faire valoir leurs exigences financires par la force (la guerre des
mercenaires qui mit Carthage en difficult le prouva bien) ; d'autre
part, trangers et soldats de mtier, ils pouvaient, obissant aveu-
glement leur chef, l'aider tenter un coup d' tat.
Les institutions politiques
La constitution de Carthage tait considre par les anciens
comme le type mme de la constitution mixte groupant les
meilleurs lments des trois principaux rgimes politiques, monar-
chique, aristocratique et dmocratique. N'tait-elle pas, en effet,
caractrise par un pouvoir excutif fort, de type monarchique, un
conseil restreint mais permanent de type aristocratique et une
assemble populaire de type dmocratique ?
En fait, tat colonial et commerant, Carthage a t ds sa
fondation dans la dpendance d' une aristocratie de commerants,
de marins et de prtres. Il est vrai qu' tant donn le caractre insuf-
fisant et trs vague des renseignements que nous fournit Aristote,
dans sa Politique, sur la constitution de Carthage, on peut difficile-
ment en voquer le mcanisme avec prcision. Cependant, il semble
bien que la cit ait connu un rgime monarchique au dbut auquel
avaient succd par la suite les deux sufftes. C'taient la fois des
juges et des leaders politiques qui taient lus pour un an par l'as-
semble populaire et qui devaient remplir certaines conditions de
naissance et de fortune. Ces sufftes runissaient et prsidaient le
Snat et l'assemble populaire et rendaient la justice, mais n'avaient
aucune attribution militaire. Le commandement des armes revenait
des gnraux lus pour une priode dtermine (la dure d' une
88.
L'ANTIQUIT
guerre par exemple). Tous les citoyens pouvaient, en thorie, tre
lus gnraux, mais en fait le commandement militaire revenait tra-
ditionnellement aux membres de certaines grandes familles comme
les Magonides ou les Barcides.
La situation des gnraux avait quelque chose de prilleux
dans la mesure o l'aristocratie carthaginoise, soucieuse de prser-
ver ses privilges, se mfiait des hommes de gnie et chtiait les
mdiocres. Cette attitude tait parfois paralysante pour les gnraux
en campagne qui, souvent, vitaient de prendre des initiatives dont
ils pourraient avoir rendre compte.
Un Snat groupant 300 membres choisis dans la classe aristo-
cratique et se renouvelant probablement par cooptation discutait
des affaires intressant la politique trangre, la guerre et la paix, le
recrutement des armes et l'administration des colonies. En cas de
conflit entre le Snat et les sufftes, on faisait intervenir, semble-t-
il, l'assemble populaire. Ds le III
e
s. trente snateurs sigeaient en
permanence pour rgler au jour le jour, les questions urgentes.
Une large part du pouvoir revenait de multiples comits de
cinq membres, les pentarchies , qui se recrutaient par cooptation
et taient chargs du contrle de certains domaines administratifs.
Une surveillance gnrale tait dvolue un tribunal de cent quatre
membres dont le rle tait comparable celui des phores Sparte
et qui faisait rgner la terreur partout. Ce tribunal devait essentielle-
ment parer toute tentative de coup d'tat ou de tyrannie. Il arrivait
galement qu'il expdit les gnraux vaincus au supplice. On
connat assez mal le rle de l'assemble populaire qui lisait les
gnraux et les sufftes, arbitrait les conflits ventuels entre Snat et
sufftes, mais qui, avant le II
e
s., ne semble pas avoir jou de rle
politique important
Il est cependant certain qu' la veille de sa chute, Carthage
avait rform sa constitution dans un sens rsolument dmocra-
tique en largissant la comptence de son assemble populaire, dont
le rle tait restreint, jusque l, l'lection de gnraux et de suf-
ftes qui devaient remplir certaines conditions de naissance et de
fortune et qui appartenaient donc la noblesse. D' autre part, il tait
Inscription punique de Carthage
Muse de Carthage
Texte de plusieurs lignes grav sur une dalle de calcaire noir dcouverte
en 1964, hors de son contexte. Elle est tronque gauche.
Ce texte a fait l'objet de plusieurs traductions non dfinitives pour certains mots.
Il commmore la ralisation d'un grand ouvrage dilitaire et plus
prcisment, semble-t-il, le percement d'une rue, moins qu'il ne s'agisse
d'une muraille et de la construction d'une porte. L'inscription date de
l'poque des guerres puniques (III
e
s. av. J.-C.).
Quartier punique de. Carthage (V
e
- IV
e
s.
Cet essai de restitution d' un quartier d'habitat en bordure de mer est ralis a
partir des fouilles dans un secteur aujourd'hui habit.
L'urbanisation du quartier s'est
faite durant la priode allant du
V
e
au III
e
s. av. J.-C. : on
remarque la muraille maritime
renforce de tours et perce
d'une porte monumentale.
Derrire elle, s'abritent
les imits d'habitation
implantes selon un schma
rgulier. Ce sont des
maisons de proportions
modestes, mais pourvues
de commodits et de confort.
90.
L'ANTIQUIT
rare que snateurs et sufftes, membres d' une mme classe, entrent
en conflit pour qu' on puisse avoir recours l'arbitrage de l'assem-
ble. Finalement la constitution punique apparat comme typique-
ment aristocratique et ne groupait pas rellement, comme l'affirmait
Aristote, les meilleurs lments des divers rgimes politiques. Il est
mme probable qu'Aristote ne l'a apprcie ce point que parce
qu'elle tait rsolument aristocratique. Nanmoins, il convient de
souligner l' attachement des Carthaginois aux structures collgiales
et leur mfiance constante l'gard du pouvoir personnel.
La cit et la socit
Importante mtropole africaine, Carthage tait, au moment de
son apoge, une des plus grandes et des plus belles villes de la Mdi-
terrane occidentale. Jusqu' une date rcente, sa configuration
urbanistique demeurait presque inconnue par suite des destruction
subies en 146 avant J.-C. et de la roccupation du site l' poque
romaine qui entrana de gigantesques travaux d' arasement, de com-
blement et de ramnagement occasionnant notamment la dispari-
tion totale de toute trace de la Ville Haute l' emplacement de
laquelle s'levrent la colonie augustenne et le forum. Cependant,
grce aux acquits des fouilles menes dans le cadre de la campagne
internationale de sauvegarde de Carthage depuis 1972, les textes lit-
traires et l'pigraphie aidant, les grandes lignes de l'volution de la
cit punique commencent tre mieux connues. On sait, prsent,
que la ville tait, ds ses dbuts, bien structure. Elle comprenait,
outre la citadelle occupant une position dominante sur l'acropole de
Byrsa et constituant le centre nvralgique de la cit, un important
habitat couvrant la plaine littorale et intgrant un secteur industriel
qui a laiss de nombreuses traces d'activits mtallurgiques, de tein-
turerie et de foulage. Les ncropoles occupaient les zones priph-
riques. De nombreux sondages ont montr que les difices s'ali-
gnaient paralllement la cte et que l'urbanisme tait dj dense et
structur l' poque archaque.
Le site de la colline de
Byrsa Carthage.
La photographie montre,
l'arrire- plan, la plaine
littorale avec le golfe domin
par le mont Boukornine;
au premier plan,
un palier du versant de la
colline de Byrsa avec des
vestiges puniques. Le pilier
massif qui se dresse au centre
appartient aux fondations
d'un monument romain dispa-
ru. L'enlvement des remblais
l'entourant a mis au jour les
vestiges puniques jusque-l
ensevelis : c 'est tout un
quartier d'habitat rvlant un
pan de l'urbanisme
carthaginois : des lots
d'habitation construits suivant
un plan rgulier, probablement sous le gouvernement d'Hannibal au dbut du
II' s. av. J.-C. Le quartier sera dtruit
lors de la prise de la ville par Scipion en 146 av. J.-C.
Coupe de la colline de Byrsa
(S. Lancel)
Le dessin montre une coupe nord-sud de la colline de Byrsa au niveau du quartier
punique prcdent. Elle illustre, travers les profondes transformations qui ont
affect le sommet de la colline l'poque romaine, la situation des vestiges
puniques subsistants. Pour la priode romaine, on observe la plateforme
cre pour recevoir les difices du forum : sommet aras,
versants surlevs et entours d'un grand mur de
soutnement pour
contenir les remblais.
Ensevelis sous la masse de
ces remblais, les
vestiges de l'habitat
punique qui ont
rapparu au jour aprs
enlvement de ces
terres par les fouilles
archologiques rcentes.
Versant mridional de la colline de Byrsa
Siveaux puniques Niveaux romains
1- ncropole 4- fondations
2- ateliers de mtallurgistes 5- forum
3- rez-de-chausse des immeubles 6- arasement du sommet
92.
L'ANTIQUIT
la trame gomtrique orthogonale de l'habitat de la plaine,
s'opposait un tissu urbain plus souple, de type rayonnant dit en
ventail , impos par la topographie escarpe des pentes de la col-
line de Byrsa. L'articulation entre les deux systmes tait assure par
l'agora, grande place publique.
Tout au long de son volution, Carthage s'agrandissait sans
cesse tantt au-del des zones industrielles et des ncropoles, tantt
leur dtriment. Jusqu'au V
e
s. avant J.-C., seul l'espace urbain de
l'acropole tait fortifi puis, partir de cette date, une grande
muraille de 5,20 m d'paisseur protgea l'ensemble de la cit du ct
de la mer, entre la colline de Borj-Jedid et la baie de Kram. La plus
grande extension de la ville se fit vers le nord, atteignant et dpas-
sant les hauteurs de Sidi Bou Sad par son faubourg de Mgara. Au
IV
e
s., une re de grande prosprit favorisa l'embellissement de la
cit et de sa parure monumentale. Loin de se ralentir l'poque des
guerres puniques (III
e
et II
e
s.), cet essor s'acclra notablement
comme en tmoigne un quartier d'habitation amnag proximit
immdiate de la mer et comportant de somptueuses demeures, cou-
vrant chacune 1000 1500 m
2
, agrmentes de pristyles et de gale-
ries et dont les sols et les murs taient richement dcors.
Carthage devait alors impressionner ses visiteurs avec sa faa-
de maritime protge par une importante muraille en pierre de taille
stuque et surmonte de corniches moulures, son acropole l'as-
pect grandiose, domine par le majestueux temple d' Eschmoun
desservi par un escalier monumental de soixante marches et ses
divers autres difices publics dont notamment le sanctuaire de Res-
chef (Apollon) admir par Appien qui le situait au bord de l'agora
et dont les vestiges semblent avoir t reprs par l'quipe alleman-
de. Celle-ci a mis au jour un monument important, dont la vaste
cour, outre des fts de colonnes et de grands chapiteaux stuqus, a
rvl des centaines de sceaux d'argile avec des empreintes de car-
touches de pharaons gyptiens et des gemmes grecques destines sceller des docu-
ments de papyrus qui ont brl lors de l'incendie de 146 avant J.-C. . D'aprs
les textes, la cella de ce temple - s'il s'agit bien de celui de Reschef -,
POQUE CARTHAGINOISE
93
avait les murs revtus de feuilles d' or et contenait une statue du cul-
te dore qui fut emporte Rome en 146 o elle tait encore visible
a u II
e
s. aprs J.-C. en bordure du circus flaminius. Non loin de ce
sanctuaire se trouvaient les clbres ports puniques.
Ces ports, que de rcents travaux font beaucoup mieux
connatre, ont t amnags vers la fin du III
e
ou au dbut du II
e
s.
avant J.-C. Auparavant, on suppose qu' on utilisait des installations
qui existaient au mme emplacement ou peut-tre en bas de la col-
l i ne de Borj Jedid, l o se trouvent les vestiges des thermes d' An-
tonin. Considrs comme l'une des grandes ralisations du monde
antique leur poque, ces ports taient constitus de deux bassins,
l'un vocation marchande, l'autre militaire. Un chenal de 20 mtres
de large les reliait.
Creus artificiellement et ouvert sur le large auquel il tait reli
par un chenal d'accs, le premier port tait de forme rectangulaire
et couvrait une surface de sept hectares ; sa profondeur tait de
2,50 m. Il tait flanqu d' un terre-plein amnag de main d' homme,
dit quadrilatre de Falbe , qui tait la fois un avant-port contre
les vents dominants et un espace de manuvres, d' embarquement
et de dbarquement des marchandises.
Situ plus au nord que le port de commerce, le port militaire,
de forme circulaire, a mieux conserv ses structures de base. Sa pro-
fondeur atteint 2 m environ et sa surface utilisable est suprieure
six hectares. Au milieu se dressait l'lot de l'amiraut sur lequel tait
amnag le pavillon du commandant de la flotte et la tour de sur-
veillance du mouvement des navires au large. Trente cales de
radoub et d'hivernage d' une longueur de 30 50 mtres environ
permettaient d'abriter une trentaine de navires qu' on faisait glisser
sur des traverses en bois. Sur le pourtour du port circulaire o les
quais ont t tablis, cent trente cinq cent quarante autres cales
d' une longueur de 40 mtres chacune ont t mises en place. L' en-
semble formait cent soixante cinq cent soixante dix cales pouvant
accueillir un nombre de navires peu prs quivalent au chiffre de
deux cent vingt avanc par Appien.
94.
L'ANTIQUIT
Cet important amnagement naval, fruit d'une prosprit
retrouve, aurait, semble-t-il, inquit Rome et suscit son attitude
belliqueuse qui devait aboutir la destruction de Carthage.
Au sein de cette ville norme se pressaient, selon Strabon,
700 000 habitants. Ce chiffre considrable pour une cit antique
parat quelque peu exagr, mais on pense que Carthage ne comp-
tait pas moins de 3 400 000 habitants.
la tte de la hirarchie sociale on trouvait une aristocratie de
prtres, de grands commerants, d'armateurs et de gros propri-
taires fonciers dtenant l'essentiel du pouvoir politique, gostes et
jalousement attachs tous leurs privilges.
En dehors de ces nobles, on comptait beaucoup de commer-
ants moyens et petits, des artisans et ouvriers mtallurgistes,
menuisiers, tisserands, potiers, verriers, fondeurs et des indignes
africains attirs par les nombreuses ressources que pouvait offrir un
grand port. Groups au sein de corporations, ils s'entassaient dans
la ville basse, comme nous l'apprend une inscription carthaginoise.
Il y avait galement de nombreux esclaves. Leur mariage tait
reconnu par la loi et ils taient parfois affranchis. Ceux qui servaient
comme domestiques en ville taient gnralement bien traits et
demeurrent fidles leurs matres.
En revanche, diffrente tait l'attitude adopte l'gard de la
masse des sujets rduits l'esclavage ou au servage, travaillant dans
les domaines des aristocrates carthaginois, odieusement exploits et
vivant dans des conditions insupportables. Aucune considration
humaine ne venait adoucir le sort de ce proltariat misrable, enti-
rement la merci d'employeurs gostes et exclusivement soucieux
d'augmenter la rentabilit de leurs entreprises. L'histoire sociale de
Carthage est avant tout celle des rvoltes explosives de ces Berbres
dshrits qui, par ailleurs, ne ratrent pas une occasion de faire cau-
se commune avec les envahisseurs et ennemis de la cit punique.
A ces divers lments s'ajoutait la masse turbulente et redou-
table des mercenaires souvent disposs s'emparer des richesses de
leurs employeurs.
Carthage punique
( Esquisse de J.-C. Golvin )
Dessin prsentant une res-
titution de la ville basse
l'poque punique, faite
partir du paysage actuel et
d'aprs les textes antiques
et les dcouvertes
archologiques rcentes.
A l'arrire-plan, le port
marchand, bassin
rectangulaire s'ouvrant sur
une petite anse. Il est bord
de quais et d'entrepts.
Il est accost, en pleine
mer, d'une large plate-
forme artificielle servant de
dbarcadre, le chma signal par les auteurs anciens.
En arrire du port marchand, le port militaire : c'est un bassin circulaire dont le
centre est occup par un lot dit de l'Amiraut. C'est un port secret et fortifi,
entour sur tout le pourtour d'une srie de loges destines abriter les navires de
guerre. Autour des deux bassins, les quartiers commerciaux, artisanaux et d'habi-
tation avec, figure au premier plan, la place commerciale de l'agora.
L'lot de l'Amiraut,
Port militaire de Carthage punique. ( Antiquarium des ports )
Reconstitution partir de l'tat des lieux, la
lumire des textes anciens et des fouilles archologiques rcentes.
C'est un immense hangar couvrant des alignements de cales construites en rampes
de carnage
inclines, disposes en
ventail. Elles rayonnent
depuis une cour
hexagonale ciel ouvert,
surmonte du pavillon de
vigie o se trouve l'amiral
de la flotte de guerre.
D'aprs l'historien
Appien, le port militaire
pouvait contenir 220
navires constitus essen-
tiellement de trirmes ou
trires.
96.
L'ANTIQUIT
En dfinitive Carthage prsentait l'aspect d'une grande cit
cosmopolite o vivaient cte cte des Orientaux, des Grecs, des
Maltais, des Siciliens, des Espagnols. Souvent mme les trangers s'y
installaient et y faisaient souche. Les Carthaginois qui ne semblent
pas avoir t racistes leur rservaient un excellent accueil et ceux
parmi eux qui faisaient preuve de valeur personnelle pouvaient
mme obtenir la citoyennet carthaginoise. Les mariages mixtes
taient d'autre part admis par la loi et frquents.
Enfin les femmes semblent avoir joui Carthage de beaucoup
de considration. Elles avaient accs aux plus hautes charges, sur-
tout dans le domaine religieux. Partant de la constatation que les
tombes, les plus anciennes surtout, contenaient des couples on a
pens que la polygamie n'existait pas. En tout cas, le fait que les
quelques noms de Carthaginoises parvenus jusqu' nous taient
troitement lis au destin de la ville montre bien la place importan-
te occupe par celles-ci dans la cit. Elissa symbolise la naissance de
Carthage, et Sophonisbe sa mort.
Sur le plan des murs et du genre de vie, les Carthaginois
taient demeurs attachs l'Orient. Ils parlaient et crivaient une
langue smitique qui est un phnicien plus ou moins altr. Ils
taient orientaux par leur costume, leurs bijoux, leurs poids et
mesures, leur calendrier. Les Romains et les Grecs leur trouvaient
bien des dfauts, mais ils reconnurent en eux d'excellents hommes
d'affaires polyglottes et intelligents.
CHAPITRE VIII
La civilisation carthaginoise :
la vie religieuse, artistique et intellectuelle
Il est devenu classique, dsormais, de distinguer deux phases
dans ce domaine : une premire marque par la prpondrance des
lments orientaux et archaques et une deuxime pendant laquelle
Carthage commence s'ouvrir largement aux courants d'influence
hellnistique.
Les dieux et les cultes
Intensment croyants, les Carthaginois adoraient plusieurs
divinits organises en un panthon aussi riche que complexe. La
plupart de leurs dieux bien qu'originaires de Phnicie, apparaissent
fortement marqus par des influences locales et mditerranennes
diverses.
Melqart, patron de Tyr, assimil Hrakls par les Grecs, tait
protecteur de Carthage et jouissait d' un culte important. Eshmoun,
dieu gurisseur et quivalent punique de l'Esculape latin, tait ador
dans un majestueux sanctuaire qui fut, au sommet de la colline de
Byrsa, le dernier bastion de la rsistance punique aux assauts romains
de 146 avant J.-C.
98.
L'ANTIQUIT
Cependant deux divinits finirent par dominer toutes les
autres et par rgner sur le panthon punique : Bal Hammon et
Tanit. Il est curieux de noter qu'elles ne furent l'objet d'aucun culte
important en Phnicie. Connaissant l'attachement des Puniques
leurs traditions nationales, les historiens de la religion ont propos
d'identifier Bal Hammon El, le pre des dieux en Phnicie ; et,
dans ce cas, sa pardre Elat ou Asherat serait Tanit. On explique le
fait que ces deux divinits n'aient pas t adores Carthage sous
leur vritable nom par une tendance viter de prononcer le nom
du dieu, charg d' une trop grande force sacre et le remplacer par
des pithtes. Cependant, malgr d'importants progrs dus l'ex-
ploitation littraire des auteurs classiques, aux apports des plus
rcentes trouvailles archologiques et aux multiples tudes actuelles,
on n'est pas encore en mesure de combler certaines lacunes dans
notre connaissance de la religion punique.
Pour certains Bal Hammon rsulterait de la fusion de deux
divinits, l'une phnicienne et l'autre africaine. Pour d'autres, son
nom serait bien phnicien et signifierait Le seigneur des autels
parfums (Bal signifiant seigneur et Hammon autel encens ou
brle-parfum). A l'appui de cette deuxime thse on peut invoquer
le rle trs important de l' offrande d'encens dans le culte punique
et la persistance de cette pratique pour Saturne, successeur de Bal
Hammon, l'poque romaine. Toutefois la racine smitique HMN
voque la notion de protection et Bal Hammon apparat comme le
dieu protecteur de la cit par excellence. C'tait aussi un dieu solai-
re, garant de prosprit et de bien-tre. Malgr la rpugnance tradi-
tionnelle des Smites prter leurs divinits des apparences
humaines et en dpit de l'absence des types canoniques prcis com-
me ceux adopts par les Grecs ou les Romains pour leurs dieux, on
a pu identifier, avec plus ou moins de certitude, Bal Hammon et
mme Tanit sur certains monuments puniques. C'est ainsi qu'une
statuette en terre cuite d'poque romaine trouve dans les ruines
d' un sanctuaire de Thinissut prs de Bir Bou Regba, reprsente Bal
Hammon barbu, assis sur un trne flanqu de deux sphinx, la tte
coiffe d'une tiare de plumes, la main droite ouverte et leve. Le
Bal Hammon.
Muse du Bardo. H. 40 cm.
Statuette en terre cuite, reprsentant
le dieu Bal Hammon, dcouverte
dans le sanctuaire nopunique
Thinissut dans le Cap Bon.
Le dieu est assis sur un trne dont
les accoudoirs sont des sphinx.
Il est vtu d'une longue tunique
et coiff d'une tiare haute laissant
dgages les boucles de cheveux
encadrant le visage dont
l'expression est calme et sereine.
Bal Hammon est le seigneur
omniprsent, omnipotent, protecteur
des hommes et garant de leur
prosprit. D'origine punique,
il a survcu l'poque romaine
sous le culte de Saturne.
Stle dite du prtre l'enfant
Muse du Bardo. H. 1,18 m L. 0,18 m.
Cette stle qui provient du tophet
de Salammb est l'une des plus
remarquables autan t par sa forme
lance en oblisque que par
l'interprtation accorde son dcor.
Elle apparat comme le signe
emblmatique de ce sanctuaire. Grav sur
la face polie de la stle, un personnage
imberbe, coiff d'une tiare haute, vtu
d'une longue robe transparente, tient dans
son bras un enfant, tandis que sa main
droite est leve en geste d'adoration.
On interprte cette figure comme un prtre
portant l'enfant vou au sacrifice.
II' s. av. J.-C.
100.
L'ANTIQUIT
mme dieu apparat sur une stle du tophet de Sousse, coiff d'une
tiare conique, tenant une lance et assis sur le trne aux sphinx face
un adorant auquel il semble donner la bndiction en levant la
main droite. C'est sans doute Bal Hammon aussi qui est reprsen-
t sur une bague d'or trouve Utique, et sur de nombreuses terres
cuites de Carthage. C'est lui seul qu' on ddia les plus anciennes
inscriptions sur cippes du tophet de Salammb et il occupa pendant
longtemps le premier rang devant sa pardre Tanit dite Pen
Bal ou face de Bal voire tenant le rle de Bal , ce qui
semble signifier qu'elle lui tait subordonne l'origine. D'ailleurs,
en Phnicie, la divinit mle a toujours eu la prsance sur la femel-
le. Cependant une curieuse rvolution spirituelle se produisit Car-
thage au cours du V
e
s. faisant passer Tanit, semble-t-il, au premier
rang.
Tanit pose encore plus de problmes que Bal Hammon ; son
nom est inexpliqu et semble d'origine libyque si l'on tient compte
du fait que dans les langues berbres les noms fminins commen-
cent et se terminent par t . On pensait qu'elle aussi rsultait de la
fusion entre une divinit phnicienne qui serait Elat ou Asherat et
une desse africaine de la fertilit. Devenus agriculteurs, les
Puniques auraient par Asherat d'attributs emprunts la desse-
mre dont le culte tait alors trs en vogue en Mditerrane. Aujour-
d'hui ses origines orientales paraissent plus sres grce des docu-
ments trouvs dans la rgion de Sidon. Les Grecs l'ont identifie
avec Hra et, d'une manire gnrale, elle fut adore comme desse
de la fcondit prsidant aux moissons et protgeant les accouche-
ments. Son caractre chtonien et fcond est soulign sur de nom-
breuses stles par la reprsentation de grenades, de figues,
d'amandes, de palmiers, de colombes, de poissons. La lune figure
aussi parmi ses nombreux symboles, car Tanit tait galement ado-
re comme une desse cleste.
Certaines ddicaces la qualifient de mre et de dame ;
elles taient gnralement ainsi conues : la Mre, la Dame,
Tanit Pen Bal... . Nous ne disposons d'aucune inscription nous
permettant d'identifier d'une manire sre une Tanit reprsente
Statue lontocphale
du Genius terrae Africae
Sanctuaire de Thinissut
(terre cuite, hauteur 1,50 m
Muse du Bardo.
La desse est reprsente avec
une tte de lion et un corps humain.
Le mufle, trs saillant, est barr par des
moustaches ; les yeux sont normes et prominents.
La gueule ferme, esquisse un rictus, ce qui donne
une expression froce. Le corps est vtu d'une
longue tunique qui s'vase vers le bas, laissant
dcouverts les pieds nus. D'abord assimile la
desse gyptienne Skhmet, cette divinit semble bien
tre le Genius terrae Africae, le gnie de la terre
d'Afrique, comme l'indiquent les trois lettres GTA
incises l'arrire. Elle est l'illustration de la
complexit du syncrtisme religieux africain
l'poque romaine.
Desse nourricire.
Muse du Bardo.
(1,18 m x 55 cm x 51 cm)
Cette statue en terre
cuite provient du sanctuaire
de Thinissut, prs de Bir Bou
Regba, qui a fourni un ensemble
abondant de statuettes, dont celles de Bal
Hammon et de la desse tte de lion. La
desse Nutrix est assise, coiffe
d'un bonnet et vtue d'une
tunique : elle offre le sein l'enfant
tendu sur ses genoux. Le sanctuaire
d'o ces objets de culte proviennent est
dat du dbut de l'empire et reprsente
la persistance des cultes des divinits
puniques auprs des populations rurales.
102. L'ANTIQUIT
par une statue ou figure sur une stle ou un cippe. On croit cepen-
dant reconnatre l'image de la desse sur un certain nombre de
monuments. On l'a reprsente en femme pressant ses seins, en
femme nue et aile, en desse assise sur un trne dont les accou-
doirs taient sculpts en forme de sphinx. Ce dernier type a surv-
cu jusqu' l'poque romaine et on a trouv dans les sanctuaires de
Thinissut et d' El Kenissia, ct de la desse, des sphinx avec des
seins accentus et portant les bretelles croises de la desse mre
pour rappeler le caractre chtonien de Tanit. Cependant, notre divi-
nit tait plus couramment reprsente par des symboles dont le
plus clbre est le signe dit de Tanit . C'est gnralement un tri-
angle surmont d'une barre horizontale et d' un disque suggrant la
silhouette d' une divinit bnissante. Quant au signe de la bou-
teille , symbole assez frquent de Tanit, il reprsenterait d'une
manire schmatique une silhouette fminine la poitrine et au bas-
sin accentus.
Les Carthaginois adoraient galement de nombreuses autres
divinits comme Astart (Aphrodite), Reschef (Apollon), Shadrapa
(Bacchus), Yam (Posidon) et Haddad (Ars).
Il faut enfin signaler les larges emprunts que les Puniques
firent l'Egypte et la popularit dont jouirent certaines divinits
gyptiennes comme Isis, Osiris et Bs dans le monde carthaginois.
De mme les desses grecques Dmter et Cor, introduites dans la
mtropole punique en 396 avant J.-C., furent l'objet d' un culte fer-
vent. Les divinits libyques taient sans doute prsentes Carthage.
La religion punique tait servie par un clerg nombreux, for-
tement organis et dont les membres se recrutaient parmi les
familles aristocratiques les plus renommes. De nombreuses
femmes ont t investies de dignits religieuses. Bien que jouissant
d' un grand prestige, les prtres n' ont jamais form de caste ni pr-
tendu exercer quelque influence politique importante. Ils ne sem-
blent pas non plus, avoir dispos d'attributions en matire de justi-
ce, d'instruction, de surveillance des murs ou de direction des
consciences. Attachs aux temples, ils se contentaient de clbrer le
culte et de prsider aux crmonies religieuses et aux sacrifices.
Joueuse au tympanon.
Muse de Carthage. H. 33 cm.
Cette statuette en terre cuite polychrome
a t dcouverte dans la ncropole
punique de Carthage en 1917.
Elle est date du VII s. av. J.-C.
On a l'habitude de reconnatre dans
cette statuette une Astart tenant clans
ses mains, contre sa poitrine, le tympanon,
qui est un attribut rituel. Dans ce personnage
se croisent les influences orientales
et grecques. L'hiratisme oriental
de l'attitude est corrig par le
sourire ionien des yeux et de la bouche.
Il est probable que la prsence
d'une telle figure dans la tombe joue
un rle de talisman protecteur.
Prtre carthaginois
Muse de Carthage.
Ce couvercle d'ossuaire reprsente un prtre
carthaginois sous les traits d'un vieillard
couch sur le dos, la tte reposant sur un
coussinet. Il porte une barbe fournie et un
bandeau lui serre les cheveux. Le corps est
vtu d'une tunique ample et longue. Sur
l'paule gauche, passe une large pitoge qui
est probablement un insigne sacerdotal. La
main droite est leve en geste d'adoration,
la main gauche tient la cassolette encens.
Cet ossuaire, sarcophage de dimension
rduite, est l'imitation du fameux grand
sarcophage du prtre qui a t trouv dans
la mme ncropole Carthage.
Fin du IV
e
- dbut du III
e
s.
104.
L'ANTIQUIT
Les Tophets et les pratiques funraires
La rputation faite aux Carthaginois de pratiquer largement
les sacrifices humains, avait suscit l' horreur et la rvolte de leurs
contemporains grecs et romains. Ces pratiques taient connues chez
certains peuples de l'ancien Orient qui les jugeaient ncessaires pour
s'attirer la faveur des dieux.
On croyait couramment en Orient que le roi, en particulier,
possdait une sorte d'nergie sacre indispensable la vie de la
communaut. Il tait donc ncessaire qu'il se sacrifit lui-mme, au
bout d' un certain nombre d'annes de rgne, pour communiquer
la nature l'nergie qu'il dtenait. Il assurait ainsi, par la rgnres-
cence des forces naturelles, salut et prosprit sa patrie. C'est dans
ce sens qu'il faut peut-tre interprter le geste lgendaire d'Elissa se
jetant dans le feu. Les successeurs de la clbre reine de Carthage
n' ont pas d chapper cette terrible exigence selon certains.
Cependant, peu peu, une mystique nouvelle fit substituer au roi
une autre victime. Celle-ci devait tre aussi proche que possible du
ddicant, donc gnralement son fils, qu'il offre tout en tant cens
se sacrifier lui-mme. Lorsque le rgime monarchique disparut de
Carthage et fut remplac par la Rpublique, les membres du Snat
se trouvrent dans l'obligation de sacrifier leurs fils ans, gnrale-
ment en bas ge. D'ailleurs cette pratique se serait tendue petit
petit tous les nobles et mme aux masses populaires, au fur et
mesure que les institutions se dmocratisaient. Les sacrifices rev-
taient un caractre particulirement imprieux en cas de dfaites
militaires ou de catastrophes quelconques. On estimait que la char-
ge du sacr sur la ville s'tait affaiblie, et on sacrifiait les enfants
pour revigorer les dieux protecteurs de la patrie. C'tait aussi une
faon de confesser ses fautes aux dieux et de les expier. En 310,
nous raconte Diodore de Sicile, alors que Agathocle poursuivait la
conqute de leur territoire, les Puniques prirent conscience de la
gravit de la situation, attriburent leurs revers la colre des dieux
et dcidrent de se racheter en sacrifiant deux enfants choisis dans
les familles les plus nobles. Trois cents autres citoyens offrirent
POQUE CARTHAGINOISE
105
volontairement leurs enfants probablement parce qu'ils avaient
mauvaise conscience. La description par Diodore de cette crmo-
nie au cours de laquelle tous ces enfants, pralablement gorgs ou
touffs, furent livrs aux flammes, inspira Flaubert son clbre
chapitre, Moloch , dans Salammb .
Il semble qu' on sacrifiait souvent aussi pour faire cesser la
scheresse ou promouvoir la fertilit. Nombreuses sont les stles o
figurent des symboles de fertilit et de fcondit comme le palmier,
l'olivier, le grenadier, ou encore certains animaux.
Partant du principe que les dieux ont droit une part de tous
les produits, on a pu penser aussi qu'en leur offrant le premier-n
des enfants, on pourrait jouir plus tranquillement du reste de la pro-
gniture. Pour donner l'acte toute sa valeur, on exigeait des
parents d'assister au sacrifice de leurs enfants.
Ces sacrifices, mentionns par quelques textes seulement, ont
t rendus plausibles par la dcouverte, notamment Carthage et
Sousse, de tophets ou enceintes sacres, l'intrieur desquelles les
Puniques enterraient leurs enfants. A l'origine, ce nom de tophet a
t donn par la Bible un endroit prcis de la banlieue de Jrusa-
lem o les Isralites faisaient des sacrifices humains.
Le tophet de Carthage se dveloppa autour et au-dessus d' un
monument primitif constitu par un dpt contenant de la cra-
mique genne du VIII
e
s. et protg par une chapelle. On pense
qu'il y avait cet endroit mme un tombeau de roi ou de hros dont
le culte aurait subsist pendant longtemps. En tout cas on a cru que
c'est dans ce tophet que, pendant prs de six sicles, les Carthagi-
nois avaient gorg, brl et enterr leurs enfants. Flaubert avait
dcrit ces crmonies sanglantes sa manire, cherchant ostensible-
ment, pouvanter le lecteur : Ees bras d'airain allaient plus vite. Ils
ne s'arrtaient plus... Ees victimes, peine au bord de l'ouverture, disparais-
saient comme une goutte d'eau sur une plaque rougi et une fume blanche mon-
tait dans la grande couleur carlate. Cependant l'apptit du dieu ne s'apaisait
pas. Il en voulait toujours. Afin de lui en fournir davantage, on les empila sur
ses mains avec une grosse chane par-dessus qui les retenait . Comme on
peut le voir, Flaubert a entirement lch la bride son imagination.
106.
L'ANTIQUIT
Il a fait du sacrifice une crmonie tellement horrible que beaucoup
de savants ont eu de la rpugnance y croire jusqu' la dcouverte
des tophets.
Pendant longtemps, les savants ont cru que les Puniques sacri-
fiaient au dieu Moloch ; en fait il a t montr que le mot Molk, trs
frquent sur les stles, dsigne le sacrifice lui-mme et non une divi-
nit quelconque. Seuls Bal Hammon et Tanit ont t concerns par
les monuments votifs du tophet. Les cendres des enfants brls en
leur honneur taient recueillies dans des vases et enterres dans le
tophet des emplacements marqus par des cippes et des stles.
Quand tout l'espace se remplissait et que la place venait manquer,
on remblayait tout et on passait un niveau suprieur. Le tophet est,
ainsi, fait de couches superposes de terre, d'urnes et d'ex-votos.
Fouiller un tel monument, c'est fatalement le dtruire. Cependant
dans le cas de Carthage, les archologues ont russi laisser
quelques buttes tmoins qui montrent aux visiteurs l'volution du
tophet.
C'est ainsi qu'au fur et mesure qu' on passe des couches inf-
rieures aux couches suprieures, on voit des sortes de sarcophages
en grs stuqu succder de vritables petits dolmens ; puis appa-
raissent les urnes directement enfouies dans le sol. Les monuments
votifs suivent galement une volution intressante. Au VI
e
s. on a
utilis des cippes en grs sculpt imitant des temples gyptiens ou
prsentant l'aspect d' un trne portant un ou plusieurs btyles. A la
fin du V
e
s. c'est l'influence grecque qui commence se manifester
travers des cippes pilastres coiffs de chapiteaux doriques ou
ioniques. Enfin dans les couches suprieures, on adopte les ob-
lisques et surtout les stles. Celles-ci portent gnralement des ins-
criptions et un dcor grav reprsentant des motifs religieux ou pro-
phylactiques : prtre portant l'enfant destin au sacrifice, animaux,
matriel cultuel, symboles et attributs divins, signes de Tanit et de la
bouteille etc....
Plus tard, l'poque no-punique, on substitue des animaux
aux victimes humaines en indiquant que c'tait anima pro anima,
sanguine pro sanguine, vita pro vita (me pour me, sang pour sang et
Le tophet, sanctuaire de Tanit et Bal Hammon
Vue sur une partie du tophet de Salammb, situ proximit des ports antiques
de Carthage ; on y voit, au fond d'une dpression creuse par les fouilles,
un groupe de cippes assembls, conservs en place. C'est ce qui apparat
aujourd'hui d'un lieu sacr entre tous de l'poque punique, dcouvert
fortuitement en 1921. L'endroit a fait l'objet de plusieurs fouilles
par divers spcialistes mais les interprtations restent encore ouvertes :
lieu de sacrifices sanglants ou simplement ncropole d'enfants ?
Restitution du tophet
Muse de Carthage
La maquette montre une coupe stratigraphique
faite travers l'paisseur des couches du
sanctuaire. On constate que l'urne contenant
les cendres et les ossements est enterre
et est surmonte d'un cippe ou d'une stle
votive portant grave la formule consacre
Tanit et Bal Hammon. S'agissant
d'un lieu sacr ayant fonctionn durant
toute la dure de la Carthage punique,
l'emplacement du tophet a constamment
t occup. Aussi les fouilles ont-elles
retrouv trois grandes couches d'occupation
superposes, les plus anciennes tant
les plus profondes. Ces couches ont
t dnommes par les spcialistes :
Tanit I pour la couche la plus ancienne,
datant des VIII -VII s. av. J.-C.
Tanit II, date du VI' au IV
e
s. av. J.-C.
Tanit III, date du III
e
et de la premire
moiti du II s av, J.C
108-
l . ' ANTIQUIT
vie pour vie). Il semble cependant que ce sacrifice de substitution
ou Molchomor attest par les stles de N' gaous (en Algrie), ne
soit qu'une partie d'un rite plus complexe qui vise essentiellement
obtenir une naissance.
Aujourd' hui, de nombreux savants commencent se
demander si l' on peut continuer voir en ces tophets des
espaces de meurtres sacrs en l' honneur des dieux. Dj, au
moment de la dcouverte du sanctuaire de Carthage, un minent
historien, Charles Saumagne, avait ragi contre les interprtations
abusives des archologues et du public en crivant : l'imagination du
public que hante le souvenir de Flaubert a promptement dramatis la dcouver-
te : ces enfants, a-t-on dit et crit aussitt, ce sont les victimes des cruels holo-
caustes que Carthage offrait Moloch. Voil un pas qu'il est imprudent et gra-
ve de franchir la lgre... Nos nerfs s'irritent et ragissent l'ide que rituel-
lement des mres ont pu livrer au feu un enfant pour acqurir des mrites . La
prudence s'impose d'autant plus que ces pratiques ont t rappor-
tes essentiellement par Diodore de Sicile et Plutarque, auteurs
connus pour leur hostilit envers Carthage alors que d'autres cri-
vains anciens parmi les plus clbres et les mieux renseigns sur la
mtropole punique comme Hrodote, Thucydide, Polybe, Tite-live
n' ont fait aucune allusion ce genre de sacrifices. D' un autre ct,
les analyses faites au cours des dernires dcennies, si elles ont
confirm la prsence dans les urnes d'ossements calcins d'enfants
trs jeunes morts-ns ou morts en trs bas ge, ne permettent gu-
re de savoir si ces enfants ont t incinrs aprs une crmonie de
sacrifice ou au terme d' une mort naturelle. Enfin on a constat que
les tombes d'enfants dans les ncropoles de Carthage taient, sinon
totalement absentes, du moins d' une raret extrme alors que la
mortalit infantile tait trs leve. Face tous ces arguments d'mi-
nents savants ont propos de considrer le tophet comme un cime-
tire d'enfants morts de manire naturelle mais prmature et vous
de ce fait aux dieux suprmes de Carthage. Les stles votives consa-
creraient une soumission la volont divine et en mme temps un
appel ces divinits pour jouir du restes de la progniture et bn-
ficier d'autres naissances.
POQUE CARTHAGINOISE
_109
Les pratiques funraires taient fort diverses. En rgle gnra-
le on inhuma les morts avant le V
e
s. puis, partir de cette poque
et sous l'influence grecque, on commena les incinrer. Au dbut,
les tombes taient de vastes chambres dont l'entre tait bloque
par une dalle et les morts taient gnralement dposs dans des
sarcophages de bois ou de pierre, s'ils ne gisaient mme le sol. On
utilisa ensuite les puits funraires o taient enterrs un, deux ou
plusieurs morts. Enfin, dans les derniers temps, on eut recours des
mausoles pour les morts illustres. On employa aussi de nombreux
sarcophages en marbre dont les couvercles portaient parfois une
ornementation d' un grand intrt iconographique. L'incinration,
particulirement rpandue Carthage l'poque hellnistique sur-
tout, n'tait pas courante ailleurs. En dehors de la mtropole et
notamment dans le Sahel et le Cap Bon, l'inhumation des morts
dans des hypoges creuss dans le rocher tait de rgle. Des puits
escalier permettaient d'accder une ou deux chambres funraires
amnages dans les parois. Parmi les rites les plus frquents on peut
noter l'application sur les morts de l'ocre rouge rappelant la couleur
du sang et se fixant sur les os aprs la dcomposition des chairs. De
mme on remarque la pratique de l'enterrement en position latra-
le contracte dite ftale et caractrise par une flexion complte des
membres infrieurs, obtenue sans doute par un ligotage pralable
du cadavre, position rappelant l'origine de la vie et augurant pour le
dfunt d' un renouveau vital. Ces pratiques relvent de traditions
libyennes. En revanche, dans les tombes inhumation de Carthage
et d' Hadrumte, fortement marques par le sceau de la Phnicie, les
squelettes sont toujours allongs sur le dos.
Les chambres funraires contenaient parfois un matriel trs
riche ; mais gnralement il tait constitu d'objets courants comme
Les, poteries, diverses,, les statuettes, les amulettes etc.
Il est possible que les Puniques aient cru en la survie des
morts. Nos informations ce sujet sont trop vagues et nous ne pou-
vons que demeurer dans le domaine des hypothses. En tout cas il
n'y a rien eu de comparable ce qui se passait en Egypte ancienne
o l'on vouait un vritable culte aux morts.
110-
l . ' ANTI QUI T
Au total, si la religion de Carthage contient certains lments
emprunts l' gypte ou l'Afrique, elle subit aussi l'influence de
l'hellnisme qui connut un rayonnement exceptionnel dans tout le
bassin mditerranen partir du IV
e
s. Comme l'a montr G.-Ch.
Picard, le mysticisme hellnistique offrait des perspectives beau-
coup plus consolantes que la religion de Carthage dans la mesure o
des divinits comme Dionysos, Aphrodite et Dmter apparais-
saient plus humaines, plus secourables, servies, par des prtres qui
ne sont pas des fonctionnaires dsigns par la cit, mais le plus sou-
vent des mages et des potes errants qui forment des thiases
ouverts aux trangers, aux esclaves, tous les isols qui fourmillent dans les
grandes villes hellnistiques en marge de cadres sociaux rguliers... leur seul
espoir est, qu'en une autre vie, un thiase ternel, transport dans les hauteurs du
ciel, leur fera goter sans terme les joies de ces orgies . Carthage, ville cos-
mopolite par excellence, accueille largement ces cultes aux perspec-
tives si mystrieuses et si douces.
En tout cas il est certain que les Puniques importrent de Sici-
le pour le rendre officiel le culte de Dmter et Cor, divinits
agraires, et de Dionysos, assimil Shadrapa, et dont les symboles
ne tardrent pas apparatre sur les stles du tophet associs ceux
de Bal Hammon et de Tanit. De mme, Hannibal parat ouvert aux
influences grecques si l' on se rfre au pacte qu'il passa avec Phi-
lippe V de Macdoine au lendemain de Cannes.
La vie artistique et intellectuelle
En dpit des destructions et des pillages systmatiques subis
par Carthage en 146 avant J.-C. et qui ont priv les historiens d' une
masse de documents susceptibles de mener une bonne connais-
sance de la civilisation punique, on est en mesure, aujourd' hui, gr-
ce aux nouvelles dcouvertes et aux progrs des recherches et des
tudes, d' apporter d' importants clairages sur la vie intellectuelle et
artistique de cette grande mtropole africaine. Le rle de celle-ci,
POQUE CARTHAGINOISE
_111
sans tre tout fait comparable, celui de la Grce ou de Rome,
n'en est pas moins considrable.
Grce des liens troits et multiformes nous avec la plupart
des pays du monde antique, Carthage devint un vritable creuset
des civilisations de l'poque. Nantie d' un prcieux legs oriental, elle
a notamment russi dvelopper un art fait de crations propres et
d' emprunts un riche rpertoire mditerranen.
L'architecture punique demeure relativement mal connue du
fait des destructions dj voques et de l'expansion de l'urbanisme
romain au dtriment des difices antrieurs. Toutefois, les fouilles
de Carthage et surtout de Kerkouane ont t d' un apport consid-
rable dans ce domaine. Elles ont montr que dans ces deux villes,
les trames urbaines procdaient de plans gomtriques, rigoureux et
taient agrementes de vastes places aux fonctions conomiques,
sociales et politiques. l'intrieur de ces espaces, les difices privs
et un degr bien moindre publics, commencent tre mieux
connus. Les maisons s'ordonnaient toujours autour d' une cour cen-
trale, parfois agrmente d' un pristyle, et flanques, ct rue, de
boutiques et d'ateliers. quipes de citernes et de puits, elles dispo-
saient d'lments de confort comme les baignoires assez labores
de Kerkouane.
De leur ct, les temples taient sans podium ni pronaos mais
organiss autour d' une cour, avec ou sans portiques, et comprenant
au fond une cella principale et deux cellae latrales. Ces sanctuaires
enclos favorisaient le droulement de processions adaptes au
rituel liturgique de la religion punique. Ce type de maison et de
temple survcut la destruction de Carthage et se maintint dans le
pays l'poque romaine et mme beaucoup plus tard. La mme
prennit devait caractriser les modes et les matriaux de construc-
tion en vogue l'poque punique : notamment les techniques de la
brique crue et du pis avec coffrage en bois et de Yopus africanum,
procd caractristique du pays qui consistait conforter les murs
en moellons par des harpes poses verticalement gale distance les
unes des autres.
112-
l .'ANTIQUIT
De nombreux autres documents fournissent de prcieux com-
plments d'information sur l'architecture et l'art puniques. Il s'agit
de centaines de cippes et de stles caractre architectural et des ex-
voto en forme de petites chapelles dposes par les fidles dans les
temples et qui sont conues l'image e ceux-ci. Les stles et les
cippes du tophet de Carthage dnotent au dbut une grande fidli-
t l'hritage oriental puis, partir du IV
e
s., ils portent la marque
d'emprunts fait l'archasme grec, avec un penchant pour le style
olien. L'ordre ionique ne connatra une certaine vogue qu'au III
e
s.
et caractrisera notamment le dcor architectural des portiques cir-
culaires du port de guerre de Carthage. Cependant le modle rduit
de temple le plus suggestif de l'art monumental de la mtropole
punique demeure le naskos de Thuburbo Majus, chapelle en
miniature ddie en ex-voto Dmter (expos au muse du Bar-
do).
Comme pour l'architecture, destructions et pillages limitent
considrablement le champ des connaissances sur la sculpture
punique. Cependant deux documents donnent une haute ide du
niveau atteint dans ce genre d'activit artistique. Il s'agit de deux
grands sarcophages mis au jour dans la ncropole dite de Sainte-
Monique / Sada Carthage et dont les couvercles sont dcors de
deux personnages en haut-relief remarquables par leur grande
finesse d'excution et leur puissant intrt iconographique.
De leur ct, les stles dont les canons diffrent de ceux de
l'art classique, sont intressantes dans la mesure o elles sont le
reflet d'un savoir-faire authentiquement populaire. D' une grande
simplicit l'poque archaque, elles s'ornent du fameux signe dit
de Tanit au V
e
s. Des transformations majeures interviennent, un
sicle plus tard : adoption d'un matriau plus dense et plus dur,
mieux adapt la sculpture, et d' un nouveau profil avec un fronton
triangulaire et des registres spars par des oves et des perles ; la
ddicace occupe le milieu de la stle et le registre infrieur, encadr
de colonnes chapiteaux oliques, est orn de motifs vgtaux, ani-
maux ou religieux. Vers le milieu du III
e
s., le dcor incis remplace
le relief et l'art de la stle atteint son apoge avec notamment le bus-
Masque grimaant
Trouv Carthage. H. 18 cm. Muse du Bardo.
Masque grimaant, en terre cuite.
Les yeux et la bouche sont vids.
Des sillons griffs parcourent le visage
tandis que des pastilles poses sur
le front figurent des verrues. Tout ceci
pour accrotre la laideur du masque.
Dpos dans la tombe, il tait destin
effrayer les mauvais esprits.
Masque d'homme
Muse du Bardo
En terre cuite polychrome.
Provient de la ncropole
archaque de Douims Carthage.
Le nez portait le nezem.
Le masque avait un rle
prophylactique.
Pendentifs en pte de verre
Muse du Bardo
Reprsentant des masques
masculins caractriss par
des cheveux et une barbe
forms de tortillons surmonts
de blire, ils jouent le rle
d'amulettes. C'est une production
caxtbasynmse... Trouvs
dans la ncropole punique
de Ardh El Kherab Carthage.
IV' s. av. J.-C.
114-
l . ' ANTIQUIT
te d' un phbe en chlamyde au visage particulirement expressif,
grav au trait ainsi que la stle du prtre l'enfant qui dnote une
grande matrise artistique.
La mme matrise peut se constater dans l'excution des
hachettes-rasoirs, objets rituels frquents dans des tombes partir
de la fin du VIL s. et dont l'usage et la destination sont nigmatiques
peut-tre les utilisait-on pour des toilettes sacres mais qui ne
manquent ni d'originalit ni de finesse. Leur dcor, incis et grav,
puise son inspiration aussi bien dans le rpertoire oriental et gyp-
tien que classique. Ainsi le dieu Melqart, frquemment reprsent
sur ce genre d'objets, est-il tantt figur la manire orientale qui
le fait apparatre debout sur un podium, au dessus d'une fleur de
lotus, vtu d'une longue tunique, coiff d' une tiare ou d' un bonnet
conique et tenant une hache, soit autant d'lments dj prsents
sur une stle des environs d'Alep du IX
e
s. avant J.-C., et tantt vo-
qu en Herakls Melqart avec la dpouille ou la tte de lion et
la massue, selon un modle inspir des monnaies grecques. Des
motifs vgtaux, animaux et divers ornent galement ces hachettes-
rasoirs.
Dans le domaine de la tabletterie, sculpteurs et graveurs riva-
lisrent d'habilet pour fabriquer toutes sortes d'objets en os ou en
ivoire destins un usage utilitaire ou dcoratif : pingles cheveux,
peignes, bracelets, boites fard, charnires, manches de miroir, sta-
tuettes, plaquettes entrant dans la composition de frises dcoratives,
masques et taslimans etc. Souvent, artisans et artistes donnent libre
cours leur propre imagination pour excuter des uvres origi-
nales, mais on note aussi une grande fidlit aux traditions gyp-
tiennes et orientales qui se prolonge jusqu' la fin de l'poque
punique. C'est ainsi qu' on a trouv dans une maison tardive de la
colline de Byrsa une plaquette reprsentant en relief une scne d' of-
frande o un personnage prsente une desse debout sur un
sphinx un vase et un pi, modle s'inscrivant tout fait dans la tra-
dition orientale. Que l'objet soit un bien de famille ancien excut
depuis des sicles et pieusement conserv ou tout simplement une
ralisation de la fin de l're carthaginoise, il ne tmoigne pas moins
d' un attachement la tradition orientale. Cet attachement est confir-
POQUE CARTHAGINOISE
_115
m par les rcentes fouilles franaises des tombes de la colline de
Byrsa qui ont permis la mise au jour d' un ensemble d'objets en ivoi-
re dont notamment des lments de plaquettes ajoures ayant pour
motif principal un cervid voluant au milieu d'un enroulement
vgtal de palmettes et de volutes. Excuts Carthage au milieu du
VIP s. avant J.-C., ces objets avaient t inspirs d'exemplaires de
Nimrud et de Chypre. Ils faisaient partie du mobilier funraire d'un
artisan qui avait tenu conserver dans sa tombe des morceaux
d'ivoire bruts et des pices finies qui tmoignent de son activit
artistique. En outre, provenant du mme secteur et datant de la
mme poque, une plaquette en ivoire figurant un personnage mas-
culin et un autre fminin dans une attitude d'adoration du disque
solaire, dnotent une influence gyptisante nette qui est galement
prsente travers les peignes ouvrags qui apparaissent ds le
VIP s. avant J.-C. Parmi ceux-ci, les modles gravs les plus anciens
semblent rattachables la tradition ornementale syro-palestinienne,
quoique produits Carthage, voire au sud de l'Espagne. Cependant,
il convient de souligner que cet attachement l'Orient n'a jamais
exclu l'ouverture la plus large toutes sortes d'autres influences
mditerranennes.
Carthage s'est galement illustre par une production d'excel-
lente facture dans le domaine de la cramique. Ce sont surtout les
terres cuites et en premier lieu les masques qui se dtachent de l'en-
semble du travail des potiers. Les plus anciens parmi ces masques
ont t trouvs dans un contexte funraire datable de la fin du VIII
e
s. avant J.-C. ou du dbut du VII
e
: hrits de Phnicie et diffuss par
Carthage, ils sont tantt de type ngrode avec une bouche tordue,
tantt grotesques avec un visage grimaant et fortement rid. Pla-
cs dans les tombes, ils sont censs protger les morts contre les
dmons. partir du VI
e
s. avant J.-C., on commence fabriquer
galement des masques pleins ou protoms o la bouche et les
yeux ne sont gure perfors. Les cheveux et la barbe sont figurs par
de petits cercles gravs. A la mme poque apparaissent des pro-
toms caractriss par une barbe allonge et creuse en son milieu
par une sorte de sillon. Paralllement ces types masculins, sont
produits des modles fminins de belle facture. Les uns ont une
116-
l . ' ANTIQUIT
allure gyptienne notamment par leur klaft, les autres, tout en
demeurant fidles l'Orient dans leur schma de base, ne compor-
tent pas moins des traits emprunts l'art grec archaque ; enfin une
troisime catgorie est dite rhodienne tellement elle parat appa-
rente des spcimens fabriqus Rhodes ds le VI
e
s. avant J.-C.
et diffuss dans tout le monde grec. Ces protoms , parfois retou-
chs au sortir du moule, sont souvent rehausss de peinture.
Le peintre et le dcorateur interviennent galement pour
orner des figurines de terre cuite reprsentant des desses enceintes
de tradition orientale, des statuettes de style gyptisant d' une rai-
deur de momie et d'autres o commence se sentir l'influence
ionienne. Le modle le plus reprsentatif de cette dernire catgo-
rie est la desse au tympanon caractrise par des traits moins
figs, une chevelure traite la manire grecque et des vtements
qui se rfrent l'Orient, tout comme le tympanon que la desse
serre contre sa poitrine. L'influence grecque se fait de plus en plus
nette avec l'introduction du culte de Dmter Carthage partir de
396 avant J.-C. De nombreuses figurines sont alors produites, repr-
sentant la desse soit assise sur un trne soit en kernophoros ,
portant sur la tte un brle-parfum. D' autres divinits comme Bal
Hammon et Tanit surtout ont t galement reprsentes. Une pla-
ce part doit tre faite une grande statuette de desse de 0,33 m
de haut richement dcore, bien conserve et donnant une ide
assez prcise de la parure fminine Carthage. De nombreuses
autres statuettes figurant des musiciennes, des danseuses et des
acteurs prsentent un intrt documentaire et esthtique certain.
Il est, toutefois, noter que l'influence grandissante du mon-
de grec, ne parvint pas effacer l'attachement aux modles hrits
de l'Orient. Jusqu' la veille de sa disparition, Carthage continua
dcorer ses moules dits gteaux de la palmette phnicienne, de
l'ibis ou de l'il oudja .
Par ailleurs, considrs comme de vritables pionniers dans
l'art de faonner le verre, les Carthaginois s'illustrrent par une pro-
duction aussi riche que diversifie dans ce domaine ainsi que par
une qualit artistique remarquable. Leur matrise des divers proc-
ds de fabrication se constate dans toutes sortes d'amphorettes,
Maison d'habitation de Kerkouane
La photographie montre des alignements de colonnes reposant sur des bases
carres au-dessus d'un sol btonn, en bordure du rivage.
Ce sont les restes d'une cour entoure de portiques : c'est le type dit maison
pristyle dont la formule fut diffuse tout autour de la Mditerrane. La
construction en tait soigne : le plan tait carr ou rectangulaire; les murs,
aujourd'hui arass, taient construits en moellons recouverts d'un crpis stuqu
Kerkouane, une salle de bain
La photographie montre un dtail intressant
d'une maison punique fouille Kerkouane: une
salle de bain. On y voit la baignoire en forme de
sabot, avec des accoudoirs et la cuvette devant
contenir les ingrdients du bain. Tout ceci est
construit avec un bton de tuileau rouge trs
rsistant.
Un vestiaire prcde cette pice. L'eau est
fournie par un puits situ dans la cour de la
maison. A n'en point douter, il s'agit d'un
perfectionnement rvlant un vritable art de
vivre. La maison fait partie de tout un groupe
de vestiges dgags dans le site punique de
Kerkouane dcouvert la pointe du Cap Bon.
Ce site a t dtruit au III
e
sicle av. J.-C.
et n 'a jamais t roccup.
118-
l . ' ANTIQUIT
d'nochos, d'aryballes et d'alabastres, inspirs de prototypes grecs
et servant de vases parfum ou fard. Leur dcor en filets concen-
triques se transformant parfois en ondulations ou en bandes de che-
vrons est rehauss de couleurs chatoyantes o le jaune, le blanc et
le turquoise se dtachent sur fond bleu, noir ou brun.
Le mme souci esthtique se remarque dans les masques pen-
dentifs en miniature fortement typs et fidles au fond artistique
oriental avec leurs visages au teint blanc, jaune ou bleu, leurs yeux
carquills, leurs sourcils abondants et leurs barbes en forme de tor-
tillons. Ils semblent reprsenter des divinits puniques appeles
protger les vivants qui les portent dans des colliers et les morts
auprs desquels on les dposait. Le verre servait galement fabri-
quer toutes sortes d'animaux et de volatiles, ainsi que de grosses
perles polychromes, des clochettes, des grappes de raisin et divers
autres lments de colliers.
Enfin, il convient de rappeler le grand attachement des Car-
thaginois aux amulettes et aux bijoux. L encore, l' influence de
l' Egypte et de l' Orient est prpondrante comme on peut le voir
travers ces amulettes multiformes o apparaissent souvent l'il
Oudja , l'uraeus, le dieu Ptah-Patque, Bs et Anubis ou les sca-
rabes et scarabodes et autres motifs constituant des talismans cen-
ss protger les vivants et surtout les morts. Les bijoux en or, en
argent ou en pierres prcieuses se rfrent tantt l'Egypte avec des
motifs classiques d'uraei, de croissants lunaires ou de disques
solaires tantt la Phnicie avec les boucles d'oreilles en nacelle ,
les bracelets en or tress, ou les perles avec dcor en filigrane.
Des lments phnicisants sont galement prsents sous for-
me de fleur de lotus, de palmette et d'arbre de vie sur des coquilles
d'ufs d'autruche retrouves en abondance dans les ncropoles et
qui sont gnralement dcores d' un visage aux yeux immenses des-
tins veiller sur le mort, soit de motifs inspirs du monde animal
ou vgtal.
Si tous les lments qui viennent d'tre voqus montrent que
Carthage a t d' un apport considrable la vie artistique du mon-
de antique, les donnes deviennent moins nombreuses quand il
POQUE CARTHAGINOISE
_119
s'agit de mesurer l'importance de son rle sur le plan intellectuel. Sa
fin dramatique a t, comme on le sait, l'origine de l'incendie de
ses bibliothques et au pillage et la dispersion de ses manuscrits.
Affirmer, comme on n'a pas hsit le faire, que les Puniques
taient essentiellement des commerants et des hommes d'affaires
peu enclins aux activits intellectuelles, est une attitude peu objecti-
ve que mme les donnes incompltes qui nous sont parvenues
dans ce domaine, permettent de nuancer considrablement.
Il sufft de rappeler, cet gard, que les Carthaginois ont hri-
t de leurs anctres phniciens l'alphabet qu'ils ont eu le mrite de
diffuser en Mditerrane occidentale. Le punique, sans supplanter
tout fait les langues autochtones, connut une trs large diffusion
sur toute l'tendue de l'empire carthaginois et dans ses zones d'in-
fluence. Il devint la langue officielle des royaumes numides et
maures qui l'utilisrent pour les lgendes de leurs monnaies. L'in-
fluence de l'alphabet punique sur le libyque fut galement consid-
rable. Mais l'apport punique dpassait largement ce niveau de base
pour s'tendre d'autres domaines de la vie spirituelle comme
l'avait not saint Augustin qui affirmait que les livres puniques
taient pleins de science et de sagesse comme le rapportent les
docteurs les plus savants . Scipion Emilien en avait offert une bon-
ne partie aux princes numides, aprs la chute de Carthage. Les
auteurs grecs et latins y puisrent de nombreux renseignements sur
le Maghreb antique et notamment sur les campagnes militaires
d'Hannibal dcrites par ses deux professeurs grecs Sosylos et Sil-
nos. De mme, Salluste y trouva de quoi enrichir sa Guerre de ]ugur-
tha en donnes diverses ethnographiques et historiques. Cependant,
l'uvre carthaginoise la plus remarquable, dans l'tat actuel de nos
connaissances, demeure l'ouvrage de Magon qui est un trait
d'agronomie en vingt-huit livres consacrs l'agriculture et l'le-
vage et contenant des recommandations techniques qui ont d
contribuer largement \a prosprit des campagnes carthaginoises.
L' agronome latin Columelle considrait Magon comme le pre de la
science rurale. Ses travaux faisaient alors autorit chez les Grecs et
120- l .'ANTIQUIT
les Romains et leur rputation dpassait de loin celle de tous les
crits antiques en la matire au point que le Snat romain dcida de
les traduire en latin en dpit de l'existence, Rome, d' un ouvrage
semblable compos par Caton.
Ce livre fut vritablement un classique dont les enseignements
ne se limitrent pas la seule antiquit selon le grand historien du
Maghreb ancien, Stphane Gsell qui a crit : Si l'on avait le texte de
Magon, l'on constaterait sans doute aussi que ses enseignements s'taient trans-
mis . aux Arabes par l'intermdiaire des gopolitiques, peut-tre aussi par
d'autres traits grecs, traduits en syriaque, en persan et en arabe .
On peut signaler aussi un autre Carthaginois, Hasdrubal, qui
parvint une certaine notorit intellectuelle Athnes et qui, en
129 avant J.-C., se hissa sous le nom grec de Clitomaque, la tte de
l'Acadmie d'Athnes.
Ville cosmopolite, largement ouverte au grand commerce,
Carthage tait un haut lieu de brassage social et culturel et ses habi-
tants taient polyglottes.
CHAPITRE IX
L'mergence du royaume numide
Le destin de Carthage, pendant les deux derniers sicles avant
l're chrtienne, est aussi tragique que curieux. Ce fut la phase la
plus tourmente de son histoire. Aprs une lente agonie au cours de
laquelle elle faillit devenir numide, elle devait disparatre, complte-
ment dtruite et rase par les Romains. Puis, aprs une clipse d' un
sicle, elle renatra de ses cendres par la volont mme de ces
Romains qui la promurent au rang de capitale provinciale.
Massinissa et l'essor du royaume numide
Massinissa profita des dernires phases du conflit punico-
romain pour rcuprer son royaume et mettre la main sur celui de
son ancien rival Syphax. Il se retrouva donc, au lendemain de Zama,
la tte d' un vaste territoire s' tendant de la Moulouya, l'ouest,
la frontire tunisienne actuelle, ou peu prs, l'est. Il avait dsor-
mais pour voisins les Carthaginois du ct est et le royaume de
Maurtanie l'ouest.
Au cours d' un rgne exceptionnellement long, marqu par
l' ordre et la scurit, en dpit de quelques guerres de conqute,
Massinissa russit accomplir une uvre d' un puissant intrt
conomique, humain et politique. Strabon et Polybe parlrent en
termes trs logieux des ralisations colossales dont il dota son
122-
l . ' ANTIQUIT
pays. Voici, dit Polybe, ce qu'il fit de plus grand et de plus merveilleux.
Avant lui toute la Numidie tait inutile et considre comme incapable par sa
nature de donner des produits cultivs. C'est lui le premier, lui seul qui montra
qu'elle peut les donner tous, autant que n'importe quelle autre contre, car il mit
en pleine valeur de trs grands espaces. Strabon, qui ne fut pas moins lo-
gieux que Polybe l'gard de Massinissa, dit que c'tait galement
lui qui civilisa les Numides et les rendit sociables. Actuellement la
tendance est de ramener l'uvre de Massinissa de plus justes pro-
portions. G. Camps crit notamment : Il est facile, je le sais, de dbou-
lonner les statues et on peut avoir mauvaise conscience le faire, mais, est-ilplus
difficile et plus juste de tout rapporter un homme parce que cet homme fut
encens par le grec Polybe ? Aprs un examen, que j'ai voulu impartial, des
conditions de vie antrieures Massinissa, de ce qui caractrisait son rgne et de
ce qui pouvait tre port l'actif de ses successeurs, je suis contraint de refuser
au souverain Massyle le mrite de certaines initiatives ou ralisations qui lui
sont traditionnellement rapportes . G. Camps a en effet bien montr
que, si l'agriculture connut un dveloppement apprciable en Numi-
die sous le rgne de Massinissa, elle n'en existait pas moins avant lui.
Cependant, il demeure certain, et G. Camps le reconnat, que c'est
grce la forte personnalit de leur chef que les Numides ont rus-
si jouer un rle dans l'histoire mditerranenne. Il y a galement
le remarquable essor urbain et de civilisation que G. Camps ne nie
pas non plus mais qu'il refuse d'attribuer au seul Massinissa. Peu
importe finalement si tout est d celui-ci ou s'il faut considrer
que l'ascension des Numides a t prpare par ses prdcesseurs et
acheve par ses successeurs ; le plus important, ici, c'est de dter-
miner l'tat du royaume numide au moment o il va entrer en
conflit avec Carthage.
S'il est difficile de croire en une transformation totale de la
Numidie grce aux seuls efforts de Massinissa, on peut nanmoins
admettre que de gros progrs furent raliss, sous son rgne, dans
le domaine agricole. Le pays n'tait certes pas en friche, comme le
prtendait Polybe, et la culture des crales y remontait des temps
trs anciens, mais l'apport de Massinissa fut considrable, tout de
POQUE CARTHAGINOISE
_123
mme, dans la mesure o il multiplia les conqutes et annexions de
terres bl tant l'ouest qu' l'est de son propre territoire. Le dve-
loppement des campagnes doit galement beaucoup la paix et la
scurit qui caractrisrent le long rgne du prestigieux souverain.
Lui-mme semblait, d'ailleurs, s'tre intress l'agriculture. Ajou-
tant ses propres biens de nouvelles terres arraches soit aux
Masaessyles soit aux Puniques, il disposa bientt d'immenses
domaines qu'il exploita avec beaucoup de soin. Veillant jalousement
la mise en valeur de ses propres terres, il chercha servir
d'exemple tous ses sujets. Diodore de Sicile nous apprend qu' sa
mort, Massinissa laissa chacun de ses quelques cinquante fils,
874 hectares munis de tout le matriel ncessaire l'exploitation.
Il se pourrait mme que certaines villes qualifies de Regia ou
Regius aient fait partie des domaines royaux et appartenu en toute
proprit au roi.
Il est possible que, profitant de conditions aussi favorables,
l'arboriculture et l'levage se dvelopprent leur tour, mais la
Numidie demeura essentiellement une terre bl. Les quantits
produites durent tre tout fait considrables. A plusieurs reprises,
Massinissa fournit l'arme romaine des dizaines de milliers d'hec-
tolitres de bl provenant de ses domaines ou des impositions. En
170, les Romains l' offusqurent en voulant lui payer les quelques
90 000 hectolitres qu'il venait de leur offrir. Sans doute, jugeait-il la
quantit plutt ngligeable. Quoi qu'il en soit, il tait un des princi-
paux fournisseurs en bl de Rome et de la Grce.
D' autre part, le commerce numide se dveloppa d'autant plus
que par suite des victoires remportes sur les Puniques et des
annexions qui en rsultrent, Massinissa s'assura le contrle de
nombreux ports commerciaux et dtruisit, peu peu, le monopole
que Carthage exerait dans ce domaine. Le royaume numide dve-
loppe alors des changes fructueux et des liens multiformes avec
divers pays mditerranens.
Les exportations vers l'Italie, la Grce et l'Egypte, de bl, de
laine, de marbre, d'ivoire et d'animaux de cirque constiturent d'im-
portantes sources de revenus pour le budget de l'tat.
124.
Au dpart, la tribu, groupant un certain nombre de familles
anctre commun, tait la cellule de base de toute vie conomique,
sociale, religieuse et politique. De la confdration de plusieurs tri-
bus sous l'gide d' un roi ou aguellid sont ns les premiers
royaumes. La ralit se diversifia, ensuite, par le jeu complexe de
l'volution interne, des contacts, des conqutes et des annexions.
Au second sicle, les territoires de Massinissa groupaient des cits
population mixte, des communauts rurales et des tribus de pas-
teurs nomades. Durant de nombreuses annes, le roi numide, qui
voulait tre un puissant souverain, s'employa fixer les tribus
errantes, les poussant dfricher le sol et leur en donnant la pro-
prit. Ainsi put-il transformer grand nombre d'entre elles en com-
munauts agricoles groupes dans des villages fortifis, l'abri des
continuelles incursions des nomades pillards. Le pays devint plus
stable et ses ressources moins alatoires. Les nouveaux sdentaires,
jusque-l matire fiscale morte , devinrent des contribuables
payant rgulirement l'tat le prix de la protection qu'il leur assu-
rait.
La stabilit politique, le dveloppement de l'agriculture et l'ac-
croissement du commerce intrieur et extrieur entranrent un
rapide essor urbain. Cirta (Constantine), capitale de Massinissa,
dpassa les 100 000 habitants et attira, grce sa grande activit co-
nomique et ses foires, de nombreux autochtones et trangers. En
Tunisie, Tbugga, Sicca Veneria (Le Kef) et surtout Zama devinrent
d'importantes capitales rgionales. L'ascension est plus remarquable
encore pour certains bourgs ou de simples marchs qui se transfor-
mrent en vritables villes. G.-Ch. Picard crit ce sujet : On ne sau-
rait asse% marquer l'importance de l'uvre de Massinissa et ses descendants.
Avec le Sahel, le pays Massyle est, de toute la Tunisie, celui o les traces de la
civilisation antique sont les plus nombreuses. Les villes qui les parsment sont
romaines : mais on voit clairement qu'elles se sont dveloppes sur les fondations
des rois numides . Il est certain que des cits comme Mactar, Bulla
Regia et d'autres doivent beaucoup aux Numides. Le pouvoir avait,
certes par intrt, favoris la sdentarisation. Il cherchait rendre les
POQUE CARTHAGINOISE
_125
populations plus dociles, plus riches et d' un meilleur rendement fis-
cal. Les bourgs n' ont peut-tre t conus que comme des rsi-
dences pour accueillir les agriculteurs et des forteresses pour les
protger, mais ils constiturent en mme temps un cadre propice
pour le dveloppement et le rayonnement de la culture et de la civi-
lisation.
Aujourd'hui, c'est sans doute Dougga qu' on peut le mieux
apprcier l'apport de la civilisation numide certaines villes
antiques de Tunisie. Avec ses vestiges impressionnants qui surgis-
sent de loin, accrochs la falaise dominant la vaste et riche valle
de l' Oued Khalled, Dougga est, l'origine, une vieille citadelle ber-
bre, comme l'indique son nom dont la racine TBG suggrerait la
notion de protection et non de pturage comme on le croyait autre-
fois. Le site occupe, en effet, une position facile dfendre, prot-
g qu'il est l'est et au nord-est par une falaise abrupte et au sud par
des pentes rapides. La dfense tait complte par des remparts en
gros appareil dont subsiste un tronon de 150 m au nord. Cet avan-
tage apprciable et d'autres atouts ont non seulement favoris l'im-
plantation de la cit ds avant le V
e
s. avant J.-C. mais aussi contri-
bu assurer son rapide essor par la suite puisqu'au IV
e
s. elle tait
d' une belle grandeur selon le tmoignage de Diodore de Sicile. Cela
lui a probablement valu de devenir la capitale de la dynastie massy-
le pendant quelque temps avant d'tre annexe au territoire cartha-
ginois. Reconquise par Massinissa au II
e
s., elle devint sans doute
une des rsidences royales comme Bulla Regia et Zama Regia sans
toutefois avoir le titre de Regia (royale). La cit s'tendait alors sur
prs de 80 hectares et disposait, en son centre, d' une agora numide
qui sera transforme plus tard en forum romain. Une inscription
bilingue, libyque et numide, nous apprend qu' un sanctuaire ddi
Massinissa, divinis aprs sa mort, y a t rig. Quelques vestiges
de l'poque numide ont subsist jusqu' nos jours. On peut citer,
cet gard, les lments architecturaux prromains encastrs dans les
murailles de la forteresse byzantine attenante au forum ; il s'agit de
chapiteaux de pilastres d'angles aux volutes dcores de fleurs,
ensemble trs analogue au dcor architectural du clbre mausole
126- l . ' ANTIQUIT
qui sera voqu plus loin ; d'autres lments de dcor hellnistiques
en mme temps que le soubassement d' un monument quadrangu-
laire, comparables l'autel sanctuaire de Chemtou ont t trouvs
proximit immdiate du capitole ; enfin, sous le temple de Saturne,
les fouilles ont rvl l'existence d' un sanctuaire plus ancien ddi
Bal Hammon et contenant, outre des urnes, des stles portant le
signe dit de Tanit et des symboles solaires et lunaires ainsi que des
tables libation et des fioles parfum.
La prosprit conomique du royaume numide s'est traduite
par la multiplication, dans les villes, de monuments publics et privs
souvent grandioses. L'exemple le plus spectaculaire de cet essor
architectural demeure sans doute le mausole de Dougga qui s'in-
sre dans la srie des grands mausoles dynastiques dont l'Algrie
possde de prestigieux modles comme le Medracen ou le Tom-
beau de la chrtienne . Les uns et les autres drivent du clbre
mausole d'Halicarnasse, rig en Asie Mineure au IV
e
s. avant J.-C.
pour le satrape Mausole, ainsi que celui d'Alexandre le Grand
Alexandrie. Par ces prestigieux monuments, les rois numides cher-
chaient souligner leur dimension surhumaine, l'instar des grands
souverains hellnistiques, et affirmer leur suprmatie.
Le mausole de Dougga, datable du second sicle avant J.-C.,
est un tombeau turriforme compos de trois tages couronns d' un
pyramidion et atteignant 21 m de haut. Le premier tage repose sur
un soubassement de cinq gradins et contient la chambre spulcrale
dont la majest est signale, de l'extrieur, par des pilastres d'angle
chapiteaux oliens aux volutes garnies de fleurs de lotus. La face
nord comporte une fentre que condamnait une dalle et les trois
autres faces sont ornes de fausses fentres. Le second tage, dis-
pos sur un pidestal de trois gradins, prsente l'aspect d' un temple
avec ses quatre colonnes ioniques canneles et engages, son archi-
trave et sa gorge gyptienne, confrant un caractre sacr au dfunt.
Le troisime tage repose sur un socle de gradins interrompus aux
angles par des pidestaux qui portaient des cavaliers dont il ne res-
te que quelques fragments. Chaque face est dcore d' un bas-relief
Mausole libyco-punique de Dougga
Haut de 21 mtres, il comprend trois tages. Ce mausole est l'un des rares
exemples d'architecture princire avoir survcu. Il est le rsultat d'un
syncrtisme architectural mlangeant les influences grecques et gyptiennes
sur fond libyco-punique.
128-
l .'ANTIQUIT
reprsentant un quadrige mont par deux personnages. Le monu-
ment se termine par un pyramidion ayant ses angles des statues
mutiles de femmes ailes tenant une boule la main gauche. Enfin,
au sommet de l'difice, se trouve un lion qui serait le symbole du
soleil et des zones clestes. Les femmes ailes, pourraient tre consi-
dres comme des porteuses d'mes , les cavaliers constitueraient
l'escorte pour le voyage terrestre du dfunt, tandis que le char,
conduit par un aurige, l'emmnerait vers se dernire demeure.
Le mausole de Dougga est demeur presque intact jusque
vers le milieu du XIX
e
s. (1842), date laquelle il fut dmoli par
Thomas Reed, consul d'Angleterre Tunis qui enleva et transporta
au British Musum la clbre inscription bilingue, en. libyque et en
punique, qui se trouvait gauche de la fentre du premier tage
selon des indications d'auteurs des sicles prcdents. Auparavant,
cette inscription dont l'intrt n'avait pas chapp aux explorateurs
les plus anciens, avait attir la convoitise de Thomas d'Arcos en
1631 mais le savant franais Peresc, dont il tait le correspondant,
l'empcha de commettre cette irrligion, pour ne pas dire impit, de faire
courirfortune un si noble et si ancien monument de prir tout fait .
Une premire lecture de cette inscription a t l'origine
d'une ide persistante tendant considrer le mausole de Dougga
comme le fastueux tombeau d'Ateban, nomm en tte du texte et
pris pour un important chef numide. Une relecture plus rcente a
permis de voir en Ateban l'architecte et l'entrepreneur qui a dirig
l'quipe de constructeurs charge de l'excution des travaux. Celle-
ci tait compose de trois artisans tailleurs de pierre, dont le fils
d'Ateban ce qui confirme que celui-ci peut difficilement tre le
destinataire d' un ouvrage d'architecture funraire de la qualit du
mausole de deux menuisiers et de deux ferronniers. L' apport le
plus important de l'inscription rside, ainsi, dans le fait que le somp-
tueux monument a t ralis par une quipe entirement numide
depuis l'architecte jusqu'aux artisans.
Les exemples d'architecture royale de Dougga et de Chemtou
ainsi que ceux des grands mausoles d'Algrie montrent la familia-
POQUE CARTHAGINOISE _129
rite des Numides avec l'art hellnistique et leur matrise de tech-
niques propres cet art. Certaines options majeures comme la pr-
dilection pour la version gyptisante prouvent que les emprunts
sont slectionns, voire repenss en fonction du dsir du comman-
ditaire, ce qui dnoterait de la maturit et une certaine autonomie de
l'hellnisme numide. Analysant ces aspects et soulignant le fait
que le mausole de Dougga est l' uvre d' autochtones, Y. Thbert
crit : la puissance du prince africain est clbre par l'emprunt et la recom-
position d'un type d'architecture labore en Orient pour exalter la dimension
divine des souverains et qui devient d'actualit en Numidie lorsque s'y affirme
un pouvoir royal de nature semblable celui des monarchies orientales. Rien ne
tmoigne d'une influence passivement subie : tout au contraire, on devine un
accaparement avec des pratiques de slection et de synthse. L'hellnisme numi-
de est numide .
l'poque prromaine, la langue maternelle des autochtones
de tout le Maghreb tait le libyque qui se rattachait l'ensemble lin-
guitique chamito-smitique comprenant notamment l'arabe, l'h-
breu, l'gyptien et le phnicien. Cependant, le bilinguisme tait d'au-
tant plus couramment pratiqu que la langue officielle des royaumes
berbres tait le punique et que les lgendes des monnaies taient
libelles en punique. L'alphabet libyque tait, comme on le sait, pro-
fondment marqu par l'influence phnicienne. L'criture tait
essentiellement consonantique et les lettres prsentaient des formes
gomtriques, rectilignes et anguleuses, proches du rpertoire de
l'art gomtrique berbre ; disposes en colonnes parallles, elles se
lisaient verticalement de bas en haut et de gauche droite. Toute-
fois, ce systme ancien, s'est substitue, sous l'influence punique,
une orientation horizontale et de droite gauche que l' on retrouve
surtout Dougga.
Dans l'tat actuel des recherches, plus de 1300 inscriptions
libyques ont t dcouvertes dans les diffrents pays du Maghreb.
Cependant, les trouvailles les plus nombreuses, de trs loin, ont t
faites dans l'est algrien et le nord-ouest tunisien dont la langue et
l'criture appartiennent au groupe libyque oriental. Extrmement
130- l . ' ANTIQUIT
rares, voire totalement absentes dans la zone littorale tunisienne o
s'taient implants les premiers tablissements phniciens puis les
cits puniques qui avaient exerc une influence rayonnante sur leur
territoire et leur arrire-pays, ces inscriptions deviennent nom-
breuses sur les plateaux et les hauteurs o les autochtones avaient
trouv une eau relativement abondante, des conditions assez pro-
pices l'agriculture et des facilits de protection et de dfense
contre les incursions nomades.
L'pigraphie libyque est essentiellement funraire avec des
textes courts et strotyps se limitant au nom du dfunt et de son
pre. Seule Dougga a livr quelques inscriptions publiques, dites
officielles, apportant de brefs renseignements sur la socit de la
cit et son organisation politique et administrative.
L'organisation municipale de Dougga l'poque numide
semble ne rien devoir aux Puniques. Le document le plus important
cet gard est le texte bilingue dj voqu et qui consacre l'difi-
cation d'un sanctuaire Massinissa. Dote avec une remarquable
prcision de la dixime anne du rgne de Micipsa (139-138 avant
J.-C.), la ddicace de ce sanctuaire est faite au nom d'un conseil des
citoyens ou des notables appel CKN en libyque et BL en
punique, organe sans doute important l'chelle municipale puis-
qu'il prend une initiative de haute porte politique et religieuse,
consacrant un temple Massinissa, chef charismatique et presti-
gieux roi des Numides, divinis aprs sa mort. Ces Baali , dont on
connat mal les attributions prcises, sont attests galement Mac-
tar, Ells, Mididi, autres cits du royaume numide. D'autres fonc-
tions sont aussi voques par le texte de Dougga. En effet, la ddi-
cace est, en outre, date de l'anne du roi (GLD, aguellid en
libyque), Shafot, fils du roi Afshan : ces rois sont apparemment
des magistrats municipaux ponymes, dont la fonction est annuee.
Ils portent curieusement le mme titre que Micipsa mais celui-ci est
nanti d'un titre plus prestigieux encore, et surtout qui lui est propre:
MNKDH, chef suprme. Dtenteur de cette fonction, le souverain
la fin du III' s. avant J.-C., coexistent deux royaumes numides avec pour rois,
Syphax chez les Masaesyles (c. 220-203) l'ouest, Gaia chez les Massyles (mort
en 206) l'est, Massinissa, fils de Gaia, lui succde partir de 206 et durant son
long rgne de 203 148 unifie la Numidie en un seul royaume en liminant le fils
de Syphax, Vermina (203-159). sa mort, en 148, le royaume de Massinissa est
partag entre ses hritiers.
132-
l . ' ANTIQUIT
numide commande alors aux chefs locaux dits rois et aux princes
des tribus. Il est le matre des princes et des cits.
Beaucoup d'incertitudes planent sur la nature prcise d'autres
fonctions voques par l'inscription : MWSN, deux chefs de cent,
GLDMCK, chef de cinquante, accomplissant des tches militaires
ou para militaires. D' autres fonctions, sans quivalents dans le mon-
de punique, ont t translitres et non traduites : MSSKW, un tr-
sorier, GLDYLM, un chef des prtres. Une approche plus rcente
propose d'autres interprtations : MWSN serait plutt un sage,
GLDMCK, un chef de maons, MSSKW, un architecte, GLDYM,
un chef d'artisans etc...
On connat mal les institutions des autres cits du royaume
numide. Tout ce qu' on peut dire c'est qu'elles ont t, peu peu,
gagnes la punicisation. L'existence de sufftes, fonctions d'origi-
ne punique, en pleine priode romaine et notamment aux I
er
et II
e
s.
avant J.-C. dans des villes de Tunisie comme Althihuros, Capsa, Limi-
sa, Mactar., Masculula et mme Thougga (en 48-49 aprs J.-C., d'aprs
une inscription latine), impliquent des changements, du moins au
niveau de cette dernire cit. Il convient de rappeler, cet gard, que
si Carthage et les autres cits puniques avaient leur tte deux suf-
ftes, les villes numides comme Mactar, Althiburos et Thougga en
eurent trois lorsqu'elles adoptrent le modle punique. Cette option
s'expliquerait par l'existence de traditions autochtones d'administra-
tion triumvirale. On sait qu' la mort de Massinissa, le royaume
numide fut partag entre ses trois fils Micipsa, Mastanabal et Gulus-
sa. Le mme principe prsida la dsignation d'Adherbal, Hiemp-
sal et Jugurtha pour succder Micipsa.
Par ailleurs, d'autres documents nous apprennent que le
royaume numide tait divis en rgions ou districts ayant leur tte
des prfets responsables devant le roi. Certaines villes royales, ou
importantes comme Dougga, taient sans doute les chefs-lieux de
ces provinces. Une inscription de Jbel Massouge voque un res-
ponsable ou prfet du territoire de Tusca (rgion de Mactar-Doug-
ga) qui comptait une cinquantaine de cits. Signals plusieurs
POQUE CARTHAGINOISE _133
reprises dans le royaume numide, ces prfets levaient les impts et
assuraient, le cas chant, le commandement de garnisons.
En revanche, on ne sait rien sur les institutions qui rgissaient
les communauts rurales si ce n' est qu' l' poque romaine, certaines
tribus taient diriges par des comits de onze membres qui n' ont
d'quivalents ni chez les Puniques, ni chez les Romains. On a pu,
toutefois, supposer l'existence dans le monde rural numide, d'insti-
tutions communautaires assez dmocratiques et plus ou moins ana-
logues aux conseils rgissant les villages kabyles (jemaa). Il semble,
en outre, admis que la tribu qui possdait des marchs et quelques
hameaux ou villages, n'exerait aucun pouvoir sur la ville. Son chef
n'tait pas le matre de la cit , dans la mesure o celle-ci s'tait
cre et organise en dehors du cadre tribal. Les villes, quand elles
n'taient pas sous l'autorit directe des prfets, s'administraient
elles-mmes selon un statut numide, punique ou mixte, ces l-
ments tant souvent imbriqus de faon plutt inextricable.
L'ouverture au monde punique et grec
De toute faon, l'essor du royaume numide est essentielle-
ment li aux villes devenues d' importants foyers de rayonnement de
la civilisation mditerranenne grce une grande ouverture aux
mondes punique et grec, notamment. En effet, la mainmise de Mas-
sinissa sur de nombreuses villes maritimes phnico-puniques et l'es-
sor de l' conomie numide favorisrent les contacts entre autoch-
tones et marchands italiens, grecs, gyptiens et syriens dont beau-
coup n'hsitrent pas s'installer en terre africaine rejoignant ceux
qui s'y taient dj fixs aux sicles prcdents. Ces communauts
contriburent certes l'enrichissement du patrimoine humain et
culturel du royaume numide, mais l'veil du monde libyque est un
phnomne d essentiellement aux Puniques et aux Grecs.
L'entit punique est ne du brassage et des croisements entre
une immense majorit d' autochtones et une minorit de Phniciens.
Carthage, les contacts et les changes entre les deux communau-
134-
l .'ANTIQUIT
ts remontent pratiquement la naissance de la cit : de la cra-
mique locale trouve dans des couches archologiques du VIII
e
s.
avant J.-C. atteste une prsence libyque ds cette poque lointaine.
Cette prsence est confirme par l'existence dans des tombes typi-
quement orientales du VIP s. avant J.-C. d'ossements peints l'ocre
rouge selon le rite caractristique des traditions funraires libyques.
En outre, on trouve des Libyens associs l'expansion carthaginoi-
se en Mditerrane comme le suggre une inscription de Moty (en
Sicile) du VI
e
s. qui commmore le sacrifice offert par un Libyen
une divinit phnicienne. Ce phnomne de fusion et d'assimilation
culturelle rciproque se dveloppe avec le temps et l'extension de
l'autorit carthaginoise la majeure partie de la Tunisie actuelle. La
symbiose devint alors telle entre les deux lments que les auteurs
anciens donnent le nom de libyphniciens cette population ethni-
quement libyque mais galement phnicienne par l'assimilation des
immigrants phniciens et de leur culture. L'onomastique montre
que l'lment autochtone a jou un rle considrable au sein de la
socit punique, participant activement la vie agricole, artisanale,
commerciale et culturelle. Des sufftes de souche libyque ont pu se
hisser la tte de nombreuses cits puniques et des fonctions reli-
gieuses importantes ont t exerces par des citoyens de mme
souche. On cite le cas d' une prtresse, au nom libyque, unie un
descendant de Phniciens. On connat aussi de nombreuses stles
votives ddies aux deux grandes divinits phniciennes Bal Ham-
mon et Tanit par des fidles portant eux-mmes et leurs anctres
des noms berbres ou des noms smitiques mais avec une filiation
trahissant une origine libyque ; certains, enfin, malgr la consonan-
ce betbte <ie Leuf noms rvlent urne ascendance smitique, voire
mixte. Ce phnomne ne se limite d'ailleurs pas au territoire de Car-
thage : des dcouvertes faites au sanctuaire de Bal et de Tanit El
Hofra (Cirta-Constantine), la capitale du royaume numide, mon-
trent une prdominance de l'lment punique. La plupart des ddi-
cants portent des noms puniques et exercent des fonctions iden-
tiques celles qu' on trouve dans tout l'univers carthaginois : prtres,
prtresses, militaires, scribes, mdecins, menuisiers et autres arti-
Restitution ralise la suite
des fouilles, des dcouvertes
et des recherches archologiques
faites sur le site de Chemtou.
Long de 12 m, large de 6 m,
le monument devait s'lever
sur une hauteur de 10 m ;
il est constitu de deux tages.
Le massif du rez-de-chausse
comporte une fausse porte
encadre de pilastres et supporte
un lment architectural figurant
le disque solaire accost de deux
serpents couronns. Une frise
sculpte d'armes court dans
la partie suprieure. Le second
tage est entour d'une colonnade dorique. Le monument est construit en grand
appareil avec le marbre qui a fait la clbrit de la carrire du site :
le numidicum marmor. Ce monument appartient l'architecture
royale numide influence par la civilisation gyptienne et
alexandrine pour ce qui concerne le dcor. Il a t construit
dans les premires annes du rgne de Micipsa, aprs la confiscation
de cette rgion Carthage par Massinissa, autour de 152 av. J.-C.
Autel-sanctuaire de
Chemtou. Muse de Chemtou.
Stle du cavalier numide.
H. 94 cm. Muse de Chemtou.
Sculpte dans un calcaire schisteux, cette stle qui reprsente un cavalier, provient
de Henchir Abassa, prs de Chemtou.
Le personnage est figur de trois quarts. Il
porte la barbe et a une chevelure coiffe en
mches. La tte est ceinte d'un bandeau.
Il est vtu d'une tunique et d'un manteau
retenu l'paule par une fibule ronde ; ses
pieds sont chausss de socques.
L'harnachement est riche, la selle est
pommeau. Devant le cheval, s'lve un
palmier. La stle ne comprend aucune
inscription ; aussi l'interprtation
reste-t-elle encore peu sre : le bandeau
ceignant les cheveux, sorte de diadme,
permettrait d'identifier le personnage
un prince numide. On a avanc
celui de Juba, dernier roi numide.
D'autres pensent qu'il s'agit d'un dieu
cavalier. I
er
s. av. J.-C.
136- l .
'ANTIQUIT
sans. Des chefs de tribus, des habitants venus des bourgades envi-
ronnantes et mme des trangers offrent des sacrifices au dieu
punique Bal Hammon. De multiples stles y attestent la prsence
de nombreux marchands grecs et italiens. Les historiens ont beau-
coup insist sur le fait que cette capitale numide revtait alors un
aspect essentiellement punique et qu' part ses origines berbres,
elle ne se distinguait en rien des autres villes du Maghreb punique.
En fait, les rois numides, et en premier lieu Massinissa, hri-
tier des fameux manuscrits carthaginois, taient imprgns de cul-
tare p\miq\ie et arment favoris la pvmieisatioti de leur royaume.
D' aprs Appien, Massinissa fut mme lev Carthage qui, sans
doute, cherchait par ce biais s'assurer la docilit des pres tout en
formant les jeunes princes de manire gagner leur fidlit. Pendant
des sicles, semble-t-il, les cercles dirigeants numides considraient
Carthage comme leur mtropole. Des mariages mixtes taient trs
frquents notamment au niveau de la famille royale dont les
membres recherchaient les mariages avec les filles de l'aristocratie
carthaginoise : pendant la guerre des mercenaires, une des filles
d'Amilcar tait promise Naravas, chef berbre qui, la tte de
2000 hommes, avait combattu les Carthaginois avant se s'allier
eux, Oesalas, oncle de Massinissa, avait pous une nice d' Hanni-
bal ; Sophonisbe, fille d' Hasdrubal eut pour poux Siphax, roi des
Massyles puis Massinissa avant de s'empoisonner pour ne pas tre
livre aux Romains, Massinissa lui-mme donna une de ses filles
un Carthaginois qui en eut un fils nomm Adherbal. Ces mariages
ne pouvaient que consolider l'influence punique en pays numide
d'autant plus que les illustres pouses amenaient avec leurs par-
fums et leurs bijoux les cultes puniques ainsi que les murs et les
coutumes de Carthage.
Ainsi la punicisation du royaume fut d'autant plus profonde
qu'elle toucha des domaines aussi divers que l'artisanat et notam-
ment la production cramique, les croyances religieuses, et la langue
dans sa version crite et parle. Le punique tait, comme on l'a vu,
la langue officielle utilise tant pour les lgendes des monnaies
numides que pour les textes administratifs ou encore pour les ddi-
POQUE CARTHAGINOISE _137
caces religieuses et les pitaphes. Pourtant il existait une criture
libyque assez rpandue dans le domaine priv et qui a connu une
grande prennit puisqu'elle existe de nos jours encore chez les
Touaregs, mais seule Dougga l'a utilise dans quelques-unes de ses
inscriptions publiques, encore que celles-ci taient accompagnes de
traductions puniques. D'ailleurs, l'empreinte de cette punicisation
tait telle qu'au VI
e
s. aprs J.-C., certains Maures se disaient des-
cendants des Cananens, selon Procope.
L'influence de la culture carthaginoise tait donc prdominan-
te en Numidie, mais non exclusive. Le monde grec y exerce une
influence notable avec ses artistes, ses architectes, ses marchands et
ses artisans, prsents un peu partout dans le royaume comme ils
l'taient partout ailleurs dans le monde mditerranen, alors pro-
fondment marqu par l'hellnisation. Massinissa favorisa consid-
rablement les contacts et les changes avec les Grecs dont la langue
et la culture devinrent familires aux lites numides. Mastanabal, fils
de Massinissa, tait selon Tite-Live s avant dans les lettres grecques .
Plus tard, Juba II (25 avant J.-C. - 23 - 24 aprs J.-C.) devint un hel-
lniste distingu, dotant sa capitale, Caesare (Cbcrcbell) de beaux
monuments et d' une grande bibliothque. Son initiation toutes les
sciences lui permit d'crire de nombreux ouvrages en grec et non
en latin ou en punique, langues qu'il matrisait aussi la perfection.
Mastanabal n'hsita pas prendre part aux jeux panhellniques et
remporta entre 168 et 163 la victoire sur l' hippodrome d'Athnes au
cours des Panathnes.
La dimension politique de ces relations est bien illustre par
des changes de bons procds entre les souverains numides et les
Grecs que Massinissa cherchait attirer chez lui en leur rservant le
meilleur accueil. Il honora Polybe d' une hospitalit qui lui valut une
grande admiration de la part de celui-ci. De mme, il reut avec
beaucoup de faste Ptoleme VIII d'Egypte. En outre il fit preuve
d'vergtisme l'gard de prestigieuses cits grecques, offrant de
l'ivoire et du bois de thuya Rhodes, du bl Dlos au profit du
temple d'Apollon. De leur ct, les Grecs ne furent pas insensibles
la gnrosit de Massinissa : ils lui rigrent des statues notam-
138- l . ' ANTI QUI T
ment Rhodes et Dlos ; le roi de Bithynie, Nicomde, en fit de
mme, en tmoignage de reconnaissance au roi numide qui lui avait,
semble-t-il, fourni son appui pour accder au trne. Massinissa se
comportait d'ailleurs en souverain hellnistique. Il fit frapper des
monnaies sur lesquelles il portait le diadme et la couronne laure
et organisait des banquets rehausss par la participation de musi-
ciens grecs. Micipsa, son successeur, vcut galement dans le com-
merce de lettrs et consacra ses loisirs s'instruire, particulirement en matire
de philosophie . Rappelons, enfin, que ces dynastes numides se fai-
saient construire des mausoles prestigieux, dignes de la grande tra-
dition hellnistique.
La religion et les coutumes funraires
Sur le plan religieux, le monde berbre attirait l'attention par
sa grande diversit. Le divin tait, au dbut, organiquement li la
nature, d' o le culte des grottes, des roches et des montagnes. La
zooltrie tait galement pratique et des animaux comme le blier,
le taureau ou le lion taient adors. De mme la terre, les fleuves,
l'eau et la vgtation, sources de toute vie, taient vnrs. Les
gnies attachs ces divers phnomnes faisaient l' objet d' hom-
mages religieux. L'astroltrie tait galement rpandue et, selon le
tmoignage d' Hrodote, les Libyens sacrifiaient la lune et au soleil...
Ce sont l des divinits qui tous les Ubjens offrent des sacrifice . La fr-
quence du croissant et du disque solaire sur les stles votives
libyques, dans les hypoges funraires (haouanet) et dans les dol-
mens confirment ce tmoignage.
Cependant, ct de gnies ou de dieux topiques rgnant sur
des territoires limits et auxquels l'univers rural demeurait attach,
on relve l'existence de divinits autochtones runies en panthons
et objets de cultes locaux ou rgionaux. Des bas-reliefs des II
e
et I
er
s.
avant J.-C. attestent l' importance de ces divinits. Le premier de ces
bas-reliefs provient des alentours de Simitthus (Chemtou). Huit per-
sonnages en buste y sont reprsents. Il s'agit de sept dieux et d' une
Stle dite de la Ghorfa
Elle appartient un groupe de pices rassembles
par un collectionneur tunisien la fin du
XIX* s. et disperses entre plusieurs muses
europens. Une srie de 12 exemplaires est
conserve au muse du Bardo. L'identification
du lieu de trouvaille a t prcise au lieu-dit
Maghraoua, dans la rgion de Mactar.
Ce sont des grandes pices spcifiques,
sculptes selon une composition en registres
domine par un souci dcoratif trs pouss.
Leur dcor constitue en effet une phase
essentielle de la pense religieuse africaine
par la reprsentation hirarchise du
cosmos : le monde cleste, le monde terrestre
et le monde infernal sont disposs en trois
registres superposs. Au milieu, le monde
terrestre est reprsent par un personnage
drap s'avanant devant un temple.
Au registre suprieur, diverses divinits
avec leurs attributs. Au registre infrieur, dans
une crypte, deux caryatides soutiennent le sol
du temple. Cette reprsentation, riche et
ordonne, rvle l'volution de la religion
libyco-punique ayant subi les influences
religieuses mditerranennes et ayant adopt
un syncrtisme ouvert sur le monde extrieur,
marqu par la pense no-platonicienne.
Bas-relief des sept divinits numides,
Provenant de la rgion de Bja. Muse du Bardo.
Calcaire, 0,99 m x 0,70 m.
Sept divinits sont reprsentes de face avec diffrents attributs et l'inscription de
leurs noms respectifs. Il s'agit d'un panthon de divinits locales
qu 'on dsigne souvent sous le
terme collectif de dii Mauri,
dieux maures, diffrents des
divinits majeures de
l'Olympe. Ce sont de petits
dieux ou gnies locaux,
vnrs et craints, objets d'une
grande ferveur
auprs des populations
paysannes ou militaires
en raison de leur caractre
protecteur et bienveillant.
140- l .'ANTIQUIT
desse. Celle-ci dont la poitrine est assez nettement indique par
del la tunique orne de dessins gomtriques qu'elle porte, est coif-
fe d' un bandeau semblable au klaft gyptien. Les dieux, l'excep-
tion d' un seul, portent barbe et moustache et arborent une impres-
sionnante chevelure touffue et crpue. Ils sont habills d' une
tunique plisse recouverte d' un manteau qui n'est pas sans rappeler
la chlamyde grecque. Sur le plan esthtique, ce bas-relief appartient
incontestablement l'art populaire africain, mais certains dtails le
rattachent la tradition orientalisante.
Un autre document, tout fait analogue ce bas-relief dans la
mesure o il reprsente galement huit divinits en buste, a t trou-
v Henchir Ouled Abid, prs de Bou Salem et non loin de Chem-
tou ( 40 km environ). Plus intressant encore, est le bas-relief mis
au jour en 1987 Thunusida (Borj Hellal, 10 km de Chemtou). Il
reprsente un panthon de huit divinits, sept dieux et une desse
et qui sont reprsents non pas en buste mais cheval ou pied.
Cinq parmi les dieux chevauchent l'animal, deux le tiennent par les
rnes et la desse qui occupe une position centrale est sans montu-
re. Sa longue chevelue est retenue par un bandeau et elle porte un
vtement, retenu par une fibule au milieu de la poitrine, et une sor-
te de double jupe . Unique en son genre dans le rpertoire ico-
nographique religieux libyco-punique, ce document a t rapproch
d' une stle de la rgion de Chemtou figurant un cavalier dot d' une
abondante chevelure calamistre et portant barbe et moustaches.
Identifi de prime abord un dynaste numide, on a pu y voir aussi
un dieu cavalier isol tant certains de ses traits et son attitude hira-
tique voquant les divinits du bas-relief de Borj Hellal.
Quoi qu'il en soit, tous ces bas-reliefs montrent une tendance
au regroupement des divinits en un panthon homogne. Cepen-
dant, les attributs de ces divinits n'tant pas indiqus, on ignore le
rle et l'importance de chacune d'elles. Il faudra attendre la priode
romaine et la dcouverte de la stle dite des sept dieux de Bja pour
tre mieux inform dans ce domaine. Il s'agit d' un bas-relief votif,
pigraphe, tmoignant d' un culte vou des dii mauri (dieux
maures) dont les images et les noms figurent sur le document o ils
Tte de libyen.
Muse du Bardo. H. 80 cm.
Cette tte berbre en calcaire noir, a t dcouverte
avec un autre pilier reprsentant un noir, dans les
thermes d'Antonin Carthage en 1946.
C'est sans doute la plus remarquable reprsentation
d'un libyen-gtule que l'art antique nous ait lgu.
La figure est puissante par ses traits. Le crne
apparat entirement ras, l'exception d'une
longue natte rituelle de cheveux tresss qui occupe
le milieu de la tte et se termine par une pendeloque
en forme de croissant sur le front.
Stle de huit divinits libyques.
Muse de Chemtou. H. 0,65 m, L. 1,59 m.
Cette stle en pierre calcaire vert-noir provient de Borj Hellal, prs de Chemtou.
Elle reprsente en bas-relief un alignement de huit bustes dont le quatrime est un
buste fminin.
Ils portent tous une chevelure abondante mches parallles et sont revtus d'une
tunique retenue l'paule par une fibule circulaire. Il s'agirait d'un panthon de
divinits libyques. La stle est date entre les rgnes de Massinissa (202-148) et
Juba 1
er
(60-46) s. av. J.-C.
142- l . ' ANTIQUIT
sont reprsents sigeant dans une palmeraie, l'abri d' une tenture.
De part et d'autre d' un dieu suprme, Bonchor, occupant la place
d' honneur au centre, sont assises deux desses : Vihinam qui veille,
semble-t-il, sur les accouchements et Varsissima qui est sans attri-
but. On trouve ensuite Macurgam dont le bton rappelle Esculape
et Matilam qui on sacrifie un blier, enfin deux dieux cavaliers
Macurtam et Iunam. Le culte vou ce panthon remonte sans
doute l'poque numide mais la stle qui l'atteste est en latin et les
noms des ddicants sont romains. La date propose pour le docu-
ment est le III
e
s. aprs J.-C.
ct de ces panthons autochtones, il conviendrait d'insis-
ter sur la place prpondrante qui revient une divinit africaine
ornant souvent l'avers des monnaies numides ou maures de Juba I
er
,
Bogud, Juba II et Ptolme. Coiffe d' une dpouille d'lphant sur-
monte d'une trompe, attribut qui permet de l'identifier la desse
Africa, dispensatrice de richesses et de fertilit, elle tait le symbole
de la prosprit de la province l'poque romaine et l'objet d'un
culte public et priv particulirement fervent que soulignait Pline en
crivant : En Afrique, personne ne prend une rsolution sans avoir au pra-
lable invoqu Africa .
Carthage, dont l'influence sur les royaumes numides fut
immense dans tous les domaines, avait galement russi marquer
la vie religieuse de sont empreinte en transmettant le culte des prin-
cipaux dieux de son panthon aux Berbres dont les classes diri-
geantes adoptrent avec ferveur Bal Hammon et Tanit. Elle a t
galement pour beaucoup dans la pntration de l'hellnisme dans
l'ensemble du Maghreb et en particulier de certains cultes grecs
dont Massinissa devait favoriser l'expansion au II
e
s. avant J.-C. Des
monnaies numides ornes des ttes de Dmter et Cor portant une
couronne d'pis prouvent l'attachement officiel et priv ces divi-
nits devenues trs populaires. Les annexions opres par Massinis-
sa sur le territoire de Carthage acclrrent le mouvement d'adop-
tion de ces desses dans le reste de son royaume dont la vocation
cralire ne pouvait qu'en tre stimule comme le soulignait l'his-
torien franais J. Carcopino en crivant : cette religion hellnique pion-
POQUE CARTHAGINOISE
_143
geait de lointaines racines dans le vieux fonds naturiste de l'ancienne civilisation
mditerranenne auquel les Numides s'taient attards, et il tait infaillible que,
transporte che^ eux, elle s'y panouit en vivaces floraisons .
L'univers religieux numide est ainsi caractris par un fonds
autochtone vivace sur lequel se sont greffs des apports puniques,
grecs et mditerranens divers qui refltent l'ouverture au monde
extrieur et le brassage culturel qui distingue le Maghreb de
l'poque prromaine marqu par le rayonnement de Carthage et
l'mergence de royaumes berbres puissants.
Dans le domaine funraire, les monuments libyco-puniques
sont caractriss par une assez grande diversit typologique. Le plus
simple de tous se prsente sous forme de tumulus compos d' une
fosse ou d' une modeste chambre funraire recouvertes de terre et
de cailloux. Cependant certains parmi ces tumuli peuvent atteindre
des proportions assez considrables comme ceux d' Enfida, prs de
Sousse, ou d' El Bazina, prs de Sjnane, 118 km au nord-ouest de
Tunis).
Les tombeaux mgalithiques, plus varis, sont galement plus
imposants. Les plus simples sont construits l'aide de trois grandes
dalles, poses de chant et recouvertes par une quatrime, souvent
plus grande. Les plus intressants et les mieux conservs parmi eux
sont dans les rgions de Bulla Regia, Dougga, Kesra et Mididi o
quatre dalles recouvertes par une cinquime protgent l'espace
funraire accessible par une ouverture pratique dans l'une d'elles.
A Maghraoua et Hammam Zouakra, les chambres funraires sont
dlimites par d' normes dalles et prcdes d' un auvent. A Ells et
Mactar les mgalithes forment des ensembles comportant plu-
sieurs chambres groupes autour de couloirs de 1,50 m de hauteur
environ. Ils sont parfois particulirement imposants, atteignant jus-
qu' 15 m de long, 7,5 m de large et comprenant de six sept cel-
lules disposes par groupes de trois avec une au fond.
Les bazinas, ayant une chambre souvent enfouie, se distin-
guent par leur forme circulaire. Un des meilleurs exemples du gen-
re se trouve dans la ncropole de Chemtou, datable du III
e
s. avant
J.-C. et remarquable par certains de ses tombeaux amnags sur
144-
l .'ANTIQUIT
podium avec quatre marches et comportant deux auges o ont t
trouvs de nombreux squelettes appartenant probablement la
mme famille.
Plus intressants encore sont les haouanets qu' on trouve en
abondance dans le Cap Bon et notamment Sidi Mhamed Latrech,
dans les rgions de Sejnane, de Mateur, de Zaghouan et de Monas-
tir o ils sont creuss dans le roc, sur les flancs des collines ou sur
les berges des oueds. Composs essentiellement d' une chambre
funraire accessible par une baie, ils sont parfois dots de ban-
quettes, niches, alcves etc...
Exclusivement utiliss par les autochtones, leur origine pose
des problmes. L'ide la plus courante la situe dans le cadre des
changes humains et culturels tablis par l'intermdiaire des les
entre les rives nord et sud de la Mditerrane, ds le Nolithique. Le
rpertoire des motifs dcoratifs de ces haouanets rvle trois ori-
gines diffrentes : un fonds local o prdominent les ornements
gomtriques simples ainsi que les reprsentations d'animaux et de
scnes de la vie quotidienne et surtout rurale ; un emprunt l'ico-
nographie punique avec le signe dit de Tanit, le mausole et le coq,
image de l'me du dfunt ; une influence gyptisante et surtout hel-
lnistique faite de dcor architectonique avec notamment des
colonnes et des chapiteaux doriques, ioniques ou oliens ainsi que
d'lments divers dus l'Egypte ancienne.
Enfin, les mausoles constituent les monuments funraires les
plus spectaculaires et les plus prestigieux des royaumes numides. Le
modle le plus reprsentatif de ce genre d'difices en Tunisie reste
celui de Dougga, dj dcrit. Le mausole de Bourgou Djerba,
moins bien conserv et moins connu, n'est pas moins digne d'int-
rt.
Vouant un vritable culte leurs morts, les Libyens leurs
rservaient d'immenses ncropoles o on a souvent relev des am-
nagements accols aux monuments funraires et destins l'ac-
complissement de certains rites. Cependant, l'originalit libyque
s'affirme surtout au niveau du mode de spulture. Alors que les
POQUE CARTHAGINOISE _145
cits d'origine phnicienne se caractrisent par l'adoption pour les
morts de la position dorsale allonge, la vieille tradition libyque
consacre la position latrale droite flchie qui est celle du sommeil.
Ces pratiques, particulirement courantes dans les tombeaux typi-
quement libyques comme les dolmens, les tumuli, les hypoges
etc..., sont galement prsentes dans les ncropoles puniques du
Sahel dont les habitants sont issus du substrat local. L'autre carac-
tristique principale qui permet de distinguer les spultures libyques
est comme on l'a vu, l'application sur le mort de l'ocre rouge qui se
fixe sur les os aprs la dissolution des chairs et qui rappelle la cou-
leur du sang. Cette mme couleur est utilise pour peindre les sar-
cophages en bois et dcorer les chambres funraires et notamment
les haouanet.
G. Camps interprte ce fard funraire comme un reconstituant
magique qui donne au mort la force qui lui permet de poursuivre une vie nou-
velle . En outre les tombes libyques, comme celles des autres
peuples antiques, sont riches en mobilier funraire et surtout en
cramiques. Celle-ci est modele, lorsqu'il s'agit de populations de
modeste condition, et importe pour les classes les plus aises, telle
la campanienne, l'artine et celle paroi fine, ou des imitations
locales de ces modles. A cela s'ajoutent aussi d'autres lments et
notamment des colliers en pte de verre et des monnaies.
En dfinitive on peut dire que l'univers des morts et des rites
funraires parat presque entirement domin par l'attachement aux
traditions ancestrales. L'influence des Phniciens et des Grecs,
omniprsente dans d'autres domaines, y a t trs faible.
Nanmoins, ce qu'il faut surtout souligner c'est que la civilisa-
tion punique, ne dans le pays du croisement entre les traditions
autochtones ancestrales et la culture orientale vhicule par les Ph-
niciens, s'est enrichie par les contacts multiformes avec la civilisa-
tions hellnistique dont le rayonnement tait alors considrable
dans toute la Mditerrane. Les historiens expliquent le caractre
vivace de la tradition punique chez les Maghrbins de l'antiquit par
le fait qu'elle ne leur tait nullement trangre mais qu'elle s'tait
146- l .
'ANTIQUIT
constitue au milieu d'eux. voquant Massinissa, G. Camps crit :
Ce Numide est aussi un Punique ; ni physiquement, ni culturellement il ne se
distinguait de ses adversaires carthaginois. Il coulait dans ses veines autant de
sang carthaginois qu'il coulait de sang africain dans celles d'Hannibal .
Inscription bilingue de Massinissa
Dcouverte Dougga en 1904
Conserve au muse du Bardo
Grave sur un bloc calcaire de 51 x 75 x 28 cm, l'inscription est bilingue :
punique et libyque, 5 lignes puniques suivies de 5 autres libyques,
la dernire ligne tant la fois punique et libyque.
C'est assurment l'une des inscriptions les plus importantes
du monde numide. C'est la ddicace d'un temple Massinissa.
Elle est exceptionnelle d'abord par l'clairage qu'elle permet dans
le dchiffrement des lettres libyques partir des lettres puniques, ensuite
par l'tablissement de la gnalogie de la dynastie
massyle : MICIPSA : fils de MASSINISSA, lui-mme fils de GAIA,
lui-mme fils de ZILALSAN.
L'inscription donnant comme rfrence l'anne X du rgne de Micipsa, le docu-
ment date donc de 138 av. J.-C.
CHAPITRE X
La troisime guerre punique,
la chute de Carthage et le triomphe
de Rome
La puissance numide face Carthage affaiblie
La puissance numide parat reposer sur une conomie pros-
pre, une paix intrieure rarement trouble et une population poli-
tiquement stable et de plus en plus volue sur le plan social et cul-
turel. Mais elle doit beaucoup galement la personnalit et au pres-
tige de Massinissa qui, de surcrot, a su doter le pays d' une impor-
tante force arme et d'institutions assez solides.
Au dbut, les bases de la puissance du roi ne reposaient que
sur l'allgeance personnelle des communauts vis--vis de lui. La
mort du souverain pouvait tout remettre en question. La succession
se faisait rgulirement l'intrieur d' une mme famille et le pou-
voir passait au plus g des descendants mles de l'anctre commun.
Il s'agit en gnral du chef de la tribu autour de laquelle s'tait
constitu le royaume. Cependant, pour exercer pleinement son
autorit et maintenir dans la soumission et la fidlit tous les
groupes de la communaut, le roi devait toujours avoir du prestige
et de l'autorit.
A partir de Massinissa, les souverains massyles vont s' efforcer
de doter cette monarchie d'institutions plus solides. Ils semblent
s'tre inspirs du pouvoir cr par les Barcides en Espagne. Au titre
148-
l . ' ANTIQUIT
d'aguellid, ils ajoutent celui, essentiellement militaire et guerrier, de
MNKDH (imperator). Le souverain parat galement revtu d' une
puissance religieuse : il est en quelque sorte l'intermdiaire entre les
dieux et les hommes. D' autre part si les rois numides ne furent pas
adors comme des dieux de leur vivant, ils semblent avoir connu
l'apothose aprs leur mort. Ceux d'entre eux qui avaient t enter-
rs dans le Medracen ou au Tombeau de la Chrtienne jouirent cer-
tainement d' un culte funraire important.
Pour freiner l'ambition de certains chefs de tribus, faire rgner
l'ordre, raliser ses projets d'expansion en Afrique et avoir du pres-
tige l'extrieur, Massinissa veilla avec un soin particulier la
constitution d'une puissante arme et mme d'une flotte. Les nom-
breuses ressources en hommes et en argent dont disposait le sou-
verain lui permirent d'organiser une arme rgulire forme d' un
noyau permanent de 50 000 hommes, semble-t-il, auxquels venaient
se joindre, en temps de guerre, les nombreux contingents fournis
par les tribus. Hannibal et les conceptions puniques semblent avoir
servi de modles l'arme numide. Les lphants taient utiliss
comme force de rupture et la cavalerie jouait un rle important dans
la conduite des batailles.
Paralllement cette remarquable ascension du royaume
numide, Carthage, au lendemain de sa dfaite, entrait dans une pha-
se de rgression militaire et politique. Le seul homme capable de
redresser quelque peu la situation, Hannibal, ayant t limin de la
scne politique, la mtropole punique devint une proie facile pour
son ambitieux voisin Massinissa.
Le trait de paix impos par Rome Carthage en 201 garan-
tissait aux Puniques leurs frontires de l'anne 218. Mais, l'int-
rieur de ces mmes frontires, Massinissa tait autoris revendi-
quer tous les difices, champs, villes et toute autre chose qui, par
le pass, avaient appartenu lui-mme ou ses anctres.
Cette clause rendait toutes les contestations et tous les abus
possibles. C'tait, dans le fond, ce que Rome cherchait. Tout ce qui
tait de nature affaiblir Carthage ne pouvait que l'arranger et elle
ne semblait pas encore redouter que son alli, Massinissa, ne devint
son tour trop puissant.
POQUE CARTHAGINOISE
_149
La conjoncture tait donc favorable, en tous points, au souve-
rain numide. Il savait qu'en manuvrant habilement, il pouvait
mettre la main sur tout ce que ses voisins avaient de plus prcieux :
campagnes fertiles et bien exploites, villes, ports et richesses de
toutes sortes. Carthage n'avait pas le droit, mme titre dfensif, de
lui faire la guerre. Elle ne pouvait lui rsister qu'en se plaignant
Rome dont le soutien lui tait acquis. Il ne lui restait plus qu'
exploiter tous les arguments et tous les prtextes pour s'agrandir
aux dpens d' un adversaire diminu.
Massinissa agit avec la plus grande prudence au dbut. Pen-
dant six annes, de 201 195, il s'abstint de toute attaque. Peut-tre,
tait-il occup organiser son royaume, ou craignait-il d' affronter
Carthage qui disposait encore d'Hannibal. Il chercha bien pntrer
en Cyrnaque avec son arme pour poursuivre un prince numide
rebelle, nomm Aphter, qui s'y tait rfugi, mais Carthage lui en
refusa l'autorisation et l'affaire s'arrta l.
Deux ans plus tard, en 193, les conditions changrent. Hanni-
bal tait parti en Orient. Massinissa n'hsita plus et, par un auda-
cieux coup de main, il s'empara de la rgion ctire sur la petite Syr-
te. Il fora quelques villes lui payer le tribut qu'elles versaient
jusque-l Carthage. Il mettait Romains et Puniques devant le fait
accompli. De leur attitude allait dpendre tout l'avenir du pays. Les
ractions furent conformes aux vux de Massinissa. Le Snat
romain, saisi de l'affaire par une plainte carthaginoise, jugea bon de
ne pas mettre fin au conflit.
Fort de ce prcdent, Massinissa revint la charge en 182. Il
s'empara d' un territoire enlev jadis par Gaa aux Carthaginois puis
restitu ceux-ci par Syphax. Rome se contenta de rassurer Cartha-
ge en lui donnant de vagues garanties de paix non seulement de sa
part mais aussi de celle de Massinissa. Ce dernier n'en garda pas
moins ses conqutes.
En 172, le Snat romain ragit aussi mollement une nouvel-
le plainte carthaginoise au sujet des empitements de Massinissa. En
l'espace de deux ans, celui-ci se serait empar de plus de soixante-
dix villes et lieux fortifis situs probablement en Tunisie centrale.
150- l .'ANTIQUIT
En 162, Massinissa frappa de nouveau un grand coup : il
devint matre des cits des emporia et en particulier de Leptis
Magna. Ce nouveau succs, couvert, une fois de plus par le Snat
romain, encouragea le souverain numide acclrer le rythme de ses
empitements. Ces contestations et les conflits devinrent alors de
plus en plus frquents.
En 153-152, Massinissa jeta son dvolu sur la moyenne valle
de la Medjerda et le territoire de Tusca. Il s'agit des plus riches terres
crales de la rgion de Jendouba (Souk el Arba) et de Bou Salem
(Souk el Khmis) ainsi que des campagnes autour de Mactar. Car-
thage essaya de faire constater aux Romains la violation du trait de
201, puis implora, vainement, leur intervention.
Ainsi au cours de cette longue priode, Massinissa russit
enlever ses voisins de vastes territoires aussi bien sur le littoral des
Syrtes que dans l'ouest et le centre de la Tunisie. Ses empitements
n'avaient pas de fondement lgitime, mais ils avaient t considra-
blement favoriss par l'impuissance de Carthage et la complaisance
de Rome.
Cependant les relations entre Massinissa et ses voisins deve-
naient de plus en plus tendues et on sentait que le conflit, latent
depuis une cinquantaine d'annes, n'allait pas tarder clater. Les
Carthaginois, bout de patience, expulsrent tous ceux qui, au sein
de leur ville, taient gagns la cause du roi numide et prconisaient
une entente avec lui. Les exils se rfugirent chez Massinissa qui
envoya ses fils Micipsa et Gulussa plaider leur cause et demander
leur rappel. Mais les princes numides furent conduits et l'un d'eux,
Gulussa, fut mme attaqu et perdit quelques soldats de son escor-
te.
Massinissa ragit en assigeant Oroscopa (ville non encore
identifie), et Carthage se dcida lui faire la guerre. Celle-ci clata
en 150 et ne dura pas longtemps. Rome envoya des dputs chargs,
selon Appien, d'arrter les hostilits si Massinissa tait en position
d'infriorit, de le stimuler s'il avait le dessus. St. Gsell pense que
c'tait plutt pour constater officiellement la violation du trait de
201 par les Carthaginois et non pour aider Massinissa dont la puis-
POQUE CARTHAGINOISE
_151
sance commenait inquiter srieusement Rome. De toute mani-
re, le roi numide vainquit Carthage et lui imposa des conditions trs
dures.
En faisant cette guerre, les Carthaginois avaient viol le trait de
201 et donn Rome le prtexte qu'elle cherchait pour intervenir.
La troisime guerre punique
Les dputs romains qui se sont succds en Afrique pour
arbitrer les incessants conflits punico-numides avaient fini par tre
frapps par l'ambition et la puissance croissante de Massinissa
devant un tat punique de plus en plus incapable de lui rsister. Un
royaume numide fort porterait ombrage la toute puissance romai-
ne. Il fallait donc ragir sans trop tarder.
Appien et Plutarque racontent qu' en 153, Caton, s'tant ren-
du en Afrique la tte d' une commission d' enqute, fut frapp par
le relvement de Carthage. Inquiet, il ne songea plus qu' dlivrer
Rome d' une menace de revanche et dbarrasser l' conomie romai-
ne d' une concurrente dangereuse. Ds son retour d' Afrique, il se
prsenta devant le Snat romain et, exhibant une belle figue frache
cueillie Carthage, symbole de la proximit de cette ville et de son
renouveau conomique, il aurait dclar ses collgues : nous avons
un ennemi si prs de nos murs ! . D' autre part, il ne cessa d'alerter ses
concitoyens en ponctuant toutes ses interventions par la fameuse
phrase : Delenda est Karthago (Carthage doit tre dtruite).
En ralit, Carthage, sans marine et sans empire, rduite par
les empitements de Massinissa l'angle nord-est de la Tunisie et
une mince bande ctire allant du golfe de Tunis au golfe de Gabs,
n'tait plus la puissante cit qu'elle fut jusqu' la deuxime guerre
punique. On ne voit pas du tout comment elle pouvait inquiter
Rome ou songer une quelconque revanche. C'tait de Massinissa
que les Romains avaient peur. Celui-ci, selon Tite Live, ne cessait
d'afGxmet ojae L'Afrir^j devait appartenir aux Africains.
152- l . ' ANTIQUIT
Il fallait, par consquent, l'empcher de runir tous les terri-
toires nord-africains en un seul royaume ayant pour capitale Car-
thage, ville riche et d' un puissant intrt stratgique. La ralisation
d' un tel projet dresserait devant Rome, plus ou moins longue
chance, un tat berbre plus homogne et certainement plus
redoutable que son hrditaire rival punique. La logique aurait vou-
lu qu' on s'attaqut directement au roi numide, mais il tait difficile
de justifier pareille attitude vis--vis d' un fidle et vieil alli et l'on
dcida froidement de dtruire Carthage. Ce fut la troisime guerre
punique.
puiss et pleinement conscients de leur infriorit, les Car-
thaginois essayrent de se concilier les bonnes grces de Rome et de
la flchir. Ils condamnrent mort les auteurs de la guerre contre
Massinissa, puis se dclarrent prts accepter toutes les conditions
qu' on leur imposerait. Mais Rome se montra peu dispose traiter.
Au dbut du printemps de l'anne 149, elle envoya d'impo-
santes forces en Afrique : 80 000 fantassins, 4 000 cavaliers et une
flotte de cinquante quinqurmes et cent autres navires de guerre.
Effrays, les Carthaginois essayrent, une fois de plus de dsarmer
leurs adversaires par une soumission totale. Ils remirent aux
Romains 200 000 armes, 2 000 machines et 300 jeunes aristocrates
en otage. Ce fut alors seulement que Carthage put prendre connais-
sance de la dcision du Snat romain : les Carthaginois taient tenus
d' abandonner leur cit, qui serait dtruite, et de la rebtir 15 kilo-
mtres l'intrieur des terres.
Les Romains se montrrent insensibles aux prires et au dses-
poir des dputs carthaginois. D'aprs St. Gsell, citant Polybe, l'un
des Carthaginois, Banno, fit un discours qui n'eut pas plus de suc-
cs : Il n 'tait plus temps, aurait-il dit, de discuter la question de droit ; cet-
te heure, les Carthaginois ne s'adressaient qu' la piti des Romains. Ils n'en
taient pas indignes, car ils avaient, pendant de longues annes, observ le trait
de Scipion et ils venaient de se soumettre tout ce qu'on avait exig d'eux. De
son ct, le Snat romain s'tait engag leur laisser leurs lois. Comment leur
tiendrait-il cette promesse, si Carthage tait dtruite ? Quels hommages rece-
POQUE CARTHAGINOISE
_153
vraient dsormais leurs dieux et leurs morts, pourtant innocents ? Quels moyens
d'existence eux-mmes trouveraient-ils loin de la mer, dont ils vivaient pour la
plupart? Home ne voudrait pas ternir sa gloire par une action aussi injuste .
Les Romains rpondirent l'auteur de ce pathtique discours que
l' ordre du Snat tait irrvocable.
Renonant plaider une cause qu'ils savaient dsormais per-
due, les Carthaginois ne songrent plus qu' vendre chrement leur
peau en luttant avec l'nergie du dsespoir. Dans la ville o rgnait
une atmosphre d'exaltation gnrale chacun trouva en lui-mme
les ressources pour lutter avec hrosme. Mme les femmes, disait-
on, sacrifirent leurs cheveux et en firent don aux guerriers pour
tresser des cordes de catapulte. On tira ingnieusement parti de ce
qu' on trouva dans la ville pour fabriquer des armes : boucliers,
pes, lances, traits de catapultes.
Seules parmi les cits importantes Hippo Diarrhjtus (Bizerte),
Clupea (Klibia) et Neapolis (Nabeul) demeurrent fidles Cartha-
ge. Utica, Hadrumetum (Sousse), Thapsus (Ras Dimas), epti Minus
(Lemta) et Acholla (Boutria) se rallirent Rome. Insensible tous
ces malheurs comme l'adversit, Carthage redoubla de rsistance.
Ch. A. Julien crit ce s u j e t Trois ans durant (de 149 146), comme
une bte force, elle fit tte aux chasseurs, avec une vigueur que le Snat n 'avait
pas prvu dans son plan .
Aprs deux annes d'checs, les Romains confirent le com-
mandement de leurs troupes Scipion Emilien, fils de Paul Emile,
le vaincu de Cannes, et fils adoptif de Scipion l'Africain.
La destruction de Carthage et le triomphe de Rome
Scipion Emilien parvint, peu peu, resserrer le blocus
autour de la ville. Il l'isola compltement et, l' empchant de se ravi-
tailler, l' affama. Au printemps de l'anne 146, il lui donna l'assaut
final. Il parvint, d' abord, s'emparer du port militaire, puis, aprs de
longs combats de rue, la ville basse tomba encre ses mains, maison
par maison, les luttes corps corps se poursuivant jusque sur les
154-
l . ' ANTIQUIT
toits. Scipion incendia ensuite les maisons et les rues qui entou-
raient l'enceinte de la colline de Byrsa afin de permettre ses
troupes d'avancer plus rapidement. La citadelle demeura bientt le
seul noyau de rsistance. Au bout de six jours et six nuits d'assaut,
55 000 habitants se livrrent enfin, Scipion. Le temple d' Esh-
moun servit d'ultime bastion aux derniers combattants. puis, tor-
tur par la faim, ne pouvant endurer davantage, le chef carthaginois
Hasdrubal se rendit son rival et implora sa piti. Sa femme,
Sophonisbe, lui reprocha sa lchet et sa trahison, puis pare de ses
habits de fte, elle se jeta dans les flammes avec ses deux fils.
Un gigantesque incendie allum par Scipion fit rage pendant
dix jours dans la cit en ruines. Le bourreau de Carthage lui-mme,
semble-t-il, en fut touch au point de pleurer. Aprs d'amres consi-
drations sur la prcarit des choses de ce monde, il rcita haute
voix les fameux vers d' Homre : Un jour viendra o prira Ilion, la vil-
le sainte, o priront Priam et le peuple de Priam, habile manier la lance .
A Polybe qui l'interrogeait sur le sens de ces paroles, il rpondit :
je ne sais pourquoi j'ai peur qu'un autre ne les rpte un jour, propos de ma
patrie .
Les Romains eurent beaucoup de mal triompher d' une ville
qu'ils avaient prive de ses armes de faon dloyale ds avant la
guerre, qui leur rsista avec hrosme et dont les hommes ne cd-
rent qu'puiss par la famine. Les vainqueurs se livrrent un pilla-
ge effrn avant de rduire en esclavage la presque totalit des sur-
vivants de la cit. Puis, tout ce qui n'a pas t consum par les
flammes fut ras ; selon les auteurs anciens le sol de la ville fut
labour, sem de sel et dclar maudit pour que personne ne son-
get plus jamais y btir.
Toutes les villes qui avaient t fidles Carthage furent
condamnes tre dtruites. Celles qui soutinrent Rome furent
dclares libres et leurs territoires agrandis. Utique qui fut la pre-
mire faire dfection vit ses possessions s'tendre jusqu' Bizerte
au nord et Carthage au sud. Elle ne tarda pas devenir la capitale
de la province de VAfrica que les Romains se taillrent sur l'ancien
territoire que possdait Carthage la veille de la troisime guerre
punique.
POQUE CARTHAGINOISE
_155
Carthage dtruite et son territoire transform en province
romaine, le sort de l'Afrique ne va plus dsormais dpendre que des
Romains et des Numides qui rgnaient sur une bonne partie de la
Tunisie actuelle.
Fort peu tendu, le territoire de cette province ne dpassait
gure 25 000 kilomtres carrs et tait limit par la fossa regia, foss
creus par Scipion Emilien. La frontire partait des environs de
Tabarka, se dirigeait vers le sud-est en passant notamment l'est des
rgions de Bja, Tboursouk et Dougga, atteignait le Jebel Fkirin,
puis vitant la steppe, elle longeait la cte jusqu'au sud de Thaenae
(Thina).
Ds le lendemain de la conqute, le sol fut soigneusement
cadastr et divis en centuries carres d'environ 50 hectares. On
essaya plusieurs reprises d'y installer des colons italiens. Caus
Gracchus (122 av. J.-C.) fut l'auteur malheureux de la plus clbre de
ces tentatives puisque ses ennemis politiques n'hsitrent pas le
discrditer puis le perdre, l'accusant d'avoir provoqu la colre des
dieux en implantant une colonie (Colonia lunonia Karthago) sur le sol
maudit de Carthage.
Les autochtones durent payer un tribut fixe pour conserver la
proprit prcaire de certaines terres et Rome transforma en domai-
ne public la presque totalit du territoire cadastr.
Rome confia enfin l'administration de la province un magis-
trat qui, partir de Sylla, reut le titre de proconsul. Ce gouverneur
se faisait assister par des lgats et des attachs qu'il choisissait lui-
mme et confiait la trsorerie un questeur dsign par le Snat.
Nomm pour une anne, il devait administrer la province, dfendre
ses frontires et y maintenir l'ordre et la scurit.
Au total si cette province ne contribuait pas encore de mani-
re sensible accrotre la puissance et les richesses de Rome, elle ne
constituait pas moins un obstacle srieux toute progression numi-
de.
la mort de Massinissa en 148 avant J.-C., les Romains s'ar-
rangrent pour rgler sa succession en partageant son royaume
156-
l . ' ANTIQUIT
entre ses trois fils : Micipsa reut l'administration, Gulussa l'arme
et Mastanabal la justice. Rome divisait pour rgner et elle cartait
ainsi pour un certain temps le pril numide.
Cependant, profitant de la mort de ses deux frres, Micipsa ne
tarda pas disposer de tout le pouvoir. Au cours d' un long rgne de
30 ans (148-118) sans troubles, il russit poursuivre l'uvre de son
pre, dveloppant le pays, organisant les cits, attirant commerants,
artistes et hommes de lettres grecs et romains et consacrant ses loi-
sirs aux tudes et particulirement la philosophie. Il eut pour suc-
cesseurs ses deux fils Adherbal et Hiempsal I
er
, et son neveu Jugur-
tha. Personnalit de premier ordre, intelligent, habile et ambitieux,
celui-ci ne pouvait se satisfaire d'un partage : il fit tuer Hiempsal,
vainquit Adherbal, qui s'enfuit Rome, et mit la main sur toute la
Numidie en 116 avant J.-C. Rome intervint pour rsoudre le conflit
entre les deux rois, et Jugurtha dut attendre prs de quatre annes
avant d'envahir le territoire d'Adherbal mettant profit les circons-
tances de Rome, menace par l'invasion des Teutons. Il russit
s'emparer de Cirta, tuer son rival et des marchands italiens pris les
armes la main.
A Rome, tous les partis furent alors d'accord pour dclarer la
guerre Jugurtha. Jusque l l'aristocratie snatoriale tait plutt
favorable au maintien d' une formule de protectorat sur la Numi-
die tandis que le parti populaire et les chevaliers, attirs par les
richesses du royaume, taient partisans de sa conqute, ce qui est
dans la logique du partage du pouvoir intervenu, l'initiative de Sci-
pion Emilien, au lendemain de la mort de Massinissa.
La guerre clata en 111 avant J.-C. et ne dura pas moins de six
annes au cours desquelles elle fut marque par des moments de
grande intensit et des priodes de relchement ainsi que par de
rapides et frquents dplacements des thtres des oprations. En
outre l'volution de la situation intrieure Rome et les conflits
d'intrt entre ses diffrents partis eurent un poids considrable sur
le droulement des vnements.
Au cours de la premire phase, les Romains conduits par le
consul L. Calpurnius Bestia et le prince du Snat, Scaurus, envahirent
POQUE CARTHAGINOISE
_157
le royaume, s'emparrent de quelques cits secondaires et ouvrirent
au commerce romain l'important port de Lepcis Magna qui avait
fait dfection au royaume ; puis la paix fut conclue avec Jugurtha
moyennant une certaine somme d'argent et des livraisons d'l-
phants, de chevaux et de btail. Selon la version de Salluste, fonde
sur les accusations du parti populaire, Jugurtha aurait corrompu les
gnraux romains pour obtenir la paix. On peut penser galement
que la perspective d'une guerre longue et incertaine, sans l'appui
d' un prince local, avait pes du ct romain sur la dcision d'enga-
ger des pourparlers de paix. Appel comparatre comme tmoin
Rome, Jugurtha manuvra habilement et vita un verdict de culpa-
bilit : c'est alors qu'il pronona sa fameuse phrase, propos de
Rome : Ville vendre et condamne prir, si elle trouve un acheteur .
Cependant cela n'empcha pas les Romains de songer une nou-
velle campagne en Numidie : ils poussrent un prince numide rfu-
gi Rome revendiquer des droits sur le royaume. Jugurtha ragit
en le faisant assassiner, ce qui provoqua une grande colre dans la
mtropole romaine et amena la poursuite de la guerre. Confie
Postumius Albinus, puis son frre A.ulus, celle-ci aboutit une cra-
sante dfaite pour les Romains prs de Calama (Guelma) en 110-
119 avant J.-C.
Devant ces preuves de vnalit et d'incomptence de la part
de ses gnraux, Rome ragit en dsignant la tte de son arme le
consul Metelhts, connu pour son intgrit et sa valeur militaire. Celui-
ci russit battre les troupes de jugurtha prs du Muthul (Oued
Mellgue) avant d'chouer dans son entreprise de s'emparer de
Zama. Mais la guerre de harclement pratique par les Numides,
leur grande mobilit et la force de frappe de leur cavalerie posaient
de gros problmes aux Romains qui essayrent en vain de dresser
les tribus conte leur roi. Metelhts a eu beau s'emparer de Thala, puis
avec l'aide de son lgat Marins d'autres villes et surtout de Cirta,
Jugurtha ne continuait pas moins la lutte contre les Romains, aid
par les tribus Gtules et par son beau-pre Bocchus I
er
, roi de Mau-
rtanie.
En 107, Marius fut lu consul et reut le commandement de
158-
l . ' ANTIQUIT
la guerre de Numidie. Ce nouveau gnral brillait beaucoup plus par
son courage et son habilet dans la pratique de la guerre que par son
intelligence. Cicron disait de lui que c'tait un homme inculte mais
vraiment un homme . Il recruta d'importants contingents et entrana
ses hommes la gurilla et aux raids sur les villes. A la fin de l't
107, il s'empara par surprise de la cit de Capsa (Gafsa), qu'il incen-
dia et dont il massacra les habitants en ge de porter les armes.
Ensuite, il tenta une expdition vers l'ouest, aux confins du royau-
me maure, prs de la Moulouya, o il s'empara d'un chteau fort qui
renfermait le trsor du roi, ce qui entrana le soulvement des tribus
maures contre les Romains. Aussi, au retour, se heurta-t-il aux
armes de Jugurtha et de Bocchus, n'vitant la catastrophe que gr-
ce la grande habilet de son questeur Sylla. Jugurtha russit mme
reprendre quelques cits, dont surtout la capitale Cirta mais il ne
la conservera pas longtemps, Marius ayant pu la reprendre.
Au cours de l'anne 105 Sylla parvint convaincre l'entoura-
ge de Bocchus pousser celui-ci abandonner la cause de Jugurtha
qui, la faveur d'un guet-apens, fut livr aux Romains. Cet pisode
mit fin une guerre jusque l indcise.
Aprs cette longue lutte contre l'imprialisme romain, Jugur-
tha connut une fin triste et Bocchus qui l'avait trahi, reut le titre
d'ami et d'alli du peuple romain, le tiers occidental de la Numidie,
tandis que la partie orientale revint Gauda. Rome ne se proccu-
pa pas d'agrandir sa province d'Afrique, n'ayant plus rien craindre
des rois numides et ayant rtabli sa prpondrance politique et co-
nomique en terre numide dsormais largement ouverte aux convoi-
tises des commerants et financiers romains et italiens. En outre
Marius dota les vtrans de son arme de riches terres agricoles
notamment dans les rgions de Thibaris (Thibar), Uchi Maius (Hen-
-Jr.-i-i Dwafflsi*, <zk. Thubumica ^S-i/di. AJLL Telkacftro^j,. [_flS Grtllles cmi
s'taient rallis ses troupes reurent, de leur ct, de vastes terres
Oued Siliana et Oued Tessa.
L'Afrique ne devait revenir au premier plan des proccupa-
tions romaines que lors de la lutte sanglante qui opposa dans tout
l'empire les partisans de Pompe ceux de Csar. Le chef des Pom-
POQUE CARTHAGINOISE
_159
pens d'Afrique, Caton, russit rallier sa cause le roi numide Juba
I
er
qui caressait secrtement l'espoir de reconqurir l'ancien territoi-
re de Carthage et de faire, son profit, l'unit de l'Afrique du Nord.
L'intervention de Csar va mettre fin ce rve et renforcer la
main mise de Rome sur l'Afrique. Dans les derniers jours de l'anne
47 avant J.-C., Csar dbarqua prs d'Hadrumetum (Sousse) et s'ins-
talla dans une position forte Ruspina (prs de Monastir) ; les pre-
miers temps furent trs difficiles pour lui : mal ravitaill, ne recevant
pas le renfort sur lequel il comptait, il fut, de surcrot, bloqu Rus-
pina. Mais il russit peu peu rtablir la situation et parvint mme
mettre en droute les troupes pompennes et celles de Juba le 6
avril 46 prs de Thapsus (Ras Dimas).
Ds lors, il ne rencontra plus de rsistance srieuse : Utique lui
ouvrit ses portes et Caton s'y donna la mort ; Juba, poursuivi jusque
vers Zama, se suicida et son territoire fut annex l'empire romain.
Ainsi en 46 toute la Tunisie et une partie de l'Algrie devin-
rent romaines. Csar projeta de fonder une nouvelle colonie (Co/o-
nia Julia Karthago) sur l'ancien emplacement de Carthage. Mais son
assassinat en 44 avant J.-C. l'empecha de raliser ce projet.
En dfinitive, il apparat clairement que la Tunisie a perdu avec
Carthage ce rle de puissance mditerranenne de premier plan
qu'elle a jou pendant longtemps. Cependant, l'aube de l're chr-
tienne, certains lments fondamentaux de sa personnalit histo-
rique commencent dj se dgager : pays africain situ en plein
cur de la Mditerrane, elle est dj une terre d'changes, de
contact et de rencontres entre des mondes aussi divers et aussi
riches que l'Afrique, l'Occident et l'Orient. Sur un fond de vieille
civilisation africaine des influences smitiques, latines et mditerra-
nennes diverses s'y taient tour tour greffes.
DEUXI ME PARTI E
POQUE ROMAINE
CHAPITRE PREMIER
La rsistance arme la domination
romaine et l'organisation
dfensive de la province
Aprs la mort de Csar, la guerre civile, Rome, reprit de plus
belle, et lAfrique connut une priode de troubles. La lutte pour le
pouvoir opposa aux Rpublicains les partisans de Csar, conduits
par Antoine, consul en 44 av. J.-C., et Octave, petit neveu et fils
adoptif de Csar. Le gouvernement de l'Africa vtus et de l'Africa nova
passa alors, au hasard des accords ou des conflits entre Csariens et
Rpublicains, aux mains d'Octave, d'Antoine et du grand pontife
Lpide.
Le snat avait confi le gouvernement de l'Africa vtus un
rpublicain, ami de Cicron, O. Cornificius ; il s'tait en mme temps
empress de priver de ses lgions T. Sextius, le gouverneur de l'Africa
nova dj nomm par Csar. Le conflit, invitable, entre les tenants
des deux politiques adverses, clata au lendemain de la constitution
du triumvirat par Octave, Marc Antoine et Lpide. Dans le partage
des provinces, l'Afrique chut Octave, avec la Sicile et la
Sardaigne. T. Sextius, qui s'tait aussitt ralli aux triumvirs, leva des
troupes dans sa province, et envahit les territoires de Q. Cornificius
qui ne reconnaissait d'autre autorit que celle du Snat. Aprs avoir
164-
l .'ANTIQUIT
essuy un premier chec, il russit grce au concours de contingents
berbres tuer Cornificius et devenir matre des deux Afriques.
Le nouveau partage des provinces, en 42 av. J.-C., promettait
les provinces africaines Lpide. Mais l'Africa vtus fut rserve, en
fait, Antoine et l'Africa nova Octave. Le conflit qui opposa bien-
tt les deux triumvirs entrana de nouvelles luttes qui se terminrent
l'avantage du gouverneur dsign par Antoine. Mais celui-ci dut
cder les deux Afriques Lpide qui gouverna de 40 36 av. J.-C.,
sans utiliser ses gros effectifs pour de nouvelles conqutes.
partir de 36, Octave devint le matre incontest des deux
provinces africaines et des territoires accords par Csar au condot-
tiere italien P. Sittius ; bientt, en 27 av. J.-C., l'ensemble ne forma
plus qu' une seule province proconsulaire et snatoriale.
Ce fut le point de dpart d' une nouvelle priode de notre his-
toire.
Les expditions contre les Garamantes,
les Musulames et les Gtules, sous Auguste
L'tablissement de la domination romaine et son expansion
vers le sud se heurtrent, cependant, des rvoltes successives dont
nous ne connaissons que les pisodes les plus saillants. Il fallut des
expditions incessantes pour assurer ce qu' on appelle, par un
euphmisme colonial, la pacification du pays ; malgr les dfaites
apparentes, la rsistance berbre - d' abord dans le sud de la
Proconsulaire, puis dans le centre et l'ouest du Maghreb - ne fut
jamais entirement subjugue.
Sous Auguste, les actions militaires les mieux connues furent
menes par les proconsuls L. Cornlius Balbus et Cossus Cornlius
Lentulus. Le premier dirigea en 21-20 av. J.-C. son expdition vers le
sud, contre les Gtules du sud de la Numidie et les Garamantes qui
POQUE ROMAINE.
165
avaient particip aux guerres entreprises, au cours des annes pr-
cdentes, par les Numides et les Gtules. L'action de Balbus russit,
du moins pour un temps, empcher ces Garamantes du Fezzan de
poursuivre leurs harclements et entraner l' arme romaine en
plein Sahara ; en effet, plus de vingt ans sparent son triomphe
de celui de Passienus Rufus qui, l'issue d' une nouvelle expdition,
clbra son tour sa victoire sur le mme ennemi en 3 ap. J.-C.
La campagne de Cossus trouve une place plus large dans les
textes littraires. Par suite du soulvement des Gtules contre Juba
II, install par Rome sur le trne de Maurtanie, les rvoltes ne se
limitrent pas au sud de la Maurtanie et atteignirent les steppes de
la Tunisie mridionale. Cossus dut combattre l' importante tribu des
Musulames, installe au sud de la Mjerda, et les Gtules voisins
des Syrtes ; il mrita les honneurs du t ri omphe et le surnom de
Gtulique , aprs avoir, en 6 ap. J.-C., russi rprimer la rvolte.
Le nombre et les dtails de ces oprations sont cependant mal
connus. Ils indiquent clairement que l' occupation des rgions mri-
dionales fut une uvre longue et difficile, seulement bauche sous
Auguste.
La rvol t e de Tacfari nas ( 17- 23 ap. J.-C.)
Au temps de Tibre, la rvolte de Tacfarinas troubla pendant
huit ans la province. Tacite la rsume en quelques lignes :
Cette mme anne (17 ap. J.-C.) la guerre commena en Afrique. Les
insurgs avaient pour chef un Numide, nomm Tacfarinas, qui avait servi
comme auxiliaire dans les troupes romaines et avait ensuite dsert. Il rassem-
bla, d'abord, quelques bandes de brigands et de vagabonds qu'il mena au pilla-
ge ; puis il parvint les organiser en infanterie et cavalerie rgulires. Bientt,
de chef de bandits, il devint gnral des Musulames, peuplade vaillante qui par-
court les rgions dpourvues de villes, en bordure des dserts d'Afrique. Les
Musulames prirent les armes et entranrent les Maures, leurs voisins, qui
166-
l .'ANTIQUIT
avaient pour chef Ma^ippa. Les deux chefs se partagrent l'arme : Tacfarmas
garda l'lite des soldats, tous ceux qui taient arms la romaine, pour les
rompre la discipline et les habituer au commandement, tandis que Ma^ippa,
avec les troupes lgres, porterait partout le fer, la flamme et l'effroi
(Ann. II, 52).
Au dbut, il ne s'agissait sans doute que de l'effervescence
habituelle des tribus mridionales, manifeste par des rvoltes et des
incursions en territoire sous domination romaine. Mais \a prsence
d' un chef d'envergure, rompu au mtier des armes, permit de trans-
former en arme rgulire la cohue des guerriers, d'organiser le
mouvement et de l'tendre jusqu' la Maurtanie l'ouest et la
petite Syrte l'est. Ce fut une rvolte gnrale des tribus du sud
dresses contre la domination romaine.
Malgr la victoire du proconsul M. Furius Camillus qui, la tte
de la III
e
lgion Auguste et de contingents auxiliaires, russit battre
Tacfarinas en bataille range (17 ap. J.-C.), la situation ne cessa de
s'aggraver. Tacfarinas adopta avec habilet la tactique ternelle de la
gurilla, que ses troupes appliquaient la perfection. Les Romains
s'puisaient vainement contre un ennemi insaisissable ; une fois
cependant, les Romains russirent surprendre Tacfarinas et le
rduisirent se rfugier au dsert. Mais ce fut encore un succs sans
lendemain, qui n'empcha pas le chef numide de reprendre ses raz-
zias et de menacer Tibre d' une guerre interminable , s'il refusait
de lui cder de bonne grce des terres. Sommation qui tmoigne,
avait-on pens, de la ncessit vitale pour les Numides de se ravitailler
dans les plaines fertiles confisques par la colonisation romaine.
Mais cette rsistance l'occupation n'avait pas concern, c'est
un fait, les rgions du nord, o la colonisation avait commenc se
dvelopper. Elle s'opposait principalement au contrle que l'arme
romaine cherchait imposer aux semi-nomades ; leurs dplace-
ments venaient, en effet, d'tre clairement menacs par la construc-
tion, en 14 ap. J.-C., d' une route stratgique qui reliait Ammaedara
POQUE ROMAINE.
167
(Hadra), sige alors du camp de la lgion romaine, Caspa (Gafsa)
et Tacapae (Gabs). Supportant mal les vexations inhrentes, sans
doute, un contrle qui cherchait limiter leurs parcours, ces popu-
lations habitues l' indpendance opposrent ainsi une rsistance
farouche.
Un nouveau proconsul, Q. Julius B/aesus, comprit la ncessit
d' adapter sa tactique aux conditions de la gurilla africaine ; il orga-
nisa des colonnes mobiles qui harcelrent les Numides, tout en ins-
tallant ses troupes dans des camps fortifis, le long des frontires. Il
russit aussi, par des promesses et des concessions, provoquer des
dfections dans les rangs des insurgs, mais ne put satisfaire le dsir
de l' empereur qui lui avait prescrit de capturer Tacfarinas. Ce fut le
proconsul P. Cornlius Dolabella qui mit un terme la rvolte. Aprs
avoir adopt la tactique de Blaesus, il russit surprendre Tacfarinas
prs d' un fortin ruin et brl jadis par les Numides, au milieu d' une
fort o il se croyait en sret. Les soldats romains massacrrent
sans piti les Numides surpris au repos ; et la fin de Tacfarinas qui
se droba la captivit par une mort qu 'ilfit payer cher marqua la fin de
la guerre. Dans le sud de la Tunisie actuelle, Rome contrlait dsor-
mais le pays jusqu'aux confins du Sahara.
La fin de la pacification
Il n'y eut pas d'autres troubles graves sous Caligula, du moins
en ce qui concerne la province d'Afrique. Mais, sous le principat de
Claude (41-54), les troubles de Maurtanie gagnrent le sud de la
Numidie, et le proconsul Ser. Sulpicius Galba, le futur empereur, fut
charg titre exceptionnel d' une expdition qu'il mena difficilement
bien.
Au cours de la priode trouble qui suivit la mort de Nron,
le lgat qui commandait la lgion stationne en Afrique, L. Claudius
168-
l .'ANTIQUIT
Macer, ainsi que le procurateur Lucceius Albinus, qui gouvernait alors
les deux provinces de Maurtanie, et le proconsul L. Calpurnius Piso,
s'engagrent successivement dans la voie de la rbellion. Macer rus-
sit mme tendre son pouvoir sur toute la province africaine et
battre monnaie. Mais ces pisodes ne suscitrent aucun cho parmi
les populations africaines.
Par contre, le lgat 1Aalerius Fesius, instigateur du meurtre de
Piso, dut intervenir en l'anne 85 contre les Garamantes du Fezzan
qui, l'appel des habitants d'Oea (Tripoli), avaient dvast les terres
des riches propritaires de Lepcis Magna et entrepris mme le sige
de cette ville. Des souvenirs de cette campagne sont, a-t-on pens,
perptus par une mosaque de Zliten - date par certains archo-
logues, probablement tort, de la fin du I
er
s. - qui reprsente des
prisonniers libyens exposs aux btes de l'amphithtre. C'est au
cours de cette guerre que Festus dcouvrit une nouvelle route de
Tripoli Mourzouk. Celle-ci, qui traverse les solitudes dsertiques
de la Hamada el-Hamra, est moins bien pourvue de points d'eau,
mais plus courte de dix jours que la route traditionnelle par la Sokna
et le mont Ater. Quand la mosaque de Zliten, elle daterait plutt
du dbut du II
e
s., et serait en relation avec la rpression d' une rvol-
te de la tribu des Nasamons, sur les rivages de la Grande Syrte.
Les textes littraires ne nous font pas connatre d'autres sou-
lvements sous Vespasien (69-79), le premier empereur de la dynas-
tie flavienne. Des textes pigraphiques en laissent cependant sup-
poser, notamment celui qui rvle un ouvrage de dfense construit
dans les premiers mois de l'anne 76, prs du pont de Tibre, au
confluent de l'oued Bj avec la Mejerda. Mais la destination relle
de ce monument ne peut tre affirme avec certitude.
Domitien (81-96) dut rprimer des soulvements sur le litto-
ral de la Grande Syrte, o les Nasamons avaient massacr les col-
lecteurs d'impts. Sous son rgne, les Romains envoyrent, peut-
tre de concert avec le roi des Garamantes, une expdition jusqu'au
Soudan.
POQUE ROMAINE.
169
partir du rgne de Trajan, la province africaine, parvenue
un degr de romanisation suprieur, ne connut pratiquement plus
de soulvements ; en effet, ce fut surtout sur les frontires de l'ouest
qu' Hadrien (117-138), Antonin le Pieux (138-161), Marc Aurle
(161-180), et Commode (180-192) eurent intervenir.
L'insurrection qui clata en 118, en Maurtanie, se prolongea durant
plusieurs annes, et dut se propager jusqu' l'Aurs. Ces troubles ne
devaient gure cesser sous Septime Svre (193-211) et Svre
Alexandre (222-235) qui connurent, leur tour, des difficults avec
les peuplades trs belliqueuses qui harcelaient les Maurtanies.
Le limes et l'avance vers le sud
Les rvoltes successives furent, chaque fois, suivies par une
extension de l' occupation romaine. Ds le rgne d'Auguste, Rome
renonait au systme dfensif ; Y Africa engloba d' abord la rgion
des Syrtes, prleve sur la Cyrnaque. Aprs la guerre de Tacfarinas,
elle annexait, sous Tibre, les contres voisines des Chotts.
Paralllement cette expansion, tait entame une oeuvre de
consolidation et de valorisation de la possession, grce un nou-
veau dveloppement de la centuriation dj ralise ds l' poque
rpublicaine, pour les territoires de l'ancienne Africa Vtus, et
l' poque triumvirale ou augustenne en Africa Nova. Cette vaste
entreprise de cadastration, qui permettait notamment d'assurer l'as-
siette des impts, fut tendue par les arpenteurs militaires, sous
Tibre, jusqu'au sud de la province, l'ouest de Tacapae (Gabs).
Plusieurs bornes, dcouvertes prs du Chott el Fjij perptuent le
souvenir de ce dernier arpentage dont le decumanus maximus orient
nord-ouest - sud-est joignait un point situ entre Philippeville et
Annaba un autre prs de Gabs ; le cardo maximus, venant du Cap
Bon, coupait la ligne du decumanus angle droit Ammaedara
(Hadra).
170-
l .'ANTIQUIT
Les arpenteurs divisrent ainsi tout le territoire de la Tunisie
actuelle en centuries quadrangulaires d'environ 50 ha, en laissant de
ct les rgions boises ou montagneuses. Les parcelles, qui consti-
turent un damier gigantesque, impliquaient qu'il y eut, lors de
l'opration, remembrement des proprits et des exploitations.
Leurs limites furent inscrites sur le sol par des chemins, des leves
de terre ou de pierres sches, ce qui a permis de laisser leur
empreinte visible, de nos jours, sur les photographies ariennes.
Mais la plupart des rgions cadastres ne reurent pas de colons :
l'opration n'tait pas, en effet, lie prioritairement une colonisa-
tion ventuelle, mais avait pour but la rpartition de l'impt foncier
et permettait de rsoudre aisment les problmes lis la proprit
foncire.
Quant au limes, ce n'tait pas, comme on l'avait longtemps
considr, une ligne fortifie que l' on aurait rapporte toujours plus
en avant, mesure que progressait la romanisation. Comme l'ont
montr les travaux de J. Baradez, fonds sur l'tude des photogra-
phies ariennes, c'tait un ensemble complexe qui comprenait trois
lments essentiels :
1) Un fossatum, foss jalonn de murs, de tours, de forts ou de
fortins en pierre ou en toub.
2) Des lments de dfense isols en avant ou en arrire de ce
fossatum.
3) Un rseau routier stratgique.
Ainsi, bien que le limes d'Afrique n'ait pas encore t l'objet,
comme celui de Numidie, d' une tude approfondie, il semble dsor-
mais acquis qu'il s'agit d' un ensemble complexe, dont l'tablisse-
ment a t une cration continue, mme si le plan d'ensemble a pu
tre pralablement tabli.
La mise en place du dispositif de dfense s'accompagnait de
colonisation et d'assignation de terres. Aussi, selon que Rome avait
annex plus ou moins compltement les zones utiles qu'elle se
proposait d'intgrer dans les limites de la province, le systme
dfensif tait dfinitif ou provisoire.
POQUE ROMAINE.
171
Ds le dbut du rgne de Tibre, l'amnagement de la fron-
tire avait commenc, comme on l'a dj signal, par l'tablissement
de la route stratgique qui unissait Tacapae (Gabs) Ammaedara
(Hadra) o s'tait tablie l'arme d'occupation, la III
e
lgion
Auguste, au cur du pays des Musulames, pour protger la rgion
de Cirta (Constantine) et la Proconsulaire. Une autre route partit de
Tacapae en direction de Repris Magna. Sous Vespasien, et probable-
ment avant le printemps 76, le camp de la lgion fut transfr
Theveste (Tbessa). Ce dplacement de 40 km environ vers l'ouest
permettait d'assurer la dfense du centre de la Numidie, au sud de
Cirta, et correspondait une extension vers le midi des rgions paci-
fies. Aprs le transfert de la lgion, une colonie de vtrans fut
dduite Ammaedara. On construisit une nouvelle route stratgique
qui relia Theveste Hippo Regius (Annaba).
En 81, sous Titus, un dtachement fut transport de Theveste
Lambaesis (Lambse), situe 170 km plus l'ouest, proximit de
l'Aurs et de l'un des passages les plus frquents entre le Sahara et
le Tell. C'est vers 115-117 sous le rgne de Trajan, et aprs avoir
peut-tre sjourn quelque temps Thamugadi (Timgad), que l'en-
semble de la lgion s'tablit Lambse, dans le cadre d' un transfert
total. Le massif de l'Aurs fut entour d' un rseau stratgique, com-
plt par des fortifications qui vinrent pauler la forteresse d'Ad
Majores (Hr Besseriani) fonde en 105. Comme Vespasien l'avait fait
Ammaedara, Trajan cra une colonie romaine Theveste.
Ainsi, la conqute romaine s'tait assigne des limites qu'elle
ne franchira que pour des raisons exceptionnelles, surtout dans le
but de contrler le commerce trans saharien, qui permettait de four-
nir au monde romain une partie des richesses tropicales. Ce terri-
toire protg par le limes, la III
e
lgion et les troupes auxiliaires, n'en-
globait que les terres cultives susceptibles d'tre exploites par des
agriculteurs sdentaires.
172-
l .'ANTIQUIT
L'arme romaine d'Afrique
Aprs la fin des guerres civiles, Auguste maintint en Afrique
deux lgions ; mais partir de 6 ap. J.-C., il n' en resta qu' une, la troi-
sime lgion Auguste (kgio tertia august). Pour la dfense du terri-
toire annex, Rome ne disposait ainsi que d' une faible arme d' oc-
cupation : cette lgion de 5 500 hommes et un nombre lgrement
suprieur d'auxiliaires pied et, surtout, cheval ; au total, 11 000
hommes environ.
La lgion tait compose de 10 cohortes de fantassins - la pre-
mire cohorte avec un effectif deux fois plus important que les
autres - et d' une cavalerie rduite de cent vingt hommes. Elle n'tait
ouverte qu'aux citoyens romains. Les premiers soldats de la III
e
lgion taient originaires des provinces occidentales de l' Empire,
notamment de Gaule ; puis, la fin du I
er
s., ils vinrent de l' Orient
grec et furent aussi levs, en partie, en Afrique mme. Ces effectifs
africains devinrent de plus en plus importants, et, ds l' poque
d' Hadrien, finirent par l' emporter sur ceux d' Orient. Le recrute-
ment fut facilit par l' incorporation massive des fils de lgionnaires,
dj habitus la vie des camps, et dont la situation juridique incer-
taine se trouvait normalise par l'entre dans la lgion.
Les corps auxiliaires taient aussi recruts, au dbut, hors
d' Afrique ; si bien que les cohortes et les ailes de cavalerie, qui les
composaient, conservrent longtemps leurs noms d'origine : les ins-
criptions attestent ainsi la prsence, en Numidie, d' Espagnols, de
Lusitaniens, de Chalcidniens, de Commagniens. Mais au milieu du
II
e
s., le recrutement local devint la rgle, aussi bien pour les lgion-
naires que pour les auxiliaires dont certains corps ne comportrent
plus que des lments exclusivement africains, tels, en Numidie, Yala
numidica et la cohors Maurorum. D' autres troupes auxiliaires furent
charges de la surveillance des steppes et des confins du Sahara.
Habitues la dfense des rgions dsertiques et appeles numeri,
elles comptaient surtout, parmi leurs effectifs, des soldats origi-
naires de Palmyre et d' Emse.
POQUE ROMAINE.
173
La lgion, stationne en Numidie, tait place sous le com-
mandement d'un lgat de rang snatorial. Avec le commandement
de l'arme d'Afrique il cumulait le gouvernement de cette province
de Numidie et tait assist, la tte de la lgion, par six tribuns. Seul,
l'un d'entre eux faisait ses premiers pas dans la carrire sntoriale,
en exerant ce commandement, alors que les cinq autres taient de
rang questre.
Virgile et les muses
Mosaque dcouverte en 1896 dans une maison romaine Sousse.
Expose au Muse du Bardo
Dans un cadre carr de 1,22 m de ct, Virgile est reprsent trnant, vtu d'une
ample tunique, tenant sur ses genoux un rouleau de manuscrit sur lequel est crit
l'un des premiers vers de l'Enide : Musa mihi causas memora quo numine laeso...
La tte haute, les yeux fixs, l'ai inspir, le pote coute ses deux inspiratrices,
debout ses cts : gauche, Clio, muse de l'histoire, tenant un manuscrit ;
droite Melpomne, muse du thtre, tenant un masque tragique.
La scne est empreinte de gravit. Par le portrait de Virgile, ce tableau a une
valeur inapprciable, car il s'agit de la seule prsentation antique que l'on ait
retrouve du plus grand pote latin. (70-19 av. J.-C.)
Il est dat du Illme s. ap. J.-C.
Virgile tait trs populaire auprs des Africains. C'est par l'apprentissage de
l'Ende clbrant les amours de Didon et Ene qu'ils acquerraient les premiers
lments de leurs humanits. Ce pome n'a cess d'tre admir, tudi,
cit et rcit durant toute l'antiquit.
CHAPITRE II
L'organisation provinciale et municipale
et les conditions des individus
La Proconsulaire et son administration
Le 13 Janvier 27 av. J. C., l' Empire romain fut partag entre le
Snat et l'empereur. Celui-ci, chef unique des armes, confiait, dans
les provinces que la romanisation n'avait pas encore entirement
gagnes, ses pouvoirs un gouverneur militaire, qui avait le titre de
lgat, et tait choisi parmi les snateurs, ou des procurateurs pris
parmi les chevaliers ; dans chacune de ces provinces, ceux-ci cumu-
laient, avec le commandement de la garnison locale, l'autorit admi-
nistrative et judiciaire.
Quant l'administration des provinces anciennes et profon-
dment romanises, elle tait assure par le Snat qui y dlguait un
proconsul. La partie orientale du Maghreb, qui correspond peu
prs la Tunisie actuelle, tait, parmi les provinces africaines, la
seule porter officiellement le nom "A fric a ; c'tait aussi, avec
l'Asie Mineure occidentale, la plus importante des provinces sna-
toriales ; leur proconsul devait tre choisi au dbut de l' Empire
parmi les anciens consuls, alors que ceux des autres provinces
taient seulement d'anciens prteurs.
176-
l .'ANTIQUIT
Depuis le moment o Caligula spara le gouvernement civil
de l'autorit militaire, en enlevant au proconsul d'Afrique les prro-
gatives militaires de ses prdcesseurs, il cra pratiquement une pro-
vince de Numidie ; mais celle-ci ne fut effectivement distincte de la
Proconsulaire et gouverne par le lgat qui commandait la troisi-
me lgion auguste qu'au dbut de l'poque svrienne. UAfrica ou
Proconsulaire n'engloba donc plus que la Tunisie actuelle presque
toute entire, jusqu'au Chott el Jerid, la Tripolitaine, qui lui tait rat-
tache et comprenait toute la plaine ctire de la Jeffara, et enfin
une bande du territoire algrien. La frontire occidentale commen-
ait au nord-ouest d'Hippo Regius (Annaba) et aboutissait prs de
Medjez-Ahmar, 12 km au sud-ouest de Guelma. Puis elle devait
suivre l' Oued Cherf jusqu'au sud-ouest de Sedrata, 53 km au sud-
ouest de Souk-Ahras.
C'est l'poque de Trajan, que la frontire mridionale fut ta-
blie de manire quasi dfinitive. Au sud-est de la Tripolitaine, hau-
teur des places dfensives des Gheriat (Gheria el-Gharbia et Gheria
es-Sherguia), elle s'loignait de la mer de 150 km environ, pour s'en
rapprocher sur le littoral dsertique de la grande Syrte. Dans le sud
tunisien, elle passait entre les chotts et la limite nord du grand erg
oriental ; et en Numidie, elle s'tendait entre les chotts prsahariens
et le versant sud des monts des Nmenchas et de l'Aurs. Par la
suite, sous Septime Svre, on tablit une srie de postes sahariens
avancs : Gholaia (Bou Njem), Cydamus (Ghdams, capitale des
Garamantes, dans le Fezzan) et Castellum Dimmidi (Messad) entre
Jelfa et l'oued Jedi, dans le sud algrien. Ces positions furent va-
cues aprs le milieu du III
e
s. et l'on revint la frontire trajane, qui
demeura stable jusqu' l'poque vandale, au V
e
s.
La Proconsulaire groupait ainsi les rgions les plus volues,
dont les populations taient dj gagnes la civilisation mditerra-
nenne, grce l'panouissement de la civilisation carthaginoise,
aussi bien le long des ctes, dans le cas des cits fondes soit par
Carthage, soit jadis par les Phniciens, ou l'intrieur des terres,
POQUE ROMAINE.
177
dans les cits du territoire domin par Carthage, comme dans celles
du territoire des rois numides. Bien avant l'arrive des Romains, des
cits actives, dont les habitants avaient adopt les institutions de
Carthage et taient forms aux pratiques commerciales et agricoles
des Puniques, s'taient dveloppes pacifiquement. Une province
aussi calme pouvait donc tre confie un proconsul, dont l'autori-
t procdait du Snat, d'autant plus que ses pouvoirs taient de plus
en plus limits par les agents directs de l'empereur.
Ce proconsul, qui dbarquait en Juillet Carthage, ne restait
en fonction que pendant une anne. Seules des circonstances excep-
tionnelles provoquaient le renouvellement de son mandat, pour une
deuxime ou une troisime anne. Ses pouvoirs, qui taient
immenses, en faisaient d'abord le juge suprme des affaires impor-
tantes, au civil comme au criminel. Il ne se dchargeait sur des juges
dlgus que des affaires insignifiantes. Sur le plan administratif, le
proconsul devait surtout assurer la communication des lois et rgle-
ments impriaux aux communes, et veiller leur application, tout en
surveillant de prs l'action de ces municipalits. Il devait aussi pr-
sider aux travaux publics d'intrt gnral, tels que les routes et les
aqueducs ; ces tches taient assures directement par ses deux
lgats, choisis parmi ses proches et qui rsidaient l'un Carthage,
l'autre Hippone (Annaba). Il dirigeait aussi les finances, grant une
caisse spciale qui recevait les recettes, et ordonnanait les dpenses
payes par le questeur. Il lui arrivait enfin d'intervenir dans la vie
conomique, surtout pour assurer le ravitaillement de Rome en
crales et aussi, parfois, pour viter les hausses de prix exagres
ou pallier, pendant les annes de scheresse, au danger de disette.
Le proconsul devait cependant tenir compte de l'attitude de
l'assemble provinciale. Celle-ci tait compose des dputs de tous
les conseils municipaux ; au terme de chaque mandat, elle avait le
droit de voter certes des flicitations ou des honneurs au proconsul,
mais elle pouvait galement critiquer, thoriquement du moins, sa
gestion.
178-
l .'ANTIQUIT
Bien que ne disposant plus, depuis Caligula, que de forces
drisoires - une cohorte urbaine dtache de la garde municipale de
Rome et forte d' un millier d' hommes, tait renforce par une cohor-
te de six cents hommes dtachs de la III
e
lgion auguste - le pro-
consul, membre minent du snat romain, tait a priori l'objet de la
suspicion du prince, chaque fois que la politique impriale s'oppo-
sait celle de la haute assemble. Aussi tait-il troitement surveill.
Un agent personnel de l'empereur exerait des pouvoirs qui ne
manquaient pas d'branler ceux du proconsul. Ce procurateur, qui
appartenait l' ordre questre et sortait souvent de la bour-
geoisie provinciale, administrait directement les services des
mines et des carrires et percevait les impts indirects, comme les
droits de douane et ceux du vingtime sur les hritages, qui taient
destins au trsor militaire plac directement sous le contrle de
l'empereur. Ainsi son ressort tait, au dpart, distinct de celui du
questeur qui administrait, sous l'autorit du proconsul, la caisse (fis-
eus) de la province, recueillant les revenus des impts directs, qui
taient adresss au trsor du snat conserv, Rome, dans le temple
de Saturne.
Le procurateur exerait aussi un pouvoir judiciaire, limit
thoriquement au contentieux fiscal, mais qui n'avait cess d'empi-
ter sur la juridiction du gouverneur. Ses attributions taient si vastes
qu'elles furent, semble-t-il, partages ds le milieu du II
e
s. entre le
directeur des domaines et celui des contributions indirectes. Mais le
rle de ces fonctionnaires ne diminua pas pour autant.
Une administration particulire rgissait, en effet, les biens
fonciers de l'empereur dans la province. Ces domaines impriaux
taient constitus de vastes exploitations agricoles appeles saltus,
groupes dans des circonscriptions rgionales appeles trartus ou
regio, l'exemple des circonscriptions domaniales de Carthage,
d'Hadrumetum (Sousse), d' Hippone, de Theveste (Tbessa) et de Lepcis
Magna (Lebda). Sous Antonin le Pieux (138-161) on distingua les
POQUE ROMAINE.
179
biens privs de l' empereur (resprivat), de ceux de la couronne imp-
riale (patrimonium) que les empereurs recueillaient en hritage.
Les institutions municipales
Les pouvoirs du proconsul et des fonctionnaires impriaux
taient, d' autre part, limits par ceux des magistrats lus des villes.
En effet, le rle politique des cits romaines tait considrable. Le
pouvoir autonome local, exerc par ces magistrats sur le centre
construit et le territoire rural de la cit, tait tel que l' Empire tout
entier apparaissait comme un ensemble de petites rpubliques lies
entre elles, en principe, par des rapports de droit international ; ces
patries minuscules, ainsi appeles dans des textes pigraphiques,
reconnaissaient cependant la suprmatie inconteste de la plus
gigantesque et de la plus puissante d' entre elles : Rome. Or, de
toutes les provinces occidentales de l' Empire romain, l' Afrique est
celle o l' on a dnombr le plus de cits ; et comme celles-ci taient
les foyers essentiels de la vie politique, l'Afrique se trouvait ainsi ani-
me d' une vie publique intense. C'est sans doute cette densit de
l'implantation urbaine, qui explique le succs de la romanisation, et
justifie le rle exceptionnel que l'Afrique a tenu dans la vie politique
de l' Empire.
A l' poque rpublicaine, aucune cit de droit romain n'existait
encore sur le sol africain. Seules sept villes d'origine phnicienne
jouissaient du statut autonome de civitas libra : Theudalis et U^alis (El
Alia), situes au nord de la province, prs de Bizerte, Utica o rsi-
dait le proprteur, Hadrumetum (Sousse), ~Lepti Minus (Lemta),
Thapsus (Ras Dimas) et Acholla (Boutria). Toutes les autres com-
munes taient prgrines ou stipendiaires, peuples de prgrins,
c'est--dire de sujets trangers presqu'exclusivement berbres, et
soumises l'autorit du gouverneur de la province ; leur territoire,
considr comme sol provincial, devait payer un impt fix par
180-
l .'ANTIQUIT
Rome, le stipendium. L'autorit romaine tolrait cependant leurs ins-
titutions traditionnelles ; elles continuaient ainsi de s'administrer
comme, jadis, la capitale de l'tat carthaginois, en lisant un conseil
de notables et des sufftes.
Ce fut Csar qui, reprenant le projet avort de Caius Gracchus,
dcida la cration de colonies romaines proprement dites. La plus
importante devait occuper l'emplacement de Carthage ; Csar mou-
rut avant d'avoir pu l'installer. La fondation fut ralise en 44, suivant
l'opinion la plus couramment admise, mais la nouvelle colonie ne
reut son assiette dfinitive que grce l'envoi de nouveaux colons
par Octave, en 29 av. J.-C.
Auguste continua l'uvre de son pre adoptif, tout en appli-
quant une politique plus librale. Il confirma ou accorda donc, une
trentaine de cits, le statut de civitas libra. En mme temps, il fonda
plusieurs colonies romaines peuples, en rgle gnrale, d'anciens
soldats ou de propritaires italiens dpossds
D'autres groupes plus restreints de citoyens romains s'instal-
lrent dans de vieilles cits prgrines, et retrouvrent d'anciens
colons dj tablis par Marius. Ils formaient comme Thugga
(Dougga), unpagus rattach la colonie de Carthage. Cette sorte de
petite cellule municipale vivait en symbiose avec la cit prgrine ;
et les immigrs italiens qui la constituaient, comme ceux qui for-
maient les colonies disperses dans la province, entretenaient avec
les autochtones les rapports les plus troits. Ce qui favorisa l'exten-
sion de la romanisation, recherche par les autochtones eux-mmes,
ou du moins par leurs notables, dsireux de participer pleinement
la vie publique de l'Empire, dont ils voulaient tre citoyens et non
plus sujets.
Bien que le problme du statut municipal des cits soit trs
complexe, nous pouvons suivre l'volution des diverses catgories
de communes vers une assimilation progressive. Ds le dbut du
II
e
s., alors que l'immigration italienne tait presque compltement
arrte, les statuts de municipe ou de colonie furent octroys des
POQUE ROMAINE.
181
cits prgrines de plus en plus nombreuses. Le premier confrait
aux habitants un statut intermdiaire entre celui de citoyen et celui
d'tranger ; appliqu en 338 av. J.-C. aux membres de la confdra-
tion latine que Rome venait de dissoudre, il accordait la citoyenne-
t romaine titre individuel, soit aux membres du snat municipal
et aux magistrats, soit seulement ces derniers. Mais on connat
aussi des municipia civium romanorum dont tous les habitants poss-
daient la citoyennet romaine. Quant au statut de colonie, il prenait
ainsi une signification toute nouvelle ; il ne s'agissait plus d'immi-
grs installs sur le sol africain, mais d' une communaut autochto-
ne parvenue une assimilation complte ; tous les habitants libres
devenaient citoyens romains et l'organisation municipale imitait
celle de Rome.
La diffrence principale entre le statut de colonie et celui de
municipe rside surtout dans le fait que ce dernier permet le main-
tien des institutions et des coutumes prromaines, qui rgissaient
auparavant ces communauts, mais sans les reconnatre de jure. Tout
en adoptant une constitution romaine, les municipes pouvaient ainsi
bnficier des avantages confrs par leurs lois et coutumes.
Municipes romains et colonies copiaient les institutions de la
cit matresse. La souverainet tait, en principe, dtenue par l'as-
semble populaire qui se runissait sur le forum, la grande place qui
tait le centre de la vie publique. Au sein de cette assemble, les
citoyens se groupaient en curies, places sous le patronage d'un dieu
ou d' une personnalit, et rgies par des rglements stricts. C'taient
de vritables clubs qui tenaient runions et banquets et avaient leurs
magistrats et leurs prtres ; soumis l'influence des notables locaux,
ils n'taient pas ouverts tous les citoyens et leurs votes fixaient
l'orientation de l'assemble du peuple municipale. Les dcisions du
populus ne concernaient d'ailleurs que des sujets d'importance limi-
te : lection des membres du snat local et des magistrats munici-
paux, parmi les candidats disposant d' une fortune suffisante pour
faire face des charges parfois trs lourdes ; vote d'loges ou octroi
182-
l .'ANTIQUIT
d' honneurs quelque grand personnage, dont une statue rige sur
le forum immortalisait souvent la mmoire et les traits.
La ralit du pouvoir appartenait cependant au snat munici-
pal et aux magistrats. Le snat comptait gnralement une centaine
de membres appels dcurions et rpartis en classes hirarchises.
En tte venaient les membres honoraires dont la cit recherchait le
prcieux patronage : snateurs ou chevaliers romains parvenus aux
plus hautes charges de l'Empire ; ces personnages tout puissants
taient souvent des enfants du pays qui, grce la fortune paternel-
le, la si tuati on familiale o n aussi leur propre mrite, avaient vu
leur carrire dpasser le cadre troit de leur petite cit et occupaient
mme parfois un poste important qui les rapprochait, plus ou
moins, de l'empereur ; toujours attachs au souvenir du sol natal, ils
ne manquaient donc pas d'intervenir devant les plus hautes ins-
tances pour protger leurs compatriotes et dfendre leurs intrts.
A la suite de ces membres honoraires, venaient les dcurions qui
avaient dj exerc les magistratures municipales : anciens duumvirs
ou quattuorvirs, anciens diles et questeurs ; les simples dcurions,
c'est--dire les snateurs municipaux qui n'avaient revtu encore
aucune autre dignit, venaient en dernier lieu.
Dans quelques cits moins profondment romanises, la
constitution municipale portait la trace d'une influence punique
persistante ; un comit restreint de onze membres, prsid par un
prince ou prieur, dtenait l'autorit effective.
La fonction snatoriale, de mme que les magistratures,
n'taient pas rtribues. Au contraire, les magistrats taient tenus,
leur entre en charge, de verser la caisse de la cit une somme hono-
raire dont le taux variait selon leur rang et l'importance de la ville.
Mais ils ne manquaient pas de dpasser le tarif obligatoire ; riva-
lisant de gnrosits ostentatoires, qui ne pouvaient d'ailleurs que
leur assurer un surcrot de popularit et de crdit ; les nouveaux
magistrats offraient des festins, organisaient des jeux, btissaient des
monuments publics : thermes, thtres, marchs, fontaines monu-
mentales, portiques, arcs de triomphe...
POQUE ROMAINE.
183
En contrepartie, ces donations ne pouvaient que favoriser la
carrire du jeune dcurion qui devait briguer tout d'abord la questu-
re. Cette charge en faisait le grant de la caisse municipale, alors que
l'dilit lui donnait la direction des travaux publics et des marchs. La
charge suprme tait partage entre deux et parfois quatre magis-
trats ; ces duumvirs ou quattuorvirs ordonnanaient les dpenses,
jugeaient les petites affaires ; ils taient aussi les responsables du
maintien de l'ordre public et taient chargs de l'excution des lois et
ordonnances du pouvoir central. Il leur appartenait enfin d'assurer la
rpartition individuelle et la leve des impts. Pour ce faire, on dres-
sait tous les cinq ans le cens, c'est--dire qu' on dterminait la fortune
de chaque citoyen et son rang dans la hirarchie sociale. On appelait
quinquennales les duumvirs ou quattuorvirs lus pour l'anne du recen-
sement ; cette charge couronnait la carrire municipale. Ces magistra-
tures taient, toutes, annuelles et collgiales.
En dehors de ces dignits qui remplaaient, dans toutes les
cits jouissant de l'organisation romaine, les anciennes magistra-
tures locales, il existait dans la plupart des colonies diffrentes charges
spciales : leurs titulaires avaient, par exemple, la responsabilit du
ravitaillement, ou de la distribution des eaux. De mme il existait
diffrentes fonctions religieuses, les unes communes toutes les
municipalits de l' Empire romain, les autres propres aux cits afri-
caines. Elles sont rappeles, comme les autres dignits, dans les cur-
sus honorum municipaux, qui contiennent l'ensemble des magistra-
tures ou des fonctions exerces par un citoyen dans sa ville ou
mme dans une association particulire.
Les conditions des individus
Au dbut de l' Empire, les individus peuvent tre classs, selon
une hirarchie juridique, dans trois catgories ethniques diffrentes
que distinguent non seulement le droit qui les rgit, mais aussi la
184-
l .'ANTIQUIT
langue et la religion : les Libyens, les Puniques et les Romains immi-
grs. La diffusion de la civilisation punique tait telle, toutefois, que
beaucoup de Libyens Mactaris par exemple ou dans les cits du lit-
toral sahlien, avaient t largement puniciss. Les immigrs italiens,
par ailleurs, l'exemple des membres du pagus de Thugga, n'avaient
tabli aucune cloison entre eux et les autochtones, tandis que les
notables puniques et libyens aspiraient surtout s'intgrer en acc-
dant la citoyennet romaine. La politique suivie cet gard par les
empereurs, de mme que l'volution de la situation conomique, ne
firent que favoriser cette aspiration. Si bien que la hirarchie de la
fortune ne tarda pas se substituer la distinction ethnique. Grce
la diffusion du droit de citoyennet romaine, toute la bourgeoisie
municipale achvera ainsi de se romaniser.
Quant la plbe urbaine, et surtout rurale, si on note sous l'in-
fluence de la romanisation une transformation des murs, de la
langue et du costume, la masse resta, semble-t-il, longtemps confi-
ne dans le statut prgrin, mme si quelques artisans ou paysans
avaient obtenu le droit de cit.
Le gouvernement imprial usa, semble-t-il, de ce droit et des
promotions individuelles et municipales comme d' un stimulant, qui
lui permit de multiplier le personnel indispensable pour dvelopper
la romanisation du pays, chaque chelon de la hirarchie. Si bien
qu'en 212, l'dit de Caracalla paracheva l'assimilation, et consacra
l'accomplissement de l'uvre de romanisation poursuivie depuis un
sicle, en proclamant citoyens tous les habitants de l'Empire l'ex-
clusion, essentiellement, des esclaves.
Ds le milieu du II
e
s., on constate que la bourgeoisie munici-
pale ne cesse de fournir l'Empire un grand nombre de hauts digni-
taires. L'entre dans l'ordre questre ouvrait la voie une brillante
carrire militaire d'officier ou, civile, d'administrateur. Dj sous
Hadrien, nous pouvons compter plusieurs milliers de chevaliers en
Proconsulaire et en Numidie ; leur nombre ne cessera de s'accrotre
Allgorie de la Victoire
Bas-relief en marbre blanc. Carthage
H. 3 m ; L. 1,20 m. - Muse de Carthage
Ce bas-relief dcouvert sur la colline de
Byrsa reprsente l'allgorie de la Victoire
sous l'image d'un personnage fminin
ail, la chevelure releve en
chignon, vtu d'une longue tunique
plisse et tenant un imposant trophe.
En haut, figurent les armes de type
romain : un casque et une cuirasse
orne d'une tte de Mduse et
de deux griffons affronts.
En bas, un arc, un carquois, une
pe, des boucliers et une pelte
voquant les armes parthes.
Inspire de l'art hellnistique, cette
uvre pourrait commmorer la victoire
de Marc Aurle et de Lucius Vrus
sur les Parthes (163-165).
Statue colossale d'impratrice
Carthage ; marbre blanc.
H. 2,65 m - Muse du Bardo
La statue procde d'un type
iconographique d'origine grecque
reprsentant Aphrodite Vnus,
desse de l'Amour.
Les mains et les avant-bras
qui manquent ici devaient
tenir soit une phiale, soit
une pomme ou une grenade
qui sont habituellement
les attributs de cette divinit.
Ici, la desse est reprsente
sous les traits d'une impratrice.
186-
l .'ANTIQUIT
par l'adjonction de nouveaux promus. Au dbut du III
e
s., on a
recens que sur l'ensemble des membres connus de l'ordre questre,
dont les procurateurs les plus influents graient les plus hautes
charges administratives de l'Empire, 30% taient d'origine africaine.
Beaucoup terminaient leur carrire en occupant les postes les plus
importants, comme la prfecture du prtoire, avec le commande-
ment des troupes d'Italie, et la justice suprme d'appel. D' autres
notables municipaux, parmi les plus riches, obtenaient l'accs au
snat romain, sans mme passer par le grade intermdiaire des car-
rires questres.
Vers la fin du II
e
s., le nombre de snateurs africains connus
jusqu' prsent grce, surtout, l'pigraphie, atteignait la centaine :
15% des membres connus de l'ordre snatorial taient ainsi d'origi-
ne africaine. Ce furent Marc Aurle, et surtout Commode, qui don-
nrent aux Africains les nombreuses charges qui leur permirent de
constituer un vritable clan qui vina celui des Espagnols, prpon-
drant durant les premires annes du II
e
s. ; la solidarit qui unis-
sait, Rome, les hauts dignitaires issus d'une mme province les
amenait aussi favoriser la carrire des parents et des amis demeu-
rs dans la province natale, pour s'entourer d' une clientle sre et
dvoue. Ils arrivaient ainsi exercer leur influence sur le pouvoir
de faon dterminante : ainsi le parti des Africains parvint-il
vincer la dynastie des Antonins, sortie de Btique, pour les sup-
planter par les Svres de Lepcis Magna.
Un grand nombre de riches commerants, de propritaires
fonciers et aussi d'orateurs et de juristes africains se hissaient de la
sorte au premier rang de la socit impriale. Certains s'agrgeaient
aux autres familles snatoriales par des mariages, des adoptions, des
associations d'intrt, et se dtachaient ainsi peu peu de leurs ori-
gines, mais sans en perdre totalement le souvenir ; tandis que
d'autres, surtout les reprsentants de l'ordre des chevaliers, auquel
appartenait notamment la famille des Svres, conservaient des
Tte de Lucius Vrus
Marbre blanc ; H. 52 cm. Muse du Bardo
Cette tte colossale, d'une trs belle facture, a t dcouverte en 1904 dans le
thtre de Dougga. Couronne de lauriers, emblme imprial, la tte est encadre
d'une chevelure et d'une barbe traites avec exubrance. Les traits du visage sont
harmonieux et les yeux creuss au foret expriment la fixit du regard et
contribuent faire de ce portrait un chef-d'uvre de la sculpture officielle.
Il s'agit en effet du portrait de l'empereur Lucius Vrus qui a rgn avec
Marc Aurle de 151-159.
188-
l .'ANTIQUIT
attaches plus solides avec le pays natal. Beaucoup connurent la cl-
brit. Ainsi Fronton, consul en 143, est demeur officiellement
patron de sa ville natale Calama (Guelma) ; il fut charg par Hadrien
de l'ducation du futur empereur Marc Aurle. Son contemporain
et compatriote, le juriste Salvius Julianus, issu d' une famille de cheva-
liers qui parat avoir habit Hadrumte, entra trs tt au snat et ne
tarda pas siger au conseil du prince ; c'est dans le cadre de cette
assemble, qui dtenait en fait l'essentiel du pouvoir lgislatif, que
cet Africain entreprit la prparation de cet dit perptuel qui assura
sa notorit. Il revint son pays natal en Juillet 168 avec le titre de
proconsul et prsida, en cette qualit, la ddicace du capitole de
Thuburbo Ma/us. Le lgat qui l'assistait dans son gouvernement
n'tait autre qu' un parent proche, M. Didius Julianus, qui rgna
quelques mois au cours des troubles qui suivirent la mort de
Commode.
Mais si quelques reprsentants de la bourgeoisie municipale
taient promus aux plus hautes destines, il ne faut pas oublier que
les 5/ 6 de la population, au moins, constituaient les classes popu-
laires divises en deux lments : les esclaves et les hommes libres,
artisans ou paysans. Les historiens considrent que le nombre des
esclaves n'a cess de dcrotre depuis le dbut de l'Empire ; et ils
expliquent ce fait par la diminution des guerres, fournisseuses de
captifs, et par la frquence des affranchissements. En Afrique, l'es-
clavage rural devait tre, jusqu' la fin du I
e
s., extrmement rpan-
du. Les latifundiaires, surtout, utilisaient principalement la main-
d'uvre servile. C'est ainsi qu'en Tripolitaine, o la grande propri-
t piri-rc tait cricorc rcpancJuc au /
e
s., TpOUSC d'Apu iCC,
Vudentilla, employait sur ses terres un nombre considrable d'es-
claves. Mais aprs la confiscation, sous Nron, de la plupart des
grands domaines privs, puis la promulgation, sous Hadrien, de
la /ex manciana , de petits mtayers libres, les coloni, prirent en gran-
de partie la place des esclaves. Quant aux domestiques de condition
POQUE ROMAINE.
189
servile, il semble que les villes africaines n'en possdaient qu'un
nombre relativement peu lev ; imports, au dbut, d'Italie mri-
dionale, puis directement d'Orient, ils avaient dj reu une duca-
tion approprie et taient, sans doute, traits moins durement que
ceux des champs. Ceux-ci taient en partie sans doute procurs par
les expditions menes contre les tribus dissidentes, ainsi que par le
commerce transaharien.
La condition des esclaves n'tait pas cependant trs diffrente
de celle de beaucoup d' hommes libres. La position sociale tablis-
sait, en effet, une ligne de dmarcation trs nette entre deux cat-
gories de citoyens : les honntes gens (honesti', honestiores) et les
humbles (plebei, humiliores, tenuiores). Les deux ordres suprieurs,
le snatorial et l'questre, dots d' un statut spcifique l'chelle de
l'empire, ainsi que l'ordre dcurional des notables municipaux, dont
le statut tait purement local, appartenaient bien entendu la pre-
mire catgorie. Comprenant, dans chaque cit, un nombre rduit
de familles, celle-ci dtenait l'essentiel de la richesse foncire. Par
contre, les tenuiores de la deuxime catgorie taient exclus de toute
responsabilit dans la cit. Beaucoup de petits marchands, artisans
et ouvriers taient mme considrs, dans certaines cits, comme
des trangers domicilis, des incolae, privs de tout droit politique et
maintenus dans une dpendance troite, voisine du servage.
La multitude des journaliers, qui battaient la campagne la
recherche d' un emploi, tait place encore plus bas. Enfin, les coloni
des domaines impriaux ou des proprits prives pouvaient certes
se prvaloir de quelques droits garantis par une lgislation agraire,
comme ce ius mancianum dont il sera question plus loin ; mais nous
verrons aussi que ce droit ne manquait pas d'tre bafou et qu'ils
taient souvent livrs l'exploitation des concessionnaires ou des
propritaires.
Ingnu ou esclave, chaque individu tait pris, cependant, dans
un rseau de solidarits et de dpendances qui, reliant directement
ou non les membres des diffrentes catgories sociales, tablissait
entre eux des rapports horizontaux associatifs et des liens verticaux.
190-
l .'ANTIQUIT
Ces derniers, toutefois, avaient la prminence, reliant l'esclave au
matre, l'affranchi l'ancien matre, maintenant le notable municipal
dans la clientle des grandes familles de la cit et des aristocrates
locaux. Toute entire, la cit se reconnaissait, par ailleurs, cliente de
l'un ou de quelques-uns de ces aristocrates : chaque cit avait, en
effet, son patron, et certaines multipliaient les contrats de patrona-
ge les liant au grand propritaire local, militaire ou administrateur
civil, snateur ou chevalier, ancien proconsul ou ancien lgat, parmi
ceux qui avaient gouvern la province ou command la lgion
d'Afrique.
Mosaque figurant au centre la desse AFRICA
Muse d' El Jem
Dans un tableau carr de 1,60 m de cot, Africa est reprsente sous les traits d'un
personnage fminin coiff de la dpouille d'lphant qui est son attribut distinctif.
Elle est entoure des quatre saisons reprsentes sous l'aspect de personnages
fminins aux divers ges de la vie. C'est l'illustration du cycle de la fcondit et de
l'abondance autour de la reprsentation centrale, Africa, desse dispensatrice de
la fertilit et de la richesse. Cette mosaque a t dcouverte dans une grande
demeure aristocratique de la cit de Thysdrus, pave de tout un ensemble de
mosaques, dont celle-ci est une des plus remarquables. Elle est date de la deuxi-
me moiti du II' s. ap. J.-C.
CHAPITRE III
Le dveloppement conomique
La population
Bien que les oprations de recensement indispensables l'ta-
blissement et la rpartition des impts aient t couramment pra-
tiques l' poque romaine, aucune statistique qui intresse la popu-
lation de la province d' Afrique ne nous est parvenue. C'est pour-
quoi toute apprciation du chiffre de la population repose sur des
dductions et des conjectures dont les rsultats restent discutables.
Les historiens sont arrivs cependant montrer que la population
de l'Afrique atteignait, dans certaines rgions, une grande densit,
suprieure mme cent habitants au km
2
. Le dveloppement inten-
se de l'agriculture et de la vie urbaine, au cours du II
e
s. et de la pre-
mire partie du III
e
, permet mme d'imaginer pour toute la zone tel-
lienne de la Tunisie, au moins, une situation comparable celle du
Sahel actuel.
Mais malgr la densit de l'implantation urbaine - plus de
deux cents cits pour la Proconsulaire qui couvrait une superficie de
100 000 km
2
environ - le peuplement rural restait important, dis-
pers loin du centre construit des cits et gravitant tout autour
d'elles, dans les fermes de leur territoire rural, ou dans des hameaux
192-
l .'ANTIQUIT
dont beaucoup, avec leurs monuments publics, plus ou moins dve-
lopps, s' efforaient d'avoir des allures de cits plus ou moins
minuscules. En tenant compte de l'accroissement dmographique
considrable dont tmoignent aussi bien les sources littraires que
les donnes archologiques, la population totale de la Proconsulaire,
l'apoge de sa prosprit entre le IP et le dbut du IIP s., a pu tre
value, plus ou moins arbitrairement, plus de 2 500 000 habitants.
Cette population tait surtout forme de Berbres. En effet,
dans cette province romaine qui constituait une colonie d'exploita-
tion plutt que de peuplement, les trangers, surtout italiens, ne for-
maient qu' une petite minorit : hauts fonctionnaires, grands com-
merants, grands propritaires et, surtout, descendants des premiers
colons, principalement des vtrans de la lgion. Encore ceux-ci
s'taient-ils mlangs rapidement la population grce de nom-
breux mariages.
L'agriculture
Le dveloppement agricole, amorc par Carthage et les rois
numides, fut poursuivi par la colonisation. Tout en maintenant la
paix, l'organisation romaine russit multiplier les moyens de pro-
duction, vivifier les terres de parcours et permettre, grce aux
progrs de l'hydraulique agricole, l'exploitation de nouvelles
rgions. Elle s'attacha, enfin, organiser et dvelopper les dbou-
chs.
Ds l' poque carthaginoise on pratiquait, selon les rgions, la
culture des crales et l'arboriculture combines souvent avec l'le-
vage. Dans le Cap Bon et les environs immdiats de la capitale
punique, on prfrait la vigne, l'olivier, les arbres fruitiers, les cul-
tures marachres et l'levage du btail ; tandis que les plaines de la
Mejerda et de l'oued Miliane constituaient, comme les fonds de val-
lons de la Byzacne, des rgions cralires.
Crs-Pomone
Marbre ; Carthage ; H. 1,42 m ;
Muse de Carthage
Desse des rcoltes et de
l'abondance, Crs est
reprsente portant une corbeille
de fruits et une gerbe d'pis.
Sous l'Empire, son culte connat
un grand dveloppement
en raison de la richesse
essentiellement agricole de
/'Africa, province toute
voue Crs, selon
l'crivain Salluste.
Champ de bl moissonn
sur fond de vestiges
archologiques
Pline l'Ancien dfinissait dj
le sol de l'Afrique qui porte les
crales. La nature l' a livr tout
entier Crs ; quant au vin
et l'huile, elle s'est content de ne
pas les lui refuser, jugeant les
moissons suffisantes sa gloire .
De fait, l'Africa fut le grenier de
Rome et eut la redoutable
charge de fournir l'annone destine
nourrir la population romaine.
Elle fit aussi sa fortune et
l'lvation de sa condition politique
comme en tmoigne la clbre
pitaphe du moissonneur de Mactar.
Je suis n d'une famille pauvre...
Depuis le jour de ma naissance, j' ai
toujours cultiv mon champ.
Ma terre et moi n'avons pris aucun
repos... Aujourd'hui je vis dans l'ai-
sance et j' ai atteint les honneurs ... .
194- l .'ANTIQUIT
Mais la prosprit de l'Afrique n'est passe l'tat de prover-
be que parce qu'elle assumait, sous le Haut Empire, la plus grande
part du ravitaillement en bl de la capitale romaine. La scheresse
du climat ne permettait certes pas de rendements rgulirement le-
vs ; mais la fcondit des terres africaines devenait prodigieuse
lorsque les pluies taient suffisantes. Pline signale des semences qui
donnaient du cent et mme cent cinquante pour un ; si elles sont
exceptionnelles, ces rcoltes sont de nos jours encore possibles,
lorsque l'anne est particulirement favorable ; elles s'expliquent par
le fait que, maintenant encore, on ensemence trs clair dans les
terres lgres du Sahel et de la Steppe.
La conqute romaine favorisa la culture du bl que l'Italie exi-
geait en abondance. Au contraire, on ne songea nullement recons-
tituer les vignes et les olivettes dvastes la fin de la priode
punique, car l'Italie dominait alors le march du vin et de l'huile, et
prenait soin d'viter toute concurrence. L'Afrique rgressa alors
vers la monoculture.
Des impratifs d' ordre politique provoqurent ainsi l'accrois-
sement de la culture du bl dur, que l'on distribuait gratuitement
200 000 citoyens de Rome. Ce bl annonaire n'tait pas achet par
Rome, mais lui tait cd titre de tribut de subordination, ou de
redevance. La quantit indispensable au ravitaillement de Rome
avait t d'abord amene d'Egypte. Mais, ds le rgne de Nron, on
jugea possible de rclamer l'Afrique les deux tiers du bl exig.
Ds lors, on a calcul que 1 260 000 quintaux de bl africain, qui
reprsentaient le montant de la dme impose toutes les terres
ainsi que le fermage du tiers vers en nature par les coloni des
domaines impriaux, furent exports annuellement vers le port ita-
lien d'Ostie. Prlvement considrable si l'on songe que la
Proconsulaire toute entire, Numidie et Tripolitaine comprises,
fournissait au temps de Nron une production globale qu' on a esti-
me 9 ou 10 millions de quintaux. Une partie de la population
POQUE ROMAINE. 195
devait donc se contenter, pour sa nourriture, de millet ou d'orge,
tandis que les scheresses devaient sans doute provoquer des
famines. L'conomie africaine avait donc, au I
er
s. aprs J.-C., un
caractre typiquement colonial ; contrainte de fournir gratuitement
le bl ncessaire l'innombrable population italienne, la province
tait aussi force d' abandonner la mtropole les cultures rentables
de la vigne et de l'olivier. Cependant, la conqute de nouvelles terres
en Numidie et dans les Maurtanies allait bientt dgrever la
Proconsulaire d' une partie de ses charges fiscales. A partir du II
e
s.,
elle put dvelopper plus librement son agriculture.
Cette volution fut rendue possible par la crise qui avait, ds
la fin du I
e
s., prcipit le dpeuplement de l'Italie et provoqu sa
dcadence politique. L'avnement, en 96, des empereurs d'origine
provinciale permit aussi, parfois, l'adoption d' une politique cono-
mique plus librale. Des avantages substantiels furent accords aux
mtayers des domaines impriaux qui acceptaient de planter des oli-
viers et des arbres fruitiers. Ces mesures taient d' abord destines
rcuprer les zones boises ou marcageuses, que les arpenteurs
avaient juges impropres la culture des crales ; mais elles provo-
qurent galement la multiplication de la vigne et des vergers dans
les montagnes du Tell, tandis que les rgions qui reoivent moins de
300 mm de pluies annuelles, et mme les steppes qui s'tendent de
Sujetula (Sbetla), Thelepte et Theveste (Tebessa), ne tardrent pas
devenir le domaine de l'olivier. Aujourd'hui encore s'y dressent, par
dizaines, les grands piliers de pierres qui maintenaient les leviers des
pressoirs.
L'oliculture connut alors une extension qui marqua toute
l'volution conomique et sociale de la province. L'huile reprsen-
tait pratiquement le seul combustible d'clairage, en mme temps
que le principal aliment gras, et le seul produit de toilette utilis
comme support des parfums. Elle fut exporte en abondance avec
tous les produits des industries annexes, comme la cramique qui
196-
l .'ANTIQUIT
produisait les lampes, ainsi que l'emballage des jarres et des
amphores, qui servaient au transport du prcieux liquide. Les avan-
tages accords aux oliculteurs africains, propritaires, transporteurs
et commerants, ne firent que s'accentuer sous Commode, qui leur
avait ouvert tout grand l'accs aux plus hauts postes de l'adminis-
tration impriale. On aboutit mme, sous le rgne de l'africain
Septime Svre, un affranchissement total de la redevance d'huile
institue depuis l'poque de Csar.
Nous avons vu que c'est titre de tribut ou de redevance que
le gouvernement imprial prlevait d' normes quantits de bl. En
effet, part les territoires des cits libres et quelques domaines
appartenant de gros propritaires, tout le sol de la province, trans-
form en agerpublicus aprs la conqute, tait devenu juridiquement
proprit du peuple romain. Celui-ci, tout en laissant la possession
effective soit aux provinciaux, soit aux immigrs romains, exigeait
des premiers le paiement de la dme de leurs rcoltes, et des seconds
une taxe d'usage sans doute plus modique. C'est pour assurer l'as-
siette de ces impts qu' on procda, comme nous l'avons vu, la
cadastration du territoire, l'enserrant dans un rseau de centuries
rectangulaires de 50 ha environ, qui ne dlaissaient que les parcelles
aux contours trop irrguliers, ainsi que les rgions impropres la
culture : bois, forts ou marcages.
Mais la terre n'appartenait pas seulement aux habitants des
cits indignes et des cits romaines. En dehors des territoires des
villes, et de ceux sans cesse limits des tribus, d'immenses domaines
avaient t achets par de riches snateurs. Au I
er
s. ap. J.-C., six
d'entre eux se partageaient, selon Pline, la moiti du sol provincial.
Aprs les avoir mis mort, Nron confisqua leurs biens ; il subsis-
ta cependant, ct des vastes domaines impriaux, un certain
nombre de saltus privs. Mais seule une faible proportion de ces lati-
fundia tait cultive directement par le propritaire ; tout le reste tait
lou des mtayers.
Installations d'huilerie dans le site
de Sbetla.
l'arrire, les deux montants du pressoir
coiffs d'une dalle appels jumelles .
C'est entre eux que passait le prlum
arbre de presse, portant l'autre bout le
contrepoids destin presser les olives dj
broyes pour en extraire l'huile.
A l'avant, cuve de broyage des olives :
C'est un plateau circulaire incurv autour
d'un axe central fixant la meule broyant
les olives. La rotation tait effectue
par un homme ou gnralement un
animal grce un essieu horizontal.
Spcimens de la
production cramique
africaine
Muse du Bardo
1- cruche cylindrique dcore de
reprsentations de scnes
mythologiques en relief.
2- Vase plastique reprsentant
la tte d'un vieil homme.
Ces deux pices ont t trouves
dans la ncropole d'El Aouja
parmi le mobilier funraire
recueilli dans les tombes.
Toutes deux portent la marque de
l'atelier NAVIGIUS qui est connu
comme un centre de production de
toutes sortes de cramiques de qualit dite sigille claire africaine . Ainsi, ces
uvres sont-elles reprsentatives de la production africaine son apoge au III
e
s.
ap. J.-C. Par leurs formes lgantes, la finesse de leur pte d'un rouge vif, la
varit de leurs dcors, ces objets illustrent l'exceptionnelle activit des
ateliers africains qui prennent leur essor la fin du Ile sicle et perdurent
jusqu 'au VII
e
sicle diffusant leurs productions autour de la Mditerrane.
198-
l .'ANTIQUIT
Nous sommes suffisamment renseigns sur ce systme, grce
surtout quatre grandes inscriptions qui nous ont permis de
connatre l'organisation des saltus impriaux de la valle de la
Mjerda aux II
e
et III
e
s. : l'empereur propritaire affermait chaque
domaine des concessionnaires (conductores), isols ou groups en
compagnies, qui en exploitaient directement une partie, et conc-
daient l'autre des mtayers (coloni) dont le statut tait dfini par une
loi, la lex manciana. A ces coloni, occupants hrditaires du sol, tait
garanti l'usage de leur parcelle moyennant la remise du tiers de leur
rcolte et la prestation d' un nombre fix de jours de corve sur la
partie du domaine exploite directement par le conductor l'aide
d' une main-d'uvre servile ; ce droit d'usage tait transmissible par
vente et par hritage, condition cependant que le nouveau bnfi-
ciaire n'interrompe pas la culture pendant plus de deux annes
conscutives. Des fonctionnaires impriaux [procuratores Augusti)
administraient les domaines et devaient veiller l'application des
rglements.
Au bas de l'chelle, les procurateurs des saltus, qui ne sont sou-
vent que de simples affranchis, taient aux ordres des procurateurs
des regiones. Ceux-ci appartenaient souvent l'ordre questre. Au
sommet de la hirarchie, les procurateurs de tractus, sont des cheva-
liers de haut rang. Ils reprsentent l'empereur, contrlent et dirigent
les autres procurateurs, disposent de la force arme. Cependant, en
surveillant la bonne application des rglements, les procurateurs
taient souvent soumis de fortes pressions ; les conductores, capita-
listes puissants et influents, avaient souvent recours leur appui
pour briser toute velleit de rvolte des coloni contre l'exploitation
dont ils taient l'objet. D' autant plus qu' partir du rgne d'Hadrien,
ces administrateurs des domaines impriaux, qui se recrutaient au I
er
et au dbut du II
e
s. parmi les affranchis de l'empereur, gnrale-
ment originaires d' Orient, furent de plus en plus choisis parmi les
propritaires locaux, c'est--dire dans la mme classe que les conduc-
POQUE ROMAINE.
199
tores qui avaient tout intrt exploiter au maximum les coloni. C'est
de cette collusion que se plaignent, en particulier, les coloni du Saltus
Burunitanus, prs de Souk el-Khmis.
Les rgles juridiques de la lex manciana s'appliquaient non
seulement aux domaines impriaux, mais aussi ceux des grands
propritaires. Les tablettes Albertini, documents rdigs l'poque
vandale, qui concernent un grand domaine situ l'est de Tbessa,
prouvent qu'elles restrent en vigueur jusqu' la fin du V
e
s. Sous
Hadrien, ces rgles furent confirmes et tendues, afin de favoriser
la rcupration de nouvelles terres et l'implantation des cultures
plus rentables de la vigne et de l'olivier ; les coloni purent ainsi s'ins-
taller sur les parcelles exclues du cadastre, comme sur les terres
rputes impropres la culture ; bnficiant du droit d'usage trans-
missible, ils taient dispenss de toute redevance, durant l'poque
ncessaire au dveloppement des nouvelles plantations. Encourags
par les avantages de cette lgislation, les agriculteurs africains entre-
prirent des travaux hydrauliques gigantesques, dont beaucoup de
monuments sont parvenus jusqu' nous.
Certes, on a trop souvent rapport l'poque romaine des ins-
tallations qui appartenaient, notamment dans les rgions steppiques,
autour de Kairouan, au haut Moyen ge arabe. Beaucoup de tech-
niques galement, taient traditionnelles et dataient de l'poque pr-
romaine, comme la construction de barrages et de terrasses.
Cependant, le creusement d' un nombre considrable de puits, la
lutte contre l'rosion torrentielle par l'amnagement de terrasses de
retenue qui fixaient la terre vgtale, la rgularisation des oueds et la
construction de petits barrages dont le trop plein permettait de
recueillir l'eau dans des bassins ou des citernes gigantesques, enfin
l'organisation, dans certaines rgions, de tout un systme tradition-
nel de canaux d'irrigation destin, selon des rgles minutieuses, la
rpartition du prcieux liquide entre les propritaires, tous ces fac-
teurs ont permis de conqurir de grandes tendues.
200-
l .'ANTIQUIT
On s'tait surtout proccup, l' poque romaine, de l'alimen-
tation en eau des cits par la construction d'aqueducs. Celui de
Carthage charriait lui seul, semble-t-il, 32 000 litres d'eau par jour.
Des quantits d'eau considrables taient ainsi emmagasines dans
des citernes, dont certaines taient gigantesques. Celles de Rougga,
l'antique Bararus, constitues par deux normes bassins circulaires
communicants, pouvaient contenir 7600 m
3
.
Mais chaque extension de l'agriculture avait pour contrepartie
la restriction des terres de parcours abandonnes aux pasteurs
nomades. Considre sous cet angle, la rvolte de Tacfarinas n'est
que l'exaspration, dans des circonstances particulires, d' une situa-
tion qui privait sans cesse les tribus des terres abandonnes aux pas-
teurs. La grande tribu des Musulames, qui avait constitu l'me de
la rvolte, se vit petit petit dpouille, sans doute, de ses terres.
Tout au long du II
e
s., on distribua aux agriculteurs de nouveaux ter-
ritoires, jusqu'aux fonds d' oueds cultivables, situs aux limites du
dsert. On en vint ainsi cantonner les tribus dans des rgions trop
exigus pour assurer leur subsistance : sous Trajan, les terres de la
tribu des Njbgemi, amputes au profit des propritaires de Tacapae
(Gabs) et de Capsa (Gafsa), furent rduites un maigre territoire
proche du chott El Fejij. Nombre de nomades furent ainsi
contraints de choisir, pour subsister, la condition misrable du jour-
nalier qui, n'ayant pour tout bien que ses bras, errait la recherche
de l'embauche.
L'industrie et le commerce
On a souvent not que l'Afrique, quoiqu'exploite de faon
plus mthodique partir du II
e
s., tait surtout exportatrice de
matires premires, plus particulirement de bl et d'huile, de laine,
de marbre, de bois, ainsi que de btes fauves et d'lphants dont
l' amphithtre faisait grosse consommation. On ne tira pas grand
parti, semble-t-il, des minerais, dont les mines taient cependant
Officine de salaison de poisson et de fabrication
de garum Neapolis
Cette srie de bassins creuss dans le sol proximit du rivage, c 'est ce qui reste
de toute une installation industrielle ayant servi obtenir, partir du poisson,
deux produits trs apprcis dans l'antiquit : les salsamenta qui
sont des salaisons et le garum qui est une liqueur proche de noak-man.
Ds qu'il est dbarqu, le poisson est prpar et trait, puis vers dans les grandes
cuves pour mariner ou macrer au soleil. Il s'agit de poissons migrateurs
longeant la cte en bancs
serrs certaines
priodes de l'anne.
L'activit de ce genre
d'officine est donc
saisonnire, mais le
nombre d'installations
similaires repres le
long de la cte tunisienne
permet d'affirmer
que l'exploitation des
ressources halieutiques a
t prospre. Les denres
obtenues de cette
ressource ont gnr un
commerce florissant
que les nombreuses
dcouvertes d'amphores
ayant contenu salsamenta
et garum prouvent
dsormais abondamment.
202-
l .'ANTIQUIT
nombreuses, mais moins riches que celles qui, en Europe, ravi-
taillaient abondamment l'Empire. Mais on reste, en ralit, trs mal
inform sur la mtallurgie de la Proconsulaire. On a aussi remarqu
que l'pigraphie ne nous rvle que rarement des activits artisa-
nales ou industrielles, dont la liste est beaucoup plus longue dans
d'autres provinces occidentales de l'Empire. Nous enregistrons
cependant l'existence de foulons, fabricants de vtements, de tan-
neurs, de teinturiers dont l'industrie avait t introduite par les
Carthaginois grce l'exploitation du murex qui fournissait la
pourpre, de charpentiers, de forgerons et d'orfvres.
Mais si ce tmoignage pigraphique est prcieux, il ne suffit
pas dmontrer le peu d'importance des artisans et des ouvriers :
ceux du btiment, qui ont difi les monuments dont les ruines
constituent les vestiges les plus importants de l'poque romaine,
taient manifestement fort nombreux ; or peine si les inscriptions
nomment un architecte ou un constructeur .
L'oliculture occupait naturellement une place de choix dans
l'conomie africaine, et dominait aussi bien l'industrie que le com-
merce, cause de la multitude d'activits annexes qu'elle suscitait
autour d'elle. La production d'huile tait massive et vritablement
industrielle ; les pressoirs, dont les vestiges sont toujours en place,
s'levaient partout, dans les montagnes de Numidie et jusque dans
les campagnes qui s'tendent entre Sbetia et Tbessa.
Lie l'oliculture, l'industrie de la cramique tait florissante.
La terre cuite tait d'ailleurs considre comme la plus importante
des industries antiques, puisque, part la vaisselle prcieuse en verre
ou en mtal, tout le domaine mnager tait pratiquement fourni par
le potier ; sans compter les jarres et les amphores, dans lesquelles on
transportait les grains, les vins et l'huile et les lampes de terre cuite
utilises presqu'exclusivement pour l'clairage. A l'poque carthagi-
noise, la production massive des nombreux potiers se proposait sur-
tout de satisfaire la demande quotidienne de vaisselle courante et
POQUE ROMAINE.
203
relativement grossire. La cramique de luxe tait gnralement
importe : d'abord de Grce et d'Etrurie, et plus tard du sud de
l'Italie. Une cramique vernis noir locale, d'excellente facture,
commena cependant concurrencer les produits italiens. La des-
truction de Carthage, qui amena un ralentissement considrable de
toute l'activit conomique, provoqua un arrt presque total de la
production de la cramique africaine ; la conqute romaine entrana
ainsi l'intensification de l'importation trangre. On continua
importer une poterie d' un noir brillant fabrique en Campanie et,
vers le milieu du I
e
s., des vases rouges et des lampes lgantes fabri-
ques notamment Arezzo, en Toscane.
Mais ds la deuxime moiti du I
e
s. ap. J.-C., une nouvelle
industrie de la cramique africaine marqua une renaissance cono-
mique gnrale et prit vite le pas sur la production du sud de la
Gaule qui avait, entre temps, envahi les marchs des deux
Maurtanies (Maroc et Algrie Occidentale) et commenc se
rpandre en Proconsulaire. Les ports de la province exportrent
leur tour vers l'Italie poterie de cuisine et vaisselle d'usage courant.
Puis, partir de la fin du sicle, la sigille claire A, fabrique dans la
rgion de Carthage, fut largement exporte, et le commerce de la
cramique prit, partir du II
e
s., des proportions tonnantes. A la
sigille A s'ajoutrent la A/ D, diffuse partir de 190/200, puis la
C, originaire de la rgion actuelle de Kairouan.
A Ostie, l'avant port de Rome, la cramique de table tait,
dans la deuxime moiti du II
e
s., aux 2/ 3 africaine ; elle le devint
totalement vers 230-240. Innombrables galement taient les
lampes huile africaines qui, jusqu' la fin de l'poque romaine,
poursuivirent l'volution de leurs formes et de leurs dcors.
Les principaux centres de production sont connus : ils se trou-
vaient dans les principales villes, notamment Hadrumte, o de
grandes familles accroissaient les bnfices tirs de leurs domaines
avec ceux de nombreuses fabriques de lampes ; d'autres ateliers
204
L'ANTIQUIT
s'tablirent dans la steppe kairouanaise, aux environs d'el-Aouja et
de Hajeb-el-Aoun ; leurs propritaires, possessionns dans cette
rgion peu fertile, trouvrent l un moyen ingnieux d'accrotre
leurs revenus. On y fabriquait, ds le dbut du II
e
s., une poterie
rouge-orange qui ne tarda pas, au III
e
s., tre exporte jusqu'aux
confins occidentaux de l'Empire. Ds la premire moiti du III
e
s.,
on utilisait, pour la dcoration des vases, des appliques en relief
dont les motifs taient inspirs, le plus souvent, par les jeux d'am-
phithtre. Plusieurs de ces potiers nous ont laiss leur signature :
les artisans de la cramique sigille C notamment, comme Septus,
Navigius, Olitresis, Saturninus etc... Les ateliers fabriquaient aussi,
outre la vaisselle et les lampes, des statuettes de terre cuite qui
taient dposes dans les tombeaux titre d'offrandes.
Ainsi l'Afrique avait russi s'affranchir de sa dpendance
conomique ; mme pour les produits fabriqus, ses importations,
qui comprenaient probablement des objets de mtal, se trouvaient
semble-t-il, au III
e
s., largement quilibres par ses exportations de
cramique et aussi de vases en verre, d' toffes de luxe teintes de
pourpre.
Et ct de la cramique, c'tait le commerce de l'huile qui
procurait aux armateurs africains leurs plus gros profits. On consta-
te que l'activit portuaire s'tait concentre dans les villes qui dis-
posaient de larges dbouchs vers l'intrieur du pays. Citons les
ports de Hippo Regius (Annaba) l'embouchure de VU bus
(Seybouse), de Thabraca (Tabarca) dbouch des carrires de marbre
de Simitthu (Chemtou) ; ouvertes par les rois numides, elles devin-
rent une norme entreprise impriale organise militairement, qui
fonctionna jusqu'au IV
e
s. Mentionnons encore, au nord, le port
d'Utique qui resta longtemps, malgr les alluvions de la Mjerda,
plus important que celui d'Hippo Diarrhjtus (Bizerte). Au Cap Bon,
les ports de Clypea (Klibia), Missua (Sidi Daoud), Carpi (Mrassa) et
Neapolis (Nabeul) exportaient des denres agricoles ; Missua servait
POQUE ROMAINE.
205
aussi de dbouch aux grandes carrires de calcaire coquillier d'El-
Haouaria, qui, depuis l'poque punique, fournissaient Carthage en
matriaux de construction.
La capitale de la province conserva son vieux cothon punique,
bassin artificiel creus l'intrieur des terres ; mais on construisit
peut-tre ct, au-dessus du sanctuaire punique de Tanit et Bal
Hammon, de vastes entrepts. Sur la cte orientale, Hadrumte
(Sousse) conserva aussi son cothon et n'eut pas besoin de grands
amnagements ; de mme que la rade de Ruspina (Monastir), bien
protge par ses lots. On ne sait pas encore si Mahdia a pris la place
de l'antique Gummi ; dans ce cas, son port fatimide, qui prsente cer-
tains caractres d'un cothon de tradition phnicienne, a peut-tre
t creus ds l'antiquit. Le port de Sullectum (Sallacta) fut dot d'un
phare, tandis qu' Acholla (Boutria) on construisit un grand mle qui
demeure toujours visible, bien que recouvert par les eaux. Ajoutons
cette liste les ports de Taparura (Sfax), Thaenae (Tina), Tacapae
(Gabs) et enfin Gigthis, situ en Tripolitaine o s'levaient encore,
sur le rivage des Syrtes, trois villes qui atteignirent leur apoge sous
la dynastie africaine des Svres : Oea (Tripoli) au centre, Sabratha
Vulpia (Sabrata) vers l'ouest et Lepcis Magna (Lebda) vers l'est.
Les exigences du ravitaillement de la capitale romaine faisaient
que les armateurs africains taient surtout en relation avec le grand
port d'Ostie, abandonnant aux Orientaux le trafic avec l'est, qui
avait connu un grand dveloppement sous Carthage et les rois
numides. S'acquittant ainsi, avec le transport du bl de l'annone,
d' un service public, ces armateurs se trouvaient soumis de plus en
plus au contrle de l'tat, tout en bnficiant de privilges tels que
Commode finit par donner, la flotte de Carthage, le mme statut
officiel que celui qui tait reconnu celle d'Alexandrie. Ce contrle
officiel laissait cependant aux armateurs (les navicularii) une marge
bnficiaire importante puisqu'au IV
e
s., elle atteignait 9 10% du
prix du bl transport, peru titre de frt. Sans compter le cot du
transport des autres denres africaines dbarques Ostie.
206-
l .'ANTIQUIT
La forme et le grement des navires sont relativement bien
connus, grce notamment une mosaque dcouverte Althiburos
(Medeina), qui dresse un vritable catalogue de la batellerie de
l'poque : vaisseaux ronds la poupe et la proue galement
releves, d'autres l'avant effil, chalands destins au transport des
amphores ou amnags pour porter les chevaux, navires de guerre
munis la fois de voiles et de rames, enfin simples canots et barques
de pche. Les gros navires de commerce, dont la charge utile pou-
vait atteindre prs de 250 tonnes, pouvaient transporter des frts
considrables.
Quant au commerce intrieur, il reste encore assez mal
connu. Nous savons cependant que les campagnards tenaient des
nundines , foires rurales hebdomadaires chelonnes sur les dif-
frents jours de la semaine, qui ne devaient gure diffrer des souks
de nos villages. Paysans et nomades y vendaient leurs rcoltes ou
leurs btes et achetaient les quelques produits fabriqus qui leur
taient indispensables.
La plupart des cits possdaient aussi, en dehors de la place du
forum, une place du march, borde comme Thuburbo Majus de
portiques sous lesquels ouvraient les choppes des marchands ; sans
compter les magasins qui bordaient souvent, comme Musti (Le
Krib), une rue importante. Des basilicae vestiariae ont t reconnus en
Algrie, Thamugadi (Timgad) et Cuicul (Djemila) ; elles tmoignent
de l'importance de l'industrie textile et du commerce des vtements.
La taxation n'tait pas lourde ; les quatre impts indirects
qu' on appelait les quattuor publica Africae comprenaient le portorium,
droit de douane considr comme une source fiscale et non comme
un moyen de rglementer les changes, le droit sur les affranchisse-
ments des esclaves, celui sur les hritages et enfin le droit sur les
ventes aux enchres. Afferms au dbut de l' Empire une socit
prive qui les rcuprait sur les contribuables, ils furent soumis,
POQUE ROMAINE. 207
partir du II
e
s., au rgime de la perception directe. Une inscription,
qui date de 202, reproduit le tarif douanier qui tait appliqu au
poste de Zara, la frontire des deux Maurtanies. Cette inscription
constitue un document capital sur les prix pratiqus cette poque,
tout en donnant de prcieux renseignements sur la nature des
changes entre ces deux provinces africaines : c'taient les esclaves,
le btail, les vtements, les peaux, le vin, le garum, les fruits secs
(dattes et figues), la glu et les ponges. L'huile et le bl sont curieu-
sement omis. valus de 3/1000 3/800 pour les esclaves et le
btail, les droits taient, semble-t-il, de 2% sur les textiles et 2,5%
sur les denres alimentaires.
Quant au transport des denres, si le cabotage offrait souvent
des facilits, le trafic le plus important se faisait par la route dont le
rseau nous est connu grce la carte routire, dite Table de
Peutinger , qui date de la fin du II
e
s., et l'Itinraire d' Antonin qui
remonte au dbut du IV
e
s., l'poque de la Ttrarchie. On en
retrouve encore plusieurs tronons, jalonns par des bornes mil-
liaires espaces de 1500 m et graves d'une inscription, qui prcise
gnralement le nom et la titulature de l'empereur sous le rgne
duquel elles furent dresses, ainsi que la ville la plus proche. Ce
rseau tait particulirement dense en Proconsulaire. Carthage
constituait un carrefour d' o rayonnaient plusieurs voies ; deux
d'entre elles se dirigeaient vers Hippo Regius (Annaba) ; l'une suivant
le littoral par Utique, Hippo Diarrbytus, Thabraca et Thuni^a (La
Calle) ; l'autre desservant la rive gauche de la Mjerda par Thuburbo
Minus (Tbourba), Cincari (Henchir Toungar), Bulla Regia (Hammam
Darraji), Simitthu (Chemtou). Mais c'est la voie Carthage-Thveste
qui tait la plus importante voie de pntration, sur laquelle s'arti-
culait une toile d'araigne de routes secondaires ; longue de 275 km,
elle passait par Membressa (Medjez el-Bab), Tichia (Testour), Tignica
(An Tounga), Thubursicu Bure (Tboursouk), Musti (Le Krib), Rares
(Lorbeus), Althiburos (Medeina), Ammaedara (Hadra). Une autre
208
L'ANTIQUIT
voie littorale, vers le sud, reliait Carthage Leps Magna en
Tripolitaine, en passant par Pupput (Souk el-Abiod), Hadrumetum
(Sousse), Acholla (Boutria), Tacapae (Gabs), Gigthis (Bou Ghrara),
Oea (Tripoli). Elle permettait, avec la voie qui suivait la cte septen-
trionale, de longer sans interruption le littoral, du Maroc la
Tripolitaine. Une autre route stratgique et commerciale, marquait
la limite mridionale des provinces africaines et aboutissait
Tacapae.
Seules les grandes voies taient solidement construites ; celle
de Carthage Theveste, pave sous Hadrien, comprenait quatre
couches superposes ; d'abord des pierres brutes, puis successive-
ment un lit de mortier, un lit de cailloux et, en surface, un pavement
de pierres irrgulires. Mais le voyage tait loin d'tre confortable,
surtout lorsqu'on utilisait le char qui tait priv de ressorts. On avait
souvent recours des travaux d'art importants : routes en corniche
ou en remblais pourvues de murs de soutnement, ponts nombreux
et solidement construits, comme celui de Vaga (Bja) qui, long de 70
m et large de 7 m 30, franchissait la Mjerda en trois arches, enfin
chausses coupant des bras de mer, comme celle qui runissait Jerba
au continent, et celle qui reliait les deux les Kerkennah. Construites
soit par la main-d'uvre militaire, soit par des rquisitions imposes
aux cits, ces voies avaient eu pour premier but d'assurer le chemi-
nement du tribut et de permettre les mouvements rapides des
troupes. Mais le commerce ne tarda pas en recueillir tous les avan-
tages, ainsi que le cursuspublicus, service de poste, qui transmettait les
directives gouvernementales aux rouages locaux, assurait les
voyages des fonctionnaires et acheminait les denres verses titre
de tribut. Ce service possdait des postes de relais et employait des
courriers ainsi que de vritables units militaires.
Le commerce transaharien, auquel l'conomie punique avait
rserv un rle important, avait conserv sa place l'poque romai-
ne. Les Carthaginois parvenaient jusqu'au Niger soit par caravanes,
qui traversaient le Fezzan et le Hoggar, soit par la voie maritime, en
Ralise par P. Salama en 1951, rvise et complte en 1986 la lumire de nou-
velles dcouvertes de bornes milliaires et d'autres dcouvertes pigraphiques.
210
L'ANTIQUIT
suivant la cte d'Afrique Occidentale. Mais seule la premire route
se maintint l'poque romaine. L'autorit romaine imposa une
sorte de protectorat aux Garamantes du Fezzan, ds la fin du I
er
s.,
et, sous les Svres, un dtachement de la lgion s'tablit
Ghadams et Gholaia (Bou Njem). Les caravaniers de Tripolitaine,
qui avaient progressivement substitu le chameau au cheval, reti-
raient de grands profits de ce trafic dont les itinraires sont jalon-
ns, de Tripolitaine au Niger, par des graffiti gravs ou peints sur les
parois rocheuses des montagnes sahariennes, notamment dans le
Tassili des Ajjers et le Hoggar.
Ce commerce fournissait surtout de l'or, mais aussi des
esclaves, de l'ivoire, des plumes d'autruche, des fauves et, au Sahara
mme, des meraudes et des escarboucles. Les fouilles du Fezzan
ont montr qu'en change, les indignes recevaient du vin, des tex-
tiles, des objets de mtal et de la verrerie.
Ainsi l'conomie africaine suit, sous le Haut Empire, une
courbe nettement ascendante ; du milieu du II
e
s. au milieu du III
e
,
la production agricole ne cesse d'augmenter grce la conqute ou
la bonification de nouvelles terres, au dveloppement de la vigne
et de l'olivier ; les progrs de l'artisanat permettent de s'affranchir
de la dpendance conomique et de compenser largement les
importations de produits fabriqus ; enfin le commerce extrieur,
maritime et transaharien, procure des bnfices substantiels.
Mais on a reproch la bourgeoisie africaine d'avoir dissi-
p follement les sommes d'argent considrables dont elle a dispos.
Les inscriptions montrent qu'elle en gaspilla beaucoup en dpenses
somptuaires, banquets et grands spectacles, parure, esclaves et
uvres d'art. Elle en ptrifia une grande partie dans une parure
monumentale des villes, en difiant des demeures somptueuses,
aussi magnifiques que striles conomiquement. Il faudrait cepen-
dant noter qu' ct des constructions purement somptuaires,
publiques et prives, il en est d'autres qui contentaient des proccu-
pations religieuses ainsi que des besoins dilitaires et utilitaires :
Carte de la Proconsulaire montrant les rgions de culture de l'olivier et les centres de production
de cramique d'aprs les tudes de H. Camps Faber, A. Carandini et M. Mackensen
212
L'ANTIQUIT
temples, rues et places publiques, portiques, ports, routes, et instal-
lations hydrauliques pour l'alimentation en eau des cits ; ajoutons
aussi que certains investissements, qui ne prsentaient pas d'utilit
conomique, procuraient cependant aux habitants des diffrentes
couches sociales des possibilits de culture en mme temps que de
loisirs : c'tait le cas des bibliothques, thermes, salles et lieux de
spectacles.
Ce furent cependant ces dpenses exagres qui, en tarissant
le numraire, alors que la pauvret de l' Empire en mtaux prcieux
ne cessait de s'aggraver, provoqurent l'altration et la dvaluation
de la monnaie. Sans excuser pour autant cet esprit de jouissance, il
faudrait aussi tenir compte des structures conomiques de l'poque.
L'agriculture, principale source de richesse, exigeait une main-
d' uvre nombreuse et ne rapportait gnralement pas beaucoup.
Quant aux possibilits d'investissements crateurs, elles taient sin-
gulirement limites par la lenteur du progrs technique. Seules les
industries alimentaires pouvaient, dans l'antiquit, connatre un
grand dveloppement : ce fut le cas en Afrique, surtout pour l'oli-
culture et l'industrie annexe de la cramique. On doit mme
admettre, propos de la cramique, l'existence d' une vritable pro-
duction de masse. Mais il tait difficile, en l'absence d' une industrie
mcanique, d'employer l'argent plus efficacement.
La colonisation et le problme social
La politique colonisatrice de Csar et d'Auguste, poursuivie
par leurs successeurs de faon ingale, jusqu' la fin du I" s., abou-
tit la dispersion de plusieurs petites colonies sur le territoire de la
province, alors que d'autres groupes d'Italiens et de Romains de
souche taient installs dans le territoire mme des cits indignes.
Les immigrants et leurs descendants furent ainsi amens vivre
dans une compntration troite avec les autochtones.
Mais en fait, le nombre total de ces colons ne devait gure tre
POQUE ROMAINE
213
important. On a calcul, en additionnant les chiffres dont on dis-
pose, depuis la refondation de Carthage en 44 av J.-C. jusqu' la
mort de Trajan en 117, qui marqua la fin de la colonisation de peu-
plement, que le nombre de Romains et d'Italiens dfinitivement ta-
blis n'aurait gure dpass quelques 15000 personnes. Ils furent sans
doute, en raison notamment des alliances matrimoniales, rapide-
ment assimils par l'ensemble de la population.
Ce qui caractrisait en ralit cette socit, dans l'ensemble de
l'Empire, c'taient ses classements censitaires. Comme on l'avait dj
mentionn, on peut affirmer qu' la hirarchie ethnique s'tait super-
pose, puis peu peu substitue, une hirarchie sociale fonde sur la
fortune.
En haut de l'chelle, la petite caste des grands propritaires
romains de latifundia a t vite remplace, surtout aprs la mise
mort, sur l'ordre de Nron, des six grands latifundiaires d'Afrique,
par les propritaires locaux ou immigrs. Mais le plus important lati-
fundiaire tait, de loin, l'empereur lui-mme. Une centaine de
familles appartenant l'aristocratie africaine, surtout originaires de
Proconsulaire, taient parvenues la fin du II
e
s. l'honneur supr-
me : tre reues au snat romain ; le cens minimum exig pour y tre
admis tait d' un million de sesterces ; mais ces nouveaux snateurs
en possdaient, en fait, bien davantage. Au second rang parmi les
honestiores venaient les chevaliers. On a estim que le nombre de
familles qui avaient obtenu l'anneau d' or et la bande de pourpre
troite, qui distinguaient les membres de l'ordre questre, dpassait
peut-tre le millier. Leur fortune, selon les exigences du cens, devait
tre comprise entre 400 000 et 1 million de sesterces ; mais beau-
coup dpassaient galement ce cens. l'poque des Antonins, les
chevaliers africains, presque tous originaires de Proconsulaire ou de
Numidie, occupaient, l'chelle de l'ensemble de l'Empire, le 1/ 8
environ des procuratelles de la haute administration romaine.
Venait ensuite la catgorie de la bourgeoisie municipale, esti-
me quelques dizaines de milliers de familles. La somme honorai-
214 L'ANTIQUIT
re, dont le versement tait requis pour accder au Snat municipal
ou aux magistratures variait selon l'importance des cits. Elle tait
de 38 000 sesterces Carthage, de 4 5000 dans une ville moyenne
comme huila Regia et de 2000 dans une petite ville comme
Althiburos. On a calcul, en se fondant sur cette base, que la fortu-
ne des magistrats municipaux devait se situer entre 30 et 40 000 ses-
terces dans les petites cits, et entre 50 000 et 100 000 sesterces dans
les villes moyennes ; alors que dans la capitale Carthage, le cens
exig pour faire partie du conseil des dcurions et exercer une
magistrature tait de 400 000 sesterces.
Ces fortunes reposaient essentiellement sur la terre, qui tait
la principale source de richesse ; ce qui n'exclut pas que parmi les
plus grosses d'entre elles, certaines appartenaient des commer-
ants et des industriels qui, d'ailleurs, possdaient en outre des
terres agricoles.
Mais mme avec les calculs les plus optimistes, nous avons vu
que les 5/ 6 de la population vivaient dans la pauvret ou dans une
misre peine attnue, dans les villes, par les sportules distribues
par les riches et la viande consomme l'occasion des sacrifices
publics. Quant l'immense plbe rurale, esclaves, colons ou
ouvriers agricoles des domaines de l'aristocratie de souche romaine
ou indigne, ou mme paysans propritaires d' un petit lopin de
terre, ils ne connurent des bienfaits de la paix romaine qu'une
organisation plus rationalise de leur labeur . La plupart demeu-
raient sans doute dans des huttes de paille, comme on en voit sur la
mosaque dite du Seigneur Julius , ou dans de simples tentes
qu' on reconnat sur la mosaque agricole d' Oudhna. Alors que les
citadins s'entassaient dans des faubourgs misrables, comme le
quartier des mapalia Carthage, form de gourbis de terre crue.
CHAPITRE IV
L'urbanisation intense de la province
Les documents historiques et archologiques, accumuls
depuis le 19
e
s., n' ont cess d'insister sur l'importance prise par l'ur-
banisation du Maghreb oriental, l'poque romaine. Textes de la
tradition historique et dcouvertes pigraphiques, prospections et
fouilles archologiques renseignent tour tour ou insistent sur les
crations urbaines et les ralisations urbanistiques, sur les cam-
pagnes de construction successives, des dbuts du II
e
s. jusqu'au
milieu du III
e
, comme sur les restaurations et les reconstructions de
monuments publics au IV
e
s.
La carte des cits romano-africaines prsente cependant des
zones o l'urbanisation est dense, sur le littoral oriental, d'Hippo
Diarrhjtus (Bizerte) jusqu' la Tripolitaine, ainsi que dans tout le
Nord-Est du pays. Pas moins de 150 cits se pressent dans cette
rgion, dans les valles de la Mejerda et de l' Oued Miliane et dans
un rectangle qui n'excde pas 175 sur 120 km ! Par contre, les
agglomrations sont quasi absentes au Centre-Est et au Sud-Est de
la province ; malgr les petites oasis et les installations caractre
militaire, ces rgions font figure de zones peu habites. Dans le
dtail toutefois, et en examinant ces rgions avec minutie, on ne
peut tirer de conclusions dfinitives, faute d'enqutes systmatiques,
2 1 6
L'ANTIQUIT
combinant analyses de la couverture arienne et vrifications sur le
terrain.
Cet panouissement, sous l'empire romain, de la civilisation
urbaine a laiss un nombre considrable de ruines et une profusion
d'inscriptions latines qui, tout naturellement, ont accapar l'atten-
tion des chercheurs. Mais l'intrt suscit par l'poque romaine s'est
rapidement doubl de considrations dictes, l're coloniale, par le
prsent. Sous l'influence des militaires de l'arme d'occupation,
mus en fouilleurs, et des milieux scientifiques et religieux acquis
l'idologie coloniale, l'archologie s'est mise au service de la coloni-
sation : matriellement en menant, par exemple, une enqute sur les
installations hydrauliques antiques susceptibles de favoriser l'agri-
culture et les exploitations des colons ; et idologiquement, en s'ap-
propriant l'hritage romain. Cette premire approche de l'histoire
ancienne du Maghreb est ainsi reste, trop longtemps, prisonnire
d' une vision singulire, celle d' une occupation romaine promue au
rang de modle de l'action de la puissance coloniale et de sa mis-
sion civilisatrice .
Au reste, cette urbanisation intense et cet urbanisme florissant
n'taient pas ns avec Rome, ex nihilo et sans ascendance prromai-
ne. L'histoire de la Tunisie tait longue de prs de sept sicles
lorsque, en 146 av. J.-C., Rome commena par tablir sa domination
sur le nord-est de son territoire. Il suffit de rappeler l'origine
punique de la plupart des villes du littoral, depuis Hippo Regius
(Annaba), Hippo Diarrhytus, Utica et Carthago jusqu' Lepcis Magna en
Tripolitaine, et de retracer les dbuts de l'urbanisation l'intrieur
du pays, sur le territoire de l'tat carthaginois comme sur celui des
royaumes numides.
Quant aux origines de l'urbanisme, et au dveloppement de
l'amnagement urbain, avant l'intervention de Rome, il a fallu
attendre les fouilles de Carthage, dans les annes soixante-dix, et
celles de Kerkouane, au milieu du sicle, pour en avoir une ide
Restitution de la Carthage romaine.
Certes, cette restitution synthtise en les tlescopant les diverses phases de
l'histoire d'une grande cit et peut induire en erreur ; mais elle permet d'avoir une
vue globale de la ville et de son territoire et, par-l, de se faire une ide gnrale de
cette mtropole antique.
La restitution prsente ce territoire vol d'oiseau : la presqu'le donnant sur le golfe
avec le cap Sidi Bou Sad au nord-est, la zone portuaire Salammb au sud-est et
le dpart du cordon menant la Goulette.
A l'ouest, limit par la Sebkha Ariana et la Behira, se dtache l'isthme rattachant la
presqu'le au continent. A travers l'tendue cle la presqu'le on distingue l'emprein-
te des deux cadastres romains : la centuriation rurale qui dcoupe le territoire en
lots carrs de 700 m de ct, et implante par-dessus, pour n'occuper que la partie
littorale, la cadastration urbaine dont le centre se trouve sur la colline de Byrsa avec
le decumanus maximus, est-ouest et le kardo maximus, nord-sud dterminant un
dcoupage orthogonal
Dans ce maillage rigoureux, matrialis sur le sol par le passage des avenues et des
rues, et dlimitant des lots, s'implantent les monuments publics et privs.
On distingue parmi les monuments les plus importants, ceux du forum au sommet de
Byrsa, l'ouest l'amphithtre et le cirque, au sud-est les bassins portuaires, l'est
les thermes d'Antonin, le temple de Borj Jdid, au nord l'odon, le thtre et la
Rotonde, les villas aristocratiques.
Dans la plaine l'ouest, on distingue le trac de l'aqueduc de Zaghouan qui arrive
aux grandes citernes de la Malga.
218
L'ANTIQUIT
moins vague et, surtout, pour carter les prjugs et les jugements
htifs. On a pu alors vrifier, par exemple, que loin d'avoir substitu
Carthage, au moment de sa refondation, un plan rgulier, chef-
d'uvre d'arpentage des gromatici romains , l'urbanisme prsup-
pos anarchique et irrgulier de la mtropole punique, la cadastra-
tion romaine n'avait fait que suivre et se plier une organisation
antrieure : des axes des constructions de la Carthage romaine con-
cident pratiquement, en effet, avec les axes des difices puniques
sous-jacents dans la plaine ctire, prs du littoral.
Une documentation, aussi nombreuse que diverse, permet
d'tudier l'panouissement de ces agglomrations l'poque romai-
ne, et de saisir la fois les dtails de leur urbanisme et sa connexion
avec la vie matrielle et politique de la cit romano-africaine. Pour
les recenser, tout d'abord, nous disposons des cartes routires que
nous avons mentionnes. Nous possdons aussi des listes de villes
dresses soit par des gographes anciens, tels Pline l'Ancien et
Ptolme, soit l'occasion des assembles piscopales ; ces der-
nires mentionnent les vques qui dirigeaient les glises des villes
africaines. Mais c'est surtout grce aux dcouvertes archologiques
- qui permettent souvent de localiser, en l'identifiant, une cit - et
aussi grce aux indications diverses des innombrables inscriptions
latines exhumes par les fouilles, qu' on a pu avancer un chiffre :
dans les limites de la seule Proconsulaire se pressaient dans
l'Antiquit environ deux cents villes romaines.
Ces cits disparues, mais bien identifies par leur nom, leur
site et parfois mme, grce aux travaux des archologues, par l'his-
toire de leur naissance, de leur panouissement et de leur dclin,
sont parfois presque entirement effaces au ras du sol. Beaucoup
cependant sont encore plus ou moins bien conserves : les unes,
toujours enfouies sous un amoncellement de dcombres et de rem-
blais attendent l'intervention des fouilleurs ; les autres, mises au jour
et compltement dgages, retrouvent en quelque sorte une vie
POQUE ROMAINE
219
nouvelle. Celles-ci, plus d' une vingtaine, laissent voir encore les der-
niers restes de leurs demeures, et surtout, dressent toujours les murs
de leurs nombreux monuments publics - forums, temples, thermes,
thtres... - qui constituent la plus solide et la plus spectaculaire par-
tie de leur architecture. Elles portaient les noms aujourd'hui encore
clbres 'Utica, Thuburbo Majus, Thugga, Bu/la Regia, Mactaris,
A-lthiburos, Hadrumetum, Thjsdrus, Sufetula, Thelepte, Cillium,
Ammaedara, Gigthi, Sabratha, Hepcis Magna...
Nous n'avons malheureusement aucun chiffre prcis pour
valuer la population de ces villes, et nous devons nous contenter
d'estimations globales fondes surtout sur l'tude topographique.
Carthage, la plus importante, et qui aprs avoir vinc Utique tait
rapidement redevenue capitale, tait, selon plusieurs auteurs
anciens, une ville trs grande et fort peuple au milieu du IIP s. On
nous assure mme qu'elle tait dpasse seulement par Rome, la
capitale de l'Empire, et qu'elle disputait ainsi le second rang
Alexandrie. Mais comme les spcialistes ne sont toujours pas d'ac-
cord sur le nombre des habitants de la mtropole romaine, il reste
trs difficile de dnombrer avec prcision la population carthagi-
noise. Les historiens avancent pour la priode de prosprit, qui va
du milieu du II
e
au milieu du III
e
s., un chiffre approximatif fix
d'abord 300 000 habitants, puis ramen 100 000, rpartis entre
la ville et ses faubourgs fort tendus. Ceux-ci occupaient toute la
pninsule, de la pointe de Gammarth la bourgade de Galabra, qui
correspond l'actuelle Goulette. Deux autres villes se distinguent
par l'tendue de leur site : Thjsdrm (El Jem) et Hadrumetum (Sousse).
On accorde chacune de 25 000 30 000 habitants, ainsi qu' la
vieille cit punique d'Utique, reste longtemps prospre l'poque
romaine, et certaines cits importantes comme Hippo Regius
(Annaba), "Lepcis Magna ou Oea (Tripoli).
Vient ensuite la foule innombrable des moyennes et petites
cits : les plus importantes atteignaient peut-tre 10 000 habitants,
Plan du site de Dougga
Le site archologique de Dougga couvre environ 25 hectares.
C'est un site d'importance moyenne mais trs clbre en raison de
l'tat de conservation de ses monuments.
Sa rputation lui vient aussi cle sa situation topographique, tage
flanc de colline, dominant le paysage.
L'anciennet de ses origines et la continuit de son occupation travers les
priodes numide, punique et romaine ont fait la richesse de son
histoire. A cela s'ajoutent les travaux archologiques, de recherches,
de fouilles et de restaurations qui en ont fait un des sites dont
la visite est la fois instructive et attrayante.
Vieille cit numide, Thugga, a subi l'influence punique dont l'lment
le plus remarquable est le fameux mausole libyco-punique
qui se dresse en bas de la ville.
A l'poque romaine, la ville abrite deux communauts, l'une indigne et
l'autre de citoyens romains. C'est ce que l'on a appel une commune double. La
romanisation progressive de la ville est marque par la construction
de monuments imitant ceux de Rome. La fusion de la civitas et du
pagus en municipe s'opre sous Septime-Svre.
Toute l'histoire architecturale de la cit est une illustration de son
lvation ce statut politique.
Principaux monuments du site
1. Cirque. 2 : Temple de Minerve. 3 : Dolmens. 4 : Citernes d'An Mizeb. 5 :
Enceinte prromaine. 6 : Temple de Saturne. 7 : Temple de Neptune. 8 : Temple
anonyme. 9 : Hypoge chrtien. 10 : Basilique chrtienne. 11 : Citernes d'An el
Hammam. 12 : Arc de Svre Alexandre. 13 : Amphithtre ? 14 : Thtre. 15 :
Temple de Caelestis. 16 : Enceinte byzantine. 17 : Temple de Saturne ? Curie ? 18
: Forum. 19 : Capitole. 20 : Temple de Mercure. 21 : Place de la Rose des Vents.
22 : Chapelle de la Pit Auguste. 23 : Temple de la Fortune ? 24 : Mosque. 25 :
March. 26 : Temple A. 27 : Temple de la Victoire Germanique de Caracalla. 28 :
Dar el Acheb (ou Dar El Achheb ou Dar Lachhab). 29 : Temple de Tellus. 30 :
Thermes liciniens. 31 : Templa Concordiae. 32 : Auditorium, 33 : Temple anony-
me. 34 Temple de Minerve. 35 : Nymphe. 36 : Maison du Labyrinthe. 37 : Maison
du trifolium. 38 : Thermes des Cyclopes. 39 : Temple dit de Pluton. 40 : Arc de
Septime Svre. 41 : Citernes d'An Doura. 42 : Thermes d'An Doura. 43 :
Latrines publiques. 44 : Mausole libyco-punique. A : Maison des fouilles.
2 2 2
L'ANTIQUIT
tandis que la plupart d' entre elles n'taient que des bourgades de
1 000 3 000 mes, l'instar des nombreux via ou castella diss-
mins dans les territoires ruraux qui relevaient des grandes cits.
En dehors des ports principaux dj mentionns, qui se suc-
cdaient sur la cte, c'est dans la valle de la Mjerda que les cits
abondaient, peut tre plus nombreuses encore que de nos jours,
malgr le grand essor de l'urbanisation qui n'a cess de se dvelop-
per depuis le dbut du sicle et, surtout, depuis les annes soixante.
Citons Simitthu (Chemtou), Huila Rgla, 1/aga (Bj), Membressa
(Mejez-el-Bab), Thuburbo Minus (Tbourba) et, au sud de l'oued, une
foule de petites villes serres autour de Musti (Le Krib), Thugga
(Dougga), Thubursicu Bure (Tboursouk) et Tignica (An Tounga).
Les agglomrations taient tout aussi nombreuses dans la val-
le de l' Oued Miliane, de Seressi (Oum el Abouab) Uthina
(Oudhna), en passant par Thuburbo Majus. Les environs de Sicca
Veneria (le Kef), A-lthiburos (Medeina), Mactaris (Mactar) et Umisa
(Ksar Lemsa) gardaient une densit urbaine relativement forte, mais
qui diminue considrablement surtout au sud d'A^mmaedara
(Haidra), Theveste (Tebessa), Thelepte (El Medina el Kdima), Cillium
(Kasrine) et Sufetula (Sbetla). Ajoutons cette liste, dans le sud-
ouest, Capsa (Gafsa), Tusuros (Tozeur) et Nepte (Nefta), en ne citant
ainsi que quelques-unes parmi les agglomrations identifies avec
certitude.
Si on considre les cits nouvelles, sans pass prromain, l'em-
placement recherch relevait de la dcision de l'autorit fondatrice,
et l'organisation de l'espace du plan directeur choisi par les urba-
nistes. Mais la fondation d' une cit tait aussi un acte sacr, soumis
un vieux rituel scrupuleusement observ et maintenu jusqu'
l'poque impriale. Le rcit en a t fait maintes fois, d'aprs les
auteurs anciens. Le magistrat fondateur dtermine d'abord, aid par
un arpenteur, le centre de l'agglomration future. Grce l'instru-
ment de vise, appel groma, il trace le decumanus maximus dans la
direction du soleil levant ; il trace ensuite le cardo, ligne perpendicu-
Le forum de Sufetula (Sbetla)
Dominant la place centrale entoure de portiques, se dresse
le capitole de la triade capitoline, constitu non pas d'un seul, mais
de trois temples spars et juxtaposs, consacr chacun
un seul dieu : Jupiter au centre, Junon et Minerve de chaque ct.
Ils sont construits en blocs de taille,
parfaitement quarris. Ils s'lvent chacun sur un podium.
Ils sont prostyles, trtrasyles, c'est--dire prcds d'un portique
de quatre colonnes supportant un fronton,
et pseudo-priptres, c'est--dire entours d'une fausse colonnade,
accole aux murs de la cella.
Le temple central, un peu plus grand, est d'ordre composite,
les deux autres sont d'ordre corinthien. Ils ne comportent
pas d'inscriptions mais on date l'ensemble du forum par la ddicace
grave sur l'attique de la porte monumentale situe en face :
139 ap. J.-C. Le forum de Sufetula occupe le centre de la
cit qui est construite selon un plan cadastr. Prserve du pillage
de ses pierres, Sbetla a gard l'aspect d'un site intact
qui est aujourd'hui l'un des plus spectaculaires de la Tunisie.
224 L'ANTIQUIT
laire la prcdente. Selon la superficie que l'on veut donner la
colonie, on mesure sur les axes ainsi obtenus des distances gales
partir de leur intersection. L s'ouvriront les portes principales, au
nombre de quatre, et correspondant chacun des points cardinaux.
Il suffit ensuite de tracer des voies secondaires ; ce sont les decuma-
ni et les cardines, respectivement parallles aux deux axes principaux.
On obtient ainsi un plan en damier, dont les lots - qui portent pr-
cisment le nom d'insulae - sont partags entre les demeures parti-
culires et les monuments publics.
Les caractres de ce plan sont les mmes que ceux du camp
militaire. Il est vrai que ces cits nouvelles prenaient parfois la place
d' un ancien camp. L'exemple le plus caractristique cet gard, en
Afrique, est celui de Timgad. Cet idal de rgularit, conu ds le
VI
e
s. av. J.-C. par l'cole ionienne et appliqu par Hippodamos de
Milet au milieu du V
e
s., fut repris par Rome pour ses fondations
coloniales caractre militaire. La rgularit de Timgad se retrouve,
en effet, dans les colonies flaviennes fondes la fin du I
er
s. au sud
de la dorsale tunisienne : Sufetula, Cillium, A.mmaedara, et Thelepte.
Le rituel de fondation, qui est dcrit par les auteurs anciens,
aurait t pratiqu par Romulus, lors de la fondation de Rome. On
sait que Remus fut tu par son frre pour avoir franchi, d' un bond,
le foss et le talus que la charrue venait de tracer autour de la futu-
re cit. Cette ligne assure en effet un rempart de protection magique
dont les divinits infernales, qui jaillissent de la terre dchire par le
soc, prennent possession, le rendant infranchissable. Quiconque ne
pntre pas par les portes devient sacer ; c'est--dire qu'il est vou
aux divinits infernales et doit tre mis mort, car il constitue une
menace pour la collectivit. Ce rite, sous ses aspects pratique et reli-
gieux, a t sans doute enseign aux Romains par les trusques,
dont l'influence se manifeste surtout par l'importance accorde aux
divinits souterraines. De mme, l'instrument de vise utilis porte
un nom probablement trusque.
Tte de Septime-Svre.
Muse de Bardo. H. 43 cm
N en 146 Leptis Magna en Syrtique, empereur de 193 211, il est
le fondateur de la dynastie svrienne qui exera le pouvoir jusqu'en 235.
Il s'agit d'un portrait officiel destin reprsenter l'autorit
du pouvoir suprme et est porteur d'une signification
idologique, celle des vertus qui veillent la
prosprit de l'empire.
2 2 6
L'ANTIQUIT
La grande colonie de Carthage fut fonde selon le mme prin-
cipe. L'opration de cadastration rgulire a t, dans ce cas, rendue
possible parce qu' on avait pu disposer sans obstacle du terrain deve-
nu dsert aprs la destruction de la ville punique. La colonie couvrit
un grand carr de 1776 mtres de ct, dont le centre se trouve
aujourd'hui proximit du chevet de l'ancienne cathdrale de
Carthage. Le cardo maximus et le decumanus maximus, larges chacun de
12 mtres, dterminaient quatre grands rectangles qui contenaient,
respectivement, 120 insulae rectangulaires, dlimites par les cardines
et les decumani secondaires larges chacun de 6 mtres. Seul l'angle
nord-ouest tait occup par des constructions qui obissaient une
orientation diffrente, celle d'une cadastration prcdente, dfinie
probablement lors de la tentative de C. Gracchus. On fut ainsi amen,
en conservant ces constructions, ajouter quelques insulae suppl-
mentaires le long du rivage.
Mais l'organisation politique et administrative, dont Rome
dota la province, provoqua surtout le dveloppement des villes dj
existantes qui bnficirent aussi, considrablement, de l'essor co-
nomique. Les anciennes villes puniques occupaient gnralement
des positions ctires remarquables : lots, presqu'les ou embou-
chures de cours d'eau, faciles dfendre contre une attaque ven-
tuelle des populations de l'intrieur. Quant aux fondations des rois
numides, elles taient gnralement tablies sur des hauteurs prot-
ges par leurs pentes abruptes comme Thugga ou Sicca Veneria ;
c'taient, avait-on pens, des forteresses destines abriter les tr-
sors du roi, et protger les agriculteurs contre les incursions des
nomades. Mais les sites de plaine n'taient pas absents, comme celui
de la ville royale de Zama Rgla. Ne pouvant s'affranchir, dans les
deux cas, ni des contingences historiques, ni des irrgularits du site,
les urbanistes furent obligs de tenir compte du terrain et des
constructions prexistantes et de remanier leur plan. Si, pour ne pas
altrer la rgularit et la rectitude de leurs rues, ils furent amens,
Carthage, crter le sommet de la colline de Byrsa, entailler les
Capitole de Dougga
Ddi la triade capitoline, le capitole est le symbole du loyalisme
de la cit envers la mtropole.
Par sa position topographique, par son architecture majestueuse et aussi
par son tat de conservation exceptionnelle et la patine de sa pierre,
le capitole de Dougga est considr comme l'un des plus
beaux monuments de l'Afrique antique. C'est un temple prostyle,
ttrastyle, pseudo-periptre. La cella abritant les statues des divinits
est prcde d'un portique d'ordre corinthien s'levant sur un podium
accessible par un escalier monumental. Le portique est form
de quatre colonnes canneles en faade et de deux en retour, monolithes
et hautes de 8 mtres. Sur la frise architrave est grave la ddicace
pour le salut des empereurs Marc Aurle et Lucius Vrus. Le tympan
du fronton est orn d'un bas-relief reprsentant un homme enlev
par un aigle : c'est la figuration symbolique de l'apothose
d'Antonin le Pieux. Construit en 166-167, ce capitole est
l'hommage clatant rendu Rome, par la population de Thugga.
228 L'ANTIQUIT
hauteurs par trop escarpes et remblayer les dpressions trop pro-
fondes, ils ne purent entreprendre partout ce travail colossal et fort
onreux. Aussi choisirent-ils souvent de s'adapter la nature tout en
respectant les donnes de l'histoire : conservant ici de vieux quar-
tiers, ils tagrent l des difices nouveaux sur les pentes escalades
par un lacis des rues sinueuses ; Dougga, la vieille cit numide,
illustre remarquablement ces drogations imposes l'ordonnance
classique habituellement applique par les urbanistes romains.
Cependant quelle que soit leur origine, les cits africaines
reproduisaient, aussi exactement que possible, les caractres essen-
tiels de la capitale romaine qui demeurait YUrbs, la Ville par excel-
lence. Les prescriptions des traits d'urbanisme classiques, notam-
ment celui de Vitruve, taient largement suivies tant pour l'empla-
cement que pour l'agencement des principaux monuments. Dans
chaque cit on retrouve, avec des formes comparables, les installa-
tions publiques ou officielles caractristiques de la ville romaine : la
place du forum, gnralement entoure par les mmes btiments
civils ou religieux, curie, basilique civile, capitole et temples des divi-
nits grco-romaines ; d'autres temples encore consacrs ces dieux
ou aux divinits africaines, l'intrieur de la cit ou dans sa pri-
phrie ; des thermes gigantesques ou de modestes bains de quartier,
des monuments de jeux, au complet dans les grandes villes, les cits
moyennes se contentant des jeux scniques. Les monuments des
eaux, les portiques et les arcs, avec leurs sculptures, participent sou-
vent, aussi, cette parure monumentale.
CHAPITRE V
Les monuments publics caractre
politique, social et religieux
Les Fora
Le forum, place publique officielle, doit occuper autant que
possible le centre de la cit. Les axes principaux - cardo maximus et
decumanus maximus - aboutissent ainsi au forum qu'ils bordent sur
deux cts ; c'est une place dalle, interdite aux charrois. Une
enceinte l'isole frquemment des constructions limitrophes. On y
accde souvent par un arc monumental.
Hrite de l'agora grecque, cette place romaine rpond
comme elle aux fonctions politiques de la cit. Les dimensions sont
ainsi proportionnes l'importance de la ville : de 700 m
2
un hec-
tare environ. C'est l que le peuple se runit pour ses affaires deve-
nues seulement municipales, pour l'lection de ses magistrats, pour
les diverses manifestations de sa vie collective. Les magistrats tien-
nent aussi leurs assises au forum ou dans les btiments qui le bor-
dent. Ils lisent l leurs communications, clbrent les sacrifices, pro-
cdent aux adjudications, rendent la justice. Le forum joue ainsi un
rle social important.
Mais cette vie sociale est empreinte d' un caractre religieux :
les cultes officiels de la Triade capitoline, de Rome et des empereurs
230
L'ANTIQUIT
diviniss taient insparables de la vie politique ; ce caractre est
parfois prdominant et confre alors la place un caractre sacr. A
ces cultes officiels s'ajoutent souvent ceux des vieilles divinits afri-
caines, protectrices de la cit depuis l'poque prromaine.
L'esplanade, gnralement rectangulaire, tait entoure sur
trois cts de galeries couvertes surleves d' une ou de plusieurs
marches, qui offraient un abri contre la pluie et le soleil et donnaient
accs des btiments publics comme la curie et la basilique, des
chapelles et des locaux qui servaient peut tre de siges des asso-
ciations religieuses ou professionnelles, ainsi qu' des boutiques et
des dbits de boissons. La curie abritait les runions du snat muni-
cipal, tandis que dans la basilique, qui comprenait dans les cits
importantes une grande nef rectangulaire borde de portiques
deux tages, les duumvirs rendaient la justice et les commerants
traitaient les affaires. Sous la colonnade des galeries, comme sur la
place mme, se dressaient les pidestaux qui portaient les statues
des empereurs, des personnages illustres, des magistrats, prtres,
bienfaiteurs et patrons de la cit. Le forum tait ainsi le centre de la
vie publique.
Pour la commodit des citoyens, le march, devenu une place
indpendante lorsque celle du forum ne suffit plus au trafic local, le
thtre et les thermes principaux se dressaient gnralement ct
de la place officielle, au centre de la cit.
Carthage, la ncessit de trouver un espace plat, assez ten-
du, avait, semble-t-il, oblig les urbanistes romains dplacer large-
ment la place primitive vers l'est, prs du littoral, en l'intgrant peut
tre aux installations portuaires. C'tait elle, sans doute, que saint
Augustin, au dbut du V
e
s., donnait le nom de platea maritima.
Il y avait cependant, au milieu de la ville, une place laquelle
on accdait, d'aprs un texte tardif, par des gradins. Comme elle est
qualifie de platea nova, on y a vu assez tt le forum d' poque imp-
riale, implant au centre de la cit, sur la colline de Byrsa, et bord
de tous cts par des plates formes qui s'tageaient sur les pentes
Vue des grands thermes de Mactar
Construits la fin du II
e
s.,
les thermes sud de Mactar comptent parmi les
tablissements balnaires les plus importants et les mieux conservs de Tunisie.
Couvrant prs de 400 m
2
, l'difice reproduit l'archtype des thermes
consistant en une succession de salles rpondant aux phases successives
du bain : frigidarium, tepidarium, caldarium ainsi que des annexes
dont la palestre qui sert de prambule au bain. Alors que
le cur du systme thermal est construit en blocage et bton permettant
de raliser de grandes votes solides, dans la palestre, qui est une sorte de
gymnase consistant en une cour ciel ouvert entoure de
portiques, c'est la pierre taille en blocs qui est en usage pour faire les
piliers et les arcades. On remarquera l'lgance de cette architecture
en blocs appareills sans mortier.
232
L'ANTIQUIT
par ressauts successifs. Les fouilles menes dans le cadre de la cam-
pagne organise par l ' UNESCO ont confirm ce diagnostic : sur le
sommet dcap de la colline l'esplanade rectangulaire du forum fut
borde, sous le rgne d' Antonin (138-161), par une basilique judi-
ciaire de dimensions gigantesques. Lui faisant face, sur l'axe longi-
tudinal, l'autre petit ct de la place tait rserv au capitole. C'est
donc seulement cette date, et en profitant de l'incendie qui rava-
gea vers la fin des annes 140 le centre de la ville, que furent com-
mencs, sinon raliss, les grands monuments du centre civique,
ainsi d'ailleurs que l'ensemble des complexes monumentaux, qui
rendirent Carthage digne de son rang de mtropole des provinces
africaines.
Par contre, les forums de plusieurs autres cits sont depuis
longtemps connus. On a dgag notamment ceux d'Althiburos, de
Huila Regia, de Simitthu, de Thugga., de Belalis Maior, de Thuburbo
Ma/us, de Mactaris, de Sufetula, de Gigthi, de Lepcis Magna, d
,
Oea et de
Sabratha. Les emplacements des forums 'Aggar (Foum el Affrit), de
Mididi (Henchir Meded), de Thigibba (prs de Souk el Jema'a) et de
Meninx dans l'le de Jerba, sont aussi connus.
Certaines villes, parmi les plus riches, comme Mactaris et 1 xpcis
Magna, ne se contentaient pas d' un seul forum. Elles disposaient,
d' une part, d' une vieille place irrgulire, sans portiques, inspire
peut tre des vieilles agorai des cits grecques, qui remonte au
moins au I
er
s. et probablement aux origines mmes de la cit ; et
elles avaient, d' autre part, un nouveau forum, rgulier, plus vaste et
plus somptueux que le premier, ajout l'occasion d' une progres-
sion avantageuse intervenue dans le statut municipal.
Les sanctuaires
Chaque cit possdait aussi plusieurs temples. La plupart,
construits selon le modle grco-romain, comportent essentielle-
Les thermes d'Antonin Carthage
Plan d'ensemble et restitution d'aprs A. Lzine
Edifi en bordure de mer, occupant prs de 3 hectares, le monument
se prsente selon un plan axial et symtrique avec
quatre salles polygonales entourant le cadarium et offrant
une faade en demi-couronne dominant
une esplanade. Ces thermes taient aliments par
l'aqueduc de Zaghouan.
234
L'ANTIQUIT
ment une salle qui abrite la statue du culte {naos, cella), hausse sur
une plateforme artificielle (podium) et souvent prcde d' un vesti-
bule ouvert entre les colonnes de la faade et la porte de la cella (pro-
naos).
Le temple principal tait ddi la Triade capitoline, Jupiter,
Junon et Minerve. l'image du capitole de Rome, ce sanctuaire se
dressait l' endroit le plus lev possible de la ville, tout en restant
proximit du forum, dont il occupait souvent l' un des petits cts.
D' autres temples consacrs des cultes officiels, celui de la famille
rgnante par exemple, se dressaient au voisinage.
Les sanctuaires consacrs des divinits africaines prsen-
taient des dispositions spciales. L'architecture religieuse hrite de
l' poque numido-punique avait, en effet, rsist trs longtemps aux
transformations qui s'opraient dans d' autres domaines. Les
temples des dieux patrons de la cit, vieilles divinits issues le plus
souvent d' une assimilation d' un dieu indigne, gnralement d'ori-
gine phnicienne, et d' un dieu romain, conservaient plusieurs parti-
cularits ; certains comportaient une crypte, tandis qu' un plus grand
nombre prsentait un plan de tradition orientale : une cour ciel
ouvert entoure de portiques, au fond de laquelle sont amnages
des cellae, gnralement au nombre de trois, jouait un rle essentiel
et rappelait peut tre l'aire sacre ciel ouvert des sanctuaires
puniques. Les processions rituelles s'y droulaient, l'intrieur
d' une enceinte qui isolait le temple. Souvent ces sanctuaires de tra-
dition prromaine s'levaient, comme le temple de Bal Hammon-
Saturne Dougga, la priphrie de la ville.
Les thermes
Les thermes publics occupaient dans les villes une place qui
correspondait leur rle dans la vie des Romains. D' autant plus
ncessaires l'hygine corporelle que les demeures particulires,
l'exception des plus luxueuses, taient dpourvues de bains et de
POQUE ROMAINE
235
latrines, c'taient aussi des centres de l'activit sportive, ainsi que de
la vie sociale et intellectuelle. Ils taient ouverts aux habitants de
toutes les conditions et des deux sexes, moyennant une redevance
trs modique. Chaque cit possdait donc des thermes de quartier,
plus ou moins modestes, ainsi qu' un tablissement central, plus
important, qui comptait parmi ses difices les plus vastes, les plus
solides et les plus richement dcors. Trs souvent on construisait
comme Thuburbo Maius, Mactar et Sbetla, deux tablissements
centraux distincts, exposs de faon servir l'un en hiver et l'autre
en t.
L'amnagement des grands thermes correspond la srie
d'oprations qu'exige un bain complet. Un vestiaire (apodyterium)
permet soit de passer directement aux oprations du bain, soit de
les prcder par le passage, si on le dsire, par un local rserv aux
onctions d'huile mle de rsine, dont on s'enduit le corps avant de
pntrer dans une palestre dcouverte dans les thermes d't, ou
une salle de gymnastique close, dans les thermes d'hiver, pour se
livrer divers exercices. L'arrt dans une tuve sche (laconicum),
pour activer la sudation, et dans le destrictarium, o s'effectue le net-
toyage l'eau chaude, est ncessaire avant d'aller s'immerger dans le
bain chaud collectif du caldarium. Un rapide plongeon dans la pisci-
ne froide du frigidarium procurait enfin une raction salutaire. Pour
viter cependant une brutale diffrence de temprature entre les
salles froides et chaudes, on amnageait des tepidaria, salles tides de
passage ou de sjour.
Le droulement des diffrentes oprations du bain impose
ainsi une circulation qui dtermine la disposition des diffrentes
salles dans le btiment. Si le plan des petits thermes prsente gn-
ralement un plan dissymtrique, celui des tablissements importants
est d' une symtrie parfaite, qui rpond surtout au souci de faciliter
l'accs et la circulation de la foule des usagers. L'ensemble des salles
s' ordonne autour de l'immense pice centrale vote du frigidarium.
Les baigneurs, diviss en deux groupes, empruntent deux circuits
sens unique, qui respectent galement la rgle de la progressivit du
Le Temple des eaux et l'aqueduc de Zaghouan
Les deux documents qui illustrent cette page ont t excuts par C.T.Fable en
1838. La premire gravure montre le temple des eaux avec le nymphe construit
au-dessus de la source, au flanc de la montagne de Zaghouan.
C'est un sanctuaire entour d'un bassin qui reoit l'eau jaillisante avant qu'elle
s'engouffre dans la conduite en direction de Carthage.
La seconde gravure montre ta file des hautes arches supportant la conduite et
traversant la plaine, avec au fond la montagne majestueuse de Zaghouan.
En dehors de ses talents de peintre, C.T.Falbe qui fut consul du Danemark
Tunis, est clbre surtout par la ralisation de la premire carte archologique
du site de Carthage dite en 1833.
Le nymphe de Zaghouan, avec son crin de verdure luxuriante au flanc de
l'une des montagnes les plus hautes de Tunisie, est un monument trs rput. Il
a inspir de nombreux peintres dont Sir Grenville Temple qui voyagea en
Tunisie dans la premire moiti du XIX
e
s.
L'aqueduc de Zaghouan et les citernes de la Malga Carthage
Cet aqueduc qui amne l'eau depuis les Jebel Zaghouan juqu' Carthage est
considr comme l'une des ralisations la fois techniques et monumentales les
plus remarquables de l'empire romain. Longue de 132 km, la conduite, tantt
arienne reposant sur un alignement de hautes arcades pour traverser les valles,
tantt souterraine pour traverser les collines, amne l'eau de manire gravitaire,
c'est--dire en pente douce depuis les sources du flanc de la montagne jusqu'aux
rservoirs des thermes monumentaux de Carthage situs en bordure de mer. On a
calcul que 32 000 m
3
taient dverss par jour, soit 270 litres la seconde.
Sa construction est attribue l'empereur Hadrien. ( 117-138 ap. J.-C.)
238
L'ANTIQUIT
degr de chaleur ; ce qui entrane le ddoublement de certaines
salles.
Quant au chauffage, il tait assur par l'air chaud qui, la sor-
tie des foyers, circulait aussi bien entre les piles de laves ou de car-
reaux de terre cuite qui surlevaient le sol, que derrire les parois
fixes la maonnerie par des clous de terre cuite, dans les salles les
plus chaudes.
Les thermes d'Antonin, Carthage, qui se classent aux pre-
miers rangs des grands tablissements romains connus, s'lvent en
front de mer, sur une esplanade de 300 m de long sur 100 m de
large. Une partie fut occupe par un parc entour de portiques sous
lesquels ouvraient une suite de pices tantt carres, tantt arron-
dies, ainsi que de vastes latrines dont subsiste seulement l'ossature ;
il s'agit de deux exdres semi-circulaires longes par un canal
d'coulement sur lequel taient tablis les siges. Ceux-ci ont dispa-
ru, ainsi que les accoudoirs qui les sparaient. Une vidange perma-
nente tait assure par un courant d'eau qui circulait dans le canal ;
eaux uses et dchets taient ainsi charris vers le collecteur de
l'gout. Face aux siges se dressait aussi une fontaine pour les ablu-
tions.
Au centre de l'esplanade, l'difice colossal des thermes com-
prenait deux tages, un rez-de-chausse de niveau avec la plage,
occup par des magasins et des salles de repos obscures, et un pre-
mier tage qui constituait l'tablissement de bains vritable. Face
la mer, des murs normes supportaient une piscine froide, dcou-
verte sans doute ; et au centre de l'difice tait amnag le frigidarium,
une immense salle aux votes soutenues par huit colonnes corin-
thiennes jumeles de granit gris, de plus de 12 m de haut ; leurs cha-
piteaux colossaux de marbre blanc dpassaient la taille d' un homme.
On entrait dans l'tablissement par les deux faades latrales. A ces
deux extrmits deux vastes palestres, entoures de portiques flan-
quaient la grande salle centrale du frigidarium. l'ouest, dans des
Citernes de Rougga
Souterraines comme toutes les citernes, celles de Rougga sont clbres par leur
forme circulaire et leur architecture monumentale : les votes en berceau et
d'artes qui les couvrent reposent sur une fort de piliers massifs donnant un
aspect impressionnant. Mieux que de simples rservoirs, les deux citernes consti-
tuent un systme hydraulique labor. Elles sont relies entre elles par une double
galerie et l'alimentation se faisait par des canalisations amenant l'eau puise dans
une nappe phratique abondante. La grande citerne a un diamtre variant entre 37
et 41 m et sa hauteur dpasse les 6 m, soit une contenance de 7 600 m
3
.
La seconde a un diamtre de 17 m et un volume de 1650 m
3
.
240
L'ANTIQUIT
salles polygonales ddoubles, taient groups les bains chauds, de
part et d'autre du grand caldarium.
Quelques vestiges du dcor architectural du premier tage
sont parvenus jusqu' nous : belles colonnes canneles en marbre
blanc veines violettes, chapiteaux corinthiens admirablement
sculpts, corbeaux, lments de corniche, plafonds caissons... Le
sol, dont on trouve d'importants morceaux effondrs, tait notam-
ment couvert d' une mosaque gomtrique gros cubes noirs et
blancs.
Ce plan ambitieux rattachait les thermes d' Antonin de
Carthage aux grands thermes de Rome, ceux de Nron et de Titus,
au I
er
s. et ceux, amliors depuis, de Trajan, au dbut du II
e
s. On a
dj indiqu que le centre civique de la capitale provinciale avait
bnfici d' un programme dilitaire fastueux, la suite de l'un de
ces incendies dvastateurs, qui ravageaient priodiquement les cits
antiques aux btiments couverts en charpente. C'est aussi dans le
cadre de ce programme, entrepris dans la dernire dcennie du
rgne d'Antonin, partir de 150 environ, qu' on imita le gigantisme
des ralisations architecturales de la capitale de l'Empire, en dotant
Carthage de ces thermes aux dimensions colossales.
L'approvisionnement en eau des cits
Ces tablissements balnaires gigantesques exigeaient beau-
coup d'eau et un approvisionnement rgulier, qui tait fourni, gn-
ralement, par des adductions et des captages trs importants.
Comme aujourd'hui, le problme de l'eau tait capital, et de sa solu-
tion dpendait, dans les villes de la province, confort et bien-tre.
La Carthage punique et les autres villes de l'hinterland carthaginois
s'taient contentes de l'eau des sources, plus ou moins rares, de
puits et surtout de citernes. A l'poque romaine on utilisa d'abord,
en les multipliant, ces modestes moyens de ravitaillement. Chaque
POQUE ROMAINE
241
maison, quelle que soit la ville antique considre, avait au moins
une citerne dont les dimensions taient parfois gigantesques.
Certaines avaient la forme d' une baignoire aux extrmits arron-
dies ; d'autres avaient l'aspect d'une carafe la panse trs large ; la
plupart cependant taient rectangulaires et couvertes d' une vote en
berceau. Cette forme, ainsi que l'enduit tanche et trs dur, dont
elles sont revtues, permettent de les reconnatre facilement, mme
si aucun vestige de maison ne les surmonte plus. Ces citernes
recueillaient l'eau de pluie ruisselant sur les toits et les terrasses am-
nages cet effet.
Mais la technique de l'poque sut trouver d'autres solutions,
souvent au prix de travaux qui ne cessent d'tre un sujet d'admira-
tion. C'est ainsi que d' normes bassins souterrains furent aliments
par des conduites qui y amenaient les eaux puises dans les nappes
profondes : cet gard, l'ensemble le plus impressionnant se trou-
ve Rougga, l'antique Bararus, au sud-est d' El Jem : deux bassins
souterrains monumentaux, dont les votes retombent sur des piliers
massifs, recueillaient le prcieux liquide.
On n'hsitait pas non plus aller chercher l'eau jusque dans
les montagnes voisines, parfois fort loignes. Les sources qui jaillis-
sent sur les flancs de ces montagnes taient ainsi achemines par des
aqueducs jusqu' la ville. L'crivain latin Frontin, qui vcut la fin
du I
er
s. ap. J.-C., nous a laiss un petit trait sur les aqueducs qu'il
place, parce que plus utiles, au-dessus de toutes les ralisations de
l'art grec et de l'art gyptien.
L'aqueduc pouvait tre aliment de diffrentes faons ; s'il
s'agissait d' une eau de source, il fallait qu'elle jaillt en un point assez
lev par rapport la ville, mme s'il en tait fort loign ; car la
technique de l'poque romaine n'tait pas encore parvenue assu-
rer convenablement l'lvation de l'eau. Pour assurer l'alimentation
de Carthage, on n'avait donc pas hsit construire un aqueduc
extrmement long : Zaghouan est plus de 70 km vol d'oiseau, et
242
L'ANTIQUIT
la longueur relle de l'aqueduc dpasse 132 km. Aucun texte pi-
graphique ou littraire ne nous renseigne sur la date de sa construc-
tion, mais comme la fonction essentielle de cette conduite tait de
ravitailler les thermes d'Antonin, on estime qu'elle devait se situer
aux environs de 160.
Carthage utilisait en fait plusieurs sources : on a retrouv, au
Jouggar, des vestiges de cap tarions qui rejoignaient le grand aque-
duc. Toutefois la source principale tait bien celle de Zaghouan,
situe environ 2 km au sud du village actuel, et prs de la source
utilise aujourd'hui pour le ravitaillement de Tunis. La falaise fut
taille en forme d'hmicycle de 30 m de diamtre et borde de
niches, qui s'ouvraient derrire un portique et abritaient les statues
des nymphes. L'eau s'coulait dans un bassin de forme ovale, tran-
gl au centre, dessin sur la base de deux cercles scants. De l, elle
empruntait une conduite ferme (specus) qui constitue la partie
essentielle de l'aqueduc. Ses dimensions sont si grandes, qu'un
homme debout peut y circuler. Mais, de faon gnrale, le calibre de
la conduite tait fonction du dbit de la source capte, et des
besoins en eau de la ville alimente.
Une fois la captation ralise, il fallait surtout tablir pour la
conduite une pente rgulire de la source au point d'utilisation. Pour
y parvenir, le canal tait tantt enterr, l o l'altitude du sol deve-
nait trop forte, tantt surlev sur des arches, lorsqu'il fallait fran-
chir une valle ou une dpression. Nous connaissons bien ces
arcades construites en blocage avec un revtement de grand appa-
reil ; elles traversent toujours la valle de l'oued Miliane, et on les
retrouve aux environs du Bardo ; mais ces dernires ne remontent
pas l'poque romaine. En effet, l'aqueduc de Zaghouan fut
maintes fois restaur au cours de notre histoire, et tait encore uti-
lisable, il y a un sicle, grce aux rfections apportes par les archi-
tectes arabes. C'est le Hafside El Mostancir qui ajouta la drivation
du Bardo ; celle-ci amenait les eaux jusqu' ses jardins de la banlieue
de la capitale. Et aujourd'hui encore, la conduite qui amne l'eau de
Thtre de Dougga
Le thtre de Dougga est l'un des mieux conservs d'Afrique.
Adoss la colline, il est de dimensions moyennes,
pouvant contenir 3 500 spectateurs.
L'achvement de sa construction en 168-169 aux frais d'un
notable de la cit est commmore par quatre inscriptions qui donnent
un luxe de dtails sur les lments composant
l'difice lui-mme et ses annexes ainsi que son ornementation.
Le thtre romain comprend quatre parties principales :
La cavea est constitue de l'ensemble des gradins.
L'orchestre au pied de la cavea est rserv aux fauteuils des notables.
La scne est surleve par un pulpitum. Le mur de fond,
dcor de colonnes superposes est perc de trois portes. Le thtre
est un difice important dans
l'quipement urbain de la cit antique.
244
L'ANTIQUIT
Zaghouan jusqu' Tunis utilise des parties enterres du specus de
l'poque romaine.
Arrive proximit de la ville, l'eau se dversait dans de
grandes citernes, dont les bassins de dcantation permettaient de
l'purer. De l partaient des conduites qui suivaient les rues princi-
pales et alimentaient les thermes, les fontaines publiques et quelques
maisons particulires appartenant des notables riches et de haute
condition.
Dans la province africaine, les aqueducs taient trs nom-
breux. La plupart des villes en possdaient, et on en construisait
mme pour alimenter des bourgades et des fermes. Si, dans la plu-
part des cas, c'tait l'eau des sources qui tait ainsi capte, d'autres
aqueducs pouvaient tre aliments aussi par les cours d'eau grce
une retenue, qui avait parfois l'aspect d'un vritable barrage pourvu
de vannes.
CHAPITRE VI
Les monuments des jeux
et des spectacles
Les cits importantes possdaient un thtre, et souvent
mme un amphithtre et un cirque. En effet, quelle que soit leur
nature, les jeux taient une ncessit imprieuse pour les foules
urbaines. Mais le plus frappant c'est que les Romains, et avant eux
les Grecs, estimaient qu'il tait du devoir des autorits publiques
d'organiser les loisirs des citoyens. Les ressources publiques des
cits taient donc officiellement utilises pour mettre la disposi-
tion des habitants divers moyens de distraction.
Les thtres
Les thtres taient rservs aux reprsentations scniques.
Les textes anciens comme les dcouvertes archologiques prouvent
que les Africains d' poque impriale apprciaient encore les pices
classiques, grecques ou latines ; mais le got de la plupart d' entre
eux les portait plutt vers le mime, un genre grand spectacle, d'in-
vention romaine : dans un dcor luxueux alternaient sketches
comiques et danses ; puis venait le tour de la pantomime qui consti-
tuait le clou de la reprsentation : c'tait une sorte de ballet, et les
L'amphithtre de Thysdrus - El Jem
Toute cit digne de sa romanit doit se doter d'un amphithtre destin
divertir sa population par l'organisation de jeux de gladiateurs
et de combats avec des animaux sauvages.
Le modle de rfrence est le cotise de Rome mais chaque cit construisait le
sien en fonction de ses moyens et de la gnrosit des ses donateurs.
Thydrus a possd tout au long de son histoire trois amphithtres successifs
dont le dernier, par sa monumentalit et sa solidit,
a survcu jusqu' nos jours. Il est en effet l'un des joyaux de l'architecture
romaine d'Afrique. Construit en terrain plat conformment au
prototype romain, le grand amphithtre d'El Jem apparat comme une
immense ellipse constitue de gradins s'levant sur trois
tages entourant une arne de mme forme comportant des amnagements
au sous-sol. Suivant les deux grands axes, le monument
mesure 148 m sur 122 m dveloppant ainsi un primtre extrieur de 427 m.
L'arne mesure 64 x 39 m. La capacit des gradins est de
27 000 places. Le plan de l'amphithtre est conu
comme une structure rayonnante divise en traves rgulires, permettant
l'accs vers les places et l'vacuation rapide d'une foule nombreuse. L'arne est
un vaste terre-plein de forme ovale.
Pour le spectacle lui-mme, il convient de se reporter la reprsentation
illustre dans la mosaque de Smirat (p. 249).
De l'extrieur, l'allure du monument est massive mais l'architecture qui dveloppe
une faade rythme par trois niveaux de colonades o les vides des 64 arcs plein
cintre alternent avec les piles dcores de colonnes engages
lui confrant une lgance monumentale.
S'y ajoute l'appareillage des murs en pierre de taille patins avec le temps.
Aussi le monument apparat-il comme un chef-uvre de l'architecture romaine
d'une matrise parfaite parce qu'il a rsolu les problmes techniques et les
contraintes de tout ordre, tout en offrant une allure architecturale
faite de puissance et d'harmonie.
Ce monument, difi entre 230 et 250, serait l'uvre d'vergtes thysdrutains
enrichis dans une cit ayant atteint son apoge conomique sous les Svres grce
au dveloppement de l'oliculture et au commerce de l'huile : les fouilles et les
dcouvertes archologiques ralises depuis un demi-sicle ont rvl de telles
richesses que l'on ne s'tonne plus aujourd'hui de la prsence d'un pareil
monument s'levant aujourd'hui en rase campagne.
La restitution de paysage esquisse par J.-C. Golvin la lumire de ces dcou-
vertes est loquente cet gard. C'est une perspective arienne montrant le parfait
ovale creux du monument s'levant la priphrie de la cit qui s'tend ses
pieds, autour du centre urbain constitu par le forum. Et tout autour,
s'talant jusqu' l'horizon, les vergers d'oliviers qui ont fait la fortune de la cit et
les routes qui ont convoy le prcieux produit jusqu 'aux ports de la cte.
Restitution par J. C. Golvin
248
L'ANTIQUIT
artistes parvenaient exprimer par leurs volutions et leurs gestes
les pripties du rcit et les tats d'me des hros.
Un thtre romain consiste essentiellement en un espace
semi-circulaire, Y orchestra, o sont placs des siges pour les grands
personnages de la cit. Le reste des spectateurs prend place sur les
gradins tags de la cavea semi-circulaire qui enserre l'orchestre. Face
aux gradins se dresse l'difice de la scne dont le mur de fond, appe-
l frons scenae, se compose de quatre massifs de maonnerie percs
gnralement par trois portes reliant la scne aux coulisses, et dco-
rs de colonnades superposes. Ce qui donnait la scne l'apparen-
ce d'un palais majestueux dont la faade atteignait, comme au
thtre de Sabratha en Tripolitaine, une hauteur de trois tages.
Devant la scne et la sparant de l'orchestre, un mur bas que creu-
sent alternativement des niches rectangulaires et circulaires, dco-
res de statues ou de fontaines. Une rainure creuse dans la partie
antrieure de ce mur permet de faire surgir du sol ou d'escamoter
un rideau qui s'abaisse au dbut de la reprsentation et se lve la
fin.
Le frons scenae est l'un des lments les plus caractristiques du
thtre romain ; mme si son caractre monumental, empchait
toute modification d' une reprsentation une autre, supprimant
tout ralisme du dcor, du moins il prsentait un avantage consid-
rable et toujours apprci par les troupes qui utilisent encore de nos
jours les thtres romains : rpercute par ce mur, la voix des
acteurs couvre facilement toute la cavea.
Parmi les thtres africains, seul celui de Sabratha, restaur par
les archologues italiens, montre encore son ancienne ordonnance.
En Tunisie, le thtre de Dougga, dont quelques gradins ont t res-
taurs et la colonnade remise en place, est le mieux conserv. La
cavea, qui pouvait contenir environ 3 500 spectateurs, fut creuse
dans le rocher de la colline, ce qui diminuait considrablement les
Mosaque des jeux d'amphithtre
Dcouverte en 1962 Smirat. Conserve au muse de Sousse.
Cette remarquable mosaque relate par l'image et le texte une journe du jeux
d'amphithtre : le spectacle des Venatores s'attaquant de grands
fauves, munis d'armes de traits.
Le combat oppose quatre bestiaires. Spittara, Bullarius, Hillarinus, Mamertinus c,
quatre lopards dont on montre les diverses phases dramatiques.
Pareil spectacle est pris en charge par un riche notable, Magerius, qui verse la
rcompense au vainqueur : quatre sacs de 1000 deniers chacun sont prsents su
un plateau. En retour, la foule des spectateurs acclame sa gnrosit.
Ainsi le souvenir de ce spectacle mmorable est-il perptu par la mosaque qui
ornait sans cloute la somptueuse demeure du donateur.
Pareils spectacles taient organiss par des entreprises spcialises connues sou.
le nom de Telegeni, Pentasii, Tauricei, et qui jouaient un rle important dans le
domaine conomique.
250
L'ANTIQUIT
frais par rapport aux thtres construits comme celui de Bulla Resta,
dont les gradins sont supports par une srie de votes tages
concentriques.
Le thtre de Carthage fut aussi amnag dans la pente d' une
colline. Il serait peu prs acquis aujourd' hui que le monument ne
fut construit que sous le rgne d' Antonin le Pieux, dans le cadre du
grand projet dilitaire dont bnficia alors la grande capitale africai-
ne. Le thtre se serait alors ajout l'ensemble monumental, sur les
hauts de Byrsa, et au gigantesque complexe thermal des thermes
d' Antonin ; et c'est dans les annes 160-170 qu'Apule, le plus
clbre des crivains africains, y pronona la plupart des discours
d' apparat qui forment les Florides dont un passage est consacr la
description de ce magnifique difice : Du reste dans un auditoire
comme celui-ci, ce qu 'ilfaut considrer ce n 'estpas le marbre des pavements, l'ar-
chitecture du proscaeniurn, la colonnade de la scne, ce ne sont pas les combles
surlevs, les caissons aux brillantes couleurs, les gradins en demi-cercle ; ce n'est
pas davantage le fait qu' d'autresjours on voit cette place un mimejouer des
rles burlesques, un comdien dialoguer, un tragdien dclamer, un danseur de
corde risquer sa vie, un escamoteur excuter des tours de passe-passe, un histrion
gesticuler, bref tous les genres d'acteurs se produire en public, chacun selon son
art, (Florides, XVIII).
L'amphithtre
Mais de tous les monuments romains exhums en Tunisie le
plus clbre est sans doute le grand amphithtre d' El Jem, l'antique
Thysdrus. Dans le classement par ordre de grandeur des amphi-
thtres romains connus, il se classerait au troisime rang, avec celui
de Vrone, en Italie, et ne serait dpass que par le colise de Rome
et l' amphithtre de Capoue. Il reste cependant le plus grand parmi
POQUE ROMAINE
251
les amphithtres africains. Les dimensions globales de l'ellipse sont
de 148 x 122 m, tandis que l'arne mesure 64 mtres sur 39. Le
nombre de spectateurs que le monument pouvait recevoir semble
avoir t jusqu'ici exagr ; on le ramne actuellement 27 000 envi-
ron, contre 43 000 l'amphithtre flavien de Rome et 35 000
celui de la cit italienne de Capoue. Le monument s'levait jusqu'
36 mtres de hauteur avec trois sries superposes de soixante-
quatre arcades dcores latralement de demi-colonnes corin-
thiennes ou composites, et surmontes d' un mur de couronnement
orn de pilastres. Le sol de l'arne est creus de deux galeries en
croix, bordes de chambres votes destines aux combattants et
aux btes, qui surgissaient par des trappes. Comme il constitue,
chronologiquement, l'une des dernires ralisations du genre dans
l'Empire, l'amphithtre d'El Jem a pu bnficier des ultimes am-
liorations dans la construction de cette catgorie d'difices.
On avait propos, pour sa construction, le rgne de Gordien
III (238-244), qui s'tait montr fort gnreux l'gard des habi-
tants de Thysdrus. Mais depuis, la richesse de cette ville, qui fut le
grand centre conomique de l'huile, et disputa Hadrumetum le rang
de capitale rgionale du Sahel et de la Basse Steppe, a t ample-
ment dmontre. On estime donc gnralement qu'il fut difi au
dbut du III
e
s., avant 238, c'est--dire l'poque de la grande pros-
prit de Thysdrus, capitale de l'olivier.
La ville possdait d'ailleurs deux autres amphithtres plus
anciens et plus petits. Le premier d'entre eux parat se rattacher
l're des balbutiements de ce type d'difices, et parat dater de
l'poque o Csar dbarqua en Afrique. Le second serait datable de
l'poque flavienne (69-96).
Seul l'amphithtre de Carthage, agrandi, sinon construit, au
cours des grands travaux dont la ville a fait l'objet au II
e
s., tait aussi
gigantesque que celui d' El Jem. Les dimensions de l'arne attei-
252
L'ANTIQUIT
gnaient 64, 66 m sur 36, 70 m. D' aprs les auteurs arabes, qui l'ont
dcrit alors qu'il tait encore intact, il comprenait environ cinquan-
te arcades qui constituaient l'ellipse du rez-de-chausse ; au-dessus,
s'levaient cinq ranges d'arcades superposes de mme forme et de
mmes dimensions, construites en pierres de taille. Mais, aujour-
d'hui, on n'en voit plus que l'arne, et les installations du sous-sol
ont t bouleverses par la construction d'une chapelle moderne
ddie aux saintes Perptue et Flicit, qui auraient d'ailleurs t
livres aux btes non pas dans cet difice, mais dans un deuxime
amphithtre, qui existait alors Carthage. Quant aux nombreux
amphithtres des autres cits, encore enfouis pour la plupart sous
les remblais, ils avaient des dimensions nettement plus modestes.
Les amphithtres ont t conus pour servir de cadre des
spectacles sanglants, qui opposaient des gladiateurs. Inconnus en
Grce, c'est l'trurie et la Campanie que les Romains les
empruntrent. L'engouement pour les spectacles de l'amphithtre
dpassait l'attrait exerc par les jeux scniques. Les milieux popu-
laires, comme les notables y prenaient un plaisir qui confinait la
passion. Aussi les sujets des mosaques reproduisent-ils souvent les
reprsentations donnes dans l'arne. Mais les combats de gladia-
teurs, couramment donns en Italie, taient beaucoup plus rares en
Afrique. C'est que le spectacle de ces affrontements meurtriers tait
d'orgine italienne, et ne trouvait sa justification que dans la religion
italique. En outre, il tait trs coteux de louer les services des gla-
diateurs, de faire appel leurs vedettes, pour combattre et s'entr-
gorger. Beaucoup plus frquemment que des combats de gladia-
teurs, les pavements africains figurent ainsi des spectacles de chasse
au cours desquelles des venatores affrontaient dans l'arne des fauves,
ou poursuivaient des antilopes et des autruches. Mais on en vint
rapidement prsenter au public des attractions odieuses : le sup-
plice des condamns de droit commun livrs aux btes.
POQUE R0MAINE
253
Le cirque
Plus prises encore que les reprsentations thtrales et les
jeux de l'amphithtre, les courses du cirque tenaient une grande
place dans la vie romaine. Toutes les classes de la socit, des plus
hautes aux plus basses, s'y intressaient avec enthousiasme. On a
mme pu dire que la passion des courses avait pris la place des pas-
sions politiques disparues.
Quatre curies se distinguaient par leur couleur, porte par les
cochers, les chars, les harnachements des chevaux : les Blancs, les
Verts, les Rouges et les Bleus. Les Blancs taient plus ou moins
associs aux Verts, tandis que les Rouges taient lis avec les Bleus.
C'taient des associations, qui se chargeaient d'organiser les courses
et les paris, d'engager un personnel nombreux et spcialis, en se
disputant les meilleurs cochers prix d'or. Des prix de valeur,
offerts par des gnrosits de toute origine, rcompensaient les
vainqueurs ; les cochers clbres finissaient par amasser des for-
tunes apprciables.
Le modle des cirques provinciaux fut videmment le anus
maximus de Rome. Cet difice affectait la forme d' un quadrilatre
allong, avec deux cts parallles de trs grandes dimensions, et
deux petits cts dont l' un avait la forme d' un demi-cercle. Les
grands cts taient garnis d' une srie de gradins qui se terminaient,
au-dessus de l'arne, par un podium, o des places taient rserves
aux personnages importants. L'arne tait divise en deux parties,
dans le sens de la longueur, par un mur ou mme une simple leve
de terre, la spina ; les chars devaient voluer tout autour. A chaque
bout se dressaient, sur un soubassement demi-cylindrique, trois
bornes hrisses de pyramides.
Les inscriptions, les mosaques et mme les intailles montrent
d' une faon loquente l' importance considrable que le cirque
tenait dans les proccupations quotidiennes des foules. Une intaille
conserve au muse de Carthage figure les quadriges lancs en plei-
254
L'ANTIQUIT
ne course sur la piste divise en son milieu par la spina ; celle-ci est
dcore de statues, d'oblisques, d'autels, d'dicules. Les cochers
devaient, chaque tour de piste, accomplir des prouesses pour vi-
ter les bornes qui marquent l'extrmit de la spina : entreprise diffi-
cile et dangereuse car plus d' un char ne terminait pas les sept tours
rglementaires. Le moindre choc risquait, en effet, de provoquer le
naufragium fatal : trs fragile, l'essieu de la roue se brisait, le char ver-
sait, et la vie du cocher ne tenait qu' la rapidit de ses rflexes ; s'il
ne tranchait pas rapidement, avec le coutelas qu'il portait la cein-
ture, les liens de rnes attaches au milieu du corps, il tait tran par
ses chevaux lancs en pleine course, et rebondissait entre le muret
de la spina et les barrires extrieures de la piste.
Statue d'aurige vainqueur
Dcouverte Carthage, proximit du cirque
Expose au muse de Carthage
C'est le portrait en pied d'un conducteur de char de course comme
le prouve le fouet qu'il tenait de la main gauche.
L'athlte est vtu d'une tunique courte, la taille entoure d'une large ceinture
destine protger l'abdomen en cas de chute du quadrige
(char tir par quatre chevaux).
Le jeu consiste parcourir une longue arne entourant la spina
centrale avec des concurrents devant un public assis sur les gradins du cirque
souvent enflamms par les rivalits et les paris des supporters.
Quatre grandes factions se partagent les quipes de cochers et de leurs
curies ; les bleus, les verts, les rouges et les blancs. Les vainqueurs
taient de vritables vedettes. Ces jeux taient trs populaires
et taient souvent reproduits sur les mosaques.
CHAPITRE VII
La parure architecturale des cits
et l'architecture domestique et funraire
Les archologues ont exhum aussi les ruines de plusieurs
monuments secondaires - arcs, colonnes, fontaines - destins essen-
tiellement l'ornementation des villes. Les arcs sont souvent dres-
ss sur les voies principales, l'entre de la ville qui, sous le Haut
Empire, n'prouvait pas encore la ncessit de s'enfermer dans des
remparts. On en voit aussi l'entre des places publiques et surtout
du forum. Ce sont alors de vritables portes monumentales, mais qui
ont aussi une valeur religieuse car elles appartiennent un dieu ;
celui-ci protge ainsi l'accs contre toute ingrence nfaste. Il s'agit
aussi, parfois, d'arcs de triomphe levs en l' honneur de l'empereur
et dont le dcor sculpt clbre une victoire impriale. D' autres fois,
l'arc est destin commmorer l'octroi de quelque privilge la
communaut.
On a retrouv aussi des colonnes ddicaces, dont le ft tait
orn d'un dcor sculpt, qui servaient souvent de support des sta-
tues divines.
Quant aux fontaines publiques, leurs dimensions comme leur
forme taient variables. Les plus simples comprenaient un bassin
rectangulaire qui recueillait l'eau crache par un masque ou une sta-
tue reprsentant un dieu, une nymphe, un enfant, voire un animal.
258
L'ANTIQUIT
D' autres fontaines, plus monumentales, prenaient les proportions
de vritables nymphes. Comme celui de Lepcis Magna qui affecte la
forme d' une grande abside richement dcore de colonnades et de
statues ; l'eau jaillissait de niches alternativement carres et arron-
dies, dcores de mosaques et revtues de marbre.
Les maisons
Si les monuments publics taient les difices les plus solide-
ment construits et partant les mieux conservs, les archologues ont
cependant exhum un grand nombre de grandes et robustes mai-
sons antiques. La plupart taient richement dcores, et apparte-
naient la bourgeoisie municipale.
La maison romano-africaine d' poque impriale n'est pas sans
prsenter des ressemblances frappantes avec la maison arabe, le dar.
Elle est caractrise par la prsence constante d' une cour ou plutt
d' un jardin central, autour duquel sont disposs les btiments, et sur
lequel ouvrent les diverses pices. On retrouve tout aussi constam-
ment la pice principale, destine aux rceptions, qui portait le nom
d'oecus ; elle fait gnralement face une fontaine, dcore et pave
de mosaque, qui orne et rafrachit le portique qui entoure la cour.
Cette ordonnance des btiments autour d' une cour intrieure
est ne, semble-t-il, l' poque hellnistique. Elle s'est rpandue, ds
le III
e
s. av. J. C., dans tout le bassin mditerranen. En Italie, on
avait vite abouti une combinaison originale entre ce type de mai-
son et le vieil atrium romain ; c'est le cas de la maison classique de
type pompien. Mais en Afrique, la maison cour intrieure avait
t importe ds l' poque carthaginoise : en effet, ds le IV
e
s. av.
J.-C., les influences hellniques n' avaient pas tard marquer de
leur sceau la civilisation punique, et nous savons maintenant, grce
aux fouilles de la ville punique de Kerkouane, que la cour intrieu-
re, avec ou sans pristyle, avait t adopte par les Carthaginois. Elle
Pristyle de l'tage souterrain
d'une maison Bul a Regia
La demeure, de type traditionnel,
s'organise autour de la cour
centrale entoure de portiques sur
les quatre cts, permettant la
distribution des pices.
La particularit de certaines
maisons Bulla Regia, dont celle-ci,
est d'avoir un tage souterrain.
L'clairage vient de la cour
centrale. La construction enterre a
permis une bonne conservation du
niveau souterrain qui se prsente
intact avec son plafond en vote, ses
murs et ses colonnes et son sol
mosaqu. Cette demeure est l'une
des plus clbres par la
qualit du dcor de ses mosaques,
en particulier celui de la pice
centrale. Il s'agit d'un triclinium : il
comprend une composition
gomtrique polychrome qui
enserre sur trois cts un tapis
central orn d'un
magnifique triomphe de Vnus
marine.
Plan de la maison de
Bulla Regia
Niveau souterrain
Le sous-sol est situ 4,80 m
de profondeur par rapport au
niveau du sol. Trois pices,
claires l'arrire par un
couloir, s'ouvrent
sur un vestibule. La pice
centrale qui donne sur le
vestibule par trois baies est
un triclinium, c'est--dire une
salle manger d'apparat.
Elle est pave de mosaques,
dont celle du triomphe de
Vnus. La construction
d'tages souterrains est
exceptionnelle.
l
260
L'ANTIQUIT
devait persister jusqu' la fin de l'Antiquit et au-del, jusqu' nos
jours.
Tout en subissant cependant des influences extrieures, la
maison romano-africaine s'tait rapidement adapte aux conditions
climatiques locales. Elle prsenta ainsi, trs tt, un certain nombre
de particularits, qui ont fait son originalit par rapport au modle
hellnistique, et sont presque toutes destines combattre la cha-
leur. L'amnagement d'un espace dcouvert, cern par les galeries
paves de mosaques et encadr par les marbres de la colonnade,
tait de rgle. Les moins riches se contentaient, toutefois, d'une
cour en terre battue, o se ctoyaient les margelles d'un puits et
d'une citerne. Plus rarement, la cour tait pave de mosaque ; mais
le parti le plus frquent, dans les riches demeures, tait une associa-
tion d'lments vgtaux et aquatiques, dans des combinaisons
diverses de jardins agrments de fontaines, ou de piscines accos-
tes de plantes.
Dougga, la maison du trifolium comprenait deux tages. Au
niveau de la rue suprieure - la ville, en effet, tageait ses difices sur
la pente de la colline - le premier tage devait rassembler surtout la
cuisine et les communs. Quant au rez-de-chausse, qui ouvrait sur
la rue infrieure, il groupait des pices fraches et agrables en t,
disposes autour d' une grande cour. Celle-ci tait particulirement
protge contre la canicule par sa situation plus de 5 mtres en
contrebas de la rue suprieure et par le grand bassin semi-circulaire
qui faisait face Yoecus.
Le souci de protger l'intrieur des maisons contre la chaleur
a mme entran l'adoption d'une architecture trs particulire ;
Bulla Regia les demeures superposaient deux tages de plan iden-
tique : un tage infrieur souterrain, obscur et frais, qui favorisait la
recherche d' une temprature plus clmente, et un tage suprieur au
niveau de la rue. Cette solution ingnieuse aux dsagrments de la
canicule n'est pas sans rappeler les demeures collectives, creuses
dans le sol, des berbres troglodytes des Matmata. Dans la lumire
POQUE ROMAINE
261
violente et la chaleur suffocante de l't, dans la rgion de Jendouba,
la fracheur et la pnombre de ces tages souterrains devaient tre
recherches et taient particulirement reposantes.
Les monuments funraires
La forme des spultures obit, principalement, des traditions
ancestrales et des rites funraires, qui se rattachent aux croyances
religieuses relatives la mort et la vie d' outre-tombe. C'est ainsi
que les traditions libyennes et carthaginoises se sont perptues
l' poque romaine, surtout dans les campagnes et dans les vieilles
cits numides qui avaient t fortement marques par l'empreinte
punique.
Les coutumes romaines ne tardrent pas tre adoptes leur
tour ; partir du I
er
s., les villes se doublrent d' une cit des morts.
La plupart des spultures taient signales, au cours des deux pre-
miers sicles de l're chrtienne, par des cippes ou par des stles. Les
premiers imitaient les autels funraires et taient souvent munis,
comme eux, d' un tuyau de libation reli l' urne qui conservait les
cendres du mort. Ce tuyau tait destin l' acheminement des
liquides qui devaient tancher la soif du dfunt. Les cippes avaient
parfois une forme rectangulaire ou polygonale ; mais la plupart
taient demi-cylindriques et portaient un dcor de feuillage, de
fleurs et de fruits. Ces ornements taient en relation avec une vieille
croyance qui accordait aux morts soit le pouvoir d' entretenir dans le
tombeau une vie diminue, soit celui de ressusciter grce la puis-
sance vitale enferme dans les vgtaux. Les guirlandes et les rin-
ceaux sculpts n' taient d'ailleurs que l'image d' offrandes vg-
tales relles accomplies, not amment , l' occasion de la fte des
Rosalies.
Les stles funraires, qui remplaaient souvent les cippes,
taient ornes du portrait du dfunt et taient destines conserver
2 6 2
L'ANTIQUIT
sa mmoire ; mais ces bas-reliefs taient gnralement dans la tradi-
tion de l'art prromain et c'est seulement dans le courant du II
e
s.
que l'usage romain substitua le portrait raliste aux images stylises
l'extrme de l'art punico-numide. La plupart des stles funraires
africaines ne portent cependant qu'une pitaphe succincte, prci-
sant le nom et l'ge du dfunt. Mais innombrables taient aussi les
spultures qu'aucune stle ne signale l'attention.
Vers la fin du III
e
s., l'inhumation des morts rapparat et rem-
place l'incinration largement rpandue au cours des sicles prc-
dents ; les urnes surmontes de cippes ou de stles laissent alors la
place aux sarcophages. Ces cercueils de marbre taient imports
d'ateliers situs en Asie Mineure, en Grce ou en Italie ; c'est pour-
quoi seuls les plus riches pouvaient en acqurir. Beaucoup se
contentaient de sarcophages de pierre et la grande majorit utilisait
soit la tombe caisson, soit la tombe ciste. Des dalles ou des tuiles,
places de champ, taient accoles de telle sorte qu'elles formaient
une caisse recouverte de tuiles poses plat ou en dos d'ne. Un
autre genre de spulture se rencontre aussi assez frquemment : la
jarre ou les fragments de jarre qui enveloppent le corps ; une super-
structure construite constituait, gnralement, la partie apparente
de la tombe. Quant aux sarcophages de marbre, ils avaient un style
et un dcor qui ont vari avec la mode et les poques, et dont la
signification se rapportait soit des croyances philosophiques ou
religieuses, soit plus simplement la vie terrestre du dfunt.
Cependant, ds l'poque punique et jusqu' l'abandon de l'in-
cinration, les familles les plus riches difiaient, pour perptuer la
mmoire de leurs morts, des spultures monumentales dont la
forme prsentait toutes sortes de variantes ; celles qui remontent
l'poque romaine et longent souvent les voies principales, l'entre
des villes, semblent inspires des mausoles monumentaux que
l'aristocratie carthaginoise avait transmis aux rois numides. C'est au
III
e
s. avant J.-C. que cette forme architecturale - une tour plan
Mausole de Kasserine
De type traditionnel, trois niveaux, s'levant encore 14 m,
ce mausole est clbre
par les deux longs pomes gravs sur la faade et servant d'pitaphe
F. FLAVIUS SECUNDUS. Ils retracent la carrire d'un ancien soldat devenu
citoyen romain, ayant cr un domaine agricole et aspirant l'immortalit
par l'lvation de ce tombeau spectaculaire lui permettant d'tre sauv de l'oubli.
Le monument qui se dresse dans la ville de Kasserine dont il est le symbole,
est datable du rgne de Marc Aurle.
264
L'ANTIQUIT
carr termine par une pyramide - avait t emprunte par Carthage
la Phnicie : on pense en effet que les mausoles puniques appar-
tiennent un type de monuments qui fut cr par les architectes de
l'Orient hellnistique et connut depuis une aire de diffusion qui a
englob tout le bassin mditerranen. Le prototype, qui devait don-
ner son nom toute la catgorie architecturale, tait le tombeau du
prince carien Mausole, bti au dbut du IV
e
s. avant J.-C.
C'est ce type d'difice funraire qui a donc survcu jusqu'
l'poque romaine. Comme l'aire de diffusion de ces monuments
n'englobe chronologiquement la Mditerrane occidentale que sous
l'Empire romain, rserve faite de certains monuments de Sicile et
d'Italie, on constate que seuls les mausoles puniques sont ant-
rieurs, dans cette rgion, l're chrtienne. On peut donc se deman-
der si les mausoles puniques de Tunisie, qui sont antrieurs aux
tours funraires d'Occident, n' ont pas constitu l'une des sources de
l'architecture funraire romaine.
CHAPITRE VIII
L'panouissement de la civilisation
romano-africaine.
Le dveloppement culturel
L'enseignement
Si le problme de la survie du punique ne soulve plus de
controverses, il n' en demeure pas moins que la seule langue admise
par l'tat romain tait la sienne, impose aux provinciaux, notam-
ment, dans toutes leurs relations officielles. Il ne fait pas de doute,
cependant, que dans les rgions occidentales, surtout, et notam-
ment dans la rgion de Mactaris, les Africains continurent utiliser
entre eux une langue compose d'lments libyques et puniques
mls avec des termes techniques latins, tandis que, dans les villes,
des noyaux de lettrs fidles la tradition phnicienne pratiquaient
peut tre toujours la lingua punica. Toutefois, la date des dernires
inscriptions puniques, dont la langue est encore correcte, n'est gure
plus rcente que la fin du I
er
s. ap. J.-C.
La diffusion du latin est due surtout l'enseignement. En
dehors de toute intervention de l' tat, c'est grce au zle des ins-
tances municipales ou de quelques riches citoyens que dans les plus
petites bourgades le litterator apprenait aux coliers lire, crire et
266
L'ANTIQUIT
compter. Mais les mthodes, voques avec amertume par saint
Augustin, taient des plus brutales. C'est aussi grce ces modestes
instituteurs africains qu'est due, semble-t-il, une invention trs
importante : celle d' une graphie, appele minuscule primitive , qui
est l'origine de l'criture manuscrite actuelle.
Sans quitter, en gnral, sa cit natale, l'enfant poursuivait ses
tudes chez le grammairien ; tout en enseignant les rgles gramma-
ticales, celui-ci faisait expliquer et apprendre les textes classiques,
surtout les plus archaques, et aussi Cicron, Ennius et Virgile, dont
les vers se glissaient souvent au milieu des pitaphes versifies, dont
l'pigraphie nous a conserv plusieurs exemples.
Il inculquait aussi ses lves des notions de mathmatiques,
d'astronomie, de philosophie, de musique et de mtrique. Certains
grammairiens connurent la clbrit : Nonius Marcellus, de Thubursicu
Numdarum (Khamissa, en Algrie), rdigea un lexique ; Terentius et
Juba, qui enseignrent en Maurtanie, laissrent des ouvrages de
mtrique, qui firent autorit au Moyen ge.
Le cycle suprieur de l'enseignement tait assur, dans les
grandes villes, par le rhteur. Celui-ci dveloppait surtout chez l'tu-
diant la technique de l'loquence, si prise et indispensable dans la
vie publique. Mais les rhteurs rputs devaient briller dans tous les
domaines ; leur rudition englobait aussi bien le droit, la littrature
et la philosophie, que l'histoire et les sciences. Seules les cits les
plus riches arrivaient se doter de ces lumires. Et notamment
Carthage, capitale intellectuelle o l'enthousiasme d'Apule ne
voyait dans la cit entire, que des hommes cultivs, et o tous (taient) ver-
ss dans toutes les sciences : enfants pour s'en instruire, jeunes gens pour s'en
parer, vieillards pour les enseigner. Carthage, cole vnrable de notre province,
Carthage muse cleste de l'Afrique, Carthage enfin Camne (,nymphe inspira-
tricej du peuple qui porte la toge . (Florides, XX).
En sus des bibliothques, prsentes parfois dans les thermes,
ces grandes cits offraient aussi aux fils de la bourgeoisie municipa-
Statue d'initi
Marbre ; H. 2,02 m ; Borj El Amri.
Muse du Bardo.
tonnante statue reprsentant un
homme hros en Hercule.
Alors que le corps est priv de tout
relief, anim seulement par les
incisions dessinant les plis de
la courte tunique, le visage est
sculpt avec le souci d'exprimer non
seulement la ressemblance du
modle mais aussi ses proccupations
spirituelles : front creus de rides,
lvres serres.
Cette expression svre est souligne
par certains symboles : le mufle
de la peau de lion qui enveloppe la
tte, les pis et le pavot qu 'il
tient et, ses pieds, la prsence
du chien Cerbre, gardien du
royaume infernal de Pluton-Hads.
C'est videmment la reprsentation
d'un initi aux mystres agraires de
Dmter et Cor. Assimil Hercule,
il s'apprte franchir le seuil de la
mort. Cette statue est un chef-d'uvre
de la sculpture. Elle se rattache
un courant expressionniste
refltant la tristesse des temps
que l'on retrouve dans certains
portraits d'empereurs de cette
poque. Elle est date la
deuxime moiti du III
e
sicle.
2 6 8
L'ANTIQUIT
le de riches bibliothques publiques. Les tudiants, qui les frquen-
taient, venus de toutes les cits de la province, taient fort nom-
breux Carthage. Mais il n'est gure tonnant de voir ces jeunes
gens, chapps la vie paisible de leur petite ville, frquenter avec
plus d'assiduit encore le thtre, l' amphithtre et le cirque, ou
mme plonger dans la dbauche. Non sans exagration, sans doute,
non exempte de svrit rigoriste, saint Augustin, vieillissant et
usant du calembour, qualifie mme Carthago de sartago, la chaudi-
re des amours honteuses .
L'humanisme
A Carthage, parvenue au rang des grands centres culturels
d' Orient, la tradition humaniste revivait, grce de grands matres
qui inculquaient leurs compatriotes le got du noplatonisme et
du mysticisme. Cet enseignement renouait d'ailleurs avec de vieilles
tendances qui remontent l' poque punique et que les stles dites
de la Ghorfa, dans la rgion de Mactar, illustrent d' une faon remar-
quable. Dates du dbut du II
e
s., elles figurent un cosmos domin
par une divinit suprme et par les astres, et communiquant avec le
monde terrestre par l'intermdiaire de divinits secondaires.
Plusieurs pavements de mosaques voquent aussi la thorie plato-
nicienne, ainsi que certaines spculations philosophiques, exprimes
de faon plus ou moins explicite.
Parmi les matres africains tablis Rome les plus illustres
taient Cornutus, rhteur et philosophe stocien, qui devint chef
d'cole au temps de Claude et de Nron, F/orus auquel Domitien
refusa injustement le prix de posie aux Jeux Capitolins, mais qui
crivit plus tard une histoire des guerres de Rome qui en fit le pan-
gyriste de l' Empire, Fronton, le prcepteur de Marc Aurle et L.
Verus, qui fut au II
e
s. l'Africain le plus en vue, Salvius Julianus, le plus
minent des juristes de l'poque. Mais l'crivain qui marqua nette-
Stle Saturne date
du 8 novembre 323
Trouve El Ayada, prs de Bja en 1965.
En calcaire. Mesurant 1,15 x 0,50 x 0,14 m
Bien conserve.
Cette stle provient sans doute d'un
temple. Dans le registre suprieur,
Saturne est reprsent trnant. Il tient
la harp et de la main gauche,
un sceptre. A sa droite, figure la tte
radie du Soleil. Le registre du milieu
montre une scne de sacrifice :
un victimciire et un blier devant l'autel
embras. Enfin vient l'inscription.
Le texte grav rappelle le sacrifice
fait par un prtre en l'honneur de
Saturne le 8 novembre 323. Cette stle,
qui est dans la tradition des uvres
populaires, est remarquable par le soin
apport au dcor. Par sa date, elle
confirme la persistance du culte
de Saturne dans les campagnes. Saturne est
l'hritier du dieu punique Bal Hammon.
Stle Saturne
Trouve aux environs de Siliana en 1943
1,55 x 0,61 x 0,15 m. Conserve au muse de Bardo
La stle reprsente la commmoration de l'excution
d'un vu fait par un propritaire terrien en l'honneur du
grand dieu Saturne : la crmonie est rapporte par des
images sculptes suivant la tradition artistique de
l'poque : en registres superposs, suivant le mode axial
et frontal. Le sommet est consacr la divinit suprme.
Un aigle aux ailes ployes au-dessus d'une banderole
reproduisant la conscration : SATURNO AUG(usto)
SACRUM accompagne de la prire BONIS BENI :
Bonheur aux gens de bien. Saturne est assis en majest
sur un taureau entour des Dioscures. Sous cette image,
Vinscription : P(atronus) N(oster) CUTTINUS VOT(um)
SOL(vit) CUM SUIS Le patron du domaine, CUTTI-
NUS, s'est acquitt cle son vu avec les siens . Les trois
registres sculpts la suite constituent l'illustration de
cette crmonie.
1- CUTTINUS offre un sacrifice
2- Scnes de la vie rurale : scne
de labour et scne de moisson
3- Scne de transport de la rcolte.
Ainsi le dur travail des champs est rcompens par une
rcolte abondante qui rentre triomphalement la ferme.
Tout cela sous la bndiction de Saturne. Ce document
est dat de la fin du III
e
- dbut du IV' sicle aprs J.-C.
270
L'ANTIQUIT
ment l'cole de Carthage fut incontestablement Apule. N vers 125
Madaure (M'daourouch, actuellement en Algrie orientale), il
appartenait la bourgeoisie municipale ; grce la fortune consid-
rable de son pre dont il recueillit en hritage un million de ses-
terces, il acheva Carthage des tudes commences dans sa ville
natale, et put complter sa culture par de nombreux voyages, tout
particulirement en Grce o il frquenta, Athnes, les cours des
sophistes renomms. C'est l qu'il reut les enseignements des
cercles platoniciens, acquit le got des sciences, et se fit initier la
plupart des religions mystres.
Lors d' un sjour Oea (Tripoli), il fut accus d'avoir ensorce-
l une riche veuve qu'il avait russi pouser. C'est cette occasion
qu'il pronona une brillante plaidoirie, dont nous avons conserv,
sous le titre d'Apologie, la version littraire.
De retour Carthage, ses confrences attiraient une foule qui
remplissait la cavea du thtre o il pronona la plupart de ses
Florides. Son activit inlassable lui permettait de se vanter, avec sa
suffisance coutumire, d'exceller dans les sujets les plus varis, de
composer des pomes dans tous les genres, aussi appropris la baguette
pique qu' la lyre, au brodequin ou au cothurne. En outre, satires et nigmes,
histoires varies, discours lous des orateurs, dialogues gots des philosophes, que
sais-je encore? Je fais de tout, en grec comme en latin, avec un mme espoir, un
%/e gal, un style semblable (Florides, IX, 27, 28, 29).
Mais le talent littraire d
!
'Apule s'panouit surtout dans ses
Mtamorphoses, o, tout en contant les aventures innombrables d'un
certain Fucius mtamorphos en ne, il entremle sans arrt, dans la
narration, pisodes secondaires et digressions. Si son got pour la
magie, l'irrationnel et le fantastique, le mysticisme exalt, les spcu-
lations compliques et l'hermtisme, est parfois excessif, par contre,
sa profonde intelligence des phnomnes sociaux, son sens du pit-
toresque et sa tendance observer avec curiosit et dcrire avec pr-
cision la ralit des individus et des choses, enchantent le lecteur et
POQUE ROMAINE
2 7 1
rendent les plus grands services l'historien. Pour juger des dons
d'observation et de la sensibilit d'Apule, comme de son got esth-
tique, voici un passage souvent cit des Mtamorphoses (II, IV) :
atrium tait magnifique. A chacun de ses quatre angles s'levait une
colonne qui supportait une statue de la Victoire. La desse, les ailes ployes,
n 'tait pas en marche : effleurant de lafrache plante de ses pieds l'instable point
d'appui d'une boule mobile, elle s'y posait sans s'y fixer et semblait prendre son
vol. Un bloc de marbre de Paros, figurant une Diane, occupait le milieu de la
salle, qu'il partageait symtriquement. Chef-d'uvre sans dfaut, la desse,
tunique au vent, semblait, dans sa course agile, se porter au-devant des entrants
et, par sa majest, inspirait la vnration. Elle tait flanque droite et gauche
de chiens, eux aussi de pierre ; ils avaient les yeux menaants, les oreilles dres-
ses, les naseaux bants, la gueule prte mordre : si, dans le voisinage, avait
retenti un aboiement, on l'aurait cru sorti de ces gosiers de marbre. Mais o le
merveilleux sculpteur s'tait surpass lui-mme : ces chiens, le poitrail haut,
avaient les membres postrieurs au repos, les pattes de devant dans l'attitude de
la course. Derrire la desse s'levait un rocher creus en forme de grotte, avec
des mousses, des herbes, des feuilles, des branches flexibles, ici des pampres, l
des arbustes - toute une floraison sortie de la pierre. L'ombre de la statue, dans
l'intrieur de la grotte, s'clairait des reflets du marbre. Sous la corniche du
rocher pendaient des fruits et des grappes de raisin d'un travail si achev que
l'art, rival de la nature, avait su leur donner l'apparence de la ralit. On et
dit qu'au temps des vendanges, quand le souffle de l'automne les aurait dors et
mris, on en pourrait cueillir pour en manger, et quand on se penchait pour
regarder la source qui rpandait aux pieds de la desse son onde au doux fr-
missement, on avait l'illusion que, telles des grappes se balanant dans la natu-
re, des attributs de la vrit il ne leur manquait pat mme le mouvements Du
milieu du feuillage, un Acton de pierre avanait la tte en posant sur la desse
un regard curieux ; dj presque chang en bte sous la forme d'un cerf, on le
voyait la fois dans la pierre du rocher et l'eau de la fontaine, qui guettait le
bain de Diane .
272
L'ANTIQUIT
Les arts dans la province
La sculpture
Aprs la chute de Carthage, les traditions de l'art prromain
persistrent, dans le domaine de la sculpture, jusqu' la fin du I
er
s.
La stle punique, notamment, se maintint dans les sanctuaires de
plusieurs villes et surtout dans celui d' El Hofra, prs de
Constantine. Mais elle connut une dgnrescence plus ou moins
rapide, qui se manifesta par la rupture complte de l' ordonnance du
dcor. En mme temps, les premires influences de l'art religieux de
Rome apparurent dans des stles qui taient pourtant consacres
dans un tophet, Hadrumte. Cet art, qu' on pourrait qualifier de
nopunique, nous a laiss quelques ex-votos apprciables, comme la
Tanit tte de lion et la desse nourricire de Thinissut, prs de Bir
Bou Regba.
On dcle aussi la naissance, aux environs de l're chrtienne,
d' un courant populaire considr comme la premire manifestation
artistique originale du gnie autochtone. La sculpture puissante de
deux lions trouvs Mactar en est le plus bel exemple. Cet art numi-
de arrive son apoge au II
e
s. ap. J.-C., avec les grandes stles
votives dites de la Ghorfa. Ces monuments, qui proviennent aussi
de la rgion de Mactar, et auxquels nous avons dj fait allusion,
allient la tradition religieuse punique aux enseignements du spiri-
tualisme grec. Elles se diffrencient des stles puniques par l'an-
thropomorphisme des divinits et le naturalisme fantaisiste du
dcor, qui figure des animaux et des vgtaux ; caractres qui s'op-
posent l'abstraction et la scheresse du dcor punique, et dno-
tent les premires influences de l'art grco-romain. Celles-ci se
manifestent aussi dans le dcor architectural des temples, qui figu-
rent en bonne place sur ces stles, dans le costume des ddicants, et
dans la langue des inscriptions rdiges en latin. Mais la conception
Statue de CREPEREIA
Marbre blanc, Hadra
H. 1,82 m -Muse du Bardo.
Portrait en pied d'une
dame de la bourgeoisie
municipale. L'inscription
grave sur
le socle qui portait la
statue rvle son nom :
CREPEREIA INNULA, et
dcline ses vertus. C'est l'hom-
mage rendu par TITUS
ARRANIUS COMMODUS
citoyen de la ville d'Ammaedara
son pouse, reprsente en
jeune femme, debout et drape
dans une attitude empreinte de
dignit et de tristesse.
II" s. ap. J.-C.
274
L'ANTIQUIT
mystique de l'univers s'loigne de ces influences : rien ne distingue
le rel du surnaturel, et le fronton des temples, surmont de statues
acrotres, constitue en mme temps la zone infrieure du monde
cleste, domaine des dieux. L'emploi, par ailleurs, du relief plat, l'ab-
sence totale de perspective, l'indiffrence absolue aux proportions,
le souci exagr du dtail comme la fidlit la symtrie et la fron-
talit, loignent aussi ces oeuvres des tendances classiques.
Jusqu' la fin de l'Antiquit, les influences prromaines se
maintiennent galement dans le style des stles votives artisanales,
fabriques en srie pour l'usage des fidles campagnards, et caract-
rises surtout par un traitement rudimentaire, l'emploi simultan du
relief plat et de la gravure, l'abstraction et la schmatisation. Mais
ds le milieu du II
e
s., la facture des innombrables monuments votifs
du pays numide ddis Bal-Saturne acquiert, si l'on excepte ce
courant populaire, un caractre romain provincial. Les proportions
des reprsentations humaines et des figures dcoratives sont res-
pectes, l'architecture des temples reprsents et leur dcor se
romanisent, la demi-bosse remplace le relief plat. Malgr tout, un
certain nombre de caractres anciens subsistent : frontalit, sym-
trie, accentuation du regard et, surtout, refus d'exprimer le mouve-
ment.
C'est dans les villes, cependant, que la bourgeoisie romanise
adopte au cours du II
e
s. l'art classique officiel, commun tout le
monde romain. Les sculptures du dcor architectural - dont cer-
taines sont fort remarquables, comme le chapiteau orn de quatre
figures de gants atlantes dcouvert Carthage aux thermes
d' Antonin -, les grandes statues divines destines aux temples, celles
des empereurs et des personnages importants, qui devaient se dres-
ser sur les forums ou dans les difices publics, ne se diffrencient
gure de leurs semblables, riges en Italie ou dans d'autres pro-
vinces. A l'instar des photographies qui s'affichent sur les murs, les
panneaux publicitaires et les journaux de nos villes, ces bustes et ces
POQUE ROMAINE
275
statues participent, en diffusant dans toutes les provinces l'image de
l' empereur et de la famille impriale, voire des personnages les plus
importants, l' affermissement de l'idologie et de la cohsion de
l' Empire, la consolidation du pouvoir imprial.
On distingue, cependant, ct de beaucoup de poncifs,
quelques beaux portraits de personnages officiels, et, surtout,
l' mouvant portrait de cet Hercule de Massicault, conserv au
Muse du Bardo, ainsi que deux bustes qui trahissent une inspira-
tion locale, ne serait-ce que par le sujet adopt : il s'agit des deux
Herms de calcaire noir, trouvs aux thermes d' Antonin. Ils repr-
sentent un Libyen et un noir, et symbolisent peut tre les territoires
qui s' tendent au sud de la province romaine. Le Libyen surtout,
avec son crne ras, orn d' une mche rituelle, constitue, dans l'art
romano-africain, le type le plus remarquable des hommes du pays.
Quant la statue-portrait funraire trouve Borj el Amri (ex-
Mas sicault), c'est avec un ralisme saisissant que l'artiste a sculpt le
front haut, le nez busqu, le regard svre sous les sourcils froncs,
la barbe rude et les rides amres d' un homme dsabus.
La mosaque
Dans les demeures fastueuses construites en dur des cits du
nord, comme dans les rgions o la pierre est rare et les murs des
maisons btis en briques crues sur une base de maonnerie, c'est la
mosaque qui permettait aux intrieurs africains d' tre somptueuse-
ment dcors. Les fouilles de Kerkouane, notamment, ont montr
que c'tait l une technique de tradition punique, pour orner aussi
bien les maisons que les difices publics. l' poque romaine, la
peinture paritale joua avec la mosaque un grand rle. Mais en
Tunisie, nous n'avons retrouv que quelques fragments de fresques
murales. La pauvret du dcor pictural est, cependant, trs large-
ment compense par le nombre et la richesse des mosaques, qui
276
L'ANTIQUIT
dcoraient les maisons, les thermes, les monuments publics, voire
les tombes.
Ds le IV
e
s. av. J.-C., les Carthaginois ornaient les sols de
bton rose de leurs maisons avec de petits cubes de marbre qui des-
sinaient un dcor gomtrique, une fleur de lotus ou un signe de
Tanit. Et c'est ds la fin du I
er
s. ap. J.-C., qu'apparat un art tout dif-
frent, un courant artistique dont la vitalit admirable se prolonge
jusqu'au Moyen ge, avec les dernires basiliques, puis les palais
arabes de l'poque fatimide.
Parmi les demeures les plus somptueuses, une villa de Zliten,
en Tripolitaine, a fourni une srie de mosaques, dont la qualit tech-
nique et stylistique rvle une perfection rarement atteinte par les
autres mosaques africaines. Outre les sols couverts 'opus sectile,
c'est--dire de plaques de marbre polychrome artistiquement
dcoupes et disposes, la maison a fourni aussi des mosaques
dcor gomtrique noir et blanc, et des pavements figurs poly-
chromes d'une grande finesse. Elles appartiennent un courant
entirement distinct de celui qui prvalait au I
L
' s. en Italie, o domi-
nait un style qui vitait autant que possible la polychromie et prf-
rait les motifs gomtriques. C'est qu'en effet, paralllement au
style svre de l'cole italienne, survivait dans quelques centres
orientaux la tendance picturale et ses nuances chromatiques, hri-
tes de la tradition hellnistique.
Les motifs reprsents cette poque taient d'abord
emprunts des sujets idylliques et mythologiques ; la plupart se
rfraient des prototypes orientaux : paysages du Nil et rpliques
de Yasartos oikos (restes d'un repas pars sur le sol) que Soos de
Pergame, un des plus clbres mosastes de l'poque hellnistique,
reprsenta avec une fidlit la nature considre comme exem-
plaire.
L'volution de ces ateliers pourrait tre suivie grce la
dcouverte d'une srie de pavements sur le site d'Acholla (Boutria),
40 km environ au nord de Sfax o le grand ensemble des thermes
Mosaque de Neptune et des Saisons, milieu du II
e
sicle
La Chebba ; 4,85 m x 4,90 m. - Muse du Bardo
Au centre, dans un mdaillon circulaire, le dieu de la mer, nimb et tenant un
poisson et un trident, monte un quadrige attel d'hippocampes que dirigent un
Triton et une Nride. Aux quatre angles du tableau, les Saisons, figures fminines
dont l'ge, le costume et les attributs varient suivant les divisions de l'anne
qu'elles reprsentent : Le Printemps, adolescente presque nue. L'Et, jeune fille,
toute nue. L'Automne, jeune femme drape. Enfin l'Hiver, en vieille femme
totalement recouverte d'une draperie.
C'est toute l'illustration du cycle agricole avec ses travaux et ses jours qui est
prsent dans cette mosaque qui pavait une grande salle colonnes dans une
maison situe en bord de mer la Chebba, sur la cte du Sahel.
278
L'ANTIQUIT
de Trajan, ralis entre 115 et 120, est d'une richesse et d'une vari-
t remarquables. Les pavements non figurs s'apparentent, par l'l-
gance svre de leurs motifs, au style gomtrique italien, mais sont,
tout comme les panneaux figurs, polychromes.
Sous le rgne d' Antonin le Pieux (138-160), une volution se
dessine o s'affirme le ralisme pictural : c'est de cette poque que
dateraient les pavements de la maison du triomphe de Neptune,
toujours zA.cholla. La scne principale, qui dcorait Yoecus, montre le
dieu conduisant son char, au milieu des flots dchans. La compo-
sition est fonde sur une trame gomtrique simple, et la muscula-
ture puissante de Neptune, mise en mouvement par le geste du bras
lev, est dtaille avec une prcision qui dnote une science anato-
mique relle. Autour du dieu, des mdaillons circulaires encadrent
les corps graciles de ses nymphes. Cette mosaque forme un grou-
pe homogne avec un autre triomphe de Neptune, dcouvert la
Chebba, et les pavements de la maison de la procession dionysiaque
d' El Jem. La matrise du mosaste est si extraordinaire qu'il arrive
galer le peintre pour rendre les dgrads de couleur, et suggrer la
vie intense du regard, par le simple assemblage de cubes de pierre
plus ou moins minuscules.
Vers la fin du II
e
s., des diffrences locales, qui se manifestent
dans le style et l'excution des mosaques africaines, indiquent l'ins-
tallation d'ateliers locaux, le long de la cte et dans les cits du nord
comme en Byzacne, l'intrieur du pays. En mme temps, l'imita-
tion de la peinture, qui caractrisait les uvres de l'poque prc-
dente, laisse la place un traitement plus libre des motifs.
L'observation directe se substitue de plus en plus au III
e
s. la tra-
dition d'atelier. Les diverses manifestations de la vie sociale roma-
no-africaine - comme la chasse, la pche, la navigation, les jeux du
cirque et de l'amphithtre, la vie domestique et les scnes agricoles
- sont reprsentes d' une faon trs vivante, rendue parfois encore
plus actuelle par les inscriptions qui commentent l'image. Il en est
de mme pour les thmes connotations culturelles, et ceux relatif
Statue colossale d'Esculape
Muse du Bardo
Elle provient de Bulla Regia ainsi que
tout un groupe de statues
reprsentant d'autres divinits
Le dieu est reconnaissable au
caduce.
Il se prsente de manire classique :
chevelure abondante et boucle,
barbe paisse, le corps drap
laissant le torse dcouvert.
Il s'agit d'un type grco-latin.
Grande statue de Saturne
Trouve dans le temple d'Apollon
Bulla Regia en 1906.
Expose au Muse de Bardo.
Statue en marbre blanc, haute de
1.92 m.
Elle reprsente Saturne en divinit
poliade, c'est--dire en protecteur
de la cit de Bulla Regia.
La tte barbue et voile, il tient une
corne d'abondance. C'est le
prototype du Saturne africain,
synthse du dieu grco-romain
et de Bal punique.
2 8 0
L'ANTIOUTT
la mer et aux eaux. Dans le style, l'exploitation trs pousse des
possibilits impressionnistes, offertes par les points de couleur de la
technique du mosaste, ne se soucie pas de dessiner avec prcision
les contours des figures ; elle esquisse plutt leurs silhouettes par
des tches colores et utilise habilement les jeux de lumire et les
effets de clair-obscur.
Pour le dcor non figur, on commence dessiner de savantes
combinaisons de fleurons et d'entrelacs ; les tresses ou les guir-
landes qui servaient d'abord seulement d'encadrement, prennent de
plus en plus d'importance ; elles enveloppent souvent des
mdaillons reprsentant des natures mortes et les motifs vgtaux
foisonnent, jusqu' envahir tout le champ. Cette tendance la sur-
charge ne tardera pas s'affirmer avec excs.
Dans la deuxime moiti du III
e
s., au cours de cette priode
trouble et inquite, les motifs ralistes et matriels sont fortement
concurrencs par des motifs d'inspiration mystique, symbolique et
irrationnelle. C'est ainsi que le rpertoire, qui s'appauvrit sans cesse,
a tendance se limiter des thmes inlassablement rpts : scnes
marines, chasses courre plus ou moins ralistes, qui illustrent
cependant les distractions des grands propritaires, et surtout srie
des triomphes dionysiaques et des thmes littraires consacrs gn-
ralement Apollon et aux Muses. D' autre part, les proccupations
superstitieuses, nes de la croyance populaire, la crainte des forces
malignes, et, surtout, du mauvais oeil, imposent des thmes pro-
phylactiques o se multiplient les motifs bnfiques pour dtourner
les malfices.
Bien qu'issue en droite ligne de la tradition grco-romaine,
aprs les premiers balbutiements de l'poque punique, la mosaque
africaine a donc russi conqurir une certaine indpendance et
acqurir une grande originalit. Elle les doit une nette extension
des sujets issus des formules traditionnelles, un largissement
considrable du rpertoire, un style propre et une polychromie
admirable.
CHAPITE IX
L'panouissement de la civilisation
romano-africaine.
Les religions romano-africaines
et les dbuts du christianisme
Cultes officiels, cultes africains et cultes orientaux
Partie intgrante de la civilisation romaine, les cultes officiels
de l' Empire furent rapidement adopts par les populations afri-
caines. En expliquant la concession du droit de cit l'ensemble des
hommes du monde romain, par le dsir de les faire participer au
culte des dieux de Rome, l'dit de 212 met intentionnellement l'ac-
cent sur l'unit morale des habitants de l' Empire et leur adhsion
unanime l'idologie et aux principes spirituels du rgime. En effet,
le loyalisme l'gard de Rome devait s'exprimer partout sous forme
religieuse, car les anciens ne sparaient jamais la religion de la poli-
tique. Si, du point de vue juridique, l' empereur n'est qu' un magistrat
exceptionnel, il est aussi pourvu d' une sorte de grce accorde par
les dieux, qui lui confre Yauctoritas et le place ainsi, du fait de ce
pouvoir absolu, au-dessus des lois. Ses vertus hroques - courage,
justice, clmence, et surtout pit - assurent le bonheur de ses sujets,
2 8 2
L'ANTIQUIT
et la victoire sur les Barbares ennemis de la communaut spirituelle
de l'Empire.
Les membres de la bourgeoisie municipale parvenus, dans leur
cit, l'apoge de leur carrire administrative, s'empressaient ainsi
de revtir la dignit de flamine perptuel, prtrise laquelle tait
dvolu le devoir et l'honneur d' offrir au couple imprial divinis les
prires et les vux de leurs concitoyens. De mme, l'assemble pro-
vinciale, compose des dputs de tous les conseils municipaux, qui
se runissait annuellement Carthage, lisait le flamine provincial,
grand prtre charg de clbrer au nom de toute la province le culte
officiel, celui de Rome et d'Auguste.
D' autre part, dans chaque cit, le culte de la triade capitoline,
Jupiter, Junon et Minerve, celui de Mars, pre et protecteur du
peuple romain, de Vnus, Crs, Apollon, Mercure, Hercule et
Bacchus constituaient aussi des formes officielles de la religion
d' Empire et du spiritualisme grco-romain.
Partout, temples, autels et statues clbraient ces divinits, glo-
rifiaient en mme temps des divinits abstraites comme la Paix, la
Concorde, la Fortune, le Gnie de l'Empire, celui du snat etc... La
population toute entire prenait part aux rjouissances populaires
qui accompagnaient les crmonies, les processions et les sacrifices
clbrs en l' honneur de ces cultes officiels.
Mais la domination romaine n'empcha nullement les autoch-
tones de manifester la plus grande fidlit leurs vieilles traditions.
Les ruraux continuaient honorer traditionnellement les gnies des
sources, des forts, des grottes et des montagnes, et ces vieux cultes
berbres avaient souvent conserv, dans d'humbles sanctuaires, leur
forme primitive. Ils furent aussi, parfois, remplacs par des divinits
grco-romaines. Les gnies des eaux fertilisantes ou salutiferes
virent ainsi leurs cultes recouverts par ceux de Neptune, de Serapis
ou d'Esculape, dont les forces sacres avaient pris la place de celles
des gnies bienfaisants.
POQUE ROMAINE
283
Beaucoup d'autres campagnards avaient cependant, depuis
longtemps, accd un stade suprieur de la croyance ; dans les
rgions de l'ancien royaume numide profondment pntres par
l'influence punique, ils taient rapidement parvenus au concept
d' une divinit personnelle, et s'taient constitus un vritable pan-
thon indigne. Plusieurs dcouvertes archologiques, notamment
un bas-relief trouv prs de Bj, nous ont conserv l'image et les
noms des divinits qui taient l'objet de la dvotion de ces popula-
tions demi-romanises ; elles continuaient encore adorer, sous
l'Empire, des divinits qui taient sans doute celles de leurs anctres
de l'poque numido-punique, quoique certaines aient commenc
tre plus ou moins assimiles des dieux grco-romains.
La domination romaine n'entrava donc nullement la pratique
et la diffusion des cultes libyques et puniques ; elle reconnut mme,
ds le dbut, Tanit et Bal Hammon la qualit de matres de
l'Afrique. Les syncrtismes, qui avaient assimil les divinits de
Carthage des quivalents grco-romains, facilitrent les choses.
On savait parfaitement que Junon-Caelestis, divinit principale de la
Carthage romaine, n'tait autre que Tanit, la desse protectrice de la
premire Carthage. De mme, Saturne tait identique au Bal
Hammon punique. Il tait rest le dieu terrible, omnipotent et trans-
cendant, clbr par des milliers de stles votives qui commmo-
raient le sacrifice molk , par lequel le ddicant tait cens s'offrir
lui-mme la divinit.
Sans doute de grandes transformations romanisrent-elles
dfinitivement la religion africaine : la langue punique disparut des
ex-voto, les symboles abstraits figurs sur les stles furent rempla-
cs par des figures humaines et par des types divins drivs en gn-
ral de l'art hellnique ou hellnistique, la forme extrieure des sanc-
tuaires se modifia peu peu sous l'influence de l'architecture grco-
romaine ; mais malgr ces transformations, le sens profond de la
religion ne fut gure atteint. On conserva mme parfois, en les am-
nageant, les anciens tophet, ou en construisant des temples l'archi-
284
L'ANTIQUIT
tecture grco-romaine en leur lieu et place ; tandis que le rituel, les
reprsentations figures des stles et mme le texte des ddicaces
latines gardaient avec une constance remarquable le souvenir de
l' poque punique.
Comme la Rome impriale accueillait de plus en plus large-
ment, par ailleurs, les divinits des rgions orientales - Egypte, Asie
Mineure, Syrie, Perse - celles-ci furent honores aussi en Afrique,
introduites par des fonctionnaires, des soldats, des marchands qui se
faisaient les missionnaires d'Isis, de Mithra ou de Cyble, la Grande
Mre des Dieux. Mais tout en se laissant gagner par le grand cou-
rant mystique qui a englob tout le monde romain, du II
e
au IV
e
s.,
la religion africaine a conserv son originalit : les dieux d' Orient ne
furent souvent accueillis en Afrique que dans la mesure o ils
s'identifiaient plus ou moins des divinits locales, comme Cyble
Caelestis ou Isis Dmter. D' autre part, et plutt que d' adhrer
d' emble aux religions de salut orientales, les lites africaines,
gagnes par ce retour au mysticisme, n'avaient qu' revenir aux
anciennes sectes grecques, naturalises Carthage ds le IV
e
s. avant
J.-C., et devenues ainsi nationales ; les thiases bachiques et dm-
triaques se multiplirent donc dans tout le pays. De mme, les doc-
trines spiritualistes, et surtout le noplatonisme, furent favorable-
ment accueillies. Nous avons vu qu' avec les stles dites de la
Gor f a , par exemple, elles furent, elles aussi, concilies avec les tra-
ditions puniques.
Ainsi, les divinits orientales ne sauvegardrent pratiquement
leur entit propre que parmi les fidles que leur fournissait la popu-
lation cosmopolite des ports, ou parmi les contingents orientaux,
dans les territoires militaires de la frontire saharienne.
Les dbuts du christianisme
Venu d' Orient, le christianisme se rpandit d' abord parmi les
petites communauts juives qui vivaient dans les ports, et plus par-
Sarcophage romain dit de l'enfant initi
Muse du Bardo
Ce sarcophage en marbre blanc a t trouv dans la rgion
de Carthage. La face de la cuve est
sculpte d'un bas-relief reprsentant au centre un jeune
garon dfunt tenant un volumen, symbole du savoir intellectuel.
Il est entour des gnies des quatre saisons voquant
les temps du bonheur du cycle de la vie.
(Fin du III' - dbut du IV
e
s. ap. J.-C.)
2 8 6
L'ANTIQUIT
ticulirement Carthage. Il ne tarda pas trouver en Afrique un ter-
rain favorable. En effet, la conception d' un Dieu transcendant et
exclusif, affirme en particulier par la religion de Bal Hammon-
Saturne, le grand dieu de l'Afrique romaine, prpara probablement,
selon certains, la voie au monothisme. Les stles de la Ghorfa, par
exemple, illustrent ces tendances monothistes influences par le
noplatonisme, mais qui remontent l'poque punique ; telle qu'el-
le est exprime par ces monuments, l'ide d' un dieu suprme, qui
agit sur le monde terrestre par l'intermdiaire d'hypostases, consti-
tuait peut-tre, pense-t-on, une vritable prparation aux dogmes du
christianisme.
Mais si la religion nouvelle fit des progrs trs rapides, son
triomphe ne fut pas soudain ; car plus d' un sicle spare l'poque
des premiers martyrs de celle o les derniers paens furent leur
tour en butte aux violences de l'glise et la rpression du pouvoir.
Entre temps, l'glise ne manqua pas de composer, sous l'empire de
la ncessit, avec les rites locaux et les habitudes ancestrales ; c'est
ainsi que jusqu'au VI
e
s. un bon nombre d'pitaphes avaient conser-
v le sigle D.M.S., qui marquait la conscration aux Dieux Mnes.
Toutefois, ds le dbut du III
e
s., un concile tenu Carthage grou-
pait soixante-dix vques qui reprsentaient les groupes chrtiens
rpartis dans autant de cits de Proconsulaire et de Numidie.
Les progrs du christianisme constituaient sans aucun doute
un grave danger pour l'Empire. Le systme politique romain tait
fond, comme nous l'avons vu, sur une idologie et une conception
du monde et des dieux qui tait fondamentalement oppose la
thologie chrtienne. Par leur refus d'accepter cette idologie, et de
s'associer notamment au culte imprial, les chrtiens se rangeaient
donc rsolument parmi les ennemis de l'Empire. Malgr son libra-
lisme et sa tolrance habituelle pour les cultes nouveaux, celui-ci ne
pouvait que manifester une intransigeance absolue l'gard de cette
secte qui menaait la cohsion et l'unit morale de l'Empire, voulait
POQUE ROMAINE
287
crer, dans toutes les provinces, des groupements de plus en plus
nombreux qui se voulaient hors des cadres du rgime et cultivaient
un idal diffrent.
Mais le gouvernement imprial ne croyait nullement aux dlits
abominables imputs publiquement aux chrtiens ; les rigueurs de la
rpression ne visaient d'ailleurs qu' provoquer l'apostasie qui met-
tait fin aux poursuites. Ds l'anne 180, le proconsul fit dcapiter
douze chrtiens de la ville numide de Scilli, tandis que l' anne 203
fut marque par le martyre des saintes Perptue et Flicit et de
leurs compagnons, qui furent livrs aux btes Carthage mme,
dans l'arne de l'amphithtre. Le rcit de leur passion, qui nous a
t conserv, compte parmi les documents les plus authentiques et
les plus mouvants de l'glise perscute. Mais les mesures de
rpression, qui taient d'ailleurs sporadiques et conjoncturelles, ne
pouvaient arrter, malgr leur horreur, le zle et l'ardeur des fidles
dont beaucoup recherchaient avidement le martyre.
Les apologistes chrtiens
Les premiers groupements chrtiens de Rome et de la partie
occidentale du monde romain, vangliss par les Orientaux,
avaient d' abord adopt la langue grecque ; mais le latin ne tarda pas
l' emporter et les livres sacrs furent traduits. Ds la fin du II
e
s., la
littrature latine chrtienne eut l' un de ses plus grands crivains,
l'apologiste Tertullien dont l'influence rayonna sur tout l' Occident.
Fils d' un officier romain, ce grand crivain chrtien d'expression
latine naquit Carthage, vers 155 ou 160, et y reut une formation
de rhteur. Il approfondit sa connaissance du grec et du latin et
acquit une rudition fort tendue. La philosophie, l'histoire et la lit-
trature lui taient aussi familires que les sciences naturelles et la
mdecine ; mais il s'appliqua surtout l'tude du droit, dont il vou-
lut peut-tre faire sa carrire. Il resta paen pendant la plus grande
288
L'ANTIQUIT
partie de sa jeunesse, et sa conversion fut soudaine. Sduit par
l'nergie des martyrs, conquis par le mystre, les dogmes et la mora-
le du christianisme, il se dressa rapidement en champion de la foi
nouvelle qu'il dfendit non seulement en aptre convaincu et
ardent, mais aussi en chrtien instruit qui avait une profonde
connaissance de la doctrine et des livres saints.
Dans son livre fondamental, Y Apologtique, il se proposait,
puisque les juges refusaient d'couter en public la dfense des chr-
tiens accuss, de dmontrer leur innocence par la rfutation des
calomnies paennes. Son but n'tait pas de faire cesser les pour-
suites, mais de faire connatre les chrtiens tels qu'ils taient, c'est-
-dire des hommes qui acceptaient de mourir hroquement pour
confesser leur foi, et non pour expier des crimes imaginaires.
Cependant, le plaidoyer tournait souvent au rquisitoire : Tertullien
protestait avec sa vhmente loquence contre la haine inique voue
au nom de chrtien. En proclamant l'innocence de ses coreligion-
naires, il demandait aux autorits de leur permettre d'adorer leur
Dieu, le seul vrai Dieu, comme on permettait tous les peuples
d'adorer leurs faux dieux ; et de fltrir alors sans retenue la mytho-
logie paenne. Mais il ne semble pas que Tertullien ait compris qu'il
ne s'agissait pas, pour l'tat romain, d'interdire une quelconque reli-
gion nouvelle, mais plutt de dfendre une conception de l'ordre
contre une secte dont la doctrine, des plus dangereuses, tait gn-
ratrice d'anarchie.
Tertullien s'attaqua ensuite, avec la mme loquence passion-
ne et dans le mme style brutal, vivant et imag, aux autres enne-
mis de l'glise : les Juifs et les sectes hrtiques. Devenu prtre, il se
consacra l'ducation des fidles ; ses sermons et ses traits de tout
genre discutaient prement des problmes de morale ou de discipli-
ne, fulminaient contre les abus, prnaient une rgle intransigeante.
Il abordait aussi les plus hauts sujets comme l'existence de Dieu, la
nature de l'me et le jugement dernier ; thologien subtil et form
aux disciplines philosophiques, il n'opposait pas la raison et la foi.
POQUE ROMAINE
289
Mais ses positions sentimentales et extrmistes ne tardrent pas le
mettre en marge de l'glise, oblige de s'adapter aux ncessits du
sicle. Sa nature fougueuse et passionne poussait tout l'extrme,
et n'admettait aucun mnagement, aucune compromission si bien
qu'il finit par tourner sa polmique acerbe et son esprit caustique
contre le christianisme lui-mme, ou du moins contre ses chefs aux-
quels il reprochait surtout une modration coupable. Il se spara
enfin de l'glise pour se rapprocher de l'hrsie pragmatique du
montanisme, soucieuse surtout d'idal moral et d'action, tout en
admettant les prdictions, les visions et les extases. Mais l'glise
triomphante lui garda une grande indulgence, sans doute en souve-
nir de son ardente sincrit, ainsi que des services rendus dans son
offensive contre le paganisme.
Trs diffrent de Tertullien, dont il n'avait ni la puissance ni la
fougueuse originalit, un autre crivain africain a une place part
dans la littrature chrtienne d'expression latine : c'est Minucius Flix
qui crivit un dialogue, l'Octavius o, dans le cadre d'un dbat plus
ou moins fictif, il montre aux prises la religion romaine officielle et
la nouvelle religion du Christ. Mais tout est calcul pour dtruire les
prventions des paens instruits et les amener admettre que le dis-
me de leurs philosophes est l'introduction naturelle au christianis-
me. L'originalit de Minucius Flix fut d'crire, l'usage des lettrs,
une apologie du christianisme aimable et habilement structure.
Quant aux nombreuses ressemblances qu' on a releves entre
YOctavius et Y Apologtique de Tertullien, elles posent toujours aux
rudits le problme historique et littraire des rapports entre les
deux auteurs, ainsi que celui de l'antriorit de l'un ou de l'autre de
ces deux ouvrages.
290
L'ylNTIOUIT
Aussi nombreuses que diverses, les donnes historiques accu-
mules depuis le dbut du XX
1
' s., et accrues considrablement par
les dcouvertes archologiques et pigraphiques innombrables des
dernires dcennies, ont permis de saisir la fois la vie matrielle,
politique et culturelle de l'Afrique antique. Grce aux progrs de
l'archologie, on s'est aperu que bien avant la conqute romaine,
l'empreinte multiforme du monde hellnistique avait marqu pro-
fondment l'ensemble des pays de la Mditerrane, et que l'intgra-
tion conomique et culturelle du Maghreb oriental ce monde tait
largement ralise. On a mme soulign que ce n'tait pas seulement
le territoire de l'tat carthaginois et, principalement, sa frange litto-
rale qui constituaient, au moment du rattachement l'Empire
romain, un partenaire actif du monde mditerranen, mais que la
Numidie des 11 et I" s av. J.-C, de par l'option de ses princes, en fai-
sait galement partie. Il n'a donc pas fallu attendre Octave, comme
l'affirmait P. Romanelli dans son ouvrage Storia delle province romane
dell'Africa, pour que le pays soit mis sur la voie du progrs matriel et spi-
rituel qui le portera, en l'espace de trois sicles, l'panouissement
0i
; car une
fois ralise l'intgration l'Empire de Rome, la civilisation de la
province africaine ne pouvait tre que l'hritire d'une longue his-
toire.
Il est vrai, cependant, qu'aprs un dsintrt suivi d'un dclin
qui, s'ajoutant la destruction de Carthage, a dur tout un sicle,
Rome ou plutt les Romano-Africains ont fait fructifier l'hritage.
En tmoignent encore les sites archologiques innombrables et la
profusion des inscriptions latines, les manifestations de l'activit et
de la richesse matrielles, l'loquence des textes littraires et des ra-
lisations artistiques.
1- P. Romanelli, Storia dette province romane dell'Africa, L' Erma di Bretschneider, Roma, 1959. p.
153.
TROI SI ME PARTIE
D E L A CRI S E D E L A CI VI L I S AT I ON
R O MA I N E L' I S LAM
A. - LES DERNIERS SICLES DE ROME
CHAPITRE PREMIER
La crise du III
e
sicle
I. - Aspects gnraux
Succs de la romanisation sous les Svres :
Le rgne des Svres a vu en Afrique, comme dans tout l'Em-
pire, l'apoge de la puissance impriale et de la civilisation romaine.
La paix sur les frontires et l'intrieur, l'essor urbain et la vie muni-
cipale, la promotion massive des provinciaux la citoyennet romai-
ne, l'activit conomique et culturelle, tout cela contribuait la pros-
prit du pays et soulignait l'importance de l'uvre entreprise par
Rome. Cet difice si brillant demeurait pourtant fragile. Certes, la
Tunisie fut l'une des provinces les plus romanises de l'Occident
romain et elle l'tait bien davantage que le reste du Maghreb, com-
me l'attestent ses villes plus nombreuses, son rseau routier plus
dense, ses plaines plus vastes qui favorisaient depuis toujours l'agri-
culture sdentaire, enfin l'absence de graves troubles intrieurs et la
scurit plus grande qui rgnait dans le pays. Les effectifs de l'arme
romaine stationns en Tunisie n'avaient jamais t importants : seu-
le une cohorte de six cents hommes, dtache de la III
e
lgion de
Numidie, formait une force de police sous les ordres des procon-
suls de Carthage. Depuis la fin du 1
er
s., la paix s'tait tendue aux
rgions montagneuses de l'ouest o, l'exemple de Mactar, les villes
294 L'ANTIQUIT
taient nombreuses et prospres. Les frontires sahariennes taient
calmes, Rome ayant refoul vers le sud les tribus nomades et dve-
lopp l'agriculture sdentaire et le peuplement dans les confins
mridionaux o se multipliaient en outre les relations commerciales
avec les oasis sahariennes. Tant du point de vue gographique que
social l'uvre de Rome fut sans doute plus acheve, plus profonde
en Tunisie que dans les autres provinces du Maghreb. L'anciennet
de la conqute, l'hritage phnicien qui a lgu une forte tradition
urbaine et une agriculture savante, la configuration du pays, qui l'ou-
vrait largement aux influences extrieures, tout cela a contribu au
succs de la romanisation.
Ses limites
Cette uvre considrable avait pourtant des limites et portait
en elle les germes de la crise ultrieure. Quelque soit le prestige - et
il fut immense - par lequel Rome et sa civilisation ont fascin les
peuples conquis, l'adhsion de ceux-ci ne pouvait avoir la mme
spontanit dans tous les milieux sociaux. Il ne faut certes pas
opposer systmatiquement les villes aux campagnes et faire, des
populations rurales, les victimes de la conception urbaine de l'im-
prialisme romain ; des cits ont, en effet, vcu en relations troites
avec leur domaine rural et l'agriculture connut une prosprit cer-
taine. C'tait pourtant la bourgeoisie municipale qui dtenait l'es-
sentiel des richesses et qui participait vraiment la romanisation ;
l'ambition suprme tait d'y accder et les promotions furent
innombrables mais elles se faisaient aux chelons suprieurs de la
hirarchie sociale. Les masses rurales demeuraient dans leur majori-
t trangres la romanisation, parlaient toujours les dialectes ber-
bres et adoraient les vieilles divinits libyques ou libyco-puniques.
L'autorit de l'tat sur les provinces s'est d'autre part consi-
drablement durcie ds le rgne des Svres. Au libralisme des
Ant omns succda peu peu une administration dirigiste qui t endai t
rglementer durement la condition des biens et des hommes. Les
guerres accroissaient sans cesse les besoins du trsor imprial, ce
DE LA CRISE DE LA CIVILISATION ROMAINE A L'ISLAM 295
qui aggravait d'autant les redevances fiscales imposes aux pro-
vinces. Dans les cits, les honneurs municipaux deviennent des
charges coteuses que l'on brigue moins facilement ; dans les cam-
pagnes, l'exploitation de la terre demeure rgie par la vieille loi man-
cienne qui donne aux colons la proprit effective de la terre, mais
les prestations et les impts sont plus lourds. Dj sous Commode,
les paysans du saltus burunitanus se plaignaient l'empereur de la
rigueur des agents du fisc et les romans de l'Africain Apule lais-
saient apparatre les difficults qui menaaient la socit rurale.
La Tunisie antique tait en outre fatalement solidaire du reste
du Maghreb o la paix romaine demeura toujours plus prcaire car
les rgions montagneuses comme l'Aurs, les Kabylies, l'Ouarsenis
formaient des lots d'inscurit qu'il a fallu isoler en les ceinturant
de postes militaires et les Maurtanies connurent des troubles
srieux mme l'poque de la Paix romaine. Rome put conjurer les
prils tant que la paix et la prosprit gnrales dans l'Empire
n'avaient pas impos de trop rudes efforts ses armes et ses
finances. Or cet quilibre fut rompu avec la crise du III
e
s. qui, au
lendemain de la mort de Svre. Alexandre et pendant de longues
et terribles annes, jeta l'Empire dans une anarchie o il faillit som-
brer. Le danger perse en Orient, les invasions germaniques en Occi-
dent, la crise conomique et l' effondrement de la monnaie, les pi-
dmies et la dpopulation, les troubles religieux lis aux progrs du
christianisme, l'anarchie dans l'arme et la cascade de pronuncia-
mentos , tout cela conduisit l'Empire au bord de la catastrophe.
L'Afrique, bien que moins atteinte que d'autres provinces, fut
cependant secoue par la tourmente du III
e
s.
IL- Les troubles civils et militaires
Rvolte de Thysdrus et usurpation de Gordien
Elle se trouva d'abord mle aux troubles civils et militaires et
participa ds 238, aux comptitions sanglantes pour la conqute du
296 L'ANTIQUIT
pouvoir imprial. L'avnement des Gordiens ne fut pourtant pas le
rsultat d'un pronunciamiento , c'est--dire d' une rvolte de sol-
dats portant leur gnral l'Empire. Les choses commencrent en
fvrier 238 Thysdrus (El Jem), au cur d' une rgion qui avait par-
ticulirement bnfici de la prosprit que le pays connut sous les
Svres. Une riche bourgeoisie de ngociants d'huile s'tait rapide-
ment leve au gouvernement de la cit grce aux progrs remar-
quables de la culture de l'olivier. Ces nouveaux riches taient trs
remuants et s'opposaient l'accroissement des charges fiscales exi-
g par l'empereur Maximin qui semblait vouloir abolir les privilges
dont ils avaient bnfici du temps des Svres ; ils trouvaient en
outre l'appui du snat de Carthage et des notabilits municipales
hostiles la tyrannie fiscale de l'tat. Lorsque le procurateur imp-
rial, accompagn du proconsul Gordien, un vieillard de 80 ans, se
rendit Thysdrus pour lever les taxes sur la vente des huiles, une
meute clata et le procurateur fut assassin ; la bourgeoisie locale
appuye par les paysans de la rgion qui souffraient aussi des nou-
veaux impts, obligea le vieux Gordien prendre la pourpre et le
ramena triomphalement Carthage. De l, l'usurpateur envoya une
dputation au snat Rome qui, en l'absence de Maximin retenu
dans le nord de l'Italie par la guerre contre les Barbares, lgitima le
coup de force et reconnut Gordien ainsi qu' son fils la dignit
d'Augustes. Mais l'affaire tait mal engage car il manquait aux Gor-
diens l'appui dcisif et indispensable des lgions. Ce soulvement
purement civil demeurait circonscrit la Proconsulaire et il ne trou-
va pas d'chos en Maurtanie et pas davantage en Numidie o sta-
tionnait la III
e
lgion qui reprsentait le gros des troupes romaines
d'Afrique. Son commandant, le lgat Capellianus, prit les armes
contre l'usurpateur ; il marcha d'abord sur Thysdrus qui fut prise et
frappe de reprsailles violentes ; beaucoup de maisons appartenant
aux bourgeois rebelles furent incendies et dtruites ; le lgat partit
ensuite pour Carthage et, sur sa route, soumit aux mmes rigueurs
les populations qui avaient embrass le parti des Gordiens. Ceux-ci
connurent une fin tragique ; le vieux Gordien se pendit et son fils
fut tu lors de la prise de Carthage sur laquelle s'abattit une rpres-
sion sanglante. L'usurpation avait dur vingt jours.
DE LA CRISE DE LA CIVILISATION ROMAINE A L'ISLAM
297
Mais la crise rebondit aprs l'assassinat de Maximin sous les
murs d'Aquile ; la raction snatoriale proclame alors un petit fils
de Gordien g de treize ans qui revtit la pourpre sous le nom de
Gordien III. Les mesures de reprsailles frapprent cette fois les
partisans de Capellianus et en premier lieu la III
e
Lgion qui fut dis-
soute et ses dbris disperss jusqu'au moment o, en 253, l'empe-
reur Valrien la reconstituera en rcompense des services que ses
troupes lui avaient rendus dans la guerre civile contre milien.
L'anarchie continua pendant le rgne de Gordien III ; en 240
le proconsul Sabinianus tenta de se faire proclamer empereur et il fal-
lut faire marcher contre lui les troupes de Maurtanie Csarienne,
tout en menaant la population de Carthage de reprsailles terribles
si elle ne livrait pas l'usurpateur. D'autres troubles du mme ordre
clatrent par la suite, notamment sous Gallien qui dut briser une
nouvelle tentative d'usurpation en 265.
Ces crises soulignaient l'affaissement de l'autorit de l'tat.
Par les reprsailles qu'elles dchanrent, elles ont appauvri le pays
et facilit le rveil de l'agitation berbre.
Les insurrections berbres
Celles-ci n' ont pas affect directement la Proconsulaire, elles
se sont droules en Maurtanie et en Numidie, mais elles ne pou-
vaient manquer d'avoir des rpercussions sur l'ensemble du Magh-
reb. Elles inauguraient les graves difficults que Rome allait dsor-
mais affronter pour imposer sa domination aux tribus berbres et
compromettaient jamais l'quilibre si instable de la paix romaine.
Les troubles commencrent en 253 et ne sont pas trangers la cri-
se qui opposa Valrien l'usurpateur milien dont l'autorit s'tait
sans doute fait reconnatre dans les provinces occidentales du
Maghreb l'affaiblissement des troupes impriales la suite de la dis-
solution de la III
e
Lgion a permis l'insurrection de s'tendre une
grande partie de la Kabylie et de durer plusieurs annes ; avec
Faraxen, on vit reparatre le type du grand chef berbre, l'exemple
de l'ternel Jugurtha ; la guerre se limitait le plus souvent une sui-
te de razzias, de coups de main, sans coordination, sans unit entre
298 L'ANTIQUIT
les tribus, d'o le succs final de Rome en dpit des effectifs mili-
taires relativement faibles dont elle disposait. L'amlioration de la
situation gnrale de l'Empire sous Gallien prcipita le retour au
calme car les troubles taient des consquences spontanes de
l'anarchie beaucoup plus qu'une action concerte contre Rome.
I I I .- Les difficults conomiques
L'Afrique souffrit aussi de la crise conomique et montaire,
aggrave par les terribles pidmies de peste qui ravagrent l'Empi-
re. A Carthage, l'vque Cyprien dploya une grande activit pour
secourir les malades et combattre le flau. Les rigueurs de la fiscali-
t et le ralentissement des changes extrieurs entranrent un
dclin de la production dans certaines rgions, en particulier celles
qui avaient souffert des suites de la crise de 238. On note ainsi une
interruption de la construction I ladrumetum et Thjsdrus, mais ce
n'est pas le cas d'autres cits comme Thuburbo Majus, et Thugga
(Dougga) o l'on trouve de belles mosaques contemporaines de
Gallien. La grande route Carthage-Thveste est jalonne de nom-
breuses bornes milliaires datant de la deuxime moiti du III
e
s.
Dans l'ensemble la Tunisie n'a pas beaucoup souffert de la crise
sauf au moment de l'expdition punitive de Capellien. Il faut cepen-
dant noter le durcissement de l'oppression fiscale et la hausse trs
rapide des prix en raison de la crise montaire qui ralentit consid-
rablement la circulation des espces et vit une rgression vers une
conomie naturelle. L' effondrement de la monnaie fut l'une des
causes de la chute de Rome en Occident
IV. - La crise religieuse
Progrs du christianisme africain au III
e
s.
Depuis le milieu du II
e
s., le christianisme voyait s'accrotre le
nombre de ses adeptes ; la religion nouvelle demeurait pourtant
DE LA CRISE DE LA CIVILISATION ROMAINE A L'ISLAM 299
interdite car elle menaait la cohsion et la scurit de l'tat. Reje-
tant le polythisme traditionnel et le culte imprial, indiffrents la
Cit terrestre qu'ils jugeaient phmre et illusoire, les chrtiens
formaient au sein mme de l'Empire, une sorte de scession et tour-
naient leurs regards vers le royaume de Dieu alors que l'tat, secou
par la crise exigeait l'adhsion de tous aux valeurs morales et poli-
tiques qu'il reprsentait. Dans une civilisation fonde sur le dvoue-
ment la cit et ses dieux, le christianisme constituait un ferment
de dissolution.
En Tunisie, la religion nouvelle avait fait de grands progrs
depuis les dernires annes du II
e
s. La fin de la perscution aprs
Septime Svre fit rgner une paix d' un demi-sicle que l'glise mit
largement profit pour faire de nouveaux adeptes et renforcer son
organisation. A l'poque de saint Cyprien il y avait plus d'vques
en Proconsulaire que dans toute la Gaule, et Carthage jouait le rle
de mtropole du christianisme africain et contribuait aux progrs de
la religion du Christ dans l'Occident latin.
Saint Cyprien, vque de Carthage
Ce prestige exceptionnel de l'glise d' Afrique tait personni-
fi au milieu du III
e
s. par l'vque de Carthage Cyprien qui fut, avec
Tertullien et Augustin, l'une des trois grandes figures du christianis-
me africain. C'tait un provincial et il passa toute sa vie en Procon-
sulaire. N vers 210 Carthage, il tait issu donc d' une famille de la
haute bourgeoisie africaine. Paen de naissance, il reut une duca-
tion complte, apprit le grec et la rhtorique, et dbuta comme avo-
cat Carthage o il se distingua par son loquence brillante, ses rela-
tions mondaines, et son ardeur dfendre l'idoltrie paenne. Sa
brusque conversion au christianisme l'ge de trente-cinq ans fut
accueillie avec surprise et entrana un changement complet dans sa
vie. Il se mit pratiquer la charit et la chastet, ce qui tonna beau-
coup les Carthaginois. La vente de ses biens personnels lui permit
de faire l' aumne et de secourir les victimes de la perscution et de
la peste. Il se dtourna de la littrature profane qui avait nourri sa
300
L'ANTIQUIT
culture classique pour se consacrer totalement aux critures.
Ordonn prtre peu aprs son baptme, il fut lu vque de Car-
thage en 249.
Son piscopat dura neuf ans et tient une place considrable
dans l'histoire de l'glise d'Afrique et de la Chrtient occidentale.
Cyprien trouvait une glise nombreuse, prospre, mais engourdie
par la longue paix qui, mettant fin aux perscutions, avait tempr
l'ardeur militante du clerg et des fidles ; les progrs du christia-
nisme dans la haute socit contribuaient ce relchement du zle
et de la discipline. L'vque de Carthage s'en plaignait amrement :
" Plus de dvotion chez les prtres, crit-il, plus de foi chez les ministres
du culte, plus de misricorde dans les oeuvres, plus de discipline dans les murs.
.L es hommes se teignaient la barbe, les femmes se fardaient... on s'unissait aux
infidles par les liens du mariage, prostituant ainsi aux gentils les membres du
Christ... L,a plupart des vques mprisaient leurs divines fonctions et se fai-
saient intendants des grands de ce monde .
La perscution de Dce
Cette glise corrompue manquait de l'nergie ncessaire pour
rsister au brusque rveil de la perscution sous l'empereur Dce.
Beaucoup de fidles apostasirent et acceptrent de sacrifier au cul-
te imprial ; d'autres, sans aller jusqu' renier leur foi, achetaient des
certificats de sacrifice qui leur taient vendus par des confesseurs
indignes. Ce fut une vritable droute dans l'glise d'Afrique ; crai-
gnant d'tre arrt Cyprien quitta Carthage pendant plus d' un an, ce
qui lui valut les critiques acerbes de ses adversaires, mais de son
refuge secret il continua de s'occuper activement des affaires de son
diocse. Rentr au printemps 251, aprs la mort de Dce, il trouva
une situation confuse et tendue en raison des graves problmes
poss par le grand nombre d'apostasies. Parmi ceux qui avaient fai-
bli devant la perscution beaucoup voulaient rintgrer l'glise sans
subir de pnitence ; ils trouvaient l'appui du prtre Novat qui accor-
dait la rconciliation tous les apostats alors que Cyprien, tout en
admettant le principe de celle-ci prconisait une pnitence dont la
dure serait fonction de la gravit du pch.
DE LA CRISE DE LA CIVILISATION ROMAINE A L'ISLAM
301
Saint Cyprien en conflit avec l'vque de Rome
La crise rebondit en 254 propos de la question du baptme
des hrtiques, et mit Cyprien en conflit avec l'vque de Rome,
Etienne, traduisant l'autonomisme de cette glise d'Afrique qui,
depuis Tertullien, affirmait avec force son indpendance. Il s'agis-
sait de savoir si les prtres qui avaient apostasi pouvaient adminis-
trer le sacrement du baptme.
Cyprien le niait, alors que le pape tienne, suivi par l'glise
d'Alexandrie, invoquait la tradition antique selon laquelle la grce du
sacrement ne procdait pas de celui qui l'administre mais du Christ.
C'est en fait le Christ qui baptise, que le ministre soit Pierre ou
Judas, et l'argument sera repris plus tard par saint Augustin contre
les donatistes qui, au nom de cette exigence sectaire de la puret, se
sont rclams de l'ecclsiologie cyprianique. Celle-ci insistait pour-
tant sur la notion fondamentale d'unit dans l'glise que devait
incarner le corps piscopal tout entier et l'ide de sectarisme tait
absente de la pense de saint Cyprien. Mais la polmique avec Rome
soulignait cette tendance autonomiste de l'glise africaine.
La perscution de Valrien et le martyre de saint
Cyprien (258)
La lutte s'apaisa avec la mort d' tienne et le rveil de la per-
scution sous Valrien qui allait coter la vie l'vque de Cartha-
ge. Les progrs du christianisme dans les hautes classes et l'accrois-
sement des richesses de l'glise en un moment de grave pnurie
financire ont donn au ministre Macrien l'ide de tirer parti de la
lgislation anti-chrtienne pour renflouer les caisses de l'tat. Un
premier dit interdisait en 257 la pratique du culte chrtien et
ordonnait au clerg de sacrifier aux divinits impriales. Cyprien fut
alors convoqu par le proconsul et dclara qu'il ne pouvait obir,
d' o sa condamnation l'exil dans une rsidence de Curubis (Kor-
ba) o il passa une anne. En 258, le deuxime dit de Valrien
302
L'ANTIQUIT
ordonnait de mettre mort tous les prtres qui n'avaient pas sacri-
fi et de confisquer les biens des chrtiens de la haute socit.
Appel de nouveau auprs du Proconsul dans sa rsidence de
l'Ager Sexti, Cyprien aprs l'interrogatoire et les sommations d'usa-
ge, refusa encore une fois de renier le Christ et fut condamn
mort ; on le livra aussitt au bourreau en prsence d'une foule nom-
breuse qui, dans la nuit, ramena son corps Carthage o il devait
tre enterr. Avec lui disparaissait l'un des grands vques du chris-
tianisme antique. Son prestige demeura immense Carthage ; deux
basiliques lui furent consacres : l'une sur son tombeau, proximi-
t de la mer, l'autre sur les lieux du martyre ; chaque anne une
fte populaire tait clbre sa mmoire et elle le sera jusqu'
la conqute arabe. L' historien grec Procope qui crit au V
e
s. rap-
porte que Cyprien est de tous les saints celui que les Carthaginois honoraient
le plus . Les marins de Carthage ont parl de vents cypriens pour
dsigner ceux qui soufflaient en septembre, mois o l'vque avait
t excut. A Rome on rendit des honneurs officiels sa mmoire
et ses uvres eurent une influence considrable sur l'glise latine.
Ce fut une forte personnalit qui donna Carthage son plus grand
vque et contribua aux progrs du christianisme dans le pays.
CHAPITRE II
Organisation administrative et problmes
militaires de la fin du III
e
s.
la conqute vandale
la fin du III
e
s. commence une priode communment
appele Bas Empire au cours de laquelle l'tat subit de profondes
transformations pour s'adapter aux conditions nouvelles cres par
la crise. Les rformes de Diocltien et de Constantin donnrent
l'Empire une physionomie nouvelle, mais elles n' ont finalement pas
empch le dclin de Rome en Occident. L'Afrique vit se pour-
suivre et s'aggraver l'volution commence au III
e
s. : autorit sans
cesse plus tyrannique de l'appareil d' tat sur la vie provinciale et
municipale, violence des crises religieuses, tendance un certain
particularisme africain qui se traduit par les insurrections berbres,
les usurpations, et peut tre aussi le schisme donatiste.
Pendant cette priode la Tunisie gardait toujours une relative
prosprit et fut encore moins atteinte par la crise que le reste du
Maghreb, mais elle subissait fatalement les consquences de la rui-
ne de l'Empire en Occident.
I. - Les rformes administratives
Les rformes de Diocltien et de Constantin avaient pour but
de renforcer l'autorit de l'tat dans les provinces, de mettre fin
304
L'ANTIQUIT
l'anarchie qui rsultait des insurrections et des usurpations, d'ac-
crotre les ressources fiscales pour affronter les menaces extrieures.
Les nouvelles provinces
Il y eut d'abord des bouleversements dans l'organisation terri-
toriale des provinces ; en Afrique les troubles du III
e
s. et leurs pro-
longements lors des premires annes de la Ttrarchie amenrent
Diocltien vacuer les rgions les plus menaces afin de mieux
dfendre les zones o l'implantation de Rome tait la plus forte ;
c'tait le cas de la Tunisie dont les frontires ne furent pas modi-
fies, sinon aux confins de la Tripolitaine o Diocltien, aprs avoir
vacu les rgions dsertiques l'Ouest de Leptis Magna, limita l'oc-
cupation romaine aux villes de la cte et renfora les abords mri-
dionaux de la Tunisie par une sorte de marche frontire qui s'ten-
dait au sud d' une ligne reliant Gabs aux chotts. Cette zone tampon
o se trouvait la fameuse troue de Mareth verrouillait le pays
contre les ventuelles incursions de tribus nomades venues du
dsert. Mais l'vacuation de la Tripolitaine intrieure portait un rude
coup aux villes ctires et en particulier l jptis Magna qui avait
connu une grande prosprit sous les Svres, grce au commerce
saharien, dont elle ne contrlait plus dsormais les routes. Isoles
les unes des autres et accules sur le rivage, les villes du littoral
taient en outre la merci des razzias dvastatrices ; ce danger ne
menaait pas encore la Tunisie qui demeurait entirement romaine.
l'intrieur du pays, Diocltien procda de nouvelles divi-
sions administratives afin de rendre plus efficace la perception de
l'impt et d'amoindrir l'autorit des anciens proconsuls dont l'om-
nipotence pouvait faire le jeu des usurpateurs. La Tunisie qui for-
mait sous les Svres la seule province d'Afrique proconsulaire fut
morcele en trois provinces autonomes places chacune sous l'au-
torit d' un gouverneur : au sud, la Tripolitaine qui empitait large-
ment sur le territoire actuel de la Tunisie puisqu'elle englobait la
Jeffara, les Matmatas et atteignait le Jerid ; au centre, la Byzacne
qui s'tendait de Gabs jusqu'aux abords du golfe de Hammamet et
La Schola des Juvenes Mactar
Tel qu'elle se prsente aujourd'hui avec ses alignements de colonnes
debout, il s'agit d'une basilique chrtienne avec ses nefs,
son abside, son chur et mme sa contre-abside. Mais c 'est l le dernier tat,
aprs transformation d'un difice paen dont l'identification
comme local de runion de l'association des Juvenes a fait la clbrit du monu-
ment au moment de sa dcouverte. En ralit, il s'agirait
simplement d'une grande maison cour centrale sur laquelle s'ouvraient
les pices, dont une avec abside reprise par l'glise ultrieurement.
Ce sont les inscriptions paennes graves sur des bases rcupres
qui ont t cause de l'erreur dans l'interprtation.
travers la longue continuit d'occupation du site,
cet exemple illustre les transformations des monuments inhrentes
l'volution de la socit.
306
L'ANTIQUIT
couvrait toutes les steppes de l'intrieur ; au nord, la Proconsulaire
proprement dite ou Zeugitane qui se limitait la Tunisie du nord et
mordait sur l'Algrie au nord-est et vers le centre jusqu' Tbessa
(Thevestej (Tebessa). Ces provinces faisaient partie du diocse
d'Afrique qui comprenait en outre la Numidie et les deux provinces
de Maurtanies sitifenne et csarienne, Rome ayant vacu une
grande partie de l'Algrie occidentale et presque tout ce qu'elle pos-
sdait au Maroc o la minuscule province de Maurtanie tingitane
tait administrativement rattache l'Espagne.
Le gouvernement provincial
la tte du diocse d'Afrique qui dpendait de la prfecture
du prtoire d'Italie, tait plac un vicaire rsidant Carthage.
Chacune de ces provinces avait son gouverneur charg uni-
quement des affaires civiles. Carthage on trouve toujours le pro-
consul d'Afrique qui demeure un personnage considrable bien que
ses prrogatives fussent amoindries par le morcellement de la pro-
vince et la cration du diocse d'Afrique ; le proconsul appartient
la noblesse snatoriale de rang consulaire, c'est--dire l'chelon le
plus lev de la hirarchie nobiliaire. Il porte le titre envi de claris-
sime et l'emporte en dignit sur le vicaire et souvent, sa sortie de
charge, il accde la prfecture de la Ville. Carthage, il rside dans
un palais somptueux sur la colline de Byrsa, mais il possde plu-
sieurs villas de plaisance notamment Yager Sexti en direction de la
Marsa, et Maxula (Rads). Son indemnit annuelle demeurait l'une
des plus importantes de l'Empire. Le proconsul rend la justice au
nom de l' empereur et son tribunal constitue une juridiction d' ap-
pel ; il est assist de deux lgats dont l' un rside Carthage et
l'autre Hippone (Bne) ; leur rle consiste contrler les affaires
municipales au nom du proconsul et instruire les procs. Les
lgats du IV
e
s. appartiennent gnralement la bourgeoisie muni-
cipale africaine, ce qui prouve l'essor des villes romaines en Tunisie
et l'importance de la promotion sociale. Il arrive aussi, mais plus
rarement que le proconsul soit de souche africaine. Comme dans le
reste de l'Empire, l'administration tend se compliquer par la mul-
DE LA CRISE DE LA CIVILISATION ROMAINE A L'ISLAM
307
tiplication des bureaux et des agents qui assistaient le proconsul et
ses lgats.
Le gouverneur de la province de Byzacne rside Hadrum-
te ; d'abord de rang questre avec le titre de praeses, il accde sous
Constantin la dignit de consulaire. Quant la Tripolitaine, elle
forme une province prsidiale dirige par un gouverneur install
Leptis Magna.
Sparation des pouvoirs civils et militaires
Vicaires et gouverneurs provinciaux ont au IV
e
s. des attribu-
tions purement civiles. La sparation des pouvoirs civils et mili-
taires, qui est l'un des traits dominants de l'administration provin-
ciale au Bas Empire, fut ralise progressivement entre le rgne de
Gallien et celui de Constantin qui lui donna sa forme systmatique
et dfinitive. Elle rpondit au souci d'viter les usurpations en pri-
vant les gouverneurs de la force arme ; ds le 1
er
s., Caligula avait
enlev au proconsul d'Afrique le commandement de la III
e
Lgion
qu'il confia au lgat de Numidie, mais la mesure n'tait pas compl-
te puisque celui-ci exerait encore au III
e
s. des pouvoirs civils.
Aprs Constantin, chaque province eut un chef militaire distinct du
gouverneur. Cette mesure traduisait en outre le dclin de la nobles-
se snatoriale qui assumait de moins en moins les commandements
militaires et depuis longtemps dj, les cadres de l'arme taient
pour la plupart issus du rang. La sparation des pouvoirs demeura
la rgle gnrale de l'administration jusqu' la cration de l'exarchat
de Carthage par l'empereur Maurice, la fin du VI
e
s.
II. - Les rformes militaires
Le commandement
Depuis Constantin le commandement des troupes est confi
au comte d'Afrique dont la charge tait dans la hirarchie militaire
l'une des plus leves de l'empire. Le comte tait vir spectabilis (hom-
308 L'ANTIQUIT
me remarquable), c'est--dire que son rang de noblesse le plaait
immdiatement au dessous du proconsul. Il commandait sur un ter-
ritoire trs tendu correspondant, en fait, toutes les provinces du
Maghreb romain. Seule la Tripolitaine semble lui avoir chapp
depuis la lin du IV
e
s. lorsqu'un dux de rang questre fut plac la
tte de ses troupes. L'extension du territoire relevant de l'autorit du
comte explique la sparation des pouvoirs civils et militaires, car, il
tait difficilement concevable qu'un mme chef militaire relevt
simultanment de plusieurs gouverneurs de province.
Effectifs et recrutement
L'arme impriale du IV
e
s. prit une physionomie nouvelle la
suite des rformes de Diocltien et surtout de Constantin. Jusque l,
l'essentiel des troupes tait mass sur le limes ou dans les camps qui
en surveillaient l'accs ; l'intrieur du pays les effectifs taient trs
peu nombreux. Les insurrections berbres en Maurtanie et la
menace de nouveaux troubles rendirent ncessaire la formation
d'une arme mobile compose essentiellement d'units de cavalerie
et d'infanterie lgionnaire comprenant chacune mille ou cinq cents
hommes et toujours prtes se dplacer rapidement vers les zones
d'inscurit. Cette arme mobile constituait la troupe d'lite ; les
soldats taient des Africains romaniss recruts essentiellement
dans la paysannerie qui vivait autour des camps. Le service militaire
devint peu peu une obligation hrditaire et fiscale, les propri-
taires fonciers tant astreints lever et quiper un nombre de
recrues proportionnel l'importance de leurs revenus. L'tat pou-
vait, selon ses besoins, percevoir l'impt en espces ou en soldats.
Ce mode de recrutement finit par compromettre la valeur de l'ar-
me car les propritaires n'hsitaient pas livrer au fisc leurs
hommes les moins valides.
Arme mobile de l'intrieur et arme des frontires
En temps de paix, les troupes de l'intrieur rsidaient dans les
villes militaires de Lambse, Tbessa (Theveste), Hadra ('Ammaedaraj
et aussi Carthage o une ancienne cohorte de la troisime lgion
DE LA CRISE DE LA CIVIL1SATI0N ROMAINE A L'ISLAM 309
occupait encore au IV
e
s. une caserne sur Borj Jedid. Les effectifs
taient peu importants en Tunisie car les troubles y furent beaucoup
moins graves que dans le reste du Maghreb. Cette scurit relative
explique l'absence de murailles dfensives autour des villes, sauf
dans les rgions de l'extrme sud, plus menaces ; Carthage demeu-
rera une ville ouverte, sans fortifications jusqu'en 425, quatre ans
avant le dbarquement des Vandales au Maroc. Les ouvrages dfen-
sifs furent en revanche beaucoup plus nombreux en Maurtanie siti-
fienne et csarienne.
Sur le limes stationnait l'arme de couverture ; il s'agissait de
paysans en armes. L'tat leur distribuait des lots de terres exempts
d'impts et, en change, ils devaient surveiller la frontire et repous-
ser les ventuelles incursions de tribus venues du sud. L encore
l'obligation du service tait hrditaire et contribuait enraciner cet-
te arme de paysans dans la zone du limes.
Comme la Tunisie du IV
e
s. n'a pas connu de graves menaces
sur ses frontires, contrairement aux provinces de l' Europe occi-
dentale inondes par le flot des invasions barbares, les troupes du
limes ont rarement eu l'occasion d'intervenir sinon pour de simples
oprations de police contre les tribus du sud ; les soldats vivaient sur
leurs terres beaucoup plus que dans les camps et ils ont largement
contribue au progrs de l'agriculture et de la vie sdentaire dans ces
rgions ; mais ils se trouvaient en mme temps moins rompus la
carrire des armes et la valeur des troupes s'en est ressentie. Celles-
ci n'taient pas rparties en units classiques - lgions, ailes,
cohortes - mais en secteurs gographiques placs chacun sous les
ordres d'unpraepositus limitis qui, la fin du IV
e
s., relevait du duc de
Tripolitaine.
Frontire de la Tunisie romaine au IV s.
Le trac du limes longeait d'abord le littoral tripolitain, remon-
tait jusqu'aux abords de Gigthis (Bou Ghrra) et bifurquait vers
l'ouest en passant par Talati (Tlalet), Telmin, Nefta d'o il gagnait
l'Algrie ; la frontire suivait gnralement une leve de terre jalon-
310 L'ANTIQUIT
ne de places fortes rparties en profondeur et relies par des routes
stratgiques ; on a trouv au sud-est du Jrid les restes d'un fort
construit sous Diocltien, le centenarium de Tibubuci (Ksar Tercine),
qui, comme l'indique son nom, devait abriter une garnison de cent
hommes ; quant au limes, on peut en suivre les traces sur dix-sept
km dans les Matmatas.
Le limes n'avait pas seulement une importance stratgique par
l'organisation d' un glacis fortifi assurant la dfense de l'arrire-
pays, et dveloppant l'agriculture et le peuplement aux confins du
dsert. C'tait aussi une frontire politique et culturelle qui mettait
les possessions romaines en contact avec l'Afrique berbre et ind-
pendante ; il s'agissait de contacts plus que d'une sparation radica-
le. Rome entretenait des relations diplomatiques avec les chefs de
tribus qui, en change d'une investiture impriale reconnaissant leur
autorit et moyennant des subsides, fournissaient des contingents
militaires pour veiller la garde du limes. C'est ainsi que la romani-
sation et le christianisme purent atteindre des rgions qui chap-
paient l'administration directe de Rome. Une lettre de saint
Augustin rapporte que, la fin du IV
e
s., les tribus Ar^uges de Tri-
politaine prtaient toujours serment l'Empire par la bouche de
leurs chefs qui Rome donnait le titre de tribuni. Ce n'est videm-
ment qu' proximit immdiate du limes que de tels contacts taient
possibles ; ils dnotent cependant la permanence de l'influence
romaine sous le Bas Empire.
III. - L'inscurit
Le rle des nomades chameliers en Tripolitaine
Au-del,, Rome se heurtait des tribus
chameliers qui apparaissent en Tripolitaine la fin du III
e
s. La ques-
tion du chameau en Afrique romaine a soulev de nombreuses et
difficiles controverses.
l'hostilit
de nomades
311
Selon une thse dfendue de la faon la plus radicale par l'his-
torien du Maghreb E. F. Gautier, le chameau, jusque l inconnu des
Africains, a fait au IIP s. une irruption massive sur les frontires
mridionales et permis aux nomades du dsert de menacer la scu-
rit des provinces.
En fait, le chameau existait dans le Sahara depuis l'poque
prhistorique ; un passage de Quinte Curce, relatant l'expdition
d'Alexandre en Egypte la fin du IV
e
s. avant J.-C, parle de cha-
meaux transportant des outres travers le dsert. Moins de trois
sicles plus tard, la prsence du chameau est atteste lors de la cam-
pagne de Csar en Afrique. Ce qui est nouveau au III
e
s., c'est l'ac-
croissement du cheptel camelin la suite de l'essor du commerce
saharien avec la Tripolitaine sous les Svres. Il n'y a donc pas de
rvolution du chameau, comme le voulait Gautier, mais une simple
volution. Celle-ci a permis aux tribus nomades refoules au del du
Unies sous le Haut Empire de trouver les moyens de transport nces-
saires la traverse du dsert et de revenir l'assaut des frontires
romaines. En fait, c'est seulement le Sahara tripolitain qui se trouve
menac par les nomades chameliers, d' o l' effort militaire accompli
par les Svres dans cette rgion.
A la fin du III
e
s., le ttrarque Maximien dut intervenir pour
repousser une incursion des Illaguas - futurs Lawtas du Maghreb
arabe - en Tripolitaine ; c'est alors que l'Empire se rsigna vacuer
la partie intrieure du pays afin de ne pas disperser ses forces.
C'est galement en Tripolitaine que la tribu des Austoriani
attaque, une soixantaine d'annes plus tard, les villes romaines du
littoral. Illaguas et Austoriani appartenaient aux grandes tribus de
nomades chameliers installes alors en Cyrnaque et formaient
quelques vagues avances d'un flot qui ne dferle sur la Tunisie qu'
la fin du V
e
s.
Sous le Bas-Empire il n'y a pas d'incursions srieuses au nord
de Leptis Magna et les frontires de Byzacne ne sont pas encore
menaces. Mais un lment nouveau a fait son apparition : l'entre
en Tripolitaine des grands nomades chameliers qui progressent len-
tement vers l'ouest.
DE LA CRISE DE LA CIVIL1SATI0N ROMAINE A L'ISLAM
312
L'ANTIQUIT
Le rveil de la rsistance berbre
N'ayant pas souffert des invasions, la Tunisie a pu conserver
une prosprit relative jusqu' la chute de Rome et mme au del. A
l'intrieur, le pays n'a pas connu de graves insurrections indignes
comme celles des Maurtanies, mais il en a subi fatalement les
rpercussions. On voit s'affirmer, notamment la fin du IV
e
s., un
particularisme africain fond non pas sur un sentiment national,
tranger la mentalit de l'poque et dmenti par les perptuelles
divisions qui n' ont pas cess d' opposer et d'affaiblir les roitelets ber-
bres, mais plutt sur un mcontentement diffus d l'oppression
fiscale toujours plus lourde, la violence des querelles religieuses,
aux ambitions de certains chefs berbres comme Firmus et Gildon
ou de fonctionnaires impriaux comme Domitius A lexander et Boni-
face.
Il existe bien une tendance au sparatisme qui reflte non pas
la prise de conscience d'une entit nationale spcifique se dfinis-
sant par opposition Rome, mais une manifestation de la dsagr-
gation interne de l'Empire d'occident de moins en moins capable de
conjurer les prils qui, de toutes parts, l'assaillaient. L'administration
impriale bureaucratique et oppressive a suscit des rsistances que
les chefs rebelles ont exploites, mais il n'y a jamais eu de mouve-
ment berbre unifi et cohrent pour librer le pays. Ce ne sont pas
les populations indignes qui ont chass Rome d'Afrique, mais les
Vandales.
La guerre de Gildon
Le grand chef berbre Gildon qui se rvolta contre Rome la
fin du IV
e
s., avait quelques annes plutt servi dans les rangs de
l'arme romaine contre son propre frre Firmus ; en rcompense il
fut investi par l'empereur Thodose de la trs haute fonction de
comte d'Afrique.
Cette charge lui permit d'acqurir une fortune considrable en
usurpant sans doute les riches terres bl du domaine imprial. Pro-
313
fitant des troubles intrieurs qui paralysaient l'Empire, et encourag
par des intrigues de cour, il se rvolta au lendemain de la mort de
Thodose (395) et sa tactique consista affamer Rome en inter-
rompant les exportations de bl africain vers l'Italie. Celui-ci tait
indispensable et pouvait devenir une arme redoutable en cas de
rbellion ; dj en 308, l'usurpateur Domitius Alexander s'en tait ser-
vi contre Maxence qui dut intervenir en Afrique, briser l'insurrec-
tion et frapper Carthage de trs lourdes reprsailles afin d'tre assu-
r du bl d'Afrique pendant la guerre civile qui l'opposait
Constantin. Gildon utilisa la mme arme une poque o la divi-
sion de l'Empire en deux parties avait dtourn les bls d'Egypte
vers Constantinople et rendait la Ville ternelle presque uniquement
tributaire de l'Afrique. Le pote Claudien, qui a racont dans ses
vers la guerre de Gildon, imagine de faire parler Rome en ces
termes : On me donna la Libye et l'Egypte pour que le peuple roi, avec son
snat, matre de la guerre, pt tre approvisionn par mer chaque t et voir ses
greniers remplis par l'un ou l'autre de ces deux pays. C'tait l'existence
assure : si Memphis me manquait, le bl de Gtulie compensait l'apport
annuel de l'Egypte. Les flottes rivalisaient pour m apporter leurs rcoltes et les
vaisseaux de Carthage faisaient concurrence ceux du Nil, quand s'leva une
seconde Rome et quand alors la production de l'Egypte passa au Nouvel Empi-
re. Restait la Libye, c'tait le seul espoir et... voici que Gildon m'a priv
de cette seule ressource .
Rome souffrit en effet de la famine et connut de graves
meutes populaires ; mais Carthage, s'accumulrent des stocks qui
firent baisser les prix du bl donnant ainsi un aspect social la poli-
tique de Gildon qui obtenait en outre l'appui des donatistes hostiles
la politique religieuse de l'empereur Thodose. On ne peut cepen-
dant faire de la guerre de Gildon une manifestation de rsistance
nationale ; comment expliquer alors la droute si complte et rapi-
de du chef berbre devant des forces impriales relativement
modestes et commandes par son propre frre Mascezel ? La
bataille dcisive eut lieu en mars 398 entre Ammaedara et Theveste ;
vaincu, Gildon se rfugia Tabarca o il tenta de s'embarquer, mais
la tempte le rejeta la cte o il fut pris et tu. Sa popularit semble
DE LA CRISE DE LA CIVIL1SATI0N ROMAINE A L'ISLAM
314
L'ANTIQUIT
avoir t grande et, si l'on en juge par la violence de la rpression
sous Honorius, elle lui a survcu plusieurs annes.
Dsagrgation de l'Empire romain en Occident
Aprs Gildon, Rome n'eut plus affronter de graves insur-
rections berbres, mais la dcadence de l'Empire d'Occident se
poursuivait et avait de nouvelles rpercussions en Afrique. En 410
les hordes barbares d'Alaric s'emparaient de Rome ; le comte
d'Afrique Hraclien demeura fidle l'empereur lgitime Honorius
et suspendit les exportations de bl vers l'Italie obligeant le chef
barbare envisager une expdition en Afrique, mais l'invasion n'eut
pas lieu cause de la brusque disparition d'Alaric. Trois ans plus
tard, le comte Hraclien, se jugeant mal rcompens des services
qu'il avait rendus Honorius, se rvolta et passa en Italie la tte
d'une arme. Vaincu, il rentra Carthage o il fut dcapit. Cette
rbellion qui, en mme temps qu'une tendance au sparatisme, tra-
duisait l'affaissement de l'autorit impriale, fut rdite la veille
de l'invasion vandale par le comte Boniface. C'est cette poque
trouble que Carthage s'entoura de murailles dfensives.
Pourtant, en ce sicle terrible pour l'Occident romain, la Tuni-
sie demeurait un pays relativement prospre, un refuge pour l'aris-
tocratie snatoriale qui fuyait Rome devant Alaric, et une sorte de
terre promise pour les envahisseurs germaniques. Son territoire n'a
connu ni les invasions ni les grandes guerres civiles qui avaient rava-
g des provinces comme la Gaule et l'Italie.
CHAPITRE III
La vie matrielle et la socit
I.- L'conomie
Au moment de l'invasion vandale, la Tunisie faisait figure de
terre promise et tous les tmoignages concordent pour en vanter la
richesse. Toutes les denres s'y trouvaient et le pays pouvait se suf-
fire lui-mme une poque o les changes commerciaux taient
bouleverss par la crise qui secouait l'Empire.
L'agriculture
- Les crales
L'conomie avant tout agricole reposait sur les crales qui
taient la ressource essentielle, excdant de beaucoup la consom-
mation locale et indispensable au ravitaillement de Rome. L'Afrique
du Bas Empire demeurait l'un des greniers bl du monde mdi-
terranen ; d'innombrables silos furent construits pour stocker les
grains destins l'annone. Cette abondance ne profitait pas tou-
jours aux habitants du pays puisqu'une large part tait prleve par
Rome. Il y avait en outre des famines priodiques dues aux vicissi-
tudes climatiques ; ainsi, celle de 366-367, qui fit tripler le prix du
bl et obligea le proconsul ouvrir les magasins de l'annone pour
distribuer des vivres au peuple de Carthage. Il va sans dire que la
316
L'ANTIQUIT
disette a d faire des ravages dans les populations rurales qui ne pou-
vaient compter sur les secours des agents impriaux. Hausse des prix
et spculation que Diocltien avait voulu combattre par son dit du
maximum , se sont poursuivies jusqu' la chute de Rome cause
des ponctions de plus en plus lourdes effectues par l'annone.
Le bl tait cultiv dans tout le pays, mais surtout dans les
plaines plus fertiles du nord et sur les immenses domaines de l'em-
pereur et de l'aristocratie snatoriale.
- L'olivier
Plus encore qu'aux crales, la Tunisie devait sa prosprit la
culture de l'olivier, qui est vraiment l'arbre roi. Il a permis de diver-
sifier l'conomie et de mettre en valeur les terres en friche ou aban-
donnes parce que peu favorables aux crales ; il a en outre favo-
ris l'extraordinaire promotion d'une bourgeoisie provinciale, parti-
culirement active en Byzacne. La qualit de l'huile s'tait beau-
coup amliore, et le temps o le pote Juvnal la repoussait avec
mpris cause de sa forte odeur est bien rvolu ; dsormais on l'uti-
lise non seulement pour l'clairage et les massages dans les thermes,
mais aussi pour l'alimentation. Elle est indispensable aux besoins de
l'Italie, et saint Augustin, lors d' un sjour dans un couvent de la
rgion de Milan, remarquait avec surprise que le dortoir n'tait pas
clair, ce qui n'arrivait jamais en Afrique. L'anecdote est intres-
sante parce qu'elle tmoigne de la prosprit relative du pays.
Trois zones principales se partageaient la culture de l'olivier :
la plaine de la Mdjerda et en particulier les rgions de Bj, Souk
El Khmis, Tboursouk, o le nombre d'arbres tait sans doute
plus important qu'aujourd'hui ; une bande littorale de dix vingt-
cinq km de profondeur depuis le Cap Bon jusqu' Gabs, s'largis-
sant dans les rgions de Sfax et d' El Jem ; les ports situs entre Taca-
pae (Gabs) et Sullectum (Salakta) ont connu, grce l'olivier, un
brillant essor au IV
e
s. supplantant celui d'Hadrumetum (Sousse) qui,
depuis la crise du III
e
s., semble avoir dclin, car la grande rgion
productrice se trouvait dsormais au coeur de la steppe, dans la
Mosaque du cirque de Gafsa
Dcouverte Gafsa en 1888
Conserve au Muse de Bardo
Le pavement est rectangulaire : 3,40 x 4,70 mais certaines parties sont mutiles.
C'est la reprsentation des jeux du cirque : on voit d'une part, les ftes des specta-
teurs encadres par les arcades des gradins, et d'autre part, la course des chars
qui se disputent les quatre factions rivales, sur la piste autour de la spina qui
constitue l'axe de l'arne.
Cette prsentation tardive des jeux du cirque tmoigne de l'engouement des popu-
lations des villes pour les divertissements malgr leur condamnation par l'glise.
Alors que l'on constate la dgradation de la cit dans sa parure monumentale et
ses institutions municipales, ces jeux sont le seul facteur non seulement de distrac-
tion mais aussi de rassemblement d'une cit autour des exploits sportifs de cochers
de chars.
318 L'ANTIQUIT
rgion de Sbetla, Kasserine, Friana. Cette vaste oliveraie qui
s'tendait vers Tbessa et dbordait sur la Numidie, connut un
plein essor au IV
e
s. ; on y a dcouvert d' innombrables pressoirs
et huileries ainsi que les restes d'un important rseau d'irrigation.
L'olivier a enrichi les villes de la rgion : Capsa (Gafsa), Cilium (Kas-
serine), Thelepte (Feriana) et surtout Sufetula (Sbetla) qui demeura
trs active jusqu' la conqute arabe. Les villes taient desservies par
un rseau routier dense et entretenu jusqu' la fin du IV
e
s. : routes
du nord vers l'axe stratgique Carthage-Tebessa puis en direction du
port de Thabraca (Tabarca) ; routes de l'est reliant l'oliveraie aux
ports de la cte ; c'tait la route de l'huile. Le commerce intrieur
demeurait actif jusqu' la fin du IV
e
s. ; certaines villes comme
Hadrumetum et Thjsdrus sont en dclin, mais le relais est pris par
d'autres.
Un grand nombre de mosaques, notamment celles de Tabar-
ca, Oudna, Carthage, tmoignent de l'importance de la vie agricole
au IV
e
s.
- Industrie et commerce
L'agriculture n'tait pas la seule ressource ; il faut signaler les
exploitations du bois dont on faisait une consommation importan-
te pour les constructions navales et le chauffage des thermes.
Les commerants et les travailleurs du bois taient organiss
en corporations bnficiant de privilges importants. La Tunisie
antique avait des forts beaucoup plus vastes que celles d'aujour-
d'hui.
Le pays exploitait aussi des carrires et des mines dans les
rgions montagneuses du nord. Les industries taient reprsentes
par la cramique et le travail du textile.
De nombreuses poteries ont t dcouvertes dans les ncro-
poles chrtiennes du IV
e
s., en particulier Hadrumte ; il s'agit
essentiellement de plats comportant des dcors avec personnages.
Les ateliers de potiers sont toujours actifs dans les centres de Byza-
cne et Carthage ; on y fabriquait des lampes, des amphores et des
319
plats. Quant l'industrie textile, elle trouvait des matires premires
abondantes dans le cheptel ovin ; elle bnficiait en outre des vieilles
traditions de teinture lgues par les Phniciens. Une main d'uvre
- sans doute fminine - tissait des tapis Carthage. Pes toffes de
laine pourpre taient fabriques dans les ateliers de Carthage et de
Meninx dans l'le de Djerba.
Toutes ces ressources donnaient lieu un commerce extrieur
dont l'activit s'est poursuivie jusqu' la fin de la domination romai-
ne. On a dj not le dclin de certains ports comme Hadrumte,
cause du dplacement de la route des huiles vers le sud. Carthage
tait toujours frquente par les commerants orientaux et juifs et
entretenait des relations avec les autres provinces de l'Empire. Seul
le commerce saharien semble avoir t perturb par la pousse
nomade dans le sud. Ailleurs, son volume a d se maintenir ; et l'on
sait quelle place tenait l'Afrique dans le ravitaillement de l'Italie.
Pays agricole et nourricier, sans industries importantes, la Tunisie
exportait plus qu'elle n'importait ; les nombreux trsors montaires
d'origine orientale que l'on a dcouverts attestent ce dsquilibre
dans les changes.
II.- La socit rurale
Contrairement l'activit conomique qui n'a pas connu de
grands bouleversements depuis le IIP s., la condition des hommes
a profondment volu sous l'effet de la crise.
Aggravation de la condition des paysans
C'est d'abord le passage progressif vers une agriculture de
type seigneurial o le matre est quasiment indpendant sur ses
terres qu'il soustrait la juridiction des cits et des agents de l'em-
pereur. Il s'arroge le droit de lever lui-mme l'impt de la capitation
sur les paysans de son domaine qui sont dsormais attachs de pre
en fils la glbe ; il y a l l'amorce d'une dsagrgation fodaliste de
DE LA CRISE DE LA CIVIL1SATI0N ROMAINE A L'ISLAM
320
L'ANTIQUIT
la socit rurale et d'une volution vers le servage. Tout cela est un
phnomne gnral au IV
e
s., particulirement en Afrique o la
grande propritaire latifundiaire - impriale ou snatoriale - a tou-
jours tenu une place prpondrante. Dj au milieu du III
e
s.
Cyprien rapporte que : Les riches ajoutent les domaines aux domaines,
chassent les pauvres de leurs confins et leurs terres s 'tendent sans mesure et sans
bornes . Une clbre mosaque de Carthage - dite du Seigneur Julius
- reprsente un riche seigneur vivant dans une superbe villa qui res-
semble dj un chteau fort ; scnes de chasses, prestations de
paysans faisant penser des serfs, belle chtelaine entoure de ser-
vantes, montrent l'opulence de ces grands domaines ruraux et l'au-
torit qu'ils exercent dans les campagnes. L'volution fut cependant
plus lente dans une Tunisie trs urbanise, moins atteinte par la cri-
se ; l'action de l'tat et des snats locaux s'y est impose plus long-
temps que dans les provinces de Gaule ou d'Espagne. Le rgime de
la proprit tait toujours rgi par la loi mancienne qui donne au
paysan le droit de disposer librement de la terre, y compris celui de
la quitter. Mais le poids de redevances sans cesse plus lourdes limi-
tait singulirement cette libert thorique. En fait, les propritaires
lacs et ecclsiastiques trouvaient l'aide de l'tat pour asservir le
colon la terre, car il fallait assurer tout prix le recouvrement de
l'impt. La condition des hommes tendait ainsi se figer et la mobi-
lit sociale fut sans doute beaucoup moins grande au IV
e
s. Il semble
pourtant excessif de gnraliser la notion de servage car le paysan
conservait encore une libert thorique de ses mouvements ; on sait
qu'il y avait en Afrique une importante classe d'ouvriers agricoles
itinrants, les circoncellions, qui se rvoltent parce qu'ils veulent
prcisment conserver leur libert et secouer la tyrannie des grands
propritaires et des agents du fisc.
Les grands propritaires fonciers
Quant aux seigneurs ruraux, il est encore rare qu'ils s'isolent
totalement sur leurs domaines. Les plus puissants d'entre eux appar-
tiennent la noblesse snatoriale ou questre et vivent le plus sou-
Mosaque du Seigneur Julius
Trouve Carthage en 1921
Expose au muse du Bardo. 5,50 x 4,50 m.
Elle pavait la partie centrale d'une grande salle de rception d'une villa
situe en bas de Byrsa. Cette uvre exceptionnelle est conue en trois registres
superposs et les scnes sont agences autour du motif central reprsentant la
demeure du matre du domaine, le seigneur Julius dont le titre et le nom
apparaissent dans le rouleau d'une mEssive.
Les scnes reprsentent les travaux et les jours de la vie d'un domaine
agricole, sjour agrable pour le propritaire et sa femme entours de leurs servi-
teurs et de leurs mtayers. De part et d'autre de
l'imposant chteau, c'est, gauche, l'arrive cheval du seigneur sur
ses terres. A droite, c'est une scne de chasse.
Sur les registres suprieur et infrieur, sont prsentes les activits
saisonnires. En bas, droite, c'est l'automne : un serviteur apporte
une hotte de raisin et un livre. Le seigneur trne dans son verger et reoit un
messager lui apportant une lettre indiquant le destinataire : IVLIO DOMINO,
le seigneur Julius lui-mme. En haut, droite, c'est l't. La matresse
des cans se prlasse dans son parc l'ombre des cyprs et accueille des
serviteurs apportant des corbeilles de fleurs. En haut, gauche, c'est l'hiver :
deux paysans gaulent un olivier. Cette mosaque est l'un des
nombreux exemplaires reprsentant la vie d'un domaine agricole.
Elle illustre le maintien de la prosprit de l'Afrique jusqu' une priode
tardive et aussi l'art de vivre de ces aristocrates propritaires fonciers.
(Fin IV
e
- dbut V
e
s).
322 L'ANTIQUIT
vent en Italie o ils exercent des fonctions officielles ; leurs
domaines sont alors confis des rgisseurs qui se rendent fr-
quemment odieux auprs des paysans ; on sait qu'ils conservent un
certain attachement leur province d'origine et continuent de s'in-
tresser de loin la vie et l'embellissement de leur cit. Les autres,
qui sont les plus nombreux et dont le seigneur julius offre un
exemple, accaparent peu peu les prrogatives d' un Etat dfaillant,
surtout dans les domaines de l'impt et de la basse justice, mais ils
ont particip jusqu'au V
e
s. la vie municipale, contrairement ce
qui se passait en Gaule o le dclin rapide des villes a favoris l'as-
cension des potentats ruraux et l'asservissement des paysans.
Cette aristocratie foncire qui semble braver l'tat en lui arra-
chant privilges et immunits, en s'interposant entre lui et la masse
paysanne, s'est pourtant montre, par un paradoxe qui n'est qu'ap-
parent, son meilleur soutien dans la crise o l'Empire menaait de
sombrer ; car c'est elle qui, au IV
e
s., prit la dfense de la romanit
dans les campagnes. A la cit en dclin s'est superpos et parfois
substitu le domaine rural comme foyer de romanisation. C'est lui
qui diffuse dsormais la langue latine et le christianisme dans les
campagnes ; aussi faut-il viter d' opposer de faon trop systma-
tique les populations rurales celles des villes lorsqu'on veut tracer
les limites de la romanisation. Au IV
e
s., celle-ci a fait des progrs
spectaculaires dans les campagnes, mme dans les rgions que
Rome avait vacues ; les tribus berbres qui ont combattu sous les
ordres de Firmus et de Gildon n'taient nullement impermables
la romanisation et au christianisme. Leur rvolte n'tait pas un refus
de la civilisation romaine mais une raction spontane contre une
autorit centrale oppressive. Ce qui est nouveau au IV
e
s., c'est le
relchement de cette immense adhsion qui, l'poque antonine et
svrienne, attachait les provinciaux l'Empire ; la contrainte
bureaucratique du Bas-Empire fut incapable de matriser les forces
centrifuges qui tendaient briser l'tat ; celui-ci devenait une enti-
t abstraite, lointaine et en mme temps de plus en plus contrai-
gnante. Des puissances locales, comme le grand domaine rural et
l'glise, se substiturent lui pour encadrer les masses et assurer la
permanence de la civilisation romaine.
Mosaque reprsentant un domaine agricole
Tabarka. Muse de Bardo. 3.50 x 5.35m
Cette mosaque en demi-cercle a t dcouverte
Tabarka en 1890. Elle appartient un ensemble
comportant trois absides formant une exdre trilobe, illustre
des divers btiments d'une exploitation agricole.
Celle qui est figure ici pavait l'abside centrale, et est dcore
de la reprsentation du chteau du matre du domaine ;
on voit une demeure avec un tage flanque de deux tourelles relies
par une galerie en arcades. Un parc avec un verger et une
volire entoure cette belle proprit qui n 'est pas sans rappeler
celle du seigneur Julius trouve Carthage.
324
L'ANTIQUIT
III- La vie municipale et les villes
Ce phnomne apparat pleinement dans le dclin de la vie
municipale qui tait l'origine l'armature de l'implantation impria-
le et le foyer par excellence de la romanisation.
La vocation urbaine de la Tunisie romaine
La Tunisie avait t dans l'Occident romain l'une des rgions
les plus intensment municipalises ; cela tient au relief du pays,
la forte tradition urbaine qui, depuis l'poque punique, le distingue
du reste du Maghreb, la prcocit de la conqute romaine et du
mouvement de colonisation qui en est rsult. La vie municipale a
connu son apoge sous les Svres et la Tunisie comptait alors plus
de deux cents villes ; il s'agissait videmment de petits centres de
quelques milliers d'habitants, mais Carthage tait de trs loin la plus
grande ville d'Afrique du Nord et rivalisait avec les autres mtro-
poles mditerranennes telles qu'Alexandrie et Antioche.
Les villes formaient avec le territoire rural qui dpendait
d'elles, des organismes autonomes appels cits ; chacune avait ses
institutions locales - snat, magistrats - , ses monuments publics -
forum, thermes , ses temples, ses divinits, l'image de Rome. Jus-
qu' l'poque svrienne, les cits africaines ont bnfici d'une lar-
ge autonomie qui a facilit la promotion d'une bourgeoisie romani-
se soucieuse par ambition ou par vanit, d'assumer les charges de
la direction des affaires locales et de gagner les suffrages de ses
concitoyens par la construction de somptueux difices publics ou
privs. Les ressources tires de l'exploitation de la terre ou du com-
merce taient ptrifies dans les travaux d'urbanisme et profitaient
du mme coup la plbe oisive des cits qui pouvait passer ses jour-
nes aux thermes, rendre hommage ses dieux, et se distraire aux
jeux du cirque ou de l'amphithtre : il y avait l une forme d'assis-
325
tance sociale au petit peuple des villes, dicte par l'idal vergtique
de l'poque. La relative prosprit et le libralisme de la priode
antonine ont permis l'ascension rapide de ces bourgeoisies afri-
caines qui, dans le cadre d'une stricte obdience l'Empire et la
romanit, ont pu gouverner elles-mmes leurs cits et s'lever par-
fois jusqu' la noblesse questre ou snatoriale.
La crise municipale
Mais cette mobilit sociale n'a pas dur longtemps ; dj sous
les Svres et surtout aprs la crise de 238, on note un raidissement
qu'expliquent les difficults financires des cits, aggraves par les
exigences fiscales de l'tat.
Au libralisme et l'autonomie succdrent peu peu l'tatis-
me bureaucratique et la contrainte. Les charges municipales qui
taient des honneurs non rmunrs, sont devenues trs lourdes et
ne suscitaient plus le mme attrait. On eut tendance les fuir et la
dsertion des curies fut un phnomne frquent au IV
e
s. Les
dpenses somptuaires ont diminu et les constructions sont moins
nombreuses et moins brillantes que sous le Haut-Empire ; c'est de
l'poque antonine et svrienne que datent les plus belles ralisa-
tions de l'art romain en Tunisie. Les curiales se drobaient leurs
obligations et, plutt que d'assurer les lourdes charges de lever l'im-
pt, construire ou entretenir les difices d'intrt public, organiser
les jeux et les spectacles, subvenir au budget des cultes, ils se rfu-
giaient dans les ordres privilgis ou se retiraient sur leurs domaines
qu'ils parvenaient dtacher du territoire de la cit et soustraire
l'action des agents de l'empereur. Il fallait fuir des charges devenues
intolrables ; la noblesse snatoriale et questre, les bureaux de l'ad-
ministration impriale, le service militaire, l'appartenance au clerg
en confraient l'immunit ; on essaya donc de s'y rfugier en usur-
pant parfois des titres de noblesse. L' tat dut prendre des mesures
draconiennes pour combattre la dsertion des curies qui quivalait
DE LA CRISE DE LA CIVIL1SATI0N ROMAINE A L'ISLAM
326
L'ANTIQUIT
une destruction de l'ordre romain puisque l'Empire avait t di-
fi sur les cits qui en constituaient les cellules vivantes.
Attitude de l'Etat vis--vis du problme municipal
La charge curiale devint une fonction obligatoire et hrditai-
re. La condition des hommes fut rigoureusement hirarchise et
fige dans un statut immuable o l'hrdit devenait la rgle ; depuis
les clarissimes du Snat jusqu'aux esclaves, la socit tendait se stra-
tifier et se fermer. L'tat combattit les immunits, et freina l'as-
cension des curiales vers les classes privilgies ; l'empereur Julien
soumit les membres du clerg aux charges municipales. Les dcu-
rions entrant dans les ordres, devaient laisser leurs biens au service
de la cit. Toutes ces mesures n' ont empch ni la dsertion ni l'ap-
pauvrissement des curies ; un dcret de Constance II, datant du
milieu du IV
e
s., nous apprend que le snat de Carthage tait
presque dsert et que plusieurs dcurions rsidaient hors de la cit
tel point que, faute du quorum requis, on ne pouvait mme plus
procder aux dlibrations. Le plus grave, c'est que c'taient les l-
ments les plus fortuns - snateurs vivant la Cour ou grands pro-
pritaires fonciers comme le Seigneur Julius - qui se drobaient et
laissaient retomber tout le poids des charges sur la petite et moyen-
ne bourgeoisie des cits. C'est elle qui tait la plus atteinte par la cri-
se et qui souffrait le plus des rigueurs de l'tatisme. Or, cette classe
moyenne constituait prcisment l'lment le plus dynamique des
cits et le meilleur test du progrs de la romanisation de la provin-
ce ; sa progressive disparition au cours du IV
e
s. traduit le dclin de
la romanit.
Prosprit relative des cits romaines de Tunisie au IV
e
s.
Pourtant l'Afrique pouvait encore faire illusion ; la dsertion
des cits n'a pas t aussi prcoce qu'en Gaule et les villes tuni-
327
siennes taient toujours nombreuses et relativement prospres. La
classe curiale demeurait assez riche et continuait de participer acti-
vement la vie des cits. Le phnomne de l'autopragie qui dta-
chait le domaine rural de l'obdience municipale et donnait au pro-
pritaire le droit de percevoir directement l'impt sur ses terres, est
trs tardif en Afrique et on ne le signale, pour la premire fois,
qu'en 429. La survivance basse poque d'une classe curiale aise
est un caractre original de la province d'Afrique. C'est ce qui a per-
mis une renaissance de la construction aprs la crise du III
e
s. ; il y
a sans doute un essoufflement et un dclin relatif par rapport
l'poque prcdente ; les plus importantes ralisations sont mainte-
nant l'uvre de l'glise dont l'architecture connut un essor prodi-
gieux, mais l' effort des cits s'est poursuivi, pendant la Ttrarchie et
plus tard sous Valentinien, dont le rgne concida avec une vritable
renaissance ; beaucoup de monuments ont t restaurs et des di-
fices nouveaux furent construits. Un grand nombre d'inscriptions
font tat de restaurations ou de constructions avec le concours du
snat et de la plbe locale. Ainsi, Thuburbo Majus, de grands travaux
sont entrepris dans les thermes et au forum ; ils se poursuivront jus-
qu'au dbut du V
e
s. Aprs les difficults du III
e
s. qui ont entran
l'abandon de certains difices, la ville connut une vritable renais-
sance l'poque valentinienne et, sous le rgne d'Honorius, elle pou-
vait se proclamer respublica felix (cit heureuse).
La plupart des villes tunisiennes connurent un essor analogue
et se couvrirent de monuments nouveaux qu'il ne serait pas utile
d'numrer ici. Citons parmi les plus actives celles de la rgion ole-
cole du centre avec Sufetula (Sbetla), Cilium (Kasserine), Thelepte
(Friana) et sur la cte les ports de Thaenae (Thina), Taparura (Sfax).
Un important difice thermal pav de mosaque du IV
e
s. a t
rcemment fouill Thaenae ; une fontaine monumentale fut gale-
ment dcouverte Sufetula et atteste la poursuite des travaux
hydrauliques basse poque. Dans le nord du pays les mosaques du
IV
e
et V
e
s. sont nombreuses ; les plus belles proviennent de Tabar-
ca, de Dougga, de Carthage, de Jebel Oust o fut construit un vas-
te complexe thermal, proximit de l'tablissement actuel.
DE LA CRISE DE LA CIVIL1SATI0N ROMAINE A L'ISLAM
328 L'ANTIQUIT
Carthage, mtropole d'Afrique
A la veille de l'invasion vandale, Carthage faisait toujours figu-
re de grande mtropole mditerranenne. Aprs la prise de Rome
en 410, beaucoup de snateurs y ont cherch refuge et il tait cou-
rant de l'appeler la Rome africaine. La vieille ville conservait tout
son clat monumental et son rle de capitale politique, religieuse et
intellectuelle, c'tait aussi le principal centre industriel et le premier
port d'Afrique. Depuis le III
e
s. de nouveaux difices avaient t
construits, en particulier les nombreuses basiliques chrtiennes et
l'enceinte de Thodose II construite en 425, peut-tre aussi des
thermes difis sous la Ttrarchie aprs l'expdition victorieuse de
Maximien. Quelques temples paens, comme celui de Caelesfis,
furent dtruits au dbut du V
e
s. lorsque l'Empire, devenu rsolu-
ment chrtien et perscuteur, dcida la fermeture des grands sanc-
tuaires paens.
Les principales basiliques chrtiennes taient d'abord celles de
saint Cyprien, au nombre de deux, et la grande basilica Majorum o
furent ensevelies Flicit et Perptue qui avaient t martyrises au
dbut du III
e
s. ; cette basilique qui est trs mal conserve se pro-
longeait vers le nord par d'importantes ncropoles. L'enceinte de
425 partait de Borj Jedid, passait par la Malga et rejoignait le
Kram ; elle dlimitait la ville proprement dite mais n'englobait pas
certains difices publics comme le cirque et l'amphithtre qui sus-
citaient toujours le mme engouement, au grand dsespoir de saint
Augustin. l'intrieur de l'enceinte qui tait perce de neuf portes
s'tendait la ville groupe autour de ses trois collines. Le quartier
des ports tait toujours frquent par une foule nombreuse de com-
merants, armateurs, artisans, boutiquiers. L'loquence passionnait
le peuple et, c'est Carthage, que l'on s'initiait la rhtorique. Saint
Augustin y fit ses tudes suprieures et enseigna pendant plusieurs
annes dans la mtropole africaine.
Ville cosmopolite et brillante, Carthage vivait encore des jours
heureux l'poque o Rome devenait la proie des invasions bar-
329
bares. La socit carthaginoise demeurait l'une des plus raffines et,
si l'on en croit les tmoignages d'auteurs chrtiens comme Salvien,
l'une des plus corrompues. Augustin dplorait la passion des Car-
thaginois pour les plaisirs, les jeux du cirque et du thtre, mais
c'tait chose courante dans la mentalit de l'poque. La violence
extrme des historiens chrtiens dnoncer la luxure, la dprava-
tion, les murs contre nature des Carthaginois taient un lieu com-
mun des prdicateurs pour justifier les malheurs issus de l'invasion
vandale et en faire une marque de la colre de Dieu. Les auteurs
paens n'hsitaient d'ailleurs pas retourner le mme argument
contre l'glise en lui attribuant la responsabilit de toutes les catas-
trophes ; mais ils n'taient dsormais qu'une minorit car le chris-
tianisme prenait, partir du IV
e
s., une importance dcisive dans la
vie de la province, tant au point de vue spirituel que dans le domai-
ne des activits matrielles, sociales et politiques.
DE LA CRISE DE LA CIVIL1SATI0N ROMAINE A L'ISLAM
CHAPITRE IV
L'essor du christianisme et les conflits
religieux
I. - La perscution de Diocltien
Aprs les rigoureuses mais brves perscutions de Dce et de
Valrien, l'glise d'Afrique connut une nouvelle priode de paix au
cours de laquelle le christianisme continua de s'tendre. Sociologi-
quement la foi nouvelle faisait dsormais des adeptes tous les
chelons de la socit : le christianisme n'tait plus seulement la reli-
gion des esclaves et des humbles, il pntrait dans l'aristocratie, dans
la bourgeoisie municipale, dans l'arme. En mme temps, l'glise
s'organisait et s'enrichissait, devenant peu peu une vritable puis-
sance sociale et conomique. Sur le plan spirituel, une intense acti-
vit naissait des contacts avec les communauts chrtiennes
d' Orient et faisait du mme coup pntrer des hrsies comme cel-
le du manichisme. Cette religion nouvelle, originaire de Perse, tait
faite d' une synthse entre le christianisme et le zoroastrisme dualis-
te minemment asctique, elle aboutissait une condamnation tota-
le du monde matriel.
C'est sur cette glise en plein essor que s'est brusquement
abattue, la fin du rgne de Diocltien, la dernire et la plus violente
des perscutions. Les causes en sont d'abord le conservatisme des
332
L'ANTIQUIT
empereurs de la Ttrarchie qui ont voulu restaurer l'tat en ressus-
citant l'attachement aux divinits de la religion romaine tradition-
nelle ; Diocltien et Maximien ont pris respectivement les noms de
Jovius et Hercu/ius, fils de Jupiter et fils d'Hercule. Diocltien consi-
drait sans doute le christianisme comme une force dissolvante
dont il fallait dlivrer l'tat. Mais c'est l une cause trs gnrale ; du
reste, l'dit de perscution ne fut promulgu qu'en 303, huit ans
aprs l'avnement de Diocltien.
Les progrs du manichisme en Afrique ont davantage inqui-
t l'empereur qui voyait dans cette secte, un agent de la propagande
perse au moment mme o l'Empire affrontait, en Orient, une
guerre difficile contre les Sassanides. C'est en 297, pendant la guer-
re perse, que furent prises les premires mesures contre les mani-
chens.
Enfin, l'tat entendait imposer l'ordre et la discipline dans
l'arme afin de combattre avec efficacit les insurrections berbres
qui ont clat en Maurtanie au dbut de la Ttrarchie et ncessit
en 296, l'intervention personnelle du ttrarque Maximien. Les pro-
cs intents aux soldats chrtiens refusant de prendre les armes, se
situent prcisment pendant cette priode de troubles et d'intense
activit militaire ; on pronona alors de nombreuses peines de mort,
suivies d'excution.
Aprs les dits de 303 qui remettaient en vigueur l'arsenal tra-
ditionnel de la perscution, interrogatoires, obligation de sacrifier au
culte imprial, confiscations des livres saints et des reliques, il y eut
des violences plus systmatiques, mais elles n' ont pas dur long-
temps.
La perscution prenait fin ds 305 et fut beaucoup moins san-
glante qu'en Orient o l'empereur Galre la poursuivit encore pen-
dant quelques annes.
En vrit, s'il y eut des martyrs, la plupart des chrtiens, y
compris des prtres, faiblirent devant la perscution et apostasirent
comme au sicle prcdent, ce qui allait faire surgir dans les annes
suivantes une crise trs grave d' o naquit le donatisme. La paix,
revenue en 305, fut confirme par les dits de tolrance signs
DE L,i CRISE DE LA Cil ILISATION ROMAINE A LTSLAM 333
Milan en 313 par les empereurs Constantin et Licinius qui inaugu-
raient une priode nouvelle dans l'histoire du christianisme.
II. - L'glise et la paix constantienne
L'dit de Milan avait proclam le principe de la libert reli-
gieuse et engag l'Etat dans une politique de tolrance de plus en
plus favorable au christianisme. L'volution vers un Empire chr-
tien est un caractre fondamental du IV
e
s. ; elle se fit progressive-
ment car il fallait compter avec l'lment paen toujours nombreux
et hautement reprsentatif puisqu'il tenait une place trs importan-
te dans l'arme, dans l'aristocratie snatoriale et dans les milieux
intellectuels.
En fait, depuis 313 la plupart des empereurs se montrrent
favorables au christianisme ; seul le rgne de Julien (361-363) fut
marqu par une raction violente mais phmre du paganisme. En
tolrant puis en adoptant le christianisme, l'Empire entendait trou-
ver dans cette religion monothiste et universelle qui rpondait aux
aspirations de l'poque, un principe d'unit et de cohsion morale
et politique ; il voulait du mme coup mettre son service cette for-
ce nouvelle et en assumer la direction. L'glise fut ainsi incorpore
aux structures mmes de l'tat et en devint un rouage essentiel ;
bnficiant de la protection de plus en plus active de l'tat, elle put
rcuprer ses biens et dvelopper au grand jour sa puissance ; autre-
fois perscute, elle devint perscutrice et, avec l'aide dcisive du
bras sculier qu'tait l'empereur, elle engagea le combat contre le
paganisme et contre les nombreux schismes qui dchiraient alors le
christianisme. Mais l'empereur du IV
e
s. n'entendait pas seulement
tre un bras sculier, il exigeait un droit d'intervention dans toutes
les affaires temporelles et spirituelles ; il se considrait comme un
vritable chef du peuple chrtien, une sorte de nouveau David. Cet-
te double attitude : faveurs croissantes et bientt exclusives l'gli-
se et intervention dans les affaires spirituelles, eut finalement des
consquences nfastes pour l'tat, d'abord parce que la puissance
334 L'ANTIQUIT
de l'glise devint considrable et finit par contribuer la dsagr-
gation de l'Empire, ensuite parce que celui-ci usa ses forces et son
autorit dans les interminables querelles religieuses.
Grce la paix et aux privilges officiels dont il bnficiait,
le christianisme africain ralisa des progrs prodigieux au cours
du IV
e
s. ; l' Afrique du Nord romaine comptait alors prs de six
cents vchs, contre une centaine peine en Gaule. Toutes les cits
avaient leur vque, et il y en aura mme deux l'poque du schis-
me donatiste.
Le christianisme apparat alors comme la grande religion
conqurante ; il pntre largement dans la plbe de Carthage qui
exige, sous Honorius, la destruction du temple de Caelestis et son
remplacement par une glise. A Sousse, les grandes catacombes, qui
pouvaient contenir prs de treize mille cinq cent tombes, attestent
sa vitalit. Il en est de mme des innombrables ncropoles ou foi-
sonnent les symboles chrtiens tels que le chrisme constantinien,
l'ancre en forme de croix, la colombe, le poisson. Le christianisme
progresse galement dans les milieux ruraux les moins romaniss :
ainsi les rebelles de Firmus et de Gildon avaient dans leurs rangs de
nombreux chrtiens. Partout le pays s'est couvert de basiliques, cha-
pelles, baptistres et l'architecture religieuse connut un essor remar-
quable partir du IV
e
s.
Dsormais, on ne construit plus des temples, mais des glises.
En Tunisie, elles se comptent par centaines et l'archologie n'a pas
fini d'en rvler ; sept ont t dcouvertes Friana, autant Sbet-
la, une douzaine dans la rgion de Carthage. D'autres furent
fouilles la Skhira. La basilique africaine se prsente en gnral
sous la forme d' un difice rectangulaire divis en trois nefs et ter-
min par une abside semi-circulaire. A l'intrieur, la nef centrale
taient spare de chacun des bas cts par une range de colonnes
ou de piliers dont les arcades supportaient les murs percs de
fntres et le toit. Les grandes glises avaient leurs dpendances :
portiques, chapelles et baptistres, particulirement nombreux en
Tunisie, le pavement en mosaque constituant l'essentiel de la dco-
ration. Beaucoup de temples paens furent transforms en glises -
Mosaque tombale de Thabarca
Dcouverte en 1904. Expose au muse du Bardo. 2,30 x 1,15 m.
Elle faisait partie d'une srie trouve dans les vestiges d'une
chapelle chrtienne consacre des martyrs dans
les environs de Thabraca. L'intrt de cette mosaque rside dans
la reprsentation d'une basilique figure la fois en coupe
et en lvation avec rabattement sur un mme plan des diffrentes surfaces
horizontales ou verticales : la porte, prcde d'un perron de
cinq marches, donne accs trois nefs supportes par sept colonnes doriques.
La face latrale de droite apparat tout entire avec son entablement
rectiligne, ses six fentres, son toit en charpente recouvert de tuiles plates.
Le mur de gauche n 'est indiqu que par l'amorce de la
colonnade de base. L'autel, avec fenestella et trois cierges allums,
est au centre de la nef. Le presbyterium, reli la nef
par un escalier de quatre marches, est prcd d'un arc trois
arceaux supports par des colonnes corinthiennes. Il a la forme d'une
abside vote claire par une ouverture circulaire.
Cette basilique reprsente l'glise, Ecclesia mater, mre des fidles ,
ainsi que nous l'apprend l'inscription trace au-dessus de l'pitaphe
ddie Valentia, sur le mur de la nef.
336
L'ANTIQUIT
par exemple, le sanctuaire de Bal et Tanit Thuburbo Majus - mais
la plupart des difices chrtiens ont t construits aprs la paix
constantinienne. Aprs la conqute musulmane, certaines glises
devinrent des mosques : c'est le cas de la grande mosque du Kef
et de la mosque Sidi Okba de Sbiba.
/
Richesse et puissance de l'Eglise d'Afrique
La grande fivre de construction qui a multipli les sanctuaires
chrtiens souligne la considrable puissance matrielle de l'glise.
Celle-ci a fait rapidement fortune grce aux donations pieuses, legs,
faveurs personnelles de l'empereur ; les progrs du christianisme
dans les classes aises ont drain vers l'glise d'importantes res-
sources surtout foncires qui lui ont permis de suppler les curiales
dfaillants ou ruins pour subvenir certains besoins des cits. L' -
glise put ainsi raliser une uvre d'assistance publique, alimenter les
caisses de charit aux pauvres et aux orphelins, payer la ranon des
captifs ; cette uvre de bienfaisance ne fut pas toujours dsintres-
se et il lui arriva de servir d' arme de propagande contre les dona-
tistes ; saint Augustin lui mme n'hsitait pas donner le choix entre
la conversion ou l'aumne. Nouvelle puissance sociale et cono-
mique, l'glise prenait sa charge une part des dpenses publiques
et insufflait une vie nouvelle aux cits dclinantes. Les conciles
d'vques runis le plus souvent Carthage et la cration des trois
provinces ecclsiastiques de Proconsulaire, Byzacne et Tripolitaine,
entretenaient des contacts entre les diverses rgions du pays.
L'glise obtenait, en mme temps, d'importants privilges fis-
caux et judiciaires qui allaient en faire progressivement une sorte
d' tat dans l'tat. L'vque devient un personnage trs puissant
dont l'autorit, vivante et concrte, tait plus efficace que celle de
l'empereur trop loign et isol des masses par une lourde et inhu-
maine bureaucratie. L'vque eut son tribunal dont la juridiction fut
reconnue par l'tat et beaucoup ont prfr soumettre leurs litiges
l'vque plutt qu'aux agents de la justice impriale qu'ils connais-
saient peu et qu'ils craignaient. L'glise agissait ainsi comme une
Mosaque reprsentant une croix
Muse de Sbetla
Elle a t dcouverte dans une chapelle
dite de l'vque Honorius proximit de Sbetla.
Une croix monogrammatique avec une boucle droite o
chrisme s'inscrit sur fond blanc ; elle reprsente
les deux premires lettres du nom du Christ en grec.
Elle occupe tout l'espace de la mosaque et est
encadre droite et gauche par des rinceaux de rosiers.
L'alpha et l'omga qui reprsentent le dbut et la fin
des choses du monde sont inscrits de part
et d'autre de la croix. Remarquer les cabochons en pierres
prcieuses qui la dcorent.
338 L'ANTIQUIT
force de dissolution puisqu'elle dressait son autorit et sa puissance
face celles de l'tat ; mais elle contribuait du mme coup per-
ptuer la romanisation car cette glise tait un produit de l'Empire
et de la civilisation antique. Aprs la chute de Rome en Afrique, elle
demeura farouchement attache la romanit et mena une propa-
gande infatigable pour la reconqute ; c'est elle qui continua de dif-
fuser la langue et la culture latines.
Ses limites
Malgr ses progrs considrables, le christianisme tait cepen-
dant loin de l'avoir dfinitivement emport sur tous les cultes tradi-
tionnels. Le vieux paganisme romain et libyco-phnicien tait enco-
re largement rpandu dans les campagnes, dans l'arme ainsi que
dans certaines lites sociales ou intellectuelles. La courte raction
paenne sous l'empereur Julien fut accueillie par beaucoup avec
enthousiasme ; l'album municipal de Timgad montre que les dcu-
rions de cette ville taient encore paens en grande majorit. Le
clbre Symmaque qui fut en Occident l'un des chefs du parti paen
tait proconsul de Carthage en 373. cette poque, les paens
taient toujours trs nombreux dans la mtropole d'Afrique. Saint
Augustin raconte qu'il y avait assist aux ftes de Caelestis et il se
reproche d'avoir frquent trop souvent les jeux du cirque et de
l'amphithtre.
La perscution systmatique du paganisme commena dans
les vingt dernires annes du IV
e
s., mais elle ne le fit jamais dispa-
ratre entirement. Les jeux provinciaux de Carthage que Thodose
avait voulu supprimer, furent rtablis par Honorius ; les prtres
paens taient encore nombreux et bnficiaient mme de privi-
lges.
Certains usages du christianisme africain laissent apparatre de
nombreuses survivances paennes. Ainsi, la coutume des banquets
funraires que l'on organisait pour la fte des saints, comme celle de
Cyprien Carthage, donnait lieu des orgies nocturnes et de vri-
339
tables bacchanales ; l'extraordinaire succs du culte des martyrs
trouve sans doute son origine dans la vieille anthropolatrie numi-
de ; il y a une permanence du paganisme qui explique peut-tre
le caractre relativement superficiel de la christianisation et sa rapi-
de disparition aprs la conqute musulmane. Le paganisme n'tait
pas le seul adversaire ; il y avait aussi de nombreuses colonies juives
qui, aprs avoir pactis avec les chrtiens et facilit sans doute leur
expansion, ont rompu ds la fin du II
e
s. Le judasme africain tait
florissant au IV
e
s., comme en tmoignent la synagogue de Naro
(Hammam-Lif) ainsi que la ncropole de Gammart. Saint Augustin
qui a crit un trait contre les juifs mentionne d'autre part leur pr-
sence Hadrumetum, Tusuros (Tozeur), Utica (Utique). Violemment
perscuts par Justinien lors de la reconqute byzantine, beaucoup
de juifs se sont rfugis dans les montagnes de Numidie o ils firent
souche. C'est peut-tre pour cette raison que certains auteurs arabes
prenaient la mystrieuse Kahenna pour une juive.
La mentalit du clerg n'tait pas non plus trs difiante ; l'am-
bition, les intrigues lors des lections piscopales, les rivalits per-
sonnelles, l'esprit de clocher, tout cela tait chose courante. Beau-
coup d'vques se mettaient ostensiblement au service de l'Empire
et pactisaient avec le sicle, d' o les compromissions qui s'en sui-
vaient. Les scandales furent nombreux dans le diocse d' Hippone
que nous connaissons bien par la correspondance de saint Augus-
tin. Voil par exemple le prtre Abundantius qui dtourne une som-
me qu'un paysan lui avait remise et s'installe chez une femme de
mauvaise vie avec laquelle il s'attable pendant le jene ; voil enco-
re le jeune Antonius que saint Augustin avait fait lire vque de Fus-
sala, aux environs d' Hippone, et qui se conduisit de manire scan-
daleuse jusqu' tre traduit devant un tribunal ecclsiastique et accu-
s de graves attentats aux murs (stuprorum crimina capitalia), d' op-
pression, de rapines et de vexations de toute espce. Mais ce genre
d'abus n'tait nullement limit l'Afrique ; il tenait la promotion
de l'glise comme puissance temporelle ainsi qu' la mentalit de
DE LA CRISE DE LA CIVIL1SATI0N ROMAINE A L'ISLAM
340
L'ANTIQUIT
l'poque. L'lan monastique fut une raction contre les compro-
missions de l'glise avec le sicle.
Beaucoup plus graves devaient tre les querelles qui, au sein
mme de l'glise, ont dchir le christianisme africain. Ce fut le cas
du donatisme.
III. - La crise donatiste
Il s'agit d'un schisme qui pendant prs d' un sicle, divisa vio-
lemment les chrtiens d'Afrique, entranant l'intervention de la for-
ce impriale en faveur de l'orthodoxie catholique et provoquant
chez les schismatiques des rvoltes de caractre social et autono-
miste. Le catholicisme l'emporta au dbut du V
e
s., mais l'glise en
sortait affaiblie et le donatisme n'avait pas disparu.
Ses causes
L'origine de la crise remonte aux nombreuses dfaillances
enregistres lors de la perscution de Diocltien. Il n'tait plus ques-
tion cette fois des fidles, mais seulement des vques qui avaient
consenti livrer les critures et les reliques aux agents impriaux
venus perquisitionner dans les glises conformment au premier
dit de Diocltien. L'vque de Carthage Mensurius fut accus
d'avoir livr les critures alors qu'il n'avait donn, en ralit, que des
livres hrtiques. Aprs la mort de Mensurius, l'archidiacre Ccilien
fut lu vque en 307, mais il se heurta l'opposition du parti rigo-
riste appuy par l'piscopat de Numidie dont l'hostilit la prima-
tie de Carthage ne fut pas trangre la crise. Un concile d'vques
numides se runit Carthage et pronona la dposition de Ccilien
sous prtexte que son lection tait entache de nullit car un tra-
diteur y avait particip ; le concile lit un nouvel vque auquel
succda, peu de temps aprs, Donat le Grand qui allait donner son
nom au schisme. Ccilien refusa de s'incliner : c'tait le dbut de la
crise. Deux glises allaient s'opposer dans une lutte farouche jus-
qu'au dbut du V
e
s.
DE LA CRISE DE LA CIVILISATION ROMAINE L'ISLAM 341
/
Attitude de l'Etat et volution du schisme
L'tat intervint immdiatement dans le conflit, ce qui contri-
bua aggraver les haines ; aussitt aprs la paix de Milan, Constan-
tin convoqua un concile qui se pronona contre les schismatiques
qu'il accusait de perturber la cohsion de l'glise et l'ordre public ;
l'tat mettait son autorit et sa force au service du catholicisme
devenu religion officielle. Aprs une perscution qui dura cinq ans
et fit de nouveau couler le sang des chrtiens, Constantin, par une
de ces volte-face qui lui taient coutumires, promulgua en 321, un
dit de tolrance.
Le donatisme fit alors des progrs rapides, s'empara par la for-
ce des glises, organisa son propre clerg ; la plupart des villes
avaient dsormais deux vques, deux clergs, deux glises. L'tat
ne pouvait tolrer cette situation qui troublait l'ordre public et por-
tait atteinte au principe fondamental d'unit. La perscution reprit
en 347 sous Constant ; une violente rpression policire dirige par
les commissaires impriaux Paul et Macaire s'abattit sur la Numidie.
On fit la chasse aux donatistes dont les lieux de culte furent confis-
qus et le clerg dispers. L'unit semblait rtablie, et le pouvoir
imprial affirmait son troite solidarit avec l'glise catholique
devenue partie intgrante de l'ordre et de la lgalit, alors que les
donatistes faisaient figure de sparatistes et de rebelles. Mais la cri-
se rebondit sous Julien qui, par hostilit au christianisme, rendit aux
donatistes leurs glises et leur libert, en mme temps qu'il rappelait
les bannis.
Le schisme connut un nouveau rveil, beaucoup plus violent
cette fois, car il trouva l'appui du proltariat rural et des grands
chefs berbres en guerre contre Rome. Cette collusion aggrava la
rigueur de la rpression ; aprs Valentinien, le donatisme n'tait
plus poursuivi en tant que crime contre l'unit mais comme une
hrsie ; de violentes reprsailles frapprent les partisans de Gil-
don. Le donatisme tait en outre affaibli par des divisions internes :
la primatie de l'vque donatiste de Carthage soulevait les mmes
342
L'ANTIQUIT
rsistances et faisait clater le schisme maximianiste qui fut particu-
lirement actif en Byzacne et en Tripolitaine et fit passer trois le
nombre des glises chrtiennes. A ces divisions, ainsi qu' l'action
rpressive du pouvoir imprial, venait s'ajouter la polmique de
saint Augustin dont la forte personnalit joua un rle considrable
dans la lutte contre le schisme.
En 405, une loi d'Honorius ordonnait de rtablir l'unit reli-
gieuse et en 411 la confrence contradictoire de Carthage consacrait
le triomphe du catholicisme.
Signification du donatisme
Plus que les pripties de la lutte, il importe de saisir les causes
profondes du schisme et, pour cela, d'en dfinir les caractres.
L'glise donatiste se distingue par son intransigeance et son
sectarisme ; elle affirme avec force que la saintet doit tre rigou-
reusement spare de la souillure du pch et se considre elle-
mme comme la seule et vritable glise des saints et des martyrs.
L'ide de saintet et de sparation est la base de la doctrine. C'est
pourquoi les sacrements administrs par les prtres traditeurs
taient considrs comme nuls parce que souills d'impuret. Selon
les donatistes, toutes les provinces avaient apostasi parce qu'elles
avaient accept le baptme des traditeurs ; la seule glise du Christ
tait dsormais la leur, dt-elle se limiter la seule communaut
donatiste d'Afrique. Cette intransigeance doctrinale a conduit aux
violences, au fanatisme et une vritable martyromanie que l'on
remarquait dj chez Tertullien. Le martyre, c'est le baptme par
excellence, le baptme du sang, qui permet de distinguer les justes
des pcheurs ; il y avait l une vision sparatiste du monde dont l'ex-
trmisme constitue un aspect de la mentalit religieuse africaine. A
cet gard, le donatisme apparat comme un refus de la paix de l'-
glise qui, en mettant fin aux perscutions, facilitait les compromis-
sions et mlait les justes aux impurs.
Cette attitude sectaire a conduit au sparatisme sur le plan
politique. Le donatisme qui, aprs avoir sollicit l'arbitrage de
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM 343
Constantin, repoussa la paix de l'glise, demeura en guerre ouverte
avec l'Empire ; il s'affirma peu peu et surtout aprs les perscu-
tions de Constant comme un mouvement exclusivement africain
qui s'appuyait sur l'lment berbre pour combattre l'glise catho-
lique romaine. Les donatistes sont nombreux aux cts de Firmus
et de Gildon, mais rien ne prouve l'existence d' un sentiment natio-
nal berbre aliment par le donatisme.
Donatistes et circoncellions
Il semble plus probable que les schismatiques ont fait des
adeptes dans les classes les plus pauvres, donc les moins roma-
nises ; c'est la masse des ouvriers agricoles ou circoncellions, qui,
aprs le milieu du IV
e
s., constitua la troupe de choc du donatisme.
Comme l'a montr Charles Saumagne, les circoncellions n'taient
pas un ramassis de vagabonds et de hors-la-loi terrorisant les cam-
pagnes, mais un proltariat rural de condition libre, occupant une
situation dtermine dans la hirarchie sociale, au-dessus des colons
et des esclaves. Les ouvriers formaient une main d'uvre mobile et
saisonnire, hostile la lgislation de l'poque, qui voulait asservir
les paysans la glbe, d' o les rvoltes et les violences dont souffri-
rent les campagnes.
Plus qu'un mouvement social, la rvolte des circoncellions
tait une affirmation spontane d'individualisme contre le corpora-
tisme tatique. Le donatisme y trouva des allis dans la mesure o il
se dressait, lui aussi, contre l'ordre et contre les catholiques qui
comptaient, dans leurs rangs, la plupart des grands propritaires
fonciers ; cette alliance tactique ne doit pas faire du donatisme un
mouvement proltarien ; au lendemain de la Confrence de 411, un
dit d'Honorius tablissait un barme des amendes que devaient
payer les donatistes et, ct des circoncellions, on y mentionnait
des snateurs et des chevaliers. On sait en outre que les vques
donatistes ont, plusieurs reprises, sollicit l'aide des troupes imp-
riales contre les circoncellions. On sait aussi qu'il y avait des circon-
cellions catholiques. Mais la majorit d'entre eux se sont rallis au
CIVILISATION
344
L'ANTIQUIT
schisme parce que les catholiques reprsentaient leurs yeux l'ordre
social et la grande proprit ; ils taient galement sduits par cette
ide de sparation sur le plan sociologique qui leur faisait consid-
rer le donatisme comme la religion des pauvres. Revenant la mora-
le chrtienne traditionnelle ainsi qu'aux ides dj dveloppes par
Tertullien et Cyprien, le donatisme condamnait la richesse au nom
de la saintet. La rvolte des dshrits trouvait ainsi une justifica-
tion morale et un stimulant.
En dfinitive, le donatisme apparat la fois comme une
scession morale par le refus d'accepter la paix constantinienne et le
retour un christianisme d'opposition intransigeant et sectaire ;
comme la manifestation d'un autonomisme provincial, dans la
mesure o ce fut un phnomne presque exclusivement africain, en
guerre contre l'Empire ; comme une rvolte du proltariat rural
contre l'oppression toujours plus lourde de l'tat et des grands pro-
pritaires fonciers (il s'agit surtout des populations peu sdentaires
de Numidie et de Maurtanie, ce qui laisse la Tunisie plus ou moins
en marge de la rbellion sous sa forme violente).
Mais il serait d' un schmatisme erron que de voir dans le
conflit entre catholiques et donatistes une opposition entre deux
races et deux civilisations ; celle-ci n'a jamais exist et un homme
comme Donat le Grand tait profondment romanis. L'origine de
la crise fut le rsultat de querelles et de rivalits dans le clerg
d'Afrique ; par la suite, si l'on exclut l'action pisodique des circon-
cellions, l'pret du conflit tient au fait qu'il s'agissait d'une guerre
de frres ennemis : deux vques, deux glises qui vivaient cte
cte dans la mme ville, se rencontraient tous les jours et se dispu-
taient les fidles.
Mais cette longue lutte fratricide a finalement us les forces du
christianisme et de la romanit face l'invasion vandale ; elle a divi-
s le pays et ht l'volution qui tendait le dtacher de l'Empire.
Pourtant le prestige du christianisme africain tait encore
immense au V
e
s., illustr par la personnalit considrable de saint
Augustin.
Portrait de saint Augustin (354-430)
Alors que l'iconographie occidentale du Moyen Age et de la Renaissance figure-
ront saint Augustin en reprsentation de gloire et de majest avec mitre et crosse,
la fresque de la basilique du Latran Rome, est la reprsentation la plus ancienne
(VI" s.) et le plus proche de l'poque de l'vque d'Hippone; on y voit ce dernier
sous l'aspect austre, tel qu'il devait apparatre devant ses fidles, du haut de sa
chaire : vtu d'une tunique de laine blanche, sans ornement, mais dans l'attitude
fervente du prtre enseignant et prchant.
C'est la reprsentation dpouille du Matre, pre de l'Eglise, anime
de toute l'ardeur de sa foi et de sa mission : sauver les hommes par la concorde,
l'amour et le pardon.
346 L'ANTIQUIT
IV.- Sai nt August i n
N en 354 Thagaste (Souk Ahras) en Numidie, Augustin tait
un africain de souche, un berbre ; il appartenait cette petite bour-
geoisie municipale, atteinte par la crise du IV
e
s. Son pre Patricius
tait paen, mais sa mre Monique avait embrass, avec ardeur, le
christianisme. Comme toute la jeunesse de son temps, il reut une
culture classique presque exclusivement latine, d' abord Thagaste
puis Carthage o il fit des tudes suprieures de rhtorique. Sen-
sible et d' un temprament fougueux, il eut une jeunesse agite et se
laissa enivrer par les plaisirs et les attraits de la grande mtropole
africaine. Il prit une matresse et se passionna pour les jeux du
cirque et du thtre. Devenu chef de famille aprs la mort de son
pre vers 374, il prit une chaire de rhtorique et enseigna l'loquen-
ce pendant dix ans. Sa personnalit trs brillante cachait une sensi-
bilit ardente et torture. Il s'intressa la philosophie, ce qui tait
devenu exceptionnel pour les rhteurs de son temps ; la lecture de
l'Hortensius de Cicron causa sur lui une profonde impression et
l'initia au platonisme. Sa religiosit inquite le fit adhrer pendant
plusieurs annes l'hrsie manichenne puis l'astrologie.
Du et fatigu du chahut de ses tudiants, il quitta Carthage
pour l'Italie en 383 ; aprs un sjour Rome, il s'tablit Milan o
il subit l'influence de l'vque Ambroise et fit connaissance avec la
philosophie noplatonicienne. C'est l qu'il se convertit au christia-
nisme l'ge de trente deux ans.
De retour Thagaste, il vendit les biens paternels et organisa,
avec quelques amis, une sorte de communaut o il vcut dans l'as-
cse et la mditation, dcid renoncer au monde. C'est malgr lui
qu'il fut ordonn prtre d' Hippone et consacr, quatre ans plus tard,
vque de cette ville (395) o il devait siger pendant trente-cinq ans
jusqu' sa mort dans la cit assige par les Vandales (430).
Augustin fut donc un vque et un homme d'action. Intellec-
tuel, il sortit de sa tour d'ivoire et se consacra aux ralits quoti-
diennes et accablantes de l'administration de son diocse ; il rendait
Baptistre de l'glise du Prtre Flix
Trouv en bordure de mer Demna, 8 km de Klibia en 1953. Dpos,
transport et conserv au muse du Bardo.
Le baptistre jouxtait l'abside d'une basilique cimteriale dont le pavement
tait couvert de plus de cinquante mosaques tombales (dont un
exemplaire figure ici la page 405). C'est dans ce local que le catechumne
tait baptis par immersion. La cuve baptismale a t trouve dans un tat de
conservation exceptionnel. Elle a une forme en croix quadrilobe
et comporte deux marches offrant des surfaces arrondies, tantt convexes et tantt
concaves. Elle est tapisse d'une mosaque au dcor polychrome. Inscrit
dans un carr de 3,30 m de ct, ce dcor prsente quatre cratres occupant les
angles, chacun laissant chapper deux rinceaux symtrique encadrant
le rebord circulaire et relev de la cuve proprement dit.
Celle-ci s'enfonce de deux paliers une profondeur de 1 m, offrant un fond circu-
laire de 75 cm de diamtre : un chrisme croix latine avec le a et le CO s'y inscrit.
Les parois et les marches de la cuve sont dcores de motifs iconographiques
d'ordre vgtal (olivier, palmier, figuier, grenadier) et animal (colombes
et dauphins) accompagns de symboles chrtiens consistant en croix et chrismes.
Une longue inscription se droule sur le rebord suprieur entourant la cuve. La
traduction du latin en est : EN L'HONNEUR DU SAINT ET BIENHEUREUX EVQUE
CYPR1EN, CHEF DE CETTE GLISE AVEC LE SAINT PRTRE ADELFIUS, AQUINIUS ET SA
FEMME JULIANA AINSI QUE LEURS ENFANTS VILLA ET DEOGRATIAS ONT POS CETTE
MOSAQUE DESTINE L'EAU ETERNELLE (c'est--dire la clbration
du baptme). Cette cuve devait tre surmonte d'une coupole supporte
par quatre piliers massifs formant un kiosque attenant la basilique.
Une inscription figurait sur le seuil d'accs : PAX, FIDES CARITAS (PAIX, FOI,
CHARIT). Ce baptistre appartient au dernier tat de l'glise
lorsqu'elle a t remanie et restaure, l'poque byzantine
au cours du VI
e
s.
348 L'ANTIQUIT
la justice tous les jours jusqu' midi et sigeait parfois jusqu'au
soir ; il administra les biens du clerg, convoqua des conciles, pr-
sida des colloques, entreprit de multiples voyages Carthage. Pol-
miste il combattit les schismes avec une ardeur infatigable, et joua
un rle dcisif dans la lutte contre le donatisme. Aprs la confren-
ce de 411, qui fut son oeuvre, il s'en prit l'hrsie plagienne qui
minimisait la notion de pch originel et de prdestination pour
mettre l'accent sur le libre-arbitre et le mrite individuel de l'hom-
me. Il multiplia galement les attaques contre toutes les hrsies,
paenne, juive, arienne, manichenne.
Thologien et philosophe, il crivit la Cit de Dieu o il rfutait
les accusations des auteurs paens qui, au lendemain de la chute de
Rome en 410, imputaient au christianisme la source des malheurs
dont souffrait l'Empire. La Cit de Dieu tait surtout une tentative
pour dfinir une philosophie chrtienne de l'histoire et devait avoir
une grande porte dans l'volution de la chrtient mdivale. Son
uvre fut norme : cent treize ouvrages, deux cent dix-huit lettres,
cinq cents sermons conservs o apparaissent la fois les qualits
de l'orateur, du penseur et de l'crivain. Les Confessions qui racontent
l'histoire mouvante d'une me, sont devenues un classique de la lit-
trature. Augustin apporta une contribution essentielle au triomphe
et l'essor du catholicisme ; homme d'action, diplomate habile et
organisateur, il sut demeurer un contemplatif qui ne se dtourna
jamais de sa vocation monastique. Il fut le promoteur du mona-
chisme africain qui se dveloppa rapidement au V
e
s., particulire-
ment en Byzacne grce des disciples de l'vque d'Hippone.
La vie et la personnalit de saint Augustin ont fait briller d' un
dernier clat la romanit africaine ainsi que la grande culture latine
en Occident dont il sut recueillir et transmettre l'hritage. Saint
Augustin est contemporain de la dcadence et de la chute de l' Em-
pire en Occident ; il mourut Hippone un an aprs le dbarque-
ment des Vandales qui ont mis fin la domination romaine et inau-
gur une priode nouvelle dans l'histoire de la Tunisie antique.
B. - LA TUNISIE VANDALE
CH APITRE I
Un grand conqurant : Gensric
I. - L'invasion vandale
Au dbut du V
e
s., le flot des invasions barbares dferla sur les
provinces occidentales de l'Empire ; la frontire du Rhin fut prise
d'assaut et franchie le 31 dcembre 406 par les tribus germaniques
des Vandales, Alains et Suves qui, aprs avoir travers et saccag la
Gaule, passrent en Espagne o elles s'tablirent. Pendant ce temps
les Wisigoths d'Alaric sillonnaient l'Italie et occupaient la Ville ter-
nelle. Ces vnements catastrophiques n'allaient pas tarder
atteindre l'Afrique livre, elle aussi, l'anarchie. Dj en 410, puis en
418, les Wisigoths avaient envisag d'y dbarquer pour s'emparer
des riches terres bl. Quelques annes plus tard, en 429, les Van-
dales installs dans le sud de l'Espagne, franchissaient le dtroit de
Gibraltar et entreprenaient la conqute de l'Afrique romaine o ils
fondrent un tat nouveau qui allait durer plus d'un sicle.
Causes de la conqute
L'ordre en Afrique tait alors troubl par la rbellion du com-
te Boniface contre la cour impriale de Ravenne. Boniface qui avait
aid, au lendemain de la mort d'Honorius, l'impratrice Galla Vlacidia
dfendre les droits de son fils, le jeune Valentien III, se jugea mal
rcompens et perdit rapidement son crdit auprs de la rgente,
350
L'ANTIQUIT
la suite d'intrigues de cour. Il manifesta d'abord une attitude ind-
pendante en pousant une arienne et en tolrant le donatisme, ce
qui lui valut l'hostilit des catholiques et les reproches de son ami
saint Augustin. Convoqu Ravenne, il refusa d'obir et fut dclar
ennemi public ; une arme, commande par le Goth Sigisvult, fut
dirige contre lui en 428. Ainsi Boniface aurait alors fait appel aux
Vandales.
Cette prtendue trahison du comte d'Afrique n'est pas abso-
lument prouve ; elle semble peu probable, car, la veille du dbar-
quement vandale, le gouvernement de Ravenne avait rappel Sigis-
vult et rtabli Boniface dans ses fonctions. Quoiqu'il en soit, la
rbellion a pu faire le jeu des Barbares en leur offrant une proie
affaiblie par l'anarchie qui venait s'ajouter aux difficults sociales et
religieuses, mais elle ne saurait en tre la cause. Mme si Boniface
avait trahi, son appel n'aurait pas suffi pour dcider les Vandales
tenter l'aventure.
Ce sont les Barbares eux-mmes et, au premier chef, leur nou-
veau roi Gensric, qui ont voulu l'expdition. Traqus par les Wisi-
goths en Espagne, ils ont voulu chercher refuge au sud de la Mdi-
terrane pour y trouver un tablissement stable, l'abri d'ven-
tuelles poursuites et de nouvelles guerres, suivies de nouveaux
exodes. C. Courtois a bien montr que les Vandales n' taient pas
des nomades professionnels condamns une mobilit permanente, mais des
sdentaires dracins par la faim . Pris dans le flot des grandes migra-
tions de peuples, ils taient la recherche de la terre promise : ce
furent d'abord les plaines d'Aquitaine et d'Andalousie. Gensric
voulut fixer dfinitivement son peuple sur les riches terres cra-
lires d'Afrique, lui pargner les vicissitudes de l'exode perptuel et
le rassembler pour fonder un tat. L'Afrique, prospre et lointaine,
rpondait pleinement ces desseins.
Les tapes de la conqute
L'expdition vandale n'a pas t une simple promenade mili-
taire. Carthage ne tomba qu'en 439, dix ans aprs le dbarquement
Bijoux de Koudiat Zateur (Carthage)
C'est un ensemble de bijoux trouvs en 1915 dans un sarcophage
de marbre blanc ayant appartenu une riche chrtienne du V
e
s.
Comprenant un collier, des fibules, des bagues,
des appliques et de petites plaques carres ou triangulaires,
d'or et de pierres prcieuses utilisant la technique
du sertissage cloisonn, cette parure appartient
l'art des grandes invasions.
352 L'ANTIQUIT
sur la cte de Maurtanie tingitane, et ce n'est qu' la mort de Valen-
tinien III, en 455, que Rome fut dfinitivement chasse d'Afrique.
Coups de force et traits diplomatiques ont jalonn cette lente di-
fication de l'tat vandale dans laquelle on peut distinguer trois
phases.
Du dbarquement Tanger au trait de 435
En 429, quatre-vingt mille Vandales, hommes, femmes,
enfants et vieillards, dbarquent prs de Tanger et s'avancent vers
l'est par voie terrestre ; aprs des combats en Oranie, ils parviennent
en t 430, sous les murs d' Hippone qui n'est prise qu'aprs un long
sige de quatorze mois ; pendant ce temps, les tribus barbares rava-
gent les campagnes de Proconsulaire. Les troupes impriales com-
mandes par Boniface sont vaincues deux reprises et les renforts
envoys de Constantinople subissent le mme sort. En 435, l' Em-
pire se rsigne ngocier ; il reconnat aux Vandales les qualits de
fdrs et leur concde les territoires romains de Maurtaine siti-
fienne et de Numidie. Juridiquement, le chef vandale mettait ses
hommes au service de l'Empire qui, en change, leur donnait des
terres ; il n'exerait pas de souverainet territoriale et son autorit se
bornait commander les Barbares. Les apparences taient sauves,
puisque l'Afrique demeurait dans l'Empire ; mais ce n'tait qu'une
fiction juridique, car Gensric se comporta en fait comme un sou-
verain et imposa son autorit aux Africains comme aux Vandales.
Du trait de 435 la mort de l'empereur Valentinien III
La paix de 435 n'tait qu'une trve ; ni l'une ni l'autre des deux
parties ne la considraient comme dfinitive. Ce que voulait Gens-
ric, c'taient les riches terres bl de Proconsulaire et de Byzacne.
En 439, profitant sans doute de nouvelles dfaites romaines en
Gaule, il s'empara brusquement de Carthage. L'Empire, impuissant
et plac devant le fait accompli, conclut un nouveau trait en 442.
Gensric recevait la Proconsulaire, la Byzacne, la Tripolitaine ainsi
353
que la Numidie orientale ; ces territoires, les plus riches de l'Afrique
romaine, taient placs dsormais sous la souverainet vandale. Les
Barbares n'avaient plus la condition de fdrs au service de l' Em-
pire ; ils devenaient un peuple indpendant et souverain. Rome
rcuprait symboliquement les territoires de l'ouest qui, en fait,
furent abandonns des roitelets berbres plus ou moins romani-
ss ; pour sauver les apparences, Valentinien III obtenait que Gen-
sric verst un tribut et envoyt son fils Hunric comme otage la
cour de Ravenne.
La rupture avec l'Empire
Aprs la mort de Valentinien III en 455, Gensric occupa sans
doute la rgion de Constantine ainsi que quelques villes sur la cte
des Maurtanies. Mais le royaume vandale n'a jamais concid avec
la totalit de l'ancienne Afrique romaine. L'Aurs fut mme aban-
donn sous le rgne d'Hunric, peut-tre plus tt. L'Afrique vanda-
le correspondait l'actuelle Tunisie, au nord-est de l'Algrie et au
littoral tripolitain. C'tait l'Afrique du bl, de l'olivier et des villes,
l'Afrique la plus riche et la plus romanise.
Le vandalisme
Il est de coutume de prsenter les Vandales comme des sau-
vages assoiffs de sang et possds par la rage de dvaster ; le mot
vandalisme a pris dans le langage courant la valeur de folie destruc-
trice.
En fait ces accusations furent colportes par les chroniqueurs
et historiens catholiques qui avaient intrt les exagrer parce que
les Vandales taient des Ariens. Le clerg catholique qui, avec l'aris-
tocratie foncire, tait demeur fidle au rgime imprial, mena une
propagande de dnigrement systmatique contre le nouvel occu-
pant. Les Vandales furent accuss des pires atrocits : pillage, incen-
dies, destruction d'uvres d'art, viols, massacres...
Certes, les violences n' ont pas manqu, mais elles taient cho-
se courante en temps de guerre et correspondaient la cruaut des
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
354 L'ANTIQUIT
murs de l'poque. L'empereur chrtien Thodose n'a-t-il pas froi-
dement fait passer au fil de l'pe les sept mille spectateurs du
cirque de Thessalonique parce que le public, mcontent de l'arres-
tation pour cause de pdrastie d' un champion du cirque, s'tait
rvolt en massacrant le matre des Milices d'Illyrie? Les Vandales
appartenaient ce V
e
s. violent et cruel ; ils furent des hommes de
leur temps. Ariens, ils ont perscut les catholiques, mais ceux-ci ne
songeaient pas leur reprocher les violences infliges aux mani-
chens.
L'uvre de Victor de Vita, source essentielle pour la connais-
sance de la priode vandale, n'est en fait qu'un long plaidoyer desti-
n l'opinion et la cour de Constantinople dont il fallait obtenir
l'intervention pour chasser les Barbares. Quant aux sermons de
l'vque Quodvultdeus, qui rapportent les atrocits commises lors de
la prise de Carthage en 439, ils forment un violent rquisitoire anti-
arien, sans accusations prcises.
Du reste, l'archologie ne rvle pas de destructions qu' on
puisse coup sr imputer aux Vandales ; le nombre des martyrs est
trs limit. La conqute vandale n'a pas ravag le pays ; une fois
rpars les dgts invitables de l'invasion, la vie a repris comme par
le pass, sans qu'il y ait rupture avec la priode prcdente. La mas-
se de la population indigne ne semble pas avoir considr la
conqute comme un vnement catastrophique et ne s'est pas sou-
leve contre les Barbares.
Les grandes invasions des nomades musulmans au XI
e
s. lais-
seront beaucoup plus de traces que le passage des Vandales en
Afrique.
II - L'organisation intrieure du royaume
vandale
L'tat vandale qui, aprs un sicle d'existence, allait disparatre
de l'histoire, fut le rsultat de la volont d'un homme. C'est Gens-
ric qui l'a voulu et conu. Entreprise la fois gigantesque et ph-
355
mre, il ne survivra pas longtemps son fondateur. Aprs la dispa-
rition du grand souverain barbare, on assiste une lente dgradation
travers laquelle apparaissent les limites et les dfauts de l'uvre
qu'il avait rv de raliser.
Gensric
Au moment de la prise de Carthage en 439, Gensric avait une
cinquantaine d'annes. Au physique, c'tait un homme petit et tra-
pu, qu'un accident de cheval avait rendu boiteux. Son got pour les
plaisirs de la table et de la boisson lui ont donn une allure massive
qui, dans les dernires annes de sa vie, tournera l'embonpoint.
Fils du roi Godagisel et d'une esclave, c'tait un btard que
rien ne prdisposait au trne. Ambitieux et rus, il savait tre cruel
et impitoyable. L'historien Procope raconte qu' la suite d'une exp-
dition sur les ctes du Ploponnse, il aurait ordonn de jeter la
mer cinq cent notables, aprs les avoir fait tailler en morceaux. Vou-
lant marier son fils Hunric avec la jeune princesse impriale
Eudoxie, il lui fit rpudier sa premire femme, qui tait la fille du roi
des Wisigoths Thodoric et aurait renvoy celle-ci chez son pre
aprs lui avoir fait couper le nez et les oreilles.
Personnalit vigoureuse et fruste, il demeura un chef barbare
et ne sut jamais bien parler le latin, contrairement ses successeurs
qui subiront beaucoup plus que lui l'attrait de la civilisation romai-
ne. Arien convaincu, il l'tait sans fanatisme et s'il a combattu le
catholicisme, c'tait pour des raisons politiques ; il a voulu briser la
puissance du clerg qui nuisait son autorit, mais il n'a pas pers-
cut le catholicisme en tant que religion.
Guerrier farouche, il savait tre diplomate et allier la force
l'habilet ; convoitant avec tnacit les plaines agricoles de Tunisie,
il sut attendre plusieurs annes avant d'y parvenir. Il acceptait de
ngocier avec l'Empire, mais n'hsitait pas violer les traits.
Gensric avait toutes les qualits du chef : l'autorit, le sens de
la dcision, l'audace, la ruse, la dtermination. Il a russi fonder le
premier royaume barbare indpendant de l'Empire dans le pays qui
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
356
L'ANTIQUIT
tait alors le plus prospre et le plus convoit ; il en a fait le seul tat
germanique hors d' Europe. A la tte de hordes barbares indiscipli-
nes, accoutumes l'anarchie tribale, il a pu fonder une monarchie
absolue et briser l'opposition tenace de l'aristocratie foncire et de
l'glise catholique d'Afrique.
Son uvre fut pourtant sans lendemain, car elle procdait
d' un rve grandiose mais chimrique. Isol du monde germanique,
coup de l'Empire, greff artificiellement sur une masse indigne
passive, le royaume vandale tournait vide. Seuls un concours de
circonstances favorables et la trs forte personnalit de Gensric
ont pu lui permettre d'exister et de durer un sicle.
L'Etat vandale : Les institutions politiques
Gensric a voulu regrouper ses tribus barbares sur une base
territoriale restreinte afin de les soumettre son autorit absolue ; il
a dtruit les structures tribales de son peuple et cr une monarchie
o le roi qui, l'origine n'tait qu' un simple chef de guerre, deve-
nait un monarque absolu et hritait des anciens pouvoirs de l'em-
pereur. Le roi des Vandales se considre empereur dans son royau-
me et traite sur pied d'galit avec Ravenne et Constantinople.
Une re nouvelle commence Carthage et adopte comme rfren-
ce l'avnement du souverain alors que l'Afrique non vandale conti-
nue d'utiliser le vieux systme de l'anne provinciale. Le roi bat
monnaie, rend la justice, lve des impts travers tout le pays, com-
mande les troupes. Pourtant ni l'Empire, ni les Africains romaniss
n' ont reconnu cette souverainet. A leurs yeux, le roi vandale n'tait
qu' un chef de fdrs et un usurpateur ; la reconqute n'a jamais
cess d'tre envisage.
Les Vandales n' ont pas apport d'institutions nouvelles ; ils
ont hrit de la vieille administration impriale dont les rouages sur-
vivent en se dgradant. L'autorit suprme appartient au roi, entou-
r d' une cour de compagnons qui lui sont attachs par un ser-
ment de fidlit personnelle et qui appartiennent, sauf exceptions
trs rares, l'lment germanique et arien. La cour vivait gnrale-
357
ment Carthage o le roi avait occup l'ancien palais des procon-
suls, sur la colline de Byrsa ; mais il y avait d'autres rsidences
royales notamment Maxula (Rads), Grassa (prs de Hamma-
met), Hermiana (dans la rgion de Mactar). Le roi tait le person-
nage le plus riche du royaume ; il hritait des biens de l'empereur et
pouvait, grce sa fortune, acheter les fidlits et domestiquer cet-
te noblesse de cour.
A la tte de l'administration centrale, qui perd de sa rigueur
bureaucratique, se trouvait un praepositus regni, sorte de premier
ministre, assist de notaires et de scribes.
l'chelon local, les institutions n' ont pas t bouleverses ;
l'ancienne division provinciale n'avait plus de raison d'tre puisque
l'Afrique formait dsormais un tat indpendant o l'autorit ma-
nait de Carthage ; les gouverneurs provinciaux ont disparu ou vg-
t dans les fonctions subalternes, tel ce proconsul de Carthage qui
conserve quelques pouvoirs judiciaires sur ses concitoyens. Les cits
existaient toujours avec leurs organismes locaux et leurs magistrats
africains, mais le dclin de la vie municipale se poursuivait cause
de la pauprisation des classes moyennes et de l'inscurit croissan-
te. Cependant la conqute vandale, en mettant fin l'oppression
bureaucratique du rgime imprial, en dtruisant la puissance des
grands propritaires fonciers et du clerg catholique, a dtendu cet-
te force qui, sous le Bas-Empire, figeait impitoyablement les
hommes dans leurs conditions. La fin des rquisitions annonaires et
des exactions fiscales a sans doute amlior le sort des masses qui
n' ont pas manifest d'hostilit particulire l'gard des conqurants.
L'organisation politique de l'tat vandale donne une impres-
sion de mdiocrit. Rien de vraiment neuf n'a t apport ; le cadre
plus ou moins vermoulu de l'difice romain a t maintenu et adap-
t aux besoins des conqurants qui ne reprsentaient qu'une infime
minorit de la population.
Le peuple vandale
Quatre-vingt mille barbares sur deux millions d'habitants,
devaient briser la double opposition de l'aristocratie foncire et de
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
358 L'ANTIQUIT
l'glise, sous les yeux d'une masse indigne indiffrente et passive.
L'une des faiblesses fondamentales de l'tat vandale fut d'tre
demeur artificiellement greff sur un corps tranger. Concentrs
dans les plaines cralires de Proconsulaire, les conqurants n'exer-
aient de contrle effectif que sur la moiti nord du pays. Ils taient
en outre coups du monde germanique qui, en Europe, consolidait
les royaumes barbares par de nouveaux apports ethniques. En
Afrique, les Vandales taient appels disparatre ou se fondre
dans la masse indigne ; les mariages mixtes furent nombreux et le
rayonnement de la civilisation romaine beaucoup plus raffine ne
tarda pas assimiler la minorit barbare et la dissoudre dans l'l-
ment autochtone. La langue des Vandales, dont nous ne savons
presque rien, n'a laiss aucune trace dans le pays et l encore, le
contraste est saisissant avec les royaumes barbares d' Europe occi-
dentale ; le latin s'est impos rapidement la fois dans l'administra-
tion o la plupart des fonctionnaires taient des Africains romani-
ss, et dans le langage courant.
L'arianisme qui, l'origine, individualisait fortement les
conqurants, s'est trouv trs isol devant l'norme appareil de pro-
pagande de l'glise catholique ; beaucoup de Vandales se converti-
rent au catholicisme, mme dans l'entourage du roi. En mme
temps, le clerg arien s'engageait dans une farouche campagne de
proslytisme dont les succs ne pouvaient que corrompre la spci-
ficit ethnique de l'hrsie. Celle-ci n'tait d'ailleurs pas inconnue en
Afrique avant la conqute ; on sait que le comte Boniface avait
pous une arienne et que saint Augustin avait d combattre l'aria-
nisme. L'action antagoniste des deux propagandes aboutissait au
mme rsultat : enlever la minorit vandale le monopole de l'aria-
nisme.
L'Afrique s'imposait enfin par sa civilisation plus brillante,
plus raffine. Trs vite les Barbares ont adopt les murs
romaines : got du luxe, frquentation du cirque, de l'amphithtre,
des thermes, plaisirs raffins de la table et de la boisson ; on s'ha-
billa bientt la romaine : riches vtements de soie orientale, che-
veux courts, barbe rase. Il y eut les mmes excs : amour des cour-
Lampes de terre cuite tardives
Trois types de lampes en terre cuite sont prsentes. L'exemplaire situ au milieu
est le prototype de la lampe dite chrtienne dont la production fut florissante et
la diffusion gnrale autour de la Mditerrane.
C'est un produit africain dont les centres de production concident avec
les ateliers de cramique dite sigille claire africaine de couleur orange.
De belle facture, fabrique avec une pte raffine, ce type comporte un dcor cen-
tral entour d'un bandeau de motifs rptitifs. Symboles chrtiens, chrismes ou
monogrammes, thmes animaux, vgtaux ou gomtriques ; quelquefois des
scnes tires de l'Ancien Testament contribuent dfinir cette production comme
chrtienne.
Carreaux de terre cuite dcors
Orns de motifs en relief moul, souvent peints, ces carreaux ont servi de revte-
ment aux murs et aux plafonds des basiliques chrtiennes. Les dcors sont varis,
emprunts l'iconographie chrtienne :
cerf biche, lion, paon, rosaces et pisodes se rapportant la vie du Christ ou tirs
de la Bible, et mme, parfois, des sujets mythologiques. C'est une production arti-
sanale destine au dcor des basiliques disperses travers toute la province. Elle
est parfois employe d'autres usages comme les parements de tombes.
360
L'ANTIQUIT
tisanes, pdrastie, orgies. La romanisation des murs s'est accen-
tue sous les successeurs de Gensric ; elle infirme la notion de van-
dalisme synonyme de barbarie et destructeur de civilisation, mais
elle a ramolli les forces d'une minorit appele vivre et s'impo-
ser dans un milieu hostile ou indiffrent. Cette hostilit provenait de
l'aristocratie foncire et du clerg catholique.
problme des terres
Ds la conqute, Gensric procda une spoliation massive
des grands propritaires et de l'glise catholique ; il s'empara, en
mme temps, des immenses domaines impriaux de l'ouest tunisien
et de la Byzacne. On comprend l'ampleur de ce transfert quand on
songe ce que reprsentait la proprit latifundiaire en Afrique.
Pourtant, la mesure fut limite, la fois dans le temps et dans l'es-
pace.
Elle se fit une fois pour toutes, au dbut du rgne de Gens-
ric et ne prit un caractre vraiment massif qu'en Proconsulaire o
furent concentrs presque tous les Vandales. Chaque groupe de mil-
le hommes reut un territoire divis en lots hrditaires et exempts
d'impts ; le millier tait plac sous la direction d' un millenarius et
devait rpondre au service militaire. Il y eut spoliation, mais non
rvolution agraire car les proprits ne furent pas dmembres ; en
Proconsulaire, il s'agissait surtout d'exploitations de taille moyenne
qui furent attribues en bloc aux familles vandales. Ailleurs, le roi ou
la noblesse de cour se substiturent aux grands propritaires et
l'empereur.
C'est la minorit des riches possdants qui a le plus souffert
de la conqute. Certains furent rduits en servitude ; d'autres, les
plus nombreux, quittrent le pays, soit qu'ils aient t transfrs vers
les territoires de l'ouest, demeurs romains aprs le partage de 442,
soit qu'ils aient prfr l'exil en Italie, en Sicile ou en Orient. Beau-
coup d'migrs africains ont ainsi tran leur infortune travers la
Mditerrane et particip la campagne de propagande anti-arien-
Le
Tablettes vandales dites Albertini (Fin du V
e
s.)
Trouves dans la rgion entre Tbessa et Friana
Conserves au muse d'Alger
Reprsente, face et revers, cette tablette, autrement dit planchette de bois, a servi
de support d'criture un acte notari d'ordre priv datant de l'poque vandale
(rgne de Gunthamund 493-496).
Il s'agit de l'acte de vente d'une parcelle de terrain agricole, comportant tous les
lments de la transaction : description de l'objet de la vente, quittance, transfert,
garantie et signature du vendeur.
L'criture est en latin cursif.
Il y est fait mention de l'ancienne loi Manciana datant du Ile s. qui permettait la
mise en valeur de terres laisses en friche.
Cet acte tmoigne de la persistance d'usages anciens sous la domination vandale.
Cette tablette fait partie d'un lot de plus d'une trentaine de tablettes datant du
rgne de Gunthamund . Elles ont t trouves dans la rgion de Tbessa - Friana.
Elles ont t dchiffres par l'minent pigraphiste Albertini dont elles portent
dsonnais le nom. Elles ont t commentes et publies en 1952 sous la signature
d'un groupe de spcialistes : C. Courtois, P. Leschi, Ch. Perrat, et Ch. Saumagne.
Cette illustration a t tir de leur ouvrage.
362 L'ANTIQUIT
ne, mene par l'glise. Mais, dans l'ensemble, ils paraissent s'tre
rsigns et certains d'entre eux purent regagner l'Afrique sous les
successeurs de Gensric et rcuprer une partie de leurs terres ; c'est
ce qui arriva la famille de saint Fulgence de Ruspe qui, aprs avoir
connu l'exil sous Gensric, retrouva, sous Huneric, une partie de ses
riches proprits de Byzacne.
Du reste, les Vandales n' ont pas occup toutes les terres ; l'ex-
ploitation romano-africaine subsistait, principalement en Byzacne
o les Barbares taient trs peu nombreux et le statut de l'exploita-
tion tait toujours rgi par la vieille loi mancienne, vritable charte
du rgime foncier de l'Afrique romaine. Les Tablettes Albertini,
documents juridiques d'poque vandale dcouverts dans la rgion
de Gafsa, prouvent que le domaine rural tait toujours divis en par-
celles sur lesquelles les fermiers (cultores) exeraient un droit de pro-
prit effective. La translation des terres fut donc partielle ; elle n'a
boulevers ni la structure agraire des exploitations, ni les conditions
d'existence des masses rurales qui n'entouraient pas d' une affection
particulire les seigneurs de l'poque impriale. La politique agraire
de Gensric porte en dfinitive les marques du conservatisme et n'a
pas rompu le rythme quotidien de la vie dans les campagnes. Celles-
ci ont accept passivement un nouveau matre qu'elles voyaient peu.
Toute autre devait tre l'attitude du clerg catholique qui, jusqu' la
reconqute byzantine, n'a pas cess de manifester son opposition.
politique religieuse de Gensric
Gensric n'tait anim par aucune idologie anti-romaine. Ses
mesures contre l'aristocratie foncire et le clerg furent dictes par
la raison d'tat. Il fallait briser une opposition militante qui, en rai-
son de l'apathie des masses et de la faiblesse numrique des conqu-
rants, ne manquerait pas de ruiner un difice si fragile. Plus que
l'aristocratie qui, parfois, se rsigna jusqu' collaborer, c'est l'glise
qui manifesta une hostilit systmatique autour de laquelle finit par
se polariser la rsistance contre l'occupant.
La
363
Elle tait pourtant moins atteinte dans ses intrts matriels
car, en face des soldats vandales et de leur famille, le clerg arien ne
reprsentait qu'une faible minorit, facile pourvoir, sans confisca-
tion massive des biens ecclsiastiques ; l encore, la spoliation fut
partielle et limite la seule Proconsulaire.
L'glise et l'tat se sont pourtant livrs une lutte sans merci
parce que l'opposition catholique s'est identifie avec celle de la
romanit qui n'a jamais cess de refuser le fait accompli. Le clerg
spoli, exil, continua d'intriguer et de solliciter l'intervention lib-
ratrice des troupes impriales ; de l'tranger, les vques africains
n'hsitaient pas correspondre avec leurs correligionnaires et ins-
pirer leur conduite. C'est cette conspiration occulte et permanente
que Gensric a voulu extirper. Ds 437, il condamna l'exil des
vques de Numidie, ce qui tait une violation du trait conclu avec
Rome, deux annes plus tt.
Aprs la prise de Carthage, le clerg de Proconsulaire fut en
partie expropri et de nombreux vques exils. Le culte catholique
fut interdit en zone vandale, o il pouvait paratre comme une
atteinte l'autorit du roi ; il tait dfendu d'enterrer les morts en
public, de citer certains passages de la Bible susceptibles d'tre
interprts comme des allusions offensantes au souverain ; ainsi, les
rfrences aux grands perscuteurs de l'histoire, tel le pharaon. En
Proconsulaire, le clerg catholique fut dcapit et pendant tout le
rgne de Gensric, Carthage n'eut pas d'vque, sauf entre 454 et
457 la suite de l'phmre rapprochement avec Valentinien III.
Le catholicisme ne fut pourtant pas vis en tant que dogme et
les fidles n' ont pas t perscuts. Certes, le roi tait arien et il
considrait l'arianisme comme un fondement idologique du rgi-
me ; seuls les ariens pouvaient briguer de hautes fonctions la Cour.
Mais celui que la propagande catholique qualifie souvent d'Ant-
christ tait guid par les ralits concrtes ; dans le catholicisme, il a
combattu la dsobissance civile qui nuisait son autorit.
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
364
L'ANTIQUIT
III. - La politique extrieure et l'Empire
vandale
L'arme et la marine
Les Vandales sont l'origine un peuple de guerriers et de
conqurants ; le mille qui en constitue la cellule forme une uni-
t militaire. Leur force reposait sur une arme terrestre de quinze
vingt mille hommes dont l'lite tait la cavalerie lourdement quipe
et ressemblant dj aux troupes du Moyen Age. La cuirasse, la lan-
ce, l'pe et l'arc formaient l'essentiel de l'armement. Dote des
meilleures terres de Proconsulaire, l'arme tait la chose du roi, qui
la convoquait et la commandait ; aprs un demi-sicle de vie erran-
te et de guerres continuelles, elle aspirait cependant la paix.
L'Afrique, avec ses riches terres bl, ses villes luxueuses, sa civili-
sation raffine, lui assura une existence facile, prospre et relative-
ment calme. Mais, du mme coup l'ardeur guerrire et la qualit de
cette arme s'en trouvrent amoindries et l'volution s'est aggrave
tout au long de l'poque vandale. Il a fallu enrler des contingents
maures qui ont pris une importance croissante dans les effectifs et
l'arme cessait peu peu d'tre exclusivement vandale. La fidlit
des troupes indignes ne pouvait tre toute preuve et flchira ds
les premiers revers. Relchement des vertus guerrires et absence de
cohsion dans l'arme seront l'une des raisons du brusque effon-
drement et de la droute vandale lors de la reconqute byzantine.
Les forces vandales disposaient galement d' une flotte impor-
tante qui ne jouait pas proprement parler de rle militaire car il n'y
avait plus depuis longtemps de grandes batailles navales en Mdi-
terrane. En 429, les quatre-vingt mille vandales ont franchi le
dtroit de Gibraltar sur une flotille de radeaux et de barques qui fit
plusieurs fois la traverse. Aprs la prise de Carthage et le trait de
442, ils s'emparrent de la flotte frumentaire d'Afrique qu'ils utili-
srent la fois pour le commerce, le transport des troupes et les
365
actions de piraterie ; mais il n'y a jamais eu de marine de guerre van-
dale ni de thalassocratie comparable celle des Phniciens.
Le dclin des troupes vandales n'a commenc se faire sentir
que sous les successeurs de Gensric, mais elles ont conserv, jus-
qu' la fin, une sinistre rputation et firent trembler l'tat-major
byzantin cause de la terrible activit qu'elles avaient manifeste
pendant le rgne du grand roi germanique.
Conqutes et pillages
Sous Gensric le royaume vandale faisait figure de grande
puissance mditerranenne, il entreprit la conqute d' un vritable
empire et multiplia les razzias dvastatrices sur les ctes d'Italie et
de Grce ainsi que les actions de piraterie. En mme temps, la diplo-
matie vandale traitait d'gal gal avec l'Empire et nouait des rela-
tions avec les autres tats barbares d'Occident.
La politique extrieure fut peu active durant les premires
annes du rgne. Aprs le partage de 442, Gensric se proccupait
avant tout d'imposer son autorit l'intrieur ; il se rapprocha de la
cour de Ravenne et, en 445, fiana son fils Hunric avec la princes-
se Eudoxie la Jeune qui n'tait alors qu'une enfant. Les bonnes rela-
tions avec l'empire d'Occident furent rompues aprs la mort de
Valentinien III en 455. A partir de cette date et pendant plus de
vingt ans, les Vandales multiplirent les initiatives et semrent la ter-
reur en Mditerrane.
L'empire vandale
Ce fut d'abord la conqute d' un empire centr sur l'Afrique et
les grandes les de l'Occident romain. En Afrique, Gensric s'em-
para de quelques places du littoral maurtanien, notamment Caesa-
rea (Cherchel) et Septem (Ceuta). Les Balares furent conquises en
455 et servirent de base stratgique contre d'ventuelles agressions
venues d'Espagne ; la Corse et la Sardaigne furent utilises comme
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
366 L'ANTIQUIT
terres de dportation et fournirent du bois pour les constructions
navales. La Sardaigne, qui tait en outre riche en bl, avait beaucoup
de prix aux yeux des souverains vandales. En 533, la veille du
dbarquement byzantin, le roi Gelimer y avait envoy l'lite de l'ar-
me pour rprimer la rbellion du gouverneur local. L'le la plus
riche tait la Sicile, grenier de l'antiquit ; les Vandales l'ont occupe
en 468. Aprs la disparition de l'empire d'Occident en 476, Gens-
ric la concda au roi d'Italie Odoacre qui devait payer un tribut fai-
sant de lui un vassal du royaume vandale. Peut-tre envisageait-il
d'imposer sa suzerainet toute l'Italie. Les progrs de l'tat ostro-
goth et le dclin vandale aprs Gensric devaient en dcider autre-
ment.
L'empire vandale, la fois africain et insulaire, prsentait, du
point de vue gographique, des analogies frappantes avec l'ancien
empire phnicien ; on a parl de quatrime guerre punique et de
revanche de Carthage. En fait, les deux tats n'avaient rien de com-
mun ; les Vandales n' ont pas fond d'empire commercial, la conqu-
te des les mditerranennes tait dicte par des considrations stra-
tgiques et par le souci de trouver de nouvelles terres bl ; les
changes commerciaux n'avaient rien de comparable avec ceux de
la priode punique ; Carthage avait en outre une grande flotte de
guerre qui manquait aux Vandales. Il n'y eut jamais de batailles
navales mais des oprations de piraterie et des razzias sur les ctes
d'Italie et de Grce.
La prise de
Rome
Le coup de force le plus clbre fut la prise de Rome en 455.
Invoquant le prtexte de ses liens de parent avec l'empereur Valen-
tinien III qui venait d'tre assassin, Gensric ralisa l'une des plus
gigantesques entreprises de piraterie de l'histoire. Ses troupes, ren-
forces de contingents maures, dbarqurent Porto, le 31 mai 455,
et firent leur entre Rome trois jours plus tard sans rencontrer de
rsistance. La Ville ternelle qui a toujours fascin les souverains
barbares, fut pille systmatiquement pendant quatorze jours, mais,
367
la requte du pape Lon le Grand, il n'y eut ni massacres ni incen-
dies. Les trsors accumuls pendant des sicle furent chargs sur les
navires qui attendaient Porto ; l'un d'eux devait sombrer lors du
voyage de retour et engloutit avec lui les fameuses tuiles de bronze
dor qui formaient la toiture du temple de Jupiter au Capitole. Dans
le butin que Blisaire devait rcuprer lors de la reconqute byzan-
tine figuraient les vases sacrs du temple de Salomon rapports de
Jrusalem par Titus. La flotte ramenait galement des milliers de pri-
sonniers ; dont l'impratrice, veuve de Valentinien, avec ses deux
filles, Eudoxie la jeune fiance d'Hunric, et Placidie ; Gaudentius, fils
du gnralissime A.etius, ainsi qu'un grand nombre de snateurs
accompagns de leurs femmes, taient aussi du voyage.
Carthage, beaucoup de prisonniers furent rduits l'escla-
vage et distribus entre les soldats ; certains parvinrent racheter
leur libert. L'vque de Carthage, Deogratias, recueillit les enfants
dans deux glises de la ville, et paya des ranons en vendant les
ornements liturgiques. Aprs le sac de Rome, l'Italie n'en tait pas
au bout de ses peines ; jusqu'en 468, plusieurs razzias furent prio-
diquement lances sur les riches plaines de Campanie. La pninsule
prive du bl d'Afrique et de Sicile tait soumise un blocus co-
nomique. L'Orient souffrit galement des entreprises vandales : pri-
se de Nicopolis en Epire et dvastation de Zacynthe ; l'chec devant
Canopolis sur la cte du Ploponnse aurait dchan la fureur du
vieux roi qui, aprs avoir massacr une partie des habitants, fit jeter
la mer cinq cents notables de la ville, dans les conditions que l'on
sait. Toutes ces razzias meurtrires ont vritablement terroris cer-
taines rgions de la Mditerrane et donn aux Vandales cette
sinistre rputation qu'ils ont garde travers les sicles.
L'attitude de l'Empire
Face Gensric, l'Empire, agonisant en Occident, dchir par
les querelles religieuses et les intrigues de cour en Orient, ne pou-
vait ragir avec vigueur.
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
368 L'ANTIQUIT
Il le fit pourtant deux reprises dont l'une et l'autre devaient
se solder par un chec complet.
En Occident
En 457, un nouvel empereur, Majorien, tenta un suprme
effort pour redresser la situation en Occident. Dou de qualits
remarquables, il voulut briser la puissance vandale qui ravageait et
affamait l'Italie. Une flotte considrable de trois cents navires fut
concentre au sud de l'Espagne, dans la baie d'Alicante ; elle devait
dbarquer en Maurtanie, tandis qu'une autre arme attaquerait par
l'est. L'expdition fut minutieusement prpare ; on raconte mme
que Majorien se serait teint les cheveux en noir pour se rendre inco-
gnito Carthage et juger sur place des forces vandales.
Impressionn par l'ampleur des prparatifs impriaux, Gens-
ric sollicita la paix, mais ses propositions furent repousses ; il aurait
alors dvast la Maurtanie et empoisonn les puits pour arrter la
marche des impriaux. L'expdition ne devait d'ailleurs pas avoir
lieu car les Vandales russirent s'emparer, par trahison, de la flot-
te romaine. Majorien dut rentrer en Gaule et se rsigna ngocier ;
un nouveau trait, sign en 460, confirmait celui de 442 et recon-
naissait aux Vandales les acquisitions faites depuis cette date,
notamment les Balares, la Corse, la Sardaigne ainsi que les nou-
velles possessions africaines. La dfaite et la mort tragique de Majo-
rien touffaient le dernier sursaut de l'Empire d'Occident.
En Orient
L'Orient, son tour, tenta d'intervenir contre Gensric qui
manifestait des prtentions exorbitantes en revendiquant l'hritage
de Valentinien III et en multipliant les actes de piraterie sur les ctes
grecques. L'avnement Constantinople d' un parti hostile aux bar-
bares a dcid l'empereur Lon entreprendre la grande expdition
de 468 dont il confia le commandement son beau frre, l'incapable
Basztiscus. L'Empire entreprit un effort considrable sur le plan
369
financier et militaire ; la flotte confie Basiliscus aurait compt jus-
qu' onze cents navires ; les forces de l'empereur d'Occident A.nthe-
mius devaient se joindre aux Grecs. Les historiens byzantins ont
manifestement beaucoup exagr l'ampleur de l'expdition afin de
souligner, travers son chec, le mrite de Blisaire et de Justinien
qui parviendront terrasser le royaume vandale moindre prix.
La flotte de Basiliscus aborda la Tunisie au nord-ouest du Cap
Bon, mais, au lieu d'attaquer aussitt, elle accorda Gensric une
trve de cinq jours que le roi mit profit pour concentrer des
troupes sur le rivage et user d'un stratagme fort habile en lanant
contre les navires grecs une flottille de barques remplies de matires
inflammables qu'un vent favorable poussait vers la cte. Pendant ce
temps, la flotte vandale empchait les Grecs de fuir vers le large,
tandis que les troupes, demeures terre, les assaillaient de traits.
Ainsi prise dans un dluge de fer et de feu, l'escadre de Basiliscus fut
totalement anantie.
L'empereur tenta une nouvelle expdition en 470 ; le com-
mandement en fut confi Heraclius qui, parti d'Egypte, navigua le
long de la cte jusqu'en Tripolitaine. Aprs y avoir dbarqu, il
remonta vers le nord et se dirigea sur Carthage par voie terrestre.
Gensric fit des propositions de paix, mais il fut sauv par les
intrigues de cour Constantinople, qui obligrent l'empereur rap-
peler l'arme. Les Vandales purent mme lancer une contre offen-
sive sur les ctes et s'emparer de Nicopolis.
La paix de 476
Byzance finit alors par se rsoudre la ngociation ; en 476,
l'empereur Znon conclut avec Carthage un trait de paix perp-
tuelle qui, moyennant l'engagement de ne plus piller les ctes
grecques, reconnaissait Gensric ses possessions en Occident.
La paix avec Byzance marquait l'apoge de la politique ext-
rieure vandale. Gensric vcut assez pour assister la chute dfini-
tive de Rome et s'imposer devant l'Empire d'Orient. Sa forte per-
sonnalit avait su exploiter la dsagrgation de l'difice imprial
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
370 L'ANTIQUIT
pour fonder un tat souverain et faire de Carthage une grande puis-
sance mditerranenne, mais une puissance aussi artificielle
qu'phmre. La mort du vieux roi, en 477, fut suivie d'une prio-
de d'immobilisme et de reflux. L'quilibre des forces en Mditerra-
ne tait peu peu modifi par l'installation d'une solide royaut
barbare en Italie et, partir de Justin 1
er
, par la renaissance impria-
le en Orient. L' Etat vandale, mal enracin et dpourvu de forces
militaires solides, fut en outre dirig par des mains moins vigou-
reuses.
CHAPITRE II
Dcadence du royaume vandale
Plus d' un demi-sicle spare la mort de Gensric de la recon-
qute byzantine ; l' tat vandale a donc survcu son illustre fon-
dateur, mais cette priode fait ressortir les faiblesses d' une entrepri-
se que la poigne vigoureuse de Gensric avait pu momentanment
conjurer. L'implantation vandale, gographiquement limite au
nord du pays et en voie d'assimilation par l'lment romano-afri-
cain, se trouvait menace la fois par la rsistance sourde et achar-
ne des catholiques et par l'agitation des tribus berbres que stimu-
laient la dsagrgation et l'absence de l'tat. Ces deux forces dis-
tinctes mais conjugues ont fini par ruiner l'uvre de Gensric.
I - La rsistance catholique
Le rgne d'Hunric (477- 484)
Caractre du roi
Combattu par Gensric, le catholicisme fut perscut avec
beaucoup plus de violence par Hunric qui a gard une rputation
de tyran sanguinaire. Le nouveau souverain avait une cinquantaine
d'annes lors de son avnement. Plus romanis que son pre, il avait
pous une princesse impriale qui devait d'ailleurs s'enfuir en 472
372
L'ANTIQUIT
et se rfugier Jrusalem. Les historiens catholiques en ont laiss un
portrait accablant ; Victor de Vita le qualifie de lion rugissant , de
dernier des sclrats ; il insiste sur la maladie pouvantable qui
a putrfi son corps grouillant de vers et frapp ainsi l' horrible per-
scuteur du chtiment divin.
En fait, le nouveau roi ne manquait pas de sens politique ; il
fut sans doute plus fanatique que son pre, mais il manifesta, au
dbut du rgne, un souci de conciliation et d'apaisement, allant jus-
qu' autoriser la clbration du culte en Proconsulaire ainsi que
l'lection d' un nouvel vque de Carthage. Peut-tre esprait-il
obtenir par cette attitude tolrante des concessions analogues de
l'empereur en faveur des ariens d' Orient ; peut-tre aussi la ruse du
roi avait-elle imagin cette bienveillance pour mettre au grand jour
l'organisation clandestine du clerg et s' apprter ainsi mieux la
briser. Quoiqu'il en soit, la paix n'a pas dur et la reprise des pers-
cutions fut contemporaine d' un grave complot dynastique auquel le
clerg catholique ne demeura pas tranger.
Le problme de la succession au trne
Avant sa mort, Gensric avait dcid que la succession au tr-
ne se ferait selon le vieux systme agnatique qui rservait le pouvoir
au prince le plus g de la famille rgnante, dans la ligne masculi-
ne. Ce procd qui, en gnral, cartait la primogniture directe du
souverain rgnant, a pouss celui-ci multiplier les crimes pour li-
miner les prtendants et frayer, son propre fils, la voie du trne.
Hunric s'acharna contre la famille de son frre dont il fit dcapiter
la femme et les enfants afin de laisser le trne son fils Hildric et
de renforcer ainsi l'absolutisme monarchique. Cette politique san-
glante provoqua des remous la cour o le vieux systme agnatique
gardait des partisans ; le clerg catholique qui semble avoir t sol-
licit par le roi pour appuyer une rvision de la loi successorale en
faveur d'Hildric, s'y serait refus. C'est cette date, au lendemain
du complot dynastique (481) que la perscution prit une tournure
violente.
373
Perscution des catholiques
Tous ceux qui n'taient pas ariens et occupaient une fonction
officielle, furent rvoqus, dpouills de leurs biens et exils en Sici-
le ou en Sardaigne. Une multitude de cinq mille clercs et lacs fut
concentre Sicca I
r
eneria (Le Kef) et Lorbeus puis lamentable-
ment achemine vers le dsert du Hodna o les Maures rduisi-
rent les survivants l'esclavage.
Hunric alla plus loin que son pre et plaa le conflit sur le
plan doctrinal. Un concile d'vques catholiques et ariens fut
convoqu en 484 Carthage, malgr les protestations de la diplo-
matie impriale qui allguait qu' une question intressant tout le
monde catholique ne pouvait tre tranche par le seul clerg
d'Afrique. D'ailleurs, les prlats ariens touffrent par la violence les
protestations des vques catholiques et le concile s'acheva dans la
confusion. Le roi en interrompit brusquement les sances et pro-
mulgua un dit de reprsailles qui frappait aussi bien le clerg que
les fidles. L'glise arienne s'emparait de tous les difices du culte ;
les catholiques taient contraints de se convertir l'arianisme sous
peine de confiscation des biens, flagellation et exil. L'glise catho-
lique spolie, traque tait dcapite par l'exil massif de tout l'pis-
copat qui fut dport dans les les. Les mmes reprsailles s'abatti-
rent sur les nombreux monastres de Byzacne ; sept moines de
Gafsa connurent le martyre Carthage.
Les atrocits furent srement plus nombreuses que sous Gen-
sric : vandales rengats littralement scalps la sortie des glises,
lames de fer rougies au feu et appliques sur le corps des victimes.
Selon Victor de Vita les rues de Carthage foisonnaient de mutils ;
en fait, le polmiste citait trs peu d'exemples concrets, l'exception
des habitants de Tipasa qui, aprs avoir tent de s'enfuir par mer,
furent repchs et amputs de leur main et de leur langue dont la
tradition catholique rapporte, qu' la suite d' un miracle, ils auraient
retrouv l'usage.
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
374
L'ANTIQUIT
La violence de la perscution ne ft que renforcer l' opposition
catholique et la solidarit des fidles avec le clerg proscrit ; la poli-
tique religieuse d' Hunric fut en dfinitive un chec, puisqu'elle
aggrava l'isolement, donc la prcarit de la domination vandale dans
le pays.
La politique religieuse sous les successeurs d'Hunric
Les hsitations de Gunthamund
Les reprsailles n' ont d'ailleurs dur que quelques mois et
devaient progressivement cesser sous le rgne de Gunthamund
(484-496). Indcis et sans relief, le nouveau roi amora un retour
hsitant vers la tolrance. Beaucoup de clercs, y compris l'vque de
Carthage, purent rentrer d'exil et rcuprer leurs glises ; peut-tre
le roi voulait-il la paix pour faire face au rveil du pril berbre. Ses
espoirs devaient tre dus car les catholiques n' ont pas cess de
considrer les Vandales comme des perscuteurs et des ennemis au
moment mme o le danger berbre leur recommandait de s'unir.
Nouvelles perscutions sous Thrasamund
Avec Thrasamund (496-523) qui fut un prince lettr et brillant,
la perscution recommena, mais, renonant aux violences, elle prit
une forme doctrinale et intellectuelle. Le roi pria le savant vque
Fulgence de Ruspe, exil en Sardaigne, de venir Carthage l' affron-
ter dans un dbat thologique sur le culte trinitaire. Arien fanatique,
Thrasamund ne se laissa pas convaincre et perscuta froidement
mais impitoyablement le clerg. Les glises furent nouveau fer-
mes, le culte interdit, les vques exils ; il fut mme interdit de
sacrer de nouveaux vques dans les siges vacants. L'piscopat
tait ainsi menac d'extinction. Mais, en dpit de nombreux cas
d'apostasie, le catholicisme demeurait solidement implant dans le
pays. Les clercs de Byzacne passrent outre l'interdiction royale
et procdrent clandestinement l'lection des vques. la mort
de Thrasamund, la crise religieuse tait toujours aussi aige.
Basilique d'El Gousset
(Rgion de Friana)
L'intrt exceptionnel de cette basilique est de prsenter deux sries d'arches
encore debout, appartenant la structure architecturale de l'difice. Il s'agit des
supports de la nef centrale et des nefs latrales qui s'appuyaient sur les murs
priphriques aujourd'hui disparus : la charpente du toit couvert de tuiles en terre
cuite reposait la fois sur ces murs extrieurs et sur ces arcades intrieures.
Le plan est celui habituel aux modestes glises rurales : trois nefs
d'gale largeur (environ 3 m) se dveloppant sur sept traves. D'un ct,
une abside centrale est accoste de deux pices. Dans l'une se trouve
la cuve baptismale, une table d'autel et un reliquaire.
Le chur, entour de chancels se prolonge dans la nef cen trale.
En face, de l'autre ct, la porte d'entre axiale, est prcde d'un porche.
L'ensemble mesure 33 m sur 11,40 m.
L'intrt de cette basilique est augment par la dcouverte de claveaux d'un arc
qui devait appartenir une entre latrale et sur lequel tait grave l'inscription :
ANNO VICESIMO VI DOMINI REGIS TASAMUNDI autrement dit la 26'""
anne du rgne du roi vandale Thrasamund (495-523)
c'est--dire l'anne 521 ap. J.-C.
376 L'ANTIQUIT
Revirement pro-catholique sous Hildric
Son successeur Hildric (523-530) fit une politique catholique
et romanophile. Fils d' Hunric et d' Eudoxie la jeune, Hildric tait
la fois petit-fils de Gensric et de Valentinien III ; dans sa jeunes-
se, il avait pass plusieurs annes Ravenne. A demi romain par le
sang, il entretenait des relations troites avec la cour de Constanti-
nople. Il rappela immdiatement les exils, autorisa la dsignation
d' un vque Carthage et rendit l'entire libert de culte ; un conci-
le fut mme runi en 525 sous la prsidence du nouvel vque de
Carthage. Cette politique lui valut la sympathie unanime des histo-
riens catholiques ainsi que les faveurs de Justinien, mais elle dcha-
na l' opposition du clerg arien et de l'aristocratie vandale, d' autant
plus que le roi manifestait une incapacit totale devant les incursions
maures. Accus de trahison, il fut victime d' une conspiration qui
porta, sur le trne, son cousin Glimer.
Chute d'Hildric et avnement de Glimer
Le nouveau roi avait la rputation d' un soldat valeureux ; dans
une lettre Justinien il affirma avec force l'indpendance du royau-
me vandale, ce qui dchana l' opposition des catholiques et leur
propagande en faveur de l'intervention impriale ; trois ans plus
tard, Glimer subissait, impuissant, la loi de Blisaire et l' tat van-
dale disparaissait de l'histoire.
Ainsi triomphait l'glise catholique qui, refusant toujours
d'accepter le fait accompli, n'avait pas cess d'intriguer, au dedans
comme au dehors, pour dcider l' Empire l'expdition libratrice.
Depuis le dbarquement de Gensric, elle s'tait engage dans un
combat sans merci qui ne prit fin qu'avec l'arrive de Blisaire et la
droute des Vandales.
Cette lutte inexpiable a politis le dbat religieux et cimen-
t la rsistance indigne contre l'envahisseur qui ne disposait plus
des forces ncessaires pour affronter le danger berbre.
377
II- Le danger berbre
/
Dcadence de l'Etat
Le rveil offensif des tribus berbres est le fait capital de la fin
de la priode vandale. Dsormais - et la reconqute byzantine n'y
changera pas grand chose - la conception romaine de l'tat, c'est--
dire d'une civilisation fonde sur la vie urbaine, la culture grco-
romaine et le christianisme est sans cesse menace par la rentre en
scne des forces berbres que Rome, incapable d'assimiler, avait
cependant russi contenir pendant des sicles.
Certes, la civilisation romaine est loin d'avoir disparu
d'Afrique, le latin est encore parl jusque dans les confins les plus
mridionaux et l'on verra survivre des communauts chrtiennes
jusqu'en plein Moyen Age musulman. Mais en fait, la romanit est
en dclin parce que l'lment berbre qui reprsente dsormais les
forces vives et agissantes du pays, n'y fut en gnral associ que de
trs loin et y demeura souvent tranger. Il est bien vident que des
forces profondes faisaient alors clater en Afrique, comme ailleurs
les structures romaines de l'tat, acclrant le morcellement de
l'autorit et l'avnement de pouvoirs locaux. Mais cela n'explique
pas la disparition de Rome en tant que civilisation et le triomphe
relativement si ais de l'Islam.
Organisation des tribus berbres
C'est la dromanisation de l'Afrique qui est le fait essentiel de
cette priode. L'Afrique romaine qui demeura toujours gographi-
quement et socialement une uvre inacheve fut, partir de la fin
du V
e
s., progressivement absorbe par les nouvelles confdrations
indignes. Celles-ci avaient dj exist avant la conqute romaine et
connu, l'poque de Masinissa, un essor particulirement brillant ;
tant qu'il en eut la force et le rayonnement, l'Empire sut imposer-
son autorit aux tribus, associant les unes, refoulant ou isolant les
autres. Mais l'vacuation progressive du pays, inaugure par Diocl-
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
378
L'ANTIQUIT
tien, s'est poursuivie sous les Vandales qui ont abandonn les Mau-
rtanies ainsi qu'une grande partie de la Numidie. Les fortifications
des villes furent dmanteles sur ordre de Gensric afin de ne pas
servir de refuge d'ventuelles rbellions. L'abandon de ces terri-
toires plaa l'autorit entre les mains de roitelets berbres plus ou
moins romaniss qui parvinrent regrouper un certain nombre de
tribus pour former de vritables royaumes indpendants, en Oranie,
dans l'Ouarsenis, le Hodna. Du point de vue politique, c'tait un
retour l'anarchie tribale ; les royaumes ainsi constitus partir des
lots montagneux d'inscurit, firent en quelque sorte tche d'huile
et absorbrent peu peu les anciens territoires romains.
Leur intervention dans le Royaume vandale
En Tunisie, l'implantation vandale tait demeure limite au
nord du pays ; ailleurs, c'est--dire aux confins de la Byzacne et de
la Tripolitaine, l'autorit de fait n'tait plus exerce par les souve-
rains de Carthage, mais par des chefs indignes avec lesquels l'tat
entretenait, sous Gensric, des relations de suzerain vassal ; c'est
ainsi que des contingents maures ont servi dans les troupes vandales
et particip la plupart des oprations de guerre et de pillage. Aprs
la mort de Gensric, l'affaiblissement de l'tat dtacha progressive-
ment ces liens de suzerainet. Ds 477. C'est la rvolte de l'Aurs
qui chasse les Germains et parvient former un royaume indpen-
dant sur lequel rgnait le chef berbre Iaudas. Plus l'est, dans l'ac-
tuelle rgion de Gafsa, naquit le royaume de Capsa. Mais c'est sur
les massifs de la Dorsale, dans une rgion que Rome avait largement
pntre, que se constitua le plus puissant et le plus redoutable de
ces tats indignes, celui d'Antalas. Ds le rgne de Gunthamund,
les steppes de Byzacne subissaient de frquentes razzias diriges
par les tribus berbres descendues des montagnes de l'ouest. Cette
inscurit devint permanente la fin du V
e
s. et explique l'abandon
de certains monastres comme celui de Fulgence de Ruspe Thelepte
(Friana). Toutes les plaines de Byzacne, l'exception du littoral,
taient, dsormais, la merci des invasions. Les tribus s'assembl-
379
rent pour former une confdration sous la direction de Guenfan
auquel succda, en 510, son fils Antalas qui infligea une grave dfai-
te aux troupes d'Hildric, prcipitant ainsi le coup d'tat de Glimer.
Les Maures d'Antalas, que le pote Corippus dsigne sous le nom
de Frexes, taient tablis dans la rgion o rsident encore aujour-
d'hui les Frechiches, c'est-a-dire autour de Thala et de Kasserine.
La victoire d'Antalas installait un royaume indpendant au
cur mme de l'tat vandale et talait au grand jour l'impuissance
de celui-ci. En mme temps, elle favorisait l'intervention des grands
nomades chameliers.
Les Nomades chameliers
tablis en Cyrnaque et en Tripolitaine jusqu' la fin du
IV
e
s., les tribus d'A.ustoriani et de Faivatas remontrent vers le nord-
ouest et parvinrent en Byzacne la veille de la reconqute byzan-
tine. Elles taient conduites par leur chef Cabaon, dont le royaume
s'tendait dans l'arrire-pays de Lepts Magna et de Oea (Tripoli) ;
Cabaon fit son apparition en Byzacne sous Thrasamund, vers 520,
et dfit les troupes vandales affoles par la multitude de chameaux
que les nomades disposaient en cercle autour du camp. Une autre
vague nomade semble avoir dferl sur la Byzacne l'poque de
Glimer.
Depuis la fin du VI
e
s., la Tunisie centrale et mridionale tait
ainsi la proie des invasions dvastatrices ; l'tat vandale s'effondrait
et ne pouvait opposer de rsistance aux troupes de Blisaire.
III.- tat matriel de la Tunisie au dbut
du VI
e
s.
La paix vandale
Malgr les dprdations dues aux incursions des tribus ber-
bres et sahariennes dans les plaines de Byzacne, la vie cono-
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
3 8 0
L'ANTIQUIT
mique demeurait relativement prospre, surtout dans le nord du
pays o rgna la paix vandale . Il ne semble pas qu'il y ait eu de
dgradation notable par rapport au Bas-Empire ; les hommes ont
vcu comme par le pass, bnficiant mme, dans de nombreux cas,
de la disparition de cette lourde machine bureaucratique et polici-
re qu'tait l'administration impriale. Aucune rvolte n'a dress la
masse des populations indignes contre l'occupant et les soldats de
Blisaire n' ont pas toujours t accueillis comme des librateurs.
Les villes
La vie urbaine poursuivait sa lente dcadence ; celle-ci fut
peut-tre acclre par la politique vandale qui a dmantel les
murailles des villes - encore faut-il noter que cette mesure a peu tou-
ch la Tunisie o, l'exception de Carthage, la plupart des cits
n'avaient pas de fortifications ; seules Leptis Magna ainsi que les villes
du littoral tripolitain semblent avoir srieusement souffert de la des-
truction de leurs murailles, et se trouvaient dsormais la merci des
nomades chameliers. La vie municipale tranait toujours une exis-
tence mdiocre, aggrave par la ruine d'une partie de la bourgeoisie
africaine spolie de ses biens fonciers ; les grands travaux d'urba-
nisme ont pris fin et nous ne connaissons que peu de monuments
d'poque vandale. Mais tous ces phnomnes taient antrieurs
l'invasion et s'affirmaient dj au dbut du V
e
s. L'aspect des
grandes villes comme Carthage n'a pas beaucoup chang sous les
Vandales ; d'importants travaux furent mme entrepris l'poque
d'Hunric, dans le quartier du port.
L'agriculture
Le bl et l'olivier faisaient toujours la richesse du pays et sus-
citaient l'admiration de Procope ; l'arboriculture fit de nouveaux
progrs au V
e
s. Les tablettes Albertini prouvent que l'on continuait
planter des oliviers et des figuiers dans la rgion de Gafsa et que
les rseaux d'irrigation taient toujours entretenus. Les Byzantins
381
ont t frapps par la richesse de la cte du Sahel et du Cap Bon ;
on sait, en outre, que de nouvelles plantations de vigne datent de
l'poque vandale.
Le commerce
La mdiocrit de l'conomie montaire atteste le dclin du
commerce extrieur boulevers par l'interruption des changes avec
l'Italie et par la piraterie vandale. Les rois de Carthage ont frapp
des pices de bronze et d'argent de valeur mdiocre, mais jamais
d'or ; on a cependant dcouvert de trs nombreuses pices d'or en
provenance de l'Orient byzantin et datant de l'poque vandale ; il
n'y avait donc pas d'autarcie, et l'Afrique continuait d'exporter vers
l'Orient. Le volume des transactions a diminu ; le pays ne livrait
plus son bl et son huile l'annone ; il vendait surtout des esclaves
dont Carthage fut un march important et achetait des produits de
luxe, comme les tissus d'Orient. La prsence de nombreux mar-
chands syriens dans le port de Carthage infirme l'ide d'autarcie.
Les Vandales ont, somme toute, rgn dans une Afrique aus-
si prospre que celle du Bas-Empire et n' ont pas succomb cause
d'une crise conomique.
Concl us i on
Reni et combattu par les catholiques, ha de l'aristocratie
dpossde, indiffrent aux masses, l'tat vandale se trouvait isol
et impuissant devant le rveil de l'anarchie berbre et les aspirations
impriales la reconqute. Aprs Gensric, il fut conduit par des
souverains moins capables et s'enlisa dans un immobilisme strile
o la minorit germanique tendait se dissoudre dans la masse afri-
caine plus civilise, tandis que l' arme perdait ses vertus guer-
rires et se diluait dans l'lment indigne. Conception chim-
rique, l' tat vandale disparaissait de lui-mme et les Byzantins
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
382
L'ANTIQUIT
n' ont fait qu' assassiner un condamn mort .
Aprs la victoire de Blisaire, les Vandales ont pratiquement
disparu de l'histoire ; contrairement aux Phniciens et aux Romains,
ils n' ont rien lgu la civilisation du pays. Incapable d'interrompre
le cours de l'histoire, leur rgne a vu se poursuivre et s'acclrer le
dclin de la romanit africaine. En vacuant de nouveaux territoires
autrefois contrls par Rome, ils ont laiss le champ libre l'anar-
chie politique des confdrations berbres ; mais ce repli avait dj
commenc sous Diocltien et rien ne prouve qu'il n'aurait pas conti-
nu mme si les Vandales n'avaient pas chass Rome d'Afrique.
Aprs 455, c'est l'Empire qui a abdiqu de lui-mme dans les pro-
vinces de l'ouest maghrbin. En abandonnant les villes elles-
mmes, les Vandales ont tari les sources de la romanisation, mais l
encore les origines du mal taient antrieures leur arrive dans le
pays.
Ariens fanatiques et perscuteurs du catholicisme, ils ont
peut-tre contribu la dcadence du christianisme africain ; selon
J. Carcopino leur farouche hostilit au culte trinitaire et aux subtili-
ts thologiques a fray la voie au monothisme absolu de l'Islam.
Peut-tre aussi leur rgne a-t-il vu renatre le vieux smitisme
punique dans certaines campagnes de Proconsulaire. Un passage,
controvers de saint Augustin, rapporte que l'on parlait punique
dans la rgion d'Hippone. C'est la dromanisation de l'Afrique qui
doit tre inscrite au bilan d' un sicle de domination vandale, bien
que celle-ci n'en soit pas la cause directe. L'volution se poursuivra
sous les Byzantins qui ne pourront faire renatre un pass bien rvo-
lu.
C- La Tunisie byzantine (533 - 698)
CHAPITRE I
Justinien ou l'illusion
d' une rsurrection du pass
I. - La reconqute
Ses causes
La haute socit africaine, spolie et perscute par les Van-
dales, tait demeure attache l'Empire dont elle n'a pas cess de
rclamer l'intervention. Beaucoup d'migrs rfugis Constanti-
nople agissaient auprs de l'empereur Justinien qui rvait de restau-
rer l'Empire universel et catholique par la reconqute des provinces
d'Occident. Le renversement d'Hildric, en 530, servit de prtexte
une expdition que l'empereur a voulue et dcide malgr le pessi-
misme de son entourage qui surestimait les forces vandales et crai-
gnait que l'entreprise ne tournt au dsastre comme celle de 468.
Glimer avait la rputation d' un chef de valeur et la flotte vandale
inspirait toujours la terreur. En effet, le roi tait un personnage
motif et dnu d'nergie, quant aux troupes barbares, nous savons
qu'elles avaient perdu depuis longtemps toute combativit. Les
meilleures d'entre elles se trouvaient du reste en Sardaigne pour
rprimer une rvolte du gouverneur local. Les tribus de Byzacne et
de Tripolitaine taient en insurrection et le loyalisme des contin-
384
L'ANTIQUIT
gents maures n'offrait aucune garantie. l'extrieur, la diplomatie
byzantine avait trouv l'appui du royaume barbare d'Italie en conflit
avec Carthage depuis le meurtre, sous Hildric, de la reine Amala-
frida, veuve de Thrasamund et fille du roi des Ostrogoths Thodo-
ric ; l'Italie barbare put ainsi favoriser les projets de Justinien en per-
mettant la flotte impriale de faire escale et de s'approvisionner en
Sicile.
La campagne de Blisaire
Le commandement de l'expdition fut confi au gnralissime
Blisaire ; l'arme s'embarqua solennellement en Juin 533, en pr-
sence de l'empereur et avec la bndiction du patriarche de
Constantinople. Elle comprenait dix mille fantassins et cinq six
mille cavaliers qui, avec les contingents barbares et la garde cuiras-
se, formaient les troupes d'lite ; au total seize mille hommes, c'est-
-dire des effectifs infrieurs de moiti ceux de l'arme vandale.
Blisaire tait entour d' un tat major dirig par le Domes-
tique Solomon qui jouera un rle trs important dans l'histoire de
l'Afrique byzantine. Il tait en outre accompagn de sa femme, l'in-
trigante Antonine.
Le gnralissime conduisit prudemment la flotte qui, aprs
avoir multipli les escales, n'accosta qu'en septembre sur les plages
du Sahel, Caput Vada (Ras Kaboudia). Craignant un combat naval
cause de la rputation de la flotte vandale, Blisaire prfra faire
dbarquer son arme et remonter vers le nord en se prsentant aux
populations comme un librateur. Les classes possdantes ainsi que
le clerg catholique lui apportrent un appui enthousiaste, mais la
masse ne semble pas s'tre dpartie de sa passivit. Jusqu'aux envi-
rons d'YLadrumetum ce fut une promenade militaire ; Glimer qui se
trouvait alors en villgiature l'intrieur de la Byzacne, fut ton-
namment pris au dpourvu et n'opposa d'abord aucune rsistance.
Mais le roi ne tarda pas ragir ; il ordonna son frre Ammatas,
demeur Carthage, de mettre mort le romanophile Hildric et
ses partisans, puis de lever une arme et de se porter au devant de
L'EmpereurJustinien (484 - 564)
Saint Vital, Ravenne
Reprsentation d'une crmonie religieuse solennelle de l'Empereur Justinien
(484-564) entour des hauts dignitaires. Mosaque murale dcorant la basilique de
saint Vital Ravenne consacre en 548.
L'empereur, vtu du manteau pourpre, la tte entoure du nimbe, l'un et l'autre
symboles du pouvoir imprial d'origine divine, s'avance, une patne d'or la
main, vers l'autel pour officier.
Il est prcd par l'archevque de Ravenne, Maximus, vtu du pallevin tole et
portant la grande croix. De l'autre ct, le gnral Blisaire, chef des armes,
vainqueur des Vandales qu'il a expulss d'Afrique (433-434) et organisateur du
retour de la province au sein de l'empire.
386
L'ANTIQUIT
Blisaire ; pendant ce temps Glimer, avec le gros des troupes van-
dales, talonnerait les Byzantins sur leurs arrires. Le plan du roi ne
manquait pas d'ingniosit : il consistait prendre les impriaux
entre deux feux et les cerner dans le dfil de Derbet Essif, au sud
de Hammam-Lif. Mais la manuvre choua par manque de coordi-
nation ; Ammatas arriva trop tt Ad Decimum (Sidi Fathallah) o il
fut culbut par l'avant-garde byzantine et tu. Lorsque Glimer se
prsenta sur le champ de bataille il s'attarda pleurer sur le corps de
son frre, au lieu de poursuivre la cavalerie impriale qui s'tait dan-
gereusement aventure et devenait trs vulnrable. Un deuxime
choc se produisit sur les rives du lac Sedjoumi et tourna de nouveau
l'avantage des Byzantins.
La victoire d Ad Decimum ouvrait Blisaire les portes de Car-
thage qui, prive de murailles et prte s'insurger, accueillit les
Byzantins avec enthousiasme ; le gnralissime s'installa aussitt au
palais des rois vandales et mangea le repas que l'on avait prpar
pour Glimer. La prise de Carthage, dont les fortifications sont
remises en tat, offrait aux Byzantins un solide point d'appui et
assurait leurs communications par mer ; c'tait aussi un succs psy-
chologique qui fit sortir les chefs berbres de leur neutralit et les
dcida offrir leur concours aux impriaux.
L'effondrement des Vandales
Restaient Glimer et les Vandales, rfugis dans la plaine de
Butta Regia. Le roi fit venir des renforts, leva des troupes parmi les
populations rurales de Sardaigne, puis marcha sur Carthage qu'il
s'apprtait bloquer en lui coupant les vivres et en dtournant les
eaux de l'acqueduc.
Trois mois aprs Ad Decimum la mi-dcembre, Blisaire se
porta au-devant de l'arme vandale tablie Tricamarum, une tren-
taine de kilomtres de Carthage ; ce fut encore une bataille confuse
et mdiocre qui finit par la droute des Vandales. Glimer aban-
donna les siens en plein combat et s'enfuit chez les Berbres du
mont Pappua, en Numidie. Traqu, il se rendit, trois mois plus tard,
387
contre la promesse d'une vie sauve et d'un traitement honorable.
Ramen Constantinople, il devait figurer au triomphe de Blisaire
et terminer ses jours dans une riche proprit de Galatie.
La reddition du roi mettait fin aux oprations militaires qui
s'achevaient par la dfaite totale des Vandales. Celle-ci tait due la
mdiocrit de leurs troupes et l'indcision du roi beaucoup plus
qu' l'action de Blisaire qui, deux reprises, aurait pu tre vaincu.
L'tat vandale s'est effondr de lui-mme et disparaissait ainsi de
l'histoire. Mais les quelques deux cent mille Germains qui habitaient
alors le pays, ne se sont pas volatiliss du jour au lendemain. Beau-
coup furent dports Constantinople et affects dans l'arme
impriale ; mais le plus grand nombre demeura en Afrique. Les
femmes pousrent des soldats byzantins et les incitrent se rvol-
ter contre Solomon, ce qui entrana, en 539, la proscription gnra-
le de l'lment germanique. Certains se rfugirent en Maurtanie
o ils rpandirent l'arianisme et favorisrent le rveil du donatisme
au VI
e
s. Aux cots du chef rebelle Stotzas, ils poursuivirent la lut-
te contre l'Empire. Ceux qui demeurrent en Tunisie furent rapide-
ment assimils par la population indigne.
Les limites d'une reconqute
Aprs une clipse d' un sicle, l'Empire reprenait pied en
Afrique, mais il n'tait plus question, malgr les prtentions initiales
de Justinien, de ressusciter l'ancienne Afrique romaine. L'occupa-
tion demeura gographiquement limite ; les royaumes indignes
existaient toujours et n' ont pas cess de prendre les armes ; les
nomades chameliers aggravaient leur pression sur les confins mri-
dionaux. l'intrieur, le dclin de la vie urbaine se poursuivait mal-
gr l' effort gigantesque pour fortifier et protger les villes. Le retour
des grands propritaires acclra le processus de concentration des
terres et la mdivalisation de la socit rurale. La reconqute
catholique rendait au clerg sa puissance et n'allait pas tarder le
dresser contre l'tat.
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
388
L'ANTIQUIT
L'volution, commence plusieurs sicles plus tt, suivait son
cours et la domination byzantine demeura toujours prcaire, ryth-
me travers cent soixante-quatre ans d'existence par les guerres
contre les princes indignes, les mutineries dans l'arme, les
troubles religieux, pour succomber enfin devant l'invasion arabe.
On ne saurait cependant mconnatre l'importance historique
d'une oeuvre dont tant de tmoignages jonchent aujourd'hui le sol
de la Tunisie. Hritire de Rome, Byzance a insuffl une vie nou-
velle la romanit africaine, propag le christianisme dans des
rgions o il n'avait pas encore pntr, perptu tant bien que mal
cette notion romaine de l'tat. Puissance orientale, elle a rapproch
l'Afrique de ces pays du Levant d' o les Arabes et l'Islam allaient
bientt dferler.
La reconqute de l'Afrique fut l'uvre de Justinien qui entre-
prit aussitt de rorganiser profondment le pays. C'est pendant
son long rgne que nous connaissons le mieux cette priode, que la
domination impriale fut le moins prcaire, en dpit de toutes les
difficults militaires et religieuses qu'elle dut affronter. Aprs Justi-
nien, nos connaissances s'estompent ; le dernier sicle de l'Afrique
antique demeure encore trs obscur, au mme titre que les premiers
ges de l'Ifriqiya. travers la pnurie de nos informations on peut
dceler l'inluctable dgradation de l'autorit impriale et l'exten-
sion de l'anarchie.
II- L'organisation administrative et militaire
_L 'administration
Gographiquement, l'Afrique byzantine n'est pas beaucoup
plus tendue que celle des Vandales. L'occupation demeura limite
la Tunisie et l'Algrie orientale ; elle s'tend dsormais jusqu'aux
environs de Stif et englobe le massif de l'Aurs ainsi que les
plaines du Zab. cela il faut ajouter quelques positions ctires en
Maurtanie. Nous sommes loin du rve de Justinien qui voulait
389
reconqurir toutes les anciennes provinces de Rome ; en fait,
l'Afrique byzantine tait beaucoup moins vaste que celle de Diocl-
tien.
Les territoires reconquis formrent le nouveau diocse
d'Afrique, plac sous un prfet du prtoire, qui tait le chef supr-
me de l'administration civile, notamment en matire de justice et
d'impts. Le prfet avait le concours de nombreux conseillers et
bureaux qui renouaient ainsi avec les traditions administratives du
Bas-Empire. On en revint la division provinciale : Proconsulaire,
Byzacne et Tripolitaine avaient chacune sa tte un gouverneur de
rang consulaire, aux attributions galement civiles. Cette lourde
machine bureaucratique crasa les populations sous le poids d'une
fiscalit trs lourde et rtablit l'oppression administrative qui s'tait
relche sous les Vandales. La corruption qui rgnait tous les che-
lons, aggrava la condition des humbles et fut, comme l'a crit Pro-
cope dans son Histoire Secrte, une des causes de la ruine du pays.
L'arme et la dfense
L'Empire s'est attach surtout restaurer la scurit, en ror-
ganisant l'arme et en couvrant le pays d' un immense rseau de for-
teresses.
Reconstitue selon les mmes principes qu'au IV
e
s., l'arme
fut divise en arme mobile destine protger l'intrieur du pays
et en troupes frontalires formes de soldats paysans. Le comman-
dement en chef tait exerc par le magister militum Ajricae, personna-
ge considrable rsidant Carthage et honor gnralement du titre
de patrice ; il tait assist par un important tat-major la tte
duquel se trouvait le Domestique . Malgr la sparation des pou-
voirs civils et militaires, il arrivait, qu'en temps de troubles, le magis-
ter militum cumult ses fonctions avec celles du prfet du prtoire :
ce fut notamment le cas des patrices Solomon et Germanos. Dans
les provinces, le commandement local tait confi des ducs assis-
ts de tribuns.
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
Carte de la Proconsulaire
aprs la rforme administrative de Diocttien (284-305)
La carte de la Proconsulaire avec le trac des frontires rsultant du dcoupage
opr par Diocltien ( fin III' - dbut IV' s.) : Zeugitane, Byzacne et Tripolitaine.
La carte montre la frontire de l'ouest entre la Numidie et la Proconsulaire telle
qu'elle rsulta de la fusion de /'Africa Vtus (ancien territoire carthaginois) avec
l'Africa Nova (ancien royaume numide de Juba annex) pour constituer une seule
province unifie entre 40-39 avant J.-C. et dnomme Africa proconsularis ou sim-
plement Proconsulaire.
Sous le rgne de Diocltien (284-305) dans le cadre de la rorganisation de l'empi-
re, la Proconsulaire est divise en trois nouvelles provinces : Zeugitane ou
Proconsulaire, Byzacne et Tripolitaine.
Le trac de la limite sparant la Zeugitane de la Byzacne a t sans cesse rectifi et
prcis par les nouvelles dcouvertes archologiques et pigraphiques et les tudes
qui en ont dcoules.
La dernire modification porte sur l'attribution de Zama Regia la Proconsulaire
plutt qu ' la Byzacne. Le trac de la frontire s'en trouve amlior parce qu 'il sup-
prime un crochet et se rapproche de la nature du relief des chanons montagneux. Le
trac de la frontire entre les deux provinces suit l'orientation de la chane monta-
gneuse de la Dorsale qui traverse le pays en charpe du S-0 au N-E.
Le trac de cette frontire a t rectifi plusieurs reprises : par la restitution
cPAmmaedara la Proconsulaire - Zeugitane et par l'attribution de Pupput la
Byzacne. De mme, il apparat qu 'Abthugni relve plutt de la Proconsulaire que
de la Byzacne.
De part et d'autre de cette frontire, se situent donc, en Zeugitane : outre Zama
Regia, Maraci, Kbor Klib, Ksar el Hadid (SULIANA ?), Seba Biar, Sidi Ahmed
Hechehi, Althiburos, Saradi, Furnos Majus, Verona, Seressi, Abthugni, Ammaedara
et Theveste.
En Byzacne : outre Pupput, Vazi Sara (Hr Bez), Marago, Sara (Hr Chaar), Macot
(Maghraoua), Thiggiba (Hr Zouakra), Thugga Terebentina, Se germes, Bia, Asadi,
Uzappa antique, Mactaris, Mididi et Thala.
Fin III
e
- dbut IV
e
s
Carte tire de l'ouvrage de Cl. Lepelley. Les cits de l'Afrique
romaine au bas-empire, T. II, hors texte.
392
L'ANTIQUIT
La dfense du pays reposait d'abord sur le limes qui fut sans
doute reconstitu et renforc. En Tunisie, son trac demeurait iden-
tique celui du IV
e
s. ; il longeait toujours le littoral tripolitain puis
s'inflchissant du nord-ouest, il s'appuyait sur les Matmatas et
gagnait la ligne des Chotts d' o il remontait vers Gafsa avant de
gagner l'Algrie.
Les forteresses
Mais ce sont les innombrables forteresses de l'intrieur dont
Solomon a hriss le pays qui caractrisent le mieux l'uvre militai-
re de Byzance. La formation de puissantes confdrations berbres
dont les incursions priodiques menaaient les villes comme les
campagnes, rendait ncessaire d'tablir des bases fortifies au cur
mme des provinces. Les villes, dont les Vandales avaient nglig la
dfense, s'entourrent de puissantes murailles protectrices, les dif-
frents points stratgiques : dfils montagneux, points d'eau,
routes importantes, furent galement surveills par des garnisons
tablies dans des forteresses. Des fortins plus modestes dfendirent
les exploitations rurales contre les razzias dvastatrices. C'est par
centaines qu' on pourrait chiffrer les constructions d'ouvrages
dfensifs l'poque byzantine et les tmoignages qu'en donne l'ar-
chologie sont innombrables. Citons les mieux conserves, celles de
Ksar Lemsa, An Tounga, Tboursouk, Hadra. La varit est infi-
nie, depuis les grandes villes fortifies comme Hadra ou Tbessa
jusqu'aux modestes borjs construits la hte pour dfendre une fer-
me.
La forteresse byzantine a, en gnral, un plan rectangulaire ;
elle comprend un mur d'enceinte qui peut s'lever jusqu' une dizai-
ne de mtres et dont les angles sont renforcs par de puissantes
tours carres garnies de meurtrires et communiquant avec le che-
min de ronde. En avant du mur, se trouve gnralement un foss,
rempli d'eau. Les portes, souvent au nombre de quatre, sont trs
protges, soit par des tours qui les flanquent, soit en prenant, com-
Ksar Lemsa
II est souvent signal comme l'un des plus beaux et des plus complets
monuments que la Tunisie ait gards de l'poque byzantine.
Murailles dores par le soleil, tours crneles, cette forteresse domine
la valle de l'oued Mahrouf, vers la plaine de Siliana.
La forteresse est de plan rectangulaire, flanque chaque coin par
une haute tour carre.
La cour intrieure mesure 28 x 31 m
La muraille est faite de pierres de taille prleves sur des difices
de l'antique Limisa. Un parapet crnel abritait le chemin de ronde.
Alors que l'a hauteur des murs varie entre 8 et IL) mtres,
celle des tours d'angle s'lve plus de 13,50 m. Sur la face sud-est,
entre deux avant-corps, une porte d'entre.
Construit sous le rgne de l'empereur Maurice (582-602), le chteau de
Lemsa est le type de castellum difi en grand nombre par le
pouvoir byzantin travers la Proconsulaire pour assurer la surveillance
de la province contre l'inscurit.
394
L'ANTIQUIT
me An Tounga, une forme coude. l'intrieur de la citadelle, se
trouvent les btiments de la garnison : magasins militaires, curies,
meules, pressoirs, souvent une glise. Quand il s'agit d'une ville for-
tifie, comme Hadra, le mur d'enceinte englobe une partie de l'an-
cienne agglomration romaine ; une telle contraction du primtre
urbain en temps de troubles est un phnomne gnral.
Le problme de l'eau est videmment capital et intervient
dans le choix du site ; la citadelle de An Tounga se trouve, comme
l'indique le nom du village, proximit immdiate d'une source. De
vastes citernes sont souvent construites pour recueillir les eaux de
pluie et assurer des rserves. La technique de construction est d'au-
tant plus remarquable que les travaux furent mens la hte et avec
des matriaux de fortune. Les murs d'enceinte sont constitus d'un
double revtement de pierres de taille en gros appareil, rgulire-
ment disposes ; l'intervalle entre les deux assises est combl par
une maonnerie grossire, le blocage. Beaucoup d'difices romains
furent dtruits et leurs pierres remployes ; l'enceinte s'appuyait
souvent sur un monument prexistant ; c'est le cas, par exemple, des
forteresses de Sbetla et de Dougga. Tbessa, l'arc de triomphe de
Caracalla a servi la fois de bastion et de porte pour la citadelle
Gographiquement, ces forteresses se rpartissent travers
tout le pays, les plus importantes s' ordonnent cependant en un cer-
tain nombre de lignes stratgiques : d'abord sur le littoral, entre
Gabs et Carthage o la plupart des villes sont entoures de
murailles ; une deuxime ligne fortifie s'organise le long de la rou-
te de Carthage-Tbessa dont l'importance stratgique demeure
essentielle ; c'est l que se trouvent les forteresses de Hadra, Hen-
chir Lorbeus, Tboursouk, An Tounga
Au centre et l'ouest de la Byzacne, aux confins des
royaumes berbres passe une troisime ligne jalonne par les forts
de Sbetla, Sbiba, Jaloula, Lemsa. Enfin, dans la valle de la Medjer-
da, le long des routes reliant Carthage Constantine et Bne s'che-
lonnent les citadelles de Bja, Wulla Regza, Le Kef.
Basilique byzantine de la citadelle de Hadra
Spectaculaires pans de murs en grand appareil patin s par l'exposition au soleil.
Adosse au rempart qui la domine, c'est la partie antrieure d'une basilique
construite l'intrieur de la citadelle byzantine. Les deux colonnes debout enca-
drent l'abside qui terminait la nef centrale. Le monument comprenait trois nefs se
dveloppant sur trois traves. L'entre principale s'ouvrait sur un porche du ct
oppos l 'abside,
Longue de 23,50, large de 13m, cette basilique a conserv une grande partie de
son lvation parce que les murs ont t construits avec de grands blocs pris sur
des btiments abandonns. Cette basilique a fait l'objet de fouilles et de recherches
ainsi que d'un essai de retitution. Cf. Dessin de J.-C. Golvin et J. Christen.
Carte des fortifications byzantines d'aprs Ch. Diehl, L' Afrique byzantine, 1896 et
des voies routires d'aprs P. Salama, Les voies romaines de l'Afrique du Nord, 1951,
ralise par R. Gury, extraite de l'ouvrage de R. Gury, C. Morrisson, H. Slim,
Recherches archologiques Rougga, fasc. 11, 1982, p. 88, fig 8.
1 CLYPEA Klibia 34 -ASSURAS Zanfour
2- VAGA Bja 35 -VAZI SARRA Henchir Bez
3-SUA Chaouach 36 - URUSI Henchir Sougda
4- UTHINA Oudna 37- AUBUZZA Henchir Gezza
5- TUBERNUC An Tebournoc 38 - Elles
6- BULLA REGIA Hammam Daradji 39 - UZAPPA Ksour Abd el Melek
7- TIGNICA An Tounga 40 -HADRUMETUM Sousse
8- Depienne 41 - THUCCA TEREBENTINA Henchir Dougga
9- NEAPOLIS Nabeul 42 - MACTARIS Maktar
10 - THUBURNICA Henchir Sidi Belgacem 43 -AGGAR Sidi Amara
11 - TUNUSIDA ? Boij Hallal 44 - CUCULIS Jelloula
12 - THUBURSICU BURE Tboursouk 45 -CHURISA La Kessera
13 - AV1TA BIBBA Henchir bou Ftis 46 - LEPTI MINUS Lemta
14 - THUBURBO MAIUS Henchir Kasbah 47 -THAPSUS Rass Dimas
15 -PUPPUT Hammamet 48 - MAMMA? Henchir Douims
16 -THUGGA Dougga 49 Gastal
17 - AGBIA An Hedja 50 - AMMAEDARA Hadra
18 - MUSTI Le Krib 51
-
Henchir Kokech
19 - THIMISSUA Sidi bou Argout 52 -SUFES Sbiba
20 -ZUCCHAR An Joukar 53 -SULLECTUM Salakta
21 - BEA An Batria 54 -THEVESTE Tbessa
22 - APHODISIUM ? 55 - CAPUT VADA Rass Kaboudia
23 -AVIOCCALA Henchir Sidi Amara 56 -CILMA Jilma
24 - MEDICCERA An Mdeker 57 -ACHOLLA Henchir Botria
25 - PHERADI MAIUS Henchir Fradis 58 -CILLIUM Kasserine
26 - SERESSI Oum el Abouab 59 -TAMESMIDA Henchir Goubel
27 - UPPENA Chigarnia 60 -THELEPTE Mdinet el Kdima
28 - SICCA VENERIA Le Kef 61 - MADARSUMA ? Henchir bou Doukkan
29 -ZAMA Jama 62 - MACOMADES MINORES Mahars
30 - HORREA CAELIA Hergla 63 - IUNCI Boij Younca
31 -LARES Lorbeus 64
-
EL Hafay
32 -LIMIZA Ksar Lemsa 65 -AGGARSELNEPTE Nefta
33 - MUZUC Henchir Kachoum 66 - GIGTHIS Bou Ghara
Carte des fortifications byzantines
398
L'ANTIQUIT
IIL- Guerres indignes et rebellions dans
l'arme
Ces gigantesques travaux entrepris pour la plupart sous Solo-
mon montrent quel point la scurit tait devenue prcaire. Byzan-
ce n'a pas apport la paix au pays, perptuellement troubl par les
guerres indignes et l'anarchie qui rgnait dans l'arme.
Les relations entre l'administration byzantine et les chefs
berbres
Aussitt aprs la victoire de Blisaire et le dpart de celui-ci,
une double insurrection faillit dj chasser les Byzantins d'Afrique.
Les chefs berbres qui taient rests neutres pendant la guerre de
reconqute se soulevrent aprs le dpart de Blisaire ; la violente
famine de 534 poussait les tribus montagnardes vers les riches
plaines bl. Byzance dut son salut aux perptuelles divisions qui
n' ont pas cess d' opposer et d'affaiblir les roitelets indignes, au
grand profit de la diplomatie impriale. Celle-ci reconnaissait leur
autorit en leur confrant une investiture qui les plaait dans une
sorte de vassalit. L'empereur s'engageait leur verser un subside
annuel et ils devaient en change fournir des contingents aux
troupes impriales.
Au lendemain de la reconqute, la diplomatie byzantine entre-
tenait des relations avec plusieurs confdrations limitrophes de la
Tunisie ; les plus importantes taient celles de Ierna en Tripolitaine,
d'Antalas et de Coutsina en Byzacne. L'insurrection fut dclenche
en 534 par les tribus de Coutsina, qui se jetrent sur les campagnes
de Byzacne, pillant les rcoltes et massacrant les populations. Gr-
ce la neutralit d'Antalas qu'une rivalit farouche opposait Cout-
sina, les troupes byzantines conduites par Solomon purent l'empor-
ter deux reprises en 535 et pacifier le pays.
399
La mutinerie de Stotzas
Mais les troubles reprirent l'anne suivante cause de la muti-
nerie qui clata dans l'arme. L'impopularit de Solomon, trop bru-
tal, le retard dans le paiement des soldes cause des perptuelles
difficults financires, la revendication des terres vandales par les
soldats qui avaient pous des femmes germaniques, l'ambition de
certains officiers comme Stotzas, tout cela conduisit la grave
rvolte de 536 ; dirigs par Stotzas, les rebelles formrent une arme
redoutable, s'tablirent dans la plaine de huila Rgza et, aprs avoir
ngoci avec les chefs berbres de Numidie, ils marchrent contre
Carthage. Solomon quitta prcipitamment la ville pour chapper au
poignard des assassins et s'embarqua pour la Sicile, o Blisaire se
trouvait la tte de troupes importantes qui s'apprtaient recon-
qurir l'Italie
Le gnralissime para au plus press et revint Carthage. Les
rebelles levrent le sige de la ville et se replirent en dsordre vers
Membressa (Medjez el Bab) o ils furent accrochs par les troupes
impriales et mis en droute. L'ordre semblait revenu mais l'insur-
rection rebondit aussitt aprs le dpart de Blisaire
Justinien confia alors le commandement au patrice Germanos
qui, alliant l'usage de la force la diplomatie, parvint briser la
rbellion. Stotzas dut se rfugier en Maurtanie, o il pousa la fille
du roitelet maure ; avec lui disparurent les derniers soldats vandales.
Aprs sa victoire, Germanos fut rappel Constantinople et l'em-
pereur rendit le commandement suprme Solomon qui reut alors
les titres de prfet du prtoire et de matre des milices. La pacifica-
tion du pays fut acheve et la domination byzantine s'tendit jusque
dans le Hodna. La Tunisie connut une priode de calme et de rela-
tive prosprit entre les annes 539 et 545 au cours desquelles
furent construites la plupart des grandes forteresses.
La rvolte d'Antalas et la mort de Solomon
Mais ce n'tait qu'un rpit. Une nouvelle crise clata en 544 et
partit, cette fois, de Tripolitaine o le duc Sergius s'tait rendu odieux
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
400
L'ANTIQUIT
aux populations. Une dlgation de Lawtas, venue se plaindre
leptis Magna des exactions commises sur son territoire, fut con-
duite et massacre. La Tripolitaine se souleva et obtint l'appui du
grand caid Antalas qui rompit avec Solomon, car celui-ci, irrit sans
doute par la fre indpendance du vieux chef berbre, lui avait cou-
p les subsides aprs avoir fait excuter son frre. Antalas se mit
ravager la Byzacne et tout fut recommencer. Coutsina ne manqua
pas l'occasion d'assouvir sa haine en passant cette fois dans le camp
des Byzantins. L'arme impriale affronta les troupes d'Antalas
dans la plaine de Kasserine ; indiscipline, cause du perptuel
retard de la solde, elle se dbanda ds le premier choc. Le dsastre
s'acheva par la mort de Solomon, tu dans une embuscade.
L' anarchie en Afrique
La dfaite et la mort du gnralissime rallumrent l'insurrec-
tion dans tout l'ouest de la Byzacne. Stotzas revint de Maurtanie
avec ses rfugis vandales et rallia les troupes d'Antalas. Pendant ce
temps, l'arme byzantine la tte de laquelle venait d'tre plac l'im-
populaire et incapable Sergius, tait paralyse par l'indiscipline et
refusait de combattre. Hadrumetum fut prise sans rsistance et sacca-
ge. L'empereur aggrava la confusion en flanquant Sergius d' un col-
lgue aussi incomptent, l'aristocrate Arobinde. C'tait la division
et la rivalit au sein mme du commandement. Sergius laissa craser
l'arme de son collgue Thacia (entre le Kef et Tboursouk) sans
intervenir. Le chef de l'infanterie, Jean, qui tait l'un des rares com-
mandants valables, fut tu dans cette bataille au cours de laquelle
devait galement succomber le rebelle Stotzas
Justinien rappela alors Sergius et remit tout le pouvoir Aro-
binde qui se montra aussi incapable de matriser l'insurrection
laquelle se joignirent bientt Coutsina et le chef de l'Aurs, Iaudas.
En mme temps, le duc de Numidie Guntharith intriguait pour ren-
verser Arobinde et ngociait secrtement avec les chefs berbres.
En mars 546 il parvenait supprimer Arobinde et s'installait en
matre Carthage. L'anarchie tait totale et l'Afrique semblait per-
401
due pour Byzance ; sans leurs divisions, les Berbres auraient pu en
finir alors avec cette arme impriale disloque. Aprs la chute de
Gunharith, dont le rgne de fantoche ne dura que trente-six jours,
l'empereur se dcida enfin confier le commandement un chef de
valeur, Jean Trogliata, la gloire duquel l'africain Corippus crivit le
pome pique de la Johannide.
Redressement provisoire sous Jean Trogliata
Jean Trogliata tait un ancien de l'arme d'Afrique ; il avait
particip la reconqute et servi sous les ordres de Solomon com-
me duc de Tripolitaine. Il combattit ensuite en Orient, contre les
Perses ; la fin de la guerre perse lui permit de recevoir des renforts.
Le nouveau magister militum qui connaissait bien le pays, russit
dtacher Coutsina de l'insurrection, puis il entreprit de pacifier la
Byzacne. L'arme rebelle, commande par Antalas et le Tripolitain
Ierna, fut battue une premire fois en 547 dans la rgion de Sbeda,
o Ierna trouva la mort ; mais Antalas parvint refaire ses troupes
et reprit ses razzias presque sous les murs de Carthage. La bataille
dcisive eut lieu dans les champs de Caton, en Byzacne, au cours
de l't 548 ; plusieurs chefs indignes dont le Lawta Carcasan y
furent tus. Antalas se soumit de nouveau. La paix tait rtablie
pour une quinzaine d'annes, mais le pays, et en particulier la Byza-
cne, avait t cruellement dvast par la guerre. Les troubles repre-
naient la fin du rgne de Justinien qui, sa mort en 565, laissait
l'Afrique byzantine dans une situation critique.
IV.- La vi e conomi que et soci al e
Jugement de Procope
Dans son Histoire secrte, Procope accuse l'administration
byzantine d'avoir saccag et appauvri le pays : C'est que Justinien,
aprs la dfaite des l 'andales, ne s'inquita pas d'assurer la solide possession du
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
402
L'ANTIQUIT
pays ; il ne comprit point que la meilleure garantie de l'autorit rside dans la
bonne volont des sujets ; mais il se hta de rappeler blisaire qu'il souponnait
injustement d'aspirer l'Umpire et lui-mme administrant l'Afrique distan-
ce, il l'puisa, la pilla plaisir. Il envoya des agents pour estimer les terres ; il
tablit des impts trs lourds qui n'existaient point auparavant ; il s'adjugea la
meilleure partie du sol ; il interdit aux ariens la clbration de leurs mystres ;
il diffra les envois de renforts et en toute circonstance, il se montra dur au sol-
dat : de l, naquirent des troubles qui aboutirent de grands dsastres
Ce sombre tableau renferme une large part de vrit qui est
confirme par la Johannide de Corrippus dcrivant : L'Afrique fuman-
te s'abmant dans les flammes .
Il convient cependant de nuancer ces tmoignages car ils
concernent surtout la Byzacne l'poque des guerres indignes,
particulirement celles du milieu du sicle. Procope gnralise en
tendant tout le pays une situation qui tait limite dans le temps
et l'espace. Il n'en reste pas moins que la condition des hommes
s'est encore dgrade cause d'une fiscalit trs lourde leve par
une administration corrompue et impitoyable, du retour des grands
propritaires qui fixent de nouveau, les colons la terre, largissent
leurs domaines et aggravent la servitude des populations rurales,
enfin de l'inscurit qui menaait priodiquement les campagnes.
Mais en dpit de la crise sociale et des troubles, la Tunisie du VI
e
s.
demeurait relativement prospre. Beaucoup de villes furent restau-
res, agrandies ; les principales cits de Tunisie s'adjoignirent le nom
de Y empereur : Justiman (Capsa, Hadrumetum, Carthago Justiniana) ;
Caput Vada, sur la plage o avait dbarqu Blisaire, les Byzantins
construisirent une ville nouvelle qu'ils appelrent Justinianopolis. A
Carthage des travaux importants furent entrepris sur la colline de
Byrsa et dans le quartier des ports ; de nouveaux thermes datent de
cette poque. Mais c'est encore l'architecture religieuse, sur laquelle
nous reviendrons, qui tient la place la plus importante dans cette
uvre de restauration urbaine. Malgr le dclin de la vie municipa-
le qui se poursuivait, la civilisation romaine brilla d'un dernier clat
et s'enrichit des influences orientales apportes par les artistes
byzantins. Dans ce domaine, l'poque byzantine fut, par rapport au
Mosaque dite de la dame de Carthage
Muse de Carthage. Dcouverte en 1953
dans le quartieur nord de Carthage dans le pavement
d'une villa ancienne.
Dans un encadrement fait de joyaux et de pierres prcieuses,
un personnage nigmatique, au visage jeune, est
reprsent de face, dans une attitude hiratique.
C'est une figure fminine par sa coiffure et ses boucles d'oreilles.
Mais son costume est masculin : un paludamentum pourpre
attach sur l'paule droite par une fibule ronde.
Le personnage, diadm et nimb, fait le geste de bndiction.
De la main gauche, il tient un sceptre.
L'interprtation de ce personnage reste incertaine.
Il ne s'agit manifestement pas d'un simple portrait.
Personnification ou allgorie ? Faute d'une inscription
qui en aurait prcis la signification, l'identification nous chappe
et continue de susciter de nombreuses interrogations.
La datation de l'excution du tableau varie du IV
e
au VI" s. selon les
spcialistes. La bibliographie concernant les tudes de
cette uvre est abondante en raison
de l'intrt qu 'elle suscite.
404
L'ANTIQUIT
sicle vandale, une renaissance : architecture militaire et religieuse,
sculpture qui produit les bas-reliefs de Damous el Karita et les nom-
breux chapiteaux que l'on retrouvera dans les mosques de Kai-
rouan, mosaque, vie littraire avec le pote historien Corippus, tout
cela traduit la fois le rveil et l'ultime clat de la civilisation antique
en Afrique.
Agriculture et vie rurale
La vie rurale fut bouleverse par l'expropriation massive des
terres vandales ; ce nouveau transfert de la proprit donna lieu de
multiples contestations et toutes sortes d'abus, en dpit du dlai
de cinq ans qui fixait la prescription. Les soldats byzantins qui
s'taient maris avec des femmes vandales revendiqurent les biens
ayant appartenu leurs pouses ; d' o le conflit avec les anciens
propritaires africains et les rebellions dans l'arme. Les terres du
domaine royal passrent de nouveau au fisc imprial ; quant l'E-
glise catholique, elle rcupra tous les biens dont elle avait t spo-
lie. Les paysans libres, cultivant leur terre selon la coutume man-
cienne, n' ont pas disparu, mais, comme l'attestent les Tablettes
Albertini pour l'poque vandale, ils furent souvent obligs de
vendre ou d'abandonner leurs exploitations aux grands propri-
taires. Le colonat, qui faisait du paysan un esclave de la glbe, rede-
vient la rgle du VI
e
s. et l'tat apportait son concours aux propri-
taires rclamant le retour des paysans fugitifs afin d'assurer, tout
prix, le recouvrement des impts.
Les ressources agricoles demeurent abondantes surtout en
Proconsulaire qui a moins souffert des troubles. Plus arrose, plus
fertile, elle tait toujours le pays des crales, des cultures arbustives
et marachres. En Byzacne, le sol tait plus pauvre, le climat plus
sec, les villes moins nombreuses, la rgion avait en outre subi les
dommages causs par les razzias, ce qui entrana une baisse de ia
population, comme le prouve la diminution des siges piscopaux.
Il ne faut cependant pas conclure une ruine totale du pays ; celui-
405
ci a guri ses blessures et, au milieu du VII
e
s., le patrice Grgoire
pouvait encore installer sa capitale Sbetla ; les historiens arabes,
comme Ibn Abdel Hakam, admiraient les riches oliveraies de Byza-
cne. Peut-tre peroit-on dj un dclin de l'agriculture sdentaire
et un retour vers l'conomie pastorale ; mais l'importance et l'en-
tretien des rseaux d'irrigation jusqu' la conqute arabe, montrent
bien que les steppes du centre et du sud demeuraient des terres
cultures. La vgtation forestire tait beaucoup plus dense qu'au-
jourd'hui ; selon Corippus la ville de Laribus (Henchir Lorbeus,
proximit du Kef) se trouvait dans un bois, les montagnes de Byza-
cne et du Cap Bon taient galement couvertes de forts.
Le commerce
Le commerce extrieur demeurait actif, et Carthage entrete-
nait d'troites relations avec l'Orient, exportant des produits agri-
coles et de la cramique et achetant des tissus, soieries et autres
objets de luxe ; le commerce fit pntrer les influences grecques et
orientales dans les grandes villes ; il explique l'importance du culte
rendu aux saints d'Orient.
V.- La politique religieuse
La reconqute byzantine fut aussi une reconqute catholique.
Guid par sa foi ardente, l'empereur avait su imposer l'expdition
son entourage hsitant et entendait qu'elle ft une croisade anti-
arienne. L'inlassable effort des migrs catholiques trouvait enfin sa
rcompense ; les Vandales balays, l'arianisme fut proscrit, ses
glises et ses biens restitus au clerg catholique. Une perscution
violente s'engagea avec l'appui total de l'empereur contre tous les
dissidents : ariens, juifs, donatistes et pa'iens qui se voyaient interdi-
re la libert de culte et l'accs toute charge publique. Temples
ariens et synagogues furent transforms en glises. Ds 534, un
concile de deux cent vingt vques se runit Carthage pour cl-
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
406
L'ANTIQUIT
brer cette revanche du catholicisme et le pape exprima sa recon-
naissance l'empereur.
Ultime essor du christianisme en Tunisie
Grce la reconqute, l'glise put ainsi briller d'un dernier
clat ; le catholicisme redevenait la religion officielle, la seule qui ft
tolre, le clerg sortait de la clandestinit et retrouvait son organi-
sation passe : trois provinces ecclsiastiques, celles de Proconsulai-
re, Byzacne et Tripolitaine, avaient, chacune sa tte, un primat.
Celui de Carthage tendait son autorit sur toute l'glise d'Afrique
et trouvait l'appui du pouvoir pour combattre les particularismes
rgionaux qui s'taient manifests au V
e
s., notamment en Byzac-
ne. La Tunisie comptait toujours prs de deux cents vques, mais
le nombre des siges semble avoir diminu en Byzacne, cause de
la dpopulation conscutive aux troubles. Le christianisme a cepen-
dant progress dans l'extrme sud du pays. Au dbut du VI
e
s., beau-
coup de tribus adoraient toujours des divinits paennes, Guenfan
et son fils Antalas interrogeaient l'avenir auprs de l'oracle d'Am-
mon ; les Lawtas de Tripolitaine adoraient le dieu Gurzil ; la pra-
tique trs courante de la polygamie dnotait la faible pntration du
christianisme. Celui-ci fit des progrs au VP s., parvenant jusqu'aux
oasis sahariennes ; en 569, les habitants du Fezzan conclurent un
trait de paix avec l'Empire et se convertirent ; il en fut de mme
Ghadams. La propagande religieuse devenait ainsi une arme de la
diplomatie impriale. En Proconsulaire, le nombre des vchs
semble avoir augment au cours de la priode byzantine.
La renaissance catholique est atteste par la frquence des
conciles, la construction de nouvelles glises, l'essor de la vie
monastique. De trs nombreuses glises furent difies travers
tout le pays. Les plus importantes sont celles de Tbessa, de
Damous el Karita Carthage, de Hadra, de Dar el Kous au Kef.
Leur plan gnral tait toujours latin : la basilique avait une forme
rectangulaire termine par une abside semi-circulaire ; au centre, la
grande nef tait spare des traves latrales par des arcades repo-
Mosaque funraire de Klibia
Mosaque tombale avec double pitaphe
Conserve au Muse de Bardo
2.20 x 1.62 m.
Elle provient d'une vaste basilique cimtriale dite du prtre Flix
et dont le baptistre est reproduit la page 347.
Dcouverte en 1953 Demna, quelques kilomtres de Klibia, cette
basilique a livr un ensemble de mosaques tombales remarquables.
La mosaque prsente couvrait ensemble deux tombes. Son encadrement est
constitu d'un rinceau de vigne ondulant garni de grappes et peupl de colombes.
Au milieu, dans un cercle, figure, sur 6 lignes, le texte des deux pitaphes,
celle de Vincentius et celle de Restitutus.
Le cercle de l'inscription est surmont d'un grand cratre renvers
d'os'chappent symtriquement deux rinceaux de rosiers peupls d'oiseaux.
En bas, entours de fleurs, des poissons et des volatiles occupent l'espace,
en particulier un paon aux couleurs varies qui symbolise la vie ternelle.
Date de la fin du IV" - dbut du V" s.
408
L'ANTIQUIT
sant sur des colonnes. Mais on remarque des influences typique-
ment orientales : l'abside est ainsi dcore de niches, comme dans
les glises de Constantinople ; quant la dcoration architecturale,
en particulier celle des chapiteaux, elle trahissait galement l'in-
fluence des artistes venus d'Orient. On construisit aussi de nou-
veaux monastres, souvent fortifis, comme celui de Tbessa.
Les querelles thologiques
La protection impriale favorisa cette restauration du catholi-
cisme, mais elle soumit l'glise l'autorit absolue de l'empereur
qui, depuis Constantin, s'arrogeait un droit d'intervention dans tou-
te la vie ecclsiastique, et en particulier dans les querelles tholo-
giques. Le caractre thocratique du souverain n'a pas cess de s'af-
firmer sous Justinien, qui entendit imposer sa volont dans l'affaire
des Trois Chapitres. Cette querelle thologique opposa violemment
une partie du clerg d'Afrique l'empereur, dchana la perscution
et compromit, durant plusieurs annes, la paix religieuse.
L'affaire commena lorsque, en 544, Justinien, influenc sans
doute par Thodora, condamna comme hrtiques trois textes
ecclsiastiques qui avaient t approuvs, au sicle prcdent, par le
concile oecumnique de Chalcdoine. La condamnation de ces
Trois Chapitres voulait donner satisfaction l'opposition mono-
physite qui enseignait que la nature du Christ tait d'essence uni-
quement divine, mais elle se heurta l'opposition violente du cler-
g occidental demeur fidle l'orthodoxie chalcdonienne. Le
pape Vigile, convoqu Constantinople et squestr, fut oblig
d'approuver les dcisions impriales, mais le clerg d'Afrique, runi
en concile Carthage, rompit avec l'evque de Rome qu'il excom-
munia, et protesta solennellement auprs de Justinien
L'vque d'Hermiane Facundus publia un trait thologique o
il s'en prenait l'empereur lui-mme. Celui-ci convoqua alors un
concile oecumnique Constantinople qui ratifia la condamnation
4 0 9
des Trois Chapitres. Les vques dissidents furent dposs, exils,
emprisonns ; la force et la corruption finirent par imposer silence
l'glise d'Afrique qui sortit branle et affaiblie de cette longue
lutte. la fin du rgne de justinien, la paix religieuse tait rtablie,
mais l'glise avait pay trs cher la protection de l'tat.
Conclusion
Ces dernires annes d' un grand rgne furent marques par la
dgradation gnrale de la situation du pays. L'empereur, vieilli, se
dtachait peu peu de la conduite des affaires, laissant son oeuvre
s'crouler. Le Trsor public tait presque vide, en dpit d'une fisca-
lit terriblement oppressive ; l'anarchie, la corruption, l'indiscipline
rgnaient dans l'administration et dans l'arme. L'Afrique, trop loi-
gne du centre de l'Empire, tait abandonne elle-mme : les
troupes, faibles et insuffisantes, ne pouvaient contenir l'inexorable
pression des tribus berbres ; les documents officiels reconnais-
saient eux-mmes cette carence de l'tat ; on lit dans une novelle de
Justinien qu' en l'absence de toutes les choses ncessaires, l'arme tait si com-
pltement dissoute, que l'Etat tait expos aux invasions incessantes et aux
insultes des Barbares .
Pourtant la domination byzantine devait encore survivre cent
trente-trois ans la mort de Justinien.
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
CHAPITRE II
La Tunisie la veille des invasions
arabes
I.- L'volution politique et administrative
jusqu'au milieu du VII
e
s.
Cette priode que nous connaissons mal a vu se poursuivre la
longue dcadence de la romanit africaine en dpit des efforts pour
rorganiser l'administration. L'impuissance politique des confdra-
tions berbres et leur incapacit fondamentale de s'unir pour for-
mer un tat, permirent la domination byzantine de durer jusqu'
la conqute arabe, et, avec Heraclius, l'Afrique put encore donner
l'Empire l'un de ses souverains les plus prestigieux. Le christianis-
me faisait de nouveaux progrs dans le sud et le pays tait toujours
prospre au VII
e
s.
L'Afrique sous Justin II et Tibre Constantin (565-582)
La guerre berbre reprit en 563 la suite de la rupture avec
Coutsina qui fut assassin, on ne sait pourquoi, sur ordre du gou-
verneur Jean Rogathinos. Les fils du vieux chef prirent alors les
armes en Numidie o l'insurrection fit rapidement tche d'huile ; il
fallut faire venir des renforts d' Orient et, l'avnement de Justin II,
, l'ordre tait rtabli.
412 L'ANTIQUIT
Le nouvel empereur, glorifi par le pote Corippus, semblait
plus nergique. Il s'effora d'assainir la situation financire, de res-
taurer la discipline dans l'arme et d'apaiser les querelles religieuses.
Des ngociations furent engages avec les tribus indignes ; de nou-
velles forteresses s'levrent dans la valle de la Medjerda ; bref, le
nouveau rgne commenait sous de bonnes auspices, ce qui faisait
dire Corippus que l'Afrique puise, retrouvait un espoir de vie .
Mais ce relvement fut phmre ; les invasions barbares en
Orient et en Italie firent passer la dfense de l'Afrique au deuxime
plan des proccupations impriales. De nouvelles insurrections
clatrent partir de 569 et l'anarchie rgna nouveau. Les troupes
byzantines furent vaincues trois reprises par le roi maure Garmul.
L'empereur, dcourag, laissa le pouvoir Tibre Constantin, sous
le rgne duquel la paix fut tant bien que mal rtablie ; le magister mili-
tum Gennadius russit dfaire les Maures et tuer, de ses propres
mains, leur chef Garmul. D'autres citadelles furent construites pour
renforcer la dfense du pays.
Ce retour l'inscurit permanente qui menaait sans cesse la
domination byzantine, explique l'oeuvre de rorganisation adminis-
trative entreprise sous l'empereur Maurice.
L exarcbat de Carthage
De profondes transformations modifirent la gographie
politique et l'administration de l'Afrique byzantine sous le rgne de
Maurice (582-602). Au point de vue territorial, la rforme ne toucha
la Tunisie que par le rattachement de la province de Tripolitaine au
diocse d'Egypte, mais l'administration s'orienta dans une voie nou-
velle depuis la cration de l'exarchat qui mettait progressivement fin
au principe de la sparation des pouvoirs civils et militaires. Dj
sous justinien, il arrivait que le gnralissime cumult ses fonctions
avec celles de prfet du prtoire ; ce fut le cas de Germanos et de
Solomon. En fait, l'lment militaire prenait une importance tou-
jours plus grande dans l'administration parce que le pays ne cessait
Arc de triomphe transform en fortin Hadra
L'arc, construit en grand appareil selon une technique soigne,
date de la fin de II's. Il ne comporte qu'une seule arche, de prs de 6 m
cl'ouverture marquant l'entre de la ville.
Les pidroits sont flanqus de deux avant-corps orns de colonnes
jumeles. Sur l'entablement dont l'architrave est richement moulure,
est grave la ddicace l'intrieur d'un cartouche.
L'difice, dat du rgne de Septime Svre, apparat intact parce qu'il
a t entour l'poque byzantine de murs le transformant
en fortin de dfense avance de la forteresse de Hctidra.
414 L'ANTIQUIT
pratiquement de vivre sur le pied de guerre. Cette volution qui
transformait les anciennes provinces de l'Empire d'Occident en
gouvernements militaires, devait aboutir au rgime des thmes du
VI
e
s. Elle a bien commenc en Afrique, mais avorta du fait de la
conqute arabe. Le prfet du prtoire demeurait la tte de l'admi-
nistration, mais il perdit peu peu ses pouvoirs au profit de
l'exarque qui, de simple chef militaire l'origine, verra son autorit
s'tendre sur toute l'administration du pays. Vritable vice-empe-
reur, revtu de la dignit de patrice, l'exarque devint un personnage
considrable. Il rsidait Carthage dans le palais des anciens rois
vandales, la place du prfet du prtoire ; il commandait aux
armes, dirigeait la diplomatie, contrlait les affaires ecclsiastiques
et intervenait au nom de l'empereur dans toute l'administration civi-
le. Le premier exarque que fut sans doute le magister militum Genna-
dius qui avait triomph de Garmul sous Tibre Constantin. La
mme volution tendait dpossder les gouverneurs civils dans les
provinces ; sans disparatre et tout en demeurant thoriquement
sous l'autorit du prfet du prtoire, ceux-ci virent leurs prroga-
tives progressivement usurpes par les ducs et les tribuns. Ce glis-
sement de l'autorit civile entre les mains des chefs militaires s'est
opr lentement, sans liminer les anciennes institutions. Il traduit
le souci d'une plus grande efficacit dans l'administration d' un pays
o les problmes de scurit devenaient essentiels, mais il dnote
aussi quel point l'emprise de Constantinople s'tait relche.
La sparation des pouvoirs civils et militaires sous le Bas-
Empire avait voulu viter que des gouverneurs tout puissants ne
fussent tents de tourner leurs forces contre le pouvoir lgitime ;
aprs l'anarchie militaire du III
e
s., il s'agissait avant tout de mettre
l'tat l'abri des usurpations. L'institution de l'exarchat la fin du
VI
e
s. rendait ce danger toute son actualit, d'autant plus que
l'Afrique se trouvait maintenant trs loigne du centre de l'Empi-
re et que l'anarchie croissante conduisait d'elle-mme le pays au
sparatisme.
415
Heraclius
La crise de 608 qui plaa Heraclius sur le trne imprial montre
quel degr d'omnipotence tait parvenue l'exarque. En 602, l'em-
pereur Maurice tomba victime d'une rvolution de palais et fut rem-
plac par Phocas, qui se rendit rapidement odieux. L'exarque de
Carthage Heraclius, g d'une soixantaine d'annes et ancien gnral
de Maurice, rompit avec l'empereur en 608 et bloqua les exporta-
tions de bl vers Constantinople. Press par tous les mcontents
d'intervenir contre la tyrannie sanglante de Phocas, l'exarque refusa
d'agir personnellement en raison de son ge. Il confia le comman-
dement des troupes son neveu Nicetas qui libra l'Egypte et son
fils Heraclius qui, aprs la prise de Constantinople et la chute de Pho-
cas, fut couronn empereur en 610.
On ignore presque tout de l'histoire de l'Afrique pendant le
grand rgne d'Heraclius. Le pays fut sans doute prospre et calme ;
les graves difficults qui, face aux Perses et aux Arabes, menaaient
l'Empire en Orient, rendaient l'Afrique son visage de terre pro-
mise.
En 619, lorsque les Perses venaient de conqurir la Syrie, la
Palestine, l'Egypte, et que la famine et la peste dvastaient Constan-
tinople, Heraclius envisagea d'installer la capitale de l'Empire Car-
thage ; il fit mme embarquer secrtement le trsor imprial pour
l'Afrique, mais une tempte aurait englouti les navires, tandis que
l'opinion publique dirige par le patriarche, finissait par convaincre
l'empereur d'abandonner son projet. Malgr son caractre anecdo-
tique, cet vnement apporte de prcieux renseignements sur l'tat
de l'Afrique ; il n'est pas concevable que l'empereur ait envisag
d'installer la capitale de l'Empire dans un pays dvast. Si, d'autre
part, l'exarque Heraclius avait pu envoyer en 610 une grande partie
des troupes d'Afrique la conqute du trne imprial, c'est qu'il ne
redoutait pas des troubles intrieurs. La prosprit est en outre
atteste par l'essor de la propagande missionnaire qui convertit de
nouvelles populations dans le Jrid, les oasis du sud algrien, les
Maurtanies, par les relations commerciales, avec la Sicile, l'Egypte.
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
416
L'ANTIQUIT
Mais il y a des ombres au tableau : les victoires des Wisigoths
en Espagne, o les positions grecques sont abandonnes, les pro-
grs fulgurants de l'invasion arabe qui aprs la conqute de l'Egyp-
te en 640 menacent la Tripolitaine, et surtout la dcomposition
interne de l'autorit byzantine.
II.- La chute de la domination byzantine
( 647- 698)
La longueur et les difficults de la conqute arabe ne doivent
pas faire illusion sur la force de l'tat byzantin. Celui-ci aurait pu
disparatre ds 647. Beaucoup plus que les armes impriales, ce
sont les crises intrieures de l'Islam et la rsistance berbre qui don-
nrent Carthage un sursis de cinquante ans.
Au milieu du VII
e
s., la Tunisie demeurait, jusqu' ses confins
mridionaux, sous la domination byzantine, mais celle-ci tait plus
que jamais compromise par la dcadence rapide de l'administration,
le renforcement des confdrations berbres, les querelles reli-
gieuses.
La crise du VII
e
s. : usurpation de l'exarque Grgoire
Depuis la cration de l'exarchat, l'administration manifestait
son indpendance vis vis de Constantinople ; elle n'hsitait plus
braver ouvertement l'autorit centrale et tyranniser les populations
qui se dtachent alors de l'Empire et cherchent protection auprs de
l'glise, faisant appel au pape et aux vques contre les fonction-
naires byzantins. La crise de l'autorit, la fin du rgne d'Heraclius,
poussait de nouveau les gouverneurs dans la voie de l'aventure. En
646, l'exarque d'Afrique, Grgoire, exploita les mcontentements
locaux et l'impuissance du jeune Constant II face au pril islamique
pour usurper la pourpre et se faire proclamer empereur. Soucieux
avant tout de repousser les invasions arabes qui, aprs la conqute
de l'gypte, devenaient imminentes, il installa sa capitale Sbetla,
417
mais il fut vaincu et tu en 647. Sa mort mettait fin la rupture avec
Constantinople, mais elle portait un coup mortel la domination
byzantine en Afrique.
Rveil du pril berbre
Celle-ci se trouvait en mme temps menace par le rveil du
pril berbre. Les liens de vassalit, qui permettaient autrefois
l'Empire de contrler et de diviser les chefs indignes, se sont rel-
chs et rompus cause de l'anarchie. Les tribus de Tripolitaine et de
Byzacne, devenues indpendantes, refusaient de payer l'impt et de
fournir des troupes. Les campagnes de Byzacne furent en partie
abandonnes par l'administration impriale, qui se replia dans les
villes fortifies et l'anarchie berbre faisait tche d'huile dans le sud
et le centre de la Tunisie.
/
Le rle de l'Eglise et les difficults religieuses
Les troubles religieux aggravrent les difficults impriales. Le
donatisme connut un nouvel essor, particulirement en Numidie ; il
est difficile, encore une fois, d'y voir une simple consquence de la
crise sociale ou un rsultat de l'migration vandale vers l'ouest. La
correspondance du pape Grgoire le Grand rvle qu'il y avait de
riches propritaires donatistes, trs romaniss, qui trouvaient sou-
vent l'appui des gouverneurs provinciaux pour multiplier les abus et
pressurer les populations. Tolrs par l'empereur Maurice qui att-
nua la rigueur des mesures prises par Justinien contre les dissidents,
ils firent des progrs certains dans la deuxime moiti du VI
e
s. Ont-
ils acclr le dclin de l'orthodoxie et fray la voie au monothis-
me absolu de l'Islam ? La question peut tre pose, mais il ne
semble pas que le donatisme ait t trs dvelopp dans les popula-
tions sdentaires de Tunisie qui, pourtant, n'opposrent pas grande
rsistance aux musulmans.
L'glise du VII
e
s. fut au contraire trs orthodoxe, rsolument
tourne vers Rome et hostile aux hrsies venues d'Orient. On
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
418
L'ANTIQUIT
retrouve, peut-tre l, ce sparatisme caractristique de l'glise afri-
caine. La corruption et les abus de l'administration impriale ont
pouss les populations chercher refuge et protection auprs des
vques ou dans les monastres. L'glise fut amene surveiller la
conduite des fonctionnaires ; ses juridictions prirent une importan-
ce croissante et son autorit remplaa peu peu celle de l'tat
dfaillant et oppresseur. Le pape Grgoire le Grand s'immisa,
maintes reprises, dans les affaires africaines, non seulement pour
rtablir la discipline ecclsiastique, combattre l'hrsie donatiste, sti-
muler la propagande catholique, mais aussi pour condamner les
abus des fonctionnaires prvaricateurs et intervenir auprs de l'em-
pereur. Cette ingrence soulignait l'effacement de l'autorit byzanti-
ne et contribuait en dfinitive aggraver l'anarchie.
Les querelles thologiques agirent dans le mme sens. Le
dbat qui avait provoqu sous Justinien le conflit des Trois Cha-
pitres, rebondit la fin du rgne d'Heraclius sous la forme de l'h-
rsie monothliste, proche du monophysisme qui enseignait la
nature uniquement divine du Verbe incarn. L'hrsie, en faveur de
laquelle Heraclius prit parti, se heurta une opposition violente en
Occident, et surtout dans l'glise d'Afrique, qui manifesta son atta-
chement l'orthodoxie en se rangeant derrire le pape, contre l'em-
pereur. La crise tait d'autant plus grave que de nombreux mono-
physites orientaux, chasss par la conqute arabe, taient venus se
rfugier en Afrique, o ils entreprirent de convertir les populations.
Le clerg catholique les combattit sous la conduite du fougueux
abb Maxime qui se ft le champion de l'orthodoxie et n'hsita pas
braver l'autorit de l'empereur, aggravant ainsi l'volution qui
poussait le pays vers le sparatisme. L'action de Maxime n'tait pas
trangre au soulvement du patrice Grgoire contre l'empereur
Constant II, suspect de monothlisme. La crise avait rvolt les
orthodoxes, propag l'hrsie dans certains lments de la popula-
tion et affaibli davantage le pays au moment de la conqute arabe.
Ainsi, les coptes monophysites s'taient rallis aux Arabes par hai-
ne de l'orthodoxie.
Trsor montaire de Rougga
L'illustration prsente comme chantillons quelques-unes
des 268 pices de sous d'or qui constituent le trsor montaire de Rougga.
Ce trsor a t dcouvert dans une petite cruche enfouie sous
une dalle du forum de la cit de Rougga (situe 13 km au S.E
d'El Jem). Les pices se repartissent entre les quatre derniers empereurs
byzantins Maurice-Tibre (1 pice), Phocas, (83 pices), Hraclius
(121 pices) et Constant (641-668) (36 pices).
La date d'enfouissement qui rsulte de l'examen dtaill
de l'ensemble des pices est situe entre 647 et 648. Cette
date concide avec le premier raid de l'arme arabe
qui mettra fin en moins d'un demi-sicle au pouvoir byzantin
en Afrique. Elle confirme la tradition historique des
auteurs arabes relative la fameuse expdition en Ifriqiya.
420
L'ANTIQUIT
Les dernires annes de Byzance en Afrique :
la Byzacne dvaste
L'expdition du gouverneur d'Egypte Abdallah Ibn Sad, en
647, n'avait t qu'une vaste opration de pillage sans consquences
immdiates ; mais ce fut un dsastre pour les Byzantins : le patrice
tu, la Byzacne saccage, Sbetla prise et dtruite. Aprs avoir accu-
mul un norme butin, les Arabes quittrent le pays prix d'or, mais
ils avaient t frapps par sa richesse, ses campagnes peuples et
verdoyantes, ses villes nombreuses. Ils ne laissrent, cependant
l'Afrique, qu'un rpit qui devait, travers le flux et le reflux de mul-
tiples invasions, se prolonger durant un demi-sicle, dans un pays
livr une complte anarchie.
Au cours de cette priode que nous connaissons si mal, la
Tunisie connut d'abord un calme relatif pendant une vingtaine
d'annes. Mais en dpit de la disparition de Grgoire, l'Empire fut
incapable d'assurer rellement son autorit sur le pays ; les querelles
religieuses faisaient toujours rage ; peut-tre un nouvel usurpateur
a-t-il succd Grgoire. Pendant ce temps, le sud de la Byzacne,
dvast par le raid de 647 et livr a lui-mme, se dtachait dfiniti-
vement de la domination impriale.
Arabes et Berbres : Okba et Koeila
Les Arabes revinrent en 665 ; Okba fit la conqute du Jrid et
de la rgion de Gafsa, sans que le gouvernement de Carthage lui ait
oppos la moindre rsistance ; la mme poque, les envahisseurs
atteignaient le Jebel Ousselet : toute la Tunisie centrale chappait
Byzance et les Arabes pouvaient entreprendre sans peine la fonda-
tion de Kairouan. Ce sont les tribus indignes, conduites par des
chefs comme Koela et la Kahena, qui leur donneront dsormais
le plus de mal. En 668, l'empereur Constant II tait assassin et des
usurpateurs surgissaient dans plusieurs provinces de l'Empire ; pen-
dant ce temps Kairouan fixait les Arabes au coeur mme de
421
l'Afrique byzantine. Celle-ci connut pourtant un nouveau rpit
aprs le rappel de Okba. On vit mme un redressement sous le
rgne de l'empereur Constantin Pogonat qui, aprs avoir mis fin
la querelle monothliste, obtint l'alliance des tribus berbres de
Koela contre les Arabes. Revenu en 681 et parti la conqute du
Maghreb occidental par les routes sahariennes, Okba parvenait
jusque aux rives de l'Adantique ; mais, son retour, il tomba dans
une embuscade tendue par Koela au sud de l'Aurs et y trouva la
mort (686). Cet vnement fut suivi d' un soulvement des Berbres
de Byzacne ; les Arabes vacurent Kairouan o s'installa Koela :
une grande confdration indigne dominait la Byzacne et entrete-
nait des relations diplomatiques avec Carthage contre l'envahisseur
arabe, devenu l'ennemi commun. Replis dans le Nord du pays
autour de Carthage, les Byzantins n'taient plus, selon les historiens
arabes, que de simples auxiliaires de Koela.
Carthage prise par les Arabes
Mais l'offensive musulmane reprit en 688 ; Koela fut vaincu
et tu par Zohar Ibn Qas, ce qui entrana l'clatement de la conf-
dration berbre de Byzacne. Cinq ans plus tard, Hassan Ibn
Noman donnait l'assaut dcisif aux possessions grecques du nord ;
Carthage tomba une premire fois en 695, mais, la suite d' un
suprme effort de Constantinople, elle fut reprise en 697 par le
patrice Jean ; en mme temps, les Berbres de la Kahena infligeaient
de graves dfaites aux Arabes dans le sud de la Numidie.
Hassan dut se replier vers Barca, mais il revint l'anne suivan-
te et Carthage fut reconquise, cette fois pour toujours. Les autres
citadelles de Proconsulaire tombrent leur tour, faisant ainsi dis-
paratre ce qui restait de la domination byzantine.
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
422
L'ANTIQUIT
Conclusion
La Tunisie tait maintenant conquise par un peuple et une reli-
gion qui devaient marquer, d'une faon dcisive, le cours ultrieur
de son histoire. Coupe de l'Occident et de sa civilisation, elle regar-
dera, dsormais, vers l'Orient musulman.
L'chec final de la romanit s'explique par le caractre inache-
v de la conqute. Rome et, plus forte raison, Byzance n' ont
jamais impos leur autorit la totalit du monde berbre. Leur civi-
lisation n'a vraiment pntr et assimil que les bourgeoisies muni-
cipales, c'est--dire une minorit dont une partie quitta dfinitive-
ment le pays aprs la conqute arabe, et se rfugia en Italie ou en
Orient.
Mais la masse des populations est demeure, mme au temps
de l'apoge de l'Empire, plus ou moins trangre la romanisation
et replie sur son atavisme. Des promotions aussi spectaculaires que
celles du paysan de Mactar ne doivent pas faire illusion. Malgr son
libralisme passager et ses idaux humanistiques , l'Empire a
exploit les provinciaux, et l'Afrique romanise n'en demeurait pas
moins la terre nourricire du peuple roi. Un phnomne frappant
est la dsaffection des masses et leur indiffrence la chute de
Rome. Comment expliquer un sicle de domination vandale avec les
moyens que l'on sait, si les foules avaient manifest une hostilit
aussi dtermine que celle des lites romanises
L'histoire de l'Afrique a vu la superposition de plusieurs civi-
lisations - berbre, punique, hellnistique, romaine - mais sans qu il
y ait eu d'assimilation profonde et durable. On peut videmment
423
allguer que celle-ci fut interrompue par la conqute arabe, sans
laquelle la Tunisie d'aujourd'hui n'aurait peut-tre pas un visage trs
diffrent de certaines rgions de l' Europe occidentale et latine. Mais
il importe ici de mesurer les limites de la civilisation antique la fin
du VII
e
s. et d'en expliquer la disparition.
Il est frappant que Rome n'a pas ralis d'unit linguistique ;
seules les lites possdaient parfaitement le latin, mais la masse par-
lait toujours les vieux dialectes libyques et ne pouvait avoir du latin
qu' une connaissance fort grossire. Le latin a remplac le punique
comme langue de culture, mais il n'a jamais pu liminer les parlers
traditionnels qui demeurent encore vivaces dans certaines rgions
du Maghreb d'aujourd'hui malgr la profonde arabisation du pays.
Depuis la haute antiquit, la Tunisie tait bilingue et empruntait sa
langue de culture une civilisation trangre ; peut-tre a-t-elle t
arabise plus largement et plus vite cause de l'empreinte smitique
lgue par l'poque punique. Mais le latin n'a pas brusquement dis-
paru aprs la conqute arabe ; il a survcu pendant des sicles ;
selon le gographe El Idrisi, on le parlait encore au XII
e
s. dans la
rgion de Gafsa.
Une autre conclusion remarquable est l'absence d'unit reli-
gieuse. Le christianisme n'a jamais pu extirper le vieux paganisme
traditionnel ; affaibli par le schisme donatiste, il fut moins conqu-
rant et moins unificateur que l'Islam qui ne s'est d'ailleurs pas tou-
jours impos sans difficults. Si la grande majorit des chrtiens
d'Afrique s'est convertie l'Islam, le christianisme n'a pas, pour
autant, disparu ds la conqute arabe. Beaucoup d'Africains sont
demeurs fidles leur foi sans avoir quitter le pays. La survivan-
ce de communauts chrtiennes est atteste jusqu'au XI
e
s. par la
correspondance du pape Grgoire VII avec le clerg d'Afrique et
par les inscriptions chrtiennes de Kairouan. Ce sont seulement les
Almohades qui semblent avoir inaugur une politique d'intolrance
radicale
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
424
L'ANTIQUIT
La diversit religieuse et linguistique s'est accompagne d'une
certaine inaptitude du monde berbre la cohsion politique que
souligne la forte survivance des vieilles traditions tribales. La notion
d' tat gnratrice d'organisation et d'autorit l'chelle de vastes
ensembles, est venue du dehors. Il n'y a rien de comparable entre le
royaume de Masinissa, profondment imprgn d'influences hell-
nistiques et les confdrations anarchiques d'Antalas ou de Koeila.
Il est vident que tous les grands tats qui, depuis les Phniciens,
ont rgn sur l'Afrique antique, furent le rsultat d'une domination
trangre. Les Berbres n' ont conu l'indpendance qu' l'chelle
du clan ou de la tribu et l'ide de nationalisme n'avait aucun sens
cette poque. Mais Rome n'a jamais pu intgrer et politiser tout
le monde berbre ; son oeuvre est demeure fragmentaire et fragi-
le, soumise aux vicissitudes des forces de l'Empire, qui se dsagr-
gea aprs le IV
e
s.
Elle fut alors incapable de contenir le rveil de l'anarchie tri-
bale. Il faudra l'apport de la force et de la civilisation musulmanes
pour organiser et structurer, de nouveau, le pays, o l'antiquit
lguait cependant de fortes traditions urbaines, administratives, agri-
coles en mme temps qu'un patrimoine culturel labor pendant
plusieurs sicles
Sans doute savons-nous, comme Valry que les civilisations
sont mortelles, mais Rome vit encore par les innombrables tmoi-
gnages qui, sur le sol de notre pays, talent sa splendeur.
/
Et at de la quest i on
Postface pour la troisime partie
Il va sans dire que, depuis la publication de ce chapitre en
1965, la recherche et les connaissances sur l'Afrique de la basse anti-
quit ont considrablement progress. Sans remettre en cause l'ide
majeure de notre travail, qui souligne la longvit et la vitalit de la
romanisation dans le nord-est du Maghreb au cours des derniers
sicles de l'antiquit, les publications rcentes ont conduit nuan-
cer et corriger certains credos de l'histoire traditionnelle. C'est le
cas des travaux de Claude Lepelley pour le Bas-Empire, et d'Yves
Modran pour la priode vandale et byzantine. Le renouvellement
des connaissances doit aussi beaucoup la prospection archolo-
gique et ses innombrables dcouvertes au cours des dernires
dcennies : fouilles internationales menes dans le cadre de la sau-
vegarde du site de Carthage, publications des recherches menes
sous l'gide de l'Institut du Patrimoine, utilisation des ressources
considrables de l'pigraphie, laboration d'un prcieux Atlas
archologique de la Tunisie, tout cela a largi notre information et
permis le rexamen de ce qui tait peu ou mal connu...
Il n'est bien sr pas question de recenser ici tous les rsultats
de ces travaux ; nous insisterons sur ceux qui nous incitent nuan-
cer ou corriger certains aspects de ce que nous crivions, voil
plus de trente ans.
426
L'ANTIQUIT
Il convient d' abord de revenir sur le tableau trop contrast
entre villes et campagnes, les premires tant des foyers sociaux et
politiques, moteurs de la romanisation et du brassage des cultures,
tandis que les secondes seraient demeures trangres aux transfor-
mations de la socit et enfermes dans leurs particularismes et
leurs traditions. Il y a plutt une symbiose entre villes et campagnes
et une synthse entre les composantes d'une socit libyco-punique
et romano-africaine. Certes, les villes constituaient des ples d'at-
traction politique et socio-culturelle, mais elles tiraient des cam-
pagnes les sources de leur richesse matrielle et de leur croissance
dmographique ; l'exemple symbolique du paysan de Mactar illustre
bien l'troitesse de ces liens, et n'est pas seulement valable pour le
Haut-Empire, ni pour la seule Proconsulaire. Les feuilles de l'atlas
archologique montrent bien l'existence, ct d' un rseau urbain
trs dense, un grand nombre de sites ruraux, par exemple celui de
Henchir el Guellel, en Byzacne, petite unit d'une cinquantaine
d'hectares, avec de nombreux pressoirs huile, un forum, des
thermes, une basilique chrtienne, signes vidents de la romanisa-
tion des campagnes. L'essor rural de la Byzacne est galement
attest par la densit du rseau d'irrigation (aqueducs, barrages,
citernes), ainsi que par les trs nombreux ateliers de cramique et de
poterie sigille, sans oublier les ateliers de sculpture, ni la construc-
tion de petites glises rurales et de sanctuaires vous au culte des
saints, comme saint Thodore, particulirement populaire en
Byzacne.
La conqute vandale n'a sans doute pas eu les consquences
catastrophiques que certains auteurs, comme Victor de Vita, ont
dnonces, le plus souvent des fins partisanes. La vie a continu,
comme par le pass, mais sans l'administration romaine, ses agents
du fisc, ses lgions.
Il faut aussi reconsidrer la baisse l'importance du pril ber-
bre et du nomadisme la fin de l'antiquit ; le mythe des nomades
chameliers menaant les frontires sud de la Byzacne doit tre
abandonn. Il est ainsi tabli que, contrairement ce que pensait C.
Courtois, les villes de Sabratha, Leptis Magna et Oea n'taient pas des
lots dans le dsert, assiges par les nomades chameliers et ne com-
muniquant plus entre elles que par voie maritime. L'ordre romain
existait encore dans l'arrire pays, mme si les capacits d'interven-
tion du pouvoir central devenaient plus lentes et moins efficaces.
La relative richesse des campagnes explique celle des villes
toujours nombreuses et florissantes, comme en tmoignent les
textes pigraphiques, ainsi que les multiples travaux de restauration
et de construction de nouveaux difices, publics et privs ; beau-
coup de ce qui tait traditionnellement attribu la haute poque est
maintenant situ au IV
e
s. ou plus tard. Le nombre considrable de
basiliques chrtiennes construites cette poque illustre bien la per-
sistance de ce dynamisme urbain, mme si les villes se dotent de
murailles dfensives et de fortifications pour faire face l'inscuri-
t.
Les institutions municipales, qui sont l'un des apports majeurs
de la romanit, survivent galement et connaissent mme un regain
de vigueur sous les rgnes de Julien ou des empereurs de la dynas-
tie valentinienne. Les curies tiennent toujours leurs assembles sur
le forum, dsignent leurs responsables locaux ; parmi les riches, il y a
toujours des vergtes qui veillent la construction ou la restau-
ration des monuments publics, ainsi qu' l'organisation des loisirs et
des activits socio-culturelles. Certes, l'autonomie municipale est
moins grande que par le pass, mais les institutions demeurent
comme cadre de tout un mode de vie et de civilisation.
La vie urbaine ne s'est pas arrte avec la conqute vandale ;
elle connat au contraire un certain renouveau l'poque byzantine.
Le meilleur exemple est celui de Carthage qui, la fin de l'antiqui-
t, tait l'une des villes les plus importantes du monde mditerra-
nen. l'occasion de la confrence piscopale de 411 Carthage,
l'empereur Honorius dclarait que cette rgion tait la plus importante de
son royaume . Tous les documents, littraires, pigraphiques, archo-
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION 427
428
L'ANTIQUIT
logiques dmontrent le dynamisme ininterrompu de Carthage jus-
qu' la conqute arabe. Les travaux de Liliane Ennabli soulignent
bien l'essor de la ville chrtienne, qui se couvre d'glises et de basi-
liques richement dcores, avec leurs marbres, leurs mosaques,
leurs baptistres. Mais Carthage demeurait aussi une capitale poli-
tique o sigrent tour tour les comtes d'Afrique, les rois vandales
et les exarques byzantins, et une ville profane, centre de loisirs, de
luxe et de plaisir, dnonce maintes reprises par les prdicateurs
chrtiens. Son cirque, le plus vaste du monde romain aprs celui de
Rome, pouvait accueillir 70 000 spectateurs. Des fouilles rcentes
sur la colline de Byrsa ont mis jour des thermes dcors de
mosaques du V
e
s. et qui sont, comme en tmoignent des monnaies
et des tessons de poterie, encore utiliss l'poque vandale et
byzantine. Carthage connut une extension de sa superficie habite,
au moins jusqu' la construction du mur de Thodose au V
e
s., et
une augmentation probable de sa population jusqu'au VII
e
s., car elle
apparaissait, en ces sicles d'invasions et de guerres, comme un
refuge et un havre de paix.
Le passage de Rome l'Islam ne doit pas tre considr
comme l'aboutissement d' un processus de longue dcadence et
d'extinction progressive de la romanit africaine ; il faut imaginer la
fin de Rome en Afrique comme le rsultat d' une rupture plus bru-
tale, qui ne s'est pas faite aux dpens d'un organisme moribond. Il
a fallu la pousse irrsistible des conqurants arabes, qui mirent
cependant plus d'un demi-sicle pour venir bout de la prsence
romaine. C'est pourquoi il faut relativiser l'ide que les Arabes
auraient profit d'une faiblesse rsultant de l'opposition entre popu-
lations romanises et peuplement berbre tranger et hostile
l'ordre romain. Cette sparation existe dans les Maurtanies, elle est
beaucoup moins vrifie dans l'est du Maghreb, o la romanisation
fut plus profonde et durable.
Une nouvelle lecture de la guerre de Gildon, la lumire d' un
travail d'Yves Modran, nous invite nuancer ce que nous crivions
propos de la rsistance berbre la romanisation. Fonde sur le
429
tmoignage de Claudien, la thse traditionnelle prsente Gidon
comme un chef maure conduisant une rvolte berbre, et s'ap-
puyant, de surcrot, sur les donatistes, autre foyer de rbellion, et,
selon Frend, autre expression du particularisme berbre. Tout cela
est rviser profondment. Claudien, pote au service de l'empe-
reur Honorius et propagandiste de Stilicon, dresse un portrait st-
rotyp, anachronique et erron de Gildon auquel il ne pardonne
pas sa rupture avec la cour de Ravenne. Gildon est en ralit un
grand propritaire terrien, d'origine maure sans doute, mais pro-
fondment romanis ; il avait dj combattu dans l'arme impria-
le, sous les ordres de Thodose l'Ancien, pour rprimer la rvolte
de Firmus. Ses services lui valurent d'tre nomm aux fonctions trs
importantes de Comte d'Afrique, et d'tre lev la dignit trs
envie de vir spectabilis ; sa fille Salvina fut en outre marie un neveu
de l'impratrice ; plus tard, aprs l'echec de son entreprise, sa
femme et plusieurs membres de sa famille se rfugirent la cour
de Ravenne. Gildon n'a rien d' un grand cad berbre entr en dissi-
dence au nom de populations rvoltes contre Rome. Les difficul-
ts de l'Empire d'Occident, et peut-tre une certaine jalousie vis--
vis de la fortune de Stilicon, l'ont entran dans une aventure d'am-
bition personnelle, qui finit lamentablement et lui valut d'tre aussi-
tt abandonn par ceux qui l'avaient d'abord soutenu. Il n'y eut
dans tout cela, ni coalition berbre contre Rome, ni alliance avec les
donatistes, ni aucune forme de sparatisme africain. Il faut donc
rcuser le mythe de l'ternel Jugurtha et de la monte du pril
maure tels que formuls dans la thse de C. Courtois, dont
nous avions fait ntres certaines conclusions.
Un autre article d'Y. Modran traite du mme problme
l'poque byzantine ; il s'agit cette fois d' un passage de la Johannide de
Corippus o il est question d'infiltrations de tribus maures formant
comme des lots indpendants du pouvoir central jusque dans le
Cap Bon, au cur des terres les plus anciennement romanises du
DE LA CRISE DE LA ROMAINE A L'ISLAM CIVILISATION
430
L'ANTIQUIT
pays. Rien ne permet d'tayer cette affirmation. L'archologie
montre au contraire que le Cap Bon demeure une rgion peuple,
prospre et sre jusqu' la fin de la priode byzantine. On a dcou-
vert autour de Klibia de nombreux site d'occupation tardive, avec
leur rseau d'huileries, leurs maisons dcores de mosaques de
basse-poque, leurs basiliques chrtiennes. Byzance n'a pas cess de
contrler le Cap Bon ; lorsque Solomon est victime d'une mutine-
rie en 536, il ne s'enfuit pas de Carthage, mais s'embarque Missua,
dans le Cap Bon. Lorsque les Arabes envahissent le pays, et arrivent
sous les murs de Carthage, c'est dans le Cap Bon que les Roums
cherchent un ultime refuge.
Il n'y eut donc pas, ni sous les Vandales, ni l'poque byzan-
tine d'installation permanente de tribus maures indpendantes dans
les provinces de Byzacne et de Proconsulaire. C'est sur les confins
mridionaux du limes, en Tripolitaine, que se forment, la fin de
l'antiquit, certaines concentrations de tribus, qui ont exerc une
pression sur les frontires et tent des incursions vers le nord, mais
sans jamais parvenir s'installer sur le territoire des provinces. Il est
vrai cependant que le flchissement de l'autorit centrale et des
moyens militaires facilitaient les oprations de harclement et de
razzias et fragilisaient les capacits de dfense.
La pax romana n'existait plus, mais la civilisation romano-afri-
caine brillait toujours sur ces terres particulirement privilgies du
monde antique.
Chronologie
AVANT J.-C.
XII
e
s. Navigations des Phniciens en Mditerrane occidentale et premiers
trafics avec les ctes africaine et ibrique et avec les les.
Autour de Date traditionnelle de fondation des comptoirs de Lixus, ( Maroc )
1100 Gads, ( Espagne ) situs de part et d'autre du dtroit de Gibraltar, et
d'Utique, ( Tunisie ) l'embouchure de la Medjerda.
Vers 1000 ge d'or des cits de Phnicie : Bjblos, Sidon, Tjr.
814 Date traditionnelle de fondation de Carthage, Qart Hadasht , par les
Tyriens.
VIII VI
s
. PRIODE ARCHAQUE DE CARTHAGE
Dcouvertes de vestiges d'habitat archaque avec de la cramique d'im-
portation date du VIII
e
s. et de ncropoles puniques, ainsi que du
sanctuaire de Bal Hammon et Tanit.
VIII
e
Fondations phniciennes Malte, en Sardaigne (Tharros, Suls, Caglia-
ri), sur la cte orientale de l'Espagne {Sexi, Trayamor), et en Sicile
(Motye).
753
VII
Fondation traditionnelle de Rome. Dbut de la royaut.
Colonisation grecque en Sicile et en Italie du Sud (Naxos; Syracuse,
Megara Hyblea, Zancle, Reghion, puis Himre, Gela, Selinonte, Agrigent).
654 Date de l'occupation des les des Balares et de la fondation 'Ibi^a, par
Carthage.
630 Fondation de Xemporium de Lepds Magna.
Vers 600 Fondation de Massilia (Marseille) par des Grecs de Thoce.
VI
e
Expansion de la colonisation phnico-punique en Sicile : fondation de
Vanormos et Solunte, en Sardaigne, de Monte Serai.
432
L'ANTIQUIT
572 Tyr est prise par les Babyloniens. Carthage s'mancipe de Tyr et s'im-
pose en Occident. Rivalits entre Carthaginois et Grecs en Sicile :
expditions, guerres, conqutes, victoires et revers. Alliance de Cartha-
ge avec les Etrusques contre les Grecs Phocens marque par la
bataille d'Alalia ( en Corse ) en 540.
Vers 530 La puissante famille des Magonides accapare le pouvoir Carthage et
tablit son hgmoie durant trois sicles.
Carthage prend en main les tablissements phniciens d'Occident.
509 Rome expulse ses rois et devient une rpublique dirige par deux
consuls lus annuellement. Elle entreprend la conqute progressive de
l'Italie. Premier trait entre Rome et Carthage interdisant aux Romains
de naviguer au-del du Beau Promontoire , Cap Sidi Ali El Mekki.
PRIODE CLASSIQUE DE CARTHAGE
Bataille navale d'Himre(Sicile) : Hamilcar,- fils de Magon, est battu par
Glon de Syracuse. Cette dfaite des Carthaginois face aux Grecs
marque le repli de Carthage sur le territoire africain.
Carthage met en valeur son arrire-pays ; la valle de la Medjerda , la
valle de l'oued Meliane et le Cap Bon sont mis en culture et les pro-
duits agricoles sont exports par Carthage. Elle entreprend deux
grandes expditions au-del du dtroit de Gibraltar : priple d'Hannon
vers l'Afrique tropicale, priple d'Himilcon vers les les britanniques en
vue de rechercher des matires prcieuses et des marchs.
Carthage transforme son rgime politique par l'institution des Sufftes
et d'un Conseil des Cent juges.
Fin du V
e
s. tablissement de la frontire ente la zone d'influence carthaginoise et
la zone d'influence grecque, au lieu dit Autel des Philnes dans le golfe
de Syrte.
409-305 Reprise des hostilits entre Grecs et Carthaginois. Alternance de
guerres et de trves.
409 Destruction de Slinonte par les Carthaginois.
406-405 Destruction d'Agrigente et de Gla.
405-369 Denys de Syracuse, champion des cits grecques en Sicile, signe un
trait reconnaissant aux Carthaginois la possession de la partie occi-
dentale et mne la revanche.
380 p^ Je l'hgmonie dynastique des Magon Carthage. Mise en place
d'un rgime oligarchique exerant le pouvoir par l'intermdiaire de
VI I I
480
480-409
CHRONOLOGIE 433
438
332
332-331
312-289
310
307-306
Milieu du
146
263-241
264
260
256
255
241
240-237
239
237-229
220
220-203
219
218
Conseil et d'un tribunal des Cent quatre magistrats. Rome
soumet la Campagnie et le Latium.
Nouveau trait de navigation entre Carthage et Rome.
Tjr est dtruite par Alexandre le Grand. Des Tyriens se rfugient
Carthage.
Alexandre le Grand fonde Alexandrie en Egypte.
Agathocle est matre de Syracuse.
Agathocle porte la guerre en Afrique et ravage le Cap Bon.
chec d'Agathocle et paix avec Carthage.
PRIODE HELLNISANTE DE CARTHAGE
PREMIRE GUERRE PUNIQUE, OU GUERRE DE Sicile
L'intervention romaine contre les Carthaginois Messine dclenche la
guerre.
Victoire navale des Romains en Mylae.
Expdition romaine de Rgulus en Afrique.
chec de Rgulus, battu et fait prisonnier.
Victoire de la flotte romaine aux les Aegates et accord de paix entre
Rome et Carthage qui perd la Sicile.
Fin de la premire guerre punique. Retour des troupes de l'arme car-
thaginoise en Afrique.
Guerre dite inexpiable des Mercenaires et des populations
libyennes contre Carthage.
Hamilcar Barca arrive bout de cette rvolte.
Rome annexe la Sardaigne et la Corse.
Hamilcar Barca entreprend la conqute de l'Espagne. Son gendre Has-
drubal lui succde dans cette entreprise. Il fonde Carthagne.
Hasdrubal est assassin. Hannibal lui succde.
Rgne de Syphax, roi des Numides Masaesyles.
Sige et prise de Sagonte en Espagne par Hannibal
Rome dclare la guerre Carthage
IIIs
434
L'ANTIQUIT
218- 201 DEUXIME GUERRE PUNIQUE, OU GUERRE D'HANIBAL
218 Hannibal traverse les Pyrnes, le Rhne et les Alpes.
Batailles du Tessin et de la Trbie.
217 Bataille du lac Trasimne.
216 Bataille et victoire de Cannes.
215 Dfection de Capoue l'alliance de Rome.
Hannibal est matre de l'Italie du sud et fait une incursion jusqu' Rome.
211 Bataille du Mtaure.
Alliance de Carthage avec Syphax.
Alliance de Rome avec Massinissa.
Victoire de P. Cornlius Scipion en Espagne.
Fin de la domination punique en Espagne.
204 Scipion dbarque en Afrique prs d'Utique. Il remporte une victoire
aux CampiMagni&t s'empare de Syphax. Hannibal rentre d'Italie.
202 Bataille dcisive de Zama. Dfaite d'Hannibal.
Victoire de Scipion surnomm dsormais l'Africain.
201 Trait de paix entre Carthage et Rome : Carthage est confine dans
son territoire africain, sans sa flotte, et doit payer une lourde indem-
nit de guerre.
203-148 Rgne de Massinissa qui unifie la Numidie et s'empare d'une partie du
territoire de Carthage.
196 Hannibal gouverne Carthage comme suffte.
195 Menac d'tre livr Rome, il s'enfuit et s'exile auprs du roi Antio-
chus, roi de Syrie.
188 Poursuivi, il se rfugie en Armnie puis en Bithynie.
183 Pour viter de tomber entre les mains des Romains, il se suicide.
Premire moi- Carthage retrouve sa prosprit. Caton lance son Delenda est Car-
ti du II
e
s. thaso .
162-161 Massinissa enlve Carthage les Emporta du golfe de Syrte.
153-152 Massinissa occupe les grandes plaines de la Tusca dans la moyen-
ne valle de la Medjerda.
Carthage tente de riposter aux empitements de Massinissa sur son
territoire.
149- 146 TROISIME GUERRE PUNIQUE
Carthage est prise d'assaut par Scipion Emilien aprs un long sige.
Elle est dtruite au printemps 146.
CHRONOLOGIE 435
Son territoire devient la province romaine d'Africa vtus, dlimit des ter-
ritoires numides par la Fossa Rega. Sept villes restent autonomes Utique,
Hadrumte, Thapsus, Leptis Minor.; Acholla, U^alis, Theudalis.
148 Mort de Massinissa.
148-118 Rgne de Mcipsa, fils de Massinissa.
123-122 Tentative de fondation d'une colonie romaine Colonia lunonia Carthago
par Caus Gracchus l'emplacement de Carthage punique.
118-105 Rgne de Jugurtha, roi des Numides.
110-106 Rome reprend la guerre, conduite par Caecilius Metellus, puis Marius
et Sylla.
105 Jugurtha est livr aux Romains par Bocchus 1
er
, roi de Maurtanie.
105-46 Rgne de la dynastie massyle l'est avec Gauda, Masteaba, Hiemp-
sal II et Juba 1" .
DYNASTIE MASSYLE
206 ou 203
Gaa, fils de Zilalsan
202-148
Massinissa, fils de Gaa
148-118
Micipsa, fils an de Massinissa
118-116
Hiempsal, 1
er
fils de Mcipsa
118-112
Adherbal, frre de Hiempsal
118-105
Jugurtha, fils de Mastanabal, fils de Massinissa
105-88
Gauda, frre de Jugurtha
88-60
Hiempsal II, fils de Gauda
60-46
Juba 1", fils de Hiempsal II
45-41
Arabion
25 av.-23 ap.
JubaH, fils de Juba 1"
J.-C.
23^10 ap. J.-C.
Ptoleme, fils de Juba II
DYNASTIE MASAESYLE
220-203
Sjphax
203-192
Vermina, son fils, rgne jusqu'en 192.
Entre 146 et 47 Priode caractrise par l'immobilisme en raison de l'absence de
politique de Rome vis--vis du territoire africain conquis.
49_48 Guerre civile romaine entre Csar et Pompe pour la conqute du
pouvoir.
47 Dbarquement de Csar en Afrique pour rduire l'un des derniers
bastions de la rsistance son pouvoir.
436
L'ANTIQUIT
Le roi numide Juba 1
er
se rallie Caton, chef des Pompiens en
Afrique.
48-44 Dictature de Csar Rome.
47-46 Guerre dAfrique et victoire dcisive de Csar Thapsus.
46 Juba 1
er
se suicide aprs sa dfaite.
Csar annexe son royaume qui devient 1 Africa nova.
44 Assassinat de Jules Csar Rome.
Aprs son assassinat, excution d'une ancienne dcision de Csar de
crer une colonie romaine Carthage.
43-42 Cette fondation s'appellera Colonia Iulia Concordia Carthago.
Elle est dote d'unepertica, c'est--dire d'un territoire d'exploitation.
40-39 Cette colonie sera la capitale de 1 Africa Proconsularis rsultant de la
fusion des deux provinces rpublicaines : Y Africa vtus et l'Africa nova.
De 43 29 Octave triomphe de ses rivaux. Il est seul matre de tous les terri-
toires conquis par Rome autour de la Mditerrane. Il renfora la
colonie de Carthage par un nouvel envoi de colons romains.
27 Outre Curubis et Cljpea, colonies fondes par Csar, Neapolis, Carpis,
Hippo Diarrhytus et Thabraca sont fondes par Auguste sur la cte.
29-19 Octave reoit le titre d'Auguste : c'est le dbut du principat et de
l'empire romain.
Virgile crit l'Enide la gloire de Rome et d'Auguste.
Outre Carthage, Auguste est le crateur en Afrique des colonies de
Maxula, Uthina, Thuburbo Minus, Simitthus, Thuburnica, Sicca Veneria,
Assuras pour faciliter l'installation des colons dans les riches terres
bl des valles de la Bagrada et de l'Oued Mliane.
APRES J.-C.
19 av. - 14 ap. J.-C. Mort d'Auguste l'ge de 76 ans
27 av. - 68 ap. J.-C. DYNASTIE JULIO-CIAUDIENNE
14 37 Tibre
37 - 41 Caligula
41 - 54 Claude
54 - 68 Nron
42 Annexion de la Maurtanie.
De 17 24 Le territoire de la tribu des Musulames est secou par la rvolte de
Tacfarinas. L'arme romaine rprime le soulvement. Politique de
sdentarisation et de pacification.
CHRONOLOGIE 437
En 37-39 Caligula enlve le pouvoir militaire du proconsul d'Afrique pour le
confier au lgat de la III
e
lgion Auguste, installe en Numidie, deve-
nue autonome.
69 Les trois empereurs Galba, Othon et Vitellius se disputent l'empire.
69-69
69-79
79-81
81-96
DYNASTIE FLAVIENN E
Vespasien
Titus
Domitien
Le rgne des Flaviens est marqu en Afrique par la pacification,
la sdentarisation et la romanisation des populations.
Ammaedara devient colonie.
Sufetula et Cillium, Bulla Regia et Hippo Regius, Lepcis Magna sont rigs
en municipes.
69-192
DYNASTIE ANTONINE
96-98
Nerva, adopte Trajan
98-117
Trajan, adopte Hadrien
117-138
Hadrien
138-161
Antonin, fils adoptif d'Hadrien
161-180
Marc Aurle, fils adoptif d'Antonin, associ avec Lucius Vrus
l'empire jusqu' la mort de celui-ci en 169, puis avec Commode
partir de 176.
180-192
Commode
192
P. Pertinax lui succde 87 jours avant d'tre assassin
Trajan cre de nouvelles colonies en levant le statut des villes de
Hadrumte, Leptis Magna, probablement Leptis Minor sur la cte, de
Thelepte, Theveste, Titngad l'intrieur.
Probablement l'occasion de son voyage en Afrique en 128, Hadrien
lve au rang de colonie : Bulla Regia, Utique, Zama Regia, Thaenae,
Lares ; et au rang de municipe : Thi^ica, BisicaLucana,Althiburos, Abthu-
gni, Thuburbo Majus, Turris Tamalkni.
Antonin le Pieux lve Gightis au rang de municipe.
Marc Aurle et Commode lvent au rang de colonie Thuburbo Majus,
Vupput, Mactaris, Sufes, et au rang de municipe, Vina, Segermes et proba-
blement Thugga.
Ces promotions municipales s'accompagnent d'un lan urbanistique et
monumental.
438 L'ANTIQUIT
193-235 DYNASTIE SVRIENNE
193-211 Originaire de Lepcis Magna, Septime Svre devient empereur
211-212 Caracalla et Geta, fils de Septime Svre et frres, rgnent ensemble.
212-217 Caracalla, fils de Septime Svre
217-218 Macrin
218-222 Elagabal
222-235 Svre Alexandre
203-204 Voyage de Septime Svre en Afrique.
235-268 Priode d'anarchie militaire dans l'empire.
235-238 Maximin le Thrace, empereur.
238 Rvolte Thysdrus contre les exactions de l'empereur Maximin : Mas-
sacre du procurateur du fisc et proclamation du proconsul Gordien
empereur.
Reprsailles par Capellien lgat de la 3
me
lgion Auguste.
Le territoire de Carthage est dmantel au profit des nouveaux muni-
cipes crs dans la valle de Bagrada : Aulodes, Avedda, Thugga, Thubursi-
cum Bure, Thignica, Agbia, Vaga devient colonie. Thysdrus, dans le sahel,
devient municipe.
238-244 Gordien III empereur.
244-248 Philippe l'Arabe, empereur.
250 puis 257-258 Perscution gnrale des chrtiens.
249-258 Cyprien, vque de Carthage.
250 Perscution des chrtiens sous l'empereur Dce.
258 Saint Cyprien vque de Carthage est condamn et excut.
260-268 Gallien empereur.
268-284 EMPEREURS ILLYRIENS.
268-270 Claude le Gothique
270-275 Aurelien
275-284 Tacite, Probus, Carus, Numrien, Carin se succdent
comme empereurs.
Diocltien, empereur, organise le partage de l'empire par la ttrar-
chie : association de deux Augustes gouvernant avec deux Csars. Il
divise YAjrica Proconsularis en trois provinces : Zeugitane, Byzacne et
Tripolitaine.
284-3000o5
CHRONOLOGIE 439
298 Sjour de Maximien Auguste en Afrique.
303-311 Grande perscution des chrtiens par Diocltien.
Naissance du donatisme.
307 Maxence, fils de Maximien Hercule, se proclame empereur en Afrique.
308 L. Domitius Alexander, vicaire d'Afrique Carthage, usurpe le pou-
voir.
311 Maxence envoie contre lui son prfet du prtoire Rufius Volusianus.
Carthage subit des reprsailles.
312 Constantin l "est vainqueur de Maxence au pont, Milvius proximit
de Rome.
313 dit de tolrance en faveur des chrtiens (dit dit de Milan). Apaise-
ment des querelles en Afrique.
324-337 Constantin est dclar empereur.
Il s'installe Constantinople qui est promue Capitale de l'empire.
354-430 Saint Augustin.
348 Rpression des donatistes en Afrique.
365 Tremblement de terre en Mditerrane.
372 Rvolte de Firmus, prince maure.
374 - 383 Sjour de saint Augustin Carthage.
386 Conversion de saint Augustin au christianisme.
396 - 430 Saint Augustin, vque de Hippone.
380 dit imprial instituant le christiannisme religion d'tat.
391 dit imprial interdisant le culte paen
395 Partage de l'Empire entre les fils de Thodose : Honorius (395-423)
pour l'occident ; Arcadius (395-408) pour l'orient.
395 - 398 Rvolte de Gildus, frre de Firmus et comte d'Afrique.
411 Convoque par l'empereur Honorius, la confrence de Carthage ras-
semble 565 vques catholiques et donatistes. Grce saint Augustin,
le donatisme est condamn. Le catholicisme triomphe.
425 Devant la menace vandale, sur ordre de l'empereur Thodose III, Car-
thage s'entoure d' un rempart.
427 Rbellion du comte d'Afrique Boniface.
429 Les Vandales dbarquent d'Espagne en Afrique.
430 Mort de saint Augustin dans Hippone assige par les Vandales.
440
L'ANTIQUIT
439 Gensric, chef des Vandales, s'empare de Carthage. Il se constitue un
tat vandale dans l'Africa proconsularis qui durera jusqu'en 533.
De confession arienne, les rois vandales sont hostiles aux catholiques
et aux propritaires terriens.
DYNASTIE VANDALE
Gensric (38 ans de rgne)
Hunric, fils de Gensric
Gunthamund
Thrasamund
Hildric, fils de Hunric
Glimer
L'affaiblissement de l'tat vandale permet aux Maures de reprendre
leur libert de mouvement et de se rvolter. L'inscurit dans les cam-
pagnes fait fuir les agriculteurs sdentaires. Les nomades se regroupent
en tribus pour subsister et rsister.
510 Antalas prend la tte de la confdration des tribus.
525 II se constitue un petit royaume autonome dans la rgion des Hautes
Steppes.
533 Justinien, empereur de l'empire byzantin depuis 5 ans, dcide de
reconqurir la province d'Afrique sous domination vandale depuis
439.
CHRONOLOGIE DES EMPEREURS BYZANTINS
527-565 Justinien (39 ans de rgne)
565-578 Justin II
578-582 Tibre II Constantin
582-602 Maurice-Tibre
602-610 Phocas
610-641 Hraclius
641-668 Constant II
668-685 Constant IV
533
Justinien envoie une flotte et une arme ayant sa tte le gnral Bli
saire.
439 477
477-484
484-496
496-523
523-530
530-533
534 Blisaire reconquiert l'Afrique sur les Vandales et commence la ror-
ganisation militaire de la province. Mais il se heurte aux rvoltes des
Maures.
CHRONOLOGIE 441
534-548 Plusieurs combats opposent Maures et Byzantins l'intrieur du pays.
Les rpressions engages rien viennent pas bout.
534-539 Justinien ordonne Solomon, successeur de Blisaire, d'organiser la
dfense des populations des villes et des campagnes contre les attaques
des Maures. Le pays se couvre de forteresses et de fortifications. Mais
les ravages continuent et l'anarchie s'installe.
546 Solomon est tu par Antalas Cillium.
546-548 Justinien envoie le gnral Jean Troglita en Afrique pour rprimer les
rvoltes maures et rtablir l'ordre.
Corripe qui accompagne Jean Troglita crit la Johannide.
548-563 Priode de paix.
563-571 Les insurrections maures reprennent et les Byzantins subissent de
nombreux revers.
565 A la mort de Justinien, la puissance romaine est gravement compro-
mise en Afrique.
579 Succs de l'arme byzantine sur les Maures.
Institution de l'exarchat d'Afrique.
646 Le patrice Grgoire abandonne Carthage pour s'installer Sujetula pro-
mue capitale.
647 Les conqurants arabes apparaissent dans le sud de Y Africa. Le premier
raid les met en face de Grgoire qui est tu dans la bataille de Sujetula.
Le pays est livr au pillage.
664-665 Deuxime raid arabe sous la direction de Mu'awiya.
L'arme arabe dfait l'arme byzantine.
668 Okba Ibn Nafa, chef de l'arme arabe, conquiert le sud de 1 Africa.
670 Kairouan est fonde.
681 Okba entreprend une chevauche jusqu'aux confins du Maghreb.
683-686 Kocila, chef maure chrtien, organise la rsistance contre l'envahis-
seur arabe. Il entre en vainqueur Kairouan et est matre du pays
durant 3 ans. Il est tu Mems par Zoharr Ibn Kas.
695-702 La Kahina, reine des Aurs, poursuit la rsistance en s'opposant l'in-
vasion arabe. Elle est finalement traque et vaincue. Ses tribus se
convertissent l'Islam.
695 Hassan Ibn Nooman s'empare de Carthage.
697 Carthage est reconquise par les Byzantins grce une flotte envoye
par Constantinople.
442 L'ANTIQUIT
698 Carthage est reprise par Hassan Ibn Nooman. Elle est dtruite et
abandonne dfinitivement.
Hassan Ibn Nooman fonde une nouvelle ville Tunis en la dotant
d'un port et d'une flotte.
702 L'Ifriqiya devient une province omeyyade de Damas, place sous
l'autorit d'un gouverneur nomm par le Calife. Kairouan devient
la capitale du pays.
7II Sous la conduite de Tariq, les contingents berbres convertis l'Is-
lam traversent le dtroit qui porte dsormais son nom (Jabel Tariq
= Gibraltar) et s'emparent du royaume Wisigothique d'Espagne.
DATE DE L'ARRIVE DES CHEFS D'ARME
ARABES EN IFRIQIYA
647
/
27 H
Abd'Allah ben Sa'ad
665
/
45 H
Mu'a'wiya ben Hudayj
670
/
50 H
Okba ben Nafaa
674
/
55 H
Abu Mohajer Dinar
681
/
62 H
Okba ben Nafaa pour la seconde fois
688
/
69 H
Zuhayer ben Qays al Balawi
692
/
73 H
Hassan ben an Nooman.
705
/
86 H
Musa ben Nusayr.
d'aprs ALaroui, L'histoire du Maghreb, 1970p. 359
.
Bibliographie
GNRALITS
CH. A. JULIEN
Histoire de l'Afrique du Nord. Des origines 1830. Paris, d. 1951,
1961, 1994, Livre I, 2
e
dition revue et mise jour par Chr.
Courtois.
H. SLIM, A. MAHJOUBI, KH. BELKODJA,
Histoire de la Tunisie. L'Antiquit, Tunis 1969, 408 p.
F. DCRET et M. H. FANTAR
"L'Afrique du Nord dans l'Antiquit. Histoire et civilisation, des origines
au V
e
s., Paris, 1981, 391 p.
HISTOIRE GNRALE DE L' AFRI QUE
Tome 2 : l'Afrique ancienne : Les chapitres suivants concernent la
Tunisie 17 (J. Desanges) ; 18 (B.H. Warmington) ; 19 (A.
Mahjoubi) ; et 20 (P. Salama) Paris, Unesco, 1980.
G. CAMPS
Berbres, aux marges de l'Histoire, Toulouse, 1980, 352 p.
Encyclopdie Berbre. En cours de parution sous forme de fascicules
partir de 1984, Aix-en-Provence.
H. SLIM et N. FAUQU
La Tunisie antique. De Hannibal saint Augustin, Paris, 2001.
444
L'ANTIQUIT
PRIODE PRHISTORIQUE ET PROTOHISTORIQUE
L. BALOUT
Prhistoire de l'Afrique du Nord, Paris, 1955.
G. CAMPS
Aux origines de la Berbrie. Monuments et sites funraires protohisto-
riques, Paris, 1961, 628 p., 24 pl.
E. G. GOBERT
Bibliographie critique de la prhistoire tunisienne, dans Cahiers de
Tunisie , t. 11, 1963, p. 37-77.
S. GRAGUEB et S. MTIMET
La prhistoire en Tunisie et au Maghreb, Tunis, 1989.
ATLAS PRHISTORIQUE DE LA TUNISIE
En cours de parution sous forme de fascicules, par carte au
200 000
e
: feuilles Tabarka, Bizerte, Cap Bon, Tunis, La Goulette,
Le Kef, Mactar, Gabs, Souk el Arba, Sousse, El Jem, Kairouan,
diteurs EFR-INP Rome-Tunis.
PRIODE PUNIQUE ET ROYAUMES INDIGNES
S. GSELL
Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Paris, 8 tomes parus entre
1913 et 1928.
A. PARROT, M. CHEHAB, S. MOSCATI
Les Phniciens. L'expansion phnicienne. Carthage, Coll. l'Univers des
formes, Paris, 1975. 314 p.
F. DCRET
Carthage ou l'empire de la mer, Paris, 1977, 254 p.
MH. FANTAR
Carthage, approche d'une civilisation, 2 tomes, Tunis, 1983.
BIBLIOGRAPHIE 445
P. CINTA S
Manuel d'archologie punique, 2 tomes. Paris, 1970 et 1976. 514 p.,
36 pl. et 415 p. 62 pl.
S. LANCEL
Carthage, Paris, 1992 ; Tunis 1999.
M. SZNYCER
Carthage et la civilisation punique, in Rome et la conqute du monde mdi-
terranen,, T. 2, Gense d'un empire.
G. CAMPS
Masinissa ou les dbuts de l'Histoire, Libyca , VIII, 1960, Alger,
320 pages.
C. et G. - CH. PICARD
La vie quotidienne Carthage au temps d'Hannibal (III
e
s. av. J.-C).,
Paris,1982.
S. Lancel
Hannibal., Paris, 1995.
Les Phniciens. Sous la direction de S. Moscati, d. Stock-Paris
1997, 672 p.
PRIODE ROMAINE
CH. COURTOIS
Les Vandales et l'Afrique, Alger, 1955.
CH. DI EHL
L'Afrique byzantine. Histoire de la domination byzantine en Afrique
(533-709), Paris, 1896.
P. - A. FVRIER
Approches du Maghreb romain, 2 vol ; Aix-en-Provence, 1989-
1990.
J. GASCOU
La politique municipale de l'Empire romain en Afrique proconsulaire de
Trajan Septime-Svre, Rome, 1972.
446
L'ANTIQUIT
J. - M. LASSRE
Ubique Populus. Veuplement et mouvements de la population dans
l'Afrique romaine, de la chute de Carthage la fin de la dynastie des
Svres, (146 av. J.-C. - 235 ap. J.-C.), Paris, 1977, 715 pages, 9
dpliants.
CL. LEPELLEY
Les cits de l'Afrique romaine au Bas-Empire, Paris, 2 tomes 1979 et
1981, 609 pages, 4 cartes.
A. MAHJOUBI
Les cits romaines de Tunisie, Tunis, s.d. (1968).
Ville et structures urbaines de la province romaine d'Afrique, Tunis,
2000, 271 pages.
La province d'Afrique, de l'occupation romaine la fin de l'poque
svrienne (146 av. J.-C. / 235 ap. J.-C.) en langue arabe, Tunis,
2002, 207 p.
Y. MODRAN
Byzantins et Berbres, Paris, 2000.
G. - CH. PICARD
La civilisation de l'Afrique romaine, Paris, 2
e
dition, 1990.
D. PRINGLE
The Defence of Byzantine Africa from Justinian of the Arab conquest,
Oxford, 1981.
P. ROMANELLI
Storia delle province romane dell Africa, Rome, 1959, 720 pages.
Topografia e archologia dell'Africa romana, Turin, 1970.
P. SALAMA
Les voies romaines de l'Afrique du Nord, Alger, 1951
P. TROUSSET
Recherches sur le limes tripolitanus du Chott El Jerid la frontire
tuniso-libyenne, Paris, 1974.
BIBLIOGRAPHIE 451
MONOGRAPHIES
A. BESCHAOUCH
La lgende de Carthage, Paris, 1993.
M. BLANCHARD-LEME, E. ENNAFER, M. MERMET, H. et L. SLIM
Sols de l'Afrique romaine, Paris, 1995.
H CAMPS-FABER
L'olivier et l'huile dans l'Afrique domaine, Alger, 1953.
S. CARANDINI
Produzione agricola et produzione ceramica nell Africa di eta imperiale,
Rome, 1970
J. -P. DARMON
Nympharum Domus, Nabeul,Leyde, 1980.
K. DUNBABIN
The mosacs of Koman North Africa, Oxford, 1978.
N. DUVAL
Les glises africaines deux absides, Paris, 2 tomes, 1973.
A. ENNABLI
Pour sauver Carthage (ouvrage collectif), Paris-Tunis, 1992.
A. ENNABLI
Lampes chrtiennes de Tunisie, Paris, 1975.
L. ENNABLI
Carthage, Une mtropole chrtienne du IV" s. la fin du VIT s., Paris,
1997.
M. ENNAFER
La citd'Althiburos et difice des Asclepeiea, Tunis, 1976.
M. FANTAR
Kerkouane, 3 tomes, 1984 - 1985 - 1986, Tunis
L. FOUCHER
Hadrumetum, Tunis, 1964.
448
L'ANTIQUIT
N. FERCHIOU
L'volution du dcor architectonique en Afrique Proconsulaire, des derniers
temps de Carthage aux Antonins, 1984.
M. GHAKI
Les haouanet de Sidi Mohamed Latrech, Tunis, 1999.
H. JAIDI
L'Afrique et le bl de Rome aux VI et V' sicles, Tunis, 1990.
S. LANCEL
Saint Augustin, Paris, 1999.
M. LEGLAY
Saturne africain. Histoire et monuments, Paris, 2 tomes, 1961 et
1966.
A. MAHJOUBI
Les cits des Belalitani Maiores, Recherches d'histoire et d'archologie
Henchir ElFaouar, Tunis, 1978.
G. CH. PICARD
Civitas Mactaritana dans Karthago , VIII, 1957, Tunis.
Les religions de l'Afrique antique, Paris, 1954.
M. YACOUB
Le muse du Bardo, Tunis 1993.
Splendeur des mosaques de Tunisie, Tunis, 1995.
En dehors des ouvrages gnraux et des monographies spcia-
lises, il faut mentionner les articles parus dans les revues et prio-
diques tant nationaux qu'internationaux, ainsi que ceux parus dans
les actes des colloques et congrs, dans les mlanges dits en l'hon-
neur de savants distingus.
C'est par ces articles que la science historique continue de pro-
gresser, apportant une contribution essentielle l'amlioration des
connaissances. En raison de leur nombre et de leur parpillement, on
BIBLIOGRAPHIE 449
ne peut les numrer. Mais il convient de signaler les priodiques les
plus connus. Citons en Tunisie, les Cahiers de Tunisie, dits par
l'Universit de Tunis.
Africa, Reppal dits par l'Institut National du Patrimoine.
En France, Karthago, Antiquits Africaines, les CRAI.
En Italie, les Mefra, la Rivista di Studi Fenici.
Les actes des colloques de Africa Romana, partir de 1983.
Les actes de colloques internationaux d'histoire du Maghreb.
Ceux de l'histoire et de l'archologie de l'Afrique du Nord, 1981,
1983, 1986,1988,1990,1993 et 1996.
Depuis 1961 jusqu'en 1986, sous les signatures de J. Desanges et S.
Lancel, puis partir de 1986 de Y Le Bohec et J. M. Lassre, une biblio-
graphie analytique de /.Afrique antique, annuelle, recense et analyse toute la
production scientifique se rapportant l'histoire de l'Afrique du Nord.
Table des illustrations et des cartes
I
E
PARTIE : L'POQUE PUNIQUE
Page
19 Hermaon d' El Guettar et pierre sculpte
23 Outillage prhistorique et Haouanet
34 Mdaillon en terre cuite
37 Carte de la Mditerrane au V' s. av. J.-C.
39 Sarcophage du Prtre
44 Carte des priples d'YLannon et d'Himilcon
47 Collier et monnaie puniques
51 Stle punique votive et restitution d'une galre antique
63 Buste en bronze
67 Carte des oprations militaires d'Hannibal et croquis de la bataille de Cannes
69 Stle punique l'lphant et cuirasse en bronze dor
73 Paysage de la rgion de Zama et croquis de la bataille de Zama
75 Restitution du quartier punique de Byrsa Carthage
79 Carthage au dbut du II
e
s. av. J.-C. et Carte du golfe de Carthage
83 Vases en terre cuite et four pain punique
84 Sarcophage dit de la prtresse
89 Inscription punique de Carthage et restitution d'un quartier du V
e
s. av. J.-C.
91 Le site de la colline de Byrsa Carthage et coupe de la colline
95 Restitution de la Carthage punique et de l'lot de l'Amiraut
99 Stle de Bal Hammon et stle dite du prtre l'enfant
101 Statue leontocphale du Genius terrae Africae et desse nourricire
103 Statuette de la Joueuse au tympanon et sarcophage du prtre
107 Le tophet, sanctuaire de Tanit et Bal Hammon. Restitution
113 Masques en terre cuite et pendentifs en pte de verre
117 Maison d'habitation de Kerkouane et salle de bain
127 Mausole libyco-punique de Dougga
131 Les dynasties numides
135 Autel-sanctuaire de Chemtou et stle du cavalier numide
452
139 Stle dite de la Ghorfa et bas-relief des sept divinits numides
141 Tte de Libyen et stle des huits divinits libyques
146 Inscription bilingue de Massinissa
2
E
PARTIE : POQUE ROMAINE
174 Virgile et les muses
185 Allgorie de la Victoire et statue d'impratrice
187 Tte de Lucius Vrus
190 Mosaque figurant la desse Africa
193 Statue de Crs-Pomone et champ de bl
197 ' Installation d'huilerie et spcimen de cramique
201 Officine de salaison de poisson
209 Carte de rseau routier de 1'Africa Proconsularis
211 Carte conomique
217 Restitution de la Carthage romaine
220-221 Pla n du site de Dougga
223 Le forum de Sbetla
225 Tte de Septime-Svre
226 Capitole de Dougga
231 Grands thermes de Mactar
233 Dessins des thermes d' Antonin Carthage
236-237 Le temple des eaux et l'aquaduc de Zaghouan Carthage
239 Les citernes de Rougga
243 Le thtre de Dougga
246-247 L'amphithtre de Thjsdrus
249 Mosaque des jeux d' amphithtre
255 Statue d'aurige vainqueur
259 Maison souterraine de Butta Regia
263 Le Mausole de Kasserine
267 Statue funraire
269 Stles Saturne
273 Statue de Crepereia
277 Mosaque de Neptune et des saisons
279 Statues d' Esculape et de Saturne
285 Sarcophage de l' enfant initi
3
E
PARTIE : DE LA CRISE DE LA CIVILISATION ROMAINE L'ISLAM
305 La Schola des Juvenes Mactar
317 Mosaques du cirque de Gafsa
321 Mosaque du Seigneur Julius
323 Mosaque reprsentant un domaine agricole
335 Mosaque tombale de Thabraca
3 3 7
3 4 5
3 4 7
3 5 1
359
361
3 7 5
3 8 5
390-391
3 9 3
3 9 5
396-397
4 0 3
4 0 7
4 1 3
4 1 9
453
Mosaque reprsentant une croix
Portrait de saint Augustin
Baptistre de l'glise du Prtre Flix
Bijoux vandales de Koudiat Zateur
Lampes et carreaux de terre cuite
Tablettes vandales dites Albertini
Basilique d' El Gousset
L' empereur Justinien
Carte de la Proconsidaire aprs la rforme de Diocletien
Ksar Lemsa
Basilique byzantine de Hadra
Carte des fortifications byzantines
Mosaque de la Dame de Carthage
Mosaque funraire de Klibia
Arc de triomphe transform en fortin Hadra
Trsor montaire byzantin de Rougga
Table des matires
AVANT-PROPOS DE L' DITEUR 7
LE MILIEUR NATUREL 9
PREMIRE PARTIE : L'POQUE PUNIQUE
CHAPITRE PREMIER - LES TEMPS PRHISTORIQUES 15
Les conditions gnrales 15 - Les principales phases de la pr-
histoire 18 - Les Berbres 26
Chapitre II - LES PHNICIENS ET LA FONDATION DE CARTHAGE.. 29
Les chelles phniciennes 29 - Elissa et la Fondation de
Carthage 30 - Lgende et ralit 33
CHAPITRE III - FORMATION DE L'EMPIRE CATHAGINOIS ET
CONFLIT AVEC LES GRECS 35
L' EMPIRE CARTHAGINOIS 35 - LA BATAILLE D'HIMRE ET SES CONS-
QUENCES 38 - LES PRIPLES DE HANNON ET DE HIMILCON 41
CHAPITRE I V - L' APOGE DE CARTHAGE ET LE PREMIER CONFLIT
AVEC ROME 45
L'ESSOR DE CARTHAGE 45 - LA PREMIRE GUERRE PUNIQUE 48 - LA
RVOLTE DES MERCENAIRES ET L'ENTRE-DEUX-GUERRES 55
CHAPITRE V- HANNIBAL ET LA DEUXIME GUERRE PUNIQUE 59
Les Barcides en Espagne et le dclenchement de la guerre 59
456
- Les victoires d'Hannibal et ses checs 62 - L'effacement de
Carthage et la fin d'Hannibal 72
CHAPITRE VI - LA CIVILISATION CARTHAGINOISE LES BASES DE
LA PUISSANCE 77
L' EMPIRE ET LE COMMERCE 77 - L'AGRICULTURE 80 - L'ARTISANAT 82
CHAPITRE VII - LA CIVILISATION CATHAGINOISE : LES INSTRU-
MENTS DE LA PUISSANCE 85
LA FLOTTE ET L'ARME 85 - LES INSTITUTIONS POLITIQUES 87 - LA CIT
ET LA SOCIT 90
CHAPITRE VIII - LA CIVILISATION CARTHAGINOISE : LA VIE RELI-
GIEUSE, ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE 97
LES DIEUX ET LES CULTES 97 - LES TOPHETS ET LES PRATIQUES
FUNRAIRES 1 0 4 - LA VIE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE 110
CHAPITRE IX - L' MERGENCE DU ROYAUME NUMIDE 121
MASINISSA ET L'ESSOR DU ROYAUME NUMIDE 121 - L'OUVERTURE AU
MONDE PUNIQUE ET GREC 133 - LA RELIGION ET LES COUTUMES FUN-
RAIRES 138
CHAPITRE X : LA TROISIME GUERRE PUNIQUE, LA CHUTE DE
CARTHAGE ET LE TRIOMPHE DE ROME 147
LA PUISSANCE NUMIDE FACE CARTHAGE AFFAIBLIE 147 - LA TROI-
SIME GUERRE PUNIQUE 151 - LA DESTRUCTION DE CARTHAGE ET LE
TRIOMPHE DE ROME 153
DEUXI ME PARTIE : L'POQUE ROMAINE 161
CHAPITRE PREMIER - LA RSISTANCE ARME LA DOMINATION
ROMAINE ET L' ORGANISATION DFENSIVE DE LA PROVINCE 163
Les expditions contre les Garamantes, les Musulames et les
Gtules, sous Auguste 164 - La rvolte de Tacfarinas (17-23
457
ap. J.-C.) 165 - La fin de la pacification 167 - Le limes et
l'avance vers le Sud 169 - L'arme romaine d'Afrique 172
CHAPITRE II : L'ORGANISATION PROVINCIALE ET MUNICIPALE ET
LES CONDITIONS DES INDIVIDUS 175
LA PROCONSULAIRE ET SON ADMINISTRATION 175 - LES INSTITUTIONS
MUNICIPALES 179 - LES CONDITIONS DES INDIVIDUS 183
CHAPITRE III - LE DVELOPPEMENT CONOMIQUE 191
LA POPULATION 191 - L'AGRICULTUREL92 - L'INDUSTRIE ET LE COM-
MERCE 200 - LA COLONISATION ET LE PROBLME SOCIAL 212
CHAPITRE IV - L'URBANISATION INTENSE DE LA PROVINCE 2 1 5
CHAPITRE V - LES MONUMENTS PUBLICS CARACTRE POLI-
TIQUE, SOCIAL ET RELIGIEUX 229
LES FORA 229 - LES SANCTUAIRES 232 - LES THERMES 234 -
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU DES CITS 240
CHAPITRE VI - LES MONUMENTS DES JEUX ET DES SPEC-
TACLES 245
LES THTRES 245 - L'AMPHITHTRE 250 - LE CIRQUE 253
CHAPITRE VII - LA PARURE ARCHITECTURALE DES CITS ET L'AR-
CHITECTURE DOMESTIQUE ET FUNRAIRE 257
LES MAISONS 2 5 8 - LES MONUMENTS FUNRAIRES 261
CHAPITRE VIII - L'PANOUISSEMENT DE LA CIVILISATION
ROMANO-AFRICAINE. LE DVELOPPEMENT CULTUREL 265
L'ENSEIGNEMENT 265 - L'HUMANISME 2 6 8 - LES ARTS DANS LA PRO-
VINCE 272 [ LA SCULPTURE 272, LA MOSAQUE 275 ]
CHAPITRE XI - L'PANOUISSEMENT DE LA CIVILISATION
ROMANO-AFRICAINE. LES RELIGIONS ROMANO-AFRICAINES ET
LES DBUTS DU CHRISTIANISME 281
Cultes officiels, cultes africains et cultes orientaux 281 - Les
dbuts du christianisme 284 - Les apologistes chrtiens 287
458
TROISIME PARTIE : De la cri se de la
civilisation romaine l'Islam 291
A - LES DERNIERS SICLES DE ROME
Chapitre I - LA CRISE DU III
1
SICLE 293
Aspects gnraux 293 [ Succs de la romanisation sous les Svres 293,
Ses limites 294 ] - Les troubles civils et militaires 295 [ Rvolte de
Thysdrus et usurpation de Gordien 295, Les insurrections berbres
297 ] - Les difficults conomiques 298 - La crise religieuse
298 [ Progrs du christianisme africain au III' s. 298, saint Cyprien,
vque de Carthage 299, La perscution de Dce 300, saint Cyprien en
conflit avec 1'vque de Rome 301, La perscution de Valrien et le mar-
tyre de saint Cyprien (258) 301 ]
Chapitre II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PROBLMES
MILITAIRES DE LA FIN DU FIN DU III
E
S. LA CONQUTE
VANDALE 303
Les rformes administratives 303 [ Les nouvelles provinces 304,
Le gouvernement provincial 306, Sparation des pouvoirs civils et mili-
taires 307] - Les rformes militaires 307 [ Le commandement 307,
Effectifs et recrutement 308, Arme mobile de l'intrieur et arme des
frontires 308, Frontire de la Tunisie romaine au IV' s. 309 ] -
L'inscurit 310 [Le rle des nomades chameliers en Tripolitaine 310,
Le rveil de la rsistance berbre 312, La guerre de Gildon 312,
Dsagrgation de l'Empire romain en Occident 314 ]
Chapitre III : LA VIE MATRIELLE ET LA SOCIT 315
L'conomie 315 [ L'agriculture 315, Les crales 315, L'olivier 316
Industrie et commerce 318] - La socit rurale 319 [Aggravation de
la condition des paysans 319, Les grands propritaires fonciers 320 ] -
La vie municipale et les villes 324 [ La vocation urbaine de la
Tunisie romaine 324, La crise municipale 325, Attitude de l'Etat vis-
-vis du problme municipal 326, Prosprit relative des cits romaines
de Tunisie au IV' s. 326, Carthage, mtropole d'Afrique 328 ]
Chapitre IV - L'ESSOR DU CHRISTIANISME ET LES CONFLITS
RELIGIEUX 331
La perscution de Diocltien 331 - L'glise et la paix constanti-
459
nienne 333 [ Richesse et puissance de l'Eglise d'Afrique 336, Ses limites
338 ] - La crise donatiste 340 [ Ses causes 340 - Attitude de l'tat et
volution du schisme 341 - Signification du donatisme 342 - Donatistes et
circoncellions 343 ] - saint Augustin 346
B- LA TUNISIE VANDALE 349
Chapitre I - UN GRAND CONQURANT : GENSRIC 349
L'invasion vandale 349 [ Causes de la conqute 349, Les tapes de la
conqute 350, Du dbarquement Tanger au trait de 435 352, Du trai-
t de 435 la mort de l'empereur Valentinien III 352, La rupture avec
l'Empire 353, Le vandalisme 353 ] - L'organisation intrieure du
royaume vandale 354 [ Gensric 355, L'Etat vandale : Les institu-
tions politiques 356, Le peuple vandale 357, Le problme des terres
360, La politique religieuse de Gensric 362 ] - La politique ext-
rieure et l'Empire vandale 364 [ L'arme et la marine 364,
Conqutes et pillages 365, L'empire vandale 365, La prise de Rome
366, L'attitude de l'Empire 367, En Occident 368, En Orient 368,
La paix de 476 369 ]
Chapitre II - DCADENCE DU ROYAUME VANDALE 371
La rsistance catholique 371 [ Le rgne d'Hunric (477-484) 371,
Caractre du roi 371, Le problme de la succession au trne 372,
Perscution des catholiques 373, La politique religieuse sous les succes-
seurs d'Hunric 374, les hsitations du Gunthamund 374, Nouvelles
perscutions sous Thrasamund 374, Revirement pro-catholique sous
Hildric 376, Chute d'Hildric et avnement de Glimer 37'6] Le dan-
ger berbre 377 [ Dcadence de l'Etat 377, Organisation des tribus
berbres 377, Leur intervention dans le Royaume vandale 378, Les
Nomades chameliers 379 ] - tat matriel de la Tunisie au dbut
du VI
e
s. 379 [ La paix vandale 379, Les villes 380, L'agriculture
380, Le commerce 381 ] - Conclusion 381
C. LA TUNISIE BYZANTINE ( 533 - 698) 383
Chapitre I - JUSTINIEN ou L'ILLUSION D' UNE RSURRECTION DU
PASS 383
460
La reconqute 383 [ Ses causes 383, La campagne de Blisaire 384,
L'effondrement des Vandales 386, Les limites d'une reconqute 387 ] -
L'organisation administrative et militaire 388 [ L'administration
388, L'arme et la dfense 389, Les forteresses 392 ] Guerres indi-
gnes et rebellions dans l'arme 398, [ Les relations entre l'admi-
nistration byzantine et les chefs berbres 398, La mutinerie de Stot^as
399, La rvolte d'Antalas et la mort de Solomon 399, L'anarchie en
Afrique 400, Redressement provisoire sous Jean Trog/iata 400 ] La vie
conomique et sociale 400 [Jugement de Procope 400, Agriculture
et vie rurale 404, Le commerce 405 ] - La politique religieuse 405
[ Ultime essor du christianisme en Tunisie 406 - Les querelles tholo-
giques 408 ] - Conclusion 409
Chapitre II - LA TUNISIE LA VEILLE DES INVASION ARABES 411
L'volution politique et administrative jusqu'au milieu du VIP s.
411 [ L'Afrique sous Justin II et Tibre Constantin (565-582) 411,
L'exarchat de Carthage 412, Heraclius 415 ] - La chute de la
domination byzantine ( 647- 698) 416 [ La crise du VU' J". : usur-
pation\ de l'exarque Grgoire 416, Rveil du pril berbre 417, Le rle
de l'glise et les difficults religieuses 417, Les dernires annes de
Bj^ance en Afrique : la Bj^acne dvaste 420, Arabes et Berbres :
Okba et Koeila 420, Carthage prise par les Arabes 421 ] -
Conclusion 422
POSTFACE POUR LA TROISIME PARTIE : TAT DE LA QUESTION 425
CHRONOLOGIE 431
BIBLIOGRAPHIE 4 4 3
TABLE DES ILLUSTRATIONS ET DES CARTES 451
TABLE DES MATIRES 455
Maquette :
Photocomposition :
Photographies :
Atelier graphique, Sud ditions.
Sur Macintosh ( Sud ditions )
Nicolas Fauqu pp. 19 - 23 - 34 - 37 - 47 - 51a -
69 -73a - 79 a - 83 - 84 - 89 - 91 - 95 a - 99 - 101
103 - 107a - 117 - 127 - 135 - 139 - 141 - 185 -
187 - 193 - 197 - 201 - 217 - 223 - 225 - 227 -
231 - 137 - 243 - 246 - 249 - 259 - 267 - 269 - 273
277 - 279 - 317 - 321 - 335 - 347 - 359 - 375 -
395 - 401 - 405 - 411
Radhia Gorg ( Sud ditions )
Sources indiques dans les lgendes
Arrangement et reprise des textes : atelier
graphique, Sud ditions.
Carte en couleur hors texte : Ammar Mahjoubi.
Flashage : Scan Flash.
Infographiste :
Cartes et plans
Les auteurs et l'diteur prsentent leurs remerciements Madame Liliane
Ennabli qui a assur la lecture et la correction des preuves de cet ouvra-
ge-
Achev d'imprimer sur les presses de
FI NZI USIN3S GRAPHIQUES
1000 Ex. - R.T. N 791 Mars 2010
En 218 av. J .-C. Hannibal conduit son arme et ses lphants travers les
Pyrnes et les Alpes, et aprs les clbres batailles de Trasimne et de
Cannes, met Rome deux doigts de sa perte. Soixante-douze ans plus tard -
en 146 avant J .-C. - Carthage cde devant les lgions de Scipion Emilien, le
Snat romain dcrte sa destruction.
Cet acte met fin prs de dix sicles d'histoire au cours desquels les
Puniques, venus de leur lointaine Phnicie construisirent sur la terre tuni-
sienne une brillante civilisation maritime et marchande. La Rpublique aris-
tocratique de Carthage devint l'une des grandes mtropoles de la
Mditerrane.
Devenue romaine, l'Africa ne tarda pas se hisser au rang des provinces les
plus prospres et les plus urbanises de l'Empire. Les muses de Tunisie sont
pleins aujourd'hui des tmoignages de cette brillante civilisation. Combien
savent que la plus grande collection de mosaques romaines dans le monde
y est expose ? Et combien parmi ceux qui lisent Apule, Tertullien et Saint
Augustin se souviennent que ces grands hommes ont grandi l'ombre des
murs de Carthage ?
Ce livre crit avec talent par quatre minents spcialistes nous conte l'histoi-
re riche et passionnante d'un pays, le notre, qui a t au cur des grands
vnements du pass mditerranen.
Une illustration abondante et largement commente, des cartes et des plans
clairs et prcis, des annexes facilitant l'accs l'ouvrage... font de ce livre
un outil indispensable au chercheur et toute personne intresse par l'his-
toire de la Tunisie en particulier et celle de la Mditerrane en gnral.
Vous aimerez peut-être aussi
- L' Islamisation de L'afrique Du NordDocument463 pagesL' Islamisation de L'afrique Du NordBen80% (5)
- Celine Louis-Ferdinand - Bagatelles Pour Un Massacre PDFDocument220 pagesCeline Louis-Ferdinand - Bagatelles Pour Un Massacre PDFLeandro Avalos Blacha83% (6)
- Traité Sur Les Noms Divins ArraziDocument671 pagesTraité Sur Les Noms Divins Arrazitestimony94% (50)
- Celine Louis-Ferdinand - Entretien Avec Le Professeur YDocument70 pagesCeline Louis-Ferdinand - Entretien Avec Le Professeur YtestimonyPas encore d'évaluation
- Penser L'histoire Penser La Religion Hichem JaitDocument176 pagesPenser L'histoire Penser La Religion Hichem Jaittestimony100% (3)
- Redressement Non Commandé PD3Document3 pagesRedressement Non Commandé PD3Çha ÏmaPas encore d'évaluation
- HISTOIRE GENERALE DE LA TUNISIE TOME 4 : L'Epoque ContemporaineDocument598 pagesHISTOIRE GENERALE DE LA TUNISIE TOME 4 : L'Epoque Contemporainetestimony100% (4)
- Histoire de La Tunisie - Sophie BessisDocument530 pagesHistoire de La Tunisie - Sophie Bessisفوزي السباعي100% (2)
- UNESCO Histoire Generale D Afrique 4Document797 pagesUNESCO Histoire Generale D Afrique 4Mostafa Boussnene100% (1)
- 12 Femmes D'orient Qui Ont Changé L'histoire Gilbert SinouéDocument134 pages12 Femmes D'orient Qui Ont Changé L'histoire Gilbert SinouéAhmed AminePas encore d'évaluation
- Jean AMROUCHE - L'Eternel JugurthaDocument13 pagesJean AMROUCHE - L'Eternel JugurthaTadukli Menouar90% (10)
- .. ClientBin Images Book720604Document613 pages.. ClientBin Images Book720604Louis MehmesPas encore d'évaluation
- Archives Marocaines Vol.29Document240 pagesArchives Marocaines Vol.29Youn80Pas encore d'évaluation
- Histoire de l’empire parthe (-250 - 227): À la découverte d'une civilisation méconnueD'EverandHistoire de l’empire parthe (-250 - 227): À la découverte d'une civilisation méconnuePas encore d'évaluation
- George Soros - La Crise Du Capitalisme MondialDocument264 pagesGeorge Soros - La Crise Du Capitalisme Mondialektor20110% (1)
- Karak AzgalDocument97 pagesKarak AzgalAubrun100% (4)
- HISTOIRE ANCIENNE de l'AFRIQUE DU NORD-par Stéphne Gsell-Tome1Document536 pagesHISTOIRE ANCIENNE de l'AFRIQUE DU NORD-par Stéphne Gsell-Tome1Belhamissi86% (7)
- L Afrique Du Nord - Henri LorinDocument443 pagesL Afrique Du Nord - Henri LorinMaya DayaPas encore d'évaluation
- La Tunisie antique et islamique: Patrimoine archéologique tunisienD'EverandLa Tunisie antique et islamique: Patrimoine archéologique tunisienPas encore d'évaluation
- HISTOIRE GENERALE DE LA TUNISIE TOME 3: Temps ModernesDocument497 pagesHISTOIRE GENERALE DE LA TUNISIE TOME 3: Temps Modernestestimony83% (6)
- Protectorat Français de TunisieDocument74 pagesProtectorat Français de TunisieRodríguez Nairda100% (1)
- Berberie Tomei PDFDocument452 pagesBerberie Tomei PDFMoundhir Abdessamed100% (1)
- La Conquête D'alger-Ou Relation de La Campagne D'afrique-1830Document149 pagesLa Conquête D'alger-Ou Relation de La Campagne D'afrique-1830Belhamissi100% (1)
- Histoire de La Tunisie - WikipédiaDocument29 pagesHistoire de La Tunisie - Wikipédiazainouba_indusPas encore d'évaluation
- Les Civilisations de L'afrique Du Nord - BerbèresDocument422 pagesLes Civilisations de L'afrique Du Nord - BerbèresTarik BenchoukaPas encore d'évaluation
- Encyclopedie Berbere Volume 1Document116 pagesEncyclopedie Berbere Volume 1Ahmed Kabil100% (1)
- En Kabylie Voyage d'une Parisienne au DjurjuraD'EverandEn Kabylie Voyage d'une Parisienne au DjurjuraÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- ALGER AVANT LA CONQUÊTE-Eudj - Ali-1930Document205 pagesALGER AVANT LA CONQUÊTE-Eudj - Ali-1930Belhamissi50% (2)
- Géographie Économique de L'afrique Du Nord Selon Les Auteurs Arabes Du IXe Siècle Au Milieu Du XIIe Siècle - VanackerDocument45 pagesGéographie Économique de L'afrique Du Nord Selon Les Auteurs Arabes Du IXe Siècle Au Milieu Du XIIe Siècle - VanackerMehdi ElPas encore d'évaluation
- Histoire de La Langue Amzighe À AlgerDocument9 pagesHistoire de La Langue Amzighe À AlgerTasedlistPas encore d'évaluation
- Massinissa Le Grand AfricinDocument33 pagesMassinissa Le Grand AfricinMouloud Issaad0% (1)
- Histoire Du MaghrebDocument527 pagesHistoire Du MaghrebAmzraw Superamazigh Yugrtn100% (1)
- Habart Michel - Histoire D'un Parjure PDFDocument103 pagesHabart Michel - Histoire D'un Parjure PDFabdel1970100% (4)
- HISTOIRE ANCIENNE de l'AFRIQUE DU NORD-par Stéphne Gsell-Tome 2Document469 pagesHISTOIRE ANCIENNE de l'AFRIQUE DU NORD-par Stéphne Gsell-Tome 2Belhamissi100% (1)
- 1893 Linares Voyage Au TafilaletDocument60 pages1893 Linares Voyage Au TafilaletAsafar Lihi75% (4)
- Histoire Des BerberesDocument21 pagesHistoire Des BerberesKhaled SghaierPas encore d'évaluation
- Liste Des Livres Sur La Guerre D'algerieDocument250 pagesListe Des Livres Sur La Guerre D'algeriedjamel eddine tebbiPas encore d'évaluation
- Les Berbères Entre Maghreb Et Mashreq (Viie-Xve Siècle) (Dominique Valérian)Document280 pagesLes Berbères Entre Maghreb Et Mashreq (Viie-Xve Siècle) (Dominique Valérian)amine churaPas encore d'évaluation
- Liste D'ouvrages Et Livres Sur Le MarocDocument12 pagesListe D'ouvrages Et Livres Sur Le MarocAhmed KabilPas encore d'évaluation
- L'histoire Du MarocDocument377 pagesL'histoire Du MarocAmi Ine100% (1)
- Histoire Ancienne de L'afrique Du NordDocument52 pagesHistoire Ancienne de L'afrique Du Nordmetu sea100% (2)
- HISTOIRE ANCIENNE de l'AFRIQUE DU NORD-par Stéphne Gsell-Tome 3Document417 pagesHISTOIRE ANCIENNE de l'AFRIQUE DU NORD-par Stéphne Gsell-Tome 3BelhamissiPas encore d'évaluation
- Berberie Tome IIIDocument577 pagesBerberie Tome IIIsofiane1963100% (1)
- Les Numides Et La Civilisation PuniqueDocument12 pagesLes Numides Et La Civilisation PuniqueJames Gutierrez100% (1)
- Le Maghreb Medieval 11e-15e SDocument174 pagesLe Maghreb Medieval 11e-15e SWalid BeddiafPas encore d'évaluation
- Algérie Vers Le Cinquantenaire de LindépendanceDocument282 pagesAlgérie Vers Le Cinquantenaire de LindépendanceÉmir DirtymindPas encore d'évaluation
- TunisieDocument38 pagesTunisieRihab ChattaPas encore d'évaluation
- Arts de la Perse: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandArts de la Perse: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Histoire de l'Afrique Septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête française (1830) ( Volume I)D'EverandHistoire de l'Afrique Septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête française (1830) ( Volume I)Évaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (2)
- Pour une poignée de terre: Du combat des Pieds-Noirs d'Algérie à la construction de la MéditerranéeD'EverandPour une poignée de terre: Du combat des Pieds-Noirs d'Algérie à la construction de la MéditerranéePas encore d'évaluation
- Algérie, France, ce qu’il faut savoir: 65 questions-réponses pour comprendre la guerre d’Algérie et ses conséquences actuellesD'EverandAlgérie, France, ce qu’il faut savoir: 65 questions-réponses pour comprendre la guerre d’Algérie et ses conséquences actuellesPas encore d'évaluation
- Femmes politiques au Maroc d'hier à aujourd'hui: La résistance et le pouvoir au fémininD'EverandFemmes politiques au Maroc d'hier à aujourd'hui: La résistance et le pouvoir au fémininPas encore d'évaluation
- Amérindiens d’Amérique du Nord: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAmérindiens d’Amérique du Nord: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Assyrie: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAssyrie: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Histoire de la Chine jusqu'en 1949: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandHistoire de la Chine jusqu'en 1949: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Wassila Bourguiba. Entretiens À Carthage de Novembre 1972 À Mars 1973Document192 pagesWassila Bourguiba. Entretiens À Carthage de Novembre 1972 À Mars 1973testimony100% (2)
- Eclairage Sur Les Recoins Sombres de L'ére Bourguibienne Bechir TurkiDocument200 pagesEclairage Sur Les Recoins Sombres de L'ére Bourguibienne Bechir TurkitestimonyPas encore d'évaluation
- Lumiéres Sur Les 40 Quarantes Hadiths NawawiDocument298 pagesLumiéres Sur Les 40 Quarantes Hadiths Nawawitestimony100% (1)
- Islam Et Economie - Abdul Hadi Gafouri (PDF Text)Document357 pagesIslam Et Economie - Abdul Hadi Gafouri (PDF Text)testimonyPas encore d'évaluation
- Ebook - Histoire Generale de La Tunisie Tome 2Document475 pagesEbook - Histoire Generale de La Tunisie Tome 2Amd Lo100% (1)
- Dictionnaire de L'astronomie Et de L'espace (PDF Text)Document539 pagesDictionnaire de L'astronomie Et de L'espace (PDF Text)testimony100% (4)
- Mémoire:Corruption :causes Théoriques Et Analyses Quantitative de Quelques Conséquences Dans Les PVDDocument27 pagesMémoire:Corruption :causes Théoriques Et Analyses Quantitative de Quelques Conséquences Dans Les PVDtestimony100% (1)
- Encyclopédie Des Mystiques II Marie-Madelaine Davy - PDF ImageDocument675 pagesEncyclopédie Des Mystiques II Marie-Madelaine Davy - PDF Imagetestimony100% (1)
- Physiocratie Ou Constitution Naturelle DupontDocument298 pagesPhysiocratie Ou Constitution Naturelle DuponttestimonyPas encore d'évaluation
- L'École Des CadavresDocument179 pagesL'École Des Cadavresjakewallace100% (2)
- La Femme en Islam - KardhawiDocument110 pagesLa Femme en Islam - KardhawitestimonyPas encore d'évaluation
- Les Femmes Dans Le Recit CoraniqueDocument141 pagesLes Femmes Dans Le Recit CoraniqueDIABAGATE APas encore d'évaluation
- Les Trous Noirs de La Science Économique Jacques SapirDocument336 pagesLes Trous Noirs de La Science Économique Jacques Sapirtestimony100% (3)
- Sytéme Theologique de LeibnitzDocument224 pagesSytéme Theologique de LeibnitztestimonyPas encore d'évaluation
- Essai Sur Les Fondements de Nos Connaissance Et Les Caractéres de La Critique Philosophique Tome2-Cournot Antoine Saint AugustinDocument439 pagesEssai Sur Les Fondements de Nos Connaissance Et Les Caractéres de La Critique Philosophique Tome2-Cournot Antoine Saint AugustintestimonyPas encore d'évaluation
- Celine Louis-Ferdinand - A L Agite Du BocalDocument6 pagesCeline Louis-Ferdinand - A L Agite Du Bocaltestimony100% (3)
- Delcroix Eric - Le Theatre de SatanDocument254 pagesDelcroix Eric - Le Theatre de SatantestimonyPas encore d'évaluation
- Essai Sur Les Fondements de Nos Connaissance Et Les Caractéres de La Critique Philosophique Tome1-Cournot Antoine Saint AugustinDocument414 pagesEssai Sur Les Fondements de Nos Connaissance Et Les Caractéres de La Critique Philosophique Tome1-Cournot Antoine Saint AugustintestimonyPas encore d'évaluation
- A Nous La France !Document93 pagesA Nous La France !Isaac Blümchen88% (8)
- TP 6 Shared Pref ISIDocument7 pagesTP 6 Shared Pref ISIGtfPas encore d'évaluation
- Rapport Annuel 2016 de l'UNICEFDocument84 pagesRapport Annuel 2016 de l'UNICEFUNICEFPas encore d'évaluation
- LES TROUBLES DU LANGAGe Cours 3Document3 pagesLES TROUBLES DU LANGAGe Cours 3roroririazPas encore d'évaluation
- Dyspnée Laryngée - Complement A L - ED - A Lire Car CA Resume La Reference Et Couvre Les ObjectifsDocument22 pagesDyspnée Laryngée - Complement A L - ED - A Lire Car CA Resume La Reference Et Couvre Les ObjectifsGeorges BakhosPas encore d'évaluation
- D00132Document2 pagesD00132Asia SentinelPas encore d'évaluation
- Chantal - 20 3 2007Document3 pagesChantal - 20 3 2007yassinaaroch6Pas encore d'évaluation
- Outils Black Belt 2Document12 pagesOutils Black Belt 2formation MagpharmPas encore d'évaluation
- Planification À Moyen TermeDocument5 pagesPlanification À Moyen Termehouda makhloufyPas encore d'évaluation
- Cours Aires Et Perimetres 1college 2Document10 pagesCours Aires Et Perimetres 1college 2mabchourabdellahhPas encore d'évaluation
- Pithiviers Et Galette Des RoisDocument2 pagesPithiviers Et Galette Des RoisBenjamin GevoldePas encore d'évaluation
- Les Questions A1Document3 pagesLes Questions A1batulPas encore d'évaluation
- 00 - Notes de Cours Semaine 02Document35 pages00 - Notes de Cours Semaine 02AdjoumaPas encore d'évaluation
- Mon Inventaire Spirituel: Je FaisDocument13 pagesMon Inventaire Spirituel: Je FaisDivine KaliPas encore d'évaluation
- Avis 2:15Document44 pagesAvis 2:15Viviane Gamond-RiusPas encore d'évaluation
- TD5 Marketing StratégiqueDocument2 pagesTD5 Marketing StratégiqueayaPas encore d'évaluation
- Cornelius Castoriadis - La Montee de L'insignifianceDocument10 pagesCornelius Castoriadis - La Montee de L'insignifianceclaudinhotavaresPas encore d'évaluation
- 2 ORIGINE Carnet SavoirDocument56 pages2 ORIGINE Carnet Savoirriverdale9669unicornioPas encore d'évaluation
- Caces Plates-Formes Élévatrices Mobiles de Personnel: Certificat D'aptitude À La Conduite en Sécurité DesDocument44 pagesCaces Plates-Formes Élévatrices Mobiles de Personnel: Certificat D'aptitude À La Conduite en Sécurité DesArsène TIA MANPas encore d'évaluation
- Libretto La Bohème de PucciniDocument45 pagesLibretto La Bohème de Puccinimarina DigimPas encore d'évaluation
- 5S - Audit - Check-List (2) FRDocument3 pages5S - Audit - Check-List (2) FRkhelladif9Pas encore d'évaluation
- Electronique Numérique-SMP-S6 Seance 1Document28 pagesElectronique Numérique-SMP-S6 Seance 1imanemaster5Pas encore d'évaluation
- Option 3GII 2022-2023Document3 pagesOption 3GII 2022-2023Youssef ElfekihPas encore d'évaluation
- Égalité Professionnelle Femme/Homme en Afrique: Défis Et PerspectivesDocument302 pagesÉgalité Professionnelle Femme/Homme en Afrique: Défis Et PerspectivessergesofonnPas encore d'évaluation
- Granulométrie de Poudre de MaltitolDocument18 pagesGranulométrie de Poudre de MaltitolNihel FarroukhPas encore d'évaluation
- Travaux Dirigés 1Document4 pagesTravaux Dirigés 1riahimelek6Pas encore d'évaluation
- CPS - Piste ROUACHEDDocument61 pagesCPS - Piste ROUACHEDYasmine RachidPas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D'année Sur La SuperhydrophobieDocument40 pagesMémoire de Fin D'année Sur La SuperhydrophobieJules Simonin100% (1)
- Introducti: Algorithme Pour La Conduite D'une Étude ProspectiveDocument11 pagesIntroducti: Algorithme Pour La Conduite D'une Étude Prospectiveamara camaraPas encore d'évaluation