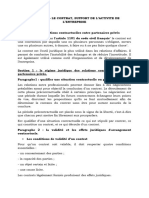Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Macroéconomie
La Macroéconomie
Transféré par
matusjuanTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Macroéconomie
La Macroéconomie
Transféré par
matusjuanDroits d'auteur :
Formats disponibles
Tantely Randriamitantsoa : Fiches dEconomie
macroconomie
1
PRSENTATION
macroconomie, discipline de la science conomique qui tudie le comportement des agrgats, tels que le produit national brut (PNB), le revenu, le taux de chmage, la balance des paiements ou le taux dinflation. La macroconomie tudie la formation du revenu national travers celle de ses composantes : la consommation, linvestissement, les dpenses publiques et les changes avec ltranger. Elle se distingue de la microconomie, qui analyse les choix individuels des agents conomiques considrs comme rationnels pour expliquer la formation des prix. La thorie macroconomique est ne avec les travaux de John Maynard Keynes dans les annes 1930. Elle se concentre sur ltude de trois marchs : celui des biens et services, celui de la monnaie et celui du travail. La porte ventuelle des politiques budgtaires pour stabiliser lconomie et lorienter vers un plein emploi sans inflation figure galement en bonne place dans toute analyse macroconomique. Ces analyses sont le plus souvent normatives (dcrivant ce qui devrait tre) que positives (expliquant ce qui est rellement) : il existe donc plusieurs courants (nokeynsiens, montaristes, noclassiques, conomistes de loffre).
KEYNSIANISME ET CLASSICISME
Les modles classiques excluaient tout rle dune dficience de la demande globale sur le march des biens et services. Ils postulaient en effet que tout cart entre lpargne et linvestissement se rduisait automatiquement par une variation du taux dintrt, de sorte que si, par exemple, lpargne excdait linvestissement, les taux dintrt baisseraient. Cette baisse rduirait loffre dpargne et en mme temps encouragerait les entreprises emprunter de largent pour investir dans des machines, des btiments et du capital humain. Autrement dit, les variations des taux dintrt taient considres comme une force rgulatrice permettant dajuster le march global des biens et services de la mme manire que nimporte quel bien sajuste par un quilibre entre loffre et la demande. Le modle keynsien, au contraire, souligne lincidence rgulatrice des variations de revenu et de production. Si la demande est infrieure loffre, autrement dit si lpargne est suprieure linvestissement dsir, les entreprises vont modifier leur production (pour couler les invendus) et non faire varier leurs prix. Cet quilibre du revenu et de la production ne correspond pas ainsi ncessairement un niveau de production pour lequel la demande de travail est gale loffre, do limportance de pouvoir influer sur la demande globale. La thorie keynsienne, qui met laccent sur la demande en tant que facteur cl du niveau de production court terme, a permis deffectuer des progrs considrables dans lanalyse des facteurs dterminant les catgories de la demande finale, tels que la demande globale de consommation, envisage dans ses relations avec les niveaux de revenus et les taux dintrt pratiqus.
Randriamitantsoa Tantely : Fiches dconomie
Tantely Randriamitantsoa : Fiches dEconomie
La macroconomie sintresse galement aux autres composantes de la demande, telles que linvestissement effectif , par opposition linvestissement de portefeuille, qui naffecte quindirectement le niveau de la demande. Une autre composante majeure de la demande finale est la dpense publique. Enfin, parmi les composantes essentielles de la demande globale, la macroconomie doit galement prendre en compte le solde de la balance commerciale, cest--dire la diffrence entre exportations et importations, et les paramtres qui lui sont associs, notamment le taux de change. En effet, les exportations jouent le mme rle que la formation de capital pour la stimulation de la demande, et les importations sont assimilables une fuite dans le circuit des revenus, car elles satisfont la demande intrieure sans crer de revenus lintrieur du pays, alors que ces revenus pourraient tre recycls pour gnrer une nouvelle demande intrieure. La macroconomie est une modlisation de lconomie travers deux types dquations : les quations dquilibre sur les marchs o loffre est gale la demande et les quations de comportement par groupes dagents conomiques (mnages, entreprises etc.). partir de ces comportements, la macroconomie cherche dterminer lquilibre et les fluctuations. Selon lcole keynsienne, la rsorption des dsquilibres se fait par un ajustement des quantits, car celles-ci sadaptent plus vite que les prix. Lconomie keynsienne est par dfinition une conomie de sousemploi linverse du modle conomique privilgi par lanalyse classique o tous les marchs sont quilibrs et o il nexiste pas dajustement possible par les quantits. On distingue trois marchs (celui des biens et services, de la monnaie et du travail) et six variables (loffre et la demande globales, le niveau de lemploi, lindice des prix, la masse montaire et le solde des changes extrieurs).
FONCTION DE CONSOMMATION
On dtermine le comportement de consommation en cherchant savoir comment stablit le partage entre consommation et pargne quand le revenu national se modifie. Pour Keynes, la consommation augmente en mme temps que le revenu mais dans des proportions moindres. Autrement dit, une augmentation de production ne trouvera pas forcment de dbouchs. Cette thorie trouve son application dans les politiques de relance par la demande dites du multiplicateur, qui permettent, en augmentant les dpenses gouvernementales et donc la demande globale, daugmenter le revenu national.
FONCTION DINVESTISSEMENT
La macroconomie cherche ensuite dfinir par quoi est dtermin linvestissement. En situation de plein emploi des facteurs de production, seule la rmunration relle des facteurs est importante alors que, si lentreprise est confronte une contrainte sur ses ventes, ce seront le cot relatif et la demande anticipe qui seront dterminants. Ainsi, en cas de sous-emploi, la thorie de lacclrateur de Samuelson tablit quune augmentation de la demande anticipe relancera linvestissement.
OFFRE ET DEMANDE DE MONNAIE
Randriamitantsoa Tantely : Fiches dconomie
Tantely Randriamitantsoa : Fiches dEconomie
Selon la vision classique, il nexiste pas dinfluence de la sphre relle de lconomie sur la sphre montaire. La thorie montaire occupe en revanche une place centrale dans la thorie keynsienne, o elle a donn lieu de vives controverses. Pour Keynes, les taux dintrt sont dans une large mesure un phnomne montaire, et leur fonction essentielle dans un monde dincertitudes est dquilibrer loffre et la demande de monnaie, plutt que lpargne et linvestissement anticips. Cette fonction de la monnaie expliquerait les variations considrables de la propension la thsaurisation pour un taux dintrt donn, et par consquent de la vitesse de circulation de la monnaie. Cette importance accorde aux facteurs court terme des taux dintrt contraste avec la conception traditionnelle selon laquelle les taux dintrt sont dtermins long terme par les forces relles de la productivit et de lpargne. La conception de Keynes reflte sa proccupation pour le court terme, et de nombreux conomistes conviennent qu long terme la moyenne des taux dintrt rels, corrige des distorsions causes par linflation ou la fiscalit, tend se rapprocher du taux de profit rel long terme du capital investi. linverse, se fondant sur lide que la demande de monnaie est lie de faon stable au niveau de richesse, certains auteurs ont soutenu quun accroissement de la masse de monnaie en circulation tendait faire baisser les taux dintrt, ce qui contribuait stimuler linvestissement et donc la demande globale. Par consquent, un autre moyen de rduire le chmage consisterait favoriser un accroissement de la masse montaire. Pourtant, et bien que les points de vue soient trs partags sur la manire dont la monnaie affecte lconomie, les partisans du montarisme seraient sans doute unanimes pour affirmer que de telles mthodes ne pourraient augmenter la production que temporairement, pour la simple raison quune augmentation de la masse montaire, toutes choses gales par ailleurs, finirait par provoquer de linflation. Pour certaines coles, notamment celles qui font appel lhypothse des anticipations rationnelles , les agents conomiques finiraient par sapercevoir du lien existant entre la masse montaire et le niveau des prix, de telle sorte quune tentative de rduction du chmage par laccroissement de la masse montaire ne produirait pas mme un rsultat court terme.
QUILIBRE DU MARCH DU TRAVAIL
Les modalits dajustement sur le march du travail font lobjet dune attention particulire. Jusqu la publication en 1936 de la Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie de John Maynard Keynes, on expliquait le chmage grande chelle par une rigidit du march du travail empchant les salaires de descendre un niveau tel que le march soit en quilibre . Lide qui sous-tendait ce modle tait quen cas de chmage grande chelle la pression des personnes la recherche dun emploi ferait baisser les salaires un point tel que, dune part, certains se retireraient du march (loffre de travail diminuerait) et que, dautre part, les employeurs chercheraient embaucher davantage, car le bas niveau des salaires accrotrait la rentabilit dembauches supplmentaires. Si des rigidits empchaient les salaires de descendre jusquau point dquilibre auquel la demande et loffre de travail deviennent gales, le chmage persisterait.
Randriamitantsoa Tantely : Fiches dconomie
Tantely Randriamitantsoa : Fiches dEconomie
Ces rigidits, qui empcheraient de parvenir un niveau de salaires permettant une compensation de loffre et de la demande de travail, sont par exemple imputes laction des syndicats pour maintenir un salaire minimal ou lexistence dune lgislation contraignante sur les salaires. La plus grande innovation de Keynes a t de montrer que le chmage permanent pouvait avoir pour cause une dficience de la demande adresse la production plutt quun dsquilibre du march du travail. De plus, une rduction des salaires dans une telle situation ne serait daucun secours pour rsorber le chmage. Keynes ne fut pas le premier conomiste expliquer le chmage en termes dinsuffisance globale de la demande sur le march des biens et, comme il le reconnut luimme, Malthus, parmi dautres, avait dj propos une explication similaire dans le pass. lpoque de Keynes et tout fait indpendamment de lui, lconomiste polonais Michal Kalecki proposa une thorie trs proche de la thorie keynsienne, que lon retrouve galement chez le Sudois Karl Gunnar Myrdal. La rvolution keynsienne consistait en fait faire admettre que, selon la terminologie macroconomique, le march des biens peut constituer un quilibre de sous-emploi , dans la mesure o il nassure pas lquilibre du march de lemploi. Cest pourquoi sur le march du travail, le nombre de travailleurs embauchs par les employeurs natteint pas le niveau qui serait profitable ces derniers si la demande avait correspondu leur production. Le concept dquilibre de sous-emploi et les concepts qui lui sont lis, comme celui de demande rationne de travail , furent largement dvelopps dans les annes qui suivirent.
DILEMME INFLATION-CHMAGE
aprs la Seconde Guerre mondiale, on a divis de faon
Pendant plusieurs dcennies
conventionnelle les thories sur linflation en thories de linflation par la demande et thories de linflation par les cots . Alors que cette dernire insiste sur le rle des hausses excessives de salaires par rapport aux hausses de productivit dans linflation continue, la premire tend attribuer plutt linflation une demande excessive sur le march des biens. Lanalyse de Phillips (labore dans les annes 1950) est devenue un concept central de la thorie de linflation. Elle montre quil existe une relation inverse entre taux dinflation et taux de chmage car le taux de salaire augmente (et les prix par contrecoup) quand le chmage est faible. Dans la mesure o lexistence dune relation stable de ce type peut tre tablie, cela suggre que la socit doit choisir entre diverses combinaisons de taux dinflation et de niveau de chmage. Cette conclusion a t infirme dans les annes 1970 par le phnomne de stagflation
(augmentation simultane du chmage et de linflation). Milton Friedman la alors expliqu par le fait que les agents forment des anticipations dinflation qui rendent la relation de Phillips instable. Paralllement, de nombreux conomistes mettent en doute lexistence dune relation stable entre chmage et niveau rel des salaires, et donc de celle dun taux naturel du chmage . Enfin, certains conomistes croient bien en un taux naturel du chmage , mais considrent que ce taux varie en permanence.
MACROCONOMIE CONTEMPORAINE
Randriamitantsoa Tantely : Fiches dconomie
Tantely Randriamitantsoa : Fiches dEconomie
Au cours des dernires dcennies, des approfondissements ont t apports la thorie keynsienne. Par exemple, bien que limportance de la rigidit des salaires ne fasse pas lunanimit, il est devenu beaucoup plus facile de lexpliquer sans avoir recours au comportement des syndicats ou la lgislation. Il semblait au dpart difficile de rconcilier la notion de rigidit salariale avec le postulat habituel des conomistes, pour lesquels les agents conomiques recherchent une utilit maximale et sont donc prts accepter un salaire moindre pour obtenir du travail. Nanmoins, cela est devenu plus facile ds lors que lon a largi la gamme des variables relatives cette utilit maximale jusqu y englober la recherche dun emploi oriente vers une maximisation du bien-tre long terme, ou encore des variables sociologiques ou psychologiques comme la loyaut. Un autre lment important, apparu rcemment dans la thorie macroconomique moderne trouve ses racines dans limportance quaccorde Keynes lincertitude du comportement conomique. Il sagit de lanalyse des lacunes dinformation dans lexplication du chmage comme agrgat, laquelle on relie certains lments de la thorie des jeux. Par exemple, des entreprises pourraient trouver souhaitable dembaucher plus de main-duvre si elles taient sres que les autres entreprises en fassent autant, car elles pourraient ainsi esprer que laccroissement du montant global des salaires qui en rsulterait entranerait une hausse de la demande globale et donc de la demande pour leurs propres produits. Labsence dans lconomie dun mcanisme permettant une dcision collective entrane un point dquilibre infrieur qui nest pas sans rappeler le dilemme du prisonnier , chaque socit dcidant individuellement de consolider ses propres profits, alors quune mise en commun de linformation et de la dcision aurait permis un plus grand bnfice commun pour toutes. Dautres thories du march du travail contribuent mieux faire comprendre comment fonctionne le march de lemploi. Cest le cas par exemple de la thorie des marchs internes du travail , qui met en lumire le conflit dintrt opposant ceux qui nont pas de travail et ceux qui en ont, ces derniers tant en mme temps ceux qui ngocient les salaires. Les thories macroconomiques constituent la base des grands modles utiliss dans les prvisions conomiques de la production, de lemploi et de diverses autres variables. Au cours de ces dernires annes, ces prvisions se sont montres trs dcevantes, et la recherche des sources derreur a conduit des rvisions rptes des modles de base ainsi qu des raffinements de la thorie. Par exemple, on accorde aujourdhui davantage dattention aux rles du crdit la consommation et de la richesse pour dterminer les comportements dpargne et de consommation, ainsi quau rle des anticipations parfois capricieuses des agents conomiques. Microsoft Encarta 2007. 1993-2006 Microsoft Corporation. Tous droits rservs.
Randriamitantsoa Tantely : Fiches dconomie
Vous aimerez peut-être aussi
- 06 Pratique Et Controle de La Paie PDFDocument38 pages06 Pratique Et Controle de La Paie PDFsid100% (2)
- Support de Cours Gestion de Production 2022.2023Document242 pagesSupport de Cours Gestion de Production 2022.2023Oussama Elkadouri100% (1)
- Contrat Travail ToppppDocument4 pagesContrat Travail ToppppjeffPas encore d'évaluation
- Théorie PopulationnisteDocument1 pageThéorie PopulationnistematusjuanPas encore d'évaluation
- Fin Du Contrat de TravailDocument59 pagesFin Du Contrat de TravailAhmed HaouariPas encore d'évaluation
- La Politique ÉconomiqueDocument3 pagesLa Politique ÉconomiquematusjuanPas encore d'évaluation
- Rapport FormuléDocument36 pagesRapport FormuléFatima ZahraPas encore d'évaluation
- Théorie de La Pression CréatriceDocument1 pageThéorie de La Pression CréatricematusjuanPas encore d'évaluation
- Théorie Des Cycles D'easterlinDocument1 pageThéorie Des Cycles D'easterlinmatusjuanPas encore d'évaluation
- Théorie de L'optimum de PopulationDocument1 pageThéorie de L'optimum de PopulationmatusjuanPas encore d'évaluation
- Théorie Marxiste de La PopulationDocument1 pageThéorie Marxiste de La PopulationmatusjuanPas encore d'évaluation
- Théorie Des Migrations Dans Le Cadre Du Dualisme Du Marché Du TravailDocument1 pageThéorie Des Migrations Dans Le Cadre Du Dualisme Du Marché Du TravailmatusjuanPas encore d'évaluation
- Théorie de L'équilibre GénéralDocument1 pageThéorie de L'équilibre GénéralmatusjuanPas encore d'évaluation
- Théorie de La Capture Ou Économie Positive de La RéglementationDocument1 pageThéorie de La Capture Ou Économie Positive de La RéglementationmatusjuanPas encore d'évaluation
- Théorie de La Coalition MinimaleDocument1 pageThéorie de La Coalition MinimalematusjuanPas encore d'évaluation
- Théorie Du Gaspillage BureaucratiqueDocument1 pageThéorie Du Gaspillage BureaucratiquematusjuanPas encore d'évaluation
- Randriamitantsoa Tantely: Fiche 13Document4 pagesRandriamitantsoa Tantely: Fiche 13matusjuanPas encore d'évaluation
- Randriamitantsoa Tantely: Fiche 6Document2 pagesRandriamitantsoa Tantely: Fiche 6matusjuanPas encore d'évaluation
- Randriamitantsoa Tantely: Fiche 7Document8 pagesRandriamitantsoa Tantely: Fiche 7matusjuanPas encore d'évaluation
- Randriamitantsoa Tantely: Fiche 10Document1 pageRandriamitantsoa Tantely: Fiche 10matusjuanPas encore d'évaluation
- Randriamitantsoa Tantely: Fiche 15Document1 pageRandriamitantsoa Tantely: Fiche 15matusjuanPas encore d'évaluation
- La MicroéconomieDocument4 pagesLa MicroéconomiematusjuanPas encore d'évaluation
- Randriamitantsoa Tantely: Fiche 15Document1 pageRandriamitantsoa Tantely: Fiche 15matusjuanPas encore d'évaluation
- Bordereau de Declaration Des SalariesDocument2 pagesBordereau de Declaration Des SalariesLouazna YoussefPas encore d'évaluation
- Chap 3 SesDocument16 pagesChap 3 Sesmaeline.gurnariPas encore d'évaluation
- Bulletin de SalaireDocument5 pagesBulletin de SalairediscipleofyehoshuaPas encore d'évaluation
- Guide Pratique Aide Au Reperage Illettrisme Web 2012 06-11-10!20!37 498Document43 pagesGuide Pratique Aide Au Reperage Illettrisme Web 2012 06-11-10!20!37 498Maximilien SanchezPas encore d'évaluation
- Hafta Le Secours Catholique RéfuteDocument5 pagesHafta Le Secours Catholique RéfuteBediha ÖztürkPas encore d'évaluation
- Aborder Les Principes Du Management BienveillantDocument8 pagesAborder Les Principes Du Management Bienveillantsamuel.chaberPas encore d'évaluation
- Fiche Formation MRHDocument2 pagesFiche Formation MRHNIDELLE ARSENE ANKENGPas encore d'évaluation
- Revue de Presse Du 9 Au 15 JanvierDocument5 pagesRevue de Presse Du 9 Au 15 JanvierMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Emergence OroccoDocument19 pagesEmergence OroccoNour SfraniPas encore d'évaluation
- Resultat Cap PDFDocument16 pagesResultat Cap PDFsouheil boussaidPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Le Contrat Support de L'activite de L EntrepriseDocument3 pagesChapitre 1 Le Contrat Support de L'activite de L EntrepriseAichadjijiPas encore d'évaluation
- Budget Masse SalarialeDocument15 pagesBudget Masse SalarialefzalyounePas encore d'évaluation
- TRANSCRIPT Jobs and Future PlansDocument2 pagesTRANSCRIPT Jobs and Future PlansJairo Echeverri BenedettiPas encore d'évaluation
- CP - Comprendre Son Compteur de Congés PayésDocument29 pagesCP - Comprendre Son Compteur de Congés PayésJean-ClaudeArnuelPas encore d'évaluation
- Cour D'appel de Besançon. Chambre Sociale 5 Juin 2012. No Répertoire Général - 11 01779Document6 pagesCour D'appel de Besançon. Chambre Sociale 5 Juin 2012. No Répertoire Général - 11 01779Gaspard da SanseverinoPas encore d'évaluation
- Concentration Et Spécialisation DesDocument44 pagesConcentration Et Spécialisation DesFakher HouassaPas encore d'évaluation
- Acta de Comite SSTDocument2 pagesActa de Comite SST1504ttonyPas encore d'évaluation
- P - RecrutementDocument5 pagesP - RecrutementChanel Pinelli SITAPas encore d'évaluation
- RISQUES ProfDocument2 pagesRISQUES ProfHicham Ed'dahmounyPas encore d'évaluation
- Exercice - AddohaDocument3 pagesExercice - AddohaKawtar BenkaddourPas encore d'évaluation
- 1 RHDocument18 pages1 RHYounesPas encore d'évaluation
- SDGN LP Chap5 OkDocument8 pagesSDGN LP Chap5 OktahaPas encore d'évaluation
- Cours 4 Outils de Recherche D'emploiDocument5 pagesCours 4 Outils de Recherche D'emploiAmina BELABIDPas encore d'évaluation
- TFC Steve UpcDocument29 pagesTFC Steve UpcAziarny Kaluta100% (1)
- 693644J Consultation Bulletins de Solde Antilop 2020 4 PDFDocument1 page693644J Consultation Bulletins de Solde Antilop 2020 4 PDFrichard faidaiPas encore d'évaluation