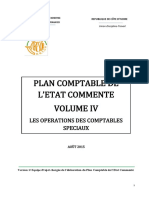Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Abossolo PDF
Abossolo PDF
Transféré par
Ibrahima DialloTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Abossolo PDF
Abossolo PDF
Transféré par
Ibrahima DialloDroits d'auteur :
Formats disponibles
n 3, Figures de ltranger dans les littratures francophones
Pierre Martial Abossolo
La rencontre de lOccidental et de lAfricain
dans le roman dAfrique francophone. Conflit
dtrangers et conflit dtrangets
Abstract: An examination of some post colonial novels and short stories
(Camara Layes Le Regard du roi, Etienne Yanous L Homme dieu de Bisso, Amadou
Kons Jusqu au seuil de lirrel and Mariama Bas Un Chant carlate) leads us to
postulate that in the situation of contact between western and african
civilizations, the feelings and frustrations the Africans experienced with the
painful spread of western civilization is also experienced with equal intensity by
those westerns who moved to Africa. In these works of art where both the
Africans and Africa based westerners contract, it is observed that in situations of
contact, that feeling of destruction and foreignness is created and borne by both
parties to similar degrees. In this regard, with the coming of western civilization,
the dramatic separation of the traditional african from this tradition can be
equated to the condition of the westerners whose convictions are challenged by
new and unfamiliar circumstances. In this paper therefore we identify the
different ideologies and convictions that are conflicting and then measure the
motivations and consequences of what finally results in contact conflict. And
finally we analyze the main issues postcolonial writers deal with in relation to the
conflict between western and african civilizations.
Keywords: Africa, West, conflict, civilization, foreignness
Rsum : En dnonant la colonisation, les critiques et auteurs africains de la
premire gnration ont surtout relev les effets que la colonisation a eus sur le
vcu africain. Or, on pouvait tout aussi dgager le phnomne inverse, cest--
dire un ensemble deffets que la vie africaine a produits dans le vcu de
lOccidental. En partant dun corpus de romans et nouvelles publis au
lendemain des indpendances (Le Regard du roi de Camara Laye, LHomme dieu de
Bisso dEtienne Yanou, Jusquau seuil de lirrel dAmadou Kon et Un Chant carlate
de Mariama B), nous pensons dans cette rflexion qui sinscrit dans la
problmatique de laltrit, pouvoir montrer que les sentiments et impressions
quon a pu dtecter chez lAfricain devant la douloureuse nouveaut occidentale
se vivent avec la mme intensit dans le vcu de lOccidental et de
lOccidentalis prsents en Afrique. Dans les textes littraires o circulent
personnages occidentaux et personnages africains, en effet, nous montrerons
quau contact de la nouveaut il sobserve dans chaque groupe, et dimensions
gales, des sentiments et des attitudes de dchirure et dtranget. En effet,
autant avec lavnement de la nouveaut occidentale, le dchirement de
La rencontre de lOccidental et de lAfricain dans le roman dAfrique
lAfricain traditionaliste arrach sa tradition se vit comme un drame, autant
lOccidental ou lOccidentalis voit ses convictions mises lpreuve face un
ensemble de ralits nouvelles qui chappent sa connaissance.
Mots cls : Afrique, altrit, Laye, Camara, Yanou, Etienne, Kon, Amadou, B,
Mariama, trangt, tranger, occidental, occidentalis.
A VEC LA REMONTE EN SURFACE DU PROBLME
migratoire conscutif au temps nouveau des grands
du flux
dplacements, produits de la mondialisation, la question de
la rencontre des cultures qui na cess dalimenter le dbat littraire
est devenue plus actuelle. Dans le contexte africain, les critiques et
auteurs de la premire gnration qui se donnaient pour mission
dexprimer le ras-le-bol de lAfricain face un systme colonial
considr comme un couteau plant au cur de la tranquillit
africaine ont surtout relev les effets dvastateurs que la
colonisation a eus sur le vcu africain. Or, on pouvait tout aussi
dgager le phnomne inverse, cest--dire un ensemble deffets
nfastes que la vie africaine a produits dans le vcu du colon, des
effets qui dpassent le seul sentiment dexotisme
quanthropologues et historiens ont souvent dgag dans lattitude
du colon devant la nouveaut africaine. En partant dun corpus de
romans et nouvelles publis au lendemain des indpendances, nous
pensons dans cette rflexion qui sinscrit dans la problmatique de
laltrit, pouvoir montrer que les sentiments et impressions quon
a pu dtecter chez lAfricain devant la douloureuse nouveaut
occidentale se vivent avec la mme intensit dans le vcu de
lOccidental prsent en Afrique. Dans les textes littraires o
circulent personnages occidentaux et personnages africains, en
effet, nous croyons pouvoir percevoir de part et dautre et
dimensions gales, des sentiments dtranget, de dchirure, de
frustration de la perte, et des attitudes de repli et de synthse face
la culture trangre. Ces sentiments finissent par gnrer une
confusion idologique gnrale conscutive au fait que chaque
groupe vit laction de lautre comme une tranget, un scandale et
surtout comme une menaante exprience qui dracine les
convictions anciennes. Lanalyse de tels sentiments et attitudes
exige que lon examine dabord les forces en prsence et leurs
convictions premires, que lon voit ensuite comment ces
convictions, dun ct comme de lautre, se heurtent la
nouveaut et quon tente de dgager en dernier lieu lenjeu dune
criture reprsentant laltercation des deux altrits dans le roman
africain.
Interfrancophonies - n3, 2010 2
Pierre Martial Abossolo
1. Les forces conflictuelles en prsence et leurs convictions
premires
Ce qui sobserve rapidement ds quon aborde un texte
africain o lOccident rencontre lAfrique cest cette espce de
conflit idologique qui amne voir comment chaque camp
sobstine faire valoir ses convictions. Que celles-ci soient remises
en question ou quelles soient acceptes, toujours est-il quau
dpart, ces convictions vibrent en opposition de phase et il est bien
difficile de simaginer comment nos deux camps peuvent
saccorder. Il y a dun ct une civilisation occidentale jalouse de
ses certitudes et de lautre une culture africaine dont les
convictions traditionalistes se veulent imperturbables. Et cest,
comme nous le verrons, de la dcouverte de lautre culture, de
ltranger, que natra le sentiment dtranget.
1.1 Une civilisation occidentale campe sur ses certitudes
Les lments de la civilisation occidentale dont sont jaloux et
intimement lis les Occidentaux et occidentaliss des textes que
nous exploitons et qui font face la nouveaut africaine sont de
plusieurs ordres. On retiendra ici le rationalisme et
lindividualisme, traits de civilisation qui tranchent avec la vision du
monde magico-religieuse de lAfricain et avec son mode de vie
communautaire.
Au sujet du rationalisme, les tres qui arrivent en Afrique ont
t forms et mouls par un systme de pense qui dissocie la
ralit explicable et dautres catgories de ralits non
objectivement intelligibles. Le rationalisme svertue en effet
rejeter de sa sphre un vaste champ de phnomnes dsigns
comme paranormaux. Il stipule que non seulement le monde est
passible dexploration scientifique, mais seule lexploration
scientifique a droit au titre [...] de connaissance (G. Durand,
1964 : p. 25). Cette vision du monde est perceptible dans nos
textes. Dans un roman comme LHomme dieu de Bisso, labb
Voulana, prtre africain fait valoir son scientisme: Elev dans la
logique cartsienne, il nadmettait pas sans preuve quun tre pt se
transformer en animal (Yanou, 1984 : 16). La prtendue existence
dun homme-panthre nest daprs lui quune invention sans
fondement. Dans la mme uvre, le forestier Franais M. Delange
sattaque larbre sacr qui, dit-on, porte le destin de la tribu et est
le gardien des biens. Un peu comme le Pre Joseph de La Carte
didentit de Jean-Marie Adiaffi qui sacharne brler les ftiches,
rcolter les statuettes, les masques sacrs pour meubler son
Interfrancophonies - n3, 2010 3
La rencontre de lOccidental et de lAfricain dans le roman dAfrique
salon (J-M. Adiaffi, 1981 : p. 85), le forestier considre ces
croyances comme des bobards (Yanou : p. 74) puisquelles
relvent selon lui de la pure superstition. Dans Jusquau seuil de
lirrel, imbu de ses convictions rationalistes, le commandant Blanc
rejette le discours que lui tient son boy au sujet de la sorcellerie, et
particulirement du boto , nuage de sauterelles que les sorciers
peuvent envoyer leur guise sur les champs. Sa raction est sans
quivoque devant les propos du jeune Africain: Mon pauvre ami,
la sorcellerie nexiste mme pas. Vous tes tous trs superstitieux,
voil tout (A. Kon, 1976 : p. 81).Ces convictions sexpliquent par
le fait quen Occident, le rapport au surnaturel depuis Descartes se
prsente de telle sorte que tout ce qui ne peut sexpliquer par la
Raison est relgu au rang de fausset et de superstition
mensongre et mis au compte des chimres, dillusions voire de la
folie. Ce qui a fait dire Gilbert Durand qu lavnement du
Rationalisme, certains savoirs empiriques ont t rejets par
lobjectivisme analytique [] du ct des superstitions, des erreurs
et des faussets (G. Durand, 1980 : p. 44). Ce rejet et cette
ignorance des ralits non objectivement explicables font que
lOccidental se retrouve souvent comme un jouet de circonstances
victime de machinations et de manipulations surnaturelles. La
preuve : dans Le Regard du roi, on saperoit par exemple que
lhomme blanc ne sapercevait de rien, et quil ne pouvait
sapercevoir de rien, car chaque pouse, en entrant dans sa case,
dposait la tte du lit une gerbe de fleurs forestires ; lodeur
aussitt se rpandait et rendait lhomme blanc inconscient (C.
Laye, 1954 : p. 159). Comment pouvait-il en tre autrement quand
on sait quen Afrique, un homme blanc ne peut pas tout voir ; et
il na pas non plus besoin de tout voir, car ce pays nest pas un
pays de blancs (p. 87). Il apparat donc logique que pour les
personnages occidentaux, certaines pratiques suscitent doute,
mfiance, voire condamnation et correspondent cette espce
dtat desprit qui se berce en des rites mcaniques et quotidiens ou
qui sengourdit dans limmobilisme et la tradition (J. Achiriga,
1978 : p. 34).
Lindividualisme, trait pertinent de la civilisation occidentale
sincarne dans le personnage de Mireille de Un chant carlate. Son
attitude semble aller lencontre de la vie communautaire
africaine : elle supporte mal les visites rptes et injustifies de sa
belle-mre et des amis de son mari. Cest pourquoi il est dit delle
quelle nenrichit pas (la) famille. Elle lappauvrit en sapant son
unit. Elle ne sintgre pas dans la communaut. Elle sisole et
entrane dans son vasion son poux [...] La Blanche manie son
homme comme un pantin. Son mari reste sa proprit [...]. Rien ne
Interfrancophonies - n3, 2010 4
Pierre Martial Abossolo
va la belle-famille (Ba, 1981 : p. 112). Cest prcisment ce qui
loppose son nouvel entourage africain et qui fait quelle se sente
branle dans ses conceptions les plus solides et les plus intimes
(p. 152). Dans Jusquau seuil de lirrel, le commandant privilgie la
culture conomique des arachides la culture communautaire
laquelle sont habitus les villageois, ce qui ne manque pas de
provoquer la rvolte des villageois. Dans LHomme dieu de Bisso, M.
Delange avoue ignorer la tribu de Bisso, faisant fi des propos
dun traditionaliste qui se demande ce que peut bien signifier le
salut dun individu si la tribu est appele disparatre (Yanou: p.
37-38). Ces exemples montrent quel point la vie traditionnelle
communautaire est ignore par des personnages occidentaux qui se
retrouvent subitement face un mode de vie inconnu quil faudra
dsormais affronter ou intgrer.
En observant comment les traits culturels et idologiques
occidentaux se veulent solides et inbranlables, on peut
comprendre pourquoi la rencontre de lEtranger, de lAfricain va
constituer une espce dlectrochoc. Ceci dans la mesure o,
comme on le verra, lAfricain reste enracin dans un
traditionalisme qui considre toute infiltration trangre comme un
affront.
1.2 Une civilisation africaine imbue de sa tradition
Lhomme Noir vit daprs une tradition laquelle il est
intimement li. Du fait de sa philosophie, de sa religion, de son
histoire et de son extrme sensibilit au rythme, il se singularise et
marque une certaine aversion pour tout lment susceptible de
fragiliser cette tradition. Il regarde ainsi tout acte de ltranger
comme un sacrilge, un scandale qui tranche avec lordre
traditionnel. On peut voir ces convictions dans la manire de vivre
ses croyances et dans son option de vie communautaire.
Au sujet des croyances, lAfricain est encore largement
enracin dans la culture traditionnelle. Cette tradition est
troitement lie la civilisation ancestrale o, comme lobserve
Jacques Chevrier, le rel nacquiert son paisseur, ne devient
vrit quen slargissant aux dimensions extensibles du surrel (J.
Chevrier, 1990 : p. 60). Nous sommes dans un univers o les
interventions surnaturelles ne surprennent personne : on les
attend. Elles vont de soi (M. Schneider, 1985 : p. 16). Et dans les
textes o lOccident rencontre lAfrique, les auteurs mettent
souvent lOccident face un certain nombre de ralits magico-
religieuses qui ne saccommodent pas des convictions rationalistes
occidentales. Ils mettent de ce fait sur pied une criture qui fait
Interfrancophonies - n3, 2010 5
La rencontre de lOccidental et de lAfricain dans le roman dAfrique
tat, comme le dit Sunday O. Anozie, des croyances (des
Africains) et de leur participation la magie, la sorcellerie, et aux
autres aspects du spiritualisme traditionnel . (S.O. Anozie, 1970 :
p. 28). Dans nos textes, nombreuses sont les situations o le
surnaturel intervient sans heurts dans la vie quotidienne de
lAfricain, la grande surprise des personnages cartsiens . On
peut numrer quelques exemples : dans Un chant carlate, lusage
dans un hpital moderne des arbres mystiques pinth et ndeup et
lexploitation de la science des bilodja, sorciers qui ont perdu le
pouvoir de tuer (M. B : p. 219), choses qui font sourire la
Blanche Mireille; dans LHomme dieu de Bisso, le ddoublement de
certains hommes en chouettes; dans Jusquau seuil de lirrel, la
mtamorphose de Kountanl un homme que (tout le village)
connaissait trs bien (Kon : p. 82), en hyne ; dans Le Regard du
roi, lexistence des femmes-poissons et de serpents familiers
dans la vie quotidienne des hommes. Des ralits comme celles-l
se vivent au grand jour et ne surprennent personne, chose qui
entre en conflit avec le mode de pense rationaliste que nous
avons analys. Jean Marie Adiaffi a expliqu ce penchant pour le
surnaturel quil juge ncessaire la matrise de lunivers:
Si ces faits sont pour le Blanc des histoires dormir debout,
[...] il est indniable quon trouvait, parmi les anciens,
quelques cas trs srieux de ceux qui dtenaient un pouvoir
surnaturel qui leur permettait de raliser des exploits, des
choses miraculeuses [...].
Il nest pas stupide de penser que le Noir a essay, lui, de
senfoncer le plus profondment possible dans la
connaissance de la surnature pour en connatre galement
les lois et en tre matre. (J. M. Adiaffi : p. 140-141).
Au sujet de la vie communautaire, il se trouve que dans les
textes que nous exploitons, il y a un certain collectivisme qui exclut
toute attitude qui va lencontre de lesprit du groupe. Chez
Yanou comme chez Laye, B et Kon, la communaut est le seul
cadre de rfrence et rien ne vit en dehors delle. Tous ceux,
comme Voulana, Lamine et Ticnci qui sexcluent du groupe sont
punis par les hommes ou par les anctres. Donc, en dehors du
groupe, ltre na plus aucun pouvoir et est vou la perte, de
mme que, comme le constate Bernard Mouralis : la vie ne semble
plus avoir un got (B. Mouralis, 1984 : p. 92). Cest pourquoi dans
un roman comme Un chant carlate, le hros Ousmane coute avec
fidlit les voix accordes des valeurs traditionnelles, dictant,
imprieuses, les droits de la vie collective (B : p. 56). Un
exemple de ce mode de vie se trouve dans la manire de manger:
Les repas taient toujours servis dans un grand plat en aluminium
Interfrancophonies - n3, 2010 6
Pierre Martial Abossolo
usage commun, pos au milieu dune natte qui, replie, regagnait
un coin la propret douteuse. Leau qui servait se laver les
mains noircissait aprs le premier usager. Cela nempchait pas
dautres plongeons de mains (p. 124). Un autre exemple est
donn dans les visites inattendues et rptes des amis. Ceux-ci
sintroduisaient dans la maison comme pour une visite au Zoo
(p. 125), de quoi renverser Mireille, oblige de se faire violence
pour adopter provisoirement un mode de vie communautaire qui
lirritait (Idem), tandis que son mari, lAfricain, affirmait
mordicus qu il ntait pas question [...] de renoncer au groupe et
cette vie collective (p. 133). Cette vie communautaire a ceci de
particulier quelle participe de l approfondissement de lafricanit
vritable (B. Mouralis, Dabla : p. 81), en mme temps quelle
remet en question un ensemble de convictions occidentales sur la
vision socitale puisquau contact de lAfricain, comme lobserve
Christiane Albert, la dimension psychologique individualiste qui
prvaut gnralement dans la tradition occidentale [...] sestompe
(C. Albert, 2005 : p. 31). On peut donc bien se demander ce que va
engendrer la rencontre des deux modes diamtralement opposs
sur la perception de la relation entre lindividu et la collectivit.
Il ne fait donc aucun doute que dans un contexte o
Africains et Occidentaux cohabitent, chacun repli sur ses
convictions, le conflit reste ouvert puisque dun ct comme de
lautre, rien ne correspond au mode de vie de ltranger. Et chacun,
comme Mireille, se sent branl dans ses conceptions les plus
solides et les plus intimes (B : p. 152). Il va donc sinstaller de
part et dautre un certain nombre dattitudes et dagissements quil
est important danalyser.
2. Les motivations et les consquences du conflit
dtrangets
On sait dj que les convictions culturelles de nos deux aires
de fiction sont diamtralement opposes et que leur rencontre en
terre africaine ne peut tre que problmatique puisque le passage
dlments dune culture une autre occasionne des sensations
dtranget. Dj, au sujet de la rencontre en Occident, la plupart
des tudes menes sont unanimes sur le fait que celle-ci a engendr
le mme sentiment dtranget. Lessai Afrique Occident. Heurs et
malheurs dune rencontre de Hubert de Leusse (1971) dgage par
exemple les diffrentes fortunes (pour la plupart tristes) des hros
des romans africains qui se sont retrouvs en Europe pour les
tudes : lenfant noir de LEnfant noir de Camara Laye, Climbi
lenfant du de Climbi de Bernard Dadi; Fatoman lenfant sage
Interfrancophonies - n3, 2010 7
La rencontre de lOccidental et de lAfricain dans le roman dAfrique
de Dramouss de Camara Laye, Kassoumi le fol tudiant de Le Devoir
de violence de Yambo Ouologuem et Samba Diallo ltudiant
dsempar de LAventure ambigu de Cheikh Hamidou Kane. Et de
Leusse de reconnatre quaussi bien pour ces hros que pour tous
les personnages africains se retrouvant en Europe, dans nombre
de cas, en raison dun certain complexe dinfriorit et disons de
ngritude , en raison aussi des difficults matrielles ou morales
de lexil - et en particulier de la solitude - ladaptation de ltudiant
africain la civilisation europenne se fait mal ou ne se fait pas et
aboutit finalement une catastrophe (p. 136). Ce que nous
croyons pouvoir dgager quand cest lOccident qui se dplace vers
lAfrique nest pas trs diffrent. On constate en effet en lisant nos
romans que du ct des Occidentaux comme du ct des
Africains, ltranger devient source dtranget puisquil provoque
la curiosit et constitue une menace. Ce qui va dclancher des
attitudes allant de la discorde lassimilation, en passant par une
certaine hsitation dans le choix oprer entre les deux cultures.
2.1 Ltranger comme source de curiosit et comme menace
des convictions premires
Le sentiment dtranget quprouvent les personnages de
nos textes au contact de ltranger est renforc par le fait que
laction de lautre soit une curiosit ou constitue une menace. Au
sujet de la curiosit dabord, ltranger est toujours regard comme
celui quon ne connat pas ou quon ne peut saisir. Cest pourquoi
dans le roman de B, Mireille est regarde avec tonnement et
stupfaction. Pour la mre dOusmane, On ne peut aimer ce
quon ne connat pas (B : p. 102). Dans le roman de Yanou,
mre Sikalli est interloque devant lattitude de son fils qui rejette
lide de lhomme panthre et se demande comment est-ce
possible que les Blancs ne connaissent pas lhomme-panthre, eux
qui savent tout (Yanou : p. 15). Dans le roman de Kon, le
commandant trouve le rcit de son boy sur la mtamorphose de
lhomme en hyne drle et en reste assez troubl (Kon : p.
180). Dcidment, ce vieux Blanc nallait jamais comprendre
lAfrique (p. 73). Chez Laye, devant le mystrieux regard du roi,
Clarence brusquement se sentit glac jusque dans les os (Laye :
p. 223).Ces ractions manent surtout de lignorance de la culture
de lautre et aussi de la conviction que lautre est diffrent. Djibril
Guye, le pre dOusmane, a longtemps travaill chez les Blancs
mais jamais, il navait oubli quil tait diffrent deux et il tait
fier de cette diffrence (B : p. 58). Dans la plupart des cas, le
type de curiosit dont il est question ici ne provoque pas
ladmiration, mais plutt le rejet, lanimosit. Et les chanes de la
Interfrancophonies - n3, 2010 8
Pierre Martial Abossolo
discorde ne peuvent que se renforcer, dautant plus que dans ce cas
ltranger devient ni plus ni moins, comme le dit Swanou Dabla,
limage [...] de ladversit trangre (S. Dabla: p. 185).
Il y a ensuite limpression de menace. Dans ce contact entre
lAfrique et lOccident, ce qui prdomine, ainsi que laffirme
Christiane Albert, cest (la peur) dtre confront une autre
culture et de sassimiler au point de se sentir dcal par rapport sa
culture dorigine (Albert : p. 31). Et cela se vit aussi bien chez
lAfricain que chez lEuropen. Dans Un chant carlate, la prsence
de Mireille dans lunivers traditionnel de son mari est considre
comme une trahison, une abomination qui peut porter un danger
la famille. Et Ousmane le sait: Choisir sa femme en dehors de la
communaut tait un acte de haute trahison et on lui avait
enseign : Dieu punit les tratres (B : p. 58). Dailleurs, il lui est
rappel que lAfrique sait tre jalouse jusqu la cruaut (p. 59).
Le mme sentiment de dracinement et de rejet est exprim par les
parents de Mireille. Son pre supporte mal le fait que sa fille
sengage dans lautre bord avec un Noir et pense quune relation
avec un Africain va dtruire le cordon naturel de la puret. Les
parents restent camps dans leur position : Fruits slectionns de
la bourgeoisie, les ralits de la vie ne leur parvenaient que tamises
et schmatises. Lhritage des bonnes penses et des bonnes
manires avait ses tabous et ses interdits (p. 46). Dans LHomme
dieu de Bisso, Voulana est condamn lexil parce quil constitue un
danger pour sa socit, tout comme labattage de larbre par M.
Delange est considr comme un crime . Le Blanc sest en effet
permis dabattre larbre qui tait le temple du dieu gardien du pays,
ne sachant pas quon ne badine pas avec les dieux du
pays (Yanou : p. 46). Et le dpart du dieu protecteur occasionne
des malheurs terribles quun personnage numre: les hommes-
chouettes sortent librement, rien narrte plus les magiciens, des
plantes qui empchent laccouchement agissent, des milliers de
chvres et de moutons prissent. Tout cela, parce que les dieux
ont t dtruits, chasss, mpriss (p. 47). De son ct, le
forestier rejette en masse ce que tente de lui imposer le village : la
confession la Valle des eaux devant une tortue. Il estime que ce
serait trahir ses convictions. Aussi prfre-t-il se concentrer sur son
contrat qui le lie la Rpublique dAbomo. Le mme antagonisme
est perceptible dans Jusquau seuil de lirrel. Ici, autant les hommes
du village considrent laction du commandant, dcid sattaquer
certains aspects de la tradition, comme un affront, autant
ladministrateur craint de voir son autorit btie sur des
convictions occidentales seffriter. Il y a donc au centre de la
Interfrancophonies - n3, 2010 9
La rencontre de lOccidental et de lAfricain dans le roman dAfrique
discorde la crainte dune dconstruction de lordre sculaire admis.
De ce point de vue, les crivains semblent reprsenter, comme le
dit Rgine Robin, un espace [...] inscrivant la permanence de
lautre, de la perte, du manque, de la non- concidence, de la
castration symbolique . (Rgine Robin, cit par C. Albert : p. 82).
travers ces exemples, on voit comment chez lAfricain,
avec le contact de la culture occidentale, comme le souligne
Georges Balandier, lordre qui structure la tradition est menac
par le dsordre quincarne la modernit dont lirruption dans le
champ social africain perturbe lensemble des systmes
traditionnels (cit par J.M. Ela, 1998: p. 59). Devant un mode
dtre-au-monde qui contraste avec son vcu, lAfricain prouve un
sentiment de menace qui, comme le constate Jean-Marc Ela,
affecte les socits mises lpreuve par les phnomnes de
contact et de domination depuis la colonisation (Ela : p. 63). Ce
sentiment de dracinement dun peuple que lOccident a rencontr
nest pas exempt dune sorte de schizophrnie culturelle. Pour le
Noir, comme le souligne de Leusse, accepter de soccidentaliser
sans rserves, cest [...] accepter dtre situ au niveau de lobjet
(de Leusse : p. 251). Egalement pour le cas de lOccidental, la
nouveaut curieuse et surprenante empche de dompter lautre
pour imposer sa culture. Places lune aux antipodes de lautre, les
deux cultures mettent en vidence une situation o le contact nest
plus une rencontre mais un tlescopage qui fatalement va
influencer terriblement les protagonistes.
2.2 Le rsultat du conflit dtrangets
Dans les textes que nous analysons, aussi bien chez les
Occidentaux que chez les Africains, on peut valuer le parcours
psychologique des protagonistes. Tout au long de leurs parcours
antagonistes, trois positions se dgagent: le rejet, lassimilation et
lhsitation. Dabord le rejet. On le retrouve chez les personnages
qui, catgoriques, nosent pas souvrir ltranger : Ousmane qui
reste ferme sur sa dcision dpouser une deuxime femme, sa
sur ; les parents de Mireille qui vouent leur fille une espce
de maldiction en refusant toute ngociation avec leur fille qui
pouse un Africain; Yaye Khady, la mre dOusmane, qui
condamne sans ambages le mariage mixte; le peuple de Bisso qui
imperturbablement croit ses dieux malgr leur mort; Mireille
qui prfre commettre un crime parce quelle ne peut supporter le
nouveau mode de vie qui lui est impos par la belle-famille; labb
Voulana qui, devant lemportement de ses ouailles, ne cesse de leur
rappeler que ce sont des choses de Satan (Yanou : p. 56).
Interfrancophonies - n3, 2010 10
Pierre Martial Abossolo
Il y a ensuite lassimilation, synonyme de conversion quon
retrouve chez Mme Delange qui finit par avoir un enfant grce
leau mystique de la Valle des dieux quelle boit. Dabord,
apprend-on, elle sort des eaux sacres allge, rajeunie (p. 80) et
plus tard les espoirs taient fonds, elle attendait un enfant (p.
81). Il y a enfin lindcision quon retrouve tour tour chez M.
Delange qui, aprs avoir vu le miracle de leau sacre garde un
tonnant silence qui contraste avec son acharnement de dpart;
chez le commandant qui, aprs lhistoire de la mtamorphose,
tait tent de croire que la sorcellerie existait (Kon : p. 82),
sans vraiment tre convaincu que la sorcellerie existe ou pas. On
peut reprsenter ce parcours psychologique des personnages dans
un tableau.
Personnages Identit Action de Action finale Etat
dpart desprit
final
M. Delange Forestier Destruction de Silence devant Indcision
Franais larbre sacr la conception
de sa femme
Le Refus de croire Interrogations Indcision
Commandant Franais lexistence de sur la
la sorcellerie sorcellerie et
les ralits
africaines
Mireille Franaise Tentative Rvolte Rejet
marie un douverture et contre le
Africain de mode de vie
comprhension africain
LAbb Prtre Rejet de lide Rejet de la Rejet
Voulana Camerounais de lHomme tradition et
form en panthre et des choses
France dun dieu de Satan
traditionnel
Ousmane Sngalais Hsitation Option pour Rejet
revenu de entre lamour la tradition et
France et la tradition rejet de
ltrangre
Yaye Khady Musulmane Rejet de la Refus dun Rejet
africaine belle-fille quelconque
Blanche compromis
Clarence Franais Dsir de Etonnement Fascination
sjournant pntrer les devant une
en Afrique ralits Afrique
mystiques sublime et
africaines mystrieuse
Interfrancophonies - n3, 2010 11
La rencontre de lOccidental et de lAfricain dans le roman dAfrique
Mme Epouse du Rejet de lide Conception Assimilation
Delange forestier dune eau dun enfant
Delange purificatrice et grce leau
thrapeutique et
changement
dide
Le peuple de Peuple Dfense Dfense de la Rejet
Bisso enracin acharne dune tradition et
dans sa vision du condamnation
tradition monde du
magico- modernisme
religieuse
De ces chantillons, il apparat que sur les neuf cas cits,
deux restent indcis, cinq restent camps sur leurs positions de
dpart, un parvient changer de camp, un reste dans un tat de
lthargie devant la ralit fascinante que lui prsente ltranger.
Tous cependant prouvent une difficult, celle des tres amens
raliser leurs faits et gestes dans un contexte socioculturel
ambivalent - et antagoniste - et dont lambivalence vient de la
confrontation ou de la coexistence antagoniste des valeurs
socioculturelles ngro-africaines et occidentales. La reprsentation
de tels tres est rvlatrice dun certain discours des auteurs
africains sur lidentit et laltrit.
3. Lenjeu dune criture confrontant altrits occidentale et
africaine
Sil est vrai que lcriture de nos quatre auteurs est rvlatrice
de lacharnement avec lequel une culture peut repousser toute
forme denvahissement tranger et destructeur, il faut aussi voir en
elle lexpression dune idologie profonde. Derrire le choc de
cultures que reprsentent Laye, Kon, B et Yanou se dissimulent
la fois lexposition dun drame existentiel conscutif la
rencontre de lautre, la remise en question dune claustration
idologique et culturelle qui ne peut enrichir lhumanit,
condamnation qui sous-entend une certaine vision de laltrit axe
vers louverture.
3.1 Un problme existentiel : comment concilier identit et
altrit ?
Ce que nos textes traduisent en premier, cest la difficult de
cohabitation avec ltranger. Le compromis ici semble difficile.
Lmergence des nouvelles valeurs, dune nouvelle faon de penser
cre une conscience douloureuse de lmergence dun monde
nouveau, voire dangereux (M. Kane, 1982 : p. 455) Dans nos
Interfrancophonies - n3, 2010 12
Pierre Martial Abossolo
textes, seule Mme Delange russit trouver un compromis entre
sa formation rationaliste et les ralits non rationalistes dAfrique.
Chacun, imperturbable et inbranlable sobstine dfendre sa
vision du monde. Lextrmisme est si frappant que la riposte
contre lautre peut provoquer le crime, comme cest le cas chez
Mireille qui, incomprise et blesse dans son amour propre, en
arrive tuer son fils mtisse pour marquer sa violente vague de
rancur (B : p. 244) vis--vis de son mari Africain qui lui prfre
une autre femme, conformment la tradition. Il est difficile
daccepter lautre sans ressentir une impression douloureuse de
trahison, de perte. Dailleurs, comme le dit un autre personnage
africain du roman de B revenu dEurope On ne peut allier deux
conceptions de vie diffrentes. Si lon est honnte, il y a un choix
faire (p. 151).Et la grande question demeure, rebelle et lancinante,
celle que pose Ousmane : Comment fuir sans amputation
profonde? Comment fuir sans hmorragie mortelle ? (p. 58).
Cest dire que, entre diffrentiation et assimilation, la soumission
est difficile, mme quand on est sduit par la culture de lautre.
Cest pourquoi on retrouve parmi nos personnages des tres
plongs dans lindcision, partags entre deux cultures. Il va natre
chez eux ce sentiment de dchirement, dcartlement entre deux
cultures, pour tout dire d ambigut (Kane : p. 446). La
question est donc l : comment cohabiter avec ltranger diffrent
de nous ? Chez les Africains, la critique a essay de lier le
sentiment dambigut lhistoire du continent. Daniel Maximin
affirme :
(Lcrivain Noir) se dclare possesseur dune Afrique
doublement charge : lourde des traditions qui ont survcu
tous les esclavages, et qui, pour le meilleur et pour le pire,
lourde aussi de limposition arbitraire dune modernit sur
laquelle nul ne peut revenir, et dont les bnfices et les
dangers apparaissent dautant plus clairement que le matre
sest retir. (D. Maximin, 1971 : p. 105)
LAfricain se trouve donc sous lemprise dune double influence et
le choix oprer ne va pas sans une certaine hsitation : peut-elle
se mettre lcole de lOccident, au risque de perdre sa tradition,
davoir la troquer contre ce que Cheikh Hamidou Kane appelle
bagatelle (C. H. Kane, 1979 : p. 133) ? Du ct des Occidentaux
aussi on peut voir le dilemme dun peuple imbu de ses convictions
mais qui les voit mises lpreuve, au point de se retrouver coinc
entre deux visions du mode. Le discours des auteurs devient donc
un peu comme celui que dcrit Christiane Albert:
Un discours qui impose la figure de limmigr comme un
personnage la croise de plusieurs [...] cultures [...] un
Interfrancophonies - n3, 2010 13
La rencontre de lOccidental et de lAfricain dans le roman dAfrique
personnage problmatique qui met en scne ce qui se joue
dans la relation avec lautre et ouvre ainsi une rflexion
sur laltrit en mme temps quil pose la question des
origines et de la perte des o origines (C. Albert : p. 17).
Il y a donc, chez les Africains comme chez les Occidentaux, une
grande difficult sortir de lambivalence spirituelle et
psychologique ne simultanment de la sduction de lautre et de la
conservation de soi. Invitablement, chaque culture a des valeurs
admirer et des tares bannir, mais le drame nat du fait que
chacune reste coince dans une sorte dimmobilisme rgressif,
attitude qui se trouve aussi dnonce par les auteurs.
3.2 Une satire dun immobilisme rgressif et une pdagogie
de louverture
Le discours des auteurs africains a pour option de
dconstruire les prjugs btis sur ltranger, de dnoncer un
certain immobilisme dangereux qui fait que ltranger soit toujours
considr comme un agresseur. La terrible consquence de cette
exclusion est que ltranger est victime dune espce de marginalit
sociale. Il y a la lecture de nos textes une double dnonciation :
celle de lOccident et celle de lAfrique. Chez les Occidentaux, les
auteurs dnoncent un progrs qui prtend limiter lessor humain
aux dimensions du monde visible sans ouverture sur linvisible et
aussi le refus dadmettre lexistence dune personnalit et dune
tradition africaines pourtant capables dapporter une contribution
au dveloppement de lhumanit. Chez lAfricain, les auteurs
dnoncent dune part un repli dangereux qui exclut de faon
catgorique la tradition rationaliste occidentale et dautre part le
maintien dun complexe dinfriorit qui fait que ltranger -
Occident- soit toujours considr comme envahisseur, puisque
technologiquement suprieur. Par del tout, ces textes semblent
rcuser toute conception monolithique de lidentit. Les textes
revtent donc une valeur hautement pdagogique.
En prsentant le choc de cultures sous un aspect tnbreux,
les auteurs en appellent une certaine adaptation de la culture de
lautre en mesurant, bien sr, ce que pareille adaptation rclame
comme clairvoyance et comme sacrifice. Aussi, des deux
civilisations en prsence, il ne peut tre question que lune sefface
devant lautre, que lune se laisse absorber par lautre. Entre elles
doit stablir un vital change. Une civilisation qui se renferme sur
elle-mme se meurt et court le risque de desschement et de
dphasage par rapport lvolution du monde. Louverture
nexclue pas la survie. Il ne sagit pas denvisager la rencontre de
Interfrancophonies - n3, 2010 14
Pierre Martial Abossolo
ltranger comme le contact de deux mondes appels ne jamais
se confondre (B : p. 187), comme le pense Ousmane, mais,
comme celui de deux altrits complmentaires pour le bien tre
de lhumanit. Ainsi, autant lAfricain doit senraciner au plus
profond de lafricanit, autant il doit demeurer ouvert lOccident
et aux autres continents. De mme, comme le clame de Leusse:
Il est temps que [...] lOccident fasse preuve de plus de
science. Il est temps surtout quil rabatte de son orgueil
[...] Nous sommes plus que jamais lheure de lchange.
Tandis que lisolationnisme appauvrit, lchange enrichit,
la condition, bien sr, que ce soit dans le respect et
lestime rciproques, dans lgalit des droits et des
devoirs (p. 294).
En plaidant en faveur dune harmonie dans la diffrence, nos
textes peuvent se lire comme des espaces de mdiation entre deux
visions du monde. Ils montrent que les cultures peuvent se
mlanger presque sans limites et pas seulement se dvelopper mais
galement se perptuer (A. L. Kroeber, cit par S. Gruzinsky,
1999 : p. 39). Cette disposition exige de limmigr une nouvelle
attitude, lui qui doit dsormais, comme le dit Christiane Albert,
ngocier son intgration dans sa socit daccueil par une
redfinition de son identit (Albert : p. 18) et peut-tre aussi
devenir un homme nouveau qui incarne la synthse et la
dterritorialisation des cultures. Il pourrait alors tre un tre
dterritorialis dune identit qui ne se dfinit plus travers une
origine prcise, mais qui est recrer individuellement dans un
tlescopage de lieux et de cultures.
En analysant les positions et les attitudes des personnages
africains et occidentaux en contact dans lespace africain de nos
quatre romans, nous avons pu percevoir un conflit ouvert entre
deux civilisations, entre deux altrits, un conflit o ltranger
reprsente presque toujours une menace et devient un motif
dtranget. Nous avons par la suite pu ressortir les motivations et
les consquences de ce conflit en montrant comment chaque camp
sobstine prserver et dfendre ses convictions premires. Ce
qui nous a permis de dboucher sur lenjeu dune criture o le
contact est finalement synonyme de choc et non de rencontre, ceci
en montrant comment les auteurs parviennent reprsenter un
univers fragment et complexe travers une criture quon peut
dfinir comme une criture du hors-lieu , se situant dans des
espaces intermdiaires entre lOccident et ses anciennes colonies
(Albert : p. 147). Il y a donc l reprsentation dune exprience
douloureuse dont les consquences sont encore perceptibles la
Interfrancophonies - n3, 2010 15
La rencontre de lOccidental et de lAfricain dans le roman dAfrique
fois dans les diffrentes cultures et dans la manire de percevoir
lautre. Mais Kon, Laye, B et Yanou parviennent transcender
les divergences. Leur production est une contribution au dbat sur
limmigration aujourdhui: la ncessit pour lAfrique et lOccident
de souvrir pour se construire, la ncessit de parvenir une
synthse bnfique pour lhumanit, une synthse o chacun
prserverait son identit tout en souvrant lautre, une synthse
qui plaide en faveur dun enracinement plus raisonnable. De la
mme manire, les textes appellent une ouverture prudente qui
doit viter la perte totale didentit qui entrane des catastrophes
comme la mort de Samba Diallo dans LAventure ambigu.
Pierre Martial Abossolo (Universit de Bua, Cameroun)1
Bibliographie
ACHIRIGA Joseph,
1978. La Rvolte des romanciers noirs, Sherbrooke, Naaman.
ADIAFFI Jean Marie,
1981. La Carte didentit, Paris, Hatier.
ALBERT Christiane,
2005. LImmigration dans le roman francophone contemporain, Paris,
Karthala.
ANOZIE Sunday O.,
1970. Sociologie du roman africain, Paris, LHarmattan.
B, Mariama,
1981. Un Chant carlate, Dakar, Les Nouvelles Editions Africaines.
BESSIERE Jean,
1981. Dracinement et littrature, Paris, PUF, Universit de Lille III.
CHEVRIER Jacques,
1990. Littrature africaine, Histoire et grands thmes, Paris, Hatier.
1 Assistant au Dpartement de Franais de l'Universit de Bua. Titulaire d'un
Doctorat en Littrature gnrale et compare lUniversit Stendhal Grenoble
II. Il enseingne actuellement les littratures franaise et francophone
lUniversite de Bua. Il a publi L'expression du fantastique identitaire dans Le
Sorcier signe et persiste, Lectures 3, Yaound, Presses Universitaires de
Yaound, 2005, pp. 189-203.
Interfrancophonies - n3, 2010 16
Pierre Martial Abossolo
DABLA Swanou,
1986. Nouvelles critures africaines, Paris, LHarmattan.
DE LEUSSE Hubert,
1971. Afrique Occident. Heurs et malheurs dune rencontre, Paris, Editions
de lOrante.
DURAND Gilbert,
1964. LImaginaire symbolique, Paris, Larousse.
1980. Lme tigre. Les pluriels de Psych, Paris, Denol.
ELLA Jean-Marc,
1999. Innovations sociales et renaissance de lAfrique noire, Paris,
Harmattan.
GRUZINSKI Serge,
1999. La Pense mtisse, Paris, Fayard.
KANE Cheik Hamidou Kane,
1961. LAventure ambigu, Paris, 10/18.
KANE Mohamadou,
1982. Roman africain et traditions, Dakar, Les Nouvelles ditions
africaines.
KON Amadou,
1976. Jusquau seuil de lirrel, Abidjan-Dakar, Les Nouvelles
Editions Africaines.
LAYE Camara,
1954. Le Regard du roi, Paris, Plon.
MAXIMIN Daniel,
Le Thtre de Wole Soyinka, , in Prsence africaine, n79, 1971, p.
105.
SCHNEIDER Marcel,
1985. Histoire de la littrature fantastique en France, Paris, Fayard.
YANOU Etienne,
1984. LHomme-dieu de Bisso, Yaound, CLE.
Interfrancophonies - n3, 2010 17
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Hathor & Les Wingmakers Pour Aller Vers L'Humain 3Document15 pagesLes Hathor & Les Wingmakers Pour Aller Vers L'Humain 3pallassi100% (1)
- Podcast Biais Cognitifs - Le RésuméDocument38 pagesPodcast Biais Cognitifs - Le RésuméMalkiyel KexhiaPas encore d'évaluation
- Stimulez Votre Energie Avec Le Qi GongDocument13 pagesStimulez Votre Energie Avec Le Qi GongLuna Estrella100% (1)
- Max Heindel - Franc-Maconnerie Et CatholicismeDocument57 pagesMax Heindel - Franc-Maconnerie Et CatholicismeȘcoala Solomonară / The Solomonary SchoolPas encore d'évaluation
- 6 Points D'acupression Pour Controler Le DiabeteDocument3 pages6 Points D'acupression Pour Controler Le DiabetepallassiPas encore d'évaluation
- Anus - L'autre PorteDocument4 pagesAnus - L'autre Portepallassi100% (1)
- Etat Des Lieux de L'afriqueDocument40 pagesEtat Des Lieux de L'afriquepallassiPas encore d'évaluation
- Connecteurs Et Expressions UtilesDocument38 pagesConnecteurs Et Expressions UtilesAnastasia CiobanuPas encore d'évaluation
- Extrait Un Cerveau A 100 Pour 100Document26 pagesExtrait Un Cerveau A 100 Pour 100pallassi100% (3)
- Henri Delassus LA MISSION POSTHUME de LA BIENHEUREUSE JEANNE D'ARC Lille 1913Document528 pagesHenri Delassus LA MISSION POSTHUME de LA BIENHEUREUSE JEANNE D'ARC Lille 1913francis battPas encore d'évaluation
- TD - GRH 2021-2Document8 pagesTD - GRH 2021-2ram ikrPas encore d'évaluation
- Une Parole de Coeur À CoeurDocument3 pagesUne Parole de Coeur À CoeurpallassiPas encore d'évaluation
- INCONTINENCE Prevenir Traiter Incontinence UrinaireDocument4 pagesINCONTINENCE Prevenir Traiter Incontinence UrinairepallassiPas encore d'évaluation
- Loi de Finances 2020-4Document1 pageLoi de Finances 2020-4pallassiPas encore d'évaluation
- PLANTES MEDICINALES - ASTRAGALE - Lettre-IESV-AstragaleDocument8 pagesPLANTES MEDICINALES - ASTRAGALE - Lettre-IESV-AstragalepallassiPas encore d'évaluation
- PLANTES MEDICINALES - TERMINALIA MANTALY - Fiche-Presentation-MantalyDocument6 pagesPLANTES MEDICINALES - TERMINALIA MANTALY - Fiche-Presentation-MantalypallassiPas encore d'évaluation
- Le Mystère Des WingMakers - ELISHEAN MagDocument20 pagesLe Mystère Des WingMakers - ELISHEAN MagpallassiPas encore d'évaluation
- Conversion de Programmes Entre Les Langages VBA Et DELPHIDocument3 pagesConversion de Programmes Entre Les Langages VBA Et DELPHIpallassiPas encore d'évaluation
- Conseil National de L'educationDocument3 pagesConseil National de L'educationpallassiPas encore d'évaluation
- La Prière de Gratitude-PrintedDocument1 pageLa Prière de Gratitude-PrintedpallassiPas encore d'évaluation
- TematicaDocument4 pagesTematicaNataly Zuñiga RojasPas encore d'évaluation
- Pfe Version Vrai 3Document55 pagesPfe Version Vrai 3youssef karym يوسف كريمPas encore d'évaluation
- 1 ImpoDocument31 pages1 ImpoSouaada SaraPas encore d'évaluation
- Le Dogme Du MonotheismeDocument11 pagesLe Dogme Du Monotheismeامة اللهPas encore d'évaluation
- Thiam, Cheikh Et Frehiwot, Mjiba (2023) - La Question Du Panafricanisme - GA 3Document15 pagesThiam, Cheikh Et Frehiwot, Mjiba (2023) - La Question Du Panafricanisme - GA 3Michel ChristPas encore d'évaluation
- Tesio 2020 DM HipsterDocument17 pagesTesio 2020 DM Hipsternoemie.soubrePas encore d'évaluation
- Le Dagobert, La Sandwicherie D'arlonDocument1 pageLe Dagobert, La Sandwicherie D'arlonkleeisa100% (1)
- Essai Sur L'architecture Laugier Narjiss OuinaksiDocument2 pagesEssai Sur L'architecture Laugier Narjiss OuinaksiAli BounherPas encore d'évaluation
- AP 1ère - L2 - PROTECTION DE LA FEMME FACE AU VIH PDFDocument5 pagesAP 1ère - L2 - PROTECTION DE LA FEMME FACE AU VIH PDFdavid amaoPas encore d'évaluation
- Conférence de Méthode EN3S 2009-2010Document1 pageConférence de Méthode EN3S 2009-2010LePetitJuristePas encore d'évaluation
- Franceza AvansatiDocument159 pagesFranceza AvansatiMimiPas encore d'évaluation
- Guide SaulDocument172 pagesGuide SaulSebastien MoattiPas encore d'évaluation
- Barry White-Cant Get Enough of Your Love - Trumpet in BBDocument2 pagesBarry White-Cant Get Enough of Your Love - Trumpet in BBCandacePas encore d'évaluation
- Plan Comptable Commente VOLUME IV PCGDocument126 pagesPlan Comptable Commente VOLUME IV PCGRoynuj TahadjoPas encore d'évaluation
- Manel Yousra FinalDocument35 pagesManel Yousra FinalManel KhirounPas encore d'évaluation
- OziasDocument26 pagesOziastifus1410Pas encore d'évaluation
- Mémoire de Projet de Fin D'étudesDocument152 pagesMémoire de Projet de Fin D'étudesanouardian2Pas encore d'évaluation
- Memoire Ram's CompletDocument116 pagesMemoire Ram's Completyolojules73Pas encore d'évaluation
- Séance 5 Corrigé Application N°1 GF 20 21Document3 pagesSéance 5 Corrigé Application N°1 GF 20 21Meryam BoujnaidPas encore d'évaluation
- Cheng - Al Final Queda El AlmaDocument4 pagesCheng - Al Final Queda El AlmaMaria Cecilia Salas GuerraPas encore d'évaluation
- Conseil D - Etat - 4 Avril 1914 - GomelDocument1 pageConseil D - Etat - 4 Avril 1914 - Gomeljlk8Pas encore d'évaluation
- Malade Imaginaire-Texte 1Document4 pagesMalade Imaginaire-Texte 1louise.arnouxPas encore d'évaluation
- Catalogo MotoresDocument2 pagesCatalogo MotoresJesus LizarazoPas encore d'évaluation
- Reg Litto Gabon PDFDocument440 pagesReg Litto Gabon PDFTarazewicz100% (1)
- ENAREFCDocument818 pagesENAREFCsawadogolucrece44Pas encore d'évaluation