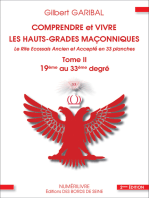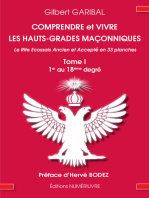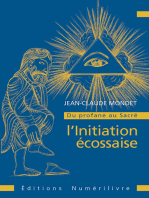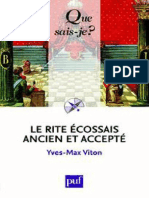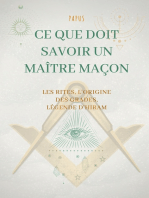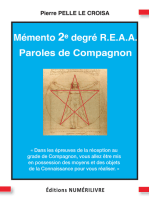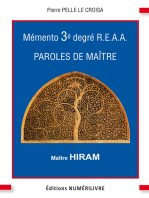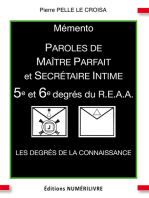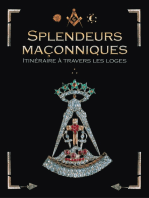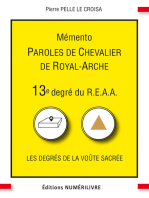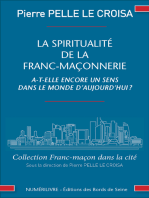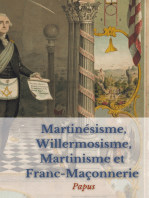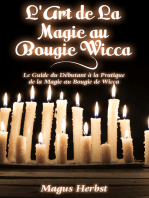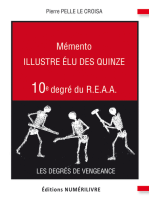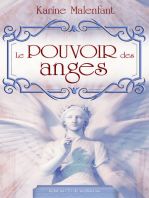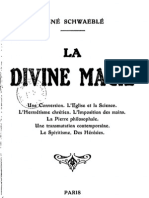Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rite Et Rituels (PDFDrive)
Transféré par
SalimTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rite Et Rituels (PDFDrive)
Transféré par
SalimDroits d'auteur :
Formats disponibles
Points de Vue Initiatiques
Revue de la
Grande Loge de France
Rite et rituels
En
résonance
avec
l’harmonie
de l’univers.
Histoire : la naissance de nos rituels
Publication trimestrielle mars 2011 N° 159 6 €
EDITORIAL
Louis Trébuchet
Harmonia Mundi
« Comme Saint Jean, que les anciens nommaient Janus, semble garder
les portes du ciel et les ouvrir à l’astre radieux du jour, la route céleste que
parcourt le Soleil fut nommée le Temple ou l’empire de Janus. De même
aussi la Loge, où travaillent les Maçons pour parvenir à la connaissance de
la Vérité qui est la vraie Lumière, est nommée Loge de Saint Jean, parce
qu’elle est une image de l’univers ».
Instruction du 1er degré du Rituel selon les Anciens Cahiers
SCDF, 1829.
Points de Vue Initiatiques N° 159 1
Le trimestre dernier, Points de Vue Initiatiques avait tenté de répondre
à la question du secret, telle qu’elle est en permanence posée par
celles et ceux qui n’appartiennent pas à la Franc-maçonnerie. Votre
revue se penche aujourd’hui sur une question elle aussi fréquemment
posée : « Pourquoi des rituels ? Qu’est-ce qu’un rite ? »
Avec l’expérience du Franc-maçon, un premier type de réponse
peut venir à l’esprit, mettant en avant la qualité d’organisation de
nos réunions. Nous avons participé il y a quelques semaines à une
magnifique tenue destinée aux apprentis et compagnons des Alpes-
Maritimes. Quatre cent frères présents, et un travail approfondi dans
l’égrégore, ce n’est possible que grâce au rituel ! L’autre jour nous
avons eu une réunion de notre loge de recherche, le matin en tenue
et l’après midi sous forme de simple cercle de travail pour cause de
diapositives : quelle pagaille l’après-midi !
Malheureusement ce type de réponse ne peut nous satisfaire, car il
reste au niveau matériel et organisationnel du non initié qui pose
la question. Ce numéro de Points de vue Initiatiques nous entraîne
bien plus profondément dans la perception des rituels, au-delà de
l’organisation matérielle, au-delà de la préparation et de la posture
psychologique, vers le fondement de tout rituel : l’entrée en résonance
avec l’harmonie de l’univers.
Nos auteurs nous feront franchir le seuil des affects pour nous
montrer que le rituel travaille sur tous les plans, nous faisant accéder
à ce que l’on appelle souvent un espace et un temps sacré. Encore
faut-il s’entendre sur l’espace sacré et l’éternité. Il ne s’agit point
ici d’accomplir les rites magiques attirant sur nous l’amabilité d’un
Dieu tout-puissant qui nous fera goûter un peu de son éternité en
transmettant une parcelle de sa puissance.
C’est au contraire pour l’un de nos auteurs, qui étudie le temps dans
un article aussi difficile qu’essentiel, l’opportunité d’échapper à « la
détresse ordinaire de l’homme confronté à une situation catastrophique,
l’impossibilité d’un recours au passé » en retrouvant « le temps immobile
du Rite », la permanence de l’univers que Platon propose dans La
République comme vrai sujet d’étude au géomètre : « Si la Géométrie
oblige à contempler l’Essence, elle nous convient. Si elle s’arrête au devenir,
elle ne nous convient pas. » Ce sera pour un autre une entrée dans
l’espace sacré en retrouvant « la faculté naturelle de relier notre expérience
physique à un ordre supérieur [que] nos sociétés modernes et matérialistes
ont perdu ».
2 Points de Vue Initiatiques N° 159
Cette mise en harmonie de soi-même, corps et esprit, avec la tâche
à accomplir est aussi celle du constructeur, de l’artisan, de l’artiste,
qui ne peuvent faire vibrer leur œuvre ou leur public s’ils ne sont
pas entrés en osmose avec l’univers qui les entoure, c’est-à-dire avec
l’ensemble de la nature, certes, mais surtout avec les êtres humains
à qui ils s’adressent.
Dans ces conditions, les rituels, au-delà de leur apport essentiel à
toute assemblée de celles et ceux qui veulent faire revivre l’Esprit
au milieu d’eux, sont incontournables dans tous ces moments où il
s’agit d’éveiller une conscience, l’initiation, ou de lui faire franchir
un état de conscience, les augmentations de salaire ou initiations
successives. Pas d’initiation sans un rituel qui introduise le néophyte,
corps et esprit, dans une situation où la Tradition, c’est-à-dire son
lien primordial, et donc spirituel, avec l’univers, lui est restituée à
travers histoire et symbolisme, mémoire collective et individuelle,
semant ou réveillant en lui des éclats de lumière à partir desquels il
développera sa propre spiritualité.
Enfin, plusieurs articles se consacrent au Rite Écossais Ancien et
Accepté, et c’est tout à fait significatif, non pas en tant que recueil de
rituels, mais en tant que voie, voie d’accès à la Connaissance, voie
symbolique et spirituelle. Notre rite n’est pas une simple variante
d’un ensemble de rituels célébrant la même divinité, peu ou prou
différents comme le rite Romain, le rite Byzantin ou le rite Melchite,
mais au contraire une voie, au même titre que le Tao ou telle Tariqa
chiite ou Ismaélienne, une voie originale qui s’est construite au long
du XVIIIe et du XIXe siècles. Chaque degré, chaque étape sur cette
voie n’est pas un brevet de savoir ou de vertu, mais un éclairage
nouveau apporté à un chemin initiatique unique sur lequel nous
peinons tous et toutes, un défi supplémentaire, un appel à nous
approcher encore et encore du principe de la Grande Architecture
de l’Univers, de cette Connaissance de l’Un, « démarche initiatique qui
convertit le regard de l’être vers l’Un, principe de toute chose ».
Et tous les rituels successifs convergent en ceci qu’ils tendent à
changer à chaque étape notre regard, pour qu’il perçoive le monde
du compas au-delà du monde de l’équerre, qu’il saisisse le symbole
sous-jacent à toute matérialité, et nous fasse retrouver ce contact
perdu avec l’Unité, dont nous avons la nostalgie. C’est là que nous
puiserons la Connaissance, l’Amour pour tous nos frères et sœurs
en humanité, et la source de notre action.n
Points de Vue Initiatiques N° 159 3
SOMMAIRE
- Éditorial
Louis Trébuchet 1
THÈMES
Fondements sociologiques et métaphysiques du rite 6
J.J.Gabut
Il faut distinguer Rite et rituels. La portée du rite maçonnique dépasse le
rôle social des rites, objet essentiel des études ethnologiques. Il façonne
l’ouvrier qui le met en œuvre tout en lui donnant des éléments pour bâtir
du sens.
Mythes, types, et rites 17
Pierre Pelle Le Croisa
La connaissance des mythes maçonniques permet d’étendre le champ
de conscience par des recoupements, des comparaisons… un travail
intellectuel qui fonde l’introspection et l’intuition, et qui réactualise une
mémoire : la Tradition.
Pas d’initiation sans rituel 23
Georges de Zerbi
L’initiation ne peut se réaliser que grâce au rituel qui introduit le profane
dans la Tradition du Rite sur les trois plans concomitants de l’histoire, du
symbolisme et de la spiritualité.
Pourquoi un rituel 31
Luc Stéphane
Quelles sont les raisons qui conduisent les Francs-maçons de la Grande
Loge de France à rester intransigeants sur la pratique du rituel ? À se
garder de l’intégrisme qui absolutise tout comme du relativisme excessif
qui ne s’engage en rien ? Si la vie intérieure a ses codes et ses repères, elle
ne s’y enferme jamais.
L’entrée dans le sacré à travers les rites et les rituels 43
F. Poilvet
Préciser les termes, souligner les invariants, affirmer les conditions
d’exécution des rituels permet d’en comprendre la nécessité dans toute
quête spirituelle. C’est un chemin vers la conscience permettant de se
relier à l’universel…
Le rite au-delà de la mise en condition psychologique 53
Henri Lentillac
Le rituel maçonnique œuvre sur tous les plans à la fois et celui des affects
n’est ni le seul, ni le plus important. Cette action transversale autorise
l’accès à un espace intérieur de véritable spiritualité.
4 Points de Vue Initiatiques N° 159
Approche spirituelle du symbolisme du REAA 61
J. E. Bianchi
Entre une pensée rationnelle desséchante et une pensée symbolique
vivifiante, le maçon féconde l’une par l’autre pour tracer sa route sur la
voie du Rite et construire un sens qu’il partagera avec ses frères.
Le rite écossais, voie d’accès à la connaissance 71
Pierre Vajda
L’Homme de Désir est l’état qui permet le passage de l’Homme du
Torrent, profane en proie à ses conditionnements, à l’Homme-Esprit,
l’initié réalisé. Les outils proposés par le Rite peuvent conduire à la
Connaissance. A ce titre on peut parler d’une Voie du Rite…
Temps profane et temps sacré 81
Jacques Van Assche
« Patience de Dieu », le temps est aussi le grand ennemi des hommes qui
s’obstinent à tenter de saisir ce qui est indéfinissable. Pourtant l’éternel,
l’immuable est là, tout près… Ne serait-ce pas le temps immobile du Rite ?
Rites, arts et initiation 92
Robert de Rosa
L’art, frontière entre le visible et l’invisible s’accompagne souvent d’une
attitude rituélique dont les arts traditionnels donnent un modèle. Le
silence émerveillé, le frisson créateur, la contemplation sereine résultent
de cette approche discrète et volontaire.
Peut-on modifier les rituels ? 101
J.F.Maury
Le rituel fait pénétrer dans un temps et un espace caractérisés par
l’immutabilité. Mais le moyen d’atteindre ce qui ne change pas peut-il
changer lui-même ? Le rituel invite bien à un projet de liberté, mais toute
liberté doit s’inscrire dans un ordre. Comment résoudre le paradoxe ?
Rituels du musée de la GLDF 109
François Rognon
HiSToirE
la naissance de nos rituels 117
Louis Trébuchet
ConTE PHiLoSoPHiQUE
la construction du temple 125
Jean Schollaert
SyMboLiSME
Gardien du temple 131
Frank Martin
bibLiograPHiE 135
LiVrES 137
Points de Vue Initiatiques N° 159 5
Jean-Jacques Gabut
Le rite, ses fondements
sociologiques et
métaphysiques
ou le rite, voie opérative de la
spiritualité maçonnique
Dans le domaine initiatique ou ésotérique, la confusion aboutit
souvent à des erreurs qui sont le résultat d’interprétations erronées.
Partant des fondamentaux classiques, il faut distinguer le Rite et les
rituels et dégager les spéciicités du rite maçonnique. La portée de ce
dernier dépasse largement le rôle social, objet essentiel des études
ethnologiques. Passage sans doute, agrégation à une communauté
certainement… mais plus que cela… C’est un outil servant à façonner
l’ouvrier qui le met en œuvre tout en lui donnant des éléments pour
bâtir du sens. À partir de cette rélexion première et fondamentale, on
comprendra que la pratique d’un rite n’a rien d’obsolète.
Procession en vue du sacrifice d’un agneau aux Charités, Peintures sur bois, Corinthie,
vers 540-530 av. J.-C., Musée national archéologique d’Athènes.
Qu’on le considère sous son aspect profane ou sous son aspect
sacré, le Rite revêt toujours des sens multiples. On sait que pour les
biologistes par exemple, il traduit un comportement à forte charge
6 Points de Vue Initiatiques N° 159
émotionnelle et il se rattache
aux fonctions de l’évolution
et de l’adaptabilité au milieu
naturel. Il existe donc aussi
bien chez l’animal que chez
l’homme et il n’est qu’à
suivre votre chien dans le
jardin pour découvrir tous
les aspects rituéliques de
« l’enterrement de l’os ».
Comportement certes
stéréotypé et non imposé par
une quelconque nécessité.
Ce premier aspect du rite
a contribué cependant à
sa définition péjorative
l’assimilant à un cérémonial Fidélité,
désuet, voire périmé. Alfred-de-Dreux, 1844.
À quoi servent les rites ?
La psychanalyse d’ailleurs, qui ne manque jamais de ramener les
comportements de l’homme aux plus bas niveaux de l’existentiel,
s’est fait un plaisir de ne voir le plus souvent dans le rite que des
aspects névrotiques relevant généralement de la psychiatrie.
Et pourtant, même stéréotypé, le rite a pour celui qui l’accomplit un
rapport avec quelque chose qui dépasse infiniment l’inconscient et
qui ressortit au surnaturel, au magique.
Le rite primitif archaïque avait, selon le sociologue Marcel Mauss,
soit un aspect positif, soit un aspect négatif, comme l’acte magique
lui-même. Mauss distinguait également à juste titre les rites de la vie
quotidienne – ceux qui deviennent vite précisément des stéréotypes
– et les rites commémoratifs faisant référence, eux, aux symboles,
aux mythes, aux modèles mythologiques. Le rite devient alors à
cet égard, une recréation dans le temps des représentations hors du
temps, permettant, comme l’a si bien vu Mircea Éliade, de retrouver
« l’éternel présent mythique » ou, si l’on préfère, de retourner au
Centre, au centre du cercle pour reprendre le langage symbolique
maçonnique.
Les liens du Rite avec la magie et la religion sont évidents. Le rite
est à la fois le « serviteur » de l’une ou de l’autre, de l’une et de
Points de Vue Initiatiques N° 159 7
Le rite, ses fondements sociologiques et métaphysiques
Rituel Indien.
l’autre. La seule différence réside en ce que le rite magique vise à
incliner le destin en commandant aux forces de la surnature, tandis
que le rite religieux s’adresse à ces forces de manière passive, par la
prière et l’invocation. On voit d’ores et déjà que le rite maçonnique
entre d’emblée dans la seconde catégorie et s’apparente de ce fait
étroitement au rite religieux.
Un phénomène qui a été souvent dénoncé par les sociologues est
l’aspect irrationnel du rite se dissimulant sous un fatras de contraintes,
d’us et coutumes imposés. Ce qui paraît à première vue évident
pour les sociétés dites primitives qui ignorent souvent la finalité des
rites qu’elles observent. Mais ce qui est vrai aussi pour les sociétés
évoluées. Prenons par exemple la multitude des rites observés chez
les fidèles du judaïsme : la plupart de mes amis juifs sont incapables,
entre autres, d’expliquer les raisons de leurs coutumes alimentaires !
Et cependant, si l’on se livre à des recherches un peu sérieuses, l’on
s’aperçoit très vite que ces rites ont une origine, qu’ils correspondent
à une fonction précise, qu’ils obéissent à une finalité bien définie.
Bergson voyait dans le rite un substitut de l’instinct : le rite, disait-il,
est inspiré par la « fonction fabulatrice ». Malinovski pensait pour
sa part qu’il avait pour objectif de pallier les déficiences du même
instinct chez l’homme. Mais ni l’un ni l’autre ne rendaient compte de
8 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Jacques Gabut
la profonde diversité des rites et surtout de leur contradiction parfois
avec le milieu social ambiant. Freud ne l’explique pas mieux lorsqu’il
décèle dans le rite la conséquence d’un traumatisme psychologique
réducteur de la psychologie individuelle !
Du profane au sacré, du social au métaphysique
Seul Durkheim a bien compris que le rite servait essentiellement
à marquer le passage du profane au sacré, à distinguer le sacré et
le profane et surtout à faire pénétrer le sacré dans la vie profane
collective. L’erreur de Durkheim en revanche est de réduire le sacré
en en faisant une émanation de la pression sociale.
Le Rite à notre sens doit donc être cherché non dans des finalités
extérieures mais bien dans ses caractéristiques propres. L’homme
social ressent en effet, malgré et peut-être à cause de sa liberté, une
certaine indétermination, une certaine insécurité face au Destin, face
à une puissance supérieure qu’il ne sait définir ni même nommer. Ce
sentiment de quelque chose qu’il ne peut maîtriser, qui le dépasse et
que Rudolf Otto appelle le « numineux », appartient à la surnature
en général et englobe le sacré. C’est ainsi que le primitif a voulu
construire sa sécurité au moyen du Rite par la purification, par la
magie, édifiant alors nécessairement des barrières, des tabous, des
règles strictes, des prescriptions sociales, hygiéniques, alimentaires.
De même, il a construit des rites de passage destinés à franchir les
diverses étapes de la vie, de la naissance à la mort en passant par la
transition de l’adolescence – que l’Église a adapté en, « communion
solennelle » - le mariage, l’adoption et aussi les différents rites
guerriers.
La Franc-maçonnerie n’a pas manqué à une certaine époque
d’adapter ses rituels à ces diverses étapes de la vie et il en reste des
cérémonials qui, pour profanes souvent qu’ils demeurent, n’en
présentent pas moins un certain intérêt. Mais surtout, comme pour
les rites anciens perpétués dans les actuelles sociétés dites primitives,
elle a continué à mimer les changements d’état des rites de passage
notamment en mimant la mort… et la renaissance en Hiram ! Tout
comme le moine ou la moniale meurent pour renaître en Christ…
Le Rite en Franc-maçonnerie n’appartient pas cependant ni aux
rites de passage proprement dits, ni aux rites de protection ou de
purification du numineux, encore moins aux rites de magie pure,
même si parfois magie il y a dans le rituel… mais ceci est une autre
histoire !
Points de Vue Initiatiques N° 159 9
Le rite, ses fondements sociologiques et métaphysiques
Diplôme de maitre, au Rite écossais ancien et accepté, 1900.
Le rite maçonnique permet au profane de se métamorphoser pour
participer au monde du sacré. La prière, l’invocation sont ainsi la
reconnaissance du caractère transcendant des forces sacrées et à
cet égard il est profondément regrettable qu’à la suite des conflits
Église et Franc-maçonnerie et de l’évolution perverse de l’Ordre
qui en découla à la fin du XIXe siècle en France, nos ancêtres
aient cru pouvoir se passer de la prière, ce qui en fait une grave
mutilation au plan spirituel. Si en effet on ne fait plus appel aux
forces transcendantes on reste dans l’immanence et donc dans le
domaine du magique !
La plupart des auteurs qui ont étudié le Rite et les rites manifestent
leur méconnaissance totale du rite maçonnique dont la signification
leur échappe totalement. Ils s’en tiennent en effet aux seuls
fondements sociologiques en axant leurs recherches sur l’étude des
sociétés dites primitives. Lévi-Strauss par exemple n’a rien compris
aux rites. Une exception toutefois : Barth. Celui-ci a compris que
l’impact du Rite est très variable et varié en fonction des individus,
des initiés. Il parle de structure lâche du message, de « clés » de
décodage différentes selon les participants. Il perçoit confusément
que le Rite est progrès en évoquant les stades parcourus par l’initié
et il comprend la valeur du secret constituant la valeur spécifique du
Rite, générateur de mystères.
En fait, le caractère social du Rite maçonnique existe indubitablement
mais il est vite transcendé par son caractère métaphysique. Ne lui
sont comparables à ce titre que la démarche monastique ou celle
10 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Jacques Gabut
des initiés extrême-orientaux avec toutefois l’importante réserve de
la Révélation qui fournit le cadre et définit la foi pour la première
et l’existence d’un contexte précis (gourou, exercices de méditation,
etc.) pour la seconde. Il faut bien comprendre que les rites en vérité
ne sont pas assimilables les uns aux autres. Ils ont tous une valeur
de singularité.
Le Rite maçonnique n’est donc que très partiellement assimilable
au rite de passage qui constitue la tarte à la crème des sociologues
car il ne correspond pas au schéma de ce dernier supposant une
séparation puis une réintégration alors que lui-même n’est qu’une
intégration ou une agrégation à un nouveau groupe (Le schéma
séparation-intégration est en revanche celui suivi par les sectes…). Il
n’y a pas de rupture du cordon ombilical : au contraire, on rappelle
sans cesse au Frère combien sa famille, son travail doivent être
importants pour lui. Pas de « life crisis » qui marque l’accès à l’état
adulte sauf à considérer que le nouvel initié passe d’un état (profane)
d’inconnaissance à l’état (sacré) d’ouverture à la connaissance…
Le rite, transmission par la parole
Le caractère spécifique du Rite maçonnique réside dans la
prééminence du mythe. Instrument révélateur du mythe par les
symboles, le Rite nous parle, nous confie des secrets – c’est son rôle
de transmission par la Parole ! – et secondairement il agit sur nous,
sur notre conscient comme sur notre inconscient, il nous transforme,
il nous façonne. Comment reconnaît-on un Franc-maçon, sinon par
son langage, son comportement, ses attitudes ? Un peu de la même
façon, le violon transforme et façonne le violoniste ou le ciseau
le sculpteur… Le Rite ainsi est l’instrument ou mieux la partition
instrumentale de notre évolution spirituelle.
De la même manière l’expression symbolique dont il est le véhicule
se révèle être par ailleurs vectrice d’une communauté d’esprits. À cet
égard le Rite n’exerce pas seulement son action sur un individu mais
aussi sur une communauté où il perpétue des sentiments collectifs.
Il va de soi que tout rite – initiatique ou religieux – est chargé de sens
et Alec Mellor a pu dire à ce propos que toute « modernisation »
d’un rite est un contresens ! Vider un rite de sa charge, de son sens,
revient à le tuer en le mutilant. De même que toute altération du rite
le dénature. On l’a vu, comme le rappelle Jean-Pierre Bayard, avec
la suppression de la référence obligée au G.A.D.L.U. par le G.O.D.F.
et le G.O. de Belgique à la fin du XIXe siècle. Et de même que la foi
Points de Vue Initiatiques N° 159 11
Le rite, ses fondements sociologiques et métaphysiques
n’a jamais existé sans rites, un rite sans foi ne saurait subsister… que
comme caricature !
Le Rite agit par une « imprégnation du subconscient » disait de son
côté Jules Boucher. C’est vrai ! Mais pour moi j’ajouterais aussi
du « surconcient » car c’est par la surconscience, convenablement
éveillée, qu’on atteint l’état d’initié grâce à la puissance du Rite,
à sa valeur magique. À l’image des différents degrés de la Franc-
maçonnerie, les rites mis en action sont des supports offerts à
l’humaine faiblesse afin que celle-ci devienne la force forte de toutes
choses, celle dont Jésus disait si bien qu’elle parvenait à déplacer les
montagnes !
Grâce à ces supports actifs, le Rite organise la mise en scène dont les
membres de l’assemblée sont à la fois les témoins, les spectateurs et les
acteurs. Il y a, comme l’a bien perçu Marguerite Guy dans son cours
de « Symbolisme et art roman » (T.1), une sorte de « conversation
constante » qui s’établit ainsi entre l’homme et le modèle divin
qu’il se propose d’imiter, voire d’égaler. « L’appareil liturgique d’une
tradition reste le cadre où doit se couler tout chercheur spirituel dans une
totale abnégation de sa personnalité » notait à ce propos J.P. Bayard,
ajoutant qu’on ne peut y changer un mot ou un geste car l’ensemble
des rites dessinent « comme le portrait secret de l’archétype céleste ». Il
y a bien là un « Ordo » indiscuté qui force l’initié à se soumettre à
l’Ordre cosmique, comme le rappelle la devise du R.E.A.A.
L’initié apprend que le visible n’est que la manifestation de l’invisible
et que la puissance de Dieu est « irrésistible. » « Dieu, disait déjà
Spinoza, n’est pas autre chose que cette puissance qui est la Vie » ce qui
n’est pas sans rappeler la parole de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité
et la Vie. »
Dans la même perspective, Maurice Cazeneuve affirmait : « Les Rites
ont pour fonction principale de faire participer la condition humaine dans
son ensemble et dans ses éléments à un Principe qui la dépasse et qui la fonde »
ajoutant que « les rites posent la transcendance du Sacré pour préparer la
sacralisation de la condition humaine. » Faut-il rappeler ici que le Rite,
qui vient du sanscrit rita signifiant la force de l’ordre cosmique et
mental, était désigné chez les Grecs par le mot thesmos qui traduit
tout simplement ce qui pose, ce qui établit. En instaurant l’Ordre
en relation avec le divin, le Rite crée donc la Loge, il la consacre, il
lui donne son existence sur le plan spirituel en en faisant, comme le
souligne Henri Tort-Nouguès – mot combien éloquent et signifiant !
– « un lieu de communion ».
12 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Jacques Gabut
En le faisant passer du
profane au sacré, le Rite
opère la transformation
de l’homme initié, de
l’éveillé. Tout comme les
mantras, les danses sacrées
des derviches, les prières
psalmodiées des moines
et moniales, le Rite opère
par ses rythmes secrets, ses
Mantras gravés sur des pierres. incantations, ses vibrations
magiques et crée l’harmonie
et la sérénité dans l’être profond de chacun d’entre nous.
Le Rite, partant d’analogies, utilisant l’équivalence, ayant
perpétuellement recours aux correspondances, met donc en
harmonie le monde visible et le monde invisible. Il ouvre les portes
de l’invisible. Un auteur du « Jardin des Dragons » a pu dire ainsi
que la vie était « un rituel cosmique » dont la principale fonction
était de maintenir l’ordre divin dans le monde créé. Le mythe sert
d’explication, le symbole d’expression et le rite les met l’un et
l’autre en action. Ce qui veut dire que le rite, par-delà son aspect
extérieur et purement matériel, se vit et vit au cœur de l’initié avec
les dispositions intérieures dont il est implicitement le signe. Il est
très proprement, très réellement, la voie opérative de la spiritualité
maçonnique.
Transmettre l’Esprit et nous relier à l’Éternel
Le grand secret du rite mis en action est de faire que la Transcendance
et l’immanence soient simultanées et complémentaires. Un rite
bien accompli crée un pont entre les pôles de l’immanence et de la
Transcendance. Transmettre l’Esprit est son rôle car tout vrai rite est
« soufflé », inspiré par l’Esprit. Jean Palou, comme René Guénon
n’affirment-ils pas que les rites ne sont pas d’origine humaine,
Mircea Eliade parlant, lui, carrément d’origine surhumaine ?
Ainsi, l’Esprit diffuse son énergie par l’intermédiaire du rite à travers
les véhicules les plus divers que celui-ci utilise, du manteau d’Élie ou
du bâton de Moïse à l’épée flamboyante du Vénérable Maître. Il y a
là comme une matière transmissible, partageable, assimilable par les
participants initiés.
Il reste cependant que pour être efficace le Rite doit être accompli
conformément à des règles strictes.
Points de Vue Initiatiques N° 159 13
Le rite, ses fondements sociologiques et métaphysiques
Tout d’abord le Rite ne doit pas être confondu avec le cérémonial qui
l’accompagne, qui en est comme le vêtement. La cérémonie n’est que
l’enveloppe du Rite, elle n’en est pas la substance et si l’on s’en tient
à ce caractère cérémonial – que dénoncent d’ailleurs les adversaires
du Rite, notamment les psychanalystes bornés qui ne considèrent
que cette enveloppe – on n’en voit que le côté conventionnel,
artificiel, ressortant à la condition humaine, trop humaine. Ce côté
cérémonial certes est un adjuvant non négligeable mais il s’agit, là
comme ailleurs, de ne point prendre l’écorce pour le fruit…
Aucune place par ailleurs ne doit être laissée, comme l’a très bien
vu Guénon, à la fantaisie individuelle ou à l’arbitraire collectif. Ce
qui condamne formellement les trafics, les arrangements du Rite. Le
rituel n’est pas un jeu, ce n’est pas quelque chose à quoi l’on joue…
Si l’on respecte cette règle basique, alors le Rite agira sérieusement,
efficacement, même à l’insu de ceux qui y prennent part… sans
toujours y prendre garde !
La référence au sacré est par ailleurs une constante impérieuse. La
perte du sacré dénature le Rite, le vide de son contenu et il ne reste
plus qu’un vague aspect cérémoniel. Tous les auteurs, maçonniques
ou autres, se montrent ici unanimes. C’est pourquoi il est si important
de ne pas réciter, ânonner même parfois hélas, un rituel car celui-
ci doit se vivre dans tous les atomes et toutes les dimensions qui
forment l’être et le mettent en rapport avec ce qui le dépasse.
Quel que soit son scénario, le mythe réactualisé par le Rite doit
comporter toujours trois niveaux : un niveau social, un niveau
cosmique (en rapport avec l’ensemble du monde créé) et un niveau
divin (en rapport avec le Principe).
Le Rite met donc en mouvement la science sacrée. Dans une
eurythmie, une harmonie, un équilibre source de joie et de délivrance.
Semblable à l’eurythmie du temple grec ou de la cathédrale, qui
allient si bien l’art visible de la construction et celui invisible du
rythme où le Logos joue le rôle de ciment divin. Paul Valéry chantait
ainsi les :
« Filles du Nombre d’or
Fortes des lois du ciel »
Alors que :
« Sur nous tombe et s’endort
Un dieu couleur de miel »
14 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Jacques Gabut
Le Rite renferme ainsi la clef d’une cosmogonie sacrée. En Franc-
maçonnerie cette cosmogonie est réglée par le Soleil et la Lune, par
les heures d’ouverture et de fermeture des travaux, par l’emplacement
des officiers en rapport avec les planètes, les signes astraux, par
les fêtes solsticiales des deux Saint Jean, par la voûte céleste et le
zodiaque de la houppe dentelée, par l’histoire biblique, qu’elle soit
vétéro ou néo-testamentaire, par le cheminement de l’initié autour
des colonnettes et tout cela sous l’Ordre dominé par le Delta qui
flamboie à l’Orient.
Tous ces éléments exercent une fonction normative, régulatrice de
l’Art royal (l’art de la règle !) et signifient le triomphe de l’Ordre sur
le Chaos.
Il existe dans chaque rite maçonnique une unité propre qui se
fonde :
- sur un même encadrement symbolique et légendaire
- sur les modalités de la réalisation initiatique offerte à l’initié
- sur l’identité conceptuelle des maçons du même rite
Mais, par-delà, il existe une unité globale des rites (ou du Rite) dans
une harmonie supérieure et universelle.
Un rituel doit se vivre dans tous les atomes et toutes les dimensions qui forment l’être et le
mettent en rapport avec ce qui le dépasse.
La référence au Sacré est l’axe invariable de la totalité des rites. Elle
inspire la construction spirituelle, de la pierre d’angle à la clef de
voûte.
Points de Vue Initiatiques N° 159 15
Le rite, ses fondements sociologiques et métaphysiques
Le Rite nous apprend ainsi à nous « relier à l’Éternel » par des
chemins souvent mystérieux.
Chez nous le Rite Écossais conserve en son sein – il en est la précieuse
arche conservatoire – les vestiges de toutes les antiques initiations
disparues dans le visible mais toujours présentes dans l’invisible, et
qui restent souchées sur le grand corps de la Franc-maçonnerie où
elles constituent la mystérieuse et très sainte fonction noachite de
l’Ordre… La vraie religion immémoriale dont parlait notre Frère
Joseph de Maistre !
Le but de la vraie Maçonnerie est de faire que la Lumière soit…
Qu’elle illumine la vie des hommes ! Et le Rite est le chemin qui
mène vers cette Lumière… n
Roue de la sagesse, philosophie bouddhiste.
16 Points de Vue Initiatiques N° 159
Pierre Pelle Le Croisa
Mythes, types, rites
Les mythes maçonniques ont leur singularité propre. Mais ils
rejoignent le grand héritage mythique de l’humanité par la
reproduction de schèmes transculturaux autour des origines et des
héros. Leur connaissance permet d’étendre le champ de conscience
par des recoupements, des comparaisons… un travail intellectuel qui
fonde l’introspection et l’intuition, et qui réactualise une mémoire
que les maçons appellent Tradition.
Le Sacrifice
d’Abraham,
Rembrandt,
1635, musée de
l’Ermitage
St Petersbourg.
Les mythes
Lévi-Strauss, étudiant les rites, met en lumière le lien qui relie les
actes de tradition et les récits mythiques. Par rapport à sa petite
histoire, l’homme cherche souvent un sens dans la grande Histoire
– sans l’y trouver, la plupart du temps. Le mythe ritualise l’une et
l’autre en les intégrant dans une continuité de sens où les schèmes
sociaux – les catégories qu’il conçoit pour lui-même et l’humanité
dans laquelle il s’inscrit – expliquent le monde, son évolution et la
raison pour laquelle il s’y trouve.
Points de Vue Initiatiques N° 159 17
Mythes, types, rites
La Chute d’Icare
Rubens, 1636
C’est donc le mythe qui fonde le rite. Et nombreux sont ceux que
le REAA évoque, puisant abondamment dans la mythologie de la
Bible et dans la mythologie des croisades les supports à la démarche
de sens qu’il poursuit.
Étymologiquement, muthos désigne ce qui est muet ; et, par
dérivation, le mystère. Mais pourquoi le mystère, si le mythe doit
donner du sens ? Plutarque l’explique en soutenant que sous une
apparence obscure la vérité se manifeste par transparence. Il faut
donc en conclure que le mythe relève du langage (qui l’éclaire) –
puisqu’il est fondateur du verbe. Et comme le langage est constitué
de symboles qui l’expriment, c’est en déchiffrant la « symbolique de
la nature » que l’homme parviendra à déchiffrer le sens du monde –
et de sa propre nature.
En effet, il traduit ses pensées par le langage en utilisant des signes, des
mots et des attouchements. Comme l’écrit Changeux, « cette capacité
du cerveau à communiquer des intentions, des contextes, des cadres de pensée
par le langage, mais aussi par des gestes, des symboles et des rituels, me
paraît tout à fait fondamentale ». La « saturation symbolique » caractérise
donc le mythe, c’est pourquoi il est au cœur du rite. La conscience
engage un sens pour la vie : elle tire de ses « traces de mémoire » des
« schémas préexistants ». Et le mythe fournit l’explication dont l’esprit
a besoin pour justifier cette démarche.
18 Points de Vue Initiatiques N° 159
Pierre Pelle Le Croisa
Autrement dit, puisque la mémoire est une reconstruction de
l’homme par laquelle il traduit ses pensées, ses gestes, ses symboles
et ses rituels, son histoire – qu’elle soit individuelle ou collective –
prend toujours la forme d’un mythe. Et « la pensée mythique combine ces
éléments pour construire un sens ». Il apporte les réponses aux questions
qu’elle se pose, en présentant une vision unifiée de l’homme dans le
monde : la vie, la mort, le bien, le mal, le destin, Dieu… Il donne
une signification à ce mystère qu’il recherche dans son histoire et
dans celle de l’humanité. Il est fondateur parce que, par lui, le passé
des hommes explique son présent d’homme.
Le mythe renferme un message dont le sens porte toujours une
vérité. Et c’est par rapport à cette vérité qu’a posteriori il construit
un récit (dit mythique) dont l’origine justifie à rebours le sens de la
vérité qu’il délivre. Mais comme cette vérité est d’origine, elle est –
par construction – première, voire primordiale. C’est parce que cet
événement qui l’origine dans le passé est unique que le mythe est à
la fois original et originaire.
Les mythes racontent l’histoire du monde (le macro-cosme) qu’un
petit être pensant habite (un micro-cosme), effrayé par sa faiblesse
face à l’immensité des espaces qui l’environnent. Cette histoire se
développe dans des récits qui exposent, par-delà son impuissance,
sa capacité à progresser dans sa vie pour lui donner un sens : c’est
l’histoire du chaos originel, l’histoire du paradis perdu, l’histoire de
l’âme exilée sur terre, l’histoire du pardon des péchés…
En remontant à l’origine de toute création (ab initio), l’homme
échappe non seulement à l’espace fini habituel dans lequel il vit -
il rejoint par l’esprit ces « espaces infinis » qu’il imag(e)ine, mais il
échappe aussi au temps quotidien qu’il appelle le temps profane.
Et cette histoire originelle qui initie sa vie, parce qu’elle fait sens,
devient modèle de vie. Le retour en arrière dans le passé est la source
d’un nouveau commencement (comme à l’origine du monde), mais
à présent pour soi (pour son monde et son futur). De fait, puisque
le mythe se situe avant la naissance des temps historiques (et qu’il
raconte une autre histoire du temps), il est hors du temps, il est
a-temporel. Sa relation au monde le fait contemporain d’un monde
dont le temps et l’espace sont infinis : sa pensée le fait être-au-monde,
pour un espace et un temps qui cessent d’être profanes parce qu’elle
les con-sacre (c’est-à-dire qu’elle décide de les rendre « sacrés »).
Le mythe transforme donc le profane en sacré, parce qu’il montre que
ce qui a été à l’origine de l’humanité peut l’être encore aujourd’hui
Points de Vue Initiatiques N° 159 19
Mythes, types, rites
pour l’homme qui fait les gestes, qui procèdent aux attouchements et
qui dit les mots qui ont fondé son histoire. Mettre en scène le mythe,
le répéter, c’est le ritualiser, le rendre à nouveau actif dans le temps
où il opère : celui de l’initiation. Un groupe se reconnaît en lui – celui
des Francs-maçons, par exemple. Il devient leur lien social. 1
Par l’apprentissage des enseignements que portent les mythes et
par la transmission des rites qui les établissent, dans ce « rapport
régulier » qui les unit, « leur valeur pédagogique traverse comme une flèche
d’intelligence les siècles qui les suivent ». En suscitant l’adhésion, leur
discours devient un discours de l’engagement.
Les types
Ces histoires sont évidemment animées par des personnages (eux-
mêmes mythiques), qualifiés d’« êtres surnaturels » (Mircéa Éliade),
de « grands initiés » (Édouard Schuré) ou de « conducteurs des
peuples » (Lénine) dans tous les cas, de bien grands titres pour
désigner simplement des « types d’hommes » pris pour modèles !
Ceux qui commémorent ou célèbrent
leurs actes se rendent contemporains
de leurs gestes (les « gesta » des héros et
des dieux dans la mythologie), dans
les temps et les lieux symboliques
où ils se sont produits. Réitérer leurs
exploits par des rites, c’est « revivre
ce temps-là » et « réapprendre leur leçon
créatrice. […] En somme, les mythes
révèlent que le monde, l’homme et la vie ont
une origine et une histoire surnaturelles, et
que cette histoire est significative, précieuse
et exemplaire ».
Cette histoire sacrée, parce qu’elle
sert d’archétype aux comportements
humains, est significative : elle modèle
les conduites sociales. Car il suffit de
les reproduire pour bien se comporter,
à l’instar des « types d’hommes » qui
les ont vécus au commencement des
temps. C’est ainsi que des personnages
testamentaires, Adam, Melchisédech,
La caravane d’Abraham,
Noé et ses enfants, puis d’autres
par James Tissot, vers 1900.
Jewish Museum, New York.
20 Points de Vue Initiatiques N° 159
Pierre Pelle Le Croisa
encore comme Moïse, Salomon ou Hiram traversent les rituels
maçonniques – quels que soient les rites. Cette approche analogique
s’étend aux grands penseurs de l’humanité : Socrate, Platon, Jésus,
Confucius… Ils expliquent comment une réalité (authentique ou
supposée) est venue à l’existence pour montrer la voie que les initiés
doivent suivre. En perpétuant leurs gestes, les rites font de leurs
actions des modèles pour les hommes sous la forme d’une démarche
de vie ; car ils touchent les étapes essentielles de l’existence humaine :
naître, travailler, créer, procréer, s’éduquer, progresser, transmettre
et mourir.
La fonction de « l’homme-type » dans le mythe est donc de « fixer
les modèles exemplaires de tous les rites et de toutes les activités humaines
significatives ». Cette répétition pour notre temps de l’activité créatrice
des dieux et des héros sacralise leurs œuvres en les réactualisant. Et
cette irruption du sacré dans le présent fonde le monde tel qu’il est
aujourd’hui, pour nous : nous sommes des êtres mortels qui aspirent
à l’éternité des dieux ; des êtres mortels parce que quelque chose s’est
passé « in illo tempore », au commencement du monde, qui explique
notre condition.
Mais qu’est-il donc arrivé ? Le mythe original et originaire révèle
qu’un dieu a été immolé pour que l’homme puisse exister. La mort
de la divinité céleste lui permet de se constituer comme être-au-
monde. Le rite réactualise le sacrifice, que l’initié réitère pour lui-
même ; et cette imitation du sacrifice le rend l’égal du dieu.
Plus généralement, Berndt décrit la structure du mythe qui fonde
les rituels de la manière suivante : « 1- un être surnaturel tue les
hommes afin de les initier ; 2- ne comprenant pas le sens de cette
mort initiatique, les hommes se vengent en le mettant à mort ; 3-
l’être surnaturel est rendu présent dans ces cérémonies par une
image ou un objet sacré, censés représenter son corps ou sa voix. »
La mort d’Hiram pour le REAA, la mort de Noé pour la tradition
noachite s’inscrivent dans la même lignée. En ritualisant sa propre
mort, l’initié transforme un acte naturel en acte culturel porteur
de sens. Ainsi, prolonge Pierre Vajda, « les degrés du Rite Écossais
Ancien et Accepté proposent aux récipiendaires des drames légendaires
leur permettant, par le jeu de l’identification à différents personnages, de
découvrir des aspects insoupçonnés de leur moi profond et par un travail
constant sur leur signification de progresser sur le chemin de la sagesse et de
la connaissance ».
Points de Vue Initiatiques N° 159 21
Mythes, types, rites
Les rites
Les mythes et les rites, en tant que « modèles divinisés » de la création
humaine, sont donc à l’origine de tout savoir. En renouvelant ces
paradigmes, l’homme devient à son tour créateur et centre de son
monde, à l’image de la création du monde par les dieux et les héros.
« Non seulement les mythes cosmogoniques portent le savoir sacré, mais
ils sont le seul moyen de sa transmission. » Cette sacralité se réfère à
des rituels qui rapprochent les hommes. Comment ? Le rite est un
« langage en acte », signifiant pour tous : le corps est un support de
re-présentation (par le regard, le mouvement, le toucher, la parole). Il
est présentation de soi sur le modèle de « l’homme-type » et du mythe
qu’il féconde. Il sacralise les gestes les plus courants de l’existence,
en leur conférant une valeur symbolique. La circumambulation
dans le temple n’exprime pas qu’une marche ; elle exprime aussi une
dé-marche.
Cassirer définit l’homme comme un « animal symbolique ». Dans
cette perspective, l’initiation est bien une cérémonie performative :
elle incite à l’action, elle induit une façon de vivre. Signifiante par les
symboles qu’elle emploie, elle fait sens. Elle fédère les initiés autour
des mêmes mythes, des mêmes types et des mêmes rites, renvoyant
à des valeurs communes. Elle est la voie d’une tradition qui nous
perpétue tant que nous la perpétuons ; car elle ne se maintient que si
nous la transmettons. n
Yggdrasil, l’arbre
cosmique, assure la
cohérence verticale des
mondes de la mythologie
nordique.
Peinture attribuée
à Oluf Olufsen Bagge.
22 Points de Vue Initiatiques N° 159
Georges De Zerbi
Pas d’initiation sans
rituel
Ni sacrement, ni cérémonie magique, l’initiation maçonnique résiste
à toute catégorisation sauf une : elle ne peut se réaliser que grâce au
rituel qui introduit le profane dans la Tradition du Rite sur les trois
plans concomitants de l’histoire, du symbolisme et de la spiritualité.
Plusieurs questions se posent alors : quel est son contenu ? est-il un
véhicule au sens bouddhique ? incarne-t’il le Maître ? Le passage
progressif de l’état de profane à candidat, récipiendaire, néophyte
et enin initié resserré en une soirée préigure toute une vie… et les
réponses sont sans doute dans ce travail lent et méthodique…
Cérémonie d’initiation XIXe siècle, Clavel.
S’il est un moment riche en émotion dont le Franc-maçon se souvienne
durablement, c’est bien du jour de son initiation. Tant d’idées se sont
bousculées dans sa tête et dans son cœur, ce jour-là, tant de choses se
sont produites avant, pendant et après la cérémonie, que le souvenir
de cet avatar demeurera toujours comme le moment fort de sa vie
maçonnique. Oui, avatar, car il s’agit bien pour le profane d’une
transformation qui le fait accéder à une « existence libre et responsable,
après avoir surmonté un certain nombre d’épreuves » comme l’écrivait
Points de Vue Initiatiques N° 159 23
Pas d’initiation sans rituel
l’un de nos anciens Grands Maîtres, Henri Tort-Nouguès dans le
n° 130 de PVI. Mais au-delà de cette métamorphose, dans cette
réflexion autour de l’initiation, il conviendra d’envisager d’autres
points et d’abord, par exemple, le poids et la réalité de la filiation
maçonnique initiatique. Ou, pour être plus clair, de s’interroger sur
la valeur véritable d’une initiation dont on sait qu’il ne s’agit ni d’un
sacrement, à l’instar du baptême catholique, ni « d’une cérémonie
magique propre à transformer miraculeusement un homme ordinaire en
mage omniscient » selon les termes employés par l’ancien Grand
Maître Alain Pozarnik dans le n° 136 de PVI. On devra, surtout,
répondre à la question dont la réponse s’inscrit explicitement dans
le titre de cette contribution, « Pas d’initiation sans rituel ».
Rites et rituels créent les conditions d’une initiation
eicace et réussie
De l’initiation nous dirons qu’il s’agit incontestablement de la
fonction majeure impartie à une loge. En effet, aucune entité autre
que la loge ne peut conférer d’initiation. Elle est l’apanage du
Vénérable Maître qui, avec ses officiers, eux-mêmes initiés et jugés
dignes par leurs frères, peut transmettre la vertu d’initiation, au
moyen d’un rituel éprouvé, avec ses symboles et ses formules, depuis
le cabinet de réflexion jusqu’à la réception finale où le néophyte
est « créé, constitué et reçu apprenti maçon ». Avec son rituel précis et
indispensable reposant sur une ancienneté largement attestée et une
richesse symbolique incomparable. Avec son rite, enfin, élaboré à
partir de textes fondateurs éprouvés et immuables, signe de la valeur
de la tradition qui le porte.
Tout au long de la cérémonie, les officiers de la loge, avec à leur
tête le Vénérable Maître, vont accompagner, guider, soutenir le
profane au cours d’épreuves symboliques et au moyen d’un rituel
parfaitement établi et efficace, jusqu’à la réception finale. Mais pour
quelle initiation ?
Si l’initiation est bien commencement, mise en chemin, selon
l’étymologie, elle ne peut se réduire, pour autant, à la cérémonie
vécue par le profane dans la loge qui le reçoit. Car elle est
aussi recherche personnelle de la Vérité, mise en route vers la
Connaissance. Cette initiation, qui commence un jour déterminé,
va se poursuivre, certes, tout au long de la vie du Franc-maçon et
ne s’achèvera qu’une fois rejoint l’Orient éternel, étape ultime de
l’initié. Ce dernier, devenu cherchant, va donc tenter de découvrir
le sens de la vie et de la création, de plonger dans son être intérieur
24 Points de Vue Initiatiques N° 159
Georges De Zerbi
afin de mieux se connaître et, partant, de mieux tirer parti de sa
personnalité pour lui-même et pour les autres. Par le travail patient
du polissage de la pierre brute, le franc-maçon poursuit sa recherche,
souvent seul, dans un face-à-face intransigeant avec lui-même, mais
sûr de pouvoir compter à tout moment, sur les frères de sa loge, sur
leur présence et sur leur aide dans le déroulement des tenues et au
cours des discussions qui ne manquent jamais de s’engager pendant
les agapes, autre moment fort des réunions de Francs-maçons.
Mais quelle peut-être alors la valeur d’une initiation, strictement
codifiée par un ensemble de mots, gestes et signes, enserrée dans un
espace-temps de fin de journée, limitée par un cérémonial suranné
dont la quintessence échappe bien souvent à un profane ballotté au
fil d’épreuves quelque peu hermétiques pour lui ?
Si elle n’est pas un sacrement ou un acte magique accordant un
état nouveau au postulant, l’initiation n’est pas, pour autant, un
« mimodrame parlé », une espèce de « pantomime non pervertie » selon la
définition d’Antonin Arnaud, ou bien encore une succession de gestes
et de paroles destinés à créer l’illusion d’une véritable cérémonie, ni
même une transe incantatoire destinée à impressionner le profane
en l’étourdissant sous un flot de formules magiques vides de sens.
Car s’il s’agissait uniquement de cela, on aurait tout avantage à
faire jouer ce qui serait alors une simagrée par de véritables artistes,
rompus à contrefaire la réalité. Imaginons en effet que la cérémonie
soit confiée à des acteurs professionnels, au fait du scénario et
connaissant par cœur leur texte. Combien la cérémonie serait-elle
empreinte d’émotion palpable, menée avec un sens de la dramaturgie
que seuls des hommes de théâtre peuvent apporter ! En quelque
sorte, une initiation plus vraie que nature ! Mais c’est justement là
que résiderait la supercherie ! Car il y manquerait alors la dimension
réelle de ce qui fonde notre cérémonie d’initiation : la valeur de la
tradition qui confère aux textes et aux gestes cette originalité, cette
authenticité mais aussi cette profondeur qui transforment ce moment
privilégié de la vie de loge en une cérémonie au caractère sacré.
Mais au fait, sur quoi la cérémonie d’initiation s’appuie-t-elle, sur
quel support prend-elle sa force ? Et la réponse nous vient alors,
claire et évidente : sur le rituel. Pourquoi donc ? Parce que « le rituel
d’initiation à la Grande Loge de France est le véritable maître spirituel,
objectif, immuable, désintéressé » écrit encore Alain Pozarnik. Mircéa
Eliade, quant à lui, donne de l’initiation une excellente définition,
à savoir qu’« elle est un ensemble de rites et d’enseignements qui veulent
entraîner la modification culturelle, spirituelle et existentielle de l’homme ».
Points de Vue Initiatiques N° 159 25
Pas d’initiation sans rituel
Par quel processus ?
Toute initiation implique d’abord la mort symbolique du sujet à
initier pour le préparer à une nouvelle naissance selon ce qu’écrivit
jadis Saint Jean l’évangéliste dont les Francs-maçons se réclament
au plus haut point : « Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé
en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de
fruits. » (Jn. 12, 24). Ainsi, le profane laisse-t-il à la porte du temple
ses métaux, c’est-à-dire tout ce qui le relie au monde matériel, ainsi
se défait-il de tous ses oripeaux, se décharge-t-il de ses soucis du
quotidien, se libère-t-il de ses préjugés et préventions pour entrer
dans une nouvelle dimension qui consiste à considérer le monde
autrement, à le regarder avec un regard neuf et même à se regarder lui-
même différemment. Pour mieux se jauger, pour mieux se connaître
et, partant, pour être mieux à même de transformer le monde. C’est
bien le Rite et le bon emploi du rituel qui créent véritablement les
conditions d’une initiation efficace et réussie.
À tous les solstices d’été et depuis 150 ans, la loge Golden Rule tient sa tenue au sommet
du Mont Owl’s Head. Cette illustration décore le hall d’entrée du temple maçonnique de la
Grande Loge du Québec. Photo prise par Déclic.
26 Points de Vue Initiatiques N° 159
Georges De Zerbi
Être conscient de son besoin d’une quête intérieure
Le Rite, fort d’une ancienneté tri séculaire, sait fort bien quel
chemin doit parcourir l’initié. Un chemin qui le conduira, en trente-
trois étapes jusqu’à la Lumière. Le rituel, quant à lui – et c’est là
une particularité de la Grande Loge de France – a conservé les
« invariants nécessaires à l’éveil de la conscience humaine ». Peu ou pas
modifié depuis la création de notre Obédience, il est chargé des
vertus et de l’authenticité qui le rendent efficace et incontestable. La
voilà bien la richesse de la Tradition, non celle qui fige le passé afin
de conserver la forme, mais au contraire, celle qui transmet le fond
afin d’enrichir le présent. Tout ce que les Francs-maçons qui nous
ont devancés dans la longue chaîne du temps, ont vécu de joies,
de peines, d’expériences, de triomphes et d’épreuves, ils nous l’ont
transmis, en grande partie, dans l’élaboration du Rite ainsi que dans
la maturation de rituels toujours efficients. Car même si, parfois, la
forme ou la formulation peut paraître un peu surannée aux yeux de
certains profanes, la force et la richesse symbolique de notre rituel
au Rite Écossais Ancien et Accepté nous fait comprendre ce que
sera notre vie d’initié. Et c’est justement sur cette compréhension,
pas toujours immédiate, que se fonde l’acte d’initiation qui aide
le cherchant à atteindre ce but, différent des buts ordinaires des
hommes. Là réside, au fond, l’efficacité de l’initiation.
Certains objecteront que de nombreux êtres humains, que chacun
de nous côtoie quotidiennement, pratiquent des vertus et vivent
une riche vie spirituelle avec autant de zèle et de ferveur que n’en
mettent beaucoup de Francs-maçons. D’où la tentation d’utiliser à
leur endroit l’expression de « maçon sans tablier ». Cela ne doit ni nous
surprendre ni nous attrister. Bien au contraire. Les Francs-maçons
ne sont pas les dépositaires exclusifs de la vertu. Bien sûr ! Et il est
même heureux de constater qu’ils n’ont pas atteint l’état extrême
de perfection. Ce qui, au demeurant, les rend bien participants de
l’humaine nature avec la fragilité qui lui est consubstantielle. Mais,
pour ne pas avoir l’apanage de la vertu, ils n’en ont pas moins
l’avantage de l’initiation. Et tout comme il ne saurait y avoir de
chrétien sans baptême, il ne peut exister de maçon sans initiation.
Cette dernière, tout comme le baptême pour le chrétien d’ailleurs,
ne rend pas le Franc-maçon supérieur, elle le rend autre. Elle le
rend conscient de son besoin d’une quête intérieure, celle d’un
monde inaccessible à la perception humaine. Et plus encore, parce
qu’elle repose sur une « transmission collective, en un temps très court »,
selon l’expression de Gérard David, dans PVI n° 110, l’initiation
Points de Vue Initiatiques N° 159 27
Pas d’initiation sans rituel
maçonnique permet au postulant d’éveiller sa conscience afin de
créer les conditions d’une quête incessante de lui-même, du monde
matériel qui l’entoure comme de celui des idées. Ce que l’initié
aurait mis une vie peut-être à découvrir – ou n’aurait même jamais
découvert – il lui est offert de le connaître en quelques heures
seulement, de façon résumée et condensée. Les premiers outils lui
sont donnés et, certes, un outil ne vaut que par l’adresse de celui qui
l’utilise. Cependant, par un long polissage fait de prises de parole
codifiées, de déplacements minutieusement réglés, de la pratique de
l’assiduité, du tracé des planches, le Franc-maçon, découvrant peu à
peu la richesse et la valeur de sa cérémonie d’initiation, va parvenir
insensiblement à la découverte de son nouvel état.
Par l’ensemble des symboles, par la richesse des gestes, par le
poids des formules, le rituel « incline à orienter l’attention vers un ou
plusieurs aspects précis de soi-même ». Il « contient dans ses structures la
clé permettant de décoder le chemin et d’accomplir les parcours malaisés
en raison des obstacles dont nous sommes porteurs » écrit encore Alain
Pozarnik dans PVI n° 136. On aura bien compris que le rituel joue,
non comme un acte mystique ou magique, contestable pour sa
rigidité et son hermétisme, mais comme un déclencheur entraînant
sur le postulant des « modifications invisibles de l’extérieur, sans effets sur
le plan social. L’initié vit sur un mode absolument personnel une relation
originale au sacré » écrit Vladimir Biaggi dans un article consacré au
rite in l’Encyclopédie de la Franc-maçonnerie.
Bijou argent sur lequel sont représentés les principaux outils utilisés dans la symbolique
maçonnique. 1763, Musée de la Grande loge de France.
28 Points de Vue Initiatiques N° 159
Georges De Zerbi
Vraiment, notre rituel d’initiation au Rite Écossais Ancien et Accepté
réalise la quintessence de ce qui constitue la véritable valeur de notre
Obédience. En effet, il concentre à la fois le poids de l’Histoire, la
grandeur de notre spiritualité, le sens du sacré, la valeur du symbole
et l’accès à la Connaissance :
- Riche de l’Histoire d’abord, qui y a déposé ses strates successives
aux heures glorieuses, comme dans les instants les plus tragiques de la
Maçonnerie, par la mise en place progressive de textes et de formules
écrits à la lumière de la rélexion des initiés et de leur engagement dans
la société.
- Riche de spiritualité, ensuite, en référence au substrat judéo-chrétien
qui, nolens volens, a imprégné durablement notre société occidentale
et continue encore de la modeler. Riche du caractère sacré, aussi, car
l’initié vit, sur un mode absolument personnel, une relation originale
à ce qui est ce domaine séparé, interdit et inviolable qui fait du Franc-
maçon, non un être secret, mais un initié qui vit une expérience intime.
- Riche de symbolisme, qui établit les fameuses « correspondances »
baudelairiennes entre idée et réel. Riche, enin, en tant qu’il apporte à
l’initié la possibilité de décrypter les idées du monde supranaturel.
René Guénon a montré que les rites étaient « les éléments essentiels
à la transmission de l’influence spirituelle et au rattachement à la chaîne
initiatique ». C’est la réponse éloquente à la remarque faite en
introduction de ce texte à propos de la filiation maçonnique
initiatique. Oui, le rituel véhicule puissamment un contenu transmis
Points de Vue Initiatiques N° 159 29
Pas d’initiation sans rituel
par des maillons antérieurs qui l’ont gardé, préservé, augmenté et
enrichi au fil du temps et des époques. Au gré des jours lumineux
mais aussi aux jours mauvais des vicissitudes. Pourtant, ce qui
transparaît de façon sensible c’est la force déposée par la tradition,
prise dans sa véritable acception de transmission, répétée par des
hommes de chair et de sang, qui ont cru de toutes leurs forces à cette
fraternité capable de rassembler des êtres différents par leur culture,
leur savoir, leurs croyances, leurs certitudes et leurs doutes. Non,
ce n’est pas un passé figé et poussiéreux qui s’est déposé dans nos
rituels mais bien la vie, qui y coule en abondance pour régénérer ce
qui semble mort dans le monde profane et qui, comme le grain de
blé semé en terre, aspire ardemment à vivre. n
Poème de l’âme : Le Grain de blé, Louis Janmot (1814-1892)
30 Points de Vue Initiatiques N° 159
Luc Stéphane
Pourquoi un rituel ?
Parmi les détracteurs de la Franc-maçonnerie, certains, profanes qui
n’en ont eu un aperçu qu’à la télévision ou en assistant à une tenue
« blanche », mais aussi initiés déçus qui quittent leur obédience à
peine devenus compagnon ou maître, dénoncent le caractère désuet
de nos cérémonies, estimant inutile le rituel qui préside à nos travaux.
On connaît au demeurant des obédiences qui ont allégé les pratiques
rituelles en les réduisant à une caricature, tandis que pour d’autres le
rituel se déroule sur une scène, devant des spectateurs. Quelles sont
les raisons qui conduisent les Francs-maçons de la Grande Loge de
France à rester intransigeants sur la pratique du rituel ? À se garder
de l’intégrisme qui absolutise tout comme du relativisme excessif qui
ne s’engage en rien ? Si la vie intérieure a ses codes et ses repères, elle
ne s’y enferme jamais.
Stonehenge, monument mégalithique composé d’un ensemble de structures circulaires
concentriques, érigées du Néolithique à l’âge du bronze (Comté du Wiltshire, Angleterre).
Le Rituel : Signiication et Fonction
Un rituel se définit selon le dictionnaire comme « l’ensemble des règles
et des rites d’une religion, d’une association ».
Le dictionnaire du CNRS donne ici deux exemples : « Les rituels
religieux dont la fonction est de répéter l’activité originaire des puissances
divines consacrent ainsi la participation des hommes à la création continuée
de l’univers » (Philos., Relig., 1957, p. 34-15). « En dehors du symbolisme
et des rituels des grades, (...) l’esprit qui anime le rite écossais ancien et
Points de Vue Initiatiques N° 159 31
Pourquoi un rituel ?
accepté a été défini dans la constitution universelle du rite approuvée le
22 septembre 1875 par tous les suprêmes conseils » (Paul Naudon, Fr.-
maçonn., 1963, p. 100).
En fait, le mot est emprunté au latin rituales (libri) « (livres) traitant
des rites », formé à partir de ritus « rite ». Le mot actuel rituel est
apparu au XVIe siècle, utilisé pour la première fois semble-t-il par
Rabelais dans le Livre Cinquième pour désigner un livre liturgique
catholique contenant les rites qui concernent l’administration des
sacrements, et particulièrement les fonctions dites curiales, telles
qu’exorcismes ou bénédictions. On utilisait habituellement à
l’époque le mot rituaire pour « les livres des rites ». Plus tard, par
extension, l’usage du substantif rituel a été étendu à l’ensemble des
textes, sur papyrus, parchemin ou papier, ou encore gravés sur les
murs des temples, indiquant l’ordonnancement des cérémonies.
D’une manière générale un rituel est un acte, ou une succession
d’actes auxquels on reconnaît un sens affectif, philosophique et
spirituel. On peut donner ici nombre d’exemples d’actes rituels dans
la vie profane : il suffit de citer par exemple la minute de silence, le
garde-à-vous, l’audition debout de l’hymne national. On pourrait
évoquer également le rituel en vigueur dans les tribunaux, ou
celui des trois coups qui marquent le début d’une représentation
théâtrale.
Surtout, chacun sait à quel point la vie religieuse comporte, quelle
que soit la croyance, de nombreuses attitudes rituelles : joindre les
Triptyque de la Dormition,
ivoire, vers 1330-1340,
Bibliothèque d’Amiens
Métroplole.
Il représente la légende
de la mort de la Vierge,
selon les textes de
Jacques de Voragine
et Vincent de Beauvais.
32 Points de Vue Initiatiques N° 159
Luc Stéphane
mains, faire le signe de croix, se mettre à genoux, se prosterner, etc.
Pour les religieux, il est manifeste que la pratique d’un rituel renforce
considérablement le sens profond des textes, des représentations
symboliques, ou allégoriques qui l’accompagnent. En fait, comme
l’écrit le P. Michel Gitton dans un ouvrage préfacé par le cardinal
Joseph Ratzinger avant qu’il ne devînt le Pape Benoît XVI, le rituel,
qu’exprime la liturgie, fait « entrer [le croyant] dans un mystère,
c’est-à-dire une réalité cachée en Dieu ».
En maçonnerie, le Rituel est l’ensemble des actes, gestes, attitudes
et paroles symboliques, hérités de la Tradition et fixés par l’usage.
C’est par le moyen du Rituel que sont transmis les enseignements
fondamentaux de notre Ordre.
Certains se sont demandé, à propos du Rituel en maçonnerie, s’il
procédait davantage de la mise en condition ou du goût pour un
certain décorum. En fait, on pourrait dire que le Rituel participe
du psychodrame au sens où le terme est employé pour désigner une
méthode de formation en groupe fondée sur la reconstitution de
situations concrètes et où les participants incarnent des rôles précis.
En clair, cela signifie que le Rituel replace les participants, par sa
répétition, son côté théâtral, son vocabulaire, sa gestuelle imposée
et ses expressions propres, dans une autre réalité que celle de leur
quotidien, une réalité partagée, hors du « ici et maintenant » de chacun.
Ainsi le Rituel permet en quelques minutes de créer pour chacun et
pour le groupe une rupture avec le monde profane et son agitation,
ses questionnements et ses querelles, pour laisser place à l’émergence
d’un autre niveau de la conscience, plus serein quoique propice aux
interrogations, voire au doute systématique.
Contrairement aux rituels religieux, le Rituel maçonnique n’est pas
le fait des seuls officiants, Vénérable Maître et Officiers impliqués.
Par la gestuelle et par la parole, il associe l’ensemble des participants,
à l’unisson, dans un mouvement qui les fait pénétrer ensemble dans
le temps et l’espace sacré du Temple symbolique.
Paradoxalement, alors qu’il contraint en apparence les attitudes, les
mouvements et les mots, il crée l’espace de la liberté de la pensée, de
la réflexion et de la méditation.
Ordo ab Chao : Franc-maçonnerie et ordre
L’article premier de la Constitution de la Grande Loge de France
énonce que « la Franc-maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel
et universel, fondé sur la Fraternité ». Dire que la Franc-maçonnerie
Points de Vue Initiatiques N° 159 33
Pourquoi un rituel ?
est un ordre implique qu’il s’agisse d’un rassemblement organisé,
administré, hiérarchisé. On peut évoquer ici les ordres religieux,
militaires ou professionnels. Dans le cas qui nous intéresse, il est
essentiel de souligner que la contradiction entre liberté – puisque
la Franc-maçonnerie s’affirme comme regroupant des hommes
libres autant que de bonnes mœurs – et ordre n’est qu’apparente.
L’ordre qui organise et structure notre institution collective crée les
conditions de la liberté de chacun.
On parle donc volontiers d’Ordre, avec un « O » majuscule, pour
désigner la Franc-maçonnerie. Cette notion est d’autant plus
prégnante pour nous, Francs-maçons de la Grande Loge de France,
que notre obédience pratique quasi-exclusivement le Rite Écossais
Ancien et Accepté, dont l’une des deux devises est Ordo ab Chao,
l’Ordre à partir du Chaos. Depuis l’instant même de la Création,
tel qu’évoqué par exemple dans le Prologue de l’Évangile de Saint
Jean à la page duquel est ouvert le Volume de la Loi Sacrée sur
les autels de nos temples, l’univers s’organise, se structure ; l’univers
s’ordonne sans cesse à mesure qu’il se différencie et se complexifie.
Le Franc-maçon est invité à comprendre ce mouvement de l’univers
vers l’ordre pour tenter de s’y inscrire harmonieusement.
Parce qu’il organise, qu’il structure, qu’il règle le fonctionnement de
la Loge, le rituel est l’expression de cette tension du Franc-maçon
vers l’ordre et l’harmonie. Le rituel est, pourrait-on dire, le symbole
le plus complet de la reconnaissance par le Franc-maçon de ce que
peut être le plan du Grand Architecte de l’Univers. Il importe donc
qu’il soit scrupuleusement respecté.
Régler la forme pour libérer la pensée
Arrêtons-nous précisément à ces impératifs de forme. Rien dans un
Temple maçonnique, rien dans un Rituel, n’est exempt de sens. Rien
n’est fortuit.
Le Temple est impérativement orné d’objets et de décors dont la
présence même participe à la nature spécifique de l’espace créé par le
Rituel. Mais au-delà, chacun de ces objets ou décor possède un sens
symbolique propre, qu’il appartient naturellement à chaque initié
de découvrir puis qui agira sur sa conscience sans même qu’il s’en
aperçoive, tant il appartiendra intimement à son référentiel mental.
Ainsi, le sens de ces éléments matériels n’est plus véritablement
caché mais au contraire parlant.
Ce qui vaut pour le décor vaut encore davantage pour les mots. Ils
34 Points de Vue Initiatiques N° 159
Luc Stéphane
ont pour vocation non seulement d’ordonnancer la cérémonie, mais
aussi d’en livrer le sens, d’en véhiculer l’enseignement. L’archaïsme
même de certains mots ou de certaines tournures, leur caractère
parfois suranné participent de la singularité du message : un sens
qui doit donner matière à réflexion et une forme qui doit exprimer
le caractère traditionnel de notre Ordre.
C’est dire l’importance d’un Rituel respecté et parfaitement exécuté,
et non simplement énoncé en pensant à autre chose, comme
pour s’en débarrasser. Notre Rituel doit être vécu, et non subi.
Il faut entrer dans le Rituel, que l’on soit Officier ou Frère sur les
Colonnes ; et il faut laisser le Rituel entrer en nous.
On pourrait naturellement défendre l’idée que le fond compte bien
plus que la forme, et que si l’on pratique le Rituel en l’intériorisant
véritablement, si on en incorpore le sens, peu importent les mots
exacts et les décors.
Sans doute la réflexion est-elle fondée dans son principe. Mais il se
trouve que la pratique maçonnique n’est pas une pratique solitaire :
notre voie est certes individuelle, on est certes Maçon par soi-même
et pour soi-même. Mais on n’est authentiquement et pleinement
Franc-maçon que par et pour les autres. Travailler en Loge, c’est
travailler sur soi parmi les autres et grâce à eux.
Et mettre à l’unisson de la conscience et du cœur trois ou quatre
dizaines d’hommes tous égaux mais tous différents ne peut se faire
en un laps de temps raisonnable qu’en les harmonisant. Telle est la
fonction essentielle et primordiale du Rituel : être un moyen d’éveil
du groupe et des individualités qui le composent.
Le Rituel possède donc une forme prescrite, qu’il convient de
respecter sans pour autant lui laisser dominer le fond, qui demeure
l’essentiel. Trop d’attention portée au décorum, une attention
excessive accordée au cérémonial, c’est le risque de privilégier la mise
en scène sur le texte et surtout le sens de ce qui nous rassemble. Ici
comme ailleurs, tout est question d’équilibre. Ce qui importe, c’est de
distinguer l’essentiel - le sens - de l’accessoire - la forme pour la forme.
En effet, à l’occasion de l’ordonnancement d’une cérémonie et de la
création d’un espace-temps sacré permettant la mise à l’unisson du
cœur et de l’esprit esprits des initiés, le Rituel est avant tout le moyen
d’exprimer le Symbolisme qui est notre langage commun, vecteur
traditionnel du Sens, c’est-à-dire de la Vérité, cette connaissance, cet
absolu vers lequel nous tentons de nous élever.
Points de Vue Initiatiques N° 159 35
Pourquoi un rituel ?
Le rituel, par nature expression d’un collectif
Les diverses religions, tant celles du Livre que celles nées en Inde ou
en Extrême - Orient, donnent la possibilité au croyant de faire montre
de comportements rituels en solitaire : on peut prier, se recueillir,
prononcer une action de grâce, en étant parfaitement seul.
Les Rituels maçonniques, eux, n’ont de sens que collectif. Leur
pratique exerce sur le groupe un effet structurant. Plus encore que le
tableau tracé ou déroulé sur le sol, c’est le Rituel qui crée la Loge.
Sous le double éclairage du Soleil et de la Lune,
se révèle une compréhension intuitive des lois de la nature.
Sous le double éclairage du Soleil et de la Lune se matérialise le
tableau de Loge, chargé des symboles du degré auquel la Loge
travaille. Chacun est assis, silencieux, à sa place et à son office,
portant tablier et gants. Le Vénérable Maître, aidé des deux
Surveillants, fait circuler la parole que chacun prend debout, dans
une posture imposée. Rien de tout cela n’aurait de sens au dehors.
Rien à l’intérieur ne ferait une Loge de cet espace-temps en dehors
de tout cela.
Le Rituel est donc constitutif de la Loge, il en est à la fois contenant
et contenu, cadre et objet ; il est le moyen organisé de mettre un
certain nombre de symboles en mouvement. Il permet ainsi aux
participants une compréhension intuitive des lois de la nature,
36 Points de Vue Initiatiques N° 159
Luc Stéphane
telles qu’elles expriment le plan tracé par le Grand Architecte de
l’Univers.
Un rituel se vit et ne s’explique pas.
Peut-on, faut-il faire évoluer les rituels ?
C’est ici semble-t-il qu’il convient de se poser la question de
l’évolution du Rituel.
Peut-on, faut-il faire évoluer les rituels, ou au contraire doit-on s’en
tenir à leur version « initiale » ?
Force est de constater, en réalité, qu’il n’existe pas une version
initiale qui pourrait être considérée comme le « canon » rituélique
au même titre que les « Old Charges » peuvent être admises par
tous les Francs-maçons spéculatifs d’aujourd’hui comme leur règle
fondatrice.
Les rituels n’ont cessé d’évoluer, à l’évidence, jusqu’à la structuration
des Rites dans leur forme actuelle, soit 1801 pour le REAA en 33
degrés, puis dans les deux siècles qui ont suivi.
Mais à l’instar de ce qui vaut pour les œuvres d’art éprouvées par le
temps, il faut bien distinguer le travail du retoucheur - restaurateur,
respectueux de l’esprit de l’œuvre initiale, de celui d’un iconoclaste,
soucieux d’imprimer sa marque ou de faire passer sa vision, au
mépris trop souvent du sens profond qu’avait voulu le concepteur
originel.
Retenons en tout cas que les
rituels maçonniques règlent
le fond comme la forme d’un
ensemble de cérémonies qui
permettent de structurer le
travail collectif effectué en
loge tout en visant à favoriser
le travail intérieur, introspectif,
de chaque franc-maçon qui y
participe.
Il n’est pas nécessaire de citer
ici ceux qu’un Apprenti a assez
vite l’occasion de connaître, de
pratiquer et donc de vivre, à
Les Rituels maçonniques, eux,
n’ont de sens que collectif.
Points de Vue Initiatiques N° 159 37
Pourquoi un rituel ?
commencer par le rituel d’initiation ; puis le soir même le rituel de
fermeture des travaux de loge et notamment le rituel de la chaîne
d’union, et rapidement le rituel d’ouverture, le rituel d’installation
du Vénérable et des Officiers de la loge, etc.
Chacun de ces rituels va mettre en œuvre le Rite, le rendre vivant, dans
sa spécificité propre à laquelle s’ajoute celle du degré pratiqué.
Par nature, le Rituel en tant que démarche intrinsèque à l’Ordre
maçonnique est conservateur. Il est relié à des usages et à des formes,
des formulations, délibérément archaïques, qui le rattachent au passé
et à la Tradition. C’est d’ailleurs une de ses fonctions que de faire
vivre au présent l’héritage du passé, son symbolisme, expression
d’archétypes venus des temps immémoriaux, ses mythes fondateurs,
posés délibérément par nos prédécesseurs du siècle des Lumières
dans l’Antiquité telle que la décrit la Bible, notre volume de la Loi
sacrée.
À ceux qui disent qu’il conviendrait que les rituels soient
« dépoussiérés », et que leur vocabulaire soit celui que nous
employons tous les jours afin d’être mieux compris de tous, il convient
de répondre qu’il s’agit d’un lexique sacré, destiné à véhiculer un
travail spirituel dans un espace sacralisé, hors du temps. Le caractère
inhabituel des mots, des signes, des attouchements, du cadre, des
décors, de la circulation de la parole, tout doit en réalité concourir à
distinguer la Loge - espace-temps sacré - des lieux profanes que nous
fréquentons habituellement.
(Doit-on rappeler ici le sens du mot profane, qui désigne ce qui est
pro fanum, devant le lieu sacré. Devant, et non dedans).
Cela dit, le Rituel doit être intelligible et ne pas prêter à des
malentendus, des contresens perturbateurs. Il est donc légitime de
veiller à ce que tel mot, telle expression qui a changé de sens au
cours des siècles, soit explicité ou adapté.
Rien n’est fortuit dans le Rituel maçonnique. Rien n’y a été inclus
qui ne soit porteur de sens. Et j’entends ici le mot « sens » au pluriel.
Certains symboles, certaines expressions, ont plusieurs sens et
cette polysémie n’est pas fortuite. Modifier une formulation ou une
gesticulation rituelle pour la rendre plus actuelle, plus explicite ou
plus esthétique, c’est courir le risque de perdre ces sens secondaires,
ces sens cachés qui ne sont peut-être accessibles qu’au terme d’un
certain travail, pour ne pas dire d’un travail certain. Il en est ainsi
d’éléments du Rituel qui figurent à un degré donné sans paraître
38 Points de Vue Initiatiques N° 159
Luc Stéphane
avoir une importance particulière, alors qu’ils annoncent, qu’ils
préfigurent un autre degré, dans la compréhension duquel ils
révéleront la plénitude de leur sens, ou en tout cas une perception
plus large de leur signification.
À ce titre, le Franc-maçon le plus honnête du monde ne saurait
sans risque altérer le Rituel s’il n’est pas en possession d’une vision
complète du Rite et de son corpus symbolique.
Le rituel mobilise le Franc-maçon de l’intérieur
Le Rituel est l’expression du Rite, qui ne peut s’entendre que dans
sa globalité.
Ainsi considéré, le Rituel est donc avant tout un outil spirituel
dont la fonction est d’inclure celui qui le pratique dans le cercle
des participants. Il a à la fois par conséquent un rôle individuel et
collectif, une fonction structurante et intégratrice.
Cette intégration met chacun des participants en résonance, en
harmonie, à l’unisson des autres Frères présents, réalisant ce que l’on
nomme parfois Egrégore. Si, grâce au Rituel, l’état de conscience
de chacun est légèrement modifié, plus ouvert, plus accueillant à
l’Autre mais aussi plus attentif à ses propres perceptions, il faut
souligner qu’il ne dérive jamais vers une aliénation de la liberté de
conscience. Au contraire, le Rituel crée les conditions d’un éveil de
la conscience, d’une attention, d’une vigilance accrues, où le libre-
arbitre peut s’épanouir.
Il n’y a pas d’action du Rituel sans l’implication volontaire de
chacun. Le Rituel n’agit pas de l’extérieur de moi, mais à l’intérieur
de moi. Il vise à me mobiliser en moi-même, et ce parmi les autres,
avec et grâce à eux.
Le Rituel est donc un cadre et une succession d’actes et de paroles
symboliques, c’est-à-dire porteuses de sens. Ce cadre et ces actions
vont impliquer, physiquement et psychiquement, chacun des Frères
rassemblés dans la Loge. Ainsi l’enseignement porté par la Tradition
est-il transmis en même temps que vécu.
À chaque réitération, tenue après tenue, année après année, degré après
degré, le Rituel va opérer sa magie inspiratrice et intégratrice. Il va
peu à peu livrer comme une évidence son contenu symbolique, qui va
se dévoiler naturellement à l’initié sincèrement impliqué, c’est-à-dire
réellement participant. La pratique du Rituel prolonge la révélation
initiatique, elle l’éclaire et lui donne son sens au travers du vécu.
Points de Vue Initiatiques N° 159 39
Pourquoi un rituel ?
C’est la raison pour laquelle on ne peut sérieusement s’affirmer
Franc-maçon si l’on reste durablement éloigné de la Loge, et partant
de la pratique du Rituel, qui, répétons-le, n’a de sens que vécu et
partagé.
Ainsi, le Rituel est un élément essentiel de notre Ordre et de notre
cheminement initiatique. Il est à la fois inducteur d’un certain état
privilégié de la conscience, propice à notre élévation spirituelle,
vecteur des contenus symboliques et des mythes qui sont les outils
et le matériau de notre progression, et enfin conservateur de ces
éléments fondateurs qui sont le patrimoine commun des Francs-
maçons répandus à la surface de la Terre. n
Les rituels anciens
Les plus anciens éléments rituéliques dont nous ayons la trace ne
sont pas des rituels à proprement parler mais ce qu’il est convenu
d’appeler des « catéchismes maçonniques », c’est-à-dire des échanges
de questions et de réponses propres à la transmission des secrets et des
symboles de la Franc-maçonnerie. Ces documents, remis à l’initié à
chaque franchissement de degré et qui développent l’instruction donnée
oralement à la fin de la cérémonie d’initiation, portent précisément
aujourd’hui le nom d’Instructions. Le mot « catéchisme » ne doit pas
cependant être rejeté pour d’éventuelles connotations religieuses :
il vient en effet du grec « katêcho », qui signifie « faire retentir aux
oreilles », « enseigner de vive voix ». C’est donc la transcription écrite
d’un enseignement fondamentalement oral.
En tout état de cause, le procédé - transmission d’un savoir par questions
et réponses - est fort ancien. Il était déjà employé par les Pythagoriciens
cinq siècles avant notre ère. Reprises par les néopythagoriciens et les
néoplatoniciens au IIIe et au IVe siècle de notre ère, ces questions-
réponses étaient appelées acousmata - choses entendues -, ce qui
renvoie bien à la notion de transmission orale de la Tradition. On leur
donnait aussi le nom de symbola, pour signifier qu’elles tenaient lieu
de signe de reconnaissance, notion qui se retrouve dans notre pratique
du tuilage.
Les fraternités de Compagnons bâtisseurs, auxquels nous avons
emprunté - à défaut d’un héritage avéré - bien des pratiques et bien
des outils symboliques, organisaient leurs réunions selon des rituels
dont nous possédons le détail. C’est ce qui amène Jean Tourniac, dans
Lumière d’Orient publié en 1979, à faire ce commentaire, que nous
reprendrons volontiers à notre compte :
40 Points de Vue Initiatiques N° 159
Luc Stéphane
« Ainsi dans les rituels de constructeurs ce qui est invariable ce sont les signes,
mots et attouchements, la description des symboles et des rites dont, évidemment
et en premier, celui de l’initiation. Voilà donc l’essentiel du Rite : la transmission
ininterrompue de symboles agis (gestes), sonores (noms et mots sacrés), figurés
(décors, tableaux), autant d’éléments qui ne sont pas le fruit d’une élaboration
ou fabrication individuelle (solitaire ou collective) référée à une date précise
et attribuée à un homme, fût-il génial. En revanche, le commentaire et
les instructions héritées d’une époque, ou d’un groupe de compositeurs de
rituels marqués par l’entendement de leur temps, ne sauraient être considérés
comme représentant la Tradition des Constructeurs ne varietur. L’aspect
fondamental et invariable c’est la chaîne, verticale (origine immémoriale ou
divine) d’inspiration directe et dépourvue d’élaboration humaine (L’aspect
variable et contingent selon l’époque et le déroulement cyclique (mentalités,
concepts religieux, etc.) c’est la trame, horizontale, produit de la réflexion et
du travail intellectuel dans une tranche d’histoire. Ainsi relèvent de la chaîne :
l’architecture d’un ensemble graduel ou sacramentel et, bien entendu, les textes
tirés directement de l’Écriture sainte. Ces éléments n’ont rien d’individuels et
ne sauraient être confondus avec les paraphrases, instructions et commentaires
subjectifs qui transmettent le point de vue contingent d’une époque. »
Parmi ces rituels de constructeurs, les statuts Shaw, qui datent de
l’extrême fin du XVIe siècle, stipulent que les Apprentis entrés et les
Compagnons devaient connaître les réponses aux questions de leur
degré sans se tromper une seule fois, sous peine d’être punis.
On retrouve un catéchisme et une description sommaire des cérémonies
de réception à ces deux degrés dans les manuscrits Edimbourg, Sloane,
Dumfries, Chetwode Crawley, Graham, etc., qui datent de la fin du
XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle.
On a même retrouvé sur le registre des procès-verbaux, lui aussi
manuscrit, des tenues de la Loge spéculative de Haughfoot, au Sud-
Est de l’Écosse, les dernières lignes d’un aide-mémoire du rituel
d’initiation, rédigé au soir de la tenue du 22 décembre 1702.
Les premiers catéchismes imprimés datent de 1723, et sont donc
contemporains des Constitutions d’Anderson. A Mason’s Examination
comporte ainsi la description brève mais détaillée d’une cérémonie de
réception au grade d’Apprenti.
On doit citer ensuite le fameux Masonry dissected de Samuel Prichard,
qui date de 1730. Dans cet ouvrage, un initié raconte sous forme
de réponses à des questions le détail de ce qu’il a vécu lors de son
initiation. Les diverses cérémonies de trois grades y sont décrites pour
la première fois.
Points de Vue Initiatiques N° 159 41
Pourquoi un rituel ?
Mais les Anglais se refusèrent toujours, et se refusent encore, à publier
officiellement, sous le sceau de leur Grande Loge et aujourd’hui de la
Grande Loge Unie d’Angleterre, les rituels de leurs différents degrés
et de leurs diverses cérémonies. Seuls existent des aide-mémoires. La
diffusion purement orale et par cœur de ces textes conduisit à quelques
altérations et donc à plusieurs versions.
De nos jours, toutes les variantes ainsi engendrées par l’histoire sont
admises, et la GLUE n’imprime toujours pas de rituel « officiel ».
Quant aux Américains, par exemple, ils mettent un point d’honneur
à apprendre et donc à réciter et à exécuter le Rituel par cœur. C’est
même là l’essentiel de leur travail en Loge.
Il en va autrement en France.
Les bibliothèques des Obédiences les plus anciennes, mais aussi la
Bibliothèque nationale possèdent également de nombreux documents
datant des premières années de la Franc-maçonnerie spéculative sur le
sol français. Il est ainsi possible de lire le rapport, la Divulgation, du
Lieutenant de Police Hérault, qui date de 1737 et décrit avec précision
et détails une cérémonie d’admission. On retrouve ce rituel et celui des
travaux de table dans Le Secret des Francs-maçons, publié en 1742 par l’Abbé
Pérau, puis celui de la réception aux trois grades, Apprenti, Compagnon
et Maître, dans le Catéchisme des Francs-maçons, qui date de 1744.
Les Français sont bien davantage uniformisateurs que les Britanniques.
C’est pourquoi, à partir de 1770, vont apparaître en France les premiers
cahiers de grades, comportant le rituel propre à chaque degré et le
Catéchisme correspondant. Le premier connu a été publié à Lyon en
1772 pour le Grade d’Apprenti. Il comporte un Rituel très détaillé
pour les initiations et les tenues ordinaires, ainsi que l’Instruction, par
questions et réponses.
Le Règlement de la Loge Saint-Jean-d’Écosse de la Vertu Persécutée,
constituée à l’Orient d’Avignon sous les auspices de la Mère Loge de
Marseille en août 1774, stipule qu’il est interdit « d’introduire dans les
grades aucune formule ni aucun usage contraire à ceux qu’elle a suivis jusqu’à
ce jour et à ce qui est contenu dans les cahiers des grades et le cérémonial consigné
dans ses archives, lequel sera nécessairement paraphé par le Vénérable, afin
qu’il ne puisse y être rien innové ». Cependant, c’est en 1804 que sera fixé
le rituel du Rite Écossais Ancien et Accepté.
De nos jours, toutes les Obédiences françaises éditent des Cahiers de
grades, pour chacun des degrés et éventuellement des Rites pratiqués.
Ces documents ne sont pas accessibles aux profanes, même si l’essentiel
en est connu par de nombreux ouvrages. n
42 Points de Vue Initiatiques N° 159
Frédéric Poilvet
L’entrée dans le sacré
par les rites et les rituels
Bien que mystérieux, le mode d’action des pratiques rituelles
peut être l’objet d’un regard externe tout autant que d’une vision
interne. Le premier apportera un savoir de surface seulement mais
permettant les rapprochements, les comparaisons, les analyses
critiques. Le second, seul, débouchera sur une connaissance et sur
la transformation de l’observateur devenu acteur. Il n’est donc pas
inutile, bien au contraire, de préciser les termes, de souligner les
invariants, d’airmer les conditions d’exécution des rituels pour en
comprendre la nécessité dans toute quête spirituelle. Un chemin vers
la conscience qui n’évacue pas le secret ultime mais permet de se relier
à l’universel…
Objets entourant la colonne de
calcaire de grande Balankanche,
(Péninsule du Yucatan, Mexique)
qui s’étend du sol au plafond.
Elle présente des ressemblances
avec l’ancienne conception
maya de l’Arbre du Monde
(Wacah Chan).
Points de Vue Initiatiques N° 159 43
L’entrée dans le sacré par les rites et les rituels
Le rite rassemble un ensemble de cérémonies.
Le rituel est le texte qui décrit le déroulement de ces cérémonies,
la disposition des lieux, les gestes accomplis et les paroles
prononcées.
Rites et rituels constituent un support formel favorable à
l’épanouissement de forces psychiques et spirituelles qui concourent
à la sacralisation d’un espace, des actions qui s’y déroulent et des
mots qui y sont prononcés.
Seul le Rite possède la faculté de sacraliser le temps et l’espace.
Généralement, le lieu n’est sacralisé que le temps du déroulement
des cérémonies, c’est-à-dire le temps durant lequel le lieu est habité
par un groupe humain en quête de spiritualisation. Le rituel propose
donc l’installation de ce lieu et sa désinstallation. L’installation
comporte des éléments visibles symboliques constitués d’objets et
de gestes rituels ; Toutefois les éléments de préparation principaux
à l’entrée dans le sacré échappent au regard, il s’agit de dispositions
mentales ouvrant la voie au travail spirituel et d’invocations d’un
principe supérieur et ordonnateur. Le rite concourt à un sentiment
d’ouverture et de réceptivité.
Lorsque le temps sacré de la cérémonie s’achève, le lieu et les objets
sont désacralisés par un processus inverse à celui qui a procédé à
leur sacralisation.
Lorsqu’on dit qu’un lieu est sacré, comme s’il l’était ontologiquement,
c’est que son état vibratoire a été élevé régulièrement et puissamment
pendant de longues périodes, et qu’il en subsiste quelque chose en
dehors des cérémonies. Pour autant, la sacralisation d’un lieu ne
présente pas de caractère définitif.
Le rite repose sur des assertions de base prises pour axiomes qui
engagent la foi de l’initié. Il n’y a pas ici à démontrer, mais simplement
à suivre son intuition pour considérer ces principes fondamentaux
comme valides. Le rite ne se discute pas et le rituel est sa loi. Il est la
partie émergeante d’un Ordre Universel qu’il révèle à la conscience
individuelle.
Le rite constitue une structure hiérarchisée. Il a ses gardiens et
nécessite une classe de lévites dévoués à sa mise en action, des hommes
qui le vivifient de l’intérieur, pour le partager et le transmettre.
Le langage et les gestes ne sont pas ceux du profane ; ils doivent être
respectés ; il en va de leur dimension sacrée. Comme la flamme qui
44 Points de Vue Initiatiques N° 159
Frédéric Poilvet
nous anime en esprit, le rite est fragile, il doit être protégé ; c’est la
raison pour laquelle il ne peut être exposé au regard des profanes et
doit être conservé dans un lieu sûr et sacré. Il ne peut être vécu que
de l’intérieur.
Le rite s’organise d’une part autour de cérémonies ordinaires et
périodiques, et d’autre part de cérémonies particulières dites de
passage.
Les unes constituent un facteur de continuité alors que les autres
concrétisent un changement d’état. Les premières sont ordonnancées
selon des cycles plus ou moins longs calqués sur le mouvement des
astres ; les secondes jalonnent le parcours initiatique d’un individu
en particulier et, à cette occasion, l’ensemble de la communauté à
laquelle il appartient revit les étapes déjà franchies avec un regard
sans cesse renouvelé.
Il s’agit de pratiques universelles qui répondent à une nécessité
première.
Les cérémonies périodiques (comme les offices religieux
hebdomadaires) ont pour vocation de renforcer le rapport au
Principe. Il s’agit d’entretenir un lien suffisamment étroit pour
maintenir l’adepte (ou le fidèle) dans l’éternel présent du temps sacré.
Invocation à Mohammed, par Gustave Doré (1832-1883).
Points de Vue Initiatiques N° 159 45
L’entrée dans le sacré par les rites et les rituels
Un cycle de courte durée encourage à superposer vie biologique et
vie spirituelle au quotidien et à achever au dehors l’œuvre entreprise
dans le temple.
L’adepte s’efforce de sacraliser chaque instant de sa vie profane.
L’action du rite passe par la répétition d’actes et de paroles qui
pénètrent l’adepte et le façonnent. La densité du rite ne permet pas
de le pénétrer au premier abord, mais petit à petit, au fil du temps,
selon une maturation progressive. Le rite ne change pas, c’est la
perception que l’on en a qui évolue et se régénère de cérémonie en
cérémonie. Ainsi, les cérémonies périodiques, par leur répétition
même, toujours identiques et pourtant toujours différentes,
accompagnent l’initié dans sa quête de Vérité. On ne se baigne donc
jamais dans le même fleuve.
L’assiduité aux cérémonies périodiques garantit la continuité du
cheminement initiatique, malgré la nécessaire immersion dans le
monde.
Les religions prescrivent des actes rituels d’ordre privé – prières,
ablutions – qui rappellent au fidèle sa nature essentielle d’heure en
heure. Le cycle est ici ramené à la journée, unité de temps de base de
notre vie terrestre dont chaque heure doit être utilement employée. Il
n’est ici que de rappeler la répartition des heures de la journée selon
la Règle en pratique dans les monastères, pour comprendre combien
la ritualisation de l’activité humaine peut pénétrer chacun des actes
de nos vies et leur donner une dimension spirituelle et sacrée.
Les cérémonies périodiques célèbrent également les cycles vitaux
tels que les solstices d’été et d’hiver qui ont présidé à la construction
des premiers temples (Stonehenge par exemple). Ces périodes
répétées à l’infini, traduisent l’ascension et le déclin qui alternent
invariablement traduisant d’année en année l’Espérance qui soutient
l’initié. Elles sont l’image de sa vie terrestre et les fêtes rituelles sont
étroitement liées, sur un plan symbolique, au cours des astres et à la
ronde des saisons.
Dans les sociétés traditionnelles, les changements d’état – naissance,
puberté, mariage, ménopause, mort – sont vécus sur un plan physique
mais aussi, et surtout, sur un plan cosmique, comme des étapes sur le
chemin de l’existence, prise dans sa dimension initiatique et sacrée.
Il s’agit là du cycle long, de la vie humaine prise dans son entièreté.
Et il est ici utile de souligner la nécessaire progression du rite qui, de
cérémonies ordinaires en cérémonies de passage, transforme peu à
46 Points de Vue Initiatiques N° 159
Frédéric Poilvet
Le Mariage des Arnolfini, Les Époux Arnolfini, ou Arnolfini et sa femme.
Jan Van Eyck, 1434, National gallery, Londres.
peu le profane en initié accompli. La validité du rite s’évalue à sa
capacité d’apporter à l’adepte les outils de réflexion dont il a besoin
au fur et à mesure de son avancement, progressivement, en fonction
de l’éveil de ses facultés spirituelles. Ainsi, on parle volontiers de
l’enseignement du Rite. On compare également les différents degrés
du Rite aux différentes classes proposées par le système scolaire
profane. La réalité est autre car les sociétés traditionnelles proposent
d’accéder à la Connaissance et non d’accumuler du savoir. Or nul
ne détient la Vérité ; la Vérité traverse toute chose sans jamais se
laisser approprier ; elle est du domaine de l’Être et non de l’avoir.
En conséquence, le seul Maître qu’il nous est donné d’écouter est
Points de Vue Initiatiques N° 159 47
L’entrée dans le sacré par les rites et les rituels
un Maître Intérieur. Seule l’Ascèse permet de trouver le Maître
Intérieur et le Rite est là pour nous soutenir, pas à pas, dans ce travail
de recherche individuelle et personnelle, avec l’aide fraternelle et
bienveillante de toute la communauté des initiés.
Nos sociétés modernes et matérialistes ont perdu la faculté naturelle
de relier notre expérience physique à un ordre supérieur et les sociétés
initiatiques ont pour vocation de la retrouver.
Le rite permet ici de relier et de rassembler ce qui peut nous paraître
épars et morcelé afin de retrouver l’Unité première. Nous ne sommes
plus des hommes isolés en proie à des épreuves chaotiques, mais
nous appartenons à des ensembles plus vastes – l’humanité, le monde
du vivant, la manifestation, le cosmos – et le rite nous permet, du
microcosme au macrocosme, de nous insérer harmonieusement dans
cet édifice qui nous dépasse infiniment que nous qualifions d’Ordre
Universel. Ainsi le rite permet d’orienter nos modestes existences,
de leur donner du sens, par – delà notre condition misérable d’être
de chair voué à la putréfaction.
Quelle que soit la nature ou la fréquence des cérémonies ou des actes
rituels auxquels participe ou s’adonne l’initié, ces instants soustraits
au temps profane obéissent à certaines règles qu’il est impossible de
contourner. Le rituel prévoit toujours une entrée dans l’espace et dans
le temps sacrés, une action dans le sacré, et une sortie de l’espace
et du temps sacré : Une séparation physique et temporelle. Cette
séparation est très marquée au début de la progression initiatique
et s’atténue avec l’ascèse. L’initié apprend à maîtriser le sacré en
lui-même et est de moins en moins tributaire d’un conditionnement
extérieur. C’est ce qu’il est convenu d’appeler la construction du
temple intérieur. La sacralisation progressive d’un espace intérieur
qui n’a plus besoin de temples de pierre. Un temple de Lumière et
de Paix : La Jérusalem céleste qui descend dans le cœur même de
l’initié.
On associe volontiers la pureté au sacré, or pour être pur, le sacré se
doit d’être séparé ; ce n’est que lorsque l’initié connaît le sacré à l’état
pur qu’il peut l’intégrer en lui et le reconnaître hors de lui. Lorsque
cette conversion du regard est accomplie, peut alors commencer
un travail de réenchantement du monde par reconnaissance de la
nature sacrée de la Manifestation : un monde d’apparences qui est
écume d’Esprit.
48 Points de Vue Initiatiques N° 159
Frédéric Poilvet
Immuabilité du rite.
Peintures de la grotte de Lascaux.
Tout, dans la Manifestation sensible, est périssable ; Il n’y a
strictement rien de durable à quoi arrimer nos vies emportées dans
un courant rapide et tumultueux. L’expérience vitale ne trouve de
sens que par rapport à un repère fixe et immuable auquel se rattache
la manifestation tout entière. C’est ce que symbolise l’Axe du
monde.
Ainsi les rites et les rituels garantissent la même immuabilité ; ils ne
doivent subir aucune variation liée au temps ou au lieu. Ils s’inscrivent
dans l’immuabilité de l’espace et du temps sacrés. Il est sacrilège d’y
apporter quelque modification que ce soit. Rites et rituels sont garants
de la Tradition et doivent être transmis de génération en génération
sans aucune altération. Les sociétés traditionnelles considèrent que
les rites et les rituels leur ont été confiés par les Dieux et que toute
intervention humaine qui engendrerait la moindre modification
de l’immuabilité sacrée, serait une profanation et leur ôterait toute
portée initiatique. Les rites et les rituels nous relient mythiquement à
l’Origine. Ils assurent une continuité infinie dans la transmission de
la Tradition, tout en nous recentrant sans cesse sur elle.
Il y a également une raison pratique dans l’immuabilité du rite : elle
réside dans le fait que le rite ne se comprend pas et ne s’explique
pas ; il se vit.
Il a pour vocation essentielle de faire entrer l’adepte en vibration
Points de Vue Initiatiques N° 159 49
L’entrée dans le sacré par les rites et les rituels
avec le monde intelligible. La raison est mise hors circuit car c’est à
la part intuitive de l’Être que s’adresse le rite.
Pour être transmis dans sa pureté originelle, malgré l’imperfection
des passeurs, il est impératif que le rite conserve son immuabilité.
Chaque génération d’adepte peut ainsi retrouver le message initial,
même si tous, dans la chaîne de transmission, ne l’ont pas forcément
perçu dans toute sa dimension.
Les religions monothéistes ont repris des rites païens, les rites
maçonniques eux-mêmes sont de constitution composite ; les rites
se transmettent selon des courants qui affluent ou divergent mais
irriguent de façon continue l’esprit des hommes et tous proviennent
d’une source unique, considérée comme la Tradition primordiale.
Immersion dans le rite par l’Initiation.
L’étude du rituel n’est accessible qu’à l’Initié qui a vécu la cérémonie
de passage correspondante. En aucun cas, le rituel ne peut délivrer
ses secrets à la lecture profane.
La dynamique que met en œuvre le rituel lors des cérémonies
d’Initiation est irremplaçable et il est impossible d’en faire l’économie ;
c’est l’acte fondateur – initial – à partir duquel se construit toute la
nouvelle vie – en esprit – de l’initié.
Les cérémonies de passage se déroulent traditionnellement en
trois phases distinctes de durée variable. Dans un premier temps,
l’impétrant meurt à son ancienne condition, s’en suit une période de
mise à l’écart pendant laquelle il est éprouvé et enfin la cérémonie
s’achève par son admission dans son nouvel état au sein de la
communauté des Initiés du degré du rite auquel il accède. Les
cérémonies de passage ont une portée symbolique et leur caractère
initiatique est d’ordre métaphysique ; la partie centrale de la
cérémonie place l’impétrant hors du temps et de l’espace, hors de sa
condition d’âge, de sexe ou de statut social ; il est momentanément
projeté hors de tout ce qui constitue son ego. Au cours de ce voyage
intérieur, il prend conscience de sa nature profonde, pour en revenir
purifié. Ces cérémonies relèvent de la transmutation alchimique
et des trois phases principales qui la composent : nigredo, albado,
rubedo.
Les cérémonies de passage successives permettent de passer d’un
degré du rite au suivant en fonction de la maturité spirituelle de
l’Initié. Elles jalonnent son chemin initiatique et lui permettent de
mesurer les progrès accomplis. Ce n’est jamais l’initié lui-même qui
50 Points de Vue Initiatiques N° 159
Frédéric Poilvet
demande à intégrer le degré suivant, mais les Initiés du degré suivant
qui le reconnaissent apte à les rejoindre. Ainsi, de la naissance à
la mort, sur les chemins de la sagesse et de la connaissance, dans
une procession infinie depuis l’Origine, se suivent et se côtoient les
initiés. Ils ne forment alors qu’un seul Être, inépuisable, qui tombe et
se relève, porteur respectueux du rite qui l’alimente et qu’il nourrit.
Le rite est porté par la communauté des initiés unis en fraternité, les
vivants et les morts et tous ceux, répartis sur la surface du globe, qui
partagent un même idéal. La première cérémonie de passage est la
cérémonie d’Initiation, qui correspond à la naissance en esprit ; c’est
le franchissement de la « porte des hommes ». L’ultime cérémonie
de passage est la Mort, le franchissement de la « porte des Dieux ».
Tenue funèbre, par Félix Robaut, 1846.
Entre les deux, le Rite est le guide sur la voie de la Sagesse et de la
Connaissance ; il évite les écueils qu’une recherche solitaire, loin de
toute organisation initiatique, risquerait de rendre stérile. Par une
démarche graduée, il prévient également de la chute d’Icare. Ainsi,
nous entrons dans les voies qui nous sont tracées, selon la Sagesse
qui préconise d’emprunter la voie du Milieu.
Le Rite est respectueux de chacun, impersonnel, il ne dicte aucun
comportement, aucune idée préconçue. Sa portée universelle en
fait un instrument fédérateur, dans l’acceptation des différences.
Il donne un cadre à l’évolution spirituelle, et si chacun suit son
chemin, tous finissent pas se retrouver. Le Rite Écossais Ancien et
Accepté que pratiquent les Francs-maçons de la Grande Loge de
France est aujourd’hui le rite maçonnique le plus pratiqué dans le
monde. S’y retrouvent des hommes de toutes nationalités, de toutes
religions, de toutes tendances politiques qui oublient ce qui les agite
dans leur vie profane pour œuvrer à la construction d’un temple
Points de Vue Initiatiques N° 159 51
L’entrée dans le sacré par les rites et les rituels
spirituel, qui mérite tous leurs efforts, toute leur vigilance et toute
leur persévérance. Unis dans un même Idéal, quelle que soit leur
langue ou leurs habitudes profanes, ils se retrouvent dans des temples
tous semblables et partagent un rite identique sur toute la surface de
la planète. Ce Rite dans lequel ils se reconnaissent comme frères en
initiation leur permet de communier en esprit et de dépasser leur
condition individuelle. Émane alors de leur assemblée un esprit
commun, pacifié et serein, qui les relie au Principe, dans un temps
hors du temps, que certains nomment Éternité et qu’il convient de
qualifier de Sacré. n
Le Rite permet de communier en esprit et de dépasser la condition individuelle.
Émane alors un esprit commun qui relie au Principe.
52 Points de Vue Initiatiques N° 159
Henri Lentillac
Le Rite au-delà de
la mise en condition
psychologique
C’est aujourd’hui un lieu commun que d’attribuer à la pratique d’un
rituel un objectif de mise en condition psychologique. Sans nier cette
réalité, il faut airmer que la fonction du rituel est plus complexe, plus
profonde et plus ambiguë. Le rituel maçonnique œuvre sur tous les
plans à la fois et celui des afects n’est ni le seul, ni le plus important.
Cette action transversale autorise l’accès à un espace intérieur de
véritable spiritualité où paradoxalement, la contrainte enfante la
liberté et le dépouillement se révèle richesse.
Le Bassin aux nymphéas, Claude Monet, 1899,
Metropolitan Museum of Art, New-York.
Points de Vue Initiatiques N° 159 53
Le Rite au-delà de la mise en condition psychologique
Une approche du Sacré
Pour celui qui le découvre, le Rite qui va soutenir une réunion d’initiés
peut n’être perçu que comme un conditionnement supplémentaire à
ceux déjà vécus dans le monde profane. Il peut être ressenti comme
un nouveau dogme développé au profit d’un prêt à penser. Or, il n’est
rien de tout cela. La Franc-maçonnerie n’est pas une secte et n’a rien
à révéler de tellement difficile à croire qu’une mise en condition
psychologique serait nécessaire. La recherche initiatique, ce sont des
idées généreuses et désintéressées, des hommes intelligents par le
cœur et l’esprit, au service en toute humilité, non d’un petit groupe
d’adeptes, mais de l’humanité et du Sacré qu’elle recèle en son sein.
Le Rite n’est pas là pour se distinguer du monde extérieur mais pour
mieux vivre en commun tout ce que les civilisations successives nous
ont apporté de sagesse et de réflexion. Il est l’expression de traditions
millénaires tournées vers la spiritualité que l’espèce humaine s’est
forgée pour mieux se transcender, dès l’émergence d’une pensée
construite et les réflexions qu’elle génère sur son devenir dans la
mort.
Guide sur la vie après la mort pour le gardien de la propriété de la déesse Mout Sesech
Papyrus Égyptien
Dans Mythe et Épopée, Georges Dumézil, en nous éblouissant par un
récit original de la vision tripartite du monde que se partageaient les
Indo-Européens, nous faisait redécouvrir cet ordre sociétal où prêtres,
guerriers et éleveurs agriculteurs prennent leur place en élaborant
des rituels qui structurent leur univers. En Franc-maçonnerie, il ne
s’agit plus de religieux ; la fonction sacerdotale, liée à la souveraineté
54 Points de Vue Initiatiques N° 159
Henri Lentillac
magique et juridique, qu’il mettait en scène par le récit d’épopées
extraordinaires, correspond alors à une structure de pensée tournée
vers une recherche de spiritualité.
Les dieux, s’ils trouvent encore leur place pour certains d’entre nous,
ne sont plus une réalité transcendante mais l’expression du besoin
humain de dépassement de soi et de recherche d’une haute élévation
spirituelle qui s’apparente en quelque sorte à une ascèse.
En effet, cette recherche est celle de toute une vie ; en Franc-
maçonnerie, il existe des maîtres mais ce sont nos égaux et il n’y a pas
de coach qui permettrait en trois séances de découvrir les secrets du
bonheur, de la réussite ou de la confiance en soi. C’est une patience
exemplaire que requiert l’aboutissement d’une vie marquée par le
désir de s’approprier une part de divin ; l’homme est à la recherche
d’un sens qu’il ne perçoit plus tant son comportement le rend
ordinaire par les nécessités de sa survie matérielle. Cette patience
et la complexité réelle de la démarche initiatique ne peuvent être
soutenues que par des traditions qu’une fausse modernité trahirait
rapidement.
Une spiritualité issue de traditions millénaires
L’expression de traditions immémoriales faites de questionnements
apparaît dans le Rite. Il est l’expression de la beauté du monde
célébrée par toutes les cultures qui, depuis l’origine de l’Homme,
ont toujours cherché à révéler, par l’art et leurs traditions orales et
écrites, le sacré qui s’en dégage. Le Rite structure notre quête tout en
lui permettant de se dégager d’un savoir par trop philosophique ou
religieux, littéraire ou émotionnel. Il nous faut d’abord pratiquer sans
croire, apprendre à évacuer l’affectif pour trouver des réponses que
les manuels de psychologie ne nous donneront jamais et réapprendre,
par le respect d’un rituel, expression d’un rite vivant susceptible de
nous positionner sur notre propre voie intérieure. En matérialisant
des signes protocolaires empreints d’une certaine simplicité, en
évoluant dans des décors et les symboles qui les accompagnent,
nous retrouvons, par le moyen de gestes premiers, une manière
millénaire de spiritualiser la matière. Il existe une nécessité puissante
de codification des cérémonies car comme l’écrit Régis Debray dans
le Feu sacré, « une liturgie tient mieux la route qu’une philosophie… et
n’importe quel rituel est une petite machine à remonter le temps ».
Remonter dans le temps, comprendre l’Histoire, se ressourcer dans
le flux des traditions juives et chrétiennes, grecques et latines grâce
Points de Vue Initiatiques N° 159 55
Le Rite au-delà de la mise en condition psychologique
au Rite Écossais Ancien et Accepté que nous pratiquons à la Grande
Loge de France, nous permet de nous projeter au-delà d’un seul
dogme. Nous ne conservons des religions que la communication
avec le Sacré que la mémoire des hommes a su nous transmettre
depuis l’origine la plus lointaine de l’humanité.
Il ne s’agit pas d’un simple bien-être psychologique que l’on
retrouverait dans la fraternité de la loge. La loge et son cérémonial
sont là pour nous mettre en pleine conscience de la synthèse de ces
traditions où l’homme puise l’influence spirituelle véhiculée par
l’Initiation. Pas de psychologie facile ni de simple camaraderie dans
l’avènement d’une fraternité initiatique qui renverse chaque individu
à l’intérieur de lui-même et lui permet de tendre vers son propre
divin. « L’âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni
l’ouïe, ni la vue, ni la douleur, ni quelque plaisir, mais qu’au contraire elle
s’isole le plus complètement en elle-même, en envoyant promener le corps
et qu’elle rompt, autant qu’elle peut, tout commerce et tout contact avec lui
pour essayer de saisir le réel. » (Platon, Phédon, Éditions Garnier) La
La loge et son cérémonial sont là pour mettre en pleine conscience la synthèse des
traditions. Plan de loge (Rituel du Premier Degré du R.E.A.A., G.L.D.F.)
56 Points de Vue Initiatiques N° 159
Henri Lentillac
pratique du Rite ne s’évalue alors plus comme un asservissement
mais comme une facilitation à la compréhension d’un monde issu
du chaos. Le Rite, au travers du rituel par lequel il est vécu, est un
élément de transmission de cette Tradition humaine de dépassement
du chaos.
Que chacun vénère les dieux selon le rite de sa cité disait Socrate. Le
respect d’un ordonnancement rythmé par un rite permet justement
de se libérer des contraintes psychologiques que la franc-maçonnerie
n’est pas là pour résoudre mais pour dépasser. Notre méthode
traditionnelle d’étude du symbolisme, des mythes et des légendes
repose sur le Rite qui lui donne son architecture et sa noblesse. René
Guénon (Aperçus sur l’Initiation, Éditions traditionnelles) écrivait que
les rites « constituent l’élément essentiel pour la transmission de l’influence
spirituelle et le rattachement de la chaîne initiatique, si bien qu’on peut dire
que, sans les rites, il ne saurait y avoir d’initiation en aucune façon… Les
rites ont toujours pour but de mettre l’être humain en rapport, directement
ou indirectement, avec quelque chose qui dépasse son individualité et qui
appartient à d’autres états d’existence. »
L’esprit de la nuit, John Atkinson Grimshaw, 1879.
Une ouverture au sens de la vie
Le Rite est présent pour ouvrir celui qui le pratique à certaines
possibilités de connaissance, profondément liées à la méthode
véhiculée par ce rite, plus que par le contenu lui-même. Aucun
mysticisme sous le Rite qui est la manifestation d’une technique
rigoureuse d’initiation qui permettra à l’individu qui l’a reçue de
Points de Vue Initiatiques N° 159 57
Le Rite au-delà de la mise en condition psychologique
conserver sa qualité d’initié quel que soit son attachement ou son
éloignement par rapport à telle ou telle obédience maçonnique.
C’est le rite lui-même, en particulier le Rite Écossais Ancien et
Accepté, qui nous fait vivre concrètement et rationnellement, avec
tant d’intensité depuis notre initiation, une réalité immatérielle
éternelle à l’humanité. De la même manière que la tradition de métiers
des constructeurs de cathédrales élève le regard par l’architecture, la
dimension spirituelle de la pratique maçonnique est soutenue par le
Rite. Cette réalité est celle
d’une construction lente
du sens, de compréhension
des qualités profondes
de l’homme et de celles
qui sont propres à nous-
mêmes. La vivre par le
Rite permet d’atteindre son
sanctuaire intérieur sans se
préoccuper de psychologie
mais en s’attachant à ne
déceler que l’essence de
la connaissance. Au-delà
de son expression par un
rituel parfois complexe
mais toujours porteur
d’une grande richesse dans
l’expression des symboles,
Élever le regard par l’architecture.
le Rite est l’expression Œuvre majeure de Franck Lloyd Wright,
même du dépouillement des le Guggenheim Muséum de New York
oripeaux du vieil homme ; (1943-1959) est sans doute la première « icône »
de l’architecturale muséale du XXe siècle.
il ne nous fait garder que la
tunique, tel Ghandi, pour
ne faire ressortir que la conscience d’appartenir à un ensemble où
l’exemplarité de l’un se fait au bénéfice de tous.
Mais le profane est en droit de se demander en quoi la pratique d’un
rite pourrait l’amener à une meilleure compréhension du monde.
En quoi une discipline rigoureuse, qui est celle de la fraternité, mais
surtout celle de l’obéissance à des règles strictes, ferait de nous de
meilleurs hommes, de véritables et sincères initiés. Je répondrai que
cette discipline dans le Rite, facteur d’union, est le meilleur chemin
de l’harmonie entre les frères ; elle leur fait oublier leur ego et toutes
les conséquences psychologiques qui s’y attachent. La prise de parole
58 Points de Vue Initiatiques N° 159
Henri Lentillac
à tour de rôle qui oblige chacun à l’écoute et à la réflexion permet
de vivre l’action initiatique ; celle-ci est « une action d’interrogation,
de perception, d’observation, de découverte et de compréhension. Quand
cette compréhension frappe de ses rayons les fibres de notre cœur, elle
éclaire tout le sens de la création… La vocation de la Franc-maçonnerie est
indiscutablement spirituelle et son exigence humaniste est… l’authentique
marque d’une vraie démarche initiatique » (Alain Pozarnik – Vivre les
rituels à la Grande Loge de France, PVI 131).
La pratique d’un rite spiritualiste dans une obédience traditionnelle
n’est pas un paradoxe comme pourrait le croire celui qui n’est pas
Franc-maçon mais bien au contraire une manière de se libérer des a
priori et des dogmes. Le Rite est l’expression même du dépouillement
psychologique qui permet de s’ouvrir à la voie spiritualiste ; il nous
donne la réponse au comment par le travail de perfectionnement
qu’il nous impose.
Une ascèse, expression de la liberté de pensée
Le terme d’ascèse est celui qui, à mon sens, exprime le mieux la
recherche initiatique et le Rite qui l’accompagne. La compréhension
du sens de la vie, l’idée au-delà du mot, exige une grande rigueur avec
soi-même. Ce n’est donc pas d’une mise en condition psychologique
dont nous avons besoin mais d’une mise en condition intellectuelle ;
toutefois, l’apport de la connaissance ne se fait pas seulement par
les images classiques de la reconnaissance universitaire mais par
l’éclosion d’une pensée reposant sur deux piliers complémentaires,
savoir et intuition. Cette ascèse magnifie la liberté de réflexion que
donne le Rite. Il nous détourne avec bonheur de nos habitudes
intellectuelles de pensée tournées vers une approche extérieure des
objets inertes pour nous recentrer vers l’intuition qui est coïncidence
fulgurante avec le réel. Nous nous retrouvons au centre de nous-
mêmes grâce à l’oubli des contingences de nos états d’âme et
des prérequis des sociétés profanes ou même maçonniques telles
les obédiences. « L’initiation traditionnelle et spirituelle comme celle
qu’institue le Rite Écossais Ancien et Accepté vise d’autres ambitions que
des cours de psychologie, de philosophie, d’histoire des religions ou autre ne
peuvent apporter. L’initiation et la spiritualité ne nient pas les connaissances
humaines, elles les intègrent en les transcendant. Pour tout dire, la voie
initiatique s’intéresse à tout ce qui construit l’homme, mais elle lui procure
un viatique particulier qui lui permet de dépasser l’univers psycho matériel
humain limité par nature pour accéder au Sacré et à l’Esprit. » (Jean-
Émile Bianchi – L’éveil spirituel sur la voie des symboles – Éditions Ivoire
Points de Vue Initiatiques N° 159 59
Le Rite au-delà de la mise en condition psychologique
Clair). Le symbole et le Rite, indissociablement liés, préservent ainsi
notre liberté d’interprétation et notre avancée spirituelle. Il ne s’agit
plus de transmettre des vérités, que nous dirons « révélées » mais de
transmettre le moyen de percevoir une vérité qui, bien qu’unique,
est, dans son ressenti sincère, parfaitement propre à chacun.
Par le Rite qui relie l’initié au Sacré, par cet éveil à l’Universel,
en nous élevant du monde sensible au monde intelligible, nous
accédons à cette Vérité première qui est celle de notre positionnement
spirituel au sein d’un « Tout ». En remontant la pente des habitudes
contractées au contact de la matière, en développant l’attention que
l’esprit se prête à lui-même, en développant notre intuition par une
méthode rituelle, nous repassons sans cesse de la matière à l’esprit
et de l’esprit à la matière. Le Rite, en tant que symbole exprimé par
l’action, est un puissant moyen de régénération spirituelle où les
acquis sont remis en cause par une modification de notre capacité à
désapprendre et à nous ouvrir à la Transcendance. Nous nous livrons
à un formidable combat, rythmé par le Rite, où la quête de sens, la
recherche d’un autre plan de la réalité, est inexprimable justement
parce qu’elle nous est singulière. n
Combat avec un centaure.
Photographie d’un dessin tiré d’une fresque de Pompéi,
Giorgio Sommer (1834-1914) et Edmond Behles (1841-1924).
60 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Emile Bianchi
Pour une approche
spirituelle du Symbolisme
du Rite Écossais Ancien et
Accepté
Il est impossible de parler du Rite sans évoquer le symbolisme qui
en est la voie essentielle. Encore faut-il l’aborder autrement que par
l’analyse et la logique seules. La pensée symbolique globalisante
ouvre son auteur à un univers tissé de correspondances et d’analogies.
La méthode maçonnique apprend à en maîtriser la confusion qui
peut être un piège. Entre une pensée rationnelle desséchante et une
pensée symbolique viviiante, le maçon ne choisit pas. Il utilise les
deux et féconde l’une par l’autre pour tracer sa route sur la voie du
Rite et construire un sens qu’il partagera avec ses frères.
Scène d’initiation de Frédéric de Prusse.
Bayreuth, Musée allemand de la Franc-maçonnerie.
Aujourd’hui, une extrême confusion règne dans la riche terminologie
de ce que nous pourrions appeler « la symbolique générale ».
Ainsi, Gilbert Durand rappelle avec pertinence cet univers confus
entre « « image », « signe », « allégorie », « symbole », « emblème »,
« parabole », « mythe », « figure », « icône », « idole », etc. (qui) sont utilisés
Points de Vue Initiatiques N° 159 61
Pour une approche spirituelle du Symbolisme du Rite Écossais Ancien et Accepté
indifféremment l’un pour l’autre par la plupart des auteurs. » Tous
ces termes représentent des réalités différentes qu’ont pu employer,
philosophes, psychologues, psychanalystes, anthropologues,
sémiologues et autres praticiens, analystes de l’imaginaire humain.
Que le symbole initiatique ait une spécificité différente de celle que
lui accordent les sciences profanes ne doit pas nous étonner. Seule
une approche spirituelle du symbolisme du Rite Écossais Ancien et
Accepté pourra mettre véritablement en lumière cette spécificité.
L’initiation spirituelle telle que la pratique un maçon de la Grande
Loge de France répond à une démarche vécue dans des conditions
particulières, ignorée de ceux qui ne peuvent les connaître que de
l’extérieur et d’une manière exclusivement intellectuelle. L’initiation
est d’abord quelque chose qui doit se vivre. Pour cela, le maçon
bénéficie de divers moyens, certains sont inhérents à sa personne,
les autres procèdent du rite qu’il pratique, en l’occurrence le Rite
Écossais Ancien et Accepté pour les maçons de la Grande Loge. Ce
rite n’est ni plus ni moins qu’une méthode qui ne vaut que par sa mise
en œuvre dans des conditions bien particulières, toutes choses qui
échappent forcément aux profanes, et même aux scientifiques qui ne
peuvent y avoir accès extérieurement que d’une façon intellectuelle
donc partielle et inadaptée.
Du mouvement pour aller outre
Il y a donc une spécificité attachée à l’appréhension du symbole et
du Rite qui procède de l’initiation en général et de l’initiation de
Rite Écossais Ancien et Accepté en particulier, initiation d’ordre
éminemment spirituel. Lorsque les symboles sont l’objet d’études
profanes, les approches qui en sont faites dénaturent souvent leur sens
spirituel pour les réduire à des objets d’analyse intellectuelle, ou à des
outils révélant des cas cliniques de dysfonctionnements psychiques.
Ce n’est pas sous cet angle que doit être abordé le symbole si nous
voulons avancer sur les voies qui nous ont été tracées par nos aînés.
En effet, il convient de ne pas se borner à une analyse systématique
du symbole même si, dans un premier temps, il est nécessaire d’en
passer par là. Il est capital de comprendre que le symbole présente
avant toute chose un caractère synthétique et qu’il doit être vécu
par des individus sains d’esprit, libres et de bonnes mœurs, et non
envisagé comme l’élément d’une thérapie psychique quelconque.
C’est la condition pour qu’il agisse et permette l’émergence de
parties de l’Être jusqu’alors occultées, car « celui qui connaît son âme
connaît son seigneur » nous dit le proverbe soufi.
62 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Emile Bianchi
Le symbolisme que nous
qualifierons désormais de
« traditionnel » (puisque son objet
essentiel est la « transmission »)
s’appuie sur la démarche
analogique généralement rejetée
par notre civilisation, reléguant
ainsi l’homme à une espèce de
sous-humanité oublieuse du Sacré.
Ainsi occulte-t-on volontairement
la situation réelle de l’homme qui,
depuis toujours, baigne dans cet
univers ordonné qui le contient
et le dépasse à la fois ; parce que,
comme l’écrit Rudolf Otto :
« au-dessus et au-delà de notre être
rationnel, il y a caché au fond de notre
nature, un élément dernier et suprême
qui ne trouve pas satisfaction dans
l’assouvissement et l’apaisement des
besoins répondant aux tendances et
aux exigences de notre vie physique,
psychique… ».
De tout temps et sous toutes les Psyché, représentée avec les ailes
latitudes, l’homme a ressenti d’un papillon, épouse d’Éros,
son appartenance à ce « quelque est la personnification de l’âme
dans la mythologie grecque.
chose » de supérieur à l’humain qui
pouvait aussi se présenter comme
un chemin vers la Lumière et la Vérité. Malebranche l’exprimait
en disant que « Nous avons toujours du mouvement pour aller outre. »
C’est le symbole et la pensée analogique qui traditionnellement
accompagnent ce mouvement naturel de l’homme jusqu’à son
propre dépassement.
La pensée occidentale évolue toujours entre deux extrêmes :
l’indéterminable et le déterminé, l’inégalité totale et l’égalité parfaite,
même si l’identité absolue est purement idéale. La pensée analogique,
elle, réfléchit différemment, elle considère les similitudes et les
dissemblances où peuvent apparaître de nombreuses nuances. Le
processus analogique permet d’explorer et d’assentir des similitudes
entre des choses apparemment différentes comme l’Homme et
l’Univers. L’analogie révèle des correspondances entre les différents
Points de Vue Initiatiques N° 159 63
Pour une approche spirituelle du Symbolisme du Rite Écossais Ancien et Accepté
ordres de réalité, elle manifeste des liens, rassemble ce qui peut à
première vue apparaître éloigné, voire opposé. Elle permet d’accéder
à toute une partie de la réalité que la logique de l’identité n’atteint
pas, elle intervient comme stimulation de l’intuition et laisse plus de
liberté au cherchant. En n’aboutissant jamais à l’identification totale,
elle est plus ouverte sur les rapports changeants entre le symbole et
le méditant.
Pour les maçons, humanistes et spiritualistes à la fois, hommes
dans le siècle, mais aussi hommes respectueux du passé, il est
nécessaire d’accepter que le savoir et la connaissance qu’ils tentent
d’acquérir reposent sur deux logiques, sur celle de l’analogie et celle
de l’identité. La civilisation ne peut s’édifier sur une seule colonne
ni sur un seul instrument du savoir. Connaître n’est pas savoir, et
le risque serait de penser découvrir un sens définitif à la vie et au
monde. Le symbole constitue la meilleure garantie parce qu’il ne
se laisse pas violer par l’évidence, au contraire il est un mystère à
moitié dévoilé à moitié caché, la part de vérité qu’il libère varie
toujours avec l’avancement spirituel de son contemplateur, et son
interprétation est inépuisable. Le symbole initiatique est riche de
significations multiples, car il les possède toutes depuis la nuit des
temps, dans l’invariabilité du Principe créateur de toutes choses
que le maçon écossais appelle Grand Architecte de l’Univers. En
effet, le symbolisme trouve ses racines dans la nature et les êtres et
il est en parfait accord avec les grandes lois cosmiques. Il suffit d’un
peu de réflexion pour comprendre très vite que ces lois naturelles
ne sont au fond qu’une expression, si l’on peut dire, de la volonté
du Grand Architecte. Le véritable fondement du symbolisme, c’est
donc la correspondance reliant les différentes réalités les unes aux
autres, depuis l’ordre naturel et visible jusqu’à, et y compris, l’ordre
surnaturel invisible. En conséquence de quoi, du fait même de cette
correspondance, la nature tout entière, l’univers manifesté que les
églises appellent « la Création » n’est lui-même qu’un symbole. Et
comme tout symbole elle est un outil qui, bien utilisé, doit nous
permettre de nous hisser à la connaissance de vérités supérieures,
des vérités « métaphysiques ou spirituelles » au sens étymologique
de ces mots. Là est précisément la fonction du symbolisme.
Le symbole, « langage des dieux ».
En matière de symbole, il faut choisir entre deux attitudes
possibles :
- Dans la première attitude, on conviendra que le symbole et le
64 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Emile Bianchi
symbolisme participent du discours socioculturel. Alors, notre
démarche symbolique ne dispose d’aucune spécificité par rapport
au monde profane, et l’objectif poursuivi peut se confondre avec une
recherche philosophique, religieuse, ou autre où il n’est pas besoin
d’être initié.
- Dans une seconde attitude, on décidera que le symbole transcende
le discours culturel dans la mesure où les rites et les mythes relient
l’initié au Sacré, production de la cause première dont l’une des
caractéristiques est de transcender l’humain. Dans cette dernière
occurrence, celle que nous avons retenue, et qui correspond pour
nous à l’esprit du symbolisme du Rite Écossais Ancien et Accepté,
les symboles expriment quelque chose qui dépasse les possibilités
ordinaires du langage humain et constituent une véritable langue
sacrée, « le langage des dieux » qui peut conduire idéalement l’initié
à la Lumière, et lui permettre de s’approcher de la Vérité une et
universelle. Alors, le symbole devient effectivement l’outil privilégié
qui ouvre les portes du Sacré parce que le Sacré n’appartient pas à la
culture profane, mais au « Tout autre », au « Tout différent ».
Le Mythe de Prométhée, métaphore de l’apport de la connaissance aux hommes.
Piero di Cosimo (1462–1521)
Ce choix fut déjà celui des sociétés antiques et il est celui de toutes les
sociétés initiatiques traditionnelles en général. Le symbole ne relève
pas du discours, de l’analyse ou du concept, il traduit une prise de
conscience globale, une vision synthétique du monde. Cette vision
nécessite d’être vécue et non pas traduite par un discours ; jamais la
Points de Vue Initiatiques N° 159 65
Pour une approche spirituelle du Symbolisme du Rite Écossais Ancien et Accepté
raison seule n’épuise sa signification qui est, par définition même,
intarissable. Mais notre société désacralisée a profané le symbole
en n’y voyant qu’un signe parmi d’autres, interchangeable dans ses
multiples significations plus ou moins arbitraires et changeantes
avec les époques et les disciplines.
Pour le Maçon écossais, l’approche du symbole traditionnel exige
un oubli temporaire de ses savoirs psychologiques, philosophiques,
religieux et linguistiques, pour communier avec sa nature profonde
en résonance harmonique avec l’autre part de l’être que le symbole
occulte dans un premier temps pour la révéler par la suite. Le
processus symbolique demande à être ressenti de l’intérieur plus
avec « l’intelligence du cœur » qu’avec les outils de l’analyse.
Il faut comprendre que le symbole n’appartient pas aux seuls signes
de l’univers humain, à son discours, à son imaginaire ou à ses
concepts. Le symbole possède une fonction particulière intimement
liée à son orientation sacrée, joint à ce qui nous dépasse.
Le symbole moyen d’accès privilégié au contenu
initiatique de nos rituels.
La Grande Loge de France appartient à un Ordre initiatique
traditionnel, son rite est une véritable école de vie, la méthode
symbolique qu’elle dispense la distingue donc de la plupart des
enseignements ordinaires. Elle ne constitue en rien le prolongement
d’une quelconque instruction profane, pas plus qu’elle ne s’y
oppose ; elle n’est pas non plus l’enseignement d’une philosophie ou
d’une morale ; cette méthode symbolique est totalement sui generis,
autrement dit : d’un ordre absolument différent.
66 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Emile Bianchi
Cette différence tient notamment à l’emploi du symbole
comme moyen de transmission de la « Connaissance ». Cette
« Connaissance » doit être envisagée comme quelque chose qui,
contenant l’universalité du savoir humain (bien peu de chose en
vérité !), le transcende immensément puisqu’elle se confond avec
l’Être. L’emploi du symbole permet à la démarche maçonnique de
tendre vers la compréhension de réalités et de principes qu’il est
impossible d’exprimer dans leur intégralité par des mots. Ces réalités
et ces principes supérieurs auxquels réfèrent nos rituels nécessitent
un langage plus universel parce qu’ils appartiennent à un ordre
également plus universel.
Nous devrions pouvoir - même dans notre vie quotidienne - envisager
toute réalité du point de vue symbolique et sacré ; de fait, c’est
l’homme qui jette sur le monde un regard profanateur créant une
distanciation entre lui et la Vérité. Par l’intermédiaire du symbole, la
démarche initiatique convertit le regard de l’être vers l’Un, principe
de toute chose. Ainsi, selon l’analyse que fait Sylvain Roux de
l’œuvre de Plotin, « la présence de l’âme à l’Unité principielle apparaîtrait
(…) comme la conversion du regard vers l’Un C’est en se détournant d’un
autre regard possible, orienté vers l’extérieur et le sensible, que la saisie de
l’Un peut avoir lieu. » Néanmoins, « la présence de l’âme à l’Un ne saurait
se faire par un rapprochement local de deux termes séparés, mais seulement
par un changement d’état, une modification d’un des termes. L’absence de
l’Un n’est donc jamais qu’un « devenir autre » de l’âme, qu’une altérité qui
résulte d’une séparation seulement « qualitative ». Ce point est capital, car il
permet à Plotin de soutenir que l’Un est toujours là, toujours présent, mais
aussi que la séparation nous incombe, puisqu’il est toujours déjà là. »
Le symbole apparaît donc comme l’outil d’une symbiose qualitative
qui rendra immanente à « l’œil du cœur » la lumière principielle.
Par son intermédiaire, le sujet contemplant et l’objet contemplé ne
font plus qu’un : le symbole participe donc à résorber la distance
entre le Principe et l’homme. Le symbole, universel par nature, se
prête à nombre d’interprétations qui ne s’opposent pas, mais qui,
au contraire, se complètent et s’enrichissent mutuellement, chacune
d’elles étant vraie dans le point de vue particulier qui s’exprime.
Mais ceci n’est possible que parce que l’approche spirituelle conduit
à appréhender le symbole comme l’image synthétique d’un ensemble
d’idées que chacun peut saisir selon ses aptitudes propres ; ceci
encore, dans la mesure où l’initié est préparé à la démarche par le
Rite, la Loge, et ses aînés chargés de lui donner la première lettre.
Le symbole constitue alors le moyen unique de transmission de ce que
Points de Vue Initiatiques N° 159 67
Pour une approche spirituelle du Symbolisme du Rite Écossais Ancien et Accepté
Parmi les huit symboles bouddhistes, le nœud éternel.
Avec ses lignes liées dans une structure fermée,
il représente la dépendance et l’interdépendance de tous les phénomènes.
Il symbolise aussi la loi de cause à effet et l’union de la compassion et la sagesse.
la raison humaine ne peut saisir ou saisir dans sa totalité. Ne pouvant
être appréhendée de manière discursive, l’expression d’une réalité,
pourtant vécue intérieurement, devient pratiquement impossible
parce qu’elle fait écho à un autre niveau de conscience de l’être.
Ce niveau de conscience supérieur est du domaine de la perception
intuitive intellectuelle ou spirituelle, lieu privilégié de l’expérience
initiatique. Il reste au maçon, par un travail personnel, à actualiser
cette potentialité. Saisir cette réalité constitue le véritable secret de
l’initiation, bien différent de celui que certains profanes se plaisent
souvent à imaginer… Ce secret sera difficilement communicable
parce qu’il s’agit toujours de quelque chose de vécu, fonction de la
personnalité de chacun, de ses facultés intellectuelles et spirituelles.
Les caractères synthétique et universel du symbole le désignent tout
naturellement pour servir « de point d’appui » à l’intuition spirituelle.
Cette dernière est seule apte à saisir la part qui demeurerait
inexprimable pour le langage analytique instrument de la pensée
rationnelle. Si les outils symboliques sont d’origine humaine par leur
conception et par leur fabrication, le symbole qu’ils évoquent, lui,
demeure étranger à tout inventeur humain. Le fil à plomb suggère
les symboles que sont : « la verticale et la perpendiculaire », aucun
inventeur humain ne peut leur être assigné, c’est pourquoi certains
auteurs comme René Guénon affirment que le symbole est d’origine
non humaine.
68 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Emile Bianchi
Symbole solaire Indien du XVIIe siècle brodé au fil d’or.
Cette origine non humaine confère au symbole traditionnel et au Rite
un caractère universel et justifie leur approche sur le mode spirituel
au sens étymologique du terme. Non au sens de la manifestation
de l’intellect telle que nous la comprenons aujourd’hui. Il ne s’agit
pas d’engager un processus cérébral, psychique ou mental, mais
de saisir la pure intellection, plus proche de l’intuition qui, dans sa
fulgurance, appréhende directement « La Réalité » en dehors de tout
sentiment et en dehors de toute ratiocination. Ce caractère universel
qui appartient en propre au symbole traditionnel nul concept humain
ne le possède. Le concept demeurera toujours la manifestation d’un
point de vue particulier et limité, source de divisions. Ainsi donc,
le symbole traditionnel, par son origine non humaine, se trouve-t-il
chargé d’un influx spirituel qui éveille et stimule la faculté intuitive
de l’être, sous réserve néanmoins que l’initié pratique l’ascèse rituelle
appropriée.
Pour le maçon de La Grande Loge de France pratiquant le Rite
Écossais, il est évident que la connaissance théorique, si elle est
nécessaire, n’est pas suffisante en soi ; la lecture d’un dictionnaire des
symboles ne pourra lui procurer qu’un savoir de plus sans apports
spirituels particuliers. En revanche, une approche des symboles et du
Rite par le cœur, l’âme, et le développement des vertus humaines,
en accord profond avec sa conscience l’aideront à franchir les degrés
de la Connaissance et lui procureront une joie ineffable. Aussi
Points de Vue Initiatiques N° 159 69
Pour une approche spirituelle du Symbolisme du Rite Écossais Ancien et Accepté
l’approche spirituelle du symbolisme rituel que la Grande Loge de
France met à la disposition de ses initiés apparaît-elle comme la
modalité la plus appropriée pour leur favoriser l’accès à un ordre
de réalité supérieur s’étendant sur les divers plans intellectuels,
moral et spirituel, à condition néanmoins qu’ils n’oublient jamais de
transférer le centre de leur conscience du cerveau au Cœur. Alors,
le chemin de la Connaissance s’ouvrira sous leurs pas et peut-être
pourront - ils dire : « Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir,
d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui
je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. » (1re
Épître aux Corinthiens XIII, 12.) Parce que « Mon cœur est devenu
capable de toute forme : il est un pâturage pour les gazelles et un couvent pour
les moines chrétiens, et un temple pour les idoles, et la Kaabah du pèlerin, et
la table de la Thorah et le livre du Qorân… » (Mohyiddin ibn Arabi)
NB : Je tiens à remercier mon éditeur qui m’a autorisé à présenter cet
article, largement inspiré par les thèmes que je développe dans mon
dernier livre L’Éveil Spirituel sur la Voie des Symboles, préface de
Claude Collin, Commandeur du Suprême Conseil de France et illustrations
de Franck Martin, aux Éditions « Ivoire-Clair » Groslay, novembre 2010. n
Alors, le chemin de la Connaissance s’ouvrira sous leurs pas.
70 Points de Vue Initiatiques N° 159
Pierre Vajda
Le Rite écossais, voie
d’accès à la connaissance
Louis-Claude de Saint-Martin distinguait l’Homme du Torrent,
le profane en proie à ses conditionnements, de l’Homme-Esprit,
l’initié réalisé. Entre les deux, l’état qui permet le passage de l’un à
l’autre, c’est l’Homme de Désir… une distinction que ne réfuterait
pas Schoppenauer caractérisant l’homme par son Vouloir-Vivre,
sa volonté. C’est bien ce qui met en chemin le maçon en quête de
spiritualité. Les outils proposés par le Rite peuvent conduire à la
Connaissance. À ce titre on peut parler, en Franc-maçonnerie, d’une
Voie du Rite…
Connaissance,
partie d’un
monument au
maharajah de
Mysore (État du
Karnataka, Inde).
L’univers maçonnique est divers dans ses obédiences, dans ses rites
comme dans les motivations initiales des candidats qui sollicitent
leur admission.
Mais au Rite Écossais Ancien et Accepté, tel qu’il est pratiqué à la
GLDF, il n’y a qu’une seule justification à l’entrée en maçonnerie :
le désir du postulant de s’élever spirituellement parce qu’il a pris
conscience d’être dans les ténèbres et de désirer la Lumière.
Points de Vue Initiatiques N° 159 71
Le Rite écossais, voie d’accès à la connaissance
Cette simple phrase résume le programme et l’ambition du REAA,
ainsi que la signification de l’initiation, à savoir passer des ténèbres
profanes à la Lumière que confère l’initiation maçonnique. Encore
faut-il comprendre ce que l’on entend par Lumière et comment le
Rite peut y conduire.
Le Franc-maçon est avant tout un cherchant, un individu en quête de
vérité. Et la vérité qu’il cherche n’est pas la vérité au sens du savoir
profane, qu’il soit scientifique ou philosophique ; non pas qu’il ignore
ou méprise les lumières de la raison et le savoir scientifique mais sa
quête se situe sur un autre plan. Sa quête est d’ordre ontologique ;
elle porte sur le sens de la vie et la manière d’assumer pleinement
son humanité.
Lorsque l’on se place sur le plan scientifique, quelque soit le
domaine considéré, est envisagé comme vrai ce qui n’est pas
contredit par l’observation des faits ou par le bon usage de la raison ;
la concordance avec les faits est l’ultima ratio qui fonde la validité des
théories. Les vérités ainsi établies sont toujours relatives à un certain
état de développement de la science. C’est pourquoi la communauté
scientifique récuse généralement toute notion de vérité absolue car
elle sait bien que dans les divers domaines qu’elle explore, la vérité
est toujours relative et susceptible
d’être remise en question par la
découverte de nouveaux faits
ou par la formulation d’une
théorie plus générale. Toute
prétention à exprimer la vérité
de façon définitive ou absolue
ne peut être que dogmatique et
relève de la croyance ; celle-ci
est aujourd’hui définitivement
évacuée hors du champ
scientifique car elle est inutile à
son développement quand elle ne
lui fait pas directement obstacle,
comme ce fut le cas aux époques
où la vérité était d’abord celle
des Écritures.
Il en va de même dans le REAA,
qui n’accepte aucune vérité
Un paysan et trois personnages animés,
révélée qui serait en quelque
Jérome Bosch, (1480-1515) sorte imposée à l’adepte du
72 Points de Vue Initiatiques N° 159
Pierre Vajda
seul fait de sa soi-disant origine divine. Tout comme le scientifique
d’aujourd’hui, le Franc-maçon de Rite Écossais Ancien et Accepté
considère toutes les opinions mais ne les accepte pour justes que
si elles lui sont apparues comme telles après les avoir examinées.
Il ne profane pas le mot de vérité en l’accordant aux conceptions
humaines. Il tient la vérité absolue pour inaccessible à l’esprit
humain et travaille ardemment à s’en approcher sans prétendre
jamais l’atteindre, encore moins la posséder.
Dans quel espace la quête du Franc-maçon se situe –t-elle ?
Quelle est la nature de la Vérité qu’il cherche ?
Sa quête appartient au domaine de la Connaissance (généralement
écrite avec un C majuscule) qui entend donner du sens à la vie
intérieure de l’homme, le mettre sur un chemin qui le reliera
harmonieusement à ses semblables et au monde, lui permettre
d’exercer pleinement sa liberté d’individu autonome et aller vers la
plénitude de la réalisation de son être profond et véritable, c’est-à-
dire débarrassé des pesanteurs et des conditionnements ordinaires
qui entravent sa perception de la Lumière.
S’engager sur le chemin initiatique proposé par le REAA, c’est
se transformer soi-même pour chercher à devenir ce que l’on est
vraiment, au-delà du personnage et des masques que tout un chacun
se fabrique pour exister et assurer sa protection dans la société.
Le Marchand de Masques par Zacharie Astruc, 1883. Jardin du Luxembourg.
Points de Vue Initiatiques N° 159 73
Le Rite écossais, voie d’accès à la connaissance
S’initier, c’est se mettre en route vers un nouvel état d’être, plus
ouvert à des vérités d’un autre ordre. C’est pourquoi l’initiation
maçonnique traditionnelle comporte une dimension ontologique
qui propose à l’adepte de faire mourir le vieil homme qui est en lui
pour renaître à une vie nouvelle, celle de l’initié.
Cela ne se fait évidemment pas par la magie d’une cérémonie
d’initiation mais par un long travail sur soi, guidé par le Rite selon
des voies éprouvées par une longue tradition initiatique.
Il faut comprendre, en effet, que l’éclatement de la pensée humaine,
en corpus et pratiques désormais séparés, philosophie, religion,
sciences de la nature, art, éthique, sagesse, est un phénomène
relativement récent dans l’histoire des hommes et que les approches
traditionnelles ignoraient ces clivages. Les grands penseurs de
l’Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance et encore du dix-
huitième siècle, étaient des esprits universels qui s’efforçaient de
mettre en harmonie leur vision globale de l’univers et la manière
dont ils conduisaient leur vie.
Grâce à la différentiation des domaines de connaissance, d’immenses
progrès ont été faits dans la compréhension et la maîtrise du
monde matériel mais les nouveaux savoirs plus spécialisés ayant
progressivement supplanté les anciens arts libéraux dans les
programmes éducatifs, l’homme moderne a beaucoup perdu de son
aptitude à progresser sur le chemin de la sagesse et de l’harmonie
intérieure. Le REAA, en tant que porteur d’un héritage de sagesse
immémoriale, est pour l’homme d’aujourd’hui, une des voies
privilégiées d’accès à la Connaissance et un chemin sans égal pour
son épanouissement spirituel et moral, en dehors de tout a priori
dogmatique ou religieux, sans pour autant récuser les enseignements
de sagesse contenus dans la tradition judéo-chrétienne, ni renoncer à
intégrer à sa réflexion ceux des autres grandes traditions humaines.
Une gnose à ne pas confondre avec le gnosticisme
Dans ce sens très général, l’initiation maçonnique apparaît comme
une gnose (gnosis = connaissance) à la fois parce qu’elle est une
quête individuelle de la Connaissance et que cette recherche de
la connaissance de soi ne se différencie pas de la connaissance du
Tout. « Connais-toi, toi-même et tu connaîtras l’univers et les dieux ». Cette
phrase attribuée à Socrate, mais dont la première partie figurait sur
le fronton du temple de Delphes, indique bien le sens que le REAA
donne à la démarche introspective : une quête spirituelle qui fait
74 Points de Vue Initiatiques N° 159
Pierre Vajda
découvrir l’unité essentielle du monde et la présence de l’Esprit qui
habite dans le cœur de l’homme, présence que l’initié est appelé à
reconnaître pour vivre dans sa lumière.
Cette gnose inhérente au cheminement initiatique proposé par le
REAA, apparaît plus comme l’héritière de la pensée hermétique
que des mouvements dits gnostiques qui se sont développés dans
les premiers siècles de notre ère et que l’on regroupe habituellement
sous l’appellation de gnosticisme
Pour le gnostique, l’homme est en exil sur la terre et vit dans un
monde fondamentalement mauvais. L’œuvre de création du dieu
bon a été détournée de son origine par un dieu mauvais. Dans
cette vision, le corps est une prison ; l’âme en est le locataire mais
l’homme posséderait deux âmes : l’âme déposée par le mauvais dieu
qui s’oppose à l’âme issue du vrai dieu et reliée à lui par une petite
étincelle. Il n’entre pas dans notre propos de développer les divers
courants et les subtilités des divers mouvements gnostiques mais de
souligner la distinction à faire entre gnose et gnosticisme, ce dernier
développant une vision du monde à l’opposé de celle qui est sous-
jacente au REAA, en raison notamment de son dualisme irréductible
et de la désignation du corps comme étant notre principal ennemi
alors que dans le Rite Écossais Ancien et Accepté, le ternaire permet
de retrouver l’unité et notre corps est appelé à devenir un Temple
que l’Esprit habite que nous en soyons conscients ou non.
En effet, les principes sous jacents de l’Ecossisme sont qu’il
existe un principe créateur, impensable, inconnaissable, pénétrant
tous les plans de l’univers, que l’harmonie universelle résulte
de la complémentarité des contraires, que l’Esprit n’est que la
manifestation de l’invisible, que l’absolu est l’Esprit existant par lui-
même, que l’analogie est l’unique clef de la nature, ce qu’exprime de
façon plus imagée la célèbre formule de la Table d’Émeraude : « Ce
qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas comme ce qui est
en haut pour réaliser les miracles d’une seule chose ».
Ces idées générales issues de la tradition hermétique occidentale,
citées à titre illustratif se retrouvent sous des formes voisines, dans
le mouvement alchimique, dans la kabbale hébraïque, dans le
bouddhisme, l’hindouisme, l’hermétisme islamique. Elles ont enrichi
de façon diffuse le REAA, dont les trois grandes lumières balisant
le chemin de l’initié sont la Bible, le compas et l’équerre, c’est-à-
dire un monument de sagesse et de spiritualité, éclairé par le juste
maniement de la raison, associé à un comportement juste et droit.
Points de Vue Initiatiques N° 159 75
Le Rite écossais, voie d’accès à la connaissance
Comment le REAA conduit - il l’initié des Ténèbres à la
Lumière ?
Le REAA ne propose à ses adeptes aucun dogme et respecte au plus
haut degré la liberté de conscience de chacun. Son enseignement
véritable est fondé sur une méthode dont le programme essentiel
est de former des individus authentiquement libres, des cœurs
conscients, à la fois épanouis dans leur être essentiel et aptes à agir
dans le monde pour le bien de leurs semblables.
La liberté comme fondement et condition du progrès initiatique
L’engagement maçonnique ne peut être que celui d’un individu
libre dont nulle autorité, nulle servitude ne contraint la libre
expression de la volonté. Cette liberté que la Franc-maçonnerie a
toujours revendiquée comme une de ses valeurs fondamentales est
une notion complexe. Il importe de souligner qu’au Rite Écossais
Ancien et Accepté, avant de revêtir une dimension politique et
sociale, cette liberté doit d’abord être une conquête personnelle qui
ne s’obtient qu’au prix d’un travail constant de dégrossissage de sa
pierre en prenant conscience des multiples conditionnements qui
l’entravent : éducation, milieu social, idées reçues de toutes sortes,
religieuses, politiques, idéologiques, d’autant plus redoutables
qu’elles sont souvent inconscientes. C’est pourquoi le REAA attire
d’emblée l’attention sur trois ennemis majeurs empêchant l’adepte
d’accéder à la Connaissance qui sont l’ignorance, le fanatisme et
l’ambition déréglée. Ces mauvais compagnons sont évidemment
La Conscience,
Lionel Le Falher.
76 Points de Vue Initiatiques N° 159
Pierre Vajda
d’abord en lui : c’est pourquoi le Rite a développé divers moyens
progressifs de sensibiliser à leur présence car ils se manifestent sous
des formes de plus en plus subtiles à mesure que l’on progresse dans
la démarche.
Dans ce travail incessant sur soi-même, véritable ascèse personnelle
librement choisie par l’initié, ce qui est en jeu, c’est une prise de
conscience de la dimension transcendantale de cette liberté qui ne
relève, ni d’une foi religieuse puisque le REAA n’admet aucune
vérité révélée, ni d’un raisonnement philosophique que l’on sait,
depuis Kant, impuissant à démontrer quoi que ce soit dans le
domaine métaphysique, mais de la démarche initiatique elle-même,
c’est-à-dire de la découverte par soi-même au plus profond de son
intériorité de vérités qui étaient restées jusque-là voilées. C’est en
cela, que l’initiation de Rite Écossais Ancien et Accepté est un
processus de transformation intérieure qui fait de l’homme, un
individu authentiquement libre et responsable, c’est-à-dire devenu
apte, par-delà tous les déterminismes mis en lumière par la biologie,
la sociologie ou la psychanalyse, à comprendre que toute Vérité
ne peut venir que d’en haut. Dans cette perspective, dès le grade
d’apprenti, l’adepte est invité à découvrir la profondeur de sens du
prologue de l’Évangile de Jean qui fait du Verbe, la lumière qui éclaire
tout homme.
Le chemin donnant accès à la vraie liberté et à la
Connaissance est la voie du cœur.
La Connaissance se distingue du savoir
profane par le fait qu’elle met en œuvre,
non la seule raison mais la totalité
des ressources de la psyché humaine :
intelligence, sentiments, intuition.
La force convaincante des savoirs profanes
est telle dans le monde d’aujourd’hui qu’ils
ont, en quelque sorte, relégué au rang
d’archaïsmes toujours un peu suspects
d’obscurantisme, d’autres facultés de
l’esprit humain comme, la puissance
imaginaire ou la pensée mythique et
déprécié dans le subjectif tout ce qui relève
du sentiment et de l’intuition.
Peter Pan, Sir Goerges Frampton, 1912,
jardins de Kensington, Londres.
Points de Vue Initiatiques N° 159 77
Le Rite écossais, voie d’accès à la connaissance
De ce fait, l’homme occidental moderne souffre d’un grave
déséquilibre psychique, source de nombreux maux individuels et
collectifs, car il se sent de plus en plus coupé de ses racines vitales et
n’est plus capable de se relier spontanément aux forces naturelles et
cosmiques dont il est une des manifestations, pour puiser son énergie
et son équilibre. C’est pourquoi, l’une des premières fonctions de
l’initiation maçonnique est de restaurer chez l’adepte, sa capacité
d’écoute de ses sensations, de ses sentiments et de ses émotions. Il
s’agit de l’ouvrir aux mouvements de sa propre sensibilité, non pour
qu’elle se substitue à sa raison mais pour rendre son fonctionnement
mental moins unilatéral, moins biaisé par la sécheresse de son
intellect et les roueries de son ego.
Les rituels et les étapes du cheminement initiatique proposés par le
REAA, ont été conçus pour favoriser la prise de conscience par l’initié
de l’importance de l’ouverture de la voie du cœur et permettre une
véritable conversion du regard qu’il porte sur lui-même, les autres
et la vie car comme l’a si bien exprimé Pascal, « les grandes pensées
viennent du cœur ». Sans cette ouverture, il ne peut y avoir d’avancée
dans la quête spirituelle. Simultanément, l’initié découvrira le
véritable sens de la fraternité maçonnique et la grandeur de l’amour
désintéressé.
La méthode : symbolisme et pensée analogique
Pour le Franc-maçon Écossais, le symbolisme est un véritable
instrument de travail pour aller à la découverte de son âme, selon la
belle expression d’un ouvrage célèbre de C.G. Jung.
La fonction du symbole
est de représenter, par une
correspondance imagée de
caractère analogique, quelque
chose qui est absent ou caché. ;
voilà pourquoi, le symbole
a une vocation particulière
à amener l’esprit à prendre
conscience des aspects de la
réalité qui resteront à jamais
cachés aux yeux de celui qui
s’en tient aux seules évidences
rationnelles.
Pere Borrell del Caso, Madrid, 1874.
78 Points de Vue Initiatiques N° 159
Pierre Vajda
Dans la tradition maçonnique, le symbolisme est fondé, avant tout,
sur un symbolisme de métier, hérité des maçons opératifs, tailleurs
de pierre et bâtisseurs de cathédrales. C’est le symbolisme de la
construction du Temple, temple intérieur de l’homme et temple de
l’humanité. Lorsque le Franc-maçon travaille sur le riche corpus
de symboles légués par la tradition, il découvre rapidement qu’ils
racontent à ceux qui savent les lire, l’histoire immémoriale de
l’homme qui veut s’élever à la plus haute compréhension de son
destin et de son devoir afin de trouver la paix du cœur et de l’esprit.
Projection du colosse sur le temple.
Reproduction des dimensions de
Ramsès II sur le temple de Louqsor :
La construction du temple est basée
sur les proportions du corps humain.
Ouvrage : Le temple de l’homme,
édition Dervy.
Points de Vue Initiatiques N° 159 79
Le Rite écossais, voie d’accès à la connaissance
Car la fonction du symbole, comme le dit lumineusement Mircea
Eliade, est de révéler une réalité totale, inaccessible aux autres
moyens de connaissance. S’il en est ainsi, c’est parce que le symbole,
dans sa fonction cognitive, conserve toujours un contenu ouvert
et susceptible de significations multiples en fonction du niveau de
conscience et d’expérience de celui qui l’utilise. L’initié qui travaille
sur le symbolisme découvre sans cesse de nouvelles significations en
fonction de la progression de son cheminement personnel.
La puissance évocatrice et la résonance imaginaire du symbole sont
telles qu’il est le mode d’expression privilégié des aspects les plus
contradictoires et les plus ineffables de l’expérience subjective. Il
jette des ponts, il réunit des éléments séparés, il relie le ciel et la terre,
la matière et l’esprit, le réel et le rêve, l’inconscient et la conscience,
l’intériorité et l’extériorité. Le symbole tend à réunifier les forces
antinomiques, à réconcilier les contraires, à faire communiquer les
processus psychiques conscients et inconscients, ouvrant l’homme à
la voie de son unification.
Le symbolisme est la langue des poètes et des mythes. Il révèle à
ceux qui ne sont pas enfermés dans la sèche et froide rationalité, les
plus nobles et les plus riches expressions de la subjectivité humaine
et de la vie spirituelle. Il fait la force et la richesse du Rite Écossais
Ancien et Accepté et constitue la clef d’accès à la connaissance
initiatique et son seul véritable mode d’expression. n
Le symbole réunit la matière et l’esprit, le réel et le rêve.
80 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jacques Van Assche
Temps profane
temps sacré
En ce temps là… Il était une fois… Le temps est la grande afaire des
mythes et des rites qui les réactualisent. S’il est « la patience de Dieu »,
c’est aussi le grand ennemi des hommes qui s’obstinent à tenter de
saisir ce qui est indéinissable. Dans ce domaine la science côtoie
la cosmologie, la métaphysique et la poésie et les réponses qu’elle
apporte ne sont que d’autres questions. Pourtant l’éternel, l’immuable
est là, tout près… Ne serait-ce pas le temps immobile du Rite ?
Tenter de cerner l’immense question du temps, L’univers quantique.
Il ne s’agit pas de reprendre et de définir dans cet article les notions
de « profane » et de « sacré », cela a été largement développé dans le
PVI N° 158, mais de tenter de cerner l’immense question du temps,
ou plus exactement d’un espace-temps sacré dans lequel s’ouvre
pour le Franc-maçon le vaste domaine de la pensée et de l’action.
Points de Vue Initiatiques N° 159 81
Temps profane, temps sacré
Candide : mais au fait qu’est-ce que le temps ?
Le savant fou : vaste question ! Mais ce besoin de définition n’est-
il pas qu’une manie de logicien car l’essentiel est que nous nous
entendions sur la signification ? Platon écrivait, dans le Timée :
« Alors le Créateur songea à faire une image mobile de l’éternité et, en même
temps qu’il organisait le ciel, il fit de l’éternité qui reste dans l’unité cette
image éternelle qui progresse suivant le nombre, et que nous avons appelée
le Temps ». La Tradition nous rappelle toutefois que le monde a été
créé in principio, qui n’est pas d’un commencement dans le temps,
mais bien une origine dans le Principe, en sorte que le monde est
créé dans l’instant éternel. Aucune définition de la notion de temps
n’a reçu, semble - t - il, une approbation unanime de la part des
philosophes, des scientifiques « Le temps est une invention, ou il n’est
rien du tout », a dit Bergson… On se souvient qu’Aristote a défini
« le temps comme la mesure du mouvement dans la perspective de l’avant
et de l’après, le passé n’est plus et le présent est insaisissable ». L’instant
lui - même, limite du temps, paraît incapable d’exister. Aucune des
parties du temps (passées, futures) n’existe, et le temps est pourtant
divisible. Et l’instant ? Ce n’est pas une partie du temps, il délimite
le passé et le futur, il constitue une limite qui permet de déterminer
un temps fini.
Candide : la science n’est-elle donc pas capable de fournir une
réponse ?
Le savant-chercheur : Aucune science ne répondra donc directement
à la question de St Augustin « Qu’est-ce que le temps ? » Pour tenter d’y
répondre, il semble utile de s’intéresser à ce que l’on nomme « flèche
du temps », c’est-à-dire quel est le sens de la direction temporelle ?
Y a- t- il symétrie entre passé et futur, irréversibilité ? En fait on peut
considérer qu’il existe trois types de flèches temporelles :
- Psychologique : qui correspond à la prise de conscience du temps
qui passe, ce sentiment par lequel nous nous souvenons du passé, et
non du futur, indiquant bien la direction de la flèche…
- Cosmologique : l’univers se dilate, il serait en expansion depuis le
Big Bang ;
- Physique ou « réelle » : le caractère unique du Second Principe
thermodynamique, est que le terme de production est toujours
positif : la production d’entropie traduit une évolution irréversible
du système.
En ce qui me concerne, je verrais le temps constitué par une ligne
82 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jacques Van Assche
horizontale indéfinie (la fameuse flèche du temps pratique à une
dimension) que couperaient, à chaque instant, des verticales
indéfinies elles aussi, remontant à l’imaginaire sans durée (ou douées
d’une durée différente).
Candide : parfait, on parle de 3 lèches du temps : n’y en a-t-il pas
une autre ?
Illustration de l’influence d’une masse (ici, la Terre) sur l’espace-temps.
Le savant cherchant : Effectivement il en existe une autre : le
temps imaginaire. Par exemple, si nous passons un film à l’envers,
nous avons l’impression de remonter le temps, en tout cas dans
l’imaginaire. Ainsi, si l’on avance dans le temps imaginaire, la
différence entre aller de l’avant et revenir ne devrait pas y être très
Points de Vue Initiatiques N° 159 83
Temps profane, temps sacré
grande, on doit donc être capable de faire demi-tour. Il n’en est pas
de même pour le temps « réel » : d’où vient cette différence entre le
passé et le futur ? Pourquoi nous souvenons-nous du passé, et non
du futur ? Mais avec Hume et Newton, le rationalisme classique
et l’empirisme factuel, ont progressivement exclu l’imaginaire des
procédures intellectuelles, le reléguant avec le fantasme, le rêve ou
le délire.
Candide : mais enin, peut-on remonter le temps ? Y a-t-il une
réversibilité de la lèche du temps cosmique ?
Le savant physicien : Cela n’est pas possible dans le monde physique,
à cause du Second Principe de la Thermodynamique de Carnot : le
rougeoiement du charbon qui brûle sans retour dans les chaudières
indique bien qu’aucune machine ne restituera au monde le charbon
qu’elle a dévoré ! L’impossibilité d’un recours au passé est en effet une
des marques principales, et sans doute la plus tragique, de la détresse
ordinaire de l’homme confronté à une situation catastrophique.
J’ajouterai simplement que selon certains astrophysiciens il serait
possible de remonter le temps si l’univers se contractait (Big Crunch)
au lieu de se dilater, ou bien était dans un trou noir ou à travers des
« trous de ver » ! Je souhaite bonne chance à ces aventuriers d’un
voyage sans retour !
Candide : Espace-temps physique, thermodynamique
psychologique, puisque nous nous intéressons à l’espace-temps
sacré, ou se situerait le domaine de la pensée ? Y a-t-il un autre
univers qui nous échappe ?
Le savant extraverti : exactement ! Un autre univers que celui que
nous connaissons habituellement ! Et pour cela, il faut faire un peu
de physique. En termes d’espace-temps, et d’après les conceptions
présentées par Régis Dutheil, il y aurait deux univers :
- Notre univers « sous-lumineux », décrit par la théorie de la
relativité et la fameuse équation E = mc², celui des particules sous-
lumineuses, dans lequel nous ne pouvons pas aller plus vite que la
vitesse de la lumière. L’apport essentiel d’Einstein tient en ce qu’il a
balayé le caractère absolu de l’espace et du temps : le véritable cadre
de la relativité, c’est l’espace-temps à quatre dimensions, et qu’on ne
peut pas séparer l’espace et le temps. Sur le plan philosophique, la
relativité a donc une importance énorme : elle détruit les concepts de
temps et d’espace, ébranle les fondements de la réalité de l’univers
classique !
84 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jacques Van Assche
Le cantique des cantiques, Marc Chagall, 1960. Musée national
Message Biblique Marc Chagall.
- Un deuxième univers, hypothétique, avec son espace-temps
spécifique, serait celui des particules super-lumineuses ou
« tachyons », terme inventé par le prix Nobel Feinberg, supposant
qu’il existe des particules qui vont toujours plus vite que la lumière et
jamais moins vite : c’est l’univers de la physique quantique. Il s’agit
là d’un modèle qui implique en particulier une dualité de la réalité et
s’apparente à la distinction que faisait Platon entre le monde des Idées
et celui des images. Cet univers-là fait appel à la physique quantique,
baptisée par S. Ortoli et J.-P. Pharabod « Cantique des Quantiques » ;
« elle est une théorie « sauvage », subversive et dévastatrice, qui a jeté à bas
l’édifice échafaudé au cours des siècles par la science traditionnelle ». Elle
nous fait entrer de plain-pied dans le monde de la science-fiction, et
par suite toutes les révolutions humaines et nos modes de pensée ont
été ou vont être bouleversés.
Ces deux univers seraient séparés par un 3e, celui des photons ou luxons,
associé au mur de la lumière, dans lequel le temps et l’espace sont
déjà très différents, frontière séparant ces deux univers, constituant
en lui-même un univers, avec son espace-temps différent du nôtre.
Points de Vue Initiatiques N° 159 85
Temps profane, temps sacré
Ainsi, la physique d’aujourd’hui a inventé les moyens de s’affranchir
du joug de la raison suffisante, de cette équivalence entre « cause
pleine » et « effet entier » et donc de s’affranchir de la sacro-sainte
rationalité classique. Nous nous frayons peut-être ainsi un chemin
à travers un réel ultime, que B. d’Espagnat appelle le « réel voilé ».
Quant à la métaphysique, qui nous préoccupe plus que la physique,
et Claude Saliceti nous éclaire à ce sujet : « le terme métaphysique
désigne la partie de la philosophie appelée d’abord « philosophie première »
ou « générale », étudiant d’abord l’être en tant qu’être, et qui va peu à peu
voir son champ d’application s’affiner en abordant les questions concernant
la nature, l’origine et la fin des êtres et leur destination ».
Candide : bon, je veux bien, mais quel rapport entre cet univers
« super-lumineux » et le temps ? S’il ne s’agit que d’un modèle,
alors qu’advint-il lorsque temps vécu et espace sont confondus ?
Le savant entropique : Régis Dutheil a tenté depuis 1972 d’édifier
une théorie s’appliquant à des corps ou à des particules ayant des
vitesses relatives supérieures à celles de la lumière. En fait il n’y a que
deux façons de concevoir la théorie de la relativité restreinte : celle
s’adressant à la théorie de la relativité sous-lumineuse habituelle et,
de l’autre côté du mur de la lumière, celle super-lumineuse. Le temps
vécu par un objet, un être, ne s’écoule plus ! Autrement dit, il y aurait,
pour un être vivant dans l’univers super lumineux, une instantanéité
complète de tous les événements constituant sa vie, les notions du
passé/présent/futur disparaîtraient. Le calcul montre que, dans
l’univers super-lumineux, l’ordre augmente en permanence ou, pour
parler de manière plus précise, l’entropie diminue constamment
(l’entropie étant le désordre) et la néguentropie (l’information)
augmente sans cesse : à l’inverse des prévisions des astrophysiciens,
nous irions du Chaos à l’Ordre !
Candide : Autant que l’on puisse en juger du point de vue classique
(celui du sens commun), eh bien… c’est complètement dément !
Bien sûr, tout cela provient du constat que le jugement classique
n’est pas le bon dans un univers quantique. On parle d’hypothèse
ou de modèle certes, mais n’y aucun support expérimental ?
Le savant devenant moins fou : La différence entre une théorie et
un modèle est que la théorie peut-être juste ou fausse, le modèle
simplement inapproprié ! Je passe sur la longue histoire de ce
parcours de la physique quantique, depuis L. de Broglie, jusqu’à plus
récemment, K.Drühl et M. O. Scully, Young, Pribam, et Greene,
86 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jacques Van Assche
dont Aharonov et Zubairy citent les expériences
qui portent un coup magistral à nos concepts
conventionnels de l’espace et du temps.
Candide : mais enin, cet univers quantique,
peut-il se trouver en nous ?
Le savant quantique : Oui certainement, car on
découvre petit à petit que cet univers-là est partout,
pas seulement dans de lointaines galaxies, mais
en particulier dans notre cerveau, entre autres ! Le
cerveau est d’une telle complexité que prétendre
en comprendre le fonctionnement à l’aide d’un
système par de simples équations revient à tenter
de garder l’eau de la mer dans un filet de pêche !
Appliqué au vaste domaine de la pensée, en
particulier de la conscience, il est instructif de
se pencher sur des expériences comme celles de
Libet, par exemple. En bref, il est montré que de
l’état neuronal ne peut pas permettre de connaître
l’état mental, puisque le temps vécu par le sujet
et le temps neuronal ne sont pas les mêmes.
Notre cerveau serait donc un univers quantique
et les échanges d’information avec le monde
infra-lumineux seraient filtrés par le cortex. Et le
principe de synchronicité laisse transiter toutes les
informations à l’état brut, sous forme de signes,
indépendant de l’écoulement temporel. Il nous doit
exister un principe d’information/signification lié
au caractère d’instantanéité et de non-écoulement
du temps super-lumineux, correspondant à une
non-localisation spatio-temporelle.
Candide : Monod se serait-il trompé ? Comment
est-il possible, alors, que l’armée déterminée et
implacable des neurosciences ne réussisse pas à
pénétrer le royaume de la conscience ?
Le savant conscient : La plupart des spécialistes du
cerveau pensent que la conscience est produite par
l’activité neuronale. Ainsi en est-il du matérialisme
sous sa forme habituelle. Mais je trouve bien plus
probable l’idée selon laquelle notre Univers, la vie,
Le corps subtil et l’homme
cosmique. Népal, 1600.
Points de Vue Initiatiques N° 159 87
Temps profane, temps sacré
la conscience feraient partie d’un processus ayant un sens, voire un
but, lorsqu’on raisonne grâce à la philosophie des sciences, sans avoir
recours à la religion ! Voilà qui aurait pu conforter un Voltaire déiste,
résumant son embarras en ces vers célèbres : « L’Univers m’embarrasse,
et je ne peux songer Que cette horloge existe et n’ait pas d’horloger »…
Tout ce dont nous venons de parler conduit à penser, comme le fait
Libet, que l’esprit qui nous anime n’est pas uniquement un produit
de l’activité neuronale, et que nos joies et nos peines ne sont que
des agitations de molécules dans nos neurones, n’en déplaise à J-P.
Changeux avec son « Homme neuronal », le seul que veuille connaître
un matérialiste ! Le dualisme redevient une hypothèse acceptable, et
cela sur le plan strict de la rationalité scientifique, surtout depuis que
des modèles montrent comment l’esprit pourrait agir sur le cerveau
sans violer les lois physiques qui ont été élaborées.
Candide : L’une des spéciicités du Rite Écossais Ancien & Accepté
est la primauté de l’esprit sur la matière, qu’en est-il avec ce modèle
de conscience ?
Le savant en quête : Certes primauté ne veut pas dire négation ! Et
puis, il n’y a pas d’esprit sans matière ou plutôt l’esprit a précédé la
matière : au commencement était le Logos, le Verbe, l’Esprit. Quant
à distinguer l’esprit et la matière, il s’agit plutôt d’une distinction
dans la manière d’utiliser son intelligence et sa volonté, en direction
de l’amour d’une part, plutôt qu’en direction des désirs et des
assouvissements animaux ou païens d’autre part, précise Louis
Trébuchet. Nous verrons que la conscience est liée à la matière, elle
est matérielle !
Candide : Si tout est illusion, si tout est imaginaire, alors qu’est la
réalité ? Esprit, matière, caractère subjectif de la réalité, qu’en est-il
de la conscience ?
Le savant super lumineux : Effectivement, qu’est-ce que la
conscience ? « Nous connaissons la signification de ce terme aussi
longtemps que personne ne nous demande de la définir », selon la formule
de William James. Son fondement n’est en fait pas autre chose
qu’une association des critères sensoriels et de l’interprétation que
donne le cerveau de ces données. En fait, au centre de la réalité
se situe le Moi, le sujet pensant et sentant. L’Homme est le siège
de sensations multiples (visuelles, auditives, tactiles…) qu’il analyse
avec sa conscience. Pourtant, si nous prenons l’exemple des couleurs,
nos sens sont « trompeurs », le réel se construit dans notre cerveau
88 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jacques Van Assche
et plus exactement dans notre conscience : ce que nous appelons
« objet » n’est qu’une construction subjective. Depuis, nous voyons
bien qu’une parcelle de conscience se trouve dans chaque être
vivant, confortant l’intuition de Leibniz ou Spinoza. Ainsi, nous
serions tous des « hologrammes », ou des « clones » de l’Univers,
ce qui donne tout son relief au précepte « Connaîs-toi toi-même et tu
connaîtras l’univers et les dieux » !
Cependant, réalité et conscience sont étroitement imbriquées : la
conscience interagit dans les expériences de la mécanique quantique,
répétons-le, mais elle est aussi au cœur des expériences mystiques. Ce
modèle se rattache à un courant de pensée dualiste dans la mesure
où il affirme que si la conscience est une substance matérielle, la
matière dont il s’agit est différente de la matière ordinaire que nous
connaissons.
Les deux modes d’approche du réel, le mode rationnel, scientifique et
le mode intuitif, débouchent tous deux sur l’affirmation de l’existence
de la conscience. La physique quantique nous démontre qu’elle est
matérielle, puisqu’elle agit sur la matière, elle est constituée d’une
matière différente de celle que nous connaissons, car tout démontre
que ses propriétés spécifiques n’appartiennent pas à notre espace-
temps. La conscience, n’est pas unique, mais multiple, elle est formée
d’états supérieurs ou inférieurs qui correspondent à un degré plus
ou moins élevé d’interaction avec le milieu ambiant. Ces états ne
seraient pas séparés, mais superposés, un peu comme les couleurs
arc-en-ciel. Ils iraient d’un niveau de conscience ordinaire jusqu’à
un celui d’un sentiment de profonde béatitude qui naît de l’union
avec « l’esprit universel ». D’ailleurs, on connaît depuis des siècles les
Représentation imagée d’une projection de conscience (voyage astral).
Points de Vue Initiatiques N° 159 89
Temps profane, temps sacré
« expériences » des grands mystiques, qui ont toutes pour objectif
d’amener l’être humain qui les pratique dans des états de conscience
élevés, l’illumination, états d’extase qui évoquent une sortie hors de
soi, c’est-à-dire hors du corps ou de la conscience. Plus récemment,
grâce à la méthode de R.A.Monroe, une exploration du conscient,
de l’inconscient et du supra-conscient permet une cartographie de la
conscience, et donc de véritables voyages dans l’espace- temps, et de
quitter en esprit le monde matériel.
Candide Mais si le philosophe doit aller plus loin que le savant,
qu’en est-il du Franc-maçon ?
Le savant enfin initié « Le philosophe doit aller plus loin que le savant
- écrivait Bergson - la détermination progressive de la matérialité et de
l’intellectualité par la consolidation graduelle de l’une et de l’autre ». Quant
à nous Francs-maçons, nous savons bien que l’Homme n’est pas le
prisonnier éternel du temps ; pour nous, fêter Jean le Baptiste, c’est
honorer le Principe Maître du temps. Nous affirmons donc très
clairement qu’en cela, Janus, le dieu aux deux visages, l’un regardant
le passé, l’autre l’avenir, serait le « Maître des siècles futurs », ce qui fait
de lui le maître de l’éternité… Cette éternité, ce point métaphysique,
se jette dans l’instant présent « où les mondes se dissolvent dans une
ampleur sans limite, une durée sans rythme, une béatitude sans fin. »
tandis que l’absence de visage symboliserait le présent signifiait sa
puissance car l’éternel présent est inconnu à l’homme qui est lié par
les chaînes du temps, il est le Verbe qui était au commencement, et
de plus le « pater futuri saeculi », souligne J.-E.Bianchi.
Le présent total, l’éternel présent des mystiques, est la stasis, la non-
durée, c’est- à-dire, traduit dans le symbolisme spatial, l’immobilité.
Celui « dont la pensée est stable », vit dans cet éternel présent, dans
le nunc stans, qui ne fait plus partie du temps, de la durée. Pour
atteindre cet état, « le moment favorable », la Réalité se présente
comme un éclair, une illumination, entre deux non - entités. C’est
en quelque sorte ce que soulignait Poincaré : tout ce qui n’est pas pensée
est pur néant… La pensée n’est qu’un éclair au milieu d’une longue nuit :
mais c’est cet éclair qui est tout ! Le Passé et l’avenir, l’instantanéité
(eka-ksana), est comparable à la révélation ou à l’extase mystique,
et se prolonge paradoxalement en dehors du temps ! Platon ne
parle-t-il pas sans cesse d’immortalité, d’éternité, de « ce qui est
toujours » (aeion), alors que Parménide se contente de dire que ce
qui est, est sans passé ni futur, et « existe maintenant » (nun esti). Cet
éternel présent, constitue la Janua Coeli, la Porte des Cieux, la Porte
90 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jacques Van Assche
des Dieux… celle par laquelle seuls peuvent passer les hommes qui
ont été capables de dominer leur agitation et leurs passions ! Par cet
intervalle qui contient et annihile en lui-même toute la succession
temporelle, demeure l’instant, seule réalité. Il n’existe pas d’autre
passage, par cette voie étroite, que ce point pour accéder au Royaume
qui est à l’intérieur de nous… L’instant unit le passé au futur, en les
fusionnant dans le présent éternel qui absorbe toute discontinuité,
toute opposition, en vérité tout se résout ici et maintenant…
Candide : alors que conclure ?
Le savant réenchanté : conclure, mais quoi ? Par l’observation de
l’Univers et de l’Homme, le « réenchantement du monde » auquel nous
assistons, selon l’expression de B. d’Espagnat, est fondé à la fois sur
le fait que l’Univers est beaucoup plus subtil et complexe que prévu,
et que l’homme ne se résume pas à un assemblage de molécules !
Nous, Francs -maçons de Rite Écossais Ancien et Accepté, que
faisons-nous dans le Temple ? Lorsqu’il est Midi Plein, le Soleil
est au zénith, le Temps et le Sans Temps perdent leur tension
d’opposés : nous sommes dans le monde sacré… Alors, pourquoi ne
pas imaginer que cet espace-temps sacré serait cet univers quantique
en nous, loin des soucis de la vie matérielle, dans le vaste domaine
de la pensée ? Lorsque le Maître de Loge clôt les travaux, l’adepte est
convié, en retournant dans le monde profane, à achever au dehors
l’œuvre commencée dans le Temple, et donc à réintégrer ce « temps
profane » : un aspect essentiel de cette phrase du rituel serait peut-
être de rappeler que le Temps sacré est le Temps véritable, le seul
réel !
J’aime beaucoup cette image proposée par Michel Meunier : le
maçon travaille de midi à minuit, dans cet espace-temps sacré qu’est
le Temple : si l’on regarde la pendule, témoin du temps physique, les
deux aiguilles se rejoignent et coïncident : la dualité devient unité et,
comme dans l’Apocalypse de Jean : « il n’y a plus de temps ! »
Rien n’est. Tout est passé. Reste le Tout possible. n
Points de Vue Initiatiques N° 159 91
Robert de Rosa
Rites, arts et initiation
Si le rituel est partout, c’est dans l’approche du mystère qu’il déploie
toutes ses possibilités. L’art, frontière entre le visible et l’invisible
s’accompagne souvent d’une attitude rituélique dont les arts
traditionnels donnent un modèle. Le silence émerveillé, le frisson
créateur, la contemplation sereine résultent de cette approche discrète
et volontaire. Le rituel prend alors le visage du maître en action.
« Fault toujours aider aux hommes que l’on cognoist avoie pauvrete... »
Beaulieu, 1599.
La cloison coulisse. Le Maître entre, tout de noir vêtu, les yeux
baissés, salue sans regarder le demi-cercle d’élèves-spectateurs
attentifs. Il avance lentement vers le milieu de la pièce où sont posés
les outils et les feuilles de papier selon un ordre précis. Sans un geste
inutile il se met à genoux et se fige dans une immobilité silencieuse
pendant quelques minutes. Sa présence remplit tout l’espace. Elle est
aussi palpable dans la façon de sortir de leur étui les pinceaux et de
les ranger devant lui. Avec des mouvements lents et sûrs, il saisit un
bâton d’encre, en frotte la pierre à encre, le mouille et recommence
puis le repose. Encre noire et encre rouge. Temps d’arrêt… Il saisit
une feuille de papier de riz et la pose avec précaution devant ses
genoux. Nouveau temps d’arrêt précédé d’une brève inclination de
92 Points de Vue Initiatiques N° 159
Robert de Rosa
la tête… Puis sa main avance avec douceur et révérence vers un
gros pinceau qu’il mouille dans l’eau d’un bol. Il le charge d’encre
avec des gestes précis comme des figures de danse. En s’aidant de
la main gauche il positionne ses doigts sur l’outil bien au-dessus de
la virole et en tenant le pinceau selon une verticale parfaite, laisse
tomber quelques gouttes sur la pierre à encre. Il se redresse alors et
s’appuyant de la main gauche sur le sol et le papier, pose la pointe
sur la feuille et trace d’un seul jet les caractères qui composent la
phrase. Pas un repentir, pas une hésitation… Temps d’arrêt… Le
pinceau est reposé sur la pierre. Le Maître ouvre la boîte à sceaux,
en prend un, le pose sur l’encre et imprime sa signature sur le côté
de la calligraphie. Toujours avec lenteur, il range le sceau, essuie
le pinceau avec un linge blanc qu’il replie avec soin. Nouvelle
inclination de la tête, il se relève et repart vers la pièce contiguë. La
leçon est terminée…
Rituel et processus de création.
Le peintre sur la route de Tarascon, Vincent Van-Gogh, 1888.
Tableau brûlé pendant la seconde guerre mondiale.
Points de Vue Initiatiques N° 159 93
Rites, arts et initiation
Pourquoi faut-il que le maître en calligraphie consacre tout ce temps à
une préparation qu’un élève compétent pourrait assumer ? Le travail
proprement dit n’a pas duré plus d’un tiers du temps total de la leçon
et il se répétera à chaque fois, aussi long et sans changement…
Le sens de ces gestes n’est pas différent de celui des rituels qui
précèdent tout travail créateur. Quand il ne s’agit que de traduire des
émotions, la mise en condition de l’auteur se fait par le travail lui-
même mais quand il s’agit de rendre sensible une autre dimension,
de rendre palpable une spiritualité immanente, profonde, il faut
approcher ce plan progressivement par une mise en résonance de
l’être avec une force qui l’habite. Pour le peintre calligraphe, la
préparation du travail est un véritable rituel qui permet cette descente
en soi, à la quête du vrai.
Presque tous les créateurs éprouvent la nécessité de ces gestes, de ces
comportements qui deviennent des repères et signent la conformité
du corps avec le courant dynamique qui se manifeste dans l’œuvre.
Dans ces moments, la conscience s’efface pour laisser place à une
autre forme de pensée qui est une pensée du corps, mais du corps
dompté, tourné vers la réception d’un inconnu qui, sans la nier ne
s’enferme pas dans la rationalité. Jacques Foussadier, moine zen,
en précise les modalités : « Lorsque l’on saisit le pinceau, la main devient
pinceau. Il n’y a plus main et pinceau, il y a main-pinceau… Toute pensée
consciente disparaît et cède la place à la transparence agissante du corps qui
est une autre forme de pensée, une pensée profonde et silencieuse qui tient
autant, et sans qu’on puisse les distinguer, de l’esprit que du corps parce
qu’elle est la source de l’un et de l’autre ».
Les exemples abondent chez
tous ceux qui tentent de saisir cet
insaisissable. Saisir n’est pas le mot
qui convient mais plutôt d’être saisi.
Quelle que soit l’intention, l’artiste
a besoin d’un ordre particulier,
personnel qui est une porte vers
le monde encore confus qui va
s’incarner avec plus ou moins de
bonheur dans l’œuvre en projet.
Avant tout nouveau roman,
Simenon faisait ses promenades
« prénatales », rangeait son bureau,
préparait ses pipes et taillait ses
crayons. Alors seulement, le vide
94 Points de Vue Initiatiques N° 159
Robert de Rosa
étant fait, les personnages pouvaient prendre corps. Thierry Hesse
(auteur du Cimetière américain – Champ Vallon) explique que « si on
veut écrire, il faut, dans la vie ordinaire, instaurer un temps qui n’est plus tout
à fait celui de la vie ordinaire ». La nécessité de ce balisage de l’inconnu
est précisée par le psychiatre Christophe André : « il y a d’autant plus
de rituels qu’il y a d’incertitude » (dans l’article de l’Express : Tics et
tocs des écrivains, du 02-01-2004). Le corps ne reste pas à la porte de
ce monde. Il œuvre en silence dans les profondeurs d’une pensée
inconsciente ou préconsciente, à la jonction du Moi corporel, ou du
moins de son image, et de la pensée consciente.
Pensée du corps, travail de la main.
Depuis Platon, qui faisait du corps le tombeau de l’âme, la plupart
des philosophes ont voulu croire que la pensée était seulement le
résultat d’un travail purement cérébral dont la grandeur se mesurait
au détachement des mouvements de la chair. Que le corps soit
hypostasié vers un idéal toujours plus exigeant ou qu’il soit méprisé
comme entrave irréductible, la négation de la substance corporelle
est longtemps restée une injonction incontournable. Elle culmine
dans les conceptions cartésiennes qui séparent définitivement la
machine organique de la machine à penser. Puis les neuro-sciences
sont arrivées… « C’est là qu’est l’erreur de Descartes – dit Antonio
Damasio (L’erreur de Descartes – page 337) – il a instauré une
séparation catégorique entre le corps fait de matière, doté de dimensions…
et l’esprit, non matériel, sans dimensions et exempt de tout mécanisme…
et il a posé que les opérations les plus délicates de l’esprit n’avaient rien à
voir avec l’organisation et le fonctionnement d’un organisme biologique ».
La psychiatrie puis la psychanalyse ont ensuite ouvert les portes à
deux battants. Un tel réajustement ne débouche pas sur la négation
de l’esprit, bien au contraire. Il lui donne une assise plus large, plus
globale et une fonction plus haute que la simple élaboration de
concepts en oubliant les exigences du vivant.
Ce qui paraît être un tournant dans les sciences cognitives n’a pourtant
jamais été totalement absent d’une forme de pensée traditionnelle.
Elle nous ramène aux sources opératives de la franc-maçonnerie. La
pratique du métier était, et reste encore, une voie de réalisation pour
l’ouvrier. L’expérience du matériau alliée à l’intelligence de la main
conduisent à une connaissance de soi et de son rapport au monde.
Et même si aujourd’hui, les outils sont devenus symboliques et la
pratique un simple rappel de la tradition, la franc-maçonnerie que
l’on dit spéculative, demeure toujours opérative. Opérative car elle
Points de Vue Initiatiques N° 159 95
Rites, arts et initiation
prescrit un véritable travail qui produit des transformations… et ce
travail comprend entre autres la pratique scrupuleuse du rituel. Il ne
s’agit pas de spéculer avec plus ou moins de brio sur des symboles
ou des mythes. Il faut, au contraire, les saisir « à bras le corps »,
s’y jeter « à corps perdu », explorer le rapport que chacun entretient
avec eux et le comparer à celui des frères qui se sont livrés à la même
quête. La démarche initiatique de la franc-maçonnerie écossaise
rejoint les pratiques traditionnelles.
Celle qui est décrite au début de ce
texte permet d’en préciser les modalités
par comparaison. Dans le bouddhisme
japonais, les pratiques sont « les deux
facettes d’un même élan cognitif, créateur,
charnel qui se cherche à la fois en gestes et
en paroles » (Basile Doganis – thèse à
Paris 8). Elle n’exclut pas la réflexion
dialectique, indispensable pour
repousser les bornes de l’inconnu en
procurant une base ferme, piste d’envol
de l’imagination. La mise en mots
de l’expérience, demandée à tous les
maçons, évite de se perdre dans « un
sensualisme flou » ou « un mysticisme
irréfutable » (idem). Les explications, les
démonstrations, les communications
aux frères instaurent un retour critique
sur la pensée de l’auteur comme sur
celle des auditeurs. La singularité de
la réflexion individuelle peut ainsi
déboucher sur une universalité qui n’est deboutBouddha Japonais
avec la main droite levée
pas un simple consensus de surface mais au niveau du torse et la main
gauche le long du corps :
un accomplissement dans la profondeur. Cette posture est la posture
Ce travail suppose un accueil particulier, dite de Pacification.
une disposition d’esprit fluide et réceptive
bien différente des controverses dans lesquelles chacun fortifie sa
position pour triompher de celle de l’autre. À cette fonction du rituel
s’en ajoutent d’autres.
Le rituel comme transition.
Comme le peintre calligraphe ou tout autre artiste sur le chemin de
la création, le franc-maçon met en œuvre un ensemble de pratiques
matérielles qui ouvrent les portes de la perception… Des portes qui
96 Points de Vue Initiatiques N° 159
Robert de Rosa
Intérieur de Temple au Premier grade d’Apprenti du R.E.A.A.
Frontispice aquarellé d’un livret de rituel manuscrit, vers 1830 (GLDF).
ouvrent le passage vers l’orient et le ferment, dans notre dos vers
l’occident… Chacune marque un peu plus la séparation dans l’espace
et dans le temps. Dans d’autres communautés cette progression
s’accomplit par une liturgie fastueuse de nature à frapper l’auditoire
qui n’est composé que de spectateurs. C’est le cas de certaines
religions. En franc-maçonnerie, le rituel n’est composé que de gestes
simples que chacun doit charger de significations pour être acteur,
quelle que soit sa place. Se lever, frapper d’une main sur l’autre,
ouvrir un livre, allumer une bougie, autant d’actes banals, à la portée
de tous mais que tous chargent de sens en se les appropriant.
Le rituel d’ouverture des travaux et son pendant symétrique de la
fermeture des travaux, assurent pour les frères le passage graduel
et commun vers un état de conscience indispensable au succès de
la tenue (nom de la réunion en loge), ou le retour fructueux vers
le quotidien. Aucune séquence filmée, aucune photographie ne
permettront jamais d’en faire sentir l’importance à celui qui ne le
vit pas. C’est la condamnation évidente et sans appel de ce qui a
pu être diffusé dans certains médias et dont le seul résultat est de
faire apparaître les maçons comme les membres bizarres de tribus
Points de Vue Initiatiques N° 159 97
Rites, arts et initiation
exotiques se livrant à des pratiques puériles et obsolètes. La tenue
maçonnique n’est pas un spectacle pour dilettantes en mal de sacré.
Elle est un temps irremplaçable dans une vie d’initié. Elle demande
un effort pour sortir des schémas de pensée qui règlent la société.
Elle est une tension vers la verticalité en ce point d’intersection où
se rencontrent immanence et transcendance. Je prétends même que
le rituel commence avant ce début collectif. Il commence quand le
maçon endosse les vêtements noirs et blancs qui affirmeront l’égalité
de tous et, un peu plus tard, quand il revêtira le tablier et les gants,
affichant sur son corps l’idéal vers lequel il tend. À chaque fois il se
rappelle sans doute le soir de son initiation où il fut reçu « ni nu, ni
vêtu », et l’expression prendra, alors, tout son sens. La répétition de
ces gestes en permet l’appropriation sur le mode symbolique et je ne
connais pas de maçon qui ne l’ait mise à profit dans le monde dit
profane en pratiquant une distanciation, un approfondissement de
son action.
Le rituel comme élévation.
L’action du rituel ne se limite pas aux deux moments décrits plus haut.
Dans la tenue, le maçon se livre à un véritable travail créateur, mais
l’œuvre ne consiste en rien d’autre que lui-même, que la construction
d’un être universel au milieu de ses frères. Didier Anzieu (Le corps
de l’Œuvre) a tenté de retracer les étapes du processus de création, en
partie comparable à ce que connaît le maçon : à la modification de
la perception du monde extérieur, succèdent une levée des censures
et un sentiment de flottement des limites. Ces deux dernières étapes
doivent déboucher sur un élargissement progressif du champ de
conscience. Là encore, c’est le corps qui parle au travers des postures
et des déplacements : assis droit et non avachi pour une réception
plus efficace et une audition active, debout et dans la position « à
l’ordre » pour prendre la parole et ne la prendre qu’une fois. L’ordre
strict appuie l’ardeur tranquille qui fait de la tenue une œuvre
commune. La maîtrise et la codification du métalangage du corps
instaurent peu à peu une discipline de la pensée. Il n’en résulte pas un
appauvrissement mais bien au contraire une liberté plus grande par
l’affranchissement des mouvements internes incontrôlés et confus,
sensibles dans une instabilité corporelle.
Le frère Frédéric Vincent, dans un livre tout à fait pertinent (Le
voyage initiatique du corps) apporte son expérience de sociologue pour
confirmer le rôle du corps dans l’initiation : « discipliner le corps est
nécessaire si l’on aspire à une amélioration de soi-même… car… le corps est
98 Points de Vue Initiatiques N° 159
Robert de Rosa
le premier et le plus naturel instrument de l’homme » (pages 132 et 133).
Plus qu’une discipline, une ascèse… Il ne s’agit pas de se conformer
à un modèle irréfutable mais de se risquer par la réflexion et par la
pratique à devenir autre, à découvrir et faire monter en soi ce besoin
de dépassement qui est accomplissement. Quand le Vénérable Maître
explique au nouvel apprenti que toutes les équerres, les niveaux, les
perpendiculaires sont de véritables signes de reconnaissance pour
un franc-maçon, ce n’est pas simplement une métaphore flatteuse.
C’est une invitation à construire une image de son corps selon la
rectitude induite par les outils et les postures qui facilitent le passage
du plan symbolique au plan réel.
Le rituel, œuvre incarnée.
La franc-maçonnerie perpétue le langage de ses prédécesseurs.
Aujourd’hui comme hier, l’homme est la mesure de toutes choses. Les
anciennes mesures : coudées, empans,
pouces et pieds l’inscrivent au cœur de
tous les édifices traditionnels. En toute
œuvre il s’incarne pour manifester
son rapport au monde et retrouver les
liens qui l’unissent à la communauté
humaine. Mais si quelques-uns ont
la faculté, donc le devoir, de le dire
ou de le peindre, ils ne parlent jamais
que de l’œuvre de tous. Les différentes
facettes de la vérité ne s’explorent que
par et dans l’altérité. L’universalité y
apparaît comme le garant de la justesse
de la démarche strictement individuelle
pourtant. L’œuvre d’art obéit aux
mêmes principes. La Voie de la peinture
qui a ouvert cet article figure par son
Proportions du visage, Léonard de Vinci. dénuement radical, la véritable épure de
cette démarche. À des degrés divers tous
les créateurs s’y reconnaissent. Les francs-maçons aussi, qui sont le
corps de l’œuvre… Ils travaillent en artistes, en poètes, en conjuguant
à toutes les personnes et selon tous les modes deux formes de pensée
qui prennent « corps » en eux-mêmes. On peut donc parler d’une
Voie du Rite, spécifique à notre culture et qui est de nature à répondre
au désenchantement du monde postmoderne. Le constat a été fait
maintes fois, que « la perte des significations symboliques constitue sans
doute la base même de la crise culturelle que nous traversons, car elle est perte
Points de Vue Initiatiques N° 159 99
Rites, arts et initiation
de cohérence et de sens. Elle est aussi perte de lien social… » (Mythes, rites,
symboles dans la société contemporaine).
La franc-maçonnerie écossaise est un ordre séculier qui applique
la règle reçue en dépôt aux réalités du présent. En ces temps de
confusion qui génèrent tribalismes et barbaries, elle répète cette
vérité sans âge que la cohérence du monde prend sa source dans
l’homme… L’homme seul, qui dit non aux facilités cyniques de la
disparition du sens… L’homme seul qui a compris que le premier
combat est celui qu’il mène contre lui-même et contre les pesanteurs
qui tentent de le réduire à un objet perdu dans la multitude.
Le Rite, le Maître.
Ma comparaison avec les voies orientales débouche pourtant sur une
différence de taille qui est aussi une difficulté. Les communautés
spirituelles, les ashrams, les fraternités regroupent les adeptes autour
d’un Maître. Si la loge maçonnique est composée de nombreux
maîtres, aucun d’eux n’est le Maître… La Voie du Rite possède cette
particularité de concevoir le Maître, le Guide de façon originale. Aux
multiples questionnements des apprentis, les maîtres expérimentés
apporteront leurs réponses, argumentées, historiquement fondées,
cependant toujours partielles. Leur souci sera surtout de renvoyer
les questions à leurs auteurs, de les inviter à une réflexion sur les
éléments symboliques en puissance de réponse. Le seul Maître est
constitué par l’ensemble qui constitue le Rite. Pas le Rite figé dans
des cahiers mais le Rite en action dans la loge, le Rite opérant en
chaque frère… Le Rite incarné, qui, s’emparant des corps transforme
le cœur. En espérant un perfectionnement sensible tout au long de la
vie de l’initié, la franc-maçonnerie écossaise restaure la dignité qui
se décline en liberté, égalité, fraternité. L’enjeu fondamental réside
dans ce projet qui, déjà, transforme le présent de chacun.
L’ambition de cette espérance ne doit pas devenir une prétention
hypertrophique. La sagesse du Rite en prévient les effets dans
d’autres degrés. Les faits ramènent toujours à une humilité qui reste
la compagne de l’initié. « Celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne
peut se tenir debout » constate le Tao Te King. Comme l’inspiration
pour l’artiste, la lumière est une expérience intérieure dont on ne
peut faire partager que les effets. Elle brille comme une signature
sur les visages des frères que le silence réunit, tout comme brûle avec
une humble obstination la bougie, symbole de Lumière Éternelle,
sur le plateau du Vénérable Maître. n
100 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Francois Maury
Peut-on modiier les
rituels ?
Le rituel fait pénétrer dans un temps et un espace caractérisés par
l’immutabilité. Mais le moyen d’atteindre ce qui ne change pas peut-
il changer lui-même ? Souvent la raison manque dans la polémique
qui oppose les tenants de l’invariabilité et les partisans de l’évolution.
L’histoire conirme la position des seconds et la symbolique
désapprouve les premiers. Pour sortir d’une logique binaire, il convient
d’examiner quels sont les diférents éléments qui composent le rituel
et quelle est sa fonction. Le rituel invite bien à un projet de liberté,
mais toute liberté doit s’inscrire dans un ordre. Comment résoudre le
paradoxe ?
Représentation d’une cérémonie en Autriche au XVIIIe siècle , Mozart est représenté
au premier plan à droite. Rosenau, musée autricihien de la Franc-maçonnerie.
À y bien regarder, les rituels ponctuent notre existence ; de même
qu’un signet est un marque-page, nous insérons dans nos vies des
« marque temps » : on célèbre son anniversaire, bougies bienvenues ;
on fête Noël et Noël n’existerait pas sans cadeaux ni repas plantureux ;
Points de Vue Initiatiques N° 159 101
Peut-on modiier les rituels ?
puis c’est le nouvel an que tous les Espagnols accueillent en gobant,
plus qu’ils ne croquent, douze grains de raisin au fur et à mesure
que s’égrènent les douze coups de minuit à l’horloge de la Puerta del
Sol ; on « se » sort le vendredi soir ; on prend du thé et du pain grillé
au petit-déjeuner ; on lit avant de s’endormir… tant et si bien que
sans ces rituels, ces manies peut-être, notre vie irait tout de guingois,
nos années ne tourneraient pas rond, nos journées seraient gâchées
par l’incertitude et nos nuits agitées quand on n’a pas pu lire avant
d’éteindre la lumière. On dit que l’homme est un animal d’habitudes,
mais les animaux aussi ont les leurs : le chat aime son fauteuil, le
chien son tapis et la vache son pré…
Changer un rituel qui varie : droit ou devoir ?
Nous, Francs-maçons, nous avons aussi notre rituel, qui est pour
les uns une douce berceuse fascinée par l’allumage des feux et
les pas solennels du Maître des Cérémonies, pour d’autres qui le
marmonnent au fur et à mesure de son déroulement, le moment de
guetter le moindre faux pas du Vénérable dans la diction ou dans le
geste. Mais quelle que soit la façon dont on le reçoit, on y est attaché
et chacun défend « son » rite : l’Écossais Ancien et Accepté, le
Français, l’Écossais Rectifié, l’Émulation, le Rite d’York, le Standard
d’Écosser, que sais-je encore… Les arguments ne manquent pas pour
prétendre que le sien est supérieur aux autres. Le problème, ce sont
les variantes à l’intérieur du même rite, voire les chambardements.
D’obédience à obédience, de loge à loge, les formulations d’un
Rituel, qui a pourtant le même nom et devrait donc être le même,
varient à telle enseigne que le voyageur, déstabilisé, tendu, attaché
aux différences plutôt qu’aux ressemblances, n’écoute plus, ne
partage plus, ne se sent plus invité mais intrus. Qui diable a pu ainsi
modifier mon rituel, le travestir, le grimer jusqu’à le rendre (presque)
méconnaissable et, en tout cas, infréquentable ?
Oui, a-t-on le droit de changer un rituel ? N’est-il pas comme une sorte
de quintessence de la Tradition, son secret, son sacré ? En changer
une lettre, c’est une espèce de sacrilège, une profanation, d’autant,
on le sait bien, que ce sont des mains profanes qui, assurément pour
de mauvaises raisons, ont osé le faire. Qui pourrait soutenir un
seul instant que l’impie qui a fait ça incarne la Tradition à lui tout
seul, si ce n’est lui-même ? Quel orgueil ! Les Anglais ont inventé
la notion de landmarks, des bornes qui marquent la régularité du
travail maçonnique ; Mackey en recense vingt-cinq et achève sa liste
par celui-ci : « Le landmark qui couronne le tout, c’est que ces landmarks
102 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Francois Maury
ne peuvent être changés ». Et pan ! Voilà
qui est clair et qui dit bien que ce qui
relève de la Tradition, et c’est le cas
d’un rituel, est intangible et ne saurait
être modifié par qui que ce soit.
Et pourtant, c’est fou ce que les rituels
ont vieilli ! Dans l’Examen d’un Maçon,
de 1723, à la question : « – Où avez-vous
été reçu [Franc-maçon] ? », la réponse
est : « – Dans la Vallée de Josaphat,
La Vallée de Josaphat,
derrière un buisson de joncs, là où on n’a Thomas Seddon, 1854.
jamais entendu l’aboiement d’un chien, ou le
chant du coq, ou en quelque autre lieu. » Il faut bien avouer, même si c’est
à regret, que notre civilisation urbaine a perdu ces références. Dans
un autre « catéchisme », celui du Manuscrit d’Édimbourg de 1696, on
trouve cet autre échange : « – Où trouverai-je la clé de votre Loge ? – A
trois pieds et demi de la porte de la Loge, sous un parpaing et une motte verte.
Et sous le repli de mon foie, là où gisent tous les secrets de mon cœur. – Qu’est
la clé de votre Loge ? – Une langue bien pendue. – Où se trouve la clé ? –
Dans la boîte d’os. », autrement dit dans le crâne, d’autres manuscrits
précisant que cette boîte est gardée par des tours d’ivoire, entendez :
les dents ! Comme quoi, l’imagination va bon train… Quand on lit
cela, on s’interroge : c’est ça, la Tradition ? c’est là qu’elle se situe ?
peut-on sérieusement affirmer qu’elle est immuable et que ne pas
transmettre ces inepties va rompre la chaîne initiatique qui relie
les générations ? Dans ces conditions, n’est-ce pas un devoir que
de modifier les rituels pour les adapter à l’évolution naturelle des
mentalités, à la culture sociale d’une époque, afin d’éviter qu’ils ne
deviennent des ritournelles désuètes, aux formulations qui prêtent à
rire au lieu de conduire au recueillement ?
C’est ici que se situe l’affrontement entre les tenants des deux thèses :
ne rien toucher pour les uns, modifier pour les autres. Les premiers
trouvent un soutien, voulu ou pas, chez les historiens qui exhument
des archives « le » manuscrit le plus ancien, le plus authentique, le
plus inattaquable, le texte fondateur ou précurseur de tel ou tel Rite.
Des coteries se forment, des groupes de défense partent en croisade,
des livres sont édités car la nostalgie des origines attire toujours.
De leur côté, les tenants du changement prétendent qu’il faut être
moderne. Ils ajoutent que le rituel appartient à l’Obédience tout
entière et qu’en conséquence c’est au Convent et à lui seul qu’il
incombe d’adopter ou de refuser une éventuelle modification, car
Points de Vue Initiatiques N° 159 103
Peut-on modiier les rituels ?
il est bien normal qu’un rituel qui doit rassembler tous les Frères
puisse être modifié par eux tous, non ? Quant aux variations que
peuvent apporter les Loges, elles sont mineures et constituent, disent
leurs membres, le lien de la loge ; uniformiser serait détruire une
identité ; d’ailleurs, les petites différences entre les ateliers font le sel
des visites, n’est-ce pas ?
Voilà quelques-uns des arguments qu’avancent
les uns et les autres ; il y en a davantage et
les discussions sont aussi nombreuses que…
discutables ! Que penser de tout ça ?
Commençons par une évidence : un rituel fait
partie d’un Rite et celui-ci comprend plusieurs
rituels. Ainsi, le Rite Écossais Ancien et
Accepté en comporte trente-trois et tous les
Rites maçonniques en comptent au moins
trois, correspondant aux grades d’Apprenti,
de Compagnon et de Maître. Par conséquent,
modifier un rituel n’est pas forcément altérer
le Rite. De plus, le rituel, quel qu’il soit, sert
à accompagner le cheminement intérieur
qui permet de passer du profane au sacré et
de retrouver en soi les valeurs fondatrices de
l’Homme. Tous les rituels ont cette fonction et
seule ma sensibilité ou mes habitudes me font
L’Arbre de la Cabbale,1985,
Davide Tonato. préférer tel rite à tel autre, car tous utilisent
les mêmes outils – les symboles et les mythes
– et me conduisent pareillement, à condition que j’accepte de m’y
abandonner, à mon ésotérisme intérieur.
Distinguons ici pensée mythique et pensée ésotérique. Alors que dans
les sociétés primitives les mythes servaient à fournir une explication
aux phénomènes naturels, ou à les réduire à des comportements
humains afin de les dominer, dans nos sociétés occidentales la
« pensée mythique » consiste à statufier des personnages ou des
événements, à en faire des modèles ou des images figées, objets de
respect, voire de vénération collective. Il s’agit, ni plus ni moins,
que de création d’idoles. On les voit portées par un unanimisme
momentané qui aurait enchanté Jules Romain : des sondages
désignent « la personnalité préférée des Français », le tsunami
suscite une émotion dont on ne se dédouane que par la générosité,
le « mondial » fédère une nation qui se déchire par ailleurs, etc. Si
la pensée mythique me soumet à l’idéologie commune, la pensée
104 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Francois Maury
ésotérique, en revanche, me libère. Elle consiste, en effet, à imaginer
un côté caché des réalités ou la perte d’un élément qui faisait partie
d’un tout. En me sortant ainsi de mon cadre, elle m’incite à la
découverte. La Franc-maçonnerie relève, bien entendu, de cette
dernière conception… sans la pratiquer toujours.
Dans le cadre de cette pensée ésotérique, le rituel joue un rôle
fondamental. Il s’appuie sur deux dimensions : l’énoncé et son
expression, autrement dit, d’une part ce qui est dit (le texte lui-
même), d’autre part la façon de le dire ; et il ouvre une troisième
voie, constitutive de la fraternité : la transmission.
L’expression du rituel
Il est clair qu’aujourd’hui cette transmission initiatique porte moins
sur le premier aspect, le contenu, que le livre et Internet ont rendu
accessible à tous, initiés ou pas, que sur le second, l’intonation et
la gestuelle qui accompagnent ou, plutôt, qui soutiennent cette
transmission et lui donnent son sens. Ainsi « l’expression », ce que
d’aucuns appellent la mise en scène du rituel, constitue la véritable
dimension de son actualisation. On sait que les rituels sont mortels : il
en a été ainsi de ceux des pythagoriciens, des orphiques ou d’Eleusis,
par exemple. Ce qui les maintient en vie, c’est la pratique vivifiante.
Mais attention : il ne s’agit pas d’une « mise en fonctionnement de la
langue par un acte individuel d’utilisation » selon la définition que le
linguiste Émile Benveniste donnait à l’énonciation ; non, il ne s’agit
en aucune façon de produire des signes personnels ou théâtraux
manifestant, révélant ou trahissant des émotions, des sentiments
et des intentions ; jouer le rituel, faire des effets de manche, le
corromprait inéluctablement. Car l’« expression » du rituel n’est pas
un acte individuel, mais un acte traditionnel dans lequel chacun est
le vecteur d’une approche collective immémoriale. Chacun, et pas
seulement le Vénérable, car tous les initiés présents en Loge « portent »
le rituel avec lui, ils le « créent » par leur attention, en se laissant
habiter par la magie qui s’en dégage et, à ce titre, contribuent à ce
qu’une cérémonie devienne initiatique et non pas touristique. Celui
qui transmet n’est, en effet, qu’un passeur qui permet à la Tradition
d’exister en l’actualisant. Dans cette perspective, l’expression du rituel
consiste à le rendre présent hic et nunc, ici et maintenant, présence
émerveillée qui fait se rejoindre les deux bouts de la chaîne du temps
initiatique, le temps immédiat et le temps infini qui confluent de midi
à minuit, insérant l’initié dans l’humanité tout entière rassemblée
dans l’éternité de son être.
Points de Vue Initiatiques N° 159 105
Peut-on modiier les rituels ?
Mais ce n’est pas là le seul rôle du rituel maçonnique. S’il diffère
de ceux du 1er mai, du 1er novembre ou du 14 juillet, c’est que sa
mission est tout autre. Le but n’est pas de célébrer un événement
factuel par une cérémonie du souvenir, mais de contribuer à une
œuvre spirituelle en favorisant une relation intime avec ses frères
autant qu’avec soi-même. Ce rôle de mise en contact qui est ainsi
confié au rituel est, de fait, une mission de confiance. Car établir
une relation, c’est accepter de devenir dépendant de l’autre à qui
j’ouvre peu à peu quelque chose de mon cœur et du mystère de ma
personne. Et cette ouverture me rend vulnérable à son regard et le
conduit à « posséder » une part de moi-même. Cette dépendance est
sans retour. Elle ne peut compter que sur l’oubli pour se délier. Ainsi
est posée la question de la liberté.
Libres ensembles et libre avec soi-même
Mais ce qui est vrai pour moi l’est pareillement pour l’autre qui se
livre aussi. Cet acte réciproque devient, au plein sens du terme, un
acte de fraternité mis en œuvre par le rituel. Et de conquête mutuelle
de la liberté. Libres ensemble et libre avec soi-même. Car notre
fraternité ne se limite pas à l’accueil de l’autre, elle commence par
l’accueil de soi : nul ne peut devenir qui n’a pas d’abord accepté ses
limites. Ce n’est qu’après que l’on pourra dire comme Térence dans
son Heautontimoriumenos (Le bourreau de soi-même) : « homo sum,
humani nil a me alienum puto » (je suis homme, j’estime que rien de
ce qui est humain ne m’est étranger).
En fait, le rituel nous invite à un projet de liberté. Non pas liberté
de l’autre (être libéré de lui), mais liberté avec l’autre. Nietzsche
nous rappelle, dans Ainsi parlait Zarathoustra, que la question n’est
pas libre de quoi mais libre pour quoi. Nul cheminement, nul projet,
nul vrai lien possible sans liberté. Or la liberté, dans son sens moral,
commande un décentrement, une distanciation d’avec soi afin de
faire advenir la possibilité du jeu initiatique. « Jeu » ne doit pas être
pris ici dans le sens de fantaisie mais dans celui de processus et,
plus encore, dans celui d’espace nécessaire entre les rouages ou, par
exemple, entre les cordes d’un violon pour jouer. La musique est
dans le « vide médian », comme dit le poète François Cheng. C’est
dans l’espace de séparation entre soi et autrui que s’instaurent les
rites de la liberté. « Le rituel initie la mise à distance de soi à soi, à autrui
et au monde, en même temps qu’il permet, par ses médiations symboliques,
de ne pas trop souffrir de l’écart. » – explique le professeur canadien
Denis Jeffrey. Pour sa part, Henry Corbin y situe l’imaginal et le
106 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean-Francois Maury
domaine des anges. C’est aussi le lieu de la rencontre et de l’égrégore.
Et ce lieu est hors de l’espace comme le temps initiatique est hors du
temps. C’est le Centre où les contraires ne se repoussent plus mais
se complètent, où la pesanteur matérielle du corps se transforme
en esprit, où la parole devient création, c’est « l’entre deux » où les
sujétions se conjuguent en liberté car c’est le vrai lieu (et le seul) de
la Connaissance et de l’accès aux Petits Mystères.
Pour s’en approcher le rituel permet de « laisser ses métaux à la
porte du Temple » c’est-à-dire d’accéder à cette liberté d’être qui est
disponibilité à soi, à autrui et au monde. La disponibilité concerne
des dimensions d’écoute, de recueillement, d’accueil, d’hospitalité,
d’échange, de don et de contre-don. La liberté est un exercice
initiatique pour s’accueillir soi-même, accueillir autrui et l’univers
dans l’étonnement et l’émerveillement, mais aussi dans la terreur et
l’épouvante. « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » – disait
Pascal. Il est vrai que la solitude les entoure. Fascinante et terrible
La liberté est un exercice initiatique.
solitude… L’affronter exige de s’unir, se réunir. C’est pourquoi le
maintien dans la liberté nécessite des pratiques rituelles. On ne
saurait rencontrer ce qui nous est étranger sans y être bien préparé
rituellement. Et celui qui m’est le plus étranger, c’est moi, avec cette
partie cachée que je me dissimule et cette façade, toute de sourires et
de séduction, que j’affiche, ce masque qui me représente et dont je
me persuade qu’il est moi. Dans ces conditions, je ne prendrais pas
le risque de me découvrir, de chercher à me connaître, si ce n’était
conquête de liberté. Et je sais bien que je n’y parviendrai que par la
transcendance.
L’instrument d’une quête
Le professeur Jeffrey explique encore que « le rite implique une
dimension symbolique qui éduque et façonne la sensibilité. Il opère, dans
sa réalité la plus profonde, un travail de conversion, car il ouvre l’esprit
Points de Vue Initiatiques N° 159 107
Peut-on modiier les rituels ?
aux symboles qui donnent à vivre du sens. » Et il ajoute : « C’est encore la
meilleure définition qu’on puisse donner d’un rituel : un acte symbolique qui
donne à vivre du sens. » Si l’on se place dans cette perspective qui ne
différencie pas rituel et rite, rien ne s’oppose à la modification des
rituels. Après tout, c’est peut-être en cassant ses habitudes que la
conscience se trouve aiguillonnée et que se manifeste l’éveil. Et rien
n’interdit non plus qu’il soit modifié si l’on ne prend en compte que
la capacité du rituel à nous mener à cet espace de liberté qui est en
même temps découverte d’un moi devenu lieu de transformation.
Sans compter que s’il y a plusieurs rituels, j’allais dire une infinité de
rituels, cela signifie que leur modification n’a que peu d’importance
par rapport à leur mode opératoire.
Mais ce n’est pas si simple. Si les rituels maçonniques s’intègrent,
comme nous l’avons vu, dans un rite, c’est qu’ils en sont les marches
ascendantes pour nous aider à progresser, non pas jusqu’à un but
défini in abstracto, mais jusqu’au bout de nos aptitudes propres.
Chaque rituel n’est qu’un élément d’un ensemble plus vaste
qui ressortit à la notion d’Ordre qu’il faut différencier de celle
d’Obédience. Face à cette dernière, qui a un rôle organisationnel,
« l’Ordre, dans son essence, est métaphysique. Dans sa manifestation il est
traditionnel. », explique Marius Lepage. Il en résulte que si le pouvoir
est à l’Obédience, l’autorité est à l’Ordre qui prend en compte une
autre notion, celle d’esprit du rite car modifier un rituel requiert d’en
respecter l’architecture globale. Toutefois, une notion aussi vague
que « l’esprit du rite » ouvre la porte à toutes les interprétations et
à tous les sectarismes. N’ouvrons pas cette porte mais ouvrons, au
contraire, notre conception ; après tout, le rituel n’est qu’un médiateur
entre le profane et le sacré ; en tant qu’instrument d’une quête il est à
son service ; ce n’est pas lui qui est premier, c’est la quête.
Dans Orient et Occident, René Guénon souligne que « la tradition admet
tous les aspects de la vérité ; elle ne s’oppose à aucune adaptation légitime ;
elle permet à ceux qui la comprennent des conceptions autrement plus vastes
que tous les rêves des philosophes qui passent pour les plus hardis, mais
autrement solides et valables ; enfin elle ouvre à l’intelligence des possibilités
illimitées comme la vérité elle-même… » Si chacun sait ou pressent qu’il
n’y a pas de Vérité avec un grand V, atteindre sa vérité intérieure
n’est pas une mince affaire et ce bâton de pèlerin qu’est le rituel sera
aussi bien appui dans l’effort ou le découragement que gourdin pour
se défendre des faux-semblants et des mauvais prétextes. Après tout,
l’essentiel, c’est d’avancer. n
108 Points de Vue Initiatiques N° 159
Francois Rognon
Les rituels des collections
de la Grande Loge de France
Les traditions maçonniques se sont longtemps transmises oralement,
mais la Franc-maçonnerie spéculative moderne a accordé une
importance capitale à la conservation de l’écrit. Malgré l’interdiction
qui était faite de les reproduire, les rituels n’y ont pas échappé ; rituels
manuscrits, puis rituels imprimés. Le musée de la GLDF dévoile dans ce
texte quelques-uns des trésors de ses collections et vous invite, ce faisant,
à parcourir l’histoire de la naissance de la Grande Loge de France.
Manuscrit Regius
(ou Halliwell,
du nom de son
découvreur), 1399.
Le manuscrit Régius (1499) peut être considéré comme l’une des
premières pièces d’archives de la Franc-maçonnerie moderne. Ce
recueil d’environ 15 000 vers, qui raconte une histoire légendaire et
biblique du métier et qui édicte les règles qui doivent permettre à
un chantier d’être efficace et harmonieux, est en effet l’un des plus
anciens « old charges », un ancien devoir, dont James Anderson
et Jean-Théophile Desaguliers se sont inspirés pour rédiger les
Constitutions de l’Ordre Maçonnique. L’un des plus anciens mais
aussi l’un des plus beaux. Lors de sa dernière « sortie », il avait été
prêté par la British Library à l’exposition maçonnique de Tours en
1997, nous avons apprécié son extraordinaire fraîcheur tant dans les
couleurs des encres, la finesse de la calligraphie que l’état du papier.
Points de Vue Initiatiques N° 159 109
Les rituels des collections de la Grande Loge de France
Cet état de fraîcheur est dû au simple fait qu’il n’a quasiment jamais
été feuilleté. Ceux qui s’y référaient le connaissaient par cœur, grâce
aux astuces mnémotechniques de sa versification ; en cas de doute, on
savait qu’il était là. L’art de la mémoire, très en vogue à la fin de la
Renaissance, a joué un grand rôle dans la transmission des traditions
maçonniques. Les Statuts Schaw (1599) estiment que cette science
doit être parfaitement maîtrisée par ceux qui souhaitent devenir
« compagnons du métier ». On retrouve cette tradition orale dans les
maçonneries anglo-saxonnes où les longues exhortations récitées par
cœur ressortissent parfois du domaine de l’exploit mais permettent à
celui qui les prononce d’assimiler le sens du rituel d’une façon profonde
et intime. D’autres influences de cette tradition orale sont nettement
visibles dans la transmission des mots de passe et des mots sacrés des
différents degrés, ainsi que dans la pédagogie des « catéchismes » qui
proposent des questions/réponses à décliner par cœur.
Il est cependant frappant de constater que dès sa fondation, la
Franc-maçonnerie spéculative moderne a accordé une importance
capitale à la conservation de documents écrits : constitutions,
règlements, patentes accordées aux loges, diplômes décernés aux
maîtres… Les rituels n’y ont pas échappé alors que de tout temps il
a été interdit de les tracer, écrire, buriner, graver ou sculpter ou de
les reproduire de quelque façon que ce soit. Ce besoin de support
écrit peut s’expliquer par la volonté de justification, de légitimation,
d’assurance d’inaltérabilité de la tradition, dont la transmission
risquait de souffrir d’ignorance, d’oubli, de négligence, ou de dérives
moins innocentes.
Pour contourner l’interdit de transcription écrite des rituels,
on voit apparaître très tôt des « divulgations », petits livres
imprimés présentés comme
antimaçonniques qui, sous
prétexte de révéler les secrets
des Francs-maçons, diffusent
et « normalisent » les tableaux
de loges, les « catéchismes »
et les descriptions des phases
de la cérémonie d’initiation :
« Réception d’un frey-maçon »
(1737), « L’Ordre des Francs-
maçons trahi et le secret des
Mopses révélé » (1745), « Le
Sceau rompu » (1745).
Mémento imprimé de «maître bleu» circa, 1775
110 Points de Vue Initiatiques N° 159
Francois Rognon
Parallèlement, de nombreux rituels manuscrits, beaucoup plus
complets et précis, circulent et alimentent les systèmes maçonniques
qui se mettent en place tout au long du XVIIIe siècle. Si les trois premiers
degrés restent stables et ne manifestent que quelques différences
distinguant les pratiques des « ancients » de celles des « moderns »,
les rituels des hauts grades prolifèrent. Les historiographes ont
recensé plusieurs dizaines de rites ; J.-M. Ragon, (1781-1766) en
dénombre 52 ! Tous n’auront pas la même durée de vie ni le même
rayonnement, mais certains d’entre eux seront assimilés et assemblés
pour donner les principaux rites pratiqués aujourd’hui. De très
belles collections sont conservées au département des manuscrits
de la Bibliothèque nationale, notamment le fonds « Chapelle », du
nom du secrétaire de la Très Respectable Grande Loge de France
qui déposa ses archives lors de la réunion de celles-ci avec celles du
Grand Orient en 1799. Un catalogue des manuscrits maçonniques
des bibliothèques publiques de France (Jacques Léglise ; 2 vol. édit
SEPP 1984-1988) présente les fonds des archives départementales et
des bibliothèques municipales dont, parmi les plus importants, ceux
d’Avignon, Bordeaux, Lyon, Nîmes ou Toulouse.
Le premier rituel français imprimé officiellement pour une institution
maçonnique est le Corps complet de maçonnerie adopté par la R.G.L. de
France, daté de 1779. Ce rituel des trois premiers degrés est précédé
d’un avis qui commence par ces mots « si quelques exemplaires de
la très peu nombreuse édition d’un corps complet de Maçonnerie, à
l’impression de laquelle on n’a pas pu se refuser par la sollicitation
de quelques loges régulièrement constituées tombent jamais en
des mains profanes, les bons et véritables Maçons ne pourront en
attribuer la cause qu’à la seule négligence des Frères auxquels il
pourra être confié, parce que l’on a pris la précaution de la faire faire
sous les yeux d’un Frère dont la discrétion est bien connue, qu’elle a
été composée et imprimée par d’autres Frères aussi très discrets et
qui outre l’obligation qu’ils ont prêtée lors de leur réception se sont
encore formellement engagés d’en remettre les épreuves et jusqu’aux
traces les plus légères de l’impression… ».
Les exemplaires étaient remis contre « des récépissés en bonne
forme » ainsi rédigés : « Je soussigné, reconnais qu’il m’a été remis
l’exemplaire imprimé ci-dessus et d’autres parts, du grade de Maître,
pour lequel j’ai donné et donne, par le présent, ma parole d’honneur
de ne communiquer à quelque Profane que ce soit, de l’un ou
l’autre sexe. Consentant à être déshonoré si, par ma faute, ou par
ma négligence, ledit exemplaire tombe jamais en d’autres mains
Points de Vue Initiatiques N° 159 111
Les rituels des collections de la Grande Loge de France
qu’en celles d’un Frère. En foi de quoi j’ai signé le présent pour ma
justification ou ma confusion. »
Manuscrit « alchimique » aquarellé dit « Chamonal » (du nom du vendeur),
milieu du XVIIIe siècle.
Les rituels continuent à être recopiés manuellement et il arrive
même que certains rituels imprimés soient retranscrits à la plume. Il
en est de très beaux comme le rituel dit du Duc de Chartres de 1784
intitulé La Vraie Maçonnerie des hommes et des femmes ou Cours complet
de l’adoption des femmes en trois grades. Suivi d’un Corps de massonerie
des hommes.
Corps complet de maçonnerie, 1770
112 Points de Vue Initiatiques N° 159
Francois Rognon
La maçonnerie des dames ou maçonnerie d’adoption apparaît en
France vers 1750. Le premier rituel connu date de 1763 et l’ouvrage
de Louis Guillemain de Saint Victor La Vraie Maçonnerie d’adoption
est imprimé pour la première fois en 1779. Le Rituel du duc de
Chartres est manuscrit et détaille les cérémonies d’initiation et les
« instructions » des grades d’« apprentisse », de « compagnonne » et
de « maîtresse ». Certains rituels d’adoption de la fin du XVIIIe siècle
proposent des systèmes à 4, 5 ou, plus rarement, 8 degrés. Ces rituels
des trois premiers degrés inspireront les rituels d’adoption remis en
vigueur par la Grande Loge de France au tout début du XXe siècle.
Rituel manuscrit aquarellé du Duc de Chartres, 1784. Rituel d’Apprentisse (sic). Au premier
degré du Rite d’Adoption, le tableau de loge représente la tour de Babel, l’échelle de
Jacob et l’arche de Noé.
Le rituel « masculin » qui suit présente de magnifiques tableaux de
loge à différents degrés. Sur le tableau de loge du 1er degré, on voit
clairement que les lettres figurant sur les deux colonnes de l’entrée
du temple, de part et d’autre du pavé mosaïque, ont été raturées
pour être inversées : le B est devenu J sur la colonne de gauche et
le J est devenu B sur la colonne de droite. Peut-on rapprocher cette
modification du titre de l’ouvrage La Vraie maçonnerie des hommes et
des femmes… qui sous-entend l’existence d’une maçonnerie « rivale » ?
Le manuscrit propose un système en 13 degrés. Le quatrième n’est
pas mentionné, le cinquième le maître parfait n’est pas numéroté,
et comme souvent à cette époque, c’est lui qui commence la série
Points de Vue Initiatiques N° 159 113
Les rituels des collections de la Grande Loge de France
des hauts grades. Suivent ensuite trois grades d’élus, deux grades
d’architecte puis trois grades, parmi les plus anciens : Chevalier
d’Orient : 11e, Noachite ou Chevalier Prussien, 12e et Rose + Croix
13e, qui s’inspire de textes plus anciens mais qui est en fait, ici, un
grade terminal. C’est ce genre de rituel qui inspirera les rédacteurs
du Régulateur du Maçon le premier rituel imprimé largement diffusé,
qui fixera les trois premiers degrés du rite français. Le Guide de maçon
écossais, lui, sera publié vers 1810.
Rituel manuscrit aquarellé du Duc de Chartres, 1784. Tableau de loge et rituel d’apprenti.
Malgré ces éditions imprimées en grand nombre des rituels
fondateurs, des tuileurs et autres vade-mecum, on trouve encore, au
XIXe siècle, plusieurs rituels manuscrits dont le magnifique rituel
aquarellé du Rite Écossais Ancien et Accepté que l’on peut dater des
environs de 1830 grâce à la précision des vêtements et de la coupe
de cheveux des deux personnages. La fraîcheur de ce document est
également due au fait qu’il n’a pas été ouvert très souvent. Ce rituel
a en effet été retrouvé avec d’autres, notamment des manuscrits du
XVIIIe siècle, dans ce que l’on a coutume d’appeler « les archives
russes ». En juin 1940 les nazis investissent les sièges des obédiences
maçonniques et s’emparent d’une partie des archives censées
contenir des secrets ésotériques, laissant les archives administratives
aux bons soins de ce qui deviendra le service des sociétés secrètes du
114 Points de Vue Initiatiques N° 159
Francois Rognon
gouvernement de Vichy et qui publiera la liste des Francs-maçons au
journal officiel. N’ayant trouvé ni le plan du trésor des Templiers ni
la formule alchimique de la transmutation des métaux, ils stockent
ces archives dans un château de Silésie orientale. C’est là que l’armée
rouge les récupère en 1944 et les ramène à Moscou où elles restent
dans une cave du KGB, pratiquement jamais consultées, à l’abri
de la lumière et des manipulations intempestives. Ce n’est qu’au
moment de la perestroïka que les négociations commencent avec le
quai d’Orsay et que ces archives sont rendues à leurs propriétaires en
2002, après plus de cinquante ans de silence… On en avait presque
oublié l’existence !
Rituel manuscrit aquarellé d’apprenti du Rite Écossais Ancien et Accepté, circa 1830.
En 1821, le Suprême Conseil crée la Grande Loge Centrale dont
l’une des sections est chargée de l’administration des loges bleues.
Certaines de ces loges bleues sont beaucoup plus anciennes que la
date de leur prise en considération administrative (Le Mont Sinaï, Les
Trinitaires, La Clémente Amitié…) Le Suprême Conseil de France leur
fournira les rituels des trois premiers degrés sous forme manuscrite,
comme celui entièrement copié à la main remis par le Suprême
Conseil à la Loge n° 148, l’Union de Perpignan, en 1857.
Le premier rituel imprimé utilisé par les loges bleues du Suprême
Conseil sera distribué en 1877, deux ans après le Convent de
Lausanne. En 1880, un certain nombre de loges du Suprême Conseil
prennent leur indépendance et fondent la Grande Loge Symbolique
Points de Vue Initiatiques N° 159 115
Les rituels des collections de la Grande Loge de France
Écossaise qui imprime un rituel
dans les années 1890. Il est
amusant de souligner que le rituel
du grade de Maître de la Grande
Loge Symbolique Écossaise
(GLSE) fait apparaître la reine
de Saba dans la légende d’Hiram
et que c’est une loge de cette
même GLSE qui initiera Maria
Deraisme, qui sera à l’origine de
la création de l’obédience mixte
Le Droit Humain en 1893. En
1894 le Suprême Conseil accorde
une certaine autonomie à ses
loges bleues qui prennent le nom
de Grande Loge de France en
Rituel de la loge L’Union de Perpignan, en 1857.
1894. La quasi-totalité des loges
de la Grande Loge Symbolique
Écossaise la rejoint en 1896. L’autonomie de la Grande Loge de
France par rapport au Suprême Conseil est confirmée et accentuée
en 1904. Jusqu’à cette date, les loges de la Grande Loge de France
utiliseront les rituels du Suprême Conseil. La page de Titre changera
en 1905 et fera apparaître clairement le sceau et le nom de Grande
Loge de France, mais le contenu restera inchangé, libre aux loges
qui le souhaitent de rayer la référence au Grand Architecte de
l’Univers. Cette incertitude concernant le Grand Architecte sera vite
levée. Les rituels de La Grande
Loge de France de 1907 ouvrent
les travaux et consacrent les
nouveaux frères À la Gloire Du
Grand Architecte de l’Univers
(ALGDGADL’U). Lors de
l’initiation, le Frère Orateur se
réfère au convent de Lausanne
sans citer les termes exacts,
dont la définition du Grand
Architecte, Principe créateur,
qui n’apparaît clairement qu’en
1955. n
Rituel de la Loge L’Humanité d’Asnières, en 1905.
116 Points de Vue Initiatiques N° 159
HISTOIRE
Louis Trébuchet
La Grande Loge Générale
Écossaise : Origine de
notre rituel du premier
degré
Quelques mois à peine après être rentré en France, alors même
qu’il constitue le Suprême Conseil de France en nommant des
Grands Inspecteurs Généraux, du 30 septembre au 25 octobre 1804,
Alexandre François Auguste de Grasse-Tilly réunit le 17 octobre
un Grand Consistoire du 32e degré pour autoriser la création de la
Grande Loge Générale Écossaise, accédant ainsi à la demande de la
Mère loge Écossaise Saint Alexandre d’Ecosse.
Points de Vue Initiatiques N° 159 117
La Grande Loge Générale Écossaise : Origine de notre rituel du premier degré
La Grande Loge Générale Écossaise se réunit pour la première
fois le 27 octobre 1804, sous la présidence effective de Grasse-Tilly,
Très Respectable Représentant du Grand Maître, car la Grande
Maîtrise a été proposée au Prince Louis Bonaparte, connétable de
l’Empire. Elle annonce son existence à la maçonnerie française par
une circulaire du 1er novembre 1804. Mais « lorsque le T.Ill.F. le Mal
d’Empire Kellermann, l’un des chefs de l’ancien Rit écossais, présenta à son
altesse sérénissime l’Archi-Chancelier de l’Empire les FF de Grasse-Tilly et
Pyron… Son Altesse Sérénissime leur annonça que Sa Majesté l’Empereur
désirait que la Gde.L.Gle se rapprochât du Gd. O ».
Sous cette irrésistible pression, les négociations avancent très vite,
et lors de sa sixième réunion, le 5 décembre 1804, « le Rble F. Pyron a
donné lecture du concordat signé entre les Comres du G.O. d’une part et les
Comres de la Gde L. Gle Ec. relativement à la réunion de l’Ancien Rit accepté
au G.O., l’orateur entendu, la Gde L. Gle Écossaise a déclaré approuver et
ratifier tout ce qui a été fait par ses Comres et qu’elle serait dès ce jour au G.O.
de France pour ne plus former à l’avenir avec lui qu’un seul et même corps
de Mac. ».
Cette Grande Loge Générale Écossaise n’a ainsi vécu qu’un mois et
demi, et pourtant elle a apporté à notre rite, qui prit avec le Concordat
son titre définitif de Rite Écossais Ancien et Accepté, un élément
essentiel : l’unification de ses rituels des degrés symboliques.
Au XVIIIe siècle les rituels des degrés symboliques utilisés par les
loges se disant écossaises sont en réalité très divers. En Amérique et
aux Antilles, lorsque Henry Francken en recopiera de nombreuses
fois dans les années 1770 à 90 les différents degrés du rite, il
commencera toujours au quatrième de gré, car aux trois premiers
degrés coexistent alors le rite ancien et le rite moderne.
En France et en Europe continentale, on ne sait quasiment rien des
rituels utilisés par les plus anciennes loges, celle créée en 1725 par
Derwentwater, MacLean et O’Heguerty qui ne doit rien à la Grande
Loge des Modernes, ou la loge Coustos-Villeroy créée dix ans plus
tard sous les auspices de Londres, si ce n’est qu’il y a des différences
entre les deux que Coustos relèvera. Une gravure de la première
moitié du XVIIIe siècle appartenant au musée de la Grande Loge
de France montre une loge ou les officiers ont encore le cordon
bleu, mais sont placés dans la disposition du rite ancien. Dans la
seconde partie du siècle, le rite écossais philosophique issu de la Mère
Loge Écossaise d’Avignon, et sans doute pratiqué par la Mère Loge
Écossaise de France Saint Jean du Contrat Social et ses loges filles,
118 Points de Vue Initiatiques N° 159
Louis Trébuchet
place Sagesse, Force et Beauté suivant le rite ancien, mais utilise les
mots du rite moderne, le rituel du marquis de Gages, 1763, comme
le rituel de la Loge La Française à Bordeaux en 1767, utilise les mots
et la position des officiers des moderne mais la disposition ancienne
des trois piliers, ainsi qu’une circulation du mot qui rappelle celle du
manuscrit écossais d’Edinburgh de 1686, alors que la Parfaite Union
de Namur travaille au rite ancien.
À compter de 1804, le R.E.A.A. a en Europe un rituel du premier
degré unifié. Quatre documents extrêmement similaires le décrivent.
Le Guide des maçons écossais, qui précise les trois premiers degrés
symboliques, circule sous forme manuscrite à partir des années
1810 et est imprimé aux alentours de 1821. Le manuscrit Kloss
XXVII de la bibliothèque de la Grande Loge des Pays Bas, rédigé
vraisemblablement entre 1805 et 1810, détaille l’ensemble du rite du
premier au trente-troisième degré. Le rituel manuscrit du premier
degré de la loge La Triple Unité Écossaise découvert récemment
par Pierre Noël dans la bibliothèque du Suprême Conseil pour la
Belgique, qui porte le sceau de la Grande Loge Générale Écossaise
et la date de 1804, reçoit le néophyte « sous les auspices de la Grande
Métropole d’Heredom sous le Régime Écossais réuni au G.O. de France »,
ce qui le situe après le 5 décembre 1804. Enfin un rituel du premier
degré appartenant à la collection de Claude Gagne semble le plus
ancien, mais de quelques semaines tout au plus, puisque la mention
manuscrite « au nom et sous les auspices de la très sérénissime Gde Loge Gle
écossaise de France » a été à moitié effacée et surchargée d’une écriture
différente par « au nom du Sérénissime G. Mre., sous les auspices du G.O.
de France ». Il a donc été écrit initialement pendant les quarante-cinq
jours d’existence de la Grande Loge Générale Écossaise, entre le
27 octobre et le 5 décembre 1804.
Au-delà de la quinzaine de variations extrêmement minimes entre
ces quatre manuscrits, deux différences seulement sont remarquables.
Premièrement, le nom du rite évolue : pour le plus ancien rituel
c’est le Rit écossais, pour le rituel de la Triple Unité Écossaise, au
moment du concordat, c’est le Rit ancien accepté reconnu écossais, pour
Points de Vue Initiatiques N° 159 119
La Grande Loge Générale Écossaise : Origine de notre rituel du premier degré
les rituels suivant c’est définitivement le Rit écossais ancien et accepté.
Deuxièmement, le rituel original n’inclut aucune vérification que la
loge est couverte, et que tous les frères sont « maçons et à l’ordre », ces
vérifications apparaissant dans le rituel de la Triple Unité Écossaise
et dans tous les rituels ultérieurs. Mais le plus remarquable est
qu’à quelques variantes près, le rituel original est la traduction en
français, élégante mais très fidèle, du rituel des Anciens exprimé par
la divulgation de 1760 Three distinct knocks, qu’il traduit d’ailleurs
par trois grands coups.
Organisation de la loge et ouverture des travaux
Three distinct knocks ne nous livre du rituel des anciens que l’ouverture,
la fermeture des travaux et l’instruction. Il ne cite donc que le
Vénérable Maître, les deux surveillants et les deux diacres. Le rituel
de la Grande Loge Générale Écossaise, qui donne en outre le détail
de l’initiation, y ajoute l’orateur, le secrétaire, le trésorier, l’expert
et le maître de cérémonie, ainsi que le frère terrible, ancêtre du
couvreur, qui assumera une partie des tâches aujourd’hui dévolues à
l’expert lors de l’initiation. Les deux diacres dont les fonctions sont
respectivement de « porter les ordres au premier surveillant et aux ouvriers
dignitaires » et de « porter les ordres du premier surveillant au deuxième »
disparaîtront dans le rituel de 1877 imprimé par le Suprême Conseil
de France après le Convent de Lausanne. Mais ne nous méprenons
pas : le titre de diacre n’a ici aucune signification religieuse, il ne
s’agit pas d’un chapelain. Diacre est la traduction du titre de
Deacon qu’utilise Three distinct knocks. Deacon est en réalité depuis le
XVe siècle le titre que porte le président de la corporation des maîtres
(incorporation). À ce titre, et tout au
long des XVIIe et XVIIIe siècle, le
diacre a joué un rôle important au
sein des loges écossaises aux côtés
du surveillant (warden).
Les plateaux du Vénérable Maître
et des deux surveillants sont
à l’emplacement du rituel des
anciens, disposition que nous
utilisons encore aujourd’hui. Le
manuscrit de la Grande Loge
Générale Écossaise ne reprenant
pas le rituel de mise en récréation
et de reprise du travail utilisé par
120 Points de Vue Initiatiques N° 159
Louis Trébuchet
les anciens, nous ne savons
pas si les plateaux des deux
surveillants portent encore la
colonnette qui au rite ancien
servait à l’indiquer, ou si on est
déjà passé aux flambeaux que
nous connaissons aujourd’hui.
Les trois piliers, Sagesse, Force
et Beauté, restent au même
emplacement que dans le rituel
ancien, très proche de ce que
nous connaissons aujourd’hui.
Les petites lumières sur les trois
piliers sont déjà allumées au
début de la tenue, comme dans
le rituel des anciens, et ne sont ni
allumées ni éteintes rituellement.
Cet ornement de notre rituel d’ouverture actuel, emprunté au Rite
Écossais Rectifié, n’apparaîtra dans le rituel du R.E.A.A. qu’en 1927.
On se demande pourquoi le rituel initial de la Grande Loge Générale
Écossaise ne reprend pas la vérification que la loge est dûment
couverte, premier acte du rituel des anciens. Cette vérification
sera pourtant présente dans tous les rituels suivants, à commencer
par celui de la Triple Unité Écossaise quelques semaines plus tard,
qui inclut aussi pour la première fois la vérification que tous les
Frères présents « sont maçons
et à l’ordre ». Cette vérification
se fait alors par les surveillants
sans quitter leur plateau. Ce
n’est qu’à partir de 1877 qu’ils
parcourront les colonnes.
Le rituel d’ouverture du plus
ancien rituel de la Grande
Loge Générale Écossaise s’ouvre
donc sur le dialogue que nous
connaissons bien « Quelle est votre
place dans la loge ? », dialogue qui
a résisté au temps presque mot
pour mot, à ceci près qu’à cette
époque il incluait naturellement
la place des deux diacres. Sa
Points de Vue Initiatiques N° 159 121
La Grande Loge Générale Écossaise : Origine de notre rituel du premier degré
conclusion actuelle, par contre,
« à quelle heure les apprentis maçons
ont-ils coutume d’ouvrir leurs
travaux ? » n’apparaîtra qu’avec le
Guide des maçons écossais, dix ou
quinze ans plus tard.
« Le Vble. frappe alors trois coups de
maillet par tems égaux, ensuite se
tournant vers le Per. Diacre, ils font
mutuellement le signe guttural et
le Vble.donne à ce Per. Diacre le mot
sacré tout bas à l’oreille, pour ouvrir
la loge d’App. Mac.du Rit écossais.
Le Diacre porte ce mot au f. Per.
Survt. qui l’envoye par son Diacre
au f. 2e. Survt., lequel après l’avoir
reçu frappe un coup de maillet et dit : Vble. tout est juste et parfait. » Cette
circulation du mot est une des rares différences avec le rituel des
Anciens, car elle n’apparaît pas dans Three distinct knocks. Elle n’est
cependant pas nouvelle car on la retrouve, sous une forme un peu
plus complète, dans le rituel de La Française de Bordeaux en 1767,
dans celui du Marquis de Gages, vers 1763, et dans le manuscrit
écossais des Archives d’Edinburgh en 1696.
Les travaux sont ensuite officiellement ouverts « au nom de Dieu
et de St Jean d’Ecosse » puis
« tous font le signe guttural puis
l’applaudissement » On ne sait si
l’applaudissement sous-entend
l’acclamation Houzé, mais celle-
ci sera confirmée dès le rituel
Kloss XXVII et le Guide des
maçons écossais, une dizaine
d’années plus tard. Il n’y a pas
d’appel, et on passe ensuite
directement à la lecture de la
planche des derniers travaux,
qui donne lieu à observations
sur les colonnes exactement
comme aujourd’hui, et c’est
enfin l’accueil des visiteurs,
après tuilage par l’expert et
122 Points de Vue Initiatiques N° 159
Louis Trébuchet
vérification des certificats. La
réception des frères visiteurs
se fait rituellement, par un
dialogue extrêmement proche
de celui décrit par notre rituel
actuel, quoiqu’un tout petit
peu plus développé.
Initiation et instruction de
l’apprenti
En lisant le rituel détaillé de
l’initiation au premier degré,
on est surpris de constater à
quel point notre rituel actuel
en est resté très proche, dans
la succession des événements
aussi bien que dans la plupart
des formulations importantes.
« Comment a-t-il osé espérer y parvenir ? Il est libre et de bonnes
mœurs ». Certaines différences sont cependant significatives : là où
actuellement nous parlons de « l’outillage rationnel » à cette époque on
demandait au candidat s’il mettait sa confiance en Dieu, s’il croyait
en un Être Suprême, et on l’associait à une prière. L’exposition de
la proclamation du Convent de Lausanne et de sa signification est
venue remplacer un ensemble
de questions et réponses
concernant le vice, la vertu et
les devoirs du maçon, dont
plusieurs expressions nous sont
cependant restées : « c’est pour
jeter un frein salutaire sur l’élan
impétueux de la cupidité : c’est
pour nous élever au-dessus des vils
intérêts qui tourmentent la foule
profane… ». Le versement du
sang, le marquage au fer ont
disparu, les quatre éléments
sont venus agrémenter la
chambre de réflexion et les trois
voyages, mais toute la structure
de l’initiation est restée dans
Points de Vue Initiatiques N° 159 123
La Grande Loge Générale Écossaise : Origine de notre rituel du premier degré
l’ensemble profondément la même jusqu’à nos jours : chambre de
réflexion, testament, ni nu ni vêtu, la pointe de l’épée, « de votre
propre et libre volonté », « soumettre ses passions », la coupe d’amertume,
les trois voyages, « libre et de bonnes mœurs », le sacrifice de son sang,
l’obligation, la scène du parjure et les épées, le parvis puis la grande
lumière, « je vous reçois et constitue », le tablier, les gants, les gants de
femme, l’instruction, le premier travail d’apprenti, la proclamation,
l’applaudissement et enfin l’accueil par le F. Orateur.
Nous ne disposons pas du rituel détaillé des Anciens concernant
l’initiation, et nous ne pouvons donc pas vérifier si cette initiation,
si proche de la nôtre même dans les détails, était dans le détail la
même que celle des Anciens. Heureusement Three distinct knocks
nous livre l’Instruction de l’apprenti, qui reprend les grandes lignes
de l’initiation. On peut alors constater que, sauf pour une partie
concernant la symbolique des outils, l’instruction de l’apprenti du
rituel de la Grande Loge Générale Écossaise, que nous reproduisons
en partie ci-dessous, est au mot près celle des Anciens. La totale
filiation de notre rituel actuel du premier degré avec celui de la
Grande Loge des Anciens est ainsi démontrée, par l’intermédiaire de
ce rituel, mis en place par les Francs-maçons écossais Français, qui
ont voulu, sous l’impulsion d’Alexandre de Grasse-Tilly en 1804,
donner à notre rite sa forme définitive, et son unité, et n’ont rajouté
au rituel des Anciens que la tradition écossaise de la circulation du
mot qui remonte au manuscrit des archives d’Édimbourg de 1696. n
Sceau de la Grande Loge Générale Écossaise de France
124 Points de Vue Initiatiques N° 159
CONTE PHILOSOPHIQUE
Jean Schollaert
La construction du temple
Désert jordanien.
Jacques m’avait dit que si je voulais me connaître, il fallait que je
m’oublie.
Antoine m’avait affirmé que ce qui embellit le désert c’est qu’il cache
un puits quelque part.
Nicolas m’avait appris que le voyage lave, rince, essore, qu’il n’existe
pas de voyage sans terme mais surtout qu’avant la dernière douane
du silence où tout conduit, il faut goûter les couleurs, les bruits,
les soleils et les hommes vrais. On voyage pour mettre son sort en
balance et pour accéder à une intensité qui élève. On voyage pour
que les choses surviennent et nous changent. Tout départ est une
nouvelle naissance.
Alors j’avais pris la route pour m’oublier, renaître, me laver et trouver
un puits où m’abreuver. Et je m’étais retrouvé dans ce petit village,
inconnu et ignoré aux portes du désert jordanien.
Points de Vue Initiatiques N° 159 125
La construction du temple
Étrange de dire « aux portes » alors qu’on se trouve face à un espace
ouvert, sans barrière, sans limite précise, aux frontières floues, où le
regard porte loin. Dire « aux portes » c’est affirmer qu’il y a un seuil
à franchir comme dans une pièce, une maison, un temple. Alors
oui, le désert est comme l’arche de Noé, comme le Saint des Saints,
comme le cœur de l’homme, un lieu où il faut faire alliance avec
soi-même, avec les hommes mais surtout avec ce qui me dépasse et
me transcende. Le désert est un espace intérieur à vivre, construire,
déconstruire et reconstruire.
Arrivé dans ce village j’avais rencontré le chef de village et lui avais
expliqué ma volonté d’aller dans le désert une dizaine de jours
pour être dans une solitude accompagnée. Il m’avait conduit à un
homme mûr, fier, altier, au regard droit qu’il présentait comme un
passeur de désert. Nous avions négocié les conditions du voyage
autour d’une grosse pierre au milieu de la place centrale. Chacun
avait posé des cailloux pour demander ou offrir, chacun ajoutant
ou retirant ses pierres au fur et à mesure pour trouver l’équilibre du
troc. Quand ce fut fait, il ramassa mes cailloux, m’invita d’un regard
à ramasser les siens. L’accord était scellé et chacun le respecterait
comme on respecte un serment prononcé sur un livre sacré et qui
engage totalement. Et tout cela dans un silence riche du respect de
l’autre. Un silence pour éviter la violence des mots car les mots sont
des êtres vivants qui peuvent devenir dangereux si on les trompe.
Le Bédouin m’avait conduit, proche et lointain, présent dans le
quotidien et absent dans l’échange de pensées, serf de mon voyage
et sire de lui-même. Il m’avait montré des levers et des couchers de
soleil à faire pâlir d’envie tout photographe, il m’avait initié au rite
des trois tasses de thé brûlant au cœur du désert (la première amère
comme la vie, la seconde forte comme l’amour et la troisième suave
comme la mort). Il m’avait montré des lieux inconnus pour tout non
initié plein de la beauté de l’inutile.
Il m’avait laissé seul dans l’obscurité d’une grotte faiblement éclairée
par une anfractuosité et après que mes yeux s’étaient dessillés, j’avais
découvert les dessins et écrits illisibles pour un occidental que les
ancêtres des ancêtres de ses ancêtres avaient tracés dans la nuit du
temps immémorial. Il m’avait fait monter en haut d’une montagne
pour que je sente sur ma peau les grains de sable que le vent violent
projetait, que je puisse respirer à pleins poumons l’odeur de son pays
et livrer au vent les confettis d’un papier où il m’avait fait écrire la
veille quelques traits de ma vie. Il disait que ces morceaux de papier
seraient les germes féconds de ma vie future. Il m’avait fait traverser
126 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean Schollaert
à gué un oued impétueux, où
il avait guidé mes pas sur des
roches invisibles et stables,
pour découvrir sur l’autre
rive un chardon rare dont les
fleurs éclaboussaient d’un
bleu intense l’orangé du sable
et le moiré des roches. Il avait
allumé à l’entrée d’un sicq
un feu de broussailles qu’il
m’avait invité à traverser pour
parcourir le défilé et découvrir
au débouché une pierre sculptée
rare de beauté et d’harmonie
écrasant de sa splendeur de
nombreux cairns laissés par les
visiteurs précédents, pierre qu’il
Un cairn, amas artificiel de pierres
appelait le Trésor, pendant dans que l’on trouve sur les reliefs, au sommet
sa culture bédouine de la Ka’ba, des montagnes. Ils remplissent plusieurs
fonctions : baliser un sentier, repérer le
de Stonehenge ou des restes du sommet d’une montagne, marquer un site
mur du Temple de Jérusalem. funéraire ou célébrer les morts.
D’un geste il m’avait incité à
élever mon propre cairn.
Un cairn se construit avec les pierres qu’on trouve sur place ou sur
son chemin, comme la vie qui s’organise au gré et au hasard des
rencontres. Un cairn veut transformer de l’aléatoire en intention,
oblige à avoir des bases stables et solides pour s’élever et défier les
lois de la pesanteur. Il est le symbole du possible entre ce qu’on
rêve, voudrait, souhaiterait et ce qu’on élabore, édifie, construit. Le
destin semble nous contraindre, nous limiter, nous soumettre à ses
impératifs. Mais nous devons rester l’architecte de notre vie et utiliser
les matériaux qu’elle nous offre, propose, impose pour construire
nos cairns successifs. Nous méritons toutes nos rencontres, il nous
appartient d’en trouver le sens, d’en goûter la saveur dans l’instant
du renoncement, de les projeter avec humilité dans l’avenir et de les
lire avec simplicité.
Dans ce voyage tout me donnait les indices d’une volonté
d’un équilibre entre des marques extérieures et mon harmonie
intérieure. Mais marques éphémères soumises aux lieux, au vent,
aux intempéries, aux passages des animaux ou des hommes, aux
aléas des rencontres. Un éphémère semblable à notre vie, à notre
Points de Vue Initiatiques N° 159 127
La construction du temple
action quotidienne, à nos volontés changeantes. Mais réel équilibre
entre la banalité de la vie et la fulgurance de la quête intérieure.
Une construction faite d’intention délibérée, de respect de l’autre,
d’harmonie et de sens exprimé. Un Temple qui a transformé du
hasard en destin, qui permet d’exprimer le passage entre expérience
et conscience puis entre conscience et connaissance, qui permet
d’aller du doute au questionnement et du questionnement au sens.
Et j’étais de retour sur la place du village où dix jours auparavant
j’avais négocié mon départ en quête de moi-même. Dix jours de
solitude, d’émerveillements où à certains moments j’avais touché
l’essence, l’unité, l’harmonie totale entre l’univers et moi, entre
l’instant et l’éternité, entre ce que j’étais et ce que je voulais être,
entre le petit garçon que j’étais resté et l’adulte qui se disait initié.
Je réfléchissais sur la nécessité du retour dans le quotidien dans
l’éphémère changeant et sur les routes qui s’ouvraient dorénavant
à moi.
C’est alors que je vis un petit garçon qui jouait à faire des empilements
de pierre, empilements qui s’effondraient régulièrement et qu’il
s’ingéniait à refaire. Je restais à l’observer, à m’inquiéter de ses
hésitations, maladresses ou audaces. Il choisissait avec attention ses
pierres, procédait à des calages artificiels, essayait de trouver des
accommodements avec les lois de l’équilibre qu’on peut appeler petits
arrangements avec le hasard. Il sollicitait régulièrement du regard
un ancien que je n’avais pas remarqué jusqu’alors. Celui-ci d’un
battement d’œil lui fit signe de s’approcher, le prit sur ses genoux et
d’un geste simple et naturel lui montra comment faire pour élever
plus haut son édifice et l’encouragea d’un sourire à persévérer. Ose
et tu réussiras, frappe et on t’ouvrira, cherche et tu trouveras, tel était
le message implicite que le grand-père délivrait au petit-fils.
Cet aïeul me rappelait mon propre grand-père et en particulier
le doigt qu’il me tendait pour marcher en équilibre sur un tronc
d’arbre. Le doigt ne donnait pas réellement de l’équilibre mais posait
la confiance, permettait de dépasser la peur de l’instant et de se
projeter avec sérénité dans l’avenir, si proche étant cet avenir que le
pas suivant sur le tronc. Il me rappelait aussi notre rituel d’ouverture
qui de questions en réponses permet d’aller du profane au sacré, de
l’individu au collectif, du solitaire au solidaire, de l’instant à l’éternité
comme le regard de cet aïeul, comme le doigt de mon grand-père.
Et le vieil homme, assis dans un coin de la place, semblait isolé,
solitaire, voire esseulé. Mais il avait un œil sur tout ce qui se passait
128 Points de Vue Initiatiques N° 159
Jean Schollaert
sur la place et au-delà sur tout le village. Régulièrement un habitant
s’approchait respectueusement, attendait à distance comme pour
quémander un instant dans une forme de rituel secret connu d’eux
seuls. Si d’un regard le vieil homme donnait une autorisation,
l’individu s’asseyait à quelques mètres, lui adressait la parole avec
calme et respect, attendait une décision, une approbation ou un
choix. Lui écoutait, attentif, proche et distancié à la fois, présent dans
l’écoute et absent dans l’affectif, à la fois dans l’instant de la demande
et dans l’éternité de la réponse. Quand celle ci avait été exprimée par
un regard, un sourire, un geste, l’autre repartait songeur, préoccupé
ou satisfait mais on devinait qu’il ne serait venu à l’idée de personne
de contester la décision. Forme de justice transpercée par l’élévation
de cet homme et par l’amour qu’il dégageait. On percevait qu’il était
l’autorité rectrice de cette assemblée, reconnue et acceptée à laquelle
chacun se soumettait avec respect et humilité. Et pendant ce temps,
le vieux sage ne quittait pas des yeux son petit-fils, attentif à chacun
de ses gestes comme s’il voyait en lui son propre avenir. Le passé et
le futur unis dans l’instant en ce lieu, belle leçon de vie, d’unité et de
soumission.
Cet ancien me rappelait quelques sages que j’ai eu l’occasion de
côtoyer au gré de mes pérégrinations de vie :
- Comme le vieux curé du village de mon enfance, qui d’un regard
arrêtait une bagarre entre garnements, une dispute entre voisins,
une démarche ondoyante vers ce qu’il appelait le péché premier, qui
d’un mot encourageait, sanctionnait, mais le mot était juste et faisait
grandir celui qui le recevait
- Comme le directeur de l’école de mon enfance vers qui on allait
tremblant présenter le cahier de devoirs ou le bulletin de notes, même
si on savait que le contenu allait le satisfaire. Il regardait calmement,
l’air doucement sévère, hochait la tête, soulignait d’un doigt les
points essentiels, disait d’un mot le chemin parcouru et celui encore
à parcourir. On redoutait auparavant, on acceptait pendant et on
était heureux après.
- Ou encore comme Swamiji qui, avec sa quiétude souriante, nous
disait avec bonhomie qu’il fallait douter, d’abord douter et de se
rendre compte après avoir agi si ce doute avait été efficace, qu’il
fallait accepter les circonstances où nous nous trouvions, en être
satisfait et de faire tout ce qui était nécessaire pour en sortir.
Tous ceux-là, et tous ceux que j’ai oubliés, avaient en commun
l’acceptation de l’autre dans sa singularité et ses différences, l’oubli
Points de Vue Initiatiques N° 159 129
La construction du temple
de soi et la sagesse de ceux qui ont gravi de nombreuses fois l’échelle
de l’expérience et qui sont redescendus parmi les hommes, leurs
frères.
Alors là mon voyage a pris sens, j’avais découvert au fond de moi une
acceptation entre mon action dans le monde et ma quête intérieure,
l’une et l’autre s’enrichissant mutuellement et se complétant
harmonieusement ; Mon action s’exerce avec discrétion, humilité et
équité, est guidée par mon idéal et mes valeurs, est portée par ma
foi en l’humanité, mon espérance en l’homme et l’amour de la vie.
Ma quête, que j’appelle parfois mon temple, c’est ma capacité à être
simultanément à chaque acte, parole ou pensée l’homme, l’aïeul et
le petit garçon. L’homme qui éclaire les autres de son expérience,
qui exerce sa charge avec respect et disponibilité, qui est sire de lui-
même et serf des autres tout en gardant son identité, sa singularité
et ses valeurs. L’aïeul capable de guider, de laisser l’autre libre de
ses choix, de lui donner les outils pour conquérir la liberté de parler,
penser, passer. Le petit garçon fragile attentif qui attend écoute et
présence, qui respecte les traditions et les anciens, qui sait rêver en
regardant l’horizon.
Dieu est silence, l’homme est le cri pour révéler ce silence. Et tout
ce qu’il bâtit (temples cathédrales, ponts et portes), tout ce qu’il
construit (lui, ses enfants, ses traces) tout ce qu’il donne ou reçoit ne
sont que des manifestations de ses cris.
Être son propre père et son propre fils en restant soi-même.
C’est peut-être cela construire son temple. n
Petra, Jordanie.
130 Points de Vue Initiatiques N° 159
SYMBOLISME
Franck Martin
Gardien du temple
Gardien du temple,
Statue située à l’entrée d’un temple bouddhiste à Bangkok, Thaïlande.
Le temple est par nature un lieu fermé dont les murs épais repoussent
les courants telluriques qui retiennent dans leurs mailles le monde du
vivant. Il recrée ainsi un univers propice au passage du plan terrestre
aux dimensions verticales qui s’ouvrent vers le ciel. De savantes
ouvertures pratiquées dans son enceinte, rendent vivant l’édifice,
autorisant la respiration de l’ouvrage de pierre que l’on conduit à la
vie, comme on ouvrirait ses chakras.
Car le temple ne peut rester clos comme un tombeau.
Le temple est un hymne à la vie et la vie est circulation, mouvement,
passage, ouverture, transformation, mutation, impermanence de
tout état et de toute chose…
Points de Vue Initiatiques N° 159 131
Gardien du Temple
La fonction première du gardien du temple est celle d’un veilleur,
accueillant avec bienveillance ceux qui s’y présentent. Il les prépare
à entrer dans un lieu séparé du monde mesuré qu’ils connaissent, et
les invite à traverser le miroir qui leur ouvrira les portes de champs
infinis. L’importance de son rôle à l’égard de ceux qui patientent
à sa porte, justifie que le gardien du temple ait exercé auparavant
les plus hautes fonctions sacerdotales ou spirituelles. Il sait lire les
intentions pures et décourage ceux qui ne savent pas ce qu’ils font.
Il conduit les néophytes, en les prenant par la main, tout en leur
indiquant le départ du chemin qui quitte petit à petit les sentiers
familiers pour s’élever vers l’inconnu, vers des sentes qui côtoient
des vides abrupts qui peuvent être fatals à qui n’est pas averti.
Ainsi sur le seuil du temple, de bouche à oreille, s’échangent des
paroles d’un autre âge communiquées dans un souffle, permettant
au gardien de s’assurer de l’élan vital qui doit porter et accompagner
chaque pas à l’intérieur du temple.
Tel un être vivant, le temple naît dans la force de ses colonnes comme
dans la fragilité de ses points de correspondance entre l’intérieur et
l’extérieur, entre le Nadir et le Zénith. Cette faiblesse rend éphémère
la présence du Sacré qui advient à sa guise. Il se retire du temple
comme les grands prêtres de l’ancienne Égypte effaçaient à reculons
la trace de leurs propres pas sur le sable du Naos.
Veillant sur les faiblesses naturelles inhérentes au temple, deux piliers
à la porte du couchant, tels deux colosses immuables prennent appui
sur la Terre pour soutenir le Ciel et permettre à l’Air de circuler, en
insufflant à l’édifice le rythme d’une respiration sacrée.
Ils sont les deux tours de nos cathédrales moyenâgeuses, ou les deux
pylônes des temples plus anciens. Ils en défendent l’entrée sur le
plan matériel, soutiennent la création et protègent la vie sur le plan
spirituel.
Telles les deux Lionnes de la porte de la cité antique de Mycènes,
ces deux colonnes sont des gardiennes. Elles assurent le changement
d’orientation de l’être préparé à dompter ses instincts pour des
pensées nobles, tournées vers la vérité du Principe éternel. Celui-
ci est représenté entre les deux Lionnes par cette colonne unique,
couronnée d’un chapiteau, qui sous-tend toute vie devenue pleine
lorsqu’elle est complétée par la dimension spirituelle à laquelle elle
aspire depuis toujours.
Ces deux colonnes sont un appel lointain, une voix dont on reconnaît
132 Points de Vue Initiatiques N° 159
Franck Martin
les accents familiers et qui
peut être entendue partout,
quelle que soit notre place
dans le monde. Ressentir cette
filiation permet à chacun
d’avancer vers sa propre
initiation, en frappant un jour
à la porte du temple. Elles y
brillent dans l’alternance de
leurs rayons blancs et rouges,
ceux de la pureté, de l’amour
et de la fraternité retrouvés
qui les rend sensibles au cœur
de tous.
Gardiennes du monde
intérieur du temple, elles
veillent et rayonnent aussi
sur le monde extérieur où
Temple Franklin Roosvelt nous naviguons sur des mers
de la Grande Loge de France
agitées, souvent poussés à
l’errance, contraints de quitter
la terre qui se dérobe sous nos pieds lorsque nous la restreignons à la
vision immédiate que nos yeux non encore dessillés, en ont.
À l’entrée du temple de Salomon, (1 Rois VII-21) les colonnes Boaz
et Jakin étaient dressées telles des gardiennes du portique du temple
qui est le lien entre le monde des hommes et le monde sacré du
divin. Ces deux mondes sont des prolongements naturels l’un de
l’autre.
Ils engendrent les mêmes êtres dans la faiblesse, le transitoire,
l’incertitude puis dans la force, l’impérissable, et l’infini.
Ainsi aucun temple ne saurait être une place forte. Clos, et trop
protégé, il ne pourrait remplir son rôle de creuset alchimique
où la matière, quel que soit son état, se transforme pour y être
sublimée. L’histoire témoigne des outrages portés aux temples qui
ne parviennent pas à en détruire le monde des idées, l’essence même
de leur raison d’exister. Car dans l’apparente vulnérabilité du temple
se trouve aussi sa Force.
Les véritables gardiens du temple savent conserver l’impérissable
en leur cœur, là où il est inaccessible à tout profanateur. Ils savent
transmettre en tout temps et en tout lieu, aux générations futures, ce
Points de Vue Initiatiques N° 159 133
Gardien du Temple
qui constitue la véritable Connaissance véhiculée par les rites et les
rituels et au-delà par la Grande Tradition. Elle est un héritage d’une
portée supérieure que nous avons du mal à appréhender à notre
échelle humaine. Cette connaissance n’est pas le savoir des hommes
qui s’apprend, se vole ou s’achète. Elle est un bien héréditaire, que
chaque génération d’initiés se doit d’assimiler, d’enrichir de son
témoignage, et de transmettre, en le restituant vivant.
Conduit à l’intérieur du temple par le gardien, face aux premiers
mystères, l’initié voit en chaque ouverture, en chaque fenêtre, un
point vital du temple parcouru par la lumière au rythme de la course
du soleil. Celui-ci allonge sur le plan horizontal de la vie humaine,
ses ombres qui se déchirent, au-delà de la porte étroite entre espoirs
et fatalité.
Il ressent alors que chaque colonne est parcourue par le souffle
de l’Esprit, au rythme des puissances psychiques spirituelles qui
façonnent l’être dans un étirement permanent, depuis le fond
obscur de son individualité jusqu’aux sommets lumineux de sa
personnalité.
Ce souffle est celui de la providence qui oriente notre vie selon sa
dimension universelle.
Il vient de faire de nous un gardien de notre propre temple intérieur. n
Maquette du temple
d’Hérode,
Musée d’Israel.
134 Points de Vue Initiatiques N° 159
BIBLIOGRAPHIE
Didier Anzieu, Le corps de l’œuvre, Gallimard, 1981, Le Moi-peau, Dunod,
1995
Jean-Pierre Bayard, Précis de Franc-maçonnerie, Dervy 1994, La spiritualité de
la Franc-maçonnerie, Dangles 1982
J.-E. Bianchi, Les mystères du dieu Janus, Ed Ivoire Clair, 2004
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Alcan 1910
Ronald Murray Berndt, Naissances mystiques. Essai sur quelques types
d’initiation, Gallimard, 1959
Jean Bottéro, L’Épopée de Gilgamesh. Le grand homme qui ne voulait pas mourir,
Gallimard, 1992
Roger Caillois, L’Homme et le sacré, P.U.F. 1939
Ernst Cassirer, La philosophie des formes symboliques, Minuit, 1972
Jean Cazeneuve, Sociologie du rite, P.U.F.
Maurice Cazeneuve, Les Rites et la condition humaine, P.U.F. 1958
Jean-Pierre Changeux et Paul Ricoeur, Ce qui nous fait penser. La nature et la
règle, Odile Jacob, Paris, 2001
Antonio Damasio, L’erreur de Descartes, Odile Jacob, 2001
Régis Debray, Les communions humaines. Pour en inir avec la religion, Fayard,
2005
B. d’Espagnat, Le réel voilé, Fayard, 1994
B. d’Espagnat & C. Saliceti Candide et le physicien Fayard, 2008
Georges Dumézil, Esquisses de mythologie, Gallimard, 2003
Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, P.U.F. 1912
R. & B. Dutheil L’Homme superlumineux, Sand, 1990
Alain Graesel, Reconstruire l’homme, PVI n° 131.
B. Greene, La Magie du cosmos. L’espace, le temps, la réalité : tout est à repenser,
Robert Laffont, Paris, 2005.
Mircéa Éliade, Aspects du mythe, Gallimard, 1963, Mythes, rêves et mystères,
Gallimard, 1989, Le sacré et le profane, Gallimard, 1965, Traité d’histoire des
religions, Payot 1989
Sigmund Freud, Totem et tabou, Payot 1965
Jean-Jacques Gabut, La Magie traditionnelle, Dangles 2001
René Guénon, Aperçus sur l’initiation, Ed. Traditionnelles 1964
Jean Hani, Mythes, rites et symboles, Trédaniel 1992
S. Hawking, Une brève histoire du temps, Champs Flammarion, 1988
Maurice Hubert et Marcel Mauss, Mélanges d’histoire des religions, Paris
1929
Michel Leiris, Le sacré dans la vie quotidienne, in Le Collège de Sociologie.
1937-1939, Gallimard, 1995
Lucien Levi-Bruhl, Le Surnaturel et la Nature dans les sociétés primitives, Paris
1931
Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, 1925, Anthropologie structurale, Plon,
1958, t.1
Points de Vue Initiatiques N° 159 135
B. Libet, Mind time, Harvard University Press, 2004
Jean Maisonneuve, Les rituels, PUF, 1988
Bronislaw Malinovski, La Sexualité et sa répression dans les sociétés primitives,
Paris 1931
Pierre Mariel, Rites et initiations des sociétés secrètes, Mame, 1973
Alec Mellor, Dictionnaire de la Franc-maçonnerie et des Francs-maçons, Belfond
1971
R. A. Monroe, Voyage hors du corps du livre, Editions Du Rocher, 1989
Blaise Pascal, Pensées in L’œuvre de Pascal, La Pléiade, 1941
Jean Palou, La Franc-maçonnerie, Payot 1989
Pierre Pelle Le Croisa, La Pré-Histoire des Francs-maçons – Les mythes
fondateurs ou Pierre d’Étoile, éditions du Cosmogone, 2007
Jean-Pierre-Pharabod, Le cantique des quantiques : Le monde existe-t-il ? Essai
(poche), 2007
Plutarque, Isis et Osiris, éd. De la Maisnie Trédaniel, coll. Ésotérisme, 1990
Alain Pozarnik, Mystère et action du rituel d’ouverture en loge, Dervy 1991
Paul Ricoeur, Finitude et Culpabilité, Aubier, 1993
Pierre Riffard, Dictionnaire de l’ésotérisme, Payot 1983
Monique Segré, Mythes, rites, symboles dans la société contemporaine,
L’Harmattan, 1997
Philippe Sellier, Qu’est-ce qu’un mythe littéraire, article de la revue Littérature,
n° 55, 1984
Jean Staune, Notre existence a-t-elle un sens ? Presses de la Renaissance, 2007
Henri Stéphane (Abbé), Introduction à l’ésotérisme chrétien, Dervy 1983
G. Tononi, Galilée et la photodiode, Odile Jacob sciences, 2006
Lao Tseu, Tao Te King, Dervy 1951
Pierre Vajda, Savoir et connaissance. Approche herméneutique du Rite Écossais
Ancien et Accepté, Dervy, 2009
Frédéric Vincent, Le voyage initiatique du corps, Detrad 2009
Dictionnaire de la Franc-maçonnerie dir. par Ligou (P.U.F. 1987)
Revues
Y-H Kim, R. Yu, S. P. Kuhli, Y. Shih & M. O. Scully, « Delayed “choice”
quantum eraser », Physical Review Letters, n° 84, 2000.
Y. Aharonov et M. S. Zubaruba, « Time and the quantum : erasing the past and
impacting the future », Science, vol. 307, n° 5711, 2005.
M. O. Scully et K. Drûhl : Quantum eraser : a proposed photon correlation
experiment concerning observation and “delayed choice” in quantum mechanics,
Physical Review A, vol. 25, n° 4
Jean Erceau, Rassembler ce qui est épars, PVI 149
B. Libet, « Conscious vs neural time », Nature, vol. 352, 1991
Sites
Lexpress.fr – tics et tocs des écrivains
Buddhaline.net – pratique de la calligraphie chinoise Cndp.fr/magphilo/philo14
Le corps retrouvé - Université paris8-Vincennes-Saintdenis : thèse de philosophie
de Basile Doganis, La pensée du corps – sous la direction d’Alain Badiou
136 Points de Vue Initiatiques N° 159
LIVRES
iMagES dES CoMPagnonS dU ToUr dE FranCE
Laurent bastard
1 volume 13x24cm, 286 pages, éditions Cyrille Godefroy, 28 euros.
La lithographie a favorisé les gravures compagnonniques
autour de 1850. De tirage modeste, elles étaient souvent
coloriées à la main. Cet échantillonnage, les diplômes n’y
figurent pas, nous informe sur les auteurs, les graveurs et
la diffusion de ces images, souvent de grand format, nous
offre vingt reproductions de qualité en pleine page. On y
trouve des représentations communes au Compagnonnage
et à la Franc-maçonnerie qu’il n’est pas toujours nécessaire
d’expliquer par un emprunt, on en trouve en effet de nombreux
exemples, tels le delta, les colonnes, les outils dans l’architecture et dans
l’art religieux. Peu connue, la composition de la planche X de « Guépin
cœur d’amour » représente un Christ central à l’ordre d’apprenti, un
soleil rayonnant lui servant d’auréole. En dessous, entre les colonnes J
et B, une agape rituelle est surmontée par une reproduction, au même
format, de la Cène de Léonard de Vinci. Le Christ est manifestement,
l’auteur le remarque, inspiré par le frontispice de l’Histoire pittoresque
de la Franc-Maçonnerie de Clavel, édité chez Pagnerre en 1842.
Le lecteur découvrira, à travers ces images et leur commentaire, des
aspects peu connus du Compagnonnage pour lequel une visite, au moins
virtuelle :http://www.museecompagnonnage.fr/page-accueil.html, du
musée de Tours dont Laurent Bastard est le conservateur s’impose.
Claude Gagne
dirES d’Un FranC-MaÇon de la gLdF
Jean-Pierre blanc-dunand
204 pages – Édition privée (Contact : Journal GLDF)
« Nous t’aimons pour la diversité des Frères qui te composent »
Ainsi s’adressait Jean Pierre Blanc-Dunand à la loge qui
l’avait élu Vénérable Maître. Mais c’est aussi à la Franc-
Maçonnerie en général que cet ouvrage posthume s’adresse.
La Tolérance mobilisait les maçons du XVIIIe siècle.
La Laïcité était le combat de ceux du siècle suivant et
la Sécurité des conditions de vie celui des maçons du
XXe siècle. Cet ouvrage recueille une série de conférences
illustrant les idéaux de Morale, d’intelligence et d’éthique de notre
nouveau siècle. L’auteur y parcourt également l’essentiel des degrés
du Rite Écossais Ancien et Accepté pour terminer sur la Chevalerie de
l’Esprit. Une Chevalerie que Jean Pierre Blanc Dunand a mise en action au
service international de l’Obédience et une exemplarité fraternelle par son
implication dans les diverses commissions qu’il a présidées depuis plus de 20 ans.
Jacques Carletto
Points de Vue Initiatiques N° 159 137
L’éVEiL SPiriTUEL SUr La VoiE dES
SyMboLES
Jean-Emile bianchi
Un vol. de 330 p., 14X21 cm. Ivoire-Clair, 2010. 24 euros
Au sous-titre : Démarche symbolique traditionnelle et spiritualité de
rite écossais, la préface de Claude Collin ajoute du Rite Écossais
Ancien et Accepté, ce qui précise le sujet.
C’est par le symbole, moins restreint que le langage discursif,
qu’une véritable méthode de spiritualité qui nous est proposée.
Elle permet de découvrir, à travers le temps et l’espace, une
unité de nature des civilisations, telle que mise en évidence
par Georges Dumézil, René Guénon et d’autres, en incitant à une
relecture attentive de la mythologie, des légendes et du folklore.
Cette convergence nous fait rejeter la conception très médiatisée, il y
a une quarantaine d’années, de l’homme unidimensionnel, sous-animal
rapidement disparu et également, celle toujours répandue, par des
religions et la nébuleuse qu’on appelle l’humanisme, de l’homme binaire
composé seulement, comme les autres mammifères, d’un corps et
d’une âme – ce qui anime. C’est l’oubli - sinon le rejet - du spirituel
qui a réduit l’homme à une individualité binaire proche de l’animal
domestique dont l’activité principale est la fabrication de produits
qu’il ne peut acheter pour ceux qui, repus, n’en consommeront qu’une
partie. L’homme ternaire – corpus-anima-spiritus – doit être conscient
de l’ensemble de ses possibilités. La nourriture spirituelle que l’auteur
nous propose est indispensable à la conservation et au développement
de ce troisième terme, l’esprit qui distingue l’homme des animaux. La
voie symbolique vers la Sagesse qu’il nous montre, aride et caillouteuse,
est ensuite jalonnée de roses qui couronnent ceux qui la parcourent
avec discernement, courage et persévérance. Pour eux, ce livre agréable
et d’une grande clarté est riche en références précises et la table des
matières est suivie de l’indispensable index.
Claude Gagne
138 Points de Vue Initiatiques N° 159
LE CabinET dE réFLEXion. Bibliothèque de la Franc-Maçonnerie
de Percy John Harvey
Percy John HARVEY
Éditions Dervy.
Le Cabinet de Réflexion
Le Cabinet de Réflexion
Après son remarquable « Janus et l’initiation maçonnique », Un voyage intérieur
notre frère Percy John Harvey, membre de la G.L.D.F.,
entreprend l’étude du cabinet de réflexion, antichambre
de l’initiation. Il rapproche ce lieu souterrain, prélude à
Percy John Harvey
la lumière, de tous les mythes chtoniens liés au culte de la
terre. L’épreuve du bandeau renvoie aux mystères d’Éleu-
€
sis, au labyrinthe de Dédale et aux mandalas bouddhistes.
L’abandon des métaux, ce sont les planètes de Pythagore.
Le cabinet de réflexion est une caverne, séjour de la déesse
Cybèle et objet de la démonstration philosophique de Platon sur l’illu-
sion du monde. Il est aussi l’athanor des alchimistes qui pratiquent sur
eux-mêmes le grand œuvre et Hermès Trismégiste est appelé en renfort
pour en expliquer le contenu symbolique. Mais c’est aussi un lieu qui
évoque la pénitence chrétienne, Marie-Madeleine, la femme de Loth.
L’initiation se révèle comme une renaissance en esprit, argumentée par
l’entretien de Jésus et Nicodème. L’ouvrage comporte de nombreuses
illustrations associées à l’alchimie, au tarot et à différents symboles re-
ligieux, pour rendre encore plus clair un texte démonstratif à la portée
de tous. Phase préparatoire, phase de séparation, l’épreuve de la Terre
détermine toute la vie initiatique ; c’est dire s’il est important de la bien
comprendre.
Jean-Luc Aubarbier
L’arT royaL ET LE PETiT PrinCE
Franc-Maçonnerie et handicap
Francine Carruel et Jean Moreau
Detrad Éditeur - 208 pages - 19 €
Plus de 101 ouvrages référencés, une vingtaine de livres
sacrés cités, autant de Mythes et légendes qui en parlent,
sans compter les revues maçonniques et les Constitutions
de multiples Obédiences, ainsi que les interviews dédiées
de hauts responsables maçonniques font de ce livre une
somme sur le handicap. Un travail de bénédictin à la gloire
de la Fraternité et de la Tolérance. L’historique des laïcs et des religieux
préoccupés par la différence humaine fait ressortir, au cours des siècles,
que la barbarie véritable, c’est de ne rien voir- rien dire- rien faire sur
ce sujet. Plus encore que l’altérophobie, cette peur de l’autre et de sa
différence, le refus d’aborder le handicap relève d’une hypocrisie que
les auteurs, eux-mêmes parents de handicapé, ne cessent de dénoncer.
Qu’ils en soient, fraternellement, remerciés.
Jacques Carletto
Points de Vue Initiatiques N° 159 139
La daME À La LiCornE
LE MESSagE iniTiaTiQUE dES TaPiSSEriES
Pierre PELLE LE CroiSa
Éditions Maison de Vie – 2010 – 152 pages – 16 euros - Heptagone
Qui ne connaît la « Dame à la licorne », un ensemble de 6
magnifiques tapisseries conservées au musée de Cluny ?
Beaucoup d’ouvrages ont été écrits sur elles ; mais peu avec
autant de profondeur dans l’analyse. L’auteur, après un bref
rappel du contexte historique, symbolique et traditionnel dans lequel
s’inscrivent ces œuvres, s’intéresse au message initiatique des tapisseries. Il
recherche d’abord dans le langage des fleurs et le symbolisme alchimique
des couleurs le fond d’une démarche qui vise à spiritualiser la matière pour
« tisser » de nouvelles pensées. Il évoque ensuite le langage des oiseaux
et l’échange des « nourritures » entre l’âme et l’esprit, grâce à l’amour.
Il s’intéresse enfin aux sens et à la conscience de l’être : entendre (la
musique et les arts libéraux), voir (le miroir et l’œil du cœur), connaître
et transmettre… Dans cette épreuve de vérité, la licorne est un symbole de
pureté. Elle nous montre un chemin de vie : « Il faut que le corps devienne
esprit et que l’esprit devienne corps », résume l’ambivalente formule de
Roger Bacon. Ce très bel ouvrage sera pour les compagnons une source
de riches réflexions (mais le texte, limpide, est accessible au profane).
De même, il devrait séduire tout initié ; car il pourra non seulement
y trouver une résonance à sa propre démarche, mais également une
ouverture sur une approche initiatique trop méconnue : celle qui était
proposée aux femmes autrefois, et que l’auteur a su faire revivre si
bellement pour nos sœurs – mais aussi pour tous les frères qui savent
que le perfectionnement de l’homme passe par la voie de l’humilité.
LE « riTE égyPTiEn » dE MEMPHiS MiSraïM
didier Michaud
Maison de Vie – Éditeur - 128 pages – 10 €
Hors du labyrinthe de la Maçonnerie égyptomaniaque,
l’ouvrage propose un décodage nouveau du miracle Égyptien.
Faut-il encenser Cagliostro qui prétendait que « toute lumière
vient de l’Orient, toute initiation vient de l’Égypte » ? ou le traiter
de vil imposteur ? Les rites d’instruction Italiens de Misraïm
doivent beaucoup à l’Ecossisme et au Martinisme. Quant à
ceux de Memphis, créés par des exclus de Misraïm ayant essaimé
en Belgique, ils devront réduire les 99 grades initiaux aux 33 tolérés par
le Rite Français du Grand Orient de France. Où se loge l’initiatique et
où transparaît la politique ? Les légendes de Memphis rappellent celles
du Chevalier de Ramsay qui irriguent les hauts grades du Rite Écossais.
Un puzzle passionnant, à lire avec intuition plus qu’avec les exigences
historico-rationalistes d’un émule de Descartes.
Jacques Carletto
140 Points de Vue Initiatiques N° 159
TroiS CLéS VErS La ConSCiEnCE
Jacques Fontaine
Grancher Éditeur - 216 pages - 16 €
L’auteur, consultant en Ressources Humaines travaille
dans 3 loges bleues d’Obédiences différentes. L’ouvrage
reprend et développe le concept de Franc-maçonnerie
libérative déjà esquissé dans sa trilogie de l’Espoir parue chez
l’éditeur Detrad. Sont abordées les trois questions essentielles : quel est
son contenu ? (quoi ?) quels seront ses buts ? (Vers quoi ?) quelle est sa
démarche ? (Comment ?). On perçoit la nécessaire catharsis du « je », la
recherche de vérités qui passent par la sagesse et l’altruisme du « moi »
pour atteindre à la finalité du « soi ». Enfin, sont revisitées la nature et
l’étude du Symbole. Une bibliographie sincère indique la « teinture »
psycho-culturelle de l’auteur, proche de la psychanalyse de Freud et de
la subtilité de Jung. Le lecteur appréciera particulièrement le glossaire
d’une grande clarté et de beaucoup de profondeur. Document que tout
Franc-maçon devrait s’approprier avant de commencer l’ébauche d’une
planche en loge.
Jacques Carletto
SoUVEnirS dE Mon VéCU aU CaMP dE
gUSEn 1
georges MarCoU
Notre frère Georges Marcou, qui fut notre Très Respectable
Grand Maître de 1977 à 1978 puis de 1981 à 1983, s’est enfin
résolu à confier à la page blanche et au poids de l’écrit ce
témoignage qu’il avait jusqu’ici transmis sans relâche par la
parole, accomplissant ce devoir de mémoire qu’ils s’étaient
assignés depuis que son ami Emile Valley prononçait le
16 mai 1945 à Mauthausen le serment « Plus jamais Cela ! »
Georges Marcou, membre du réseau C.N.D. Castille des Forces
Françaises Combattantes, est arrêté à 19 ans, le 10 juin 1942, interné à
Fresnes puis déporté à Mauthausen le 23 mars 1943, affecté au camp
Gusen 1 du 7 avril 1943 à sa libération le 27 avril 1945. Ce livre est un
témoignage bouleversant de ce monde barbare et déshumanisé qu’il
a connu pendant trois ans, dans lequel le prisonnier n’est plus qu’une
« chose » faible et volatile, à la merci d’une machine qui le broie et des
kapos qui s’en font complices. Mais c’est un témoignage encore plus
bouleversant de cette sourde et endurante résilience pour conserver,
certes les capacités physiques, mais surtout la dignité personnelle,
nécessaire à la survie individuelle, résilience qui s’appuiera sur le lien
d’amour fraternel réunissant le groupe des « Bordelais ».
C’est aussi un témoignage dense, précis et documenté sur ce que furent
la déportation et les camps de travail nazis. Ce livre, édité jusqu’ici par
l’auteur, mérite de trouver un imprimeur qui en assurera la pérennité.
Louis Trébuchet
Points de Vue Initiatiques N° 159 141
La Loi inTEriEUrE
François rachline
Edition Harmann - Paris 2010 - Isbn : 978 2 7056 7032 0
167 pages
Cet essai passionnant nous propose une lecture de la
Bible dépourvue de toute référence religieuse, tout
en précisant que cette lecture ne prétend pas être la
seule. Voilà un sujet qui ne peut manquer de nous
interpeller !
Nous entrons dès les premières pages dans le vif du
sujet qui est de mettre en évidence la construction
d’une « éthique de l’intériorité » que le texte biblique invite
à promouvoir. Cela conduit l’auteur à étudier la façon dont s’affirme
dans l’ancien testament la conscience de soi couplée au principe de
responsabilité (chapitres I à V) avant d’aborder la relation avec autrui
et les déterminants de la reconnaissance mutuelle (chapitres VI à IX)
puis de terminer par la question plus difficile du tétragramme et une
brillante conclusion sur l’intériorité. À titre d’illustration quelques lignes
de la page 48 qui viennent en conclusion de la réflexion sur Moïse et
l’épisode du buisson ardent : « Il [Moïse] craint de cheminer sur le sentier qui
conduit à l’indicible de l’homme, de le suivre dans ses méandres, d’arpenter les
immensités intérieures sans jamais en voir le bout. Qui sait ce qu’il découvrira
au passage ? N’est-ce d’ailleurs pas là une attitude commune ? Ne craignons-
nous pas de savoir ce qui bouillonne en nous, de peur d’être submergés, de ne
plus rien maîtriser ? »
La méthode utilisée par l’auteur est intéressante, car elle fait appel à
la fois à la réflexion sur le symbolisme des situations, aux traductions
comparées des passages étudiés et à l’exégèse des textes originaux avec de
nombreux rappels à la langue hébraïque et à ses subtilités sémantiques.
L’approche est originale, car nous sont épargnés les arcanes de l’analyse
cabalistique et de la guematria, pour privilégier une approche littéraire
voire grammaticale en l’illustrant par des rapprochements avec la
langue française pour mieux faire comprendre les subtilités de telle ou
telle construction ou interprétation.
Tout cela donne cela nous donne un texte certes dense, mais vif, alerte
agréable à lire de bout en bout et si on se surprend à relire quelque chapitre,
c’est pour mieux s’imprégner de la richesse des développements.
Patrick Caux
142 Points de Vue Initiatiques N° 159
Vous aimerez peut-être aussi
- Comprendre et vivre les hauts-grades maçonniques - Le rite écossais ancien et accepté en 33 planches - Tome 2: Du 19eme au 33eme degréD'EverandComprendre et vivre les hauts-grades maçonniques - Le rite écossais ancien et accepté en 33 planches - Tome 2: Du 19eme au 33eme degréPas encore d'évaluation
- Mémento 1er degré R.E.A.A.: Paroles d'ApprentiD'EverandMémento 1er degré R.E.A.A.: Paroles d'ApprentiÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Comprendre et vivre les hauts-grades maçonniques - Le rite écossais ancien et accepté en 33 planches - Tome 1: Du 1er au 18eme degréD'EverandComprendre et vivre les hauts-grades maçonniques - Le rite écossais ancien et accepté en 33 planches - Tome 1: Du 1er au 18eme degréPas encore d'évaluation
- Le rite écossais ancien et accepté - 33 degrés de sagesse pratique: Le lumineux voyage de Pierre et SylvieD'EverandLe rite écossais ancien et accepté - 33 degrés de sagesse pratique: Le lumineux voyage de Pierre et SylviePas encore d'évaluation
- Midi Plein - Introduction À La Pensée Maçonnique (Extraits) PDFDocument20 pagesMidi Plein - Introduction À La Pensée Maçonnique (Extraits) PDFmonnom30100% (2)
- Les trois piliers initiatiques d'occidentD'EverandLes trois piliers initiatiques d'occidentÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (9)
- Le Rite Ecossais Ancien Et Acce - Viton Yves-Max PDFDocument74 pagesLe Rite Ecossais Ancien Et Acce - Viton Yves-Max PDFDeroy Garry100% (3)
- Spitualite Et Franc MaconnerieDocument3 pagesSpitualite Et Franc MaconnerieWerta'a RastapopoulosPas encore d'évaluation
- Ce que doit savoir un Maître Maçon : les Rites, l'origine des Grades, la Légende d'Hiram: édition complète et définitiveD'EverandCe que doit savoir un Maître Maçon : les Rites, l'origine des Grades, la Légende d'Hiram: édition complète et définitivePas encore d'évaluation
- Le voyage fabuleux de celui qui un jour devint guibulum: Regards sur le Reaa du 3e au 14e degrésD'EverandLe voyage fabuleux de celui qui un jour devint guibulum: Regards sur le Reaa du 3e au 14e degrésPas encore d'évaluation
- De l’origine de la Franc-Maçonnerie (Annoté): Précédé d'un article de J.J de Lalande sur l'histoire des francs-maçons (Annoté)D'EverandDe l’origine de la Franc-Maçonnerie (Annoté): Précédé d'un article de J.J de Lalande sur l'histoire des francs-maçons (Annoté)Pas encore d'évaluation
- Mémento 4er degré R.E.A.A.: Paroles de Maître SecretD'EverandMémento 4er degré R.E.A.A.: Paroles de Maître SecretÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Mémento 2e degré du R.E.A.A.: Paroles de CompagnonD'EverandMémento 2e degré du R.E.A.A.: Paroles de CompagnonPas encore d'évaluation
- Vocabulaire des Francs-Maçons: SUIVI De REGLEMENTS basés sur les CONSTITUTIONS générales de l'Ordre de la Franche-Maçonnerie, d'une Invocation Maç:. à Dieu, de quelques pièces de Poésie et cantiques inédits.D'EverandVocabulaire des Francs-Maçons: SUIVI De REGLEMENTS basés sur les CONSTITUTIONS générales de l'Ordre de la Franche-Maçonnerie, d'une Invocation Maç:. à Dieu, de quelques pièces de Poésie et cantiques inédits.Pas encore d'évaluation
- Devenir Franc-Maçon: L'initiation, le symbolisme et les valeurs symboliquesD'EverandDevenir Franc-Maçon: L'initiation, le symbolisme et les valeurs symboliquesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- L'égrégore, quatrième dimension de la franc-maçonnerie ?D'EverandL'égrégore, quatrième dimension de la franc-maçonnerie ?Pas encore d'évaluation
- Mémento 5e et 6e degrés du R.E.A.A.: Paroles de Maître Parfait et Secrétaire IntimeD'EverandMémento 5e et 6e degrés du R.E.A.A.: Paroles de Maître Parfait et Secrétaire IntimeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Livret de L ApprentiDocument23 pagesLivret de L ApprentiMarly Coelho75% (4)
- Extraits SchibbolethDocument55 pagesExtraits SchibbolethLaura Andrei100% (3)
- Mémento 7e et 8e degrés du R.E.A.A.: Paroles de Prévôt et Juge & Intendant des BâtimentsD'EverandMémento 7e et 8e degrés du R.E.A.A.: Paroles de Prévôt et Juge & Intendant des BâtimentsPas encore d'évaluation
- Mémento 11e degré du R.E.A.A.: Sublime Chevalier ÉluD'EverandMémento 11e degré du R.E.A.A.: Sublime Chevalier ÉluÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Isis, clef des métamorphoses: Au Rite de Memphis MisraïmD'EverandIsis, clef des métamorphoses: Au Rite de Memphis MisraïmPas encore d'évaluation
- Mémento 13e degré du R.E.A.A.: Paroles de Chevalier de Royal-ArcheD'EverandMémento 13e degré du R.E.A.A.: Paroles de Chevalier de Royal-ArcheÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Ce que doit savoir un Maître Maçon (Annoté): Les Rites, l'Origine des Grades, Légende d'HiramD'EverandCe que doit savoir un Maître Maçon (Annoté): Les Rites, l'Origine des Grades, Légende d'HiramÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- La spiritualité de la franc-maçonnerie a-t-elle encore un sens dans la monde d'aujourd'hui ?D'EverandLa spiritualité de la franc-maçonnerie a-t-elle encore un sens dans la monde d'aujourd'hui ?Pas encore d'évaluation
- Mémento 14e degré du R.E.A.A.: Grand Élu, Parfait et Sublime MaçonD'EverandMémento 14e degré du R.E.A.A.: Grand Élu, Parfait et Sublime MaçonÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Martinésisme, Willermosisme, Martinisme et Franc-Maçonnerie : la quatre piliers de l'ésotérisme: édition intégrale annotéeD'EverandMartinésisme, Willermosisme, Martinisme et Franc-Maçonnerie : la quatre piliers de l'ésotérisme: édition intégrale annotéePas encore d'évaluation
- Mémento grand maitre architecte - 12e degré du reaaD'EverandMémento grand maitre architecte - 12e degré du reaaPas encore d'évaluation
- L'ecossisme, Rite REAADocument23 pagesL'ecossisme, Rite REAApouch12Pas encore d'évaluation
- Petit Dictionnaire PDFDocument23 pagesPetit Dictionnaire PDFStephany Granderson100% (1)
- CompDocument41 pagesCompHarryBianchi0% (1)
- Mémento 9e degré du R.E.A.A.: Paroles de Maître élu des neufD'EverandMémento 9e degré du R.E.A.A.: Paroles de Maître élu des neufÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Éthique en franc-maçonnerie: Comment porter nos valeurs hors du temple ?D'EverandÉthique en franc-maçonnerie: Comment porter nos valeurs hors du temple ?Pas encore d'évaluation
- L'Elevation A La MaitriseDocument17 pagesL'Elevation A La Maitrisemichokette100% (2)
- Histoire de la Magie: Une histoire des procédés et rituels secrets au cours des siècles (édition intégrale : 7 livres)D'EverandHistoire de la Magie: Une histoire des procédés et rituels secrets au cours des siècles (édition intégrale : 7 livres)Pas encore d'évaluation
- Omh PDFDocument37 pagesOmh PDFChad Villarreal100% (1)
- L'Art de La Magie au Bougie Wicca: Le Guide du Débutant à la Pratique de la Magie au Bougie de WiccaD'EverandL'Art de La Magie au Bougie Wicca: Le Guide du Débutant à la Pratique de la Magie au Bougie de WiccaÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Mémento 10e degré du R.E.A.A.: Illustre Élu des QuinzeD'EverandMémento 10e degré du R.E.A.A.: Illustre Élu des QuinzePas encore d'évaluation
- La Voie Métaphysique: l'enseignement secret de la GnoseD'EverandLa Voie Métaphysique: l'enseignement secret de la GnosePas encore d'évaluation
- La Philosophie de la Magie Naturelle (Traduit)D'EverandLa Philosophie de la Magie Naturelle (Traduit)Pas encore d'évaluation
- Temple ApprentiDocument12 pagesTemple ApprentiBerny Bhl100% (3)
- Venerable MaitreDocument18 pagesVenerable MaitreIng Berjugal Junior100% (4)
- 5 Rituels Puissants de Magie Noire: (Partie 2)D'Everand5 Rituels Puissants de Magie Noire: (Partie 2)Évaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- LIVRET ProfanesDocument30 pagesLIVRET ProfanesCHRIST HERMES LOUYOKO NIANZAPas encore d'évaluation
- Livret Du Maitre PDFDocument29 pagesLivret Du Maitre PDFkilobravo100% (8)
- Lucien Lévy-Bruhl - L'expérience Mystique Et Les Symboles Chez Les PrimitifsDocument156 pagesLucien Lévy-Bruhl - L'expérience Mystique Et Les Symboles Chez Les PrimitifszazatoPas encore d'évaluation
- LKKRR KFSWDDocument21 pagesLKKRR KFSWDSalimPas encore d'évaluation
- Apprentissage de La Geomancie PDFDocument184 pagesApprentissage de La Geomancie PDFSalim90% (42)
- Adages Erasme (Saladin)Document69 pagesAdages Erasme (Saladin)rodolfoenjaPas encore d'évaluation
- Livre de Tabdil A 100%Document10 pagesLivre de Tabdil A 100%Salim83% (30)
- Secrets Merveilleux de La Magie Naturelle Et Caballistique Du Petit Albert 1867 PDFDocument203 pagesSecrets Merveilleux de La Magie Naturelle Et Caballistique Du Petit Albert 1867 PDFJuan Carlos Gomez APas encore d'évaluation
- Les Explications Et L Efficacite Des Psaumes PDFDocument43 pagesLes Explications Et L Efficacite Des Psaumes PDFkobi berenger93% (74)
- Grimoire Des PlantesDocument194 pagesGrimoire Des PlantesFrancois Wong Kem100% (2)
- Des IncantationDocument34 pagesDes IncantationIbrahim Magnan Coulibaly100% (4)
- Rituels Lunaires PDFDocument41 pagesRituels Lunaires PDFJarkikurta ORZ100% (4)
- 1837 de Fontanelle Nouveau Manuel Complet Des SorciersDocument436 pages1837 de Fontanelle Nouveau Manuel Complet Des SorciersPaulo Sequeira Rebelo100% (3)
- Mohamed Dosso Tome Ii PDFDocument42 pagesMohamed Dosso Tome Ii PDFIssa Traoré91% (47)
- Manuel de Formation Op - CE Edition 2020 - Finale-1Document46 pagesManuel de Formation Op - CE Edition 2020 - Finale-1SalimPas encore d'évaluation
- Livre de Tabdil A 100%Document10 pagesLivre de Tabdil A 100%Salim83% (30)
- Tome III de Sabawol PDFDocument30 pagesTome III de Sabawol PDFAnonymous 5fdw4C80Yd83% (42)
- THIEBISSABADocument29 pagesTHIEBISSABAabdel100% (3)
- Secrets Et Puissances Des Figures Merveilleuses Dans Les Lais de Marie de France (PDFDrive)Document92 pagesSecrets Et Puissances Des Figures Merveilleuses Dans Les Lais de Marie de France (PDFDrive)Salim100% (2)
- Le Livre Des Jeux de Cartes - Règles Et Astuces de 32 Jeux Indispensables (PDFDrive) PDFDocument384 pagesLe Livre Des Jeux de Cartes - Règles Et Astuces de 32 Jeux Indispensables (PDFDrive) PDFSalim100% (1)
- Schwaeblé René - La Divine MagieDocument145 pagesSchwaeblé René - La Divine Magiehaitivox100% (1)
- GeomancieDocument88 pagesGeomancieMoussa Fofana87% (103)
- Le Code de Moise de J. Twyman (PDFDrive)Document91 pagesLe Code de Moise de J. Twyman (PDFDrive)Salim97% (31)
- Calendrier Lunaire Perpétuel (PDFDrive)Document74 pagesCalendrier Lunaire Perpétuel (PDFDrive)SalimPas encore d'évaluation
- Secrets Et Puissances Des Figures Merveilleuses Dans Les Lais de Marie de France (PDFDrive)Document92 pagesSecrets Et Puissances Des Figures Merveilleuses Dans Les Lais de Marie de France (PDFDrive)Salim100% (2)
- Formulaire Affiliation Pour Fondation Nvelle ImplantationDocument1 pageFormulaire Affiliation Pour Fondation Nvelle Implantationsamir abousamraPas encore d'évaluation
- Ini CompagnonsDocument34 pagesIni Compagnonsecaekelberghs100% (1)
- Cuvant Masonic Franceza 2016Document58 pagesCuvant Masonic Franceza 2016Viorel DanacuPas encore d'évaluation
- Triangle Noir - Niko TackianDocument230 pagesTriangle Noir - Niko TackianDONATELLOPas encore d'évaluation
- Lucifer DemasqueDocument302 pagesLucifer Demasquebtkmouad100% (3)
- Sebottendorf - LA PRATIQUE OPERATIVE DE L'ANCIENNE FRANC-MAÇONNERIE TURQUEDocument37 pagesSebottendorf - LA PRATIQUE OPERATIVE DE L'ANCIENNE FRANC-MAÇONNERIE TURQUEelyos421100% (2)
- Rituel Initiation LouveteauDocument20 pagesRituel Initiation LouveteauYves Paul Claudel GermainPas encore d'évaluation
- Rituel Jumelage Loge PDFDocument29 pagesRituel Jumelage Loge PDFron100% (1)
- 33 Secrets Sur La Franc-Maçonnerie (Lopez, Gérard)Document117 pages33 Secrets Sur La Franc-Maçonnerie (Lopez, Gérard)Marc T100% (1)
- Rituel Rite FrancaisDocument269 pagesRituel Rite FrancaisTurgut TiftikPas encore d'évaluation
- Le Tableau de Loge - RERDocument5 pagesLe Tableau de Loge - RERzorkot100% (1)
- UN ACHEMINEMENT VERS LA PAROLE - Louis Trebuchet (2008) PDFDocument9 pagesUN ACHEMINEMENT VERS LA PAROLE - Louis Trebuchet (2008) PDFAlkimistPas encore d'évaluation
- Confrence 18 MaiDocument3 pagesConfrence 18 MaiCarlton Charmond100% (2)
- La Règle D'abraham N°1 PDFDocument38 pagesLa Règle D'abraham N°1 PDFAboumyriam Abdelrahmane100% (2)
- R Inauguration PDFDocument14 pagesR Inauguration PDFronPas encore d'évaluation
- Lesfauxnomsde DieuDocument11 pagesLesfauxnomsde Dieupaul_fredric3173100% (1)
- Renseignements GenerauxDocument2 pagesRenseignements GenerauxAnge-Roland ObandaPas encore d'évaluation
- Les Societes SecretesDocument28 pagesLes Societes SecretessoubiseboisdeboutPas encore d'évaluation
- Biblio Rite Français 2019 (Ordres de Sagesse GO)Document2 pagesBiblio Rite Français 2019 (Ordres de Sagesse GO)ron100% (1)
- 1 Guide-du-Paris 1 4Document45 pages1 Guide-du-Paris 1 4garberer175% (4)
- Venerable MaitreDocument18 pagesVenerable MaitreIng Berjugal Junior100% (4)
- Jakob Frank Le Faux Messie Nodrm PDFDocument198 pagesJakob Frank Le Faux Messie Nodrm PDFAdrien Bock100% (3)
- InitiationDocument11 pagesInitiationMlgdrPas encore d'évaluation
- Joseph Santo - Le Formidable Secret de La Franc-MasonnerieDocument172 pagesJoseph Santo - Le Formidable Secret de La Franc-MasonnerieCesar Palacios100% (1)
- Les Debuts Du MartinismeDocument12 pagesLes Debuts Du MartinismekoffiPas encore d'évaluation
- Le Culte Du Grand Architecte KlapkaIMPDocument429 pagesLe Culte Du Grand Architecte KlapkaIMPTabasCowPas encore d'évaluation
- Chambre Du MilieuDocument2 pagesChambre Du MilieuBernard Junior GallantPas encore d'évaluation
- Jannet Claudio - La Franc-Maconnerie Et La RevolutionDocument550 pagesJannet Claudio - La Franc-Maconnerie Et La RevolutionSharklo KipetrovitchiPas encore d'évaluation
- Extrait de Noir ChiracDocument14 pagesExtrait de Noir Chiraccloclo24Pas encore d'évaluation
- Les Super Loges Internationales ExtraitDocument10 pagesLes Super Loges Internationales ExtraitLeonardo Limeira100% (3)