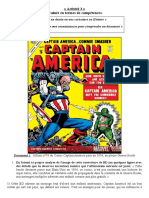Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Outre 1631-0438 2013 Num 100 378 4995
Outre 1631-0438 2013 Num 100 378 4995
Transféré par
Jodel PierreTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Outre 1631-0438 2013 Num 100 378 4995
Outre 1631-0438 2013 Num 100 378 4995
Transféré par
Jodel PierreDroits d'auteur :
Formats disponibles
Outre-mers
Territoire, territorialité : objets d’étude de la géographie pour une
analyse des territoires de l’histoire antillaise
Françoise Pagney Bénito-Espinal, Thierry Nicolas
Citer ce document / Cite this document :
Pagney Bénito-Espinal Françoise, Nicolas Thierry. Territoire, territorialité : objets d’étude de la géographie pour une
analyse des territoires de l’histoire antillaise. In: Outre-mers, tome 100, n°378-379,2013. Les territoires de l’histoire
antillaise. pp. 13-26;
doi : https://doi.org/10.3406/outre.2013.4995
https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2013_num_100_378_4995
Fichier pdf généré le 17/01/2019
Prolégomènes
Territoire, territorialité :
objets d’étude de la géographie pour une analyse
des territoires de l’histoire antillaise
Françoise PAGNEY BÉNITO-ESPINAL* et Thierry NICOLAS**
S’il est vrai que l’histoire a pour finalités, notamment, d’extraire du
passé les actions et rétroactions des individus, groupes, sociétés, les
événements, les segments temporels plus ou moins longs, et d’en ana-
lyser les logiques et évolutions plurifactorielles avec la distanciation du
temps, en revanche, la géographie s’ancre dans l’espace pour en
extraire, entre autres, les mosaïques, fragmentations, fluctuations et
dynamiques, ressortissant de préférence des temps courts, du présent
au subprésent. Historiens et géographes nourrissent leurs identités
respectives de leurs différences, justification même de leur existence
conjointe et distincte. Pourtant, des concepts et outils utilisent un
vocabulaire commun aux deux disciplines, avec toutefois des accep-
tions qui identifient a priori les différences, mais aussi mutualisent les
visions. Parmi ces fondements, tant la géographie que l’histoire font des
territoires et de la territorialité des clés d’analyse qui allient le temps
et l’espace et, de ce fait, lient les deux champs disciplinaires en en
rejoignant/recoupant certains objets d’études.
Que l’historien se préoccupe des territoires d’une histoire, l’histoire
antillaise, ne peut qu’interpeller le géographe pour qui le territoire est
un filtre d’interprétation qui connecte les sociétés à l’espace et au
temps. Aussi, que des géographes s’insèrent dans les réflexions menées
* Professeur des Universités en géographie, Université des Antilles et de la Guyane,
directrice de l’équipe AIHP-GEODE.
** Docteur en géographie, chercheur associé à AIHP-GEODE.
Outre-Mers,T. 101, No 378-379 (2013)
14 f. pagney bénito-espinal, t. nicolas
sur les territoires de l’histoire antillaise est non seulement justifié, mais
aussi judicieux, ne serait-ce que, de prime abord, par la délimitation
même du sujet d’étude : les Antilles. Quelle existence cet archipel
a-t-il, si ce n’est, en tout premier lieu, une existence à ressort spatial
donc géographique ? Identifier une histoire en phase de construction,
autocentrée sur les Antilles comme l’ambitionne le programme de
recherche en cours, implique une réflexion sur les notions de territoire
et de territorialisation, qui ne peut s’abstraire de l’apport de la géogra-
phie.
Nombreux sont les définitions et les auteurs qui ont développé des
réflexions sur le, les territoires et la territorialité, et ce, depuis plusieurs
décennies, d’où une inévitable évolution de la sémantique. Pour s’inté-
grer dans les réflexions sur les territoires de l’histoire antillaise, et voir
en quoi la vision des géographes et des écoles de pensée géographiques
peut constituer un apport substantiel et nourrir la complémentarité des
disciplines, nous tenterons de faire un résumé succinct de ce que les
géographes entendent par territoire et ses caractéristiques. Il aura pour
but de faire apparaître des liens possibles entre la géographie et l’his-
toire, ainsi que l’archéologie, cette discipline s’inscrivant aussi au cœur
des questionnements sur les territoires de l’histoire antillaise. Et,
comme les courants de pensée que nous rappellerons le montrent, ces
liens deviendront très rapidement des évidences, au point que les
territoires de l’histoire antillaise apparaîtront comme un objet de
problématiques aussi géographiques. Cette analyse offrira de même
l’opportunité d’évoquer les réflexions de géographes sur les territoires,
non pas de l’histoire antillaise, mais de l’espace archipélique des
Antilles. Il s’agira ensuite, pour les chercheurs historiens et archéolo-
gues, de mettre ces complémentarités en perspective et de nourrir leurs
réflexions en les enrichissant de l’apport de l’autre discipline, car le
territoire est avant tout objet d’étude de la géographie.
Pour développer ces définitions, quelques sources bibliographiques
sont incontournables. Elles permettent de sérier les approches et de
mieux les intégrer dans les réflexions en cours.
1. Des fondamentaux qui précisent ce qu’est le territoire pour
les géographes
Les références auxquelles il est incontournable de se reporter ressor-
tissent de la bibliographie de base de tout étudiant de premier et second
cycles. Les éluder sous prétexte qu’elles constituent des fondamentaux
que tous connaissent a priori, ne s’inscrit pas dans la logique des
réflexions engagées ici. Celles qui sont mentionnées ci-dessous n’ont
aucune visée exhaustive. Elles ne font que reprendre quelques titres
parmi un ensemble de productions fécondes et prolixes, ouvrages,
territoire, territorialité 15
manuels ou dictionnaires, desquels il est possible d’extraire des défini-
tions des territoires. Nous nous limiterons à quelques références, le but
n’étant pas d’atteindre l’exhaustivité mais plutôt d’opérer une brève
incursion, à simple titre introductif. Nous n’entrerons pas davantage
dans les débats des écoles, qui ont bien souvent et trop souvent ressorti
du rejet, voire de la mise au pilori des positions autres, injustement
considérées comme dépassées ou condamnables, sous prétexte, notam-
ment, qu’elles se situaient dans le prolongement des positionnements
initiaux de la géographie. Tolérance et acceptation de la diversité des
points de vue nous semblent, à nous, des principes de base qui juste-
ment ouvrent le champ de tous les possibles, dans le respect de la
complémentarité.
Nous nous intéresserons aux dictionnaires et encyclopédies de géo-
graphie qui fournissent des définitions conséquentes du territoire.
Quatre d’entre eux ont retenu notre attention en proposant une pensée
réflexive formalisée permettant de mieux cerner ce que l’on entend
aujourd’hui à travers ce concept.
Ê Le premier dictionnaire, Les Mots de la géographie 1, réalisé notamment
sous la direction de Roger Brunet, est intéressant car il est l’un de
ceux qui ont fourni de la substance à un concept importé dans les
années 1980 en géographie. Paru en 1992 et réédité à de nombreuses
reprises, ce dictionnaire critique, devenu paradoxalement un classi-
que, éclaire le lecteur sur le sens conféré au territoire et la distinction
que l’on doit nécessairement opérer avec l’espace géographique.
Ê Le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés 2, rédigé sous la
direction de Jacques Lévy et de Michel Lussault est également digne
d’intérêt. Il s’inscrit en effet dans la lignée du précédent en ayant
comme objectif de lutter contre « le repli du propos géographique sur
des connaissances idiographiques, peu propices aux montées en géné-
ralité et aux constructions théoriques » 3. Ce faisant, ce dictionnaire
nous fournit près de huit définitions établies du territoire auxquelles
se rajoute une neuvième conceptualisée par les auteurs.
Ê En troisième lieu nous avons retenu une encyclopédie accessible en
ligne, Hypergéo, consacrée à l’épistémologie de la géographie, où se
trouvent les acceptions de nombreux termes relevant notamment de
la géographie sociale et culturelle. Les entrées concernant le territoire
sont de loin les plus fournies, notamment celle qu’a rédigée Bernard
Elissalde 4.
1. Roger Brunet, Robert Ferras, Hervé Théry, Les Mots de la géographie, Paris, La
Documentation française, 1992.
2. Lévy Jacques et Lussault Michel (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des
sociétés, Paris, Belin, 2003.
3. Ibid., p. 8.
4. Bernard Elissalde, « Territoire », Hypergéo : http://www.hypergeo.eu/spip.php?
article285
Outre-Mers,T. 101, No 378-379 (2013)
16 f. pagney bénito-espinal, t. nicolas
Ê Il est difficile de ne pas évoquer ici le dictionnaire de la géographie
d’un des géographes les plus connus de la sphère médiatique : Yves
Lacoste. Dans son corpus de mots pour comprendre le monde, inti-
tulé De la géopolitique aux paysages 5, l’auteur nous apporte une vision
du territoire du point de vue politique qui complète idéalement les
visions développées par les géographes précédents.
À ces supports, dont l’effort visant à stabiliser le concept est sensible,
nous pouvons ajouter cinq manuels et ouvrages généraux où le terri-
toire est l’objet d’une définition approfondie :
Ê Le manuel de Jean-François Deneux a le grand mérite de présenter de
façon simple, claire et explicite, l’Histoire de la pensée géographique 6,
dans laquelle s’intègre la notion de territoire. Y sont soulignés les
termes sous lesquels se retrouvent aujourd’hui la plupart des cher-
cheurs en géographie : espaces, territoires et sociétés 7. Le territoire
est bien au cœur des préoccupations des géographes.
Ê On se reportera volontiers à l’ouvrage de base, Les concepts de la
géographie humaine dirigé par Antoine Bailly 8, qui a le mérite d’offrir
une vision synthétique et globale des branches de la géographie
humaine, et a été réactualisé.
Ê Dans Éléments d’épistémologie de la géographie d’Antoine Bailly et
Robert Ferras 9, on trouve dans le chapitre consacré aux définitions et
concepts fondamentaux de la géographie, un développement sur le
territoire 10.
Ê L’ouvrage Logiques de l’espace, esprit des lieux. Géographies à Cerisy 11,
inscrit systématiquement dans la bibliographie des cours en géogra-
phie humaine, regroupe lui aussi des auteurs spécialistes de la ques-
tion, notamment Guy Di Méo.
Ê L’ouvrage d’Hélène Velasco-Graciet, Territoires, mobilités et sociétés,
contradictions géographiques et enjeux pour la géographie 12, plus récent,
fait une synthèse des positions.
Nous nous limiterons à ces quelques titres. D’autres auraient mérité
notre attention, toutefois, au sein de ceux que nous avons mentionnés
se trouvent de multiples références à des auteurs et à leurs publications.
5. Yves Lacoste, De la géopolitique aux paysages, Paris, A. Colin, 2003.
6. Jean-François Deneux, Histoire de la pensée géographique, Paris, Belin, coll. Atouts
géographie, 2006.
7. Ibid, p. 175.
8. Antoine Bailly (dir.), Les concepts de la géographie humaine, Paris, Masson, 2005.
9. Antoine Bailly et Robert Ferras, Éléments d’épistémologie de la géographie, Paris,
A. Colin, 2004.
10. Ibid., p. 113 et suivantes.
11. Jacques Lévy et Michel Lussault (dir.), Logiques de l’espace, esprit des lieux. Géogra-
phies à Cerisy, Paris, Belin, 2000.
12. Hélène Velasco-Graciet, Territoires, mobilités et sociétés. Contradictions géographiques et
enjeux pour la géographie, Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2009.
territoire, territorialité 17
Il y a donc dans la consultation de cette bibliographie de quoi alimenter
une réflexion sur les territoires.
Pour Claude Raffestin (1986), cité par Bernard Elissalde 13, les pro-
cessus d’organisation territoriale doivent s’analyser à deux niveaux
distincts mais fonctionnant en interaction : celui de l’action des sociétés
sur les supports matériels de leur existence et celui des systèmes de
représentation, d’où les deux dimensions du territoire reconnues par
les géographes : le territoire espace social, espace vécu, et le territoire
espace de la représentation mentale.
2. Le territoire : espace social, espace vécu et espace de repré-
sentation mentale
Espace de vie, espace du groupe
Le territoire est une portion d’espace terrestre envisagée dans ses
rapports avec des groupes humains qui l’occupent et l’aménagent :« Le
territoire peut être défini comme la portion de la surface terrestre,
appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la
satisfaction de ses besoins vitaux », spécifie Maryvonne Le Berre 14.
Cette première définition relève de la géographie sociale, qui considère
justement les relations spatiales d’une société à partir des transactions
objectives qu’elle produit. L’un des grands artisans de cette géographie
est Paul Claval. Comparer la territorialité, dans cette acception du
terme, édifiée par les sociétés précoloniales et coloniales des Antilles,
mérite attention et permet justement d’illustrer cette première défini-
tion. Au premier abord, les territorialisations précoloniales et coloniales
avaient des ressorts différents : les territoires centrés sur les canaux (ce
que montrent les travaux de Benoît Bérard), se distinguaient de ceux,
certes à ancrages littoraux et sublittoraux, mais à assises avant tout liées
à la terre et non à la mer, du début de l’ère coloniale. Ne peut-on
considérer aussi l’« habitation » (ou plantation) comme un territoire, et
la société coloniale basée sur l’entité socio-économique de l’habita-
tion/plantation comme édificatrice de territoires aux dimensions com-
patibles avec la double exigence du système spéculatif colonial et des
contraintes de subsistance de ses occupants ? Les études historiques
spécialisées sur les constructions socio-économiques, leurs évolutions
et leurs spécificités comparées entre les îles des Grandes et des Petites
Antilles, ressortiraient, dans ce cadre, d’une territorialisation issue des
sociétés créoles, donc à ressort en partie endogène, dont les fonde-
ments furent les habitations/plantations.
13. Bernard Elissalde, « Territoire », art. cit.
14. « Le territoire selon Maryvonne Le Berre », Hypergéo : http://www.hypergeo.eu/
spip.php?article335
Outre-Mers,T. 101, No 378-379 (2013)
18 f. pagney bénito-espinal, t. nicolas
Ne peut-on de même, dans un tout autre registre, et ce, à simple titre
d’exemple, analyser les déplacements des populations des exploitations
cannières vers certains centres tels que Fort-de-France après la
Seconde Guerre mondiale, comme des translations territoriales, et non
des déterritorialisations, les personnes ayant conservé dans leur nouvel
espace de vie leurs pratiques quotidiennes et leurs liens nourriciers à la
terre ? Le questionnement sur la pertinence de l’usage de la notion
d’exode rural dans les îles, par des historiens impliqués dans le pro-
gramme de recherche en cours 15, trouve des justifications au regard de
l’acception du territoire ici retenue. Le qualificatif « rural » implique de
sortir d’un milieu à vocation agricole pour entrer dans un territoire à
urbanité prononcée. Les jardins créoles des zones cannières, sources
des déplacements évoqués, furent dupliqués sur les espaces d’accueil.
Par exemple, les jardins du quartier de Trénelle-Citron (Fort-de-
France), n’étaient-ils pas la reproduction de ceux des campagnes d’ori-
gine des populations qui s’y installèrent ? Si l’exode rural, tel qu’il se fit
au xixe siècle dans l’hexagone, impliqua une déterritorialisation, il est
contestable de trouver une stricte identité de processus dans les dépla-
cements des terres cannières vers les bourgs/villes tels que Fort-de-
France, où la ruralité était encore très prégnante lors de la crise sucrière
qui s’accompagna de la fermeture d’usines postérieure à la Seconde
Guerre mondiale.
L’étude historique de ces translations territoriales, même comparées,
relève bien, nous semble-t-il, de territoires de l’histoire antillaise.
Mais, pour les géographes, la construction de territoires implique
une dimension supplémentaire à celle de l’espace vécu et assurant la
reproduction des groupes. Le territoire témoigne ainsi d’une appro-
priation politique de l’espace par des groupes.
Espace à construction intentionnelle
Cette idée d’appropriation, contenue dans bon nombre de défini-
tions du territoire, renvoie aux domaines décisionnel et organisationnel.
Dans le domaine décisionnel, les acteurs font valoir leurs préférences et
pèsent sur les choix collectifs. La territorialisation implique donc aussi
un jeu d’acteurs, d’opérateurs. Ce territoire où s’exerce l’appropriation
est le support par excellence des investigations menées sur l’intention-
nalité des acteurs 16. Il illustre la nature intentionnelle, le caractère
volontaire de sa création. Il y a là, à l’évidence, une approche du
territoire qui concerne les édifications de toutes les échelles spatiales,
depuis celle des États jusqu’à celle des plus petites entités adminis-
tratives, et ce, à partir d’une vision pluriscalaire de l’actuel, du passé
proche, comme des passés plus ou moins lointains. Tout comme les
15. Voir l’article de Jacques Dumont dans ce numéro.
16. B. Elissalde, « Territoire », art. cit.
territoire, territorialité 19
habitations/plantations, pour donner un exemple certes élémentaire,
peuvent être considérées comme des formes de territoires, objets
d’étude, donc, de l’histoire antillaise, il est tout aussi possible d’appré-
hender les processus de mutations politiques, des colonies aux États ou
territoires sous tutelle du xxe siècle, comme des résultantes de proces-
sus de territorialisation des Antilles. Les exemples donnés sont volon-
tairement simples.
On ne peut pas, à ce niveau de la définition du territoire, omettre
d’évoquer la place fondamentale jouée par la géographie politique, ou
géographie des territoires, considérées comme des constructions volon-
taires, issues de jeux d’acteurs, et bien sûr, de conflits d’acteurs.
La géographie politique renaît en France avecYves Lacoste et Claude
Raffestin. En 1976 paraît le célèbre ouvrage d’Yves Lacoste, La géogra-
phie, ça sert, d’abord, à faire la guerre 17, tandis qu’est lancée la revue
Hérodote. Le terme de géopolitique apparaît en sous-titre en 1983.
Outre les facteurs économiques, des facteurs historiques, sociaux et
idéologiques sont abordés afin que les territoires soient envisagés
comme des espaces politiques, enjeux de rivalités de pouvoir et même
comme le terrain de conflits armés. Il s’agit de comprendre les logiques
spatiales des États, notamment par les rapports de force qu’ils entre-
tiennent entre eux. La géopolitique est au cœur de la construction de
territoires et de leur devenir. L’histoire politique des îles trouve ses
fondements dans des territoires à fluctuations dimensionnelles et rela-
tionnelles.
Nous venons de voir que le territoire a une double définition : il est
construit par les groupes qui y vivent et s’y reproduisent, il répond donc
à des logiques socio-économiques, de même qu’à des logiques déci-
sionnelles, objectives, qui relèvent entre autres de la politique. Mais une
autre dimension est aussi avancée par les spécialistes. Le territoire n’est
pas seulement objectivé, il est subjectivé.
Espace des représentations, espace subjectivé
Le territoire traduit un mode de découpage et de contrôle de l’espace
garantissant la spécificité, la permanence, la reproduction des groupes
humains qui l’occupent, ainsi que la force des représentations sociales.
Pour Claude Raffestin, « en s’appropriant concrètement ou abstraite-
ment un espace, l’acteur territorialise l’espace » 18. Pour le même
auteur, d’après Bernard Elissalde, les processus d’organisation territo-
riale doivent s’analyser à deux niveaux distincts mais fonctionnant en
interaction : « celui de l’action des sociétés sur les supports matériels de
leur existence » (c’est ce que nous avons vu plus haut), « et celui des
17. Yves Lacoste, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris, F. Maspero,
1976.
18. Claude Raffestin, Pour une géographie du pouvoir, Paris, Litec, 1980, p. 129.
Outre-Mers,T. 101, No 378-379 (2013)
20 f. pagney bénito-espinal, t. nicolas
systèmes de représentation » 19. Chaque individu, dans son expérience
vécue, possède une relation intime avec ses lieux de vie, lieux qu’il
s’approprie et qui contribuent à façonner son identité individuelle ou
collective. Le territoire possède donc, certes, une dimension matérielle,
mais aussi idéelle. Le processus lié à sa construction et à son dévelop-
pement se fonde tant sur sa substance physique, sur des actions et des
aménagements, que sur des discours et des symboles.
Relevant de la psyché individuelle, la territorialité s’identifie à un
rapport a priori émotionnel et présocial de l’homme à la terre. Le
territoire participe donc bien de l’ordre des représentations culturelles,
donc de la géographie culturelle, fondée par Paul Claval. Cette dernière
privilégie les rapports de sens entre l’homme, ses groupes sociaux et les
lieux.
De cette acception conceptuelle, idéelle du territoire, il résulte en
toute logique que le territoire est un espace identitaire à haute charge
symbolique. Aménagé par les sociétés qui l’ont investi, il constitue un
remarquable champ symbolique. Certains de ses éléments, instaurés en
valeurs patrimoniales, contribuent à fonder ou à raffermir le sentiment
d’identité collective des hommes qui l’occupent 20. Il participe de
l’ordre des représentations sociales et culturelles. Le territoire identi-
taire devient un puissant outil de mobilisation sociale par sa double
fonction politique et symbolique, par les effets de solidarité qu’il engen-
dre. C’est « une forme spatiale de la société qui permet de réduire les
distances à l’intérieur et d’établir une distance infinie avec l’extérieur
au-delà des frontières » 21.
Appropriation et enracinement se manifestent par des éléments
matériels mais aussi idéels, et certaines matérialités du territoire possè-
dent une forte valeur symbolique 22. Des éléments emblématiques ren-
forcent les effets d’appropriation, tels que les « lieux de mémoire ». Les
lieux qui constituent l’architecture de base du territoire peuvent en
effet être investis du sens d’une quête mémorielle par un groupe
humain. Cependant, les lieux de mémoire du géographe se distinguent
de ceux de l’historien. Si, pour Pierre Nora, un manuel de classe, un
testament, la notion de lignage et de génération et même une minute de
silence peuvent devenir des lieux de mémoire 23, en revanche pour le
géographe, il en va autrement. Ce dernier considère généralement que
les lieux de mémoire ne peuvent s’entendre « dans tous les sens du
19. Bernard Elissalde, « Territoire », art. cit. : B. Elissalde s’appuie sur Claude Raffes-
tin, « Écogénèse territoriale et territorialité », in Franck Auriac et Roger Brunet (dir.),
Espaces, jeux et enjeux, Paris, Fayard, 1986.
20. « Le territoire selon Guy di Méo », Hypergéo : http://www.hypergeo.eu/spip.
php?article485 (Extrait de Guy di Méo, Géographie sociale et Territoire, Paris, Nathan,
1998).
21. Denis Retaillé, Le Monde du géographe, Paris, FNSP, 1997, cité par Guy Di Méo in
ibid.
22. B. Elissalde, « Territoire », art. cit.
23. Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 3 t., 7 vol., 1984-1992.
territoire, territorialité 21
terme » en particulier dans leur dimension abstraite ou intellectuelle-
ment construite. Cela sous-tend deux distinctions majeures à l’égard de
la définition de l’historien, en particulier celle de Pierre Nora :
Ê La première distinction tient à la nature même du lieu qui est cette
entité géographique première à laquelle il est impossible d’appli-
quer la notion d’étendue. Le lieu constitue un objet géographique
bien réel qui s’observe dans le paysage et dont l’unité de mesure
principale est le mètre. Il faut donc entendre, lorsque l’on évoque le
concept de « lieu », un point précis du territoire, localisable par des
données géographiques et que l’on qualifie le plus souvent par un
nom (toponyme).
Ê La seconde distinction tient au fait que le lieu ne devient un lieu de
mémoire que lorsqu’une trace matérielle existe et symbolise le
passage de l’idée à la forme, enfermant ainsi un maximum de sens
dans un minimum de signes.
Les lieux de mémoire du géographe associent par conséquent les
idées de localisation, de matérialité et de sémiologie.
Les Antilles sont devenues en quelques décennies des territoires
prolifiques en lieux de mémoire. Il faut souligner que, depuis les années
1990, une vague mémorielle, dont les lieux mémoire apparaissent
comme l’expression géographique la plus marquante, semble avoir
envahi ces territoires. Les territoires antillais portent, au détour de
ronds-points, de squares ou de places publiques, les stigmates d’une
volonté de leurs habitants de se souvenir et de rendre hommage. Près
d’une centaine de ces marqueurs spatiaux indiquent désormais au
visiteur le rapport particulier qu’entretiennent les Antillais à leur passé.
Les territoires français participent de façon remarquable à cette dyna-
mique en raison de la multiplication de monuments, de statues, de
stèles à la mémoire des populations précolombiennes, esclaves ou enga-
gées. Le mémorial de l’Anse Caffard en Martinique, la statue de Lady
Liberty à Saint-Martin (partie française), celle de Suvaku à Saint-
Barthélemy, ou le monument du premier jour en Guadeloupe, sont
autant de lieux de mémoire qui marquent désormais de leur empreinte
ces territoires. Il semble ainsi difficile de faire l’économie d’une
réflexion sur l’émergence d’une nouvelle territorialité antillaise où la
sensibilité à l’égard du passé et des communautés humaines qui l’ont
marqué est grande.
Outre-Mers,T. 101, No 378-379 (2013)
22 f. pagney bénito-espinal, t. nicolas
3. Le territoire : un système complexe
Une entité autonome en constant devenir :Territoire versus insularité ?
Évoquer les territoires antillais nous pousse également à réfléchir à
leurs limites et plus particulièrement aux liens qui existent avec
l’étendue-support de nature insulaire. La permanence d’une disconti-
nuité physique apparaît comme une donnée fondamentale qui, dans
une large mesure, participe à la définition des contours territoriaux.
Toutefois, l’expérience nous montre que les territoires antillais ne se
superposent pas toujours au tracé des côtes. Les cas de dédoublement
de l’insularité sur l’île d’Hispaniola et de mono-insularité partagée
propre à Saint-Martin sont là pour en témoigner. Les rivalités entre les
grandes puissances ont eu pour effet de déboucher sur la partition des
îles et l’édification de frontières internes. Saisir les territoires antillais
exige par conséquent de les appréhender autrement que par l’interface
terre-eau qui semble les clore. On ne peut se contenter de concevoir le
territoire martiniquais, par un « effort d’imagination », comme « un
crabe à une pince », et le territoire guadeloupéen comme « un papillon
qui, après une longue traversée, se serait posé sur l’Atlantique sans
avoir eu la force de replier ses ailes » 24. Il faut dépasser la tentation de
réduire les territoires Antillais à la seule figure insulaire qui leur confé-
rerait le statut d’entités différenciées à la surface de la terre.
En réalité, de multiples composantes (environnementale, sociale,
économique, institutionnelle, etc.) donnent de la spécificité et de
l’identité à la configuration et au fonctionnement de cet ensemble
qu’est le territoire. Comprendre un territoire, c’est mettre en évidence
les interactions entre ses différentes composantes et non pas les consi-
dérer comme des couches successives dont la totalité constituerait un
ensemble appelé territoire. Le territoire peut donc être apprécié comme
un système complexe. Il s’insère dans un ensemble spatial, que fonde la
société qui l’aménage, le gère et l’organise, alors que, dans le même
temps, le territoire rétroagit sur la société. Son analyse implique donc
un mode d’approche particulier qui ne ressortit pas de la causalité
linéaire mais bien de la démarche systémique.
Dans le chapitre des Concepts de la Géographie humaine intitulé
« Espace et pouvoir », rédigé par Claude Raffestin et Angelo Baram-
pama, le territoire est aussi défini comme produit à partir de l’espace
par les réseaux, circuits et flux projetés par les groupes sociaux. On
entre alors dans les notions d’interaction spatiale, donc d’analyse spa-
tiale 25. Le territoire implique, non seulement sa nature systémique,
avec son individualité propre et son autonomie fonctionnelle, mais
24. Jardel J.-P., Antilles françaises, Éditions Arthaud, Paris, 2001.
25. Parmi les auteurs fondateurs de cette géographie spatiale figurent Denise Pumain,
Thérèse Saint-Julien et Roger Brunet.
territoire, territorialité 23
aussi un ressort spatial. Ce dernier comprend les notions de maillage et
de réseau, donc des instantanés inscrits dans le temps et l’espace, ainsi
que les réseaux et les flux, ce qui introduit une notion tout aussi
majeure en géographie : celle du/des mouvements. C’est bien en cela
que le territoire est une entité systémique en constant devenir. De ces
considérations résulte l’inévitable problématique des méthodes, outils
d’analyse et de représentation, parmi lesquels la cartographie et la
géomatique tiennent une place majeure. Le territoire est une entité en
constante construction/déconstruction, donc en mouvement. Son ana-
lyse s’accompagne ainsi de sa représentation cartographique, graphi-
que, schématique ... Cette édification résulte, pour certains, de lois
universelles de l’espace 26. Leurs représentations impliquent l’applica-
tion de la table des chorèmes et en cela insèrent les territoires étudiés
dans l’expression de toutes les représentations spatiales.
Ces observations ont un intérêt tout particulier dans la réflexion
menée ici sur les territoires de l’histoire antillaise. Comment ne pas
envisager des recherches sur l’histoire et l’archéologie des Antilles,
considérées comme le résultat de processus émanant de territoires
dotés d’une forte identité ? Comment ne pas admettre que les prismes
d’analyse de l’histoire des Antilles puissent être fortement marqués par
les systèmes de cet archipel à forte identité socio-spatiale, individualisés
au fil du temps ? Le nier serait nier la notion même de territoires au
sens de ces boucles d’actions et rétroactions entre toutes les composan-
tes, environnementales, sociales, économiques, institutionnelles ..., qui
font des Antilles des territoires. La prise en compte du territoire dans
ses acceptions géographiques et plus particulièrement dans sa concep-
tion systémique fournit ainsi toute sa pertinence au projet de recherche
sur les territoires de l’histoire antillaise.
Un espace qui ressortit du multi-scalaire et du pluri-temporel
La plupart des études sur la territorialisation privilégient avant tout
la mise au jour des logiques de fonctionnement interne d’un territoire.
Tout se passe alors comme si elles reposaient sur un implicite, qui est
celui du fonctionnement autonome du lieu étudié. Cet implicite est
cependant capital car il reconnait bien dans le territoire un système,
donc une entité identifiable et analysable.
Claude Raffestin, notamment, intègre la notion d’échelles spatiales
dans la définition du territoire. La géographie politique classique est en
fait celle de l’État. Or Raffestin suggère de traquer le politique partout
où est le pouvoir, donc à toutes les échelles, y compris aux échelles
régionale, locale, et aujourd’hui aussi mondiale. Le territoire, nous
l’avons déjà évoqué ci-dessus, s’identifie de ce fait à différentes échelles
de l’espace géographique : du champ de la localité à l’aire de l’État-
26. Cf. les travaux de Roger Brunet.
Outre-Mers,T. 101, No 378-379 (2013)
24 f. pagney bénito-espinal, t. nicolas
nation ou à celle des entités plurinationales et mondiales. L’emboîte-
ment des échelles spatiales est une constante de la géographie et sur-
tout l’un des liens entre les géographies.
Dès leur origine, les territoires antillais ont été conçus dans cet
emboîtement d’échelles afin de répondre aux besoins en matières pre-
mières des mères-patries. Ces échelles ont varié au fil du temps et au
rythme des rivalités entre les puissances tutélaires. Aujourd’hui encore,
cet emboîtement d’échelles varie d’une île à une autre. Aux îles indé-
pendantes s’ajoutent celles qui sont liées à d’anciennes ou de nouvelles
métropoles. Ainsi, les Îles Vierges ne peuvent être appréhendées comme
un ensemble territorial homogène. Il est difficile de faire abstraction du
fait qu’une partie d’entre elles est rattachée aux États-Unis et l’autre au
Royaume-Uni. D’ailleurs la dépendance semble être une caractéristi-
que des Antilles, en particulier des plus petites d’entre elles. Lorsque
l’on s’arrête sur une carte politique de ce chapelet d’îles, on s’aperçoit
que près de la moitié d’entre elles demeurent dans le giron d’une
grande nation. Contrairement à l’idée souvent véhiculée selon laquelle
l’insularité aboutirait à la multiplication de territoires-nations, il s’avère
que les Petites Antilles échappent à ce schéma. Les statuts sont varia-
bles et vont de l’intégration la plus poussée à l’autonomie la plus large.
Parfois, ces différences sont visibles au sein d’un même ensemble
politique. L’outre-mer néerlandais voit ainsi cohabiter des « pays » qui
disposent d’un degré d’autonomie important, à l’image d’Aruba ou de
Curaçao, et des « communes spéciales » davantage dépendantes de la
couronne des Pays-Bas comme Saba ou Saint-Eustache. De même,
dans les Antilles françaises se juxtaposent des départements d’outre-
mer fortement intégrés à leur métropole et des collectivités d’outre-mer
jouissant de prérogatives locales plus importantes.
Les territoires de l’histoire antillaise impliquent inévitablement ces
échelles emboîtées et c’est ce qui en fait aussi la pertinence. Du micro
au macro en passant par le méso-spatial, les territoires de l’histoire
antillaise ont leur justification. Cette dimension scalaire méritera d’être
tout particulièrement mise en évidence dans les réflexions en cours, car
le territoire est indissociable de cet emboîtement d’échelles.
Si l’importance des échelles spatiales est essentielle et ressortit bien
de l’identité géographique du territoire, il en est une autre qui conforte
encore plus la pertinence du thème fédérateur de recherche : c’est celle
des temps, du plus long au plus court. L’importance du temps long de
l’histoire en matière de construction symbolique des territoires retient
l’attention de la plupart des auteurs, comme le remarque Guy Di Méo :
« L’espace a besoin de toute l’épaisseur du temps, de répétitions
silencieuses, de maturations lentes, du travail de l’imaginaire social et
de la norme pour exister comme territoire » 27. Pour Yves Lacoste, en
27. Michel Marié cité par Guy Di Méo, « De l’espace subjectif à l’espace objectif :
l’itinéraire du labyrinthe », in L’espace géographique, tome 19-20, no 4, 1990, p. 359-373.
territoire, territorialité 25
géopolitique, il y a nécessité de prendre en compte les pas de temps
courts à très courts. Quoi de plus pertinent que cette intégration du
passé dans les constructions des territoires, et quel meilleur lien
peut-on trouver entre deux disciplines, l’histoire (l’archéologie aussi)
et la géographie, que cette notion de territoire, objet d’étude géogra-
phique par excellence, mais dont la construction ressortit du passé,
donc de l’analyse historique ?
Conclusion
Ce survol de définitions du territoire au sens que lui donnent les
géographes s’inscrit pleinement dans les problématiques antillaises
actuelles. Ce concept, qui était pratiquement absent du champ de la
géographie française jusqu’au début des années 1980, se révèle utile
pour comprendre le fonctionnement socio-spatial des Antilles. À titre
de comparaison, la géographie anglo-saxonne, qui constitue la réfé-
rence principale pour cette aire d’étude, ne dispose pas de terme
équivalent. Le territoire y apparaît largement lié à sa double définition
originelle. La géographie de langue anglaise retient tout d’abord une
conception inspirée du territorium latin et largement reprise par la
science politique, qui y voit un espace aux frontières établies, contrôlé
par un État ou tout autre pouvoir. En second lieu, cette géographie
considère le territoire comme une zone d’exclusion devant être défen-
due, à l’image de l’approche développée par les sciences naturelles et
écologiques à propos du territoire animal. L’avancée considérable réa-
lisée dans le champ géographique français réside dans le fait que le
territoire ne se réduit plus à ces deux acceptions. Il est devenu en trois
décennies ce support géographique à l’interface de l’espace et du social.
Il est un espace à construction intentionnelle dans lequel se mêlent le
vécu, le culturel, le religieux ou encore le sensible.
Cette rapide présentation montre aussi combien les cloisonnements
disciplinaires sont bien peu étanches et comment les échanges se font,
sans même que leurs auteurs sachent qu’ils se placent davantage dans
le transdisciplinaire qu’ils ne s’enferment dans la segmentation discipli-
naire. Dès lors, la diversité des usages, des significations et des angles
d’approche ne doit pas constituer des obstacles à la communication
entre les chercheurs.
Outre-Mers,T. 101, No 378-379 (2013)
26 f. pagney bénito-espinal, t. nicolas
Bibliographie complémentaire
Ardrey R., The Territorial Imperative, New-York, Atheneum, 1966.
Bonniol J.-L., « De la construction d’une mémoire historique aux figurations
de la traite et de l’esclavage dans l’espace public antillais », in Bonniol
Jean-Luc et Crivello Maryline (dir.), Façonner le passé. Représentations et
cultures de l’histoire (XVIe-XXIe siècle), Aix-en-Provence, Presses de l’Univer-
sité de Provence, 2004.
Chivallon C., « Rendre visible l’esclavage aux Antilles françaises (Marti-
nique) : muséographie et lieux de mémoire ou les hiatus d’une mémoire
difficile à énoncer », L’homme, no 180, 2006-4, p. 7-41.
Debarbieux B., Vanier M. (dir,), Ces territorialités qui se dessinent, L’Aube,
2002.
Di Méo G., Géographie sociale et territoires, Paris, Nathan Université, 1998.
Elissalde B., « Une géographie des territoires », L’Information géographique,
no 3, 2002, p. 193-205.
Garcia P., « Les lieux de mémoire : une poétique de la mémoire ? », Espaces-
Temps, no 74/75, 2000, p. 122-142.
Gumuchian H., De l’espace au territoire, représentations spatiales et aménagement,
Grenoble Université de Grenoble I, 1988.
Moine A., Le territoire : comment observer un système complexe, Paris, L’Harmat-
tan, 2007.
Nora P. (dir.), 1984-1992, Les lieux de mémoire, Gallimard, Paris.
Saez J.-P., Identités, cultures et territoires, Paris, Desclée de Brouwer, 1995.
Thual F., Le désir de territoires, Paris, Ellipses, 1999.
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Langues Du Saint EspritDocument28 pagesLes Langues Du Saint EspritjuniorPas encore d'évaluation
- Thse Kouba A SalahDocument386 pagesThse Kouba A SalahJodel PierrePas encore d'évaluation
- Termes de Référence Pour Atelier de Validation Startégie PFNL Mali March 2016Document7 pagesTermes de Référence Pour Atelier de Validation Startégie PFNL Mali March 2016Jodel PierrePas encore d'évaluation
- BOMPAS Elise - Réflexion Autour Du Travail de Groupe Et de La CréativitéDocument46 pagesBOMPAS Elise - Réflexion Autour Du Travail de Groupe Et de La CréativitéJodel PierrePas encore d'évaluation
- 2015 Guide Aide Constitution Dossier Pro GPXDocument8 pages2015 Guide Aide Constitution Dossier Pro GPXJodel PierrePas encore d'évaluation
- Memoire MaatoukDocument68 pagesMemoire MaatoukJodel PierrePas encore d'évaluation
- Conf1 JGP1Document17 pagesConf1 JGP1Jodel PierrePas encore d'évaluation
- Activité 3 Évaluée Histoire GéographieDocument2 pagesActivité 3 Évaluée Histoire GéographieSajeevan ThamilmaranPas encore d'évaluation
- Honneur Foi CroyanceDocument12 pagesHonneur Foi CroyanceSergi BouzoPas encore d'évaluation
- Ansart - Histoire Sociologie MoraleDocument30 pagesAnsart - Histoire Sociologie MoralejosiannefcPas encore d'évaluation
- These Du PR Rawane Mbaye Vol 1 Tome 1 3Document411 pagesThese Du PR Rawane Mbaye Vol 1 Tome 1 3Mamadou MbenguePas encore d'évaluation
- GUIDE Pédagogique de L'université de Strasbourg - 2016-2017Document132 pagesGUIDE Pédagogique de L'université de Strasbourg - 2016-2017Emmanuel SalanskisPas encore d'évaluation
- Point Zéro PDFDocument51 pagesPoint Zéro PDFNémuel BacoulPas encore d'évaluation
- Dissertation LescautDocument4 pagesDissertation LescautDan PirauPas encore d'évaluation
- Littérature ComparéeDocument3 pagesLittérature ComparéeNadia El Hnaoui100% (1)
- Écrits Sur Laliénation Et La Liberté 2018Document829 pagesÉcrits Sur Laliénation Et La Liberté 2018mehdi berPas encore d'évaluation
- Comp-1 1 ADocument2 pagesComp-1 1 APaul KOMANOPas encore d'évaluation
- La Pensee ChinoiseDocument445 pagesLa Pensee Chinoiseyields100% (1)
- Article La Mission Dans La Bible OperationsauvetageDocument6 pagesArticle La Mission Dans La Bible OperationsauvetageDestica NguittaPas encore d'évaluation
- LEFEBVRE, Henri. Du Contrat de CitoyennetéDocument40 pagesLEFEBVRE, Henri. Du Contrat de CitoyennetéClara CirqueiraPas encore d'évaluation
- 03 Fiche Pedagogique Raconter Une Scene Depuis Un Point de Vue Different B1 AlexakisDocument13 pages03 Fiche Pedagogique Raconter Une Scene Depuis Un Point de Vue Different B1 AlexakisKahina Agouillal MeftoutPas encore d'évaluation
- MARCEL GAUCHET - La Religion Dans La DémocratieDocument174 pagesMARCEL GAUCHET - La Religion Dans La DémocratieMohamed Ayari100% (1)
- FukuyamaDocument3 pagesFukuyamaamine tohmePas encore d'évaluation
- Dom Antoine Joseph Pernety - Les Fables Égyptiennes Vol.2Document319 pagesDom Antoine Joseph Pernety - Les Fables Égyptiennes Vol.2Almuric59Pas encore d'évaluation
- PDF Etude D Exemple Le Chemin de FerDocument29 pagesPDF Etude D Exemple Le Chemin de FerMRS 2Pas encore d'évaluation
- Tzvetan Todorov Les Categories Du Recit LitteraireDocument27 pagesTzvetan Todorov Les Categories Du Recit LitteraireHossam EddinPas encore d'évaluation
- Le Coran, Enquête Sur Un Livre SacréDocument10 pagesLe Coran, Enquête Sur Un Livre Sacrérayane ouzmihPas encore d'évaluation
- Regards Sur La Société Africaine - Ki ZerboDocument206 pagesRegards Sur La Société Africaine - Ki ZerboismaelPas encore d'évaluation
- Histoire Des Sciences CM L2Document49 pagesHistoire Des Sciences CM L2fofanasibiri49Pas encore d'évaluation
- Foucault - Sur L'archéologie Des Sciences. Réponse Au Cercle D'épistémologie (Dits Et Écrits I, Gallimard, 1994)Document32 pagesFoucault - Sur L'archéologie Des Sciences. Réponse Au Cercle D'épistémologie (Dits Et Écrits I, Gallimard, 1994)kairoticPas encore d'évaluation
- 1 PB Revue InterdisciplinaireDocument14 pages1 PB Revue InterdisciplinaireSamia RahmaniPas encore d'évaluation
- 26 01 08francais LIR Et ECR Le Schema NarratifDocument17 pages26 01 08francais LIR Et ECR Le Schema Narratifxqe2003Pas encore d'évaluation
- Colonisation Développement Aide Humanitaire Pour Une Anthropologie de L'aide Internationale PDFDocument12 pagesColonisation Développement Aide Humanitaire Pour Une Anthropologie de L'aide Internationale PDFPaolo GodoyPas encore d'évaluation
- Cours de L'histoire de L'art Figurer La "Nature"Document112 pagesCours de L'histoire de L'art Figurer La "Nature"Elodie RèsPas encore d'évaluation
- Les Questions Campus FrancedocxDocument4 pagesLes Questions Campus FrancedocxkajbkjPas encore d'évaluation
- Observation ExempleDocument48 pagesObservation ExempleInes MeddahPas encore d'évaluation