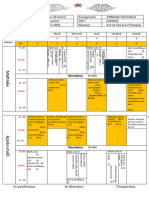Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Guide Pratique Du Mentoring
Guide Pratique Du Mentoring
Transféré par
EL KANDOUSSI KM0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
8 vues7 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
8 vues7 pagesGuide Pratique Du Mentoring
Guide Pratique Du Mentoring
Transféré par
EL KANDOUSSI KMDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 7
Introduction 1
I n t r o d u c t i o n
D’où vient le mentoring ?
Le terme « mentorat » s’inspire de la mythologie grecque. Au
moment de partir en guerre pour le siège de Troie, Ulysse, roi
d’Ithaque, demanda à son ami, Mentor, de prendre soin de son
fils, Télémaque, et de devenir son enseignant, conseiller, gar-
dien et ami. Dès son origine, le mentor personnifie une figure
plurielle et complète. Pédagogue, il a un rôle éducatif dans la
transmission des valeurs et de la connaissance. Formateur, il
partage son expérience et son analyse des situations pour éclai-
rer les parcours des « mentorés » qu’il accompagne. Conseillers
politiques, stratèges, éducateurs d’exception, figures inspira-
trices, avec ou sans titre officiel, les mentors ont toujours existé.
Philippe II de Macédoine confia l’éducation de son fils
Alexandre le Grand au philosophe Aristote. Sénèque fut le
précepteur et le conseiller de Néron. Au-delà de ces deux
couples célèbres de mentors et mentorés, le personnage du
mentor évoque une posture particulière dans l’écoute et incarne
une présence bienveillante sans enjeu hiérarchique. Il transmet
à la fois des savoir-faire concrets et des savoir-être. Il donne des
orientations sur le comportement et sur les actions à mener.
Le mentoring aujourd’hui
Au 20e siècle, le mentoring émerge sous la forme de pro-
grammes de tutorat se définissant par une méthodologie
© 2014 Pearson France – Guide pratique du mentoring – Gisèle Szczyglak
2 Guide pratique du mentoring
d’apprentissage active. Cette pédagogie unique a pour objec-
tifs l’acquisition, le développement et la transmission de com-
pétences. C’est dans les années 1970, dans les pays anglo-saxons,
que cette pratique se formalise au sein des universités améri-
caines, des écoles, des associations et des entreprises. Le men-
toring se stabilise ensuite dans les années 1980 pour croître
fortement dans la seconde moitié des années 1990. Le men-
toring contribue avec succès, depuis son émergence, à l’amé-
lioration des performances des individus et des organisations
et inscrit ses bénéfices dans une logique de longue-terme1.
Au 21e siècle, les trois quarts des plus grandes organisations
américaines ont instauré des programmes de mentoring. En
France, des grands groupes s’y intéressent de plus en plus. Au
cours des années 2000, Total, Sodexo, Carrefour, AXA, GDF
Suez, EDF, Société Générale, Crédit Agricole, Bouygues Télé-
com, Coca Cola, Les Galeries Lafayette, L’Oréal, Saint-Gobain,
BNP Paribas, Pernod Ricard, Groupe BPCE, Peugeot Citroën,
Areva, Veolia, Sanofi Aventis Groupe, France Télécom,
Orange, Auchan, Renault, Vivendi, SNCF, Generali France,
Lafarge, Schneider Electric ont implanté des programmes de
mentoring. Les réseaux professionnels, les business schools et
les institutions s’intéressent à cette forme unique d’empower-
ment des individus et des organisations. Les entrepreneurs et
les chefs d’entreprise établis mettent en place des programmes
de mentoring. Inspirée par le modèle canadien, la chambre
de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) a fondé, en 2008,
l’institut du mentorat entrepreneurial (IME) pour accompa-
gner la croissance des entreprises. Les réseaux professionnels
externes de femmes, comme EPWN, offrent à leurs adhérentes
des programmes de mentoring pro bono. Les réseaux internes
d’entreprises ajoutent le mentoring à leurs agendas. Des fon-
1. Pierre Angel et Dominique Cancellieri-Decroze, Du coaching au mentoring,
Paris, Armand Colin, 2011.
© 2014 Pearson France – Guide pratique du mentoring – Gisèle Szczyglak
Introduction 3
dations proposent du mentoring solidaire comme c’est le cas
de la Cherie Blair Foundation for Women (CBFW).
Pourquoi un tel engouement pour
les programmes de mentoring ?
Le mentoring se présente aujourd’hui comme un programme
d’accompagnement professionnel et personnel qui favorise
qualitativement et durablement la montée en compétences,
le transfert d’expertises, de savoirs, le partage d’expériences
et la coopération. Le mentoring a pour objet l’évolution des
carrières, les relations professionnelles, les problématiques
organisationnelles et managériales. Il apporte des solutions,
et aborde les enjeux et les problématiques liés à la transver-
salité : la gestion de la diversité, la communication intercul-
turelle, la coopération intergénérationnelle, la connaissance
intermétiers. Le mentoring accélère la compréhension des
environnements professionnels et des cultures internes. Il
contribue à une meilleure adaptation des individus aux
contraintes et aux challenges des organisations en permettant,
aux mentors et aux mentorés, de mutualiser expériences et
solutions pour trouver des réponses adaptées aux probléma-
tiques rencontrées sur le terrain.
À qui s’adresse le mentoring ?
Le mentoring s’adresse aux entreprises, aux organisations et
aux institutions qui cherchent des réponses innovantes aux
impératifs économiques de nos sociétés et aux mutations à
l’œuvre dans le monde du travail : la compétitivité, la coopé-
ration, le travail en réseau, en mode transverse, le développe-
ment du potentiel humain, l’évolution qualitative de
l’employabilité, l’engagement et la fidélisation des collabora-
© 2014 Pearson France – Guide pratique du mentoring – Gisèle Szczyglak
4 Guide pratique du mentoring
teurs. Dans un monde global dont le changement est la
constance, le mentoring joue un rôle majeur pour accompa-
gner les transitions requises.
Proposer des programmes de mentoring à leurs salariés,
c’est aussi, pour les organisations, nourrir la marque employeur
en valorisant une méthode qui favorise la liberté des échanges,
promeut la confiance, la transmission, la coopération et aug-
mente la performance. Un tel dispositif contribue à créer des
environnements de travail producteurs de bien-être selon les
critères établis par l’institut Great Place to Work®.
Le mentoring est destiné aux dirigeants, aux directions
RH, à l’ensemble des acteurs décisionnaires et stratégiques
des organisations qui ont la volonté et le désir d’instaurer des
pratiques d’accompagnement innovantes, efficaces et durables.
Il concerne les cadres et les salariés en quête de dispositifs
uniques basés sur la transmission et la coopération pour
atteindre leurs objectifs et répondre avec efficacité aux exi-
gences de leurs organisations.
Véritable booster de carrière et outil de développement
personnel, le mentoring est une démarche positive d’em-
powerment des personnes et des organisations qui repose sur
une méthodologie précise que nous vous présenterons dans ce
livre.
Deux méthodologies majeures du mentoring
Le mentoring individuel
La forme de mentoring la plus courante, depuis la formalisa-
tion des premiers programmes au 20e siècle, est le mentoring
individuel.
Le mentoring individuel s’articule autour de la création de
paires, ou binômes, qui réunissent un mentor et un mentoré.
Le point de départ de cette relation est l’établissement des
objectifs proposés par le mentoré à son mentor. Mentors et
© 2014 Pearson France – Guide pratique du mentoring – Gisèle Szczyglak
Introduction 5
mentorés clarifient ensemble la formalisation de ces objectifs
à travers leurs premiers échanges et le déploiement d’un plan
d’action dans la durée. Chaque rencontre ou échange est l’oc-
casion d’avancer de concert sur l’atteinte des objectifs et la
totalité des points abordés par le mentoré avec son mentor au
sein d’un programme qui dure, en moyenne, entre six et dix-
huit mois.
La relation de mentoring est à la fois challengeante, bien-
veillante et créatrice pour le mentor et le mentoré. Une
méthodologie précise organise, cadre les échanges et rythme
l’ensemble de l’agenda. Un accompagnement structurant est
délivré à la fois par des référents internes et externes.
Le mentoring individuel développe une relation unique de
confiance, sans enjeu hiérarchique, tout en étant ancrée à
l’intérieur d’un périmètre professionnel. L’engagement réci-
proque du mentor et du mentoré dans la relation, la liberté
des échanges et le partage authentique des expériences, l’enri-
chissement de chacun sont les facteurs clés de la réussite de
ce programme et contribuent à sa forte attractivité.
Comment se fait la sélection des mentors et des mentorés ?
Qui crée les paires ? Qu’est-ce que la relation mentorale ? Quel
processus de mentoring suivent les mentors et les mentorés ?
Comment se construit un tel programme ? Nous répondrons
à ces questions dans les deux premières parties du livre.
Le mentoring collectif
La seconde forme majeure de mentoring, plus rare et très
innovante, est le mentoring collectif.
Unique sur le marché actuel en France, le mentoring col-
lectif se déroule sous la forme de sessions réunissant des
groupes constitués de mentors et de mentorés. En amont de
celles-ci, les mentorés proposent un thème précis dont les
problématiques abordées sont traitées par plusieurs mentors
au cours de la séance de mentoring collectif. Cette approche
© 2014 Pearson France – Guide pratique du mentoring – Gisèle Szczyglak
6 Guide pratique du mentoring
accroît considérablement la richesse des solutions trouvées et
rend les sessions immédiatement utiles et efficaces.
Le mentoring collectif est un instrument puissant de capi-
talisation de l’intelligence collective qui accélère et amplifie
l’apprentissage, la transmission des connaissances et des pra-
tiques.
Comment choisir les sujets ? Comment constituer les
groupes et animer les sessions de mentoring collectif ? Nous
répondrons à ces questions dans la troisième partie de ce livre.
Vers plus de transversalité : le cross-mentoring
et le mentoring 2.0
Le mentoring continue son évolution en proposant de nou-
veaux formats d’empowerment des personnes et des organi-
sations. Des programmes de cross-mentoring voient le jour :
en interne, entre plusieurs entités d’une même organisation
ou, en externe, entre différentes compagnies. Assimilation
des valeurs d’un groupe au-delà du multiculturalisme des
entités, amélioration de la communication, mutualisation
des best practices, régulation des modes de travail en réseau,
nouvelles façons de rechercher des clients et des partenaires
ou de faire du benchmark, le mentoring se situe au cœur de
l’innovation.
À l’ère des réseaux sociaux, avec l’émergence continue des
environnements numériques, le mentoring 2.0 fait son appa-
rition. Des plates-formes de mentoring se développent, encou-
rageant la multiplicité des échanges, une plus grande
globalisation des ressources entre mentors et mentorés, le
partage d’expériences et de solutions. Ce dispositif technolo-
gique impulse la création de communautés virtuelles réunies
autour du partage d’une même pratique professionnelle. La
gestion des agendas et la disponibilité des participants s’en
trouvent facilitées. Les participants ont la possibilité de pro-
© 2014 Pearson France – Guide pratique du mentoring – Gisèle Szczyglak
Introduction 7
longer les bénéfices de cette expérience dans une perspective
de long terme. Le mentoring communautaire est né.
Nous vous proposons d’aborder le cross-mentoring et
l’e‑mentoring dans ce livre. Dans ce guide pratique, vous
trouverez une description du déroulement et des enjeux des
différents parcours de mentoring, des étapes clés des pro-
grammes, des conseils, des exemples de situations, des fiches
pratiques de suivi et d’évaluation, ainsi que des témoignages
de participants.
© 2014 Pearson France – Guide pratique du mentoring – Gisèle Szczyglak
Vous aimerez peut-être aussi
- Banque de ProjetsDocument48 pagesBanque de ProjetsAmi BennounaPas encore d'évaluation
- 2014 09 SC Strategie Achat v07 Construire Plan StrategiqueDocument120 pages2014 09 SC Strategie Achat v07 Construire Plan StrategiqueAmi BennounaPas encore d'évaluation
- Cas IAM Maroc TélécomDocument37 pagesCas IAM Maroc TélécomMohamedHamousti50% (8)
- Brochure BTP PDFDocument7 pagesBrochure BTP PDFAmi BennounaPas encore d'évaluation
- Implantation D'églises - 7 ÉtapesDocument24 pagesImplantation D'églises - 7 ÉtapesOladele J. IGBOHOU100% (1)
- Le PapayerDocument129 pagesLe PapayerJean Bernard MboliPas encore d'évaluation
- Cours D'assurance - LP Bfa FasegDocument149 pagesCours D'assurance - LP Bfa FasegTayéwo Efr100% (1)
- TP 5 Les AttaquechimiqueDocument5 pagesTP 5 Les AttaquechimiqueNasro OuahabPas encore d'évaluation
- Strategie DecathlonDocument18 pagesStrategie DecathlonAmi BennounaPas encore d'évaluation
- TDR Consultants Soft SkillsDocument2 pagesTDR Consultants Soft SkillsAmi BennounaPas encore d'évaluation
- Apercu Sur Evolution Du Froid Industriel Au MarocDocument4 pagesApercu Sur Evolution Du Froid Industriel Au MarocAmi Bennouna100% (1)
- Outils 6 Et 7 EMOFF Et PACDocument7 pagesOutils 6 Et 7 EMOFF Et PACAmi BennounaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Definition Et ProblematiqueDocument45 pagesChapitre 1 - Definition Et ProblematiqueAmi BennounaPas encore d'évaluation
- Visite STEF-TFE Givors 20110407Document10 pagesVisite STEF-TFE Givors 20110407Ami BennounaPas encore d'évaluation
- Etude de Positionnement de La Branche Entreposage Frigorifique. SynthèseDocument15 pagesEtude de Positionnement de La Branche Entreposage Frigorifique. SynthèseAmi Bennouna100% (1)
- Unité de Collecte Et de Conditionnement de Fruits Et LégumesDocument3 pagesUnité de Collecte Et de Conditionnement de Fruits Et LégumesAmi BennounaPas encore d'évaluation
- Dossier de Presse La Chaine Logistique Du FroidDocument4 pagesDossier de Presse La Chaine Logistique Du FroidAmi BennounaPas encore d'évaluation
- Chapitre 2: Diagnostic StratégiqueDocument59 pagesChapitre 2: Diagnostic StratégiqueAmi BennounaPas encore d'évaluation
- BPH3 Maitrise Du Stockage OkDocument2 pagesBPH3 Maitrise Du Stockage OkAmi BennounaPas encore d'évaluation
- Pde TerreDocument26 pagesPde TerreAmi BennounaPas encore d'évaluation
- 5458 Dabf 494 D 9Document12 pages5458 Dabf 494 D 9Ami BennounaPas encore d'évaluation
- Les Gourous de La Com' - Aurore Gorius & Michaël MoreauDocument304 pagesLes Gourous de La Com' - Aurore Gorius & Michaël MoreauNovembrePas encore d'évaluation
- Guide Santé ABYLSEN 2023Document12 pagesGuide Santé ABYLSEN 2023Ferid HentatiPas encore d'évaluation
- Méthodologie APC HISTOIREDocument8 pagesMéthodologie APC HISTOIREArmand Roger KWEDIPas encore d'évaluation
- 1 Chapitre 4 Barrages-VoutesDocument10 pages1 Chapitre 4 Barrages-VoutesFatima zahra BerakheliPas encore d'évaluation
- Discours Journalistique Et Positionnements Énonciatifs. Frontières Et DérivesDocument46 pagesDiscours Journalistique Et Positionnements Énonciatifs. Frontières Et DérivesOkba DjaberPas encore d'évaluation
- SFE FinalDocument19 pagesSFE FinalLeila FilaliPas encore d'évaluation
- XérostomieDocument8 pagesXérostomieelghachi98Pas encore d'évaluation
- Mon Emploi Du Temps Ennajah SouhailaDocument1 pageMon Emploi Du Temps Ennajah SouhailaennajahsouhailaPas encore d'évaluation
- Devis Plomberie SanitaireDocument4 pagesDevis Plomberie SanitaireBarro Ahmed EliePas encore d'évaluation
- Frigider IndesitDocument60 pagesFrigider IndesitmandymcsPas encore d'évaluation
- 21 Diarrhee Chronique 01Document37 pages21 Diarrhee Chronique 01Asma TurkiPas encore d'évaluation
- قسم الرياضيات والإعلام الآليDocument13 pagesقسم الرياضيات والإعلام الآليSlimaniAhmedPas encore d'évaluation
- MERIS Formation Methodes D Analyse Merise PDFDocument2 pagesMERIS Formation Methodes D Analyse Merise PDFCertyouFormationPas encore d'évaluation
- Devoir Français Nouvelle Romain GaryDocument4 pagesDevoir Français Nouvelle Romain GaryZerka StarsPas encore d'évaluation
- Examen de Fin de Formation Commerce TSC 2015 Synthese 2Document10 pagesExamen de Fin de Formation Commerce TSC 2015 Synthese 2brahim brahimPas encore d'évaluation
- Bert Flint - Art Rural Du Maroc 2-ConvertiDocument16 pagesBert Flint - Art Rural Du Maroc 2-ConvertiHammadi HabadPas encore d'évaluation
- FiclpopanDocument2 pagesFiclpopanSofiPas encore d'évaluation
- Cryptage Mails en Local Sous LinuxDocument18 pagesCryptage Mails en Local Sous LinuxndarndarPas encore d'évaluation
- Exposé BertozziDocument19 pagesExposé BertozziEbig50Pas encore d'évaluation
- 011l02310723v7n3 o Dembele Et Al. Gestion Dossier PatientDocument21 pages011l02310723v7n3 o Dembele Et Al. Gestion Dossier PatientAbdou Moumouni ArafatPas encore d'évaluation
- Compte-Rendu AG Communauté de Communes D'avranches - 22/12/2012Document12 pagesCompte-Rendu AG Communauté de Communes D'avranches - 22/12/2012avranches.infosPas encore d'évaluation
- Slide Year 9 Speaking May 22Document2 pagesSlide Year 9 Speaking May 22ehsanlooyiPas encore d'évaluation
- PC Emission Des Bips Au DémarrageDocument2 pagesPC Emission Des Bips Au DémarrageworkfreelyPas encore d'évaluation
- Formation VHDL FPGA Cours 5Document103 pagesFormation VHDL FPGA Cours 5Bouhafs AbdelkaderPas encore d'évaluation
- Comment Interpréter La Capacité D'autofinancementDocument1 pageComment Interpréter La Capacité D'autofinancementnada chiboubPas encore d'évaluation