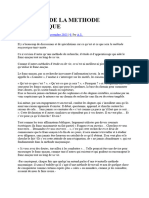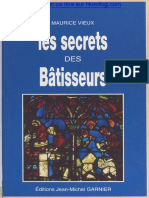Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Maçon Face Au Symbole
Le Maçon Face Au Symbole
Transféré par
Valérie Hombert-scohierTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Maçon Face Au Symbole
Le Maçon Face Au Symbole
Transféré par
Valérie Hombert-scohierDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le maçon face au symbole
Dominique Jardin
Dans La chaîne d'union 2019/4 (N° 90) , pages 41 à 55
Éditions Grand Orient de France
ISSN 0292-8000
DOI 10.3917/cdu.090.0041
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Article disponible en ligne à l’adresse
https://www.cairn.info/revue-la-chaine-d-union-2019-4-page-41.htm
Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s’abonner...
Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.
Distribution électronique Cairn.info pour Grand Orient de France.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le
cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est
précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Le GODF a-t-il vraiment le sens de son histoire ?
DOSSIER
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Aquarelle,
le recipiendaire,
circa 1760
cdu-n90-INT-BAT.indd 40 22/10/2019 09:29
DOSSIER
PENSER LE SYMBOLE
le maçon
face au sYmBole
Par doMinique Jardin
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
« Les francs-maçons se font du symbolisme une idée très vague
et ils appellent symbolisme le vague même de cette idée »1.
[ 41 ]
L a notion de symbole et la pratique du symbolisme sont chères à tous
les maçons qui en font une boite noire consensuelle. Par définition et
étymologiquement le symbole réunit. Cependant la notion même de symbole
est ambigüe et particulièrement en maçonnerie. Si on l’approfondit, on
s’aperçoit que son interprétation clive autant qu’elle rassemble car il y a
plusieurs manières, parfois antinomiques, de considérer les symboles et le
symbolisme selon l’importance que l’on attribue à la démarche initiatique.
Le symbole est constitutif de cette culture symbolique et initiatique,
certes plus ou moins approfondie et appropriée, mais indispensable au
vécu maçonnique.
LES DÉFINITIONS ET LES GLISSEMENTS DE SIGNIFICATION DU
MOT SYMBOLE
L’origine du symbole ; réunir les hommes
Le sumbolon grec est un signe de reconnaissance entre deux individus
puisque les deux moitiés réunies d’une monnaie ou d’un tesson de poterie
permettent à leurs possesseurs de se reconnaître. Cette reconnaissance est
essentielle en maçonnerie « Mes frères me reconnaissent comme tel » et
repose sur un consensus : le rituel concrétise cette reconnaissance. L’objet
symbolique concret par exemple un compas, selon sa position par rapport
à l’équerre ou l’angle de son ouverture, crée une cohésion de groupe car
1
Jean-Charles Nehr, Symbolisme et franc-maçonnerie, Edimaf, Paris, 1997, p. 11
qui utilise une citation de P. Valéry.
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 41 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
il s’inscrit dans une mise en système des symboles appelée symbolisme2.
Le symbole représente l’abstraction des lois de l’hospitalité que se doivent
les possesseurs des deux parties du sumbolon. « Le symbole, c’est ce qui
permet de rendre concrètement présent un lien abstrait, dont il est à la
fois la marque et la preuve »3, mais c’est aussi la représentation matérielle
d’une alliance immatérielle.
Le symbole comme accès au sacré
Le symbole glisse ensuite de signe de reconnaissance interhumain
au moyen d’accès au plan supra-humain. Le symbole permet de passer
du visible à l’intelligible et se retrouve être le lieu d’unité de ces deux
sphères en revêtant une dimension qui élève l’esprit du sensible au sacré
et éventuellement au divin4. Le sacré, dans la rigueur du terme et considéré
comme notion historique, est définit par M. Gauchet comme :
« conjonction tangible du visible et de l’invisible, de l’ici-bas et
de l’au-delà, il naît avec le tournant capital de l’histoire religieuse de
l’humanité que marque le surgissement de l’État... Le sacré émerge avec la
conjonction du fondement (qui devient divin dans l’opération) et du pouvoir
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
qui sera désormais séparé. Il y a sacré quand il y a rencontre matérielle
entre la nature et la sur-nature [...] Le sacré est l’attestation de l’au-delà
dans les lieux, des choses ou des êtres de l‘ici-bas »5 .
[ 42 ]
Le symbolisme a ses limites, différenciées pour chacun des systèmes
symboliques : les symbolismes religieux, maçonnique,... qui peuvent (ou
non) établir de nouvelles correspondances entre eux ou se fixer des champs
d’application, comme les Landmarks6.
« Symboliser c’est produire des signes qui font sens » affirme
M. Godelier7. Dès les Pères de l’Église la symbolique est conçue comme
le seul moyen d’accès aux objets qui échappent à la raison.
2
« Un symbole a cours dans une culture donnée comme une monnaie... l’action
symbolique se dessine sur le fond d’un consensus qui la rend opérante... le
consensus soumis à un certain nombre de conditions symboliques est ici le véritable
moteur de cette efficacité » F. A. Isambert, « Rite et efficacité symbolique », cité
in Dictionnaire culturel en langue française sous la direction d’Alain Rey, 4 vol.,
T. 4, p. 1144.
3
Dictionnaire culturel en langue française sous la direction d’Alain Rey, 4 vol.,
T. 4, p. 1142. L’ouvrage consacre une douzaine de pages au symbole et au
symbolisme.
4
« Il est ce qui, trouvé ou créé par l’homme, fait signe vers une entité qui
n’intervient jamais physiquement (idée, figure divine, imaginaire, etc.). D’autre
part, à l’objet séparé (sumbolon) se substitue un objet unique, élément matériel
et incomplet d’un doublet qui ne pourra jamais être complété du fait de la nature
introuvable de l’élément manquant » Ibid. Voir par exemple R. Guénon, Symboles
fondamentaux de la science sacrée.
5
L. Ferry et M. Gauchet, Le religieux après le religieux, Grasset, Collection
Le collège de philosophie, Paris 2004, p. 65.
6
Un landmark est une limite, ou un repère maçonnique, lié aux « Anciens Devoirs ».
7
M. Godelier, L’imaginé, l’imaginaire & le symbolique, CNRS éditions, 2015, p. 59.
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 42 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
« L’imaginaire religieux produit une véritable mutation dans la
nature des symboles. Les symboles religieux ne sont plus seulement des
réalités matérielles culturellement fabriquées par les humains et choisies
pour signifier la divinité et communiquer avec elle. Ils sont transformés
par la Divinité elle-même en moyen pour elle de communiquer avec les
humains et d’agir sur eux de l’intérieur... Or ce sens émanant de Dieu ou
des dieux il faut y croire pour le recevoir »8.
Puis à la Renaissance, une étude des images symboliques, comme
les allégories et les emblèmes se met en place, à laquelle emprunte la
maçonnerie dès les XVIIe et XVIIIe siècles, pour construire petit à petit
et par emprunts successifs, son propre corpus symbolique. La difficulté
est que ses rituels, prétendumment intemporels, ne donnent pas leurs
sources qui doivent être identifiées par les historiens !
Les conflits d’interprétation
Le symbole est objet qui évoque une association d’idées, une
analogie9 avec quelque chose d’abstrait ou d’absent. Ferdinand de Saussure
opposait symbole (signification ouverte, ambivalente ou plastique) et
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
signe (arbitraire). Pourtant la notion de symbole interfère avec celle de
signe comme outil de communication. Si le symbole permet d’accéder
à une identité absente ou cachée, il peut être déchiffré et interprété.
L’interprétation des symboles correspond à l’herméneutique. Le symbole [ 43 ]
est donc sujet aux conflits d’interprétation qui se cristallisent souvent sur
la « quête de l’origine » ; et en maçonnerie, comme ailleurs, qui détient
l’origine détient le pouvoir !
La notion de symbole est ambigüe et particulièment en maçonnerie.
Si on l’approfondit, son interprétation clive autant qu’elle rassemble car
il y a plusieurs manières de considérer les symboles et le symbolisme.
Derrière ces mots se dissimulent alors des enjeux idéologiques, rituelliques
voire des manières différenciées de concevoir la maçonnerie. En fait, soit
le symbole permet simplement de communiquer entre les hommes, soit
il permet de se « brancher » sur le sacré.
Certains essentialisent ce sacré sous la forme de Tradition avec un T
majuscule, elle même remontant au divin. Mais la question est redoublée
par celle du sacré : soit le sacré (divin) et l’essence des choses sont au
bout du symbole qui permet d’y accéder (essentialisme), soit le maçon
produit, au moyen du symbole et du rituel, ce sacré qui reste humain
dans l’opération (constructivisme). J’aurais tendance à soutenir que la
8
M. Godelier, L’imaginé, l’imaginaire & le symbolique, CNRS éditions, 2015, pp.
177-178.
9
La pensée analogique s’est développée de l’Antiquité à la Renaissance : toutes
les parties du monde sont distinctes et singulières. Pour les rendre pensables
malgré leur très grand nombre, il faut les relier par un réseau de correspondances
qui reposent sur l’analogie, ainsi il y a correspondance entre le macrocosme et
le microcosme etc. voir P. Descola, La fabrique des images, visions du monde et
formes de la représentation, Somogy Éditions d’Art, Paris, 2010.
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 43 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
démarche maçonnique permet au maçon de construire (c’est un bâtisseur)
son essentialisme (c’est à dire son rapport au sacré à partir d’emprunts
symboliques) à travers sa quête du sens.
Pour résumer, on peut distinguer deux grands types d’approches
• Une approche herméneutique, cherchante, spiritualiste,
traditionnaliste... essentialiste10. Le symbole est l’objet d’une
méditation ou d’une approche poétique qui transcende la temporalité
dans laquelle il s’inscrit. Il est an-historique, méta-historique ou
archétypal.
• Une approche historienne, chercheuse, matérialiste, progressiste...
constructiviste11. Cette attitude cherche à proposer les explications
qui livrent les significations des symboles. Elles sont sourcées
par des documents précis dont la datation et la mise en contexte
permettent des interprétations argumentées et rationnelles.
Ces deux approches cohabitent parfois avec difficulté et le
symbolisme qui « explique l’obscur par le ténébreux »12 peut être qualifié
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
de symbolâtrie par les tenants de la deuxième approche13. Au contraire
les tenants du symbolisme considéré comme la grammaire essentielle
au vécu maçonnique, se veulent les détenteurs des clefs initiatiques de
[ 44 ] l’Ordre transmises par les voies les plus régulières qui s’opposent parfois
aux canaux les plus historiques.
Mais négliger la dimension symbolique de la maçonnerie, c’est se
couper de la compréhension du patrimoine maçonnique. De même qu’il
existe une histoire laïque des religions, il peut et doit exister une histoire de
la méta-histoire symbolique des rituels. C. Porset reste fidèle à la première
partie de la définition du symbolisme qui induit un sens restreint : « Il est
clair que le symbolisme n’est qu’un lien, un liant qui permet aux maçons
de se reconnaître entre eux, ni plus, ni moins ». De son côté, J-C. Nehr
qui étudie finement les impasses du symbolisme conçu comme contenu
essentialiste, relève de manière positive :
« le rôle fondamental, exceptionnel du symbolisme [ comme outil ]
dans l’histoire de la Franc-Maçonnerie et dans le travail du Franc-maçon [ ... ]
Seul le respect des symboles et du rituel permet au Franc-maçon, par le
contenu qu’ils sous-tendent, de se libérer, de se construire et de bâtir, en
se créant continuellement. 14»
10
« Survivance d’une science sacré immémoriale, le symbole échappe à toute
explication cartésienne. Il se réfère à l’essence... » J.-J. Gabut, « Les fondements
symboliques de la franc-maçonnerie » in J.-L. Maxence, sous la direction de, La
Franc-Maçonnerie, histoire et Dictionnaire, R. Laffont, coll. Bouquins, p. 655.
11
D. Jardin, La tradition des Francs-Maçons, histoire et transmission initiatique,
Dervy, 2014.
12
C. Porset.
13
J.-C. Nehr, Symbolisme et franc-maçonnerie, A l’Orient, Paris.
14
ibid.
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 44 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
Les clivages relevés sont toutefois relatifs. On trouve des clivages
entre partisans du seul travail en loge bleue qui abriterait « tout » le
symbolisme et ceux des hauts grades. À l’intérieur de ces hauts grades on
retrouve les mêmes clichés que ceux véhiculés à propos des obédiences :
tel rite serait plus progressiste que tel autre plus spiritualiste dans
l’appropriation du symbolisme. Mais dans la pratique même du rite qui,
bien qu’il s’en défende toujours, ne cesse d’évoluer, ce même clivage
traverse en fait chaque maçon15.
Derrière ces différentes lectures des grades ou des rites se pose le
problème de qui dit la bonne interprétation : le maçon libre dans la loge
libre, le surveillant ?, le V.M. ?, le rituel ? mais lequel ? Celui, soit disant
immuable, qui n’arrête pas d’être relu c’est-à-dire modifié ? Les détenteurs
de tel haut grade, le Suprême Conseil de telle ou telle Juridiction ?
Définies ainsi par simplification méthodologique, ces deux approches
sont caricaturales et caricaturées. Elles semblent irréconciliables et
irréductibles alors qu’elles traversent, répétons-le, chaque maçon et se
complètent assez bien à condition de ne pas les mélanger. Dès lors les
historiens maçons doivent impérativement distinguer l’attitude cherchante
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
qui recherche la Connaissance par le sens (herméneutique), de celle
de l’historien chercheur, en recherche de connaissances au pluriel. Les
maçons sont capables d’être tour à tour historiens et herméneutes mais
auraient intérêt à ne pas confondre les genres, confusion dont sont [ 45 ]
coutumiers certains d’entre eux pour des raisons maçonniques précises
et pas toujours innocentes.
LE REGARD DE L’HISTORIEN : DU FEUILLETAGE DES SYMBOLES À LEUR
COMPRÉHENSION
L’historien doit rester modeste face aux symboles ! Cependant
l’histoire des interprétations des symboles, de la lecture et de la construction
des rituels, est une discipline passionnante et émancipatrice, à la fois
du salmigondis d’une certaine approche du symbolisme mais également
de la téléologie et du finalisme progressiste dont ont du mal à se départir
les plus « rationnels » des maçons16. Dans le champ maçonnique ces
interprétations ne sont jamais innocentes et conditionnent des rapports
de pouvoir et d’influence à l’intérieur même des structures maçonniques
et sur leurs positionnements respectifs.
Les objets symboliques ne sont pas tous sacrés et ne sont pas
sacrés en eux-mêmes : ils deviennent sacrés parce qu’on les sacralise
notamment par le rituel qui sert à produire du symbolique, voire du
sacré, selon un processus passionnant à étudier aux plans historique et
anthropologique. Il convient de traiter le contenu des textes des rituels
pas seulement comme symbolique (surtout s’il l’est) mais aussi comme
15
Les analyses de C. Rosset ont montré la difficulté à se déprendre de la recherche
du sens qui est derrière toute démarche symbolique.
16
C. Rosset, Le Réel, Traité de l’idiotie, Les Éditions de Minuit, Paris, 1985, pp.
52-66 cf. les figures de « l’inguérissable » et de « l’illusionniste ».
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 45 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
le résultat d’une mise en système de symboles dont il faut identifier les
mécanismes. Il s’agit donc de dévoiler un feuilletage de significations.
Chaque symbole doit faire l’objet de la plus grande attention car différents
grades « emboitent » ces significations ou les juxtaposent.
Illustrons ce feuilletage des significations symboliques par trois exemples.
L’exemple des colonnes à l’entrée du temple
Aux deux premiers grades, les colonnes J et B (ou B et J selon
les rites) représentent celles du temple de Salomon (Fig. 1). Elles sont
attribuées aux grades d’apprenti et de compagnon à qui on dévoile leur
signification symbolique. Ces colonnes déterminent aussi la place des
maçons en tablier blanc dans le temple maçonnique « sur les colonnes »
du nord et du sud.
Dans les grades Écossais, ces colonnes sont croisées et à leur jonction,
repose une pierre sur laquelle s’entrelaçent des cercles et des carrés qui
portent la lettre J dont la signication est très différente de celle de la
colonne J puisqu’il s’agit de l’ancien mot des maîtres qui anime la Création
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
(Fig. 2, Maître Parfait, futur cinquième grade du REAA).
Puis dans le grade de Maître Écossais, les colonnes sont brisées
[ 46 ] et elles symbolisent la destruction du temple (Fig. 3).
Dans d’autres grades, liés au noachisme, les colonnes, rouge et
blanche comme dans le grand temple parisien de la Fédération française
du Droit Humain, symbolisent les colonnes de Seth ou d’Hermès qui
anté-diluviennes, abritent les secrets de la Création. Cette interprétation
est présente dès le manuscrit Cooke de 1430 puis au grade de compagnon
dans le rituel du Parfait Maçon (1744), sur celui des Chevaliers de l’Étoile
d’Orient de Jérusalem (Fig. 4) ou dans certains rituels de la Maçonnerie
d’adoption.
Dans le deuxième grade des Chevaliers de l’Étoile d’Orient de
Jérusalem, les deux colonnes ont une tout autre signification : à droite,
celle percée d’« étoiles » est la figure de « celle qui servait à conduire
les Rois mages à la Suprême Vérité , l’autre servait à cacher, durant le
jour, les Israélites de la vue des Égyptiens » (Fig. 5).
On voit bien que le même symbole des deux colonnes renvoie à
des significations très différentes qui se succèdent dans le même parcours
initiatique. Tous ces symboles construisent leurs propres correspondances
qui peuvent elles-mêmes alimenter d’autres considérations symboliques.
Certains vont s’indigner : comment peut-on dévoiler les secrets d’autres
grades ? Et en particulier de hauts grades ? Tout simplement parce que
ces significations qui se trouvent dans les premiers grades sont déjà
présents dans les manuscrits anciens des Old Charges et préexistent à
la légende d’Hiram qui remplace Noé dans le légendaire maçonnique :
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 46 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
les secrets noachites ont été expulsés de la maçonnerie bleue symbolique
jusqu’au vingt - et - unième grade du REAA : le Noachite ou Chevalier
Prussien. En revanche ce noachisme a été préservé dans les grades bleus
de la Maçonnerie d’adoption, ou féminine, telle qu’elle est encore pratiquée
de manière extraordinaire dans une loge de la GLFF (Cosmos). Les colonnes
brisées apparaissent dès le grade de maître dans le livre Les Francs-maçons
écrasés (1747) puis au dix-huitième grade du REAA ou au quatrième Ordre
du Rite Français. Présentes aussi dans les grades de Chevalier de l’Étoile
d’Orient, elles ont encore d’autres significations (Fig. 1,2,3,4 et 5).
Un exemple de « migration des symboles » : VITRIOL17
C. Porset, historien éminent, affirme que « VITRIOL n’est introduit
en maçonnerie que dans la seconde moitié du XIXe siècle »18. Au premier
grade on retrouve VITRIOL dès le « cabinet de réflexion » (Fig. 6) mais
VITRIOL a d’abord été dès le XVIIIe siècle un symbole clef du grade
de Chevalier du Soleil (futur vingt-huitième grade du REAA) lui-même
emprunté à la littérature alchimique des XVIe et XVIIe siècles (Fig. 7 et 8).
On constate donc la nécessité de « remonter aux sources » des symboles
pour en saisir la signification.
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Le symbole de la croix
Prenons comme troisième et dernier exemple le symbole de la croix [ 47 ]
qui peut se conjuguer de manière très différente en maçonnerie (Fig. 8 et 9).
On trouve en effet beaucoup de croix en maçonnerie et celles du grade
de Chevalier Rose-Croix ont connoté le grade de multiples interprétations.
Ainsi l’interprétation chrétienne (Fig. 10) et l’interprétation alchimique
(Fig. 11). Les choses se compliquent lorsque qu’il s’agit de déterminer
laquelle est la première, donc « la bonne »... Les historiens savent bien que
la première est la version chrétienne du grade mais au XIXe siècle Ragon
de Bettignies introduit un rituel de Rose-Croix hermétique. Il accuse les
jésuites d’avoir infiltré les Rose-Croix puis de les avoir christianisés alors
que, selon lui, les Rose-Croix d’origine étaient hermétiques, tandis que c’est
lui - Ragon - qui plaque de l’hermétisme sur le 18e grade. Au XXe siècle,
A. Doré, pourtant peu suspect de négligence, verra lui aussi une origine
alchimique au grade de Rose-Croix en le confondant le Chevalier R+ de
l’Aigle Noir19.
DE L’UTILITÉ DES SYMBOLES ET DU SYMBOLISME
Le maçon qui devient Vénérable Maître, Sublime Prince, Sublime
Écossais, Sublime Chevalier etc. muni de tous les décors afférents, peut
considérer ces titres et ces décors comme de vains déguisements mais il
peut aussi prendre au sérieux ce théatre et sa mise en scène. À la fin de
17
L’expression provient du titre français de l’ouvrage de Rudolf Wittkower Allegory
and the Migration of Symbols, Thames & Hudson, 1992 pour la traduction française.
18
C. Porset, « Du bon usage du symbolisme », postface à J.-C. Nehr, p. 195.
19
P. Mollier, « Le grade maçonnique de Rose-Croix et le christianisme : enjeux et
pouvoirs des symboles », in Deux siècles de REAA, Dervy, 2004, p. 177, note n° 32.
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 47 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
la cérémonie de l’initiation, le Vénérable qui manie l’épée flamboyante,
« crée » véritablement le maçon au moyen de la parole du rituel. Sans
rituel et sans symboles, il n’y a pas de de maçonnerie.
Du symbole au pouvoir symbolique
J. Assmann nous éclaire sur le contexte dans lequel se mettent
en place les écrits hermétiques et le développement du symbolisme
dans l’Égypte antique mais aussi la substitution du pouvoir symbolique
au pouvoir politique. Depuis la conquête de l’Égypte par les Perses en
525 avant J.-C., les prêtres et les élites égyptiennes perdent de leur pouvoir
politique. Comme l’explique J. Assmann :
« Les élites réagirent à cette perte d’influence politique et de
statut social par une sorte d’immigration intérieure et se retirèrent dans
les temples. Les traditions religieuses furent développées en un système
extrêmement compliqué combinant rituel, science [...] une sorte de jonglerie
virtuose qui, par ses prétentions à un pouvoir magique d’ordre spirituel [...]
dédommageait l’élite sacerdotale pour la perte de sa participation au
pouvoir politique. »20
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Cette analyse qui constate le déplacement du pouvoir réel au pouvoir
symbolique confié au prêtres, trouve également son illustration dans le champ
[ 48 ] maçonnique - lequel connait des grades à la dimension sacerdotale - qui
permet de recycler un pouvoir réel disparu en pouvoir symbolique.
En Égypte « le nombre de signes de l’écriture hiéroglyphique est multiplié par
dix, l’apprentissage de l’écriture devient une initiation durant des dizaines
d’années ». La multiplication des grades et des rituels pour parvenir au
faîte de l’initiation maçonnique connait pareille inflation et se construit
dès lors comme « culture enclavée »21. Sur le plan intellectuel, ce repli
sur soi dans les loges et la culture du secret maçonnique correspond à un
effet de clôture qui fait songer à la réaction nobiliaire pré-révolutionnaire.
Cette crispation identitaire s’appuie sur une ésotérisation qui va nourrir
les hauts grades de l’Écossisme.
P. Bourdieu montre comment les institutions existent sous deux
formes que sont d’une part les corps socialisés qu’il appelle les habitus,
d’autre part des objets matériels. Il explique comment « un ciboire, du
jour où il n’y a plus de chrétiens pour s’en servir chrétiennement, devient
un objet décoratif ».
Il évoque les tableaux dans les églises italiennes dont certains
continuent de « fonctionner parce qu’on prie et allume des cierges devant :
comprendre le tableau, c’est s’agenouiller, mettre une offrande etc. Ce qui
fait qu’une messe peut être dite, c’est-à-dire qu’un acte qu’on appellera
catholique peut exister, c’est la rencontre entre un habitus clérical dressé
à utiliser des objets d’institution conformément à des règles qui font
20
J. Assmann, Religio duplex, p. 28, cité par D. Jardin, La tradition des Francs-
maçons, p. 417.
21
Mary Douglas.
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 48 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
l’institution »22. On constate la même chose avec les symboles maçonniques
qui doivent être maniés par les maçons au moyen d’un rituel pour vivre et
faire advenir leur signification. Une salle d’auberge quelconque devient
une loge maçonnique par la seule présence d’un tableau de loge griffonné
sur le sol.
Le pouvoir symbolique maçonnique
Les symboles sont pensés par et pour des groupes différents qui
ne sont pas toujours en interaction même lorsqu’il s’agit de circulation
et d’appropriation de symboles d’un groupe à un autre. Par exemple les
symboles chrétiens peuvent être utilisés en maçonnerie par des maçons
non chrétiens. La portée du symbole sera plus ou moins réelle selon
un gradient d’appartenance ; la rose parlera différemment à un maçon
chrétien du dix-huitième grade du REAA, à un maçon non chrétien de ce
même dix-huitième grade, à un maçon qui n’a pas le dix-huitième grade,
à un maçon qui n’a pas le dix-huitième grade mais qui connait ce qu’en
dit Bonaventure (1217-1274) dans sa Vitis Mystica lorsqu’il compare
la Passion du Christ à une rose sanglante. Il s’agit donc de produire des
concepts à portée prétendument universelle mais à partir de particularismes.
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Comme les rituels, dont ils sont une partie de la substance, les
symboles ont le double avantage d’être non seulement transmissibles
mais également transmetteurs et médiateurs : ils sont supports privilégiés [ 49 ]
de l’imaginaire. Le symbole représente une concentration d’énergie, sa
signification réelle n’ayant aucune commune mesure avec l’apparente
banalité du sens immanent à sa forme. Dans ces conditions, le rituel
structure la répétition du symbole et contribue à faire intérioriser des
comportements à l’aide de l’imagination.
Les lectures du symbolisme sont multiples mais deux éléments
sont communs à tous les sens du mot symbole. L’anthropologue E. Sapir
distingue deux formes de symbolisme, l’une qu’il qualifie « de référence »
qui prend forme dans le conscient et qui comprend langue parlée et codes :
c’est la première fonction du symbolisme, celle de la communication. Une
autre forme de symbolisme appelée « symbolisme de condensation » permet
de libérer une tension affective, sous forme consciente ou inconsciente.
Le symbolisme de condensation s’enracine dans l’inconscient et « charge
d’affectivité des situations qui n’ont pas l’air d’entretenir le moindre rapport
avec le sens originel du symbole. Si une expression symbolique de référence
est ‘contaminée’ par une affectivité refoulée, les deux symbolismes se
confondent et les significations inconscientes (affectives) se rationalisent
alors sous forme de simples références »23.
Les symboles particulièrement chargés en affectivité influencent
le champ maçonnique. Les comportements eux-mêmes peuvent devenir
symboles, comme lors des mises à l’ordre spécifiques à chaque grade ou
22
P. Bourdieu, « Piété religieuse et dévotion artistique », Actes de la recherche en
sciences sociales, vol. 105, 1994. persee.fr.
23
E. Sapir, Anthropologie, Paris, Seuil, 1967.
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 49 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
la formation d’une chaîne d’union : les maçons créent ainsi et recréent
au moyen du rituel, un égrégore qui n’est plus seulement symbolique.
En maçonnerie, le rituel constitue donc la synthèse du secret maçonnique
et de sa transmission par symboles interposés et le symbole constitue le
paravent idéal de la tradition en même temps que son mode essentiel
(au sens propre) de transmission. Le pouvoir symbolique est un pouvoir
de construction de la réalité ou plutôt des représentations tenues pour
acquises de cette réalité.
Les symboles, instruments par excellence de « l’intégration sociale,
facilitent une effervescence qui détermine la condensation en ciment social »
selon l’expression de E. Sapir. Le monde de l’imaginaire est un monde
réel mais composé de réalités mentales (images, idées, intentions, etc.)
que M. Godelier désigne comme réalités « idéelles » et qui restent souvent
confinées dans l’esprit des individus. L’initiation maçonnique cherche,
au-delà de la compréhension par l’initié de ces processus, à le rendre
acteur puisqu’il travaille à construire un, deux ou trois temples qui n’en
font qu’un : son propre temple intérieur, le temple de la société et le Grand
Temple Universel. Ces trois temples sont subsumés sous la métaphore
ou le symbole du temple de Salomon. En fait l’imaginaire n’est certes
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
pas identifiable au symbolique, mais il ne peut acquérir d’existence et
d’efficacité sociale sans s’incarner dans des pratiques symboliques.
[ 50 ] Y-a-t-il une spécificité du regard maçonnique sur les symboles ?
Bien sûr il n’y a pas de symboles maçonniques en soi et la plupart
d’entre eux empruntent aux symboles opératifs, religieux et ésotériques.
De plus chaque maçon porte sur les symboles le regard qu’il souhaite
ou correspond le mieux à sa sensibilité ou ses convictions. Finalement
au-delà des clivages théoriques dont on ne saurait négliger la prégnance,
se déploie une grande tolérance et une grande liberté d’interprétation
maçonnique des symboles selon les époques, les individus et les rites avec
lesquels les maçons choisissent de travailler et de cultiver leur imaginaire.
La simple attention au symbole est petit à petit constitutive d’une culture
symbolique et initiatique plus ou moins approfondie et appropriée mais
indispensable au vécu maçonnique.
◼ D.J.
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 50 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
Figure 1.
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Manuscrit GLNF bib. 2007, in D. Jardin,
Aux sources de l’Écossisme..., p. 281, détail
Figure 2. [ 51 ]
Tableau de loge
de Maître Parfait,
détail, Mons,
Musée belge
de la Franc-
Maçonnerie,
Bruxelles, in D.
Jardin, Voyages
dans les Tableaux
de Loge, pl. II
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 51 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
Figure 3.
Maitre Écossois, BnF FM icono n°4 in 9 pl. 3, détail. in D. Jardin, Voyages dans les
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Tableaux de Loge, pl. I
[ 52 ]
Figure 4.
Tableau du 3e grade de Chevalier de l’Etoile d’Orient, détail, Maçonnerie des Hommes,
CMC, Musée Prinz Frédérick, GENL, La Haye (Pays-Bas). in D. Jardin,
Le Temple ésotérique des Francs-Maçons, Pl. II
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 52 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
Figure 5
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Tableau du 2e grade de Chevalier de l’Étoile d’Orient, détail, in D. Jardin, Le Temple
ésotérique des Francs-Maçons, Pl. III
[ 53 ]
Figure 6
Cabinet de réflexion, Colmar site Bartholdi in L. Marcos, R. Loaëc, À la découverte des
temples maçonniques de France, Dervy 2017, p. 249
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 53 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
Figure 7.
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Tableau de loge de Chevalier du Soleil, 28e grade du REAA, détail, coll.
particulière
[ 54 ]
Figure 8.
Manuscrit alchimique du XVIe siècle, in Roob,
Le Musée Hermétique - Alchimie & Mystique
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 54 22/10/2019 09:29
DOSSIER
Le Maçon face au symbole
Figure 5
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
© Grand Orient de France | Téléchargé le 18/05/2023 sur www.cairn.info par val hombert (IP: 78.114.66.47)
Le premier appartement du grade de Chevalier Rose-Croix, [ 55 ]
la crucifixion, une vision catholique du grade, Bibliothèque
A. Doré, 16, rue Cadet Paris, in D. Jardin, Aux sources de
l’Écossisme
Figure 6
Une vision très alchimique de la croix, « La croix est le
développement de la pierre cubique » F.- N. Noël, La Physique
du maçon, Fo 26, BnF, 1805. Repris par P. Mollier
in Renaissance Traditionnelle
LA CHAÎNE D’UNION n°90 [Octobre 2019]
cdu-n90-INT-BAT.indd 55 22/10/2019 09:29
Vous aimerez peut-être aussi
- Amour Fraternel, Aide Et VeriteDocument3 pagesAmour Fraternel, Aide Et VeriteValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Autorité, Hiérarchie Et SermentDocument3 pagesAutorité, Hiérarchie Et SermentValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Franc Maconnerie Magazine - 028Document68 pagesFranc Maconnerie Magazine - 028Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- CartouchesDocument8 pagesCartouchesValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- 7 Arts LibérauxDocument5 pages7 Arts LibérauxValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Franc Maconnerie Magazine - 026Document68 pagesFranc Maconnerie Magazine - 026Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Bien Penser Pour Mieux VivreDocument5 pagesBien Penser Pour Mieux VivreValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Franc Maconnerie Magazine - 027Document66 pagesFranc Maconnerie Magazine - 027Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- A Propos de La Methode MaconniqueDocument3 pagesA Propos de La Methode MaconniqueValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Anciens DevoirsDocument2 pagesAnciens DevoirsValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Franc Maconnerie Magazine - 023Document64 pagesFranc Maconnerie Magazine - 023Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Franc Maconnerie Magazine - 025Document68 pagesFranc Maconnerie Magazine - 025Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Revue de La Maçonnerie Universelle 22Document17 pagesRevue de La Maçonnerie Universelle 22Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Fil 4Document28 pagesFil 4Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Fil 2Document16 pagesFil 2Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Revue de La Maçonnerie Universelle 21Document21 pagesRevue de La Maçonnerie Universelle 21Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- 16 Points de Vue Initiatiques 1974Document54 pages16 Points de Vue Initiatiques 1974Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Degré Est Le Terme Exact Pour Grade. Les Degrés Sont Les Étapes Initiatiques Dans Un Rite Donné. Chaque Degré Confère Un Autre Niveau deDocument33 pagesDegré Est Le Terme Exact Pour Grade. Les Degrés Sont Les Étapes Initiatiques Dans Un Rite Donné. Chaque Degré Confère Un Autre Niveau deValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- 1 Points de Vue Initiatiques 1971Document53 pages1 Points de Vue Initiatiques 1971Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- 5 & 6 Points-De-Vue-Initiatiques 1972Document132 pages5 & 6 Points-De-Vue-Initiatiques 1972Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- 2 Points de Vue Initiatiques 1971Document76 pages2 Points de Vue Initiatiques 1971Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- 3 & 4 Points-De-Vue-Initiatiques 1971Document128 pages3 & 4 Points-De-Vue-Initiatiques 1971Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- AnalogieDocument1 pageAnalogieValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- La Construction Du Temple InterieurDocument6 pagesLa Construction Du Temple InterieurValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Je Suis Un CompagnonDocument5 pagesJe Suis Un CompagnonValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Secret Des BatisseursDocument24 pagesSecret Des BatisseursValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Pourquoi Je Suis Devenu Franc-MaçonDocument8 pagesPourquoi Je Suis Devenu Franc-MaçonValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- La Franc-Maçonnerie. Histoire Et ActualitéDocument108 pagesLa Franc-Maçonnerie. Histoire Et ActualitéValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- Application Des SymbolesDocument1 pageApplication Des SymbolesValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- À La Gloire Du Grand Architecte de L Univers Rite Ancien Et Primitif de Memphis-Misraïm BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA GRANDE LOGE MIXTE FRANÇAISEDocument16 pagesÀ La Gloire Du Grand Architecte de L Univers Rite Ancien Et Primitif de Memphis-Misraïm BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA GRANDE LOGE MIXTE FRANÇAISEValérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation