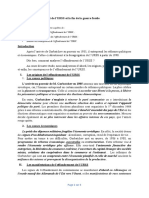Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Duprat G., Max Weber Politique Et Histoire, 1995 PDF
Duprat G., Max Weber Politique Et Histoire, 1995 PDF
Transféré par
andresabelrTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Duprat G., Max Weber Politique Et Histoire, 1995 PDF
Duprat G., Max Weber Politique Et Histoire, 1995 PDF
Transféré par
andresabelrDroits d'auteur :
Formats disponibles
Max Weber: Politique et histoire
Author(s): Gérard Duprat
Source: Revue européenne des sciences sociales, T. 33, No. 101, Max Weber Politique et histoire
(1995), pp. 5-10
Published by: Librairie Droz
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40370095 .
Accessed: 21/06/2014 18:01
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Librairie Droz is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue européenne des
sciences sociales.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 168.176.5.118 on Sat, 21 Jun 2014 18:01:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Revueeuropéennedes sciencessociales, Tome XXXIII, 1995,N° 101,pp. 5-10
GérardDUPRAT
MAX WEBER:
POLITIQUE ET HISTOIRE
«Nous dironsqu'il y a de la théorieau cœur mêmedu fait.»
GOETHE, citépar Weber
L'ensemble d'étudesque nousprésentons au lecteur de la Revuesousle
titreresserré
Max Weber, Politique ethistoire, pourrait:êtreuneexplicitation
etuneinterprétation de la proposition que Weberemprunte à Goethe,mais
aussila miseenpratique de celle-ci
parleursauteurs, à proposde la relation
quis'estconstamment nouéedansl'œuvrewébérienne entre politiqueethis-
toire:enprécisant toutde suitepourindiquer trèsexactement l'intentionde
recherche quia sous-tendu le travailcollectifsurcetterelation, quele dipty-
que «politiqueet histoire» doitêtrecomplété par«modernité».
Sansdoutela familiarité que les auteursontdepuislongtemps acquise
avecl'œuvrewébérienne leurpermet-elle d'affronter au mieuxla complexité
del'entrepriseetsesdifficultés:avecpolitique ethistoire, on a voulutoucher
à unthème centraldansla penséedeWeber, et,deplus,ona choisid'aborder
ce thèmesousl'angled'undesconcepts lesplusdélicatsà cerner danscette
pensée,la «modernité». Mais tousontl'expérience des interrogations que
la lecturede Webersuscitepresqu'àchaqueligne,tantsurl'arrière-plan de
connaissance desfaitsquesurlesprésupposés théoriques, lorsquel'oncroise
ainsil'éclaircissement
d'unthèmeetl'intelligence d'unconcept.Des interro-
gationsqu'ilfautalorslonguement expliciterpourquela justesseetla perti-
nencedu commentaire nesoientpaselles-mêmes compromises parle risque
d'interprétationsambiguës, sinonpardeserreurs de perspective surle sens
dela démarche ducommentateur. Lesétudesquel'onvalireontprislesplus
grands soinspouréloigner cesrisquesetprévenir ceserreurs. Lesdiscussions
rigoureuses auxquellesla présentation de chacunea donnélieuenpremière
version lorsd'uncolloquetenuà l'Institut d'étudespolitiques deStrasbourg,
ne sontnaturellement pas étrangères à ces efforts.
On saitaussilesincertitudes qui entourent la construction desconcepts
wébériens. Même,surtout peut-être,pourceuxdontle rôleestcardinal, que
l'on retrouvera nécessairement ici, formant réseauavecceluide «moder-
nité»:«légitimité», «rationalité», «culture»...Ces conceptssontprécisé-
mentceux-mêmes la a
que postéritéfétichisés, ceuxdontelleusedogmati-
quementpourcloresansles avoirouvertes des questionsqui restent chez
Weberautantde problèmes subtilement déconstruits. Il n'estaucunegrande
This content downloaded from 168.176.5.118 on Sat, 21 Jun 2014 18:01:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
6 G. DUPRAT
questionsociologique,politique,historique, dontle traitement n'aitétéchez
lui multidimensionnel, obéissanten quelque sorteà une logique «ondula-
toire»au filde la réflexion. Il fautenfinaffronter chaque foisà neufla com-
plexitémêmedu déroulement de la penséede Weber,la lenteélaborationde
son œuvre,et suivrela progressive miseau jour,parinventions aussibienque
par reprises,des articulationsmaîtressesde problématiquesoù, constam-
ment,la mise en ordredes «faits» et la préoccupationde «théorie» se
mêlent,se fécondent.
On ne trouveradonc dans les étudesqui vontsuivreni, naturellement,
hagiographiedu penseur,ni mêmequelque complaisanceà l'égarddes incer-
titudesou obscuritésde sa recherche.Il n'y aura non plus aucune facilitéà
l'égardde ce que cettesociologiepeutavoirà nous proposerfaceà nos pro-
presinterrogations surpolitiqueet histoire, faceà notreprésentpolitique.Et
l'on ajouteraalorsceci: chercherquel estfinalement l'apportde cettepensée
«pour nous», pour l'intelligence de nos sociétéset particulièrement de leur
relationavec la questionde la démocratiequi devientdès lors primordiale,
n'impliqueaucune attitudeinstrumentale à son égard.Au contraired'une
hypothèseaussi grossière, c'estnon seulementtenircettepenséepourencore
vivante,en la contredisant si nécessaire- et l'on verraque cela serafaitavec
unevigueurcertainepar quelques-uns- , mais c'estaussi imprimer aux étu-
des une préoccupationcommune,qui a aussi marquéleur confrontation:
réfléchir surla réceptionde l'œuvrewébérienne, à laquellele colloque parti-
cipaitainsi lui-même,de fait.En tantque telle,cetteréflexion- et donc
l'examenéventueldes cas d'instrumentalisation de la pensée wébérienneà
la
laquelle réception de l'œuvre a pu parfois se réduire - restaitsans doute
un objectifde recherche secondpourle colloque; les exigencescritiquesspé-
cifiquesà cette recherchene s'en projetaientpas moins directement sur
l'ensemblede sa tenue.
La formede l'avertissement que l'on vientde donnerau début de cet
Avant-proposn'étaitpas inutilement provocante.Pour deux raisons.
On voudraitd'abord rappelerles Etudes sur Max Weberde Julien
Freund,auquel on s'est plu à emprunter la citationgoethéenneliminaire,
citationtellementsignificative que Freundy recourtpar deux foisdans son
ouvrage(Droz, Genève,1990). Ces Etudesont à nos yeuxpour qualitépre-
mièred'illustrermagistralement la nécessitédu travailcritiquedontles exi-
genceset la complexitéviennentd'êtrebrièvement rappelées.Freunda mon-
trélà que ce travailne doitpas êtretenupourun simplepréalableà la contes-
tationde la penséede Weberpar les faits,par elle-même,et par nous. Il est
au contraire le passage obligéà travers lequelcette«auto-contestation», pri-
des
vilège grandespenséeset signede leurfécondité, peuts'effectuer et deve-
nirréellement efficacepourla compréhension de Weber,et pournous. Il fal-
lait le rappeler,commeun principeélémentaire, dont l'expériencemontre
qu'il est parfoisméconnu,mais qui a été retenuici par tous - et direaussi
le regretcommunqu'une contribution de Freundn'aitpu enrichir ce volume.
Politiqueet histoireau regardde la «modernité»a d'autrepartétéchoisi
précisément en raisonde ce que, sous la conditionde cettecritique,«l'effica-
This content downloaded from 168.176.5.118 on Sat, 21 Jun 2014 18:01:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
WEBER: POLITIQUE ET HISTOIRE 7
cité»de la penséewébérienne peutyêtremesuréesans douteplusexactement
qu'ailleurs- en epistemologie des scienceshumaineset socialespar exemple.
On reviendradans un instantsurles termesmêmesde ce choix: surce que
celui-cisignifieen termesde «contenusde pensée». Une seconde mise au
points'impose au préalable,aussi généraleque la précédente.
C'est en effetla penséesociologiquede Weberqui seratravailléeici,pour
elle-mêmeet pour nous, dans le même mouvementcritique.Le lecteur
pourranoterque la qualificationde «pensée» pourspécifierle foyerde leur
recherche,reviendrasouvent sous la plume des auteurs. Inadéquate à
d'autres«scientifiques»,cetteattitudeconvientau respectde la vocationde
penseurscientifique propreà Weber:la scienceals Berufti cettescienceelle-
mêmecommevouée à l'établissement d'une «sociologie de la domination»
en donneraientune formulation ramassée,provisoirement commode.Mais
le choixde cettespécification par les organisateurs du colloque est,de nou-
veau,une questionde principe.Mettrela spécificité de cettevocationscienti-
fiqueet la richessede sa recherche réellement au travailsurnos questionset
sur notreprésent,oblige à ce que seule conviennela considérationde ce
qu'elle peut nous apporter«en substance»,commepensée.
Aucun angélismedonc dans ce respectdu savant,aucun idéalismenon
plusà l'égardde sa science.D'un côté,un désintérêt évidentpourles querel-
les de chapellesoù, sous le couvertd'une lecturejuste de Weber,la passion
pourfaireprévaloirune orthodoxieen méthodesociologique- ou politolo-
gique - l'emportesurl'urgenced'un jugementinformé, équilibré,objectif
surles faitssociauxet politiquesétudiés,ainsique surle souci d'êtreau clair
quant à la pertinencede la théorie.Si tantest que la théoriesociologique,
ou politique,soit alors réellementconcernée;car le désintérêtdevientde
Péloignement lorsquece qui estditthéorien'estplus que véhiculede l'idéo-
logie. Il y a beau tempspar exempleque la question,faussement théorique,
du «libéralisme»de Weberest régléepour toutpraticienconséquentde sa
pensée.Renvoyonsen cela, commedernièredémonstration de l'inadéqua-
tionde la question,à l'une des étudescontenuesdans le recueilde Freund
cité plus haut, peut-êtrela plus connue précisément pour cetteraison. Et
disonsqu'en faisantde la démocratie etde la relationde celle-ciavec le libéra-
lismeune questionque plusieursdes étudesici réuniesposentdirectement et
sous diversesformescritiquesà la penséesociologiquede Weber,ce n'esttou-
jours que sous le contrôled'une règlepremière qui estcellede l'ensembledes
travauxde ce recueil:l'adéquation à leurobjet, la recherche wébérienneet
les «apports substantifs»de celle-ci sur l'articulationentre les modes
concretsd'exercicedu pouvoiret les processusde légitimation de celui-ci,où
se trouvel'originalitéde cettepensée de la domination.
Mais dans la réunionmêmede ces travauxet leurfocalisationprioritaire
surla penséewébérienne et secondairement surla réceptionde celle-ci- de
Webercomme«penseurscientifique»si l'on préfère, etl'on voitbienque dès
lorsWeberpenseurde la scienceestconcerné- , il y a aussi une indifférence
délibéréeà l'égarddes affrontements pourle contrôlede territoires scientifi-
ques. Webern'a pas en effetéchappé à cetteterritorialisation, dans des
This content downloaded from 168.176.5.118 on Sat, 21 Jun 2014 18:01:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
8 G. DUPRAT
affrontements qui ne sontplus que querellesdérisoiresau regarddes ques-
tionsenjeu dans son œuvre.Des guerrespluspicrocholines que wébériennes,
dirait-on,saufà lesconsidérer au seconddegré.Car si Weberyeutsansdoute
vu unetrahisonde la scienceals Beruf,ellesillustrent aussi un paradoxequ'il
a fortement éclairésans le fairedisparaître, car il est l'effet,pour formuler
la chose dans ses termes,de l'indépassable «polythéismedes valeurs»
moderne.Pas plus que tout autre,le milieusavantn'échappe en effetau
conflitentrel'intérêtprofessionnel - l'intérêtpour la connaissancedans le
cas de ce milieu,et la «neutralitéaxiologique» qu'il imposeà ceux qui font
profession de lui appartenir- etl'intérêtpourla dominationdans la profes-
sion.
En réunissantle colloque dont ces étudessontle produitet dontil sait
gréau Centrenationalde la recherche scientifiqued'avoirsoutenuintellec-
tuellement et financièrement l'entreprise,le Centred'étudede la penséepoli-
tiquepoursuivaitsurun terrainparticulièrement intéressant pourla connais-
sanceet particulièrement adéquat pour la théorie, sa recherche propresurla
relationentrel'une etl'autrequand la politiqueesten question;ou plusexac-
tement,l'intérêtmême du sujet suffisaità justifierl'entreprise,à juger
qu'étudierla sociologiede la dominationwébériennede manière«substan-
tive»sous l'anglede la «modernité»,pourelle-mêmeet pournous,étaitune
finen soi.
Le terrainsemblaitsuffisamment préparé,balisé,pour permettre désor-
maisdes confrontations fines,mêmesi on le savaitmoinstravailléen France
sous cetangleque lorsqu'ils'agitde discuterde l'epistemologie wébérienne.
Les étudesmontreront toutespar les travauxauxquels elles se réfèrent,y
comprisceux que la modestiedes auteursles empêcheparfoisde rappeller
aussi souventque cela eût été nécessaire,que les controverses auxquelles
l'œuvrede Webera donné lieu en ces affairesont désormaisleur histoire,
solidementconstituée.Aussia-t-onpu adopterune démarchetrèsclassique.
Marcheront de frontdes étudesgénérales,qui placentd'entréeleurapproche
sous le signedes grandsconceptsde la sociologiepolitiquewébérienne, per-
mettantainsi à leursauteursde donnerle point sur leur «réflexionwébé-
rienne»,et des travauxplus précis,qui prennentleur sourcedans le traite-
mentpar Weberd'une questionde «faits», ou de «théorie».
Appartenantau premiergenre,l'étudede David Beethamouvreune série
consacéeà la problématiquewébérienne de la démocratie.Le constatdressé
par Beethamd'un échec«à rendrecomptede la démocratiereprésentative»
s'appuie surles analysesdu conceptwébériende légitimité et de la typologie
de l'autoritélégitime.Le travailde CatherineColliot-Thélèneprivilégie
ensuitedans l'œuvrewébériennela sociologie- ou «prétendue»telle- de
la villepar rapportaux autressources.Elle cherchedans cettesociologieles
origineset caractèresque la pensée de la démocratiemodernerevêtchez
Weber,de manièreà y pointerl'importanced'une analysedes conditions
socialesde l'individuation,à partirde laquelle le Bürgermoderne,l'homme
libre-citoyen,se laisseraitanticiper.StefanBreuerpousse enfinau plus loin
This content downloaded from 168.176.5.118 on Sat, 21 Jun 2014 18:01:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
WEBER: POLITIQUE ET HISTOIRE 9
la tentativepour relierla sociologie wébériennede la dominationet une
typologiemodernede la démocratie,non sans rendreraisontoutau longde
son étudeà ce que l'on disaitplus hautdans cetAvant-propos surles exigen-
ces critiquesauxquellestouteréflexionwébériennedoit satisfaire.
Focaliséetrèsprécisément surla questionde la révolutionetlaissantainsi
celle de la démocratieà son horizon,l'étude de François Chazel tend à
contribuerà une «reconsidération de la penséepolitique» de Weber.Elle se
situeainsidans unedes lignesrécentesde la réflexionwébérienne, dontle tra-
vail publiépar Beethama commencéà poser dès 1974quelques jalons. La
substanceen est puiséepar Chazel dans des écritsde Weberpeu fréquentés
parcequ'en apparencesecondaires,ceux qui concernentles événements rus-
ses de 1905-1906;et,toutemesureprise,avec la circonspection qui s'impose
faceà une généralisation hâtivedontil relèveles dangers,Chazel croitpou-
voirprésenter à partirde ces écritsl'hypothèsed'une réelle,quoiqu'impli-
cite,«théoriede la révolution»chez Weber.
La secondesériede ce recueildéplacel'accentde la questionde la démo-
cratieverscelle de la modernité, restéejusque-là latenteou implicite.Wolf-
gang Küttleradopte pour cela un pointde vue résolumenthistoriciste. Ce
qui l'intéresse est alors de prendre en considérationl'œuvre wébérienne en
ce qu'elle concourtà rendrecomptede la modernité par la «crise», au regard
des rapportsposé commeantinomiquesentrela théoriede la scienceet les
exigencesde l'action concrète.L'extrêmedensitéet complexitédu concept
wébériende modernité que les deuxétudessuivan-
trouvelà une illustration,
tes,de Pietro Rossi et Jean-Marie Vincent, cherchent aussi à maîtrisercha-
cuneà sa manière,maisen concentrant toutesdeuxleurattentionsurla ques-
tion,directement culturelle,du «désenchantement».
Rossi abordece thèmedevenusi célèbrequ'il tournemaintenantau cli-
ché, de manièrerigoureuse,par l'indispensablemiseau pointinitialede la
problématiquewébériennede la rationalisation, sous son aspect«formel»,
propre à l'Occident moderne et à sa culture.A la suite de la revisitation
conceptuellegénéraleà laquelle se livreRossiet dontla conclusionestexpli-
citementtirée«pour nous» - c'est-à-dire, pour citerRossi: en «traduisant
le discoursde Weberen termesactuels» - , Vincentdressel'analysecroisée
du désenchantement du mondeselonWeberet Benjamin.Mais si, malgréce
thèmecommun,la distanceentreces deux penseursde la modernitéet de la
cultureest évidemmentconsidérable,Vincentveut finalementmettreen
lumièrela différence entre,d'un côté, le «réalisme» wébérienet la para-
doxaleabsencede réponsede sa partaux questions«extra-empiriques» que
pourtantil pose - la limitede la sociologiewébérienneseraitlà, selonVin-
cent-, et, de l'autre,la critiquemêmede l'empirietelleque Benjaminet
Adorno l'ont proposée,à partirde laquelle les sciencessociales pourraient
obtenirun «contenude vérité».
On a dit plus haut - et l'on espèreque la lecturede l'ensemblede ces
travauxne nousdémentira pas auprèsdu lecteur- que le tempsdes confron-
This content downloaded from 168.176.5.118 on Sat, 21 Jun 2014 18:01:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
10 G. DUPRAT
tationsfinessurla sociologiewébérienne de la dominationnous avaitsemblé
désormaisvenu.Le colloque a montréque teln'étaitpas encorele cas à pro-
pos des questionsposées par la réceptionde cettesociologie.La table-ronde
terminale, spécialementconsacréeau sujeta certesété richeen perspectives
sur les traitscaractéristiquesdes réceptionspar les diversessociologies
«nationales» et, par delà celles-ci,par les sciencessociales et humainesdes
différentesprovincesde l'Europe scientifique - la sciencehistoriqueen par-
ticuliermais aussi la philosophiesontévidemment concernées,commecela
futfortement souligné.Cependant,malgréles travauxdéjà effectués ou ceux
en cours,le domainede recherche, immense,resteencorelargement inconnu.
Aussia-t-onpréféréà la publicationd'un compterenduanalytiquede cette
table-ronde,que l'on aurait pu craindrefrustrant pour le lecteur,que ce
recueils'achève par une étude qu'HinnerkBruhnsconsacreà la question
franco-allemande, exemplairedes difficultés d'une réceptionlargeet dialo-
guée du wébérianisme.
de Paris VIII
Université
Départementde sciencepolitique
Centred'étudede la penséepolitique
This content downloaded from 168.176.5.118 on Sat, 21 Jun 2014 18:01:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Vous aimerez peut-être aussi
- Cea - CemacDocument14 pagesCea - CemacAmine Chbihi100% (1)
- Chevallier J., Doctrine Juridique Et Science Juridique, 2002Document19 pagesChevallier J., Doctrine Juridique Et Science Juridique, 2002andresabelrPas encore d'évaluation
- Achille Mbembepolitique de L'inimitiéDocument189 pagesAchille Mbembepolitique de L'inimitiéMakaïla IssaPas encore d'évaluation
- Gény F, Science Et Technique en Droit Privé Positif, Vol IV, 1924 PDFDocument310 pagesGény F, Science Et Technique en Droit Privé Positif, Vol IV, 1924 PDFandresabelr100% (1)
- Bouglé C., Le Solidarisme, 1907 PDFDocument348 pagesBouglé C., Le Solidarisme, 1907 PDFandresabelrPas encore d'évaluation
- La Loi Est Elle L Oeuvre Du Parlement Sous La Veme RepubliqueDocument3 pagesLa Loi Est Elle L Oeuvre Du Parlement Sous La Veme RepubliqueOsmanli Umut100% (1)
- Arminjon P, Nolden B, Wolff M, Traité de Droit Comparé Tome I, 1950 PDFDocument525 pagesArminjon P, Nolden B, Wolff M, Traité de Droit Comparé Tome I, 1950 PDFandresabelr100% (1)
- Capitant R., Le Droit Constitutionnel Non Écrit, 1934Document10 pagesCapitant R., Le Droit Constitutionnel Non Écrit, 1934andresabelrPas encore d'évaluation
- Global Politics Paper 2 HLSL MarkschemeDocument16 pagesGlobal Politics Paper 2 HLSL MarkschemeAnnePas encore d'évaluation
- Durkheim - Leçons de Sociologie (Physique Des Moeurs Et Du Droit)Document157 pagesDurkheim - Leçons de Sociologie (Physique Des Moeurs Et Du Droit)Massinissa ÅhmimPas encore d'évaluation
- GÉNY, Francois, La Notion de Droit en France. Son État Présent. Son Avenir, 1931Document19 pagesGÉNY, Francois, La Notion de Droit en France. Son État Présent. Son Avenir, 1931andresabelrPas encore d'évaluation
- ESMEIN, Adhémar, Deux Formes de Gouvernement, 1894Document29 pagesESMEIN, Adhémar, Deux Formes de Gouvernement, 1894andresabelr100% (2)
- DAVY, Georges, Éléments de Sociologie. I. - Sociologie Politique, 1950Document32 pagesDAVY, Georges, Éléments de Sociologie. I. - Sociologie Politique, 1950andresabelrPas encore d'évaluation
- Cuvelier C, Huet D, Janssen-Bennynck C, La Science Française Du Droit ConstitutionnelDocument30 pagesCuvelier C, Huet D, Janssen-Bennynck C, La Science Française Du Droit ConstitutionnelandresabelrPas encore d'évaluation
- ARDANT, Philippe, Le Contenu Des Constitutions - Variables Et Constantes, 1989Document12 pagesARDANT, Philippe, Le Contenu Des Constitutions - Variables Et Constantes, 1989andresabelrPas encore d'évaluation
- Chénon, Émile, Histoire Générale Du Droit Français Public Et Privé Des Origines À 1815, Vol I, 1926Document992 pagesChénon, Émile, Histoire Générale Du Droit Français Public Et Privé Des Origines À 1815, Vol I, 1926andresabelrPas encore d'évaluation
- CAPITANT, René, Introduction À L'étude de L'illicite L'impératif Juridique, 1928Document239 pagesCAPITANT, René, Introduction À L'étude de L'illicite L'impératif Juridique, 1928andresabelrPas encore d'évaluation
- Éduquer Dans Et Hors L'école - Introduction. Institutions Et Milieux D'éducation (XVIIe-XXe Siècle) - Concurrences, Complémentarités, Influences - Presses Universitaires de RennesDocument10 pagesÉduquer Dans Et Hors L'école - Introduction. Institutions Et Milieux D'éducation (XVIIe-XXe Siècle) - Concurrences, Complémentarités, Influences - Presses Universitaires de RennesWahedSportPas encore d'évaluation
- Guide Asile FRDocument58 pagesGuide Asile FRMoHadrielCharki100% (1)
- Code Deontologie Police Gendarmerie 06-12-2013Document11 pagesCode Deontologie Police Gendarmerie 06-12-2013IbraxusPas encore d'évaluation
- 1.HGGSP.t4.A. Les Grandes Révolutions Techniques de L'informationDocument9 pages1.HGGSP.t4.A. Les Grandes Révolutions Techniques de L'informationclelia.ozwaldPas encore d'évaluation
- ENAM Cycle A Auditeurs de Justices 2018 FRDocument10 pagesENAM Cycle A Auditeurs de Justices 2018 FRCamerounWebPas encore d'évaluation
- Afrilex - WELLA Mazamesso-Les Effets Juridiques Des Constatations Des Inspecteurs en Droit InternationalDocument30 pagesAfrilex - WELLA Mazamesso-Les Effets Juridiques Des Constatations Des Inspecteurs en Droit InternationalMazamesso WellaPas encore d'évaluation
- Abus de Minorite - Ph. MerleDocument2 pagesAbus de Minorite - Ph. MerleNadim TarabayPas encore d'évaluation
- Sujet ChoisiDocument4 pagesSujet Choisimrabet18Pas encore d'évaluation
- Effondrement de l'URSS, NMEFDocument4 pagesEffondrement de l'URSS, NMEFLylian MabickaPas encore d'évaluation
- Contexte Des FaitsDocument3 pagesContexte Des FaitsGayo Cadet BashimwendaPas encore d'évaluation
- 9527 27287 1 PBDocument20 pages9527 27287 1 PBAsmae LaguelilPas encore d'évaluation
- FoucaultDocument9 pagesFoucaultAndreas FalkenbergPas encore d'évaluation
- Fiches TD Droit Des Contrats Publics 2012Document128 pagesFiches TD Droit Des Contrats Publics 2012Jean-christophe R. SerraPas encore d'évaluation
- LLL - Les Littératures en Langues Africaines Ou L'inconscient Des Théories Postcoloniales PDFDocument12 pagesLLL - Les Littératures en Langues Africaines Ou L'inconscient Des Théories Postcoloniales PDFdrago_rossoPas encore d'évaluation
- Les Actes Du Forum DakarGSEF2023 FRDocument236 pagesLes Actes Du Forum DakarGSEF2023 FRBOUCARY DIAOPas encore d'évaluation
- TDR Identitif - Mobilisation - Zone CRASC - 21 Au 30 Mai - 2024Document5 pagesTDR Identitif - Mobilisation - Zone CRASC - 21 Au 30 Mai - 2024Yapo Assi HyacinthePas encore d'évaluation
- Patrimoine Culturel Et Identité Nationale - Construction Historique D'une Notion Au Sénégal - ImprimirDocument33 pagesPatrimoine Culturel Et Identité Nationale - Construction Historique D'une Notion Au Sénégal - ImprimirIriadesIriaPas encore d'évaluation
- Accre FormulaireDocument1 pageAccre FormulaireEllapin MichaelPas encore d'évaluation
- Les Fichiers de Police (PDFDrive) PDFDocument134 pagesLes Fichiers de Police (PDFDrive) PDF2020 RecrutementPas encore d'évaluation