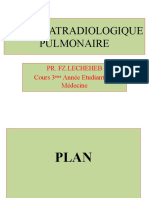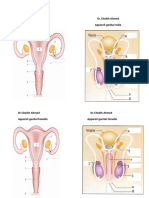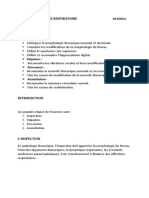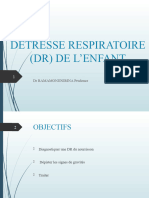Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Exa Pneumo
Exa Pneumo
Transféré par
Niang0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues9 pagesTitre original
exa pneumo
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues9 pagesExa Pneumo
Exa Pneumo
Transféré par
NiangDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 9
Asthme aigu grave
Questions
1/ Quel est le nombre de décès annuels par asthme aigu grave en France ?
A - moins de 100
B - environ 500
C - environ 2 000
D - environ 5 000
E - plus de 10 000
2/ Vous recevez un patient pour asthme aigu aux urgences. Quels sont les facteurs de
risque d'asthme aigu grave que vous recherchez ?
A - asthme dans un contexte allergique
B - hospitalisation pour asthme dans l'année précédente
C - intolérance à l'aspirine et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
D - asthme diagnostiqué dans la petite enfance
E - consultation pour asthme aigu le mois précédent
3/ Vous examinez un patient en crise d'asthme aux urgences. Quels signes cliniques de
gravité devez-vous rechercher ?
A - sueurs profuses
B - fréquence respiratoire > 30/min
C - orthopnée
D - pouls paradoxal > 20 mmHg
E - difficultés à parler
4/ Un asthmatique de 30 ans, de taille 1, 85 m, est examiné aux urgences pour une
exacerbation évoluant depuis 3 jours. Il ne présente pas d'orthopnée et est capable de
faire des phrases courtes. Sa valeur de débit expiratoire de pointe (DEP) est de 200
l/min, manoeuvre correctement effectuée. À votre avis, s'agit-il ?
A - d'une crise d'asthme simple
B - d'une exacerbation sévère
C - d'un asthme aigu grave
D - d'une exacerbation légère
E - d'une crise simple prolongée
5/ Les β2 agonistes, administrés par voie inhalée, ont une action bronchodilatatrice nette
après :
A - 3 à 5 minutes
B - 15 à 20 minutes
C - 30 à 40 minutes
D - 60 à 90 minutes
E - 4 à 6 heures
6/ Les corticoïdes administrés par voie intraveineuse ont un effet sur l'obstruction
bronchique net après :
A - 3 à 5 minutes
B - 15 à 20 minutes
C - 30 à 40 minutes
D - 60 à 90 minutes
E - 4 à 6 heures
Réponses
1/ Quel est le nombre de décès annuels par asthme aigu grave en France ?
La réponse est : C. La mortalité par asthme aigu grave est stable, autour de 2 000 par an depuis
plusieurs années.
2/ Vous recevez un patient pour asthme aigu aux urgences. Quels sont les facteurs de
risque d'asthme aigu grave que vous recherchez ?
Les réponses sont : B, C, E. Les crises d'asthme d'origine médicamenteuse sont souvent explosives
et graves.
3/ Vous examinez un patient en crise d'asthme aux urgences. Quels signes cliniques de
gravité devez-vous rechercher ?
Les réponses sont : A, B, C, E. La présence de sueurs profuses témoigne, a priori, d'une
hypercapnie habituellement associée à un volume expiratoire maximal/seconde (VEMS) < à 25 % de
la théorique. La polypnée témoigne de l'impossibilité de réaliser des expirations prolongées, par
contraction des muscles abdominaux, et annonce l'épuisement respiratoire. La mesure du pouls
paradoxal, difficile à réaliser, ne fait pas partie des recommandations.
4/ Un asthmatique de 30 ans, de taille 1, 85 m, est examiné aux urgences pour une
exacerbation évoluant depuis 3 jours. Il ne présente pas d'orthopnée et est capable de
faire des phrases courtes. Sa valeur de débit expiratoire de pointe (DEP) est de 200
l/min, manoeuvre correctement effectuée. À votre avis, s'agit-il ?
La réponse est : C. La valeur mesurée du DEP doit être rapportée à la valeur prédite, dépendante du
sexe, de l'âge et de la taille du sujet. Dans le cas présent (homme jeune et grand), la valeur prédite
se
situe autour de 630 l/min. Il s'agit donc probablement d'un asthme aigu grave quelle que soit la
durée
d'évolution de la crise.
5/ Les β2 agonistes, administrés par voie inhalée, ont une action bronchodilatatrice nette
après :
La réponse est : A. Les β2 agonistes sont les bronchodilatateurs les plus puissants et les plus
rapides.
6/ Les corticoïdes administrés par voie intraveineuse ont un effet sur l'obstruction
bronchique net après :
La réponse est : E. L'action des corticoïdes est différée de 4 à 6 heures, aussi bien avec la voie
intraveineuse qu'avec la voie orale. La voie intraveineuse n'est pas obligatoire et souvent inutile.
Définitions et classifications des bronchopneumopathies chroniques
obstructives
Questions
1/ Parmi les éléments suivants concernant la bronchite chronique, l'un est inexact :
A - elle résulte de l'hypersécrétion chronique ou récidivante de mucus
B - elle est à l'origine d'une expectoration au moins 3 mois par an pendant au moins 2 années
consécutives
C - elle ne peut être la conséquence d'une affection cardiaque
D - elle ne peut être la conséquence de bronchiectasies
E - elle est une des manifestations de la BPCO
2/ Parmi les propositions suivantes, laquelle n'autorise pas le diagnostic de BPCO ?
A - la diminution du VEMS
B - la diminution du rapport VEMS/CV
C - la diminution du rapport VEMS/CVL
D - la diminution du rapport VEMS/CVF
E - l'inhalation préalable de bronchodilatateur avant le test
3/ Parmi les caractéristiques concernant le syndrome ventilatoire obstructif, quelle est
la réponse inexacte ?
A - il ne peut être diagnostiqué que par la spirométrie
B - il résulte d'une maladie des petites voies aériennes
C - il résulte d'une destruction parenchymateuse
D - il est défini par un rapport VEMS/CV < 70 %
E - il est toujours dû au tabagisme.
4/ Parmi les propositions suivantes concernant l'emphysème, indiquez celle qui est
erronée :
A - c'est une augmentation au-delà de la normale de la taille des espaces aériens distaux aux
bronchioles terminales avec une destruction de leurs parois
B - il existe deux types d'emphysème dans la BPCO
C - l'emphysème panlobulaire est le plus fréquent
D - l'emphysème panlobulaire atteint toutes les structures de l'acinus
E - l'emphysème panlobulaire est à l'origine d'une hypoxémie précoce lors des exercices
5/ Parmi les étiologies possibles des BPCO, l'une n'est pas fondée :
A - le tabagisme
B - la pollution par des fumées de matières végétales
C - la pollution par des fumées de fuels
D - la pollution atmosphérique urbaine
E - le déficit en alpha-1-antitrypsine
6/ Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une BPCO grave ?
A - VEMS/CVF < 70 % ; VEMS > 80 % de la valeur théorique
B - VEMS/CVF < 70 % ; 50 % ≤ VEMS < 80 % de la valeur théorique
C - VEMS/CVF < 70 % ; 30 % ≤ VEMS < 50 % de la valeur théorique
D - VEMS/CVF < 70 % VEMS < 30 % de la valeur théorique
E - VEMS < 50 % de la valeur théorique et insuffisance respiratoire chronique
7/ Parmi les éléments suivants, quel est celui qui n'intervient pas dans le calcul de
l'index de Bode ?
A - VEMS (%)
B - distance parcourue en 6 minutes (m)
C - dyspnée (échelle MRC)
D - IMC (kg/m2)
E - l'âge (ans)
Réponses
1/ Parmi les éléments suivants concernant la bronchite chronique, l'un est inexact :
La réponse est : E
2/ Parmi les propositions suivantes, laquelle n'autorise pas le diagnostic de BPCO ?
La réponse est : A
3/ Parmi les caractéristiques concernant le syndrome ventilatoire obstructif, quelle est
la réponse inexacte ?
La réponse est : E
4/ Parmi les propositions suivantes concernant l'emphysème, indiquez celle qui est
erronée :
La réponse est : C
5/ Parmi les étiologies possibles des BPCO, l'une n'est pas fondée :
La réponse est : D
6/ Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une BPCO grave ?
La réponse est : C
7/ Parmi les éléments suivants, quel est celui qui n'intervient pas dans le calcul de
l'index de Bode ?
La réponse est : E
Facteurs étiologiques et épidémiologie des bronchopneumopathies
chroniques obstructives (BPCO)
Questions
1/ Parmi les facteurs suivants, citez ceux retrouvés comme prédictifs de la mortalité chez
les patients BPCO :
A - la sévérité de l'obstruction
B - l'état nutritionnel (IMC)
C - la capacité à l'exercice par le test de marche de 6 minutes
D - la sévérité de la dyspnée (index BODE)
E - les comorbidités associées
2/ Que retrouve-t-on parmi les principaux facteurs de risque de la BPCO ?
A - le tabagisme actif
B - les facteurs influant sur la fonction respiratoire au cours de l'enfance
C - les expositions professionnelles
D - les infections
E - l'état nutritionnel
3/ Parmi les traitements prescrits dans la BPCO, quels sont ceux ayant démontré un
effet sur la survie ?
A - l'arrêt du tabac
B - l'oxygénothérapie
C - les bronchodilatateurs
D - la corticothérapie
E - la kinésithérapie respiratoire
Réponses
1/ Parmi les facteurs suivants, citez ceux retrouvés comme prédictifs de la mortalité chez
les patients BPCO :
Les réponses sont : A, B, C, D
2/ Que retrouve-t-on parmi les principaux facteurs de risque de la BPCO ?
Les réponses sont : A, B, C, D
3/ Parmi les traitements prescrits dans la BPCO, quels sont ceux ayant démontré un
effet sur la survie ?
Les réponses sont : A, B
Sarcoïdose
Questions
1/ La sarcoïdose est :
A - consécutive à l'inhalation de béryllium
B - une maladie héréditaire à transmission autosomique dominante
C - une affection systémique d'étiologie indéterminée caractérisée par la formation de granulomes
immunitaires dans les organes atteints
2/ Quelles sont les particularités concernant les granulomes de la sarcoïdose ?
A - présence au niveau de plusieurs organes
B - mise en évidence par biopsies perendoscopiques bronchiques dans plus de 60 % des cas
C - présence possible de nécrose fibrinoïde
D - présence possible de nécrose caséeuse
E - présentation sphérique avec délimitation nette
3/ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes à propos de la sarcoïdose ?
A - la radiographie de thorax est anormale dans plus de 85 % des cas
B - l'élévation du dosage sérique de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I est spécifique de la
sarcoïdose
C - il est établi que la cause de la sarcoïdose est Propionibacterium acnes
D - son incidence est augmentée chez les membres de la famille des cas index touchés par la
sarcoïdose
E - elle est ubiquitaire
4/ Les propositions suivantes concernant le traitement de la sarcoïdose sont-elles
exactes ?
A - la corticothérapie générale lorsqu'elle est indiquée doit être prescrite pour une durée minimale
de douze mois
B - le thalidomide est proposé en cas de localisation pulmonaire sévère devant un échec des
corticoïdes généraux
C - le méthotrexate est contre-indiqué en cas d'alcoolisme chronique non contrôlé
D - le méthotrexate est proposé en cas d'échec ou de mauvaise tolérance des corticoïdes
E - en cas de bloc auriculoventriculaire complet, il faut proposer un entraînement électrosystolique
et une corticothérapie générale
Réponses
1/ La sarcoïdose est :
La réponse est : C
2/ Quelles sont les particularités concernant les granulomes de la sarcoïdose ?
Les réponses sont : A, B, C, E
3/ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes à propos de la sarcoïdose ?
Les réponses sont : A, D, E
4/ Les propositions suivantes concernant le traitement de la sarcoïdose sont-elles
exactes ?
Les réponses sont : A, C, D, E
Pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques
Questions
1/ La fibrose pulmonaire idiopathique :
A - est la plus fréquente des pneumopathies interstitielles idiopathiques
B - peut comporter un aspect histopathologique de pneumopathie interstitielle commune ou de
pneumopathie interstitielle non spécifique
C - nécessite toujours une biopsie vidéochirurgicale pour établir le diagnostic
D - débute habituellement entre 50 et 70 ans
E - évolue vers l'insuffisance respiratoire chronique avec une médiane de survie de 3,5 ans
2/ Une efficacité sur la survie a été démontrée au cours de la fibrose pulmonaire
idiopathique pour les traitements suivants :
A - pirfénidone
B - ciclophosphamide
C - azathioprine
D - N-acétyl-cystéine
E - aucun des traitements ci-dessus
3/ Les éléments suivants appartiennent aux critères du diagnostic tomodensitométrique
de la fibrose pulmonaire idiopathique :
A - opacités réticulaires à prédominance sous-pleurale
B - prédominance aux bases
C - plages de condensation alvéolaire
D - images microkystiques sous-pleurales en « rayon de miel »
E - Opacités en verre dépoli
4/ Un aspect histopathologique de pneumopathie interstitielle non spécifique peut se
rencontrer au cours des contextes étiologiques suivants :
A - sclérodermie systémique
B - myopathie idiopathique inflammatoire
C - syndrome de Gougerot-Sjögren
D - prise médicamenteuse
E - exposition à l'amiante
5/ Parmi les affections suivantes, quelles sont celles qui sont considérées comme liées au
tabagisme :
A - pneumopathie interstitielle non spécifique
B - pneumopathie interstitielle desquamative
C - pneumopathie organisée cryptogénique
D - bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle
E - pneumopathie interstitielle aiguë
Réponses
1/ La fibrose pulmonaire idiopathique :
Les réponses sont : A, D et E
2/ Une efficacité sur la survie a été démontrée au cours de la fibrose pulmonaire
idiopathique pour les traitements suivants :
La réponse est : E
3/ Les éléments suivants appartiennent aux critères du diagnostic tomodensitométrique
de la fibrose pulmonaire idiopathique :
Les réponses sont : A, B et D
4/ Un aspect histopathologique de pneumopathie interstitielle non spécifique peut se
rencontrer au cours des contextes étiologiques suivants :
Les réponses sont : A, B, C et D
5/ Parmi les affections suivantes, quelles sont celles qui sont considérées comme liées au
tabagisme :
Les réponses sont : B et D
Tuberculose résistante
Questions
1/ Définition de la tuberculose ultrarésistante (OMS révisé en octobre 2006) :
A - résistance à l'isoniazide + rifampicine
B - résistance à au moins cinq antituberculeux
C - MDR + résistance à un injectable et aux fluoroquinolones
D - résistance à l'isoniazide + rifampicine + trois médicaments de deuxième ligne
2/ L'incidence mondiale de la tuberculose multirésistante est évaluée à :
A - 200 000
B - 400 000
C - 700 000
D - 1 000 0000
3/ Les résultats des méthodes de cultures du BK en milieu liquide :
A - sont obtenus en 4 à 6 semaines
B - sont obtenus en 8 à 10 jours
C - permettent de déterminer la sensibilité aux substances de deuxième ligne
D - il existe plus de faux sensibles et de faux résistants pour l'éthambutol et la streptomycine par
rapport à la méthode de référence
E - ces méthodes sont peu coûteuses et de réalisation aisée dans les pays aux ressources limitées
4/ Un diagnostic moléculaire rapide et fiable est possible par la détection de gènes
associés aux principales résistances :
A - pour la rifampicine et l'isoniazide directement sur un prélèvement positif au direct
B - par hybridation sur bandelettes pour la rifampicine avec l'innolipa RifTB
C - la mutation sur l'inhA est responsable d'une résistance de bas niveau à l'isoniazide croisée avec
une résistance à l'éthionamide
D - la mutation du gène pncA est responsable de la résistance à l'éthambutol
E - les mutations des gènes GyrA et GyrB sont responsables de la résistance aux fluoroquinolones
5/ Quel protocole doit être utilisé en attendant les résultats du deuxième
antibiogramme ?
A - pyrazinamide
B - éthambutol
C - amikacine
D - fluoroquinolone
E - PAS
F - éthionamide
G - cyclosérine
H - linézolide
I - capréomycine
6/ Quelle est la durée habituelle de traitement d'une tuberculose multirésistante ?
A : 12 mois
B : 18 mois dont 1 mois d'aminoside ou apparenté
C : 18 mois dont au moins 12 mois après la négativation des cultures
D : 24 mois dont 6 mois d'aminoside ou apparenté
7/ Concernant les aminosides apparentés :
A - la streptomycine est à utiliser en première intention compte tenu du peu de résistance de
Mycobacterium tuberculosis à cet antibiotique
B - la résistance bacillaire n'est pas croisée entre la streptomycine et les autres aminosides
C - la résistance à la kanamycine n'est habituellement pas croisée à celle de l'amikacine
D - leur toxicité cochléovestibulaire est en relation avec l'accumulation de la substance dans les
liquides labyrinthiques
E - l'insuffisance rénale avec lésions des cellules tubulaires proximales est irréversible sous
aminosides
8/ Concernant les fluoroquinolones :
A - l'effet bactéricide des fluoroquinolones est dû à leur liaison à l'ADN gyrase
B - la résistance de classe n'est pas complète avec l'ensemble des fluoroquinolones
C - les fluoroquinolones ont une activité bactéricide précoce vis-à-vis de Mycobacterium
tuberculosis, mais inférieure à celle de l'isoniazide
D - la résistance aux fluoroquinolones se développe lentement
E - les principaux effets secondaires sont les troubles neuropsychiatriques, des atteintes
tendineuses, des troubles cardiaques et la photosensibilisation cutanée
9/ Concernant l'éthionamide :
A - l'éthionamide comme l'isoniazide est un dérivé de l'acide nicotinique inhibant la synthèse de
l'acide mycolique
B - l'éthionamide à haute concentration tissulaire est bactéricide vis-à-vis de Mycobacterium
tuberculosis
C - il diffuse bien dans tous les organes y compris le LCR
D - il diminue la neurotoxicité de la cyclosérine
E - associé au PAS, il majore les risques de dysthyroïdie et d'hépatotoxicité
10/ Citez les médicaments nécessitant des précautions d'emploi en cas d'insuffisance
rénale :
A - isoniazide
B - pyrazinamide
C - éthambutol
D - cyclosérine
E - éthionamide
11/ Citez les médicaments à utiliser avec précaution en cas de troubles psychiatriques :
A - isoniazide
B - pyrazinamide
C - cyclosérine
D - fluoroquinolones
E - PAS
Réponses
1/ Définition de la tuberculose ultrarésistante (OMS révisé en octobre 2006) :
La réponse est : C
2/ L'incidence mondiale de la tuberculose multirésistante est évaluée à :
La réponse est : B
3/ Les résultats des méthodes de cultures du BK en milieu liquide :
Les réponses sont : B, C, D
4/ Un diagnostic moléculaire rapide et fiable est possible par la détection de gènes
associés aux principales résistances :
Les réponses sont : A, B, C, E
5/ Quel protocole doit être utilisé en attendant les résultats du deuxième
antibiogramme ?
Les réponses sont : D, E, F, G, I ou A, D, E, F, G, I
6/ Quelle est la durée habituelle de traitement d'une tuberculose multirésistante ?
Réponse : C
7/ Concernant les aminosides apparentés :
Les réponses sont : B, D
8/ Concernant les fluoroquinolones :
Les réponses sont : A, C, E
9/ Concernant l'éthionamide :
Les réponses sont : A, B, E
10/ Citez les médicaments nécessitant des précautions d'emploi en cas d'insuffisance
rénale :
Les réponses sont : toutes les réponses sont justes.
11/ Citez les medicaments à utiliser avec précaution en cas de troubles psychiatriques :
Les réponses sont : A, C, D
QCM © UMVF - Université Médicale Virtuelle Francophone QUESTION 1/3 :
Lors d’une pleurésie, on rencontre les anomalies suivantes :
A - Augmentation des vibrations vocales
B - Diminution des vibrations vocales
C - Matité à la percussion
D - Tympanisme à la percussion
E - Présence d’un souffle tubaire
F - Présence d’un souffle pleurétique
G - Présence de râles crépitants inspiratoires
H - Diminution de la transmission vocale à l’auscultation
I - Augmentation de la transmission vocale à l’auscultation
K - Présence d’un frottement pleural (Réponse : BCFHK )
QCM QUESTION 2/3 : Lors d’un pneumothorax, on rencontre les anomalies suivantes :
A - Augmentation des vibrations vocales
B - Diminution des vibrations vocales
C - Matité à la percussion
D - Tympanisme à la percussion
E - Présence d’un souffle tubaire
F - Présence d’un souffle pleurétique
G - Présence de râles crépitants inspiratoires
H - Diminution de la transmission vocale à l’auscultation
I - Augmentation de la transmission vocale à l’auscultation
K - Présence d’un frottement pleural
Reponse BDH
QUESTION 3/3 : Lors d’un syndrome de condensation alvéolaire, on rencontre les anomalies
suivantes :
A - Augmentation des vibrations vocales
B - Diminution des vibrations vocales
C - Matité à la percussion
D - Tympanisme à la percussion
E - Présence d’un souffle tubaire
F - Présence d’un souffle pleurétique
G - Présence de râles crépitants inspiratoires
H - Diminution de la transmission vocale à l’auscultation
I - Augmentation de la transmission vocale à l’auscultation
K - Présence d’un frottement pleural (Réponse ACEGI )
QCM PNO
QCM 1 : Toutes les propositions suivantes concernant le pneumothorax sont vraies, sauf
une, laquelle ?
A. Il réalise une
B. hyperclarté thoracique Le poumon rétracté est visible au niveau du hile
C.Le pneumothorax est mieux visible en inspiration qu’en expiration
D. Il peut ne pas être visible qu’au sommet
E. Abondant, il refoule le médiastin vers le côté opposé
QCM 2 Quels sont, parmi les signes suivants, ceux qui s’obervent au cours d’un pneumothorax
?
A. Hypersonorité
B. Diminution du murmure vésiculaire C.Matité
D.Exagération des vibrations vocales E.Frottement pleural
QCM 4 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au traitement d’un premier
épisode de pneumothorax spontané, avec poumon rétracté au hile, chez un sujet jeune ?
A. Kinésithérapie respiratoire
B. Décortication chirurgicale
C. Evacuation par drainage thoracique. D Pleurectomie
E. Injection de talc dans la plèvre
Vous aimerez peut-être aussi
- Enoncés: Exercice N°2Document10 pagesEnoncés: Exercice N°2Niang75% (4)
- DR 4Document1 pageDR 4NiangPas encore d'évaluation
- Iexo CardiaqDocument2 pagesIexo CardiaqNiangPas encore d'évaluation
- ITEM 343: Insuffisance Rénale Aiguë - Anurie: QuestionsDocument7 pagesITEM 343: Insuffisance Rénale Aiguë - Anurie: QuestionsNiangPas encore d'évaluation
- Composition Du 2eme Trimestre 2022Document1 pageComposition Du 2eme Trimestre 2022NiangPas encore d'évaluation
- Urgences6an-Medicaments Essentiels2020achourDocument26 pagesUrgences6an-Medicaments Essentiels2020achourNiangPas encore d'évaluation
- DR 3Document1 pageDR 3NiangPas encore d'évaluation
- DevoirDocument1 pageDevoirNiangPas encore d'évaluation
- DrreproDocument1 pageDrreproNiangPas encore d'évaluation
- Infectieux4an-Sepsis Bgn2020berbadjDocument26 pagesInfectieux4an-Sepsis Bgn2020berbadjNiangPas encore d'évaluation
- Vaxilor Cas Clinique NEPHRODocument8 pagesVaxilor Cas Clinique NEPHRONiangPas encore d'évaluation
- Sommaire: Les Items de l'ECN Sont Présentés Par Nombre de Questions Isolées Et TombabilitéDocument1 pageSommaire: Les Items de l'ECN Sont Présentés Par Nombre de Questions Isolées Et TombabilitéNiangPas encore d'évaluation
- Radio3an-Exploration Pulmonaire2019lechehbDocument71 pagesRadio3an-Exploration Pulmonaire2019lechehbNiangPas encore d'évaluation
- Repro 1Document1 pageRepro 1NiangPas encore d'évaluation
- Gyneco05 Td-Metrorragie 3eme TrimestreDocument4 pagesGyneco05 Td-Metrorragie 3eme TrimestreNiangPas encore d'évaluation
- QCM NephrologieDocument20 pagesQCM NephrologieNiangPas encore d'évaluation
- Annales - Médecine - Lyon Est - 2010-2011 - DCEM3Document28 pagesAnnales - Médecine - Lyon Est - 2010-2011 - DCEM3NiangPas encore d'évaluation
- Gyneco5an Map2019bichaDocument32 pagesGyneco5an Map2019bichaNiangPas encore d'évaluation
- Neuro4an-Myasthenie Syndromes Myastheniques2022serradjDocument15 pagesNeuro4an-Myasthenie Syndromes Myastheniques2022serradjNiangPas encore d'évaluation
- Evaluation Os MusclesDocument2 pagesEvaluation Os MusclesNiangPas encore d'évaluation
- Gynecologie - ObstetriqueDocument7 pagesGynecologie - ObstetriqueNiangPas encore d'évaluation
- Souffrance Fœtale Chronique Et Retard de Croissance IntraDocument20 pagesSouffrance Fœtale Chronique Et Retard de Croissance IntraNiangPas encore d'évaluation
- Gyneco5an-Presentations Dystociques2019saidiDocument36 pagesGyneco5an-Presentations Dystociques2019saidiNiangPas encore d'évaluation
- Urgences Abdominales Et GrossesseDocument34 pagesUrgences Abdominales Et GrossesseNiangPas encore d'évaluation
- HémotysieDocument55 pagesHémotysieNiangPas encore d'évaluation
- Insuffisance-Respiratoire-AigueDocument54 pagesInsuffisance-Respiratoire-AigueNiangPas encore d'évaluation
- Cours-Sarcoidose - 2020Document64 pagesCours-Sarcoidose - 2020NiangPas encore d'évaluation
- GVVGKDocument5 pagesGVVGKNiangPas encore d'évaluation
- Exo PR 7dDocument2 pagesExo PR 7dNiangPas encore d'évaluation
- Pneumothorax-2020Document78 pagesPneumothorax-2020Niang100% (1)
- L'Appareil Respiratoire Humain 2Document2 pagesL'Appareil Respiratoire Humain 2Hritcu CatalinaPas encore d'évaluation
- Guide SVT 1ac Print-Final-1Document108 pagesGuide SVT 1ac Print-Final-1ennassikiPas encore d'évaluation
- Bronchopneumopathie Chronique Obstructive BPCODocument17 pagesBronchopneumopathie Chronique Obstructive BPCOAhmed Dbb100% (1)
- Pfe Biomedical 2Document51 pagesPfe Biomedical 2Haitem KhelfatPas encore d'évaluation
- Exo Anatomie SystemiqueDocument118 pagesExo Anatomie SystemiquePatrick EvinaPas encore d'évaluation
- Tuberculose Pulmonaire-Aspects RadiologiquesDocument46 pagesTuberculose Pulmonaire-Aspects Radiologiquesmerige673642Pas encore d'évaluation
- Item 360 PNEUMOTHORAX 2021 Ex Item 3561Document15 pagesItem 360 PNEUMOTHORAX 2021 Ex Item 3561KarimPas encore d'évaluation
- Physio Resp 2020-1Document235 pagesPhysio Resp 2020-1Sabrina MubengaPas encore d'évaluation
- Examens Physiques RespiratoireDocument13 pagesExamens Physiques RespiratoireAbdou Zerbo bekalePas encore d'évaluation
- Detresse Respiratoire Du NourrissonDocument22 pagesDetresse Respiratoire Du NourrissonErick AndersonPas encore d'évaluation
- Correction TD Physiologie AnimaleDocument6 pagesCorrection TD Physiologie Animaleabdoulay100% (1)
- Physio RespirationDocument40 pagesPhysio RespirationEric Charles HadjiPas encore d'évaluation
- Trauma-Thoracique 0000Document35 pagesTrauma-Thoracique 0000ElbordjiPas encore d'évaluation
- Stryker 40L ManualDocument84 pagesStryker 40L Manualxavier antezanaPas encore d'évaluation
- OAP PharmatieDocument29 pagesOAP PharmatieanessafkPas encore d'évaluation
- KInésithérapie Respiratoire en Service de Réanimation 2Document21 pagesKInésithérapie Respiratoire en Service de Réanimation 2baptistechabance1Pas encore d'évaluation
- La RespirationDocument4 pagesLa Respirationlibourkilaila322Pas encore d'évaluation
- Corrige DMDocument2 pagesCorrige DMbourimn3374Pas encore d'évaluation
- Oxygénothérapie, Conventionnelle Et À Haut Débit.: Dr. Emna Ennouri, Réanimation Médicale, Farhat Hached, So UsseDocument47 pagesOxygénothérapie, Conventionnelle Et À Haut Débit.: Dr. Emna Ennouri, Réanimation Médicale, Farhat Hached, So UsseAdel DekPas encore d'évaluation
- Physiologie RespiratoireDocument48 pagesPhysiologie RespiratoireFranky StonePas encore d'évaluation