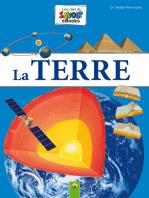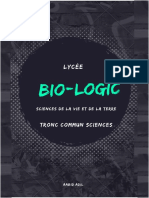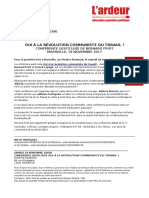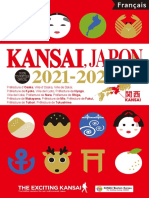Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Résumé L2 Sciences-Biologiques Ecologie-Générale
Transféré par
PLX SteelFaktoryTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Résumé L2 Sciences-Biologiques Ecologie-Générale
Transféré par
PLX SteelFaktoryDroits d'auteur :
Formats disponibles
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
INTRODUCTION
1. Définition
Le mot « écologie » a été crée partir de deux mots grecs : oikos qui veut dire : maison, habitat, et logos
qui signifie science.
L’écologie apparaît donc comme la science de l’habitat, étudiant les conditions d'existence des êtres
vivants et les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux.
2. Notion de système écologique : Ecosystème
Un écosystème est par définition un système, c’est-à-dire un ensemble d’éléments en interaction les uns
avec les autres. C’est un système biologique formé par deux éléments indissociables, la biocénose et le
biotope.
La biocénose est l’ensemble des organismes qui vivent ensemble (zoocénose, phytocénose)
Le biotope (écotope) est le fragment de la biosphère qui fournit à la biocénose le milieu abiotique
indispensable.
La biosphère est la partie de l’écorce terrestre où la vie est possible. La biosphère comprend une partie
de la lithosphère ; une partie de l’atmosphère.
Exemple : une forêt constituée d’arbres, de plantes herbacées, d’animaux et d’un sol.
Ecosystème : forêt.
Biocénose : phytocénose (arbres, plantes herbacées) et zoocénose (animaux).
Biotope : sol.
Suivant l’échelle de l’écosystème nous avons :
- un micro-écosystème : exemple un arbre ;
- un méso-écosystème : exemple une forêt ;
- un macro-écosystème : exemple une région.
Un individu est un spécimen d’une espèce donnée.
Une population est un groupe d’individus de la même espèce occupant un territoire particulier à une
période donnée.
Une communauté ou biocénose est l’ensemble des populations d’un même milieu, peuplement animal
(zoocénose) et peuplement végétal (phytocénose) qui vivent dans les mêmes conditions de milieu et au
voisinage les uns des autres.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 1
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
CHAPITRE I. FACTEURS DU MILIEU
Notion de facteur écologique
On appelle « facteur écologique » tout élément du milieu pouvant agir directement sur les êtres vivants au
moins durant une phase de leur cycle de vie.
Les facteurs écologiques sont de deux types :
Facteurs abiotiques : ensemble des caractéristiques physico-chimiques du milieu tel que les facteurs
climatiques et édaphiques.
Facteurs biotiques : ensemble des interactions qui existent entre des individus de la même espèce ou
d’espèces différentes.
I.1. Facteurs abiotiques
A- Facteurs climatiques
1. Définition du climat
Le climat est l'ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques propres à une région du globe.
2. Principaux facteurs climatiques
2.1. Température
La grande majorité des êtres vivants ne peut subsister que dans un intervalle de températures comprise
entre 0 et 50°C en moyenne. Les températures trop basses ou trop élevées déclenchent chez certains
animaux un état de dormance appelé estivation ou hibernation.
2.2. Humidité et pluviosité
L’eau représente de 70 à 90% des tissus de beaucoup d’espèces en état de vie active. En fonction de leurs
besoins en eaux, et par conséquent de leur répartition dans les milieux, on distingue :
Des espèces aquatiques qui vivent dans l’eau en permanence (ex : poissons) ;
Des espèces hygrophiles qui vivent dans des milieux humides (ex : amphibiens) ;
Des espèces mésophiles dont les besoins en eau sont modérés et qui supportent des alternances de
saison sèche et de saison humide ;
Des espèces xérophiles qui vivent dans les milieux secs où le déficit en eau est accentué (espèces des
déserts).
Les êtres vivants s’adaptent à la sécheresse selon des modalités très variées :
Chez les végétaux
Réduction de l’évapotranspiration par développement de structures cuticulaires imperméables.
Réduction du nombre de stomates.
Réduction de la surface des feuilles qui sont transformées en écailles ou en épines.
Le végétal assure son alimentation en eau grâce à un appareil souterrain puissant.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 2
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
Chez les animaux
Utilisation de l’eau contenue dans les aliments.
Réduction de l’excrétion de l’eau par émission d’une urine de plus en plus concentrée.
Utilisation de l’eau du métabolisme formée par l’oxydation des graisses (dromadaire).
2.3. Lumière et ensoleillement
L’ensoleillement est défini comme étant la durée pendant laquelle le soleil a brillé.
L’éclairement a une action importante non seulement par son intensité et sa nature (longueur d’onde)
mais aussi par la durée de son action (photopériode).
Action sur les végétaux
Les végétaux sont adaptés à l’intensité et à la durée de l’éclairement. Cette adaptation est importante
lorsque les végétaux passent du stade végétatif (phase de croissance et de développement) au stade
reproductif (floraison).
Les végétaux peuvent être divisés en trois catégories :
Les végétaux de jours courts : ils ne fleuriront que si la photopériode au moment de l’éclosion des
bourgeons est inférieure ou égale à 12h d’éclairement.
Les végétaux de jours longs : qui ont besoin pour fleurir d’au moins 12h d’éclairement.
Les indifférents : la durée d’éclairement ne joue aucun rôle dans la floraison.
Action sur les animaux
Chez les animaux, le rôle essentiel de la photopériode réside dans l’entretien des rythmes biologiques
saisonniers, quotidiens (circadiens) ou lunaires.
Rythmes biologiques saisonniers : ils sont de deux types :
- Rythme de reproduction chez les vertébrés : ils ont pour résultat de faire coïncider la période de
reproduction avec la saison favorable.
- Diapause : la photopériode est le facteur essentiel qui déclenche chez l’animal l’entrée en
diapause avant que ne survienne la saison défavorable.
Rythmes quotidiens ou circadiens
Il s’agit de rythmes dont la période est égale à 24h. Ils sont entretenus par un mécanisme interne mal
connu appelé « horloge biologique », dont le réglage est conditionné par l’éclairement et la température.
Rythmes lunaires
Il s’agit de rythmes d’activité déclenchés par la lumière lunaire. Ils sont surtout connus chez les animaux
marins.
2.4. Vent
L’impact de ce facteur sur les êtres vivants peut se résumer comme suit :
Il a un pouvoir desséchant car il augmente l’évaporation.
Il a aussi un pouvoir de refroidissement considérable.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 3
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
L’activité des insectes est ralentie par le vent.
2.5. Neige
C’est un facteur écologique important en montagne. La couverture de neige protège le sol du
refroidissement. Sous un mètre de neige, la température du sol est de -0,6°C, alors qu’elle est de -33,7°C
à la surface.
B- Facteurs édaphiques
1. Définition du sol
Le sol est un milieu vivant complexe et dynamique, définit comme étant la formation naturelle de surface,
à structure meuble et d'épaisseur variable, résultant de la transformation de la roche mère sous-jacente
sous l'influence de divers processus : physiques, chimiques et biologiques, au contact de l'atmosphère et
des êtres vivants. Il est formé d'une fraction minérale et de matière organique.
Les facteurs édaphiques
1.1. La texture du sol
La texture du sol est définie par la grosseur des particules qui le composent : graviers, sables, limons,
argiles.
Particule Diamètre
Graviers >2 mm
Sables grossiers 2 mm à 0,2 mm
Sables fins 0,2 mm à 20 µm
Limons 20 µm à 2µm
Argiles < 2µm
On détermine les textures suivantes :
Textures fines : comportent un taux élevé d’argile (>20%) et correspondent à des sols dits « lourds »,
difficiles à travailler, mais qui présentent un optimum de rétention d’eau.
Textures sableuses ou grossières : elles caractérisent les sols légers manquant de cohésion.
Textures moyennes : on distingue deux types :
- Les limons argilo-sableux qui ne contiennent pas plus de 30 à 35% de limons, qui ont une texture
parfaitement équilibrée et qui correspond aux meilleurs terres dites « franches ».
- Les sols à texture limoneuse, qui contiennent plus de 35% de limons, sont pauvres en humus.
1.2. La structure du sol
La structure est l'organisation du sol. On distingue principalement trois types de structures :
Particulaire : où les éléments du sol ne sont pas liés, le sol est très meuble (sols sableux).
Massive : où les éléments du sol sont liés par des ciments (matière organique, calcaire). Ce type de
sol est compact et peu poreux.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 4
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
Fragmentaire : où les éléments sont liés par des matières organiques et forment des agrégats de
tailles plus ou moins importantes. Cette structure est la plus favorable à la vie des êtres vivants, car
elle favorise l’activité biologique en général, en permettant la circulation de l’air et de l’eau.
1.3. L’eau du sol
L’eau hygroscopique : provient de l’humidité atmosphérique et forme une mince pellicule autour des
particules du sol. Elle est retenue très énergiquement et ne peut être utilisée par les organismes
vivants.
L’eau capillaire non absorbable : occupe les pores d’un diamètre inférieur à 0,2 mm. Elle est
également retenue trop énergiquement pour être utilisée par les organismes vivants.
L’eau capillaire absorbable : située dans les pores dont les dimensions sont comprises entre 0,2 et
0,8mm. Elle est absorbée par les végétaux et elle permet l’activité des bactéries et des petits
Protozoaires comme les flagellés.
L’eau de gravité : occupe de façon temporaire les plus grands pores du sol.
1.4. Le pH du sol
Les organismes vivants tels que les Protozoaires supportent des variations de pH de 3,9 à 9,7 suivant les
espèces : certaines sont plutôt acidophiles alors que d’autres sont basophiles. Les neutrophiles sont les
plus représentées dans la nature.
1.5. La composition chimique
Les éléments les plus étudiés en ce qui concerne leur action sur la faune et la flore sont les chlorures et le
calcium.
Les sols salés, ayant des teneurs importantes en chlorure de sodium, ont une flore et une faune très
particulière. Les plantes des sols salés sont des halophytes.
En fonction de leurs préférences, les plantes sont classées en calcicoles (espèces capables de supporter
des teneurs élevées en calcaire), et calcifuges (espèces qui ne supportent que de faibles traces de
calcium).
Les sols dits anormaux renferment de fortes concentrations d’éléments plus ou moins toxiques : soufre,
magnésium…etc.
I. 2. Facteurs biotiques
Les facteurs biotiques sont l’ensemble des actions que les organismes vivants exercent directement les
uns sur les autres. Ces interactions, appelées coactions, sont de deux types :
Homotypiques ou intraspécifiques, lorsqu’elles se produisent entre individus de la même espèce.
Hétérotypiques ou interspécifiques, lorsqu’elles ont lieu entre individus d’espèces différentes.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 5
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
1. Coactions homotypiques
1.1. L’effet de groupe
On parle d’effet de groupe lorsque des modifications ont lieu chez des animaux de la même espèce.
L’effet de groupe est connu chez de nombreuses espèces d’insectes ou de vertébrés, qui ne peuvent se
reproduire normalement et survivre que lorsqu’elles sont représentées par des populations assez
nombreuses.
Exemple : On estime qu’un troupeau d’éléphants d’Afrique doit renfermer au moins 25 individus pour
pouvoir survivre.
L’effet de masse
L’effet de masse se produit, quand le milieu, souvent surpeuplé, provoque une compétition sévère aux
conséquences néfastes pour les individus. Les effets néfastes de ces compétitions ont des conséquences
sur le métabolisme et la physiologie des individus qui se traduisent par des perturbations, comme la
baisse du taux de fécondité, la diminution de la natalité, l’augmentation de la mortalité.
La compétition intraspécifique
Apparaît dans les comportements territoriaux, c’est-à-dire lorsque l’animal défend une certaine
surface contre les incursions des autres individus.
Le maintien d’une hiérarchie sociale avec des individus dominants et des individus dominés.
La compétition alimentaire entre individus de la même espèce est intense quand la densité de la
population devient élevée.
Chez les végétaux, la compétition intraspécifique, liée aux fortes densités se fait surtout pour l’eau et la
lumière.
2. Coactions hétérotypiques
2.1. Le neutralisme
On parle de neutralisme lorsque les deux espèces sont indépendantes : elles cohabitent sans avoir aucune
influence l’une sur l’autre.
2.2. La compétition interspécifique
La compétition interspécifique peut être définit comme étant la recherche active d’une même ressource du
milieu (nourriture, abri, lieu de ponte, etc…).
Cependant, deux espèces ayant exactement les mêmes besoins ne peuvent cohabiter, l’une d’elle étant
forcément éliminée au bout d’un certain temps. C’est le principe de Gause ou principe d’exclusion
compétitive.
2.3. La prédation
Le prédateur est tout organisme libre qui se nourrit aux dépend d’un autre. Il tue sa proie pour la manger.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 6
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
2.4. Le parasitisme
Le parasite est un organisme qui ne mène pas une vie libre : il est au moins, à un stade de son
développement, lié à la surface (ectoparasite) ou à l’intérieur (endoparasite) de son hôte.
2.5. Le commensalisme
Interaction entre une espèce, dite commensale, qui en tire profit de l’association et une espèce hôte qui
n’en tire ni avantage ni nuisance.
2.6. Le mutualisme
C’est une interaction dans laquelle les deux partenaires trouvent un avantage.
Exemple : Les graines des arbres doivent être dispersées au loin pour survivre et germer. Cette dispersion
est l’œuvre d’oiseaux, de singes…qui en tirent profit de l’arbre (alimentation, abri…).
L’association obligatoire et indispensable entre deux espèces est une forme de mutualisme à laquelle on
réserve le nom de symbiose. Dans cette association, chaque espèce ne peut survivre, croitre et se
développer qu’en présence de l’autre.
Exemple : Les lichens sont formés par l’association d’une algue et d’un champignon.
2.3. L’amensalisme
C’est une interaction dans laquelle une espèce est éliminée par une autre espèce qui secrète une substance
toxique.
I.3. Interaction des milieux et des êtres vivants
Les êtres vivants sont éliminés totalement, ou bien leurs effectifs sont fortement réduits lorsque l’intensité
des facteurs écologiques est proche des limites de tolérance ou les dépasse.
A. Notion de niche écologique
Les organismes d’une espèce donnée peuvent maintenir des populations viables seulement dans un certain
registre de conditions, pour des ressources particulières, dans un environnement donné et pendant des
périodes particulières. Le recoupement de ces facteurs décrit la niche, qui est la position que l’organisme
occupe dans son environnement, comprenant les conditions dans lesquelles il est trouvé, les ressources
qu’il utilise et le temps qu’il y passe.
Les organismes peuvent changer de niches quand ils se développent.
B. Notion de facteur limitant et loi du minimum
Tous les facteurs écologiques sont susceptibles de se comporter comme des facteurs limitant lorsqu'ils
atteignent des valeurs incompatibles avec la vie d'une espèce. Par exemple, la truite nécessite une eau
dont la concentration en O2 dissous est au moins de 7 mg/l.
La loi du minimum dit que " la croissance des végétaux n'est possible que si tous les éléments minéraux
sont présents en quantité suffisante dans le sol.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 7
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
C. Loi de tolérance (ou loi de Shelford)
Pour tout facteur de l'environnement, il existe un intervalle de tolérance pour un bon déroulement de la
vie. C’est seulement à l’intérieur de cet intervalle que la vie de tel ou tel organisme, population ou
biocénose est possible. La borne inférieure le long de ce gradient délimite la mort par carence, la borne
supérieure délimite la mort par toxicité. A l’intérieur de l’intervalle de tolérance, existe une valeur
optimale, dénommée « optimum écologique » pour lesquelles le métabolisme de l’espèce ou de la
communauté considérée s’effectue à une vitesse maximale (Figure 1).
E. Notion de Valence écologique
La valence écologique d'une espèce représente sa capacité à supporter les variations plus ou moins
grandes d'un facteur écologique.
Une espèce à forte valence écologique c’est-à-dire capable de peupler des milieux très différents et
supporter des variations importantes de l’intensité des facteurs écologiques, est dite euryèce.
Une espèce à faible valence écologique ne pourra supporter que des variations limitées des facteurs
écologiques, elle est dite sténoèce.
Une espèce à valence écologique moyenne, est dite mesoèce.
LIMITES DE TOLERANCE DE
L’ESPECE
ZONE OPTIMALE
(Conditions létales)
(Conditions létales)
(conditions défavorables)
(conditions défavorables)
Espèce absente
Espèce absente
Espèce rare
Espèce rare
Espèce abondante
(Conditions optimales)
Minimum Optimum Maximum
Intensité du facteur écologique
Figure 01 : Limites de tolérance d’une espèce en fonction de l’intensité du facteur écologique étudié.
(L’abondance de l’espèce est maximale au voisinage de l’optimum écologique).
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 8
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
CHAPITRE II. STRUCTURE DES ECOSYSTEMES
II.1. La chaîne trophique
II.1.1. Définition
Une chaîne trophique ou chaîne alimentaire est une succession d’organismes dont chacun vit au dépend
du précédent. Tout écosystème comporte un ensemble d’espèces animales et végétales qui peuvent êtres
réparties en trois groupes : les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs.
II.1.2. Les producteurs
Ce sont les végétaux autotrophes photosynthétiques (plantes vertes, phytoplancton : cyanobactéries ou
algues bleus : organisme procaryote).
II.1.3. Les consommateurs
Il s’agit d’êtres vivants, dits hétérotrophes, qui se nourrissent des matières organiques complexes déjà
élaborées qu’ils prélèvent sur d’autres êtres vivants.
A. Les consommateurs de matière fraiche, il s’agit de :
Consommateurs primaires (C1) : Ce sont les phytophages qui mangent les producteurs. Ce sont
en général des animaux, appelés herbivores.
Consommateurs secondaires (C2) : Prédateurs de C1. Il s’agit de carnivores se nourrissant
d’herbivores.
Consommateurs tertiaires (C3) : Prédateurs de C2. Ce sont donc des carnivores qui se
nourrissent de carnivores.
B. Les consommateurs de cadavres d’animaux
Les charognards ou nécrophages désignent les espèces qui se nourrissent des cadavres d’animaux frais
ou décomposés. Exemple : Chacal, Vautour,…
B.1. Les décomposeurs ou détritivores
Les décomposeurs s’attaquent aux cadavres et aux excrétas et les décomposent peu à peu en assurant le
retour progressif au monde minéral.
Saprophyte : Organisme végétal se nourrissant de matières organiques en cours de décomposition.
Saprophage : Organisme animal qui se nourrit de matières organiques en cours de décomposition.
Détritivore : Invertébré qui se nourrit de détritus ou débris d’animaux et/ou de végétaux.
Coprophage : Animal qui se nourrit d’excréments.
B.2. Les fixateurs d’azote
Ils ont une position particulière dans la chaîne trophique. Leur nutrition azotée se fait à partir de l’azote
moléculaire. Ils sont donc autotrophes pour ce qui est de l’azote et hétérotrophes du point de vue carbone.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 9
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
II.2. Différents types de chaînes trophiques
Chaîne de prédateurs
Dans cette chaîne, le nombre d’individus diminue d’un niveau trophique à l’autre, mais leurs tailles
augmentent.
Exemple : (100) Producteurs + (3) Herbivores + (1) Carnivore.
Chaîne de parasites
Cela va d’organismes de grandes tailles vers des organismes plus petits, mais de plus en plus
nombreux.
Exemple : (50) Herbes + (2) Mammifères herbivores + (80) Puces + (150) Leptomonas.
Chaîne de détritivores
Va de la matière organique morte vers des organismes de plus en plus petits et nombreux.
Exemple : (1) Cadavre + (80) Nématodes + (250) Bactéries.
II.3. Représentation graphique des chaînes trophiques
a) La pyramide des nombres
À la base de cette pyramide se trouve habituellement le niveau trophique inférieur de toute chaîne
alimentaire : celui des producteurs (les végétaux) au-dessus duquel s’empilent les niveaux trophiques
supérieurs. Les pyramides des nombres n’ont pas toutes une base plus large que le sommet.
Cette représentation pourrait illustrer la chaîne
alimentaire suivante :
herbe - sauterelle - grenouille -faucon.
Cette représentation pourrait illustrer la chaîne
alimentaire suivante :
herbe - lapin - renard - puces.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 10
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
b) La pyramide des biomasses
Les pyramides des biomasses sont utiles pour comparer, en termes de masse totale des organismes, les
niveaux trophiques d’une chaîne alimentaire. La forme des pyramides des biomasses est relativement
constante : la biomasse décroît au fur et à mesure que le niveau trophique est plus élevé.
c) La pyramide d’énergie
Ni la pyramide des nombres, ni la pyramide des biomasses ne renseignent sur l’aspect énergétique associé
à un aliment bien que cet aspect soit important à considérer dans une chaîne alimentaire.
Exemple : 500 g d’herbes n’a pas la même importance énergétique que 500 g de viande.
CHAPITRE III. FONCTIONNEMENT DES ECOSYSTEMES
III.1. Définition
Productivité brute (PB): Quantité de matière vivante produite pendant une unité de temps, par un
niveau trophique donné.
Productivité nette (PN): Productivité brute moins la quantité de matière vivante dégradée par la
respiration. PN = PB – R.
Productivité primaire : Productivité nette des autotrophes chlorophylliens.
Productivité secondaire : Productivité nette des herbivores, des carnivores et des décomposeurs.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 11
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
III.2. Transfert d’énergie
Les relations trophiques qui existent entre les niveaux d’une chaîne trophique se traduisent par des
transferts d’énergie d’un niveau à l’autre.
Une partie de la lumière solaire absorbée par le végétal est dissipée sous forme de chaleur.
Le reste est utilisé pour la synthèse de substances organiques (photosynthèse) et correspond à la
Productivité primaire Brute (PB).
Une partie de (PB) est perdue pour la Respiration (R1).
Le reste constitue la Productivité primaire Nette (PN).
Une partie de (PN) sert à l’augmentation de la biomasse végétale avant d’être la proie des bactéries et
des autres décomposeurs.
Le reste de (PN), sert d’aliment aux herbivores qui absorbent ainsi une quantité d’énergie Ingérée
(I1).
La quantité d’énergie ingérée (I1) correspond à ce qui réellement utilisé ou Assimilé (A1) par
l’herbivore, plus ce qui est rejeté (Non Assimilée) (NA1) sous la forme d’excréments et de déchets :
I1= A1+ NA1
La fraction assimilée (A1) sert d’une part à la Productivité Secondaire (PS1) et d’autre part aux
dépenses Respiratoires (R2).
On peut continuer le même raisonnement pour les carnivores.
III.3. Les rendements
On peut donc caractériser les divers organismes du point de vue bioénergétique, par leur aptitude à
diminuer ces pertes d’énergie. Cette aptitude est évaluée par les calculs de rendements :
Rendement écologique : C’est le rapport de la production nette du niveau trophique de rang (n) à la
production nette du niveau trophique de rang (n-1) : (PS1/PN x 100) ou (PS2/PS1 x 100).
Rendement d’exploitation : C’est le rapport de l’énergie ingérée (I) à l’énergie disponible. C’est la
production nette de la proie : (I1/PN x 100) ou (I2/PS1x 100).
Rendement de production nette : Qui est le rapport de la production nette à l’énergie assimilée :
(PS2/A2x100) ou (PS1/A1x100).
Rendement d’assimilation : C’est le rapport de l’énergie assimilée (A) à l’énergie ingérée (I). Ce
rendement exprime l’aptitude d’une espèce à utiliser l’énergie contenue dans les aliments : (A1/I1 x
100) ou (A2/I2x 100).
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 12
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
III.5. Les cycles biogéochimiques
On peut distinguer 4 principaux types de cycles biogéochimiques :
5.1. Le cycle de l'eau
Le cycle de l'eau consiste en un échange d'eau entre les différents compartiments de la Terre :
l'hydrosphère, l'atmosphère et la lithosphère.
Sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des mers, des fleuves et des lacs s'évapore.
L'évapotranspiration joue un rôle également important dans le cycle de l'eau.
Le ruissellement : phénomène d'écoulement des eaux à la surface des sols.
L'infiltration : phénomène de pénétration des eaux dans le sol, à travers les fissures naturelles des sols et
des roches, assurant ainsi l’alimentation des nappes phréatiques.
5.2. Le cycle du carbone
Lors de la respiration, les êtres vivants consomment de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone
(CO2) dans l'atmosphère. De même, les industries, les véhicules de transports rejettent du CO2 dans
l'atmosphère après combustion d'un carburant, en présence d'oxygène. Les éruptions volcaniques sont
également considérées comme source naturelle de CO2. Le CO2 est absorbé par les plantes
(photosynthèse) et l'eau (dissolution). Photosynthèse et dissolution sont les phénomènes permettant le
recyclage du gaz carbonique.
5.3. Le cycle du phosphore
En dépit de la rareté du phosphore minéral dans la biosphère, cet élément reste important pour la matière
vivante (c’est un constituant de l’ADN, de l’ARN et de l’ATP). Son réservoir principal est constitué par
diverses roches qui cèdent peu à peu leurs phosphates aux écosystèmes. Dans le milieu terrestre, la
concentration en phosphore assimilable est souvent faible et joue le rôle de facteur limitant.
5.4. Le cycle de l’azote
Trois processus de base sont impliqués dans le recyclage de l’azote: la fixation de l’azote diatomique N 2,
la nitrification et la dénitrification.
III. 6. Influence des activités humaines sur les équilibres biologiques
6.1. L’eutrophisation
L’eutrophisation est une forme singulière mais naturelle de pollution de certains écosystèmes aquatiques
qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues et que celles-
ci prolifèrent. Les principaux nutriments à l’origine de ce phénomène sont le phosphore et l’azote.
L’eutrophisation s’observe surtout dans les écosystèmes dont les eaux se renouvellent lentement et en
particulier dans les lacs profonds.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 13
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
L'eutrophisation devient un problème écologique (et économique) quand il y a déséquilibre entre un
apport (excessif) et la consommation naturelle de nutriments par l'écosystème. :
Ce milieu déséquilibré est dit dystrophe et peut devenir hypertrophe. Les variations de conditions du
milieu abiotique (oxydo-réduction) ou biotique (sous l'influence de l'activité bactérienne et des racines,
ainsi que du métabolisme végétal, fongique et animal) peuvent faire passer l'azote, le carbone et le
phosphore de l'une de leurs formes à une autre. Or ces formes sont plus ou moins toxiques ou
écotoxiques.
Ce processus a comme principales origines :
- Des épandages agricoles de fumiers, lisiers ou engrais chimiques trop fréquents ou trop
concentrés (en azote et phosphore).
- Des rejets industriels et/ou urbains d'eaux usées ou de boues d'épuration trop riches en nitrates,
ammonium, phosphore et matières organiques incomplètement traitées ;
- La déforestation et les coupes rases qui aggravent le ruissellement du phosphore, et
les incendies de forêts qui sont suivis d'une augmentation des nitrates dans l'eau de ruissellement.
6.2. Les pluies acides
Les pluies acides se forment lorsque les oxydes de soufre et d'azote s'associent à l'humidité de l'air pour
libérer de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique qui sont ensuite transportés très loin de leur source avant
d'être précipités par la pluie sous forme de PLUIES ACIDES.
a) Les gaz qui sont à l'origine des pluies acides
Le dioxyde de soufre : SO2. C'est l'un des plus dangereux gaz et il provient surtout des sources
industrielles et d'électricité mais aussi des combustibles, usines à charbon…etc.
Le dioxyde de carbone : CO2. Ce gaz provient des transports en tout genre, des feux de forêts…etc.
Oxyde d'azote : NOx. Provient essentiellement des combustions de carburants de véhicules automobiles,
des combustibles d'appareils de chauffage domestiques et de l'alimentation des centrales thermiques.
b) Les effets des pluies acides
Les enfants, les personnes âgées et celles qui ont des problèmes respiratoires et cardiaques voient leur état
de santé se détériorer lorsqu'ils vivent dans des régions où il y a des pluies acides. Les différents
composants de notre environnement peuvent être affectés par les pluies acides : eaux, sol, matériaux et
végétaux.
- Les conséquences sur l'eau et la vie des lacs : L'eau parait plus transparente car le plancton a
disparu. Les poissons respirent mal. Les différentes espèces disparaissent.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 14
ECOLOGIE GENERALE/ Résumé du cours Dr. Fellah F.
- Les conséquences sur les matériaux : Lorsque les précipitations lavent l'atmosphère de ses
polluants, pratiquement tout l'ensemble des différents matériaux ou monuments est susceptible
d'être dégradé. L'acidification des précipitations entraîne une corrosion des surfaces métalliques
- Les conséquences sur les plantes et les forêts : Les pluies acides participent au dépérissement des
forêts. Sous l'action des polluants la perméabilité de la cuticule des feuilles et des aiguilles est
modifiée.
- Les conséquences sur les sols : Les précipitations acides modifient la composition chimique de
certains sols en les acidifiant. Ces effets se traduisent par une perte d'éléments minéraux nutritifs
pour les arbres et la végétation.
6.3. Effet de serre
Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent à l'effet de serre. Ces
gaz ont pour caractéristique commune d'absorber une partie des infrarouges émis par la surface de la
Terre. Sous l'effet des gaz à effet de serre, l'atmosphère terrestre se comporte en partie comme la vitre
d'une serre, laissant entrer une grosse partie du rayonnement solaire, mais retenant le rayonnement
infrarouge réémis.
Effets des activités humaines
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle. Mais certains d'entre eux sont
uniquement dus à l'activité humaine ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en
raison de cette activité. C'est le cas en particulier de l'ozone (O3), du dioxyde de carbone (CO2) et
du méthane (CH4). La combustion des carbones fossiles comme le charbon, le lignite, le pétrole ou le gaz
naturel (méthane) rejette du CO2 en grande quantité dans l'atmosphère. La seconde cause d'émission de
gaz à effet de serre est la déforestation, qui est responsable à elle seule de 20 % des émissions mondiales.
Conséquences pour l'environnement
L'effet de serre n'est pas en soi nocif aux écosystèmes ; sans lui, la Terre ne serait qu'une boule de
glace où la vie ne serait pas possible, car il n'y aurait pas d'eau liquide. Le danger pour les écosystèmes
réside plutôt dans la variation trop rapide et trop importante des conditions climatiques pour que la
plupart des espèces dites évoluées puissent s'adapter en cas de changements de température et de
pluviométrie. Des écosystèmes marins et littoraux pourraient également être touchés par une hausse
du niveau de la mer et des modifications des courants marins et des conditions physico-chimiques de l'eau
de mer (acidité, taux de gaz dissous…). Les populations humaines seraient évidemment touchées par le
réchauffement climatique. En effet, une hausse des températures aide à la prolifération des maladies
infectieuses puisque celles-ci survivent mieux dans des milieux chauds et humides.
2ème année Sciences Biologiques 2019/2020 15
Vous aimerez peut-être aussi
- Fonctionnement Se Écosystèmes - Partie1 - BOUZERIBADocument7 pagesFonctionnement Se Écosystèmes - Partie1 - BOUZERIBAOussama Bouchetit100% (1)
- 2 Notion de Facteurs EcologiquesDocument6 pages2 Notion de Facteurs Ecologiquesbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- La Terre, sa formation et sa constitution actuelleD'EverandLa Terre, sa formation et sa constitution actuellePas encore d'évaluation
- Facteurs EdaphiqueDocument53 pagesFacteurs EdaphiqueKaouthar IzmanPas encore d'évaluation
- Les Facteurs ClimatiquesDocument5 pagesLes Facteurs ClimatiquesSere100% (2)
- SVT Fait 2Document5 pagesSVT Fait 2Abdoul Aziz ThiombianoPas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2020-11-01 À 18.38.09Document9 pagesCapture D'écran . 2020-11-01 À 18.38.09hamdani hiba0% (1)
- Fascicule Cours 6 IèmeDocument61 pagesFascicule Cours 6 IèmeOne XbetPas encore d'évaluation
- Les Facteurs EdaphiquesDocument5 pagesLes Facteurs Edaphiquesbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Cours SVT 6iemeDocument46 pagesCours SVT 6iemeouedraogoPas encore d'évaluation
- Les Facteurs ClimatiquesDocument10 pagesLes Facteurs ClimatiquesMãř ÝëmPas encore d'évaluation
- Définition de L'aire Minimale - Recherche GoogleDocument1 pageDéfinition de L'aire Minimale - Recherche Googlekn. design221Pas encore d'évaluation
- Cours de SVT 2de CDocument17 pagesCours de SVT 2de CYatie Mamadou DAYOPas encore d'évaluation
- Cours D'histoire Geographie Classe de CinquiemeDocument89 pagesCours D'histoire Geographie Classe de Cinquiemecissemamefana906Pas encore d'évaluation
- Cours SVT 5èDocument49 pagesCours SVT 5èYatie Mamadou DAYO100% (1)
- Cycle MatièreDocument7 pagesCycle Matièrehappy nefPas encore d'évaluation
- Cahier D'activités de SVT 4ème 2023 2024 Normal ÉlèveDocument72 pagesCahier D'activités de SVT 4ème 2023 2024 Normal Élèvediopstart11Pas encore d'évaluation
- Les Facteurs Climatiques Et Leurs Relations Avec Les Etres Vivants CoursDocument14 pagesLes Facteurs Climatiques Et Leurs Relations Avec Les Etres Vivants CoursSalma ElfaroukiPas encore d'évaluation
- Les Facteurs Edaphiques Et Leurs Relations Avec Les Etres Vivants Cours 1Document20 pagesLes Facteurs Edaphiques Et Leurs Relations Avec Les Etres Vivants Cours 1OUSSAMA SBAI100% (1)
- Fiche Technique CriquetDocument2 pagesFiche Technique Criquethugo duboisPas encore d'évaluation
- CHP 2Document10 pagesCHP 2PIPALO•YT KO•Pas encore d'évaluation
- l3 Paleontologie Chap1Document7 pagesl3 Paleontologie Chap1Driss Dama100% (1)
- DocHistoire Série Complète CORRECTIONDocument20 pagesDocHistoire Série Complète CORRECTIONHanounaKHPas encore d'évaluation
- SVT 1ère D - L6 - Les Activités Internes Du Globe TerrestreDocument15 pagesSVT 1ère D - L6 - Les Activités Internes Du Globe TerrestreYedson Grâce100% (2)
- Le Soleil Chap 1 Rayonnement SolaireDocument29 pagesLe Soleil Chap 1 Rayonnement Solaireflo bil100% (1)
- Organismes UnicellulairesDocument2 pagesOrganismes UnicellulairesMARIAPas encore d'évaluation
- La DésertificationDocument2 pagesLa DésertificationMaguie Lune100% (1)
- Correction Devoir SVT Octobre 2017.5Document9 pagesCorrection Devoir SVT Octobre 2017.5Zineb ELPas encore d'évaluation
- Theme Interdependance Des Etres VivantsDocument4 pagesTheme Interdependance Des Etres VivantsONDE KEIBIGUE Oliver100% (1)
- Les Relations AlimentairesDocument21 pagesLes Relations Alimentairesmehdi mabroukiPas encore d'évaluation
- Cours SVT SV 2nde p.36-43Document8 pagesCours SVT SV 2nde p.36-43enzoPas encore d'évaluation
- Evaluation Standadissees 1er Semestre SVT 2nde S 2020-2021 SenegalDocument3 pagesEvaluation Standadissees 1er Semestre SVT 2nde S 2020-2021 SenegalDaouda FallPas encore d'évaluation
- Cours de SVT 6emeDocument26 pagesCours de SVT 6emeYatie Mamadou DAYO100% (3)
- Bioclimatologie - 2Document12 pagesBioclimatologie - 2Kamal KamelPas encore d'évaluation
- Guide Bio-Logic Tronc CommunDocument114 pagesGuide Bio-Logic Tronc CommunAabid AdilPas encore d'évaluation
- Guide 2nde-1Document57 pagesGuide 2nde-1CEG1 DASSA-ZOUMEPas encore d'évaluation
- 2 Devoir 2 Seconde 2016 2017Document2 pages2 Devoir 2 Seconde 2016 2017MOR GUEYEPas encore d'évaluation
- La - Nutrition - Des - Vegetaux SEANCE 6Document3 pagesLa - Nutrition - Des - Vegetaux SEANCE 6Alibi hela0% (1)
- Chapitre II Le Facteur Edaphique Et SonDocument18 pagesChapitre II Le Facteur Edaphique Et SonChaiMaePas encore d'évaluation
- Les Techniques Adaptatives A L Etude Ecologique Sur Le Terrain Cours 1Document12 pagesLes Techniques Adaptatives A L Etude Ecologique Sur Le Terrain Cours 1Naranja 22Pas encore d'évaluation
- Ecologie 1Document3 pagesEcologie 1Oscar LUBOYA100% (1)
- Cours 1 Resp PDFDocument4 pagesCours 1 Resp PDFMouhamadou Tidiane Seck100% (2)
- Concours Miss Sciences: Epreuve de SVT Classe de 2 Durée: 1h30Document3 pagesConcours Miss Sciences: Epreuve de SVT Classe de 2 Durée: 1h30Dahirou kebePas encore d'évaluation
- Questionnaire de GeologieDocument6 pagesQuestionnaire de Geologiejoinvilfeddy9Pas encore d'évaluation
- 1er Devoir Du 2ème Semestre SVT 2nde D 2020-2021 Ceg1 AgatogboDocument2 pages1er Devoir Du 2ème Semestre SVT 2nde D 2020-2021 Ceg1 AgatogboPathe ThionganePas encore d'évaluation
- Chapitre I Spécialisation Cellules 2021Document3 pagesChapitre I Spécialisation Cellules 2021Daba byegoPas encore d'évaluation
- Les Phénomenes Geologiques ExternesDocument27 pagesLes Phénomenes Geologiques Externesrabie dahmaniPas encore d'évaluation
- Les Techniques Adaptatives A L Etude Ecologique Sur Le Terrain Serie D Exercices 1Document6 pagesLes Techniques Adaptatives A L Etude Ecologique Sur Le Terrain Serie D Exercices 1Aya EssamriPas encore d'évaluation
- Bilan Cours Seconde GénétiqueDocument3 pagesBilan Cours Seconde GénétiqueLou Anne Godot100% (1)
- É Preuve Écrite #1 de SVT: Conseils Pour L'épreuveDocument2 pagesÉ Preuve Écrite #1 de SVT: Conseils Pour L'épreuveFirass Biad100% (1)
- Activité 18 - La Production de Matière Organique Par La Plante.Document1 pageActivité 18 - La Production de Matière Organique Par La Plante.BADR-EDDINE OUEZGHARI100% (2)
- Réalisation D'une Sortie ÉcologiqueDocument26 pagesRéalisation D'une Sortie ÉcologiqueEl Mahjoub EssalamiPas encore d'évaluation
- Progression 5èmeDocument14 pagesProgression 5èmeYacouba sanda HadizaPas encore d'évaluation
- 2nde H4 - La Prehistoire en Afrique Et Dans Le Reste Du MondeDocument8 pages2nde H4 - La Prehistoire en Afrique Et Dans Le Reste Du Mondeouagninincouli7Pas encore d'évaluation
- Examen Fondement de L'écologieDocument4 pagesExamen Fondement de L'écologieAmadou Ndiaye0% (1)
- Cours Écopedologie1Document27 pagesCours Écopedologie1nasroddine100% (1)
- L Air Qui Nous Entoure Activites 2Document2 pagesL Air Qui Nous Entoure Activites 2Idrissi KhalidPas encore d'évaluation
- Bac Blanc GéoDocument2 pagesBac Blanc GéoSalahina Koureiche100% (2)
- Bookchin Qu Est Ce Que L Ecologie SocialeDocument55 pagesBookchin Qu Est Ce Que L Ecologie SocialePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Bookchin - L'écologie Sociale Et LibertaireDocument14 pagesBookchin - L'écologie Sociale Et LibertairePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Hayao MiyazakiDocument5 pagesHayao MiyazakiPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- 2019 04 Ecologie Sociale AT SvODocument5 pages2019 04 Ecologie Sociale AT SvOPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Ecologie-Barbarie (LeMondeDiplo Juil2016)Document5 pagesEcologie-Barbarie (LeMondeDiplo Juil2016)PLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Miyazaki HayaoDocument5 pagesMiyazaki HayaoPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- La RucheDocument8 pagesLa RuchePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Murray Bookchin Le Municipalisme LibertaireDocument14 pagesMurray Bookchin Le Municipalisme LibertairePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Écosocialisme Ou Écologie SocialeDocument8 pagesÉcosocialisme Ou Écologie SocialePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Economie Solidaire Socialisme Libertaire-1Document15 pagesEconomie Solidaire Socialisme Libertaire-1PLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Org-Le Mouvement Libertaire - L AnarchieDocument2 pagesOrg-Le Mouvement Libertaire - L AnarchiePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Dossier Pedagogie Critique FinalDocument20 pagesDossier Pedagogie Critique FinalPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- LPL Pédagogie Libertaire LenoirDocument4 pagesLPL Pédagogie Libertaire LenoirPLX SteelFaktory100% (1)
- JM Monde LibertaireDocument17 pagesJM Monde LibertairePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Lutte Des ClassesDocument5 pagesLutte Des ClassesPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Zfirstimpact LIVRET MISSIONS BOX1Document7 pagesZfirstimpact LIVRET MISSIONS BOX1PLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Le Mouvement OuvrierDocument22 pagesLe Mouvement OuvrierPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Propos Sur L Éducation LibertaireDocument6 pagesPropos Sur L Éducation LibertairePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Bernard Friot Gesticule 0Document1 pageBernard Friot Gesticule 0PLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Salaire À Vie DébatDocument7 pagesSalaire À Vie DébatPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Bushido LE CODE DU SAMOURAÏDocument24 pagesBushido LE CODE DU SAMOURAÏPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Alternative Au Revenu de Base Le Salaire À Vie Change Le Travail Et La Pratique de La Valeur RéssalaDocument9 pagesAlternative Au Revenu de Base Le Salaire À Vie Change Le Travail Et La Pratique de La Valeur RéssalaPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Vin D Alsace Cultiver Son JardinDocument60 pagesVin D Alsace Cultiver Son JardinPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Processus Identitaires Dans Le Monde Ouvrier Et Intervention de L Etat Le Cas Du Batiment de Lyon 1850 1940Document140 pagesProcessus Identitaires Dans Le Monde Ouvrier Et Intervention de L Etat Le Cas Du Batiment de Lyon 1850 1940PLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- CNR 2022 Route-Des-Vins-D-AlsaceDocument2 pagesCNR 2022 Route-Des-Vins-D-AlsacePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- GuidedesvinsdalsaceDocument27 pagesGuidedesvinsdalsacePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- CP Friot MarseilleDocument2 pagesCP Friot MarseillePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- 4 Ouvrier BourgeoisDocument3 pages4 Ouvrier BourgeoisPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Kansai Tourist Guide2021 FRDocument13 pagesKansai Tourist Guide2021 FRPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Le Plan Touristique ChantillyDocument2 pagesLe Plan Touristique ChantillyPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation