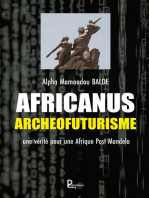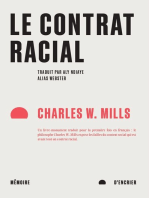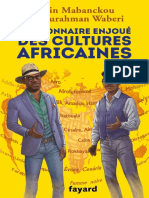Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Un Dictionnaire Decolonial
Transféré par
francisbarb filCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Un Dictionnaire Decolonial
Transféré par
francisbarb filDroits d'auteur :
Formats disponibles
Un dictionnaire décolonial
Perspectives depuis Afro Abya Yala
Sous la direction de Claude Bourguignon Rougier
licence License Creative Commons
Licence Attribution
Creative - Partage dans les mêmes
Commons 4.0.
1 conditions 4.0 International, sauf indication contraire.
Licence Creative Commons 4.0.
2
Introduction
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Ce livre destiné à un public francophone n’a pas pour objet de parler des luttes décoloniales ni des
études décoloniales en général. Son objectif est plus précis. Le but est de revenir sur la
« colonialité du pouvoir » et le mouvement dans lequel le concept « décolonial » a pris en Amérique
ibérique et dans la Caraïbe. Ce n’est donc pas l’acception du terme « décolonial » en France, en
Belgique, au Canada ou dans les pays africains francophones qui nous intéressera ici, ni son
utilisation par les groupes antiracistes de ces pays. Nous voulons seulement présenter le versant
latino-américain de la théorie décoloniale.
Il est certain que la décolonialité a une histoire différente en «Amérique latine » ou dans des pays
comme la France, le Canada ou sur le continent africain. Mais tous ces mouvements
décoloniaux ont un point commun : il est difficile de séparer les élaborations théoriques des
pratiques de luttes et ces dernières de la réappropriation de l’histoire. En France, au Canada, en
Belgique, sur les continents africains ou américains, l’écriture de la décolonialité change avec les
mouvements sociaux qui eux-mêmes se construisent dans une connexion à ces apports tout en
les modifiant.
Le but précis de ce dictionnaire est de contribuer à faire apparaître cette connexion, celle qui relie
les luttes décoloniales et la perspective Modernité/Colonialité (MCD) dans une aire
spécifique, l’Amérique ibérique et la Caraïbe. Ce qu’on appelle le projet ou la perspective MCD
renvoie à ces rencontres d’intellectuel-le-s latino-américain-e-s qui se réunirent au tournant
du siècle et, un peu après, autour des concepts de colonialité du pouvoir et de modernité/colonialité.
Bien sur, les lecteurs et lectrices ne trouveront là que des pistes, nous n’avons pas eu la prétention
de fournir une analyse de fond. Mais il importe de relever qu’on ne fait pas une histoire des idées
comme si ces dernières s’engendraient les unes les autres. Vu qu’un des concepts essentiels de la
théorie décoloniale est celui de la colonialité du savoir, nous avons décidé d’appliquer la méthode
à ce travail. Plutôt que de présenter un mouvement de pensée, nous avons voulu tracer une
cartographie sommaire du moment décolonial en tendant des ponts entre des catégories, des
pratiques, des itinéraires et des événements.
La généalogie du concept de colonialité nous renvoie à une articulation décisive, la dernière
décennie du XX e siècle. En 1992, le concept de la colonialité du pouvoir apparaît dans les travaux
Licence Creative Commons 4.0.
3
d’Aníbal Quijano. C’est l’anniversaire des 500 ans de la « Découverte » mais c’est aussi le passage
à une autre période, avec l’essor des mouvements indiens et afro-américains. Cette co-émergence de
la théorie et des résistances multiples n’est pas une coïncidence, elle est consubstantielle. Si nous ne
prenons pas en compte le puissant soulèvement de l’Inti Raymi en Équateur en 1990 et le
mouvement indigène ou afrodescendant en général, la généalogie du concept de colonialité est
biaisée.
Car en « Amérique latine », la toile de fond de la théorie de la colonialité, c’est une résistance
ancienne qui commence avec la colonisation espagnole et qui continue de nos jours à travers
les nombreux mouvements indigènes ou afrodescendants, les luttes contre l’extractivisme, le
communalisme et les diverses formes de féminisme décolonial. Walter Mignolo, un des membres du
projet MCD, l’a dit à plusieurs reprises dans ses travaux, entre autres dans La colonialidad a lo
largo y lo ancho : la décolonialité commence avec la colonialité, et se manifeste comme résistance
indigène. Le sémioticien argentin va même jusqu’à faire du texte d’un indigène andin du XVI e
siècle, Guamán Poma de Ayala, un des premiers éléments du corpus théorique décolonial. L’idée
semble d’autant plus fondée qu fut composée après deux mouvements d’ampleur : la résistance
d’un petit état andin à l’envahisseur espagnol et la révolte du Taqui Ongoy, mouvement populaire
qui aurait pu en finir avec la colonisation espagnole. Encore une fois, remarquons cet
entrelacement des théorisations et des luttes, dès l’origine.
La théorie de la colonialité du pouvoir et du savoir a pour terreau diverses traditions latino-
américaines; elle puise dans la théorie de la dépendance ou la théologie et la philosophie de
la libération. Elle doit aussi beaucoup à des intellectuel-le-s hétérodoxes comme Mariátegui,
marxiste andin des années 1930, qui posa d’une façon inédite la « question indienne », des
sociologues comme le colombien Orlando Fals Borda, qui a pensé la décolonisation intellectuelle
dans les années 1970 ou au mexicain Pablo González Casanova, qui a élaboré dans les
années1960 la notion de colonialisme interne.
Mais ce ne sont là que les mouvements d’idées et ces idées se sont abreuvées à la source des luttes
du XX e siècle et du XXI e siècle autant qu’elles les ont inspirées : dans les luttes armées
du XX e siècle, la notion d’hégémonie d’un Gramsci a joué un rôle important. Dans l’expérience
des combats du XXI e siècle, des luttes zapatistes et des communautés indigènes ou
afrodescendantes en conflit avec des états complices de multinationales prédatrices, l’idée
d’autonomie s’est affirmée comme pratique. Cette idée représente un pan considérable de
l’approche décoloniale de certain-e-s auteurs et autrices. Les travaux d’un groupe d’intellectuel-le-s
issu-e-s de divers pays du continent qui ont remis en question la colonialité du pouvoir
Licence Creative Commons 4.0.
4
occidental ne sont finalement que la partie émergée de cet iceberg brûlant. Je veux parler de celles
et de ceux qui ont travaillé dans le cadre du projet MCD à la charnière du XXI e siècle.
Nous présenterons ici certains de leurs concepts, leur enracinement dans une histoire américaine,
essaierons d’empêcher des confusions et des piratages, de faire apparaître les emprunts,
parfois, de noter les limites ou incohérences, et suggérerons en quoi, et pourquoi, à notre sens, les
perspectives critiques latino-américaines n’intéressent pas seulement les habitant-e-s du
continent.
Ce travail a été mené en solitaire pendant un an, mais il a fini par devenir collectif. Paul Mvengou
Cruz Merino, maître de conférence en anthropologie à Libreville, et Sébastien Lefèvre,
enseignant à l’Université de Saint louis du Sénégal m’ont rejointe. C’était une collaboration
prévisible puisque nous travaillons ensemble depuis quelques années dans le cadre de la Revue
d’Études Décoloniales. Ils ont pris en charge les entrées concernant les mouvements
afrodescendants en « Amérique latine ». Jonnefer Barbosa, professeur de philosophie à Sao Paulo,
dont j’avais découvert il y a quelques années le concept de « sociétés de disparition », a également
apporté sa contribution au volet brésilien de cette problématique. Fernando Proto, également
professeur de philosophie en Argentine, a contribué à cette publication, avec une réflexion sur
l’apport du philosophe argentin Agustín de la Riega. Nous aimerions donner une idée de la diversité
d’une perspective décoloniale latino-américaine qui a toujours été multiple et qui passe par de
véritables oppositions. Il y a cependant un accord entre ceux et celles qui, en « Amérique latine »,
revendiquent leur ancrage décolonial : la modernité a deux faces dont l’une est coloniale. Son
discours d’émancipation, côté obscur, s’est transformé en discours de domination (grâce à des
stratagèmes comme la mission civilisatrice). Cette domination qui ne dit pas son nom s’ancre dans
un racisme structurel qui commence avec la colonisation de l’Amérique. Cet accord sur
la nature raciste et ethnocentrée de l’Occident est incontournable dans la vision des membres de ce
groupe par ailleurs très informel.
Nous avons souhaité revenir sur une approche du décolonial qui a cours dans certains pays et
identifie le décolonial latin-américain à un mouvement académique, vision qui nous semble
infondée. L’apport des militant-e-s est une donnée fondamentale pour comprendre l’émergence de
la décolonialité latino-américaine. Nous avons tenu à contribuer à la correction de cette
méprise. Pour cette raison, nous avons fait en sorte de rendre visible l’apport fondamental des
féminismes décoloniaux et des mouvements indigènes ou afrodescendants dans la gestation d’une
pensée qui s’est nourrie de la richesse des luttes.
Licence Creative Commons 4.0.
5
Le rôle fondateur de chercheuses et activistes comme Ochy Curiel, Yukerdis Espinosa, Maria
Lugones, Julieta Paredes, Silvia Rivera Cusicanqui, ou encore Rita Segato, pour ne citer que les
plus connues, est indéniable. Le féminisme décolonial comme pratique existe depuis longtemps,
mais il ne se revendique comme tel que depuis une dizaine d’années. Certaines féministes le font
remonter à la colonisation, d’autres à des révolutions comme celle du Pérou et de la Bolivie de
l’époque coloniale. Sans cette approche féministe, toute théorie, toute pratique de la décolonialité
serait tronquée et là encore, les femmes ont du faire leur place dans le mouvement et dans le corpus
théorique.
Quant aux intellectuel-le-s indigènes ou afrodescendant-e-s, le travail qu’ils et elles ont mené, en
liaison avec les mouvements du XX e et XXI e siècle, a souvent anticipé les productions des
auteurs et autrices reconnu-e-s du courant décolonial. Je pense par exemple à la pensée de la
militante Dolores Cacuango en Équateur, qui imagina une autre fondation nationale pour le peuple
équatorien ou à celle du bolivien Fausto Reynaga. Dès les années 1970, engagé dans le mouvement
katariste, il écrivit La revolución india remettant en question de façon radicale un mythe du
métissage sur lequel reviendrait Aníbal Quijano vingt ans plus tard. Certaines idées n’auraient pas
pu émerger s’il n’y avait pas eu avant un travail préalable mené par des Indigènes ou des Afro-
descendant-e-s qui ne jouissaient pas d’une position leur permettant d’avoir des relais. Et le travail
de ces intellectuel-le-set militant-e-s s’enracinait lui-même dans l’histoire de cinq siècles
de révoltes, résistances et révolutions. Comment comprendre une pensée du refus sans considérer
les manifestations de ces refus dans l’histoire : qu’il s’agisse des révoltes indiennes ou du
phénomène du marronnage ou encore de ces communautés noires clandestines que furent les
Quilombos ou Palenques de la colonisation.
Ce courant décolonial comme tel est extrêmement riche et les individus qui participèrent au projet
Modernité/ Colonialité entre1994 et 2006 ont produit un corpus théorique important, inégal
mais très riche. Il faut à la fois leur rendre justice et éviter de les isoler dans une starification ne
rendant pas compte du mouvement très vaste dans lequel leurs pensées ont pu se développer. Les
principales figures de ce courant théorique sont beaucoup plus connues aux États-Unis, en Afrique
ou au Canada qu’en France.Mais dans l’ensemble certain-e-s auteurs et autrices l’emportent
sur les autres. Aníbal Quijano, le sociologue péruvien, Walter Mignolo, le sémioticien argentin, et
Enrique Dussel, le philosophe sont les plus connus. Ramón Grosfoguel et Nelson Maldonado
Torres, respectivement sociologue et et philosophe, sont plusreconnus dans les cercles de militant-e-
s décoloniaux, décoloniales hors d’Amérique latine. Maria Lugones jouit d’une certaine aura
Licence Creative Commons 4.0.
6
dans les milieux féministes, mais Catherine Walsh est pratiquement inconnue en Europe. Arturo
Escobar,l’anthropologue colombien, qui commence à être traduit en français grâce au groupe de
traduction de la Revue d’Études Décoloniales a acquis une certaine réputation. Par contre, un
philosophe comme Santiago Castro Gómez dont l’œuvre est importante et qui produit une
passionnante lecture critique des gouvernementalités foucaldiennes, n’est pas connu ni traduit en
zone francophone, à l’exception d’un article sur Foucault et des extraits de la Hybris del punto cero
publiés dans la Revue d’Études Décoloniales.
Nous avons donc essayé de faire plus de place à leurs approches. De même, je suis revenue sur les
écrits de deux Vénézueliens qui participaient au mouvement à ses débuts, les
sociologues Edgardo Lander et et Fernando Coronil. Ils sont absolument inconnus en zone
francophone, hormis des spécialistes. Et j’ai fait une place importante aux concepts
|d interculturalité développés par la chercheuse Catherine Walsh, laquelle travaille avec des
communautés andines en Équateur. Ce sont là les « historiques » du mouvement décolonial, un
groupe marqué par sa composante masculine. Il faudra, dans une autre édition, évoquer également
le rôle ponctuel de Zuma Palermo et Freya Schiwy, ou encore du critique littéraire bolivien
Sanjinés.
Cet abécédaire ne prétend pas à l’exhaustivité. ll reviendra à d’autres de continuer ce qui est un
work in progress. La théorie de la colonialité du pouvoir, comme les enfants créatifs, échappe a ses
géniteurs et génitrices et a migré dans plusieurs disciplines et plusieurs pans de la vie sociale latino-
américaine. Un aspect important de son histoire est sa diffusion-transformation dans les sociétés
ibéro-américaines. Et son articulation à d’autres courants de pensée. La pensée « décoloniale
» s’est fondue dans d’autres pensées radicales. Son influence sur la pensée écologiste radicale est
indéniable. En 2018, un cours de l’IHEAL parisienne s’intitulait : Colonialité de la nature et
extractivisme. Il émanait d’une chercheuse qui ne revendique son appartenance au courant, ce qui
donne une idée de l’appropriation du terme dans les milieux académiques latino-américains ou
apparentés. En « Amérique latine », nombreuses sont les revues qui proposent une approche critique
de la réalité sociale sur des bases décoloniales comme la revue Faia ou Analéctica.
L’approche décoloniale latino-américaine met longtemps à se diffuser en zone francophone, car elle
a été très longtemps confondue avec l’approche postcoloniale d’un Edward Saïd ou
celles des penseurs et penseuses de la subalternité indienne. En France, cette confusion était
manifeste dans l’approche, datée déjà, de Jean-Loup Amselle avec L’Occident décroché. Il y a
encore une certaine cécité des milieux français. Mais une tendance à l’ouverture prend forme depuis
quelques années en France, le Canada et la Belgique étant d’ailleurs en avance sur l’hexagone.
Licence Creative Commons 4.0.
7
En rend compte la réception favorable de certain-e-s autrices et auteurs, comme Arturo Escobar en
2018. En France, la résistance à la décolonialité persiste cependant, la lenteur des traductions qui
s’y font étant un signe de cette méfiance. El giro décolonial, traduit en 2014 sous le nom de Penser
l’envers obscur de la modernité, était la première anthologie publiée. Un décalage de vingt ans.
En Europe comme sur le continent américain, on a reproché au courant décolonial, quand on s’y est
(brièvement) intéressé, une certaine univocité dans l’analyse de la modernité, l’utilisation de
concepts a-historiques ou une tendance à diaboliser l’Occident. Certaines critiques étaient justifiées,
mais trop souvent, elles étaient d’abord motivées par le désir de jeter le bébé avec l’eau du bain. La
théorie décoloniale n’est pas un programme. Elle émane d’auteurs et d’autrices divers-es qui sont
souvent en désaccord sur bien des points. Et elle a une histoire. Si une première phase
correspond à l’approche des années 1990, avec la prééminence d’auteurs et d’autrices comme
Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo, dans la deuxième phase, la première décennie du
XXI e siècle, l’approche féministe apporte un changement profond et l’intervention de philosophes
et d’anthropologues dégage des perspectives nouvelles, d’autant plus que certain-e-s vont s’ouvrir
à la perspective féministe. Enfin, de nos jours, chaque auteur et autrice poursuit sa route avec des
productions particulièrement originales et des chemins aussi différents que celui de Ramón
Grosfoguel, très engagé dans la lutte politique contre l’islamophobie et la critique de l’impérialisme
américain au Vénézuela, ou celui d’Arturo Escobar, lequel essaie de combiner engagement auprès
des peuples autochtones et intégration critique de certains aspects de la modernité ( par exemple, le
design pensé dans son rapport à la communauté), sont un bon exemple de cette variété.
Nous entrons dans un autre moment, marqué par la diversité des approches, par l’apport de ceux et
de celles qui étaient encore étudiant-e-s quand le courant est apparu et par l’évolution des
fondateurs et des fondatrices. Il n’y a pas une perspective décoloniale latino-américaine. De
nombreuses revues surgissent qui mentionnent toutes leur dette envers cette pensée.
Nous espérons avec cet abécédaire donner envie d’aller voir plus loin. Il ne vise pas l’objectivité, ni
l’expertise. Un des buts était de fournir une perspective sur la colonialité du pouvoir et
ses ramifications. Cela n’engage qu’une autrice et des auteurs, membres de la Revue d’Études
Décoloniales. Ce livre est un point de vue, qui en appelle d’autres.
Le deuxième but était pédagogique; apporter une vulgarisation et un ouvrage consultable
rapidement à une époque où l’extension des articles critiques n’en finit pas de croître alors que le
temps nous manque de plus en plus. Nous avons néanmoins tenu à permettre aux lecteurs et aux
lectrices d’approfondir, s’ils et elles le souhaitaient, les points évoqués. D’où les références très
Licence Creative Commons 4.0.
8
nombreuses qui renvoient presque exclusivement à des articles ou livres en accès libre sur le net, en
français et en anglais, et en espagnol.
Notre travail s’inscrit dans la ligne qui est celle de la Revue d’Études Décoloniales depuis le début :
faire connaître les travaux d’intellectuel-le-s et d’activistes latino-américain-e-s en traduisant
leurs textes, en proposant des approches critiques de leurs travaux, et donner accès librement à ces
informations
Ce livre est la première version d’un travail qui est évolutif : nous lui donnons une forme
collaborative, que le principe de glossaire rend d’autant plus aisée. Le format est ouvert. Nous vous
invitons à nous rejoindre pour la deuxième version, pour enrichir le contenu ou le traduire vers une
autre langue. Il sera publié au Quebec aux éditions Science et Bien Commun et en France, aux
Presses d’EuroPhilosophie.
À bientôt !
Licence Creative Commons 4.0.
9
|Autrice et auteurs
Jonnefer Barbosa
Professeur du Département de philosophie de la Faculté de communication, de philosophie, de
littérature et d’arts de l’Université catholique de Sao Paulo. Professeur du programme d’études
supérieures en philosophie de la même institution. Ses activités de recherche dans le domaine de la
philosophie sont axées sur la philosophie des sciences humaines et la philosophie politique. Il a
particulièrement étudié l’œuvre d’Agamben et de Benjamin.
https://jonneferbarbosa.academia.edu/
Claude Bourguignon Rougier
Agrégée d’espagnol et docteur en civilisation latino-américaine. Son travail de recherche porte
sur l’imaginaire moderne/colonial, la problématique raciale, et la question des gouvernementalités
en Amérique latine. Depuis 2008, elle mène un travail de traduction, diffusion et d’analyse du
courant décolonial. Elle a coordonné pendant cinq ans la Revue d’Études Décoloniales fondée en
2016 avec des collègues américanistes. Traductrice de Penser l’envers obscur de la modernité, elle
a créé un atelier, la Minga, grâce auquel a été traduit Sentir penser avec la terre, d’Arturo
Escobar .
https://independent.academia.edu/clauderougier
Sebastien Lefévre
MCF à l’Université Gaston Berger Saint Louis/Sénégal, après une thèse sur l’identité afro-
mexicaine à travers la musique, la danse et l’oralité à Paris X. Il oriente ses recherches sur l’étude
de la diaspora africaine hispano- américaine issue des Traites et des Esclavages depuis une «
perspective afro-diasporique décoloniale » (études des afro-latino-Amériques à partir d’une vision
multi-située entre l’Amérique, les Caraïbes, l’Europe et l’Afrique, corpus basé sur la littérature, la
civilisation afro-latino-américaine). Par ailleurs, il mène un travail sur la représentation des Afro-
descendant-e-s dans le monde hispanique notamment à travers les manuels scolaires
Licence Creative Commons 4.0.
10
d’enseignement d’espagnol.
https://revues.mshparisnord.fr/cultureskairos/index.php?id=1755
Paul Mvengou Cruz Merino
MCF au département d’Anthropologie de l’Université Omar Bongo à Libreville. Il travaille sur les
identités noires et afro entre Amériques Latines et Afriques. Il s’intéresse en particulier aux enjeux
épistémologiques et méthodologiques des pensées décoloniales comparatives entre Amériques
Latines et Afriques. Il est membre du Centre d’Études et de Recherches Afro- Ibéro-Américaines
(CERAFIA) à l’Université Omar Bongo (Gabon).
https://universiteomarbongo.academia.edu/PaulMvengouCruzMerino
Fernando Proto Gutierrez
Il a fait sa formation en philosophie au collège Maximo San José de l’Université de San Salvador,
en Argentine. Il est enseignant-chercheur en philosophie interculturelle, épistémologie et bioéthique
à L’université nationale de la Matanza, et à l’Université Ouverte Internationale. Membre du
Réseau de Pensée Décoloniale, il dirige la revue Analéctica et il fait partie du comité scientifique de
la Revue d’Études Décoloniales. Il a contribué à cette publication avec une réflexion sur les
philosophes argentins Agustín de la Riega et Juan Carlos Scannone.
http://www.analectica.org/
Licence Creative Commons 4.0.
11
À propos des traductions
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Une des difficultés qu’a présenté ce travail tenait au fait que le corpus considérable sur lequel il
repose est très peu traduit en français. En effet, jusqu’en 2014, les traductions de penseurs et
penseuses du groupe Modernité/Colonialité étaient pratiquement inexistantes. Deux articles
avaient été publiés dans Mouvements et Multitudes. Capucine Boidin avait dirigé en 2009 un
numéro spécial de la revue de l’IHEAL consacré à la perspective décoloniale, ce qui constitue
l’exception notable de ce début de siècle.
Remarquons néanmoins qu’à la même époque, le versant féministe décolonial était, lui, beaucoup
plus représenté dans les traductions, avec cependant un décalage très important puisque un texte
fondateur, comme celui de Maria Lugones, n’a été traduit qu’en 2019.
Inutile de dire que tout le travail réalisé dans le cadre des mouvements de peuples originaires est
encore quasiment invisible, et que les intellectuel-le-s latino-américain-e-s qui ont été des
précurseur-e-s sont également, pour la plupart, inaccessibles aux lecteurs et lectrices francophones.
En France, avec Philippe Colin et Ramón Grosfoguel, nous avons été les premiers à éditer la seule
anthologie d’auteurs décoloniaux et d’autrices décoloniales traduits en français : Penser l’envers
obscur de la modernité. Et l’atelier de traduction de la Revue d’Études Décoloniales, qui diffuse
depuis quatre ans des traductions d’articles, a également traduit deux ouvrages
d’Arturo Escobar : Sentirpenser avec la terre et Autonomie et design, publié par les presses
d’Europhilosophies à Toulouse. Mais il faut bien dire que la masse des textes traduits reste infime
et que des auteurs et autrices, aussi fondamentaux que Quijano, sont à peine présent-e-s dans
la traduction, malgré leur prolixité.
Cela explique que malgré nos efforts pour indiquer aux lecteurs et aux lectrices des références de
textes en français, cela n’ait été possible qu’occasionnellement.
Autre conséquence : pratiquement toutes les citations que les lecteurs et lectrices trouveront ont
donc été traduites par nos soins. Nous ne l’avons pas précisé dans le corps du texte car cela aurait
rendu la lecture pénible. Sébastien Lefèvre, qui a souvent commenté des textes de nature littéraire,
a pris soin de faire figurer les deux langues. Paul Mvengou Cruz Merino a souvent fait figurer les
deux textes.
La traduction est un des axes essentiels de la production d’un vrai dialogue vers le Plurivers. Pour le
moment, il faut bien dire que ce travail, souvent fait bénévolement, est réalisé à la marge et dans de
Licence Creative Commons 4.0.
12
mauvaises conditions. Nous souffrons d’un manque crucial de traducteurs et traductrices. Cette
situation est une métaphore des rapports Nord-Sud actuels.
Cette page est aussi un appel à venir nous rejoindre dans le cadre de la Minga, l’atelier de traduction
de la Revue d’Études
Décoloniales.https://www.academia.edu/28920376/%20Sociedades_de_la_desaparici%C3%B3n1.
Licence Creative Commons 4.0.
13
Abya Yala
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Abya Yala. C’est ainsi que les Kunas de l’actuel Panama nommaient la terre de leurs ancêtres. C’est
un lieu où sont possibles des pratiques de vie et de connaissance qui ne laissent pas place au
dualisme nature/culture.
Les Kunas sont un peuple caractérisé par sa profonde combativité qui l’a amené, entre autres, à
s’opposer à la colonialité du pouvoir panaméen. En 1925, après plusieurs années de résistance, ce
peuple se souleva contre le gouvernement panaméen lors de ce que l’on a appelé la Révolution
Tule. La politique ethnocidaire de la jeune république avait provoqué une révolte générale. Au cours
de leurs luttes, les Kunas surent agir à plusieurs niveaux, usant de pratiques traditionnelles comme
l’emploi de poésies chantées pour communiquer mais aussi de stratégies « modernes », telles que le
recours à la Justice ou la déclaration d’une éphémère République de Tule. La révolte aboutit à un
accord qui permit aux Kunas de garder leurs us et coutumes et leur procura une relative autonomie.
Cela fait de ce peuple un véritable précurseur des luttes actuelles (Martínez Maura, 2008).
Abya Yala veut dire « Terre de vie », « terre de pleine maturité », « terre de sang ». Les
organisations indigènes latino-américaines ont décidé, lors du cinquième anniversaire de la «
Découverte », de ne plus employer le terme d’« Amérique ». Elles y voient une trace de l’ego
européen, plus précisément italien, l’ombre d’Amerigo Vespucci. Elles ont donc adopté le mot kuna
pour désigner le continent. Une façon de faire comprendre qu’il n’ y a pas plus d’Amérique qu’il
n’y a eu d’Indien-ne-s.
En dehors des autochtones, de nombreux chercheurs et nombreuses chercheuses et militant-e-s
emploient aujourd’hui le terme pour se référer au continent. Ils et elles provoquent parfois des
réactions hostiles qui prennent la forme de l’ironie y compris dans le milieu décolonial. Le terme
« abyayalisme » est apparu. Cette expression dépréciative, à rapprocher du terme « pachamamisme
», est destinée à disqualifier la perspective de certaines luttes indigènes, présentées par leurs
détracteur-e-s comme des mouvements tournés vers le passé et nécessairement inefficaces à l’heure
de lutter contre la colonialité du pouvoir. Pour des auteurs et autrices comme Santiago Castro
Gómez, l’abyayalisme c’est l’illusion qu’un changement est possible à partir d’autres bases que
celles posées par la modernité : «Certains penseurs qui s’identifient au « tournant décolonial » ont
fait du latino-américanisme une sorte d’abyayalisme, pour eux, il faut renoncer et quitter la
modernité. Mais, à mon avis, cette idée aussi est coloniale, et elle est fausse » (Castro Gómez,
2018).
Licence Creative Commons 4.0.
14
Une telle position, chez un auteur associé au courant décolonial, rend compte de divergences
profondes au sein de la perspective décoloniale. Elle renvoie aux débats sur l’autonomie, sur l’État
et sur la nature de la modernité. La question de l’autonomie y est centrale et va bien au-delà de
la reconnaissance d’une particularité qui se serait maintenue à travers les âges; question déjà au
centre de la Révolution Tule en 1925. Finalement, au regard de l’histoire du continent, il n’est pas
surprenant que ces divergences s’articulent autour de ce que les États nommaient la « question
indienne ».
Références
Castro Gómez, Santiago. 2018. « Cuestiones abiertas en teoría decolonial. Reflexiones desde
Mariátegui ». Communication faite lors du symposium sur l’actualité de Mariátegui. Instituto Caro
y Cuervo, Bogotá. 23 août 2018.(La traduction française est à paraître).
Martinez Maura, Mónica. 2008. « De tule nega à kuna yala. Médiation, territoire et écologie au
Panama, 1903-2004 ». Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Thèse de doctorat. Espagne : Universidad
Autónoma de Barcelona.
https://journals.openedition.org/nuevomundo/15592
Licence Creative Commons 4.0.
15
2.Afro Abya Yala
SEBASTIEN LEFÉVRE
Abya Yala, comme nous l’avons vu, était le nom avec lequel les Kunas nommaient leur terre : «
Terre de pleine maturité », « terre de sang ». La question que soulève le nom n’est pas anodine et
révèle plus de cinq siècles de débats touchant à des questions d’ordre identitaire, culturel, social,
politique, etc. Il est d’ailleurs intéressant de noter que c’est justement en 1992 que les peuples
originaires l’ont choisi pour renommer collectivement leur terre. En effet, cette année correspondait
à l’anniversaire du cinquième centenaire de la fameuse « Découverte » qui projeta tout un continent,
voire le monde entier, dans la spirale universalisante de l’Occident. Cette spirale de l’Occident n’a
pas entraîné que les peuples originaires mais également un nombre très important d’Africains et
d’Africaines qui ont souffert de la déportation la plus massive de l’histoire de l’humanité connue
à ce jour. Dans le cadre de cette déportation, la question des noms allait également concerner
directement les populations africaines, et ce, depuis les côtes africaines, car les négriers, avec
l’appellation Guinée, par exemple, ont uniformisé des peuples allant du Sénégal au Nigeria, au
détriment de leurs milliers de noms culturels endogènes. De la même façon, le nom de Congo
dénommaient les peuples au sud du Nigeria. Le terme de « Noir-e » est encore plus révélateur
puisqu’il va réduire les cultures africaines subsahariennes à la seule couleur de peau.
L’évangélisation forcée parachevait le tout en donnant des noms catholiques aux esclavagisé-e-
s. À ce propos, on peut citer comme révélateur un épisode de la série « américaine » fictionnelle
Kunta Kinté qui retrace le parcours d’un esclavagisé déporté en Abya Yala du nord où le
protagoniste principal refuse le nouveau nom qu’on lui donne. Le maître décide alors de le fouetter
en lui demandant son nom. Ce dernier donne toujours son nom endogène, Kunta Kinte. C’est
seulement, après avoir subi une série de coups de fouet, qu’il accepte de dire : « Je m’appelle Tobby
». Cet exemple montre bien l’enjeu de nommer les choses et les personnes.
Afro Abya Yala rentre en résonance directe avec cette problématique. Dans le champ d’études
décolonial, la plupart des auteurs et autrices n’abordent pas la question afrodescendante et ne
parlent pratiquement pas de cette appellation. Faut-il y voir un reste d’un certain eurocentrisme qui
reste à analyser dans les études décoloniales ne faisant référence quasiment qu’aux seul-e-s
Européen-ne-s et Indigènes, pour ne pas dire Indien-ne-s, lorsque la Modernité occidentale est
questionnée? L’un des rares auteurs et autrices qui font référence à cette appellation est Arturo
Escobar dans l’article intitulé « Desdes abajo, por la izquierda, y con la tierra : la diferencia de
AbyaYala/Afro/Latino/América ». L’auteur convoque les trois versants principaux de la
Licence Creative Commons 4.0.
16
composition culturelle de la (mal)dite « Amérique latine ». L’intérêt de cette appellation réside dans
le fait qu’effectivement elle met les trois présences-héritages sur le même niveau et ce dans le but
de problématiser la façon de nommer. Dans son introduction, il l’explique de la façon suivante :
Ce n’est pas un nom idéal, étant donné la diversité interne de chacun des trois axes identitaires, et il
cache d’autres axes clés (rural/urbain ; classe, genre, génération, sexualité, religion et spiritualité)
mais c’est une première façon de problématiser, et au moins de nous faire bégayer lorsque nous
invoquons si naturellement l’Amérique latine. (Escobar, 2017 : traduction de Sebastien Lefévre)
En effet, cette notion d’Afro Abya Yala permet de réintégrer les populations africaines diasporiques
dans la genèse même de ce qui est communément appelé, à tort, « Amérique latine ». Un autre
auteur de la génération décoloniale, Walter Mignolo, pointait quelque peu dans un ouvrage intitulé
La idea de América latina. La herida colonial y la opción decolonial (2007 : 133-135) cette
appellation biaisée de la latinité — latinité attribuée, en général, quasi exclusivement aux
descendant-e-s de criollos (né.e.s sur le continent américain mais d’origine espagnole) et aux métis-
ses. Or, les descendant-e-s d’Africain-e-s, selon l’auteur, réclament également cette part de latinité.
Cependant, ce n’est pas pour autant que « Los afroandinos y afrocaribeños (no) necesariamente son
latinos » . Nous avons là toute la complexité du débat…
Finalement, pour retrouver cette réintégration pluriverselle, il faut se diriger non pas comme on
vient de le souligner vers « l’avant garde intellectuelle » (masculine le plus souvent), mais vers les
mouvements sociaux dont se fait l’écho régulièrement Arturo Escobar. L’institut de la femme noire
GELEDES, au Brésil, a notamment convoqué, en 2019, une rencontre internationale d’afro-
féminismes d’Abya Yala où il était question de faire émerger des réflexions féministes non
hégémoniques de femmes « noires » de tout le continent. Un autre groupe de femmes a également
mis en avant cette notion, le groupe féministe Poder Afro y Abya Yala Fuerza
Feminista basé à Toronto.
Finalement, même si cette notion n’est pas encore établie ou mise en avant dans le champ d’études
décoloniales, elle émerge dans les mouvements sociaux contemporains et est porteuse à la fois d’un
questionnement quant à la Modernité occidentale et quant à la contre-Modernité décoloniale.
Références
Licence Creative Commons 4.0.
17
Escobar, Arturo. 2017. « Desde abajo, por la izquierda, y con la tierra. La diferencia de Abya
Yala/Afro/Latino/América ». Dans Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir,
re(existir) y (re)vivir. Tomo II. Sous la direction de Catherine Walsh. Quito, Ecuador : Abya Yala.
« Kunta Kinte – Quel est ton nom? (Roots 1977) ». Vidéo Youtube. Chaîne de
Kofi Jicho Kopo. 2 février 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=_9dc4fcsKPE
Mignolo, Walter. 2007. La idea de América latina. La herida colonial y la opción
decolonial. Barcelona : Gedisa.
s.a.. 2019. « Encontro Internacional Afro-Feminismos De Abya Yala: Uma
aposta crítica para o agora ». Sur le site web de l’organisation politique
Geledés Black Women’s Institute. 20 janvier 2020.
https://www.geledes.org.br/encontro-internacional-afro-feminismos-de-abya-yala-uma-aposta-
critica-para-o-agora/
Site internet officiel de l’OBNL Poder Afro y Abya Yala Fuerza Feminista. 20
janvier 2020.
https://poderff.org
Licence Creative Commons 4.0.
18
3. Afro-décolonialité
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
La perspective décoloniale classique latino-américaine insiste sur le référent « indígena » pour
montrer les enjeux des différentes instances de la colonialité (du pouvoir, de l’être et du savoir). Les
textes classiques de Dussel (1994) et de Quijano (2000) ont ouvert la voie à une relecture critique
des expériences de domination vécues et incorporisées par les populations indiennes au sein du
colonialisme ibérique. Ces auteurs partagent le point central de l’expérience décisive européenne de
l’Autre Indien-ne dans le processus de « découverte de l’Amérique » et les récits hégémoniques de
la modernité.
Cette orientation tend à rendre univoque et irréductible toute autre trajectoire pourtant liée à la
domination européenne. De plus, elle peut avoir pour conséquence politique de poser la question du
caractère « autochtone » ou « légitime » de certaines communautés. Toutefois, il faudrait signaler
quelques incursions sur les liens entre afrodescendance et décolonialité, notamment celles de Joaze
Bernadino Costa, Nelson Torres Maldonado et Ramón Grosfoguel (2018). L’Afro-décolonialité
serait une perspective décoloniale s’intéressant particulièrement aux communautés afro-
descendantes. Il ne s’agit pas de reprendre une taxinomie à la mode suite à la célèbre Conférence de
Durban de 2001, mais de se focaliser sur les trajectoires des populations descendantes
d’esclavagisé-e-s et aujourd’hui toujours citoyen-ne-s marginalisé-e-s (politiquement,
symboliquement et épistémologiquement) des États latino-américains. L’Afro-décolonialité vise à
critiquer les colonialités dans lesquelles sont plongées les Afro-descendant-e-s. Concrètement, il
s’agira de réfléchir sur la place des Afro-descendant-e-s dans le processus de « encubrimiento del
otro »1 et sur comment elles-mêmes ont été « encubiertas ». Par conséquent, il convient de prendre
au sérieux les différents épistémicides 2vécus par les populations afro-descendantes dans
11. L a réduction du non Européen au silence et à la domination, expression utilisée par
Dussel au sujet de l’expérience indígena et de la « Découverte de l’Amérique »
2 C’est-à-dire comment ils et elles ont été réduit-e-s au silence depuis le XV siècle,
utilisé-e-s dans l’objectif colonial d’affaiblir les communautés indígenas et fondu-e-s
dans un métissage romantique.
Licence Creative Commons 4.0.
19
le cadre du capitalisme colonial européen : expérience de départ d’Afrique, le Passage de Milieu,
l’Institution esclavagiste, assimilationnisme métis et national et les réactions culturelles, politiques
et sociales mises en place par ces populations. Ces différents épistémicides ont eu des incidences
dans le quotidien de ces communautés, car ils justifient, selon l’idéologie moderniste, leur plasticité
culturelle ou leur résilience. Plusieurs instances de la colonialité pourraient être éprouvées dans
cette perspective à savoir celle de Race et de Pouvoir, de l’Être, du Genre, du Territoire et du Savoir.
Augustin Lao Montes (2007), par exemple, nous exhorte à penser la condition de la femme afro-
descendante en « Amérique latine » car elle est produite par une intersection de domination :
raciale, de genre et de savoir. À cette orientation diasporique s’ajoute une lecture plus globale de la
condition « afro », qui cherche à penser ensemble l’afro-descendance et l’africanité dans leur
rapport à la Colonialité. En effet, ces deux versants sont traversés par la colonialité du pouvoir, de
l’être et du savoir. Aussi, certains travaux proposent de les croiser et de les faire dialoguer pour
signaler leur résistance, comme celui de Lefèvre (2019). Par ailleurs, l’une des caractéristiques de la
perspective afro-décoloniale est d’articuler de manière transnationale l’ensemble des projets
politiques, intellectuels, scientifiques et artistiques des établissements des diasporas afro aux
Amériques. Tels que l’ont signalé des auteurs et autrices comme Carvahlo, Bell Kooks, Joaze
Bernadino Costa, Nelson Torres Maldonado et Ramón Grosfoguel, la condition afro est marquée par
l’existence de plusieurs circulations d’initiatives visant à déconstruire les rapports coloniaux.
Bien qu’étant en construction, cette perspective afro-décoloniale se donne à voir dans le travail de
certains mouvements afro-diasporiques qui élaborent des pédagogies, des formes de savoirs
alternatifs, des organisations de territoires et des pratiques écologiques anti-capitalistes.
Comme de toutes les orientations se réclamant du tournant décolonial, l’afro-décolonialité n’est pas
une discipline académique, mais une conversation critique puisant dans les mouvements sociaux et
Références
Bernadino-Costa, Joaze, Nelson Maldonado-Torres, et Ramón Grosfoguel. 2018. « Introduçaõ.
Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico ». Dans Decolonialidade e pensamento
afrodiaspórico. Sous la direction de Joaze Bernadino-Costa, Nelson Maldonado-Torres et Ramón
Grosfoguel, 9-26. Belo Horizonte : Autêntica Editora.
Lao Montes, Augustin. 2007. « Hilos descoloniales. Trans-localizando los espacios de la diáspora
africana ». Tabula Rasa (7) : 47-79.
http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n7/n7a03.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
20
Lefèvre, Sébastien. 2019. « Hispanismos, afrohispanismos y afrodiasporismos: más allá de las
disciplinas y de los territorios. Propuestas para un análisis desde las costas africanas » .
Communication virtuelle, le 5 juin, dans le cadre du colloque organisé par la
SFH, Hispanisme de la marge au croisement des disciplines.
Mencé-Caster, Corinne, et Cécile Bertin-Elisabeth. 2018. « Approches de la
pensée décoloniale ». Archipélies (5).
https://www.archipelies.org/189
Licence Creative Commons 4.0.
21
4. Amérique latine
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Dans un article de 1992, Aníbal Quijano et Immanuel Wallerstein définissaient l’« américanité ».
D’après eux, elle présentait quatre caractéristiques : colonialité, ethnicité, racisme et idolâtrie du
nouveau.
Colonialité : Les divers États du monde ne sont pas égaux les uns avec les autres, certains ont plus
de pouvoir que d’autres. Il y a là une réalité qui était plus visible à l’époque de la colonisation, mais
qui n’a pas disparu avec la décolonisation. Il subsiste des hiérarchies qui marquent la différence
entre les anciens centres et les anciennes périphéries.
Ethnicité : Elle renvoie aux relations inégales entre les divers groupes ethniques, à un système de
différences culturelles légitimant les inégalités sociales. On est passé de l’esclavage pour les Noir-e-
s, de la servitude pour les Indigènes et du salariat pour les Blanc-he-s à des formes plus subtiles de
différenciation, mais le fond de la division du travail reste la hiérarchisation ethnique. L’ethnicité a
deux formes : c’est une façon de penser définie par les dominant-e-s, qui impose l’idée d’une
société formée de groupes ethniques perçus comme inférieurs, mais c’est aussi, en contrepartie, un
mécanisme d’identification des dominé-e-s qu’ils et elles peuvent mobiliser dans le cadre
de luttes.
Racisme : C’est une conséquence de l’ethnicité. Si les attitudes et les propos racistes sont présents
dès la colonisation, ce n’est que tardivement qu’apparaît, au XIX siècle, le racisme biologique
comme tel.
Idolâtrie de la nouveauté : C’est cette admiration de la modernité comme telle, qui conduit à rejeter
la tradition et empêche de comprendre ce qui structure la société. Elle aboutit au consumérisme. Le
processus n’aurait pas pu se mettre en place si, depuis plusieurs siècles, ne s’était développée une
façon de penser basée sur la dévalorisation de la tradition et des modes de vie et de connaissance
afférents. Rejet de l’archaïsme, destruction des communautés traditionnelles et des langues
vernaculaires ont été nécessaires. Il n’ y a pas eu un suave passage du temps qui nous aurait
porté des sociétés naïves et conservatrices du passé vers le monde axé sur le changement et la
nouveauté qui est le nôtre. La dévalorisation des connaissances traditionnelles, ce que l’on nomme
en jargon décolonial « colonialité du savoir », était un des moments de cette histoire violente qui
continue son expansion aujourd’hui.
Licence Creative Commons 4.0.
22
Amérique : Le nom actuel du continent a mis très longtemps à s’imposer. Il apparaît d’abord en
1507 sur le planisphère de Martin Waldseemüller. Le cartographe souabe, lorsqu’il baptise les terres
nouvelles du nom d’Amérique, fait la part belle à Amerigo Vespucci, l’instituant comme le véritable
« découvreur » du continent. Pourquoi cette disparition du malheureux Génois? Parce que Vespucci
comprit rapidement que les terres abordées étaient un autre continent, ce que Colomb, lui, ne put
jamais réaliser. Le caractère arbitraire de l’opération est une métaphore des divers tours de
passe-passe qui caractérisent une « Découverte » dont le vrai nom est Conquête. Le prénom
Amerigo, au XVI siècle, apparaît à nouveau dans une gravure du Flamand Jan Van der Straet,
lequel, avec son America, impressionnera de façon durable l’imaginaire européen, dans ce qui
constitue une des manifestations de la colonialité esthétique.
L’articulation continentaméricain-anthropophagie s’y enracinera durablement. Néanmoins, jusqu’au
XIX siècle, cette appellation restera confidentielle et, pendant toute la colonisation, le continent fut
marqué par la méprise de Colomb : il demeura l’Empire des Indes.
Amérique latine :
Latine? Parlons-en. L’idée d’Amérique, comme celle d’« Amérique latine », est une invention
coloniale, nous dit Walter Mignolo dans La idea de América latina. L’Amérique latine est un
concept composite formé de deux parties, une partition qui se cache derrière l’ontologie magique du
sous-continent. Vers le milieu du XIX siècle, l’idée d’une Amérique comme ensemble a commencé
à se diviser, au moment où divers États- nations émergeaient au rythme des différentes histoires
impériales de l’hémisphère occidental. Le résultat fut l’apparition d’une « Amérique saxonne » au
nord et d’une « Amérique latine » au sud.
À cette époque, l’Amérique latine fut le nom choisi pour désigner la restauration, en Amérique du
Sud, de la « civilisation » du sud de l’Europe, catholique et latine. (Walter Mignolo, 2007)
C’est donc au XIX siècle qu’apparaît l’expression dans le cadre des rivalités entre États-nations de
la deuxième expansion coloniale moderne. La France est en concurrence avec l’Angleterre et les
États-Unis en expansion. Dans une démarche en miroir, contre la continuité saxonne États-Unis/
Angleterre, les Français-es inventent l’expression « Amérique latine ». Ainsi, le continent apparaît
dans l’aire latine à laquelle appartient la France. L’idée d’une Amérique hispanique de Bolívar
disparaît au profit de celle d’une « Amérique latine ». Les pays qui sont alors en train de se
construire, à travers l’acceptation de leurs élites, adoptent une latinité qui, de fait, exclut les
Licence Creative Commons 4.0.
23
peuples indiens et afrodescendants. La latinité, en réalité, permet de régler partiellement la question
épineuse du métissage essentiel aux projets nationaux, les sujets métis-ses n’ayant souvent pas un
niveau de blanchité suffisant pour s’inscrire dans des projets nationaux qui nient la race tout en
s’appuyant sur cette dernière. La latinité inscrit l’héritage européen dans les « gènes » du peuple
métis et réalise une forme de blanchiment unificateur.
L’expression « Amérique latine » fera flores et elle colle toujours à nos
usages contemporains.
Références
Mignolo, Walter. 2007. La idea de América latina. La herida colonial y la opción
decolonial. Barcelona : Gedisa.
Mignolo, Walter. 2009. « La idea de América Latina (la derecha, la izquierda y
la opción decolonial) ». Crítica y Emancipación (2) : 251-276.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/CyE/CyE2/09idea.pdf
Il s’agit d’une réponse de l’auteur à la critique faite à son livre.
Quijano, Aníbal, et Immanuel Maurice Wallerstein. 1992. « De l’américanité comme concept: ou,
Les Amériques dans le système mondial moderne ».
Revue Internationale des Sciences Sociales XLIV (4) : 617-625.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000092840_fre
Licence Creative Commons 4.0.
24
5. Ancestralité
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Dans les sociétés et cultures afro-latino, l’ancestralité renvoie au rapport au temps, à la mémoire, à
la généalogie et au lien avec l’Afrique. Cette perspective d’inscription temporelle permet de
construire et de transmettre un discours sur soi, sur l’identité et sur les Autres. Dans le cas des
cultures afro, le passé est marqué par une série d’épistémicides, principalement celui
de la Traite transatlantique. L’ancestralité peut apparaître comme une réponse pédagogique et
concrète face aux formes d’exclusion ou de domination vécues par les communautés afro-
descendantes comme le suggère Catherine Walsh (2014). Elle est mobilisée du fait de la persistance
de pratiques et modes de vie spécifiques aux communautés afro. Ainsi, elle est utilisée également
dans le contexte religieux et spirituel qui permet à ces dernières d’exprimer leur relation horizontale
avec la nature et la surnature.
L’ancestralité renvoie aussi aux formes de solidarité et de parenté. Elle est souvent au cœur des
rhétoriques et des pratiques des mouvements politiques et sociaux afro-descendants, dans le cas
particulièrement de l’organisation territoriale de certains de leurs espaces. Au sein des
communautés afro-colombiennes, il s’agit des « conseils communautaires » appuyés par la
reconnaissance de l’État de leur « ancestralité ». Elle est donc à la fois matérielle et symbolique.
Pour certain-e-s auteurs et autrices comme l’équatorien John Antón Sánchez (2014), elle construit
une épistémologie particulière qui rassemble l’ensemble des savoirs, comportements, valeurs et
croyances et qui ne s’appuie pas sur un modèle positiviste européocentré.
Références
Antón Sánchez, John. 2014. « El conocimiento ancestral desde unaperspectiva
afrodescendiente ». Dans AMAWTA, Seminarios de Investigación, Tomo I. Sous la direction de
Freddy Javier Álvarez González, Palmira Chavero Ramírez, et Martín Oller Alonso, 33-62. Quito :
Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN.
https://www.researchgate.net/publication/
Walsh, Catherine. 2014. « Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos ».
Licence Creative Commons 4.0.
25
Santiago de Querétaro : Colectivo Zapateándole al mal gobierno. En cortito
que’s pa’largo.
http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/370.pdf
Voir à ce sujet :
« Kilombos, medicina ancestral afro en Colombia – Fractal ». Vidéo Youtube.
Chaîne de Canal Trece Colombia. 21 mai 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=IGrenX1a6ts
« Playa Renaciente: Historia de un Consejo Comunitario en Cali – Colombia.
Parte II. ». Vidéo Youtube. Chaîne de ocularcentrismo. 15 mars 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=kQBe31ddpWY
Licence Creative Commons 4.0.
26
6.Anthropologies autres
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
L’anthropologie est une discipline marquée, comme les autres sciences sociales, par la colonialité
du savoir. Elle nous amène à mieux percevoir la différence entre le colonialisme, moment fondateur
de la discipline dont les anthropologues reconnaissent les complicités avec le pouvoir colonial, et
la colonialité, cette propriété transversale et trans-historique des sociétés modernes, caractérisée par
l’hégémonie d’un système de connaissances né en Europe et identifié au seul type de savoir
légitime. On admet que la discipline ne naît pas au XIX siècle. En fait, elle apparaît avec la
Conquête de l’Amérique. Pour Enrique Dussel (1994), la question anthropologique, la question de
l’Autre, est au centre de la Découverte » : quand se forme un ego européen dans son opposition à
l’Indien-ne. Dès le XVI siècle, dans les textes « ethnologiques » de la Conquête (Diaz del Castillo,
Sahagún, Diego de Landa, etc.), on trouve déjà en place les procédés qui caractériseront
l’anthropologie par la suite : eurocentrisme, monologue, réduction des populations étudiées à des
informateurs et informatrices, généralisation de la relation supérieur/ inférieur (Krotz, 2002 : 205-
216).
La question de la culture et celle de la temporalité révèlent la colonialité du savoir anthropologique
Le concept de culture joue un rôle central dans l’anthropologie du XX siècle et la différencie
profondément de l’anthropologie raciale du XIX siècle. Si les principes de hiérarchisation
entre cultures n’y sont plus fondés sur des critères biologiques, ils sont toujours à l’oeuvre. La
naturalisation des différences, l’essentialisation des identités n’ont pas disparu non plus. L’usage de
la notion d’ethnie est, à ce titre, exemplaire. Le mot prend souvent la place laissée vacante par le
mot race. Pour Eduardo Restrepo et Julio Arias, ce glissement renvoie à la différence entre racisme
culturel et racisme biologique. Il est symptomatique d’un dualisme culture/biologie caractéristique
de notre époque.
Le but de cette historisation radicale est d’apporter une contribution conceptuelle à la lutte contre la
pensée raciale. Une pensée qui pèse encore très lourd, toujours à l’œuvre à travers des ré -
agencements multiples, y compris lorsqu’il est question de culture, un concept qui lui est en fait
apparenté. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, lorsqu’ils élaborent certains termes pour éviter
le mot race, les chercheurs ou les acteurs, à leur corps défendant, remettent en circulation des
catégories liées à la race on ne peut plus conventionnelle. (Arias et Restrepo, 2018). Quant au
versant temporalité, son histoire est particulièrement problématique. Johannes Fabian, en 1983,
écrivait déjà que l’anthropologie, qui « apporte une justification intellectuelle à l’entreprise
Licence Creative Commons 4.0.
27
coloniale », a créé un système dans lequel : Non seulement les cultures du passé mais également
toutes les sociétés vivantes ont été irrévocablement placées sur une même pente temporelle (…). La
civilisation, l’évolution, le développement, la modernisation et l’acculturation sont tous des termes
dont le contenu dérive, de façon parfaitement explicite, du temps révolutionnaire (…). Un discours
contenant des termes comme primitif, sauvage (mais aussi tribal, traditionnel, Tiers Monde ou
n’importe quel autre euphémisme à la mode) ne pense, ni n’observe, ni n’étudie de manière critique
le primitif; il pense, observe et étudie en termes de primitif. En tant que concept temporel par
essence le terme primitif correspond à une catégorie et non à un objet de la
pensée occidentale. (Fabian, 2006 [1983])
Les auteurs décoloniaux et autrices décoloniales ont su articuler cette particularité temporelle à leur
analyse de la modernité/colonialité. Dans Désobéissance épistémique, Walter Mignolo (2014)
remarque : « avec le concept de primitif, la différence temporelle externe fait son entrée dans le
récit de la modernité; les barbares jusque là relégués dans un espace autre deviennent les primitifs
ou ceux qui appartiennent à un temps révolu ».
Au-delà de ces fragments de généalogie de la discipline, on remarquera que son organisation
actuelle dévoile une géopolitique de la connaissance férocementoccidentale. Aujourd’hui,
elle repose toujours sur des fondamentaux établis dans le Nord global : États-Unis, Angleterre et
France, pour l’essentiel. Les anthropologues du Sud global passent par les universités du Nord pour
être adoubé-e-s, souscrivent à un type de publication et d’indexation qui ne valide que le savoir
correspondant à l’inconscient de la discipline et sont soumis au diktat de l’anglais. Comme le
remarquait dans un article récent Eduardo Restrepo, anthropologue colombien, parler de
l’anthropologie au singulier rend compte de la colonialité du champ : « Au- delà d’un idéal
normatif, l’anthropologie au singulier n’existe pas ni n’a jamais existé à aucun moment (Escobar et
Restrepo, 2009). Mais ce qui existe, moment du système monde moderne/colonial raciste et
patriarcal, c’est un « système monde » de l’anthropologie marqué par le déséquilibre entre des
anthropologies hégémoniques construites en France, en Angleterre et aux États-Unis, et d’autres
dissidentes. Ces anthropologies venant du Sud global mais aussi parfois du Nord global, elles, vont
à l’encontre du sens commun disciplinaire et introduisent une rupture dans ce champ, constituant de
fait un moment de la décolonialité.
Cette réflexion est possible aussi grâce aux transformations des années 1980, lorsqu’ont surgi des
analyses de la modernité qui peuvent rejoindre sur bien des points « l’inflexion décoloniale »,
comme la nomme Eduardo Restrepo (2010). Pour l’anthropologue argentine Rita Segato (2015) :
Licence Creative Commons 4.0.
28
Dans les années 1980 (…), sous l’influence de la critique postmoderne, les anthropologues ont pris
du recul, commencé à se situer et à identifier le reflet de leur propre monde dans le miroir de
l’autre, leur propre ethnicité est ainsi exposée et explicite, à ce moment-là, une nouvelle étape a été
franchie dans la production du savoir : se voir reflété dans le miroir des différences, voir
l’appartenance à l’autre, la particularité et la relativité de ses propres certitudes, sa
perspective personnelle. Ce fut sans aucun doute un grand moment dans la discipline, qui a ainsi
progressé dans sa capacité de réflexion.
Dans ces années-là, l’anthropologue Rabinow (1986) écrivait :
Nous devons anthropologiser l’Occident : montrer à quel point la conformation de sa réalité a été exotique;
mettre l’accent sur les domaines qui ont été considérés comme les plus évidents (y compris l’épistémologie et
l’économie); les rendre aussi uniques que possible sur le plan historique; montrer que leurs revendications de
vérité sont liées aux pratiques sociales et, de la sorte, sont devenues des forces efficientes au sein du monde
social.
Et il y a eu de nombreuses analyses dans la discipline qui ont connecté les études sur le
développement, les technologies, la science, aux discours philosophiques sur la modernité de
Foucault, Latour et Giddens. Cependant, pour l’anthropologue libanaise Elena Yehia (2007), il
s’agissait d’analyses intra-européennes de la modernité. La limite de cette anthropologie était
de réduire toutes les pratiques sociales à des manifestations de l’expérience européenne. L’écueil
étant la réintroduction d’un métarécit qui se fondait sur ou aboutissait à un relativisme culturel.
Peut-être parce que pour rompre avec la tradition euro-centrée de la production de connaissance, il
faut favoriser le développement d’échanges avec des formes de savoir subalternes, comme les
savoirs indiens, et leur donner le même statut épistémique que le savoir académique. (Segato, 2015)
Une telle démarche est présente dans l’anthropologie « œcuménique » que propose la brésilienne
Alcida Ramos (2017). C’est-à-dire une anthropologie qui adopterait la transdisciplinarité, qui
s’opposerait à la pensée qui fractionne le réel, aux violentes antithèses modernes/coloniales,
à l’atomisation d’un savoir universitaire mouliné dans le vortex de la logique néolibérale et
capitaliste. Il faudrait favoriser cette transculturalité dont parlait déjà l’anthropologue cubain Ortiz
(1940), faire se rencontrer diverses disciplines, mais aussi les formes subalternes de connaissance et
celles qui sont reconnues. Pour l’anthropologue décolonial Arturo Escobar (2007), qui a longtemps
travaillé sur les notions de développement et rejette l’idée de modernité alternative, il faut une
alternative à la modernité. La construction d’une anthropologie de la modernité comme phénomène
culturel fait partie du projet de changement. Il faut traiter les produits culturels occidentaux
Licence Creative Commons 4.0.
29
comme des objets « exotiques » afin de les voir tels qu’ils sont. Reprenant la proposition de
Rabinow (1986), Escobar affirme que nous devons anthropologiser l’Occident. Une anthropologie
de la modernité pourrait se baser sur des approches ethnographiques spécifiques appréhendant les
formes sociales comme le résultat de pratiques historiques, elles-mêmes ancrées dans des dispositifs
de savoir/pouvoir. Cela permettrait de décortiquer des constructions comme celle de « tiers-monde
», essentielles à la diffusion et l’imposition du discours du développement.
Vues du tiers-monde, les pratiques sociales et culturelles les plus raisonnables de l’Occident
peuvent sembler assez particulières, voire étranges. Cela n’empêche pas la majorité des
Occidentaux et Occidentales– et de nombreux et nombreuses habitant-e-s du tiers-monde – d’être
incapables de penser les personnes et situations du tiers-monde en termes autres que ceux admis par
le discours du développement (Escobar, 1998).
Pour Elena Yehia (2006), qui a travaillé dans la Red de Antropologías del Mundo, laquelle essaie de
mettre en acte cette vision, la question est : « est-il possible de produire des ethnographies
décolonisantes à partir des pratiques décolonisantes des mouvements sociaux? ». La Red de
Antropologías del Mundo/World Anthropologies Network 3vise à créer les conditions d’une
possibilité de pluralisation de l’anthropologie et, plus généralement, de décolonisation des
connaissances spécialisées, comme l’expliquent Gustavo Ribeiro et Arturo Escobar (2006). Le
résultat final est une transformation des conditions de « conversabilité » entre les anthropologies du
monde. Paraphrasant un des slogans du projet Modernité/Colonialité, « des mondeset des
connaissances autres », ce projet a été défini comme « des anthropologies autres » et « une autre
façon de faire de l’anthropologie ».(Restrepo et Escobar, 2005)
L’Argentine Rita Segato (2015) apporte elle aussi une réponse à la question. Elle estime nécessaire
de pratiquer une anthropologie « à la demande ». Parlant de la crise de l’objet de l’anthropologie, du
« primitif », elle écrit dans l’introduction à Huit essais sur la colonialité du pouvoir (à paraître en
français chez Europhilosophies) :
Ce que je propose, c’est que notre vieil « objet » classique soit aujourd’hui celui qui nous interroge, nous dise
qui nous sommes et ce qu’il attend de nous, et nous demande d’utiliser notre « boîte à outils » pour répondre à
ses questions et contribuer à son projet historique. (…) La boîte à outils des anthropologues, la profession
d’ethnographe, fournit des réponses/ à ceux et celles que nous avons construit comme nos « indigènes ». Ils/Elles
nous demandent instamment des interprétations, des données dont ils ont besoin pour concevoir leurs projets
(…). Dans la défense de ces objectifs historiques, la pratique sera celle d’une anthropologie du contentieux et du
litige.
3 http://www.ram-wan.net/
Licence Creative Commons 4.0.
30
Contre les anthropologies hégémoniques, une pensée et un travail « au
service de » et un Plurivers.
Références
Dussel, Enrique. 1994. 1492 : El encubrimiento del Otro, Hacia el origen del « mito de la
Modernidad ». La Paz : Plural Editores.
Escobar, Arturo et Gustavo Lins Ribeiro. 2006. World Anthropologies, Disciplinary
Transformations within Systems of Power. Oxford : Berg Publishers.
Fabian, Johannes. 2006 [1983]. Le temps et les autres, Comment l’anthropologie construit son
objet. Traduction française par Estelle Henry-Bossoney et Bernard Müller. Toulouse : Anacharsis.
Ortiz, Fernando. 1940. Contrapunteo cubano del tabaco y del azucar. La Havane : Éditions Jesús
Montero.
Rabinow, Paul. 1986. « Representations Are Social Facts: Modernity and Post- Modernity in
Anthropology ». Dans Writing culture: the poetics and politics of ethnography. Sous la direction de
James Clifford Marcus et George E. Marcus : 241. Berkeley : University of California Press.
Ramos, Alcida Rita. 2018. « Por una crítica indígena de la razón antropológica ». Anales de
Antropología 52 (1) : 59-66.
http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/
Restrepo, Eduardo et Arturo Escobar. 2009. « Anthropologies hégémoniques
et colonialité ». Cahiers des Amériques latines (62) : 83-95.
http://journals.openedition.org/cal/1550
Restrepo, Eduardo, et Axel Rojas. 2010. Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y
cuestionamientos. Popayán : Universidad del Cauca, Instituto Pensar.
Licence Creative Commons 4.0.
31
Segato, Rita. 2015. La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda.
Buenos Aires : Prometeo.
Yehia, Elena. 2007. « Descolonización del conocimiento y la práctica: un encuentro dialógico entre
el programa de investigación sobre modernidad /colonialidad / decolonialidad latinoamericanas y la
teoría actor-red ». Tabula Rasa (6) : 85-114.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24
Licence Creative Commons 4.0.
32
7. Anthropophage
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
L’anthropophage comme fondement de l’imaginaire moderne. Cette modernité, qui se construit
dans l’opposition à une altérité inquiétante, trouve dans l’anthropophage à la fois son antithèse et
l’icône de ce qu’il faut combattre. Le cannibalisme est un des éléments du discours qui justifie la
Conquête, l’exploitation de la main d’œuvre indienne, la destruction et l’infériorisation du monde
indigène. La Guerre Juste puisait sa légitimité dans l’anthropophagie, abondamment mentionnée par
Ginés de Sepúlveda lors de la Controverse de Valladolid. L’horreur qu’inspirait la consommation de
viande humaine, réelle ou fantasmée, était une des raisons qui justifiait la mise sous tutelle de
l’Autre. L’anthropophagie, supposée ou réelle, de certains groupes se constituerait en paradigme
représentatif d’un continent : l’Amérique. Le bon sauvage de la Découverte serait alors supplanté
par le sauvage mangeur de chair humaine. Fauve sans foi ni loi lorsqu’il refusait d’être asservi par
les Espagnol-e-s, le cannibale pouvait être éliminé. Être aux rituels effrayants, s’il collaborait, il
devait être civilisé. Les gravures diffuseront abondamment, dès le XVI siècle, l’image de l’Indien
anthropophage (Bourguignon Rougier, 2010). Elles inspireront les cartes de l’Amérique. Il existe
une véritable cartographie de l’altérité cannibale. Les cartographes du XVI siècle étaient au service
d’un régime de l’œil où s’affirmait une volonté eurocentriste et patriarcale. Sur la première carte
d’une ville américaine, qui accompagnait un courrier d’Hernán Cortés à Charles Quint, des cultes
anthropophages associés aux sacrifices sont
représentés. Sur une carte d’Holbein l’Ancien, de 1532, les anthropophages, près de la hutte qui les
incarne, découpent joyeusement des corps humains surunétal de boucher, représentation d’un
cannibalisme assimilé à un régime alimentaire. Et sur une carte de Munster, on retrouve exactement
la même représentation de la hutte anthropophage avec des bouts de membres qui pointent hors du
toit, comme les fanes de carottes d’un panier de marché. La circulation du motif rend compte d’un
processus de stéréotypie en formation assez rapidement; il est également fréquent de trouver des
images du festin cannibale généralement sous la forme du barbecue humain.
Les représentations de corps embrochés sur des grils ressemblant à des bûchers côtoient celles des
étals de bouchers et toute leur coutellerie fantasmatique (carte d’Hulsius, 1599). L’association
Nouveau Monde et pratique cannibale est essentielle pour la diffusion du stéréotype. Sur la carte du
Brésil de Diogo Homem, de 1565, on peut lire : Antropofagosterra. Ces représentations de la
Licence Creative Commons 4.0.
33
cartographie s’appuieront sur d’autres supports, par exemple, sur les fresques et tableaux des
édifices sacrés. L’Enfer comme bouche anthropophage serait une image très fréquente en
Amérique à l’entrée des églises. Et il y a un glissement entre bûcher anthropophage et bûcher
infernal, car l’« Indien-ne » est associé-e au démoniaque, créature infernale qui mérite l’Enfer.
L’Enfer anthropophage est l’Amérique.
L’historien de l’art Joaquím Barriendos (2011) écrit que la représentation du cannibale est un des
régimes géo-épistémologiques où s’identifie le plus clairement la naissance de la colonialité de la
vision. Ces représentations ne se circonscrivent pas à la période coloniale. Jusqu’au XX
siècle, la littérature recyclera l’image du cannibale en particulier dans la littérature dite de la « foret
vierge » où fleurit l’image de la forêt anthropophage, discrète métaphore de l’« Indien-ne ». Il
semble exister un lien entre le renouvellement du stéréotype et la nécessité de conquérir de
nouvelles forces de travail comme ce fut le cas lors du cycle du caoutchouc en Amazonie à la
charnière des XIX et XX siècles. Anthropophage, sauvage, barbare, différents moments d’une soit
disant « Rencontre » après laquelle il s’agit de construire cet Autre « civilisable » ou
« jetable » de la modernité.
Références
Barriendos, Joaquín. 2011. « La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico
». Revista Nómadas (35) : 13-29.
https://www.redalyc.org/pdf/1051/105122653002.pdf
Bourguignon-Rougier,Claude. 2010. Stratégies romanesques et construction des identités
nationales : essai sur l’imaginaire postcolonial dans quatre fictions de la forêt. Thèse de doctorat.
France : Université Stendhal de Grenoble.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00580561/document
Licence Creative Commons 4.0.
34
8. Archaïsme
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Paul Zumthor (1967), notant que la première occurrence du terme chez un grammairien date de
1659, relevait un de ses traits sémantiques : une nuance relative à quelque sentiment d’une distance
dans le temps, d’un écoulement de durée dont le locuteur prend conscience d’une manière qui
l’engage plus ou moins, et implique de sa part un jugement de valeur. L’emploi d‘archaïsme
supposerait donc, d’emblée, une certaine façon de nous situer dans le temps. En fait, ce substantif
est un petit rouage non négligeable de cette rhétorique de la modernité dont nous parle Walter
Mignolo (Pereira Lázaro, 2017), car il actualise cette/la coupure sur la base de laquelle s’établit le
discours moderne. Son emploi entérine la coupure entre un passé condamné à l’immobilité ou à la
disparition et un présent tourné vers le futur.
Plus qu’un élément factuel, l’archaïsme est (alors) le lieu même de la cristallisation de valeurs,
permettant de revenir sur la question du rapport au passé, au classicisme, ou à la modernité.
(Zumthor, 1967) Il rend compte d’un rapport au passé et à la modernité et aussi à un
espace peuplé de temps différents, le nôtre contre celui des peuples dits « archaïques », par
exemple. L’apparition du mot chez le lettré cité par Paul Zumthor indique la mise en place d’un
certain rapport au temps, différent de celui d’un homme ou d’une femme du XVI siècle, pour
lesquel-le-s le temps et l’histoire étaient ceux de la rédemption et du Salut. Les guerres
de religion entameront cette unité, la « découverte » de l’Amérique et les découvertes scientifiques
également, du moins pour une certaine partie de la population. L’idée d’une séparation avec un
avant révolu mais surtout, comme le remarque Paul Zumthor (ibid.), d’un jugement de valeur
associé au passé est neuve. L’idée d’une distance est, là, inséparable de celle de mesure.
L’histoire de la diffusion du mot connaîtra plusieurs étapes. L’une d’entre elles est liée au
développement, en Occident, de disciplines comme l’histoire, au XVIII , puis, au XIX siècle, de
l’anthropologie. Lorsque s’imposera un schéma unilinéaire de l’histoire (lui-même emprunté à la
vision chrétienne du Jugement dernier), les peuples qui vivent dans un autre rapport au temps,
cyclique, et qui ne s’inscrivent pas sur la flèche du temps, vont voir leur singularité niée. Ils
deviendront des attardés, ceux qui ont raté le train du progrès, son envers. L’archaïsme renvoie à la
survie. Et survivre s’oppose à vivre. L’archaïsme est difficilement pensable dans son sens actuel
avant le XIX siècle, en dehors d’une théorie de l’évolution appliquée à l’histoire, qui fait
Licence Creative Commons 4.0.
35
des formes culturelles autres des anomalies, des monstruosités, des scories, appartenant à un temps
révolu et appelées tôt ou tard à disparaître. À partir de ce moment-là, le succès de l’expression sera
remarquable dans tous les domaines : politique, culturel, économique. À la fin du XX
siècle, avec la montée des politiques néolibérales, la lutte contre l’archaïsme fera partie des
missions des nouveaux gouvernements. Investis de la logique économique, ils désigneront comme
tels les individus, institutions, groupes et idées qui freinent l’harmonieux développement du
marché. Certain-e-s se souviennent peut-être des propos du philosophe français Paul Ricoeur, en
1995, déplorant le caractère archaïque des grèves contre la réforme des retraites. Ce succès ne s’est
pas terni, la langue courante, la langue médiatique ou le discours politique sont émaillés de termes
qui appartiennent à son champ sémantique. Et il nous faudra bien reconnaître qu’une des réussites
de la rhétorique de la modernité, au XXI siècle, en Occident, aura été de transformer les luttes
sociales des phénomènes « archaïques ». La série libéralisation économique/réforme
politique/progrès/marche en avant s’oppose à une autre série : maintien des acquis
sociaux/régression/ archaïsme. De leur côté, les gouvernements d’Amérique du Sud, de droite
comme de gauche, avec la reprise des politiques extractivistes, ont veillé à disqualifier
symboliquement leurs adversaires. Les mouvements indiens d’opposition aux grands projets
miniers ou agricoles sont souvent réduits à des phénomènes archaïques sous prétexte qu’ils
s’appuieraient sur une tradition ou une identité réduites à la défense du passé. La globalisation a
réalisé une syncope : les mouvements sociaux des anciennes métropoles comme les luttes
autochtones des anciennes colonies sont relégués dans un même
passé.
L’archaïsme n’est pas un concept, plutôt une arme au service de la destruction massive des
traditions et des communs.
Références
Pereira Lázaro, João Paulo. 2017. « La retórica de la modernidad, la lógica de la colonialidad y la
globalización en el ámbito de las migraciones trasnacionales: formación de subjetividades negadas
y cotidianidad de migrante del sur ». Pacarina del Sur (31).
http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1460-la-retorica-de-la-modernidad-la-
logica-de-la-colonialidad-y-la-globalizacion-en-el-ambito-de-las-migraciones-trasnacionales-
formacion-de-subjetividades-negadas-y-cotidianidad-de-migrante-del-sur
Licence Creative Commons 4.0.
36
Zumthor, Paul. 1967. « Introduction aux problèmes de l’archaïsme ». Cahiers
de l’Association internationale des études françaises (19) : 11-26.
https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1967_num_19_1_2328
Licence Creative Commons 4.0.
37
9. Autonomie
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
L’autonomie est une notion clé des mouvements sociaux actuels en « Amérique latine ».
L’envisager à partir de la perspective de ce continent oblige à réviser ses fondamentaux européens.
Il faut s’extirper d’une critique sociale marquée par la colonialité du savoir. L’autonomie, dans les
pays latino-américains, ne recouvre pas la même chose qu’en Europe parce que l’histoire de l’État y
est différente, parce que les personnes engagées ne sont pas les mêmes. L’autonomie en Afro Abya
Yala est devenue l’arme des peuples, indiens ou afro-descendants, mais aussi des paysan-ne-s, des
exclu-e-s urbain-e-s et des femmes.
C’est quoi l’autonomie en Europe?
En Occident, l’autonomie a été une matrice de la pensée d’émancipation. Elle est liée à la tradition
d’autogestion des usines par les ouvriers et les ouvrières entre la Première et la Seconde Guerres
mondiales Elle était au centre de la pratique des « conseillistes » belges, par exemple. Anton
Pannekoek (1936) y voyait le moyen d’échapper au pouvoir des syndicats et du parti et de laisser
place aux initiatives de la « base ». En Espagne, pendant la guerre civile (1936-1939), les
communistes libertaires menèrent pendant plusieurs mois des expériences d’autogestion générale,
dans les villes comme dans les campagnes, en Aragon, en Catalogne et en Andalousie.
En France, dans les années 1960, pour le groupe Socialisme ou barbarie, l’autonomie était la
capacité des masses de se diriger seules, ce que l’auto-éducation du peuple rendait possible, d’après
Cornelius Castoriadis (David,2000). Mais, toujours pour ce dernier, cette autogestion n’était
possible que parce qu’existait une puissante tradition démocratique. L’autonomie, en
France, c’était des aventures comme celle de Lipp dans les années 1970, lorsque des ouvriers et
ouvrières auto-gérèrent le temps de huit mois de grève,au grand dam des organisationspolitiques
et syndicales traditionnelles.
|
Et en Afro Abya Yala ?
En « Amérique latine », la généalogie n’est pas la même; les repères sont la révolution de Tupac
Amaru à la fin du XVIII siècle, la révolution mexicaine, la révolution haïtienne, le marronage.
Licence Creative Commons 4.0.
38
Notons que dans les mouvements sociaux blancs ou mixtes, c’est du côté anarchiste que l’on trouve
le plus d’éléments communs avec les traditions occidentales.
L’autonomie ne peut pas prendre les mêmes formes parce qu’en «Amérique latine » la violence
n’est pas ce qu’emploie l’État en dernier recours mais une dimension de la vie quotidienne. Pour
être autonomes, les gens doivent s’éloigner de l’État, prendre leurs distances. Si l’autonomie, en
Occident, a pu se réaliser dans des espaces communs aux divers secteurs sociaux, les usines par
exemple, les habitant-e-s des pays « émergents », eux et elles, doivent se protéger et souvent se
cacher. Le sociologue urugayen Raúl Zibechi remarque :
Dans la communauté du 8 de Marzo, j’ai pu comprendre, au cours de conversations qui permettaient
d’approfondir la question, pourquoi les zapatistes, avant le soulèvement, se réunissaient dans des grottes qu’ils
atteignaient après de longues promenades nocturnes, pourquoi ils ont gardé un secret prudent sur leur
organisation pendant une décennie. Le secret est la condition nécessaire pour que le soulèvement ait lieu, une
évidence : dans un camp de concentration, on ne dévoile pas ses intentions à ses geôliers. (Zibechi, 2015)
Toujours pour Raúl Zibechi, l’autonomie ne préfigure pas le monde à venir en « Amérique latine »,
elle n’est pas ce qui se produit en fonction d’un état futur souhaitable de la société mais ce qui peut
se faire à un moment donné. Elle est pratique. Les autonomies noires ou indiennes ne font pas
partie du monde capitaliste, elles tendent vers l’autonomie intégrale. Elles semblent être une mise
en œuvre possible de ce qu’entend Enrique Dussel lorsqu’il parle d’extériorité.
C’est qui l’autonomie en « Amérique latine »? C’est où?
En « Amérique latine », l’autonomie est le fait de mouvements comme celui des zapatistes et leurs
Conseils de Bon Gouvernement, celui de la commune de Oaxaca en 2006 ou encore les
mouvements mapuche du Chili.Il y a aussi les mouvements afrodescendants et indigènes de
Colombie dans le Cauca et sur la côte pacifique, les piqueteros et piqueteras argentin-e-s des années
2000 et le Mouvement des sans-terre au Brésil. S’ils sont les plus connus, il ne faut pas omettre,
sous le chavisme, des initiatives populaires que l’on peut aussi qualifier d’autonomes.
Sur le continent, cette tendance apparaît dans les années 1980 et s’est intensifiée dans les années
1990. Elle est liée à la critique du colonialisme comme à l’émergence et à l’articulation des
mouvements autochtones. La charnière des années 1990, au cours desquelles les constitutions de la
Licence Creative Commons 4.0.
39
Bolivie, de l’Équateur, de l’Argentine, du Mexique et de la Colombie reconnaissent la présence
première des peuples indiens et leurs particularités ethniques et historiques, est le moment où des
sujets collectifs, à travers les organisations indiennes ou afrodescendantes qui se
constituent, présentent à leur gouvernement respectif des demandes d’autonomie. Ces demandes
visent à permettre aux organisations de régler des problèmes que l’État ne prend pas en compte ou à
sortir des impasses produites par l’implémentation des politiques néolibérales.
Cette demande d’autonomie prendra deux formes. Elle trouvera parfois un relai dans les États
progressistes des années 2000, relai qui pourra être instrumentalisé. Ce sera le cas de la Bolivie et
de l’Équateur. Parfois, au contraire, le mouvement devra affronter l’État. C’est ce qui arriva au
mouvement zapatiste qui, au début, voulait pourtant négocier avec l’État mexicain. Face au non
respect de ses engagements par ce dernier, il s’est vu obligé de développer des stratégies
d’autonomie dans l’illégalité.
Si les peuples indigènes du Mexique, du Chili, de la Colombie, ou les Afro-descendant-e-s
mexicain-e-s, équatorien-ne-s, et colombien-ne-s sont les plus engagé-e-s dans la démarche
d’autonomie, les exclu-e-s urbain-e-s jouent également un rôle important dans les mouvements, tout
comme les petit-e-s paysan-ne-s blanc-he-s ou métis-ses. D’autre part, un courant important du
féminisme latino-américain dit « autonome » travaille en lien avec ces mouvements.
Pourquoi l’autonomie ?
Les diverses revendications pour l’autonomie et le droit à l’autodétermination ont pris de la force
depuis les années 2000 et leurs objectifs sont devenus plus complexes. Mais ces changements sont
inséparables de ceux qui se sont produits dans l’économie mondiale, avec la pression du land
grabbing, le piratage biologique, l’extension de monocultures dévastatrices et l’intensification d’un
extractivisme auquel, amère ironie, les gouvernements de gauche ont eu recours plus encore
que leurs prédécesseurs. Cette nouvelle donne économique s’est appuyée sur une intensification de
la violence étatique et de la violence criminelle liées aux cartels. Les diverses formes de criminalité
organisée ont prospéré, pas seulement à cause du narcotrafic dont l’épicentre allait se déplacer
de la Colombie au Mexique, mais aussi parce que les États pratiquent une politique d’impunité pour
ces groupes et ferment les yeux sur la corruption. D’autre part, les gouvernements favorisent des
économies extractivistes qui provoquent la révolte des peuples indiens et afro-colombiens.
Licence Creative Commons 4.0.
40
Dans ces conditions, l’autonomie apparaît comme la défense des territoires menacés par les projets
des multinationales de l’agroalimentaire ou extractivistes et comme une façon de résister aux
stratégies létales des divers secteurs mentionnés qui, sans se concerter nécessairement, ont des
intérêts communs.
La militante colombienne Vilma Almendra, membre du peuple nasa du Cauca, remarque :
Bien sur, les années 1980 et 1990 ont été un moment important dans notre histoire, mais c’est surtout dans
les années 2000, que de multiples espaces autonomes ont pris forme. Nous voulions réfléchir de manière
critique non seulement aux agressions extérieures dont nous étions victimes, mais aussi à nos propres
faiblesses. (Almendra,2017)
Lutter pour les territoires et pour la vie
Ce début de siècle semble donc marquant pour de nombreux mouvements centrés sur la question de
l’autonomie. Si cette revendication et les pratiques afférentes s’affirment, c’est aussi parce que,
comme Vilma Almendra le remarque dans le passage ci-dessus, la terreur est devenue le
quotidien. En Colombie, cette stratégie de terreur, reposant sur la complicité des forces armées qui
envahissent sous couvert de protection les resguardos (propriété collective de la terre reconnue
légalement), est destinée à permettre aux multinationales de s’installer sur les territoires abandonnés
par les populations terrifiées. « Il ne faut pas dire qu’en Colombie, il y a déplacement parce qu’il y a
la guerre : en Colombie, il y a la guerre pour qu’il y ait déplacement », nous dit Manuel Rozental
(2017), activiste colombien engagé auprès des communautés nasa. Et il ajoute : « Faire face à la
guerre capitaliste et construire l’autonomie sont des questions vitales face à la mort et à la
dépossession » (Ibid.).
L’autonomie s’articule autour du lieu et du territoire. C’est une donnée fondamentale que l’on soit
un-e Zapotèque ou un-e Tzetzal du Mexique, un-e Mapuche chilien-ne ou un-e Afro-colombien-ne.
Dans son article, Manuel Rozental (2017) parle de « guerre », un terme déroutant pour un Occident
encore habitué à une représentation très ancienne de ce qu’est la guerre.
Mais l’« Amérique latine » est un des territoires où se déroulent les guerres modernes. Celle-ci
serait la quatrième selon le sous-commandant Marcos (Velasco Yáñez, 2003). Autres facteurs qui
ont renforcé la demande d’autonomie, il faut mentionner la criminalisation des pratiques et des
semences traditionnelles, au bénéfice de multinationales comme Monsanto; la guerre idéologique
menée avec les nouvelles technologies; le travail constant de démobilisation
et de capture des mouvements à travers l’assassinat de leurs têtes pensantes. Le rôle des ONG est
dénoncé par Vilma Almendra (2017) :
Licence Creative Commons 4.0.
41
C’est ce qui s’est passé au début de l’année 2000 dans le Cauca, une table ronde sur les droits de l’homme allait
être mise sur pied avec les ONG respectives. Elles nous ont dit alors qu’il valait mieux se concentrer uniquement
sur la dénonciation des violations des droits humains, que si nous commencions à critiquer le modèle politique et
le système, nous n’aboutirions à rien.
On voit bien là le rôle d’organismes dont la neutralité sert, en fait, au nom de l’efficacité (la défense
des droits humains), le système même à l’origine de la violence qu’ils dénoncent. La bonne foi
éventuelle des acteurs et actrices ne change rien à la question. Pour Vilma Almendra, il n’y a pas
résistance d’un côté et autonomie de l’autre mais les deux ensemble. L’autonomie amène à faire
partie de fronts de résistance qui se créent pour défendre la communauté, à participer au système de
garde indienne et aux travaux des « tisseurs » et « tisseuses ». Pour beaucoup de mouvements, une
des grandes leçons des années 2000 a été la constatation que l’État, y compris les États
multiculturels et plurinationaux comme l’Équateur et la Bolivie, ne pouvait pas être un « sujeto
descolonizador » comme le remarque Raúl Zibechi (2015). C’est sans doute en Bolivie que c’est
apparu de la façon la plus claire. L’autonomie s’inscrit dans cette lucidité-là. Le pouvoir des États
monoculturels s’est renforcé, annulant les espaces de revendication politique grâce à des stratégies
d’incorporation des dirigeants et des secteurs indigènes dans un modèle de productivité et de
consommation défini par le marché. Comme le souligne Catherine Walsh, les exigences de
plurinationalité et d’interculturalité du début du XXI siècle sont une critique frontale de l’échec des
projets des États multiculturels, qui ont transformé les demandes des peuples autochtones et des
autres minorités ethniques en un exercice purement rhétorique qui a étouffé le potentiel subversif de
ces mouvements. (Zibechi, 2015) Le multiculturalisme ethnique de ces années-là, politique des
nombreux États de la région, fut appréhendé par les institutions internationales (FMI ou Banque
Mondiale) comme une des façons d’intégrer les peuples indigènes dans l’économie néo-libérale et
d’avoir accès à des territoires riches en ressources naturelles ou touristiques. Dans ce contexte,
l’interculturalité et la pluriculturalité, qui sont des demandes postérieures formulées dans les
années 2000, rendaient compte de la volonté de refonder intimement la structure des États
nationaux4 .
Pour les peuples autonomes, il ne s’agit pas de changer le monde car celui-ci n’est pas un ensemble
homogène et la question n’est plus de prendre le pouvoir et devenir colon-e à la place du colon. La
question ne peut plus être posée au niveau de l’État. Il est impossible de changer le monde sans
tomber dans le totalitarisme, remarque Raúl Zibechi (2015), mais il est possible de changer de
4Voir les nouvelles chartes du Vénézuela (1999), de l’Équateur (2008) ou de la Bolivie (2009).
Licence Creative Commons 4.0.
42
monde, d’en faire un autre. C’est pourquoi l’autonomie est inséparable du Plurivers que prônent les
décoloniaux et les décoloniales. Elle n’est pas une politique identitaire même si elle se sert de
l’identité. Les sujets impliqué-e-s dans des démarches d’autonomie n’ont pas
le sentiment de se battre pour des intérêts strictement identitaires. Ils et elles sont persuadé-e-s que
la guerre dans laquelle ils et elles sont impliqué- e-s est une guerre totale :
Nous avons la conviction absolue (c’est même plus que cela, il s’agit d’une évidence) que cette guerre en
Colombie apparaît comme un phénomène local et particulier précisément parce que l’objectif, c’est d’empêcher
de comprendre qu’elle fait partie d’une guerre globale contre tous les peuples. (Rosenthal, 2017)
Références
Almendra, Vilma. 2017. « Tejer resistencias y autonomías es un imperativo para caminar nuestra
paz desafiando la guerra global ». Dans Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras,
para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía. Sous la direction de Jorge Regalado,
79-92. Guadalajara : CIESAS-Jorge Alonso.
https://www.academia.edu/35329882/Pensamiento_cr%C3%ADtico_cosmovisiones_y_epistemolog
%C3%ADas_otras_para_enfrentar_la_guerra_capitalista_y_construir_autonom%C3%Ada
David, Gérard. 2000. Cornelius Castoriadis, le projet d’autonomie. Paris : Éditions Michalon.
González, Miguel, Araceli Burguete Cal y Mayor, et Pablo Ortiz-T.. 2010. La autonomía a debate:
autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina. Quito : FLACSO.
https://www.iwgia.org/images/publications//0468_Libro_autonomia_a_debate_eb.pdf
Pannekoek, Anton. 1936. « Les conseils ouvriers ». International Council Correspondance 2 (5).
https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1936/00/pannekoek_19360000.htm
Preciado, Jaime, et Pablo Uc. 2010. « La(s) autonomía(s) en América Latina. Una expresión socio-
espacial del Estado novísimo y sus efectos en el proceso de integración regional ». L’Ordinaire
latino-américain (214) :199-220.
http://journals.openedition.org/orda/747
Licence Creative Commons 4.0.
43
Rozental, Manuel. 2017. « ¿ Guerra? ¿ Cuál guerra ? ». Dans Pensamiento crítico, cosmovisiones y
epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía. Sous la direction
de Jorge Regalado, 94-97. Guadalajara : CIESAS-Jorge Alonso.
http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/content/pensamiento-cr%C3%ADtico-cosmovisiones-y-
epistemolog%C3%ADas-otras-para-enfrentar-la-guerra
Velasco Yáñez, David, S.J. 2003. « La comprensión zapatista de la guerra ». Xipe-Totec (46) : 152-
174.
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5709/La%20comprensi%c3%b3n%20zapatista%20de
%20la%20guerra.pdf?sequence.
Zibechi, Raúl. 2015. « Movimientos antisistémicos y descolonialidad ». Dans Pensar desde la
resistencia anticapitalista y la autonomía. Sous la direction de Rafael Sandoval, 105-120. México
D.F. : CIESAS.
http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/sites/default/files/pensardesde.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
44
10. Barbarie
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Bartolomé de las Casas (1474-1566) avait établi quatre catégories de barbare. Le barbare américain
entrait dans la quatrième catégorie, celle du barbare infidèle, la pire. On peut s’étonner de ce que le
défenseur des « Indien-ne-s » ait été aussi véhément dans sa condamnation mais ce serait oublier
que le but du dominicain était l’évangélisation et la rationalisation du gouvernement des « Indien-
ne-s ». Le barbare n’est pas le sauvage, il n’est pas non plus ce que l’on entend par là en Europe au
XIX siècle ou au XX siècle. Le sauvage vit dans un univers éloigné. Le barbare, lui, est celui qui
habite les frontières et menace la nation. C’est une notion qui se précise dans le mouvement de
formation des États-nations en Europe comme en Amérique et dont l’antithèse Civilisation/Barbarie
est l’exemple le plus abouti. Il est d’abord image. Les chroniques et les gravures s’épaulèrent dans
la diffusion de cette représentation. D’ailleurs, les gravures, comme celle de Théodore De Bry, se
fondent sur ces récits.
La barbarie renvoie à la nature : qu’il s’agisse de la nature porteuse du mal, du péché originel,
marquant à jamais l’humanité, ou de la nature qui se reconfigure à partir de l’âge moderne et prend
ses traits actuels vers le XIX siècle avec le triomphe de la biologie. Plus précisément, la barbarie
renvoie au Mal de la nature. Pour un conquistador, chrétien, ce mal est compris sous la forme de la
Chute; pour les élites du XIX siècle, puis pour les habitant-e-s du XXI siècle, sous celle de la
dégénérescence ou de la décadence. Dans les deux cas, on retrouve ces archétypes qu’avait
identifiés Gilbert Durand (1984) et qui soutiennent la vision moderne dominante. Avec l’Amérique,
prend forme une nouvelle version du paradigme Civilisation/Barbarie. La civilisation n’est plus
celle des Grecs et des Grecques, articulée autour d’une langue et d’une culture. Elle est synonyme
de chrétienté. Les Espagnol-e-s qui colonisent le continent au XVI siècle parlent de « police
chrétienne », ils et elles ont conscience de ne pas vouloir imposer seulement une religion mais un
mode de vie chrétien : vivir bajo campana, littéralement « vivre au son de la cloche ». Et les
Espagnol-e-s s’opposent à ce qu’ils et elles identifient à la tyrannie, c’est-à-dire une forme
de gouvernement illégitime, un pouvoir qui n’a pas sa justification dans un mandat divin comme la
royauté espagnole. La barbarie, c’est la question des justes titres, liée à celle de la Guerre juste.
Dans la construction de cette dernière, le Pape ayant donné aux Rois Catholiques les terres
américaines, les autochtones devenaient illégitimes sur leur propre territoire, sauf s’ils et
elles se soumettaient à l’autorité.
Licence Creative Commons 4.0.
45
Les Grecs avec Hérodote, avaient déjà abordé la question de la tyrannie des peuples opposés a la
démocratie athénienne, s’appuyant sur le couple vice/vertu. Ce couple, au XIII siècle, s’affûta dans
le cadre de la théologie chrétienne quand la vertu prit sa source dans le lignage. Pour la pensée
médiévale, il y avait deux définitions du tyran : celui qui abusait de son pouvoir et celui qui n’avait
pas de justes droits. À l’époque, le barbare était perçu comme chez Aristote : tant que le barbare
était chez lui, il était libre d’agir, mais à partir du moment où il entrait en contact avec le civilisé, il
devait se soumettre à cette tutelle. C’est la fameuse thèse de l’esclavage naturel qui serait reprise
par les Espagnol- e-s et où l’on trouve déjà ce qui motiverait la mission civilisatrice du colonialisme
au XIX siècle.
Cette thèse justifierait leur façon d’administrer les « Indien-ne-s » : Gouvernement royal pour les
hommes et les femmes libres, tyrannie pour les esclavagisé-e-s. Le requerimiento était la procédure
qui transformait les Indien-ne-s en rebelles (contre la foi) et usurpateurs et usurpatrices (du
pouvoir royal). Même Las Casas, qui défendait les gouvernements indiens au nom de la coutume,
les trouvait « tyranniques ». Le concept de tyrannie était inséparable de celui d’emprise
démoniaque. La croyance au démon comme grand tyran, obsession du XVI siècle, avait d’abord
concerné les hérétiques et les marginaux et marginales européen-ne-s, et elle se transmettrait aux
Indien-ne-s. Cet aspect-là du barbare est peu connu en Occident où l’on le voit plus comme cet être
de la frontière décrit par Foucault (1997) dans Il faut défendre la société. Une telle façon de le
percevoir nous empêche de comprendre, aujourd’hui, l’appréhension d’un phénomène comme le
terrorisme par les Américain-e-s. Au XIX siècle, le paradigme Civilisation/Barbarie serait révisé sur
la base de l’évolutionnisme, le barbare devenant l’attardé ou le dégénéré. Historiquement, en
Amérique du Sud comme au Nord, le barbare serait souvent l’« Indien-ne », mais il ou elle pouvait
aussi s’incarner dans certains types de petit-e-s Blanc-he-s. Il faudrait, dans une étude qui reste à
faire, identifier les diverses formes que prendrait, à cette époque, le paradigme du
barbare dans les divers pays d’« Amérique latine ». Nous nous contenterons ici d’évoquer un pays,
l’Argentine, qui a joué un rôle important dans la diffusion de ce dualisme lors de ses deux moments
génocidaires, en 1870 et à la fin des années 1970. L’intellectuel Domingo Sarmiento avait écrit, en
1845, Facundo. Civilización y barbarie, qui fut traduit dans de nombreux pays et exportait la vision
d’un pays où les hommes et les femmes portent la marque d’une nature violente. Le livre, à priori,
se présentait comme la dénonciation d’un caudillo fédéraliste opposé au centralisme de la capitale,
centralisme, bien sûr, identifié au progrès et au développement. Le fédéralisme y était assimilé à la
violence de l’arrière pays et à « l’ignorance » de ses populations racisées, en particulier les gauchos
et gauchas métis-ses ou noir-e-s. Derrière la critique politique d’un partisan de la ville et du progrès
Licence Creative Commons 4.0.
46
réapparaissait la vieille question de la tyrannie évoquée plus haut, qui agitait déjà les chroniqueurs
du XVI siècle. Cette nature, ce désert interminable, c’est la nature qui n’est pas encore ce futur
territoire de l’État argentin, c’est la nature toujours occupée par les « Indienne-s », pas encore
civilisée. C’est l’absence de villes, de bonnes manières, de civilisation. Il faut donc lutter contre
cette nature américaine en s’appuyant sur l’influence européenne et celle de la ville. Le futur
président déplore l’inaction du peuple argentin. Il dit que « leurs enfants sont sales et couverts de
haillons, vivent avec une meute de chiens; que les hommes sont allongés par terre, dans l’inaction la
plus totale; partout le désordre et la pauvreté » (Sarmiento, 1845). Quant à l’habitant-e des pampas,
le gaucho ou la gaucha, il le et la décrit comme un être bête et inculte, « heureux au milieu de sa
pauvreté et de ses privations, qui du reste n’en sont point pour qui n’a jamais connu de plus grandes
jouissances ». Un quart de siècle plus tard, la campagne dite du « Désert », menée contre les «
Indien-ne-s » tehuelches de Patagonie permit l’extension de l’État national au prix d’un génocide
planifié depuis Buenos Aires. Au début du XX siècle, les gauchos et les gauchas qui représentaient
une part importante des habitant-e-s de l’intérieur et les Noir-e-s auraient pratiquement disparu dans
les guerres interétatiques. L’exemple argentin est emblématique d’une histoire continentale marquée
par la destruction menée au nom de la civilisation. Ce cas de figure nous montre qu’au XIX siècle le
paradigme a évolué; on est passé du pessimisme religieux quant à la nature humaine, au pessimisme
des classes dominantes quant à la nature, qu’elle soit humaine ou non, un pessimisme qui se fonde
dans la biologie émergente. Il permettrait de disqualifier des populations dont la disparition,
planifiée ou non, ne poserait pas problème puisqu’elles avaient déjà été mises hors jeu par le
discours du progrès, du développement et de la civilisation. Mais il faut noter les processus
d’euphémisation qui entrent alors en jeu. La pampa n’était pas un Désert, c’était un lieu fertile,
souvent cultivé et habité par des nombreux peuples. Les Blanc-he-s racistes en firent un Désert.
Au XX siècle, la question de la barbarie et de la civilisation serait liée dans de nombreux pays
latino-américains à celle de l’identité et de la sécurité nationale. Cette articulation serait visible dans
les États policiers du Cône Sud, à partir des années 1970. C’est au nom de la civilisation chrétienne
et occidentale que les dictatures militaires ont éliminé les populations « subversives ». Et nous
sommes toujours un peu courts aujourd’hui lorsque nous réfléchissons à la question. Nous ne
prenons pas la mesure de deux événements liés :
• La doctrine de la sécurité nationale qui fut appliquée dans ces régimes répressifs avait été
empruntée aux États-Unis et était indissociable de la défense de la civilisation chrétienne. De même,
la politique de l’État argentin du XIX siècle avait été inspirée par la Conquête de l’Ouest et le
génocide aux États-Unis.
Licence Creative Commons 4.0.
47
• L’autre volet des politiques de répression menées au nom de la civilisation était le développement.
Ce développement, qu’appelait déjà de leurs vœux les partisan-e-s de Sarmiento au XIX
siècle, ce développement, bien sûr, était économique et il s’incarnerait au Chili dans le champ libre
laissé à l’École de Chicago. Comme le souligne le théologien costaricain Soto Moreira, nous
oublions que la répression atroce des années 1970 n’était que la partie visible d’un programme
accepté par la plus grande partie de la population qui croyait en la civilisation et au développement,
cas de la plupart des Occidentaux et Occidentales (Moreira, 2015).
Cette défense de la civilisation avait déjà justifié les génocides d’ « Indien-ne-s » en Amérique du
Nord et du Sud et pouvait être appliqués à des barbares d’un autre type, des Blancs et des Blanches.
Ils et elles partageaient avec les populations autochtones un même trait : ils et elles étaient des
ennemis de la nation, des archaïsmes. Après « la défense de la frontière » contre les Indien-ne-s, il y
avait la défense de la nation contre ses menaces. Les forces armées y appliqueraient une
interprétation nouvelle de leur rôle de défenseur de la frontière, contre leur propre peuple.
De tout cela, il semble que nous ne soyons pas sorti-e-s.
Références
Durand, Gilbert. 1984. Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris : Éditions Payot.
Foucault, Michel. 1997. Il faut défendre la Société. Paris : Gallimard.
Lepe-Carrión, Patricio. 2012. « Civilización y barbarie. La instauración de la « diferencia colonial »
durante los debates del siglo XVI y su encubrimiento como « diferencia cultural ». Andamios 9
(20) : 63-88.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000300004
Mora, Luis Adrián. 2011. « Guerre, barbarie et politique : la défense de l’Indien et la condamnation
de la violence chez Bartolomé de Las Casas ». Revista Ixel 3.
https://www.academia.edu/1499937/Guerre_barbarie_et_politique_la_d
%C3%A9fense_de_lIndien_et_la_condamnation_de_la_violence_chez_Bartolom
%C3%A9_de_Las_Casas
Licence Creative Commons 4.0.
48
Sarmiento, Domingo. 1845. Facundo. Civilización y barbarie. Santiago : Impresa del progreso.
Soto Morera, Diego. 2015. En carne propia : religión y (bio)poder ; una lectura de Michel
Foucault. San José : Ediciones Arlekín.
Licence Creative Commons 4.0.
49
|11. Blanchité
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La blanchité (blancura en espagnol) n’est pas une notion biologique et n’est pas une couleur. Mais
elle passe le plus souvent par cette dernière. Elle permet à un groupe doté de caractéristiques
phénotypiques particulières de jouir d’une position supérieure par rapport à d’autres groupes. Pour
le philosophe colombien Castro Gómez (2005) l’imaginaire de la blanchité correspondait à «
l’ethnicisation de la richesse » lors de la colonisation de l’actuelle Colombie. La blanchité n’est pas
une cause mais un effet du processus d’association d’une impureté (liée à l’impureté de sang) et
d’une couleur, processus qui mettra à peu près deux siècles à se mettre en place. « Être blanc, n’est
pas tant une couleur de peau que la mise en scène d’un imaginaire culturel tissé de croyances,
modes, comportements et types de connaissance » (Gómez, 2005). Il faut paraître blanc-he et pour
cela, se justifier d’une ascendance irréprochable, sans « tache de Juif ni de Maure », ou, pire encore,
de Noir-e. Dans les colonies espagnoles, la pureté de sang était assimilée à une preuve de noblesse
parce que, pour obtenir un titre de noblesse, il fallait se justifier d’un lignage sans tache5. Elle était
un capital culturel permettant d’affirmer sa distinction. Elle correspondait aussi
à un style de vie, à la croyance en certaines valeurs, comme l’honneur. L’impossibilité de justifier sa
pureté de sang rendait la mobilité sociale difficile sinon impossible et permettait de barrer l’accès au
pouvoir politique ou social des groupes non blancs Ce n’était donc pas seulement la
domination des groupes de couleur qu’elle rendait possible, mais aussi la reproduction de cette
domination. Elle pouvait d’ailleurs se négocier, y compris au sens propre du terme (voir l’achat de
blanchité dans toute l’«Amérique latine » du XVIII siècle avec les Reales Cédulas de Gracias
Sacar).Mais peu à peu la blancheur devint la condition indispensable de la blanchité.
La blancura, de Castro Gómez ne doit pas être confondue avec la blanquitud de Bolivar Echeverría,
qui n’est pas un auteur décolonial. Pour ce dernier, la blanquitud est un des fondements du racisme
qui constitue la modernité capitaliste : la modernité a besoin d’un imaginaire de la blancheur
d’ordre éthique qui, dans des cas extrêmes, comme celui du nazisme allemand, peut devenir une
blancheur d’ordre ethnique, biologique. Pour Bolivar Echeverría (2010), l’identité moderne
capitaliste passe par l’identité nationale, qui est une identité fausse mais concrète et dans cette
identité, la blanquitud est essentielle. Parce que la matrice de la modernité fut activée par des
5 Voir sections Race et Pureté de sang
Licence Creative Commons 4.0.
50
hommes blancs, cette couleur devint le trait caractéristique des peuples nationaux.Quelque part
entre le XVI et le XVIII siècle, le phénomène fit d’un trait hasardeux une condition.
On peut appeler blanquitud la visibilité de l’identité éthique capitaliste dans la mesure où elle est surdéterminée
par la blancheur raciale, mais par une blancheur raciale qui se relativise en exerçant cette surdétermination (…).
Le racisme ethnique de la blancheur, apparemment dépassé par et dans le racisme civilisateur ou éthique de la
blancheur, est toujours prêt à reprendre le dessus, avec sa tendance à discriminer et éliminer l’autre, toujours prêt
à relancer son programme génocidaire (Echeverría, 2010).
Il semblerait que nous vivions un moment caractérisé par ce qui est décrit dans la dernière phrase.
Voilà deux conceptions différentes mais qu’il faudrait essayer de penser ensemble, avec en
contrepoint les analyses de la blanchité qui sont faites en Europe.
Références
Castro Gómez, Santiago. 2005. La hybris del punto cero : ciencia, raza e ilustración en la Nueva
Granada (1750-1816). Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/pensar-puj/20180102042534/hybris.pdf
Echeverría, Bolívar. 2010. Modernidad y « blanquitud ». México : Editorial
ERA.
Echeverría, Bolivar. Bogotá. « Images de la blanchité ». Site internet officiel
de Revue Période.
http://bolivare.unam.mx/ensayos/imagenes_de_la_blanquitud
Licence Creative Commons 4.0.
51
|12. Brujo/Hechicero/Doble-Animal
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Ces trois termes renvoient à des croyances, des pratiques et des savoirs à partir de l’Afro Abya Yala.
De manière générale, ce sont des catégories négatives construites en direction de certains savoirs,
formes de pensée afro-descendant.e.s du fait de l’hégémonie du monothéisme catholique en «
Amérique Latine ». Plus concrètement, ici, il s’agit du cas afro-mexicain. La croyance en un double
de l’Homme qui serait un animal (désigné souvent localement par l’expression le « double-animal
»), très partagée au sein de la Costa Chica, se caractérise par le lien entre un humain et un animal,
initié très précocement par l’initiative d’un-e spécialiste (identifié-e comme un « tono » dans cette
relation). L’animal et l’humain partagent une destinée commune, ils ont des vies parallèles et
peuvent être complémentaires. Si l’animal tombe malade, l’humain aussi, et vice versa. D’après
certains récits, l’animal et l’humain peuvent avoir la même odeur. Certains « tonos » peuvent
soigner grâce à leurs connaissances thérapeutiques et à leur apprentissage de la relation entre
l’animal et l’humain. Ce système de relations établit donc une lecture horizontale entre le genre
humain et l’animal, ce qui en soi relève d’une critique forte du rapport occidental face à tout ce qui
n’est pas humain. En outre, il se constitue un ensemble de savoirs, savoir-faires thérapeutiques, qui
permet de soigner le matériel et l’immatériel. En ce sens, il s’agit d’une forme de connaissance qui
se transmet et qui accorde une valeur aux deux dimensions de l’être humain.
Références
Demol, Céline Marie-Jeanne. 2017. Protección y cura : medicina tradicional en comunidades
negras de la Costa Chica, Oaxaca. México D.F. : UNAM.
http://www.cndh.org.mx/documento/proteccion-y-cura-medicina-tradicional-en-comunidades-
negras-de-la-costa-chica-oaxaca
Re, Adriana. 2019. « Corralero y los afrodescendientes de la Costa Chica de
Oaxaca ». Investigación (16) : 151-174.
Licence Creative Commons 4.0.
52
13. Buen Vivir
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Dans les années 1980, le mythe du développement commença à se fissurer de façon spectaculaire.
La promesse des États-Unis de combler le fossé entre les pays « avancés » et les autres s’avérait
fallacieuse. Le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
résume ainsi les changements : l’écart entre les pays dits développés et en développement se creuse
(en 1965, le PIB moyen par habitant des 20% les plus riches de la population mondiale était trente
fois supérieur à celui des 20% les plus pauvres, et en 1990, cet écart avait doublé,
devenant soixante fois supérieur) (Alvarez Leguizamón, 2007). Le « développement », finalement,
avait été une très bonne affaire pour les pays riches et une très mauvaise pour les autres. Les récits
bienheureux qui, dans les années 1950, promettaient à des pays comme le Mexique ou le Brésil de
se développer au plus tard à la fin du siècle s’étaient effondrés, victimes de leur propre poids : les
pays sous-développés avaient pris de plus en plus de retard. Ils ne deviendraient jamais des pays
semblables à ceux qu’ils avaient choisis pour modèle.
Dans le dernier quart du siècle, la vigueur des mouvements indigènes, la question de la détérioration
de la planète et l’opposition à la pauvreté remirent également en question le modèle du
développement dans un contexte où l’échec du développement avait eu, selon Gustavo Esteva
(2010), deux effets : la détermination féroce des élites locales qui décidèrent, en dépit du contexte
économique, de vivre aussi bien, voire mieux, qu’en Occident, aux dépends des locaux (c’est ce que
Esteva nomme le Nord des pays du Sud), et l’émergence, parmi les populations marginalisées,
d’une conscience de leur spécificité et de leur dignité, de leur propre vision de ce qu’était une vie «
bonne ». C’est à ce moment-là qu’on commença à parler de post-développement. Face à la
suprématie d’un american way of life inaccessible, les nombreuses appréciations locales de ce
qu’est la vie bonne devinrent l’objet d’un vaste débat. Et des propositions inaudibles jusque-là,
parce qu’elles ne s’inséraient pas à l’intérieur d’une vision organisée par les principes de
progrès et croissance, émergèrent. Le Buen Vivir devint audible parce que le projet indigène était
devenu visible. Concept andin, le Buen Vivir, Sumak Kawsay en quechua et Suma Qamaña en
aymara, renvoie à une cosmovision très ancienne. Il n’a de sens que dans une opposition ferme aux
stratégies de développement et à la politique des « besoins » qui les sous-tendent.
Contre les dégradations de la nature réduite à « l’environnement » et contre l’asservissement des
êtres humains hypnotisés par la consommation, le Buen vivir propose un nouveau type de
Licence Creative Commons 4.0.
53
démocratie : on y refuse la croissance et on y recherche un état d’équilibre entre êtres humains,
animaux et Mère Terre pour arriver à survivre. Ce Buen Vivir est l’expression de quelque
chose que Quijano appréhenda dès les années 1990. Le penseur péruvien, dans son texte Buen
Vivir : entre le développementet la décolonialité (2014), insistait sur la particularité de ce qui n’est
pas un ensemble de recettes pour (sur)vivre mieux. C’est un projet ne pouvant se réaliser que dans
le cadre d’une transformation sociale d’ampleur. Ce qu’ont prétendu accomplir les gouvernements
progressistes de l’Équateur ou de la Bolivie. Une option à laquelle ont cru certain-e-s intellectuel-le-
s comme Esteva ou Gudynas lorsqu’en 2011, ils insistaient sur le caractère en construction de ce
concept. Et il est indéniable qu’en Équateur le Sumak KawsayKichwa fut au centre des luttes et des
processus constituant de 2007 et 2008. Indéniable aussi qu’en Bolivie avec le Suma Qamaña, il se
passa la même chose. Il donna donc lieu à des changements importants. Mais ce concept, lorsque
les États progressistes s’en emparèrent dans la première décennie du XXI siècle, devint un véritable
programme gouvernemental géré de façon pyramidale par les gouvernements et échappant de fait à
ceux et celles qui l’avaient porté.
Pour les partisan-e-s de l’autonomie en « Amérique latine », un État, quel qu’il soit, ne peut pas
mener la politique décolonisatrice qui est inséparable du Buen Vivir. Les pratiques extractivistes et
les économies des gouvernements progressistes des années 2000 entraient en contradiction
avec le socle du Buen Vivir : quel sens cela avait-il de revendiquer une cosmovision respectueuse
de la nature et, dans le même mouvement, d’encourager des programmes extractivistes miniers ou
pétroliers à des échelles jamais vues jusque là? Quant à l’Europe, qui adopta le concept elle aussi,
elle le détourna de son sens politique originel pour en faire un des éléments d’une écologie
consensuelle ne remettant pas en cause les fondements capitalistes de l’ordre social.
L’instrumentalisation du Buen Vivir semble faire partie de ce qui a produit, dans la deuxième
décennie du XXI siècle, un renforcement de l’autonomie dans les mouvements indigènes, noirs et
paysans.
Références
Esteva, Gustavo. 2010. « Au-delà du développement ». Site internet officiel de Alterinfos. Diffusion
d’information sur l’Amérique latine. DIAL 3129. Consulté le 28 août 2019.
http://www.alterinfos.org/spip.php?article4699
Licence Creative Commons 4.0.
54
Gudynas, Eduardo. 2011. « Développement, droits de la Nature et Bien Vivre : l’expérience
équatorienne ». Mouvements 4 (68) : 15-37.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2011-4-page-15.htm
Leguizamón, Sonia Alvarez. 2007. « La producción y reproducción de la pobreza masiva, su
persistencia en el pensamiento social latinoamerican». Dans Produção de pobreza e desigualdade na
América Latina. Sous la direction de Alberto Cimadamore et Antonio David Cattani, 79-124. Porto
Alegre : Clacso.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/cattapt/
Quijano, Aníbal. 2012. « « Buen vivir » : entre « développement » et décolonialité du pouvoir ».
Viento Sur (122) : 46-56.
https://semillasdelsur.wordpress.com/2018/03/15/bien-vivir-entre-le-developpement-et-la-de-
colonialite-du-pouvoir/
Vanhulst, Julien et Adrian E. Beling. 2013. « Buen vivir et développement durable : rupture ou
continuité? », Écologie & politique 1 (46) : 41-54.
https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2013-1-page-41.html
Licence Creative Commons 4.0.
55
|14. Calle 13/Latinoamérica
SEBASTIEN LEFÉVRE
Calle 13 est le nom d’un groupe musical « latino-américain » composé par des personnes venant
tout d’abord de Puerto Rico et enrichi par d’autres musicien-ne-s du reste du continent. Le groupe
peut être qualifié d’artistes engagé-e-s dénonçant régulièrement dans leurs chansons les différents
problèmes sociaux de l’« Amérique latine » et l’ingérence étasunienne. Par ailleurs, il se distingue
par une vision pan-latino-américaine du continent.
Nous tenons à intégrer ce type de discours, car ces artistes pointent souvent beaucoup plus de
choses sur les différentes formes de colonialité que n’importe quel texte théorique. C’est le cas de
leur chanson Latinoamérica (2011) qui aborde la question de la pluriversalité latino-américaine. La
chanson commence d’ailleurs par une introduction en langue quechúa de Cuzco avant de poursuivre
en espagnol. Même si le groupe ne remet pas en cause le nom du continent dans leur chanson, il
reprend la tension entre unité et diversité. Cette tension est palpable au niveau de l’emploi entre un
Je qui débouche sur un Nous. Par ailleurs, la chanson est accompagnée d’un clip vidéo où les
différentes facettes du continent sont mises en scènes. Les différents reliefs et climats (montagne,
fleuve, plaine, désert, pampa, forêt tropicale, etc.), les différentes formes culinaires, les différentes
croyances religieuses (africaines, peuples originaires), les différentes cultures, les différents alcools,
les différents animaux, les différents visages humains (descendant-e d’Européen-ne-s, d’Africain-e-
s, de peuples originaires, métisse). Tous ces éléments font qu’il est impossible de réduire le
continent à une unicité. Il est bien pluriel, la somme de toutes ces facettes. Il s’agit donc d’une
remise en question de la vision universalisante occidentale du continent au profit d’une vision
pluriverselle des réalités latino-américaines.
Références
« Calle 13 – Latinoamérica ». Vidéo YouTube. Chaîne de el vecindario calle13. 27 septembre 2011.
https://youtu.be/DkFJE8ZdeG8
Licence Creative Commons 4.0.
56
|15. Castro Gómez, Santiago
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Santiago Castro Gómez est un philosophe colombien, enseignant à la Javeriana de Bogotá, qui a
participé au projet Modernité/Colonialité dès ses débuts.
Comme Enrique Dussel, il est parti d’une réflexion sur la philosophie latino-américaine, mais ses
prémisses et ses conclusions ne sont pas les mêmes. Il fut élève de professeurs qui appartenaient au
groupe de Bogotá et contribuèrent à diffuser, en Colombie, la perspective de la philosophie
latino-américaine, laquelle s’inscrivait dans le projet déjà ancien de Nuestramérica du penseur
cubain José Martí. Santiago Castro Gómez travailla également avec l’institut Pensar qui fut lié à la
vague des Études Culturelles en AL à la fin du XX siècle. Il faut d’ailleurs remarquer à cet égard
que c’est par le biais des Études Culturelles que le courant décolonial a pu prendre place dans les
universités latino-américaines.
Dans son premier livre, Crítica de la razón latinoamericana (1996), Castro Gómez s’intéresse à la
philosophie latino-américaine, courant décolonial inclus (à travers l’œuvre de deux intellectuels,
Enrique Dussel et Walter Mignolo). Il revient sur le travail de plusieurs penseurs latino- américains
dont le philosophe péruvien Salazar Bondy, les Argentins Arturo Andrés Roig, Carlos Cullen,
Ezquiel Martinez Estrada et Rodolfo Kusch, le mexicain José Vasconcelos et le bolivien Felipe
Estrada. La particularité du fondateur de la chaire d’Études Culturelles, du spécialiste de Michel
Foucault, est qu’il propose d’utiliser la généalogie foucaldienne comme outil d’analyse : « La
généalogie est une méthode d’analyse qui me permet de ne pas tomber dans les pièges de
l’humanisme et de comprendre que ce que nous sommes aujourd’hui est le produit de ce que nous
avons été » (Castro Gómez, 1996).
Pour Damián Pachón Soto, Castro Gómez s’attache à décrire un discours objet, le «
latinoaméricanisme », pour le critiquer. En bon foucaldien, il affirme que ;
Au lieu de nous interroger sur la vérité de l’identité latino- américaine, nous nous interrogeons maintenant sur
l’histoire de la production de cette vérité. [...] Ce qui est recherché n’est pas un référent porteur de vérité sur
l’Amérique latine, mais un cadre interprétatif dans lequel cette vérité est produite et énoncée. (Castro Gómez,
1996)
Licence Creative Commons 4.0.
57
Dans ce livre qui aborde également la question du modernisme américain (cette articulation
originale dans la culture latino-américaine du discours moderne), il analyse les problèmes posés par
l’historicisme et la philosophie de la conscience, ce que faisait déjà Enrique Dussel, mais à
partir d’une position complètement autre. Santiago Castro Gómez assume le désabusement des
postmodernes vis a vis du projet révolutionnaire, contrairement au philosophe argentin qui ne
remettra jamais en question la nécessité d’un changement social radical. Il est méfiant par rapport
aux utopies en général, et cette méfiance est indissociable de sa critique de notions comme celle de
peuple, ou de nation, qui ont longtemps été l’axe des approches en « Amérique latine ». Pour lui, «
peuple » et « utopie » sont des notions liées à la question de l’identité, elle-même indissociable de
celle du sujet. Il voit l’utopie comme la volonté de créer un monde harmonieux, l’expression d’un
désir qui ne tient pas compte des différences et de l’hétérogénéité de la société :
Le problème de l’utopisme n’est pas tant qu’il offre de fausses solutions à nos problèmes sociaux que son
incapacité à accepter que la vie ne soit pas canalisée par nos projets rationnels et moraux. [ ...] Le pluralisme
démocratique dont nous avons besoin en Amérique latine exige que nous renoncions à l’humanisme comme
fondement. Pour que la démocratie existe, aucun agent ne doit revendiquer une quelconque centralité (cognitive,
esthétique ou morale) dans la société. (Castro Gómez, 1996)
Pour Damián Pachón Soto, Castro Gómez essaie de se débarrasser de l’humanisme en tombant dans
le réductionnisme : il assimile la modernité à l’humanisme et fait de ce dernier un discours
inoffensif. Selon Santiago Castro Gómez, le discours latino-américain s’enracine dans le populisme,
dans la vision d’une altérité latino-américaine comprise comme l’Autre radical de l’Occident; une
inversion qui prend au mot le discours de la modernité sur elle-même. Fidèle à cette prise de
position, dans ses œuvres ultérieures, il étudiera les formations discursives colombiennes, retracera
l’histoire de l’héritage colonial en Colombie avec La hybris del punto cero (2005). Son travail sur la
blanchité dans le vice-royaume de Nouvelle Grenade et son analyse de l’hybris du point zéro
constituent une mise en contexte historique du discours décolonial sur la race et sur la colonialité du
savoir. Dans ses livres, Santiago Castro Gómez utilise la distinction colonialisme/colonialité et a
recours aux concepts de colonialité du pouvoir, du savoir et de l’être élaborés, entre autres, par
Aníbal Quijano, Walter Mignolo et Nelson Maldonado Torres. Mais il est plus attentif aux
spécificités des héritages coloniaux dont la logique n’est pas celle du colonialisme. Pour lui, si le
colonialisme est un phénomène ontologique, la colonialité est une forme d’expérience inscrite dans
le corps, un mode de relation avec le monde. Il faut donc capter la microphysique du pouvoir et voir
comment, et à partir de quelles techniques de pouvoir, se reproduisent les héritages coloniaux, pour
Licence Creative Commons 4.0.
58
identifier ce qui se passe aux trois niveaux de la colonialité. Dans une communication récente sur
Mariátegui, dont la traduction française est à paraître, il écrit, revenant sur la généalogie :
Dans mes propres travaux sur la colonialité du pouvoir, j’ai préféré écouter l’avertissement de Mariátegui
concernant l’attention à la méthodologie et, plutôt que de privilégier l’analyse macrosociologique, j’ai choisi de
m’appuyer sur la généalogie. Les avantages heuristiques liés à cette méthode sont nombreux. Tout d’abord, la
généalogie est un « modèle d’interprétation » et non
une « science sociale », qui étudie la façon dont les relations de pouvoir opèrent historiquement dans des
contextes spécifiques. La généalogie ne s’appuie pas sur la thèse selon laquelle ces relations dépendent « en
dernière instance » d’une formation mondiale du pouvoir (la naissance de la division raciale du travail comme
fruit de l’expansion coloniale européenne), mais elle étudie le pouvoir en tant que relationalité multiple à partir
d’un point de vue inductif. Ce qui veut dire que les relations coloniales ne germent pas en premier lieu dans les
régimes globaux de pouvoir, mais dans les pouvoirs plus locaux qui leur servent de soutien. (Castro Gómez,
2018)
Comme Arturo Escobar, Santiago Castro Gómez se sert de la perspective foucaldienne mais en
pointe les limites, en particulier lorsqu’il est question de généalogie de la modernité. Foucault,
d’après lui, réduit le colonialisme à une conséquence de la modernité européenne en formation. Il a
réalisé une analyse décoloniale qui décortique les ambiguïtés de la théorie de la gouvernementalité
propre au chercheur français. Il insiste en particulier sur la disparition de l’idée de biopolitique
comme de celle du concept de guerre des races dans les derniers séminaires.
Ce connaisseur de la philosophie politique européenne démonte l’approche de Antonio Negri et
Michael Hardt lorsque ces derniers, dans leur célèbre Empire (2000), proclamaient la fin de
l’impérialisme, manifestant par là leur incompréhension du fonctionnement de la colonialité.
Critique par rapport à l’idée de système-monde, mais pour d’autres raisons que Mignolo lequel
incrimine surtout l’oubli de la dimension américaine de la modernité, et reprenant l’idée, ancienne
chez lui, d’une nécessaire compréhension hétérarchique du pouvoir, il essaie de faire place
à une conception du pouvoir conçu comme autre chose qu’une simple domination, comme une
relation d’assujettissement/subjectivation.
Pour le comprendre, il ne suffit pas d’avoir une conception « hiérarchique » du pouvoir comme celle que brasse
l’analyse du système-monde, mais il faut se diriger vers une vision où le pouvoir n’est pas seulement perçu
comme une force irrésistible imposée d’en haut par les dominateurs et dominatrices à travers l’usage de la force
et de la violence, mais comme un rapport de force consenti par les dominé.e.s. La colonialité du pouvoir ne
signifie pas seulement un exercice de la violence, mais un ensemble de technologies capables de générer des
types déterminés de subjectivité. Ce qui signifie que la colonialité n’est pas une « totalité » qui sur détermine
toutes les hiérarchies sociales, comme le suggère Quijano, mais un type spécifique de pouvoir qui s’articule
stratégiquement avec d’autres pouvoirs. (Castro Gómez, 2018)
Licence Creative Commons 4.0.
59
S’il met en question l’idée d’une surdétermination des hiérarchies sociales chez Quijano, il
reconnaît au Péruvien une conscience de ce que la critique de la modernité n’implique pas un
détachement absolu, citant ce passage :
Nous ne sommes pas obligés de confondre le rejet de l’eurocentrisme dans la culture et dans la logique
instrumentale du capital avec une stratégie obscurantiste de rejet ou d’abandon des promesses originelles de
libération de la modernité : à commencer par la désacralisation de l’autorité dans la pensée et dans la société; des
hiérarchies sociales; des préjugés et des mythes qui s’y enracinent; la liberté de pensée et de connaître; de douter
et de questionner; d’exprimer et de communiquer; la liberté individuelle libérée de l’individualisme; l’idée de
l’égalité et de la fraternité de tous les humains et de la dignité de toutes les personnes. Tout cela n’est pas né en
Europe. Mais c’est avec elle que tout cela a voyagé versl’Amérique latine. (Quijano, 1988 : 33)
Pour lui, Aníbal Quijano comprend qu’il ne faut pas confondre modernité et capitalisme. Cette
critique de la totalité l’amène à se distancier clairement de certaines approches décoloniales et à
prôner un « républicanisme transmoderne ». Si le dernier concept semble pour le moment encore
assez peu défini, ses critiques de l’univocité de la théorie décoloniale lorsqu’il est question de
modernité semblent par contre tout à fait pertinentes. Il s’oppose à la vision de l’histoire de Walter
Mignolo ou de Ramón Grosfoguel lorsqu’il défend une toute autre vision de la révolution
française :
Affirmer, par exemple, que le capitalisme a représenté le triomphe final des idéaux politiques de la bourgeoisie et
que ce triomphe a été renforcé par la révolution française, n’est rien de plus qu’une
absurdité idéologique. Car en réalité, c’est tout le contraire qui a eu lieu. Si la bourgeoisie capitaliste a bien
triomphé, elle l’a fait à l’encontre des idéaux d’émancipation de la révolution française… Si elle prétendait
soumettre la société à un « état de droit » et éviter la tyrannie de quelque instance particulière (y compris ici la
tyrannie du marché), c’est tout le contraire qui a eu lieu. Le capitalisme est devenu une dictature, dénaturant les
idéaux de la révolution et capitalisme. (Castro Gómez, 2018)
Pour lui, il faut reconnaître que ce sont précisément les idéaux de la modernité qui nous permettent
de penser le dépassement des limites actuelles de cette dernière, ce pourquoi il écrit :
D’autre part, j’ai l’impression que certains penseurs dé coloniaux s’engagent souvent dans ce que nous,
philosophes, appelons « la contradiction performative ». Je fais allusion à ces situations où
l’argumentation, en tant qu’acte performatif, contredit en fait son contenu. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une
personne critique la modernité dans sa totalité parce qu’elle est un projet colonialiste et eurocentré, mais pour
défendre sa position, se sert des ressources mises à sa disposition par cette même modernité (ibid.).
Licence Creative Commons 4.0.
60
La position originale de Santiago Castro Gómez au sein du courant décolonial et la jonction qu’il
réalise entre l’apport de Foucault et la perspective décoloniale font tout le prix de l’apport de cet
auteur. On regrettera néanmoins, chez quelqu’un qui a déconstruit avec autant de finesse le discours
latino-américain et les notions de peuple ou d’État, une certaine ingénuité lorsqu’il appelle à utiliser
des institutions républicaines. Ces dernières ont montré, partout dans le monde, leurs limites et leur
violence, leur détournement. Quant à sa vision des mouvements indigènes, elle est regrettablement
biaisée par sa position hostile à des identités qu’il a du mal à envisager comme des constructions
politiques. Cependant, il pose des problèmes de fond qui ne sont pas toujours abordés parmi les
auteurs décoloniaux et autrices décoloniales et certaines de ses critiques sont essentielles pour que
la théorie décoloniale puisse évoluer dans le sens d’une plus grande ouverture.
Références
Allen, Amy. 2016. The end of progress. New York : Colombia University Press.
Bourguignon Rougier, Claude. 2017. « Le chapitre manquant d’Empire. Une approche décoloniale
». Intervention dans le cadre du séminaire Empires. Université Stendhal, Grenoble. 27 janvier 2017.
https://empires.hypotheses.org/283
Castro Gómez, Santiago. 1996. Crítica de la razón latinomaericana. Barcelona : Puvill Libros.
Castro Gómez, Santiago. 2006. « Le chapitre manquant d’Empire. La réorganisation postmoderne
de la colonisation dans le capitalisme postfordiste ». Multitudes 3 (26) : 27-49.
http://1libertaire.free.fr/Negri-Hardi04.html
Castro Gómez, Santiago. 2017. « L’hybris du point zéro. Science, race et lumières en Nouvelle-
Grenade (1750-1816). Introduction ». Revue d’études décoloniales. Consulté le 28 août 2019.
reseaudecolonial.org/20201717/09/26/lhybris-du-point-zero-science-race-et-lumieres-en-nouvelle-
grenade-1750-1816-2/
Castro Gómez, Santiago. 2018. « Penser les décolonisations : Questions ouvertes dans la théorie
décoloniale. Réfléxions à partir de la pensée de Mariátegui ». Conférence dans le cadre du cycle de
conférences : Penser les décolonisations. Université de Louvain, Louvain-La-Neuve. 25 juin 2018.
Licence Creative Commons 4.0.
61
Martínez Andrade, Luis. 2016. « Compte rendu du livre : Santiago Castro Gomez, Revoluciones sin
sujeto Slavoj Zizek y la critica del historicismo moderno ». Francfort : Acta Universitatis
Carolinae, Interpretationes, Studia Philosophica Europeanea.
https://karolinum.cz/data/clanek/4895/15_Andrade.pdf
Pachón Soto, Damián. 2015. « Crítica del antilatinoamericanismo de Santiago Castro Gómez ».
Cuadernos Americano 1 (151) : 129-153.
Quijano, Aníbal. 1988. Modernidad, identidad y utopía en América latina. Lima : Sociedad y
politica ediciones.
Licence Creative Commons 4.0.
62
|16. Changó el gran putas
SEBASTIEN LEFÉVRE
Changó el gran putas est l’œuvre de l’Afrocolombien Manuel Zapata Olivella, né en 1920 et mort
en 2004. Ce dernier est un personnage multifacétique, à la fois écrivain, médecin et anthropologue,
voire selon ses propres propos, « vagamundo ». Avec sa sœur Delia, il anime des ateliers et
des groupes de danse et de théâtre folklorique afrocolombiens. Leur souci est d‘intégrer les cultures
afrocolombiennes dans la culture officielle de l’État-nation colombien. Le duo lutte entre autres
contre ce qu’on appelle l’invisibilisation des communautés afro. Ce livre est publié en 1980. Il est le
fruit, selon l’auteur, de plus de trente ans de recherches et de voyages. L’auteur a eu l’occasion de
parcourir à pied une partie de l’Amérique centrale et du nord pendant les années 1940, arrivant
jusqu’à New York où il a rencontré l’effervescence du mouvement Harlem Renaissance. Il confesse
d’ailleurs, dans un autre de ses livres, que l’écriture de Changó a été déclenchée par un voyage au
Sénégal :
Transcurría la noche con los misteriosos sonidos y olores del vientre fértil de la tierra abriéndose en la oscuridad,
cuando escuchamos el retumbar de unos tambores en la distancia. Sentimos pasos en el patio central. Algunos
llegaban y otros partían. Nos levantamos al calor de las voces, preocupados de que ocurriera alguna novedad
adversa. El jefe creyó tranquilizarnos al decirnos que en la aldea vecina se iniciaba laceremonia ritual de
enucleación del clítoris a una púber. De inmediato le manifesté mi deseo de sumarme a los que marchaban,
revelándole mi condición de médico. Mi intérprete, conocedor de aquellas culturas, me repitió lenta y
pausadamente la respuesta:
-Sólo los dyolas pueden concurrir al ceremonial.
En la madrugada, a la luz de la lámpara, escribía en mi libreta los trazos vivos de mi novela Changó, el gran
putas, recogiendo los entrecruzados sentimientos que me inspiraba el continente de mis antepasados en lo cual
todo me era extraño y familiar. La víspera de abandonar a Dakar en un avión que me conduciría al Brasil mulato
y a la, desde Senegal, mi lejana Colombia triétnica, visité la isla de Gorée donde concentraban encadenados a los
rebeldes wolofs, sereres y dyolas del Senegal y Gambia, en espera de los barcos negreros. La respiración abierta,
el espíritu recogido, me bebí todas las sangres, los gritos, dolores y llantos acumulados sin que los siglos
hubieran podido expulsarlos de la Casa de los Muertos donde los sembraron las maldiciones de los que partían
contra la “loba blanca. Esa tarde, cuando sobre los muros de la isla imperial describí la factoría imaginaria de
Nembe en las orillas del río Níger, las páginas de mi novela también se tiñeron de sangre. (Zapata Olivella,
1983 ).
La nuit s’écoulait emplie par les bruits mystérieux et les odeurs de la terre fertile qui s’ouvrait dans l’obscurité,
lorsque nous avons entendu le grondement des tambours au loin. Nous avons senti des pas dans la cour centrale.
Licence Creative Commons 4.0.
63
Il y avait des va-et-vient. Nous nous sommes levés à la chaleur des voix, inquiets qu’un événement défavorable
puisse se produire. Le chef s’est cru rassurant en nous disant que dans le village voisin commençait la cérémonie
rituelle d’excision d’une jeune pubère. J’ai immédiatement exprimé mon désir de me joindre à ceux qui s’y
rendaient, lui révélant mon statut de médecin. Mon interprète, qui connaissait bien ces cultures, a répété
lentement et calmement la réponse :
-Seuls les Dyolas peuvent assister à la cérémonie.
À l’aube, à la lumière de la lampe, j’ai écrit dans mon carnet les premiers jets de mon roman Changó, ce sacré
dieu, en rassemblant les sentiments confus inspirés par le continent de mes ancêtres où tout m’était étrange et
familier.
La veille de mon départ de Dakar, dans un avion qui me conduirait au Brésil mulâtre et, du Sénégal, à ma
lointaine Colombie triethnique, j’ai visité l’île de Gorée où les rebelles Wolof, Serere et Dyola du Sénégal et de
la Gambie étaient rassemblés et enchaînés, attendant les navires négriers. Le souffle ouvert, l’esprit recueilli, j’ai
bu tout le sang, les cris, les douleurs et les larmes accumulés sans que les siècles aient pu les expulser de la
Maison des morts où les malédictions de ceux qui partaient contre la « louve blanche » les avaient semés. Cet
après-midi-là, lorsque j’ai décrit le comptoir imaginaire de Nembe sur les rives du fleuve Niger, les pages de
mon roman se sont également tachées de sang.
Son expérience d’écriture est ce que l’Occident caractériserait comme une écriture mystique,
d’autant que dans un autre livre, il relate que lors de ce voyage à Gorée, alors qu’il avait demandé
au Président Senghor l’autorisation de séjourner une nuit dans la maison des esclaves, il a vu
défiler des dizaines de personnes enchaînées et l’une d’elle s’est arrêtée pour le regarder. Il
s’agissait, toujours selon son expérience, de l’un de ses ancêtres. Cette expérience dépasse la raison
occidentale et renvoie à une raison ancestrale africaine.
Changó el gran putas peut être vu comme un roman décolonial car il prend sa source sur les rives
africaines où est présenté le cadre de ce que sera la future déportation africaine. Zapata Olivella
nous parle de ces cultures africaines millénaires. Il s’appuie sur une discursivité traditionnelle
africaine qui est celle des griots; l’auteur débute son ouvrage par un chant épique qui va expliquer
pourquoi les Africain-e-s ont été déporté-e-s. Les personnages premiers de son roman sont les
orishas du panthéon yoruba, notamment Changó. Si l’on se base sur la conception littéraire
occidentale du personnage, on pourrait assimiler ces derniers à de purs personnages
fictionnels. Or, il s’agit des différents orishas qui accompagnent la vie des gens au quotidien, et ce
depuis des millénaires. Zapata Olivella s’inscrit d’emblée dans une manière non occidentale de
concevoir la relation entre l’individu, la communauté, les dieux et les ancêtres, car toutes ces entités
interagissent réellement. Il postule par là-même l’historicité propre aux populations africaines. Une
historicité niée par la traite, l’esclavage et la déportation.
Licence Creative Commons 4.0.
64
Par ailleurs, l’ouvrage de Zapata, à travers la saga de la diaspora africaine au « Nouveau Monde »,
va contribuer à livrer une autre version de l’histoire officielle. Toute la narration constitue un
contre-discours à la Modernité occidentale car l’histoire est racontée depuis les positions des
déshumanisé-e-s. Un point de vue quasi inexistant dans l’historiographie officielle. Mais
surtout il va doter les sujets afrodiasporiques d’une capacité d’agir sur leur propre destinée. Image
qui va à l’encontre de la passivité avec laquelle sont souvent présentées les populations
afrodescendantes. Le cas le plus emblématique est celui de Bolivar, considéré dans tous les livres
d’histoire comme le grand libérateur. Dans son livre, Zapata Olivella organise le procès
du grand libérateur devant les ancêtres qui lui signalent qu’il a trahi son engagement à l’égard
d’Haïti. En effet, peu de livres d’histoire rapportent le fait que Simón Bolívar, après avoir reçu
l’aide d’Haïti, devait à la demande du président Pétion, libérer les Noir-e-s de l’esclavage partout où
il commanderait. Chose que Bolívar n’a pas fait.
Le reste de l’ouvrage est parsemé de figures historiques afrodiasporiques comme le premier
libérateur de Palenque, Benkos Bioho, le libérateur afro-mexicain José María Morelos, Boukman
d’Haïti, Toussaint l’Ouverture, José Prudencio Padilla (fusillé sur l’ordre de Bolivar), Nat Turner
aux États-Unis, Malcom X, les Blacks Panthers, etc.
Zapata Olivella s’érige donc en contre-discours à la Modernité occidentale quant à l’historicité des
populations africaines, leur capacité d’agir et de transformer leur propre réalité, mais surtout leur
participation à la construction des terres nouvellement « découvertes ». En filigrane,
l’idée avancée par Zapata Olivella est que sans l’Afrique et la main d’oeuvre africaine, il n’y aurait
pas eu d’Amérique et que ces populations sont dotées de cultures ancestrales, certes reformulées
dans un contexte d’oppression intense, qui sont tout aussi valables que celles de l’Occident.
Il n’écarte pas pour autant les peuples originaires puisqu’il les intègre dans un même mouvement de
résistance. Sa conception de l’Amérique est triethnique : Peuples originaires, Afrique et Amérique.
Références
Zapata Olivella, Manuel. 1983. Changó el gran putas. Bogotá : Oveja Negra : 337-338.
Zapata Olivella, Manuel. 1990. ¡ Levántate Mulato! Por mi raza hablará el espíritu. Bogotá : REI
ANDES LTDA.
Licence Creative Commons 4.0.
65
Zapata Olivella, Manuel. 1997. La rebelión de los genes. El mestizaje americano en la sociedad
futura. Bogotá : Altamir Ediciones,
Traduction française de Changó el gran putas: Zapata Olivella, Manuel. 1991. Changó, ce sacré
dieu. Éditions du Miroir. 84 |Changó el gran putas
Site internet du documentaire sur Manuel Zapata Olivella. https://manuelzapataolivella.co
Licence Creative Commons 4.0.
66
| 17. Chaos
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Le chaos est un élément majeur de la colonialité imaginaire. Il parcourt les discours littéraires,
politiques et religieux depuis la Conquête jusqu’à nos jours. Il est toujours rattaché à des territoires
qui furent coloniaux ou, dans les anciennes métropoles impériales, aux marges sur lesquelles
s’exerce ou s’est exercé un colonialisme intérieur.
La figure du chaos est très ancienne dans les textes européens mais elle s’affirme particulièrement
lorsque les grands États-nations commencent à prendre forme, à partir du XVI siècle ,et depuis, elle
continue d’imprimer sa marque à l’imaginaire moderne.
Dans les écrits de la Conquête, les chroniques en particulier, le Chaos représente à la fois la mise en
danger d’un système politique, la royauté et un état du monde indien où l’indifférencié l’emporte :
inceste, anthropophagie qui rabaissent l’humain à l’état de moins qu’animal; langue dépourvue de
grammaire et de concepts; coutumes dissolues; nourriture immonde. Cet univers est un grouillement
qui constitue une sorte d’avant goût de l’Enfer, souvent représenté dans la peinture coloniale
comme une bouche anthropophage (Bourguignon Rougier, 2010).
À l’époque contemporaine, lorsque l’imposition du système-monde moderne/colonial et les
migrations qu’il entraîne rendent nécessaire un contrôle accru des populations, toute remise en
question de l’ordre établi est rapidement assimilée au chaos.
Le terroriste est la figure idéale de ce dispositif sécuritaire qui fait son apparition à partir du XVII
siècle. Ce terroriste dont le contour est beaucoup plus incertain que ne le voudraient les honnêtes
gens, jadis, opposant à l’occupation allemande, aujourd’hui, guerrillero amazonien, djihadiste ou
militant de certaines organisations kurdes, est à la fois un représentant de la barbarie et celui par qui
advient le chaos. Mais d’autres peuvent postuler : Zadistes, Blacks Blocs, écologistes radicaux et
radicales, ultragauchistes subversi.f.ve.s, musulman-e-s « radicalisé-e-s », Gilets jaunes.
Dans un Occident mécréant, ce n’est plus l’image de la dévoration cannibale qui effraie, mais le
spectre de la destruction de l’ordre. Un ordre qui ne renvoie plus à l’ordonnancement divin de
l’univers mais à la disciplinarisation, aux processus de normalisation et de normation à travers
lesquelles se construisent les subjectivités modernes.
Les prêtres menaçaient les peuples chrétiens de finir en Enfer, aujourd’hui, les gouvernements
manipulent la peur du chaos. Le chaos, c’est celui de la nature, mais aussi de la culture. L’idée
Licence Creative Commons 4.0.
67
d’une nature chaotique qu’il faut ordonner, entre autres, à travers les processus de classement et
taxinomies, est présente dès les débuts de l’époque moderne.
Mais il est remarquable que la figure de la nature comme potentiellement destructrice et
désorganisatrice se soit affirmée avec la colonisation de l’Amérique qui deviendrait la nature par
antonomase. Jusque-là, elle était pensée comme dégénération suite à une Création dont la perfection
n’avait pu se maintenir. La force de la pensée catholique de la Chute s’exprimait aussi à travers ce
sentiment d’une déperdition perpétuelle de la vitalité et la pureté d’une Création attaquée par les
forces de corruption.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans ce discours chrétien de la dégénération, mais le chaos
reste un des outils des discours gouvernementaux et médiatiques. C’est le chaos à Haïti quand le
cyclone détruit les villes et décime les populations, ou encore à La Nouvelle Orléans lors de la crue
du fleuve. C’est le chaos en France chaque fois que les inondations, comme celle de 1992,
réactivent l’archétype terrifiant de l’eau destructrice. Mais c’est aussi le chaos quand des révoltes
populaires prétendent remettre en question le consensus. Lorsque des citoyens et citoyennes
envisagent une sortie d’un modèle en Europe (l’Euro par exemple) ou au Soudan, en 2019,
lorsqu’un pouvoir allié à des forces génocidaires réprime la population lasse de cette domination.
Le chaos fonctionne rarement seul, il est associé à d’autres images, comme celle de
l‘anthropophagie et fait partie d’un essaim d’images qui composent l’imaginaire de la barbarie :
ténèbres infernales, violence qui mutile, dévoration et chute dans la bestialité.
Dans la littérature latino-américaine, le chaos est spirale, tourbillon et vortex. En cela, il est l’image
terrifiante de cosmogonies qui ont été combattues par les pays occidentaux lors des phases
coloniales : spirales des calendriers et arithmétiques mayas (figuration de l’infini), des coquillages
sacrés africains, double hélice du malinalli mexicain (force vitale), spirale des mythes de nombreux
peuples amazoniens. Car cette peur du chaos fut aussi celle des symboles de l’Autre.
Le chaos ou colonialité de l’imaginaire, même dans un monde désacralisé, renvoie toujours à
l’Enfer et à la punition. Si les paradigmes qui soutiennent la domination du Nord sur le Sud ont
changé, si l’on est passé comme disait Ramón Grosfoguel (2006) du « christianise-toi! » au «
civilise-toi! » et de celui-ci au « développe-toi! », il reste que notre imaginaire résulte de la
sédimentation de ces époques diverses et, n’en déplaise au présentéisme de notre époque, avec la
ronde de ces archétypes, le passé continue de s’agiter.
Références
Licence Creative Commons 4.0.
68
Bourguignon Rougier, Claude.2010. « Stratégies romanesques et construction des identités
nationales ». Thèse de doctorat. France :Université de Grenoble.
https://www.academia.edu/11778386/Strat%C3%A9gies_romanesques_et_construction_des_identit
%C3%A9s_nationales._Essai_sur_limaginaire_post-colonial_dans_quatre_fictions_de_la_for
%C3%A
Grosfoguel, Ramón. 2006. « La descolonización de la economía política y los estudios
poscoloniales. Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global ». Población (80) :
53-74. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Panama/cela/20120718102251/descolonizacion.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
69
18. Citoyenneté
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La citoyenneté est un élément essentiel des rapports de pouvoir modernes. Elle est une interface
subjective entre l’état moderne et les populations. Si cette relation, malgré tout ce qu’elle suppose
de renoncement, fonctionne assez bien, ou plutôt, a fonctionné assez bien, dans les ex-métropoles
impériales, dans les ex-pays colonisés, aujourd’hui pays en voie de développement ou Tiers monde,
la catégorie pose de nombreux problèmes. L’exclusion d’une partie de la population, depuis les
débuts des républiques indépendantes, y est trop massive. La citoyenneté a été pensée à partir d’une
extériorité violente avec ce qui n’était pas le monde occidental ou la civilisation. C’est la
citoyenneté d’un homme blanc, patriarche, hétérosexuel, propriétaire et lettré.
Aujourd’hui, on pourrait dire qu’avec le développement du multiculturalisme et de l’interculturalité,
le plurinationalisme équatorien ou bolivien, on a fait un pas. Mais que sont ces politiques de
reconnaissance?
S’agit-il d’une reconnaissance véritable? Et quel sens cela a-t-il de reconnaître une différence qui
continue de se traduire par l’exclusion et la marginalisation?
Comme le remarque un intellectuel mixe, la citoyenneté multinationale n’est pas la citoyenneté
indigène. Le premier concept identifie minorités nationales et minorités indiennes, le second attire
l’attention sur la ligne abyssale qui sépare zone de l’Être et zone du non Être. Si la « citoyenneté
multinationale », caractéristique du discours libéral, occulte la différence, la distinction entre
minorités nationales et peuples autochtones, la « citoyenneté autochtone » propre à l’approche
décoloniale, elle, reconnaît la différence, et pointe du doigt la ligne abyssale entre la zone de l’Être
et la zone du non Etre. (Martínez Andrade, 2017)
Le concept de citoyenneté, comme celui de démocratie, fonctionne au mieux partiellement en «
Amérique latine ». Non pas comme nous poussent à le croire gouvernements, élites et médias
internationaux, parce qu’une nature violente accablerait les populations indisciplinables de cette
partie du monde, mais parce que les nouvelles formes d’impérialisme n’autorisent pas la
généralisation du modèle. L’existence d’une démocratie de « faible intensité » dans les pays en voie
de développement apparaît comme une nécessité structurelle. Des théoriciens et théoriciennes de la
dépendance, comme André Gunder Frank, l’ont démontré à propos du Brésil par exemple.
Au-delà des formes spectaculaires d’atteinte à la démocratie, lors des dictatures des années 1960 ou
1970, il faut que se perpétue dans les pays dépendants une surexploitation nécessaire au bien-être
Licence Creative Commons 4.0.
70
des groupes dominants et cette surexploitation est contradictoire avec l’existence d’un État de droit.
La précarité de la vie de certains-e-, de préférence les racisé-e-s, mais pas seulement eux ou elles,
est un prérequis.
Références
Martínez Andrade, Luis. 2017. « Pedro Garzón López, Ciudadanía Indígena : Del multiculturalismo
a la colonialidad del poder ». Amerika (16). http://journals.openedition.org/amerika/7889
Licence Creative Commons 4.0.
71
19. Colonialisme interne
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Nous ne devons pas ignorer que les termes « colonialité du savoir » ou « pensée décoloniale », par
exemple, sont postérieurs à celui de « colonialisme interne » et qu’ils y plongent leurs racines.
(Torres Guillén, 2014 : 86) Le concept de colonialisme interne ne fait pas partie du lexique
décolonial, mais il présente des points communs avec la théorie du projet Modernité/Colonialité. Ce
concept a d’ailleurs une histoire assez ancienne qui renvoie, entre autres, à celle de la révolution
russe. La notion de colonialisme interne n’est cependant apparue qu’à l’occasion du Congrès des
peuples de l’Est qui s’est tenu à Bakou en septembre de cette année-là. C’est alors que les
musulmans d’Asie, « véritable colonie de l’empire russe », tracèrent les premières lignes
de ce qu’ils ont appelé « le colonialisme à l’intérieur de la Russie ». En outre, ils firent les
premières propositions dans la sphère marxiste- léniniste de ce que l’on nommerait plus tard, «
l’autonomie des groupes ethniques ». Plus précisément, ils ont fait valoir que « la révolution ne
résout pas les problèmes de relations entre les masses laborieuses des sociétés industrielles
dominantes et les sociétés dominées » si le problème de l’autonomie de ces dernières n’est pas
également soulevé. (González Casanova, 2003 : 412)
Par la suite, le concept tomba un peu dans l’oubli; en Afrique et en Asie, dans le cadre des guerres
de libération, il rencontra peu de succès, comme si l’urgence des combats et de la lutte de classe le
rendait obsolète ou qu’il avait perdu de son sens.
En « Amérique latine », Pablo González Casanova, Rodolfo Stavehnhagen et Silvia Rivera
Cusicanqui ont contribué à réhabiliter la notion. La thèse du colonialisme interne a été largement
utilisée sur le continent dans les années 1970 pour caractériser la constitution sociétale des États-
nations à forte présence indigène : « elle a été spécifiquement utilisée pour décrire les formations
sociales du Mexique, de la Bolivie, de l’Équateur et dans une moindre mesure du Pérou et du
Guatemala » (Martins, 2018 : 320).
Il est intéressant de noter que ce concept apparaît en « Amérique latine » à la même époque que la
théologie de la libération et la théorie de la dépendance, qui ont beaucoup inspiré la théorie
décoloniale. Dans les trois approches, nous trouvons des réactions diverses, à partir d’angles
différents, aux politiques de développement mises en place en « Amérique Latine » à la
Licence Creative Commons 4.0.
72
fin des années 1950. La thèse du colonialisme interne fut abordée dans un cadre théorique
particulier : celui de l’hégémonie de l’analyse marxiste dans les sciences sociales latino-américaines
et de la discussion autour de la « marginalité » et des « sociétés duelles ».
La théorie de la marginalité renvoyait aux sociétés ou groupes que le développement urbain n’avait
pas encore touchées, des secteurs qui ne participaient pas à la vie politique du pays, à certaines
populations indigènes n’ayant pas encore le droit de vote (voir le cas de l’Équateur, de la Bolivie
par exemple) ou exerçant ce droit à condition d’oppressions symbolique et pratique. L’analyse de la
marginalité se connecta alors à celle du colonialisme interne. Il n’expliquait pas seulement la
domination économique et politique mais aussi la question de la « superposition culturelle ».
Quant à la « société duelle », il s’agissait d’une approche qui s’intéressait aux raisons pour
lesquelles une région ou un secteur d’un pays donné s’était développé aux dépends d’un autre, sans
qu’il soit possible de rattraper ce décalage. C’est une notion que le Mexicain, Pablo González
Casanova utilisa dans La democracia en México. Les théoriciens de la dépendance Rodolfo
Stavenhagen et André Gunder Franck furent extrêmement critiques avec cette approche. Pour
Rodolfo Stavenhagen, l’idée d’une société duelle avec un pole « féodal » et un autre moderne était
erronée, car elle empêchait de voir qu’il s’agissait d’un seul et même processus. De son côté, André
Gunder Frank (1973) questionnait l’emploi de termes comme « sociétés duelles » ou « tiers-monde
», car ils cautionnaient une certaine vision de la réalité et ne remettaient pas en question le dogme
du développement. Le concept de colonialisme interne lui semblait également lié à une vision
conservatrice de la société et il taxait de « thèse bourgeoise » la vision de González Casanova; son
anthropologie culturaliste donnait plus de poids à l’inégalité et à la discrimination qu’à la
domination et à l’exploitation (Torres Guillén, 2017 : 5). Le sociologue mexicain accepta ces
critiques et développa une idée de l’exploitation dans Sociología de la explotación (González
Casanova), mais il ne passa pas pour autant à une analyse en termes de lutte de classes car l’idée
d’un colonialisme interne lui permettait d’aborder des aspects qui ne relèvent pas seulement de la
domination, par exemple, les politiques humanitaires ou religieuses.
Dans La democracia en México, Pablo González Casanova fut le premier à soutenir que les
relations sociales étaient de type colonial. Wright Mills, auquel le sociologue Aníbal Quijano
consacra d’ailleurs un article, avait déjà employé l’expression « colonialisme interne » en 1963.
Pablo González Casanova est un intellectuel mexicain, surnommé le comandante Pablo Contrera.
C’est ainsi que l’ont baptisé les Zapatistes en 2018 en honneur à sa pensée libre et son soutien. Dès
les années 1960, il se demandait, partant du cas du Mexique, pourquoi le colonialisme perdurait
après les indépendances politiques en « Amérique latine ».
Licence Creative Commons 4.0.
73
Rejetant l’idée que le colonialisme ne devait être envisagé qu’à l’échelle internationale, j’ai affirmé qu’il se
produit aussi au sein d’une même nation, dans la mesure où il existe une hétérogénéité ethnique en son sein, où
certaines ethnies sont liées aux groupes et classes dominantes, d’autres aux dominé-e-s. (González Casanova,
1965)
En 1965, Pablo Casanova se demandait dans quelle mesure cette catégorie permettait d’expliquer
les phénomènes de développement, d’unpoint de vue sociologique, dans leur interactions mutuelles
(González Casanova, 1963 : 17). Et il précisait que ce qui l’intéressait, c’était le potentiel du
concept de colonialisme interne pour l’analyse du sous-développement et des problèmes rencontrés
par les sociétés sous-développées. Dès 1963, il s’intéresse à un colonialisme qu’il voit comme un
phénomène intégral que l’on peut observer au niveau international et à l’intérieur de la nation.
La définition du colonialisme comme système dans lequel des groupes ethniques exercent leur
domination sur d’autres groupes ne le satisfaisait pas, car elle ne concernait que la sphère politico-
juridique. Pour lui, le processus, qui commence par les inégalités économiques, politiques ou
culturelles entre les femmes et les hommes de la métropole et ceux et celles de la colonie, se
transfère au niveau interne avec les inégalités entre les métropolitain-e-s et les peuples autochtones.
Ces inégalités prennent diverses formes : inégalités raciales, de caste, de juridiction, religieuses,
rurales et urbaines, la lutte de classe n’étant pas la seule manifestation de cette structure, il y a aussi
des logiques de résistance, d’obéissance, la rébellion et des luttes pour la reconnaissance (Torres
Guillén, 2017 : 11).
On voit ici que la problématique n’était pas alors une remise en question du concept de
développement, mais plutôt une tentative de l’analyser. L’auteur affirmait la nécessité d’une théorie
du sous-développement qui ne soit pas seulement économique. C’est la limite de son approche qui
est aussi celle de son époque. Cependant, lorsqu’on lit un ouvrage comme La democracia en
México, on y trouve déjà toutes les bases de ce qui sera conceptualisé beaucoup plus tard par
l’approche décoloniale. La logique coloniale qui fait passer de la civilisation au progrès et du
progrès au développement est présente dans son analyse mais elle n’est pas encore remise en
question. Il appartiendra aux théoriciens décoloniaux et théoriciennes décoloniales d’inverser la
logique et de montrer que l’analyse de Casanova est encore prise dans le mythe que la modernité
entretient sur elle-même. Le terme de développement économique est le successeur et l’héritier
d’autres mots tels que « Civilisation » ou « Progrès ». Peut- être moins techniques mais plus
complets que le premier, ces derniers renvoyaient à la même idée, à un type de morale égalitaire,
Licence Creative Commons 4.0.
74
qui est à l’origine de toute éthique sociale depuis le XVIII siècle, et à la base de toute activité
politique – pacifique ou violente – depuis le début, de façon soutenue, de la révolution des grandes
attentes populaires dans ce siècle. (González Casanova, 1965 : 13)
À la fin des années 1960, il a aiguisé son analyse du colonialisme interne, le définissant comme :
Une structure de relations sociales de domination et d’exploitation entre des groupes culturels hétérogènes et
distincts. Ce qui la différencie des autres types de relations de domination et d’exploitation (ville-pays, classes
sociales), c’est l’hétérogénéité culturelle à laquelle a abouti la conquête de certains peuples par d’autres. Cela
nous autorise à parler non seulement de différences culturelles (comme celles qui existent entre la population
urbaine et rurale ou entre les classes sociales) mais de différences decivilisation. (González Casanova, 1969)
Le concept permet également de faire émerger certains aspects d’une relation sociale asymétrique
que l’analyse de classe ne peut prendre en compte. Dans une structure coloniale, la relation de
domination et d’exploitation ne s’exerce pas du ou de la propriétaire au travailleur ou à la
travailleuse. Elle ne passe pas d’individu à individu ni de classe à classe.
Dans la structure coloniale, une population donnée (formée de différentes populations, classes,
propriétaires, travailleurs et travailleuses) est dominée et exploitée par une autre (elle-même formée
par différentes classes). Le souci de Casanova pour « ceux d’en bas », son idée d’une « démocratie
des pauvres » renvoient aussi bien aux propositions actuelles d’Arturo Escobar qu’à la vision des
opprimé-e-s de Enrique Dussel ou au « desde abajo y a la izquierda » des Zapatistes. Et son concept
de colonialisme global, élaboré plus tardivement à la fin du XX siècle, ainsi que son analyse de
la colonisation du monde par un petit groupe de personnes qui affament les autres, rejoint les
analyses des mouvements indigènes. Silvia Rivera Cusicanqui a insisté sur le rôle précurseur de cet
homme pour lequel les analyses qu’il construit doivent d’abord aider les pauvres à bâtir la
démocratie universelle.
Il y a dans la démarche de Casanova quelque chose qui la rapproche de celle de Aníbal Quijano. Il a
fait partie des rares intellectuel-le-s à remettre en question un dogme des années 1960, la thèse du
stade semi-féodal de l’« Amérique latine ». Comme Quijano, il a été attentif à la combinaison des
diverse formes de travail qui ont existé sur le continent depuis la colonisation (travail salarié, semi
servage, servage, esclavage). Comme Quijano, il a vu dans les classes autre chose qu’un élément
structurel, comprenant qu’elles se mettaient en place à travers une articulation concrète : la race.
Le concept de colonialisme interne s’est diffusé en « Amérique latine » et eut un champ
d’application important dans un pays comme le Guatemala. Aujourd’hui, la féministe
guatémaltèque Aura Cumes, lorsqu’elle affirme qu’il n’y a pas de colonialité mais du colonialisme
Licence Creative Commons 4.0.
75
pour les indigènes, s’inscrit dans cette vision. Dans un article de 2003, Pablo González Casanova
remarquait d’ailleurs que c’est en Amérique centrale et en Afrique du Sud que le concept
a été le plus analysé et débattu.
Références
González Casanova, Pablo. 1965. La democracia en México. México : Ediciones Era : 10, 11, 13.
González Casanova, Pablo. 1969. Sociología de la explotación. Siglo Veintiuno Editores. 190.
Gonzalez Casanova. 2003. « Colonialismo Interno (una redefinición) ». Revista Rebeldía (12).
http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/412trabajo.pdf
Gunder Frank, André. 1973. América Latina : subdesarrollo y revolución. México : Ediciones Era.
Martins, Paulo Henrique. 2018. « La actualidad de la Teoría del Colonialismo Interno para el debate
sobre la dominación y los conflictos inter-étnicos ». Dans Encrucijadas abiertas. América Latina y
el Caribe. Sociedad y Pensamiento Crítico Abya Yala (Tomo II). Sous la direction de Alberto L.
Bialakowsky, Nora Garita Bonilla, Marcelo Arnold Cathalifaud, Paulo Henrique Martins et Jaime
A. Preciado Coronado, 311-334. Buenos Aires : Teseopress.
Mencé-Caster, Corinne et Cécile Bertin-Elisabeth. 2018. « Approches de la
pensée décoloniale ». Archipélies (5). https://www.archipelies.org/189
Quijano, Aníbal. 2007 [1994]. « Race et colonialité du pouvoir ». Mouvements 3 (51) : 111-118.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3-page-111.htm
Torres Guillén, Jaime. 2014. « El carácter analítico y político del concepto de colonialismo interno
de Pablo González Casanova ». Desacatos (45).
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2014000200008
Torres Guillén, Jaime. 2017. « El concepto de colonialismo interno ». Instituto de investigaciones
sociales. Universidad Autónoma de México.
Licence Creative Commons 4.0.
76
https://www.academia.edu/34242352/EL_CONCEPTO_DE_COLONIALISMO_INTERNO
Licence Creative Commons 4.0.
77
20. Colonialité de l'être
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
D’abord proposé par le sémioticien Walter Mignolo, le concept de colonialité de l’être est repris par
le philosophe portoricain Nelson Maldonado-Torres. Pour Norman Ajari, ce concept est central
parce qu’il montre que la colonisation a « pour condition de possibilité un rapport particulier au
monde, aux autres et à l’histoire ». Pour Damián Pachón Soto, il synthétise celui de savoir et de
pouvoir, vu l’importance du racisme.
Enrique Dussel fut le premier à entrevoir la colonialité de l’être, en pointant le lien qui unissait
entreprises coloniales et subjectivité, mais c’est Nelson Maldonado-Torres qui l’a posé
expressément :
Si la colonialité du pouvoir renvoie à la relation entre les formesmodernes d’exploitation et de domination, et la
colonialité du savoir,au rôle de l’épistémologie et des taches relatives à la production de connaissance dans la
reproduction de régimes de pensée coloniaux, la colonialité de l’être, elle, se réfère à l’expérience vécue de la
colonisation et à son impact dans le langage. (Maldonado-Torres, 2007 : 130)
Pour Nelson Maldonado-Torres (2004), « L’émergence du concept de colonialité de l’être répond
donc à la nécessité de clarifier l’influence de la colonisation sur l’expérience vécue, pas seulement
sur les représentations des sujets subalternes », car les effets concernent autant les sujets
dominants que les habitant-e-s du côté obscur, l’infériorisation des subalternes et les divers degrés
de déshumanisation qu’elle implique pouvant être considérés comme une caractéristique de la
colonialité de l’être.
Dans son essai Sur la colonialité de l’être. Contribution au développement d’un concept, le
philosophe portoricain revient sur le concept afin de construire sa généalogie, faisant un détour par
l’ontologie de Martin Heidegger. Il reprend le questionnement de Martin Heidegger sur l’être-
là, le Dasein, qu’il faut élucider. Martin Heidegger a une conception de la mort comme facteur
individualisant singulier, lié au fait que personne ne peut être remplacé dans sa mort. C’est ce qui
rend possible une authenticité propre, et une authenticité collective grâce à la figure du leader dans
lequel le « un » s’incarne. Il appartiendrait à Emmanuel Levinas de montrer que cette connexion
authenticité propre/authenticité collective révèle un lien essentiel entre ontologie et pouvoir. Et
Nelson Maldonado-Torres reviendra sur l’analyse d’Emmanuel Levinas, insistant sur les apports de
sa critique, et sur la place qu’elle fait à la figure de l’autre.
Licence Creative Commons 4.0.
78
Mais si Emmanuel Levinas part de l’expérience de l’antisémitisme, Nelson Maldonado-Torres, lui,
part de la violence subie par les peuples autochtones avec la colonisation espagnole. Cette même
violence que Enrique Dussel analyse, lorsque, partant du postulat d’Emmanuel Levinas, il
mettra en évidence la connexion entre l’être et les expériences coloniales et les dotera d’un
historicité liée à la formation du système-monde moderne/ colonial. Dans cette perspective, la
formation d’une subjectivité nouvelle, celle du Conquistador, de l’ego conquiro, est fondatrice.
Nelson Maldonado- Torres reprendra cette idée d’ego conquiro, et la développera avec la notion
de « non éthique de la guerre », en s’appuyant sur l’approche de Frantz Fanon. La non éthique de la
guerre, c’est le pouvoir de tuer, piller, violer, qui passe du statut d’exceptionnalité à celui de règle,
qui naturalise la relation létale. Le racisme s’insère dans ce moment liminal, lorsqu’il s’agit de dire
l’autre après s’être contenté de le dominer. Et le philosophe portoricain montre que si Enrique
Dussel a mis en évidence la dimension historique de la colonialité de l’être, Frantz Fanon lui donne
sa dimension vécue, en rapport avec l’expérience du racisme. Pour Emmanuel Levinas, le point de
départ c’est un moment a-historique, la constitution de la subjectivité dans son rapport avec l’autre.
Pour Nelson Maldonado-Torres, c’est ce que Frantz Fanon a théorisé : le trauma de la rencontre
entre un sujet racialisé et l’autre impérial, le : « Regarde, un Nègre! ». « Les Noirs et les colonisés
deviennent des points de départ radicaux pour toute réflexion sur la colonialité de l’être »
(Maldonado-Torres, 2007), leur expérience de misère et de mort les condamnant à la
déshumanisation. Cette expérience vécue de la subalternité coloniale, de la différence coloniale est
fondamentale : « Le Damné est pour la colonialité de l’être ce que le Dasein est pour l’ontologie
fondamentale »(ibid.).
Références
Ajari, Norman. 2016. « Réflexions polémiques sur la colonialité de l’être ». Revue d’études
décoloniales (1).
https://reseaudecolonial.org/2016/09/02/etre-et-race-reflexions-polemiques-sur-la-colonialite-de-
letre/
Licence Creative Commons 4.0.
79
Maldonado-Torres, Nelson. 2007. « Sobre la colonialidad del ser : contribuciones al desarrollo de
un concepto ». Dans El giro decolonial. Sous la direction de Santiago Castro Gómez et Ramón
Grosfoguel, 127-167. Bogotá : Siglo del Hombre.
Traduction française. 2014. « A propos de la colonialité de l’être. Contribution à l’élaboration d’un
concept » . Dans Penser l’envers obscur de la modernité. Une anthologie de la pensée décoloniale
latino-américaine. Sous la direction de Claude Bourguignon Rougier. Philippe Colin et Ramon
Grosfoguel. Limoges. Pulim.
Licence Creative Commons 4.0.
80
21. Colonialité de genre
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Il ne s’agit pas seulement d’introduire le genre comme l’un des thèmes de la critique décoloniale ou comme l’un des
aspects de la domination envisagée à partir du modèle de la colonialité. Il faut lui donner un véritable statut théorique et
épistémique, l’analyser comme une catégorie centrale susceptible d’éclairer tous les autres aspects de la transformation
qui s’imposa aux communautés lorsqu’elles furent prises dans le nouvel ordre colonial moderne.
(Segato, 2011)
L’idée de colonialité du genre a été avancée par la féministe argentine Maria Lugones. Dans un
article datant de 2008, elle remarquait que la domination coloniale d’Abya Yala s’est accompagnée
d’une modification du statut des femmes et de la perte de l’autonomie dont elles jouissaient jusque-
là à des degrés divers. Cela a fait d’elles les subalternes des hommes colonisés. Maria Lugones est
la première à interroger d’un point de vue féministe le concept de colonialité du pouvoir en posant
l’hypothèse d’un système moderne-colonial de genre. Elle affirme que l’idée de genre est aussi
centrale que celle de race pour comprendre la colonialité. Pour elle, avant la Conquête, il n’y avait
pas de genre en Abya Yala. Elle reproche à AníbalQuijano de ne pas interroger la question de la
domination de genre parcequ’il envisage le sexe comme une différence biologique, pas comme une
construction. Aníbal Quijano voit le sexe comme un attribut biologique reconfiguré comme
catégorie sociale. Il oppose le sexe biologique au phénotype, qui ne repose pas sur des
caractéristiques biologiques différenciatrices : « La couleur de la peau, la forme et la couleur des
cheveux, des yeux, la forme et la taille du nez, etc. n’ont aucune conséquence sur la structure
biologique de la personne » (2000 : 373). Le cadre de Aníbal Quijano réduit le genre à
l’organisation du sexe, ses ressources et semble reposer sur certains présupposés quant à la
responsabilité et la détermination de ce qui qui est constitué comme une « ressource ». Quijano
semble tenir pour acquis que le conflit sur le contrôle du sexe est un conflit entre hommes, relatif au
contrôle des hommes sur des ressources pensées comme « féminines ». Les hommes ne semblent
pas non plus être considérés comme des « ressources » dans les rapports sexuels. Et il ne semble pas
non plus que les femmes se disputent le contrôle de l’accès sexuel. Les différences sont pensées
dans les mêmes termes que ceux de la biologie reproductive (Lugones, 2008).
Par la suite, son point de vue sera développé et parfois critiqué par d’autres féministes qui
contribueront, comme Maria Lugones, à modifier la notion de colonialité de pouvoir. Breny
Licence Creative Commons 4.0.
81
Mendoza, féministe et universitaire hondurienne, et Rita Segato, anthropologue argentine, vont elles
aussi développer les angles morts de l’approche décoloniale tout en complexifiant l’analyse de
Maria Lugones. Breny Mendoza opérera une jonction entre les concepts de race, de genre et de
classe. Quant à Rita Segato, elle nuancera l’idée d’un monde pré-Conquête d’où le patriarcat était
absent. Pour elle, la période précolombienne était caractérisée par un patriarcat de basse intensité et
l’après-Conquête serait marquée par le passage à un patriarcat de haute intensité. L’étude des
travaux concernant les relations de genre avant la Conquête font état de situations extrêmement
différentes en ce qui concerne le statut social des femmes, la liberté dont elles jouissaient et les
formes de sexualité acceptées. Si les sociétés andines étaient souvent caractérisées par une grande
liberté, si le monde maya semblait également assez ouvert, l’empire aztèque, par contre,
impressionne par la répression violente de l’homosexualité qui y avait cours. Hors des grands
empires, les cas de figure sont extrêmement variés.
Comme on le sait, des peuples autochtones comme les Warao du Venezuela, les Cuna du Panama, les Guayaquís
du Paraguay, le Trio du Surinam, les Javaés du Brésil et du monde inca précolombien, entre autres, ainsi que
plusieurs peuples autochtones d’Amérique du Nord et les premières nations canadiennes, et tous les groupes
religieux afroaméricains, ont eu des discours et des pratiques transgenres stabilisées. Ils autorisaient des
mariages entre personnes du même sexe pour les Occidentaux, et d’autres transitivités de genre, inconcevables
pour le rigide système de genre moderne-colonial. (Segato, 2011)
Pourquoi cette irruption de la colonialité de genre avec la colonisation ? Pour Lugones, les Blanc-
he-s ont passé un pacte avec les hommes vaincus. Leur subordination aux vainqueurs aurait eu des
bénéfices secondaires : les colon-e-s auraient modifié la structure sociale des peuples vaincus dans
un sens qui avantageait les hommes et privait les femmes de l’autonomie relative dont elles
bénéficiaient jusque-là. Rita Segato rejoint cette analyse dans la mesure où, pour elle, la
colonisation c’est la fin d’un dualisme qui reconnaissait des différences mais aussi des
complémentarités. Les hommes, déjà au premier plan, de fait, sur le front de guerre, se sont ensuite
retrouvés seuls sur les fronts de négociation. Les travaux sur le genre faits en « Amérique latine »,
comme celui de Rita Segato, lorsqu’ils l’analysent dans son historicité rejoignent d’autres
recherches récentes faites sur le genre en Europe, à la lueur desquelles la période qui commence
avec la colonisation espagnole semble avoir été, des deux côtés de l’Atlantique, une phase de mise
au pas des femmes. Un phénomène identique s’était déjà produit en Occident lorsque les solidarités
populaires hommes-femmes qui mettaient en danger les classes dominantes furent peu à peu
détruites grâce aux manipulations de ces mêmes classes (Federici 2014).
Licence Creative Commons 4.0.
82
La colonialité de genre reposait sur la réorganisation du Monde village (Mundo aldea) qui était
celui des autochtones mais reposait aussi sur la violence. Elle s’est exprimée entre autres dans la
violence extrême des conquérants avec les femmes. Maria Lugones a insisté sur la brutalisation et
la déshumanisation caractéristiques de cette période. Le viol n’étant qu’une des multiples
manifestations de cette violence. Dès le XVI siècle, dans les deux centres du pouvoir colonial, la
vice-royauté du Pérou et la vice-royauté de Nouvelle Espagne, les femmes, parce qu’elles
opposèrent un front de résistance souvent plus nourri que les hommes (voir par exemple leur rôle
essentiel dans la résistance du Taqui Ongoy des Andes au milieu du XVI siècle) furent les victimes
ciblées de l’oppression espagnole. Au Yucatán ou dans les Andes, lors des campagnes d’extirpation
des idolâtries, elles furent particulièrement persécutées et les envahisseurs mirent en place un
véritable système de terreur.
Mais il ne faut pas voir dans ces phénomènes des excès lié aux « débordements » de la période. Il
s’agit d’un ressort profond, présent tout au long de la colonisation et qui ne disparaît pas avec les
Indépendances. Dans certaines circonstances de l’histoire américaine, pendant la colonisation et
après, durant des périodes qui correspondent en général à des changements dans le mode de
structuration économique, les horreurs de la Conquête se reproduisent. Pour les Amazonien-ne-s de
la fin du XX siècle, le « cycle du caoutchouc », on le sait généralement, fut l’occasion d’un
génocide. On ignore par contre à quel point les femmes et surtout les petites filles ont souffert de
cette période de regain de l’extractivisme. Les supplices qu’elles endurèrent et le système très
élaboré d’exploitation sexuelle qui se mit alors en place sont comparables pour leur atrocité et leur
codification à ceux que subissent aujourd’hui les femmes de la République démocratique du Congo.
Ces excès, dans leur férocité même ne sont pas, n’étaient pas des moments de folie. Ils
s’inscrivaient dans une démarche de terreur, un système, une stratégie dont des auteurs et autrices
aussi divers que Sylvia Federici (2014) ou Michaël Taussig (1987) ont montré qu’elle était un des
incontournables des phases d’accumulation rapide dans l’histoire.
Une des raisons pour lesquelles les femmes, dès les débuts, ont été victimes de la colonialité tient au
fait que, dans plusieurs parties du continent, ce que nous conceptualisons comme « nature » était
associé au féminin. Certes, les autochtones andins, par exemple, parlent de la Terre Mère, pas de «
nature », mais cette féminité du cosmos, présente dans toutes les cosmogonies précolombiennes
(Marcos, 2018) était en contradiction absolue avec le patriarcat qu’il fallait enraciner alors.
Le drame est qu’aujourd’hui, les ex-colonisé-e-s n’ont pas rompu avec cette généalogie. Ils et elles
reproduisent ces schémas. Il a fallu le temps long de la colonisation et l’apparition d’un État-nation
marqué par le racisme et le sexisme pour que cette colonialité de genre s’installe durablement.
Licence Creative Commons 4.0.
83
Sa violence n’a pas disparu, au contraire, elle s’est renforcée, ce dont rend compte le féminicide ou
le fémigénocide.
Tous les hommes des sociétés latino-américaines, quelque soit la classe ou l’ethnie à laquelle ils
appartiennent, sont impliqués dans la colonialité de genre. Et la question est particulièrement
délicate à aborder lorsqu’il s’agit des mondes autochtones, car les femmes y subissent une double
oppression : celles des hommes de leur communauté (ou des autres) et celle, symbolique, des
Occidentaux et Occidentales. Les hommes de leur communauté présentent la subordination des
femmes comme ce qui relève de la tradition; les autres hommes répètent avec elles des
comportements racistes, enracinés dans la colonisation. Dans la situation des femmes autochtones
ou des femmes noires apparaît de façon criante la connexion entre racisme et sexisme. De
nombreuses féministes ou militantes indigènes, qui ne se nomment pas féministes, affrontent
actuellement la tension entre genre et ethnie. Pour elles, le défi consiste à « repenser l’autonomie
indigène dans une perspective de la culture dynamique en transformant les éléments de la tradition
qu’elles trouve répressifs et excluants » (Hernández, 2003).
Pour les femmes autochtones latino-américaines, dénoncer la colonialité de genre, c’est refuser à la
fois la violence exercée par les hommes de leur communauté et la récupération occidentale. Car les
Européen-ne-s sont prompt-e-s à voir dans le mâle indigène un être violent, primitif et bestial et
lorsqu’ils et elles appellent à lutter contre la domination des femmes hors de l’Occident, ils et elles
réaffirment en même temps le primat de la civilisation européenne, et finalement, le bien fondé de
sa domination. Le manque de clarté sur les changements qui ont eu lieu (depuis la colonisation)
amène les femmes à se soumettre sans savoir que répondre à cette phrase que répètent les hommes :
« nous avons toujours été ainsi », et à leur revendication d’une coutume qu’ils supposent ou
affirment traditionnelle (…). D’où un chantage permanent exercé sur les femmes : si elles touchent
à cet ordre, qu’elles modifient cet ordre, leur identité, leur capital politique, et leur culture, référence
symbolique de leurs luttes pour leur continuité en tant que peuple, seraient affectée, et cela
affaiblirait leurs demandes de territoires, de ressources et de droits (…). L’effet de profondeur
historique est une illusion d’optique (…) nous nous trouvons ici face un culturalisme pervers.
(Segato, 2011)
L’autre acteur de la colonialité de genre, c’est l’État national. Rita Segato, à partir de son analyse de
la situation des femmes au Brésil, a montré son rôle ambigu : ce n’est pas seulement qu’il s’est
fondé sur un modèle patriarcal comme tous les États-nations, c’est aussi le fait que, d’un coté,
il promulgue des lois pour défendre les femmes, mais, de l’autre, il détruit, depuis la colonisation,
les liens traditionnels qui protégeaient les femmes de la violence. Segato prend l’exemple de
Licence Creative Commons 4.0.
84
l’apparition de la distinction espace public/espace privé qui, en faisant de l’espace privé celui où
personne ne peut pénétrer, livre les femmes à l’arbitraire de leur conjoint.
Le langage hiérarchique (du Monde village), au contact du discours égalitaire de la modernité, se transforme en
un ordre super- hiérarchique, en raison de deux facteurs (…) : l’hyperinflation des
hommes, dans leur rôle d’intermédiaires avec le monde extérieur du Blanc; et l’hyperinflation de la sphère
publique, ancestralement habitée par les hommes, avec l’effondrement et la privatisation de
la sphère domestique (…). Ce qui se passe, en général, mais tout particulièrement dans les zones où la vie
considérée comme « traditionnelle » est censée être mieux préservée et où l’on valorise
l’autonomie de la communauté vis-à-vis de l’État, (…) c’est que les chefs et les hommes occupent le terrain, font
valoir qu’il n’y a aucun domaine dont l’État ne doive parler avec les femmes, sous prétexte qu’il en a toujours
été ainsi. Arlette Gautier appelle cette myopie historique « l’invention du droit coutumier ». (Segato, 2011)
Les féministes mexicaines, actuellement, montrent que la colonialité de genre est le pivot de la
colonialité du pouvoir mexicain et que l’État joue un rôle essentiel dans cette oppression. Une
chercheuse comme Sayak Valencia révèle que l’histoire de l’État mexicain passe par une
survalorisation de la masculinité guerrière, phénomène qui s’accentue lorsque les classes
populaires subissent une grave paupérisation — depuis l’inféodation du Mexique aux politiques
néolibérales qui ont détruit certains secteurs traditionnels de l’économie. Aux hommes qui n’ont
plus rien, on donne en pâture symbolique les femmes de leur groupe. Cette conception du genre
propre à l’« Amérique latine » marque une grande différence vis-à-vis de la perspective qui prévaut
en Europe. En effet, le féminisme occidental :
(…) affirme que le problème de la domination du genre, de la domination patriarcale, est universel, sans
différences majeures,justifiant, sous la bannière de l’unité, la possibilité de transmettre les avancées de la
modernité en matière de droits aux femmes non blanches, indigènes et noires des continents colonisés. Elle
soutient ainsi une position de supériorité morale des femmes européennes ou eurocentrées, les autorisant à
intervenir avec leur mission civilisatrice – modernisatrice coloniale. Cette position est, à son tour, inévitablement
a-historique et anti-historique, parce qu’elle fait de l’histoire le cristal de l’époque très lente, presque stagnante
du patriarcat, et surtout elle occulte la torsion radicale introduite par l’entrée de l’époque coloniale moderne dans
l’histoire des rapports de genre. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la race et le sexe, bien qu’ils aient été installés
par des ruptures épistémiques qui ont fondé de nouvelles époques – celle de la colonialité pour la race, et celle de
l’espèce pour le sexe – entrent dans l’histoire dans la stabilité de l’épistémè qui les a créés. (Segato, 2011)
Une problématique féministe conséquente passe donc par une approche géopolitique du genre, dans
laquelle la question de la race et de la classe sont inextricablement liées. Ces remarques de Breny
Mendoza ouvrent le débat :
Licence Creative Commons 4.0.
85
Hypothèse : que se passerait-il si Quijano et les autres post- occidentalistes associaient l’idée de race qui surgit
avec la Conquête avec les chasses aux sorcières et l’Inquisition d’Espagne? Ne pourraient-ils pas plus facilement
reconnaître le caractère historique du genre et voir le rapport entre le génocide des femmes lié à l’expansion du
christianisme et le génocide américain? Mais Quijano, comme la plupart des post-occidentalistes, n’arrive pas à
voir dans le génocide ou le féminicide, qui a lieu en même temps que l’expulsion des Juifs et des Maures et la
colonisation de l’Amérique, l’un des déploiements de l’idée de race. C’est cela qui inspire les féministes
africaines ou indiennes lorsqu’elle disent que le genre comme tel n’existait pas dans les sociétés pré-coloniales.
Sur leur territoire, il n’ y avait pas quelque chose comme le génocide des femmes ou le féminicide qu’a constitué
la chasse aux sorcières pendant plusieurs siècles en Europe. Cela n’aurait lieu que plus tard, comme effet de la
colonisation et de la colonialité de genre qui caractériserait la structure coloniale. (Mendoza, 2018)
Références
Federici, Sylvia. 2014. Caliban et la sorcière. Paris : Entremonde.
Hernández Castillo, Rosalva Aída. 2003. « Repensar el multiculturalismo desde el género. Las
luchas por el reconocimiento cultural y losfeminismos de la diversidad ». Revista de Estudios de
Género. La ventana, (18,) : 9-39
Lugones, Maria. 2008. « Colonialidad y género ». Tábula Rasa (9) : 73-101.
http://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf
Marcos, Sylvia. 2018. « Théoriser le genre en Mésoamérique : dimension ontologique d’une
approche féministe et décoloniale ». Revue d’études décoloniales (3).
http://reseaudecolonial.org/2018/10/24/theoriser-le-genre-en-mesoamerique-dimension-
ontologique-dune-approche-feministe-et-decoloniale/
Mendoza, Breny. 2018. « Épistémologie du Sud, colonialité de genre et féminisme latino-américain
». Revue d’études décoloniales (3). http://reseaudecolonial.org/2018/10/17/lepistemologie-du-sud-
la-colonialite-de-genre-et-le-feminisme-latino-americain/
Licence Creative Commons 4.0.
86
Quijano, Aníbal. 2000. « Colonialidad del Poder y Clasificación Social ». Dans « Festschrift for
Immanuel Wallerstein ». Journal of World Systems Research XI (2) : 342-386.
http://jwsr.pitt.edu/ojs/public/journals/1/Full_Issue_PDFs/jwsr-v6n2.pdf
Segato, Rita. 2011. « Género y colonialidad : en busca de claves de lectura y de un vocabulario
estratégico descolonial ». Dans Feminismos Y Poscolonialidad : descolonizando el feminismo desde
y en America latina. Sous la direction de Karina Bidaseca et Vanesa Vazquez Laba, 17-48. 31. 34.
35. 37. Buenos Aires : Ediciones Godot.
Segato, Rita. 2015. « La norma y el sexo : frente estatal, patriarcado, desposesión, colonialidad ».
Dans Desposesión : género, territorio y luchas por la autodeterminación. Sous la direction de
Marisa Belauste, Guigoitia Rius et María Josefina Saldaña-Portillo, 34-35. México : UNAM.
Segato, Rita. 2018 [2011]. « Colonialité et patriarcat moderne : expansion du domaine de l’État,
modernisation et vie des femmes ». Revue d’études décoloniales (3).
http://reseaudecolonial.org/2018/10/15/colonialite-et-patriarcat-%20moderne-expansion-du-
domaine-de-letat-modernisation-et-vie-des-%20femmes1/
Taussig, Michael. 1987. Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and
Healing. Chicago and London : the University of Chicago Press.
Licence Creative Commons 4.0.
87
22. Colonialité de la nature
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Si la nature s’oppose à nous, nous lutterons contre elle et ferons en sorte qu’elle nous obéisse. (Simón Bolívar, père des
Indépendances américaines, après le tremblement de terre de 1812)
Le Vénézuélien Edgardo Lander fut le premier à parler de colonialité de la nature. Et s’il y a bien un
domaine qui illustre de façon remarquable la notion de colonialité, c’est celui de la nature.
L’écologie politique latino- américaine semble s’être construite pour une bonne part autour de cette
notion. Elle est expressément revendiquée par des écologues ou des universitaires comme Enrique
Leff, Hector Alimonda, Maristella Svampa, Catalina Toro.
La colonialité de la nature renvoie à une certaine formation discursive, à des pratiques qui s’assoient
sur des représentations. L’idée de maîtrise, de contrôle est inséparable de celle de colonialité,
inséparable de celle de : le progrès passant par l’exploitation d’une nature qui existe là, un
monde extérieur à l’homme, qu’il lui faut dominer, voire dompter. Une telle vision a pu se
développer aussi grâce à la violence fondatrice de la Conquête, l’extractivisme qui commence alors
en est la métaphore.
Les mines d’or et d’argent du Potosí et les plantations de canne du Brésil et des Antilles font un
écho sinistre aux mines actuelles du continent ou au développement de l’agro-industrie. La
Conquête fut un désastre écologique : montagnes éventrées, déploiement dévastateur du régime des
plantations, érosion et stérilisation des sols suite au développement dantesque des troupeaux de
bovins introduits par les Espagnols, déséquilibres écologiques dus à l’invasion des plantes invasives
européennes, disparition de modes de cultures qui préservaient les écosystèmes suite à la baisse
démographique et à l’interdiction de pratiquer certaines cultures. La colonialité de la nature passa
aussi par des inventaires qui prirent une intensité particulière au XVIII siècle (voir, entre autres, les
Expéditions Botaniques Royales). Au XIX siècle, l’expansion agressive des nouvelles nations sur le
territoire et l’avancée des fronts extractivistes (Patagonie argentine, Amazonie du caoutchouc,
mines chiliennes, etc.) s’inscrit dans la continuité de ce mouvement : un rapport à une nature
exubérante et infinie, perçue comme gisement de matières premières qu’il va s’agir d’utiliser. Ce
phénomène se produit dans un contexte donné, celui de l’expansion capitaliste et, comme le
remarque le philosophe mexicain Bolívar Echeverría (Inclán, Linsalata et Millán, 2012), de la
subsomption de la « forme naturelle de la vie » par son double ,« la forme valeur ». La recherche du
Licence Creative Commons 4.0.
88
profit, de l’accroissement de valeur, avait trouvé dans la prodigalité de la nature américaine un
terrain idéal. Cette pratique, sous-bassement du rapport industriel moderne à la nature et de la
notion de ressources (utilisables comme bon nous semble), renvoie à ce Grand Partage dont nous
parlent les tenant-e-s du tournant ontologique, et à l’invention de l’idée de Nature, inséparable de sa
conception utilitariste. Là encore, modifications des représentations et des pratiques
s’étayent mutuellement. Comprendre la mise en place de ce dispositif global et des formations
discursives qui en font partie exige de prendre en compte le rôle joué par le continent latino-
américain, le processus de diabolisation qu’y subit la « nature ». L’histoire américaine contribuerait
aux transformations de ce dispositif et à l’imposition d’un type déterminé de « régime de nature »
dans le monde. Dans ce qui deviendrait l’Empire des Indes, lors de la « Découverte », la Nature
américaine avait été perçue comme un Eden. Le journal de Colomb et les divers témoignages de
l’époque faisaient état de représentations oscillant entre la vision d’un monde d’avant la Faute et
celle d’un pays de Cocagne ou d’une Corne d’abondance. Mais lorsque la Conquête en tant que
telle commença, les représentations changèrent et la résistance opposée par les autochtones modifia
l’imaginaire de la nature américaine. Elle fut assimilée à ses habitant-e-s, qui de bon-ne-s sauvages,
étaient devenu-e-s des barbares démoniaques. La construction de l’Indien satanique, rebelle,
cannibale se fit en même temps que celle d’une nature diabolique (les expéditions des Espagnols
relatées dans les chroniques sont souvent présentées comme une descente aux Enfers) indomptable
et anthropophage. De même qu’il devint légitime de mener une Guerre juste aux Indien-ne-s qui
refusaient l’autorité pourtant sacrée du Roi, il devint logique de se servir, de puiser dans les
ressources d’une nature dangereuse et hostile. Cette opération de disqualification ne se cantonnerait
pas à l’espace américain, elle voyagerait en Europe et contribuerait à l’élaboration de la nouvelle
conception de la nature que nous mentionnions plus haut. Dans Par delà nature et culture (2005),
Philippe Descola remarque que l’apparition de l’idée de nature à la Renaissance est inséparable de
celle de nature humaine et l’Amérique offre un exemple abouti de cette continuité. De la même
façon, l’exploitation de la nature américaine est indissociable de l’exploitation des êtres humains à
grande échelle, qu’il s’agisse du semi-servage des Indien-ne-s ou de l’esclavage des Noir-e-s
déporté-e-s en Amérique. Nous savons que la grande modification de l’idée de nature s’achèverait
avec la révolution épistémique qu’annonçait déjà le tournant cartésien du XVII siècle, lorsque se
propagerait une conception scientifique de la nature gouvernée par des lois. Elle prendrait forme
face à l’être humain dans une réalité « objective ». Elle existerait dans un dualisme sujet-objet. Plus
tard, elle existerait dans un dualisme Nature-Culture. Mais au XVII siècle, l’apparition de l’idée de
nature correspondrait à la disparition de l’idée d’un monde-organisme et son remplacement par
Licence Creative Commons 4.0.
89
celui d’une nature-machine. Bruno Latour (2012) a aussi évoqué ce qu’il nomme
epistemicenthybridisation : une autre coupure qu’il situe au moment de l’Illustration. Elle préparait
la partition sciences humaines/sciences sociales qui se produirait au XIX siècle avec l’avènement de
l’objet « société ». La nature serait alors abordée dans le cadre des sciences de la nature après
l’avoir été dans celui de la Botanique illustrée, autre domaine dans lequel l’apport américain est
incontestable.
Ces phénomènes complexes, cette partition, auraient-ils été possibles sans l’expérience américaine?
Est-ce qu’on aurait pu penser la nature séparée des humains si les pratiques de la Conquête et de la
colonisation ne l’avaient pas pratiquement transformée en objet? Si elle n’avait pas été séparée de
ses habitant-e-s dans la violence, qu’il s’agisse de l’Amérique du Sud ou du Nord? Si, comme le
disait Karl Polanyi, l’utopie de la transformation de la nature en terre n’avait pas pu se réaliser?
Cette prédation primitive n’a-t-elle pas inspiré les phénomènes qui marqueraient les XVI et XVII
siècles européens, après la Conquête? La violente extirpation des savoirs populaires liés à la nature
et l’imposition par la force d’un régime de nature unique ne peut-elle se voir comme cet effet
boomerang de la colonisation sur l’Occident dont nous parlait Foucault? Si, en Amérique, pendant
toute la colonisation, dès les débuts, on poursuivait les chamans appelés alors « sorciers », en
Europe, on chasserait les sorcières. Ces persécutions, qui se produisirent sur les deux continents,
sont exemplaires de la volonté d’en finir avec un certain régime de nature préscientifique, grâce à
l’élimination de ses représentant-e-s qui, sur le continent européen, étaient d’abord des femmes
(penser la colonialité de la nature suppose de penser en même temps la colonialité de genre,
articulation qui explique la vigueur de l’écoféminisme). Ce concept de colonialité de la nature est
probablement celui qui est le moins développé à ce jour dans le cadre même du courant décolonial
mais aussi le plus fertile. Un anthropologue comme Arturo Escobar est celui qui s’est le plus penché
sur la question. Mais comme je le remarquais plus haut, une bonne part de l’écologie politique
latino-américaine a adopté le concept et cela rend compte de sa force. Il permet de lier l’analyse des
inégalités sociales aux changement environnementaux et aux politiques environnementales
globales, ou encore aux pratiques d’appropriation de la nature et aux imaginaires de cette dernière.
C’est un champ d’études qui se déploie.
Références
Licence Creative Commons 4.0.
90
Albán, Adolfo et Rosero, José. 2016. « Colonialidad de la naturaleza : ¿imposición tecnológica y
usurpación epistémica? Interculturalidad, desarrollo y re-existencia ». Nómadas (45) : 27-41.
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n45/n45a03.pdf
Alimonda, Héctor. 2017. « En clave de sur : la Ecología Política Latinoamericana y el pensamiento
crítico ». Dans Ecología política latinoamericana : pensamiento crítico, diferencia latinoamericana
y rearticulación epistémica 1. Sous la direction de Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez et
Facundo Martín, 33-49. Buenos Aires : CLACSO.
Descola, Philippe. 2005. Par delà nature et culture. Paris : Gallimard.
Domingo Diaz, José. 2012 [1829]. Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. Caracas : Fundación
Biblioteca de Ayacucho.
Gallien, Claire. 2019. « Pour une écologie décoloniale ». La vie des idées.
https://laviedesidees.fr/Pour-une-ecologie-decoloniale.html
Inclán, Daniel, Márgara Millán et Lucia Linsalata. 2012. « Apuesta por el “valor de uso” :
aproximación a la arquitectónica del pensamiento de Bolívar Echeverría ». Íconos. Revista de
Ciencias Sociales (42) : 19-32.
https://www.researchgate.net/publication/
276306455_Apuesta_por_el_valor_de_uso_aproximacion_a_la_arquitectonica_del_pensamiento_d
e_Bolivar_Echeverria
Lander, Edgardo. 1999. « ¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre
la universidad y la geopolítica de los saberes hegemónicos ». Revista de Estudios Latinoamericanos
7, (12-13) : 25-46. UNAM.
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rel/article/view/52369/46620
Latour, Bruno. 2012. Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes. Paris :
La Découverte.
Leff, Enrique. 2015. « La complexité environnementale ». Écologie & politique 2 (51) : 159-171.
Licence Creative Commons 4.0.
91
Polanyi, Karl. 1983 [1944]. La Grande Transformation. Paris : Gallimard.
Svampa, Maristella. 2011. « Néo-« développementisme » extractiviste, gouvernements et
mouvements sociaux en Amérique latine ». Problèmes d’Amérique latine 3 (81) : 101-127.
Licence Creative Commons 4.0.
92
23. Colonialité du pouvoir
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La modernité, le capital et l’Amérique latine sont nés le même jour. (Quijano. 1991)
Le concept appartient à Aníbal Quijano, sociologue péruvien, qui l’a formulé dans les années 1990.
Il apparaît expressément dans l’article « Colonialidad, Modernidad y racionalidad », en cette date
phare de 1992, alors que certain-e-s fêtaient les 500 ans de la « Découverte ».
La colonialité, c’est la poutre maîtresse de l’édifice théorique décolonial. Le terme désigne, au-delà
des superstructures politiques qui furent celles de la colonisation espagnole, un certain type de
rapport social basé sur des prémisses qui survivront aux guerres d’indépendance du XIX siècle : la
division du monde et du travail à partir d’une hiérarchie raciale et la diffusion d’une relation au
savoir et à la connaissance fondée sur les principes d’une rationalité européenne qui condamnerait
et détruirait les autres formes de connaissances et de savoirs. Ce n’est donc pas ce qui reste du
colonialisme ni ce qui succède au colonialisme, mais l’autre face du monde moderne.
Cette division du monde commence avec la conquête de l’Amérique, la première colonisation étant
donc celle du continent mal nommé, pas celle de l’Afrique ou de l’Asie par les nations européennes
des XVIII et XIX siècles. Elle prend la forme d’une mise au travail forcé des populations, qu’il
s’agisse de la première phase esclavagiste ou du semi-servage qui se mettrait en place dans le cadre
des encomiendas, doctrinas et reducciones destinées à la disciplinarisation des autochtones. La
particularité de cette exploitation massive, sa nouveauté radicale est qu’elle s’exerce à grande
échelle, dans le cadre d’une économie extractiviste, sur une population donnée, les autochtones,
ceux et celles qu’on nommera « Indien-ne-s », et qui seront ensuite identifié-e-s comme une race.
Le racisme est l’axe de la colonialité du pouvoir. Il n’est pas seulement une idéologie; il existe
d’abord comme pratique. Le racisme est aussi une forme de gestion des populations, il commence
avec l’imposition de dispositifs de gouvernement inédits : regroupements de populations,
évangélisation, destruction des coutumes, chasse aux sorciers et sorcières, destruction des religions,
mise au travail forcé, éloignement des circuits monétaires pour les populations mises au travail, etc.
Puis, la pratique devient réflexive et des lois et discours racistes apparaissent, d’après certain-e-s
historien-ne-s vers la fin du XVII siècle, pour légitimer l’encadrement hors du commun qui se met
en place. Ce n’est pas un épiphénomène ni une perversion du système mais le pivot du mode
Licence Creative Commons 4.0.
93
d’organisation du travail et de structuration de la société et du monde. Il naît en Amérique. Les
autres empires ont mis au travail les populations conquises mais pas sur la base d’un projet de
gouvernement pastoral légitimé par l’infériorité relative des populations à gouverner; pas dans le
cadre du développement capitaliste d’un monde dont l’axe avait changé, se déplaçant de la
Méditerranée à l’Atlantique, et faisant système à partir de ce moment-là.
La colonialité est l’autre face de la modernité capitaliste. Le concept fonctionne à l’intérieur de
l’idée de système-monde moderne-colonial. Il désigne à la fois la particularité du pouvoir dans la
première colonie au sens moderne du terme, l’Amérique espagnole; et l’autre versant d’une
modernité dont les principes de rationalité, progrès, humanisme, seront systématiquement bafoués
sur la face coloniale du monde. Un tel concept n’a donc de sens que dans le cadre d’une
appréhension globale du monde. Il n’est compréhensible qu’à partir d’une réflexion qui s’appuie sur
la critique du colonialisme, de l’impérialisme et du système monde. Mais cette réflexion se fait à
partir d’une expérience historique, celle de l’Amérique latine, et d’une localisation géopolitique :
c’est un Péruvien, un Andin qui énoncera cette théorie. Le membre d’un état qui connut très tôt à la
fin du XVI siècle, avec le vice -roi Toledo) des processus de disciplinarisation des peuples conquis
inédits tant par leur ampleur que par leur férocité.
Pour répondre aux problèmes de « développement » que rencontrent les pays latino-américains en
général et le Pérou en particulier, problèmes que les sciences sociales eurocentrées ne permettent
pas de résoudre, l’idée de colonialité va émerger. Le concept constitue à la fois une réponse à la
crise mondiale de la pensée critique et du projet révolutionnaire à la fin du XX siècle et un
programme de transformation sociale géopolitiquement située, une énonciation faite à partir de
l’histoire sociale, politique et intellectuelle d’Abya Yala. C’est une façon de penser la réalité à deux
niveaux : celui du monde global et celui de l’Amérique, un duo qui se traduit dans la partition
modernité/colonialité. L’appareil théorique produit en Occident est un patron trop étroit pour
comprendre la réalité américaine et surtout trouver des solutions à ce que certain-e-s nomment «
sous-développement ». C’est le cas en particulier du marxisme dont l’obsolescence est fulgurante
mais aussi des cadres de pensée de la sociologie ou de l’histoire de la fin du siècle dernier. À un
moment où la déconstruction post-moderniste triomphe, où les idées de classe, structure et totalité
sont pulvérisées, la colonialité du pouvoir peut se voir comme la tentative de maintenir l’idée de
totalité sociale mais sur des bases qui ne sont ni marxistes ni structuralistes. Ce tour de force s’ancre
dans l’analyse de l’hétérogénéité des sociétés américaines. L’approche qui prévalait jusqu’aux
années 1980, dans laquelle le continent américain était vu comme un ensemble marqué par la
coexistence de divers modes de production (semi-féodal, capitaliste, etc.) va être déplacée : pour la
Licence Creative Commons 4.0.
94
théorie qu’on nommera plus tard décoloniale, il ne s’agit pas d’une coexistence d’éléments séparés
mais de l’articulation nécessaire, dans le cadre d’un continent dépendant, de ces diverses formes. Et
cette articulation s’explique par une histoire qui a produit la domination de certains groupes, les
vaincus de la Conquête, et les a condamnés à ne pouvoir sortir de leur statut, par le biais d’un
dispositif nouveau : la race, essentialise les autochtones et permet de les maintenir dans une
position de dominés, bloquant ainsi la mobilité sociale.
En 2006, Aníbal Quijano employait l’idée de classification sociale. Dans cette vision, l’idée d’une
totalité sociale est maintenue mais les concepts de classe, caste, structure sont eux révisés.
Si l’analyse du système-monde de Immanuel Wallerstein a recours à l’idée de classe et reste marquée par l’idée
de détermination économique, avec le système-monde moderne/colonial le rôle central du processus de travail
caractéristique de la vision marxiste est déplacé, remplacé par une vision du capitalisme comme réseau de
relations marquées par la race. (…) le pouvoir, dans cette approche, est un maillage d’exploitation/
domination/conflits, des relations qui se configurent entre les gens pour le contrôle du travail, de la « nature », du
sexe, de la subjectivité et de l’autorité. Par conséquent, le pouvoir ne se réduit pas aux « relations de production
» ni à « l’ordre et l’autorité », pris séparément ou ensemble. Et la classification sociale renvoie au rôle et à la
place des personnes dans le contrôle du travail, des ressources (y compris celles de la nature) et de ses produits;
du sexe et de ses produits; de la subjectivité et de ses produits (d’abord et avant tout l’imaginaire et le savoir); et
de l’autorité, de ses ressources et de ses produits. (Quijano, 2007)
La théorie de la colonialité constitue l’acmé d’une réflexion sur l’exploitation dans laquelle la «
différence coloniale » amènera à interroger la notion de race et à inverser la construction de
l’impérialisme qui prévalait jusque-là. L’impérialisme économique y était une conséquence du
capitalisme. En articulant l’idée d’un système-monde qui prend naissance avec la Conquête avec
celle de colonisation, Quijano fait de l’Amérique la condition du capitalisme mondial. Le
colonialisme n’est plus une conséquence du capitalisme mais sa condition, et la colonialité, l’autre
face, cachée de la modernité capitaliste.
Mais ce caractère global de la théorie ne doit pas cacher une autre de ses caractéristique : la
colonialité surgit dans le cadre d’une pensée locale de l’utopie. Le concept a émergé dans un pays
andin qui avait connu une révolution indigène au XVIII siècle et produit des penseurs et penseuses,
comme José Carlos Mariátegui, ou des auteurs et autrices lesquel-le-s, à l’instar de José Maria
Arguedas, ont essayé de faire vivre une utopie andine. L’histoire de l’« Amérique latine », depuis la
période coloniale jusqu’à nos jours, a été traversée par ces poussées du monde indigène ou
afrodescendant contre la domination coloniale. L’utopie d’un monde où les « Indien-ne-s »
occuperaient enfin leur place a marqué l’histoire du Pérou et les diverses résistances. Avec
Licence Creative Commons 4.0.
95
l’irruption de la théorie de la colonialité du pouvoir, qui est basée sur la race, le pouvoir est pensé à
partir de la perspective du groupe qui fut infériorisé, exploité, réprimé, parfois éliminé et, en même
temps, invisibilisé. C’est un pachakuti théorique, le pachakuti étant ce renversement de l’histoire,
cette remontée des fleuves à contre-courant qui irrigue la pensée andine. En cela, Aníbal Quijano se
situe dans la lignée du projet de l’écrivain métis Arguedas. Celui-ci essaya de créer une littérature
métisse véritable : rédigée en langue espagnole mais avec la sonorité du quechua. Une âme indienne
dans un corps blanc. Une intégration de la civilisation andine et de la société créole. La tentative
tourna court, car le nœud de contradictions fut trop serré pour l’auteur et il l’étrangla. Mais elle a
finalement trouvé un prolongement dans l’idée de colonialité.
Le concept, depuis son émergence, a essaimé. Il est celui sur lequel s’accordent tous les tenants et
toutes les tenantes du courant décolonial. Tous et toutes le réutilisent et Walter Mignolo a sans doute
été son plus grand vulgarisateur. Depuis sa création, il a été exploré par divers membres du projet
décolonial et il se décline comme colonialité de l’être, du savoir, du genre et de la nature, entre
autres.
Son impact a été très fort : il fait désormais partie du lexique de la pensée critique latino-américaine.
De nombreuses organisations indigènes l’ont adopté, ce qui apparut par exemple à Lima, lorsqu’en
2008, les 1500 représentant-e-s réuni-e-s déclarèrent : « il n’ y aura pas d’intégration sans
décolonialité du Pouvoir, du Savoir et du Sentir ». Il est également entré dans les universités qui
proposent plusieurs programmes (à Quito, à Lima, à Córdoba) élaborés à partir du corps conceptuel
décolonial. On ne peut que constater son installation dans le panorama intellectuel critique de notre
époque en « Amérique Latine », et il se taille une place de choix au sein des études coloniales
latino-américaines. Il est cependant très loin de faire l’unanimité et bien des historien-ne-s de la
période coloniale, en Amérique, en Espagne ou en France, le manipulent avec des pincettes ou
l’ignorent. S’il arrive de trouver le mot sous la plume de l’un-e d’entre eux ou d’entre elles, il faut
plus y voir une concession faite à l’époque qu’une réelle parenté de pensée.
Quoi qu’il en soit, il y a eu un avant et un après l’apparition du concept dans les sciences sociales et
dans la pensée critique.
Références
Arguedas, José Maria. 1964. Todas la sangres. Buenos Aires : Losada.
Licence Creative Commons 4.0.
96
Bourguignon Rougier, Claude. 2011. « Le concept de race chez Aníbal Quijano, à l’épreuve de deux
approches historiques ». Revue d’études décoloniales (1).
http://reseaudecolonial.org/2016/09/02/test2/
Mariátegui, José Carlos. 1928. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima :
Editorial Minerva.
Quijano, Aníbal. 1994. « Colonialité du pouvoir et démocratie en Amérique latine ». Multitudes.
https://www.multitudes.net/Colonialite-du-pouvoir-et/
Quijano, Aníbal. 1992. « Colonialidad, Modernidad y racionalidad ». Perú Indígena 13 (29) : 11-20.
https://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/04/quijano.pdf
Quijano, Aníbal. 2007. « « Race » et colonialité du pouvoir ». Mouvements 3 (51) : 111-118.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3-page-111.htm
Segato, Rita. 2013. La crítica de la colonialidad y una antropologia por demanda. Buenos Aires :
Prometeo.
Licence Creative Commons 4.0.
97
24. Colonialité du savoir
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
L’idée de colonialité du savoir constitue un des développements logiques du concept de colonialité
du pouvoir et elle se développe chez Aníbal Quijano de façon parallèle à sa réflexion sur la
colonialité du pouvoir. Il faut la rattacher à certains pans de la pensée critique latino-américaine du
XX siècle et en particulier la critique du colonialisme intellectuel que porta à cette époque le
sociologue colombien Orlando Fals Borda. Ce dernier, comme les intellectuel-le-s qui
s’intéressèrent à l’Investigation Action Participative, chercha à créer des outils aptes à décoloniser
les sciences sociales, en finir avec la domination eurocentrée et permettre d’élaborer des pensées
politiques alternatives. Cela impliquait de reconnaître les pensées qui se construisaient dans les
milieux populaires et de comprendre que la science n’était pas neutre. Ce projet avait un versant
politique concret : il visait la résistance qu’opposaient au capitalisme et à la rationalité
instrumentale les paysan-e-s et les indigènes colombien-ne-s des Andes et des tropiques. Fals Borda
chercha à comprendre l’histoire de la modernité et de l’épistémologie occidentale, une histoire dont
les contradictions engendraient des crises comme le manque d’eau, l’insécurité alimentaire, la
corruption, l’extrême pauvreté, les changements climatiques et les déplacements.
Le concept de colonialité du savoir, systématisé dès les années 2000 par le sociologue Edgardo
Lander, permet de rendre compte de la dimension géopolitique du savoir hégémonique et de
comprendre les processus par lesquels les conceptions non européennes du savoir sont tenues pour «
non-existantes » (Boaventura de Sousa Santos, 2017). La colonialité du savoir, c’est la dépréciation
des savoirs et connaissances autres qui s’opère à partir de la Conquête. Certes, le mépris pour le
savoir de l’Autre n’est pas une invention des Espagnol-e-s, les Grecs et Grecques ancien-ne-s
considéraient qu’il n’y avait qu’une culture, la culture grecque et que les autres peuples étaient des
barbares. Mais leur argumentaire ne reposait pas sur les mêmes fondements. Et la colonialité du
savoir n’est pas un phénomène qui corresponde à un pays déterminé; elle doit plutôt se comprendre
dans le cadre de l’effacement des empires orientaux regroupés autour de la Méditerranée et
l’émergence de l’Atlantique et des Européen-ne-s sur la scène mondiale. La colonialité du savoir
n’est pas un plan, un projet conscient de destruction des systèmes de pensées autres, du moins pas
toujours. Elle est l’élaboration, en divers points de l’Europe ou de l’Amérique, de systèmes de
pensée qui justifient la domination de l’Autre par son infériorité, laquelle sera analysée de façons
Licence Creative Commons 4.0.
98
assez différentes pendant les trois siècles de la colonisation : ces systèmes se baseront d’abord sur
l’idée de la supériorité de la civilisation chrétienne, au XVI siècle (à partir du XVII siècle, ils
verront dans la raison objectivante et neutre l’étalon de toute pensée digne de ce nom); puis, au
XVIII siècle, la pensée scientifique fera de la vérité l’arme absolue de la destruction. Ce
savoir essentiellement colonial et eurocentré s’inscrit dans un modèle de progrès et de croissance,
caractérisé par un dualisme réducteur. La croyance aveugle en la prétendue universalité de nos
dispositifs de connaissance – l’hybris du point zéro (Castro Gómez, 2005) – nous rend aveugles aux
systèmes de pensée autres que le nôtre et s’accompagne souvent de la destruction de ces
connaissances, une disparition programmée qui engendre souvent une paradoxale mélancolie. La
critique de la colonialité du savoir, en mettant à nu le « projet de mort » qui constitue la trame de la
modernité, nous permet d’envisager des alternatives.
Références
Castro Gómez, Santiago. 2005. La hybris del punto cero : ciencia, raza e ilustración en la Nueva
Granada (1750-1816). Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana.
Da Sousa Santos, Boaventura. 2017. Épistémologies du Sud. Mouvementscitoyens et polémique sur
la science. Paris : Desclée de Brouwer.
Escobar, Arturo et Eduardo Restrepo. 2009. « Anthropologies hégémoniques et colonialité ».
Cahiers des Amériques latines (62) : 83-95.
http://journals.openedition.org/cal/1550
Fals Borda, Orlando. 1979. El problema de cómo investigar la realidad para transformarla. Bogotá
: Tercer Mundo.
Mignolo, Walter. 2001. « Géopolitique de la connaissance, colonialité du savoir et différence
coloniale ». Multitudes 3 (6) : 56-71.
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2001-3-page-56.htm
Mignolo, Walter. 2013. « Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée
frontalière et désobéissance épistémologique ». Mouvements 1 (73) : 181-190.
Licence Creative Commons 4.0.
99
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-1-page-181.htm
Licence Creative Commons 4.0.
100
25. Coronil, Fernando
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Enseignant dans les départements d’histoire et d’anthropologie de l’Université du Michigan,
Fernando Coronil, Vénézuélien de Caracas, dirigea le centre d’études latino-américaines de cette
université et y créa le programme d’anthropo-histoire. Il participa aux réunions du projet
Modernité/Colonialité entre 2000 et 2008, et s’est particulièrement intéressé à définir le nouveau
type de pouvoir mondial et à caractériser les nouvelles formes d’impérialisme après le 11 septembre
2001. D’après lui, ces formes mettaient en évidence l’imbrication de pratiques et de discours
coloniaux et impériaux et la fusion entre impérialisme colonial, national et global. Étudiant la façon
qu’avait eu de se reconfigurer la géopolitique du pouvoir, il remarquait que la violence, auparavant
monopolisée par l’État, s’était privatisée même si l’on observait la coexistence de processus privés
(le terrorisme par exemple) et de processus étatiques (contre-violence de la répression et du contrôle
accru des populations). Mais, notait-il, c’est cette violence aveugle et privée qui inquiète les
populations, pas celle que déploient les États, y compris avec leurs propres citoyen-ne-s, comme
c’est le cas pour les États-Unis et l’Europe. Il notait également qu’à partir du 11 septembre 2001, le
rôle dominant des États-Unis, critiqués jusqu’à la fin du siècle dernier, avait été perçu globalement
comme positif. La montée du terme « empire » coïncidait avec cette valorisation positive tandis que
disparaissait la notion d’impérialisme, à un moment, pourtant, où les processus de soumission aux
grands centres capitalistes n’avaient jamais été aussi puissants.
Parallèlement, il notait qu’au niveau des idées, le champ des études postcoloniales avait explosé
après la fin du colonialisme comme tel. Or, les formes modernes de sujétion des ex-colonies
n’intéressent qu’à la marge ces études. Les études culturelles et post-coloniales ont approché
l’impérialisme, mais seulement celui du passé. Leurs tenant-e-s ont éclairé les mécanismes du
pouvoir colonial, mais ils et elles ont laissé dans une « commode obscurité » (Coronil, 2004) les
mécanismes actuels de la domination, les rapports entre impérialisme colonial et national cessant
d’être un sujet central, au même titre que l’économie et la politique.
Ce n’est pas le cas avec l’approche décoloniale latino-américaine, énoncée à partir d’un continent
qui connaît le passage des formes anciennes d’impérialisme aux nouvelles. Cela explique le
potentiel critique bien supérieur de la perspective décoloniale qui, au début du XXI siècle, brillait
encore par son absence dans les anciennes métropoles impériales. Car, dans les universités
occidentales, l’impérialisme et le colonialisme appartiennent à des champs d’études différents, une
Licence Creative Commons 4.0.
101
séparation logique, vu les intérêts qui sont en jeu. Il est donc plus facile, même si les résistances
furent coriaces en France par exemple, d’y accueillir les études post-coloniales, lesquelles
entérinent de fait cette séparation. L’« Amérique latine » échappe à cette tendance car elle peut faire
le lien entre ces deux moments historiques. Il y existe une vaste tradition de réflexion sur la relation
entre colonialisme et néocolonialisme. Cela a commencé avec des libérateurs ou révolutionnaires
comme Simón Bolívar ou François-Dominique Toussaint Louverture, et continue avec des
politiques comme le cubain José Martí, qui affronta à la fois le colonialisme espagnol et
l’impérialisme nord-américain après 1898, ou des intellectuel-le-s comme José Carlos Mariátegui.
L’histoire de l’« Amérique latine », qui glissa de la domination impériale espagnole à l’impérialisme
nord-américain, la met en situation de pouvoir appréhender ce lien. La difficulté à concevoir un
projet national que rencontrèrent des intellectuel-le-s comme Mariátegui ou Raul Prebisch les
amena à réfléchir à la question au début du XX siècle. Dans la deuxième moitié du siècle, la théorie
de la dépendance, dont l’influence est indéniable chez Aníbal Quijano, affronta elle aussi le
problème. La perspective latino-américaine change notre regard : prenons par exemple la
périodisation de l’impérialisme qui avait cours au début du XXI siècle, qui faisait de 1850 l’aube du
colonialisme et de l’impérialisme, et de 1950, la date de leur déclin. Vue de l’« Amérique latine », la
périodisation change de sens; la période évoquée y devient celle de l’ascension des États-Unis
comme pouvoir impérialiste hémisphérique, soit dans toute l’Amérique et 1950 ne marque plus la
fin du colonialisme mais le moment où l’impérialisme américain d’hémisphérique
devient global.
Fernando Coronil n’oppose donc pas globalisation, impérialisme et colonialisme. Il les articule
historiquement, s’attachant à préciser leurs contours respectifs. Avant l’impérialisme global, il y eut
l’impérialisme colonial, puis national, qui l’ont rendu possible :
Dans l’impérialisme colonial, ces unités sont des empires politiques, souvent personnifiés par des monarques ou
des sociétés aux identités juridiques claires et aux champs d’action bien précis, qui exercent une domination
directe ou indirecte sur leurs territoires et peuples d’outre-mer. Dans l’impérialisme national, ces unités sont des
nations indépendantes, nées de l’impérialisme colonial, liées par des relations économiques et politiques
asymétriques à travers lesquelles les relations de subordination et de dépendance sont maintenues.
Dans l’impérialisme colonial comme dans l’impérialisme national, le pouvoir politique s’exerce par le contrôle
des territoires, (leurs frontières sont des lignes tracées par l’État sur la géographie physique, et il s’agit de tirer le
meilleur parti de ses frontières naturelles, côtes, rivières et montagnes), qu’un État armé défend avec zèle. A
l’intérieur de ces frontières, qui définissent la portée des identités impériales, il y a les États, qui continuent à
exercer un contrôle considérable sur les sujets et les biens. Dans l’impérialisme mondial, les unités géopolitiques
sont définies par des processus qui intègrent la politique-territoriale à l’économique-mondiale, c’est-à- dire que
Licence Creative Commons 4.0.
102
le pouvoir social s’exerce à travers les États et les unions économiques dans un marché mondialisé qui est de
plus en plus flexible quant à ses formes territoriales. Tout semble indiquer que dans cette forme d’impérialisme,
ce qui compte ce n’est pas tant la réorientation de l’État avec son territoire juridico-naturel, que les nouvelles
formes de territorialité sociale définies par le marché
mondial. Elles concernent des populations dont la localisation spatiale reflète la structure changeante
asymétrique du marché mondial. Si dans les empires coloniaux et nationaux, la prédominance des États fait de la
territorialité un fondement déterminant des unités géopolitiques de base, dans l’impérialisme mondial, la
prédominance du marché mondial – qui passe par les institutions étatiques et transnationales, notamment des
entreprises économiques, des organisations non gouvernementales et des communautés d’experts – fait que la
territorialité exprime plutôt la structure du marché mondial. Loin de rejeter les États, l’impérialisme mondial en
dépend. (Coronil, 2004)
Pour lui, il allait de soi que l’impérialisme n’était pas un moment du passé : « Le « globocentrisme
» des discours dominants de la mondialisation néolibérale cache la présence de l’Occident et le fait
qu’il reste dépendant de l’assujettissement des Autres et de la Nature » (Coronil, 2000). Il a fait
partie de ceux et de celles qui ont identifié la re-primarisation de l’économie latino-américaine avec
le regain d’extractivisme propre au début du nouveau siècle. C’est la raison pour laquelle il insistait
sur la nécessité de repenser la relation entre terre, travail et capital, et de ne pas en rester au rapport
capital/travail, ce qu’il développe particulièrement dans El estado mágico. Il notait que la division
internationale du travail supposait une division parallèle de la nature. Dans un article intitulé «
Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo », il exposa sa conception
du globocentrisme, que nous présentons plus loin. L’idée de colonialité du pouvoir de Aníbal
Quijano lui semblait très pertinente et il le rejoignait dans son analyse d’un capitalisme qui s’est
construit à travers le rapport colonies espagnoles/métropoles, dans le cadre du nouveau marché
mondial, impérialisme et capitalisme se constituant mutuellement. Mais il suggérait de remplacer «
colonialité du pouvoir » par « pouvoir de la colonialité » afin d’éviter une certaine réification du
pouvoir vu comme un. Une remarque à méditer aujourd’hui où le terme de colonialité est employé
souvent de façon simplificatrice. Pour Fernando Coronil, plus que de « colonialité du pouvoir »,
nous devrions parler de « pouvoir de l’impérialité ». Cet engagement explique l’enthousiasme avec
lequel il soutint le projet bolivarien mais aussi les réserves qu’il émit à ce sujet. Comme les
activistes des mouvements récents liés à l’autonomie et la communalité, il remarquait que le modèle
économique du Vénézuela était conservateur. Ce modèle de production était basé sur le pétrole, sur
des entreprises mixtes dont les capitaux étaient ceux du secteur public vénézuélien mais aussi des
capitaux transnationaux, et il était destiné avant tout aux exportations sur le marché mondial. Le
livre El estado mágico est une analyse du processus vénézuélien qui a suscité bien des polémiques.
Licence Creative Commons 4.0.
103
Son auteur n’avait pas pour autant renoncé à son projet de transformation sociale et peu avant de
mourir, à la fin de El futuro en ruedo. Política y utopía en América latina, il redéfinissait la gauche
à partir de l’expérience récente des pays latino-américains; il y faisait le bilan des politiques de
gauche en « Amérique latine » dans la première décennie du XXI siècle, montrant qu’elles
s’organisaient dans le cadre d’une double chronologie : la gestion du présent était celle d’une
économie capitaliste, pas différente de celles de la droite traditionnelle, le futur était le lieu où se
réaliserait le programme révolutionnaire ou réformiste. Il essayait de voir dans quelle mesure
l’histoire latino-américaine permettait de sortir de ce cul-de-sac. Il y voyait des moments où des
possibles étaient apparus et reprenait les propos de Gary Wildar, lorsque ce dernier discutait :
Des avenirs qui ont été imaginés mais qui n’ont jamais pu advenir, des avenirs alternatifs qui auraient pu être, et
dont les possibilités d’émancipation n’ont pas pu se réaliser, mais qui, aujourd’hui, pourraient être reconnus,
reprendre vie car ils constituent un héritage toujours actuel toujours crucial. (Wilder, 2009 : 103)
Ainsi, il s’inscrivait dans la tradition utopiste de l’« Amérique latine », terreau du projet décolonial.
Références
Coronil, Fernando. 2002. El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela.
Caracas : Nueva Sociedad.
Coronil, Fernando. 2000. «Naturalezadelposcolonialismo:deleurocentrismo al globocentrismo ».
Dans La colonialidad del saber :eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas.
Sous la direction de Edgardo Lander, 54. Buenos Aires : Sur-Sur.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708044815/6_coronil.pdf
Wilder, Gary. 2009. « Untimely Vision : Aimé Césaire, Decolonization, Utopia ». Public Culture 21
(1).
Licence Creative Commons 4.0.
104
|26. Curiel, Ochy
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Ochy Curiel est une féministe décoloniale dominicaine qui théorise le genre et la race à partir de sa
position de lesbienne afro-descendante latino-américaine. Elle fait de la théorie à partir d’une
pratique et, pour cette raison, se méfie des approches qui ont surgi à l’université dans le dernier
quart du XX siècle.
Je me demande vraiment dans quelle mesure les études dites subalternes, postcoloniales ou culturelles
décentralisent vraiment « le » sujet, comme elles le prétendent. Se pourrait-il que ces nouveaux discours fassent
appel à ce qui est supposé « marginal » ou « subalterne » pour asseoir leur autorité symbolique et qu’ils usent du
« différent » comme stratégie de légitimation? (Curiel, 2007)
Cette militante, musicienne et anthropologue, refuse la distinction entre théorie critique et pratique
critique, qui est, pour elle, un des symptômes de l’ontologie moderne qu’elle déconstruit.
Je dis toujours que le féminisme décolonial est une reconnaissance et une récupération de différents mouvements
politiques — auxquels certaines d’entre nous ont participé —, qui complexifient le lieu du politique, ses
théorisations et jusqu’à sa méthodologie. (Curiel, 2007)
Elle interroge le concept de colonialité du pouvoir, reconnaît son intérêt pour l’étude des effets du
colonialisme dans les sociétés contemporaines mais la voit simplement comme un outil. Pour elle,
d’abord, il y a les mouvements sociaux, et de ces mouvements naissent les théories. Les féministes
racisées, engagées dans un combat antiraciste, n’ont pas eu besoin du concept de colonialité pour
analyser la trame du pouvoir moderne. Mais, en dépit de leur travail, ces féministes sont peu
visibles. Insistant sur le rôle du feminismo de color des États-Unis, elle met également en avant le
rôle des féministes latino-américaines, qui ont été parmi les premières à lutter contre l’idéologie
métisse à la base de la construction des identités nationales, une idéologie qui était, en fait, raciste
et se basait sur la violence coloniale fondatrice (viols et soumission des femmes à un nouvel ordre
social plus patriarcal). Les travaux des latino-américaines ont mis en évidence l’importance des
femmes dans les mouvements de résistance lors de la colonisation, ce que l’on appelle le «
marronnage domestique » et qui consistait en diverses formes de résistance quotidienne; elles ont
insisté sur la fréquence des fuites chez les femmes réduites en esclavage, elles ont inventé le
Licence Creative Commons 4.0.
105
concept d’ « améfricanité » qui remet également en question l’idée de « l’Amérique latine ». Lélia
González, dans les années 1970, fut une des premières à mettre en avant l’interrelation
entre racisme sexisme et classisme dans la vie des femmes noires. Le travail de femmes, comme
Jurema Wernerk et Sueli Carneiro sur le leadership de femmes africaines ou sur l’absence de
division public-privé dans la vie des esclaves africaines en Amérique, a contribué à parfaire la
compréhension des mécanismes de la domination.
Refusant l’opposition sexe biologique/genre construit, Ochy Curiel propose une critique de
l’hétérosexualité comme système politique de domination, entrant en jeu dans la construction
nationale, qui essentialise les différences et produit autant la domination des femmes lesbiennes que
des femmes hétérosexuelles. Elle critique, comme d’autres féministes latino-américaines, la notion
de « femme ». En effet, son expérience de la discrimination liée à la race lui a permis de voir cette
catégorie comme un universel qui ne peut pas rendre compte de la domination spécifique à certains
groupes. Attentive aux limites de la notion de genre, elle évite également les essentialisations qui «
menacent », car les identités, si elles sont nécessaires aux combats politiques, restent des moyens,
pas des fins.
Je pense qu’il y a encore beaucoup d’essentialisme chez certaines lesbiennes féministes qui disent comprendre le
régime de l’hétérosexualité, mais qui se concentrent sur une mise en valeur, une
« politisation de la vulve », avec une volonté de la mettre au centre de la politique. Personnellement, ce n’est pas
ma manière de voir les choses. (Falquet et Quiroz, 2018)
Dans le cadre de sa pratique artistique, elle a beaucoup œuvré pour la récupération de l’héritage
musical africain, dès les années 1990, à un moment où le courant décolonial comme tel n’était pas
apparu, ce qui montre que l’on ne saurait traiter séparément les deux versants du décolonial ni le
restreindre à sa stricte expression théorique. Et elle explique la position qui est la sienne vis-à-vis de
la séparation théorie/pratique. La fin de cet article qu’elle avait rédigé il y a quelques années rend
compte avec élégance de sa position.
Je crois que c’est plus important d’être antiracistes que d’être orgueilleusement noires, d’être féministes que de
nous reconnaître femmes, d’en finir avec le régime de l’hétérosexualité que d’être
lesbiennes, je crois que ce qui est important, ce sont les projets de transformation qui surgissent avec les
mouvements sociaux mais aussi dans la pensée critique académique. (Curiel, 2017)
Références
Licence Creative Commons 4.0.
106
Curiel, Ochy, Sabine Masson et Jules Falquet. 2005. « Féminismes dissidents en Amérique latine et
aux Caraïbes ». Nouvelles Questions Féministes 24 (2) : 4-13.
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2005-2-page-4.htm
Curiel, Ochy. 2007. « Critique postcoloniale et pratiques politiques du féminisme antiraciste ».
Mouvements 3 (51) : 119-129.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3-page-119.htm
Curiel, Ochy. 2007. « Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista ».
Nómadas (26) : 92-101.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105115241010
Curiel, Ochy. 2017. « Genero, raza, sexualidad. Debates contemporáneos ». Intervenciones en
estudios culturales (4) : 41-61.
https://intervencioneseecc.files.wordpress.com/2017/07/n4_art03_curiel.pdf
Falquet, Jules et Lissell Quiroz. 2018. « Interview d’Ochy Curiel ». Revue
d’Etudes décoloniales (3).
http://reseaudecolonial.org/2018/10/16/interview-dochy-curiel/,
Pons Cardoso, Cláudia. 2015. « À Lélia de Almeida Gonzalez, précurseuse du féminisme Noir au
Brésil ». Les cahiers du CEDREF (20).
http://journals.openedition.org/cedref/774
Licence Creative Commons 4.0.
107
27.Dépendance (théorie)
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La théorie de la dépendance est un courant latino-américain, porté par des économistes et des
sociologues qui ont remis en question le dogme de la croissance et du développement. On sait qu’à
partir des années 1950, l’idée d’un sous-développement des anciennes colonies (Amérique, Afrique,
Inde et Sud-Est asiatique) s’est imposée dans le monde. C’était un des volets du dogme du
développement colporté par des ingénieur-e-s expert-e-s ainsi que par des organisations
internationales. Cette vision qui, de fait, permettait à l’Occident de garder un certain contrôle sur les
anciennes colonies au moment où elles commençaient à leur échapper, vendait le projet d’un
développement de type européen aux pays dits « sous-développés » : ils pourraient, avec une
politique de croissance adaptée, accéder, comme les pays occidentaux, à l’abondance. Très tôt, des
intellectuel-le-s latino- américain-e-s, qui étaient aussi parfois des militant-e-s, ont critiqué cette
vision en montrant que le sous-développement était structurel car les pays « développés » en avaient
besoin pour leur propre croissance et expansion.
Mais cette critique passa par plusieurs phases, la première étant caractérisée par l’optimisme de ces
auteurs et autrices et leur croyance que les pays latino-américains pouvaient accéder au
développement. Certain- e-s représentant-e-s de la théorie de la dépendance s’impliquèrent dans
les projets d’industrialisation, entre autres, à travers la CEPAL (Commission économique pour
l’Amérique latine) et étudièrent les processus d’Industrialisation par Substitution des Importations
(ISI). Dans ce cadre, l’Argentin Raúl Prebisch et d’autres intellectuel-le-s, marqué-e-s par le
structuralisme émergent et qui travaillaient avec la CEPAL, commencèrent à analyser les entraves
au développement. C’est Raúl Prebisch qui, bien avant de travailler à la Cepal, dès les années
vingt, aurait recours le premier à la notion de centre/périphérie, à partir d’une analyse de l’emprise
des capitaux financiers européens en Argentine. Ces auteurs et autrices voyaient les asymétries
existantes, savaient que les économies traditionnelles dégageaient une faible valeur ajoutée et que la
structure industrielle était hétérogène. Mais dans « l’Amérique latine » du début des années 1950,
l’idée que la bourgeoisie et l’industrialisation pourraient jouer un rôle vertueux dans la formation de
véritables économies nationales l’emportait. C’était le cas même dans les milieux marxistes
orthodoxes (puisqu’en vertu d’une vision étapiste alors indiscutable, avant la phase socialiste, il
fallait passer d’une société semi–féodale à une société capitaliste). Il fallait répéter dans un autre
espace l’histoire industrielle européenne et rattraper le temps perdu.
Licence Creative Commons 4.0.
108
Dans les années 1960, le peu de résultats de l’ISI entama ce bel enthousiasme. Un autre courant
apparut au sein de la théorie de la dépendance, ce qui deviendrait la théorie marxiste de la
dépendance (TMD) dont les représentant-e-s les plus connu-e-s sont Theotonio Dos Santos,
Vania Bambirra, Orlando Caputo, André Gunder Frank et Ruy Mauro Marini.
Ces auteurs et cette autrice observèrent qu’avec l’expansion du mode de production capitaliste dans
les pays périphériques, les différences entre centre et périphérie avaient en fait tendance à se
renforcer :
(…) la dépendance est comprise comme une relation de subordination entre les nations formellement
indépendantes, un cadre dans lequel les relations de production des nations subordonnées sont modifiées ou
recréées pour assurer la reproduction étendue de la dépendance. Le fruit de la dépendance ne peut être que plus
de dépendance. (Marini, 1972 : 37)
La tendance marxiste de la dépendance émane d’une gauche différente, qui ne pense pas comme les
partis communistes locaux. Ainsi que nous le remarquions plus haut, les cinq intellectuel-le-s
soutenaient en fait le modèle proposé par la CEPAL. Ils et elle voyaient l’« Amérique latine »
comme un ensemble de sociétés sous-développées auxquelles manquait une révolution bourgeoise.
Un auteur comme Marini développerait des concepts particulièrement pertinents dans ce qui
constitue finalement une nouvelle Critique de l’Économie Politique versus Amérique latine. Il
inventerait par exemple les concepts de surimpérialisme et surexploitation, que l’on pourrait
articuler à ceux de colonialisme interne et de colonialisme intellectuel.
L’une des différences les plus importantes entre les penseurs et penseuses structuralistes de la
dépendance et la TMD tient à la question du sous-développement de la périphérie et de son lien
avec le centre. Seul-e-s les second-e-s font une lecture historique des conditions différentielles dans
lesquelles la périphérie est intégrée dans un système global.
Un penseur qui a eu une influence importante dans ce courant, mais qui n’est pas latino-américain,
est l’Allemand André Gunder Frank. Il serait peut- être excessif de lui accorder, comme le font
plusieurs spécialistes anglo-saxon-ne-s, un rôle déterminant dans la théorie, mais on ne saurait nier
qu’il a popularisé une idée fondatrice, celle d’un « développement du sous-développement ». Il a
également, dès 1967, dénoncé une façon de penser erronée. Il s’est attaqué précisément à
l’ethnocentrisme qui faisait de l’«Amérique latine » un continent dans une phase antérieure du
développement. Il montra que cela tenait à l’application mécanique d’un modèle européen à des
pays dont l’histoire relevait de tout autres paramètres. Dans l’historique qu’il fait de la dépendance
Amérique latine/ Occident, on trouve déjà des idées essentielles à la perspective décoloniale :
Licence Creative Commons 4.0.
109
il déconstruit donc l’idée de l’Amérique comme passé de l’Europe ou de l’Occident, faisant du
sous-développement quelque chose qui se produit avec la Conquête et qui se maintient jusqu’à nos
jours. Ce sous-développement apparaît donc comme le fruit d’une histoire qui est aussi celle du
capitalisme, pas seulement parce que s’y réalise la fameuse phase d’accumulation primitive mais
aussi parce que s’y mettent en place les conditions d’un rapport aussi asymétrique que structurel.
Cette position explique les distances que prit Gunder Frank avec les représentant-e-s structuralistes
du courant, pour lesquel-le-s le développement de l’« Amérique latine » ne pouvait pas se faire sans
« l’aide » occidentale. Il voyait-là une chimère et affirmait que la vraie urgence, c’était de se
détacher économiquement. Il est remarquable de voir que l’idée de détachement émerge dans le
domaine de la pensée critique économique avant de réapparaître, vingt ans plus tard, en
épistémologie avec Walter Mignolo. La fin tragique de l’expérience chilienne, qui toucha
personnellement Gunder Frank, démontra que ce projet de détachement n’était pas impossible
économiquement mais politiquement.
Au Brésil, cette pensée de la dépendance a eu un dynamisme particulier avec des penseurs comme
Theotonio Dos Santos ou Celso Furtado. Il y a d’ailleurs une correspondance chronologique entre la
phase dictatoriale brésilienne des années 1960, qui précède d’une décennie les régimes militaires du
Cône Sud et l’apparition de cette réflexion autochtone. Pour Eduardo Restrepo et Axel Rojas,
l’influence de ce courant sur le projet Modernité/Colonialité est passée par deux canaux. Deux des
passeurs furent Enrique Dussel et Aníbal Quijano, l’un, parce que très proche de la théologie de la
libération elle-même très liée à la théorie de la dépendance, l’autre, parce que marxiste et intéressé
par la question des inégalités structurelles. André Gunder Frank et Immanuel Wallerstein publièrent
ensemble des ouvrages portant sur la notion de crise et l’apparition de nouveaux mouvements
sociaux et Immanuel Wallerstein a reconnu la dette de la théorie du système-monde envers la
critique de la dépendance.
Pour Eduardo Restrepo et Axel Rojas, ce qui a retenu l’attention des auteurs décoloniaux et autrices
décoloniales dans cette approche, c’est l’idée d’un système global d’inégalités structurelles qui
organisent un rapport centre-périphérie, et celle que le sous-développement est lui aussi produit.
Il pense que « l’opposition structurelle centre-périphérie qui configure le système global et qui
devient le principe d’intelligibilité dans la théorie de la dépendance, se traduit dans le vocabulaire
du courant décolonial en celui de modernité/colonialité ». Toujours d’après l’anthropologue
colombien, la force du marxisme dans la pensée de la dépendance et l’idée de classe sociale
n’ont pas été recyclées par le projet Modernité/Colonialité.
Licence Creative Commons 4.0.
110
Arturo Escobar, au sein du mouvement décolonial, est de ceux et de celles qui ont le plus contribué
à cette visée en déconstruisant l’idée de développement dans des ouvrages comme La invención del
tercer mundo, El final del salvaje, ou Más allá del desarrollo.
Le singulier n’est pas adapté pour parler de la théorie de la dépendance dans la mesure où un de ses
versants est nettement marqué par le marxisme et par une visée révolutionnaire, l’autre tendance
s’inscrivant plutôt dans une vision social-démocrate. Remarquons à ce propos que, dans l’approche
du projet Modernité/Colonialité, on retrouvera quelque chose de cette divergence, qui est apparue
par exemple dans les différentes façons d’appréhender la situation vénézuélienne ces dernières
années
Références
Bambira, Vania. 1977. Teoría de la dependencia: una anticrítica. México : Era.
Caputo, Orlando. 2000. « La crisis actual de la economia chilena en los marcos de la globalizacion
de la économía mundial ». Dans El ajuste estructural en América latina. Costos sociales y
alternativas. Sous la direction de Emir Sader et Irma Manrique Campos, 99-136. Buenos Aires :
Clacso.
Dos Santos, Theotonio. 1969. « La crise de la théorie du développement et les relations de
dépendance en Amérique latine ». L’Homme et la société, Sociologie et tiers-monde (12) : 43-68.
https://doi.org/10.3406/homso.1969.1204
Furtado, Celso. 1972. « Sous-développement, dépendance : une hypothèse globale ». Tiers-Monde
13 (52) : 697-702.
https://doi.org/10.3406/tiers.1972.1879
Marini, Ruy Mauro. 1972. « Dialéctica de la dependencia ». Sociedad y dependencia : 35-51.
http://www.marini-escritos.unam.mx/pdf/024_dialectica_dependencia_1972b.pdf
Martins, Carlos Eduardo. 2013. « El pensamiento de Ruy Mauro Marini y su actualidad para las
ciencias sociales ». Argumentos 26 (72) : 31-54.
http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v26n72/v26n72a3.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
111
Passadéos, Chrostos, et André Gunder Frank. 1972. « Le développement du sous-développement.
L’Amérique latine ». Tiers-Monde 13 (51) : 675-677.
www.persee.fr/doc/tiers_0040-7356_1972_num_13_51_5716_t1_0675_0000₃
Peixoto, Antonio Carlos. 1977. « La théorie de la dépendance : bilan critique ». Revue française de
science politique 27 (4-5) : 601-629.
https://doi.org/10.3406/rfsp.1977.393739
Prebisch, Raúl. 2012. El desarrollo economico de America latina y algunos de
sus principales problemas. México : Cepal.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40010/4/prebisch_desarrollo_problemas.pdf
Restrepo, Eduardo, et Axel Rojas. 2010. La Inflexión decolonial. Popayán : Instituto Pensar.
Slipak, Ariel M.. 2016. « Ruy Mauro Marini, un imprescindible para el debate latinoamericano ».
Cuestiones de Sociología (14).
https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn14a07
Licence Creative Commons 4.0.
112
28. Détachement
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Le détachement, desprendimiento, est une notion que Walter Mignolo (2012) a particulièrement
développée et qui vient à l’origine de Samir Amin. Elle apparaît également dans les premiers écrits
de Quijano sur la colonialité. Pour Walter Mignolo, le détachement s’est produit plusieurs fois dans
l’histoire, par exemple au XVII siècle, avec Guamán Poma de Ayala et sa Nueva Corónica y buen
gobierno. Ce dernier, contrairement à Las Casas, parce qu’il portait en lui la culture européenne et
la culture andine, avait pu critiquer le système de l’intérieur. Car, toujours pour Walter Mignolo,
ce qu’il faut changer « ce n’est pas seulement le contenu mais les termes de la conversation ». C’est
à dire, les fondements sur lesquels reposent la connaissance et l’entendement. Cela constitue un acte
de décolonialité épistémique. Et passe par un abandon de la problématique de l’émancipation
au profit de celle de libération :
La problématique de l’émancipation ne convient pas aux projets émancipatoires car ils ne sont pas en rupture
avec la tradition linéaire de l’histoire et de la pensée occidentale. (Mignolo, 2014 : 48)
Une stratégie de détachement passe donc par la « déconstruction des concepts et des champs
conceptuels qui totalisent le réel en une seule réalité » (Idem.). Le détachement va aussi à
contresens de l’assimilation car assimiler suppose que l’on n’appartient pas à ce que l’on assimile. Il
s’attaque à la théopolitique et à l’egopolitique et repose sur la géopolitique et la corpopolitique,
deux épistémologies de la frontière et de l’extériorité.
Pour le sémioticien, la philosophie de la libération de Dussel constitue un manifeste de détachement
épistémique, à deux titres : parce qu’elle vise la libération des opprimé-e-s, des assujetti-e-s et parce
qu’elle est libération de la philosophie occidentale, grâce à la pensée décoloniale. Il fait de la
coupure décoloniale quelque chose qui se produit dans l’ordre spatial de la géopolitique, ce qui la
différencie de la rupture épistémique de Foucault ou du changement de paradigme de Thomas
Kuhn.
Références
Licence Creative Commons 4.0.
113
Mignolo, Walter. 2012. « Delinking decoloniality and dewesternization ». Critical Legal Thinking.
http://criticallegalthinking.com/2012/05/02/delinking-decoloniality-dewesternization-interview-
with-walter-mignolo-part-ii/
Mignolo, Walter. 2014. Désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité, logique de la
colonialité et grammaire de la décolonialité. Bruxelles : Éditions Peter Lang.
Licence Creative Commons 4.0.
114
29. Développement
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Que savez-vous de l’idée de développement? C’est vrai, qu’en savons- nous? Nous utilisons le terme
développement, sous toutes ses formes, en permanence. Nous parlons de pays développés, sous-développés ou
en développement, de stratégies de développement, d’objectifs de développement, de développement durable…
Du développement en tant qu’objectif, en tant que but à poursuivre, et selon des voies assez bien établies. Mais
d’où vient cet objectif? De qui vient-il? Et quand est-il devenu efficient? En quoi consiste-t-il? Est-il aussi
souhaitable qu’il le semble? (Gudynas, 2016)
Quelques éléments pour une généalogie du développement
En 1996, dans le Dictionnaire du développement édité par Wolfang Sachs, Gustavo Esteva avait
déjà proposé des réponses en établissant une généalogie de ce terme. Il expliquait que le
développement était à l’origine une notion biologique, qui se référait d’abord au processus
génétique par le biais duquel les organismes réalisaient leur potentiel génétique. Vers le milieu du
XVIII siècle, cette conception aurait évolué, le développement apparaissant alors comme
l’évolution vers une forme plus parfaite. Dans les milieux scientifiques, évolution et développement
deviendraient à partir de ce moment-là des termes interchangeables. C’est seulement dans le dernier
quart du XVIII siècle que le développement deviendrait un concept opératoire pour l’histoire
sociale. L’interprétation de l’histoire universelle de Herder établirait des corrélations globales entre
les âges de la vie et l’histoire sociale. À la même époque, un savant comme Bonnet essaierait de
combiner la théorie de la nature et la philosophie, faisant du développement historique la
continuation du développement naturel, les deux phénomènes constituant des variantes du
développement homogène d’un cosmos créé par Dieu. Au XIX siècle, Dieu commencerait à
disparaître de la conception populaire de l’univers et on passerait du « développement » au fait de «
se développer ». Le développement, émancipé du dessein divin, deviendrait la catégorie centrale
d’une œuvre comme celle de Marx. Le fondateur du matérialisme historique le présenterait comme
un processus historique se développant avec la force d’une loi naturelle.
À côté de cette approche de l’écrivain mexicain, nous avons celle de l’anthropologue Arturo
Escobar. Dans les mêmes années, il se pencherait aussi sur la notion, l’attaquant non plus sous
l’angle sémantico-historique mais sous celui de son utilisation dans les discours et pratiques du
monde de l’après Seconde Guerre mondiale. Encountering Development est un ouvrage
Licence Creative Commons 4.0.
115
séminal qui retraçait lui aussi la généalogie de concepts comme le développement, le tiers-monde,
le sous-développement, mais à partir d’une nouvelle économie politique.
Remontant aux origines d’un discours qu’on peut situer en 1949, lorsque le président américain
Harry Truman exposa ce qui allait s’imposer partout comme le seul mode de vie et de production
souhaitable, ce livre montrait que le développement, loin d’être la solution aux problèmes du
monde, représentait en fait la mainmise des centres occidentaux sur les anciennes colonies en train
de s’émanciper. Il correspondait à une adaptation aux mutations de la colonialité du pouvoir et du
savoir. Escobar y rappelait qu’avant la Seconde Guerre mondiale, « l’Amérique latine »
n’intéressait pas le nouvel hégémon mondial. En effet, les États-Unis méprisaient ce continent
habité par des populations qu’il jugeaient ignorantes, incapables, profondément infantiles. En fait,
leur vision n’était qu’une transcription actualisée de celle du barbare qui s’était élaborée au cours de
la colonisation.
Mais après la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, la Guerre froide et le besoin d’étendre
leurs marchés, pléonasme, poussèrent les États-Unis à s’intéresser au continent qui, dès les années
1950, serait redéfini comme « tiers-monde ». C’est d’ailleurs en Afrique que le lancement du
développement apparut dans sa vraie nature, car la connexion entre déclin de l’ordre colonial et
naissance du développement, déjà relevée par l‘historien et spécialiste de la décolonisation
Frederick Cooper, y fut particulièrement remarquable. Cooper (1991), à propos de l’Acte
britannique de développement des années 1940, disait qu’il était la première apparition
1. Princeton University Press, 2011[1995] de l’idée de développement, ajoutant qu’il fallait le
comprendre comme une tentative de revitaliser l’empire qui se manifesta de façon évidente dans les
États d’Afrique.
Ce développement, nous dit Escobar, est un discours, au sens foucaldien du terme. Celui qui fut
tenu en « Amérique latine », le discours officiel du développement, par le truchement de
l’International Bank, en 1945, était à la fois nouveau et très ancien : d’un côté, il y était question de
« rédemption » et d’effort, et de l’autre, on y employait une phraséologie guerrière. Il fallait
« attaquer globalement les sociétés du tiers-monde », les transformer radicalement. C’était un peu
une seconde Conquête, par les Américain-e-s du Nord cette fois-ci, avec des promesses qui, comme
celles des Espagnol-e-s, ne seraient pas tenues. L’ordre instauré par les Conquistadors sur le
continent avait été ce mélange de promesse de salut pour les autochtones qui se soumettraient et de
menaces d’extermination pour les résistant-e-s. L’alliance de la théopolitique et de l’ego conquiro,
identifiée par Dussel dans le logos de la colonisation, nous la retrouvons dans les propos des
Licence Creative Commons 4.0.
116
évangélisateurs du développement. La théorie de la dépendance, dans les années 1960, dénoncerait
le caractère illusoire de ce discours et plus tard, c’est le post-développementisme qui le
déconstruirait .
Au centre de ce rêve qui tourna au cauchemar, il y avait l’idée de pauvreté (qui n’a jamais fait
l’objet d’une véritable définition, ni d’une réflexion, comme le remarque l’anthropologue
colombien), de « besoins » et de faim. Qu’est-ce qui est nécessaire et pour qui, et qui peut le
définir? La pauvreté à l’échelle mondiale a été une découverte de la période qui 2a suivi la Seconde
Guerre mondiale. (Escobar, 2011). Revenant sur la généalogie de la pauvreté et de la faim, Escobar
cite Polanyi qui déjà, en 1941, avait analysé l’apparition de la pauvreté dans l’Europe du XIX siècle
et la transformation des pauvres en assisté-e-s. Pour l’économiste austro-hongrois, la pauvreté,
l’économie politique et la découverte de la société étaient indissociables (Polanyi, 1957). Une
pauvreté associée à des traits tels que le vagabondage, la frugalité, l’ignorance, le refus d’accepter
les devoirs sociaux, de travailler et de se soumettre à la logique de l’élargissement des « besoins ».
Pour Escobar, nous avons-là la première phase de la construction du discours de la pauvreté, la
deuxième phase se produisant avec la mondialisation du phénomène, après 1945. Les deux tiers
du monde seront alors redéfinis comme pauvres; on passera de l’échelle de l’individu pauvre à celle
du pays pauvre (Rahnema, 1997). En 1948, quand la Banque mondiale définira comme pauvres les
pays dont le revenu par habitant-e est inférieur à 100 dollars, le tiers-monde deviendra ce qui existe
à travers sa pauvreté.
La montée en puissance de la question de la faim est un autre moment de cette construction. La
définition des populations du tiers-monde comme gens qui ont faim, fut un outil efficace,
permettant de déshumaniser les habitant-e-s de ces contrées, réduit-e-s à des ventres vides. L’image
du corps en carence et de l’excès démographique transformerait ces peuples en masses anonymes
flottant au bord de la mort, des groupes impersonnels, figés dans la menace de leur prochaine
disparition.
D’une certaine façon, le développement auquel ont souscrit la plupart des pays du tiers-monde a
d’ailleurs produit la disparition de ceux et de celles qu’il prétendait aider : si les trois quarts de leurs
habitant-e-s étaient des ruraux et rurales dans les années 1950, aujourd’hui, ce groupe ne
représente plus qu’un tiers de la population. De fait, tout un monde paysan a partiellement disparu,
comme si le développement avait impliqué la disparition, sinon des êtres biologiques, du moins
d’une catégorie sociale.
Licence Creative Commons 4.0.
117
Le discours du développement s’est appuyé sur des théories de la société diverses parmi lesquelles
la théorie du décollage, qui renvoie aux étapes de la croissance économique. Dans cette conception,
qui prétend être valable pour toutes les sociétés, l’humanité serait passée de l’étape de la société
traditionnelle à celle de la consommation après que certaines conditions historiques aient rendu
possible, d’abord le démarrage, puis le progrès. Le développement était vu comme un processus
d’évolution vers une finalité, la consommation de masse présentée comme l’étape ultime. Cet idéal
uniformisant établissait que toutes les sociétés du monde passent par les mêmes étapes pour accéder
au développement, en l’occurrence un développement orienté vers la croissance et la production
économique. À ce sujet, Gilbert Rist (1996 : 153) affirme que c’est par un effet de sociocentrisme
que l’historien de l’économie [en l’occurrence Rostow] imagine que toutes les sociétés se
comportent de la même manière et nourrissent les mêmes désirs. Or l‘homo economicus, frustré par
la rareté qui l’oblige à choisir parmi ses désirs illimités, n’est pas universel.
Bref retour sur la chronologie des politiques de développement
Ce discours et ces pratiques du développement passèrent par plusieurs phases. Elles s’appuyèrent
sur des dispositifs puissants qui alliaient des organismes internationaux comme l’ONU, des banques
nationales ou internationales comme la Banque Mondiale, et des ensembles complexes d’expert-e-s
travaillant pour des laboratoires, universités, fondations nationales et internationales, en liaison avec
les gouvernements et leurs relais locaux et nationaux.
Dans les années 1960, le développement « social » fut considéré comme une condition préalable à
la croissance économique mais à la fin de la décennie, les déficiences des politiques et processus en
cours devinrent plus perceptibles et il s’avéra impossible d’ignorer que la croissance rapide était
toujours accompagnée d’inégalités croissantes.
Il fut question alors d’aller au-delà de simples mesures brutales destinées à promouvoir la
croissance économique et d’envisager d’autres indicateurs que le PNB. Mais son « détrônement »
comme on l’appela alors ne se fit pas. En effet, parvenir à un consensus international ou
académique sur une autre définition fut impossible. On formula alors un nouveau paradigme,
celui de l’intégration : il fallait intégrer les ressources physiques, les processus techniques, les
aspects économiques et le changement social. La stratégie pour le développement international,
adoptée en 1970, était une stratégie globale qui concernait tous les domaines de la vie économique
et sociale.
Licence Creative Commons 4.0.
118
En fait, la deuxième décennie évolua vers une autre direction sur la base d’un autre principe
unificateur. La Conférence sur l’emploi, la répartition des revenus et le progrès social de 1976
déplaça l’approche vers celle des besoins fondamentaux, le but étant d’atteindre un niveau de vie
minimum avant la fin du XX siècle. Parallèlement, les expert-e-s de l’Unesco, pour leur part,
avaient promu le concept de développement endogène qui rejetait la thèse de nécessité
ou la possibilité d’imiter mécaniquement les sociétés industrielles, ce qui revenait à remettre en
question la notion même de développement. Ils et elles furent, on s’en doute, peu écouté-e-s.
La décennie de 1980, appelée souvent « la décennie perdue pour le développement » fut marquée
par le pessimisme. Il y fut question de « processus d’ajustement », ce qui signifiait souvent
l’abandon de ce qui avait été fait jusque là. En 1985, l’ère post-développement semblait se profiler à
l’horizon.
En revanche, en 1990, une nouvelle éthique du développement vit le jour. Au Sud, le re-
développement passait désormais par le démantèlement de ce qui restait du « processus
d’ajustement » des années 1980. Cette zone allait se voir attribuer un autre rôle : devenir le lieu de
recyclage des déchets du Nord (déchets radioactifs, usines de fabrication obsolètes ou contaminants,
marchandises invendables ou interdites, etc.) et celui de l’activité des maquiladoras, activités
temporaires que le Nord maintiendrait en activité pendant la période de « transition ».
En 1990, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a publié le premier
rapport mondial sur le développement humain, avec pour l’objectif primordial de produire un indice
de développement humain. Ce dernier s’obtiendrait grâce à la combinaison de l’indice
d’espérance de vie, d’alphabétisation des adultes et de PNB réel par habitant-e.
Post-développement?
Dès les années 1960, il y a eu des critiques du discours du développement, son caractère
ethnocentriste fut dénoncé et les catégories sur lesquelles il reposait furent remises en question. La
théorie de la dépendance était la première critique de cette vision, ancrée dans un socle
épistémologique particulier, cet évolutionnisme à la racine des sciences sociales que Foucault
déconstruisit dans ses derniers séminaires.
Le post-développementisme est cette tendance qui, à partir des années 1980, avec des auteurs et
autrices comme Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Majid Rahnema, Wolfgang Sachs, James
Licence Creative Commons 4.0.
119
Ferguson, Serge Latouche et Gilbert Rist, remit en question l’ethnocentrisme du concept et son
échec pratique. Selon Wolfgang Sachs (1996), qui écrivit dans les années 1990 un Dictionnaire
du développement, « le concept de développement fait partie des ruines de notre paysage mental et
il est temps de le balayer ». Il remarquait qu’il reposait sur une grille hiérarchique : les nations les
plus développées y étaient considérées plus avancées, les autres, inférieures. Les modèles de
développement sont souvent universalistes mais le patron occidental ne peut pas être répété car il
n’est pas soutenable, les ressources de la planète étant limitées. D’autre part, ils sont pensés par des
personnes qui ne connaissent pas les contextes locaux, culturels et historiques des pays dans
lesquels ils sont appliqués et qui ne jugent pas nécessaire de les connaître parce qu’ils les
méprisent, la colonialité du savoir jouant un rôle puissant dans l’élaboration de ces modèles. Pour
les critiques du développement, sa pratique est d’abord une dynamique de domination.
Aujourd’hui, la critique du développement a montré ses limites. Le post-développementisme ne
s’est pas attaqué au cœur du problème, car critiquer le discours du développement ne suffit pas pour
montrer qu’il ne tient pas ses promesses. Ce discours connaît l’art de la métamorphose, il se modifie
quand ses contradictions et ses dégâts apparaissent. Par exemple, le tiers-monde est désormais
inséré dans un discours des limites. Le socle épistémique du développement n’a pas encore été
vraiment remis en question.
D’autre part, l’idée d’Occident sur laquelle se basait la critique post- développementiste s’est
complexifiée : on ne peut plus homogénéiser l’Occident car il est pluriel; la critique actuelle n’est ni
anti-européenne ni anti-occidentale. Elle vise la défense de la Terre Mère et des Plurivers.
Il est devenu clair qu’il faut éviter l’idéalisation des peuples autochtones pour construire le
Plurivers. Enfin, la nécessité d’assumer une perspective décoloniale et d’envisager le
développement, pas seulement comme un discours de pouvoir mais aussi en tant que discours
hégémonique produit dans le cadre de rapports de pouvoir modernes-coloniaux,s’est imposée.
Références
Escobar, Arturo. 2007. La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del
desarrollo. Caraca : El perro y la rana.
Licence Creative Commons 4.0.
120
Esteva, Gustavo. 2009. « Más allá del desarrollo : la buena vida ». Revista América Latina en
Movimiento (La agonía de un mito : ¿Cómo reformular el « desarrollo »?) (445).
https://www.alainet.org/es/revistas/445
Esteva, Gustavo. 2009 – 2016. Portail d’articles de l’auteur en français sur le site web La voie du
jaguar . Consulté le 7 décembre 2019.
https://lavoiedujaguar.net/_Gustavo-Esteva
Esteva, Gustavo, et Arturo Escobar. « Postdesarrollo a los 25 : sobre ‘estar estancado’ y avanzar
hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás y de otrasmaneras ». Comahue : Otros Logos. Revista de
estudios críticos.
http://www.ceapedi.com.ar/otroslogos/Revistas/0008/4-escobar-esteva.pdf
Fernández del Rincón, Belén. 2016. « Post-desarrollo : superando el discursodesarrollista y
generando alternativas ». Economistas sin frontera.
Consulté le 7 décembre 2019.
https://ecosfron.org/post-desarrollo-superando-el-discurso-desarrollista-y-generando-alternativas/
Ferguson, James et Akhil Gupta. 1997. « Culture, Power, Place: Explorations » in Critical
Anthropology. Duke University Press.
Gudynas, Eduardo. 2016. Site web personnel de Eduardo Gudynas. Consulté le 7 décembre 2019.
http://gudynas.com/publicaciones/articulos-academicos/
Latouche, Serge. 2019. La décroissance. Paris : Presses Universitaires de France.
Rahema, Majid et Victoria Bawtree. 1997. The Post-Development Reader. Chicago : The University
of Chicago Press Books.
Rist, Gilbert. 1996. Le développement. Histoire d’une croyance occidentale. Paris : Presses de la
Fondation nationale de Sciences politiques.
Sachs, Jeffrey. 2020. « COVID-19 and Multilateralism ». Site web personnel.
Licence Creative Commons 4.0.
121
Consulté le 7 décembre 2019.
https://www.jeffsachs.org/journal-articles/9jpr4cnkm6gstkc6tge3glwkl5wpha
Sachs, Wolfang. 1996 [1992]. Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder.
Perú : PRATEC.
https://www.uv.mx/mie/files/2012/10/SESION-6-Sachs-Diccionario-Del-Desarrollo.pd
Licence Creative Commons 4.0.
122
|30. Différence impériale, différence coloniale
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Les concepts appartiennent à Walter Mignolo (2015) : « Les différences spatio-temporelles doivent
être considérées simultanément en tant que différence impériale et en tant que différence coloniale
». La différence coloniale, c’est la façon qu’a d’exister la colonialité du pouvoir, de l’être et du
savoir. Cette notion permet d’explorer les hiérarchies épistémiques mises en place avec le système-
monde moderne/colonial.
Elle ramène au premier plan ce qui est occulté dans les discours de la modernité ou de la civilisation
occidentale, entre autres, la dévalorisation des connaissances non occidentales et l’imposition de
cadres « universels » pour la pensée. Pour cela, il a fallu construire et imposer un schéma espace-
temps nouveau, séparant le monde entre aires modernes et aires archaïques.
Mais la différence coloniale est aussi ce qui rend possible la résistance, laquelle s’enracinera
précisément dans cette différence et permettra le détachement. J’ajouterai que la différence
coloniale aura des effets boomerang dans les espaces métropolitains, comme l’avait d’ailleurs
remarqué Michel Foucault dans ses derniers séminaires et comme le prouvent les travaux récents de
Gérard Noiriel sur le peuple français. L’invention du colonialisme interne dans les pays européens
passera aussi par la diffusion d’un imaginaire des classes laborieuses qui s’inspire de celui du
barbare américain du XVI siècle ou du peuple métis du XIX siècle. Nous assistons donc à des
greffes, des branchements et des articulations imprévus de cette différence, qui peut se
manifester aussi dans les anciennes métropoles.
Quant à la différence impériale, selon Mignolo, elle tient à la façon qu’eurent les agents de la
Couronne espagnole et de l’Église de définir leurs rapports avec l’Islam ou les Ottoman-e-s et de
s’en distinguer. Concept solidaire du premier : les peuples américains, à partir du XVI siècle, furent
classés en bas de l’échelle humaine, mais on leur accordait quand même une certaine innocence.
C’est ce qui les différenciait des peuples habitant la différence impériale, les Turcs et Turques et les
Arabes en particulier (en|fait, les rivaux des pays européens) qui vivent dans l’erreur. Les premiers
étaient récupérables, les seconds, des ennemis. Les peuples musulmans ne pouvaient pas être tenus
pour inférieurs, comme les Indien-ne-s, et la seule façon de les disqualifier passait par le
dénigrement de leur religion, son infériorisation. L’Espagne qui ne colonisa jamais les peuples
musulmans, ne les reconnut jamais comme des égaux, bien qu’ils fussent eux aussi des
monothéistes. Mignolo identifie également une différence impériale externe qui a trait
Licence Creative Commons 4.0.
123
au protestantisme, une différence qui fut problématisée dans les écrits sur la barbarie de Las Casas
(1552) :
La barbarie « contraire » n’était pas l’Islam ni les juifs, mais le protestantisme qui traquait le christianisme
catholique. L’Islam, dans le système de Las Casas, constitue la différence impériale externe puisqu’il
reconnaissait qu’au niveau organisationnel l’Islam n’était pas inférieur au christianisme. Il l’était cependant, au
niveau religieux. Le protestantisme, par contre, allait être à l’origine de la différence impériale interne, qui
donnerait naissance (…), en partie à cause de Las Casas, à la légende noire dont Elizabeth d’Angleterre se
servirait contre les Castillans. (Mignolo, 2015)
Références
Grosfoguel, Ramón. 2017. « Visages de l’islamophobie ». Bruxelles Panthères.
Consulté le 9 novembre 2019.
https://bruxelles-panthere.thefreecat.org/?p=3218
Mignolo, Walter. 2001. « Géopolitique de la connaissance, colonialité du savoir et différence
coloniale ». Multitudes 3 (6) : 56-71.
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2001-3-page-56.htm
Mignolo, Walter. 2015. La désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité logique de la
colonialité et grammaire de la décolonialité. Bruxelles : P.I.E. Peter Lang.
Tangorra, Manuel. 2017. « Différence culturelle et frontière, une approche à partir de la pensée
décoloniale : Le cas Rodolfo Kusch ». Eikasia (77).
http://revistadefilosofia.com/77-15.pdf
Las Casas, Bartolomé. 1552. Apologética Historia Sumaria. El Libro Total – La Biblioteca digital
de América.
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=4072
Licence Creative Commons 4.0.
124
31. Dussel, Enrique
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Enrique Dussel est un philosophe d’origine argentine, naturalisé mexicain. C’est un des intellectuel-
le-s d’« Amérique latine » les plus reconnu-e-s et il a joué un rôle essentiel dans la pensée critique
de ce continent. En France, il commence à peine à être connu malgré une œuvre considérable, ce en
quoi, une fois de plus, nous reconnaissons les effets de la colonialité du savoir. Ce philosophe, qui
est aussi un théologien, a produit, conjointement avec des penseuses et penseurs comme Scannone,
la philosophie de la libération, laquelle doit autant à sa démarche chrétienne qu’à son
investigation des spécificités de la philosophie latino-américaine.
À l’origine du projet Modernité/Colonialité, dans les années 1990, avec des intellectuel-le-s tels que
Aníbal Quijano et Walter Mignolo, Dussel a remis en question l’idée de la « Découverte » comme «
Rencontre », lancée par l’intellectuel mexicain León Portilla à l’époque du cinquième centenaire du
débarquement de Colomb. Sa propre conception fait apparaître la Conquête comme un processus
d’occultation. 1492. L’occultation de l’Amérique est un livre qui a fait date dans l’histoire
intellectuelle du continent parce que l’auteur y expose, pour la première fois, son idée d’un ethos
moderne occidental fondé sur la conquête et l’anéantissement de l’Autre à des fins personnelles et
parce qu’il montre que ce processus est un moment d’un autre, plus vaste : le discours que la
modernité crée sur elle-même.
Son attention aux fondements épistémiques qui se mettent en place avec la colonisation s’inscrit
dans une réflexion critique sur l’eurocentrisme et sur la dépendance de « l’Amérique latine » vis-à-
vis de l’Occident. Parti d’un engagement radical auprès des pauvres qui passait par la volonté d’une
révolution sociale, marchant sur les traces des philosophes Sebastián Salazar Bondy et Leopoldo
Zea, qui cherchaient à établir les fondements d’une philosophie latino-américaine, il a fini par
abandonner ce projet trop lié à une modernité qu’il remettrait plus tard en question de façon
radicale.
En formulant sa philosophie de la libération, il interroge « l’ontologie monologique » de la
modernité et invente l’analectique comme nouvelle méthode de pensée critique intégrale de la
réalité humaine. On trouve chez lui à la fois une théologie de la libération, qui s’inscrit
Licence Creative Commons 4.0.
125
dans son expérience de chrétien dans l’Argentine des années 1950, une philosophie de la libération,
et une théorie politique et éthique de la libération. Son œuvre, très variée, rend compte de ces trois
dimensions.
L’approche a ceci de remarquable : sa cohérence, l’effort constant pour lier théologie de la
libération, philosophie de la libération et pratique politique de libération. Il est, dans le courant
décolonial, celui chez qui cette exigence a été le plus aboutie, car ce grand lecteur de Marx, des
Grundrisse en particulier, qui n’est pas marxiste, essaie de penser le plus radicalement
possible la notion de praxis.
La politique a toujours été au centre des préoccupations de Dussel. Dès les années 1970, il disait
que la politique est la première philosophie. Comme Ernesto Laclau, il a connu le populisme
péroniste, une expérience marquante pour les intellectuel-le-s de son époque, mais a très tôt visé un
au-delà du péronisme. Cette détermination et son courage par rapport à ses engagements l’ont
amené à quitter l’Argentine lors de la dictature de Videla et à s’exiler au Mexique, où il vit toujours
aujourd’hui.
Très tôt, il a voulu penser au-delà des catégories de classe, inclure d’autres catégories pour être en
phase avec les mouvements de libération de son temps et penser les fondements de luttes pour
l’hégémonie. Parmi les écrits politiques de Dussel les plus éclairants, nous trouvons les 20 thèses
publiées en 2006, après cet événement extraordinaire que fut l’élection d’un président indien en
Bolivie. Il reprend dans ce travail une idée dont il est familier, celle de la corruption des élites
nationales latino-américaines. Ces dernières ne peuvent pas exercer le pouvoir de façon
démocratique car leur rôle, depuis la colonisation, consiste à être le relais des métropoles
coloniales puis néo-coloniales. Et il envisageait à l’époque d’événements comme l’élection de Luiz
Inácio Lula au Brésil ou de Evo Morales en Bolivie, l’auto-organisation des mouvements indiens,
ou encore la venue de gouvernements de gauche, comme un signe : le moment était venu
d’élaborer une théorie politique latino-américaine. Une position qu’il maintient aujourd’hui, malgré
les défaillances des gouvernements en question. Pour lui, l’approche est nouvelle et repose sur des
bases différentes. Cette théorie, il la voit comme une ré-élaboration éthique, théorique et politique
fondamentale de la pensée de gauche. Dans un texte écrit à Annenecuilco (lieu de naissance
d’Emiliano Zapata), il écrivait : Ce qui s’annonce est une nouvelle civilisation transmoderne, et
donc transcapitaliste, au-delà du libéralisme et du socialisme réel, où le
pouvoir était domination, et la politique, un simple exercice de la domination. (Dussel, 2006)
Il faudra voir, dans une « Amérique latine » où disparaissent peu à peu, souvent dans la violence, les
gouvernements progressistes, quel tour prendra sa réflexion.
Licence Creative Commons 4.0.
126
Dans ses 20 thèses, il analyse l’état du champ politique au Mexique et ailleurs, et définit les
concepts de pouvoir, de peuple et d’hégémon, posant les bases d’une praxis de libération à même de
transformer la société. Il se demande comment unifier ce qu’il nomme la « communauté politique »
et reprend le concept de peuple de Chantal Mouffe et Laclau. Il en fait
ce qui surgit au moment où se forme un « hégémon » rebelle. C’est dans l’échange d’informations,
le dialogue, la traduction et le partage de praxis militante que se constitue cet hégémon analogique,
lorsque les intérêts particuliers arrivent à faire bloc dans le mouvement de l’action. Le peuple, pour
Enrique Dussel, n’est pas un sujet mais un acteur, la coalition desopprimé-e-s et des exclu-e-s. Il
revient sur le concept de pouvoir, au sujetduquel il remarque qu’il est d’abord volonté (on notera
l’influence du Paul Ricoeur de Lectures 1). Le pouvoir, c’est ce que le peuple récupère dans les
moments où il apparaît. Son concept de poder obediencial est directement inspiré par celui de
mandar obedeciendo des zapatistes. Son approche se veut « réaliste », éloignée des divagations
idéalistes des anarchistes ou de certains mouvements contemporains et de leur critique de l’État.
Elle met l’État et les institutions au centre du programme révolutionnaire, l’idée restant de
s’emparer des institutions pour les transformer; ce qui n’est pas neuf. Que l’on partage ou non son
point de vue sur la question de l’État et la légèreté avec laquelle il expédie les expériences
libertaires du XX siècle (libertaires dont l’anticléricalisme lui est sans doute insupportable, bien que
les anarchistes aient beaucoup puisé dans expérience christique), on est frappé par la cohérence de
sa logique qui fait de l’extériorité le fondement de la méthode analectique, l’élément permettant la
transformation révolutionnaire : la révolution n’est pas un processus dialectique dans lequel la
totalité contradictoire évolue vers la résolution des contradictions mais
un moment qui se produit de l’extérieur de cette totalité puisque ce sont les exclu-e-s et les victimes
qui s’y manifestent, faisant intrusion dans un champ où ils et elles n’avaient pas de place.
Un peu plus tard, en 2009, dans sa Politique de la libération, il reprend ces propos et développe une
critique de l’apport de Ernesto Laclau qu’il articule à sa philosophie de la libération. Comme
Ernesto Laclau, il met en question la validité de l’approche marxiste mais, à la différence de son
compatriote, ne finit pas par faire du monde politique le lieu de la contingence absolue. Ernesto
Laclau essayait de prendre acte, avec l’émergence de nouveaux sujets et l’échec de la vision
marxiste de l’histoire, de l’échec de la classe ouvrière comme sujet révolutionnaire. Dussel, lui,
propose une autre vision du politique qui n’est pas radicalement contingente et garde l’idée d’un
sujet révolutionnaire ou, pour le moins, insurrectionnel.
Chez lui, comme chez Ernesto Laclau, les sujets cessent d’avoir une identité préétablie, car celle-ci
surgit dans le combat. Et s’il pense que dans la cartographie des relations sociales, aucune n’est
Licence Creative Commons 4.0.
127
déterminante, il n’accepte pas l’idée d’absence de fondement du politique, ce qui l’amène à
critiquer les présupposés de logiques politiques autonomes, libres de toute détermination et logique
matérielle propres à Ernesto Laclau. Pour lui, une politique ne peut rassembler que si elle est au
service de la vie. Alors que Ernesto Laclau ne voit pas de détermination ultime dans le socio-
économique et considère la politique comme une tentative de donner du sens à ce qui n’en a pas,
Dussel, lui, voit la politique comme ce qui est lié de façon radicale à la vie et à la survie, la
condition de possibilité pour l’hégémonie étant donc la possibilité de vivre pour les opprimé-e-s.
Selon Dussel, Laclau vide la politique de son sens. Enfin, contrairement à Ernesto Laclau qui défait
ontologie et métaphysique, il s’intéresse à l’ontologie et à la métaphysique, toutes deux marquées
par la prépondérance du politique. Il propose une historicisation de l’ontologie vue par Ernesto
Laclau. En effet, l’ontologie ne surgit pas de rien, remarque-t-il, elle s’enracine dans la domination,
et, l’histoire du monde étant coloniale, l’ontologie ne peut qu’être eurocentrée, une des
manifestations de la domination de l’Europe sur le reste du monde. Seul existe le centre, la
périphérie, l’Amérique, puis les autres colonies, ne sont pas. L’Autre représente l’extériorité au
système à la totalité. Or, si tout système tend à la totalisation, il n’y parvient pas. Nous retrouvons-là
cette extériorité qui ouvre la voie à autre chose que la domination et l’écrasement,
ce qui permet le changement politique.
Enrique Dussel, à l’égal d’Aníbal Quijano, est un des penseurs et penseuses dont la perspective a
renouvelé la pensée critique en « Amérique latine ».
Références
Pour l’œuvre monumentale qui est la sienne, nous renvoyons les lectrices et lecteurs au site
personnel d’Enrique Dussel. Extrêmement riche, exceptionnel, il propose des textes dans diverses
langues.
https://enriquedussel.com/
Dussel, Enrique. 1992. 1492. L’occultation de l’autre. Paris : Les Éditions Ouvrières.
Dussel, Enrique. 2006. 20 Tesis de política. México : Siglo XXI Editores.
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/56.20_Tesis_de_politica.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
128
Dussel, Enrique. 2009. Política de la liberación. Volumen II. La arquitectónica. Madrid : Editorial
Trotta.
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/61.Politica_liberacion_arquitectonica_Vol2.pdf
León Portilla, Miguel. 1950. Visión de los vencidos : relaciones indígenas de la Conquista.
Mexico : Universidad Autonoma de México.
Mouffe, Chantal. 1994. Le politique et ses enjeux. Pour une démocratie plurielle. Paris : La
Découverte/MAUSS.
Ricoeur, Paul. 1999. Lectures 1. Autour du politique. Paris : Seuil.
Salazar Bondy, Sebastián. 2017. 6 artículos sobre Lima . Vallejo & Co.
Consulté le 11 novembre 2019.
http://www.vallejoandcompany.com/6-articulos-sobre-lima-de-sebastian-salazar-bondy/
Scannone, Juan Carlos. 2017. « Irrupción del pobre, quehacer filosófico y lógica de la gratuidad ».
Pensamiento : Revista de investigación e Información filosófica 73 (278) : 1115-1150.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6273391
Tarragoni, Federico. 2017. « Le peuple selon Ernesto Laclau ». La Vie des idées. Consulté le 11
novembre 2019.
http://www.laviedesidees.fr/Le-peuple-selon-Ernesto-Laclau.html
Zea, Leopold. 1958. « L’Amérique hispanique et le monde occidental ». Revue Esprit.
https://esprit.presse.fr/article/zea-leopold/l-amerique-hispanique-et-le-monde-occidental-30979
Licence Creative Commons 4.0.
129
32. Disparition
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La disparition est une des formes de la colonialité de l’être. Le terme même nous renvoie aux
ambiguïtés de la modernité. Disparaître, c’est cesser d’être visible, mais c’est aussi un euphémisme
pour désigner la mort.
À partir de la « découverte » de l’Amérique, nous voyons « disparaître » les populations caraïbes
des Antilles, puis des civilisations comme celles des Aztèques et des Incas. Plus tard, disparaîtront
les Noir-e-s esclavagisé-e-s lors des traversées. La liste est longue et n’a pas fini de s’allonger. Les
êtres humains et leurs civilisations ne sont pas seuls concernés. On parle de la « disparition » des
bisons d’Amérique du Nord ou des dodos d’Australie. Or, dans tous les cas cités, il ne s’agissait pas
de disparitions mais de massacres ou d’ethnocides liés à la colonisation. La rhétorique moderne
aime à employer un terme qui inscrit ces morts dans une vaste histoire, géologique ou biologique.
Elle naturalise l’extrême violence qui fut nécessaire pour en arriver là.
Depuis cinq siècles, ceux et celles qui vivent en dessous de la ligne de l’être, c’est-à-dire d’abord
dans les colonies, puis dans les périphéries, sont des sujets « jetables ». Leur vie a peu de valeur; on
peut les faire disparaître, dans tous les sens du terme. La disparition ne doit pas être vue comme un
excès, une bavure des pouvoirs, typique de pays qui n’auraient pas encore su/pu accéder à la
démocratie. Elle s’inscrit dans la longue durée d’histoires nationales qui n’ont pas rompu avec le
colonialisme. Au centre, une fois de plus, nous retrouvons le racisme, car il y a un lien entre la
perception des autochtones comme sujets « archaïques », voués à la disparition, les génocides
(campagne du « désert » argentine au XIX siècle, génocide du caoutchouc à la fin du XIX siècle et
au début du XX siècle, guerres du Yucatán au XIX siècle) et les disparitions du XX et XXI siècles
(« disparus » des dictatures du cône Sud, cimetières « d’indigents » du Brésil actuel, fosses
communes de la Colombie ou du Mexique).
C’est une culture de pouvoir continentale dans la continuité de la violence fondatrice de la
Conquête. Elle vise d’abord les populations racisées mais peut aussi toucher les Blancs et les
Blanches. Elle n’est pas le seul fait d’élites corrompues et incapables d’exercer le pouvoir dans le
cadre de la démocratie, comme aiment à le penser les Occidentaux et les Occidentales,
Licence Creative Commons 4.0.
130
car ces élites sont aussi le relais de l’Occident. Dans le cas du Chili, par exemple, grâce à la
dictature, les Chicago Boys disposèrent d’un magnifique laboratoire pour leurs théories, les mêmes
qui s’imposeraient par la suite dans le monde entier.
Mais si la méthode a pu toucher les Blancs et les Blanches, la disparition n’a concerné qu’à la
marge ces groupes alors que les autochtones et les Noir-e-s, depuis la colonisation, paient le prix. La
disparition touche toujours doublement les populations racisées : dans les années 1970, lorsque les
persécutions subies par les membres des classes moyennes blanches argentines sont devenues
visibles, les opinions publiques des pays concernés et du reste du monde se sont mobilisées. Mais
qu’en a-t-il été des Indien-ne-s ou des Noir- e-s qui ont subi la même chose à cette époque? Qui
s’est intéressé-e au sort des Guaranies massacré-e-s entre 1968 et 1975 par le régime de Stroessner
au Paraguay? Ou aux leaders mapuches éliminés par les sbires de Pinochet ou Videla? Ces victimes
sont mortes deux fois, dans leur corps et dans la mémoire. La colonialité du pouvoir, le racisme qui
la met en mouvement, est apparue là d’une façon criante, dans l’indifférence de l’opinion publique.
La mort des Indien-ne-s n’avait pourtant pas lieu dans un clair obscur, elle n’était pas cachée
comme celle des Blancs et des Blanches. Il y avait tout un système de relais, très ancien, depuis la
complicité avec les bourreaux jusqu’à l’habitude de fermer les yeux sur les persécutions de
populations auxquelles il arrive depuis longtemps des choses terribles mais « inévitables ». Elles
disparaissaient de façon relativement visible tout en restant invisibles.
La disparition au sens strict n’est qu’une des faces d’un projet « desaparecedor » apparu avec la
Conquête, qui peut gagner d’autres groupes. Il ne s’agit pas d’imputer systématiquement cette
violence à l’État, aux gouvernements, même si, de façon régulière, ils sont impliqués dans ces
scénarios d’horreur. Les acteurs et les actrices sont nombreux, nombreuses narcotrafiquant-e-s,
guerrilleros, paramilitaires, etc. Lorsqu’on prend la mesure des massacres perpétrés dans le Cône
Sud durant les années 1970, on voit que des États modernes ont pu employer avec des groupes
jusque-là protégés, les populations blanches, des méthodes longtemps réservées aux Indien-ne-s ou
aux Noir-e-s. Peut-être est-ce là un phénomène qu’on peut ranger dans la catégorie « colonialisme
interne »? Jonnefer Barbosa (2016) parle de « sociétés de disparition ». Il met en cause l’approche
foucaldienne du biopouvoir, ce pouvoir qui est celui de gérer la vie. Les techniques de disparition
sont au cœur des pratiques des gouvernements modernes, la digitalisation et les algorythmes ayant
permis l’émergence d’une crypto-police ou d’un crypto-pouvoir. Diachroniquement, la vie « sans
traces » écrit une contre-histoire paradoxale de la politique occidentale. Elle permet d’y inclure
depuis l’histoire des morts sans traces des navires négriers (navio negreiro, guineamen également
appelés « navires tumbeiros portugais » au cours de la longue période allant du XVI au XIX
Licence Creative Commons 4.0.
131
siècles), jusqu’à celle des activistes politiques disparus pendant les dictatures d’Amérique latine des
années 1960, qu’il s’agisse de personnes tuées par des narcotrafiquants ou par des
groupes militaires ou paramilitaires (les escadrons de la mort »). Le concept de disparition est
essentiel pour comprendre le contexte politique latino-américain. Si l’on prend en considération ne
serait-ce que la situation du Brésil, on constate qu’il est impossible d’établir une analyse
minimalement critique des questions de gouvernementalité sans prendre en compte une
donnée récurrente: l’existence cachée mais constante, non seulement de processus d’exterminations,
mais aussi de fosses communes comme zones de disparition des traces. Ici les techniques de
gouvernement passent par des circuits autres que les institutions et les statistiques officielles.
(Barbosa, 2016)
Aujourd’hui, la disparition prend la forme des massacres de leaders indigènes ou afro-descendant-e-
s, qui luttent avec acharnement pour défendre leurs territoires ou celle des morts anonymes des
grandes villes brésiliennes. Les cimetières remplis de cadavres d’hommes et de femmes
assassiné-e-s par les escadrons de la mort ou de prisonniers et prisonnières politiques tel que celui
de San Luis, à Sao Paulo, nommé cimetière des « indigents ». Les acteurs et les actrices sont
toujours impuni-e-s et l’opinion publique internationale, indifférente. Quant aux classes moyennes
du continent américain, elles tournent la tête ou ferment les yeux. Pour beaucoup de ces urbain-e-s,
les autochtones sont un poids mort pour la société; ou des gens qui sont pris dans une spirale de
malheurs qui ne peut que finir sur leur totale défaite, leur disparition. Ces groupes, en effet,
profitent précisément du développement extractiviste qui met en péril Indien-ne-s et Noir-e-s.
Comment pourraient-ils et elles comprendre leur résistance? Pour eux et elles, c’est un acharnement
à lutter contre le progrès : tous ces territoires collectifs pourraient être exploités et rapporter des
devises à la nation, n’est-ce pas un gâchis inconcevable dans un pays moderne? Un anachronisme?
Il faut bien donner du travail aux citoyens et citoyennes! Prendre la « locomotive du progrès » (!),
comme le disait l’ancien président de Colombie, Santos. Donc, il faut forer dans des réserves
indiennes, polluer leurs rivières, usurper leurs terres et laisser d’autres les éliminer quand ils et elles
empêchent la bonne marche des travaux. Leurs univers et leurs savoirs sont superfétatoires, un
folklore qui ne fait pas le poids face à l’impératif de développement. Il a un prix, leur sacrifice. Il
n’est pas nécessaire qu’ils meurent mais il faut qu’ils disparaissent en tant qu’Indien-ne-s.
L’ethnocide serait suffisant. Nous trouvons un exemple abouti de cette tendance chez l’écrivain
péruvien Mario Vargas Llosa ou dans la plupart des romans dits réalistes des XIX et XX siècles qui,
sous couvert de mélancolie, écrivaient déjà la chronique d’une mort annoncée pour les populations
indigènes.
Licence Creative Commons 4.0.
132
Mais ces morts en puissance se sont avérés particulièrement coriaces. Le projet « desaparecedor »
de la modernité qu’identifient certain-e-s historien-ne-s, comme Rita Segato et Mario Rufer par
exemple, avec son corollaire de silence, butte sur la résistance obstinée des cadavres pourtant
programmés.
Jusqu’à quand?
Références
Barbosa, Jonnefer. 2016. « Sociedades de desaparición ». Conférence présentée au colloque 2as
Jornada Transdisciplinares de Estudios enGubernamentalidad;« Prácticas de subjetivación
y derivas de la Gubernamentalidad ». Santiago de Chile. 28 septembre 2016.
https://www.academia.edu/28920376/%20Sociedades_de_la_desaparici%C3%B3n
Bourguignon Rougier, Claude. 2013. « Biopolítica y gran relato nacional. Presencia espectral del
mundo indígena en tres novelas de la selva ». Kipus : revista andina de letras (32) : 31-83.
https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/3944
Rufer, Mario. 2017 [2010]. La temporalité comme politique. Revue d’études décoloniales (2).
https://www.academia.edu/28920376/%20Sociedades_de_la_desaparici%C3%B3nhttps://
reseaudecolonial.org/2017/10/01/la-temporalite-comme-%20politique-nation-formes-politiques-et-
perspectives-decoloniales/
Segato, Rita. 2006. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez
Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado. Buenos Aires : Tinta limón.
Salas Astrain, Ricardo. 2014. « Violence fondatrice, mémoires de la dictature et politiques de la
reconnaissance ». Appareil.
https://journals.openedition.org/appareil/1977
Licence Creative Commons 4.0.
133
33. |Ego Conquiro
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Dans un livre fondateur, 1492. L’Occultation de l’autre, Enrique Dussel(1992 : 39-48) consacre un
chapitre au passage de la Conquête à la colonisation du monde de la vie. Il y établit une
phénoménologie de l’ego conquiro. Après une première phase de découverte des territoires, a eu
lieu celle du contrôle des personnes, généralement nommée « pacification ». L’agent de ce contrôle,
le soldat, le Conquistador selon Dussel, a été le premier homme moderne actif, celui qui « impose
son humanité violente à d’autres personnes ». La subjectivité du Conquistador s’est construite dans
une praxis de négation de l’Autre, nié dans son altérité et intégré comme objet, force de
travail, à l’empire espagnol. L’archétype de cet homme-là, c’est Hernán Cortés, le premier avant le
roi. L’individualisme moderne qu’il incarne, rencontre un Nous autochtone, intégré au sacré. Il le
défait plus par la sidération due au sacrilège que par la force.
L‘ego conquiro, selon Dussel, annonce l’ego cogito. Pour que puisse se développer le sujet
européen abstrait qui identifie être et pensée abstraite, il a fallu que se produise préalablement un
processus inverse de soumission et de colonisation d’une partie du monde : le continent américain.
Le déploiement d’une culture d’expansion violente était nécessaire à la formation du monde
moderne et les valeurs liées à l’ego cogito avaient besoin, pour exister, d’être contredites dans les
faits sur une partie du globe : liberté et « civilisation » pour les uns rimeraient avec esclavage et
violence pour les autres.
Cet ego conquiro reposerait sur quatre bases : la « rencontre » avec le Nouveau monde, le face à
face autochtone/envahisseur, la soumission, et l’imposition de la civilisation (Montano, 2018).
À propos du premier moment, la « rencontre », Dussel parle de l’invention d’un « être asiatique »,
de l’Indien. Ce que les « découvreurs » ont inventé, c’est une « ontologie de l’Asiatique », c’est-à-
dire qu’ils ont identifié le territoire découvert à une autre forme d’expression de l’Asiatique
(Dussel, 1990). Le second moment consiste en un face à face entre l’intrus et l’autochtone. C’est en
quelque sorte l’inverse de ce que nous disait Levinas sur le visage : un moment unilatéral où l’intrus
fixe ce que doit faire l’autre et lui annonce ce qui lui arrivera s’il ne se conforme pas à ses
prescriptions. C’est le discours du requerimiento qui enjoint l’Indien à se soumettre et lui promet
que s’il résiste, il sera exterminé. Le troisième moment, c’est celui de la violence et de la victoire
pour l’intrus. L’explorateur devient l’ego conquiro. Avec le quatrième moment commence
l’imposition de la civilisation. En utilisant la violence comme ressource, l’ego va conquérir et
Licence Creative Commons 4.0.
134
imposer son hégémonie à l’indigène, c’est-à-dire qu’il va adopter avec lui une attitude de mépris, il
va le dévaluer, le réduire à rien. Postérieurement, il imposera la « civilisation » à l’indigène conquis
pour en faire un « citoyen ». Cependant, ce changement implique que le conquis ne sera pas un
citoyen du même niveau que le citoyen européen. Son insertion dans la « citoyenneté » le situera à
un niveau inférieur, il restera le membre d’un peuple soumis, esclavagisé. Sa praxis sera celle d’un
travailleur, pas celle d’un citoyen qui existe dans un monde politique. (Montano, 2018)
La dialectique qui se met en place est celle de la rationalité contre l’irrationalité. Cette tension
naturalise la soumission de l’autochtone et la légitime, justifiant son maintien indéterminé dans un
purgatoire politique. La citoyenneté, ce sera pour plus tard. Pour le conquérant, « l’irrationnel »,
l’Indien donc, face à lui, le « rationnel »6 , ne cessera jamais de l’être même si on lui inculque des
traditions, une religion et une culture propres à la société occidentale. Le conquis restera à jamais un
soumis, qui atteindra un certain niveau de rationalité, insuffisant nénamoins pour faire de lui un
citoyen. Il devra répondre au conquérant par le travail, qui fait lui aussi partie du processus de
tension vers la citoyenneté. Mais pour ce travail, le conquis ne touchera pas un juste salaire. Et ce
d’autant plus que l’Église sera hostile à la circulation de l’argent parmi les autochtones, arguant
qu’il risque de les corrompre. Le contractualisme jésuite a été ce tour de passe-passe. Le travail de
l’autochtone sera seulement un moyen d’atteindre la rédemption et, surtout, une aide pour le
conquérant qui pourra ainsi tirer profit de propriétés qui lui appartiennent désormais. C’est là une
version de ce que McPherson (2005), commentant Locke, appelle la « rationalité différenciée » :
l’idée de Locke d’une rationalité différenciée justifiait non pas l’esclavage naturel, mais la
subordination d’une partie du peuple par l’aliénation contractuelle continue de leur force de
travail.
Références
6 On trouve encore le terme rationnel pour designer le Blanc dans un célèbre roman colombien du premeir XX siècle
Licence Creative Commons 4.0.
135
Dussel, Enrique. 1492. L’occultation de l’autre. Paris : Éditions Ouvrières.
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/45.1492_l.occultation_de_l.autre.pdf
Martínez Andrade, Luis. 2018. « L’ego Conquiro comme fondement de la subjectivité moderne ».
La Revue Nouvelle (1).
https://www.academia.edu/36017494/
Lego_conquiro_comme_fondement_de_la_subjectivité_moderne
McPherson, Crawford Brough. 2005. La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a
Locke. Madrid : Éditions Trotta.
Montano, Rudy. 2018. « El ego conquiro como inicio de la modernidad ». Teoría y praxis 16 (32).
https://www.camjol.info/index.php/TyP/issue/view/902
Licence Creative Commons 4.0.
136
|34. Egopolitique et théopolitique
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
L’ego-politique, selon Walter Mignolo, est un des deux grands modes de contrôle de la
connaissance par les sujets européens, l’autre étant la théopolitique. Ces deux manifestations de la
connaissance absolue touchent toutes les dimensions de la subjectivité et trouvent leur origine dans
la Renaissance et dans les Lumières. La théopolitique se déploie dans le système qui s’était mis en
place avec la Conquête : il reposait sur des subjectivités chrétiennes et supposait la prééminence
d’un sujet absolu qui était Dieu. Ce système entra en crise à partir du XVI siècle et on verrait, avec
le mouvement de sécularisation et de désenchantement du monde, l’avènement d’un nouveau sujet
de la connaissance, l’Ego de Descartes, ce sujet abstrait sans lieu ni corps. Un nouveau type
d’individu, séparé des autres, responsable, « libre », était apparu. La théopolitique ne disparaîtrait
pas mais coexisterait avec l’ego-politique, dans le domaine de la morale. Ces deux politiques
constituent le cadre hégémonique de la modernité dans sa diversité interne; modernité, qui, à en
croire Mignolo, n’est pas plurielle mais plutôt un exemple de ce que l’on appela, au tournant du
siècle dernier, la pensée unique. Aujourd’hui, l’ego-politique a été mise en défaut par la conception
organisationnelle de la politique, inspirée du modèle entrepreneurial du travail en équipe qui
détrône l’individu. Aujourd’hui, c’est l’organo-politique qui l’emporte mais l’ego-politique et la
théopolitique n’ont pas disparu.
Références
De Souza, Fabiana. 2018. « Réactualiser l’archive, réécrire l’histoire. Des pratiques artistiques
décoloniales ». Revue Asylon(s) (15).
http://www.reseau-terra.eu/article1406.html
Mignolo, Walter. 2008. « La opción decolonial : desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un
caso ». Tábula Rasa (8) : 243-281.
http://www.revistatabularasa.org/numero-8/mignolo1.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
137
Mignolo, Walter. 2013. « Géopolitique de la sensibilité et du savoir.(Dé)colonialité, pensée
frontalière et désobéissance épistémologique ». Mouvements 1 (73) : 181-190.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-1-page-181.htm
Licence Creative Commons 4.0.
138
35. Émancipation
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Dans ses 16 thèses, le philosophe Enrique Dussel revient sur la question de la différence entre
émancipation et libération, déjà abordée dans La filosofía de la liberación (1977). Il relaie les
propos de Antonio Negri et Mickael Hardt. Ces derniers remarquaient que l’émancipation est une
lutte pour la liberté de l’identité tandis que la libération vise la liberté d’autodétermination et de
l’auto-transformation. Dussel ajoute :
La praxis critique et créatrice qui est produite à ce moment-là est ce que nous avons appelé la libération, avec un
forte connotation politique lévinasienne. La perspective rejoint celle de la rédemption chez Franz Rosenzweig et
du messianisme chez W. Benjamin, mais s’inspire aussi des luttes de libération du Maghreb ou d’Amérique
centrale. Le fils réalise son émancipation vis-à-vis de son père quand il atteint l’âge adulte; l’esclave accomplit
sa libération du seigneur libre quand il atteint sa liberté. Aujourd’hui, le mot émancipation est utilisé pour effacer
ce qu’il y a de critique et de politique dans le mot libération. La philosophie de la libération n’est pas une
philosophie de l’émancipation. (Dussel, 2014 : 258)
Selon Mignolo, dans La filosofía de la libéración, Dussel fait un choix important : il remplace le
terme d’émancipation par celui de libération. Ce déplacement lui permet de se situer, dès lors, dans
la perspective des mouvements de libération africains, asiatiques ou latino-américains. Un tel
déplacement, cette migration vers la périphérie, a une valeur géopolitique; il constitue un moment
du tournant décolonial. Le sémioticien, précisant que « parler de libération nous renvoie à deux
types de projets différents qui sont toutefois reliés : la décolonisation politique ou économique et la
décolonisation épistémologique » (Mignolo, 2015), voit l’émancipation comme un phénomène qui
se produit dans un autre espace, celui des métropoles impériales, son envers. Il nous propose
un historique de la notion : au XVIII siècle, le concept d’émancipation « s’enracinait dans trois
expériences fondamentales : la révolution Glorieuse de 1688, l’indépendance des colonies de la
Nouvelle-Angleterre et de la Virginie en Amérique par rapport à l’Empire britannique en 1776 et la
révolution française en 1789 ». Et il ajoute : « L’émancipation fut le concept utilisé pour penser la
libération d’une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie » (Mignolo, 2015).
Une libération pensée de l’intérieur de la modernité dans ce qui s’affirmerait comme Europe et
centre du monde. Le concept appartiendrait aux discours des Lumières et à leur rhétorique de
l’égalité. Son universalité semble aller de soi. Pourtant, selon qu’il se déclinait dans l’Ancien
Licence Creative Commons 4.0.
139
Monde ou dans le Nouveau, son caractère universel put être remis en question. Les luttes de la
révolution haïtienne, qui invoqueraient le modèle révolutionnaire français, feraient apparaître la
nature raciste de la modernité : elle prône dans les métropoles ce qu’elle interdit dans les colonies.
La France essaierait de réprimer la révolution haïtienne et elle lui ferait payer très cher son
indépendance. Le discours d’égalité des révolutionnaires français-es serait contredit par les
pratiques réelles de la République dans les colonies. Nous aurions donc deux logiques :
émancipation/modernité versus libération/ colonialité.
Par la suite, paradoxe révélateur, la rhétorique de l’émancipation inspirerait les luttes populaires
comme les politiques colonialistes de l’Europe. D’un côté, il y aurait un discours universel qui
serait repris par le prolétariat et s’exporterait dans le monde entier, de l’autre, des pratiques
coloniales dans lesquelles la réalité de la domination et de l’exploitation se justifieraient au nom du
progrès civilisateur, le « fardeau de l’homme blanc ». Ce discours de l’émancipation a été porté par
le mythe de la modernité, par l’idéologie du progrès, auquel les deux conflits mondiaux du XX
siècle infligeraient pourtant un sanglant désaveu. Pour Mignolo, l’émancipation appartient à un
univers discursif ancré dans des conceptions historiques et philosophiques emboîtées. Le
sémioticien affirme que le concept d’émancipation n’a jamais été l’objet d’une théorisation dans le
discours des Lumières et qu’on y observe le passage de la théopolitique à la géopolitique :
« le concept d’émancipation voit le jour (…) lors du déplacement de l’idée de rédemption propre au
christianisme vers celle d’émancipation propre à la bourgeoisie » (Mignolo, 2015).
Cette analyse, partagée par plusieurs auteurs décoloniaux et autrices décoloniales, ne fait cependant
pas l’unanimité. Chez l’anthropologue Eduardo Restrepo et le philosophe Santiago Castro Gómez,
nous trouvons un questionnement de cette polarisation absolue. Santiago Castro Gómez, par
exemple, estime qu’il n’est pas possible de critiquer la modernité dans son ensemble car l’idée
même de libération est inséparable de son avènement. La problématique de l’émancipation est
certes limitée par son approche euro-centrée mais elle est ce qui nous permet de penser le
dépassement du concept d’émancipation. Et le philosophe colombien critique la réduction
de la Révolution française à un phénomène bourgeois, en se fondant en particulier sur les histoires
récentes du peuple, allusion probable aux travaux de Gerard Noiriel ou de Sophie Wannich.
Références
Dussel, Enrique. 2009. « De la philosophie de la libération ». Cahiers des Amériques latines (62) :
37-46.
Licence Creative Commons 4.0.
140
http://journals.openedition.org/cal/1525
Dussel, Enrique. 1996. Filosofía de la liberación. Bogotá : Nueva América.
Dussel, Enrique. 2014. 16 tesis de economía política. Mexico : Siglo XXI.
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Obras_Selectas/(F)28.16_Tesis_economia_politica.pdf
Mignolo, Walter. 2015. Désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité, logique de la
colonialité et grammaire de la décolonialité. Bruxelles : Éditions Peter Lang. 43. 44. 80.
Noiriel, Gérard. 2018. Une histoire populaire de la France : De la guerre de Cent Ans à nos jours.
Paris : Éditions Agone.
Restrepo, Eduardo et Axel Rojas. 2010. La inflexión decolonial. Fuentes, conceptos y
cuestionamientos. Colección política de alteridad. Popayán : Universidad del Cauca.
http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/Inflexion.pdf
Wannich, Sophie. 2003. La liberté ou la mort. Essai sur la terreur et le patriotisme. Paris : La
Fabrique.
Wannich, Sophie. 2008. La Longue Patience du peuple : 1792, naissance de la République. Paris :
Payot.
Licence Creative Commons 4.0.
141
|36.Esclave vs esclavagisé-e / Esclavage et esclavagisation
SEBASTIEN LEFÉVRE
La langue n’est pas un espace neutre, elle est le résultat d’une construction sociohistorique et
culturelle. Il est coutume de dire qu’une langue est une culture. La manière d’exprimer les couleurs,
les joies et les peines, de nommer des plats, des rituels etc. fait référence à des pratiques
culturelles précises. La langue est aussi le fruit de dominations. L’espace où sont inscrites les
dominations. Cette dernière idée n’est pas nouvelle. Marina Yagüello, par exemple, dans son livre
Les mots et les femmes, soulignait déjà la domination du genre masculin. Par ailleurs, toutes les
langues ne fonctionnent pas de la même manière et ne permettent pas de neutraliser ces processus
de dominations.
Nous observons cette différence entre l’espagnol et le français en ce qui concerne les notions
d’esclave et d’esclavagisé-e. En espagnol, nous avons la possibilité de former à partir du suffixe
verbal -ado, le terme esclavizado, c’est-à-dire qui a été mis en esclavage (processus terminé). La
différence entre esclavo (esclave) et esclavizado n’est pas qu’une simple nuance, elle implique
toute une réflexion épistémologique concernant la vision que l’historiographie et les sciences
humaines occidentales ont développé quant aux populations africaines mises en esclavage et
déportées aux « Amériques».
Quand on dit de quelqu’un qu’il est esclave, c’est une définition totale de l’être ou plutôt une
réduction de l’être à la qualité d’esclave. C’est comme si cette personne avait toujours été esclave. Il
y a donc une négation de ce que la personne était avant cette condition d’esclave. Autrement dit, le
fait de dire de cette personne qu’elle est esclave efface ce que la personne était avant. Plus
précisément, ce qui pose problème avec le terme esclave est qu’il ne permet pas de différencier un
avant d’un après de la condition d’esclave. Quand on dit « les esclaves africain-e-s », cela occulte le
processus de mise en esclavage, processus d’ailleurs qui sous-entend beaucoup d’étapes bien plus
complexes, notamment la résistance des populations à leur mise en esclavage, leur capture, leur
transport, leur rébellion, leur collaboration etc.
En français, nous devons passer par un néologisme verbal pour rendre compte du processus :
esclavagisé. De la même façon la réflexion doit être appliquée au terme d’esclavage (esclavitud en
espagnol) qui escamote ce processus actif et nous devrions préférer esclavagisation (esclavización
en espagnol). Cette réflexion tente de montrer la réduction qui est faite des sujets africain-e-s
Licence Creative Commons 4.0.
142
déporté-e-s. Réduction qui rejoint l’enjeu des nominations comme Noir-e, Indien-ne, Blanc,
Blanche, etc. et qui révèle la colonialité occidentale quant à l’assignation identitaire.
Cependant, dans tout processus d’assignation, il y a des refus de subir cette dernière. C’est le cas
d’une grande majorité d’auteurs et d’autrices et de mouvements afroabyayaliens qui ont décidé de
se réapproprier leurs propres histoires, leurs propres noms, leurs propres visions culturelles. La
décolonialité passe par l’enjeu des mots. Toutefois, cet enjeu ne semble pas faire partie des
préoccupations de la majeure partie des discours décoloniaux où l’on constate toujours l’emploi de
esclavo et esclavitud.
Licence Creative Commons 4.0.
143
|37. Escobar, Arturo
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Arturo Escobar est un anthropologue colombien qui a enseigné jusqu’en 2019 à l’Université de
Chapell Hill, en Caroline du Nord. Cet intellectuel7, natif de Cali, qui a une formation en sciences «
dures » , assez rare dans le milieu décolonial, et a travaillé longtemps sur la question de
l’alimentation et de la faim dans le monde, est surtout connu en Europe pour sa critique du
développement, ou plutôt du « développementisme ». Il a participé aux rencontres du projet
Modernité/Colonialité des années 1990 et des années 2000, et poursuit aujourd’hui une démarche
originale qui s’appuie toujours sur l’idée de colonialité, sur la critique de la modernité et du
capitalisme.
Dans des ouvrages comme El final del salvaje, Territorios de diferencia, il a posé une réflexion sur
le développement. À la différence des théoriciens et théoriciennes de la dépendance, il ne s’est pas
seulement intéressé à l’échec inévitable du projet de développement; ses succès mêmes lui semblent
problématiques, dans la mesure où ils constituent l’imposition durable d’un modèle de pensée aux
pays pauvres. Il réfléchit donc à l’articulation du dispositif de savoir/pouvoir, ou, pour employer la
terminologie décoloniale, à la relation colonialité du pouvoir/colonialité du savoir manifeste dans
l’idéologie et la pratique du développement. Et il applique, pour cette visée, la méthode de la
généalogie8, abordant le développement comme un discours.
Pour lui, celui que tint Harry Truman en 1949 inaugurait une construction discursive des pays
pauvres comme tiers-monde et passait par la mise en place d’un appareil qui, de fait, permettait
d’imposer l’hégémonie américaine dans ces régions du monde. Cette idée, qu’il développera dans
de nombreux ouvrages, s’appuie sur l’expérience particulière de la Colombie et en particulier de la
côte pacifique.
Il était logique que sa critique du développement amène Escobar à aborder la question du
déplacement. Sa critique, moins connue que celle du développement, est particulièrement
intéressante car menée dans le cadre d’une réflexion radicale.
7Il a été ingénieur chimiste
8On peut définir la généalogie de Foucault comme la tentative, non pas de rechercher l’origine d’un phénomène, mais
d’étudier les embranchements significatifs dans les systèmes de pouvoir
Licence Creative Commons 4.0.
144
Pour dire les choses brièvement, ce que l’on soutient ici c’est que le déplacement fait partie intégrante de la
modernité eurocentrique et de la manifestation qu’elle a prise après la Seconde Guerre mondiale en Asie, en
Afrique, en Amérique latine, à savoir : le développement.
La modernité comme le développement sont l’un et l’autre des projets spatio-culturels qui exigent une conquête
incessante de territoires et de populations ainsi que leur soumission écologique
et culturelle aux impératifs d’un ordre rationnel et logocentrique.
(Escobar, 2011)
Observant que l’écart entre les effets négatifs du déplacement et les moyens censés les contrecarrer
ne cesse d’augmenter, il insiste sur la nécessité pour les populations concernées de pouvoir rester
sur leur territoire et l’indispensable appui des instances internationales à cette nécessité. Dans le
Pacifique colombien, les populations afrodescendantes, pour la plupart, avaient obtenu des droits
sur les territoires reconnus par la Constitution de 1991. Mais, depuis la fin du siècle dernier, ces
peuples ont été menacés par les paramilitaires, les narcotrafiquant-e-s et les guérilleros qui
se sont introduit-e-s sur ces territoires. Les populations noires se sont donc heurtées à une violence
brutale qui se traduit toujours par la suppression de leurs différences ethniques et culturelles, de
leurs droits à la différence qui, pourtant, avaient été reconnus. Cette violence est indissociable des
grands projets de développement ou d’agriculture qui se font aux dépens de la forêt et des
exploitations agricoles locales. Signe du pouvoir limité des solutions légales, les déplacements de
populations se sont accrus quand les territoires collectifs ont commencé à être délimités et à faire
l’objet de titres. Pour l’auteur, ces déplacements dans la région ont lieu dans le contexte d’une
riposte aux avancées culturelles et territoriales des communautés ethniques à l’échelle de
l’ensemble du continent, depuis le mouvement zapatiste jusqu’à la résistance des Mapuches. On
pourrait élargir encore le point de vue et établir un lien entre déplacement, guerre et racisme, depuis
l’Afrique jusqu’aux Balkans et au Pacifique. (Escobar, 2010 : 87)
Sa critique du déplacement l’a amené à s’intéresser aux alternatives imaginées par les populations
qui n’ont pas accepté de rentrer dans ce cadre et ont réalisé une critique en acte du développement,
à partir de solutions locales. Avec Territoires de différence, la question écologique prend place dans
le cadre d’une réflexion située, car le territoire relie entre elles la problématique environnementale,
la question des droits des populations racisées et celle de l’extractivisme dans lequel s’incarnent
l’idéologie et la pratique du développement. Arturo Escobar arrive à penser la question écologique
dans une approche qui échappe à l’atomisation et à la séparation caractéristiques des sciences
sociales modernes. L’écologie, ce concept symptomatique du dualisme nature/culture ou sujet/objet
propre à la modernité y prend d’autres contours et se combine à d’autres perspectives.
Licence Creative Commons 4.0.
145
Elle perd ce caractère a-politique qui, aujourd’hui, permet soninstrumentalisation par des États, des
institutions ou encore des firmes extractivistes.
Mais qu’est-ce qu’un territoire? Notre vision est marquée par celle de l’État-nation dans laquelle le
territoire est l’espace sur lequel existe l’État. C’est une notion qui nous renvoie à la cartographie, à
la géographie, à la frontière, notions ou pratiques qui doivent toutes beaucoup à la colonisation.
En Occident, le territoire comme la nation, dont nous parlait Benedict Anderson, est une «
communauté imaginée ». La nation est impensable en dehors de ce phénomène imaginaire dans
lequel les citoyen-ne-s s’approprient mentalement un territoire que, pendant longtemps, la plupart
d’entre eux et elles ne connaîtront jamais. Ce n’est pas le territoire vécu mais plutôt une
représentation et un rapport de nature assez religieuse, qui consiste à se reconnaître à l’intérieur
d’une communauté abstraite, vivant sur un sol donné, posé comme commun mais ne l’étant que
dans l’esprit. La vision développée par les peuples autochtones au cours de leur combat pour le
territoire est bien différente. Le territoire, au centre des luttes qui ont commencé il y a plus de trois
décennies en « Amérique Latine », est une notion qui s’est forgée dans une pratique. Je crois que
c’est là le point majeur : la notion n’a pas été pensée dans un bureau ni dans une classe, dans une
agence ou un organisme spécialisé. Elle a pris corps dans le cadre de luttes, elle a émergé en même
temps que se produisaient ces luttes, qualifiées d’environnementales par ceux et celles qui n’y
participaient pas. Escobar, dans Territoires de différence et dans Sentir-penser avec la
Terre, se réfère régulièrement aux conflits vécus par les populations afrodescendantes du Pacifique
colombien et aussi par les Nasa du Cauca.
Le territoire dont il nous parle est un monde vécu. Il renvoie à des notions fondamentales : celles de
lieu, de Terre Mère et de vie. Escobar part de cas particuliers : le Pacifique colombien ou le Cauca
des Nasa – mais nous aurions pu parler aussi bien de la vision des Collas argentin-e-s, des
Zapatistes mexicain-e-s, des Mapuches chilien-ne-s ou des Shuars équatorien-ne-s. Tous ces peuples
pensent le territoire. En Colombie, au milieu des années 1990, les autochtones et les activistes noir-
e-s ont élaboré conjointement une conceptualisation du Pacifique comme « territoire-région des
groupes ethniques ». C’est devenu l’axe des stratégies politiques et des politiques de conservation.
Le lieu y demeure une source importante de culture et d’identité, malgré la délocalisation
dominante de la vie sociale. Nous retrouvons-là une critique en acte de cet
hors sol de la vie moderne/coloniale. Un autre aspect important du territoire est qu’il s’organise
autour de la lutte pour la récupération de ce qui a été volé, dans le cas des Indien-ne-s,
ou pour la reconnaissance des mondes qui ont été établis dans les marges du système esclavagiste,
dans le cas des Noir-e-s marrons. Le territoire est organisé autour de l’autoconsommation et de
Licence Creative Commons 4.0.
146
l’autoproduction sur une petite surface. Cette petite taille est déjà en soi une réponse à l’habitat
colonial et à la grande propriété foncière qui le rend possible. Il se constitue comme lutte contre cet
habitat, et ce, depuis la colonisation du continent. Mais les mouvements pour le territoire ne sont
pas ancrés dans le passé comme on le leur reproche parfois. Ils sont au contraire dramatiquement
modernes, nous dit le Brésilien Carlos Porto Gonçalves. Ces utopies réalistes mettent en
avant une stratégie politique d’avant garde.
C’est dans les années 1980 que s’est affirmée cette tendance avec le slogan : « Nous ne voulons pas
une terre, nous voulons un territoire ». Des mouvements comme ceux des seringueiros, avec Chico
Mendes, nous permettent de comprendre ce slogan. Ils disent, par exemple, qu’il n’y a
pas de forêt sans les gens qui la peuplent. Ils recadrent la problématique environnementale à leur
façon, en revisitant la notion de biodiversité. Pour eux, biodiversité = territoire–culture.
Contrairement au territoire national, le territoire-région, ce « territoire de différences », comme le
nomme Escobar, n’a pas une forme fixe. Ses limites sont poreuses car elles dépendent de ce qui est
énacté tous les jours. Il constitue également une innovation juridique et politique exceptionnelle
dans un univers où le cadre est l’État-nation, car le territoire, pour se réaliser comme tel, a besoin de
l’autonomie et il correspond donc à l’émergence d’une autre logique juridique politique et
régionale. Le territoire redéfinit l’environnement en vue de construire un monde durable, les luttes
devenant des mouvements pour la ré-existence, un terme dont l’emploi n’est pas hasardeux. Les
territoires, à travers leurs membres, se définissent eux- mêmes comme renacientes, renaissants. Il
s’agit donc d’une démarche politique qui s’enracine dans une critique de l’histoire coloniale, de son
habitat colonial et qui met en avant une certaine ontologie. Dans Sentir-penser avec la Terre,
Escobar a exposé à nouveau cette question du territoire mais il l’a articulée à d’autres approches. Il
s’est intéressé aux ontologies des peuples qui proposent des alternatives au développement. Sa
collaboration avec des anthropologues comme Marisol de la Cadena ou Mario Blaser l’a amené à
réfléchir à cette notion. Il associe la notion d’ontologies relationnelles et politiques à la défense des
modes de vie des populations autochtones ou afrodescendantes, en lutte contre les États nationaux.
Cette notion est articulée à sa critique des ontologies dualistes atomisées de la modernité. Pour
qu’une écologie décoloniale puisse advenir, pour décoloniser le concept, il faut sortir des cadres de
luttes et des cadres de pensée dans lesquels l’écologie a été énactée, diraient les biologistes
Varela et Manturana. Il faut sortir de l’ontologie dualiste de la modernité que l’anthropologue
colombien s’acharne à démonter depuis qu’il a commencé sa critique du développement dans les
années 1980. En fait, cela l’a amené, finalement, à construire une anthropologie du développement
et à dénoncer le dualisme sujet/objet, civilisation/barbarie, rationalité/pensée magique,
Licence Creative Commons 4.0.
147
développement/tradition, progrès/archaïsme, — j’en passe —, qui est à la base de notre façon de
penser et d’agir. Pour Escobar, notre ontologie repose sur quatre piliers : économie; science;
individu; réalité. Ces fondements expliquent notre incapacité ầ affronter le « défi climatique »,
métaphore dans laquelle s’exprime le mythe prométhéen de l’individu et celui de l’entreprise, ces
ornières dont nous ne sommes pas encore sorti-e-s. Escobar a abordé dans plusieurs textes ce socle
ontologique de la modernité. Pour lui, notre rapport à ces fondements peut être qualifié de
croyances. Il les voit comme des inventions de l’ontologie moderne qui se présentent soit comme
naturelles soit comme supérieures. La croyance en l’individu, c’est l’idée que nous existons en tant
qu’entités séparées, autonomes, dotées de droits et de libre arbitre. Pourtant cette croyance est
locale, de nombreux groupes humains ne voyant pas les personnes comme des individus séparés
mais comme des entités relationnelles ou voyant dans le « je » un principe de souffrance plus que de
liberté, comme c’est le cas par exemple pour les boudhistes. La deuxième grande structure, c’est le
« réel »; l’idée d’un monde externe qui préexiste aux relations à travers lesquelles il existe. Cette
croyance va à l’encontre du fait que la vie est un flux et que le monde, s’il a une apparence
solide, est le produit d’activités incessantes, variées et interconnectées. Pour Escobar, il faut donc
montrer comment se crée un certain réel, expliquer qu’il résulte de l’abandon de certaines options
au profit d’autres et que le comprendre suppose cette sociologie des émergences et des absences
dont parle Bonaventura de Sousa Santos.
La science, seule forme de connaissance que nous reconnaissions, valide ce rapport à la nature.
Cette hégémonie du discours scientifique est un des aspects de ce que les décoloniaux et
décoloniales désignent sous le nom de colonialité du savoir. C’est le fait que les savoirs pré-
modernes sont dévalorisés et détruits. L’avènement de la science comme celui du marché n’est pas
un phénomène naturel lié à une implacable progression de l’histoire. Il a été possible grâce à des
épistémicides comme celui que j’évoquais plus haut. La science organisée est la religion du monde
moderne, écrit Escobar, et elle n’accepte pas le dialogue avec les autres formes de connaissance. La
conséquence, très grave, est qu’elle devient la complice des processus de domination dans le
monde. Le piratage scientifique de la biodiversité ou l’imposition de semences transgéniques aux
pays du Sud sont des exemples de cette alliance entre les anciennes puissances coloniales et
les biosciences.
Quant à la croyance en l’économie, nous ne pouvons la critiquer qu’à partir de sa généalogie :
l’avènement d’une sphère séparée de l’existence, qui existe sous la forme du marché autorégulé.
Dans La grande transformation, partant de l’exemple de l’Angleterre après le mouvement des
enclosures, Karl Polanyi a montré quelle violence il a fallu mettre en place dans la société
Licence Creative Commons 4.0.
148
pour que le marché « apparaisse ». L’économie existe à travers des pratiques qui l’énactent, à
travers des narrations dont les États et les médias sont de puissants relais. Sa dénaturalisation nous
permettra peut-être de cesser de nous voir comme des individus condamnés à agir sur des marchés
régulés par des prix.
Aujourd’hui, la force des mouvements hâtivement classés comme « environnementaux » en «
Amérique latine » tient à ce qu’ils reposent sur une ontologie qui n’est pas dualiste mais
relationnelle. Dans Sentir-penser avec la Terre et dans Autonomie et design, Escobar décrit des
ontologies relationnelles, celles des Afrodescendant-e-s du Pacifique et des Nasa Colombien-ne-s,
et celle qui s’organise autour de l’ayllu, qui n’est pas seulement un mode andin de propriété de la
terre ou d’organisation sociale, mais aussi une cosmovision. Il explique que l’Afrodescendant qui
apprend à sa fille à naviguer sur son potrillo, une sorte de pirogue, vit dans un monde connecté; il
s’y déplace d’une façon qui ne met pas en danger le milieu, il peut profiter de son trajet pour pêcher,
se rendre au village où il vendra ce qu’il a cultivé. Il transmet à sa fille les éléments qui lui
permettront de continuer à exister dans un monde qui est à la fois respecté et vécu : ce n’est pas une
réserve, un parc dans lequel on doit se déplacer comme dans un musée mais un véritable lieu de vie.
Ce qui unit ces ontologies, c’est qu’elles supposent toutes la pratique de la communalité et de
l’autonomie. Le lien territoire-autonomie-communalité est une constante dans les derniers ouvrages
d’Escobar. Il s’agit clairement d’un appel à une autre logique que celle de l’État.
Mais, dira-t-on, les Nasa peuvent se baser sur leur histoire, mais nous qui avons coupé le cordon
avec notre passé, qui ne pouvons plus nous référer à une tradition, quelle solution avons-nous?
C’est là qu’intervient l’idée de « design ». Le design est la façon que nous avons de donner une
forme au monde. C’est bien plus que le design d’objet, apparu avec la phase industrielle du
capitalisme. Le design désigne notre monde autant qu’il nous désigne, nous. Dans Autonomie et
design, Escobar fait sur le design un retour inattendu. Ce livre représente la tentative de
penser ensemble design, autonomie et communalité, résistance et changement dans le Sud global et
dans le Nord global. Il contribue à faire connaître, en France, la notion de communalité et
d’autonomie. On ne peut pas penser la civilisation capitaliste sans le design, qui est finalement
l’interface visible, tactile et concrète dans laquelle s’exprime notre ontologie. Ce design, la plupart
des grand-e-s designers actuel-le-s l’ont dit, est mortifère car insoutenable. Pour Tony Fry par
exemple, le design du XX siècle a été une arme de destruction massive. Aujourd’hui, le monde du
design est donc partagé entre celui des petites mains du système et celui des critiques, qu’il s’agisse
du mouvement du design social ou de ce que Escobar nomme « le design ontologique ». Changer de
monde, c’est changer d’ontologie et changer d’ontologie suppose une politique ontologique.
Licence Creative Commons 4.0.
149
Changer notre monde ne se fera pas dans notre tête, mais passera par une autre façon d’entrer en
contact avec lui. Son dernier ouvrage, Otro posible es posible : caminando hacia las transiciones
desde Abya Yala Afro-latino-América, revient sur la critique du dualisme, sur les ontologies
relationnelles, le post-développement et le design de transition. Il est également l’occasion de
dresser un bilan des contradictions de la théorie sociale latino-américaine et de l’état de la notion
de post-développement. Pour lui, la pensée critique latino-américaine est en pleine effervescence et
l’apport des peuples indiens ou afrodescendants en résistance joue un rôle essentiel dans ce
renouveau. Cet apport vient de ce qu’il appelle la pensée autonome et la pensée de la terre, qui
s’enracinent dans une tradition de résistance depuis la Conquête. Pendant longtemps, ces
connaissances « autres » ont été inaudibles et, malgré leurs indéniables avancées, même des savoirs
récents comme les théories post-marxistes, post-structuralistes, culturelles n’échappaient pas à cet
eurocentrisme. Ces connaissances « autres » n’ont commencé à attaquer la forteresse
académique et son eurocentrisme que très récemment avec l’ouvrage de Fals Borda, Ciencia propia
y colonialismo intelectual, et celui de Freire, Pedagogia dos oprimidos. Aujourd’hui, l’écologie
économique, les théories de la complexité, de l’émergence, de l’autopoïese ou de l’organisation
nous permettent d’aller plus loin dans la critique du « réel ». Ces nouvelles ontologies matérialistes
témoignent d’une rupture avec l’anthropocentrisme de la modernité.
Nous pouvons donc aujourd’hui comprendre l’importance de cette pensée de l’autonomie ou de
celle de la Terre Mère. L’autonomisme, nous dit Escobar, c’est le spectre qui hante l’Europe à
nouveau. La vague des damné-e-s de la terre qui se révoltent pour défendre leurs territoires. Au
niveau théorique, c’est une pensée liée à la décolonisation du savoir, au concept de justice
cognitive, à l’interculturalité. Politiquement, c’est une pratique qui renvoie à la communalité et à la
territorialité.
Qu’entendre par communalité? C’est cet horizon des cultures profondes de « l’Amérique latine »
que l’anthropologue Bonfill Batalla a décrit dans Mexique profond. L’autonomisme est l’émergence
de mondes relationnels dans lesquels le communal prime sur l’individuel et la connexion avec la
terre sur la séparation entre humains et non humains. L’idée est de repenser l’organisation sociale à
partir d’autonomies locales et régionales, une économie en autogestion mais articulée au marché et
une relation avec l’État visant avant tout à le neutraliser. Quant à la libération de la Terre Mère, elle
lui apparaît comme la figure emblématique capable de se substituer à celle de l’être humain. Il cite à
ce sujet Foucault, remarquant que les sciences de l’être humain s’étaient développées en même
temps que la dissection et constatant que la médecine avait progressé à partir du savoir produit sur
un corps mort.
Licence Creative Commons 4.0.
150
La particularité de l’approche de cet anthropologue spécialiste des populations noires colombiennes
tient à ce qu’il n’a pas seulement étudié ces mouvements mais les soutient dans leur combat contre
l’État et les multinationales. Sa volonté et d’être à la fois sur le versant théorique et sur celui de
l’action militante, de réfléchir au pouvoir libérateur de la tradition et d’inclure certains des apports
de la modernité.
Références
Bourguignon Rougier, Claude. 2018. « Décoloniser les savoirs ». Revue d’études décoloniales.
http://reseaudecolonial.org/2018/10/16/decoloniser-les-savoirs-2/
Escobar, Arturo et Eduardo Restrepo. 2009. « Anthropologies hégémoniques et colonialité ».
Cahiers des Amériques latines (62) : 83-95.
http://journals.openedition.org/cal/1550
Escobar, Arturo. 2010. Territorios de diferencia. Lugar, movimientos, vida, redes. Popayán :
Editorial Envión.
Escobar, Arturo. 2012. « Más allá del desarrollo : postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso ».
Revista de Antropología Social 21.
http://dx.doi.org/10.5209/rev_RASO.2012.v21.40049
Escobar, Arturo. 2014. Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y
diferencia. Medellín : Ediciones UNAULA.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/escpos-unaula/ 20170802050253/pdf_460.pdf
Escobar, Arturo. 2016. « Les dessous de notre culture ». Revue d’études décoloniales (3).
http://reseaudecolonial.org/2016/09/02/les-dessous-de-notre-culture/
Escobar, Arturo. 2017. Autonomía y diseño. Buenos Aires : Tinta Limón.
Escobar, Arturo. 2018. Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy, and the
Making of Worlds. Durham et Londres : Duke University Press.
Licence Creative Commons 4.0.
151
Escobar, Arturo. 2019. « Desde abajo, por la izquierda, y con la Tierra : SUReando desde Abya
Yala/Afro/Latino/América ». Revista interdisciplinar Sulear 2 (2) : 36-48.
https://revista.uemg.br/index.php/sulear/article/view/4141
Licence Creative Commons 4.0.
152
38. Être-Ser et Être-estar
FERNANDO PROTO GUTIERREZ
Le mot quechua qui désigne le séjour des entités sur la terre est cay ou kashay. L’anthropologue
Rodolfo Kusch et le philosophe Juan Carlos Scannone y voient un point de départ pour la
philosophie latino-américaine : En quechua, le verbe copulatif cay est l’équivalent des verbes
espagnols ser et estar, mais avec un sens qui tend fortement vers celui d’estar. (Kusch, 1999 : 89)
Mario Mejía Huamán traduit kay comme « l’être de ce qui est », le mettant en relation avec le terme
grec einai et celui en latin esse : Il ne serait pas incorrect d’affirmer que dans le monde andin ce qui
est, nécessairement est un « il y a », que l’être est quelque chose (kaqqa kanmi) et que le néant
n’existe pas (mana kaqqa manan kanchu). (Mejía Huamán, 2004 : 5)
Ainsi, Scannone part de l’articulation entre « être-ser » – héritage grec-, « advenir » – tradition
judéo-chrétienne – et « être-estar », propre à l’Amérique profonde, pour poser la formule : « être là
– en étant ainsi ». Le philosophe argentin poursuit :
Le concept d’être est intimement lié à celui de terre (qui n’est pas seulement une réalité en soi, mais aussi un lieu
où l’on est enraciné et une sphère animée par un symbolisme profond) et de symbole (symbole qui, parce qu’il
colle à la terre, ne passe jamais totalement dans le langage) ». (Scannone 1990)
Il convient également de noter que « La terre est ce sur quoi un peuple se tient. C’est la
Pachamama, la Terre Mère, l’origine abyssale, la sphère sacrée de l’habitat ». (Picotti, 1990 : 54).
De telle sorte que l’affirmation « être là – en étant ainsi » implique la facticité de la terre, tandis que
le fait d’habiter implique le caractère situé d’un lieu et celui, factuel, du temps : le particulier, le
contingent, l’historique, le matériel (Scannone, 2005 : 245).
Scannone, passant par Levinas, fait appel à une dimension éthique qui se distingue de la dimension
subjective-individualiste de la philosophie moderne, pour affirmer le caractère populaire de
l’écologie des savoirs propre au « nous sommes là », qui naît de la réflexion sur la terre (Kay
Pacha) et, plus largement, sur le monde comme totalité située. Scannone cite les caractéristiques
que Werner Marx attribue à « l’être », « compris avant tout comme identité, besoin (intelligible),
intelligibilité et éternité (ou présence) » (Scannone, 1990) pour les opposer aux « notes d’altérité
(ou de différence), de gratuité, de mystère et de nouveauté historique » (Scannone, 1990) propres à
l’« advenir » judéo-chrétien. Ainsi, pour Scannone, « l’être-estar » est surdéterminé, multi-
Licence Creative Commons 4.0.
153
significatif et pré-juridique, c’est-à-dire qu’il est antérieur à toute norme logique ou éthique; il
affirme aussi le caractère abyssal de « l’être-estar qui se dérobe, comme mystère irréductible à un
problème ».
Augustin de la Riega, de son côté, considère que l’« être-estar » renvoie essentiellement au sujet qui
est là et au projet qui le constitue. Mais il n’insiste pas sur le fait que l’« être-estar » se produit dans
l’ordre de l’ « il y a », un ordre trans-ontologique que le philosophe considère antérieur à
l’« être là – en étant ainsi ». Quel débordement du côté du mystère et de l’ambiguïté, comme nous
l’ont enseigné les maîtres et maîtresses de l’être- estar. Mais sans esquiver le « Il y a » qui est la
base de l’objectivité (au-delà de tout « monde d’objets » matérialisé) et la base du dialogue entre
l’Ambigu et l’Univoque » (De la Riega, 1987 : 57). Par conséquent, Scannone considère que
Heidegger signale une caractéristique proto-ontologique de l’être-estar pré-ontologique lorsqu’il
s’intéresse à l’être, sans approfondir le « da (là) » (Scannone, 1990 : 49). C’est alors que, avec
Kusch, l’estar apparaît comme l’équivalent homéomorphique de « Da » dans Dasein, de sorte que
ce « là » de l’« être » est soustrait aléthiquement. Selon Werner Marx, dans Heidegger und tradition
(1961), l’« être » de la philosophie grecque a quatre caractéristiques spécifiques, à savoir :
1. L’Identité, voir Parmenides, DK 28 B 6.1-2 ἔστι γὰ|ρ εἶνὰι (est/est là, alors,
étant);
2. La nécessité, voir Parmenides, DK 28 B 2.1-8 : ἡ µε|ν ὅπως ἔστιν τε κὰι| ὡςοὐκ ἔστι µὴ| εἶνὰι (il y
a un être et il n’est pas possible qu’il n’y en ait pas),phrase dont on déduit la logique disjonctive
excluante qui caractérise la pensée européenne;
3. L’Intelligibilité, voir Parmenides, DK 28 B3 : το| γὰ|ρ νοεῖν ἐστίν τε κὰι| εἶνὰι et
d. Éternité. Voir la phrase de la section B.8 : Τῷ ξυνεχε|ς πᾶν γὰ|ρ- ἐο|ν γὰ|ρἐόντι πελάζει. Αὐτὰ|ρ
ἀκίνὴτον µεγάλων ἐν πείρὰσι ἔστιν ἄπὰυστον, ἐπει| γένεσις κὰι| ὄλεθρος τῆλε ἐπλάχθὴσὰν, ἀπῶσε
δε| δεσµῶν ἀλὴθής. Τὰὐτόν τ΄ ἐν τὰὐτῷ τε µάλ΄ ἑὰυτό τε κεῖτὰι.
4. Éternité. Voir la phrase de la section B.8 : Τῷ ξυνεχε|ς πᾶν γὰ|ρ- ἐο|ν γὰ|ρ ἐόντι πελάζει. Αὐτὰ|ρ
ἀκίνὴτον µεγάλων ἐν πείρὰσι ἔστιν ἄπὰυστον, ἐπει| γένεσις κὰι| ὄλεθρος τῆλε ἐπλάχθὴσὰν, ἀπῶσε
δε| δεσµῶν ἀλὴθής. Τὰὐτόν τ΄ ἐν τὰὐτῷ τε µάλ΄ ἑὰυτό τε κεῖτὰι.
Puis, le lecteur de Max Müller qu’est Scannone oppose les notes caractéristiques de la tradition
judéo-chrétienne relatives à l’« événement » ou « Ereignis » et en déduit ainsi, à partir de la pensée
de Rodolfo Kusch, les notes caractéristiques de l’« être américain », à savoir :
1. L’Ambiguïté, ce qui ne relève ni de l’identité ni de la différence, et renvoie à la polysémie du
symbolique;
Licence Creative Commons 4.0.
154
2. Destinalité, puisqu’il ne renvoie ni à la nécessité logique grecque ni à la gratuité d’Ereignis, mais
à la nécessité factuelle (encore inintelligible) et à la gratuité d’un destin qui se joue dans le « nous »;
3. Abyssalité, qui répond au caractère aléthique de l’estar, et l’ouvre à la dimension du mystère;
4. Arché, parce que dans l‘estar, il faut favoriser l’idée de ce qui n’a pas d’origine qui est soustrait
au présent et qui ne peut pas se comprendre à partir du futur, comme c’est le cas avec l’« événement
», qui renvoie à la « nouveauté historique ».
Références
De la Riega, Agustín. 1987. Identidad y universalidad. Buenos Aires : Docencia.
Kusch, Rodolfo. 1999. América profunda. Buenos Aires : BIBLÓS.
Kusch, Rodolfo. 1978. Esbozo para una antropología latinoamericana. San Antonio de Padua :
Ediciones Castañeda.
Marx, Werner. 1961. Heidegger und die Tradition. Eine problemge – achichtliche Einfuhrung in die
Grundbestimmungen des Seins. Stuttgart : Kohlhammer.
Mejia Huaman, Mario. 2004. Hacia una filosofia andina. Doce ensayos sobreel componente andino
de nuestro pensamiento. Lima : première édition numérique.
https://www.academia.edu/7829173/Filosofia_Andina_Mario_Mejia_Huaman?auto=download
Picotti. 1990. El descubrimiento de América y la otredad de las culturas. Buenos Aires : Rundi
Nuskin Editor.
Proto Gutierrez, Fernando. 2013. « Diálogo con el pensamiento de M. Henry y Agustín de la Riega
». Revista Faia 2 (8).
http://editorialabiertafaia.com/pifilojs/index.php/FAIA/article/view/54
Scannone, Juan Carlos. 1990. Nuevo punto de partida de la filosofia latino- américana. Buenos
Aires : Editorial Guadalupe. : 46. 53. 52. 40. 49
Licence Creative Commons 4.0.
155
Scannone, Juan Carlos. 2005. Religión y nuevo pensamiento. Hacia una filosofía de la religión para
nuestro tiempo desde América Latina. Barcelona: Anthropos Editorial.
Tangorra, Manuel. 2017. « Différence culturelle et frontière, une approche à partir de la pensée
décoloniale : Le cas Rodolfo Kusch ». Eikasia (77).
http://revistadefilosofia.com/77-15.pdf
Tasat, José Alejandro. 2013. « El pensamiento de Rodolfo Kusch, estar siendo en América Latina:
“un pensamiento que conlleva la esperanza de otro horizonte humano” ». Séminaire donné au
Centro de Estudos Sociais. Universidade de Coimbra. 5 février 2013.
https://ces.uc.pt/pt/agenda-noticias/agenda-de-eventos/2013/el-pensamiento-de-rodolfo-kusch-estar-
siendo
Licence Creative Commons 4.0.
156
|39. E.sy kennenga
SEBASTIEN LEFÉVRE
E.sy Kennanga est un artiste musicien de la Martinique. Il fait partie de la jeune génération. Il est
presque difficile de le réduire à cette seule entité territoriale, car il revendique dans ses chansons
une identité beaucoup plus vaste qui englobe toute la Caraïbe, mais également l’Afrique, l’Océan
indien et la France « métropolitaine ». C’est le cas du titre We are (2013) où il met en avant cette «
diversalité », pour reprendre une notion chère à feu Édouard Glissant. En effet, il chante le verbe
être à la première personne du pluriel pour refléter ce collectif caribéen, c’est-à-dire « West Indies
», mais également « Vincent, lamentinois, martiniquais et puis antillais » et « Caribéen, français,
descendant d’Africain! ». Nous avons-là une représentation multiple de la Caraïbe. Par ailleurs,
cette diversalité passe aussi par un usage pluriel de la langue : « Je m’exprime en créole, en français
et aussi en anglais ». Mais de préciser que cela ne représente qu’un aperçu de ce que sont les
Antilles : « Je ne suis qu’un échantillon, car en effet / Chez nous, les couleurs se mêlent! / Plus de
nuances que dans un arc-en- ciel ». Cette idée de mélange est reprise dans la mise en scène du
vidéoclip, car toute une série de visages apparaissent qui vont du « blanc » au « noir ». Loin de
constituer un frein, cette diversalité constitue une richesse : « Un héritage commun plutôt complexe
» / « Mais qui aujourd’hui fait notre richesse ». Et d’ajouter :
Car en vérité différentes cultures sont sorties du même endroit /
je ne cesserai de le répéter / nous devons lutter ensemble /
se battre pour l’unité / plus de fraternité /
l’histoire veut que nous soyons divisés / décrédibilisés /
nous devons être sûrs de dire ce que nous visons /
car personne ne peut compter sur ceux qui nous ont oppressés /
nous ont blessés / nous ont traînés dans la boue ou malmenés dans le passé /
nous devons nous organiser pour que le message soit diffusé /
nous devons nous mobiliser / monter en haut comme une fusée.
Par conséquent, les textes d’E.sy Kennenga sont intéressants car ils révèlent toute la complexité des
peuples de la Caraïbe que l’Occident a voulu enfermer dans une identité. Cette dernière, de par ses
processus de mélanges culturels, est un espace qu’on ne peut réduire à une seule entité et exige de
penser une certaine unité dans la diversité ou, pour parler en terme décolonial, une pluriversalité.
Licence Creative Commons 4.0.
157
Or, cette pluriversalité n’est pas pratiquée par les différents États de la Caraïbe. Cuba, par exemple,
ne reconnaît pas encore officiellement les présences afrocubaines, elles sont noyées dans une
idéologie de classe qui ne permet pas cette reconnaissance. Le contrevenant risque de passer pour
contre-révolutionnaire car il va à l’encontre de l’unité postulée par l’approche marxiste (Zurbano
Torres, 2015). Les Afroportoricain-e-s, eux et elles, se débattent encore contre les élites qui
quémandent une reconnaissance fédérale de la part de l’État américain… Et en ce qui concerne les
Antilles françaises, depuis la départementalisation de 1946, la France continue d’avoir un rapport
colonial avec ses territoires.
C’est ce rapport que dénonce E.sy Kennenga dans une autre chanson intitulée Un truc de fou. Dans
cette dernière, il est question d’une analyse rétrospective de l’expérience du rapport à la métropole.
Le chanteur part de ses souvenirs d’école où il a eu la sensation de ne pas exister :
J’apprends l’histoire d’un pays qui me paraît si loin /
Et selon certains
ne serait pas le mien /
Dans les bouquins je ne trouve quasiment rien
/ sur l’endroit d’où je viens.
Il y dénonce clairement la colonialité du savoir dont les sujets afrodiasporiques des Antilles
françaises souffrent. En effet, les programmes scolaires ne sont pas en harmonie avec les réalités
pluriverselles des Antilles où il est question d’appliquer les mêmes programmes qu’en métropole.
Cette colonialité passe également par l’usage du français à l’école ; il apparaît comme langue du
savoir, opposé ou en compétition avec le créole qui est parlé par les enfants : « Avec mes camarades
de classe / on parle créole à voix basse ». D’ailleurs, dans son texte, E.sy Kennenga inclut des
passages en créole, notamment pour refléter cette relation de domination et les enjeux symboliques
que représente la langue : « Paskè yo di nou kréyòl sé ba vyé nèg ki pa fè lékòl » [l’école c’est pas
pour les vieux Noirs qui n’ont pas été à l’école].
La violence épistémique se reflète en outre dans l’apprentissage de l’histoire des grands hommes
qui n’ont pas de connexion concrète avec l’histoire de la Martinique, mais surtout dans l’incapacité
potentielle du sujet afrodescendant-e d’atteindre les mêmes prouesses du fait de la couleur de
peau :
J’apprends l’histoire des grands hommes de ce pays lointain /
qu’il me sera plus difficile de suivre le même chemin /
Licence Creative Commons 4.0.
158
Certains disent que mon teint serait un frein pour aller loin.
La pertinence du texte d’E.sy Kennenga est qu’il montre le côté subtil de
la colonialité :
Je viens de ressentir un truc de fou / Une part de mon histoire me /
semble tout à coup un peu floue / L’impression qu’on ne me dit pas tout /
De mon histoire on m’a caché un grand bout.
C’est de l’ordre du ressenti, de l’impression, car la colonialité est présentée d’une façon tellement
naturelle qu’elle n’apparaît pas directement aux yeux des enfants.
Le réveil se fait, en général, lorsque les enfants, une fois adolescent-e-s ou adultes, quittent la
Martinique pour la métropole et se retrouvent immédiatement en situation d’étranger et d’étrangère
dans leur propre pays
:
Voilà deux mois que j’ai pris mon envol / vers cette métropole /
étudier sur les bancs de l’école / J’ai 20 ans et le seul bémol /
c’est cette drôle d’impression bien assez folle /
d’être une enfant illégitime de cette mère patrie.
Et pourtant, le sujet afrodescendant-e a appris toute l’histoire et la culture de ce pays mais il se sent
finalement rejeté par ce dernier car il subit le plus souvent un traitement discriminatoire qui le
ramène à une étrangeté : « à propos de laquelle je me rappelle avoir tant appris / Et en contre-
partie, semble faire fi d’une partie de l’histoire qui nous lie ». Cette dernière idée est intéressante
car le sujet ne rejette pas cette patrie mais indique qu’effectivement leurs histoires, qu’on le veuille
ou non, sont liées. Il s’en suit alors une série de questionnements pour tenter de comprendre cette
situation :
Serait-ce une méprise? / Mes enseignements auraient-t-ils manqué
de franchise? / Vu que certains me disent : Sache d’où tu viens pour
être sûr de ce que tu vises…
Licence Creative Commons 4.0.
159
La chanson termine par une prise de conscience du sujet qui replace tout cela dans cette fameuse
colonialité du savoir où l’Occident a voulu escamoter les trajectoires spécifiques des Antilles
françaises :
Aujourd’hui, j’y vois un peu plus clair, même si / il reste beaucoup à
faire je me dis / que si je veux avancer je ne peux pas vivre dans le
passé / même s’ils ont voulu l’effacer.
Finalement, cette conscientisation passera par une ré-adéquation culturelle des différents Moi du
sujet (moi antillais, caribéen et métropolitain), (« c’est kréyòl ka palé fransé… » [c’est un créole qui
parle français]), où l’on observe un équilibre serein mais où l’on ne perd pas de vue l’enjeu de la
colonialité française aux Antilles :
Aujourd’hui, je suis fier de ce que je suis / le passé est derrière mais
tombera jamais dans l’oubli / même si les choses ont changé grâce
aux combats qui ont été menés / le chemin a été tracé / le combat
ne fait que commencer.
Pour terminer, il faut ajouter que la vidéo reflète très bien tout ce mouvement de conscientisation.
Au début, le spectateur peut voir une cours sur Napoléon, donnée dans une classe de primaire en
Martinique et rapidement, un autre personnage semble venir hanter le chanteur et remplacer
Napoléon : Toussaint Louverture. Il y a donc une mise en parallèle de deux mémoires : l’une issue
de la victoire épistémique de l’Occident qui présente Napoléon comme le conquérant de l’Europe et
l’autre issue de l’histoire afrodiasporique qui, même si elle ne jouit pas d’une reconnaissance
officielle, fait partie de la mémoire afrodescendante comme constituant un moment de
recouvrement de la dignité humaine de par la victoire des esclavagisé-e-s haïtien-ne-s sur les armées
européennes.
Références
Zurbano Torres, Roberto. 2015. « Racismo vs. Socialismo en Cuba : un conflicto fuera de lugar.
Apuntes sobre/contra el colonialismo interno ». Revista Meridional (4) : 11-40.
Site internet officiel d’E.sy Kennenga.
https://www.esykennenga.fr
« Truc de Fou – E.sy Kennenga ». Vidéo YouTube. Chaîne de E.sy Kennenga. 23 septembre 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=m6DaDuGshpE
Licence Creative Commons 4.0.
160
« We Are – E.sy Kennenga – EK Trip 2 ». Vidéo YouTube. Chaîne de E.sy
Kennenga. 12 janvier 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=ZvBty6s9CyY
Licence Creative Commons 4.0.
161
40.Ethno-éducation
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Cette notion renvoie à l’articulation des différents savoirs endogènes et à leur valorisation,
systématisation, transmission et partage dans des projets pédagogiques. L’ethno-éducation vise à
valoriser des savoirs afro souvent tus ou dévalorisés en les mettant au cœur de projets éducatifs
différents de ceux du système classique dominant. Généralement mise en place dans les secteurs
ruraux, elle s’appuie sur l’environnement direct et les savoirs pratiques accessibles des apprenant-e-
s. Pour certain-e-s autrices et auteurs comme Edisson Díaz Sánchez (2017 : 13), elle peut être
définie en termes généraux comme une « proposition alternative basée sur une méthode éducative
anti-hégémonique à partir de laquelle l’on fait cours en tenant en compte la réalité de la
communauté ». Dans la même logique, selon les commentaires oraux de Juan García recueillis par
Walsh (2004 : 342), il s’agit de « la construction d’un modèle éducatif qui permet de penser une
ré-encontre avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, et surtout avec ce que nous avons apporté
pour la construction de chaque nation dans laquelle nous nous trouvons (…), un effort des peuples
exclus pour rendre visible et appliquer un projet dans lequel les aspirations et les critères culturels
constituent le fondement ».
L’ethno-éducation appliquée aux communautés afro-descendantes en « Amérique Latine » surgit
dans le cadre des premières décennies de mouvements politiques et sociaux des années 1980. Pour
le cas de la Colombie, Yeison Arcadio Memeses Copete évoque l’effet combiné du mouvement de
l’éducation populaire et l’émergence d’un mouvement pédagogique à caractère ethnique qui posent
le débat autour des contenus de cours, d’apprentissage, d’évaluation et de la différence culturelle.
Avec l’essor de l’État multiculturel de Colombie, se crée un cadre dans lequel les communautés
afro-colombiennes peuvent avoir accès à une éducation liée à leur contexte culturel et être
reconnues pour leur apport à la communauté nationale. En Équateur, l’ethno-éducation prend la
forme de la « maison de dedans », soit un projet de renforcement.
Le caractère décolonial de l’ethno-éducation se situe dans sa déconstruction de la subalternité des
savoirs afro qui a une longue histoire, dans sa critique de la géopolitique du savoir (qui a localisé le
« bon savoir universel dans l’Occident » ou dans les segments européens des Amériques,
et la nature même du savoir), dans son articulation entre culture et pédagogie. Ainsi, Catherine
Walsh (2013 : 43) montre qu’« en établissant l’eurocentrisme comme perspective unique et
universelle de la connaissance (…) la colonialité a écarté la connaissance et la pensée des
Licence Creative Commons 4.0.
162
descendants d’africains affirmant ainsi leur éloignement face au progrès, culture et civilisation. (…)
Et bien sûr, elle a établi et fixé les paramètres des systèmes éducatifs ». Cet engagement ethno-
éducatif vise également à produire de la sociabilisation, le renforcement de l’estime de soi et de la
confiance pour des communautés et individus qui sont encore marqué-e-s par des exclusions.
Ainsi, par exemple, des initiatives telles que l’insertion des afro-descendant- e-s dans des manuels
scolaires relève de ce renversement.
Références
Díaz Sánchez, Edisson. 2017. « La etnoeducación afrocolombiana : entre saberes y prácticas en el
norte del Cauca ». Horizontes Pedagógicos 19 (1).
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/article/view/hop.19102
Meneses Copete, Yeison Arcadio. 2016. « La etnoeducación afrocolombiana : conceptos, trabas,
patriarcado y sexismo. A propósito de los 20 años de la Ley General de Educación 115 de 1994 ».
Revista de la historia de la educación latinoamericana 18 (27) : 35-66.
https://www.redalyc.org/pdf/869/86948470003.pdf
Walsh, Catherine. 2004. « Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-andina : construyendo
etnoeducación e interculturalidad en la universidad ». Dans Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los
estudios de la gente negra en Colombia. Sous la direction de Eduardo Restrepo et Axel Rojas, 331-
346. Popayán : Editorial Universidad del Cauca.
Walsh, Catherine. 2013. « Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial : Entretejiendo caminos
».Dans Pedagogias decoloniales. Practicas insurgentes de (re)sistir, (re)existir, y (re)vivir. Tomo 1.
Sous la direction de Catherine Walsh, 23-68. Quito : Éditions Abya Yala.
Voir à ce sujet:
« HELLEN SERNA: « LA AUTOESTIMA AFRO DEBE AUMENTARSE CON ETNO-
EDUCACIÓN ». ». Vidéo YouTube. Chaîne de Panorama Azultv. 27 septembre 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=sb6S2e-ULOM
Licence Creative Commons 4.0.
163
« 1° ENC. ETNO EDUCACION AFRODESCENDIENTE. ». Vidéo YouTube.
Chaîne de Lumbanga de Arica. 19 novembre 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=RgVrmt871rQ
« La sabiduría afro hecha etnoeducación ». Vidéo YouTube. Chaîne du Conseil Norvégien pour les
Réfugiés. 27 novembre 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=NVij05vyoN0
Licence Creative Commons 4.0.
164
41. Études transatlantiques afrodiasporiques
SEBASTIEN LEFÉVRE ET PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Cette réflexion est née à partir de différentes recherches que nous avons menées sur la diaspora
africaine en « Amérique latine ». En général, la plupart de ces recherches abordent la question afro
du seul point de vue occidental. Du moins, ce sont ces dernières qui ont pignon sur rue. Il
existe bien sûr des recherches effectuées par des sujets afrodiasporiques, mais elles ne bénéficient
pas souvent des canaux de diffusion dont jouit la recherche occidentale. On pourrait même parler
d’une certaine confiscation de la parole des Afrodescendant-e-s. En effet, pour exemple, lors du
congrès national d’anthropologie en Colombie, en 2005, sur cinq cents participant-e-s, il y avait
seulement deux Afrodescendant-e-s, un Afrocolombien et un Africain. En Colombie, pourtant, la
population afro représente, selon les recensements, à peu près 10% de la population totale et, dans
ces 10%, il y a des anthropologues et ethnologues afrocolombien-ne-s, mais ils et elles n’avaient
pas été invité-e-s. Cependant, il y avait des ateliers sur la nourriture et sur les pratiques esthétiques
afrocolombiennes menés par des descendant-e-s d’Occidentaux et d’Occidentales.
Par conséquent, lorsque l’on parle d’études afrodiasporiques, il faut, dans un premier temps,
s’interroger sur qui parle mais surtout depuis quelles positions épistémologiques l’on parle. Ensuite,
il est nécessaire de s’interroger sur les différentes instances convoquées. Et dans ces instances,
l’Afrique n’apparaît pas ou très peu. Un autre exemple révélateur est celui de la présentation d’une
série de dix disques qui compilaient des chants religieux afrocubains. Ils ont été présentés lors des
journées annuelles organisées par la Casa de África à la Havane en 2007. La compilation avait
été à la charge d’une cubaine, descendante d’Européen-ne-s, qui avait été présentée comme une
référence de la recherche afrocubaine. Lors de la présentation, il nous a été expliqué que tel chant
était dédié à telle divinité ou tel autre chant à telle autre divinité, etc. Or, à aucun moment donné on
ne nous a expliqué le contenu de ces chants, car personne ne les comprenait…
Comment est-ce possible? Les chants religieux afrocubains viennent en grande partie de la zone du
Nigéria et du Bénin. N’était-il pas possible de faire un travail de traduction avec des personnes qui
parlent fon ou yoruba? Il est évident qu’il aurait été possible de le faire; à Cuba, les ambassades
africaines sont présentes. Mais, c’est ce possible qui n’est pas envisagé et qui est révélateur d’une
vision occidentalocentrée, qui ne pense même pas à convoquer l’Afrique dans les lectures qu’on
peut faire des processus culturels afro des Caraïbes et de l’« Amérique latine ». Dans la pensée
Licence Creative Commons 4.0.
165
occidentale, les populations africaines ont laissé leurs cultures respectives lors de la traversée de
l’Atlantique et tout ce qui existe sur ces terres ne peut être que métissage ou syncrétisme. Il
convient donc d’élaborer un concept qui puisse inscrire dans son fondement même cette approche.
Ce concept pourrait être celui d’études afrodiasporiques, car il reprend le point de départ et prend en
compte le point d’arrivée. Ce concept s’inscrit en porte-à-faux des concepts historiques, comme «
Amériques noires », qui ôtent leurs trajectoires culturelles et historiques aux populations africaines.
Il est d’ailleurs intéressant de souligner que le « maître » des « Amériques noires » n’a été en
Afrique que sur la fin de sa vie. Il aura fait toute sa carrière sans convoquer ce qui se passe en
Afrique, contrairement à quelqu’un comme Pierre Verger qui se rendait régulièrement au Bénin
pour participer et observer les cultures yoruba originelles afin de les comparer avec celles du «
Nouveau Monde ». Et c’est parce qu’il a été en Afrique qu’il a pu écrire son fameux livre, Orisha,
les dieux Yoruba en Afrique et au Nouveau-Monde. La position de Pierre Verger semble être plus
honnête et véritablement décoloniale, car il réintègre les populations africaines dans les lectures que
l’on peut avoir des cultures afro d’Abya Yala. Pour notre part, nous avons tenté de délimiter ce que
pourrait être de telles études afrodiasporiques. Dans un article intitulé « Propuestas para una «
relectura » trasatlántica afrodiaspórica de las Américas Negras a partir del caso mexicano » nous
évoquions :
(…) la prise en compte méthodologique et théorique de la transversalité des phénomènes, des pratiques sociales
et culturelles issus des sociétés afro-latino-américaines et d’autres, issus des contextes africains, européens parce
qu’ayant été forgés dans le creuset de la Traite, de l’Esclavage et de la Colonisation et de ces conséquences dans
la construction des sociétés contemporaines.
Et remarquions que
La posture transatlantique afrodiasporique n’est pas un dialogue duel afro-centré entre afro-Amérique et
Afrique(s) mais une prise en compte de la triangularité des rapports que la Traite-Esclavage et le colonialisme
ont de fait érigé. Il s’agirait également de faire dialoguer chercheurs et non chercheurs (c’est-à-dire musiciens,
plasticiens, danseurs, conteurs, qui font de la recherche mais d’une autre façon) des différentes rives pour faire
une lecture croisée des phénomènes.
(Mvengou Cruzmerino et Lefèvre, 2016 : 25)
Pour terminer, il faut préciser que cette posture n’apparaît que très peu dans le champ d’études
décoloniales qui, d’une certaine façon, reproduit une forme de colonialité du savoir.
Licence Creative Commons 4.0.
166
Références
Bastide, Roge. 1996. Les Amériques noires : les civilisations africaines dans le Nouveau Monde.
Paris : L’Harmattan.
Lefèvre, Sébastien, et Paul Mvengou Cruz Merino. 2016. « Propuestas para una « relectura »
trasatlántica afrodiaspórica de las Américas Negras a partir del caso mexicano ». Dans Nuestra
América Negra. Huellas, rutas y desplazamientos de la afrodescendencia. Sous la direction de Flor
Márquez, Inés Pérez-Wilke et Eduardo Cobos, 5-44. Caracas : Ediciones de la Universidad
Bolivariana de Venezuela.
Verger, Pierre. 1982. Orisha, les dieux Yorouba en Afrique et au Nouveau- Monde. Paris : Métailié.
Licence Creative Commons 4.0.
167
|42. Exteriorité
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Un concept fondamental dans la construction de la philosophie d’Enrique Dussel, en particulier
lorsqu’il s’agit de penser le dépassement de la modernité et de l’ontologie qui s’y est affirmée. Au
départ, le concept d’extériorité prend sa source dans la théologie de la libération, dans le cadre
d’une réflexion théologique qui se veut latino-américaine. C’est l’idée du ou de la pauvre comme
possibilité de penser un au-delà de la domination.
À la fin des années 1960, la lecture d’Emmanuel Levinas produit chez Enrique Dussel une rupture
avec l’ontologie de Martin Heidegger. Totalité et infini joua un rôle déterminant : c’est la
découverte de l’extériorité métaphysique d’autrui. Jusque-là, l’extériorité était conçue comme celle
de Dieu, comme absolument Autre ou comme extériorité de la personne. Avec Levinas, les
catégories de totalité, d’extériorité, d’intériorité apparaissent dans un lien à la politique.
L’extériorité devient une pratique subversive, politique, l’expression d’un face à face avec
l’opprimé-e. D’un côté, la prise de conscience du ou de la pauvre entraîne la volonté de défaire le
système qui l’opprime; d’un autre côté, l’existence même du ou de la pauvre est le signe de
l’impossible fermeture de tout système de domination, quel qu’il soit. Les philosophes de la
libération, réfléchissant depuis la réalité concrète de l’Amérique latine ont rapidement été attirés par
la pensée levinasienne, en particulier le groupe qui constitue le courant nommé « analectique » de la
philosophie de la libération –principalement Enrique Dussel et Juan Carlos Scannone. Chez ces
derniers, la lecture de l’œuvre de Levinas, Totalité et Infini, a provoqué un subversif renversement
de leurs pensées et de tout ce qu’ils avaient appris jusque là. D’une part, elle les a soudainement
réveillés du rêve ontologique. D’autre part, l’œuvre de Levinas constituait un événement
philosophique qui a ouvert la pensée à une dimension nouvelle : celle de l’autrement qu’être, c’est-
à-dire l’accès vers la transcendance et l’ouverture à l’altérité et à une différence qui brise
l’enfermement de l’être. (Hurtado Lopez, 2013 :184)
La découverte d’une extériorité par rapport à l’être, d’une altérité antérieure au système, sera
centrale dans cette nouvelle étape de Dussel. Pour lui, l’éthique ne répond pas à des problématiques
épistémiques. Ces dernières, au contraire, prennent leur sens à partir de l’éthique. Mais l’Autre
de Levinas était trop abstrait, hors de la politique et même, hors de son corps. Dussel introduit la
notion de « basar », la chair, en hébreu. Il fait de cet autre un sujet charnel, terrestre et situé : le ou
Licence Creative Commons 4.0.
168
la pauvre d’« Amérique latine ». Selon Dussel, « la chair, la chair d’autrui, son visage est la seule
réalité sainte parmi les choses créées, elle a une dignité suprême après Dieu ». Le point de départ de
l’éthique dusselienne est l’exclusion et la domination comme négation de l’extériorité constitutive
et historique de l’autre. Il part d’une réalité empirique de contenu matériel qui est celle de la
corporéité dans une perspective de la vie concrète en général de chaque sujet dans une communauté
déterminée. (Séjour, 2009 : 51)
Cette dimension concrète place l’altérité dans une dimension philosophique nouvelle qui exige de
nouvelles voies. Dussel entreprend alors le développement de la méthode analectique avec
l’intention d’approcher la réalité de l’altérité d’une manière adéquate. Dans les années 1980, la
lecture de Marx modifiera encore cette appréhension de l’extériorité, le point de vue de Enrique
Dussel sur le savant allemand évoluant. Critiquant la notion de classe pour ce qu’elle a de
réducteur, Enrique Dussel reprendra à son compte la notion de peuple, qui est pour lui l’opprimé
comme extériorité. L’idée de peuple se développera avec les apports de Ernesto Laclau et l’idée du
« bloc social des opprimé-e-s».
Références
Hurtado López, Fátima. 2013. « Dialogues philosophiques Europe-Amérique latine : vers un
universalisme ouvert à la diversité. Enrique Dussel et l’éthique de la libération. » Thèse de doctorat
soutenue à l’Université Paris 1 et à l’Université de Grenade.
http://www.sudoc.abes.fr/
Maesschalck, Marc. 2016. « Penser à partir de la communauté des victimes. Enrique Dussel ou
l’intellectuel face à son pouvoir ». Problemata : Revista internacional de filosofia 7 (3) : 29-45.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5774091
Martínez Andrade, Luis. 2019. « Marxisme anticolonial, modernité et politique d’émancipation.
Lire Echeverría et Dussel ».Revue Contretemps. Consulté le 21 novembre 2019.
https://www.contretemps.eu/marxisme-modernite-emancipation-echeverria-dussel/
Séjour, Délèce. 2009. « L’éthique théologique de la libération de Enrique Dussel : une réponse à la
morale dominatrice ». Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention
du grade de M.A. en théologie option « Éthique théologique ». Canada : Université de Montréal.
Licence Creative Commons 4.0.
169
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5201/Sejour_Delece_DS_
%202009_m%C3%A9moire.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Licence Creative Commons 4.0.
170
43. Extractivisme
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
En général, on définit l’extractivisme comme l’exploitation massive des ressources de la nature ou
de la biosphère sans retour vers ces dernières, un processus qui participe donc massivement à la
crise énergétique et au changement climatique. Pour l’Uruguayen Eduardo Gudynas qui a inventé
le néologisme, l’extractivisme représente les activités minières mais aussi l’exploitation pétrolière,
les monocultures d’exportation, la pêche intensive, une exploitation industrielle de la nature liée à la
globalisation économique. Toutes ces formes d’extractivisme sont présentes en « Amérique latine »,
la plus développée restant l’activité minière, avec exploitation à ciel ouvert, que l’on trouve
absolument dans tous les pays. Mais l’agriculture intensive, soja, maïs, palmier à huile, s’est
énormément développée en Argentine, au Brésil, en Bolivie, en Colombie et en Amérique centrale.
L’élevage bovin intensif dont on connaît les conséquences dramatiques pour l’érosion des sols est
également important, et il faut ajouter à cela les fronts pétroliers toujours en expansion au Mexique,
Vénézuela, Colombie et Brésil, ou celui du gaz en Équateur et en Bolivie, ou encore l’intense
activité liée à la construction de méga barrages pour produire de l’électricité et rendre navigables
d’énormes tronçons de fleuves (4500km de fleuves interconnectés au centre du
continent).
Tous ces fronts avancent, et il ne s’agit pas d’initiatives isolées; il convient de les voir comme des
moments d’un projet. Fait particulièrement remarquable, tous les gouvernements, depuis bientôt
deux décennies, encouragent l’extractivisme et, plus encore, ne voient de solution que dans
ce type d’économie. Gouvernements conservateurs, gouvernements progressistes, pour tous, le
slogan est le même : extractivisme = développement.
Raúl Zibechi (2019), journaliste uruguayen, dans un article très pointu sur l’Amazonie, déconstruit
la généalogie de l’extractivisme en « Amérique Latine ». Il montre qu’il s’agit d’un projet qui
remonte à loin, aux temps de la dictature brésilienne des années 1970 et à l’idée qui avait déjà
germé alors de promouvoir une « Amérique du Sud intégrée », dans laquelle le Brésil jouerait
un rôle déterminant. En fait, c’est un projet de type impérialiste, à l’échelle du continent. Pour
Zibecchi, au-delà du caractère apparemment dispersé des divers projets et réalisations extractivistes
existant sur le contient, il importe d’identifier une logique globale qui s’appuie sur des institutions
et des organismes dont la plus importante est l’IIRSA, une logique qui sert les
Licence Creative Commons 4.0.
171
intérêts des multinationales et des États du Premier Monde et du Brésil. C’est dans les années 2000
que le président brésilien de l’époque, Cardoso, posa les bases du projet d’Intégration Régionale
Sud-américaine (IIRSA) et définit l’objectif « de travailler ensemble », en dirigeant sans imposer,
pour « résoudre nos problèmes internes, qui sont nombreux ». Il ne faisait que reprendre ce qui avait
été déjà proposé dans les années 1990, au moment ou le virage néolibéral s’affirmait dans le monde.
Mais il se trouve qu’à ce moment-là, en « Amérique latine », un décalage s’était produit
avec l’histoire sociale en Europe ou aux États-Unis, dans la mesure où de puissants mouvement
sociaux indiens et afrodescendants s’étaient affirmés, obligeant les gouvernements à prendre en
compte les revendications populaires. Cela expliquait donc un certain retard dans la mise en place
de ces mesures extractivistes, mais le discours de Cardoso, homme de droite, serait repris grosso
modo par le président « progressiste », Lula. L’extractivisme est un phénomène qui rend compte de
l’intensification de la colonialité du pouvoir. En effet, si dans les années 1960, les pays latino-
américains avaient cherché à sortir de la dépendance et à créer des économies nationales,
aujourd’hui, ils ont renoncé à ce projet. Leur rôle historique d’exportateurs de matières premières,
qui avait commencé dès la Conquête, s’est en fait renforcé. Comme l’écrit Alberto Acosta (2014) :
L’extractivisme a été une constante de la vie économique, sociale et politique de nombreux pays du
Sud. Ainsi, avec plus ou moins d’intensité, tous les pays d’Amérique latine subissent cette pratique.
Cette dépendance à l’égard des métropoles, par l’extraction et l’exportation de matières premières,
est restée pratiquement inchangée jusqu’à aujourd’hui. Par conséquent, au-delà de certaines
différenciations plus ou moins importantes, la modalité d’accumulation extractiviste semble être au
cœur de la proposition productive des gouvernements tant néolibéraux que progressistes.
Si le prix à payer est minoré ou invisibilisé, il est pourtant considérable : désastres écologiques,
nouvelles formes de dépendance économique et répression violentes, souvent létales, des
populations qui n’acceptent pas d’être spoliées. Autre signe de la colonialité à l’œuvre : les
personnes concernées étant souvent indiennes ou noires, la progressive disparition à laquelle elles
sont condamnées n’émeut pas les gouvernements ni beaucoup de leurs compatriotes, ce en quoi
nous reconnaissons ce racisme fondateur mentionné plus haut.
Le travail qui est mis en jeu dans les projets extractivistes, par exemple la construction de grands
barrages comme celui de Jirau au Brésil, rappelle celui qui a caractérisé les pires phases de
l’exploitation en « Amérique latine ». On observe-là la réalité d’un lien indissoluble : l’exploitation
de la nature à grande échelle suppose celle des humains à grande échelle. Quand l’exploitation met
la nature en danger, elle n’épargne pas plus les humains : les mines coloniales du Potosí, les
plantations des Antilles, les champs d’hévéas de l’époque du caoutchouc, les mines du Chili ont été
Licence Creative Commons 4.0.
172
des lieux où régnait la violence et la terreur : le travailleur ou la travailleuse, libre ou esclave, y était
volé-e, surexploité-e, souvent violenté-e, torturé-e, emprisonné-e, parfois tué-e. Aujourd’hui, à
Jirau, la journée de travail dure douze heures; il y a des prisons privées pour les travailleurs et
travailleuses récalcitrant-es; des gatos « aident » les travailleurs et travailleuses à se rendre sur les
lieux d’extraction contre rétribution, les obligeant à s’endetter; sur place, l’approvisionnement est
tellement onéreux que les ouvriers et ouvrières finissent pas perdre de l’argent comme aux pires
temps de l’enganche au Brésil ou dans le trapèze du Putumayo. Ce lien indissoluble, d’exploitation
de l’humain, de la nature et du genre (voir l’augmentation de la prostitution et des abus sexuels liée
à l’extension de ces grands chantiers qui transforment parfois un village de 1000 habitant-e-s en une
ville de 10 000 personnes) est une constante.
Enfin, ces projets extractivistes sont une catastrophe d’un point de vue environnemental : les
industries minières, parce qu’elles exigent d’aller toujours plus loin dans les sols, obligent à remuer
profondément les diverses couches de roches, entraînant ainsi des émanations souvent très toxiques;
certaines formes d’extraction nécessitent l’emploi de produits chimiques très toxiques, le cyanure
ou le mercure par exemple, qui empoisonnent les eaux, les rendent impropres à la consommation et
tuent la faune et la flore. L’agriculture et l’élevage intensifs épuisent les sols et ils requièrent des
pesticides et des engrais qui provoquent des empoisonnements ou de graves maladies pulmonaires.
Plus globalement, l’échelle gigantesque des projets suppose un bouleversement des écosystèmes qui
aboutit toujours à leur appauvrissement et souvent à des catastrophes, par exemple avec la
destruction des zones humides qui régulent le débit des grands fleuves.
L’extractivisme passe toujours par le sacrifice de certaines populations. Pour toutes les raisons
évoquées, les habitant-e-s des zones concernées font doivent faire un choix : céder leurs territoires
ou les abandonner. Soit qu’on leur prennent de force, soit que les effets des travaux qui se
produisent à proximité entraînent des pollutions ou des dommages tels que rester reviendrait à
mourir. Pour éviter ces extrémités, ces peuples se sont engagés dans des luttes acharnées, qu’on
désigne souvent sous le terme de luttes socio-environnementales et pour lesquelles ils paient le prix
fort. En octobre 2019, 97 leaders indigènes en lutte pour leur communauté avaient été assassinés
pour la seule Colombie depuis le mois de janvier. L’extractivisme, depuis la colonisation, nous
renvoie aux génocides ou aux ethnocides.
Références
Licence Creative Commons 4.0.
173
Acosta, Alberto. 2014 [2011]. « Extractivisme et néoextractivisme : les deux faces d’une même
malédiction ». Traduction et publication autorisée par l’auteur sur le portail en ligne DIAL. [«
Extractivismo y neoextractivismo : dos caras de la misma maldición ». Dans Más allá del
desarrollo. Sous la direction de Miriam Lang et Dunia Mokrani Chávez, 83-118 (83-88, 95-104,
113-118). Quito : Abya Yala / Fundación Rosa Luxemburg.]
http://www.alterinfos.org/spip.php?article6236
Gaudichaud, Franck. 2016. « Ressources minières, « extractivisme » et développement en Amérique
latine : perspectives critiques ». IdeAs (8).
http://journals.openedition.org/ideas/1684*
Zibecchi, Raúl. 2015 [2012]. « BRÉSIL – La nouvelle conquête de l’Amazonie. 1, La rébellion de
Jirau ». Traduction et publication autorisées par l’auteur
disponible sur le portail en ligne DIAL. [Brasil potencia : entre la integración
regional y un nuevo imperialismo. Bogotá : Ediciones Desde Abajo.]
http://www.alterinfos.org/spip.php?article6216
Zibecchi, Raúl. 2019. « La nouvelle Conquête de l’Amazonie ». Dans Le piège de l’abondance.
Sous la direction de Nicolas Pinet, 123-163. Paris : Les Éditions de l’Atelier.
Zubizarreta, Miguel. 2018. « La question extractiviste en Amérique latine ». Travail présenté dans le
cadre du cours Penser l’Amérique latine contemporaine. France : Institut d’études politiques de
Paris.
https://www.academia.edu/39098441/La_Question_Extractiviste_en_Amerique_Latine
Licence Creative Commons 4.0.
174
|44. Fanon, Frantz
SEBASTIEN LEFÉVRE
Il serait prétentieux de notre part de penser, dans le cadre de cet ouvrage, aborder la pensée de
Fanon dans son ensemble. Ses œuvres sont peu nombreuses mais très denses en termes de réflexion
et d’analyse. Par ailleurs, la littérature sur ses œuvres est tellement nombreuse qu’il est délicat de
s’y atteler… Toutefois, nous allons essayer de pointer quelques éléments qui nous semblent
intéressants en termes de propositions de lectures décoloniales, qui peuvent être formulées à partir
de ses écrits.
Tout d’abord, il faut préciser que, durant longtemps, Fanon a été repris et travaillé par le courant des
études postcoloniales aux États-Unis. Ce n’est que ces dernières années que le courant d’études
décoloniales a repris ses travaux, notamment Ramón Grosfoguel avec « la zone de non-être ».
Ensuite, la plupart des travaux se concentrent davantage sur son ouvrage Les damnés de la terre. Or,
il nous semble que l’ouvrage fondamental reste Peau noire, masques blancs car, dans ce livre,
Fanon pointe et analyse cette fameuse colonialité de l’être qui a pour toile de fond celle du pouvoir
et du savoir.
Limitons-nous à prendre des exemples tirés de l’introduction et de la conclusion de son ouvrage
pour présenter ses visées programmatiques, car il s’agit bien d’un programme d’action. En effet, il
précise d’entrée que son ouvrage s’inscrit dans un nouvel humanisme et qu’il prétend libérer l’être
humain de couleur de lui-même. On peut dire, pour schématiser, que les analyses de Fanon partent
du constat de colonialité pour tendre vers un programme décolonial.
En outre, Fanon souligne différentes formes de colonialité comme la « zone de non-être », mais
également la réduction de l’homme noir à un Noir et l’enfermement que cela suppose. Il observe
également qu’aussi bien le Noir que le Blanc sont enfermés dans un rapport pathologique où « celui
qui adore les nègres est aussi « malade » que celui qui les exècre. Inversement, le ou Noir qui veut
blanchir sa race est aussi malheureux que celui ou celle qui prêche la haine du Blanc. » (Fanon,
1952 ) Selon lui, le Noir a intégré son infériorité par une épidermisation de cette dernière. Cette
aliénation est aussi passée par une auto-anormalisation du Noir due, sans doute, au fait que le Blanc
est mystificateur et mystifié. Même si le Noir reste enfermé dans son passé d’esclavagisé, le Blanc
n’est pas en reste puisqu’il a connu, en tant qu’acteur du processus de déshumanisation, une
certaine forme d’inhumanité. Par ailleurs, dans ses analyses, Fanon différencie diverses formes
d’aliénation selon que les sujets sont des Antilles ou d’Afrique. En effet, pour le ou la Noir-e
Licence Creative Commons 4.0.
175
antillais-e, l’aliénation se situe plutôt au niveau culturel (assimilation à la française) alors que pour
l’Africain-e, l’aliénation se situe sur le plan de la supériorité raciale (civilisation vs barbarie) et
économique.
En ce qui concerne ce que l’on pourrait nommer son programme décolonial, il précise, comme nous
l’écrivions plus haut, qu’il s’agit pour lui de libérer l’être humain de couleur. D’après Fanon la
désaliénation doit passer par une prise de conscience des réalités économiques et sociales. Il refuse,
en outre, de se laisser enfermer dans un passé, revendiquant son statut d’humain avant tout et non
pas de Noir. Or, il n’est pas hostile à la revendication d’un certain passé à condition qu’il s’agisse de
ne plus reproduire aucun type d’asservissement de l’humain par l’humain. Il revendique donc une
vision universelle de l’humanité où toutes les cultures se valent, mais surtout où l’on ne réduit pas
les personnes à leur couleur et aux contingences historiques du passé. Il refuse également de
culpabiliser les ancien-ne-s maîtres et maîtresses pour leurs actions de déshumanisation passées. Et,
de la même façon, il est contre le fait de chercher la reconnaissance du Blanc et de la Blanche.
Fanon se situe en fait dans un mouvement d’identité en relation :
Pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l’autre, de sentir l’autre, de me révéler l’autre? Ma liberté ne
m’est-elle donc pas donnée pour édifier le monde du Toi? À la fin de cet ouvrage, nous aimerions que l’on sente
comme nous la dimension ouverte de toute conscience (Fanon, 1952)
Le constat qu’il formule est limpide et malheureusement encore d’actualité… Il y a, dans les
analyses de Fanon, deux points qu’il faudrait soumettre au débat. Le premier concerne celui de la
réparation. Il ne revendique aucune réparation par rapport aux conséquences des colonialités subies
par les sujets afrodescendant-e-s et africain-e-s. Ce point fait débat au sein même des mouvements
afrodescendants. Certain-e-s y sont favorables, d’autres non. Les questions que nous pouvons
formuler sont les suivantes : pourquoi les maîtres et maîtresses, à la suite des abolitions, ont-ils été
dédommagé-e-s? Pourquoi les terres, notamment pour le cas des Antilles, sont-elles encore aux
mains des descendant-e-s des ancien-ne-s maîtres et maîtresses? Pourquoi Haïti continue-t-il de
payer une dette qui date de son indépendance? Ne faut-il pas réparer pour pouvoir avancer
sereinement?
Toutes ces questions ne trouveront pas de réponse dans cet ouvrage, mais il va de soi que nous nous
situons dans une perspective de questionnements à partir de postulats critiques qui tentent de
prendre en compte les persistances coloniales des situations des Afrodescendant-e-s et des Africain-
e-s.
Licence Creative Commons 4.0.
176
Le deuxième point touche l’idée selon laquelle, d’après Fanon, il ne servirait pas à grand-chose
(même s’il s’en féliciterait), pour la situation des Afrodescendant-e-s des Antilles, de retrouver des
traces passées de productions culturelles « nègres » d’avant Jésus Christ ou de l’époque des
philosophes grecques :
Que surtout l’on nous comprenne. Nous sommes convaincu qu’il y aurait un grand intérêt à entrer en contact
avec une littérature ou une architecture nègres du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous
serions très heureux de savoir qu’il exista une correspondance entre tel philosophe nègre et Platon. Mais nous ne
voyons absolument pas ce que ce fait pourrait changer dans la situation des petits gamins de huit ans qui
travaillent dans les champs de canne en Martinique ou en Guadeloupe. (Fanon, 1952).
Ce dernier point nous semble, en fait, symptomatique de son époque, car la situation des enfants
antillais-es (et africain-e-s également) a changé. En effet, depuis les années 1960, la plupart de ces
enfants ont subi la « la bibliothèque coloniale » (Mudimbe, 1988). Prenons la chanson d’E.sy
Kennenga où il mentionne le « blanchiment de l’histoire » et l’invisibilisation des histoires des
Afrodescendant-e-s où les enfants ne se retrouvent pas et se posent des questions légitimes quant à
leur passé. Nous pourrions prendre également l’exemple des universités africaines où l’on enseigne,
dans leur grande majorité, tout type de savoir sauf les savoirs endogènes.
N’est-il pas nécessaire, par conséquent, de passer d’abord par une récupération culturelle de sa
propre culture (ou leurs propres cultures pour les Africain-e-s), quitte à transiter par une période
essentialisante (Stuart Hall, 2007), pour pouvoir rentrer en relation avec l’Autre? Et ainsi éviter de
passer par une oblitération du passé qui conduirait inexorablement à une détérioration culturelle
psychologique néfaste ?
Références
Fanon, Frantz. 1952. Peau noire, masques blancs. Paris : Le Seuil :208-50.
Grosfoguel, Ramón. 2012. « Un dialogue décolonial sur les savoirs critiques entre Frantz Fanon et
Boaventura de Sousa Santos ». Mouvements. LaDécouverte 4 (72) : 42-53.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-4-page-42.htm
Hall, Stuart. 2007. Identités et cultures : Politiques des cultural studies. Paris : Amsterdam.
Licence Creative Commons 4.0.
177
Mudimbe, Valentin Y.1988. The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of
Knowledge. London : James Currey.
Licence Creative Commons 4.0.
178
45. Féminisme décolonial
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Quand commence le féminisme décolonial? À quel moment les femmes s’emparent-elles de
l’adjectif?
Ou encore :
Quand leurs pratiques rendent-elles manifeste une lutte contre la colonialité? Y a t-il déjà dans le
concept de colonialité du pouvoir quelque chose qui le lie à la critique de la domination masculine
ou a-t-il fallu l’intervention des féministes pour que cette imbrication du genre dans la colonialité
apparaisse? Doit-on penser, comme Francesca Gargallo, que le féminisme décolonial est une
invention au profit de deux femmes qui ont fait du « décolonial » une chasse gardée? Ou, comme
Brenny Mendoza, qu’il n’y a pas de féminisme décolonial? Ou au contraire, avec Márgara Millán,
estimer qu’il y a, en « Amérique latine », un féminisme décolonial?
Le féminisme décolonial a cette particularité qu’il fait apparaître les limites de l’approche féministe
mainstream, mais aussi la quasi-absence de critique du patriarcat dans la problématisation de la
colonialité du pouvoir par les tenant-e-s du projet Modernité/Colonialité. Le féminisme décolonial
n’est pas celui de la classe moyenne blanche de la région. Bien sur, il ne saurait y avoir une
généalogie « objective » du féminisme décolonial puisqu’en fonction du point d’ancrage, les
histoires ne sont pas les mêmes.
Le féminisme latino-américain existe depuis longtemps et un de ses pans, comme ce fut le cas en
Europe dans les années 1970, a été lié à la critique révolutionnaire et à la volonté de sortir du
capitalisme. Il est passé par des ruptures significatives, en particulier lorsque son
institutionnalisation et son ONGéisation a produit des scissions profondes dans le mouvement
féministe, mais aussi lorsqu’a émergé un féminisme autonome. D’autre part, la nécessité de
prendre position avec l’émergence du féminisme indigène a également contribué à l’apparition de
ces tensions.
Au début des années 1990, le courant féministe qui se proclame autonome apparaît dans un moment
charnière de l’histoire d’Abya Yala et de l’histoire globale. Car il y a un lien entre l’anniversaire de
la « Découverte », le surgissement du zapatisme, la montée des revendications indiennes et
afrodescendantes sur tout le continent, et, d’un autre côté, l’institutionnalisation du féminisme avec
son insertion dans des politiques étatiques et l’emprise des ONG. Le tournant « étatiste » pris par le
féminisme avait produit un malaise au sein des organisations féministes abyayalenses. Il se
Licence Creative Commons 4.0.
179
manifesta clairement en 1993, lors de la sixième rencontre féministe continentale, au Salvador. Il
prit la forme d’une opposition à une vision « réaliste » de la lutte féministe, dans laquelle
l’idée d’une transformation radicale de la société s’était effacée. La sensibilité de femmes qui
avaient fait partie d’organisations de lutte armée ou qui étaient sur des positions anarchistes joua un
rôle important dans la gestation de ce féminisme autonome. Il articulait une critique de
l’impérialisme et des formes nouvelles de colonialité, même si le terme n’apparut pas comme tel à
l’époque. Il est intéressant de relever que le mot venait d’émerger, un an plus tôt, dans un article de
Aníbal Quijano. La critique du développement durable, des ONG et du système humanitaire que
développeraient ces groupes rejoignait la critique du développement que l’on trouvait déjà chez
certain-e-s tenant-e-s de la théorie décoloniale, comme Arturo Escobar. Pour les féministes
autonomes, il fallait articuler les luttes aux mouvements existant, pas aux centres de pouvoir
nationaux ou internationaux, ce que faisaient les féministes mainstream. Une autre question
importante serait posée, celle de l’autonomie, qui finirait par s’affirmer après divers aléas. Dans le
même temps s’affirmerait l’articulation race-sexe-classe et la montée en puissance des militantes
antiracistes et des mouvements lesbiens, avec leurs agendas politiques précis, basés sur
l’indépendance vis-à-vis des partis, l’importance du choix des espaces et des formes de réunion, et
la critique de l’argent. Les rencontres de 2007 prônaient un féminisme qui ne devait pas se limiter à
une politique de la sexualité; dans celles de 2009, la volonté d’autonomie, en liaison avec des
mouvements sociaux comme le zapatisme, se structurait autour d’une critique de la recolonisation
du continent dans le cadre des politiques néolibérales.
Le Glefas, à partir de 2008, donnerait au mouvement autonome son originalité, avec des
personnalités emblématiques comme Yuderkys Espinosa et Ochy Curiel, deux militantes engagées
dans l’antiracisme et les luttes pour l’autonomie. Elles insistaient sur l’importance de la formation,
la nécessité de penser la praxis féministe à partir d’une position non hégémonique et affirmaient que
les premières expériences décolonisatrices étaient celles des femmes racialisées et des lesbiennes du
tiers-monde. Pour Yuderkys Espinosa, le féminisme décolonial est un moment contemporain
de l’histoire du féminisme dont la particularité est le lien profond qui le lie aux subalternes : les
personnes qui s’y expriment ne se revendiquent pas nécessairement comme féministes mais sont
impliquées dans des luttes pour l’autonomie et la communalité, un retour du refoulé historique en
quelque sorte. Yuderkys Espinosa souligne la différence entre ce féminisme et le féminisme
mainstream, qui regarde vers le futur comme si l’histoire des femmes n’avait été qu’une succession
de dominations. Au contraire, le courant latino-américain, à travers les nombreuses recherches qui
ont été faites et grâce aux féministes indigènes, fait découvrir un passé-présent que les femmes
Licence Creative Commons 4.0.
180
peuvent réutiliser pour leur combat. Et il rejoint les recherches de féministes européennes comme
Sylvia Federici, laquelle, dans Caliban et la sorcière, a démontré le caractère historique et daté du
patriarcat.
C’est là un féminisme autonome.
Dans la naissance du féminisme décolonial, le Black feminism américain et le féminisme de couleur
jouent un rôle très important. Leur particularité est de partir d’abord de luttes puis de les théoriser.
Les féministes noires ont été parmi les premières à remarquer qu’on ne pouvait se contenter
d’une approche fondée sur le genre. Dans le cadre du mouvement autonome, l’influence de ce
courant est manifeste chez Ochy Curiel ou Yuderkys Espinosa.
Quant au féminisme indigène, il est à la fois une composante du féminisme décolonial et un intérêt
commun à plusieurs de ses courants qui s’en inspirent. Ce féminisme indigène existe avant tout
comme pratique, et il renvoie à la longue tradition de luttes des femmes indiennes qui se battirent
avec acharnement lors des innombrables conflits de la période coloniale. Donc, il ne se revendique
pas nécessairement comme tel, parfois seulement. Aura Cumes, Maya guatémaltèque, ou Vilma
Almendra, Embera colombienne, sont des féministes indigènes qui portent un regard à la fois très
critique et plus pragmatique. Elles ne partent pas des mêmes présupposés que les féministes
occidentales, ce qui est d’ailleurs leur point commun avec les féministes autonomes ou
communautaires.
Dans une interview, l’anthropologue Mercedes Olivera écrit à propos de la pratique des femmes
indigènes :
|
On peut commencer à travailler pour les droits sexuels, les droits reproductifs, l’avortement, le droit au choix
sexuel, mais nous, nous faisons un travail totalement inverse : nous partons de la violence systémique, de la
violence économique et nous nous rapprochons petit à petit de l’individualité. […] Théoriquement, on ne sait pas
très bien ce qu’est le féminisme autochtone. La discussion sur ce que j’appelle « l’individuation » est très
intéressante. Notre féminisme occidental positiviste part de l’individu, d’un individu excluant, qui,
historiquement, a exclu les femmes. Dans l’approche des camarades indigènes, il s’agit de droits collectifs. Nous
avons discuté avec Celia Amorós, laquelle soutient que les collectifs sont contraires à l’autodétermination
féministe. Il ne s’agit pas d’annuler l’individu, mais de reconnaître que le collectif est composé de personnes
différentes. L’individuation implique cette reconnaissance collective de l’existence de l’individu. On ne peut pas
faire de collectifs s’il n’y a pas cette reconnaissance et ce respect de l’autodétermination. Il s’agit aussi d’arriver
à l’autodétermination, mais qu’elle soit générée le dans le collectif. (Olivera, 2013 )
Licence Creative Commons 4.0.
181
Il y a, chez ces féministes indigènes, une critique lucide du rôle des ONG mais elles n’oublient pas
non plus que leur arrivée a permis à beaucoup de femmes indiennes d’avoir accès à des métiers
autres que ceux de servantes.
Pour moi, le féminisme qui vient d’atteindre nos territoires est le féminisme de l’égalité, le féminisme qui ne
lutte que contre l’idée d’être des femmes. C’est sans doute très bien pour celles qui ont cette expérience, mais
nous, femmes autochtones et noires, nous ne pourrons pas résoudre nos problèmes sur la seule base du
féminisme. (Cumes, 2017)
Aura Cumes fait une critique pertinente de l’idée de culture, critique qui n’a malheureusement pas
encore assez de résonance dans le mouvement :
Les peuples autochtones apparaissent comme les gardiens de la culture, mais jamais comme des sujets politiques.
Ensuite, il y a une « muséification » des indigènes qui nie notre statut de sujets
politiques. La gauche voit la domination comme de l’exploitation, et dans une large mesure, c’est le cas. Pour
nous, le colonialisme n’est pas un système d’exploitation, mais un mode de domination,
d’oppression, qui ne repose pas seulement sur l’économie. S’il n’avait été question que de cela, tant de gens ne
seraient pas morts pour défendre le christianisme. (ibid.)
Cette idée de muséification s’accompagne d’une vision qui tranche avec celle du courant décolonial
: pour elle, la colonisation n’est pas terminée.
La colonialité peut bien rendre compte de la réalité vécue par les peuples métis ou blancs, mais pas
de celle propre aux Indien-ne-s. Il est intéressant de noter cette approche recoupe celel d’historiens
d’anthropologues comme Rita Segato ou l’Argentin Mario Rufer qui parle ou de «conquistalidad »
du pouvoir en « Amérique Latine » ou de Rita Segato.
Existe également un féminisme communautaire qui correspond à la perspective de Julieta Paredes,
Bolivienne aymara. C’est une autre tendance importante au sein du féminisme décolonial. Paredes,
qui emploie le concept de patriarcat car il renvoie aussi bien au racisme qu’au capitalisme et à
l’hétérosexualité, soutient que le féminisme communautaire est une solution viable pour le monde
entier et elle entrevoit les alliances avec des femmes non féministes et des hommes. Son but est de
construire la Communauté des Communautés – un point de vue qui est cependant loin de faire
l’unanimité dans le monde indien. Pour Francesca Gargallo, Julieta Paredes a séquestré
le mouvement aymara, car elle est devenue une féministe étatique au service d’Evo Morales. Elle
empêcherait les femmes aymara qui n’ont pas la même opinion ni les mêmes projets qu’elle de
s’exprimer.
Licence Creative Commons 4.0.
182
Le féminisme communautaire existe en zone andine, mais aussi chez les Nasa de Colombie et chez
les Zapotèques mexicain-e-s, ou en Amazonie, ou au Guatemala. Dans ce pays à forte population
autochtone, Lorena Cabnal a été expulsée de sa communauté parce qu’elle avait dénoncé la
violence sexiste et les féminicides. Pour Francesca Gargallo, le mouvement zapatiste, dans lequel
les femmes ont pris une place déterminante, et le mouvement colombien Quintín Lame de la fin des
années soixante–dix ont été des moments fondateurs pour le féminisme décolonial.
Les problèmes soulevés par l’emploi de la catégorie de genre sont très représentatifs de la
spécificité et du pouvoir critique du féminisme décolonial. L’idée de genre fut d’abord adoptée avec
enthousiasme par le mouvement féministe. Mais elle fut rapidement critiquée car elle était
utilisée dans le cadre de politiques néolibérales qui réduisaient la question du genre à celle de
l’équité. À cet égard, Julieta Paredes ne se contente pas d’analyser la réduction opérée par l’«
oenegisation » du genre dans le contexte néolibéral. Elle pointe la position de classe et de race des
femmes qui s’investissent dans ce type de féminisme. L’idée d’équité de genre est aussi absurde que
celle d’équité de classe; ce qu’il faut c’est un dépassement concret de la réalité du genre.
Ce qui frappe dans le mouvement féministe d’Abya Yala, c’est son extrême richesse et son
imbrication à des stades divers dans la question de l’autonomie et de la communalité. D’où une
puissance critique exceptionnelle.
Références
Cumes, Aura. 2017. « La cosmovision maya et le patriarcat : une interprétation critique ».
Recherches féministes 30 (1) : 47-59.
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2017-v30-n1-rf03181/1040974ar/
Cumes, Aura. 2017. « Tenemos que sacarnos las telaranas ». Glefas. (Traduction dans le numéro 6
de la Revue d’Etudes Décoloniales).
Curiel, Ochy. 2018. « Entretien avec Jules Falquet et Lissel Quiroz Perez ». Revue d’études
décoloniales (3).
http://reseaudecolonial.org/2018/10/16/interview-dochy-curiel/
Licence Creative Commons 4.0.
183
Espinosa, Yuderkys. 2019. « Une « histoire du féminisme latino-américain depuis une position
subalterne ». Entretien avec Y. Espinosa-Miñoso ». Contretemps.
https://www.contretemps.eu/entretien-espinosa-minoso-feminisme-decolonial/
Falquet, Jules. 1998. « Le débat du féminisme latino-américain et des Caraïbes à propos des ONGs
». Cahiers du GEDISST (21) : 131-147.
www.persee.fr/doc/genre_1165-3558_1998_num_21_1_1046
Falquet, Jules. 2011. « Les « féministes autonomes » latino-américaines et caribéennes : vingt ans
de critique de la coopération au développement ». Recherches féministes 24 (2) : 39-58.
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2011-v24-n2-rf5005937/1007751ar/
Falquet, Jules. 2017. « Les racines féministes et lesbiennes autonomes de la proposition décoloniale
d’Abya Yala (Première partie) ». Contretemps.
http://www.contretemps.eu/racines-feministes-lesbiennes-autonomes-dabya-yala/
Gargallo Celentani, Francesca. 2014. Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las
mujeres de 607 pueblos en nuestra América. México : Editorial digital Corte y Confección.
https://francescagargallo.files.wordpress.com/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-abya-
yala-ene20141.pdf
Guzmán, Adriana, América Maceda, Julieta Paredes & PDTG. 2013. «AMÉRIQUE LATINE –
Féminisme communautaire : la nature n’est pas un sein intarissable ». DIAL.
http://www.alterinfos.org/spip.php?article6221
Martínez Andrade, Luis. 2019. « Une approche des féminismes du Sud global». Revue d’études
décoloniales (4). Version française de « Un acercamiento a los feminismos del Sur Global ». Dans
Feminismos a la contra. Entrevistas al Sur Global. Sous la direction de Luis Martínez Andrade, 29-
68. Santander : La vorágine.
http://reseaudecolonial.org/2019/11/13/une-approche-des-feminismes-du-sud-global/
https://www.academia.edu/40464954/Feminismos_a_la_contra._Entre-vistas_al_Sur_Global
Licence Creative Commons 4.0.
184
Millán, Márgara. 2019. « En Amérique latine, Il y avait un féminisme décolonial avant le boom du
courant décolonial ». Revue d’études décoloniales (4). Version française de « En América latina,
había un feminismo descolonial anterior al boom de la corriente descolonial ». Dans
Feminismos a la contra. Entre-vistas al Sur Global. Sous la direction de Luis
Martínez Andrade, 199-213. Santander : La vorágine.
https://www.academia.edu/40464954/Feminismos_a_la_contra._Entre-vistas_al_Sur_Global
https://reseaudecolonial.org/2019/11/04/en-amerique-latine-peut-on-parler-de-lexistance-dun-
feminisme-decolonial-anterieur-au-boom-du-courant-decolonial/
Olivera, Mercedes. 2013. « Mercedes Olivera y la construcción del feminismo indígena ». Entretien
avec Itandehui Reyes Diaz pour Cimacnoticias.
https://cimacnoticias.com.mx/noticia/mercedes-olivera-y-la-construccion-del-feminismo-indigena/
Licence Creative Commons 4.0.
185
46. Féminicide
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Le féminicide n’est pas une simple question de rapports hommes-femmes, nous dit Rita Segato
(2018b). Il est l’expression d’une stratégie de mort des États modernes. En « Amérique latine », il
s’enracine dans ce que Maria Lugones a été l’une des premières à analyser, soit le processus pervers
par lequel les hommes colonisés, dominés par les Conquérants, ont accepté le contrat de dupes
qu’on leur proposait. Certes, ils étaient contraints de travailler pour les Blancs et les Blanches, mais
ils pouvaient reproduire avec leurs femmes les rapports d’exploitation et de hiérarchie qu’ils
subissaient. Une forme de collaboration que l’on peut mettre en parallèle avec le rôle des anciennes
élites andines, les curacas, qui devinrent, après la Conquête, le vecteur de la domination des
peuples indiens par les Espagnol-e-s. C’est ainsi que s’est mise en place une instrumentalisation des
femmes par les hommes colonisés et, dans ce contexte, une vision dégradante de ces dernières a pu
se développer. Elles ont été réduites à des sous-êtres, sont devenues inférieures aux inférieurs, en
dessous de ceux qui étaient déjà en dessous de la « ligne de l’être » (Santos, 2007). Cette généalogie
qui établit l’existence d’une sorte de transfert de pouvoir permet de comprendre celui de tuer dans
une perspective décoloniale.
L’idée d’une stratégie de mort est reprise par des nombreuses féministes décoloniales. L’Italo-
mexicaine Francesca Gargallo a été parmi les premières à dénoncer les féminicides de Ciudad
Juarez à la fin des années 1990, lorsqu’elle travaillait avec les mères de Ciudad Juarez, et
collaborait avec des associations indiennes. Pionnière, elle a dénoncé le rôle de l’État, établissant
une responsabilité qui tient à sa permissivité. Elle constate que le phénomène du féminicide est le
signe d’un délitement global de la société.
Pour Rita Segato, la culture de la violence machiste, dont le féminicide est une des manifestations, a
pu s’établir grâce à une modification du seuil de tolérance des populations. Ce qu’elle appelle la «
pédagogie de la cruauté » programme les personnes pour que ce seuil évolue. C’est une pédagogie
de« chosification » : « il s’agit de faire de la vie et des corps des choses : la chose-corps la chose-
nature (…) » (Segato 2018b). Elle renvoie le féminicide à la relation particulière qui s’établit entre
ce système d’objets et les dueños,littéralement les propriétaires ou les maîtres. Les Méxicain.e.s, par
exemple,vivraient une époque de dueñidad, due à l’accélération de la concentration de la richesse et
à la fusion des fonctions entrepreneuriales et politiques dans le système de représentation mexicain.
Licence Creative Commons 4.0.
186
Les « seigneuries » s’étendent de plus en plus dans une monde re-féodalisé et l’espace public, lui,
rétrécit de plus en plus.
La transféministe mexicaine Sayak Valencia, dans son livre Capitalisme gore, parle de « necro-
empoderamiento ». Elle fait allusion au croisement entre des logiques d’enrichissement rapide, de
socialisation violente de certaines populations masculines et des logiques néolibérales, dans les
zones frontalières comme celle de Tijuana. Dans ce contexte, crime organisé, division des sexes et
usages prédateurs des corps convergent. Son idée est que le crime organisé n’est pas le seul lieu qui
produit cette violence; l’origine est économique. La violence se construit aussi comme subjectivité
dans le cadre d’une distribution internationale du travail. Les bases de ce capitalisme gore sont la
colonialité du pouvoir, la masculinité machiste (qui s’est élaborée avec les États-nations, qui ont
fait de la masculinité une machine de guerre au service de l’État), la précarisation des populations et
l’acceptation frénétique du non-projet néolibéral. Valencia parle d’un sujet endariago (monstrueux,
dragon) recruté par la machine nécropolitique : cet homme nié dans ses fonctions de chef de famille
et recyclé dans la violence. Il s’agit d’une forme de biopouvoir mexicain. Pour elle, il faut détisser
le lien entre cette subjectivité tératologique et le machisme d’État.
Références
Gargallo, Francesca. 2008. « Libre (para una oración por Juarez) ». La calle es de quien la camina,
las fronteras son asesinas.
https://francescagargallo.wordpress.com/ensayos/ensayos-letras/libre-oracion-por-juarez/
Segato, Rita. 2018a. « Crueldad : pedagogías y contra-pedagogías. ». Lobo suelto.
http://lobosuelto.com/crueldad-pedagogias-y-contra-pedagogias-rita-segato/
Segato, Rita. 2018b. « Colonialité et patriarcat moderne : expansion du domaine de l’État,
modernisation et vie des femmes ». Revue d’Etudes Décoloniales (3). Version française de «
Colonialidad y patriarcado moderno: expansión del frente estatal, modernización, y la vida de las
mujeres». Dans Tejiendo de otro modo. Feminismo epistemologias y apuestasdescoloniales en Abya
Yala. Sous la direction de Yuderkis Espinosa Minoso, Diana Gómez Correal, Karina Ochoa Muñoz,
75-91. Popayán : Editorial Universidad del Cauca.
Licence Creative Commons 4.0.
187
http://reseaudecolonial.org/2018/10/15/colonialite-et-patriarcat-moderne-expansion-du-domaine-de-
letat-modernisation-et-vie-des-femmes1/
https://www.escuelaformacionpolitica.com/uploads/6/6/7/0/66702859/01_tejiendo.pdf
Valencia, Sayak. 2019. « La violence devient un écosystème et un espace de production de sens : la
mort ». Revue d’Etudes D écoloniales (4). Version française de « La violencia se está convirtiendo
en un ecosistema y en unespacio de producción de sentido : sentido de muerte ». Dans Feminismos
a la contra. Entre-vistas al Sur Global. Sous la direction de Luis MartínezAndrade, 215-226.
Santander : La vorágine.
https://www.academia.edu/40464954/Feminismos_a_la_contra._Entre-vistas_al_Sur_Global
Licence Creative Commons 4.0.
188
47. Firmin, Anténor
SEBASTIEN LEFÉVRE
Haïti, comme nous l’avons souligné, marque une rupture dans la Modernité occidentale avec
l’obtention, par les armes, de son indépendance en 1804. Toutefois, cela n’a pas exempté Haïti, par
la suite, de passer par des étapes de reproduction de certaines colonialités, jouant souvent sur le
critère de couleur.(Osna, 2019). Or, Haïti a produit beaucoup de textes intéressants tout au long du
XIXe siècle. Parmi ces textes, on peut mentionner celui d’Anténor Firmin, De l’égalité des races
humaines. Anthropologie positive (1885). L’auteur est à cheval entre le XIX et le XX siècle. Il était
à la fois homme politique et essayiste. Ayant fait une partie de ses études à Paris, il a intégré la
Société d’Anthropologie de Paris suite au patronage de M. Auburtin. Cet ouvrage constitue une
réponse au livre d’Arthur de Gobineau, De l’inégalité des races humaines, paru en 1853 à Paris. À
la fin du XIX siècle, certain-e-s penseurs et penseuses ont mis en place des théories qui prétendaient
démontrer la supériorité de la race blanche. Ces théories avaient court au sein de la Société à
laquelle appartenait Firmin. Ces positionnements lui paraissaient en contradiction avec sa présence
puisqu’il était issu lui-même d’une soi-disant race inférieure. Mais, plutôt que de provoquer le débat
au sein de la Société, il trouva plus utile d’écrire un livre.
L’ouvrage de Firmin est intéressant à plus d’un titre. Premièrement,il s’agit d’un ouvrage qui
s’inscrit déjà, pour l’époque, dans un projet de réhabilitation de la race noire. Il ne fait pas de
différence entre les Noir-e-s d’Haïti et ceux et celles d’Afrique, car pour lui, les Noir-e-s haïtien-
ne-s viennent du continent africain même s’ils et elles n’ont pas développé les mêmes aptitudes
intellectuelles et physiques. Firmin n’est pas aveugle non plus aux préjugés de couleur qui opèrent
dans la société haïtienne, conséquences de toutes les théories sur l’inégalité des races.
Dans son ouvrage, il va s’atteler à passer en revue tous les arguments d’alors qui s’obstinent à
démontrer l’inégalité entre les races. Il analysera le champ anthropologiste de l’époque et ses
différents domaines d’études :les premières classifications opérées et leur hiérarchisation, les
différences physiques, l’espèce animale, la morale, les arguments religieux, le métissage
comme soi-disant dégénérescence, etc. Il répondra et démontrera avec toute une série d’arguments
le non-fondement d’une telle hiérarchisation raciale et la mauvaise foi d’une grande partie des
savant-e-s français-es et européen-ne-s, pour ensuite mobiliser le passé de l’ancienne Égypte afin de
démontrer que la race noire a fait preuve d’une grande richesse au niveau de la création humaine. Il
Licence Creative Commons 4.0.
189
est intéressant de noter que déjà, à la fin du XIX siècle, il était connu et admis par nombre de
savant-e-s occidentaux et occidentales que l’œuvre de l’Égypte ancienne était celle d’Africain-e-s «
noir-e-s ». Firmin convoque dans ses arguments ceux des savant-e-s européen-ne-s, mais également
fait référence au fameux témoignage d’Hérodote qui décrit les traits physiques des ancien-ne-s
Égyptien-ne-s. Firmin explique que le savoir européen, grec notamment, est issu en grande partie de
cette région du globe et qu’il serait ainsi redevable à une race supposément inférieure. Dans son
ouvrage, il montre comment les savant-e-s occidentaux et occidentales ont en quelque sorte «
blanchi » l’histoire.
Même s’il récuse les théories sur l’inégalité des races, Firmin ne se situe pas moins dans une vision
évolutive des sociétés, où une société doit passer par différents stades avant d’atteindre un certain
progrès. Il s’agirait de voir de quel progrès il s’agit. Pour autant, le livre de Firmin constitue un vrai
mouvement de pensée décoloniale car il remet en question la colonialité due savoir de la fin du XIX
siècle siècle.
Mais à quel point ne serais-je pas particulièrement fier, si tous les hommes noirs et ceux qui en descendent se
pénétraient, par lalecture de cet ouvrage, qu’ils ont pour devoir de travailler, de s’améliorer sans cesse, afin de
laver leur race de l’injuste imputationqui pèse sur elle depuis si longtemps! (Firmin, 1885 : 16)
Firmin s’inscrit également contre la colonialité de l’être. En effet, il se situe dans un mouvement de
réhabilitation de l’être noir-e en le et la réhumanisant et en le et la dotant de force, d’intelligence, de
beauté, etc.
Même si son ouvrage est intéressant par rapport à tous les aspects cités antérieurement, il reste
parfois essentialisant lorsqu’il parle, par exemple,de la beauté et de la démarche des jeunes femmes
d’Haïti, ou bien lorsqu’ile xplique qu’il y a plus de beaux hommes que de belles femmes noires en
Haïti, ou encore lorsqu’il parle des « mulâtres » et de leurs manières efféminées. Quoiqu’il en soit,
il arrive à la conclusion que :
(…) l’unité de l’espèce humaine est un fait clair et intelligible, pour tous ceux qui l’étudient au point de vue des
sciences naturelles ; maisqu’on y applique le mot monogénisme, il survient subrepticementune notion arbitraire,
indémontrable, dont l’adjonction affaiblitconsidérablement ce qu’il y a de vrai dans le fait primitif.
Malheureusement, la majorité des défenseurs de la théorie unitairese compose de naturalistes essentiellement
attachés aux idéesreligieuses. Ils ne peuvent séparer les intérêts de la foi de ceux de lascience; et pour sauver les
uns ils compromettent les autres. (Firmin,1885 : 116)
Licence Creative Commons 4.0.
190
Et pour terminer, il avance un positionnement qui pourrait être assimilable à une position
pluriverselle :
Les races, se reconnaissant égales, pourront se respecter et s’aimer.En effet, leurs aptitudes sont généralement les
mêmes; mais chacuned’elles trouvera dans son milieu un stimulant spécial pour la production spontanée de
certaines qualités exquises du cœur, de l’esprit ou du corps. Cela suffira pour qu’elles aient toujours besoin de se
compléter les unes par les autres; pour qu’elles vivent toutes et se développent, florissantes, sous les latitudes qui
leur sont propres.
Elles pourront bien s’entraider dans l’exploitation de la nature, sans qu’il y en ait des supérieures et des
inférieures dans l’œuvre du progrès universel, où l’ouvrier et le penseur devront se rencontrer côte à côte, parmi
les noirs comme parmi les blancs. Avec l’abandon des idées de domination et de suprématie que les unes
nourrissent à l’égard des autres, on se rapprochera davantage, on s’étudiera, on apprendra à se connaître. (Firmin,
1885 : 660)
Références
Anténor, Firmin. 1885. De l’égalité des races humaines. Anthropologie positive. Paris : Librairie
Cotillon.
http://classiques.uqac.ca/classiques/firmin_antenor/de_egalite_races_humaines
de_egalite_races_humaines.html
Gobineau (de), Arthur. 1855. Essai sur l’inégalité des races humaines. Paris :Librairie de Firmin
Didot Frères.
Osna, Walner. 2019. « Colonialité du pouvoir en Ayiti ». Revue d’Etudes Décoloniales (4).
http://reseaudecolonial.org/2019/11/11/etat-et-colonialite-en-ayiti-traduction-de-la-colonialite-dans-
les-actions-politiques-de-jean-pierre-boyer-1818-1843-walner-osna-universite-dottawa-grad-celg/
Licence Creative Commons 4.0.
191
48. Géopolitique de la connaissance
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
« Il faut souligner la relation entre les lieux — constitués par l’histoire et la géographie — et la
pensée, ce qu’on appelle la géopolitique de la connaissance », voilà ce que dit Walter Mignolo de ce
concept, exposé par Dussel dans sa philosophie de la libération. La connaissance repose sur un
déséquilibre : les sciences et connaissances produites dans le monde occidental ont une valeur dite
universelle et les autres sciences et connaissances africaines, américaines ou asiatiques, elles, sont
ramenées à leur particularité. Pour Catherine Walsh, qui reprend l’analyse de Walter Mignolo :
La plus grande conséquence de la géopolitique du savoir est peut-être qu’elle nous permet de
comprendre que le fonctionnement du savoir :
C’est celui de l’économie, il est organisé à travers des centres de pouvoir et des régions subordonnées, les
centres du capital économique étant aussi ceux du capital intellectuel. Par conséquent, la production
intellectuelle d’Amérique latine en général (et c’est encore pire pour les cas particuliers, comme l’Équateur) a
peu de poids dans le monde. Mais il y a un autre problème. Le discours de la modernité a créé l’illusion que la
connaissance est abstraite, non incorporée, non localisée. Cela nous pousse à croire que la connaissance est
quelque chose d’universel, qu’elle n’a ni maison ni corps, ni genre ni couleur. Ce même discours de la modernité
crée le besoin, dans toutes les régions de la planète, de « s’élever» à l’épistémologie de la modernité (…). Parler
de géopolitique du savoir, c’est donc reconnaître le caractère hégémonique de la (re)production, de la diffusion et
de l’utilisation du savoir, pas seulement en tant qu’exercice académique, mais comme partie fondamentale du
système capitaliste et moderne du monde, qui est à la fois et encore colonial. (Walsh, 2004)
La géopolitique de la connaissance, comme la corpopolitique, permet une réappropriation. Elle
redonne une place aux connaissances et aux savoirs qui furent dévalorisés et permet d’historiciser,
de relativiser la place des savoirs et connaissances produits dans le premier monde.
Références
Mignolo, Walter. 2001. « Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence
coloniale ». Multitudes 3 (6) : 56-71.
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2001-3-page-56.htm?contenu=resume
Walsh, Catherine. 2004. « Geopolíticas del conocimiento, interculturalidady descolonialización ».
Boletín ICCI-ARY Rimay 6 (60). Conférence d’inauguration du ICCI, présentée sous le titre
Licence Creative Commons 4.0.
192
Geopolíticas del Conocimiento y la Descolonización de las Ciencias.
http://icci.nativeweb.org/boletin/60/walsh.html
Licence Creative Commons 4.0.
193
|49. Globocentrisme
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
En 1998, Fernando Coronil écrivait dans un article sur la globalisation :
De mon point de vue, il y a deux processus qui modifient la puissance impériale. On est passé « d’une position
centrale en « Europe »ou en « Occident » à une position moins identifiable dans un «globe ». D’une part, la
mondialisation néolibérale a homogénéisé e trendu abstraites diverses formes de « richesse », y compris la
nature, devenue pour beaucoup de nations un avantage comparatif et une source de revenus des plus sûres;
d’autre part, la déterritorialisation de l’«Europe» ou de «l’Occident» a entraîné leur territorialisation, dans la
figure évasive du monde, phénomène moins visible, qui cache les réseaux financiers et politiques transnationaux,
socialement concentrés mais diffus géographiquement, et intégrant les élites urbaines comme celles de la
périphérie. Dans ce contexte, la montée en puissance de l’«Euroland » ne doit pas occulter son articulation
étroite avec le «Dolarland ». La « transparence » exigée par les partisans du libre marché n’inclut pas la visibilité
ou la responsabilité publique par rapport aux hiérarchies de commandement émergentes du pouvoir économique
et politique mondial. (Coronil, 2000 : 62)
Il se fait l’écho des analyses du sous-commandant Marcos pour lequel ce processus est caractérisé
par « la concentration de la richesse et répartition de la pauvreté; la mondialisation de l’exploitation;
la migration et les guerres locales; la mondialisation de la finance, la généralisation de la criminalité
etla transformation de l’État en un agent de répression sociale; l’apparition de « foyers de résistance
» dont la force réside, au contraire, dans leur diversité et leur dispersion ». Et il reprend le terme de
quatrième guerre mondiale qu’il emprunte au zapatiste. Marcos, effectivement, parle de troisième
etquatrième guerre mondiale : s’il accepte l’interprétation de l’historiographie officielle sur les deux
premières guerres mondiales comme conflits impériaux qui tournaient autour d’une redistribution
des territoires et des aires d’influence des pouvoirs occidentaux, il rebaptise « troisième guerre
mondiale » la Guerre froide, remarquant que ce fut une guerre très « chaude», qui coûta la vie à 23
millions de personnes dans 129 pays, et qui se produisit dans le tiers-monde. La quatrième guerre
mondiale est la mondialisation néolibérale actuelle qui, selon Marcos, prend la vie d’un grand
nombre de personnes soumises à une pauvreté et une marginalisation croissantes. Alors que la
troisième guerre mondiale a été menée entre le capitalisme et le socialisme avec plus ou moins
d’intensité dans des territoires du tiers-monde dispersés et localisés, la quatrième guerre mondiale
implique un conflit entre les centres financiers métropolitains et les majorités du monde, et se
déroule avec une intensité constante à l’échelle mondiale dans des espaces diffus et variables.
Licence Creative Commons 4.0.
194
L’expression de « guerre mondiale » a l’avantage de dévoiler la violence qui se cache derrière
l’euphémisation de la prédation, usurpation et la dépossession.
Coronil note également qu’avec le globocentrisme, le processus de disparition de l’État et des
processus d’intégration sociale ont, parmi leurs conséquences, une recrudescence du racisme
comme cela a pu se voir en1999 au Vénézuela.
La globalisation libérale est la nouvelle forme de l’impérialisme. À certains égards, nous pourrions considérer ce
processus de répression comme une régression vers des formes coloniales de contrôle fondées sur l’exploitation
des produits primaires et une main-d’œuvre peu coûteuse. Cependant, ce processus s’inscrit dans un cadre
technologique et géopolitique qui transforme le mode d’exploitation de la nature et du travail. Le mondo
centrisme, en tant que modalité de l’occidentalisme, se réfère également aux pratiques de représentation
impliquées dans l’assujettissement des populations non occidentales, mais dans ce
cas leur assujettissement (ainsi que la subordination des secteurs subordonnés au sein de l’Occident) apparaît
comme un effet de marché, plutôt que comme une conséquence d’un projet politique (occidental) délibéré.
Contrairement à l’eurocentrisme, le globocentrisme exprime la domination persistante de l’Occident par des
stratégies de représentation qui comprennent : 1) la dissolution de l’Occident dans le marché et sa cristallisation
en nœuds de pouvoir financier et politique moins visibles mais plus concentrés;
2) l’atténuation des conflits culturels par l’intégration des cultures éloignées dans un espace mondial commun; et
3) le passage de l’altérité à la subalternité comme mode dominant d’ instauration des différences culturelles.
(Coronil, 2000 : 63)
Contrairement à d’autres stratégies de représentation occidentales qui mettent en évidence la
différence entre l’Occident et les autres, la mondialisation néolibérale vend l’égalité et l’uniformité
potentielles de tous les peuples et cultures.
Références
Coronil, Fernando.2000.«del poscolonialismo:deleurocentrismo al globocentrismo ». Dans La
colonialidad del saber :eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Sous la
direction de Edgardo Lander, 53-67. Buenos Aires : CLACSO.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708044815/
Licence Creative Commons 4.0.
195
50. Grosfoguel, Ramón
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Ramón Grosfoguel est un sociologue portoricain qui enseigne à l’Université de Berkeley, dans le
département d’études ethniques qu’il contribua à créer dans les années 1980. Il a participé au projet
Modernité/Colonialité depuis ses débuts et défend une vision engagée de la perspective décoloniale,
se traduisant entre autres par son soutien actif aux luttes des populations racisées, qu’il s’agisse
des Noir-e-s de Californie, des populations caribéennes, portoricaines en particulier, ou des Français
d’origine coloniale qui souffrent du racisme structurel.
Il a collaboré à de nombreuses publications, dont El giro decolonial, traduit en français sous le titre
de Penser l’envers obscur de la modernité. Il a écrit plusieurs ouvrages sur des thèmes divers :
analyses des migrations caribéennes, critiques de l’islamophobie ou des penseurs et penseuses
européen-ne-s de la post-modernité. Il parle d’un système-monde européen-euro-nord-américain-
chrétien-moderne-colonial-capitaliste-patriarcal. L’articulation de la pensée décoloniale à la critique
du capitalisme et à la lutte contre ses effets impérialistes est quelque chose de structurel
dans sa démarche. Parmi les concepts qu’il a élaboré ou contribué à diffuser, on retiendra celui de «
fondamentalisme occidentaliste eurocentré » ou encore d’« extractivisme idéologique ». Ce dernier
terme désigne le processus de piratage de savoirs ou de problématiques indigènes par des
intellectuel-le-s européen-ne-s, l’exploitation des ressources du continent se poursuivant dans le
domaine de la connaissance. On peut dire que le concept de Buen Vivir, par exemple, a été victime
de cet extractivisme idéologique puisqu’il a été acclimaté en Europe avec une valeur qui pervertit
son sens originel. La notion d’extractivisme cognitif a été lancée en 2013 par Leanne Betasamosake
Simpson, une intellectuelle Nishnaabeg de Mississauga au Canada. Elle a étendu le concept
d’extractivisme économique à de nouveaux domaines de domination coloniale. Ramón Grosfoguel
écrit :
L’extractivisme est une forme très ancienne de fascisme : il commence avec le « christianise-toi » du XVI siècle,
se poursuit avec le « civilise-toi » du XIX siècle et le « développe-toi » au XX siècle, pour culminer avec le «
démocratise-toi » du XXI siècle. Tous ces projets coloniaux globaux, depuis le XVI siècle, ont été associés à l’«
extractivise-toi ou je te tue »; c’est pour cela qu’aujourd’hui, en Amérique latine et dans le monde néo-colonisé,
Licence Creative Commons 4.0.
196
les processus de consultation préalable des communautés non occidentales ressemblent à une mauvaise blague
(…). Le vol épistémicide fait partie de l’extractivisme mondial occidental. (Grosfoguel, 2016 : 141)
Ramón Grosfoguel défend l’idée d’un racisme et d’un sexisme épistémique qu’il distingue du
racisme politique ou économique. Ils sont produits par un Occident patriarcal, convaincu d’être le
seul à pouvoir produire des connaissances universelles et persuadé de la faible valeur des
connaissances produites ailleurs dans le monde. Le discours de l’objectivité scientifique et de la
neutralité est une constante qui a pour effet de cacher le lieu d’énonciation de celui qui parle : un
homme blanc occidental. Pour lui, l’épistémologie euro-centrée qui domine dans les sciences
sociales a une couleur et un genre. Historiquement, c’est avec la destruction d’Al Andalus et
la conquête de l’Amérique que cette épistémè s’est mise en place.
Évoquant la « politique identitaire » qui privilégie les canons européens et contre laquelle les
dominé-e-s ont développé une contre-politique identitaire, le sociologue attire l’attention sur le
risque que comporte l’opération pour les dominé-e-s. Ces derniers et dernières finissent par
maintenir les termes de départ, se contentant d’inverser l’équation : les inférieur-e-s deviennent les
supérieur-e-s, les Européen-ne-s remplacent les non Européen-ne-s et le système hiérarchique qui
est le cadre ne bouge pas. Exemple des dérives possible, celui des « fondamentalistes du tiers-
monde », comme il les nomme (Bourguignon Rougier, 2016). Ces «fondamentalistes » reprennent à
leur compte le préjugé européen en vertu duquel l’Orient est autoritaire et finissent par soutenir des
gouvernements autoritaires comme si la démocratie était un colifichet européen qui entrait
nécessairement en contradiction avec la tradition.
Sa critique du fondamentalisme tiers-mondiste s’insère dans une critique plus globale du
fondamentalisme. Il remarque que ce dernier n’est pas l’apanage de ces seuls groupes, qu’il
correspond à la conviction de détenir le seul système explicatif valable et universel, ce en quoi
l’occidentalisme semble détenir la palme. Ce fondamentalisme, dans le contexte de la guerre contre
le terrorisme, répand l’idée que la raison est du côté des Occidentaux et Occidentales et l’absence
de rationalité, de celui des peuples de l’Orient. En Europe, explique-t-il, la forme la plus courante
de ce racisme épistémique est l’islamophobie. Un processus qui a une longue histoire. Il a
commencé il y a plusieurs siècles avec la dévalorisation des connaissances produites dans le monde
musulman, puis a continué au XVIII et XIX siècles avec de nombreux penseurs et penseuses
européen-ne-s, de positions parfois très différentes mais s’accordant tous et toutes sur
l’incompatibilité entre rationalité et Islam. C’était le cas de Ernest Renan, mais aussi de Max Weber,
de Karl Marx ou de Friedrich Engels. Renan voyait une incompatibilité entre science et Islam,
Weber pensait que l’Islam faisait obstacle au type de doctrine et de mode de vie nécessaire au
Licence Creative Commons 4.0.
197
développement capitaliste (celui que le calvinisme, lui, avait rendu possible). Marx et Engels
légitimaient la colonisation de l’Algérie et de l’Inde car ils voyaient une supériorité dans la
civilisation européenne et le développement qu’elle avait permis. Pour Ramón Grosfoguel, l l’Islam
n’entre pas dans la vision sécularisée des religions qui prévaut en Europe (Grosfoguel, 2017). Sortir
de l’impasse actuelle passera par un dialogue entre les scientifiques de diverses traditions
épistémiques : Boaventura de Sousa Santos, Salman Sayyid, Ali Shariati, Aníbal Quijano, Silvia
Rivera Cusicanqui, W. B. Dubois, Silvia Wynter, etc.
Ses essais sur les gouvernements sud-américains des années 1990 font apparaître l’originalité et le
caractère émancipateur de luttes généralement présentées comme dangereusement populistes. Il a
analysé les processus vénézuélien ou bolivien, qu’il critique mais soutient, à l’instar d’Enrique
Dussel. Récemment, il a contribué à la création, à Caracas, d’un centre décolonial. Très proche du
PIR français, il a contribué à faire passer certains éléments de la perspective décoloniale latino-
américaine dans la théorisation de ce mouvement antiraciste décolonial français. En 2017, il a
suivi de près les événements de Catalogne et a proposé une vision originale du problème de la
souveraineté et de l’État, ainsi qu’une critique des limites de Podemos.
Références
Bourguignon Rougier, Claude. 2016. « Entretien avec Ramón Grosfoguel ». Revue d’Etudes
Décoloniales (1).
http://reseaudecolonial.org/2016/09/02/entretien/
Grosfoguel, Ramón. 2006. « Quel(s) monde(s) après le capitalisme ? Les chemins de l »utopistique
» selon Immanuel Wallerstein ». Mouvements 3-4 (45-46) : 43-54.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2006-3-page-43.htm
Grosfoguel, Ramón. 2006. « Les implications des altérités épistémiques dans la redéfinition du
capitalisme global. Transmodernité, pensée frontalière et colonialité globale ». Multitudes 3 (26).
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2006-3-page-51.htm
Grosfoguel, Ramón. 2009. « Les immigrés caribéens dans les métropoles du système-monde
capitaliste et la « colonialité du pouvoir » ». Cahiers des Amériques latines (62) : 59-82.
http://journals.openedition.org/cal/1536
Licence Creative Commons 4.0.
198
Grosfoguel, Ramón. 2012. « Un dialogue décolonial sur les savoirs critiques entre Frantz Fanon et
Boaventura de Sousa Santos ». Mouvements 4 (72) :42-53.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-4-page-42.htm
Grosfoguel, Ramón. 2016. « Del “extractivismo económico” al “extractivismo epistémico” y
“extractivismo ontológico” : una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo ». Tábula
Rasa (24) : 123-143.
http://www.revistatabularasa.org/numero-24/06grosfoguel.pdf
Grosfoguel, Ramón. 2017. « Visages de l’islamophobie ». Revue d’études décoloniales.
http://reseaudecolonial.org/2017/04/05/visages-de-lislamophobie/
Licence Creative Commons 4.0.
199
51. Habencia (la) comme point de départ de la philosophie de la libération
FERNANDO PROTO GUTIERREZ
Agustín Tobías de la Riega (1942-1984) naquit et mourut à Buenos Aires. Il obtint son diplôme
d’avocat à l’Université de Buenos Aires et sa licence de philosophie de l’Université del Salvador. Il
travailla comme professeur à l’Université del Salvador (Centre de San Miguel), à l’Université
Nationale de Lomas, à Zamora, ainsi qu’à l’Université Nationale de Resistencia, dans le
Chaco.
Ses ouvrages les plus remarquables sont Raison et incarnation (1978), Connaissance, violence et
culpabilité (1979) et Identité et universalité : culture, éthique et politique (1987) qui fut publié à
titre posthume. Il a fait partie du noyau dur de la philosophie de la libération à travers ses activités
dans le cadre de l’Association de la philosophie et des sciences sociales latino- américaines (1973)
et de la Revue de philosophie latino-américaine. Son premier numéro s’intitulait « Hacia una
filosofía de la liberación latinoamericana » (1973) et y avaient contribué Osvaldo Ardiles, Hugo
Assmann, Mario Casalla, Horacio Cerutti, Carlos Cullen, Julio de Zan, Enrique Dussel, Aníbal
Fornari, Daniel Guillot, Antonio Kinen, Rodolfo Kush, Diego Pró, Agustín de la Riega, Arturo Roig
et Juan Carlos Scannone.
La pensée d’Agustín de la Riega est, dans son essence, révolutionnaire. Il parle d’un humain libre
de toute réduction aux catégories et à la différence ontologique, ces constructions théoriques
élaborées par la philosophie occidentale et qui soumettent la vie au joug de la force de l’être et de la
dette ontologique. Pour cela, De la Riega déconstruit le premier fondement de la philosophie
phénoménologique et ouvre la pensée philosophique à un ordre de réalité effectif, au-delà des
dichotomies modernes : objet/sujet, immanence/transcendance, être/être, etc. Ainsi, il appelle à
décentrer la vie de l’axe fondateur de la raison en tant qu’essentialisation ou source du droit
d’être et invoque le « il-y-a » comme dimension inaccessible à toute tentative de réduction
technico-rationnelle.
Contre la philosophie phénoménologique, il comprend que l’acte de décentrer l’être en l’orientant
vers la différence radicale du radical du vivant. Ce n’est pas une tâche qui appartient à la conscience
intentionnelle, laquelle spécule sur les aspects constitutifs de l’avoir; et il s’agit là plutôt d’une
expérience du factuel comme possibilité qui vibre ontologiquement dans son ouverture en «juste
être là » ambiguë, plurimorphe et contingente.
Licence Creative Commons 4.0.
200
Selon De la Riega, le concept d’haber, qu’on ne trouve que dans les langues espagnole, anglaise
(there to be) et française (il-y-a), récupère la factualité et résout la problématique du es gibt
phénoménologique allemand (le es de es gibt dénote un ordre cosmique et objectif, le pur don à la
pensée d’un sujet de connaissance), par la violence qui interdit le il-y-a à un domaine absolument
préalable à la pensée et indépendant de celle-ci. Le il-y-a est premier et pré-juridique, ce qui
implique que toute essence doit être considérée ou, en tout cas, est instituée à partir de celle-ci; le
caractère pré-juridique du il-y-a institue d’abord une priorité ontologique face à l’être et à la pensée.
Dans cette perspective, il-y-a ne peut être temporisé ni dynamisé a priori puisque le temps ne peut
être pensé qu’à partir du il-y-a lui-même : la pré-juridicité et toute impossibilité de le temporiser
permettent, selon De la Riega, une meilleure installation dans la facticité, car elles empêchent de
faire de cette facticité un don nécessaire d’elle-même à la pensée humaine (on donne de l’être, on
donne du sens : des termes qui renvoient toujours à la phénoménologie). Le il-y a, libre alors du
binôme être/penser, supprime la Nécessité-Justice du pur don phénoménologique : l’allemand es
gibt est problématique car il indique la présence inévitable de la modernité subjectiviste qui marque
la phénoménologie idéaliste de Husserl et Heidegger. Pour cela, la « directionalité à priori » du es
gibt est en fait un don pour moi :
Donner est une dualité. Une dualité entre ce qui est concrètement donné et ce qui est retenu. S’il y a quelque
chose de mystérieux dans le don – puisqu’il n’est pas d’un il-y-a -, la manière dont est retenu de ce qui est retenu
est encore plus mystérieuse. (De la Riega, 1979 : 43)
Cependant, le don de soi est en réalité, un don de soi à la pensée de l’humain et non plus à un
humain en particulier. L’anéantissement de ce pur don de soi, nécessaire et juridique, place Agustín
de la Riega face à la violence d’un il-y-a qui n’est pas du tout saisissable par la pensée, ni même
susceptible d’être contemplé dans une attitude d’abandon. C’est ainsi que le il-y-a est exposé
comme une dimension irréductible à la systématisation unificatrice propre à la pensée moderne-
phénoménologique, laquelle installe l’humain dans la facticité de la différence et de la vie. En effet :
Le il-y-a est la dimension unique. En ce sens, le il-y-a est total. Mais il n’est pas licite de le penser et de
représenter à partir du tout, c’est le tout qui doit être appréhendé à partir du il-y-a et de son ouverture. (De la
Riega, 1979 : 63)
Le il-y-a ne doit pas être réduit à un tout géométriquement fermé et arrondi : un tel raisonnement
suppose de concevoir la sphère comme un apriori immédiat d’un il-y-a qui se laisse déterminer par
une forme pure. Donc, l’être–il-y-a est total mais par le tout lui-même : il est, il-y-a, avant le
Licence Creative Commons 4.0.
201
tout et d’une façon non exclusive, car le il-y-a contribue, par son ouverture, à la pluralité, hôte de la
différence et de la vie. Si l’ensemble excluant de la philosophie classique, de Ionie à Iéna, a forgé
l’identité d’un discours unidimensionnel et absolu, la philosophie du il-y-a conçoit la différence
comme possible dans la mesure où elle est, sans plus, une modalité irréductible du il-y-a .
Le caractère pré-juridique du il-y-a le rend premier parce que chaque désignation linguistique
suppose le il-y-a : il-y-a-être, il-y-a-discours, il-y-a-pensée. Il n’y a donc pas de norme qui le
détermine, étant entendu quele point de départ (qui n’est plus fondateur) n’est pas la Nécessité-
Justice en tant qu’a priori normatif, mais le il-y-a.
La tâche de la philosophie de la libération consiste plutôt à se libérer de la philosophie
phénoménologique qui a mis en place le bel appareil cognitif, par lequel passe l’accès au il-y-a-vie.
S‘installer dans la vie, dans son action, dans sa communication, dans son conflit, dans sa tension,
dans son risque, nous oblige à soulever le voile mythique de la connaissance. Nous oblige à détruire
l’appareil que nous avons construit : une médiation purement gnoséologique. Car la vie médiée par
la raison est envisagée et non plus vécue.
L’installation de l’humain dans l’ouverture du il-y-a nécessite donc une critique de l’intentionnalité
phénoménologique, d’où l’on déduit la directionnalité a priori du phénomène pour comprendre, en
termes non phénoménologiques, la violence radicale du il-y-a qui se présente comme l’expérience
ontologique d’une différence radicale irréductible. Si la vie est en soi ontique, la philosophie est
ontique. Si la philosophie est ontologique, la vie l’est antérieurement. La vérité n’inclut pas
l’humain parce qu’il pense, mais parce qu’il vit.
Par sa critique de l’exposition du « donné » et du Dasein contemplatif, De la Riega affirme
l’inexistence a priori d’une pure compréhension pré-prédicative qui installe l’humain dans la
factualité la plus violente :
Heidegger exige comme préalable à la violence « l’ouverture » d’un monde qui est enfermement. Un
enfermement dans le sens. (…) Heidegger maintient la déconnexion entre la connaissance et l’entrée en jeu (…);
il soumet le il-y-a et sa facticité violente à la sérénité du langage et à sa puissance de signification originelle. (De
la Riega, 1979 : 192)
La réduction est comprise par De la Riega comme l’acte d’annihilation d’un secteur de l’entité de
sorte que son sens ou son fondement advienne, lui soit donné d’« autre » chose, entité ou non, ce
qui rend compte d’une sous- mission. Et toute philosophie phénoménologique soumet puisqu’elle
produit une « dette ontologique » par rapport à ce qui est donné au sujet. Par conséquent, le contexte
Licence Creative Commons 4.0.
202
significatif qui « est donné » soumet, annihile et subsume les entités intramondaines. Mais en
dernière instance, cette totalité d’entités se montre, « se donne » grâce à un monde (la non-
entité, l’être) par lequel les entités doivent leur existence à un principe fondamental.
Il est vrai que le stylo forme une structure avec le papier, ma main, l’appui que je prends (…); mais c’est
seulement dans le cadre d’une abstraction (…) que je peux supposer un thème stylo séparé du reste, ou, plus
radicalement, quelque chose d’isolé et « en soi » dépourvu de sens, en notant que le sens vient d’une totalité de
conformité. (De la Riega, 1979 : 180)
En ce sens, la sectorisation phénoménologique (néokantienne) de l’être (le tout) est considérée
comme illégitime, en défense de l’il-y-a comme factum primaire où la structure se fonde :
Ce n’est pas que le total survienne sur le partiel pour le structurer. C’est le fait qu’il n’y ait pas de pures parties,
que ce qu’on appelle partiel soit déjà structurel, soit déjà. (De la Riega, 1979 : 181)
Ensuite, De la Riega souligne la façon qu’a d’être réduite et cachée la violence originelle et
factuelle, en premier lieu, du fait de l’apparition-don d’un contexte significatif; dans un deuxième
temps, du fait de l’articulation interprétative de ce sens pré-compris-compréhensible, car l’ouverture
de Dasein ne l’ouvre pas à la différence effrayante de la factualité, mais à un paisible réseau de
significations et de rémissions. De sorte que pour « suspendre » la directionalité métaphysique, cette
pensée devrait détruire la significativité et passivité de la pensée – qui laisse être l’être -, et
s’installer ainsi dans la dimension première de ce qui existe, dont la caractéristique fondatrice est
d’éliminer la réduction et la sous-mission du donné ou de l’apparu à un Dasein qui le contemple
passivement sans être violenté. En fait, pour la phénoménologie, la factualité se comporte d’abord
comme signifié : elle est pur spectacle – là (devant nos yeux).
La philosophie de la libération a donc la tâche substantielle de déconstruire la « dette ontologique »
qui tient à la médiation cognitive de l’humain avec l’ordre factuel des choses, afin de le libérer
d’une philosophie oppressive.
Références
De la Riega, Agustín Tobías. 1979. Conocimiento, violencia y culpa. Buenos Aires : Paidós.
Licence Creative Commons 4.0.
203
Proto Gutierrez, Fernando. 2013. « Diálogo con el pensamiento de M. Henry y A. T. de la Riega.
Sobre la auto-afección inmanente de la subjetividad y el haber-vida : Barbarie y liberación ».
Revista FAIA 2 (8).
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4714281
Proto Gutierrez Fernando. 2013. El pensamiento de Agustín de la Riega. Refutación de la filosofia
fenómenologica en dialogo. Buenos Aires : FAIA.
https://philarchive.org/archive/FEREPD-9
Proto Gutierrez, Fernando. 2015. Crítica de la razón fenomenológica : el pensamiento de Agustín de
la Riega. Buenos Aires : FAIA.
Licence Creative Commons 4.0.
204
|52. Haïti/Ayiti
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Au contraire d’une certaine littérature ibéro-centrée qui insiste sur la différence linguistique pour
désigner les espaces latino-américains, il est nécessaire de rétablir l’importance historique et
paradigmatique de Haïti pour l’« Amérique Latine » et pour l’Afro-amérique-latine, en commençant
précisément avec l’importance de la révolution haïtienne (1791-1804). Cette dernière est d’abord
une révolution historique parce qu’elle a été le fait des révoltes des esclavagisé-e-s africain-e-s et
qu’elle réussit à établir la « première république noire libre » en 1804. A la même époque
l’institution et le commerce esclavagiste se poursuivent dans d’autres anciennes colonies
européennes aux Amériques et l’Afrique centrale, par exemple, est confrontée aux débuts de
l’installation territoriale et coloniale française. L’insurrection des esclavagisé-e-s débute en 1791 et
aboutit en 1804 à l’établissement d’Haïti. Or, cette révolution haïtienne souffre d’un désintérêt
analytique de la part de l’historiographie européenne, que Hurbon (2007) explique pertinemment à
partir de l’héritage de l’interprétation des penseurs des Lumières. Plus précisément, la focalisation
sur l’importance de la révolution française par les philosophes des Lumières a oblitéré la portée
décisive de la révolution haïtienne. En effet, le récit de la révolution française a constitué le discours
occidental sur la « Modernité » universaliste et sa propension à s’imposer comme modèle humain
de « révolution ». L’Homme triomphant de la révolution française et de la déclaration des droits de
l’homme est un Homme occidental qui se caractérise par un type de langue, une organisation
familiale, une raison qui sont éminemment occidentaux et donc ethno-centrés. Ainsi, une telle
perspective aboutit à interpréter la révolution haïtienne comme conséquence de la révolution
française alors même que les données historiographiques montrent que le débat sur l’esclavage
durant la révolution française n’était pas clos. Dès lors, on perçoit la colonialité et l’ethnocentrisme
d’une réduction de la révolution haïtienne à l’humanisme de la révolution française. La révolution
haïtienne revêt plusieurs dimensions. La première est qu’elle est anti-esclavagiste, elle s’oppose à
un ordre social raciste capitaliste violent à une époque durant laquelle l’esclavage a été rationalisé
et s’inscrit comme une modalité capitaliste banale. De plus, cette révolution haïtienne provoqua des
révoltes d’esclavagisé-e-s dans d’autres colonies européennes : notamment au Vénézuela (les
révoltes de Coro/Maraicabo) ou à Cuba (révolte de Güines). Ce caractère translocal et
translinguistique montre sa puissance révolutionnaire au sein des communautés d’esclavagisé-e-s
Licence Creative Commons 4.0.
205
des Amériques, ce qui exprime la densité historique de l’afro-diaspora. En outre, tel que le suggère
l’historien Ngou-Mvé (2012), la révolution haïtienne est :
l’aboutissement de siècles de luttes et de résistances, plus ou moins abouties, des esclavagisé-
e-s africain-e-s depuis les côtes africaines jusqu’aux Amériques. En effet, des guerres contre
les Portugais en plein royaume du Kongo au travers du kilombo au XVI siècle jusqu’aux
révoltes, par exemple, au Mexique colonial ou en Colombie coloniale, les Africain-e-s, ont
cherché à se défaire d’un ordre colonial.
La deuxième spécificité est son caractère anti-colonial. La révolution haïtienne remet en cause des
niveaux de la colonialité du pouvoir et du savoir. Elle déconstruit le discours philosophique
hégelien sur l’incapacité des Noir-e-s à agir et à lutter contre l’esclavage. La dialectique du maître et
de l’esclave ne tient plus, ce n’est plus l’esclave qui préfère la vie à la liberté; avec la révolution
haïtienne, l’esclave préfère la mort à la poursuite d’une vie d’esclave. De même, la révolution
haïtienne s’appuie sur des éléments culturels qui ont été combattus par la colonialité du savoir
eurocentré (le Code Noir et l’institution esclavagiste), notamment la pratique du vaudou, les
cultes aux morts et la langue créole. Ainsi, même durant les affrontements, les esclavagisé-e-s ont
mobilisé des référents vaudous qui ont pu renforcer leur solidarité.
Références
Adler, Camilus. 2017. « La Révolution haïtienne de 1804 entre les études postcoloniales et les
études décoloniales latino-américaines ». Revue d’études décoloniales (2).
http://reseaudecolonial.org/2017/10/01/la-revolution-haitienne-de-1804-entre-les-etudes-
postcoloniales-et-les-etudes-decoloniales-latino-americaines/
Hurbon, Laënnec. 2007. « La révolution haïtienne : une avancée postcoloniale ». Collège
international de Philosophie 4 (58) : 56-66.
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2007-4-page-56.htm
Voir aussi à ce sujet :
« Penser Haïti avec et à travers Haïti : un regard décolonial. Jean CASIMIR ». Vidéo YouTube.
Chaîne de CAFE PHILO HAITI. 5 janvier 2019.
Licence Creative Commons 4.0.
206
https://www.youtube.com/watch?v=ENf6h-o_9qk&t=438s
https://www.youtube.com/watch?v=LwYmhxdqWB8
Licence Creative Commons 4.0.
207
Indépendances latino-américaines et caribéennes
SEBASTIEN LEFÉVRE
Nous n’avons pas intitulé cette entrée indépendance d’Abya Yala car la vision qui est présentée dans
tous les ouvrages est celle de l’« Amérique latine » ou de la Latino-amérique ou hispano-amérique,
etc. Et cette vision l’orientation européocentrée du regard. En effet, prenons l’exemple de la figure
quasi mythique des Indépendances : Simón Bolívar. Aux yeux de tous et de toutes, il est vu comme
le libérateur de l’Amérique du Sud. Cependant, Bolívar n’est pas le premier libérateur et pas non
plus le plus grand. En effet, la première indépendance est celle arrachée par des milliers
d’esclavagisé-e-s de l’île française de Saint Domingue (ultérieurement République d’Haïti), en
1804, une vingtaine d’année avant Bolívar… Or, bon nombre d’ouvrages font la part belle au
Libérateur sans mentionner l’exploit des hommes et des femmes de Saint Domingue qui ont dû
lutter contre une coalition militaire européenne unie pour l’occasion. Il est intéressant de poser cette
absence ou plutôt cette omission qui pourrait être considérée comme un lapsus colonial! Haïti
représente une rupture paradigmatique dans la modernité occidentale car elle réfute de fait tous les
argumentscoloniaux à l’égard des « Nègres » et constitue de fait un mouvement décolonial
victorieux.
Le paroxysme de tout cela est que, sans Haïti, Bolívar n’aurait pas pu mener à bien ces fameuses
campagnes de libération. Alors qu’il était en difficulté, ce dernier a demandé de l’aide au seul pays
qui ait accepté de le recevoir : Haïti. Le gouvernement d’Haïti a accepté de donner armes,
volontaires et bateaux à la seule condition qu’il libère partout où il les trouvera les esclavagisé-e-s.
Sauf que Bolívar n’a jamais accompli cette condition malgré l’aide qu’il avait reçue. Il ira même
jusqu’à exécuter un chef afrodescendant, José Prudencio Padilla, sous-prétexte que ce dernier aurait
conspiré contre lui et aurait envisagé une guerre raciale, étant donné que Padilla bénéficiait d’un
certain aura parmi les esclavagisé-e-s. Il faut dire que la révolte victorieuse d’Haïti hantait les
esprits et les élites créoles « blanches » avaient peur de perdre leur suprématie.
Par ailleurs, il faut signaler que derrière chaque grand libérateur « créole » (criollo), c’est-à-dire
descendant d’européen, se profile des descendant-e-s d’Africain-e-s. Souvent les chefs militaires
allaient recruter parmi les esclavagisé-e-s pour grossir les troupes, leur promettant leur libération.
Par conséquent, sans les troupes afrodescendantes, les victoires n’auraient pas été aussi nombreuses.
Nous pourrions avancer que cet argument est valable autant pour les libérateurs que pour les tenants
Licence Creative Commons 4.0.
208
du pouvoir péninsulaire car les afrodescendant-e-s luttaient pour ceux et celles qui leur promettaient
la liberté, peu importe le bord. Il s’agit bien évidemment d’un positionnement
stratégique.
En outre, d’autres afrodescendant-e-s ont joué un rôle majeur dans les processus d’indépendance, et
ce, dès les débuts de la conquête. Les premiers indépendantistes étaient ceux qui ont été mal
nommés Noirs marrons. Dénomination assignée une nouvelle fois par les représentants de l’ordre
colonial. « Marron » viendrait de l’espagnol cimarrón qui désignait le bétail échappé du troupeau et
qu’il fallait rechercher. Il serait nécessaire d’opérer une réflexion quant à ce problème de
catégorisation. Certes, ce mot représente la résistance, la rébellion, la fuite des esclavagisé-e-s, mais
il ramène ces derniers et dernières à une dimension animale problématique.
Quoiqu’il en soit, les premiers territoires libres d’Abya Yala ont été libérés par les Africain-e-s
esclavagisé-e-s. Les plus connus sont Yanga, qui a sévi près de l’actuel Veracruz au Mexique (XVI
et XVII siècles) et Benkos Bioho près de Cartagena en Colombie (XVI et XVII siècles). Il y eut
également Nanny en Jamaïque (XVIII siècle), Zumbi au Brésil (XVII siècle), Mabucha Algarín au
Vénézuela (XVIII siècle) ou encore Illescas en Équateur (XVI siècle).
Ces noms sont les plus connus mais il y en avait sûrement d’autres, qui n’ont pas été recensés ou
dont la mémoire n’a pas gardé trace. Néanmoins, les groupes de rebelles sont tous arrivés à faire
respecter leurs territoires et autonomies respectifs, où le pouvoir colonial ne pouvait pas entrer. Il
s’agit bien d’une souveraineté à part entière. Par conséquent, il n’est pas possible, comme c’est le
cas actuellement, de se contenter uniquement des figures tutélaires descendantes d’Européen-
ne-s telles que Simón Bolívar, car derrière chaque figure historique officielle se profile un-e
afrodescendant-e tout aussi fondateur et fondatrice des territoires d’Abya Yala. Nous pourrions citer
le cas, pour Cuba, de José Martí et d’Antonio Maceo. Le premier est excessivement connu pour son
rôle dans l’indépendance de Cuba et de la même façon que Simón Bolívar, il monopolise
pratiquement tout le discours révolutionnaire, alors qu’Antonio Maceo a joué un rôle prépondérant
pour libérer l’Est de l’île, mais ne bénéficie de la même reconnaissance ni dans l’imaginaire ni dans
les faits. Faut-il préciser que Maceo est afrocubain et que l’Est du pays est peuplé
majoritairement par des descendant-e-s d’Africain-e-s de Cuba et de la Caraïbe. D’ailleurs, toute sa
famille a participé à la guerre d’indépendance. À ce propos, deux chefs d’État de la Caraïbe et de
l’Amérique du sud ont reconnu ces mouvements fondateurs. Le premier fut Fidel Castro qui
avait reconnu, lors d’un discours, que les premiers révolutionnaires étaient les marron-e-s de Cuba.
Quant à Hugo Chávez, lors du tremblement de terre de 2010, il s’était empressé d’envoyer des
Licence Creative Commons 4.0.
209
vivres et du matériel pour venir en aide au peuple frère d’Haïti, car selon ses propos, Haïti avait aidé
Bolívar dans son entreprise de guerre d’indépendance et il fallait rendre ce geste de
solidarité.
Références
C.L.R., James. 2008. Les jacobins noirs. Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue.
Paris : Éditions Amsterdam.
De Fridemann, Nina S. 1993. La saga del negro, presencia africana en Colombia. Bogotá :
Universidad Javeriana.
Laviña, Javier, et José Luis Ruiz-Peinado. 2006. Resistencias esclavas en las Américas. Madrid :
Doce Calles.
Lucio Acosta, Carlos. 1983. « Yanga, primer pueblo libertador de América ». Universidad
Veracruzana 2 (20) : 41-42.
Navarrete, María Cristina. 2003. Cimarrones y Palenques en el siglo XVII. Santiago de Cali :
Universidad del Valle.
Licence Creative Commons 4.0.
210
54. Indien-ne/Indigène/Peuple originaire
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Ces trois catégories identificatrices posent la question de la nomination, de la désignation et de la
reconnaissance de groupes humains. Le terme « indien-ne », à partir de Abya Yala, renvoie à la
configuration coloniale du pouvoir, du savoir et de l’être. En effet, ce sont des centaines
de peuples présents aux Amériques qui ont été désignés comme «indiens », à partir de l’erreur
d’interprétation de Colomb, qui croyait être arrivé dans les « Indes ». Dans cette perspective, cette
imposition d’une identification nie la spécificité des groupes vivant sur les territoires bien avant
l’arrivée des Européen-ne-s. Par la suite, le terme va être associé à un régime social d’exploitation
économique (encomienda, etc). « Indien-ne » possède donc une charge coloniale dans la mesure où
ce vocable est l’expression de la domination économique, politique, identitaire des colons espagnols
sur les populations du continent.
L’anthropologue mexicain Bonfil Batalla disait à ce sujet qu’il s’agissait d’une catégorie supra-
ethnique qui ne dénote aucun contenu spécifique des groupes qui la constituent, sinon une relation
spécifique entre eux et d’autres secteurs du système social global dont ils font partie.
La catégorie d’indien dénote la condition de colonisé et fait référence à la relation coloniale. (Bonfil
Batalla, 1972) En outre, l’usage social contemporain de cette catégorie est très
dépréciatif car associé à des valeurs coloniales (l’Indien-ne serait le et la « non civilisé-e », le et la «
pauvre »). De plus, la marginalisation sociale et politique de ces populations s’est traduite au niveau
épistémique, certaines disciplines ayant œuvré pour le maintien de cette catégorie. Ainsi, au
Mexique, l’anthropologie naît de l’intérêt porté aux questions « indiennes». Le terme « indigène »
est souvent employé comme synonyme d’« indien- ne ». Or, selon Ana Luz Ramírez Zavala, ce
basculement semble intervenir après la deuxième décennie du XIX siècle. À l’origine, le terme
indigène renvoyait de manière générale à tout-e natif et native originaire d’un pays.
Cette acception consacre la différence culturelle des populations d’Abya Yala mais sous un angle
négatif : une infériorité culturelle. De nos jours, se maintient une valeur dépréciative du terme
associé à une hiérarchisation raciale et culturelle coloniale. Contrairement aux deux précédents
termes, l’expression « peuple originaire » est plus récente. Elle désigne le caractère ancestral des
populations vivant dans les Amériques et leur mode de vie différencié. Elle est utilisée dans
plusieurs mouvements sociaux pour souligner l’importance de modes de vie alternatifs au
capitalisme eurocentré.
Licence Creative Commons 4.0.
211
Ces trois termes ont été repris et critiqués d’un point de vue politique et théorique par les
communautés vivant dans le territoire d’Abya Yala. Comme d’autres configurations sociales et
historiques de domination et de stigmatisation, un processus de recalibrage de ces catégories a
permis de construire des mouvements de revendication des populations d’Abya Yala.
Ainsi, par exemple, dans de nombreux pays d’« Amérique Latine », les populations établissent leur
auto-identification dans leur langue et à partir de leur histoire.
Références
Bonfil Batalla, Guillermo. 1972. « El concepto de indio en América : una categoría de la situación
colonial ». Anales de Antropología 9 : 105-124.
http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/ 23077/pdf_647
Ramírez Zavala, Ana Luz. 2011. « Indio/indígena, 1750-1850 ». Historia Mexicana 60 (3) : 1643-
1681.
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/327
Voir à ce sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=25tRtSnsvms
Licence Creative Commons 4.0.
212
55. Inti Raymi
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Ceux qui ont envahi, conquis et massacré la population indienne sont arrivés il y a cinq cent ans et leurs descendants
sont toujours au pouvoir. Nous, nous réclamons nos droits en toute légitimité.
(CONAIE, 1990)
L’Inti Raymi, la fête du Soleil, de 1990, c’est la décolonialité en acte. À cette date, c’est-à-dire
avant la parution des grands textes critiques du courant décolonial, qui suivront l’anniversaire du
cinquième centenaire de la « Découverte », les Indien-ne-s de nombreuses régions de l’Équateur se
soulèvent à l’appel de la CONAIE (Confédération des Nationalités Indigènes
de l’Équateur). Cette dernière est une organisation créée quelques années auparavant. Elle marque
un changement dans les luttes indiennes qui ont gagné en autonomie par rapport aux partis
traditionnels. Ce soulèvement créa une véritable stupeur dans un pays où existait pourtant une
remarquable tradition de révoltes depuis la Conquête. Les actrices et acteurs eux-mêmes ne
s’attendaient pas à un tel succès. Il est certain qu’une fois de plus, la question de la terre fut au
centre du mouvement.
Mais cet appel de la CONAIE fut seulement le relai d’une démarche autonome des communautés et
des cabildos (assemblées indigènes). Pour des historien-ne-s du mouvement comme Pablo Ospina,
la CONAIE fut beaucoup plus le produit du soulèvement que sa cause. L’année 1990 créerait
le succès et la force de rassemblement de la CONAIE. Le mouvement, plus suivi en région andine
qu’en région amazonienne, désorganisa la vie nationale au début du mois de juin 1990. Les Indien-
ne-s paralysèrent le pays, coupant les routes, occupant des grandes propriétés terriennes, gênant
l’approvisionnement des villes, empêchant la tenue de marchés ou affrontant les forces de police.
Il ne s’agissait pas seulement d’obtenir des réponses à des revendications anciennes ni d’exiger la
reconnaissance d’une identité culturelle ou ethnique. Le but, manifeste dans la liste de
revendications présentée par la CONAIE, était de s’affirmer non pas en tant qu’ethnies mais
en tant que nationalités.
Ils ont affirmé la catégorie des nationalités contre celle des ethnies, car ils considéraient que cette dernière était
une dénomination extérieure au mouvement (…). En s’affirmant en tant que nationalités, ils ont remis en
question le caractère « uninational » de l’État, qu’ils percevaient comme la continuation de la domination
coloniale et ont refusé de se se dissoudre dans l’identité nationale métisse. (Rodriguez, 2012 : 208)
Licence Creative Commons 4.0.
213
Les seize points de la liste des revendications de la CONAIE comprenaient, entre autres, la
résolution des conflits fonciers, l’annulation des dettes envers les banques de développement, la
prise de responsabilité de l’État dans l’éducation bilingue et l’autodétermination territoriale, mais
aussi la reconnaissance des nationalités autochtones, de territoires autonomes en Amazonie et le
passage à un État plurinational. Et ces demandes furent celles qui soulevèrent le plus de rejet.
Ce Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas fut finalement
pris en compte par le gouvernement qui prétendit presque aussitôt que les Indien-ne-s étaient
manipulé-e-s — un classique depuis la Colonie — et leur demanda d’arrêter leurs actions s’ils et
elles voulaient négocier.
Puissant, déterminé, le mouvement n’arriva pas, finalement, à établir un véritable dialogue avec le
gouvernement. Mais c’était la première fois qu’un mouvement indigène autonome et national se
manifestait avec une ampleur aussi spectaculaire. Et il y avait là le début d’un processus qui
aboutirait à UN changement social profond. Plus tard, en 1998, la Constitution reconnaîtrait
le caractère multiculturel de la nation, le droit des indigènes à une certaine forme d’autonomie.
À peu près à la même époque, celui qui fut le leader charismatique de la CONAIE, Luis Maca,
écrirait :
Pour le mouvement indigène, le pouvoir réside dans les communautés, dans la capacité réelle et effective qu’ont
nos organisations, la commune, le centre, la coopérative, de décider de manière souveraine, indépendante,
participative, juste et éthique du destin de chaque peuple, de chaque personne. C’est là que réside l’essence du
pouvoir. Ce que le mouvement indigène a toujours proposé, c’est une construction du pouvoir par le bas, par les
bases, par les fondations.
L’idée n’est pas nouvelle. Aujourd’hui, on dit que les Indiens voulaient prendre le pouvoir, mais il ne s’agissait
pas d’attaquer le Congrès national, le palais du gouvernement. En réalité, il s’agissait de mettre en place des
mécanismes, non pas pour prendre le pouvoir, mais pour ouvrir l’espace politique à la construction d’un pouvoir
démocratique et participatif. (Maca, 2000)
La diversité culturelle, la reconnaissance de l’interculturalité, la revendication d’un État
plurinational commencèrent à faire partie du débat politique après le soulèvement d’Inti Raymi. Et
il est remarquable que ce soulèvement indien ait réussi à réunir autour de lui la plupart des secteurs
populaires opposés au système néolibéral depuis les années 1990. Le soulèvement de 1990 rendit
possible la démocratisation de la société équatorienne dans son ensemble. C’est là qu’apparaît la
puissance décoloniale : un groupe racisé, de par la position cruciale qu’il occupe dans la société, en
Licence Creative Commons 4.0.
214
remettant en question la domination dont il est victime, conteste la structure globale de la société et,
en particulier, un nationalisme intrinsèquement lié au racisme. Pour les mouvements indiens
d’Amérique latine, le soulèvement de l’Inti Raymi joua un rôle fondamental et leur plateforme de
revendications inspira celle d’autres organisations et mouvements.
Références
Macas, Luis. 2000. «Diez años del Levantamiento del Inti Raymi en Ecuador». América latina en
Movimiento.
https://www.alainet.org/es/active/764
Rodriguez, Edwin. 2012. Movimientos indígenas, identidad y nación en Bolivia y Ecuador. Una
genealogía del estado plurinacional. Quito : Abya Yala.
https://www.academia.edu/36987913/MOVIMIENTOS_IND
%C3%8DGENAS_IDENTIDAD_Y_NACI%C3%93N_EN_BOLIVIA_Y_ECUADOR
Taylor, Anne-Christine. 1994. « Santana R. Les Indiens d’Equateur, citoyens dans l’ethnicité ? ».
Journal de la Société des Américanistes. Tome 80 : 358-366.
www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1994_num_80_1_1568
Zibecchi, Raul. 2019. « De la Comuna de Quito al estallido en Chile ». Ecuador, 1ª parte.
Entrepobos.
https://www.entrepobos.org/news/de-la-comuna-de-quito-al-estallido-en-chile-ecuador-1a-parte/
Licence Creative Commons 4.0.
215
56. Kilombo, Mocambo, Palenques, Cumbes
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Ces quatre termes renvoient à un ensemble de pratiques de résistance utilisées par les esclavagisé-e-
s africain-e-s depuis l’Afrique jusque dans les colonies ibériques en Amérique. Désigné au Brésil
colonial comme « kilombo », ou « mocambo » (cachette en imbundu), au Mexique comme «
palenque », au Vénézuela comme « cumbe », il s’agissait d’une même réalité : la constitution
d’espace de liberté pour des esclavagisé-e-s africain-e-s affrontant l’institution esclavagiste
espagnole ou portugaise.
Tout d’abord, il convient de préciser l’antécédent africain de la résistance face à la Traite
transatlantique. Au XVI siècle, les Portugais sont présents en Afrique Centrale et entament des
relations avec l’ancien Royaume du Kongo (qui s’étendait de l’actuel Gabon jusqu’en Angola)
avant 1492. Par la suite, la rapide exploitation économique de l’Amérique par les
Espagnols, le besoin de main d’œuvre, l’union des couronnes d’Espagne et du Portugal vont être
des circonstances qui vont faire débuter la Traite transatlantique à partir de la région de l’Afrique
Centrale. Ainsi, les commerçants et militaires portugais vont fournir aux Espagnol-e-s une main
d’œuvre africaine à partir de la région du Kongo de l’époque, principalement entre 1580 et 1640.
De là surgissent des premières résistances africaines : la fuite face aux Portugais et l’affrontement.
Ce fut le principal fait des fameux Jaggas, ou Imbangala, des guerriers mobiles, utilisés ou
combattus par le royaume du Kongo et qui finirent par imposer leurs efficaces techniques
de guerres. Selon l’historien Ngou-Mvé, ces dernières comportaient notamment l’édification de
camps retranchés et fortifiés, des techniques d’embuscades et des rites d’intégration transethnique.
Le camp et la communauté de guerriers étaient désignés sous le terme « kilombo ». Or,
l’observation par les Portugais, qui combattaient donc déjà les Imbagala en Afrique, d’un
phénomène similaire au Brésil fit en sorte qu’ils le désignèrent de la même manière : « quilombo ».
Ensuite, concrètement, il s’agissait pour les esclavagisé-e-s africain-e-s d’échapper au joug
esclavagiste en s’installant dans des territoires éloignés et généralement très difficiles d’accès, car
protégés par le relief. La communauté s’organisait généralement autour d’un chef qui avait eu une
expérience et une sociabilité africaine : Yanga au Mexique, Bayano au Panama, Zumbi au Brésil,
Benkos Biohó en Colombie. Elle accueillait des esclavagisé-e-s en fuite et pouvait constituer une
milice capable de harceler les forces espagnoles ou portugaises. En outre, il s’agissait dans ces
Licence Creative Commons 4.0.
216
territoires de reconstruire des pans de la culture africaine à partir des premières générations
d’esclavagisé-e-s grâce aux langues, à la similarité des paysages, à une filiation transafricaine.
Par conséquent, ces quatre termes désignent une organisation spatiale, sociale, culturelle et
épistémologique de la résistance des esclavagisé-e-s depuis l’Afrique jusque dans les Amériques.
L’organisation de la résistance face à l’esclavage a pris sa forme la plus aboutie dans l’instauration,
la continuité de ces communautés et leur capacité à recourir à des savoirs- faire antérieurs à leur
expérience d’esclavagisé-e-s tout en s’adaptant face aux nouvelles configurations. On peut
considérer ces organisations comme des réponses très précoces à l’épistémicide colonial et au
processus de domination. Par ailleurs, le recours à cette expérience de résistance par les
afrodescendant-e-s contemporain-e-s montre l’importance de cet espace- temps transversal à toutes
ces communautés et, par-là même, leur conscience de leur présence au monde.
Références
Landers, Jane. 2005. « Una cruzada americana: expediciones españolas contra los cimarrones del
siglo XVII ». Pautas de convivencia étnica en la América Latina colonial (indios, negros, pardos y
esclavos), sous la dir. de Juan Manuel Serna : 73-87. México : CCyDELUNAM/Universidad de
Guanajuato.
Ngou-Mvé, Nicolas. 2008. « Los orígenes de las rebeliones negras en el México colonial».
Dimensión antropológica.
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1228
Voir à ce sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=zIy8DK7dkoo nº16.Kilombo, Mocambo, Palenques, Cumbes
Licence Creative Commons 4.0.
217
57. Lander, Edgardo
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Vénézuélien, Edgardo Lander est un sociologue, professeur émérite de l’Université Centrale du
Vénézuela. Dans les années 1990, il a travaillé avec les membres du projet Modernité/Colonialité et
publié, entre autres, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas (1993). Dans l’article qu’il y écrivit, il soulignait déjà la difficulté de construire
une alternative théorique et politique au néolibéralisme. Il remarquait que la caractéristique de cette
pensée est la naturalisation des relations sociales. L’idée que la société actuelle serait l’expression
d’un phénomène naturel, fatalement, a débouché sur ce qui existe aujourd’hui, un monde « sans
idéologies ». Il propose donc de débattre et d’affronter le néolibéralisme pour ce qu’il est :
le discours hégémonique d’un modèle civilisateur, c’est-à-dire une synthèse extraordinaire des
hypothèses et des valeurs fondamentales de la société libérale moderne concernant l’être
humain, la richesse, la nature, l’histoire, le progrès, le savoir et le bien vivre. (Lander, 1993)
D’après lui, cet art du discours néolibéral, qui arrive à faire passer son mythe fondateur pour une
connaissance scientifique, est sa grande force. Mais ce discours n’a pu s’imposer que parce que les
mouvements ouvriers et les projets alternatifs ont disparu des sociétés contemporaines, ce qui
permet de présenter l’état actuel de consensus apparent et de domination réelle comme la fin de
l’histoire. Cependant, ce mythe fondateur a une histoire : elle remonte à plusieurs siècles. Pour
déconstruire son caractère prétendument naturel et universel, il faut remettre en question les
instruments qui lui donnent une caution scientifique. Et il relève les tendances qui sont allées à
l’encontre de cet universalisme dans le monde : les diverses courants de la critique féministe, la
remise en question de l’histoire européenne comme histoire universelle, la critique de
l’orientalisme, l’apport des études subalternes indiennes, la production d’intellectuel-le-s africain-e-
s et les études postcoloniales.
Pour lui, deux éléments expliquent le pouvoir « naturalisateur » des disciplines modernes : la
tendance à la séparation de la réalité en unités autonomes et le dispositif de savoir/pouvoir dans
lequel s’insèrent ces savoirs. Historiquement, la première séparation s’opère au début de l’ère
moderne, avec l’idée de Dieu qui se développe en Occident, lorsque nature, humanité et Dieu sont
séparés, scission qui rendra possible un rapport instrumental à la nature. Puis, avec l’Illustration et
le développement des sciences, cette tendance s’accentuera, notamment à partir la rupture corps/
Licence Creative Commons 4.0.
218
esprit, monde/raison de Descartes, le monde devenant un mécanisme vide de spiritualité qui peut
être capturé par la raison scientifique.
Aujourd’hui, Lander est membre de la Plateforme de Défense de la Constitution. Il fait partie du
groupe de travail permanent de la Fondation Rosa Luxembourg et travaille sur les alternatives au
développement en association au Transnational Institute.
Longtemps soutien du gouvernement Chavez, à partir de l’année 2013, il a pris ses distances avec le
gouvernement. En 2017, il signe Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución dont les
membres avaient été des supporters de Chavez mais critiquaient son successeur, Maduro. La
déclaration appelait à boycotter l’assemblée constituante car elle ne remplissait pas le rôle de
dialogue que Maduro s’était engagé à lui donner. En 2019, une autre déclaration incriminait
également les actions de Maduro, mais s’opposait à l’intervention des États-Unis ainsi qu’à la
proposition d’un État parallèle piloté par l’opposant, Juan Guaido, ce qui risquait, d’après les
signataires, d’entraîner une guerre civile. En 2019, il a néanmoins rencontré Guaido, ce qui a ravivé
des divergences déjà présentes à l’intérieur du camp décolonial.
Références
Lander, Edgardo. 1993. «Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos», Dans La
colonialidad del saber: eurocentrismo y cienciassociales. Perspectivas latinoamericanas, sous la
dir. de Edgardo Lander. Buenos Aires: CLACSO : 12.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/lander.html
Lander, Edgardo. 2018. «Amérique latine : la fin d’un age d’or? Progressismes, post-libéralisme et
émancipation radicale», entretien avec Frank Gaudichaud et Miriam Lang. Contretemps.
https://www.contretemps.eu/amerique-latine-progressismes- neoliberalisme-emancipation/
Lander, Edgardo. 2019. «Venezuela. La lutte pour le pouvoir et le besoin d’une sortie négociée».
Barril. Info.
https://www.barril.info/fr/actualites/la-lutte-pour-le-pouvoir-et-le- besoin-d-une-sortie-negociee
Licence Creative Commons 4.0.
219
58. Lugones, Maria
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La philosophe argentine Maria Lugones, décédée le 14 juillet 2020, est une des principales
références du féminisme décolonial latino-américain.
Elle enseignait aux États-Unis et a toujours milité au sein du « feminismo de color ». Ce terme
renvoie à une coalition rassemblant des femmes de différentes origines ethno-raciales. « Mujer de
color » ne désigne pas ce qui sépare mais véritablement une coalition de femmes ciblées par la
colonialité, Noires comme Indiennes. Elle vise la constitution de sujets en lutte au-delà
d’une reconnaissance de leurs « droits ».
La théorie décoloniale de Maria Lugones repose sur plusieurs notions ou critiques : la mise en cause
de la naturalisation du genre, l’usage de la catégorie d’engeneramiento et le concept de « système
de genre moderne-colonial ». Elle a entrepris, au début du siècle, une réflexion qui articule
les apports de la théorie décoloniale (ceux de Quijano sur la racialisation du travail) et ceux du
Black Feminism (les œuvres de Audre Lorde ou de Patricia Hill Collins). Son travail se situe dans la
continuité de celui des penseuses chicanas Chema Sandoval et Gloria Anzaldúa qui ont insisté sur la
question des identités « métissées ». Cette dernière notion s’appliquant chez Anzaldúa à la fois à la
question raciale et aux questions de genre. Maria Lugones affirme :
Jamais je n’ai pensé comme une Blanche métisse eurocentrée. Le métissage est pensé de différentes manières
dans les différents endroits d’Amérique latine, y compris le sud-ouest des États-Unis.
(García Gualda, 2014)
Le concept de métisse, nous dit-elle, varie avec le lieu d’énonciation et son sujet. Il ne doit pas être
confondu avec l’idée de métissage manipulée par les États nationaux latino-américains. Ce
métissage-facteur d’intégration est inséparable d’un blanchiment de la notion. La métisse
d’Anzaldúa, de Sandoval et de Lugones est la métisse sur le territoire étasunien. C’est à
partir de ces éléments que la philosophe essaie de penser une politique des
coalitions.
Son rôle dans le courant décolonial est singulier car elle a été la première à articuler la colonialité
du pouvoir et du genre. Fait essentiel : son point d’énonciation. Elle part de l’oppression des
femmes racialisées. Dans un article de 2008 qui vient enfin d’être traduit en français, « Genre et
colonialité », elle pondère l’analyse de Quijano :
Licence Creative Commons 4.0.
220
Le prisme de Quijano présuppose également des interprétations patriarcales et hétérosexuelles des conflits autour
du contrôle du sexe, de ses ressources et de ses produits. Quijano accepte
l’interprétation globale, capitaliste et eurocentrée, de ce qui est censé relever du genre. Ces éléments du cadre
théorique servent à masquer les manières dont les femmes colonisées « non blanches » ont été assujetties et
privées de leur pouvoir. On peut établir le caractère hétérosexuel et patriarcal oppressif de ces arrangements, en
dévoilant les présupposés du cadre conceptuel. En effet, il n’est pas nécessaire que les relations sociales soient
organisées en termes de genre — pas même les relations sociales qui sont considérées comme sexuelles.
(Lugones, 2019)
Elle continue la critique de cette analyse en disant :
Dans le modèle (schéma) de Quijano, le genre semble être contenu dans l’organisation de ce « domaine de base
de l’existence » qu’il appelle « le sexe, ses ressources et ses produits ». C’est-à-dire qu’il existe dans ce cadre
théorique une description du genre qui n’est pas elle-même soumise à un examen attentif, qui est trop étroite et
sur-biologisée, car elle présuppose le dimorphisme sexuel, l’hétérosexualité (…). Quijano présente le sexe
comme ayant une qualité biologique, par contraste avec le phénotype, qui n’inclut pas d’attributs biologiques
différentiels. « La couleur de la peau, la forme des yeux et des cheveux, n’ont aucun rapport avec la structure
biologique » (Quijano, 2000b, 373). Le sexe, en revanche, semble être considéré comme biologique par Quijano,
sans que cela ne pose de problème. Il caractérise la « colonialité des relations de genre », c’est-à-dire la mise en
ordre des rapports de genre autour de l’axe de la colonialité du pouvoir, comme suit distribution patriarcale du
pouvoir et ainsi de suite. (Lugones, 2019)
Et elle conclue à la nécessité de déterminer ce qui se passait dans le monde précolonial, de voir si
on pouvait parler d’une organisation en fonction du genre, questionnement qui aboutira à la
négative. Elle postule donc l’existence d’un monde pré-conquête où la colonialité de genre n’aurait
pas existé pour la simple raison que le genre serait une conception propre à la modernité. Pour elle,
colonialité du genre et colonialité du pouvoir se présupposent l’une l’autre, il faut que la race soit un
principe organisateur pour que le genre apparaisse. La réalité, c’est ce qu’elle nomme « le système
de genre moderne colonial ». Soulignons que, pour elle, le genre n’est pas synonyme d’identité,
donc quand elle affirme qu’il n’y a pas de genre dans le monde pré-colonial, elle veut parler d’un
système de genre et d’une catégorie d’analyse.
Comprendre la place du genre dans les sociétés précoloniales est essentiel pour saisir la nature et l’ampleur des
changements dans la structure sociale imposés par les processus constitutifs du
capitalisme moderne/colonial euro-centré. Ces changements furent introduits par des processus lents, discontinus
et hétérogènes qui infériorisèrent violemment les femmes colonisées. Le système de genre mis en place était
Licence Creative Commons 4.0.
221
largement façonné par la colonialité du pouvoir. Comprendre la place du genre dans les sociétés précoloniales est
également essentiel pour mesurer l’étendue et
l’importance du système du genre dans la désintégration des relations communales, des relations égalitaires, de
la pensée rituelle, de la prise de décision collective, de l’autorité collective et des
économies. Et ainsi, comprendre à quel point l’imposition de ce système de genre était aussi constitutive de la
colonialité du pouvoir, que la colonialité du pouvoir le constituait. (Lugones, 2019)
Son appréhension du rapport genre/race apparaît clairement quand elle dit, à propos du féminicide,
qu’on ne meurt pas parce qu’on est une femme; on meurt parce qu’on est une femme indienne ou
une femme noire. Car on n’est pas « femme » mais femme noire, métisse, etc. D’où sa vision
critique d’un féminisme occidental blanc qui s’est construit au XIX siècle, du côté clair du monde
moderne colonial, à partir de la situation des femmes blanches. Dans ce courant de pensée, il est
question des « femmes » en général, comme si toutes les femmes étaient reconnues comme telles
alors que les femmes racisées n’ont pas ce statut. Dans le monde colonial, il n’ y a pas de femmes
mais des femelles; les femmes sont réduites à l’état de « nature ». Pourtant, pour les Occidentales,
femme blanche = femme. Le féminisme des années 1970 s’est construit sur cette base, il visait la
défense des femmes blanches. La sororité fut construite à partir d’un genre qui n’était pas
questionné, d’une identité corporelle de femme. Historiquement, les femmes blanches ont été
construites comme fragiles et sexuellement passives, ce qui les opposait aux femmes noires
puissantes et sexuellement actives. La faiblesse des femmes blanches les rendait vulnérables, mais
elle était à la fois ce qui rendait nécessaire la protection de l’homme et ce qui pervertissait. Elles
étaient sensées ne pas désirer et l’homme qui les désirait, s’il avait droit à leur corps dans le cadre
du mariage, pratiquait en fait un viol légal. Le système de genre se renforça au moment de la
modernité tardive. Côté clair, métropole, il excluait les femmes blanches de la sphère du pouvoir
et du savoir, et il imposait une hétérosexualité qui permettait le contrôle de la reproduction. Côté
obscur, colonial, il ne prévoyait pas de protection pour la femme racisée car elle était considérée
comme sexuellement agressive donc coupable de l’agression du mâle. D’autre part, la force
physique qu’on lui attribuait légitimait un travail forcé qui entraînait souvent à la mort. Ces
caractéristiques se sont mises en place avec la colonisation et subsistent après la décolonisation. La
situation a même empiré dans des pays comme le Mexique, le Brésil ou la Colombie, où le
féminicide a atteint des proportions effrayantes.
Dans une interview de 2014, à propos de la résistance qu’opposent à la colonialité de genre les
femme racisées, Maria Lugones développe l’idée d’une résistance ancrée dans des ontologies
relationnelles autres et le pouvoir de voyager entre des mondes. Cette idée apparaissait déjà dans un
Licence Creative Commons 4.0.
222
texte de 2011 dans lequel elle évoquait le voyage entre plusieurs mondes des femmes racisées qui se
déplacent dans un monde blanc et anglo-saxon. Elle insiste sur la richesse intérieure de ces
voyageuses, sur leur flexibilité, leur capacité de jouer, pas le jeu agonistique qui a pour but
l’affirmation d’une compétence mais le jeu comme ouverture et perception non arrogante des
autres femmes.
J’ai conscience de ce que voyager avec une attitude joueuse est quelque chose que nous devons faire pour
résister et répondre au capitalisme colonial moderne, à l’intersection de la race/genre/
classe/sexualité. Mais j’avance, je propose, j’offre cette pratique comme une pratique libératoire grâce à laquelle
nous voyageons dans les mondes de résistance les unes des autres, à l’intersection/
fusion de multiples oppressions. (Lugones, 2011b)
Références
Anzaldúa, Gloria. 2011a. « La conscience de la Mestiza. Vers une nouvelle conscience ». Les
Cahiers du CEDREF.
https://journals.openedition.org/cedref/679
Lugones, Maria. 2011b. « Attitude joueuse, voyage d’un « monde » à d’autres et perception aimante
». Les Cahiers du CEDREF : 14.
http://journals.openedition.org/cedref/684
Lugones, Maria. 2008. « Colonialidad y género ». Tábula rasa. n° 9.
http://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf
García Gualda, Suya. 2014. « Género y decolonialidad : debates y reflexiones. Entrevista a María
Lugones ». Otros Logos : 213.
Lugones, Maria. 2019. « La colonialité du genre ». Les Cahiers du CEDREF : 51.
56. 72.
http://journals.openedition.org/cedref/1196
Licence Creative Commons 4.0.
223
59. Lumbalú
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Les Lumbalú sont des cérémonies funéraires spécifiques aux populations afro-colombiennes de la
communauté San Palenque. Cette dernière a été un palenque fortifié, c’est-à-dire un territoire ou un
village fondé par les esclavagisé-e-s africain-e-s qui ont résisté à l’esclavage. Il est situé près de
Carthagène qui fut le principal port négrier, durant l’époque coloniale, de la Colombie. Le port de
Carthagène, comme celui de Veracruz au Mexique, reçut principalement des esclavagisé-e-s
originaires d’Afrique centrale. Ces cérémonies funéraires sont destinées aux personnes ayant été
membres de la confrérie de la communauté. Le terme fait référence au nom du tambour principal
qui est utilisé pour les chants et la danse funéraires. Le vocable lumbalú désigne en kikongo la
mélancolie. L’organisation en confréries par les esclavagisé-e-s africain-e-s fut une organisation
transversale à toutes les colonies ibériques durant l’époque coloniale. Les chants funéraires portent
des traces de références à l’Afrique centrale, comme Luango, Congo, Angola, Zumbi. Il s’agit donc
d’une pratique associant musicalité, oralité, corporalité et religiosité (celle des cultes des morts)
relevant d’une vision du monde non européo-centrée. Elle montre ainsi la persistance d’un savoir-
être et savoir-faire ayant résisté aux épistémicides coloniaux.
Références
Escalante, Aquiles. 1989. « Significado del Lumbalú, ritual funerario del Palenque de San Basilio ».
Huellas 26 : 11-24.
Friedmann, Nina. 1990. « Lumbalu: ritos de la muerte en Palenque de San Basilio, Colombia ».
Filología y Linguistíca 16 (2) : 51-63.
Hernández, Rubén. 2014. « Identidad cultural palenquera, movimiento social afrocolombiano y
democracia ». Reflexión política 16 (31) : 94-113.
Voir à ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=0PSvBL-zAJM
Licence Creative Commons 4.0.
224
60. Maldonado Torres, Nelson
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Enseignant à la Rutgers University, à New Brunswick, dans le New Jersey, Nelson Maldonado-
Torres est un philosophe qui a participé à la construction du projet Modernité/Colonialité dès les
années 1990. Comme Ramón Grosfoguel, il est natif d’une des « plus vieilles colonies de
l’Occident, Porto Rico », et c’est aussi dans cette expérience que s’enracine sa réflexion.
Secrétaire, puis président de l’Association caribéenne de philosophie entre 2008 et 2013, très
engagé dans son travail pour l’association Frantz Fanon, il porte depuis longtemps un intérêt
particulier aux questions relatives aux Caraïbes et à l’émigration caribéenne aux États-Unis. Son
domaine de recherche est la pensée décoloniale et la question de la décolonisation. Son
approche accorde une place centrale à l’éthique et à la colonialité de l’être, concept dont il a exploré
les implications. Sa réflexion sur le racisme repose autant sur sa connaissance du corpus théorique
décolonial latino-américain que sur la pensée de Frantz Fanon, Aimé Césaire ou Sylvia Wynter. Elle
passe par une analyse de l’histoire des Caraïbes, de la pensée panafricaine, des
études ethniques ou encore de la situation des émigré-e-s caribéen-ne-s aux États-Unis. Comme
Ramón Grosfoguel, cet universitaire accorde une grande importance à l’engagement politique qui
est le versant pratique de l’attitude décoloniale, ce qui se traduit, par exemple, par sa participation
aux luttes des étudiant-e-s sud-africain-e-s.
Depuis Against war (2008), il développe une réflexion sur la colonialité de l’être qui rencontre
souvent celle de Dussel. Dans ce livre, l’auteur se penche sur la naissance de la subjectivité
moderne, incarnée dans le personnage du conquérant espagnol Hernán Cortés. Cortés, pris pour un
Dieu par les Aztèques, se considérerait lui-même comme tel et agirait en conséquence. Avec le
désastre de la Conquête du Mexique se mettrait en place une non éthique de la guerre, qui
représenterait « la suspension ou le déplacement radical des relations éthiques et politiques au profit
d’une éthique particulière de la mort qui naturalise le massacre et les différentes formes de génocide
» (Maldonado Torres, 2016).
Cette subjectivité nouvelle est marquée par ce que Dussel avait identifié comme ego conquiro.
Nelson Maldonado Torres prolonge cette réflexion en recourant à des notions comme la « négation
ontologique » ou le « scepticisme misanthrope colonial raciste », doute fondamental sur
l’humanité de l’Autre, ce barbare. Le scepticisme misanthrope est le ver au cœur même de la
Licence Creative Commons 4.0.
225
modernité. Les réalisations de l’ego cogito et de la rationalité instrumentale s’inscrivent dans la
logique que ce scepticisme misanthrope a aidé à établir. C’est la raison pour laquelle l’idée de
progrès a toujours eu, dans le modernité, un champ limité : progrès, oui, mais pour certains
seulement. C’est pour cela que les droits de l’homme ne s’appliquent pas de la même façon à tous,
une contradiction évidente parmi d’autres contradictions Le scepticisme misanthrope fournit la base
permettant d’opter pour l’ego conquiro, le système dans lequel il devient concevable que la
protection de certains soit obtenue au prix de la vie d’autres. Cette attitude impériale rend possible
une position fondamentalement génocidaire à l’égard des sujets colonisés et racialisés. Avec elle, les
sujets coloniaux et racialisés deviennent des sujets « jetables ». (Maldonado Torres, 2007)
Ce scepticisme est donc à la base de la colonialité de l’être, dont Nelson Maldonado Torres
développera l’analyse dans On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a
Concept (2007). Il rend possible la « négation ontologique» dont nous parle le philosophe
portoricain. Et c’est là qu’apparaît le lien entre colonialité de l’être et colonialité du savoir. La
Modernité/Colonialité est une sorte de catastrophe métaphysique qui naturalise la guerre, idée que
nous retrouverons plus tard dans les Ten Theses on Coloniality and Decoloniality (2016).
Pour ce qui est de la conception de l’humanité qui la sous-tend et des rapports humains qu’elle
produit, la Modernité/Colonialité constitue une véritable catastrophe. À partir de ce moment-là, les
populations mondiales ont été divisées en fonction de degrés d’humanité, et plus seulement des
pratiques ou croyances spécifiques qui étaient les leurs. Cette catastrophe peut être qualifiée de
métaphysique parce qu’elle a transformé la signification et les relations de domaines de
base de la pensée et de l’être, en particulier le rapport entre le soi et l’autre, ou la temporalité et la
spatialité. (Maldonado Torres, 2016)
Cette catastrophe, qui aboutit à l’existence de ce groupe de Damnés dont Fanon a analysé
l’expérience, amène le philosophe à poser la question de l’identité de l’Europe et de la modernité. Il
considère en effet que c’est cette expérience qui permet, oblige, l’Europe à comprendre sa propre
identité et la réalité de son projet historique. En ce sens, son travail trouve un écho dans la
perspective du français Norman Ajari qui pose lui aussi la nécessité de partir de l’expérience de
l’esclavage pour penser la modernité et la non éthique de l’homme blanc.
La non éthique de l’homme blanc imprime sa marque même aux réalisations les plus « éthiques »
de l’Occident, comme l’idéologie des droits humains. Dans le sillage d’autres auteurs décoloniaux
et autrices décoloniales, entre autres Ramón Grosfoguel, Catherine Walsh et Aníbal Quijano, Nelson
Maldonado Torres a écrit l’article « On the Coloniality of Human Rights » en 2017. Il y revient sur
sa généalogie du système des droits humains, son inscription à l’intérieur d’un projet humaniste de
Licence Creative Commons 4.0.
226
plus en plus marqué par la sécularisation. Pour lui, cette idéologie qui prend forme au XVIII siècle
constitue une transformation du discours de la « chaîne de l’être au Moyen Âge » parce que l’idée
de chaîne, et la pensée analogique qui la sous-tendait, s’efface au profit du tracé d’une ligne de
démarcation entre le divin, l’humain et l’animal. Cette ligne apparaît au XVI siècle, dans l’œuvre de
l’humaniste Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate, remaniement de l’histoire chrétienne
de la Rédemption. Cette nouvelle Genèse place l’humain entre Dieu et les animaux, l’humain
s’affirmant comme doué d’une ouverture et de possibilités absentes dans la « Nature ». Et ce
discours se présente comme celui de la dignité. Un saut qualitatif se produira lorsque cette dignité, à
la fin du XVIII siècle, ne sera plus une simple assertion mais prendra la forme d’une Déclaration.
Un nouvel ordre social se construira à partir de cet ordre discursif inédit qui avait commencé à
émerger au XVI siècle. Il passerait entre autres par le discours de la méthode de Descartes, l’essai
sur l’entendement humain de Locke, le traité sur la nature humaine de Hume et, plus tard, par le
discours sur l’origine de l’inégalité de Rousseau. Des discours tous constitutifs de la colonialité du
savoir.
Au XX siècle, Fanon et Césaire contre-attaqueront ce discours structurel de la modernité, réalisant
ce que Sylvia Wynter nomme une nouvelle oratio. Un tournant décolonial. Si les philosophes
modernes avaient remis en question le discours chrétien, Césaire et Fanon remettront en
question l’ordre moderne colonial et ses narrations et ce, à partir de l’expérience vécue des
colonisé-e-s. Ils déconstruiront ce discours qui, pour faire une nouvelle place à l’humain, doit le
séparer de la nature et des animaux. Ils montreront que le concept de l’humain qui s’impose passe
par une ligne de couleur qui distingue les humains des autres et fait mesurer l’humanité en terme de
degrés. Il est indispensable de comprendre que la ligne manichéenne qui se trace alors joue un rôle
aussi important dans la constitution de la modernité et la montée du discours des droits humains que
le phénomène de la sécularisation. Cette ligne divise le monde en zones claires, celles de la
civilisation, des droits humains et zones d’ombre, celles où il n’ y a pas de droits mais la mort
prématurée et la torture. Césaire et Fanon se demandent qui parle au nom de l’humain dans le
discours des droits humains, qui sont ces expert-e-s qui expliquent aux colonisé-e-s qu’ils et elles
ont des droits. Au XX siècle, la Déclaration universelle des droits humains sera la nouvelle forme
du discours des droits humains, qui incorporera la nation au nouvel ordre mondial (Cours de justice
internationales, ONU, etc.). Nelson Maldonado Torres estime que la suite de la décolonisation a
montré que, souvent, les droits humains étaient le cheval de Troie d’un impérialisme culturel. Il
considère nécessaire autant qu’ardu de construire une théorie critique des droits humains, du point
Licence Creative Commons 4.0.
227
de vue de la décolonisation, dans la lignée de ce qui a déjà été fait par la philosophie de la libération
et son éthique de l’altérité.
Cette question de la décolonisation est au centre de ses travaux. La décolonisation en acte passe par
une lutte, aux cotés des damné-e-s du XXI siècle. Il s’en suit que l’enjeu continue de résider dans la
lutte contre les relations coloniales formelles, mais aussi dans l’élaboration de stratégies
d’opposition et de changement orientées contre les dimensions coloniales, racistes et
déshumanisantes des États-nations et d’une matrice de pouvoir mondiale que l’on ne saurait réduire
à sa dimension capitaliste. (Maldonado Torres, 2011)
Fanon lui-même, dans Les Damnés de la terre, mettait en garde contre les propositions qui réduisent
le problème du colonialisme et du racisme à une problématique de classe. La décolonisation, en
Amérique ou en Afrique, c’est aussi sortir des narrations centrées sur les épopées indépendantistes
du XIX et XX siècles. Ces narrations identifient la décolonisation à l’indépendance, légitiment la
modernité et sont au centre de la formation des citoyen-ne-s et de l’éducation. Ces narrations font
de l’État-nation la structure politique qui a permis de sortir du colonialisme et d’entrer dans la
modernité. L’échec relatif de la forme État-nation dans les ex pays colonisés et celui de la tentative
d’homogénéiser les populations devraient pourtant amener à revenir sur ces mythes fondateurs.
La décolonisation passe par l’adoption d’une attitude décoloniale. L’attitude décoloniale prend
naissance dans un cri d’effroi face à cette politique létale de la modernité, à ce monde
moderne/colonial qui transforme une partie de l’humanité en rebut. Elle s’enracine dans cette
exhortation de Fanon dans Peaux noires, masques blancs : Ô mon corps, fais de moi toujours un
homme qui interroge. Elle est une corpopolitique et débouche sur une politique de l’amour.
Mon dialogue avec les travaux de Frantz Fanon et Chela Sandoval m’amène à théoriser l’attitude
décoloniale comme une attitude d’amour ou ce que Sandoval appelle « l’amour décolonial ».
L’amour décolonial est une expression de notre désir d’un autre être humain dans un espace où les
corps, les connaissances et les expériences sont séparés et cloisonnés. Je vois l’amour décolonial
comme une forme de connexion et d’interrelation, comme la racine de l’intérêt dans la recherche de
la communication et de la connexion érotique avec les autres personnes. Cet amour est dangereux
dans la Modernité/Colonialité, car il essaie de franchir les frontières établies et de créer de nouvelles
façons d’être, de pouvoir et de savoir. L’amour décolonial implique l’aptitude à reconnaître nos
limites face à ce que nous ne connaissons pas mais aussi à montrer notre colère face à tout ce qui
conduit à toutes sortes de séparations déshumanisantes. L’amour décolonial conduit au désir de
former une communauté d’insurgés contre la colonisation et joue un rôle crucial dans la rencontre
intra-et inter-culturelle entre les groupes subalternes eux-mêmes. Sans ce genre d’amour, le moi
Licence Creative Commons 4.0.
228
traumatisant ou le moi traumatisé de la Modernité/Colonialité peut même conduire à la critique de
la coexistence d’une sorte d’hybris qui empêche la formation d’une communauté contre la
colonisation dans le processus de création d’un monde où de nombreux mondes peuvent se relier les
uns aux autres et où ils créent de nouveaux mondes. (Barroso Tristán, 2016)
L’art est un des domaines dans lesquels les racialisé-e-s peuvent élaborer des stratégies d’opposition
au racisme et à la déshumanisanisation du monde actuel. Dans El arte como territorio de resistencia
(2017), Nelson Maldonado Torres écrit que « Dans le monde moderne/colonial, la
résistance dans son sens le plus radical devrait peut-être être comprise comme un effort de re-
existence ». Il définit la re-existence comme une irruption, ce qui nous renvoie à ce cri d’effroi face
à la létalité du monde. Il la met en rapport avec la problématique de la dépossession, du
déplacement forcé, qui caractérise notre époque et met la question du territoire au centre
de tant de luttes.
Références
Maldonado Torres, Nelson. 2011. « Con Fanon, ayer y hoy ». Kaosenlared.
https://kaosenlared.net/con-fanon-ayer-y-hoy/
Maldonado Torres, Nelson. « Sobre la colonialidad del ser. Contribución al desarrollo de un
conceptoé ». Dans El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del
capitalismo global, sous la dir. De Santiago Castro Gómez et Ramón Grosfoguel : 136. Bogotá :
Siglo del hombre Editores.
Maldonado Torres, Nelson. 2007. Against War. Views from the Underside of Modernity. North
Carolina : Duke University Press.
Maldonado Torres, Nelson. 2016. « Outline of Ten Theses on Coloniality and Decoloniality ».
Fondation Frantz Fanon : 11.
http://fondation-frantzfanon.com/outline-of-ten-theses-on-coloniality-
and-decoloniality/
Maldonado Torres, Nelson. 2017. « El arte como territorio de re-existencia: una aproximación
decolonial ». Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales VIII : 26.
Licence Creative Commons 4.0.
229
http://iberoamericasocial.com/arte-territorio-re-existencia-una-aproximacion-decolonial
Barroso Tristan, José María. 2016. « Descolonizando. Diálogo con Yuderkys Espinosa Miñoso y
Nelson Maldonado-Torres ». Iberoamerica social : 17.
https://iberoamericasocial.com/descolonizando-dialogo-yuderkys-espinosa-minoso-nelson-
maldonado-torres/
Maldonado Torres, Nelson. 2017. « On the Coloniality of Human Rights ». Revista Crítica de
Ciências Sociais. 114.
http://journals.openedition.org/rccs/6793
Les lect.eur.rice.s trouveront de nombreux articles en anglais sur le portail de l’auteur.
https://rutgers.academia.edu/NelsonMaldonadoTorres
Le livre Penser l’envers obscur de la modernité, publié en 2014 aux Pulim de Limoges offre la
traduction française de deux articles en français de Nelson Maldonado Torres, « À propos de la
colonialité de l’être : contributions à l’élaboration d’un concept » ainsi que « Actualité de la
décolonisation et tournant décolonial ».
Licence Creative Commons 4.0.
230
|61. Malambo et Perro Viejo
SéBASTIEN LEFÉVRE
Malambo et Perro Viejo sont deux romans écrits par des autrices afrolatinoaméricaines. Lucía
Illescas Charún est l’autrice de Malambo (2001). Elle est la première Afropéruvienne à avoir publié
un roman, roman qui se situe pendant l’époque coloniale au Pérou. L’action se passe principalement
dans le quartier de Malambo où vivent les esclavagisé-e-s africain-e-s. Perro viejo (2007) est un
roman écrit par Teresa Cárdenas, une Afrocubaine. L’action se situe au cœur d’une plantation durant
l’époque coloniale à Cuba.
Il nous a semblé important d’inclure ces deux romans au Dictionnaire, car ils représentent une
certaine rupture décoloniale. Premièrement, nous sommes face à des autrices afrodescendantes,
c’est-à-dire des descendantes d’esclavagisé-e-s qui ont pris leur plume pour raconter leur propre
histoire.
Cet élément peut paraître ordinaire mais il reflète plutôt l’exception. Les histoires, les cultures, les
religions afro, par le passé, ont presque toujours été racontées par des non-afrodescendant-e-s. Cela
posait la question de la légitimité du discours et d’une certaine confiscation de ce dernier, car les
Afrodescendant-e-s ne s’exprimaient pas et subissaient ces discours. Cette prise de parole constitue
’une rupture dans le champ des représentations et offre une autre vision de l’histoire, de la culture
etc. des Afrodescendant-e-s.
Et cette vision autre, non hégémonique, se retrouve dans les schémas narratifs des deux ouvrages.
Dans Malambo, l’action principale se passe essentiellement dans le quartier des esclavagisé-e-s. Et
lorsque l’action se a lieu chez les maîtres (Ciudad de los Reyes), elle est vue en général à travers
la vie des esclavagisé-e-s qui servent les maîtres. Enfin, lorsque l’action se déroule en dehors de la
ville, l’autrice nous fait voyager dans les villages où les cultures populaires sont présentes.
Dans Perro Viejo, même si l’on se situe dans les habitations de l, toutes les actions se déroulent là
où vivent les esclavagisé-e- s (baraquement, place, arbre, champ etc.). L’habitation du maître n’est
présente que très rarement.
De fait, les deux autrices opèrent un décentrement qui nous donne accès à d’autres points de vue,
celui des subalternes. À travers la vision des esclavagisé-e-s, nous voyons la façon dont ils et elles
vivaient, ce qu’ils et elles ressentaient, quelles étaient leurs traditions, leurs nourritures, leurs
Licence Creative Commons 4.0.
231
savoir-faire. Les deux romans adoptent une perspective ré–humanisante des sujets esclavagisé-e-s,
en leur donnant un statut d’acteurs et d’actrices de leur propre destin, conscient-e-s de leurs
trajectoires historiques spécifiques et conscient-e-s, surtout, des moyens à mettre en place pour
rester libres malgré tout, soit par la fuite, dans Perro Viejo, soit par l’établissement d’espaces de
négociations avec les maîtres, dans Malambo. La religion est un autre aspect convoqué par les deux
autrices. Elles font référence aux pratiques religieuses africaines des Yoruba déporté-e- s en Abya
Yala. A la cosmovision de ces esclavagisé-e-s et à la science qui accompagnait leurs pratiques
(ethnobotanique). La présence des Orishas montre surtout que le prétendu métissage, syncrétisme
n’était pas aussi systématique que ne le prétendent bon nombre d’ouvrages historiques.
Enfin, elles réinsèrent là aussi les esclavagisé-e-s dans une perspective ré- humanisante, en les
dotant d’une culture. Par conséquent, ces deux ouvrages constituent des contre-discours à la
modernité occidentale.
Références
Illescas Charún, Lucía. 2001. Malambo. Lima : Universidad Nacional Federico Villareal.
Cárdenas, Teresa. 2007. Perro viejo. Toronto : Groundwood Books.
Licence Creative Commons 4.0.
232
62. Malês (Soulèvement des)
JONNEFER BARBOSA
Le 25 janvier 1835, des Africain-e-s et des esclavagisé-e-s affranchi-e-s prennent la ville de
Salvador. Le soulèvement ne dura que trois heures, mais il sema une traînée de poudre dans les
autres villes du Brésil esclavagiste, déjà hanté par la plus importante des révolutions modernes, la
révolution haïtienne (1791-1804). Il convient de rappeler que la pratique de l’haïtianisme,
comprise comme une conspiration ou une incitation à la révolte, pouvait conduire les esclavagisé-e-
s à la prison (ou aux cachots) dans le Brésil du début du XIX e siècle. La révolte des Malês, terme
Nagô désignant les esclavagisé-e-s musulman-e-s, donna lieu à de nouvelles pratiques
policières contre les Africain-e-s dans la monarchie brésilienne. Une révolte significative si on
considère qu’elle se produisit dans une ville dont seule 25% de la population était blanche, et
qu’elle réalisa une jonction entre les luttes des esclavagisé-e-s africain-e-s et celles des Afro-
brésilien-ne-s né-e-s libres ou esclaves. Dans une société où l’esclavage était un mode
de production, où les seigneurs des engenhos (plantations et installations destinées à la fabrication
du sucre) n’étaient pas les seuls à posséder des esclaves, car c’était aussi le cas des petit-e-s
commerçant-e-s et des professionnel-le-s libéraux, et où la population pauvre d’origine africaine,
ancien-ne-s esclavagisé-e-s ou affranchi-e-s avait augmenté, le Spartakisme a pris sa dimension la
plus intense. Selon Claudio Medeiros (2012) :
Aux yeux du propriétaire d’esclaves, la présence de l’homme noir dans la vie urbaine traçait une ligne entre
esclaves et autorités policières, surtout après le soulèvement de Malês9 en 1835 à Salvador. Il faut penser qu’à
Rio de Janeiro, en 1849, 48,8 % de la population urbaine était composée de « bras », asservis ou affranchis. Une
population habilement insérée dans la division du travail impérial,qui se déplaçait dans la machine économique
urbaine, travaillant comme maçons, cordonniers ou marchands de fruits et légumes, blanchisseuses, barbiers,
gens de maison, etc., qui partageaient parfois une même foi et une même langue maternelle. La Cour avait vécu
la fin de la décennie de 1840 dans une angoisse qu’entretenaient les rumeurs de soulèvements d’esclaves dans les
fazendas voisines –à Campos, Valença, Vassouras, etc. Que se passerait-il si l’esprit des insurgés des zones de
plantation gagnait les captifs de la capitale qui étaient plus de 100 000?
9L’histoire du soulèvement de Malês n’a été mise en lumière qu’au XX siècle grâce à un travail fait à partir des
archives policières de l’époque. Il a donné lieu à une des recherches les plus importantes qui ait été faite sur les révoltes
politiques au Brésil, puis à la parution de l’ouvrage de João José Reis,Rebelião escrava no Brasil, a história do levante
do Malês em 1835.Clóvis Moura a également consacré une entrée au soulèvement de Malês dans son Dictionnaire de
l'esclavage des Noirs au Brésil. (2013)
Licence Creative Commons 4.0.
233
Au bilan de la révolte, en dehors des très nombreux exilé-e-s en Afrique, plus de 70 mort-e-s,
comme Mama Adeluz, Gertrudes, Flamé, Batanho, Combé, Vitório Sule, Nicobé, Gustard, Noé,
Hipólito, Constantino. Si le droit romain condamnait les esclavagisé-e-s rebelles à la crucifixion
(Apiano, dans son Histoire romaine, raconte que des milliers de spartakistes furent crucifiés et
placés sur la route de Capoue à Rome), dans l’Empire du Brésil, les corps des esclavagisé-e-s furent
jetés dans des fosses communes, traitement funéraire qui fut celui de la plupart des personnes
réduites en esclavage au Brésil jusqu’à la fin du XIX siècle.
L’origine d’un concept n’est pas dans un début archétypal, mais accompagne son devenir à travers
ses variations historiques. Si la politique et la démocratie sont des butins gréco-romains, les
premières révoltes que nous connaissions sont les révoltes des esclavagisé-e-s contre leurs maîtres,
la contre-tradition des opprimé-e-s qui nous arrive par la voie latine. Nous devons à Plutarque cette
description de Spartacus et de la révolte des Spartakistes, menée par un esclave gladiateur, « plus
hellène que thrace »:
L’insurrection des gladiateurs qui causa des ravages en Italie, et qu’on appelle en général « la guerre de
Spartacus », eut l’origine suivante. Un certain Lentulus Batiatus avait à Capoue une école de gladiateurs, dont la
plupart étaient des Gaulois et des Thraces. En raison d’une injustice de leur maître, et non qu’ils se fussent mal
conduits, ils étaient restés en captivité dans l’attente du combat. Deux cents d’entre eux décidèrent de
s’échapper, mais ils furent dénoncés. Ceux qui l’apprirent à temps, au nombre de soixante-dix-huit, réussirent à
s’échapper, ils prirent des couteaux et des broches dans une cuisine et s’enfuirent précipitamment. Sur la route,
croisant des chars qui
transportaient des armes de combat de gladiateurs vers une autre ville, ils les pillèrent et s‘armèrent. Puis, ils
prirent une place forte et désignèrent trois dirigeants. Le premier d’entre eux était Spartacus, un Thrace nomade,
doté non seulement d’un grand courage et d’une grande force, mais aussi d’une sagacité et d’une culture
supérieure à sa fortune, plus hellène que thrace. (Plutarque, 1916)
Spartakisme et révolte sont des termes synonymes, car la révolte dans ses premières étapes a
toujours été une révolte des esclavagisé-e-s. Les Spartakistes ont marqué le Brésil du XVIII siècle.
La révolte des Malês n’a duré que trois heures, mais elle a hanté le pays après l’Indépendance,
au point de susciter la mise en place d’appareils contre-insurrectionnels. Les réformes urbaines qui
ont suivi, ou ce qu’on a appelé plus tard l’haussmanisation de villes comme Salvador et Rio de
Janeiro, avaient pour but explicite d’éviter le soulèvement des esclavagisé-e-s. Walter Benjamin a
écrit que les révoltes ne se font pas au nom des descendant-e-s libéré-e-s, mais des ancêtres asservi-
e-s, en connexion avec un passé d’oppression. Il est donc possible de faire l’hypothèse d’une
Licence Creative Commons 4.0.
234
continuité reliant les exterminations du présent à celles du passé brésilien. La révolte des Malês
hantait les policiers et policières qui attaquèrent et tuèrent des étudiant-e-s brésilien-ne-s en 1968.
Ce serait aussi le spectre du Malês qui flottait dans les massacres perpétrés par les groupes de police
en 2015, à Osasco et Barueri, et il hante aujourd’hui les assassins de Marielle Franco et des milliers
de jeunes gens ou d’enfants tué-e-s par la police dans les bidonvilles du pays.
Traduit du portugais par Claude Bourguignon Rougier.
Références
Apiano de Alexandria. 1913. The Histories of Appian. Livro III. Harvard University Press : 523.
Capo Chichi, Sandro. 2018. « La révolte d’esclaves de 1835 au Brésil ». Nofi Medias.
https://www.nofi.media/2018/02/la-revolte-desclaves-de-1835-a-bahia-au-bresil/6732
Medeiros, Claudio. A experiência da epidemia no século XIX: do corpo- microcosmo à cidade
fronteiriça. Tese UERJ : 83.2.
Moura, Clóvis. 2013. Dicionário da escravidão negra no Brasil. São Paulo : Edusp : 254-259.
Plutarch. 1916. The Parallel Lives. The Life of Crassus. Harvard University
Press : 337.
Reis, João José. 2012. Rebelião escrava no Brasil. A história do Levante dos Malês em 1835. São
Paulo: Companhia das Letras.
Licence Creative Commons 4.0.
235
63. Malungaje
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Le malungaje est un concept construit par le chercheur guyanais Jérôme Branche qui travaille sur
les cultures et littératures afro-latino-américaines. Il s’agit du « langage du malungo ». Cet auteur le
développe à partir de la notion de « malungo » qu’il tire du travail de l’historien Robert Slenes. En
effet, ce dernier signale l’existence du terme « malungu/malungo » commun aux esclavagisé-e-s
originaires d’Afrique centrale au XVIII siècle, principalement des locuteurs et locutrices kikongo,
ubundu, kibundu, déporté-e-s vers le Brésil. Cette notion renvoie à l’idée de parenté, de grande
barque et d’infortune. L’hypothèse est que la création de ce terme soit issue d’une rationalisation
linguistique entre les trois zones culturelles de provenance des esclavagisé-e-s, en Angola et en
République Démocratique du Congo. Le concept « malungo » désignerait schématiquement : « le
compagnon d’infortune avec qui j’ai pris la grande barque qui a traversé l’Océan ». D’après Slenes,
cette notion a eu une modalité sociale effective au sein de la sociabilité esclavagisée au Brésil
colonial. Jérôme Branche montre que cette catégorie se retrouve dans d’autres zones des
Amériques, établissant son caractère transversal. Ce concept de « malungo » est décisif car il
montre la conscience qu’avaient les esclavagisé-e-s de leur situation malgré l’expérience de la
colonialité du pouvoir ; ce qui va à l’encontre d’une certaine littérature scientifique, qui insiste sur
le triomphe de l’épistémicide lié à l’institution esclavagiste. En outre, le recours à des catégories
linguistiques non européennes et à un imaginaire africain souligne le caractère décolonial de ces
tentatives de donner sens à leur expérience. Recours qu’il faut classer dans les multiples formes de
résistance des esclavagisé-e-s. De plus, l’idée de solidarité entre groupes ethnoculturels
esclavagisés permet de critiquer sérieusement l’interprétation historique classique qui voudrait que
les esclavagisé-e-s ne se soient pas compris entre eux ou que leurs différences culturelles aient été
irréductibles. Jérôme Branche voit dans la notion de « malungo » un « déterminant systémique
qui a façonné » la vie des afro-latino-américain-e-s. Le malungaje serait cette relation intime au
Monde des afro-descendant-e-s, caractérisée par la connaissance de leur solidarité et la résistance
développée dans les conditions les plus effroyables de la colonialité du pouvoir.
Références
Branche, Jérôme. 2009. « Malungaje : Hacia una poética de la diáspora africana». Poligramas
Licence Creative Commons 4.0.
236
https://pdfs.semanticscholar.org/1f9c/6804d953c59423223b4edd19d6964aad513c.pdf?
_ga=2.237507013.43148924 4.1581694550-639385133.1581694550
Slenes, Robert W. 1995. « “Malungu, Ngoma vem!” África encoberta e descoberta no Brasil».
Luanda: Ministério da cultura.
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25575/27317
Voir à ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=81-UoeyQyUA
Licence Creative Commons 4.0.
237
64. Mendoza, Breny
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Hondurienne, Breny Mendoza enseigne à l’Université de Californie, dans le département d’Études
de genre. Elle fait partie des rares féministes latino- américaines qui aient analysé l’approche de
Dussel et de Quijano à partir d’une perspective décoloniale et féministe. Dans l’article «
Épistémologie du Sud, colonialité de genre et féminisme latino-américain », elle aborde
certains points cruciaux. Elle se demande « jusqu’à quel point cette autre forme de connaissance
latino-américaine qu’est la théorie décoloniale intègre la pensée féministe et la question du genre »;
si il est possible « dans cette nouvelle épistémologie du Sud d’articuler féminisme et genre de sorte
que les rêves et les souffrances des femmes soient enfin pris en compte au lieu d’être mis au
placard, comme d’habitude ». Elle s’interroge également sur la place des féministes latino-
américaines dans cette épistémologie du Sud en construction. Pour elle, il n’ y a pas (encore?) de
féminisme décolonial qui prenne en compte la spécificité de l’« Amérique latine ». Analysant la
perspective du genre qui est celle d’Aníbal Quijano, elle remarque que l’usage qu’il en est fait est a-
historique. Quijano considére que la race englobe tout, et de ce fait, il ne peut pas voir que le genre
est une construction historique et un instrument de la colonialité du pouvoir.
Brenny Mendoza s’inscrit alors dans l’approche de Lugones, estimant que
Penser comme Quijano (2008) que le genre est un concept antérieur à la société et à l’histoire aboutit à
naturaliser les relations de genre, l’hétérosexualité (…) et à occulter ce que les femmes du tiers-monde ont dû
endurer avec la colonisation et ce qu’elle continuent à vivre. (2018)
Pour elle, Quijano et la plupart des décoloniaux et décoloniales n’arrivent pas à analyser la chasse
aux sorcières, ce féminicide qui commença à l’époque de l’expulsion des Juifs et des Juives et de la
colonisation de l’Amérique, comme l’un des déploiements de l’idée de race. Elle remarque
d’ailleurs que les féministes africaines ou indiennes affirment que le genre comme tel n’existait pas
dans les sociétés pré-coloniales et qu’il n’apparaîtrait que plus tard avec la structure coloniale. Ce
n’est pas tout à fait exact, dans la mesure où la féministe aymara Julieta Paredes, et d’autres
féministes indigènes ne partagent pas ce point de vue. D’autre part, sa chronologie de la chasse aux
sorciéres, et son interprétation mériterait un débat contradictoire. Breny Mendoza souligne
également que lorsque Quijano aborde la séparation entre travail salarié pour les Blancs et servage
Licence Creative Commons 4.0.
238
pour les autres, il ne tire pas les conséquences du fait que les salariés soient des hommes. Car « il ne
prend pas en compte le fait que pour généraliser le salariat, il fallut passer par la domestication des
femmes de la métropole puis soumettre les femmes des colonies à la domination genrée (Mendoza,
2018).
En ce qui concerne Dussel, elle écrit :
Une première chose qui attire l’attention, c’est cette affirmation de Dussel dans ses 20 thèses : pour lui, l’espace
privé est l’espace intersubjectif qui met les sujets à l’abri des regards et des attaques
d’autres membres d’autres systèmes subjectifs. (Mendoza, 2018)
Or,
Pour les femmes, définir l’espace privé comme un topos où il n’ y a pas de relation de pouvoir, ou comme un
espace pré-politique est problématique. Dans la mesure où l’auteur considère que l’exclusion des femmes et les
demandes féministes ne peuvent trouver de résolution que dans la sphère publique, la théorie ne se saisit pas des
conflits liés à la vie quotidienne et à la microphysique du pouvoir (...). Et, ce qui est encore pire, le transfert de
micro-pouvoirs de la sphère privée vers la sphère publique (par exemple, les tortures sexuelles à Abu Graib, les
viols de femmes, les assassinats de transsexuels lors de crises politiques comme le coup d’État au
Honduras), seraient incompréhensibles si nous utilisions le prisme de Dussel, où le privé et le public constituent
des sphères séparées (…). Le paradoxe, c’est que Dussel ne voit pas que le principe à
l’œuvre dans son discours est féminin et même féministe. En effet, le nouveau paradigme politique qu’il propose
ressemble fort à la pensée maternelle de Sarah Ruddick et sa construction d’une politique de la paix et de la non-
violence. Nous pourrions dire que cette pensée féministe va plus loin que celle de Dussell, car elle est
profondément anti-militariste et ne justifie en aucun cas la violence. Or, de façon surprenante, Dussell défend
l’usage de la violence par la communauté lorsqu’elle se justifie par l’auto-défense, sans préciser à partir de quel
moment cette violence devient légitime. (Mendoza, 2018)
Il y a dans son œuvre et son enseignement une réflexion sur ce qu’elle appelle les fondements non
démocratiques de la démocratie (2006). Pour elle, la construction de la nation et de la citoyenneté
est liée viscéralement au colonialisme. Elle parle d’une colonialité de la démocratie. Le fondement
de la démocratie européenne ou américaine, ce n’est pas la Grèce antique mais la Conquête d’Abya
Yala. L’expérience de la Conquête, la controverse relative à l’humanité des Indien-ne-s, la question
du droit des personnes, tout cela n’appartient pas à un temps révolu. La controverse de Valladolid
est un des fondements de la démocratie actuelle, car il a fallu construire la notion d’« humanité »
dans le fracas de la Conquête, pour justifier les atrocités commises. Et, en même temps, élaborer
l’idée de « guerre juste », c’est à dire justifier l’extermination de ceux et de celles qui ne voulaient
pas de la domination. Elle considère que les débats actuels relatifs aux droits humains sont un
prolongement de cette histoire inachevée. L’invocation de la démocratie justifie les nouvelles «
Licence Creative Commons 4.0.
239
guerres justes » qui sont menées contre les peuples du monde anciennement colonial. L’échec de
l’éthique de la non- violence, au moment de la Colonisation, annonçait l’échec de la démocratie
aujourd’hui. La démocratie, qui a pris la place tenue jadis par la conversion, s’inscrit dans la même
pulsion civilisatrice. Pour Mendoza, le corps détruit des Indigènes résistant à la Conquête, la
pulsion génocidaire du XVI siècle, annoncent les féminicides du XX et XXI siècles, les corps
démembrés des femmes qui vont travailler dans les maquiladoras. Destructions qui se
produisent dans le cadre de ce qui leur a été vendu comme une émancipation : l’accès au salariat.
Quand je parle de la colonisation de la démocratie, je la comprends comme un système de domination. Ce n’est
pas que je sois contre la démocratie; je crois simplement que nous allons devoir inventer un système qui tienne
compte de nos contradictions. À mon avis, la démocratie libérale repose précisément sur notre exclusion. Nos
pays n’ont pas l’égalité juridique au sein de la communauté internationale. À tout moment, on peut décider d’une
intervention militaire ou un coup d’État généré de l’extérieur. Notre souveraineté est toujours compromise; et
pour que la démocratie fonctionne, la souveraineté est fondamentale. Je crois que nous devons remettre en
question tous ces concepts auxquels nous croyons beaucoup, mais qui, en fait, font partie de notre situation de
domination et de subordination. (Sime, 2006)
Breny Mendoza s’interroge également sur la préoccupation récente pour l’environnement.
Une de mes interventions, « Le subalterne peut-il nous sauver », concerne ce qui inquiète aujourd’hui beaucoup
de gens : la crise écologique et celle du capitalisme. On se dit que le monde va s’achever, que la vie humaine ne
sera plus possible. Et il semblerait que l’on cherche des solutions surtout dans le monde indigène. Ce que j’essaie
de relever, c’est l’ironie de la situation; ces cultures que l’Occident a tenté d’extirper ou de détruire, d’un coup,
sont présentées comme le salut. (Sime, 2006)
Elle a publié trois livres : Sintiéndose Mujer, Pensandose Feminista (1986), qui est une analyse du
mouvement féministe hondurien; Rethinking Latin American Feminisms (2000), qui porte sur la
formation du mouvement féministe latino-américain; Ensayos de Crítica Feminista en Nuestra
América (2014), qui est une approche des féminismes latino-américains, des théories féministes
occidentales, du post-colonialisme, de la théorie queer, du marxisme, des théories de l’empire et des
nouvelles théories de la décolonialité en « Amérique latine ».
Références
Licence Creative Commons 4.0.
240
Mendoza, Brenny. 2018. « Can the subaltern save us? ». Latin American Science, Technology and
Society : 109-122.
Mendora, Breny. 2006. « Los fundamentos no democráticos de la democracia ». Revista
Centroamericana de Ciencias Sociales. Vol. 3, nº 2.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2658177
Mendoza, Breny. 2015.«Coloniality of Gender and Power: From Postcoloniality to Decoloniality ».
The Oxford Handbook of Feminist Theory.
Mendoza, Breny. 2018. « L’épistémologie du sud, la colonialité de genre et le
féminisme latinoaméricain ». Revue d’Études Décoloniales.
http://reseaudecolonial.org/numero-3-feminismes-decoloniaux/
Sime, Sunny. 2018. « La democracia liberal se basa precisamente en nuestra exclusión (Entretien
avec Breny Mendoza) ». Punto Edu.
https://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/la-democracia-liberal-se-basa-precisamente-en-nuestra-
exclusion/
Licence Creative Commons 4.0.
241
65. Métissage
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Je ne parle pas de l’idée de race qui domine la classification mécaniciste nord-américaine, mais de la race en tant
que marque de ces peuples dépouillés qui sont en train de refaire surface aujourd’hui. La race comme trace
voyageuse, changeante, et qui, malgré son caractère imprécis, pourra nous aider à rompre avec le métissage
politiquement anodin et secrètement génocidaire, que l’on
déconstruit depuis quelques temps. (Segato, 2013)
Rita Segato écrit ces mots dans un article où elle analyse « la couleur de la prison », c’est à dire la
présence écrasante des Noir-e-s dans le système carcéral brésilien. Réalité difficile à faire admettre
car au Brésil, à gauche comme à droite, il ne faut pas parler de race.
Voilà un point commun avec l’Amérique hispanique où le métissage (qui ne fut pas seulement cette
réalité incontestable mettant en échec la stratégie de séparation des « races » dans les colonies
espagnoles) reste un des piliers des discours de construction nationale. Une notion qui, tout en
prétendant englober et rassembler, recèle en fait une horreur de la mácula,la tache liée à la naissance
ou à la « mauvaise race ».
Dans l’Amérique hispanique, le métissage devient visible au XVII siècle. Malgré la volonté royale
de séparer république d’Espagnol-e-s et république d’Indien-ne-s, malgré les obstacles créés aux
mariages entre Indien-ne- s et Espagnol-e-s, le métissage se produit, d’abord dans la violence de la
Conquête, avec les viols, mais aussi à travers les stratégies matrimoniales des élites et, plus tard,
avec le concubinage généralisé. Arrive un moment où cette réalité devient visible. Et c’est là que se
met en marche un nouveau processus de séparation. Le métissage sera d’abord mis en question
parce qu’il produisait des individus susceptibles de trahir le groupe des Blancs et des Blanches. Il
sera accompagné du mépris et du déshonneur lié à la bâtardise. C’est caractéristique du statut des
métis-ses lors de période coloniale.
Après les Indépendances, le statut du métissage sera très ambigu : parfois, il sera vu comme le
vecteur de transmission des tares des races considérées inférieures, Noir-e-s, castes, Indien-ne-s;
parfois, au contraire, comme moyen de blanchir les populations, de créer un peuple cohérent pour
la nation émergente. Quoiqu’il en soit, le fondement raciste des discours relatifs au métissage est là.
Parmi les intellectuel.le.s lié.e.s au projet Modernité/Colonialité, Aníbal Quijano est un de ceux et
de celles qui ont le plus approfondi la question. Il comprenait le métissage dans son opposition à
l’identité « créole », cette identité du sujet des Guerres d’Indépendances, en guerre avec les autres
Licence Creative Commons 4.0.
242
Blancs et Blanches, les Chapetones, ces Espagnol-e-s de la péninsule qui avaient le pouvoir sous la
colonisation. Quijano, à l’époque où il cherchait une solution nationale au problèmes sociaux et
raciaux, pensait qu’il pouvait y avoir un métissage d’en bas, celui du cholo, métis-ses d’Indien-ne-s,
stigmatisé-e-s pour leur andinité, qui descendent de la montagne et s’installent à la ville, ceux et
celles qu’on voit dans les films de Sylvia Vargas.
Quijano pensait que ces métis-ses porteurs et porteuses de l’indianité péruvienne étaient légitimes,
qu’ils et elles étaient les seul-es à avoir une culture authentiquement nationale et pouvaient donc
être les sujets unifiant de la nation. Cette position serait celle du gouvernement « révolutionnaire »
velazquiste des années 1970, qui capturerait de façon autoritaire et modernisatrice ces sujets cholo
sans remettre en question les structures sociales profondément racistes et inégalitaires du pays.
L’itinéraire de Quijano, qui finirait par renoncer à ce projet pour développer sa thèse d’un
racisme matriciel, rend compte de la complexité de la question du métissage en « Amérique latine »,
de l’illusion puissante qu’a été et continue d’être le thème et de la nécessité de renoncer à ces sujets
métis-ses pour arriver à penser la racialisation.
C’est chez les féministes décoloniales, en particulier, les féministes indigènes que cette question du
métissage est pensée avec le plus de radicalité. Le vieux mythe n’est pas mort et il a entre autres été
repris dans les associations féministes classiques qui n’ont pas vu qu’elles faisaient ainsi le jeu de la
domination raciale d’un groupe sur les autres. Mais la montée des mouvements de femmes
indigènes a mis sur le tapis la question de l’identité « métisse ».
Pour Rita Segato, le métissage est
ethnocide, annulation de la mémoire du non-Blanc par la force. Un effet d’autorité des États républicains, tant
dans le domaine de la culture que de la sécurité publique, qui imposèrent une clandestinité de plusieurs siècles
aux veines souterraines du sang originel, aux fleuves profonds de la mémoire qui leur sont liés. Mais il est aussi
une projection vers le futur de l’être de l’Indien, de l’être du noir, qui nagent dans du sang neuf, nourris par
l’apport d’autres lignées, ou de nouveaux contextes sociaux, fécondé par de nouvelles cultures, passant par les
universités, mais sans perdre jamais le vecteur de leur différence et leur mémoire, ce trésor de l’expérience
accumulée dans le passé qui est aussi projet pour le futur. (Segato, 2010)
Pour le penseur bolivien Fausto Reynaga, le métissage est corruption, imposition de la culture
blanche. Chez Silvia Rivera Cusicanqui, qui est elle aussi bolivienne, le métissage sera vu d’une
façon plus complexe. Elle parle de l’« illusion du métissage », car, en fait, il s’agit d’un discours qui
feint d’intégrer des identités différentes et en réalité renforce la structure hiérarchique patriarcale et
raciste de la société. Le discours du métissage a permis d’exclure les peuples de l’espace public.
Mais cela n’empêche pas l’autrice de proposer, comme Rita Segato, un autre rapport au métissage :
Licence Creative Commons 4.0.
243
Cusicanqui utilise la notion de double contrainte chez Gregory Bateson pour se référer à la situation insoutenable
du métis : la sorte de schizophrénie collective dans laquelle il vit avec des injonctions contradictoires. La
penseuse bolivienne propose de reconnaître cette double contrainte – cette condition bigarrée – au lieu de la nier.
Il s’agit de revendiquer l’Indien, non pas dans sa pureté – comme le fait le capital qui se l’approprie dans une
sorte d’extractivisme symbolique – dans ce mélange bigarré que constitue le cholo. Face à l’injonction de la
modernité qui exige de refouler la part indienne, de l’expulser, le cholo apparaît comme une option souhaitable,
comme l’expression d’un métissage irrévérencieux et rebelle. Nous devons, nous dit Rivera Cusicanqui, «
décoloniser le métissage ». (Castro Buzón, 2018)
Références
Boidin, Capucine. 2008. « Métissages et genre dans les Amériques ». Clio. Histoire‚ femmes et
sociétés : 27.
http://journals.openedition.org/clio/7492
Bourguignon, Claude. 2010. « Les trois races dans les récits de la foret ». Stratégies romanesques et
construction des identités nationales. p. 387. 397.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00580561/document
Castro Buzón, Nazaret. 2018 .« Descolonizando el mestizaje ». Amazonas.
https://www.revistaamazonas.com/2018/08/29/descolonizando-el-mestizaje/
Segato, Rita. 2010. « Los cauces profundos de la raza latinoamericana. Una relectura del mestizaje
». Crítica y emancipación. Revista latinoamericana de Ciencias Sociales.
https://www.academia.edu/12049805/
Segato, Rita. 2013. La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropologia por demanda.
Buenos Aires : Promoteo.
Wade, Peter. 2003. « Repensando el mestizaje ». Revista colombiana de Antropología.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-65252003000100009
Licence Creative Commons 4.0.
244
Wade, Peter. 2005. « Rethinking Mestizaje: Ideology and Lived Experience ». Lat. American.
Studies. 37 : 239–25
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-latin-american-studies/article/abs/rethinking-
mestizaje-ideology-and-lived-experience/FE08F30F74F8274B2515E559E2ED4815
Licence Creative Commons 4.0.
245
66. Mignolo, Walter
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Enseignant à la Duke University, Walter Mignolo est un sémioticien argentin qui a été très impliqué
dès les débuts dans les rencontres du réseau Modernité/Colonialité. Il a eu un rôle de passeur dans la
mesure où, au tournant du XXI siècle, il réalisa la jonction entre le concept de colonialité
qui venait d’émerger chez Quijano, la perspective de libération de Dussel et sa propre critique de la
rhétorique de la modernité occcidentale. Il a particulièrement développé les concepts de
géopolitique de la connaissance, de rhétorique de la modernité, de border thinking, de détachement
et désobéissance épistémique10.
Comme il l’explique dans un entretien avec Nelson Maldonado Torres, son travail a d’abord
concerné la littérature latino-américaine à partir d’une perspective très inspirée par le post-
structuralisme français, la grammaire générative et la philosophie du langage. Plus tardivement, son
intérêt pour l’historiographie des Indien-ne-s et pour des questions de linguistique et de
géographie a abouti à la rédaction de The darker side of the Renaissance, paru en 1995. D’après le
philosophe belge Marc Maesschalck, ce livre représente un tournant important dans l’œuvre de
Mignolo. C’est la première fois que le sémioticien expose de façon systématique une perspective
localement située et critique le projet eurocentré d’une histoire universelle indissolublement liée à
des systèmes de représentation politiquement orientés .
Ce livre expose les processus de hiérarchisation symbolique à l’œuvre à partir de la Conquête. Il
analyse la colonisation des langages, des mémoires et de l’espace dans l’Amérique des XVI et XVII
siècles. C’est l’héritage de la Renaissance qui est remis en question et présenté comme le dispositif
permettant de justifier l’événement inouï de la Conquête et de la colonisation. La langue est au
centre de ces dispositifs. L’auteur rappelle que les Indigènes étaient perçu-e-s comme de personnes
« dépourvues d’écriture, d’alphabet et de lumière sur quoi que ce soit ». Et il parle du statut quasi
ontologique qui était celui de la lettre alphabétique, de l’obsession des grammairiens qui comptaient
les « lettres manquantes » des langues amérindiennes. Ils mettaient en place, en fait, une opération
de réduction des langages, pendant symbolique des reducciones, ces regroupements forcés
d‘indigènes, dans des villages construits sur le modèle espagnol, destinés à favoriser
l’évangélisation. Le grammairien Nebraska avait présenté sa grammaire à Isabelle de Castille
comme un des instruments de sa domination sur le monde.Il considérait qu’elle permettrait la «
101. Voir la préface de Désobéissance épistémique.
Licence Creative Commons 4.0.
246
castellanisation » forcée des autochtones, voyant une alliance de fait entre les armes et les lettres
contre les Barbares. L’idée fait contrepoids à celle, répandue, d’une alliance entre l’épée et la croix
ou l’épée et le goupillon. Elle fait comprendre que la colonisation est bien ce processus évoqué plus
haut qui unit christianisation et civilisation, la langue étant comprise comme l’instrument de cette
dernière.
Le privilège exorbitant conféré à l’écriture alphabétique justifierait le mépris avec lequel les langues
amérindiennes seraient considérées, du fait de leur oralité. L’incapacité à prendre en compte
d’autres systèmes de mémorisation que l’écriture, par exemple les kipus andins, renforcerait le
déni de langues appréhendées comme dénuées de rationalité et inaptes à la transmission de notions
abstraites. La conséquence serait importante pour l’appréhension de l’histoire de ces peuples. De
leur absence d’archives, on déduirait une absence de mémoire et d’histoire. Certes, quelques
savants, religieux pour la plupart, découvriraient et transcriraient des grands récits nahuas, mayas ou
incas, mais leurs travaux resteraient invisibles et n’empêcheraient pas la construction d’un
imaginaire des autochtones comme peuples sans histoire.
Mignolo aborde également la colonisation de l’espace, entre autres, le rôle de la cartographie,
représentative de l’hybris du point zéro nous parle le philosophe colombien Santiago Gastro
Gómez. L’hybris du point zéro est cette illusion fondatrice de l’épistémè scientifique occidentale en
vertu de laquelle les savant-e-s prétendent à un savoir objectif, ne dépendant d’aucun point de vue.
L’espace de la carte moderne apparaît comme l’illustration de cette position qui prétend ne pas en
être une, un regard qui prend la place de celui de Dieu.
Dans The darker side of the renaissance, j’ai traité de la colonisation de l’imaginaire, en appliquant cette idée de
Serge Gruzinski au langage, oral et écrit; à la mémoire; à l’histoire et à la cartographie. Mais j’ai aussi abordé les
réponses apportées par les Indigènes à ce que les Espagnols leur imposaient. Comme tu le sais, la plupart des
études portant sur la mondialisation, l’empire ou les empires, ne racontent qu’une moitié de l’histoire : l’histoire
impériale. C’est comme si l’espace où l’empire s’étendait n’existait pas, comme si la terre des premiers moments
de la Conquête était vide et les esprits de ceux qui l’habitaient, vides, également. Pour rétablir la vérité, j’avais
besoin d’une « méthode » et j’ai découvert alors l’herméneutique pluritopique, grâce à Edmond Pannikar, qui
avait déjà rencontré le même problème en Inde, dans le cadre de son étude des religions. (Maldonado Torres,
2007)
Dans le même entretien, l’auteur explique que la transition de The darker side of the renaissance à
Local histories/Global designs, paru en 1999, était logique. Il était passé de l’analyse des trois
sphères de domination citées plus haut à celle de la connaissance et de l’épistémologie comme
instruments de colonisation. Il avait élargi l’échelle temporelle de son étude. Local Histories/
Licence Creative Commons 4.0.
247
Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking est donc une critique de la
raison occidentale et une réflexion sur les sciences sociales dans le « système monde ». L’auteur y
modifie la notion de Wallerstein grâce à celle de différence coloniale. Le système monde qu’il décrit
est un système monde moderne-colonial, basé sur la « différence coloniale » dont il retrace la
généalogie, l’étude de la modernité devenant inséparable de celle de la colonialité. La différence
coloniale prend forme comme un classement, opéré par ceux et celles qui décident des critères et
des hiérarchies, c’est-à-dire par les métropoles occidentales, à travers leurs systèmes de
connaissance et de savoir. Elle se configure en même temps que les territoires de la chrétienté et
justifie le projet d’expansion moderne sous divers prétextes qui varient : suivant les époques, on
invoquera la religion vraie, la civilisation, le développement ou la démocratie.
Mais on ne saurait réduire la différence coloniale à l’espace où se déploie la colonialité. Elle a un
autre versant : la production de résistances et de réponses à la colonisation, par exemple ce que
Mignolo nomme la « pensée frontalière ». La pensée ou la gnose frontalière peut se voir comme une
réponse logique et une conséquence de la différence coloniale à partir d’un lieu d’énonciation «
fracturé », quand se noue un dialogue avec les épistémologies infériorisées lors de la colonisation.
Dans cet ouvrage de 1999, Mignolo se penche sur le concept de colonialité de Quijano et celui de
transmodernité de Dussel, développant leurs conséquences. Il s’intéresse également à la pensée
d’autres habitant-e-s du côté obscur. Il aborde par exemple l’idée de « double critique » et de
« pensée autre » d’Abdelkhebir Khatibi, la notion de créolisation d’Edouard Glissant, de double
conscience de Du Bois et la « conscience de la métisse » d’Anzaldúa.
Analysant les configurations géopolitiques de la production de connaissance, il passe en revue
plusieurs de leurs formes depuis la Conquête jusqu’à la reconfiguration étasunienne de la fin du
XIX siècle. La notion de postcolonialité jouant le rôle d’une sorte de connecteur des diverses
histoires coloniales. Il est question aussi de post-occidentalisme, ce qui nous renvoie à sa
définition d’un Occident qui, il faut le remarquer, englobe « l’Amérique latine ». Passé le premier
moment d’embarras posé par la « Découverte » qui remettait en question l’ordonnancement du
monde chrétien, nous dit Mignolo, les Occidentaux et Occidentales feraient de l’Amérique un
prolongement de l’Occident, un continent sous responsabilité des Espagnol- e-s. Aujourd’hui, le
post-occidentalisme serait le discours critique latino- américain le plus approprié pour aborder la
question du colonialisme.
Il incombe à la théorie décoloniale de diffuser une autre conception de la raison et de déplacer le lieu
d’énonciation de la pensée du premier au tiers-monde. Le sujet épistémologique de ce nouveau
Licence Creative Commons 4.0.
248
discours pense depuis et vers les frontières, du point de vue de la subalternité. C’est la seule façon de ne pas
produire une énième version de l’épistémologie moderne. (Mignolo, 1997)
Ce livre est un des discours fondateurs du courant décolonial, dans la mesure où il retrace une
généalogie de la pensée décoloniale au moment même où prenait forme le projet
Modernité/Colonialité. Si l’auteur ne connaissait pas les thèses de Aníbal Quijano lorsqu’il était en
train d’écrire The darker side of the renaissance, elles ont été pour lui un guide lors de la
rédaction de son second livre. De même, la réflexion de Gloria Anzaldúa a été pour lui séminale.
À l’époque où j’écrivais mon premier livre (The darker side of the renaissance), Anzaldúa m’a ouvert la voie
vers les réponses décolonisatrices, dirions-nous aujourd’hui. Lorsque j’étais à l’œuvre sur le second, elle m’a
montré l’accès à la pensée frontalière ou épistémologique. Comment pense-t-on à partir de la subalternité? Et
bien, si on ne peut pas éviter l’imposition impériale, on n’est pas non plus obligé d’y obéir. Anzaldúa pense
comme une femme et affronte le patriarcat. Elle pense comme une lesbienne et affronte les normes
hétérosexuelles. Et elle pense en tant que Chicana confrontée à la suprématie anglo-blanche. (Maldonado Torres,
2007)
Dans un livre paru peu après, La idea de América latina, il reprend des idées déjà formulées dans
les deux livres antérieurs sur la conscience européenne et poursuit sa réflexion à partir des concepts
d’extériorité, de pensée frontalière et d’option décoloniale. Il insiste sur le « je suis là où je
pense ».
Son dernier ouvrage, paru en français, Désobéissance épistémique, développe l’idée du déplacement
du lieu d’énonciation. La désobéissance en question est ce détachement qui passe par une
insurrection contre l’épistémologie occidentale. L’auteur prolonge sa réflexion sur la connaissance
et l’épistémologie comprises comme modalités de la colonialité. Il se demande comment penser
l’émancipation et la décolonisation de la connaissance à partir d’une position de subalterne. Le
détachement, dont la géopolitique et la corpopolitique de la connaissance sont deux moments
indispensables, permet de se dégager de la matrice épistémique du pouvoir et de produire « el
vuelco descolonial ». Walter Mignolo explique comment passer de l’ego politique et la
théopolitique à une géopolitique et une corpopolitique, insistant sur le lien entre corps et pensée et
soulignant l’importance du mépris du corps qui s’est mis en place avec le christianisme et la
philosophie cartésienne. Il revient sur la différence émancipation/libération, affirmant que la
libération diffère du projet émancipatoire de la modernité. En effet, rationalité et « émancipation »
sont les principes cadres de la modernité mais ils ne fonctionnent que du côté moderne du monde,
pas de son côté colonial. La tache consiste à poursuivre la construction d’une grammaire de la
Licence Creative Commons 4.0.
249
décolonialité qui a commencé avec la conférence de Bandung, en 1955. La modernité est la
rhétorique qui met en avant l’idée de progrès et d’émancipation tout en cachant sa véritable
signification. Et la « grammaire de la décolonisation » qu’il propose est une insurrection contre les
grandes méta-narrations impériales et les disciplines qui ont émergé dans ce contexte. Selon lui, le
dévoilement de la géopolitique et de la corpopolitique introduit une fracture dans l’hégémonie de la
théopolitique et de l’ego politique. Nous avons donc besoin d’une réécriture de l’histoire du monde
à partir d’une perspective corpopolitique et géopolitique de la connaissance. Il faut apprendre à
désapprendre, y compris de la théorie critique. La critique du capitalisme ne suffit pas, c’est la
matrice coloniale du pouvoir qu’il faut attaquer et, pour cela, il faut apprendre à partir des histoires
locales qui ont été niées, penser depuis l’extériorité de la modernité. En cela, il se situe dans la
perspective qui est celle de Dussel.
L’idée est de créer une alternative à la modernité au lieu de poursuivre des modernités alternatives
qui sont toujours ancrées dans la théopolitique (christianisme) ou dans l’egopolitique (libéralisme
ou marxisme), et partagent la foi en un même credo : modernité = rationalité et progrès. D’après lui,
la théorie critique occidentale n’a pas su aller au-delà de ce qu’il nomme une dé-modernité.
On pourra regretter que quelqu’un qui critique les post-modernes accorde une telle importance à
l’idée d’un discours unique, que la modernité tiendrait sur elle-même, comme le remarque
l’anthropologue colombien Eduardo Restrepo. Il est en effet probable qu’une des forces de cette
modernité avec laquelle nous n’arrivons pas à prendre congé réside dans son coté polymorphe qui
rend possible ses incessantes mutations. Il conclue sur l’idée que la notion de détachement « guide
le glissement épistémique décolonial vers l’universalité – l’autre, c’est-à-dire vers la pluriversalité
comme projet universel ». (Mignolo, 2015)
Un autre versant du travail de l’auteur porte sur la décolonisation de l’art et le concept d’aesthesis
décoloniale. Le concept fut introduit par Adolfo Albán Achinte, un artiste et activiste afro-
colombien originaire du Pacifique colombien. À partir de ce moment furent publiés une série de
travaux, avec Zulma Palermo en Argentine et Pedro Pablo Gómez en Colombie. Le travail
des étudiant-e-s et de professeur-e-s du programme de doctorat Études culturelles latino-
américaines coordonné par Catherine Walsch en Équateur a joué également un rôle important. À
partir de 2009, l’aesthesis décoloniale commença à se diffuser et la parution de l’article « Aesthesis
Decolonial » contribua à sa circulation.
Licence Creative Commons 4.0.
250
Références
Maldonado Torres, Nelson. 2007. « Walter Mignolo. Una vida dedicada al proyecto decolonial ».
Nómadas. n. 26. p. 192. 193.
https://www.academia.edu/4262822/Una_vida_dedicada_al_proyecto_decolonial
Mignolo, D, Walter. 1995. The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, &
Colonization. Ann Arbor : The University of Michigan Press.
Mignolo, D, Walter. 2000. Local Histories Global Designs : Coloniality, Subaltern Knowledges,
and Border Thinking. Princeton. NJ : Princeton University Press.
Mignolo, D, Walter. 2007. La idea de América latina. La herida colonial y la opción decolonial.
Barcelona : Gedisa Editorial
.
Mignolo, D, Walter. « Aiesthesis decolonial », Dialnet – Artículos de revista, ID.
https://artlabourarchives.files.wordpress.com/2012/08/mignolo-aiesthesis-decolonial.pdf
Mignolo, D, Walter. 2015. Désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité, logique de la
colonialité et grammaire de la décolonialité. Bruxelles : PIE Peter Lang. p. 39.
https://www.academia.edu/11799835/La_désobeissance_épistémique
Il n’existe pas de livre de Walter Mignolo en accès libre légal. Mais une quantité conséquente
d’articles critiques circulent à son sujet. La lectrice et le lecteur pourront consulter, entre autres, son
site, avec des articles en anglais et en espagnol
http://waltermignolo.com/
et sa page sur Academia edu
https://duke.academia.edu/WalterMignolo
ainsi que plusieurs articles critiques
Licence Creative Commons 4.0.
251
https://www.academia.edu/Documents/in/Walter_Mignolo
Deux articles en français sur Mouvements et Multitudes
Mignolo, Walter. 2013. « Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée
frontalière et désobéissance épistémologique ». Mouvements. n° 73.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-1-page-181.htm
Mignolo, Walter. 2006. « Géopolitique de la connaissance, colonialité du
et différence coloniale ». Multitudes.
https://www.multitudes.net/Geopolitique-de-la-connaissance/
https://contemporaryand.com/fr/magazines/%20decolonial-aestheticsaesthesis-has-become-a-
connector-%20across-the-continent/
Licence Creative Commons 4.0.
252
67. Modernité
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Les interprétations traditionnellement admises de la notion de modernité sont eurocentrées. Elles
s’enracinent dans la tradition des Lumières et véhiculent encore la vision des grands philosophes
comme Hegel, pour lequel l’Europe était le continent qui portait l’esprit universel.
Cette approche, qui relègue les autres cultures dans l’immaturité et l’archaïsme, relève d’un
eurocentrisme qui ne sera critiqué que très tardivement.
L’« Amérique latine » a joué un rôle important dans ce décentrement. Si l’on peut remonter assez
loin, à la tradition de l’essai, pour trouver des élaborations qui visaient à critiquer cette suffisance
européenne, les années 1960 semblent avoir été un moment charnières. Des historien-ne-s comme
le mexicain Edmundo O’Gorman avec son Invention de l’Amérique, l’anthropologue brésilien
Darcy Ribeiro et son analyse du rôle du génocide dans la formation de l’État brésilien, Pablo
González Casanova et son concept du colonialisme interne, Fals Borda et sa critique du
colonialisme intellectuel, les philosophes de la libération, ont tous et toutes contribué à attaquer ce
mythe moderne. Plus tard, Aníbal Quijano, Walter Mignolo et d’autres encore continueraient à
attaquer la forteresse eurocentrée.
Paradoxalement, le premier à avoir fait passer en Occident une critique non post-moderne de la
modernité fut l’économiste américain Immanuel Wallerstein. Son concept de système–monde posait
la colonisation de l’Amérique comme le moment d’apparition du premier système monde. En effet,
c’est à ce moment-là qu’émerge l’Atlantique comme nouvel espace de commerce. On sait que l’idée
de système monde s’abreuve à diverses sources : la conception marxiste de l’accumulation, l’idée
chère à la théorie de la dépendance de centre et périphérie, et celle d’économie monde de Fernand
Braudel. D’autre part, l’expérience et les travaux de Immanuel Wallerstein relatifs à l’Afrique
post-coloniale ont alimenté sa réflexion et l’ont amené très tôt à rejeter une idée de tiers-monde qui
permettait d’occulter l’existence d’une seule économie-monde avec diverses formes d’articulations.
Pour lui, la modernité est indissociable de la relation entre un pouvoir central et une périphérie,
idée qu’il emprunte à la théorie de la dépendance mais qui est insérée dans une perspective
historique.
Mais pour Enrique Dussel, Immanuel Wallerstein ne sort pas de l’eurocentrisme, il nomme
d’ailleurs sa vision « le second eurocentrisme ».
Licence Creative Commons 4.0.
253
La modernité est définie chez lui comme la mise en place d’un système de hiérarchisation de type
dualiste, profondément antithétique. Il s’impose grâce à la domination militaire, administrative et
symbolique. Sa rhétorique est le mythe du progrès et de la raison émancipatrice, un mythe qui ne
fonctionne que du côté lumineux du binôme. Côté obscur, existent la violence épistémique et
ontologique comme la praxis génocidaire.
Pour Enrique Dussel, on peut distinguer deux modernités. La première modernité fut administrée
par l’Espagne et produisit la première subjectivité moderne-coloniale. Cette subjectivité espagnole
se fondait sur l’ego conquiro et la négation de l’Autre. L’ego conquiro serait la base de l’ego
cogito qui s’affirmerait un siècle plus tard. La modernité, en tant que nouveau « paradigme » de la
vie quotidienne, de la compréhension de l’histoire, de la science, de la religion, émerge à la fin du
XV siècle et avec la domination de l’Atlantique. Le XVII siècle est déjà le fruit du XVI siècle; la
Hollande, la France, l’Angleterre sont déjà des développements ultérieurs dans un horizon ouvert
par le Portugal et l’Espagne. L’Amérique latine entre dans la modernité (bien avant l’Amérique du
Nord) alors que « l’autre visage », dominé, était exploité, couvert. (Restrepo, 2009). La seconde
modernité, qui prétend être la seule, commence à la fin du XVII avec la montée de nouvelles
puissances comme la France, l’Angleterre et la Hollande, et donnera lieu à ce qu’on a l’habitude de
désigner sous le terme de colonialisme. C’est là la différence entre Enrique Dussel et Immanuel
Wallerstein; le second différenciant la naissance du système monde et la modernité, qu’il identifie
lui aussi à l’Illustration alors que le premier oppose à cette vision d’une modernité eurocentrée
celle d’une modernité advenant dans le cadre d’un système monde.
L’administration de cette phase du système monde se caractériserait entre autres par le principe
d’efficacité dans le cadre de la gestion des populations, le développement du capitalisme et la
destruction de la base traditionnelle des sociétés concernées.
Cette idée d’une modernité univoque est, selon l’anthropologue Eduardo Restrepo, une des limites
de l’approche de Enrique Dussel. En effet, comme il le remarque dans La inflexión decolonial,
parler de la modernité comme d’une identité qui se maintiendrait relativement stable depuis son
émergence au XVI siècle est assez problématique — ce qu’on peut dire également de
l’historicisation de Enrique Dussel. L’anthropologue va jusqu’à parler de modernité « hyperréelle ».
Cet hyperréalisme, notion qu’il emprunte à Albán Achinte, désigne une stratégie d’énonciation
propre au discours décolonial dans laquelle un signifiant maître, la modernité, organise la pensée et
ne doit surtout pas être pensé. Supposer que la modernité est Une, qu’elle se serait dédoublée en une
Licence Creative Commons 4.0.
254
première et une deuxième modernité, articulée comme différence impériale et coloniale, avec une
essence qui se serait maintenue identique à elle- même, quel que soit l’endroit où elle opérait,
revient pour Restrepo à reproduire les imaginaires et les récits avec lesquels a opéré la dite
modernité. Une des conséquences est la réification de la modernité et de ce que l’on identifie
comme son côté sombre et constitutif : la colonialité.
L’approche féministe actuelle qui est en train de renouveler le corpus décolonial permettra peut être
de problématiser cette idée de modernité. C’est ce que tentent de faire des militantes comme
Márgara Millán lorsqu’elles pensent ensemble la modernité vue par Dussel et celle du philosophe
Bolívar Echeverría qui a passé une grande partie de sa vie à penser la modernité et à identifier ses
diverses et contradictoires manifestations.
Fin de la modernité
Les études culturelles et les courants postmodernes en parlent depuis des décennies. Comme le
remarque Santiago Castro Gómez (2005), la crise de la modernité pourrait n’être que celle de
l’ancien dispositif, celui qui excluait l’autre et qui a fonctionné jusqu’à la période
de décolonisation. Depuis plusieurs années, nous assisterions à son recyclage. Un dispositif peut
être remplacé par un autre sans qu’on sorte de la modernité/colonialité, conception qui avait déjà été
exploitée au début du XXI siècle par quelqu’un comme Antonio Negri (Bourguignon Rougier,
2017). L’Autre absolu disparaîtrait, remplacé par le et la subalterne; car il faut bien, lorsque s’étend
le marché mondial, étendre également la masse des consommateurs et consommatrices, l’exclusion
absolue devenant une limite.
Dans La postcolonialidad explicada a los niños, Santiago Castro Gómez développera l’analyse de
ce changement de dispositif qui n’est pas pour autant la fin de la modernité. Et il en profitera
d’ailleurs d’ailleurs pour régler leur compte à certaines affirmations de Antonio Negri sur la fin de
l’empire qui rendent compte d’un certain aveuglement face aux formes actuelles d’impérialisme —
ce que Coronil avait déjà très bien vu.
Mythe de la modernité
Le mythe de la modernité, dont l’analyse est développée par Enrique Dussel dans les conférences de
Francfort, s’est construit autour de l’idée d’une supériorité épistémique qui justifiait
l’asservissement d’autres peuples. C’est un mythe qui correspond au premier dispositif moderne
Licence Creative Commons 4.0.
255
colonial évoqué plus haut mais qui reste prégnant. Il fait de la raison ce qui a permis aux humains
de sortir d’une phase d’immaturité et d’accéder enfin à l’âge adulte. Dussel dénonce ce discours
fondé sur une négation de l’autre, qui alla jusqu’à l’imposition d’un nom (Amérique) à un continent
et d’une identité fantasmée (Indien-ne-s) à des populations. Il pointe les récits que véhicule ce
mythe : la rhétorique qui fait de la Grèce et de la Rome antique les fondements de l’âge moderne.
Cette stratégie permet d’ancrer l’Europe dans les imaginaires, ruse d’autant plus nécessaire que
jusqu’au XVI siècle, l’Europe ou plutôt la Chrétienté n’était pas un foyer civilisationnel équivalent
au monde musulman. Les hypothèses constitutives de ce mythe de la modernité sont décrites par
Enrique Dussel dans les termes suivants :
1) La civilisation moderne se comprend comme plus développée (ce qui l’amènera à défendre une position
eurocentrée sans en prendre conscience);
2) Cette supériorité oblige les modernes à contraindre les peuples plus primitifs, plus grossiers, plus barbares à se
développer. C’est un impératif moral;
3) Pour se développer, les peuples en question doivent imiter l’Europe (il s’agit en fait d’un développement
unilinéaire. Cela aboutit au « mensonge du développement », un discours aveugle à ce qu’il est vraiment);
4) Le barbare résistant au processus de civilisation, la praxis moderne doit recourir à la violence si c’est
nécessaire, pour détruire les obstacles à cette modernisation (voir la « Guerre Juste »
coloniale);
5) Une telle domination produit des victimes, pour des raisons diverses, mais cette violence est jugée inévitable.
De façon quasi sacrificielle, le héros civilisateur transforme ses propres victimes
en holocauste d’un sacrifice salvateur (l’Indien-ne colonisé-e, l’esclavagisé-e africain-e, les femmes, la
destruction écologique de la terre, etc.);
6) Pour l’homme moderne, le barbare est coupable (de s’opposer au processus civilisateur). Cela permet à la «
modernité », non seulement d’invoquer son innocence, mais aussi de se présenter
comme l’instrument de la rédemption de ses victimes;
7) Enfin, et en raison du caractère « civilisateur » de la « modernité », les souffrances ou les sacrifices (les coûts
de la modernisation) des autres peuples « arriérés » (immatures), des
autres races réduites en esclavage, de l’autre sexe pour sa faiblesse, etc. sont présentées comme des aléas
inévitables. (Restrepo, 2009)
Licence Creative Commons 4.0.
256
Dévoilant l’eurocentrisme qui est à la base de ces représentations et de ces pratiques, Dussel pose la
nécessité d’un dépassement de la modernité. Il ne cessera d’en préciser les contours par la suite. La
transmodernité, ce n’est pas seulement l’écriture d’une histoire mondiale qui ne sera plus
eurocentrée mais un projet pratique de libération des victimes de cette histoire de domination.
|
Projet de modernité
Le philosophe Santiago Castro Gómez revient sur cette expression que Jurgen Habermas emploie
pour différencier deux moments de la modernité. Pour le Colombien, dans le nouveau dispositif de
pouvoir, qui correspond à son deuxième moment néolibéral, ce que Fernando Coronil nomme
globocentrisme, il ne s’agit plus de sanctionner les différences mais de les produire. Parler de la
modernité comme d’un projet, c’est parler d’une instance centrale et cette dernière, c’est l’État
moderne qui n’a pas seulement le monopole de la violence mais organise rationnellement la vie
des populations qu’il gère dans le cadre de ces gouvernementalités décrites par Michel Foucault.
Cette gestion rationnelle repose sur la participation de sciences sociales qu’il ne faut pas voir
comme un plus mais comme un des fondements de l’État moderne. En effet, la taxonomie des
sciences sociales légitime autant qu’elle organise l’action de l’État et l’adaptation des
populations à l’appareil de production. Cette subjectivation des individus a un corollaire : la
question de l’autre, celui ou celle qui n’est pas subjectivé-e comme le ou la citoyen-ne et qui sera
d’ailleurs moins caché-e que construit-e. L’invention de l’autre et l’invention de la citoyenneté sont
liées de façon indissoluble. Si la modernité est un projet, c’est parce que ses dispositifs
disciplinaires sont ancrés dans une double gouvernementalité : d’un côté, la gouvernementalité
projetée vers l’intérieur des États, la création d’une identité homogène à l’aide de politiques de
subjectivation, de l’autre, la gouvernementalité projetée vers l’extérieur, la volonté de s’assurer les
flux de matières premières de la périphérie. D’où l’idée de Santiago Castro Gómez que la
globalisation que nous vivons n’est pas un projet, car elle n’a pas besoin de ces instances centrales
qui régulent les mécanismes de construction sociale.
On peut émettre un doute sur cette analyse si on pense à la violence actuelle de la répression partout
dans le monde. Les populations sont réprimées ou massacrées par des gouvernements qui
soutiennent les projets d’une minorité de prédateurs. Certes, ce projet ne renvoie plus dans ce
cas-là à un projet civilisationnel mais à une simple appropriation par une minorité. D’autre part, en
« Amérique latine » comme ailleurs, l’accentuation des processus de normation des individus amène
Licence Creative Commons 4.0.
257
à tempérer cette idée séduisante. S’il y a un projet, c’est peut-être celui des dueños, comme le dit
Rita Segato, celui d’un monde construit pour des maîtres.
Références
Achinte, Adolfo Albán. 2018. « Epistemes “otras”: ¿Epistemes disruptivas? » Conférence donnée à
l’Université catholique de Pereira.
http://www.revistakula.com.ar/wp-content/uploads/2014/02/KULA6_2_ALBAN_ACHINTE
Bourguignon Rougier, Claude. 2017. « Le chapitre manquant d’empire. Un regard décolonial. »
Intervention à l’Université Stendhal dans le cadre du séminaire Empire organisé par Olga
Bronnikova et Marta Ruiz Galbete.
https://www.academia.edu/31237971/Le_chapitre_manquant_dEmpire._Un_regard_d
%C3%A9colonial
Castro Gómez, Santiago. 2005. La postcolonialidad explicada a los niños. Popayán : Editorial
Universidad del Cauca.
https://territoriosendisputa.files.wordpress.com/2015/09/158.pdf
Dussel, Enrique. 2000. «Europa, modernidad y eurocentrismo». Dans La colonialidad del saber:
eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, sous la dir. de Edgardo Lander.
Buenos Aires. CLACSO. : 49.
Echeverría, Bolívar. 1998. La modernidad de lo barroco. México: Era.
Foucault, Michel. 2004. Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France. 1977-1978.
Paris : Gallimard
Licence Creative Commons 4.0.
258
Martinez Andrade, Luis. 2019. «Marxisme anticolonial, modernité et politique d’émancipation. Lire
Echeverría et Dussel». Contretemps.
https://www.contretemps.eu/marxisme-modernite-emancipation-echeverria-dussel/
O’Gorman, Edmundo. 1993 [1958]. La invención de América. Investigación de la estructura
histórica del nuevo mundo y del sentido de su devenir. México: Fondo de Cultura Económica.
Restrepo, Eduardo et Rojas, Axel. 2009. La inflexión decolonial. Introducción crítica al
pensamiento descolonial. Bogotá. Universidad Javeriana. p. 44. 43.
https://www.academia.edu/2186931/Inflexion_decolonial
Jürgen Habermas. 1988 [1985]. Le discours philosophique de la modernité. Douze conférences.
Paris : Gallimard.
Wallerstein, Immanuel. 1990. « L’Occident, le capitalisme et le système- monde moderne ».
Sociologie et sociétés, 22 (1), 15–52.
https://doi.org/10.7202/001837
Licence Creative Commons 4.0.
259
68. Monte
Monte pourrait se traduire comme la « brousse » ou la « forêt » ou le maquis. Ce terme est très
présent dans le vocabulaire des communautés afro-latino-américaines.On le retrouve notamment au
sein des communautés afrodescendantes au Mexique, à Cuba, en Colombie, en Équateur et au
Panama. Il désigne d’abord un espace naturel qui entoure les communautés afro rurales. Dans ce
milieu, sont menées certaines activités économiques : chasse, cueillette, élevage. D’autre part, le
monte a une dimension épistémologique.
Premièrement, il a constitué un espace historique pour les communautés afro-latino-américaines car,
durant la période de l’esclavage, le monte servit de lieu de résistance pour les esclavagisé-e-s. En
effet, afin d’échapper et de s’opposer au joug colonial et racial, ces esclavagisé-e-s vont s’installer
dans des zones très difficile d’accès et fonder des communautés, des villages libres qui, dans
certains cas, vont être des lieux de repli après des attaques menées contre les intérêts des colons
européens, comme à Panama, Veracruz et sur la Costa Chica au Mexique, et même, la tentative
de reproduire une « Afrique ». Le monte est l’environnement historique de résistance noire, ce que
la langue castillane consacrerait en l’associant à l’invention du terme « cimarrón ». Le monte est
l’écosystème où se trouve le village marron, le palenque, kilombo. Or, pour saisir toute la portée
anticoloniale du monte durant cette période d’esclavage et de traite, il faut rappeler que la
connaissance intime du milieu forestier ou de certaines niches écologiques provient de l’expérience
préalable en Afrique. Plusieurs esclavagisé-e-s africain-e-s ont été sociabilisé-e-s dans des
écosystèmes qui ressemblent à ceux à partir desquels ils et elles ont été déporté-e-s. En outre,
certains cycles de l’activité esclavagiste ont parfois rassemblé des populations africaines issues
d’aires culturelles proches dans les mêmes colonies espagnoles. Ce fut le cas des populations
d’Afrique centrale déportées vers le Mexique ou vers la Colombie.
Deuxièmement, en lien avec cette dimension historique, le monte renvoie à un espace surnaturel
ambivalent dans lequel se trouvent des entités et des forces capables de menacer ou de protéger
l’être humain. Au sein de la religion afro-cubaine palo monte d’ascendance bantoue (Afrique
centrale), le monte est l’endroit où le divin guérisseur trouve les éléments (herbes, feuilles)
nécessaires à la guérison des malades. Dans les mambos (chants rituels) du palo monte, la brousse
est le lieu de vie des génies et esprits. En Colombie, le monte constitue aussi un lieu d’initiation aux
connaissances des guérisseurs et guérisseuses. Au sein de la Costa Chica, le monte est le lieu de vie
du « double animal », de celui qui est considéré comme un « sorcier ». Dans ces communautés afro-
Licence Creative Commons 4.0.
260
mexicaines, certains individuspossèderaient un « double » qui serait un « animal » et qui vivrait
parallèlement dans le monte.
Par ailleurs, le monte a souvent été représenté dans certains discours européocentrés comme
contraire aux valeurs de la civilisation. Il est vu comme le lieu d’une certaine irrationalité, d’une
pensée rétrograde, d’une oralité à laquelle on ne peut se fier, de pratiques suspicieuses, d’une
violence. À cela, il faut ajouter la constante racialisation du monte : l’endroit des Noir-e-s. Dès
l’époque coloniale, les colon-e-s observent, pour mieux les dénoncer, les pratiques de certaines
communautés d’esclavagisé-e-spromptes à « entrer en brousse ».
Le monte apparaît comme une expérience du monde productrice de sens et de pratiques
transversales aux communautés afro-descendantes en « Amérique Latine ». Bien qu’elle ne soit pas
(encore?) théorisée comme une notion décoloniale, elle montre, par ses logiques empiriques et son
articulation historique, qu’elle relève d’une perspective critique de la domination épistémique
européocentrée. Le monte a une dimension décoloniale parce qu’il a été construit de manière
subalterne, dans d’autres espaces, depuis l’époque coloniale ; mais beaucoup des interprétations qui
en sont faites ne saisissent qu’un de ses multiples versants.
Références
Aguirre Beltrán, Gonzalo. 1989. Cuijla. Esbozo etnográfico de un pueblo negro. México: Fondo de
Cultura Económica.
Cabrera, Lydia. 1975. El monte, igbo finda, ewe, orisha, vititinfunda: notas sobre las religiones, la
magia, las supersticiones y el folklore de los negros criollos y del pueblo de Cuba. Habana:
Ediciones C.R.
Camacho, Juana et Restrepo, Eduardo (dir). 1999. De montes, ríos y ciudades: territorios e
identidades de la gente negra en Colombia. Bogotá: Fundación Natura.
Licence Creative Commons 4.0.
261
|69. Noir/Noire/Nègre/Mulâtre/Mulâtresse/Blanc/Blanche
SEBASTIEN LEFÉVRE
En la vida conocí mujer igual a la flaca / Coral negro de la Habana, tremendísima mulata / Cien libras de piel y
hueso, cuarenta kilos de salsa / Y en la cara dos soles que sin palabras hablan.
Ces vers sont tirés d’une chanson intitulée « La flaca », du groupe de rock espagnol des années
1990, Jarabe de palo. À première vue, rien de choquant: le protagoniste a connu une femme à la
Havane, à Cuba et il l’a trouvée très jolie. Or, pour la nommer, il utilise le terme de mulata
(mulâtresse) et coral negro (corail noir). De plus, il emploie le suffixe superlatif -ísima. L’auteur de
la chanson se réfère donc à des catégories coloniales : mulato est le nom donné à une certain
métissage biologique et corail noir renvoie à la couleur de la peau. Par conséquent, ce qui paraît «
anodin » ne l’est pas du tout. En effet, même si le langage commun utilise spontanément une
certaine type de lexique, les mots ont un sens et convoquent certaines formes de pensée.
La « mulâtresse » était le nom donné à la femme issue d’un métissage biologique entre un « Blanc
et une Noire ». Mais il signifie à l’origine le mélange entre un cheval et une mule. Il est donc
question d’abord d’un métissage entre deux animaux, c’est-à-dire des non-humains. Finalement, le
problème n’est pas tant les différents noms employés pour désigner les personnes mais le locuteur
ou la locutrice qui les emploie. Les implications changent s’il s’agit d’un « Blanc » vers une « Noire
», car le locuteur émetteur ou la locutrice émettrice, dans ce cas, ne peut se défaire de cette fameuse
colonialité de l’être; s’il ou elle la reprend telle quelle, comme c’est le cas ici, il ou elle est
comptable de cette terminologie socio-historique occidentale.
Prenons un autre exemple pour que les choses apparaissent plus clairement. Il s’agit du poème
chanté, et souvent mis en scène, Me gritaron Negra, de Victoria Santa Cruz. Il s’agit d’une
compositrice et chorégraphe née au Pérou en 1922 qui revendique ouvertement son afro-péruvianité
et dont les œuvres rendent compte de la culture et des traditions afro- péruviennes. Dans Me
gritaron Negra, Victoria Santa Cruz aborde la problématique corporelle en montrant clairement que
l’on ne naît pas « Noir-e », mais qu’on le devient. Le poème parle en effet d’une petite fille de cinq
ans qui découvre qu’elle est « Noire ». C’est la société dans laquelle elle vit qui lui assigne une
étiquette (« Ellos decían » [eux ils disaient]). Le Pérou, d’où est originaire Victoria Santa Cruz, est
issu, comme les autres pays d’« Amérique latine », d’une société coloniale où a été instaurée une
axiologie raciale assez rigide. Il y avait des « Noir-e-s », des « Mulâtres-ses », des « Zambos » ou «
Licence Creative Commons 4.0.
262
Zambaigos », des « Métis-ses », des « Indien-ne-s », des Espagnol-e-s et des « Criollos ». Les seul-
e-s à jouir d’un véritable statut de personne humaine étaient les Espagnol-e-s et leur descendant-e-s,
les «Criollos ». Dans ce poème, la petite fille est d’abord vue comme Negra et non pas comme une
petite fille. Elle se demande à ce propos ce que veut dire être Negra. Ce n’est pas par conséquent
quelque chose de naturel mais de construit. La société coloniale puis la société postcoloniale ont
stigmatisé les populations issues de la diaspora africaine en tant que « Negros ». Le stigmate se fixe
sur le « corps noir ». Ces catégorisations vont se révéler performatives en quelque sorte pour le
sujet. Et dans le poème, c’est de ce corps noir dont la petite fille voudrait d’abord s’échapper. Elle
cherche à défriser ses cheveux (« me lacié el cabello » [ je me suis lissé le cheveu]) puis à blanchir
sa peau (« me polveé la cara » [ je me suis poudré le visage]) et ressent même de la haine envers la
grosseur de ses lèvres (« odié mis labios gruesos » [ j’ai haï mes grosses lèvres]). Le stigmate
produit de la honte chez le ou la sujet, l’entraîne dans un processus aliénant. Et de fait, il ou elle
cherche à tout prix à éviter d’être vu-e à la place que la société lui assigne. Le stigmate agit comme
un véritable poids dans le parcours du sujet « noir-e » : « Seguía llevando a mi espalda, mi pesada
carga » [ je continuais à porter sur mon dos, ma lourde charge]. Le ou la sujet débute donc sa vie
avec un « capital racial » déficient dans une société qui n’accepte pas les « Noir-e-s » comme
personnes humaines, mais comme « Noir -e-s » avant tout. Pour autant, ce poème chanté par
Victoria Santa Cruz n’est pas du tout pessimiste puisqu’il montre la voie d’une possible ré–
humanisation par la construction d’un sentiment de fierté et d’estime de soi. Cette construction
passe par la reprise du stigmate, mais cette fois-ci pour le neutraliser et le transformer en quelque
chose de positif : « Negra soy » [ je suis Noire]. Pour Victoria Santa Cruz, la clé des choses se
trouve à ce niveau : « Ya tengo la llave » [ j’ai maintenant la clé].
Cet exemple montre très bien l’enjeu de la catégorisation de la personne, à la fois « blanche », «
noire », « mulâtresse », etc. Si l’on reprend ces catégories sans les questionner ou sans les mettre
entre guillemets, cela signifie que l’on accepte ces constructions socio-historiques. Le ou la « Noir-
e », pas plus que le ou la « Blanc-he », n’existent en tant que tel.le.s. Il faut différencier les
différents locuteurs et locutrices. Une Victoria Santa Cruz qui s’inscrit dans un processus de ré–
humanisation à partir de postulats se rattachant à la Négritude est tout à fait légitime. Un-e « Blanc-
he » qui dit à un-e sujet africain-e ou afrodiasporique qu’il est « Nègre-sse », « Noir-e », etc. impose
une assignation identitaire.
Pour terminer, il serait opportun de s’interroger sur un certain emprisonnement de la Négritude qui
cantonne le ou la sujet afro dans une prison mentale finalement imposée par le rapport aux « Blanc-
hes ». Et si la Négritude ne débouche pas sur une ré-humanisation complète qui permette au sujet
Licence Creative Commons 4.0.
263
afro de ne plus se penser en tant que sujet « noir-e », elle reste dans les assignations imposées par
l’Occident. C’est tout le débat entre Césaire-Senghor-Glissant-et surtout–Fanon.
Licence Creative Commons 4.0.
264
|70. Ontologie(s)
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
L’ontologie est un concept qui avait disparu de la scène philosophique après la Seconde Guerre
mondiale, et qui avait été mis à mal par des penseurs et penseuses de l’« autrement qu’être »,
comme Emmanuel Levinas. Il est réapparu, avec un détour par la discipline anthropologique, lors
du « tournant ontologique », incarné par des chercheurs et chercheuses comme Philippe Descola et
Eduardo Viveiros de Castro.
C’est un concept important pour l’abord de la théorie décoloniale, qui ne prend pas le même sens
selon qu’il est utilisé par Enrique Dussel ou Arturo Escobar. Pour Enrique Dussel, l’ontologie c’est
ce domaine de la philosophie occidentale caractérisé par une interrogation sur l’être. Mais c’est
aussi la pratique qu’il imagine, à partir de la remise en question de cette ontologie, comme une
réflexion sur le monde quotidien en tant que totalité du sens pratique. À partir de l’étude de Totalité
et infini, Enrique Dussel élabore une opposition à l’ontologie qui prend forme dans sa philosophie
et son éthique de la libération. Il voit la totalité comme une figure centrale de l’ontologie
qu’il ramène à son mode d’existence historique : il rappelle que l’ontologie de la philosophie
occidentale a été imposée par la rationalité occidentale moderne aux dépends de ses Autres. Et il
effectue un virage, abandonnant l’ontologie pour se tourner vers la métaphysique, qu’il voit comme
un aller vers un au-delà qui n’est pas la métaphysique de la modernité. La métaphysique de l’altérité
qu’il construit est finalement une ontologie négative : elle nie l’ontologie moderne, elle-même basée
sur la négation de cette Altérité. En l’occurrence, le premier autre de la modernité, c’est l’autre
latino-américain. L’Altérité est la manifestation d’une rationalité occidentale qui réduit le Différent
au Même et qui, dans le domaine politique, existe comme destruction de l’humanité autre,
différente, étrangère. Dans ses 14 thèses, il écrit que « l‘ontologie est une philosophie du pouvoir,
de l’injustice, du dogmatisme, tandis que la métaphysique est l’expression de l’éthique comme
première philosophie, la critique de l’ontologie, le questionnement du Soi, l’acceptation de l’autre et
du différent (Dussel, 2016). La négation del’ontologie rend nécessaire l’intervention de l’extériorité.
Chez Arturo Escobar et chez Mario Blaser qui travaillent sur le concept, l’ontologie désigne autre
chose qui ne renvoie pas, comme chez Dussel, à la philosophie occidentale mais à l’anthropologie.
L’émergence du « tournant ontologique » dans les sciences sociales peut nous permettre de mieux
Licence Creative Commons 4.0.
265
appréhender la valeur que prend cette notion chez ces anthropologues latino-américains. Ce qui se
joue alors nous ramène à un problème évoqué au début de ce dictionnaire, cette question de la
culture, qui a succédé à celle de la race dans la discipline anthropologique, la remplaçant mais se
construisant néanmoins sur le même antagonisme nature/culture. Parmi ceux et celles qui repensent
l’articulation nature/culture, Philippe Descola décrit l’ontologie comme le système des propriétés
que les êtres humains attribuent aux êtres et qui intervient dans la détermination des relations
qui peuvent exister entre identités humaines et identités non-humaines. La notion d’entités et d’«
existant », est importante pour comprendre cette approche. Plus que l’être abstrait de la
problématique philosophique, l’ontologie c’est l’ensemble des choses que l’on fait exister, le monde
que l’on énacte et que l’on fait exister.
On serait tenté de dire que par des voies différentes les deux auteurs essaient de remettre en
question un même phénomène historique : l’imposition du Soi occidental comme seule réalité. Mais
si Enrique Dussel part de la philosophie et de la conceptualisation de l’être pour la critiquer
et la dépasser, s’il attaque le versant destructeur et dominateur de cette ontologie, Arturo Escobar,
lui, s’intéresse à une remise en question de la partition nature/culture qui structure le dualisme
moderne. Pour répondre à la question « qu’est ce que la réalité? », il faut passer par une
désarticulation des antinomies modernes et partir de conceptualisations autres, de l’expérience des
Autres. Car si la déconstruction de cette ontologiemoderne/coloniale, de l’égoïsme qui la fonde, de
sa propension à dissocier constamment la réalité et la fragmenter est une phase nécessaire, il est
aussi urgent de rendre visibles les ontologies qui ne sont pas basées sur la séparation mais au
contraire sur la relation. C’est le cas de l’ayllu andin étudié par Marisol de la Cadena, ou de la
Madre Tierra des Nasa colombien- ne-s. Aujourd’hui, les peuples en question ont un rapport
politique à leurs ontologies; pour les faire exister ils doivent nécessairement affronter le
modèle politique et économique moderne qui fait de la nature et de leurs territoires des
marchandises. La notion d’ontologie relationnelle chez Arturo Escobar, Mario Blaser et Marisol de
la Cadena est donc indissociable de ce qui va précisément à l’encontre de l’ontologie moderne
dénoncée par Enrique Dussel et de l’ épistémologie qui l’accompagne. Dans les deux cas, le
rapport à l’ontologie est politique.
Références
Andrade Perez, Roberto, Bordai, Ella. 2018. « Luttes éco-sociales, migrations des savoirs et
pratiques politiques ontologiques avec Arturo Escobar : la nécessité de traduire l’anthropologie».
Licence Creative Commons 4.0.
266
Revue d’Études Décoloniales.
http://reseaudecolonial.org/2018/10/18/luttes-eco-sociales-migrations-des-savoirs-et-pratiques-
politiques-ontologiques-avec-arturo-escobar-la-necessite-de-traduire-lanthropologie/
Blaser, Mario et De la Cadena, Marisol. 2017. «The Uncommons : An Introduction».
Anthropologica 59 (2): 185-193.
https://utpjournals.press/doi/full/10.3138/anth.59.2.t01
De la Cadena, Marisol. 2015. «Uncommoning Nature». e-flux August. http://supercommunity.e-
flux.com/texts/uncommoning-nature/
Descola, Philippe. 2000-2004. « Figures des relations entre humains et non humains ». Cours
donnés au Collège de France.
https://www.college-de-france.fr/site/philippe-descola/course-2001-2002.htm
Dussel, Enrique. 1974. «Capítulo VIII : unidad replanteada por superación de la ontología». Dans
El dualismo en la antropología de la cristiandad. Buenos Aires : Editorial Guadalupe.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120130114110/10cap8.pdf
Dussel, Enrique. 2016. 14 tésis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Madrid :
Éditions Trotta. p. 124.
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/68.14_Tesis_Etica.pdf
Escobar, Arturo. 2018. «Les dessous de notre culture». Revue d’Etudes Décoloniales
http://reseaudecolonial.org/2016/09/02/les-dessous-de-notre-culture/
Escobar, Arturo. Sentipensar con la tierra : nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia.
Medellín : Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/escpos-unaula/20170802050253/pdf_460.pdf
Oslender, Ulrich. 2017. «Ontología relacional y cartografía social: ¿hacia un contra-mapeo
emancipador, o ilusión contra-hegemónica?». Tábula Rasa. n°. 26.
Licence Creative Commons 4.0.
267
https://www.redalyc.org/jatsRepo/396/39652540012/html/index.html
Vieira, Antonio Rufino. 2008. «L’éthique matérielle de la vie : le projet éthique-politique critique de
la philosophie de la libération». n° 134. Les carnets de centre de philosophie du droit.
https://sites.uclouvain.be/cpdr/docTravail/RufinoVieiraA.134.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
268
71. Opprimé-e-s (pédagogie)
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La pédagogie des opprimé-e-s du Brésilien Paolo Freire représente une des innovations les plus
importantes dans la pensée critique latino- américaine. Freire a accompli, au niveau de l’éducation
et de la pédagogie, une révolution semblable à celle qu’ a réalisé Dussel dans le monde de la
philosophie. Aujourd’hui, la perspective de Freire a toujours un rayonnement important même si
elle n’a plus l’incroyable aura qui fut la sienne il y a cinquante ans..
Pédagogie des opprimés est un livre qui annonce l’émergence de la philosophie de la libération et
fut publié par l’auteur en exil, durant la dictature brésilienne des années 1960. La dictature semble
avoir été un facteur d’accélération pour la genèse de ce livre-monument, comme le serait quelques
années plus tard la dictature argentine pour la philosophie de la libération. Dans Pédagogie des
opprimés, Freire fait de l’éducation une stratégie révolutionnaire de transformation sociale; c’est un
livre en phase avec la critique économique de la dépendance, dont beaucoup de tenant-e-s étaient
d’ailleurs, comme Freire, brésilien-ne-s.
Pour Freire, l’opprimé-e doit construire lui-même, elle-même sa propre libération, donc commencer
par être conscient-e de son oppression. Il ou elle devient alors son ou sa propre pédagogue. On
retrouve chez lui une radicalisation des idées qu’avait commencé à explorer le pédagogue conseiller
de Bolívar, Simón Rodriguez, pour lequel les républiques ne se faisaient pas avec des docteur-e-s ni
des lettré-e-s mais avec des citoyenne-s. La véritable mission était donc de « tener pueblo », soit un
peuple qu’il fallait former certes, mais à partir de la particularité latino-américaine, et pas de la
norme occidentale qui s’imposerait après les Indépendances.
L‘opprimé-e est la clé pour comprendre le fonctionnement du pouvoir. Les opprimés ne sont pas
seulement ceux qui endurent la domination, l’oppression est une relation dialectique entre
l’oppresseur et l’opprimé, dans laquelle ces derniers intègrent une logique oppressive. La libération
n’est donc pas seulement une lutte contre l’oppresseur, mais aussi une lutte des opprimés pour se
découvrir, tout en découvrant leur oppresseur. Il s’agit pour les opprimés de découvrir la
contradiction avec leur antagoniste et leur identification avec lui, afin de surmonter sa peur de la
liberté, qui est l’une des conséquences de la domestication réalisée grâce aux
Licence Creative Commons 4.0.
269
structures sociales de domination (Restrepo, 2010). Un des grands défis de l’opprimé-e, qui, en se
libérant, libère aussi le ou la dominant-e déshumanisé-e par la relation qui l’enchaîne au dominé-e,
sera donc de ne pas reproduire à son tour les structures de la domination.
Le but de la pédagogie des opprimés est la réappropriation de leur humanité, mais pour ce faire, ils doivent
découvrir l’oppresseur et eux-mêmes. La réalité des opprimés est contradictoire : ils doivent
affronter leur peur de la liberté, tout en dépassant leur identification avec ce qui les nie. Sans cela, les opprimés
peuvent transformer les conditions de l’oppression, mais seulement pour les reproduire, et cette fois-ci, sur leur
ancien oppresseur. (Restrepo, 2010)
Voilà pourquoi Freire ne pense pas que les opprimé-e-s soient les agent- e-s prédestiné-e-s de la
révolution. Il est persuadé qu’il n’ y a pas de révolution sans une praxis organisée par les opprimé-e-
s mêmes. La révolution existe dans la formation des sujets révolutionnaires. Les sujets ne
sont pas un résultat de la lutte, ils et elles adviennent dans la lutte, d’où l’importance de la
pédagogie. Cette perspective donne aux intellectuel-le-s un rôle particulier : s’ils et elles doivent
travailler aux côtés des opprimé-e-s, leur rôle n’est pas de faire la révolution pour les opprimé-e-s,
mais avec eux et elles dans un processus d’éducation dialogique. Freire critique l’arrogance et
l’autoritarisme des intellectuel-le-s de gauche et de droite qui se considèrent propriétaires des
savoirs ou des universitaires qui prétendent « conscientiser » les travailleurs ruraux et urbains et les
travailleuses rurales et urbaines. Il est le premier à formuler une critique de la colonialité du savoir
et surtout à décoloniser le rapport au savoir dans la pratique.
Dans la pensée de Dussel, cette pédagogie des opprimé-e-s a joué un rôle fondamental. L’opprimé-e
incarne cette extériorité sans laquelle l’édifice de la philosophie de la libération ne tient pas, même
si le rôle que le philosophe accorde aux intellectuel-le-s dans le processus révolutionnaire ne cadre
pas avec la vision qu’a le Brésilien. Eduardo Restrepo dit que chez Dussel il y a un privilège
épistémique des opprimé-e-s, car leur condition d’extériorité leur permet d’articuler la praxis et la
philosophie de la libération.
Restrepo remarque que pour la perspective décoloniale, il est aussi question d’extériorité mais celle-
ci est plus précise : elle tient à la différence coloniale qui n’est pas une extériorité absolue, mais qui
est produite. Si Paulo Freire et Enrique Dussel abordent l’opprimé-e en tant que peuple ou que
pauvre, dans la pensée décoloniale, l’opprimé-e c’est celui ou celle qui a été racialisé-e au cours du
processus de constitution de la modernité/ colonialité : l’Indien-ne ou le ou la Noir-e (Restrepo,
2010). Une autre différence tient au fait que la pédagogie des opprimé-e-s n’a pas été élaborée
Licence Creative Commons 4.0.
270
comme un contre-récit de la modernité ou de l’eurocentrisme. Le point de départ, contrairement à
ce qui se passe dans l’approche décoloniale, ce sont les problèmes rencontrés par les « va-nu-
pieds ».
À une époque où les discours sont déconnectés des pratiques de façon obscène, l’apport de Paulo
Freire a ceci de précieux : on ne peut être « freirien » uniquement en paroles. Assumer une
pédagogie freirienne suppose un engagement pour la démocratie, le refus d’une science neutre et
une cohérence entre le discours et la pratique. Quand on pense à la conception aseptisée qui domine
aujourd’hui dans l’enseignement, les propos de Freire, cinquante plus tard, restent tristement
d’actualité.
Références
Freire, Paulo. 1970. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro : Paz e terra.
http://www.tlaxcala-int.org/upload/telechargements/150.pdf
Freire, Paulo. 2018 [1974]. Pédagogie des opprimés. Résistance 71. Traduction à partir des textes
anglais et portugais.
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/la-pedagogie-des-opprimes-de-paulo-freire-
public3a9-en-1970.pdf
Restrepo, Eduardo et Rojas, Axel. 2009. La inflexión decolonial. Bogotá : Master d’études
Culturelles. p. 27. 28. 29.
https://www.academia.edu/2186931/Inflexion_decolonial
Licence Creative Commons 4.0.
271
72. Orishas en déportation
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Le culte des orishas est un phénomène religieux issu de la Traite transatlantique. Il est issu de culte
de divinités dans la culture yoruba d’Afrique de l’Ouest, notamment dans l’actuel Nigeria et au
Bénin. On retrouve sa pratique à Cuba, sous le nom de Santería et au Brésil, sous le nom du
Candomblé. Cette région d’Afrique de l’Ouest a été affectée par la Traite esclavagiste
transatlantique et ses reflux. La fin tardive de l’institution esclavagiste à Cuba et au Brésil a entraîné
une importante présence démographique des ethnies et populations de cette partie de l’Afrique.
La religion yoruba s’organise autour de divinités intermédiaires entre un être suprême, Olodumare,
et les humains. Ces divinités peuvent représenter des domaines spécifiques de la nature (eaux,
vents, plantes) ou des activités humaines (justice, guerre). Elles peuvent être perçues comme des
ancêtres mythiques dans une société lignagère. Cette religion a été l‘objet d’une abondante
littérature historique et anthropologique et, plutôt que de procéder à une interprétation anachronique
ou à rebours de la réflexion sur les religions des Afro-descendant-e-s, il nous paraît important
d’observer les correspondances et continuités entre culte orishas et pratique yoruba en
Afrique. Bastide (1973) l’a fait déjà en signalant que les principales divinités s’étaient maintenues
de part et d’autre de l’Atlantique, il a noté aussi l’existence d’une organisation sacerdotale yoruba
plus ou moins identique (avec un groupe de prêtres/divins, chefs de confréries et des sociétés
secrètes), l’usage de chants et de tambours tant à Cuba qu’au Nigeria et les même séquences lors
des rites (sacrifices d’animaux, préparation de la fête, appel premier à Eleggua/Eshu, danses mimant
les récits des divinités yoruba). Cette pérennité caractéristique tant de la Santería que du
Candomblé, fait que Bastide les désigne comme des « religions en conserve ». Bien évidemment, la
dynamique de transnationalisation ou de flux à l’œuvre actuellement a produit des changements
dans la pratique de ces religions. Mais cette transnationalisation a lieu parce qu’il y a un minimum
de pratiques, de signes et d’objets en commun entre adeptes de cette religion en Afrique et Afro
Abya Yala. On ne peut dès lors s’affranchir d’un questionnement sur ces éléments partagés bien
qu’ils s’opposent à une lecture créolisante. Le maintien de cette religion a une signification sociale
et politique puisqu’elle a permis une sociabilité afro-descendante et une expressio culturelle dans
le contexte d’une colonialité exacerbée.
Licence Creative Commons 4.0.
272
Les correspondances transnationales et le regain des mouvements afro- descendants dans le culte
des orishas laissent entrevoir la valeur accordée à cette religion comme espace de connaissances et
d’identification pour les communautés afro-descendantes.
Références
Bastide, Roger. 1973. Les Amériques Noires. Paris : l’Harmattan.
Basilio Nunes, Victor Hugao. 2016. « Orixá, natureza e homem: o candomblé na perspectiva
decolonial». Congreso Internacional Historia.
http://www.congressohistoriajatai.org/2016/resources/anais/6/
Magalhães Santos, Beatriz. 2019. « Território e religiosidade no Brasil e em Cuba: expressão de um
patrimônio-territorial afro-religoso». ANPEGE.
http://www.enanpege.ggf.br/2019/resources/anais/
8/1562589292_ARQUIVO_TERRITORIOERELIGIOSIDADENOBRASILEEMCUBAEXPRESSAOD
EUMPATRIMONIO-TERRITORIALAFRO-RELIGOSO.pdf
Voir à ce sujet:
https://www.youtube.com/watch?v=LYPs1Y913LA
Licence Creative Commons 4.0.
273
73. Palo Monte (el)
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Le palo monte est une religion afro-cubaine d’origine bantoue, d’Afrique centrale. Elle a deux
variantes : palo-mayombe et kimbisa. Elle se manifeste par la croyance en des forces non-humaines
appelées mpungus qui représentent les forces et attributs de la nature. Elles peuvent prendre la
forme des esprits des défunt-e-s, des ancêtres. Le palo monte se différencie de la Santería du fait de
son héritage kongo, d’Afrique centrale. Cet héritage se donne à voir dans son rattachement de la
part de ses pratiquants à l’origine kongo, ce qui souligne la dimension mémorielle. D’ailleurs dans
un récit mythique recueilli par Dianteill, il est fait mention de la figure de la reine Nzinga, grande
figure au XVI siècle de la résistance face aux Portugais dans la région du Ndongo et qui a vu son
influence s’étendre dans toute la zone de l’actuelle Angola. En outre, la majorité des termes
initiatiques sont d’origine kikongo ou issus des langues d’ethnies limitrophes, souligne Dianteill en
reprenant les travaux de González Huguet et Baudry (1967). On pourrait citer : nganga, nkisi,
kimbisia ou encore mayombe. Le nkisi, conçu dans le système kongo est le réceptacle rituel pour
construire le lien entre un esprit et un humain. Dans la pratique afro-cubaine, la fonction est
la même. Le maintien d’un système de représentations et de pratiques en lien avec l’aire culturelle
kongo souligne la spécificité afro-cubaine et son orientation de résistance.
Références
Dianteill, Erwan. 2002. « Kongo à Cuba. Transformations d’une religion africaine ». Archives de
Sciences sociales des Religions, nº117 : 59-80.
Silva Ribeiro, José da. «Palo Monte, um rito Congo em Cuba ». IC – Revista Científica de
Información y Comunicación.
https://icjournal.files.wordpress.com/2013/01/1259073988-1silva.pdf
Voir à ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=_cQHCT9fJlU
Licence Creative Commons 4.0.
274
74. Paredes, Julieta
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Nous les femmes, nous sommes la moitié de tout. (Paredes, 2008) Julieta Paredes est une militante
féministe lesbienne aymara. Elle a créé dans les années 1990, avec María Galindo, à La Paz, un
atelier qui accueillait les femmes en détresse. C’est un moment marqué par l’imposition violente
du modèle néo-libéral en « Amérique latine », au nom de la liberté, un moment où l’exploitation des
populations comme la restructuration des mécanismes coloniaux de colonisation se renforcent.
Mujeres creando publie une revue, Mujer Pública (Femme Publique) émet un programme de radio
hebdomadaire et organise un lieu d’accueil qui offre gîte et couvert,ainsi que des ateliers artisanaux
et des formations, aux femmes de la rue. À ce moment-là, en Bolivie, la gauche voyait le féminisme
comme un facteur de division et s’accommodait de la domination du modèle hétérosexuel sur les
hommes et les femmes. Il était alors impensable de revendiquer son
lesbianisme. C’est dans ce contexte sinistré qu’apparaît Mujeres creando, un mouvement
qui a développé plusieurs stratégies politiques, communicationnelles, et joue très habilement de la
provocation. Elles sont des « agitatrices de rue ». Leur action subversive s’appuie sur des œuvres
artistiques qui peuvent avoir divers supports, des graffitis par exemple, lesquels deviendront une
griffe parfaitement identifiable du mouvement. La performance, la littérature, le graffiti, la musique,
l’espace numérique permettent de rendre visible cette lutte. Les interventions de Mujeres
creando au sein de la ville de La Paz étaient de véritables exploits, parfois clandestins, parfois
publics, et elles continuent 27 ans plus tard. La rue est la scène de leurs performances. Ces femmes
soutiennent des mouvements comme celui d’une organisation pour les personnes endettées avec des
institutions de microcrédit. Elles prônent une éducation sexuelle nationale pour contrer le machisme
et défendent le droit à l’avortement. Récemment, en 2018, Maria Galindo a aspergé de peinture
rouge les murs de la Maison du Peuple pour protester contre le peu d’énergie déployée par le
gouvernement d’Evo Morales dans la lutte contre le féminicide.
Depuis quelques années, Julieta Paredes a quitté Mujeres creando et milite dans Mujeres creando
comunidad qu’elle a fondée en 2002. Elle pensait alors que le féminisme autonome anarchiste qui
était à la base de Mujeres creando n’était plus adapté, car le féminisme se devait désormais d’être
communautaire. Cela s’est traduit dans des écrits comme dans sa lutte contre le néolibéralisme.
Licence Creative Commons 4.0.
275
Patiemment, à partir d’avril 2002, nous avons construit des relations avec les femmes des quartiers
et aussi de El Alto. En 2003, lors de l’insurrection, nous nous sommes retrouvées dans les rues avec
elles pour combattre le néolibéralisme et récupérer les ressources naturelles de notre peuple. Là, les
compañeras ont compris qu’on ne faisait pas un show féministe pour la télé et que ce n’était pas un
produit d’exportation. Elles ont pu voir la réalité, que nous étions des féministes qui partaient du
peuple et agissaient pour le peuple. Depuis, nous avons continué à nous réunir au café « Carcajada »
etl’Assemblée Féministe est née, comme coordination de collectifs et de personnes. (Paredes, 2008)
Aujourd’hui, Julieta Paredes pense un féminisme indigène communautaire à partir d’une critique
des féminismes occidentaux, qui est exposée dans le livre Hilando fino, publié en 2010. Cette
critique prolonge ce qui a été fait à peu près à la même époque, notamment par Ochy Curiel
ou Maria Lugones. En Occident, remarque-t-elle, le féminisme répond aux besoins des femmes
dans les sociétés qui sont les leurs.
Nous, avec notre féminisme communautaire, nous avons un autre point de départ, parce que
nous ne nous situons pas individuellement, nous nous situons aux côtés de nos frères. Partant
d’une identité commune nous faisons une proposition politique, non pas individualiste mais englobant tous les
droits communautaires et pas seulement nos droits individuels de femmes. Cela suppose que nous reconnaissions
que nous subissons les mêmes discriminations, les mêmes oppressions, les mêmes exploitations que nos frères,
tout en dénonçant le fait que dans la communauté, ils deviennent à leur tour nos oppresseurs et nos exploiteurs.
(Paredes, 2012)
Sa position diffère de celle de Maria Lugones pour ce qui est des rapports entre mondes indigènes et
système de genre. Contrairement à la féministe argentine, elle pense que le genre existait déjà dans
les sociétés amérindiennes.
Nous, nous disons qu’il y a eu une convergence des patriarcats. Mes frères aymaras n’y échappent pas car avant
ils se comportaient aussi en patriarches. J’en veux pour preuve la négociation qu’ils menaient entre hommes au
sujet de celles qu’on appelait les Vierges du Soleil, utilisées pour le service sexuel, économique, politique et
éducatif des classes dominantes incas. Ces filles venaient des peuples conquis. Si, comme le disent quelques-uns
de nos frères, c’était le paradis avant que les q’aras (les Espagnols, littéralement « hommes nus » en aymara)
arrivent, pourquoi les hommes n’étaient-ils pas le butin ou l’objet de l’échange entre les Aymaras et les Incas, par
exemple? (Paredes, 2012)
Sa critique attaque donc le mythe de la paire chacha-warmi, présentée comme complémentaire et
harmonieuse :
Licence Creative Commons 4.0.
276
Les frères indianistes nous disent que le féminisme est uniquement occidental et que nos peuples n’ont pas
besoin de ces pensées occidentales car existe déjà la pratique de la complémentarité chacha-warmi, homme-
femme, qu’il nous suffit de pratiquer puisque le machisme est arrivé avec la colonisation. Mais même si on le
voulait, même si on forçait les choses en dissimulant les problèmes,le fait est que chacha-warmi n’est pas le
point de départ de ce que nous cherchons. Pourquoi? Parce que le chacha-warmi ne reconnaît pas la situation
réelle des femmes indiennes, il n’intègre pas la dénonciation du genre dans la communauté et naturalise la
discrimination. (Paredes, 2008)
Cette dualité masculin/féminin, on la retrouve aussi dans la cosmogonie aztèque et elle donne lieu à
une image du monde comme complémentarité et équilibre. Mais une chose est la complémentarité,
dit elle, une autre, la naturalisation de l’hétérosexualité. C’est ce glissement d’un symbolisme à une
norme qu’elle remet en question. Comme le caractère subalterne du rôle de la femme dans la
communauté traditionnelle. Elle remarque que lorsqu’un homme est élu pour une fonction politique
dans une communauté indienne, sa compagne, de façon automatique, est associée à son travail
politique mais dans le cadre d’une dépendance vis-à-vis de l’homme, car sa représentation
n’a pas de légitimité :
Nous conservons l’idée de paire complémentaire, mais pour partir de ce concept nous devons obligatoirement
nous éloigner de la pratique machiste et conservatrice du chacha-warmi. Il faut le dénoncer comme un espace de
forte résistance machiste, de privilèges pour les hommes et de violence en tous genres envers les femmes. Dans
la perspective du féminisme communautaire qui est la nôtre, nous le repensons comme paire complémentaire
d’égaux warmi-chacha, femme-homme (…). Ce n’est pas un simple changement de place des mots, mais la
reconceptualisation de la paire complémentaire opérée par les femmes, parce que, nous les femmes, nous
sommes celles qui sommes subordonnées et que construire un équilibre, une harmonie au sein de la
communauté, de la société, cela se fait en partant des femmes. (Paredes, 2008)
Pour elle, il faut partir de la paire femme-homme, de la femme, des femmes en communauté, pour
créer le temps des femmes. La communauté n’est pas seulement la communauté indienne mais une
autre façon de penser la vie; une communauté constituée d’hommes et de femmes lié-e-s par
la réciprocité. Elle ne part pas de la famille ou du couple mais de la communauté. Pour elle, dans
l’imaginaire de la Bolivie d’aujourd’hui, la communauté renvoie aux hommes de la communauté,
pas aux femmes, car ce sont les hommes qui parlent, décident, sont chargés de représenter la
communauté. Les femmes, elles, sont en retrait, subordonnées aux hommes. Pourtant :
Soumettre la femme à l’identité de l’homme ou vice versa, c’est priver de la moitié de son potentiel la
communauté, la société ou l’humanité. Soumettre la femme, c’est soumettre la communauté car
Licence Creative Commons 4.0.
277
la femme est la moitié de la communauté et en soumettant une partie de la communauté, les hommes se
soumettent eux-mêmes car eux aussi sont la communauté. (Paredes, 2008)
Elle propose comme modèle social la communauté des communautés
car :
Nous plaçons au fondement de nos relations humaines la reconnaissance de l’altérité, entendue comme
l’existence réelle de l’autre et non comme fiction d’altérité. Cette reconnaissance n’est
pas nominale, reconnaître l’autre existence entraîne une série de conséquences, par exemple, la redistribution des
bénéfices du travail et la production à parts égales. (Paredes, 2008)
Références
Julieta Paredes. 2017 [2008]. Tisser fin, en partant du féminisme communautaire. DIAL.
http://www.alterinfos.org/spip.php?article7898
Chapitre 1
http://www.alterinfos.org/spip.php?article7900
Chapitre 2
http://www.alterinfos.org/spip.php?article7899
Chapitre 3
http://www.alterinfos.org/spip.php?article7932
Gascó, Emma et Cúneo, Martin. 2012. « Sans les femmes, ils n’auraient pas résisté trois jours »,
entretien avec Julieta Paredes. DiaL
http://www.alterinfos.org/spip.php?article5439
Paredes, Julieta. 2008. « Hilando fino desde el feminismo comunitario ». Mujeres del mundo babel.
pp. 8. 9. 10. 11
https://mujeresdelmundobabel.org/files/2013/11/Julieta-Paredes-Hilando-Fino-desde-el-Fem-
Comunitario.pdf
11
11
Licence Creative Commons 4.0.
278
75. |Passage du Milieu (le)
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Le Passage du Milieu est une expression issue de la littérature anglo- saxonne, des études littéraires
et culturelles. Elle renvoie à l’expérience de la traversée de l’Atlantique, dans le navire négrier, des
esclavagisé-e-s de l’Afrique vers les colonies aux Amériques. La particularité de ce passage
conceptualisé tient à ce qu’il constitue la transition d’un espace africain connu des esclavagisé-e-s
vers un autre territoire, inconnu. Durant cette expérience de la traversée, les esclavagisé-e-s
subissaient toute la violence de la colonialité du pouvoir : réduction de leur vie à la condition de
pure force de travail, racialisation des relations sociales, contrôle et répression, annihilation de la
culture et de la subjectivation. On pourrait d’ailleurs lire ce Passage du Milieu comme l’un des
moments constitutifs de la modernité capitaliste et donc de son intrinsèque colonialité. Cette
expérience est, dès lors, un des préalables épistémologiques à considérer lorsqu’on s’intéresse
aux productions, savoirs, discours et identités dans l’Afro Abya Yala.
Références
Equiano, Olaudah. 2008. Ma véridique histoire: Africain, esclave en Amérique, homme libre.
Mercure : Paris.
Guillén, Nicolas. 1957. Motivos de son. West Indies Ldt. Sóngoro cosongo : poemas en cuatro
angustias y una esperanza. Buenos Aires : Losada.
Glissant, Edouard. 1990. Poétique de la relation. Poétique III. Le chapitre sur la Cale du navire
négrier. Paris : Gallimard.
Rediker, Markus. 2013. A bord du négrier. Une histoire atlantique de la traite. Paris : Seuil
Voir à ce sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=UrvJMi5dYsg
Licence Creative Commons 4.0.
279
76. Patriarcat
Claude Bourguignon Rougier
La critique du patriarcat, dont Claudia Von Werlhof, en Europe, est une des représentantes les plus
conséquentes, a trouvé en « Amérique latine » des prolongements particulièrement créatifs. Rita
Segato, anthropologue argentine, a élaboré les concepts de patriarcat de « basse intensité » et de «
haute intensité ». Le premier s’applique aux sociétés précolombiennes. Dans ces « mondes-villages
», les femmes avaient un statut subalterne mais elles avaient aussi un rôle à jouer, ailleurs que dans
la sphère de la reproduction.
Elles n’étaient pas enfermées dans une sphère domestique car celle-ci, contrairement à ce qui se
passe aujourd’hui, n’était pas dépolitisée. La réflexion féministe décoloniale remet en question
l’opposition espace public/espace privé qui repose sur un dualisme caractéristique de la pensée
moderne. Lorsque la sphère privée devient un lieu inaccessible, le contrôle de la communauté sur
les rapports et comportements familiaux n’est plus possible. Comme l’écrit Rita Segato, la
repolitisation de l’espace privé le rend vulnérable et fragile; les femmes sont celles qui paient le prix
de cettetransformation. L’expression patriarcat de « haute intensité », s’applique au monde
moderne/colonial actuel, marqué par la séparation espace public/ espace privé.
Quant à María Lugones, elle estime que l’emploi du terme « sphère domestique » pour parler de
l’espace où les femmes avaient un certain pouvoir est problématique car il renvoie à la division
espace privé/espace public. En fait, la réalité communautaire n’était pas organisée sur le modèle
de la séparation propre à la modernité occidentale, les espaces « privés » et « publics » y étaient
tous traversés par le politique. Le genre et la séparation des différents espaces de la vie en champs
relativement hermétiques sont des phénomènes liés à la perte de pouvoir politique des femmes après
la colonisation.
Aujourd’hui, beaucoup de féministes latino-américaines, en particulier au Mexique où le féminicide
atteint des proportions inégalées, construisent décolonialement une critique du patriarcat. Aura
Cumes, Maya cakchikel, ou Julieta Paredes, Aymara, parlent toutes les deux de la colonialité
comme de la rencontre entre patriarcat, capitalisme et colonialisme. Mais si Julieta Paredes pense
que la Conquête a produit la rencontre de deux patriarcats, Aura Cumes, elle, comme de
nombreuses féministes décoloniales, voit plus de la domination que du patriarcat dans les
mondes pré-colombiens.
Licence Creative Commons 4.0.
280
Pour moi, le patriarcat qui a germé dans les terres où nous vivons est un patriarcat colonial. D’abord, parce qu’il
s’agit d’un patriarcat formé dans l’anéantissement des femmes en tant que sujets politiques en Europe pendant
près de trois cents ans, l’expression la plus spectaculaire et la plus féroce de ce processus ayant été la chasse aux
sorcières. À cette époque, les femmes avaient plus de contrôle sur leur corps, sur la terre, et soumettre ces
femmes à l’autorité des hommes fut ce qui permettait de mieux contrôler la société. Cette même idée a été
reprise par le capitalisme, l’Inquisition, le protestantisme, lorsqu’il a été question de réduire et discipliner les
femmes – au prix d’une violence extrême – et de les parquer au sein du foyer. C’est un patriarcat génocidaire, un
féminicide, pour employer les termes à la mode. Et ces persécuteurs patriarcaux des femmes sont ceux qui sont
venus ici, en Amérique, sur nos terres. Eh bien, lorsque les féministes de la communauté disent qu’il y avait un
patriarcat ici qui était lié à celui-là, je ne suis pas tout à fait d’accord. (Cumes, 2017)
Julieta Paredes dans Hilando fino, écrivait pour sa part :
Nous devons reconnaître qu’il existait historiquement un lien patriarcal entre le patriarcat pré-colonial et le
patriarcat occidental. Pour comprendre ce lien historique entre intérêts patriarcaux, revenir sur la dénonciation du
genre pour le décoloniser peut être utile. (…) Des relations injustes entre les hommes et les femmes, ici, dans
notre pays, il y en eu aussi avant la colonie, le patriarcat n’est pas seulement un héritage colonial. Il y a aussi un
patriarcat et un machisme bolivien, autochtone et populaire. Décoloniser le genre, en ce sens, c’est retrouver la
mémoire des luttes de nos arrière-arrière- arrière-grands-mères contre un patriarcat qui s’est établi avant
l’invasion coloniale. Décoloniser le genre, c’est dire que l’oppression sexuelle n’est pas venue seulement des
colonisateurs espagnols, mais qu’il y avait aussi une version de l’oppression sexuelle dans les cultures et sociétés
précolombiennes. (Paredes, 2010)
Références
Cumes, Aura. 2017. « Tenemos que sacurdirnos las telarañas del pensamiento único que encubren el
despojo». Periodismo hasta mancharse.
https://latinta.com.ar/2017/04/aura-cumes-tenemos-que-sacudirnos-las-telaranas-del-pensamiento-
unico-que-encubren-el-despojo/
Cet article a été traduit et publié dans le numéro 75 de la Revue d’Études décoloniales.
Paredes, Julieta. 2010. Hilando fino desde el feminismo comunitario. La Paz : El Rebozo.
https://sjlatinoamerica.files.wordpress.com/2013/06/paredes-julieta-hilando-fino-desde-el-
feminismo-comunitario.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
281
Mies, Maria, Veronika, Bennholdt, Veronika, Von Wherlhof, Claudia. 1988. Women: The Last
Colony. Londres : Zed Books.
Licence Creative Commons 4.0.
282
|77. Philosophie de la libération
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La philosophie de la libération apparaît dans les années 1970. Pour Fatima Hurtado López (2013),
elle a eu deux foyers précurseurs : l’un au Mexique avec Leopoldo Zea, l’autre au Pérou, avec
Augusto Salazar Bondy. Ceci revient à la relier au débat relatif à l’existence d’une philosophie
latino- américaine dans les années soixante.
Existe-t-il une philosophie latino américaine?
La discussion qu’eurent à ce sujet le Péruvien Augusto Salazar Bondy et le Mexicain Leopoldo Zea
eut une portée cruciale. Le philosophe péruvien considérait qu’il n’y avait pas de philosophie latino-
américaine mais une simple réception et répétition des différentes vagues de pensée étrangère,
liées à une grande réceptivité à tout ce qui venait des grands centres de culture occidentaux et une
regrettable propension à l’imitation. Cette position provoqua la réaction de Zea, lequel, en 1969,
publia La philosophie américaine comme une philosophie tout court. Il y affirmait que l’adaptation
de la pensée européenne à la réalité latino-américaine crée finalement une pensée propre à ce sous-
continent.
Une autre influence notable est celle de la théologie de la libération. Si elle a beaucoup de points
communs avec la théologie de la libération, la philosophie éponyme ne met pas l’expérience du
Christ au centre de sa problématique. Comme le remarquait Enrique Dussel dans un entretien
avec Fatima Hurtado López, la philosophie est née dans un contexte particulier. Les massacres de
Tatelolco au Mexique en 1968 et le Cordobazo argentin sont des événements qui sensibilisèrent les
tenant-e-s du mouvement à la question de la victime. Pour Dussel, à ce moment-là se produisit une
politisation de l’ontologie qui marque la différence entre la philosophie latino-américaine et la
philosophie dite de la libération. À Salazar Bondy qui disait qu’il ne pouvait y avoir de philosophie
dans un monde colonial, Dussel répondait : « dans ce monde colonial, appréhender le fait de la
domination rend possible l’émergence d’une philosophie ». Cette philosophie met donc les dominé-
e-s, les pauvres et les victimes au centre de sa réflexion. En ce sens, une des caractéristiques
fondamentales de la philosophie de la libération est son « inculturation », c’est-à-dire le fait qu’elle
émerge directement de la réalité sociale, culturelle, historique et politique de ces pays. (Dussel,
2002)
Licence Creative Commons 4.0.
283
C’est par des rencontres d’un groupe d’intellectuel-le-s latino- américain-e-s, essentiellement
argentin-e-s, qu’est née cette philosophie entre 1970 et 1975, portée par des penseurs et penseuses
qui avaient vécu l’expérience du populisme péroniste. Hacia una filosofía de la liberación
latinoamericana, paru en 1973, avec la participation de Osvaldo Adelmo
Ardiles, Mario Casalla, Horace Cerruti Guldberg, Carlos Cullen, Enrique Dussel, Rodolfo Kusch,
Arturo Andrés Roig et Juan Carlos Scannone est un livre qui rend compte de la diversité du
mouvement. Le point commun entre ces penseurs est leur conviction que l’« Amérique latine » doit
passer par un double processus de libération, une rupture avec un double système de
dépendance de l’Occident.
L’approche de la philosophie de la libération serait donc difficilement compréhensible sans l’apport
de la théorie critique des années 1960, entre autres, la théorie dite de la dépendance, une approche
globale qui remet en question le dogme du développement. Cette dernière dénonce la « falacia del
desarrollismo », une tromperie qui consiste à faire croire que les économies latino-américaines
peuvent atteindre le niveau des européennes alors que le sous-développement est structurel,
nécessaire aux pays riches. Certains des théoricien-ne-s de la dépendance voyaient le « sous-
développement » comme la conséquence de processus historiques liés à la colonisation et à
l’impérialisme, et pour renverser la tendance, prenaient un parti ouvertement politique : il fallait
passer de la dépendance à la libération. Cette rupture constituait également une prise de distance
avec les systèmes de pensée occidentaux, distance déjà présente dans la recherche de la philosophie
latino-américaine évoquée plus haut. Il est d’ailleurs assez remarquable que pour Enrique Dussel,
contrairement à ce qu’on peut observer chez le philosophe Santiago Castro Gómez, la philosophie
latino- américaine est moins une impasse qu’un moment de ce détachement.
L’affirmation d’une philosophie propre n’était pas le signe d’un provincialisme, mais celui d’une
ouverture à autre chose qu’un universalisme trop abstrait. Enfin, autre apport essentiel pour la
constitution de la philosophie de la libération, la pédagogie des opprimé-e-s de Freire,
contemporaine de la théorie de la dépendance. Paolo Freire est un pédagogue qui inscrit la
mission de la pédagogie dans les luttes sociales. La pédagogie des opprimé- e-s est ainsi une
éducation où les opprimé-e-s s’éduquent eux-mêmes et elles-mêmes. Maître-sse et élève sont sur un
pied d’égalité dans une situation dialogique. Ainsi, pour Freire, l’alphabétisation fut un travail
d’éducation dialogique dans lequel l’alphabétisation s’identifiait au processus de conscientisation.
Pour lui, les intellectuel-le-s avaient un rôle important à jouer dans ce processus de conscientisation,
mais ils et elles ne devaient jamais oublier que leur rôle n’était pas de s’approprier un processus
Licence Creative Commons 4.0.
284
mais d’aider les opprimé-e-s à se libérer eux-mêmes et elles-mêmes. Freire opposait l’éducation «
bancaire », qui revient à transmettre passivement des connaissances, à l’éducation « libératrice » où
l’initiative émane du sujet concerné-e. Pour Enrique Dussel, Freire est l’anti-Rousseau. Bien des
critiques ont été faites à la philosophie de la libération depuis sa naissance. L’utilisation du concept
de peuple, par exemple, car le péronisme et les autres populismes ont manipulé ce concept que
reprendraient les philosophes de la libération. Dussel, par exemple, se défend d’avoir un usage
populiste de la notion.
Plus généralement, on reproche à la théorie une certaine obsolescence dans le contexte de la globalisation. Les
dualismes simplistes – centre/périphérie, développement/sous-développement, dépendance/libération,
exploiteur/exploité, tous les niveaux de genre, classe ou race qui fonctionnent dans la bipolarité
dominant/dominé, civilisation/barbarie, principes universels/incertitude, ainsi que totalité/extériorité – doivent
être surmontés (« overcome ») s’ils sont utilisés d’une manière superficielle ou réductrice. Mais surmonter («
overcome ») n’implique pas de « décréter » (« to decree ») son inexistence ou son inutilité (« uselessness »)
épistémique. Au contraire, (…) ces catégories binaires dialectiques doivent être replacées à des niveaux concrets
de plus grande complexité et être articulées à des catégories médiatrices au niveau micro. Néanmoins, supposer
qu’il n’y a ni dominants ni dominés, ni centre ni périphérie et ainsi de suite, c’est tomber dans une utopie
dangereuse ou une pensée réactionnaire. Il est temps, en Amérique latine, d’avancer vers des positions plus
nuancées, sans le fétichisme ou le terrorisme linguistique qui, sans preuve particulière, caractérise de « vieillottes
» (« antiquated ») ou d’« obsolètes » les positions qui sont exprimées dans un langage que le locuteur (« speaker
») n’apprécie pas. (Dussel, 2008)
Références
Dussel. Enrique 2002. Philosophie de la libération à l’heure de la mondialisation et de l’exclusion.
Paris : Editions Lharmattan.
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/50.L.etique_liberation.pdf
Dussel, Enrique. 2009. « De la philosophie de la libération ». Cahiers des Amériques latines. 62
http://journals.openedition.org/cal/1525
Dussel, Enrique. 2008. « Philosophy of Liberation, the Postmodern Debate, and Latin American
Studies ». Dans Coloniality at large. Latin America and the Postcolonial Debate, sous la dir. de
Mabel Moraña, Enrique Dussel et Carlos A. Jáuregui, Durham, p. 343. Duke University Press.
Licence Creative Commons 4.0.
285
Hurtado López, Fatima. 2009. « Pensée critique latino-américaine : de la philosophie de la
libération au tournant décolonial ». Cahiers des Amériques latines. 62
https://www.academia.edu/Documents/in/Filosof%C3%ADa_de_la_Liberaci%C3%B3
Hurtado López, Fatima. 2009. « De la philosophie de la libération. Entretien avec Enrique Dussel ».
Cahiers des Amériques latines.62
https://journals.openedition.org/cal/1525
Hurtado López, Fatima. 2013. Dialogues philosophiques Europe-Amérique latine : vers un
universalisme ouvert à la diversité. Enrique Dussel et l’éthique de la libération. Thèse de doctorat.
Chapitre 1.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00867569/document
Portail sur Academia edu
https://www.academia.edu/Documents/in/Filosof%C3%ADa_de_la_Liberaci%C3%B3
Licence Creative Commons 4.0.
286
|78. Plurivers
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Nous voulons un monde qui en contienne plusieurs.
Quatrième déclaration de la Forêt Lacandonne.
Le Plurivers est une remise en question de l’Univers, ce singulier plein de menaces. Il constitue la
critique radicale d’un des fondements de la pensée occidentale moderne, l’universalisme et d’une
réalité actuelle, la globalisation. Sa réalisation passe donc à la fois par la critique des cadres
de pensée de l’universalisme et par la création d’un projet alternatif à la globalisation néolibérale.
Si nous nous plaçons du point de vue de la critique des idées, le Plurivers ou la pluriversalité
problématisent l’ensemble des croyances à la base de notre monde. La vision hégémonique de ce
que l’on peut connaître présuppose une certaine conception de la vérité et de la connaissance.
L’approche pluriverselle, elle, interroge la validité universelle de certains énoncés sur le monde
physique et social, validité que garantirait le modèle scientifique qui les fonde. Cette certitude qui
ressemble à une foi poussa Wallerstein à écrire que la science est le seul véritable opium du monde
moderne.
Pour Ramón Grosfoguel, le Plurivers passe par la déconstruction de la tradition de pensée
universaliste fondée sur Descartes et sa conception de la connaissance comme un œil de Dieu
sécularisé. Toute la connaissance philosophique de Descartes à Marx, et jusqu’aux post-modernes,
est marquée par cet universalisme qu’il faut déconstruire. Au XX siècle, un-e des premier-e-s à
avoir élaboré cette critique fut Aimé Césaire, lorsqu’il pointa du doigt le gouffre séparant le projet
universaliste moderne de ses réalisations pratiques, la contradiction entre son projet d’émancipation,
de progrès et la réalité de l’exploitation, de la discrimination.
Le provincialisme? Pas du tout. Je ne m’enferme pas dans un particularisme étroit. Mais je ne veux pas non plus
me perdre dans un universalisme décharné. Il y a deux façons de se perdre : en
se murant dans le particulier ou en se dissolvant dans l’universel. Dans ma conception, l’universel est dépositaire
universel de tout le particulier, de tous les particuliers, il est approfondissement et
coexistence de tous les particuliers (Césaire, cité dans Grosfoguel, 2008)
Licence Creative Commons 4.0.
287
De nombreux intellectuels et nombreuses intellectuelles des pays anciennement colonisés, après
Césaire, ont continué l’analyse critique de l’universalisme et de ses fondement pour mieux imaginer
les fondements du Plurivers. Arturo Escobar a développé une vision du Plurivers intimement liée à
la lutte contre l’idéologie développementiste : il l‘envisage à partir du Nord et du Sud; en Amérique,
avec le Buen Vivir et les ontologies relationnelles qui fondent les cosmovisions traditionnelles; en
Occident, avec le design ontologique qui permettra de construire une monde concret différent.
Le Plurivers est une dénonciation de l’éthique de séparation et de la pensée unique. Le changement vers le
Plurivers, suppose entre autres l’adoption d’une autre conception de la nature, éloignée de l’anthropocentrisme et
du dualisme. Il passe aussi par l’adoption de nouveaux récits, qui incluent la
diversité, comme celle qui alimente les mythes indigènes américains. Il existe une convergence intéressante entre
certains récits philosophiques, biologiques et ceux des indigènes, leur commune
affirmation que la vie implique la création de la forme (différence, morphogenèse) à partir de la dynamique de la
matière et de l’énergie. Dans ces conceptions, le monde est pluriel, pris dans un mouvement incessant, un réseau
en constante évolution d’interrelations entre les êtres humains et non-humains. Il est important de noter,
cependant, que le Plurivers a une cohérence et se cristallise dans des pratiques et structures, par des processus
qui renvoient à la question du sens et au pouvoir. (Escobar, 2012)
Pour Arturo Escobar, il ne s’agit pas d’un folklore mais de la possibilité de maintenir un ordre social
différent de celui du capitalisme, car le Plurivers est cette opposition à la globalisation mentionnée
plus haut. Nous serions dans une phase où s’affrontent deux visions de la globalisation : modernité
universaliste versus Plurivers. Il est à construire, et ce n’est pas une utopie destinée à se réaliser
dans un futur improbable. Plutôt une perspective qui s’est affirmée comme opposition et alternative
au modèle civilisationnel promu par cette globalisation. Avec le Plurivers, ce n’est pas seulement
d’un changement de mode de production dont il est question ni de façon de penser, ou de vivre, ou
de consommer. La crise climatique, alimentaire, la violence intra ou inter-étatique renvoient à la
nécessité d’un changement de paradigme, à la transition à un nouveau modèle.
Ce qui ressort de cette interprétation est une question fondamentale, celle de « pouvoir stabiliser dans le temps
un mode de régulation en dehors, contre et au-delà de l’ordre social imposé par la production capitaliste et l’État
libéral » (Gutiérrez, 2008 : 46). Cette proposition implique trois points fondamentaux : prendre ses distances
avec l’économie capitaliste grâce à l’expansion conséquente de formes d’économie diversifiées, y compris des
formes communautaires et non capitalistes; faire de même avec la démocratie représentative au profit de
communautaire; formes et de établir démocratie des directe, mécanismes autonome de et pluralisme épistémique
et culturel (interculturalité), entre les différentes ontologies et mondes culturels. (Escobar, 2012)
Licence Creative Commons 4.0.
288
En Europe, cette idée de Plurivers est reprise par certain-e-s philosophes, mais sans qu’une
convergence avec les penseurs et penseuses latino-américain-e-s se dessine pour le moment.
Références
Eberhard, Christoph. 2008. « De l’univers au plurivers. Fatalité, utopie,alternative ? ». Dans
Mondialisation : utopie, fatalité, alternatives, sous la dir. de Anne-Marie Dillens. Bruxelles :
Presses de l’Université Saint-Louis.
<http://books.openedition.org/pusl/22948>
Escobar, Arturo. 2012. « Más allá del desarrollo. Postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso ».
Revista de Antropología Social : 47. 50
https://core.ac.uk/download/pdf/38821953.pdf
Barbara Glowczewski. 2018. « Le pluriversel à l’ombre de l’universel ». Terrestres. Revue des
livres, des idées et des écologies.
https://www.terrestres.org/2018/11/15/le-pluriversel-a-lombre-de-luniversel/
Grosfoguel, Ramón. 2010. « Vers une décolonisation des « universalismes » occidentaux : le «
pluri-versalisme décolonial », d’Aimé Césaire aux Zapatistes». Dans Ruptures postcoloniales. Les
nouveaux visages de la société française, sous la dir. d’Achille Mbembé : 10. Paris : La Découverte.
http://www.arquitecturadelastransferencias.net/images/p-grosfogel/Grosfoguel-Vers-un-
decolonisation.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
289
79. Politiques de disparition
JONNEFER BARBOSA
La définition bien connue de la souveraineté politique comme pouvoir de vie et de mort, pouvoir
d’instiller la mort, ne suffit pas si nous voulons caractériser un gouvernement néocolonial dont les
marquages ne concernent pas seulement les corps de ses sujets et dont les stratégies ne se limitent
plus au gouvernement des populations. Produire des disparitions, ce n’est pas seulement anéantir
des vies humaines, mais gérer l’effacement de leurs traces. Par « sociétés de la disparition », il faut
entendre aussi bien un réseau de multiples modalités de pouvoir que le diagramme très parlant d’un
nouveau modèle de gouvernement à l’époque du capitalisme cyberfinancier néocolonial.
La disparition en tant que technique gouvernementale met en évidence une déterritorialisation de la
gestion biopolitique des populations. Auparavant il s’agissait de régir l’impersonnalité de la vie
biologique en tant que multiplicité productive (fécondité, natalité, mortalité dans les registres
statistiques), assimilations ou déviations. La multiplicité des nouvelles modalités du pouvoir dans
les sociétés de disparition s’exprime à travers des dispositifs divers et singuliers, aux caractères et
aux intensités variables. Cela va de l’algorithme crypto-cybernétique à la normalisation de
l’anéantissement et des exécutions sommaires comme pratique gouvernementale, qu’elle soit
dirigée par la police ou par des appareils para-étatiques. Des formes de violence mises en place dans
des territoires comme l’« Amérique latine », et qui se généralisent aujourd’hui comme modèle
paradigmatique et explicatif de gouvernement mondial.
Tout comme les sociétés de souveraineté et disciplinaires, les sociétés de disparition ne surgissent
pas du néant, d’une façon a-historique. Il est clair que l’histoire de la politique moderne est
indissociable de la production de disparitions. Pas la vie nue dont nous parle Agamben, ni la
politisation de la vie biologique telle que l’énonce Foucault. Les techniques de disparition
produisent une « vie qui ne laisse aucune trace ». Produire la disparition d’une personne, une vie qui
ne laisse aucune trace, ne se réduit pas à l’acte du meurtre. La personne disparue n’est pas
seulement un corps soumis à la punition d’un-e souverain-e ou aux disciplines qui le dompteront.
Diachroniquement, la vie sans trace constitue une contre-histoire paradoxale de la politique en
Occident. On peut y inclure, avec l’histoire sans trace de ceux et celles qui sont mort-e-s dans les
navires négriers , le long génocide qui court du XV siècle jusqu’au XIX siècle, et même les disparu-
e-s politiques des dictatures latino-américaines des années 1960-1970, en passant par les victimes
Licence Creative Commons 4.0.
290
des narcotraficant-e-s ou des groupes d’extermination militaires et paramilitaires comme les
Escadrons de la mort. Le concept de disparition est un critère d’intelligibilité de la politique
gouvernementale latino-américaine. Même si on s’en tient au seul cas du Brésil, il est impossible
d’y établir une analyse un tant soit peu critique des questions de gouvernementalité sans prendre en
compte la réalité cachée mais constante, non seulement de processus d’extermination, mais aussi de
fosses communes comme zones de disparition des traces.
Les fosses communes au Brésil ont d’abord été un dispositif colonial, à l’époque de l’esclavage.
Lorsqu’une personne capturée et réduite en esclavage avait survécu à la traversée de l’océan sur les
navires12, mais était morte sur le sol brésilien, qu’elle meure d’épuisement, de maladie,
2ou suite à un châtiment (pendue, décapitée ou « cuite en vie13 »), son corps était enterré dans une
de ces fosses communes non identifiées, qu’on nommait alors les « cimetières d’esclaves ». Après
1888, année de la fin de l’esclavage au Brésil, les fosses communes persistèrent sous la forme des
cimetières dits des indigent-e-s, à la périphérie des grandes villes brésiliennes : par exemple, le
cimetière de São Luís, entre Capão Redondo et Jardim Ângela, dans la ville de São Paulo.
Appelé « cimetière des homicides », il a été inauguré en 1981 et s’étend sur 326 mille mètres carrés.
C’est le deuxième plus grand cimetière d’« Amérique 3latine »14. En 1996, l’ONU a classé la région
du Garden Angela comme la zone la plus violente du monde, devant Cali, qui à l’époque vivait un
pic de violences liées au trafic de drogue. Selon Letícia Mori (2011), « au début de la décennie, on
procédait à 800 ou 1000 enterrements par mois, 90% des défunt-e-s étant décédé-e-s de mort
violente. Il y avait tellement de personnes enterrées le même jour que les employé-e-s ne prenaient
même pas la peine de fermer les tombes, car elles devaient être rouvertes peu de temps après. Dans
les cimetières dits des indigent-e-s, comme celui de Saint Louis, en vertu d’une règle municipale,
les corps sont exhumés au bout de trois ans et envoyés dans des centaines d’ossuaires pour faire
place à de nouvelles sépultures, dans le cadre d’une politique de réutilisation des tombes (Russo,
2016).
En 1971, pendant la dictature militaire, un cimetière pour personnes indigentes nommé Don Bosco
fut construit dans le quartier de Perus. On commença à y entreposer les cadavres de personnes non
identifiées, des pauvres, mais aussi des victimes de la répression politique. Selon Edson Teles
12Ils étaient également nommés navires tombeaux à l'époque de l'Empire portugais.
13La cuisson en vie était cette forme cruelle de torture par immersion dans de l'eau bouillante, qu’on forçait d’autres
personnes réduites en esclavage à appliquer aux condamné-e-s. Moura, Clóvis. 2013. Cozinhar escravos. Dicionário da
escravidão negra no Brasil. São Paulo: Edusp. p. 118.
14 Le cimetière de Vila Formosa, dans une région pauvre et violente de São Paulo, est le plus grand d'« Amérique
latine », avec ses 763 mille mètres carrés.
Licence Creative Commons 4.0.
291
(s.d.) :
En 1990, le 4 septembre, la fosse Perus située dans le cimetière Don Bosco, à la périphérie de la ville de São
Paulo, fut ouverte. On y trouva 1 049 ossements d’indigents, de prisonniers politiques et de victimes des
Escadrons de la mort. Le projet initial était de mettre en place un crématorium, ce qui sembla étrange et fit naître
des soupçons y compris chez l’entrepreneur appelé à le construire. Ce projet de crémation des restes des
indigents, dont nous ne saurions rien sans la mémoire des employés du cimetierre, fut abandonné en 1976. Les
ossements exhumés en 1975 furent entassés dans la chambre funéraire du cimetière et, en 1976, enterrés dans
une fosse commune clandestine.
La question de la Fosse de Perus est restée sans réponse des institutions brésiliennes, car une loi
d’amnistie empêche désormais de juger les tortionnaires et les meurtriers; sans compter, en 2019, la
restructuration de la Commission spéciale sur les décès et disparitions politiques (CEMDP), le
gouvernement Bolsonaro ayant nommé des militaires à des postes-clé et des enquêtes médico-
légales ayant été closes.
Les milliers de fosses communes où gisent des personnes réduites en esclavage lors du génocide
africain sur le territoire brésilien, les fosses communes qui dissimulent les assassinats politiques et
les cimetières de pauvres comme celui de Jardim Ângela, sont le témoignage d’une lutte des
classes qui se déroule dans la sphère de l’effacement des traces, de la destruction massive des
mémoires.
Si le lieu emblématique de la gouvernementalité biopolitique était la métropole, c’est-à-dire
l’espace urbain apparu avec le passage du pouvoir territorial de l’ancienne souveraineté à la
gouvernementalité biopolitique, un gouvernement des humains et des choses qui avait pour
contrepoint les nécropoles, terme qui en grec désignait les cimetières (νεκρόπολις, littéralement «
ville des morts » ou les champs sacrés au Moyen Âge), aujourd’hui, les fosses communes
disséminées dans le monde entier sont l’expression visible et dérangeante d’une extermination qui
est la pratique habituelle des gouvernements et de politiques de disparition qui transforment les
anciens territoires de la ville et de la métropole en lieux de frai et de dissimulation des cadavres.
Traduit du portugais par Claude Bourguignon Rougier
Références
Barbosa, Jonnefer. 2016. « Sociedades de la desaparición ». Conférence le 28/09/16 sur le théme
Gouvernamentalité y Subjetivation, lors des II Journées Transdisciplinaires d’Études en
Gouvernamentalité à Santiago du Chili.
Licence Creative Commons 4.0.
292
https://www.academi.edu/28920376/Sociedades_de_la_desaparición
Mori, Letícia. 2011. « Vida e morte na periferia ». Revista Babel.
http://www.eca.usp.br/babel/antes/index3.php?tema=Espera&id=17
Moura, Clóvis. 2013. Dicionário da escravidão negra no Brasil. São Paulo:Edusp: 118.
Russo, Rodrigo. 2016. « Cemitério dos homicídios ». Jornal Folha de SP.
http://temas.folha.uol.com.br/cemiterio-dos-homicidios/introducao/cemiterio-na-zona-sul-de-sp-
tem-
Teles, Edson. Vala de Perus. Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF).
http://www.desaparecidospoliticos.org.br/pagina.php?id=39[
Licence Creative Commons 4.0.
293
80. Poma de Ayala (Guamán)
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Guamán Poma de Ayala était un Indigène quechua qui vécut au XVI siècle, dans le vice royaume du
Pérou. Cet homme avait deux cultures : celle, chrétienne, des Espagnol-e-s et la culture andine qui
s’était maintenue en dépit des violentes campagnes « d’extirpation » des idolâtries. Pauvre
mais de souche noble pré-incaïque, ce lettré, qui était un bon dessinateur, travailla comme scribe et
interprète pour les Espagnol-e-s, parcourant le vice royaume dans le cadre des Visites. Il écrivit une
Nueva corónica y buen Gobierno, laquelle, comme les chroniques de l’époque, s’inscrit dans le
schéma de l’histoire du Salut mais pose en même temps la question de l’indignité du gouvernement
espagnol en Amérique et de l’injustice subie par les « Indien-ne-s ». Détournant de façon
remarquable les principes des chroniques de la Conquête, à l’aide de textes comme de dessins
rendant compte de la situation des autochtones, ce livre, pour certain-e-s, constitue la première
remise en question systématique de la légitimité du pouvoir espagnol par un représentant des
vaincu-e-s. Cette longue lettre adressée au roi d’Espagne, comme le veut le genre, ne prétend pas
seulement informer le monarque sur un monde incasique où aurait existé déjà les fondements
d’une religion chrétienne. Il se propose également d’aider le roi à établir aux Indes un bon
gouvernement. Depuis la découverte de ce manuscrit au Danemark au début du XX siècle, les
interprétations divergent : certain-e-s y voient une véritable dénonciation de la Colonisation dans un
langage crypté (Rolena Adorno, Walter Mignolo); d’autres identifient plutôt une tentative de la
réformer; d’autres encore récusent ces oppositions, arguant du fait que la pensée andine, marquée
par une dualité qui n’est pas un dualisme, avait la capacité d’intégrer des cadres de pensée
différents.
Quoiqu’il en soit, sa façon de s’approprier la foi catholique et d’appliquer ses principes en retour
sur des Espagnol-e-s qui, contrairement aux autochtones, ne savaient pas les respecter, s’inscrit à
l’intérieur d’une tradition qui est celle de la résistance, des révoltes et des soulèvements. En
effet, pendant toute la colonisation, des « Indien-ne-s » se sont emparé- e-s de symboles catholiques
lorsqu’ils et elles ont résisté aux pressions de l’État ou des colon-e-s. Dans le cadre de l’Équateur
actuel, la grande révolte de Ríobamba opposa, en 1764, Indien-ne-s et Espagnol-e-s. Les
autochtones s’enfermèrent dans l’Église, se regroupant autour de la statue de la Vierge pour lui
demander sa protection contre les Espagnol-e-s, puis sortirent se battre, se croyant protégé-e-s par
Licence Creative Commons 4.0.
294
cette dernière. Ce phénomène, assez classique lors des révoltes, est à rapprocher des propos tenus
par certain-e-s Indien-ne- s qui avaient participé au soulèvement : « Somos más cristianos (que los
Españoles) y hubo castigo de Dios contra los señores de Ríobamba » (nous sommes plus chrétiens
que les Espagnols, et Dieu a châtié les seigneurs de Riobamba). Nous retrouvons ici
l’argumentation d’Ayala au sujet des Indien- ne-s, qui se comportent en bon-ne-s chrétien-ne-s
contrairement aux Espagnol-e-s qui les dirigent. Il y a des continuités entre ces pratiques et
l’existence en « Amérique latine » d’un christianisme d’un autre type, religion du peuple et des
opprimé-e-s dont la théologie de la libération constitue une branche. Guamán Poma de Ayala est
une des racines de cet arbre si tant est qu’il y ait à chercher une origine. Si, comme le dit Foucault
(Hulak, 2017), l’idée de l’origine en histoire nous immobilise dans la pensée de l’évolution, la
logique de la mémoire, différente, suppose des héros et des héroïnes, ou des moments qui brillent
dans l’histoire, d’un éclat fugace mais suffisant, lors des insurrections.
Références
Adorno, Rolena. 1978. « Felipe Guaman Poma de Ayala : an andean view of the Peruvian
Viceroyalty, 1565-1615 ». Journal de la Société des Américanistes. Tome 65, 1978 : 121-143.
https://doi.org/10.3406/jsa.1978.2159
Graulich, Michel, Núñez Tolin Serge. 2000. « Les contenus subliminaux de l’image chez Felipe
Guamán Poma de Ayala ». Journal de la Société des Américanistes. Tome 86 : 67-112.
https://doi.org/10.3406/jsa.2000.1808
Hulak, Florence. 2017. « Michel Foucault, la philosophie et les sciences humaines : jusqu’où
l’histoire peut-elle être foucaldienne ? ». Tracés. Revue de Sciences humaines.
http://journals.openedition.org/traces/5718
Le lecteur pourra consulter, même s’il ne parle pas espagnol, le très beau site danois, qui reproduit
intégralement La Nueva corónica y Buen gobierno.
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/frontpage.htm
Licence Creative Commons 4.0.
295
Thomas, Jérôme. 2016. « Un pont entre deux cultures. El primer nueva corónica y buen gobierno de
Felipe Guamán Poma de Ayala (1615) ». Dans Exils, migrations et identité dans l’imaginaire ibéro-
américain, sous la dir. de Michel Bœglin, Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-
américaines–CECIL, n°2.
http://cecil-univ.eu/c2_1/
Licence Creative Commons 4.0.
296
|81. Post-occidentalisme
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Comme l’orientalisme, l’occidentalisme est un imaginaire qui n’existe pas seulement à travers des
subjectivités mais aussi des modes de vie, des habitus, des institutions. Dans son livre séminal,
Edward Saïd avait montré que l’Orient est une construction coloniale, le grand discours que
l’Europe construit sur l’Orient dans le cadre du deuxième colonialisme. Mais avant l’orientalisme,
remarque Walter Mignolo (2002), il y a eu l’occidentalisme. L’Amérique est l’extrême Occident,
l’Occident plus la différence coloniale. L’occidentalisme, c’est l’élaboration de ce discours qui
sculpte l’image d’une Amérique n’existant que dans les représentions européennes, un ensemble
de pratiques et de représentations caractérisées par la déconnexion et le dualisme (barbare/civilisé,
femme/homme, progrès/archaïsme, etc.) qui occultent la violence du colonialisme en mettant en
avant la « mission civilisatrice » et les plans de modernisation ou de développement. C’est là la
première phase de l’occidentalisme, comme le remarque Fernando Coronil (2000) :
J’ai parlé de l’occidentalisme comme d’un « ensemble de pratiques et de représentations qui participent à la
production de visions du monde » qui 1) divisent les composantes du monde en unités isolées; 2) désagrègent
l’histoire de leurs relations; 3) transforment la différence en hiérarchie; 4) naturalisent ces écrits de plus en plus
nombreux sur la mondialisation (…). Ces modalités de représentation, structurées en termes d’oppositions
binaires, obscurcissent la
constitution mutuelle de l’Europe et de ses colonies, et de l’Occident et de ses post-colonies. Elles dissimulent la
violence du colonialisme et de l’impérialisme derrière le manteau flatteur des missions civilisatrices et des plans
de développement.
La seconde, nous pouvons l’observer de nos jours. Elle prend les atours des discours néolibéraux,
du globocentrisme analysé par Fernando Coronil, un mode pervers de représentation dans lequel
l’Occident dissimule sa présence et brouille les frontières qui le séparent des Autres; l’altérité d’hier
est remplacée par la subalternité d’aujourd’hui.
Contre l’occidentalisme, la réponse est le post-occidentalisme. Le premier à employer le terme fut
le poète et essayiste cubain Roberto Fernández Retamar dans son classique Nuestra América y
Occidente (1976). Il avait eu recours à ce néologisme dans le cadre de sa réflexion sur les
Licence Creative Commons 4.0.
297
relations entre l’« Amérique latine » et l’Europe, puis entre l’« Amérique latine » et l’Amérique
anglo-saxonne après 1898. Ce moment correspond à la perte des dernières colonies espagnoles,
Cuba et Porto Rico, et à l’émergence de ce qui sera le grand empire du XX siècle, les États-Unis. Il
s’agit donc d’une analyse qui met en perspective deux formes de domination ou de colonisation et
le transfert de l’une à l’autre, ce qui amène Mignolo (2002) à écrire :
Pour les penseurs d’Amérique latine, le croisement et le chevauchement des puissances impériales ont moins été
conçus en termes de colonisation que d’occidentalisation. C’est pour cette raison que « post-occidentalisme » (au
lieu de « post-modernisme » et « post-colonialisme ») est un mot qui trouve sa place « naturelle » dans la
trajectoire de la pensée en Amérique latine, tout comme « post-modernisme » et « post-colonialisme » trouvent
leur place en Europe, aux États-Unis et dans les anciennes colonies britanniques, respectivement.
Walter Mignolo remarque que chez Fernández Retamar, le terme surgit dans un texte où émerge
également la question de la race. Après avoir noté que l’occidentalisation n’a pas marché, parce que
certaines communautés sont là comme signe de la résistance à l’irruption violente sur leurs terres, le
poète cubain Fernandéz Retamar écrit :
Les Indiens et les Noirs, donc, loin d’être des corps étrangers à notre Amérique parce qu’ils ne sont pas des «
Occidentaux », lui appartiennent de plein droit : plus que les étrangers « civilisateurs
». Et il était naturel que cela soit pleinement révélé ou souligné par les penseurs marxistes, car avec l’émergence
du marxisme en Europe occidentale dans la seconde moitié du XIX siècle, et son
enrichissement ultérieur par le léninisme, est apparue une pensée qui met le capitalisme, c’est-à-dire le monde
occidental, au banc des accusés. Mais il ne s’agit plus d’une idéologie occidentale, plutôt d’une idéologie post-
occidentale, qui permet de comprendre pleinement l’Occident, de le surmonter pleinement, et donne donc au
monde non occidental les moyens de comprendre pleinement sa réalité dramatique et de la dépasser. (Mignolo,
2002 / Fernández Retamar 1976,)
Pour Walter Mignolo, qui par la suite, réinvestirait le terme, ainsi que pour Fernando Coronil,
l’approche est encore marquée par une perspective marxiste qui ne peut rendre compte de la réalité
latino-américaine mais, déjà, opére une inversion des mécanismes de colonisation intellectuelle de
l’« Amérique latine » et de la vieille antinomie fondatrice civilisation/barbarie. À la même époque,
sur le continent, le concept de colonialisme interne de González Casanova, la démarche des
théoricien-ne-s de la dépendance ou encore celle des philosophes de la libération peuvent être
qualifiées d’approches post-occidentales. Car le post-occidentalisme est bien ce projet critique qui
vise à dépasser l’occidentalisme. L’appellation post-occidentalisme désigne mieux le discours de
décolonisation intellectuelle en « Amérique latine » que celle d’études post-coloniales. En effet, le
Licence Creative Commons 4.0.
298
terme qui fut utilisé pour nommer le continent après la Conquête, les Indes Occidentales, ou, plus
tard, celui d’« Amérique latine », montre bien que dès les débuts, l’occidentalisation et
l’occidentalisme ont été à l’œuvre. La notion de post-occidentalisme a donc l’avantage de renvoyer
à une histoire propre, celle de la pensée critique latino-américaine.
Références
Coronil, Fernando. 2000. «Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo.
Incolonialidad del saber ». Dans Eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas,
sous la dir. de Edgardo Lander : 89. Buenos Aires
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708044815/6_coronil.pdf
Mignolo, Walter. « On orientalism and occidentalism ». Vidéo.
https://www.opendemocracy.net/en/walter-mignolo-on-orientalism-and-occidentalism/
Mignolo, Walter. 2002. « Posoccidentalismo : les epistemologías fronterizas y el dilema de los
estudios latinoamericanas de area ». Revista Iberoamericana, vol. LXVIII, n°. 200 : 848, 849.
http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5978/6119
Fernández Retamar, Roberto. 1976. « Nuestra américa y el occidente ». Cuadernos de cultura
latinoamericana » : 51.
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/2954/10_CCLat_1978_Fernandez_Retamar.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Licence Creative Commons 4.0.
299
82. Pureté de sang
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La limpieza de sangre peut être comprise comme une catégorie normative puisqu’elle a été créée en tant que Sentence
Statut par la mairie de Tolède en 1449. (Herring Torres, 2003)
Selon Mignolo, ce discours a opéré comme le premier schéma de classification de la population
mondiale. Le sémioticien argentin, n’est pas le premier à avoir perçu l’importance capitale de la
limpieza de sangre dans le processus émergence de politiques racistes. En 1933 déjà, le juristeEric
Voegelin avait ébauché une image du racisme comme circulation d’une impulsion partant d’Europe
(de la péninsule iberique), se réalisant en Amérique et revenant en Europe sous la forme de l’état
racial nazi du premier XX siècle. Le spécialiste de l’Inquisition espagnole Henri Méchoulan, en
1979, avait analysé ensemble les discriminations visant les Amérindiens, les Juifs et les Morisques
(musulmans convertis au catholicisme) des terres ibériques ». Comme le remarque Jean-Fréderic
Schaub (2015), le discours de la pureté de sang n’est pas apparu lors de la Conquête de l‘Amérique
» mais avec la « Reconquête » de la péninsule Ibérique. Pendant des siècles, des petits royaumes
asturiens, léonais, castillans et aragonais affrontèrent les diverses entités politiques qui composèrent
Al Andalus. Au fur et à mesure que les Chrétiens gagnaient des terres sur les Musulmans, et que les
royaumes se fortifiaient, le processus de concentration du pouvoir s’affirmant au profit de la
Castille et l’Aragon, la société chrétienne commença à distinguer Vieux et Chrétiens et Nouveaux
Chrétiens (les Juifs et Maures assimilés). Il est remarquable que la nécessité ait été autant de se
distinguer des Musulman-ne-s que des Juifs et Juives qui étaient intégré-e-s aux États catholiques15.
Il fallut démontrer qu’on n’avait pas d’ancêtre juif ou musulman car cette faute, cette erreur dans
laquelle se trouvaient les infidèles, s’héritait par le sang. L’Église participa à la diffusion de cette
croyance, qui infériorisait un groupe sur une base religieuse : la faute des Juifs et des Juives qui
avaient crucifié le Christ se transmettait comme un héritage maudit. Cette idéologie était en fait en
contradiction totale avec le message fondamental des Écritures et la possibilité de la rédemption. Il
faut la voir dans son lien avec deux phénomènes : le premier est lié à la suspicion à l’égard des Juifs
et Juives converti-e-s, les conversos et conversas. Les grands pogroms du XIV siècle, en particulier
celui de Seville en 1391 avaient en effet poussé beaucoup de Juifs et de Juives à embrasser la
15 Sur l'identité chrétienne, la coexistence et la conversion dans l’Espagne du XV siècle, voir notamment : Nirenberg,
David. 2016. Neighboring Faiths: Christianity, Islam, and Judaism in the Middle Ages and Today. University of
Chicago : Chicago.
Licence Creative Commons 4.0.
300
religion chrétienne. Le deuxième nous renvoie à l’idéologie de la lignée qui avait été celle des
hidalgos castillans dès le XIII siècle. Elle reposait, entre autres, sur l’idée de la qualité particulière
de leur sang. Cette importance du lignage à l’époque est visible dans l’expression « noblesse de
sang » qui n’est pas valable pour les seuls royaumes de la péninsule ibérique mais pour la noblesse
de la chrétienté en général. L’emprise des idéaux nobiliaires de la noblesse espagnole expliquerait
que toute la société ait été gagnée à leur modèle. À un moment donné, il devint nécessaire pour
intégrer certaines universités ou avoir accès aux certaines charges ou métiers de présenter un
certificat de pureté de sang attestant qu’aucun-e Juif ou Juive ou Maure
n’avait souillé la lignée. Le processus « administratif » commence au XV siècle et prend une
ampleur considérable au XVI siècle. D’après certain-e-s auteurs et autrices, l’inclusion de la
catégorie de villano (vilain) dans les statuts montre bien qu’ils sont le pendant de l’idéologie de la
noblesse de sang (Zuñliga, 1999). De fait, les statuts de pureté de sang permirent de freiner
l’ascension de certains groupes sociaux, pas seulement ceux dont les membres avaient des ancêtres
juifs et juives, mais aussi ceux qui n’arrivaient pas à prouver le contraire.
En Amérique, où il fallait pour émigrer obtenir un certificat, le système se transforma, ne
s’appliquant plus aux Juifs et Juives ou aux Maures, mais aux autochtones et aux Noir-e-s. Cette
tache, mácula, à l’origine de nature religieuse, deviendrait une tache liée à l’appartenance à un
groupe de vaincu-e-s ou d’esclavagisé-e-s; mácula de la tierra pour les Noir-e-s. Il est assez
difficile encore de préciser à quel moment cette idéologie du sang se combina aux nouvelles
configurations des notions de race et de couleur pour donner naissance à une des premières formes
de d’idéologie raciste de la modernité.
Aujourd’hui, de nombreux historiens européens, états-uniens ou latino-américains, rejoignent la
perspective de Walter Mignolo, et d’Aníbal Quijano pour ce qui est de l’importance de la pureté de
sang dans l’émergence de la race. L’historien Francisco Bethencourt « propose de situer la
formation des catégories raciales dans l’Occident chrétien à une certaine époque, entre fin
du Moyen Âge et Renaissance et dans des territoires identifiés, la péninsule ibérique » (Schaub :
2015). Le spécialiste de l’Inquisition romaine Adriano Prosperi, pour sa part, considère que le XV
siècle ibérique constitue une date fondamentale en Occident, l’expulsion des juifs en 1492
représentant pour lui le moment où la haine religieuse devient haine raciale. Ce en quoi le travail de
ces historiens vient étayer la démarche du projet Modernité/Colonialité et la nuancer.
Références
Licence Creative Commons 4.0.
301
Bethencourt, Francisco. 2013. Racism, from the Cruzades to the twentieth Century. Princeton :
Princeton University : 60-61.
Castro-Gómez, Santiago. 2005. La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva
Granada (1750-1816). Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana
http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/157.pdf
Herring Torres, Max. 2003. « Limpieza de sangre : Racismos en la Edad Moderna? ». Tiempos
Modernos : 9.
http://www.tiemposmodernos.org/viewarticle.php?id=34
Mechoulan, Henri. 1979. Le sang de l’autre ou l’honneur de Dieu. Indiens, juifs et morisques au
siècle d’or. Paris : Fayard.
Prosperi, Adriano. 2011. Il seme dell’intoleranza. Ebrei, eritici, selvaggi : Granada 1492. Rome-
Bari : Laterza.
Schaub, Jean-Fréderic. 2015. Pour une histoire politique de la race.Paris : Le Seuil : 79-87.
Voegelin, Eric. 2007 [1933]. Race et état. Paris: Vrin.
Zagefk, Polymnia. 2006. « Indios, Ibériques, Mestizos, Mulatos en Amérique espagnole : un point
historique sur la construction sociale des catégories ethniques ». Archives Ouvertes.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00110011/document
Zuñiga Jean-Paul. 1999. « La voix du sang. Du métis à l’idée de métissage en Amérique espagnole
». Annales. Histoire, Sciences Sociales. n° 2 : 425-452.
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1999_num_54_2_279755
Licence Creative Commons 4.0.
302
83. Projet Modernité/Colonialité. Brève généalogie
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Je me contenterai ici de donner quelques repères en me basant essentiellement sur les élaborations
ultérieures des acteurs et actrices. Le Projet Modernité/Colonialité a pris forme grâce à la rencontre
d’intellectuel- le-s latino-américain-e-s venant d’horizons différents. La globalisation
néolibérale était déjà en place depuis plusieurs années, la crise de la pensée critique et l’échec de
projets d’émancipation avaient été actés. Mais en «Amérique latine », la fin de la dernière décennie
du XX siècle avait été porteuse de grands changements qui pouvaient, à l’encontre de ce qui se
passait en Europe, inspirer de grands espoirs. Dans le domaine des idées, l’anniversaire du
cinquième centenaire de la Conquête avait ouvert un débat de fond. Au niveau social et politique,
des mouvements d’un type inédit étaient apparus : en Équateur, le soulèvement de l’Inti Raymi et au
Mexique, l’insurrection zapatiste.
Ces intellectuel-le-s voulaient penser la réalité latino-américaine en construisant leurs propres
outils. Ils et elles remettaient en question l’eurocentrisme et interrogeaient la soi-disant fin de
l’histoire ainsi que la naturalisation du capitalisme dans sa version néo-libérale. Peu à peu, le
concept de colonialité du pouvoir s’imposa comme dénominateur commun. Se retrouvèrent dans
cette démarche les sociologues Aníbal Quijano, Edgardo Lander et Ramón Grosfoguel, les
sémiólogues Walter Mignolo, Zulma Palermo et Freya Schewy, la pédagogue Catherine Walsh, les
anthropologues Arturo Escobar et Fernando Coronil, le critique littéraire Javier Sanjinés et les
philosophes Enrique Dussel, Santiago Castro-Gómez, María Lugones et Nelson Maldonado-Torres,
pour ne citer que les plus connu-e-s. Ces chercheurs et chercheuses issu-e-s de pays divers, dont
plusieurs vivaient aux États-Unis, avaient des profils disciplinaires variés mais remettaient tou.te.s
en question l’approche disciplinaire à l’Université. Comme le disait Arturo Escobar (2003), il
s’agissait d’« une communauté d’argumentation qui travaille sur des concepts et des stratégies »,
des universitaires qu’unissait l’adoption d’un nouveau paradigme et d’une démarche frontalière, en
marge des systèmes de pensée occidentaux hégémoniques.
Une contextualisation et une généalogie appropriées du programme de recherche sur la
modernité/colonialité restent à faire. Pour l’instant, contentons-nous de dire qu’un nombre
conséquent de repères peuvent aider à tracer la généalogie de la démarche propre à ce qui n’est pas
un groupe, notamment : la théologie de la libération depuis les années 1960 et 1970; en philosophie
et dans les sciences sociales latino- américaines, les débats relatifs à la philosophie de la libération
Licence Creative Commons 4.0.
303
et à l’autonomie des sciences sociales (par exemple, le questionnement du concept de « sciences
sociales »); le fait que les « sciences sociales» ne fassent pas partie de la culture latino-américaine
(Enrique Dussel, Rodolfo Kusch, Orlando Fals Borda, Pablo Gonzáles Casanova
et Darcy Ribeiro); la théorie de la dépendance; les débats en Amérique latine sur la modernité et la
postmodernité dans les années 1980, suivis par les discussions sur l’hybridité en anthropologie,
communication et études culturelles dans les années 1990; et, aux États-Unis, le groupe latino-
américain d’études subalternes. (Escobar, 2003)
Tout en insistant sur le caractère cosmopolite des sources d’inspiration, Arturo Escobar soulignait
l’importance du caractère situé d »une réflexion produite à partir de la réalité de l’« Amérique
latine » :
Le groupe modernité/colonialité a trouvé son inspiration dans un large éventail de sources, des théories critiques
de la modernité européennes et nord-américaines au groupe d’études subalternes
d’Asie du Sud, en passant par la théorie féministe chicano, la théorie postcoloniale et la philosophie africaine
(…). Toutefois, sa principale force directrice est une réflexion permanente sur la réalité culturelle et politique de
l’Amérique latine, y compris la connaissance subalterne des groupes exploités et opprimés. (Escobar, 2003)
Quant à Walter Mignolo, dans une interview accordée à Otros Logos, il remarquait que, dès les
débuts, l’idée d’une approche pluriverselle avait été déterminante et s’était traduite par une grande
liberté.
Ce qui est merveilleux avec le collectif, c’est qu’il fonctionne de manière décoloniale. Personne ne représente
personne, nous n’avons ni président ni directeur. Nous partageons cependant deux concepts centraux : la «
colonialité du pouvoir » (Aníbal Quijano) et la « transmodernité » (Enrique Dussel). À partir de ces concepts,
chacun de nous suit son propre chemin, toujours lié à des élaborations communes qui, depuis plus d’une
décennie maintenant, nous interpellent de temps en temps et nous maintiennent dans une relation de convivialité
grâce à la tâche épistémique-politique que nous partageons. Nous ne recherchons pas une « plate-forme unique,
commune et universelle ». Dans le collectif, la pluriversité est ce qui distingue nos actions, la pensée. (Carballo,
2012)
La première rencontre date de 1998. Elle fut organisée par Edgardo Lander, avec l’appui de la
CLACSO, à Caracas, où furent invités Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Arturo
Escobar et Fernando Coronil. La même année, le colloque organisé par Ramon Grósfoguel et
Agustin Lao Montes à Binghamton, intitulé Transmodernité, capitalisme historique et
colonialité.Un dialogue transdisicpilinaire, réunissait Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter
Mignolo et Immanuel Wallerstein. Autre date, le symposium du sociologue vénézuélien Edgardo
Licence Creative Commons 4.0.
304
Lander intitulé Alternatives to Eurocentrism and Colonialism in Contemporary Latin American
Social Thought, organisé lors du congrès mondial de sociologie qui se tint à Montréal en 1998, et
auquel participèrent également l’anthropologue colombien Arturo Escobar et l’anthropologue
vénézuélien Fernando Coronil. Par la suite, Lander publia La colonialidad del saber: eurocentrismo
y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (2000). La parution du livre marque un tournant.
Dans l’introduction, Edgardo Lander écrivait :
L’objectif de ce symposium est de rassembler, avec une perspective historique, les débats actuels en Amérique
latine sur ces questions. Dans un monde où semblent s’imposer la pensée unique néolibérale, la décentralisation
et le scepticisme de la postmodernité, quelles sont les potentialités du continent en matière de connaissances, de
politique et de culture? En quoi peuvent-elles aider à relancer autrement le débat? Quel est le rapport entre ces
perspectives théoriques et la résurgence des luttes de peuples historiquement exclus comme les populations
noires et indigènes d’Amérique latine? Comment toutes ces interrogations amènent-elles à reposer les vieilles
questions sur l’identité et l’hybridation, la transculturation et la spécificité de l’expérience historico-culturelle du
continent? Dans quelle mesure est-il possible, réalisable, aujourd’hui, de lancer le débat à partir des régions que
les savoirs eurocentrés et coloniaux ont exclues ou subalternisées (Asie, Afrique, Amérique latine)? (Lander,
2000)
C’est une introduction qui pose déjà certaines des bases de l’approche décoloniale jusqu’à nos jours
: critique de l’eurocentrisme; questionnement du rôle du continent dans l’élaboration de nouvelles
approches théoriques; réflexion sur le lien entre l’émergence des luttes de racisé-e-s et les
changements théoriques; approfondissement des questions liées à l’identité. Le livre propose
un article où Dussel expose sa conception de l’eurocentrisme et de l’invention de l’Europe, un autre
où Mignolo expose sa vision de l’Occident ainsi que son idée de la double conscience créole, un
texte essentiel de Fernando Coronil sur le globocentrisme, un autre où Arturo Escobar aborde la
question du post-développement ou encore un texte dans lequel Santiago Castro Gómez met à
l’épreuve les notions de biopouvoir et gouvernementalité pour analyser la constitution de la
colonialité en « Amérique latine ». Enfin, l’anthologie se clôt sur le texte de base de Quijano qu’est
Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.
À Bogotá, en 1999, Santiago Castro Gómez et d’autres enseignant-e- s colombien-ne-s de l’Institut
Pensar organisèrent un Symposium International. Bogotá, et plus particulièrement l’Institut Pensar,
fut en « Amérique latine », le premier lieu où la perspective du collectif eut une audience. Lors de
ce colloque, il fut question entre autres de l’incidence de l’eurocentrisme et du capitalisme sur la
construction des modèles analytiques des sciences sociales. Il donna lieu à une publication, La
Licence Creative Commons 4.0.
305
restructuration des sciences sociales dans les pays andins, où figurent des articles de Walter
Mignolo, Edgardo Lander et Zulma Palermo, une sémioticienne argentine qui rejoignit à partir de ce
moment-là le collectif. D’après Eduardo Restrepo, c’est à ce moment-là que Walter Mignolo
commença à employer un vocabulaire et des catégories propres à « l’inflexion décoloniale » et à
interpeller Aníbal Quijano et Enrique Dussel sur la base de présupposés communs.
En 1999, l’Institut Pensar de l’Université Javeriana publia Pensar (en) los intersticios. Teo-ría y
práctica de la crítica poscolonial, qui comprenait des textes de Fredric Jameson, Aijaz Ahmad,
Walter Mignolo, Enrique Dussel, Immanuel Wallerstein, Madan Sarup, Aníbal Quijano et Edgardo
Lander, sur la question postcoloniale.
En novembre 2000, un atelier de la Duke University organisé par Mignolo et Freya Schwy, «
Knowledge and the Known: Capitalism and the Geopolitics of Knowledge », réunit Aníbal Quijano,
Edgardo Lander, Arturo Escobar, Fernando Coronil, Santiago Castro-Gómez Javier Sanjinés et
Catherine Walsh qui, à partir de cette date, collaborera avec le collectif.
En 2000, une rencontre à Quito fut organisée par Catherine Walsh : « Primer encuentro
internacional sobre estudios culturales latinoamericanos: retos desde y sobre la región andina ».
En 2002, lors d’un congrès de latino-américanistes à Amsterdam, Arturo Escobar présenta le
collectif comme un réseau transdisciplinaire de chercheurs et chercheuses latino-américain-e-s qui
réfléchissaient au rapport entre modernité et colonialité, avec une perspective nouvelle sur la
globalisation.Le projet Modernité/Colonialité a donné lieu à plusieurs rencontres pendant une
dizaine d’années et à de nombreux ouvrages collectifs.
Aujourd’hui, les auteurs et autrices continuent de développer leur approche en reconnaissant ce
qu’ils et elles doivent à la perspective mais aussi, dans certains cas, en prenant leurs distances. Il y a
toujours des rencontres entre certain-e-s d’entre eux et elles, toujours des présupposés communs,
mais des dissensions importantes sont apparues, en particulier en ce qui concerne l’appréhension
des changements politiques en « Amérique latine ».
Références
Carballo, Francisco. 2012. « Hacia la cartografía de un nuevo mundo: pensamiento descolonial y
desoccidentalización. Un diálogo con Walter Mignolo ». Otros Logos. Revista de estudios críticos.
http://www.ceapedi.com.ar/otroslogos/Revistas/0003/13.%20Carballo.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
306
Escobar, Arturo. 2003. « Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de
modernidad/colonialidad latinoamericano ». Tábula Rasa : 53.
https://www.redalyc.org/pdf/396/39600104.pdf
Lander, Edgardo. 2000. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas. Buenos Aires : CLACSO : 3.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
307
84. Quijano, Aníbal
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Aníbal Quijano Obregón, qu’on peut légitimement présenter comme le père fondateur de la théorie
de la colonialité du pouvoir, fut sociologue, militant et théoricien politique. Il a contribué, dans les
années 1960, à la fondation d’une sociologie latino-américaine critique avant d‘élaborer, à la fin de
sa vie, le concept de colonialité. Il le développerait ensuite en collaboration avec divers penseurs et
penseuses latino-américain-e-s. C’est dans son œuvre, avec la notion de matrice coloniale du
pouvoir, qu’apparaît pour la première fois une analyse globale qui met la race et l’eurocentrisme au
cœur de la Modernité. Son rôle a été crucial dans le projet Modernité/Colonialité, d’autant plus que
sa carrière et ses divers exils l’ont amené à voyager en « Amérique latine » et ailleurs dans le monde
et à exposer devant des scientifiques de diverses branches une conception qui contribuerait à
remettre en question le partage disciplinaire caractéristique de la colonialité du savoir. Ce Péruvien,
qui a connu les bouleversements politiques du « court XX siècle », a enseigné dans de nombreuses
universités, au Chili, un des pôles de la recherche en sciences sociales des années 1970, au Mexique
et aux États-Unis. Son séjour à Bighnamton, dans l’État de New York, l’amena à travailler avec
Immanuel Wallerstein et à élaborer une reconstruction de sa théorie du système monde. À Lima, il a
fondé la chaire Amérique latine et la colonialité du pouvoir. Aníbal Quijano est un intellectuel
latino-américain typique du XX siècle dans la mesure où il a été à la fois un militant très engagé
politiquement, un des spécialistes les plus éminents de sa discipline, la sociologie, mais aussi un
homme extrêmement polyvalent et érudit, qui ancrait son analyse dans le droit autant que dans
l’histoire ou la sociologie et qui avait sur les rapports entre esthétique et utopie une réflexion
originale. Mais il fut aussi un homme du XXI siècle puisqu’à la charnière des XX et XXI siècles, au
lieu d’écouter, comme bien des intellectuel-le-s, les sirènes du néolibéralisme, il mit au point une
théorie qui décentrait l’analyse du système monde et remettait en question de façon radicale
l’eurocentrisme des sciences sociales et la généalogie consensuelle de la modernité.
Les cinquante dernières années de l’histoire de la pensée critique latino-américaine
se confondent avec les biographies des intellectuel-le-s d’une génération de sociologues engagé-e-s
qui ont traversé une période de transition historique et de défaites politiques face aux vicissitudes du
capitalisme périphérique dans la région. La trajectoire d’Aníbal Quijano (1930-2018) est un
exemple incontournable qui se fond dans l’histoire des sciences sociales en
Licence Creative Commons 4.0.
308
Amérique latine. (Rubbo, 2019)
Indigénisme péruvien, luttes agraires et mouvements sociaux
Dans le parcours riche et complexe qui est le sien, il me semble nécessaire de faire apparaître une
continuité : Quijano a toujours pensé à partir d’une situation donnée, celle de son pays et du
continent américain. Sa vie fut celle d’un latino-américain andin, qui voulut comprendre les
changements au Pérou et sur le continent à partir d’un usage critique d’outils de pensée eurocentrés.
L’approche qui serait la sienne dans les années 1990, lorsqu’il mettrait le racisme au centre du
système monde moderne colonial et ferait des Indien-ne-s la première population racisée d’un
système global, s’enracine dans des engagements très anciens, présents dès les années 1950 et une
histoire personnelle andine. Aníbal Quijano, dans les années 1950, rallierait l’APRA16 , cette
alliance politique anti-impérialiste fondée en 1930 par Raúl Haya de la Torre. Très inspirée par la
révolution mexicaine, son agrarisme et son indigénisme, cette organisation, qui à l’origine se voulait
inter-américaine, analysait la situation du Pérou des années 1930 comme celle d’un pays semi
féodal. Elle fut persécutée par les divers pouvoirs, au même titre que le parti communiste. À cette
époque, l’indigénisme, depuis le Mexique, avait gagné tout le continent sud-américain. Il est
difficile pour un lecteur ou une lectrice européen-ne de percevoir l’importance politique de
l’indigénisme en « Amérique latine ». Pendant toute la colonisation et après les Indépendances du
XIX siècle, les « Indien-ne-s » des classes populaires avaient vécu une condition de semi-servage et
n’avaient pas le statut de citoyen-ne-s. Ce monde essentiellement agraire était exploité par celui des
grand-e-s propriétaires terrien-ne-s qui
maintenaient avec eux et elles des relations d’exploitation longtemps qualifiées de féodales
et poursuivaient férocement le processus d’expropriation de leurs terres commencé plusieurs siècles
auparavant avec la Conquête. L’indigénisme était un courant de pensée multiforme, parti du
Mexique et de sa révolution, qui prétendait donner une place aux « Indien-ne-s ». Les indigénistes
appartenaient généralement à la classe moyenne et étaient des blancs, des blanches ou des métis-se-
s. Ils et elles appartenaient souvent à des milieux intellectuels, littéraires ou artistiques. Leurs
positions et leurs analyses étaient très variables et souvent très ambiguës : elles oscillaient entre le
paternalisme le plus abject, lorsque le courant était récupéré par les pouvoirs en place; le désir
radical d’un changement révolutionnaire, tel fut le cas de l’approche communiste hétérodoxe de
Mariátegui; et le désir de préserver une authenticité culturelle, une âme indienne.
16 Alliance populaire révolutionnaire américaine.
Licence Creative Commons 4.0.
309
Globalement, qu’il s’agisse de l’indigénisme d’État ou de celui des partis de gauche, il allait de soi
que l’Indien-ne devait être intégré-e à la nation. Il y avait donc un lien étroit entre la question
nationale (réussir la transition vers une nation moderne) telle qu’elle se posait au Pérou et dans les
pays à majorité indienne du continent et la réflexion ou les programmes relatifs à cette partie de la
population. En fait, dans l’indigénisme, ce n’était jamais l’Indien-ne qui parlait. Quijano, de par son
histoire familiale17, son affiliation à l’APRA et sa lutte contre le pouvoir des grand-e-s propriétaires
terrien-ne-s péruvien-ne-s, avait vécu dans sa première jeunesse les contradictions
des révolutionnaires de son pays qui voulaient en finir avec l’exploitation des paysan-e-s indien-ne-
s et avaient vu leurs luttes se briser contre le mur de la répression et l’instauration d’une dictature à
la fin des années 1940. Il est important d’insister sur le fait que c’est dans cette histoire située, de
défaites et de répressions, que s’ancre sa réflexion. Les Indien-ne-s, dont il théoriserait quarante ans
plus tard la situation de premiers et premières racisé-e-s de l’histoire, ne sont pas seulement le
rouage essentiel d’un dispositif théorique sophistiqué, mais constituent un groupe dont il a
toujours combattu l’oppression et dont il a analysé les luttes à partir des années 1960.
Cet intérêt est manifeste dans le rapport particulier qui fut le sien à la littérature. En 1965, il
participa au débat sur Todas las sangres, œuvre de l’écrivain et anthropologue métis José María
Arguedas. Aníbal Quijano, féru de littérature, connaissait très bien l’œuvre d’Arguedas qu’il suivait
depuis les années 1950 et avait placé beaucoup d’espoir dans la production d’un auteur qui,
confiait-il, l’avait guéri du profond pessimisme causé par l’échec du projet apriste. Les livres
d’Arguedas mettaient au premier plan des Indien- ne-s qui n’étaient plus les figures mélancoliques
et misérables, quasi minérales, de la littérature indigéniste. Et le roman qui suscita un débat
mettait en scène le problème qui avait agité les courants anthropologiques indigénistes, puis les
sciences sociales péruviennes émergentes des années 1960 : le monde indien reposait-il toujours sur
l’existence d’un système de caste ou devait-on plutôt, comme l’indiquait la position de
l’anthropologue Henri Favre, penser que l’« Indien-ne » était devenu-e un-e paysan-e et
que seul-e-s les gamonales, ces grand-e-s propriétaires terrien-ne-s, avaient intérêt à ce que l’on
parle d’une réalité indienne? Quijano, à l’époque, semblait plutôt identifier Indien-ne et paysan-e
comme le fit pendant longtemps la gauche latino-américaine. C’est du moins ce qui transparaît
17Anibal Quijano était natif des Andes, du petit village de Yanama dont la population était quechuaphone. Il a vécu son
enfance dans les années 1930 en contact de ce monde andin, sa musique, avec son rapport particulier à la langue et à la
culture— circonstances qui ne seraient pas étrangères à ses questionnements ultérieurs et son intérêt pour l’indigénisme.
Lui-même parlait et chantait en quechua, comme son père, instituteur qui fonda le premier centre scolaire de Yanama et
consacra une grande partie de sa vie à soutenir les villageois-es contre les grand-e-s propriétaires terrien-ne-s qui les
exploitaient.
Licence Creative Commons 4.0.
310
de son essai de 1965 sur les mouvements paysans. Invité à participer au débat sur Todas las sangres,
il y développerait une ligne personnelle. Une prémonition de la conceptualisation qu’il ferait plus
tard de la race comme catégorie sociale y est déjà perceptible. Il perçoit que le cadre théorique de
l’époque est trop étroit pour permettre de comprendre vraiment ce qu’est la situation de l’Indien-ne
dans cette société en mutation qu’est le Pérou des années 1960. Dans son intervention, il définit la
culture indienne comme un mélange de culture préhispanique reconfigurée, de culture espagnole et
culture occidentale, également reconfigurées, quelque chose de profondément différent de la culture
de l’occidental ou du créole péruvien. Il va s’interroger sur la situation de caste décrite dans le livre
de José María Arguedas et sur la façon d’appréhender « lo indio ». Pour lui, le roman, bien que
caricatural sociologiquement, rend compte d’une transition profonde, d’une situation effective de
mélange, mais pas suffisamment.
Le roman ne met pas l’accent sur le processus de transition, le conflit d’intégration culturelle auquel
la population paysanne est soumise en même temps du fait d’un système de métissage (…). Il me
semble que d’un côté on voit y apparaître la théorie du changement comme remplacement
progressif des éléments de la culture traditionnelle au profit des éléments de la culture que nous
pouvons appeler moderne, Mais en même temps, on y trouve des éléments d’une théorie
parallèle à celle du changement, qui ne peuvent être intégrés à l’autre, et selon laquelle la culture
paysanne indigène traditionnelle pourrait se développer et s’intégrer sans perdre son contenu dans le
nouveau cadre de la culture moderne. (Quijano, 1965) On remarquera le terme de « population
paysanne ». Le personnage du cholo Rendón Wilka, l’Indien qui revient de la ville au village,
s’intègre à nouveau à la société traditionnelle et retrouve sa façon de penser et d’agir d’avant,
comme s’il n’avait pas été acculturé, semblait irréaliste à Quijano. Il mettrait en rapport la théorie
du changement qui sous-tend le personnage de Rendón Wilka avec sa propre expérience des
mouvements sociaux, remarquant, à tort, qu’il n’ y avait pas de leaders indien-nes, que des leaders
cholos et cholas. Pour lui, l’indianité semble alors liée au passé, l’Indien contemporain est d’abord
un métis. Et la perspective d’Arguedas, regrette-t- il, est tournée elle aussi vers ce passé.
Aujourd’hui, l’indianité ne peut plus être envisagée ni du point de vue racial ni du point de vue
strictement de la caste. (Quijano, 1965)
L’absence de réalisme reproché à l’auteur, si tant est qu’elle ait existé puisque l’écrivain-
anthropologue disait parler d’expérience, lui permettait pourtant de mettre en scène une utopie
indienne moderne. C’est peut-être plus tard que Quijano mesurerait toute sa profondeur, peu de
temps avant de commencer à parler de colonialité, lorsqu’il écrirait « Estética de la utopía «
(1990).
Licence Creative Commons 4.0.
311
Mais à cette époque, il aborde la question de la situation du groupe indien à partir de sa réflexion
sur le changement et la transition. Il avait porté une attention particulière au traitement littéraire du
personnage de Rendón Wilka, le cholo, parce que dans ces années-là, il s’intéressait lui
aussi particulièrement à cette figure essentielle de cette transition. Mais si Arguedas voyait dans le
cholo un être qui peut aussi retourner vers la tradition, Quijano, lui, voulait le voir comme le porteur
d’une culture nationale nouvelle dans ce pays de transition qu’était le Pérou. Son essai La
emergencia de un grupo Cholo y sus consecuencias en la sociedad peruana, publié en 1964, un an
avant la table ronde évoquée ici, pose une hypothèse : une nouvelle classe serait apparue, les cholos
et les cholas. Ces Andin-e-s qui se déplacent de la montagne vers la ville et qui créent un monde
nouveau, une culture nouvelle, à la frontière de la modernité et de la tradition, participaient à la fois
« de la condition de caste » et de celle de classe sociale.
À une époque, il évoluait de l’aprisme vers un marxisme hétérodoxe et croyait à la possibilité de
construire des États-nations américains qui seraient des sociétés sans classe. Il pensait que la culture
chola, synthèse de culture indienne andine, traditionnelle, et de modernité, pouvait devenir
une authentique culture nationale. Plus tard, il constaterait que ce groupe ne pouvait pas accéder à la
reconnaissance car le mythe du métissage, fondamental dans la genèse des États latino-américains,
occultait un racisme toujours à l’œuvre. En effet, si le discours national ventait le
métissage, les métis-ses idéalisé-e-s étaient, en définitive, des Indien-ne-s blanchi-e-s. Les pratiques
sociales et étatiques excluaient dans les faits les métis-ses réel-le-s, les cholos et cholas. C’est-à-dire
que l’auteur, en 1965, était encore pris dans le mythe de l’intégration, même s’il percevait son
échec. La conviction que les « Indien-e-s » ne pouvaient pas encore être considéré-e-s comme les
sujets possibles d’un changement social amènerait Quijano, pendant plusieurs années, à s’intéresser
aux cholos et cholas.
Créer une sociologie critique
Pour comprendre la position de Aníbal Quijano vis-à-vis des Indien-ne-s ou des cholos et cholas, il
est nécessaire revenir sur les cadres de pensée de l’époque. Les années 1960 sont celles où se
structure la sociologie au Pérou et en « Amérique latine ». Les sciences sociales émergentes sont
très
marquées par la vision américaine, par la sociologie de la modernisation. La théorie de la
modernisation était une invention américaine conçue dans la même matrice que le discours du
Licence Creative Commons 4.0.
312
développement. Par « modernisation », on entendait alors ce processus de changement grâce auquel
des sociétés peu développées acquièrent des caractéristiques proches de celles des sociétés
les plus développées. Mais à la différence du discours sur le développement, apparu après la
Seconde Guerre mondiale, la théorie de la modernisation était née avec la décolonisation. Les États-
Unis s’y présentaient comme un modèle bienveillant pour les jeunes nations et cherchaient à
contrecarrer la séduction du modèle soviétique. Ce discours américain se structurait autour de l’idée
d’un développement pour tous et toutes, d’une rhétorique anticolonialiste (une critique des empires
coloniaux européens) et la célébration enthousiaste du caractère avant-gardiste des jeunes nations
africaines. Le discours de la modernisation s’appuyait sur l’optimisme qu’avait suscité le succès du
Plan Marshall en Europe, mais c’était-là oublier que réindustrialiser était la même chose
qu’industrialiser. La force et le danger de cette théorie, du dispositif puissant qu’elle permettait de
mettre en œuvre, tenait à sa volonté d’agir sur la société, de transformer les valeurs culturelles. Au «
cœur » de la théorie de la modernisation, il y avait l’idée que pour qu’advienne une « croissance
auto- entretenue » il fallait autre chose que des processus de production et de consommation
purement économiques. Les pays sous-développés étaient invités à prendre pour modèle les pays
développés. Dans cette logique, la tradition était identifiée au sous-développement et le
développement, à la modernité, en tout cas, ce qui était défini comme tel. Persuadés que
le passage de la tradition à la modernité relevait d’une loi historique, les tenant-e-s de cette
idéologie proposaient des réponses fonctionnalistes à la question de la transition.
Au Pérou, les années 1960 sont celles d’intenses changements. C’est le 3 moment où est remise en
question la structure du gamonalisme18 . La modernisation avait commencé bien avant, dans les
années 1940, avec l’exode rural, et s’était accompagnée de mouvements sociaux importants.
Dans les années 1940-1950, Quijano, comme beaucoup d’autres, avait soutenu ces mouvements,
violemment réprimés. Il avait été emprisonné deux fois et avait même dû s’exiler. Il avait été
confronté à la réalité de la modernisation et du changement. Cette expérience concrète, il
l’aborderait d’une façon qui était déjà une critique du modèle de la modernisation. Il ne serait pas
un imitateur, contrairement à ce qui arrivait à de nombreux chercheurs et nombreuses chercheuses
latino-américain-e-s, comme le déplorait le sociologue Orlando Fals Borda. Ainsi que Fals Borda en
Colombie ou Pablo González Casanova au Mexique, il travaillerait à rendre critique la sociologie
latino-américaine naissante en la libérant de son positivisme et de son fonctionnalisme. Comme
18 On appelait gamonal ce grand propriétaire terrien andin, qui régnait sur son monde en patriarche et soumettait les
populations indiennes travaillant sur ses terres à une exploitation féroce
Licence Creative Commons 4.0.
313
eux, il percevait la nécessité de ne pas appliquer des schémas importés à la réalité en transition de
leur pays et voulait construire une science engagée.
Par conséquent, son analyse de la sociologie latino-américaine, qui intègre un certain marxisme, n’est pas
celle d’un savant détaché et neutre mais d’un homme actif, qui contribua à la construction d’un arsenal
socio-scientifique. À cette époque, la sociologie apparaissait comme une « science d’opposition », porteuse
d’une promesse sociale : permettre aux hommes d’intervenir de façon rationnelle dans leur propre histoire.
(Rubo, 2019)
Il n’est pas étonnant que pour Aníbal Quijano, comme pour Pablo González Casanova, le
sociologue Charles Wrigth Mills, qui travailla sur la connaissance, la théorie du conflit et le
pouvoir, ait joué un rôle important. La perspective du sociologue américain aidera Aníbal Quijano à
construire sa propre vision, entre autres, à critiquer le caractère a-historique de la sociologie
structuraliste ou
fonctionnaliste. Sa critique de l’impérialisme, déjà présente lors de sa période apriste et enrichie de
rencontres et lectures hétérodoxes, était déjà le socle d’une distance critique face à l’invasion de la
sociologie américaine. En fait, dès les années 1960, l’étude de la situation sociale et politique
de son pays amènerait Aníbal Quijano à formuler une critique de l’eurocentrisme. Il affirmerait la
nécessité de construire les sciences sociales latino- américaines sur d’autres bases et mettrait en
question, dès 1965, l’universalisme et le « provincialisme » occidental, dans une démarche
pionnière, bien avant les dénonciations d’écrivain-e-s postcoloniaux et postcoloniales, comme
Chakrabarty.
Personne ne peut plus ignorer que les sciences sociales qui ont été élaborées dans les sociétés industrialisées, et
particulièrement aux États-Unis, sont très marqués par l’ethnocentrisme et, ce n’est pas une façon de parler, le
provincialisme. Leur prétention à l’universalité doit désormais passer par un filtrage aussi ferme que minutieux.
(in Ríos, 2010)
Enfin, autre élément important, entre 1966 et 1971, Aníbal Quijano sera recruté par la CEPAL
(Commission économique pour l’« Amérique latine »), commission régionale de l’Organisation des
Nations Unies fondée en 1948, à l’origine des stratégies de développement d’industrialisation par
substitution aux importations (ISI) dans les pays d’« Amérique latine », au cours des années 1960.
La CEPAL, déjà définie dans un article sur la dépendance, n’échappait pas aux objectifs de la
théorie de la modernisation, mais elle était structurée de telle sorte que des iconoclastes comme
Quijano pouvaient y élaborer des théories hors du mainstream. Le sociologue a reconnu plus tard
Licence Creative Commons 4.0.
314
l’importance de cette période pour sa pensée :
Ce qu’il y avait, c’était un grand débat, pas une théorie, un grand débat qui était également très hétérogène et
différencié (…). Maintenant, un nouveau débat émerge en Amérique latine, et parmi ses axes, il y a la théorie de
la colonialité du pouvoir, la critique de l’eurocentrisme, de la modernité/colonialité eurocentrée. Mais sa
généalogie remonte évidemment à ce débat latino-américain actif et productif à partir de Prebisch et de la
CEPAL (Rios, 2009).
Aníbal Quijano collaborerait donc à la CEPAL mais lutterait activement contre certaines des idées
qui avaient cours, entre autres celle de « marginalité culturelle ». Le concept s’appliquait à un effet
des processus de d’industrialisation, le fait qu’ils n’absorbaient pas une partie de la main d’œuvre,
qui restait alors en marge. Il serait développé par certains des membres de l’organisme sous un
angle culturel, la difficile transition des nations latino-américaines vers la modernisation étant
expliquée par un « dualisme structurel » (les rythmes asynchrones du développement). La pauvreté
(concept opératoire de la théorie du développement) était donc analysée grâce à l’idée de « culture
de la pauvreté », elle devenait quelque chose d’hérité culturellement, qui se transmettait et se
diffusait alors de génération en génération. Ou encore, elle était expliquée par l’absence de liens
culturels entre les marginalisé-e-s et la société. Aníbal Quijano s’opposerait à ces analyses qui
tenaient d’ailleurs plus de la description. Elles faisaient de la marginalité ou de la dépendance
quelque chose d’endogène, de non relationnel, qui ne remettaient pas en question une organisation
sociale.
Pour lui, au contraire, il fallait comprendre la marginalité comme un mode d’intégration particulier
de certaines parties de la population dans le cadre d’une dépendance structurelle.
Dans son article « Redefinición de la dependencia y proceso de marginalización en América Latina
», il pense la dépendance en terme de développement inégal et essaie de comprendre les formes de
domination politique qui produisent la marginalisation. C’est là qu’apparaît son idée de « pôle
marginal ».
À travers la relation entre « centre » et « périphérie » et la notion de « dépendance structurelle », Quijano a
cherché à repenser de manière critique le problème du développement en tant que récit de la modernité. (Rubbo,
2019)
Elle lui permet d’approfondir sa réflexion sur la transition :
Licence Creative Commons 4.0.
315
En vertu des lectures dualistes et évolutionnistes de l’histoire, qui inspiraient la plupart des courants «
modernisateurs » des sciences sociales et les manuels politiques des partis communistes d’Amérique, on passait
de façon linéaire et homogène d’une société « traditionnelle » à une société « moderne ». L’auteur se démarquait
de cette approche et mobilisait comme antidote la catégorie d’« hétérogénéité historico-structurelle ». Il affirmait
que la formation économico-sociale péruvienne articulait diverses temporalités historiques. (Rubbo, 2019)
Aníbal Quijano va développer cette idée d’hétérogénéité structurelle, combattant l’idée de la
dépendance comme processus qui oppose globalement une société dominante au centre à une
société dominée à la périphérie, et montrant que les classes supérieures du pôle dominé sont en
phase avec celles du pôle dominant. C’est le moment où se diffuse l’idée du dualisme social des
sociétés latino-américaines. Aníbal Quijano ne va pas s’orienter comme Rodolfo Stavenhagen ou
Pablo González Casanova vers une critique du colonialisme interne. Il va, partant de la constatation
d’un changement dans les sociétés latino-américaines, s’attaquer à l’épineuse question de la
transition et remettre en question l’approche habituelle.
En général, dans la théorie sociologique contemporaine, les processus de changement sont perçus comme un
passage, une transition d’un type de société à un autre, de sorte qu’une situation de changement peut être
considérée comme une certaine étape sur le chemin de la transition d’un pôle social ou culturel vers un autre,
dont on sait déjà ce qu’il sera. (Pacheco, 2018)
Cela revenait à remettre en question la conception étapiste du changement qui était alors celle de la
gauche latino-américaine et planétaire et à voir dans la société péruvienne une société de transition
plus qu’en transition puisqu’il est difficile de savoir vers où va une société.
Une telle position constituait déjà un éloignement considérable avec les approches de la gauche de
l’époque, très marquée par un marxisme dogmatique et l’idée que la modernisation passerait
nécessairement par l’industrialisation. Dans les années 1970, Aníbal Quijano fonderait une revue,
Sociedad y Política (1972-1983), qui essaierait de poser autrement la question de la révolution. Il y
critiquerait le gouvernement de l’époque, qui avait récupéré les thèmes des luttes antérieures et
réussi à tromper une partie de la gauche péruvienne. Quijano ne serait pas dupe; sa revue serait
d’ailleurs censurée car il y affirmait qu’avec le velazquisme :
Il n’était pas question de révolution, mais d’une variante de capitalisme d’État matinée de corporatisme, qui
cherchait à subordonner et à castrer le mouvement populaire. Il était indispensable de mettre l’autonomie
politique au premier plan. (Espinosa, 2018)
Licence Creative Commons 4.0.
316
Contraint à l’exil en 1974, lorsqu’il revint au Pérou, il fonda, en 1976, le Movimiento
Revolucionario Socialista (MRS) qui critiquait un marxisme léninisme dogmatique, économiciste,
stalinien et surtout assoiffé de pouvoir. Ce MRS ne voulait pas être hégémonique, il ne cherchait pas
à s’ancrer dans un processus électoral, mais voulait simplement contribuer à l’auto- organisation
populaire. Cette autonomie qui se faisait jour également dans les mouvements sociaux européens à
l’époque, voir les Lipp, cette autonomie qui prendrait de la force dans les années 1990 en «
Amérique Latine », en particulier avec les mouvements indigènes, intéressa donc l’auteur dès les
années soixante-dix.
La crise des paradigmes
Cette distance avec les courants de son temps lui vaudrait des inimitiés féroces à gauche, en
particulier au Pérou, où remettre en question les cadres de pensée marxistes orthodoxes était
pratiquement impossible. Mais elle explique également pourquoi la grande crise des années 1980-
1990, suite à l’écroulement du système soviétique, ne toucherait pas Aníbal Quijano aussi
radicalement que le seraient bien des intellectuel-le-s européen-ne-s. Certes, le militant était
consterné par le reflux de la pensée conservatrice et la décomposition de la gauche, mais le fait que,
depuis des années, il ait dû affronter les modèles de pensée occidentaux pour arriver à rendre
compte de la spécificité latino-américaine, que son marxisme hétérodoxe lui ait valu bien des
déconvenues avec les partis révolutionnaires de son pays, qu’il ait toujours émis des réserves claires
sur l’étatisation du projet révolutionnaire et qu’il ait vécu des expériences d’autonomie de type
anarchiste dans le cadre de Villa El Salvador, tout cela lui permit de développer une approche hors
du 4commun19. Parmi les textes paradigmatiques de cette époque, citons la conférence de 1985,
Flacso piensa Flacso, où il prend acte de la défaite de la gauche et de la nouvelle mission du
chercheur et de la chercheuse en sciences sociales : produire une analyse de cette défaite.
Mais il ne s’agissait pas seulement, pour lui, de résister et ainsi de risquer de se fossiliser,
expérience qui serait le lot de beaucoup d’intellectuels de gauche en Europe. Dès 1985, il avait
19 L’expérience de la Communauté urbaine autonome de Villa El Salvador (CUAVES), se produisit à un moment
crucial de l'histoire politique du Pérou, entre 1971 et 1983. Les CUAVES avaient vu le jour sous l'impulsion initiale du
gouvernement militaire du général Velasco (1968-1975), qui avait proposé une troisième voie, non pas capitaliste
ou socialiste, mais participative et autogestionnaire; il avait cherché à transformer Villa El Salvador en une ville «
coopérative » sur un modèle d'autogestion, en soutenant l'organisation d'entreprises communales visant à satisfaire les
besoins fondamentaux du peuple, mais le tout sous la direction (et le contrôle) du gouvernement militaire. Voilà une des
raisons pour lesquelles la réflexion de Quijano put non seulement résister mais s’affirmer
Licence Creative Commons 4.0.
317
exposé la nécessité de repenser les sciences sociales à partir de la différence latino-américaine et la
rencontre avec Immanuel Wallerstein, à Birmanghton, l’amènerait à étoffer sa réflexion sur la
globalisation et l’hétérogénéité culturelle. Pour lui, la décomposition des cadres européens de la
pensée de gauche s’avére l’occasion de réécrire l’histoire à partir d’une expérience non
européenne : celle des latino-américain-e-s.
L’idée que rien n’est établi dans les sociétés latino-américaines et celle, ancienne chez lui, qu’il
s’agit de sociétés de transition, vont orienter son analyse vers l’histoire et la culture et finiront
par aboutir à la conceptualisation du pouvoir moderne/colonial des années 1990. Peu de temps
avant l’anniversaire de la « Découverte », dans « Colonialidad, Modernidad y racionalidad », publié
par Perú Indígena (1991), au moment où Serge Gruzinski publiait son essai sur le métissage,
apparaît pour la première fois la notion de colonialité du pouvoir, dès la deuxième page, à propos du
colonialisme. L’auteur affirme que la structure coloniale qui reposait sur la différence
colon-e-s/colonisé-e-s, codifia les différences sociales comme des différences raciales, ethniques et
nationales. Ces constructions intersubjectives, écrit-il, furent transformées en catégories qui se
prétendaient objectives et scientifiques, et dépourvues de toute signification historique. Elles
devenaient des phénomènes naturels apparemment étrangers à l’histoire du pouvoir.
Il notait également la permanence de ce phénomène bien après la décolonisation, les dominé-e-s
d’hier étant les sous-développé-e-s ou peuples en voie de développement d’aujourd’hui. La fin du
colonialisme n’était pas celle de la domination ni de la colonialité.Dans un second article, « Raza,
etnia y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas » (retour sur un hétérodoxe marxiste très présent
dans la réflexion décoloniale), il analyserait plus profondément le thème de la race et mettrait
l’accent sur l’articulation des relations de travail et des nouvelles identités historiques. Il affirmerait
que l’existence de diverses formes de travail, salariat, semi-servage, esclavage, coïncide avec
l’apparition d’un classement racial de la population mondiale et insisterait sur le caractère
radicalement nouveau de la société qui émerge. Il énonce alors sa théorie :
Le racisme et la discrimination ethnique furent originellement inventés en Amérique, et par la suite reproduits
dans le reste du monde colonisé, devenant les fondements d’un rapport de pouvoir
très spécifique entre l’Europe et les populations du reste du monde.
Cette idée constituait une remise en cause de l’approche consensuelle du racisme qu’on a tendance
à relier au racialisme scientifique du XIX siècle, donc à la deuxième colonisation, ainsi qu’au
racisme biologique du XX siècle, dont le nazisme serait l’expression la plus radicale. Mais surtout,
les critiques du racisme jusque-là en faisaient d’abord un mouvement lié à l’histoire des idées — via
Licence Creative Commons 4.0.
318
l’empreinte de l’anthropologie raciale par exemple. Aníbal Quijano analyse le racisme comme une
pratique et une structure en place avant même que l’idéologie raciste comme telle existe. C’est un
système. Et la modernité, en dehors de ce système, n’est pas compréhensible puisque son
développement se base précisément sur l’exploitation des populations infériorisées. Par la suite, il
développerait cette approche jusqu’à son décès en 2018, et d’autres auteurs et autrices, qui étaient
également engagé-e-s dans une critique de l’eurocentrisme et de la soumission intellectuelle aux
cadres de pensée occidentaux, rencontreront son œuvre.
Aníbal Quijano a donné à l’invention de la race un rôle fondamental dans la construction du
capitalisme mondial et la répartition inégale des formes de travail et de rémunération. Comme
Enrique Dussel et Walter Mignolo, il a critiqué l’eurocentrisme propre aux sciences sociales
occidentales. Si Enrique Dussel, autre pilier de l’approche décoloniale, a enraciné sa construction
du décolonial dans son rapport éthique aux pauvres et aux opprimé-e-s, si Walter Mignolo s’est
intéressé aux processus concernant la connaissance, la pensée et épistémologie, Aníbal Quijano, lui,
est parti d’un questionnement sur les rapports entre sociologie et engagement au service d’une
réalité en transition dans un pays indien et métis. À partir de cette réflexion située, il a produit une
théorie qui permet d’envisager une sortie de la modernité eurocentrée.
Références
Climaco, Danilo Asis. 2014. Aníbal Quijano. Cuestiones y Horizontes. Antología esencial. De la
Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Descolonialidad del Poder. Buenos Aires :
Clacso.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140424014720/Cuestionesyhorizontes.pdf
Une mine d’articles de l’auteur dont les plus importants. Contrairement à ce qui se passe avec
l’autre anthologie de qualité éditée par Zulema Palermo et Pablo Quintero, ce document est en accès
libre.
Delgado Foch, Emmanuel et Bogio Ewange Epée, Felix. 2014. « Aníbal Quijano et la colonialité du
pouvoir ». La Nouvelle revue des livres.
https://issuu.com/revuedeslivres/docs/rdl3glbal/64
Licence Creative Commons 4.0.
319
Espinosa, Roberto. 2018. « Aníbal Quijano: Vivir contra el poder, contra todo tipo de poder ».
Rebelión.
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=242821
Kutxiko Txoko txikitxutik. 2017. «La comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador o la
construcción comunitaria de una utopía autogestionada ». Dans Kutxiko txoko txikitxutik : 2.
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/category/gomendioak-recomendaciones/
Pacheco Chavez, Víctor Hugo. 2018. « Aníbal Quijano: la apuesta por una sociología crítica (1962-
1980) ». Nómadas : 204-205.
http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_50/50_12P_anibal_quijano.pdf
Quijano, Aníbal. 1965. Intervention dans la table ronde du 23 juin 1965 ¿He vivido en vano? Mesa
Redonda sobre Todas las Sangres : 56-61. Lima : Institut d’Études Péruviennes.
https://www.academia.edu/30087119/_He_vivido_en_vano
Quijano, Aníbal (1990). “Estética de la utopía”. Hueso Húmero; n° 27. Lima.
Quijano, Aníbal. 1993. “Raza, etnia, y nación en Mariátegui. Cuestiones abiertas”. José Carlos
Mariátegui y Europa. El otro aspecto del descubrimiento. El Amauta : Lima
Quijano, Aníbal. 2015. « Race, Colonialité et Eurocentrisme ». Site du Parti des Indigènes de la
République.
http://indigenes-republique.fr/race-colonialite-et-eurocentrisme/
Ríos, Jaime. 2010. « Crisis y ciencias sociales. Entrevista a Aníbal Quijano ». Tareas, N° 136 : 88.
https://www.redalyc.org/pdf/5350/535055544004.pdf
Ríos, Jaime. 2009. « Aníbal Quijano: Diálogo sobre la crisis y las ciencias sociales en América
Latina ». Revista del Colegio de Sociologos del Perú : 37.
Licence Creative Commons 4.0.
320
https://issuu.com/colegiodesociologosperu/docs/revista_n1
Alfaro Rubbo, Deni. 2019. « Quijano em seu labirinto: metamorfoses teóricas e utopias políticas ».
Sociologias. n°. 52 : 241-244-246.
http://dx.doi.org/10.1590/15174522-89913
Rubbo, Deni Alfaro. 2018. « Aníbal Quijano e a racionalidade alternativa na América Latina ».
Estudos Avançados. 32(94).
https://doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0025
Valladares Quijano, Manuel. 2019. « Aníbal Quijano y su tiempo (1930-2018) ». Discursos Del Sur.
Lima : Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/discursos/article/view/16316/14177
Licence Creative Commons 4.0.
321
85. Race et Abya Yala
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Pour les penseurs décoloniaux et les penseuses décoloniales, l’invention de la race est indissociable
de l’apparition du système monde-moderne- colonial. Le racisme est la naturalisation de relations
de domination et d’exploitation.
Race et colonialité du pouvoir
La question de la race est un sujet qui divise. En Europe, et en France en particulier, le traumatisme
lié à l’expérience du régime racial nazi fait qu’après guerre le terme même de race fut banni du
vocabulaire. Aujourd’hui encore, un homme politique français comme François Hollande, au nom
de l’inexistence des races, et de la lutte contre le fléau raciste, alla jusque à proposer de faire
disparaître le terme de la constitution, ce qui fut l’occasion d’un vaste débat auquel participèrent
historiens et juristes.
Mais faire disparaître le mot serait donc équivalent à en finir avec le phénomène ?
On peut craindre le contraire. On peut craindre également que la répulsion, compréhensible,
provoquée par le mot race n’entrave la compréhension du phénomène socio-politique qu’est le
racisme, de son émergence, ses permanences, et de la multiplicité de ses formes.
En Amérique latine, les intellectuels qui ont participé au MC, Aníbal Quijano et Walter Mignolo les
premiers, se sont intéressés à cette émergence. Ils ont proposé une généalogie des catégories
raciales et de leurs usages politiques qui remettait en cause les approches qui faisaient autorité.
Aníbal Quijano, dans les années 90, a insisté sur la différence entre le type de hiérarchisation qui se
met en place avec la colonisation de l’Amérique et les formes de xénophobie, de classement des
populations et d’infériorisation observables antérieurement dans l’histoire humaine, par exemple
dans le cadre des empires territoriaux islamiques, romains ou chinois. Il remarqua alors que la
discrimination ethnique avait existé dans tous les colonialismes, à toutes les époques, mais que le
racisme surgirait seulement avec la modernité, en Abya Yala.
Dans « Raza, etnia, y poder en Mariategui, cuestiones abiertas » (1992), il voit la race comme un
dispositif qui se met en place après la Conquête de l’« Amérique latine ». Celui-ci permet de fixer la
position occupée par l’ego européen et les non-Européen-ne-s. L’idée de Quijano est que la race
Licence Creative Commons 4.0.
322
constitue la première catégorie moderne, car elle permet de classer la population et de faire passer
ce processus de différentiation et de subordination pour un processus naturel. Le racisme serait à
l’oeuvre lorsque des qualités relevant d’un processus soit-disant « naturel » sont attribués par
le groupe dominant à un groupe subalterne. Ce qui revient à bouleverser la chronologie
généralement admise pour le racisme, laquelle en fait un phénomène du XIX ou du XX siècle.
Le sociologue péruvien propose un historique de la problématique qui se met en place avec la «
Découverte », revenant sur la discussion du XVI siècle relative à l’âme des « Indien-ne-s ». En
d’autres termes, à leur humanité, puisque dans un monde chrétien, l’âme est ce qui fait l’être
humain. Discussion qui serait essentielle, affirme-t-il, en ce qui concerne les rapports
de l’Europe et du reste du monde. La papauté affirma l’humanité des Indien-
ne-s, mais :
À partir de ce moment-là, les rapports intersubjectifs et les pratiques sociales du pouvoir furent marqués par
l’idée que les non-Européens avaient une structure biologique différente de celle des Espagnols et surtout qu’ils
appartenaient à un type inférieur. D’autre part, on commença à penser que cette inégalité biologique était assortie
d’une différence culturelle, et n’avait rien à voir avec le processus historique de la rencontre entre les deux
cultures. (Quijano, 1992)
Dans le même article, plus loin, réapparaît le terme « biologique » :
L’idée de race signifie que les différences correspondent à des niveaux de développement biologique différents
entre les groupes humains, sur une échelle qui part de l’animal pour arriver à l’humain. (ibid.)
Plus loin, il suggère une comparaison entre la pureté de sang espagnol et le système de la race
américain, comparaison plus développée chez Walter Mignolo qui la reliera à sa théorie de
l’occidentalisme et à la division du monde des chrétien-ne-s :
L’idéologie de la pureté de sang, apparue sur la péninsule ibérique pendant la guerre contre les Musulmans et les
Juifs, est sans doute ce qui s’approche le mieux de ce qui fut codifié comme race lors de la Conquête des sociétés
autochtones américaines, ou du nettoyage ethnique pratiqué ensuite dans l’Allemagne nazie, ou encore
aujourd’hui dans l’ex-Yougoslavie. La pureté de sang, phénomène qui apparaît dans le contexte de luttes
religieuses, est une $ représentation qui sous-entend que les idées et les pratiques religieuses, comme la culture,
se transmettent par le sang. Il se passe exactement la même chose avec l’idée de race après la colonisation des
autochtones en Amérique : ce sont des déterminations raciales qui font des Indiens, des Noirs, et des Métis, des
êtres d’une culture inférieure, ou incapables d’accéder à une culture supérieure. Et bien, c’est cela la « race »,
l’association entre biologie et culture. (Quijano, 1992)
Licence Creative Commons 4.0.
323
Aujourd’hui, à la lumière des travaux effectués par les historien-ne-s, le découpage temporel établi
par Quijano peut être nuancé. Des analyses comme celle de Max Herring Torres montrent que le
racisme en tant qu’idéologie apparaîtrait plutôt à la fin du XVII siècle, à la confluence de
l’idéologie de la pureté de sang, de celle la couleur et des modifications sémantiques du terme race.
Mais l’hypothèse de Quijano touche juste cependant : pendant la colonisation, il semble que se soit
mis en place quelque chose d’inédit et ce, pour des raisons qui ne tiennent pas exclusivement au
déploiement de la violence ou au caractère génocidaire20 souvent relevé pour la Conquête. Ce
racisme-là, qu’il n’est pas nécessaire de qualifier de proto-racisme, car cela reviendrait à continuer à
penser dans un cadre explicatif évolutionniste, remet en question les définitions actuelles les plus
courantes et, par effet boomerang, bouleverse les certitudes que nous entretenons sur les rapports
entre pouvoir et race. Ce qui s’est produit alors sur le continent américain doit être envisagé dans la
perspective de l’émergence du corps, ou d’un nouveau statut de ce dernier, émergence dont les
formes en Europe et en Amérique furent différentes, avec cependant des interactions dont la nature
est loin d’avoir été élucidée. Pour l’anthropologue colombienne, Zandra Pedraza, le support de la
race en « Amérique latine », c’est le corps. Pour elle, l‘histoire de la notion de race est indissociable
de celle du corps. Phénomène de la modernité, il apparaît au XVI siècle, en même temps que la
colonisation, sur les tables de dissection européennes. Nous devons comprendre quel est le corps au
centre de ce racisme, corps qui n’est pas encore celui de la biologie, mais qui n’est plus celui de la
période médiévale, corps dont l’apparition n’a peut-être de sens que dans la perspective dualiste
héritée d’un certain christianisme et transformée par des penseurs et penseuses comme Descartes.
Ébauche d’une généalogie
Revenons donc sur la spécificité du processus analysé par Quijano et sur cette pureté de sang liée à
l’histoire de la péninsule ibérique. Les statuts de limpieza de sangre sont l’expression d’un
phénomène unique en Europe qui s’est affirmé aux XVI et XVII siècles et dont les premières
manifestations correspondent au XV siècle. La séquence de la « Reconquête » est le
contexte dans lequel apparurent ces statuts. Les communautés juives établies depuis des siècles dans
les petits royaumes en guerre contre les Maures avaient connu plusieurs vagues d’antisémitisme
20. La polémique ethnocide ou génocide dans l’Amérique de la colonisation n’est pas terminée, mais il semble que la
question de l’intentionnalité qui, jusqu’ici, prétendait clore le débat soit abordée sous un autre angle. Voir notamment :
Norman Ajari 2019. La dignité ou la mort. Paris : la Découverte.
Licence Creative Commons 4.0.
324
religieux qui avaient débouché, dans certains cas comme en 1391 à Séville, à des pogroms. Une
première vague de conversion, sous l’effet de la terreur, avait eu lieu à cette époque, suivie par
d’autres au début du XV siècle et, surtout, en 1492 après l’expulsion des Juifs et des Juives décrétée
par les Rois Catholiques. Ce mouvement de conversion des Juifs et des Juives au catholicisme avait
eu deux effets, liés mais différents. D’un côté, le soupçon d’apostasie chez les convers.es ne
cesserait de se répandre et aboutirait à la création de l’Inquisition d’Espagne et aux grands bûchers
de la fin du XV siècle et du début du XVI siècle. D’autre part, se mettrait en place une pratique de
réglementation de l’assimilation des convers-es, pratique discriminatoire visant à écarter de
certaines charges ou postes ceux et celles qui avaient eu, deux, trois ou quatre générations
auparavant, un-e ancêtre juif ou juive ou convers-e dans leur lignée. Peu à peu, en même temps que
se construisait un embryon d’État espagnol, la pratique attachée aux statuts de pureté de sang
s’imposerait ; néanmoins, elle n’eut jamais un statut juridique officiel. Cette pratique se déploie à
partir de la moitié du XV siècle, c’est-à-dire bien avant l’unification des royaumes de Castille et
d’Aragon, bien avant la fin de la « Reconquête », dans diverses instances, conseils, chapitres, ordres
religieux, mairies, ordres militaires ou confréries et, bien sûr, à partir de 1482, dans l’administration
du Saint-Office de l’Inquisition. Elle obligeait tout individu
désireux d’accéder à une charge dans le cadre de ces institutions ou ordres, à justifier de la pureté de
son sang et à remonter ainsi à plusieurs générations.
En quoi consistait donc cette « pureté »?
Rappelons d’abord que le terme français n’est que la traduction du terme limpieza, de l’espagnol
limpio, lequel succéda au mot lindo. Limpio et lindo renvoyaient à l’impeccabilité. Il est important
de le noter dans la mesure où impeccable, c’est ce qui est sans péché. C’est-à-dire que le terme
même employé nous signifie que le terrain où se déploie l’idée de pureté de sang est celui de la
religion. Pour l’historien Max Herring, la pureté de sang se décline sous trois registres : un registre
normatif, un autre social et un autre discursif.
En tant que catégorie normative, la pureté de sang désigne ce qui commença en 1449 à Tolède, lors
de la publication des Sentences Statuts. Jusque-là, il existait déjà des procédés de discrimination
mais pas de réglementation de cette dernière. Les Statuts de Tolède ne sont en fait que la
ratification d’un quasi pogrom qui eut lieu en 1449; le détonateur avait été la levée d’un impôt
destiné à financer les armées du roi et qui avait été prélevé par un collecteur d’impôts convers. Les
habitant-e-s, encouragé-e-s par le maire de la ville et les religieux, se soulevèrent contre la
communauté des convers-es et incendièrent le quartier où ils et elles habitaient avec les Juifs
Licence Creative Commons 4.0.
325
et les Juives. Le maire, pour justifier la révolte, élabora avec son conseil la Sentence Statut qui est la
première ébauche des Statuts de pureté de sang à venir.
Compte tenu de « leurs hérésies, de leurs crimes et de leurs rébellions » contre les vieux chrétiens
de la ville, ils jugèrent les convers indignes
d’exercer une quelconque fonction, privée ou publique, dans la ville de Tolède et sur l’ensemble du
territoire de leur juridiction. (Sicroff, 1985)
Tous et toutes les convers-es perdirent leurs postes ou charges. Par la suite, malgré la réprobation
papale (initiale) les Sentences Statuts se généralisèrent dans divers ordres ou institutions.
En tant que catégorie sociale, la pureté de sang renvoie à la pratique généalogique mentionnée plus
haut qui se mit en place sur l’ensemble du territoire castillan à la fin du XV une administration
complexe, siècle, grâce à la création d’une permettant de vérifier que les arbres généalogiques
présentés par les postulant-e-s à une charge étaient bien sans tache. Il fallait pouvoir le prouver pour
toutes les branches paternelles et maternelles sans que soit précisé jusqu’où il fallait remonter. Les
postulant- e-s devaient fournir les fameuses probanzas ou pruebas, des preuves de leur sang pur.
Cela supposait donc tout un système de témoignages, voyages, consultations de registres
paroissiaux. Lors du déroulement de ces enquêtes s’activait en fait une lutte sourde pour le pouvoir
entre deux catégories de chrétien-ne-s; le moyen d’éliminer un-e concurrent-e pouvant prendre la
forme d’une accusation, de faux témoignages ou de simples insinuations.
En tant que registre discursif, la pureté de sang renvoie à plusieurs réalités : la pureté, le péché, le
péché originel, la crucifixion du Christ et aussi, en dernière instance, à un phénomène qu’on
pourrait dire de « biologisation ». Au XV siècle, l’idée de pureté de l’Ancien testament, pureté
rituelle, avait évolué vers celle de pureté intérieure. Quant au péché, celui qui était commis par une
personne, quelle qu’elle soit, sous l’influence de Thomas d’Aquin, il était devenu ce qui tache de
façon durable. C’est l’idée de la mácula, de la tache. La crucifixion, elle, renvoyait au déicide des
Juifs et des Juives.
Ces trois notions allaient évoluer, s’entrecroiser et donner lieu à des transformations notables :
l’idée du péché durable de Thomas d’Aquin, transférée aux Juifs, aux Juives et aux Maures,
deviendrait autre chose. Si les Chrétien-ne-s pouvaient être absout-e-s de leurs péchés, la tache des
convers-es, elle, ne disparaissait pas. Quand au déicide commis par les Juifs et les Juives, par la
crucifixion, il deviendrait un deuxième péché originel, et comme ce dernier, serait transmissible.
Concrètement, ces élucubrations donneraient, par exemple, naissance aux théorisations d’un
fanatique de la limpieza de sangre comme l’inquisiteur del Corro et son idée de lignée : La qualité
que l’on hérite de ses ancêtres, quand aucun d’eux, aussi loin que l’on puisse remonter, ne descend
Licence Creative Commons 4.0.
326
de Juifs, de Maures, d’hérétiques ou de convers, et lorsqu’ils n’ont été souillés (infectados) par
aucune tache (mácula). La pureté de sang est aussi l’éclat qui résulte d’une lignée dans laquelle tous
les ancêtres ont observé la foi catholique et l’ont transmise à leurs descendants. (Herring, 2011)
Race
Avant de voir comment cette pureté de sang s’exporterait et s’acclimaterait dans l’Amérique
coloniale, considérons maintenant l’autre notion qui interviendrait dans la formation de cette
première idéologie raciste, soit celle de « race ».
Y a-t-il du racisme lorsque le mot race est présent?
« Non », répondent Eduardo Restrepo ou Marisol de la Cadena lorsqu’ils insistent sur la nécessité
de ne pas confondre lexique, concept et pratique sociale. Le mot raza existe sur la péninsule bien
avant la Conquête ou même la fin de la Reconquête. Au départ, il renvoyait à l’élevage et en
particulier à celui des chevaux (en France, par exemple, « race » renvoyait aux races
de chiens et à la chasse). Sur la péninsule, le terme était surtout employé lorsqu’il était question
d’un défaut dans une race équine21. Postérieurement, le mot serait utilisé avec un sens équivalent à
celui de lignée. Il n’aurait jamais, avant le XVIII siècle, une valeur qui le rapprocherait de celle
d’une catégorie des sciences naturelles. Il n’existe donc pas de lien sémantique entre le terme
race aux XVI et XVII siècles et celui employé à partir du XVIII jusqu’au XX siècle.
Vers le milieu du XV siècle, en Castille, ainsi que dans les colonies après la Conquête, la « race »
commença à signifier la même chose que lignage. La race pouvait aussi, dans le jargon des artisan-
e-s, signifier un défaut dans le tissu (Herring, 2011). « Race » et « pureté » vont s’articuler à partir
du XV siècle : le mot race commence à signifier « avoir un défaut dans la lignée » ou avoir une «
lignée tachée », l’idée de lignée étant le commun dénominateur. Ce qui veut dire qu’à partir de ce
moment-là, on n’appartient pas à une race : on a ou on n’a pas de « race ». D’où les expressions du
type « sont purs les Vieux Chrétiens sans race, tache » (Herring, 2011). La race peut être vue
comme un facteur de contamination : « cette race tache beaucoup » (XVII siècle). Le concept de
race prend cette valeur chez les moralistes, les théologien-ne-s, mais aussi dans la vie pratique, par
exemple pour l’établissement d’une généalogie, car c’est là où se vérifie le lien entre pureté et race.
Ce sont de Vieux Chrétiens, purs et au sang pur, sans tache ni race de Maure ou de Juif, d’hérétiques ou de
convers, ni d’une mauvaise souche de nouveaux convertis. (Herring, 2011)
21 Il manque encore des études qui fassent le lien entre le développement de l’élevage, la naissance des
gouvernementalités modernes et le pastoralisme, et l’idéologie raciste.
Licence Creative Commons 4.0.
327
Race et pureté de sang en « Amérique latine »
Dans l’empire des Indes, on retrouve les mêmes valeurs au XVII siècle : le concept de race y
signifie lignage, mais également avoir un défaut, une tache dans le lignage. Ce qui est certain c’est
que la problématique de la pureté de sang va prendre une inflexion particulière sur le continent
avec l’explosion du métissage et l’échec du projet de séparation république d’Indiens/république
d’Espagnols. L’idéologie de la pureté de sang avait voyagé en Amérique dans la mesure où les
convers-es étaient interdit-e-s de voyage. Mais comment expliquer ce transfert, dans l’empire des
Indes, d’une conception qui ne s’appliquerait plus aux convers-es mais aux autochtones
et aux Noir-e-s? Il se pourrait que, dans les deux cas, la question centrale ait été celle de la
conversion. En effet, ce qui s’était produit sur le territoire des royaumes ibériques
se reproduisit sur le continent américain avec les Indien-ne-s et les conversions de masse, forcées ou
non, qui eurent lieu alors. La masse d’indigènes converti-e-s occupa, dans l’imaginaire des
conquérants, la place qui était celle des convers-es sur le territoire castillan ou aragonais. Indien-
ne-s et Afrodescendant-e-s, et plus encore, leurs mélanges, les fameuses « castes », furent perçu-e-s
comme marqués par la tache. Le caractère social de cette mutation est remarquable dans le fait que
les nobles indien-ne-s, eux et elles, n’étaient pas touché-e-s par le processus : ils et elles restaient
pur-e-s. La tache liée à la condition noire, la mácula de la tierra, était la pire (« negrerura »), ce qui
montre la connexion qui s’établit à un moment donné entre couleur, impureté, et statut ou absence
de statut social. Les Noir-e-s étant des esclavagisé-e-s, ils et elles n’avaient même pas un statut, des
hors de la société.
Le grand saut semble se faire au moment où la tache ne tiendrait plus seulement à la qualité ou à la
mémoire mais s’articulerait à la couleur de la peau. Le phénomène serait notable à partir de la fin du
XVII siècle et deviendrait évident tout au long du XVIII siècle. Ce rôle de la couleur est
d’autant plus nouveau que le sens même des couleurs va changer. Pendant longtemps, en Europe, la
couleur de peau avait été dépourvue de connotation positive ou négative. Plus encore, au Moyen
Âge, époque pendant laquelle la théorie des tempéraments ou de la complexion restait en vigueur, la
couleur blanche était plutôt le signe d’un tempérament chétif.
Phénomène nouveau, le blanc commence à signifier ce qui est pur et gai, en opposition au noir qui
renvoie à la tristesse et à l’amoralité. Et tout un complexe de qualités morales ou physiques
commence également à se rattacher à ce système de la couleur :
Licence Creative Commons 4.0.
328
La pureté de sang en Espagne était une question généalogique qui n’avait rien à voir avec la couleur de la peau.
Le passé généalogique n’était visible que par la reconstruction généalogique et dépendait de la renommée et de
l’opinion publique. Cependant, en Amérique, cette catégorie devint quelque chose que l’on pourrait appeler «
somatisation généalogique », dans la mesure où avec la couleur de la peau on cherchait à retracer l’origine et la
qualité d’un individu. Elle devenait ainsi un déterminant possible des relations sociales. Vu sous cet angle, on
peut dire que le corps se manifeste comme objet de discours et objet de représentation, et des signifiés qui
régulent les interactions sociales s’y inscrivent grâce à l’articulation de la couleur de peau, la pureté de sang, et la
race. (Herring, 2011)
Corps et biologie
La biologie qui fonde le racisme moderne présuppose autre chose qu’un changement dans la science
et dans l’épistémè de l’époque; il fallait aussi qu’apparaisse le corps. Et si on peut ne pas être
d’accord avec Quijano quand il parle de racisme « biologique », il faut reconnaître qu’il pointe
néanmoins avec justesse une nouveauté qui a trait au corps et à son rôle dans la discrimination.
C’est l’émergence d’un corps qui n’est pas cette entité stable, souvent le présupposé de bien des
travaux. Ce qui est difficile à démêler, c’est ce qui est proprement américain dans ce phénomène, ce
qui relève de l’histoire du corps en Occident et des interactions :
Le corps doit être compris non seulement comme une réalité biologique, mais aussi comme une
construction et une représentation discursives, des processus qui créent un « corps sémiotique »; le
corps, en bref, est aussi « une expérience culturelle construite par différents types de discours et de
pratiques » (Borja, 2006). Le corps peut être compris comme une variable historique avec de
multiples significations en corrélation avec le temps et l’espace. C’est-à-dire que la corporéité n’est
pas constituée comme une catégorie a-historique, au contraire, elle représente une catégorie
extrêmement dynamique. (Herring, 2008)
Cette sommaire généalogie de la construction de la race en Abya Yala rend compte de la complexité
du sujet et de la difficulté à dire la réalité du racisme. La force de la perspective de Quijano tient à
ce qu’il remit en question les approches consensuelles, qui faisaient du racisme un
phénomène tardif de la modernité. Il sut reconnaître le rôle fondateur du racisme ibérique, basé sur
la pureté de sang, et l’articuler au type de racisme qui prendrait forme en Abya Yala dans le cadre de
la mise au travail forcé de populations vaincues.
Le terme de racisme « biologique » est peut être un anachronisme appliqué à l’Amérique coloniale,
mais il a le grand mérite de faire apparaître l’existence de politiques racistes sur ces territoires
impériaux. L’approche de Quijano remet en question les oppositions qui ont cours et distinguent
Licence Creative Commons 4.0.
329
une période dans laquelle « la question raciale entrait en composition avec d’autres éléments, et un
moment hyper racial qui coïncide avec la nouvelle vague coloniale du XIX siècle » (Schaub, 2015).
Comme l’écrit l’historien comparatiste cité, dans l’histoire de la race, « on ne progresse pas d’un
minimum de présence de la question raciale à ce maximum que réalise le triptyque Lois Jim Crow-
nazisme -apartheid »(idem).
Depuis la fin du Moyen Age et son racisme ibérique, chaque époque élabore diverses formes
politiques de racisme, diverses fictions et légendes létales. Jusqu’à aujourd’hui. Quijano et les
membres du projet Modernité/Colonialité ont identifié à partir de leurs recherches un racisme
latino-américain colonial. Aujourd’hui, les travaux d’historiens comme Max Herring Torres ou
Jean- Frédéric Schaub viennent confirmer leurs analyses .
Références
Borja, Jaime Humberto. 2007. « Cuerpo y mortificación en la hagiografía neograndina ».
Theologica Xaveriana : 233.
https://javeriana.edu.co/theologica/UserFiles/Descarga/ediciones/162/%20Cuerpo%20y
%20mortificacion%20%E2%80%93162.pdf
Garrush, Hamza. 2017. «La modélisation de la prise de pouvoir selon Ibn Khaldoun. Étude du coup
d’état en deux temps de Qadhafi». French Journal For Media Research–n° 7/201.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01423389/document
Herring Torres, Max. 2011. « Color, pureza, raza: la calidad de los sujetos coloniales». Dans La
cuestión colonial, sous la dir. de Heraclio Bonilla: 458. Bogotá : Universidad Nacional de
Colombia.
https://www.academia.edu/619117/
Hering_Torres_Max_S._Color_pureza_raza_la_calidad_de_los_sujetos_coloniales._En_Heraclio_B
onilla_Ed._La_cuesti%C3%B3n_colonial._Universidad_Nacional_de_Colombia_Bogot
%C3%A1_2011_pp._451-470
Hering Torres, Max. 2008. « Introducción: cuerpos anómalos ». Dans Cuerpos Anómalos sous la
dir. de Max Hering Torres: 15. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia.
https://www.academia.edu/196056
Licence Creative Commons 4.0.
330
Pedraza, Zandra. 2014. « 3 Claves para una perspectiva histórica del cuerpo». Dans El cuerpo en
Colombia. Estado del arte cuerpo y subjetividad, sous la dir. de Nina Alejandra Cabra et Manuel
Roberto Escobar. Bogotá : Universidad Central.
https://www.academia.edu/10440506/Tres_claves_para_una_perspectiva_histórica_del_cuerpo
Quijano, Aníbal. 1992. « Raza, etnia, y poder en Mariategui, cuestionesabiertas ». Dans Cuestiones
y horizontes : de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder.
Sous la dir. De Danilo Assis Clímaco. Buenos Aires : CLACSO
http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/59.pdf
Restrepo, Eduardo et Arias, Julio. 2018 [ 2010 ]. « Historiciser la race ». Revue d’Études
Décoloniales.
http://reseaudecolonial.org/2018/10/23/historiciser-la-race-quels-concepts-et-quelle-meth
Schaub, Jean-Frédéric. 2015. Pour une politique de la race. Paris : Vrin :208-277.
Licence Creative Commons 4.0.
331
86. Rébellion (la Grande)
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Cataclysme dans un univers colonial
Au XVIII siècle, une rébellion andine, qui se produisit sur le Haut-plateau péruvien22 et dans le
Haut Pérou, mit en danger l’administration coloniale espagnole. La Grande Rébellion, comme on
l’appela, était en fait la confluence de plusieurs types de révoltes sur des aires assez différenciées,
dont l’une dépendait de la vice-royauté du Pérou et l’autre du tout récent vice-royaume de la Plata.
Elle se produisit dans un contexte de transformation du colonialisme espagnol, lorsque l’État
Bourbon absolutiste s’employa à ponctionner plus amplement ses colonies et à intensifier le
taux d’exploitation des populations. Les modifications ne concernaient pas seulement l’organisation
administrative et fiscale. Le système social colonial, basé sur la séparation république d’Indien-ne-
s/république d’Espagnol-e-s23 avait évolué. Un processus de différentiation socio-économique
important s’était produit sur le Haut-plateau péruvien, qui serait le siège de l’insurrection
tupamariste, avec l’apparition d’un groupe de commerçants riches. Dans la même région, la
noblesse d’origine inca avait affirmé avec panache son identité, entretenant des rapports de quasi
égalité avec la noblesse créole. Par contre, dans l’autre zone de la rébellion, le Haut Pérou,
les fondements de la société coloniale, qui passaient par la domination du chef ethnique traditionnel,
le curaca, chargé de percevoir les impôts, d’organiser le travail forcé et de trancher la question des
terres, avait été remis en question à plusieurs reprises. Les communautés paysannes indigènes
mettaient en cause leur implication dans la ponction toujours plus âpre de l’État colonial, leurs
connivences avec les fonctionnaires locaux. Elles avaient violemment affirmé une volonté
d’autonomie et d’égalité.
On a souvent présenté la Grande Rébellion, dans ses deux phases, comme une réaction au caractère
prédateur de l’administration espagnole du XVIII siècle, en particulier à l’augmentation de l’impôt
indien (la capitation) et à la généralisation du mécanisme du reparto qui permettait au
corregidor, sorte de préfet local, de vendre sous la contrainte aux indigènes des marchandises aux
prix exorbitants. L’historien Alberto Flores Galindo a bien montré que ce schéma mécanique
oppression-réaction n’épuisait pas l’explication de ce qu’il définit comme une révolution.
22 La région du Cuzco et celle du lac Titicaca
23 Cette séparation fut imposée au Pérou à partir de la deuxième moitié du XVI siècle.
Licence Creative Commons 4.0.
332
On divise habituellement la rébellion en deux phases. La première, avec le leadership de Túpac
Amaru II, riche curaca de la région du Cuzco, se déroula entre novembre 1780 et mai 1781, dans la
vice-royauté du Pérou, sur le Haut-plateau andin. Les armées de Tupac Amaru II parcoururent le
Haut- plateau pendant quelques mois, plusieurs régions se soumettant à l’autorité de l’Inca
autoproclamé24. Tupac Amaru II avait un programme qui n’incluait pas seulement les populations
autochtones mais tous les natifs et natives non espagnol-e-s. Ce programme, les runas (paysan-e-s
indien-ne-s) qui le suivirent l’interprétèrent à leur façon, comme on le verra. Cette première
phase assez brève, marquée par l’échec du siège de Cuzco, se termina avec l’arrestation et le
supplice du « traître » Tupac Amaru II.
La deuxième phase continua sur le territoire du Haut Pérou, à partir de 1781, avec le leadership de
Julian Apaza, dit Tupac Katari, mystérieux Indien aymara. Elle serait marquée par l’échec du siège
de la ville de La Paz, métropole incontestée de l’Amérique du sud à cette époque. Officiellement,
il y eut jonction entre les tupamaristes, héritiers et héritières du défuntTupac Amaru et les
tupakataristes qui combattirent aux côtés de Tupac Katari. Mais les alliances s’avèrent compliquées
et les motivations des communautés entrées dans la rébellion, différentes. Le type de stratégie
guerrière fut plus sophistiqué dans la deuxième partie du conflit et l’aspect guerre de castes, ainsi
que la violence sacrificielle, plus prononcé. Les deux mouvements se conclurent sur la même
défaite et la même mise à mort des chef-fe-s, par des autorités coloniales qui, particulièrement
échaudées, réprimèrent avec férocité ce qui restait du mouvement et profitèrent de la
situation pour mettre au pas la noblesse indigène.
Une situation complexe
Cette chronologie empêche de voir la nature polymorphe d’une situation insurrectionnelle complexe
qui était déjà en place dans les deux aires de la rébellion, pour des raisons qui n’étaient pas toujours
les mêmes.
Avant même que Tupac Amaru levât une armée et parcourût le Haut-plateau afin de rallier les villes
et villages à son projet de république de créoles et d’Indien-ne-s, dans le Haut Pérou, les
communautés paysannes luttaient contre la domination de curacas qu’elles estimaient illégitimes,
fédéré-e-s autour de la figure charismatique de leur représentant Tomás Katari. Ce dernier avait
dénoncé, dès 1777, auprès de l’Audience (tribunal) de Potosí, les stratagèmes de l’Espagnol Blas
24Tupac Amaru I est le souverain inca qui résista aux Espagnols lors de la Conquête. Il fut écartelé et décapité.
Licence Creative Commons 4.0.
333
Bernal, lequel avait usurpé la charge de curaca à son détriment. Blas Bernal, grâce à un système de
taxation falsifié, s’enrichissait aux dépends de la monarchie espagnole. Les péripéties liées
à la requête de Katari (emprisonnements répétés, longs et périlleux déplacements dans la vice-
royauté pour obtenir justice, interventions régulières des communautés pour le défendre,
manœuvres, mensonges et duplicité des diverses autorités en place) se terminèrent sur son
assassinat commandité secrètement par le tribunal de sa région de Charcas. Cela provoqua un
soulèvement général des communautés indiennes, lesquelles essayèrent de prendre la ville de
Chuquisaca, la plus importante de la région. Le soulèvement échoua mais il avait eu une ampleur
considérable et fait apparaître des revendications radicales. Katari, que ses deux frères avaient
rejoint rapidement et qui continuèrent le combat après sa disparition, avaient, eux, un programme,
qui n’était pas celui des Tupamaristes : il ne s’agissait pas seulement de libérer les communautés
des dîmes et autres impôts ou de revenir aux temps de l’Inca Roi. Il s’agissait aussi de récupérer
les terres usurpées par les Espagnol-e-s depuis la Conquête. L’un des frères de Tomas Katari disait à
ce sujet :
Le gouvernement devrait changer dans tous les domaines. Il devait être équitable, bienveillant et ne plus reposer
sur les impôts (…). Ils (les membres de communautés) souhaitaient être libérés des taxes, des gabelles, des
achats forcés de marchandise, des dîmes, vivre déchargés du souci que représentaient toutes ces contributions, et
devenir enfin les maîtres de leurs terres et de leur productions, dans la paix et la tranquillité. (Serulnikov, 2010)
Or, ce qui se passait dans le Haut-plateau à peu près au même moment était d’une autre nature25. La
révolte y résultait d’une synergie entre le projet du curaca José Gabriel Condorcanqui, dit Tupac
Amaru II, d’une partie des élites indigènes locales, de certain-e-s créoles et métis-ses (en général
des cadres du mouvement) et d’une population de runas qui acceptait son leadership, ce qui ne
l’empêcha pas de déborder le mouvement. Le pouvoir des curacas, dans la zone de Cuzco, loin
d’avoir été remis en question, était au contraire très fort. Le projet de Tupac Amaru II supposait la
fin des impôts et des droits de douanes intérieurs comme du travail forcé, mais la question de la
terre et de sa récupération n’y jouait pas le même rôle. De même, la structure hiérarchique de la
société n’y était pas remise en question.
On retrouverait cette différence lors de la deuxième phase de la Grande Rébellion, après l’exécution
de Tupac Amaru et l’assassinat de Tomas Katari. Le soulèvement, du moins au début, ne résulta pas
d’un effet de contagion lié au déplacement de ce qui restait des troupes rebelles tupamaristes vers le
25Katari est assassiné en janvier 1781 et le mouvement tupamariste débute deux mois plus tôt.
Licence Creative Commons 4.0.
334
Haut Pérou. Ce fut un mouvement original qui s’inscrivait dans l’histoire de rébellions évoquées
plus haut. Le leader, Juan Apaza dit Tupac Katari, n’était pas un aristocrate, et la rébellion,
qu’annonçait déjà celle qu’avait déclenchée la mort de Tomas Katari, apparaissait plus comme
l’émanation du monde indigène populaire, comme le résultat de la multiplication de soulèvements
locaux.
Utopie andine : deux lectures
Même si l’utopie andine joua un rôle différent dans les deux zones, cela n’empêcha pas le mythe de
fonctionner dans les deux aires de la rébellion. Des deux côtés, la révolte s’appuierait sur un
messianisme, celui du retour de l’Inca. Tupac Amaru II incarnait Tupac Amaru I, le souverain du
XVI siècle qui résista aux Espagnols dans son bastion de Vilcabamaba avant de finir décapité et
écartelé. Ce mythe du retour, véhiculé par l’histoire orale, avait traversé les âges depuis la Conquête
et il circulerait durant toute la colonisation et même après l’Indépendance. Mais il ne jouerait pas le
même rôle dans les deux zones de la rébellion. Si, pour les Tupamaristes, il s’inscrivait dans un
projet de restauration concret, pour les rebelles du Haut Pérou, il était plus un symbole fédérateur
qu’un programme. Et le fait que cette région, l’actuelle Bolivie, fût une région Aymara, conquise
tardivement par l’Empire inca, joua certainement un rôle. L’Empire inca avait été un empire
colonisateur et ses armées avaient imposé la domination à de nombreux peuples andins, dont les
Aymaras du Haut Pérou. Lorsque les troupes tupamaristes, après l’arrestation et le supplice de leur
leader, arrivèrent dans le Haut Pérou et campèrent sur les hauteurs de La Paz, face aux troupes de
Tupac Katari qui préparaient le siège de la ville, elles eurent du mal à faire entendre qu’elles
assumeraient le commandement des opérations. Le mythe de l’Inca fonctionnait très bien à distance,
mais les Indien-ne-s du Haut Pérou n’avaient pas envie de s’inféoder à d’autres groupes. Les
Tupamaristes, en la personne de Diego Tupac Amaru et Andrés Tupac Amaru, cousin et neveu de
l’Inca décapité, allèrent jusqu’à faire arrêter Tupac Katari. Mais ils comprirent vite qu’il était l’âme
de la rébellion et durent le relâcher. La tension entre les deux groupes demeura jusqu’à la fin,
particulièrement lorsque l’échec du siège de La Paz amena les Tupamaristes à négocier séparément
avec les autorités coloniales, ce que ne fit pas Tupac Katari.
Les noms de guerre des deux chefs rebelles rendent compte également de deux positions
différentes. José Gabriel Condorcanqui avait passé des années à essayer d’obtenir la reconnaissance
de sa filiation avec la famille impériale inca. Tupac Katari, lui, venait du peuple, ce qui ne
l’empêcha pas de se proclamer vice-roi. C’était un homme dont le trajet reste mystérieux,
Licence Creative Commons 4.0.
335
qui fit irruption avec splendeur dans le conflit et disparut avec lui. Il parlait aymara et disait être
marchand de coca et de tissu, comme les nombreux et nombreuses marchand-e-s indien-ne-s qui
circulaient entre les vallées et les centres urbains Et s’il changea son nom pour Tupac Katari (katari
voulant dire en aymara serpent, comme amaru, en quechua) ce fut plus par ralliement à un symbole
qu’à la personne du souverain assassiné. C’était moins le rappel d’une hiérarchie et d’une légitimité
que l’inscription dans une histoire de révoltes; ce à quoi la moderne insurrection zapatiste fait écho.
L’insurrection tupamariste fut-elle plutôt un projet anticolonial conservateur qui visait le retour à
l’ancien État andin? Doit-on plutôt voir la décolonialité du côté tupakariste, de ces communautés du
Haut Pérou qui, sur des bases égalitaires, voulurent instaurer un autre type de justice, entre autres
dans la répartition des terres? Répondre à ces questions impliquent de différencier les programmes
des dirigeant-e-s et la marche réelle des opérations, comme de comprendre le rôle joué par la
question de la race dans le mouvement.
Le contenu du programme de Tupac Amaru ne fait pas l’unanimité parmi les historien-ne-s. Ces
derniers et dernières s’accordent néanmoins sur certains points. Tupac Amaru voulait supprimer la
charge de corregidor, relai du pouvoir royal, le reparto, la mita, ce travail obligatoire que les Indien-
ne devaient fournir dans les mines ou les haciendas. Il voulait également que soit nommé dans
chaque province un maire indien et qu’une Real Audiencia26 soit créée à Cuzco. Lors de son
avancée avec ses troupes, Tupac Amaru détruisit parfois les obrajes, ces ateliers textiles qui
dépendaient des haciendas et qui étaient en fait des manufactures-bagnes. Il aurait proclamé qu’il
voulait les détruire. Il décréta également l’abolition de l’esclavage des Noir-e-s. Mais ce riche
commerçant, qui possédait une mine, ne remettait pas en question la structure hiérarchique de la
société ni le rôle des curacas.
Pas de programme agraire dans son projet. Était-il séparatiste? Voulait-il maintenir la soumission du
Pérou à la Couronne d’Espagne? Il semble en tout cas certain que dans son plan, la vice-royauté du
Pérou n’était plus gouvernée par un Espagnol mais un Inca.
Pour l’historien Alberto Flores Galindo, la Grande Rébellion ne fut pas seulement une révolte mais
un programme alternatif à la royauté des Espagnol-e-s. La présence dans le pays d’une importante
élite indienne avait rendu possible un tel événement. Un homme comme Tupac Amaru, qui parlait
espagnol, quechua et latin, qui connaissait la culture européenne comme la culture andine et qui
26L’Audiencia est une des pièces majeures du dispositif colonial. Cour de justice, elle était présidée par le vice-roi ou le
gouverneur de la région et les juges (oídores). Son rôle ne se bornait pas à rendre la justice, elle intervenait également
dans la police et l’administration et pouvait même assumer le pouvoir en cas de vacance du vice roi ou
du gouverneur
Licence Creative Commons 4.0.
336
avait accumulé une fortune importante, avait conscience de sa différence et de sa qualité, autant que
de celle de son monde. Selon l’historien péruvien, l’équivalence caste/classe, sur laquelle
s’était fondée la partition coloniale république d’Indien-ne-s/république d’Espagnol-e-s ne
fonctionnait plus. Il y avait eu dans la société des vaincu- e-s une importante différentiation. Nous
aurions donc affaire à une très moderne question de gestion des populations, le problème étant plus
une nouvelle répartition des taches et des revenus dans un royaume où les Espagnol-e-s étaient
perçu-e-s comme illégitimes. Le leader, du moins dans la première phase de la révolution, se situait
dans le sillage de Guamán Poma de Ayala avec sa Nueva Córonica y Buen Gobierno. Il proposait lui
aussi un bon gouvernement et une nouvelle chronique de l’empire, dans laquelle les Indien-ne-s
renversaient l’ordre des choses. Guamán Poma de Ayala écrivait au roi que les Indien-ne-s étaient
de meilleur-e-s chrétien-ne-s que les Espagnol-e-s. Tupac Amaru, qui était un bon croyant, mettait
en acte cette perspective un siècle plus tard. Son projet visait une république de locaux et locales.
Si l’on considère maintenant le mouvement non plus à partir de la perspective de son dirigeant mais
de celles des acteurs et actrices dans leur ensemble, on constate que, sur le terrain, Tupac Amaru fut
débordé et que son projet fut interprété d’une autre façon par les populations. Si le but du curaca de
Tungasuca était de rétablir un empire défunt, celui des Runas était d’obtenir une plus grande égalité,
ce en quoi la pratique des paysan-ne-s du Haut-plateau rejoignit celle des paysan-ne-s du Haut
Pérou. Le mythe andin, l’utopie andine de la résurrection de l’Inca, relia efficacement les diverses
classes sociales qui rallièrent le projet, mais il fut interprété de diverses manières par les divers
acteurs et actrices. Changement de souveraineté pour les un-e-s, renversement des hiérarchies pour
les autres.
La question de la race
La question de la race, au centre de cette révolution, est un bon exemple des contradictions du
mouvement comme de sa profondeur. Tupac Amaru voulait fonder un État qui engloberait tous les
natifs et toutes les natives : créoles, Blanc-he-s, métis-ses, Indien-ne-s, Noir-e-s et Castes27 . C’est
pour cela que l’on a souvent évoqué à son sujet un proto-nationalisme. Le commandement du
27On appelait « castes » les diverses combinaisons de métissage entre « Espagnols », « Indiens » et « Noirs » . Ce
processus de métissage, développé dés le XVII siècle, avait fait échouer le projet de séparation entre Espagnols et «
Indiens » qui avait été celui de la Couronne espagnole : république d’ « Indiens », d’un côté, et république d’
« Espagnols », de l’autre. Le terme est connu pour son emploi dans le cadre de la « peinture de castes « qui se
généralisa au XVIII siècle au Mexique et au Pérou. Il s’agit de classifications établies en fonction du degré de «
blanchité » qui prennent la forme de planches divisées en 16 cases le plus souvent. Comme dit dans une autre rubrique,
Licence Creative Commons 4.0.
337
mouvement était socialement hétérogène. Parmi les personnes jugées pour avoir dirigé la rébellion,
O’Phelan Godoy a dénombré 19 Espagnol-e-s ou créoles, 29 métis-ses, 17 Indien-ne-s, quatre Noir-
e-s ou mulâtres-ses et trois individus d’origine ethnique non déclarée. Ces personnes venaient de
plus d’une dizaine de provinces différentes du Pérou et quelques-un-e-s du Chili, du Río de la Plata
et de l’Espagne. La direction du mouvement revenait à une classe moyenne coloniale, un groupe
qui, sans être pauvre, se trouvait exclu des cercles économiques et politiques dominants.
Mais les troupes, le gros des forces, étaient composées d’Indien-ne-s. Si originellement seul-e-s les
Espagnol-e-s, les chapetones, devaient être expulsé-e-s ou éliminé-e-s, avec le temps, pour les
troupes indiennes, définir l’ennemi s’avéra plus compliqué. Qu’entendait-on par Indien-ne? Par
Espagnol-e? Parfois, être Espagnol-e, c’était avoir la peau blanche, d’autrefois, c’était s’habiller à
l’espagnole. Ainsi, il arriva que des créoles ou des métis-ses fussent massacré-e-s par les rebelles. Et
la violence avec laquelle les populations furent parfois exterminées, femmes, vieillards et enfants
compris, la décision de ne pas donner de sépulture aux cadavres, le démembrement dont ils et elles
furent victimes, les viols de cadavres rendent compte d’un acharnement que Flores Galindo
explique par un mythe sacrificiel : le Pachakuti, ce passage à une autre ère ne pourrait se faire que
dans la douleur.
Les tergiversations des acteurs et actrices montrent que la question de la race, peu à peu, innerva le
combat. Elle prenait forme dans les actes, dans la violence de la guerre, comme couleur de peau,
parfois aussi comme civilisation. Le renversement qui se produisait était celui de l’équation
coloniale. Ce n’était pas seulement le fait que les Blanc-he-s pussent être massacré-e-s comme des
sous-êtres, sort qui avait été celui des Indien-ne-s lors de la Conquête; pas seulement que les
rebelles leur imposassent de s’incliner devant un pouvoir autochtone. Ce que les Espagnol-e-s
avaient posé comme un binôme indissociable, l’union de la religion et de la civilisation, subissait
une transformation qu’ils et elles n’auraient pu prévoir: les Indien-ne-s s’étaient approprié-e-s le
binôme religion-civilisation, mais la civilisation avait changé, désormais, c’était celle des vaincu-e-
s, et les Barbares, dans ce renversement, c’était les Blanc-he-s. Ils et elles étaient devenu-e-s des «
monstres », des « démons », attributs qui, lors de la guerre de Conquête, concernaient
exclusivement les autochtones. Ces pishtacos (mangeurs de graisse humaine) ne méritaient pas de
sépulture puisqu’ils et elles n’étaient pas des êtres humains. Faut-il voir la hargne des Indien-ne-s
contre les Blanc-he-s tous et toutes confondu-e-s comme le signe d’un débordement dans la fureur
il est difficile de savoir dans quelle mesure ces peintures de caste rendaient compte de pratiques et représentations
généralisées dans l’ensemble du monde colonial.
Licence Creative Commons 4.0.
338
révolutionnaire? Les massacres ne s’inscrivent-ils pas plutôt dans une séquence logique? Ils étaient
inévitables, côté tupamariste comme côté tupakariste. En effet, les créoles ayant de terres ne
pouvaient qu’entrer en conflit avec les communautés qui, dans le passé, avaient possédé ces
territoires. Et on ne pouvait attendre de ce groupe, par ailleurs attaché à sa blanchité, qu’il renonça à
ce qu’il considérait comme son bien légitime. Les Indien-ne-s qui massacrèrent sans distinction les
Blanc-he-s espagnol-e-s et les Blanc-he-s créoles avaient probablement une conscience aiguë de
cette situation. Il ne pouvait y avoir de négociation : les un-e-s ou les autres
devaient l’emporter.
Si l’on considère maintenant ce qui se passa dans l’autre zone de l’insurrection, la continuité
leader/base populaire y est manifeste. Au XVIII siècle, l’administration coloniale avait souvent
cherché à remplacer les curacas, chefs « ethniques » traditionnels qui prélevaient la capitation pour
les autorités coloniales et organisaient le reparto, par des non-Indien-ne-s ou d’autres plus dociles,
plus en phase avec le corregidor. Cela avait entraîné de nombreuses révoltes, comme celle, citée
plus haut, de Tomás Katari. Ces révoltes rendaient compte d’une logique de la négociation
différente de celle qui serait mise en acte par Tupac Amaru. Dans le Haut Pérou, des communautés
luttaient pour se faire une place à l’intérieur du système de justice colonial et de fait, y arrivaient
parfois. Julián Apaza s’appuyait sur des communautés indigènes conscientes de leurs prérogatives,
qui voulaient mettre en place une organisation plus égalitaire. Elles refusaient les mauvais
traitements que leur infligeaient parfois leurs élites et voulaient, par exemple, choisir elles-mêmes
leurs représentants dans leur propre groupe social. Le rapport entre curacas et communautés était
bien différent dans les deux zones de la rébellion; la légitimité d’un cacique de Cuzco et celle d’un
cacique du Titicaca n’étaient pas comparables.
Les nobles indiens étaient le sommet de la société indigène. La barrière juridique qui les séparait du Pérou créole
s’avéra plus poreuse sur le plan personnel et familial que la frontière sociale érigée entre eux et les Indiens
communs. En même temps, l’autorité de ces chefs traditionnels ne semblait pas remise en question par les
villageois. À en juger par la faible fréquence des protestations collectives contre eux au XVIII siècle, leur
légitimité ici était beaucoup plus forte qu’au sud du Titicaca, où les chefs ethniques (qu’il s’agisse de la noblesse
de sang ou d’« intrus ») étaient au cœur même de l’histoire du pays. (Serulnikov, 2010)
Cela explique que la violence ait été plus radicale. Quoiqu’il en ait été, des deux côtés, la structure
coloniale fut attaquée dans ses fondements. La violence même des insurgé-e-s apparaît comme
inévitable et nécessaire. Au-delà des projets des leaders, la Grande Rébellion attaqua les bases du
Licence Creative Commons 4.0.
339
système vaincu-e/vainqueur-e, mais surtout elle mit en scène des classes populaires indiennes qui
bouleversèrent les hiérarchies. La terre et la race furent au centre du conflit car l’appropriation de la
terre et la politique de la race avaient été les axes de la colonisation.
À la lumière des luttes actuelles dans la zone andine, où de nombreux mouvements sont organisés
autour de la communalité, de l’autonomie et du territoire, la Grande Rébellion apparaît comme un
mouvement d’une actualité certaine.
Références
Flores Galindo, Alberto. 1987. Buscando un Inca. Lima : Instituto de apoyo agrario.
Serulnikov, Sergio. 2010. Revolución en los Andes. La era de Túpac Amaru. Buenos Aires :
Editorial Sudamericana: 101-57.
https://www.academia.edu/26674373/Revoluci%C3%B3n_en_los_Andes._La_era_de_T
%C3%BApac_Amaru_Buenos_Aires_Editorial_Sudamericana_2010_._Libro_completo
P. Walker, Charles. 2014. « La rébellion de Túpac Amaru : proto-nationalisme et revivalisme inca.
Deuxième partie ». Alterinfos América latina
http://www.alterinfos.org/spip.php?article6424
Licence Creative Commons 4.0.
340
87. Rencontre des Peuples Noirs.
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
La « Rencontre des Peuples Noirs » est une manifestation organiséeannuellement depuis les années
1990 au Mexique par l’association afro- mexicaine, México Negro. Elle rassemble une bonne partie
des représentant-e-s d’association et militant-e-s afro-mexicain-e-s, de certaines communautés afro-
mexicaines, des intellectuel-le-s, des chercheurs, chercheuses et militant-e-s étrangers et étrangères.
Le but de ce rassemblement est de valoriser les pratiques culturelles différenciées afro- mexicaines,
telles que la Danse de la Artesa, la Danse de la Tortue, les arts culinaires, la musique, et de
construire et de revendiquer un discours politique représentatif des communautés afro-mexicaines.
La « Rencontre des Peuples Noirs » est à considérer comme un espace collaboratif, politique,
polémique relevant de la prise en charge par les communautés afro- mexicains de leur réalité. Tel
que déjà indiqué dans plusieurs publications, les Afro-mexicain-e-s sont construit-e-s comme des «
objets » de connaissance dans différentes littératures scientifiques. Or, la « Rencontre des Peuples
Noirs » vise à rétablir la subjectivité afro-mexicaine. Cette dernière est éminemment polémique
puisqu’elle a été, depuis très longtemps, rendue « invisible » soit par un métissage orienté et
hiérarchique, soit par un déni de son existence; c’est-à-dire deux formes de colonialité du pouvoir
(racialisation). Ce caractère polémique se donne à voir dans le jugement ou l’interprétation d’une
certaine branche de l’anthropologie mexicaine qui fustige les implications des mouvements noirs
étrangers.
Références
Mvengou Cruzmerino, Paul. 2015. Entre Afriques et Amériques Latines. Citoyennetés, Mémoires
noires et Mondialisation. Thèse de Doctorat en Anthropologie, Université Lumière Lyon 2.
Vinson, Ben III et Vaughn, Bobby. (2004). Afroméxico. El pulso de la población negra en México:
una historia recordada, olvidada y vuelta a recordar. México.D.F: Fondo de Cultura Económica.
Voir à ce sujet:
https://www.youtube.com/watch?v=KI1PS3YSfcU;
https://www.youtube.com/watch?v=YTdGVHTM2KY
Licence Creative Commons 4.0.
341
Licence Creative Commons 4.0.
342
88. Reinaga, Fausto
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Fausto Reinaga, de son vrai nom José Félix Reinaga, est un penseur d’origine aymara qui est né au
tout début du XX siècle en Bolivie. Cet homme, qui fut longtemps marxiste, fonda en 1962 le Parti
des Indiens Aymara et Quechua, amorçant dans ces années-là un virage théorique. Il s’éloigna alors
de la théorie des classes pour s’intéresser à une autre forme de critique de la modernité basée sur
l’idée d’un Poder Indio, d’une nation indienne. C’est une perspective qu’il faut situer dans le
contexte de la décolonisation des années 1960-1970 et aussi du Black Power américain.
Son œuvre, longtemps confidentielle, annonçait l’émergence des mouvements indiens des années
1980-1990. Liée à l’indianisme et au katarisme, elle trouverait, au XXI siècle, avec le
gouvernement d’Evo Morales, la reconnaissance qu’elle n’avait pas eu jusque-là. L’indianisme est
cette philosophie de la libération produite par un sujet indien, quant au katarisme, il s’agit d’un
mouvement aux composantes à la fois politiques, syndicales et intellectuelles, qui opère une
relecture de l’histoire à partir de l’identité indigène.
Le programme de Fausto Reinaga est contenu dans le livre qu’il publia en 1970, La revolución
india. À l’époque où le livre est écrit, l’État bolivien sort d’une phase de gouvernement populiste,
durant laquelle les revendications des Indien-ne-s relatives à la propriété de la terre ont été prises en
compte mais sans que la spécificité de ce groupe ait été reconnue : ils et elles sont resté-e-s des
paysan-ne-s, « assimilé-e-s » aux métis-se-s. Reinaga se démarque de cette approche qui est encore
celle de la gauche latino-américaine. Il refuse de réduire l’« Indien-ne » à une travailleuse ou un
travailleur qu’il faut intégrer à la nation. Inversant la problématique, il questionne le bien fondé de
la nation bolivienne. À une époque où l’existence d’États plurinationaux était encore inconcevable,
Reinaga élabore une approche décoloniale de la nation, cette pièce essentielle du dispositif de
savoir pouvoir moderne colonial.
La revolución india est une virulente dénonciation de la domination des Indien-ne-s par les Blanc-
he-s, puis par les métis-se-s depuis la Conquête de l’Amérique. Cette dénonciation se démarque des
approches qui prévalaient alors : celle des populistes au pouvoir en Bolivie entre 1952 et 1964 et
celle des Indigénistes. Dans le deuxième quart du XX siècle, les élites métisses des sociétés latino-
américaines avaient remis en cause la discrimination subie par les Indien-ne-s. Ces élites s’étaient
érigées en protectrices des Indien-ne-s et elles avaient élaboré un discours hégémonique à leur sujet.
Ce discours inspirerait postérieurement les programmes d’assimilation qu’élaboreraient les États
nationaux équatoriens, boliviens ou péruviens, dans le sillage des centres indigénistes. Après avoir
Licence Creative Commons 4.0.
343
été, tout au long du XIX siècle, les exclu-e-s ou les invisibles de la nation, les Indien-ne-s
devenaient ceux et celles qu’il fallait assimiler, mais cela supposait de les « civiliser », entre autres,
à l’aide de campagnes d’alphabétisation. Il va de soi que les principaux et les principales concerné-
e-s n’étaient pas consulté-e-s ni associé-e-s à ces projets et que la citoyenneté que l’on commençait
à leur faire miroiter appartenait à un futur toujours plus lointain. La littérature à laquelle a donné
lieu ce mouvement, en Amérique du sud ou en Amérique centrale, a puissamment contribué à
diffuser l’image de la créature sans défense, victime des Blanc-he-s, qu’il fallait aider et éduquer.
Quant aux populistes, s’ils et elles avaient réalisé partiellement la réforme agraire réclamée par les «
Indien-ne-s » et aboli le servage, pongueaje, qui existait encore en 1952, avec le syndicalisme
obligatoire imposé à tous et toutes les « camarades paysan-ne-s » dans le cadre de la triade État-
parti révolutionnaire-syndicat, ils et elles instauraient une relation de type paternaliste et clientéliste
entre ce groupe et l’État. Leur politique reposait sur l’affirmation du métissage, pas le métissage
idéal auquel avaient rêvé les élites blanches libérales du XIX siècle, pas ce métissage qui aurait
blanchi le peuple, mais celui des métis-se-s réel-le-s. Il n’ y avait pas de place pour une spécificité
indienne.
Reinaga rompt avec cette approche qui vise l’intégration de l’Indien-ne à la nation bolivienne. Il
propose de remplacer une nation bolivienne privée d’un fondement populaire authentique et ne
représentant en fait que les intérêts d’une oligarchie blanche, par la nation authentique, la nation
indienne. Pour lui, on peut parler d’une nation indienne parce qu’il existe un passé, celui du
Tawantinsuyu, l’Empire inca, modèle d’équilibre social dont l’économie aurait été quasiment
socialiste. Il fut détruit par la Conquête et la colonisation, mais on peut le reconstruire; il peut
revivre parce que certaines de ses structures n’ont jamais disparu. Selon lui, la vraie nation est la
nation indienne parce que les Indien-ne-s sont majoritaires dans un pays ou les Blanc-he-s et les
métis-ses sont très minoritaires; parce que les travailleurs et travailleuses, ceux et celles qui font
vivre le pays, ce sont eux, ce sont elles.
Il n’y a pas de nation bolivienne ou alors, une nation « fictive », un terme qui reviendra souvent
dans les années 1990 chez les dirigeant-e-s indien-ne-s de Bolivie et d’ailleurs. Parler d’une nation
bolivienne, c’est souscrire au mythe du métissage, ce mythe que l’on retrouve sous des formes
diverses dans toutes les nations « latino-américaines » et qui a en fait organisé l’expulsion
symbolique et juridique des indigènes.
La présentation de ce que Fausto Reinaga appelle le cholaje, terme qui vient du mot cholo–a,
appellation méprisante pour l’Indien-ne métissé-e et « blanchi.e » est particulièrement violente : le
cholaje est un conglomérat de personnes incompétentes, vendues aux intérêts nord-américains,
Licence Creative Commons 4.0.
344
corrompues et dépourvues de toute éthique. Ainsi, seul-e-s les Indien-ne-s, parce qu’ils et elles ont
gardé une spiritualité et un sens moral qui caractérisaient la période pré-coloniale, peuvent être les
citoyen-ne-s d’un État national. Tout au long de son livre, Reinaga ne cessera pas d’opposer
la morale indienne traditionnelle (basée sur le : « tu ne mentiras pas; tu ne voleras pas; tu ne resteras
pas sans rien faire ») à l’absence de morale des Blanc-he-s et des métis-ses, de même qu’il opposera
une race indienne à celle des Blanc-he-s et des métis-se-s.
Pour exposer son projet, Fausto Reinaga élabore une critique de la société, du gouvernement et de
l’État bolivien. Il reconstruit aussi l’histoire de la nation depuis la Conquête, en faisant d’elle un
affrontement permanent entre les deux races. Il attache une importance particulière aux épisodes de
la résistance indienne aux pouvoirs coloniaux, puis républicains et consacre une partie conséquente
de La révolution indienne à ce qu’il appelle « l’épopée » indienne. Dans la deuxième partie du livre,
ou plutôt du manifeste, il reprend la question des révoltes. Nous sommes face au type de texte que
certain-e-s taxeraient immédiatement d’essentialiste : imaginer le retour à un monde disparu, celui
de l’ancien empire inca démantelé par la Conquête et la colonisation, témoignerait d’une vision
naïve, d’une négation de l’historicité des formations sociales et de la constante hybridité qui les
travaille. Certes, dans ce livre, la haine du pouvoir blanc est manifeste, le mépris des métis-se-s y
transpire, mais cette haine est le produit logique d’une histoire de spoliation, d’exclusion et de
discrimination. La violence que l’on reproche souvent aux écrits de Fausto Reinaga, parce qu’il
prône la guerre des races, est une réponse aux diverses formes de violence à l’œuvre depuis la
Conquête. Pour lui, il y a donc deux nations en Bolivie : la nation chola, métisse, ficticia, « fictive
», et la nation indienne, real, la vraie. La nation indienne est réelle parce qu’elle s’enracine dans une
histoire.
Avant même que les peuples européens ne sortent de leur chrysalide proto- nationale, la nation
existait déjà dans les Andes et cette nation c’était le Tawantinsuyo, l’empire des quatre cotés.
Antériorité de la nation clandestine, donc. La nation chola, elle, est fictive parce qu’elle correspond
seulement à la tentative de réaliser une greffe impossible : importer une conception occidentale dans
un pays dont l’histoire n’a rien à voir avec celle des nations européennes. Le modèle européen de
nation ne fonctionne que dans un cadre géopolitique déterminé. C’est pour cela que « la nation qui a
pris naissance en Occident n’est pas une catégorie universelle », dit Reinaga. On ne peut pas
appliquer le schéma européen à l’histoire de l’Asie, de l’Afrique ou de l’Amérique. Contrairement à
ce que pensent les Européen-ne-s, leur modèle n’est pas universel, il n’est pas exportable. Il y a là
une première dénonciation des limites de l’universalisme politique occidental qui sera remise en
question de façon systématique par les intellectuels décoloniaux et les intellectuelles décoloniales,
Licence Creative Commons 4.0.
345
mais beaucoup plus tard. De même, chez lui, la race prend le rôle essentiel qu’elle aura chez Aníbal
Quijano. La race ne doit pas se comprendre au sens biologique ou culturel. Quand Fausto Reinaga
parle de la « race » indienne, il faut se rappeler qu’il disait : « No soy indio, carajo, ustedes han
hecho de mi un indio ». (Je ne suis pas indien, bordel, c’est vous qui avez fait de moi un Indien).
La « race indienne » est le résultat d’un processus d’identité assignée avec laquelle les autochtones
ont du négocier depuis la Conquête, parfois en l’acceptant, parfois en la contournant, parfois en la
revendiquant. Processus qui s’est déroulé sur un continent où le projet des conquérant-e-s passait
par la séparation des « races » : république d’Espagnol-e-s d’un côté, république d’Indien-ne-s de
l’autre. Il y a eu des va-et-vient entre ce type particulier de formation de subjectivité qui s’est
produit en « Amérique latine » et qui a abouti à ce que l’on nomme l’Indien-ne, processus qui s’est
produit comme domination et acculturation, et l’élaboration qu’on fait, de leur côté, les autochtones
et qui a débouché, entre autres, à la fin du XX siècle, sur les mouvements dits identitaires.
La guerre des races est donc cette histoire qui a commencé avec l’irruption européenne en Abya
Yala, nom indigène du continent. Elle est celle de la nation clandestine avec la nation dominante,
qui est minoritaire, incompétente et illégitime. Et elle s’exprime dans des histoires clandestines.
À l’histoire nationale bolivienne, dont le sujet est un peuple métis abstrait, Reinaga oppose
l’histoire de la nation indienne. La nation indienne n’est pas à faire, elle est déjà là, sous la nation
fictive qui la recouvre, comme on peut retrouver le temple inca sous l’église chrétienne. Ou comme
on pouvait retrouver, sous la culture chrétienne, le culte clandestin des Huacas (lieu de culte
pouvant prendre diverses formes), ces manifestations de l’énergie cosmique que vénéraient les
peuples andins, et qui ont précédé historiquement le culte du Soleil imposé par l’Inca. Cette image
de ce qui a été recouvert et peut réapparaître correspond à une remise en question de l’idée de «
Découverte » qui s’affirmera particulièrement dans le dernier quart du XX siècle, surtout après la
date anniversaire de 1992, avec l’approche décoloniale en particulier. Cette image de la nation
cachée permet de faire place à un imaginaire de ce qui a été occulté, invisibilisé, cette vision des
vaincu-e-s dont parlait déjà Nathan Watchel en 1971. L’intuition de Fausto Reinaga prendra forme,
beaucoup plus tard, en 1989, avec le beau film du Bolivien Javier Sanjinés, La nación clandestina.
Dans ce film, le héros, Sebastián Mamani, un indigène qui a adopté les valeurs du cholaje et trahi sa
communauté, finit par mourir pour cette dernière en reprenant une danse sacrificielle, le Jacha Tata
Danzante. Ce faisant, il répète en fait le trajet de ces nombreux et nombreuses Indien-ne-s du XVI
siècle, qui, après la grande période d’extirpation des idolâtries, reprirent leur culte des huacas. Ils et
elles attendaient de ces dernières qu’elles en finissent avec les Espagnol-e-s et répandaient la
nouvelle de leur retour grâce à des danses rituelles. Le Taqui Ongoy, qui mettait sur un même plan
Licence Creative Commons 4.0.
346
le culte des Huacas du Soleil et de la Lune et les rites relégués à un second plan avec la domination
inca, n’était pas un retour du même. Il s’agissait déjà une alternative originale à la domination des
Incas puis des Espagnol-e-s.
Reinaga parle de reconstruire le Tawantinsuyo, ce qui est surprenant pour un Bolivien, dans la
mesure où, historiquement, le projet étatique lié au Twantinsuyo a moins mobilisé les indigènes que
la demande d’égalité et de terres. Cela nous renvoie à l’utopie andine. L’utopie andine, comme
l’expliquait l’historien péruvien Alberto Flores Galindo, dans le livre Buscando un Inca, fut une des
réponses des vaincu-e-s à la Conquête. Le moment fondateur du mythe, c’est la décapitation du
premier Inca à s’opposer aux Espagnol-e-s. Ce fut le début de ce que l’on appelle le mythe de
l’Inkarri, terme qui est une contraction de Inca rey, Inca roi. Les Espagnols auraient
enterré secrètement la tête de l’Inca pour éviter la propagation d’un culte mais l’idée se répandit
qu’un jour où l’autre, miraculeusement épargnée par la putréfaction, la tête retrouverait son corps.
Ces diverses versions du mythe, toujours orales, annonçaient que ce serait alors le retour de
Tawantinsuyo et la fin de la domination espagnole. De l’utopie andine, qui connut son acmé au
XVIII siècle, avec la révolution de Tupac Amaru II, Alberto Flores Galindo et Manuel Burga disent
qu’elle est une véritable création historique, une reconstruction de l’histoire comme mémoire
commune, dans un effort qui suppose précisément une modification de la façon de penser
autochtone suite à l’événement historique de la Destruction et de la Défaite. Le Bolivien Blithz
Lozada pense qu’il s’agit d’une reproduction du passé dans la mémoire collective des sociétés
andines qui a pour effet de la transformer en alternative au présent. Mais ce qui a lieu,
c’est l’appropriation de ce qui n’avait pas d’existence historique ou existait comme mémoire
officielle, mémoire du temps passé. La mémoire construit le temps de l’expérience; elle peut être
mobilisée pour l’action, le moment venu, comme le prouvèrent les grandes rébellions des XVIII et
XIX siècles. Fausto Reinaga ne veut pas réduire cette utopie à une séquence historique, qui
correspondrait seulement à la phase coloniale, révolue de la Bolivie. En cela, il a été visionnaire
puisque ses idées ont été reprises au XXI siècle par le premier président « indien » de Bolivie.
Reinaga ne veut pas d’un discours homogénéisateur qui prétende faire de tous et toutes les
Bolivien-ne-s des citoyen-ne-s et efface l’histoire de la violence. Pas seulement parce que ce
discours ne tient pas ce qu’il promet; parce qu’il s’inscrit dans une temporalité qui est celle de l’État
national et de son histoire officielle; parce qu’il s’appuie sur le discours de la science.
Avec Reiinaga, on est très loin de la nation en marche vers un futur toujours meilleur, la nation
symbole de progrès. Parce qu’il se tourne vers un passé qu’il veut faire revivre, le penseur échappe
à ce discours du progrès qui est aussi celui du racisme et que les nations modernes, malgré la crise
Licence Creative Commons 4.0.
347
qu’elles n’en finissent pas de traverser, n’ont pas abandonné. Paradoxalement, celui qui emploie le
terme de race, usage trop systématiquement attribué aujourd’hui à une façon de penser raciste, se
tient en marge de ce racisme fondateur des États modernes. Historiquement, en même temps
qu’apparaissait la nation, émergeait le discours qui transférerait à l’intérieur des limites de l’État
l’idée de la guerre : avec l’idée de l’ennemi intérieur, de celui qui menace la cohésion interne de la
nation, qu’il s’agisse du fou, du malade, du criminel, de l’étranger ou de l’immigré. Mais si Fausto
Reinaga échappe à ce racisme, c’est parce qu’il se tient, en fait, à côté de la nation. Il suffit de lire
son programme jusqu’au bout : d’abord construire le Collasuyo (équivalent de la Bolivie et du nord
de l’Argentine actuelle), puis passer au Tawwantinsuyo (toute la zone andine de l’Amérique) et
finalement à l’Amérique « indienne ». « Indiens d’Amérique, unissez vous! », écrit-il à la fin du
livre. En fait, la nation de Reinaga, c’est l’Amérique de Bolívar, sans le racisme.
C’est un continent, ce n’est plus une nation.
Références
Alvizuri, Verushka. 2012. Le savant, le militant et l’aymara. Histoire d’une construction identitaire
en Bolivie (1952-2006). Paris : Armand Colin,
La perspective n’a rien de décolonial mais les lecteurs et lectrices y trouveront des informations
utiles.
Bourguignon Rougier, Claude. 2016. « Nation, utopie andine et extériorité ». Intervention dans le
cadre du colloque d’EuroPhilosophie à Toulouse.
https://www.academia.edu/28071781/Nation_utopie_andine_et_exteriorit%C3%A9
Burga, Manuel. 2005 [1988]. Nacimiento de una utopia. Muerte y resurrección de los incas. Lima :
Fondo editorial.
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/2006/nacimien_utop/contenido.htm
Casen, Cécile. 2012. « Le katarisme bolivien : émergence d’une contestation indienne de l’ordre
social ». Critique internationale. n° 57 : 23.
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2012-4-page-23.htm,
Licence Creative Commons 4.0.
348
Gaudichaud, Franck. 2009. « Indianisme et transformation sociale en Bolivie. Comment penser un
marxisme critique ouvert aux problématiques identitaires ? ». Contretemps. n°4.
https://npa2009.org/content/indianisme-et-transformation-sociale-en-bolivie-comment-penser-un-
marxisme-critique-ouvert-a
Lozada Pereira, Blithz. 2006. Cosmovisión, historia y política en los Andes. La Paz : Carmelo
Corzón.
Reinaga, Fausto. 2007 [1970]. La revolución india. La Paz : Fausto et Hilda Reinaga.
http://www.manuelugarte.org/modulos/biblioteca/r/La-Revolucion-India-Fausto-Reinaga.pdf
Wachtel, Nathan. 1974. La Vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole
(1530-1570). Paris : Gallimard.
Licence Creative Commons 4.0.
349
89. Rivera Cusicanqui, Silvia
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Silvia Rivera Cusicanqui est une activiste et sociologue bolivienne qui a consacré sa vie à lutter
pour la décolonisation des cadres de pensée et de vie. Elle anime des ateliers libres, fait partie du
collectif ChTixi et a enseigné pendant vingt ans, en tant que professeure émérite de sociologie, à
l’Université Publique de La Paz (Universidad Mayor de San Andrés – UMSA).
Née à la fin des années 1940, elle a connu jeune la situation que dénonçait son compatriote Fausto
Reynaga : vivre dans un pays « indien » qui, jusqu’à la fin du XX siècle, avait été gouverné par des
Blanc-he-s ou des métis-ses. Mais, contrairement à Reynaga, plus âgé qu’elle, elle a pu vivre le
bouleversement de 2007, lorsque un Aymara28, Evo Morales, est parvenu au poste de Président de la
république. C’était un événement impensable jusque-là, puisque dans ce pays, avant 195229 , les «
Indien-ne-s » n’avaient pas accès au vote et étaient interdit-e-s des places publiques. Cette
situation n’était en rien exceptionnelle : en Équateur, par exemple, ils et elles avaient accédé à la
citoyenneté encore plus tard.
L’histoire de Silvia Rivera Cusicanqui s’inscrit dans celle des résistances et des sciences sociales
boliviennes. Elle a par exemple théorisé le katarisme comme ce qui a fédéré une histoire indigène
complexe, marquée par la recherche d’une autodétermination. Le katarisme indianiste est ce
mouvement multiforme qui apparut dans les années 1970 et s’incarna particulièrement dans une
nouvelle forme de syndicalisme paysan. Le katarisme réalisa une critique de l’expérience «
révolutionnaire » nationale initiée en 1952 et permit l’émergence d’une identité aymara. Le terme
« katarisme » renvoie au leader de la révolution tupakatariste qui eut lieu dans le dernier quart du
XVIII siècle. Comme j’ai essayé de le montrer dans l’article consacré à la question, Tupak Katari,
cet homme issu du peuple, fut certes un leader, mais il surgit parmi des populations qui avaient déjà
une pratique autonome de la lutte. La rébellion de Tupac Katari fut portée par des Indien-ne-s, qui
voulaient créer une plus grande égalité sociale et récupérer leurs terres. Une histoire qu’il faut avoir
à l’esprit aujourd’hui lorsqu’on essaie de comprendre la nature des conflits actuels en Bolivie,
28Il n’y a pas d'accord sur les origines d’Evo Morales, ses détracteurs et détractrices l’accusent de ne pas être Indien. À
travers ce genre de polémique, se repose la question de ce que c’est d’être Indien-ne, sachant que l’indianité est une
construction historique et que seule une perspective raciste permet de rattacher l’indianité à un phénotype ou une
généalogie. Cela pose également la question de l’identité assignée ou revendiquée.
29Date de la Révolution Nationale, laquelle, dans son projet de partage des terres et de justice sociale, avait aboli le
servage et lancé une réforme agraire.
Licence Creative Commons 4.0.
350
notamment celle de l’opposition de certains groupes autochtones au centralisme étatique d’Evo
Morales.
Le katarisme fut donc ce projet politique qui se matérialisa dans un syndicalisme d’un type nouveau
et qui donna naissance, dans les années 1980, à une branche politique nationaliste aymara, incarnée
dans le mouvement révolutionnaire Tupaj Katari et à une organisation de guérilla El ejercito
guerrillero Tupajk katari. Les kataristes, souvent des indigènes qui
avaient pu faire des études à la ville dans le cadre du programme éducatif de la révolution, avaient
critiqué le syndicalisme paysan mis en place par l’État révolutionnaire après 1952. Ils et elles
avaient également attaqué le caractère clientéliste et autoritaire de l’État, à un moment où les
populations indiennes de Bolivie avaient besoin que soit reconnue la spécificité d’une histoire
coloniale et néo-coloniale de domination et de discrimination. Au lieu de célébrer, comme la gauche
bolivienne, le métissage fondateur de la nation, ils et elles dénoncèrent le racisme dont souffraient
les « Indien-ne-s » depuis des siècles. C’est surtout dans la phase dictatoriale qui suivrait la période
révolutionnaire et celle du pacte Militaire-paysan, que leurs actions
rencontreraient les aspirations des indigènes.
À la fin des années 1960, une tentative de réforme fiscale avait créé les conditions pour la
mobilisation de quelques secteurs paysans afin de rompre le pacte. Un cycle de luttes paysannes
contre l’État vit alors le jour, s’achevant avec la mobilisation contre la politique des prix du général
Bánzer et la répression acharnée des forces armées connue sous le nom du massacre de Tolata en
1974. Ce massacre finit par enterrer le pacte de non-agression entre les paysans et les
militaires en contribuant par la suite au développement rapide d’un syndicalisme paysan
indépendant dont les kataristes furent les chefs de files. (Cusicanqui, 2010)
Pour Cusicanqui, le massacre de Tolata avait fait apparaître le caractère « ficticio » de la citoyenneté
accordée aux Indien-ne-s par le gouvernement révolutionnaire. C’était une citoyenneté de seconde
zone, ce dont rendait compte la réforme agraire. Insulte à leurs pratiques communautaires, elle
exigeait des « Indien-ne-s » qu’ils et elles se nient en tant que membres
d’une communauté puisque les parcelles qui leur étaient attribuées l’étaient seulement à titre privé.
L’indigène n’existait que comme « camarade paysan-e ». Quant au syndicalisme des années 1960, il
était de fait une forme de clientélisme. Les kataristes permirent aux mouvements « indiens » de
l’époque d’affirmer autre chose que la subordination à un État bienfaiteur et paternaliste. Ils et elles
postulèrent une identité aymara. Le processus s’alimenta à deux sources : l’expérience de la
discrimination raciale et culturelle et l’affirmation d’une identité propre, grâce au retour vers les
Licence Creative Commons 4.0.
351
enseignements de la tradition orale et la lecture de penseurs et penseuses « indien-ne-s » comme
Fausto Reynaga. Il est remarquable que la zone où commença le mouvement de protestation ait été
précisément celle où, deux siècles plus tôt, avait démarré la révolution tupakatariste. Le massacre
des paysan-e-s de Cochabamba, trahison des engagements des militaires, mit les kataristes sur la
scène et leur permit de démanteler le syndicalisme para- étatique officiel. Les grands mouvements
de blocage des routes des années 1970 leur donneraient un incontestable rôle de leader et leur
permettraient de rester à la tête de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) jusqu’en 1988. Pour Cusicanqui, le syndicat de ces années-là devint l’espace où
pouvait prendre forme un désir de vivre ensemble comme unité dans la diversité, quelque chose qui
remettait en question l’esprit de la république bolivienne depuis son indépendance comme celui du
Mouvement National révolutionnaire et son projet de citoyenneté forcée dans le cadre d’un État
unitaire et homogène. Mais avec le temps, le katarisme fut gagné par ce qu’il avait lui-même
critiqué et s’éloignerait, par exemple, des organisations amazoniennes, du nord Potosí
et même de l’altiplano.
Dès les années 1970, Silvia Rivera Cusicanqui a été en phase avec le désir d’écrire l’histoire des
propre aux kataristes. Ses premières publications sont parues en 1970, pendant la dictature militaire
d’Hugo Bánzer. Elle fonda, en 1983, l’Atelier d’Histoire Orale Andine (THOA). Son but était de
décoloniser les sciences sociales en récupérant l’histoire des autochtones. Le travail avec le THOA
débuta à l’Université avec Tomás Huanca, avec une équipe composée de personnes qui parlaient
aymara, quechua, ou qui étaient à la recherche de leur identité. Il s’agissait de faire de la recherche,
à partir d’archives écrites et orales, sur les rébellions d’avant 1952, comme celle du mallku (chef)
aymara Pablo Zárate Willka, qu’elle analyserait dans Oprimidos pero no vencidos.
Le titre renvoie aux propos d’un leader katariste, Génaro Flores, en 1979. Il remettait alors en
question les postulats de Nathan Wachtel et de León Portilla. En effet, si le premier, dans un
ouvrage célèbre, avait vulgarisé l’idée d’une Conquête achevée et si le second avait transformé la
catastrophe de la Conquête en Rencontre, Silvia Rivera, elle, refuserait l’habillage dialogique de
la Conquête et revisiterait l’histoire à partir de l’hypothèse d’une dialectique domination/résistance
inachevée : histoire engagée, volonté de rompre l’asymétrie entre acteurs et actrices et chercheurs et
chercheuses, conscience de la nécessité d’un engagement politique avec les kataristes d’abord, avec
ceux et celles qui luttaient pour l’ayllu30 avec les producteurs et productrices de coca dans les
années 1990 ou encore le mouvement anarchiste urbain ou le mouvement pour l’eau des années
30L’ayllu, présenté traditionnellement comme une forme collective de propriété de la terre, est en réalité beaucoup plus
que cela. C’est aussi une mode de relation entre les membres d’une communauté, un rapport à la terre et une
cosmogonie. Arturo Escobar parle à ce sujet de « relationalité ».
Licence Creative Commons 4.0.
352
2000. Une histoire qui s’inscrit également dans celle des sciences sociales en Bolivie car la
sociologie y émergea plus tardivement encore que dans les autres pays, soit à partir des années 1970
et des années 1980 pour l’anthropologie.
Aujourd’hui, elle parle au nom d’un « nous » qui est un collectif complexe, indigène et métis. Elle
remet en question la notion d’universel et reprend à son compte le concept de colonialisme interne
de González Casanova. Dans le cadre d’une recherche axée sur la question indigène, plus
particulièrement dans les Andes, Rivera Cusicanqui (2012) affirme l’existence d’un colonialisme
interne à deux faces : la première renvoie au renforcement de la politique coloniale menée avec les
populations indigènes et la seconde, aux alliances de l’État colonial avec les puissances
colonisatrices. L’autrice trouve le concept de colonialisme interne plus intéressant que celui de
colonialité, car, explique-t-elle,
(…) le colonialisme interne facilite la compréhension de l’internalisation du pouvoir colonial. Le colonialisme
ne pourrait pas être aussi efficace si nous n’avions pas mis l’ennemi à l’intérieur, c’est pourquoi nous cherchons
à surmonter cette vision misérabiliste de la mémoire comme une plainte, sans pour autant banaliser la douleur.
(Martins, 2018)
On retrouve ici cette idée déjà exprimée dans les propos de la militante nasa Vilma Almendra
(2015), sur « cette hydre qui est en nous ». Une analyse peu développée chez les penseurs et
penseuses du projet Modernité/Colonialité, qui insistent plus sur la catégorie de domination que
sur celle de subjectivation, ou qui, lorsqu’ils et elles parlent de subjectivation, la réduisent souvent
aux effets de la domination. Lutter contre l’« hydre interne », c’est donc aussi écrire soi-même son
histoire.
Aujourd’hui, elle vit son militantisme en réalisant son utopie à El Tambo, un espace politique et
culturel de La Paz où, avec ses collègues du collectif Chi’xi, elle organise des cours et des activités,
des fêtes et des présentations, reliant connaissances théoriques et travail manuel. Chaque année,
depuis son départ forcé de l’Universidad Mayor de San Andrés en Bolivie, elle organise l’atelier de
sociologie de l’image, un espace de formation pour décoloniser les points de vue. La sociologue
conçoit l’image comme « un récit, une syntaxe entre l’image et le texte, et comme une façon de
raconteret de communiquer ce que nous avons vécu » (Barber, 2019).
La cohérence de son approche se traduit dans une certaine pratique de la recherche et de l’écriture.
Pour elle, le travail manuel et le travail intellectuel doivent fonctionner ensemble : l’écriture est un
artisanat. Attachée au lien entre image et texte31 , émotion et raison, elle se situe dans cette
31 Voir son travail sur le cinéma.
Licence Creative Commons 4.0.
353
perspective relationnelle dont nous parle Arturo Escobar, cette remise en question de la raison
moderne.
Il y a eu une évolution dans son approche depuis Oprimidos pero no vencidos car elle considère
aujourd’hui que, durant les années 1980, elle avait eu tendance à développer une conception trop
essentialiste de l’indianité, ce que l’on reprocha aussi aux kataristes. Aujourd’hui, elle parle
d’identités « bigarrées », concept emprunté à l’historien bolivien René Zavaleta Mercado. Dans un
ouvrage récent, elle nous renvoie à la possibilité d’un monde chi’xi. Mais cette vision de l’identité
bigarrée ne doit pas se confondre avec le discours consensuel sur le métissage et c’est bien parce
qu’elle a mené une critique de cette rhétorique officielle qu’elle peut différencier les deux. Ce livre
est le résultat d’un long cheminement théorique sur l’histoire du métissage. Dans Violencias en-
cubiertas en Bolivia (2012), elle retrace cette histoire : pendant une très longue période, qui court de
la période coloniale jusqu’au milieu du XX siècle, le métissage fut très mal vu, considéré comme la
cause de tous les malheurs du pays. Puis, dans les années 1930, la position des élites au pouvoir vis-
à-vis du métissage changea avec la guerre du Chaco et la montée des discours nationalistes; enfin,
après 1952, le métissage devint l’idéologie officielle de l’État bolivien révolutionnaire.
[Ils voulaient] rêver ou imaginer une Bolivie homogène, éduquée et universaliste, ancrée dans un « homme
nouveau », le métis dont le sang avait été versé dans le Chaco. Ce modèle culturel devrait être introjecté, grâce à
la pédagogie, par l’ensemble de la population et devenir le corollaire du Sujet nation. (Cusicanqui, 2010)
Mais l’« Indien-ne » disparaissait dans ce métissage.
Le « métis » est ainsi devenu une figure presque mythique, qui a agi comme l’axe, le dépositaire, le sujet et le
protagoniste de la modernité bolivienne (cf. Rivera, 1993). La série de récits intitulée Sangs de métis, d’Augusto
Céspedes, est précisément un exemple – comme l’a souligné Rubén Vargas – de la façon dont cette notion de
métissage s’articule à la conception et la construction hégémonique du nationalisme révolutionnaire.
(Cusicanqui, 2010)
Pour elle, le discours sur le « mestizaje » construit une image à la fois occidentale et masculine de la
cité et s’articule autour de la notion de citoyenneté eurocentrée. Il est remarquable de constater que,
comme Fausto Reynaga, elle perçoit ce qu’il a y a de raciste et d’autoritariste derrière cette notion
mais que son analyse passe par d’autres chemins. En effet, lorsque Reynaga dénonce l’absurdité de
la célébration du métissage dans une société d’abord « indienne », il s’appuie sur un discours
hautement moral, une attaque au vitriol de la corruption des élites et du pouvoir métis.
Mais ce discours de la corruption, qui prend chez lui des formes assez apocalyptiques,
Licence Creative Commons 4.0.
354
est précisément l’imaginaire qu’employèrent les colonisateurs et colonisatrices, puis les élites des
Indépendances pour parler des populations indiennes. On pourrait dire que Reynaga détourne le
discours et le registre de la pureté et de la corruption qui était celui des Blanc-he-s. Mais on peut
aussi craindre qu’un tel registre, qui s’enracine dans une formation discursive européenne puissante
et qui a à voir avec les premières strates de l’idée de race, n’enferme dans ses rets celui qui
l’utilise. Silvia Rivera dénonce sans équivoque le mythe du métissage mais sur une base autre. Elle
s’intéresse moins à l’affirmation d’une pureté capable de résister à la dégradation de la modernité
qu’à l’étude des stratégies de résistance de ceux et celles qui luttent contre des élites racistes qui
n’ont pas cessé de se reconfigurer au cours de l‘histoire coloniale puis nationale.
C’est une métaphore qu’un sculpteur aymara – Victor Zapana – m’a communiquée, en parlant d’animaux comme
le serpent ou le lézard : ils viennent d’en bas, mais sont aussi d’en haut, ils sont mâles et aussi femelles. C’est-à-
dire qu’ils ont une dualité implicite dans leur constitution. Et cela m’a semblé une très bonne métaphore pour
expliquer un type de métissage qui reconnaît la force de son côté indigène et le pouvoir, et l’équilibre avec la
force de l’Européen. Ce Ch’ixi que je propose comme une force qui décolonise le métissage. La solution n’est
pas la fusion ou l’hybridité, il s’agit d’habiter les contradictions. Pas de nier l’une ou l’autre des deux parties, ni
de chercher une synthèse, mais d’admettre la lutte permanente dans notre subjectivité entre l’Indien et
l’Européen. (Barber, 2019)
Pour elle la question du genre et la « question indienne » ont des points communs. Elle ne se dit pas
féministe mais considère que sa démarche personnelle l’a placée, en quelque sorte, « à côté » de
tous les problèmes soulevés par le féminisme depuis les années 1960.
Quand je dis « à côté », ce n’est pas parce que je ne me sentirais indifférente aux idées et espoirs
féministes, mais parce que j’ai toujours vécu l’identité féminine de l’intérieur, historique et politique, du
colonialisme interne, car la réalité féminine se construit dans la colonisation »
dit Silvia dans son livre Violencias (re) encubiertas en Bolivia.
En Bolivie, le discours féministe est particulièrement médiatisé par les ONG et par l’État. Il y
a, c’est vrai, des groupes comme Mujeres Creando qui sortent de cette approche, mais je trouve cela encore très
marginal. (Barber, 2019)
Aujourd’hui, refusant d’être « la voix des sans voix », elle pense une action qui génère une
connaissance d’arrière-garde à un moment où la critique du colonialisme perd de sa vigueur au
profit de versions multiculturalistes apolitiques. Cette radicalité l’amène à affirmer, sous la
Licence Creative Commons 4.0.
355
présidence d’Evo Morales, qu’il n’y a pas de gouvernement indigène en Bolivie.
L’indianisme est piégé dans une approche totalement centrée sur l’État, une idolâtrie de l’État. Il est pris dans un
discours nationaliste, la recherche d’un État aymara et d’une nation aymara, ce qui à mon avis est inacceptable.
Cette approche essentialiste ne rend pas compte de la réalité. La réalité bolivienne est une réalité variée,
composée d’identités très confuses et mélangées. L’indianisme est
enfermé dans le carcan de l’État. (Barber, 2019)
Il est clair que sa position s’ancre dans des présupposés qui sont ceux de l’autonomie et rejoignent
les positions anarchistes. Cela explique peut être la violence des attaques dont elle a été victime lors
du coup d’État en Bolivie parce qu’elle n’a pas soutenu le gouvernement de Morales. La polémique
qui a éclaté alors pourrait être une résurgence contemporaine du vieil affrontement
marxisme/anarchisme au sujet de l’État, dans le contexte d’une « Amérique latine » où les luttes
autonomes se développent.
Références
Vilma, Almendra. «Pensamiento critico frente a la hidra capitalista». Radioteca (portail
radiophonique d’échange)
https://radioteca.net/audio/pensamiento-critico-frente-a-la-hidra-capitalista/
Barber, Katalin, 2019. «Tenemos que producir pensamiento a partir de lo cotidiano (entretien avec
Silvia Rivera Cusicanqui) ». El Salto .
https://www.elsaltodiario.com/feminismo-poscolonial/silvia-rivera-cusicanqui-producir-
pensamiento-cotidiano-pensamiento-indigena
Gómez Muller, Alfredo. 2019. Recension de «Un monde ch’ixi est possible. Essais à partir d’un
présent en crise », de Silvia Rivera Cusicanqui. Revue d’Études décoloniales
http://reseaudecolonial.org/2019/01/22/un-monde-chixi-est-possible
Martins, Paulo Henrique. 2018. « Actualidad de la teoría del colonialismo interno para el debate
sobre la dominacion y los conflictos interetnicos ». Buenos Aires. Encrucijadas abiertas. América
Licence Creative Commons 4.0.
356
latina y el Caribe Sociedad y pensamiento crítico en Abya Yala (T.II), sous la dir.de Alberto L.
Bialakowsky, Nora Garita Bonilla, Marcelo Arnold Cathalifaud, Paulo Henrique Martins,
Jaime A. Preciado Coronado : 311. Buenos Aires : Clacso.
https://www.teseopress.com/encrucijadasabiertas/chapter/71/
Rivera Cusicanqui, Silvia. 2008. «Décoloniser la sociologie et la société». Journal des
anthropologues .
http://journals.openedition.org/jda/2473
Rivera Cusicanqui, Silvia. 1984. Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y
qhechwa 1900-1980. La Paz : Hisbol – CSUTCB
Rivera Cusicanqui, Silvia. 2010. Violencias (re) encubiertas en Bolivia. La Paz. Editorial Piedra
Rota : 125.130.
Portail de Silvia Rivera sur Academia edu. Plusieurs textes en anglais
https://independent.academia.edu/SilviaNRiveraCusicanqui
Licence Creative Commons 4.0.
357
|90. Segato, Rita Laura
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Argentine, Rita Segato est une anthropologue féministe qui enseigne à l’Université de Brasilia dans
le cadre de la chaire d’anthropologie et de bioéthique de l’Unesco. Elle a étudié plus
particulièrement la violence de genre dans les communautés afro-américaines ou indiennes et les
relations entre genre, racisme et colonialité. À partir de son analyse de la transformation des
sociétés américaines avec la colonisation, elle a élaboré une représentation du monde actuel comme
monde qui fait la guerre aux femmes, monde de maîtres, où l’exercice de la cruauté est une valeur.
Pour elle, le genre n’est pas une catégorie sociologique ou anthropologique, mais une
caractéristique essentielle de toute vie sociale.
Ce n’est pas un des aspects de la domination mais une catégorie capable d’éclairer « tous les autres
aspects de la transformation imposée à la vie des communautés lorsqu’elles ont été capturées par le
nouvel ordre colonial moderne » (2011). Son travail sur cette violence et les liens qu’elle entretient
avec le patriarcat l’a amenée à écrire de nombreux ouvrages et à participer à la défense des victimes
de ce qu’elle appelle « la guerre contre les femmes », dans le cadre d’enquêtes et de procès pour
viols et assassinats (2016).
Dans Les structures élémentaires de la violence (2003), un texte fondateur, elle alerte les esprits en
démontant la condition politique de la soumission qui ne s’enracine pas dans la sexualité mais dans
une subjectivation politique. Pour elle, il n’y a pas de crimes sexuels mais des crimes de pouvoir, de
domination et de punition. Elle considère que la violence exercée contre les femmes doit se
comprendre dans le contexte d’une époque de « maîtres », où les hommes obéissent à un impératif
de masculinité qu’ils mettent en acte à travers leur pouvoir sur le corps des femmes. Le concept de
violence de genre lui paraît productif parce qu’il fait apparaître la violence contre les femmes
comme une structure. Selon elle, le féminicide est favorisé par des effets d’appel qui rendent la
violence contagieuse et la transforment en spectacle. Les hommes sont victimes eux aussi de ces
structures qui les enferment dans la violence.
Rita Segato les appelle à se désolidariser de l’ordre social qui les pose comme prédateurs, une
analyse qu’elle développe entre autres dans un livre récent, Contre-pédagogies de la cruauté
(2018).Pour lutter contre la guerre faite aux femmes, elle propose de distinguer
féminicide et fémigénocide :
Licence Creative Commons 4.0.
358
Nous avons besoin d’une catégorie qui puisse être portée au niveau juridique de la juridiction internationale des
droits humains, qui définisse un type de crime d’un autre ordre, où la femme meurt non pas à cause de la
dynamique des relations interpersonnelles, mais meurt à cause du genre (gender), c’est-à-dire que la victime
n’avait pas de relations personnelles avec ses tortionnaires, ils ne ne la connaissent pas et nous n’avons pas non
plus une relation simple entre un meurtrier et une victime. Au contraire, il y a un groupe et un chef qui font une
grand nombre de victimes. C’est pour cette catégorie-là que je propose de réserver la catégorie de fémigénocide.
(Segato, 2012)
Elle attire l’attention sur le fait que le féminisme ne doit pas aboutir au lynchage, médiatique ou
réel, l’ennemi n’étant pas les hommes mais l’ordre patriarcal :
Que la femme du futur ne soit pas l’homme que nous sommes en train de laisser dernière nous! (2018)
Références
Très peu de textes en français en accès libre sur ou de Rita Segato. Par contre, son portail Academia
edu offre plusieurs articles et livres en espagnol, portugais et anglais.
Anonyme. 2014. «A propos du livre de Rita Laura Segato, «L’Œdipe noir. Des nourrices et des
mères ». Des nouvelles du front.
https://nouvellesdufront.jimdofree.com/social-d-ailleurs-et-du-reste/nouvelles-du-front-de-111-
%C3%A0-120/l-oedipe-noir-de-rita-laura-segato/
Campoalegre Septien, Rosa. 2018. « L’essentiel ne doit être ni invisible ni invincible ». Revue
d’Études Décoloniales.
http://reseaudecolonial.org/2018/10/16/feminicide-lessentiel-ne-doit-etre-ni-invisible-ni-invincible/
Muniagurria, Mandela Indiana. 2019. «Recension de Contra-pedagogías de la crueldad de Rita
Segato». Revista Pilquen.
Segato, Rita. 2011. « Género y poscolonialidad : en busca de claves de lectura y de un vocabulario
estratégico descolonial », Dans Descolonizando el feminismo desde y en América latina, sous la dir.
de Karina Bidaseca et Vanesa Vazquez Laba, p. 22. Buenos Aires : Ed. Godot.
Licence Creative Commons 4.0.
359
Segato, Rita. 2012. « El femigenocidio, ¿De qué se trata? ». Fundacion Iberoamericana para el
desarrollo.
http://www.fundacionfide.org/comunicacion/noticias/archivo/81564.html
Segato, Rita Laura. 2014. « Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres ». vol. 29. n.
2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
Segato. Rita Laura 2018. « Colonialité et patriarcat moderne : expansiondu domaine de l’État,
modernisation et vie des femmes ». Revue d’Études Décoloniales.
http://reseaudecolonial.org/2018/10/15/colonialite-et-patriarcat-moderne-expansion-du-domaine-de-
letat-modernisation-et-vie-des-femmes1
Segato Rita Laura. 2016. La Guerra contra las Mujeres. Madrid : Traficantes de Sueños.
https://www.academia.edu/33587701/La_Guerra_contra_las_Mujeres_Traficantes_de_Suen_os.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
360
91. Syncrétisme
PAUL MVENGOU CRUZ MERINO
Le syncrétisme est un concept très utilisé en sciences sociales pour renvoyer aux situations de
rencontres entre cultures et sociétés, notamment sur le plan religieux. Il renvoie à un « amalgame
d’éléments mythiques, cultuels et organisationnels de sources diverses au sein d’une même
formation religieuse » (Rivière, 2004). Il ne s’agit pas d’une fusion ni d’un mélange, mais d’une
composition d’’éléments hétérogènes qui cohabitent.
Selon l’anthropologue André Mary, il existerait quatre logiques syncrétiques: la ré-interprétation
(appropriation des contenus culturels exogènes au travers de la pensée de la culture native);
l’analogie (qui pourrait prendre la forme d’une équivalence fonctionnelle); le principe de coupure
(cohabitation de logiques opposées dans un individu ou dans une même culture); la dialectique de la
matière et de la forme. Cette notion a été très utilisée pour rendre compte de la vitalité des cultures
religieuses afro-descendantes notamment avec les travaux de Roger Bastide.
La critique décoloniale de cette notion part d’un réflexion sur l’altérité épistémique qui caractérise
les rapports au monde propres aux religions afro-descendantes, et surtout, de l’analyse des rapports
de domination. Le théoricien portoricain Ramón Grosfoguel (2004) engage cette critique :
Vus depuis une perspective eurocentrique, c’est-à-dire du côté hégémonique de la différence
coloniale, ces processus culturels sont conçus comme syncrétiques car l’on reconnaît une
horizontalité dans les relations culturelles. Cependant, depuis la perspective subalterne de la
différence coloniale, hybride et métis constituent des stratégies politiques, culturelles, sociales de
sujets subalternes qui, à partir de positionnements de subordination, donc depuis une expérience
d’une verticalité des relations interculturelles, insèrent des épistémologies, cosmologies et stratégies
politiques alternatives à l’eurocentrisme.
Par-là, il s’agit d’insister sur les relations de pouvoir à l’œuvre au sein des formations culturelles
qui font que les recours aux éléments exogènes ne sont pas horizontaux ou ne sont pas pré-
contraints.
Références
Licence Creative Commons 4.0.
361
Grosfoguel, Ramón. 2004. « Hibridez y mestizaje: sincretismo o a complicidad subversiva? La
subalternidad desde Ia Colonialidad del poder ». De Signis. nº6 : 54.
http://www.designisfels.net/publicaciones/revistas/6.pdf
Rivière, Claude (2004). “Syncrétisme”, In Dictionnaire de l’ethnologie et de
l’anthroplogie. Paris : PUF : 692.
Licence Creative Commons 4.0.
362
92. Syncrétisme et métissage : l’exemple des orishas en déportation
SEBASTIEN LEFÉVRE
Nous avons déjà abordé dans le chapitre « Études transatlantiques afrodiasporiques » l’enjeu que
recouvre une étude triangulaire des trois continents lorsqu’il s’agit d’interpréter les cultures afro
dans le contexte actuel d’Abya Yala. Il convient d’y revenir un peu plus précisément. En effet,
le problème que posent les notions de syncrétisme et de métissage se situe à plusieurs niveaux. Tout
d’abord, ces notions laissent entendre qu’il existe une certaine dilution, un certain effacement des
cultures au profit d’une nouvelle culture. D’autre part, dans le surgissement de cette nouvelle
culture, quels sont les éléments qui sont présents ? Et surtout, quels sont les éléments qui vont être
mis en valeur par rapport à cette création culturelle? Enfin, en ce qui concerne les cultures afro
présentes dans ces syncrétismes et métissages, elles apparaissent souvent comme étant totalement
diluées ou du moins comme des cultures qui auraient disparu avec l’esclavage. On peut citer
l’exemple emblématique de Miguel Rojas Mix, chercheur chilien, qui, au demeurant, avait mené
une réflexion très pertinente sur l’enjeu de la dénomination d’Abya Yala avec son livre Los cien
nombres de América (Les cents noms de l’Amérique). Lors d’une conférence, il mentionnait
d’ailleurs :
Otro concepto es él de Afroamérica, es el concepto de la Negritud. El tema de la identidad para los
Afroamericanos era bastante diferente que para las poblaciones indígenas, las poblaciones indígenas tenían un
pasado al cual mirar, en cambio, los Negros, la esclavitud había hecho tabula rasa de sus culturas y por lo tanto
no tenían identidad, la identidad tenían que inventarla y construirla.
Un autre concept est celui d’Afro-Amérique, c’est le concept de Négritude. La question de l’identité pour les
Afro-américain-e-s était très différente de celle qui se posait aux populations indigènes.
En effet, les populations indigènes avaient un passé, elles pouvaient regarder en arrière. Mais pour les Noir-e-s,
l’esclavage avait fait table rase de leurs cultures et ils et elles n’avaient donc pas d’identité, leur identité devait
être inventée et construite. (Rojas Mix, 2016)
Cette citation reflète à merveille, malheureusement, une opinion souvent répandue dans les études
sur Abya Yala lorsqu’il s’agit des cultures africaines. On pourrait également citer l’exemple deJosé
Carlos Mariátegui (1976) qui considérait les « Noir-e-s » comme des alluvions de la culture
péruvienne. Et même quand il s’agit de les réintégrer dans la culture nationale comme avec le
Licence Creative Commons 4.0.
363
fameux ajiaco nacional (bouillon national) du cubain Fernando Ortiz, c’est pour mieux les diluer
dans une cubanité neutralisée.
Au Mexique, d’après les travaux d’Aguirre Beltrán, durant les années 1940, les « Noir-e-s »
auraient été désintégré-e-s dans un métissage national au point de ne laisser que quelques traces.
Pourtant, dans les pays mentionnés ci-dessus, il existe des mouvements afrodescendants qui
montrent que ce syncrétisme n’allait pas de soi. L’enjeu rentre bien dans le cadre d’une géopolitique
du savoir. Est-ce que les populations africaines déportées en Abya Yala avaient des cultures,
possédaient des savoirs ancestraux comme n’importe quelle culture au monde? Est-ce que ces
cultures ont été à l’origine de la fondation de ce qu’est devenu Abya Yala à la suite de la Conquête?
Est-ce qu’elles pouvaient constituer des supports valables dans le cadre de reformulations
culturelles? Que serait Abya Yala aujourd’hui sans les apports africains : infrastructures construites,
religions, arts, musiques et danses, arts culinaires, ethnobotanique, etc.?
Pour illustrer les enjeux épistémologiques des concepts de syncrétisme et de métissage, prenons le
cas de la religion yoruba (Nigéria et Bénin principalement) qui mobilise un panthéon assez
conséquent d’orishas (divinités). Au Brésil, par exemple, les premières populations à avoir
été déportées venaient de la région du Congo et de l’Angola actuel. Étant donné la demande
croissante en main d’oeuvre et les résistances, très vite, les marchands d’esclaves ont dû multiplier
les points d’approvisionnements. Ainsi, arrivèrent au Brésil les populations de l’actuel golfe du
Bénin, connue à l’époque sous le tristement célèbre nom de la « Côte des esclaves ». Selon
Nina Rodrigues, cité par Pierre Fatumbi Verger (2018), vers la fin du XIX siècle, le syncrétisme
n’avait pas eu totalement lieu car il n’y avait pas une correspondance systématiquement établie
entre les divinités du panthéon yoruba et les saints catholiques. Il semblerait donc que ce
syncrétisme/ métissage ait eu lieu plus récemment.
Il faut préciser par ailleurs que, pour le Brésil, ce « syncrétisme » a été rétro alimenté par des va-et-
vient entre Abya Yala et le Bénin et le Nigéria, dus aux nombreux voyages que des esclavagisé-e-s
libéré-e-s faisaient. Lors de leur retour, ils et elles intégraient les savoirs appris en Afrique dans
les pratiques religieuses afrobrésiliennes. Cela a été possible parce que les différentes pratiques
n’étaient pas si éloignées. Cette idée remet déjà en cause l’idée de « syncrétisme ». En outre, les
Africain-e-s du Brésil étaient capables de différencier les deux systèmes religieux, le catholique et
le yoruba. Les pratiques, pour eux et elles, n’étaient pas antagoniques. Cette conception
pluriverselle est due au fait que les pratiques religieuses yoruba reposent sur une conception
plurielle des divinités, conception explicitée dans un discours d’un roi bamiléké du Cameroun, dans
les années 2000. Le roi assistait à l’ordination d’un jeune bamiléké pour devenir prêtre. Lors de la
Licence Creative Commons 4.0.
364
cérémonie, il expliqua que le « Blanc » pensait avoir réussi l’évangélisation et imposé son dieu,
mais que les choses étaient plus complexes. En effet, pour lui, Jésus avait été accepté comme une
protection supplémentaire parmi d’autres protections ancestrales bamiléké. Cette idée nous avons
pu la retrouver à Cuba où une famille qui était initiée dans les religions afrocubaines d’origine
yoruba avait tenu à baptiser son enfant à l’église catholique. Lorsque nous leur avons demandé pour
quelles raisons la famille tenait à le faire, on nous a répondu que c’était une protection
supplémentaire. Il existe donc une capacité à faire coexister plusieurs systèmes religieux, sans
contradictions, pour les populations afro et africaines. Pierre Fatumbi Verger (2018), parlant des
Afrobrésilien-ne-s, relève ces différentes approches dans son livre :
Concebem os seus santos ou orixás e os santos católicos como de categoria igual, embora perfeitamente
distintos. Os africanos escravizados se declaravam e aparentavam convertidos ao catolicismo; as práticas
fetichistas puderam manter-se entre eles até hoje quase tão estremes de mescla como na África. Depois, as
viagens constantes para a África com navegação e relações comerciais diretas facilitaram a reimportação de
crenças e práticas, porventura um momento
esquecido ou adulterado. Com o passar do tempo, com a participação de descendentes de africanos e de mulatos
cada vez mais numerosa, educada num igual respeito pelas duas religiões, tornaram-se eles tão sinceramente
católicos quando vão à igreja, como ligados às tradições africanas, quando participam, zelosamente, das
cerimônias de Candomblé.
Ils conçoivent leurs saints ou orixás et les saints catholiques comme appartenant à la même catégorie, bien que
parfaitement distincts. Les Africain-e-s réduit-e-s en esclavage se disaient et semblaient converti-e-s au
catholicisme; jusqu’à ce jour, ils et elles ont pu conserver des pratiques fétichistes presque aussi mélangées qu’en
Afrique. Ensuite, les voyages constants en Afrique avec la navigation et les relations commerciales directes ont
facilité la réimportation
de croyances et de pratiques, une phase qu’on a peut-être oubliée ou adultérée. Au fil du temps, avec la
participation d’un nombre croissant de descendant-e-s africain-e-s et de mulâtres-ses, éduqué-e-s dans un respect
égal des deux religions, ils et elles sont devenu-e-s des catholiques sincères, qui vont à l’église, tout en
maintenant leur lien avec les traditions africaines, et en participant avec zèle aux cérémonies du candomblé.
De la même façon, toujours selon Verger (2018), le système religieux yoruba a sans doute intégré
des éléments des religions d’origine bantoue, de l’actuel Congo et Angola :
Não se pode excluir também a possibilidade de que certas influências bantus se tivessem produzido entre os
nagôs, levando em conta que foram trazidos, em grande número, escravos do Congo e de Angola até os fins do
século XVII para todo o Brasil.
Licence Creative Commons 4.0.
365
Il n’est pas non plus exclu que certaines influences bantoues se soient produites chez les Nagô, sachant que des
esclaves ont été amenés en grand nombre du Congo et de l’Angola jusqu’à la fin du XVII siècle dans tout le
Brésil.
Ces différentes cohabitations et intégrations montrent la capacité des sujets africain-e-s à avoir une
position réflexive sur leur vécu d’esclavagisé- e-s en situation de domination extrême, mais surtout
leur capacité à s’adapter pour continuer à exister et faire exister leurs cultures ancestrales :
Quando precisam justificar o sentido dos seus cantos, os escravos declaravam que louvavam, nas suas línguas, os
santos do paraíso. Na Verdade, o que eles pediam era ajuda e proteção aos seus próprios deuses. (Verger, 2018)
Lorsqu’ils et elles devaient justifier le sens de leurs chants, les esclavagisé-e-s déclaraient qu’ils et elles louaient,
dans leur langue, les saints du paradis. En vérité, ce qu’ils et elles demandaient, c’était l’aide et la protection de
leurs propres dieux.
On peut observer ces diverses capacités d’adaptation et d’intégration dans les différents
rapprochements que les Africain-e-s déporté-e-s ont effectué entre leurs dieux et les saints
catholiques, qui diffèrent selon les pays. Par exemple, le dieu Shangó à Cuba est assimilé à Sainte
Barbe alors qu’au Brésil, il est couplé avec Saint Jérôme. Au Brésil, Yemayá est assimilée à
Notre Dame de l’Immaculée Conception et à Cuba, à la vierge de Regla, une vierge noire. Ogún, à
Cuba, est rattaché à Saint Jacques et au Brésil, à Saint Antoine de Padoue.
À travers ces différents exemples, nous voulons montrer la conscience des esclavagisé-e-s africain-
e-s déporté-e-s à Abya Yala et la capacité qu’ils et elles avaient d’user d’une multitude de stratégies
afin de continuer à pratiquer leurs cultures. Et ce qui pose vraiment problème, dans les notions de
syncrétisme et de métissage, c’est qu’elles amputent la part de conscience, de décision des
esclavagisé-e-s, comme s’ils et elles avaient uniquement subi alors qu’ils et elles ont été à
l’initiative de ces processus et ont dû opérer des synthèses et des réajustements pour pouvoir
s’adapter. Si on lit les « syncrétismes » et les « métissages » de cette façon, alors le champ
d’analyse n’en devient que plus riche. Enfin, il faut préciser que si ces postulats épistémologiques
ne sont pas accompagnés d’une réintégration des cultures africaines dans les lectures qui seront
faites d’Abya Yala, elles ne feront que reproduire des lectures occidentales qui, par manque de
connaissance des Afriques, noient les cultures afro dans un « syncrétisme »
et un « métissage » simplistes.
Licence Creative Commons 4.0.
366
Références
Conférence de Miguel Rojas Mix dans le cadre de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar,
consulté le 15 juin 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=6n0aRGiuo
-On peut renvoyer les lecteurs et lectrices à la chanson afrocubaine « Y tú ¿ qué quieres que te den ?
» du chanteur Adalberto Álvarez où l’on voit très bien toute cette conscience stratégique :
https://www.youtube.com/watch?v=24lHSU35Aqs,
Verger Fatumbi, Pierre. 2018. Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo. Brazil :
Fundação Pierre Verger: 136-17
Mariátegui, José Carlos. 1976. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Barcelona :
Editorial Crítica.
Licence Creative Commons 4.0.
367
93. Théologie de la libération
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Comme le remarque Fatima Hurtado López (2013), la théologie de la libération se différencie de la
philosophie de la libération, mais certain-e-s de ses acteurs et actrices ont été impliqué-e-s dans les
deux courants. Les théologien-ne-s de la libération partent du discours de la théorie de la
dépendance et font de la libération sa conséquence politique. Également appelée « christianisme de
la libération », cette Église des pauvres fait son apparition en « Amérique latine » au début des
années 1970, dans le sillage de l’ouverture amorcée dès les années 1960 par Vatican II. Il s’agit
d’intellectuel.le.s comme Frei Betto, Leonardo Boff, Juan Carlos Scannone, Enrique Dussel, pour
ne citer que les plus connu.e.s. Ils et elles ont donné une grande répercussion à un vaste mouvement
qui avait démarré dès les années 1960. En effet, selon Lowy Michael (2005), ce « christianisme de
la libération » se manifeste à travers un réseau de pastorales populaires, de communautés ecclésiales
de base, de groupes de quartier, de commissions Justice et paix, de formations de l’Action
catholique (JUC, JOC, JEC), de prêtres, de religieux et de religieuses qui ont assumé de façon
active ce qui deviendra l’idée centrale de la théologie de la libération : l’option préférentielle pour
les pauvres ».
En « Amérique latine », avec les conférences de Medellín, puis de Puebla, un secteur radical de
l’Église, engagé concrètement dans la lutte pour l’amélioration de la vie des pauvres, s’est affirmé.
Cette lutte pouvait aller jusqu’à la prise des armes, comme ce fut le cas pour certains prêtres au
Nicaragua dans les années 1970. Le contexte historique de l’époque, en particulier une pauvreté que
les politiques de développement ne pouvaient pas éliminer, est un élément essentiel pour
l’émergence de ce mouvement. Et la théorie économique de la dépendance, qui a été une critique à
partir de l’« Amérique latine » de ces politiques imposées par l’étranger, avait trouvé dans la
théologie de la libération un écho. Le franciscain Leonardo Boff affirmait que toute théologie se
vivait à partir de deux lieux, celui de la foi et celui du monde social dans laquelle la foi était vécue.
Tout en prenant en compte la réalité économique et politique de l’oppression, les théologien-ne-s de
la libération se différencient du marxisme en ce qu’ils et elles trouvent réductrices la notion de
classe et préfèrent parler de peuple pour rendre compte des multiples visages de l’opprimé-e :
indien-ne, noir-e, paysan-ne. D’autre part, la théologie de la libération parle davantage de libération
intégrale que d’émancipation économique.
Licence Creative Commons 4.0.
368
Une des forces de cette approche est la critique du capitalisme vue comme religion. Depuis la fin
des années 1980, les théologien-ne-s de la libération soulignent le caractère idolâtre du capitalisme.
À leurs yeux, le problème central en « Amérique latine » n’est pas l’athéisme mais bien
l’idolâtrie qui rend un culte à de faux dieux. Ainsi, des théologiens comme Franz Hinkelammert et
Hugo Assmann ont développé une réflexion sur le caractère fétichiste du capitalisme, reprenant à
leur compte la thématique wébérienne de la lutte des dieux.
On ne peut pas aujourd’hui envisager la théologie de la libération comme une simple version
exotique de la théologie. Elle apparaît dans le mouvement d’idées particulièrement riche,
révolutionnaire que connaît l’« Amérique latine » de la deuxième partie du XX siècle. Comme
l’écrit Luis Martínez Andrade (2017) :
Si l’on ne peut parler de critique décoloniale s’agissant de la théologie de la libération sans risquer
l’anachronisme, la ligne de force est pourtant bien visible. Notre but est donc de montrer que la théologie de la
libération est un antécédent épistémique et géo-historique du
tournant décolonial.
Références
Assmann, Hugo. 1973. Teología desde la praxis de la liberación: ensayo teológico desde la
América dependiente. Salamanque : Agora.
Chaouch, Malik Tahar. 2007. « La théologie de la libération en Amérique latine ». Archives de
sciences sociales des religions : 9. 28.
http://journals.openedition.org/assr/4822
Frei Betto. 2009. « Quelles alternatives au capitalisme ». A l’indépendant.
http://alainindependant.canalblog.com/archives/2009/10/13/15426397
Hurtado López, Fátima. 2013. Dialogues philosophiques Europe-Amérique latine : vers un
universalisme ouvert à la diversité. Enrique Dussel et l’éthique de la libération. Thèse de Doctorat.
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/29525/21876757.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Libanio, Joao Batista. 2005. « La théologie de la libération. Nouvelles figures ». Études. Tome 402.
Licence Creative Commons 4.0.
369
Lowy, Michaël. 2014. « La théologie de la libération ». L’Indépendant.
http://alainindependant.canalblog.com/archives/2014/11/24/31016995.html
Lowy, Michaël. 2005. « Religion, politique et violence : le cas de la théologie de la libération ». La
brèche numérique.
http://www.preavis.org/breche-numerique/article197.html
Martínez Andrade, Luis. 2016. Écologie et Libération. Critique de la modernité dans la théologie
de la libération. Paris : Van Dieren Éditeur ; 28.
Martínez Andrade, Luis. 2017. « Le capitalisme comme religion. La théologie de la libération au
tournant décolonial ». Tumultes. n° 48.
https://www.academia.edu/35461525/Le_capitalisme_comme_religion._La_th
%C3%A9ologie_de_la_lib%C3%A9ration_au_tournant_d%C3%A9colonial
Pasquier, Raphaël. 2009. « Dialogue avec Leonardo Boff ». Cotmec. n°305.
http://www.ired.org/modules/infodoc/files/french/cotmec_-_dialogue_avec_leonardo_boff.pdf
Scannone, Juan Carlos. 2009. «La filosofía de la liberación: historia, características, vigencia
actual». Teología y Vida, vol. L. 59 – 7.
https://scielo.conicyt.cl/pdf/tv/v50n1-2/art06.pdf
Vergara Estévez, Jorge. 2001. « Franz Hinkelammert, El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la
globalización ». Polis. 4.
http://journals.openedition.org/polis/7220
Licence Creative Commons 4.0.
370
94. Tournant décolonial
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
L’idée du « tournant décolonial » revient à Nelson Maldonado Torres, qui l’avait avancée lors d’une
réunion avec divers membres du projet Modernité/ Colonialité. Il emploie pour la première fois le
terme de Giro décolonial dans un article de 2006 consacré à Aimé Césaire, puis dans La
descolonización y el giro descolonial (2008). L’expression fut ensuite reprise par Santiago Castro
Gómez et Ramón Grosfoguel avant de s’imposer.
La notion de « tournant décolonial » est apparue comme telle en 2005, lors d’une conférence que j’avais
organisée à l’Université de Californie, Berkeley. Il s’agissait d’une plate-forme destinée à
favoriser les contacts et le dialogue entre les philosophes et les théoricien-ne-s afro-caribéen-ne-s critiques de la
population latino aux États-Unis et en Amérique latine. À cette époque, les féministes chicanas avaient déjà
réalisé des travaux dans lesquels elles utilisaient le concept de decoloniality, avec un sens qui n’était pas celui de
la théorie de la décolonialité d’Aníbal Quijano et Walter Mignolo. C’est à ce moment-là que j’ai suggéré
l’emploi de la notion de « tournant décolonial », pour faire le pont entre ces différentes formes de pensée critique
sur la décolonisation, puisque le concept était en train de devenir une notion-clé. (Maldonado Torres, 2008)
Cette notion permet de préciser ce que nous devons entendre par décolonisation ou, plutôt,
décolonialité. Elle désigne à la fois prise de conscience d’une réalité (la discrimination létale de
certains sujets dans le monde moderne/colonial) et la construction d’alternatives aux types de
pouvoir/savoir sur lesquels repose cette domination. Nelson Maldonado Torres insiste sur le fait que
le tournant décolonial passe d’abord par une réaction sensible, un cri d’effroi face à la réalité. Il
s’agit de l’horreur que nous éprouvons face au déploiement des formes modernes de colonialité.
Cette horreur produit une attitude, cette attitude décoloniale que le philosophe a théorisée dans de
nombreux travaux. Elle se traduit par des actes, car l’horreur débouche sur une posture critique et
sur l’affirmation de la vie de ceux et de celles qui sont nié-e-s. Avec le tournant décolonial, l’enjeu
n’est pas seulement la décolonisation de la pensée mais le passage à une critique en acte de la
modernité : opposer une politique de l’amour à la politique de mort, rompre avec le monde de la
mort coloniale, « c’est là le moment le plus fondamental du tournant décolonial. La décolonisation
ne peut avoir lieu sans un changement de sujet » (Maldonado Torres, 2016).
L’attitude décoloniale est liée à une éthique et une politique de libération et à l’émergence de tournants subjectifs
de décolonisation, propres aux différentes communautés mais dont la pertinence
Licence Creative Commons 4.0.
371
dépasse les frontières de celles-ci, comme l’attitude quilombola ou cimarrona sur laquelle certains travaillent
aujourd’hui. (idem, 2008)
Cette attitude décoloniale a donné naissance à divers mouvements dans l’histoire du monde
moderne/colonial, mais c’est seulement au XX siècle que ces projets entrèrent en relation les uns
avec les autres. La révolution haïtienne, par exemple, fut un mouvement important, car elle avait
entraîné une modification ontologique : les ancien-ne-s esclavagisé-e-s ne voulaient pas seulement
échapper à une exploitation féroce. Ils et elles voulaient être reconnu-e-s comme des êtres humains.
Pour autant, Nelson Maldonado Torres ne considère pas la révolution haïtienne comme un moment
décolonial, il la voit plutôt comme l’annonce de quelque chose de nouveau. En effet, c’est à partir
d’Haïti que vont surgir d’autres révolutions et d’autres changements : les discours panafricains, les
décolonisations du XX siècle, 1992, l’insurrection zapatiste. Le discours sur le colonialisme de
Césaire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est le nouveau discours de la méthode,
l’articulation d’une raison décoloniale. Césaire opère un renversement de la dialectique coloniale
civilisation/barbarie en montrant que le colonialisme, non seulement ne civilise pas les colonisé-e-s
mais dé-civilise les colon-e-s.
Il sera un des premiers à établir le lien entre la colonisation et le nazisme, ce système colonial
appliqué à certain-e-s Blanc-he-s par des Blanc-he-s. À faire de cette période, que l’on a voulu
circonscrire à un moment, le nazisme, et à un pays, l’Allemagne, un effet boomerang général de la
colonisation. Le tournant décolonial a donc lieu quand la perception qu’ont d’eux-mêmes et d’elles-
mêmes les colonisé-e-s ou ex-colonisé-e-s change. Si le travail des intellectuel-le-s racisé-e-s et si
les traditions orales avaient déjà depuis longtemps amorcé ce tournant, ce n’est qu’après la Seconde
Guerre mondiale que tous ces apports fusionnent et que la décolonisation apparaît pour ce qu’elle
est : un projet inachevé en « Amérique latine ». À la fin du XX siècle et au début du XXI siècle, on
va voir s’opérer des tournants décoloniaux, en particulier au Mexique et dans les Andes, à travers
des révolutions culturelles qui prôneront la décolonisation. À côté de la notion de « tournant
décolonial », nous trouvons celle « d’option décoloniale » de Walter Mignolo, qui fait les remarques
suivantes à ce sujet :
Je dois préciser dans quel sens nous employons, par principe, à l’intérieur du collectif, les expressions « tournant
décolonial » et « option décoloniale ». Le but n’est pas de choisir un des termes qui serait plus adapté que l’autre.
Cela reviendrait à faire comme si nous pensions en termes d’universels abstraits, comme s’il ne pouvait y avoir
qu’une seule expression adéquate pour désigner la réalité. Lorsque nous utilisons l’un ou l’autre termes, nous
faisons apparaître l’un ou l’autre des aspect d’un même phénomène. « Giro », en espagnol, est la traduction de
Licence Creative Commons 4.0.
372
l’anglais « turn ». Mais « turn » a un autre sens en anglais que « giro » n’a pas. Quand on dit « it is your turn »,
ça ne veut pas dire « giro » mais plutôt quelque chose comme « c’est ton tour », ou « à toi maintenant », etc. En
ce sens, « decolonial turn » (giro décolonial) pourrait signifier en anglais à la fois « giro » et « turno ». « C’est le
moment de la pensée décoloniale » ou « le moment de de la pensée décoloniale est arrivé ». Pour ma part,
j’utilise aussi l’expression « decolonial shift » qui serait traduisible par « cambio », au sens de « changement de
vitesse » dans les voitures.
C’est l’expression caractéristique de la proposition de l’Association caribéenne de philosophie : « shifting the
geography of reason, changer la géographie de la raison ». Mais j’utilise aussi « shift » et « shifting » dans le
sens de « Pachakuti ». Pachakuti a fini par signifier, pour les Quechua et Aymara qui ont vécu l’invasion
hispanique, « renversement » ou « retournement » : le monde à l’envers, comme le disait Guamán Poma de
Ayala. C’est en ce sens, qu’en espagnol, je parle du « vuelco de la razón ». C’est cela le « renversement » de la
raison (…). (Carballo, 2012)
Références
Carballo, Francisco. 2012. « Hacia la cartografía de un nuevo mundo : pensamiento descolonial y
desoccidentalización (un diálogo con Walter Mignolo) ». Otros logos. Revista de estudios críticos :
243. 244.
https://www.academia.edu/4262693/
Para_desinventar_Aérica_Latina_y_de_paso_construir_un_mundo_nuevo_Un_diálogo_con_Walter
_Mignolo
Boidin, Capucine et Hurtado López, Fatima. 2009. « La philosophie de la libération et le courant
décolonial ». Cahiers des Amériques latines. 62.
http://journals.openedition.org/cal/1506
Maldonado Torres, Nelson. 2008. « La descolonización y el giro desconial ».Tabula Rasa. n°.9 : 61-
72.150.
http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a05.pdf
Maldonado Torres, Nelson. 2012. «Thinking through the Decolonial Turn: Post-continental
Interventions in Theory, Philosophy, and Critique—An Introduction ». Dialnet.
https://escholarship.org/uc/item/59w8j02x
Licence Creative Commons 4.0.
373
95. Transmodernité
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Le terme « transmodernité » a été employé pour la première fois par Rosa María Rodríguez Magda
pour désigner la période actuelle. La philosophe espagnole affirmait que le postulat postmoderne,
celui de la remise en question des grands récits, s’avérait caduc à l’heure du grand récit que
constitue la globalisation. Parce qu’il y avait eu un changement de paradigme, l’emploi d’un
nouveau préfixe s’imposait : la trans-modernité évoquerait mieux un monde en constante
transformation. Le terme prendra un sens différent chez Dussel. Pour le philosophe argentin, la
transmodernité est le dépassement de la modernité, entendue comme ce projet spécifique qui
apparaît en Occident entre le XV siècle et le XX siècle.
Si, au début, il s’agissait pour Dussel de prendre des distances avec la position désabusée des
postmodernes, par la suite s’est affirmée chez lui l’idée que les exclu-e-s de la modernité ont opposé
à cette dernière une résistance plus grande que prévue. Et cela l’a amené à intégrer ce qui
disparaît en général chez les postmodernes : l’idée du changement social.
La transmodernité, c’est l’inclusion des peuples soumis politiquement dans le passé et aujourd’hui,
économiquement dépendants. Cette catégorie donne accès à une lecture de l’histoire du monde
centrée sur la décolonisation et renvoie à l’instauration d’un dialogue entre les diverses cultures.
En 1999, dans le livre Posmodernidad y Transmodernidad. Diálogos con la filosofía de Gianni
Vattimo, le philosophe questionne la transition vers une transmodernité. Le concept, d’après
Eduardo Restrepo, prend forme dans une critique qui vise autant l’École de Francfort que les tenant-
e-s de la post-modernité. Dans ce livre, qui n’est en aucune façon un simple dénigrement de la
modernité, s’exprime le refus d’un désenchantement postmoderne qui peut tourner au nihilisme ou
au pessimisme. Enrique Dussel est animé par la conviction qu’il n’y a pas de solution à l’intérieur
du schéma de la modernité; il faut aller au-delà de ses limites, pour passer à un
post qui sera un dépassement de la modernité et intégrera ce qu’elle avait de
positif.
Contre le postmoderne, nous ne critiquerons pas la raison comme telle, mais nous admettrons leur critique de la
raison dominante, victimisante, violente. Contre le rationalisme universaliste, nous ne
nierons pas son noyau rationnel, mais son moment irrationnel, son mythe sacrificiel. Nous ne rejetons pas la
raison, mais l’irrationalité de la violence du mythe moderne; nous ne nions pas l’existence d’une raison, mais
Licence Creative Commons 4.0.
374
rejetons l’irrationalité postmoderne; nous affirmons la « raison de l’Autre » vers un monde transmoderne.
(Dussel, 1994)
Ce dépassement est lié de façon inextricable à l’extériorité, l’irruption de ce qui est différent, à des
cultures capables d’assumer l’héritage de la modernité mais à partir d’un lieu et d’expériences
autres et, ainsi, à même d’apporter des solutions que ne peuvent trouver les modernes. La
transmodernité, ce serait l’inclusion de l’altérité niée dans le mythe moderne.
Si Dussel se positionne toujours à partir d’un lieu d’énonciation précis, Abya Yala ou le Sud global,
il ne fait pas de l’extériorité quelque chose qui serait propre seulement au Sud. En effet, les pays du
Nord global ont désormais leur propre Sud interne, leurs propres opprimé-e-s et exclu-e-s,
notamment en la personne des migrant-e-s. Comme l’écrivent Ana Silvia Solorio Rojas et
Juan Diego Ortiz Acosta (2019) :
Pour Dussel les cultures niées passent par cinq moments.
1) Elles doivent d’abord affirmer l’extériorité qui a été niée, à partir de la découverte de leurs propres valeurs.
2) Puis, critiquer leurs propres traditions à partir de leurs ressources internes et procéder à la déconstruction de la
tradition sur cette base.
3) Ensuite, élaborer des stratégies de résistance. Pour arriver à produire cette résistance culturelle, il faut du
temps, celui que mettent à mûrir les valeurs d’une culture donnée. Pour cela, il ne
faut pas seulement prendre le temps, mais aussi avoir une très bonne connaissance des éléments constitutifs de
cette culture.
4) Puis, créer un dialogue interculturel entre les critiques de leur culture à travers le monde, dialogue qui doit
avoir lieu d’abord entre les critiques de la périphérie. C’est un dialogue Sud-Sud qui doit précéder le dialogue
Nord-Sud. Un dialogue transversal.
5) Enfin, construire des stratégies de croissance transmoderne libératrice. Cela présuppose de planifier des
projets de libération transmodernes (Dussel, 2004 : 20-26). Pour que cette démarche
aboutisse, il faut en finir avec un des corollaires du mythe européen : la foi en son pouvoir salvateur, sa capacité
de sauver les autres, les Barbares, les sous-développés, les attardés, comme on préférera les appeler.
Dans 16 tesis de economía política, la question de la transmodernité est la
clé d’une pratique économique critique :
Les différentes cultures (…) « produisent une « réponse » variée au « défi » moderne et font irruption, sous une
forme nouvelle, dans un horizon culturel au-delà de la modernité ». (Dussel, 2004 : 201) (…) « La
transmodernité correspondrait précisément au projet alimenté
par ce projet d’extériorité qui n’a pas été subsumée et qui devient la source de l’au-delà de la modernité
européenne ». (Dussel, 2004)
Licence Creative Commons 4.0.
375
La transmodernité, c’est l’alternative au monstre du transhumanisme.
Références
Maesschalck, Marc. 2017. « Décolonialité et transmodernité : quels enjeux pour l’Europe? ».
Chemins Critiques.
https://www.cheminscritiques.org/386
Benito Climent, José Ignacio. La condition transmoderne de Rosa María Rodríguez Magda. Paris :
Ici et ailleurs.
https://ici-et-ailleurs.org/IMG/pdf/La_condition_transmoderne.pdf
Dussel, Enrique. 1994. 1492. El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad.
La Paz : Éditions Plural : 22.
Dussel, Enrique. 2004. 16 tesis de economía politica. Buenos Aires : Éditions Docencia : 201.
Dussel, Enrique. 2012. « Transmodernity and Interculturality : An Interpretation from the
Perspective of Philosophy of Liberation ». Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural
Production of the Luso-Hispanic World.1 (3).
https://escholarship.org/uc/item/6591j76r
Grosfoguel, Ramón. 2010. «Vers une décolonisation des Universalismes occidentaux: le
Pluriversalisme décolonial d’Aimé Césaire aux Zapatistes ». Ruptures postcoloniales.
http://www.arquitecturadelastransferencias.net/images/p-grosfogel/Grosfoguel-Vers-un-
decolonisation.pdf
Grosfoguel, Ramón. 2006. « Les implications des altérités épistémiques dans la redéfinition du
capitalisme global. Transmodernité, pensée frontalière et colonialité globale ». Mouvements.
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2006-3-page-51.htm
Rogríguez Magda, Rosa María. 2014. La condition transmoderne. Paris : Éditions l’Harmattan.
Licence Creative Commons 4.0.
376
https://ici-et-ailleurs.org/parutions/article/la-condition-transmoderne-de
Solorio Rojas, Ana Silvia et Ortiz Acosta, Juan Diego. 2019. « La Transmodernidad como
posibilidad de realización de otro mundo. Una mirada desde el pensamiento de Enrique Dussel »,
dans Siete ensayos sobre la Filosofía y Política de la Liberación de Enrique Dussel, sous la dir.
de Federico Ledesma Zaldívar et Juan Diego Ortiz Acosta. Guadalajara : Université de Guadalajara.
https://www.academia.edu/38462225
Licence Creative Commons 4.0.
377
96. Walsh, Catherine
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Nous sommes comme la paille des collines, que l’on arrache et qui, toujours, repousse. De cette paille, nous couvrirons
le monde. (Dolores Cacuango, militante indigène équatorienne)
Catherine Walsh enseigne à l’Université Simón Bolívar de Quito où elle est responsable du
programme d’Études Culturelles. Elle supervise également le Fond Documentaire Afro-Andin, un
projet qui s’organise autour de la récupération des savoirs des communautés afro-andines. Cette
intellectuelle et militante américaine collabora avec Paulo Freire avant de s’intéresser à la
perspective décoloniale. Elle s’emploie à renouveler la pédagogie critique à partir des approches
décoloniales. Pour elle, l’apport de Fanon et de Freire, qui se sont intéressés tous les deux à la prise
de conscience des opprimé-e-s, est une piste d’inspiration. Elle voit la pédagogie comme une
méthodologie dont on ne peut se passer pour les luttes sociales, ontologiques et épistémiques qui
visent la libération.
Soy sustantivamente político, y sólo adjetivamente pedagógico. (Freire, 2003)
Catherine Walsh envisage la décolonisation du processus éducatif à partir de concepts comme la
pensée-autre d’Abdelkebir Khatibi32, la décolonialité et la pensée critique de la frontière.
À Quito, son travail se situe dans une perspective qui est celle d’une interculturalité authentique.
Une interculturalité « critique », opposée à ce qu’elle appelle l’interculturalité « fonctionnelle » qui
fait abstraction des rapports de domination. Sa démarche a une dimension intercontinentale et
collaborative : à partir de 2001, des conventions passées entre l’Université de Duke, l’Université de
Caroline du Nord, l’Université Javeriana de Bogotá et l’Université Andine de Simón Bolivar à
Quito et des intellectuel-le-s venu-e-s de nombreux pays d’« Amérique latine », a rendu possible un
dialogue qui a inspiré les thèmes du premier Programme de doctorat en Études Culturelles
mentionné plus haut.
32 Khatibi remet en question l’idée d’identité culturelle. Dans la préface au livre de son ami Jacques Derrida (Derrida,
Jacques. 1991. L’Autre cap. Paris : Minuit : p. 16.), il écrivait : « Le propre d’une culture, c’est de n’être pas identique à
elle-même. Non pas de n’avoir pas d’identité, mais de ne pouvoir s’identifier, dire « moi » ou « nous », de ne pouvoir
prendre la forme du sujet que dans la non-identité à soi, ou si vous préférez, la différence avec soi».
Licence Creative Commons 4.0.
378
Pour elle, la décolonialité part de la déshumanisation et des luttes des « peuples subalternisés », ce
qui implique de rendre visibles les luttes contre la colonialité à partir des personnes, de leurs
pratiques sociales épistémiques et politiques. Cela implique également l’abandon de visions basées
sur la « crise » du capitalisme ou de la civilisation, une façon de penser qui a été celle des
gouvernements progressistes en « Amérique Latine », gouvernements qui n’ont pas su rompre avec
la logique nationaliste, l’idéologie du développement et son corollaire, l’extractivisme. Pour elle, les
luttes décoloniales supposent une appropriation de nouveaux concepts et l’invention de nouvelles
pratiques.
Ce sont ces moments complexes d’aujourd’hui qui provoquent des mouvements de théorisation et de réflexion,
des mouvements non linéaires mais serpentins, non pas ancrés dans la recherche ou le projet d’une nouvelle
théorie critique ou de changement social, mais dans la construction de chemins – d’être, de penser, de regarder,
d’écouter, de sentir et de vivre avec le sens ou l’horizon du colonialisme. (Walsh, 2013)
Très liée au mouvement indien équatorien qui s’est développé depuis la fin des années 1980, Walsh
met en question l’influence des ONG et organismes internationaux dans la construction d’une
interculturalité qui vise plus l’affaiblissement des États-nations que l’affirmation des Indien-ne-
s comme sujets politiques. Sa réflexion concerne autant les pratiques de libération des communautés
andines que leur rapport à la tradition et à leur ontologie. Elle s’intéresse particulièrement à la
mémoire collective, ce savoir mis en commun, dans laquelle s’ancre la résistance à la colonialité du
pouvoir. L’expérience de Silvia Rivera Cusicanqui avec son atelier d’histoire orale andine, qui a
construit une véritable méthodologie de dés-occidentalisation et de décolonisation, est un exemple
de la réussite de ce type d’approche. À ses yeux, une vie comme celle de la leader indigène
équatorienne Mama Dulu (Dolores Cacuango) est exemplaire de cette démarche, car la militante ne
visait pas seulement la lutte contre, mais la construction d’un monde autre, où la renaissance était
centrale. Cette idée de renaissance est là chez les zapatistes, chez les Nasa de Colombie ou chez
certaines communautés noires du Pacifique; le Buen Vivir, qu’ils et elles affirment, ne défie pas
seulement le mauvais gouvernement, mais la matrice coloniale du pouvoir. C’est un autre moment
de l’affrontement entre deux projets de vie qui a commencé avec la résistance à la Conquête.
Walsh considère également la question du « positionnement critique de frontière » dans la
différence coloniale, ou encore s’intéresse à un processus dans lequel la fin n’est pas une société
idéale, comme universel abstrait, mais le questionnement et la transformation de la colonialité du
pouvoir, du savoir et de l’être. Il faut toujours avoir conscience de ce que ces relations de pouvoir
Licence Creative Commons 4.0.
379
ne disparaissent pas, mais qu’elles peuvent être reconstruites ou transformées en s’adaptant d’une
autre manière.
Références
Bourguignon Rougier, Claude. 2020. « Histoire, nation et effraction. Un récit de Dolores Cacuango.
Penser, dire et représenter la race dans les Amériques : le point de vue des intellectuels noirs et
indigènes (XVIIIe-XXe siècles), sous la dir. de Philippe Colin. Pulim. Limoges.
https://www.academia.edu/17052363/Histoire_nation_et_effraction._Un_r
%C3%A9cit_de_Dolores_Cacuango
Mignolo, Walter, Walsh, Catherine. 2008. On decoloniality. Durham et Londres : Duke University
Press.
https://rampages.us/goldstein/wp-content/uploads/sites/7807/2018/08/Mignolo-and-Walsh-2018-
On-Decoloniality-Concepts-Analytics-Praxis.pdf
Ouyachchi, Anouar. 2017. « Pensée-autre chez Abdelkébir Khatibi : plaidoyer pour une
pensée plurielle ». Revue Sciences, Langage et Communication.vol.1.n.°2.
Pereira, Irène. 2016. « Une approche décoloniale : la pédagogie interculturelle critique ».
Question(s)s de classe.|
https://www.questionsdeclasses.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=3551
Walsh, Catherine. 2002. Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y
colonialidad del poder: perspectivas desde lo andino. Quito : Abya-Yala.
Walsh, Catherine. 2003. Estudios culturales latinoamericanos: retos desde y sobre la región andina.
Quito : Abya-Yala.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5496384
Walsh, Catherine. 2005. Pensamiento crítico y matriz (de)colonial: reflexiones latinoamericanas.
Quito : Abya-Yala.
Licence Creative Commons 4.0.
380
https://www.uasb.edu.ec/web/area-de-estudios-sociales-y-globales/publicacion?pensamiento-
critico-y-matriz-decolonial-reflexiones-latinoamericanas-227
Walsh, Catherine. 2009. Interculturalidad, Estado, sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra
época. Quito : Abya-Yala.
https://www.uasb.edu.ec/web/area-de-letras/publicacion?interculturalidad-estado-sociedad-luchas-
decoloniales-de-nuestra-epoca-415
Walsh, Catherine.2012.« Other”Knowledges,“Other”Citiques:Reflections on the Politics and
Practices of Philosophy and Decoloniality ».“Other » America Transmodernity. Vol. 1, Nº. 3.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3982163
Walsh, Catherine. 2013. Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y
(re)vivir. Quito : Abya Yala : 24.
https://www.academia.edu/35225456/Pedagogias_decoloniales_TomoI.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
381
97. Zapatisme
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
Le zapatisme est un mouvement social mexicain qui émerge à un moment charnière, en 1994 : avec
le déploiement des politiques néo-libérales en Amérique et dans le monde. Dans l’aire américaine,
c’est le début du traité de l’ALENA, qui va entraîner une paupérisation importante du Mexique.
Mais il y a aussi, depuis les années 1980, la montée en puissance des mouvements indigènes et
l’émergence d’une nouvelle façon de penser la politique et l’histoire latino-américaine dans le
monde intellectuel, politique et universitaire. De nouvelles catégories de pensée surgissent, des
réflexions autres, chez les militant-e-s qui vont réviser leur appareil critique et leur
réflexion sur le pouvoir. Le Chiapas, État du Mexique où démarre l’insurrection, a toujours
souffert de l’exclusion économique et politique et de la main mise sur les terres par de grand-e-s
propriétaires terrien-ne-s, ce que nulle réforme agraire n’a jamais vraiment remis en question. C’est
un État particulièrement marqué par la question du territoire. Dans cette région coexistent la
propriété privée, la propriété communale indienne et ce qu’on appelle l’ejido, une structure foncière
héritée de la réforme agraire révolutionnaire du siècle dernier. L’État révolutionnaire répondit aux
demandes de terres des paysan-ne-s par des dotations de terres. Depuis la Conquête, les petit-e-s
paysan-ne-s chiapanéques ont toujours essayé de récupérer les terres qui leur ont
été dérobées par les Espagnol-e-s. La guerre d’indépendance du XIX siècle et la révolution de 1910
ne changèrent pas la situation : les Indien-ne-s continuèrent à réclamer leurs terres tandis que le
processus de concentration et d’exploitation se développait, marqué dans la deuxième partie du XX
siècle par une pression sur la terre particulièrement forte de la part des éleveurs et éleveuses.
Dans cette zone à fort peuplement indien, maya essentiellement, les disparités sociales sont
énormes. Cela explique que la théologie de la libération, axée sur le souci pour les pauvres, s’y soit
développée à partir des années 1960. L’évêque Samuel Ruiz, gagné à cette position, y encouragea la
création d’associations paysannes indépendantes. Une autre caractéristique de cet État tient au fait
qu’il fut le havre des militant-e-s d’extrême gauche qui fuyaient la guerre sale menée par le pouvoir
après le massacre de Tlatelolco. Cette culture de résistance et d’organisation, qui s’enracinait dans
diverses histoires, exacerbait la violence des élites locales qui faisaient régulièrement assassiner les
leaders paysan-ne-s.
C’est dans ce contexte, le 1er décembre 1994, que l’EZLN fait irruption en armes à San Cristóbal,
entrant en rébellion contre le gouvernement local de l’État du Chiapas et celui du Mexique. Motif?
Licence Creative Commons 4.0.
382
Ils et elles revendiquent le respect des droits et de la dignité des indigènes, s’inscrivant d’emblée
dans une histoire multiséculaire. Comme on peut le lire dans la Declaración de la
Selva Lacandona (1994):
Nous sommes le produit de cinq cent ans de luttes.
Rapidement, les militant-e-s obtiennent l’autonomie de plusieurs municipalités qui sont aujourd’hui
autogérées et regroupées en cinq caracoles33. Aujourd’hui, l’expérience zapatiste se déploie dans la
moitié orientale, majoritairement indienne, du Chiapas, l’équivalent d’un territoire comme la
Belgique. Mais, sur ce territoire, vivent aussi des gens qui ne sont pas zapatistes, ce qui implique
donc la coexistence, pas toujours pacifique, de deux systèmes politiques différents.
Le zapatisme a eu une existence compliquée et violente durant ses vingt-cinq ans d’existence. Il est
important de noter qu’au départ les zapatistes envisageaient de négocier avec l’État. Lorsqu’ils et
elles ont vu que les accords de San Andrés , passés en 1996, n’aboutissaient à rien et que
l’État mexicain adoptait une stratégie de terreur, ils et elles ont abandonné l’idée d’une
reconnaissance institutionnelle des revendications indiennes.
Aujourd’hui, les communes autonomes zapatistes ne reçoivent aucun financement d’un État fédéral
qui a tout fait pour en finir avec le mouvement34: à travers les interventions directes de l’armée en
1994 et 1995, les interventions massives de paramilitaires, les déplacements de population
et les massacres comme celui d’Acteal35 dans les années 1995-2000. L’État a également pratiqué
une politique de division des communautés, ce qui aboutirait au XXI siècle à des assassinats, et a
manipulé les populations avec des programmes clientélistes.
Le nom du mouvement zapatiste renvoie à la figure indienne du révolutionnaire Emiliano Zapata,
natif d’Anenelcuico, et mort assassiné, comme la plupart des révolutionnaires de l’époque. La
légende dit qu’il reviendrait après sa mort. Ce mythe, à prendre au sens anthropologique du
33 Au début, il y eut les Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez). Puis apparurent les caracoles,
littéralement « coquillages ». Ce sont des communes autonomes libres avec leurs assemblées de Bon Gouvernement,
apparues en 2006.Le terme caracol renvoie à l’imaginaire maya et à la cosmogonie toujours vivante
de de ces peuples. Le coquillage est lié au mystère de la naissance et à la guerre.Il est également une figuration de la
spirale de l’infini et du zéro. Dans l’imaginaire occidental, la spirale, vortex ou tourbillon, est négative ( Bourguignon
Rougier, 2010).
34 En 1996, le gouvernement mexicain accepta de passer un compromis avec les représentants de l'EZLN, s’engageant
à mettre en place un nouveau pacte social avec les peuples indigènes, qui prenait en compte leurs revendications
d’autonomie mais il fit marche arrière au dernier moment.
35Il s’agit du massacre perpétré en 1997 par des membres de groupes armés ou paramilitaires dans un village du
Chiapas, au cours duquel 45 villageois, majoritairement indigènes, furent assassinés
Licence Creative Commons 4.0.
383
terme, s’inscrit dans une tradition plus vaste qui est celle de la résistance indigène et de tous ces
mort-e-s qui reviendraient, comme l’Inka Tupac Amaru, décapité par les conquérants à Vilcabamba.
Une image de la résurrection qu’il faut voir autant dans la perspective d’un Walter Benjamin
que dans celle d’une culture christique. En effet, nous y retrouvons l’écho des espérances
millénaristes liées à la venue du règne du Christ comme la remise en question benjaminienne de la
conception moderne du présent.
Dans tous les mouvements indiens importants de l’histoire, la question de la résurrection a fait surface d’une
façon ou d’une autre, mais la forme demeure : le retour du refoulé. La conquête espagnole a été suivie de 500 ans
de messianisme et de prophéties, avec des expressions spécifiques au fil du temps (…). Dans cette perspective de
fond, il n’est pas surprenant que, parmi les peuples indigènes, des présages ou des expressions messianiques
annoncent la fin de l’exploitation, des revendications auxquelles ils furent soumis et des bons moments à venir.
À la fin du XVII siècle, les millénarismes ont été réaffirmés, les peuples indiens avaient besoin d’un rédempteur
pour se libérer de l’oppression à laquelle ils étaient soumis. (Tarrio et Concheiro Borquez, 2006)
Emiliano Zapata, lors de la révolution mexicaine et de la marche vers le palais présidentiel, avait
refusé de s’asseoir sur le fauteuil présidentiel, contrairement à Pancho Villa. Et c’est aussi la ligne
du mouvement actuel: les zapatistes ne veulent pas prendre le pouvoir, ils et elles ne veulent pas
s’emparer de l’État, ce qui pose ainsi les bases de l’autonomie et de la communalité, deux notions
essentielles aux mouvements autochtones qui se sont développés depuis.
Ce qui est également remarquable dans ce mouvement, c’est l’union entre métis-ses. et Indien-ne-s,
car Marcos, ce leader métis, de tradition marxiste-léniniste, contrairement à une vieille habitude qui
avait culminé avec l’indigénisme, va cesser de parler au nom des Indien-ne-s. Il essaiera d’établir
un pont entre la critique sociale et la cosmovision indigène, son rôle devenant avec le temps de plus
en plus discret et les leaders étant désormais tous et toutes indigènes, une place importante ayant été
prise par les femmes.
Les aspects les plus innovateurs du mouvement ne sont pas les plus connus : on a beaucoup focalisé
sur la figure charismatique de Marcos36 et son sens génial de la mise en scène et de la parole.
Beaucoup moins sur les principes d’organisation et de luttes ou sur la puissance et l’originalité
du féminisme zapatiste. Jérôme Baschet (2014) qui suit le mouvement et le soutient depuis le début
a produit de nombreuses analyses sur ce mandar obedeciendo qui les caractérise. Les zapatistes ne
36“sous-commandant Marcos”, appellation ironique dans la mesure où un tel grade n’existe pas dans la hiérarchie
militaire, est le nom de guerre de Rafael Sebastián Guillén Vicente, militant altermondialiste méxicain qui a été
jusqu’en 2014 le porte- parole officiel et le leader de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale qu’il avait
rejoint en 1984 dans le Chiapas.
Licence Creative Commons 4.0.
384
veulent prendre le pouvoir, mais ce n’est pas pour autant qu’ils et elles refusent de l’exercer dans le
cadre de la société qu’ils et elles organisent. Depuis 2003, les 38 communes autonomes désignent
des représentant-e-s dans cinq Conseils de bon gouvernement. On remarquera ici la ressemblance
avec la proposition faite dans Nueva corónica y buen gobierno par Guamán Poma de Ayala, au XVI
siècle. Pour Jérôme Baschet, 2003 a été un moment décisif, durant lequel les zapatistes ont décidé
d’appliquer ce qui aurait du l’être dans le cadre de l’État et si les accords de San Andrés n’avaient
pas été trahis.
L’organisation des communes autonomes se fonde sur celle, traditionnelle, de la commune indienne.
Il n’y a pas de spécialistes de la gestion sociale mais des « charges » municipales non payées,
exercées pendant deux ou trois ans au maximum. Chaque commune délègue deux ou trois
représentant-e-s au Conseil de sa zone. Les délégué-e-s au conseil se relaient par période de 12 à 15
jours. Un des aspects intéressants des délibérations dans les conseils est la forme qu’elles y
prennent. Leur lenteur, incompréhensible pour un-e occidental-e, s’explique par la volonté de
rechercher un consensus et surtout d’empêcher la formation d’une distance entre le Conseil et les
communes. D’autre part, le fait que certaines propositions ne soient pas adoptées ne signifie pas
nécessairement qu’on les rejette mais simplement qu’elles sont mises de coté. Les zapatistes sont
attentifs et attentives à la dé-spécialisation de la politique. En ce qui concerne l’organisation de
communes, qui tiennent leur propre registre d’état civil, et administrent la justice, il s’agit moins,
dans le cadre de la justice par exemple, d’infliger une punition que de chercher une réconciliation
négociée entre les parties. Quant au système éducatif, dans lequel les enseignant-e-s ne reçoivent
pas de salaire mais sont pris-es en charge par la commune, il repose sur des principes qui auraient
plu à Paolo Freire. Il s’agit de donner du sens à ce que les jeunes apprennent, de créer et de
participer à une dynamique de transformation sociale où la revendication indienne s’inscrit dans le
mouvement plus vaste d’une humanité rebelle.
Pour ce qui est de l’expérience féministe, dont rend compte la figure médiatique de la comandante
Esther, on remarquera qu’elle ne s’énonce pas nécessairement à travers ce vocabulaire. Dans ce
mouvement, il n’est pas nécessaire de se dire féministe pour agir comme tel-le. Le féminisme
autochtone zapatiste n’est pas anti-homme comme certaines formes de féminisme séparatiste
radical, mais il change profondément la commune indienne. Son influence sur le mouvement
féministe latino-américain décolonial est importante, comme en témoigne l’interview de Márgara
Millán ou celle de Karina Ochoa dans Feminismos a la contra (2019).
Le mouvement zapatiste est un des premiers a avoir développé et posé la question de l’autonomie et
donc, à proposer une façon de penser la politique et la vie autrement que dans les structures
Licence Creative Commons 4.0.
385
habituelles de l’État-nation. Il a également été capable de montrer à travers sa pratique que les
structures du pouvoir sont patriarcales, racistes et capitalistes. Enfin, leur slogan « un
monde qui en comprenne plusieurs », a fait d’eux et d’elles les premiers et premières à établir la
nécessité de sortir de l’Univers pour aller vers le Plurivers.
Références
Antillón, Ximena. 2005. « Caracoles et conseils de bon gouvernement. Une autre façon de
gouverner : « Commander en obéissant » ». Revue DIAL.
http://www.alterinfos.org/spip.php?article960
Arnaud, Julia et Espoir Chiapas. 2019. « Nouvelles zapatistes : « Notre lutte est pour la vie » ».
Ballast.
https://www.revue-ballast.fr/nouvelles-zapatistes-notre-lutte-est-pour-la-vie-2/
Baschet, Jérôme. 2014. « Autonomie, indianité et anticapitalisme : l’expérience zapatiste ». Actuel
Marx, vol. 56, no. 2 : 23-39.
Bourguignon Rougier, Claude. 2010. Stratégies romanesques et construction des identités
nationales. Essai sur l’imaginaire postcolonial dans quatre fictions de la forêt : 181.
Comandancia general del EZLN. 1994. Primera Declaración de la Selva Lacandona. Enlace
zapatista.
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-selva-lacandona/
Goutte, Guillaume. « Que deviennent les zapatistes, loin des grands médias?». Ballast.
https://www.revue-ballast.fr/guillaume-goutte-la-lutte- zapatiste/?pdf=505
Ochoa, Karina. 2019. « Un desafío para los feminismos descoloniales : complejizar la cuestión del
mestizaje ». Feminismos a la contra, sous la dir. de Luis Martínez Andrade : 53.175.
Tarrío García, María et Concheiro Bórquez, Luciano. 2006. « Chiapas : los cambios en la tenencia
de la tierra ». Argumentos. vol.19. n.51 : 34
http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v19n51/v19n51a2.pdf
Licence Creative Commons 4.0.
386
98. Zone de non être
CLAUDE BOURGUIGNON ROUGIER
La zone de non-être est un concept de Frantz Fanon. Dans l’introduction de Peaux noires, masques
blancs, il écrit :
Il y a une zone de non-être, une région extraordinairement stérile et aride, une rampe essentiellement dépouillée,
d’où un authentique surgissement peut prendre naissance. Dans la majorité des cas, le Noir n’a pas le bénéfice de
réaliser cette descente aux véritables Enfers. (Fanon, 1952)
Ce concept a donné lieu à des interprétations diverses. Ramón Grosfoguel a souvent recours à cette
métaphore de la zone du non-être mais il lui donne un sens plus sociologique, moins ambigu. Chez
lui, l’idée rappelle celle de « ligne abyssale » propre à Boaventura de Sousa Santos. Elle devient
une interprétation décoloniale de ces anciennes lignes qui furent tracées avec la « Découverte » de
l’Amérique et découpaient l’écoumène d’une façon inédite, instaurant, dans les faits, une certaine
division du monde dont nous ne sommes pas sorti-e-s.
Pour Fanon, le racisme est une hiérarchie de supériorité et d’infériorité, située sur la ligne séparant l’humain du
non-humain. Cette hiérarchie est politiquement produite et reproduite depuis plusieurs siècles par le système
impérialiste/occidentalocentré/ capitaliste/patriarcal/moderne/colonial. Les personnes situées au-dessus de cette
ligne sont reconnues socialement comme des êtres humains ayant accès non seulement à des droits (humains,
citoyens, civils, sociaux) mais aussi à la subjectivité. L’humanité des personnes situées au-dessous de cette ligne
est questionnée. (Grosfoguel, 2012)
Il insiste sur l’existence des deux zones :
Dans la zone de non-être, parce que les sujets sont racialisés en tant qu’êtres inférieurs, ils vivent l’oppression
raciale et non le privilège racial. L’oppression de classe, de genre et d’orientation sexuelle vécue dans la zone de
non-être est qualitativement distincte de celle vécue dans la zone de l’être. Il y a une différence qualitative entre
la manière dont les oppressions intersectionnelles sont vécues dans la zone de l’être ou celle du non-être dans le
système-monde moderne, colonial, capitaliste, patriarcal, occidentalo-centré et christiano-centré. (Grosofguel,
2012)
Pour Nelson Maldonado Torres, la zone du non-être apparaît liée à la colonisation de trois
dimensions de l’être : le temps, l’espace et la subjectivité. Elle renvoie à la ligne ontologique
moderne/coloniale qui crée des zones d’être et d’autres de non être :
Licence Creative Commons 4.0.
387
La ligne ontologique moderne/coloniale ne fait pas de distinction entre l’Être et les êtres, comme le proposait
Heidegger avec sa notion de différence ontologique. Elle établit plutôt une division entre l’Être et les êtres tels
qu’ils sont vus à l’intérieur de la modernité et ceux qui sont conçus comme extérieurs à cette sphère. Il s’agit
d’une différence ontologique moderne/coloniale, à laquelle j’ai également fait référence en tant que co-différence
sous-ontologique. (Maldonado, 2012)
Mais il y a une ambiguïté propre à la phrase de Fanon et sa remise en question radicale de
l’ontologie, nous dit le philosophe argentin Alejandro de Oto (2014). Elle tient à cette
transformation des Noir-e-s, qui est possible lors de leur trop rare descente aux véritables Enfers.
Pour Alejandro De Oto, il s’agit d’une transformation qui n’est pas la possibilité d’une nouvelle
ontologie, cette ontologie que le colonialisme a rendu pratiquement impossible. La transformation
dont parle Fanon est le dépassement de l’ontologie et des registres de l’identité qui lui sont liés. Il
ne faudrait pas lire la zone du non être chez Fanon comme celle qui est la plus défavorisée, la plus
victimisée par la relation moderne/coloniale. Cela nous enfermerait dans le dualisme propre à la
modernité, qui oppose l’Être au non être, l’opulence à la misère, la vie à la mort. Ce serait la
confondre avec la ligne abyssale de Boaventura de Sousa Santos ou, encore, avec la ligne de
couleur de William E.B. Du Bois. Il y a, dit Alejandro de Oto (2014), chez Frantz Fanon, l’idée d’un
au-delà de l’être qui est un dépassement de la modernité/colonialité. Frantz Fanon, parce qu’il
constate qu’il n’y a qu’un destin possible, être blanc, (les Noir-e-s n’existant que dans leur relation
aux Blanc-he-s, n’ayant pas d’être) fait émerger des spectralités qu’il n’est pas possible de dominer
par le discours. C’est là que peut commencer un voyage qui émancipe vraiment.
Le concept fanonien apparaît ici dans toute sa complexité.
Références
Fanon, Frantz. 1952. Peaux noires, masques blancs. Chicoutimi : Les Classiques des Sciences
Sociales : 29.
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/
peau_noire_masques_blancspeau_noire_masques_blancs.pdf
Ramón Grosfoguel, Jim Cohen. 2012. « Un dialogue décolonial sur les savoirs critiques entre
Frantz Fanon et Boaventura de Sousa Santos » : 43. 44. Mouvements.
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-4-page-42.htm?contenu=resume
Licence Creative Commons 4.0.
388
Nelson Maldonado-Torres, 2012. « Transdisciplinariedad y decolonialidad ».
© Quaderna : 9.
https://quaderna.org/transdisciplinariedad-y-decolonialidad/
Oto, Alejandro de, Katzer Molina, Maria Leticia. 2014. « Trás la huella del acontecimiento: entre la
zona del no ser y la ausencia radical». Maracaibo: Utopía y praxis latinoamericana.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/37527
Oto, Alejandro de. 2018. « A propósito de Frantz Fanon. Cuerpos coloniales y representación ».
Pléyade.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-
36962018000100073&lng=es&nrm=iso
Licence Creative Commons 4.0.
389
Index
Introduction, 4.
Claude Bourguignon Rougier
1. Abya Yala, 15.
Claude Bourguignon Rougier
2. Afro Abya Yala, 17.
Sébastien Lefévre
3. Afro-décolonialité, 20. .
Paul Mvengou Cruz Merino
4. Amérique latine- 23
Claude Bourguignon Rougier
5. Ancestralité, 26.
Paul Mvengou Cruz Merino
6. Anthropologies autres, 28.
Claude Bourguignon Rougier
7. Anthropophage, 34.
Claude Bourguignon Rougier,
8. Archaïsme, 36.
Claude Bourguignon Rougier
9. Autonomie, 39.
Claude Bourguignon Rougier
10. Barbarie, 46.
Claude Bourguignon Rougier
11. Blanchité, 51.
Claude Bourguignon Rougier
12. Brujo/Hechicero/Doble-Animal, 53.
Paul Mvengou Cruz Merino
13. Buen Vivir, 54.
Claude Bourguignon Rougier
14. Calle 13/Latinoamérica, 57 .
Sébastien Lefévre
15. Castro Gómez, Santiago, 58.
Licence Creative Commons 4.0.
390
Claude Bourguignon Rougier
16. Changó el gran putas, 64.
Sébastien Lefévre
17. Chaos, 68
Sébastien Lefévre
18. Citoyenneté, 71.
Claude Bourguignon Rougier
19. Colonialisme interne, 73.
Claude Bourguignon Rougier
20. Colonialité de l'être-79.
Claude Bourguignon Rougier, p.
21. Colonialité de genre, 82.
Claude Bourguignon Rougier
22. Colonialité de la nature, 89.
- Claude Bourguignon Rougier
23. Colonialité du pouvoir, 94
- Claude Bourguignon Rougier,
24. Colonialité du savoir, 99.
Claude Bourguignon Rougier
25. Coronil, Fernando, 102.
Claude Bourguignon Rougier
26. Curiel, Ochy, 106.
Claude Bourguignon Rougier
27. Dépendance (théorie), 109.
Claude Bourguignon Rougier,
28. Détachement, 114.
Claude Bourguignon Rougier
29. Développement, 116.
Claude Bourguignon Rougier
30. Différence impériale, différence coloniale, 124.
Claude Bourguignon Rougier
31. Dussel, Enrique, 126.
Claude Bourguignon Rougier,
32. Disparition, 131.
Claude Bourguignon Rougier,
33. Ego Conquiro, 135.
Claude Bourguignon Rougier
34. Egopolitique et théopolitique, 138.
Claude Bourguignon Rougier
Licence Creative Commons 4.0.
391
35. Émancipation, 140.
Claude Bourguignon Rougier
36. Esclave vs esclavagisé-e /Esclavage et esclavagisation, 143.
Sebastien Lefévre
37. Escobar, Arturo, 145.
Claude Bourguignon Rougier
38. Être-Ser et Être-estar, 154.
Fernando Proto Gutierrez,
39. E.sy kennenga, 158.
Sébastien Lefévre
40. Ethno-éducation, 163.
Paul Mvengou Cruz Merino
41. Études transatlantiques afrodiasporiques, 166
-Sébastien Lefévre et Paul Mvengou Cruz Merino,
42. Extériorité, 169..
Claude Bourguignon Rougier,
43. Extractivisme, 172.
Claude Bourguignon Rougier,
44. Fanon, Frantz, 176.
Sébastien Lefévre
45. Féminisme décolonial, 180.
Claude Bourguignon Rougier,
46. Féminicide, 187.
Claude Bourguignon Rougier
47. Firmin, Anténor, 190.
Sébastien Lefévre
48. Géopolitique de la connaissance, 193.
Claude Bourguignon Rougier,
49. Globocentrisme, 195.
Claude Bourguignon Rougier
50. Grosfoguel, Ramón, 197.
Claude Bourguignon Rougier,
51. Habencia (la) comme point de départ de la philosophie de la libération, 201.
Fernando Proto Gutierrez
52. Haïti/Ayiti, 206.
Paul Mvengou Cruz Merino
53. Indépendances latino-américaines et caribéennes, 209.
Sébastien Lefévre
54. Indien-ne/Indigène/Peuple originaire, 212.
Paul Mvengou Cruz Merino
Licence Creative Commons 4.0.
392
55. Inti Raymi, 214.
Claude Bourguignon Rougier
56. Kilombo, Mocambo, Palenques, Cumbes, 217.
Paul Mvengou Cruz Merino
57. Lander, Edgardo, 219.
Claude Bourguignon Rougier
58. Lugones, Maria, 221.
Claude Bourguignon Rougier
59. Lumbalú, 225.
Paul Mvengou Cruz Merino
60. Maldonado Torres, Nelson, 226.
Claude Bourguignon Rougier
61. Malambo et Perro Viejo, 232.
Sébastien Lefévre
62. Malês (Soulèvement des), 234.
Jonnefer Barbosa
63. Malungaje, 237.
Paul Mvengou Cruz Merino
64. Mendoza, Breny, 329.
Claude Bourguignon Rougier
65. Métissage, 243.
Claude Bourguignon Rougier
66. Mignolo, Walter, 247.
Claude Bourguignon Rougier
67. Modernité, 254.
Claude Bourguignon Rougier
68. Monte, 261.
Paul Mvengou Cruz Merino
69. Noir/Noire/Nègre/Mulâtre/Mulâtresse/Blanc/Blanche, 263.
Sébastien Lefévre
70. Ontologie(s), 266.
Claude Bourguignon Rougier
71. Opprimé-e-s (pédagogie), 270.
Claude Bourguignon Rougier
72. Orishas en déportation, 273.
Paul Mvengou Cruz Merino
73. Palo Monte (el), 275.
Paul Mvengou Cruz Merino
74. Paredes, Julieta, 276.
Claude Bourguignon Rougier
Licence Creative Commons 4.0.
393
75. Passage du Milieu (le), 280.
Paul Mvengou Cruz Merino
76. Patriarcat, 281.
Claude Bourguignon Rougier
77. Philosophie de la libération, 284.
Claude Bourguignon Rougier
78. Plurivers, 288.
Claude Bourguignon Rougier
79. Politiques de disparition, 291.
Jonnefer Barbosa
80. Poma de Ayala (Guamán),
Claude Bourguignon Rougier
81. Post-occidentalisme,
Claude Bourguignon Rougier
82. Pureté de sang,
Claude Bourguignon Rougier
83. Projet Modernité/Colonialité. Brève généalogie-,
Claude Bourguignon Rougier
84. Quijano, Aníbal,
Claude Bourguignon Rougier
85. Race et Abya Yala, 323.
Claude Bourguignon Rougier
86. Rébellion (la Grande), 333.
Claude Bourguignon Rougier
87. Rencontre des peuples Noirs. Encuentro de los Pueblos Negros, 342.
Paul Mvengou Cruz Merino
88. Reinaga, Fausto, 344.
Claude Bourguignon Rougier
89. Rivera Cusicanqui, Silvia, 351.
Claude Bourguignon Rougier
90. Segato, Rita Laura, 359.
Claude Bourguignon Rougier
91. Syncrétisme, 362.
Paul Mvengou Cruz Merino
92. Syncrétisme et métissage : l’exemple des Orishas en déportation, 364.
Sébastien Lefévre
93. Théologie de la libération, 369.
Claude Bourguignon Rougier
94. Tournant décolonial, 372.
Claude Bourguignon Rougier
Licence Creative Commons 4.0.
394
95. Transmodernité, 375.
Claude Bourguignon Rougier
96. Walsh, Catherine, 379.
Claude Bourguignon Rougier
97. Zapatisme, 383.
Claude Bourguignon Rougier
98. Zone de non être, 388.
Claude Bourguignon Rougier,
Licence Creative Commons 4.0.
395
Vous aimerez peut-être aussi
- Hollywar - Hollywood, Arme de P - Pierre ConesaDocument96 pagesHollywar - Hollywood, Arme de P - Pierre Conesavece100% (2)
- A6C - Les Marrons de La Liberté (Resenha)Document5 pagesA6C - Les Marrons de La Liberté (Resenha)Anonymous OeCloZYzPas encore d'évaluation
- Mes Etoiles Noires Lilian ThuramDocument317 pagesMes Etoiles Noires Lilian ThuramMadiop NgomPas encore d'évaluation
- FEDERICI. Aux Origines Du Capitalisme Patriarcal. Entretien PDFDocument9 pagesFEDERICI. Aux Origines Du Capitalisme Patriarcal. Entretien PDFLeticiaGarducciPas encore d'évaluation
- 2020-0161812 - L'effet Pangolin - La Tempête Qui Vient en Afrique PDFDocument6 pages2020-0161812 - L'effet Pangolin - La Tempête Qui Vient en Afrique PDFAli AmarPas encore d'évaluation
- A Propos Du DécolonialDocument6 pagesA Propos Du DécolonialethanPas encore d'évaluation
- Africanus Archéofuturisme: Une vérité pour une Afrique Post MandelaD'EverandAfricanus Archéofuturisme: Une vérité pour une Afrique Post MandelaPas encore d'évaluation
- L'art Negro AfricainDocument66 pagesL'art Negro AfricainrebeccafroyPas encore d'évaluation
- CASIMIR, Jean - Haiti e Sa CréolitéDocument8 pagesCASIMIR, Jean - Haiti e Sa CréolitéRodrigo CBPas encore d'évaluation
- La Démocratie Est Un Pur MensongeDocument157 pagesLa Démocratie Est Un Pur MensongeAmendaPas encore d'évaluation
- Nord CamerounDocument331 pagesNord CamerounChi MadonnaPas encore d'évaluation
- Quand l'Afrique s'éveille entre le marteau et l'enclume: RomanD'EverandQuand l'Afrique s'éveille entre le marteau et l'enclume: RomanPas encore d'évaluation
- F 038021Document336 pagesF 038021SouleyPas encore d'évaluation
- Firmin de L'egalite Des Races HumainesDocument685 pagesFirmin de L'egalite Des Races HumainesGiles Colbert CharlestonPas encore d'évaluation
- Le Congo-Kinshasa Est Un Eldorado by José Mulenda-Zangela (Mulenda-Zangela, José)Document184 pagesLe Congo-Kinshasa Est Un Eldorado by José Mulenda-Zangela (Mulenda-Zangela, José)Leblanc BahigaPas encore d'évaluation
- Pour Comprendre Les Discriminations Racistes. Dialogue Imaginaire Entre Deux HabitantsDocument14 pagesPour Comprendre Les Discriminations Racistes. Dialogue Imaginaire Entre Deux HabitantsbakuninjaPas encore d'évaluation
- LAfrique Noire Pré-Coloniale (Cheikh Anta Diop) (Z-Library)Document256 pagesLAfrique Noire Pré-Coloniale (Cheikh Anta Diop) (Z-Library)willbaPas encore d'évaluation
- Femmes Et Décolonisation en Afrique Occidentale FrançaiseDocument21 pagesFemmes Et Décolonisation en Afrique Occidentale FrançaiseCidinalva CâmaraPas encore d'évaluation
- W. E. B. Du Bois Les Ames Du Peuple Noir PDFDocument353 pagesW. E. B. Du Bois Les Ames Du Peuple Noir PDFFBS Groupe100% (1)
- Amadou Hampate Ba Le Sage Qui RiaitDocument2 pagesAmadou Hampate Ba Le Sage Qui RiaitkountiyouPas encore d'évaluation
- Ident It e Martini Quais eDocument277 pagesIdent It e Martini Quais erosadosreisciprianoPas encore d'évaluation
- Le Role de L'intellectuel CongolaisDocument5 pagesLe Role de L'intellectuel CongolaisLorraine M. ThompsonPas encore d'évaluation
- Sakata (Peuple) - WikipédiaDocument1 pageSakata (Peuple) - WikipédiaGlody mbembePas encore d'évaluation
- La Rupture Epistemologique de Cheikh Anta DiopDocument9 pagesLa Rupture Epistemologique de Cheikh Anta DiopKOFSocker100% (1)
- Pensee Africaine e EducationDocument7 pagesPensee Africaine e EducationaelijahPas encore d'évaluation
- LesSociétésColoniales BibliographieAgreg 2012Document43 pagesLesSociétésColoniales BibliographieAgreg 2012anargratos100% (3)
- Pensees Africaines - Titinga-Frederic PacereDocument378 pagesPensees Africaines - Titinga-Frederic PacereAmendaPas encore d'évaluation
- Etat Des Lieux de L'afriqueDocument40 pagesEtat Des Lieux de L'afriquepallassiPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de La Négritude - Mongo BetiDocument251 pagesDictionnaire de La Négritude - Mongo BetiAndré David KrouboPas encore d'évaluation
- Histoire PanafricanismeDocument209 pagesHistoire PanafricanismePrivat YACOLIPas encore d'évaluation
- La Littérature Africaine Dans Son EssenceDocument226 pagesLa Littérature Africaine Dans Son EssencerwatzaPas encore d'évaluation
- Rehabilitation Race Noire HaitiDocument697 pagesRehabilitation Race Noire HaitiEmmanuel SaintunyPas encore d'évaluation
- La Philosophie Bantoue PDFDocument10 pagesLa Philosophie Bantoue PDFPaulo MarquesPas encore d'évaluation
- L'ecriture Sowfallienne Au Secours D'une Societe en Degenerescence: Une Etude de Festins de La DetresseDocument133 pagesL'ecriture Sowfallienne Au Secours D'une Societe en Degenerescence: Une Etude de Festins de La DetresseJustin OduroPas encore d'évaluation
- 03-Historiographie Africaine T. BahDocument66 pages03-Historiographie Africaine T. BahBouta chrysPas encore d'évaluation
- Les Royaumes Unis de Kama FRENCHDocument101 pagesLes Royaumes Unis de Kama FRENCHLaurent Ferry Siégni100% (1)
- Histoire de Léducation en Afrique Subsaharienne (Laurent Falay Lwanga)Document192 pagesHistoire de Léducation en Afrique Subsaharienne (Laurent Falay Lwanga)Abdou halidou tidjaniPas encore d'évaluation
- Culture Et Colonisation (21p) - Aimé CesaireDocument21 pagesCulture Et Colonisation (21p) - Aimé CesaireMichal wojcikPas encore d'évaluation
- Dictionnaire Enjoué Des Cultures Africaines (Mabanckou Alain Etc.) French (Z-Library)Document285 pagesDictionnaire Enjoué Des Cultures Africaines (Mabanckou Alain Etc.) French (Z-Library)sambaPas encore d'évaluation
- La Mygale Et La Panthere NotuéDocument390 pagesLa Mygale Et La Panthere NotuéJéhu Nicolas Konda YansaPas encore d'évaluation
- Encre, Sueur, Salive Et SangDocument216 pagesEncre, Sueur, Salive Et SanghelcsePas encore d'évaluation
- Les Âmes Du Peuple NoirDocument316 pagesLes Âmes Du Peuple NoirJEanPas encore d'évaluation
- Theme de MemoireDocument46 pagesTheme de Memoireemana44100% (1)
- Dieu Est Ne en Afrique NoireDocument7 pagesDieu Est Ne en Afrique NoireNfoundi FefePas encore d'évaluation
- ProblématiqueDocument6 pagesProblématiqueaminaPas encore d'évaluation
- Bungunza Complet NewDocument258 pagesBungunza Complet NewDavid ChristPas encore d'évaluation
- Sur La Piste Des MythesDocument165 pagesSur La Piste Des MythesRobert Gauthier100% (2)
- Le Problème de L'afrique Par Peter VakuntaDocument2 pagesLe Problème de L'afrique Par Peter VakuntaPeter Massimo De QuissemaPas encore d'évaluation
- Hurbon, Laennec (1987) Comprendre Haïti. Essai Sur L'état, La Nation, La Culture PDFDocument167 pagesHurbon, Laennec (1987) Comprendre Haïti. Essai Sur L'état, La Nation, La Culture PDFFelipe SilvaPas encore d'évaluation
- FLO - Intérêt de La Philosophie Négro Africain PDFDocument35 pagesFLO - Intérêt de La Philosophie Négro Africain PDFdrago_rossoPas encore d'évaluation
- D'un Maître À L'autre - L'histoire D'un Transfert Amadou Hampaté Bâ Entre Tierno Bokar Et Theodore MonodDocument30 pagesD'un Maître À L'autre - L'histoire D'un Transfert Amadou Hampaté Bâ Entre Tierno Bokar Et Theodore MonodIbrahima SakhoPas encore d'évaluation
- Imaginaires Et UtopiesDocument249 pagesImaginaires Et UtopiesGeorges J-f Bertin100% (1)
- OMOTUNDEDocument3 pagesOMOTUNDEclaro leger100% (1)
- Aimé Césaire - Discours Sur Le ColonialismeDocument41 pagesAimé Césaire - Discours Sur Le ColonialismeKonan Arsene Kouadio100% (1)
- Conséquences Actuelles de La Traite Négrière en AfriqueDocument6 pagesConséquences Actuelles de La Traite Négrière en AfriqueMohamed Lamine KABAPas encore d'évaluation
- Capitalisme Et EsclavageDocument264 pagesCapitalisme Et EsclavageSergePas encore d'évaluation
- De L'égalité Des Races Humaines - Antenor FirminDocument686 pagesDe L'égalité Des Races Humaines - Antenor FirminPensées Noires100% (1)
- La Mauritanie Et Les Etudes Postcolonial PDFDocument18 pagesLa Mauritanie Et Les Etudes Postcolonial PDFvordevanPas encore d'évaluation
- Le Peuple Contre La Démocratie - Yascha MounkDocument4 pagesLe Peuple Contre La Démocratie - Yascha MounkakPas encore d'évaluation
- Rapport Bande Dessinée-Pierre LungherettiDocument162 pagesRapport Bande Dessinée-Pierre LungherettiActuaLitté100% (3)
- Histoire Du Parti Libéral BelgeDocument18 pagesHistoire Du Parti Libéral BelgeMélisa MaggioPas encore d'évaluation
- La Françafrique Le Plus Long Scandale de La République (François-Xavier Verschave)Document386 pagesLa Françafrique Le Plus Long Scandale de La République (François-Xavier Verschave)Service AdministratifPas encore d'évaluation
- Catholique Et AntisemiteDocument26 pagesCatholique Et AntisemiteChevalier Du Christ TemplierPas encore d'évaluation
- L'invasion Allemande de La Belgique, Léon Van Der Essen, 1917 PDFDocument572 pagesL'invasion Allemande de La Belgique, Léon Van Der Essen, 1917 PDFsucrionPas encore d'évaluation
- 768 PDFDocument27 pages768 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Le Concert Européen - La Construction Des Relations Internationales Par La Nation.Document8 pagesChapitre 2 - Le Concert Européen - La Construction Des Relations Internationales Par La Nation.Mica CastilloPas encore d'évaluation
- Ecrire Un RomanDocument13 pagesEcrire Un RomanNorman DestexhePas encore d'évaluation
- La Révolution Haïtienne - Une Avancée PostcolonialeDocument12 pagesLa Révolution Haïtienne - Une Avancée PostcolonialeJorge LuisPas encore d'évaluation
- Min-Jus 2017-01-26 Circulaire DCM - Presentation Des DispositionsDocument38 pagesMin-Jus 2017-01-26 Circulaire DCM - Presentation Des DispositionsRAMONASPas encore d'évaluation
- 675 Em10062012Document20 pages675 Em10062012elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation