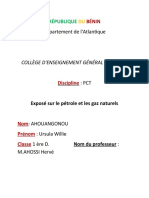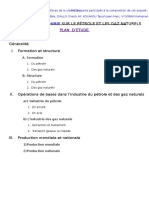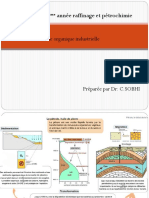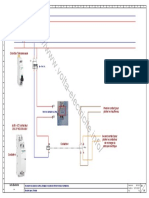Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
tleF4BAMEB Courspdf
tleF4BAMEB Courspdf
Transféré par
Landry MelodyTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
tleF4BAMEB Courspdf
tleF4BAMEB Courspdf
Transféré par
Landry MelodyDroits d'auteur :
Formats disponibles
Leçon3 : Les pétroles et les gaz naturels
Objectif :
-Définir : craquage, le reformage, la distillation, la polymérisation et polycondensation.
-Connaitre les problèmes écologiques liés à l’industrie du pétrole, les tests d’identification
des polymères:
1-Origine et extraction des pétroles et gaz naturels.
1.1-Origine
Les pétroles et gaz naturels proviennent de la décomposition des matières organiques
enfouies dans le sol.
-Entre 1000 et 4000m de profondeur, ces matières organiques se transforment en pétrole.
-Entre 4000 et 5000m, les conditions géothermiques transforment ces matières organiques
en gaz naturel.
1.2-Technique d’extraction
Le pétrole est extrait des profondeurs du sol par des forages. Le pétrole extrait par forage est
traité par divers techniques pour donner de multiples dérivés.
1.3-Dérivés du pétrole
Les dérivés ou coupes du pétrole sont : l’essence, le fuel, le kérosène, le pétrole lampant, le
gasoil, le bitume. Une coupe de pétrole est l’ensemble des constituants du pétrole ayant la
température d’évolution voisine.
2-Constituants du pétrole et des gaz
2.1-Pétrole
Les pétroles sont des liquides visqueux de couleur brune ou noire. Ce sont des mélanges
d’alcanes, de cyclanes et d’hydrocarbures aromatiques.
2.2-Gaz naturel
Les gaz naturels contiennent toujours de l’eau, les alcanes et d’autres constituants comme le
sulfure d’hydrogène. Les opérations de traitement des gaz naturels comportent au moins
trois étapes : Le séchage, la désulfuration et la distillation fractionnée.
3-Raffinage
3.1-Définition
Le raffinage est l’ensemble des opérations de traitement du pétrole brut. Il comporte deux
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
étapes : la distillation, les opérations de craquage et de reformage.
3.2-Distillation
C’est le procédé de séparation des différents constituants d’un mélange homogène liquide -
liquide. Elle consiste à chauffer le mélange jusqu’à vaporisation et les premières vapeurs
recueillies sont condensées à l’aide d’un réfrigérant. Il existe deux types de distillation : la
distillation simple et la distillation fractionnée (distillation du distillat).
3.3-Craquage
C’est une opération chimique qui transforme les hydrocarbures lourds en hydrocarbures
légers.
Exemple: CH3-(CH2)2-CH3 → CH3-CH3 + CH2=CH2
3.4-Le reformage
C’est une opération qui consiste à modifier la structure d’un hydrocarbure sans modifier son
nombre d’atomes de carbone afin d’améliorer son indice d’octane.
CH3 CH3
Exemple: CH3-(CH2)6-CH3 → CH3-CH-CH2-C-CH3
CH3
On appelle indice d’octane, le degré de résistance d’un carburant à l’auto inflammation.
3.5-Vapocraquage
C’est un craquage qui se fait en présence des vapeurs d’eau sans catalyseur vers 800°C. Son
intérêt est d’obtenir majoritairement des alcènes qui sont utilisés dans la synthèse des
matières plastiques.
Exemple: CH3-(CH2)2-CH3 → 2CH2=CH2 + H2
4-
Transformation des produits pétroliers.
4.1-Consommation
Les produits pétroliers sont utilisés comme source d’énergie et engrais
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
-production d’électricité : centrales à fuel
-les transports : voitures, train, avion, route bitumée
-cuisson des aliments : four à gaz, réchaud à pétrole -Engrais chimique.
4.2-Problème de pollutions liées au traitement et à l’industrie
L’utilisation du pétrole est responsable de plusieurs types de pollution :
-La pollution atmosphérique : combustion, effet de serre dû à l’augmentation du taux de
dioxyde de carbone dans l’atmosphère, pollution acide due aux oxydes de carbones, de
soufre et d’azote.
- La pollution des eaux : les marées noires dû aux accidents des pétroliers dans les océans.
5-Les matières plastiques
5.1: Synthèse
Les matières plastiques s’obtiennent par association des adjuvants à certains polymères. On
les classe en trois catégories : les matières thermoplastiques, les matières thermodurcissables,
les élastomères. Les plus courants sont :
-le polyéthylène (PE), de motif (-CH2-CH2-), est utilisé pour les emballages. Il peut être de
basse densité (PEBD) ou de haute densité (PEHD).
-Le polyéthylène téréphtalate (PET). Il est utilisé pour les bouteilles de boissons gazeuses.
-Le polychlorure de vinyle (PVC), de motif (-CH2-CHCl-) est utilisé en tuyauterie. Il peut être
simple ou rigide.
-Le polystyrène (PS), de motif (-CH2-CHC6H5-) est utilisé pour les objets comme la règle
transparente, boîtes rigide. Sous sa forme expansée (PSE) est utilisée pour les emballages des
appareils électroniques.
5.2-Tests d’identification
Pour distinguer les matières plastiques, on peut utiliser les tests suivants :
-Test de densité : Seul le polyéthylène flotte sur l’eau.
-Test au chauffage : PE, PVC, PS, et PET se ramollissent à chaud. Seul le PVC donne une
flamme verte.
-Test de solubilité : le PS et le PVC sont solubles dans l’acétone alors que PE et PET ne le sont
pas.
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
Leçon4 : COMPOSITION CHIMIQUE DES SOLS, LES ENGRAIS
Objectifs :
-Montrer l’importance des engrais et leurs utilisations dans l’agriculture.
-Montrer les risques de pollution des sols et des eaux qui en découlent
Introduction :
L’homme se nourrit principalement des produits de culture or ces cultures appauvrissent le
sol en éléments nutritifs. L’homme a donc toujours cherché à enrichir le sol par divers moyens
entre autre, l’utilisation des fumiers, de cendres etc. L’augmentation de la population
mondiale actuelle a pour conséquence l’augmentation du rendement des cultures. Pour
pallier à ce problème, l’homme utilise de nos jours les engrais pour fertiliser les sols.
1. la composition des sols.
On appelle sol la partie supérieure de l’écorce terrestre. En culture, on s’intéresse à la seule
partie arable du sol (celle cultivable), celle-ci est constituée de l’air, d’eau, de matière
minérale et organique.
1-1. Les matières minérales.
Elles sont constituées essentiellement :
-De sable (SiO2 silice).
- d’argiles constituées d’ions tels que (SiO44-, Al3+, K+, Fe3+, Ca2+, Mg2+).
-De calcaire (CaCO3)
Selon leur prédominance, on parle de sol sableux, argileux ou calcaire.
1-2.Les matières organiques.
Elles constituent l’humus qui provient de la décomposition des déchets animaux et végétaux.
L’humus s’associe en général à des particules d’argiles pour constituer le complexe argilo-
humique (CAH).
1-3.le complexe argilo-humique(C.A.H).
L’association des ions calcium avec l’argile dont l’ion SiO44- et l’humus (RCOO-) donne le CAH
représenté par :
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
Son rôle est :
De retenir les cations tels que H3O+, Ca2+, Mg2+, NH4+, K+.
D’échanger les ions avec la solution du sol ce qui permet la nutrition des plantes.
Remarque : Les anions ne sont pas retenus par le CAH sauf PO43- qui est retenu par l’ion Ca2+
pour former un pont calcique.
2.Le pH des sols.
Certaines plantes ont besoins des sols acides d’autres des sols basiques mais le rendement est
meilleur pour un sol dont le pH varie entre 6 et 8. La connaissance du pH permet d’adapter la
culture à un sol.
3.les besoins des plantes
Avant de répondre aux besoins des plantes, il faut connaître leurs compositions.
3.1 Composition chimique des plantes.
En masse, l’eau est le constituant le plus abondant des plants (90%), puis la matière sèche
formée à 99% de carbone, O, N, H, P, K, Ca, Mg. Les autres éléments sont en traces on les
appelle les aligo éléments. Ils sont indispensables en faible quantité et sont prélevés dans le
sol sous forme Fe2+, Cu2+, Mn2+, Zn2+ etc.
Les éléments C, O, H sont assimilés par les plantes lors de la synthèse chlorophyllienne
(photosynthèse).
-L’élément azote (N) est assimilé à l’état d’ion NO3- contenu dans la solution du sol ou à l’état
d’ion NH4+ qu’on trouve dans le CAH.
-L’élément phosphore (P) est assimilé sous forme d’ion PO43-, d’hydrogénophosphate (HPO42-)
dihydrogénophosphate (H2PO4-) le phosphore est essentiel à la reproduction d’une plante et la
fructification des fruits.
L’élément potassium est assimilé sous la forme d’ion K+. Il est indispensable à la synthèse
chlorophyllienne, favorise la croissance des plantes et augmente la résistance de celles-ci.
Les éléments calcium (Ca) et magnésium (constituant de la chlorophylle) sont prélevés du sol
sous forme d’ions Ca2+ et Mg2+.
3.2 Nécessité de fertilisé un sol.
Certains sols sont de nature pauvre, d’autres ne conviennent pas à une culture donné. En
général, les sols s’épuisent à cause des cultures, il faut donc les fertiliser par apports
d’éléments fertilisants dont les principaux sont N, P, et K. Ces éléments sont apportés sous
forme d’ions par les engrais.
4. les types d’engrais.
4.1 Définition :
Un engrais est un composé naturel ou chimique apporté dans un sol pour sa fructification. Il
existe des engrais organiques et des engrais minéraux.
4.2 Les engrais organiques.
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
Les engrais organiques sont obtenus à partir des produits animaux ou végétaux, ce sont :
-Le compost : produit de biodégradation d’herbes de déchets ménagers triés et de cendres.
Il a l’avantage d’être de faible cout et de fabrication facile. Il enrichie le sol de l’élément N.
-Le fumier : Il provient de la fermentation d’un mélange de paille, d’urine et d’excrément
d’animaux, il contient (N, P2O5, K2O).
4.3 Les engrais minéraux.
Ils se caractérisent par les éléments fertilisants qu’ils contiennent : L’azote (N), le phosphore
(P) et le potassium (K).
4.3.1 Les engrais simples.
a)-les engrais azotés.
Ces engrais contiennent l’élément fertilisant azote (N) Exemple : le nitrate de sodium :
(NaNO3), le nitrate de calcium Ca(NO3)2, l’urée CO(NH2)2, le nitrate d’ammonium (NH4NO3).
La teneur en N est la masse en kg de l’élément azote contenu dans 100kg d’engrais.
b)-les engrais phosphatés.
Ces engrais apportent du phosphore sous forme d’ion phosphate Exemple : Ca3(PO4)2
insoluble dans l’eau. On les transforme en engrais soluble en les faisant réagir avec l’acide
sulfurique ou l’acide phosphorique pour obtenir les ions dihydrogénophosphate (H2PO4-). La
richesse d’un engrais phosphaté s’évalue par sa teneur en élément phosphate. Elle représente
la masse en kilogramme de l’oxyde de phosphore (P2O5) que l’on peut obtenir à partir de
100kg d’engrais.
c Les engrais potassiques.
Les engrais potassiques apportent au sol l’élément potassium. Les principaux engrais qui
apportent l’élément potassium sont : le chlorure de potassium (KCl) et le sulfate de potassium
(K2SO4). La richesse d’un engrais potassique s’évalue par sa teneur en élément potassium. Elle
représente la masse en kilogramme de l’oxyde de potassium (K2O) que l’on peut obtenir à
partir de 100kg d’engrais.
4.3.2 Les engrais composés.
Ils contiennent au moins deux éléments fertilisants, on distingue :
- les engrais binaires qui contiennent deux éléments fertilisant ce sont : NP, NK, PK.
-Les engrais tertiaires ou ternaires qui contiennent les trois éléments fertilisants NPK.
Remarque : Un engrais est caractérisé par sa formule de 3 nombres X-Y-Z indiquant
respectivement et en kg, la masse d’azote (N), d’oxyde de phosphore (P2O5) et d’oxyde de
potassium (K2O) que l’on peut obtenir à partir de 100kg d’engrais.
Exercice d’application.
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
Sur un sac d’engrais on peut lire 5-12-15.
a)-Donner la signification de ces chiffres?
b)-Déterminer la masse de chaque élément fertilisant dans 100kg de cet engrais.
5. la pollution par les engrais.
Le mauvais emploi des engrais les rends dangereux pour l’environnement les ions PO43- sont
moins entrainés parce que retenus par le CAH.
Mais, sur les pentes, ils sont entrainés vers les lacs et les cours d’eaux ou ils fertilisent les
plantes aquatique qui absorbent le dioxygène dissout dans l’eau ce qui entraine la disparition
de la faune (ensemble de animaux aquatique) : c’est l’eutrophisation.
Les ions NO3- constituent la plus grande source de pollution car ne sont pas retenus par le
CAH. Ils sont facilement entrainés vers les lacs et les cours d’eaux. La consommation d’eau
riche en nitrate provoque l’anémie. Ces ions sont cancérigènes en grande dose.
Exercice d’application
L’urée de formule CO(NH2)2 s’obtient naturellement par action combinée du dioxyde
de carbone et de l’ammoniac.
1)- Ecrire l’équation de la réaction.
2)- De quel type engrais s’agit-il ?
3)-Calculer la teneur en azote de cet engrais. La comparer à celle du nitrate d’ammonium.
4)-Le nitratre d’ammonium est utilisé pour améliorer les cultures de maïs.
4.1)- Quel est l’élément fertilisant dans cette engrais ?
4.2)-Comment les plantes l’assimilent-il ?
4.3)-Quel problème pose l’utilisation abusive et incontrôler de cet engrais à l’environnement ?
4.4)-Quel danger encoure la population environnante ?
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
Leçon5 : La métallurgie, Elaboration des métaux
Objectifs:
-Interpréter un diagramme de solidification d’un alliage binaire pour décrire la solidification de
cet alliage
-Interpréter un diagramme de fer-carbone afin d’en déduire la constitution qualitative d’un
acier
1-Structure des métaux
1.1-Métaux purs et alliages
En métallurgie, les métaux purs ont peu d’utilisation, car leurs caractéristiques mécaniques
(élasticité, dureté) sont médiocres. C’est pour améliorer celles-ci que l’on constitue des
alliages par addition d’éléments étrangers en faible quantité.
1.2-Structure atomique de métaux purs
L’étude aux rayons X montre que les métaux ont une structure cristalline. Les métaux purs
sont constitués d’ions positifs identiques. Les métaux cristallisent dans les systèmes suivants :
Système Description Représentation
Cubique simple (CS) Les ions métalliques
occupent les sommets
du cube
cubique centrée (CC) Les ions métalliques
occupent les sommets
du cube et le centre du
cube
cubique à face centrée Les ions métalliques
(CFC) occupent les sommets et
le centre des faces du
cube.
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
2-Analyse thermique des alliages
2.1-Définition
L’analyse thermique consiste à relever, en fonction du temps température d’un produit.
L’alliage chauffé jusqu’ à l’état liquide se refroidit lentement sous la pression atmosphérique.
Cette analyse permet l’étude des phénomènes qui accompagnent la solidification des alliages.
2.2- Courbes de refroidissement des alliages binaires
Pour des alliages de deux éléments chimiques M1 et M2, de compositions différentes, on peut
relever trois types de courbes de solidification :
Courbe a : solidification à température constante.
Pendant la solidification la température reste égale à 𝜃s et l’analyse chimique montre que le
solide qui se dépose et le liquide conservent la même composition.
S’il s’agit d’un métal pur (100% de M1), ce palier est normal car un corps pur fond et se
solidifie à température constante.
Il n’en est pas de même dans le cas d’un alliage et l’on complète alors l’analyse thermique par
un examen micrographique:
-S’il montre un produit homogène, l’alliage est une combinaison chimique définie (C.C.D).
-S’il montre un produit hétérogène, l’alliage est un Eutectique.
Courbe b : Solidification à température variable.
Le premier cristal apparait à 𝜃𝑖 et la dernière goutte de liquide disparait à 𝜃i. L’analyse
chimique montre que l’alliage est un mélange ayant une structure homogène : il s’agit d’une
solution solide.
Courbe c : solidification en deux parties
De 𝜃1 à 𝜃2, il se dépose un solide homogène (métal pur, C.C.D, ou solution solide). A la
température 𝜃2 le solide devient hétérogène par formation d’un Eutectique.
3-Diagramme de solidification des alliages binaires
3.1-Construction du diagramme
Deux éléments chimiques M1 et M2 forment des alliages de composition variable. L’analyse
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
thermique de ces alliages permet de reporter, en fonction de leur composition centésimale en
masse, les températures de début et de fin de solidification. On relie ensuite ensemble:
-Les températures de début de solidification pour obtenir une courbe appelée liquidus.
-Les températures de fin de solidification pour obtenir une courbe appelé solidus.
L’ensemble constitue le diagramme de solidification des alliages (figure 6) constitués des
éléments chimiques M1 et M2.
3.2-Zones du diagramme de solidification
Les deux courbes (liquidus et solidus) divisent le diagramme en zones. Considérons l’alliage
constitué par x% de M2.
-A la température 𝜃1, son point représentatif de coordonnées (x, 𝜃1) se trouve en P1, au dessus
du liquidus : l’alliage est sous forme liquide (phase liquide).
-A la température 𝜃2, en P2, l’alliage est en cours de solidification (liquide + solide).
-A la température 𝜃3, en P3, l’alliage est solide (phase solide).
NB: Au-dessus du liquidus : nous avons le domaine des alliages liquides.
En dessous du solidus : nous avons le domaine des alliages solides.
3.3-Diagramme de solidification fer-carbone.
Selon la vitesse de refroidissement et la présence d’éléments chimiques étrangers. On
distingue deux diagrammes :
-Le diagramme Fer-graphite ou diagramme d’équilibre stable, caractérisé par la présence de
carbone C libre, correspond aux fontes grises.
-Le diagramme Fer-Cémentite ou diagramme d’équilibre métastable, caractérisé par la
présence de cémentite Fe3C, correspond aux aciers et aux fontes blanches.
M TCHUIDJAN Marcel Page 1 sur 1
Vous aimerez peut-être aussi
- Expose Sur Le PetroleDocument6 pagesExpose Sur Le Petrolerachel ahern88% (26)
- Fiche de Validation Au Poste - EX1Document1 pageFiche de Validation Au Poste - EX1LE CORREPas encore d'évaluation
- Camara Laye DramoussDocument65 pagesCamara Laye DramoussHanane Ben97% (33)
- MODELE Demande Récupération Cahier Des Charges Et Fiche de RenseignementDocument2 pagesMODELE Demande Récupération Cahier Des Charges Et Fiche de Renseignementfatima bouhassounPas encore d'évaluation
- Van Den Abbeel Travel As Metaphor From Montaigne To RousseauDocument205 pagesVan Den Abbeel Travel As Metaphor From Montaigne To RousseauRocío Cázares100% (1)
- PÉTROLEDocument8 pagesPÉTROLEsuccès imprimPas encore d'évaluation
- Expose de PhysiqueDocument6 pagesExpose de PhysiqueKouame Christian KOUADIO100% (1)
- Cours 3 Année Raffinage Et Pétrochimie: Chimie Organique IndustrielleDocument62 pagesCours 3 Année Raffinage Et Pétrochimie: Chimie Organique IndustrielleHadia Djelti100% (1)
- Expose Sur Le PetroleDocument5 pagesExpose Sur Le Petrolesidibelamine006Pas encore d'évaluation
- Expose Sur Le PetroleDocument5 pagesExpose Sur Le Petroleter100% (2)
- Copie de Copie de Constituants Du Petrole Et Composants Des Gaz NaturelsDocument7 pagesCopie de Copie de Constituants Du Petrole Et Composants Des Gaz NaturelsJEMI KASSIPas encore d'évaluation
- PC 1ere CD-C5 Petrole Et Gaz NaturelsDocument5 pagesPC 1ere CD-C5 Petrole Et Gaz Naturelskf2759073Pas encore d'évaluation
- IntroductionDocument5 pagesIntroductionDometanhan TuoPas encore d'évaluation
- PDF FileDocument3 pagesPDF FilebehoucarloskedePas encore d'évaluation
- Cour Chimie Industrielle Chapitre 1 Et 2Document60 pagesCour Chimie Industrielle Chapitre 1 Et 2Hadia Djelti100% (1)
- Chap 5 Petroles Et Gaz NaturelsDocument4 pagesChap 5 Petroles Et Gaz Naturelstoto TOTOROTOPas encore d'évaluation
- PetrolDocument5 pagesPetrolpeniel kedeshPas encore d'évaluation
- UntitledDocument7 pagesUntitledOuattara Mamadou FranckyPas encore d'évaluation
- Exposé PCDocument11 pagesExposé PCLouis GauvinPas encore d'évaluation
- Collège D'ensei-Wps OfficeDocument16 pagesCollège D'ensei-Wps OfficeFidèle Borîse AgrPas encore d'évaluation
- INTRODUCTIONDocument6 pagesINTRODUCTIONYvan Cedric AgoPas encore d'évaluation
- Expose Petrole Et GazDocument9 pagesExpose Petrole Et GazCYBERCAFE SKY-NET100% (5)
- Géologie Du PétroleDocument23 pagesGéologie Du Pétrolealascofast85Pas encore d'évaluation
- Corps Exposé Petrole Et GazDocument3 pagesCorps Exposé Petrole Et GazetsduniaPas encore d'évaluation
- Fiche SLC Les Combustibles FossilesDocument18 pagesFiche SLC Les Combustibles FossilesNPas encore d'évaluation
- Pétrole Et GazDocument10 pagesPétrole Et GazmekloujeanlucPas encore d'évaluation
- PC Gaz NaturelsDocument7 pagesPC Gaz NaturelsDometanhan TuoPas encore d'évaluation
- Exposé P.CDocument6 pagesExposé P.CchristellePas encore d'évaluation
- Expose de Petrole Et Gaz NaturDocument7 pagesExpose de Petrole Et Gaz NaturIdrissa Fanni100% (2)
- Noms Et Prenoms Des Eleves de La ClasseDocument7 pagesNoms Et Prenoms Des Eleves de La ClasseachieangelePas encore d'évaluation
- 537ddb3b87976 PDFDocument7 pages537ddb3b87976 PDFAimen D BouzidPas encore d'évaluation
- Expose de PCDocument4 pagesExpose de PCOumar FondioPas encore d'évaluation
- Chapitre I, Introduction À La Notion de LenvironnementDocument6 pagesChapitre I, Introduction À La Notion de Lenvironnementmoustafa soudaniPas encore d'évaluation
- Les Roches Combustibles SLGDocument2 pagesLes Roches Combustibles SLGkerroudaristidePas encore d'évaluation
- Pétrole Et GazDocument8 pagesPétrole Et GazAMADOU DOUMBIAPas encore d'évaluation
- Exposee Sur Le Petrole Et Les Gaz NaturelsDocument10 pagesExposee Sur Le Petrole Et Les Gaz NaturelsKonan Christophe N'goran100% (1)
- Cours Madame SobhiDocument95 pagesCours Madame SobhiHadia Djelti100% (1)
- Cours 1Document12 pagesCours 1WaliD MerabeTPas encore d'évaluation
- Les Petroles Et Les Gazs NaturellesDocument11 pagesLes Petroles Et Les Gazs Naturellesben sylvanus ezanni FAMIENPas encore d'évaluation
- RAFFINAGEDocument42 pagesRAFFINAGEabderrahimebougarechePas encore d'évaluation
- Cours Combustion BonDocument105 pagesCours Combustion BonInoussa OuedraogoPas encore d'évaluation
- Pétrochimie 2 Chap1Document17 pagesPétrochimie 2 Chap1Momo Lasad100% (1)
- Exposee Sur Le Petrole Et Les Gaz NatureDocument7 pagesExposee Sur Le Petrole Et Les Gaz NatureFranck ArthurPas encore d'évaluation
- Le PetroleDocument5 pagesLe Petroleyendoupabemiadou18Pas encore d'évaluation
- ExposéDocument7 pagesExposéCoeur BlancPas encore d'évaluation
- Module 2 - Les Menaces Aux SolsDocument35 pagesModule 2 - Les Menaces Aux SolsEva RöbenPas encore d'évaluation
- Preparation Session 1 - New1Document71 pagesPreparation Session 1 - New18vdn9kcmsvPas encore d'évaluation
- TD 05Document7 pagesTD 05chamsPas encore d'évaluation
- Expose - Petrole - Et - Gaz - Naturel 2023 N°3Document10 pagesExpose - Petrole - Et - Gaz - Naturel 2023 N°3Berthe inza100% (3)
- Exposer de Gaz Et Petrole NaturelDocument9 pagesExposer de Gaz Et Petrole NaturelKouame100% (1)
- 1ère A - APC - Pétrole Et Gaz NaturelsDocument3 pages1ère A - APC - Pétrole Et Gaz NaturelsLAWSON NICOLASPas encore d'évaluation
- PollutionDocument5 pagesPollutionAhmed KhaffouPas encore d'évaluation
- Est Chap 1Document12 pagesEst Chap 1badrezzamane100% (1)
- 5 - Les Équilibres NaturelsDocument10 pages5 - Les Équilibres NaturelsoussalemPas encore d'évaluation
- Formes de Pollution Dues Au Pétrole Et Ses DérivésDocument2 pagesFormes de Pollution Dues Au Pétrole Et Ses DérivéslaurellejenniferPas encore d'évaluation
- Genèse de PétroleDocument8 pagesGenèse de PétroleAbderrazak BerrahalPas encore d'évaluation
- Exposee Sur Le Petrole Et Les Gaz NatureDocument11 pagesExposee Sur Le Petrole Et Les Gaz Naturekouadiokdesire92Pas encore d'évaluation
- Expansion de La Chimie Organique Cours 1Document3 pagesExpansion de La Chimie Organique Cours 1zakaria zakiPas encore d'évaluation
- Chap IV CH - VerteDocument12 pagesChap IV CH - VerteAbidi OumaimaPas encore d'évaluation
- BiogazDocument10 pagesBiogaznasroddinePas encore d'évaluation
- Gaz Et PetroleDocument11 pagesGaz Et PetroleDoffou guy-charles BédéPas encore d'évaluation
- Hello WorldDocument4 pagesHello Worldyassirjaber4Pas encore d'évaluation
- Le Petrole Et Les Gaz NaturelsDocument7 pagesLe Petrole Et Les Gaz NaturelsSERVICES MANGOPas encore d'évaluation
- Arthroscopie de L'épauleDocument15 pagesArthroscopie de L'épauleFredivb1993hotmail.comPas encore d'évaluation
- Elts de Telecoms Et Reseaux Mobiles 2021 Final AoutDocument446 pagesElts de Telecoms Et Reseaux Mobiles 2021 Final Aoutjonathan kabongoPas encore d'évaluation
- Facture Stone Island (GalerieLafayette)Document1 pageFacture Stone Island (GalerieLafayette)ya393367Pas encore d'évaluation
- Activités Chapitre1,1bac SC Ex, Réalisation de La Carte Geologique D - Une Région DonnéeDocument20 pagesActivités Chapitre1,1bac SC Ex, Réalisation de La Carte Geologique D - Une Région Donnéeسكينة ايت عابدPas encore d'évaluation
- Accueil Client PDFDocument4 pagesAccueil Client PDFdestin mboumbaPas encore d'évaluation
- Exemple Analyse Fonctionnelle PDFDocument2 pagesExemple Analyse Fonctionnelle PDFStacyPas encore d'évaluation
- Amortiguadores StockbridgeDocument4 pagesAmortiguadores StockbridgeskylinesharePas encore d'évaluation
- BMCIDocument8 pagesBMCINajwa BenslimanePas encore d'évaluation
- Résumé CloudDocument15 pagesRésumé CloudKarim TroudiPas encore d'évaluation
- Le One Bud CDocument2 pagesLe One Bud CArthur CostaPas encore d'évaluation
- Polissage Electrolytique de L Inox PDFDocument2 pagesPolissage Electrolytique de L Inox PDFKhouloud GharbiPas encore d'évaluation
- Contact LinkyDocument1 pageContact LinkyYao N'GoranPas encore d'évaluation
- La Redaction Des Principaux Ecrits ProfessionnelsDocument14 pagesLa Redaction Des Principaux Ecrits ProfessionnelsBouchra BoudaliPas encore d'évaluation
- Pourquoi Il Est Indispensable de Preserver La BiodiversiteDocument5 pagesPourquoi Il Est Indispensable de Preserver La Biodiversiteabdelhak.benabouraPas encore d'évaluation
- RevueAE 02 20141 - 2Document294 pagesRevueAE 02 20141 - 2Madelbrot AzarPas encore d'évaluation
- Liste ADocument78 pagesListe Amath62210Pas encore d'évaluation
- Loi Cadre N°09-21 Du 23 Mars 2021Document18 pagesLoi Cadre N°09-21 Du 23 Mars 2021Brahim EL AmraouiPas encore d'évaluation
- polySeriesChros PDFDocument31 pagespolySeriesChros PDFNoureddineLahouelPas encore d'évaluation
- Phy 105Document3 pagesPhy 105Amelie mPas encore d'évaluation
- Module 3 Le Père Goriot - Balzac Roman Réaliste Prof RachidDocument7 pagesModule 3 Le Père Goriot - Balzac Roman Réaliste Prof RachidMohammed MoughadPas encore d'évaluation
- 2nde 3b Extraits de Sujets de Bac Et BTS CORRIGEDocument3 pages2nde 3b Extraits de Sujets de Bac Et BTS CORRIGEdhouah maghraouiPas encore d'évaluation
- Examen Math Fin 2018Document2 pagesExamen Math Fin 2018Mustapha Manar El idrissiPas encore d'évaluation
- Module 2 - Cycle Achats-FournisseursDocument32 pagesModule 2 - Cycle Achats-FournisseursDahMalikiHabibouPas encore d'évaluation
- Deconstruction de L'Ancienne Salle de L'Auzelou (Désamiantage Et Démolition) 19000 TULLEDocument33 pagesDeconstruction de L'Ancienne Salle de L'Auzelou (Désamiantage Et Démolition) 19000 TULLEngansob fosso jean victorPas encore d'évaluation
- Les Tests de Khi-DeuxDocument32 pagesLes Tests de Khi-Deuxibtihaj moulouadPas encore d'évaluation
- PLMDocument5 pagesPLMImedooImed100% (1)