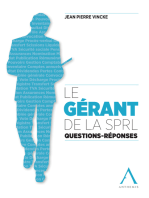Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
33175
33175
Transféré par
Tsix AndriaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
33175
33175
Transféré par
Tsix AndriaDroits d'auteur :
Formats disponibles
GUIDE PRATIQUE
DE LA SARL
et de LEURL
Cration et gestion de la SARL, de lEURL,
de la SELARL, de la SELU et de lEARL
ditions dOrganisation
Groupe Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris cedex 05
www.editions-organisation.com
www.editions-eyrolles.com
Le Code de la proprit intellectuelle du 1
er
juillet 1992 interdit
en effet expressment la photocopie usage collectif sans
autorisation des ayants droit. Or, cette pratique sest gnra-
lise notamment dans lenseignement, provoquant une baisse
brutale des achats de livres, au point que la possibilit mme
pour les auteurs de crer des uvres nouvelles et de les faire
diter correctement est aujourdhui menace.
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intgra-
lement ou partiellement le prsent ouvrage, sur quelque support que ce soit,
sans autorisation de lditeur ou du Centre Franais dExploitation du Droit
de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.
Groupe Eyrolles, 1996, 2002, 2004, 2008, 2010
ISBN : 978-2-212-54686-6
P
ASCAL
D
NOS
Diplm dexpertise-comptable
DESS en banques et finances
GUIDE PRATIQUE
DE LA SARL
et de lEURL
Cration et gestion de la SARL, de lEURL,
de la SELARL, de la SELU et de lEARL
Complments en ligne sur
www.editions-organisation.com/livres/denos
Cinquime dition
D
U
MME
AUTEUR
D
ANS
LA
MME
COLLECTION
Guide pratique de lentreprise individuelle
Guide pratique de la SAS et de la SASU
Guide pratique de la SCI
Gestion de patrimoine : optimisez votre investissement immobilier
V
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
LES QUESTIONS AUXQUELLES
RPOND CE LIVRE
LE CHOIX DE LA SARL COMME STRUCTURE JURIDIQUE
Pourquoi choisir la SARL ?
Comment constituer la SARL ?
Comment modifier les statuts de la SARL ?
Les structures de partenariat
Transformer la SARL
Restructurer la SARL
Comment dissoudre la SARL
Cession, transmission, nantissement et location des parts sociales
La responsabilit pnale de la SARL
LE STATUT DU GRANT DE LA SARL
Nomination, rvocation et dmission du grant
Cumul des fonctions de grant et de salari
La protection sociale du grant
Le statut du conjoint du grant
Les responsabilits du grant
Imposition des rmunrations du grant
LE FINANCEMENT DE LA SARL
Les apports des associs
Les emprunts auprs des tiers ou des associs
La garantie par les associs des engagements financiers de la SARL
Laugmentation de capital
La rduction de capital
Les emprunts obligataires
Guide pratique de la SARL et de lEURL
VI
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
LA GESTION ET LE CONTRLE DE LA SARL
Les pouvoirs du grant
Les pouvoirs des associs
Le commissaire aux comptes
Le comit dentreprise
La dtermination et laffectation du rsultat
La gestion fiscale de la TVA
La gestion fiscale de limposition des bnfices
La gestion fiscale de lISF
La gestion fiscale de la distribution des bnfices
Limposition des plus-values
Rduction des droits de donation et de succession
LA PRVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTS
FINANCIRES DE LA SARL
La prvention des difficults
Le rglement amiable des difficults de lentreprise
Le redressement et la liquidation judiciaire
LENTREPRISE UNIPERSONNELLE RESPONSABILIT LIMITE
Pourquoi choisir lEURL ?
Comment crer lEURL ?
Fonctionnement de lEURL
La cession des parts sociales de lEURL
Comment dissoudre lEURL ?
Comment transformer lEURL ?
LA SOCIT DEXERCICE LIBRAL CONSTITUE SOUS FORME
DUNE SARL OU DUNE EURL
Droit dexercer la profession librale par les associs
Capital social
Responsabilit des associs
Comptes courants dassocis
Cession de parts sociales
Le grant
Conventions rglementes
Non-dductibilit des intrts demprunts contracts pour lacquisition
des parts de la SELARL
Transformation dune SARL en SELARL
Les questions auxquelles rpond ce livre
VII
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
LENTREPRISE AGRICOLE RESPONSABILIT LIMITE
Dnomination sociale
Capital social
Les apports
La rmunration des associs
Les associs exploitants
Le statut social des associs exploitants
Les dcisions collectives
Limposition des bnfices de lEARL
Cession des parts de lEARL
Dissolution de lEARL
LA SARL POUR DVELOPPER UN PROJET
DENTREPRENEURIAT SOCIAL
La socit cooprative dintrt collectif (SCIC)
La socit cooprative de production (SCOP)
Les coopratives de commerants et les coopratives dartisans
IX
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
SUPPLMENTS INTERNET
Pour obtenir les supplments Internet de cet ouvrage (imprims s-
caux comments, actes types pour le suivi juridique et complments
dinformation), rendez-vous sur le site des ditions dOrganisation :
http://www.editions-organisation.com
, puis tapez le code de louvrage
(54686), dans le champ de recherche en haut gauche.
Une fois sur la che de louvrage, vous pouvez tlcharger les suppl-
ments dans la rubrique Tlchargements de la colonne de droite.
Sommaire des annexes disponibles en tlchargement
Les dclarations fiscales remplies
Les dclarations pour la TVA
Rgime de rel simplifi
Rgime du rel normal
Les dclarations pour limposition des bnfices
Dclaration de rsultat n 2065
Liasse fiscale rel simplifi
Liasse fiscale rel normal
Dclaration de rsultat n 2031
Les formalits de publicit
Les actes types pour le suivi juridique de la SARL
Les actes types standard
Assemble gnrale ordinaire ou extraordinaire des associs
Consultation crite des associs
Dcision unanime des associs
Guide pratique de la SARL et de lEURL
X
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le choix de la SARL comme structure juridique
Constitution de la SARL
Les statuts-types
Modifier les statuts de la SARL
Cession de parts sociales
Transformer la SARL en Socit anonyme
Le statut du grant de la SARL
Nomination du premier grant
Changement de grant
Fixation de la rmunration du grant
Le financement de la SARL
Augmentation de capital
Rduction de capital
Perte de la moiti du capital social
La gestion et le contrle de la SARL
Approbation des comptes annuels
Le contrle des conventions rglementes
Les pouvoirs du grant
XI
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
TABLE DES MATIRES
Chapitre 1
L
E
CHOIX
DE
LA
SARL
COMME
STRUCTURE
JURIDIQUE
1. La SARL en bref
.........................................................................1
2. Pourquoi choisir la SARL ?
......................................................2
2.1. Avantages et inconvnients de la SARL................................2
2.2. Pour quels projets utiliser la SARL ? ...................................10
3. Comment constituer la SARL ?
.............................................18
3.1. Chronologie des dmarches et dlais respecter .................19
3.2. Les caractristiques essentielles de la socit ......................21
3.3. La rdaction des statuts ........................................................32
3.4. Les formalits pour limmatriculation de la socit.............35
3.5. Le cot de la constitution .....................................................39
4. Comment modifier les statuts de la SARL ?
.......................50
4.1. La dcision de modification .................................................50
4.2. Les formalits accomplir ...................................................51
4.3. Les principales modifications statutaires..............................52
5. Les structures de partenariat
.................................................53
5.1. Les groupes de socits ........................................................53
5.2. Les autres structures de partenariat ......................................58
6. Transformer la SARL
..............................................................60
6.1. Pourquoi transformer la SARL ?..........................................60
6.2. Comment transformer la SARL en socit par actions
simplifie ou en socit anonyme ?......................................61
6.3. La transformation de la SARL en une socit
autre que la SA ou la SAS....................................................69
7. Restructurer la SARL
..............................................................70
7.1. Comment restructurer un groupe ?.......................................70
7.2. Les fusions, scissions, et apports partiels dactif..................71
Guide pratique de la SARL et de lEURL
XII
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
8. Comment dissoudre la SARL
.................................................75
8.1. Les modalits pratiques de dissolution.................................77
8.2. Consquences fiscales de la dissolution...............................80
9. Cession, transmission, nantissement et location
des parts sociales
.......................................................................85
9.1. Cession et transmission des parts sociales............................85
9.2. Le nantissement et la saisie des parts sociales....................100
9.3. La location et le crdit-bail des parts sociales ....................102
10. La responsabilit pnale de la SARL
.................................106
Chapitre 2
L
E
STATUT
DU
GRANT
DE
LA
SARL
1. Nomination, rvocation et dmission du grant
..............109
1.1. Comment sont nomms les grants ? .................................109
1.2. Comment prennent fin les fonctions du grant ?................113
2. Cumul des fonctions de grant et de salari
.....................118
2.1. Les conditions du cumul.....................................................118
2.2. Intrt pratique et consquence du cumul ..........................119
2.3. Les formalits respecter...................................................120
3. La protection sociale du grant
...........................................121
3.1. Quand un grant est-il assimil un salari ? ....................122
3.2. Que doit choisir le grant : le statut de salari
ou le statut de travailleur indpendant ?.............................123
3.3. Comment se couvrir contre le chmage ? ..........................127
4. Le statut du conjoint du grant
...........................................129
4.1. Le conjoint collaborateur de la SARL................................129
4.2. Le conjoint salari de la SARL ..........................................131
4.3. Le conjoint associ de la SARL .........................................134
5. Les responsabilits du grant
...............................................137
5.1. La responsabilit civile.......................................................137
5.2. La responsabilit fiscale .....................................................139
5.3. La responsabilit au titre des cotisations sociales ..............140
5.4. La responsabilit pnale .....................................................140
5.5. La responsabilit du grant en cas de difficults
financires de la SARL.......................................................143
6. Imposition des rmunrations du grant
...........................148
6.1. Comment le grant est-il rmunr ?..................................148
6.2. Comment sont imposes les rmunrations du grant ?.....149
Table des matires
XIII
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Chapitre 3
LE FINANCEMENT DE LA SARL
1. Les apports des associs.........................................................153
1.1. Les apports en numraire....................................................154
1.2. Les apports en nature..........................................................156
1.3. Les apports en industrie......................................................159
1.4. Le rgime fiscal des apports ...............................................159
2. Les emprunts auprs des tiers ou des associs .................159
2.1. Les emprunts auprs des tiers.............................................159
2.2. Les apports en comptes courants des associs ...................160
3. La garantie par les associs des engagements
financiers de la SARL............................................................163
3.1. Le cautionnement ...............................................................163
3.2. La lettre dintention............................................................164
3.3. Condamnation de lassoci excuter les engagements
de la SARL.........................................................................165
4. Laugmentation de capital ....................................................165
4.1. Laugmentation de capital par souscription
en numraire .......................................................................166
4.2. Laugmentation de capital par apports en nature ...............170
4.3. Laugmentation de capital par incorporation
des bnfices et des rserves ..............................................171
5. La rduction de capital ..........................................................172
5.1. Dans quels cas procde-t-on une rduction
de capital ?..........................................................................172
5.2. Quelle est la procdure suivre ?.......................................172
5.3. Opposition des cranciers...................................................173
5.4. Incidence fiscale .................................................................174
5.5. La rduction de capital en cas de perte de la moiti
du capital social ..................................................................174
6. Les emprunts obligataires.....................................................178
Chapitre 4
LA GESTION ET LE CONTRLE DE LA SARL
1. Les pouvoirs du grant ..........................................................179
1.1. Les pouvoirs du grant lgard des tiers ..........................179
1.2. Les pouvoirs du grant lgard des associs....................180
1.3. Actes du grant interdits ou soumis autorisation.............181
1.4. Le grant peut-il dlguer ses pouvoirs ?...........................182
Guide pratique de la SARL et de lEURL
XIV
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2. Les pouvoirs des associs.......................................................182
2.1. Le pouvoir de dcision des associs...................................182
2.2. Le pouvoir dinformation des associs...............................193
2.3. Le pouvoir de contrle des conventions entre la socit
et lun de ses grants ou associs .......................................194
3. Le commissaire aux comptes................................................197
4. Le comit dentreprise ...........................................................198
4.1. Documents communiquer au comit dentreprise
avant lassemble dapprobation des comptes ...................198
4.2. Expert-comptable du comit...............................................198
4.3. Modifications de lorganisation conomique
ou juridique de lentreprise.................................................199
4.4. Prvention des difficults des entreprises...........................199
5. La dtermination et laffectation du rsultat ...................200
5.1. tablissement des comptes annuels....................................200
5.2. Le rapport de gestion..........................................................201
5.3. Lapprobation des comptes.................................................203
5.4. La publicit des comptes ....................................................204
5.5. Laffectation des rsultats...................................................204
6. La gestion fiscale de la TVA.................................................209
6.1. Lexigibilit de Ia TVA dpend de la nature
de lopration......................................................................210
6.2. Les rgimes dimposition Ia TVA de la SARL...............211
6.3. Dclaration et paiement de la TVA....................................212
6.4. Calcul et dclaration de la TVA au rel normal .................213
6.5. Calcul et dclaration de la TVA au rel simplifi ..............215
7. La gestion fiscale de limposition des bnfices ...............217
7.1. Le rgime dimposition de la SARL ..................................217
7.2. La comptabilit de la SARL...............................................221
7.3. Calcul de limposition et tablissement des dclarations
fiscales de la SARL............................................................222
7.4. La gestion des dficits ........................................................232
7.5. Les aides fiscales ................................................................234
7.6. Les aides inter-entreprises ..................................................235
7.7. Les transactions intra-groupe .............................................237
7.8. Lintgration fiscale............................................................238
8. La gestion fiscale de lISF .....................................................239
9. La gestion fiscale de la distribution des bnfices ...........242
9.1. Imposition des dividendes ..................................................243
9.2. Le rgime des socits mres et filiales .............................246
Table des matires
XV
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
9.3. La retenue la source.........................................................247
10. Limposition des plus-values ................................................248
10.1. Imposition des plues-values de cession..............................248
10.2. Exonration des plus-values de cession .............................252
11. Rduction des droits de donation et de succession..........252
Chapitre 5
LA PRVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTS
FINANCIRES DE LA SARL
1. La prvention des difficults ................................................256
1.1. Les actions linitiative du grant......................................256
1.2. Linformation comptable et financire...............................259
1.3. La procdure dalerte..........................................................261
2. Le rglement amiable des difficults de lentreprise ......264
2.1. Quelles sont les entreprises concernes ?...........................265
2.2. Quelle est la procdure suivre ?.......................................265
3. Le redressement et la liquidation judiciaire .....................269
3.1. Quels sont les cas douverture de la procdure
de redressement ou de liquidation judiciaire ? ...................269
3.2. Qui ouvre la procdure de redressement
ou de liquidation judiciaire ? ..............................................270
3.3. Comment se droule la procdure ? ...................................270
Chapitre 6
LENTREPRISE UNIPERSONNELLE RESPONSABILIT
LIMITE (EURL)
1. LEURL en bref.......................................................................273
2. Pourquoi choisir lEURL ?...................................................274
2.1. Pour quels projets utiliser lEURL ? ..................................274
2.2. Entreprise individuelle, EURL, SASU, SELU
ou EARL ?..........................................................................275
3. Comment crer lEURL ?.....................................................279
3.1. Constitution dune socit nouvelle ...................................279
3.2. Transformation dune SARL en EURL..............................282
3.3. Transformation dune SASU en EURL..............................283
4. Fonctionnement de lEURL..................................................284
4.1. La gestion de lEURL.........................................................284
Guide pratique de la SARL et de lEURL
XVI
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
4.2. Le contrle de lEURL.......................................................287
4.3. Le pouvoir de dcision de lassoci unique........................290
4.4. La gestion fiscale de lEURL.............................................291
5. La cession des parts sociales de lEURL............................294
6. Comment dissoudre IEURL ? ............................................295
6.1. Les causes de la dissolution................................................295
6.2. Les modalits de la dissolution...........................................295
7. Comment transformer lEURL ?........................................298
7.1. Transformation de lEURL en SASU.................................298
7.2. Transformation de LEURL en SARL...............................298
Chapitre 7
LA SOCIT DEXERCICE LIBRAL CONSTITUE
SOUS FORME DUNE SARL OU DUNE EURL
1. Droit dexercer la profession librale par les associs....302
2. Capital social ............................................................................303
3. Responsabilit des associs ...................................................305
4. Comptes courants dassocis ................................................305
5. Cession de parts sociales........................................................305
6. Le grant ...................................................................................306
7. Conventions rglementes.....................................................306
8. Non-dductibilit des intrts demprunts contracts
pour lacquisition des parts de la SELARL......................306
9. Transformation dune SARL en SELARL.......................307
Chapitre 8
LENTREPRISE AGRICOLE RESPONSABILIT
LIMITE (EARL)
1. LEARL en bref.......................................................................309
2. Dnomination sociale..............................................................310
3. Capital social ............................................................................310
4. Les apports ...............................................................................311
4.1. Nature et valuation des apports.........................................311
4.2. Les droits denregistrement ................................................311
5. La rmunration des associs...............................................312
5.1. Fixation de la rmunration................................................312
5.2. Imposition de la rmunration............................................312
Table des matires
XVII
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
6. Les associs exploitants..........................................................313
7. Le statut social des associs exploitants .............................314
8. Les dcisions collectives .........................................................315
9. Limposition des bnfices de lEARL...............................315
9.1. EARL soumise limpt sur le revenu ..............................315
9.2. EARL soumise limpt sur les socits ...........................317
10. Cession des parts de lEARL................................................318
10.1. EARL soumise limpt sur les socits ...........................318
10.2. EARL soumise limpt sur le revenu ..............................318
11. Dissolution de lEARL...........................................................319
Chapitre 9
LA SARL POUR DVELOPPER UN PROJET
DENTREPRENEURIAT SOCIAL
1. La socit cooprative dintrt collectif (SCIC).............321
1.1. Les associs de la SCIC......................................................322
1.2. Financement par les collectivits publiques .......................324
1.3. Lagrment de la SCIC.......................................................325
1.4. Lutilit sociale de la SCIC ................................................325
1.5. La rpartition des excdents et les rserves
impartageables....................................................................326
1.6. La rvision cooprative ......................................................326
1.7. Le rgime fiscal de la SCIC................................................327
1.8. La direction de la SCIC......................................................327
1.9. Transformation dune association en SCIC........................327
2. La socit cooprative de production (SCOP) .................328
3. Les coopratives de commerants et les coopratives
dartisans...................................................................................328
ANNEXE
1. Les tableaux comparatifs entre les diffrentes
structures juridiques ..............................................................332
1.1. Comparatif de la SARL avec la SNC, la SA et la SAS......332
1.2. Comparatif de lEURL avec la SASU et lentreprise
individuelle.........................................................................337
INDEX..........................................................................................................341
1
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1
LE CHOIX DE LA SARL COMME
STRUCTURE JURIDIQUE
Lessentiel sur la socit responsabilit limite (SARL)
La SARL est une structure juridique bien adapte aux petites et moyennes entre-
prises. Elle permet de dvelopper un projet sans changer de forme juridique. La
SARL est une socit dont la responsabilit des associs est limite au montant
de leurs apports. La SARL est une socit ferme avec un petit nombre dassocis
qui se connaissent bien. Cependant, pour ne pas freiner son dveloppement, le
nombre dassocis peut tre port cent. Les parts sociales ne sont pas librement
cessibles des tiers : il faut lagrment des autres associs. La SARL ne peut pas
faire appel public lpargne mais peut mettre des obligations non cotes. Deux
associs sufsent pour constituer une SARL. Une SARL peut tre constitue avec
un seul associ : elle devient une EURL (entreprise unipersonnelle responsabi-
lit limite). La SARL est constitue facilement et son fonctionnement est simple.
Un seul grant suft pour diriger la SARL. Le grant peut avoir le statut scal et
social de salari (grant minoritaire) ou de travailleur indpendant (grant
majoritaire). Aucun capital minimum nest exig. En effet, le montant du capital
social est librement x par les associs. Le capital doit tre libr du cinquime
au moins lors de la constitution. Le capital peut tre variable.
1. La SARL en bref
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
2
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Avantages et inconvnients de la SARL
Le choix de la SARL comme structure juridique peut intervenir tout
moment de la vie de lentreprise : la cration, lors de son dveloppe-
ment, ou lorsque le chef dentreprise envisage de quitter ses responsa-
bilits.
Le chef dentreprise a deux possibilits pour exercer son activit :
il peut opter pour lentreprise individuelle
1
. Dans ce cas, son
patrimoine professionnel se confond avec son patrimoine priv, et
selon la nature de lactivit exerce, il aura le statut de commer-
ant, dartisan ou de professionnel libral ;
il peut crer une socit. Il y a alors distinction entre le patri-
moine professionnel, qui est celui de la socit, et son patrimoine
priv.
Les apports en industrie sont possibles : des parts inalinables sont remises en
contrepartie du travail et du savoir-faire de lassoci. Elles donnent droit au par-
tage du bnce et de participer aux dcisions collectives. Elles ne contribuent
pas la formation du capital. La SARL est soumise limpt sur les socits.
Une SARL de famille peut opter pour limpt sur le revenu (IR). Les jeunes
SARL peuvent opter pour limpt sur le revenu pour une priode de 5 ans. Les
dividendes distribus par une SARL soumise limpt sur les socits sont taxs
au niveau des associs soumis limpt sur le revenu aprs un abattement de
40 %. Les associs doivent respecter des rgles de fonctionnement imposes par
la loi. Le commissaire aux comptes nest pas obligatoire, sauf dans les SARL
importantes. Les apports en industrie sont autoriss dans les SARL de famille.
Les associs nont pas la qualit de commerant. Les cessions de parts sociales
sont imposes au taux de 5 %.
1. Voir le Guide pratique de lentreprise individuelle responsabilit limite (EIRL) aux
ditions dOrganisation.
2. Pourquoi choisir la SARL ?
2.1.
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
3
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Sil choisit la socit, il doit alors choisir entre deux grands types de
socits commerciales :
les socits de personnes, comme la socit en nom collectif,
qui prsentent peu de diffrences par rapport lentreprise indi-
viduelle.
La responsabilit des associs est illimite car ils ont le statut de
commerant ; ils sont responsables solidairement et indniment
des dettes de lentreprise. Lassoci engage non seulement sa
mise de fonds, mais galement lintgralit de son patrimoine.
La cessation de paiements de la socit entrane le rglement judi-
ciaire ou la liquidation des biens de chaque associ.
Lintuitu personae est trs fort, cest--dire que la personna-
lit de chaque associ compte avant tout. Lapport de moyens et
dargent nest pas prdominant.
Les socits de capitaux, comme la socit anonyme ou la SAS
1
:
les associs, appels actionnaires, nont pas la qualit de commer-
ant, et ne sont responsables qu hauteur de leur apport de fonds.
Le chef dentreprise peut galement crer une socit avec un seul
associ : une entreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL
voir page 273), une socit par actions simplie unipersonnelle
(SASU)
1
, une socit dexercice libral unipersonnelle (SELU) sil
exerce une profession librale ou une entreprise agricole responsabilit
limite unipersonnelle (EARL) pour lexercice dune activit agricole.
La SARL est une socit de capitaux qui possde certaines caractris-
tiques des socits de personnes. La SARL est une formule simple et
souple qui concilie les principaux avantages de la socit en nom col-
lectif et de la socit anonyme.
De nombreux chefs dentreprise optent pour la SARL car elle chappe
la plupart des inconvnients prsents par lentreprise individuelle et
parce que sa constitution et son mode de fonctionnement sont plus
simples et moins onreux que ceux de la socit anonyme.
La SARL est la forme de socit la plus rpandue en France essentielle-
ment pour deux de ses avantages : elle permet de limiter la responsabi-
lit des associs, et elle donne le statut de salari au grant minoritaire.
1. Voir le Guide pratique de la SAS et de la SASU aux ditions dOrganisation.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
4
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les dveloppements qui suivent ont pour objectif de permettre au chef
dentreprise de dcider si la SARL est la meilleure structure juridique
pour son entreprise. Ltude dans le dtail de ces diffrents lments
de rexion sera prsente dans les autres parties du guide.
2.1.1. Avantages de la socit responsabilit limite
1. La responsabilit des associs est limite au montant de leurs
apports, de leur mise initiale : si les associs constituent une SARL
en apportant 5 000 de capital, leur risque maximum est de perdre
ces 5 000 si la SARL ne peut pas payer ses dettes. Par opposition,
le dirigeant dune entreprise individuelle est indfiniment responsa-
ble des dettes professionnelles sur son patrimoine priv. Il en est de
mme pour les associs de socits de personnes qui ont la qualit
de commerant, et sont responsables indfiniment et solidairement
des dettes sociales. Cependant, dans une EIRL (entreprise indivi-
duelle responsabilit limite), la responsabilit de lentrepreneur
peut tre limite au patrimoine quil affecte lentreprise.
2. Le grant minoritaire ou galitaire est assimil un salari :
Au regard de la Scurit sociale, il cotise au rgime gnral de la
Scurit sociale et au rgime des cadres, et il bnficie de la
mme couverture de risques quun salari, lexception du
rgime dassurance chmage (le bnfice du rgime dassurance
chmage peut dans certains cas tre accord).
Au regard de la lgislation fiscale, son salaire bnficie, comme
pour un salari, de la rduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels.
Le salaire de son conjoint est dductible. Dans lentreprise indi-
viduelle, le salaire du conjoint nest dductible que dans certaines
limites.
3. Pour financer son dveloppement, la SARL peut avoir recours aux
apports en capital : une personne trangre lentreprise peut lui
apporter de largent qui augmentera son capital social, et elle
deviendra ainsi associe de lentreprise. Ce mode de financement
connat un dveloppement constant car il permet de drainer les
fonds des socits de capital-risque de proximit, des fonds dinves-
tissement crs par les collectivits locales Cest un avantage
Le choix de la SARL comme structure juridique
5
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
dcisif pour la socit par rapport lentreprise individuelle qui ne
peut recourir, en dehors des apports du chef dentreprise, quaux
emprunts bancaires ou familiaux. Alors que lemprunt donne lieu,
obligatoirement, paiement dintrts et remboursement du prin-
cipal, lapport en capital est rmunr par un paiement de dividen-
des si la trsorerie de lentreprise le permet ; le remboursement de
lapport initial intervient uniquement quand lassoci se retire.
De plus, un associ peut renforcer son soutien financier la SARL
sous forme de compte courant rmunr. La SARL peut mettre des
obligations afin de financer son dveloppement.
4. Si lentreprise est fortement bnficiaire, la SARL permet un gain
net de cotisations sociales. En effet, dans une SARL, les cotisa-
tions sociales sont calcules uniquement sur la rmunration ver-
se au grant, quil soit minoritaire ou majoritaire (le bnfice de la
SARL vers au grant, sil est associ, sous forme de dividendes,
nest pas soumis cotisations sociales). En revanche, dans une
entreprise individuelle les cotisations sociales sont calcules par-
tir de la totalit du bnfice de lentreprise individuelle, mme si ce
bnfice nest pas prlev par lexploitant. Cependant, quand
lEIRL opte pour limpt sur les socits, les charges sociales sont
calcules sur la rmunration de lentrepreneur.
5. La SARL permet galement un gain dimpt si lentreprise est for-
tement bnficiaire.
Les rsultats de la SARL sont obligatoirement soumis limpt sur
les socits au taux de 15 %
1
(sauf pour les SARL de famille et les
jeunes SARL). En revanche, les rsultats dune entreprise indivi-
duelle, dune EURL, ou dune socit de personnes (si lassoci est
une personne physique) sont imposs limpt sur le revenu dans
la catgorie des BIC (bnfices industriels et commerciaux) pour
une activit industrielle, commerciale ou artisanale (BNC pour les
professions librales). Le taux de limpt sur le revenu est progres-
sif, et peut atteindre 40 % pour la partie des rsultats qui dpasse
certains montants (application du barme progressif). LEIRL peut
cependant opter pour limpt sur les socits.
Si lentreprise est fortement bnficiaire, la constitution dune
SARL permet de raliser un gain fiscal immdiat : le bnfice est
1. Pour les petites SARL, voir page 234.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
6
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
impos au taux de 15 % au lieu dun taux proche de 40 %. Cette
conomie dimpt peut tre consacre lautofinancement de
lentreprise. Le rsultat de la SARL tax lIS au taux de 15 %
pourra tre distribu aux associs sous forme de dividendes
1
.
Le dividende distribu sera alors soumis limpt sur le revenu
dans la catgorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. La SARL permet une conomie de droits denregistrement au
moment de la cession de lentreprise ; ce qui permet de ngocier un
prix de vente plus important, dans la mesure o lacheteur paie des
droits denregistrement plus faibles.
En effet, dans la SARL, la cession de lentreprise se fait par la
vente des parts sociales dont le montant est impos au taux de 5 %.
Alors que la cession dune entreprise individuelle est assujettie
un droit denregistrement qui est galement de 5 %, mais qui
sapplique la valeur brute des biens vendus (cest la valeur du
fonds de commerce qui est retenue sans la minorer du montant des
dettes de lentreprise).
7. La SARL permet dorganiser la transmission de lentreprise :
Dans une entreprise individuelle, en cas de dcs du chef dentre-
prise, ses enfants, et ventuellement son conjoint sil est mari sous
le rgime de la communaut, deviendront propritaires indivis de
lentreprise. Or, lindivision, surtout si elle nest pas organise, est la
pire structure juridique pour assurer la prennit de lentreprise. En
effet, lentreprise devra tre vendue si les hritiers qui veulent pour-
suivre lactivit nont pas les moyens de racheter la part des cohri-
tiers qui voudraient immdiatement encaisser leur hritage (le Code
civil permet tout indivisaire de demander le partage tout moment,
en sadressant la justice, le cas chant). De plus, lindivision est
rgie par le principe de lunanimit qui oblige les indivisaires un
consensus permanent sur la faon de conduire lactivit ; ce qui est
incompatible avec une gestion rapide et souple de lentreprise.
La SARL permet dviter ces inconvnients. Il est facile dattri-
buer chaque hritier le nombre exact de parts sociales lui reve-
nant sans remettre en cause la prennit de lentreprise. Par
ailleurs, pour grer la SARL, il suffit que les hritiers qui poursui-
1. Voir page 243.
Le choix de la SARL comme structure juridique
7
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
vent lexploitation soient majoritaires afin de ne pas tre gns par
lopposition ventuelle des autres hritiers car le principe de ges-
tion de la SARL est la majorit.
8. Lassoci dune SARL na pas la qualit de commerant, alors que
dans une socit en nom collectif lassoci a obligatoirement la
qualit de commerant. La SARL est donc une forme juridique
intressante pour des personnes :
qui nont pas la capacit juridique pour tre commerant si un
associ dune SARL dcde, et que ses hritiers sont des mineurs,
la SARL pourra continuer sans transformation ;
qui exercent des fonctions incompatibles avec la qualit de
commerant : la SARL autorise lexercice dune profession lib-
rale dont la dontologie est incompatible avec le statut de commer-
ant un fonctionnaire peut devenir associ dune SARL
9. Il faut seulement deux associs pour constituer une SARL (le chef
dentreprise et son conjoint, par exemple) alors quil faut sept asso-
cis pour constituer une socit anonyme.
10. Lapport minimal pour constituer une SARL est plus faible que
celui ncessaire pour constituer une SA puisquaucun capital mini-
mum nest exig. De mme, aucun capital minimum nest exig
pour la SAS.
11. Le commissaire aux comptes nest pas obligatoire pour une petite
SARL, alors quil est obligatoire pour une socit anonyme quelle
que soit sa taille et son chiffre daffaires. De mme, le commissaire
aux comptes nest pas obligatoire dans une petite SAS.
12. Les formalits de constitution sont relativement simples et beaucoup
moins complexes que celles exiges pour une socit anonyme.
13. Le fonctionnement de la SARL est plus simple que celui de la SA :
le grant a lessentiel des pouvoirs (dans une SA, il y a au moins
trois administrateurs), et la consultation des associs peut tre
effectue par crit (sauf pour lapprobation annuelle des comptes).
14. La SARL permet dorganiser les pouvoirs avec deux cogrants. Par
contre, dans une entreprise individuelle, le chef dentreprise est le
seul patron, et il ne lui est pas possible de partager le pouvoir
moins de le dlguer (au conjoint collaborateur ), ou de crer
une socit de fait.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
8
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.1.2. Inconvnients de la socit responsabilit limite
1. La responsabilit des associs est souvent engage au-del de leurs
apports car :
les banques demandent aux dirigeants de se porter caution pour
la SARL afin de garantir les crdits dont elle a besoin pour son
activit. La qualit de caution permet la banque de poursuivre
le dirigeant sur ses biens personnels pour obtenir le rembourse-
ment des prts si la SARL est dfaillante ;
en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le
tribunal de commerce peut estimer quil y a eu faute de gestion
et que les dettes sociales, en totalit ou en partie, seront suppor-
tes par le grant, de droit ou de fait.
2. Le grant majoritaire est assimil un entrepreneur individuel :
Au regard de la Scurit sociale, il cotise au rgime des em-
ployeurs et travailleurs indpendants, et ne bnficie donc pas de
tous les avantages sociaux du grant minoritaire salari. Cepen-
dant, le rgime des travailleurs indpendants, par rapport au
rgime des salaris dont relve le grant minoritaire, est avanta-
geux au niveau trsorerie car les cotisations sont moins importan-
tes que les charges sociales sur salaires. La trsorerie ainsi
dgage peut tre consacre au dveloppement de lentreprise, ou
des rgimes complmentaires, des investissements personnels
pour complter les prestations sociales, prparer un complment
de retraite.
SARL ou SAS au capital d1 : est-ce bien raisonnable ?
Le montant du capital social dune SARL ou dune SAS est librement x par les
associs. La socit peut donc tre constitue avec seulement 1 . En revanche, le
capital minimum de la SA est de 37 000 et doit tre libr de la moiti au moins
lors de la constitution : une SA ne peut donc tre constitue quavec au minimum
18 500 . Cependant, le montant du capital doit tre sufsant pour raliser lobjet
social. Sil est drisoire par rapport aux besoins de lexploitation, les associs peu-
vent tre condamns au paiement des pertes de la SARL car ces pertes sont la
consquence directe de la faiblesse du capital lors de la cration, mme sil est sup-
rieur au minimum lgal.
Zoom n 1
Le choix de la SARL comme structure juridique
9
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Au regard de la lgislation fiscale, le grant majoritaire ne peroit
pas un salaire mais une rmunration impose fiscalement selon
larticle 62 du CGI rmunration des dirigeants . Cependant la
rmunration du grant majoritaire bnficie de labattement de
10 % comme pour un salari. Sa position est donc proche de celle
du grant minoritaire.
La dduction fiscale du salaire du conjoint est soumise aux
mmes limites que dans lentreprise individuelle.
3. Des droits denregistrement sont exigibles sur les biens apports
pour la constitution de la SARL. Dans lentreprise individuelle,
aucun droit nest exigible puisquil y a confusion entre le patrimoine
professionnel et le patrimoine personnel. Cependant, lapport dune
entreprise individuelle une SARL est exonr de droits denregis-
trement si lassoci prend lengagement de conserver les titres reus
en rmunration de son apport pendant au moins cinq ans.
4. Un associ de SARL ne peut pas cder librement ses parts sociales
des tiers comme cest le cas dans une socit anonyme. Cepen-
dant, un associ peut quitter la socit sil a trouv un acheteur : si
les associs refusent dagrer lacheteur, ils doivent alors acheter ou
faire acheter les parts sociales du cdant. Par ailleurs, il est frquent
dans la SA que des clauses limitent la libre cessibilit des actions.
5. La SARL entrane, par rapport lentreprise individuelle, des frais
de constitution plus levs (les honoraires pour la rdaction des
statuts, les droits denregistrement, les frais de publicit lgale et
les frais de greffe), et des frais de fonctionnement juridique car il
faut tenir des assembles dassocis (temps pass, honoraires dun
avocat pour faire le juridique ). Cependant, pour une entreprise
de moyenne importance (cest le cas, en principe, dune SARL),
ces frais ne sont pas significatifs.
6. Dans une SARL, le chef dentreprise devient un associ qui ne doit
pas confondre le patrimoine de la socit et son patrimoine per-
sonnel (pour viter dtre poursuivi pour abus de biens sociaux),
mme sil possde la quasi-totalit des parts sociales.
7. Si la SARL est dficitaire, le dficit se reporte sur les bnfices
venir sans limitation de dure. Le dficit reste captif au sein de la
SARL. En revanche, dans une entreprise individuelle, le dficit
Guide pratique de la SARL et de lEURL
10
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
viendra en diminution des autres revenus ventuels, et permettra
ainsi un gain dimpt sur le revenu.
8. Une partie des bnfices de la SARL doit tre mise en rserve, et
ne peut donc pas tre distribue.
9. Le redressement fiscal portant sur une insuffisance de recette dcla-
re aura une incidence plus lourde que pour une entreprise indivi-
duelle car, dune part, la socit devra payer un complment dimpt
sur les socits et, dautre part, le grant devra payer un complment
dimpt sur le revenu au titre des distributions occultes (cascade
dimpts).
10. La SARL ne peut pas bnficier, comme lentreprise individuelle,
du rgime fiscal des micro-entreprises, et de la comptabilit super-
simplifie .
Pour quels projets utiliser la SARL ?
2.2.1. Dvelopper un projet professionnel
La SARL est une bonne formule pour un crateur. Il pourra consti-
tuer rapidement et peu de frais une SARL pour dbuter son activit
avec un capital qui nest pas important. Si son entreprise se dveloppe
vite, il pourra envisager la transformation de la SARL en SA ou en
SAS si besoin est.
La SARL est galement une formule simple et souple pour un dirigeant
qui souhaite mettre en socit une entreprise individuelle de
moyenne importance ou dvelopper un partenariat avec dautres
entreprises.
La constitution de la SARL permettra au chef dentreprise de limiter
sa responsabilit au montant du capital quil apporte, dviter davoir
le statut de commerant, de runir dautres associs dans le cadre dun
partenariat, de prparer la transmission de son entreprise tout en assu-
rant sa prennit, de se faire pauler tout en restant le matre de
laffaire, de payer moins de charges sociales et scales sur les bnces
laisss dans lentreprise pour en assurer lautonancement, dattirer des
capitaux pour son dveloppement, et de bncier du statut de salari
(grant minoritaire).
2.2.
Le choix de la SARL comme structure juridique
11
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Voir le Guide pratique de lentreprise individuelle responsabilit limite
(EIRL) aux ditions dOrganisation.
2. Voir Guide pratique de la SAS et de la SASU aux ditions dOrganisation.
Entreprise individuelle ou SARL pour dbuter votre activit ?
Vous pouvez dbuter votre activit sous la forme dune entreprise individuelle ou
dune auto-entreprise, et lorsque vous aurez atteint un certain niveau dactivit, vous
transformez votre entreprise individuelle en SARL
1
. Vous naurez pas payer de
droits denregistrement sur lapport du fonds de commerce la SARL si vous prenez
lengagement de conserver les titres reus en rmunration de cet apport pendant au
moins cinq ans. Les plus-values bncieront dun rgime dimposition de faveur.
En revanche, si vous voulez dvelopper rapidement votre entreprise, attirer des capi-
taux an de nancer le lancement et le dveloppement de lentreprise et la vendre
terme, vous avez intrt opter pour une structure socitaire de type SARL ou SAS
2
ds la cration. Il en est de mme si lentreprise gnre des bnces importants
laisss pour partie dans lentreprise pour son autonancement.
La SARL est-elle la structure adapte votre projet ?
Une synthse des avantages et inconvnients de la SARL par rapport aux autres
formes sociales est expose sous forme de tableaux en annexe page 332 et sui-
vantes.
Crer une SARL uniquement pour amliorer
sa protection sociale : une stratgie dpasse
Pour les rgimes obligatoires dassurance maladie-maternit, la protection sociale
du travailleur indpendant est aujourdhui quasi identique celle dun salari. Pour
les autres risques, la protection sociale des salaris est meilleure mais cot plus
lev. Lentrepreneur individuel peut faire des arbitrages pour amliorer sa couver-
ture sociale et dcider de saflier ou non tel ou tel rgime facultatif.
Zoom n 2
Zoom n 3
Zoom n 4
Guide pratique de la SARL et de lEURL
12
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La simple mise en SARL de votre entreprise individuelle va permettre
une importante conomie dimpt sur le revenu et de charges
sociales car vos prlvements pour vivre sont infrieurs aux bnces
dgags par votre activit.
Les sources dconomie sont les suivantes :
Charges sociales. La transformation en SARL diminue la base
de calcul des charges sociales. Dans une entreprise individuelle,
tout le bnce est soumis cotisations alors que dans une
SARL, seule la rmunration attribue au grant (quil soit majo-
ritaire avec un statut de travailleur indpendant, ou minoritaire
avec un statut de salari) est soumise cotisation.
Impt sur le revenu sur la rmunration (IR). Tout le bnce
de lentreprise individuelle est impos lIR (dans la catgorie
BIC ou BNC ou BA) alors que seule la rmunration du grant est
impose lIR (dans la catgorie traitements et salaires ou art. 62
du CGI). Cependant le bnce de la SARL est impos lIS
mais un taux de 15 % alors que lIR peut atteindre 40 %. Une
partie plus importante, car moins impose, pourra tre consacre
au dveloppement de la SARL.
Impt sur le revenu sur les distributions. Dans une SARL, si
vous dcidez de distribuer le bnce sous forme de dividendes,
ils seront soumis limpt sur le revenu dans la catgorie des
RCM (revenus de capitaux mobiliers). En revanche, dans une
Transformer son entreprise individuelle en SARL pour raliser
dimportantes conomies de charges sociales et dimpt sur le revenu
Vous exploitez un fonds de commerce ou une clientle valu 1 000 000 dans le
cadre dune entreprise individuelle qui na pas opt pour lIS. Votre entreprise dgage
un bnce annuel de 100 000 avant rmunration et charges sociales. Vous avez
besoin de 50 000 par an pour vivre. Votre taux marginal dimposition est de 35 %.
Les charges sociales sont de 42 %.
Vous dcidez de mettre en SARL votre entreprise individuelle. La SARL est impose
lIS. En tant que grant, vous vous attribuez une rmunration de 50 000 . Le
bnce pourra tre distribu sous forme de dividendes ou mis en rserve pour
assurer lautonancement de lentreprise.
Cas n 1
Le choix de la SARL comme structure juridique
13
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Le taux de prlvements sociaux volue. On retient 11 % par convention.
entreprise individuelle, vous pouvez prlever sur la caisse sans
formalisme (unicit du patrimoine ; le patrimoine priv et profes-
sionnel ne font quun) et sans imposition (confusion de patri-
moine : le bnce a dj t intgralement impos).
Autonancement Distribution
SARL
Au niveau de la SARL
Bnce
Rmunration du grant
Charges sociales
100 000
50 000
21 000
100 000
50 000
21 000
Bnce imposable
IS 15 %
29 000
4 350
29 000
4 350
Rsultat net comptable de la SARL
Dividendes
24 650
0
24 650
24 650
Affectation aux rserves 24 650 0
Au niveau du grant
Rmunration aprs dduction de 10 % pour frais
Impt sur le revenu calcul sur rmunration aprs
dduction pour frais de 10 %
50 000
15 750
50 000
15 750
Dividendes
Abattement de 40 %
Abattement pour un couple mari ou pacs
34 250 34 250
24 650
9 860
3 050
Dividende imposable
Impt sur le revenu aprs crdit dimpt de 230
Prlvements sociaux de 11 % sur le brut
1
11 740
3 879
2 712
18 060
Au niveau consolid
Imposition globale
Net disponible
41 100
58 900
47 691
52 310
100 000 100 000
Guide pratique de la SARL et de lEURL
14
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Entreprise individuelle
Au niveau du chef dentreprise individuelle
Bnce
Charges sociales
100 000
42 000
Bnce imposable
Impt sur le revenu
58 000
20 300
Net disponible
Imposition globale
Net disponible
37 700
62 300
37 700
100 000
CONOMIE GLOBALE
en
en %
21 200
21 %
14 610
15 %
Vendre son entreprise individuelle une SARL pour raliser
dimportantes conomies de charges sociales et
dimpt sur le revenu et rebondir
Vous exploitez un fonds de commerce ou une clientle valu 700 000 dans le
cadre dune entreprise individuelle. Votre entreprise dgage un bnce annuel de
70 000 avant amortissement. Vous tes propritaire des locaux commerciaux qui
sont inscrits lactif de votre entreprise individuelle pour une valeur de 100 000 .
La dure damortissement est de 20 ans. Leur valeur de march est de 300 000 .
Votre taux marginal dimposition est de 35 %. Les charges sociales sont de 42 %.
Vous constituez une SARL dexploitation de famille qui opte pour limpt sur le
revenu et une SCI pour limmobilier qui nopte pas pour lIS. Vous vendez le fonds de
commerce la SARL dexploitation et les locaux commerciaux la SCI. La SARL et
la SCI achtent avec un prt in ne au taux de 5 % (remboursement du capital en n
de priode). La SCI loue les locaux pour un loyer annuel de 30000 . Vous investissez
le prix de vente dans une assurance-vie investie en produits euros avec un rendement
raisonnable de 4 % net de frais de gestion.
Autonancement Distribution
Cas n 2
Le choix de la SARL comme structure juridique
15
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La SARL est impose lIR pour simplier la comparaison. Le mon-
tage est optimis si on prend en compte lconomie de charges sociales
et dimpt sur le revenu li au passage de lentreprise individuelle vers
la SARL (cas n 1).
Le montage propos va permettre une importante conomie dimpt
sur le revenu et de charges sociales. En effet, les intrts sur
lemprunt sont dductibles au niveau de la SARL et de la SCI et per-
mettent ainsi de faire une conomie dimpt sur le revenu (SARL et
SCI) et de charges sociales (SARL uniquement). Alors que les int-
rts de lassurance-vie ne sont pas imposables. Seuls les prlve-
ments sociaux sont exigibles. On ralise ici une conomie globale
bien que le taux dintrt de lemprunt soit suprieur (5 %) au taux de
rendement de lassurance-vie (4 %).
Au niveau de lexploitation
Avant Aprs
Entreprise
individuelle
SARL
dexploitation
Bnce avant amortissement 70 000 70 000
Amortissement
base amortissable
dure damortissement
100 000
20
amortissement 5 000
Loyers 30 000
Intrts demprunt
montant
taux
700 000
5 %
intrts 35 000
Bnce aprs charges sur immeuble
Charges sociales
65 000
27 300
5 000
2 100
Bnce imposable 37 700 2 900
Impt sur le revenu 13 195 1 015
Trsorerie disponible 24 505 1 885
Guide pratique de la SARL et de lEURL
16
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Au niveau priv Avant Aprs
SCI de location
Loyers 30 000
Intrts demprunt
montant
taux
300 000
5 %
intrts 15 000
Revenus fonciers 15 000
Impt sur le revenu 5 250
Trsorerie disponible 9 750
Assurance-vie
Capital 1 000 000
Taux de rendement 4 %
Intrts capitaliss 40 000
Impt sur le revenu 0
Prlvements sociaux (11 %)
1
4 400
Trsorerie disponible 35 600
Trsorerie disponible Avant Aprs
Au nal
Gain de trsorerie de
qui sexplique par :
29 505 47 235
17 730
une conomie dIR sur lexploitation
une charge dIR sur la SCI
une conomie de charges sociales
une perte entre le taux de lemprunt et le taux
de lassurance-vie
des prlvement sociaux sur lassurance-vie
12 180
5 250
25 200
10 000
4 400
17 730
1. Le taux de prlvements sociaux volue. On retient 11 % par convention.
Le choix de la SARL comme structure juridique
17
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Voir Gestion de patrimoine : optimisez votre investissement immobilier de Pascal
Dnos aux ditions dOrganisation pour une tude complte du statut de loueur
en meubl professionnel (LMP).
2. Voir le Guide pratique de la SCI aux ditions dOrganisation.
3. Une SARL de famille est impose lIS avec la possibilit dopter pour lIR.
Une EURL comme une SCI est impose lIR avec la possibilit dopter pour
lIS.
2.2.2. Se constituer et grer un patrimoine immobilier
La SARL permet de dvelopper une activit dinvestisseur en immobi-
lier locatif an de se constituer un patrimoine immobilier. La SARL
est la structure patrimoniale idale pour dvelopper une activit de
loueur en meubl professionnel
1
.
2.2.3. Dvelopper un projet dutilit sociale
La socit cooprative dintrt collectif (SCIC) constitue sous
forme de SARL permet dassocier autour dun projet dutilit sociale
diffrents acteurs : salaris, bnvoles, usagers, nanceurs, entreprises,
associations (Voir page 321 et suivantes).
La gestion dun patrimoine immobilier : SARL, EURL ou SCI
2
?
La responsabilit des associs de la SARL est limite leurs apports alors que les
associs de la SCI sont tenus indniment au passif. Le choix de la SARL permet de
limiter la responsabilit des associs. De plus, dans une petite SARL comme dans
une SCI, le commissaire aux comptes nest pas obligatoire. La SCI a le choix de son
mode dimposition : limpt sur les socits ou limpt sur le revenu. La SARL de
famille peut opter pour limpt sur le revenu
3
uniquement si elle exerce une activit
commerciale (location meuble). Lactivit de la SCI doit tre obligatoirement
civile : si elle devient commerciale (location meuble), la SCI est automatiquement
impose lIS. En revanche, une SARL peut exercer une activit civile ou commer-
ciale. Mais la SARL noffre pas toute la souplesse dune SCI.
Zoom n 5
Guide pratique de la SARL et de lEURL
18
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.2.4. Investir dans une centrale de production
dlectricit photovoltaque
Linvestissement dans une centrale de production dlectricit photovol-
taque doit tre isole dans une socit commerciale (SARL, SAS)
car la vente dlectricit est une activit commerciale impose en BIC
(bnces industriels et commerciaux).
Une centrale installe sur une exploitation agricole (dans le sud de la
France, les vignes sont arraches pour tre remplaces par des panneaux
photovoltaques la prime darrachage europenne peut alors servir
implanter la centrale !) pourrait tre isole au sein dune socit civile
agricole (EARL, GAEC, GFA, SCEA). En effet, la vente dlectricit
photovoltaque, dans la limite de 100 000 ou de 50 % des recettes agri-
coles, ne remet pas en cause limposition dans la catgorie des bnces
agricoles (BA). Au nal, la vente dlectricit est considre comme
accessoire lactivit agricole et impose en BA (et non en BIC). Mais,
sur le plan juridique, le non respect de lobjet civil (activit agricole) de la
socit civile pourrait lui faire perdre sa personnalit morale : la responsa-
bilit des associs indnie deviendrait aussi solidaire ; la validit des
contrats dachat de llectricit avec EDF pourrait tre remise en cause
Isoler la centrale dans une SCI transparente (socit civile immobi-
lire impose en revenus fonciers limpt sur le revenu) risquerait de
la faire basculer lIS (impt sur les socits) car une socit civile
qui exerce une activit commerciale bascule lIS. En effet, une
socit civile ne peut exercer une activit commerciale sur le plan s-
cal que dans la limite de 10 % de ses recettes hors taxes.
Nous avons donn les lments qui permettent de choisir la SARL
comme structure juridique de lentreprise. Les dveloppements qui
suivent donnent la marche suivre pour constituer une SARL.
Dans un premier temps, il faut effectuer un certain nombre de dmar-
ches an dtablir les documents constitutifs de la socit. Puis, dans
3. Comment constituer la SARL ?
Le choix de la SARL comme structure juridique
19
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Dlai lgal.
un deuxime temps, il faut accomplir les diffrentes formalits permet-
tant dimmatriculer la socit.
Chronologie des dmarches et dlais respecter
Avant dexaminer dans le dtail les diffrentes tapes de la constitution
de la SARL, nous proposons une synthse des dmarches et des forma-
lits accomplir pour permettre limmatriculation de la socit.
Dmarches et formalits Dlais respecter
1. Dnir les caractristiques essentielles de la socit an
dlaborer les statuts
Quels sont les associs ?
Dans quel local sera tabli le sige social ?
Quel est lobjet de la socit ?
Quelle dnomination donner la socit ?
Quelle est la dure de la socit ?
Quel est le montant du capital social et par quel type
dapports sera-t-il constitu (en nature, en numraire) ?
Ds la conception du projet
an de mettre sur pied
la future socit.
Dsigner un commissaire aux apports en cas dapports
en nature.
Qui sera grant ?
Les cessions et les transmissions de parts sociales
sont-elles soumises lagrment des associs ?
Faut-il dsigner un commissaire aux comptes ?
Prvoit-on la rpartition des bnces annuels ?
Penser la reprise des engagements des fondateurs.
Penser la possibilit de prendre les dcisions
collectives par voie de consultation crite.
Faut-il dsigner un arbitre pour rgler les futures
contestations ?
2. Avant la signature des statuts
Pour les apports en espces
1. Souscription au capital et libration intgrale.
2. Versement des fonds lun des fondateurs.
3. Dpt des fonds pour le compte de la socit dans un
compte bloqu la banque (chez le notaire, sil a rdig
les statuts).
4. Remise dun certicat du dpositaire, tabli par le banquier
(ou par le notaire) avec la liste des souscripteurs.
Dans les 8 jours
de leur rception
1
.
3.1.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
20
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dmarches et formalits Dlais respecter
Pour les apports en nature
1. Dsignation par les associs lunanimit
dun commissaire aux apports.
2. Rapport du commissaire aux apports dpos au sige
de la socit, et annex aux statuts.
Autres dmarches
1. Trouver un sige social.
2. Choisir ventuellement un commissaire aux comptes.
3. Effectuer les recherches dantriorit auprs de lINPI pour
le nom de la socit et des marques.
4. Se procurer lensemble des pices dposer au centre
des formalits des entreprises (CFE) aprs la signature
des statuts.
30 jours au moins avant
la signature des statuts.
3. tablissement et signature par tous les associs
des statuts
Sont annexs aux statuts, et signs par tous
les associs :
le rapport du commissaire aux apports, en cas dapports
en nature ;
ltat des actes accomplis pour le compte de la socit
en formation.
4. Formalits accomplir aprs la signature des statuts
pour permettre limmatriculation
1. Publication dun avis de constitution dans un journal
dannonces lgales.
2. Dpt des pices au centre de formalits des entreprises
(CFE).
3. Si le dossier est complet, le CFE se charge de :
limmatriculation de la socit au registre
du commerce et des socits ;
linscription lURSSAF (Scurit sociale pour le grant
et pour les salaris) ;
lafliation aux Assedic ;
la dclaration linspection du travail ;
la dclaration lINSEE.
4. Enregistrement des statuts au centre des impts.
5. Raliser des formalits diverses selon la nature des biens
apports la socit pour que lapport soit opposable aux
tiers.
Le plus rapidement
possible car
limmatriculation
en dpend.
Dans le mois de
la signature des statuts
1
.
1. Dlai lgal.
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
21
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. LEURL est constitue avec un seul associ (voir page 273). La runion de toutes
les parts sociales en une seule main suite une cession ou une transmission
entrane la transformation immdiate de la SARL en EURL (voir page 298).
Les caractristiques essentielles de la socit
Pour mettre sur pied leur future socit, les fondateurs doivent dnir
les caractristiques essentielles de la socit an dtablir les statuts, et
runir les pices ncessaires laccomplissement des formalits.
3.2.1. Les associs
La SARL comprend gnralement un nombre restreint dassocis.
Deux associs
1
sufsent pour constituer une SARL. Cependant, le
nombre maximum dassocis est de cent. La SARL permet donc de
Dmarches et formalits Dlais respecter
5. Aprs limmatriculation de la socit
1. Retrait des fonds sur prsentation de lextrait
dimmatriculation (extrait K bis).
2. Se procurer des registres cots et paraphs pour
enregistrer les procs-verbaux des assembles
gnrales, et pour les livres comptables.
3. Demander lafliation aux caisses de retraite
et de prvoyance des cadres et non-cadres (elle nest
pas effectue par le CFE).
4. Les grants majoritaires doivent demander eux-mmes
lafliation aux caisses dont relve lactivit de lentreprise
(caisse dallocations familiales, caisse dallocation vieillesse
des commerants), et ventuellement souscrire
des assurances complmentaires.
5. Le grefer du tribunal de commerce effectue la publicit
au Bulletin ofciel des annonces civiles et commerciales
(BODACC).
6. LINSEE communique les numros SIREN, SIRET
et code APE.
7. Faire ouvrir un compte en banque ou rgulariser le compte
ouvert au nom de la socit en formation.
8. Crer un registre de paye pour le personnel.
9. Souscrire polices ou avenants auprs des compagnies
dassurances.
10. Dmarches diverses : EDF, GDF, France Tlcom
Dans les 8 jours
de limmatriculation.
Dans les 15 jours
de limmatriculation.
3.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
22
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
mobiliser un grand nombre dassocis pour assurer un meilleur nan-
cement sans tre oblige de se transformer en socit anonyme. Des
socits civiles (SCI) ou commerciales (SNC, SA, SAS, SARL),
un GIE ou un syndicat peuvent tre associs dune SARL.
Les associs dune SARL nont pas la qualit de commerant
Lassoci na donc pas besoin davoir la capacit de faire du com-
merce sous son nom personnel pour tre associ dune SARL. Ainsi,
la personne dont la profession est incompatible avec lexercice dun
commerce peut souscrire des parts de SARL : personne exerant une
profession librale
1
(cependant, les associs ou le grant doivent avoir
certaines qualications professionnelles), fonctionnaire, tranger
nayant pas la carte de commerant tranger
Constituer une SARL entre deux poux
Deux poux peuvent seuls constituer une SARL et participer ensemble
ou sparment la gestion
2
. Dans ce cas, il est prfrable que les sta-
tuts soient tablis sous forme dacte notari an dviter que les
apports soient considrs comme des donations dguises.
La qualit dassoci est reconnue lpoux qui acquiert les parts de la
SARL (mme si cette acquisition est faite avec des biens communs).
Cependant, la qualit dassoci est reconnue lautre poux pour la
moiti des parts, lorsquil a noti la socit son intention dtre per-
sonnellement associ.
Lpoux qui acquiert les parts dune SARL doit tre agr par les
autres associs. Cet agrment vaut pour le conjoint qui notie son
intention dtre personnellement associ. Cependant, si cette notica-
tion est postrieure lacquisition, les clauses statutaires relatives
lagrment lui sont opposables (lpoux asssoci ne peut pas participer
au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quo-
rum et de la majorit).
Notre conseil : les deux poux doivent tous les deux participer la
constitution de faon ce que les parts soient partages en deux.
1. Certaines professions librales doivent tre obligatoirement exerces sous la
forme dune socit dexercice libral (voir page 301).
2. Cest une SARL de famille qui peut opter pour lIR (voir page 23).
Le choix de la SARL comme structure juridique
23
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Voir galement zoom n 8.
Attention la SARL constitue avec des prte-noms pour bncier
du statut scal et social de grant minoritaire tout
en restant seul matre bord !
An de sattribuer le statut de grant minoritaire pour bncier des avantages
sociaux et scaux de ce statut, le crateur peut tre tent de crer une SARL ctive
avec un associ de complaisance, un prte-nom auquel il remettra des parts, contre
une cession en blanc (sur le bordereau de cession, ne gure aucune indication quant
la date de cession, aux modalits de paiement, et parfois mme quant au prix de ces-
sion et au nom du cessionnaire).
Une telle pratique prsente des risques :
la SARL est une socit ctive puisquelle na quun seul propritaire. Les tiers qui
en auraient connaissance pourraient invoquer devant les tribunaux la nullit de
cette structure juridique ;
si le prte-nom dcde brutalement, le dtenteur des cessions en blanc ne pourra
pas les faire enregistrer avant la date du dcs du prte-nom : les parts sociales
seront rputes appartenir aux hritiers qui devront acquitter des droits de succes-
sion et ne se contenteront peut-tre pas de jouer les gurants au sein de la socit ;
si le prte-nom est mis en redressement ou en liquidation judiciaire, le grant, pour
mettre labri les cessions en blanc, devra les enregistrer avant la date de cessation
de paiements de son associ de complaisance. Or, les tribunaux font gnralement
remonter la date de cessation des paiements bien avant la date du dpt de bilan et
lenregistrement risque dtre effectu pendant la priode critique : les parts pour-
raient tre liquides ;
Le statut social de grant majoritaire (statut de travailleur indpendant) qui est
devenu plus attractif devrait dissuader la cration de SARL avec des prte-noms.
La SARL de famille
1
La SARL de famille est compose dassocis qui sont membres de la mme
famille : parents en ligne directe, ascendants, descendants, frres et surs ainsi que
les conjoints (les concubins sont exclus).
Zoom n 6
Zoom n 7
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
24
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Transmission et cession des parts sociales
La SARL est une socit ferme car la cession de parts sociales des
personnes trangres la socit est obligatoirement soumise lagr-
ment des associs (majorit des associs reprsentant au moins les
trois quarts du capital).
En revanche, la cession de parts un autre associ, un conjoint, un
ascendant, ou un descendant est libre en principe. Cependant, les sta-
tuts peuvent imposer que ces cessions soient soumises un agrment
des associs.
En cas de dcs dun associ, les parts sont transmises librement aux
hritiers. Toutefois, les statuts peuvent indiquer que la socit conti-
nuera entre les seuls associs survivants, ou entre les associs survivants
et les hritiers agrs ou toute autre personne dsigne dans les statuts.
Elle est impose lIS (impt sur les socits) mais elle peut opter pour lIR (impt
sur les revenus) sans limitation de dlai.
Le grant a le statut social de travailleur indpendant. Cependant, loption de la
SARL de famille pour lIR est sans incidence sur le rgime de Scurit sociale des
associs qui exeraient une activit salarie au sein de la SARL pralablement
loption (le grant minoritaire ou galitaire demeure assimil un salari).
La responsabilit des associs est limite au montant de leurs apports comme
dans la SARL de droit commun.
Si un associ sans lien de parent entre dans le capital de la SARL de famille, elle
redevient une SARL normale impose lIS.
La SARL de famille pour mettre en socit une entreprise individuelle familiale
La SARL de famille peut tre envisage pour la transformation dune entreprise indi-
viduelle familiale en socit an de prparer la succession du chef dentreprise tout
en limitant sa responsabilit. En revanche, la SARL de famille est dconseiller aux
entreprises qui veulent, terme, faire entrer au capital un associ tranger la famille
pour faire face aux perspectives de dveloppement car le changement de rgime scal
(IR IS) a des consquences scales lourdes (voir page 67).
(Suite zoom n 7)
/
Zoom n 8
Le choix de la SARL comme structure juridique
25
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Se renseigner auprs de la Direction du trsor.
2. Des concubins et des partenaires pacss peuvent tre associs dune SARL. La
loi ne prvoit aucune disposition particulire.
3. Voir en annexe la formule davertissement adresser au conjoint de lassoci.
3.2.2. Le sige social
Le sige social constitue le domicile lgal de la socit et dtermine :
le lieu o doivent tre effectues les formalits de publicit au
moment de la constitution, ou en cours de vie sociale ;
Peuvent-ils devenir associs dune SARL ?
Mineur mancip Oui car il a la mme capacit quun majeur.
Mineur non
mancip sous
tutelle
Pour les apports en numraire : le tuteur devra obtenir
lautorisation du conseil de famille.
Pour les apports en immeubles ou en fonds de commerce :
le tuteur devra tre autoris par le conseil de famille au vu
du rapport dun expert dsign par le juge des tutelles.
Mineur non
mancip dont
les biens sont sous
ladministration
lgale des parents
Pour les apports en numraire : les parents peuvent souscrire
ensemble ; dfaut daccord entre eux, le juge des tutelles doit
donner son autorisation.
Pour les apports en immeubles ou en fonds de commerce :
les parents doivent obtenir lautorisation du juge des tutelles.
Socits civiles ou
commerciales, GIE,
syndicats
Oui en tenant compte des rgles sur les liales et les participations.
tranger Oui mme sil na pas la carte de sjour temporaire autorisant
lexercice dune activit non salarie. Cependant, il convient de tenir
compte de la rglementation en matire dinvestissements raliss
en France par des trangers
1
.
Chacun des poux
2
Pour les biens propres : un poux peut les apporter une SARL
sans lautorisation de son conjoint.
Pour les biens communs : un poux ne peut les apporter sans
lautorisation de son conjoint
3
. dfaut, le conjoint peut demander
lannulation de lapport dans les deux annes o il en a eu
connaissance. La qualit dassoci est reconnue au seul poux
qui fait lapport.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
26
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
les tribunaux comptents pour toutes les actions judiciaires concer-
nant la socit (signications et assignations en justice ; redresse-
ment judiciaire en cas de cessation de paiements) ;
la nationalit de la socit les socits dont le sige social est
situ en territoire franais sont soumises la loi franaise.
Si le sige rel de la socit est situ dans un autre lieu (organes de
direction) que le sige statutaire, les tiers peuvent se prvaloir du sige
statutaire ou du sige rel de la socit. Cest au tribunal dapprcier le
caractre rel ou ctif du sige social.
Le greffe du tribunal de commerce qui dlivre le numro dimmatricu-
lation exige que la SARL ait un local commercial affect lusage de
sige social (la socit doit tre propritaire ou locataire du local o
est situ son sige). Cependant, an de faciliter limmatriculation de
socits qui ne disposent pas dun tel local, la loi autorise la domicilia-
tion collective et la domiciliation temporaire.
La domiciliation collective
Le sige social de la SARL peut tre tabli en partageant un local avec
dautres socits condition que soit tabli un contrat crit de domici-
liation
1
. Cependant, les socits dun mme groupe qui tablissent leur
sige dans un mme local dont lune a la jouissance ne sont pas tenues
de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
1. Les locaux peuvent tre mis disposition par une socit de domiciliation.
Une socit de domiciliation ne doit pas servir
uniquement de bote aux lettres
Une socit de domiciliation doit mettre disposition de la SARL un local pour la
tenue des assembles et la consultation des documents sociaux. La SARL domicilie
doit sengager utiliser ces locaux comme sige social.
Zoom n 9
Le choix de la SARL comme structure juridique
27
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La domiciliation temporaire
1
Le sige social de la SARL peut tre tabli en utilisant le local dhabi-
tation du grant :
pour une dure maximale de deux ans compter de la cration de
lentreprise
2
;
condition que la domiciliation ne saccompagne pas dun change-
ment de destination des lieux (le local ne doit pas devenir un
bureau, un atelier, ou un entrept ; la clientle ne doit pas sy dpla-
cer pour acqurir des marchandises mises en vente sur place) ;
condition que le futur grant ait noti pralablement par crit
(lettre recommande avec accus de rception) au bailleur, ou au
syndic de la coproprit (selon sa qualit de locataire ou de pro-
pritaire) son intention duser de cette facult de domiciliation
temporaire (modle de lettre au bailleur ou au syndic de copro-
prit en annexe).
3.2.3. Lobjet social
Lobjet social permet de dnir les activits
3
qui seront exerces par la
socit. Lactivit exerce peut tre commerciale ou civile. Si lactivit
est civile, la SARL reste commerciale par sa forme, et se trouve donc
soumise aux rgles du droit commercial
4
(seul le tribunal de commerce
est comptent).
1. La domiciliation temporaire ne sapplique que lors de la constitution de la
socit. Elle nest donc pas possible en cas de transformation dune entreprise
individuelle en socit.
2. Au-del, le transfert est obligatoire sous peine de radiation de la SARL.
3. Les activits professionnelles qui ne peuvent pas tre exerces sous forme de
SARL sont les suivantes : assurances, rassurances, crdit diffr, socit de
capitalisation et dpargne. Pour des activits rglementes, la SARL est possi-
ble si les associs ont les diplmes requis (agences de voyage).
4. Cependant, pour la SELARL, SARL dexercice libral, seul le tribunal civil est
comptent en cas de litige et seul le tribunal de grande instance est comptent
en cas de procdure collective (voir page 297).
Guide pratique de la SARL et de lEURL
28
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Attention la rdaction de lobjet social !
Un objet trop vague pourra tre assimil une absence dobjet
social.
Un objet trop prcis pourra obliger les associs procder ult-
rieurement une modication statutaire de lobjet social sil ne
correspond plus lactivit exerce du fait du dveloppement de
la SARL. Cette modication statutaire reprsente un cot et des
formalits. De plus, le changement dobjet social quivaut, sur le
plan scal, une cessation dentreprise avec des consquences
scales importantes.
Un objet trop large peut engager la socit. En effet, dans ses rap-
ports avec les tiers, si le grant accomplit un acte nentrant pas
dans lobjet social, la socit pourra ne pas tre engage par cet
acte en prouvant que le tiers savait que lacte dpassait cet objet,
ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances.
Incidence du changement dobjet social
Le changement de lobjet social ou de lactivit relle de la SARL a des incidences s-
cales trs lourdes :
Imposition immdiate lIS des bnces en cours au moment du changement
mais les plus-values latentes et les provisions bncient dun sursis dimposition.
Les dcits raliss avant le changement sont perdus. Ils peuvent cependant tre
imputs sur les bnces et plus-values imposables au titre de lexercice de chan-
gement.
Le changement de lobjet social nentrane pas dinscription modicative au RCS si
lactivit principale de la SARL mentionne au RCS nest pas modie.
SARL ctive
Une Socit civile immobilire cre une liale sous forme de SARL pour loger son
activit commerciale an de ne pas remettre en cause sa forme civile. La SCI sera
condamne rembourser les dettes de la SARL car cest une liale ctive.
Zoom n 10
Zoom n 11
Le choix de la SARL comme structure juridique
29
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. La recherche dantriorit peut tre demande lINPI par crit en reprenant le
modle en annexe (INPI 32, rue des Trois-Fontanot 92016 Nanterre Cedex
Tl. : 01 46 92 58 00).
3.2.4. La dnomination sociale
Le nom de la socit est librement choisi par les associs. Il peut tre en
rapport avec lobjet social, de pure fantaisie, ou incorporer le nom dun
ou plusieurs associs (il peut tre dconseill dintroduire dans la dno-
mination sociale le nom dun associ, car cet associ peut se retirer un
jour de la socit).
La dnomination sociale doit tre prcde ou suivie des mots Socit
responsabilit limite ou SARL , ainsi que du capital social. Ces
mentions, ainsi que le numro dimmatriculation au registre du com-
merce et des socits, doivent gurer obligatoirement sur tous les actes
et documents que la socit destine aux tiers (factures, lettres). Si la
socit est en cration, il faut spcier sur les documents Socit en
formation .
3.2.5. La dure de la socit
La dure de la socit est librement xe par les associs, mais elle ne
doit pas dpasser 99 ans.
vitez dutiliser une dnomination dj existante
Le fondateur doit sassurer que le nom choisi na pas t pris par une autre socit
au titre de sa dnomination sociale, ou des marques de ses produits.
Par prudence, il faut interroger les services de lINPI (Institut national de la proprit
industrielle)
1
qui dtient la liste de toutes les marques et dnominations utilises en
France, et protges. Cependant, cette recherche dantriorit noffre pas une garantie
absolue car lINPI ne garantit pas la priode immdiate qui vient de scouler en raison
des dlais assez longs de centralisation des renseignements.
Zoom n 12
Guide pratique de la SARL et de lEURL
30
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
3.2.6. Le capital social et les apports
Les associs font des apports la SARL qui sont rmunrs par des
parts sociales dont le montant est librement x. Lensemble des
apports constitue le capital social qui est librement x par les asso-
cis. La SARL ne peut pas faire appel public lpargne. Un capital
trop faible par rapport aux besoins de lexploitation peut entraner la
responsabilit des associs pour faute de gestion (voir zoom n 1).
Les apports en numraire doivent tre librs la souscription du cin-
quime au moins de leur valeur nominale. Le solde doit tre vers dans
les cinq ans.
Le montant du capital social doit obligatoirement gurer dans les sta-
tuts ainsi que dans les documents mis par la socit et destins aux
tiers (factures).
Les apports des associs peuvent tre des apports en numraire (som-
mes dargent), des apports en nature (fonds de commerce, immeuble),
ou, sous certaines conditions, des apports en industrie (lapporteur met
la disposition de la socit ses connaissances techniques ou profession-
nelles, son exprience, ses relations). Les apports seront dvelopps
page 153.
Le capital dune SARL peut tre variable. Une clause de variabilit du
capital doit alors gurer dans les statuts lors de la constitution de la
socit ou en cours de vie sociale. Le capital peut ainsi librement
varier entre un minimum (le capital plancher ) et un maximum (le
capital plafond ).
Ne xez pas une dure trop courte
En effet, si vous voulez, lexpiration du terme normal, que la socit continue, il fau-
dra proroger la dure mentionne dans les statuts par une dlibration extraordinaire
des associs ; ce qui entrane des formalits et des frais. De plus, un associ mino-
ritaire qui dispose dune minorit de blocage, peut sopposer la prorogation lors de
larrive du terme, et provoquer ainsi la dissolution de la socit.
Zoom n 13
Le choix de la SARL comme structure juridique
31
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Larticle 48 de la loi de 1867 dispose quune clause de variabilit du capital
peut tre stipule dans les socits qui nont pas la forme de socit
anonyme . LEURL peut avoir un capital variable (voir page 273).
2. La diminution du capital social peut seffectuer par diminution du montant
nominal des parts sociales de la SARL, par le retrait volontaire dun associ ou
par lexclusion dun associ. Le droit de retrait des associs qui est dordre
public ne peut pas tre supprim par les statuts. Lexclusion dun associ ne
peut tre dcide que par une dcision collective des associs reprsentant la
majorit en nombre et les trois quarts du capital social.
3. Le nouvel associ pourra faire lobjet dune procdure dagrment (voir
page 88). Le nombre dassocis ne doit pas dpasser le plafond lgal de 100.
4. Les oprations doivent tre consignes dans un registre transactionnel pour ta-
blir vis--vis des tiers la qualit dassoci.
5. Le banquier exigera de solides garanties prises sur le patrimoine personnel des
associs (hypothques).
3.2.7. Les engagements pris avant limmatriculation
Limmatriculation au RCS donne naissance la personnalit morale
de la SARL. Avant cette immatriculation, la socit ne peut donc pas
contracter. Ce sont alors les fondateurs qui accomplissent les actes pour
le compte de la socit. Mais les actes accomplis par les fondateurs
au nom de la socit sont juridiquement souscrits pour leur propre
SARL et capital variable
1
Avantages Inconvnients
Les rductions
2
ou augmentations
3
de capital comprises dans les limites
du capital plancher et du capital plafond ne
sont pas soumises la dcision collective
des associs et aux formalits
de publicit
4
.
Le capital dune SARL capital variable
doit tre libr dun montant minimum
qui ne doit pas tre infrieur au dixime
du capital social. Comme la loi nimpose
aucun dlai de libration intgrale du
capital, les associs pourraient ne jamais
librer le solde.
La SARL aura du mal obtenir un crdit
bancaire
5
cause de la responsabilit
limite des associs et de la faiblesse
des actifs de la SARL.
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaire les associs peuvent tre
condamns au paiement des pertes de la
SARL car la faiblesse du capital constitue
une faute de gestion, mme sil est
suprieur au minimum lgal.
La variabilit du capital ne peut pas tre
envisage dans une SARL ayant un fort
intuitu personnae car le fonctionnement
risque dtre perturb par des
changements frquents dassocis.
Les clauses statutaires de la SARL doivent
tre compatibles avec les rgles relatives
la variabilit du capital.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
32
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
compte. Les engagements qui rsultent de ces actes entranent une res-
ponsabilit indnie et solidaire des fondateurs. Ces engagements doi-
vent tre repris par la socit. Cependant, cette dcision de reprise ne
produit ses effets qu partir de limmatriculation de la socit.
La rdaction des statuts
3.3.1. Comment laborer les statuts ?
Le chef dentreprise peut laborer lui-mme les statuts en compltant
des statuts types, si la socit crer ne prsente pas de complexit juri-
dique.
Les actes accomplis par les fondateurs avant limmatriculation
de la SARL doivent tre repris par la socit
La dcision de reprise ne produit ses effets
qu partir de limmatriculation de la socit.
Avant la signature des statuts Aprs la signature des statuts
tablir un tat des actes accomplis par les
fondateurs pour le compte de la socit
en formation, avec lindication pour chacun
deux de lengagement qui en rsulterait
pour la socit.
Cet tat des actes est tenu la disposition
des associs trois jours au moins avant
la signature des statuts.
Cet tat est annex aux statuts dont
la signature emportera reprise des
engagements ainsi lists par la socit.
Les associs peuvent, dans les statuts
ou par acte spar, donner mandat
lun ou plusieurs dentre eux de prendre
des engagements pour le compte de
la socit.
Si ces engagements sont dtermins et
si leurs modalits sont prcises par le
mandat, limmatriculation de la socit au
RCS emportera reprise des engagements
par la SARL.
SARL capital variable
Deux associs dcident de crer une SARL au capital de 10 000 . Le montant du
capital plancher doit tre de 1 000 (soit un dixime du capital souscrit, cest--dire
10 000 ). Le montant du capital plafond est librement dtermin par les associs.
La variation du capital social se fait librement entre 1 000 et le montant du capital
plafond.
Cas n 3
3.3.
Le choix de la SARL comme structure juridique
33
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Cependant, le temps pass la rdaction des statuts par le chef dentre-
prise ne lest pas au dveloppement de ses affaires. De plus, des erreurs
dans la rdaction peuvent savrer dommageables par la suite. Le diri-
geant peut donc avoir intrt coner la rdaction des statuts un avo-
cat ou un notaire spcialis en droit des socits (les honoraires sont
ngociables et dpendent de la complexit du montage juridique envi-
sag). Ce professionnel devra prendre en compte les proccupations des
fondateurs pour que les statuts soient adapts la situation, an dviter
de srieuses difcults dans la vie de la socit par la suite.
Les statuts sont obligatoirement rdigs par crit, par acte sous seing
priv ou par acte notari (lacte notari est recommand quand deux
poux entrent simultanment dans la socit).
Les futurs associs se trouvent engags les uns envers les autres ds la
signature des statuts (et non seulement partir de limmatriculation de
la socit).
Il convient de laisser une marge gauche qui permet au receveur de
lenregistrement dy apposer sa mention, et aux associs de faire des
renvois lorsquune erreur a t commise. Chaque renvoi sera approuv
au moyen des paraphes des parties. Chaque page est numrote et
paraphe. Chaque original sera sign par chacun des associs.
Les pices suivantes seront annexes aux statuts :
le rapport du commissaire aux apports en cas dapports en nature ;
ltat des actes accomplis pour le compte de la socit en forma-
tion, avec lindication pour chacun deux de lengagement qui en
rsulte pour la socit.
Combien dexemplaires des statuts ?
Exemplaires originaux signer
par chacun des associs
Copies certies conformes
par le grant
un conserver au sige social ;
un pour le service de lenregistrement ;
deux pour le greffe du tribunal de commerce ;
un par associ ;
un pour lINPI en cas dapport de brevet
dinvention ;
un pour le propritaire en cas dapport de droit
au bail, si le bail le prvoit.
pour la banque ;
pour les administrations.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
34
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
3.3.2. Promesse de socit
Si la constitution de la SARL est subordonne la ralisation de cer-
tains vnements (achat dun fonds de commerce, dun droit au bail
pour les locaux du futur sige social), les futurs associs, dans
lattente de la constitution dnitive, peuvent sengager en changeant
des lettres portant promesse de socit.
Ces lettres prcisent les modalits essentielles de la future socit (nom
des associs, apports, sige) et indiquent les conditions auxquelles
est subordonne la constitution dnitive de la socit. La lettre peut
prciser que si lune des parties refuse de signer les statuts sans motif
lgitime, elle devra verser aux autres une somme dtermine titre de
dommages-intrts.
3.3.3. Les pactes extra-statutaires
Les associs ont la possibilit de conclure des contrats qui organisent
leurs rapports au sein de la socit, mais qui sont distincts des statuts
(do le nom pacte extra-statutaire ).
Les pactes extra-statutaires sont utiliss :
pour donner un caractre condentiel ces accords puisquils ne
sont pas, comme les statuts, dposs au greffe, et ne sont donc
pas communiqus aux tiers ;
pour limiter ces accords certains associs uniquement. ce
titre, ils ne lient que les associs qui les ont signs, et pendant
une dure limite, infrieure celle des statuts.
Ces pactes peuvent avoir de multiples objets :
La clause de premption permet dorganiser la cession des parts
sociales entre les associs signataires : si un associ envisage de
cder ses parts, il sengage les proposer un associ signataire.
Ainsi, les associs signataires de la clause peuvent contrler la
rpartition du capital entre eux. Si cette clause de premption est
introduite dans les statuts, elle vaut pour lensemble des associs.
La convention de vote permet dorganiser le vote des associs
signataires aux assembles dassocis : les associs signataires
sengagent voter dans un sens dtermin an de solidier une
majorit. Pour tre valable, cette clause ne doit pas tre signe par
Le choix de la SARL comme structure juridique
35
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
un associ en contrepartie dune rmunration ( dfaut, il y
aurait dlit de trac de voix) ; elle ne doit pas aller lencontre de
lintrt de la socit ( dfaut, il y aurait abus de droit de vote) ;
enn, elle doit tre limite dans le temps ( dfaut, lassoci per-
drait la libert de son vote qui constitue lune de ses prrogatives
fondamentales).
3.3.4. Statuts types comments
Les statuts doivent comporter les mentions imposes par la loi, mais
aussi les modalits de fonctionnement pratique de la socit (choix et
pouvoirs des grants, mode de consultation des associs, majorit
requise pour certaines dcisions) de faon disposer des renseigne-
ments ncessaires quand se pose une question ( dfaut, il faudrait en
permanence se rfrer aux dispositions lgales ou rglementaires).
loppos, les statuts ne doivent pas reproduire toutes les dispositions
lgales car le texte serait volumineux sans tre adapt aux besoins de
la socit. De plus, les statuts, pour tre jour, devraient tre modis
par une assemble gnrale extraordinaire chaque fois que les textes
lgaux font lobjet dune modication ; ce qui entrane un cot et un
formalisme importants. Cest pourquoi les statuts types proposs dans
les supplments Internet ralisent un compromis entre des statuts trop
longs et des statuts trop courts.
Les formalits pour limmatriculation de la socit
Aprs la rdaction et la signature des statuts, et lorsque tous les rensei-
gnements ncessaires auront t obtenus, un certain nombre de forma-
lits doivent tre accomplies pour permettre limmatriculation de la
socit au registre du commerce et des socits. Cest seulement aprs
Les pactes extra-statutaires ont une porte limite
En cas dinexcution par un signataire dune clause dun pacte extra-statutaire, il
pourra tout au plus tre condamn titre de dommages et intrts envers ses co-
contractants. Il ne peut pas tre contraint excuter son obligation.
Zoom n 14
3.4.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
36
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
cette immatriculation que la socit a la personnalit morale, et que le
grant peut retirer les fonds dposs sur prsentation de lextrait K bis
remis par le greffe et qui atteste de limmatriculation de la SARL au
registre du commerce.
Cependant, an de faciliter le retrait des apports lorsque la socit na
pas t dnitivement constitue ou immatricule en cas de carence du
grant, les associs peuvent mandater collectivement une personne
pour faire retirer les fonds dposs par les associs.
3.4.1. Lenregistrement des statuts
Lenregistrement des statuts consiste remettre un original sign des
statuts au service des impts qui procde son enregistrement.
Les statuts doivent tre enregistrs dans le dlai dun mois compter
de leur signature au service des impts du sige social de la SARL,
la diligence du grant (ou du notaire si les statuts sont rdigs par acte
notari). Il est donc possible de procder limmatriculation de la
socit avec des statuts non enregistrs. Sil y a apport la SARL dun
fonds de commerce, dune clientle, ou dun immeuble, le service
comptent est celui dans le ressort duquel se trouve le bien.
Le service des impts dtermine, aprs analyse des statuts, les droits
dapport payer qui sont exigibles au plus tard lexpiration dun dlai
de trois mois qui court partir de lenregistrement des statuts. Ce dlai
permet la socit dobtenir son immatriculation et le dblocage des
fonds dposs qui lui permettront de payer ces droits denregistrement.
3.4.2. La publication dun avis de constitution
Lavis de constitution est destin avertir les tiers de la naissance de la
socit et doit tre publi dans un journal habilit par la prfecture
recevoir des annonces lgales dans le dpartement du sige social.
La justication de lannonce, ou de la demande dannonce, doit tre
jointe au dossier de constitution. La socit peut donc tre immatricule
avant que lavis ne soit paru. Lapport, lachat ou la location-grance
Le choix de la SARL comme structure juridique
37
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Le dossier de demande dimmatriculation de la SARL peut tre prsent direc-
tement au greffe du tribunal de commerce condition davoir saisi pralable-
ment le CFE.
2. Voir dans les supplments Internet pour les pices complmentaires.
3. Ou deux expditions sils sont tablis par acte authentique ; lacte sous seing
priv indique, le cas chant, le nom et la rsidence du notaire au rang des
minutes duquel il a t dpos.
4. Idem note prcdente.
5. NB : Le prsident et les commissaires aux comptes sont dsigns dans les statuts.
6. La liste des souscripteurs doit mentionner le nombre de parts sociales souscrites
et les sommes verses par chacun deux.
7. Ou une copie de la demande de publication adresse ce journal.
8. Si le sige social est situ dans des locaux occups en commun par une ou plu-
sieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation.
9. Dautres pices justicatives sont produire selon le cas, notamment pour les
trangers et les professions rglementes.
dun fonds de commerce exploit par une SARL doit galement faire
lobjet dune annonce distincte dont la justication doit tre jointe au
dossier de constitution.
3.4.3. Le dpt du dossier au centre de formalits
des entreprises du tribunal de commerce
Les pices dposer au centre de formalits des entreprises du tribunal
de commerce
1
de la situation du sige social de la SARL
Principales pices
2
dposer au CFE :
1. deux originaux des statuts
3
;
2. deux originaux des actes accomplis pour le compte de la socit avant son
immatriculation
4
(voir page 31) ;
3. deux copies des actes de nomination du grant de la SARL, et le cas chant
des commissaires aux comptes, si la nomination se fait hors statuts
5
;
4. une demande dimmatriculation sur limprim M 0 ;
5. deux exemplaires du certicat du dpositaire des fonds avec la liste des souscripteurs
6
;
6. le rapport en double exemplaire du commissaire aux comptes sur lvaluation
des apports en nature ;
7. justicatif de linsertion de lavis de constitution de la SARL dans le journal dannonces
lgales
7
;
8. justicatif du sige social
8
;
9. attestation sur lhonneur par le grant relative labsence de condamnation certaines
sanctions pnales ;
10. extrait dacte de naissance du grant
9
ou dclaration sur lhonneur de liation ;
11. un extrait K bis du registre du commerce, de moins de 3 mois, fournir par les associs
personnes morales (SA, SARL) ;
12. un chque libell lordre de Monsieur le Rgisseur dAvances du tribunal de commerce .
Guide pratique de la SARL et de lEURL
38
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le dossier de demande dimmatriculation de la SARL est dpos au
centre de formalits des entreprises du lieu du sige social de la socit
au moyen de limprim M 0 qui se charge alors de transmettre la dcla-
ration au registre du commerce et des socits, au service des impts,
lURSSAF, lASSEDIC, linspection du travail et lINSEE.
Le Centre de formalits des entreprises (CFE) doit dlivrer un rc-
piss de dpt de cration dentreprise (RDCE) aux entreprises qui
dposent un dossier complet de demande dimmatriculation. Le
RDCE comporte la mention en attente dimmatriculation et permet
aux crateurs dentreprises daccomplir les dmarches ncessaires au
lancement de leur activit : ouverture dun compte EDF-GDF, inser-
tion dans lannuaire, dclaration La Poste Le crateur ou repre-
neur dentreprise est responsable des actes quil accomplit dans le
cadre de ce rcpiss. Consultez sur le site www.apce.com la rubrique
Choisir un statut juridique .
Les dmarches administratives de cration peuvent tre effectues
par Internet. Le crateur pourra donc effectuer les formalits dimma-
triculation de son entreprise chez lui par Internet (voir tlprocdure
sur le site www.service-public.fr). Pour plus dinformations, consultez
sur le site www.apce.com la rubrique Les formalits de la cration .
3.4.4. Les autres formalits suivant la nature des apports
Certaines formalits sont ncessaires suivant la nature des biens
apports la socit pour que ces apports soient opposables aux tiers.
Bien apport Formalits
Immeuble Les statuts doivent tre rdigs par un notaire qui se charge
des formalits auprs de la conservation des hypothques.
Fonds
de commerce
Une insertion dans un journal dannonces lgales du lieu du fonds
de commerce dans les 15 jours de la signature des statuts ;
Un avis publi au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC) dans les 15 jours de linsertion
dans le journal dannonces lgales.
Marque de fabrique
Brevet dinvention
Inscription sur un registre spcial tenu lInstitut national de
la proprit industrielle (INPI).
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
39
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le cot de la constitution
La constitution dune SARL entrane des frais qui sont la charge de
la socit. Elle peut galement entraner une taxation supporte par
lassoci sur lapport quil fait la socit.
3.5.1. Les frais la charge de la socit
a) Les droits dapport
Pour constituer une SARL, les associs doivent raliser des apports en
numraire (de largent) ou des apports en nature (un immeuble) :
Ces apports sont en principe rmunrs par des parts sociales de
la SARL : ce sont les apports titre pur et simple .
Cependant, un associ peut apporter un immeuble ou un fonds de
commerce dont il a nanc lacquisition par un emprunt qui nest
pas encore rembours au moment de lapport. Lassoci peut
demander la SARL la prise en charge du remboursement de cet
emprunt. Lapport est alors rmunr par des parts sociales de la
SARL et par la prise en charge du passif. La partie de lapport
rmunr par la prise en charge de lemprunt est un apport
titre onreux .
Dessins et modles Aucune formalit.
Apport dune
crance
Lapport dune crance par un associ la socit doit tre signi
au dbiteur ou accept par lui dans un acte authentique, pour tre
opposable aux tiers.
Droit au bail Lapport du droit au bail doit tre signi au bailleur par huissier,
sauf si le bailleur intervient lacte dapport notari, et sous rserve
du respect de la clause limitant le droit de cession.
Constitution dune SARL et rpartition des apports
Deux associs Graccus et Enak constituent une SARL. Graccus apporte 10 000 ,
ainsi que son savoir-faire estim 30 000 . Enak apporte un fonds de commerce
dune valeur de 100 000 et grev dun emprunt de 30 000 qui sera pris en
charge par la SARL. Procder la rpartition des apports.
3.5.
Cas n 4
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
40
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le savoir-faire est un apport en industrie qui ne contribue pas la
formation du capital. Cet apport nest pas soumis aux droits denregis-
trement.
Les apports titre onreux (rmunrs par la prise en charge dun
passif) sont imposs comme les ventes au taux de 5 %.
La taxation des apports titre pur et simple (rmunrs par des
parts sociales) dpend de la nature du bien apport et du rgime dim-
position de lapporteur.
Les apports en numraire sont exonrs de droits denregistre-
ment.
Lapport dun immeuble ou dun fonds de commerce par un
associ personne physique
1
une SARL est tax au taux de 5 %.
Rpartition des apports (en euros)
Associs
Nature de
lapport
Montant de
lapport
Apport
titre pur
et simple
Apport
titre
onreux
Capital de
la SARL
Rpartition
des parts
sociales
Graccus Numraire 10 000 10 000 10 000 12,50 %
Enak Fonds
Emprunt
100 000
30 000
70 000 30 000 70 000 87,50 %
80 000 80 000 30 000 80 000 100 %
Bilan de dpart de la SARL (en euros)
Fonds de commerce
Trsorerie
100 000
10 000
Capital
Emprunt
80 000
30 000
110 000 110 000
1. Lapport dun immeuble ou dun fonds de commerce est exonr de droits
denregistrement dans les cas suivants : apport une SARL par une socit
impose lIS ; apport par une personne physique une SARL de famille
ayant opt pour lIR ; apport par une personne physique une EURL impose
1IR (nayant pas opt pour lIS).
Pour un fonds de commerce : 0 % jusqu 23 K ; 3 % de 23 K 107 K ;
5 % au-del.
Le choix de la SARL comme structure juridique
41
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Pour certains apports, la TVA immobilire se substitue aux droits
denregistrement, en particulier :
les terrains btir lorsque la SARL prend lengagement de cons-
truire dans un dlai de quatre ans ;
les immeubles construits depuis moins de 5 ans et dont cest la
premire mutation depuis lachvement.
La SARL pourra rcuprer la TVA paye sur lachat. En cas de vente
de limmeuble social plus de 5 ans aprs lachvement de limmeuble,
la cession est soumise aux droits denregistrement et la TVA initiale-
ment dduite devra tre reverse pour partie ltat.
Par ailleurs, la mise en socit dune entreprise individuelle est exo-
nre de droits denregistrement :
si lapporteur prend lengagement de conserver pendant trois ans
au moins les titres remis en contrepartie de lapport ;
et sil apporte lensemble des lments de lactif immobilis
affects lexercice de la profession. Cependant, le transfert dans
le patrimoine priv de lapporteur des immeubles affects
lexploitation ne remet pas en cause lexonration pour les autres
lments si la socit peut continuer dutiliser les immeubles
affects lexploitation
1
.
1. Lapport dune seule branche dactivit lorsque lactivit en comporte plusieurs
ne remet pas en cause lexonration pour la branche transfre.
Apporteur
Personne morale
lIR (SNC)
Ou personne physique
Nature de lapport
Impos comme une vente
Fonds de commerce
Immeuble
Socit bnficiaire
de lapport
SARL lIS
Guide pratique de la SARL et de lEURL
42
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Lapport du fonds la SARL est exonr si le boulanger prend lenga-
gement de conserver les parts sociales de la SARL pendant 3 ans au
moins. En revanche, lapport de limmeuble la SCI sera tax au taux
de 5 % (si lapport est titre pur et simple). Cet apport ne remet pas en
cause lexonration de droits denregistrement pour le fonds car la SCI
loue les murs la SARL.
Une SARL peut tre constitue par apport partiel dactif : une
socit apporte une SARL une partie de ses lments dactif et
reoit, en change, des parts sociales de la SARL. Si lapport partiel
dactif porte sur une ou plusieurs branches compltes et autonomes
dactivits, lapport est exonr de droits denregistrement.
Hypothse n 1 : SARL classique soumise limpt sur les socits
partir de la rpartition des apports effectue prcdemment (cas
n 4), les droits denregistrement pays par la SARL sont les suivants :
1. Apport en numraire de 10 000 : apport titre pur et simple
pas dimposition.
Mise en socit dune entreprise individuelle
sous la forme dune SARL
Un boulanger apporte son fonds de commerce une SARL et dcide disoler les
murs au sein dune SCI qui opte pour lIS et qui loue les murs la SARL. Quels
sont les droits dapport ?
Constitution dune SARL et calcul des droits dapport
Deux associs Graccus et Enak constituent une SARL. Graccus apporte 10 000 .
Enak apporte un fonds de commerce dune valeur de 100 000 et grev dun
emprunt de 30 000 qui sera pris en charge par la SARL.
Calculer les droits denregistrement pays par la SARL en retenant les deux hypo-
thses suivantes :
Hypothse n 1 : SARL classique soumise lIS.
Hypothse n 2 : SARL de famille ou EURL soumise lIR.
Cas n 5
Cas n 6
Le choix de la SARL comme structure juridique
43
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Pour un fonds de commerce : 0 % jusqu 23 K ; 3 % de 23 K 107 K ;
5 % au-del.
2. Ainsi que les meubles corporels, les crances, les valeurs mobilires
3. Ou personne morale soumise limpt sur le revenu (SNC).
2. Apport dun fonds de commerce dune valeur de 100 000 et
grev dun emprunt de 30 000 qui sera pris en charge par la
SARL :
apport titre pur et simple pour 70 000 imposition un
taux qui peut atteindre 5 %
1
(70 000 23 000 ) 3 %
= 1 410 ;
apport titre onreux pour 30 000 impos comme une
vente 30 000 3 % = 900 .
Au nal, la SARL paiera 2 310 de droits denregistrement.
Hypothse n 2 : SARL de famille ou EURL soumise limpt
sur le revenu
Les droits dapports sont identiques sauf pour lapport titre pur et
simple pour 70 000 qui est exonr de droits denregistrement.
Cependant, si les associs sengagent conserver les actions reues
en contrepartie des apports pendant au moins 3 ans, aucun droit
denregistrement nest d. Si cet engagement nest pas respect,
les droits de 2 310 deviennent rtroactivement exigibles.
Au nal, la SARL de famille ou lEURL paiera 900
de droits denregistrement
Droits denregistrement sur les apports titre pur et simple une SARL
Les droits denregistrement sur les apports titre pur et simple une SARL
(rmunrs par des parts sociales) dpendent de la nature du bien
apport et du rgime dimposition de lapporteur.
Type dapport Apporteur Droits denregistrement
Numraire
2
Personne physique
3
Pas de droits
denregistrement
Socit impose lIS
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
44
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Immeuble usage professionnel ou usage dhabitation.
2. Ou personne morale soumise limpt sur le revenu (SNC).
3. Pas de droits denregistrement si la SARL est une SARL de famille ou une
EURL soumise limpt sur le revenu.
Pour les apports titre onreux, lorsque lapport porte sur un
bien unique (un fonds de commerce comme dans le cas n 4),
limputation du passif ne pose aucun problme. En revanche,
lorsque lapport porte sur une masse de biens de nature dif-
frente, les associs peuvent librement choisir (le choix doit
tre indiqu dans lacte de socit) les lments dactif qui
seront considrs comme apports titre onreux. Ils effectue-
ront ce choix de faon payer le moins possible de droits. Pour
cela, le passif sera imput par priorit sur les biens dactif dont la
monte ne supporterait pas de droits (espces, crances) ou
encore sur des biens relevant de la TVA (terrains btir, immeu-
bles dont lachvement remonte moins de cinq ans). Lorsque
cette imputation est puise, il faut se rsigner imputer le solde
du passif sur les immeubles, ce qui entrane lexigibilit des droits
de mutation.
Type dapport Apporteur Droits denregistrement
Immeuble
1
ou fonds
de commerce
Personne physique
2
5 % que lapport soit titre
pur et simple ou titre
onreux
3
Socit impose lIS Pas de droits
denregistrement
Calcul des droits en cas de constitution dune SARL Cas de synthse
Jacques Hraklion souhaite transformer son entreprise individuelle en SARL. II sera
associ de la SARL avec ses ls an de leur transmettre la direction de son affaire,
tout en assurant le contrle. Lentreprise individuelle apportera la SARL les l-
ments suivants :
un fonds de commerce valu 440 000 , et grev dun passif de 230 000 qui
sera pris en charge par la SARL ;
Cas n 7
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
45
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
sJacques Hraklion apporte des lments dont la valeur brute est de
530 000 . Ses apports sont titre onreux concurrence du passif
pris en charge par la socit, soit 230 000 ; ils sont titre pur et sim-
ple pour le surplus, soit 300 000 . Dans les statuts, il faut prvoir
limputation du passif dabord sur le numraire apport par Jacques
un terrain btir valu 40 000 , sur lequel la SARL prend lengagement de
construire un ensemble immobilier usage professionnel dans les quatre ans ;
un apport en numraire de 50 000 destin nancer en partie la construction
dier sur le terrain btir.
Les deux enfants de Jacques Hraklion apporteront chacun 1 500 en numraire.
Calculer les droits exigibles.
Bilan de dpart de la SARL (en euros)
Fonds de commerce
Terrain btir
Trsorerie
440 000
40 000
53 000
Capital
Emprunt
303 000
230 000
533 000 533 000
Calcul des droits exigibles (en euros)
Associs
Apports Droits exigibles sur apports
Nature Montant
titre pur
et simple
titre
onreux
titre pur
et simple
titre onreux
Hraklion
pre
Fonds de
commerce
440 000 300 000 140 000 Droits de mutation de 19 170
Passif 230 000
Terrain
btir
40 000 40 000
TVA immobilire
= 7 840
Numraire 50 000 50 000 0
Total 300 000 300 000 230 000
Hraklion
ls
Numraire 3 000 3 000 0
Total 3 000 3 000
(Suite cas n 7)
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
46
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Le prsent guide est sufsant pour une SARL simple.
Hraklion (50 000 ), ensuite sur le terrain btir (40 000 ), le solde
(140 000 ) tant imput sur le fonds de commerce. Limputation sur
le numraire nentrane lexigibilit daucuns droits de mutation. Pour
les autres imputations, les droits payer seront les suivants :
TVA sur le terrain btir : 40 000 19,60 % = 7 840 qui est
rcuprable par la SARL.
Droits de mutation sur lapport du fonds de commerce quil soit
titre pur et simple ou titre onreux : 5 % (440 K 107 K)
+ 3 % (107 K 23K) = 19 170 . Lapport titre pur et
simple une EURL ou une SARL de famille soumise limpt
sur le revenu aurait t exonr de droits denregistrement.
b) Les honoraires de constitution de la SARL et les autres frais
savoir
II est interdit dimputer le passif propre un apporteur sur des lments apports
par un autre associ (dans le cas n 5, le passif na pas t imput sur les
3 000 de numraire apports par les deux enfants).
Si les associs navaient rien prvu dans les statuts, lAdministration aurait
imput le passif sur les diffrents lments apports par Jacques Hraklion,
proportionnellement leur valeur (le cot aurait t plus lev).
Si les associs sengagent conserver les actions reues en contrepartie des
apports pendant au moins 3 ans, aucun droit denregistrement nest d. Si cet
engagement nest pas respect, les droits deviennent rtroactivement exigibles.
Nature des frais Tarif
Les honoraires de lavocat ou du notaire
1
:
pour la rdaction des statuts ;
pour laccomplissement des diverses
formalits de constitution.
Pas de barme lgal des honoraires : prvoir
environ 3 000 .
Les frais de publication dun avis de
constitution dans un journal dannonces
lgales.
Tarif x par arrt prfectoral : prvoir
environ 230 pour un texte succint.
Le centre de formalits des entreprises
(y compris les frais de dpt dacte).
Prvoir 85 .
Le choix de la SARL comme structure juridique
47
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Une entreprise individuelle ou une entreprise impose lIR.
2. La plus-value est exonre de toute imposition si, lanne de la cession, le chiffre
daffaires nexcde pas le double des limites de la micro-entreprise et si lactivit
est exerce depuis au moins 5 ans.
3. Diverses exonrations sont prvues.
NB : Les SARL bncient de lexonration du droit de timbre accord
aux socits commerciales, car elles participent lconomie nationale.
3.5.2. Les frais la charge des associs
a) Limposition des plus-values dapport
Lapport une SARL est impos comme une vente (la valeur dapport
constitue le prix de vente) et dclenche ainsi limposition des plus-
values ralises par lassoci sur lapport quil fait la SARL.
Cette plus-value est impose selon le rgime :
des plus-values des particuliers si le bien fait partie du patri-
moine priv de lapporteur ;
des plus-values professionnelles si le bien est apport par une
entreprise.
Imposition des plus-values dapport
Lapport est fait par
une socit
impose lIS
une entreprise
impose lIR
1
une personne physique
Exonration
de la
plus-value
Pas dexonration. Exonration
possible pour
les petites
entreprises
2
.
La plus-value est exonre
de toute imposition compter
de la 15
e
anne de dtention
du bien
3
.
Dtermina-
tion de la
plus-value
La plus-value est gale la diffrence
entre le prix de cession et la valeur
en comptabilit du bien (cot dachat
diminu des amortissements) :
pour les biens dtenus depuis moins
de deux ans, la plus-value est court
terme ;
La plus-value est gale la
diffrence entre le prix de
cession et le cot dachat
major des frais dacquisition.
Les frais dacquisition titre
onreux sont valus 7,50 %
du prix dacquisition.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
48
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Pour un brevet, la plus-value est long terme en totalit.
2. Abattement de 10 % annuel compter de la cinquime anne de possession du
bien. Abattement de 1 000 par cession.
b) Lapport dune entreprise individuelle une SARL
Lapport dune entreprise individuelle une SARL est assimil
une cessation dactivit qui entrane limposition immdiate des bn-
ces en cours et des plus-values. Cependant, lapporteur bncie
dun rgime de faveur sil sengage conserver les parts sociales de la
SARL reues en contrepartie de lapport pendant au moins cinq ans et
sil apporte lensemble des lments de lactif immobilis affects
lexercice de la profession.
pour les biens dtenus depuis plus de
deux ans, la plus-value est court
terme hauteur des amortissements,
et long terme au-del
1
.
Pour une socit impose lIS, la plus-
value est entirement court terme.
La cession est exonre si elle
ne dpasse pas 15 000 par
an. La plus-value ainsi obtenue
est diminue dun certain
nombre dabattements
2
.
Imposition
de la
plus-value
Les plus-values
sont soumises
lIS au taux de
33
1/3
%. Seules
les plus-values
sur titres de
participation
dtenues depuis
plus de deux ans
sont exonres
dimposition.
Les plus-values
court terme
sont soumises
lIR avec
possibilit
dtalement
sur trois ans.
Les plus-values
long terme
sont imposes
au taux de 28 %.
La plus-value est soumise
lIR au taux de 16 % major
des prlvements sociaux
au taux de 12,1 %. La CSG de
5,10 % nest pas dductible.
Les plus-values dapport de lentreprise individuelle la SARL
bncient dun rgime de faveur
La plus-value sur les lments non amortissables est exonre dimposition.
Elle sera impose au moment de la vente des parts sociales de la SARL reues en
rmunration de lapport ou de la vente du bien apport. La plus-value est alors
calcule par rapport la valeur que ces biens avaient dans la comptabilit de
lapporteur. La transmission titre gratuit (donation, succession) des parts socia-
les de la SARL ne remet pas en cause lexonration dimposition.
/
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
49
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le fonds de commerce est un lment non amortissable. La plus-value
sur lapport du fonds la SARL est exonre si le boulanger prend
lengagement de conserver les parts sociales de la SARL pendant
3 ans au moins. En revanche, la plus-value sur lapport de limmeuble
la SCI sera taxe selon le rgime des plus-values des particuliers
(voir tableau page 47). Cet apport ne remet pas en cause lexonration
de la plus-value pour le fonds car la SCI loue les murs la SARL.
c) Lapport partiel dactif
En cas dapport partiel dactif, lapport bncie dun rgime de
faveur pour limposition des plus-values dapport si lapport partiel
dactif porte sur une ou plusieurs branches compltes et autonomes
La plus-value sur les immobilisations amortissables nest pas impose au
niveau de lapporteur
1
mais au niveau de la SARL soumise lIS au taux de 33
1/3
%.
La plus-value peut tre tale sur cinq ans
2
. En contrepartie, la SARL calcule les
amortissements et les plus-values
3
en cas de cession daprs les valeurs dapport.
Les prots sur stocks ne sont pas imposs si la SARL bnciaire de lapport ins-
crit les stocks lactif de son bilan la valeur comptable. Les provisions ne sont
pas rapportes aux rsultats si elles sont justies. Ltalement de limposition
des subventions dquipement peut galement tre maintenu.
Mise en socit dune entreprise individuelle sous la forme dune SARL
Un boulanger apporte son fonds de commerce une SARL et dcide disoler les
murs au sein dune SCI qui opte pour lIS et qui loue les murs la SARL.
Comment sont imposes les plus-values dapport ?
Cas n 8
/
1. Lapporteur peut opter pour limposition 28 % de la plus-value nette long
terme sur ses immobilisations amortissables an, le cas chant, de compenser
les dcits ou les amortissements rputs diffrs restant reporter.
2. Quinze ans pour les constructions et agencements de terrains.
3. Les biens tant rputs acquis depuis leur entre dans le patrimoine de lentre-
prise individuelle.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
50
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
dactivits
1
, et si la socit apporteuse prend lengagement de conser-
ver les titres reus en contrepartie de lapport pendant trois ans.
Pour limposition des plus-values sur les lments dactif, le rgime
est le mme que pour lapport de lentreprise individuelle la SARL
(voir page 48).
Les provisions inscrites au bilan de la socit apporteuse qui deviennent
sans objet du fait de lapport sont imposes lIS au taux de 33
1/3
%
chez la socit apporteuse. Les rsultats de la branche dactivit appor-
te jusqu la date dapport sont imposables chez la socit apporteuse
la clture de lexercice dapport.
Les dcits de la socit apporteuse peuvent tre imputs sur les rsul-
tats de la SARL bnciaire des apports condition dobtenir un agr-
ment spcial
2
. Si la socit apporteuse dtient une crance sur le
Trsor provenant du report en arrire de ses dcits, elle peut la trans-
frer la SARL si elle obtient un agrment pralable.
La dcision de modication
Les modications des statuts doivent, en principe, tre dcides par les
associs reprsentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Toute clause statutaire exigeant une majorit plus leve est rpute
non crite.
lissue de lassemble gnrale extraordinaire qui dcide de la modi-
cation, un procs-verbal est dress (voir modles dans les suppl-
ments Internet). Le grant doit alors effectuer diffrentes formalits.
1. dfaut, lapport partiel dactif doit avoir t pralablement agr par le
ministre de lconomie et des Finances.
2. dfaut, le report des dcits demeure possible sur les bnces de la socit
apporteuse sans limitation de dure.
4. Comment modier les statuts de la SARL ?
4.1.
Le choix de la SARL comme structure juridique
51
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les formalits accomplir
4.2.1. Enregistrement du procs-verbal
de lassemble
Le procs-verbal de lassemble doit tre soumis dans le dlai dun
mois la formalit de lenregistrement uniquement si la modication
des statuts concerne :
la prorogation, la transformation ou la dissolution de la socit ;
laugmentation, lamortissement, ou la rduction du capital social.
Cette formalit donne lieu au paiement dun droit denregistrement de
230 , et dun droit de timbre de 2,60 par page.
4.2.2. Insertion dans un journal dannonces lgales
Dans la mesure o il y a modication des statuts, un avis sign par le
grant doit tre publi dans le dlai dun mois qui suit lassemble
dans un journal dannonces lgales du dpartement du sige social
(voir modle dans les supplments Internet).
4.2.3. Dpt dun dossier au centre
de formalits des entreprises
Au centre de formalits des entreprises, le grant dpose dans le dlai
dun mois qui suit la modication un dossier destin au greffe du tri-
bunal de commerce ainsi quaux organismes scaux et sociaux. Le
dpt du dossier permet deffectuer linscription modicative au regis-
tre du commerce et des socits qui sera publie au BODACC (Bulle-
tin ofciel des annonces civiles et commerciales) par le grefer, an
de rendre la modication opposable aux tiers.
Le dossier comprend : une liasse modle M2 ; deux exemplaires du
procs-verbal de lassemble modiant les statuts (aprs enregistre-
ment si cette formalit est obligatoire) ; deux exemplaires certis
conformes par le grant des nouveaux statuts ; un exemplaire du jour-
nal ayant publi lavis de modication ; un chque lordre du greffe.
4.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
52
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les principales modications statutaires
Les dveloppements qui suivent concernent uniquement les modica-
tions statutaires qui ne sont pas exposes dans les autres parties du
guide.
4.3.1. Modication de lobjet social
Lobjet social de la SARL peut tre modi pour diffrentes raisons :
acquisition dune participation dans une socit ayant un objet
diffrent ;
vente dun fonds de commerce dont lexploitation est express-
ment mentionne dans lobjet social ;
mise en grance libre du fonds de commerce alors que lexploita-
tion indirecte nest pas prvue dans lobjet social.
Sur le plan scal, le changement de lobjet social dune SARL est assi-
mil une cessation dentreprise qui entrane limposition immdiate
du bnce dexploitation ralis jusqu la date de changement, la
suppression du droit au report des dcits raliss jusqu cette date et
la rintgration des provisions rglementes (il ny a cependant pas
dimposition immdiate des autres bnces en sursis dimposition et
des plus-values latentes).
4.3.2. Modication de la dure de la socit
La dcision de proroger la dure de la socit doit intervenir avant larri-
ve du terme x par les statuts qui a pour effet dentraner, de plein
droit, la dissolution de la socit. Un an au moins avant la date dexpira-
tion de la socit, les associs doivent tre consults par le grant an de
dcider si la socit doit tre proroge. ( dfaut, tout associ peut
demander au prsident du tribunal statuant sur requte la dsignation
dun mandataire de justice charg de provoquer cette consultation).
La prorogation de la dure na aucune incidence scale (pas de cration
dune personne morale nouvelle). Elle doit tre soumise la formalit
de lenregistrement.
4.3.
Le choix de la SARL comme structure juridique
53
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
4.3.3. Changement de dnomination
sociale Transfert du sige social
Ces modications nont pas dincidence scale et ne sont pas soumi-
ses la formalit de lenregistrement. En ce qui concerne le transfert
du sige social, il est frquent que les statuts permettent au grant de
dcider seul le transfert du sige dans la ville ou dans les limites du
ressort du tribunal de commerce du lieu du sige social, sous rserve
de la ratication de cette dcision par la plus prochaine assemble
gnrale ordinaire.
Une socit peut envisager une collaboration avec dautres entreprises
an dassurer ou de rationaliser son dveloppement, ou de la rendre
moins vulnrable face aux alas du march. Cette collaboration peut
tre ralise dans le cadre dun groupe de socits, dun GIE (groupe-
ments dintrt conomique), ou dune socit en participation. La
socit peut galement conclure des accords de coopration ou de
sous-traitance.
Les groupes de socits
5.1.1. Quest-ce quun groupe ?
Un groupe de socits comprend diverses socits qui conservent leur
personnalit juridique, qui sont unies par des liens plus ou moins
troits. La socit mre exerce le contrle, dnit une politique,
impose ses dcisions aux autres socits du groupe (ce rle peut tre
exerc par un holding). En revanche, le groupe de socits na pas de
ralit juridique : ce nest pas une structure dote dune personnalit
juridique propre et autonome.
5. Les structures de partenariat
5.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
54
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dnition du groupe de socits
Le droit des socits ne donne pas de dnition du groupe de socits,
mais prcise la qualication juridique de la situation selon
limportance de la fraction de capital dtenue.
% dtenu Qualication
Plus de 50 % du capital Filiale
La socit propritaire des titres est appele
socit mre.
Elle exerce une influence dterminante puisquelle
peut nommer les organes de gestion de sa filiale.
Plus de 40 % des droits de vote Contrle prsum
1
Entre 10 et 50 % du capital Participation
La socit propritaire des titres exerce une certaine
inuence
2
.
Moins de 10 % du capital Simple placement de capitaux
La socit propritaire des titres ne peut avoir de
relle inuence.
Franchissement de certains seuils Participations signicatives
Une participation devient signicative lorsque sont
franchis certains seuils reprsentatifs dune fraction
du capital social dune socit (1/20, 1/10, 1/5, 1/3,
1/2).
1. Une socit contrle une autre socit dans les cas suivants :
elle dtient directement ou indirectement une fraction du capital lui conf-
rant la majorit des droits de vote dans les assembles gnrales de la
socit ;
elle dispose seule de la majorit des droits de vote dans la socit en vertu
dun accord conclu avec dautres associs ou actionnaires et qui nest pas
contraire lintrt de la socit ;
elle dtermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les dcisions
prises dans les assembles gnrales de la socit.
Une socit est prsume contrler une autre socit si elle dispose, directe-
ment ou indirectement, de plus de 40 % des droits de vote et quaucun autre
associ ne dtient directement ou indirectement une fraction suprieure la
sienne.
2. Toute participation, mme infrieure 10 %, dtenue par une socit contrle
est considre comme dtenue indirectement par la socit qui exerce le contrle.
Le choix de la SARL comme structure juridique
55
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
5.1.2. Participations rciproques et auto-contrle
1. Participations rciproques
La prise de participation dans des liales est libre. Cependant, des
rgles particulires sappliquent en cas de participations rciproques
an dviter que soit mis en place un auto-contrle. Ainsi, lorsquune
socit par actions est associe dune SARL, deux hypothses doi-
vent tre envisages :
1. Si la socit par actions dtient plus de 10 % du capital de la
SARL, la SARL ne peut pas dtenir des actions mises par la SA.
2. Si la socit par actions dtient une fraction du capital de la
SARL gale ou infrieure 10 %, la SARL peut dtenir au maxi-
mum une fraction gale ou infrieure 10 % des actions mises
par la SA.
Si la SARL vient possder des actions en violation de ces disposi-
tions, elle doit les aliner dans le dlai dun an compter de leur
acquisition. De plus, elle ne peut exercer le droit de vote attach ces
actions. Le grant et le commissaire aux comptes, sil en existe un,
doivent informer les associs lors de lassemble suivante, de lalina-
tion de ces actions.
2. Auto-contrle
Une socit peut assurer son propre contrle par lintermdiaire dune
ou plusieurs socits, quelle contrle directement ou indirectement
(cas dune structure circulaire qui permet le verrouillage du pouvoir).
Le droit de vote attach aux actions dauto-contrle est alors supprim
et il nest pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
5.1.3. Information des associs
1. Le grant doit informer les associs des prises de participation
signicatives
Dans son rapport de gestion prsent lassemble gnrale annuelle,
le grant doit :
faire tat de toute prise de participation dans une socit interve-
nue dans lexercice et reprsentant plus de 1/20, du 1/10, du 1/5,
Guide pratique de la SARL et de lEURL
56
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
du 1/3 ou de la 1/2 du capital de la socit ou de toute prise de
contrle ;
rendre compte de lactivit et des rsultats de lensemble de la
socit, des liales de la socit et des socits quelle contrle
par branche dactivit ;
annexer, au bilan de la socit, un tableau faisant apparatre la
situation des liales et des participations. (Sanction pnale : le
grant risque une amende de 9 000 .)
2. La SARL doit dclarer les participations signicatives dans le
capital de socits par actions dans les 15 jours la socit intres-
se qui doit rpercuter cette information ses actionnaires. Si la SA
est cote, la SARL en informe galement dans les 5 jours de bourse le
Conseil des bourses de valeurs qui en informera le public. (Sanction
pnale : le grant risque une amende de 18 000 .)
3. Lorsquune SARL est contrle par une ou plusieurs socits
par actions, elle notie ces dernires, dans le mois suivant le jour o
la prise de contrle est connue, le montant des participations quelle
dtient directement ou indirectement dans le capital ainsi que les varia-
tions de ce montant. (Sanction pnale : le grant risque une amende de
18 000 .)
4. La SARL publiera des comptes consolids si le groupe de soci-
ts dpasse pendant deux exercices deux des trois critres suivants :
1,5 M de total de bilan, 30 M de chiffre daffaires HT, 500 salaris
permanents.
5.1.4. Incidence de la constitution dun groupe
1. Autonomie juridique
Lautonomie juridique des socits membres du groupe permet :
dindividualiser la gestion de chaque entit (responsabilisation
des cadres et dirigeants, meilleur suivi des rsultats dexploi-
tation) ;
de sparer juridiquement les diffrentes activits an que les dif-
cults de certaines socits du groupe ne se rpercutent sur les
autres. Cependant, un crancier dune socit du groupe peut
Le choix de la SARL comme structure juridique
57
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
mettre en cause une autre socit du groupe, en invoquant la tho-
rie de lapparence (dans les faits, il ny a quune seule socit).
2. Rgime scal du groupe
En principe, chaque socit du groupe conserve son autonomie scale.
Elle doit donc dclarer son rsultat imposable et payer ses impts.
Cependant, deux rgimes spciques sappliquent aux groupes de
socits.
Le rgime des socits mre et lle
Les dividendes verss par la filiale la socit mre (pourcen-
tage de participation suprieur 5 %) ne sont pas imposables
dans les rsultats de la socit mre bien que constituant pour la
socit mre un vritable revenu (voir page 246).
Lintgration scale
Le rgime de lintgration fiscale permet la socit mre dtre
la seule redevable de lIS pour tout le groupe, sur la somme
algbrique des rsultats des socits membres. Ce rgime per-
met ainsi de compenser la perte fiscale dune filiale par le bn-
fice dune autre.
Le rgime de lintgration fiscale ne peut sappliquer quaux
filiales dtenues 95 % par la socit mre (voir page 238).
3. Incidences juridiques
La constitution dun groupe se traduit par un accroissement de la com-
plexit administrative.
Conventions rglementes
Lorsque les socits du groupe possdent des dirigeants com-
muns, il est ncessaire de respecter les procdures de contrle
des conventions rglementes (voir page 195).
Informations, suivi juridique et comptable
Pour chaque socit du groupe, il faut tenir des assembles, ta-
blir les comptes annuels, les dclarations fiscales
De plus, la constitution dun groupe gnre un accroissement
des obligations dinformation pesant sur la socit mre (voir
page 55).
Guide pratique de la SARL et de lEURL
58
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les autres structures de partenariat
5.2.1. Le groupement dintrt conomique
Le groupement dintrt conomique est destin la mise en commun
par des entreprises existantes de certaines de leurs activits an den
faciliter le dveloppement : services dimportation ou dexportation,
organismes de recherche, publicit et diffusion des produits
Le GIE prsente lavantage dune constitution trs simple (rdaction
dun contrat constitutif et immatriculation au registre du commerce et
des socits ; les apports ne sont pas obligatoires), et dun fonctionne-
ment trs souple (les membres du GIE dnissent, comme bon leur
semble, les rgles de gestion, la rpartition du bnce).
Comme pour une socit de personnes, les membres du GIE sont soli-
dairement et indniment responsables des dettes sociales. Malgr
cette lourde responsabilit et limpossibilit dacqurir un fonds de
commerce, le GIE est une formule intressante de coopration entre
les entreprises.
5.2.2. La socit en participation
Utilisez la socit en participation avec prudence
Dans une socit en participation occulte, le grant est trs puissant puisque cest le
seul pouvoir agir lgard des tiers. Lui seul agit au vu et au su des tiers. Au-del
de la relation de conance entre les participants et le grant, les relations internes
doivent donc tre parfaitement dnies.
Dans une socit en participation occulte, le grant est indniment responsable : il
pourra tre mis en redressement judiciaire. Cette responsabilit trs lourde peut tre
tendue aux associs si leur identit est rvle.
Si la socit en participation nest pas occulte et si lactivit de la socit est commer-
ciale, les associs sont responsables solidairement des engagements pris par chacun
dentre eux.
5.2.
Zoom n 15
Le choix de la SARL comme structure juridique
59
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La socit en participation est une structure trs souple, facile mettre
en place, pour un cot trs rduit, et qui nest pas immatricule au
registre du commerce (elle peut donc ne pas tre porte la connais-
sance de la concurrence). La socit en participation est trs utilise
dans le domaine des affaires, surtout sous sa forme occulte, pour des
oprations de toute nature, et pour des dures trs variables.
Comme dans le cadre dune socit de personnes, les associs dispo-
sent dune grande libert contractuelle pour organiser leurs rapports.
Pour viter tout problme, les participants rdigeront des statuts (les
statuts ne sont pas obligatoires).
Organisation de la socit en participation
Plus dinformations : www.apce.com chemin daccs :
choisir un statut juridique, les socits, SEP .
Les associs Au moins deux associs qui peuvent tre des personnes physiques
ou morales.
Le grant La socit en participation est gre par un ou plusieurs grants
qui sont seuls habilits agir au nom de la socit.
Responsabilit Le grant supportera sur son patrimoine la consquence des actes
accomplis au profit de la socit.
Les associs, dans la mesure o ils nagissent pas aux yeux
des tiers en cette qualit (socit qui reste occulte), ne sont pas
responsables des dettes de la socit vis--vis des co-contractants
de la socit.
Fonctionnement Les associs mettent la disposition de la socit des biens qui
leur appartiennent ou quils acquirent en indivision (la socit en
participation ntant pas immatricule, elle ne peut pas tre
propritaire de biens).
Les associs conviennent des modalits de partage des bnfices,
et des pertes.
Les associs sont imposs en fonction de la quote-part de bnfice
de la socit en participation qui leur est attribue par les statuts.
Pour dterminer ses rsultats, la socit en participation tablit des
comptes annuels (la socit inscrit son bilan des biens dont elle
nest pas propritaire et un passif qui ne lui incombe pas).
Cession de parts Un associ peut cder la part quil dtient dans la socit, selon les
modalits prvues aux statuts et moyennant le paiement dun droit
denregistrement de 4,80 %.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
60
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Pourquoi transformer la SARL ?
La transformation de la SARL en une socit dune autre forme peut
tre impose par la loi ou dcide par les associs. Dans la pratique la
transformation en socit par actions simplie (SAS)
1
ou en socit
anonyme (SA) est la plus frquente, notamment parce que la transfor-
mation en une socit dune autre forme aggrave la responsabilit des
associs lgard des dettes sociales.
1. Transformation impose par la loi
Lorsquune SARL compte plus de 100 associs, elle doit, dans un
dlai de deux ans, ou prendre des dispositions en vue davoir 100 asso-
cis au plus, ou se transformer en socit par actions simplie ou en
socit anonyme ; dfaut, elle est dissoute.
2. Transformation dcide par les associs
Pour nancer le dveloppement de lactivit : les associs peuvent
transformer la SARL en socit anonyme an de pouvoir mettre des
actions et des obligations dans le public.
An damliorer son statut scal et social : la transformation de la
SARL en socit par actions simplie ou socit anonyme permet au
grant majoritaire de contrler le capital de la socit tout en bn-
ciant du statut scal et social de salari. loppos, la transformation
en socit en nom collectif permet au grant minoritaire dadopter le
statut scal et social de travailleur indpendant.
1. Voir le Guide pratique de la SAS et de la SASU aux ditions dOrganisation.
6. Transformer la SARL
6.1.
Le choix de la SARL comme structure juridique
61
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Comment transformer la SARL en socit par actions
simplie
1
ou en socit anonyme ?
6.2.1. Conditions et modalits de la transformation
en SAS ou en SA
La transformation dune SARL en SAS ou en SA est soumise aux condi-
tions xes pour la constitution de la SAS ou de la SA. La transforma-
tion entrane une modication des statuts qui doit faire lobjet dune
publicit (voir annexe dans les supplments Internet).
Conditions et modalits de la transformation
de la SARL en SAS ou en SA
Capital social
minimal
Le capital de la SARL et de la SAS est librement fix dans les statuts.
La SARL pourra donc se transformer en SAS et garder un montant
de capital identique.
Le capital social doit tre au moins gal 37 000 dans une SA.
Il faut augmenter le capital social de la SARL pour le porter ce
minimum. Cette augmentation doit tre dnitivement ralise
au jour de la dcision de transformation.
Nombre dassocis Au minimum sept associs pour la transformation en SA.
Un associ suft pour la transformation en SAS
2
.
Libration
du capital social
Lors de la constitution de la SA ou de la SAS, le capital social doit
tre libr de la moiti au moins.
Lors de la transformation dune SARL, il faudra librer une partie
du capital par anticipation car la SARL a lobligation de ne librer
quun cinquime du capital lors de la constitution.
Rapport
du commissaire
aux comptes
ou du commissaire
la transformation
La dcision de transformation :
dune SARL en SAS doit tre prcde, peine de nullit de
la transformation, dun rapport sur la situation de la socit
tabli par un commissaire aux comptes inscrit ;
6.2.
1. Voir le Guide pratique de la SAS et de la SASU aux ditions dOrganisation.
2. Une EURL peut tre transforme en SAS car la SAS peut ne comprendre quun
seul associ. Il sagit alors de la SAS unipersonnelle (SASU).
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
62
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Rapport
du commissaire
aux comptes
ou du commissaire
la transformation
dune SARL en SA doit tre prcde dun rapport dun
commissaire la transformation sur la situation de la socit
attestant que le montant des capitaux propres est au moins
gal au montant du capital social et devant apprcier sous
sa responsabilit la valeur des biens composant lactif social et
les avantages particuliers
1
. Si le capital est entam par les pertes,
la transformation devra tre prcde dune rduction du capital
(voir cas n 9).
Dcision
de transformation
2
La dcision de transformation de la SARL doit tre prise
lunanimit des associs pour la transformation en SAS et la
majorit des trois quarts des parts sociales pour la transformation
en SA.
Formalits Dresser un procs-verbal des dlibrations et le soumettre
lenregistrement.
Les autres formalits sont les mmes que pour toute modication
statutaire
3
(voir page 51).
1. Si la SARL a un commissaire aux comptes, il peut tre nomm commissaire
la transformation lunanimit des associs. Si la SARL na pas de commis-
saire aux comptes, le commissaire la transformation est dsign par le prsi-
dent du tribunal de commerce statuant sur requte du grant. Le rapport est
tenu au sige social la disposition des associs au moins huit jours avant la
date de lassemble qui dcidera de la transformation, et dpos dans ce mme
dlai au greffe du tribunal.
2. Sil existe dans la socit qui se transforme des parts reprsentatives dapports
en industrie, les droits de lapporteur en industrie doivent tre liquids prala-
blement la transformation. Le non-respect des dispositions xant les modali-
ts de la transformation peut tre sanctionn par la nullit de lopration. Les
associs doivent : approuver la transformation aprs avoir pris connaissance du
rapport de la grance et du rapport du commissaire aux comptes ou du commis-
saire la transformation (les associs doivent approuver expressment lva-
luation des biens gurant dans le rapport), xer sa date de prise deffet (par
exemple, le premier jour du prochain exercice), constater la rpartition des
actions entre les divers associs, tablir de nouveaux statuts et nommer les
organes de direction et les premiers commissaires aux comptes.
3. Cependant, limmatriculation au registre du commerce et des socits devra
comporter un certain nombre dindications supplmentaires : noms des admi-
nistrateurs, des commissaires aux comptes
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
63
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le capital dune SARL est librement x par les statuts. Comme le
capital de la SAS est galement librement x dans les statuts, la
SARL peut rduire son capital pour se transformer en SAS. Au nal,
on peut proter de la transformation en SAS pour assainir la situation :
la socit, pralablement la transformation, peut rduire son capital
social de 45 000 par imputation des pertes an de les ponger. Nous
obtenons la situation suivante :
Transformation dune SARL en SA : vitez la requte
au prsident du tribunal de commerce
Pour viter la requte au prsident du tribunal de commerce en vue de la dsignation
dun commissaire aux comptes pour tablir un rapport sur la transformation, il faut
nommer un commissaire aux comptes avant la transformation. Cest ce commissaire
aux comptes que les associs dsigneront pour tablir le rapport sur la situation de
la socit.
Transformation dune SARL en SAS et capitaux propres positifs
mais infrieurs au capital social
Le bilan (en euros) dune SARL pour la transformation en SAS est le suivant :
Avant
Rduction
du capital
Augmentation
du capital
Aprs
Capital social
Pertes
Rserves
75 000
30 000
15 000
45 000
30 000
15 000
0 30 000
0
0
Capitaux propres 30 000 0 0 30 000
Zoom n 16
Cas n 9
Capital social
Pertes
Rserves
75 000
30 000
15 000
Capitaux propres 30 000
Guide pratique de la SARL et de lEURL
64
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Comme les capitaux propres sont ngatifs, la socit doit procder
un coup daccordon . Cette opration consiste rduire zro le
capital social pour ponger les pertes avant de procder une augmen-
tation de capital pour permettre la constatation, aprs dduction des
pertes restantes (seconde rduction de capital) dun capital atteignant
le capital de la SAS, librement x par les associs 20 000 , an
quelle ne soit pas sous-capitalise pour faire face aux besoins de tr-
sorerie de son activit. Nous obtenons alors la situation suivante :
6.2.2. Effets de la transformation en SAS ou en SA
La transformation de la SARL en SAS ou en SA prend effet compter
du jour o elle a t dcide. Elle ne peut pas avoir deffet rtroactif.
Cependant, elle ne devient opposable aux tiers quaprs lachvement
des formalits de publicit (voir page 62).
Transformation dune SARL en SAS et capitaux propres ngatifs
Le bilan dune SARL pour la transformation en SAS est le suivant :
Avant
Rduction
de capital
Augmentation
de capital
Rduction
de capital
Aprs
Capital
social
Pertes
Rserves
150 000
250 000
30 000
150 000
150 000
90 000 70 000
100 000
30 000
20 000
0
0
Capitaux
propres 70 000 0 90 000 0 20 000
Cas n 10
Capital social
Pertes
Rserves
150 000
250 000
30 000
Capitaux propres 70 000
Le choix de la SARL comme structure juridique
65
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Exemple : transformation dune SARL avec un grant en SA avec un conseil
dadministration ou en SAS dote dun prsident sans organe collgial.
2. Si lancien grant parvient dmontrer que la transformation a pour seul objet
de porter atteinte ses droits, il peut obtenir en justice des dommages-intrts
ou lannulation de la transformation.
3. Les salaris continuent bncier de la mme anciennet (primes, indemnits
de licenciement) ainsi que des mmes avantages attachs leur appartenance
la socit (comit dentreprise).
4. Les statuts doivent prciser lorgane social auprs duquel les reprsentants des
salaris peuvent obtenir cette information.
Les effets de la transformation de la SARL en SAS ou en SA
lgard
de la socit
La transformation nentrane pas la cration dune personne morale
nouvelle. La socit conserve son numro dimmatriculation au
registre de commerce et des socits. La socit na pas lobligation
darrter ses comptes au jour de la transformation (voir cas n 12).
lgard
de la socit
En revanche, la transformation de la SARL en SA ou en SAS a
une incidence significative sur les modalits de sa gestion et de
sa direction
1
.
Le cot fiscal peut tre lourd (voir page 68).
lgard
du grant
La transformation met fin aux fonctions du grant. Il ne peut pas
bnficier de dommages-intrts car la transformation nquivaut pas
une rvocation sans juste motif
2
.
Si le grant a cautionn des dettes de la socit avant sa
transformation, il a, le cas chant, lobligation de rgler ces dettes
aprs la transformation si lacte de caution a t conu en termes
gnraux et ntait pas limit la dure des fonctions de grant.
Les dirigeants de la SA ou de la SAS sont salaris.
lgard des
commissaires
aux comptes
Si la socit avait un commissaire aux comptes, sa transformation
en SAS ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes.
Ses fonctions expireront la date initialement prvue en tenant compte
du temps accompli dans la socit avant sa transformation.
Si la socit navait pas de commissaire aux comptes avant sa
transformation en SAS, les associs doivent procder la nomination
dun commissaire aux comptes lors de lassemble dcidant de la
transformation en SAS.
lgard
des cranciers
et du bailleur
Les cranciers conservent leurs droits de poursuite lgard de la
socit et des associs pour les crances nes avant la transformation.
Ils conservent notamment les srets et les cautionnements dont ils
bnciaient avant la transformation (voir cas n 11).
Le bail commercial se poursuit lidentique (voir cas n 11).
lgard
des salaris
Les contrats de travail en cours ne subissent aucun changement
3
.
Les reprsentants des salaris doivent continuer bncier dune
information sufsante sur la marche de la socit
4
.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
66
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Pour ses contrats de prt et de crdit-bail, la socit doit obtenir,
pralablement la transformation, un engagement crit du co-
contractant, qui renonce se prvaloir de la clause de rsolution
anticipe. Ainsi, la socit a lassurance que la restitution du bien
nanc ou le remboursement anticip des fonds prts ne lui
seront pas demands.
Le bail commercial se poursuit lidentique, dans les mmes
termes et conditions. La socit bncie donc, son terme
contractuel, du droit au renouvellement, sauf versement dune
indemnit dviction. Cependant, il faut notier la dcision de
transformation au propritaire car ses garanties sont diminues
dans la mesure o les associs ne sont plus responsables indni-
ment.
La socit na pas lobligation darrter ses comptes le 30/06/N (date
de la transformation en SAS), sauf dcision contraire des associs. Le
bilan et les comptes de lexercice de lanne N (anne de la transfor-
mation en SAS) sont arrts le 31/12/N. Les comptes au 31/12/N sont
approuvs et les bnces au 31/12/N sont rpartis conformment aux
modalits prvues par les statuts de la SAS.
Les effets de la transformation dune SARL
en SAS ou en SA sur les contrats
Les contrats de prt et de crdit-bail dune SARL stipulent que la transformation de
la socit est une cause de rsolution anticipe par dchance du terme. Par ailleurs,
la socit bncie dun bail commercial comprenant une clause qui impose que
toute modication statutaire susceptible de diminuer ses garanties lui soit notie.
Les effets de la transformation dune SARL en SAS
sur les comptes de la socit et le rapport de gestion
Une SARL qui arrte ses comptes le 31 dcembre est transforme en SAS le 30/06/N
avec changement des dirigeants sociaux.
Cas n 11
Cas n 12
Le choix de la SARL comme structure juridique
67
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le rapport de gestion est tabli par les anciens dirigeants (le grant
de la SARL) et les nouveaux dirigeants (le prsident de la SAS). Ils
peuvent tablir deux rapports distincts ou, dun commun accord, un
seul rapport couvrant la totalit de lexercice. Les anciens dirigeants
qui refuseraient dtablir le rapport sexposent une action en respon-
sabilit de la part de la socit.
6.2.3. Cot de la transformation en SAS ou en SA
Comme la transformation dune SARL en SA ou en SAS nentrane
pas la cration dune personne morale nouvelle, la dcision de transfor-
mation a un cot trs faible (le droit xe denregistrement est exigible).
En revanche, si la transformation entrane un changement de rgime s-
cal (une SARL de famille ou une EURL transforme en SA ou en SAS
change de rgime scal car elle passe de lIR lIS) et/ou saccompa-
gne dun changement dactivit relle, les incidences scales sont trs
lourdes.
Cependant, en cas de changement de rgime scal, larticle 202 ter du
CGI permet dattnuer les incidences scales en matire dimposition
des bnces. En effet, seuls les bnces en cours au moment de la
transformation sont imposs immdiatement. En revanche, les plus-
values latentes et les provisions bncient dun sursis dimposition si
la socit ne modie pas les valeurs comptables de son bilan (la trans-
formation a un simple caractre intercalaire).
Guide pratique de la SARL et de lEURL
68
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Cot de la transformation dune SARL en SAS ou en SA
Le cot de la transformation dpend du changement
de rgime scal et/ou du changement dactivit relle.
Imposition
Transformation en SAS ou en SA dune SARL impose
lIS
(SARL classique)
lIR
(SARL de famille ou EURL)
Droits
denregistrement
Uniquement le droit xe
de 375 .
Droits denregistrement exigibles
au taux de 5 % sur les apports
dimmeubles ou de fonds de
commerce
1
.
Uniquement le droit fixe si
les associs prennent lengagement
de conserver les actions de la SA ou
de la SAS pendant au moins cinq ans.
Impt
sur les bnces
La transformation nest pas
assimile une cessation
dentreprise :
pas dimposition des
bnfices en cours
au moment de la
transformation ;
les dficits raliss avant
la transformation sont
reportables sur les
bnfices raliss aprs.
La transformation est assimile une
cessation dentreprise :
imposition immdiate des bnfices
en cours au moment de la
transformation ;
les plus-values latentes et les
provisions bnficient dun sursis
dimposition ;
les dficits raliss avant la
transformation ont dj t imputs
sur lensemble des revenus des
associs (transparence fiscale). Ils ne
peuvent donc pas tre imputs une
deuxime fois sur les bnfices
raliss aprs la transformation ;
les rserves ont dj t imposes.
Leur distribution aprs la
transformation ne sera pas impose.
1. Pour les fonds de commerce : 0 % jusqu 23 K ; 3 % de 23 K 107 K ;
5 % au-del. Les biens qui entraient dans le champ dapplication de la TVA lors
de lapport ne sont pas soumis aux droits denregistrement.
Le choix de la SARL comme structure juridique
69
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Hypothse 1. Comme la transformation nentrane pas un changement
de rgime scal (une SARL transforme en SAS reste impose lIS)
et ne saccompagne pas dun changement dactivit relle, il ny a pas
dimposition des bnces et les dcits sont reportables.
Hypothse 2. Comme la transformation saccompagne dun change-
ment dactivit relle, la transformation est assimile une cessation
dentreprise :
imposition immdiate des bnces en cours au moment de la
transformation ;
les dcits raliss avant la transformation sont dnitivement
perdus : ils ne sont plus reportables ;
cependant, les plus-values latentes et les provisions bncient
dun sursis dimposition sauf pour les provisions rglementes
(provisions pour hausse des prix) qui sont immdiatement
imposes.
La transformation de la SARL en une socit autre que la SA
ou la SAS
La transformation de la SARL en une socit en nom collectif aggrave
la responsabilit des associs lgard des dettes sociales puisque les
associs deviennent solidairement et indniment responsables du
passif social, alors que dans la SARL, leur responsabilit est limite au
montant de leurs apports. Il en rsulte que cette dcision doit tre prise
lunanimit des associs.
Il rsulte de la transformation que les associs peuvent ventuellement
tre condamns un paiement par solidarit des dettes sociales, mme
si elles sont nes avant la transformation.
Incidence scale de la transformation dune SARL en SAS
Une socit est transforme en SAS le 30/06/N. Elle clture son exercice le 31/12/N.
Hypothse 1 : La transformation ne saccompagne pas dun changement dacti-
vit relle.
Hypothse 2 : La transformation saccompagne dun changement dactivit
relle.
Cas n 13
6.3.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
70
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. En cas de fusion par voie dapport une socit existante (socit absorbante),
la socit reoit, titre dapport, tout lactif des autres socits fusionnes qui
se trouvent dissoutes (socits absorbes).
2. En cas de fusion par voie de constitution dune socit nouvelle, la socit nou-
velle reoit, titre dapport, tout lactif des socits fusionnes qui se trouvent
ainsi dissoutes. Voir galement note suivante.
3. Les associs des socits dissoutes acquirent la qualit dassocis de la socit
bnciaire des apports. Cependant, il nest pas procd lchange de parts
ou dactions de la socit bnciaire contre des parts ou actions de la socit
qui disparat lorsque ces parts ou actions sont dtenues, soit par la socit bn-
ciaire, soit par la socit qui disparat (pour la fusion, on parle de fusion
renonciation : la socit mre renonce recevoir ses propres titres en change
de sa participation dans la liale).
Comment restructurer un groupe ?
Pour assurer son dveloppement, lentreprise peut tre amene revoir
sa structure juridique : croissance externe par absorption de concur-
rents, restructuration interne par regroupement dactivits disperses,
lialisation de certaines branches dactivit, cession dune branche
dactivit an de se recentrer sur lactivit principale
Comment restructurer un groupe ?
Opration Objectifs Modalits
Fusion Absorption dun concurrent.
Regroupement dactivits
disperses dans plusieurs filiales
au sein dune seule socit.
Les socits fusionnes transmettent
leur patrimoine :
une socit existante
1
;
ou une nouvelle socit quelles
constituent
2
.
Scission Filialisation de branches dactivit
disparates dune socit, et
dissolution de cette socit.
La socit est divise an de
transmettre son patrimoine
plusieurs socits existantes ou
plusieurs socits nouvelles.
La socit est dissoute.
Apport
partiel
dactif
Cession dune branche dactivit
afin de se recentrer sur lactivit
principale.
La socit apporte une partie de son
actif une autre socit qui lui remet,
en contrepartie, des parts ou des
actions nouvelles cres par
augmentation de capital. La socit
nest pas dissoute
3
.
7. Restructurer la SARL
7.1.
Le choix de la SARL comme structure juridique
71
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les fusions, scissions, et apports partiels dactif
7.2.1. Les modalits pratiques
1. Conditions
Toutes les socits commerciales, quelle que soit leur forme, peuvent
raliser une fusion, une scission ou un apport partiel dactif (exemple :
une SARL peut fusionner avec une socit anonyme et/ou avec une
socit en nom collectif). Les socits en liquidation peuvent faire
lobjet dune fusion ou dune scission condition que la rpartition de
leurs actifs entre les associs nait pas commenc.
Le montant de la soulte en espces que peuvent recevoir les associs
des socits qui transmettent leur patrimoine ne peut dpasser 10 % de
la valeur nominale des parts ou actions attribues.
2. Rapports du commissaire la fusion ou la scission
Lorsquelle concerne des socits par actions ou des SARL, un ou plu-
sieurs commissaires la fusion, dsigns par le prsident du tribunal
de commerce la demande des dirigeants, tablissent deux rapports
sous leur responsabilit.
1. Un rapport crit sur les modalits de fusion
Dans le cadre de leur mission, ils peuvent auprs de chaque
socit procder toutes les vrications quils jugent nces-
saires.
Le rapport du commissaire la fusion est mis la disposition
des associs.
Ils vrient que les valeurs attribues aux parts des socits
participant lopration sont pertinentes et que le rapport
dchange est quitable.
2. Un rapport crit o ils donnent leur apprciation sur lvaluation
des apports en nature et les avantages particuliers.
Les commissaires aux comptes des socits participant lopration
ne peuvent pas tre commissaires la fusion.
7.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
72
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
3. Procdure simplie quand la socit absorbante dtient
la totalit du capital de la socit absorbe
Lorsque la socit absorbante dtient la totalit des droits sociaux
dune socit absorbe (la fusion est alors ralise sans augmentation
de capital), la loi nimpose pas lintervention dun commissaire la
fusion et lapprobation de la fusion par lAGE de la socit absorbe.
Cependant, la socit absorbante doit statuer au vu du rapport dun
commissaire aux apports.
4. Constitution de socits nouvelles
Si lopration comporte la cration dune socit nouvelle, elle est
constitue selon les rgles propres la forme de la socit adopte.
Mais si la socit nouvelle est une SARL, elle peut tre constitue uni-
quement avec les apports des socits qui fusionnent.
La procdure respecter
Dlais tapes
tablissement dun projet de fusion ou de scission
Le projet de fusion ou de scission est tabli par le grant (ou le conseil
dadministration) de chacune des socits participant lopration.
Au moins
un mois avant
lAGE
Dpt au greffe du projet de fusion
Le projet de fusion ou de scission doit tre dpos au greffe du tribunal
de commerce du lieu du sige social des socits.
Avis du projet de fusion insr dans un journal dannonces lgales
Le projet de fusion doit faire lobjet dun avis insr dans un journal
dannonces lgales du dpartement du sige des socits (publicit au
BALO si lune des socits fait publiquement appel lpargne).
Dclaration de conformit
Une dclaration de conformit doit tre dpose par lintermdiaire dun
CFE au greffe du tribunal de commerce par les dirigeants des socits
participant lopration de fusion ou de scission. Ils y relatent les actes
effectus en vue de la fusion ou de la scission, et affirment que
lopration est conforme aux exigences lgales.
Le fait de ne pas dposer cette dclaration entranerait la nullit de
lopration (NB : la dclaration de conformit a t supprime par la loi
Madelin uniquement pour la constitution de la socit).
Ouverture du dlai dopposition des cranciers
Les cranciers peuvent former opposition au projet de fusion, par
dclaration au greffe du tribunal de commerce de la socit dbitrice
dans le dlai de trente jours.
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
73
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dans les
15 jours qui
prcdent lAGE
Rapport du commissaire la fusion
Le rapport crit des commissaires la fusion est dpos au sige
social, et tenu la disposition des associs pendant le dlai dun mois
qui prcde la runion de lassemble appele statuer sur le projet
de fusion ou de scission.
En cas de consultation par crit, ce rapport est, en outre, adress aux
associs avec le projet de rsolution qui leur est soumis.
AGE Runion dune assemble gnrale extraordinaire pour approuver
le projet de fusion
Les oprations de fusion ou de scission sont dcides par chacune des
socits intresses, dans les conditions requises pour la modification
de ses statuts (approbation par lAGE), au vu du projet de trait tabli par
les dirigeants des socits concernes, et du rapport des commissaires
la fusion.
Cependant, la dcision de fusion ncessite un vote unanime des associs
lorsquelle entrane une augmentation des engagements des associs
(absorption dune SARL par une socit en nom collectif : la responsabilit
limite des associs dans la SARL devient indfinie dans la SNC).
Formalits de publicit
Les formalits de publicit prvues pour la cration dune socit (socit
absorbante), et les modifications statutaires (socit absorbe qui est
dissoute, socit absorbante qui augmente son capital) doivent tre
respectes (dpt au greffe des statuts, radiation au registre du commerce
et des socits de la socit qui disparat, inscription au RCS de la socit
nouvelle, ou inscription modificative sil sagit dune socit existante).
Le projet de fusion ou de scission
Un projet de fusion ou de scission est tabli par le grant (ou le conseil dadmi-
nistration) de chacune des socits participant lopration. Le projet de fusion
ou de scission doit contenir les indications suivantes.
1. La forme, la dnomination et le sige social de toutes les socits participantes.
2. Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission.
3. La dsignation et lvaluation de lactif et du passif dont la transmission aux
socits absorbantes ou nouvelles est prvue.
4. Les modalits de remise des parts ou des actions et la date partir de laquelle
ces parts ou ces actions donnent droit aux bnces, ainsi que toute modalit
particulire relative ce droit, et la date partir de laquelle les oprations de la
socit absorbe ou scinde seront, du point de vue comptable, considres
comme accomplies par la ou les socits bnciaires des apports.
5. Les dates auxquelles ont t arrts les comptes des socits intresses uti-
liss pour tablir les conditions de lopration.
/
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
74
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
7.2.2. Les effets lgard des tiers
La fusion ou la scission prend effet la date de la dernire assemble
gnrale ayant approuv lopration. Cependant, la fusion peut pren-
dre effet rtroactivement au plus tt la date de clture du dernier
exercice clos de la socit absorbe.
1. Effets lgard des cranciers
En cas de fusion, la socit absorbante devient dbitrice des cranciers
de la socit absorbe. Les cranciers peuvent faire opposition au pro-
jet de fusion. Le tribunal de commerce rejette lopposition ou ordonne
le remboursement des crances, ou la constitution de garanties si la
socit absorbante en offre et si elles sont juges insufsantes.
dfaut de remboursement des crances ou de constitution des garanties
ordonnes, la fusion est inopposable aux cranciers.
Lopposition forme par un crancier ninterdit pas la poursuite des
oprations de fusion. Le crancier peut exiger le remboursement
immdiat de sa crance si une convention prvoit le remboursement de
la crance en cas de fusion.
En cas de scission, la socit bnciaire des apports devient dbitrice
solidaire des cranciers de la socit scinde. Cependant, il peut tre
stipul que la socit bnciaire de la scission ne sera responsable
que du passif apport dans le cadre de la scission.
2. Effets lgard des salaris
Tous les contrats de travail en cours au jour de la fusion ou de la scis-
sion subsistent entre le nouvel employeur (la socit bnciaire de
lapport) et le personnel de lentreprise. Ces dispositions sont dordre
6. Le rapport dchange des droits sociaux et, le cas chant, le montant de la
soulte.
7. Le montant prvu de la prime de fusion ou de scission.
8. Les droits accords aux associs ayant des droits spciaux et aux porteurs de
titres autres que des actions ainsi que, le cas chant, tous les avantages par-
ticuliers.
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
75
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
public (on ne peut pas y droger). Cependant des licenciements sont
possibles sils interviennent dans le cadre dune fusion accompagne
dune rorganisation de lentreprise et dans le respect du droit du tra-
vail. Le comit dentreprise doit tre consult pralablement aux opra-
tions de fusion ou de scission.
3. Effets lgard des bailleurs des locaux
La socit absorbante (fusion), ou la socit bnciaire de lapport
(scission) bncie du bail de la socit qui a fait lapport. Le tribunal
peut modier les conditions de lobligation de garantie.
Par ailleurs, le bailleur des locaux lous la socit absorbe ou scin-
de a le droit de former opposition la fusion ou la scission, dans les
mmes conditions que les cranciers.
Les causes de dissolution de la SARL
La runion de toutes les parts sociales en une seule main nest pas
une cause de dissolution car lassoci unique est immdiatement
soumis au rgime de lEURL.
Arrive du terme
de la socit
La SARL se trouve dissoute de plein droit par lexpiration de la
dure pour laquelle elle a t constitue. Les associs peuvent
dcider de proroger la socit par dcision prise en assemble
extraordinaire.
Cessation de lobjet
social
La SARL finit par la ralisation ou lextinction de son objet.
Cependant, une simple interruption de lactivit sociale ne suffit pas
entraner la dissolution de la socit (exemple : la vente du fonds
de commerce exploit par la SARL est une cause de dissolution si
lobjet social prvoit uniquement lexploitation de ce fonds).
Capitaux propres
infrieurs la
moiti du capital
Si, du fait de pertes constates dans les documents comptables,
les capitaux propres de la socit deviennent infrieurs la moiti
du capital social, les associs dcident sil y a lieu de la dissolution
anticipe de la socit (voir page 172).
8. Comment dissoudre la SARL
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
76
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dcision
des associs
Les associs peuvent, toute poque, prononcer la dissolution
anticipe de la socit par une dcision extraordinaire nommant,
conformment aux statuts, un ou plusieurs liquidateurs auxquels
sont confrs les pouvoirs ncessaires laccomplissement de leur
mission.
Dissolution
judiciaire
Tout associ peut demander au tribunal de commerce de prononcer
la dissolution de la socit pour justes motifs, notamment en cas de
msentente entre associs paralysant le fonctionnement de la
socit.
La dissolution judiciaire peut aussi rsulter de la responsabilit
pnale de la SARL (voir page 106).
Il peut galement y avoir dissolution judiciaire en cas dinexcution de
ses obligations par un associ : la socit ne peut pas fonctionner
dans les conditions prvues sa constitution car un associ, qui a
promis un apport en numraire une certaine date, ne leffectue pas
Autres causes
de dissolution
Jugement de liquidation judiciaire ou de cession totale des actifs de
la socit.
Laccroissement du nombre des associs de la SARL
peut rsulter du dcs dun associ
En cas de dcs dun associ, tous les hritiers entrent dans la SARL sans agrment
pralable. Chaque indivisaire doit tre considr comme un porteur de parts. La
jurisprudence considre parfois que lindivision compte pour un seul associ car
cest elle qui est propritaire des parts.
Dissolution de la SARL et associs minoritaires
Si la dcision de dissolution de la SARL nuit aux associs minoritaires qui ne lont
pas vote, des dommages-intrt peuvent leur tre allous en rparation du prju-
dice subi du fait de la privation des bnces normalement esprs pour les exerci-
ces ultrieurs.
Zoom n 17
Zoom n 18
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
77
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les modalits pratiques de dissolution
Le Code du commerce prvoit deux procdures de liquidation.
La procdure statutaire ou conventionnelle : les rgles de
liquidation sont prvues par les statuts ou rgles par les associs
la majorit des trois quarts des parts sociales.
La procdure lgale qui sapplique dfaut de rgles statutaires
ou conventionnelles ou lorsque la liquidation est dcide par le
tribunal de commerce, la demande des cranciers, ou des asso-
cis reprsentant au moins le dixime du capital.
La liquidation aboutit la cession des biens composant le patrimoine
de la socit, au paiement de ses cranciers, et la rpartition entre les
associs des fonds restants. Nous examinerons les dispositions gnra-
les qui sappliquent toutes les liquidations.
1. Continuation de la personnalit morale
La personnalit morale de la socit subsiste pour les besoins de la liqui-
dation jusqu la clture des oprations. Pour viter toute confusion, la
mention Socit en liquidation ainsi que le nom du liquidateur doi-
vent gurer sur tous actes et documents manant de la socit et desti-
ns aux tiers (notamment, sur toutes les lettres, factures, annonces et
publications diverses). Le dfaut de cette mention peut engager la res-
ponsabilit du liquidateur lgard des tiers qui ont cru contracter
avec une socit normale (amende de 1 500 par infraction).
Il en rsulte les consquences suivantes :
la socit continue passer des actes juridiques, agir en justice,
dans la mesure o cela est ncessaire pour sa liquidation ;
Clause statutaire de dissolution
Dans un groupe, une clause statutaire peut prvoir la dissolution dune liale com-
mune pour des raisons de concurrence ou de condentialit (prise de contrle par un
tiers de la participation de lun des associs). La clause statutaire de dissolution
est gnralement assortie de lobligation de rachat des parts de lassoci qui souhaite
dissoudre.
Zoom n 19
8.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
78
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
elle peut tre mise en rglement judiciaire ou en liquidation des
biens ;
elle conserve son patrimoine qui ne peut tre immdiatement
cd aux associs ;
les baux des immeubles quelle utilise pour son activit sociale
ne se trouvent pas rsilis de plein droit ;
si, en cas de cession du bail, lobligation de garantie ne peut plus
tre assure, il peut y tre substitu, par dcision de justice, toute
garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers et juge suf-
sante ;
la socit dissoute ne peut pas commencer une nouvelle activit ;
elle peut participer une opration de fusion ou scission condi-
tion que la rpartition de son actif entre les associs ne soit pas
commence.
2. Le liquidateur
Nomination
Dans le dlai dun mois, le liquidateur devra publier sa nomina-
tion dans un journal dannonces lgales du dpartement du sige
pour que les tiers soient avertis de la situation de la socit.
Le liquidateur procde une inscription modificative au registre
du commerce et des socits, et au dpt au greffe de lacte de
dissolution. La dissolution de la socit ne produit ses effets
lgard des tiers qu partir de la date laquelle elle est publie
au registre du commerce et des socits. Jusqu cette date, cest
donc le grant qui engage la socit vis--vis des tiers.
Cession de lactif
Le liquidateur ne peut pas, sauf consentement unanime des asso-
cis ou autorisation du tribunal de commerce, cder tout ou
partie de lactif de la socit en liquidation une personne ayant
eu la qualit de grant, ou de commissaire aux comptes, ou de
contrleur.
De mme, la cession de tout ou partie de lactif de la socit au
liquidateur ou ses employs, ou leurs conjoints, ascendants
ou descendants, est interdite.
Le choix de la SARL comme structure juridique
79
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La cession globale de lactif de la SARL ou lapport de lactif
une autre socit, notamment par voie de fusion, ncessite
lautorisation des associs la majorit exige pour la modifica-
tion des statuts.
Responsabilit du liquidateur
Le liquidateur peut engager sa responsabilit civile et pnale.
Le liquidateur est responsable lgard de la socit et des tiers
des consquences dommageables des fautes quil a commises
dans lexercice de ses fonctions (exemple : le liquidateur a
liquid tout lactif et a rgl toutes les dettes sans tenir compte
dune dette dun tiers ou dun salari). Laction en responsabi-
lit se prescrit par trois ans compter du fait dommageable ou,
sil a t dissimul, de sa rvlation (dix ans si le fait est qualifi
crime).
3. Clture de la liquidation
Les associs doivent tre convoqus en n de liquidation pour statuer
sur le compte dnitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la
dcharge de son mandat et pour constater la clture de la liquidation.
dfaut, tout associ peut demander la dsignation par le prsident du
tribunal de commerce dun mandataire charg de procder la convo-
cation.
Si lassemble de clture ne peut dlibrer ou si elle refuse dapprou-
ver les comptes du liquidateur, le liquidateur ou tout intress peut
demander au tribunal de commerce de statuer la place de lassemble
des associs.
Le liquidateur signe et publie un avis de clture de la liquidation dans
le journal dannonces lgales qui a reu la publicit de lacte de nomi-
nation du liquidateur. De plus, dans le dlai dun mois, le liquidateur
doit demander la radiation de limmatriculation de la socit au registre
du commerce et des socits.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
80
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Consquences scales de la dissolution
Droits denregistrement
La dissolution de la SARL doit tre enregistre
dans le dlai dun mois
1
.
Actif net partag Droit de partage de 1 % sur lactif net partag
2
.
Actif net partag = valeur vnale relle des biens partags passif
soultes.
Le passif comprend notamment les frais de liquidation
3
et les impts
exigibles
4
.
Soultes Lorsquun associ reoit des biens dont la valeur excde la part
dactif qui lui revient normalement compte tenu de ses droits
sociaux, il doit verser une soulte.
La soulte est taxe comme une vente. Le droit de mutation est
exigible au taux prvu pour les biens attribus lassoci
5
.
Biens attribus Lattribution de biens un associ autre que lapporteur peut tre
taxe comme une vente si lapport du bien a t soumis au droit fixe
(voir page 40).
8.2.
1. compter de lacte qui constate la dissolution ou, dfaut dacte, par une
dclaration dans le mois suivant la dissolution.
2. Quelles que soient lorigine des biens partags (apports ou acquts sociaux) ou
la qualit du bnciaire du partage (apporteur ou autre associ).
3. Honoraires du liquidateur, frais de publicit relatifs la clture de la liquida-
tion
4. Droit de partage, prcompte mobilier en revanche, la retenue la source exigi-
ble sur le boni de liquidation revenant des actionnaires domicilis ltranger
nest pas dductible.
5. Si les biens attribus sont de nature diffrente, la soulte est rpartie proportion-
nellement leur valeur respective.
Le choix de la SARL comme structure juridique
81
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Imposition du boni de liquidation
Le boni de liquidation est impos en tant que distributions
entre les mains des associs.
Boni de liquidation = actif net partag montant des apports
1
Perte de liquidation
2
= montant des apports actif net partag
Lassoci est une entreprise (IR ou IS) un particulier
Boni de liquidation Le boni de liquidation est rparti
entre un revenu mobilier et
une plus-value ou moins-value
(voir cas n 14 page 82) :
le revenu mobilier est impos
comme un dividende
3
;
la plus-value ou moins-value
est impose selon le rgime
des plus-values
professionnelles.
Le boni de liquidation major
de lavoir fiscal est impos lIR
dans la catgorie des revenus
de capitaux mobiliers (RCM)
comme un dividende
3
.
Si le boni de liquidation est
considr comme un revenu
exceptionnel
4
, lassoci peut
bnficier du systme du
quotient
5
qui permet dattnuer
les effets de la progressivit de
lIR
6
.
Perte de liquidation Lentreprise constate une
moins-value impose selon
le rgime des plus-values
professionnelles.
La perte ne peut pas tre
retranche du revenu imposable
de lassoci car elle constitue
une perte en capital.
1. Boni de liquidation = Actif net partag prix dachat des titres pour les asso-
cis qui ont acquis leurs titres un prix suprieur au montant des apports.
2. Les associs ne sont pas rembourss de tout ou partie de leurs apports.
3. Voir page 245.
4. Le boni est considr comme exceptionnel si son montant dpasse la moyenne
des revenus nets des trois annes prcdentes.
5. Le mcanisme du quotient consiste ajouter au revenu courant le quart du
boni de liquidation et multiplier par 4 la cotisation supplmentaire dIR ainsi
obtenue.
6. Lassoci qui dispose habituellement de revenus moyens et qui peroit au titre
dune anne un boni de liquidation dun montant lev, subit de plein fouet les
effets de la progressivit. Le mcanisme du quotient permet dattnuer cette
brusque lvation de la progressivit de lIR.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
82
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Imposition des bnces
La dissolution dune SARL est assimile une cessation dentreprise
qui entrane limposition immdiate des bnces
et plus-values non encore taxs.
Imposition des
bnces
Imposition immdiate des :
bnfices dexploitation raliss entre la fin du dernier exercice
et la date de la dissolution
1
;
provisions devenues sans objet du fait de la dissolution
2
;
plus-values ralises sur les immobilisations lors de leur vente
des tiers ou lors de leur attribution en nature aux associs.
Les bnfices sont imposs lIS 33
1/3
%. Cependant, les
plus-values long terme sur titres de participation sont exonres
dimposition.
Dclaration et
paiement de lIS
Les bnfices doivent tre dclars dans un dlai de 60 jours
3
partir de la date laquelle prend fin la liquidation de la socit.
La socit doit verser spontanment au Trsor lIS dont elle est
redevable au plus tard le 15 du mois suivant celui de lexpiration
du dlai de 60 jours.
Rpartition de boni de liquidation
Une SARL au capital de 40 000 divis en 4 000 parts sociales de 10 a un actif
net sa dissolution de 60 000 . Un des associs est une SAS. Les parts sociales de
la SARL gurent lactif de la SAS pour leur prix dachat qui est de : 8 pour lhypo-
thse n 1, 18 pour lhypothse n 2 et 12 pour lhypothse n 3.
Cas n 14
1. Les dcits reportables sont imputs sur le bnce imposable lIS 33
1/3
%
(voir page 232).
2. Dune manire gnrale, il sagit des bnces en sursis dimposition.
3. Le dlai pour la TVA est de 30 jours.
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
83
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le boni de liquidation est rparti entre un revenu mobilier et une plus-
value ou moins-value.
Hypothses 1 2 3
+ Actif net 15 15 15
Prix dachat des titres 8 18 12
= Boni de liquidation 7 3 3
Rpartition du boni de liquidation
Revenu mobilier 5
Plus-value ou moins-value 2 3
7 3 3
Dissolution dune SARL
Deux associs ont dvelopp une librairie sur un site Internet selon un concept ori-
ginal dans le cadre dune SARL. Plus de 5 ans aprs la cration de la SARL, les asso-
cis dcident de vendre leur fonds commercial valu 800 000 une entreprise
cherchant simplanter dans ce domaine.
Les autres actifs sont liquids pour leur valeur comptable majore de 30 000 . Les
associs dcident de mettre n par anticipation la socit. Les associs sont soumis
limpt sur le revenu au taux marginal de 40 %.
(Suite cas n 14)
/
+ Actif net
Montant des apports
60 000
40 000
= Boni de liquidation
Nombre de parts sociales
20 000
4 000
Boni de liquidation par part sociale 5
Actif par part sociale
Actif total
Nombre de parts sociales
60 000
4 000
15
Cas n 15
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
84
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Cot de la dissolution ?
Une solution plus avantageuse est-elle envisageable ?
Bilan avant la dissolution (en euros)
Cot de la dissolution : solution A
Imposition des bnfices
Bnfices dexploitation
Provisions devenues sans objet
Plus-values ralises
sur nom commercial
sur les autres actifs
60 000
20 000
790 000
30 000
Impt sur les socits 33
1/3
%
900 000
300 000
Droit de partage de 1 %
+ Valeur vnale relle des biens
Passif
Soultes
1 350 000
420 000
= Actif net avant droit de 1 %
Droit de partage de 1 % (actif net 1/101)
930 000
9 208
= Actif net aprs droit de 1 % 920 792
Imposition du boni de liquidation chez lassoci
+ Actif net
Montant des apports
920 792
250 000
670 792
(Suite cas n 15)
/
Actif Passif
Nom commercial
Matriel et agencements
Stocks
Disponibilits
10 000
140 000
300 000
80 000
Capital
Rserve
Rsultat avant IS
Provisions dductibles
Dettes
250 000
100 000
60 000
20 000
100 000
530 000 530 000
Le choix de la SARL comme structure juridique
85
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Cession et transmission des parts sociales
Une SARL est une socit cre entre un nombre limit dassocis qui
se connaissent bien, qui se font conance. La cession de parts sociales
des tiers ou leur transmission un hritier la suite du dcs dun
associ pourraient introduire dans la SARL un tiers dont les associs
ne veulent pas ncessairement. Il est donc logique que les associs
donnent leur avis sur lagrment du cessionnaire. Une attention par-
ticulire doit tre accorde au moment de la rdaction des statuts
concernant les clauses relatives la cession ou la transmission de
parts (voir partie sur la constitution).
Boni pour un associ
IR et PS pour un associ au taux de 51 %
(IR 40 % + PS 11 %)
IS pay par la socit + IR des deux associs (A)
335 396
167 698
635 396
Vente des parts sociales : solution B
Valeur relle des parts sociales (actif net avant IS)
Cot dacquisition des parts sociales
1 230 000
250 000
Plus-value mobilire
Plus-value pour un associ
IR et PS pour un associ au taux de 27 %
(IR 16 % + PS 11 %)
Imposition pour deux associs (B)
conomie dimposition globale (A-B)
980 000
490 000
137 200
274 000
360 996
9. Cession, transmission, nantissement
et location des parts sociales
9.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
86
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
9.1.1. Prendre les bonnes options au moment
de la rdaction des statuts
Au moment de la rdaction des statuts, il convient de rdiger avec le
plus grand soin les clauses concernant les cessions ou les transmissions
de parts selon que lon souhaite que la SARL soit ouverte ou ferme.
1. Ce que vous devez savoir
Le cessionnaire doit tre agr par les associs
Les parts sociales ne peuvent tre cdes des tiers trangers
la socit quavec le consentement de la majorit des associs
reprsentant au moins les trois quarts des parts sociales. La
SARL est donc bien une socit ferme dans la mesure o les
tiers ne peuvent y entrer librement.
Cependant, dans certains cas, les parts peuvent tre cdes
librement
Les parts peuvent tre cdes librement, sauf dispositions
contraires des statuts, entre les associs, entre conjoints, et entre
ascendants et descendants. Elles sont aussi librement transmissi-
bles par voie de succession ou en cas de liquidation de commu-
naut de biens entre poux.
La dissolution de la communaut peut avoir pour cause non seu-
lement le dcs mais encore le divorce, la sparation de corps ou
de biens, ou le changement de rgime matrimonial en applica-
tion de larticle 1397 du Code civil.
Le conjoint dun associ peut devenir associ
Le conjoint dun associ qui a libr ses parts au moyen de biens communs peut se
voir reconnatre la qualit dassoci. En effet, si vous nimposez pas dans les statuts
lagrment du conjoint, il peut, tout moment, devenir associ en notiant la
socit son intention dtre personnellement associ pour la moiti des parts ainsi
souscrites ou acquises.
Au moment de la constitution de la SARL, veillez bien rdiger les clauses relatives
la cession des parts sociales.
Zoom n 20
Le choix de la SARL comme structure juridique
87
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2. Quelles options faut-il prendre au moment de la rdaction
des statuts ?
9.1.2. Comment cder les parts de SARL
Cessionnaire Les options prendre
Cessions des tiers Aucune option ne peut tre prise car toute
clause contraire serait rpute non crite.
Cessions entre associs, entre conjoints,
entre ascendants et descendants
Vous pouvez limiter la libert de cession de
parts entre associs.
Vous ne pouvez pas rendre les cessions de
parts entre associs plus difficiles que celles
consenties des tiers.
Transmissions par dcs Vous pouvez limiter la libre transmissibilit
des parts sociales en stipulant dans les
statuts que la socit continuera :
entre les seuls associs survivants.
Les hritiers sont alors seulement
cranciers de la socit et nont droit qu
la valeur des parts sociales de lassoci
dcd (ils nont jamais la qualit
dassoci) ;
entre les associs survivants et les
hritiers qui auront t agrs par
la socit ;
entre les associs survivants et une
personne dsigne dans les statuts
(le conjoint survivant, un ou plusieurs
des hritiers).
Vous ne pouvez pas imposer des conditions
plus difficiles que celles qui sont applicables
aux cessions consenties des tiers.
savoir sur la cession des parts sociales
La cession des parts constituant des biens communs exige le consentement du
conjoint.
Les parts dindustrie sont incessibles.
Zoom n 21
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
88
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
9.1.2.1. La marche suivre
1. tablir un acte de cession
La cession des parts sociales doit tre constate par un crit (acte sous
seing priv ; un acte notari nest obligatoire quen cas de donation)
soumis au droit de timbre.
Nombre dexemplaires : autant dexemplaires quil y a de parties + un
exemplaire pour lenregistrement + deux exemplaires pour le dpt en
annexe au registre du commerce et des socits + un exemplaire pour
le dpt au sige social de la SARL (ou la signication, selon le cas).
2. Obtenir lagrment du cessionnaire
Lagrment est ncessaire lorsque les parts sociales sont cdes des
tiers trangers la socit. Il faut alors le consentement de la majorit
des associs reprsentant au moins la moiti des parts sociales. Les
statuts peuvent relever ce dernier seuil. Dans les autres cas (entre asso-
cis, entre conjoints, entre ascendants et descendants) les parts sont
librement cessibles, sauf si les statuts prvoient une procdure dagr-
ment.
Un associ peut, en cas de refus dautorisation de cder ses parts un tiers, exiger
lacquisition par les associs, ou dfaut raliser la cession, ds lors quil dtient
ses parts depuis au moins deux ans.
La cession consentie un tiers sans lagrment des associs est inopposable la
socit et aux associs. Cette irrgularit peut cependant tre couverte par la rati-
cation postrieure des associs.
Pour les poux maris sous le rgime de la communaut
La cession de parts dpendant de la communaut, par lun des poux, ne peut se
faire sans le consentement de lautre.
(Suite zoom n 21)
/
Zoom n 22
Le choix de la SARL comme structure juridique
89
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. En cas de contestation pour la dtermination du prix, le prix est x par un
expert dsign par les parties, ou dfaut daccord entre elles, par ordonnance
du prsident du tribunal statuant en la forme des rfrs et sans recours possible.
Droulement de la procdure dagrment
J
J + 8 jours
Notication du projet de cession
Le projet de cession doit tre notifi la SARL, ainsi qu chacun des
associs, par lettre recommande avec demande davis de rception (par acte
extrajudiciaire ventuellement).
Dcision des associs
Dans le dlai de huit jours compter de la notification, le grant doit :
convoquer lassemble des associs pour quelle dlibre sur le projet de
cession de parts sociales ;
ou, si les statuts le permettent, consulter les associs par crit sur le projet
de cession.
La dcision de la socit est notifie au cdant par lettre recommande avec
demande davis de rception.
Refus dagrment
Dans
les 3 mois
du refus
3 mois
aprs
le refus
En cas de refus dagrment, dans un dlai de trois mois compter de ce
refus :
les associs sont tenus dacqurir ou de faire acqurir les parts un prix
dtermin
1
;
les associs peuvent aussi dcider, avec le consentement de lassoci
cdant, de rduire le capital de la SARL du montant de la valeur nominale
des parts de cet associ et de racheter ces parts au prix dtermin. Un dlai
de paiement qui ne saurait excder deux ans peut, sur justification, tre
accord la socit par dcision de justice. Les sommes dues portent
intrt au taux lgal.
Si aucune solution (acquisition ou rachat des parts) nest intervenue
lexpiration du dlai de trois mois, lassoci peut raliser la cession
condition quil dtienne ses parts depuis au moins deux ans.
Absence de dcision
J + 3 mois Si la socit na pas fait connatre sa dcision dans le dlai de trois mois
compter de la dernire des notifications faites par le cdant la socit et aux
associs, la socit est rpute donner son accord.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
90
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
3. Informer la socit de la cession
Pour tre opposable la socit, la cession doit tre constate par le
dpt dun original de lacte de cession au sige social contre remise
par le grant dune attestation de ce dpt (lacte peut tre signi par
exploit dhuissier ou accept dans un acte authentique).
4. Formalits de publicit
Laccomplissement des formalits suivantes rend la cession opposable
aux tiers :
enregistrement de lacte dans le mois de sa date ;
dpt de deux originaux de lacte de cession en annexe au regis-
tre du commerce et des socits si lacte de cession est sous seing
priv (deux expditions de lacte constatant la cession sil a t
tabli dans la forme authentique).
5. En cas de changement de grance la suite de la cession
Si le cdant est en mme temps le grant de la SARL, et que la cession
de parts entrane sa dmission, des formalits supplmentaires sont
exiges en consquence de cette dmission et de la nomination du
nouveau grant :
dpt au registre du commerce et des socits de deux exemplai-
res sur papier libre des statuts mis jour ;
avis dans un journal dannonces lgales ;
inscription modicative au registre du commerce et des socits.
Tableau des formalits en cas de cession de parts un tiers
J Projet de cession.
Notification du projet de cession la socit et chacun des associs
par acte extrajudiciaire ou par LR avec AR.
J + 8 jours Convocation de lassemble par le grant.
J + 3 mois Runion de lassemble et signature de lacte de cession si lassemble
approuve.
Dans le mois de
lassemble
Enregistrement de lacte de cession.
Notification la socit (ou acceptation par elle dans un acte notari ;
ou dpt dun original de lacte de cession au sige social contre
remise par le grant dune attestation dudit dpt).
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
91
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
9.1.2.2. Les consquences de la cession
1. lgard du cessionnaire
Le cessionnaire devient associ en lieu et place du cdant.
Il devient associ dans ltat o se trouve la socit au moment
de son acquisition, et notamment avec ses crances et ses dettes.
Dpt de deux exemplaires au registre du commerce et des socits.
Dpt au greffe du tribunal de commerce en 2 exemplaires par
lintermdiaire dun CFE dune copie des statuts mis jour.
Si la cession entrane une modication dans la grance :
publication dans un journal dannonces lgales ;
dpt au greffe de deux exemplaires du procs-verbal ;
inscription modificative au registre du commerce et des socits ;
notification aux banques o les pouvoirs des grants sont dposs ;
ventuellement, notification aux organismes sociaux.
Une procdure dagrment rapide : lacte unique
La procdure est gnralement la suivante : tous les associs participent lacte
de cession ; lagrment du cessionnaire est constat dans lacte qui procde la
modication des statuts.
Cette procdure est valide par la loi du 11 fvrier 1994 qui stipule que les dci-
sions collectives autres que celles concernant lapprobation annuelle des comptes
peuvent valablement rsulter dun acte exprimant laccord unanime des associs,
condition que ce soit prvu par les statuts (voir page 192).
Nos conseils pour la cession des parts sociales
Veillez ce que le cdant prenne lengagement de ne pas porter directement ou indi-
rectement concurrence la socit pendant une dure et dans un espace dtermins.
Veillez ce que le cdant prenne lengagement de garantir le passif imprvu.
An dviter tout litige quant au partage des dividendes, il est recommand aux par-
ties de prciser de faon trs claire le sort des dividendes. En gnral, lacte de ces-
sion stipule que le cessionnaire aura seul droit toute rpartition de bnces qui
pourrait tre faite postrieurement la cession.
Zoom n 23
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
92
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Il peut participer aux votes des associs et aux distributions de
bnces sociaux.
2. lgard du cdant
Le cdant cesse de faire partie de la socit uniquement sil cde la
totalit de ses parts. Comme tout vendeur, le cdant doit garantie au
cessionnaire : il ne doit pas dissimuler la situation nancire de la
socit, de sorte que le nouvel associ aurait acquis des parts ayant une
valeur bien moindre. Le cdant, sauf clause contraire, reste tenu des
cautionnements accords.
9.1.3. Limposition de la cession des parts sociales
9.1.3.1. Droits denregistrement
Les cessions de parts sociales sont soumises un droit denregistre-
ment de 3 % calcul sur le prix de cession auquel on applique un abat-
tement de 23 000 si la cession porte sur la totalit des parts sociales
1
.
Le partage des dividendes non distribus au moment de la cession
En ce qui concerne le partage des dividendes non distribus lors de la cession et
dfaut daccord entre les parties :
si lassemble na pas dcid au jour de la cession la distribution des dividendes,
les dividendes sont acquis au cessionnaire ;
si lassemble a dcid antrieurement ou concomitamment la cession la distri-
bution de dividendes, les dividendes sont acquis au cdant.
Zoom n 24
1. Labattement de 23 000 est appliqu au prorata du pourcentage des parts
sociales cdes. Les cessions de parts de socits prpondrance immobilire
sont exclues de cet abattement.
Le choix de la SARL comme structure juridique
93
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Hypothse n 1 : Le fonds de commerce est exploit dans le cadre
dune entreprise individuelle
Mme si lacheteur prend sa charge le passif (il achte pour
70 000 ), les droits denregistrement au taux de 3 % sont calculs sur
la valeur brute du fonds de commerce
1
:
3 % (100 000 23 000) = 2 310
Hypothse n 2 : Le fonds de commerce est exploit dans le cadre
dune SARL
La vente porte sur des parts sociales qui ont une valeur de 70 000
(100 000 30 000). Les droits denregistrement au taux de 3 % sont
calculs sur le prix de cession :
(70 000 23 000) 3 % = 1 410
La constitution dune SARL a donc permis de faire une conomie de
900 .
La mise en SARL de lentreprise individuelle permet de faire une conomie
de droits denregistrement lors de la vente de lentreprise
Un commerant dcide de vendre son fonds de commerce valoris 100 000 et
grev dun passif de 30 000 (fournisseurs et emprunt bancaire).
Le fonds de commerce est exploit dans le cadre :
Hypothse n 1 : dune entreprise individuelle.
Hypothse n 2 : dune SARL.
Respectez votre engagement de conserver les parts sociales
pendant trois ans pour viter les mauvaises surprises
Un commerant met en SARL son entreprise individuelle en juin N. Il apporte un
fonds de commerce dune valeur de 400 000 . Il prend lengagement de conserver
les parts sociales reues en change pendant un dlai de trois ans.
Cas n 16
Cas n 17
1. 0 % jusqu 23 K ; 3 % de 23 K 107 K ; 5 % au-del.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
94
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Hypothse n 1 : Les parts sociales sont vendues pour 700 000
en juin N + 8
Lengagement de conserver les parts sociales pendant trois ans est res-
pect. Les droits denregistrement au taux de 3 % sont calculs sur le
prix de cession :
(700 000 23 000) 3 % = 2 310
Hypothse n 2 : Les parts sociales sont vendues pour 700 000
en juin N + 2
Lengagement de conserver les parts sociales pendant trois ans nest
pas respect. Lapport du fonds de commerce aurait d tre tax 3 %
au lieu dtre exonr. Il faut donc payer le complment de droits
denregistrement :
5 % (400 000 107 000) + 3 % (107 000 23 000) = 17 170
auxquels sajoutent les droits denregistrement sur la cession des
parts sociales 20 310 .
9.1.3.2. Plus-values de cession
Lassoci qui cde ses parts sociales est impos sur les plus-values de
cession de ses parts sociales. Le rgime dimposition de la plus-value
dpend de la qualit de lassoci.
Si lassoci est un particulier, la plus-value est impose selon le
rgime des plus-values mobilires des particuliers (scalit des
mnages).
Si lassoci est une entreprise, la plus-value est impose selon
le rgime des plus-values professionnelles (scalit des entre-
prises).
Les parts sociales sont vendues pour 700 000 .
Hypothse n 1 : en juin N + 8.
Hypothse n 2 : en juin N + 2.
(Suite cas n 17)
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
95
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Lassoci qui cde ses parts sociales est un particulier
Si les parts sociales sont dtenues par un particulier, la cession des
parts sociales est impose selon le rgime des plus-values mobilires
des particuliers.
La plus-value est impose au taux de 30,1 %
1
. Limposition nest
dclenche que si le montant des cessions de titres ralises au cours
de lanne dpasse le seuil de 25 730 .
Les moins-values se compensent avec les plus-values ralises au cours
de lanne. La moins-value nette est reportable sur les plus-values
mobilires des 10 annes suivantes.
2. Lassoci qui cde ses parts sociales est une entreprise
Si les parts sociales de la SARL sont inscrites lactif dune entreprise
individuelle ou dune socit, la cession des parts sociales est impose
selon le rgime des plus-values professionnelles.
1. 18 % dIR + 12,1 % de PS = 30,1 % dimposition globale.
SARL prpondrance immobilire
et cession de parts sociales
Une SARL est prpondrance immobilire si plus de 50 % de son actif est compos
dimmeubles.
Si la SARL est impose lIR, la cession des parts sociales est impose selon le
rgime des plus-values immobilires et non des plus-values mobilires : la plus-
value est gale la diffrence entre le prix de cession et le prix dacquisition des
parts major des frais dacquisition titre onreux valus 7,50 % du prix
dacquisition. La plus-value ainsi obtenue est minore dun abattement de 10 % par
anne de dtention au-del de la cinquime. Sur la plus-value calcule, un abatte-
ment de 1 000 par cession sapplique. La plus-value est assujettie limpt sur
le revenu au taux de 16 % major des prlvements sociaux au taux de 12,1 %. La
CSG de 5,10 % nest pas dductible.
En revanche, si la SARL est impose lIS, la plus-value est impose selon le
rgime des plus-values mobilires.
Zoom n 25
Guide pratique de la SARL et de lEURL
96
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le rgime des plus-values professionnelles
Lentreprise qui possde
les parts sociales est
une
Les parts sociales de la SARL sont inscrites
lactif de lentreprise depuis
moins de 2 ans :
la plus-value
est court terme
plus de 2 ans :
la plus-value
est long terme
entreprise individuelle
ou
socit soumise lIR
(SNC)
La plus-value est un simple produit
ajout au rsultat de lentreprise
qui est soumis limpt sur le
revenu au niveau de lentrepreneur
individuel ou de lassoci (pour la
quote-part qui lui revient). Le taux
de lIR est progressif.
La plus-value est
impose au taux
de 28,1 %.
socit soumise lIS
(SA, SARL) ET titres
comptabiliss en titres
de participation
La plus-value est un simple produit
ajout au rsultat de lentreprise
qui est soumis limpt sur les
socits au niveau de la socit.
Le taux de lIS est de 33
1/3
%.
La plus-value
est exonre
dimposition.
Cependant une
quote-part de 5 %,
correspondant aux
frais de gestion de
la participation, reste
imposable.
socit soumise lIS
ET titres non comptabiliss
en titres de participation
La plus-value est un simple produit ajout au rsultat de
lentreprise qui est soumis limpt sur les socits au
niveau de la socit. Le taux de lIS est de 33
1/3
%.
Imposition de la cession des parts sociales dune SARL
Un associ vend le 30/06/N des parts sociales dune SARL pour un prix de vente de
20 000 . Il avait achet ses parts sociales pour 2 000 le 30/06/N-3.
1. Calculer les droits denregistrement.
2. Calculer limposition de la plus-value :
Hypothse 1 : lassoci est un simple particulier.
Hypothse 2 : lassoci est une SNC.
Hypothse 3 : lassoci est une SA. La SARL est une liale commune dexploi-
tation dun nouveau projet.
Hypothse 4 : lassoci est une SA. Linvestissement dans la SARL a t ralis
en vue de raliser une plus-value moyen terme.
Cas n 18
Le choix de la SARL comme structure juridique
97
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les droits denregistrement payer slvent : 20 000 3 % =
600 .
Imposition de la plus-value :
Hypothse 1. Pour un simple particulier, la plus-value est impo-
se au taux de 30,1 %.
Hypothse 2. Pour la SNC, la plus-value est long terme. Elle
est impose au taux de 28,1 % au niveau des associs.
Hypothse 3. Pour la SA, les parts sociales de la SARL consti-
tuent des titres de participation car ils sont utiles lactivit de
lentreprise. La plus-value est long terme. Elle est exonre
dimposition hauteur de 95 %.
Hypothse 4. Pour la SA, les parts sociales de la SARL consti-
tuent des titres de placement. La plus-value est impose lIS au
taux de 33
1/3
% au niveau de la socit.
9.1.4. Comment prparer la transmission des parts
dans le cadre dun dcs ou dune liquidation
de la communaut
Associs Plus-value Taux dimposition Impt
Simple particulier 18 000 30,1 % 5 418
SNC 18 000 28,1 % 5 058
SA et titres de participation 18 000 0 % 300
SA et titres de placement 18 000 33
1/3
% 6 000
Quelques conseils pour la transmission de parts sociales
Le grant doit veiller la convocation du reprsentant de lindivision pour viter
toute contestation ultrieure quand le partage sera fait.
Pensez lattribution prfrentielle pour assurer la prennit dune entreprise fami-
liale.
Les parts reprsentatives dapport en industrie ne sont pas transmissibles et doivent
tre annules.
La SARL peut continuer avec certains hritiers seulement, ou avec les seuls asso-
cis survivants.
Zoom n 26
Guide pratique de la SARL et de lEURL
98
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La SARL nest pas dissoute par le dcs dun associ, sauf stipulation
contraire des statuts. Les parts sociales sont librement transmissibles
par voie de succession, ainsi quen cas de liquidation de communaut
de biens entre poux, sauf agrment prvu dans les statuts.
Par consquent, si les statuts ne contiennent aucune clause restrictive :
en cas de dcs de lun des associs, ses hritiers seront associs,
suivant le partage de la succession qui aura pu tre fait entre eux ;
en cas de liquidation de la communaut (dcs, sparation de
corps ou sparation de biens), lpoux auquel sont attribues les
parts de la SARL, du fait de la liquidation de la communaut,
devient de plein droit associ de la socit (les parts de la SARL
appartenaient la communaut).
Les associs sont libres de continuer ou non la socit avec le succes-
seur de lassoci dcd. Les statuts peuvent galement prvoir
dagrer le successeur. La procdure dcrite page 88 sapplique alors.
Si lhritier nest pas admis en tant quassoci, la socit doit lui verser
la valeur des droits sociaux entrs en succession (article L. 223-13 du
Code de commerce).
9.1.4.1. Quelles sont les consquences du partage des parts
dpendant de la succession ou de la communaut ?
Tant quil na pas t procd au partage des parts dpendant de la suc-
cession ou de la communaut, ces parts sont indivises entre les hri-
tiers et le conjoint survivant.
Ils devront se faire reprsenter auprs de la socit par lun
deux, considr par elle comme seul propritaire. Sils ne peu-
vent sentendre, un mandataire sera dsign par le prsident du
tribunal de commerce.
Lorsque le partage aura t ralis, chacun des attributaires de
parts sociales sera considr comme le propritaire des parts
mises dans son lot compter du jour du dcs, mais il ne pourra
remettre en question les dcisions prises dans lintervalle par les
autres associs, ds lors que le reprsentant de lindivision, dont
la nomination aura t rgulirement notie la socit, aura
t convoqu aux runions.
Le choix de la SARL comme structure juridique
99
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les parts sociales appartenant un associ dcd doivent tre compri-
ses dans la dclaration de succession pour leur valeur vnale au jour du
dcs an de calculer les droits de mutation par dcs. Cette valeur doit
tre apprcie en tenant compte de tous les lments dont lensemble
permet dobtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui quaurait
entran le jeu normal de loffre et de la demande.
9.1.4.2. Pensez lattribution prfrentielle
Le conjoint survivant ou tout hritier copropritaire peut demander
lattribution prfrentielle par voie de partage, charge de soulte sil y
a lieu, dune entreprise commerciale, industrielle ou artisanale,
caractre familial. dfaut daccord amiable, la demande dattribu-
tion prfrentielle est porte devant le tribunal, qui se prononce en
fonction des intrts en prsence.
Pour plus dinformations, reportez-vous page 87.
9.1.5. Lvaluation des parts
Sauf dans le cas o un expert doit tre dsign, la valeur des parts est
librement dtermine par lacqureur et le vendeur. Il existe de nom-
breuses mthodes pour parvenir cette valuation. Le but de lvalua-
tion des parts de la SARL est de dterminer la valeur quaccepterait de
payer un acqureur prudent, guid principalement par la recherche
dun prot.
Les mthodes les plus gnralement pratiques par les experts profes-
sionnels indpendants sont la valeur patrimoniale, la valeur de rende-
ment, la mthode du cash-ow, la mthode du PER ou la mthode du
Goodwill. Dautres mthodes sont galement pratiques par les experts
judiciaires et ladministration scale.
Les principales mthodes pour valuer les parts sociales
La valeur
patrimoniale
La valeur patrimoniale sobtient en remplaant les valeurs
comptables du bilan par les valeurs relles.
La valeur
de rendement
La valeur de rendement sobtient en capitalisant un taux donn
(taux de capitalisation) le dividende net moyen mis en distribution
par la SARL au cours des deux ou trois dernires annes.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
100
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le nantissement et la saisie des parts sociales
9.2.1. Le nantissement des parts sociales
La mthode du PER
(Price Earning
Ratio)
Cest une mthode dvaluation par capitalisation du bnfice net.
Cette mthode est souvent retenue pour les socits cotes en
Bourse mais peut servir de rfrence pour la dtermination de
la valeur de petites entreprises. La valeur de laction est gale au
dividende par action multipli par le PER du secteur.
La mthode
du GOODWILL
Dorigine anglo-saxonne, le terme GOODWILL correspond la valeur
immatrielle dune entreprise, reprsente par sa rputation, fonde
sur lhabilit de son management (la direction et lencadrement),
son noyau douvriers spcialiss, sa situation gographique
favorable, sa rputation auprs de la clientle Cest donc
le fonds de commerce et dindustrie, le savoir-faire (know-how).
Le GOODWILL se dtermine par capitalisation du superbnfice,
cest--dire, la partie des bnfices qui excde la rmunration
normale des capitaux engags.
Mthode
des experts
Les experts et les tribunaux (notamment dans la rgion parisienne)
utilisent un barme dvaluation des fonds de commerce qui na
aucun caractre officiel.
Mthode utilise
par ladministration
scale
Ladministration fiscale procde des valuations pour contrler la
cohrence des valeurs dclares par les contribuables pour le calcul
des droits denregistrement, de lISF
Pour lAdministration, la valeur du droit au bail constitue une valeur
plancher du fonds de commerce.
Le crancier doit obtenir le consentement
des associs au nantissement
En effet, si lassoci dbiteur ne respecte pas ses engagements, le crancier qui
bncie du nantissement peut faire vendre les parts. Cependant, les associs ne
sont pas obligs dagrer lacqureur des parts si cest un tiers (les rgles dagr-
ment en cas de cession volontaire sappliquent galement en cas de vente force).
Dans ce cas, les parts nanties perdent une bonne partie de leur valeur puisque le
crancier ne peut pas les vendre un acqureur qui nest pas agr ; do lintrt
dobtenir le consentement des associs.
9.2.
Zoom n 27
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
101
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Un associ de SARL peut nantir tout ou partie de ses parts sociales
au prot de lun de ses cranciers. Le crancier, en cas de non-paiement
lchance, pourra faire vendre les parts aux enchres an dtre
pay.
Le crancier peut galement demander un nantissement judiciaire des
parts sociales de son dbiteur sil peut justier de circonstances sus-
ceptibles de menacer le recouvrement de sa crance.
Cette sret donne au crancier un droit de prfrence en cas de vente
(le prix de vente sert en priorit payer sa crance) et un droit de suite
en cas de cession des parts.
Procdure respecter
1. Le nantissement doit tre effectu par acte sous seing priv (ou
par acte notari), enregistr, et avec laccord du conjoint lorsque
les parts dpendent de la communaut.
2. Le nantissement doit tre signi la socit par acte extrajudi-
ciaire (ou accept par la socit dans un acte authentique).
3. Pour obtenir le consentement des associs au nantissement, la
procdure respecter est la mme que pour une cession un tiers
(voir page 88 notication du projet de nantissement la socit
et chacun des associs ; consentement donn par la majorit des
associs reprsentant les trois quarts des parts sociales ; consen-
tement tacite si la socit na pas fait connatre sa dcision dans
les trois mois de la dernire des notications).
Si les associs donnent leur consentement au projet de nantis-
sement, ce consentement emportera agrment du cessionnaire
en cas de ralisation force des parts nanties. Cependant, les
associs peuvent, aprs la cession et avec le consentement du
cessionnaire, racheter immdiatement les parts en vue de
rduire le capital de la socit.
Si les associs ne donnent pas leur consentement, ou si le con-
sentement nest pas demand, lacqureur des parts devra tre
agr, comme en matire de cession volontaire, par lassem-
ble des associs. En cas de refus dagrment, la socit devra
racheter elle-mme les parts (rduction de capital), ou les faire
racheter par un autre associ ou par un tiers quelle agre.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
102
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
9.2.2. La saisie des parts sociales
Le crancier dun associ peut faire saisir ses parts an de les vendre
par adjudication (la socit pourrait galement saisir les parts dun
associ dont elle est crancire).
Procdure suivre
1. La saisie doit tre signie la socit par acte dhuissier.
2. La saisie doit tre porte la connaissance du dbiteur dans les
8 jours de sa ralisation.
3. Lacqureur des parts doit tre agr par les associs. En cas de
refus dagrment, les associs doivent acheter ou faire acheter les
parts vendues par adjudication.
La location et le crdit-bail des parts sociales
Les parts sociales dune SARL assujettie limpt sur les socits
peuvent faire lobjet dun contrat de location ou de crdit-bail au prot
dune personne physique (C. com., art. L. 239-1 L. 239-5 et C. mon.
Fin., art. L. 313-7).
9.3.1. Objectif et recommandations
Lassoci dune SARL loue les parts sociales un futur repreneur.
Lobjectif du contrat de location est de favoriser la transmission de
la SARL en permettant au candidat repreneur de prendre connaissance
de la socit pendant la priode de location avant dacqurir les parts
sociales. Le bailleur pourra limiter la garantie de passif puisque le
repreneur a une bonne connaissance de la socit.
Alors que la location-grance porte sur le fonds de commerce de la
socit, la location des parts sociales porte sur la socit. Alors que le
locataire-grant est personnellement responsable de sa gestion, le
locataire de parts est plac dans la position dun simple associ.
Le contrat de location de parts sociales est trs souple. Sa rdaction
dpend essentiellement de la volont des parties et des statuts de la
socit.
9.3.
Le choix de la SARL comme structure juridique
103
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les parties doivent donc tre vigilantes lors de la rdaction du contrat
de location des parts sociales.
Le locataire doit prvoir une option dachat des parts lissue
de la priode de location pour viter le refus du bailleur de lui
cder les parts sociales.
Le bailleur doit prvoir une clause de condentialit et un
engagement de non-concurrence de la part du locataire en cas
de refus dacqurir les parts sociales, puisque le locataire aura eu
accs lensemble des informations (documents comptables,
sociaux) de la socit.
Le contrat doit galement prvoir la valeur de rachat des parts ou
lventuelle indemnisation du bailleur en cas de dprciation des
parts sociales.
Comme le locataire dispose du droit de vote aux assembles ordi-
naires, le bailleur ne doit pas donner en location un nombre de parts
reprsentant une majorit sufsante pour permettre au locataire de
prendre seul des dcisions aussi importantes que le changement de
grant ou laffectation des rsultats de la socit.
9.3.2. Les conditions respecter
Les statuts doivent prvoir que les parts sociales de la SARL peuvent
tre donnes bail, au sens des dispositions de larticle 1 709 du Code
civil . La SARL doit tre soumises limpt sur les socits.
Le contrat de location doit tre crit et comporter les mentions obliga-
toires suivantes (art. R. 239-1) :
la nature, le nombre et lidentication des parts sociales loues ;
la dure du contrat et du pravis de rsiliation ;
le montant, la priodicit et, le cas chant, les modalits de rvi-
sion du loyer ;
si les parts sociales loues sont cessibles par le bailleur en cours
de contrat, les modalits de cette cession ;
les conditions de rpartition du boni de liquidation, dans le res-
pect des rgles lgales applicables lusufruit.
Ces mentions sont obligatoires sous peine de nullit du contrat. Cepen-
dant, en labsence de mentions relatives la rvision du loyer et la
Guide pratique de la SARL et de lEURL
104
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
cession des titres en cours de bail, le contrat nest pas nul, le loyer est
rput xe et les titres incessibles pendant la dure du contrat.
Les parts loues font lobjet dune valuation en dbut et en n de con-
trat, ainsi qu la n de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est
une personne morale. Cette valuation doit tre certie par un commis-
saire aux comptes.
La location nest possible quau prot dune personne physique, ce qui
exclut le recours un holding de reprise. La procdure dagrment
prvue par la loi ou les statuts en cas de cession de parts est applicable
la location.
Le locataire est considr comme un usufruitier des parts. Il a donc
droit lensemble des informations sociales devant tre fournies aux
associs et dispose du droit de vote aux assembles ordinaires. Le
bailleur, considr comme le nu-propritaire, reste en revanche seul
habilit voter pour les dcisions relevant des assembles extraordi-
naires.
Le contrat de bail est constat par acte authentique, ou sous seing priv,
soumis la procdure de lenregistrement. Certains droits sociaux sont
exclus (art. L 239-1, al. 3).
Sous peine de nullit, les parts loues ne peuvent pas faire lobjet dune
sous-location ou dun prt de titre. Dans les socits dexercice libral,
les parts sociales ne font lobjet dun contrat de bail quau prot de pro-
fessionnels libraux.
Lorsque la socit subit une procdure de redressement judiciaire, la
location de ses parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions
xes par le tribunal ayant ouvert la procdure.
Le contrat de location est rendu opposable la socit dans les formes
prvues larticle 1690 du Code civil (signication par huissier ou
acceptation par la socit).
Les dispositions lgales ou statutaires prvoyant lagrment du ces-
sionnaire de parts ou dactions sont applicables dans les mmes condi-
tions au locataire.
Le bail est renouvel dans les mmes conditions que la conclusion
du bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de
Le choix de la SARL comme structure juridique
105
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
rsiliation, la partie la plus diligente fait procder la radiation de la
mention porte dans les statuts de la SARL.
Les oprations de location de parts sociales peuvent tre assorties
dune promesse unilatrale de vente moyennant un prix convenu
tenant compte, au moins pour partie, des versements effectus titre
de loyers (art. L. 313-7 du Code montaire et nancier).
La dlivrance des parts est ralise la date laquelle est inscrite dans
les statuts de la SARL, ct du nom de lassoci, la mention du bail et
du nom du locataire. compter de cette date, la socit doit adresser au
locataire les informations dues aux associs et prvoir sa participation
et son vote aux assembles. Dans les SARL, le grant peut inscrire lui-
mme dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire ct
du nom de lassoci concern, sous rserve de la ratication de cette
dcision par les associs. Il peut, dans les mmes conditions, supprimer
cette mention en cas de non-renouvellement ou de rsiliation du bail
(art. L. 223-18, al. 9 du Code du commerce).
Tout intress peut demander au prsident du tribunal statuant en rfr
denjoindre sous astreinte au reprsentant lgal de la SARL, en cas de
signication ou darrive terme dun contrat de bail portant sur des
parts sociales de la socit, de modier les statuts et de convoquer
lassemble des associs cette n.
9.3.3. Le rgime scal
Lassoci dune SARL (le bailleur) loue les parts sociales un futur
repreneur (le locataire) qui a la qualit dassoci.
Le bailleur peroit des loyers qui sont imposables dans la catgorie des
bnces industriels et commerciaux (BIC).
Le locataire est associ. Il peroit donc des dividendes de la SARL qui
sont imposs dans la catgorie des revenus de capitaux mobiliers. Les
loyers dcaisss sont imputs sur les dividendes encaisss. Labatte-
ment de 40 % sapplique sur le net. Lventuel dcit nest pas imputa-
ble sur le revenu global, mais seulement reportable sur les dividendes
des six annes suivantes.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
106
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Depuis le 1
er
mars 1994, la responsabilit pnale dune personne
morale peut tre engage pour les infractions limitativement dnies
par le Code pnal. La responsabilit de la personne morale ne peut donc
exister que dans les cas o la loi le prvoit expressment ; dfaut,
linfraction demeure la charge du grant.
La responsabilit de la socit ne peut tre engage que dans la mesure
o linfraction a t commise pour le compte de la socit.
Ainsi, la socit nest pas responsable des infractions commises :
par lun de ses employs dans lexercice ou loccasion de
lexercice de ses fonctions si celui-ci a agi de sa propre initiative
et mme si la socit a pu bncier de linfraction ;
par le grant si celui-ci a agi pour son propre compte et dans son
seul intrt personnel (mme parfois au prjudice de la personne
morale).
La responsabilit pnale de la socit peut tre engage en labsence
de volont dlibre du grant : infractions de ngligence ou dimpru-
dence notamment en cas dhomicide ou de blessure involontaires.
La responsabilit du grant peut tre retenue concurremment celle de
la socit si le grant est auteur ou complice des mmes infractions.
Les personnes qui peuvent accder au casier judiciaire des personnes
morales sont restreintes : collectivits locales dans le cadre des mar-
chs publics, prsident des tribunaux de commerce dans les cas de
redressement ou de liquidation judiciaire, et lAMF en cas dappel au
march public.
La socit peut encourir des peines contraventionnelles, criminelles
ou correctionnelles en fonction de la gravit des infractions
Nature de linfraction Sanction
Crimes ou dlits
les graves manquements la scurit
lorsquils sont dlibrs ;
les accidents du travail ;
amende dont le taux maximum est le
quintuple de celui prvu pour les
personnes physiques.
10. La responsabilit pnale de la SARL
/
Le choix de la SARL comme structure juridique
107
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Crimes ou dlits
les installations ou les produits
dfectueux ;
les atteintes aux systmes informatiques ;
les vols, les escroqueries, ou les abus de
confiance ;
usage de faux, corruption active ;
infractions en matire de droit de
lenvironnement, ou de droit de la
consommation.
Et dans les cas prvus par la loi :
interdiction pour une dure de cinq ans
dmettre des chques ou dexercer une
activit professionnelle ;
la socit peut tre dissoute pour les
infractions les plus graves.
Contraventions
Toutes les contraventions.
Les contraventions de la cinquime classe.
Les contraventions de la cinquime classe
les plus graves.
amende dont le taux maximum peut tre
le quintuple de celui prvu pour les
personnes physiques.
amende dont le taux peut aussi tre
le quintuple ;
OU confiscation de la chose qui a servi ou
tait destine commettre linfraction ;
OU interdiction, pour une dure maximale
dun an, dmettre des chques.
amende dont le taux peut aussi tre le
quintuple ;
ET confiscation de la chose qui a servi ou
tait destine commettre linfraction ;
ET interdiction, pour une dure maximale
de trois ans, dmettre des chques.
La responsabilit pnale de la SARL
La SARL, comme toute personne morale, peut tre pnalement responsable des
infractions commises pour son compte par son grant. Cette responsabilit ne peut
tre mise en cause que dans les cas o la loi ou le dcret le prvoient expressment.
dfaut, linfraction demeure la charge du grant. Cette responsabilit nexclut
pas la responsabilit pnale du grant. La SARL peut galement tre condamne
en tant que complice. Il existe un casier judiciaire pour les personnes morales. Les
peines applicables vont de lamende la dissolution.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
108
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Responsabilit pnale dune socit
Une socit charge dorganiser un chantier na pas mis en place un dispositif de
protection adapt. Cela a entran la chute mortelle dun salari.
La socit a t dclare coupable dhomicide involontaire par inobservation de la
rglementation en matire dhygine et de scurit du travail.
Cas n 19
109
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2
LE STATUT DU GRANT
DE LA SARL
Comment sont nomms les grants ?
1.1.1. Les conditions de nomination
La SARL est administre par un ou plusieurs grants : le nombre des
grants est donc x librement dans les statuts.
Sil est prvu plusieurs grants, indiquez dans les statuts leurs
pouvoirs respectifs. Attention ! La pluralit de grants risque
dentraner des conits.
Conseils pour nommer le grant
Assurez-vous que la personne que vous envisagez pour tre grant peut occuper
cette fonction (interdiction de grer, incompatibilit).
Insrez dans les statuts les conditions pour la nomination du grant (limite dge
au-del de laquelle il cesse ses fonctions, le grant doit tre associ).
1. Nomination, rvocation et dmission du grant
1.1.
Zoom n 28
Guide pratique de la SARL et de lEURL
110
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le grant de la SARL peut tre un associ ou un tiers tranger la
socit. Cest obligatoirement une personne physique.
Une socit, mme si elle est associe majoritaire de la SARL, ne
peut donc pas tre grante. Cependant, le reprsentant lgal de
cette socit peut tre grant titre personnel.
Le mari et la femme peuvent tous deux tre grants mme sils
sont les seuls associs.
Lautorisation du conjoint nest pas ncessaire, quel que soit le
rgime matrimonial.
Les statuts peuvent stipuler que le grant sera obligatoirement
choisi parmi les associs remplissant certaines conditions.
Le grant na pas la qualit de commerant.
La SARL permet donc une personne de faire du commerce sans
devenir personnellement commerante.
Attention ! Si le grant est de nationalit trangre, il faut cepen-
dant quil soit titulaire de la carte de sjour temporaire autorisant
lexercice dune activit non salarie (carte demander la pr-
fecture du lieu du sige social), sauf sil est ressortissant de lun
des tats membres de la Communaut europenne, ou titulaire
dune carte de rsident (le dfaut de carte de commerant tran-
ger est sanctionn par un emprisonnement de six mois et par une
amende de 3 000 ).
Un mineur mancip peut exercer les fonctions de grant car il
suft au grant davoir la capacit juridique requise pour tre
mandataire.
Le grant de SARL ne doit pas tre frapp dune interdiction de grer
la suite dune condamnation pnale (loi du 30 aot 1947 relative
lassainissement des professions commerciales et industrielles), ou de
la faillite personnelle prononce par le tribunal de commerce.
Le centre de formalits des entreprises exige, lors de la constitu-
tion dune SARL et lors dun changement de grant, une dclara-
tion de non-condamnation date et signe par le grant (voir
modle dans les supplments Internet).
Certaines professions ou fonctions sont incompatibles avec les fonc-
tions de grant : notaires, avocats, fonctionnaires, parlementaires,
Le statut du grant de la SARL
111
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
membres du gouvernement (les sanctions des incompatibilits sont
essentiellement disciplinaires). En outre, le commissaire aux comptes
dune SARL ne peut en devenir grant pendant les cinq ans qui suivent
la cessation de ses fonctions.
Si la SARL exerce une profession rglemente, le grant doit person-
nellement remplir certaines conditions : le grant dune SARL qui
exploite une ofcine de pharmacie doit tre associ et titulaire du
diplme de pharmacien. Il en est de mme pour les SARL qui exploi-
tent un cabinet dexpert-comptable ou darchitecte, un tablissement
de prparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques. Dans
une agence de voyages ou un laboratoire danalyses mdicales, le
grant doit justier de son aptitude professionnelle.
1.1.2. La procdure de nomination
Le grant est dsign dans les statuts, ou nomm ultrieurement par un
ou plusieurs associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales.
Lors dune deuxime consultation, les associs peuvent dcider la
majorit des votes mis de nommer le grant. La nomination du
grant seffectue donc dans les mmes conditions de majorit que cel-
les exiges pour les dcisions collectives ordinaires (voir page 182).
Un associ majoritaire peut donc lui seul se dsigner valable-
ment comme grant.
Attention ! Si vous prvoyez dans les statuts une majorit plus
forte, vous renforcez la position des associs qui disposent de la
minorit de blocage. Notez quune majorit plus faible est inter-
dite.
Noubliez pas que la nomination du grant doit tre publie dans le
dlai dun mois compter du jour de la constitution de la socit.
Veillez bien respecter la procdure de nomination
Les tiers pourraient se prvaloir dune irrgularit dans la nomination pour se sous-
traire leurs engagements.
Zoom n 29
Guide pratique de la SARL et de lEURL
112
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Que le grant soit nomm dans les statuts ou postrieurement, les
conditions de rvocation sont identiques.
Lacceptation des fonctions de grant peut tre tacite.
La dure des fonctions du grant est xe par les statuts ou par la dci-
sion de nomination des associs.
Si vous navez prcis aucune dure, le grant est nomm pour
toute la dure de la socit, jusqu sa dmission, sa rvocation,
ou son dcs.
Si vous prcisez une dure, le mandat du grant expirera au
terme prvu sans quil soit besoin de signier un cong ou de res-
pecter un pravis. Si vous dcidez de renouveler ses pouvoirs,
vous tes dispens des formalits de publicit.
Veillez bien respecter la procdure de nomination car les tiers pour-
raient se prvaloir dune irrgularit dans la nomination pour se sous-
traire leurs engagements :
Vous ne pouvez pas opposer aux tiers (clients, fournisseurs) la
nomination ou la cessation de fonction dun grant tant quelle
na pas t rgulirement publie, moins que vous puissiez ta-
blir que les tiers avaient connaissance des changements interve-
nus au moment o ils ont trait avec la socit.
Si un tiers prouve avoir t dans limpossibilit davoir connais-
sance de la nomination ou de la cessation de fonction dun
grant, ces changements ne lui sont pas opposables SAUF si cette
preuve est apporte partir du 16
e
jour qui suit celui de la publi-
cation au BODACC.
Tableau des formalits pour la nomination du grant
la constitution de la socit
J Signature des statuts ou procs-verbal de nomination.
J + 1 mois Publication dans un journal dannonces lgales du dpartement du
sige social.
Dpt, par lintermdiaire du CFE, au registre du commerce et des
socits dune expdition des statuts et, le cas chant, de deux copies
de lacte de nomination.
Immatriculation au registre du commerce et des socits.
Insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
la diligence du greffier du tribunal de commerce.
Le statut du grant de la SARL
113
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Comment prennent n les fonctions du grant ?
Tableau des formalits en cas de nomination dun nouveau grant
J Procs-verbal de nomination.
J + 1 mois Publication dans un journal dannonces lgales du dpartement
du sige social.
Dpt, par lintermdiaire du CFE, au registre du commerce et
des socits de deux exemplaires du procs-verbal de nomination
et de deux copies sur papier libre des statuts remis jour sil y a eu
modification des statuts.
Inscription modificative au registre du commerce et des socits
(demande en trois exemplaires sur formule dlivre par le greffe).
Insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
la diligence du greffier du tribunal de commerce.
Liste des pices fournir par le grant
(rubrique 1 A de lannexe Al de larrt du 9 fvrier 1988)
Extrait dacte de naissance.
Ou copie de la carte didentit ou du passeport accompagne dune dclaration de
lintress faisant connatre sa liation si celle-ci ne gure pas sur les documents
fournis.
Ou document quivalent pour les trangers.
Sil y a lieu tout document justiant la nationalit.
Attestation sur lhonneur relative labsence de condamnations ou de sanctions.
Le bulletin n 2 du casier judiciaire du grant est demand par le juge commis
la surveillance du registre.
De plus pour les trangers :
Copie de la carte de sjour temporaire autorisant lexercice dune activit non
salarie.
Ou copie du titre de sjour pour les ressortissants des tats membres de lUnion
Europenne et des tats avec lesquels ont t conclus des accords particuliers.
Ou copie de la carte de rsident.
Dmission en blanc
Vous pouvez faire signer au grant une lettre de dmission non date (dmission en
blanc) an de rester matre de laffaire : cette pratique est dangereuse et peut vous
obliger verser des dommages-intrts au grant.
1.2.
Zoom n 30
Guide pratique de la SARL et de lEURL
114
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1.2.1. Expiration du mandat du grant
Si les statuts prvoient une dure dtermine, le mandat du grant
expirera au terme prvu, sans quil soit besoin de signier un cong ou
de respecter un pravis.
1.2.2. Dcs ou incapacit du grant
Certains vnements mettent n immdiatement aux fonctions de
grant : le dcs, la faillite, linterdiction de grer une socit, et
lexercice dune fonction incompatible avec celle de grant de SARL.
La cessation des fonctions dun grant nentrane pas la dissolu-
tion de la socit.
Sil sagit dun grant unique, les associs doivent procder la
nomination dun autre grant. En cas de difcult, ils peuvent
saisir par voie de requte le prsident du tribunal de commerce
an de faire dsigner un mandataire charg de convoquer
lassemble. En cas de dcs du grant unique, les statuts peu-
vent prvoir un droit de convocation de lassemble gnrale par
un associ en vue de procder son remplacement.
En cas de pluralit de grants, il nest pas ncessaire de dsigner
un autre grant.
1.2.3. Dmission du grant
Le grant de SARL peut dmissionner tout moment sans avoir jus-
tier dun motif quelconque. Cependant, la socit peut obtenir des
dommages et intrts si la dmission lui cause un prjudice (dpart
imprvu).
Veillez bien respecter les formalits de publicit de la cessation
des fonctions du grant pour quelle soit opposable aux tiers
Si la rvocation dun grant rgulirement dcide par lassemble des associs nest
pas publie, le grant peut continuer engager la socit pour les contrats passs
avec les tiers.
Zoom n 31
Le statut du grant de la SARL
115
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les statuts peuvent prvoir un dlai de pravis : le non-respect de
ce pravis contribuera prouver que le grant a dmissionn bru-
talement.
Attention la dmission en blanc ! Les associs, pour rester ma-
tres de laffaire, peuvent faire signer au grant, lors de sa nomina-
tion, une lettre de dmission non date. Cette dmission en blanc
peut tre considre comme une rvocation sans juste motif et
donner lieu des dommages-intrts.
Le grant doit notier sa dmission par lettre recommande aux
associs (ou aux autres grants, sil y a pluralit de grants). La
dmission na pas besoin dtre accepte par lassemble pour
produire ses effets.
Le grant dmissionnaire doit convoquer rapidement les associs
an de leur permettre de dsigner un nouveau grant (modles
de remplacement dun grant en annexe dans les supplments
Internet).
1.2.4. Rvocation du grant
Le grant peut tre rvoqu par les associs reprsentant plus de la
moiti des parts sociales. Lors dune deuxime consultation, les asso-
cis peuvent dcider la majorit des votes mis de rvoquer le
grant. La rvocation du grant seffectue donc dans les mmes condi-
tions de majorit que celles exiges pour les dcisions collectives ordi-
naires (voir page 182). Le grant, sil est associ, participe au vote.
Toute clause contraire est rpute non crite.
Un grant galitaire ou majoritaire dispose dun nombre de voix
sufsant pour sopposer sa rvocation puisquil prend part au
vote. Cependant, il nest pas inamovible car il est rvocable par
le tribunal de commerce pour une cause lgitime la demande
de tout associ, mme si le demandeur est trs minoritaire. Pour
viter tout blocage pour la nomination du nouveau grant, il est
conseill de prvoir une simple majorit de moiti pour la nomi-
nation des grants.
Les associs peuvent rvoquer tout moment le grant. Ils ne sont pas
obligs de motiver cette rvocation.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
116
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Si la rvocation est dcide sans juste motif, elle peut donner lieu
dommages-intrts. Le grant doit pouvoir justier dun prju-
dice (perte de rmunration + prjudice moral).
En cas de rvocation judiciaire, le tribunal doit justier sa dci-
sion par une cause lgitime.
La rvocation du grant doit en principe gurer lordre du jour
de lassemble (la rubrique gestion du grant lordre du jour
est sufsante).
Si le grant refuse de convoquer lassemble, tout associ peut
demander au prsident du tribunal de commerce statuant en rfr
la dsignation dun mandataire qui sera charg de convoquer cette
assemble et de xer son ordre du jour.
Les statuts peuvent prvoir une indemnit.
1.2.5. Formalits respecter et consquences
de la cessation des fonctions
Les actes accomplis par le grant aprs la cessation de ses fonctions
sont nuls condition que les formalits soient rgulirement effectues.
An dassurer la continuit de la grance, les associs peuvent, sur
dcision prise la majorit ordinaire, supprimer dans les statuts la
mention relative au nom du grant.
Constituent de justes motifs
de rvocation
Ne constituent pas de justes motifs
de rvocation
Abandon injustifi des fonctions.
Msentente grave entre cogrants.
Dfaut de convocation de lassemble
annuelle.
Faute de gestion : pertes leves
Perte de confiance des associs,
des banquiers et des administrations.
Dcouvert bancaire de la socit trs
suprieur au dcouvert autoris.
Commande au nom de la socit mais
pour lusage personnel du grant dun
appareil lectromnager.
Emploi de salaris non dclars.
Changement de majorit intervenu et dsir
de nouveaux associs de nommer un
grant de leur choix alors quaucune faute
de gestion nest reproche au grant en
exercice.
Simples considrations dopportunit,
de politique intrieure de la socit ou
du groupe dont elle fait partie.
Fautes personnelles commises par
le grant, ds lors quelles nengagent pas
sa responsabilit en tant que grant.
Dsaccords dordre secondaire qui
auraient pu tre surmonts par une
dmarche amiable.
Le statut du grant de la SARL
117
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Lancien grant doit veiller ce que ces formalits soient effectues.
dfaut, la cessation de ses fonctions serait inopposable aux tiers, et il
pourrait, par exemple, tre condamn payer une partie du passif au
cas o la socit viendrait cesser ses paiements.
En cas dinaction du nouveau grant, le grant dmissionnaire (ou tout
intress) peut requrir une inscription modicative au registre du com-
merce et des socits : il le met en demeure et, un mois aprs, demande
en rfr la nomination dun mandataire charg de laccomplissement
des formalits.
Aprs la cessation de ses fonctions, lancien grant :
peut exercer la mme activit condition quune clause statutaire
de non-concurrence ne le lui interdise pas. Pour tre valable,
cette clause de non-concurrence doit tre limite dans le temps et
dans lespace et ne pas sopposer en fait la reprise dune acti-
vit par lancien grant ;
doit sabstenir de tout acte de concurrence dloyale (dmarchage
danciens clients) ;
doit rendre compte de lexcution de ses fonctions jusqu la ces-
sation de celles-ci dans le rapport de gestion soumis lassem-
ble gnrale.
Tableau des formalits en cas de cessation des fonctions du grant
La cessation des fonctions doit tre publie pour tre opposable aux tiers.
Par simplication, effectuez les formalits de nomination
du nouveau grant en mme temps.
J Procs-verbal constatant la cessation
des fonctions du grant.
J + 1 mois Insertion dans un journal dannonces
lgales du lieu du sige social.
Dpt au greffe par lintermdiaire
dun CFE dune copie de la dcision ou
de la dlibration, certifie conforme.
Inscription modificative au registre
du commerce et des socits.
Insertion au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales la diligence
du greffier du tribunal de commerce.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
118
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les conditions du cumul
Le grant peut cumuler ses fonctions de grant (mandat social) avec
une fonction de salari sous rserve que le contrat de travail corres-
ponde un emploi effectif et quil nait pas t conclu pour empcher
les rgles de rvocation des grants.
Le contrat de travail correspond un emploi effectif si trois critres
sont runis.
1. Il doit exister une distinction entre le mandat social et le contrat
de travail : dans le cadre du mandat social, le grant assure la
direction gnrale de la socit ; dans le cadre du contrat de tra-
vail, il doit assurer une fonction technique distincte.
Le contrat de travail doit tre crit et dnir prcisment la
fonction technique.
Si un grant dcide de conclure un contrat de travail, le procs-
verbal de lassemble des associs doit mentionner quune
fonction technique spciale vient sajouter ses attributions de
mandataire.
La fonction technique ne doit pas tre une fonction de direc-
tion car il ny a pas de distinction sufsante avec la fonction
de grant.
La fonction technique ne doit pas entrer directement dans
lobjet social de la SARL : responsable des ventes nest
pas une fonction distincte pour une socit dont lobjet est la
distribution de produits ; en revanche, cette fonction est dis-
tincte si la socit a pour objet linstallation et la maintenance
dascenseurs.
Dans une entreprise de dimension modeste, la sparation entre
la direction gnrale qui incombe au grant et la direction
technique est difcile tablir.
2. La fonction technique doit faire lobjet dune rmunration dis-
tincte.
Par simplication, le mandat social peut tre exerc gratuite-
ment. Une rmunration unique est verse en contrepartie du
travail salari.
2. Cumul des fonctions de grant et de salari
2.1.
Le statut du grant de la SARL
119
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La rmunration doit correspondre au salaire normal de
lemploi technique quoccupe le grant (elle ne doit tre ni
excessive, ni trop faible).
Au titre de son contrat de travail, le grant doit bncier de
tous les avantages dun salari (indemnits journalires de
maladie).
3. Comme tout salari de lentreprise, le grant doit exercer sa fonc-
tion technique dans un tat de subordination lgard de lentre-
prise, cest--dire sous lautorit et le contrle de lentreprise.
Le grant doit tre minoritaire ou galitaire (il doit dtenir au
maximum 50 % des parts sociales).
Le grant ne peut pas tre majoritaire car il disposerait alors
dans la socit de pouvoirs trs importants qui excluent lexis-
tence dun lien de subordination.
Le grant ne doit pas conduire la socit comme une entre-
prise personnelle (absence dassembles pour consulter les
associs), car il ne serait plus alors dans un tat de subordi-
nation puisquil se comporte comme le seul matre bord.
Prvoyez dans les procs-verbaux dassemble, la dnition
des missions qui sont cones au grant an dtablir le lien
de subordination.
Le grant dune SARL dont la majorit des parts sociales est
dtenue par son pre et qui dtient le monopole des connais-
sances techniques nest pas dans un tat de subordination.
Intrt pratique et consquence du cumul
Le cumul dun mandat social et dun contrat de travail permet au grant
de bncier des avantages dun salari :
la protection sociale et le rgime scal des salaris, la garantie
dun salaire ;
la protection en cas de licenciement : les indemnits de licencie-
ment, les allocations de lassurance chmage, la garantie de paie-
ment des indemnits par lAGS et le super-privilge des salaris
en cas de liquidation judiciaire. Cependant, les cas dindemnisa-
tion par les ASSEDIC et lAGS deviennent de plus en plus rares
(voir La protection sociale du grant page 127).
2.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
120
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La rvocation du grant par les associs nentrane pas, en principe, la rsi-
liation du contrat de travail. Cependant, la perte de conance qui en rsulte
constitue gnralement une cause relle et srieuse de licenciement.
Les formalits respecter
Les autres consquences du cumul
Convention
collective
Le grant bnficie des dispositions des conventions collectives
applicables dans lentreprise.
Rmunration Le salaire qui est vers au grant en contrepartie du contrat de travail doit
tre au moins gal :
au salaire minimum de croissance ;
ou aux minima prvus par la convention collective applicable
dans lentreprise.
Congs pays Le grant bnficie :
de la lgislation sur les congs pays ;
de lindemnit de congs pays qui doit tre calcule sur la base
des salaires quil peroit au titre de son contrat de travail (lventuelle
rmunration en tant que grant nest pas prise en compte).
Reprsentant
du personnel
Le grant ne peut pas tre lu dlgu du personnel ou membre du
comit dentreprise malgr son statut de salari car il exerce le rle de
lemployeur. Le grant ne fait pas partie de leffectif pour lapprciation
des seuils retenus pour lapplication de la lgislation sur les reprsentants
du personnel.
Intressement
aux bnfices
de lentreprise
Le grant a droit de bnficier de la participation au bnfice,
de lintressement, du plan dpargne entreprise, et des exonrations
fiscales et sociales qui leur sont attaches.
lections
prudhomales
Le grant a la qualit dlecteur au collge des employeurs condition
que la SARL emploie un ou plusieurs salaris.
Seuils deffectif Le grant entre en compte dans le calcul des seuils deffectifs car il fait
partie du personnel salari de lentreprise.
Respectez bien la procdure de contrle par les associs
pour les avantages accords au salari
Soumettez lapprobation des associs loctroi dun complment de retraite ou de
primes danciennet, une augmentation de salaire mme si elle rsulte dune aug-
mentation gnrale applicable tous les salaris. dfaut, la socit pourrait rcla-
mer au grant la restitution des sommes perues en application de ces conventions
non approuves par les associs.
2.3.
Zoom n 32
Le statut du grant de la SARL
121
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les associs de la SARL doivent approuver les conventions intervenues
entre la socit et lun de ses grants ou associs, sauf si la convention
porte sur des oprations courantes et conclues des conditions norma-
les (la procdure dapprobation est expose dans le dtail page 194).
Les associs doivent donc approuver la conclusion dun contrat de tra-
vail avec un grant en fonction, ainsi que les modications ultrieures,
et notamment les modications portant sur le salaire.
En revanche, si un salari devient grant, son contrat de travail qui est
antrieur sa nomination en tant que grant na pas tre approuv
par les associs. Cependant, si ce contrat de travail fait lobjet dun
renouvellement ou dune modication aprs la nomination en tant que
grant, lapprobation des associs est alors ncessaire.
Le rgime social auquel est afli le grant dpend de son statut :
Le grant minoritaire ou galitaire qui peroit une rmunra-
tion est assimil un salari : il est afli obligatoirement au
rgime gnral de la Scurit sociale.
Le grant majoritaire, mme non rmunr, est assimil un tra-
vailleur indpendant (artisan, commerant, profession librale) :
il est afli obligatoirement au rgime gnral de Scurit
sociale des travailleurs non salaris.
Nos conseils
Le grant doit bien rchir au choix de son statut social : statut de salari (grant
minoritaire ou galitaire), ou statut de travailleur indpendant (grant majoritaire).
Diffrents critres doivent tre pris en compte : ge, tat de sant, composition de
la famille Le statut de salari ne doit plus tre considr comme le plus avanta-
geux. En effet, le rgime des non-salaris offre des prestations de plus en plus
proches de celles du rgime des salaris (indemnits journalires de maladie pour
les artisans, indemnit journalire de maternit) pour un cot souvent moindre.
3. La protection sociale du grant
Guide pratique de la SARL et de lEURL
122
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Quand un grant est-il assimil un salari ?
Le grant est assimil un salari sil est minoritaire ou galitaire,
cest--dire sil ne possde pas plus de la moiti du capital social.
En cas de grance collgiale, les grants ne doivent pas possder
ensemble plus de la moiti du capital social.
Les grants de fait ne sont pas pris en considration.
Les parts appartenant en toute proprit ou en usufruit au conjoint
et aux enfants mineurs non mancips dun grant sont consid-
res comme lui appartenant (cependant, les parts dtenues en nue-
proprit ou en indivision ne sont pas prises en compte).
Les parts du conjoint associ de la SARL en rmunration dun
apport en industrie ne sont pas prises en compte.
Les parts du concubin ne sont pas prises en compte.
Le grant minoritaire ou galitaire non rmunr ne bncie daucune
couverture sociale puisquil ne relve ni du rgime des non-salaris, ni
du rgime gnral des salaris.
Il peut pallier labsence de couverture sociale en exerant une
autre activit qui lui ouvre droit aux prestations sociales (salari,
travailleur indpendant).
Il ne peut pas bncier de lassurance maladie de son conjoint
salari.
Il peut souscrire une assurance personnelle.
Le grant ne doit pas exercer un contrle majoritaire sur la SARL
Ce grant exerce un contrle majoritaire et ne peut donc tre assimil un salari
(il contrle 85 % de la SARL : 20 % directement et 65 % indirectement).
3.1.
Zoom n 33
Grant
minoritaire
SARL
60 % 65 %
SA
20 %
Le statut du grant de la SARL
123
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
noter : le grant majoritaire, mme sil nest pas rmunr, doit
cotiser au rgime des non-salaris tant que la socit nest pas
dissoute.
Un grant non associ est assimil un salari sauf sil appartient un
collge de grants majoritaire ou si son conjoint ou ses enfants
mineurs dtiennent plus de la moiti du capital social.
Un grant de fait, mme sil est minoritaire, est toujours assimil un
travailleur indpendant (rgime des non-salaris).
Enn, loption de la SARL de famille pour le rgime scal des soci-
ts de personnes ne remet pas en cause le statut de salari du grant
minoritaire ou galitaire (les bnces de la SARL sont alors imposs
limpt sur le revenu comme ceux dune entreprise individuelle).
Que doit choisir le grant : le statut de salari
ou le statut de travailleur indpendant ?
Le grant attache beaucoup dimportance sa couverture sociale.
Le statut de grant minoritaire ou galitaire lui permet de bncier de
la protection sociale du salari, et notamment du rgime de retraite
obligatoire des cadres (le grant minoritaire a le statut de cadre). Quant
au grant majoritaire, il est assimil un travailleur indpendant ; il
bncie de prestations moins avantageuses (pas de couverture ch-
mage, retraite beaucoup plus faible que celle dun cadre salari, garan-
tie de ressources en cas dinterruption dactivit uniquement pour les
artisans) mais les cotisations sont sensiblement plus faibles ( protec-
tion sociale forte correspond un cot lev).
Le moindre cot des cotisations du rgime des travailleurs indpen-
dants prsente lavantage de ne pas affecter la capacit bnciaire de
lentreprise, de laisser plus de trsorerie disponible. Le grant peut
grer comme bon lui semble lconomie ralise en matire de cotisa-
tions sociales : consacrer la trsorerie dgage au dveloppement de
lentreprise, ou la recherche dune protection sociale plus complte,
et donc plus scurisante. ce titre, la SARL peut adhrer des rgi-
mes facultatifs dassurance an de faire bncier le grant de presta-
tions complmentaires ; elle peut galement effectuer des placements
3.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
124
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Voir limposition des rsultats de la SARL, page 217, pour une meilleure compr-
hension.
2. SARL de famille ou EURL impose lIR.
dont la rentabilit peut savrer suprieure celle dgage par les coti-
sations aux rgimes de retraite obligatoires des cadres salaris.
An daider le grant dans son choix, nous prsentons les cotisations
et les prestations du rgime des travailleurs indpendants au regard de
celles du rgime des salaris. Nous indiquons galement les diffren-
tes possibilits pour amliorer la protection sociale du grant.
3.2.1. Lassiette des cotisations
La base de calcul des cotisations dpend du statut du grant et du
rgime scal de la SARL.
Base de calcul des cotisations
Rgime dimposition
de la SARL
1
Impt sur les socits Impt sur le revenu
2
Grant majoritaire Travailleur indpendant
Les cotisations sont
calcules :
uniquement sur la
rmunration que verse
la SARL au grant ;
les dividendes que reoit
le grant en contrepartie de
ses droits sociaux ne sont
pas pris en compte.
Travailleur indpendant
Les cotisations sont
calcules :
sur la fraction des bnfices,
distribus ou non, qui
revient au grant au prorata
de ses parts sociales ;
et sur la rmunration
que peroit le grant.
Grant minoritaire
ou galitaire rmunr
Salari
Les cotisations sont calcules sur le salaire brut.
Grant minoritaire
ou galitaire non rmunr
Il na pas lobligation davoir une couverture sociale.
Il ne cotise donc pas.
Associs qui exercent
une activit
Les associs qui exercent une activit dans la SARL sans tre
grant ont le statut de salari (sauf en labsence de lien de
subordination). Les cotisations sont calcules sur le salaire
brut.
Associs qui nexercent
pas dactivit
Les associs qui nexercent pas dactivit dans la SARL
ne cotisent pas car ils nont pas lobligation davoir
une couverture sociale.
Le statut du grant de la SARL
125
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dans la majorit des cas, les cotisations sont calcules sur la rmun-
ration brute du grant. Cependant, quand la SARL opte pour limpt
sur le revenu (SARL de famille), toute la quote-part de bnce de la
SARL qui revient au grant majoritaire est soumise cotisations,
mme si elle nest pas prleve par le grant (sous forme de rmunra-
tion ou de dividendes). La situation est semblable celle dune entre-
prise individuelle.
Pour le grant dune SARL soumise limpt sur le revenu, les cotisa-
tions sont calcules sur un revenu net de charges sociales alors que le
revenu pris en compte dans les autres cas est un revenu brut.
3.2.2. Les cotisations et les prestations sociales
Les cotisations et les protections sociales dpendent du statut du
grant de SARL : salari (grant minoritaire) ou travailleur indpen-
dant (grant minoritaire).
Le site du rgime social des indpendants (RSI), http://www.le-rsi.fr,
propose une approche comparative cotisation/prestation pour permet-
tre au grant de choisir en toute connaissance de cause son rgime de
protection sociale.
Pour le grant majoritaire dune SARL soumise limpt sur le revenu,
les cotisations sont calcules sur la quote-part du bnce
que le grant dclare limpt sur le revenu
augment des dficits des annes antrieures et des amortissements rputs
diffrs ;
des abattements pour adhsion aux centres de gestion ;
des allgements fiscaux pour entreprises nouvelles ;
des cotisations facultatives aux contrats dassurance groupe
loi Madelin , ou des rgimes facultatifs.
diminu des cotisations personnelles obligatoires dassurance maladie,
dassurance vieillesse et dallocations familiales.
sans tenir
compte
des plus ou moins-values professionnelles nettes long terme
provenant de la cession des lments de lactif immobilis dans
lentreprise.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
126
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
3.2.3. La dclaration des revenus du grant
majoritaire aux organismes sociaux
La dclaration commune de revenus des professions indpendantes non
agricoles (DCR) permet dtablir la base de calcul de toutes les cotisa-
tions obligatoires dues pour leur activit indpendante aux caisses
dassurance maladie, dassurance vieillesse et aux URSSAF (alloca-
tions familiales), ainsi que la base de calcul de la contribution sociale
gnralise (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette
sociale (CRDS). Cette dclaration permet galement de dterminer le
rgime dassurance maladie habilit rembourser les dpenses de soins
(rgime de lactivit principale) des personnes exerant simultanment
une activit indpendante et une activit salarie ou agricole. Le site
www.net-entreprises.fr est le portail ofciel propos aux entreprises
ou leur mandataire par les organismes de protection sociale pour
effectuer gratuitement des dclarations sociales en ligne.
3.2.4. Limite de dduction
des assurances volontaires
An damliorer sa protection sociale, le grant majoritaire peut adh-
rer des rgimes facultatifs. Les cotisations sociales sont en principe
dductibles du bnce imposable de la SARL. Cependant, si les
cotisations sont trop importantes, elles ont plus la nature dun place-
ment nancier en franchise dimpt que dune juste protection sociale
complmentaire. Cest la raison pour laquelle les cotisations sont
dductibles dans certaines limites.
Les cotisations aux rgimes obligatoires sont intgralement dduc-
tibles : assurance maladie-maternit, allocations familiales, invalidit-
dcs, assurance vieillesse obligatoire de base et complmentaire.
En revanche, les cotisations des rgimes facultatifs complmen-
taires de prvoyance (maladie, dcs, invalidit), de retraite et de perte
demploi subie sont dductibles dans certaines limites.
Le statut du grant de la SARL
127
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Comment se couvrir contre le chmage ?
Le rgime dassurance chmage est rserv aux salaris. Le grant de
SARL en est donc exclu puisquil a la qualit de mandataire social.
Cependant, le grant minoritaire ou galitaire peut tre titulaire dun
contrat de travail et avoir ainsi le statut de salari (voir Cumul des
fonctions de grant et de salari page 118). Il peut alors bncier du
rgime dassurance chmage, mais les cas sont trs rares.
dfaut de pouvoir tre assujetti au rgime dassurance chmage, le
grant de SARL peut adhrer lun des deux rgimes dassurance
chmage volontaires mis en place par les syndicats patronaux : la
garantie sociale des chefs et dirigeants dentreprise (GSC), et lasso-
ciation pour la protection des patrons indpendants (APPI).
3.3.1. Grant minoritaire ou galitaire afli aux ASSEDIC
Si le grant minoritaire ou galitaire cumule son mandat social de
grant avec un contrat de travail, il peut tre afli aux ASSEDIC sil
exerce rellement son emploi dans un tat de subordination.
LASSEDIC peut toujours invoquer le caractre ctif du contrat pour
refuser au grant qui a cotis le bnce des allocations chmage (cest
lASSEDIC den apporter la preuve).
LASSEDIC refuse le bnce des allocations chmage des grants
minoritaires ou galitaires qui ont cotis tort dans les situations sui-
vantes :
dans une petite entreprise, il ne peut pas y avoir de relle spara-
tion entre la fonction de direction du grant (mandat social), et sa
Grant minoritaire et ASSEDIC
Faites une demande de renseignements lASSEDIC pour savoir si le grant minori-
taire ou galitaire peut bncier des allocations chmage, et si la SARL doit cotiser
au rgime dallocations chmage.
3.3.
Zoom n 34
Guide pratique de la SARL et de lEURL
128
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
fonction technique (contrat de travail). Il nexerce donc pas son
emploi dans un tat de subordination ;
quand la fonction technique entre dans lobjet social de la SARL,
elle fait partie intgrante de la fonction de grant. Le contrat de
travail est alors ctif (exemple : responsable des ventes dans une
socit dont lobjet est la distribution de produits) ;
un grant minoritaire qui est le seul dans la socit dtenir les
connaissances techniques ne peut pas tre dans un tat de subor-
dination, et ne peut donc pas avoir le statut de salari.
Le grant peut faire une demande de renseignements lASSEDIC qui
devra rpondre au vu des lments communiqus :
Si le grant nest pas considr comme salari pour le rgime
dallocations chmage :
la SARL ne doit pas cotiser ;
elle peut obtenir le remboursement des cotisations patronales
et ouvrires indment verses dans la limite des cinq dernires
annes et sur prsentation de justicatifs.
Si le grant est considr comme salari pour le rgime dalloca-
tions chmage :
la SARL doit cotiser et le grant bnciera des allocations
chmage (lASSEDIC est engage par sa rponse) ;
elle doit payer les cotisations patronales et ouvrires non ver-
ses durant les cinq dernires annes.
3.3.2. Grant afli aux rgimes spciaux
des chefs dentreprises
Le grant qui ne bncie pas du rgime dassurance chmage, peut
saflier, sous certaines conditions, lun des deux rgimes facultatifs
crs spcialement par les syndicats patronaux (GSC ou APPI).
Le grant majoritaire peut dduire les cotisations ces rgimes faculta-
tifs de son revenu imposable. Les prestations qui lui seraient verses en
contrepartie sont soumises limpt sur le revenu.
Pour le grant minoritaire ou galitaire, si la cotisation est prise en
charge par la SARL, elle est dductible des bnces imposables de la
SARL, et elle constitue pour le grant un supplment de rmunration
Le statut du grant de la SARL
129
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
imposable limpt sur le revenu. Si le grant la paie personnelle-
ment, elle nest pas admise en dduction de son revenu imposable,
mais les prestations qui lui seraient verses en contrepartie ne sont pas
soumises limpt sur le revenu.
Le conjoint du grant qui exerce de manire rgulire une activit
professionnelle dans une SARL familiale doit opter pour le statut de
conjoint collaborateur, de conjoint salari ou de conjoint associ
(C. com., art. L. 121-4).
Le conjoint collaborateur de la SARL
Pour plus dinformations sur ce statut, voir le site www.le-rsi.fr dans
lannexe 8 de la rubrique Renseignements pratiques et annexes de
longlet Objectif entreprise .
4.1.1. Conditions et formalits remplir
Pour bncier du statut de conjoint collaborateur de la SARL, le
conjoint doit tre mari au chef dentreprise (le concubin et le partenaire
dun PACS sont donc exclus de ce statut). Le chef dentreprise dans une
SARL est lassoci unique de lEURL, ou le grant majoritaire de la
Le conjoint du grant doit avoir un statut clair
Si les conditions pour tre conjoint collaborateur ne sont pas remplies et que le conjoint
nest ni salari ni associ, il assiste librement le grant en dehors de tout statut. Ce sta-
tut est dconseill car il prsente des risques : le conjoint na quun pouvoir informel
au sein de la socit mais peut voir sa responsabilit engage par les cranciers (les
conjoints sont solidaires des dettes dune socit cre de fait entre conjoints).
4. Le statut du conjoint du grant
Zoom n 35
4.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
130
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
SARL ou de la SELARL dont leffectif nexcde pas vingt salaris. Le
conjoint doit participer effectivement et de manire rgulire lactivit
de lentreprise. Son travail nest pas rmunr (dans le cas contraire il
serait considr comme conjoint salari). La SARL doit exercer une
activit artisanale, industrielle, commerciale ou librale.
Le choix du statut du conjoint collaborateur doit tre mentionn
auprs du CFE dont relve la SARL. Cette option doit tre porte la
connaissance des autres associs lors de la premire assemble gn-
rale suivant la mention de ce statut auprs du CFE.
4.1.2. Les consquences du statut de conjoint collaborateur
Le conjoint collaborateur bncie dune protection sociale, dune
protection de ses biens propres dans ses rapports avec les tiers, parti-
cipe lactivit de lentreprise et a droit une rmunration diffre
prleve sur lactif de succession. Il bncie aussi de la formation
professionnelle continue.
a) Protection sociale et retraite
Le conjoint collaborateur bncie gratuitement des prestations
dassurance maladie et maternit du rgime social des indpendants
(RSI), en qualit dayant droit du chef dentreprise. Comme conjointe
collaboratrice, lpouse bncie, en cas de maternit ou dadoption,
dune allocation forfaitaire de repos maternel et dune indemnit jour-
nalire de remplacement si elle se fait remplacer dans son travail ou
la maison par du personnel salari.
Le conjoint collaborateur peut se constituer une pension de retraite
comme le grant de la SARL. En contrepartie, le conjoint doit cotiser
aux rgimes de retraite de base, complmentaire et invalidit-dcs
des professions indpendantes sur un revenu forfaitaire ou sur un
pourcentage du revenu professionnel du grant.
b) Participation la conduite de lentreprise
Le conjoint collaborateur peut reprsenter le grant dans la conduite de
lentreprise. Il est rput avoir reu du grant le mandat daccomplir en
Le statut du grant de la SARL
131
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
son nom les actes de gestion courante. Le conjoint collaborateur peut
participer aux lections professionnelles, tre lecteur ou ligible.
c) Protection et droits renforcs
La protection des biens propres du conjoint est renforce. En effet,
dans ses rapports avec les tiers, les actes de gestion et dadministration
accomplis par le conjoint collaborateur pour les besoins de lentreprise
sont rputs ltre pour le compte du chef dentreprise et nengagent
donc pas sa responsabilit personnelle (en dehors de toute faute).
Le conjoint a droit la formation professionnelle continue et peut
participer au plan pargne de lentreprise.
Au dcs du chef dune entreprise, le conjoint collaborateur bncie
dune rmunration diffre prleve sur lactif de succession. Le con-
joint survivant, sil a particip sans tre rmunr lactivit de
lentreprise pendant dix ans, pourra percevoir un capital. Ce dernier
est prlev sur lactif de succession au moment de la liquidation de
lentreprise. Dun montant maximum quivalent trois fois le SMIC
annuel en vigueur au moment du dcs, il ne peut pas excder 25 % de
la valeur des biens professionnels.
Le conjoint salari de la SARL
4.2.1. Les conditions pour tre salari
Le conjoint peut tre salari de la SARL dont son poux est grant.
Compte tenu des liens particuliers existant entre le grant de la SARL
et son conjoint salari, des conditions doivent tre respectes pour que
le contrat de travail soit rel.
Conjoint salari et exonration
La SARL ne peut pas bncier de lexonration des cotisations de Scurit sociale
pour lembauche du premier salari sil sagit du conjoint.
4.2.
Zoom n 36
Guide pratique de la SARL et de lEURL
132
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Le salaire doit correspondre aux fonctions rellement exerces
par le conjoint salari
Une majoration du salaire peut tre rintgre par ladministration s-
cale dans le bnce imposable de la socit lors dun contrle.
Une minoration du salaire an de rduire pour lentreprise la charge
salariale peut remettre en cause toute la protection sociale du conjoint.
Le salaire est au moins gal au SMIC ou aux minima prvus par la
convention collective.
2. La rmunration doit tre verse
Si, an de ne pas dtriorer sa trsorerie, lentreprise ne paie pas le
salaire du conjoint, il bncie cependant de la protection sociale des
salaris. Le contrat de travail sera alors considr comme ctif et
pourra entraner un redressement scal ou une remise de la protection
sociale loccasion dune vrication administrative.
3. Le conjoint doit fournir un travail effectif
Le conjoint doit travailler de manire habituelle et non simplement
occasionnelle, en fonction de son bon vouloir. Il peut trs bien tra-
vailler temps partiel. Le conjoint doit travailler sous lautorit du
grant, dans un tat de subordination. Le dfaut de subordination peut
entraner le refus des prestations sociales (allocations de chmage).
4. Le conjoint salari ne doit pas, sous le couvert du contrat
de travail, se comporter en grant de fait de la socit
5. Le contrat de travail doit tre crit et prcis sur les obligations
du conjoint salari
4.2.2. Les consquences de ce statut
1. Le salaire du conjoint salari est scalement dductible en
totalit ou en partie selon le rgime dimposition de la SARL
et le statut matrimonial du conjoint
Le statut du grant de la SARL
133
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2. Le conjoint bncie de la protection sociale des salaris
et des garanties en cas de licenciement
Le conjoint est compris dans leffectif de lentreprise pour toutes les
rgles de reprsentation collective, de protection des salaris ou de
scurit et de conditions de travail. Lembauche du conjoint en tant
que salari peut donc faire franchir certains seuils deffectif.
Cependant, lentreprise ne peut pas bncier de lexonration des
cotisations de Scurit sociale pour lembauche du premier salari sil
sagit du conjoint. En revanche, si un salari est embauch aprs le
conjoint, lentreprise peut bncier de cette exonration.
Les poux sont maris sous un rgime de
sparation
de biens
communaut
La SARL est
assujettie
limpt sur
les socits
Le salaire et les charges sociales sont intgralement
dductibles du rsultat de la SARL.
Le salaire est soumis limpt sur le revenu dans
la dclaration dimpt des poux.
limpt sur
le revenu
1
Le salaire et les
charges sociales
sont intgralement
dductibles du
rsultat de
la SARL.
Le salaire est
soumis limpt
sur le revenu.
Les charges sociales sont
dductibles.
Le salaire annuel est intgralement
dductible si la SARL a adhr
un centre de gestion agr
2
.
dfaut, le salaire est dductible
dans la limite de 13 800 .
Le salaire qui nest pas dductible
est impos dans la catgorie des
BIC ou des BNC selon lactivit
exerce par la SARL.
1. SARL de famille qui a opt pour limpt sur le revenu ou EURL (voir limposi-
tion des rsultats, page 217).
2. Ou une association agre pour une activit BNC (voir page 292).
Guide pratique de la SARL et de lEURL
134
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le conjoint associ de la SARL
4.3.1. Comment le conjoint peut-il devenir
associ de la SARL ?
1. Le conjoint cre une SARL avec son poux
Les poux peuvent constituer une SARL quel que soit leur rgime
matrimonial. Par prcaution, les statuts doivent tre tablis par acte
notari pour viter quil soit reproch lun des poux davoir consenti
une donation dguise au prot de lautre.
2. Le conjoint mari sous un rgime de communaut revendique
sa qualit dassoci
Les poux sont maris sous un rgime de communaut. Un des poux
devient associ dune SARL en utilisant les biens de la communaut
(les biens de la communaut lui servent acqurir des parts dune
SARL existante, ou raliser des apports au moment de la constitution
dune SARL). Lautre conjoint peut intervenir et revendiquer la qua-
lit dassoci (article 1832-2 du Code civil). (Voir Comment consti-
tuer la SARL page 18).
Le conjoint qui notie la SARL son intention de devenir associ lors
de lapport ou de lacquisition sera associ pour la moiti des parts
souscrites ou acquises. Il se trouve alors dans la mme situation que
des poux maris sous le rgime de la communaut qui ont dcid, ds
lorigine, de sassocier en utilisant des biens communs.
3. Le conjoint dune entreprise artisanale apporte son savoir-faire
Lorsquune personne apporte une SARL son fonds de commerce ou
son entreprise artisanale, son conjoint peut apporter son industrie (son
savoir-faire). Le conjoint peut devenir ainsi associ sous rserve que
Conjoint et grance majoritaire
Lassociation du conjoint peut modier le rgime scal ou social de la grance.
4.3.
Zoom n 37
Le statut du grant de la SARL
135
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
son activit principale soit consacre lexploitation de lentreprise. En
contrepartie de son apport, il a droit des parts en industrie (son apport
nest pas pris en compte dans la formation du capital car le capital
constitue le gage des cranciers : le savoir-faire ne peut pas servir de
gage en cas de mauvaises affaires).
Le conjoint associ en industrie :
participe la vie sociale de la SARL (assembles dassocis)
et aux rsultats de la socit (dividendes ; boni de liquidation) en
proportion de ses droits qui sont librement xs par les statuts ;
contribue aux pertes : sa quote-part dans la contribution aux pertes
est dtermine dans les statuts sans quelle puisse tre suprieure
celle de lassoci qui a le moins apport.
4.3.2. Les consquences de ce statut
1. Lassociation du conjoint peut modier le rgime scal
ou social de la grance
Un grant peut bncier du statut scal et social de salari sil est
minoritaire ou galitaire. Comme les parts appartenant au conjoint sont
retenues pour apprcier le caractre minoritaire de la grance, lassocia-
tion du conjoint peut modier le rgime scal ou social du grant (le
rgime des travailleurs indpendants se substitue celui des salaris sil
devient majoritaire). (Voir La protection sociale du grant page 121).
2. Le conjoint associ peut galement tre salari de la SARL
Si le conjoint associ devient salari de la socit, il bncie du rgime
gnral de la Scurit sociale des salaris sans aucune restriction.
Cependant, sil devient grant ou cogrant de la SARL, son rgime
social dpendra du caractre majoritaire ou non de la grance.
Le conjoint grant ou cogrant majoritaire, rmunr ou non, relve du
rgime des travailleurs indpendants (il doit, au minimum, payer les
cotisations forfaitaires).
Le conjoint grant ou cogrant minoritaire ou galitaire relve du
rgime des salaris, sil est rmunr. Sil nest pas rmunr, il ne
relve daucun rgime mme en tant quayant droit de son poux
Guide pratique de la SARL et de lEURL
136
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
grant. Il doit donc, pour bncier dune protection sociale, souscrire
une assurance personnelle (il ne peut pas adhrer au rgime des tra-
vailleurs indpendants).
3. Le conjoint associ dun grant majoritaire qui participe
lactivit de lentreprise doit tre afli personnellement
au rgime des travailleurs indpendants
Le conjoint bncie des mmes prestations (il a droit notamment aux
allocations de maternit ou dadoption) et cotise sur les mmes bases
que le grant. (Pour plus dinformations, voir La protection sociale
du grant page 121).
4. Consquences scales
Le statut de conjoint associ na aucune incidence sur le rgime
dimposition de la SARL. Sil est salari de la SARL, son salaire sera
dductible des rsultats selon les modalits vues ci-dessus (page 132).
Limposition des rmunrations du conjoint associ dans une SARL
soumise limpt sur les socits, dpend du statut de son poux
grant.
Dans une SARL soumise limpt sur le revenu, le conjoint associ est
assimil, comme le grant, un entrepreneur individuel : sa quote-part
de bnce est soumise limpt sur le revenu dans la catgorie des
Lpoux est
Le conjoint associ
travaille dans la SARL
ne travaille pas
dans la SARL
grant minoritaire
Le salaire bnficie de labattement de 10 %
pour frais professionnels.
/
Les dividendes sont imposs en tant que revenus de capitaux
mobiliers .
grant majoritaire
La rmunration est impose selon larticle 62
du CGI, rmunration des dirigeants .
Elle bnficie de labattement de 10 % pour frais
professionnels.
/
Les dividendes sont imposs en tant que revenus de capitaux
mobiliers .
Le statut du grant de la SARL
137
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
bnces industriels et commerciaux (BIC). Ladhsion de la SARL
un centre de gestion agr permet au conjoint dviter une majoration
de 25 % de son BIC.
La responsabilit civile
5.1.1. Les cas de responsabilit du grant
La responsabilit civile du grant peut tre engage dans les cas sui-
vants.
Infractions la rglementation applicable aux SARL : inob-
servation des formalits de constitution, dfaut de publication des
modications statutaires
Attention la grance de fait !
Est considr comme grant de fait, toute personne qui, directement ou par personne
interpose, aura, en fait, exerc la gestion de la socit sous le couvert ou en lieu et
place de son grant lgal. Sera quali de grant de fait, par exemple, un associ majo-
ritaire qui, pour rester le vritable matre de laffaire, et se soustraire toute respon-
sabilit, dsigne comme grant un homme de paille qui nagit que sur ses directives.
Les sanctions pnales sont applicables non seulement au grant lgal de la SARL,
mais aussi tout grant de fait. De plus, le grant de droit ne peut chapper aux
sanctions en prtextant quil na t quun homme de paille, quun prte-nom, quil
na jamais eu, en ralit, le moindre pouvoir, recevant ordres et instructions du grant
de fait. En cas de cessation de paiements de la socit, le tribunal peut dcider que les
dettes sociales seront supportes par tous les grants de droit ou de fait. De mme,
la faillite personnelle peut galement tre prononce contre tous les dirigeants de droit
ou de fait.
Le grant de fait risque de faire perdre la grance son caractre minoritaire : le
grant lgal risque ainsi de perdre son statut scal de salari car les parts du grant
de fait sont prises en compte.
5. Les responsabilits du grant
Zoom n 38
5.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
138
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Violation des statuts : dcision prise par le grant seul, alors que
les statuts prvoient la ncessit dune autorisation pralable des
associs
Fautes de gestion. Le grant, en tant que mandataire social, est
responsable des dommages causs la socit par ses fautes de
gestion, mme sil ny a pas de manuvres frauduleuses (enga-
gement de dpenses disproportionnes avec les ressources de la
socit ; manque de surveillance ayant facilit un dtournement
de fonds par un employ ; transfert des activits sociales sans en
rfrer aux associs et au mpris de leurs intrts ; le grant a t
ngligent dans le recouvrement dune crance qui est devenue
irrcuprable).
En cas de pluralit de grants, seul le grant qui a commis la faute peut
tre poursuivi ; cependant, si plusieurs grants ont coopr aux mmes
faits, le tribunal dtermine la part contributive de chacun dans la rpa-
ration du dommage.
5.1.2. La mise en uvre de la responsabilit du grant
Laction en responsabilit peut tre engage contre le grant :
par toute personne, associ ou tiers, qui a subi personnelle-
ment un prjudice du fait de la faute commise (un associ na
pas pu participer une assemble parce quil ny a pas t
convoqu ; un fournisseur a t ls la suite de manuvres frau-
duleuses du grant) ;
par les associs lorsque cest la socit qui a subi un prjudice
(notamment en cas de mauvaise gestion). En principe, laction en
responsabilit est engage par le nouveau grant si le grant cou-
pable a t rvoqu. dfaut, ce sont les associs qui intentent
laction. Les associs qui reprsentent au moins le dixime du
capital social peuvent demander un ou plusieurs dentre eux de
les reprsenter.
Laction en responsabilit peut tre engage devant le tribunal de
commerce ou devant les juridictions pnales si le grant a commis un
dlit dabus de biens sociaux.
Le statut du grant de la SARL
139
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Est rpute non crite toute clause des statuts qui a pour effet de subor-
donner lexercice de laction en responsabilit lavis pralable ou
lautorisation de lassemble, ou qui comporterait par avance renon-
ciation lexercice de cette action.
De plus, aucune dcision de lassemble ne peut avoir pour effet
dteindre une action en responsabilit contre le grant pour faute
commise dans laccomplissement de son mandat : le quitus habituelle-
ment accord au grant par les associs approuvant les comptes dun
exercice social est donc inoprant.
Laction en responsabilit se prescrit par trois ans ou par dix ans lorsque
le fait est quali de crime. Le dlai de prescription court compter du
fait dommageable ou, sil a t dissimul, de sa rvlation.
La responsabilit scale
Le grant, de droit ou de fait, peut tre dclar solidairement res-
ponsable des impts de la socit en cas de manuvres frauduleuses
ou lorsque son inobservation grave et rpte des obligations scales a
rendu impossible le recouvrement des impositions. Le dlai de pres-
cription est de trois ans et a pour point de dpart le non-paiement des
impts.
Grant majoritaire et responsabilit scale
La responsabilit scale des grants majoritaires est plus facile tablir par
lAdministration.
Le grant est-il condamn au paiement des impts dans les cas suivants ? Rponse
Les dettes fiscales sont postrieures la cessation effective des fonctions
du grant.
Non
Malgr les efforts du grant, le passif fiscal na pu tre acquitt la suite
de lchec du plan de sauvetage de lentreprise.
Non
Le grant majoritaire dune SARL a une comptabilit mal tenue et a dissimul
des recettes et des bnfices.
Oui
5.2.
Zoom n 39
Guide pratique de la SARL et de lEURL
140
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La responsabilit au titre des cotisations sociales
En cas de retard ou de dfaut de paiement des cotisations de Scurit
sociale :
le grant peut tre condamn uniquement aux pnalits et, le cas
chant, des dommages-intrts. Cependant, sil y a faute de
gestion, sa responsabilit civile peut tre engage ;
la SARL doit payer le montant des cotisations arrires et les
majorations de retard.
La responsabilit pnale
5.4.1. La responsabilit pnale prvue
par le Code de commerce
Les sanctions pnales prvues par le Code de commerce sont nom-
breuses : certaines sanctionnent des infractions commises volontaire-
ment ou de mauvaise foi ; dautres sont attaches la seule existence
de linfraction (la simple transgression, mme involontaire de la rgle
lgale est sufsante pour quil y ait infraction).
Les dlits suivants sont lourdement sanctionns car ils constituent les
infractions les plus dangereuses pour les associs et les tiers (empri-
sonnement de cinq ans et/ou amende de 375 000 ) :
prsentation de comptes annuels ne donnant pas une image dle ;
distribution de dividendes ctifs ;
Grant et abus de bien sociaux
Si le grant fait un usage abusif des biens de la SARL, il est coupable du dlit dabus
de biens sociaux mme si tous les associs sont daccord, mme sil sagit dune
SARL compose des membres dune mme famille, mme si au nal la socit na
pas subi de dommage.
Respectez bien le formalisme de la SARL car, dfaut, mme si vous tes de bonne
foi, vous tes passible dun dlit.
5.3.
5.4.
Zoom n 40
Le statut du grant de la SARL
141
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
abus de biens sociaux : le grant a, de mauvaise foi, fait un usage
des biens ou du crdit de la socit quil savait contraire lint-
rt de celle-ci, des ns personnelles ou pour favoriser une autre
socit ou entreprise dans laquelle il tait intress directement
ou indirectement (exemple : un grant fait effectuer des travaux
dans un immeuble lui appartenant avec les fonds de la socit).
Ds lors que le dlit dabus de biens sociaux est constitu, les
lments suivants nont aucune incidence :
lusage abusif a reu laccord de tous les associs ;
la socit na pas subi de dommage (exemple : un grant
emprunte de largent la socit pour nancer ses vacances et
le restitue ultrieurement) ;
la socit est exclusivement compose de membres dune
mme famille.
Dlits prvus par le Code de commerce
Lensemble des dlits sera expos systmatiquement
dans les autres parties du prsent guide.
la constitution de
la socit ou lors
dune augmentation
de capital
Fausse dclaration concernant la rpartition des parts sociales
entre tous les associs, la libration des parts ou le dpt des
fonds.
Survaluation des apports : attribution frauduleuse un apport en
nature dune valuation suprieure sa valeur relle.
Au cours de la vie
sociale
Au cas o les capitaux propres de la socit, du fait de pertes
constates dans les documents comptables, deviennent infrieurs
la moiti du capital social, dfaut davoir consult les associs
dans les quatre mois, afin de dcider sil y a lieu dissolution
anticipe, et dfaut de raliser les formalits de publicit
concernant la dcision adopte par les associs.
Faux bilan : prsentation aux associs de comptes annuels ne
donnant pas pour chaque exercice une image fidle du rsultat
de lexercice, de la situation financire et du patrimoine en vue
de dissimuler la vritable situation aux associs.
Rpartition entre les associs de dividendes fictifs, en labsence
dinventaire ou au moyen dinventaires frauduleux.
Abus de biens sociaux.
Pas de bilan : dfaut dtablissement, loccasion de chaque
exercice, de linventaire, des comptes annuels et du rapport
de gestion sur les oprations de la socit.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
142
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
5.4.2. La responsabilit pnale du grant
en tant que chef dentreprise
Le grant peut engager sa responsabilit dans le cadre de lexploitation
de lentreprise. Il est responsable des infractions suivantes, mme si ce
nest pas lui qui les a commises directement.
1. Infractions la rglementation spcique lactivit
de lentreprise
Un grant peut tre dclar solidairement responsable avec la socit
pour importation de marchandises sans dclaration.
2. Infractions la rglementation gnrale applicable
toutes les entreprises
Un grant peut tre condamn pour tout dfaut de surveillance, ngli-
gence, ou imprudence qui a caus, ou risque de causer des dommages
corporels : un salari de lentreprise est victime dun accident du travail
car les normes de scurit ne sont pas respectes ; un chef dentreprise
Bilan non communiqu aux associs : dfaut de mise la
disposition de tout associ des documents prcdents concernant
les trois derniers exercices.
Pas dAGO sur les comptes annuels : dfaut de runion
de lassemble des associs dans les six mois de la clture
de lexercice ou, en cas de prolongation, dans le dlai fix par
le prsident du tribunal de commerce.
Ne pas informer les tiers quils traitent avec une SARL :
omission de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents
manant de la socit et destins aux tiers, lindication de la
dnomination sociale, prcde ou suivie immdiatement des
mots Socit responsabilit limite ou des initiales SARL
et de lindication du capital social.
Entrave la fonction de commissaire aux comptes (dans le cas o
celui-ci est ncessaire) :
Dfaut de dsignation ou non-convocation dun commissaire aux
comptes toute assemble dassocis.
Faire sciemment obstacle aux vrifications ou au contrle des
commissaires aux comptes, et refuser de leur communiquer toutes
les pices utiles lexercice de leur mission.
/
Le statut du grant de la SARL
143
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
narrte pas immdiatement la vente dun des produits fabriqu alors
quil peut tre dangereux.
Le grant qui est reconnu responsable peut tre condamn des peines
demprisonnement et damendes (un cinq ans demprisonnement et/
ou 375 000 damende) ainsi qu des dommages-intrts. La res-
ponsabilit civile et pnale de la socit pourra galement tre mise en
uvre (voir page 106).
Cependant, le grant ne sera pas responsable sil nest pas en mesure
dagir sur lauteur de linfraction, ou si, par exemple, lauteur de
linfraction a la comptence et lautorit ncessaires pour assurer ef-
cacement ses fonctions.
La responsabilit du grant en cas de difcults
nancires de la SARL
Quand une entreprise est en tat de cessation de paiements (elle ne
peut plus faire face ses paiements), elle est dclare par le prsident
du tribunal de commerce en redressement judiciaire, qui peut aboutir
la liquidation de lentreprise, ou en liquidation judiciaire immdiate
(voir La prvention et le traitement des difcults nancires de la
SARL page 255).
La responsabilit du grant peut tre engage dans le cadre de ces pro-
cdures judiciaires. Indpendamment des sanctions applicables au
grant, tudies dans la prsente partie, le tribunal peut ordonner dans
le cadre de ces procdures :
le remplacement du grant lorsque la survie de lentreprise le
requiert ;
des restrictions la libre cessibilit des parts sociales et actions
dtenues par le grant (la cession ne peut alors intervenir que
dans les conditions xes par le tribunal) ;
la privation du droit de vote attach la part sociale (ce droit est
alors exerc par un mandataire de justice) ;
la cession force des parts sociales moyennant un prix x par
expert.
5.5.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
144
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
5.5.1. Condamnation du grant supporter tout
ou partie des dettes de la socit
Le grant de la socit peut tre condamn par le tribunal supporter
sur son patrimoine personnel tout ou partie des dettes de la socit ds
lors que lactif est insufsant pour rembourser ces dettes (cest
laction en comblement du passif ).
Le grant, de droit ou de fait, doit avoir :
commis une faute de gestion : la faute de gestion doit tre
dmontre par le tribunal dans lancienne lgislation la faute
tait prsume ;
qui a contribu linsuffisance dactif : la faute doit simple-
ment contribuer linsufsance dactif, mme si elle nest pas la
cause unique ou principale.
Les hritiers peuvent tre condamns
payer les dettes de la SARL
Laction en comblement de passif peut tre intente contre :
les hritiers du grant en cas de dcs du grant ;
les grants ayant cess leurs fonctions sil existe un lien entre leur gestion et
linsufsance dactif.
Les dettes de la SARL rembourses par le grant
sont dductibles de son revenu global
Les sommes verses par le grant quand il est condamn supporter les dettes de
la SARL sont dductibles de limpt sur le revenu, sauf sil est condamn pour abus
de biens sociaux.
Zoom n 41
Zoom n 42
Le statut du grant de la SARL
145
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Laction en comblement de passif se prescrit par trois ans compter du
jugement qui arrte le plan de redressement ou, dfaut, qui prononce
la liquidation judiciaire. Le tribunal peut se saisir dofce, ou tre saisi
par ladministrateur, le reprsentant des cranciers, le commissaire
lexcution du plan, le liquidateur ou le procureur de la Rpublique.
Les sommes verses par le grant sont affectes, en cas de continuation
de lentreprise, selon les modalits prvues par le plan dapurement du
passif. Elles sont rparties, en cas de liquidation ou de cession, entre
tous les cranciers en proportion de leurs crances.
5.5.2. Mise en redressement judiciaire du grant
Le grant peut tre mis personnellement en redressement judiciaire sil
ne sacquitte pas du passif mis sa charge dans le cadre de laction en
comblement de passif, ou sil a commis certains faits (voir encadr).
Dans ce cas, le passif comprend le passif personnel, et celui de la
socit. La date de la cessation des paiements est celle xe par le
jugement douverture de la procdure judiciaire de la socit.
Exemples de fautes de gestion
Le grant nance des travaux indus et poursuit une exploitation dcitaire.
Le grant tarde dclarer la cessation des paiements, privant lentreprise du bnce
dun plan de redressement qui aurait pu la sauver.
Le plan du repreneur dune socit est vici par des erreurs dapprciation.
Le grant peut tre mis personnellement en redressement
judiciaire sil a commis les faits suivants
1. Avoir dispos des biens de la socit comme des siens propres.
2. Sous le couvert de la socit masquant ses agissements, avoir fait des actes de
commerce dans un intrt personnel.
3. Avoir fait des biens ou du crdit de la socit un usage contraire lintrt de
celle-ci des ns personnelles ou pour favoriser une autre socit ou entre-
prise dans laquelle il tait intress directement ou indirectement.
4. Avoir poursuivi abusivement, dans un intrt personnel, une exploitation d-
citaire qui ne pouvait conduire qu la cessation des paiements de la socit.
Zoom n 43
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
146
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
5.5.3. Condamnation du grant la faillite personnelle
Le tribunal peut prononcer, pour une dure qui ne peut tre infrieure
cinq ans, la faillite personnelle du grant de droit ou de fait, toute
poque de la procdure, sil a commis certains faits (voir encadr).
La faillite personnelle a des consquences graves puisquelle entrane :
linterdiction de diriger, grer, administrer ou contrler toute entre-
prise commerciale ou artisanale quelle que soit sa forme (entreprise
individuelle ou socit), ainsi que toute personne morale ayant une
activit conomique ;
la privation des droits politiques ; lexclusion des fonctions
publiques, administratives ou judiciaires ; lincapacit dexercer
une fonction publique lective
la privation du droit de vote dans les assembles de la socit.
Cependant, pour tous les faits prsents dans lencadr, le tribunal de
commerce peut prononcer, la place de la faillite personnelle, linter-
diction de diriger, grer, administrer ou contrler, directement ou indi-
rectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale et toute
personne morale, soit une ou plusieurs dentre elles (NB : linterdiction
de diriger entrane lincapacit dexercer une fonction publique lec-
tive). Linterdiction de diriger peut frapper galement le grant qui, de
mauvaise foi, naura pas remis au reprsentant des cranciers la liste
complte et certie de ses cranciers et le montant de ses dettes dans
les 8 jours suivant le jugement douverture.
Le grant peut toujours demander au tribunal de le relever, en tout ou
partie, des dchances et des interdictions sil a apport une contribu-
tion sufsante au paiement du passif.
5. Avoir tenu une comptabilit ctive ou fait disparatre des documents compta-
bles de la socit ou stre abstenu de tenir toute comptabilit conforme aux
rgles lgales.
6. Avoir dtourn ou dissimul tout ou partie de lactif ou frauduleusement aug-
ment le passif de la socit.
7. Avoir tenu une comptabilit manifestement incomplte ou irrgulire au regard
des dispositions lgales.
/
Le statut du grant de la SARL
147
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
5.5.4. Condamnation du grant pour banqueroute
Dans le cadre dune procdure de redressement judiciaire, le grant de
fait ou de droit, ainsi que ses complices, peut tre poursuivi pour ban-
queroute si certains faits (voir encadr) peuvent lui tre reprochs.
La banqueroute est une infraction correctionnelle punie de cinq ans
demprisonnement et de 75 000 damende. Le tribunal correctionnel
peut aussi prononcer la faillite personnelle, ou linterdiction de grer.
Le banqueroutier encourt galement un certain nombre de peines
complmentaires : exclusion des marchs publics, interdiction de ch-
quier
Le grant peut tre condamn la faillite personnelle
sil a commis les faits suivants
1. Les faits qui peuvent entraner la mise en redressement judiciaire du grant
(voir encadr page 145).
2. Avoir exerc une fonction de direction ou dadministration dune socit
contrairement une interdiction prvue par la loi.
3. Dans lintention dviter ou de retarder louverture de la procdure de redres-
sement judiciaire, avoir fait des achats en vue dune revente au-dessous du
cours ou employ des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
4. Avoir souscrit, pour le compte dautrui, sans contrepartie, des engagements
jugs trop importants au moment de leur conclusion, eu gard la situation de
la socit.
5. Avoir pay ou fait payer, aprs cessation de paiements et en connaissance de
cause de celle-ci, un crancier au prjudice des autres cranciers.
6. Avoir omis de faire, dans le dlai de quinze jours, la dclaration de ltat de ces-
sation de paiements.
7. Le grant ne sest pas acquitt du passif mis sa charge dans le cadre de
laction en comblement de passif.
Le grant peut tre condamn pour banqueroute
sil a commis les faits suivants
1. Avoir, dans lintention dviter ou de retarder louverture de la procdure de
redressement judiciaire, soit fait des achats en vue dune revente au-dessous
du cours, soit employ des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
148
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Comment le grant est-il rmunr ?
La rmunration du grant est dtermine par les statuts, ou par lacte
qui nomme le grant, ou par une dcision ordinaire des associs (dci-
sion adopte par un ou plusieurs associs reprsentant plus de la moiti
des parts sociales). Le grant ne peut pas, de son propre chef, augmen-
ter la rmunration ainsi xe par les associs. Le dpassement de la
rmunration, ainsi quune rmunration excessive compte tenu de
lactivit de lentreprise ou de la comptence du grant, constitue un
dlit dabus de biens sociaux.
2. Avoir dtourn ou dissimul tout ou partie de lactif du dbiteur.
3. Avoir frauduleusement augment le passif du dbiteur.
4. Avoir tenu une comptabilit ctive ou fait disparatre des documents compta-
bles ou stre abstenu de tenir toute comptabilit.
5. Avoir tenu une comptabilit manifestement incomplte ou irrgulire au regard
des dispositions lgales.
Comment xer la rmunration du grant
Ne xez pas le montant de la rmunration dans les statuts car sa modication
ncessite une modication des statuts (formalits de publicit majorit des trois
quarts). Posez le principe de la rmunration dans les statuts ; son montant sera
dtermin par une dcision de lassemble gnrale ordinaire.
Pour viter toute difcult, prvoyez dans les statuts que le grant ne doit pas pren-
dre part au vote de sa rmunration.
Pour viter toute contestation, indiquez avec prcision les modalits de calcul de la
rmunration.
Nattribuez pas au grant en n dexercice une gratication xe arbitrairement en
vue dponger au maximum les bnces, car vous risquez un redressement scal.
Attention ! Une rmunration excessive constitue un dlit dabus de biens sociaux.
6. Imposition des rmunrations du grant
6.1.
Zoom n 44
/
Le statut du grant de la SARL
149
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le grant associ ne doit pas, en principe, prendre part au vote de sa
rmunration car il sagit dune convention rglemente , cest--
dire une convention conclue entre la socit et un grant ou associ qui
ne porte pas sur une opration courante (se reporter au contrle des
conventions rglementes page 195).
Le grant dune SARL peut demander au tribunal de xer sa rmun-
ration en cas de blocage (abstention ou refus de certains associs) si
cela est de nature compromettre la bonne marche de la socit.
La rmunration du grant peut tre xe ou proportionnelle au chiffre
daffaires ou aux bnces, ou comporter la fois un xe et une parti-
cipation aux bnces. Le grant a droit des avantages en nature
(voiture, logement de fonction) et au remboursement de certains
frais.
Comment sont imposes les rmunrations du grant ?
Limposition des rmunrations du grant dpend de son statut (le
nombre de parts sociales quil dtient) et du rgime dimposition de la
SARL.
Rmunration du grant xe ou proportionnelle ?
vitez une rmunration xe car sa rvision dpend entirement des associs si le
grant ne dtient pas directement ou indirectement la majorit requise.
Privilgiez une rmunration proportionnelle, pour partie, car elle permet dintres-
ser le grant au dveloppement de lentreprise (NB : si le bnce est comprim
articiellement, la participation aux bnces perd son caractre incitatif).
Une rmunration proportionnelle uniquement au chiffre daffaires peut inciter le
grant chercher avant tout laccroissement du chiffre daffaires sans se soucier de
la rentabilit.
Zoom n 45
6.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
150
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
6.2.1. Imposition des rmunrations dans les SARL
soumises limpt sur les socits
1. Grant minoritaire ou galitaire Grant non associ
Le grant minoritaire et le grant non associ bncient du rgime
scal des salaris : la rmunration est soumise limpt sur le revenu
dans la catgorie des traitements et salaires aprs une dduction de
10 % pour frais professionnels.
Imposition
des rmunrations
du grant
Le grant
nest pas associ
est minoritaire
ou galitaire
est majoritaire
La SARL est
soumise
limpt
sur les
socits
Le grant est
un salari qui
bnficie de
labattement de
10 % pour frais
professionnels.
Le grant est
assimil un
salari, et bnficie
de labattement
de 10 % pour frais
professionnels.
Le grant nest
pas assimil un
salari. Cependant,
la rmunration
du grant bnficie
de labattement de
10 % pour frais
professionnels.
limpt
sur le
revenu
1
Le grant est assimil un entrepreneur
individuel : sa quote-part de bnfice est
soumise limpt sur le revenu dans la
catgorie des bnfices industriels et
commerciaux (BIC)
2
. Ladhsion de la SARL
un centre de gestion agr
3
permet au
grant dviter une majoration de 25 % de
son BIC.
1. SARL de famille qui a opt pour lIR ou EURL qui na pas opt pour lIS (voir
page 218).
2. BNC pour une activit librale ; BA pour une activit agricole.
3. Association de gestion agre pour un BNC.
Le statut du grant de la SARL
151
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2. Grant majoritaire
Le grant na pas la qualit de salari. La rmunration du grant
majoritaire et les remboursements forfaitaires de ses frais sont soumis
limpt sur le revenu dans la catgorie article 62 du CGI aprs
dduction des frais rels supports par le grant dans lexercice de ses
fonctions. De plus, il peut opter pour la dduction forfaitaire de 10 %
pour frais professionnels, comme un salari.
Dtermination du salaire imposable du grant minoritaire ou galitaire
Le salaire net est minor dune dduction forfaitaire pour frais professionnels de
10 % encadre par un minimum et un maximum (voir Fiche de calculs facultatifs
sur le site www.impots.gouv.fr). Le grant peut demander la dduction des frais quil
a rellement supports pour les besoins de sa profession ; il doit dans ce cas ajouter
son salaire les indemnits forfaitaires pour frais quil a perues.
Le grant non associ peut tre impos comme un grant majoritaire
Si son conjoint ou ses enfants mineurs dtiennent plus de 50 % des parts.
Dtermination de la rmunration imposable du grant majoritaire
Rmunration imposable
Rmunration (xe et/ou proportionnelle) + remboursements forfaitaires de frais
+ avantages en nature valus leur valeur relle (lutilisation des ns person-
nelles dune voiture appartenant la socit est considre comme un avantage
en nature imposable).
Frais dductibles
Les frais doivent tre justis, pays par le grant et ncessaires lexploitation
sociale et la fonction exerce.
Sont dductibles :
les frais de mission, de dplacement, les dpenses de rception de clients ou
de fournisseurs, les charges sociales personnelles verses titre obligatoire ;
les frais pays par le grant quand il se porte caution dans lintrt de la SARL ;
Zoom n 46
Zoom n 47
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
152
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. BNC pour une activit librale ; BA pour une activit agricole.
6.2.2. Imposition des rmunrations dans les SARL
soumises limpt sur le revenu
Le grant non associ est assimil un salari.
Le grant associ est assimil un entrepreneur individuel. La tota-
lit de sa quote-part de bnce dans la SARL est soumise limpt
sur le revenu dans la catgorie des BIC
1
(Bnces industriels et
commerciaux) mme si elle nest pas prleve par le grant (sous
forme de rmunration ou de dividendes).
Le grant peut adhrer un centre de gestion agr an dviter une
majoration de 25 % applique au montant de sa quote-part imposable
(voir page 292).
les intrts des emprunts contracts pour souscrire au capital de socits nou-
velles, ou pour participer des oprations de rachat dentreprises avec dautres
salaris (dans certaines conditions et limites) ;
les cotisations aux rgimes facultatifs de Scurit sociale et les primes affren-
tes des contrats dassurance groupe dans certaines limites (loi Madelin
voir Limite de dduction des assurances volontaires page 126).
Ne sont pas dductibles :
les dpenses rembourses par la socit, ainsi que les dpenses prives.
Quand un grant est-il salari pour ladministration scale ?
Le grant est assimil scalement un salari sil est minoritaire ou galitaire. Il doit
donc possder, seul ou avec les autres grants, au maximum la moiti des parts.
Cette question a t dveloppe pour lapprciation de la grance minoritaire sur le
plan social (voir page 122). Ladministration scale admet les mmes rgles avec les
exceptions suivantes :
les parts en indivision doivent tre prises en compte si le grant peut exercer les
droits attachs ces parts indivises ;
les parts possdes par un grant de fait sont prises en considration.
Zoom n 48
/
153
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
3
LE FINANCEMENT DE LA SARL
En phase de dmarrage, le nancement de la SARL est assur essen-
tiellement par les apports des associs qui constituent le capital social.
Pour assurer le nancement de son dveloppement, la SARL peut :
pratiquer une politique dautonancement (le bnce nest pas dis-
tribu aux associs sous forme de dividendes, mais mis en rserve) ;
augmenter son capital par de nouveaux apports ;
emprunter auprs des tiers (la SARL ne peut cependant pas faire
publiquement appel lpargne), ou auprs des associs qui lui
consentent une avance ;
mettre des obligations non cotes.
Enn, le capital social constitue le gage des cranciers puisque la respon-
sabilit des associs, dans la SARL, est limite au montant du capital
quils apportent. Aussi, an de protger leurs intrts, le lgislateur a
dict des rgles prcises lorsque des pertes entament fortement le capital.
Les apports des associs peuvent tre :
des apports en numraire (sommes dargent) ;
1. Les apports des associs
LE FINANCEMENT DE LA SARL
Guide pratique de la SARL et de lEURL
154
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
des apports en nature (fonds de commerce, immeuble) trans-
mis en proprit ou en jouissance ;
des apports en industrie (lapporteur met la disposition de la
socit ses connaissances techniques ou professionnelles, son
exprience, ses relations) qui ne contribuent pas la formation du
capital, et qui sont rmunrs par des parts en industrie (et non
des parts sociales).
Les apports en numraire
Le capital doit tre intgralement souscrit. Les parts sociales de num-
raire doivent tre libres du cinquime au moins de leur nominal, le
solde devant tre appel dans un dlai de cinq ans maximum compter
de limmatriculation de la socit au registre du commerce.
SARL et capital minimum vers par les associs
Une SARL a un capital de 7 500 . Les apports pour former ce capital sont :
hypothse 1 : constitus uniquement par des apports en numraire ;
hypothse 2 : constitus par des apports en numraire hauteur de 3 000 et par
lapport dun brevet valu 4 500 .
Dterminer le capital minimum libr par les associs au moment de la consti-
tution.
1.1.
Cas n 20
En euros Apport
Libration
immdiate
Libration
dans un dlai
maximum de 5 ans
hypothse 1
Apports en numraire 7 500 1 500 6 000
7 500 1 500 6 000
hypothse 2
Apports en numraire
Apports en nature
3 000
4 500
600
4 500
2 400
7 500 5 100 2 400
Le financement de la SARL
155
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Les versements sont effectus en espces. Les versements par chque ou vire-
ment ne seront raliss quaprs lencaissement dnitif. Le paiement par remise
de bons du Trsor ou de bons de caisse payables vue ou chus est possible.
Lassoci qui ne ralise pas son apport en numraire est redevable, de plein droit,
des intrts de retard (intrts lgaux ou intrts prvus par les statuts). Les sta-
tuts doivent mentionner le dpt des fonds ainsi que la libration des parts.
2. Le dpositaire peut tre une banque, une entreprise dinvestissement habilite
pour exercer lactivit de conservation et dadministration dinstruments nan-
ciers, un notaire, la Caisse des dpts et consignations.
3. Non prvu par la loi.
4. Lorsque le numro dimmatriculation nest pas attribu dans un dlai de 5 jours
compter de la demande dimmatriculation, le grefer doit remettre la socit
un rcpiss qui permet le dblocage des fonds.
5. Le dpositaire peut tre une banque, une entreprise dinvestissement habilite
pour exercer lactivit de conservation et dadministration dinstruments nan-
ciers, un notaire, la Caisse des dpts et consignations.
1.1.1. La marche suivre pour les apports en numraire
La marche suivre pour les apports en numraire
Lors de la constitution de la SARL
Les fonds verss lors de la constitution sont indisponibles jusqu limmatriculation
de la socit au registre du commerce.
Dpt
des fonds
Les associs versent
1
les sommes :
aux fondateurs qui doivent, dans les huit jours de leur rception,
dposer les fonds dans une banque
2
pour le compte de la socit en
formation ;
ou directement la banque.
Certificat
du dpositaire
Les versements sont dans la pratique constats par un certificat du
dpositaire
3
tabli, au moment du dpt des fonds, sur prsentation de
la liste des associs mentionnant les sommes verses par chacun deux.
Retrait
des fonds
Un extrait de K bis de la socit
4
, qui atteste que la socit a bien t
immatricule, doit tre prsent au dpositaire des fonds
5
.
Lors des appels ultrieurs de fonds
Le capital non libr lors de la constitution doit tre appel
dans un dlai maximum de cinq ans
Appel
des fonds
Les fonds sont appels par le grant qui est responsable pnalement et
civilement. La socit na aucune justification fournir pour procder
aux appels de fonds.
Libration
des fonds
Lassoci doit librer les parts souscrites ds lors que lappel de fonds
est rgulirement effectu.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
156
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les apports en nature
Les apports en nature peuvent consister en lapport dun terrain, dun
fonds de commerce, de marques, de brevets dinvention, de dessins et
modles, dun droit au bail, de crances, de matriel, de marchandises
Dfaut
de versement
des sommes
appeles
La socit peut :
poursuivre en justice le paiement des sommes qui lui sont dues ;
ou utiliser la procdure spciale de lexcution qui permet aprs
une mise en demeure sans effet pendant un mois de poursuivre, sans
aucune autorisation de justice, la vente des parts sociales.
Libration
par anticipation
Un associ peut se librer avant lappel de fonds lorsque les statuts
autorisent les librations par anticipation. Les versements alors effectus
ont le caractre dapports en capital et non de simples sommes verses
en dpt.
Restitution des fonds et saisie-arrt
Si la socit nest pas constitue dans le dlai de six mois compter du premier dpt
de fonds, les apporteurs peuvent demander au prsident du tribunal de commerce du
lieu du sige social lautorisation de retirer le montant de leurs apports. Les fonds
dposs tant indisponibles, ils ne peuvent faire lobjet dune saisie-arrt de la part
dun crancier personnel de lapporteur.
valuez correctement les apports en nature
Lapport ne doit pas tre survalu car cela dsavantage les autres associs, et les
cranciers pour lesquels le capital social constitue le gage. Les associs risquent
alors dengager leur responsabilit civile et pnale.
Lapport ne doit pas non plus tre sous-estim, car cela dsavantage lapporteur et
ladministration de lenregistrement qui peut demander un rehaussement pour per-
cevoir des droits plus levs.
Si les apports sont de faible importance, le commissaire aux apports nest pas obli-
gatoire. Cependant, il est conseill pour viter tout risque de survaluation.
Zoom n 49
1.2.
Zoom n 50
/
Le financement de la SARL
157
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Lapport dimmeubles, de fonds de commerce, de brevets dinvention
ou de marques est soumis des formalits de publicit spcique.
1.2.1. Comment sont valus les apports en nature ?
Chaque apport en nature doit faire lobjet dune valuation dans les
statuts. Cest sur la base de cette valuation que des parts sociales sont
attribues en rmunration de lapport.
Lvaluation des apports est faite au vu dun rapport tabli par un com-
missaire aux apports :
Il est dsign, avant la signature des statuts, par les futurs asso-
cis lunanimit, ou, en cas de dsaccord, par une ordonnance
du prsident du tribunal de commerce qui statuera la demande
de lassoci le plus diligent.
Sa nomination est faite par un crit (un acte sous seing priv suf-
t) sign par tous les associs.
Il doit tre choisi parmi les commissaires aux comptes ou parmi
les experts judiciaires.
Son rapport doit tre annex aux statuts.
Les associs peuvent lunanimit carter la nomination dun commis-
saire aux apports si :
la valeur de chaque apport en nature est infrieure ou gale
7 500 ;
et si la valeur totale de lensemble des apports nexcde pas la
moiti du capital.
1.2.2. Quelle est la responsabilit des associs
vis--vis de lvaluation ?
Les associs demeurent libres de donner aux apports une valeur diff-
rente de celle xe par le commissaire aux apports, mais ils risquent :
dengager leur responsabilit en cas de survaluation :
ils sont solidairement responsables pendant cinq ans lgard
des tiers de la valeur attribue aux apports ;
ils risquent un emprisonnement de cinq ans et/ou une amende
de 375 000 ;
Guide pratique de la SARL et de lEURL
158
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
un redressement en matire de droits denregistrement en cas de
sous-valuation (lAdministration se fonde alors sur la valeur
attribue par le commissaire aux apports).
Apport dun fonds de commerce
Lapport dun fonds de commerce doit tre valu partir du bilan de lentreprise ta-
bli la date de la constitution de la socit. Si ce nest pas possible, lapport peut tre
valu la date de clture du dernier bilan et prendre effet rtroactivement cette
date. La SARL prend alors sa charge toutes les oprations effectues par lentre-
prise depuis cette date jusqu la signature des statuts.
Apport dun droit au bail
Lapport dun droit au bail est assimil une cession de bail. Il doit tre signi au
propritaire qui doit donner son autorisation expresse (lautorisation peut tre sim-
plement tacite dans le cas de lapport dun droit au bail avec un fonds de commerce).
Aucune clause ne peut interdire au locataire dapporter son droit au bail la SARL qui
acquiert son fonds de commerce.
Veillez bien respecter les clauses du bail relatives la forme de la cession. dfaut,
le bail peut tre rsili ou ne pas tre renouvel sans indemnit (exemple : le bail peut
stipuler lintervention du bailleur lacte de cession).
Quand le droit au bail est apport en mme temps que le fonds de commerce, la
SARL obtiendra automatiquement le renouvellement. Cependant, si le droit au bail
est apport isolment, la dure du bail restant courir doit tre au moins de trois ans
pour que la socit obtienne le renouvellement.
Apport de biens communs
Si lapport de biens communs porte sur un fonds de commerce ou un immeuble, les
deux poux doivent ensemble faire lapport (ainsi que pour des droits sociaux non
ngociables ou des meubles corporels dont lalination est soumise publicit). Si
lapport de biens communs est un apport en numraire, il faut en informer pralable-
ment le conjoint de lapporteur (si lapporteur peut prouver que les espces provien-
nent de ses biens propres, la notication pralable son conjoint nest pas ncessaire).
Zoom n 51
Zoom n 52
Zoom n 53
Le financement de la SARL
159
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les apports en industrie
Un apport en industrie est la mise disposition de la socit de son
savoir-faire, de ses relations, de son travail Comme cet apport ne
constitue pas un gage pour les cranciers (il ne peut pas tre vendu !),
il ne peut pas concourir la formation du capital social et ne peut donc
pas tre rmunr par des parts sociales.
Cependant, dans une SARL constitue pour exploiter un fonds de
commerce ou une entreprise artisanale, le commerant ou lartisan qui
ont ralis lapport, ou leur conjoint, peuvent galement apporter la
SARL leur industrie qui sera alors rmunre par des parts en industrie :
les parts en industrie sont des parts sociales spciques dont les
modalits dattribution sont dtermines par les statuts ;
lapport en industrie ne concoure pas la formation du capital ;
la contribution aux pertes de lapporteur en industrie est dtermi-
ne par les statuts : elle ne peut pas tre suprieure celle de
lassoci qui a le moins apport ;
les statuts dterminent la part de lapporteur en industrie dans les
bnces et la partage de lactif net.
Le rgime scal des apports
Le rgime scal des apports a t dvelopp page 39 Le cot de la
constitution .
Les emprunts auprs des tiers
La SARL ne peut pas faire publiquement appel lpargne. Elle ne peut
donc pas mettre des valeurs mobilires sur un march boursier, comme
le second march, mme si cette mission transite par une banque.
1.3.
1.4.
2. Les emprunts auprs des tiers ou des associs
2.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
160
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. La fraction non dductible des intrts est rintgre de manire extra-comptable
dans le bnce imposable de la SARL.
2. Les produits des clauses dindexation sont assimils des intrts pour lappli-
cation des limitations.
3. Le TMPV est le taux maximal dintrts dductibles gal la moyenne annuelle
des Taux effectifs Moyens pratiqus par les tablissements de crdit pour des
Prts taux Variable aux entreprises, dune dure initiale suprieure 2 ans.
La SARL peut emprunter auprs de banques ou de particuliers :
La SARL doit dclarer les contrats de prts ainsi que les intrts
la direction des services scaux du sige social. La dclaration
doit tre adresse au plus tard le 15 fvrier de lanne suivant
celle du paiement des intrts ou de la conclusion du contrat.
Les intrts sont dductibles si lemprunt a t contract pour les
besoins de lentreprise.
Les apports en comptes courants des associs
Les associs peuvent prter de largent la SARL sous forme dune
avance en compte courant. Dans ce cas, il faut dclarer ces avances et
les intrts aux services scaux et bien respecter le formalisme des
conventions rglementes (voir page 195). En revanche, les associs
ou le grant ne peuvent pas emprunter de largent la SARL car les
comptes courants dbiteurs sont interdits. Cependant, les comptes cou-
rants dbiteurs sont autoriss lorsque les avances sont consenties par
une socit mre sa liale, dans le cadre dune centrale de trsorerie.
Imposition des intrts des comptes courants dassocis
Type davance
Dduction des intrts
du rsultat de la SARL
Imposition des intrts
chez lassoci
Comptes
courants
La dduction
1
des intrts
2
est
soumise deux limitations :
1. le capital doit tre entirement
libr ;
2. le taux maximal des intrts
dductibles est plafonn au
TMPV
3
.
Si lassoci est une personne
physique :
Les intrts dductibles du
rsultat de la SARL sont soumis
limpt sur le revenu au taux
progressif, dans la catgorie
des revenus de capitaux
mobiliers ;
2.2.
/
Le financement de la SARL
161
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Pour les associs dirigeants, loption nest pas admise si le total des avances
excde 46 000 . Par ailleurs, le compte courant ne doit pas contenir de clause
dindexation. Le prlvement libratoire est de 18 % auquel sajoute les prl-
vements sociaux de 12,1 %, soit une imposition globale de 30,1 %.
Type davance
Dduction des intrts
du rsultat de la SARL
Imposition des intrts
chez lassoci
ou, sur option du bnciaire,
au prlvement libratoire
au taux de 30,1 %
1
.
Les intrts non dductibles
sont soumis limpt sur le
revenu sans possibilit dopter
pour le prlvement libratoire.
Si lassoci est une entreprise,
les intrts sont compris dans le
bnce imposable lIR ou lIS.
Avances des
socits mres
leurs liales
Chez la filiale, la dduction
des intrts nest pas soumise
la deuxime limitation sil sagit
dune centrale de trsorerie.
Chez la socit mre, les intrts
dductibles sont compris dans
le bnfice imposable lIS.
Les intrts non dductibles
constituent une distribution
irrgulire qui bnficie du rgime
dexonration des socits mres
(voir page 246).
Compte courant dassoci
Dans une SARL au capital de 30 000 , des associs ont laiss durant tout lexercice
N des sommes en compte courant rmunres au taux de 6 %.
Hypothse 1 : les associs sont des personnes physiques.
Hypothse 2 : lassoci possdant 10 % des droits sociaux est galement four-
nisseur de la SARL. II a accord un crdit moyen de 40 000 durant tout lexer-
cice N rmunr au taux de 6 %.
Cas n 21
Le grant de la SARL
Un associ possdant plus de 50 % des droits de vote
Un associ possdant 10 % des droits sociaux
5 000
50 000
15 000
70 000
Le TMPV est de 5,00 %
Guide pratique de la SARL et de lEURL
162
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Hypothse 2. Les limitations aux intrts de compte courant ne
sappliquent pas aux intrts de dettes commerciales, pays aux asso-
cis agissant en tant que client ou fournisseur. Le montant des intrts
rintgrer slve galement 700 .
Hypothse 1
Limitation portant sur le taux dintrt
Intrts comptabiliss 70 000 6 %
Intrts dductibles 70 000 5 %
4 200
3 500
Intrts rintgrer 700
Comptes courants dbiteurs :
une pratique hauts risques
Les associs ou le grant ne peuvent pas emprunter de largent la SARL car les
comptes courants dbiteurs sont interdits. De plus, ils ne peuvent pas non plus se
faire cautionner par la SARL leurs emprunts ou engagements envers les tiers.
dfaut, ils sont passibles du dlit dabus de biens sociaux. De plus, ladministration
scale considre que les charges nancires de la SARL sont supportes dans lint-
rt de lassoci, et non dans celui de la SARL. Les charges nancires correspondant
au nancement du compte courant ne sont pas dductibles du rsultat imposable de
la SARL.
Les associs ou le grant peuvent
prter de largent la SARL
Veillez dclarer ces avances et les intrts aux services scaux.
Veillez bien respecter le formalisme des conventions rglementes (conventions
intervenues entre la socit et lun de ses grants ou associs voir page 195).
Pour viter tout problme (abus de biens sociaux), sachez quun intrt sur les
avances consenties ne peut tre accord que si les avances sont vraiment nces-
saires pour la socit et pas seulement justies par lavantage personnel des pr-
teurs.
Prvoyez dans les statuts les modalits de remboursement des comptes courants
(prvoir notamment un pravis).
Zoom n 54
Zoom n 55
Le financement de la SARL
163
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les associs de la SARL peuvent tre appels garantir les engage-
ments de la socit lgard des tiers. Le cautionnement est la garantie
la plus pratique. La lettre dintention qui est rserve aux associs
personnes morales se substitue souvent au cautionnement. Lassoci
peut aussi tre condamn excuter les engagements de la SARL.
Le cautionnement
Lassoci qui se porte caution sengage envers le crancier excuter
lobligation la charge de la socit si elle ne le fait pas elle-mme. La
caution doit alors verser une somme dargent ou excuter en nature
lobligation garantie (excution dun march).
Lassoci qui se porte caution ne peut pas devoir plus que la socit
elle-mme. Il peut se prvaloir comme la socit des exceptions tires
du contrat de base (la caution na pas excuter lobligation garantie si
le crancier na pas excut ses obligations contractuelles). Lextinc-
tion de la dette principale dcharge la caution de ses obligations.
Rsiliez de manire expesse la caution dure illimite quand vous quittez
la SARL pour ne pas tre engag par des dettes postrieures votre dpart
Lassoci qui vend ses parts sociales, ou le grant qui cesse ses fonctions, doivent
rsilier expressment leur engagement. dfaut, la banque pourrait valablement leur
rclamer le remboursement de crdits accords la socit aprs quils ont cess
den faire partie. Le grant et lassoci resteront tenus du passif ventuel existant au
jour de leur rsiliation mais non des dettes contractes postrieurement.
Veillez limiter le cautionnement car il est lourd de consquences
La caution peut tre donne hauteur dun certain montant, ou pour une dure dter-
mine.
3. La garantie par les associs
des engagements nanciers de la SARL
3.1.
Zoom n 56
Zoom n 57
Guide pratique de la SARL et de lEURL
164
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La lettre dintention
La lettre dintention est adresse par une socit mre un crancier
de sa liale pour lassurer du respect des engagements contracts par
sa liale.
Quelles que soient les circonstances, la caution dure
limite ne pourra pas tre rsilie
La dure limite de la caution peut ne pas tre expressment indique mais rsulter
des termes du contrat. Ainsi, un cautionnement garantissant une ouverture de crdit
en compte courant jusqu son complet remboursement est un engagement dure
dtermine qui ne peut pas tre rsili par le grant.
Ce quil faut savoir sur le cautionnement
Quelles sont
les dettes que
garantissent les
hritiers quand
la caution dcde ?
Les hritiers ne sont pas engags par les dettes cres
postrieurement au dcs de la caution : toute clause contraire
peut tre annule.
Les hritiers doivent garantir les dettes existantes la date du
dcs de la caution mme si elles ne sont pas exigibles : des billets
ordre garantis par un cautionnement, et qui viennent chance
aprs le dcs de la caution doivent tre pays par les hritiers de
la caution faute de paiement du billet lchance.
Quelle est
lincidence de
la transformation
de la SARL sur
la caution ?
Toute opration de transformation, de fusion ou de scission na
aucune incidence sur lengagement de caution du dirigeant de la
socit transforme ou absorbe.
Les sommes
verses par
la caution sont-elles
dductibles de son
revenu imposable ?
Le grant dune SARL peut dduire de son revenu imposable les
sommes verses dans le cadre dun engagement de caution ou de
garantie quil a souscrit au profit de la socit si lengagement :
1. a t souscrit dans le cadre dune gestion normale de
lentreprise ;
2. est li laccomplissement normal de la fonction de grant et
non celle dassoci (la dduction est refuse pour un associ ;
elle est autorise pour un grant mme majoritaire) ;
3. est proportionnel la rmunration du grant (en pratique, il ne
doit pas dpasser le triple de la rmunration annuelle du grant).
Zoom n 58
3.2.
Le financement de la SARL
165
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Condamnation de lassoci excuter les engagements
de la SARL
Le crancier dune socit dun groupe peut demander une autre
socit du groupe le paiement de sa crance sil peut prouver que les
deux socits sont unies par une communaut dintrt et nen forment
quune seule, ou que lune des socits a eu un comportement fautif en
faisant croire quelle prend part lengagement de lautre.
Lorsque la SARL est soumise une procdure de redressement ou de
liquidation judiciaire, la responsabilit de ses dirigeants, de droit ou de
fait, peut tre engage. En cas de ctivit de la SARL ou de confusion
de son patrimoine avec celui de ses associs, une seule procdure col-
lective peut tre ouverte contre la SARL et ses associs.
Lettre dintention et responsabilit de la socit mre
Ltendue de lobligation de la socit mre dpend
des termes employs dans la lettre dintention.
Simple
engagement
moral
La lettre dintention nentrane pas dobligation juridique la charge
de la socit mre (la socit mre indique simplement que la
situation financire de sa filiale permettra celle-ci de faire face
ses engagements). Cependant, la responsabilit de la socit mre
peut tre engage si elle a induit en erreur le cocontractant par
un comportement fautif (la socit mre fait croire la solvabilit
de sa filiale dont la situation est compromise).
Lettre
dintention valant
cautionnement
La socit mre sengage envers le crancier remplir lobligation de
sa filiale si elle ne le fait pas elle-mme (la socit mre indique que
si sa filiale est dfaillante elle paiera en son lieu et place).
Respectez bien le formalisme des augmentations de capital
Une augmentation de capital irrgulire est susceptible dengager la responsabilit
civile et pnale des associs.
3.3.
4. Laugmentation de capital
Zoom n 59
Guide pratique de la SARL et de lEURL
166
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Diffrents vnements peuvent rendre ncessaire une augmentation de
capital : le dveloppement des affaires de la socit ncessitant une mise
de fonds ; le dsir dintroduire dans la socit de nouveaux associs sans
que les associs existant aient cder leurs parts ; la mise disposition
dnitive de la socit de rserves ou de bnces non distribus
Laugmentation de capital peut tre ralise par apports en numraire,
par apports en nature, ou par incorporation de rserves ou de bnces.
Laugmentation de capital par souscription en numraire
4.1.1. Qui peut souscrire laugmentation
de capital en numraire ?
Les associs ou les tiers peuvent souscrire laugmentation de capital
en numraire.
Les associs ne bncient pas dun droit prfrentiel de sous-
cription comme les actionnaires dans les socits anonymes.
Cependant, ce droit peut leur tre accord par les statuts, ou par
une dcision extraordinaire des associs.
Les tiers doivent tre agrs par les associs (majorit des trois
quarts des parts sociales).
Lpoux de lapporteur mari sous un rgime de communaut doit
autoriser lapport et renoncer devenir personnellement associ.
Librez le capital initial avant de laugmenter
Pour procder une augmentation de capital, les apports en numraire lors de la
constitution de la SARL doivent tre intgralement librs. dfaut, laugmentation
de capital est nulle.
Augmentation de capital par apports en numraire dans une SARL
Une SARL au capital de 10 000 a besoin dautonancer hauteur de 60 000 sur
une dure de trois ans un projet de dveloppement pour viter un trop grand recours
lendettement. La SARL envisage donc une augmentation de capital le 30/06/N.
4.1.
Zoom n 60
Cas n 22
/
Le financement de la SARL
167
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Quel montant doivent apporter immdiatement les associs ?
Besoin en autonancement (a) 60 000
Valeur relle de laction (b) 30
Les associs nont pas lobligation de librer intgralement les parts
sociales nouvelles lors de leur souscription. En effet, laugmentation
de capital peut tre libre du cinquime seulement de sa valeur
nominale (g). La totalit de la prime dmission doit tre verse (h). La
libration du surplus (i) doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans
le dlai de cinq ans compter du jour o laugmentation du capital est
devenue dnitive (au plus tard le 30/06/N + 5).
Un tiers peut-il participer laugmentation de capital ?
Les associs ne bncient pas dun droit prfrentiel de souscription.
Pour permettre un tiers de participer laugmentation de capital, le
tiers doit tre agr par les autres associs (voir page 86).
4.1.2. Veillez ne pas lser les associs qui ne participent
pas laugmentation de capital
Lvaluation des parts mises en contrepartie de laugmentation de
capital doit correspondre la valeur relle de lentreprise. Elle doit
La part sociale a une valeur nominale de 10 et une valeur relle de 30 . Ses asso-
cis ont des capacits nancires limites. Il serait envisag de faire appel un tiers.
Quel montant doivent apporter immdiatement les associs ?
Un tiers peut-il participer laugmentation de capital ?
Augmentation de capital
Libration
immdiate diffre
nombre dactions mettre (c = a/b)
valeur nominale des actions (d)
augmentation de capital (e = c d)
prime dmission (f = a e)
2 000
10
20 000
40 000
4 000 g
40 000 h
16 000 i
60 000 44 000 h 16 000 i
(Suite cas n 22)
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
168
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
incorporer les rserves inscrites au bilan, les plus-values latentes, le
goodwill de lentreprise (la valeur de son fonds de commerce). Ainsi
les associs qui ne participent pas laugmentation de capital ne
seront pas lss, et ne pourront pas demander la nullit de lopration.
La diffrence entre la valeur nominale de la part et sa valeur de sous-
cription (montant que paie lacqureur) constitue la prime dmission
quencaisse la SARL. Les anciens associs disposent alors de droits
proportionnels leur part dans le nouveau capital sur cette prime
dmission.
Un droit prfrentiel de souscription peut tre cr ou prvu dans les
statuts : les associs qui ne participent pas encaissent immdiatement
le prix de leur droit de souscription quils ont cd lacqureur des
parts.
4.1.3. Augmentation de capital
par compensation de crance
Les parts sociales souscrites dans le cadre dune augmentation de capi-
tal peuvent tre rgles par compensation avec une crance apparte-
nant au nouvel associ envers la socit.
La crance doit tre liquide et exigible : le paiement doit pouvoir
tre rclam immdiatement par le crancier. Si la crance est exi-
gible terme, la compensation peut jouer sil y a renonciation au
terme. Le procs-verbal constatant laugmentation de capital et la
libration des parts doit mentionner que la libration par compen-
sation seffectue bien avec des crances liquides et exigibles.
Laugmentation de capital peut tre aussi ralise par compensa-
tion de comptes courants dassocis.
4.1.4. Quelle est la procdure suivre ?
Les parts souscrites dans le cadre de laugmentation de capital peuvent
ntre libres que du cinquime seulement. Le dpt, puis le retrait
des fonds ainsi obtenus obissent aux mmes rgles que lors de la
constitution de la socit (voir page 155).
Le financement de la SARL
169
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Si laugmentation de capital nest pas ralise dans le dlai de six mois
compter du premier dpt de fonds, les apporteurs peuvent demander
au prsident du tribunal de commerce du lieu du sige social lautorisa-
tion de retirer le montant de leurs apports.
Il y a accord entre tous les associs anciens et nouveaux
La procdure est la suivante :
1. Mise au point dun commun accord des modalits de lopration.
2. Libration de toutes les souscriptions.
3. Runion dune seule assemble gnrale extraordinaire. Les rso-
lutions adoptes lunanimit par cette assemble, laquelle tous
les associs sont prsents ou reprsents, indiquent notamment les
modalits de lopration, le nom des nouveaux associs, le mon-
tant des parts de chacun et la modication des statuts rsultant de
laugmentation du capital (voir formules n 400 412).
Tous les associs ne sont pas daccord
La procdure est la suivante :
1. Une premire dcision extraordinaire des associs, prise la
majorit des trois quarts, arrte le principe de laugmentation de
capital, en xe les principales modalits, et donne tous pouvoirs
la grance an de xer les autres conditions de lmission et de
recevoir les souscriptions.
2. Le grant constate, par crit, la souscription des parts mises,
leur libration intgrale, ainsi que le dpt des fonds.
3. Une seconde dcision extraordinaire des associs :
agre les associs nouveaux si des souscriptions ont t faites
par des tiers ;
prend acte et reconnat la sincrit des dclarations de sous-
cription et de libration faites par le grant ainsi que par les
souscripteurs ;
constate la ralisation dnitive de laugmentation de capital ;
dsigne, sil y a lieu, un mandataire pour le retrait des fonds
dposs ;
approuve les modications statutaires (nouveau montant du
capital et nouvelle rpartition des parts sociales) ;
donne les pouvoirs ncessaires pour laccomplissement des
formalits de publicit.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
170
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
4.1.5. Incidence scale
Laugmentation de capital en numraire supporte un droit xe de 75 .
Le procs-verbal de lassemble qui constate laugmentation de capital
doit tre enregistr dans le mois.
Laugmentation de capital par apports en nature
Les formalits sont les mmes que pour les apports en nature effectus
au moment de la constitution de la socit (se reporter page 156).
4.2.1. Quelle est la procdure suivre ?
La procdure est la suivante :
1. Dnition par crit entre le grant et lapporteur des modalits de
laugmentation de capital, sous la condition suspensive de son
approbation par une dcision extraordinaire des associs (notam-
ment la nature exacte des apports et leur valuation, le montant
de laugmentation de capital ayant pour but de les rmunrer).
2. Dsignation dun commissaire aux apports par le prsident du
tribunal de commerce la demande du grant (obligatoire mme
pour les apports en nature de faible importance).
3. Rapport du commissaire, qui est annex au procs-verbal cons-
tatant laugmentation de capital ( dfaut de ce rapport, laug-
mentation de capital est irrgulire).
4. Dpt du rapport au greffe du tribunal de commerce huit jours au
moins avant la date de lassemble gnrale appele statuer sur
laugmentation de capital.
5. Une dcision extraordinaire des associs approuve laugmen-
tation de capital comme dans le cas dun apport en numraire
(une seule assemble extraordinaire si tous les associs sont
daccord ; deux assembles extraordinaires des associs dans le
cas contraire).
4.2.
Le financement de la SARL
171
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
4.2.2. Attention la majoration
des apports en nature !
Le grant et les apporteurs sont responsables pendant cinq ans de
la valeur attribue aux apports si elle est diffrente de celle pro-
pose par le commissaire aux apports.
Lorsque la valeur dun apport a t frauduleusement majore, les
associs sexposent une peine demprisonnement de cinq ans
et/ou dune amende de 375 000 .
4.2.3. Incidence scale
Les droits sont les mmes que pour les apports en nature effectus au
moment de la constitution de la socit (voir page 39).
Laugmentation de capital par incorporation des bnces
et des rserves
Laugmentation de capital par incorporation de bnces ou de rser-
ves est ralise par lattribution de parts nouvelles aux associs, au
prorata du nombre de parts anciennes dtenues par chacun deux (une
augmentation de la valeur nominale des parts est galement possible).
Cette augmentation de capital est dcide par les associs reprsentant
au moins la moiti des parts sociales (et non les trois quarts qui est la
rgle pour les dcisions extraordinaires).
Peuvent tre capitaliss toutes les rserves disponibles, les primes
dmission et de fusion, les bnces de lexercice ou des exercices
antrieurs (report nouveau), la rserve lgale et lcart de rvalua-
tion.
Laugmentation de capital par incorporation de bnces ou de rserves
est soumise un droit xe de 75 .
4.3.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
172
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dans quels cas procde-t-on une rduction de capital ?
5.1.1. En cas de pertes
La rduction du capital peut tre dcide :
Pour permettre de distribuer des dividendes puisque les pertes
doivent tre entirement absorbes pour procder une distribu-
tion de dividendes.
Pour faciliter une augmentation de capital en numraire an de se
procurer de nouvelles disponibilits pour redresser la situation de
lentreprise. dfaut, personne ne voudrait souscrire de peur de
supporter les pertes anciennes (la rduction permet de prsenter un
bilan propre, nettoy de ses pertes). La rduction du capital suivie
de son augmentation immdiate est appele coup daccordon .
Pour se conformer la rglementation en cas de perte de la moi-
ti du capital social (les capitaux propres de la socit devien-
nent infrieurs la moiti du capital social la suite des pertes).
5.1.2. Autres cas de rduction
Pour permettre le retrait dun ou plusieurs associs lorsque
lagrment dun cessionnaire na pas t accord (voir page 89).
Le capital est trop important pour les besoins de la socit.
Les apports ont t surestims.
Quelle est la procdure suivre ?
La rduction du capital ne peut, en aucun cas, porter atteinte lgalit
entre associs.
La rduction de capital est autorise par une assemble extraordinaire
des associs statuant la majorit des 3/4 des parts sociales, ou
lunanimit toutes les fois que lgalit des associs risque de ne pas
tre respecte.
5. La rduction de capital
5.1.
5.2.
Le financement de la SARL
173
Sil existe un commissaire aux comptes, le projet de rduction du capi-
tal doit lui tre communiqu quarante-cinq jours au moins avant la date
de la runion de lassemble des associs. Il fait connatre lassem-
ble son apprciation sur les causes et conditions de la rduction.
Attention ! La rduction de capital ne peut commencer pendant le dlai
dopposition des cranciers.
5.2.1. La rduction concerne tous les associs
Si la rduction concerne tous les associs, on procde gnralement en
rduisant la valeur nominale de chaque part ou le nombre de parts de
chaque associ.
Le procd le plus commode est la rduction de la valeur nominale de
chaque part car il permet de bien respecter le principe de lgalit entre
les associs.
La rduction du nombre de parts est plus dlicate car elle risque de
crer des rompus portant atteinte au principe de lgalit entre asso-
cis. De plus, en cas dchange de toutes les parts anciennes contre des
parts nouvelles, lassemble ne peut autoriser le grant acheter un
certain nombre de parts pour les annuler que si la rduction de capital
nest pas motive par des pertes.
5.2.2. La rduction ne concerne pas tous les associs
Si la rduction concerne seulement un ou plusieurs associs, la socit
annule tout ou partie de leurs parts par voie de rachat, ou par voie
dattribution de biens sociaux en nature. Comme le principe de lgalit
entre associs nest pas respect, cette rduction nest possible quen
cas de retrait dun associ qui dsire cder ses parts et na pu obtenir
lagrment du cessionnaire, ou que si tous les associs sont daccord.
Opposition des cranciers
Comme le capital constitue le gage des cranciers, ils peuvent soppo-
ser la rduction du capital dans la mesure o elle diminue leur gage.
5.3.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
174
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les cranciers peuvent sopposer la rduction de capital :
si la rduction de capital nest pas motive par des pertes (une
rduction de capital motive par des pertes ne diminue pas le
gage des cranciers) ;
et si la crance est antrieure la date de dpt au greffe du tribu-
nal de commerce du procs-verbal de lassemble qui a approuv
le projet de rduction.
Les cranciers peuvent sopposer la rduction de capital dans un
dlai dun mois compter du dpt au greffe du procs-verbal.
Lopposition est signie la socit par acte extrajudiciaire et porte
devant le tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce peut rejeter lopposition ou ordonner, soit le
remboursement des crances, soit la constitution de garanties si la
socit en offre et si elles sont juges sufsantes.
Incidence scale
La rduction de capital en cas de perte de la moiti
du capital social
Dans la SARL, la responsabilit des associs est limite au montant du
capital quils apportent. Aussi, an de protger les intrts des tiers
dont le capital constitue le gage, le lgislateur a dict des rgles parti-
culires lorsque des pertes entament fortement le capital.
Incidence scale de la rduction de capital
Type de rduction Droits denregistrement
Rduction pour compenser les pertes. Droit fixe de 125 .
Rduction avec remboursement
en numraire.
Droit de partage de 1 % sur le montant
du remboursement.
Rduction avec attribution un associ
dun bien.
Droit de partage de 1 % sur la valeur relle
du bien.
Rduction avec attribution un associ dun
bien + soulte mise la charge de lassoci.
Droit de vente selon la nature du bien.
5.4.
5.5.
Le financement de la SARL
175
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Si les comptes font apparatre une perte qui rend les capitaux propres
infrieurs la moiti du capital social, le grant doit, dans les quatre
mois qui suivent lapprobation des comptes, consulter les associs sur
lopportunit de prononcer la dissolution anticipe de la socit.
La dcision des associs est prise la majorit des trois quarts
des parts sociales.
Elle doit tre publie dans un journal dannonces lgales, dpo-
se au greffe du tribunal de commerce, et inscrite au registre du
commerce et des socits.
Le grant qui, volontairement, ne convoque pas les associs ou
qui neffectue pas les formalits de publicit, risque un empri-
sonnement de six mois et/ou une amende de 9 000 .
Tout associ ou tout crancier de la socit peut demander en jus-
tice la dissolution de la socit si le grant, ou dfaut le com-
missaire aux comptes, na pas convoqu lassemble, ou si les
associs nont pu dlibrer valablement (le tribunal peut alors
accorder la socit un dlai maximal de six mois pour rgulari-
ser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si la situation
a t rgularise).
Si lassemble dcide de ne pas dissoudre la socit, elle dispose
dun dlai, qui expire la clture du deuxime exercice suivant
celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue,
pour rgulariser la situation.
Si la situation nest pas rgularise dans le dlai de deux ans,
il ny a pas de sanctions pnales. En revanche, comme indiqu
Si vous dcidez daugmenter le capital pour assainir la situation
nancire, vous avez intrt pratiquer le coup daccordon
Laugmentation du capital est prcde dune rduction du capital qui permet dapurer
les pertes :
si ce sont de nouveaux associs qui apportent les capitaux, ils naccepteront de
participer laugmentation de capital que si les pertes sont supportes par les
anciens associs ;
si ce sont les anciens associs qui participent laugmentation de capital, lapure-
ment des pertes permettra ultrieurement une distribution de dividendes.
Zoom n 61
Guide pratique de la SARL et de lEURL
176
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
ci-dessus, tout intress peut demander en justice la dissolution
de la socit.
La situation peut tre rgularise :
1. En reconstituant les capitaux propres concurrence dune
valeur au moins gale la moiti du capital social. Cette recons-
titution peut tre obtenue par :
la ralisation de bnces permettant de rsorber les pertes ;
une augmentation du capital par des apports en numraire, par
compensation avec des crances ou par des apports en nature ;
des abandons de crances : une socit mre, par exemple,
renonce sa crance sur sa liale pour aider celle-ci retrouver
son quilibre nancier ;
la rvaluation libre du bilan : une socit dont le bilan
comporte des plus-values latentes augmente lactif la valeur
de ses immobilisations, et au passif, en contrepartie, le mon-
tant de ses capitaux propres (cart de rvaluation libre).
2. Ou par une rduction du capital dun montant au moins gal
celui des pertes qui nont pu tre imputes sur les rserves.
Rduction de capital en cas de perte
de la moiti du capital social
Au 31/12/N, les comptes de la SARL se prsentent comme suit.
Les capitaux propres (9 000 ) sont infrieurs la moiti du capital social (20 000 /2
= 10 000 ).
Les associs constatent cette situation au moment de lapprobation des comptes
(lassemble gnrale ordinaire qui approuve les comptes de lexercice clos le
31/12/N se tient le 30 juin N + 1, par exemple).
Ils doivent donc se runir en assemble au plus tard le 31 octobre N + 1 pour dcider
sil y a lieu dissolution anticipe de la socit (dans les quatre mois).
Cas n 23
Capital social :
Pertes cumules :
+ 20 000
11 000
Capitaux propres : = 9 000
/
Le financement de la SARL
177
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Si les associs dcident de ne pas dissoudre la socit, ils doivent alors rgulariser
la situation au plus tard au 31/12/N + 3 (deux exercices aprs).
Pour rgulariser la situation, les associs peuvent dcider de :
1. Rduire le capital an de compenser les pertes.
Si pendant la priode N + 1, N + 2 et N + 3, la socit fait une perte cumule de
3 000 , elle devra rduire au minimum son capital de 8 000 .
La situation serait alors la suivante :
Les capitaux propres (6 000 ) sont alors au moins gaux la moiti du capital
social (12 000 /2 = 6 000 ).
2. Attendre que la socit fasse des bnfices pour ponger les anciennes pertes.
Dans notre exemple, il suffit que la socit fasse un bnfice cumul de 1 000 en
N + 1, N + 2 et N + 3.
La situation serait alors la suivante :
Les capitaux propres (10 000 ) sont alors au moins gaux la moiti du capital
social (10 000 ).
3. Augmenter le capital.
Si la socit continue de faire des pertes pendant la priode N, N + 1 et N + 2 pour
un montant cumul de 3 000 , laugmentation de capital devra tre au minimum
de 8 000 .
La situation serait alors la suivante :
Les capitaux propres (14 000 ) sont alors au moins gaux la moiti du capital
social (28 000 /2 = 14 000 ).
(Suite cas n 23)
/
Capital social :
Pertes cumules :
12 000
6 000
(+ 20 000 8 000 )
( 11 000 3 000 + 8 000 )
Capitaux propres : = 6 000
Capital social :
Pertes cumules :
+ 20 000
10 000 ( 11 000 + 1 000 )
Capitaux propres : = 10 000
Capital social :
Pertes cumules :
+ 28 000
14 000
(+ 20 000 + 8 000 )
( 11 000 3 000 )
Capitaux propres : = 14 000
Guide pratique de la SARL et de lEURL
178
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La SARL peut mettre des obligations non cotes
1
si :
elle a tabli les comptes de trois exercices approuvs par les asso-
cis et certis par un commissaire aux comptes ;
et si elle a lobligation de nommer un commissaire aux comptes.
Elle doit donc remplir deux des trois critres suivants : actif du
bilan > 1 550 000 ; CA HT > 3 100 000 ou nombre de
salaris > 50.
Lmission dobligations est dcide par lassemble gnrale des
associs. Les obligations mises doivent tre nominatives, accompa-
gnes dune notice et de documents dinformation. Les obligataires
sont regroups en assembles pour dfendre leurs intrts.
1. Article L. 223-11 du Code de commerce.
6. Les emprunts obligataires
179
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
4
LA GESTION ET LE CONTRLE
DE LA SARL
Les pouvoirs du grant lgard des tiers
Dans ses rapports avec les tiers, le grant est investi des pouvoirs les
plus tendus pour agir en toute circonstance au nom de la socit.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des grants sont
inopposables aux tiers.
La SARL est engage mme par les actes de son grant qui
dpassent lobjet social moins quelle ne prouve que le tiers en
avait connaissance ou ne pouvait lignorer (la seule publication
des statuts nest pas sufsante pour apporter cette preuve).
Pour limiter les pouvoirs du grant
Prcisez bien dans les statuts les limites du pouvoir du grant.
Dnissez bien lobjet social.
1. Les pouvoirs du grant
Zoom n 62
1.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
180
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le grant peut consentir une hypothque ou toute autre sret
relle sur les biens de la socit (le grant na pas besoin de pou-
voirs exprs).
En cas de pluralit de grants, chaque grant a les mmes pou-
voirs que sil tait seul, lgard des tiers.
Le grant ne peut cependant pas sattribuer les pouvoirs que la loi
rserve expressment aux associs. Les actes du grant nengagent
donc pas la socit sils sont de la seule comptence des associs.
La cession dun fonds de commerce qui implique une modica-
tion des statuts (lobjet social dune SARL consiste en lexploita-
tion nommment de ce fonds de commerce) est de la seule
comptence des associs. Si la cession est ralise par le grant,
elle ne peut pas engager la socit.
Les actes suivants sont, par exemple, rservs expressment par
la loi aux associs : la cession des tiers de parts sociales, leur
nantissement, la modication des statuts, la nomination des grants
et des commissaires aux comptes.
Les pouvoirs du grant lgard des associs
Dans ses rapports avec les associs, le grant peut faire tous les actes
de gestion dans lintrt de la socit, y compris les actes de disposi-
tion des biens sociaux (vente dun immeuble).
De plus, le grant peut dplacer lui-mme le sige social dans le mme
dpartement ou dans un dpartement limitrophe et mettre en confor-
mit les statuts de la socit avec les lois et rglements en vigueur.
Une homologation de lassemble gnrale est cependant ncessaire.
1.2.1. Les statuts peuvent restreindre les pouvoirs du grant
Les statuts peuvent, par exemple, interdire au grant, sauf accord pra-
lable des associs, dengager un nouveau directeur, de contracter des
emprunts autres que des crdits de trsorerie, de vendre un immeuble
ou un fonds de commerce, de consentir une hypothque sur un immeu-
ble ou un nantissement sur un fonds de commerce, de raliser une op-
ration qui engage la socit au-del dun certain montant
1.2.
La gestion et le contrle de la SARL
181
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Si le grant accomplit un acte quil na pas le droit daccomplir
daprs les statuts, cet acte demeure valable vis--vis des tiers :
la socit se trouve ainsi tenue de respecter ses engagements ;
les associs peuvent rvoquer le grant pour juste motif ;
ils peuvent aussi lui rclamer des dommages-intrts, sils prou-
vent que ses dcisions ont caus un prjudice certain la socit.
1.2.2. Les statuts peuvent augmenter les pouvoirs du grant
Les statuts peuvent autoriser, par exemple, le grant transfrer le
sige social dans la mme ville ou dans un dpartement limitrophe et
modier en consquence les statuts.
Actes du grant interdits ou soumis autorisation
1.3.1. Le grant ne peut pas emprunter la SARL
ou lui demander une caution son prot
peine de nullit du contrat, il est interdit au grant (ou aux associs
autres que les personnes morales) de contracter, sous quelque forme
que ce soit, des emprunts auprs de la socit, de se faire consentir
par elle un dcouvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de
faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers
(conventions interdites).
Cette interdiction sapplique aux conjoints, ascendants et descen-
dants des grants et des associs, aux reprsentants lgaux des
personnes morales associes, ainsi qu toute personne interpose.
La socit ne peut pas sopposer cette interdiction (nullit
dordre public).
Un crancier peut demander la nullit de la caution donne par la so-
cit au prot du grant, mme avec laccord unanime des associs.
1.3.2. Le grant doit tre autoris par les associs
pour conclure une convention avec la SARL
Si le grant (ou un associ) conclut une convention avec la socit qui
ne porte pas sur des oprations courantes et conclues des conditions
1.3.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
182
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Cependant, un ou plusieurs associs peuvent demander la runion dune
assemble sils dtiennent la moiti des parts sociales, ou si, reprsentant au
moins le quart des associs, ils dtiennent le quart des parts sociales. Toute
clause contraire est rpute non crite.
normales, il devra respecter la procdure applicable aux conventions
rglementes (voir page 195).
Le grant peut-il dlguer ses pouvoirs ?
Le grant na pas le droit de dlguer un tiers lintgralit de ses
pouvoirs. Cependant, il peut dlguer ses pouvoirs pour des oprations
dtermines et limites dans le temps (une autorisation pralable des
associs peut tre prvue par les statuts).
Dans la SARL, le grant a un pouvoir important. Les statuts peuvent
augmenter les pouvoirs des associs, ou sen tenir aux rgles lgales,
en fonction de la faon dont la marche de lentreprise est envisage.
Le pouvoir de dcision des associs
Les dcisions des associs peuvent tre prises en assemble, par consul-
tation crite, ou par consentement dans un acte.
Type de dcision Forme de la dcision
Approbation annuelle
des comptes
La dcision dapprobation des comptes annuels est
imprativement prise en assemble (approbation du rapport
de gestion, de linventaire et des comptes annuels).
Autres dcisions En principe, la dcision est prise en assemble.
Les statuts peuvent stipuler que toutes les dcisions
ou certaines dentre elles seront prises par consultation
crite des associs ou rsulteront du consentement
de tous les associs dans un acte
1
.
1.4.
2. Les pouvoirs des associs
2.1.
La gestion et le contrle de la SARL
183
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.1.1. Les assembles dassocis
2.1.1.1. Comment sexerce le droit de vote aux assembles
Une part sociale = une voix aux assembles
Chaque associ peut participer aux assembles dassocis. Il dispose
dun nombre de voix gal celui des parts sociales quil possde. Seul
lassoci peut exercer le droit de vote attach ses parts sociales.
Les statuts ne peuvent pas instituer un vote plural, ou exiger un
minimum de parts pour pouvoir voter.
Le mode dacquisition des parts na pas dincidence sur le droit
de vote (parts obtenues lorigine en rmunration des apports ;
ou, par la suite, par voie de cession entre vifs ou de transmission
successorale).
Le crancier qui a obtenu un nantissement sur les parts ne peut
pas voter aux assembles.
Le droit de vote ne peut pas tre cd car il ne peut pas tre
dissoci de la part sociale.
Un associ peut se faire reprsenter aux assembles par son conjoint
(sauf si la SARL est constitue uniquement entre les deux poux), ou
par un associ (sils sont au moins deux), ou par une autre personne
uniquement si les statuts le permettent.
Le mandat est donn pour une seule assemble ou pour deux
assembles tenues dans un dlai de sept jours (exemple : deux
assembles successives, lune extraordinaire et lautre ordinaire).
Le mandat donn pour une assemble vaut pour les assembles
successives convoques avec le mme ordre du jour (exemple : la
premire assemble na pas runi le quorum, il faut donc en tenir
une seconde).
Comment protger les intrts des associs lorsquun seul associ
possde lui seul plus de la moiti des parts sociales
Vous pouvez prvoir une double majorit en nombre dassocis et en nombre de
parts dans les statuts pour les dcisions ordinaires.
Zoom n 63
Guide pratique de la SARL et de lEURL
184
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.1.1.2. Attention labus de majorit ou de minorit !
a) Abus de majorit
Il y a abus de majorit quand la dcision de lassemble est prise con-
trairement lintrt gnral de la socit, avec pour seul objectif de
favoriser les membres de la majorit au dtriment des membres de la
minorit. Dans ce cas, la dcision abusive est annule par les tribunaux.
Proprit des parts Qui vote aux assembles ?
Indivision (les hritiers dun
associ par exemple)
Le co-indivisaire qui reprsente lindivision. dfaut
dentente, le co-indivisaire le plus diligent peut faire dsigner
par justice un mandataire charg de les reprsenter tous.
Parts dmembres
en usufruit et nue-proprit
Le principe :
Dcisions concernant laffectation des bnfices :
vote de lusufruitier ;
Autres dcisions : vote du nu-propritaire.
Les statuts peuvent stipuler :
Assembles gnrales ordinaires : vote de lusufruitier ;
Assembles gnrales extraordinaires :
vote du nu-propritaire.
Mineur ou majeur protg Administrateur lgal de ses biens.
Le conjoint qui a acquis
les parts avec des biens
communs
Le conjoint qui possde des parts
(il bnficie de la prsomption de pouvoirs).
Abus de majorit
Deux associs qui dtiennent 95 % du capital dune SARL et qui peroivent des
rmunrations et des avantages divers mettent en rserve, tous les ans, la totalit
des bnces alors que la socit nemploie pas cette trsorerie (ils ne distribuent
jamais de dividendes). Lassoci minoritaire qui nexerce aucune fonction dans la
socit ne retire aucun prot de sa participation.
Les bnces sont systmatiquement affects aux rserves ; les associs majori-
taires bncient de rmunrations importantes qui leur permettent dacqurir per-
sonnellement des immeubles quils donnent en location la socit.
Une SARL est transforme en SA an dvincer lassoci minoritaire.
Cas n 24
/
La gestion et le contrle de la SARL
185
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
b) Abus de minorit
Il y a abus de minorit lorsque lattitude de lassoci est contraire
lintrt gnral de la socit, et a pour seul objectif de favoriser ses
propres intrts au dtriment de lensemble des autres associs.
Labus de minorit est surtout retenu en cas daugmentation de
capital : les minoritaires qui ne peuvent pas ou ne veulent pas sous-
crire une augmentation de capital refusent de voter laugmentation
an de ne pas diluer davantage leur participation.
Si labus de minorit est retenu, le tribunal ne peut pas se substituer au
minoritaire dfaillant. Il peut en rsulter une situation de blocage.
Le juge peut estimer quun associ dune SARL commet un abus de
minorit sil soppose une augmentation du capital, ou la transfor-
mation en socit anonyme. Cependant, si la majorit requise des trois
quarts des parts sociales nest pas atteinte cause de labstention de
lassoci minoritaire, le juge ne peut pas dsigner un mandataire an
de remplacer les associs minoritaires dfaillants.
2.1.1.3. Assemble gnrale ordinaire ou extraordinaire ?
Cependant, la dcision daffectation des bnces en rserve suivie dune augmen-
tation de capital par incorporation de ces rserves an daugmenter le crdit de la
socit et la valeur des parts ne constitue pas un abus de majorit.
Assemble gnrale ordinaire
Nature
des dcisions
prises
Le principe
Dcisions ne modifiant pas les statuts ou ne portant pas agrment
de nouveaux associs :
approuver les comptes de lexercice (montant des dividendes,
reports nouveau, affectations aux rserves, quitus la grance) ;
nommer ou rvoquer un grant ;
montant et modalits de calcul de la rmunration alloue
la grance ;
nommer ou renouveler, le cas chant, le commissaire aux
comptes titulaire et son supplant ;
(Suite cas n 24)
/
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
186
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
autoriser le grant effectuer les oprations qui dpassent
les limites fixes par les statuts ;
approuver, ou autoriser selon le cas, les conventions intervenues
entre la socit et lun de ses grants ou lun de ses associs.
Les exceptions
le grant, mme statutaire, peut tre rvoqu par une dcision
ordinaire ;
une SARL dont les capitaux propres excdent 750 000 peut tre
transforme en SA par une dcision ordinaire ;
la cession de parts entre associs qui entrane modification
implicite des statuts peut se faire par une dcision ordinaire.
Majorit Pour une premire assemble ou une premire consultation
Les dcisions sont adoptes par un ou plusieurs associs
reprsentant plus de la moiti des parts sociales : lassoci qui
dtient 50 % des parts sociales + une part dtient la majorit
(majorit absolue).
Pour une deuxime assemble ou une deuxime consultation
Les dcisions sont adoptes la majorit des votes mis, quel que
soit le nombre de votants (majorit relative).
NB : il parat prfrable de prciser dans les statuts que, mme sur
seconde convocation, la majorit des parts sociales sera ncessaire.
Les statuts peuvent imposer pour les dcisions ordinaires une
majorit plus leve (sauf pour la rvocation des grants).
Assemble gnrale extraordinaire
Nature
des dcisions
prises
Dcisions pour lagrment de nouveaux associs ou la modification
des statuts :
transformation en socit anonyme dune SARL dont les capitaux
propres sont infrieurs 750 000 ;
transfert du sige social ;
changement de la dnomination sociale ;
modification de lobjet social ;
augmentation ou rduction du capital ;
agrment de nouveaux associs
Quorum
et majorit
Les associs prsents ou reprsents doivent possder au minimum
(quorum) :
un quart des parts sociales sur premire convocation ;
un cinquime des parts sociales sur deuxime convocation.
Les modications sont dcides la majorit des deux tiers des
parts dtenues par les associs prsents ou reprsents.
Les statuts peuvent prvoir un quorum et une majorit plus levs
sans pouvoir exiger lunanimit pour la majorit.
La loi a aussi prvu certaines exceptions. Ainsi, lunanimit est
requise pour augmenter les engagements des associs
(transformation dune SARL en SNC).
/
La gestion et le contrle de la SARL
187
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.1.1.4. Modalits pratiques de tenue dune assemble
Qui convoque lassemble ?
La convocation de lassemble est faite par le grant ; ou, dfaut, par
le commissaire aux comptes, sil en existe un ; ou par un mandataire
dsign en justice la demande dun associ.
Convocation par le grant
Le grant peut librement convoquer lassemble. Cependant, il doit
obligatoirement convoquer lassemble dans les cas suivants :
approbation annuelle des comptes : lassemble qui approuve les
comptes de lexercice doit tre runie obligatoirement dans les
six mois compter de la clture de lexercice ;
capitaux propres infrieurs la moiti du capital social ;
nombre des associs suprieur cinquante ;
conventions rglementes (entre la socit et lun de ses grants
ou associs) ;
convocation demande par un ou plusieurs associs dtenant la
moiti des parts sociales ou, sils reprsentent au moins le quart
des associs, dtenant le quart des parts sociales (les associs
peuvent ainsi vaincre la rsistance dun grant qui se refuserait
provoquer une runion des associs).
Convocation par le commissaire aux comptes
Si le commissaire aux comptes dcide de convoquer lassemble des
associs, il doit respecter la procdure suivante :
il envoie une lettre recommande avec avis de rception au
grant pour tablir sa carence ;
il xe lordre du jour de lassemble ;
il lit son rapport lassemble pour lui exposer les motifs de la
convocation (les frais de runion sont la charge de la socit).
Dans quels cas le commissaire aux comptes convoque-t-il lassemble
des associs ?
Dcs ou absence du grant.
Le grant refuse de mettre lordre du jour la mesure souhaite
par les associs car le grant est en conit avec la majorit des
Guide pratique de la SARL et de lEURL
188
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
associs (le grant refuse, par exemple, de mettre lordre du
jour sa propre rvocation).
La situation de la socit est proccupante du fait de labsence de
dcision de la grance et des associs.
Convocation par un mandataire dsign en justice
Lassoci doit respecter la procdure suivante :
il met en demeure le grant de runir lassemble ;
si la mise en demeure reste sans effet, lassoci demande au pr-
sident du tribunal de commerce de dsigner un mandataire qui
devra convoquer lassemble.
Lassoci peut demander au tribunal de convoquer lassemble des
associs dans les cas suivants :
pour permettre un fonctionnement normal de la socit ;
des questions de lassoci concernant la rsiliation de cautions, le
rachat de parts, lvolution des ventes ltranger sont demeu-
res sans rponse plusieurs mois aprs une assemble ;
le grant refuse quune question dun associ gure lordre du
jour. Lassemble convoque par le tribunal comportera son
ordre du jour la question.
1. Ordre du jour
La xation de lordre du jour est importante car une assemble, en
principe, ne peut valablement dlibrer que sur les questions inscrites
lordre du jour :
la rvocation du grant peut toujours tre dcide par les associs
mme si la question ne gure pas lordre du jour ;
les questions inscrites lordre du jour sont rdiges de telle
sorte que leur contenu et leur porte apparaissent clairement sans
quil y ait lieu de se reporter dautres documents ;
les questions diverses doivent prsenter une faible importance ;
quand les associs posent des questions crites pour lassemble
dapprobation des comptes, la question est obligatoirement dis-
cute en assemble. Cependant, aucun vote ne peut intervenir
sur le point soulev car il nest pas lordre du jour ;
La gestion et le contrle de la SARL
189
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. ventuellement, les comptes consolids, le rapport sur la gestion du groupe et
le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolids. De plus, les
SARL trs importantes doivent publier dans un journal dannonces lgales
leurs comptes annuels. Il nest pas obligatoire de communiquer aux associs le
rapport spcial sur les conventions rglementes.
lordre du jour est x par le grant. La lettre de convocation
une assemble doit indiquer son ordre du jour.
2. Lieu de lassemble
Les assembles dassocis doivent tre convoques au lieu prvu par
les statuts (gnralement le sige social). dfaut, le grant a toute
libert pour xer le lieu de tenue de lassemble (le grant peut convo-
quer lassemble en un lieu loign du sige social an de gner la
participation dun associ).
3. Dlai de convocation
La convocation lassemble doit tre effectue, par lettre recomman-
de, quinze jours au moins avant la runion de lassemble (un dlai
plus long peut tre prvu par les statuts).
Comment calculer le dlai ?
Le jour denvoi de la lettre ne compte pas ; le jour de runion de
lassemble est pris en compte. (Si la runion de lassemble est le
15 juin, le dernier jour pour envoyer la lettre de convocation est le
31 mai).
4. Quels sont les documents communiquer aux associs ?
Dlai/Sanctions
Assemble dapprobation
des comptes
Autres assembles
15 jours au moins
avant la date de
lassemble
Le grant adresse aux associs :
les comptes annuels ;
le rapport de gestion ;
le texte des rsolutions
proposes ;
le rapport du commissaire
aux comptes, le cas chant,
sur les comptes annuels
1
.
Le grant adresse aux associs :
le texte des rsolutions
proposes ;
le rapport du grant ;
et, le cas chant, le rapport
des commissaires aux
comptes.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
190
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
5. Comment se tient lassemble ?
Prsident de lassemble
le grant ;
si le grant nest pas associ, lassoci prsent qui possde ou
reprsente le plus grand nombre de parts sociales (si deux
associs possdent ou reprsentent le mme nombre de parts,
la prsidence de lassemble est assure par le plus g).
Feuille de prsence
Elle nest pas obligatoire (modle en annexe dans les suppl-
ments Internet).
Elle est conseille afin de prouver que la majorit requise a bien
t obtenue.
Dbats
Les associs peuvent participer librement la discussion. Le
prsident de sance doit cependant carter les observations qui
nont aucun rapport avec les questions lordre du jour.
Chaque question inscrite lordre du jour est dbattue successi-
vement et fait lobjet dun vote distinct.
Dlai/Sanctions
Assemble dapprobation
des comptes
Autres assembles
Ds la rception
des documents
Les associs peuvent poser par
crit des questions auxquelles
le grant sera tenu de rpondre
au cours de lassemble.
Dans les 15 jours
qui prcdent
la date de
lassemble
Linventaire est la disposition
des associs, au sige social.
Ils ne peuvent pas en prendre
copie.
Tous ces documents sont
la disposition des associs,
au sige social. Ils peuvent en
prendre copie.
Sanctions Lassemble peut tre
annule ;
Le grant peut tre condamn
une amende de 9 000 .
Le grant peut tre condamn
une amende de 1 500
(3 000 en cas de rcidive).
La gestion et le contrle de la SARL
191
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Conseil pratiques pour tablir le procs-verbal de lassemble
La dlibration de lassemble des associs est constate par un procs-verbal
(voir modle dans les supplments Internet) tabli et sign par le grant
1
sur un
registre spcial cot et paraph et tenu au sige social
2
.
Les procs-verbaux peuvent tre tablis sur des feuilles mobiles numrotes sans
discontinuit et paraphes
3
:
les pages non utilises doivent tre annules ;
la reproduction peut tre directement assure par photocopie (pas de photo-
copie de la signature) ;
le collage des originaux des procs-verbaux est interdit.
Le grant est responsable de ltablissement du procs-verbal.
Un secrtaire charg de noter le compte rendu des dbats peut tre dsign par
le grant.
Un brouillon dtaill des dlibrations, notamment en cas dassemble ora-
geuse, peut tre tabli. II sera sign par le grant, et si possible par un autre
associ pour viter toute contestation ultrieure.
Toutes les rsolutions mises aux voix doivent tre consignes (et pas seulement
les rsolutions adoptes).
Les copies des procs-verbaux sont certies conformes par le grant.
Le procs-verbal doit rsumer les dbats (le rsum doit tre dle et objectif).
Le grant doit donc se contenter de relater succinctement les observations des
associs et les ventuels incidents, mme si des associs demandent la consigna-
tion au procs-verbal de leurs observations. Il en est de mme pour les questions
crites.
Attention aux erreurs ou aux omissions !
1. vitez les erreurs en communiquant, pour avis, le procs-verbal aux associs,
avant de le consigner sur le registre paraph (NB : il nest pas obligatoire de
donner lecture lassemble suivante du procs-verbal et de le faire approuver
par une rsolution).
1. Ou le prsident de sance dans le cas dun grant qui nest pas associ.
2. Soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal dins-
tance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire dans la forme
ordinaire et sans frais.
3. Soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal dins-
tance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire dans la forme
ordinaire et sans frais.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
192
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.1.2. Consultation crite
La consultation crite est peu utilise cause de son formalisme, du
nombre plus lev dabstentions, de son manque de rapidit. En dehors
de lapprobation annuelle des comptes, les statuts peuvent indiquer que
les dcisions peuvent tre prises par consultation crite des associs.
La procdure est alors la suivante.
1. Le grant adresse
1
aux associs le texte des rsolutions propo-
ses, son rapport, et, le cas chant, le rapport des commissaires
aux comptes.
2. Les associs votent
1
par crit 15 jours au moins compter de la
date de rception des documents.
3. Le grant tablit le procs-verbal en mentionnant que la consul-
tation a lieu par crit ; la rponse de chaque associ doit y tre
annexe.
2.1.3. Dcision des associs dans un acte
An de faciliter le suivi juridique des SARL, la loi Madelin a
introduit la dcision par consentement de tous les associs exprim
dans un acte (appel acte unanime ).
2. Soyez rigoureux : avant de consigner le procs-verbal sur le registre, vriez
que vous navez pas oubli de consigner une dcision antrieure (pointez les
dcisions qui sortent de la routine de lassemble annuelle : autorisation dune
convention rglemente entre la SARL et un grant ou un associ, autorisation
donne au grant pour un acte dpassant ses pouvoirs).
3. Si le procs-verbal est consign sur le registre avec une erreur ou une omission
dans sa rdaction, vous devez : rayer et numroter les mots nuls ; piquer un ren-
voi en marge ; ajouter dans cette marge ou en bas de page les mots ou membres
de phrases rectis ; faire parapher par le grant ; et, la n du procs-verbal,
rappeler le nombre de mots rays, nuls et ajouts bons et faire signer par le
grant cette mention.
4. Tout associ peut contester lexactitude dun procs-verbal.
1. Les statuts prcisent gnralement que les envois se font par lettre recommande.
/
La gestion et le contrle de la SARL
193
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les statuts doivent autoriser lacte unanime (la SARL doit ven-
tuellement modier ses statuts).
Lacte unanime ne peut pas tre utilis pour lapprobation
annuelle des comptes.
Lacte unanime ne peut pas tre utilis pour lapprobation dune
convention rglemente puisque lassoci intress ne peut pas
voter (il ny a donc pas unanimit).
Lacte unanime est conseiller quand la dcision prendre est le
complment dun acte (les cessions de parts entre vifs).
Lacte unanime peut tre mentionn sa date dans le registre des
procs-verbaux (la loi ne prvoit rien).
Le pouvoir dinformation des associs
2.2.1. Droit de communication permanent
Tout associ a le droit, toute poque et au sige social :
1. De prendre lui-mme connaissance et copie (sauf pour linven-
taire) des documents suivants : bilans, comptes de rsultat,
annexes, inventaires, rapports soumis aux assembles et procs-
verbaux de ces assembles concernant les trois derniers exercices.
Lassoci peut se faire assister dun expert judiciaire.
Dcision par acte unanime
Avantages Inconvnients
Permet de remplacer les assembles
fictives qui se tiennent uniquement
sur le papier , et qui exposent le grant
des sanctions pnales.
Permet de prendre des dcisions
rapidement car il ny a pas de convocation
dassemble ou de dlai de rponse en cas
de consultation crite.
Permet de rassembler en un acte unique
des dcisions ncessitant deux assembles
successives (autorisation puis dcision ;
dcision prise sous la condition suspensive
dune autre dcision).
Comme lassemble est obligatoire pour
lapprobation des comptes, plutt que de
recourir lacte unanime, il est plus simple
de complter lordre du jour de lassemble
ordinaire ou de convoquer une assemble
extraordinaire qui se tient immdiatement
aprs.
Lunanimit peut tre difficile obtenir.
Si les associs sont nombreux, le procd
est difficilement praticable.
La rdaction dun acte est plus difficile
que ltablissement dun procs-verbal.
Lintervention dun juriste est ncessaire.
2.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
194
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le grant qui ne met pas la disposition des associs ces
documents est passible dune amende de 9 000 .
De plus, un associ qui ne peut pas obtenir, avant une assem-
ble, des documents indispensables une prise de dcision en
connaissance de cause, pourrait contester en justice la validit
des dcisions prises par lassemble.
2. Dobtenir une copie certie conforme des statuts en vigueur
au jour de la demande. La socit doit annexer ce document la
liste des grants et, le cas chant, des commissaires aux comptes
en exercice. Elle peut exiger au maximum 30 .
Pas de sanction en cas de non-respect de ces dispositions (tout
intress peut sadresser au registre du commerce et des soci-
ts pour obtenir une copie des statuts).
2.2.2. Droit de communication temporaire
Pour les assembles, le grant doit communiquer certains documents
(voir page 193).
Le pouvoir de contrle des conventions entre la socit
et lun de ses grants ou associs
Le grant ou les associs peuvent conclure des conventions avec la
socit. Comme les intrts personnels du grant ou de lassoci, et les
intrts de la socit ne sont pas toujours convergents, ces conventions
sont soumises une procdure particulire (conventions rglemen-
tes). Cependant, si la convention porte sur des oprations courantes et
conclues des conditions normales, la procdure nest pas applicable
(conventions libres). Enn, certaines conventions sont interdites
peine de nullit (voir page 181).
Dans le doute, respectez la procdure dautorisation
Si vous ntes pas certain que la convention doit tre soumise au contrle des asso-
cis, par prudence, respectez la procdure dautorisation par les associs.
2.3.
Zoom n 64
La gestion et le contrle de la SARL
195
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.3.1. Les conventions libres
Une convention qui porte sur des oprations courantes et conclues
des conditions normales nest pas soumise au contrle des associs.
Oprations courantes : oprations effectues par la socit dune
manire habituelle dans le cadre de son activit.
Conditions normales : lopration ne comporte pas un gain exorbitant
ou des conditions exceptionnelles (clause dexclusivit, dlais excessi-
vement longs, remises anormalement avantageuses), au prot du
grant ou de lassoci, ou dune autre socit dont un des dirigeants est
aussi grant ou associ de la SARL concerne. Le caractre normal des
conditions consenties doit sapprcier en tenant compte des usages de
la socit, ou des socits du mme secteur dactivit.
2.3.2. Les conventions rglementes
La procdure de contrle par les associs sapplique si la convention
avec la SARL :
ne porte pas sur des oprations courantes et conclues des condi-
tions normales ;
est conclue avec le grant ou lun des associs, directement ou
par personne interpose ;
ou est conclue avec une autre socit dont un dirigeant est simul-
tanment grant ou associ de la SARL (dirigeant = associ ind-
niment responsable, grant, administrateur, directeur gnral,
membre du directoire ou membre du conseil de surveillance).
Une convention passe entre la SARL et le conjoint, les enfants ou les parents
du grant ou de lassoci est-elle soumise au contrle des associs ?
La convention passe entre la SARL et le conjoint, les ascendants ou les descen-
dants du grant ou de lassoci nest pas soumise au contrle des associs (ce
nest pas une convention rglemente). Le lien de parent nest pas sufsant, lui
seul, pour prouver lexistence dune prsomption dinterposition de personnes (il
y a interposition de personnes quand le grant ou lassoci est en fait le bn-
ciaire direct de la convention).
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
196
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Deux procdures sappliquent.
Autorisation pralable de la convention : cette procdure sapplique
uniquement quand la convention est passe entre la socit et le grant
non associ, et en labsence de commissaire aux comptes. Dans ce cas,
la convention est soumise lapprobation pralable de lassemble.
Autorisation a posteriori de la convention : cette procdure sapplique
dans tous les autres cas.
1. Comment se droule la procdure dautorisation par les associs ?
Un rapport spcial est prsent lassemble par le grant
Sil existe un commissaire aux comptes, celui-ci tablit le rap-
port. Le grant doit alors aviser le commissaire aux comptes
des conventions rglementes dans le dlai dun mois de leur
conclusion.
Lorsque lexcution de conventions conclues au cours dexer-
cices antrieurs a t poursuivie au cours du dernier exercice,
le commissaire doit tre inform de cette situation dans le
dlai dun mois compter de la clture de lexercice.
Le rapport est joint aux documents communiqus aux associs
en cas de consultation crite.
Lassemble peut tre lassemble annuelle ou toute autre
assemble.
Le rapport spcial doit tre adress aux associs 15 jours au
moins avant la date de lassemble, et tenu leur disposition
au sige social pendant le dlai de 15 jours qui prcdent
lassemble.
Lassemble statue sur le rapport spcial
Lassoci ou le grant qui a conclu la convention ne peut pas
prendre part au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la majorit.
Le vote se fait aux conditions de majorit requises pour les
dcisions ordinaires.
La preuve de linterposition de personnes est plus facile tablir pour des poux
maris sous un rgime de communaut des biens. Dans ce cas, il est prudent de
respecter la procdure dautorisation.
/
La gestion et le contrle de la SARL
197
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2. Que se passe-t-il si la convention nest pas approuve ?
Si les associs napprouvent pas la convention, elle produit nanmoins
ses effets.
Le grant et/ou lassoci contractant, peuvent tre condamns
supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les
consquences du contrat sil est prjudiciable la socit.
Il en est de mme si la convention est conclue entre la SARL et
une autre socit ds lors que le grant de la SARL est aussi diri-
geant de cette seconde socit.
Laction en responsabilit se prescrit par trois ans compter du
fait dommageable ou, sil a t dissimul, de sa rvlation (lors-
que le fait est quali crime, laction se prescrit par dix ans).
Le commissaire aux comptes nest pas obligatoire dans les
petites SARL. En effet, le commissaire aux comptes est obliga-
toire si la SARL dpasse la clture dun exercice social deux des
seuils suivants : 1 550 000 pour le total du bilan, 3 100 000 pour
Que doit contenir le rapport spcial
sur les conventions rglementes ?
Voir modle dans les supplments Internet
Lnumration des conventions soumises lapprobation de lassemble.
Le nom du grant ou des associs intresss.
La nature et lobjet desdites conventions.
Les modalits essentielles de ces conventions, notamment lindication des prix
ou tarifs pratiqus, des ristournes et commissions consenties, des dlais de
paiement accords, des intrts stipuls, des srets confres et, le cas
chant, toute autre indication permettant aux associs dapprcier lintrt qui
sattachait la conclusion des conventions analyses.
Limportance des fournitures livres ou des prestations de services fournies
ainsi que le montant des sommes verses ou reues au cours de lexercice en
excution desdites conventions.
3. Le commissaire aux comptes
Guide pratique de la SARL et de lEURL
198
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
le chiffre daffaires HT ou le nombre moyen de 50 salaris au cours
de lexercice. Une socit qui se cre na donc pas dsigner un
commissaire aux comptes.
Le comit dentreprise est obligatoire si leffectif est, au moins, de cin-
quante salaris. Le rle du comit dentreprise est essentiellement
consultatif.
Documents communiquer au comit dentreprise
avant lassemble dapprobation des comptes
Le grant doit communiquer au comit, avant leur prsentation
lassemble des associs, lensemble des documents obligatoirement
transmis aux associs et, le cas chant, le rapport du commissaire aux
comptes (voir page 189). Aucun dlai nest prcis : le comit doit
cependant disposer dun dlai dexamen sufsant.
Le comit peut :
mettre des observations sur la situation conomique et sociale
de lentreprise qui sont obligatoirement transmises lassemble
des associs en mme temps que le rapport du grant ;
convoquer le commissaire aux comptes pour recevoir ses expli-
cations sur les tats nanciers communiqus ainsi que sur la
situation nancire de lentreprise.
Expert-comptable du comit
An dexaminer les comptes annuels de lentreprise, le comit peut se
faire assister dun expert-comptable de son choix, rmunr par len-
treprise.
Le chef dentreprise ne participe pas au vote lorsque le comit
dlibre sur le choix de lexpert-comptable.
4. Le comit dentreprise
4.1.
4.2.
La gestion et le contrle de la SARL
199
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Lexpert-comptable claire le comit sur les comptes et la situation
de lentreprise. Il a accs aux mmes documents que le commis-
saire aux comptes. Il est tenu au secret professionnel.
Lexpert-comptable est rmunr par lentreprise. Tout litige sur
sa rmunration est soumis au prsident du tribunal de grande
instance.
Le comit peut galement se faire assister par un expert-comptable :
dans la limite de deux fois par exercice, pour lexamen des docu-
ments dinformation nancire et prvisionnelle (si la socit est
tenue de les tablir, elle doit les communiquer au comit, ainsi
que le rapport du commissaire aux comptes) ;
et une fois par exercice dans le cadre de la procdure dalerte
dclenche par le comit (voir page 262).
Modications de lorganisation conomique
ou juridique de lentreprise
Le comit est inform et consult sur les modications de lorganisation
conomique ou juridique de lentreprise, notamment en cas de fusion,
de cession, de modication importante des structures de production de
lentreprise, ainsi que lors de lacquisition ou de la cession de liales.
Le grant doit indiquer les motifs des modications projetes et
consulter le comit sur les mesures qui sont envisages lgard
des salaris lorsque ces modications comportent des cons-
quences pour ceux-ci.
Le grant est galement tenu de consulter le comit dentreprise
lorsquil prend une participation dans une socit et de linfor-
mer lorsquil a connaissance dune prise de participation dont
son entreprise fait lobjet.
Prvention des difcults des entreprises
Le comit dentreprise dispose de prrogatives dans le cadre de la pr-
vention des difcults des entreprises. Elles seront examines dans la
partie La prvention et le traitement des difcults nancires de la
SARL , page 255.
4.3.
4.4.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
200
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dans les six mois de la clture de lexercice, lassemble gnrale ordi-
naire doit approuver les comptes de lexercice coul et dcider de
laffectation du rsultat. Cest ltape nale dun long processus qui
commence par ltablissement des comptes, se poursuit par leur contrle
par le commissaire aux comptes (sil en existe un), leur arrt par le
grant, et enn, leur prsentation aux associs.
tablissement des comptes annuels
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de rsultat et
lannexe.
Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de len-
treprise, et fait apparatre, de faon distincte, les capitaux propres
(cest ltat du patrimoine de lentreprise : ce quelle possde
moins ce quelle doit).
Le compte de rsultat rcapitule les produits et les charges de
lexercice, sans quil soit tenu compte de leur date dencaissement
ou de paiement. Il fait apparatre, par diffrence aprs dduction
des amortissements et des provisions, le bnce ou la perte de
lexercice. Les produits et les charges, classs par catgorie, doi-
vent tre prsents soit sous forme de tableaux, soit sous forme de
liste.
Lannexe complte et commente linformation donne par le bilan
et le compte de rsultat.
moins quun changement exceptionnel nintervienne dans la situa-
tion de lentreprise, la prsentation des comptes annuels comme les
mthodes dvaluation retenues ne peuvent tre modies dun exer-
cice lautre. Si des modications interviennent, elles sont dcrites et
justies dans lannexe.
5. La dtermination et laffectation
du rsultat
5.1.
La gestion et le contrle de la SARL
201
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le rapport de gestion
Le rapport de gestion est un instrument de communication entre le
grant et les associs. Le rapport de gestion doit exposer la situation de
la socit durant lexercice coul, son volution prvisible, ses activi-
ts en matire de recherche et de dveloppement et les vnements
importants survenus entre la date de clture de lexercice et la date
dtablissement du rapport.
Prsentation simplie des comptes annuels
Cette possibilit est perdue lorsque les conditions ne sont pas remplies
pendant deux exercices successifs.
Prsentation simplie
Si ne sont pas dpasss la clture de lexercice
deux des trois critres suivants
du bilan et du compte
de rsultat
total du bilan : 267 000
montant net du chiffre daffaires : 534 000
nombre moyen de salaris permanents employs
au cours de lexercice : 10
de lannexe total du bilan : 2 M
montant net du chiffre daffaires : 4 M
nombre moyen de salaris permanents employs
au cours de lexercice : 50
Quelques conseils pour ltablissement du rapport de gestion
Toute personne, y compris un concurrent, peut prendre connaissance du rap-
port de gestion au greffe du tribunal. Le grant devra tre guid par un souci de
condentialit an de ne pas dvoiler les projets stratgiques de lentreprise
(projets commerciaux).
Cependant, le rapport de gestion doit tre un vecteur dinformation privilgi et
non une contrainte. Cest loccasion pour le grant de faire le point, avec le recul
ncessaire, sur lactivit de lanne coule, les difcults rencontres et les
progrs raliss an de dnir une stratgie sur lavenir de lentreprise.
Lexpos de la conjoncture conomique densemble et de la conjoncture du sec-
teur auquel appartient lentreprise permettra dclairer les conditions dans les-
quelles sest droule lactivit de la socit pendant lexercice coul.
Soyez mesur pour les perspectives davenir, an dviter que lvolution ult-
rieure des faits contredise votre pronostic.
5.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
202
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le rapport de gestion doit aussi comporter un certain nombre de men-
tions obligatoires (voir modle dans les supplments Internet).
1. Filiales, participations et socits contrles
Le rapport doit mentionner toute prise de participation
1
et 2
dans
une socit ayant son sige social en France.
Le rapport doit rendre compte de lactivit et des rsultats de
lensemble de la socit et de ses liales, ventils par branche
dactivit.
Le rapport doit indiquer les participations rciproques.
2. Autres mentions
Changement de prsentation et de mthode dvaluation des
comptes annuels.
Montant des trois dividendes prcdents et des avoirs scaux
correspondants et/ou montant des dpenses non dductibles
scalement (uniquement pour les SARL soumises limpt sur
les socits, lexclusion des SARL de famille qui ont opt pour
le rgime scal des socits de personnes).
Dcision dinjonction ou de sanction du Conseil de la concur-
rence en cas de pratique anticoncurrentielle.
Rapport sur la gestion du groupe, le cas chant.
Le rapport de gestion doit :
tre mis la disposition du commissaire aux comptes un mois
avant la date de lassemble ;
tre adress aux associs quinze jours au moins avant la date
de lassemble ;
tre dpos en double exemplaire au greffe du tribunal de com-
merce dans le mois de lapprobation des comptes.
3. Sanctions pnales
Dfaut dtablissement du rapport de gestion : amende de 9 000 .
1. En cas dinfraction commise sciemment, le grant est passible dun emprison-
nement de deux ans et/ou une amende de 9 000 .
2. Il sagit des prises de participation initiales et ultrieures qui reprsentent plus
du vingtime, du dixime, du cinquime, du tiers, de la moiti ou des deux tiers
du capital ou des droits de vote aux assembles gnrales de cette socit.
La gestion et le contrle de la SARL
203
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Ne pas soumettre le rapport lassemble : emprisonnement de
six mois et/ou amende de 9 000 .
Lapprobation des comptes
Les comptes de lexercice sont approuvs par une assemble ordinaire
des associs. Dans cette partie, seront dveloppes uniquement les
spcicits de lassemble dapprobation des comptes. Pour dautres
informations sur les assembles, se reporter page 183.
Lassemble qui statue sur les comptes doit tre runie dans les
six mois de la clture de lexercice.
Seule une assemble peut approuver les comptes.
dfaut, le grant peut voir engage sa responsabilit civile (il
est responsable du prjudice subi par les associs du fait du
retard apport lassemble), et sa responsabilit pnale mme si
le retard est involontaire (emprisonnement de six mois et/ou
amende de 9 000 ).
Le dlai de six mois peut tre prolong par dcision du prsident
du tribunal de commerce. La requte en vue de la prolongation du
dlai de six mois doit tre prsente avant lexpiration du dlai de
six mois (voir modle dans les supplments Internet). dfaut, le
dlit de runion tardive de lassemble annuelle est constitu.
Lassemble des associs peut approuver les comptes ou les modier.
Ds que les comptes sont approuvs, ils ne peuvent tre rectis quen
cas derreur, omission ou double emploi.
Lapprobation des comptes est souvent suivie du vote dun quitus
donn au grant pour laccomplissement de son mandat au cours de
Le grant doit bien respecter le formalisme de lassemble
dapprobation des comptes
Il est passible de sanctions pnales en cas de non-respect du calendrier lgal
dapprobation des comptes annuels.
5.3.
Zoom n 65
Guide pratique de la SARL et de lEURL
204
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
lexercice en question. Ce quitus na pas beaucoup de valeur car
aucune dcision des associs ne peut teindre une action en responsa-
bilit contre le grant pour une faute commise dans laccomplissement
de son mandat.
La publicit des comptes
La SARL doit dposer, dans le mois qui suit lapprobation des comptes
annuels par lassemble des associs, en double exemplaire, et au
greffe du tribunal :
les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du commis-
saire aux comptes (les mmes documents pour les comptes conso-
lids, le cas chant) ;
la proposition daffectation du rsultat soumise lassemble et
la rsolution daffectation vote ;
une copie de la dlibration de lassemble en cas de refus
dapprobation par les associs.
Les documents dposs doivent tre certis conformes par le grant
(le dpt doriginaux nest pas obligatoire).
Le dpt des comptes annuels cote autour de 40 en fonction du tri-
bunal de commerce.
Si le grant ne dpose pas les comptes annuels, il est passible dune
amende de 1 500 , et en cas de rcidive, dune amende de 3 000 .
Tout intress peut demander, ses frais, copie ou extrait des documents
qui ont t dposs au registre du commerce et des socits.
Laffectation des rsultats
Par souci de souplesse, les statuts doivent viter
de prvoir une rserve statutaire
En effet, cette rserve devant tre constitue obligatoirement, si les associs souhai-
tent y droger, la dcision devra tre prise dans les conditions requises pour une
modication des statuts.
5.4.
5.5.
Zoom n 66
La gestion et le contrle de la SARL
205
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les associs approuvent les comptes de lexercice, et dcident de
laffectation du rsultat selon quil sagit dun bnce ou dune perte.
Le bnce peut tre distribu aux associs sous forme de dividendes,
ou conserv dans lentreprise (il est mis en rserve ) pour nancer
son dveloppement (cest lautonancement qui lui vite demprun-
ter). Certaines rserves doivent tre obligatoirement constitues.
La perte est impute sur les rserves ou reporte an dtre impute
sur les bnces des exercices futurs. La gestion scale du dcit est
tudie page 232.
5.5.1. Laffectation des bnces
La SARL qui ralise un bnce peut :
le mettre en rserve an de contribuer lautonancement de
lentreprise ;
le distribuer aux associs sous forme de dividendes : cest la
rmunration de largent que lassoci a investi dans la SARL
(en contrepartie des risques quil prend, il espre un prot) ;
le distribuer sous forme de dividendes en parts sociales et per-
mettre ainsi de satisfaire la fois lautonancement et la distribu-
tion dun dividende.
1. Quelques dnitions
Le bnfice de lexercice est la diffrence entre les produits (ventes)
et les charges (achats, loyers) de lexercice aprs dduction des
amortissements (usure du matriel) et des provisions (client qui ris-
que de ne pas payer). Le bnce apparat sur le compte de rsultat.
Le bnfice distribuable est le bnce qui peut tre distribu aux
associs. Il est constitu :
du bnce de lexercice ;
diminu des pertes antrieures (la socit ne peut distribuer que
ce quelle a gagn, il faut donc quelle ponge les pertes du
pass avant de distribuer les bnces actuels) ;
diminu des sommes porter en rserve en application de la loi
(la rserve lgale), ou des statuts (la rserve statutaire) ;
et augment du report bnciaire (bnces dexercices prc-
dents qui nont pas t affects en rserves).
Guide pratique de la SARL et de lEURL
206
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les sommes distribuables sont le montant maximum que lentreprise
peut distribuer. Le montant distribuable est :
le bnce distribuable ;
et les rserves dont lassemble gnrale a la disposition.
Lorsque lassemble dcide la distribution de sommes prleves sur
les rserves, la dcision de distribution doit indiquer expressment les
postes de rserve sur lesquels les prlvements sont effectus. Les
dividendes doivent tre prlevs par priorit sur le bnce distribuable
de lexercice.
2. Les rserves qui doivent tre constitues
La dotation la rserve lgale
Aprs avoir imput ventuellement les pertes antrieures, un pr-
lvement dun vingtime au moins sur les bnfices de lexercice
doit tre effectu, et affect la formation dun fonds de rserve
appel rserve lgale (cest la dotation la rserve lgale ).
Le prlvement au prot de la rserve lgale cesse dtre obli-
gatoire ds que la rserve lgale atteint le dixime du capital
(il doit recommencer en cas daugmentation du capital jusqu
ce que la nouvelle limite soit atteinte).
Toute dcision contraire des associs est nulle.
Rserves statutaires et rserves facultatives
Le principe est le mme que pour la rserve lgale : la socit ne
distribue pas tout son rsultat, mais bloque une partie de celui-ci
sur un compte de rserve.
La rserve est statutaire quand les statuts imposent daffecter
un pourcentage des bnces une rserve.
Exemple chiffr
Une SARL au capital de 7 500 a un bnce comptable de 1 500 . Sur ce bn-
ce comptable, il faut prlever au moins 75 (1 500 5 %) pour doter la rserve
lgale. Ds que la rserve lgale atteint 750 (7 500 10 %), la dotation la
rserve lgale cesse dtre obligatoire.
Cas n 25
La gestion et le contrle de la SARL
207
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Une dcision extraordinaire, prise dans les conditions requises pour une modi-
cation des statuts, peut la rendre distribuable.
La rserve est facultative quand les statuts prvoient la possibi-
lit de doter par prlvement sur les bnces un ou plusieurs
fonds de rserves an daugmenter le fonds de roulement de la
socit, dassurer sa politique dinvestissement, de faire face
des pertes ventuelles
3. Les rserves qui peuvent tre distribues aux associs
4. Fixation et paiement des dividendes
Aprs approbation des comptes annuels et constatation de lexistence
de sommes distribuables, lassemble gnrale des associs dtermine
le montant des dividendes :
Toute somme qui serait distribue sans respecter cette procdure
est un dividende fictif.
Il est interdit de stipuler un intrt xe ou intercalaire au prot
des associs.
Les statuts peuvent prvoir lattribution, titre de premier divi-
dende, dun intrt calcul sur le montant libr et non rem-
bours des actions.
Nature de la rserve
Seules les rserves dont lassemble a la disposition
peuvent tre distribues.
Peut tre
distribue
Oui Non
Rserve lgale
montant de la rserve infrieure au dixime du capital social
partie de la rserve suprieure au dixime du capital social
(dotation excdentaire, ou rduction du capital) X
X
Rserve statutaire
montant de la rserve infrieure au montant impos par les statuts
1
partie de la rserve suprieure au montant impos par les statuts
transformation de la rserve statutaire en rserve ordinaire la suite
dune dcision extraordinaire des associs
X
X
X
Rserve facultative X
Primes dmission, dapports ou de fusion X
Guide pratique de la SARL et de lEURL
208
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Bnce aprs amortissements et provisions, dduction faite, sil y a lieu, des
pertes antrieures ainsi que des sommes porter en rserve en application de la
loi ou des statuts et augment du report bnciaire.
Les modalits de paiement des dividendes sont dtermines par
lassemble gnrale ou, dfaut, par le grant :
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un dlai
de neuf mois aprs la clture de lexercice.
La prolongation de ce dlai peut tre accorde par le prsident du
tribunal de commerce, la demande du grant (suite des dif-
cults de trsorerie, par exemple).
Les dividendes sont pays en espces. Ils peuvent tre rgls par
lattribution de parts sociales, la suite dune augmentation de
capital.
Si lassoci ne rclame pas son dividende dans un dlai de
cinq ans, il appartient la SARL (le dlai de prescription pour une
distribution non priodique rpartition de rserves par exemple
est cependant de 30 ans).
Des acomptes sur dividendes peuvent tre distribus avant lapproba-
tion des comptes de lexercice :
un bilan tabli au cours ou la n de lexercice et certi par un
commissaire aux comptes doit faire apparatre que la socit,
depuis la clture de lexercice prcdent, a ralis un bnce
1
;
le montant des acomptes ne peut pas tre suprieur au montant de
ce bnce.
cest le grant qui dcide de distribuer un acompte sur dividendes.
Il xe le montant et la date du paiement.
Les dividendes pays aux associs peuvent-ils tre remis en cause ?
Les dividendes rgulirement distribus et pays sont dnitivement acquis aux
associs qui ne peuvent pas tre contraints de les reverser la socit, mme si
celle-ci subit des pertes par la suite.
Cependant, les associs peuvent tre tenus de reverser les dividendes sils ne cor-
respondent pas des bnces rellement acquis, mme si les associs sont de
bonne foi. Laction en rptition se prescrit par le dlai de trois ans compter de la
mise en distribution des dividendes.
Zoom n 67
La gestion et le contrle de la SARL
209
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
5.5.2. Laffectation des pertes
La perte de lexercice est reporte nouveau ou impute sur les rser-
ves ou sur le capital. Au niveau scal, elle permettra une conomie
dimpt sur les socits par son imputation sur les bnces des exer-
cices futurs, ou passs, de la socit (voir page 232).
Imputation sur des rserves : la perte peut tre impute sur les rser-
ves, y compris la rserve lgale, puisquune rserve a pour objet de
faire face des pertes. Si la rserve utilise pour imputer la perte a
bien support limpt sur les socits, les pertes ainsi compenses
demeurent scalement dductibles des bnces des cinq exercices
suivants.
Imputation sur des primes : limputation du dcit sur des primes
dmission ou des primes dapports est possible et permet de bn-
cier du report scal du dcit.
Imputation sur le capital : limputation des pertes sur le capital entrane
une rduction du capital, et doit donc tre dcide par une assemble
extraordinaire des associs.
Les oprations ralises par une SARL sont imposables la TVA car
elle a la qualit dassujetti la TVA. La TVA est un impt que supporte
uniquement le consommateur nal. La TVA est donc une taxe totale-
ment neutre pour lentreprise :
elle reverse au Trsor la TVA quelle encaisse sur ses ventes ;
elle rcupre auprs du Trsor la TVA quelle paie sur ses
achats.
La rcupration sopre par imputation. Lentreprise fait la soustrac-
tion entre la taxe exigible (la TVA sur les ventes) et la taxe dductible
(la TVA sur les achats) au titre de chaque mois ou de chaque tri-
mestre :
si le solde est positif, le montant en est vers au Trsor ;
6. La gestion scale de la TVA
Guide pratique de la SARL et de lEURL
210
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
si le solde est ngatif, il constitue un crdit de TVA qui est repor-
table sur la TVA des mois suivants jusqu puisement sans limi-
tation de dlai. De plus, lentreprise peut en demander le
remboursement.
Quand la TVA sur une vente est exigible, elle doit tre reverse au Trsor
public. Symtriquement, la TVA supporte par le client peut alors tre
rcupre. Lexigibilit de la TVA dpend de la nature de lopration.
Le rgime dimposition la TVA applicable lentreprise dpend de
son chiffre daffaires et de son secteur dactivit comme en matire
dimposition des bnces.
Lexigibilit de Ia TVA dpend de la nature de lopration
Lexigibilit de la TVA dpend de la nature de lopration
Nature des oprations ralises Date dexigibilit
Ventes de marchandises. Livraison du bien. Par simplification, on retient la date
de facturation.
Prestations de services et travaux
immobiliers.
Encaissement du prix ou des acomptes.
Facturation si option pour le paiement de la TVA
daprs les dbits .
Faut-il opter pour les dbits ?
Quand la TVA est paye daprs les dbits la date dexigibilit nest pas lencaissement
mais la facturation. Ainsi, quand lentreprise vend un service, la TVA collecte sur la vente est
exigible quand la facture est mise et non au moment de lencaissement. Lautorisation de
paiement de la TVA daprs les dbits doit obligatoirement tre mentionne sur toutes les
factures. En cas davances ou dacomptes, la TVA redevient exigible sur les encaissements :
lentreprise doit alors payer la TVA sur le montant de lacompte mme si lentreprise a opt
pour le paiement daprs les dbits.
Lautorisation de payer la TVA daprs les dbits facilite la gestion des entreprises qui
ralisent des ventes et des prestations de services, car toute la TVA est exigible au moment
de la facturation quelle que soit la nature de lopration ralise. Par contre, elle noptimise
pas la gestion de trsorerie car le paiement de la TVA intervient beaucoup plus rapidement.
6.1.
La gestion et le contrle de la SARL
211
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les rgimes dimposition Ia TVA de la SARL
La TVA europenne
La rception ou lenvoi de marchandises un client install dans un autre tat
europen sont soumis un rgime scal particulier qui se caractrise notamment
par lexonration des ventes intracommunautaires et limposition des acquisitions
intracommunautaires.
Lorsquune entreprise franaise envoie des marchandises un client install dans
un autre tat europen, elle ralise une livraison intracommunautaire qui est
nest pas soumise la TVA en France, condition que lentreprise cliente soit elle
aussi soumise la TVA dans son pays et que le fournisseur franais justie que les
biens vendus ont effectivement quitt la France.
Larrive en France de marchandises provenant dun autre pays europen consti-
tue une acquisition intracommunautaire . Exonre dans le pays de dpart,
elle est soumise en France la TVA (au taux de 19,60 % ou 5,50 % selon les
biens). La taxe est due par le client franais. Il doit la verser son centre des
impts au plus tard le 15 du mois suivant celui de la livraison.
Les factures correspondant des ventes en Europe doivent comporter les men-
tions gnrales habituelles, le numro didentication intracommunautaire la
TVA et la mention exonration de TVA, article 262 ter-I du CGI .
Tous les mois, une dclaration rcapitulative appele dclaration dchanges
des biens (DEB) doit tre envoye.
Les prestations de services suivent un autre rgime.
Les rgimes dimposition la TVA de la SARL
Les rgimes dimposition dpendent du chiffre daffaires
annuel HT et du secteur dactivit.
Vous pouvez toujours opter pour le rgime du seuil suprieur.
Pas de rgime auto-entrepreneur et micro-entreprise pour la SARL !
Secteur
dactivit
Ventes
Prestations de services
et professions librales
Rel normal
CA annuel HT suprieur
763 000
CA annuel HT suprieur
230 000
Rel simplifi
CA annuel infrieur
763 000
CA annuel infrieur
230 000
6.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
212
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dclaration et paiement de la TVA
Dclarations et paiement de la TVA
Les modalits de dclaration et de paiement de la TVA varient selon
que la SARL relve du rgime du rel normal ou du rel simpli.
Rgime du
rel normal
Lentreprise doit adresser tous les mois
1
lAdministration une dclaration CA 3
dtaillant la TVA encaisse au cours du mois coul, ainsi que la TVA dductible :
si le solde est positif, lentreprise acquitte aussitt la TVA nette dont elle est redevable
2
;
si le solde est ngatif, elle dgage un crdit reportable
3
les mois suivants.
Rgime du
rel simpli
Lentreprise calcule la TVA quelle doit pour lanne N uniquement au dbut de lanne
N + 1. Cependant, au cours de lanne N elle paie quatre acomptes de TVA calculs
sur la TVA due au titre de lanne N-1. Si les acomptes pays en N sont insufsants
par rapport la TVA due au titre de N, elle paie le complment.
1. Paiement dacomptes trimestriels
Durant lanne N, lentreprise paie quatre acomptes trimestriels
4
calculs sur la TVA due
au titre de lanne N-1 avant dduction de la TVA sur immobilisations selon lchancier
suivant.
6.3.
Date dexigibilit Avril Juillet Octobre Dcembre
En % de la base 25 % 25 % 25 % 20 %
1. La dclaration peut tre trimestrielle si les sommes dues annuellement sont
infrieures 1 830 .
2. La dclaration doit tre dpose la n de chaque priode mensuelle ou tri-
mestrielle entre le 15 et le 19 du mois suivant, selon lordre alphabtique (pre-
mire lettre du nom de lexploitant). Le paiement doit tre effectu lors du
dpt de la dclaration. Un paiement diffr est possible grce aux obligations
cautionnes.
3. Quand une entreprise se trouve en situation de crdit de taxe, elle peut en
demander le remboursement le 31 dcembre si le crdit est au moins de 150 ;
en n de trimestre si le remboursement demand est au moins de 760 .
4. Le premier acompte peut tre calcul partir de la TVA due de N-2 si la TVA
due de N-1 nest pas encore connue. Pour les nouveaux redevables, la TVA
peut tre acquitte par des acomptes dont ils dterminent eux-mmes le mon-
tant, chaque acompte devant toutefois reprsenter au moins 80 % de la taxe
rellement due pour le trimestre prcdent. Une modulation des acomptes est
possible pour tenir compte de lvolution relle du chiffre daffaires. Le rede-
vable peut se dispenser de nouveaux versements lorsquil estime que le total
des acomptes dj verss est gal ou suprieur au montant qui sera nalement
d. II devra remettre au Trsor public une dclaration date et signe.
/
La gestion et le contrle de la SARL
213
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Calcul et dclaration de la TVA au rel normal
Rgime du
rel simpli
2. Dclaration annuelle de la TVA
Au dbut de lanne N + 1, lentreprise dclare la TVA collecte et la TVA dductible de
lanne N sur un imprim CA 12 adresser lAdministration au plus tard le 30 avril
N + 1. Lentreprise compare alors la TVA due au titre de N et les acomptes provisionnels
quelle a pays en N. En cas dinsuffisance, le solde est pay au Trsor. Lexcdent
ventuel constitue un crdit reportable.
Dclaration de TVA en ligne
Sur le site www.mine.gouv.fr vous pouvez dclarer et payer en ligne votre TVA
1
grce la procdure dchange de formulaires informatis (EFI). La procdure de
lEDI (change de donnes informatis) est une procdure de transmission de
chiers. Vous devez alors utiliser les services dun prestataire spcialis qui trans-
mettra vos dclarations de TVA pour votre compte. Vous pouvez aussi devenir vous-
mme partenaire EDI et mettre pour votre compte. Les chiers transmis respectent
la norme technique EDIFACT.
Calcul et dclaration de la TVA au rel normal
La SARL Espranza exerce une activit de distribution partir de son site Internet. Elle
est impose selon le rgime rel. Elle vous communique les informations suivantes
pour le mois de mai.
Calculer la TVA due pour le mois de mai et tablir la dclaration CA 3.
6.4.
Zoom n 68
Cas n 26
/
Lentreprise qui, au titre de lexercice prcdent, a pay moins de 1 000 de
TVA (hors TVA dductible sur immobilisations), est dispense de verser les
4 acomptes de TVA. Elle peut se contenter de payer, en une seule fois, la TVA
due au moment de dpt de la dclaration annuelle.
1. Si vous nutilisez pas ces procdures, veillez bien respecter les dates limites.
Cest la date de la rception de la dclaration qui est retenue par lAdministra-
tion. Vous devez donc tenir compte des dlais normaux dacheminement du
courrier. Sil sagit du dernier jour, il est plus prudent daller dposer la dclara-
tion sur place. Cependant, pour la dclaration personnelle de revenus et la dcla-
ration des rsultats adresses par La Poste, cest la date du cachet qui fait foi.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
214
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les informations complmentaires concernant le mois de mai
Ce quil faut savoir pour tablir la dclaration CA 3
La vente au Japon (hors UE) est une exportation exonre de TVA.
La vente en Allemagne (dans lUE) est une livraison intra-commu-
nautaire exonre de TVA.
Lachat en Espagne (dans lUE) est une acquisition intra-commu-
nautaire qui est imposable la TVA. Comme la TVA ne peut pas
tre paye au moment du ddouanement (il ny a pas de frontires
lintrieur de lUE), lentreprise collecte la TVA pour le compte
de ltat et la dduit immdiatement. La TVA sur acquisitions
intra-communautaires se retrouve donc en TVA collecte et TVA
dductible.
Ventes de mai
Ventes en France 19,60 %
Ventes en France 5,50 %
Ventes en Allemagne
Ventes au Japon
Camion doccasion
HT
80 000
20 000
10 000
20 000
4 000
Achats de mai
Ordinateurs
Achats en France
Achats en Espagne
Prestations de services payes
10 000
40 000
8 000
5 000
Crdit de TVA reportable davril 1 200
Calcul de la TVA payer pour le mois de mai N et tablissement de la CA 3
TVA collecte 19,60 % HT TVA
Ventes en France
Cession dimmobilisations
Achats intracommunautaires
80 000
4 000
8 000
92 000 18 032
TVA collecte 5,50 %
Ventes en France 20 000
20 000 1 100
19 132
La gestion et le contrle de la SARL
215
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La dclaration remplie est prsente dans les supplments Internet.
Vous pouvez la remplir sur le site www.impots.gouv.fr
Calcul et dclaration de la TVA au rel simpli
Les informations complmentaires sont les mmes que celles du
cas n 26 page 213.
Lire galement Ce quil faut savoir pour tablir la dclaration
page 214.
TVA dductible HT TVA
Sur immobilisations
Sur autres biens et services
achats en France
achats intra-communautaires
10 000
45 000
8 000
1 960
63 000 10 388
Crdit de TVA 1 200
13 548
TVA payer 5 584
Oprations imposables
Ventes
Autres oprations imposables
Acquisitions intra-communautaires
100 000
4 000
8 000
Oprations non imposables
Exportations
Livraisons intra-communautaires
20 000
10 000
Calcul et dclaration de la TVA au rel simpli
La SARL Espranza exerce une activit de distribution partir de son site Internet.
Elle est impose selon le rgime du rel simpli. Les acomptes pays en N slvent
6 000 . Elle vous communique les informations suivantes pour lanne N.
Calculer la TVA due pour lanne N et tablir la dclaration CA 12.
Calculer les acomptes payer en N + 1.
6.5.
Cas n 27
Guide pratique de la SARL et de lEURL
216
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La dclaration remplie est prsente dans les supplments Internet.
Vous pouvez la remplir sur le site www.impots.gouv.fr
Calcul de la TVA payer pour lanne N et tablissement de la CA 12
TVA collecte 19,60 % HT TVA
Ventes en France
Achats intra-communautaires
80 000
8 000
88 000 17 248
TVA collecte 5,50 %
Ventes en France 20 000
20 000 1 100
18 348
TVA dductible sur biens et services HT TVA
achats en France
achats intra-communautaires
45 000
8 000
53 000 9 784
8 564
TVA sur immobilisations 1 960
TVA due
TVA sur cession dimmobilisation
6 604
784
7 388
Acomptes pays en N 6 000
TVA payer le 30 avril N + 1 1 388
Oprations non imposables
Base des acomptes 8 564
Date des acomptes 04/N + 1 07/N + 1 10/N + 1 12/N + 1
Montant en % 25 % 25 % 25 % 20 %
Montant en euros 2 141 2 141 2 141 1 712
La gestion et le contrle de la SARL
217
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le rgime dimposition de la SARL
7.1.1. Les modalits dimposition
Le bnce de la SARL est soumis limpt sur les socits (IS
rgime scal des socits de capitaux). Cependant, la SARL de famille,
la jeune SARL et lEURL peuvent tre imposes limpt sur le
revenu (IR rgime scal des socits de personnes voir page 231).
7.1.1.1. SARL soumise limpt
sur les socits : lopacit scale
Le bnce ralis par la SARL est soumis limpt sur les socits
au taux de 33
1/3
% ou de 15 % pour une petite SARL. Cependant, les
plus-values professionnelles long terme sur cession de titres de parti-
cipation sont exonres dimposition
1
. Les bnces raliss par la
SARL sont imposs quelle que soit leur affectation (mise en rserve,
distribution). Tant que ces bnces restent investis dans lentre-
1. La plus-value nette est long terme si les titres sont dtenus depuis plus de
deux ans.
7. La gestion scale de limposition des bnces
7.1.
SARL lIR
Transparence fiscale
Bnfice impos lIR
au niveau des associs
Dividende non impos
chez lassoci
Activit
professionnelle
SARL lIS
Opacit fiscale
Bnfice impos lIS
au niveau de la socit
Dividende impos chez
lassoci en RCM
Guide pratique de la SARL et de lEURL
218
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Cas dun associ personne physique.
2. Si lassoci est une socit soumise IIS, le dividende est impos lIS en
tant que produit nancier. Dans ce cas, le rgime des socits mres tend att-
nuer la double imposition.
3. SARL de famille ou jeune SARL qui a opt pour lIR ; EURL qui na pas opt
pour IIS.
4. BA (bnces agricoles) pour une activit agricole ; BNC (bnces non commer-
ciaux) pour une activit librale.
prise, ils ne supportent aucune autre imposition. Lorsque les bnces
sont distribus, les associs sont imposs sur le dividende encaiss
(voir page 243).
7.1.1.2. SARL soumise limpt sur le revenu :
la transparence scale
a) Modalits dimposition : la transparence scale
Dans une SARL de famille ou une jeune SARL qui a opt pour
limpt sur le revenu, lassoci est soumis limpt sur le revenu sur
sa quote-part de bnce, majore de la rmunration qui peut lui tre
attribue dans la socit au titre de ses fonctions (le bnce est sou-
mis limpt sur le revenu dans la catgorie BIC bnces indus-
triels et commerciaux
4
dans la dclaration densemble des revenus).
Il est donc dans la mme situation quun entrepreneur individuel.
Modalits dimposition du bnce de la SARL suivant son rgime scal
SARL soumise Bnce de la SARL Dividendes aux associs
limpt
sur les socits
Le bnfice est impos au niveau
de la SARL au taux de 33
1/3
% ou
de 15 % pour une petite SARL.
Les dividendes sont imposs
au niveau des associs dans la
catgorie des revenus mobiliers
1
.
Un abattement de 40 % permet
dattnuer la double imposition
2
.
limpt
sur le revenu
3
Le bnfice est soumis directement au niveau des associs
limpt sur le revenu dans la catgorie des bnfices industriels
et commerciaux (BIC).
En cas de distribution, les dividendes ne sont pas imposables
au niveau des associs puisque lintgralit du bnfice a dj t
taxe limpt sur le revenu.
La gestion et le contrle de la SARL
219
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les bnces sont donc soumis au niveau de lassoci limpt sur le
revenu mme sils ne sont pas distribus : en fait, lassoci est rput
avoir la disposition des bnces sociaux ds la clture de lexercice,
mme sils sont mis en rserve et rinvestis dans lentreprise.
Comme un exploitant individuel impos selon un rgime de bnce
rel, lassoci peut adhrer un centre de gestion agr
1
. Ladhsion
permet dviter une majoration de 25 % de son bnce imposable
(voir page 292).
Si la SARL distribue des dividendes aux associs, ils ne sont pas
imposs car ils correspondent des bnces qui ont dj t soumis
chez lassoci limpt sur le revenu.
b) SARL de famille qui opte pour lIR
La SARL peut opter pour limpt sur le revenu (rgime scal des
socits de personnes) si elle exerce une activit industrielle, com-
merciale, artisanale ou agricole et si elle a un caractre familial
(SARL forme uniquement entre personnes parentes en ligne directe,
ou entre frres et surs, ainsi que les conjoints). La socit peut com-
prendre soit des parents en ligne directe, soit des frres et surs, soit
des conjoints ou simultanment des membres de lun et lautre de ces
groupes. Mais chacun des associs doit tre directement uni aux autres
soit par des liens de parent directe ou collatrale jusquau deuxime
degr, soit par le mariage. Ainsi, la SARL ne peut pas bncier du
rgime des socits de personnes si elle est constitue entre deux
frres et le ls de lun deux, ou entre deux beaux-frres. Les acti-
vits librales sont donc exclues.
La SARL qui dsire opter pour lIR compter dun exercice dtermin
doit notier son option avant la date douverture de cet exercice au ser-
vice des impts auprs duquel doit tre souscrite la dclaration des
rsultats. La notication doit tre signe par tous les associs. La
SARL peut rvoquer loption ; elle est alors soumise au rgime scal
des socits de capitaux. Elle na plus le droit dopter nouveau.
Loption cesse ses effets si la SARL perd son caractre familial.
1. Association agre de gestion (AAG) pour une activit BNC. Les Associations
de gestion comptabilit (AGC) inscrites lOrdre des experts-comptables peu-
vent tenir la comptabilit des entreprises.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
220
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
c) Jeune SARL qui opte pour lIR
Une jeune et petite SARL peut opter pour limpt sur le revenu
(IR) pour une dure de cinq exercices (CGI art 239 bis AB sur
http://www.legifrance.gouv.fr). Le bnce de la SARL est alors
directement impos au niveau des associs lIR. Cette transparence
permet dimputer les dcits de la SARL pendant le dbut dactivit
sur les autres revenus imposables des associs (salaires, revenus fon-
ciers) et de raliser ainsi une conomie dIR. De plus, les associs
bncient quand mme de la rduction dimpt pour souscription
au capital.
Loption pour lIR est rserve aux SARL :
qui emploient moins de 50 salaris et dont le chiffre daffaires
annuel ou le total de bilan est infrieur 10 M ;
et dont le capital ou les droits de vote sont dtenus hauteur de :
50 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques ;
34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant la qualit
au sein de la SARL de grant ;
qui exerce titre principal une activit industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou librale, lexclusion de la gestion de son
propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Loption est exerce avec laccord de tous les associs et notie au ser-
vice des impts dans les trois premiers mois de lexercice au titre duquel
elle sapplique. Loption est valable pour une priode de cinq exercices.
La SARL peut renoncer lIR. Cette renonciation doit tre notie
dans les trois premiers mois de la date douverture de lexercice
compter duquel la renonciation sapplique. La sortie anticipe du
rgime scal de lIR est dnitive : la SARL ne peut plus opter nou-
veau pour lIR.
7.1.2. Les modalits de dclaration
Les rsultats de la SARL, quelle soit soumise lIS ou lIR, doivent
tre dclars en remplissant une dclaration de rsultat dont lpais-
seur varie avec la taille de lentreprise. Les rgimes de dclaration,
appels rgimes dimposition, varient en fonction du volume de chiffre
daffaires et de la nature de lactivit.
La gestion et le contrle de la SARL
221
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Elle na donc pas, en labsence de bilan, produire une dclaration provisoire
pour la premire anne civile dactivit.
2. Si lentreprise a commenc son activit en cours danne, les limites de chiffre
daffaires doivent tre ajustes en proportion de la priode dactivit effective
(sauf pour les entreprises saisonnires). Par exemple, si lentreprise a ralis un
chiffre daffaires sur sa priode dactivit qui na t que de six mois, la limite
pour le rgime rel normal est de : 763 000 6/12 = 381 500 .
3. La SARL impose au rel simpli peut opter pour le rel normal. Cette option
est valable pour le rgime dimposition et la TVA. Elle doit tre exerce avant
le 1
er
fvrier de lanne N pour que le rgime choisi soit applicable en N. Elle
sapplique alors de manire irrvocable pour lanne N et lanne N + 1. Elle
se reconduit ensuite tacitement.
4. Le secteur des ventes englobe le secteur industriel, commercial et artisanal,
ainsi que les activits dhtels, de loueurs en meubl, de cafs et de restaurants.
5. Lorsque lactivit se rattache aux deux catgories doprations, le rgime sim-
pli dimposition est applicable si le chiffre daffaires total annuel nexcde
pas 763 000 HT ; et si, lintrieur de cette limite, le chiffre daffaires relatif
aux oprations relevant du secteur des services ne dpasse pas 230 000 HT.
Pour lexercice de cration de la SARL, la premire dclaration (et le
paiement de limpt correspondant) porte (en labsence de bilan au
cours de lanne de cration) sur la priode coule depuis le dbut
dactivit jusqu la clture du premier exercice ou, au plus tard, jus-
quau 31 dcembre de lanne suivant celle de la cration
1
.
La comptabilit de la SARL
Une SARL doit tenir une comptabilit dengagement car cest une
socit commerciale. Le rsultat est dtermin partir des produits ra-
liss (crances acquises) et des charges supportes (dettes certaines).
Une vente est comptabilise en produits ds quelle est facture mme
Les rgimes dimposition et de dclaration de la SARL
Les rgimes dimposition dpendent du chiffre daffaires
annuel HT
2
et de la nature dactivit.
Vous pouvez toujours opter pour le rgime du seuil suprieur
3
.
Secteur
dactivit
Ventes
4
Prestations de services
et professions librales
Rel normal CA annuel HT suprieur 763 000 CA annuel HT suprieur 230 000
Rel simplifi
5
CA annuel infrieur 763 000 CA annuel infrieur 230 000
7.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
222
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
si elle nest pas encaisse. Une facture dachat est enregistre en charge
mme si elle nest pas paye. Il faut prendre en compte les amortisse-
ments et constituer dventuelles provisions.
Une EURL impose lIR qui exerce une activit librale doit tenir
une comptabilit dengagement. Cependant, sa dclaration scale
( dclaration contrle ) doit tre base sur les encaissements et les
dcaissements (voir page 231).
Calcul de limposition et tablissement des dclarations
scales de la SARL
7.3.1. SARL soumise limpt sur les socits
7.3.1.1. Les tapes respecter
tape n 1. La SARL doit tenir une comptabilit pour dterminer le
rsultat comptable quelle a rellement ralis. Le rsultat comptable
ainsi dtermin nest pas ncessairement le rsultat imposable. En
effet, certaines charges comptabilises ne sont pas entirement dduc-
tibles alors que des produits comptabiliss ne sont pas imposables ou
sont imposs un taux rduit.
tape n 2. partir du rsultat comptable, lentreprise dtermine le
rsultat imposable de son activit et calcule limpt sur les socits.
Il faut corriger le rsultat comptable pour dterminer le rsultat scale-
ment imposable. Ces corrections sont appeles corrections extra-
comptables car elles sont effectues en dehors de la comptabilit sur
un imprim scal
1
:
Pour neutraliser les charges qui ne sont pas dductibles, il faut
les ajouter au rsultat comptable : on dit quon procde une
rintgration extra-comptable ;
Pour neutraliser les produits qui ne sont pas imposables, il faut
les retrancher du rsultat comptable : on dit quon procde une
dduction extra-comptable ;
1. Pour le rel simpli : case B de limprim n 2033-B ; pour le rel normal :
imprim n 2058-A (voir supplment Internet).
7.3.
La gestion et le contrle de la SARL
223
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
tape n 3. Lentreprise remplit la dclaration fiscale de son rsultat.
Cette dclaration doit tre dpose dans les trois mois de la clture de
lexercice
1
.
tape n 4. Lentreprise paie lIS. Limpt sur les socits est pay
sous forme dacomptes suivis dun versement complmentaire pour
liquider limpt exigible.
7.3.1.2. Charges dductibles Produits imposables
Rel simpli Rel normal
Dclarations
remplir
Imprim 2065 et ses annexes. Imprim 2065 et ses annexes.
Charges dductibles Produits imposables
Les points savoir
Les dividendes encaisss par la SARL sont comptabiliss en produits nanciers
et sont imposables. Cependant, lorsquils sont distribus par une socit soumise
lIS, la SARL peut appliquer le rgime des socits mres pour viter une double
imposition (voir page 246).
Les rmunrations
2
verses par la SARL son grant sont dductibles, quel que
soit leur mode de calcul (traitement xe ou proportionnel aux bnces).
Les indemnits ou allocations forfaitaires pour frais verses au grant sont assimi-
les un supplment de rmunration. Elles sont dductibles du rsultat imposable.
Les intrts des comptes dassocis sont dductibles dans certaines limites (voir
page 160).
1. Avant le 30 avril de lanne suivante si aucun exercice nest clos au cours dune
anne. Pour les socits qui arrtent leur exercice le 31 dcembre, le dlai de
dclaration est habituellement report au 30 avril, sous la condition du paie-
ment du solde de lIS le 15 avril au plus tard.
2. Les statuts doivent autoriser la rmunration. Les rmunrations verses doi-
vent correspondre un travail effectif et leur montant ne doit pas excder la
rtribution normale des fonctions.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
224
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
7.3.1.3. Comment payer limpt sur les socits ?
Une petite SARL peut tre impose lIS au taux de 15 % pour
la partie de son bnce scal qui ne dpasse pas 38 120 . Au-del,
lIS 331/3 % sapplique. Le capital de la SARL doit tre libr ; son
chiffre daffaires HT ne doit pas dpasser 7 630 000 ; et son capital
doit tre dtenu 75 % au moins par des personnes physiques.
Comment payer limpt sur les socits ?
Date Modalits de paiement
Paiement de limpt sur les socits
Limpt sur les socits est pay sous forme dacomptes suivis
dun versement complmentaire pour liquider limpt exigible.
Date de paiement
1
:
15 mars N
15 juin N
15 septembre N
15 dcembre N
1. Acomptes dimpt sur les socits
Les acomptes sont accompagns dun bordereau-avis
valable pour tout lexercice.
8,1/3 %
8,1/3 %
8,1/3 %
8,1/3 %
au plus tard 15/04/N + 1
3
2. Solde de limpt sur les socits
Le solde doit tre pay spontanment
4
.
Contribution sociale de 3,30 % pour les grosses SARL
La contribution sociale de 3,30 % nest pas due par les entreprises qui ralisent moins
de 7 630 000 de chiffre daffaires HT. Contribution = 3,30 % (IS 763 000 ).
}
du bnce ralis au cours
de lexercice clos le 31/12/N-1
2
1. La premire chance est celle qui est la plus rapproche du dbut de lexercice.
2. Pour le premier acompte, les rsultats de lexercice prcdent ntant par encore
connus, le calcul est effectu sur la base de lavant-dernier exercice (31/12/N-2).
La rgularisation a lieu ultrieurement lors du versement du deuxime acompte.
Les socits nouvelles sont dispenses du paiement des acomptes dIS au titre
de leur premier exercice dactivit ou priode dimposition.
3. Au plus tard le 15 du mois suivant celui la n duquel expire le dlai de dpt
de la dclaration de rsultats. Pour un exercice clos le 31 dcembre N, date
limite de paiement = 15 avril N + 1.
4. Lexcdent des acomptes peut tre rembours dans les trente jours du dpt du
bordereau-avis, moins de limputer sur le premier acompte suivant.
La gestion et le contrle de la SARL
225
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Lamortissement sur un vhicule de tourisme nest dductible que
pour la fraction TTC qui ne dpasse pas 18 300 .
Limpt sur les bnces est comptabilis dans les charges. Cependant,
cet impt nest pas dductible. Il faut donc rintgrer cette charge pour
dterminer le bnce imposable.
Passage du rsultat comptable au rsultat scal
La SARL Hra est impose au rel simpli. Pour lexercice N, les produits quelle a
comptabiliss slvent 400 000 et les charges 250 000 (avant comptabili-
sation de lIS).
Elle a comptabilis en charge lamortissement sur 5 ans dun vhicule de tourisme
achet en N-1 pour 26 300 TTC.
Dterminer le rsultat scalement imposable et remplir limprim scal.
Amortissement comptabilis 5 260 26 300 20 %
Amortissement fiscal 3 660 18 300 20 %
Amortissement non dductible 1 600
B = 30 000
Au 15/04/N+1
Liquidation solde IS
IS d = 15 000
Acomptes = 10 000
Solde = 5 000
444 ?
444 512
Paiement de lIS
Schmas comptables
Acompte = B 8
1/3
% = 2 500
33
1/3
%
N-1 N N+1
4 acomptes = 10 000
Au 31/12/N
B = 45 000
IS = 15 000
695 444
444 512
Excdent rembours
dans les 30 jours
Cas n 28
Guide pratique de la SARL et de lEURL
226
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
7.3.1.4. Cas de synthse
Rsultat
Comptable Fiscal
Produits
Charges
Impt sur les bnfices
Impt sur les bnfices non dductibles
Amortissement non dductible fiscalement
Produit imposable au taux rduit de 19 %
400 000
250 000
43 545
400 000
250 000
43 545
43 545
1 600
/
106 455 151 600
Montant
Rsultat comptable
Corrections extra-comptables
Rintgrations
Amortissement non dductible
Impt non dductible
Dductions
106 455
1 600
43 545
/
Rsultat imposable 151 600
Calcul de limpt
IS 15 %
IS 33
1/3
%
5 718
37 827
38 120 15 %
(151 600 38 120) 33
1/3
%
43 545
Calcul de limposition et tablissement de la dclaration
scale de rsultat dune SARL
Une SARL exploite un nouveau concept de vente darticles dominante cologique.
La SARL tient la comptabilit de lentreprise sur un logiciel. La balance suivante est
dite aprs avoir comptabilis les critures dinventaire. Des informations compl-
mentaires sont galement donnes.
Cas n 29
/
La gestion et le contrle de la SARL
227
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Balance des comptes au 31/12/N aprs inventaire (en euros)
Dterminer le rsultat scalement imposable et remplir la dclaration scale du
rsultat.
Hypothse 1 : lentreprise est soumise au rgime simplifi dimposition.
Hypothse 2 : lentreprise a opt pour le rgime rel dimposition.
Comptes de la comptabilit gnrale Soldes
N Intituls Dbiteur Crditeur
Comptes de bilan
101
1061
1068
151
164
205
211
213
2182
2183
261
2751
2805
2813
28182
28183
371
397
401
411
416
42
431
437
444
44551
491
Capital
Rserve lgale
Rserves facultatives
Provisions pour risques
Emprunts
Licence dexploitation
Terrains
Constructions
Matriel de transport
Matriel et mobilier de bureau
Titres de participation
Dpts et cautionnements verss
Amortissements des licences dexploitation
Amortissements des constructions
Amortissement du matriel de transport
Amortissements matriel et mobilier de bureau
Stocks de marchandises
Provisions pour dprciation des stocks
de marchandises
Fournisseurs
Clients
Clients douteux
Personnel
Scurit sociale
Autres organismes sociaux
tat, impt sur les bnfices
tat, TVA dcaisser
Provision pour dprciation des comptes clients
15 000
10 000
90 000
20 000
10 000
50 000
5 000
20 000
40 000
10 000
25 000
2 500
37 500
4 000
63 000
12 000
45 000
4 000
8 000
5 000
40 000
8 000
7 000
2 000
1 960
3 000
9 000
(Suite cas n 29)
/
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
228
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Informations complmentaires concernant lanne N (en euros)
Achat dimmobilisations
503
512
590
Valeurs mobilires de placement
Banque
Provision pour dprciation des valeurs
mobilires
6 000
15 000
1 000
291 000 277 960
Bnfice comptable 13 040
Comptes de rsultat
607
6037
611
612
615
616
622
626
631
635
641
645
661
671
675
6811
6816
695
707
764
775
Achats de marchandises
Variation des stocks de marchandises
Sous-traitance
Redevances de crdit-bail
Entretien et rparations
Primes dassurance
Honoraires
Frais postaux et de tlcommunication
Impts et taxes sur les salaires
Autres impts et taxes
Rmunration du personnel
Charges de Scurit sociale
Intrts
Charges exceptionnelles sur oprations
de gestion
Valeur nette comptable sur lments
dactif cds
Dotations aux amortissements dexploitation
Dotations aux provisions dexploitation
Impt sur les bnfices
Ventes de marchandises
Intrts des valeurs mobilires de placement
Produits des cessions dlments dactif
120 000
10 000
20 000
10 000
9 000
4 000
5 000
2 500
1 400
7 500
180 000
60 000
7 000
2 000
27 000
14 000
16 000
4 960
420 000
400
73 000
480 360 493 400
Bnfice comptable 13 040
Vhicule de transport 21 300
/
La gestion et le contrle de la SARL
229
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Pour lanalyse, voir page 47.
Ventes dimmobilisations
Dotations aux amortissements et aux provisions
Autres renseignements
tape n 1 : Lentreprise dtermine son rsultat comptable
Prix de
vente HT
Valeur comptable Plus-value
Prix
dacquisition
Amort. ou
provisions
Valeur
nette
Court
terme
1
Long
terme
Constructions
Voiture
Titres de participation
45 000
8 000
20 000
30 000
15 000
8 000
18 000
8 000
12 000
7 000
8 000
33 000
1 000
12 000
73 000 53 000 26 000 27 000 34 000 12 000
Amortissements Provisions
Licences dexploitation
Constructions
Matriel de transport
Matriel de bureau
2 000
6 000
4 000
2 000
Risque de litige
Dprciation clients
Dprciation stocks
3 000
8 000
5 000
14 000 16 000
Le matriel de transport comprend une voiture de tourisme achete en N pour 21 300
et amortie sur 5 ans.
Les charges non dductibles (amendes, cadeaux non justifis, provisions non admises
fiscalement) slvent 13 465 .
Lemprunt sera rembours partir de N + 2.
partir de la balance des comptes gnraux :
Produits
Charges
493 400
480 360
Rsultat comptable 13 040
Guide pratique de la SARL et de lEURL
230
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
tape n 2 : Lentreprise dtermine son rsultat imposable,
calcule lIS et remplit sa dclaration scale
La dclaration remplie est prsente dans les supplments Internet.
Vous pouvez la remplir sur le site www.impots.gouv.fr
Passage du rsultat comptable
au rsultat scal
Voir
page
Euros
Imprim scal
n 2033-B
Rel
simpli
n 2058-A
Rel
normal
Rsultat comptable
Corrections apporter au rsultat
comptable
ajouter ( Rintgrations )
Impt sur les bnfices
Amortissement sur vhicule de tourisme
non dductible
1
Charges non dductibles
226
225
13 040
4 960
1 600
13 465
312
324
318
330
WA
WK
WE
WQ
retrancher ( Dductions )
Plus-value long terme impose 19 %
1
225
20 025
/ 350
WR
WV
Rsultat imposable 33 065 352 XH
Calcul de limpt
Impt sur les socits 15 %
Impt sur les socits 33
1/3
%
4 960 33 065 15 %
non applicable
4 960
1. Pour des explications sur ces corrections scales, voir le cas prcdent.
La gestion et le contrle de la SARL
231
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Elle applique les rgles BIC si lactivit est industrielle, commerciale ou
artisanale ; les rgles BNC (rsultat imposable = produits encaisss charges
dcaisses) si lactivit est librale.
2. Imprim n 2031 au lieu de limprim n 2065.
3. BNC si lactivit est librale ; BA Si lactivit est agricole.
7.3.2. SARL de famille soumise limpt sur le revenu
tapes n
os
1, 2 et 3. La SARL dtermine son rsultat comptable
(tape n 1 voir page 222), puis son rsultat imposable
1
(tape n 2
voir page 222) et remplit la dclaration scale de son rsultat
2
(tape
n 3 voir page 223).
tape n 4. Le rsultat imposable de la SARL est rparti entre les
associs. Chaque associ ajoute son revenu global imposable la
quote-part de bnce qui lui revient dans la SARL dans la catgorie
des bnces industriels et commerciaux (BIC)
3
. Lassoci paie
limpt sur le revenu en fonction de son revenu imposable (+ quote-
part de bnces dans la SARL + salaires + ). Si la SARL ralise un
dcit, ce dcit sera rparti entre les associs. Ladhsion de lassoci
un centre de gestion agr lui permet dviter la majoration de 25 %
de sa quote-part de bnce imposable.
Calcul de limposition et tablissement de la dclaration
scale de rsultat dune SARL de famille
Deux surs, Roxane et Marion, ont constitu une SARL qui a opt pour limpt sur
le revenu. Roxane qui dtient 60 % des parts sociales assure la gestion de la SARL.
Des informations complmentaires vous sont donnes.
Dterminer la quote-part de rsultat imposable de chaque associ et remplir la
dclaration de rsultat n 2031.
Cas n 30
Informations complmentaires (en euros)
Rsultat comptable
Rmunration du grant
Intrts excdentaires des comptes courants
Roxane
Marion
180 000
60 000
2 000
1 000
Guide pratique de la SARL et de lEURL
232
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Loption pour le report en arrire fait lobjet dune dclaration spciale
(n 2039) jointe la dclaration de rsultats.
tape n 1 : Dtermination du rsultat imposable de chaque
associ
tape n 2 : Dclaration de rsultat n 2031.
La dclaration remplie est prsente dans les supplments Internet.
Vous pouvez la remplir sur le site www.impots.gouv.fr
La gestion des dcits
Si la SARL ralise un dcit, elle peut le reporter sur ses bnces en
avant ou en arrire.
7.4.1. Le report en avant du dcit
Le report en avant seffectue sur les bnces des exercices suivants
sans limitation de dure. Limputation du dcit doit se faire sur les
premiers bnces imposables au taux normal des exercices suivants.
7.4.2. Le report en arrire du dcit
Le report en arrire du dcit permet dimputer le dcit la clture
dun exercice sur les bnces des 3 exercices prcdents
1
. Cette
Dtermination du rsultat imposable SARL
Quote-part des associs
Roxane Marion
Pourcentage de participation 60 % 40 %
Rpartition du rsultat comptable
Rmunrations spcifiques aux associs
Rmunrations
Intrts excdentaires
180 000
60 000
3 000
108 000
60 000
2 000
72 000
1 000
Total 243 000 170 000 73 000
7.4.
La gestion et le contrle de la SARL
233
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Sont exclus de limputation les distributions, les plus-values long terme et les
bnces totalement ou partiellement exonrs.
imputation donne naissance une crance sur le Trsor correspondant
lexcdent dimpt antrieurement vers.
La crance sur le Trsor est gale au produit du dcit imput par le
taux normal de lIS applicable lexercice dcitaire. Le dcit est
imput sur les bnces taxs lIS au taux de droit commun
1
des
3 exercices prcdents, en commenant par le plus ancien.
La crance est utilise dans un dlai de 5 ans au paiement de limpt
sur les socits d au taux normal ou au taux rduit. La crance est
rembourse au terme de ce dlai de 5 ans si elle na pas pu tre utili-
se. La crance peut aussi tre mobilise auprs dun tablissement de
crdit en application de la loi Dailly.
Gestion du dcit dans une SARL ou une EURL
soumise limpt sur le revenu
Dans une SARL soumise limpt sur le revenu, le dcit est rparti entre les asso-
cis. Chaque associ impute sa quote-part de dcit sur lensemble de ses revenus
(salaires, dividendes). Si ces revenus ne sont pas sufsants pour ponger ce d-
cit, le reliquat de dcit pourra simputer pendant les six annes suivantes sur
lensemble des revenus du contribuable. Au-del, il sera perdu.
Bnfice
dimputation
Dficit
N-4 N-3 N-2 N-1 N
400
400
300
dduire
100
100
100
444 699
33,33 %
Dficit
Report en arrire
Report en avant
IS
Crance dIS
50 50 150
Le report en arrire des dficits
Zoom n 69
Guide pratique de la SARL et de lEURL
234
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les aides scales
Pour obtenir des informations actualises sur les aides scales
Sur le site www.apce.com en suivant le chemin daccs : Crer une entreprise,
Toutes les tapes, les aides, principales aides fiscales, Jeune entreprise innovante
(JEI).
Les aides scales
Taux dIS 15 % Les SARL qui ralisent moins de 7 630 000 de chiffre daffaires HT
sont imposes lIS au taux de 15 % dans la limite de 38 120 de
bnfice (voir page 231).
Rduction dIR pour
les souscriptions au
capital de la SARL
Les souscriptions en numraire effectues par des personnes
physiques au capital dune SARL exerant une activit industrielle,
commerciale, artisanale, librale ou agricole ouvrent droit pour
lassoci une rduction dimpt sur le revenu de 25 % des
versements effectus dans la limite dun plafond annuel de
versements de 20 000 (personne seule) ou 40 000 (couple).
Art. 199 terdecies OA du CGI.
Dduction des
intrts demprunt
pour les
souscriptions au
capital de la SARL
Les intrts demprunt pour la souscription au capital de SARL
nouvelles soumises lIS taux plein peuvent tre dduits du revenu
imposable par les associs percevant une rmunration de la socit
(dirigeants, salaris).
Le montant maximal dductible est plafonn 50 % du montant brut
de la rmunration de lemprunteur verse par la socit dans
la limite de 15 250 . Cette mesure nest pas cumulable avec
la prcdente. Art. 83-2 quater du CGI.
Prlvement
libratoire
Les intrts de comptes courants dassocis peuvent tre imposs au
taux de 18 % (prlvement libratoire) au lieu dtre imposs au taux
marginal dimposition de lassoci (TMI) qui peut atteindre 40 %
(voir page 160).
Dduction des
pertes en capital
Les associs qui ont souscrit en numraire au capital dune socit
nouvelle (SARL) ou une augmentation de capital ralise par une
socit dans le cadre dun redressement judiciaire, peuvent dduire
les pertes en capital subies dans la limite annuelle de 6 000 pour
un couple mari et 3000 pour les autres contribuables.
Art. 163 octodecies A du CGI.
7.5.
Zoom n 70
/
La gestion et le contrle de la SARL
235
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les aides inter-entreprises
La solidarit nancire entre socits appartenant un mme groupe
justie quune socit mre vienne au secours dune liale en difcult.
Elle peut conforter le crdit de sa liale en se portant caution (voir
page 163). Elle peut consentir sa liale une avance. Elle peut contri-
buer au dsendettement de la liale en lui accordant des subventions ou
des abandons de crances qui sont justis par le souci daider une
liale qui connat des difcults passagres. Labandon de crance peut
tre quali dabandon caractre commercial ou caractre nancier.
7.6.1. Labandon de crance caractre commercial
Labandon de crance prsente un caractre commercial lorsquil est
justi par les relations daffaires qui unissent les deux partenaires :
une liale qui commercialise les produits fabriqus par la socit mre.
Labandon de crance caractre commercial est dductible pour la
socit qui consent labandon et imposable pour le bnciaire.
Rduction dimpt
de 60 % des dons
Les entreprises (notamment les SARL) bnficient dune rduction
dimpt de 60 % du montant des dons verss aux organismes agrs
dont lobjet exclusif est de verser aux petites et moyennes entreprises
des aides financires permettant la ralisation dinvestissements
ou de leur fournir des prestations daccompagnement. Les dons sont
plafonns 5 % du chiffre daffaires HT.
Abandon de crance ou augmentation de capital
pour aider une liale en difcult ?
Si une liale a des difcults nancires, il vaut mieux lui consentir un abandon de
crance ou une subvention plutt que de la recapitaliser (augmentation de capital) ou
de lui consentir une avance car laugmentation de capital ou lavance la liale nest
pas dductible. En revanche, les abandons de crances ou les subventions qui se tra-
duisent par une diminution de lactif net sont, en principe, scalement dductibles et
permettent ainsi une conomie dimpt.
7.6.
Zoom n 71
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
236
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
7.6.2. Labandon de crance caractre nancier
Labandon de crance caractre nancier est justi par le lien nancier
entre la mre et la liale (participation de la mre au capital de la liale).
Le rgime scal des abandons de crances est moins avantageux.
Tant que la situation nette de la liale demeure ngative, laban-
don est dductible pour la mre et imposable pour la liale.
Ds que la situation nette de la liale devient positive,
labandon de crance nest plus dductible pour la mre car il y
a augmentation correspondante de la valeur relle des titres
dtenus par la socit mre qui ne sappauvrit donc pas. Lop-
ration est assimile un apport en socit,
labandon nest pas imposable chez la liale si elle prend
lengagement daugmenter son capital dans les deux ans pour
un montant gal laide qui lui a t consentie.
Labandon de crance est caractre nancier car il est justi unique-
ment par le lien nancier entre la mre et la liale. De plus, la crance
est de nature nancire.
Abandon de crance caractre nancier
Une socit mre abandonne un prt de 400 000 sa lle qui connat des dif-
cults nancires. La mre dtient une participation de 40 % dans le capital de la lle.
La situation nette de la lle avant abandon est ngative de 300 000 .
Avant
abandon
de crance
Abandon
de crance
Aprs
abandon
de crance
Situation nette de la filiale
% de participation de la mre
300 000
40 %
400 000 100 000
40 %
Quote-part de situation nette dtenue
par la mre 120 000 40 000
Valeur des titres dtenus par la mre 0 40 000
Augmentation de la valeur de la participation
Abandon de crance fiscalement dductible
40 000
360 000
Cas n 31
La gestion et le contrle de la SARL
237
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Majorations ou diminutions du prix dachat ou de vente, versement de redevan-
ces excessives ou sans contrepartie, octroi de prts sans intrts ou un taux
rduit, abandons de crances
Les transactions intra-groupe
7.7.1. Les transactions intra-groupe
avec des socits franaises
Des socits composant un mme groupe ralisent entre elles des tran-
sactions (achats, ventes) appeles transactions intra-groupe. En prin-
cipe, les transactions intra-groupe doivent tre conclues aux conditions
du march. En effet, lune des socits contractantes ne doit pas tre
avantage et lautre pnalise. Ainsi, en cas davance nancire, un
intrt normal doit tre stipul. dfaut, il y a acte anormal de gestion
avec double imposition : imposition du gain anormal ralis par la
socit avantage, et non-dduction de la perte subie par lautre socit.
Cependant, pour les transactions courantes portant sur des services
(facturation dune prestation de services) ou des stocks (facturation de
marchandises), la socit mre peut les facturer prix cotant, sans
marge bnciaire, des liales dont elle possde lessentiel du capital.
7.7.2. Les transferts indirects de bnces ltranger
Si une SARL est sous la dpendance ou possde le contrle dune
entreprise situe hors de France, les avantages consentis
1
cette entre-
prise sont inclus dans le bnce imposable de la SARL car ils corres-
pondent un transfert de bnces. Cependant, si la SARL prouve que
Transactions intra-groupe courantes
Lorsque la socit mre prend en charge un certain nombre de tches fonctionnelles
(organisation gnrale, tenue de comptabilit, recherche, publicit), elle doit fac-
turer chacune des liales une quote-part du cot de ces services. Ces services peu-
vent tre facturs leur cot de revient et non au prix du march.
7.7.
Zoom n 72
Guide pratique de la SARL et de lEURL
238
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Les rsultats positifs et ngatifs des diffrentes socits du groupe sont imm-
diatement compenss permettant ainsi une conomie dIS immdiate. Les d-
cits et les avoirs scaux dune liale risquent moins dtre perdus car ils sont
imputs sur le rsultat densemble du groupe.
ces avantages correspondent des ncessits commerciales relles ou
sont consentis dans son intrt, ces avantages ne sont pas imposs car
ils constituent un acte normal de gestion.
La procdure daccord pralable permet aux entreprises dobtenir
laccord de ladministration scale sur la mthode de xation de leurs
prix de transfert pour les futures transactions intra-groupe et dviter
ainsi un redressement scal.
Lintgration scale
7.8.1. Les modalits de fonctionnement
Une socit mre, dite tte de groupe , peut se constituer seule rede-
vable de limpt sur les socits (ainsi que de lIFA) raison du rsultat
densemble quelle forme avec les socits dont elle dtient, directe-
ment ou indirectement, 95 % au moins du capital et de manire continue
au cours dun exercice.
La socit mre tte de groupe doit tre franaise et soumise limpt
sur les socits dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, son
capital ne doit pas tre dtenu, directement ou indirectement, plus de
95 % par une autre personne morale passible de lIS. Mais il peut tre
dtenu par une ou plusieurs socits franaises si aucune ne dtient
95 % et, mme plus de 95 %, par une personne morale trangre.
7.8.2. Avantages et inconvnients
Les avantages de ce rgime sont de permettre de compenser les rsultats
positifs et ngatifs des diffrentes socits du groupe
1
et de neutraliser
7.8.
La gestion et le contrle de la SARL
239
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
les oprations internes au groupe
1
. Comme le bnce de la liale
remonte vers la socit tte de groupe, ces bnces sont immdiate-
ment disponibles pour la mre sans imposition.
Le rgime dintgration prsente des inconvnients. Son champ dappli-
cation est assez restreint, en raison du taux de participation de 95 % au
moins exig de la socit mre dans le capital des liales. Les modalits
complexes de ce rgime et lobligation dun suivi prcis des oprations
intra-groupe peuvent alourdir la gestion. De plus, certains ajustements
du rsultat peuvent tre remis en cause si les socits concernes sortent
du groupe.
Limpt de solidarit sur la fortune sapplique si la fortune du contri-
buable dpasse 790 000 . En principe, tous les biens sont soumis
lISF. Cependant, il existe des biens qui sont exonrs de faon
expresse. Ce sont essentiellement les biens professionnels. Les biens
professionnels sont les biens qui sont affects lexercice dune acti-
vit professionnelle.
Intgration scale
Lintgration scale facilite le fonctionnement des groupes de socits en permettant
de calculer un rsultat global et de neutraliser les oprations intra-groupe. Cepen-
dant, sa lourdeur peut inciter recourir dautres procds tels que la constitution
de liales sous la forme de socits de personnes ou le rgime scal des socits
mres lles.
Zoom n 73
8. La gestion scale de lISF
1. Les doubles impositions inhrentes aux oprations internes aux groupes sont
limines. Les ajustements les plus importants concernent les abandons de
crances, les subventions internes au groupe, les cessions dimmobilisations ou
de titres au sein du groupe et les provisions intra-groupe.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
240
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Les parts sociales sont exonres dISF mme si elles appartiennent un mem-
bre du foyer scal autre que celui qui exerce la fonction de grant dans la SARL.
2. Pour apprcier ces seuils, voir cas n 33, page 241. Pour la dtermination du seuil
de 25 %, il peut tre tenu compte de la participation dtenue directement par le
redevable et les membres de son groupe familial au sens large (son conjoint ou
concubin notoire, ses ascendants, descendants, frres et surs, les ascendants,
descendants, frres et surs de son conjoint ou concubin notoire) et de la partici-
pation que ces mmes personnes dtiennent par lintermdiaire dune autre
socit possdant une participation dans la socit o sexercent les fonctions,
dans la limite dun seul niveau dinterposition, ce qui exclut les sous-liales.
Pour les parts sociales dtenues dans la SARL, lassoci peut bncier
de lexonration attache loutil de travail sil est dirigeant de la
SARL, sil dtient au moins 25 % de son capital et si la rmunration
verse par la SARL reprsente au moins la moiti de ses revenus.
Si les parts sociales ne sont pas exonres dISF en tant que bien pro-
fessionnel, la moiti de leur valeur est exonre dISF si les parts
sociales ont fait lobjet dun engagement collectif de conservation
dune dure minimale de six ans. Lactivit exerce par la SARL doit
tre industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou librale. La
SARL peut tre soumise lIS ou lIR. Lengagement collectif doit
porter sur au moins 34 % des parts sociales.
Les parts sociales de la SARL sont exonres dISF si elles reprsentent
loutil de travail de lassoci
Lassoci doit tre
1. dirigeant Lassoci est considr comme dirigeant de la SARL sil est grant
1
.
2. bien pay La rmunration verse par la SARL doit reprsenter plus de la moiti des
revenus nets professionnels de lassoci pour lanne prcdant celle de
limposition lISF. En cas dexercice simultan de fonctions de direction
et de fonctions techniques dans la socit, lensemble des rmunrations
est pris en compte.
3. et capitaliste Le dirigeant doit possder au moins 25 %
2
des droits financiers et
des droits de vote de la SARL.
dfaut, la valeur brute des parts sociales de la SARL doit dpasser
50 %
2
de la valeur brute du patrimoine taxable lISF, y compris
les parts sociales de la SARL.
La gestion et le contrle de la SARL
241
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La valeur des parts sociales est exonre en tant que biens professionnels
dans la mesure o elle correspond lactif professionnel de la socit.
Les biens de la socit sont considrs comme biens professionnels sils
ont un lien de causalit directe sufsant avec lexploitation et sils sont
utiliss effectivement pour les besoins de lactivit professionnelle.
Le taux de participation de lassoci dans Fintan est de :
Les parts sociales dtenues par lassoci sont exonres dISF.
Parts sociales de SARL et outil de travail
Un associ redevable de lISF remplit toutes les conditions pour que ses parts sociales
soient exonres dISF en tant que biens professionnels. Ses parts sociales sont valo-
rises 100 000 . La socit est value 5 000 000 . Son patrimoine comprend
un immeuble conserv dans un but spculatif et valoris 500 000 .
Valeur des parts sociales
exonre dISF
=
Valeur des
parts sociales
Valeur de lactif
professionnel de la socit
Valeur du patrimoine
de la socit
90 000 = 100 000
4 500 000
5 000 000
Le dirigeant doit possder au moins 25 % du capital de la SARL
Un associ redevable de lISF remplit toutes les conditions pour que ses parts sociales
dans la SARL Fintan soient exonres dISF en tant que biens professionnels. Lasso-
ci dtient 10 % de Fintan et 40 % dune socit Maou qui dtient 30 % de Fintan. Son
ls dtient 5 % de Fintan.
Dtention directe
Dtention indirecte par Maou
Dtention par le ls
10 %
12 %
5 %
27 %
Cas n 32
Cas n 33
Guide pratique de la SARL et de lEURL
242
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dans une SARL, les bnces distribus subissent une double impo-
sition.
1. Le bnce est dabord soumis limpt sur les socits au taux
de 33
1/3
% au niveau de la SARL.
2. Le bnce distribu (dividende) est ensuite soumis au niveau de
lassoci :
limpt sur le revenu dans la catgorie des revenus de capi-
taux mobiliers si lassoci est une personne physique ou une
socit impose lIR (SNC)
1
;
ou lIS en tant que produit nancier si lassoci est une
socit soumise lIS.
Cependant, labattement de 40 % et le rgime des socits mres et
liales tendent attnuer la double imposition.
De plus, la distribution des bnces aux associs peut mettre la
charge de la SARL la retenue la source de 25 % si le bnciaire du
dividende a son domicile (personne physique) ou son sige (personne
morale) hors de France (sauf conventions scales internationales).
ISF et SARL ou EURL impose IIR
Pour une SARL qui a opt pour lIR ou une EURL impose lIR, les parts sociales sont
considres comme un lment dactif affect lexercice de la profession. Pour lasso-
ci qui exerce son activit principale dans la socit, ses parts sociales sont exonres
dISF quel que soit son pourcentage de participation dans la socit.
1. Lassoci de la SNC dclare sa quote-part de dividendes lIR dans la catgorie
des revenus de capitaux mobiliers.
Zoom n 74
9. La gestion scale de la distribution
des bnces
La gestion et le contrle de la SARL
243
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Imposition des dividendes
Le dividende distribu par la SARL ouvre droit un abattement gal
40 % des sommes distribues si lassoci est une personne physique
ou une socit impose lIR. En revanche, si lassoci est une socit
impose lIS, aucun abattement ne sapplique.
9.1.1. Dividende distribu un associ personne physique
Sur le dividende encaiss par une personne physique, on applique un
abattement de 40 %. Sur ce dividende net, on applique un abattement
gnral de 1 525 pour un clibataire ou 3 050 pour un couple. Le
dividende est alors soumis limpt sur le revenu au taux marginal de
lassoci (le dividende est impos dans la catgorie des revenus de capi-
taux mobiliers. Il est ajout aux autres revenus du contribuable. Cest ce
revenu global qui est impos lIR via le mcanisme du quotient fami-
lial). Limpt ainsi calcul est minor dun crdit dimpt
1
plafonn
annuellement 115 pour un clibataire (230 pour un couple).
Lassoci doit galement payer les prlvements sociaux au taux de
12,1 % calculs sur le dividende brut avant labattement de 40 %.
Lassoci peut opter pour le prlvement libratoire au taux de
18 % calcul sur le dividende encaiss.
Si lassoci de la SARL est une SNC
2
, cest lassoci de la SNC qui
dclare sa quote-part de dividendes lIR dans la catgorie des reve-
nus de capitaux mobiliers.
1. Le crdit dimpt est gal 40 % du montant des dividendes avant application de
labattement de 40 % et de labattement gnral annuel de 1 525 ou 3 050 .
2. Dune manire gnrale, une socit impose lIR.
Imposition du dividende distribu par une SARL un associ personne physique
Un associ mari est soumis limpt sur le revenu au taux marginal de 40 %. II per-
oit un dividende de 100 000 pay par une SARL.
9.1.
Cas n 34
Guide pratique de la SARL et de lEURL
244
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
a) Rgime de droit commun
b) Option prlvement libratoire
Dividende peru
Abattement de 40 %
Abattement gnral
100 000
40 000
3 050
Base imposable 56 950
Impt sur le revenu au taux de 40 %
Imputation du crdit dimpt
22 780
230
Impt sur le revenu net 22 550
Prlvements sociaux
Base
CSG + CRDS + PS au taux de 12,1 %
100 000
12 100
Imposition globale 34 650
34 %
Dividende encaiss
Prlvement libratoire de 18 %
Prlvements sociaux de 12,1 %
100 000
18 000
12 100
Imposition globale 30 100
30 %
Jouer sur les distributions de dividendes pour minorer limpt sur le revenu
Le dividende distribu un associ personne physique est ajout ses autres reve-
nus. Son revenu global est impos limpt sur le revenu qui est progressif (barme
par tranche). Le dividende est donc impos au taux marginal dimposition (TMI) du
contribuable. Le contribuable peut avoir des revenus annuels qui uctuent beaucoup,
notamment sil exerce une activit indpendante. Si lanne N, les revenus du contri-
buable sont faibles, il aura intrt distribuer le maximum de dividendes pour quils
soient imposs un TMI relativement faible. Si la SARL a des problmes de trsorerie,
elle nest pas oblige de dcaisser le dividende : elle peut se contenter de linscrire en
compte courant (linscription en compte courant vaut paiement).
Sur le site www.mine.gouv.fr, vous pouvez faire des simulations de calcul dIR.
Zoom n 75
La gestion et le contrle de la SARL
245
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
9.1.2. Dividende distribu une socit impose lIS
Le montant net du dividende est comptabilis en produits nanciers.
LIS est calcul sur ce montant net. La socit na pas payer les diff-
rents prlvements sociaux qui sappliquent uniquement aux personnes
physiques.
Imposition du dividende distribu par une SARL une socit soumise IIS
Une SAS est associe dune SARL. La SARL verse la SAS un dividende de 100 000 .
Dividende comptabilis en produits nanciers 100 000
Rsultat imposable lIS 100 000
IS 33
1/3
% 33 333
Cas n 35
Double imposition !
SARL soumise lIS
Opacit fiscale
Associs personnes
physiques
Dividende impos lIR
en RCM chez lassoci
Chaque associ
dclare sa quote-
part de bnfices lIR
Dividende non
impos chez
lassoci
Dividende
Dividende
Bnfice impos au
niveau de la socit
lIS 15 % ou 33
1/3
%
SARL soumise lIR
Transparence fiscale
Associs personnes
physiques
Guide pratique de la SARL et de lEURL
246
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
9.1.3. Dividende distribu par une SARL impose lIR
Une SARL soumise limpt sur le revenu est transparente sca-
lement. Le bnce quelle ralise nest pas impos son niveau mais
remonte directement au niveau des associs. Chaque associ dclare
limpt sur le revenu dans la catgorie BIC
1
sa quote-part de bnces
dans la SARL.
Quand la SARL distribue des dividendes ses associs, ces dividendes
ne sont pas imposables chez lassoci car ils correspondent des bn-
ces qui ont dj t imposs.
Le rgime des socits mres et liales
Une liale lIS distribue un dividende sa socit mre impose
lIS. Le dividende est prlev sur le bnce de la liale qui a dj
support lIS. Le dividende encaiss par la mre est comptabilis en
produits nanciers. Il va donc tre impos deux fois lIS. Pour viter
cette double imposition, la socit mre peut appliquer le rgime des
socits mres et liales.
Pour bncier du rgime des socit mres et liales, la socit mre
doit dtenir au moins 5 % du capital de la liale
2
.
Mcanisme dimposition. Quand la socit mre applique le rgime
mres et liales, le dividende nest pas impos lIS. Le dividende
Imposition du dividende distribu par une SARL
une socit soumise IIS
Une SAS est associe dune SARL. La SARL verse la SAS un dividende de 100 000 .
9.2.
Cas n 36
1. BNC pour une activit librale ; BA pour une activit agricole.
2. Les titres doivent avoir t souscrits lmission ou, dfaut, avoir fait lobjet
dun engagement pris par la socit de les conserver pendant deux ans au moins.
La gestion et le contrle de la SARL
247
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
comptabilis en produits nanciers est dduit
1
sur le plan scal pour
ne pas tre inclus dans le rsultat imposable lIS. En revanche, la
socit doit rintgrer une quote-part de frais et charges xe 5 % du
dividende. La socit na pas payer les diffrents prlvements
sociaux qui sappliquent uniquement aux personnes physiques.
La retenue la source
La distribution de dividendes des non-rsidents (associs qui nont pas
leur domicile scal ou leur sige en France) est soumise la retenue
la source. Cest ltablissement payeur qui doit oprer cette retenue (il
est fait interdiction la socit de prendre la retenue sa charge).
La retenue est calcule au taux de 25 %, sauf application des conven-
tions internationales. Elle doit tre acquitte la recette des impts au
plus tard le 15 du mois suivant lexpiration du mois au cours duquel
les dividendes ont t pays. Lentreprise doit utiliser la liasse 2777.
Les dividendes de source franaise verss des personnes qui nont
pas leur domicile scal ou leur sige en France et qui ouvrent droit au
transfert de lavoir scal en vertu dune convention internationale, en
vue dviter les doubles impositions peuvent ne supporter, lors de leur
mise en paiement, que la retenue la source au taux rduit de 15 %
prvu par la convention.
1. Le dividende est dduit extra-comptablement (voir page 222).
Dividende comptabilis en produits financiers 100 000
Bnfice comptable 100 000
Dduction extra-comptable du dividende 100 000
Rintgration dune quote-part pour frais et charges 5 000
Rsultat imposable 5 000
IS 33
1/3
% 1 667
9.3.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
248
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Imposition des plues-values de cession
10.1.1. SARL soumise lIS
Si la SARL est soumise lIS, les plus-values ralises lors de la ces-
sion dune immobilisation (construction, machine) sont qualies
de plus-values court terme imposes au taux de droit commun de
33
1/3
% ou de 15 % si la SARL bncie du taux rduit.
Les plus-values sur cession de titres de participation dtenus depuis
plus de deux ans sont qualies de plus-values long terme exonres
dimposition hauteur de 95 %.
10.1.2. SARL impose lIR
Si la SARL est soumise lIR (SARL de famille ou EURL), les plus-
values de cession dimmobilisations ou de titres de participation sont
qualies de plus-value court terme ou long terme. Le rgime scal
est diffrent selon que la plus-value ou la moins-value est court terme
ou long terme.
Qualication des plus-values de cession
pour une SARL soumise lIS
La plus-value ou la moins-value est court terme ou long terme
en fonction de la dure de dtention et de la nature du bien.
Nature du bien
Bien dtenu depuis
Moins de 2 ans Plus de 2 ans
Immobilisations Court terme
Titres de participation Simple produit (ou charge)
nancier
Long terme
10. Limposition des plus-values
10.1.
La gestion et le contrle de la SARL
249
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Imposition des plus-values et des moins-values court terme
la clture de lexercice, les plus-values et les moins-values court
terme se compensent pour faire apparatre une plus-value ou une moins-
value nette.
Imposition des plus-values et des moins-values long terme
la clture de lexercice, les plus-values et les moins-values long
terme se compensent pour faire apparatre une plus-value ou une moins-
value nette :
La plus-value nette long terme peut tre utilise pour compenser
les moins-values nettes long terme subies au cours des dix exer-
cices antrieurs et non encore imputes, le dcit de lexercice et
des exercices antrieurs. Le solde non imput est tax au taux
rduit de 28,1 % (16 % dimpt sur le revenu + 12,1 % de prl-
vements sociaux).
La moins-value nette long terme simpute sur les plus-values
long terme ralises au cours des dix exercices suivants.
Qualication des plus-values de cession pour une SARL soumise lIR
La plus-value ou la moins-value est court terme ou long terme
en fonction de la dure de dtention et de la nature du bien.
Nature du bien
Bien dtenu depuis
Moins de 2 ans Plus de 2 ans
Plus-value Moins-value Plus-value Moins-value
Non amortissable Court terme Court terme Long terme Long terme
Amortissable Court terme Court terme court terme hauteur
des amortissements
long terme au-del
Court terme
Imposition des plus-values de cession
Une SARL a ralis un rsultat comptable de 40 000 pour lexercice. Durant lexer-
cice N elle a ralis les cessions suivantes.
Cas n 37
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
250
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Dure de dtention > 2 ans.
1. Pour une SARL soumise lIS 33
1/3
%
tape n 1. Qualication des plus-values.
tape n 2. Imposition des plus-values.
Les plus-values court terme sont imposes au taux de droit commun
de 33
1/3
% : elles sont donc maintenues dans le rsultat imposable au
taux de droit commun. Les plus-values long terme sont exonres
dimposition hauteur de 95 % : il faut donc dduire du rsultat impo-
sable au taux de droit commun 5 700 (6 000 95 %) pour viter
que ce montant soit impos 33
1/3
%.
Dterminer le rsultat imposable de N de la SARL.
Hypothse 1 : SARL impose lIS 33
1/3
%.
Hypothse 2 : SARL impose lIR. Les associs ont un taux marginal dimpo-
sition (TMI) de 35 %.
lments cds Plus-value Court terme Long terme
Constructions
Camions
Titres de participation
1
33 000
2 000
6 000
33 000
2 000
6 000
37 000 31 000 6 000
(Suite cas n 37)
/
lments cds
Prix
de vente
HT
Prix
dacquisition
Apport, ou
provisions
Valeur
nette
comptable
Plus-value
Constructions
Camions
Titres de
participation
1
45 000
5 000
8 000
30 000
15 000
2 000
18 000
8 000
12 000
7 000
2 000
33 000
2 000
6 000
58 000 47 000 26 000 21 000 37 000
La gestion et le contrle de la SARL
251
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Dure de dtention > 2 ans.
2. Pour une SARL soumise lIR
tape n 1. Qualication des plus-values.
tape n 2. Imposition des plus-values.
La plus-value nette court terme bncie dun talement sur 3 ans
(N, N + 1 et N + 2). Il faut donc en dduire deux tiers du rsultat
comptable pour dterminer le rsultat imposable. La plus-value nette
long terme est impose au taux rduit de 28,1 %. Il faut donc la
dduire du rsultat comptable pour dterminer le rsultat imposable au
taux de droit commun.
Rsultat comptable 40 000
Dductions fiscales
Dduction de la plus-value long terme 5 700
Rsultat imposable 33
1/3
% 34 300
IS 33
1/3
% 11 433 34 300 33
1/3
%
lments cds Plus-value Court terme Long terme
Constructions
Camions
Titres de participation
1
33 000
2 000
6 000
18 000
2 000
15 000
6 000
37 000 16 000 21 000
Rsultat comptable 40 000
Dductions fiscales
Dduction de la plus-value long terme
Dduction des 2/3 de la plus-value court terme
21 000
10 667
Rsultat imposable lIR au TMI de 35 % 8 333
Guide pratique de la SARL et de lEURL
252
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Lexonration est partielle si les recettes annuelles sont comprises entre 250 000
et 350 000 pour les activits commerciales ou agricoles, et entre 90 000 et
126 000 pour les prestataires de services.
Exonration des plus-values de cession
La SARL soumise lIS ne bncie daucune exonration des
plus-values de cession. En revanche, la SARL soumise lIR (SARL
de famille ou EURL) peut bncier de lexonration des plus-
values de cession des petites entreprises.
Les plus-values de cession dimmobilisations ralises par une SARL
soumise lIR sont exonres dimposition :
si lanne de ralisation de la plus-value, les recettes annuelles
1
sont infrieures 250 000 pour les activits commerciales ou
agricoles et 90 000 pour les prestataires de services ;
et si lactivit professionnelle est exerce depuis au moins cinq
ans au jour de la ralisation de la plus-value.
Les droits de succession ou de donation sont calculs sur la moiti de la
valeur des parts sociales (la moiti de la valeur des parts sociales est
donc exonre de droit de succession ou de donation) si les parts ont fait
lobjet dun engagement collectif de conservation dune dure minimale
de deux ans compter du jour du dcs. Lengagement collectif doit
IR 35 % 2 917 8 333 35 %
IR 16 % 3 360 21 000 16 %
6 277
Prlvements sociaux de 12,1 % 760 6 277 12,1 %
Imposition totale 7 037
10.2.
11. Rduction des droits de donation
et de succession
La gestion et le contrle de la SARL
253
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
porter sur au moins 34 % des parts sociales. Les parts sociales doivent
tre donnes en pleine proprit. De plus, chaque donataire doit
sengager, dans lacte de donation, conserver les parts pendant 6 ans
compter de la n de lengagement collectif et lun dentre eux doit
exercer des fonctions de direction pendant 5 ans.
De plus, en cas de donation des parts sociales, les droits de mutation
peuvent tre rduits si le donateur est g de moins de 75 ans. Le mon-
tant de la rduction dpend de la nature de la donation.
1. compter du 1
er
juillet 2005. Pour les donations ralises en pleine proprit
entre le 25 septembre 2003 et 30 juin 2005, le taux de rduction est gal
50 %, quel que soit lge du donateur.
Rduction des droits
de donation
Donations de la pleine
proprit
1
et de lusufruit
Donations
de la nue-proprit
Le donateur a moins de 65 ans 50 % 35 %
Le donateur a entre 65 et 75 ans 30 % 10 %
255
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
5
LA PRVENTION ET LE TRAITEMENT
DES DIFFICULTS FINANCIRES
DE LA SARL
20 % des dpts de bilan sont dus la dfaillance dun client de
lentreprise. An dviter les consquences dun impay, le grant doit
veiller au dpistage prcoce des difcults de ses clients an dappr-
cier leur solvabilit.
Comment apprcier la solvabilit dun client ?
1. Les greffes des tribunaux de commerce permettent lanalyse des comptes
annuels des socits clientes (service tlmatique comme Infogreffe ou Euridile).
2. Les socits de renseignement commercial disposent dinformations privil-
gies car elles ont connaissance des incidents de paiement des clients du fait de
la fonction de recouvrement de crance quelles exercent frquemment. Elles
procdent lanalyse des bilans des clients, et aussi des analyses plus infor-
melles (interview tlphonique, visites, presse, syndicats professionnels).
Elles peuvent procurer :
un renseignement commercial classique avec les banques de donnes acces-
sibles par e-mail : le renseignement est gnralement succinct et peut ne pas
tre jour (une information, pour tre able, doit tre rcente : une informa-
tion datant de trois mois na pas de valeur pour une dcision en matire de
crdit) ;
LA PRVENTION ET LE TRAITEMENT DES
DIFFICULTS FINANCIRES DE LA SARL
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
256
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La loi sur la prvention et le rglement amiable des difcults des
entreprises a pour objectif damliorer linformation nancire au sein
de lentreprise, de crer des procdures de contrle et dalerte en cas
dvolution proccupante de la situation de lentreprise.
Cependant, en dehors de ce cadre lgal de prvention, lentreprise peut
ngocier avec ses partenaires au cas par cas pour viter les difcults.
Les actions linitiative du grant
1.1.1. Transiger avec un crancier
En dehors du rglement amiable, ou de la dsignation dun mandataire
ad hoc, le grant peut conclure des transactions individuelles avec ses
des rapports actualiss chaque demande : lorsque la ligne de crdit est
importante, il est fortement conseill de faire appel ce type de rapport dont
le cot peut varier de 35 160 environ ;
une note dvaluation du client ( credit-scoring ) ;
une veille permanente sur une liste de clients dsigns, sur lesquels lentre-
prise reoit toute information nouvelle, ds leur mission.
3. Lentreprise doit tre aux aguets ( veille crdit ) de toute information sur
ses clients lui permettant dapprcier le risque en effectuant :
des visites des clients et des prospects, conversations tlphoniques avec le
personnel de lentreprise qui peut donner de prcieuses informations sur
lambiance, lecture de la presse spcialise, renseignements auprs de syn-
dicats professionnels pour obtenir des informations sur le secteur, sur la
concurrence, conversation avec les confrres ;
lanalyse des retards de paiement : les retards peuvent provenir dun litige
commercial mais le plus souvent ils sont signes de difcults nancires
(lorsquune entreprise a des difcults, ses litiges avec les fournisseurs aug-
mentent ; il sagit en fait de manuvres dilatoires pour retarder le paiement) ;
lanalyse des lenteurs dans le retour des effets de commerce, des demandes
de prorogation dchance ou des retours deffets de commerce avec une
modication de la date dchance impose au fournisseur (signicatifs de
difcults nancires).
1. La prvention des difcults
1.1.
/
La prvention et le traitement des difficults financires de la SARL
257
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
cranciers. Le crancier peut avoir intrt accepter lorsque lentre-
prise est en difcult, ou lorsquelle conteste le montant de la crance
(le crancier peut prfrer abandonner une partie de sa crance an
dviter les alas dune ventuelle procdure collective ou dun procs).
La transaction est inattaquable si chacune des parties a consenti des
concessions rciproques.
1.1.2. Obtenir une remise de dette
Sil existe un courant daffaires entre deux entreprises, le grant de
lentreprise en difcult peut ngocier un abandon de crance. Pour
viter toute contestation ultrieure, la remise de dette sera concrtise
par un crit qui peut comporter une clause de retour meilleure for-
tune (la crance sera paye ultrieurement si lentreprise ralise, par
exemple, un bnce au cours des exercices ultrieurs).
1.1.3. Demander en justice des dlais de paiement
Le grant peut solliciter en justice des dlais pour retarder le paiement
dune dette (deux ans maximum) mme si le crancier a dj engag
une procdure de saisie.
Le grant doit dmontrer au juge que lentreprise ne peut pas faire face
au paiement cause dun problme nancier conjoncturel, et quelle
est en mesure dy remdier rapidement. Si la SARL est dans un tat de
cessation des paiements, le juge refusera daccorder des dlais de paie-
ment (louverture dune procdure collective est obligatoire dans ce
cas).
1.1.4. Ngocier avec lURSSAF
Si lentreprise a des difcults nancires, le grant doit :
remplir, dans les dlais, les dclarations sociales an dviter les
pnalits ;
rgler la part salariale des cotisations (le dfaut de rglement du
prcompte est sanctionn pnalement) ;
Guide pratique de la SARL et de lEURL
258
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
ngocier lamiable avec lURSSAF des dlais de paiement sur
les cotisations, et une remise des pnalits et des majorations de
retard.
1.1.5. Ngocier avec le Trsor public
Si lentreprise a des difcults nancires, le grant doit :
dposer, dans les dlais, les dclarations scales an dviter les
pnalits ;
solliciter du receveur des impts un plan de rglement chelonn.
Le plan peut tre accept si la proposition du grant est raliste.
Dans ce cas, lentreprise peut ngocier une remise des majora-
tions de retard (NB : si lentreprise est elle-mme crancire de
ltat, des dlais de rglement et des remises de pnalits lui
seront systmatiquement accords).
1.1.6. Le CODEFI
Si lentreprise est dbitrice du Trsor public et des organismes sociaux,
le grant peut sadresser auprs :
de la commission des chefs des services nanciers et des repr-
sentants des organismes de Scurit sociale pour obtenir des
dlais de rglement ;
du comit dpartemental pour lexamen des problmes de nan-
cement des entreprises (CODEFI) pour obtenir des dlais de
rglement et bncier dune aide nancire publique.
NB : les entreprises de taille importante (plus de 250 salaris) relvent
du CORRI, comit rgional, ou du CIRI, comit national.
Ngocier avec lURSSAF des dlais de paiement
LURSSAF dlivrera une assignation en redressement ou liquidation judiciaire en cas
de dfaut de paiement.
Zoom n 76
La prvention et le traitement des difficults financires de la SARL
259
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Dans la pratique, les entreprises importantes tablissent les comptes annuels
dans les quatre mois qui suivent la clture de lexercice coul.
Linformation comptable et nancire
1.2.1. Lobligation dinformation de la SARL
1. Quand la SARL a-t-elle lobligation de prsenter
des documents prvisionnels ?
Lobligation dtablissement de documents prvisionnels concerne les
SARL relativement importantes puisquelles doivent, la clture dun
exercice social, employer au moins 300 salaris, ou raliser un chiffre
daffaires au moins gal 18 millions deuros (la SARL cesse dtre
tenue dtablir ces documents lorsquelle ne remplit aucune de ces
conditions pendant deux exercices successifs).
Les documents prvisionnels comprennent :
le tableau de nancement ;
le plan de nancement prvisionnel ;
le compte de rsultat prvisionnel ;
la situation de lactif ralisable et disponible, valeurs dexploita-
tion exclues, et du passif exigible.
2. Dlais respecter pour ltablissement des documents
prvisionnels
Documents prvisionnels Frquence Dlai respecter
La situation de lactif ralisable et
disponible, et du passif exigible
Semestriel Dans les quatre mois qui suivent la fin
du semestre.
Le tableau de financement Annuel En mme temps que les comptes
annuels
1
.
Le plan de financement Annuel lexpiration du quatrime mois qui
suit louverture de lexercice en cours.
Le compte de rsultat Annuel lexpiration du quatrime mois qui
suit louverture de lexercice en cours.
1.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
260
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
3. Comment tablir les documents prvisionnels ?
Les rgles de prsentation et les mthodes utilises pour llabo-
ration des documents prvisionnels ne peuvent pas tre modies
dune priode lautre, sauf si ces changements sont justis
dans le rapport du grant qui doit en dcrire lincidence.
Le tableau de nancement, le plan de nancement prvisionnel et
le compte de rsultat prvisionnel doivent comporter les chiffres
de lexercice prcdent.
La situation de lactif ralisable et disponible, et du passif exigi-
ble doit comporter les chiffres des deux semestres prcdents.
Les documents doivent faire apparatre la situation de trsorerie
de la SARL, ses rsultats prvisionnels ainsi que ses moyens et
prvisions de nancement.
Le compte de rsultat prvisionnel peut comporter plusieurs
simulations.
Les documents sont analyss dans un rapport tabli par le grant.
4. Contrle des documents prvisionnels
Les documents prvisionnels accompagns du rapport du grant sont
adresss au commissaire aux comptes et au comit dentreprise dans
les huit jours de leur tablissement.
Si les documents prvisionnels ou le rapport du grant appellent des
observations de la part du commissaire aux comptes, il le signale dans
un rapport qui doit tre adress au grant ainsi quau comit dentre-
prise dans le mois qui suit lexpiration des dlais impartis pour lta-
blissement des documents prvisionnels.
Le commissaire aux comptes peut demander que son rapport soit
communiqu aux associs. Dans ce cas, le grant doit ladresser aux
associs dans le dlai de huit jours compter de la rception du rapport.
1.2.2. Le droit des associs de sinformer
1. Les questions crites des associs sur tout fait de nature
compromettre la continuit de lexploitation
Tout associ non grant dune SARL a le droit de poser deux fois
par exercice au grant des questions crites sur tout fait de nature
La prvention et le traitement des difficults financires de la SARL
261
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
compromettre la continuit de lexploitation. La rponse du grant
doit tre communique au commissaire aux comptes.
2. Lexpertise sur oprations de gestion
Un ou plusieurs associs reprsentant au moins le dixime du capital
social peuvent demander au prsident du tribunal de commerce de
dsigner un expert charg de prsenter un rapport sur une ou plusieurs
oprations de gestion. Le ministre public et le comit dentreprise
peuvent former la mme demande.
Le grant est convoqu laudience par lettre recommande avec
demande davis de rception.
Le prsident du tribunal de commerce dnit la mission et les
pouvoirs des experts (lexpert a une mission limite qui porte
seulement sur une ou plusieurs oprations de gestion, et non sur
lensemble de la gestion sociale). Le prsident peut mettre les
honoraires la charge de la socit.
Le rapport dexpertise est adress au demandeur, au ministre
public, au comit dentreprise, au commissaire aux comptes et au
grant.
Le rapport doit tre annex celui tabli par le commissaire aux
comptes en vue de la prochaine assemble gnrale et tre sou-
mis aux mmes formalits de publicit.
La procdure dalerte
1.3.1. Lalerte par le commissaire aux comptes
Si la SARL est dote dun commissaire aux comptes, il peut mettre en
uvre une procdure dalerte qui se droule comme suit.
Dlit dentrave
Le grant qui fait sciemment obstacle aux vrications et contrles de lexpert est
coupable dun dlit sanctionn des mmes peines que le dlit dentrave au commis-
saire aux comptes : emprisonnement de cinq ans et/ou amende de 18 000 .
Zoom n 77
1.3.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
262
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Le commissaire aux comptes demande au grant des explications
sur les faits de nature compromettre la continuit de lexploita-
tion. Le grant, dans les 15 jours de la rception de la demande
dexplications, doit rpondre par lettre recommande avec accus
de rception. Dans sa rponse, le grant donne son analyse de la
situation et prcise, le cas chant, les mesures envisages.
Le grant doit adresser une copie de sa rponse au comit
dentreprise par lettre recommande avec accus de rception
dans les 15 jours de la rception de la demande dexplications
du commissaire aux comptes.
Le commissaire informe immdiatement le prsident du tribu-
nal de commerce de lexistence de la procdure dalerte par
lettre recommande avec AR, ou par lettre remise en mains
propres contre rcpiss.
2. En cas dinobservation des dispositions prcdentes, ou si en
dpit des dispositions prises, le commissaire aux comptes cons-
tate que la continuit de lexploitation demeure compromise, il
tablit un rapport spcial et invite par crit le grant faire dli-
brer la prochaine assemble sur les faits relevs. Le rapport est
galement communiqu au comit dentreprise.
3. Si, lissue de lassemble gnrale, le commissaire constate que
les dcisions prises ne permettent pas dassurer la continuit de
lexploitation, il en informe immdiatement le prsident du tribu-
nal de commerce par lettre recommande avec accus de rcep-
tion. Le commissaire communique la copie de tous les documents
utiles linformation du prsident du tribunal ainsi que lexpos
des raisons qui lont conduit constater linsufsance des dci-
sions prises.
1.3.2. Lalerte par le comit dentreprise
Le comit dentreprise peut mettre en uvre une procdure dalerte
sil constate des faits de nature affecter de manire proccupante la
situation conomique de lentreprise. Son droulement est le suivant.
1. Lorsque le comit dentreprise constate des faits de nature
affecter de manire proccupante la situation conomique de
lentreprise, il peut demander lemployeur de lui fournir des
La prvention et le traitement des difficults financires de la SARL
263
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
explications. Cette demande devra tre inscrite lordre du jour
de la prochaine sance du comit dentreprise.
2. Si le comit dentreprise na pu obtenir de rponse sufsante de
lemployeur ou si sa rponse conrme le caractre proccupant de
la situation, le comit pourra tablir un rapport qui sera transmis
lemployeur et au commissaire aux comptes. Pour ltablissement
de ce rapport, le comit peut se faire assister de lexpert-compta-
ble quil a choisi pour lexamen annuel des comptes, convoquer le
commissaire aux comptes et sadjoindre avec voix consultative
deux salaris de lentreprise choisis pour leur comptence et hors
du comit.
3. Le comit dentreprise dcide sil convient de demander au grant
de communiquer ce rapport aux associs. Le grant doit commu-
niquer le rapport aux associs dans les huit jours de la demande
du comit.
Les dlgus du personnel, en cas dabsence de comit dentreprise,
peuvent mettre en uvre la procdure dalerte dans les mmes condi-
tions que le comit dentreprise.
1.3.3. Lalerte par le prsident du tribunal de commerce
Sil rsulte dune procdure en cours, ou dun document, que la SARL
connat des difcults de nature compromettre la continuit de lex-
ploitation, le prsident du tribunal de commerce peut convoquer le grant
pour que soient envisages les mesures propres redresser la situation.
lissue de lentretien, le prsident du tribunal peut obtenir communi-
cation des renseignements de nature lui donner une exacte information
En tant que grant, prsentez-vous la convocation
du prsident du tribunal de commerce
dfaut, il peut prononcer dofce le redressement judiciaire ou la liquidation de lentre-
prise sil considre quelle est en tat de cessation de paiements. De plus, si plusieurs
mois aprs cette convocation, vous dposez votre bilan pour insufsance dactif, le tri-
bunal sera tent dengager des poursuites contre vous en comblement de passif.
Zoom n 78
Guide pratique de la SARL et de lEURL
264
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
sur la situation conomique et nancire de lentreprise, en sadressant
au commissaire aux comptes, aux membres ou reprsentants du person-
nel, aux administrations publiques, aux organismes de scurit et de
prvoyance sociales ainsi quaux services chargs de la centralisation
des risques bancaires et des incidents de paiement.
Le prsident peut dsigner un mandataire ad hoc qui peut tre charg,
par exemple, de rechercher un accord entre lentreprise, son banquier
et les autres cranciers.
Si le prsident estime que lentreprise est en tat de cessation des paie-
ments (au vu des renseignements recueillis au cours de lentretien, ou
dans le cadre de la mission cone au mandataire ad hoc), le prsident
peut saisir dofce le tribunal en vue dun redressement judiciaire, ou
de la liquidation judiciaire immdiate.
La procdure de rglement amiable permet au grant dune entreprise
en difcult de solliciter du prsident du tribunal de commerce la dsi-
gnation, pour quatre mois maximum, dun conciliateur dont la mission
sera de rechercher la conclusion dun accord avec les cranciers.
la demande du conciliateur, le prsident du tribunal peut ordonner
que toutes les poursuites des cranciers de lentreprise soient suspen-
dues pendant quatre mois, au maximum. Si le conciliateur parvient
un accord, il sera soumis lhomologation du prsident du tribunal de
commerce.
La procdure de rglement amiable permet dimposer des solutions
avant que lentreprise ne soit en tat de cessation de paiements
Certains cranciers, notamment le Trsor public et lURSSAF, ne souhaiteront pas
participer laccord amiable dans la mesure o leurs intrts sont mieux protgs
dans une procdure de redressement ou de liquidation judiciaire.
2. Le rglement amiable des difcults
de lentreprise
Zoom n 79
/
La prvention et le traitement des difficults financires de la SARL
265
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Quelles sont les entreprises concernes ?
Le rglement amiable est une procdure destine une entreprise
commerciale ou artisanale qui nest pas en tat de cessation de paie-
ments, mais qui connat cependant une difficult juridique, conomi-
que ou nancire ou des besoins ne pouvant pas tre couverts par un
nancement adapt aux possibilits de lentreprise.
Quelle est la procdure suivre ?
2.2.1. Demande de rglement amiable
Le grant de la SARL saisit le prsident du tribunal de commerce de sa
demande de rglement amiable. Il lui expose les difcults juridiques,
conomiques ou nancires de lentreprise.
Le grant indique les mesures de redressement envisages, ainsi
que les dlais de paiement ou les remises de dettes permettant de
mettre en uvre ces mesures.
Dautres cranciers accepteront un rglement amiable dans la mesure o cest leur
seule chance de rcuprer leur crance.
La procdure de rglement amiable devrait permettre dobtenir plus facilement du
banquier de lentreprise des dlais de rglement car il serait difcile de lui reprocher
un soutien abusif ds lors que les dlais de rglement quil a accords ont t homo-
logus par le prsident du tribunal de commerce.
Rglement amiable
Une entreprise est condamne pour concurrence dloyale au paiement de domma-
ges et intrts avec excution provisoire. Elle fait appel, mais le paiement immdiat
des dommages et intrts met en pril la poursuite de lexploitation. Cette entreprise
qui nest pas en tat de cessation de paiements a tout intrt utiliser la procdure
de rglement amiable.
(Suite zoom n 79)
/
2.1.
Cas n 38
2.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
266
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le grant communique des documents comptables et nanciers
qui sont annexs la demande.
Ds rception de la demande de rglement amiable, le prsident du tri-
bunal de commerce :
convoque le grant pour entendre ses explications ;
en informe le procureur de la Rpublique.
Le prsident du tribunal de commerce peut charger un expert :
dtablir un rapport sur la situation conomique, sociale et nan-
cire de lentreprise (le rapport est communiqu au conciliateur) ;
et, dobtenir des tablissements bancaires et nanciers tout ren-
seignement de nature donner une exacte information sur la
situation conomique et nancire de lentreprise.
2.2.2. Nomination dun conciliateur
Le prsident du tribunal de commerce qui ouvre la procdure de rgle-
ment amiable, dsigne un conciliateur pour une priode qui ne peut
excder trois mois (elle peut tre proroge dun mois la demande du
conciliateur). Sa mission est de favoriser le fonctionnement de lentre-
prise et de rechercher la conclusion dun accord avec les cranciers.
Dans le dossier quil communique, le grant doit dmontrer au prsident
du tribunal de commerce la faisabilit du rtablissement de lentreprise
Les sources potentielles de rduction de charges (effectifs, frais gnraux) ; les
actifs de lentreprise qui peuvent tre cds pour gnrer de la trsorerie, ou qui peu-
vent tre donns en garantie aux cranciers qui participent au rglement amiable ;
peu importe si tous les documents comptables exigs ne sont pas runis.
Conciliateur ou mandataire ad hoc
La dure de la mission du conciliateur est de quatre mois au maximum. Comme
ce dlai est souvent trop court pour obtenir un accord de rglement des cranciers,
le grant a intrt faire dsigner un mandataire ad hoc avant dengager la procdure
de rglement amiable an dallonger la priode de discussion avec les cranciers.
Zoom n 80
Zoom n 81
La prvention et le traitement des difficults financires de la SARL
267
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.2.3. Suspension provisoire des poursuites
Si le conciliateur estime quune suspension provisoire des poursuites
faciliterait la conclusion dun accord avec les cranciers, il en saisit le
prsident du tribunal de commerce.
Le conciliateur en informe les cranciers et sollicite leur avis.
Le conciliateur communique la liste des cranciers dont il a
connaissance, le montant de leur crance exigible et leur avis sur
la suspension provisoire des poursuites.
Le prsident du tribunal de commerce sollicite lavis du procureur
de la Rpublique.
Le prsident du tribunal de commerce, sil a laccord des principaux
cranciers, peut ordonner la suspension provisoire des poursuites de
toutes les crances pour une dure qui ne peut dpasser le terme de la
mission du conciliateur. La dcision est notie au grant, au procureur
de la Rpublique et aux cranciers.
Consquences de la suspension provisoire des poursuites sur les cran-
ces antrieures la dcision :
la suspension ne sapplique pas aux crances des salaris ;
elle suspend ou interdit toute action en justice pour condamner
lentreprise au paiement, ou la rupture dun contrat pour dfaut
de paiement (exemple : le propritaire des locaux ne peut pas
demander la rsiliation du bail en invoquant les loyers impays) ;
elle arrte ou interdit toute voie dexcution sur les biens de
lentreprise ;
les dlais de dchance ou de rsolution sont suspendus ;
le grant ne peut pas payer, en tout ou partie, une crance, ou
dsintresser une caution, ou faire un acte de disposition contraire
la gestion normale de lentreprise, ou consentir une hypothque
ou un nantissement (sauf autorisation du prsident du tribunal).
Suspension provisoire pour faire pression sur les cranciers
La suspension provisoire des poursuites permet de faire pression sur les cranciers
qui accepteront plus facilement les propositions du conciliateur dans la mesure o ils
ne peuvent plus agir en justice pour se faire payer.
Zoom n 82
Guide pratique de la SARL et de lEURL
268
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
2.2.4. Obtention dun accord avec les cranciers
Si un accord est conclu avec :
tous les cranciers, il est homologu par le prsident du tribunal
de commerce ;
les principaux cranciers seulement, le prsident du tribunal de
commerce peut lhomologuer et accorder lentreprise les dlais
de paiement prvus larticle 1244-1 du Code civil pour les
crances non incluses dans laccord.
2.2.5. Effets de laccord amiable
Pendant toute la dure de son excution, laccord amiable a les
mmes consquences que la suspension provisoire des poursuites.
En cas dinexcution des engagements rsultant de laccord
amiable :
le tribunal prononce la rsolution de laccord ainsi que la
dchance de tout dlai de paiement accord ;
linexcution nentrane plus dofce louverture dun redres-
sement judiciaire ;
la procdure de redressement judiciaire peut tre demande par
le procureur de la Rpublique, par le grant ou par un crancier
partie laccord.
2.2.6. Secret professionnel
Toute personne qui a connaissance du rglement amiable est tenue
au secret professionnel (sous peine de sanctions pnales : emprisonne-
ment dun six mois et amende de 1 200 ).
Le mandataire ad hoc
Le grant dune entreprise en difcult peut demander au prsident du tribunal de
commerce de dsigner un mandataire ad hoc. Comme lordonnance qui dsigne le
mandataire ne fait lobjet daucune publicit, les clients de lentreprise ne sont pas, en
principe, informs de cette nomination.
Zoom n 83
/
La prvention et le traitement des difficults financires de la SARL
269
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La loi du 10 juin 1994 relative la prvention et au traitement des dif-
cults des entreprises a institu deux types de procdure collective.
Le redressement judiciaire qui lissue dune priode dobser-
vation et faute dun plan de continuation viable aboutit la liqui-
dation ou la cession de lentreprise.
La liquidation judiciaire immdiate qui peut tre prononce sans
ouverture dune priode dobservation lorsquaucun redressement
nest envisageable.
La loi de 1994 a rtabli les droits des cranciers munis de privilges ou
de srets, et a renforc le contrle de lexcution du plan de redresse-
ment an de sassurer que le repreneur respecte ses engagements.
Quels sont les cas douverture de la procdure
de redressement ou de liquidation judiciaire ?
La cessation des paiements : le dbiteur est dans limpossibilit
de faire face son passif exigible avec son actif disponible.
Le mandataire ne simmisce pas dans la gestion quotidienne de lentreprise. Son rle
est de prparer une restructuration ou un accord de rglement avec les cranciers
an de rsoudre les difcults de lentreprise.
An dobtenir un accord avec ses cranciers, le grant peut avoir intrt faire dsi-
gner un mandataire ad hoc au lieu de recourir la procdure de rglement amiable
pour les raisons suivantes :
le rglement amiable est une procdure plus lourde ;
la condentialit est plus facile conserver avec un mandataire ad hoc (la perte de
condentialit peut porter atteinte au crdit de la socit et accentuer encore ses
difcults) ;
le mandat ad hoc peut tre un pralable au rglement amiable.
(Suite zoom n 83)
/
3. Le redressement et la liquidation judiciaire
3.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
270
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Linexcution dun rglement amiable : le dbiteur ne respecte
pas les engagements nanciers conclus lamiable avec un ou
plusieurs de ses cranciers.
Linexcution dun contrat de location-grance : le locataire-
grant ne respecte pas son engagement irrvocable dacqurir
lentreprise dans un certain dlai.
Linexcution du plan de continuation de lentreprise : le dbi-
teur de lentreprise en redressement judiciaire ne respecte pas ses
obligations et engagements dans les dlais xs par le plan. Dans
ce cas, le tribunal peut prononcer la rsolution du plan et louver-
ture dune procdure de liquidation judiciaire.
Qui ouvre la procdure de redressement
ou de liquidation judiciaire ?
Le grant : il doit demander louverture de la procdure au plus
tard dans les 15 jours qui suivent la cessation de paiements sous
peine dtre condamn la faillite personnelle.
Le crancier impay sur assignation en redressement ou en liqui-
dation quelle que soit la nature de sa crance. Lentreprise assi-
gne prfrera souvent rgler tout de suite le crancier plutt que
dtre engage dans une procdure collective.
Le procureur de la Rpublique par le biais dune requte au tri-
bunal.
Le tribunal de commerce dofce sur la base dinformations
vries, de dclarations de protts
Le tribunal comptent est celui dans le ressort duquel la SARL a son
sige.
Comment se droule la procdure ?
Le tribunal lors du jugement douverture la suite de la cessation des
paiements peut dcider :
la liquidation judiciaire immdiate si le redressement est mani-
festement impossible, ou lorsque lentreprise a cess toute acti-
vit ;
3.2.
3.3.
La prvention et le traitement des difficults financires de la SARL
271
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
ou le redressement judiciaire qui se droule en deux phases :
1. une phase dobservation pendant laquelle un bilan conomi-
que et social est tabli, et un plan de redressement labor sous
lgide dun administrateur ;
2. lissue de la phase dobservation, le tribunal peut :
entriner le plan de continuation : lentreprise essaiera de se
redresser ;
dcider un plan de cession un repreneur ;
prononcer la liquidation judiciaire (il peut le faire toute
tape de la phase dobservation) ; lactif de la socit est
vendu pour apurer partiellement ou totalement le passif.
Lors du jugement douverture la suite de la cessation des paiements,
le tribunal :
ne peut statuer quaprs avoir entendu le grant et les reprsen-
tants du comit dentreprise (ou, dfaut, les dlgus du per-
sonnel) ;
xe la date de cessation des paiements qui ne peut remonter plus
de dix-huit mois avant la date du jugement douverture ;
nomme un juge-commissaire, un mandataire liquidateur, un
reprsentant des cranciers (en cas de redressement), et demande
au comit dentreprise de dsigner un reprsentant des salaris.
Le juge-commissaire dsigne un cinq contrleurs choisis parmi les
cranciers qui en font la demande.
Cessation des paiements
Saisine du tribunal
Liquidation judiciaire Redressement judiciaire
Priode dobservation
Liquidation
judiciaire
Plan de
continuation
Plan de
cession
Guide pratique de la SARL et de lEURL
272
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Redressement judiciaire : rgime gnral ou simpli ?
Pour les SARL qui emploient moins de cinquante salaris et dont le chiffre
daffaires hors taxes est infrieur 3 100 000 , le tribunal peut
choisir le rgime gnral ou le rgime simpli.
Pour les autres entreprises, seul le rgime gnral est applicable.
Rgime gnral Rgime simpli
Priode dobservation Elle peut atteindre vingt mois Elle ne peut excder huit mois
Rle du grant Le tribunal dsigne
un administrateur qui
remplace le dirigeant.
Le tribunal nest pas tenu de
dsigner un administrateur ;
le grant continue de
diriger lentreprise sous
la surveillance du juge-
commissaire.
En % des procdures 10 %. 90 %.
En % de succs Plus de 48 % obtiennent
un plan de redressement.
Plus de 90 % sont liquides.
273
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
6
LENTREPRISE UNIPERSONNELLE
RESPONSABILIT LIMITE (EURL)
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL) est
une SARL avec un seul associ. Elle est donc soumise aux mmes
rgles que la SARL avec certaines adaptations rendues ncessaires
par lexistence dun associ unique. Nous ne prsenterons donc ici
que les spcicits de lEURL. Pour les rgles applicables la SARL,
il vous suft de vous reporter aux autres parties de ce guide.
Lessentiel sur lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL) est une SARL avec un
seul associ. LEURL permet de limiter la responsabilit de lentrepreneur indivi-
duel au montant de ses apports. Elle offre les avantages de la SARL tout en vitant
les inconvnients de lentreprise individuelle. La fonction de grant nest pas obli-
gatoirement exerce par lassoci unique. Lassoci unique peut tre une per-
sonne physique ou une personne morale.
Le montant du capital social est librement x par lassoci. Le capital doit tre
libr du cinquime au moins lors de la constitution.
1. LEURL en bref
/
LENTREPRISE UNIPERSONNELLE
RESPONSABILIT LIMITE (EURL)
Guide pratique de la SARL et de lEURL
274
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Que la personne morale soit impose lIS ou lIR.
Pour quels projets utiliser lEURL ?
2.1.1. Dvelopper un projet professionnel
LEURL est une structure bien adapte pour lentrepreneur
individuel. LEURL peut tre utilise par le crateur dentreprise ou
par lexploitant individuel qui souhaite apporter son fonds de com-
merce une socit. Le chef dentreprise qui adopte lEURL reste
seul matre de laffaire quil a cre ou dveloppe. La responsabilit
de lassoci unique est limite au montant de ses apports. La spara-
tion des patrimoines astreint le dirigeant une plus grande rigueur
dans la gestion comptable et nancire de son entreprise. Les clauses
statutaires permettent de moduler la structure en fonction du projet
de lentrepreneur. En cas dvolution, lEURL peut se transformer
en SARL pour bncier de lapport de nouveaux associs.
LEURL pour la cration de filiales totalement matrises au sein
dun groupe. LEURL permet de constituer des liales totalement
matrises au sein dun groupe. Elle permet une simplication de
lorganisation des groupes, une diminution des cots de fonctionne-
ment et limite la responsabilit de la socit mre. LEURL permet de
coner la grance un cadre de la socit. LEURL sera obligatoire-
ment soumise lIS car son associ unique est une personne morale
1
.
Le capital peut tre variable. Un commissaire aux comptes nest pas obligatoire
dans les petites EURL.
LEURL est soumise limpt sur le revenu avec la possibilit dopter pour limpt
sur les socits. Le grant associ de lEURL a obligatoirement le statut de tra-
vailleur indpendant. Les cessions de parts sociales sont imposes au taux de
5 %. Avec larrive de nouveaux associs, lEURL devient automatiquement une
SARL. Les rgles de fonctionnement de la SARL sappliquent lEURL avec une
plus grande souplesse car il ny a quun seul associ.
2. Pourquoi choisir lEURL ?
2.1.
/
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
275
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Voir le Guide pratique de lentreprise individuelle aux ditions dOrganisation.
LEURL vite des montages avec des associs ctifs pour respecter
les exigences lgales relatives un nombre minimal dassocis. Pour
ces liales 100 %, il faudra viter la confusion de patrimoine et
respecter la rglementation sur les participations rciproques. Ainsi,
si LEURL a pour associ une socit par actions, elle ne pourra pas
dtenir dactions mises par la socit par actions.
LEURL pour isoler chaque activit dans une structure juridi-
que distincte. Une personne physique ou une socit qui a plusieurs
activits peut isoler chacune de ces activits dans une EURL car une
personne peut tre associe unique de plusieurs EURL.
2.1.2. Grer un patrimoine immobilier
LEURL est une structure bien adapte pour la gestion dune acti-
vit de loueur en meubl professionnel. Lactivit de loueur en
meubl professionnel peut tre isole au sein dune EURL ou dune
SARL de famille. LEURL se transforme automatiquement en SARL
de famille avec lentre au capital de membres de la famille. LEURL
devient alors une structure patrimoniale permettant doptimiser la
gestion et la transmission du patrimoine immobilier.
LEURL permet une personne de placer ses capitaux dans lacqui-
sition dun fonds de commerce et de le faire grer par un tiers tout
en limitant sa responsabilit. La personne vite ainsi le recours au
salariat ou la location-grance. Le fonds de commerce isol au sein
dune EURL facilite la transmission de lentreprise car il est plus
facile, moins onreux et moins formaliste de cder des parts sociales
quun fonds de commerce.
Entreprise individuelle, EURL, SASU, SELU ou EARL ?
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL) est une
SARL associ unique. Cet associ ne possde pas le statut social et
scal dun grant minoritaire de SARL mais celui dun entrepreneur
individuel
1
.
2.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
276
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Voir le Guide pratique de la SAS et de la SASU aux ditions dOrganisation.
2. La limitation de la responsabilit de lassoci unique au montant de ses apports
peut tre remise en cause si les cranciers exigent des garanties personnelles ou
en cas daction en comblement de passif si la socit vient dposer son bilan.
3. Cependant, dans une EIRL (Entreprise individuelle responsabilit limite), la
responsabilit de lentrepreneur peut-tre limite au patrimoine quil affecte
lentreprise. Voir le Guide pratique de lEIRL aux ditions dOrganisation.
La socit par actions simplie unipersonnelle (SASU) est une
socit par actions cre par une seule personne. Lassoci unique est
gnralement le prsident de la SASU. Le prsident de la SASU a le
statut social et scal dun salari
1
.
La socit dexercice libral unipersonnelle (SELU) permet dexercer
une profession librale sous la forme dune EURL adapte aux spci-
cits de lexercice libral (voir, page 301, la partie consacre la SEL
sous forme de SARL).
Lentreprise agricole responsabilit limite unipersonnelle (EARL)
est une socit civile responsabilit limite qui a pour objet lexercice
dune activit agricole. Lassoci est obligatoirement une personne
physique (voir, page 309, la partie consacre lEARL).
Entreprise individuelle, EURL ou SASU ?
Le fonctionnement de la SASU et de lEURL est trs lourd par rapport celui
lentreprise individuelle mais la SASU et lEURL sont plus adaptes pour le
nancement et la transmission de lentreprise. La limitation de la responsabilit
dans la SASU et lEURL peut tre remise en cause. La SASU permet
lentrepreneur de bncier du rgime scal et social des salaris.
Entreprise individuelle SASU EURL
Responsabilit
du dirigeant
Le chef dentreprise
est responsable
indfiniment des dettes
de lentreprise sur ses
biens personnels
3
.
La responsabilit de lassoci unique
est limite au montant du capital
2
.
/
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
277
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Entreprise individuelle SASU EURL
Sparation des
patrimoines
et rigueur dans
la gestion
La confusion entre le
patrimoine priv du chef
dentreprise et le
patrimoine professionnel
ne contribue pas une
sparation trs nette
entre la comptabilit
prive et celle de
lentreprise.
La gestion de lentreprise est plus rationnelle
car le patrimoine de la socit est distinct de
celui de lassoci.
Transmission
de lentreprise
Lentrepreneur doit
cder lintgralit de
son entreprise.
Lassoci peut organiser son dsengagement
progressif par des cessions successives de
titres sociaux
1
.
Cot
de la cession
lev car calcul au taux
de 3 % sur la valeur
brute du fonds de
commerce
2
.
Plus faible car
calcul au taux de
3 % plafonn
5 000 sur la valeur
des actions
3
.
Plus faible car
calcul au taux de
3 % sur la valeur
des parts sociales
3
.
Formalits
de la cession
La cession dun fonds de
commerce est soumise
des formalits
contraignantes.
La cession des titres sociaux
1
est soumise
une simple inscription en compte.
Sauvegarde de
lentreprise
en cas de
dcs
En cas de dcs, les
hritiers deviennent
propritaires indivis de
lentreprise. Lindivision
entranera la vente de
lentreprise
4
.
Lassoci peut attribuer chacun de ses
hritiers le nombre exact des titres sociaux
1
lui
revenant sans remettre en cause la prennit
de lentreprise.
1. Actions pour la SASU ; parts sociales pour lEURL.
2. On ne peut pas dduire les dettes de la valeur brute du fonds de commerce pour
le calcul des droits denregistrement. Pour un fonds de commerce : 0 % jusqu
23 K ; 3 % de 23 K 107 K ; 5 % au-del. Pour les parts dune SARL
abattement de 23 000 .
3. La valeur des actions ou des parts sociales correspond la valeur du fonds de
commerce minore des dettes (= situation nette rvalue de lentreprise).
4. Lentreprise devra tre vendue si les hritiers qui veulent poursuivre lactivit
nont pas les moyens de racheter la part des cohritiers qui voudraient imm-
diatement encaisser leur hritage.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
278
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Entreprise individuelle SASU EURL
Financement Le financement ne peut
tre assur que par des
apports personnels
ou par des emprunts
bancaires.
La transformation
de la SASU en SAS
permet de drainer
des capitaux par une
simple augmentation
de capital. La SASU
peut mettre des
obligations
1
.
La transformation
de lEURL en SARL
2
permet davoir de
nouveaux associs
qui apportent des
fonds.
mission dobligations
autorise.
Rgime fiscal
et social
du dirigeant
Lentrepreneur
individuel a le statut
social de travailleur
indpendant.
Sa rmunration est
constitue par le
bnfice dgag par
son entreprise
3
.
Le prsident a le
statut fiscal et social
de salari comme le
prsident-directeur
gnral dans la SA.
Le grant de lEURL
a le statut social
de travailleur
indpendant.
Sa rmunration
est constitue par
le bnfice dgag
par lEURL
3
.
Standing Entrepreneur individuel. Prsident. Grant.
Capital Le financement est
assur par les apports
de lexploitant (pas de
minimum ; pas de
capital car ce nest pas
une socit).
Le capital est fix par lassoci. Pour constituer
une EURL ou une SASU il suffit dun euro.
Imposition
des bnfices
Le bnfice dgag par
lentreprise est soumis
lIR au niveau de
lentrepreneur dans
la catgorie BIC
4
. LEIRL
peut opter pour lIS.
Le bnfice est
soumis lIS au
niveau de la SASU.
Le bnfice est
soumis lIR au
niveau du grant dans
la catgorie des BIC
4
.
LEURL peut opter
pour lIS.
1. La SASU doit avoir deux ans dexistence et un bilan approuv.
2. La transformation de lEURL en SARL est ncessaire pour assurer le nance-
ment du dveloppement.
3. Ladhsion un centre de gestion agr permet dviter la majoration de 25 %
du bnce imposable. Quand lEIRL opte pour limpt sur les socits, les
charges sociales sont calcules sur la rmunration de lentrepreneur.
4. BIC, BNC ou BA voir page 291.
/
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
279
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Le fonctionnement dune SASU ou dune EURL est contraignant : constata-
tion des dcisions dans un registre spcial, obligation de nommer un commis-
saire aux comptes pour la SASU et pour les EURL importantes, dpt au greffe
des comptes annuels LEURL et la SASU sont exclues du rgime des micro-
entreprises, du rgime de la comptabilit super-simplie et du bnce de la
dispense dtablissement du bilan.
2. Pour un fonds de commerce : 0 % jusqu 23 K ; 3 % de 23 K 107 K ;
5 % au-del. Pour les parts dune SARL abattement de 23 000 .
3. Sont dots de la personnalit morale : les socits franaises ou trangres rgu-
lirement constitues, les associations dclares, les syndicats, les personnes
morales de droit public.
LEURL peut tre cre :
par constitution dune socit nouvelle : un entrepreneur qui veut
exploiter son activit sous forme dune socit unipersonnelle
constitue une EURL ;
ou par transformation dune SARL existante ou dune socit
dune autre forme.
Constitution dune socit nouvelle
Les conditions de constitution dune EURL sont les mmes que celles
de la SARL (voir page 18) sous rserve des commentaires qui suivent.
Lassoci unique peut tre une personne physique ou une personne
morale
3
. Si lassoci unique est une personnalit morale, lEURL
devient alors une liale 100 %. Cependant, une EURL ne peut pas
Entreprise individuelle SASU EURL
Fonctionnement Trs souple. Trs lourd
1
.
Droits
denregis-
trement
Lachat dun fonds
de commerce est
soumis aux droits
denregistrement
2
.
Lapport dun fonds de commerce est soumis
aux droits denregistrement
2
.
3. Comment crer lEURL ?
3.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
280
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
tre lassoci unique dune autre EURL. Une personne physique ou
une personne morale peut tre associe unique de plusieurs EURL.
La dnomination sociale de lEURL doit tre prcde ou suivie de
la mention Socit responsabilit limite ou SARL . La men-
tion Entreprise unipersonnelle responsabilit limit ou EURL
nest pas obligatoire.
Le capital social de lEURL est librement x par lassoci unique et
peut tre libr du cinquime seulement lors de la constitution. Le
capital de lEURL peut tre variable. Dans ce cas, lentre de nou-
veaux associs transforme lEURL en SARL.
Pour les apports, lassoci doit avertir son conjoint en cas dapport
dun bien commun. Si le conjoint ne renonce pas expressment deve-
nir associ, lEURL est transforme en SARL (voir page 21 pour les
consquences). En cas dapports en nature, lassoci unique qui na
pas lobligation de dsigner un commissaire aux apports doit conser-
ver les lments lui permettant de prouver le bien-fond de son valua-
tion. Comme dans une SARL, les apports en industrie sont possibles
mais ne prsentent aucun intrt dans une EURL.
Le cot de la constitution dpend du rgime scal de lEURL. Reportez-
vous page 37. Le cot de constitution dune EURL impose :
lIR est le mme que celui dune SARL de famille ayant opt
pour lIR ;
lIS est le mme que celui dune SARL classique impose lIS.
Pour limiter sa responsabilit, lassoci unique de lEURL doit viter
la confusion de patrimoine et de rendre lEURL ctive
Lassoci unique, personne physique ou personne morale, qui cre une EURL doit se
comporter comme un vritable associ dune personne morale : il doit respecter
lobjet social de lEURL et viter toute confusion entre les biens qui composent
le patrimoine social de lEURL et ses biens personnels
1
.
Zoom n 84
1. Voir tableaux page 281.
/
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
281
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Si lassoci unique ne respecte pas avec rigueur les exigences de formalisation
des diverses dcisions sociales, il encourt le risque dune condamnation au
comblement du passif car il sest comport comme dirigeant de fait.
2. Lattribution dune rmunration lassoci unique dirigeant est conseille
pour viter toute confusion entre le patrimoine de lEURL et celui de lassoci
unique.
Lassoci unique grant de lEURL ne doit pas donner limpression aux tiers quil agit
en son propre nom et pour son propre compte. II doit veiller prendre des dcisions
conformes lintrt de LEURL. Il doit formaliser de manire rigoureuse les actes
sociaux. De plus, lEURL ne doit pas tre ctive. dfaut, en cas de mise en redres-
sement ou de liquidation judiciaire de lEURL, lassoci unique sexpose lextension
de la procdure collective.
Pour limiter sa responsabilit, lassoci unique de lEURL doit viter
la confusion de patrimoine et de rendre lEURL ctive
Y a-t-il confusion de patrimoine entre lEURL et lassoci unique ?
La confusion de patrimoine rsulte de limbrication des intrts et de lexistence
de ux nanciers anormaux entre lEURL et lassoci qui font quil nest plus
possible de distinguer ce qui est propre lEURL et son associ unique.
Oui Non
Les comptes ou les activits de lEURL et de lassoci unique sont dans
un tat dimbrication inextricable.
X
Lassoci unique non dirigeant se fait consentir un dcouvert par lEURL
pour ses besoins personnels. Le rgime des conventions interdites ne
sapplique pas lassoci unique.
X
Lassoci grant conclut un acte dpassant lobjet social de lEURL. X
Lassoci unique ne formalise pas ses dcisions et ne les rpertorie pas
sur un registre
1
.
X
Le dirigeant de lEURL est lassoci unique. II est rmunr. X
2
Entre lEURL et lassoci unique, il y a des liens troits qui rsultent de
leur sige social et de leur dirigeant commun.
X
(Suite zoom n 84)
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
282
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Acquisition par un associ de lensemble des parts dtenues par ses coassocis ;
refus dagrment ; dcs dun associ dans une SARL constitue entre deux
poux ; rduction du capital pour permettre des associs de se retirer.
2. Contrairement au rgime de droit commun, il nest pas possible tout intress
de demander en justice la dissolution de la socit si celle-ci nest pas redeve-
nue pluripersonnelle lexpiration du dlai dun an, sauf si lassoci unique est
une autre EURL.
Transformation dune SARL en EURL
La runion de toutes les parts sociales dune SARL entre les mains dun
mme associ
1
nentrane pas la dissolution
2
de la SARL mais sa simple
transformation en EURL. Le passage de la SARL lEURL est opposa-
ble aux tiers aprs la ralisation du virement de compte compte.
Le passage de la SARL lEURL peut entraner un changement de
rgime scal si lEURL est soumise limpt sur le revenu (la SARL
transforme en EURL change de rgime scal car elle passe de lIS
LEURL est-elle ctive ?
Une EURL est fictive lorsquelle nest quune faade
masquant les activits de lassoci unique.
Oui Non
Une EURL nest quun service dune autre socit. X
Une EURL a t cre uniquement dans lintrt dune autre socit dont
elle gre le fonds de commerce.
X
Une EURL est dans un tat de dpendance financire et na pas dactivit
conomique relle.
X
Rdigez les statuts pour permettre lalternance SARL-EURL
En cours de vie sociale, une EURL peut devenir SARL, et une SARL peut devenir une
EURL. Pour viter de modier les statuts, des clauses dagrment applicables en cas
de pluralit dassocis (SARL) peuvent tre insres dans les statuts ds la constitu-
tion de lEURL.
Zoom n 85
3.2.
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
283
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
lIR). Dans ce cas, les incidences scales sont trs lourdes (voir le
tableau de synthse page 68).
En revanche, si lEURL opte pour lIS, le passage de la SARL
lEURL nest pas assimil une cessation dentreprise car la socit
continue dexister avec un seul associ sous le mme rgime scal
1
.
Les bnces en cours ou les plus-values latentes ne sont pas imposes
lIS (voir page 68 le tableau de synthse).
La cession des parts sociales qui aboutit la runion des parts sociales
entre les mains dun mme associ est soumise aux droits denregis-
trement au taux de 3 %. Un abattement de 23 000 sapplique (voir
page 92).
La plus-value ralise par le cdant des parts sociales est impose :
selon le rgime des plus-values des particuliers au taux de 30,1 %
si le cdant est un particulier
2
;
selon le rgime des plus-values professionnelles si le cdant est
une entreprise
3
.
Transformation dune SASU en EURL
La SASU peut tre transforme en EURL car cest galement une
socit unipersonnelle (la SASU et lEURL ont un seul associ).
3.3.1. Conditions de la transformation
La transformation dune SASU en EURL doit tre dcide par lasso-
ci unique
4
. Les conditions de la transformation sont les mmes que
pour la transformation dune SAS en SARL.
La SASU doit avoir au moins deux ans dexistence.
1. Il en est de mme pour une SARL de famille impose lIR qui se transforme
en une EURL impose lIR.
2. Ces rgimes sont dtaills page 94.
3. Voir note prcdente.
4. Le projet de transformation de la socit doit tre soumis lassemble gn-
rale des obligataires.
3.3.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
284
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le bilan des deux premiers exercices sociaux doit avoir t tabli
et approuv par lassoci unique.
Le commissaire aux comptes de la SASU tablit un rapport attes-
tant que le montant des capitaux propres est au moins gal au
montant du capital social.
Le capital doit tre entirement libr.
La transformation a des consquences, exposes page 64. Comme
toute modication des statuts, la dcision de transformation est sou-
mise aux formalits de publicit, exposes page 51.
3.3.2. Cot de la transformation
La transformation dune SASU en EURL nentrane pas la cration
dune personne morale nouvelle. La dcision de transformation a un
cot trs faible (le droit xe denregistrement de 75 est exigible).
En revanche, la transformation dune SASU en EURL entrane un
changement de rgime scal (une SASU transforme en EURL qui
na pas opt pour lIS change de rgime scal car elle passe de lIS
lIR) qui a des incidences scales lourdes. Cependant, les incidences
scales en matire dimposition des bnces peuvent tre fortement
attnues (voir tableau page 68) ; la colonne 2 concerne lEURL qui a
opt pour lIS ; la colonne 3, lEURL impose lIR).
La gestion de lEURL
4.1.1. Qui gre lEURL ?
Comme dans une SARL, le grant est obligatoirement une personne
physique. LEURL peut tre dirige par un ou plusieurs grants. Si
lassoci unique est :
une personne physique, elle se dsignera souvent comme grant
dans les statuts ou dans un acte postrieur ;
4. Fonctionnement de lEURL
4.1.
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
285
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
une personne morale, elle devra dsigner un tiers qui peut tre un
cadre au sein dun groupe.
Le grant associ unique de lEURL est irrvocable. En revanche, si le
grant est un tiers, lassoci unique peut le rvoquer. Si la rvocation
est dcide sans juste motif, elle peut donner lieu dommages-intrts
(voir page 115).
4.1.2. La rmunration du grant
Comme dans une SARL, la fonction de grant peut tre rmunre ou
gratuite. Lattribution dune rmunration au grant associ unique est
conseille pour viter toute confusion entre le patrimoine de lEURL
et celui de lassoci unique.
Lassoci unique doit procder aux formalits
de publicit de la nomination du grant
En cas domission, les tiers pourront toujours engager la responsabilit du grant sur
la base de la thorie du mandat apparent ou de la gestion de fait.
Ni rmunration excessive du grant associ,
ni gratuit pour viter la confusion de patrimoine
Si la rmunration du grant associ unique est excessive (elle nest pas compa-
tible avec la capacit nancire de lEURL), il en rsulte, en cas de cessation de paie-
ments, une faute de gestion pouvant entraner une action en comblement de passif
lencontre du grant.
Si la fonction du grant associ unique est gratuite, il ne peut percevoir que des
bnces sous forme de dividendes ou dacomptes sur dividendes. Cette procdure
est lourde car elle implique lapprobation des comptes pour les dividendes ou linter-
vention dun commissaire aux comptes pour les acomptes. Le grant ne devra surtout
pas prlever librement dans la caisse sociale comme peut le faire un entrepreneur
individuel, car il commettrait le dlit dabus de biens sociaux.
Zoom n 86
Zoom n 87
Guide pratique de la SARL et de lEURL
286
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
4.1.3. Le statut scal du grant de lEURL
Si lEURL est soumise limpt sur le revenu, le grant associ uni-
que est assimil un entrepreneur individuel. Sa rmunration nest
pas dductible pour le calcul du rsultat imposable de lEURL.
Le bnce de lEURL est soumis directement au niveau de lassoci
limpt sur le revenu dans la catgorie :
des bnces industriels et commerciaux (BIC) si lactivit est
commerciale ;
des bnces non commerciaux (BNC) si lactivit est librale.
Si lEURL adhre un centre de gestion agr, lassoci unique vite
la majoration de 25 % de son bnce imposable.
Si lEURL est soumise limpt sur les socits, la rmunration du
grant associ unique est dductible dans le calcul du rsultat impo-
sable de lEURL. Le grant nest pas assimil un salari mais sa
rmunration qui est impose dans la catgorie art. 62 du CGI bncie
de la dduction de 10 % pour frais professionnels comme un salari.
Si le grant nest pas associ, sa rmunration est dductible des
rsultats de lEURL. Elle est impose en tant que salaire au niveau du
grant. Si le grant non associ est le conjoint de lassoci unique de
lEURL, sa rmunration est dductible dans les conditions exposes
page 133.
Pour plus dinformation, reportez-vous page 150.
4.1.4. Le statut social du grant de lEURL
Lassoci grant a obligatoirement le statut de travailleur indpen-
dant comme le grant majoritaire dune SARL impose lIS (voir
page 123). Lassiette des cotisations dpend du rgime scal de lEURL
(voir les informations concernant le grant majoritaire dans le tableau
page 124).
Le grant non associ a le statut de salari. Cependant, sil cogre
avec lassoci unique ou sil est le conjoint de lassoci unique, il est
assimil un grant majoritaire et a obligatoirement le statut de tra-
vailleur indpendant.
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
287
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le grant non associ non rmunr ne relve daucun rgime obli-
gatoire.
4.1.5. Les pouvoirs du grant
Les pouvoirs du grant lgard des tiers sont les mmes que dans la
SARL (voir page 179). Ainsi, les actes du grant nengagent pas la
SARL sils sont de la seule comptence des associs. Cependant, dans
une EURL, cette rgle ne semble pas pouvoir sappliquer car tous les
pouvoirs sociaux sont runis entre les mains du grant associ unique.
Cette rgle sapplique si le grant nest pas lassoci unique.
4.1.6. La responsabilit du grant
Le grant de lEURL encourt les mmes responsabilits civiles, pnales
et scales que le grant de la SARL pluripersonnelle (voir page 137).
De plus, en cas de confusion de patrimoine, la responsabilit de lasso-
ci unique pourra tre mise en uvre dans le cadre dune procdure de
redressement judiciaire frappant lEURL dfaillante (voir page 143).
Le contrle de lEURL
4.2.1. Les conventions entre lEURL et lassoci unique
Lassoci unique peut passer avec lEURL une convention rglemen-
te. Le domaine des conventions rglementes est le mme que dans la
SARL (voir page 195).
Limiter les pouvoirs du grant de lEURL
Si le grant nest pas lassoci unique, les statuts peuvent limiter les pouvoirs du
grant et prvoir que certaines oprations importantes sont subordonnes lauto-
risation pralable de lassoci unique.
Zoom n 88
4.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
288
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
En revanche, la procdure est plus simple
1
. En effet, les conventions
rglementes sont seulement mentionnes au registre
2
des dcisions. Il
ny a donc pas de rapport spcial du grant ou du commissaire aux
comptes et dapprobation par lassoci unique.
Les conventions interdites sont les mmes que dans la SARL (voir
page 181). Linterdiction sapplique lassoci unique personne phy-
sique
3
et au grant non associ. En revanche, linterdiction ne sappli-
que pas lassoci unique personne morale.
4.2.2. Lapprobation des comptes sociaux
Pour chaque exercice, le grant doit dresser linventaire, arrter les
comptes annuels
4
(bilan, compte de rsultat et annexe) et tablir le rap-
port de gestion.
1. Cependant, la procdure a posteriori sapplique si la convention est intervenue
entre lEURL dote dun commissaire aux comptes et le grant non associ.
Lautorisation pralable de la convention par lassoci unique sapplique si
la convention est intervenue entre lEURL non dote dun commissaire aux
comptes et le grant non associ. Lautorisation est alors mentionne au registre.
2. Il faut mentionner la nature et lobjet de la convention, les modalits nanci-
res de la convention (prix et modalits de paiement), les srets ventuellement
consenties
3. Ainsi qu son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Conventions entre lEURL et lassoci unique
Le grant associ dune EURL peut cautionner au nom de lEURL les engagements
dune SARL dont il est associ. Cette convention rglemente doit tre mentionne
au registre des dcisions.
Le compte courant de lassoci unique ne peut pas tre dbiteur car cest une conven-
tion interdite.
4. LEURL pourra adopter une prsentation simplie des comptes annuels (voir
page 201).
Zoom n 89
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
289
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Aprs rapport du commissaire aux comptes, sil est obligatoire. Lassoci unique
peut demander la prolongation du dlai de six mois.
2. 5 % au moins du bnce social, diminu des pertes antrieures, doit tre
affect au compte Rserve lgale . Cette obligation cesse lorsque la rserve
atteint le dixime du capital.
3. Lassoci unique dispose de manire exclusive de tous les droits pcuniaires
attachs aux parts sociales. Tout dividende prlev par lassoci unique en viola-
tion des rgles concernant lapprobation pralable des comptes et la constatation
de lexistence de sommes distribuables constitue un dividende ctif et expose le
grant, quil soit ou non lassoci unique, des sanctions pnales.
4. Conditions requises : tablissement dun bilan certi par un commissaire aux
comptes faisant apparatre que la socit, depuis la clture de lexercice prc-
dent, aprs constitution des amortissements et provisions ncessaires et dduc-
tion faite, sil y a lieu, des pertes antrieures ainsi que des sommes porter aux
rserves lgales et, ventuellement, statutaires, a ralis un bnce dun mon-
tant au moins gal celui des acomptes.
5. En revanche, lassoci unique non grant ne peut pas poser par crit des ques-
tions auxquelles le grant est tenu de rpondre au cours de lassemble.
Lassoci unique doit approuver les comptes dans le dlai de six mois
compter de la clture de lexercice
1
. LEURL doit dposer ses comptes
annuels au greffe du tribunal de commerce.
Laffectation des rsultats seffectue dans les mmes conditions que
dans la SARL (voir page 204) :
en cas de bnce : dotation la rserve lgale
2
, versement
lassoci unique dun dividende
3
aprs constatation de lexistence
de sommes distribuables et attribution ventuelle dacomptes sur
dividendes
4
;
en cas de pertes : imputation des pertes et rgularisation en cas
de perte de la moiti du capital.
4.2.3. Le droit de communication et dinformation
de lassoci unique non grant
Lassoci unique grant accde tous les documents sociaux. En
revanche, si lassoci unique nest pas le grant, il dispose dun droit
de communication.
Comme dans une SARL, lassoci unique bncie dun droit de
communication permanent, dun droit de communication temporaire
et du droit de poser des questions par crit
5
(voir page 193).
Guide pratique de la SARL et de lEURL
290
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
4.2.4. Le commissaire aux comptes
Comme dans la SARL, le commissaire aux comptes est obligatoire
uniquement si lEURL est importante (voir page 197). Les comptes
annuels et le rapport de gestion doivent tre tenus, au sige social, la
disposition du commissaire aux comptes deux mois au moins avant la
dcision dapprobation des comptes par lassoci unique (ce dlai est
de quarante-cinq jours dans la SARL).
Le pouvoir de dcision de lassoci unique
Lassoci unique de lEURL exerce les pouvoirs de lassemble des
associs de la SARL (voir page 182). Il peut notamment procder aux
modications statutaires : les rgles de majorit de la SARL ne
sappliquent pas puisquil ny a quun seul associ dans lEURL.
Lassoci unique a linitiative des dcisions. Cependant, si la grance
est cone un tiers, le grant peut provoquer les dcisions de lasso-
ci unique (approbation des comptes annuels).
Si lEURL a un commissaire aux comptes, lassoci doit aviser lavance
le commissaire aux comptes de la dcision quil compte prendre.
Lassoci unique ne peut pas dlguer ses pouvoirs dassoci, mme
au prot de son conjoint. En revanche, en tant que grant, lassoci
unique grant peut dlguer certains de ses pouvoirs de grance (voir
page 182).
La SARL est-elle la structure adapte votre projet ?
Le grant dune EURL refuse de mettre la disposition de lassoci unique lun des
documents suivants concernant les trois derniers exercices : les comptes annuels,
les inventaires, les rapports du grant et, le cas chant, des commissaires aux
comptes, les dcisions de lassoci unique.
Lassoci unique peut mettre n aux fonctions du grant. Le refus injusti de satis-
faire au droit de communication permanent constitue un juste motif de rvocation
faisant chec loctroi de dommages-intrts au grant rvoqu.
Cas n 39
4.3.
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
291
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les dcisions unilatrales de lassoci unique sont rpertories dans
un registre. Le registre est tenu au sige social. Il est cot et paraph.
Les copies ou extraits du registre sont certis conformes par le grant.
Les dcisions prises en violation des dispositions prcdentes
1
peuvent
tre annules la demande de tout intress.
La gestion scale de lEURL
4.4.1. Limposition des bnces raliss par lEURL
LEURL est soumise limpt sur le revenu. Cependant, elle peut
opter pour limpt sur les socits. En revanche, si lassoci unique est
une personne morale, lEURL est obligatoirement soumise limpt
sur les socits, mme si la personne morale est soumise limpt sur
le revenu. Reportez-vous page 217 et suivantes pour connatre les
modalits dtailles de limposition des bnces.
LEURL soumise limpt sur le revenu peut adhrer :
un centre de gestion agr (CGA) si elle exerce une activit
industrielle, commerciale ou artisanale (BIC) ;
une association agre de gestion (AAG) si elle exerce une acti-
vit librale (BNC) ;
ou un centre de gestion agr agricole si elle exerce une activit
agricole (BA).
1. Violation des rgles lgales ou statutaires relatives aux formes et conditions de
validit des dcisions sociales, y compris de linterdiction pour lassoci unique
de dlguer ses pouvoirs.
Imposition des bnces raliss par lEURL
Si lassoci unique de lEURL est une
personne physique personne morale
LEURL est
soumise
limpt sur le revenu avec option
possible pour limpt sur les socits
IR ou IS
limpt sur les socits
IS uniquement
4.4.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
292
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Ladhsion un centre de gestion agr permet ladministration scale
de mieux connatre les revenus du grant qui est assimil un travailleur
indpendant. En contrepartie, il bncie davantages essentiellement
scaux.
Avantages et obligations de ladhsion un centre de gestion agr
ou une association agre de gestion
Avantages
vite la majoration
de 25 % du bnce
imposable
dfaut dadhsion, le bnfice imposable est major de 25 %.
Meilleure
dductibilit du
salaire du conjoint
de lassoci
Le salaire du conjoint de lassoci est entirement dductible.
dfaut, le salaire du conjoint est dductible dans la limite de
13 800 en cas de rgime de communaut. En cas de rgime
de sparation de biens, le salaire est toujours dductible sil nest
pas excessif et sil correspond un travail effectif.
Rgularisation de
la situation fiscale
antrieure sans
pnalit
Dans les trois mois de ladhsion, les dclarations antrieures
errones peuvent tre rgularises sans pnalit (sauf manuvres
frauduleuses), et sous rserve de payer le supplment dimpt dans
le dlai imparti.
Formation Les centres organisent des runions, des sminaires de formation
et diffusent des informations pour amliorer les connaissances
conomiques, comptables et fiscales des adhrents.
Comptabilit Le centre de gestion fournit ladhrent, dans les six mois de
la clture de lexercice, un dossier de gestion (ratios divers, tableau
de financement, commentaires sur la situation conomique et
financire).
Obligations
Ladhrent doit
sengager
tenir une comptabilit sincre de lexploitation ;
communiquer au centre le bilan, le compte de rsultat
et les annexes ;
accepter les rglements par chques et en informer la clientle
dans la correspondance et dans les locaux professionnels ;
payer un droit dentre et une cotisation annuelle.
NB : La rduction dimpt de 915 pour frais de comptabilit et dadhsion un centre de ges-
tion agr sapplique uniquement aux entreprises individuelles.
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
293
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Avantages de ladhsion un centre de gestion agr
Monsieur Dmter exerce une activit de vente de matriel informatique doccasion
dans le cadre dune EURL impose lIR. Son chiffre daffaires pour N est
de 100 000 . Ses charges sont de 80 000 dont 23 800 de salaire vers son
conjoint et 1 000 de frais de tenue de comptabilit. Ils sont maris sans contrat. Le
taux moyen dimposition du couple est de 30 %.
Dterminer le bnce imposable selon que Monsieur Dmter adhre ou non
un centre de gestion agr.
Adhsion un CGA
Non Oui
Produits
Charges
100 000
80 000
100 000
80 000
Rsultat comptable 20 000 20 000
Salaire du conjoint non dductible 10 000
30 000 20 000
Majoration de 25 % 7 500
Rsultat imposable 37 500 20 000
Impt sur le revenu au taux de 30 %
Prlvements sociaux au taux de 8 %
11 250
3 000
6 000
1 600
Imposition globale
conomie dimpts
Pour un cot dadhsion de
14 250 7 600
6 650
300
conomie globale 6 350
Les intrts demprunt pour lacquisition des parts
sociales dune EURL impose lIR sont dductibles
Si lassoci qui exerce son activit professionnelle dans le cadre dune EURL soumise
lIR, a contract un emprunt pour acqurir les parts sociales, il peut dduire les int-
rts demprunt de son bnce dans lEURL.
Cas n 40
Zoom n 90
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
294
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
4.4.2. Limposition des bnces distribus par lEURL
Si lEURL est soumise lIS, les dividendes quelle distribue sont
imposs au niveau de lassoci unique et ouvrent droit lavoir scal.
En revanche, si lEURL est soumise lIR, les dividendes distribus
ne sont pas imposs au niveau de lassoci unique car ils correspon-
dent des bnces qui ont dj t directement imposs au niveau de
lassoci unique (lEURL est transparente scalement). Reportez-vous
page 242 et suivantes pour connatre les modalits dtailles de lim-
position des bnces distribus par lEURL.
4.4.3. LISF
Si lEURL est soumise lIS, les parts sociales de lEURL sont exon-
res dISF si elles reprsentent loutil de travail de lassoci unique.
Lassoci unique doit tre grant et tre bien pay (par dnition, il
possde au moins 25 % des droits nanciers et des droits de vote de la
socit puisquil est lassoci unique). Les modalits dtailles sont
exposes page 239.
Si lEURL est soumise lIR, les parts sociales de lEURL sont consi-
dres comme un lment dactif affect lexercice de la profession.
Pour lassoci unique grant qui exerce son activit principale dans
lEURL, ses parts sociales sont exonres dISF.
Si lassoci unique cde la totalit de ses parts sociales un ache-
teur, lEURL ne change pas de rgime (lEURL reste unipersonnelle).
En cas de transformation dune SARL soumise lIS en une EURL soumise lIR, les
intrts dductibles sont les intrts dus uniquement aprs la transformation. Ces
dispositions sappliquent la SARL de famille qui a opt pour lIR.
(Suite zoom n 90)
/
5. La cession des parts sociales de lEURL
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
295
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Sur le plan scal, cette cession dactions nest pas assimile une ces-
sion dentreprise.
Si lassoci unique cde ses parts sociales plusieurs personnes,
lEURL devient alors une SARL.
La cession des parts sociales est impose au taux de 5 %. Les plus-
values ralises lors de la cession des parts sociales sont imposes
selon un rgime dimposition qui dpend de la qualit de lassoci (voir
page 91).
Les causes de la dissolution
Les causes de dissolution de lEURL sont les mmes que celles de la
SARL lexception de celles qui supposent une pluralit dassocis.
LEURL peut donc tre dissoute pour toutes les causes indiques au
tableau page 75 lexception de la dissolution pour msentente entre
les associs qui ne sapplique pas lEURL car elle nest compose que
dun seul associ. De plus, la dissolution pourra intervenir si lassoci
unique est une EURL. Le dcs de lassoci unique nentranera pas la
dissolution de lEURL.
Les modalits de la dissolution
6.2.1. La liquidation quand lassoci unique
est une personne physique
Si lassoci unique est une personne physique, la dissolution de lEURL
est obligatoirement suivie de sa liquidation
1
. Les modalits de liquidation
1. La loi sur les nouvelles rgulations conomiques modie larticle 1844-5 du
Code civil : la dvolution universelle du patrimoine ne sapplique pas si lassoci
unique est une personne physique.
6. Comment dissoudre IEURL ?
6.1.
6.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
296
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
de la SARL sappliquent donc lEURL (voir page 71). Les cons-
quences scales de la liquidation sont les mmes (voir page 75).
6.2.2. La dissolution-partage quand lassoci
unique est une personne morale
Si lassoci unique est une personne morale, la dissolution de lEURL
nest pas suivie de sa liquidation
1
. La dissolution de lEURL entrane
simplement lappropriation par lassoci unique personne morale de
lensemble du patrimoine de la socit
2
dissoute sauf si les cranciers
de la socit font opposition la dissolution dans les trente jours de sa
publication. Lassoci unique devient indniment responsable des
dettes de la socit (voir cas n 41, page 297).
La personnalit morale de la socit va subsister pendant le dlai de
trente jours ouvert aux cranciers sociaux pour faire opposition. Pendant
cette priode, la socit doit tre reprsente. Le grant peut assurer
cette reprsentation
3
.
Les cranciers sociaux peuvent faire opposition la dissolution de
lEURL pour sauvegarder leurs droits. Lopposition doit tre prsente
devant le tribunal de commerce du lieu du sige de lEURL dissoute,
dans un dlai de trente jours compter de la publication de la dissolu-
tion dans un journal dannonces lgales.
Le tribunal peut alors rejeter lopposition, ou ordonner le rembourse-
ment des crances ou ordonner la constitution de garanties. La trans-
mission du patrimoine de lEURL lassoci unique et la disparition
de sa personnalit morale ne sont ralises
4
quaprs lexcution de la
dcision prise par le tribunal.
1. Labsence de liquidation et la transmission universelle lassoci unique
sappliquent de plein droit sans quil soit possible dy droger.
2. Lassoci unique recueille lintgralit du patrimoine de lEURL et se substitue
la socit dissoute dans tous ses biens, droits et obligations.
3. Le grant assure la gestion courante de la socit, la reprsente en justice
notamment en cas dopposition dun crancier, arrte la situation comptable
des biens et dettes transfrs lassoci unique, constate la date partir de
laquelle soprent la transmission du patrimoine et la disparition de la personne
morale et accomplit les formalits de publicit.
4. Opposition rejete en premire instance ou remboursement des crances effectu
ou garanties constitues.
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
297
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La dissolution de lEURL par lassoci unique personne morale entrane
la transmission universelle du patrimoine de la socit y compris le pas-
sif lassoci unique. Lassoci unique devient indniment responsa-
ble des dettes de la socit alors que sa responsabilit tait limite au
montant de ses apports.
Lassoci unique peut dcider la dissolution de la socit. La dis-
solution-confusion de larticle 1844-5 du Code civil est lun des
seuls moyens de fusionner des socits dont lune prsente un
actif net ngatif.
Lassoci unique peut dcider de ne pas dissoudre la socit. Il
peut alors cder un tiers une partie de ses parts sociales.
LEURL devient pluripersonnelle. La responsabilit de lassoci
restera alors limite au montant de ses apports. La dissolution de
lEURL sera suivie de la liquidation. Lassoci ne sera pas con-
traint au paiement des dettes sociales non rembourses dans le
cadre de la liquidation.
La dissolution de lEURL entrane la confusion du patrimoine de
lEURL avec celui de lassoci unique. Cette confusion porte prjudice
La dissolution de lEURL entrane la responsabilit
indnie de lassoci personne morale
Lassoci unique personne morale dune EURL souhaite dissoudre sa socit. Il dresse
un tat complet et valoris de tous les lments dactif et de tous les engagements de
sa socit, y compris ceux qui nont quun caractre latent (engagements pouvant
rsulter dun contrle scal et dun contentieux avec un salari). Il en rsulte quil na
pas la certitude que les lments dactif seront sufsants pour payer les dettes sociales.
Doit-il envisager la dissolution de lEURL ?
Les cranciers dune socit, associ unique dune EURL,
peuvent-ils sopposer la dissolution de lEURL ?
Une EURL en difcult nancire est dissoute. Sa dissolution risque dentraner une
diminution du patrimoine de lassoci unique.
Cas n 41
Cas n 42
Guide pratique de la SARL et de lEURL
298
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
aux cranciers de lassoci unique puisquelle entrane une diminution
du patrimoine de lassoci unique. Comme le droit dopposition est
rserv aux cranciers, ce droit peut tre exerc par les cranciers de
lEURL et, semble-t-il, par les cranciers de lassoci unique.
LEURL peut tre transforme en SASU car cest galement une
socit unipersonnelle (lEURL et la SASU ont un seul associ).
LEURL peut tre transforme en une socit pluripersonnelle si
lassoci unique cde au pralable ses parts sociales. LEURL devient
alors une SARL. La transformation dune SARL en une socit dune
autre forme est expose page 61.
Transformation de lEURL en SASU
Lassoci unique dune EURL peut transformer sa socit en SASU
par simple dcision unilatrale. Comme le capital de lEURL et de la
SASU est librement x par les associs, la transformation de lEURL
en SASU na pas dincidence sur le capital. Dans sa dcision de trans-
formation, lassoci unique doit indiquer les nouveaux statuts de la
socit, les nom, prnom et domicile de la personne qui sera le prsi-
dent de la SASU, ainsi que ceux du commissaire aux comptes (pour
les modalits prcises et les effets de la transformation, voir page 60).
Le cot de la transformation de lEURL en SASU dpend du change-
ment de rgime scal de lEURL (EURL soumise lIR ou EURL
ayant opt pour lIS) et/ou du changement dactivit relle (voir
tableau page 67).
Transformation de LEURL en SARL
Si lassoci unique cde ses parts sociales plusieurs personnes,
lEURL devient alors une SARL.
7. Comment transformer lEURL ?
7.1.
7.2.
Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)
299
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Pour viter de modier les statuts, des clauses dagrment pour limiter
la libre cessibilit des parts sociales applicables en cas de pluralit
dassocis peuvent tre insres dans les statuts ds la constitution de
lEURL (voir page 86). Ainsi, le passage la forme pluripersonnelle
de la SARL nentrane pas de modication des statuts.
Le passage de lEURL la SARL peut entraner un changement de
rgime scal si la SARL est soumise limpt sur les socits (lEURL
transforme en SARL change de rgime scal car elle passe de lIR
lIS). Dans ce cas, les incidences scales sont trs lourdes (voir page 68
le tableau de synthse).
En revanche, si la SARL peut opter pour lIR, le passage de lEURL
la SARL nest pas assimil une cessation dentreprise car la socit
continue dexister sous le mme rgime scal (IR)
1
. Les bnces
en cours ou les plus-values latentes ne sont pas imposes lIS (voir
page 68 le tableau de synthse).
La cession des parts sociales est impose au taux de 3 %. Les plus-
values ralises lors de la cession des parts sociales sont imposes
selon un rgime dimposition qui dpend de la qualit de lassoci
(voir page 91).
1. Il en est de mme pour une EURL impose lIS qui se transforme en une
SARL impose lIS.
301
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Cependant, certaines professions librales ne peuvent tre exerces que sous la
forme dune socit dexercice libral : administrateur judiciaire, avocat, avou,
chirurgien-dentiste, commissaire-priseur, expert agricole et foncier, expert
forestier, grefer des tribunaux de commerce, huissier de justice, inrmier, man-
dataire-liquidateur, masseur-kinsithrapeute, mdecin, notaire, vtrinaire.
2. La socit dexercice libral, cre par la loi du 31 dcembre 1990, peut tre
constitue sous la forme dune SARL (SELARL), dune EURL (SELU), dune
SA (SELAFA), dune SAS (SELAS), dune SCA (SELCA) ou dune socit en
participation dexercice libral (SEPEL).
7
LA SOCIT DEXERCICE LIBRAL
CONSTITUE SOUS FORME
DUNE SARL OU DUNE EURL
Une profession librale peut tre exerce dans le cadre :
dune SARL classique car la qualit dassoci dune SARL ne
confre pas la qualit de commerant qui est interdite aux mem-
bres des professions librales
1
;
ou dune socit dexercice libral constitue sous la forme dune
SARL
2
(SELARL) ou dune EURL (SELU : socit dexercice
libral unipersonnelle pour certaines professions rglementes).
La socit dexercice libral a t cre par la loi du 31 dcembre 1990.
Des dcrets en Conseil dtat pris pour lexercice de chaque profession
librale dterminent les conditions dapplication de cette loi.
LA SOCIT DEXERCICE LIBRAL CONSTITUE
SOUS FORME DUNE SARL OU DUNE EURL
Guide pratique de la SARL et de lEURL
302
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
La socit dexercice libral responsabilit limite (SELARL) est
une socit dexercice libral constitue sous forme dune SARL. Elle
est soumise aux mmes rgles que la SARL avec certaines adapta-
tions. Nous ne prsenterons donc ici que les spcicits de la SELARL.
Pour les rgles applicables la SARL, il vous suft de vous reporter
aux autres parties de ce guide.
Les dcrets en Conseil dtat pris pour lexercice de chaque profes-
sion librale dans le cadre de la loi du 31 dcembre 1990 :
dterminent les effets de linterdiction temporaire dexercer la
profession dont la socit ou un associ serait frapp ;
peuvent prvoir quun associ nexerce sa profession quau sein
dune seule SEL et ne peut exercer la mme profession titre
individuel ou au sein dune socit civile professionnelle (SCP) ;
peuvent prciser les conditions dexercice personnel de la profes-
sion concerne par les associs ;
peuvent prvoir des cas o un associ peut tre exclu de la SEL et
prciser les garanties morales, procdurales et patrimoniales qui
lui sont accordes dans ce cas.
Exercer une profession librale en socit
Une profession librale (conseil) peut tre exerce dans le cadre dune SARL clas-
sique. Cependant, certaines professions rglementes doivent adopter une structure
juridique spcique. Lexercice en commun dune profession librale rglemente
peut tre effectu dans le cadre dune socit civile professionnelle (SCP) ou dune
socit dexercice libral (SEL). La socit civile de moyen (SCM) est une structure
juridique rserve aux professions librales dont lobjet est la fourniture de moyens
matriels (locaux, personnel, matriel) ses membres an de faciliter lexercice de
leur profession.
Pour plus dinformations : www.apce.com chemin daccs : choisir un statut juridique,
les socit, SCP, SEL et SCM.
Zoom n 91
1. Droit dexercer la profession librale
par les associs
La socit dexercice libral constitue sous forme dune SARL ou dune EURL
303
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Lassoci peut cesser lactivit professionnelle quil exerce dans la
SEL, condition den informer la socit par lettre recommande avec
demande daccus de rception dans un dlai x par les statuts (sans
quil puisse excder six mois compter de la notication de cessation
dactivit), et den aviser le prfet du dpartement du sige social.
La SEL ne peut exercer la profession constituant son objet social
quaprs son agrment par lautorit comptente ou son inscription sur
la liste ou au tableau de lordre professionnel.
En cas de contentieux, la loi du 31 dcembre 1990 prvoit que, sous
rserve des comptences des juridictions disciplinaires, les tribunaux
civils sont seuls comptents pour connatre des actions en justice dans
lesquelles lune des parties est une SEL ainsi que des contestations
entre associs dune SEL. Les associs peuvent convenir dans les sta-
tuts de soumettre des arbitres les contestations qui surviendraient
entre eux.
Plus de la moiti du capital social doit tre dtenue
1
par des profes-
sionnels en exercice au sein de la socit
2
.
2. Capital social
1. Directement ou par lintermdiaire dune socit constitue exclusivement
pour le rachat de tout ou partie du capital dune entreprise par les salaris de
lentreprise rachete (article 220 quater A du CGI).
2. Le complment du capital peut tre dtenu par des personnes physiques ou
morales exerant la ou les professions constituant lobjet social de la socit ;
pendant un dlai de dix ans, par des personnes physiques qui, ayant cess toute
activit professionnelle, ont exerc cette profession ou ces professions au sein
de la socit ; par les ayants droit des personnes physiques mentionnes ci-des-
sus, pendant un dlai de cinq ans suivant leur dcs ; par une socit constitue
dans les conditions prvues par larticle 220 quater A du CGI si les membres
de cette socit exercent leur profession au sein de la SEL ; par des personnes
exerant une des professions librales soumise un statut lgislatif ou rgle-
mentaire ou dont le titre est protg, selon que lexercice de cette profession
constitue lobjet social.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
304
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les dcrets en Conseil dtat peuvent :
prvoir la facult pour toute personne physique ou morale de
dtenir un quart au plus du capital des socits constitues sous
la forme de SELARL
1
;
limiter le nombre de SEL constitues pour lexercice dune pro-
fession dans lesquelles une mme personne physique ou morale
peut dtenir des participations ;
interdire la dtention de parts dune SELARL des catgories de
personnes physiques ou morales dtermines si cette dtention
est de nature mettre en pril lexercice de la profession concer-
ne dans le respect de lindpendance de ses membres et de leurs
rgles dontologiques propres.
Si les conditions concernant la dtention du capital social ne sont plus
remplies en cours de vie sociale, la SEL a un an pour se mettre en con-
formit. dfaut, tout intress peut demander en justice la dissolution
de la socit. Le tribunal de commerce peut accorder la socit un
dlai maximal de six mois pour rgulariser sa situation. La dissolution
ne pourra pas tre prononce par le tribunal si, au jour o il est statu
sur le fond, cette rgularisation a eu lieu.
1. Cette disposition nest pas applicable aux professions judiciaires ou juridiques.
Rpartition du capital social dune SELARL
Une SEL na pas lobligation douvrir son capital. Ainsi, les statuts dune SEL peuvent
stipuler que le capital social ne pourra tre dtenu que par des personnes exerant la
profession constituant lobjet social.
Il ny a pas de pourcentage minimum ou maximum du capital devant tre dtenu par
lun des professionnels en exercice au sein dune SEL. Chaque professionnel peut
dtenir un pourcentage diffrent du capital de la SEL. Cependant, il faut viter un par-
tage qui conduit une prise de contrle de la socit par lun des professionnels
associs.
Zoom n 92
La socit dexercice libral constitue sous forme dune SARL ou dune EURL
305
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Comme dans une SARL, la responsabilit des associs est limite au
montant de leurs apports. Cependant, dans une SEL, chaque associ
rpond, sur lensemble de son patrimoine, des actes professionnels
quil accomplit, la SEL tant solidairement responsable avec lui.
Le montant des sommes verses en compte courant ne peut tre sup-
rieur
1
:
au double de la participation dans le capital pour les associs
exerant au sein de la SEL ;
au montant de la participation dans le capital pour les autres
associs.
Les sommes en compte courant ne peuvent tre retires, en tout ou en
partie, quaprs notication la socit, par lettre recommande avec
demande daccus de rception, moyennant un pravis dau moins
2
:
six mois pour les associs exerant au sein de la SEL ou leurs
hritiers ;
un an pour les autres associs.
Quand la cession des parts sociales de la SELARL est soumise agr-
ment, lagrment doit tre donn par lassemble gnrale extraordi-
naire statuant la majorit des trois quarts des porteurs de parts exerant
la profession au sein de la SELARL. Toute clause contraire, ayant
1. Des seuils infrieurs peuvent tre xs dans les statuts.
2. Des seuils suprieurs peuvent tre xs dans les statuts.
3. Responsabilit des associs
4. Comptes courants dassocis
5. Cession de parts sociales
Guide pratique de la SARL et de lEURL
306
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
notamment pour effet de modier, dans quelque sens que ce soit, la
rgle de majorit, est rpute non crite.
Le grant de la SELARL est obligatoirement choisi parmi les associs
exerant leur profession au sein de la SELARL. Le grant de la SELU
est donc ncessairement lassoci unique. Les fonctions de grant peu-
vent tre gratuites ou rmunres.
Les conventions conclues entre la socit et un grant ou un associ,
portant sur des oprations courantes et conclues des conditions nor-
males, peuvent tre passes librement. Les autres doivent tre soumises
lapprobation des associs. Seuls les professionnels exerant au sein
de la SELARL prennent part aux dlibrations lorsque les conventions
en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur
profession.
Les associs exerant une activit professionnelle dans le cadre dune
socit de personnes ont la qualit de travailleur indpendant. Les
parts sociales dans la socit de personnes reprsentent leur patrimoine
professionnel. Les associs peuvent dduire de leur quote-part de
rsultat dans la socit de personnes les intrts des emprunts quils ont
contracts pour lacquisition de ces parts sociales.
6. Le grant
7. Conventions rglementes
8. Non-dductibilit des intrts demprunts
contracts pour lacquisition
des parts de la SELARL
La socit dexercice libral constitue sous forme dune SARL ou dune EURL
307
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Dans une SELARL, les associs nont pas la qualit de travailleur ind-
pendant mais celle de salari (grant minoritaire ou galitaire) ou de
grant au sens de larticle 62 du CGI (grant majoritaire). Ils ne peu-
vent donc pas dduire les intrts demprunts contracts pour lacquisi-
tion des parts de la SELARL.
Pour se transformer en SELARL, une SARL doit simplement se met-
tre en conformit avec les dispositions de la loi du 31 dcembre 1990.
Constituer un holding dans le cadre dun RES pour dduire les intrts
demprunts contracts pour lacquisition des parts de la SELARL
Les professionnels constituent entre eux, dans le cadre dun RES, un holding qui
contracte lemprunt et rachte au moins 95 % des titres de la SEL. Grce au rgime
de lintgration scale, le holding peut regrouper son rsultat avec celui de la SEL.
Les intrts du holding viennent ainsi en dduction des bnces de la SEL. Cepen-
dant, ce montage manque de souplesse.
Zoom n 93
9. Transformation dune SARL en SELARL
309
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
8
LENTREPRISE AGRICOLE
RESPONSABILIT LIMITE (EARL)
Lexploitation agricole responsabilit limite (EARL) a t cre par la
loi du 11 juillet 1985 an de rduire les risques encourus par les
agriculteurs qui sont responsables des dettes de leur exploitation sur la
totalit de leur patrimoine et an de faciliter la transmission des exploi-
tations individuelles ou des socits civiles dexploitation agricole (en
particulier de GAEC en cas darrive dun associ non exploitant).
Lentreprise agricole responsabilit limite en bref
Lexploitation agricole responsabilit limite (EARL), cre par la loi du 11 juillet
1985, est une socit civile dont la responsabilit des associs est limite au
montant de leurs apports. Les associs de lEARL ne supportent donc les pertes
qu concurrence de leurs apports.
LEARL a pour objet lexercice dactivits rputes agricoles dans des conditions
comparables celles existant dans les exploitations agricoles de caractre familial.
1. LEARL en bref
LENTREPRISE AGRICOLE RESPONSABILIT
LIMITE (EARL)
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
310
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
LEARL est dsigne par une dnomination sociale laquelle peut tre
incorpor le nom dun ou plusieurs associs et qui doit tre prcde ou
suivie immdiatement des mots Exploitation agricole responsabilit
limite ou des initiales EARL et du montant du capital social.
Le capital social doit au minimum tre de 7 500 . Il peut tre variable
(voir page 274).
En cas de rduction du capital social en dessous de 7 500 , il est
ncessaire, dans un dlai dun an :
de procder une augmentation pour porter le capital au montant
minimal de 7 500 ;
ou de transformer lEARL en socit dune autre forme.
dfaut, tout intress (associ, crancier) peut demander en justice
la dissolution de lEARL, aprs mise en demeure. Le tribunal ne peut
pas prononcer la dissolution si la situation a t rgularise le jour o
il statue au fond.
La surface mise en valeur ne peut excder 10 fois la supercie minimum dinstal-
lation.
LEARL est constitue par une ou plusieurs personnes physiques majeures. Le
nombre dassocis est limit dix. Les associs exploitants doivent obligatoire-
ment dtenir plus de 50 % du capital social. Le grant doit tre choisi parmi les
associs exploitants.
LEARL est en principe soumise limpt sur le revenu avec option possible pour
limpt sur les socits. Les associs exploitants ont le statut social de travailleur
indpendant. Ils relvent du rgime de la mutualit sociale agricole (MSA).
2. Dnomination sociale
3. Capital social
/
Lentreprise agricole responsabilit limite (EARL)
311
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Nature et valuation des apports
Les apports peuvent tre des apports en numraire, des apports en
nature, en proprit ou en jouissance. Les apports en nature doivent
tre valus dans les statuts.
Lintervention dun commissaire aux apports est, en principe, obliga-
toire pour vrier cette valuation. Cependant, les futurs associs peu-
vent dcider lunanimit que le recours un commissaire aux apports
ne sera pas obligatoire lorsque la valeur daucun apport en nature
nexcde 7 500 et si la valeur totale de lensemble des apports en
nature non soumis lvaluation dun commissaire aux apports
nexcde pas la moiti du capital. Les associs sont solidairement res-
ponsables pendant cinq ans, lgard des tiers, de la valeur attribue
aux apports en nature.
Lapporteur de biens communs une EARL doit en avertir son conjoint
comme dans la SARL (voir page 21). Pour les apports en industrie, voir
page 159.
Les droits denregistrement
Les apports lEARL sont soumis aux droits denregistrement qui
dpendent de la nature des biens apports, du type dapport ( titre
Apports en jouissance pour constituer une EARL
Le fermier peut mettre disposition dune EARL les biens quil prend bail
1
. Cet
apport en jouissance concourt la formation du capital social et donne donc lieu
lattribution de parts sociales. Il est estim la valeur de la jouissance apporte. Cet
apport ne doit pas modier le contrat de bail.
4. Les apports
4.1.
Zoom n 94
4.2.
1. Dans les conditions prvues par larticle L. 411-37 du Code rural.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
312
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
onreux ou titre gratuit), du rgime scal de lapporteur et de lEARL
(IR ou IS). Ces rgles sont exposes dans le dtail page 39 et suivantes.
Cependant, les apports titre onreux qui rsultent de la prise en
charge du passif grevant les immeubles apports une EARL sont
assimils des apports titre pur et simple : exonration de droits
denregistrement lors de la cration de lEARL et droit xe de 230
en cas daugmentation de capital.
Fixation de la rmunration
La rmunration des associs qui participent de faon effective aux tra-
vaux est xe par les statuts. Cette rmunration ne peut tre ni inf-
rieure au SMIC ni suprieure trois fois ce salaire (ou quatre fois ce
salaire pour les grants de lEARL).
Imposition de la rmunration
Dans une EARL impose lIR, cette rmunration est une charge
dexploitation inscrire au compte 641 Rmunrations du per-
sonnel , mais qui nest pas dductible dans le calcul du rsultat scal
de lEARL. Lassoci est soumis lIR sur sa quote-part de bnce
agricole dans lEARL (voir page 217). La rmunration est une simple
avance sur cette quote-part de bnce. Lassoci peut adhrer un
centre de gestion agricole pour viter une majoration de 25 % de sa
quote-part de bnce agricole dans lEARL (voir page 218).
Dans une EARL impose lIS, cette rmunration est une charge
dexploitation inscrire au compte 641 Rmunrations du per-
sonnel , qui est dductible dans le calcul du rsultat scal de lEARL.
La rmunration de lassoci est soumise lIR dans la catgorie de
larticle 62 du CGI (rmunration des dirigeants) ou dans la catgorie
des traitements et salaires (voir page 150).
5. La rmunration des associs
5.1.
5.2.
Lentreprise agricole responsabilit limite (EARL)
313
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
LEARL est constitue par une ou plusieurs personnes physiques
majeures. Le nombre dassocis est limit dix. Les associs peuvent
tre :
des associs exploitants participant effectivement lexploitation
et qui doivent obligatoirement dtenir plus de 50 % du capital
social ; le ou les grants doivent tre choisis parmi eux ;
des associs simples apporteurs de capitaux.
LEARL comprend obligatoirement un ou plusieurs associs exploi-
tants
1
. Les statuts doivent mentionner le nom des associs exploitants.
Les associs exploitants doivent dtenir ensemble plus de 50 % des
parts reprsentatives du capital. Les associs exploitants disposent de
la majorit des voix dans lEARL car les associs disposent de droits
de vote dans les assembles proportionnels au nombre de parts quils
dtiennent. Les statuts peuvent prvoir que les associs exploitants se
rpartissent dune faon galitaire les droits de vote quils dtiennent
ensemble.
Le grant (ou les grants) doit tre dsign parmi les associs exploi-
tants titulaires de parts reprsentatives du capital. Les grants sont
La rmunration de lassoci est impose lIR dans la catgorie
EARL impose
lIS
de larticle 62 du CGI des traitements et salaires
De plein droit Grants majoritaires Grants minoritaires
Associs non grants
Sur option Les associs grants ou non
6. Les associs exploitants
1. Les associs exploitants doivent participer effectivement lexploitation au
sens de larticle L. 411-59 du Code rural qui dnit les bnciaires du droit de
reprise.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
314
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
nomms pour la dure de la socit si aucune dure na t prvue par
les associs. Les statuts xent le mode dorganisation de la grance.
Si les associs exploitants ne dtiennent plus la majorit du capital ou
si la grance nest plus cone un associ exploitant
1
, tout intress
(associ, crancier) peut demander en justice la dissolution si la situa-
tion na pas t rgularise dans le dlai dun an
2
.
Les associs exploitants ont le statut social de travailleur indpen-
dant. Ils relvent du rgime de la mutualit sociale agricole (MSA).
Lassiette des cotisations dues par les associs exploitants dune EARL
est rpartie en parts gales entre eux, sauf si les statuts prvoient une
participation aux bnces diffrente.
Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies des
coexploitants dune EARL ne peut excder celui de la pension qui
serait servie un agriculteur dirigeant seul la mme exploitation.
Les prestations dinvalidit sont galement alloues aux associs
exploitants dune EARL qui prsentent une invalidit rduisant au
moins des deux tiers leur capacit lexercice de la profession agricole.
Lassurance accidents du travail-maladies professionnelles garantit
galement le versement dune pension dinvalidit aux associs exploi-
tants dune EARL qui prsentent une invalidit rduisant au moins des
deux tiers leur capacit de travail.
1. Jusqu la rgularisation de la situation, lEARL peut tre gre par une per-
sonne physique dsigne par les associs ou, dfaut, par le tribunal la
demande de tout intress. Le grant provisoire peut tre un associ ou un tiers.
2. Ce dlai est port 3 ans si la situation rsulte de la cessation dactivit dun
associ exploitant la suite de son dcs ou dune inaptitude lexercice de la
profession agricole (dans les conditions exiges pour lattribution dune pen-
sion dinvalidit). Le tribunal ne peut pas prononcer la dissolution si la situa-
tion a t rgularise le jour o il statue au fond.
7. Le statut social des associs exploitants
Lentreprise agricole responsabilit limite (EARL)
315
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les dcisions collectives sont prises lunanimit des associs ou
selon les dispositions statutaires, en assemble, lors dune consultation
crite ou dans un acte (voir page 183). Lassoci unique exerce les
pouvoirs de lassemble.
EARL soumise limpt sur le revenu
LEARL unipersonnelle (EARL constitue dun seul associ), lEARL
de famille (EARL compose des membres dune mme famille
1
) et
lEARL cre avec un exploitant qui sinstalle
2
sont soumises lim-
pt sur le revenu. Elles peuvent opter pour lIS.
Le bnce de lEARL est dtermin en appliquant les rgles des
Bnces agricoles (BA) car cest lactivit qui dtermine le mode
dimposition. Le bnce (le dcit) dgag par lEARL est soumis
limpt sur le revenu (dduit) directement au niveau des associs
hauteur de leur quote-part dans les droits sociaux (lEARL est transpa-
rente scalement). Le mcanisme dimposition est donc le mme que
celui dune SARL de famille ou dune EURL soumise limpt sur le
revenu (voir page 231).
1. Les membres de la famille sont les parents en ligne directe, les frres et surs
ainsi que les conjoints de ces personnes. Chacun des associs doit tre directe-
ment uni aux autres soit par des liens de parent directs ou collatraux jusquau
deuxime degr, soit par le mariage.
2. EARL cre depuis le 1
er
janvier 1989 uniquement entre lapporteur de tout ou
partie dune exploitation individuelle et un exploitant qui sinstalle simultan-
ment. Les membres de leurs familles peuvent entrer en cours de vie sociale.
LEARL doit disposer dune supercie au moins gale la moiti de la SMI
(surface minimale dinstallation) multiplie par le nombre dassocis dans la
limite de dix SMI.
8. Les dcisions collectives
9. Limposition des bnces de lEARL
9.1.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
316
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les intrts demprunt contracts pour lacquisition des parts sociales
sont dductibles de la quote-part de bnce de lassoci.
LEARL peut dduire une fraction de son bnce la clture de chaque
exercice en vue de nancer, dans les cinq annes qui suivent, les stocks,
les immobilisations amortissables ou des parts de socits coopratives
agricoles.
EARL de famille
La dnition de lEARL de famille est plus librale que celle de la SARL de famille
(voir page 23). Ainsi, une socit entre beaux-frres est une EARL de famille. LAdmi-
nistration exclut de la dnition des EARL de famille une EARL constitue entre
deux frres et le ls de lun deux.
EARL cre avec un exploitant
qui sinstalle mais impose lIS
LEARL doit rsulter de lapport dune exploitation et de linstallation simultane dun
jeune agriculteur pour pouvoir tre soumise limpt sur le revenu. dfaut, lEARL
est soumise limpt sur les socits. Sont ainsi soumises limpt sur les socits
les EARL suivantes :
une EARL associ unique dont un jeune exploitant qui sinstalle, non apparent
lassoci unique, devient associ ;
une EARL de famille dont un jeune exploitant non apparent devient associ.
Une EARL impose lIS reste impose lIS
Une EARL soumise lIS qui au cours de sa vie vient tre compose de deux familles
qui pourraient remplir les conditions pour constituer une EARL de famille reste sou-
mise lIS.
Zoom n 95
Zoom n 96
Zoom n 97
Lentreprise agricole responsabilit limite (EARL)
317
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Pour la vente dlectricit photovoltaque, les limites sont de 50 % du CAHT
ou 100 000 .
2. Les droits denregistrement sur les immeubles apports lEARL avant loption
pour lIS deviennent alors exigibles.
EARL soumise limpt sur les socits
LEARL soumise limpt sur le revenu peut opter pour limpt sur les
socits
2
. Dautres EARL sont soumises limpt sur les socits : il
sagit des EARL composes de plusieurs associs non parents en
dehors de lEARL cre avec un exploitant qui sinstalle.
Une EARL impose lIR peut raliser
des activits commerciales accessoires
Une EARL dont lactivit commerciale ne dpasse 30 % du chiffre daffaires tir de
lactivit agricole ou 30 000 est soumise limpt sur le revenu pour lensemble de
son activit
1
. En cas de dpassement de ces limites, IEARL est impose lIS. Ce
changement de rgime scal a des consquences scales lourdes (voir page 67).
Une EARL de famille ralisant des activits commerciales importantes
doit se transformer en SARL de famille pour chapper lIS
Une EARL dont lactivit commerciale dpasse 30 % du chiffre daffaires dgag par
lactivit agricole ou 30 000 est impose lIS pour lensemble de son activit.
LEARL de famille peut alors se transformer en SARL de famille qui opte pour lIR
dans lacte constatant la transformation vitant ainsi un changement de rgime scal
(la socit reste lIR voir page 66). La SARL de famille aura alors deux activits
distinctes :
lactivit agricole sera impose selon les rgles des BA (Bnces agricoles) ;
lactivit commerciale sera impose selon les rgles des BIC (Bnces indus-
triels et commerciaux).
Chaque associ devra dclarer limpt sur le revenu sa quote-part de BA et de BIC
en proportion de ses droits sociaux (la SARL impose lIR est transparente sca-
lement).
Zoom n 98
Zoom n 99
9.2.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
318
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Le bnce de lEARL est impos lIS au niveau de lEARL car
lEARL est opaque. Elle peut distribuer des dividendes qui seront im-
poss au niveau des associs dans la catgorie des revenus de capi-
taux immobiliers . Le mcanisme dimposition est donc le mme que
celui dune SARL impose lIS (voir page 222).
En principe, les parts sociales ne peuvent tre cdes quavec laccord
unanime de tous les associs et les cessions des ascendants ou des
descendants ne sont pas soumises agrment. Cependant, les statuts
peuvent librement dfinir les modalits dagrment en cas de ces-
sion de parts sociales.
EARL soumise limpt sur les socits
Si lEARL est soumise limpt sur les socits, les cessions de parts
sont soumises au droit de 3 %, que la cession soit ou non constate par
un acte (voir page 91).
EARL soumise limpt sur le revenu
Si les parts cdes lamiable sont reprsentatives dapport de cheptel
et autres biens mobiliers dpendant dune exploitation agricole et que
leur cession nest pas corrlative la cession au mme acqureur de
parts reprsentatives du fonds exploit, la cession est soumise au
TVA et CET dans une EARL
Le rgime de la TVA agricole sapplique lEARL dans les conditions ordinaires.
LEARL est exonre de contribution conomique territoriale, tant pour son activit
agricole quau titre de sa participation un groupement demployeurs.
Zoom n 100
10. Cession des parts de lEARL
10.1.
10.2.
Lentreprise agricole responsabilit limite (EARL)
319
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
droit fixe de 75
1
, quel que soit le dlai coul depuis la ralisation
dnitive des apports.
Les autres cessions de parts dEARL sont soumises au droit de 3 % si
la cession intervient plus de trois ans aprs lapport des biens. Si la
cession intervient moins de trois ans aprs lapport des biens, elle est
considre comme ayant pour objet les biens en nature reprsents par
les titres cds :
Le droit denregistrement sur les ventes dimmeubles sapplique
lorsque les parts cdes sont reprsentatives de tels biens. Comme
il est galement de 3 %, cela ne change rien.
En revanche, pour les biens meubles, lapport est exonr. Il y
aura donc exonration au lieu de taxation 3 %.
Si 1EARL est pluripersonnelle, voir les dveloppements page 75
concernant la SARL.
Si 1EARL est unipersonnelle, voir les dveloppements page 295
concernant lEURL.
1. Pour bncier de ce rgime de faveur, lacte (ou la dclaration) de cession doit
contenir toutes les indications sur la composition du capital de lEARL.
11. Dissolution de lEARL
321
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
9
LA SARL POUR DVELOPPER
UN PROJET DENTREPRENEURIAT
SOCIAL
La socit cooprative dintrt collectif (SCIC)
constitue sous forme dune SARL
La socit cooprative dintrt collectif (SCIC) est une forme dentreprise coo-
prative qui a pour objet la production ou la fourniture de biens et de services
dintrt collectif, qui prsentent un caractre dutilit sociale . La SCIC peut con-
cerner tous les secteurs dactivit si lintrt collectif se justie au regard des biens
et services proposs, mais galement au regard de lorganisation du travail et des
relations avec les partenaires de la SCIC. La SCIC a un statut de socit commer-
ciale, de SARL ou de SA capital variable. Comme toute entreprise commerciale,
elle est soumise aux impratifs de performance et de bonne gestion. En tant que
cooprative, la SCIC respecte les rgles de rpartition du pouvoir selon le principe
1 personne = 1 voix. Cependant, elle peut constituer des collges permettant de
pondrer les voix selon des rgles approuves en assemble gnrale. La SCIC
implique tous les associs la vie de lentreprise et aux dcisions de gestion.
1. La socit cooprative
dintrt collectif (SCIC)
LA SARL POUR DVELOPPER UN PROJET
DENTREPRENEURIAT SOCIAL
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
322
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Les associs de la SCIC
Les associs sont des personnes physiques ou des personnes morales
qui ont un intrt sufsant dans le projet conomique et socital de la
SCIC pour souhaiter participer aux dcisions dorientation, en parta-
geant le risque de lentreprise.
1.1.1. Les catgories dassocis
Peuvent tre associs dune SCIC :
1. les salaris de la cooprative ;
2. les bnciaires des biens et services proposs par la cooprative ;
3. les bnvoles ;
4. les collectivits publiques et leurs groupements (dans la limite de
20 % du capital) ;
5. toute personne physique ou morale contribuant lactivit de la
cooprative.
Le nombre minimum de catgories dassocis est de trois.
La catgorie des associs salaris ainsi que celle des associs
bnciaires doivent tre obligatoirement reprsentes dans la
Elle affecte une part signicative de son rsultat des rserves impartageables.
Cest lassemble des associs qui lit les administrateurs et les dirigeants de la
cooprative. La SCIC doit tre agre. Une association peut tre transforme en
SCIC. Comme une socit commerciale, la SCIC est soumise lIS et la TVA.
La SCIC permet dassocier autour du mme projet dutilit sociale, tous types
dacteurs (salaris, bnvoles, usagers, nanceurs, entreprises, associations)
qui peuvent tre associs au capital de la cooprative. La SCIC concrtise lavne-
ment en France de la coopration en multisocitariat (multi-stakeholder).
Limpartageabilit des rserves de la SCIC la prserve dune prise de contrle
majoritaire par des investisseurs extrieurs et garantit ainsi son indpendance et
sa prennit.
Pour en savoir plus : consultez les sites www.scic.coop, www.avise.org,
www.scop.coop.
1.1.
/
La SARL pour dvelopper un projet dentrepreneuriat social
323
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
SCIC. Mais tous les usagers et tous les salaris ne doivent pas
tre obligatoirement associs.
Une autre catgorie doit tre au moins prsente, en fonction du
projet port par la SCIC (collectivits locales, nanceurs).
La loi ne xe pas de nombre maximum de catgories. Une SCIC SARL
doit donc comprendre au moins 3 associs et au plus 50.
Chaque associ ne peut reprsenter quune seule catgorie dassocis
la fois. Si un associ relve de plusieurs catgories (bnvole et usager
par exemple), il devra choisir une seule catgorie dans laquelle il
pourra tre associ. Une personne peut changer de catgorie si son
rapport la cooprative sest modi. Les statuts de la SCIC doivent
dnir avec prcision les catgories dassocis.
1.1.2. Lengagement nancier des associs
Pour devenir associ, il faut souscrire au moins une part sociale dans la
cooprative. Le montant dune part est x par les statuts de la SCIC.
En contrepartie de cet apport en capital, la SCIC pourra verser des
intrts annuels dont le taux est gal, au plus, au taux moyen de rende-
ment des obligations des entreprises prives. Pour une SARL, le mon-
tant du capital est librement x par les associs en fonction de la
taille, de lactivit, et des besoins en capitaux de la socit. La respon-
sabilit des associs est limite leurs apports en capital.
Le capital est variable : il peut augmenter ou diminuer sans aucune for-
malit denregistrement. Les augmentations et diminutions sont cons-
tates en assemble gnrale ordinaire. Le capital ne doit cependant
jamais descendre en dessous du quart du capital le plus lev atteint
dans lhistoire de la cooprative.
Les associs peuvent donc entrer et sortir facilement de la socit par
voie dapport ou de retrait de leur apport (application de la rgle gn-
rale des coopratives de la libre entre et sortie ). Si un associ
dcide de quitter la SCIC, le montant du capital quil avait apport la
cooprative lui est rembours. Aucune plus-value sur les parts ne
pourra tre ralise lors de la sortie de la cooprative. Certaines pertes
de la cooprative peuvent tre imputables sur la valeur des parts. Les
Guide pratique de la SARL et de lEURL
324
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
statuts peuvent prvoir les dlais dans lesquels les cooprateurs qui
quittent la cooprative se verront restituer le montant quils avaient
immobilis dans la cooprative.
Les limites des apports en capital des collectivits publiques concernent
uniquement les collectivits territoriales et leurs groupements, dont le
total cumul des parts dans le capital de la SCIC ne peut excder 20 %.
1.1.3. Les collges dassocis
Les statuts de la SCIC peuvent prvoir le regroupement des associs
en collges au nombre de 3 minimum et 10 maximum.
Les statuts dterminent librement les modalits de la constitution des
collges. Cependant, la constitution des collges ne peut pas reposer
sur le montant du capital apport par lassoci. part cette restriction,
tout critre est valable sil a t approuv par lassemble gnrale :
gographique, secteur dactivit, par projet, par afnit accepte et
vote par tous et qui a un sens dans la gestion de la prise de dcision
collective Un associ ne peut appartenir qu un seul collge.
Pour lorganisation des votes en assemble gnrale, on applique,
comme dans toute cooprative, la rgle de base un associ = une
voix car chaque associ a le mme pouvoir.
Cependant, si la cooprative a fait le choix de mettre en place des col-
lges, cette rgle est applique diffremment :
1. Au sein des collges dassocis, chaque associ a le mme pou-
voir : 1 personne = 1 voix .
2. Chaque collge dispose dun nombre de voix dni dans les sta-
tuts dans les limites prvues par la loi (10 % du total des voix au
minimum, et 50 % au maximum).
Financement par les collectivits publiques
Les collectivits territoriales peuvent soutenir nancirement les SCIC
sur les trois postes suivants :
Aide au fonctionnement : 100 000 pour chaque priode de
trois ans.
1.2.
La SARL pour dvelopper un projet dentrepreneuriat social
325
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Aide linvestissement : 15 % du montant des investissements,
(7,5 % pour les entreprises employant plus de 50 personnes).
Aide la formation : 70 % du montant des projets de formation.
Les autres collectivits publiques peuvent attribuer des subventions
dans les limites de leur cadre rglementaire.
Lagrment de la SCIC
La SCIC doit tre agre par le prfet du dpartement du sige de la
socit pour une dure de 5 ans renouvelable. Lagrment doit tre
demand aprs la demande dimmatriculation auprs du CFE. Limma-
triculation est alors suspendue dans lattente de la dcision dagrment.
Le prfet doit rpondre dans les deux mois de la demande dagrment.
dfaut, lagrment est considr comme obtenu dofce.
Pour obtenir lagrment, la SCIC doit justier de sa conformit (sta-
tuts, capital, prinscription au RCS, liste des dirigeants), et de son
caractre dutilit sociale.
En cas de retrait ou de non-renouvellement dagrment, la SCIC
reste une cooprative. Sil y a des collectivits publiques dans les asso-
cis, elles devront quitter la cooprative et demander le remboursement
de leurs parts sociales. Sil y avait des collges, toutes les dispositions
les concernant devront tre abroges. La cooprative devra limiter
laccs de ses services aux seuls cooprateurs.
Lutilit sociale de la SCIC
Pour apprcier lutilit sociale de la SCIC, le prfet vrie notamment si
lactivit de la SCIC rpond des besoins mergents ou non satisfaits,
contribue linsertion sociale et professionnelle, au dveloppement de
la cohsion sociale, laccessibilit des biens et services, et dans quelles
conditions lactivit est exerce (dcret du 21 fvrier 2002).
Selon la jurisprudence, le caractre dutilit sociale dune institution
ne dcoule pas du secteur dans lequel elle exerce son activit, mais
bien des conditions dans lesquelles elle lexerce. Tout secteur daction
1.3.
1.4.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
326
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
socio-conomique, quil sagisse de la sant, de lducation, de la culture
ou, demain, de la protection de lenvironnement, peut donner lieu des
activits sociales. (arrt du 30 novembre 1973 : association Saint-Luc,
clinique du Sacr-Cur, n 85586-85598).
La rpartition des excdents et les rserves impartageables
Les excdents de lentreprise sont rpartis de la manire suivante :
1. Rserve lgale : comme toute cooprative, la SCIC doit affecter
au minimum 15 % de ses rsultats une rserve dite lgale
(ce prlvement cesse lorsque le montant de la rserve slve au
montant le plus lev atteint par le capital).
2. Rserve statutaire : une fois la rserve lgale dote, la SCIC a
lobligation de verser au minimum 50 % du solde une rserve
dite statutaire ou fonds de dveloppement (soit 42,5 %
des excdents : (100 % 15 %) 50 % = 42,5 %).
3. Rmunration des parts sociales : le solde peut tre en partie
affect la rmunration des parts sociales.
4. Aprs dduction des ventuelles aides publiques et associatives,
qui doivent tre affectes aux rserves impartageables, le dernier
solde est affect ces mmes rserves. Au nal, 57,5 % mini-
mum des excdents nets annuels sont affects des rserves
impartageables.
Les rserves impartageables constituent le patrimoine propre de la
cooprative. Elles servent lexploitation pour nancer les investisse-
ments ou alimenter le fonds de roulement.
Les rserves impartageables ne peuvent pas tre rparties entre les
associs. En cas de liquidation de lentreprise, ces rserves seront attri-
bues une autre structure poursuivant le mme but dutilit sociale
que la SCIC : coopratives, collectivits publiques
La rvision cooprative
Les SCIC sont soumises lobligation de rvision cooprative. Le rvi-
seur est agr par la Commission nationale de la rvision. La rvision
1.5.
1.6.
La SARL pour dvelopper un projet dentrepreneuriat social
327
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
cooprative a pour vocation de valider la conformit du fonctionnement
de la cooprative au regard de ses obligations lgales (rpartition des
excdents, organisation du socitariat), et dclairer les associs sur
la situation conomique de la cooprative.
Le rgime scal de la SCIC
On applique les rgles de droit commun
1
. La SCIC est donc soumise
limpt sur les socits, la TVA et la taxe professionnelle comme
une SARL classique.
La direction de la SCIC
La SCIC est dirige par un (ou plusieurs) dirigeant, qui peut tre
choisi :
soit parmi les associs. Sil sagit dun associ dtenant un con-
trat de travail au sein de la SCIC avant son lection, celui-ci
pourra continuer bncier de son statut de salari ;
soit lextrieur de la SCIC. Les statuts peuvent alors prvoir
lobligation de salariat pour le dirigeant.
Les dirigeants sont, comme dans toute SARL, responsables de leurs
fautes de gestion.
Transformation dune association en SCIC
Toute association, cooprative ou socit de droit public ou priv, a la
possibilit de se transformer en SCIC sans quil y ait cration de per-
sonne morale nouvelle : lensemble des actifs et du patrimoine reste
donc proprit de la SCIC. De plus, lensemble des contrats et des
conventions ne sont pas remis en cause.
1. La Commission europenne a accord aux coopratives sociales italiennes
la possibilit de soustraire du bnce imposable 30 % du montant vers en
rserves impartageables.
1.7.
1.8.
1.9.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
328
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Une socit cooprative de production (SCOP) a un statut de socit
commerciale, de SARL ou de SA. Les salaris sont associs majori-
taires de lentreprise dont ils dtiennent au moins 51 % du capital. Ils
dcident collectivement selon le principe coopratif une personne =
une voix , indpendamment du montant de capital dtenu. Les salaris
runis autour dun mme projet conomique et des mmes valeurs,
simpliquent totalement dans lentreprise. Tous les salaris ont vocation
devenir associs dans des modalits dnies par les associs existants
et avec leur accord.
La SCOP peut accueillir tous types dassocis extrieurs, dans la
limite de 49 % du capital et de 35 % des droits de vote, attribus
comme pour le salari selon le principe une personne = une voix ,
quel que soit le montant du capital dtenu.
Les SCOP peuvent tre cres dans tous les secteurs dactivit : com-
merce, industrie, artisanat, services, multimdia et mmes certaines
professions librales rglementes (architectes, gomtres-experts).
La SCOP se constitue un patrimoine propre grce des rserves nan-
cires impartageables qui ne peuvent pas tre incorpores dans le capi-
tal social ou distribues. Limpartageabilit de ces rserves prserve la
SCOP dune prise de contrle majoritaire par des investisseurs ext-
rieurs et garantit ainsi son indpendance et sa prennit.
Une association peut se transformer en SCOP.
Pour en savoir plus : consultez les sites www.scop.coop et www.apce.
com chemin daccs : choisir un statut juridique, les socits, SCOP.
Lorganisation des artisans et des commerants en cooprative
leur offre des complmentarits de moyens et des conomies dchelle
2. La socit cooprative de production (SCOP)
3. Les coopratives de commerants
et les coopratives dartisans
La SARL pour dvelopper un projet dentrepreneuriat social
329
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
indispensables pour sadapter aux exigences du march, faire face la
concurrence, et rpondre aux besoins des socitaires et de leurs clients.
Le groupement dachat offre aux cooprateurs les moyens de regrou-
per leurs achats et dorganiser dans le cadre dune structure commune
la ngociation des prix, la gestion des stocks et la rationalisation des
approvisionnements. Le groupement de commercialisation permet
aux cooprateurs de dcupler leurs moyens de promotion et de vente.
La cooprative de commerants permet de mettre en place une poli-
tique commerciale commune an daffronter les rseaux intgrs ou
franchiss. Le groupement de production et de services permet aux
petites entreprises de mutualiser leurs outils de production, leurs
investissements ou certains de leurs services tertiaires pour assurer
leur modernisation et leur comptitivit.
Les coopratives de commerants et les coopratives dartisans peuvent
tre constitues sous forme de SARL ou de SA capital variable.
Deux associs sufsent pour crer la cooprative sous forme de SARL.
En tant que cooprative, les associs dune cooprative, la fois soci-
taires et utilisateurs, dcident collectivement selon le principe coopra-
tif une personne = une voix , indpendamment du montant de
capital dtenu. Paralllement lengagement dactivit de leurs mem-
bres, les coopratives constituent des rserves impartageables qui
reprsentent un mode de dveloppement durable pour les entreprises
adhrentes. Les rsultats des coopratives sont rpartis au prorata des
oprations ralises.
Les coopratives dartisans ou de commerants peuvent recruter des
associs tablis sur le territoire de lUnion europenne an de faciliter
leur accs aux marchs. Les coopratives dartisans peuvent adhrer
dautres coopratives en tant quassocis non cooprateurs an de
mieux diffuser les savoir-faire. Le conjoint collaborateur peut reprsen-
ter lentreprise adhrente au sein de la cooprative dartisans.
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
ANNEXE
Guide pratique de la SARL et de lEURL
332
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Concerne les apports en numraire. Les apports en nature doivent tre immdiate-
ment librs.
2. Ou deux si le capital est au moins gal 75 000 , cinq si le capital est au moins
gal 1 500 000 .
1. Les tableaux comparatifs entre les diffrentes
structures juridiques
1.1. Comparatif de la SARL avec la SNC, la SA et la SAS
Critres juridiques
SNC SARL SA SAS
Capital
minimum
Pas de minimum
exig.
Pas de minimum
exig.
37 000 . Pas de minimum
exig.
Libration
du capital
Selon la volont des
associs.
Le capital doit
tre libr
1
du
cinquime au
moins lors de
la souscription.
Le solde dans
les 5 ans.
Le capital doit tre libr
1
:
de la moiti au moins lors de
la souscription,
le solde dans les 5 ans.
Capital
variable
Possible. Possible. Interdit. Possible.
Appel public
lpargne
Interdit. Interdit. Autoris si capital
dau moins
225 000 .
Interdit.
Nombre
dassocis
Minimum : 2 ;
Pas de
maximum sauf
clause statutaire
limitant le
nombre.
Minimum : 2
(1 pour lEURL) ;
Maximum : 100.
Minimum : 7 ;
Pas de
maximum.
Minimum : 2
(1 pour la SASU) ;
Pas de
maximum sauf
clause statutaire
limitant le
nombre.
Nomination
des dirigeants
Grant nomm
par les statuts, ou
par lassemble
des associs.
Si rien de prvu,
tous les associs
sont grants.
Le ou les grants
sont nomms par
les statuts, ou
par les associs
reprsentant plus
de la moiti du
capital sauf
majorit plus forte
prvue par les
statuts.
Le prsident-
directeur gnral
est nomm par
le conseil
dadministration ;
Il est assist,
sil le souhaite,
dun directeur
gnral
2
personne
physique, nomm
par le CA ;
Un prsident,
personne
physique ou
morale, doit tre
obligatoirement
dsign.
Sa nomination
est fonction
des clauses
statutaires ;
/
Annexe
333
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Octroi de dommages-intrts en labsence de juste motif de rvocation.
SNC SARL SA SAS
Le conseil
dadministration
(3 24 membres)
est nomm par
lassemble
gnrale
ordinaire.
Dautres organes
de direction
peuvent tre
institus par
les statuts :
vice-prsident,
directeur
gnral, collge
de dirigeants.
Rvocation
des dirigeants
Rvocation
des grants non
associs la
majorit simple
des associs ;
Rvocation
lunanimit des
grants associs
dsigns dans
les statuts.
Rvocation du
grant par les
associs la
majorit des parts
sociales, sans avoir
en justifier
le motif, et sans
indemnits
1
.
Le prsident et
les directeurs
gnraux sont
librement
rvocables par
le CA sans motif
ni pravis ;
Les membres
du CA sont
librement
rvocables par
lassemble.
Selon les clauses
statutaires :
rvocation libre
ou pour juste
motif avec ou
sans indemnits ;
rvocation la
majorit simple
ou renforce
des associs.
Pouvoir
des dirigeants
Dcisions
courantes prises
par le grant.
Autres dcisions
prises par
lassemble
lunanimit (un
associ = une voix).
Le grant a les
pouvoirs les plus
tendus dans ses
rapports avec les
tiers tant que ses
dcisions restent
dans le cadre de
lobjet social.
Le prsident
dispose de
pouvoirs tendus,
mais il agit dans
les limites de la
politique fixe par
le conseil
dadministration.
Le prsident
reprsente la
socit envers
les tiers.
Il a les pouvoirs
les plus tendus
dans ses rapports
avec les tiers.
Mode de
consultation
des associs
Le mode de
consutation des
associs est dfini
par les statuts :
assemble des
associs,
consultation crite,
dcision dans
un acte, runion
informelle
Les dcisions
des associs
sont prises en
assemble.
Cependant :
possibilit de
consultation
crite si les
statuts lont
prvu ;
possibilit dacte
sign de tous
les associs.
Les dcisions des
actionnaires sont
prises uniquement
en assemble.
Possibilit de vote
par correspondance
auquel est attach
un grand
formalisme.
Le mode de
consultation des
associs est dfini
par les statuts :
assemble des
associs,
consultation crite,
dcision dans
un acte, runion
informelle
Quorum
pour les
assembles
gnrales
dassocis
Les statuts peuvent
prvoir un quorum.
Quorum pour
les AGE.
Pour une AGO :
1/4 des actions
sur 1
re
convoca-
tion, pas de
quorum sur
2
e
convocation.
Les statuts peuvent
prvoir un quorum.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
334
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Double majorit pour cession des parts des tiers.
2. Elles se transmettent par virement de compte compte.
3. dfaut, signication par huissier dans les termes de larticle 1690 du Code civil.
4. Ces clauses dagrment ne peuvent sappliquer en cas de cession entre poux, un
ascendant ou un descendant. La clause dagrment ne peut jouer entre actionnaires.
5. Lagrment peut tre gnral, y compris pour les cessions entre associs, ou limit
certains associs ; lagrment peut tre donn par les associs ou le prsident.
SNC SARL SA SAS
Majorit pour
les dcisions
des associs
Les conditions
de majorit sont
dfinies par les
statuts :
Un droit de veto
peut tre institu
pour un ou
plusieurs
associs ;
Lunanimit
est exige pour
adopter ou
modifier des
clauses
statutaires
restreignant
les droits des
actionnaires.
AGO : plus de la
moiti des parts
sociales ;
AGE : 2/3 des
parts sociales
1
.
AGO : plus de
50 % des voix ;
AGE : 2/3 des
voix.
Les conditions
de majorit sont
dfinies par
les statuts :
Un droit de veto
peut tre institu
pour un ou
plusieurs
associs ;
Lunanimit
est exige pour
adopter ou
modifier des
clauses
statutaires
restreignant
les droits des
actionnaires.
Approbation
des comptes
annuels
Lapprobation par
les associs est
obligatoire.
Cependant, les
modalits sont
prvues par les
statuts.
AGO. AGO. Lapprobation par
les associs est
obligatoire.
Cependant, les
modalits sont
prvues par les
statuts.
Dpt
des comptes
au greffe
Non. Obligatoire.
Cession
des droits
sociaux
La cession
ncessite laccord
de lensemble
des associs.
Lagrment doit, en
principe, tre donn
lunanimit des
associs.
Ncessit dun
acte ;
Un original de
lacte de cession
est dpos au
sige social
contre remise par
le grant dune
attestation du
dpt
3
;
Les actions sont
ngociables
2
;
Les cessions
sont faites
librement sauf
clause
dagrment ou
de premption
4
;
Les actions sont
ngociables.
Les statuts
dterminent
les modalits
de cession des
actions :
cessions libres
ou soumises
un agrment
pralable
5
;
/
Annexe
335
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
SNC SARL SA SAS
La cession aux
tiers ncessite le
consentement de
plus de la moiti
des associs
reprsentant au
moins 3/4 des
parts sociales.
Le conseil
dadministration
peut tre dclar
comptent pour
statuer sur les
demandes
dagrment.
dautres clauses
statutaires
peuvent
sappliquer
1
.
Commissaire
aux comptes
Nomination obligatoire uniquement
pour les entreprises importantes
3
.
Nomination
obligatoire
2
.
Pas de
commissaire
aux comptes pour
les petites SAS
4
.
Statut de
lassoci
Statut de
commerant.
Les associs ne sont pas commerants.
Responsa-
bilit des
associs
Les associs sont
responsables
indfiniment et
solidairement des
dettes sociales.
La responsabilit des associs est limite au montant de
leurs apports.
Responsa-
bilit des
dirigeants
Le grant est responsable des dettes
sociales en cas de faute de gestion.
Sa responsabilit fiscale peut tre
engage.
Le prsident est responsable des dettes
sociales en cas de faute de gestion.
Sa responsabilit fiscale peut tre
engage.
1. Inalinabilit des actions pendant 10 ans maximum ; exclusion dun ou plusieurs
associs et obligation de cder les actions aux conditions prvues ; suspension du
droit de vote et exclusion sous certaines conditions de la socit actionnaire dont le
contrle est modi.
2. Nomination obligatoire dau moins un commissaire aux comptes pour 6 exercices
par les associs.
3. Nomination obligatoire si deux des critres ci-aprs sont dpasss la clture dun
exercice : bilan : 1,55 million deuros ; CA : 3,1 millions deuros ; nombre moyen
de salaris permanents : 50.
4. Le commissaire aux comptes est obligatoire si la SAS dpasse la clture dun
exercice social deux des seuils suivants : 1 000 000 pour le total du bilan,
2 000 000 pour le chiffre daffaires HT ou le nombre moyen de 20 salaris au
cours de lexercice.
Guide pratique de la SARL et de lEURL
336
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Pas dassurance chmage UNEDIC.
2. Pas dassurance chmage sauf si contrat de travail rel cumulable avec le mandat.
3. Ladhsion un centre de gestion agr permet lassoci de bncier dun abat-
tement de 20 % sur sa quote-part de bnce.
Critres sociaux
SNC SARL SA SAS
Statut social
du dirigeant
Grant associ :
rgime des
travailleurs
indpendants
1
;
Grant non
associ : rgime
des salaris.
Grant
majoritaire :
rgime des
travailleurs
indpendants
1
;
Grant
minoritaire :
rgime des
salaris
2
.
PDG et directeur
gnral : rgime
des salaris
2
.
Prsident de
la SAS : rgime
des salaris
2
.
Cumul avec
un contrat
de travail
Impossible pour
le grant associ.
Grant
minoritaire :
possible si
les critres
du contrat sont
runis ;
Grant galitaire :
difficile ;
Grant
majoritaire :
impossible.
Possible si les
critres du contrat
de travail sont
runis.
Possible pour le
prsident personne
physique si les
critres du contrat
de travail sont
runis.
Critres scaux
SNC SARL SA SAS
Imposition
de la
rmunration
du dirigeant
La quote-part de
bnfice de la SNC
qui revient
lassoci en
fonction de ses
droits sociaux
constitue sa
rmunration.
Elle est impose
limpt sur
le revenu
3
.
Le grant
majoritaire ou
minoritaire est
assimil un
salari : il bnficie
des mmes
abattements quun
salari (dduction
forfaitaire de 10 %
pour frais
professionnels).
Le PDG et le DG
sont imposs
comme un salari :
ils bnficient
des mmes
abattements
quun salari.
Le prsident de
la SAS est impos
comme un salari.
/
Annexe
337
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1.2. Comparatif de lEURL avec la SASU
et lentreprise individuelle
SNC SARL SA SAS
Imposition
des bnfices
de lentreprise
Les bnfices sont
soumis limpt
sur le revenu
au niveau des
associs.
Les bnfices sont soumis limpt sur les socits au taux
de 33
1/3
%, major des contributions exceptionnelles.
Cession
des droits
sociaux
3 % sur le prix
de cession ou
la valeur vnale.
3 % sur le prix
de cession aprs
abattement de
23 000 .
3 % plafonn 5 000 par cession quelle
quen soit la forme.
Entreprise individuelle EURL SASU
Capital Aucun minimum exig. Aucun minimum exig. Aucun minimum exig.
Libration
du capital
Lexploitant fait des
apports et des retraits
en fonction des besoins
de lentreprise.
Libration du 1/5 la
constitution, le solde au
plus tard dans les 5 ans
de limmatriculation
au RCS.
Libration de la 1/2
la constitution, le solde
au plus tard dans les 5 ans
de limmatriculation
au RCS.
Associ Lexploitant na pas
la qualit dassoci (ce
nest pas une socit).
Une personne physique ou
une personne morale. Une
EURL ne peut pas avoir
pour associ unique une
autre EURL.
Une personne physique
ou une personne morale.
Une SASU peut avoir pour
associ unique une autre
SASU.
Direction Lexploitant assure
la direction en tant que
chef dentreprise.
Un grant personne
physique, associ ou non.
Un prsident personne
physique ou personne
morale, associ ou non.
Commissaire
aux comptes
Non. Non. Non.
Droits sociaux Le capital correspond
au compte de lexploitant
(pas de droits sociaux).
Parts sociales
non ngociables.
Droit de revendication
du conjoint commun
en biens.
Actions librement
ngociables.
Pas de droit de
revendication du conjoint
commun en biens.
Financement Apports au compte de
lexploitant qui nest pas
un compte courant.
Impossibilit dmettre
des obligations.
Apports en compte
courant.
Possibilit dmettre
des obligations.
Apports en compte
courant.
/
Guide pratique de la SARL et de lEURL
338
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
1. Imposition lIS si lassoci unique est une personne morale ou si lEURL opte
pour lIS. Le salaire du conjoint nest dductible que sous certaines limites.
2. La petite SAS peut opter pour limpt sur le revenu pour une priode de
5 ans.
3. En pratique, les tablissements de crdit demandent la caution solidaire du dirigeant
et de son conjoint.
Imposition Imposition lIR au niveau
du chef dentreprise.
Imposition lIR au niveau
de lassoci unique
personne physique
1
.
Imposition lIS au niveau
de la SAS
2
.
Responsabilit Le chef dentreprise est
responsable indfiniment
des dettes de lentreprise
sur ses biens personnels
car il y a confusion de
patrimoine. Cependant,
la responsabilit de
lentrepreneur peut-tre
limit au patrimoine quil
affecte lentreprise.
La responsabilit de
lassoci unique non
grant est limite
son apport.
Lassoci unique grant
3
peut tre responsable sur
ses biens personnels en
cas de faute de gestion.
La responsabilit de
lassoci unique non
prsident est limite
son apport.
Lassoci unique prsident
3
peut tre responsable sur
ses biens personnels en
cas de faute de gestion.
Pouvoirs Le chef dentreprise
est seul dcider.
Le grant a tous les
pouvoirs envers les tiers.
Le prsident tous
pouvoirs envers les tiers.
Formalisme Aucun formalisme li
la structure sociale nest
respecter (confusion
de patrimoine).
Lassoci unique doit
respecter le formalisme et
la rglementation propres
la SARL. Ainsi, pour
lapprobation des comptes,
il doit rdiger un procs-
verbal.
Lassoci a une trs grande
libert dorganisation de la
SASU. Ainsi, lassoci peut
approuver les comptes
dans un acte.
Cession des
droits sociaux
Droit sur le fonds
de commerce : 0 %
jusqu 23 K ; 3 %
de 23 K 107 K ; 5 %
au-del.
Droit de 3 % sur la valeur
des parts aprs abattement
de 23 000 .
Droit de 3 % plafonn
5 000 sur la valeur
des actions cdes.
Statut fiscal
du dirigeant
Le chef dentreprise est
impos sur le bnfice
dgag par lentreprise
individuelle dans
la catgorie des BIC
ou BNC.
Le dirigeant est impos
sur le bnfice dgag par
lEURL dans la catgorie
des BIC ou BNC.
Le prsident est assimil
un salari : son salaire est
imposable entre ses mains
et dductible du bnfice
de la SASU.
Entreprise individuelle EURL SASU
/
Annexe
339
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
ISF Les biens affects
lexercice de la profession
sont exonrs dISF si
la profession est exerce
titre principal.
Les parts de lassoci sont
des biens professionnels
exonrs dISF si lassoci
exerce son activit
professionnelle principale
dans lEURL.
Les actions sont des biens
professionnels exonrs
dISF si la fonction de
prsident est
effectivement exerce
et rmunre
1
.
Statut social Rgime des travailleurs
indpendants
2
.
Rgime des travailleurs
indpendants
2
.
Le prsident de la SASU
bnficie du rgime gnral
de la Scurit sociale.
Entreprise individuelle EURL SASU
1. La rmunration doit reprsenter plus de la moiti des revenus professionnels.
2. Possibilit de dduire dans certaines limites les cotisations pour nancer la protec-
tion sociale complmentaire.
341
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
INDEX
A
AAG 219, 291
Abattement rgime fiscal
de la grance 135
Abus
~ de biens sociaux 141
~ de majorit 184
~ de minorit 185
Acompte sur dividendes 208
Acte
~ accompli pour le compte
de la socit en formation 33
~ notari 22, 33, 88, 134
~ sous seing priv 33, 88, 101, 157
Action
~ en comblement du passif 144
~ en responsabilit contre le grant
139, 204
Affectation des rsultats 204
Agrment
~ cession de parts 85
~ dcs dun associ 98
Aides
~ fiscales 234
~ inter-entreprises 235
Annonce lgale 36
Appointements
~ du conjoint 131
~ du grant 148, 285, 312
Apports
~ titre onreux 39, 153
~ titre pur et simple 39, 153
~ dun droit au bail 158
~ dun fonds de commerce 158
~ de biens communs 22, 86, 134,
158, 184
~ EARL 311
~ en industrie 159
~ en nature 156
~ en numraire 154
~ valuation 157
~ rgime fiscal 36
Approbation
~ des comptes 203
~ des rmunrations 148
Arrive du terme de la socit 30,
52
Assemble
~ annuelle 203
~ gnrale extraordinaire 185
~ gnrale ordinaire 185
Associ
~ agrment 85
Guide pratique de la SARL et de lEURL
342
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
~ capacit 22
~ de complaisance 23
~ dcs 7
~ exploitant 313
~ nombre 21
~ pouvoir 182
~ profession librale 302
~ reprsentation 183
~ responsabilit 4, 8, 157
~ statut social 135
~ unique 273
Assurance chmage 127
Attribution prfrentielle 99
Augmentation de capital
~ en nature 170
~ en numraire 166
~ par incorporation des bnfices
et des rserves 171
Auto-contrle 55
Avoir fiscal 294
B
BA 315
Bail, apport en socit 39, 156
Banque, dpt des fonds 155
Banqueroute 147
Bnfices
~ affectation 205
~ distribus (imposition) 246
BIC 286, 291
BNC 286, 291
Boni de liquidation 81
C
Capacit 22
Capital
~ augmentation 165
~ montant 30, 305, 310
~ rduction 172
Capitaux
~ mobiliers (revenus des) 243
~ propres infrieurs la moiti
du capital 175
Carte de commerant tranger 22,
110
Cautions
~ conventions interdites 181
~ donnes par le grant ou
un associ pour garantir
la socit 163
Centre de formalits
des entreprises 38
Cessation des fonctions
(grants) 116
Cessions
~ de parts sociales 85, 294, 305,
318
~ en blanc 23
CGA 291
Charges sociales 133
Clauses dagrment 88
Comblement du passif 144
Comit dentreprise 198, 262
Commissaire
~ la transformation 62
~ aux apports 157
~ aux comptes 197
Communaut entre poux 98, 134,
196
Compensation des dettes 168
Comptabilit irrgulire (sanctions
en cas de) 146
Index
343
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Compte
~ annuel 200
~ consolid 56
~ courant 160
~ de rsultat prvisionnel 259
Conjoints 24, 86, 129
Constitution 18
Consultation crite 192
Contrat
~ de socit 34
~ de travail du conjoint 131
~ de travail du grant 118
Conventions entre la socit
et les associs ou grants
~ interdites 181
~ libres 195
~ rglementes 195, 306
Convocation de lassemble 187
Cotisations de scurit sociale 125,
140
Cot de la constitution 39
Cumul des fonctions (contrat
de travail et mandat social) 118
D
Dcs
~ dun associ 98
~ dun grant 114
Dcisions
~ extraordinaires 207
~ ordinaires 183, 186
Dclaration
~ de cessation de paiements 270
~ des contrats de prts 160
Dficit 209, 232
Dlai de convocation 189
Dlgation de pouvoirs 182
Dmission du grant 114
Dnomination sociale 29, 310
Dpt
~ au greffe 34, 204
~ des comptes 204
~ des fonds 155
Dsignation judiciaire
dun expert 261
Dettes fiscales
(responsabilit des grants) 139
Dirigeants de fait 137
Dissolution 295, 319
Dividende
~ abattement 243
~ acompte 208
~ paiement 207
Divorce 86
Documents prvisionnels 259
Domiciliation 26
Droit
~ au bail 39, 156
~ de communication 193194, 289
~ de vote 183
~ prfrentiel de souscription 166
Dure
~ de la socit 29, 52
~ des fonctions grants 113
E
EARL 309
Emploi dans la socit 118, 127,
302, 314
Emprunts 159, 178
Engagements pris avant
limmatriculation 31
Guide pratique de la SARL et de lEURL
344
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Enregistrement 36
Entreprise agricole
responsabilit limite
~ apports 311
~ associs exploitants 313
~ cession de parts sociales 318
~ dcisions collectives 315
~ dissolution 319
~ imposition 315
~ rmunration 312
Entreprise individuelle 2, 275
poux 22, 88
tranger 22, 110
EURL
~ associ unique 290
~ cession des parts sociales 294
~ contrle 287
~ cration 279
~ dissolution 295
~ fiscalit 291
~ gestion 284
valuation des apports
en nature 156, 311
Examen des comptes 198
Expertise sur une ou plusieurs
oprations de gestion 261
F
Faillite personnelle 146
Feuille de prsence 190
Filiale 54
Financement 153
Fonds de commerce
(Apport dun) 158
Formalits 35
Frais de constitution 39
Fusion 71
G
Grant
~ assurance chmage 127
~ capacit 110
~ contrat de travail 118
~ conventions avec la socit 181
~ cumul de fonctions 118
~ de fait 137
~ dcs 114
~ dlgation de pouvoirs 182
~ dmission 114
~ dure des fonctions 114
~ EARL 313
~ tranger 110
~ EURL 284
~ expiration du mandat 114
~ imposition 148
~ incapacit 114
~ incompatibilit 110
~ majoritaire ou minoritaire 121,
150
~ nombre 109
~ nomination 109
~ non rmunr 121
~ non salari 121
~ quitus 203
~ rapport de gestion 201
~ rmunration 148
~ responsabilit 137
~ rvocation 115
~ SEL 306
~ statut fiscal 149
~ statut social 121
GIE 53
H
Hritiers 23, 97
Hypothques 38, 180, 267
Index
345
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
I
Immatriculation 31
Immeuble (Apport dun) 38
Impt sur les bnfices 225
Indivision 59, 76, 97, 122, 184
Infractions (Responsabilit
pnale) 106, 140
Intgration fiscale 238
ISF 239
L
Libration
~ des parts 155, 168
~ par compensation 168
Liquidation 77, 269, 295
M
Majoration frauduleuse
des apports 171
Majorit
~ dcisions extraordinaires 183
~ dcisions ordinaires 183
Mandataire
~ assembles 184
~ dsign par justice (convocation
de lassemble) 187
Msentente 116
Montant
~ minimum du capital 30
~ nominal des parts 30
N
Nantissement des parts
sociales 100
O
Objet social 27
Option pour le rgime fiscal
des socits de personnes 219
Ordre du jour 183
P
Pacte extra-statutaire 34
Paiement des dividendes 207
Participation 48
Parts sociales
~ cession 85, 87, 9192
~ dindustrie 159
~ libration 154
~ nantissement 100
~ rduction de la valeur
nominale 173
~ saisie 102
~ transmission par dcs 97
Personnalit morale 31, 77
Pertes de la moiti du capital 174
Plus-values
~ dapport 47
~ sur cession de parts 94
Prsidence de lassemble 190
Prestations sociales 125
Prte-nom 23
Prvention des difficults
~ comit dentreprise 262
~ commissaire aux comptes 261
~ procdure dalerte 261
~ questions crites 260
Procs-verbal 191
Promesse de socit 34
Guide pratique de la SARL et de lEURL
346
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Prorogation 203
Publicit des comptes 204
Q
Questions crites
~ assemble ordinaire annuelle 182
~ prvention des difficults 256
R
Rapport
~ de gestion 201
~ du commissaire aux apports 156
~ sur conventions rglementes
195
Rdaction des statuts 32
Redressement judiciaire 269
Rduction de capital 172
Rgime
~ fiscal de la socit 217, 299, 317
~ fiscal du grant 150, 286
~ social 121
Registre
~ des procs-verbaux 191
~ du commerce et des socits 35,
204
Rglement amiable 264
Rmunration
~ des associs EARL 312
~ du grant EURL 285
~ du grant majoritaire 121, 150
~ du grant minoritaire 121, 150
Report en arrire des dficits 232
Reprise des engagements 32
Rserve 206
Responsabilit
~ de la socit 106
~ des associs 3, 157, 305
~ du grant 137, 287
Retrait des fonds 155
S
SA 332
Sanctions pnales 137, 140, 202
SARL de famille 23
SAS 332
SASU 3, 275276, 283, 298, 337
SELARL 302, 305307
SELU 3, 275, 301, 306
Sige social 25
Situation de lactif ralisable
et disponible et du passif
exigible 259
SNC 332
Socit dexercice libral
~ capital 303
~ cession de parts sociales 305
~ comptes courants 305
~ conventions rglementes 306
~ grant 306
~ profession librale 302
~ responsabilit 305
~ transformation 307
Socit en participation 58
Statuts 32, 35, 50
T
Terme (arrive du) 30
Transfert du sige 53
Index
347
G
r
o
u
p
e
E
y
r
o
l
l
e
s
Transformation de la SARL 60, 64,
69, 307
Transmission de parts 85
Trsorerie 64
TVA 209, 211
U
Usufruit 122, 184
V
Vote aux assembles 183
Compos par Sandrine Rnier
N dditeur : 4071
Dpt lgal : juin 2010
Vous aimerez peut-être aussi
- Business Plan Exemple Excel GratuitDocument13 pagesBusiness Plan Exemple Excel GratuitDouja OmraniPas encore d'évaluation
- 2022 06 29 - Conditions Type Applicables Freelance - TotalEnergies - MaltDocument67 pages2022 06 29 - Conditions Type Applicables Freelance - TotalEnergies - MaltHicham ChamPas encore d'évaluation
- Contrat Apporteur Affaires PDFDocument6 pagesContrat Apporteur Affaires PDFJean-Joel LEKANGAPas encore d'évaluation
- Guide Pratique de La SciDocument33 pagesGuide Pratique de La SciahboPas encore d'évaluation
- Calculer Le Taux D'intérêt D'un Leasing Ou D'un Crédit-Bail Sous ExcelDocument7 pagesCalculer Le Taux D'intérêt D'un Leasing Ou D'un Crédit-Bail Sous ExcelRabah AitPas encore d'évaluation
- PWC CDP 2014-06-04 Memento Fusions AcquisitionsDocument1 pagePWC CDP 2014-06-04 Memento Fusions AcquisitionsDalal ZouhdiPas encore d'évaluation
- (Création D'entreprise) Denos, Pascal - Guide Pratique de La SAS Et de La SASU-Eyrolles (2016) PDFDocument240 pages(Création D'entreprise) Denos, Pascal - Guide Pratique de La SAS Et de La SASU-Eyrolles (2016) PDFAmine Schwarz100% (1)
- Comment Creer Une HoldingDocument8 pagesComment Creer Une HoldingaliasjanusPas encore d'évaluation
- L'année 2020 en Tendances: Un Monde À EntreprendreDocument53 pagesL'année 2020 en Tendances: Un Monde À EntreprendreLeonardPas encore d'évaluation
- Le gérant de la SPRL: Questions - Réponses (Droit belge)D'EverandLe gérant de la SPRL: Questions - Réponses (Droit belge)Pas encore d'évaluation
- Cas Pratique SARL - SAS LE JARDIN SARTHOIS Énoncé Et CorrigéDocument4 pagesCas Pratique SARL - SAS LE JARDIN SARTHOIS Énoncé Et CorrigéPierre DelarueaPas encore d'évaluation
- Le Guide Ultime Pour Developper Son Business en FreelanceDocument30 pagesLe Guide Ultime Pour Developper Son Business en FreelanceAnaellePas encore d'évaluation
- Fiche APCE Ser 28 - Secretaire A Domicile - Telesecretariat.31048Document25 pagesFiche APCE Ser 28 - Secretaire A Domicile - Telesecretariat.31048ganath33Pas encore d'évaluation
- Guide Pratique de La SARLDocument33 pagesGuide Pratique de La SARLDayang DayangPas encore d'évaluation
- Business Plan 2022Document43 pagesBusiness Plan 2022Imane BamhaouedPas encore d'évaluation
- Societe Civile ImmobiliereDocument23 pagesSociete Civile Immobilierecclaudel09Pas encore d'évaluation
- Business Plan Previsionnel SCIDocument8 pagesBusiness Plan Previsionnel SCIMaria Thiziri0% (1)
- Bouygues Immobilier Renforce Sa Présence OnlineDocument3 pagesBouygues Immobilier Renforce Sa Présence OnlineBouyguesImmobilierPas encore d'évaluation
- TOP 6-Business-PlanDocument24 pagesTOP 6-Business-PlanAbdellah AterchanePas encore d'évaluation
- Présentation BP Dossier FinancierDocument16 pagesPrésentation BP Dossier FinancierkbgroupPas encore d'évaluation
- Plan Busines 2Document17 pagesPlan Busines 2Houda BeniPas encore d'évaluation
- Guide de La Creation D EntrepriseDocument225 pagesGuide de La Creation D Entreprisecolgate008100% (1)
- Outils Tableau FinancierDocument14 pagesOutils Tableau FinancierHadi TioutiPas encore d'évaluation
- Tableau Comparatif Des Différents StatutsDocument3 pagesTableau Comparatif Des Différents StatutsseagullaPas encore d'évaluation
- Guide Pratique Pour Financer Son EntrepriseDocument32 pagesGuide Pratique Pour Financer Son EntrepriseArmel Hamidou100% (1)
- Création Et Reprise D'entreprise PDFDocument18 pagesCréation Et Reprise D'entreprise PDFl'OpinionPas encore d'évaluation
- Exemple Plan D'affaireDocument9 pagesExemple Plan D'affaireKarim BenaceurPas encore d'évaluation
- Offre de Conseil - Edition 2021Document23 pagesOffre de Conseil - Edition 2021Jade CLAPINPas encore d'évaluation
- Les HoldingsDocument16 pagesLes HoldingsMohamed AghmirPas encore d'évaluation
- Statut JudiriqueDocument2 pagesStatut JudiriqueZH HamzaPas encore d'évaluation
- La Creation D Entreprise Creation Reprise Developpement PDFDocument849 pagesLa Creation D Entreprise Creation Reprise Developpement PDFDuval BaronPas encore d'évaluation
- Tournier Evaluation Entreprise PDFDocument90 pagesTournier Evaluation Entreprise PDFMAAATIPas encore d'évaluation
- BP ExempleDocument11 pagesBP ExempleGolden key100% (1)
- Code Général Des ImpôtsDocument1 221 pagesCode Général Des ImpôtsGNABRO RICHMOND CHRIS CEDRIC DORVALPas encore d'évaluation
- Contrat de Partenariat-ConvertiDocument2 pagesContrat de Partenariat-ConvertiYoro DialloPas encore d'évaluation
- Business Plan de La Création D'une Entreprise de Géomètre-ExpertDocument95 pagesBusiness Plan de La Création D'une Entreprise de Géomètre-ExpertSafa MtirPas encore d'évaluation
- Immobilier Et Reseaux Sociaux HD PDFDocument46 pagesImmobilier Et Reseaux Sociaux HD PDFberouayelPas encore d'évaluation
- Je Crée Mon EntrepriseDocument155 pagesJe Crée Mon EntrepriseMohamed KadiriPas encore d'évaluation
- Sommaire Détaillé Créer Son Entreprise PDFDocument21 pagesSommaire Détaillé Créer Son Entreprise PDFManu2testPas encore d'évaluation
- La Holding Au Service de La Transmission Des Entreprises Familiales : Un Cadre Légal Globalement Satisfaisant Mais Encore ImparfaitDocument36 pagesLa Holding Au Service de La Transmission Des Entreprises Familiales : Un Cadre Légal Globalement Satisfaisant Mais Encore ImparfaitArnaud DumourierPas encore d'évaluation
- Etude de Cas Ferme AgricoleDocument41 pagesEtude de Cas Ferme Agricolezao1020004497Pas encore d'évaluation
- Modèle de Business Plan ExcelDocument13 pagesModèle de Business Plan ExcelHamza MouridPas encore d'évaluation
- OFF3 Modèle Business Plan Création V2 01 06 2016Document12 pagesOFF3 Modèle Business Plan Création V2 01 06 2016Daddy MBOMBO MUKUNAPas encore d'évaluation
- Comparatif Type Societe Gestion ImmoDocument14 pagesComparatif Type Societe Gestion ImmokokofioloPas encore d'évaluation
- Plan D'affaires AEJ-simplifié Micro-EntrepriseDocument7 pagesPlan D'affaires AEJ-simplifié Micro-Entreprisepaul vigneron100% (1)
- Plan D'affairesDocument14 pagesPlan D'affairesSalimata koné100% (1)
- Devis Cuquel9935241 Et 9935242Document5 pagesDevis Cuquel9935241 Et 9935242Patrick SudriePas encore d'évaluation
- Incubateur Silicon Sentier V4Document49 pagesIncubateur Silicon Sentier V4josephchainesPas encore d'évaluation
- Le Capital Investissement - Une Voie de Financement AlternatifDocument7 pagesLe Capital Investissement - Une Voie de Financement Alternatiflns kariPas encore d'évaluation
- Apport en Nature D'un Bien ImmobilierDocument5 pagesApport en Nature D'un Bien ImmobiliersamyPas encore d'évaluation
- 5 Régime Fiscal de La Société Civile ImmobilièreDocument2 pages5 Régime Fiscal de La Société Civile Immobilièreel kadiriPas encore d'évaluation
- Formulaire de Renseignement Relative À Une Demande D'investissement National PrivéDocument7 pagesFormulaire de Renseignement Relative À Une Demande D'investissement National PrivébenhabilesPas encore d'évaluation
- Prévisionnel FinancierDocument27 pagesPrévisionnel FinancierElhadji KANDJI100% (1)
- Bonnes Pratiques IncubateursDocument10 pagesBonnes Pratiques IncubateursDAGHAYRACHIDPas encore d'évaluation
- Ing Arch Iznasni+BenzaghouDocument256 pagesIng Arch Iznasni+BenzaghouWalaa Ben BoubakerPas encore d'évaluation
- La Gérance de La SARLDocument9 pagesLa Gérance de La SARLAnas JalalPas encore d'évaluation
- Eco-Parc Fare FenuaDocument45 pagesEco-Parc Fare FenuaRadio 1 TahitiPas encore d'évaluation
- Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleD'EverandAspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Sarl EurlDocument361 pagesSarl EurlhmidPas encore d'évaluation
- La Cession de Parts Sociales D'une SARL Au MarocDocument15 pagesLa Cession de Parts Sociales D'une SARL Au MarocBUSINESS LAW PARTNERSPas encore d'évaluation
- EntrepriseDocument82 pagesEntrepriseNaoufal FouadPas encore d'évaluation
- Le Guide de La SARL - Q3 2018Document14 pagesLe Guide de La SARL - Q3 2018stephpovoPas encore d'évaluation
- Quiz SarlDocument4 pagesQuiz SarlGondwanais LamdaPas encore d'évaluation
- Chapitre 03Document2 pagesChapitre 03nadialamaniPas encore d'évaluation
- PrésentationDocument16 pagesPrésentationh.goutorbePas encore d'évaluation
- Deductibilite Loi Madelin Et Msa.20130125.150440Document3 pagesDeductibilite Loi Madelin Et Msa.20130125.150440musclejet0Pas encore d'évaluation
- Amo MarocDocument27 pagesAmo MarocOuahid AbdelfatahPas encore d'évaluation
- 7 RÈGLES D or ConsultantDocument25 pages7 RÈGLES D or ConsultantJamal KalkouliPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Les Criteres de Choix de L'activité Professionnelle (Modifier)Document7 pagesChapitre 3 - Les Criteres de Choix de L'activité Professionnelle (Modifier)Stephane AugustinPas encore d'évaluation
- Freelances, 30 Idées Pour Dynamiser Votre IndépendanceDocument11 pagesFreelances, 30 Idées Pour Dynamiser Votre IndépendanceDominique100% (2)
- Comment Devient-On EntrepreneurDocument56 pagesComment Devient-On EntrepreneurMly Hamza Mourtadi75% (4)
- Les Travailleurs Des Plateformes Numériques: Regards CroisésDocument8 pagesLes Travailleurs Des Plateformes Numériques: Regards Croisésbertaud benjaminPas encore d'évaluation
- Gig EconomyDocument12 pagesGig EconomyMohamed El MimouniPas encore d'évaluation
- Freelancer Guide BookDocument26 pagesFreelancer Guide BookMihai LucescuPas encore d'évaluation
- +95 Méthodes & Idées Pour Générer Un REVENU en LigneDocument73 pages+95 Méthodes & Idées Pour Générer Un REVENU en LignemiagreygermanyPas encore d'évaluation
- Suppot DSS - LP3 2022-2023Document98 pagesSuppot DSS - LP3 2022-2023dantagrozPas encore d'évaluation
- Guide D'accompagnement À La Création D'entreprise en Brabant WallonDocument52 pagesGuide D'accompagnement À La Création D'entreprise en Brabant WallonMarioPas encore d'évaluation
- Contrat Type de Collaboration LibéraleDocument10 pagesContrat Type de Collaboration LibéraledeudeuPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document35 pagesChapitre 1asmakucuktasPas encore d'évaluation
- CONSIGNES ECO5 Pour SAE501 - VJ Vers2Document2 pagesCONSIGNES ECO5 Pour SAE501 - VJ Vers2darkv2hdPas encore d'évaluation
- Compréhension Écrite C1 - La Génération D....Document4 pagesCompréhension Écrite C1 - La Génération D....Carmen PănuțăPas encore d'évaluation
- Cejm BTS1 CH13 Livre ProfDocument13 pagesCejm BTS1 CH13 Livre ProfjeanPas encore d'évaluation
- Freelance - Le Guide Du Personal BrandingDocument6 pagesFreelance - Le Guide Du Personal BrandingChouchouPas encore d'évaluation
- La Répartition Des RevenusDocument16 pagesLa Répartition Des RevenusAyoub FakirPas encore d'évaluation
- Je 03 03 14Document100 pagesJe 03 03 14fatinetteflowerPas encore d'évaluation
- FreelanceDocument10 pagesFreelanceTendry RavelojaonaPas encore d'évaluation
- Devenez Dating Assistant - Sept2022 PDFDocument18 pagesDevenez Dating Assistant - Sept2022 PDFGuillaume ZacchelloPas encore d'évaluation
- Entreprise de Service VraiDocument9 pagesEntreprise de Service VraiYves BayiliPas encore d'évaluation
- Agent Commercial PDFDocument6 pagesAgent Commercial PDFfatime-zzahraPas encore d'évaluation
- Le Contrat FreelanceDocument7 pagesLe Contrat FreelanceMeite SagessePas encore d'évaluation