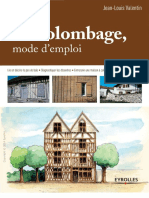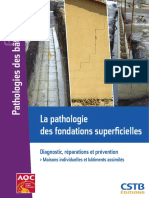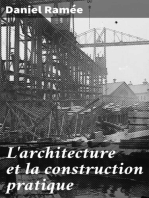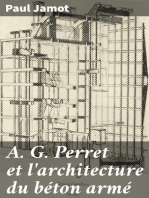Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Manuel de Sensibilisation A La Maconnerie PDF
Manuel de Sensibilisation A La Maconnerie PDF
Transféré par
rems32Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Manuel de Sensibilisation A La Maconnerie PDF
Manuel de Sensibilisation A La Maconnerie PDF
Transféré par
rems32Droits d'auteur :
Formats disponibles
Ministre de la Culture
et de la Communication
Direction de l'Architecture
et du Patrimoine
Mission Ingnierie
et Rfrences Techniques
Manuel de sensibilisation
la restauration de la
MAONNERIE
1 La maonnerie
Ce manuel a t labor par Patrice de Brandois( ) et Florence Babics,
Architectes du Patrimoine. Il s'inspire du guide de matrise douvrage
et de matrise duvre des ouvrages de maonnerie. Les auteurs remercient Philippe Bromblet
du laboratoire de recherches des monuments historiques
Jeannie Meyer du centre de recherche des monuments historiques pour leur participation.
Nous remercions galement le groupement franais des entreprises de restauration des monuments historiques (GMH),
la confdration de l'artisanat et des petites entreprises du btiment (CAPEB), lcole dAvignon, le laboratoire de recherche
des monuments historiques (LRMH), et le centre de recherche des monuments historiques (CRMH) pour les photographies
qu'ils ont bien voulu nous communiquer.
Juin 2006
Manuel de sensibilisation la restauration de
LA MAONNERIE
Ministre de la culture et de la communication
Direction de l'Architecture et du Patrimoine
Sous-direction des monuments historiques et des espaces protgs
Mission Ingnierie et Rfrences Techniques
3 La maonnerie
Le Manuel de sensibilisation la restauration de la maonnerie est destin attirer
lattention des intervenants sur les monuments historiques concernant les prcau-
tions prendre lors des restaurations les plus courantes.
Il comporte un historique sommaire des techniques de construction, la composi-
tion des matriaux et les cueils viter lors de leur mise en uvre. Il ne traite pas
de la rglementation en vigueur, notamment vis vis des dispositifs de scurit
mettre en place sur les chantiers. Il ne constitue pas non plus un relev exhaustif
des normes en vigueur en matire de construction. A cette occasion, il convient
de noter que nombre de normes ne sont pas adaptes aux problmes spcifiques
du bti existant et quune dmarche mthodologique normalise serait plus adap-
te ces cas, tous particuliers.
Ce document sadresse aux matres douvrage concerns par les travaux sur les
difices protgs, voire sur le patrimoine en gnral. En effet, lattention nces-
saire aux modifications susceptibles daltrer les qualits esthtiques ou structu-
relles des monuments historiques est applicable tout lment bti intressant.
Ajoutons que cet aperu des diffrentes techniques de maonnerie a sembl par-
ticulirement opportun dans le cadre de la dcentralisation.
Il a t dvelopp partir du Guide de matrise douvrage et de matrise duvre
sur la maonnerie, ralis grce lexprience de lensemble de nos partenaires
sur les difices protgs : historiens, architectes, entrepreneurs, que nous remer-
cions pour leur contribution sans laquelle ce travail naurait pu tre ralis.
Souhaitons que cet ouvrage puisse faire comprendre lintrt de connatre la
conception dorigine et les apports successifs de lvolution du btiment ancien et
la ncessit de leur prise en compte pour une intgration adquate de linterven-
tion programme.
AVANT-PROPOS
4 La maonnerie
Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ICHAPITRE 1 OUVRAGES DE TERRASSEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DISPOSITIONS RELATIVES L'HYGINE ET LA SCURIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DISPOSITIONS PARTICULIRES RELATIVES AUX FOUILLES ARCHOLOGIQUES . . . . . . . . . 6
I CHAPITRE 2 ASSCHEMENT DES MAONNERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRAMBULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LES DIVERSES SOURCES D'HUMIDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LES DIFFRENTES TECHNIQUES D'ASSCHEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1 - Cas de l'humidit ascensionnelle en provenance du sol . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 - Cas de l'humidit provoque par les infiltrations d'eau de pluie . . . . . . . . 13
3 - Cas des condensations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4 - Cas de lhumidit accidentelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
LE TRAITEMENT DES ALGUES ET MOUSSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ICHAPITRE 3 TYPES DE MAONNERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
LES MAONNERIES DE MOELLONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1 - Montage des murs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2 - Rejointement des maonneries anciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 - Confortations internes de maonneries par injection de coulis . . . . . . . . . . 21
LES MAONNERIES DE BRIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1 - Historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2 - Diffrentes caractristiques rgionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3 - Systme constructif "briques et pierres" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4 - Techniques de faonnage et cuisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5 - Principaux constituants de la brique et caractristiques chimiques . . . . . . 31
6 - Mortiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7 - Joints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8 - Ragrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PATHOLOGIES DES MAONNERIES EN BRIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1 - Mortiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2 - Brique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
DIAGNOSTIC ET RESTAURATION DES MAONNERIES DE BRIQUE . . . . . . . . . . . . . . 35
1 - Injection de coulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2 Traitements de surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3 - Rejointoiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4 - Hydrofugation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5 - Sablage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6 - Nettoyage par micro-sablage et hydrogommage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7 - Comblement de zones manquantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8 - Remplacement de brique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
LES COLOMBAGES OU PANS DE BOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1 - Elments constitutifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2 - Capacit portante et dimensionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3 - Diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4 - Restauration des pans de bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SOMMAIRE
page
5 La maonnerie
LA CONSTRUCTION EN TERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1 - Dfinition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2 - Mise en uvre du coffrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3 - Construction des murs en piss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4 - Construction des murs en msse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ICHAPITRE 4 LES MORTIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
LES SABLES ET GRANULATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
LES LIANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1 - Chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2 - Pltres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3 - Ciments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4 - Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5 - Produits d'ajout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6 - Adjuvants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7 - Matriaux non normaliss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
I CHAPITRE 5 LES ENDUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
COMPOSITION ET MISE EN UVRE DES ENDUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1 - Excution de la premire couche denduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ou gobetis ou couche daccrochage
2 - Excution de la deuxime ou corps denduit ou dgrossi . . . . . . . . . . . . . . 66
3 - Couche de finition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
LES DIFFERENTS TYPES DENDUITS ET DE FINITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
EXECUTION DES ENDUITS A DEUX COUCHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ENDUITS AU MORTIER DE PLATRE ET PLATRE-ET-CHAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1 - Composition du mortier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2 - Mise en uvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3 - Protection des enduits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
CONTROLE DE LA QUALITE DES ENDUITS EXECUTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
LES ENDUITS INTERIEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
REFECTION ET RESTAURATION DES ENDUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1 - Analyses pralables et prparation des supports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2 - Reconnaissance de ltat existant du support et de lenduit . . . . . . . . . . . . 77
3 - Rfection totale dun enduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4 - Rfection partielle dun enduit lacunaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5 - Consolidation dun enduit ancien altr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6 - Donnes connatre sur les produits utiliss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7 - Vrification de la consolidation de lenduit ancien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
LES BADIGEONS ET LAITS DE CHAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1 - Matriaux constitutifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2 - Supports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3 - Techniques de mise en uvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Par ouvrage de terrassement, on entend l'ensemble des travaux destins
modifier, de faon provisoire ou dfinitive, la forme d'un terrain dans le but d'y
installer une construction ou tout autre ouvrage. Le dblai ou remblai de ter-
res, le creusement de trous ou tranches, et mme le dcapage de terrains sont
des terrassements.
Pralablement la ralisation d'un ouvrage de terrassement, il convient de
prendre un certain nombre de dispositions et d'obtenir toutes les autorisations
ncessaires.
I DISPOSITIONS RELATIVES
L'HYGINE ET LA SCURIT
Le Dcret du 8 Janvier 1965, relatif aux mesures gnrales d'hygine et de
logement provisoire des travailleurs respecter sur les installations de chan-
tier doit tre respect.
Lemprise du chantier doit tre dlimite au moyen de cltures, palissades et
autres lments agrs, et les zones excaves doivent tre balises par des
garde-corps.
Pendant la dure des travaux, des dispositifs assurant la stabilit des coupes
de terrain et protgeant les lments architecturaux doivent tre installs.
Ne pas entreprendre de travaux sans avoir acquis une bonne connaissance du
terrain (nature et rsistance du sous-sol, plan de rcolement des rseaux, etc...).
I DISPOSITIONS PARTICULIRES RELATIVES
AUX FOUILLES ARCHOLOGIQUES
Les fouilles archologiques ne peuvent tre entreprises qu'aprs avis accord par
l'Etat, et s'exercent dans le cadre des Lois du 27 septembre 1941 et du 17 jan-
vier 2001.
Il existe principalement deux modes de ralisation de fouilles archologiques :
1- les oprations d'archologie prventive, qui sont prescrites pralablement
l'amnagement de sites lorsque des travaux, publics ou privs sont susceptibles
d'affecter le patrimoine archologique.
2- les oprations d'archologie programme, qui sont motives par des
objectifs de recherche scientifique indpendants de toute menace pesant
sur un gisement archologique.
Lorsque des travaux concernent le sous-sol d'un monument susceptible de
comporter un intrt archologique (une glise, par exemple), ou de ses
abords, il faut en aviser pralablement le Service Rgional de lArchologie et
lui fournir un dossier du projet, avec descriptif et plans des travaux envisags.
Cas de dcouverte fortuite
Les dcouvertes dites "fortuites" demeurent rgies par la loi du 27 septembre
1941 : elle oblige tout dcouvreur en faire la dclaration auprs du maire de la
commune. Celui-ci doit alors prvenir le Prfet, qui saisit le Service Rgional de
l'Archologie. En cas de dcouverte de vestiges archologiques mobiliers ou
immobiliers pendant des travaux, le Service Rgional de lArchologie examinera
avec le Matre de l'ouvrage, dans les plus brefs dlais, les mesures prendre pour
permettre ltude ou la conservation des vestiges en respectant au mieux la pour-
suite des travaux.
L'administration dispose cet effet d'un droit de visite sur les proprits prives.
6 La maonnerie
Chapitre 1
OUVRAGES DE TERRASSEMENT
7 La maonnerie
I PRAMBULE
Rappelons que l'humidit dans les matriaux est l'une des principales causes
de dgradation d'un btiment : gonflements et pourrissement des bois, cris-
tallisation saline, gonflement des pltres, oxydation des mtaux, dveloppe-
ment d'organismes cryptogamiques* parasites tels que mousses et moisis-
sures, formations de salptre, etc qui sont autant de facteurs de destruc-
tion, plus ou moins rapides, des composants d'un difice.
Il convient donc de lutter contre ce phnomne par la mise en uvre de
techniques visant l'liminer et empcher son retour.
Nous tudierons ici le problme spcifique de l'humidit dans les maonneries
l'exception des maonneries immerges et les moyens d'y remdier.
I LES DIVERSES SOURCES D'HUMIDITE
On recense essentiellement quatre types d'humidit :
1- l'humidit ascensionnelle en provenance du sol
2- les infiltrations d'eau de pluie travers les murs
3- la condensation de l'humidit contenue dans l'air
4- l'humidit d'origine accidentelle (lie par exemple une rupture
de canalisation d'eau, une fuite de gouttire, etc.)
Une cinquime cause d'humidit est celle de l'eau de construction, mais il s'a-
git l d'un phnomne marginal dans la restauration des monuments anciens.
Il n'est pas rare que certaines sources d'humidit se combinent entre elles :
Il convient donc, avant toute prconisation d'un traitement d'asschement,
de procder un diagnostic prcis et complet qui permettra d'identifier la ou
les origines de l'humidit.
I LES DIFFERENTES TECHNIQUES D'ASSECHEMENT
Quel que soit le cas, il faut savoir tre patient quant aux rsultats attendus ;
le dlai d'asschement d'une maonnerie est en gnral trs long : de l'ord-
re de plusieurs mois.
1
CAS DE L'HUMIDITE ASCENSIONNELLE EN PROVENANCE DU SOL
Il s'agit de l'humidit contenue dans le sol et remontant par capillarit dans
les maonneries des murs et dans les dallages.
Cette humidit peut provenir :
soit deaux circulant en surface ou dans les couches superficielles du
sol, dorigines diverses mais localisables au niveau du diagnostic : eaux
de ruissellement, sources, canalisations enterres rompues, etc.
soit de la nappe phratique, lorsque celle-ci se trouve faible profondeur,
soit deaux baignant le pied des btiments telles que douves, cours deau,
lac ou autres tangs. Les remdes apporter sont alors les mmes que
ceux utiliss pour lutter contre les remontes dues la nappe phratique.
Chapitre 2
ASSCHEMENT DES MAONNERIES
8 La maonnerie
A
Lutter contre les infiltrations latrales dues aux eaux superficielles
La solution idale est de russir tarir la source dhumidit : dans ce cas,
le problme sera facilement rgl.
Citons titre dexemple, le captage dune source ou la rparation dune
canalisation.
a
interception des eaux superficielles
Si la source dhumidit ne peut tre tarie, il faudra mettre en uvre des pro-
cds permettant dintercepter les eaux superficielles avant quelles nattei-
gnent les fondations et les murs.
Ces procds sont tous bass sur le mme principe : le creusement dune
tranche dinterception des eaux.
Il pourra parfois sagir dune simple tranche ouverte permettant de dgager
la base de murs enterrs par des remblais inopportuns.
Mais, le plus souvent, la tranche devra tre dune profondeur telle quil
sera impossible de la laisser ouverte.
Il sera alors possible de la couvrir, en crant une galerie priphrique quil
faudra ventiler convenablement par des grilles judicieusement rparties.
Cest une solution efficace, qui a aussi lavantage dassainir au moins par-
tiellement par vaporation, les ventuelles remontes capillaires. Mais cest
une solution onreuse, et les grilles daration peuvent parfois tre gnantes
sur le plan esthtique.
b
ralisation d'un drainage
La mthode la plus classique consiste raliser un drainage au pied de la
maonnerie ou faible distance.
On commence par terrasser le long du mur assainir, au maximum jusqu'au
niveau des fondations. La partie du mur alors dgage, est rejointoye, si
ncessaire, avec un mortier de chaux hydraulique naturelle. Le cas chant,
une semelle de bton est coule en fond de fouille au niveau des fondations,
un drain tuyau perfor, en PVC, ou en poterie est pos, sur toute la lon-
gueur du mur, avec un regard chaque changement de direction.
Coupe sur drainage
Puis, la fouille est comble de cailloux, de gravillons et de sable propre, aprs
qu'elle ait t pralablement tapisse d'un gotextile empchant la terre
d'infiltrer et de colmater l'ensemble du drainage.
En finition superficielle, on remettra, suivant les cas, de la terre vgtale, un
gravillonnage ou un revers pav non jointoy.
Toute application sur la surface des murs, avant comblement, d'un enduit
microporeux base de rsine, impermable leau mais permable la
vapeur deau doit tre tudie soigneusement, car elle n'est pas sans risque.
CONSEILS DE PRUDENCE
- ne pas mettre en uvre une finition de surface en pavage
rejointoy car l'eau de pluie rejaillirait sur les parements,
- ne jamais poser le drain au-dessous du niveau des fondations, car
il risquerait d'asscher le sol de fondations, d'en changer la consis-
tance, et de provoquer ainsi des dsordres,
- assurer un exutoire au drainage, situ en contrebas de celui-ci. Il
est possible davoir recours des pompes de relevage, mais il sa-
git l dune solution viter, car dune surveillance et dun entre-
tien par trop contraignants,
- viter les prescriptions du DTU 20.11 concernant lexcution dun
enduit tanche sur la paroi enterre dune construction neuve. Il
est en effet indispensable quune maonnerie ancienne puisse
respirer, aussi bien pour permettre lvacuation de leau emma-
gasine avec le temps, que lvaporation dune ventuelle remon-
te dhumidit.
Dans le cas d'un mur avec contrefort, on ralisera le drainage au ras des
contreforts, de faon viter la multiplication des regards quil convient
dinstaller chaque changement de direction.
Variantes
Certaines variantes apportes la technique traditionnelle du drainage
consistent intercaler, entre le mur et la terre dans laquelle il se trouve enter-
r, un bardage de plaques ondules, des plaques de bton, ou des blocs
drainants en bton poreux.
Une autre variante consiste intercaler des nappes filtrantes constitues de
deux matriaux accols : un non tiss du cot des terres, une bourre de fib-
res synthtiques, denviron 1 cm dpaisseur le long des murs.
On peut toutefois se poser la question du bien-fond de cette dernire solu-
tion, qui consiste appliquer contre un mur assainir, un matriau humide.
En tout tat de cause, ces variantes ont toutes pour inconvnient, la nces-
sit de crer un becquet de protection en tte, qui peut tre difficile rali-
ser sans nuire lesthtique du btiment.
La solution consiste alors enterrer le becquet ou la faire affleurer au
niveau du terrain.
B
Lutter contre les remontes capillaires des eaux de la nappe phratique
ou deau baignant le pied des btiments
L encore, diverses mthodes peuvent tre employes : nous nous attache-
rons aux procds visant mettre en uvre une barrire tanche la base
des murs, et ceux permettant dvacuer leau contenue dans les murs.
9 La maonnerie
10 La maonnerie
a
mise en place d'une barrire tanche la base des murs
Un premier procd consiste raliser des saignes dans le mur, sur toute
son paisseur, et y insrer un matriau tanche, en chape ou en feuilles.
Cette insertion se fait par longueurs alternes successives de l'ordre de 80
cm, avec dans le cas d'utilisation de matriaux en feuille, un recouvrement
d'une dizaine de cm coll ou soud. La longueur de saigne est raccourcie
dans les zones ou il existe des concentrations de charges.
Ces saignes peuvent tre ralises soit par dmontages d'une ou deux assi-
ses du mur, soit par sciage, la scie circulaire, la chane, ou la scie main.
Comme matriau d'insertion, ou pourra utiliser :
une chape tanche de mortier de ciment laitier avec hydrofuge ou de
mortier de rsine ou dasphalte coul, etc.
un matriau en feuille : plomb de 2,5 mm d'paisseur minimum, poly-
thylne, feutre bitum, etc.
Les matriaux en feuille seront poss sec, sur une chape de ciment lisse,
aprs schage de celle-ci et interposition, dans le cas d une feuille de plomb
(sous rserve que son utilisation reste autorise), dun matriau isolant ; en
effet, le plomb, sous peine de dsintgration dans le temps, ne doit jamais
tre mis en contact direct avec un mortier de chaux ou de ciment.
Inconvnients de cette mthode
son caractre destructif
les risques de tassement du matriau insr
les difficults de mise en uvre dans des murs pais
son cot lev
Ce procd a t utilis pour prot-
ger les sculptures du portail de l'-
glise de Moissac (Tarn et Garonne).
Les pierres prsentaient dimpor-
tantes altrations chimiques pro-
voques par les sels vhiculs par
les remontes capillaires des eaux
de la nappe phratique, et se
dsagrgeaient peu peu.
La mise en uvre d'une barrire
en feuille de plomb permis
d'enrayer ce phnomne.
Interposition dune feuille de plomb
11 La maonnerie
b
injection de produit impermabilisant
Une autre solution consiste injecter, par gravit ou sous faible pression, des
produits impermabilisants la base des murs, tels que gels acrylamides,
rsines poxydes, silicones, mthylsiliconates, starates daluminium, etc
Ces produits se diffusent dans les maonneries par capillarit, et polymri-
sent en six mois environ, formant un cran impermable l'eau.
Mise en uvre :
Percement de trous de diamtre de 2,5 cm, l'espacement d'environ
15 cm, de part et d'autre du mur, de profondeur variant en fonction
de l'paisseur de ce dernier.
Injection du produit, soit par gravit l'aide de tubes mtalliques per-
fors et couds, relis un rservoir contenant le produit injecter, soit
sous pression, chaque trou tant reli par une canalisation une
pompe permettant dinjecter le produit.
Dans les maonneries de pierre, il faut injecter de prfrence dans les
joints.
Ce procd donne de bons rsultats dans les maonneries de briques.
Le rsultat escompt ne pourra tre obtenu que si ont bien t prises en compte :
les caractristiques de capillarit des matriaux injecter,
ladquation ces caractristiques du produit injecter (composition
chimique, viscosit, vitesse de polymrisation, etc)
ladquation de la technique de mise en uvre : emplacement, dia-
mtre, profondeur et espacement des trous, quantit de produit
injecter, dure dinjection, pression ventuelle.
La capacit du support recevoir ce traitement.
Cela suppose que lon ne sadresse qu des entreprises hautement qualifies.
CONSEILS DE PRUDENCE
Avant toute mise en uvre, procder un essai sur une partie de
mur traiter, et attendre quelques mois pour juger du rsultat.
Ne pas oublier de bien limiter la zone traiter par deux lignes ver-
ticales dinjection, pour viter la contamination latrale dhumidit.
C
vacuation de l'eau contenue dans les murs
a
l'lectro-osmose
Il s'agit d'une mthode base sur l'utilisation des tensions lectriques
pour faire migrer l'eau en sens inverse de la remonte capillaire. Cest
au 19me sicle que lon dcouvrit quen soumettant une tension
lectrique un corps poreux satur deau, il tait possible de faire se
dplacer le liquide de lanode (pole +) vers la cathode (pole -).
En 1940 , P. ERNST fit breveter un dispositif dasschement des murs bas
sur ce phnomne dlectro-osmose : une diffrence de potentiel est
cre entre le mur humide et le sol, le mur tant le ple + et le sol,
le ple .
Pour ce faire, on cre une pile lectrique en utilisant des mtaux diffrents
- ou plus rcemment des fibres de carbone - disposs de la faon suivan-
te : dans le sol, des blocs de magnsium relis par un fil de cuivre formant
cathode et, dans le mur humide, des fils de cuivre, espacs de 30 50 cm,
relis eux aussi par un fil de cuivre, formant anode. La diffrence de
12 La maonnerie
potentiel cre est de l'ordre de 1 volt et serait suffisante pour faire che-
miner l'eau vers la base du mur.
Il convient toutefois de noter que son utilisation est impossible si la rsistan-
ce lectrique de sol est trop leve, ainsi que sil existe dans le sol des cou-
rants vagabonds, risquant dinverser le sens de passage du courant mur-sol.
L'inconvnient majeur de cette mthode est qu'elle ncessite l'excution
d'une engravure importante et de nombreux percements, ce qui rend diffici-
le son utilisation dans une maonnerie de pierres apparentes.
Cette mthode dite lectro-osmose "passive" - a t amliore en inter-
posant une batterie, produisant un courant continu de lordre de 2 volts
environ, entre la prise de terre et les conducteurs engravs dans le mur. Cest
la mthode dite "active".
Ces divers procds dlectro-osmose ont connu des fortunes diverses : des
checs, comme au muse du Jeu de Paume Paris, mais aussi des russites,
comme au chteau de LAXENBURG, en Autriche.
En l'tat actuel des connaissances, ce n'est donc pas un systme tota-
lement fiable.
Une variante de la "mthode active" a t mise au point, dans laquelle le sol
nest pas sollicit. Ce procd consiste forer, sur une ligne horizontale, une
suite dlectrodes dans le mur assainir, en alternant cathodes et anodes,
soit de part et dautre de la maonnerie, soit sur la mme face.
Ces lectrodes sont alternes en courant continu, les anodes tant des bar-
res en acier doux, en cuivre ou en aluminium, et les cathodes, des tuyaux
perfors de matriaux identiques leau migrant des anodes vers les catho-
des est recueillie et vacue par celles-ci.
Il faut nutiliser que des courants de faible intensit de 0,1 1,00 A/m
3
.
Des intensits suprieures pourraient provoquer un chauffage des maonne-
ries, et par voie de consquence, lapparition defflorescences.
b
llectro-osmose phorse
Les divers procds dlectro-osmose prsentent tous linconvnient majeur
de ncessiter un entretien et une surveillance constante : ds que, pour une
raison accidentelle ou autre, le courant sinterrompt, lhumidit rapparat.
On a donc imagin un procd qui complte les effets de l'lectro-osmose
par ceux du phnomne dlectro-phorse, cest dire, du mouvement de
particules en suspension dans un liquide qui, sous laction dun champ lec-
trique, se dplacent du pole + vers le pole -.
On comprend aisment que si, dans un systme dlectro-osmose classique
avec terre en ple et mur humide en ple +, lon injecte dans les trous o
se trouvent les lectrodes du mur , un produit de phorse contenant des par-
ticules mtalliques en suspension, celles-ci vont migrer, avec leau de lhumi-
dit du mur, vers la terre (ple -), et dans ce mouvement, colmater les capillai-
res des maonneries.
On aura ainsi, aprs une dure d'un an et demi deux ans si toutefois, l-
lectro-osmose fonctionne normalement cr la base du mur, une barrire
tanche, et le systme dlectro-osmose pourra tre dpos.
Il semble que cette technique ait donn de bons rsultats en Autriche, en
Allemagne et en Suisse. En France galement, mais elle nest pas utilise depuis suf-
fisamment longtemps pour que lon puisse juger avec sret de lefficacit relle
du systme.
13 La maonnerie
c
lasschement lectronique des murs
Son principe consiste, laide dun appareil compos de circuits lectro-
niques passifs inverser les champs lectromagntiques existants dans un
btiment soumis des remontes capillaires dhumidit, et par-l, inverser
le sens de celles-ci, comme dans llectro-osmose.
Cet appareil fonctionne sans quil soit ncessaire de le relier aux maonne-
ries , et donc sans agression sur ces dernires.
Il sagit l dun systme rcent qui na pas encore fait lobjet de suffisamment
dapplications pour que lon puisse juger de son efficacit.
Seul lavenir dira sil sagit l dune solution "miracle"
d
les siphons atmosphriques
Cette mthode, trs en vogue jusque dans les annes '70, a montr
son inefficacit depuis, voire sa nocivit (perforations multiples des
parois), et a t abandonne.
Elle consistait sceller la base des murs traiter et par assises horizonta-
les, des siphons en poterie, appels "siphons atmosphriques" dont le fonc-
tionnement thorique tait le suivant :
Ces siphons "pompaient" lhumidit du mur, l'air l'intrieur du siphon se
chargeait dhumidit par l'vaporation des parois, et devenu plus lourd, s'-
coulait l'extrieur en faisant place une nouvelle quantit d'air sec, et ainsi
de suite jusqu complet puisement de l'humidit.
Aprs essais contrls sur des murs exprimentaux, ce procd s'est rvl
inefficace et les siphons atmosphriques mis en place Versailles ou au
Louvre dans les annes '30 ont t dposs.
2
CAS DE L'HUMIDITE PROVOQUEE PAR LES INFILTRATIONS
D'EAU DE PLUIE
La pluie frappe contre les parois des murs et pntre dans ceux-ci, les murs
exposs aux vents dominants tant les plus vulnrables.
Cette action est aggrave en bord de mer, car la pluie charge d'embruns
dpose du sel sur les maonneries ; celles-ci deviennent alors hydrophiles et
retiennent l'eau : les murs sont alors constamment humides.
Un diagnostic prcis des parois traiter s'impose afin de dterminer l'origi-
ne exacte de la fuite, son tendue, et la raison pour laquelle l'tanchit du
mur n'est pas assure.
Selon le rsultat du diagnostic, les techniques utiliser seront diffrentes,
adaptes chaque cas.
On peut citer :
la reprise d'un jointoiement dgrad,
la rfection d'un enduit n'assurant plus son rle protecteur
un remaillage ou des injections (mortiers, rsines) pour colmater
d'ventuelles fissures
l'amlioration de limpermabilit de surface par l'application d'un
repousseur d'eau ou "hydrofuge".
14 La maonnerie
LES HYDROFUGES
Les produits hydrofuges sont des silicones, des rsines fluores ou des com-
plexes organo-mtalliques de mtaux trivalents qui modifient la force qui
s'oppose au mouillage.
Ces produits se prsentent soit sous forme solvante, soit en mulsion dans
leau. Appliqus sur une surface, ils la rendent hydrophobes*. De ce fait,
l'eau roule sur la paroi ainsi traite sans pntrer l'intrieur de la pierre
(effet perlant).
Un bon produit doit empcher l'eau de pntrer, mais imprativement per-
mettre l'vaporation de la vapeur d'eau contenue l'intrieur du mur et pro-
venant soit des condensations, soit des remontes capillaires. Sinon, cette
eau emprisonne va dgrader la maonnerie de l'intrieur. Les premiers
hydrofuges, filmognes*, sont aujourd'hui proscrits.
Il conviendra, avant tout traitement, de vrifier l'tanchit des gouttires,
chneaux, descentes d'eaux pluviales et autres canalisations d'eau.
L'application se fait habituellement comme suit :
prparation des fonds et le cas chant, schage ;
application d'une premire couche la brosse ou au pulvristateur suivant
les produits, en utilisant le produit dilu selon les indications de la Fiche
technique et le pourcentage de matire active dans le produit.
Mur humide dgrad
CONSEIL DE PRUDENCE
Ces produits tant relativement rcents sur le march, il convient
d'tre extrmement prudent lors de leur prconisation, en raison
du manque de recul sur leurs effets long terme.
Des essais devront toujours tre raliss pralablement, sur une
zone peu visible du btiment, afin d'observer notamment les
modifications ventuelles de coloration du support (dans le cas de
la pierre, par exemple). Mais il faut garder l'esprit que ces essais
ne sont pas rversibles.
Les restrictions et les prconisations d'application du fabricant
seront scrupuleusement respectes.
3
CAS DES CONDENSATIONS
Deux phnomnes sont considrer selon qu'il s'agit des murs intrieurs ou
des murs extrieurs.
Murs intrieurs :
Lorsqu' un froid vif succde un temps tide et humide, la vapeur se dpo-
se sur les maonneries qui n'ont pas eu le temps de se rchauffer et n'ont
pas encore atteint la temprature ambiante.
En effet, une temprature et une pression dtermines, l'air ne peut
contenir l'tat de vapeur, qu'une certaine quantit d'eau, dfinie par son
poids par mtre cube d'air. Cette quantit d'eau diminue avec la
temprature.
Si l'air ambiant se trouve brusquement refroidi, l'eau excdentaire que l'air
ne peut plus retenir se condense en gouttelettes et se dpose sur les murs
les plus froids.
Murs extrieurs :
En t, les gaz humides de l'atmosphre se dposent la base des murs qui
est la partie la plus froide.
En hiver, la terre refroidit moins vite que les murs extrieurs : les gaz humi-
des remontant de la terre se dposent donc la base des murs, l aussi.
Pour lutter contre ces condensations, on peut envisager, suivant
les cas de :
mettre en place une ventilation mcanique contrle,
renforcer, par un doublage ventil, l'isolation thermique des parois.
(ce procd est le plus souvent impossible raliser dans un monument
ancien pour des raisons esthtiques videntes)
mettre en uvre un chauffage des locaux ou des murs.
4
CAS DE L'HUMIDIT ACCIDENTELLE
Suite un accident ou un dfaut d'entretien, des ouvrages en toiture (ch-
neaux, gouttires ou descentes), ou des canalisations (colonnes montantes,
rseau de distribution encastr, chutes d'eaux uses, etc) se mettent fuir,
parfois de faon insidieuse, non dtectable immdiatement. l'eau pntre
alors dans les maonneries et cre des dsordres.
Un diagnostic prcis des parois traiter s'impose afin de dterminer avec cer-
titude la cause et l'origine exacte de la fuite, ainsi que l' tendue des dgts.
Aprs avoir remdi aux causes, la purge des ventuels lments pourris et
une bonne ventilation des zones touches par la fuite viendra gnralement
bout de l'humidit.
15 La maonnerie
16 La maonnerie
I LE TRAITEMENT DES ALGUES ET DES MOUSSES
Dans certains cas, l'humidit, d'origines diverses, provoque la prolifration
de mousses et d'algues sur les murs, du plus dplorable effet.
Pour lutter contre ces phnomnes, on peut employer les mthodes suivantes :
Une mthode ancienne consiste traiter le mur avec de l'eau zingue.
Malheureusement le taux de concentration du zinc tant trs faible, l'effica-
cit du traitement est de courte dure.
On obtient des rsultats plus tendus en employant le naphtnate de zinc, ou
d'autres produits tels qu'algicides ou fongicides, une solution aqueuse dilue
de sels d'ammonium quaternaire.
Il convient d'arroser les murs traiter, de prfrence au dbut du printemps,
avec une solution aqueuse d'ammonium quaternaire, produit qui prsente
l'avantage de ne pas contenir de composants corrosifs (phnol, iode, chlore,
ou mercure).
Ce traitement arrtant, mais ne supprimant pas, la vgtation existante, il est
possible de faire une application pralable de boue (paisseur minimum 0,4
cm) forme d'Attapulgite contenant des concentrations de l'ordre de 0,5 %
de Hyamine 1622 et de brosser lgrement aprs schage.
Aprs traitement
Avant traitement
Traitement chimique de pierres colonises
par des mousses et des algues
17 La maonnerie
I LES MAONNERIES DE MOELLONS
Dans nos pays, en dehors des constructions en bois, la pierre a t, jusqu'
l'apparition des matriaux actuels tels que le bton ou l'acier, le matriau de
construction par excellence.
Les diverses caractristiques des pierres, leur extraction, l'volution de leur
mise en uvre aux diffrentes poques, ainsi que les maladies qui peuvent
les atteindre, seront tudies dans un autre ouvrage de la mme collection,
traitant essentiellement de la restauration des difices en pierre de taille.
Dans le cadre du prsent volume, nous nous attacherons uniquement aux
maonneries de moellons, c'est dire, aux maonneries composes de blocs
de pierre, bruts ou quarris, suffisamment petits pour tre manipuls par un
homme sans l'assistance d'un appareil de levage, et assembls l'aide d'un
mortier.
Chapitre 3
TYPES DE MAONNERIES
Moellons assiss - Bourgogne
Caractristiques
Le choix des pierres est important, et seffectue en fonction du type douvrage
raliser. Il est indispensable de connatre la provenance des moellons (carri-
res dextraction), les caractristiques gomtriques auxquelles ils doivent satis-
faire, ainsi que leur forme, leur couleur et leur texture.
Les caractristiques des moellons mis en uvre doivent pouvoir tre contrles
en rfrence deux chantillons limites prsents au dbut du chantier.
Les moellons doivent tre exempts des dfauts suivants
fils ou poils (matire terreuse en veines minces)
moyes (matire terreuse remplissant des cavits)
artes, pouffes (la pierre s'grne l'humidit ou sous le choc de l'outil)
bousin (partie tendre interpose entre les lits de carrire)
cendrures ou terrasses (fente ou cavit remplie d'une matire trangre
pulvrulente)
clous (rognons trs durs qui rendent la taille trs difficile)
fissures, pouvant tre trs fines, d'origine naturelle ou artificielle (usage
de la poudre ou d'outils pneumatiques ou mcaniques suivant la nature
de la pierre).
Toutefois, certains de ces dfauts peuvent tre admis, s'ils sont connus ou exis-
tants dans le moellon d'origine et n'altrent pas les caractristiques prvues.
Les particularits, telles que veinages, coquilles, godes, crapauds, trous,
nuds, strates, verriers, oxydes et pyrites de fer, peuvent tre aussi considres
comme acceptables si elles restent un degr de simple diffrence de nuance.
Emploi des pierrres calcaires par temps froid
Dans de nombreuses rgions, les clatements de la pierre dus au gel consti-
tuent les dgradations les plus importantes sur les btiments : elles rsultent
de l'expansion volumique de la glace.
En priode de risque de gel, pour diminuer les risques de dtrioration par le
gel en priode de froid, (d'octobre mars inclus), les pierres calcaires livres
sur chantier doivent avoir une teneur en eau infrieure, ou au plus gale,
75% de la teneur en eau critique dfinie par la norme NF.B.10.512.
Ces prcautions ne concernent que les pierres calcaires.
Moellon Tte de chat- Dordogne
18 La maonnerie
19 La maonnerie
1
MONTAGE DES MURS
Les murs en moellons sont les plus courants ; ils sont souvent en calcaire, facile
tailler, mais peuvent tre raliss avec toutes sortes de pierres.
La qualit de la maonnerie dpend beaucoup de la pose et de la qualit du liant.
A
POSE DES MOELLONS A BAIN SOUFFLANT DE MORTIER
Les moellons sont poss sur un lit de mortier, bien serrs, de faon ce que
le mortier reflue en surface.
Il faut veiller ce que les moellons soient convenablement humidifis avant
lemploi, mais non ruisselants.
Ils doivent tre bien enrobs afin quil ny ait aucun contact direct entre eux ;
les petits intervalles sont remplis de mortier et les plus importants sont garnis
de cales de mme nature que les moellons, de manire obtenir une maon-
nerie bien pleine.
Les moellons dits "de longue queue" alternent avec ceux de queue plus
courte de faon assurer une bonne liaison avec le reste de la maonnerie.
Si les moellons sont destins tre enduits, la maonnerie est monte par
assises sensiblement horizontales mais non rgles, sans souci dune rectitu-
de parfaite des lits.
Les joints verticaux sont dcals, autant que possible, et ne se prolongent
jamais au-del de deux hauteurs de moellons.
Lpaisseur des lits de mortier et des joints dpend des techniques rgionales.
Lorsquil est prvu un jointoiement aprs coup, les joints sont dgarnis sur
une profondeur de 3 6 cm, humidifis, puis garnis au moyen dun mor-
tier adquat.
Selon sa forme, sa taille ou son utilisation, le moellon est dit :
assis ou d'appareil : parfaitement quarri comme la pierre de taille
en paralllpipdes de 0,01 0,06 m3 aux cotes prcises,
de banc-franc, s'il s'agit d'un calcaire tendre qui ne convient gure
que pour des murets et murs de clture,
bloqu, bourru, brut ou gisant : sans forme prcise, il est utilis sur-
tout comme blocage dans l'paisseur des murs et dans les massifs de
fondations,
cliv : s'il rsulte du tranchage par clivage de pains de pierre scis (on
utilise une cliveuse, appareils de coupe guillotine,
en coupe : plac sur chant dans la construction d'une vote, par oppo-
sition au moellon plat qui est pos sur son lit,
dmaigri : si sa face arrire est moins large que sa face de parement,
bauch, bousin ou pin : grossirement taill, mais comportant
au moins une face de parement rectangulaire,
clat, s'il rsulte d'une taille grossire au pic, au marteau pneuma-
tique ou la masse,
quarri : peu prs taill en paralllpipde rectangle,
lit : si ses faces de lit sont grossirement tailles,
piqu, smill (ou esmill) ou ttu : selon qu'il est taill la pointe
(calcaire dur), la smille ou au ttu.
20 La maonnerie
B
POSE DES MOELLONS SUR CALES OU BAGUETTES
La pose est effectue sur baguettes ou cales en bois blanc, humidifies,
rgles l'paisseur du joint ; les cales ou baguettes en chne sont exclues,
le tanin du chne pouvant provoquer des taches et des coulures.
La couche de mortier tale est plus paisse que les baguettes et les cales,
de faon bien enrober le moellon.
Le moellon est pos sur le mortier et assujetti jusqu' ce qu'il repose sur les
baguettes ou les cales, qui sont retires, au minimum, 24 heures aprs.
Si un jointoiement est prvu aprs coup, on procde comme pour les moel-
lons poss " bain soufflant".
Surface de rfrence ou surface tmoin
Si les moellons doivent rester apparents, on aura pris soin au pralable, de
slectionner une "surface de rfrence" d'appareillage et de parement exis-
tants.
Sil n'existe aucune surface laquelle se rfrer, il faudra prvoir l'excution
d'une "surface tmoin", afin de pouvoir juger de l'aspect obtenu.
Le mur ne sera mont qu'aprs acceptation de cette "surface tmoin".
2
REJOINTOIEMENT DES MAONNERIES ANCIENNES
Les joints des anciennes maonneries en moellons doivent tre dbarrasss
de toute trace de pollution (peinture ventuelle, pltre, salissure, vgtaux,
etc.) et tre dgarnis sur une profondeur de 3 6 cm.
Toutes les parties descelles, fissures et friables doivent tre limines.
Une fois dgarnis, les joints sont nettoys soit la brosse, soit lair compri-
m, une pression adapte la friabilit des moellons et des mortiers, puis
humidifis.
Maonnerie mixte de granit
et roches mtamorphiques
21 La maonnerie
Le jointoiement nest effectu quaprs prsentation et acceptation par l'ar-
chitecte dune surface tmoin.
3
CONFORTATIONS INTERNES DE MAONNERIE PAR INJECTION DE COULIS
La technique d'injection de coulis consiste faire pntrer au cur des
maonneries un mortier, plus ou moins liquide, en confortement ou en rem-
placement du mortier de pose initial dfectueux ou manquant. Ce procd
convient aussi bien aux maonneries en lvation qu'aux fondations, pour
un emploi localis ou gnralis.
Objectif et intrt
Le pourcentage de vides au cur d'une maonnerie ancienne est parfois
important : il peut dater de l'origine de la construction ou avoir t aggrav au
fil du temps et des intempries, en particulier dans les ouvrages trs exposs.
Un apport de mortier par coulis d'injection permet de redonner une cohsion
nouvelle aux maonneries anciennes, et de leur restituer leurs proprits
mcaniques initiales, sans procder leur dmontage. Elles peuvent ainsi
conserver leur dformation et toute leur authenticit; ce titre, l'injection de
coulis peut tre considre comme un des outils de la restauration moderne,
respectant les principes de la Charte de Venise.
Rejointement d'un mur
volution de la technique d'injection
Vers 1840, lorsque dbutent les premiers grands chantiers de res-
tauration de monuments historiques, le seul procd connu pour
consolider des maonneries fortement altres est la dpose/recons-
truction, avec les risques de modification dlibre que cela sous-
entend.
A la fin du XIX
me
sicle, avec l'avnement du ciment arm, la consoli-
dation sans dpose devient possible. Entre temps, l'exprience acquise
sur les chantiers et le dveloppement de l'archologie ont fait voluer
la connaissance et merger la notion d'authenticit.
22 La maonnerie
A
NATURE DES PRODUITS CONSTITUANT LES COULIS
Le choix des matriaux constitutifs du coulis est trs important : il est dfini
partir des tudes prliminaires. Le risque, en effet, est d'obtenir aprs injec-
tion, un mlange htrogne constitu de l'ancien mortier d'une part, et du
nouveau liant se prsentant sous forme de blocs compacts et de filaments.
Par ailleurs, la prise s'effectuant l'intrieur des maonneries, le temps de
schage est trs long : les liants ariens (chaux grasse, argile) doivent donc
tre additionns des liants hydrauliss, suivant des pourcentages fixs au
cas par cas.
Les liants utiliss pour la confection de coulis sont de 3 catgories
la chaux de construction,
le pltre,
sous certaines conditions, les ciments conformes la norme NF P 15-
301, ou les ciments spciaux (par exemple : ciments finement broys),
additionns de l'eau de gchage.
Peuvent galement s'ajouter :
des charges dont le rle peut tre d'expanser le coulis, de le rendre
thixotrope, ou de s'opposer sa dcantation,
des produits agissant sur les conditions de prise ou sur les performan-
ces finales (par exemple : addition des fumes de silice).
B
CARACTERISTIQUES DES COULIS
Les coulis doivent possder les qualits suivantes :
1- facilit d'injection : le coulis doit rester fluide pendant toute la dure
d'injection.
Les premires injections consistent gnralement introduire du
ciment dans les maonneries affaiblies pour crer des zones "dures"
devant se comporter comme des lments structurels enfouis dans la
maonnerie.
Au dbut du XX
me
sicle, les Allemands exprimentent la cathdra-
le de Strasbourg des injections de ciment liquide sous pression. Les
dgts occasionns par la 1
re
Guerre mondiale donnent un coup d'ac-
clrateur l'utilisation du ciment : on injecte jusqu' 20 tonnes de
ciment dans telle glise de Caen, et Reims, la pression d'injection est
si forte que les assises de pierre sont rejetes vers l'extrieur ! Il faut
attendre les annes '40 pour voir voluer la restauration vers des tech-
niques plus lgres.
C'est durant les vingt dernires annes que la technique d'injection
de coulis actuelle s'est affine :
Vers 1980, le lavage pralable l'eau des maonneries internes est
rserv aux cas particuliers, ainsi que l'injection sous forte pression.
Les deux dcennies suivantes progressent principalement dans la
composition des coulis et le choix des adjuvants, dans le but de s'ac-
corder au mieux aux diffrents types de mortiers rencontrs.
Les dconvenues observes sur les maonneries hourdes au pltre inci-
tent paralllement la mise au point de formules de coulis fluidifi
base de pltre.
Des progrs importants sont galement oprs dans les techniques de
sondage non destructif permettant de reprer les faiblesses internes des
maonneries.
23 La maonnerie
2- stabilit : le coulis doit effectuer le moins de retrait possible, tre
stable dans le temps et ne pas perdre ses caractristiques mcaniques sous
l'action d'agents extrieurs.
Mode et condition de pose
PRECAUTIONS A PRENDRE PREALABLEMENT A LINJECTION
Il faut vrifier :
l'tanchit des joints entre les matriaux constitutifs de la
maonnerie, ou procder la rfection des joints, en rservant
des trous de coulage et des vents,
l'tanchit et la bonne adhrence des enduits ventuels et, si
besoin, mettre en place un platelage de maintien pour conso-
lider les enduits fragiles conserver (pousse hydrostatique),
l'tanchit de la base du mur injecter pour viter que le
coulis ne s'infiltre et ne se perde dans le sol,
la protection des ouvrages craignant l'humidit, l'injection
provoquant un apport d'eau.
Pour les maonneries trs fragilises ou instables, il faut :
mettre en place des taiements avant le dbut des travaux
d'injection car l'apport d'eau dans la fourrure par le coulis
peut diminuer les liaisons internes, ce qui peut conduire la
ruine de l'ouvrage,
remailler les fissures.
C
ETUDE PREALABLE D'INJECTABILITE
Toute confortation par injection doit faire l'objet d'une tude pralable d'injec-
tabilit, adapte aux objectifs. Cette tude comporte trois volets principaux :
Identification de la maonnerie existante
Etude des coulis en laboratoire
Epreuve de convenance sur chantier
a
Identification de la maonnerie existante
Cette tude consiste identifier les caractristiques physico-chimiques des
matriaux composant la maonnerie dans toute son paisseur (pierres de
taille, moellons, briques, mais aussi les matriaux de remplissage, fourrure,
mortier de pose, etc...).
La connaissance de la nature des liants composant le mortier en place per-
met de dterminer la formulation du coulis de confortation, afin dviter une
incompatibilit entre matriaux. Ainsi, les maonneries anciennes prsentant
des restes de pltre interdisent linjection de coulis base de ciment.
Elle dtermine aussi les dimensions respectives des murs, des matriaux de
parements, des fourrures, des maonneries de fondation, etc... afin d'esti-
mer les volumes de vide injecter.
b
formulation du ou des coulis en laboratoire
A partir de l'tude de la maonnerie, les caractristiques du ou des coulis
sont dfinies : nature des liants, fluidit, maniabilit, retrait, etc.
L'tude en laboratoire permet de mettre au point le ou les coulis ayant les
caractristiques recherches et compatibles avec la maonnerie existante.
Il est notamment important dviter les risques de cration de points durs
l'intrieur des maonneries, prjudiciables la stabilit de l'difice et risquant
24 La maonnerie
de perturber les changes hygromtriques, avec des effets graves sur les
enduits intrieurs et les peintures murales notamment (condensation).
c
Epreuve de convenance sur chantier
Cet essai consiste raliser une preuve, bien dlimite, d'injection permettant
de tester sur le chantier la composition du coulis mis au point par le laboratoire.
Il permet d'affiner la composition du coulis, de prciser le maillage d'im-
plantation des injecteurs et la pression d'injection, d'observer les rsurgen-
ces de coulis par le sol ou par le parement, etc...
La pression d'injection doit en effet tre adapte l'tat de la maonnerie :
trop forte, elle peut dformer les parements, voire mme ruiner la maon-
nerie sous l'effet de la pousse hydrostatique; trop faible, elle ne permet pas
au coulis de s'infiltrer efficacement dans la maonnerie consolider.
Les zones exprimentales sont ensuite contrles (par carottage, par mesure
de vitesse de propagation du son, ou par auscultation au radar ou autre) pour
juger de l'efficacit de l'injection et au besoin revoir certains paramtres.
Si les rsultats sont favorables, on peut alors estimer plus prcisment la
quantit de coulis injecter et valuer son incidence sur la statique de ldifice.
d
injection du ou des coulis
Pour l'injection du coulis, des trous sont raliss dans les joints de maonne-
rie, espacement rgulier, et des vents sont mis en place. A titre indicatif,
l'espacement est gal, au maximum, l'paisseur de la maonnerie.
L'injection se fait de prfrence par gravit (injection gravitaire), ou sous
faible pression (0.2 ou 0.3 MPa).
L'opration d'injection est effectue par tronons sur une hauteur maximale
d'un mtre.
Pendant l'opration d'injection, il est ncessaire de mesurer la quantit de
produit inject par injecteur, la pression d'injection, le fonctionnement des
vents et d'examiner la zone injecte et l'ouvrage pour dceler toute fuite ou
dformation de la structure.
Des prlvements sont effectus la sortie des vents pour vrifier la quali-
t du coulis, en particulier la fluidit au cne de Marsh.
Le dlai entre deux coulages doit correspondre au temps ncessaire la prise
du coulis dtermin par l'chantillon tmoin.
e
contrle de l'injection
Des contrles sont systmatiquement prvus avant les travaux de finition. Ils
ont pour objectif de vrifier la cohsion du produit inject par rapport au
mortier en place, ladhsion du coulis la maonnerie, et la conformit des
proprits entre les matriaux injects et anciens.
Ils peuvent tre raliss par carottage (ventuellement complt par des
essais mcaniques raliss sur ces carottages), par examen endoscopique
depuis le forage, par mesure de la vitesse de propagation du son avec com-
paraison la valeur initiale, par auscultation au radar, ou par analyse chi-
mique du coulis.
Afin dobtenir des rsultats probants, il est ncessaire de coupler les examens
destructifs et non destructifs et de procder un contrle de linjection
plus long terme.
25 La maonnerie
I LES MACONNERIES DE BRIQUES
1
HISTORIQUE
La brique est le fruit d'une longue volution, qui prend sa source dans
l'Orient mditerranen ds le VIII
e
millnaire avant J.C., ce qui fait d'elle le
plus ancien des produits "industriels".
C'est sur le site de Jricho que l'on trouve, cette poque, des constructions
en boules d'argile sches, qui, ds le millnaire suivant, commencent tre
moules dans leur forme paralllpipdique.
A Abydos, en haute gypte, des parois en briques sont visibles dans une
tombe princire du IV
e
millnaire avant J.C., soit un millnaire avant les pre-
mires constructions en pierre de Sakkhara.
Exemple de problme de compatibilit entre la maonnerie
existante et le coulis inject :
Eglise de Neauphle-le-Chteau
Lglise Saint-Nicolas de Neauphle-le-Chteau a t rige au XII me
sicle, mais elle est surmonte dune grosse tour n-gothique leve en
1854. Construite de faon conomique, celle-ci est compose de murs
de faible paisseur (35 40 cm), constitus pour moiti dun parement
extrieur en pierre de taille et dune maonnerie de moellons hourde
au pltre gros, comme cest souvent le cas en rgion parisienne.
En 1990, une importante campagne de restauration est lance, com-
prenant notamment des travaux de confortement de la tour, dont la
construction fragile a souffert au cours des dcennies.
On procde des changements de pierres, la mise en place dun cha-
nage en bton arm la base de la tour, et surtout des injections gra-
vitaires de coulis de confortement des maonneries. Ce coulis est for-
tement dos en chaux XHA, cest dire chaux hydraulique artificielle,
ou ciment.
Mais en 1994, d importants dsordres apparaissent sur la tour, fissura-
tions, chutes de matriaux, basculement des pinacles, etc Ces dsord-
res sintensifient au cours de lhiver.
A lissue de plusieurs expertises des dsordres et analyses des mortiers,
il est dtermin que la cause du sinistre provient de la production mas-
sive de sels de thaumasite provoque par la raction chimique entre le
pltre existant dans les maonneries et le ciment du coulis, en prsen-
ce dhumidit. Ces sels sont fortement gonflants, particulirement
basse temprature, et poussent sur les maonneries jusqu les fendre
et les disloquer. Il est noter que la chaux hydraulique naturelle opre
une raction identique.
La seule solution possible au problme a consist dposer entirement
la tour, purger compltement les mortiers en cause, et la remonter
lidentique, conforte par un chanage en bton arm.
26 La maonnerie
L'ide d'appliquer la brique les mthodes de cuisson employes pour la
cramique depuis le nolithique ne voit le jour qu' la fin du III
e
millnaire,
Ur en Msopotamie, o l'on trouve des briques cuites estampilles.
Ce sont les Romains qui gnraliseront l'emploi de ce matriau, faisant une
fois encore preuve de leur facult rcuprer et amliorer ce qu'ils dcou-
vraient d'intressant dans les pays qu'ils soumettaient.
Introduite au sud de la pninsule, vers le V
e
sicle avant J.C. par des colonies
grecques, la brique s'y diffuse rapidement, essentiellement comme matriau
de construction, voire de parement de murs construits en blocage ; ces pare-
ments taient eux-mmes recouverts de marbres ou de stucs travaills li-
mitation des monuments grecs, dcors actuellement tous disparus.
La raison principale de l'utilisation massive du nouveau matriau est trs cer-
tainement sa maniabilit et sa grande rapidit de mise en uvre, qui per-
mettait de rduire les dlais d'excution des normes programmes raliss
par les Romains. La construction des thermes de Caracalla, par exemple,
monument de plus de douze hectares, n'a dur que cinq ans.
Ce n'est qu' partir du II
e
sicle aprs J.C., sous Trajan, puis Hadrien, que se
dveloppe une architecture o la brique devient un matriau noble et se
montre, la fois matriau de structure et lment de parure : seule, avec
effets de polychromie obtenus par des briques de teintes diffrentes, ou
associe de la pierre ou du marbre.
En Gaule romaine, cependant, l'exception de la rgion toulousaine, rares
sont les monuments construits entirement en brique. Cette dernire est
plutt utilise dans des maonneries dites en "opus mixtum" o alternent
assises de moellons et assises de briques.
Avec l'effondrement de l'empire romain, la brique disparat, au mme titre
que les autres constructions "en dur", jusqu' la priode mdivale.
Mais partir du XII
e
sicle, son expansion est nouveau considrable, prin-
cipalement dans les rgions o la bonne pierre est rare, cest dire, dans la
grande plaine d'argile et de limon d'Europe du Nord (Flandres, Hollande,
Allemagne du Nord), d'o elle atteindra l'Europe centrale et l'Angleterre.
Elle se rpand galement au sud, dans la rgion toulousaine essentiellement
pour ne parler que de la France.
Grce lindustrialisation, le XIX
e
sicle offre la brique un renouveau cer-
tain, notamment dans les innombrables demeures et pavillons de style "vill-
giature", o elle se prte l'illusion, au pastiche, au rustique et au pitto-
resque ; les catalogues des fabricants s'enrichissent de multiples modles et
dcors, et la sculpture dcorative en faade devient accessible au plus grand
nombre.
D'autre part le dveloppement de l'architecture industrielle fait appel la
brique, laisse apparente qui, marie au mtal, permet de raliser de grands
volumes btis en mme temps que les cits ouvrires adjacentes.
Au dbut du XX
e
sicle, les programmes de logements sociaux des grandes
villes font largement appel ce matriau encore abondant et bon march.
Aujourd'hui, la plupart des briqueteries locales ont ferm, uniformisant la
production, le type et l'aspect des briques.
27 La maonnerie
2
DIFFRENTES CARACTRISTIQUES RGIONALES
A
Les rgions du Sud
Dans ces rgions sont conservs, l'poque mdivale et plus tard, les
grands formats hrits de l'poque romaine : 23 x 38 cm et 30 x 56 cm, pour
la brique rectangulaire, et jusqu' deux pieds de cot pour la carre.
Elle tait toutefois souvent refractionne en triangles, dont une face tait
place en parements permettant ainsi une grande conomie de matriau et
une bonne liaison avec le massif du mur excut en bton de tout venant.
Dans le Roussillon, le "cairo" traditionnel (ou "cayrou") mesure 22 x 44 x 6
cm, la "rajole" a les mmes dimensions mais est plus fine, tout comme la
"barcelonine" qui correspond un demi "cairo".
La brique de base que l'on dnommera "brique foraine" partir du XVIII
e
si-
cle, a des dimensions stables, de tournant autour de 28 x 40 ou 30 x 42 cm,
et une paisseur variant de 4,5 5 cm.
Cette paisseur est maintenue sur les autres formats plus rduits : la "violet-
te" de 36 x 12 cm (utilise pour les votes), le "tiercerine" ou "barrot" de
27 x 12 cm.
Le principal atout des grandes briques est d'assurer, de par leur large surfa-
ce, une bonne liaison entre les constituants du mur, et galement d'viter la
distinction entre noyau du mur et parement.
Brique - Rgion du Sud
28 La maonnerie
B
Les rgions du Nord
Il existe une coupure importante entre le Nord et le Sud du pays.
La brique que lon trouve dans les rgions septentrionales lpoque mdi-
vale, est dun format diffrent de la "foraine" toulousaine ; mesurant environ
27 x 13 cm, voire 22 x 11 cm pour une paisseur de 6 7 cm, elle est plus faci-
le manipuler et favorise une maonnerie de parements, souvent polychro-
mes, qui seront abondamment dclins, suivant des caractristiques locales.
En Flandre franaise, o la brique a t utilise massivement, se sont dve-
loppes des architectures composites, de briques de sable, de briques roses,
noires, de pierre, de briques et pierres enduites.
La brique de sable, de couleur jaune, constitue d'argile et de sable mlan-
gs, tait essentiellement employe dans la plaine maritime, Calais,
Bergues, Saint-Omer ou Dunkerque. Utilise brute, sculpte ou moulure et
enduite l'imitation de la pierre, elle a servi l'dification ddifices civils,
mais aussi ddifices religieux ou de remparts. Vers l'intrieur de la Flandre,
on la trouve galement mlange des briques roses, en assises alternes ou
en motifs dcoratifs gomtriques, comme au chteau d'Esquelbecq (dbut
XVII
e
).
A Lille, partir du milieu du XVII
e
sicle, fleurit une architecture de pierres et
de briques, le plus souvent revtues de badigeons et de peintures (parfois
limitation de briques) dont le succs perdurera jusqu'au XIX
e
sicle.
Jeux de briques - Rgion du Nord
29 La maonnerie
C
Les autres rgions
La brique a t utilise dans beaucoup d'autres rgions franaises, souvent
en remplissage de pans de bois, en Normandie, par exemple, et frquem-
ment aussi en architecture de briques et de pierres alternes.
Parmi les particularismes locaux, il convient de signaler les jeux d'appareils de
la Sologne bourbonnaise, o les faades prsentent de faon quasi systma-
tique, un parement polychrome de briques noires et rouges, motifs go-
mtriques, forms de doubles bandes obliques d'une couleur, dlimitant des
losanges de l'autre couleur, avec, au centre, un motif de quatre briques de
la premire couleur.
3
SYSTME CONSTRUCTIF "BRIQUES ET PIERRES"
L'introduction d'lments de pierre intervient frquemment dans l'architec-
ture de brique de qualit.
Larchtype de cette architecture, est sans doute, l'ancienne Place Royale,
actuellement Place des Vosges, qui a dfinitivement fix l'ide d'un style
"Louis XIII", n sous Henri IV.
Mais ds le XV
e
sicle, le chteau de Rambure, dans la Somme, ou l'aile Louis
XII du chteau de Blois ont dj adopt ce parti esthtique,
La pierre vient s'insrer, grce un harpage soigneux, dans le mur de briques
pour en former l'ossature et marquer la modnature, plus particulirement
au droit des fentres et en chanage dangle.
Ce chanage de pierres en harpe sera rig en systme, et se dveloppera jus-
qu' devenir, l'poque classique, un appareil parfaitement rgulier qui
constituera le seul dcor de la faade.
En 1528, un systme invers de "pierres et briques" est mis la mode au
chteau de Fontainebleau : les murs sont en moellons enduits, et l'ossature
et la modnature sont en briques.
Appareil craie et brique
30 La maonnerie
4
TECHNIQUES DE FAONNAGE ET CUISSON
La production de la brique est un travail complexe qui, pour permettre une
production en grande quantit des cots raisonnables, demande une par-
faite organisation ; c'est la raison qui, sans doute, explique qu'il a fallu atten-
dre la naissance, au troisime millnaire avant J.-C., d'une socit organise,
pour que l'on envisage de cuire des briques, alors que la cramique existait
depuis l'poque nolithique.
Cinq stades se succdent dans la fabrication de la brique
l'extraction de la terre (argile ou limon)
la prparation de la pte
le faonnage
le schage
la cuisson.
L'extraction, jusqu' la fin du XIX
e
sicle o furent inventes les premires
excavatrices motorises, se faisait la pelle.
La prparation de la pte - mlange d'une ou plusieurs terres argileuses, ou
de limon, avec de l'eau et des lments dits "dgraissants", comme le sable,
indispensables lorsque les terres sont trop fines se faisait aussi manuelle-
ment, ou avec l'aide d'un mange animal.
Pour le faonnage, ds l'antiquit, on voit apparatre le moule, cadre de bois
avec ou sans fond, aux dimensions de la brique produire. Dans ce moule,
pralablement saupoudr de sable pour viter que la pte y adhre, le bri-
quetier tasse et arase la main, une portion d'argile qu'il dmoule ensuite
en la renversant sur une surface plane, elle aussi sable.
Ce travail, long et fastidieux (un bon ouvrier pouvait faonner plusieurs cen-
taines de briques par jour) restera inchang jusqu'au milieu du XIX
e
sicle,
o un Allemand, Schlickeysen, met au point la premire machine faon-
ner : l'tireuse.
L'tireuse de M. Schlickeysen
Introduite par la partie suprieure de la machine, la terre est malaxe
dans un cylindre par une vis d'Archimde, actionne par un mange
(puis par la suite, motorise) ; sous l'effet de la pression produite, la
pte est expulse par un orifice rectangulaire, la base du cylindre, et
sort sous la forme d'un boudin parfaitement rectangulaire, qu'il suffit
de le sectionner, au fur et mesure de son apparition, intervalles
rguliers pour obtenir un paralllpipde rectangle parfait.
Ce systme, entirement mcanis et automatis, est toujours utilis
pour la production des briques mcaniques qui, hlas, ne peuvent en
aucun cas convenir pour une restauration de btiment ancien tant
elles sont lisses et rgulires, impossibles marier avec des briques
anciennes faonnes manuellement.
31 La maonnerie
Schage
Il est en effet indispensable de faire scher doucement la brique de terre
crue, avant de la cuire, si l'on ne veut pas la voir se fendiller et clater sous
l'action de la chaleur.
Ce schage se fait actuellement en schoir artificiel, mais autrefois, la brique
tait mise scher sous de vastes hangars l'air libre, uniquement pendant
les priodes de l'anne o aucun risque de gel ntait craindre. Ce qui,
dans les rgions d'Europe du Nord, interdisait toute campagne de produc-
tion de novembre mars.
Cuisson
C'est l l'opration la plus dlicate, la brique est mise cuire dans un four.
Les fours taient l'origine, de vastes cylindres de maonnerie, la base des-
quels on entretenait un violent feu de bois, sous la sole, grille de maonne-
rie sur laquelle ont entreposait, tel un chteau de cartes, les diffrents l-
ments de terre cuire : briques, carrelage, tuiles, etc.
Dans ce type de four, les degrs de cuisson taient diffrents suivant la posi-
tion des lments : cuisson trop intense proximit du feu, donnant des
briques dures et sombres, trop faible la partie suprieure, produisant des
briques ples et gnralement trop tendres pour prsenter de bonnes carac-
tristiques mcaniques.
Les lments les mieux cuits, de trs bonne qualit ne reprsentaient que le
quart d'une fourne et taient rservs aux jambages, encadrements ou
parements extrieurs visibles. Les autres taient utiliss en remplissage.
De nos jours, les fours industriels utilisent d'autres combustibles que le bois
(gaz, fuel, etc.) et sont optimiss de manire obtenir une chaleur rpartie
de faon rgulire, pour une cuisson la plus homogne possible.
5
PRINCIPAUX CONSTITUANTS DE LA BRIQUE
ET CARACTRISTIQUES CHIMIQUES
Les briques cuites sont fabriques avec tous types d'argile : les ilitiques (cou-
leur marron gris rouge, aprs cuisson), les kaoliniques (trs claires) et les
bravaisitiques (couleur orange rose).
On trouve dans la pte argileuse essentiellement des lments mtalliques,
sous forme d'oxydes plus ou moins hydrats :
- les lments dits "rfractaires" dont le degr de fusion est trs suprieur
celui de la temprature (de 800 1000) des fours briques : il s'agit de
la silice (SiO2), et de l'aluminium (AI2O3).
- les lments "colorants" dont la proportion dtermine la couleur basique
de la brique (le degr de cuisson tant l'autre facteur dterminant de cette
couleur). Ce sont :
l'oxyde de fer,
l'oxyde de titane,
l'oxyde de manganse.
- les "fondants", de deux types :
les oxydes alcalins : oxydes de sodium et de potassium,
les oxydes alcalino-terreux : chaux et magnsie.
Que se passe-t-il lors de la cuisson ?
La phase de cuisson est dterminante pour la duret de la brique, sa couleur
et sa rsistance aux agents atmosphriques - au gel essentiellement.
32 La maonnerie
Sous l'action de la chaleur maximale du four, et pendant un temps dtermi-
n, les oxydes fondants provoquent la formation d'un verre siliceux impur,
car charg d'une importante quantit d'lments rests en phase cristalline,
tandis que les oxydants colorants teintent cette masse partiellement vitreuse :
en rouge pour l'oxyde de fer,
en jaune pour le titane,
en noir pour le manganse.
Mais pour les briques anciennes, ces colorations pouvaient tre nanmoins
affectes par la position des briques dans le four. Les diffrences de teintes
avaient pour corollaire des diffrences de duret, donc de taillabilit et de
durabilit.
Un dficit de 20 30 dans la chaleur du four avait des consquences trs
importantes sur la qualit des briques. Mais cette diffrence de temprature
ncessitait un supplment considrable de combustible, qui a conduit
fabriquer des briques de moindre qualit.
CONSEIL DE PRUDENCE
Il convient de prciser que seules les briques de bonne qualit
taient destines rester apparentes : certaines maonneries,
excutes plus grossirement ou avec des briques de moindre
qualit, taient recouvertes d'enduits, et c'est donc une erreur de
vouloir tout prix supprimer ces enduits ; il s'agit l d'une mode
aussi dplorable que celle de la "pierre apparente" systmatique,
qui met jour de mdiocres maonneries de moellons originelle-
ment prvues pour tre enduites.
6
MORTIERS
Le mortier d'une maonnerie de briques doit avoir deux proprits spci-
fiques : l'adhrence vis vis de la brique et une cohsion interne importan-
te : c'est lui qui constitue la phase continue de l'assemblage et qui assure
la maonnerie son monolithisme.
Il est gnralement compos de sable et d'un liant plus ou moins hydrau-
lique fait de chaux ou actuellement de ciment.
Les mortiers romains taient raliss avec de la chaux arienne et de la pou-
dre de brique pile.
En Flandres, dans les rgions o le sable manquait, le mortier de hourdage
pouvait tre compos d'argile crue et d'adjuvants comme la farine de seigle
par exemple ; seul le rejointoiement tait fait d'une bourre de quelques milli-
mtres de chaux pure et de crin, ou de mortier traditionnel sable et chaux.
La granulomtrie du sable est importante : un sable trop fin a tendance
faire trop de retrait.
Caractristiques
Les proprits physiques et mcaniques de la brique et de son mortier doi-
vent tre proches, sous peine de provoquer l'altration rapide soit des
briques, soit du mortier.
Mais la capacit de monte capillaire de l'eau travers le mortier, par exem-
ple, ne doit pas tre infrieure celle de la brique : le mortier doit pouvoir
agir comme une sorte de drain liminant l'eau absorbe par les briques.
Dans le cas contraire, c'est la brique qui sera attaque.
De mme, les mortiers doivent aussi avoir une rsistance mcanique un peu
plus faible que celle de la brique, mais un coefficient de dilatation proche.
33 La maonnerie
Les mortiers base de chaux arienne remplissent en gnral ces conditions,
mais ils sont peu utiliss cause de leur faible durabilit ; afin d'augmenter
leur dure de vie, les entrepreneurs appliquent beaucoup de ciment et peu
de chaux, et serrent ce mortier dans les joints.
L'utilisation de chaux hydraulique adjuvante permet d'augmenter la dura-
bilit du mortier, mais diminue sa capacit de capillarit, ce qui peut nuire
la maonnerie. En revanche, l'adjonction d'argile lve la vitesse de la mon-
te capillaire, de mme que l'ajout de sable, mais au prix d'une moindre
rsistance mcanique.
Il faut veiller n'employer que du sable de rivire lav.
Les dosages du mortier de pose sont donc adapter aux caractristiques de
la brique mettre en uvre, et notamment sa vitesse de capillarit.
7
JOINTS
Dans une maonnerie de parement classique, la surface du joint reprsente
environ 15 25 % de la surface totale, ce qui n'est pas ngligeable, et
ncessite de la part de l'architecte une dfinition prcise esthtique et qua-
litative (forme du joint, paisseur, couleur, ).
Le joint joue un rle de protection important et doit avoir un comportement
irrprochable dans le temps, quelles que soit les conditions d'exposition.
Sa duret est valuer en fonction des sollicitations de l'ouvrage et doit
s'harmoniser avec celle du mortier de pose et de la brique.
Il y a deux faons de faire les joints :
Soit "en montant", c'est--dire au fur et mesure que le mur est mont, en
utilisant le mortier de pose, soit "postrieurement", c'est--dire aprs que le
mur soit fini.
Cette deuxime mthode donne un rsultat plus soign, tant du point de
vue esthtique (choix de la composition du joint, rgularit de couleur et de
structure) que du point de vue qualitatif (possibilit de maturation et de sta-
bilisation du mortier de pose, mise en uvre par des rejointoyeurs profes-
sionnels).
Le rejointoyage "a posteriori" permet au mortier de pose d'effectuer son
schage et son retrait, et limite ainsi les risques de fissuration des joints ; l'ob-
servation montre que les murs rejointoys ainsi ont moins de problmes d'in-
filtrations d'eaux.
Le joint doit avoir une profondeur de l'ordre de 1,5 fois sa largeur.
8
RAGRAGE
Les parements de briques de moindre qualit taient enduits et souvent trai-
ts en faux appareils de briques ! Le mortier de ragrage pouvait tre com-
pos dhuile de lin, de poudre de brique et de sang de buf. Cette disposi-
tion existe au Capitole de Toulouse, par exemple.
34 La maonnerie
I PATHOLOGIES DES MAONNERIES EN BRIQUE
En dehors des problmes strictement structurels (tassements, fondations,
sismes, ) on peut classer les pathologies en deux grandes catgories : cel-
les lies l'humidit et celles lies la pollution atmosphrique.
Les pathologies destructives peuvent affecter soit la brique soit le mortier de
pose, soit les deux. En outre, les joints peuvent tre dgarnis et ne plus jouer
leur rle.
1
MORTIER
C'est en fait la dsagrgation du mortier de pose qui fragilise, puis dtruit,
les structures en maonnerie de brique ; en effet, le mortier constitue la
fois la partie la plus "stratgique" et la plus faible de l'ensemble, et la rup-
ture de sa continuit, pour quelque cause que ce soit, met en pril toute la
maonnerie.
Les causes de pathologies des mortiers peuvent tre de 3 ordres :
1- causes mcaniques : des contraintes dues des tassements diffrentiels,
ou sismes, qui peuvent dpasser la rsistance du mortier et le fissurer. Les
contraintes peuvent aussi tre provoques par la croissance de vgtaux s'in-
sinuant l'intrieur des joints.
2- causes chimiques dues l'eau ou la pollution : la chaux et le ciment,
de nature basique, sont sensibles l'action des acides, ce qui se traduit par
des chanes de dcomposition qui produisent des sels dont certains (les chlo-
rures et nitrates) s'liminent par dissolution dans l'eau, et d'autres (les sulfa-
tes) cristallisent en produisant des gonflements (gypse ou ettringite).
3- causes biologiques : la capacit des micro-organismes, bactries, levu-
res et champignons transformer de l'azote atmosphrique en acide
nitrique, ou des pyrites en acide sulfurique ; la multiplication de ces phno-
mnes provoque des altrations parfaitement observables.
A cela s'ajoute l'action mcanique des intempries lorsque les joints sont vids.
2
BRIQUE
Les pathologies de la brique rsident dans l'altration de sa surface, de son
aspect, dans l'augmentation de sa porosit et sa friabilit, jusqu' la ds-
agrgation..
Lorsqu'elle est apparente, la brique subit l'action mcanique et chimique des
intempries. Le phnomne le plus grave est "l'alvolisation" qui dsagrge
la brique : elle apparat la base des murs anciens, dans les zones soumises
remontes capillaires. Cela est d la structure cristalline cubique des chlo-
rures prsents dans l'eau.
La prsence permanente d'eau peut mme provoquer la dissolution interne
des briques, qui prennent un aspect cartonneux et perdent leur rsistance
mcanique ; cette dsagrgation est due des effets lectrolytiques sur l'ar-
gile. Ce phnomne affecte particulirement les briques du XVIII
e
sicle,
encore cuites dans des fours bois.
Elle peut aussi se dsagrger peu peu du fait de la trop faible capacit de
capillarit du mortier et de sa trop forte tanchit qui va empcher l'eau
contenue dans la brique de migrer dans le mortier et de s'vaporer : la face
avant de la brique va reculer peu peu et se creuser par rapport au joint.
35 La maonnerie
L'utilisation d'un mortier trop rsistant, peut aussi provoquer l'miettement
ou la cassure de la brique, par manque de souplesse.
Enfin, les parements de brique peuvent prsenter des traces de salissures
(noires), des traces moisissures (noires ou vertes), des traces de salptre (blan-
ches et cotoneuses), ou encore des traces d'efflorescences (blanches granu-
leuses et sches).
Il est noter que salptre et efflorescences sont deux phnomnes diffrents.
I DIAGNOSTIC ET RESTAURATION
DES MAONNERIES DE BRIQUE
Face un mur de brique altr, il convient tout d'abord de procder un
examen permettant d'identifier le type de pathologies : problme d'humidi-
t, dfaut de stabilit ?
On tchera ensuite d'en dterminer la (ou les) causes : s'il s'agit d'altrations
dues l'humidit, on identifiera si elle provient d'une faiblesse de la couver-
ture - zinguerie, d'une porosit excessive du parement ou de remontes
capillaires venues du sol.
Dans un premier temps, on s'attachera donc tenter de supprimer les fac-
teurs dtriorants.
Ensuite on entreprendra de restaurer le parement abm.
Pour cela, il faut identifier le type de brique concern (terre cuite, brique de
sable, brique silico-calcaire) et ventuellement retrouver son lieu de prove-
nance.
Des analyses chimiques et des examens minralogiques et microscopiques
permettent aussi de dterminer la composition du mortier et la nature des
altrations subies.
Par ailleurs, un examen visuel soigneux, appuy ventuellement par des ana-
lyses, doit permettre de vrifier si la brique tait nue ou apparente derrire
un badigeon, ou totalement couverte.
Dans ces deux derniers cas, elle ne doit pas tre dcape car, vraisemblable-
ment sa qualit de cuisson ou d'aspect ne lui permet pas d'tre laisse visible.
Salptre et efflorescences
Le salptre provient d'une cristallisation de nitrates (d'ammonium, de
calcium ou de potassium) la surface de la maonnerie, qui apparat
souvent proximit d'gouts, d'anciennes tables ou curies. Les sols
y sont gorgs de bactries nitrifiantes qui migrent dans les murs et
cristallisent. Le salptre met de nombreuses annes se dvelopper.
Pour stopper le phnomne, il faut liminer les bactries l'aide de
formol ou de bactricides anioniques, et traiter la cause de l'humidi-
t.
Les efflorescences, elles, apparaissent trs rapidement ; elles sont pro-
voques par la migration de sulfate de sodium provenant du mortier
de jointoiement. Elles cdent facilement au traitement par un gel
acide, suivi ventuellement d'un hydrofuge microporeux.
36 La maonnerie
1
INJECTION DE COULIS
Si l'intgrit de la maonnerie est menace, des injections de coulis de mor-
tier peuvent tre envisages ; elles permettront de combler les vides ou les
fissures reprs dans la maonnerie.
Comme pour l'injection dans les maonneries de pierre, la composition du
coulis et le protocole suivi pour l'injection ont une grande importance pour
la qualit des rsultats.
Le coulis d'injection doit tre compatible avec l'existant et prsenter des
caractristiques analogues, car il doit y avoir une parfaite adhrence du cou-
lis inject sur le mortier existant et sur les briques ; la composition de ceux-
ci doit donc tre analyse pralablement et des essais raliss.
2
TRAITEMENTS DE SURFACE
Il est souvent ncessaire d'utiliser plusieurs mthodes de nettoyage avant de trou-
ver la plus convenable, cause des divers types de salets qui se forment sur la
maonnerie en brique et des diffrentes caractristiques des briques et mortiers.
Le nettoyage des efflorescences peut s'effectuer en grande partie l'aide
d'une brosse ; si c'est insuffisant, il faut laver le mur l'eau, frotter la bros-
se, et rincer de nouveau. Si le rsultat n'est pas satisfaisant, on peut appli-
quer une solution d'acide muriatique (solution 1 pour 9 d'eau) sur le mur
bien mouill, puis rincer.
Mais si des efflorescences apparaissent soudain sur un mur ancien, il faudra d'a-
bord identifier la source de l'humidit excessive qui a engendr ce phnomne.
Le nettoyage des mousses, lichens, vignes et plantes grimpantes, nuisibles
la maonnerie cause de l'insinuation des racines dans les joints, s'effectue
par l'application de sulfamate d'ammonium ou d'une solution de silico-fluor
de zinc ou de magnsie (proportion 1 pour 40 d'eau) ; on peut galement
employer un herbicide commercial.
Le nettoyage des parasites, champignons, etc, s'effectue aisment avec un
fongicide. Il peut tre suivi d'un hydrofuge si l'on veut prolonger l'effet.
3
REJOINTOIEMENT
La rfection des joints est une opration de protection primordiale pour la
conservation du mur. Dans la mesure du possible, on s'attachera conserver
les joints des restaurations antrieures en bon tat ; pour les autres, on pro-
cdera la rfection des joints avec un mortier soigneusement adapt, ou
conforme l'tat d'origine s'il est connu.
Colorer le mortier si ncessaire, avec de l'oxyde.
4
HYDROFUGATION
La brique semble mieux ragir que la pierre aux procds d' hydrofugation ;
la brique ancienne particulirement, qui est gnralement plus poreuse et
qui peut tre amliore par ce procd. L'hydrofugation peut, pendant un
certain temps, permettre la brique d'viter les altrations dues la stagna-
tion d'humidit.
Toutefois, le traitement hydrofuge, en rendant moins aiss les changes
hydriques, favorise les problmes de pathologies dues au gel : il faut donc
parfaitement matriser l'intervention.
37 La maonnerie
5
SABLAGE
Comme pour les parements de pierre, le sablage a t considr une poque
comme une solution efficace de nettoyage ; mais cette technique, trop agres-
sive, rode la couche extrieure protectrice qui, l'image du calcin pour la pier-
re, protge la brique. Les actions destructives du gel s'en trouvent facilites et
mettent en pril la brique, surtout si sa cuisson n'a pas t parfaite.
6
NETTOYAGE PAR MICRO-SABLAGE ET HYDRO-GOMMAGE
Le nettoyage des encrassements, dpts noirs et salissures de suie s'effectue soit
par application de compresses, soit par micro-sablage ou hydro-gommage.
Ces techniques de nettoyage, relativement douces, peuvent tre adoptes pour
la brique en bon tat ; nanmoins, on se souviendra que la brique tant plus
poreuse que la pierre, l'utilisation de l'eau doit tre parfaitement contrle.
Mais attention, si la brique est trs ancienne, il faut rflchir l'utilit d'ef-
fectuer un nettoyage qui ne durera pas plus de dix ans.
7
COMBLEMENT DE ZONES MANQUANTES
Les rparations au mortier d'imitation sont plus difficiles raliser pour la
brique que pour la pierre, d'une part pour des questions d'aspect, et d'aut-
re part pour des question de porosit :
la composition de ces mortiers leur donne gnralement une capillarit plus
faible que la brique qui ne permet pas la continuit des migrations hydriques.
8
REMPLACEMENT DE BRIQUE
C'est la solution la plus souvent choisie, car la pulvrulence de la brique nest
pas rversible, et le remplacement est techniquement assez simple raliser.
Toutefois, il faut tre en mesure de retrouver le mme type de brique, avec
les mmes caractristiques et un aspect identique.
Ensuite il faut s'assurer, par une uniformisation des joints et une patine ven-
tuelle, de l'intgration des lments neufs dans le mur ancien.
C'est pourquoi le remplacement de briques anciennes doit tre fait avec soin
et parcimonie.
I LES COLOMBAGES OU PANS DE BOIS
Si la tradition romaine de construction en pierres et en briques sest mainte-
nue dans de nombreux pays au Moyen-ge, dans les pays du centre de
lEurope et en France, on btissait essentiellement en bois.
Ce type de construction a subsist pendant plusieurs sicles, pour les difi-
ces civils essentiellement, la technique samliorant et laissant une place
croissante la maonnerie, cela vraisemblablement pour deux raisons essen-
tielles : lloignement progressif des lieux dexploitation d la diminution
des forts, et les risques dincendie inhrents ce type de construction.
En outre, cette volution technique amliora la prennit des constructions.
Pour viter le pourrissement des bois en contact avec le sol, on commena
par raliser des soubassements en maonnerie.
Les remplissages ne se firent plus uniquement en terre ou en torchis, mais en
maonneries diverses : de moellons, de briques, de tuileaux, etc.
38 La maonnerie
Puis, les murs sparatifs entre deux maisons mitoyennes furent entirement
construits en maonnerie, ce qui permettait dy adosser des chemines en
toute scurit, et damliorer considrablement lisolation entre btiments
conscutifs. Seules les faades et les refends continurent dtre difis en pan
de bois, et ce malgr les nombreux textes de loi qui, de faon constante depuis
le 16
me
sicle, tentrent de rglementer, voire dinterdire leur utilisation.
Notons :
un arrt du Parlement du 17 mai 1571, exigeant la dlivrance dune per-
mission spciale pour pouvoir btir en pan de bois,
un dit royal de 1607 qui proscrit lusage du pan de bois au rez-de-chausse,
une ordonnance des Trsoriers de France grands voyers de Paris, date du
18 aot 1667, qui limite huit toises (environ 15,60 m) la hauteur des
faades en pans de bois, interdit les pignons sur rue et oblige revtir les
pans de bois, lextrieur comme lintrieur, dun enduit de pltre sur
lattes cloues,
un rglement du matre gnral des btiments, du 1er juillet 1712, prci-
sant les conditions de mise en uvre de plinthes dentablements, de cor-
niches, etc. en pltre,
les ordonnances de police du 28 avril 1719 et du 13 octobre 1724 qui
interdisent de nadosser aucun conduit de chemine un pan de bois, et
damliorer la liaison des maonneries avec les poteaux de bois par che-
village et rainurage de ces derniers.
Malgr toutes ces rglementations et interdictions, lusage du pan de bois
sest maintenu de faon courante jusqu la fin du XIX
e
sicle.
Dfinition
Un pan de bois est un mur constitu dune ossature de pices de bois assem-
bles dans un plan vertical, et dun remplissage ou hourdis, comblant les
vides entre les diffrentes pices, ralis soit en torchis, soit en maonneries
de briques, de tuiles, de gravats ou de petits moellons, hourds la chaux
ou au pltre.
La technique de mise en uvre dun pan de bois relve la fois du savoir-
faire du charpentier, et de celui du maon.
En effet, ses exigences fonctionnelles sont identiques celles dun mur de
Faade pans de bois
Strasbourg, la petite France
39 La maonnerie
maonnerie : stabilit aux efforts verticaux et horizontaux, tanchit leau
et lair, isolation au froid et au bruit : Il est donc normal de ltudier dans
le cadre dun ouvrage sur la maonnerie.
1
LMENTS CONSTITUTIFS
A
La structure
La structure dun pan de bois est compose principalement :
de pices de bois verticales appeles poteaux, vhiculant verticalement
charges et surcharges,
de pices horizontales hautes et basses, appeles respectivement sabli-
re hauteet sablire de chambre, dans lesquelles les poteaux sont
assembls, par tenon et mortaise, et maintenus ainsi en position verticale,
de pices inclines remplissant la fonction de contreventement, nommes
dcharges ou charpes. Si les charpes forment un angle avec la ver-
ticale infrieur 30, elles sont nommes guettes ; si elles sont assem-
bles en croix, ce sont les croix de St Andr.
Ces pices obliques sont, elles aussi, assembles par tenons et mortaises
dans les sablires.
Ce type dassemblage ne peut transmettre que des efforts de compression,
et les charpes sont toujours inclines symtriquement par rapport la ver-
ticale pour reprendre les efforts horizontaux parasites (vent, etc.), sexerant
dans un sens ou dans lautre.
Les pans de bois ont une hauteur dtage, et peuvent se superposer de fond
en comble dun difice. Les solives et poutres des planchers viennent alors
prendre appui sur les sablires hautes.
La rigidit de lensemble est assure par des poteaux de plus fortes sections
que les autres, filant sur la hauteur dau moins deux tages, et interrompus
de faon alterne des tages diffrents.
Ces poteaux se trouvent systmatiquement dans les angles ce sont les
"poteaux corniers".
Dautres lments structurels interviennent encore dans la composition de
pans de bois .
Ils peuvent tre raliss en diffrentes espces de bois, le plus souvent en chne,
mais aussi suivant les rgions, en chtaignier, en peuplier, en rsineux, etc.
Ossature d'un pan de bois
40 La maonnerie
B
Les hourdis
Comme indiqu dans la dfinition du pan de bois, les hourdis remplissant les
vides entre les bois peuvent tre de plusieurs sortes.
Leur nature est un lment dterminant pour lespacement des bois.
a
Le torchis ou pis
Cest un mlange dargile et de paille, ou dautres fibres vgtales, comme
la bourre de mas par exemple, ou encore de crins danimaux, ces divers l-
ments tant utiliss pour une meilleure isolation thermique.
Il est bourr entre les tournisses rainures cet effet, et entre lesquelles sont
bloques pour le maintenir, des clisses, pices de bois de faible section, ver-
ticales, horizontales ou obliques.
En Sologne, on trouve aussi un systme de remplissage par palissons,
petits fuseaux de bois enrobs de torchis.
Ce torchis a une rsistance faible ; lorsquil est utilis en surfaces larges (Sologne,
Champagne humide), les pans de bois sont particulirement dtriors.
b
Les hourdis de briques ou de moellons
Les briques ou les petits moellons, sont hourds au mortier de chaux ou de
pltre, ou encore la terre argileuse.
Ce hourdis est stable par lui-mme, et permet donc dutiliser une structure
de bois aux lments assez espacs. On le rencontre dans les Landes, dans
le pays de Braye.
c
Les hourdis de tuileaux
Les tuileaux, empils entre les potelets, sont hourds au pltre ou la chaux ;
ils exigent, de par leurs faibles dimensions, que les pices de bois soient trs
rapproches.
d
Les hourdis de pltre
Pltras de dmolition ou blocs de gypse, hourds au pltre, ce type de hourdis
est trs frquent en rgion parisienne. Il nest pas prvu pour rester apparent,
mais est recouvert par un lattis clou qui sert de support un enduit pltre.
Dans tous les cas, la bonne adhrence entre maonnerie et pices de bois est
assure par le rainurage de ces dernires et par un lardage de clous bteaux.
Pan de bois, torchis dargile
et paille, recouvert denduit la chaux
41 La maonnerie
Dans tous les cas, la bonne adhrence entre maonnerie et pices de bois est
assure par le rainurage de ces derniers et par un lardage de clous bteaux.
2
CAPACIT PORTANTE ET DIMENSIONNEMENT
La capacit portante dun pan de bois sexprime en kilogramme-force.
Elle est le produit de la capacit portante dun des poteaux, multipli par le
nombre de poteaux, et affect dun coefficient de vtust.
La capacit portante P dun poteau est gale au produit de sa section trans-
versale S, exprime en cm
2
, par la contrainte de compression n, exprime en
kg/cm
2
et prise gale la plus petite des valeurs de la contrainte de flambe-
ment (nf) ou de la contrainte de compression transversale localise (nc).
Ces diffrentes valeurs varient en fonction des essences de bois utilises.
La capacit portante thorique ainsi obtenue, ne tient pas compte des
assemblages, de leur vtust ni du degr daltration des bois, mais elle per-
met de se rendre compte, par comparaison avec les charges et les surchar-
ges de louvrage, si le pan de bois a t dimensionn au plus juste ou, au
contraire, trs largement.
Seule une auscultation prcise permet de dterminer le coefficient de vtus-
t qui, appliqu la capacit portante thorique, donnera la capacit por-
tante relle.
Dimensionnements
Une donne de base intressante connatre est celle de Rondelet qui, dans
son Art de Btir, prconise une paisseur de pan de bois gale la moiti de
celle dun mur en maonnerie soumis aux mmes contraintes.
Pan de bois et Hourdis de briques
42 La maonnerie
3
DIAGNOSTIC
En prsence dun mur enduit, comment dterminer sil est en maonnerie ou
en pan de bois et procder au diagnostic ?
A
Lpaisseur
Lpaisseur du mur est une premire indication intressante : dans le cas
dune maonnerie de pierres, il ne sera jamais infrieur une quarantaine de
centimtres.
Dans le cas dun pan de bois, son paisseur est comprise entre 20 et 25 cm
pour un mur extrieur et entre 14 et 20 cm pour un mur de refend.
Mais cette indication est loin dtre suffisante : un mur de briques pourra
avoir des paisseurs similaires, ou encore, dans des constructions postrieu-
res aux annes 1850, on pourra se trouver en prsence dun pan de fer.
Le dtecteur de mtaux et la camra infra-rouge.
Un passage au dtecteur de mtaux permettra une identification immdiate
dventuel pan de fer dans un mur.
Lutilisation dune camra infrarouge, dans la mesure o il existe une dif-
frence de temprature entre les deux faces du mur, permettra, elle, liden-
tification d un pan de bois par le barrage thermique quil constitue.
B
Lanalyse des fissures
Avant tout, et si lon ne dispose pas dappareils techniques, une analyse
dventuelles fissures peut renseigner efficacement tant sur les matriaux mis
en uvre que sur les pathologies.
- Dans une maonnerie, les fissures ne seront jamais parfaitement rectilignes :
dans un mur de briques, par exemple, elles seront en escalier, suivant les joints
de la brique.
Dimensionnements
Les dimensions des sections les plus utilises sont donnes dans plusieurs
manuels, datant pour la plupart du 19
me
sicle.
Nous citerons celle rpertories par le Colonel EMY dans son trait de 1837
sur lArt de la charpenterie, pour un pan de bois de quatre niveaux et dune
hauteur dtage comprise entre 3,25 et 4 m.
1) Pan de bois extrieur
paisseur 22 24 cm
Poteaux et cornires et poteaux de fond 24 27 cm
Sablires hautes et basses 22 24 cm
Poteaux 19 22 cm
Poteaux de remplage 16 22 cm
cartement des poteaux de remplage 27 32 cm
Guettes ou dcharges 16 22 cm
Tournisses et potelets 14 22 cm
2) Pan de bois intrieur
paisseur 16 cm
Grosseur des poteaux
- portant planchers 14 16 cm
- ne portant pas planchers 11 14 cm
43 La maonnerie
- Dans un pan de bois, les fissures vont suivre les pices de bois, et seront
donc rectilignes, verticales, horizontales ou, ce qui est plus caractristique,
obliques, en suivant les charpes.
- Dans une maonnerie pan de fer, ces fissures obliques nexistent pas.
C
Les sondages
Enfin, des sondages localiss pourront tre raliss dans les zones prsentant
une forte altration visible, ainsi quaux points considrs comme les plus
nvralgiques, cest dire :
- sur les pices de bois dtermines, par lanalyse thorique, comme tant les
plus sollicites,
- aux liaisons mtalliques et leur assemblage avec les pices de bois,
- dans les zones les plus susceptibles dtre atteintes de pathologies :
par des infiltrations :
murs exposs aux pluies et vents dominants, balcons, tages en retrait,
pour les extrieurs,
cuisines, salles deau, passages de chutes et de canalisations deau
pour les intrieurs,
par la condensation :
dans les zones manifestement modifies par rapport aux dispositions
dorigine,
cuisines, salles deau, zones traverses par des canalisations deau froide.
4
RESTAURATION DES PANS DE BOIS
A
Restauration des structures
Suivant ltat de dtrioration des pices de bois, le plus souvent au niveau
des assemblages poteaux/sablires et charpes/poteaux, plusieurs solutions
sont envisageables :
- Le remplacement des pices abmes - travail dlicat et onreux - suppo-
sant la dmolition du hourdis avoisinant et sa reconstruction aprs change-
ment des pices,
- Lenture, aprs dgradation des parties altres, de pices de bois greffes
sur les parties saines - travail galement assez dlicat et onreux -
- Linsertion, dans la pice de bois, de tiges en fibre de verre renforces, asso-
cies une rsine de polyester,
Pans de bois manquants et hourdis altrs
44 La maonnerie
- La restauration, voire la reconstitution, des parties altres (aprs purge de
celles-ci), par lutilisation dun mortier poxydique lger, employ en masse,
coffr et recouvert dune rsine de renforcement poxydique qui peut se
teinter et se travailler limitation des bois anciens contigus.
Cette dernire mthode permet la conservation dun maximum de pices
anciennes, et une intervention plus lgre et moins onreuse. Elle est particu-
lirement recommandable dans le cas dun pan de bois destin tre enduit.
Si au contraire, ce dernier doit rester apparent, son emploi est plus discutable,
surtout pour les pices vision rapproche.
CONSEIL DE PRUDENCE
Pan de bois apparent ou enduit ?
Lors dune restauration dun pan de bois enduit, la question se pose le
plus souvent de la suppression de lenduit. De mme qu'une certaine
mode a conduit dcaper les enduits des maonneries, la tendance
dshabiller les pans de bois pour les laisser apparents s'est dvelloppe.
Cette suppression nest envisageable que si lon acquiert la certitude
que le pan de bois a t lorigine conu pour rester apparent.
Dans le cas contraire, on prive le pan de bois de sa protection initiale, ce
qui le met en danger, et l'on modifie fortement sa physionomie naturelle.
Un moyen simple est de procder des sondages pour examiner dune
part, sil a t apport un soin particulier la finition des pices de bois,
et vrifier, dautre part, sil existe sous le lattis et lenduit de protection,
un enduit ancien recouvrant le hourdis, et parfaitement aras au nu des
pices de bois.
Pan de bois et hourdis restaurs
45 La maonnerie
B
Restauration du hourdis
Dans les zones o il est dtrior, ou supprim pour permettre le remplace-
ment de pices malades, le hourdis sera restitu lidentique des parties
avoisinantes.
On veillera ce que la liaison entre hourdis et structure bois soit parfaitement
assure, gnralement par un lardis de clous.
Si le pan de bois est destin rester apparent, le hourdis sera recouvert dun
enduit dont la composition et la teinte seront identiques celles de lenduit
dorigine. Cet enduit sera parfaitement aras au nu des pices de bois,
et ne sera en aucun cas en saillie ou en retrait par rapport celui-ci.
Certains matriaux, comme la brique ou les tuileaux, peuvent rester appa-
rents, en fonction des caractristiques stylistiques rgionales.
I LA CONSTRUCTION EN TERRE
La terre a t utilise pour la construction dans le monde entier, depuis les
temps les plus reculs, avec une tonnante varit de mises en uvre.
La plus ancienne de ces mises en uvre est sans aucun doute la terre creu-
se de lhabitat troglodyte, concentr essentiellement en Chine, dans les
pays mditerranens dEurope et dans les pays dAfrique du Nord.
Nous avons vu la terre, mlange des substances vgtales, utilise en gar-
nissage dune structure de bois (Cf. le chapitre "Pan de bois").
Elle a t aussi employe pour crer des lments de maonnerie : mottes de
terre dcoupes directement dans le sol, lments mouls : briques de for-
mes diverses de terre cuite sche au soleil, extruds, adobes, boudins, etc.
Elle a t faonne en colombins, en boules empiles (bauge), en tresses, etc.
Mais, cest en "pis" quelle a t le plus employe, aussi bien dans nos
rgions, que dans des pays aussi diffrents que le Danemark, le Maroc, le
Prou ou la Chine.
De nombreux documents anciens dcrivent ce dernier procd, utilis en
France depuis les Romains et transmis depuis lors de gnration en gnra-
tion, dans le lyonnais tout dabord, puis de proche en proche jusqu des
provinces aussi loignes que, par exemple, la Bretagne ou la Picardie (da-
prs ce quen dit Goiffron dans un ouvrage dat de 1772, intitul "lart du
maon piseur".
1
DFINITION
Nous emprunterons la dfinition du pis louvrage de Cointereaux
"Les Cahiers de lcole dArchitecture Rurale", paru en 1790.
Le pis est un procd daprs lequel on construit les maisons avec de la
terre, sans la soutenir par aucune pice de bois, et sans mlange de paille, ni
de bourre. Il consiste battre, lit par lit, entre des planches, lpaisseur
ordinaire des murs de moellons, de la terre prpare cet effet. Ainsi bat-
tue, elle se lie, prend de la consistance, et forme une masse homogne qui
peut tre leve toutes les hauteurs donnes pour les habitations.
(Cointereaux Les Cahiers de lcole dArchitecture Rurale)
Cette technique dune mise en uvre simple, a permis ldification de bti-
ments trs sains, car le pis est trs respirant, et contrairement ce que lon
pourrait penser, trs solide.
46 La maonnerie
A condition, toutefois, quait t particulirement soigne la protection
leau : les constructions en terre sont en effet, plus que toutes autres, sensi-
bles aux actions de leau : que celle-ci coule la surface des murs et sva-
pore aussitt, la maonnerie de terre nen sera pas affecte. Si, par contre,
elle y pntre, la dgradation est invitable.
Tout doit donc tre mis en uvre pour viter les pathologies humides par
pntration de leau dans la masse des murs, plus particulirement la base
de ceux-ci et en partie haute.
Comme le dit un diction populaire du Devon : une maison en terre ne
demande quun bon chapeau et de bonnes bottes .
2
MISE EN UVRE DU COFFRAGE
Lon distingue deux techniques assez diffrentes, qui taient utilises essentiel-
lement dans le Lyonnais et en Auvergne, pour une part, et dans le Bugey pour
lautre part.
Un tmoignage du 18
me
sicle sur la solidit dun difice en pis.
Lorsque les murs en pis sont bien faits, ils ne forment quune seule
pice, et lorsquils sont revtus lextrieur dun bon enduit, ils peu-
vent durer des sicles. En 1764, je fus charg de restaurer un ancien
chteau dans le dpartement de lAin. il tait bti en pis depuis plus
de 150 ans. Les murs avaient acquis une duret et une consistance
gales aux pierres tendres de moyenne qualit, telles que la pierre de
St-Leu. On fut oblig, pour agrandir les ouvertures et faire de nou-
veaux percements, de se servir de marteaux pointe et taillant,
comme pour la pierre de taille."
(J. Rondelet)
Coffrage bauge et dtail du montage
d'une de ses banches dans une clef
47 La maonnerie
A
Mthode du Lyonnais et dAuvergne
Dans ces deux rgions, les coffrages sont composs de deux banches, dont
lcartement est maintenu en pied par des entretoises (les "clefs" ou "lan-
onniers"), dans lesquelles sont fichs des poteaux (les "aiguilles"), serrs
la base par des coins, et en tte par une corde bride par un bton (Lyonnais)
ou par un "joug" du mme principe que les "clefs" (Auvergne).
Lcartement des banches est assur, en partie suprieure, par un petit bois
appel "gros du mur".
Les banches sont composes de trois ou quatre planches de bois, de deux
quatre mtres de longueur, assembles rainures et languettes par quatre
montants, (les "barres"), et quipes de poignes (les manettes) pour en
faciliter la manutention.
Les dimensions optimales seraient de 2,60 ml de longueur et 80 cm de hauteur.
Un fond de banche, appel "closoir" ou "tte de moule", est utilis pour
fermer le coffrage lors de la ralisation des angles ou des baies. Il est consti-
tu de deux planches verticales, assembles extrieurement par deux plan-
chettes. Sa forme est lgrement trapzodale lorsque lon veut donner du
fruit au mur.
Les poteaux, de mme constitution que les clefs, dpassent la banche denvi-
ron 50 cm. Ils serrent les banches sur lassise du mur dj excut par linter-
mdiaire de coins de bois enfoncs dans les mortaises des clefs et des jougs.
B
Mthode du Bugey
Le procd de construction est identique mais avec un systme de maintien
des banches par perches verticales de la hauteur du mur construire. Celles-
ci sont mises en uvre au pralable sur toute la priphrie de ldifice, ce qui
facilite grandement le montage et le dmontage des coffrages quil suffit de
faire glisser dune srie de quatre poteaux la suivante, en dliant et reliant
les cordes de serrage des perches, et en soutenant les banches latralement.
Ce systme prsente lavantage de la rapidit, mais il ne permet ddifier que
des constructions de hauteur limite, et le matriel ncessaire sa mise en
uvre est encombrant et difficile transporter.
3
CONSTRUCTION DES MURS EN PIS
A
Extraction et prparation de la terre
Il convient de choisir une bonne terre : grasse, non organique, pas trop
argileuse elle se compacterait mal pas trop humide, ferme mais plas-
tique et sans mottes dures (catons).
La composition idale :
limon : 20 35 %
argile : 15 25 %
sable : 40 50 %
graviers : 0 15 %
Cette terre est pioche, bien divise la pelle, mise en tas, pour permettre
aux grumeaux et aux trop gros cailloux de rouler en bas du tas. Les vgtaux,
qui risquent de pourrir, sont soigneusement enlevs.
48 La maonnerie
Cette prparation se fait en quantit suffisante pour une seule journe de
travail ; il est en effet impossible de "piser" une terre dtrempe ou trop
sche on prvoira donc des bches pour la protger de la pluie ou dun
soleil trop ardent, si cela savre ncessaire.
B
Confection du soubassement
Les murs de terre sont particulirement sensibles aux risques drosion par leau :
eaux stagnantes, ruissellements, rejaillissements, remontes capillaires, etc.
Pour viter la dgradation de la partie basse des murs, on difie un soubas-
sement en maonnerie de pierres ou de briques dau moins quarante centi-
mtres de hauteur.
Sa largeur est dtermine par la hauteur de ldifice ; en effet, le bon rap-
port entre la hauteur et lpaisseur du mur est situ entre 1/10 et 1/15. Mais
il est difficile de descendre en dessous de 40 cm dpaisseur sans gner le
travail des maons piseurs.
C
lvation du mur, suivant les mthodes lyonnaise et auvergnate
Sur le soubassement tabli et nivel, lemplacement des ds est trac, un
espacement dtermin par la longueur de la banche ( ~ 80 cm daxe en axe
pour des banches de 2,60 m). La maonnerie est remonte dune assise, en
rservant des tranches au droit de ces emplacements, pour pouvoir y loger
les entretoises.
Puis, partir dun angle de ldifice, la premire srie de quatre clefs est
pose, les banches montes, avec poteaux, jougs ou liages de cordes, gros
du mur, fond de banche laplomb de langle, le tout bien serr avec les
coins (et les cordes dans les banches auvergnates), la partie infrieure des
banches enserrant le mur de soubassement.
Les tranches des clefs sont ensuite couvertes de quelques pierres minces et
dun coulis de mortier de chaux, pour rattraper larase gnrale du mur du
soubassement.
Le mme mortier est prolong en filet, sur le pourtour de lencaissement,
afin dassurer une bonne finition des joints entre deux banches.
La terre est ensuite verse dans le coffrage, par couches successives (les
"tarrdes") dune vingtaine de centimtres dpaisseur, ramene 10 cm
par damage coups de pisoirs administrs par des piseurs monts dans la
banche, ceci pour assurer une parfaite adhrence entre les deux lits.
Aprs plusieurs passages successifs, la premire couche est bien battue, et
lon passe la suivante, jusqu remplir le moule, lit aprs lit.
Le coffrage est alors immdiatement dmont, et remont, en recouvrant
lextrmit de la banche prcdente.
Cette extrmit est soit verticale soit, le plus souvent, oblique, 45. Cette
disposition permet dviter lutilisation du fond de banche, ce qui facilite le
montage et le dmontage du coffrage, et permet, en outre, une meilleure
liaison de deux banches successives.
Un joint de mortier est mis en uvre en bordure de cette extrmit, avant
de commencer la banche suivante. Lopration est rpte jusqu avoir fait
le tour complet de ldifice, faades et refends tout ensemble.
On aura pris soin de vrifier de temps autre, la verticalit du mur, laide
dun fil plomb.
49 La maonnerie
La seconde assise est alors excute de la mme faon, en chevauchant per-
pendiculairement, dans langle, la premire assise, en dcalant les trous des
cls, pour viter la formation de fissures verticales, et en tournant dans le
sens contraire.
Puis, on laisse scher de une trois semaines, avant de recommencer les
mmes oprations.
Selon les rgions, le pis est laiss brut, ou badigeonn dun lait de chaux,
ou enduit la chaux, au pltre, ou encore recouvert dun torchis ou dun
blanc de bourre, mlange de chaux, dargile blanche, de sable et de poils
danimaux.
D
Traitement des points particuliers
a
les angles :
ils peuvent tre en pis, avec interposition de lits de chaux entre chaque cou-
che, ou bien faits dune armature de branchages intervalles rguliers.
On trouve souvent des traitement dangles en chanages de maonneries :
pierres, galets, briques, etc.
b
les chanages :
les murs sont gnralement chans, en encastrant dans lpaisseur des
murs, dans le plan horizontal, des madriers denviron 15 cm de ct, assem-
bls aux angles. Ces bois sont noys dans un bain de mortier de pltre ou de
terre, sils sont en chne, de chaux sils sont en sapin, raison de deux ou
trois plans de chanage sur une hauteur dtage.
c
les ouvertures :
elles sont ralises en posant deux closoirs dans la banche, lgrement va-
ss vers lintrieur pour crer un brasement biais.
Elles peuvent tre traites avec des jambages et des linteaux en bois ou enco-
re en maonneries de briques.
d
les planchers :
deux mises en uvre sont possibles :
soit en creusant le logement des poutres et solives dans les murs une
fois quils sont monts sur toute leur hauteur,
soit en rservant lencastrement des poutres et solives au sommet des
murs, lorsque lon a mont une hauteur dtage. Ces rservations doi-
vent se faire en dessous du niveau des clefs de la premire assise de
ltage immdiatement suprieur.
Toutes prcautions doivent tre prises pour protger labout des pices de
bois noyes dans les murs (enduction dasphalte, par exemple).
e
les charpentes et couvertures :
on ne trouve gnralement pas de fermes de charpente dans les maisons en
pis, mais plutt des charpentes simplifies, pannes reposant sur les
pignons et sur des refends.
La couverture est celle utilise traditionnellement dans la rgion. Elle peut
tre de tout type : chaume, ardoises, tuiles plates ou canal, etc., mais ne pr-
sente pas forcment de grands dbords.
Elle doit tre parfaitement tanche, les infiltrations deau dans les parties
hautes des murs de pis tant particulirement redoutables pour la prenni-
t de ldifice.
50 La maonnerie
4
CONSTRUCTION DES MURS EN "MSSE"
Le mode de construction appel "msse" ou "bauge" tait trs rpandu en
Angleterre et proximit des zones argileuses du Cotentin : de nombreux
btiments construits ainsi subsistent encore. Exploitant au mieux les ressour-
ces locales, le mur en msse est constitu d'un mlange d'argile, de sable,
d'clats de pierre et de fibres vgtales, la texture uniforme.
Particularit : le mur en msse est construit sans ossature interne ; c'est sa
forte paisseur et sa cohsion interne qui lui confrent sa solidit.
A
Technique de construction traditionnelle :
L'argile est mouille, retourne, tape la fourche et pitine par des chevaux,
jusqu' l'obtention d'un mlange plastique. On y ajoute ensuite des fibres
(paille, foin, crin) raison de 25 kg environ par m
3
, et on la foule au pied.
Le mlange frais est alors mont la fourche, en lits superposs et croiss,
puis tass la trique. Aprs 2 3 semaines de schage, les murs sont retaills
la serpe ou la bche pour verticaliser les parements intrieurs et extrieurs ;
puis un coup de truelle lisse les parements si aucun enduit n'est prvu.
Sur la hauteur de rejaillissement des eaux de pluie, la base du mur est gn-
ralement ralise en maonnerie traditionnelle de moellons. Les angles du
btiment le sont parfois aussi, qu'il s'agisse d'une disposition d'origine ou
d'un renfort ultrieur.
Fentres et portes sont trs peu nombreuses et se limitent de simples trous
rservs lors du montage du mur, avec jambages et linteau en bois. Il arrive
qu'ils soient mme simplement retaills la hache dans le mur fini et sec.
B
Principales pathologies
Les principales pathologies sont lies l'humidit. Ce sont aussi les plus gra-
ves car elles sont dordre structurel. Non traites, elles peuvent affecter rapi-
dement la construction jusqu son effondrement.
Les dsordres se manifestent essentiellement de trois faons :
les fissures,
le flambement des murs,
la dcomposition de la terre.
Maison construite en msse
51 La maonnerie
a
Les fissures :
Les plus caractristiques sont les fissures de retrait, dues la mauvaise qua-
lit de la terre employe, sa trop grande humidification lors de llvation
des murs, un schage trop rapide ou encore de fortes variations hygro-
mtriques.
Elles sont verticales et espaces assez rgulirement, de 50 cm 1 m.
Dautres types de fissures, plus proprement structurales, sont dues un dpas-
sement des possibilits de rsistance du matriau des contraintes mcaniques.
Rappelons ce sujet que le matriau terre supporte mal les efforts de trac-
tion, flexion ou cisaillement, et ne travaille bien quen compression.
Les fissures structurales sont en gnral localises en des points prcis :
ouvertures, appuis de poutres, liaisons avec des matriaux durs.
Elles peuvent aussi apparatre en pleine masse du mur, en cas de dsordres
au niveau des fondations.
b
Le flambement des murs :
Il arrive que les murs forment un ventre, sans pour autant que des fissures
apparaissent, la terre prsentant dimportantes caractristiques de fluage.
Ce phnomne est du de fortes contraintes mcaniques, quun trop grand
lancement du mur, labsence de chanage ou le nombre trop important
douvertures ne lui permet pas dencaisser.
c
Dcomposition de la terre :
Cette dcomposition relve le plus souvent dune pathologie humide : le
matriau devient friable, seffrite, srode ; l aussi, peuvent tre mis en
cause un mauvais choix de terre, une mauvaise excution, laction de para-
sites vgtaux, dinsectes ou de rongeurs, les influences climatiques (vent +
pluie).
Construction en masse : dtail
du soubassement en pierre
52 La maonnerie
La mthode de construction la plus rpandue consiste assembler des lments
de pierres ou de briques avec un mortier.
Le rle de ce mortier est trs important : il permet de donner une certaine coh-
sion aux lments de pierres ou de briques, et de mieux rpartir les charges.
Il convient toutefois de ne pas les considrer comme une colle ou un adhsif,
rendant la construction monolithique et indformable. Bien au contraire et
ceci est particulirement vrai pour les constructions des poques romane et
gothique - ils conservent une certaine "souplesse" et permettent ainsi aux di-
fices de mieux supporter nombre de dformations dues des causes diverses :
trop fortes pousses de votes, faiblesse des fondations, etc.
Pour restaurer une maonnerie ancienne, il est donc trs important de bien
analyser le mortier d'origine, et d'en employer un identique.
I LES SABLES ET GRANULATS
Dans tout mortier, quelle que soit la nature du liant, on utilise des granulats,
charges inertes permettant de rduire la quantit de liant et dont le rle et
les effets varient selon la nature de ce dernier.
Mlangs des ciments et des chaux artificielles, les granulats doivent tre
les plus neutres et uniformes possible, le liant assurant lui seul, de par ses
caractristiques mcaniques leves et son opacit, la rsistance et la colo-
ration du mortier.
Dans les mortiers raliss avec des liants naturels (chaux ou pltres) les seuls
pratiquement qui nous intressent pour la restauration des monuments
anciens le choix des granulats est important car ils ont pour rle :
de donner de la rsistance aux mortiers, dont ils constituent l'ossature,
de diminuer les phnomnes de retrait, en donnant du volume au mortier,
de colorer les mortiers, en jouant sur l'effet de transparence de la chaux,
de personnaliser l'aspect du mur et lui donner ses caractristiques
rgionales par la diversit des matriaux locaux employs.
Chapitre 4
LES MORTIERS
Fabrication d'un mortier sable et chaux
Les mortiers sont constitus
essentiellement par malaxage
de sable ou granulats, de liant et d'eau.
Certains produits peuvent y tre
ajouts pour changer leur coloration
ou amliorer leurs proprits.
53 La maonnerie
Les granulats utiliss pour la ralisation des mortiers d'enduit sont les sables.
Matriaux forms de granulats fins, ils proviennent de la dsagrgation,
naturelle ou artificielle, d'une roche sdimentaire. Ils sont le plus souvent sili-
ceux, ou silico-calcaires, rarement calcaires (poudre de marbre, par exemple).
Ils proviennent principalement :
du lit des rivires,
du littoral marin (soigneusement lavs),
de carrires,
de gnration artificielle, par concassage de roches.
Dans le bti ancien, les sables prsentent des grains variant de l'infiniment
petit (fines) des lments de plus de 10 mm, voire 15 mm pour les plus gros
d'entre eux (graviers).
En tout tat de cause, un sable bien "quilibr" doit prsenter des grains de
diamtres diffrents, permettant de limiter les vides, et donc d'viter le sur-
dosage en liant pour combler ceux-ci. En effet, un dosage trop riche en liant,
peut provoquer un retrait important et des risques de micro-fissuration
(faenage).
Proprits requises
Le sable utilis pour raliser des mortiers denduit doit :
comporter une courbe granulomtrique rpartie (granulats de taille dif-
frente) : les enduits sont raliss avec des sables dont la courbe gra-
nulomtrique idale est comprise entre 0,3 mm et 15 mm.
Dans le bti traditionnel on observe des sables plus grossiers :
il conviendra donc de faire des essais.
A linverse, des sables trop fins et un dosage important entranent du
retrait, ils sont donc utiliser avec prudence et sur de faibles pais-
seurs. On les associera avec des chaux ariennes permettant un res-
serrage successif de lenduit. Dans tous ces cas, des essais de conve-
nance sont raliser.
tre propre :
les sables ne doivent pas comprendre plus de 5 % dlments trs fins
comme les argiles, terre vgtale, charbons.
tre inerte :
le sable utilis doit tre chimiquement inerte. Il faut viter tous les sols
comportant des sels, des dchets organiques. Dans le cas de sable peu
sr, il sera ncessaire de raliser des tests de convenance, notamment
dans le cas de sable de mer.
tre homogne :
pour la ralisation d'un enduit, et afin dobtenir une bonne homog-
nit sur lensemble des zones traites, un approvisionnement global
et unique du chantier doit tre recherch.
Foisonnement des sables
Dans la composition du mortier, les volumes indiqus pour les sables suppo-
sent qu'ils sont l'tat sec. Or, dans la plupart des cas, les sables sont plus
ou moins humides : la prsence de l'eau augmente leur volume apparent,
c'est le foisonnement.
54 La maonnerie
Le foisonnement augmente en fonction du degr de finesse du sable. Il peut
atteindre des valeurs relativement importantes, et si l'on n'en tient pas
compte, on obtiendra un sous-dosage en sable prjudiciable la bonne com-
position du mortier et son ouvrabilit.
Sauf tude plus dtaille du problme, on peut, en premire et grossire
approximation, prendre en compte un coefficient de foisonnement de + 25%.
Autrement dit, pour un volume apparent de sables sec de 400 litres, il faut
compter en fait 500 litres.
Granulats particuliers
Certains granulats sont recherchs pour leur raction pouzzolanique
(raction des silicates et aluminates contenus dans les granulat avec la chaux
et leau de gchage pour former un hydrate stable donnant au mortier une
certaine hydraulicit).
Parmi ces principaux granulats, on peut citer :
les tuileaux, tuiles, briques piles, pouzzolanes, cendres, etc
D'autres granulats sont recherchs pour des questions d'aspect ou de coloration :
certaines poudres de pierre (marbre notamment), talc,
certains limons ou argiles, utiliss notamment pour la coloration,
ou en revtement particulier sur certaines maonneries argileuses.
I LES LIANTS
On appelle "liants" les matires qui ont pour proprit d'assembler par col-
lage des matriaux inertes. Le liant a une influence sur les rsistances des
mortiers, notamment la rsitance l'crasement.
Selon leur origine, on distingue trois catgories de liant :
organique
minral
synthtique
Les principaux liants utiliss dans la construction mais dont certains sont
proscrire dans les maonneries des monuments anciens sont d'origine
minrale : ce sont les chaux, les pltres et les ciments.
1
CHAUX
La chaux a t utilise depuis 6000 ans de faon trs constante dans la cons-
truction.
Jusqu' la rvolution industrielle, elle a t le principal liant de la construction,
qu'elle ait t incorpore des mortier de hourdage, des enduits de parement,
ou bien utilise l'tat pur pour lier des peintures ou badigeons. Elle a galement
servi raliser les stucs et les fresques.
Elle a donc grandement particip la solidit et la beaut des difices, pres-
tigieux ou non, de l'Antiquit l'poque moderne.
55 La maonnerie
La chaux est obtenue par calcination de pierres calcaires rduites en poudre,
suivie d'une opration d'extinction l'eau : selon la qualit des roches extrai-
tes, la nature de la chaux obtenue sera diffrente.
Composition
Analyses chimiquement, les chaux ont pour principaux composants, essen-
tiellement des oxydes de calcium (CaO) et/ou des hydroxydes de calcium
[Ca(OH)2], pouvant comprendre des quantits moindres de magnsium
(MgO), d'hydroxyde de magnsium [Mg(OH)2], de silicium (SiO2), d'alumi-
nium (Al2O3) et de fer (Fe2O3).
C'est actuellement la marque europenne EN 459 qui s'applique. Les chaux
se divisent en deux catgories bien distinctes, selon que leur prise s'effectue
sous l'action du gaz carbonique de l'air - chaux ariennes - ou sous l'action de
l'eau - chaux hydrauliques -.
A
Les chaux ariennes
Grasses ou maigres suivant qu'elles sont obtenues partir de calcaires trs
purs (chaux grasses) ou de calcaires contenant des impurets (magnsie, sili-
ce, aluminium, fer), on les trouve sous deux formes :
a
les chaux vives
Elles sont constitues principalement d'oxyde de calcium et ventuellement
d'oxyde de magnsium (chaux Dolomitiques). Elles sont obtenues par calci-
nation dans un four, vers 900-1000, de roches calcaires (carbonate de cal-
cium CaCO3, dit pierre chaux), donnant l'oxyde de calcium CaO, ou chaux
vive anhydre, et un dgagement de gaz carbonique.
Elles taient autrefois trs rarement aujourd'hui teintes sur le chantier :
lors de l'opration d'extinction, les chaux vives ont une raction exother-
mique lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau.
Fosse chaux sur un chantier en Roumanie
56 La maonnerie
b
les chaux teintes
A partir de chaux vives finement broyes, on procde l'hydratation, ou
"extinction contrle" de cette chaux vive pour obtenir l'hydroxyde de cal-
cium Ca(OH)
2
, ou chaux teinte, prte utiliser comme liant aprs tamisage
ou blutage.
La raction de prise de cette chaux est une raction de carbonatation, dans
laquelle le gaz carbonique de l'air (CO2) se combine avec la chaux teinte
pour donner du carbonate de calcium (calcite) et de l'eau qui s'vapore :
Ca(OH)2 + CO2 >> CaCO3 + H2O.
Cette raction, lente et progressive, s'effectue l'air (d'o le nom de chaux
arienne) : le durcissement complet qui suit la prise d'un enduit ou d'un mor-
tier de chaux arienne peut durer plusieurs mois ; sous l'eau, ou l'abri de
l'air, la chaux grasse peut rester 6 mois un an (ou mme plus voir encart)
avant de faire prise.
Fabrication de la chaux grasse sur un chantier mdival
1 Opration de cuisson : elle dure 3 jours, les pierres calcaires sont
calcines 900 C ou 1000 C, dans un four.
2 Opration d'extinction : on teint ces pierres calcines en les
mlangeant de l'eau dans un bac en tle ou en bois. ct de cette
cuve, a t creuse une fosse de terre bien dame qui servira de bas-
sin de refroidissement pour la chaux. Il est conseill de limiter les pha-
ses successives de fabrication de 70 140 litres de chaux. On verse de
l'eau sur la chaux en roche raison de 50 % du volume, soit 35 litres
d'eau pour 70 litres de chaux. La chaux fuse et c'est alors qu'il faut la
malaxer avec beaucoup de patience pour en faire une espce de pte
jusqu' la fin de l'bullition. On laisse couler cette sorte de pte dans
la fosse, en prenant soin de retenir les morceaux de roche non enco-
re fondus. On laisse reposer cette masse pendant 15 jours, au moins,
l'air. Cette chaux peut tre conserve pendant plusieurs annes.
(Y.M. FROIDEVAUX "Techniques de l'architecture ancienne").
De la "souplesse" des constructions riges avec un mortier de chaux
arienne.
Lors de la dernire guerre mondiale, la ville de Rouen subissait un
bombardement en rgle. De nombreux obus clataient l'intrieur
de la cathdrale, dtruisant le bas ct sud et dtriorant bon nomb-
re de piles dans les autres parties de l'difice. En particulier, une des
piles du transept, forme d'un faisceau de colonnettes, et atteignant
12 m de circonfrence, tait si gravement atteinte qu'il fut dcid de
la remonter et de la reconstruire.
Aprs avoir mis en place le chevalement ncessaire l'excution de
ces travaux, le dmontage commena.
Quelle ne fut la stupfaction de dcouvrir qu'au centre de la pile, o
l'air n'avait pu pntrer, le mortier du 13me sicle tait l'tat
pteux, n'ayant toujours pas fait sa prise !
57 La maonnerie
B
les chaux hydrauliques NHL et HL
Les chaux hydrauliques peuvent contenir jusqu 22% d'argile : cela leur
donne des proprits proches de celles des ciments.
Au contact de l'eau, elles ont la proprit de faire prise et de durcir. Le dioxy-
de de carbone prsent dans l'air contribue galement au processus de dur-
cissement.
Le taux d'argile dfinit "l'indice d'hydraulicit" ; une chaux est dite :
faiblement hydraulique si son taux d'argile est infrieur 8 %,
moyennement hydraulique, avec un taux d'argile de 8 14 %,
minemment hydraulique, partir de 20 % d'argile.
On distingue :
a
les chaux hydrauliques naturelles dites chaux vives
(NHL / Natural Hydraulic Lime)
Ce sont des chaux obtenues par la calcination de calcaire plus ou moins argileux
ou siliceux, avec rduction en poudre par extinction, avec ou sans broyage , et
sans ajout ; elles sont appeles "chaux hydrauliques naturelles" (NHL).
Les chaux hydrauliques naturelles auxquelles on additionne de faon appro-
prie des matriaux pouzzolaniques ou hydrauliques, jusqu' 20 %, sont
dsignes par NHL-Z.
b
les chaux hydrauliques (HL / Hydraulic Lime)
Elles sont fabriques par calcination de calcaires contenant de l'argile l'-
tat naturel ; aprs cuisson, broyage et extinction, on leur incorpore d'autres
constituants pour corriger ou amliorer le produit obtenu : fillers calcaires,
laitier, pouzzolanes, grappiers broys.
Ces chaux sont constitues principalement de silicates de calcium, d'alumi-
nates de calcium et d'hydroxyde de calcium produits par la calcination, l'ex-
tinction et le broyage de calcaires argileux et/ou par le mlange avec de l'hy-
droxyde de calcium de matriaux appropris.
Des additifs organiques peuvent tre ajouts tous les types de HL et NHL.
CONSEIL DE PRUDENCE
L'ancienne appellation "chaux hydraulique artificielle" ou XHA, qui
distinguait des ciments Portland additionns de fillers calcaires iner-
tes, n'existe plus. Ces produits rejoignent dsormais les ciments.
Marquage
Les chaux de construction conformes au prsent document doivent porter
un marquage sur le sac ainsi que sur le bon de livraison, sur la facture, ou sur
tout autre document joint la livraison, avec les indications suivantes :
1- le type de chaux de construction
2- l'appellation commerciale du type de chaux de construction (si diffrente du type)
3- le lieu de fabrication
4- le poids brut (si le conditionnement est en sac)
Classification des types
de chaux de construction
Les diffrents types de chaux sont classs en fonction
de leur teneur en hydroxyde de calcium (chaux cal-
ciques / CL), en hydroxyde de magnsium (chaux
dolomitiques / DL) ou en fonction de leur rsistance
la compression (chaux hydrauliques HL et NHL),
comme suit :
1- chaux calcique 90 . . . . . . . . . . . . . . . .CL 90
2- chaux calcique 80 . . . . . . . . . . . . . . . .CL 80
3- chaux calcique 70 . . . . . . . . . . . . . . . .CL 70
4- chaux dolomitique 85 . . . . . . . . . . . .DL 85
5- chaux dolomitique 80 . . . . . . . . . . . .DL 80
6- chaux hydraulique 2 . . . . . . . . . . . . . . .HL 2
7- chaux hydraulique 3,5 . . . . . . . . . . . .HL 3,5
8- chaux hydraulique 5 . . . . . . . . . . . . . . .HL 5
9- chaux hydraulique naturelle 2 . . . . .NHL 2
10-chaux hydraulique naturelle 3,5 . . .NHL 3,5
11-chaux hydraulique naturelle 5 . . . . . .NHL 5
Plus la teneur en argile est importante, plus lindice
dhydraulicit est important et plus la rsistance la
compression augmente.
58 La maonnerie
2
PLTRES
Le pltre est connu depuis environ 10000 ans : la pyramide gyptienne de
Chops (2800 avant J.C.) en comporte.
Dj utilis par les Grecs, le pltre a t introduit en Gaule par les Romains,
et ses traditions de fabrication ont t maintenues par les moines (Citeaux,
Cluny) ; son utilisation sest dveloppe partir du XIII
e
sicle pour les cloi-
sons, jointoiements, crpis, puis pour les plafonds et la dcoration.
La prsentation de ce matriau millnaire en lments prfabriqus (carreaux
et plaques de pltre) en fait un composant actuel et moderne du btiment,
en particulier en France o les gisements de gypse sont abondants (surtout
en rgion parisienne, Provence et sud-ouest).
Composition
Le pltre est obtenu partir de sulfate de chaux (gypse) dit "pierre pltre"
(CaSO4, 2H2O) dshydrat par cuisson modre, puis broy.
On l'utilise en le rhydratant par mlange dans l'eau. Il se forme alors un gel
collodal qui cristallise de faon irrversible, avec un lger gonflement et un
dgagement de chaleur. L'enchevtrement des cristaux en aiguilles, dit feu-
trage, donne sa cohsion au pltre.
Mme serr, le pltre est toujours gch avec une quantit d'eau (60
90 %) trs suprieure celle qui serait thoriquement ncessaire sa rhy-
dratation (de l'ordre de 25 % de son poids) ; d'o un temps de schage rela-
tivement long avant limination complte de l'eau en excs.
Principales caractristiques du pltre
Le pltre est un matriau de duret moyenne (sauf pltre spcifique) : selon
son taux d'eau de gchage, sa rsistance la compression aprs 7 jours de
schage, va de 30 90 kg/cm2. Sa rsistance l'arrachement va de 10 16
kg/cm2.
La densit apparente du pltre dpend aussi de son taux de gchage : elle
va de 1 (gchage 80 % d'eau) 1,45 (gchage 45 %) et 1,70 pour le
pltre alun. Le pltre offre une excellente rsistance au feu mais rsiste mal
une exposition frquente l'humidit.
Principales varits et dnomination des pltres utiliss dans la res-
tauration des monuments anciens
Pltre gros de construction ou PGC : pltre courant de mouture grossire, uti-
lis surtout pour les premires couches d'enduits et les scellements au pltre.
Pltre fin de construction, ou PFC : pltre de mouture fine, exempt de gros
grains, utilis pour les plafonds et les couches de finition des enduits coups
Fabrication du pltre
Selon le niveau de dshydratation auquel on soumet le gypse par
"cuisson", on obtient diverses qualits de pltres allant des hmihy-
drates ou semi-hydrates, vers 150C (CaSO, 1/2HO) aux anhydrites
(CaSO4), de 200 1200C. La fabrication a lieu par voie sche, par cuis-
son du gypse concass dans des fours verticaux (four Beau). Elle est
suivie d'un broyage (mouture) et de mlanges avec des ajouts ou avec
d'autres qualits de pltre pour obtenir les caractristiques voulues.
Bien que rare, la fabrication par voie humide se pratique aussi, en
autoclave, sous pression, pour des pltres spciaux (par exemples, pl-
tres mouler dentaires).
59 La maonnerie
ou lisss.
D'autres types de pltres sont employs pour des ouvrages spcifiques.
Par exemple :
Le pltre alun : aprs une premire cuisson vers 150 C, le pltre est addi-
tionn, par immersion, d'une solution d'alun, puis recuit. Sans retrait ni
expansion, il peut tre utilis en mortier par addition de granulats (calcaire,
marbres) ; dur, pouvant tre poli comme un marbre, il sert surtout la
confection des ouvrages en stuc.
Le pltre borat : pltre pour stucs, obtenu en lui ajoutant une petite quan-
tit de borate de soude.
Le pltre-chaux
Cest un mlange souvent employ : il est constitu de pltre, de chaux
arienne et dune petite quantit de sable.
On lutilise pour la confection d'enduits extrieurs, surtout dans la rgion
parisienne ; une impermabilisation superficielle est ncessaire par fluatation
ou par traitement au silicate de potasse. Cette formule est plus rsistante, en
extrieur, que celle des enduits ou mortiers de pltre pur qui ncessitent des
ouvrages de protection contre la pluie et les ruissellements d'eau bandeaux
larmier chaque tage, peinturage priodique.
Principaux emplois du pltre
Les emplois du pltre dans le btiment concernent en quasi-totalit des
ouvrages intrieurs : enduits sur murs et plafonds, doublages et cloisons en
lments prfabriqus (carreaux et plaques cartonnes) ; le jointoiement au
pltre des pierres de taille, les ouvrages de stuc, de staff et certains ragra-
ges de sols base de pltre compltent ces emplois intrieurs ; par contre,
l'emploi du pltre se retrouve sous forme d'augets de planchers.
L'emploi en enduit extrieur se trouve frquemment dans les vieux quartiers
de Paris, sous forme de mortier pltre-chaux ou de pltre gros peindre.
CONSEILS DE PRUDENCE
- ne pas raliser un enduit de pltre sur un support avant qu'il n'ait
termin son retrait et soit bien stabilis.
- sur une cloison mince, ne pas appliquer de pltre (lger gonfle-
ment) sur une face, et un enduit de ciment (lger retrait) sur l'aut-
re face.
- ne jamais recouvrir de pltre un joint de structure ou de dilata-
tion.
- ne jamais appliquer de ciment sur un support contenant du plt-
re. Une exception concerne cependant des mortiers-colles spciaux
base de ciment casn, destins la pose de revtements cra-
miques sur pltre.
- ne pas utiliser le pltre pour des ouvrages qui risquent d'tre fr-
quemment exposs l'humidit.
- tenir compte du fait que le pltre attaque les mtaux ferreux
(chssis de baies, armatures, outillage, )
3
CIMENTS
Le ciment est un liant minral en poudre, obtenu partir de clinker, finement
broy les clinkers sont de petites boulettes dures de silicate, ou nodules,
60 La maonnerie
qui rsultent de la cuisson d'un mlange d'argile et de calcaire.
Cette poudre, tout comme la chaux ou le pltre, mlange de l'eau, fait
prise et permet d'agglomrer entre eux des sables et des granulats pour
constituer des mortiers ou des btons qui sont de vrais roches artificielles.
La mise au point du premier ciment, en 1824 Portland (Angleterre) est la-
boutissement de longues recherches et exprimentations menes par les
btisseurs, puis les ingnieurs, pour lamlioration des proprits et des per-
formances des mortiers de chaux.
La priode de la reconstruction, aprs la Seconde Guerre mondiale, marque
un tournant dcisif dans le dclin de la chaux et lavnement du ciment dans
la construction. Mais, quelques dcennies plus tard, ce dernier a clairement
montr ses limites, tant au niveau de son comportement en particulier lors-
quil est alli aux maonneries anciennes - que de son aspect esthtique. Les
proprits ingalables de la chaux sont redcouvertes la faveur de la sau-
vegarde et la rhabilitation des centres anciens.
CONSEIL DE PRUDENCE
Mme pour une utilisation, mesure et matrise, en coulis de
confortation interne ou en ralisation de certaines structures de
consolidation, l'emploi du ciment dans les maonneries de pierres
est formellement dconseill.
Pendant les annes '60 '80, le ciment a t considr comme une
panace cause de sa rsistance mcanique et son tanchit.
Mais ce produit a depuis largement dmontr sa dangerosit,
notamment sur le bti ancien. Les dommages sont souvent irr-
versibles, car derrire la faade recouverte de ciment, la maon-
nerie ou le pan de bois se sont dsagrgs.
En effet, le ciment agresse la pierre : s'il est utilis pour hourder
des maonneries de moellons, des sels se produisent, drains par
l'effet de capillarit diffrentielle vers la zone de jointure. La pier-
re subit alors une perte de ses particules ultra fines et devient
poudreuse.
De mme, lorsqu'un enduit de ciment et de sable est appliqu sur
un mur en pierres, lhumidit emprisonne ronge la pierre, len-
duit cloque et se dtache en plaques. Les pierres, irrmdiable-
ment altres devront tre remplaces. (cf. photo ci-dessus).
Pierres altres par l'utilisation
de mortier de ciment
61 La maonnerie
Lorsque les joints sont effectus au ciment, ils constituent une barrire tan-
che et contraignent lhumidit migrer travers la pierre ; la longue, celle-
ci est comme ronge, en retrait de plusieurs centimtres par rapport aux
joints de ciment.
Autre erreur souvent commise : appliquer du ciment en soubassement d'une
faade en maonnerie : l'eau emprisonne dans la maonnerie est contrain-
te remonter par capillarit jusqu'au bord suprieur du soubassement pour
s'vaporer. cette zone se dgrade alors rapidement.
4
EAU
Leau rentre dans la composition des mortiers afin de rendre plastique les
mlanges poudreux, de permettre la carbonatation des chaux par dissolution
du gaz carbonique, de permettre la prise des chaux hydrauliques.
Proprits
Leau doit tre propre (norme NFP 18.303). Il est conseill dutiliser leau
potable. Dans le cas contraire, il convient dtre attentif ne pas utiliser les
eaux charges en sels (sulfates, eaux rsiduelles...) ou acides.
Dans le cas de leau de mer dont lusage traditionnel est attest mais qui est
a priori proscrite, il est ncessaire deffectuer des essais de tenue et daspect
(possibilit dapparition de nuances, defflorescences).
5
PRODUITS DAJOUTS
Certains produits peuvent, par ailleurs selon les cas, tre ajouts au mortier
afin den modifier les proprits, cest notamment le cas pour :
Ancienne usine doxyde rouge
62 La maonnerie
les pigments, pour colorer les mortiers
les armatures, pour renforcer la cohsion des mortiers
les liants complmentaires divers
A noter : lajout de ciment blanc, ou autre liant artificiel, doit tre vit ou
rester trs limit.
Les pigments
Les pigments sont des poudres colores, insolubles, dorigine minrale.
Ils sont utiliss traditionnellement pour peindre des parements en les mlan-
geant un lait de chaux. Aujourdhui on les utilise aussi en les mlangeant au
mortier pour les colorer dans la masse, dans ce cas la norme du DTU 26.1 pr-
voit de ne pas dpasser 3 % du poids de chaux, mais on peut y droger en
fonction de la granulomtrie et de la propret du sable.
Lemploi de ces pigments oblige contrler leur tenue en milieu alcalin (com-
patibilit avec la chaux) : celle-ci est trs bonne pour les terres naturelles
(terre de Sienne, terre d'Ombrie, etc.) et les ocres, elle doit tre vrifie dans
le cas doxyde mtallique ou de tout autre produit colorant (gnralement
dconseiller).
Les armatures
On trouve de nombreux cas darmatures denduits faites de soies animales
(poils de vache), de fibres vgtales (lins), de pailles. Ces lments consti-
tuent principalement une armature de lenduit, ils ne sont pas normaliss et
toute utilisation impose des essais de convenance, de tenue.
6
ADJUVANTS
Certains produits appels "adjuvants" peuvent tre incorpors au mortier
dans des quantits trs faibles (
1 %du poids de liant ) afin den amliorer
les proprits.
Amlioration des proprits des mortiers
Les adjuvants utiliss peuvent amliorer la tenue, la duret, lentranement
dair, les proprits hydrofuges du mortier.
Amlioration des proprits de mise en uvre
Les adjuvants utiliss peuvent amliorer louvrabilit, la plasticit, la rtention
deau, le caractre mouillant. Ces adjuvants peuvent tre des produits tradi-
tionnels ; il convient cependant de raliser des essais pralablement et de
vrifier la non-dgradation des proprits des mortiers.
Les adjuvants contemporains doivent tre utiliss conformment aux normes
et prescriptions du fabricant, il convient dans ce cas de vrifier la compatibi-
lit avec la chaux (milieux alcalins).
7
MATERIAUX NON NORMALISES
Ce sont des contraintes dordre historique, de conformit daspect, de compati-
bilit avec la structure, etc qui parfois imposent lusage de matriaux non nor-
maliss.
Ces matriaux, qui peuvent tre de toutes origines (liant, terre, vgtale, ani-
male, etc.) seront employs avec prudence, aprs chantillonnage et essais
systmatiques de convenance sil n'existe aucun avis technique ou procs-
verbaux dessais de laboratoire rfrencs.
63 La maonnerie
Les difices anciens prsentent frquemment des maonneries recouvertes de
mortier le plus souvent de mme composition que celui utilis pour la cons-
truction des murs dnomm "enduit" lorsqu'il est utilis en revtement.
Le rle de ces enduits est trs important, aussi bien du point de vue de
l'aspect de l'difice que de celui de sa prennit : c'est l'enduit qui confre
son aspect final la maonnerie, mais galement qui protge le parement
extrieur du mur des intempries.
Si le premier point voqu fait appel essentiellement la culture et la sen-
sibilit du restaurateur, le second point mobilise ses connaissances et com-
ptences techniques.
Il n'est qu' voir, en effet, les consquences dsastreuses qu'un enduit de
mauvaise composition peut avoir sur une maonnerie, allant jusqu' provo-
quer des altrations graves de la pierre.
Il est donc indispensable de bien connatre et d' utiliser bon escient les dif-
frentes compositions et techniques de mise en uvre des enduits.
Si la composition de base est en gnral simple et assez constante, la pro-
portion des lments constituants, leur teinte, l'ajout de certaines matires,
la mise en uvre et surtout la finition de surface varient beaucoup d'une
rgion l'autre, d'un type d'difice l'autre.
I COMPOSITION ET MISE EN UVRE DES ENDUITS
Les enduits traditionnels sont le plus souvent des mortiers base de chaux.
ils sont raliss en deux ou trois couches.
1- une premire couche daccrochage ou gobetis
2- une seconde couche formant le corps denduit ou dgrossis
3- une troisime couche appele couche de finition
La rsistance mcanique du mortier de chacune des couches constituant
lenduit doit tre dgressive, la plus forte rsistance mcanique tant assu-
re par la 1
re
couche daccrochage (ou gobetis).
Chapitre 5
LES ENDUITS
Faade enduite en Provence
64 La maonnerie
Le dosage des mortiers d'enduit
La matrise des dosages est importante pour la russite de lenduit, tant pour
sa rsistance mcanique et sa prennit que pour son aspect esthtique. Par
le pass, des spcialistes comme Vitruve, Pline ou Palladio ont chacun dcrit
leurs dosages et leur faon de faire. Actuellement, un DTU donne le dosage
en liant par m3 de mortier, pour support neuf et support ancien.
COUCHE SUPPORT NEUF SUPPORT ANCIEN
1
re
couche/gobetis 500 600 kg/m
3
400 450 kg/m
3
2
me
couche/corps 350 400 kg/m
3
300 350 kg/m
3
3
me
couche/finition 250 300 kg/m
3
150 250 kg/m
3
On remarque quun support neuf ncessite un dosage plus riche en liant
quun support ancien.
CONSEIL DE PRUDENCE
Certains tableaux peuvent indiquer un poids ou un volume de
liant par m
3
de sable : il convient de prendre en compte qu il sa-
git alors de sable sec; dans le cas de sable humide, son volume
augmente par suite du foisonnement quentrane la prsence
deau, ce qui modifie le dosage.
Schma de principe
de l'enduit trois couches
3
me
couche : LA FINITION
C'est la couche de prsentation,
de l'esthtique le mortier
est faiblement dos,
la couche est fine 5 mm maxi
2
me
couche : LE CORPS D'ENDUIT
C'est la masse de l'enduit
qui assure la protection l'tanchit, le dosage
adapt limite la fissuration l'paisseur peut-tre
rduite au centimtre
1
re
couche : LE GOBETIS
C'est la couche d'accroche
au support, le mortier
est bien dos, l'paisseur faible.
65 La maonnerie
Voici en "volumes", un dosage moyen pour un enduit ralis en trois couches.
Chaux arienne Chaux hydraulique Agrgats
naturelle
Couche d'accrochage 0 1 vol. 2 vol.
Corps d'enduit 0,5 vol. 0,5 vol. 3 vol.
Couche de finition 1 vol. 0 4 vol.
Plus le mortier est "arien" prs de la surface, plus il est "maigre", c'est
dire charg en agrgats.
- pour obtenir un bel et bon mortier de chaux l'ancienne, la matire du
liant est essentielle. Pas de salut hors de la chaux arienne. Pas d'effets satis-
faisants avec des liants hydrauliques (chaux hydrauliques, ciments) et ceci
quels que soient les agrgats.
- le choix des agrgats ne vient qu'ensuite : sable de rivire, sablon color,
rognures de pierre, tuileau ou brique pils, pouzzolane, etc.
- le tour de main de l'ouvrier est galement essentiel. Il faut parfois rap-
prendre aux entreprises le mlange des agrgats, le dosage en eau, les pr-
cautions prendre dans l'application en fonction de la surface traiter, du
temps qu'il fait, de l'ensoleillement ; les gestes de la truelle et de la taloche,
la sensibilit, le brossage, aprs la premire prise, sont retrouver.
Mais un bon mortier n'est pas tout. L'architecte n'intervient pas seulement
pour dfinir sa composition. Il doit dfinir les parties enduire et s'assurer
qu'il opre sur des surfaces saines et protges de l'eau. L'eau dans les
maonneries est en effet l'ennemi n1 pour la conservation de la peau des
difices.
1
EXCUTION DE LA PREMIRE COUCHE DENDUIT
OU GOBETIS OU COUCHE DACCROCHAGE
La premire couche a pour fonction dassurer ladhrence de lenduit au sup-
port. Elle est donc fortement dose en chaux, mais le dosage du liant doit
tre adapt aux caractristiques du support.
Son paisseur doit rester faible de faon que son retrait soit pratiquement
achev avant lapplication de la 2
me
couche.
Le sable utilis doit tre de granulomtrie grossire.
J. Claude Rochette, inspecteur gnral des Monuments Historiques, donne
dans une intervention aux "Entretiens du Patrimoine" d'Amiens, en octobre
1989, les recommandations suivantes :
Comment raliser un enduit complet ? En principe, trois couches sont
ncessaires :
1- la couche d'accrochage ou gobetis qui doit pntrer le plus possible dans le
support et rester trs rugueuse doit tre ralise avec un mortier hydrau-
lique.
2- le corps de l'enduit gnralement ralis avec un mortier "btard" de chaux
arienne et de chaux hydraulique. Il doit tre plus "maigre" que la couche
d'accrochage.
3- la couche de finition ralise avec un mortier de chaux arienne pure. Cette
couche de finition peut tre applique de plusieurs manires : taloch, jet
la truelle. Mais en gnral, pour un enduit destin rester apparent, on
recommande de gratter ou de brosser un enduit appliqu la taloche. Ceci
afin d'ter la laitance de chaux blanche et de faire "chanter" l'agrgat. Pour
les mortiers destins tre badigeonns, on peut le lisser.
66 La maonnerie
Le dosage en eau doit tenir compte notamment des conditions climatiques
de pose.
CONSEIL DE PRUDENCE
La premire couche permet de donner l'enduit une accroche
semblable celle d'un mur maonn ; elle n'est donc pas toujours
indispensable sur une maonnerie traditionnelle.
Le mortier est projet vigoureusement sur le support, soit manuellement, soit
la machine. La surface de cette premire couche doit tre rugueuse pour favo-
riser ladhrence de la 2
me
couche : pas d'opration surfaage sur cette couche.
2
EXCUTION DE LA DEUXIME COUCHE
OU CORPS DENDUIT OU DGROSSIS
La deuxime couche, qui constitue le corps de lenduit, lui donne sa forme
dfinitive : elle assure le "planage" et la fonction dimpermabilisation.
Elle doit tre homogne et compacte : sa compacit est obtenue par un ser-
rage la taloche*. Son dosage en liant est plus faible que celui de la pre-
mire couche afin de rduire les risques de fissuration (plus un mortier est
charg en chaux, plus le risque de faenage est grand, li au phnomne de
retrait de la chaux au moment de la prise).
Cette couche est excute lorsque la premire couche a effectu une partie
de son retrait. Le dlai dattente, jamais infrieur 3 jours, est variable et
dpend de plusieurs paramtres (conditions atmosphriques, nature du sup-
port, constitution de lenduit de 1
re
couche).
Le mortier du corps denduit doit avoir une consistance ferme mais mania-
ble. La couche support (gobetis) doit tre humidifie, mais non ruisselante.
Lapplication du corps denduit peut tre effectue en une ou deux passes,
frais sur frais, suivant lpaisseur, la machine ou manuellement.
Ltat de surface doit tre rugueux (le lissage la truelle est interdit).
Cette couche doit tre ralise en fonction des caractristiques visuelles
recherches (planit, rectitude des artes, gorges, arrondis, etc.) que lon
aura dfinies. Mais on ne doit pas rechercher une planit totale : la prsen-
ce des pierres doit pouvoir se sentir.
La valeur moyenne de lpaisseur des deux premires couches doit assurer un
recouvrement des maonneries denviron 10 mm.
Il est noter que la plupart des enduits anciens taient trs peu pais,
de 5 10 mm. En tout tat de cause, l'important est de ne pas dpas-
ser le nu extrieur des pierres d'encadrement (voir photo ci-contre).
Luniformit daspect ne pouvant pas tre garantie avec ce type denduit, il
doit tre complt par une couche de finition et un badigeon.
67 La maonnerie
3
COUCHE DE FINITION
La couche de finition est celle la plus fine. Elle peut ne pas dpasser 2 3 mm.
Plus elle est fine, plus elle va "vibrer" dans la lumire. Les finitions denduits
couvrent une large gamme dont les variations et les nuances constituent un
patrimoine et un savoir-faire lis aux particularits rgionales.
Linventaire ci-aprs, qui n'est pas exhaustif, prsente les principales finitions
denduits et leurs utilisations frquentes.
La couche de finition dtermine l'aspect de ldifice; dans le cas de finitions
lisses, taloches, stuques, elle assure galement un rle de protection et
contribue lamlioration de limpermabilisation.
On ne saurait trop insister sur la ncessit d'employer sauf cas bien spci-
fique tel que la restauration d'une tyrolienne de ciment d'un btiment
rcent, par exemple la chaux arienne pour cette couche de finition.
En effet, avec cette chaux, un lger brossage ou mme un lavage l'ponge
de l'enduit excut dans les 48 heures aprs sa mise en uvre, permet d'li-
miner la laitance de chaux qui vient en surface lors du talochage de l'enduit,
faisant ainsi ressortir la texture et la couleur des agrgats.
A l'inverse, la laitance de la chaux hydraulique, tout comme celle du ciment,
est parfaitement indlbile, et recouvre totalement les agrgats, d'une teinte
uniforme et froide : l'enduit ne "chante" pas.
Problme d'enduit en saillie
par rapport la pierre
68 La maonnerie
Dans la composition de certains enduits se trouve une proportion de
pltre (en Ile de France). Dans d'autres, ce sont des poils de vache
blancs, en particulier sur la face intrieure des murs des habitations en
pan de bois, pour leur qualit isotherme. Il s'agit d'une recette locale
dont voici la formule :
1re et 2me couches (couches de fond et de dressage) :
- 2 parties de sable rude
- 1 partie de chaux grasse coule
- 8 kg de poils de vache par mtre cube de mortier.
Il est conseill d'adjoindre ce mlange entre 5 et 25 % de pltre
pour acclrer le durcissement.
3me couche :
- 100 l de chaux grasse coule,
- 5 l de sable de rivire tamis,
- 500 g de poils de vache blancs,
- adjonction de pltre (entre 15 et 25 %).
On trouve beaucoup de ces enduits dans les Ardennes.
Y.M. Froidevaux Techniques de l'architecture ancienne
RECOMMANDATIONS DIVERSES :
Les enduits ne doivent jamais tre entrepris en priode de gel
ni, sauf prcautions spciales :
- sur des supports trop chauds ou desschs
- par vent sec.
Pour viter les phnomnes defflorescences, il est interdit dap-
pliquer les enduits teints par une temprature infrieure 8C
et pendant les priodes particulirement humides.
Les dosages en liant du mortier de chacune des couches consti-
tuant lenduit doivent de prfrence tre dgressifs, le gobetis
(ou couche daccrochage) tant le plus charg en liant.
Les joints de structure doivent obligatoirement traverser l-
paisseur totale de lenduit et tre obturs par un calfeutrement.
Au voisinage des chanes dangles en pierre apparente, lenduit
doit tre lgrement en retrait ou au mme nu que la pierre,
mais jamais en saillie.
Les pices en bois de faible largeur (20 cm) doivent tre recou-
vertes par un papier fort, feutre, etc., et lenduit doit comporter
une armature de renfort. Pour les pices importantes le C.C.T.P.
prcisera la mthode particulire de traitement de la jonction.
La tranche suprieure dun enduit doit tre protge. Si la pro-
tection nest pas assure par une toiture ou une saillie (appui de
baie dbordant par exemple), il peut tre ncessaire de rappor-
ter un ouvrage complmentaire (bavette de zinc, de cuivre ou
de plomb, par exemple).
Les enduits doivent tre protgs contre les vents secs et chauds
ou contre un fort ensoleillement par bches, parapluies, etc. Les
bches en plastique translucide, susceptibles de provoquer une
surchauffe, sont proscrites.
69 La maonnerie
I LES DIFFERENTS TYPES D'ENDUITS ET DE FINITION
Au-del de son rle technique de protection, lenduit assure la mise en scne
de larchitecture ; il possde son langage, ses codes, ses modes, et selon les
effets quil dveloppe, donne une signification au bti quil habille.
Les diffrentes techniques de finition permettent de dcliner tout un jeu de
textures et de colorations, allant de limitation dautres matriaux - souvent
la pierre, plus inaccessible - la cration plastique pure.
C'est du bon "coup de main" du compagnon et de sa dextrit que dpen-
dent le bel aspect de l'enduit mais aussi sa tenue dans le temps.
Crpis jets la truelle
Dfinition : La couche de finition est simplement jete la truelle, ce qui
donne un aspect de surface grossier. Suivant la souplesse du mortier, les
reliefs sont plus ou moins vifs, anguleux.
Utilisation frquente : Traitement des faades secondaires (pignons) de bti-
ment darchitecture plus labore.
Mise en uvre : Laspect et le grain de lenduit sont lis essentiellement au
choix de granulat (nature roule ou concasse et granulomtrie). Lutilisation
de la chaux arienne et/ou hydraulique naturelle est possible.
Crpis jets au balai
Dfinition : La couche de finition est projete l'aide d'un balai (gent,
cyprs, bouleau, buis... suivant les rgions) tremp dans un mortier trs sou-
ple que l'on frappe sur un bton ou rciproquement. Comme pour l'enduit
jet la truelle, les reliefs peuvent tre plus ou moins affirms, jusqu' pren-
dre l'apparence d'une tyrolienne.
Crpi aspect
de finition "fouette"
Dans certaines rgions, le mme balai de buis est utilis pour ensuite frap-
per l'enduit au moment o il commence faire sa prise. Il en rsulte un
aspect de surface trs particulier et vivant, o l'on arrive lire, en l'exami-
nant de prs, les empreintes des feuilles de buis dans l'enduit. Un exemple
intressant de cette technique peut se voir sur le btiment de relevage des
eaux (XVIII
e
sicle), au chteau de Mreville, dans l'Essonne.
70 La maonnerie
Utilisation frquente : Traitement des btiments d'habitation et difices
majeurs (chteaux).
Architecture d'enduits composs (panneautage, faux appareils).
Mise en uvre : Laspect et le grain de lenduit sont lis essentiellement au
choix de granulat (nature roule ou concasse et granulomtrie). Lutilisation
de gravillons et de sable trs fin peut tre ncessaire pour obtenir un grain
important.
Lutilisation de chaux hydraulique naturelle permet de meilleurs rsultats.
Cette technique oblige une bonne matrise des gestes.
Crpis "tyroliens"
Dfinition : Utilisation d'une tyrolienne pour projeter la couche de finition
(appareil projeter des gouttelettes).
Utilisation frquente : Utilisation de ce type de crpis ds la fin du XIX
me
sicle et jusqu'au milieu du XX
me
sicle, pour des architectures trs types
(rocaillage, Art Dco, etc)
Mise en uvre : Lutilisation de liant trs hydraulique (ciment prompt) est
ncessaire.
Traditionnellement ces enduits sont teints par des oxydes saturs, bleus, lie-
de-vin, gris fonc etc
Enduits talochs
Dfinition : La couche de finition est lisse par une taloche de bois qui va
permettre l'obtention d'une surface frotte.
Utilisation frquente : Traitement de btiments d'habitation et d'difices
majeurs. C'est certainement le type d'enduit le plus courant. Peut servir de
support aux enduits jets.
Crpis tyrolien
71 La maonnerie
Mise en uvre : Utilisation prfrentielle de chaux arienne ou hydraulique
naturelle.
Lutilisation dune taloche bois limite les remontes de laitance.
Le choix de la granulomtrie influe sur la texture de la surface.
Enduits lisss la truelle
Dfinition : Comme pour l'enduit taloch, la surface est lisse, mais cette
fois-ci avec le dos de la truelle. Cette technique permet de faire sortir en sur-
face la laitance du mortier et d'obtenir un aspect plus ferm.
Utilisation frquente : C'est certainement le traitement le plus ancien.
Mise en uvre : Prfrer lemploi dune chaux arienne. Utiliser un sable
fin et propre.
Enduits grss
Dfinition : Lorsque le mortier a fait sa prise, la couche de finition a durci,
elle est ponce l'aide d'une pierre abrasive.
Utilisation frquente : Pratique frquente au dbut du XXe sicle (volont
de perfectionnisme).
Mise en uvre : Utilisation indispensable dun liant trs hydraulique.
Enduits talochs regarnis
Dfinition : Sur la couche de finition taloche, une couche de pte de chaux
et de charge (lait de chaux color, trs pais) est incorpore et serre la lis-
seuse sur sous-couche encore frache.
Utilisation frquente : Traitement de btiment d'habitation et ddifices
majeurs
Mise en uvre : Sur la couche de finition, lapplication dune pte de chaux
arienne colore avec des pigments seffectue la lisseuse.
Enduits stuqus
Dfinition : La couche de finition de cet enduit est trs dose en liant et les
granulats sont trs fins (poudre de marbre). L'effet recherch est une gran-
de finesse de surface, proche de la brillance d'un marbre.
Utilisation frquente : Utilisation plus frquente l'intrieur, mais possible
l'extrieur uniquement sur enduit frais (marmorino). Influence italienne.
Mise en uvre : Les applications imposent lutilisation de chaux arienne.
La mise en uvre se fait en diffrentes passes frais sur frais. En extrieur, pos-
sible uniquement sur enduit taloch frais.
Talochage de l'enduit
72 La maonnerie
Imitation de matires
Cest la pierre taille qui est le plus souvent imite, au minimum les enca-
drements de fentre, bandeaux moulurs ou chanes dangle, mais parfois la
faade toute entire.
Dfinition : La nature du mortier varie suivant les ouvrages raliss, les
matriaux locaux, lutilisation de mortier de pltre et chaux ou de prompt et
chaux est frquente.
Utilisation frquente : Traitement de btiments dhabitation, et ddifices
majeurs.
Mise en uvre : Essentiellement le savoir-faire
Vieillissement artificiel des enduits
Certaines techniques de finition denduits sont parfois envisages pour don-
ner lenduit un vieillissement artificiel (suppression des laitances, dgage-
ment des grains de granulat...).
On peut citer :
a
Les enduits pierre vue :
Ils sont raliss comme un enduit, dont l'paisseur ne suffit pas couvrir l'en-
semble des moellons des pierres, le nu de rfrence tant la "tte" des moel-
lons. Ce type d'enduit cherche imiter une surface use dont les parties les
plus fines, rodes, laissent apparatre la pierre.
b
Les enduits feutrs, lavs :
En fin de talochage, on utilise une ponge, une taloche-ponge ou un feut-
re imbib d'eau, que l'on passe sur la surface de l'enduit.
L'objectif est de laver la laitance pour faire apparatre le granulat en surface.
C'est une technique de vieillissement qui tend reproduire un enduit lg-
rement rod et faire ressortir la couleur des granulats.
c
Les enduits gratts :
En fin de talochage, on utilise le tranchant de la truelle ou une planche
clous, pour gratter la pellicule de mortier de surface.
Effet de rocaille imitant des rondins de bois Imitation d'un appareil en pierre de taille
73 La maonnerie
Cette opration cherche, comme la prcdente mettre en valeur le granu-
lat, en lui confrant l'illusion d'un enduit us.
Ce traitement est toutefois dconseiller, car il favorise l'encrassement du
parement et une mauvaise impermabilit.
I EXCUTION DES ENDUITS A DEUX COUCHES
Il est possible, dans certains cas o l'enduit doit tre de faible paisseur - par
exemple, lorsque la saillie des pierres de chanage d'angle est faible par rap-
port au nu gnral de la maonnerie de raliser des enduits deux couches.
Ces enduits comprennent :
une couche formant le corps denduit ou dgrossis
une deuxime couche appele couche de finition
L'excution de ces deux couches sera mene comme celles des couches cor-
respondantes de l'enduit trois couches, avec un trs grand soin.
I ENDUITS AUX MORTIERS DE PLATRE
ET PLATRE-ET-CHAUX
En rgion parisienne, les enduits traditionnels sont souvent base de pltre
ou pltre et chaux. Les techniques dcrites ci-dessous visent les rfections
denduit sur des maonneries hourdes de pltre, de chaux, de pltre et
chaux et ossature de pans de bois et lattes.
1
COMPOSITION DU MORTIER
Mortier de pltre et chaux CL
Le pltre gros de construction et la chaux calcique CL sont compatibles quels
que soient les dosages.
Enduit pierre vue
Faade enduite au pltre
74 La maonnerie
Les plus courants utiliss sont :
1 volume de pltre gros
2 volumes de chaux CL
3 volumes de sable trs propre
1 volume de pltre gros
1 volume de chaux CL
1 volume de sable trs propre
3 volumes de pltre gros
1 volume de chaux CL
2 volumes de sable trs propre
Le mlange doit tre effectu sec, avec des sables trs secs, et hydrat au
fur et mesure des besoins.
2
MISE EN UVRE
Les renformis ne doivent pas dpasser pas 5 cm dpaisseur. Au-del, une mise en
uvre de petite maonnerie sera excute.
Lorsque des supports de nature diffrente sont juxtaposs, un grillage non corro-
dable formant armature doit tre appliqu chaque jonction en dbordant de
part et dautre dau moins 15 cm, ce grillage sera fix au support au moyen de
clous, agrafes ou crochets non corrodables.
Si des fers sont mis nu, ils doivent tre brosss et soigneusement passivs.
Le mortier est mis en uvre exclusivement par application manuelle, dans des
paisseurs moyennes de 3 5 cm, en une ou deux passes successives rapproches.
Chaque passe doit tre recoupe dune manire suffisamment grossire (Berthelet
ou autre) avant lapplication de la suivante pour en faciliter laccrochage.
La dernire passe du mortier doit tre coupe ou lisse pour donner laspect
de finition. Les finitions jetes-truelle ou feutres sont dconseilles et les
finitions grattes sont proscrire.
Dans tous les cas, il est prfrable dy associer un lait de chaux, une huile de
lin, une colature ou un badigeon, pour renforcer l'impermabilisation.
75 La maonnerie
3
PROTECTION DES ENDUITS
Lenduit doit tre protg contre la pluie battante par le dbord de toiture et
par l'ensemble des modnatures de faade : corniches, bandeaux et enca-
drements de baies.
Contre le ruissellement, les faades doivent tre recoupes dans leur hauteur,
chaque niveau de plancher, par un bandeau excut dans le mme mat-
riau que le corps d'enduit, et recouvert sur sa partie suprieure dune pro-
tection (zinc, cuivre, inox...) munie dune goutte deau. La pente de ce ban-
deau doit tre importante et tourne vers lextrieur pour viter les rejaillis-
sements deau vers la faade.
Protection des soubassements : pour rsister aux rejaillissements en pied de
mur, les soubassements ne doivent pas tre excuts avec des mortiers au
pltre ou au pltre et chaux.
Coupe sur un bandeau horizontal
NON OUI
Les moulures horizontales doi-
vent permettre d'loigner les
eaux de ruissellement au
niveau des "gouttes d'eau"
tout en apportant un lment
dcoratif la faade, accen-
tuant les jeux d'ombre et de
lumire.
76 La maonnerie
Enduit au mortier de chaux hydraulique NHL 3.5
sur support base pltre
Cette technique est utilise pour la rfection ou la ralisation denduit
hydrauliques sur supports ou enduits au pltre, pltre-chaux et moel-
lons de gypse, gnralement incompatibles. Elle est employe notam-
ment pour protger les bases de mur des rejaillissements.
Elle nest possible quavec un certain type prcis de chaux hydraulique
naturelle de type NHL 3,5, et doit faire l'objet d'essais prliminaires
pour vrification de la compatibilit avec le support.
Excution de lenduit
Gobetis
Dans certains cas, un gobetis peut tre effectu. Le dosage courant
utilis est le suivant :
5 volumes de chaux NHL 3,5 + 10 volumes de sable
Renformis ou corps denduit
Le renformis, et/ou le corps denduit, sera excut avec un mortier
dont le dosage couramment utilis est de :
- 4 volumes de chaux NHL 3,5 + 10 volumes de sable
- soit un dosage de 300 350 Kg de chaux par m3 de sable sec
La mise en uvre se fera :
- manuellement par passes successives de 2 cm dpaisseur
- mcaniquement par passes successives de 2 10 cm dpaisseur
(ce type de projection ne ncessite pas la mise en uvre dun gobetis
pralable).
Finition
A linverse des enduits pltre-chaux CL, ce type denduit, dans le cas
d'une rfection totale, supporte tous les types de finition, du fait de
limpermabilisation acquise avec le renformis ou le corps denduit.
Composition
Le mortier utilis peut-tre de toute nature y compris base de liant
hydraulique, pour autant que ses caractristiques performantielles,
aprs application dune paisseur suprieure 5mm, soient voisines
du mortier utilis pour le corps d'enduit.
Maonneries htrognes
Lorsque des supports de nature diffrente sont juxtaposs, un grillage
non corrodable ou un treillis cramique formant armature devra tre
appliqu chaque jonction en dbordant de part et dautre dau
moins 15 cm et fix au support au moyen de clous, agrafes ou crochets
rsistants en masse la corrosion.
Si des fers sont mis nu, ils devront tre traits et passivs.
Protection des enduits
Ce type denduit ne demande pas de protection particulire aprs ex-
cution. Il permet la ralisation denduit de soubassement des faades
enduites avec le mortier de type pltre-chaux CL.
77 La maonnerie
I CONTRLE DE LA QUALIT
DES ENDUITS EXECUTS
Les contrles de la qualit des enduits concernent principalement l'paisseur, la
planit, l'aplomb et l'aspect de l'enduit; ils sont effectus par contrle visuel.
Un essai darrachement peut galement tre ncessaire pour vrifier ladh-
rence de lenduit au support : la rupture doit se produire dans lenduit mais
ni linterface pierre/enduit (adhrence trop faible), ni dans la pierre (adh-
rence trop forte, dommageable pour lenduit)
Dans le cas dune rfection parcellaire, des contrles concernant le dosage
des sels solubles, la composition de lenduit (granulats et phase liante), son
imbibition et sa permabilit lair et la vapeur deau permettent de sas-
surer de la compatibilit du nouvel enduit avec lenduit conserv.
I LES ENDUITS INTERIEURS
Lorsque la fonction dimpermabilisation nest pas requise, les enduits int-
rieurs peuvent tre appliqus en une ou deux couches en fonction de la
nature du support et de laspect recherch et conformment aux prescrip-
tions indiques dans les chapitres relatifs aux supports correspondants.
La couche de finition pourra tre de chaux pure lisse la truelle, ou com-
portera certains adjuvants.
I REFECTION ET RESTAURATION DES ENDUITS
Les causes de dgradation des enduits anciens sont diverses : remontes
deau par capillarit, infiltrations dues aux agents atmosphriques (vent,
pluies et gel), condensation, etc Les enduits ainsi agresss prsentent des
dsordres essentiellement de trois types qui peuvent d'ailleurs se combiner :
Ils deviennent pulvrulents,
ils se dcollent de la couche support (perte de cohsion) ou
ils se fissurent.
1
ANALYSES PREALABLES ET PREPARATION DES SUPPORTS
Avant toute restauration, on commence par procder l'analyse prcise des
enduits anciens existant sur l'difice, ainsi qu' celle des mortiers de cons-
truction des murs.
Paralllement, on analyse l'tat des maonneries et, le cas chant, on pr-
pare le support pour accueillir le nouvel enduit.
2
RECONNAISSANCE DE LETAT EXISTANT DU SUPPORT ET DE LENDUIT
Les donnes connatre seront diffrentes suivant que l'on se propose de :
1- procder la rfection totale d'un enduit,
soit que la maonnerie se prsente sans enduit, soit qu'elle soit recouverte
d'un enduit rcent ou inadapt, qu'il convient de piocher.
2- refaire partiellement un enduit lacunaire,
lorsque l'on se trouve en prsence d'une maonnerie prsentant
des restes plus ou moins importants d'enduits.
78 La maonnerie
3- consolider un enduit ancien altr,
lorsque celui-ci prsente des pathologies.
Pour chacun de ces cas, les examens et essais dcrits ci-aprs peuvent tre
raliss suivant des ordres de priorit diffrents.
A
Etude de la nature des altrations de l'enduit et du support
Qu'il s'agisse de la reprise d'un enduit lacunaire ou de la consolidation d'un
enduit ancien, il convient d'analyser tout d'abord la nature des altrations de
l'enduit conserv.
Les altrations les plus courantes d'un enduit ancien sont la fissuration, le
dcollement, l'effritement ou pulvrulence, les efflorescences et les
colonisations biologiques.
On observera donc la morphologie des altrations de l'enduit et leur locali-
sation, l'tat du support, la prsence d'humidit, etc en procdant aux
quatre examens suivants :
B
Examen du support
Cet examen doit permettre d'identifier la nature et ltat du support et de
reprer les altrations particulires du support qui ncessitent une interven-
tion pralable la restauration.
Enduit altr et lacunaire
79 La maonnerie
C
Observation de lenduit l'il nu et la loupe de terrain
Cette observation approfondie de ltat de conservation de lenduit permet-
tra de reprer les altrations particulires de lenduit qui ncessitent une
intervention pralable la restauration.
D
Dosage des sels solubles
Il permettra de connatre la teneur en sels solubles de lenduit et du support,
et de mettre ventuellement en vidence une salinisation.
E
Mesure de lhumidit
Elle donnera des informations sur le taux dhumidit dans lenduit et dans
son support, et permettra, le cas chant, de mettre en vidence des remon-
tes capillaires ou des infiltrations.
Remarques
la liste propose n'est pas exhaustive, et d'autres essais peuvent appor-
ter des informations intressantes,
les rsultats et les donnes exigs peuvent, pour certains, tre obtenus
par des essais ou des observations rapides sur le terrain sans ncessiter
obligatoirement des essais de laboratoire,
les donnes fiables dj obtenues par des cas trs proches de celui
traiter peuvent tre rutilises sans qu'il y ait ncessit de refaire sys-
tmatiquement de nouveaux essais,
tous les essais mentionns ne sont pas mettre en uvre systmati-
quement.
F
Etude des caractristiques de l'enduit ancien
L'analyse de prlvements effectus par carottage ou sciage permettra d'obte-
nir de prcieuses informations ; il existe en effet toute une panoplie dexamens
plus ou moins sophistiqus qui permettent dobtenir des informations sur :
l'paisseur de l'enduit, sa stratigraphie
sa colorimtrie
sa composition (granulats et phase liante)
sa porosit
sa capillarit
sa permabilit l'air (ou l'azote) ou la vapeur d'eau
sa duret superficielle
etc
80 La maonnerie
3
RFECTION TOTALE DUN ENDUIT
C'est le cas d'une maonnerie sans enduit, ou avec un enduit rcent piocher.
Donnes connatre sur le support
Il sagit principalement de sassurer de la compatibilit de lenduit prvu avec
son support.
On procdera essentiellement un diagnostic visuel pour examiner la
nature des supports : type de pierre, mortier de joint, etc
On tudiera leurs altrations ventuelles : observation des morphologies des
altrations (pulvrulence, fissuration, dcollement, efflorescences, salissures,
Selon les informations recherches, on pourra procder
aux examens suivants :
Examen l'il nu et la loupe binoculaire de prlvements denduit
Il renseigne sur la stratigraphie de l'enduit, sur l'paisseur des couches
qui le composent, et sur la technique denduit utilise.
Colorimtrie
Cet examen fournit un code couleur (correspondant la Charte de
Munsel) qui aura valeur de rfrence pour la consolidation de l'enduit.
Examen ptrographique en section polie ou en lame mince
Il renseigne sur la texture de l'enduit, la nature des liants et des gra-
nulats et aidera la dtermination de la formulation de lenduit
consolider.
Permabilit la vapeur deau ou permabilit lair
Cet essai indique la capacit de transfert de lair et de la vapeur deau
par le matriau avant consolidation.
Imbibition capillaire
Cet examen renseigne sur la capacit de transfert de leau du mat-
riau avant consolidation.
Mesure de duret ou rsistance labrasion ou au percement
Cet essai indique la valeur de duret superficielle ou de rsistance
superficielle de l'enduit avant consolidation.
Diffraction des rayons X :
Elle renseigne sur la composition chimique de l'enduit.
Analyse chimique :
Elle donne galement la composition chimique de l'enduit.
Porosit totale ou porosimtrie :
Elle donne la capacit de stockage des fluides et fixe une valeur de
rfrence avant consolidation.
Essai ATD/ATG :
Il dtermine la courbe de dshydratation de l'enduit et sa perte pon-
drale en fonction de la temprature, ce qui permet de dterminer la
formulation de l'enduit consolider.
Examen MEB sur cassure :
C'est un examen de la pte, des contacts pte/granulats, qui permet
une recherche des phases hydrauliques.
81 La maonnerie
colonisations biologiques, remontes capillaires, infiltration deau...) et leur
localisation.
Le mortier de joint sera galement prendre en compte si celui-ci reprsen-
te une part importante de la surface enduire.
Les essais effectuer auront pour objectif de dterminer :
la nature et l'tat du support
la prsence de sels solubles
la porosit
la capillarit
la permabilit lair (ou lazote) la vapeur deau
(sur chantillons carotts)
l'humidit du support si infiltrations ou remontes capillaires possibles.
A
PIOCHEMENT TOTAL OU PARTIEL DANCIENS ENDUITS
Piochement
Que le support soit destin rester apparent ou non, l'opration de pioche-
ment s'effectuera de faon ne pas mutiler lpiderme du mur, sauf si
lArchitecte prescrit formellement le piquage ou le martelage des moellons
pour permettre ladhrence du nouvel enduit.
Nettoyage
Au terme de l' opration de piochage, les zones enduire ou r-enduire
devront tre dbarrasses de tous les revtements anciens tels quenduit de
chaux, de mortier de ciment, de pltre, de stuc, etc.
CONSEIL DE PRUDENCE
Le piochement d'anciens enduits requiert une attention particuli-
re car ils peuvent recouvrir des lments caractre archologique.
Aussi, avant tout piochage, on effectuera une campagne de son-
dage pour vrifier qu'il n'existe pas de fresques ou de peintures
murales sous les badigeons ou les diffrentes couches d'enduit
superposes.
Il faudra nanmoins rester vigilant pendant toute la dure du pio-
chage, pour ragir la dcouverte, toujours possible, d'autres l-
ments intressants, tels que briques vernisses ou mailles, par
exemple.
B
PREPARATION DES SUPPORTS
Nettoyage
La surface des supports doit tre propre, exempte de traces de suie, de pous-
sire, de salptre, etc susceptibles de nuire ladhrence.
Toutes les matires sans cohsion et pulvrulentes devront tre limines,
essentiellement par piquetage, brossage ou lavage.
Dressement du parement
Si la surface enduire prsente des ingalits de 3 5 cm, ne permettant
pas lapplication directe de lenduit, on excutera une surcharge "en renfor-
mis", pour redresser la maonnerie. Celle-ci sera excute avec un mortier
compatible la fois avec le support et avec l'enduit de finition prvu, le plus
souvent un mortier de chaux hydraulique naturelle, excut en plusieurs pas-
ses successives de 1,5 cm chacune, et arm d'un treillis non corrodable (galva
ou inox, laiton, etc.).
82 La maonnerie
Lorsque les creux et ingalits sont suprieurs 5 cm, le renformis sera rem-
plac par un ouvrage en maonnerie compatible avec celle du support (moel-
lons de petites tailles, briquettes, tuileaux, etc. hourds au mme mortier
que celui du mur).
Cas de support composite
Si le support est constitu de matriaux diffrents, un treillis non corrodable
doit tre mis en place au droit de la jonction des deux matriaux, afin dem-
pcher la fissuration de lenduit due aux mouvements diffrentiels des deux
matriaux.
Rejointoiement
Les joints seront dgarnis sur 1 3 cm de profondeur, suivant leur cohsion
et leur adhrence. Ils seront ensuite brosss, dpoussirs la brosse mtal-
lique ou lair comprim (adapter la pression la friabilit des mortiers). Ils
seront regarnis en mme temps que la premire passe d'enduit.
Humidification du support
Aprs protection des ouvrages existants, le support sera humidifi dans la
masse, jusqu 24 heures avant lapplication de lenduit : leau ne doit plus
perler ni ruisseler en surface au moment de la mise en uvre de l'enduit.
C
PREPARATION DES SUPPORTS EN BRIQUE
Les peintures ou les vernis, de toute nature, appliqus sur les surfaces de
murs doivent tre enlevs mcaniquement, par brossage et lavage.
Les dcapants chimiques, risquant de ragir sur lenduit, sont proscrits.
Sil existe des briques mailles ou vernisses, deux solutions sont possibles :
- le vernis ou lmail seront enlevs pour mettre vif la terre cuite,
- une solution de pontage de la zone non adhrente peut tre envisage.
D
PREPARATION DES SUPPORTS EN MOELLONS
Les moellons, caillasses ou parties de blocs crevasss et dgrads doivent tre
purgs vif, enlevs et remplacs.
Si les asprits du moellon ne sont pas juges suffisantes pour permettre
ladhrence de lenduit, les parements peuvent tre piqus ou martels.
4
REFECTION PARTIELLE D'UN ENDUIT ANCIEN LACUNAIRE
C'est le cas o la maonnerie existante prsente des restes d'enduit, plus ou
moins importants, conserver et complter par un enduit neuf.
Il s'agit d'analyser la fois les caractristiques du support et les proprits de
l'ancien enduit encore prsent sur le parement, afin de dterminer les carac-
tristiques de l'enduit compatible mettre en uvre.
Les altrations de l'enduit et de son support
Les essais effectuer auront pour objectif de dterminer :
- la nature et l'tat du support
- la prsence de sels solubles
- la porosit
- la capillarit
- la permabilit lair (ou lazote) la vapeur deau
(sur chantillons carotts)
- l'humidit du support si infiltrations ou remontes capillaires possibles.
83 La maonnerie
Donnes connatre sur l'enduit ancien
Les essais effectuer auront pour objectif de dterminer :
- l'paisseur de l'enduit, sa stratigraphie
- sa composition (granulats et phase liante)
- sa colorimtrie
- sa porosit
- sa capillarit
- sa permabilit l'air (ou l'azote) ou la vapeur d'eau
- sa duret superficielle.
5
CONSOLIDATION D'UN ENDUIT ANCIEN ALTR
C'est le cas o la maonnerie existante prsente un enduit plus ou moins
altr que l'on souhaite nanmoins conserver.
Consolidation
La consolidation des enduits anciens s'opre de la manire suivante :
1- recherche et limination des causes de pntration deau par tout proc-
d adapt.
2- consolidation des parties pulvrulentes laide de silicate dthyle ou dun
autre durcisseur test et approuv par le laboratoire.
3- reconstitution de ladhrence de lenduit la maonnerie-support aprs col-
matage des fissures, et ralisation de solins autour des surfaces conserves
(la technique la plus utilise consiste injecter un coulis par seringue - voir
encart - complt ventuellement dun accrochage mcanique par clous
non corrodables).
4- mise en uvre de complment denduit dans les zones lacunaires avec un
mortier de mme nature pour la sous-couche et la couche de finition
(duret, grain et couleur) selon les rsultats des analyses des enduits exis-
tant ralises comme dcrit prcdemment.
Injection d'un coulis de consolidation d'un enduit
Aprs colmatage de fissures et ralisation des solins ncessaires
autour des surfaces conserves, on procder des micro-injections
obliques, excutes la seringue dans un semis de forages en quin-
conce espacs dau moins 15 cm.
Dans le cas de grandes surfaces dplaques, lopration sera ralise
en apposant des plaquettes de bois maintenues sous pression sur len-
duit ancien. Lutilisation de clous de cramique pourra garantir une
bonne tenue terme.
Exemples de coulis :
Coulis base de :
Chaux hydraulique naturelle
Pouzzolane superventile
mulsion acrylique
Inconvnient de ce coulis : coloration grise due la pouzzolane.
Formule simplifie :
Chaux hydraulique
Poudre de marbre
Eau
Produits prts l'emploi aprs essais prliminaires
84 La maonnerie
6
DONNES A CONNATRE SUR LES PRODUITS UTILISS
Produit de consolidation
Il est indispensable de connatre la formulation du produit (fournie par le
fabricant dans la fiche technique ou dans tout autre document officiel), de
manire identifier sa nature, son type et ses principales proprits.
Il est galement ncessaire de procder des essais d'application in situ, de
manire observer le comportement du produit.
Mortier de colmatage
Il est indispensable de connatre la formulation du produit de manire identi-
fier sa nature, son type et ses principales proprits.
Comme pour le produit de colmatage, des essais d'application in situ sont
ncessaires, de manire observer le comportement du produit mis en oeuvre.
Par ailleurs, il est important de connatre la teneur en sels solubles, de mani-
re viter dutiliser des matriaux susceptibles dapporter des sels solubles.
Coulis dinjection
Outre la connaissance de la formulation du produit, les essais in situ doivent
permettre de contrler la prise du coulis en milieu ferm, la qualit du rem-
plissage et la facilit dinjection.
La teneur en sels solubles doit tre connue, de manire viter dutiliser des
matriaux susceptibles dapporter des sels solubles. Un essai de d'imbibition
capillaire, valuant la capacit de transport de l'eau et de l'air, permet d'a-
dapter cette capacit du coulis celle de l'enduit.
Un essai de rsistance larrachement permet d'valuer ladhrence du cou-
lis et l'examen dtaill du type de rupture; une rupture linterface
coulis/enduit indique une adhrence trop faible.
D'autres essais, souhaitables, peuvent fournir des renseignements utiles, en
calculant la "valeur de retrait linaire", ou la "valeur de viscosit" ou enco-
re "l'injectabilit" (ou facilit injecter).
7
VERIFICATION DE LA CONSOLIDATION DE L'ENDUIT ANCIEN
Selon les possibilits, les contrles sont raliss en laboratoire sur des frag-
ments ou sur des prlvements faits dans les zones d'essais de convenance
(prlvement par carottage ou sciage).
Ils porteront essentiellement sur :
- la duret superficielle ( comparer avec les rsultats sur l'enduit altr)
- la colorimtrie (valuation des variations de couleur induite par la consoli-
dation)
- la porosit
- la capillarit ou permabilit
- la profondeur d'imprgnation et consommation
Ce dernier examen sera gnralement effectu par sondage ; il est en effet
important de vrifier que la consolidation a t ralise de faon homogne
qualitativement et quantitativement.
Ces contrles sur l'enduit restaur seront rapprocher de ceux effectus pr-
alablement sur l'enduit altr, afin de comparer les proprits de ce dernier
avant et aprs consolidation.
85 La maonnerie
I LES BADIGEONS ET LAITS DE CHAUX
Le lait de chaux dsigne un mlange de chaux et deau, color ou non, des-
tin tre appliqu en revtement peint laide d'une brosse sur des pare-
ments minraux (enduits, pierre).
En faisant varier sa fluidit et ses adjuvants, on obtient :
le chaulage : lait de chaux trs pais, blanc, destin principalement aux usa-
ges agricoles, aux usages sanitaires, ou comme "bouche-pores" sur un sup-
port micro-fissur.
la colature : lait de chaux paissi dune charge minrale (poudre de pierre,
talc...) appliqu la brosse et serr loutil.
le badigeon : lait de chaux plus dilu que le chaulage, gnralement colo-
r, destin tre appliqu sur des parements enduits, ou de pierres tailles.
Il est masquant et attnue la texture du support et les dfauts daspect de
lenduit.
leau forte ou dtrempe la chaux : badigeon dilu permettant la pose
de couleurs plus satures, donnant un aspect aquarell, transparent, sans
attnuer la texture du support.
la patine : lait de chaux trs dilu, transparent, rserv essentiellement
lhomognisation des parements minraux.
Faades chaules (Hautes-Alpes)
DOSAGES
Le dosage eau/chaux dpend de la texture et de laspect recherchs : plus
la proportion deau diminue, plus le lait de chaux est pais, plus son aspect
est masquant ; linverse, plus il contient deau, plus il donne un effet
"aquarell".
chaulage 1 volume deau pour 1 volume de chaux
badigeon 2 3 volumes deau pour 1 volume de chaux
eau-forte 4 6 volumes deau pour 1 volume de chaux
patine jusqu 20 volumes deau pour 1 volume de chaux
86 La maonnerie
1
MATERIAUX CONSTITUTIFS
A
Le liant : chaux arienne ou chaux hydraulique
La chaux arienne teinte pour le btiment (chaux CL), ou chaux en pte,
permet, dosage gal, des laits de chaux plus pais et une plus faible sdi-
mentation des pigments.
La chaux hydraulique naturelle oblige appliquer le lait de chaux dans la
demi-journe suivant sa prparation.
B
Leau
Leau a pour rle essentiel de donner sa plasticit au lait de chaux.
Elle doit tre propre. Il est conseill dutiliser de leau potable. Dans le cas
contraire, ne pas utiliser des eaux charges en sels (sulfates, eaux rsiduelles,).
Dans le cas de leau de mer, dont lusage traditionnel est attest mais qui est
a priori proscrite, il, est ncessaire deffectuer des essais de tenue et d aspect
(possibilit dapparition de nuances et defflorescences).
C
Les pigments
La coloration des laits de chaux est faite laide de pigments en poudre, tels
que les terres naturelles ou ocres, dutilisation trs ancienne, gnralement
compatibles avec la chaux.
Elle peut tre ralise aussi base d'oxydes, dont le pouvoir colorant est
important. Toujours vrifier la compatibilit des pigments utiliss avec la
chaux (milieu alcalin).
Le mlange seffectue en deux ou trois tapes : dabord le mlange eau et
chaux, ensuite lajout de pigments ou adjuvants, enfin, si ncessaire, redilu-
tion de lensemble.
D
Les adjuvants
Ils sont utiliss pour faciliter la mise en oeuvre ou la durabilit des laits de
chaux. Quils soient de caractre traditionnel (casine, huile de lin...) ou de
caractre contemporain (rsine de synthse...), leur dosage doit tre adapt
et leur compatibilit avec le lait de chaux (milieu alcalin) et le support doit
tre vrifie.
Dcor en trompe l'il
l'aide de badigeons d'eau forte
2
SUPPORTS
Lapplication de lait de chaux seffectue sur des parements minraux neufs
ou anciens, nettoys de toutes traces de pulvrulence ou de matriaux dau-
tre nature (rouille, peinture, suie....), et pralablement humidifis de faon
uniforme.
Lorsque le support est un enduit, des essais de convenance sont ncessaires.
3
TECHNIQUES DE MISE EN UVRE
Deux techniques de mise en uvre sont possibles : la technique " sec", la
plus frquente, ou la technique " fresque", principalement utilise pour les
eaux-fortes.
Lapplication se ralise laide de brosse badigeon (brosse rectangulaire ou
ronde, de grande action, en soie naturelle) en couche croise en terminant
verticalement.
Suivant la qualit du support, deux ou trois couches peuvent tre ncessai-
res, en augmentant chaque fois la dilution (entre 15 et 50 %).
Dans le cas de lapplication sec, il convient d'humidifier pralablement le
support et d'avoir contrl l'homognit du schage.
Dans le cas de supports denduits neufs, lapplication dun lait de chaux de
type "eau-forte" peut tre ralise sur lenduit encore frais, selon la tech-
nique " fresque"; on prfrera dans ce cas lutilisation dune chaux arien-
ne pour le support et le lait de chaux.
87 La maonnerie
Badigeon de lait
de chaux sur enduit textur
88 La maonnerie
Adjuvant : produit ajout, en faible quantit, un mortier pour en modifier les
proprits.
Arienne : qualificatif dune chaux qui fait sa prise lair.
Agrgat : matriau dorigine minrale constituant la charge dun mortier (sable,
gravier, cailloux concasss, )
Alcalin : qui a des proprits basiques.
Aluminate : sel daluminium qui contribue lhydraulicit de la chaux.
Carbonate de calcium : CaCO3, constituant des roches calcaires.
Carbonatation : opration de prise de la chaux arienne par transformation de
lacide carbonique (gaz carbonique dissous dans leau) en carbonate.
Casine : sous-produit du lait utilis dans la fabrication de certains matriaux en
raison de son pouvoir collant.
Chaux : oxyde de calcium (CaO) obtenu par la calcination des pierres chaux ou
pierres pltre. Elles sont ariennes si leur prise seffectue sous laction du gaz car-
bonique de lair et hydraulique lorsque ce rsultat est obtenu sous laction de
leau.
Chaux grasse : qualificatif employ pour voquer la plasticit et lonctuosit des
mortiers de chaux arienne.
Chaux en pte : chaux arienne teinte avec un excs deau et gnralement
conserve dans une fosse.
Chaux calciques : chaux enrichie en calcium .
Chaux calciques hydrates : chaux teintes constitues principalement dhy-
droxyde de calcium.
Chaux de carbure : produits drivs de la fabrication dactylne partir de car-
bure de calcium.
Chaux de coquillages : chaux teintes fabriques par la calcination de coquilles
suivie dextinction
Chaux dolomitiques : chaux vives constitues principalement doxyde de cal-
cium et de magnsium.
Chaux dolomitiques hydrates : chaux teintes constitues principalement
dhydroxyde de calcium, dhydroxyde de magnsium et doxyde de magnsium.
Chaux teintes : chaux ariennes constitues principalement dhydroxyde de cal-
cium et ventuellement de magnsium, rsultant dune extinction contrle de
chaux vives. Elles nont pas de raction exothermique lorsquelles entrent en
contact avec leau. Elles sont produites sous forme de poudre ou de pte.
Chaux hydrates : (=chaux teinte, ou chaux arienne) Hydroxyde de calcium
(Ca(OH)2)
Chaux vives : chaux ariennes constitues principalement doxyde de calcium et
de magnsium produites par la calcination de calcaire et/ou de dolomie. Les chaux
vives ont une raction exothermique lorsquelles entrent en contact avec leau. Les
chaux vives se prsentent en diffrents tats granulaires, allant de la roche des
matriaux finement pulvriss.
Ciment : liant hydraulique obtenu par calcination de composants mlangs (cal-
caires, fillers, clinkers, pouzzolane, laitiers, cendres, ) ; les chaux dites hydrau-
liques artificielles sont des ciments.
GLOSSAIRE
89 La maonnerie
Clinker : petites boulettes dures de silicate, rsultant de la cuisson du mlange
dargile et de calcaire, constituant le matriau de base de fabrication du ciment.
Cne de Marsh : cne dcoulement destin mesurer la fluidit et la rduction
deau des coulis dinjection.
Couvrant : proprit dun lait de chaux couvrir de faon opaque une surface.
Crpi : enduit dont la finition est grossire
Efflorescence : dpt cristallin blanchtre traduisant une migration de sels solu-
bles entrans par lhumidit vers la surface des murs
Endoscopique : avec un instrument permettant dexaminer les cavits profondes
(camras vidoscopiques, etc..)
Event : orifice en partie haute dun rceptacle destin faciliter lvacuation de
lair pendant son remplissage.
Faenage : Micro-fissuration de lenduit provoqu par un schage trop rapide,
une composition trop riche en liant ou un excs de particules trs fines.
Foisonnement : augmentation du volume de la chaux lors de son extinction ; varia-
tion du volume dun sable en fonction de son taux dhydromtrie et de tassement.
Fresque : technique de dcor mural seffectuant par application de lait de chaux,
trs arienne, color par des pigments naturels sur un enduit encore frais (a fresco).
Gobetis : premire couche daccrochage dun enduit.
Gypse : roche sdimentaire compose de sulfate de calcium qui, chauffe, pro-
duit le pltre.
Hourder : maonner.
Jointoyer : excuter les joints dune maonnerie.
Ocre : pigment naturel minral color par des oxydes de fer ; les ocres varient
principalement du jaune ple au rouge fonc ou brun.
Ouvrabilit : dlai dutilisation dun mortier.
Parement : faces verticales dun mur.
Pigment : substance colore insoluble, colorant la surface sur laquelle il est appli-
qu, mais sans pntrer dans la matire.
Portland : nom dune carrire en Angleterre o fut dcouvert le ciment ; par
extension : ciment.
Pouzzolane : cendre volcaliques, riches en alumine, silice, chaux et fer qui,
mlang de la chaux, confre au mortier obtenu des proprits hydrauliques.
Retrait : diminution du volume dun mortier au moment de sa prise, due lva-
poration de leau.
Serrage : action de tasser un enduit, la truelle par ex., de faon en refermer
les pores pour obtenir une finition lisse et ventuellement prvenir sa fissuration.
Stuc : enduit de finition compos dun mlange de chaux arienne et de poudre
de marbre, imitant un parement de marbre color ou blanc.
Taloche : outil en bois utilis pour porter le mortier et ventuellement lappliquer
en finition de parement.
Tuileau : fragments de poteries de terre cuite.
Thixotrope : produit qui se liqufie lorsquon lagite et se rgnre lorsque lagi-
tation cesse.
90 La maonnerie
ADAM Jean-Pierre,
"La construction romaine, matriaux
et techniques", 2
me
dition,
Grand Manuel Picard, Paris.
BOUINEAU Alain,
"Le renforcement
des maonneries anciennes
l'aide de coulis d'injection", LEM
BINDA L., BARONIO G., ABANEO S.
(Politecnico Milano), MODENA C.
(Univ. de Padova),
"repair and investigation techniques for stone
masonery walls".
CARLI Flicien,
"le petit guide illustr de la chaux",
Les cahiers de Terre et Couleurs.
Centre scientifique et technique
de la construction,
"Ravalement des faades :
choix des mthodes de nettoyage",
note d'information technique,
Bruxelles 1978.
COIGNET Jean, COIGNET Laurent,
"La maison ancienne, construction,
diagnostic, interventions",
Ed. Eyrolles, 2003 Paris.
COLLOMBET R.,
"L'humidit des btiments anciens,
causes et effets, diagnostic, remdes",
Ed. du Moniteur, 1985, Paris.
CRATerre,
"Trait de construction en terre",
Ed. Parenthses, 1989.
DUVAL Georges,
"Restauration et rutilisation
des monuments anciens",
Ed. Mardaga, 1990, Lige.
Ecole d'Avignon,
"Techniques et pratique de la chaux",
Ed. EYROLLES, 1995, 2003, Paris.
FAUK Gilles,
"Pathologies de la brique,
des maux communs avec la pierre",
article des Cahiers Techniques du Btiment n179,
avril 1997, Paris.
FROIDEVAUX Yves-Marie,
"Techniques de l'architecture ancienne,
construction et restauration",
Ed. Mardaga, 1993, Lige.
FREAL Jacques,
"L'architecture paysanne en France.
La maison", Ed. Serg, 1977, Ivry.
ICOMOS, "La consolidation des mortiers dans
les maonneries anciennes", Journe technique
internationale de l' ICOMOS, 1999, Paris.
Inventaire gnral des monuments et des richesses
artistiques de la France,
dir. J.-M. PEROUSE DE MONTCLOS,
"Architecture, mthode
et vocabulaire",
Ed. du Patrimoine, 2001, Paris.
"La protection des pierres -
guide sur les hydrofuges de surface",
Les cahiers du cercles des partenaires
du patrimoine, 2000.
"Les remontes d'eau du sol
dans les maonneries",
LRMH / ICOMOS, 1994, Paris.
Journes d'tude de la SFIIC,
"Le dessalement des matriaux poreux",
1996 Poitiers.
Ministre de l'Urbanisme et du Logement,
"Guide du diagnostic des structures",
Agence Nationale pour l'Amlioration de l'Habitat,
1984, Paris.
PIEN A., de BRUYN R. (CSTC Belgique),
"Traitement et contrle de l'humidit
ascensionnelle dans les maonneries",
1994, Paris.
VERGES-BELMIN, BROMBLET Ph.,
"Dossier sur le nettoyage",
Monumental, 2000, Paris.
VIROLLEAUD F., LAURENT M.,
"Le ravalement, guide technique,
rglementaire et juridique",
Ed. du Moniteur, 1990, Paris.
VITRUVE, "Les dix livres d'architecture,
corrigs et traduits en 1684 par C. Perrault",
Ed. Pierre Mardaga, Paris.
BIBLIOGRAPHIE
91 La maonnerie
Ecole dAvignon,
Avignon, p.20, p.63, p.64, p.69, p.70, p.72a, p.72b, p.73, p.74, p.85, p.86, p.87,
Florence BABICS,
p. de couverture, p.17, p.18, p.27, p.28, p.50, p.51, p.60, p.61, p.67, p.75, p.78,
CAPEB,
Paris, p.14, p.21, p.39, p.44, p.52, p.71,
Centre de Recherche sur les Monuments Historiques,
Paris, p.29, p.40, p.41, p.43,
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques,
Champs-sur-Marne, p.16a, p.16b, p.55,
Jean-Manuel PAOLI,
p.38
J. FREAL, droits rservs,
p.46
Droits rservs,
p.8, p.10.
CREDIT PHOTOGRAPHIQUE
Ministre de la Culture et de la Communication
Manuels de sensibilisation de la direction de larchitecture et du patrimoine
Manuel de sensibilisation la restauration de la maonnerie
Manuel de sensibilisation la restauration, la conservation et la cration de vitraux
Les manuels sur internet
http://www.culture.gouv.fr/culture/min/index-min.htm
ISBN : 2-11-094663-6
Vous aimerez peut-être aussi
- Techniques Et Pratique de La ChauxDocument171 pagesTechniques Et Pratique de La ChauxRado RazafindralamboPas encore d'évaluation
- Le Colombage, Mode D'emploi 3e Edition - Eyrolles PDFDocument80 pagesLe Colombage, Mode D'emploi 3e Edition - Eyrolles PDFFarid TataPas encore d'évaluation
- NIT 250 - Détails Pour Constructions EnterréesDocument44 pagesNIT 250 - Détails Pour Constructions EnterréesAlexandre ZeimetPas encore d'évaluation
- Henri Renaud Charpentes Et CouverturesDocument81 pagesHenri Renaud Charpentes Et CouverturesMohamed Iziki100% (3)
- Maconnerie GeneraleDocument30 pagesMaconnerie Generalecbochris100% (4)
- STRESS - FAEQ2 - Etanchéités PDFDocument93 pagesSTRESS - FAEQ2 - Etanchéités PDFNuno GeirinhasPas encore d'évaluation
- Manuel Technique1 PDFDocument50 pagesManuel Technique1 PDFTOURE100% (1)
- Construire en Béton CellulaireDocument132 pagesConstruire en Béton CellulaireYacine Tilaoui100% (9)
- MaconnerieDocument84 pagesMaconnerieSsewan Jovial100% (1)
- Construire en TerreDocument274 pagesConstruire en Terreridha1964100% (4)
- Maçonnerie PortanteDocument36 pagesMaçonnerie Portantertbf00Pas encore d'évaluation
- CNAC Dossier 127Document64 pagesCNAC Dossier 127ebicudajuPas encore d'évaluation
- Construire en Terre PDFDocument39 pagesConstruire en Terre PDFcopsam100% (2)
- MaconnerieDocument283 pagesMaconnerieNes Ben100% (1)
- Fabem 1Document470 pagesFabem 1charrue100% (2)
- MACONNERIE OkDocument60 pagesMACONNERIE OkBertrand ChevestrierPas encore d'évaluation
- Maçonneries Murs Terre CuiteDocument36 pagesMaçonneries Murs Terre CuiteNERI000100% (1)
- A3 FondationsDocument9 pagesA3 FondationsiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- R Rex Construction BoisDocument25 pagesR Rex Construction BoisHabib LajiliPas encore d'évaluation
- MaçonnerieDocument100 pagesMaçonnerieedein2013Pas encore d'évaluation
- Bardage FaçadeDocument118 pagesBardage FaçadeArmel100% (1)
- Ossatures MetalliquesDocument99 pagesOssatures Metalliquesgaci kenzaPas encore d'évaluation
- CT-B62 - Construire en Béton Préfabriqué PDFDocument260 pagesCT-B62 - Construire en Béton Préfabriqué PDFmlamourPas encore d'évaluation
- Fabem 6.1 PDFDocument221 pagesFabem 6.1 PDFValentin GuillotPas encore d'évaluation
- Les Produits de Structure en Bois Et Dérives Du Bois en FranceDocument76 pagesLes Produits de Structure en Bois Et Dérives Du Bois en FranceDeejay Chris100% (2)
- Chap5 98 99 RenaudDocument3 pagesChap5 98 99 RenaudAndrei SimonPas encore d'évaluation
- Extr Etancheite ToitureDocument8 pagesExtr Etancheite ToitureNazim KASSAB0% (1)
- Mecanique SolDocument10 pagesMecanique SolHamza Echaoui0% (2)
- Guide Charpente Traditionnelle 092010Document24 pagesGuide Charpente Traditionnelle 092010nicoteen100% (2)
- O Pathologie Carrelages Chapes Associees SommaireDocument11 pagesO Pathologie Carrelages Chapes Associees SommairekhassimPas encore d'évaluation
- L'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirD'EverandL'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirPas encore d'évaluation
- 2006 Manuel de Sensibilisation À La Restauration de La Maconnerie MCC DAPDocument93 pages2006 Manuel de Sensibilisation À La Restauration de La Maconnerie MCC DAPMascariPas encore d'évaluation
- 100 Fiches Pratiques de Menuiserie, Agencement Et B Nisterie... Wawacity - BooDocument224 pages100 Fiches Pratiques de Menuiserie, Agencement Et B Nisterie... Wawacity - BooGildas EyiPas encore d'évaluation
- Manuel VitrailDocument115 pagesManuel Vitrailstelianpascatusa100% (1)
- Equipement Ouvrage - 2 - EtancheitéDocument93 pagesEquipement Ouvrage - 2 - EtancheitéFatiha ZelmatPas encore d'évaluation
- Fusion de La Fonte Au Cubilot: TechnologieDocument31 pagesFusion de La Fonte Au Cubilot: Technologieimen mehri100% (2)
- Table Des MatieresDocument27 pagesTable Des Matierestizgroup17Pas encore d'évaluation
- LCPC - Compactage Des Enrobes Hrydrocarbones A ChauxDocument81 pagesLCPC - Compactage Des Enrobes Hrydrocarbones A Chauxiftstpbdiro50% (2)
- Guide Tech Réparation Fond OA (2016)Document56 pagesGuide Tech Réparation Fond OA (2016)zazaPas encore d'évaluation
- CONSTR A3 10 Avril 2021 CoursDocument119 pagesCONSTR A3 10 Avril 2021 CoursArchi diyaPas encore d'évaluation
- Barrages 1Document26 pagesBarrages 1yara3Pas encore d'évaluation
- CCTP Elements Architecturaux PrefabriqDocument64 pagesCCTP Elements Architecturaux Prefabriqwhmidi7331Pas encore d'évaluation
- Joints de PontsDocument83 pagesJoints de PontsibsonsPas encore d'évaluation
- Béton CT-T47Document97 pagesBéton CT-T47Aboubacry SOWPas encore d'évaluation
- Guide Des Travaux en PolythéléneDocument105 pagesGuide Des Travaux en PolythéléneAchraf Abdelmaksoud100% (2)
- Manual Restaurare Vitralii LRMH 2014Document116 pagesManual Restaurare Vitralii LRMH 2014App Protecţia PatrimoniuluiPas encore d'évaluation
- 7 BTC StabiliséDocument37 pages7 BTC StabiliséLEIS DJIFACK100% (1)
- Poly OA 2016Document259 pagesPoly OA 2016El RachidPas encore d'évaluation
- 206E Guide-Conception-Voirie 2019 BDliensDocument64 pages206E Guide-Conception-Voirie 2019 BDliensAMOUZOUN ChristophePas encore d'évaluation
- Emprisonnons La ChaleurDocument156 pagesEmprisonnons La ChaleurNils Lövgren BouliannePas encore d'évaluation
- Technique Et Méthodes Des Laboratoires, Ponts Et ChausséesDocument71 pagesTechnique Et Méthodes Des Laboratoires, Ponts Et ChausséesАли Рафик100% (1)
- Tech de L'ing - Calfeutrement Des Joints PDFDocument12 pagesTech de L'ing - Calfeutrement Des Joints PDFIdriss ZakiPas encore d'évaluation
- Annexe 01 BKF 061 vp03Document192 pagesAnnexe 01 BKF 061 vp03NANGUITA EMMANUELPas encore d'évaluation
- GAZ NATUREL LIQUEFIE: Procédés Et TechnologieDocument200 pagesGAZ NATUREL LIQUEFIE: Procédés Et TechnologiedoufethiPas encore d'évaluation
- T Proc Notices Notices 075 K Notice Doc 73632 319084913Document42 pagesT Proc Notices Notices 075 K Notice Doc 73632 319084913HelmsmanPas encore d'évaluation
- AbaqusDocument41 pagesAbaqusauto31000100% (1)
- Cours TunnelsDocument80 pagesCours TunnelsAbakarTahir100% (1)