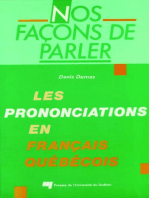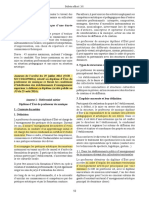Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Sax Pour Les Compositeurs PDF
Le Sax Pour Les Compositeurs PDF
Transféré par
haha44000Droits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- El Tango de Roxanne (String Quintet) - Score and PartsDocument16 pagesEl Tango de Roxanne (String Quintet) - Score and PartsBoris Leonardo100% (3)
- 2.eric Sammut Hombre D AoutDocument1 page2.eric Sammut Hombre D AoutJhon JairoPas encore d'évaluation
- Analisis Concierto GlazounovDocument26 pagesAnalisis Concierto GlazounovRoberto Suarez TouzonPas encore d'évaluation
- Acerquemonos Todos Al Altar - Francisco PalazónDocument2 pagesAcerquemonos Todos Al Altar - Francisco PalazónLeonardo D Amador100% (5)
- A Wizard Sheet MusicDocument9 pagesA Wizard Sheet MusicAndrew FrankPas encore d'évaluation
- Mix Viejo VerdeDocument33 pagesMix Viejo VerdeEmerson Chavez100% (1)
- Elegy (Renascence)Document6 pagesElegy (Renascence)Caleb McCarrollPas encore d'évaluation
- Phonetique Et Prononciation CN PDFDocument102 pagesPhonetique Et Prononciation CN PDFFarid Joujou100% (2)
- Fil D'ariane 3eDocument300 pagesFil D'ariane 3esylvie100% (2)
- I Wish - Tenor Sax.Document1 pageI Wish - Tenor Sax.Miquel JustCardona100% (1)
- Let's Go To Work-TABDocument6 pagesLet's Go To Work-TABMiquel JustCardona100% (1)
- Saxo Cubano - Tenor Sax.Document2 pagesSaxo Cubano - Tenor Sax.Miquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Sueno Imposible Partitura Completa PDFDocument1 pageSueno Imposible Partitura Completa PDFAldrack BorkrusPas encore d'évaluation
- Halleluja Sophisticated Arrangement of Cohen S Classic String Quartet PDFDocument13 pagesHalleluja Sophisticated Arrangement of Cohen S Classic String Quartet PDFVelizar Prodanov100% (1)
- PedagogietDocument89 pagesPedagogietEsaDrawPas encore d'évaluation
- STUCKI DelphineDocument45 pagesSTUCKI DelphineJeanPas encore d'évaluation
- Devoir 2as2Document7 pagesDevoir 2as2Jacinthe Violette FleurPas encore d'évaluation
- Accordeón Diatonique Et Musiques TraditionnellesDocument44 pagesAccordeón Diatonique Et Musiques TraditionnellesMaryanneFrancesconPas encore d'évaluation
- Mégalithes de Carnac, Du Golfe Du Morbihan Et de La Baie de Quiberon: Dossier de Confirmation Sur La Liste IndicativeDocument184 pagesMégalithes de Carnac, Du Golfe Du Morbihan Et de La Baie de Quiberon: Dossier de Confirmation Sur La Liste IndicativePaysagesDeMégalithes100% (7)
- Oriane Marck - La Musique Dans La Societe Traditionnelle Au Royaume Kongo XVe-XIXe SiecleDocument177 pagesOriane Marck - La Musique Dans La Societe Traditionnelle Au Royaume Kongo XVe-XIXe SiecleMerland Handréas DibPas encore d'évaluation
- Le Paysage Façonné Les Territoires Postindustriels, Lart Et LusageDocument257 pagesLe Paysage Façonné Les Territoires Postindustriels, Lart Et LusageRichard Kennith Asto AltamiranoPas encore d'évaluation
- Ary Carpman - L'Influence Du Moyen de Composition Sur La Musique Électroacoustique - Les Supports de Sonofixation - 2014Document163 pagesAry Carpman - L'Influence Du Moyen de Composition Sur La Musique Électroacoustique - Les Supports de Sonofixation - 2014ManesPas encore d'évaluation
- Nos façons de parler: Les prononciations en français québécoisD'EverandNos façons de parler: Les prononciations en français québécoisPas encore d'évaluation
- Le Tuba Contemporain PDFDocument58 pagesLe Tuba Contemporain PDFTino HernándezPas encore d'évaluation
- Vocable All English - 27 Juin 2019Document36 pagesVocable All English - 27 Juin 2019Fatma Gözdenur MercanPas encore d'évaluation
- Acoustique Du Bâtiment - 4GCUDocument98 pagesAcoustique Du Bâtiment - 4GCUHamza MamiPas encore d'évaluation
- La transparence en communication: Une clé théorique et pratique pour la réussiteD'EverandLa transparence en communication: Une clé théorique et pratique pour la réussitePas encore d'évaluation
- Musique Pour Luth Jouée À La Guitare Moderne. Adaptation de Suites de Silvius Léopold Weiss Pour La Guitare À 11 CordesDocument100 pagesMusique Pour Luth Jouée À La Guitare Moderne. Adaptation de Suites de Silvius Léopold Weiss Pour La Guitare À 11 CordesAfshin TorabiPas encore d'évaluation
- UntitledDocument20 pagesUntitledMairie de LannoyPas encore d'évaluation
- Activité D'écouteDocument42 pagesActivité D'écouteAlanPas encore d'évaluation
- LaporteDocument161 pagesLaportethechnurfPas encore d'évaluation
- Jean-Nicolas de Surmont - Chanson - Son Histoire Et Sa Famille Dans Les Dictionnaires de Langue Française. Étude Lexicale, Théorique Et HistoriDocument258 pagesJean-Nicolas de Surmont - Chanson - Son Histoire Et Sa Famille Dans Les Dictionnaires de Langue Française. Étude Lexicale, Théorique Et HistoriDJEHA14Pas encore d'évaluation
- 2016 MM2 PoullaouecM PartielleDocument161 pages2016 MM2 PoullaouecM PartielleMeher ZitouniPas encore d'évaluation
- CO 20-01-2014 Ainsi Fond Fond FondDocument2 pagesCO 20-01-2014 Ainsi Fond Fond FondAntoromePas encore d'évaluation
- Tesis Sobre La Entrada de La Figura Del Solista en Los ConciertosDocument655 pagesTesis Sobre La Entrada de La Figura Del Solista en Los ConciertosDavid Fiel100% (1)
- Description Guadeloupe CreoleDocument318 pagesDescription Guadeloupe CreolemilesPas encore d'évaluation
- Item 2Document153 pagesItem 2Myma WeundePas encore d'évaluation
- Le Tuba Contemporain LQ PDFDocument58 pagesLe Tuba Contemporain LQ PDFjpisisPas encore d'évaluation
- Paris - Le Parc de La Villette - ExercicesDocument4 pagesParis - Le Parc de La Villette - ExercicesgwendolynlmPas encore d'évaluation
- P17054coll23 125Document108 pagesP17054coll23 125afgccgfaPas encore d'évaluation
- Etude Bob Revel - Analyse Enseignement Musiques Actuelles PDFDocument186 pagesEtude Bob Revel - Analyse Enseignement Musiques Actuelles PDFfranck GARCIAPas encore d'évaluation
- Controle 1 FDocument4 pagesControle 1 FouyoubbrahimPas encore d'évaluation
- STIEVENART Manuel D Elevage Des Escargot Geants AfricainsDocument41 pagesSTIEVENART Manuel D Elevage Des Escargot Geants AfricainsOrios AdklPas encore d'évaluation
- Thèse RifaliDocument123 pagesThèse RifaliAbdelhamid ElgarbiPas encore d'évaluation
- Les Oiseaux Dans L'écriture Égyptienne AncienneDocument152 pagesLes Oiseaux Dans L'écriture Égyptienne AncienneVincent DonvalPas encore d'évaluation
- Rapport Stage F. Lanckriet Juillet 2017Document63 pagesRapport Stage F. Lanckriet Juillet 2017DahirouPas encore d'évaluation
- BARREIRO La Construction D'un Imaginaire Environnemental Dans Trois Romans Hispano-AméricainsDocument477 pagesBARREIRO La Construction D'un Imaginaire Environnemental Dans Trois Romans Hispano-AméricainsptqkPas encore d'évaluation
- Janvier 2 14Document87 pagesJanvier 2 14delgeomeongbeingPas encore d'évaluation
- Loeil DémeraudeDocument23 pagesLoeil DémeraudeLegrandPas encore d'évaluation
- Cours Phya 2eme AnneeDocument48 pagesCours Phya 2eme Anneemamisoaella3Pas encore d'évaluation
- SOLOMOS Makis XenakisDocument132 pagesSOLOMOS Makis XenakisCédric Segond-GenovesiPas encore d'évaluation
- Les Tables PFE Final PDFDocument4 pagesLes Tables PFE Final PDFAyad SaidPas encore d'évaluation
- Livre-Cusimano, Christophe - Sens en Mouvement Études de Sémantique InterprétativeDocument139 pagesLivre-Cusimano, Christophe - Sens en Mouvement Études de Sémantique InterprétativeaksilPas encore d'évaluation
- TerroireuxDocument25 pagesTerroireuxtadidafPas encore d'évaluation
- Le de Historia Stirpium de Leonhart Fuchs Histoire D Un Succes Editorial 1542 1560Document110 pagesLe de Historia Stirpium de Leonhart Fuchs Histoire D Un Succes Editorial 1542 1560Julia VillardPas encore d'évaluation
- Acoustique Du Batiment: Auteurs de La Ressource Pédagogique Mrs Krauss Gérard, Yezou René, Kuznik FrédéricDocument102 pagesAcoustique Du Batiment: Auteurs de La Ressource Pédagogique Mrs Krauss Gérard, Yezou René, Kuznik FrédéricMbaye NdoyePas encore d'évaluation
- CITE DU DESIGN - Création Et Ville Solidaire: Etat de L'art Des Dispositifs CréatifsDocument338 pagesCITE DU DESIGN - Création Et Ville Solidaire: Etat de L'art Des Dispositifs CréatifsDélégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées (Dihal)Pas encore d'évaluation
- Accordeon MondeDocument114 pagesAccordeon Monderichardgaetan53Pas encore d'évaluation
- CO 131220 RTS Lac LemanDocument3 pagesCO 131220 RTS Lac LemanInes Ben DhahbiPas encore d'évaluation
- MAURIN Anne M2 RECH 2013 DUM VERSION CORRIGEEDocument117 pagesMAURIN Anne M2 RECH 2013 DUM VERSION CORRIGEEIlo IloPas encore d'évaluation
- Vocabulaire International de La DiplomatiqheDocument153 pagesVocabulaire International de La DiplomatiqheRaul AbajoPas encore d'évaluation
- These Arlette CAPDEPUY AnnexesDocument195 pagesThese Arlette CAPDEPUY Annexesseck.diakaryPas encore d'évaluation
- 2014 Pest 0032Document704 pages2014 Pest 0032sevilPas encore d'évaluation
- Memoire God inDocument135 pagesMemoire God inHbb HbbPas encore d'évaluation
- 1602-2290-Dossier de Nomination-FrDocument127 pages1602-2290-Dossier de Nomination-Frxx xxxPas encore d'évaluation
- L Evolution Des Bibliotheques MusicalesDocument87 pagesL Evolution Des Bibliotheques MusicalesDaniel PerezPas encore d'évaluation
- Eschig Pedago 1999Document12 pagesEschig Pedago 1999belacqua16Pas encore d'évaluation
- Https:::dumas CCSD Cnrs Fr:dumas-01144608:documentDocument90 pagesHttps:::dumas CCSD Cnrs Fr:dumas-01144608:documentRémy Bres-FeuilletPas encore d'évaluation
- Correction Évaluation Familles de Mots Préfixes SuffixesDocument2 pagesCorrection Évaluation Familles de Mots Préfixes Suffixesmohamed67% (3)
- Rites de La Mort en AlsaceDocument63 pagesRites de La Mort en AlsaceMònica Miró Vinaixa0% (1)
- All of Me - Johnny HodgesDocument2 pagesAll of Me - Johnny HodgesflexbwebbPas encore d'évaluation
- A Flower Is A Lovesome Thing - Joe Henderson PDFDocument2 pagesA Flower Is A Lovesome Thing - Joe Henderson PDFMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Vals Mariposas GrallaDocument1 pageVals Mariposas GrallaMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Vals Mariposas Gralla - Mus1 - PiccoloDocument1 pageVals Mariposas Gralla - Mus1 - PiccoloMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Vals Mariposas Gralla - Mus1Document1 pageVals Mariposas Gralla - Mus1Miquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Les Is MoDocument2 pagesLes Is MoMiquel JustCardona100% (1)
- Spherical Brecker SoloDocument3 pagesSpherical Brecker SoloMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- The Brecker Brothers-Heavy Metal BebopDocument47 pagesThe Brecker Brothers-Heavy Metal BebopMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Yellow Jackets IndigoDocument46 pagesYellow Jackets IndigoMiquel JustCardona50% (2)
- Come, Christians, Join To Sing!: Christian H. Bateman Joel RaneyDocument16 pagesCome, Christians, Join To Sing!: Christian H. Bateman Joel RaneyEze JasperPas encore d'évaluation
- Oh Señor Delante de Ti, Canto de OfertorioDocument7 pagesOh Señor Delante de Ti, Canto de OfertorioRojas RichardsPas encore d'évaluation
- Diana Sax TenorDocument1 pageDiana Sax TenorAugusto RodriguezPas encore d'évaluation
- Infantes em Marcha - J. RaposoDocument1 pageInfantes em Marcha - J. RaposovmiraPas encore d'évaluation
- (Superpartituras - Com.br) Cheira A Lisboa PDFDocument1 page(Superpartituras - Com.br) Cheira A Lisboa PDFMarcos SantiagoPas encore d'évaluation
- Sax Quintet MVT 2Document10 pagesSax Quintet MVT 2Jiggly HippoPas encore d'évaluation
- Lilium - Sax - Full Score PDFDocument1 pageLilium - Sax - Full Score PDFEdwin SablonPas encore d'évaluation
- 1.10 Yellow Submarine in Pepperland HOF Trumpet in BBDocument2 pages1.10 Yellow Submarine in Pepperland HOF Trumpet in BBJakub WaszczeniukPas encore d'évaluation
- Accord de Do Septième de Dominante Do Mi Sol Sib (C E G BB)Document2 pagesAccord de Do Septième de Dominante Do Mi Sol Sib (C E G BB)CDAN40Pas encore d'évaluation
- Du Rhum Des Femmes Chords by Soldat Louis @Document1 pageDu Rhum Des Femmes Chords by Soldat Louis @Bottox ToxiicPas encore d'évaluation
- Jubilate DeoDocument7 pagesJubilate DeoLuca MozzilloPas encore d'évaluation
- Dual Gres General 2016 2017Document200 pagesDual Gres General 2016 2017Basem UsamaPas encore d'évaluation
- Hit The Road JackDocument2 pagesHit The Road JackAleksidkPas encore d'évaluation
- MATILDE SINFONICA - Tenor Sax - .MusxDocument2 pagesMATILDE SINFONICA - Tenor Sax - .MusxHayder MariñoPas encore d'évaluation
- In quegli anni in cui val poco 莫扎特Document5 pagesIn quegli anni in cui val poco 莫扎特郑曌Pas encore d'évaluation
- Dossier de Presse Fêtes Musicales 2018 PDFDocument14 pagesDossier de Presse Fêtes Musicales 2018 PDFLe Journal du CentrePas encore d'évaluation
- Schubert La Jeune Fille Et La Mort 1mvt Clarinet QuartetDocument20 pagesSchubert La Jeune Fille Et La Mort 1mvt Clarinet QuartetMaria Angela Saiz BlancoPas encore d'évaluation
- Annexes de Musique - Juillet 2016Document13 pagesAnnexes de Musique - Juillet 2016Cécile LeroyPas encore d'évaluation
- Resvellies VousDocument2 pagesResvellies VousMaite Cerezo cremadesPas encore d'évaluation
- WorshipDocument7 pagesWorshipMay Ann Mendoza CayananPas encore d'évaluation
- Salve Pater SalvatorisDocument1 pageSalve Pater SalvatorisPalendo ItopoPas encore d'évaluation
- Salmo 127 GregorianoDocument1 pageSalmo 127 GregorianoJean NardottoPas encore d'évaluation
- Manual Ampeg Micro VRDocument8 pagesManual Ampeg Micro VRJuanGuajardoPas encore d'évaluation
Le Sax Pour Les Compositeurs PDF
Le Sax Pour Les Compositeurs PDF
Transféré par
haha44000Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Sax Pour Les Compositeurs PDF
Le Sax Pour Les Compositeurs PDF
Transféré par
haha44000Droits d'auteur :
Formats disponibles
4
Prface
Le saxophone est un instrument de musique dont la popularit
est un fait notoire. Cette popularit, et lapprciation
hautement favorable de linstrument quelle vhicule, ne se
limitent pas aux utilisations conventionnelles dans des
rpertoires familiers tels que jazz, musiques populaires,
classiques, militaires, rock; elles touchent de plus en plus
diffrents milieux de la cration musicale contemporaine :
musiques alternatives, actuelles, savantes, multimdias, etc. Aux
dires de certains saxophonistes de rputation internationale et
de plusieurs compositeurs reconnus, le saxophone se prsente
comme tant linstrument daujourdhui et, surtout, de demain.
En effet, le saxophone a de grandes aptitudes techniques et
musicales, ce qui le rend attrayant et, par consquent, incite un
nombre grandissant de compositeurs crire pour lui. Bien que le
nombre duvres originales pour saxophone ait fait un bond
considrable depuis les trente dernires annes et que leur
diffusion soit en plein essor dans plusieurs pays, il reste
important denrichir le rpertoire faisant appel aux possibilits
multiples du saxophone, si on veut faire connatre davantage
notre instrument non seulement du public en gnral mais aussi
des compositeurs.
En tant que saxophonistes canadiens, nous nous devons de
faire la promotion de notre instrument auprs des compositeurs de
talent de chez nous, de manire augmenter la qualit et la
quantit duvres, ce qui est primordial pour lavenir et
limportance du saxophone. Dj, plusieurs pionniers des
saxophonistes importants du Qubec et du Canada ont trac la
voie vers une mergence importante du saxophone et de son
rpertoire. Nous devons poursuivre ce travail et donner
linstrument une place de choix dans le monde musical non
seulement canadien mais aussi international.
Le saxophone pour les compositeurs , prsent par Mathieu
Gaulin, est un outil important pour les compositeurs. Dabord,
par son srieux et sa qualit, cet ouvrage est un bon incitatif
pour le compositeur averti tent par un ventuel projet
dcriture pour le saxophone. Ensuite, ce document va permettre
des compositeurs moins familiers dapprcier les possibilits du
saxophone et les amnera peut-tre composer pour lui. Enfin, il
est dun prcieux apport sur le plan de la connaissance
approfondie de linstrument, parfois un peu sommaire, et il
5
pourrait entraner la cration duvres plus aventureuses sur
le plan technique. Il va de soi que cet ouvrage permettra aux
compositeurs davoir accs un ventail plutt large des
possibilits du saxophone.
crit de faon claire et prcise, Le saxophone pour
compositeurs est facile comprendre et consulter. Les
exemples musicaux enregistrs sur disque compact sont loquents
et dune rigoureuse propret de jeu. Il mapparat important de
diffuser ce document afin daider llargissement de notre
rpertoire.
Jean-Franois Guay
6
Table des matires
BRVE INTRODUCTION ...............................................................................................................................................8
A) INFORMATIONS GNRALES............................................................................................................................9
I. Anatomie du Saxophone ................................................................................................................................9
II. Tessiture.....................................................................................................................................................9
a- Tessiture de base........................................................................................................................................9
a. Le Soprano...........................................................................................................................................10
b. LAlto..................................................................................................................................................10
c. Le Tnor ..............................................................................................................................................10
d. Le Baryton...........................................................................................................................................10
e. Le Basse...............................................................................................................................................10
b- Ajout du suraigu......................................................................................................................................11
a. Au Soprano..........................................................................................................................................11
b. lAlto................................................................................................................................................11
c. Au Tnor..............................................................................................................................................11
d. Au Baryton..........................................................................................................................................11
e. Au Basse..............................................................................................................................................11
c- Considrations relatives aux diffrents registres.....................................................................................11
III. Transposition...........................................................................................................................................12
a. Soprano transpos................................................................................................................................12
b. Alto transpos......................................................................................................................................12
c. Tnor transpos....................................................................................................................................12
d. Baryton transpos................................................................................................................................12
e. Basse transpos....................................................................................................................................12
IV. Timbres ....................................................................................................................................................13
a- Au sujet de lanche..................................................................................................................................13
b- Au sujet du bec........................................................................................................................................13
c- Au sujet de linstrument lui-mme..........................................................................................................13
V. Orchestration...........................................................................................................................................13
a- Rle des saxophones dans les grands ensembles.....................................................................................13
b- Volume versus intensit...........................................................................................................................14
c- Au sujet du vibrato..................................................................................................................................14
d- Analogies timbrales.................................................................................................................................15
e- Exemples tirs du rpertoire orchestral ...................................................................................................15
a. Solo de saxophone...............................................................................................................................15
b. Flte et saxophone alto........................................................................................................................16
c. Clarinettes et saxophone tnor.............................................................................................................16
d. Hautbois et saxophone.........................................................................................................................17
e. Basson et saxophone alto.....................................................................................................................17
f. Plusieurs bois et saxophone.................................................................................................................18
g. Bois, cors et saxophone alto................................................................................................................19
h. Cors et saxophone alto.........................................................................................................................19
i. Cuivres (autres que le cor) et saxophone.............................................................................................19
j. Cordes et saxophone alto.....................................................................................................................19
k. Bois, cordes et saxophone alto.............................................................................................................20
l. Voix et saxophone alto........................................................................................................................21
f- Emplacement sur la partition...................................................................................................................21
g- Le saxophone dans les traits dorchestration.........................................................................................22
VI. Virtuosit digitale (vlocit, volubilit) ...................................................................................................23
7
a- Limites de la virtuosit digitale...............................................................................................................23
b- Dure du travail de rptition ncessite.................................................................................................24
B) POTENTIEL SAXOPHONIQUE..........................................................................................................................24
1. Le Saxophone et linfluence Classique........................................................................................................24
1.1 Types dattaques......................................................................................................................................24
1.2 Dtach simple.........................................................................................................................................27
1.3 Nuances (intensits).................................................................................................................................27
1.3.1 Fluctuation de lintensit.............................................................................................................27
1.4 Vibrato et tremblement............................................................................................................................28
1.5 Trilles et batteries (trmolos)...................................................................................................................28
1.5.1 Shake...........................................................................................................................................29
1.6 Dure du souffle......................................................................................................................................29
2. Le Saxophone et le Jazz ...............................................................................................................................29
2.1 Inflexion...................................................................................................................................................29
2.1.1 Glissement...................................................................................................................................30
2.2 Glissando.................................................................................................................................................30
2.3 Dtimbr (subtone)..................................................................................................................................30
2.3.1 Marmonnement............................................................................................................................31
2.4 Harmoniques naturels..............................................................................................................................31
2.4.1 Balayement des composantes harmoniques.................................................................................31
2.5 Doigts alternatifs....................................................................................................................................32
3. Le Saxophone, instrument Contemporain....................................................................................................32
3.1 Souffle.....................................................................................................................................................32
3.2 Bruits de cls et sons tambourins.............................................................................................................32
3.2.1 Attaque tambourin .....................................................................................................................33
3.3 Effets vocaux...........................................................................................................................................33
3.4 Fins et milieux des sons...........................................................................................................................33
3.5 Slap..........................................................................................................................................................33
Pour la notation, voir 1.1 Types dattaques. ........................................................................................34
3.6 Sans le bec...............................................................................................................................................34
a- Sons-trompettes.................................................................................................................................34
b- Slap du bocal .....................................................................................................................................34
3.7 Bec seulement..........................................................................................................................................34
3.8 Bec et bocal..............................................................................................................................................35
3.9 Flattement, flatterzunge ou frullato (anglais : flutter)..............................................................................35
3.10 Double dtach........................................................................................................................................36
3.11 Lllll .......................................................................................................................................................36
3.12 Multiphoniques ou Sons multiples...........................................................................................................36
3.13 Respiration continue................................................................................................................................37
3.14 Micro-intervalles......................................................................................................................................37
3.15 Bisbigliando ou flattement.......................................................................................................................38
3.16 Suraigus extrmes....................................................................................................................................38
3.17 Barrissement............................................................................................................................................38
C) CONCLUSION................................................................................................................................................39
D) POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS/POUR NOUS CONTACTER ..........................................................................40
E) INDEX DE LENREGISTREMENT DES EFFETS...................................................................................................40
F) LISTE DCOUTE...........................................................................................................................................42
G) BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................42
H) MICRO-BIOGRAPHIES DES PERSONNES CITES...............................................................................................43
8
Le Saxophone
pour les Compositeurs
tude des possibilits des cinq principaux saxophones
Brve introduction
Cest aprs avoir assist un concert donn par des compositeurs tudiant luniversit que nous
nous sommes rendus compte que le saxophone est un instrument mconnu. En effet, les
instrumentations des diverses oeuvres taient trs varies et seul le saxophone ntait pas de la partie.
Ce problme affecte les saxophonistes contemporains (ceux-ci choisissent parfois daller gagner leur
vie ailleurs), les compositeurs (tous les compositeurs srieux composent maintenant pour saxophone), la
population (qui est limite ne connatre que les tounettes de ceux qui ont largent pour passer leurs
annonces la tl) et notre culture musicale (le rpertoire, les mthodes et les enregistrements sont en
majorit europens et amricains).
Parmi les nombreuses tapes nous permettant de remdier cette situation, nous, saxophonistes,
nous devons de promouvoir notre instrument vous, crateurs.
Lobjectif de ce document nest pas de cataloguer de faon prcise toutes les capacits du saxophone;
ce propos, dautres livres sont disponibles. Aussi, un interprte ny dcouvrira pas de secrets
techniques : les moyens pour matriser les effets ne sont pas lobjet de louvrage. En fait, les trs
nombreuses possibilits de linstrument, telles que nous les avons dcrites, permettront au compositeur
dimaginer les contextes et mme, grce une collaboration compositeur-interprte, dlargir les
frontires du champ daction saxophonique. Ainsi, les possibilits ne vous sont pas proposes comme des
limites mais bien comme un matriau de base transcendant. Dailleurs, si vous avez des questions, si vous
notez certaines imprcisions, des erreurs de franais ou dordre musical, etc., ou pour tout autre
commentaire, veuillez sil vous plat nous en faire part (voir D) Pour plus de renseignements/Pour nous
contacter).
Avant tout, cet ouvrage est ddi aux compositeurs.
9
A) Informations gnrales
Antoine-Joseph (Adolphe) Sax naquit en 1814 et mourut en 1894. Il fut cet inventeur prolifique qui
cra, entre autres, la famille des sept saxophones (sopranino, soprano, alto, tnor, baryton, basse et
contrebasse). Linstrument fut brevet en 1846, bien quil vt le jour en 1842.
I. Anatomie du Saxophone
II. Tessiture
Si on tient compte de lextension de sa tessiture par lutilisation du suraigu, le saxophone offre une
tendue apprciable. Toutefois, nous commencerons par tablir son tendue de base.
a- Tessiture de base
Chaque saxophone a une tessiture de 2 octaves. Le quatuor SATB (soprano, alto, tnor, baryton)
couvre 4 octaves.
10
a. Le Soprano
Linstrument sensuel par excellence. Il nen reste pas moins un saxophone et il savre tout aussi
original que ses frres. Cest souvent lusage quen font certains interprtes connus qui finit par identifier
un instrument un style.
De lab3 fa6 (plusieurs modles noffrent encore que jusqu mi6), soit 2 octaves + 6te majeure.
b. LAlto
Le plus utilis des saxophones, tous styles confondus. La grande majorit du rpertoire
classique pour saxophone est ddie lalto.
De rb3 la5, soit 2 octaves + 6te mineure.
c. Le Tnor
Le favori des jazzophiles et souvent des popophiles. Son registre lui permet de sassocier
efficacement de petites formations comprenant une ou plusieurs trompettes et un ou plusieurs
trombones.
De lab2 mi5, soit 2 octaves + 6te mineure.
d. Le Baryton
Le dernier du quatuor mais non le moindre. Beaucoup de saxophonistes et de compositeurs
idoltrent le charme de ce petit titan (la famille des 7 saxophones comprend aussi le basse et le
contrebasse).
De do2 la4, soit 2 octaves + 6te majeure.
* Le quatuor SATB offre donc ltendue dlimite par do2 et fa6, soit 4 octaves + 4te juste.
e. Le Basse
Ce saxophone assez inusit bien que disponible a des capacits musicales tonnantes. Il pourrait
tre intressant de composer pour une formation ATBBs (alto, tnor, bary et basse), ou de seulement
remplacer le baryton par le basse: SATBs. Notez quen 1994, il ny avait aucune pice rpertorie pour
lune ou lautre de ces formations. De plus, rien ne nous indique quil y en ait eu dcrites depuis. La raison
de cette discrimination face au basse ne peut tre que due au fait que linstrument et ses interprtes sont
relativement rares. Toutefois, de nos jours, quiconque sy intresse peut dnicher un saxophone basse
sans problmes.
Bien que sa tessiture est comparable celle du baryton, le basse, par sa grosseur titanesque, offre
un timbre plus riche, voire plus naturel, que celui de son frre en mib.
De lab1 rb4, soit 2 octaves + 4te juste. Les saxophones basses actuels montent jusquau mi4.
Malheureusement, ce nest pas tout le monde qui a la chance den ctoyer un... (Renseignez-vous auprs
de votre saxophoniste pour connatre les capacits de son saxophone basse.)
11
b- Ajout du suraigu
Le suraigu est aujourdhui largement utilis. Il permet lextension du registre naturel du
saxophone. Le timbre des notes suraigus, que lon peut aussi appeler harmoniques, est plus perant. Le
compositeur doit tenir compte que le saxophoniste obtient ces notes en effectuant des doigts plus ardus
et que la production de ces sons est moins aise. Lagilit du saxophone en prend donc un coup (jusqu' la
moiti de la vitesse habituelle) et lintensit ne devrait pas se situer en de de piano. De toute faon,
loreille tant trs sensible ces frquences, linterprte se retrouve dans lincapacit de produire une
intensit plus basse. Malgr ces limitations, il ne faut pas avoir peur dutiliser le suraigu : liminer cette
possibilit rduirait considrablement les capacits tessiturales du saxophone. Ltendue du suraigu
dpend surtout de linterprte. De plus, plus linstrument joue aigu, moins cette tendue est vaste. Voici
les balises que nous jugeons convenables (il ne sagit pas seulement de jouer les notes, il faut pouvoir les
jouer justes; pour des notes encore plus aigus mais plutt incontrlables, voir 3.16 Suraigus extrmes):
a. Au Soprano
De fa#6 do7, soit une 5te juste de plus. Registre total: lab3 do7, soit 3 octaves + 3ce majeure.
b. lAlto
De sib5 lab6, soit une 7me majeure de plus. Registre total: rb3 lab6, soit 3 octaves + 5te juste.
c. Au Tnor
De fa5 mi6, soit une 8ve de plus. Registre total: lab2 mi6, soit 3 octaves + 6te mineure.
d. Au Baryton
De sib4 si5, soit une 8ve + 2de majeure de plus. Registre total: do2 si5, soit 3 octaves + 7me
majeure.
* Tenant compte du suraigu, le quatuor de saxophones conventionnel (soprano, alto, tnor et
baryton) offre une tendue dlimite par do2 et do7, soit 5 octaves.
e. Au Basse
De r4 mib5, soit une 8ve de plus. Registre total: lab1 mib5, soit 3 octaves + 5te juste.
c- Considrations relatives aux diffrents registres
Le saxophone tant un instrument perce conique, ses diffrents registres sonnent de faon
uniforme. En gnral, le compositeur na pas se soucier des difficults inhrentes aux registres extrmes
car les interprtes doivent les matriser. Nanmoins, lusage du suraigu tant beaucoup moins frquent
dans le rpertoire, les interprtes ont tendance moins le pratiquer.
12
III. Transposition
Les saxophones sont des instruments transpositeurs. Pour des raisons pratiques, les parties pour
chaque saxophone sont notes en cl de sol. Les sopranino, alto, baryton et contrebasse sont des
instruments transpositeurs en mib. Les soprano, tnor et basse transposent en sib.
a. Soprano transpos
Not partir du sib sous la porte jusquau double sol (registre normal).
Suraigu: du double sol# jusquau double r.
b. Alto transpos
Not partir du sib sous la porte jusquau fa# au-dessus de la porte (registre normal).
Suraigu: du double sol au double mi.
c. Tnor transpos
Not partir du sib sous la porte jusquau fa# au-dessus de la porte (registre normal).
Suraigu: du double sol au double fa#.
d. Baryton transpos
Not partir du la sous la porte jusquau fa au-dessus de la porte (registre normal).
Suraigu: du fa# au-dessus de la porte jusquau triple sol#.
e. Basse transpos
Not partir du sib sous la porte jusquau r# au-dessus de la porte (registre normal). Les
saxophones basses actuels montent jusquau fa#. Malheureusement, ce nest pas tout le monde qui a la
chance den ctoyer un... (Renseignez-vous auprs de votre saxophoniste pour connatre les capacits de
son saxophone basse.)
Suraigu : du mi au-dessus de la porte jusqu'au triple mib.
13
IV. Timbres
Chaque type de saxophone a son timbre caractristique. De plus, chaque saxophoniste sonnera
diffremment en fonction de son exprience, de sa physionomie, de ses gots et de lquipement quil
utilise. Chaque interprte possde une palette de timbres quil utilise plus ou moins consciemment. Celle-
ci est habituellement guide par lintention musicale du musicien. Comme il sagit dun monde trs
abstrait, nous laisserons au compositeur la tche de trouver le langage pour communiquer linterprte
ce quil souhaite entendre comme couleur de son. Voici tout de mme quelques exemples relativement
concis: Brillant, Strident, Clair, Mystrieux, Large, Mince, Venteux, Chaleureux, etc.
Aussi, par lutilisation dautre matriel (nous restons toujours dans le domaine purement
acoustique), le saxophoniste peut obtenir des timbres vraiment diffrents. Il peut donc savrer pratique
de connatre quelques secrets techniques bien connus des saxophonistes.
a- Au sujet de lanche
Une anche plus forte donnera un son plus venteux et plus dur et permettra datteindre des
harmoniques (notes suraigus) plus levs. Une anche faible pourra jouer plus doux mais moins fort; le
timbre sera plus mince, plus petit, moins rond. Lanche parfaite, le juste milieu, tout le monde la
cherche...
b- Au sujet du bec
Un bec plus ouvert aura les mmes consquences quune anche plus dure, et un bec plus ferm,
celles dune anche plus molle. De plus, il existe deux catgories de becs: DC piste 1 ceux qui sont plutt
ferms (pour les musiques classique et contemporaine) et DC piste 2 ceux qui sont plutt ouverts (pour
les musiques jazz et populaire). Ce qui suit devrait intresser particulirement ceux qui recherchent des
timbres varis: les jazzmen, parce quils embouchent le bec dune faon sensiblement diffrente de celle
des interprtes classiques/contemporains, ont une palette de sons rellement diffrente de ces derniers.
Ainsi, le compositeur pourrait demander au saxophoniste dutiliser un bec de jazz et dadopter
lembouchure qui simpose. videmment, tout cela dpend des capacits de linterprte: il ne sagit pas
que dun changement de matriel.
c- Au sujet de linstrument lui-mme
Chaque saxophone a un timbre lgrement, voire imperceptiblement, diffrent. Les variations de
timbres ntant pas assez concluantes et le cot dun saxophone supplmentaire tant assez lev, nous
croyons sage de rejeter lide dadopter plusieurs saxophones de la mme taille.
V. Orchestration
a- Rle des saxophones dans lorchestre symphonique
Le saxophone peut remplir divers rles, cela dpend du traitement quen fait chaque compositeur.
14
Une constante se dgage toutefois : le saxophone agit de connivence avec les bois.
Voici dautres rles notables :
Soliste (ou accompagnement mis en vidence)
Quelques exemples tirs du rpertoire orchestral : LArlsienne de Bizet, Sinfonia da
requiem de Britten, Bolro de Ravel, Romo et Juliette de Prokofiev
1
.
Section autonome
Exemple : Jeanne dArc au bcher de Honegger. Les saxophones y remplacent la section de
cor.
Partie autonome
Exemple : Der Wein de Berg. Ici, chaque instrument jouit dune grande indpendance
contrapuntique rendant triviale leur identification.
b- Volume versus intensit
On reproche parfois au saxophone de trop ressortir par rapport aux autres instruments de
lorchestre. Cela est surtout d au large volume
2
du saxophone, dont il est impratif de se soucier.
En gnral, on peut tenir leur volume comme intermdiaire entre ceux des cors et des
clarinettes, et de mme pour leur intensit (Koechlin, Trait de lorchestration, premier volume, p.221).
intensits gales, le saxophone est prdominant lorsquil joue avec quelques bois; dans ce cas, il
est prfrable de lui donner une partie prpondrante. Nanmoins, lorsquil accompagne la section de
bois entire, le saxophone ajoutera sa couleur sans sarroger le premier plan.
Dans les intensits fortes, les cuivres sont dominants face aux saxophones.
c- Au sujet du vibrato
Le saxophone orchestral est souvent vibr. Cela sexplique en partie par le fait que la partie de
saxophone est joue par un seul saxophoniste (et non double par plusieurs saxophonistes), ce qui permet
une plus grande libert expressive de la part de linstrumentiste.
Certains saxophonistes rpriment le vibrato, tandis que dautres ne peuvent sen passer. En
gnral, le saxophoniste se sert du vibrato avec parcimonie, aux endroits ncessitant un appui expressif.
Si le vibrato agace le compositeur, il peut spcifier sans vib. ou non vib. .
1
Le saxophone tnor de Romo et Juliette apparat priodiquement pour chanter son solo. Prokofiev semble avoir
hsit utiliser le saxophone tnor autrement que comme instrument soliste. Les exemples dans le rpertoire o on
retrouve le saxophone comme instrument densemble (non-soliste) sont pourtant nombreux et loquents.
2
Dans son premier volume du Trait de lorchestration, Koechlin expose la notion de Volume et intensit .
15
d- Analogies timbrales
Le grave du soprano sapparente au hautbois.
Laigu du soprano sapparente la clarinette.
Le medium de lalto sapparente au cor.
Le grave du tnor sapparente au trombone.
On pourrait multiplier ce genre danalogies subjectives perptuit, mais le saxophone nest gal
qu lui-mme. On distingue dailleurs facilement chacun des membres de la famille des saxophones;
chacun a son timbre particulier.
Le saxophone se mlange parfaitement aux autres bois
3
et aux cors
4
. Les couplages avec dautres
instruments se fait aussi et de l toutes les possibilits sont envisageables.
e- Exemples tirs du rpertoire orchestral
5
a. Solo de saxophone
DC piste 3 Saxophone tnor accompagn par les cordes : Romo et Juliette de Prokofiev, Juliette
enfant, section 17.
DC piste 4 Saxophone alto accompagn par les bois et les cordes : Sinfonia da Requiem de Britten,
section 3. Remarquez comme le timbre du saxophone alto sapparente celui des violons altos.
DC piste 5 Saxophone alto imit par les bois : Sinfonia da Requiem de Britten, section 9.
Remarquez comme le solo du saxophone alto ressort sans effort malgr lintensit piano. La note finale do
(son rel) est reprise par les cors (cors et saxophone alto ont un timbre semblable).
3
Malgr son corps cuivr, le saxophone est sans contredit un bois car il sagit dun instrument anche et cls.
4
Le timbre du saxophone alto ressemble tellement celui du cor que Honegger, dans Jeanne dArc au bcher, a
remplac la section de cors par trois saxophones altos.
5
Des exemples sonores de musique de chambre sont aussi fournis sur le disque compact; ce sujet, veuillez
consulter la partie F) Liste dcoute.
16
Sinfonia da Requiem de Britten, section 3.
Sinfonia da Requiem de Britten, section 9.
b. Flte et saxophone alto
Le saxophone et la flte forment un joli duo dgal gal lorsque le saxophone demeure en dessous
de la flte.
DC piste 6 LArlsienne de Bizet
6
suite no2, Menuet, mes. 67-86. Tchons de faire fi du vibrato
omniprsent et large.
c. Clarinettes et saxophone tnor
Il faut deux clarinettes pour galer le volume dun saxophone. ct du saxophone alto, la
6
La seconde suite de LArlsienne a t crite par Ernest Guiraud quatre annes aprs la mort de Bizet. Guiraud a
laiss une grande place au saxophone alto.
17
clarinette a un timbre pauvre. registres gaux, on obtient de bons rsultats en la joignant au saxophone
tnor ou au soprano.
DC piste 7 Romo et Juliette de Prokofiev, Romo auprs de Juliette avant leur sparation, section
45*.
Romo et Juliette de Prokofiev, Romo auprs de
Juliette avant leur sparation, section 45.
d. Hautbois et saxophone
Nous navons trouv aucun exemple mettant en exergue le hautbois dialoguant avec le saxophone.
Nous croyons que hautbois et saxophone soprano ou sopranino feraient bon mnage. Les saxophones
plus graves que le soprano ont un timbre trs loign de celui du hautbois, et il faut ajouter des
instruments intermdiaires (dautres bois) afin dobtenir un fondu.
e. Basson et saxophone alto
Le timbre du saxophone est plus large que
celui du basson, ce qui nempche pas le dialogue.
DC piste 8 Der Wein de Berg, dbut. Berg a
crit Der Wein en prparation de son opra Lulu.
Le timbre particulier du saxophone favorise ici
latmosphre dvergonde du monde de la
prostitution.
DC piste 9 Jeanne dArc au bcher de Honegger, Scne VIII, section 58.
Jeanne dArc au bcher de Honegger, Scne VIII,
section 58.
18
f. Plusieurs bois et saxophone
Le saxophone est un bois et il apparat rgulirement avec le reste de sa famille. moins de le
camoufler par un nombre imposant de bois, on doit traiter le saxophone en tant quinstrument dominant
de la section : mieux vaut lui donner un rle mlodique que purement harmonique.
DC piste 10 Fltes, hautbois, clarinettes et saxophone tnor : Bolero
7
de Ravel, section 11.
DC piste 11 Hautbois, flte, basson puis saxophone tnor (solos successifs) : Romo et Juliette de
Prokofiev*, Juliette enfant, section 20.
Romo et Juliette de Prokofiev, Juliette enfant,
section 20.
Bolero de Ravel, section 11.
DC piste 12 Flte, clarinette et saxophone
alto : LArlsienne de Bizet suite no2, Intermezzo,
mes. 50-57. Remarquez la couleur du saxophone alto
et de la flte (celle-ci jouant une octave plus haut que
le saxophone). La clarinette, qui sonne la mme
octave que le saxophone, est difficile distinguer :
la mme hauteur, le saxophone alto est dominant par
rapport la clarinette.
LArlsienne de Bizet suite no2, Intermezzo.
7
Les saxophones sont actifs tout au long du Bolero. Ils jouent en solo dans les section 6 8. partir de la section
13, et pour le reste de la pice, ils ajoutent leur couleur aux bois et aux cordes. Le fondu est efficace.
19
DC piste 13 Hautbois, cor anglais, clarinette
et saxophone alto : Der Wein de Berg, mes. 69-71.
la mesure 70, remarquez la souplesse du passage du
la (son rel) du saxophone alto au premier cor.
g. Bois, cors et saxophone alto
DC piste 14 Hautbois, clarinettes, bassons,
saxophone alto et cors : LArlsienne de Bizet
suite no2, Intermezzo, mes. 33-36. Le saxophone alto et
le hautbois ont un timbre foncirement diffrent : le
son du saxophone est sombre et large tandis que celui du hautbois est plutt mince et un tantinet
nasillard. Ainsi, nous percevons clairement les deux timbres mme si saxophone et hautbois jouent la
mme mlodie lunisson.
Der Wein de Berg.
h. Cors et saxophone alto
Le saxophone et le cor, lorsque jous intensit piano, ont un timbre semblable et minemment
compatibles.
DC piste 15 LArlsienne de Bizet suite no2, Intermezzo, mes. 17-24. Notez que le timbre du cor,
cette hauteur, sapparente beaucoup celui du saxophone tnor. Faisons abstraction du vibrato qui est,
notre avis, anormalement rapide.
i. Cuivres (autres que le cor) et saxophone
Nous navons trouv aucun exemple probant dagencements cuivres-saxophone. Cela sexplique
par le fait que les cuivres lexception des cors - sont plus souvent quautrement utiliss dans des
intensits fortes. Or, ces intensits, le saxophone est noy par les cuivres.
Notons toutefois que dans la musique de jazz, les cuivres se joignent rgulirement au saxophone.
Lusage de becs au timbre brillant et clatant permet au saxophoniste dgaler le cuivre en intensit.
j. Cordes et saxophone alto
Seul, le son maigre du violon ne peut composer avec un saxophone. Nanmoins, en section, les
cordes font bon mnage avec le saxophone.
DC piste 16 Saxophone alto et violons : LArlsienne de Bizet suite no2, Pastorale, mes. 41-43. Le
saxophone alto et les deuximes violons fusionnent pleinement.
20
LArlsienne de Bizet suite no2, Pastorale, mes. 41-44.
DC piste 17 Cordes et saxophone alto, puis bois et saxophone alto : Sinfonia da Requiem de
Britten, section 42-43.
Sinfonia da Requiem de Britten, section 42-43.
LArlsienne de Bizet suite no2, Pastorale, mes.
36-39.
k. Bois, cordes et saxophone alto
DC piste 18 Clarinette, saxophone alto et
violons : LArlsienne de Bizet suite no2,
Pastorale, mes. 36-39. Le saxophone alto vient
enrichir le timbre de la clarinette.
DC piste 19 Saxophone tnor (poursuivant le trait prcdent jou par la harpe) accompagn par
les fltes et les clarinettes : Romo et Juliette de Prokofiev, Juliette enfant, section 20*.
(OUM). Le saxophone tnor y est admirablement jou par Isabelle Choquette de St-Athanase.
* Lextrait audio est issu du concert du 29 novembre 2002 de lOrchestre symphonique de lUniversit de Montral
21
l. Voix et saxophone alto
DC piste 20 Ondes Martenot, chorale et saxophones altos : Jeanne dArc au bcher de Honegger,
dernire scne, section 101.
DC piste 21 Voix de tnor et section de trois saxophones altos : Jeanne dArc au bcher de
Honegger, Scne IV, section 32.
DC piste 22 Chorale et trois saxophones altos : Jeanne dArc au bcher de Honegger, section IX.
Trois saxophones soutiennent aisment une chorale entire.
Jeanne dArc au bcher de Honegger, Scne IV,
section 32.
Jeanne dArc au bcher de Honegger, section IX.
f- Emplacement sur la partition
On retrouve la porte du ou des saxophones entre celles des clarinettes et du basson, ou entre
celles du basson et des cors. Dautres dispositions sont possibles
8
mais les deux manires proposes nous
semblent les plus logiques compte tenu de la tessiture et de la fonction du saxophone.
8
titre dexemples, nous notons que dans la partition du Bolero, Ravel a dispos le saxophone la fin des vents,
soit entre le tuba et les timbales. Dans Der Wein de Berg, le saxophone alto se situe entre les hautbois et les
clarinettes.
22
g- Le saxophone dans les traits dorchestration
Le saxophone ne fait pas toujours bonne figure dans les traits dorchestration et dans les murs.
Voici les mythes les plus rpandus :
tous les Saxophones, le pp et mme le p ne sont pas possibles aux dernires notes
graves
9
( ce sujet, voir la section 2.3 sur le subtone)
Tous les traits dorchestration consults ne sont pas jour quant la tessiture normale
de linstrument (on y omet des notes graves et des notes aigues).
most clarinettists double on saxophone because the fingering and all other playing
techniques are very similar to those of the clarinet
10
.
Soyons cyniques : un trompettiste peut passer au cor franais, et un violoncelliste au
violon sans problmes. Trve de plaisanterie : 1) les doigts du saxophone et de la
clarinette sont radicalement diffrents car le saxophone octavie et la clarinette quintoie.
Ainsi, les doigts du saxophone sapparente plutt ceux de la flte et du hautbois. 2)
Que le lecteur savise souffler dans un saxophone et une clarinette et il conviendra que
les diffrences sont videntes : pression, souffle demand, position de la langue, dtach,
souplesse de lintonation Bref, le saxophone est la clarinette ce que la trompette est au
cor. Le saxophone orchestral est souvent jou par un clarinettiste uniquement pour des
raisons budgtaires.
Modern developments in saxophone playing have completely changed the nature and
sound of the instrument from what it was when melodies were assigned to it by Bizet and
other European composers before 1920. From a pure, steady tone, partaking of both horn
and reed instrument qualities, its tone has become, coincident with its ascendancy in the
field of popular dance music, tremulous, oversweet, sentimental; and it is almost
invariably played out of tune. ()
11
.
Certains orchestres engagent indiffremment des saxophonistes de varit pour jouer du
rpertoire classique, do le problme vident de lesthtique dnature. Le calvaire est
moindre lorsquon demande au clarinettiste de souffler dans le saxophone, mais lobjectif
nest vraiment atteint que lorsquun saxophoniste de formation classique interprte le
rpertoire classique pour saxophone. (!)
9
Koechlin, Trait de lorchestration, premier volume, p.96. Malgr quelques informations inexactes, Koechlin
demeure lauteur le plus sympathique au saxophone et il en fait un tableau logieux.
10
Adler, The Study of Orchestration, p.217.
11
Piston, Orchestration, p.186. Le lecteur ne sera pas surpris dapprendre que Piston ne parle du saxophone que
dans sa section ddie la clarinette
23
VI. Virtuosit digitale (vlocit, volubilit)
La virtuosit est un concept bien large qui suppose un flirt entre les limites techniques de
linstrument et les possibilits cognitives de lhumain interprte.
Par virtuosit, on a tendance penser maximum de notes , donc vitesse des doigts. Cependant,
laspect digital ne reprsente quune infime partie de la virtuosit totale qui implique aussi justesses
dintonation et des attaques, constance dans le soutien du diaphragme, respect des dtails subtils propre
luvre, perfection rythmique, etc.
Ainsi, la virtuosit totale se dfinit par lexcution heureuse dune accumulation dlments
extrmes. Dans ce sens, Mitzvot de Michel-Georges Brgent est moins exigeant que Hard ou Steady
study on the Boogie de Christian Lauba.
12
a- Limites de la virtuosit digitale
Voici quelques limites auxquelles devraient se restreindre les compositeurs lorsquils crivent pour
saxophone. Les informations notes en italique reprsentent des facteurs contraignant la vitesse
dexcution.
Mouvement
mlodique
Articulation Intensit Registre
Vlocit
(notes par
seconde)
chromatique
seulement
legato avec attaques
non conscutives
constante dans la
tessiture
normale
12 14
chromatique et
disjonctions ne
dpassant pas loctave
legato avec accents
disperss et notes
rptes a et l
constante dans la
tessiture
normale
11 13
tissage
13
chromatique legato avec accents
disperss
constante dans la
tessiture
normale
11 12
chromatique et
disjonctions ne
dpassant pas loctave
legato avec accents
disperss et notes
rptes a et l
constante aigu 9 11
intervalles disjoints
dpassant loctave
legato et/ou dtache constante dans la
tessiture
largie
14
8 9
intervalles disjoints ne
dpassant pas loctave
legato avec accents
disperss
changeante
abruptement et
progressivement
dans la
tessiture
normale
7 8
12
Des trois pices cites, seul Mitzvot nest pas inclus sur le disque compact qui accompagne ce document. Cette
uvre pousse lextrme lutilisation du chromatisme enchan une vitesse effarante, sans arrt et pendant plus de
treize minutes.
13
Tissage : magma de notes se maintenant dans un intervalle serr. Ce phnomne sapparente au cluster mis
sous forme mlodique.
14
La tessiture largie comprend la tessiture normale laquelle sajoute le registre suraigu.
24
b- Dure du travail de rptition ncessite
Deux semaines de pratique quotidienne permettra au saxophoniste aguerri datteindre ces limites.
Toutefois, il faut tenir compte de la quantit de travail : par exemple, si le musicien est en mesure de
pratiquer la moiti de la pice chaque jour, il faudra valuer quatre semaines la priode ncessaire
lassimilation du langage par linterprte.
B) Potentiel saxophonique
Entrons maintenant dans le monde des possibilits sonores quoffre le saxophone. Cette partie de
notre ouvrage est divise en trois groupes: 1. Le Saxophone et linfluence Classique, 2. Le Saxophone et le
Jazz, 3. Le Saxophone, instrument Contemporain.
1. Le Saxophone et linfluence Classique
Dabord utilis dans les musiques militaires, le saxophone sest exprim sporadiquement dans
lorchestre. Quelques-unes de ces apparitions:
la fin du XIXe sicle: le Hamlet (1868) dAmbroise Thomas, lHrodiade et le Werther de
Massenet;
dans les annes 1920-30: le Bolero de Ravel et son orchestration des Tableaux dune exposition de
Mussorgsky, le Concerto la mmoire dun ange de Berg, Belshazzars Feast de Walton,
Lieutenant Kij et Romo et Juliette de Prokofiev;
dans des oeuvres de Vincent dIndy, Stockhausen, Honegger,
Si le saxophone a su mieux se faire connatre en tant que soliste et en formation de quatuor, cest
grce aux importants interprtes que furent, entre autres, Marcel Mule et Sigurd Rascher.
Le saxophone classique a d imiter pendant longtemps les instruments qui avaient dj leur
rpertoire et leurs fonctions strotypes. Comme le dmontrent les interprtations du rpertoire
noclassique, ces techniques sculaires ont t efficacement transposes au saxophone.
1.1 Types dattaques
Les informations du tableau des attaques sont en partie tires des recherches de Jean-Marie
Londeix (Hello! Mr. Sax) et de Jean-Franois Guay (Les Attaques au Saxophone). Voir aussi: 3.4 Fins et
milieux des sons. Pour une description du slap, voir 3.5 Slap.
25
DC Nom Notation Graphique Phontique
23 (attaque de base)
aaa
24 accent
kaaa
25 staccato, point
taaa
26 lour
laalaa
27 sforzando
aaaaa
30 slap
kaaa
32 appui, tenuto
aaaa
33 griffe, point allong
tat
34 l'air
aaaa
chevron, chapeau
35 classique
kaaa
jazz
dt
36 crneau
aamm
37 accent allg
kmmm
38 accent appuy
kaaaa
39 appui allg
aaaa...
Types d' attaques
Linterprtation des diffrents signes dattaque varie plus ou moins rationnellement dun individu
lautre. En gnral, la conception des attaques au saxophone classique jouit dune standardisation
exceptionnelle, surtout grce lcole franaise qui fait autorit en ce domaine. Nous avons certaines
remarques formuler afin dclairer le domaine des signes suivants :
26
Le staccato
Il existe deux traditions de staccatos :
o Le staccato qui allge DC piste 25
Ce staccato agit sur lintensit de la note. Le son est pos puis il disparat
progressivement en accompagnant sa rsonance naturelle. Le signe est utile car il
vite davoir crire un decrescendo pour chaque note. Cest la forme de staccato
utilise le plus couramment au saxophone, et cest celle que nous recommandons.
o Le staccato qui courte
Ce staccato agit sur la dure de la note, qui est habituellement coupe de moiti. Il
est rare quon constate cette forme de staccato dans le rpertoire original pour
saxophone, et nous le rejetons allgrement. De surcrot, il existe deux autres
faons efficaces dagir sur la dure des notes :
pour obtenir une note de dure tronque de moiti, nous conseillons de
noter la vraie valeur : une noire courte de moiti scrira croche demi-
soupir;
pour obtenir une note sche, dtache et incisive, nous conseillons la
griffe (aussi appele point allong ou trait vertical ) DC piste 33.
Lopposition staccato griffe se justifie clairement dans le rpertoire
grce linfluence de Beethoven qui en faisait couramment usage.
Le sforzando DC piste 27
Renforce le mileu du son, et non son attaque.
Pour obtenir une attaque plus dure que laccent, nous conseillons le sfp (= subito forte
piano) ou tout autre agencement du type subito [intensit 1] [intensit 2] . On peut
pousser la logique davantage en affirmant la possibilit dun spf ou encore dun sfmpff
(fera entendre trois intensits successives).
Le slap DC pistes 28 31
Le slap est dcrit plus particulirement au point 3.5. Il est toutefois utile de mentionner ici
que lintensit de lattaque peut tre plus ou moins forte et que le son peut tre de la dure
voulue. Un slap sec produira un claquement danche qui peut avoir une hauteur ou ntre
que percussif, au got.
Le crneau DC piste 36
Lattaque en crneau est particulire au saxophone car elle seffectue laide du subtone
(cf 2.3 Subtone ou dtimbr) obtenue par lapposition rapide de la langue sur lanche afin
de diminuer subitement lintensit. Elle est surtout efficace dans loctave grave de
linstrument.
Noter que le rsultat de lattaque en crneau sapparente celui du sfp (ou sffmp, etc.).
27
Toutefois, laction de lattaque en crneau est plus immdiate.
Il existe une multitude dattaques combines. Celles qui ne sont pas mentionnes dans le tableau
ci-dessus mriteraient dtre dfinies dans une lgende afin dviter toute msinterprtation.
1.2 Dtach simple
La vitesse du dtach simple peut aller jusqu 4 double-croches un tempo de 132 noires par
minute.
1.3 Nuances (intensits)
Les saxophones ont une vaste palette dintensits. Un saxophone peut jouer aussi fort quune
trompette et aussi doux quun piano et ce, tous registres confondus.
Comme pour tous les instruments vent (except la clarinette, seul vent cylindrique), les
extrmits sont les plus difficiles jouer douces : les pianissimi sont ardus au-dessus du mi aigu et en-
dessous du mi grave (en sons transposs, pour tous les saxophones). Ils sobtiennent mieux par
mouvement conjoint partir des registres aiss. Ainsi, le summum de la difficult est dattaquer un sib
grave pianissimo (et juste). Les saxophonistes professionnels sont trs au fait de ces difficults et ils les
travaillent constamment avec plus ou moins de succs dpendamment, entre autres facteurs, de lattitude
de lanche et du positionnement des astres (!); les compositeurs peuvent donc utiliser toute la panoplie de
nuances sur toute ltendue mais les plus empathiques viteront les embches.
Quelques mesures prcises: 0,5 mtre en avant dun saxophoniste alto jouant avant un bec
classique conventionnel, on note un minimum de 62 dB(SPL) et un maximum de 118 dB(SPL). La
dynamique dun quatuor est donc de 56 dB : de 68 dB(SPL) 124 dB(SPL).
Le compositeur peut choisir parmi les paliers conventionnels suivants : pp DC piste 42, p DC piste
43, mp DC piste 44, mf DC piste 45, f DC piste 46, ff DC piste 47. ceux-ci, nous ajoutons le (niente
ou silence; peut prcder un crescendo ou tre laboutissement dun decrescendo), le pppp (voir 3.1
Souffle) DC piste 40, le ppp (voir 2.3 Dtimbr (subtone)) DC piste 41 et le ffff (son dfinitivement trop
fort pour linstrument : le timbre et la justesse sont sensiblement altrs) DC piste 48.
1.3.1 Fluctuation de lintensit
Le saxophone tant un instrument vent, linterprte a la possibilit de modifier lintensit de
faon trs souple : leffet peut tre soudain (comme pour un fp ou un pppmf) ou progressif (crescendo ou
decrescendo).
28
1.4 Vibrato et tremblement DC pistes 49 53
Le style de vibrato, dtermin par sa frquence et son amplitude, varie selon les diffrentes
poques. Au dbut du sicle, la frquence du vibrato tait beaucoup plus leve (approximativement
quatre vibrations par temps, tempo de 92 temps par minute). Puis, les gots ont chang et nous prfrons
maintenant un vibrato de 4 vibrations un tempo entre 76 et 84. Quelques rares saxophonistes optent
mme pour llimination de cette technique et interprtent le rpertoire tonal sans vibrer, ce que nous
considrons tre un appauvrissement de la palette expressive. En rgle gnrale, lusage du vibrato est
dict par le bon got et lesthtique, permettant de souligner la valeur expressive de certaines notes.
Certaines musiques contemporaines utilisent le vibrato dans une toute autre optique: il est indiqu
quand et comment il faut vibrer (traditionnellement, cest linterprte qui choisit).
La frquence du vibrato peut aller jusqu 4 vibrations un tempo de 100. Plus vite, il sagirait
plutt dun tremblement, celui-ci, difficile jouer gal, se situant entre 4 vibrations un tempo de 116 et 4
vibrations un tempo de 144.
On peut aussi prciser le degr de lamplitude du vibrato. Celle-ci a une marge de manuvre qui
est fonction du registre utilis: plus la note est aigu, plus lamplitude peut tre grande. Comme le vibrato
est obtenu grce une alternance pression-relchement de la lvre infrieure sur lanche et que cette
dernire obstrue lair lorsquelle est repousse vers le bec, le saxophoniste pourra faire inflchir le son
dun intervalle peu prs 8-10 fois plus large vers le bas que sil tente de le faire vers le haut. Ainsi, un
altiste jouant son do moyen (troisime espace dans la porte, transpos en mib) pourra inflchir le son
d de ton vers le haut pour atteindre le do ou dune 3ce mineure vers le bas pour obtenir un la. Il lui
serait donc possible deffectuer un vibrato large de 1 ton ( vers le haut, 1 ton vers le bas, note de
base: do moyen). videmment, la frquence dun vibrato si large damplitude ne devrait pas tre trop
leve pour permettre la lvre du saxophoniste daller et revenir tout en contrlant le son. Dans
lexemple prcdent, il serait possible daller jusqu une frquence de 4 vibrations un tempo de 86.
Le compositeur peut spcifier sil veut ou non que linterprte vibre sa guise. Il est aussi possible
de dfinir le vibrato graphiquement ou littralement. Voici quelques exemples de termes usits: Sans
vibrato ou Senza vibrato, Vibrer ou Vib., Vib. ton, Vibrato trs serr, Vibrato large,
Vibrato ingal, Vibrato accel., Poco a poco vib., Molto vib., etc.
1.5 Trilles et batteries (trmolos) DC pistes 54 et 55
Grce au nombre important de cls que comporte le saxophone, linstrumentiste peut effectuer un
nombre quasiment infini de trilles dintervalles conjoints et disjoints. Il est conseill au compositeur de
vrifier avec linterprte si les trilles choisis sont efficaces.
29
En plus de pouvoir faire varier sa vitesse, on peut y apposer dautres techniques: flatterzunge (voir
3.9 Flatterzunge ou frullato), variations dintensit, variations damplitude (sans oublier les micro-
intervalles - voir 3.14), trilles de multiphoniques (voir 3.12 Multiphoniques ou Sons multiples).
1.5.1 Shake DC piste 56
partir de certaines notes dans le suraigu, le saxophoniste peut excuter un trille large de
frquence modre semblable au shake des trompettistes.
1.6 Dure du souffle
La dure de tenue dun son ne dpend pas seulement de la capacit pulmonaire du joueur. Le type
de saxophone utilis est un facteur important considrer. Voici les dures de tenue maximales pour un
sol grave (cette note est au centre du registre moyen du saxophone), une intensit moyenne (mf) :
a- Soprano : 27 secondes
b- Alto : 19 secondes
c- Tnor : 15 secondes
d- Baryton : 12 secondes
e- Basse : 11 secondes
La force de lanche est un facteur tout aussi important : une anche faible vibrera avec moins de
souffle quune anche forte. Il incombe au saxophoniste de trouver lanche idale.
Dernier facteur : un son aigu demande moins de souffle quun son grave ; certains ajustements
simposent.
Lors dusage de multiphoniques, diviser la dure du souffle par deux.
N.B. Veuillez consulter 3.13 Respiration continue , permettant une extension de cette dure maximale.
2. Le Saxophone et le Jazz
De Sidney Bechet, Johnny Hodges, Coleman Hawkins (...), en passant par Lester Young, Charlie
Parker, Gerry Mulligan (...), sans oublier Sonny Rollins, Dexter Gordon, John Coltrane (...), Wayne
Shorter, Michael Brecker, Steve Coleman (...), la liste de saxophonistes jazz de talent sallonge, sallonge
(...). Grce ces gens, le saxophone sest, trs tt, taill une place de choix dans le jazz.
2.1 Inflexion DC pistes 57 60
Linflexion est une modification de lintonation lintrieur dun mme son. Cest un vibrato sans
priode, sans rythme redondant. En jazz, on lutilise sous forme de slur (inflexion avant le son ou attaque
par en-dessous) ou fall (inflexion descendante la fin du son). Linflexion est aussi utilise dans la
musique contemporaine.
30
2.1.1 Glissement DC pistes 61 et 62
Le glissement, ne pas confondre avec glissando (voir 2.2 Glissando), est lextension de
linflexion. En soulevant et/ou refermant doucement les cls du saxophone tout en stabilisant le son avec
ses lvres, linstrumentiste peut obtenir des inflexions dont lintervalle ne dpend que de la capacit du
joueur. Plus les notes sont aigus, plus cette technique est efficace (il est ardu deffectuer un glissement
souple dans le registre grave). Exemple populaire: le glissement de la clarinette au dbut de Rhapsody in
Blue de Gershwin.
2.2 Glissando
Lorsque deux notes sont spares dun glissando, le saxophoniste jouera la premire note puis,
pour se rendre la deuxime, fera entendre tous les sons intermdiaires. Habituellement, le glissando est
une gamme chromatique mais, si la vitesse est trop leve, linterprte jouera les notes qui lui tombent le
mieux sous les doigts.
2.3 Dtimbr (subtone)
Le saxophoniste touffe lanche en appliquant plus de lvre infrieure ou en apposant la langue. La
membrane vibre ainsi sur une tendue moins large. Grce cette technique, on peut obtenir dun quatuor
lintensit limite de 68 dB(SPL) (mesure prise 0,5 mtre en face des instrumentistes, toujours). Le
timbre est aussi affect : le son est dtimbr, moins riche en harmoniques. Inconvnients de cette
31
technique : ne fonctionne que dans les registres grave et moyen (du sib grave au do moyen); baisse un peu
lintonation, ce que les interprtes corrigeront par dautres moyens. On peut passer du jeu normal au
subtone sans problme, do lusage frquent des notes fantmes (ghost notes).
Le compositeur note Subtone, Sub., Dtimbr ou tout simplement ppp et les
interprtes se serviront du subtone sils en ont besoin pour atteindre la nuance indique.
2.3.1 Marmonnement DC piste 63
Trs efficace chez les saxophones graves, le marmonnement est adquat du do sous la porte
jusqu'au r quatrime ligne (hauteurs relatives; l'tendue est la mme pour chaque saxophone). En
valeurs absolues :
a- Soprano : sib3 do5
b- Alto : mib3 fa4
c- Tnor : sib2 do4
d- Baryton : mib2 fa3
e- Basse : sib1 do3
Il existe une variante intressante : le marmonnement venteux. Il s'obtient en utilisant une anche
trop forte (vent inhrent au son) ou en laissant fuir une partie de l'air par les coins des lvres.
Selon la prise de son utilise, on peut accentuer (prise de son rapproche) ou liminer (prise de
son loigne) les bruits de cls.
2.4 Harmoniques naturels DC pistes 64 66
Le saxophoniste peut obtenir diffrents harmoniques naturels partir du doigt de la
fondamentale. Ainsi, partir du sib grave, le musicien aura la capacit de produire le sib moyen, le fa
moyen, le sib aigu, le r aigu, le fa aigu, le lab suraigu, le sib suraigu, etc. La fondamentale peut tre
nimporte quelle note qui ne soit pas octavie. Toutefois, plus la fondamentale sloigne du sib grave,
moins les harmoniques sont justes (il tendent monter par rapport lchelle tempre). Dun point de
vue pratique, seuls les fondamentales sib grave, si grave et do grave sont valables ( moins quon ne sen
fasse pas pour la justesse).
Les harmoniques ont un timbre assez diffrent des notes normales. Ils servent souvent comme
doigts alternatifs (voir 2.5) ou pour crer un bisbigliando (voir 3.15).
2.4.1 Balayement des composantes harmoniques
Il s'agit, comme son nom l'indique, du passage d'un harmonique l'autre sans que l'on perde pour
autant la hauteur de la note fondamentale. C'est une faon subtile de modifier le timbre d'une note
donne.
32
2.5 Doigts alternatifs
Obtention de timbres diffrents par lusage des harmoniques naturels ou de doigts trafiqus. Voir
aussi 3.15 Bisbigliando. Le compositeur peut indiquer quil souhaite entendre un autre timbre pour une
note dtermine ou il peut crire le doigt voulu (le cas chant, se rfrer un saxophoniste). Certaines
notes peuvent facilement tre obtenues par cinq doigts, chacun ayant des qualits timbrales diffrentes.
Les doigts alternatifs sont efficaces partir de la deuxime octave du saxophone (on peut alors
utiliser les harmoniques naturels). Le suraigu n'est pas propice cette technique : l'effet est pratiquement
inaudible.
3. Le Saxophone, instrument Contemporain
Grce aux professeurs de composition Paul Hindemith, Darius Milhaud et Nadia Boulanger, tous
trois favorables au saxophone, notre instrument sest trouv des admirateurs noclassiques qui ont
compos pour lui. Heureusement pour nous, interprtes contemporains, des saxophonistes chevronns
tels Daniel Kientzy et Jean-Marie Londeix se sont chargs de promouvoir les vertus encore inexploites
du saxophone. Enfin! Linvention de Sax est considre comme un lment incontournable de la musique
daujourdhui.
3.1 Souffle
Le souffle est beaucoup utilis dans le rpertoire contemporain du saxophone. On peut y
incorporer des nuances, des bruits de cls et sons tambourins (voir 3.2), des bruits bucaux (tout ce que
notre langue, nos joues et notre gorge peuvent produire comme effets), des effets vocaux (voir 3.3), etc. Si
le saxophoniste souffle dans linstrument tout en faisant les doigts correspondant aux notes crites, on
percevra, une intensit trs basse, chacune de ces notes. On peut alors parler de la nuance pppp.
3.2 Bruits de cls et sons tambourins DC pistes 67 et 68
Ces deux effets sobtiennent sans souffler dans linstrument, seulement en appuyant sur les
touches du saxophone.
- Les bruits de cls sont un effet percussif, cest--dire quon ne distingue pas de hauteur.
- Les sons tambourins sont mlodiques et percussifs : on distingue une note de faible intensit. Le
registre effectif est, en sons transposs, de sib grave (la grave pour le baryton) do moyen.
33
3.2.1 Attaque tambourin
Variante intressante du son tambourin, lattaque tambourin est un son court qui dbute par
un claquement de cl.
3.3 Effets vocaux DC piste 69
En plus de pouvoir produire des bruits, la voix peut avoir un rle mlodique. Il est possible pour le
saxophoniste de chanter tout en jouant. La note chante peut et devrait tre autre que celle joue car la
voix nayant pas la puissance du saxophone, on ne percevrait pas la note entonne. Comme la pice peut
tre joue autant par un homme que par une femme, le compositeur devrait prvoir un ossia ou sassurer
que la note est valable pour toute catgorie de chanteux (tout saxophoniste nest pas chanteur) pour
sassurer que les deux sexes pourront interprter son oeuvre.
3.4 Fins et milieux des sons DC pistes 70 et 71
Parce quil est un instrument vent et parce quil a une palette de nuances et deffets si vaste, le
saxophone a des possibilits inestimables en matire de milieux et de terminaisons de son. Chaque type
dattaque, nous lavons vu, a son symbole. Comme ce nest pas le cas pour les milieux
15
et fins des sons, le
compositeur peut laisser aller sa crativit et utiliser les signes qui lui sembleront le plus opportuns.
3.5 Slap DC piste 28 31
Attaque ponctue par un claquement danche. Le slap peut tre utilis pour seule fin percussive ou
comme amorce de son fort accentue. Cest au compositeur de choisir sil veut navoir un effet que
percussif, que mlodique ou une dose des deux. Habituellement, plus lanche sera faible, plus le slap sera
sonore.
Vitesse maximale pour des slaps successifs (exprim en pulsations/minute, une pulsation
reprsentant quatre attaques): 108 au soprano, 104 lalto, 100 au tnor, 96 au baryton, 92 au basse. La
15
Nous rappelons quil existe dj le sfz pour signifier un renforcement du milieu du son.
34
vitesse dpend moins de l'endurance de la langue que de la rsistance de l'anche : plus celle-ci sera leve,
plus basse sera la vitesse maximale.
Nombre de slaps successifs possibles au tempo maximal : proportionnel l'entranement du
saxophoniste; peu prs 20 pour une langue moyennement entrane. La limite de slaps successifs
dpend de la limite de chaque langue : une langue shwarzeneggerienne pourrait slapper sans arrt. En
outre, comme pour les autres muscles, un court repos de la langue permet de la recharger partiellement. Il
peut donc y avoir plusieurs passages rapides de slaps parpills un peu partout dans un mouvement. Dans
ce cas, la seule limite possible est la rsistance de l'anche : le slap tant l'attaque la plus dure (dans le sens
de "violente"), l'anche est mise l'preuve. Aprs une centaine de slaps, nous ne croyons pas que l'anche
soit encore bonne, ou du moins, qu'elle soit encore capable de slapper. Solution si cela arrive: changer
d'anche.
16
Bien que les slaps se fassent dans tous les registres, ils sont difficiles (parfois impossibles)
obtenir dans le suraigu. Consultez votre saxophoniste.
Pour la notation, voir 1.1 Types dattaques.
3.6 Sans le bec
Les deux techniques suivantes seffectuent laide du saxophone dont on a retir le bec.
a- Sons-trompettes DC piste 72
Le saxophoniste colle ses lvres sur lextrmit du bocal et produit un son au timbre hybride
sapparentant un mlange de cor et de saxophone. Cette technique relativement rare est assez difficile.
Plus linstrument est gros, plus lmission du son est aise.
Ambitus (en hauteurs absolues):
a- Soprano: de r4 fa5
b- Alto: de lab3 si4
c- Tnor: de sol3 do5
d- Baryton: de sol3 rb5
e- Basse: de sol3 (fa3) fa4
b- Slap du bocal DC piste 73
Lorsquon frappe la langue contre lextrmit du bocal, on entend des hauteurs de notes
correspondant plus ou moins au doigt utilis.
3.7 Bec seulement DC piste 74
16
Ceci vaut pour les anches en roseau. Les anches synthtiques possdent habituellement une rsistance ahurissante,
leur permettant de slapper perptuit. La compagnie canadienne Lgre produit, depuis 1998, des anches
exceptionnelles tant du point de vue de la longvit que de la qualit sonore.
35
Lorsque le saxophoniste ne joue quavec son bec (videmment, lanche est toujours l), il a accs
un nombre limit de hauteurs. En utilisant ses mains pour boucher une partie de lextrmit du bec,
linterprte peut obtenir des notes plus graves. Le timbre est trs particulier. Plus linstrument est petit,
moins cette technique est matrisable.
Voici les intervalles de hauteurs disponibles, en hauteurs absolues, pour chaque grosseur de bec:
a- Bec de Soprano: de sib4 fa6
b- Bec dAlto: de sol4 do6
c- Bec de Tnor: de r4 lab5
d- Bec de Baryton: de si3 fa5
e- Bec de Basse: de mib4 fa5
3.8 Bec et bocal DC piste 75
Permet lobtention dun intervalle de hauteurs assez mince:
a- Bec et bocal de Soprano: de solb4 mi5
b- Bec et bocal dAlto: de si3 lab4
c- Bec et bocal de Tnor: de la3 mi4
d- Bec et bocal de Baryton: de lab3 fa4
e- *Bec et bocal de Basse: de lab3 do4
Le timbre est, encore une fois, trs particulier. Aussi, cette technique recle un multiphonique peu
usit bien qu'efficace. Intensits conseilles : de p ff.
a- (Aucun multiphonique du bocal pour le soprano)
b- Multiphonique du bocal de lAlto : intervalle de 9me majeure; de r4-mi5 fa#4-sol#5
c- Multiphonique du bocal de Tnor : intervalle de 9me mineure; mi4-fa5
d- (Aucun multiphonique du bocal pour le baryton)
e- *Multiphonique du bocal du Basse: intervalle de 10me majeure avec rsidu dune 14me
mineure, ce qui donne un accord de 7me de dominante; de lab3-do5(-solb5) rb4-fa5(-si5).
*Important: les bocaux de basse ne sont pas tous de la mme dimension. Ces donnes sont
valables pour un saxophone basse de marque Selmer construit dans les annes 80.
3.9 Flattement, flatterzunge ou frullato (anglais : flutter) DC pistes 76 78
Rend le son plus agressif en lui incorporant un rrrrr gargarisant ou un trrrr de battement de
langue. (Le moyen utilis est laiss la discrtion de linterprte.) Trs efficace, sauf pour le registre
36
suraigu ( cette hauteur, le saxophoniste peut obtenir le mme effet en criant dans linstrument).
Lorsquon ajoute du flatterzunge, lintensit du son sera sensiblement hausse.
3.10 Double dtach DC pistes 79 et 80
Le double dtach (ou double coup de langue) a deux fonctions : lextension du dtach et le
pseudo-flatter.
a- Dans un premier lieu, cette technique permet de dtacher beaucoup plus rapidement que le
dtach simple : jusqu 4 attaques par battement, 168 battements par minute (comparez avec 1.2
Dtach simple). Cette pratique est moins efficace dans les registres extrmes et dfinitivement
irralisable dans le suraigu. Aucune notation nest requise : linterprte lutilisera si le dtach simple
nest pas suffisant.
La rgion rellement efficace pour le double dtach, pour chaque saxophone, se situe entre le fa#
grave et le r aigu inclusivement (notes transposes selon linstrument).
b- Deuximement, le double dtach peut agir comme une variante moins agressive du
flatterzunge.
3.11 Lllll DC piste 81
Le lllll est une phontique que nous utilisons pour nommer une variante de la deuxime fonction
du double dtach (voir 3.10 Double dtach). Par le va-et-vient rapide de la langue sur lanche, on
obtient un dtach extrmement rapide ( peu prs 4 attaques par battement un tempo de 200
pulsations par minute) mais difficile rendre gal. Trs efficace si le compositeur ne ddaigne pas
linconstance rythmique obtenue.
3.12 Multiphoniques ou Sons multiples DC piste 82 84
Un multiphonique est un accord jou par un instrument monodique. Certains doigts de sons
multiples projettent clairement chaque composante alors que dautres noncent un bouillon agressif de
hauteurs fixes. On peut isoler un son, passer dun multiphonique un autre, arpger lagrgat, etc. Daniel
Kientzy a recens un nombre apprciable de multiphoniques pour les quatre saxophones du quatuor dans
son livre Les Sons simultans aux saxophones. Voir aussi Hello! Mr.Sax de Jean-Marie Londeix. Les
possibilits ne sont pas toutes catalogues : nous trouvons parfois de nouveaux multiphoniques. Nous
37
conseillons au compositeur de se rfrer aux deux volumes cits plus haut et de travailler avec linterprte.
Pour noter le multiphonique, le compositeur transcrit chaque composante du son multiple en
prenant bien soin dindiquer les altrations arrondies au de ton prs. Linterprte ne connaissant pas
tous les quelque 140 doigts par cur, il serait bien dindiquer le doigt correspondant et/ou le numro
du multiphonique (le doigt et le numro sont crits dans les ouvrages de Kientzy et de Londeix).
Limitations : - Dans la plupart des cas, on ne peut effectuer la respiration continue tout en
jouant un multiphonique.
- Les multiphoniques ncessitent beaucoup de souffle. Ainsi, il faut diviser la dure
de tenue du son habituelle par deux.
- Les hauteurs des multiphoniques varient sensiblement dun instrument et dun
interprte lautre. Il est sage de vrifier leur efficacit auprs de votre
saxophoniste.
3.13 Respiration continue
Cette technique permet dviter linterruption du discours caus par un manque de souffle.
Relativement aise raliser mais assez difficile matriser parfaitement, la respiration continue est trs
efficace lorsque utilise conjointement avec le subtone. Plus la note produite est grave, plus elle demande
de souffle donc moins la technique est efficiente. Ainsi, la respiration continue se fait plus facilement au
saxophone soprano quaux autres membres de sa famille. Nous pouvons fixer la rgle gnrale suivante :
une intensit moyenne, la respiration continue devient inefficace en de du do3. Aussi, cette technique
ne fonctionne pas dans le registre suraigu.
Ce procd est parfaitement transparent lorsque le discours est mouvant et legato.
Linstrumentiste adroit sera en mesure de dtacher tout en respirant. Le double dtach est incompatible
avec la respiration continue.
Le compositeur na pas se soucier de cette possibilit significative : linterprte lutilisera sil en
sent le besoin. Ce qui revient dire que le compositeur na pas prvoir de pause pour permettre au
saxophoniste de respirer.
1/4 de ton plus haut
1/4 de ton plus bas
B
1/8 de ton plus haut
1/8 de ton plus bas
1/16 de ton plus haut
1/16 de ton plus bas
3/4 de ton plus haut
Symboles micro-tonaux
proposs
3.14 Micro-intervalles DC pistes 85 87
Le saxophone, ayant de nombreux doigts possibles grce son
nombre important de cls, peut obtenir tout micro-intervalle souhait par le
compositeur. Habituellement, on ne va pas plus loin que le de ton mais
tout est ralisable. Nanmoins, certaines notes sobtiennent moins bien : le
sib grave hauss, le si grave hauss, le do grave hauss, le sol moyen hauss
et le sol aigu hauss.
La nomenclature des micro-intervalles ntant pas standardise, il
38
n. est conseill dinsrer une lgende la partitio
3.15 Bisbigliando ou flattement DC pistes 88 et 89
Roulement de timbre sans variation de la hauteur obtenu par lalternance de plusieurs doigts.
Laigu est le registre idal pour cet effet; les sib, si, do et do# graves noffrent aucun bisbigliando. Leffet
se note Bisbi..
3.16 Suraigus extrmes DC piste 90
En apposant les dents sur lanche, le saxophoniste produit des notes dune hauteur trs aigu
indtermine. titre dexemple, voici la note la plus leve obtenue pour chacun des quatre saxophones
tudis:
a- Soprano: lab7
b- Alto: mib7
c- Tnor: la6
d- Baryton: sol6
e- Basse: mib7
3.17 Barrissement DC pistes 91 et 92
En faisant ressortir les harmoniques naturels dans une sorte de glissement, les saxophones basse,
baryton et tnor ont la capacit de parler le langage des lphants. Les alto et soprano ont aussi cette
capacit mais leffet est moins spectaculaire tant donn que la hauteur du son de dpart est plus leve.
Donc, plus linstrument sera grave, plus ce sera efficace.
39
C) Conclusion
Je souhaite remercier les personnes suivantes :
Jean-Franois Guay, pour son expertise, son soutien musical et moral, et surtout parce quil se
dvoue hardiment pour la cause du saxophone au Qubec. Cest grce lui, en bonne partie, que nous
avons la chance, chaque anne, de bnficier des connaissances dexperts venant dailleurs. Aussi,
pour ne nommer quun vnement, il est linitiateur du Congrs Mondial du Saxophone de lan 2000.
James Dowdy et Richard Dsilets, pour mavoir inspir des effets supplmentaires.
Caroline Blaquire et Sbastien Laplante, les concepteurs des pages couvertures et du dessus
du disque compact.
Isabelle Choquette, pour tout ce quelle reprsente pour moi (ce nest pas de vos affaires !). Elle
ma, entre autres, aid pour les techniques du saxophone tnor, pour lenregistrement des effets et
pour la mise en page.
Alan Belkin, qui ma conseill pour la conception de la section sur lorchestration.
Francis Molloy, qui ma aid dans la conception du disque compact.
Andr Pelchat et les dirigeants de lAssociation des saxophonistes du Canada, qui travaillent
fort pour la cause et qui nen retirent parfois que des dettes personnelles... Nous vous sommes
reconnaissants.
Tous les compositeurs srieux qui saventurent dans lunivers du saxophone.
Monique Boivin, Raymond Gaulin, Robert Lemay, Isabelle Choquette et Annie
Pettigrew, mes critiques littraires et musicaux.
Et, je ne saurais les passer sous silence, mes parents, Monique et Raymond, qui sont mes amis les
plus fidles.
Nous esprons sincrement que cet ouvrage offrira une vision valable des capacits du saxophone.
Ensemble, nous pouvons contribuer ce que lhistoire du saxophone se passe aussi au Qubec, et non
seulement ailleurs.
Mathieu Gaulin
40
D) Pour plus de renseignements/Pour nous contacter
Initiateur du projet
Mathieu Gaulin : mathieugaulin@hotmail.com
Disponible pour recevoir des critiques, commentaires, interrogations, etc.
E) Index de lenregistrement des effets
moins davis contraire, les effets ont t enregistrs laide du type de saxophone le plus commun,
le saxophone alto.
#
Technique
1 Ivb Timbre classique
2 ... jazz
3
22
Extraits orchestraux voir V.
Orchestration.
23 1.1 Types dattaques normale
24 ... accent
25 ... staccato
26 ... lour
27 ... sforzando
28 ... slap percussif
29 ... slap mlodique, son court
30 ... slap comme amorce de son long
31
... slap; variante: plus de langue que
de son
32 ... appui
33 ... griffe
34 ... lair
35 ... chevron classique
36 ... crneau
37 ... accent allg
38 ... accent appuy
39 ... appui allg
40 1.3 Nuances pppp (souffle)
41 ... ppp (subtone)
42 ... pp
43 ... p
44 ... mp
45 ... mf
46 ... f
47 ... ff
48 ... ffff (forc)
49 1.4 Vibrato et tremblement vibrato
classique conventionnel
50 ... tremblement (soprano)
51 ... application 1
52 ... application 2
53 ... application 3 (basse)
54 1.5 Trilles exemple 1
55 ... exemple 2
56 1.5.1 Shake
57 2.1 Inflexion exemple 1
58 ... exemple 2
59 ... exemple 3
60 ... exemple 4
41
61 2.1.1 Glissements exemple 1
62 ... exemple 2 (soprano)
63 2.3.1 Marmonnement effectu par un
alto, un tnor et un baryton prise de
son relativement rapproche
64 2.4 Harmoniques naturels
65 ... jeu alatoire attaqu partir de
trois fondamentales (basse)
66 ... jeu alatoire li partir de trois
fondamentales (basse)
67 3.2 Sons tambourins et bruits de cls
au basse
68 ... lalto
69 3.3 Effets vocaux
70 3.4 Fins et milieux de son exemple 1
71 ... exemple 2
72 3.6a Sons-trompettes
73 3.6b Slap du bocal
74 3.7 Bec seulement
75 3.8 Bec et bocal
76 3.9 Flatterzunge avec la langue puis
avec la gorge
77 ... au basse
78 ... au soprano
79 3.10a Double dtach; Extension du
dtach
80 3.10b Double dtach; Pseudo-
flatterzunge
81 3.11 Lllll
82 3.12 Multiphoniques
83 ... trilles de multiphoniques
84 ... trilles de multiphoniques
agrments de slaps
85 3.14 Micro-intervalles; de ton
86 ... trilles dintervalles non temprs
(soprano)
87 ... extrait de gamme au de ton
(soprano)
88 3.15 Bisbigliando ou flattement
lalto
89 ... au soprano
90 3.16 Suraigu extrme
91 3.17 Barrissement lalto
92 ... au basse
93 Souffle, bruit de cls et voix (basse)
94 Quelques effets dans le suraigu
42
F) Liste dcoute
# de
piste
Compositeur
Titre
dition
Particularits
95 LAUBA,
Christian (1952)
Tunisie/France
Hard (1988) Fuzeau Virtuosit totale.
Interprt par Isabelle Choquette
(tnor).
96 YAMAMOTO,
Hiroyuki (1967)
Japon
Noli me tangere
(2000)
- Trilles et mordants, de ton, grands
intervalles, suraigu.
Cr par Mathieu Gaulin (alto) et
lEnsemble contemporain de Montral.
97 LAUBA,
Christian (1952)
Tunisie/France
Reflets (1986) Fuzeau Intensits varies, subtone,
flatterzunge, multiphoniques.
Interprt par le Quatuor de
saxophones Nota Bene.
98 ENGEBRETSON,
Mark (1964)
tats-Unis
She Sings She
Screams (1996)
Apoll
Edition
Interprt par Isabelle Choquette (alto)
accompagne par bande.
99 GAULIN,
Mathieu (1979)
Qubec
Invention bleutre
(2000)
- Jazz avec improvisation.
Cr par le Quatuor de saxophones Nota
Bene.
G) Bibliographie
Adler, Samuel, The study of orchestration, Norton, 1982.
Arnold, Denis, Dictionnaire encyclopdique de la musique, ditions Robert Laffont, 1988.
Fordham, John, Jazz, ditions HMH, 1995.
Forsyth, Cecil, Orchestration, Dover Publications, 1982.
Guay, Jean-Franois, Les Attaques au saxophone dans la musique franaise du 20e sicle, 1992.
Kientzy, Daniel, Les Sons simultans aux saxophones, ditions Salabert, 1982.
Koechlin, Charles, Trait de lOrchestration, ditions Max Eschig, 1954.
Londeix, Jean-Marie, 150 ans de musique pour saxophone, Roncorp Publications, 1994.
Londeix, Jean-Marie, Hello! Mr. Sax, ditions Alphonse Leduc, 1993.
Piston, Walter, Orchestration, Norton, 1955.
43
H) Micro-biographies des personnes cites
Association des saxophonistes du Canada
Organisation cre en 1995 visant le regroupement des saxophonistes qubcois, la diffusion
dinformations saxophonistiques au Qubec, et louverture au monde. Stend dun ocan lautre depuis
2000.
BELKIN, Alan
Compositeur, pianiste et organiste, professeur titulaire de composition, dcriture et dorchestration la
facult de musique lUniversit de Montral.
BLAQUIRE, Caroline (1978)
Caroline a dbut sa formation de saxophoniste en 1991 dans la rgion des Laurentides o elle tudia avec
Cynthia Beyea. Par la suite, elle continua ses tudes au Cgep de Saint-Laurent avec M.Pierre Tremblay et
lUniversit de Montral o elle a tudi avec M. Jean-Franois Guay. Elle a galement suivi des classes
de matres avec les saxophonistes Claude Brisson (Qubec), Eugne Rousseau (Etats-Unis) et Jean-
Michel Goury (France). Elle a remport, en tant que soliste, trois fois le concours des Jeunes Musiciens
des Laurentides, une fois le Festival des harmonies du Qubec et elle a deux participations au Concours
du Canada.
Elle enseigne prsentement le saxophone lcole Cur-Antoine Labelle de Laval ainsi qu la Polyvalente
Cur-Mercure de Saint-Jovite, deux coles secondaires concentration musique. Saxophoniste baryton
du Quatuor de saxophones Nota Bene, elle est galement membre de lEnsemble KORE de Montral.
CHOQUETTE, Isabelle (1978) => www.qnb.qc.ca
DOWDY, James
Bachelier en piano-interprtation de l'Universit de Montral; tudes en composition avec Andr Prvost
et techniques d'criture avec Alain Belkin; prim lors du concours des jeunes compositeurs de la Socit
d'excution du Canada avec sa composition Scnes d'hiver pour guitare seule; premier prix du concours
de composition International Trumpet Guild avec sa pice Mouvement pour trompette et orgue; boursier
MAC pour une uvre pour orgue et orchestre.
Depuis 1987, professeur au Conservatoire de Val-d'Or et directeur de la Chorale du Conservatoire;
membre fondateur de la S.A.L.A.T. et directeur musical de la Chauve-Souris (1994) et les Brigands (1997).
ENGEBRETSON, Marc (1964)
Compositeur et saxophoniste tasunien ayant tudi avec Jean-Marie Londeix et Michel Fust-Lambezat.
Membre du Vienna Saxophone Quartet.
FORTIER, Claude (1973)
Saxophoniste ayant commenc ses tudes musicales 19 ans avec Pierre Tremblay lcole de musique
Vincent-dIndy Outremont.
44
GAULIN, Mathieu (1979) => www.qnb.qc.ca
GUAY, Jean-Franois
Important pdagogue et saxophoniste classique du Qubec. Il est actuellement professeur de
saxophone au Cgep Marie-Victorin, l'Universit de Montral ainsi qu'au camp musical du Domaine
Forget. Il est aussi prsident de l'Association des Saxophonistes du Canada et il fut prsident du Congrs
mondial du saxophone de lan 2000 Montral.
KIENTZY, Daniel (1951)
Saxophoniste de musique contemporaine franais. Auteur du livre Les Sons simultans aux saxophones.
LAUBA, Christian (1952)
Compositeur franais, n Sfax en Tunisie. Fortement influenc par la musique de Franois Ross et de
Ligeti. Il a compos un nombre important duvres pour saxophones.
LEMAY, Robert (1960)
Compositeur qubcois. A travaill avec Franois Morel, L. Andriesson, B. Ferneyhough, D. Erb et Michel
Longtin. La musique de Robert Lemay se caractrise par une utilisation de lespace scnique, une
attention particulire, un comportement des interprtes et une exploration de la technique des
instrumentistes.
LONDEIX, Jean-Marie (1932)
Saxophoniste, professeur et arrangeur franais. Enseigna aux conservatoires de Dijon (1953), Bordeaux
(1971), et, entre-temps, lUniversit du Michigan (1968). Il est lauteur dun nombre important
douvrages consacrs au saxophone.
NABAHI, Arsalane (1977)
Compositeur qubcois dascendance iranienne ayant tudi lUniversit de Montral. Actuellement, il
sintresse aux registres extrmes des instruments.
PELCHAT, Andr (1945)
Saxophoniste, professeur, compositeur et arrangeur qubcois. Il enseigne actuellement lUQAM et
lcole secondaire Pierre-Laporte. Il est le rdacteur en chef du Publi-Sax, journal qubcois consacr au
saxophone.
Quatuor de saxophones Nota Bene (QNB) => www.qnb.qc.ca
YAMAMOTO, Hiroyuki (1967)
Compositeur japonais, il a tudi lUniversit des arts de Tokyo. Gagnant de plusieurs prix japonais et
internationaux, il a crit 5 pices comprenant le saxophone.
Vous aimerez peut-être aussi
- El Tango de Roxanne (String Quintet) - Score and PartsDocument16 pagesEl Tango de Roxanne (String Quintet) - Score and PartsBoris Leonardo100% (3)
- 2.eric Sammut Hombre D AoutDocument1 page2.eric Sammut Hombre D AoutJhon JairoPas encore d'évaluation
- Analisis Concierto GlazounovDocument26 pagesAnalisis Concierto GlazounovRoberto Suarez TouzonPas encore d'évaluation
- Acerquemonos Todos Al Altar - Francisco PalazónDocument2 pagesAcerquemonos Todos Al Altar - Francisco PalazónLeonardo D Amador100% (5)
- A Wizard Sheet MusicDocument9 pagesA Wizard Sheet MusicAndrew FrankPas encore d'évaluation
- Mix Viejo VerdeDocument33 pagesMix Viejo VerdeEmerson Chavez100% (1)
- Elegy (Renascence)Document6 pagesElegy (Renascence)Caleb McCarrollPas encore d'évaluation
- Phonetique Et Prononciation CN PDFDocument102 pagesPhonetique Et Prononciation CN PDFFarid Joujou100% (2)
- Fil D'ariane 3eDocument300 pagesFil D'ariane 3esylvie100% (2)
- I Wish - Tenor Sax.Document1 pageI Wish - Tenor Sax.Miquel JustCardona100% (1)
- Let's Go To Work-TABDocument6 pagesLet's Go To Work-TABMiquel JustCardona100% (1)
- Saxo Cubano - Tenor Sax.Document2 pagesSaxo Cubano - Tenor Sax.Miquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Sueno Imposible Partitura Completa PDFDocument1 pageSueno Imposible Partitura Completa PDFAldrack BorkrusPas encore d'évaluation
- Halleluja Sophisticated Arrangement of Cohen S Classic String Quartet PDFDocument13 pagesHalleluja Sophisticated Arrangement of Cohen S Classic String Quartet PDFVelizar Prodanov100% (1)
- PedagogietDocument89 pagesPedagogietEsaDrawPas encore d'évaluation
- STUCKI DelphineDocument45 pagesSTUCKI DelphineJeanPas encore d'évaluation
- Devoir 2as2Document7 pagesDevoir 2as2Jacinthe Violette FleurPas encore d'évaluation
- Accordeón Diatonique Et Musiques TraditionnellesDocument44 pagesAccordeón Diatonique Et Musiques TraditionnellesMaryanneFrancesconPas encore d'évaluation
- Mégalithes de Carnac, Du Golfe Du Morbihan Et de La Baie de Quiberon: Dossier de Confirmation Sur La Liste IndicativeDocument184 pagesMégalithes de Carnac, Du Golfe Du Morbihan Et de La Baie de Quiberon: Dossier de Confirmation Sur La Liste IndicativePaysagesDeMégalithes100% (7)
- Oriane Marck - La Musique Dans La Societe Traditionnelle Au Royaume Kongo XVe-XIXe SiecleDocument177 pagesOriane Marck - La Musique Dans La Societe Traditionnelle Au Royaume Kongo XVe-XIXe SiecleMerland Handréas DibPas encore d'évaluation
- Le Paysage Façonné Les Territoires Postindustriels, Lart Et LusageDocument257 pagesLe Paysage Façonné Les Territoires Postindustriels, Lart Et LusageRichard Kennith Asto AltamiranoPas encore d'évaluation
- Ary Carpman - L'Influence Du Moyen de Composition Sur La Musique Électroacoustique - Les Supports de Sonofixation - 2014Document163 pagesAry Carpman - L'Influence Du Moyen de Composition Sur La Musique Électroacoustique - Les Supports de Sonofixation - 2014ManesPas encore d'évaluation
- Nos façons de parler: Les prononciations en français québécoisD'EverandNos façons de parler: Les prononciations en français québécoisPas encore d'évaluation
- Le Tuba Contemporain PDFDocument58 pagesLe Tuba Contemporain PDFTino HernándezPas encore d'évaluation
- Vocable All English - 27 Juin 2019Document36 pagesVocable All English - 27 Juin 2019Fatma Gözdenur MercanPas encore d'évaluation
- Acoustique Du Bâtiment - 4GCUDocument98 pagesAcoustique Du Bâtiment - 4GCUHamza MamiPas encore d'évaluation
- La transparence en communication: Une clé théorique et pratique pour la réussiteD'EverandLa transparence en communication: Une clé théorique et pratique pour la réussitePas encore d'évaluation
- Musique Pour Luth Jouée À La Guitare Moderne. Adaptation de Suites de Silvius Léopold Weiss Pour La Guitare À 11 CordesDocument100 pagesMusique Pour Luth Jouée À La Guitare Moderne. Adaptation de Suites de Silvius Léopold Weiss Pour La Guitare À 11 CordesAfshin TorabiPas encore d'évaluation
- UntitledDocument20 pagesUntitledMairie de LannoyPas encore d'évaluation
- Activité D'écouteDocument42 pagesActivité D'écouteAlanPas encore d'évaluation
- LaporteDocument161 pagesLaportethechnurfPas encore d'évaluation
- Jean-Nicolas de Surmont - Chanson - Son Histoire Et Sa Famille Dans Les Dictionnaires de Langue Française. Étude Lexicale, Théorique Et HistoriDocument258 pagesJean-Nicolas de Surmont - Chanson - Son Histoire Et Sa Famille Dans Les Dictionnaires de Langue Française. Étude Lexicale, Théorique Et HistoriDJEHA14Pas encore d'évaluation
- 2016 MM2 PoullaouecM PartielleDocument161 pages2016 MM2 PoullaouecM PartielleMeher ZitouniPas encore d'évaluation
- CO 20-01-2014 Ainsi Fond Fond FondDocument2 pagesCO 20-01-2014 Ainsi Fond Fond FondAntoromePas encore d'évaluation
- Tesis Sobre La Entrada de La Figura Del Solista en Los ConciertosDocument655 pagesTesis Sobre La Entrada de La Figura Del Solista en Los ConciertosDavid Fiel100% (1)
- Description Guadeloupe CreoleDocument318 pagesDescription Guadeloupe CreolemilesPas encore d'évaluation
- Item 2Document153 pagesItem 2Myma WeundePas encore d'évaluation
- Le Tuba Contemporain LQ PDFDocument58 pagesLe Tuba Contemporain LQ PDFjpisisPas encore d'évaluation
- Paris - Le Parc de La Villette - ExercicesDocument4 pagesParis - Le Parc de La Villette - ExercicesgwendolynlmPas encore d'évaluation
- P17054coll23 125Document108 pagesP17054coll23 125afgccgfaPas encore d'évaluation
- Etude Bob Revel - Analyse Enseignement Musiques Actuelles PDFDocument186 pagesEtude Bob Revel - Analyse Enseignement Musiques Actuelles PDFfranck GARCIAPas encore d'évaluation
- Controle 1 FDocument4 pagesControle 1 FouyoubbrahimPas encore d'évaluation
- STIEVENART Manuel D Elevage Des Escargot Geants AfricainsDocument41 pagesSTIEVENART Manuel D Elevage Des Escargot Geants AfricainsOrios AdklPas encore d'évaluation
- Thèse RifaliDocument123 pagesThèse RifaliAbdelhamid ElgarbiPas encore d'évaluation
- Les Oiseaux Dans L'écriture Égyptienne AncienneDocument152 pagesLes Oiseaux Dans L'écriture Égyptienne AncienneVincent DonvalPas encore d'évaluation
- Rapport Stage F. Lanckriet Juillet 2017Document63 pagesRapport Stage F. Lanckriet Juillet 2017DahirouPas encore d'évaluation
- BARREIRO La Construction D'un Imaginaire Environnemental Dans Trois Romans Hispano-AméricainsDocument477 pagesBARREIRO La Construction D'un Imaginaire Environnemental Dans Trois Romans Hispano-AméricainsptqkPas encore d'évaluation
- Janvier 2 14Document87 pagesJanvier 2 14delgeomeongbeingPas encore d'évaluation
- Loeil DémeraudeDocument23 pagesLoeil DémeraudeLegrandPas encore d'évaluation
- Cours Phya 2eme AnneeDocument48 pagesCours Phya 2eme Anneemamisoaella3Pas encore d'évaluation
- SOLOMOS Makis XenakisDocument132 pagesSOLOMOS Makis XenakisCédric Segond-GenovesiPas encore d'évaluation
- Les Tables PFE Final PDFDocument4 pagesLes Tables PFE Final PDFAyad SaidPas encore d'évaluation
- Livre-Cusimano, Christophe - Sens en Mouvement Études de Sémantique InterprétativeDocument139 pagesLivre-Cusimano, Christophe - Sens en Mouvement Études de Sémantique InterprétativeaksilPas encore d'évaluation
- TerroireuxDocument25 pagesTerroireuxtadidafPas encore d'évaluation
- Le de Historia Stirpium de Leonhart Fuchs Histoire D Un Succes Editorial 1542 1560Document110 pagesLe de Historia Stirpium de Leonhart Fuchs Histoire D Un Succes Editorial 1542 1560Julia VillardPas encore d'évaluation
- Acoustique Du Batiment: Auteurs de La Ressource Pédagogique Mrs Krauss Gérard, Yezou René, Kuznik FrédéricDocument102 pagesAcoustique Du Batiment: Auteurs de La Ressource Pédagogique Mrs Krauss Gérard, Yezou René, Kuznik FrédéricMbaye NdoyePas encore d'évaluation
- CITE DU DESIGN - Création Et Ville Solidaire: Etat de L'art Des Dispositifs CréatifsDocument338 pagesCITE DU DESIGN - Création Et Ville Solidaire: Etat de L'art Des Dispositifs CréatifsDélégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées (Dihal)Pas encore d'évaluation
- Accordeon MondeDocument114 pagesAccordeon Monderichardgaetan53Pas encore d'évaluation
- CO 131220 RTS Lac LemanDocument3 pagesCO 131220 RTS Lac LemanInes Ben DhahbiPas encore d'évaluation
- MAURIN Anne M2 RECH 2013 DUM VERSION CORRIGEEDocument117 pagesMAURIN Anne M2 RECH 2013 DUM VERSION CORRIGEEIlo IloPas encore d'évaluation
- Vocabulaire International de La DiplomatiqheDocument153 pagesVocabulaire International de La DiplomatiqheRaul AbajoPas encore d'évaluation
- These Arlette CAPDEPUY AnnexesDocument195 pagesThese Arlette CAPDEPUY Annexesseck.diakaryPas encore d'évaluation
- 2014 Pest 0032Document704 pages2014 Pest 0032sevilPas encore d'évaluation
- Memoire God inDocument135 pagesMemoire God inHbb HbbPas encore d'évaluation
- 1602-2290-Dossier de Nomination-FrDocument127 pages1602-2290-Dossier de Nomination-Frxx xxxPas encore d'évaluation
- L Evolution Des Bibliotheques MusicalesDocument87 pagesL Evolution Des Bibliotheques MusicalesDaniel PerezPas encore d'évaluation
- Eschig Pedago 1999Document12 pagesEschig Pedago 1999belacqua16Pas encore d'évaluation
- Https:::dumas CCSD Cnrs Fr:dumas-01144608:documentDocument90 pagesHttps:::dumas CCSD Cnrs Fr:dumas-01144608:documentRémy Bres-FeuilletPas encore d'évaluation
- Correction Évaluation Familles de Mots Préfixes SuffixesDocument2 pagesCorrection Évaluation Familles de Mots Préfixes Suffixesmohamed67% (3)
- Rites de La Mort en AlsaceDocument63 pagesRites de La Mort en AlsaceMònica Miró Vinaixa0% (1)
- All of Me - Johnny HodgesDocument2 pagesAll of Me - Johnny HodgesflexbwebbPas encore d'évaluation
- A Flower Is A Lovesome Thing - Joe Henderson PDFDocument2 pagesA Flower Is A Lovesome Thing - Joe Henderson PDFMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Vals Mariposas GrallaDocument1 pageVals Mariposas GrallaMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Vals Mariposas Gralla - Mus1 - PiccoloDocument1 pageVals Mariposas Gralla - Mus1 - PiccoloMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Vals Mariposas Gralla - Mus1Document1 pageVals Mariposas Gralla - Mus1Miquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Les Is MoDocument2 pagesLes Is MoMiquel JustCardona100% (1)
- Spherical Brecker SoloDocument3 pagesSpherical Brecker SoloMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- The Brecker Brothers-Heavy Metal BebopDocument47 pagesThe Brecker Brothers-Heavy Metal BebopMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Yellow Jackets IndigoDocument46 pagesYellow Jackets IndigoMiquel JustCardona50% (2)
- Come, Christians, Join To Sing!: Christian H. Bateman Joel RaneyDocument16 pagesCome, Christians, Join To Sing!: Christian H. Bateman Joel RaneyEze JasperPas encore d'évaluation
- Oh Señor Delante de Ti, Canto de OfertorioDocument7 pagesOh Señor Delante de Ti, Canto de OfertorioRojas RichardsPas encore d'évaluation
- Diana Sax TenorDocument1 pageDiana Sax TenorAugusto RodriguezPas encore d'évaluation
- Infantes em Marcha - J. RaposoDocument1 pageInfantes em Marcha - J. RaposovmiraPas encore d'évaluation
- (Superpartituras - Com.br) Cheira A Lisboa PDFDocument1 page(Superpartituras - Com.br) Cheira A Lisboa PDFMarcos SantiagoPas encore d'évaluation
- Sax Quintet MVT 2Document10 pagesSax Quintet MVT 2Jiggly HippoPas encore d'évaluation
- Lilium - Sax - Full Score PDFDocument1 pageLilium - Sax - Full Score PDFEdwin SablonPas encore d'évaluation
- 1.10 Yellow Submarine in Pepperland HOF Trumpet in BBDocument2 pages1.10 Yellow Submarine in Pepperland HOF Trumpet in BBJakub WaszczeniukPas encore d'évaluation
- Accord de Do Septième de Dominante Do Mi Sol Sib (C E G BB)Document2 pagesAccord de Do Septième de Dominante Do Mi Sol Sib (C E G BB)CDAN40Pas encore d'évaluation
- Du Rhum Des Femmes Chords by Soldat Louis @Document1 pageDu Rhum Des Femmes Chords by Soldat Louis @Bottox ToxiicPas encore d'évaluation
- Jubilate DeoDocument7 pagesJubilate DeoLuca MozzilloPas encore d'évaluation
- Dual Gres General 2016 2017Document200 pagesDual Gres General 2016 2017Basem UsamaPas encore d'évaluation
- Hit The Road JackDocument2 pagesHit The Road JackAleksidkPas encore d'évaluation
- MATILDE SINFONICA - Tenor Sax - .MusxDocument2 pagesMATILDE SINFONICA - Tenor Sax - .MusxHayder MariñoPas encore d'évaluation
- In quegli anni in cui val poco 莫扎特Document5 pagesIn quegli anni in cui val poco 莫扎特郑曌Pas encore d'évaluation
- Dossier de Presse Fêtes Musicales 2018 PDFDocument14 pagesDossier de Presse Fêtes Musicales 2018 PDFLe Journal du CentrePas encore d'évaluation
- Schubert La Jeune Fille Et La Mort 1mvt Clarinet QuartetDocument20 pagesSchubert La Jeune Fille Et La Mort 1mvt Clarinet QuartetMaria Angela Saiz BlancoPas encore d'évaluation
- Annexes de Musique - Juillet 2016Document13 pagesAnnexes de Musique - Juillet 2016Cécile LeroyPas encore d'évaluation
- Resvellies VousDocument2 pagesResvellies VousMaite Cerezo cremadesPas encore d'évaluation
- WorshipDocument7 pagesWorshipMay Ann Mendoza CayananPas encore d'évaluation
- Salve Pater SalvatorisDocument1 pageSalve Pater SalvatorisPalendo ItopoPas encore d'évaluation
- Salmo 127 GregorianoDocument1 pageSalmo 127 GregorianoJean NardottoPas encore d'évaluation
- Manual Ampeg Micro VRDocument8 pagesManual Ampeg Micro VRJuanGuajardoPas encore d'évaluation