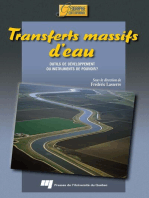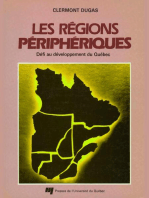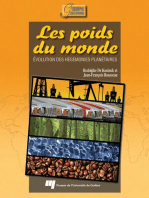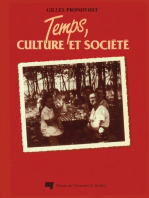Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Paysage Façonné Les Territoires Postindustriels, Lart Et Lusage
Transféré par
Richard Kennith Asto AltamiranoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Paysage Façonné Les Territoires Postindustriels, Lart Et Lusage
Transféré par
Richard Kennith Asto AltamiranoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Collection Géographie, dirigée par Guy Mercier
Discipline de longue tradition, la géographie jette un regard original sur les
sociétés humaines en étudiant leurs modes d’occupation de l’espace, leurs façons
d’organiser les territoires et leurs manières d’habiter les lieux. Toujours en éveil, elle
rend compte des transformations les plus récentes et offre ainsi un éclairage utile
aux populations et aux décideurs qui doivent y faire face. La géographie sait égale-
ment s’interroger sur elle-même et sur l’exercice de la pensée en général afin de
renouveler ses approches et ses méthodes. Sensible à tous ces aspects, la collection
veut témoigner du riche apport de la géographie au développement des sciences
sociales et de sa contribution aux grands débats d’aujourd’hui.
Pour s’adapter aux différents besoins de la géographie en matière d’édition
savante, la collection est divisée en quatre séries.
• La série Recherche accueille des monographies ou des ouvrages collectifs qui
présentent des avancées récentes de la connaissance g éographique.
• La série Pédagogie réunit des textes (traités, manuels, précis ou synthèses)
destinés à l’enseignement tout en étant susceptibles d’intéresser l’ensemble
du public cultivé.
• La série Référence est réservée à la réédition d’ouvrages qui ont marqué la
géographie et qui trouvent encore un intérêt auprès du public ; elle fait aussi
place à des anthologies qui retracent l’évolution d’une pensée ou qui font le
point sur une problématique.
• La série Débat publie des réflexions et des prises de position sur des questions
d’actualité.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 2 11/12/08 15:03:41
le paysage façonné
Les territoires postindustriels,
l’art et l’usage
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 3 11/12/08 15:03:41
Page laissée blanche intentionnellement
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 4 11/12/08 15:03:41
Suzanne Paquet
le paysage façonné
Les territoires postindustriels,
l’art et l’usage
Les Presses de l’Université Laval
2009
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 5 11/12/08 15:03:41
Les Presses de l’Université Laval reçoivent chaque année de la Société de
développement des entreprises culturelles du Québec une aide financière pour
l’ensemble de leur programme de publication.
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par
l’entremise du Programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition
pour nos activités d’édition.
Mise en pages et conception de la couverture : Hélène Saillant
Photographies de la couverture : Suzanne Paquet
© Les Presses de l’Université Laval, 2009
Tous droits réservés. Imprimé au Canada
Dépôt légal 1er trimestre 2009
ISBN 978-2-7637-8593-6
Les Presses de l’Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université, bureau 3103
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
www.pulaval.com
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 6 11/12/08 15:03:41
Pour Lynda, bien sûr,
et parce que le bout du monde n’est jamais très loin.
Pour Gervaise aussi, qui nous a quittés
un jour splendide de novembre.
« Beau temps pour voyager », a dit l’un de ses frères.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 7 11/12/08 15:03:41
Page laissée blanche intentionnellement
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 8 11/12/08 15:03:41
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES ILLUSTRATIONS.................................................... xi
REMERCIEMENTS....................................................................... xv
PRÉFACE....................................................................................... xvii
INTRODUCTION........................................................................ 1
CHAPITRE UN : INVENTIONS.................................................. 13
Le paysage............................................................................. 14
La photographie................................................................... 25
Le désert............................................................................... 33
Le tourisme........................................................................... 45
CHAPITRE DEUX : APPROPRIATIONS.................................... 55
Portrait de l’artiste en touriste............................................ 58
Le centre et la périphérie.................................................... 67
Une nouvelle topographie (ou l’art de la périphérie)...... 82
CHAPITRE TROIS : MODULATIONS....................................... 97
L’art, en déplacement.......................................................... 101
L’inévitable engagement...................................................... 113
Places publiques................................................................... 130
Le village global.................................................................... 142
CHAPITRE QUATRE : APPARITION OU DISSOLUTION...... 161
Conditions photographiques............................................... 162
Destinations.......................................................................... 181
Le spectacle........................................................................... 193
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 9 11/12/08 15:03:41
x Le paysage façonné
CONCLUSION............................................................................. 201
POSTFACE Note sur un essai de méthode................................. 207
BIBLIOGRAPHIE......................................................................... 217
Catalogues............................................................................. 233
Documents............................................................................ 234
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 10 11/12/08 15:03:41
TABLE DES ILLUSTRATIONS
1.1 SCENIC OUTLOOK, GREAT NORTHERN HIGHWAY...... 25
1.2 TIMOTHY O’SULLIVAN, EXPEDITION OF 1873,
EXPLORERS COLUMN, CANYON DE CHELLE, ARIZONA, 1873 36
1.3 TIMOTHY O’SULLIVAN, HORSESHOE CANYON,
GREEN RIVER, CA.1872................................................................ 41
2.1 ROBERT SMITHSON, NONSITE, (FRANKLIN,
NEW JERSEY), 1968....................................................................... 63
2.2 ROBERT SMITHSON, SPIRAL JETTY, 1970........................ 68
2.3 ROBERT SMITHSON, STILLS FROM THE FILM
SPIRAL JETTY, 1970..................................................................... 69
2.4 NANCY HOLT, VIEW THROUGH A SAND DUNE,
1972. NARRAGANSETT BEACH, RHODE ISLAND................. 71
2.5 NANCY HOLT, BURIED POEMS (DÉTAIL), 1969-1971....... 72
2.6 NANCY HOLT, SUN TUNNELS, 1973-76,
GREAT BASIN DESERT, UTAH ................................................. 75
2.7 LEWIS BALTZ, QUATRE ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE
THE NEW INDUSTRIAL PARKS NEAR IRVINE, CALIFORNIA
COMPOSÉE DE 51 PHOTOGRAPHIES, 1974-75...................... 85
2.8 LEWIS BALTZ, DEUX ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE NEVADA
COMPOSÉE DE 15 PHOTOGRAPHIES, 1978........................... 86
2.9 LEWIS BALTZ, QUATRE ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE
PARK CITY COMPOSÉE DE 102 PHOTOGRAPHIES, 1978-81 88
2.10 ROBERT SMITHSON, TAILINGS POND, 1973.................. 93
3.1 ROBERT MORRIS, EARTHWORK AT JOHNSON PIT NO 30,
1979. KING COUNTY, WASHINGTON...................................... 125
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 11 11/12/08 15:03:42
xii Le paysage façonné
3.2 MICHAEL HEIZER, EFFIGY TUMULI, 1983-1985. BUFFALO,
STATE PARK, OTTAWA, ILLINOIS.
PANNEAU DIDACTIQUE............................................................ 129
3.3 NANCY HOLT, CATCH BASIN, 1982. ST-JAMES PARK,
TORONTO, ONTARIO............................................................... 132
3.4 NANCY HOLT, DARK STAR PARK, 1979-1984.
ROSSLYN, ARLINGTON COUNTY, VIRGINIA......................... 134
3.5 NANCY HOLT, SKY MOUND, 1984. HACKENSACK
MEADOWLANDS, NEW JERSEY. …........................................... 139
3.6 SECOND VIEW. THE REPHOTOGRAPHIC SURVEY
PROJECT. TIMOTHY O’SULLIVAN, QUARTZ MILL
NEAR VIRGINIA CITY NEVADA, 1868 ; MARK KLETT,
SITE OF QUARTZ MILL, 1979...................................................... 147
3.7 LEWIS BALTZ, DEUX ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE
SAN QUENTIN POINT COMPOSÉE DE 58 PHOTOGRAPHIES,
1981-1983....................................................................................... 150
3.8 LEWIS BALTZ, DEUX ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE FOS,
SECTEUR 80 COMPOSÉE DE 21 PHOTOGRAPHIES, 1986..... 154
3.9 LEWIS BALTZ, ÉLÉMENT NO 11 DE LA SÉRIE FOS,
SECTEUR 80 COMPOSÉE DE 21 PHOTOGRAPHIES, 1986..... 157
4.1 PETER WALKER, TANNER FOUNTAIN, 1980, HARVARD
UNIVERSITY. ............................................................................... 175
4.2 CARL ANDRE, STONE FIELD, 1977. HARTFORD,
CONNECTICUT. ......................................................................... 176
4.3 PETER WALKER, TANNER FOUNTAIN, 1980,
HARVARD UNIVERSITY. . .......................................................... 176
4.4 CARL ANDRE, STONE FIELD, 1977. HARTFORD,
CONNECTICUT........................................................................... 177
4.5 PUBLICITÉ « SPIRAL JETTY WEEKEND »,
PARUE DANS SCULPTURE, JUILLET/AOÛT 2004.................. 180
5.1 LEWIS BALTZ. RONDE DE NUIT, 1992.
DE LA SÉRIE THE POWER TRILOGY......................................... 205
6.1 ZABRISKIE POINT, DEATH VALLEY, CALIFORNIE.......... 208
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 12 11/12/08 15:03:42
Table des illustrations xiii
6.2 VIRGIN RIVER VALLEY VUE DE LA MORMON MESA,
NEVADA........................................................................................ 209
6.3 LES SUN TUNNELS (1973-1976) DE NANCY HOLT.
GREAT BASIN DESERT, UTAH.................................................. 210
6.4 TERRILS LAISSÉS EN TÉMOIGNAGE
DES ACTIVITÉS MINIÈRES. BUFFALO STATE PARK,
OTTAWA, ILLINOIS.................................................................... 210
6.5 EFFIGY TUMULI (1983-85) DE MICHAEL HEIZER,
EN RÉFECTION. BUFFALO STATE PARK, OTTAWA,
ILLINOIS...................................................................................... 211
6.6 LE DOUBLE NEGATIVE (1969) DE MICHAEL HEIZER.
MORMON MESA, NEVADA........................................................ 211
6.7 LA CABANE, AU LIGHTNING FIELD DE WALTER
DE MARIA. HAUTS PLATEAUX DU NOUVEAU-MEXIQUE.. 212
6.8 LE LIGHTNING FIELD (1974-1977) DE WALTER
DE MARIA. HAUTS PLATEAUX DU NOUVEAU-Mexique.. 213
6.9 LE JOHNSON PIT NO 30 (1979) DE ROBERT MORRIS.
KING COUNTY, WASHINGTON................................................ 213
6.10 PERTH, WESTERN AUSTRALIA........................................ 215
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 13 11/12/08 15:03:42
Cet ouvrage a été publié grâce à une subvention de la Fédération canadien-
ne des sciences humaines, de concert avec le programme d’aide à l’édition
savante (PAES), dont les fonds proviennent du Conseil de recherche en scien-
ces humaines du Canada.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 14 11/12/08 15:03:42
REMERCIEMENTS
Cet ouvrage, qui fut d’abord une thèse de doctorat, aura été un
travail de longue haleine. Plusieurs personnes m’ont assistée au long
de ce processus et j’aimerais leur dire toute ma reconnaissance. En
premier lieu mes « anges gardiennes », Lise Lamarche et Anne
Cauquelin, qui m’ont apporté leur soutien moral et de précieux
conseils – en plus, pour la première, de s’appuyer de fastidieuses
lectures et relectures et pour la seconde, d’avoir écrit la belle préface
qu’on lira plus loin. Qu’elles soient remerciées de toutes leurs géné-
rosités. Je remercie également Francine Couture, grâce à qui j’ai pu
m’initier à la sociologie de la médiation. Merci à Philippe Poullaouec-
Gonidec.
Un grand merci aux collègues et amis qui m’ont aidée et soute-
nue de diverses façons, me laissant lire leur thèse, me donnant accès
à certains documents, partageant avec moi leurs réflexions : Iris
Amizlev, Serge Bérard, Joanna Sassoon, Bernard St-Denis, Louise
Thibodeau. Merci à Lynda Gormley pour son indéfectible soutien.
Plusieurs organismes et membres de leur personnel ont bien
voulu me recevoir et fournir des documents fort utiles à mes recher-
ches : Liz Andres, Seattle Art Museum ; Galerie Michèle Chomette,
Paris ; Bernard Gouin, Fos Action Culture, Fos-sur-Mer ; Jean-François
Seguin, bureau des paysages, ministère de l’Aménagement du terri-
toire et de l’Environnement, France ; Diane Testa, King County Public
Art Program, Seattle. D’autres personnes et organismes m’ont obli-
geamment fourni des photographies et l’autorisation de les repro-
duire : Lisa Cameron, New Jersey Meadowlands Commission ; Bill
Kaszubski, Peter Walker and Partners Landscape Architecture ; Karin
Dubreuil, Greater Hartford Arts Council ; Roni Thomas, Salt Lake Art
Center. Merci également au Département d’histoire de l’art et d’étu-
des cinématographiques de l’Université de Montréal, de même qu’au
Centre de Coopération interuniversitaire France-Québec (Paris
7-Jussieu) pour le soutien à la recherche.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 15 11/12/08 15:03:42
xvi Le paysage façonné
Je tiens à remercier les Presses de l’Université Laval de prendre
le risque, loin de l’esprit mercantile ambiant, de publier ce genre
d’ouvrage. Un remerciement tout particulier à Guy Mercier, direc-
teur de la collection « Géographie » aux PUL, pour m’avoir fait
confiance. Merci à Sandra Breux pour son travail irréprochable.
Finalement, et ce n’est pas la moindre des choses, je souhaite
exprimer toute ma gratitude aux artistes qui m’ont si aimablement
donné l’autorisation de reproduire leurs œuvres et pour m’avoir dili-
gemment transmis tous ces pixels : mille mercis à Lewis Baltz, à Nancy
Holt et à Mark Klett.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 16 11/12/08 15:03:42
PRÉFACE
Voyager, dit-elle
Une préface est nécessairement un voyage. Une sorte de tourisme textuel,
qui a pour but d’établir des repères, de reconnaître les points de vue, en somme
de photographier des sites dans l’œuvre à lire, de façon à tracer, pour le lecteur
sédentaire, un itinéraire engageant…
Tout comme le voyageur qui fait l’Égypte en huit jours, et la Mésopota-
mie en deux semaines, l’auteur d’une préface ne prétend pas tout dire, tout
voir, tout rapporter du pays qu’il traverse, mais il peut en partager les impres-
sions.
Ce sont bien des impressions ou des instantanés que je voudrais rassem-
bler ici, revenant de ce voyage dans le texte de Suzanne Paquet. Voyage dans le
voyage, car ce livre, qui parle de paysage, en efface les limites, en franchit les
frontières et en déplace les points de fuite.
Dès l’abord et résolument, l’auteure nous place devant la réalité : nous
sommes dans l’ère post-industrielle. L’économie gère le monde, et pas seulement
au sens politique et social, car la culture aussi a son économie, qui façonne des
standards, distribue les avantages, partage ou retient les ressources. Le pay-
sage, comme l’art et ses œuvres, sont des objets exploitables, et rentables pour
peu qu’on s’y attache.
Nous voici déjà loin de l’étalon-paysage traditionnel, dont nous avons
l’image et l’idée en tête. Nous voyons s’effacer peu à peu les paysages de Poussin
et les ciels de Turner, les ruines des romantiques et les abîmes de Friedrich ; non
qu’ils aient disparu, mais ils ont changé de statut ; ce ne sont plus des tableaux
de musée, propres à la contemplation, des instants éternels destinés à la vue,
non, ils ont pris la tangente, ils voyagent, maintenant. Et avec eux, la concep-
tion qui les a fait naître et les a soutenus tout au long des siècles jusqu’à
aujourd’hui. Car les concepts aussi, voyagent, et c’est bien ce que montre ce
livre de manière très originale.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 17 11/12/08 15:03:43
xviii Le paysage façonné
L’auteure entreprend ici, en effet, d’ébranler l’évidence bien établie que le
paysage est « naturel », qu’il se propose à nous dans son ingénuité, comme
l’essence même de la nature.
Or, cette évidence est si bien ancrée, qu’il est difficile de l’attaquer : il y a
en nous quelque chose qui refuse que nos paysages, nos parcs, nos jardins ne
soient pas l’expression directe de la nature. Fraîcheur de l’enthousiasme, naï-
veté de l’innocence. Aller à contre-courant, alors, c’est prendre le risque de
fâcher. Suzanne Paquet assure le risque et pour convaincre, choisit un point de
départ irréfutable : personne ne peut mettre en doute que les paysages contem-
porains sont « défigurés », en ruines – friches et catastrophes – ou au contraire,
sacralisés, surestimés, portés au pinacle, paradisiaques ; en somme, dit-elle,
« façonnés ».
« Façonné », tel est le terme qui rend compte à la fois de l’artifice paysager
tel qu’il se donne à voir et à sentir, in situ, mais aussi tel que le concept le
construit pour la connaissance. L’originalité de l’étude qui est présentée ici
c’est justement d’insister sur ce point : le site réel et le site mental voyagent
ensemble.
Car, si le paysage semble avoir changé au regard de nos anciennes
images, c’est que son concept a voyagé, soit qu’il ait suscité des attaques bien
pensées, soit qu’il ait subi des érosions hasardeuses.
Voyage du concept paysage à travers ses avatars. Voyage des sites paysa-
gers à travers leur histoire. Telle est l’histoire que nous raconte l’auteure.
D’abord paysage peint, produit culturel issu d’une invention technique
– la perspective – le paysage, prend peu à peu la forme que nous connaissons.
Ou plutôt, dit Suzanne Paquet, que nous « reconnaissons ». Car les peintres
nous ont appris à voir du paysage là où nous ne verrions rien ou un simple
fouillis. Peu à peu le tableau de paysage devient la forme perceptuelle, affective,
émotionnelle, de notre rapport à la nature. J’ajouterai pour ma part que cette
forme paysagère agit sur nos perceptions du monde comme forme a priori qui
trace le cadre de ce que nous sommes à même d’appréhender.
Bien qu’elle l’évoque ce n’est pourtant pas la peinture de paysage et son
devenir qui intéressent Suzanne Paquet, c’est le présent du paysage, l’actualité
de ses transformations mêmes.
Or, et là réside la seconde originalité de ce livre, ces transformations ne
sont pas imputées, comme c’est le cas le plus souvent dans les ouvrages sur
l’environnement, à une seule cause : le régime absurde de la vie économique,
avec ses dysfonctionnements, mais à une pluralité d’interventions qu’on peut
qualifier de techniques. L’auteure lie ainsi trois inventions entre elles, et trois
inventions qui ne sont pas toutes de la même espèce. Elles appartiennent au
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 18 11/12/08 15:03:43
préface xix
domaine de l’art, à celui de l’industrie et à celui des médias communication-
nels. Le land art avec la photographie, la voiture automobile avec la
car culture et le tourisme avec ses médiations culturelles se trouvent ainsi
portés sur le devant de la scène, pour notre plus grand plaisir. Car ce trio per-
cutant casse le décor statique du paysage à contempler et fait de ce dernier un
enjeu pluriel, où les différents intervenants se lient entre eux, dans des confi-
gurations et des dispositifs singuliers.
Suzanne Paquet analyse en effet le parcours méandreux des métamor-
phoses – successives parfois, mais parfois simultanées – que les land artists
font subir au paysage. Sa connaissance, très érudite, des œuvres et des écrits de
Smithson et du mouvement dématérialiste américain, sert à merveille son
propos et constitue la partie incontournable de la démonstration. Sur cette
assise, déjà nomade, se greffe alors l’alliage automobile + photographie qui,
tout en répétant l’ancienne pratique d’une reconnaissance in situ des peintu-
res de paysages, la renouvelle entièrement. On sait en effet que les aristocrates
anglais (pour ne parler que de ceux-là) faisaient le voyage en Italie pour « voir »
en réalité ce qu’ils avaient déjà vu en peinture, et tenter d’en reproduire la
composition dans leurs propres jardins.
De manière plus simple, et plus populaire, nous allons maintenant sur
place reconnaître des paysages que nous proposent les dépliants touristiques.
Nous allons, comme dit Suzanne Paquet « en reconnaissance du déjà vu »,
celle d’une nature façonnée en « site » à ne pas manquer. Voyages à la carte,
prêts-à-porter, photographiés pour le souvenir. La photographie a sur le paysage
un impact inattendu : elle le transforme en objet portable et le nomadise en
quelque sorte.
La culture de l’automobile, du car, de la caravane, du voyage organisé,
prend prétexte de la photographie pour renforcer son pouvoir. Et cela, même si
ce que nous voyons au cours de ces itinéraires touristiques sont plutôt des
r uines, des restes de cataclysme ou même les dévastations produites par les
guerres. À ce propos, la série vidéo « War Tourist1» d’Emanuel Licha est un
énoncé critique de ce goût du paysage, du montrable et du visible coûte que
coûte, une certaine dénonciation du sadisme pitoyable qui guide ces excur-
sions. Il est possible que le goût contemporain pour les friches et les espaces
« autres » que décrivait Foucault participe de cette même dérive, sans toutefois
rien changer au concept traditionnel de paysage. C’est le cas, comme le note fort
bien Suzanne Paquet, des confins, des paysages limites ou extrêmes qui attirent
les touristes.
1. Une partie de cette œuvre peut être vue à l’adresse suivante : http://www.emanuel-licha.
com/war_tourist.html
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 19 11/12/08 15:03:43
xx Le paysage façonné
La pratique et le concept
Mais le point fort de ce livre avant-coureur, sur lequel il faut insister, à
mon sens, c’est le nœud complexe qui est clairement montré ici, entre le voyage
« réel » que l’on accomplit en personne en se déplaçant dans des sites, et le
voyage « mental » entre des conceptions différentes de l’environnement dit
naturel. Autrement dit le lien entre pratique et concept, l’un se pliant à l’autre
et vice-versa dans un enlacement continuel.
Ainsi, l’auteure parle-t-elle de ces lieux-cultes du land art que sont
Spiral Jetty ou le Double Negative, ou encore les Sun Tunnels, que l’on
connaît par les photographies et les textes, mais qui sont littéralement invisibles
si l’on se déplace pour les voir. Ils ne sont appréhendés que par un déplacement
mental. Le concept de paysage mis en œuvre dans ces installations trouble
ainsi à la fois la perception de la chose et la pensée de ce qu’est un paysage, s’il
est invisible. Ces œuvres sont donc heuristiques, ce sont des pistes pour la
réflexion, tout en étant aussi des pistes dans le désert. Marches circulaires
autour d’un inconnu : le site non-site.
Mobilité, fluidité, inachèvement de l’interrogation, comme aussi retour-
nements et dérives. C’est cela que l’art nous apprend. Dans les mains des artis-
tes, la photographie défie le code des agences de voyage et des lois sur la sauve-
garde des monuments. Ce faisant, cette arme critique ne touche pas seulement
le résultat des politiques de l’environnement, elle touche au plus profond l’idée
qu’on se fait du paysage. Elle en invente les traits contemporains.
Paysage invisible et mobilité électronique
Un récit, ironique et captivant, clôt, ou plutôt ouvre la conclusion de ce
petit livre passionnant. L’auteure entreprend la visite des sites prestigieux du
land art… sans les trouver. Ils sont invisibles, et ce doit être non un hasard,
mais une nécessité. Le voyage du paysage l’a conduit hors de vue, hors de
portée du regard ; l’espace dédié au paysage s’illimite et disparaît ; seule reste
une trace, celle du récit qui fait œuvre.
Cette recherche n’est pas étrangère à ce que l’on peut augurer de cette
autre invention technique contemporaine, autre avatar de l’étendue : l’espace
du numérique, ou cyberespace. Là, les questions soulevées par Suzanne Paquet
trouvent un nouveau terrain. Comme elle l’a montré à propos du paysage
traditionnel, la reconception de l’espace numérique suit la pratique, et se trans-
forme à mesure des usages.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 20 11/12/08 15:03:43
préface xxi
Cependant, à la différence du paysage qui est une invention achevée ou
qui s’achève, l’invention du cyberespace reste encore à faire. Le paysage invisi-
ble d’un espace uniquement mental attend son concept.
On ne peut guère décrire cet espace lui-même, en effet, à l’aide du lexique
paysager, non plus qu’architectural. Aucun des éléments qui sert à désigner, à
construire ou même à concevoir l’espace que le paysage présente comme a priori
– et même si le concept de cet espace est dilaté à l’extrême, étendu au-delà des
limites du végétal, du minéral, de l’urbain, ou de l’environnement global –
aucun de ces éléments ne peut être utilisé quand il s’agit du cyberespace. Là est
peut- être le dernier pas à faire pour s’arracher aux conventions. Là est la
tâche qui attend le chercheur d’espace : une invention à poursuivre.
Et cette poursuite, comme le montre la belle analyse de Suzanne Paquet
sur le land art et la photographie, ne se peut qu’à la condition de l’art et de ses
œuvres.
Anne Cauquelin
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 21 11/12/08 15:03:43
Page laissée blanche intentionnellement
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 22 11/12/08 15:03:44
INTRODUCTION
Le paysage est un « fait culturel » usité depuis plusieurs siècles, à
tel point qu’il serait devenu un acquis qui ne prêterait pas à l’interro-
gation. Toutefois, le désigner comme un objet façonné est une façon
d’affirmer que le paysage est une production humaine dont les mo-
dalités d’élaboration fluctuent le temps passant.
Cet ouvrage propose une description attentive des mutations
subies par cette notion à double entrée, objet ou forme culturelle.
Ayant préalablement décrit les pratiques par lesquelles tradition
nellement elle vient à l’existence, il s’agira d’en cerner les aspects
contemporains. Car la manière d’« inventer » le paysage change.
D’abord composition – ou genre – uniquement artistique, ce sont
maintenant des procédés hybrides qui lui donnent naissance. Et l’ap-
port de l’art, pourtant essentiel à sa conception, semble peu à peu
s’estomper à mesure que le paysage suscite une attention grandis-
sante. En dépit de cette tendance, l’activité artistique sera ici l’élé-
ment premier et décisif de l’analyse et ce sont les formes de son usage
qui devront être dégagées afin de comprendre son importance.
Incontestablement, l’art contribue toujours à la création de paysages
nouveaux, mais cette contribution s’avère fort différente de ce qu’elle
a pu être avant le XIXe siècle.
Apparemment détaché de son origine artistique le paysage, au
XXe siècle, est converti en (une des formes du) spectacle1, en une mar-
chandise qui peut être fabriquée et consommée, et ce, en grande
partie à cause de l’emprise d’une industrie dont la croissance est pro-
digieuse, le tourisme. La photographie, indissociable sous ses formes
commerciale et populaire du phénomène touristique, est au fonde-
ment de cette transformation ; son rôle historique, son essor et son
ubiquité, tout particulièrement en relation au paysage, à sa consom-
mation et à la mobilité conséquente, sont déterminants.
1. Le spectacle, selon Guy Debord, est à la fois la marchandise produite et « le moment où la
marchandise est parvenue à l’occupation totale de la vie sociale » (Debord, 2001 : 39).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 1 11/12/08 15:03:44
2 Le paysage façonné
Auparavant bien symbolique le paysage devient, à l’ère post
industrielle, un objet que l’on produit, tangiblement, selon des règles
qui ne sont autres que celles de l’offre et de la demande : on en
fait une « ressource exploitable et utilisable » (Cazes, Lanquar et
Raynouart, 1993 : 34). Mais, fait singulier, bien que le paysage ne soit
plus strictement affaire d’art, on use toutefois de certains travaux
d’artistes pour légitimer le façonnement du territoire en un autre
aspect du « spectaculaire intégré » pour emprunter l’expression de
Guy Debord (2001 : 8). En retour, le tourisme, le déplacement en re-
connaissance devenu « temps spectaculaire consommable » (Debord,
2001 : 153), associé à l’omniprésente photographie, est vraisembla-
blement le nœud par lequel la pérennité des représentations paysa
gères, du paysage, est assurée. Ainsi, si l’art, qui a été le facteur consti-
tutif de l’« invention » du paysage conserve à la fin du XXe siècle une
part dans son façonnement – sa composition, perceptive et matérielle
–, c’est vraisemblablement parce qu’une certaine attitude très large-
ment partagée, à la fois position et disposition, qui sera ici identifiée
comme le mode touristique, envahit jusqu’aux productions artistiques
tout en s’insinuant dans leur réception et dans leur lecture. C’est dire
que ce mode touristique détermine vraisemblablement tous les
aspects contemporains du paysage et modèle toutes les possibles rela-
tions à celui-ci, sa saisie tout comme sa production physique. Ce sont
donc les correspondances et les interactions entre l’art, le tourisme,
la mobilité et la photographie, désormais fondamentales dans
l’élaboration et l’intellection du paysage, qui seront décrites et dé-
brouillées dans les chapitres qui suivent.
Le paysage, l’art et l’usage
D’abord création artistique, comme le démontre Anne Cauque-
lin dans L’invention du paysage, le paysage est le fait de peintres qui
traduisent les connaissances relatives aux lois de l’optique en une
série de règles et de procédés de réduction perspective, système qui
permet d’introduire dans les tableaux la vue par la fenêtre. À partir
de la Renaissance, dans certaines toiles, la description de l’espace
entourant les « scènes » prend de plus en plus d’importance, de sorte
que le paysage sera finalement consacré genre artistique à part
entière. Éventuellement ces compositions picturales, ces paysages,
induisent les déplacements de quelques connaisseurs vers les lieux
dépeints. On veut constater de visu, recomposer sur les lieux mêmes,
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 2 11/12/08 15:03:44
introduction 3
et par soi-même, les perspectives saisies par les artistes, reproduire in
situ leur point de vue. C’est ainsi que le paysage devient, particulière-
ment au XVIIIe siècle, objet de quête pour le voyageur. Ce phéno-
mène de déplacement en re-connaissance vers les lieux représentés par les
artistes est de toute première importance eu égard au développement
de la notion de paysage. De même, grâce à l’universalité de son usage
en peinture le dispositif perspectif est, à la longue, si bien assimilé
que la façon d’appréhender l’espace en est à tout jamais modifiée. Ce
système artificiel agit comme un filtre qui s’introduit systématique-
ment entre l’observateur et le site observé, faisant de ce dernier aussi,
un paysage.
Simon Schama, dans son ouvrage Landscape and Memory, sou-
tient que les paysages peu à peu se transforment en lieux de mémoire
ou en symboles d’identités régionales et nationales, la mémoire et
les mythes paysagers étant de l’ordre de l’héritage transmis. Selon
Schama, le regard que l’on porte sur le paysage en fait un donné
culturel essentiel, intégré par tous2. Et avant que d’être un enchante-
ment pour les sens, le paysage est une fabrication de l’esprit ; il s’éla-
bore aussi bien à partir des strates de la mémoire que des strates de
roc, dit Schama (1996 : 6-7).
C’est sans doute parce que l’on en vient à confondre la repré-
sentation et son objet et parce qu’en lui se matérialisent pour ainsi
dire mémoires et identités, que le paysage est aussi considéré comme
le résultat physique de l’action des humains sur leur milieu. Le paysage
est alors compris comme un palimpseste où les modifications se
recouvrent les unes les autres, les territoires étant différemment adap-
tés selon les époques et les modes de vie. C’est ce qu’ont voulu
démontrer, dans la mouvance de tout un champ d’études paysagères
actif en France depuis une trentaine d’années3, les auteurs Augustin
Berque et Alain Roger, entre autres. Pour eux, le milieu est modelé
par ses occupants, mais il faut également y poser un regard particu-
lier pour qu’existe le paysage. Double construction, donc. Berque
propose le néologisme de « médiance » pour décrire une réciprocité,
action sur le milieu et sens ou valeur symbolique donnés par le regard
(Berque, 1990), alors que Roger parle de « double articulation », pays-
paysage et d’« artialisation » (autre néologisme) in visu et in situ :
« “du pays” ne devient un paysage que sous la condition d’un Paysage,
2. Il est bien entendu question ici des seules cultures occidentales, comme dans tout le reste
de cet essai.
3. Pour un aperçu de la diversité et du grand nombre de ces études, on peut consulter Roger
(1995a).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 3 11/12/08 15:03:44
4 Le paysage façonné
et cela, selon les deux modalités, libre et adhérente, de l’artialisa-
tion » (Roger, 1995b : 443)4. Pour Roger, l’artialisation in situ est celle
qui se fait sur le terrain, qui est directe, et l’artialisation in visu se réa-
lise dans et par le regard, de façon indirecte.
John Brinckerhoff Jackson, auteur états-unien qui étudie le pay-
sage de son pays à partir des années 1950 et pendant plus de qua-
rante ans, présente quant à lui le paysage comme un fait matérielle-
ment élaboré, son aspect culturel étant strictement déterminé par
l’intervention humaine à même le territoire. Ce qui n’exclut pas
totalement (énoncé de manière un tant soit peu conventionnelle)
l’importance du fait artistique : « L’art a aussi sa part dans les études
du paysage comme je les envisage, car c’est seulement lorsqu’un pay-
sage demande notre participation émotionnelle que son unicité et sa
beauté nous sont révélées. » (Jackson, 1980 : 185)
Ainsi, quel que soit le point de vue selon lequel on le considère
et bien que les premiers paysages à « apparaître » (la montagne, le
littoral, le rural) soient des lieux de nature, le paysage n’est en aucun
cas une donnée naturelle. Les propositions des différents auteurs
brièvement passées en revue ici seront plus amplement analysées
dans le premier chapitre du présent ouvrage. Pour les besoins de
cette entrée en matière, posons simplement que je m’intéresserai
plus particulièrement, et pour des raisons différentes, aux deux thèses
respectivement formulées par Anne Cauquelin et John B. Jackson qui
établissent deux formes fortes pouvant être tenues comme décrivant
bien ce qu’est le paysage. Il faut souligner que ces deux formes dési-
gnent jusqu’à un certain point des « positions » opposées ; retenons
toutefois que Jackson tout aussi bien que Cauquelin, quoique leurs
propositions soient antagoniques, mettent tous deux en évidence le
côté construit, artificiel, du paysage (Cauquelin, 2000 : 8, 30 et 68 ;
Jackson, 1997 : 304-305). Chez Cauquelin la construction par le cadre,
le point de vue et la réduction perspective empruntés aux règles pic-
turales puis appliqués à l’appréciation sur place, détermine une mo-
dalité d’abord artistique, ensuite généralement intégrée. Pour Jackson
le paysage se crée par la transformation physique du milieu par les
usages, une formule qu’il propose à partir du mot landscape et de ses
divers sens dans différentes langues, un concept qui d’après lui exis-
tait dès avant l’invention du paysage en peinture (Jackson, 1997 : 299-
306). Jackson étudie l’impact de la multiplication des infrastructures
4. Voir également Roger (1997 : 18).
5. Je traduis. Il en va de même pour toutes les autres citations en anglais intégrées dans le
texte.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 4 11/12/08 15:03:44
introduction 5
destinées aux transports, phénomène qui, au XXe siècle, modifie ra-
dicalement le territoire et son appréciation. Ses études sont particu-
lièrement pertinentes lorsqu’il s’agit de comprendre, en relation au
paysage et à la mobilité, certaines formes d’art pratiquées au cours
des dernières décennies du XXe siècle.
À cause de leur égale importance et des croisements possibles
entre les deux cas de figure, représentation et perception ou espace
possédant ses caractéristiques propres, il semblerait présomptueux
de définir trop strictement le terme paysage. Anne Cauquelin insiste
d’ailleurs sur les perpétuels allers et retours entre l’image et sa chose qui
lui sont propres. De même, l’examen des théories le concernant
montre qu’il y a toujours une hésitation ou une sorte de va-et-vient
entre l’art et l’usage, dans les modes de conception ou les modalités
de formation du paysage. Il faudra donc considérer qu’en substance,
le paysage reste attaché au fait perspectif qui passe d’abord par la
représentation pour être ensuite comme tout naturellement reproduit
dans la perception, selon la thèse de Cauquelin. La notion de mobi-
lité, sur laquelle s’appuient les travaux de John B. Jackson, pourra se
greffer à cette figure première du paysage, car elle influe doublement
sur tout ce le qui concerne au XXe siècle : cela parce que le territoire
est transformé par la mobilité, et qu’en retour celle-ci procure le
détachement nécessaire à son appréciation comme paysage. Il est
rare en effet que l’on considère son propre milieu de vie comme un
paysage, car il faut du recul, de la distance (Cosgrove, 1998 : 18-19).
L’âge industriel
Le XIXe siècle est assurément le moment où se mettent en place
les éléments indispensables à la transformation qui sera ici analysée.
C’est un temps fort de l’ère industrielle, de nouvelles découvertes
techniques autorisant le développement des moyens de locomotion,
avec pour conséquences l’augmentation de la mobilité des personnes
aussi bien que l’émergence d’une nouvelle façon de percevoir le pay-
sage. Alain Corbin, de même que John B. Jackson ont bien explicité
ce phénomène : les transports rapides commandent une nouvelle
posture, une attitude différente du voyageur, qui auparavant se dépla-
çait de toute autre manière (Corbin, 2001 : 111-112 ; Jackson, 1997 :
199-209).
La mise au point du procédé photographique en 1839 est
concurrente de cette augmentation de la mobilité. Produit de
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 5 11/12/08 15:03:45
6 Le paysage façonné
l’industrie, la photographie est « elle-même un emblème de progrès
industriel et technologique » (Snyder, 1994 : 187). Elle contribue,
tout comme les transports rapides, à modifier les manières d’appré-
hender le paysage. Photographie et mobilité, appariées, forment une
variante du mouvement induit par la peinture, ce déplacement en
re-connaissance vers les lieux représentés par les artistes, variante
associée à de nouvelles conquêtes.
L’ouverture au XIXe siècle d’un rare territoire encore à conqué-
rir en cette ère industrielle est révélatrice de la portée de la combinai-
son mobilité et photographie. L’avancée vers l’Ouest, aux États-Unis,
marque le début d’une double quête qui est illustrée et renforcée par
la production intensive de photographies. D’une part, la recherche
de bénéfices matériels se concrétise par l’ouverture et l’occupation
de nouvelles terres ainsi que par l’exploitation des ressources du sous-
sol. D’autre part, la poursuite de richesses symboliques, d’images
fortes et significatives de son identité et de sa destinée pour la popu
lation états-unienne donne lieu à la production d’images nombreu-
ses.
C’est toute l’importance du couple photographie et mobilité,
son impact sur les façons d’apprécier, voire de fabriquer le paysage,
que l’on pourra comprendre à partir de l’étude de la conquête de la
frontière, qui sera analysée à travers deux types de photographies réa-
lisées par Timothy O’Sullivan, entre 1868 et 1874. La photographie
telle que pratiquée par O’Sullivan sert deux buts, l’un scientifique et
l’autre commercial : l’objectif scientifique correspond à la recherche
de richesses matérielles – surveys et investigations géologiques – et
l’objectif commercial répond au besoin naissant de biens symboliques
– images de sites grandioses diffusées dans tout le pays. En observant
quel rôle ont joué de telles images, il sera possible de démontrer que
dès le XIXe siècle, en partie à cause de ces pratiques photographiques
particulières, le paysage commence à se détacher de son a priori artis-
tique. S’amorce alors un important processus, le glissement du pay-
sage vers son nouvel état de produit façonné ; « évolution » graduelle
qui trouvera son aboutissement en Occident, après la Deuxième
Guerre mondiale.
L’ère postindustrielle et ses territoires
À l’époque postindustrielle, un certain nombre de facteurs
concourent à la progression du changement de condition du paysage.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 6 11/12/08 15:03:45
introduction 7
La production et la diffusion de plus en plus soutenues d’images ob-
tenues par des moyens mécaniques, tout comme l’augmentation puis
la massification des déplacements agissent en prolongement des in-
novations du XIXe siècle. De plus, en Occident, après la Deuxième
Guerre mondiale, l’attention portée aux altérations subies par les
territoires (ce que l’on appelle l’environnement) et la volonté de
contrôler, et même de réparer les torts causés par l’exploitation des
ressources naturelles, suscite l’émergence de divers mouvements
sociaux et la prise en compte du fait environnemental à différents
niveaux décisionnels. Bien des sites, que l’on a de plus en plus ten-
dance à qualifier immédiatement de paysages, sont reconnus comme
des richesses à sauvegarder, mais surtout comme des lieux de mé-
moire ou des figures d’identités culturelles que l’on se ré-appropriera
localement ou selon des politiques nationales concertées, pour l’usa-
ge de groupes, de communautés, de visiteurs. Dean MacCannell
observe que la primauté de la recherche des biens symboliques dans
la société moderne, pour lui synonyme de société postindustrielle,
conduit au marquage puis à la sacralisation de sites, au profit des touris-
tes (MacCannell, 1999 : 39-48), ce qui semble être l’une des manières
contemporaines de « fabriquer » du paysage, un mode de façonne-
ment fondé comme il sera montré, sur l’importance réciproque de la
photographie et de la mobilité.
Les années 1960, 1970 et 1980 sont particulièrement importan-
tes à cet égard, puisque ce sont les années pendant lesquelles se pro-
duit le recul de l’industrie lourde et partant, un changement de
régime économique. Ce sont les années où s’intensifie rapidement la
mobilité des Occidentaux, phénomène directement lié à l’abondance
d’après-guerre et dont l’impact sur le territoire et le paysage est consi-
dérable. Ce « paysage » de la mobilité, c’est-à-dire l’espace radicale-
ment modifié par des fluctuations économiques sera ici considéré
comme postindustriel au sens large. Plus strictement – et l’un n’exclut
pas l’autre –, le territoire postindustriel, ses lieux et ses terrains,
seront des motifs d’investigation, car en eux se télescopent pour ainsi
dire l’âge industriel et l’ère postindustrielle. Certains sites, les zones
dévastées par l’extraction des matières premières puis désaffectées,
portent les traces de la frénésie industrielle prédominante pendant
plus d’un siècle. Une frénésie causée par les besoins grandissants de
matières premières, par la production à grande échelle de biens de
consommation et la construction de voies pour leur transport. Ces
territoires sont les séquelles de la conquête de la mobilité. D’autres
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 7 11/12/08 15:03:45
8 Le paysage façonné
lieux, aussi étudiés ici, peuvent être vus comme les produits ou les
emblèmes de l’intensification radicale des déplacements – une mobi-
lité territoriale mais aussi sociale – et du développement d’une
économie postindustrielle. Ce sont les territoires suburbains, la ban-
lieue, et périurbains, de vastes zones transitionnelles entre l’urbain,
le suburbain et le rural.
Ces motifs et ces lieux ont été largement appropriés et exploités
par les trois artistes à partir des travaux desquels on pourra observer
comment dans la deuxième moitié du XXe siècle s’opère le change-
ment d’état du paysage, comment à cet égard le travail artistique de-
vient partie de vastes entreprises, comment l’art y est instrumentalisé.
Les travaux de Robert Smithson (1938-1973) et de Nancy Holt (née
en 1938), tous deux artistes du land art, ainsi que ceux de Lewis Baltz
(né en 1945), artiste photographe, seront analysés suivant cette pers-
pective. Certaines œuvres d’autres artistes qui leur sont contempo-
rains, par exemple Robert Morris et Michael Heizer, seront aussi
parfois examinées. Deux types de pratiques artistiques, le land art et
la photographie, sont donc pris en compte ; mais tous deux tendent
finalement à se rejoindre. Cette conjonction s’accomplit par la
commande, que caractérisent d’incessants glissements entre l’art et
l’usage, et qui prend de plus en plus d’importance dans le domaine
artistique à partir des années 1960.
Le passage du paysage de bien symbolique à objet façonné adve-
nant par des processus hybrides et par la conjugaison de multiples
éléments, ce sont les interactions entre ceux-ci qui seront décrites,
selon un modèle inspiré par la sociologie de la médiation telle que
proposée en sciences par Bruno Latour et appliquée au domaine des
arts par Antoine Hennion (Latour, 1995 ; Hennion, 1993a et 1993b ;
Latour et Hennion, 1993).
Selon Bruno Latour, les innovations sont généralement le résul-
tat du travail collectif d’agents hétérogènes, de choses et de gens de
toutes sortes6. Lorsqu’elles sont bien au point, parfaitement opéra-
tionnelles et durables, les innovations se propagent et sont reprises
par d’autres groupes et en d’autres lieux et d’autres contextes : « cha-
que fois qu’un objet devient « indiscutable » il se répand ailleurs »
(Latour, 1995 : 321). Des déplacements permettent aux innovations,
devenues entre-temps des faits et des concepts avérés ou des objets
fonctionnels, d’être utilisées à d’autres fins que ce pourquoi elles
6. « Décrire l’association des choses ou décrire l’association des humains, c’est un seul et
même travail » (Latour, 1995 : 341).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 8 11/12/08 15:03:45
introduction 9
avaient été élaborées, parce qu’on les intégrera à d’autres faits et
objets ou parce qu’elles seront transformées par de nouveaux groupes.
Si ce modèle peut être appliqué à ces recherches sur le paysage, c’est
qu’en le suivant, il est possible d’examiner un processus « en train de
se faire » (Latour, 1995 : 29). Ainsi j’observerai les séries d’actions
réciproques ou successives des humains et des « non humains » (les
choses), les réseaux d’alliances et de controverses par lesquels on en
arrive à ce résultat, connu à l’avance, mais dont il s’agira d’analyser
les tenants et aboutissants, le paysage devenu spectacle, c’est-à-dire
un objet que l’on façonne selon les lois de l’offre et de la demande. Il
importera donc de « moins s’intéresser aux réalités installées qu’à
l’installation des réalités » (Hennion, 1993a : 224).
Bref itinéraire
Le premier chapitre expose comment certaines innovations, la
perspective des peintres, la photographie et le tourisme, deviennent
des faits et des concepts avérés qui, parce que tous trois sont de plus
en plus indissociables et aussi parce qu’ils feront éventuellement
l’objet de reprises et de combinaisons inédites, sont les éléments
constitutifs du processus étudié dans cet ouvrage. Ce détour histori-
que par la Renaissance puis le XIXe siècle permettra d’établir les assi-
ses de l’argumentation développée dans les chapitres subséquents,
démontrant comment les « non- humains » – objets et œuvres d’art,
territoires, systèmes politiques et économiques – et les humains –
artistes, critiques, membres d’institutions muséales, autres groupes
professionnels –, tous considérés comme des « opérateurs de transfor-
mations ou de traductions » (Heinich, 2001 : 66), concourent, par
leurs actions mutuelles à faire passer le paysage (l’idée ou la chose)
par diverses modulations, pour que finalement se définissent une
forme et une approche très différentes de celles que l’on connaissait
jusqu’à l’époque industrielle.
Le chapitre deux est consacré à l’étude des liens land art, photo-
graphie, mobilité et paysage. Il y est montré que grâce à ces associa-
tions, le land art peut devenir un art du paysage, cependant que la
photographie artistique, même lorsque son motif est le paysage, ne
peut tenir ce rôle. Il est ainsi observé que le land art, par son utilisation
de photographies aux fins de documentation d’une action à même le
territoire, participe de la mécanique de « représentation incitant aux
déplacements en re-connaissance » qui conditionne à la fois l’appari-
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 9 11/12/08 15:03:46
10 Le paysage façonné
tion des paysages et le tourisme. L’analyse des travaux de Robert
Smithson et de ceux de Nancy Holt est à cet égard révélatrice. On
comprendra pourquoi on a dit des land artists qu’ils ont créé de « nou-
veaux » paysages et qu’il s’ensuit qu’à l’ère postindustrielle le land art
a un rôle de premier plan – quoique occulté pendant un certain
temps – dans l’évolution de l’idée de paysage. On pourra aussi voir
pourquoi il n’est pas étonnant que les artistes du land art, en particu-
lier Smithson, se soient intéressés les premiers aux zones postindus-
trielles, l’agitation des années 1960 disposant les artistes à réfléchir à
leur fonction sociale, ce qui les conduira éventuellement à la réalisa-
tion d’œuvres d’art public. On comprendra par quelles interactions
ils en viennent à prendre part à des opérations d’aménagement de
lieux en zones de loisir ou de tourisme7, quelquefois sur des sites
r uinés par l’industrie, et comment leurs travaux feront l’objet de tra-
ductions et éventuellement de reprises par d’autres groupes profes-
sionnels. Suivant ces observations, au chapitre trois, toutes les média-
tions par lesquelles l’art et les artistes en viennent à contribuer à la
constitution de l’espace postindustriel en spectacle sont décrites et
disséquées, pour montrer quelle est à cet égard la part du land art
dans les villes (et dans les banlieues) et quelle est, à l’échelle de terri-
toires nationaux, la part de la photographie artistique.
Concurremment, aux chapitres deux et trois, les rapports entre
les recherches de Robert Smithson et celles de Lewis Baltz sont exa-
minés, car les deux artistes collectionnent les paysages postindustriels,
le premier un peu à la manière d’un touriste et le second comme le
photographe engagé qu’il est. Mais si le land artist peut se permettre
l’ironie de jouer au touriste, l’artiste photographe dont l’outil de
travail est aussi l’instrument privilégié du touriste doit se démarquer
de ce dernier. Il est, d’une part, un « activist landscape photographer »
selon les termes de Lucy R. Lippard (1998 : 60), sa production s’éloi-
gnant de la photographie commerciale qui agit comme invitation au
voyage. D’autre part, l’artiste photographe produit des photogra-
phies pour certains usages « scientifiques » à la façon des prédéces-
seurs du XIXe siècle, parmi lesquels Timothy O’Sullivan. Les images
réalisées pour des « missions photographiques », des commandes sur
le modèle des surveys du siècle précédent, servent les mêmes fins
7. Cette association loisir et tourisme sera généralement employée ici, les loisirs « de courte
durée des populations urbaines » étant une forme de tourisme de proximité. (Cazes,
Lanquar et Raynouart, 1993 : 5). John Urry décrit par ailleurs une sorte d’indifférenciation
des activités qui mène au remodelage « en mode touristique » de nombre de sites aupara-
vant consacrés aux activités quotidiennes (2002 : 161). L’envergure de ce phénomène est
décrite aux chapitres trois et quatre.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 10 11/12/08 15:03:46
introduction 11
qu’un certain art public inspiré du land art : le façonnement des lieux
en aires de loisir et de tourisme ; cette pratique, la mission photogra-
phique, s’inscrit donc comme un autre opérateur de transformation
dans la production de l’espace postindustriel.
Ces analyses successives ou synchrones de différentes matières
abordées en résonance permettront de comprendre que l’espace
ainsi façonné, ainsi produit, en vient à s’envisager globalement comme
une série de paysages, devenant capital (touristique), lorsque de nou-
veaux acteurs tendent à s’instituer en gardiens et dépositaires de tout
ce qui concerne le paysage. Le dernier chapitre explique comment le
land art et la photographie artistique font l’objet de reprises lorsque
de nouveaux groupes ou un nouveau champ s’en réclament et en
usent pour légitimer leurs entreprises et comment, en retour, cette
médiation assure une certaine pérennité au land art : « S’ils ne le
reprennent pas à leur compte, l’énoncé sera restreint à un point de
l’espace et du temps […], mais s’ils le reprennent, ils peuvent le trans-
former jusqu’à le rendre méconnaissable » (Latour, 1995 : 260).
*
Le paysage est donc, depuis son « invention » une fabrication,
un objet qui est de l’ordre de l’artificiel, qu’il s’agisse de construction
visuelle fondée sur les règles de la projection perspective ou bien
d’intervention à même le milieu ou le site. Les lieux ici étudiés sont
déjà radicalement artificialisés, construits, altérés (selon les deux ac-
ceptions du mot), dévastés. De plus, ils se prêtent si mal à l’exercice
conceptuel qui pourrait en faire des paysages que l’on voudra littéra-
lement les modeler à cet effet. C’est pourquoi il faudra tenir compte
des oscillations entre le sens large et le sens plus étroit de la notion de
« paysage postindustriel ». Quelques constats au sujet de possibles
définitions de ce paysage particulier et de ses conditions d’apparition
sont offerts en conclusion.
Prenant pour motif ces singuliers territoires, tout au long d’un
examen attentif des rapports entre représentation et mobilité à tra-
vers la photographie, le land art et le tourisme, il sera possible de
vérifier dans quelle mesure le paysage se produit et se consomme et
quelles sont la part de l’art et la part de l’usage dans cette nouvelle
conception des lieux, le paysage façonné en une des formes du spec-
taculaire intégré. Aux fins de cette investigation, de nombreux fac-
teurs devront être pris en compte, au risque parfois de certains allers
et retours – on aura déjà compris l’importance de ce mouvement –
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 11 11/12/08 15:03:46
12 Le paysage façonné
pour tenter d’en arriver à circonscrire ce qu’a pu devenir le paysage
à la fin du XXe siècle, un « paysage postindustriel » qui est celui-là
même de la mobilité, de la communication, du transport et de la
transmission érigés en mode de vie.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 12 11/12/08 15:03:46
C H APITRE U N
inventions
Dans le présent chapitre, il est question d’inventions dont cer
taines se présentent en succession et d’autres en synchronie. En fait,
il s’agit de montrer comment certaines « boîtes noires », essentielles
au changement d’état du paysage tel qu’il est examiné dans le pré-
sent essai, se sont « fermées » à certains moments. Les « boîtes noires »,
décrites par Bruno Latour dans La science en action (1995), sont des
concepts, des faits, des techniques ou des objets qu’un travail collectif
et que diverses transformations ont rendu parfaitement fonctionnels
et utilisables, stables et finis1. Ces « boîtes noires » peuvent s’apparen-
ter aux paradigmes scientifiques définis par Thomas S. Kuhn, para-
digmes qui produisent « engagement et accord apparent » et qui
« fournissent des modèles qui donnent naissance à des traditions
particulières et cohérentes de recherches scientifiques » (Kuhn,
1972 : 26). Les boîtes noires « fermées » sont les faits ou les objets et
les techniques dont l’usage est entendu comme « naturel » et univer-
sel, dont on ne met plus en question l’évidence et la nécessité, qui
sont devenus des « points de passage obligés » (Latour, 1995 : 346). Ce
qui ne veut pas dire que certaines d’entre elles ne seront pas réouver-
tes par la suite (les théories que l’on réfute par exemple) ou différem-
ment combinées pour fabriquer d’autres faits et objets et même repri-
ses et transformées à d’autres fins que celles qu’on leur connaît.
Les faits et techniques examinés ici sous cet angle sont : la pers-
pective des peintres qui est le facteur déterminant de l’apparition du
paysage, la photographie dont la mécanique intègre le fait perspectif
et le tourisme qui naît et prolifère en rapport avec les représentations
1. L’expression « boîte noire » est utilisée par les cybernéticiens pour désigner un appareil
ou une série d’instructions d’une grande complexité, mais qui se présente comme « un
tout unique » et « durable » (Latour, 1995 : 26 et 320-321).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 13 11/12/08 15:03:46
14 Le paysage façonné
picturales et photographiques. Si les interactions entre ces trois
phénomènes sont nombreuses à mesure de leur transformation en
« boîtes noires fermées », le tourisme est, à terme, celui qui aura la
plus grande importance au regard du paysage.
Il faut donc remonter jusqu’à la Renaissance pour ensuite s’ar-
rêter plus longuement au XIXe siècle, afin de bien comprendre quels
sont ces faits qui, installés il y a longtemps, ont déterminé des inter
relations qui perdurent et des modèles qui pourront s’organiser de
manière que le paysage, à l’ère postindustrielle, devienne un objet
façonné.
LE PAYSAGE
C’est d’abord par l’art, la majorité des théoriciens en convien-
nent, que s’inventent les paysages. S’agissant de décrire des lieux de
manière qu’ils soient dignes d’intérêt, les poètes et les peintres s’oc-
cupent à rendre remarquables des territoires qui auparavant inspi-
raient l’horreur ou la crainte. La montagne est le premier paysage à
apparaître ainsi : c’est le récit de son ascension du mont Ventoux par
Pétrarque au XIVe siècle (Corbin, 2001 : 15 ; Schama, 1996 : 419-422)
qui marque pour la première fois une importante métamorphose des
lieux : « À l’aube des temps modernes, les montagnes figurent les
verrues de la création ; elles semblent un territoire satanique. Peu à
peu, elles apparaissent comme de délicieuses horreurs qui procurent
le frisson ; en un mot elles sont sublimes » (Corbin, 2001 : 88). Bien
que l’on accorde à Pétrarque le bénéfice de la première invention, de
même que généralement on donne préséance à la littérature (rela-
tions de voyages, poésie, etc.) en regard des inventions successives des
différents paysages (après la montagne au XIVe siècle, le rivage et la
mer au XVIe siècle, et ainsi de suite), la peinture vient à peu près au
même moment établir une emprise sur le paysage (et pas nécessaire-
ment les paysages) qui va perdurer pendant des siècles.
C’est la peinture qui retient ici l’attention ou plutôt une
construction picturale, la perspective centrale, perspectiva artificialis
ou costruzione legittima, qui est la perspective des peintres et non celle
de la géométrie. L’emploi de ce procédé permettant la description
(soi-disant) exacte d’une spatialité en trois dimensions sur une sur-
face plane se propage chez les peintres dès le XIVe siècle. On le sait,
c’est à partir des travaux des peintres Giotto et Duccio, ces « fonda-
teurs de la vision perspective moderne de l’espace » comme les
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 14 11/12/08 15:03:47
chapitre 1 • inventions 15
omme Erwin Panofsky (1975 : 115) que se développe cette techni-
n
que, qui sera après eux perfectionnée et fera l’objet de nombreux
traités, particulièrement aux XVe et XVIe siècles. Les peintres de l’épo-
que veulent atteindre le plus haut niveau d’excellence dans l’imita-
tion de la nature, « la peinture n’étant pas autre chose qu’une contre-
façon de tout ce qui existe dans la nature, telle qu’elle nous le
présente, simplement par le dessin et les couleurs », comme l’écrit
Vasari2. Les historiens de l’art attribuent généralement à Brunelleschi
l’exacte démonstration (Damisch, 1993 : 1103), ou la forme définitive
de la construction perspective. Panofsky affirme cependant que c’est
Alberti qui en a donné la première définition juste : « Le tableau est
une intersection plane de la pyramide visuelle » (1975 : 147). Mon
propos n’étant pas ici de tracer l’histoire des alliances et des contro-
verses qui ont donné à cette invention sa forme finie, je préfère poser
simplement que le fait stable et avéré que devient la perspective est
issu d’une suite de modifications et d’améliorations dont le relais se
passe d’un peintre à l’autre aux XIVe, XVe et XVIe siècles, appuyés en
cela par les traités et les vies d’artistes qui viennent en démontrer
l’importance, simultanément ou après coup4. Un certain va-et- vient,
une série de traductions et d’emprunts réciproques de la peinture à la
géométrie à l’architecture, contribuent au processus par lequel le fait
perspectif se fixe de façon définitive.
Ainsi, lorsque c’est par la peinture que s’invente le paysage, c’est
spécialement par le rayonnement de la perspective comme procédé
de représentation qu’il prend forme. L’étude des principales compo-
santes de ce procédé révèle comment la notion de paysage a pu deve-
nir à tel point universelle et naturelle, bien qu’il s’agisse d’une notion
médiate et non pas immédiate. La perspective s’élabore à partir du
point de vue, à l’intérieur du cadre qui est la limite du plan – le
tableau – à l’intersection de la pyramide visuelle, selon la réduction
perspective, soit l’organisation en lignes convergentes vers un point
de l’horizon, organisation par laquelle l’espace est résolu comme
« un système de pures relations entre hauteur, largeur et profondeur »
(Panofsky, 1975 : 92).
2. Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e arcitetti, Florence, 1568, cité par Marisa
Dalai Émiliani, « La question de la perspective », préface à Erwin Panofsky (1975 : 18).
Cette préface offre par ailleurs des sources bibliographiques abondantes sur la dite ques-
tion.
3. Pour un point de vue critique sur l’histoire de la perspective légitime, voir p. 87-111.
4. En effet, le travail collectif qui est à l’origine de la fermeture des boîtes noires est tissé
d’alliances et de controverses (Latour, 1995 : 320-321).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 15 11/12/08 15:03:47
16 Le paysage façonné
On a dit que la perspective légitime ne fait que synthétiser la
façon dont l’œil humain perçoit son entourage. Cette idée a ensuite
été contestée par Erwin Panofsky entre autres, sous prétexte que l’œil
voit plutôt des courbes que des lignes droites, que le champ visuel
rendrait une image sphérique plutôt qu’orthogonale (1975 : 44 et
suiv.), conception qu’Hubert Damish qualifiera d’« absurde »
(1993 : 26). Tous deux s’entendent néanmoins sur l’évidence que la
perspective est un artifice au service de la représentation en deux
dimensions, une méthode développée pour cette fonction précise,
mais qui finalement détermine tout le rapport moderne à l’espace ou
à la réalité. Et, ne serait-ce que rétrospectivement, on ne peut contour-
ner l’évidence que la réduction perspective a une relation avec le
monde réel, en ce qu’elle donne la formule d’une synthèse de l’espace. À
rebours, c’est le regard qui calquerait la construction perspective.
Si on réduit le réel à une représentation paysagère sur le plan
d’un tableau délimité, une coupe s’opère dans un monde plus vaste
pour n’en montrer qu’une partie. Tout le tableau devient une « fenê-
tre » (Panofsky, 1975 : 1215) qui cerne et resserre un motif tout en
laissant supposer qu’il est continu au-delà de la bordure. L’espace du
tableau s’organise à l’intérieur de cette limite selon une série de
lignes convergeant vers un point de fuite (ou un point de vue qui lui
est symétrique, aux deux extrémités d’un axe perpendiculaire à la
ligne d’horizon) où elles sont rassemblées. L’ensemble de ces lignes
et des transversales qui les coupent permet de présenter les objets et
l’espace qui les sépare en une relation cohérente, de succession dans
la distance. Ce que je retiens de ce mode de composition, avec Anne
Cauquelin – et aussi avec Erwin Panofsky lorsqu’il parle de « pures
relations » – c’est le lien qui se crée dans la correspondance de tous
les éléments entre eux, y compris les « intervalles » (Panofsky,
1975 : 125), une homogénéité qui autorise à ne voir qu’une seule chose
dans toute cette organisation : un paysage.
Par la fenêtre peinte sur la toile illusionniste on voit ce qu’il faut voir :
la nature des choses montrées dans leur liaison. Ce qu’on voit alors ce
ne sont pas les choses, isolées, mais le lien entre elles, soit un paysage.
Les objets, que la raison reconnaît séparément ne valent plus que par
l’ensemble proposé à la vue. Car l’invention de la perspective donne
les règles d’une réduction et d’un rassemblement (Cauquelin,
2000 : 74).
5. « […] la « portion » d’une spatialité illimitée » (Panofsky, 1975 : 121).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 16 11/12/08 15:03:47
chapitre 1 • inventions 17
La perspective, en ses manifestations picturales, depuis fort
longtemps ordonne ce qu’offre le réel, ce qui se donnerait à la vue de
manière moins synthétique. Il devient dès lors difficile, pour un œil
moderne, de départager ce que serait une réalité sans cette construc-
tion et ce qu’elle conditionne : il est en effet malaisé de voir autre-
ment, étant donné le nombre de représentations qui reconduisent ce
procédé et auxquelles l’œil est exposé. Cela surtout parce que la pers-
pective situe le regardeur en un point précis, un lieu central, là où
convergent les obliques tracées par – ou pour – la réduction perspec-
tive, le lieu du point de vue, à partir – ou autour – duquel s’organise
tout le dispositif. Et cette position, plus qu’uniquement celle du spec-
tateur devant un tableau, se transforme rapidement en un rapport au
monde, la vision perspective.
Panofsky explique que la perspective crée une distance entre
nous et les choses, ce qui serait son côté objectif, et que tout à la fois
elle supprime cette distance, car elle permet de s’approprier les
choses, ce qui serait la subjectivité du point de vue (1975 : 160-161),
déjà le lieu de ce sujet que les philosophes n’ont cessé de discuter
(Panofsky, 1975 : 1596). C’est une appréhension spécifique de l’espa-
ce que Martin Heidegger, parlant du sujet tel que conçu par le carté-
sianisme, nommera « the world picture » (1977 : 1327). Ce rapport
à l’espace façonne un sujet tout à la fois individuel et collectif, ce
qu’Hubert Damisch explicite ainsi :
À la façon dont toute « vision » doit pouvoir être partagée par d’autres
pour que le « sujet » puisse voir : il n’y a de vision qu’ordonnée à une
description, une désignation possibles, et astreinte du même coup à
une distance en même temps qu’à un point de vue donnés, et donnés
comme l’est un jeu de langage, au titre de la condition même de la
vision. Pas plus qu’il n’y a de propriété privée dans le langage, il n’y en
a dans la perception : l’idée même d’une « perspective » y contredit. Le
problème est alors de savoir comment le perçu se distinguera du
représenté (1993 : 56).
Parce qu’elle articule un point de vue à la fois subjectif et partagé
à la jonction des lignes qui réduisent et rassemblent, la perspective
centrale accomplit ce travail qui est de faire voir le paysage toujours
selon l’exacte position et la juste distance. Il est dès lors aisé de trans-
poser sur le motif réel cette façon de voir : le paysage est là, là-bas, pas
6. « Cette vision de l’espace est pourtant déjà celle que le cartésianisme devait plus tard ratio-
naliser et la doctrine kantienne formaliser » (Panofsky, 1975 : 159).
7. « That the world becomes picture is one and the same event with the event of man’s
becoming subiectum in the midst of that which is » (Heidegger, 1977 : 132).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 17 11/12/08 15:03:47
18 Le paysage façonné
trop proche et saisi à partir d’un point de vue généralement domi-
nant d’où l’on sait 8 opérer une coupe pour le cadrer mieux, mieux
en rassembler les éléments.
C’est vraisemblablement parce que la perspective se partage que
l’on voudra se déplacer pour apprécier, sur les lieux mêmes, la réalité
reproduite dans le tableau, que l’on voudra re-créer ce dernier (ou se
le re-présenter) in situ. À mesure que s’inventent les paysages, la pein-
ture prend le relais de la poésie et des récits pour montrer, ce que ne
peut faire la littérature qui décrit sur un autre mode et ne donne pas
aussi directement à voir, la montagne, la mer, pour en faire des lieux de
beauté plutôt que des territoires sauvages, horrifiants et hostiles. Les
membres de « l’élite de la société » (Cauquelin, 2000 : 81) tiennent
dès lors à se déplacer pour voir les chefs d’œuvres de la peinture, mais
aussi pour s’exposer à la réalité de ces paysages qu’ils ont vus, dépeints
par les artistes. Peu à peu, pour cette même élite, un long voyage dans
le but d’apprécier monuments et lieux pittoresques devient un pas-
sage obligé. Au XVIIIe siècle particulièrement, les riches Britanniques
se prêtent à une sorte de « tournée de contemplation » chez eux et
sur le continent, qui leur permettra de voir nombre de paysages « ty-
piques » que l’on identifie à la « manière » de certains peintres (Gom-
brich, 19789). Ils auront volontiers lu quelques traités sur le sublime
et sur le pittoresque, ouvrages qui départagent les genres de lieux, de
paysages, qu’ils pourront observer en chemin – parmi ceux-ci : John
Baillie, An Essay on the Sublime écrit en 1757 ; William Gilpin, Observa-
tions Relative to Picturesque Beauty de 1789 ; Uvedale Price, An Essay on
the Picturesque, as Compared with the Sublime and Beautiful ; and, on the
Use of Studying Pictures, for the Purpose of Improving Real Landscape, 1794-
1798. C’est le Grand Tour, que l’on effectuera en ayant soin de se
munir de quelques articles singuliers dont le Claude glass, sorte de
filtre ou de cadre portatif composé d’un miroir convexe serti dans un
coffret. Le miroir, grâce à sa convexité agissant un peu comme les
objectifs photographiques à grand angulaire d’aujourd’hui, permet
de cadrer et de voir les lieux à la manière d’un tableau de Claude Le
8. « Oui, mais nous devrions aussi savoir qu’un travail considérable est à l’origine de cette
intuition instantanée, travail que nous accomplissons à notre insu, pour maintenir vivante
cette perfection. À quelles sortes d’opérations médiates ne devons-nous pas soumettre nos
« allers de soi » pour qu’ils nous offrent l’assise impeccable du sentiment de la perfection
immédiate » (Cauquelin, 2000 : 112).
9. « There are countless passages in eighteenth-century literature like the one from a guide-
book through the Lake District promising to lead the tourist from the delicate touches of
Claude, verified at Coniston Lake, to the noble scenes of Poussin, exhibited at Winder-
mere Water, and from there to the stupendous romantic ideas of Salvator Rosa, realized in
the Lake of Dervent » (Gombrich, 1978 : 120).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 18 11/12/08 15:03:48
chapitre 1 • inventions 19
Lorrain. Les voyageurs du Grand Tour pratiquent également la dis-
tanciation ou le détachement pictural (pictorial detachment) qui consis-
te à regarder un site d’une certaine distance afin de le voir comme un
tout unifié et encadré (Chard, 1999 : 226).
À partir de ce moment, le voyage, le déplacement, deviennent
des modes privilégiés d’appréciation du paysage. J’y reviendrai. Pour
le moment, de ces expéditions, il importe d’observer attentivement
ce qui les motive, c’est-à-dire la nécessité de re-connaître les lieux que
l’on a vus, peints sur la surface plane du tableau. « On ne voit que ce
qui a déjà été vu, et on le voit comme il doit être vu » (Cauquelin,
2000 : 8410). Dans les tableaux, tout est mis en œuvre pour reproduire
au mieux la nature. Ce jeu de l’illusion naturaliste, de la mimesis, tout
artificiel qu’il soit est rapidement accepté comme garant de vérité,
soit qu’il reproduise vraiment les caractéristiques de l’œil humain, soit
que le point de vue qu’il met en place corresponde effectivement à un
« sentiment bien déterminé et spécifiquement moderne de l’espace
ou, si l’on préfère, du monde » (Panofsky, 1975 : 54).
« Un usage social s’instaure, venu de l’image. Fonction publici-
taire de la peinture » (Cauquelin, 2000 : 83). À travers l’acceptation
universelle de la construction perspective réalisée par les déplacements
en re-connaissance s’installe une certaine confusion entre l’image et sa
chose, c’est-à-dire entre la représentation d’un lieu et le lieu lui-même.
L’étroite association des deux bouts du circuit ou « l’identification
abusive des deux extrémités de la chaîne » (Cauquelin, 2000 : 64)
entraîne une suite d’allers et retours, une circularité, de paysage
représenté à paysage « vrai ». Et lorsque ce dernier devient objet de
quête, l’on aura de plus en plus tendance à oublier qu’il a fallu en un
premier temps que le premier, le peint, existe pour que l’on accorde
tant de valeur au second, le vrai.
Le temps passant, cet oubli progressif de la nécessité d’une re-
présentation artistique préalable au donné paysage, causé par le va-et-
vient entre l’image et sa chose, s’enracine si profondément que l’on
finit par assimiler le paysage au territoire. Le paysage correspond dès
lors au lieu, le regard que l’on porte sur celui-ci, ou la « lecture »
(Corbin, 200111) que l’on en fait, demeurant l’élément essentiel pour
que cette réciprocité opère. L’art ne ferait plus alors que figure de
valeur ajoutée, qui vient après, de sorte qu’au bout de la chaîne, il ne
10. Je souligne.
11. « En bref, le paysage est une lecture, indissociable de la personne qui contemple l’espace
considéré » (Corbin, 2001 : 11) et « L’appréciation individuelle peut se référer à une lec-
ture collective » (Corbin, 2001 : 12).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 19 11/12/08 15:03:48
20 Le paysage façonné
serait plus du domaine de la représentation, mais une forme d’inter-
vention dans le milieu, assimilé à l’aménagement.
« Dans l’hypothèse de la transition paysagère, l’histoire du pay-
sage occidental est, dans une large mesure, une histoire du sujet occi-
dental » affirme avec raison Augustin Berque (1990 : 125). Mais, pour
Berque, au dernier stade de ce passage, le sujet doit réintégrer l’objet,
l’objet doit comprendre à nouveau le sujet : ce long intermède qui
s’étend du XVe siècle jusqu’au deuxième tiers du XIXe siècle que serait
la « transition paysagère » débute avec l’invention de la perspective
(moment où s’amorce la distanciation du sujet par rapport à l’objet
« environnement » ou « milieu » ou « nature ») et prend fin avec l’« ins-
titutionnalisation » de la coupure entre « espace naturel » et « espace
humanisé » qui correspond à la fondation du premier parc national,
Yellowstone (Berque, 1990 : 123-124). Cette coupure, le « point de
vue » de la médiance (pour employer les termes mêmes de Berque)
se propose de l’abolir. Le paysage est alors considéré comme la
dimension sensible et symbolique d’un milieu sans cependant qu’on
puisse les dissocier l’un de l’autre, ce qui distingue le « point de vue »
de la médiance de celui du sujet moderne conditionné par la pers-
pective légitime et sa mise à distance de l’objet-paysage. Ce « sens du
milieu » qu’est la médiance se résout donc en d’incessantes « trajec-
tions » (Berque, 1990 : 81) du factuel au sensible, du physique au phé-
noménal, de l’objectif au subjectif et inversement ; le subjectif étant
ici du domaine collectif, non pas individuel.
La médiance s’entend donc comme l’« intégration réciproque
de la réalité sensible et de la réalité factuelle » (Berque, 1990 : 36-37)
ou du phénoménal et du physique. S’il n’était fortement question
d’écologie dans le système d’Augustin Berque, on pourrait n’y voir
qu’un moyen de résoudre, en ré-unissant le sujet et l’objet que la
modernité avait divisés, les incessants allers et retours entre représen-
tation/perception et objet réel que suppose la notion de paysage.
Mais, au terme de la « transition paysagère », le rapport au paysage
qui était d’abord représentation s’inverse et c’est « notre environne-
ment [qui] devient une représentation » (Berque, 1990 : 130). Il faut
alors nommer autrement le paysage, ce que Berque tente de faire en
introduisant le concept d’« outre-pays » dont il accorde une part du
mérite de la création aux artistes du land art : « l’œuvre d’art devenant
environnement, l’art engendre l’outre-pays, ce que traduisent aussi
bien l’apparition de l’art-paysage aux États-Unis dans les années
soixante que la diffusion, contemporaine, du terme paysagement dans
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 20 11/12/08 15:03:48
chapitre 1 • inventions 21
les travaux publics en France » (Berque, 1990 : 13212). Voici qui s’ac-
corde à ce que j’ai avancé plus tôt, soit que l’art et l’aménagement
sont peu à peu identifiés l’un à l’autre lorsque le paysage cesse d’être
l’affaire de la peinture.
Si la théorie (ou le « point de vue ») de la médiance avec tous ses
néologismes est un tant soit peu obscure et que de toutes façons selon
son auteur même, pour le moment « peu de monde y accède »
(Berque, 1990 : 140), elle a par ailleurs l’avantage d’étudier les effets
réciproques des sociétés et des milieux les uns sur les autres :
[…] la société perçoit son milieu en fonction de l’usage qu’elle en fait ;
réciproquement, elle l’utilise en fonction de la perception qu’elle en
a. Des matrices phénoménologiques (les schèmes de perception et
d’interprétation d’un milieu) ne cessent ainsi d’engendrer des em-
preintes physiques (les modes d’aménagement du milieu) ; lesquels, à
leur tour, influencent ces matrices et ainsi de suite (Berque, 1990 : 43-
4413).
Chez John B. Jackson, les interactions société et milieu sont éga-
lement de première importance. En revanche si Augustin Berque, au
même titre que Anne Cauquelin, bâtit sa théorie à partir de la nature
qui serait indissociable de l’idée de paysage – ou dont l’idée de pay-
sage serait indissociable –, John B. Jackson propose une toute autre
conception du paysage, qui à la fois évacue complètement l’antério-
rité de l’art (Berque fait de même14) et pose le paysage comme parfai-
tement artificiel et humanisé. Il faut souligner, et cela sera vérifié plus
loin, que paradoxalement, pour les artistes du dernier tiers du
XXe siècle, la possibilité que le paysage soit autre chose que de la na-
ture revêtira une importance cruciale.
[..] a landscape is not a natural feature of the environment but a
synthetic space, a man-made system of spaces superimposed on the face
of the land, functioning and evolving not according to natural laws but
to serve a community – for the collective character of the landscape is
12. Les italiques sont de l’auteur.
13. Plus simplement posé : « Toute société a besoin de s’adapter au monde qui l’entoure. Pour
ce faire, il lui faut continuellement fabriquer des représentations du milieu au sein duquel
elle vit. Ces représentations collectives permettent de maîtriser l’environnement, de l’or-
donner, de le peupler de symboles de soi, d’en faire le lieu de son bonheur, de sa prospé-
rité et de sa sécurité. » (Corbin, 2001 : 12)
14. « Le point de vue de la médiance, lui, ne reconnaît pas cette précédence [sic]. Pour diffé-
rent du monde physique que soit le paysage, il s’y enracine néanmoins ; et cosmologique-
ment (sinon mésologiquement), le physique précède, sous-tend et enveloppe le phéno-
physique » (Berque, 1990 : 119).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 21 11/12/08 15:03:48
22 Le paysage façonné
one thing that all generations and all points of view have agreed upon
(Jackson, 1997 : 30515).
Le rapport au paysage est donc chez Jackson, comme chez
erque, de l’ordre du collectif (un point de vue partagé? – l’on aura
B
remarqué et l’on remarquera à quel point, justement, il est difficile
de traiter de paysage en excluant la notion de point de vue). Dans
une série de commentaires qui prennent la forme de courts textes
dont les premiers paraissent au début des années 1950, John B. Jack-
son propose le paysage comme une stricte réalité factuelle ou maté-
rielle qui serait du « domaine public », c’est-à-dire de l’espace possé-
dant des composantes culturelles et géomorphologiques distinctives
et dont la principale caractéristique serait d’être au service d’une com-
munauté en ce sens que son évolution et ses transformations seraient
définies par–pour les usages collectifs. N’était-ce de l’importance de
ses aspects culturels ou humanisés, ce que Jackson nomme paysage,
ce pourrait tout aussi bien être le territoire, strictement parlant. Pour
Jackson, le paysage se présente comme un palimpseste, chacune des
strates pouvant donner des indications sur les sociétés qui ont adapté
le territoire à leur usage. Et là où Berque voit, au XXe siècle, le « déla-
brement du paysage grandeur nature sous l’effet de la « rurbanisa-
tion » (Berque, 1990 : 122), Jackson constate les effets inévitables des
modes de vie occidentaux, effets avec lesquels il faut composer.
On ne peut nier qu’à l’époque où Jackson publie ses observa-
tions, avec le développement de l’industrie, avec l’accroissement de
la production et de la consommation, le territoire des pays occiden-
taux subit des modifications radicales sur de courtes périodes de
temps ; corollaire de l’industrie, le transport est certes le facteur de
changement le plus formidable16. À une toute autre échelle que celle
de l’action traditionnelle des occupants sur leur milieu, les liaisons
ferroviaires et routières entre les sites de production des matières pre-
mières et ceux de leur transformation, puis les lieux de consomma-
tion des produits finis, changent complètement l’espace. Une partie
de la marchandise fabriquée, les voitures dites de tourisme, nécessi-
tera d’ailleurs des voies spécifiques à son usage. À commencer par le
train qui transporte choses et gens, bientôt suivi par la prolifération
des routes et l’envahissement des véhicules personnels, les modes de
locomotion rapide modifient l’aspect des continents : les distances à
parcourir semblent plus courtes, il est plus aisé de visiter de nouveaux
15. Les italiques sont de l’auteur.
16. « [The building of roads] is now the most powerful force for the destruction or creation
of landscapes that we have » (Jackson, 1980 : 122).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 22 11/12/08 15:03:49
chapitre 1 • inventions 23
endroits et on peut les voir en plus grand nombre et plus rapide-
ment.
Si l’avènement des transports rapides bouleverse physiquement
le territoire, sa perception, c’est-à-dire la façon d’apprécier les paysa-
ges, en est également modifiée. Les infrastructures routières et tout
ce qui les accompagne, routes et autoroutes mais aussi banlieues,
strips, maisons mobiles, terrains de stationnement et ainsi de suite,
marquent fortement le paysage des États-Unis d’abord, ensuite de
tout l’Occident, pendant que les véhicules eux-mêmes déterminent
une nouvelle position des voyageurs par rapport aux lieux. Une pos-
ture relativement passive et la vue latérale, qui est la vue – mouvante
– par la fenêtre d’un véhicule (Wilson, 1991 : 19-51), caractérisent dé-
sormais l’attitude de ceux qui se déplacent en quête de paysages.
Les débuts de la commercialisation de l’automobile sont mar-
qués par l’enthousiasme pour l’exploration de lieux auparavant diffi-
ciles d’accès et les « plaisirs abstraits du mouvement rapide et relative-
ment sans effort » (Jackson, 1980 : 123) que procure cette nouvelle
mécanique ont pour conséquence directe, selon Jackson, la populari-
sation de sports qui, tels le ski, la descente de rivières, l’escalade,
la motocyclette, impliquent la locomotion. Ces activités sont, dit
Jackson, des manières moins contemplatives et plus directes de
« conquérir » la nature.
As I see it, those who adopted those sports did so because they had had
enough of contemplation, and of the old sublimities which a century
of poets and painters and musicians had interpreted over and over
again (Jackson, 1997 : 20317).
Il ne s’agit pas de découvrir de nouveaux paysages, mais de les
ressentir autrement. John B. Jackson suppose ainsi qu’avec le déve-
loppement de ces pratiques, les façons anciennes d’appréhender les
lieux, y compris la « perspective traditionnelle », sont vouées à l’obso-
lescence, remplacées par des comportements novateurs18, qui éven-
tuellement entraînent des changements d’attitudes, des développe-
ments culturels inédits au regard du paysage. Mais, cela n’équivaut-il
pas simplement à participer au spectacle au lieu d’uniquement y assis-
ter? John Urry souligne d’ailleurs que ces nouveaux comportements,
qu’il assimile à un certain tourisme « d’aventure », se résument à se
17. Voir également Corbin (2001 : 27-28).
18. « […] the traditional perspective, the traditional way of seeing and experiencing the world
is abandoned » (Jackson, 1997 : 205).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 23 11/12/08 15:03:49
24 Le paysage façonné
rendre sur des lieux visuellement distincts pour y pratiquer des activités
plus physiques (2002 : 155).
Néanmoins, même à « l’âge de la vitesse » selon les termes de
Jackson, ces pratiques demeurent marginales. Le paysage, massive-
ment, est surtout « éprouvé » par la fenêtre des véhicules motorisés,
ce nouveau cadre. Et le point de vue, s’il est devenu « mouvant », n’en
est pas moins le lieu du sujet et n’est finalement qu’actualisé en une
succession de perspectives fixes rapidement modifiées dans le temps.
De plus, le long de la route, les « points de vue » (outlooks qui veut
aussi dire façon de voir), attendus, se multiplient et signalent tout ce
qu’il y aurait à voir19. On s’y arrête et reprenant la position fixe et fron-
tale, on absorbe le tableau : « pour documenter un voyage, la méthode
usuelle du touriste est la recherche assidue et la prise photographi-
que des vues pittoresques, pas trop loin de l’autoroute » (Jussim et
Lindquist-Cock, 1985 : 106). Le voyageur, dit-on, est grand consom-
mateur de paysage.
Quelle que soit la manière de l’envisager (de le qualifier ?), re-
présentation et perception chez Cauquelin, intégration réciproque
de l’écologique et du symbolique de Berque ou stricte matérialité –
qui s’accompagne pourtant nécessairement de perception – pour
Jackson, « l’expérience du paysage » reste de l’ordre du visuel, à tout
le moins pour la majorité. D’accord en cela avec Anne Cauquelin
pour qui le paysage « n’est pas un lieu » (1990 : 92-96), je soutiens
qu’il est de l’ordre du perspectif/perceptif, élaboré à partir du point
de vue (du sujet) qui le met à distance et le rassemble. Ce qui n’em-
pêche toutefois pas le territoire d’être modifié par les usages, par
l’activité humaine, ce que décrit fort bien John B. Jackson.
Au XVIIIe siècle déjà, le voyageur-sujet du Grand Tour se posait
généralement comme un spectateur immobile, progressant d’un
moment de contemplation statique à un autre. Au XXe siècle, c’est
toujours de la vision perspective que naît le paysage, d’un regard qui
est ordinairement filtré par « des verres fumés et le viseur d’une
caméra » (Graburn, 1989 : 35), objets qui seraient possiblement les
versions contemporaines du Claude glass. Et si ce sont encore des ima-
ges qui appellent au déplacement, elles seront désormais photogra-
phiques.
19. « Sous-produit de la consommation des marchandises, la circulation humaine considérée
comme consommation, le tourisme, se ramène fondamentalement au loisir d’aller voir ce
qui est devenu banal. L’aménagement économique de la fréquentation de lieux différents
est déjà par lui-même la garantie de leur équivalence » (Debord, 2001 : 164). Les italiques
sont de l’auteur.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 24 11/12/08 15:03:49
chapitre 1 • inventions 25
1.1 SCENIC OUTLOOK, GREAT NORTHERN HIGHWAY
Photographie : Suzanne Paquet, 2003
LA PHOTOGRAPHIE
La perspectiva artificialis, ayant atteint son niveau de finitude, de-
venue un fait stable, continue d’agir à travers les siècles : « aujourd’hui
encore, notre culture est massivement informée par le modèle pers-
pectif, et beaucoup plus profondément sans doute que ne l’aura été
celle de la Renaissance » (Damisch, 1993 : 110). Que la vision contem-
poraine soit encore et toujours réglée en point de vue, cadre et liaison
est l’un des témoignages de cette persistance.
La photographie tire sa première légitimité de sa capacité d’imi-
tation de la nature encore plus parfaite que celle de la peinture. C’est
ainsi que l’on a pu supposer la photographie apte à supplanter la
peinture, au moment même où celle-ci commence à s’éloigner de
l’imitation du réel, au XIXe siècle. Je n’épiloguerai pas sur cet épiso-
de, coïncidence ou évidence… d’autres l’ont fait et là n’est pas mon
propos. Constatons simplement que la construction perspective,
parce qu’elle est désormais une généralité incluse dans le rapport
occidental au monde, peut être reprise et utilisée ailleurs qu’en pein-
ture, de façon que soit reconduite cette vision qui est née avec elle. Le
dispositif photographique répond admirablement aux règles de la
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 25 11/12/08 15:03:50
26 Le paysage façonné
perspective centrale, comme à sa suite le cinéma, la vidéo et aussi,
d’une certaine façon l’image numérique20.
C’est par le moyen de la camera obscura que la photographie
reprend à son compte la projection perspective. Les peintres (après
les scientifiques pour qui elle fait office d’observatoire) font usage de
cette chambre noire depuis le XVIe siècle, moment où l’on a rem-
placé le sténopé, la petite ouverture qui admet la lumière dans la
chambre, par une lentille. Le sténopé, ou la lentille, fait converger les
rayons lumineux qui ensuite divergent vers un plan, au fond de la
camera obscura, traçant en quelque sorte automatiquement une vue en
perspective. L’appareil photo conserve ces caractéristiques en les
améliorant. Et sa lentille, cet objectif « dont on a soigneusement
corrigé les « aberrations » et redressé les « erreurs », cet objectif ne
l’est point tant qu’il paraît » (Damisch, 2001 : 10), en ce qu’il reprend
terme à terme la formule de synthèse de l’espace connue depuis le
XIVe siècle et usitée depuis le XVe siècle. L’objectif est cet œil unique,
le point de vue de la perspective centrale. De là, les rayons lumineux
sont projetés sur une surface plane au cadre bien délimité. Tous les
éléments sont rassemblés pour reconduire le « paradigme perspectif »
(Damisch, 1993 : 17), le modèle, ou l’image du monde, inventé par la
perspective des peintres dont, au XIXe siècle, on ne remet plus en
question plus la vraisemblance ni l’autorité. La société de l’époque,
toute imprégnée qu’elle est dudit paradigme et avide de nouvelles
découvertes techniques et d’innovations scientifiques, ne peut que
recevoir avec bonheur ce nouveau mode d’enregistrement des choses.
Car la véritable innovation du dispositif photographique est son pro-
cédé physico-chimique qui permet d’enregistrer et de fixer de façon
durable la projection lumineuse qui se dépose au fond de la camera
obscura ; ce procédé qui, comme le déclare Jacques Louis Mandé
Daguerre (1839), « consiste dans la reproduction spontanée des ima-
ges de la nature ». Si déjà grâce au modèle perspectif on ne met plus
en doute la vérité de la nature en peinture, avec la photographie et sa
capacité d’enregistrement la médiation se fait encore plus transpa-
rente. Tous les sujets et les objets du monde pourront être représen-
tés (ou reproduits) sans que l’on mette en question la véracité de leur
existence. Les images circulent, leur réalité est si saisissante que l’on
croit voir la chose elle-même :
20. Pour cette dernière technologie, le procédé d’enregistrement est différent (n’étant pas
analogique) cependant que le produit, qui reconduit souvent la profondeur illusoire du
système perspectif est parfaitement similaire à celui rendu par les techniques précéden-
tes.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 26 11/12/08 15:03:50
chapitre 1 • inventions 27
Si la photographie est considérée comme un enregistrement parfaite-
ment réaliste et objectif du monde visible, c’est qu’on lui a assigné (dès
l’origine) des usages sociaux tenus pour « réalistes » et « objectifs ». Et
si elle s’est immédiatement proposée avec les apparences d’un « lan-
gage sans code ni syntaxe », bref d’un « langage naturel », c’est avant
tout que la sélection qu’elle opère dans le monde visible est tout à fait
conforme dans sa logique, à la représentation du monde qui s’est im-
posée en Europe depuis le Quattrocento (Bourdieu, 1965 : 109).
Svetlana Alpers soutient que la photographie ne dériverait pas
de l’invention italienne du modèle perspectif au XVe siècle. Elle serait
plutôt en continuité avec le « mode descriptif » des peintres néerlan-
dais du XVIIe siècle et partagerait les mêmes caractéristiques : frag-
mentation, cadrage arbitraire, immédiateté. Elle serait donc, à l’ins-
tar de son modèle historique, le mode descriptif, « une riche alliance
du voir, du comprendre et du peindre ». « L’image photographique
peut, au même titre que la peinture hollandaise, imiter le mode
albertien. Mais les conditions de son élaboration la placent dans un
mode que j’appelle keplérien – ou, pour user d’un terme moderne,
parmi les signes indiciels décrits par Peirce » (Alpers, 1983 : 43-44).
Ernst Gombrich observe les mêmes différences entre les manières du
Nord (mode descriptif) et celles du Sud (mode perspectif). Toutefois
il rattache, au lieu de les opposer, les pratiques néerlandaises et ita-
liennes en termes d’échanges d’une région à l’autre, ce qui aurait
permis à la perspective de passer du Sud au Nord. Et c’est précisé-
ment selon Gombrich, ce passage qui aurait donné naissance au
« genre » pictural « paysage » (1978 : 109-110). Quoi qu’il en soit (et
certains des arguments d’Alpers étant discutables – en particulier
l’idée de cadrage « arbitraire » appliquée à la photographie), il me
semble erroné de réfuter la conformité du dispositif photographique
au modèle albertien. Je suggère plutôt que mode perspectif et qualité
indicielle21 peuvent agir de concert, ce qui avait été compris il y a bien
longtemps :
Monsieur Daguerre est parvenu à fixer les images de la chambre obs-
cure et à créer ainsi, en quatre ou cinq minutes, par la puissance de la
lumière, des dessins où les objets conservent mathématiquement leurs
formes jusque dans leurs plus petits détails, où les effets de la perspec-
21. Sur la qualité indicielle de la photographie, on peut consulter Rosalind Krauss, (1993 : 63-
91). « Par index j’entends ce type de signe qui émerge comme la manifestation physique
d’une cause dont participent les traces et les empreintes. » (Krauss, 1993 : 79) Krauss
s’appuie sur les travaux de Charles Saunders Peirce : « L’action des indices dépend de
l’association par contiguïté et non de l’association par ressemblance ou d’opérations intel-
lectuelles », cité par R. Krauss (1993 : 65).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 27 11/12/08 15:03:51
28 Le paysage façonné
tive linéaire, et la dégradation des tons provenant de la perspective
aérienne, sont accusés avec une délicatesse inconnue jusqu’ici (Cham-
bre des députés, deuxième session 1839, exposé des motifs et projet de loi par le
Ministre de l’intérieur, cité dans Daguerre, 1839 : 1).
En effet, sa qualité d’empreinte lumineuse produite par le pro-
cédé physico-chimique ne vient que renforcer l’authenticité de la pho-
tographie. Depuis son « invention », aidée en cela par ses promoteurs
et par la croyance en son aspect scientifique parce que mécanique,
une photographie n’est en général nullement détachée de « ce qu’elle
représente22 ». Au XIXe siècle, les déclarations et témoignages à cet
effet ne manquent pas, la photographie révélant « l’absolue vérité, la
plus parfaite identité d’aspect avec la chose représentée » (Poe,
1840 : 38). Il est ici question, et il faut y insister, de la réception com-
mune des images photographiques de tous genres, de celles que l’on
voit (ou que l’on ne voit plus à force d’en voir) partout et en tout
temps, pratiquement depuis le moment où « une folie, un fanatisme
extraordinaire s’empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil »
et que « la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour
contempler sa triviale image sur le métal » du daguerréotype23.
S’agissant des représentations photographiques de paysages
tout particulièrement, on remet encore rarement en question leur
aspect construit. Elles font partie des allers de soi, le « signifiant étant
subordonné au signifié » comme le dit Pierre Bourdieu (1965 : 123).
Par effet de va-et-vient on passe à travers cette empreinte du réel
qu’est la photographie, vers l’objet lui-même, le paysage, comme on
passe en retour, de l’objet-paysage à son image sans intellection claire
de l’aspect médiat de cette dernière. Il y a coïncidence (ou agglutina-
tion) entre l’image et ce qu’elle dépeint. Et quoi qu’en disent les
auteurs qui voudraient que l’expérience du paysage change à partir
de la fin du XIXe siècle – la fin de la « transition paysagère » d’après
Berque ou « la perspective traditionnelle abandonnée » selon Jackson
–, on ne peut ignorer qu’avec l’avènement de la photographie un
double filtre culturel qui opère par transparence est à l’œuvre, et cet état
de fait perdurera pendant plus d’un siècle et demi. On l’a vu avec le
paysage peint depuis le XVIe siècle, déjà la « forme culturelle » appe-
lée paysage est « remplie par un contenu qui y adhère » (Cauquelin,
22. «…ou du moins elle ne s’en dissocie pas tout de suite ou pour tout le monde » (Barthes,
1980 : 16).
23. Charles Baudelaire (1961 : 1034). « Baudelaire’s attack on photography is really an attack
on the emergence of the commodities of popular culture and the increasing importance
of a growing taste for – in his words, the “purely material developments of culture” »
(Snyder, 1994 : 181).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 28 11/12/08 15:03:51
chapitre 1 • inventions 29
2000 : 106), ce qui rend interchangeables lieu et paysage. La photo-
graphie ne vient qu’accentuer, ou redoubler, cette réciprocité :
«[q]uoi qu’elle donne à voir et quelle que soit sa manière, une photo
est toujours invisible : ce n’est pas elle qu’on voit » (Barthes, 1980 : 18).
Et, en un mouvement semblable à celui provoqué par la peinture,
l’on ira sur un site, ajuster sa vision à l’image déjà connue. N’existe
plus alors que le paysage vrai, l’image photographique dans son
authenticité n’en est plus qu’un équivalent rapetissé et portable. De
même que le voyage devient le mode privilégié d’appréciation du
paysage, l’image photographique et l’appareil photo, encore plus
que la peinture, seront ses attributs.
La photographie est rapidement popularisée par la diffusion
massive des stéréogrammes peu coûteux qui font l’objet de collec-
tions très appréciées24. Les nouvelles images photographiques, une
fois fixées, sont peu encombrantes, quoique le dispositif qui permet
de les réaliser le soit encore dans les quelques années qui suivent im-
médiatement sa mise au point. Les images peuvent voyager et l’on
peut donc admirer à distance des merveilles lointaines. Les motifs les
plus prisés par les collectionneurs de stéréogrammes sont les monu-
ments (généralement architecturaux en Europe et naturels – Natural
Monuments – en Amérique) ainsi que les sites qui correspondent aux
catégories du sublime et du pittoresque, motifs déjà recherchés par
les adeptes du Grand Tour.
De plus, parce que son produit est un « double » mécanique de
la réalité et qu’elle ne requiert pas d’habileté manuelle particulière25,
la photographie devient, peu d’années après son invention, d’usage
courant partout et par tous. Les moyens techniques étant prompte-
ment améliorés en cette époque industrielle, George Eastman arrive
dès 1888 à miniaturiser l’appareil photo au point de fabriquer le pre-
mier Kodak au maniement facile et à prix raisonnable26. Quelques
décennies seulement après que Daguerre et Arago en aient exposé
les avantages, la photographie s’installe déjà en Occident comme « le
support diffus et omniprésent de la réalité en tant que telle, sa preuve »
24. Ce phénomène est examiné dans la section suivante.
25. « Le daguerréotype ne comporte pas une seule manipulation qui ne soit à la portée de tout
le monde ; il ne suppose aucune connaissance du dessin, il n’exige aucune dextérité ma-
nuelle. En se conformant point par point à des prescriptions très-simples et très-peu nom-
breuses, il n’est personne qui ne doive réussir certainement et aussi bien que M. Daguerre
lui-même. » (Arago, 1839 : 17)
26. Et, selon Bruno Latour : « Le photographe amateur et l’appareil Kodak sont inventés,
construits, définis en même temps. » (1995 : 278)
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 29 11/12/08 15:03:51
30 Le paysage façonné
(Lamarche-Vadel, 1993 : 1927) : des images produites en grand nom-
bre et massivement diffusées font connaître le monde jusque dans ses
recoins les plus retirés et ainsi, « non avec leurs couleurs mais avec
une grande finesse de dégradation de teintes » (Daguerre, 1839), des
choses éloignées et jusqu’alors inaccessibles entrent dans le quoti-
dien de chacun, tandis que l’on commence à documenter son propre
monde et la moindre de ses possessions.
À la fin du XIXe siècle, pendant que d’aucuns – et c’est l’amorce
d’une longue bataille – essaient de prouver que la photographie peut
être aussi artistique, commence à s’établir une sorte d’esthétique
populaire liée à la photographie, esthétique fondée, d’une part, sur
les tirages commerciaux largement diffusés et collectionnés et,
d’autre part, sur les images que l’on fait soi-même. Dorénavant, au
regard du paysage, chacun peut opérer ses propres conquêtes et sur-
tout en montrer les témoignages. S’il y a un point de vue que l’on par-
tage, c’est bien celui de la photographie. Joel Snyder constate que la
photographie de paysage au XIXe siècle est comprise comme une vue
enregistrée (recorded sight) en ce sens que si n’importe qui se rendait
sur les lieux reproduits dans la photographie, la vue serait là, disponi-
ble et telle qu’en elle-même28.
Mais, il y a petites conquêtes et grandes conquêtes, petites et
grandes collections. La deuxième moitié du XIXe siècle est aussi le
moment des grands inventaires photographiques.
Si l’objectif du dispositif photographique rend, de façon méca-
nique, le point de vue de la construction perspective, s’y additionne
le point de vue de qui opère la mécanique en question. Dans le cas de
la photographie commerciale ou personnelle, il s’agit de rendre
attrayant (vendable, la vue comme le site lui-même) ou conforme
(dans l’optique d’une esthétique populaire, la preuve que l’on a vu,
comme il le faut, ce qui doit être vu : le témoignage de petites conquê-
tes), ce qui a été saisi par l’objectif. En revanche, pour les inventaires
ou les missions photographiques, il y aura interférence idéologique :
le point de vue sera, de préférence, celui de qui commande l’image à
exécuter : « Le statut de technologie [de la photographie] varie selon
les relations de pouvoir qui l’investissent. Sa nature comme pratique
dépend des institutions et des agents qui la définissent et la mettent
au travail » (Tagg, 1988 : 63).
27. Je souligne.
28. « The assumption is that photographs stand in a special relation to vision, but vision
detached from any particular viewer. It is a distributed vision, one that transcends
individual subjectivity and, accordingly, individual interest. » (Snyder, 1994 : 183)
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 30 11/12/08 15:03:51
chapitre 1 • inventions 31
Parce qu’il offre la possibilité d’enregistrer « scientifiquement »
et systématiquement choses et lieux et d’ainsi les classifier, bref d’or-
donner le monde, le procédé photographique arrive à un moment
particulièrement bien choisi pour répondre à la passion moderne
pour la possession, la collection, la classification. Et avant même
qu’elle ne devienne facile de manipulation, la photographie est em-
ployée pour diverses stratégies institutionnelles, gouvernementales et
impériales : classification et mise en archives et en collections, mais
aussi contrôle territorial.
What gave photography its power to evoke a truth was not only the
privilege attached to mechanical means in industrial societies, but also
its mobilization within the emerging apparatuses of a new and more
penetrating form of the state (Tagg, 1988 : 61).
Sites et monuments sont inventoriés à des fins de restaurations
(Inventaire de la Commission des Monuments Historiques de France,
1851). À l’intérieur de certains pays, on effectue des relevés photo-
graphiques dans le cadre de recherches topographiques et géolo
giques (aux États-Unis : Fortieth Parallel Survey, 1868-1869, 1870 et
1872 ; F. V. Hayden Survey, 1870-1878 ; One Hundredt Meridian Survey,
1871, 1873, 1874 ; au Canada : Assiniboine and Saskatchewan Exploring
Expeditions, 1858 ; entre autres). La photographie est aussi utile pour
des campagnes de promotion et de propagande orchestrées par l’État
et par son appareil institutionnel. Des événements comme les guerres
de Crimée (Fenton, 1853-1855) et de Sécession (Gardner, Russell,
O’Sullivan, 1861-1864) et de grandes épopées telle la construction du
chemin de fer est-ouest aux États-Unis (Union Pacific Railroad, 1866)
sont soigneusement documentés, aussi bien par des commerçants –
que l’on associerait aujourd’hui à des « agences » de photographie –
que par l’armée et les gouvernements, au service de visions politiques
nationales et expansionnistes. Les terres conquises et leurs richesses,
naturelles et archéologiques, font l’objet de répertoires photographi-
ques commandés par les puissances coloniales (Égypte, Nubie, Palestine
et Syrie : dessins photographiques recueillis pendant les années 1849, 1850 et
1851, accompagnés et précédés d’une introduction de Maxime Du Camp,
chargé d’une mission archéologique en Orient par le ministère de l’Instruction
publique ; Photographic Surveys by the Royal Engineers in the Holy Land,
1864-1868 ; etc.). Des images sont ramenées de la périphérie conquise
vers le centre, la métropole, aux mêmes fins que des objets haute-
ment symboliques, les obélisques par exemple, y ont été déplacés.
Simultanément, des entreprises commerciales envoient des photo-
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 31 11/12/08 15:03:52
32 Le paysage façonné
graphes en mission pour inventorier les sites et les monuments les
plus célèbres. Les photographies ainsi exécutées sont rassemblées en
des albums reliés (N. M. P. Lerebours, Excursions daguerréennes : Vues et
monuments les plus remarquables, 1841) ou en des séries de vues stéréo
scopiques (William England et London Stereoscopic Company,
America in the Stereoscope, 1859) que l’on offrira aux voyageurs, à ceux
qui partent en reconnaissance comme à ceux qui préfèrent ne voya-
ger qu’en imagination, les armchair travellers. Moyen de découverte du
monde pour les uns ou de démonstration de leur puissance et de
l’envergure de leur empire pour les autres, la photographie dès 1840,
est l’instrument par excellence des conquêtes, petites et grandes. Elle
contribue également à renforcer la symbolique identitaire déjà impli-
cite au paysage sous sa forme picturale : « L’on supposait que l’envi-
ronnement physique formait le caractère de ses habitants et donc, les
paysages et les images de paysages étaient fréquemment vus comme
l’essence d’un caractère national. » (Jäger, 2003 : 11829)
Les photographies produites pendant les années 1860 et 1870
pour les Geographical et les Geological Surveys à l’ouest des États-Unis
ont d’abord des buts d’exploration scientifique. Elles concourent
également à témoigner de nouvelles emprises sur le territoire et à
former une conscience territoriale spécifiquement états-unienne en
révélant des paysages étroitement liés aux aspirations nationales, à sa
Manifest Destiny30, en multipliant les images de vastes étendues sauva-
ges et indomptées (le wilderness) que l’Amérique apprécie résolu-
ment. Simon Schama signale que les images photographiques de
Yosemite par Watkins – publiées par le California State Geological Survey
de Josiah D. Whitney, mais aussi à titre personnel par Watkins (Naef
et Wood, 1975 : 51) – ont participé à former le goût des Américains
pour les grands arbres (Schama, 1996 : 190-195). On a dit aussi – et j’y
reviendrai – que ce sont les travaux de Watkins, de O’Sullivan, de
Muybridge qui ont fait de certains parcs nationaux de puissants sym-
boles pour la nation américaine, posant l’importance de son héritage
naturel comme particularité identitaire. Un héritage pourtant usurpé
29. ������������������������������������������������������������������������������������������
Aussi : « At a minimum we need to explore the possibility that the representation of land-
scape is not only a matter of internal politics and national or class ideology but also an
international global phenomenon, intimately bound up with discourses of imperialism . »
(Mitchell, 1994b : 9)
30. Le territoire de l’ouest des États-Unis, représenté sous forme de paysages grandioses, sera
considéré comme un signe de la destinée, elle aussi grandiose, de la nation américaine qui
aura pour tâche de le maîtriser. L’un des tenants de cette théorie est William Gilpin,
premier gouverneur du Colorado, qui fait paraître en 1873 The Mission of North American
People : Geographical, Social and Political. Sur le rôle des images et du chemin de fer au regard
de cette notion de Manifest Destiny, on peut consulter Daniels (1999 : 180-196).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 32 11/12/08 15:03:52
chapitre 1 • inventions 33
par des avancées expansionnistes achevées au détriment des premiers
occupants.
*
Depuis la Renaissance, diverses innovations dont la perspective
des peintres, la camera obscura, et aussi l’imprimerie, informent le
« sentiment spécifiquement moderne de l’espace ou, si l’on préfère,
du monde » (Panofsky, 1975 : 54) de l’individu occidental, de ce sujet
que Marshall McLuhan appellera « l’homme typographique » :
l’espace se conçoit comme un tout unifié, appréhendé à partir d’un
point de vue fixe, « de là où je me tiens » (« from where I am sitting »
(McLuhan, 2002 : 112)), cette saisie étant fondée sur l’homogénéité,
la linéarité et l’uniformité. La reproductibilité est un autre terme
essentiel de cette « grammaire logique de relations spatiales »
(McLuhan, 2002 : 126) que domine le sens de la vue. L’imprimerie,
très tôt, présente ce caractère de reproductibilité. Elle s’affirme dès le
XVIe siècle, selon McLuhan, comme la première production de
masse, c’est-à-dire le premier produit qui peut être reproduit de façon
uniforme par la première chaîne de montage. La photographie qui
participe de la même « grammaire logique » n’apparaît qu’au
XIXe siècle, mais en très peu d’années après sa « découverte », elle
devient aussi un produit de consommation de masse.
Déjà, au XIXe siècle, l’abondance des images photographiques
et leur propagation laissent présager d’une culture photographique
dont la structure est certes dérivée du « paradigme perspectif ». Autre
marque de cette autorité grandissante, la manière d’appréhender
certains lieux et la possibilité de les voir comme des paysages passeront
bientôt par la photographie. Le désert est l’un de ces paysages « in-
ventés » grâce à la photographie.
LE DÉSERT
Le paysage désertique occidental, s’il apparaît grâce à la photo-
graphie, reste toutefois un paysage qui hésite, un terrain vague en
quelque sorte. Je m’intéresserai ici à son émergence car il y a, et cette
hésitation en est une, de nombreuses similarités entre le désert et les
territoires postindustriels. Ce point sera détaillé plus loin, de même
que la façon dont le désert lui-même fait, à l’ère postindustrielle, l’ob-
jet d’une grande attention chez les artistes – à tout le moins chez ceux
dont les travaux sont ici examinés.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 33 11/12/08 15:03:52
34 Le paysage façonné
Le désert de l’Ouest des États-Unis est un paysage d’invention
relativement récente. L’image que l’on en a aujourd’hui émerge dans
la première moitié du XXe siècle avec, entre autres facteurs, la prise
en charge par les institutions artistiques des photographies réalisées
par Timothy O’Sullivan au XIXe siècle. O’Sullivan, qui travaille avec
les expéditions de Clarence King (Geological Explorations of the Fortieth
Parallel) et pour celles de George Wheeler (One Hundredth Meridian
Surveys) en Californie, au Nevada, en Arizona, au Nouveau-Mexique
et en Utah, est à peu de choses près le seul opérateur de l’époque qui
photographie le désert.
Les zones désertiques d’Afrique et d’Asie ont été reconnues
comme des paysages par les Occidentaux avant même que n’appa-
raissent les déserts situés sur leurs propres continents, l’Amérique et
l’Océanie. Les déserts de l’Ancien Monde, grâce aux trois grandes
religions monothéistes, le Judaïsme, l’Islam et le Christianisme, sont
vite réputés être des lieux mystiques ou des lieux de mysticisme et les
textes sacrés de ces religions y font abondamment référence. Mais,
avant que de devenir « objet de regard, spectacle, motif de poésie,
littérature ou image » (Dagron et Kacimi, 1992 : 11), bref des paysa-
ges, ce sont des lieux d’épouvante. Dès l’Antiquité, de nombreux
moines et autres ermites venus d’Europe les parcourent, parfois s’y
fixent. Puis au XVIIIe siècle les déserts orientaux, en particulier le
Sahara, sont re-découverts, cette fois par les puissances coloniales, les
empires français et britannique qui les convoitent afin d’en exploiter
les richesses. Car tous les déserts, ceux de l’Ancien Monde comme
ceux du Nouveau Monde, sont riches en minerais.
L’apparition du désert états-unien est aussi une histoire de
conquête, l’histoire d’une sorte d’impérialisme de l’intérieur, celui
de la frontière que l’on repousse vers l’Ouest pour deux motifs princi-
paux : le passage des colons et la recherche de richesses minérales. Au
XIXe siècle, en période d’expansion industrielle, on explore les terres
arides de l’Ouest et on en effectue le relevé au profit du gouverne-
ment central. Puis, s’y installent non pas des colons mais des cher-
cheurs d’or et des mineurs31. Le territoire est considéré uniquement
pour ses métaux précieux, car la vie y est difficile. Le désert reste
longtemps un lieu maudit, où souvent les colons en route vers la
Californie laissent leur bétail et leurs biens, si ce n’est leur vie.
La plupart des grands surveys commandés par l’État tout au long
du XIXe siècle (et avant, en ce qui concerne les zones plus à l’Est) ont
31. À ce sujet on peut consulter l’amusant compte rendu de Twain (1913).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 34 11/12/08 15:03:52
chapitre 1 • inventions 35
pour objectif de quadriller le territoire, de le subdiviser en lots pour
l’établissement de nouveaux occupants qui arrivent de l’Est. Certains
ont également pour but de trouver des passages qui permettraient de
relier par chemin de fer la côte ouest au reste du pays en évitant les
zones trop arides et leur dangereuse traversée. Les surveys examinés
ici visent plus particulièrement à répertorier les richesses minérales
– les missions géologiques – et aussi à acquérir une meilleure connais-
sance de territoires jusque-là relativement inexplorés – les surveys
géographiques32.
À partir de 1859, nombre de photographes visitent l’Ouest des
États-Unis, dont William H. Jackson, Carleton E. Watkins, Edweard
J. Muybridge et Timothy H. O’Sullivan. Les premiers paysages qu’ils
photographient sont des sites grandioses, tels Yosemite (où Watkins
se rend dès 1861), qui deviennent des lieux emblématiques, autant
de richesses symboliques pour le peuple états-unien : en 1864 Yosemi-
te est déclaré zone réservée au « loisir public » alors que Yellowstone
est consacré Parc National en 1872, « un acte apparemment influencé
par les photographies de Jackson » (Naef et Wood, 1975 : 7833). Ces
sites font en un premier temps l’objet de missions photographiques,
pour lesquelles les photographes réalisent des images de grand format
dont les chefs de missions disposent à leur guise. Les photographes y
retournent ensuite volontiers pour exécuter des stéréogrammes,
images doubles à regarder avec un appareil conçu pour donner une
impression de profondeur, très en vogue dans les années 1860 et
1870. C’est grâce à ces stéréogrammes produits et reproduits en quan-
tité que l’image des majestueux sites de l’Ouest sera connue jusque
dans l’Est et en Europe. Ces photographies ont la faveur populaire et
sont collectionnées par plusieurs.
By 1875 viewing landscape photographs had become a national pasti-
me […]. The stereograph rose to phenomenal popularity, providing a
market for the work of countless photographers (Naef et Wood,
1975 : 73).
Comme tous ses collègues, Timothy O’Sullivan fabrique à la fois
des tirages grand format (mammoth plates et imperial plates) et des
32. The conjunction of “pure” science and imperial economic enterprise (Trachtenberg,
1989 : 289).
33. Il semble que les images de Watkins auraient également influé sur la décision concernant
Yosemite : « When Congress passed legislation ceding Yosemite to the State of California as
a preserve in 1864, it established a precedent for all of the national parks that followed. As
Watkins’s biographer Peter Palmquist notes, the Watkins photographs, widely exhibited
and circulated in Washington clearly influenced the vote in favor of the wilderness pre-
serve. » (Loeffler, 1992 : 2) Pour une interprétation plus nuancée, on pourra consulter Nye
(2003 : 82).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 35 11/12/08 15:03:53
36 Le paysage façonné
stéréogrammes, ces derniers distribués à des fins promotionnelles
par les responsables de missions. Cependant, très peu d’images du
désert sont ainsi diffusées. Seules quelques merveilles géologiques
telles le Canyon de Chelly font concurrence aux paysages plus conven-
tionnels et plus avenants de montagnes, de forêts, de lacs et de riviè-
res.
1.2 TIMOTHY O’SULLIVAN, EXPEDITION OF 1873,
EXPLORERS COLUMN, CANYON DE CHELLE, ARIZONA, 1873
Stéréogramme. National Archives (USA) : Surveys West of the 100th Meridian
(Wheeler Expeditions), photographie no 077-07-002
Les stéréogrammes peu coûteux ont, à l’époque, le rôle que
tiennent aujourd’hui les magazines de tourisme, c’est-à-dire qu’ils
font découvrir au plus grand nombre des lieux de beauté, sublimes
ou pittoresques, dans une tradition paysagère déjà installée en Amé-
rique.
The typical American notion of landscape was on the grand scale, not
in acres to be measured, but in hundreds of square miles. Expansive-
ness, melodrama, and above all the sensation of open space, the idea
of a physical frontier that knew no bounds, were the expectations not
only of the landscape painters like Frederic Church, Albert Bierstadt
and Thomas Moran, but of photographers like Carleton Watkins,
Edweard Muybridge and their ideological descendants, like Ansel
Adams (Jussim et Lindquist-Cock, 1985 : 6).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 36 11/12/08 15:03:53
chapitre 1 • inventions 37
Les stéréogrammes produits dans l’Ouest, tout en étant en par-
faite conformité avec cette tradition paysagère, proposent aussi une
expérience particulière, la sensation d’être véritablement transporté en
des lieux distants (Schwartz, 1996 : 20). De fait, « l’espace stéréosco
pique est un espace perspectif qui aurait été rendu plus puissant encore »
(Krauss, 1990 : 42), l’appareil permettant de voir les images « en pro-
fondeur » et recréant, selon Rosalind Krauss, un panorama à la ma-
nière dont on l’appréhende physiquement :
Ce sont en quelque sorte des représentations – mais à une échelle très
réduite – de ce qui se passe lorsqu’un large panorama s’ouvre devant
soi. Le réajustement des yeux d’un plan à un autre qui se produit
effectivement dans le champ stéréoscopique correspond à une repré-
sentation par un organe du corps de ce qu’un autre organe, les pieds,
ferait en traversant l’espace réel (Krauss, 1990 : 42-43).
Rosalind Krauss expose de façon détaillée en quoi les stéréo-
grammes de Timothy O’Sullivan reprennent terme à terme les règles
de la perspective centrale, pour laisser la nature s’exprimer fortement
à travers une technique dont le regardeur oublierait qu’elle est une
médiation. Si c’est par la volonté de son opérateur même que l’inter-
médiaire, le dispositif photographique, est rendu à ce point indécela-
ble, il est évident que l’artiste a ici peu de place. Krauss oppose en
effet vues et paysages afin d’établir que la photographie « de paysage »
telle qu’elle est pratiquée au XIXe siècle n’a rien à voir avec l’art, que
ce sont l’histoire de l’art et ses institutions – particulièrement les
musées – qui lui auraient conféré ce nouveau statut, par une ré-
appropriation tardive (1990 : 37 et 45-46). Selon elle, cette photogra-
phie ne répond pas aux critères qui font d’une image un paysage :
elle relie son concept de vue à une représentation du monde plus
topographique que paysagère (qu’artistique, donc). Lorsqu’il s’agit
des épreuves de grand format réalisées pour les surveys, cette analyse
se vérifie. Mais, l’histoire de l’art tend à ne pas dissocier ces mammoth
plates et ces imperial plates des stéréogrammes, alors que les motifs de
leur production, leurs destinations, leurs modes de diffusion et les
modalités de leur réception devraient contribuer à les distinguer.
Les stéréogrammes exécutés dans le cadre des surveys servent à
promouvoir la nécessité de l’expansion territoriale et à intégrer
l’Ouest à la destinée et à l’identité américaine, raison pour laquelle
ils sont largement diffusés auprès de la population. Quant aux stéréo-
grammes produits par des entreprises privées, ils s’adressent aux
voyageurs et remplissent cette « fonction publicitaire » propre aux
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 37 11/12/08 15:03:54
38 Le paysage façonné
r eprésentations paysagères34. Ces stéréogrammes ne sont toutefois
pas appréciés parce qu’ils sont l’œuvre d’individus particuliers,
contrairement à l’engouement du XVIIIe siècle pour le style distinctif
d’artistes tels Salvator Rosa ou Claude Le Lorrain. Les droits des ima-
ges stéréographiques sont généralement détenus par ceux qui les
commandent, les institutions gouvernementales entre autres, ou par
ceux qui les commercialisent sous leur nom, qui n’est pas celui du
photographe, mais bien celui de compagnies spécialisées dans la pro-
duction et la diffusion de photographies en tous genres. S’il s’agit de
vues c’est donc plutôt au sens de recorded sights tel que l’entend Joel
Snyder, c’est-à-dire au sens d’un point de vue que l’on pourra partager.
L’idée de recorded sights n’a cependant rien non plus d’artistique, puis-
que, pour le public du XIXe siècle, ces vues ne font que redoubler exac-
tement le site réel.
La diffusion et la très large appréciation de ces stéréogrammes
soulèvent une question : que fait la photographie au paysage à partir
du moment où elle devient populaire? Car c’est le paysage qui cesse
effectivement d’être du domaine de l’art : vraisemblablement, dans
les années 1850 et 1860, le paysage passe irrévocablement au domai-
ne du spectacle, détaché de ses attaches artistiques premières. Le pro-
cessus reste le même, fonction publicitaire d’une image, déplacement
en re-connaissance et expérience in situ du paysage, à ceci près que,
d’une part, l’auteur de l’image est effacé par l’aspect mécanique de
la photographie et que, d’autre part, l’image elle-même n’est plus
comprise comme une médiation, de par sa double conformité au mo-
dèle perspectif et au motif enregistré. Il y a bien une médiation, mais
sous sa nouvelle forme photographique on ne la voit plus puisqu’elle
opère par transparence.
Par ailleurs, il est aussi vrai qu’à rebours de ce glissement du
paysage vers le spectaculaire, les institutions artistiques et la critique
ont effectué une reprise des photographies de surveys et des stéréo-
grammes du XIXe siècle et les ont, à certains égards, forcés à entrer
dans un cadre artistique35. Je n’affirme pas ici que les photographies
de l’Ouest américain sont dénuées de toute subjectivité d’auteur ou
34. « The creation of a large and definable market for landscape photographs began in the
mid-to-late 1850s by means of the incorporation of localized photographic businesses, in
the form of combined photographic and publishing houses, that were dedicated to the
production and sale of travel, architectural and landscape prints and stereographic views
to incoming tourists » (Snyder, 1994 : 179).
35. « The new art history of photography at its too prevalent worst rummages through archives
of every sort in search of masterpieces to celebrate and sell » (Sekula, 1983 : 197).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 38 11/12/08 15:03:54
chapitre 1 • inventions 39
de toute volonté de concordance aux conventions du genre artistique
– pictural – qu’est le paysage, mais que l’histoire de l’art (ou l’histoire
de la photographie) comme le démontre Rosalind Krauss a, rétros-
pectivement, élaboré les « codes » de ce qui est somme toute devenu
une catégorie, « la photographie de paysage au XIXe siècle » (Krauss,
1990 : 37). Les images de O’Sullivan seront donc, après coup, inté-
grées à cette catégorie.
Au XIXe siècle, les stéréogrammes, parce qu’ils font l’objet d’un
grand engouement populaire, peuvent être considérés comme des
paysages mais cela, dans la mesure où le paysage se détache de son a
priori artistique. Par contre, les photographies de surveys ne sauraient
en aucun cas être vues de cette façon au moment où O’Sullivan les
exécute36. Les seules photographies de O’Sullivan qui sont publiées
et connues du grand public au XIXe siècle sont, précisément, les sté-
réogrammes correspondant au goût du jour, des vues enregistrées qui
montrent des lacs, des montagnes, des monuments naturels. Les
zones arides de l’Ouest et les déserts, photographiés par O’Sullivan,
n’obtiendront pas si rapidement le succès populaire des Yosemite et
Yellowstone. Cela pour deux raisons : parce que les images sont,
comme l’affirme Krauss, des descriptions topographiques et non pas
des paysages, mais aussi à mon avis parce que les territoires photogra-
phiés ne peuvent faire figure de vues que l’on pourrait aller admirer
et partager, contrairement à ceux montrés par les stéréogrammes.
En 1867, l’expédition de Clarence King, Geological Explorations of
the Fortieth Parallel (1867-1870) dont Timothy O’Sullivan est le photo-
graphe en titre, prend le départ vers la Californie, le Nevada et
l’Utah.
From Virginia City (Nevada) to Denver City, a stretch of 800 or 900
miles in length. This strip includes the proposed route of the Central
Pacific Railroad, on which the work is progressing so rapidly, and it is
the object of the Government to ascertain all the characteristics of the
region which is thus to be traversed… The minerals, flora and the
fauna of the country, and its agricultural capacity are likewise to be
36. La plupart des auteurs du XXe siècle font preuve d’une belle ardeur lorsqu’il s’agit de
prêter des préoccupations esthétiques au photographe et des qualités artistiques à ses œuvres.
Voir par exemple Naef et Wood (1975 : 125-136). Les auteurs vont jusqu’à comparer la
façon dont O’Sullivan « traite le paysage » avec celle de Cézanne, « son contemporain »
(1975 : 136). Au sujet de cet ouvrage, ce commentaire d’Allan Sekula : « This project, while
rich in information, manifests its art-historicist bias in its reference to United States
government-sponsored geographical and geological surveys as instances of “government
patronage” as if we were talking about some nineteenth century version of the National
Endowment for the Arts » (Sekula, 1983 : 230).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 39 11/12/08 15:03:54
40 Le paysage façonné
studied and reported on. In fact, all the work of nature in that wild and
unknown region is to be scanned by shrewd and highly educated ob-
servers37.
Cette mission, de même que les Geographical and Geological
xplorations of the One Hundredth Meridian (1871 et 1873-1874) de
E
George Wheeler a, outre ses objectifs d’études scientifiques, des buts
industriels, soit le relevé d’indications sur la présence des matières
premières dans les zones visitées. O’Sullivan photographie tout aussi
bien des installations minières que de vastes étendues sauvages : la
conquête de territoires jusqu’alors à peu près inexplorés et l’indus-
trialisation étant indifféremment significatives de progrès.
Ainsi, lorsqu’elles satisfont à des programmes scientifiques et
industriels, les photographies de surveys ne peuvent vraisemblable-
ment être des photographies de paysages, étant plutôt de l’ordre de
l’inventaire de ressources, d’illustrations topographiques. Elles ne
sont faites que pour fournir des repères, des ordres de grandeur et de
comparaison en rapport avec des études spécifiques de sites bien dé-
terminés. N’ayant aucune visée esthétique, elles ne sont pas non plus
proposées à l’appréciation du public. Au moment où il les fabrique,
les images de O’Sullivan sont à l’usage exclusif de ses chefs de mission
et si elles correspondent à certaines visions, ce sont celles de ces der-
niers : « malgré le fait que King remplaçait le « soldat-ingénieur » des
missions antérieures par le spécialiste scientifique, le Fortieth Parallel
Survey était, dès sa mise sur pied, partie de larges stratégies de
conquête, de colonisation et d’industrialisation » (Sekula, 1983 : 130).
Les photographies prises en cours de mission ne paraissent que dans
les rapports, soit sous forme de lithographies, soit dans des albums
reliés comprenant des tirages sur papier, documents qui sont expé-
diés aux agences gouvernementales concernées, à certaines universi-
tés et certains gouvernements étrangers.
Ayant ensuite été déposées dans les archives de l’État, invisibles
pendant plusieurs décennies, les photographies réalisées en Califor-
nie, au Nevada et en Utah par Timothy O’Sullivan ne réapparaîtront
qu’en 1939. C’est alors seulement que ces relevés de territoires « lugu-
bres, inhospitaliers, oubliés des dieux, anesthésiants » (Snyder,
1994 : 191) se transformeront en paysages.
37. Édition du 8 mai 1867 du New York Times, cité par Naef et Wood (1975 : 127).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 40 11/12/08 15:03:54
chapitre 1 • inventions 41
1.3 TIMOTHY O’SULLIVAN, HORSESHOE CANYON,
GREEN RIVER, CA.1872
National Archives (USA) : Geological Exploration of the Fortieth Parallel
(The King Survey), photographie no 77-KN-49
La découverte en 1939 de ces photographies par Ansel Adams,
qui les transmet à Beaumont Newhall alors directeur du Département
de photographie du Museum of Modern Art de New York marque,
plusieurs années après sa mort, les débuts de la carrière artistique de
Timothy O’Sullivan. Selon Snyder, Newhall affirme à leur sujet que ce
sont des « prototypes de paysages photographiques modernistes »
(Snyder, 1994 : 192). Mais, plus important encore, de nouveaux lieux
sont montrés, qui n’attendent que d’être rattachés au grand spectacle
du wilderness états-unien. Le dépouillement, le vide des images de
O’Sullivan ressortissent au caractère pré-sublime de ces terres horri-
fiantes où l’humain, au moment où il les photographie, n’a pas sa
place. Au XIXe siècle de tels territoires, de telles images, même si elles
avaient été diffusées, n’auraient pu trouver la faveur populaire. Les
paysages que l’on préférait à ce moment devaient être plus agréables,
verdoyants et fertiles et à la limite, domestiqués :
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 41 11/12/08 15:03:56
42 Le paysage façonné
The modern understanding of wilderness required, however, that it be
engaging and not threatening, understandable and not too myste-
rious. During the period when Yosemite was being celebrated in ima-
ges as primal wilderness, the actual environment of the valley was being
domesticated, and turned increasingly into a natural theme park
(Schwarzer, 1998 : 60).
L’apparition tardive du Grand Canyon où Timothy O’Sullivan est
le premier photographe à se rendre illustre bien l’écart entre les
zones désertiques et les sites rapidement populaires tels les Yosemite
et Yellowstone, exemples d’ailleurs généralement exploités lorsqu’il
s’agit de décrire le wilderness américain comme élément formateur
d’une identité nationale et d’expliciter le rôle de la photographie à
cet égard.
Le Grand Canyon, aujourd’hui mondialement connu et célébré
pour son sublime minéral n’a, en 1871, que très peu de valeur aux yeux
de George Wheeler qui l’explore avec entre autres, O’Sullivan. L’ex-
pédition de Wheeler, One Hundredth Meridian Survey, cherche, comme
toutes les autres du genre, du minerai à exploiter, des rivières naviga-
bles et des terres propres à la culture, tout ce dont le Grand Canyon
est parfaitement exempt. Il est donc inexploitable, en plus d’être
difficilement accessible38. Le photographier s’avère également ardu,
l’endroit étant vaste et sans motifs remarquables que l’on pourrait
cadrer pour en faire des repères (landmarks) et, à défaut de richesses
à exploiter, le présenter comme un autre paysage typiquement états-
unien.
Peu à peu cependant, l’image du Grand Canyon se construit,
tout d’abord grâce à l’ouverture d’un accès jusqu’à son bord sud qui
permet que l’on aille le contempler selon une vue en plongée – les
premières explorations ayant été effectuées à partir du fond du
canyon – et surtout, d’en faire des photographies qui déterminent,
pour les décennies à venir, la manière de l’apprécier. À cette vue privilé-
giée doit toutefois s’ajouter la compréhension du phénomène géolo-
gique qui a modelé le site, du temps très long qu’a pris le fleuve
Colorado pour lui donner sa forme. La conjugaison de cette intellec-
tion, rendue possible par les guides touristiques, et de la vue ouverte
à partir du bord sud réalisera, quoique tardivement, la transforma-
tion du lieu en un « espace fondamentalement américain » (Nye,
2003 : 75). Alors que Yosemite et Yellowstone sont consacrés et mis en
réserve très tôt après leur découverte par les missions d’exploration,
38. Je m’appuie ici sur l’analyse de Nye (2003 : 74-95).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 42 11/12/08 15:03:56
chapitre 1 • inventions 43
le Grand Canyon attendra 1908 pour devenir National Monument et
1919 pour être classé parmi les parcs nationaux. Il y a là un bel exem-
ple de la transformation d’un lieu en paysage par l’interaction de
phénomènes dont aucun n’est artistique sauf, de façon résiduelle,
l’essentiel point de vue qui est là absolument prescrit (il faut être au
bord sud) et coïncide parfaitement lorsque l’on s’y rend, avec les
représentations photographiques connues. Lorsque la nature du site
est comprise, lorsque l’on peut s’y rendre et accorder l’expérience du
lieu avec son image, le Grand Canyon peut devenir unique : « le
Canyon incarnait une forme nouvelle, le sublime temporel » (Nye,
2003 : 89).
Le goût états-unien pour les zones arides et les canyonlands se
développant grâce à l’émergence de ce sublime temporel, les paysa-
ges désertiques peuvent alors commencer d’exister. De plus, au
XXe siècle, la mobilité grandissante dont les manifestations sont la
construction de quantité de routes39 et l’augmentation du nombre de
voitures de tourisme, commande la recherche d’expériences inédites
et de nouveaux endroits à explorer – en termes de petites conquêtes
évidemment. Le sud-ouest des États-Unis devient tour à tour lieu de
contemplation de ces formations géologiques intemporelles, puis
lieu de dépassement physique, d’un mysticisme nouveau genre, et
par la suite l’objet d’un grand enthousiasme populaire. Le désert est
dès lors assimilé à un bien symbolique à conquérir, l’aventure étant
facilitée par le fait qu’il sera peu à peu irrigué, aménagé, même ha-
bité. À partir des premières décennies du XXe siècle, grâce aux avan-
cées techniques qui permettent qu’on les traverse sans risque d’y
laisser sa peau, le Great Basin Desert, le Mohave, le Sonora devien-
nent peu à peu accessibles, puis dignes d’intérêt. « Il est venu le jour
où l’automobile climatisée nous transporte à travers Death Valley sans
inconfort, sans gêne physique aucune, et sans aucune expérience
digne de mention » (Jackson, 1997 : 207) … autre que visuelle. À
terme, et au même titre que les stéréogrammes de paysages majes-
tueux du XIXe siècle, la « photographie de désert » dont le Sierra
Club et autres Arizona Highways seront les parangons, aura un succès
proprement phénoménal, comme toutes les images fixes ou animées
qui le dépeignent40. Et il en va des déserts comme des canyons, ce
39. La fameuse Route 66 qui traverse le désert du Mohave, entre autres zones où O’Sullivan a
travaillé, est complétée en 1938.
40. « Our era is dominated by desires to end up in the wasteland: the lone figure of the man
with no name heading out into the salt flats at the end of A Fistful of Dollars, women on the
run driving into the void at the end of Thelma and Louise » (Schwarzer, 1998 : 65). Sur
l’aspect cinématographique intrinsèque au désert, voir Baudrillard (1986 : 68-70).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 43 11/12/08 15:03:56
44 Le paysage façonné
sont les photographes, en tout premier lieu, qui ont contribué à défi-
nir les façons de les voir et de les représenter. David Nye souligne que,
quoique les peintres de paysage aient suivi de près les photographes
(Thomas Moran est au Grand Canyon en 1873), ils usent volontiers
de photographies pour leurs compositions, parfois même pour pein-
dre des motifs qu’ils n’ont pas vus. Cette dernière façon de faire est
assez habituelle à l’époque des grands surveys, les peintres s’inspirant
ou reproduisant des photographies des Muybridge, Watkins, etc.
(Nye, 2003 : 7841).
Les photographies de Timothy O’Sullivan auront une fortune
double. D’une part, lorsque le désert devient un paysage qui peut
être largement apprécié, O’Sullivan est introduit au panthéon des
photographes du wilderness états-unien, ces « maîtres involontaires du
XIXe siècle », comme le dit si bien Lucy R. Lippard (1998 : 60). D’autre
part, l’entrée de ses photographies au musée, avec le discours auquel
cette nouvelle situation donne lieu, fait de O’Sullivan l’un des inspi-
rateurs de toute une tradition artistique, celle d’une photographie
directe, qui réfléchit ses caractéristiques propres, ses conditions de
fabrication et les exigences du métier de photographe. « Car ce sont
des images photographiques d’actes d’investigation d’un espace où le
défi le plus grand n’est pas la survie mais la perception, l’observation
elle-même » (Trachtenberg, 1989 : 155). Le désert, on l’a vu avec le
Grand Canyon, ne peut être digne d’intérêt selon l’optique photo-
graphique habituelle, ne présentant ni singularités, ni perspectives
propres à en faire un paysage pittoresque ou grandiose ; il est aride,
rébarbatif. Timothy O’Sullivan trouve cependant le moyen de rem-
plir ce vide photographique et de faire voir, comme le signale Alan
Trachtenberg, la nature sous enquête, scrutée par la photographie
ou par d’autres moyens, en train de subir un processus de transposi-
tion en connaissance, en représentation. C’est ainsi que l’on pourra
plus tard qualifier le travail de O’Sullivan de moderniste, c’est-à-dire
d’autoréflexif : dans ses images, la photographie se révèle découvrant
ou se montre photographiant.
Avec New Topographics (1975), exposition qui fera date et à
laquelle je reviendrai plus loin, Timothy O’Sullivan devient une réfé-
rence obligée pour bon nombre de photographes de la génération
de Lewis Baltz. Ceux-ci cherchent à réaliser des photographies qui
seraient vraiment documentaires, des images qui, comme celles de
O’Sullivan, décriraient leur objet tout en mettant en question le lien
entre l’objet représenté et la représentation elle-même (Jenkins,
41. Voir également : Naef et Wood (1975 : 62-65).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 44 11/12/08 15:03:56
chapitre 1 • inventions 45
1975 : 7). Ces photographes sont ceux-là mêmes qui retourneront
vers les déserts, les déserts de l’Ouest désormais domestiqués, irri-
gués, industrialisés, altérés par les essais nucléaires et par l’exploita-
tion des minerais, mais aussi les déserts domestiques, périurbains, de
la banlieue.
Mais avant d’en arriver au XXe siècle et à ses territoires, il
importe d’examiner une autre invention du XIXe siècle qui, associée
avec la photographie, sera déterminante eu égard au paysage et à son
appréciation.
LE TOURISME
For most of this century the cult of desert photography has numbed us
so that about the only desert we can recognize is a Cibachrome
Bowden, Blind in the Sun.
Le XIXe siècle, entre autres innovations, voit naître le tourisme
populaire, qui est en quelque sorte une transformation de ce rite de
passage qu’était le Grand Tour pour les élites des XVIIe et XVIIIe siè-
cles en une activité de loisir largement pratiquée.
Before the nineteenth century few people outside the upper class
travelled anywhere to see objects for reasons unconnected with work
or business. And it is this which is the central characteristic of mass
tourism in modern societies, namely that much of the population in
most years will travel somewhere else to gaze upon it and stay there for
reasons basically unconnected with work (Urry, 2002 : 5).
Si le tourisme se constitue en un phénomène social dont les
conditions de possibilité sont les changements qui adviennent en
cette ère industrielle, il peut aussi être conçu comme « un ensemble
d’options rhétoriques et théoriques » (Chard, 1999 : 216) en conti-
nuité avec le Grand Tour. Le passage du Grand Tour au tourisme
s’effectuerait ainsi progressivement, dès la fin du XVIIIe siècle, par la
reconduction, l’augmentation et la stabilisation – bref, la généralisa-
tion – de certains thèmes et de certaines attitudes déjà perceptibles
dans l’exercice du Grand Tour. Parmi ces thèmes et attitudes, on
trouve les plaisirs innocents que procurent les séjours à l’étranger,
l’indolence permise par le voyage, la fuite temporaire hors de son
identité et de ses responsabilités habituelles et, plus important, l’ac-
centuation de la distance du sujet à l’objet. Cette distance, déjà existante
pour les adeptes du Grand Tour, admettait que parfois on se laisse
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 45 11/12/08 15:03:57
46 Le paysage façonné
happer ou déstabiliser par la différence ou par l’autre, alors que la
pratique du tourisme installe un écart absolu envers l’« étranger42 ».
Une certaine manière de se déplacer est aussi en conformité
avec les usages propres au Grand Tour, soit un itinéraire déterminé
d’avance d’un site à l’autre, au long duquel on s’arrêtera pour
contempler certaines merveilles déjà décrites : « la topographie ima-
ginative du Grand Tour est, dès le début du XVIIe siècle, organisée
comme une séquence pré-établie d’endroits à visiter » (Chard,
1999 : 223). Ce type d’itinéraire « ne connaît qu’un espace, celui qui
tisse à travers quelques vides innommables une chaîne serrée »
d’attractions, de monuments, de paysages (Barthes, 1957 : 115). Bien
entendu, à chacun des arrêts du parcours, les attractions seront regar-
dées selon le point de vue et la distance convenus qui permettent tout
à la fois de les voir comme un tout unifié et cadré (pictorial detachment)
et comme étrangères (exotiques). Et au XXe siècle, là où de tels itiné-
raires parsemés de points de vue où l’on doit s’arrêter ne sont pas le
résultat d’une longue tradition, ils seront fabriqués de toutes
pièces43.
On attribue l’invention du tourisme tel qu’on le connaît
aujourd’hui à Thomas Cook, ministre baptiste qui organise les pre-
miers voyages de groupe. Tous les facteurs sont réunis pour favoriser
la propagation de cette activité et ils sont tous les effets de l’industria-
lisation croissante des pays occidentaux. Une classe moyenne pro-
gresse rapidement, qui aura de plus en plus de moyens, de loisirs et
aussi le désir de voyager. Simultanément, la photographie, technique
récemment mise au point et vite améliorée, s’installe comme une
esthétique populaire liée au voyage et au paysage. Les transports
rapides, les liaisons ferroviaires complétées sur les continents nord-
américain et européen et plus tard le perfectionnement du moteur à
explosion et de l’automobile, permettent à la classe moyenne de réa-
liser son désir de partir vers les lieux dont elle connaît et collectionne
déjà les images sous forme de stéréogrammes et autres tirages photo-
graphiques. C’est en 1841 que Thomas Cook offre le premier voyage
organisé vers une rencontre de… tempérance44. Le système ferroviai-
42. C’est cette position particulière, qui n’admet plus que la distance parfois se rétrécisse, que
Chloe Chard appelle tourisme. Sur ces thèmes et attitudes, voir Chard (1999 : 213 et 217-
220).
43. Entre autres exemples, voir Alexander Wilson sur le Blue Ridge Parkway, parfaite démons-
tration de ce type de construction d’itinéraire (1991 : 33-37).
44. Voici comment Gérald Messadié décrit les débuts du tourisme: « Phénomène économique
du monde moderne, le tourisme est une invention fortuite d’un missionnaire baptiste né
en 1808 et membre d’une ligue de tempérance. On sait le zèle des zélotes: en 1841, il
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 46 11/12/08 15:03:57
chapitre 1 • inventions 47
re européen, parfaitement fonctionnel, sera le pivot de son organisa-
tion. Cook programme nombre d’excursions « tout inclus » à l’inté-
rieur du Royaume-Uni d’abord, ensuite sur le continent et même
jusqu’au Moyen-Orient dans les années 1870. Ce sont là les débuts de
l’empire touristique que l’on connaît, une organisation inspirée au
révérend Cook par sa double inclination pour le voyage démocratisé
et pour la promotion de la sobriété.
Après Cook, le tourisme de masse se développe peu à peu, l’aug-
mentation du temps de loisir puis l’avènement des congés payés per-
mettant que l’on quitte son domicile pendant un certain temps pour
découvrir le monde, ou plutôt pour aller vers des panoramas dont la
nouvelle industrie touristique fait la promotion au moyen de brochu-
res, de cartes postales et d’autres vues largement diffusées. À la fin de
la Première Guerre mondiale, le déplacement en re-connaissance
devient une activité de plus en plus appréciée qui, malgré un temps
d’arrêt pendant la dépression des années 1930, reprend de plus belle
pendant la période d’abondance qui suit la Deuxième Guerre mon-
diale. Et, à partir des années 1980, le tourisme se classe au premier
rang mondial des industries.
Les premières manifestations du tourisme populaire au XIXe siè-
cle suivent aussi de très près l’expansion impérialiste et commerciale
de l’Europe (Graburn, 1989 : 30). Les petites conquêtes s’effectuent
en grand nombre, selon des schèmes assez semblables à ceux selon
lesquels opèrent les empires coloniaux. Les voyageurs partent d’une
métropole qui dispose d’une mainmise sur la périphérie visitée parce
qu’elle y installe des infrastructures propres à recevoir l’afflux des
touristes. Et la trajectoire est généralement à sens unique, toujours de
la métropole vers la périphérie (Nash, 1989 : 40-41). Ce mouvement
peut aussi être intérieur, par exemple pour les voyageurs qui vont vers
les déserts des États-Unis, suivant les mêmes itinéraires est-ouest que
les conquérants de la frontière. La prise de possession des lieux, aupa-
ravant concrète devient plus symbolique, par la prise photographi-
que, mais elle peut être aussi plus tangible, et c’est l’envahissement.
Au pillage des territoires conquis par les métropolitains pour mar-
quer leur puissance se substitue la rafle d’artéfacts commerciaux en
tous genres, (généralement) plus inoffensive.
persuade la Midland Counties Railway Company d’affréter un train spécial pour convoyer
des abstinents de Leicester à Loughborough, où ils devaient assister à une réunion de sa
ligue, et de les ramener chez eux. L’arrangement devint permanent » (2003 : 13).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 47 11/12/08 15:03:57
48 Le paysage façonné
La transformation de lieux en paysages, entre autres lorsque
l’État crée un parc national, les vide de leurs occupants et du sens
qu’ils avait pour ceux-ci, ce sens « originaire » étant remplacé par une
double convention, le paysage-image, à laquelle se rallient les nou-
veaux arrivants, toujours en transit. Le paysage, que le touriste s’ap-
proprie en le photographiant, est à la fois un emblème national fabri-
qué parce que mis en réserve et ainsi rendu spectaculaire, de même
que le site d’une vision du monde convenue et partagée, là où sont
reconduits point de vue, mise à distance et cadre. Dans les parcs
nationaux de l’Ouest américain, est reproduit à l’infini le geste des
premiers conquérants, les militaires et les scientifiques des surveys
qui, aidés de leurs collègues photographes, ont construit un « mythe
critique » aux fins d’« inventer un pays » (Mitchell, 1994b : 2245). Le
« primitif », le premier occupant, assujetti, devient alors une attrac-
tion liée au tourisme « de nature » (nature tourism) (Schwarzer,
1998 : 63), catégorie qui pourrait tout aussi bien se nommer tourisme
de paysage puisque généralement le voyageur est véhiculé d’une
réserve paysagère à une autre, ces territoires circonscrits et voués à la
contemplation.
Le pays du premier conquérant, d’abord considéré pour sa
valeur matérielle (qui valait bien que l’on déloge quelques fâcheux),
est en partie mis en réserve et devient un paysage, une valeur symbo-
lique dont les images, photographiques dans le cas de l’Ouest améri-
cain, sont l’instrument de diffusion. Mais après coup, la mobilité
aidant, cette valeur symbolique devient monnayable.
At the most basic, vulgar level, the value of landscape expresses itself in
a specific price : the added cost of a beautiful view in real estate value ;
the price of a plane ticket to the Rockies, Hawaii, the Alps, or New
Zealand. Landscape is a marketable commodity to be presented and
re-presented in “packaged tours”, an object to be purchased, consu-
med, and even brought home in the form of souvenirs such as post-
cards and photo albums. In its double role as commodity and potent
cultural symbol, landscape is the object of fetishistic practices invol-
ving the limitless repetition of identical photographs taken on identi-
cal spots by tourists with interchangeable emotions (Mitchell,
1994b : 14-15).
Le déplacement à partir d’un centre, la métropole, vers la péri-
phérie est aussi le mouvement du sujet occidental (celui-là même qui
est structuré par le « paradigme perspectif ») vers l’autre ou vers un
45. Ceci au sujet de la Nouvelle Zélande, mais qui s’applique parfaitement aux États-Unis.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 48 11/12/08 15:03:57
chapitre 1 • inventions 49
objet dont il est dissocié (dont il se dissocie) par la (mise à) distance,
autant que par la culture ou par son aisance matérielle.
It is the middle class that systematically scavenges the earth for new
experiences to be woven in a collective touristic vision of other people and
other places. This effort of the international middle class to coordinate
the differenciations of the world into a single ideology is intimately linked
to its capacity to subordinate other people to its values, industry and
future designs (MacCannell, 1999 : 1346).
Déjà au XIXe siècle le voyageur européen, se conformant à la
position idéologique de l’Empire dont il est sujet, accomplit à travers
les photographies, qu’il les prenne ou qu’il les regarde, une mise à
distance qui contribue à « objectifier » l’autre, humain ou paysage.
« Les photographies démontraient et maintenaient les différences
culturelles et renforçaient la supériorité culturelle européenne qui
servait à justifier la règle coloniale » (Schwartz, 1996 : 30). La photo-
graphie, « instrument d’impérialisme culturel » (Schwartz, 1996 : 3147),
contribue ainsi largement à définir sur le monde un point de vue par-
tagé, d’abord par les Européens, puis par une majorité d’Occiden-
taux, ceux qui appartiennent à la classe moyenne et qui ont les moyens
de se déplacer, bref les touristes.
Dean MacCannell décrit la « structure de l’attraction touristi-
que » comme la relation empirique de trois éléments : tourist – sight –
marker, un touriste, un spectacle et un marqueur ou indicateur
(1999 : 41). L’indicateur est un fragment d’information en rapport
avec le spectacle (sight) qui prend diverses formes, du guide touristi-
que au diaporama. Le terme français spectacle est retenu pour sight,
car ce mot signifie à la fois vue et champ de vision, spectacle et site
pittoresque (scenic place) ou curiosité. Spectacle, dans son sens de
« ensemble de choses ou de faits qui s’offre au regard48 » et aussi au
sens de « marchandise49 », semble parfaitement adéquat. On l’aura
compris, ce qui m’intéresse ici c’est le rapport de l’indicateur enten-
du comme photographie – stéréogrammes commerciaux, magazines
touristiques, « photographie de désert » et ainsi de suite – au spectacle
46. Je souligne.
47. Il est utile de noter que le point de vue du sujet « impérialiste » est associé à une position
typiquement masculine, que la photographie reconduirait. Voir, entre autres, Taylor
(1994).
48. Le Petit Robert, version électronique.
49. Ou « marchandise spectaculaire » dans son sens restreint de « produit de consommation »
(Debord, 2001 : 152).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 49 11/12/08 15:03:58
50 Le paysage façonné
– la vue ou le site –, rapport bien entendu articulé par le(s) touriste(s),
le sujet (collectif50).
Le processus de « sacralisation » de spectacles, qui permet de
créer un large consensus autour de certaines attractions touristiques,
tel qu’il est analysé par MacCannell (1999 : 45), se résout en cinq
phases successives : la phase de dénomination, naming phase ; la phase
du cadrage et de la mise en vue, framing and elevation phase ; la phase
d’enchâssement, enshrinement ; celle de la reproduction mécanique ;
et finalement la phase de reproduction sociale. Je reviendrai plus loin
à ces différentes étapes de la sacralisation de sites, en rapport avec le
land art. Pour l’heure, deux de ces phases retiennent l’attention : la
première, naming phase qui est la phase de « marquage » ou de mise à
part ou en réserve dont les mécanismes ont été étudiés plus haut et la
quatrième phase, qui est celle de la reproduction mécanique. De cette
dernière, MacCannell affirme que c’est celle qui est responsable de la
mise en mouvement du touriste, dans son parcours pour trouver
« l’objet véritable » (1999 : 113). Il appelle d’ailleurs ces reproductions
mécaniques – photographies et autres illustrations, modèles réduits,
etc. – des copies, ce qui rejoint la définition que j’ai précédemment
proposée pour la photographie de paysage telle qu’elle est pratiquée
depuis les années 1850, c’est-à-dire un équivalent rapetissé et portable
de la chose même. Ces reproductions deviennent bien entendu des
indicateurs ou des marqueurs.
MacCannell divise les indicateurs en deux catégories, les on-sight
markers, indicateurs physiques de la première phase de sacralisation
(naming phase) qui sont ces panneaux et ces balises qui signalent les
différentes attractions et leurs limites physiques et que l’on trouve par
exemple dans les parcs nationaux. Les off-sight markers forment la
deuxième catégorie d’indicateurs. Ce sont toutes les pièces informa-
tives afférentes au spectacle-sight mises en circulation, quoiqu’elles en
soient parfois physiquement éloignées, et dont font partie les copies,
les reproductions mécaniques. Selon MacCannell, l’indicateur de
spectacle (sight marker) peut s’avérer plus décisif que le spectacle lui-
même : « l’élément essentiel d’une (agréable?) visite n’est pas néces-
sairement le spectacle ; plus important que celui-ci est l’interaction
avec le marqueur » (1999 : 113). Ne verrait-on le spectacle que comme
50. « By chance, the words site and sight in English sound the same, and their meaning can
overlap: landscape is both a site (as in a “place”) and a sight (as in “view”). This accident
of the English language is matched by another, in which the noun “eye” and personnal
pronoum “I” signify the privilege of the observer, who always stands at the vantage point
and commands the view » (Taylor, 1994 : 13).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 50 11/12/08 15:03:58
chapitre 1 • inventions 51
il doit être vu (Cauquelin, 2000 : 84)? L’indicateur et le spectacle
seraient ainsi interchangeables et le touriste posséderait nécessaire-
ment une faculté de reconnaissance qui serait l’effet d’un usage ou
d’une construction sociale :
Constructed recognition : sightseers have the capacity to recognize sights by
transforming them into one of their markers. Society has the capacity
to “recognize” places, men and deeds by building a marker up to the
status of a sight (MacCannell, 1999 : 123).
Cette reconnaissance à double entrée indique deux usages
s ociaux distincts, celui de la consécration de lieux ou d’événements
par l’édification de monuments-indicateurs et, dans le cas de l’identi-
fication spectacle-indicateur, l’opération de mise en forme par
laquelle on fait coïncider l’objet pour la saisie duquel on s’est déplacé
et l’information que l’on possède sur cet objet. Lorsqu’il s’agit de
sites pittoresques, l’opération serait celle de mise en paysage d’un lieu
par laquelle, en se positionnant au bon point de vue et à la bonne
distance, l’on fait correspondre le lieu à son image, déjà connue.
MacCannell va plus loin et explique qu’une « merveilleuse capacité »
de voir les objets réels comme s’ils étaient des photos, des cartes ou
des panoramas d’eux-mêmes, est à la portée de tous les touristes
(1999 : 122). Cette considération va au-delà de l’habituelle affirma-
tion selon laquelle le monde est déjà une image51. Il y a là proposée
une réciprocité, mieux une circularité : le monde étant une image,
l’on se déplace pour ajuster l’image et son image – ou pour remettre
l’image en image – et pourquoi pas, l’on photographie l’image qui
témoignera de cette réciprocité, ou d’une parfaite concordance. Il va
sans dire que tout ceci illustre parfaitement la puissance couplée du
« paradigme perspectif » et de la culture photographique occidenta-
le.
L’activité touristique ainsi présentée recouvre exactement le
geste de qui part en re-connaissance après avoir vu un paysage peint.
Les innovations techniques de l’ère industrielle, transports rapides et
photographie ne viennent que faciliter l’expérience, populariser (ou
universaliser) au profit d’une classe sociale montante un rituel déjà
bien établi au XVIIIe siècle et dont la photographie constituera, dès
51. « L’autosuffisance iconique d’une présentation photographique du mont Blanc repose sur
le fait que pour la plupart des récepteurs cette montagne est, de toute manière, une image
(elle fait partie des choses qu’on va visiter et dont les guides touristiques disent qu’elles
sont à voir). Le mont Blanc n’existe pas comme une entité réelle mais uniquement comme
image paradigmatique (le massif montagneux ne devient « le mont Blanc » que si on
l’aborde selon un angle de vision synthétique, à partir du « point de vue panoramique »
qui convient) » (Schaeffer, 1987 : 152-153).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 51 11/12/08 15:03:58
52 Le paysage façonné
son invention, l’aspect normatif. La photographie est à ce point deve-
nue l’instrument de l’entreprise touristique (invitation au voyage) et
celui du touriste (preuve que l’on s’est approprié les vues recomman-
dées) tout à la fois, que le couplage obligé photographie-déplacement
est devenu comme naturel, s’est transformé en une telle évidence
que l’on ne prend même pas garde (ou très rarement) d’en examiner
les tenants et aboutissants52. La plupart des auteurs qui traitent de
tourisme glissent en effet rapidement sur la photographie, habituel
outil de promotion ou inévitable prothèse du touriste, ou bien
l’incluent dans des catégories plus larges, tels les indicateurs de
MacCannell53.
C’est pourtant la photographie qui, en ajoutant la trace effective,
l’irréfutable empreinte d’existants réels (Schaeffer, 1987 : 57) à une
vision du monde universelle en Occident, assure la pérennité du pay-
sage alors même que celui-ci n’a plus rien d’artistique, que l’on a
oublié jusqu’à son aspect médiat et construit, tandis qu’une fonction
sociale déterminée par la représentation paysagère subsiste.
Dean MacCannell appelle « productions culturelles » l’ensemble
des facteurs qui donnent lieu à des expériences culturelles, ces « su-
prêmes concentrés de valeurs, incluant les valeurs économiques, dans
la société moderne » (1999 : 28), au rang desquelles s’inscrit le tou-
risme. Ces facteurs sont les producteurs – différents agents humains
–, les modèles culturels et leurs influences, ainsi que les médias qui
véhiculent ces modèles – tous éléments non humains –, le tout
formant ce type de chaîne qui détermine la venue à l’existence d’un
objet stable, ici les productions culturelles54. Toute une industrie – ou
un ensemble de structures commerciales – contrôle la production de
l’expérience touristique.
French social theorist Guy Debord has called tourism “a by-product of
the circulation of commodities”. The mass circulation of the middle
classes around the globe is a phenomenon of vast proportions – now
over 400 million people a year – overseen by an industry that has
extended its management techniques out to the land itself. That world
52. C’est ainsi que l’on sait que les « boîtes noires » sont bien « fermées ». Pour paraphraser
Bruno Latour : « N’est-ce pas une machination intelligente grâce à laquelle la photographie
est devenue un point de passage obligé pour les gens, l’industrie et les lieux? » (Latour, 1995 :
316).
53. Deux exceptions notoires, tout de même : Urry (2002 : 130 et suiv.) et Osborne (2000 :
70).
54. Je fais ici volontairement correspondre l’élaboration des productions culturelles au mo-
dèle de la sociologie de la médiation, puisque le tourisme est aussi une boîte noire qui s’est
fermée.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 52 11/12/08 15:03:58
chapitre 1 • inventions 53
is a changed one, fragmented by development, diversified by marke-
ting strategies, and overlaid with technologies like the car and the
camera (Wilson, 1991: 51).
Dans l’Occident d’après la Deuxième Guerre mondiale, les États
envisagent de plus en plus la prise en charge globale de ces produc-
tions (MacCannell, 1999 : 25), soit en se faisant la courroie de trans-
mission pour toute l’industrie touristique (campagnes de promotion
nationales s’adressant aux étrangers ou aux populations locales) ou
bien en dirigeant des instances de concertation nationales ou régio-
nales. Et, plus intéressant en ce qui concerne mon objet d’étude, les
États établissent de vastes politiques d’aménagement du territoire, de
conservation, de partage en zones touristiques spécifiques, bref de
mise en valeur du paysage. MacCannell remarque que très souvent un
soutien institutionnel massif est nécessaire au « marquage » des sites
(sights) (1999 : 44). Au XIXe siècle aux États-Unis, l’intervention insti-
tutionnelle prend la forme des surveys commandés par le gouverne-
ment central qui aboutissent à la mise en réserve de certains sites. À
la fin du XXe siècle, cela se traduit en études de tous genres, incluant
les missions photographiques, qui seront suivies de la mise en patri-
moine et de l’aménagement de certains lieux. De même que les re-
présentations paysagères ont contribué à former des identités natio-
nales et à affermir le pouvoir d’Empires et d’États centralisateurs, de
même et à des fins similaires, le territoire sera façonné en paysage55.
Ces phénomènes sont examinés de façon plus détaillée au chapitre
quatre.
Quoi qu’il en soit, parce qu’il est de plus en plus considéré
comme une ressource exploitable à des fins touristiques, le paysage
tend à devenir une production culturelle au même titre que les festi-
vals, les défilés, les monuments historiques, les élections, autres pro-
ductions identifiées par MacCannell. ��������������������������������
Il s’agit véritablement de spec-
tacle :
Sightseers buy and take home an “advertisement” (marker or memo-
ry) for a “commodity” (sight – experience) which they leave behind
for reuse by other tourists (MacCannell, 1999 : 158).
Voilà donc ce que devient le paysage lorsqu’il n’est plus l’affaire
de la peinture, lorsque le voyage est le mode principal de son appré-
ciation et la photographie son équivalent et son véhicule tout à la fois.
55. « le capitalisme qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et doit
maintenant refaire la totalité de l’espace comme son propre décor » (Debord, 2001 : 165). Les
italiques sont de l’auteur.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 53 11/12/08 15:03:58
54 Le paysage façonné
Alors que, dans les années 1960, l’âge industriel tire à sa fin, le pay-
sage ne sera plus, à peu de choses près, qu’une question de tourisme,
fut-il de proximité.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 54 11/12/08 15:03:59
C H APITRE DE U X
Appropriations
Industrial society is that kind of society that develops in a cumulative, unidimen-
sional, growth sequence, by simply adding on new elements – a new factory,
population growth, a new social class, for example. […] Postindustrial or
modern society is the coming of consciousness of industrial society, the result of
industrial society’s turning in on itself, searching for its own strengths and weaknes-
ses and elaborating itself internally. The growth of tourism is the central index of
modernization so defined
Dean MacCannell, The Tourist.
L’économie industrielle domine en Occident pendant une
onne partie du XXe siècle, l’impérialisme et les guerres stimulant la
b
production et la transformation des matières premières. Sous ce
régime, la mobilité des personnes ainsi que la production des images
augmentent. Jusqu’au moment où, à partir des années 1960, l’expan-
sion industrielle cède progressivement à une organisation économi-
que dominée par le secteur tertiaire, un type d’économie dont les
produits caractéristiques sont les services, les communications, les
productions culturelles et les loisirs, incluant le tourisme qui est lui-
même l’une de ces productions culturelles, « qui de façon quasi magi-
que génèrent continuellement du capital, souvent sans consumer
aucune énergie » (MacCanell, 1999 : 29).
Disparaissent alors bon nombre de grands complexes indus-
triels , des industries plus légères sont implantées dans les régions
1
périurbaines, tandis que les zones suburbaines s’étalent et s’étendent
autour des villes, drainant les classes moyennes hors de celles-ci. Aux
1. La production des biens en dur ne cesse évidemment pas. Elle est plutôt transportée dans
des pays que l’on dit en développement.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 55 11/12/08 15:03:59
56 Le paysage façonné
États-Unis se produisent également de grands mouvements de popu-
lations vers l’Ouest et vers le Sud. C’est donc en périphérie qu’émerge
un nouveau paysage états-unien : à l’Ouest, hors des centres tradition-
nellement industriels de l’Est, dans les déserts transformés, irrigués,
mais également dans les zones périurbaines et en banlieue, cette nou-
velle frontière2.
Si la notion de wilderness, de même que la banlieue trouvent
toutes deux leurs origines historiques au XIXe siècle (l’époque des
grands surveys de l’Ouest précédemment examinés), la banlieue
gagnera au milieu du XXe siècle, en très peu de temps, énormément
de terrain3. C’est que l’automobile est devenue « la machine de rêve
américaine – un symbole d’aisance financière et de mobilité » (Gilbert,
1986 : 272), mobilité sociale ascendante qui amène la classe moyenne,
en quête d’une meilleure qualité de vie, à délaisser massivement les
villes après la Deuxième Guerre mondiale. Le déplacement sur de
plus longues distances, soit la pratique du tourisme, est aussi une
façon d’affirmer son statut social4, au même titre que les collections
et les albums de stéréogrammes de sites et de monuments lointains
avaient pu l’être au XIXe siècle : dans les années qui suivent la
Deuxième grande guerre, il s’agit de revenir avec sa propre photo,
puisque l’on se déplace, physiquement, vers des lieux et des monu-
ments célèbres.
Le territoire des États-Unis est transformé par l’omniprésence
de la route et de toutes les structures et installations conçues en fonc-
tion du transit, « les terrains de stationnement, les installations acces-
sibles en voiture (drive-in facilities) et les routes surélevées, et les bre-
telles et les échangeurs et d’étranges petites tranches de verdure »
(Jackson, 1997 : 74). C’est désormais le perpétuel mouvement auto-
mobile qui modèle – et module – l’espace en Occident.
Tandis que ses résidants délaissent périodiquement la banlieue
pour partir à la conquête de nouveaux lieux et paysages, ceux du
wilderness tout particulièrement, certains artistes investissent ces
secteurs suburbains, et aussi les zones périurbaines où d’anciennes
2. « As an individual fortune waned, the opportunity of fresh start could be have elsewhere
– if not a western, then on a surburban frontier » (Jackle, 1990 : 299). Voir aussi Lippard
(1997 : 225-244).
3. « some eight percent of the nation’s land has been designated as wilderness while the
remaining ninety-two percent has been deeded unconditionally to civilisation – to the
highway, the commercial strip, the suburban development, the parking lot, and of course,
the lawn » (Pollan,1998 : 70).
4. « The duty to appropriate the foreign that competive participation in the vanities of a
consumer culture imposes » (Chard, 1999 : 220).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 56 11/12/08 15:03:59
chapitre 2 • appropriations 57
exploitations industrielles tombent en désuétude. Ces nouveaux sites
postindustriels deviennent d’importants motifs, des objets de recher-
che inédits pour les artistes. Ces territoires seront vraisemblablement
les derniers paysages qu’il leur sera permis d’inventer, peut-être à
cause de leur étrangeté qui confine au sublime :
The semi-derelict industrial landscape […] represents a special terri-
tory which, for the mid to late twentieth-century artist, becomes a per-
verted equivalent of sublimity that the wilderness represented for Cole
and others in the nineteenth century. Precisely
�������������������������������
because it is nondes-
cript, indescribable, an “other” » (Seddon, 2000 : 91).
L’appropriation symbolique, par les artistes, de sites et de terri-
toires modelés et altérés par la mobilité et par certaines activités éco-
nomiques est aussi tributaire d’un discours critique qui se développe
dans les années 1960, discours conséquent selon MacCannell de
l’introspection et de l’élaboration interne propres à la société postin-
dustrielle – et postmoderne si l’on en croit Fredric Jameson5 : ré-
flexion sur le(s) développement(s) socioéconomique(s), apparition
d’une pensée écologiste, nouvelle attitude des artistes envers les insti-
tutions et de celles-ci envers les artistes.
Dans le présent chapitre, certains travaux réalisés dans les
années 1960 et 1970 par Robert Smithson, Nancy Holt et Lewis Baltz
sont analysés en relation aux faits stables et finis, aux activités univer-
sellement acceptées et pratiquées que sont devenus le tourisme et son
corollaire, la photographie de paysage. Je m’attarde donc ici aux
choses, c’est-à-dire aux boîtes noires que nous avons vues se fermer au
précédent chapitre, en rapport avec les œuvres d’art qui s’élaborent
dans les années 1960, question de comprendre ce que font les objets.
Il convient d’examiner les agents non humains, tout autant que les
acteurs humains, puisque « l’objet est soumis à des modifications mul-
tiples quand il passe de main en main » (Latour, 1995 : 251) et qu’en
retour, l’objet agit sur le monde. Car « il n’existe pas de moyen d’atta-
cher entre eux des groupes intéressés à moins que d’autres éléments
leur soient liés », les objets : « Le lien social n’est pas fait avec du
social. » (Latour, 1995 : 302) Il s’agira d’abord de saisir quelles inter
actions entre tourisme, photographie et land art font en sorte que le
land art sera de plus en plus « naturellement » associé au paysage, alors que la
photographie artistique, elle, ne pourra l’être. Et ce, bien que les deux types
5. Selon Jameson, en effet, la transition de la « haute modernité » à la « postmodernité »
s ’effectue lorsque la « nature » disparaît et que la « ville » et « le jardin » s’homogénéisent
en « banlieue globale » (1991 : 366). Il est à remarquer que là où Jameson constate l’émer-
gence d’une société postmoderne, MacCannell voit la manifestation d’une société moderne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 57 11/12/08 15:03:59
58 Le paysage façonné
d’art favorisent et se partagent, en quelque sorte, les mêmes motifs.
S’ajouteront ensuite à ces observations les considérations du chapitre
suivant dans lequel les œuvres seront plus largement mises en con
texte. Les « longues chaînes de traduction » (Latour, 1995 : 133)
nécessaires à l’émergence du paysage comme objet façonné, comme
(partie du) spectacle, deviendront alors apparentes.
Il est utile de signaler que l’appellation land art sera générale-
ment utilisée pour les travaux de Smithson et de Holt, de préférence
à earthworks ou à toute autre dénomination. Les œuvres ici présentées
ont un rapport évident avec l’endroit où elles sont construites ou
bien le lieu qu’elles annexent, beaucoup plus qu’avec les matériaux
dont elles sont faites, certaines d’entre elles d’ailleurs, que l’on songe
aux Sun Tunnels de Nancy Holt, n’étant pas faites de matériaux natu-
rels. Les œuvres de land art, de même que les photographies de Lewis
Baltz, sont examinées au regard des notions de centre et périphérie,
de mobilité et déplacement, donc en termes de site et situation, toutes
notions qui mettent en lumière les rapports qu’entretiennent paysa-
ge, tourisme, photographie et land art. Une nouvelle forme de com-
munication que certains artistes voudront intégrer à leurs œuvres
sera aussi prise en compte. Il s’agit de la mobilité électronique.
Through the discovery yesterday of the railway, the motor car and the
aeroplane, the physical influence of each man, formerly restricted to a
few miles, now extends to hundreds of leagues or more. Better still:
thanks to the prodigious biological event represented by the discovery
of electro-magnetic waves, each individual finds himself henceforth
(actively and passively) simultaneously present, over land and sea, in
every corner of the earth (Teilhard de Chardin, cité par McLuhan,
2002 : 32).
On a pu croire que cette nouvelle forme de mobilité supplante-
rait les anciennes, tout spécialement dans une société postindustrielle.
Dans ce chapitre et dans ceux qui le suivent, il sera montré que cela
n’est pas tout à fait exact.
PORTRAIT DE L’ARTISTE EN TOURISTE
En 1966, Robert Smithson affirme publiquement son intérêt
pour l’entropie, alors qu’il fait paraître dans le numéro de juin d’Art-
forum « Entropy and the New Monuments », un essai qui traite du tra-
vail de ses collègues les artistes minimalistes, Dan Flavin, Donald
Judd, Robert Morris et Sol LeWitt, entre autres. L’idée d’entropie,
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 58 11/12/08 15:03:59
chapitre 2 • appropriations 59
empruntée à la physique, veut qu’un état de désordre tende toujours
vers un désordre encore plus grand, jusqu’à l’éclatement ou à la dis-
solution. L’entropie, c’est l’évolution à l’envers ou la déperdition
constante d’énergie :
In a rather roundabout way, many of the artists have provided a visible
analog for the second law of Thermodynamics, which extrapolates the
range of entropy by telling us energy is more easily lost than obtained,
and that in the ultimate future the whole universe will burn out and be
transformed into an all-incompassing sameness (Flam, 1996 : 116).
Cette même année, Smithson entreprend ses premières expédi-
tions vers de curieux endroits, des lieux qu’il appelle « low profile land
scapes » ou « paysages entropiques » (Flam, 1996 : 293) : les carrières à
l’abandon, les zones minières et aussi, la banlieue. De nombreuses
excursions en ces lieux étranges lui permettront d’accumuler le ma-
tériel nécessaire à la fabrication de ses Nonsites, une importante série
d’œuvres qu’il créera en 1968 et 1969. Ces travaux, s’ils conservent
certaines caractéristiques des œuvres géométriques des années précé-
dentes, des objets sculpturaux assez rigides faits de matériaux « indus-
triels » que l’on a qualifié de « quasi-minimalistes » (Boettger, 2002 : 52-
54 ; Alloway, 1983 : 125), commandent l’utilisation de matières
différentes.
« A Tour of the monuments of Passaic, New Jersey », peut être
considéré comme la promenade inaugurale à partir de laquelle
Smithson développera ses Nonsites. Cette œuvre, parue dans Artforum
en 1967 est littéralement un récit de voyage7, incluant des photogra-
phies prises par l’auteur avec son Instamatic 400, petit appareil photo
d’usage très répandu chez les touristes des années 1960 et 1970. La
description de la visite quasi-touristique de cette banlieue et des « mo-
numents » que Smithson y photographie illustre bien l’intérêt de
l’artiste pour l’entropie et les sites en mutation. Décrivant les lieux,
Smithson revient sans cesse au chaos et à la désintégration, pour clore
sur sa fameuse « preuve d’entropie » (experiment for proving entropy) éla-
borée à partir du dernier « monument », The Sand-Box Monument, une
6. Le livre de Flam (1996) rassemble tous les textes, publiés ou inédits, écrits par Robert
Smithson de 1965 à 1973. L’ouvrage est une mise à jour de la version de Nancy Holt de
1979. Outre les écrits de Smithson, il comprend plusieurs entrevues accordées par l’artiste
à divers auteurs, de même qu’une discussion entre Robert Smithson, Michael Heizer et
Dennis Oppenheim. Les propos de Smithson cités ici sont donc généralement suivis de la
référence Flam 1996.
7. « Smithson’s “tour” to his birthplace parodies the old idea of the artist’s grand tour (and
subsequent recorded travel diary) to the birth place of ancient classical culture, princi-
pally Rome » (Seddon, 2000 : 90).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 59 11/12/08 15:04:00
60 Le paysage façonné
boîte de sable, ce jeu pour enfants. Il explique que si l’on remplit la
boîte pour moitié de sable noir et pour moitié de sable blanc et que
l’on y fait courir un enfant des centaines de fois dans le sens des
aiguilles d’une montre, le sable se mêlera et deviendra gris. Et si après
cela on demande à l’enfant de courir à nouveau, mais dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre, le résultat « ne sera pas la
restauration de la division originale, mais encore plus de gris et un
accroissement de l’entropie » (Flam, 1996 : 74).
À travers ces considérations sur l’entropie, un certain visage de
l’Amérique se révèle, son paysage modelé par la mobilité traduite en
car culture : la banlieue elle-même (« les ruines à l’envers »8) ; les routes
perpétuellement en réfection et la construction de nouveaux highways
(« il était difficile de différencier la nouvelle autoroute de l’ancienne
route ; toutes deux se confondaient en un chaos unitaire ») ; les ven-
deurs d’automobiles neuves (« les vitrines de City Motor auto sales pro-
clamaient l’existence de l’Utopie ») et usagées (« j’avais peut-être
glissé dans un stade inférieur du futur ») ; le terrain de stationnement
(« je pris quelques clichés apathiques et entropiques de ce monument
lustré » (Flam, 1996 : 71-73). Sur le même mode (entropique), les ins-
truments et les attributs du touriste, appareil photo, photographies,
cartes, sont aussi très présents dans le récit. Au sujet du premier
monument qu’il prend en photo, The Bridge Monument (ou Monument
of Dislocated Directions), l’auteur déclare que le soleil de midi « cinéma-
isait le site, transformant le pont et la rivière en une photo surexpo-
sée. Photographier avec mon Instamatic 400 était comme photogra-
phier une photographie » (Flam, 1996 : 70). Un peu plus loin il
signale : « en fait, le paysage n’était pas un paysage mais « un genre
particulier d’héliotropie » (Nabokov), une sorte de carte postale en
train de s’autodétruire » (Flam, 1996 : 72). Le dernier monument, le
sand-box monument or model desert est une « carte de désintégration et
d’oubli infini » (Flam, 1996 : 74). À un autre moment de sa relation,
le lieu même, Passaic, devient sa propre carte :
I had been on a planet that had a map of Passaic drawn over it, and a
rather imperfect map at that. A sidereal map marked up with “lines”
the size of streets, and “squares” and “blocks” the size of buildings. At
any moment my feet were apt to fall through the cardboard ground
(Flam, 1996 : 74).
8. « the buildings don’t fall into ruin after they are built but rise into ruin before they are
built » (Flam, 1996 : 72).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 60 11/12/08 15:04:00
chapitre 2 • appropriations 61
Si ce passage contient une allusion évidente aux étranges carto-
graphies développées par Jorge Luis Borges ou par Lewis Carroll, il
indique, tout comme les précédents extraits cités, que Smithson pos-
sède certainement, du touriste, cette étonnante « qualité qui permet
de voir les objets réels comme s’ils étaient des photos, des cartes ou
des panoramas d’eux-mêmes » (MacCannell, 1999 : 122).
Cet intérêt envers la photographie et les photographies, les
cartes et la cartographie, les fragments et la synecdoque9 manifeste
dans « A Tour of the Monuments Of Passaic », informe également les
travaux subséquents de Smithson, les Nonsites, des sculptures compo-
sites qu’il fabrique en 1968 et 1969. Comme à Passaic avec ses
« prises » photographiques, Smithson procède pour ses non-sites par
prélèvements, dans ce cas des minéraux rassemblés sur un site parti-
culier et qui sont déposés dans des contenants d’acier ou de bois aux-
quels il donne diverses formes : point de fuite tronqué ou carte en
trois dimensions, « la carte que j’ai établie suivant mon expérience du
site » (Flam, 1996 : 198). Les sites à partir desquels sont conçus les
non-sites sont généralement, tout comme Passaic New Jersey où l’ar-
tiste est né, situés en banlieue de New York où il habite. Ce sont des
mines désaffectées (A Nonsite, Franklin, New Jersey, 1968 ; Nonsite, Site
Uncertain, 1968), des aires de remplissage (Nonsite, « Line of Wrecka-
ge », Bayonne, New Jersey, 1968), des terrains vagues (Nonsite (Palis
ades), Edgewater, New Jersey, 1968), des carrières (Six Stops on a Section,
1968), certaines à l’abandon (Nonsite, Slate from Bangor, Pa., 1968).
Smithson quitte aussi parfois le New Jersey pour se rendre vers l’Ouest,
ses lieux de prédilection étant alors les zones désertiques (Mono Lake
Nonsite, 1968 ; Double Nonsite, California and Nevada, 1968 ; Nonsite
Death Valley, 1968). Autant de paysages « entropiques », des sites « qui
ont été, d’une certaine façon, bouleversés ou pulvérisés » (Flam,
1996 : 244).
Si certains non-sites se présentent comme le seul contenant à
minéraux, la plupart sont toutefois plus complexes, comprenant des
cartes géographiques ou topographiques, des photographies, de
courts textes. Tous ces éléments conjugués constituent l’œuvre10, qui
est une invite au déplacement, une exhortation à (re)faire le par-
cours effectué par l’artiste, vers le site.
9. Ou la métonymie. Voir Jones (1996 : 320) et également Tsai (1991 : 36-37).
10. Bien que pour certaines expositions les responsables aient rejeté photos, cartes et textes
– les qualifiant de « matériel didactique » – pour ne montrer que les « sculptures », les
contenants seuls. Voir Jones (1996 : 318-319) et Alloway (1981 : 43).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 61 11/12/08 15:04:00
62 Le paysage façonné
The range of convergence between Site and Nonsite consists of a
course of hazards, a double path made up of signs, photographs, and
maps that belong to both sides of the dialectic at once. Both sides are
present and absent at the same time. […] Two-dimensional and three-
dimensional things trade place with each other in the range of conver-
gence. […] The rules of this network of signs are discovered as you go
along uncertain trails both mental and physical (Flam, 1996 : 153).
De ces déplacements, commandés par les non-sites, deux choses
sont retenues. Tout d’abord, un non-site, parce qu’il contient le site
tout en le pointant, restitue l’idée de limite imprécise entre la repré-
sentation et son objet, confusion qui est particulière au paysage. Éga-
lement, ou conséquemment, les non-sites agissent comme des indica-
teurs (les sight markers de Dean MacCannell), en relation au site (sight)
qu’ils désignent. MacCannell, on le sait, définit les caractéristiques de
l’attraction touristique en une relation empirique entre trois termes :
l’indicateur, le spectacle et le touriste. Dans le système – ou le non-
système – proposé par Smithson, le touriste serait l’artiste, mais aussi
le visiteur de l’exposition, incité par le non-site à effectuer le parcours,
du centre (le non-site, le lieu d’exposition, la ville) vers la périphérie
(le site, la banlieue, le désert). La relation s’établissant, de centre à
périphérie, le déplacement demandé par l’œuvre reproduit d’une
certaine façon l’itinéraire du sujet occidental lorsqu’il pratique l’acti-
vité touristique. Signalons par ailleurs que l’on assimile volontiers le
rapport site/non-site à une correspondance sight-non sight (Hobbs,
1981 : 14). Ce sont donc autant de voyages qui sont recommandés par
Smithson : « Eh bien dans mon cas, l’œuvre est là dans le musée, abs-
traite, et elle est là pour être regardée, mais vous êtes projeté loin
d’elle. Vous êtes en quelque sorte catapulté vers les marges du site. Le
site est un endroit que vous pouvez visiter et cela implique aussi
l’aspect voyage. » (Flam, 1996 : 81)
Les non-sites illustrent parfaitement le va-et-vient typique au
paysage, ce mouvement entre l’image et sa chose. Lawrence Alloway
affirme d’ailleurs que pour Smithson, le paysage et ses « systèmes
d’ordonnancement » sont parfaitement familiers et que leur présen-
ce peut être remarquée partout dans son art et dans sa pensée (1983 :
140). Outre les allers et retours entre sites et non-sites, un autre aspect
des « systèmes d’ordonnancement » du paysage ou du territoire,
manifeste dans le travail de l’artiste, est cette figure du palimpseste, la
« stratification » du terrain. Extraire ou prélever un fragment du site,
c’est comme creuser l’histoire, c’est-à-dire établir une section trans-
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 62 11/12/08 15:04:00
chapitre 2 • appropriations 63
versale11 de la formation du territoire, cet espace synthétique qui est
selon John B. Jackson, une accumulation de couches superposées par
les usages humains sur la face de la terre (Jackson, 1997 : 30512).
2.1 ROBERT SMITHSON, NONSITE
(FRANKLIN, NEW JERSEY), 1968
© Estate of Robert Smithson/VAGA (New York)/SODART (Montréal) 2007.
Coll. Museum of Contemporary Art, Chicago
Ainsi, un non-site est l’assemblage d’un fragment du site et de
quelques documents. Par exemple Nonsite, (Franklin, New Jersey) est
composé d’un contenant à minéraux qui prend la forme trapézoïdale
d’un point de fuite tronqué et segmenté et d’une carte aérienne de
Franklin découpée selon la même forme que le contenant. Vingt-
cinq photographies du site (faites à l’Instamatic 400) et un texte dac-
tylographié expliquant en détail le format du contenant et l’échelle
de la carte sont aussi réalisés par l’artiste relativement au non-site
Franklin. Tous ces éléments permettent d’identifier et de repérer le
site, afin que l’on puisse s’y rendre. S’établit donc, et à la demande
même de Smithson (« en d’autres mots, tous les non-sites vont vous
conduire aux sites » (Flam, 1996 : 221)), une nécessaire suite d’allers
et retours sur cette « double voie faite de signes […] qui appartiennent
11. « Digging through the histories » (Flam, 1996 : 295). « It’s like a cross section of the site »
(Flam, 1996 : 221).
12. Voir également Corboz (2001 : 201-229).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 63 11/12/08 15:04:01
64 Le paysage façonné
aux deux versants de la dialectique au même moment », un réseau de
déplacements dont les « règles se découvrent en suivant des voies
mentalement et physiquement incertaines » (Flam, 1996 : 153). De
même, lorsqu’il s’agit du paysage tel qu’il est décrit par Anne
Cauquelin, « les deux versants échangent des attributs selon une règle
inconnue » (2000 : 3213).
Dean MacCannell explique que la première phase de sacralisa-
tion d’un lieu ou d’un objet, son passage à l’état de spectacle, se pro-
duit lorsqu’un site ou un objet est distingué parmi d’autres sites ou
objets similaires et perçu comme digne d’être préservé (MacCan-
nell, 1999 : 44). Ce premier « marquage » correspond au « site selec-
tion » opéré par Smithson dans les premières étapes de ses recherches
pour créer ses non-sites – souvent au cours de promenades avec ses
amis et collègues artistes dans les lieux qu’il affectionne, carrières à
l’abandon, aéroports vides, terrains vagues en tous genres. Il affirme
en 1967 que le « site selection study » est, en soi, en voie de devenir un
nouvel art. Cela consiste, selon l’artiste, à « exposer le site » (Flam,
1996 : 60). Une forme d’art inédite émerge donc, que décrira en 1979
Rosalind Krauss :
la combinaison du paysage et du non-paysage commença à être explorée
à la fin des années soixante. Le terme de sites marqués permet d’identi-
fier des œuvres comme la Spiral Jetty (1970) de Smithson, Double Nega-
tive (1969) de Heizer, ou encore certaines œuvres réalisées dans les
années soixante-dix par Serra, Morris, Carl Andre, Dennis Oppen-
heim, Nancy Holt, George Trakas, et beaucoup d’autres. « Sites
marqués » renvoie à des transformations concrètes de sites, mais aussi
à d’autres formes de marquage – soit par production de marques
éphémères (Dépressions de Heizer, Time Lines d’Oppenheim, Mile Long
Drawing de De Maria), soit par utilisation de la photographie (les
Mirror Displacements in the Yucatan de Smithson en sont le premier
exemple célèbre, et Richard Long et Hamish Fulton ont depuis centré
leur travail sur l’expérience photographique du marquage) (Krauss,
1993 : 122-12314).
Cette opération de « marquage » correspond effectivement à
e xposer le site. Le site lui-même et sa photographie sont en étroite
correspondance, voire interchangeables.
13. « […] et dont l’unité est maintenue dans et par l’expérience ordinaire » (Cauquelin 2000 :
32).
14. L’original en anglais du texte « La sculpture dans le champ élargi » dont est tirée cette
citation est paru en 1979 dans October.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 64 11/12/08 15:04:01
chapitre 2 • appropriations 65
La phase suivante de la sacralisation selon MacCannell est la
phase « d’encadrement et d’élévation » qui consiste à mettre un objet
en exposition (on display) (1999 : 44). C’est bien ce que fait Smithson
avec le site, qui est à la fois désigné et contenu par (ou contracté
dans) le non-site. Quant à la troisième phase de sacralisation, celle de
« l’enchâssement » (enshrinement), elle se traduit par un re-doublement
de « l’encadrement », qui rendrait l’objet d’autant plus précieux. On
sait que les non-sites figurent une périphérie (le site) ramenée au
centre, le non-site lui-même, mais aussi la galerie, dans la ville.
L’étape qui succède à l’enchâssement est celle de la « reproduc-
tion mécanique », lors de laquelle sont créés des modèles, des effigies,
des photographies de l’objet, des copies « qui seront elles-mêmes
mises en valeur et en exposition » (MacCannell, 1999 : 45). Le non-
site, parfois considéré comme métonymie ou synecdoque (il pointe
et contient le site) devient certes une effigie ou une copie du site. D’évi-
dence, les non-sites de Smithson répondent parfaitement à tout le
processus élaboré par MacCannell, jusqu’à exemplifier chacune des
phases de la sacralisation de l’objet touristique. J’aurai d’ailleurs l’oc-
casion de revenir à la phase de « reproduction mécanique », lorsqu’il
sera question des grandes œuvres de land art du désert et de leur
exposition.
Mais auparavant, il convient de souligner un autre aspect de ce
curieux parallèle land art/tourisme. Rosalind Krauss soutient, en par-
lant de « l’expérience photographique du marquage », que photogra-
phier les sites serait une manière de les marquer. En fait, si le site et
son marqueur finissent par se confondre, ce qui est évident dans les
travaux de Smithson et conséquent du va-et-vient implicite tant au
paysage qu’au site/non-site (« les deux côtés sont à la fois présents et
absents »), cela tiendrait selon MacCannell, à l’interchangeabilité du
signifiant et du signifié (1999 : 118). On aura certainement remarqué
que le système de MacCannell, indicateur-spectacle-tourisme (marker-
sight-tourist) s’inspire de la formule sémiotique de Charles Sanders
Peirce qui se lit ainsi : un signe représente quelque chose à quelqu’un.
MacCannell fabrique donc le parallèle suivant : indicateur/représen-
te, spectacle/quelque chose, touriste/à quelqu’un ; le tout corres-
pondant à l’attraction touristique/le signe (1999 : 109-110). Beau-
coup d’auteurs qui s’intéressent au travail de Robert Smithson
signalent la similitude entre le site/non-site et l’énoncé de Peirce.
Lawrence Alloway écrit : « La relation du non-site au site est aussi com-
me celle du langage au monde ; c’est un signifiant et le site est ce qui
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 65 11/12/08 15:04:02
66 Le paysage façonné
est signifié » (Alloway, 1981 : 4115), propos qu’Eugenie Tsai reprend
dans son Unearthed. Quant à Caroline A. Jones, elle établit un lien
plus complexe. Pour elle, les sites/non-sites correspondent tout à la
fois à une figure de style et forment un « système de signes » (1996 : 318-
320). Le non-site est une métonymie qui prend littéralement la forme
d’un déplacement physique. En même temps, c’est un signe de type
indiciel, tout comme la photographie, ce type de signe que Rosalind
Krauss définit ainsi : « les index établissent leur sens sur l’axe d’une
relation physique à leur référent » (1993 : 64). Krauss fait d’ailleurs
remarquer dans ses « Notes sur l’index » l’importance pour les
earthworks d’un « supplément documentaire » (1993 : 76). Dans le cas
des non-sites de Smithson, ce supplément est tout à la fois l’œuvre et
une trace du site qui, reportée dans le temps et dans l’espace, agira
comme une incitation à se mettre en mouvement.
Ainsi, on pourrait partir en quête du « paysage entropique »,
tout comme à une autre époque, l’on se déplaçait volontiers pour
re-connaître des lieux pittoresques ou sublimes préalablement
dépeints par les artistes :
In 1976 Elizabeth Wilde and Kristina Heinemann consulted Smith-
son’s Nonsites. Each piece was studied for orientation to the sites and
supplemented by discussions with Nancy Holt and Smithson’s gallery.
Wilde and Heinemann compiled an itinerary and drove to New Jersey,
following the implicit command of the Nonsites to convert their infor-
mation into “the real thing” (Alloway, 1981 : 44-4516).
Le touriste ne se conduit pas autrement. Les « reproductions
mécaniques » sont, selon MacCannell, la principale motivation du
départ du touriste afin de trouver l’objet véritable : parallèlement aux
copies, il doit bien y avoir la chose vraie (The Real Thing) (MacCan-
nell, 1999 : 45). À ceci près qu’aucun des sites de Smithson ne peut
rester intact ou tel qu’en lui-même, puisque c’est la progression du
désordre qui les caractérise :
They had difficulty in locating the Sites at first, but as one of the women
noted, “I was no longer concerned at being wrong or lost” and they
persisted. At the Palisades, Edgewater, there was “a slick high-rise apart-
ment complex overlooking Smithson’s original site”. At Line of
Wreckage, Bayonne: “The site now looks like a set from Antonioni’s
statement on the environmental crisis, Red Desert” (Alloway, 1981: 44-
45).
15. Voir également Alloway (1983 : 128-130).
16. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 66 11/12/08 15:04:02
chapitre 2 • appropriations 67
Le cahier des illustrations de l’ouvrage En chemin, Le land art
(1999) d’Anne-Françoise Penders est en grande partie composé de
photographies prises par l’auteure elle-même sur nombre de sites,
dont ceux des monuments de Passaic, New Jersey. Elle raconte égale-
ment le voyage qu’elle y a fait, sur les traces de Smithson (Penders,
1999 : 170-177). Eugenie Tsai quant à elle, se rend à Passaic en 1988
et n’y trouve que le Bridge Monument, l’autoroute, alors achevée, ayant
altéré le site (1991 : 45).
Peu importe si l’on n’arrive pas à retrouver le site tel quel ce-
pendant, puisque le spectacle (site-sight) et son indicateur peuvent
être interchangeables, l’indicateur et le site étant amalgamés en une
représentation unique, à l’instar de ces « choses en deux ou trois
dimensions [qui] échangent leurs places respectives dans le champ
de convergence » comme le dit lui-même Smithson. Mais, il réfute la
possibilité que le rapport du non-site au site soit un rapport de repré-
sentation. Sa défense est toutefois laborieuse, l’artiste affirmant qu’il
n’y a pas d’aspect de représentation entre non-site et site tout en
spécifiant que le non-site est une abstraction… « qui représente le
site 17 ».
LE CENTRE ET LA PÉRIPHÉRIE
À la fin des années 1960, Robert Smithson passe de la banlieue
au désert. De la recherche ou sélection de sites pour ses non-sites, il
en viendra à travailler sur le site lui-même, à le marquer physique-
ment. Ce qui ne l’empêche pas d’appliquer sa « dialectique18 » site/
non-site aux œuvres monumentales qu’il crée – ou tente de créer – de
1970 à 1973. Et, cette « dialectique », ou plutôt la relation indicateur-
spectacle (marker-sight) que j’analysais à l’instant, deviendra une ten-
dance générale pour tout le land art états-unien de l’époque.
17. « Content usually involves some kind of representational aspect which I try to avoid. The
non-site is an abstraction that represents the site » (Flam, 1996 : 199).
18. C’est Smithson lui-même qui qualifie son système site/non-site de dialectique. Pour com-
prendre le côté laborieux du terme et le pourquoi je juge utile de le mettre entre guille-
mets, voir Hobbs (1981 : 19-30). Également : « he yanked and tugged the word dialectic,
until, in the end, he found a meaning for it that would have given Marx a hearth attack : it
came to mean : accommodation » (Leider, 2001 : 77).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 67 11/12/08 15:04:02
68 Le paysage façonné
2.2 ROBERT SMITHSON, SPIRAL JETTY, 1970
© Estate of Robert Smithson/VAGA (New York)/SODART (Montréal) 2007.
Great Salt Lake, Utah. Coll. Dia Foundation, New York
La Spiral Jetty de 1970, la première œuvre vraiment monumen-
tale de Smithson, est construite dans le désert : « le désert est moins
de la « nature » qu’un concept, un lieu qui engloutit les frontières »
(Flam, 1996 : 109). Au même titre que la banlieue, le désert est pour
Smithson une autre périphérie. C’est un paysage low profile et de même
que les sites de ses non-sites l’étaient relativement, le site sélectionné
pour la Jetty est très difficile d’accès. Pour cette raison, Smithson
conçoit, simultanément à la construction de l’œuvre, une série de
non-sites (qu’il considère comme autant d’œuvres, double marqua-
ge) qui, tout comme les précédents, seront montrés en galerie, rame-
nés au centre où ils feront connaître la Jetty, ou pourront même en
tenir lieu19. Car, « où donc existe la Jetty si ce n’est dans le film que
Smithson a fait, le récit qu’il a publié, les photographies qui accompa-
gnent ce récit et toutes les cartes, les diagrammes, les dessins, etc.,
qu’il a faits d’elle? » (Owens, 1992 : 47).
19. « Since he felt that many significant experiences in the twentieth century are vicarious
ones available through secondary media such as film, video, and essays, Smithson decided
to make secondary primary in Spiral Jetty. The Earthwork, then, does not consist merely of
the spiralling causeway in Utah: the entire piece comprises the several works of art that
frame the original Jetty » (Hobbs, 1981 : 17).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 68 11/12/08 15:04:03
chapitre 2 • appropriations 69
2.3 ROBERT SMITHSON,
STILLS FROM THE FILM SPIRAL JETTY, 1970
© Estate of Robert Smithson/VAGA (New York)/SODART (Montréal) 2007.
Museum of Modern Art Circulating Film and Video Library, New York
Comme la plupart des œuvres monumentales du land art états-
unien, la Spiral Jetty est en effet difficile à visiter. Construite dans le
Great Salt Lake en Utah à une centaine de milles de Salt Lake City, un
site où l’on se rend en empruntant des chemins de terre peu entrete-
nus, elle est complètement isolée. Qui plus est, elle sera submergée
deux ans après sa construction par une hausse subite des eaux du lac,
ce qui ajoute évidemment aux problèmes de sa visibilité.
Les autres land artists qui, comme Smithson, fabriquent des
œuvres monumentales, Walter De Maria, Michael Heizer, Nancy Holt,
privilégient eux aussi les lieux éloignés, désertiques, pour leurs tra-
vaux. On a vu dans ce choix d’emplacements une volonté de sortir
des lieux traditionnellement dévolus à l’art, ce qui est à mon avis
inexact. Ces artistes sont en effet sortis de leurs ateliers, mais non pas
des institutions muséales ou des galeries commerciales avec lesquelles
ils ont gardé des liens tout au long de leurs carrières. Ce sont plutôt
les galeristes, la critique et les institutions qui s’adapteront à ces pra-
tiques nouvelles. Le chapitre suivant détaillera ces tendances.
Les sites isolés, le désert en particulier mais aussi les zones in-
dustrielles à l’abandon, sont vastes et permettent de travailler à des
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 69 11/12/08 15:04:04
70 Le paysage façonné
échelles colossales, tout en étant sources de matériaux peu coûteux et
déjà sur place. De si grandes surfaces ne pourraient être ni trouvées,
ni exploitées en régions urbaines. Ainsi Smithson, tout en affirmant
qu’il ne saurait travailler dans les villes, qu’il est nécessaire pour lui
d’aller en périphérie, en marge, ajoute : « l’immobilier aussi, dans les
villes, est trop cher ; alors c’est pratique, en fait, d’aller vers les zones
vides et désaffectées, qu’elles soient naturelles ou qu’elles soient le
résultat de l’intervention humaine, et de les reconvertir » (Flam,
1996 : 29720).
Pour l’emplacement de la Spiral Jetty, Smithson conclut un bail
emphytéotique de vingt ans, que sa succession – Nancy Holt – a par la
suite reconduit. La construction de la Jetty est assurée avec l’aide
financière de Virginia Dwan, la galeriste-mécène qui fournit aussi les
fonds pour la fabrication du Double Negative (1969) de Michael Heizer.
Celui-ci, pas plus que Smithson, ne coupe les liens avec les galeries
commerciales. Pour cet artiste, le land art s’exprime en déplacement
de masse, en volume, en matière, en espace. Alors que Smithson sou-
tient qu’un artiste n’est pas plus libre dans le désert qu’à l’intérieur
d’une salle, Heizer déclare qu’il travaille dehors parce que c’est le
seul endroit où il peut déplacer de la matière, à très grande échelle
(Flam, 1996 : 251 et 245). D’ailleurs, pour chacune des œuvres de
Heizer, la quantité de masse extraite ou déplacée est toujours soi-
gneusement indiquée : par exemple, pour le Double Negative, 200 000
tonnes de pierre et de sable retirées. D’autres artistes, comme Nancy
Holt, se dirigent vers le désert par intérêt pour son paysage, pour la
possibilité d’y observer des phénomènes naturels. Car l’art de celle-ci
est nettement dirigé vers le paysage et c’est, selon ses propres termes,
un art à caractère perceptif (perceptual art) (Tiberghien, 1996 : 48). Si
pour Holt les œuvres se développent à partir de leur site, ce n’est pas
comme chez Smithson par une sorte de correspondance formelle
entre l’œuvre et son site mais parce qu’en certains endroits comme le
désert la perception est aiguisée, leur vastitude entraînant une
conscience plus aiguë de la nature, des cycles célestes. Il en va ainsi
des Sun Tunnels où l’on peut observer à partir d’un lieu privilégié les
solstices et les constellations, de même que l’impressionnant paysage
du Great Basin Desert, (en)cadré21 par les quatre tubes géants qui
composent l’œuvre.
20. Je souligne.
21. « a framing of the landscape » (Holt, 1977 : 35).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 70 11/12/08 15:04:04
chapitre 2 • appropriations 71
Préalablement à cette œuvre monumentale, Holt réalise d’autres
travaux similaires mais plus petits et non permanents, les locators (View
through a Sand Dune et Missoula Ranch Locators de 1972), qui sont aussi
des viseurs permettant de cadrer le paysage : « l’œuvre devient un
point focal humain et ainsi ramène le vaste paysage à des proportions
humaines, faisant de l’observateur le centre des choses » (Holt,
1977 : 34).
2.4 NANCY HOLT, VIEW THROUGH A SAND DUNE, 1972.
NARRAGANSETT BEACH, RHODE ISLAND
Photographie : Nancy Holt.
Œuvre reproduite avec l’aimable autorisation de l’artiste
Nancy Holt connaît bien la photographie22, on dirait même
qu’elle fabrique des appareils basés sur ses modalités premières, point
de vue (le sujet comme centre), rassemblement et perspective. « Il
s’agit d’élaborer des structures pour concentrer nos perceptions, les
canaliser et leur donner une profondeur et aussi, une désorientation
visuelle dans l’espace, que nous n’avons pas habituellement l’oppor-
22. Elle fait ses débuts à titre de photographe : « In the mid-1960s Nancy Holt was known in
New York City as a photographer, a filmmaker and a concrete poet » (Shaffer, 1983 : 169).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 71 11/12/08 15:04:06
72 Le paysage façonné
tunité d’expérimenter » (Castle, 1982 : 90). Expérience inhabituelle,
sauf lorsqu’il s’agit de prise photographique.
Le déplacement, tout comme le paysage, tient une grande place
dans les travaux de Holt. De 1969 à 1971, elle conçoit les Buried Poems
qui sont comme autant d’invitations au voyage adressées à cinq de ses
amis, Heizer, Philip Leider, Carl Andre, John Perreault et Smithson.
Pour eux, elle ensevelit des poèmes dans différents sites isolés et leur
offre un ensemble de documents et de directives, formant plaquette,
pour s’y rendre. Cette plaquette contient des textes et indications,
des cartes postales et plusieurs cartes géographiques à diverses échel-
les, en rapport avec le lieu choisi.
2.5 NANCY HOLT, BURIED POEMS (DÉTAIL), 1969-1971
Reproduit avec l’aimable autorisation de Nancy Holt
De même que Smithson avec ses non-sites et bien d’autres de
leurs collègues land artists, Nancy Holt fait grand usage de cartes géo-
graphiques. Et celles-ci sont généralement associées à la représenta-
tion paysagère, quoiqu’elles « construi[sen]t le réel plus qu’elle[s] ne
le représente[nt] » (Tiberghien, 1993 : 165). Selon Malcolm Andrews,
cette identification de la carte au paysage serait due au fait que les
travaux du cartographe et ceux du peintre de paysage ont longtemps
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 72 11/12/08 15:04:07
chapitre 2 • appropriations 73
été intimement liés – au XVIIe siècle, peintre et cartographe n’étaient
souvent qu’une seule et même personne. Andrews soutient par
ailleurs que l’on s’absorbe de manière similaire dans l’observation
d’une carte et dans celle de tableaux ou de photographies de paysage
offrant une vue large (1999 : 82). Je crois pour ma part ce n’est pas
tant la manière d’appréhender cartes et représentations paysagères
qui crée cette analogie réceptive, mais bien leur étroite relation au
déplacement, au voyage qui est le mode privilégié d’appréciation du
paysage. Les cartes sont, tout comme les paysages représentés, alliées
aux conquêtes, grandes et petites. Elles permettent d’obtenir une
description (ou de bâtir l’image) des empires (McLuhan, 2002 : 11),
de rêver à des destinations lointaines et exotiques ou bien d’effectuer
le voyage. Carte et photographie partagent en outre cette « sournoise
rhétorique » de la neutralité (Harley, 2001 : 168) qui fait que l’on ne
met pas en question la réalité ou la vraisemblance de la chose dont on
voit une image.
This is one of many parallels that can be drawn between the analysis of
maps and the interpretation of photographs based on the traditional
assumptions that cartographic and photographic representation are
neutral and objective, the former due to its scientific origins, the latter
because of its mechanical origins (Schwartz, 1996 : 45).
On prête à la cartographie la même objectivité, la même capa-
cité de mimétisme, voire la même transparence qu’à la photographie,
allant même jusqu’à parler, au sujet de la carte, de « miroir de la na-
ture » (Harley, 2001 : 154) comme on a dit de la photographie qu’elle
était un miroir qui garde toutes les empreintes dès l’apparition des pre-
miers daguerréotypes. La carte, en mettant généralement le pays qui
l’émet au milieu de la représentation, reprend également un point
de vue central, qui serait celui de la nation (le sujet collectif) produc-
trice, les autres territoires lui devenant périphériques. Cette sorte
d’élaboration graphique permet d’établir une « perspective sélective
sur le monde » (Harley, 2001 : 162), en même temps qu’une image
ordonnée de celui-ci.
Étant donnée l’immensité du territoire où les land artists opè-
rent, il n’est pas étonnant qu’ils partagent avec leurs concitoyens une
« image topographique » typiquement états-unienne23 et que pour
eux, la carte soit à la fois un dispositif opératoire permettant de se
23. «The trucker listening to WABP, the cowboy reciting his brag, the earth artist executing a
gigantic work at a distance of a few feet, all carry in their head the topographical image,
which, at any given point on the surface, has more interest than the terrain they can
actually see » (Hickey, 1971: 47).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 73 11/12/08 15:04:07
74 Le paysage façonné
rendre sur les lieux de leurs travaux et un objet en soi, une partie de
l’œuvre. D’après Smithson, l’on peut parler de mapscapes et de carto-
graphic sites (Flam, 1996 : 91). Pour Nancy Holt, le spectateur de ses
œuvres est un voyageur auquel elle fournit tous les instruments utiles
au déplacement et à la découverte, des outils qui lui permettront
d’aller en re-connaissance vers un site sélectionné et marqué ; ainsi
les mots et les photographies de l’œuvre sont des traces mémorielles,
et non des objets d’art, soutient-elle. Au mieux, elles incitent les gens
à aller voir l’œuvre elle-même (Holt, 1979 : 37).
Holt invite donc le spectateur à se rendre sur les lieux, à faire in
situ l’expérience de son travail. Paradoxalement, lorsqu’on en a vu les
photographies, l’œuvre est sans surprise. Comme si l’aspect photo-
graphique était contenu à même les travaux de Holt, ce qui les ren-
drait comparables à bien des destinations touristiques :
La plupart des touristes « visionnent » des paysages, des objets célè-
bres, plutôt que de rentrer réellement en contact avec une culture
vivante. Ils vont moins vers des hommes et des pays que vers la chose à
voir, vers une image de ces populations et de ces territoires. Or cette
vision n’a pas grande ressemblance avec la réalité ; elle est réponse à
l’attente des touristes. Ils n’auront même pas à déchiffrer, mais simple-
ment à reconnaître (Bugnicourt cité dans Lanquar, 1990 : 8724).
C’est ainsi que de sa visite aux Sun Tunnels, Gilles A. Tiberghien
affirme : « J’arrive enfin sur le site avec un peu le sentiment de péné-
trer dans une photographie mais pas du bon côté. » (1996 : 41)
La parcelle de terrain sur laquelle ses Sun Tunnels sont érigés
appartient à Nancy Holt qui en fait l’acquisition en 1974. Elle est par
ailleurs propriétaire d’un certain nombre de terrains voisins de celui
où se trouvent les Tunnels, dans le Great Basin Desert.
L’acquisition de terrains, par achat ou par bail emphytéotique,
est pratique courante chez les land artists états-uniens. Cette nécessité
de posséder des terres pour édifier des œuvres colossales, ainsi que le
déplacement de matière et le terrassement à grande échelle qui dis-
tinguent le land art des États-Unis, sont dénoncés par d’autres prati-
ciens que l’on associe également au land art, des artistes européens
qui n’opèrent généralement le « marquage de sites » que par des
interventions très légères, ou par la photographie. Richard Long,
artiste britannique qui pratique déjà dans les années 1960 et pour qui
« c’est la photo qui est la sculpture » (Lippard, 1973 : 74), accuse ainsi
24. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 74 11/12/08 15:04:08
chapitre 2 • appropriations 75
le « soi-disant « land art américain » d’être « de l’art vraiment capita-
liste » (Long cité dans Andrews, 1999 : 215).
I never identified myself as a “land artist”. To me, this was a term coi-
ned by American curators or critics to define an American movement
which, for me as an English artist in the sixties, I saw as American
artists working in their own backyards, using their deserts to make mo-
numental work, and only in America. They needed a lot of money to
make art as they had to buy land, or hire bulldozers, so it was about
ownership, real estate, machinery, American attitudes (Long cité dans
Boettger, 2002 : 172).
2.6 NANCY HOLT, SUN TUNNELS, 1973-1976.
GREAT BASIN DESERT, UTAH
Photographie : Suzanne Paquet, 2000
Le fait est que ces artistes ne veulent pas faire autre chose qu’un
art qui serait américain, précisément. Pour Heizer, c’est l’échelle qui
donne à sa sculpture ce caractère (Celant, 1997 : 404), tandis que
pour Smithson, il s’agit de trouver une manière qui serait ancrée dans
sa propre expérience en Amérique, une manière lui permettant de
« trouver [s]a voie propre, pour émerger de sous les amoncellements
d’histoire européenne » (Flam, 1996 : 284-286). Et quoi de plus im-
portant pour la nation états-unienne et ses citoyens que l’étendue de
son territoire, et sa domination? On peut voir dans la sortie des artis-
tes de leurs ateliers pour aller vers les déserts de l’Ouest une réédition
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 75 11/12/08 15:04:09
76 Le paysage façonné
de la conquête du XIXe siècle, alors que c’est par la mobilité, par la
prise sur le territoire de même que par la description de son paysage,
en peinture et en photographie, que passait la quête d’identité du
pays, sa Manifest Destiny25. Lawrence Alloway parle d’American Sublime
au sujet des grandes œuvres du désert, un sublime qui serait lié à la
peinture de paysage des XVIIIe et XIXe siècles (Alloway, 1976 : 52). On
peut sans doute assimiler les land artists des années 1960 et 1970 à des
surveyors, des topographes nouveau genre, qui re-découvrent les terri-
toires de l’Ouest. Ils mettront aussi en vue d’autres frontières, la ban-
lieue et les zones périurbaines postindustrielles.
The regional self-identification with the pioneer spirit celebrated by
westerns can be considered akin to that of the avant-garde – both ope-
rate as explorers in advance of a regiment treading paths previously
established. Recalling their first trip to New Jersey to look for land on
which to investigate the possibility of building sculptures directly in
the ground, Dwan remarked of the group, which included “Morris,
Andre, the two Smithson [Robert and Nancy , who used that last name
in the sixties], and myself…We had a terrifically pioneering feeling”.
For several reason, then, it was inevitable that earth-workers would
turn to the West – sometimes even assuming the demeanor of cowboy
bravado – to probe a cultural frontier (Boettger, 2002 : 126).
Comme tous les conquérants, les land artists vont systématique-
ment du centre vers la périphérie, où ils mettent en réserve, marquent ou
façonnent des paysages emblématiques dont la pérennité, au centre,
sera assurée par des images. Cela se passe exactement comme pour
les grandes et les petites conquêtes, l’ouverture de la frontière à
l’Ouest, ou bien le tourisme. Dans tous les cas, le land art compris, la
chose vraie, tout comme sa reproduction mécanique, sont peu à peu sacra-
lisées.
Pourtant, à la fin des années 1960, d’aucuns supposent au
contraire que le mouvement des artistes vers l’extérieur, le caractère
éphémère de certaines interventions et l’importance prise par leur
documentation feront sortir l’art du circuit commercial.
It seemed in 1969 […] that no one, not even a public greedy for no-
velty, would actually pay money, or much of it, for a Xerox sheet refer-
ring to an event past or never directly perceived, a group of photogra-
phs documenting an ephemeral situation or condition, a project for
work never to be completed, words spoken but not recorded ; it seemed
25. Hamish Fulton, autre artiste britannique dont les interventions sont des photographies :
« I feel the three artists you mention [Smithson, Heizer, De Maria] use the landscape with-
out… any sense of respect for it… I see their art as a continuation of “Manifest Destiny”…
the so-called “heroic conquering” of nature. » (Cité par Beardsley, 1984 : 44)
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 76 11/12/08 15:04:09
chapitre 2 • appropriations 77
that these artists would therefore be forcibly freed from the tyranny of
a commodity status and market-orientation (Lippard, 1973 : 263).
Des artistes du land art il est vrai de dire, tout comme de leurs
contemporains, tenants d’un art conceptuel, qu’ils utilisent les mé-
dias de masse, les magazines, les journaux et les médias électroniques
tels la télévision pour mieux diffuser leurs travaux. Des artistes font
paraître des œuvres et des documents dans les revues, spécialisées ou
non. C’est ainsi que, par exemple, les « Incidents of Mirror-Travel in
the Yucatan » de Smithson, qui est un non-site tout comme « A Tour
of the Monuments of Passaic, New Jersey », est publié dans Artforum
en 1969 et « Sun Tunnels » de Nancy Holt, article plutôt documen-
taire, paraît dans le même magazine en 1977 ; Smithson publie aussi
dans Harper’s Bazaar (1966) et dans Landscape Architecture (1968). Des
œuvres de land art sont filmées pour la « galerie télévisuelle » (Fernse-
hengalerie) de Gerry Schum, par laquelle seront présentées sur les
ondes en 1969 des œuvres de Smithson, de De Maria, de Heizer et de
Dennis Oppenheim, ainsi que des travaux des Européens Marinus
Boezem, Jan Dibbets, Barry Flanagan et Richard Long. En 1967,
Smithson prévoit déjà retransmettre à l’intérieur des travaux exécu-
tés à l’extérieur (Flam, 1996 : 56). Pour lui, « aussi loin que vous alliez
en périphérie, l’art sera toujours transmis d’une façon ou d’une
autre, il y aura un retour d’information » (Flam, 1996 : 234). À propos
de ses travaux éphémères, il affirme que si une œuvre est suffisam-
ment forte et proprement photographiée elle est incorporée dans une
situation de distribution de masse (Flam, 1996 : 235). Cet intérêt pour
la photographie comme véhicule apte à transmettre l’art est manifes-
tement partagé par ses collègues Oppenheim (« Alors l’œuvre d’art
doit maintenant être visitée, ou abstraite, par une photographie,
plutôt que fabriquée. ») et Heizer (« Je crois que certaines photogra-
phies proposent une manière précise de voir les œuvres. ») (Flam,
1996 : 251).
Il convient de considérer l’importance que l’on a bien voulu
accorder à la dématérialisation des œuvres d’art et aux effets de leur
transmission à la lumière d’une certaine pensée qui se répand à la fin
des années 1960, celle de l’avènement d’un « village global » dans
lequel l’information et sa circulation seraient un principe essentiel.
Marshall McLuhan est l’un des plus célèbres tenants de cette pensée
qu’illustrent deux de ses principaux ouvrages qui ont un grand succès
dès leur publication. La galaxie Gutenberg dénonce la spécialisation
visuelle du sujet moderne et prédit un grand changement social, une
« re-tribalisation » du monde entier, formant ce fameux « village », qui
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 77 11/12/08 15:04:09
78 Le paysage façonné
s’effectuerait grâce aux « conditions électriques du mouvement
simultané de l’information et la totale interdépendance humaine »
(McLuhan, 2002 : 276). Dans un autre livre, Pour comprendre les médias,
l’auteur propose ceux-ci comme « les prolongements technologiques
de l’homme ». McLuhan est aussi celui qui déclarera que « le message
est le médium », formule qui aura une grande fortune et à laquelle on
peut déjà associer l’art conceptuel et toutes ces formes d’art qui se
présentent comme « des signes qui véhiculent des idées, qui ne sont
pas des choses mais des symboles ou des représentants de choses »
(Lippard et Chandler, 1968 : 32). À propos de ce type d’œuvres, Lucy
R. Lippard et John Chandler affirment en effet : « Un tel travail est
un médium plutôt qu’une fin en soi ou de “l’art pour l’art”. »
(1968 : 32)
Pourtant, malgré le fait que les land artists investissent des lieux
inédits et qu’en conséquence ils cherchent des moyens de transmet-
tre leurs œuvres (d’où l’importance prise par les documents), ce sont
plutôt d’anciennes notions qui restent omniprésentes dans le land
art : le point de vue de la photographie, qui fait apparaître le paysage
et aussi, cette impulsion nationaliste (états-unienne) qu’est sans
aucun doute le retour à la frontière des artistes dans les années 1960.
Dans The Gutenberg Galaxy, Marshall McLuhan explique que c’est
l’homogénéité, la linéarité et la reproductibilité, caractéristiques tant
de l’imprimerie que de la perspective picturale dont les inventions sont
concurrentes dans le temps, qui fondent le sujet occidental et ce
point de vue qui lui est propre26. La photographie est évidemment,
pour McLuhan, en prise directe avec l’homme typographique et son
point de vue fixe (2002 : 129). Fait à signaler, ce point de vue est celui,
subjectif, de l’individu, mais aussi le point de vue partagé dont sont
issus les nationalismes. Et pour McLuhan, le nationalisme dérive du
point de vue fixe qui naît alors qu’émergent l’imprimé, la perspective
et la quantification visuelle. Il ajoute qu’un point de vue peut être
collectif ou individuel ou les deux, suscitant d’importantes discordan-
ces et une grande diversité de visions (2002 : 220).
De même, en dépit de l’apparition de l’« image mosaïque »,
celle de la télévision absolument différente de l’image photographi-
que qui, selon McLuhan, en parcellisant et en animant le « point de
vue fixe » de l’homme typographique, doit provoquer l’avènement
26. Rejoignant ainsi les affirmations de Gombrich (que McLuhan examine), de Panofsky et de
Damisch : voir le premier chapitre.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 78 11/12/08 15:04:10
chapitre 2 • appropriations 79
d’un homme nouveau (« l’homme électronique de l’ère graphique »),
les artistes du land art travaillent toujours avec les outils anciens du
conquérant-surveyor, du voyageur. Smithson est à ce propos fort réa-
liste : « Les manifestations de la technologie sont parfois moins des
« extensions » de l’homme (l’anthropomorphisme de McLuhan) que
des agrégats d’éléments. Même les outils et les machines les plus per-
fectionnés sont tous faits de la matière brute de la terre. » (Flam,
1996 : 100-101) L’usage de photographies, de cartes, voire de films et
d’images télévisuelles, l’importance de la mobilité, tant des artistes
que de leurs œuvres – mobilité qui serait transmission dans le cas de
celles-ci –, sont certainement des éléments déterminants dans l’art
des années 1960 et 1970 aux États-Unis. Mais, les moyens dont usent
les artistes ne participent pas, ou si peu, de cette mobilité « électroni-
que » ou de ces modes de communication qui seraient au fondement
d’un « village global » selon McLuhan.
Si l’on considère les déplacements d’objets et de gens qui carac-
térisent le land art, ceux-ci font plutôt des artistes et des spectateurs,
des topographes ou des touristes. Côté communications, comme le
dit Lucy Lippard, il n’y a rien d’autre qu’une « révolution mineure »,
grâce aux quelques images diffusées à la télévision, aux quelques per-
cées effectuées dans les mass media. Et Lippard ne prend que six ans
pour comprendre que la dématérialisation de l’œuvre d’art n’aura
pas lieu.
Clearly, whatever minor revolutions in communication have been
achieved by the process of dematerializing the object (easily mailed
work, catalogues and magazine pieces, primarily art that can be shown
inexpensively and unobtrusively in infinite locations at one time), art
and artist in a capitalist society remain luxuries (Lippard, 1973: 263).
Quoi que l’on ait pu croire à la fin des années 1960, il n’y aura
pas de réelle indépendance des artistes envers les objets, non plus
que de changements foudroyants dans les modes de communication.
Et les documents, qui parfois sont l’œuvre elle-même, avant même que
d’être sacralisés, bientôt se monnayent. En effet, même si les artistes
veulent user des médias aux fins d’une plus large propagation de
leurs œuvres, cela n’empêche nullement l’insertion dans le circuit
commercial de ces « reproductions mécaniques » (des produits déri-
vés?), photographies, films, photostats et montages en tous genres :
Smithson : “That’s the collecting situation. The Jetty and the Broken
ircle really aren’t collectibles. They’re supported through the coope-
C
ration of different groups that have no commodity fetish.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 79 11/12/08 15:04:10
80 Le paysage façonné
Kurtz : But there’s a commodity fetish in photographs, and the film –
that sort of things.
Smithson : Oh, yeah, but realistically speaking… film is another area
again… the prices for photographs and films and that sort of things
are equitable. I sell prints of my film for 500 $, I’m not saying down
with money or anything like that. I’m saying let’s understand an alter-
native value system where actually artists might be more in control of
their own value” (Flam, 1996 : 267).
Lawrence Alloway affirme que la distribution d’information
concernant les earthworks dépend encore des ressources tradition
nelles des marchands d’art et que seul Smithson imagine une façon
d’utiliser ces ressources en les intégrant directement à ses œuvres
(1983 : 133). Il parle évidemment des non-sites, en particulier de ceux
qui sont rattachés à des œuvres existant ailleurs, en périphérie, dont
Spiral Jetty. Ce sont sans conteste les documents ou les reproductions
mécaniques des œuvres, celles de Smithson comme celles de ses collè-
gues, qui auront tout l’impact (lorsque ramenés au centre), un peu à
la façon dont les collections de stéréogrammes de l’Ouest lointain
fascinaient leurs collectionneurs de l’Est au XIXe siècle. Toutefois, si
les images photographiques du XIXe siècle avaient un air de neutra-
lité parfaite (le double ou l’équivalent du réel), on sera tenté de voir
dans les indicateurs, les reproductions d’œuvres monumentales du
land art, un effet de la saisie différente qu’appellent ces travaux, une
appréhension qui ferait appel à autre chose que le point de vue tradi-
tionnel du sujet par rapport au paysage :
Unintelligible at close range, the spiral form of the Jetty is completely
intuitable only from a distance, and that distance is most often achie-
ved by imposing a text between viewer and work. Smithson thus accom-
plishes a radical dislocation of the notion of point-of-view, which is no
longer a function of physical position, but of the mode (photographic,
cinematic, textual) of confrontation with the work of art (Owens,
1992 : 47).
Ce qu’Owens décrit comme une « dislocation radicale de la no-
tion de point de vue » m’apparaît comme étant l’exact contraire. Une
approche autre, plus physique, semble nécessaire à l’appréciation des
œuvres du land art, approche effectivement revendiquée par les land
artists tout comme par les minimalistes, après le récit que fait Tony
Smith de son expérience sur le New Jersey Turnpike en construction
(Wagstaff Jr, 1966 : 1927). Dès lors, on suppose que le spectateur doit
27. « There is no way you can frame it, you just have to experience it. » L’épisode est célèbre,
qui donne lieu à une longue controverse, Smith (et par la suite ses collègues) privilégiant
la « théâtralité », contre Michael Fried qui la rejette (1967).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 80 11/12/08 15:04:10
chapitre 2 • appropriations 81
se situer dans l’œuvre, plutôt que devant elle et que son appréciation
nécessite un certain mouvement, dans ou autour d’elle. Il y a là une
volonté que l’on pourrait qualifier de mcluhanesque de faire éclater
le point de vue unique généralement posé sur les œuvres. Cepen-
dant, dans la mesure où à peu près personne ne fait l’expérience in
situ des œuvres, le fait qu’elles ne soient connues que par des images
réinstaure précisément, à mon avis, la position conventionnelle du
sujet, le point de vue. D’une part, la distance est une composante
nécessaire à la saisie perspective ; d’autre part, interposer une photo-
graphie, ou même un texte (le « from where I am sitting », la position de
« l’homme typographique » de McLuhan), entre l’œuvre et le specta-
teur reconduit (ou même fabrique) le point de vue. Il n’y a de vision
qu’astreinte à une distance en même temps qu’à un point de vue
donné, affirme Hubert Damish, comme on l’a vu précédemment. Du
coup, dans le cas de la Jetty comme dans celui de la plupart des gran-
des œuvres du désert – celles de Heizer, de De Maria, de Holt –, cette
interposition est susceptible de transformer les œuvres en paysages.
Car il semble que lorsqu’il est question du land art, les photographies
qui interviennent entre l’œuvre et le spectateur agissent plutôt
comme ces vues à l’usage des touristes qui redoublent le site réel – les
recorded sights de Joel Snyder –, que comme des reproductions d’œuvres
d’art.
Regarder une image de Yosemite Valley prise par Ansel Adams n’est
pas la même chose que contempler une reproduction photographi-
que des Ménines de Velasquez. La photo d’Adams est une vue et non
pas un simple tenant-lieu de la vallée réelle, alors que la reproduction
des Ménines n’est que le tenant-lieu du tableau réel. La reproduction
ne fonctionne pas comme une vue analogique du tableau. On ne dira
jamais : Ah, voilà une belle vue des Ménines ! (Schaeffer, 1987 : 28).
Les photographies des earthworks monumentaux sont précisé-
ment plus que des tenants-lieux. L’usage qui est fait de ces images
corrobore une telle idée. Car ce sont des vues qui assureront la for-
tune du land art, non pas seulement dans le champ de l’art, mais dans
un domaine connexe, celui du « paysage » – conçu comme objet de
l’aménagement et comme objet théorique. Et l’on peut présumer
que l’allure d’American Sublime des œuvres de land art contribuera à
en faire les paysages spectaculaires que l’on sait.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 81 11/12/08 15:04:10
82 Le paysage façonné
UNE NOUVELLE TOPOGRAPHIE
(OU L’ART DE LA PÉRIPHÉRIE)
Le « supplément documentaire » (Krauss, 1993 : 76), sur le mo-
dèle des indicateurs de spectacles, lorsque ramené de la périphérie vers le
centre ferait donc du land art un « art du paysage ». J’aurai plus loin
l’occasion de décrire longuement la chaîne des médiations par la-
quelle cela peut advenir, de façon à faire ressortir, tout particulière-
ment, les interactions entre différents agents humains issus de diffé-
rents champs professionnels.
Mais auparavant, suivons encore un moment quelques-uns des
topographes nouveau genre des années 1970, de ceux que l’on re-
trouve sur cette nouvelle frontière postindustrielle, la banlieue et ses
zones périurbaines.
Suburbia literally means a “city below” ; it is a circular gulf between city
and country – a place where buildings seem to sink away from one’s
vision – buildings fall back into sprawling babels or limbos. Every site
glides away towards absence. An immense negative entity of formles-
sness displaces the center which is the city and swamps the country
(Flam, 1996 : 91).
Robert Smithson, avec ses non-sites, est indiscutablement l’un
des pionniers des artistes-topographes en territoires postindustriels.
Sa « dialectique » centre et périphérie l’attire d’abord en banlieue,
puis dans le désert et plus tard vers des sites dévastés par l’industrie.
En plus de prélever en ces lieux des matériaux pour ses œuvres et
bientôt de les marquer physiquement, il en dresse des cartes, il en fait
des relevés, photographiques ou autres.
Les artistes du land art utilisent largement les documents photo-
graphiques, tout comme les artistes dits conceptuels, à la même épo-
que. Que l’on songe à Edward Ruscha avec ses Twentysix Gasoline
Stations de 1962, Some Los Angeles Appartments de 1965 ou à Dan
Graham avec ses « Homes for America » de 1966. Au même moment
la photographie, dont les praticiens cherchent encore à lui donner
ses lettres de noblesse, émerge peu à peu comme un art à part entiè-
re. (Dennis Oppenheim affirme en 1970 que l’image photographi-
que sera, un jour, plus importante qu’elle ne l’est à ce moment, que
les photographes s’attireront plus de respect. « Nous pouvons croire »,
dit-il, « que l’art s’est éloigné de sa phase matérielle et que mainte-
nant les préoccupations en sont plutôt la localisation des matériaux
et la spéculation » (Flam, 1996 : 251)).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 82 11/12/08 15:04:11
chapitre 2 • appropriations 83
Déjà, un certain nombre de photographes s’occupent à faire
des relevés dans les zones industrielles à l’abandon et sur les sites des
nouvelles industries légères en régions périurbaines, ainsi que dans
les banlieues. Bernd et Hilla Becher sont de ceux-là. Dès la fin des
années 1950, ils répertorient les architectures techniques à l’aban-
don, usines, châteaux d’eau, chevalements et moulins de mines, entre
autres. Anne-Françoise Penders fait d’ailleurs remarquer que les
photographies de « A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey »
de Smithson sont « comme construites sur le modèle de celles de
Bernd et Hilla Becher » (Penders, 1999 : 16928). Il est évident qu’en
cette ère postindustrielle qui s’amorce, un intérêt pour la documen-
tation de la désaffec(ta)tion et des changements que subit le paysage
occidental est partagé par divers groupes d’artistes (chez les land
artists, Smithson est toutefois le seul à s’y intéresser, l’attention de ses
collègues ne se manifestera que plus tard) et que l’usage de la photo-
graphie, certes, les rassemble : « Pour chaque photographe qui se
prétend artiste, il y a un artiste qui court le grave danger de se trans-
former en photographe » (Foote, 1976 : 4629).
En 1975, Bernd et Hilla Becher participent à l’exposition New
Topographics présentée au International Museum of Photography de
Rochester, exposition qui deviendra un incontournable de l’histoire
de la photographie. À tel point que l’on parle de nos jours d’un grou-
pe qui porterait ce nom et que tous ceux qui photographient des
paysages postindustriels dévastés se réclament de celui-ci, alors que
les images montrées dans New Topographics sont toutes des images…
de banlieues et de strips, sauf celles des Becher. L’appellation « new
topographics » est ainsi devenue une sorte de paradigme, une « boîte
noire ».
New Topographics regroupe outre les Becher, Robert Adams, Joe
Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore,
Henry Wessel Jr. et Lewis Baltz. La plupart de ces photographes,
jeunes à l’époque, deviendront par la suite des spécialistes du paysage
altéré ou du paysage économique. Le commissaire William Jenkins
revendique une certaine unité stylistique pour New Topographics. Il
propose deux prédécesseurs en termes (d’absence) de style des
images réunies dans l’exposition : Edward Ruscha dont les séries sont
apparemment parfaitement neutres et Timothy O’Sullivan qui,
28. Penders ajoute que Smithson connaissait « plus que certainement déjà » le travail des
Becher.
29. Dans cet article, Foote rapproche les « Monuments of Passaic » du travail des Becher et
ceux-ci d’Edward Ruscha (1976 : 50-51).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 83 11/12/08 15:04:11
84 Le paysage façonné
t ravaillant sans précédent d’aucune sorte lorsqu’il photographiait les
déserts de l’Ouest, ne pouvait avoir de style particulier. En outre,
selon son commissaire, New Topographics rassemble des photographies
strictement descriptives selon le sens premier du mot topographie,
soit la description précise et détaillée d’un endroit ou d’un territoire
particulier. L’ensemble doit être objectif, c’est-à-dire sans opinion et
sans jugement (non-judgemental) envers les choses et les situations
photographiées ; il s’agit d’exposer, c’est-à-dire d’énoncer par la pho-
tographie, « ce que cela veut dire de faire une photographie docu-
mentaire » (Jenkins, 1975 : 7).
The ideal photographic document would appear to be without author
or art. Yet of course photographs, despite their verisimilitude, are abs-
tractions ; their information is selective and incomplete (Baltz, cité par
Jenkins (1975 : 7)).
Lewis Baltz fait ses débuts à la fin des années 1960 avec des ima-
ges qui rappellent en effet (et que longtemps la critique comparera
à) certaines œuvres d’art conceptuel, celles de Ruscha en particulier.
Il travaille en séries, la réalisation de certaines d’entre elles pouvant
s’étaler sur plusieurs années. Ces séries se composent d’images froi-
dement cadrées, généralement frontales, de motifs tous similaires,
telles les Tract Houses (1969-1971) photographiées dans les faubourgs
de Los Angeles. Le travail de Baltz est aussi parfois associé à l’art
minimal parce qu’il organise ses photographies en grilles et que les
sujets photographiés, à tout le moins dans ses premières séries, sont
géométriques30.
Dans l’exposition New Topographics, Baltz présente l’une de ces
suites disposées en grille, The New Industrial Parks Near Irvine, Califor-
nia, réalisée en 1974 et en 1975. Les motifs photographiés sont des
bâtiments et des parties d’édifices dans lesquelles l’artiste cherche
manifestement les formes régulières, géométriques. Ces nouveaux
parcs industriels qui apparaissent dans l’Ouest, tout comme les mai-
sons de banlieues et les roulottes photographiées par Robert Adams,
Joe Deal et Henry Wessel Jr. sont typiques du nouveau paysage états-
unien d’après-guerre, celui-là même, modelé par l’automobile et la
car culture qu’étudie John B. Jackson dans divers essais, entre
autres The Westward-Moving House (1953), The Movable Dwelling and
30. Association un peu abusive à mon avis, mais souvent reprise. Voir, entre autres, Rian
(2001 : 7-8) ; l’essai de Mark Haworth-Booth pour Lewis Baltz (1986). Voir également
Lamarche-Vadel (1993 : 17-18) : « il est clair que cette époque de son travail répercute tout
autant, entre Edward Ruscha et Bruce Nauman, entre Warhol et Carl Andre, les principes
de la réduction formelle radicale élaborée par le minimalisme » (!).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 84 11/12/08 15:04:11
chapitre 2 • appropriations 85
How It Came to America (1984) et Auto Territoriality (1968), dans lequel
il affirme : « Alors que les visions utopiques traditionelles ont été
bâties à partir d’une structure communale, les Américains modernes
tentent de construire des utopies très personnelles, ou tout au moins
familiales – des utopies structurées autour de maisons séparées, de
télévisions, d’automobiles » (Jackson, 1997 : 353).
2.7 LEWIS BALTZ, QUATRE ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE
THE NEW INDUSTRIAL PARKS NEAR IRVINE, CALIFORNIA
COMPOSÉE DE 51 PHOTOGRAPHIES, 1974-1975
Reproduit avec l’aimable autorisation de Lewis Baltz
Coll. Centre canadien d’architecture, Montréal.
Les parcs industriels se trouvent en zones périurbaines, autour
des banlieues ou à la sortie des villes. Ce sont des regroupements
d’industries légères qui usinent des composantes informatiques, qui
se consacrent à la fabrication des pièces nécessaires aux technologies
de l’information d’apparition récente et en progression constante.
Another product of sprawl is the “technoburb” found along highways
[…]: mysterious buildings in yardlike settings are called “research
parks”, and there is little indication of what goes on inside them.
Replacing easily identified heavy industry, they blur the lines between
city and country, home and business (Lippard, 1997 : 233).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 85 11/12/08 15:04:12
86 Le paysage façonné
Malgré la volonté purement descriptive de l’observateur neutre
que Baltz défend à ses débuts (le document « sans art », « sans auteur »),
sa photographie, et celle de ses collègues également, devient bientôt
critique. Devant ces paysages en mutation, en dissolution, les photo-
graphes prennent finalement position, contrairement à Robert
Smithson pour qui l’entropie et le désordre, même causés par l’hu-
main, sont dans l’ordre des choses31.
Lewis Baltz réfère lui aussi à l’entropie, mais ce sera pour
dénoncer les manœuvres d’une économie en changement. À l’instar
de Robert Smithson, Baltz s’intéresse à la périphérie, que l’on peut
d’après ses travaux des années 1970 et 1980, classer en deux types : le
périurbain des technoburbs et les déserts de l’Ouest en voie de (sub)
urbanisation. Peu de temps après avoir terminé sa série sur Irvine,
Baltz entreprend de nouveaux projets, retraçant l’apparition d’habi-
tations dans les déserts de l’Ouest des États-Unis. Du milieu jusqu’à la
fin des années 1970, il travaille surtout en Californie, au Nevada et en
Utah, toutes régions qui sont montrées comme des zones en transfor-
mation. Sur des sites arides, autrefois exploités uniquement pour leur
richesse minérale, se déploient de nouvelles constructions, banlieues
de nulle part. La série Nevada (1977), qui comprend quinze images,
décrit une pareille irruption.
2.8 LEWIS BALTZ, DEUX ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE NEVADA
COMPOSÉE DE 15 PHOTOGRAPHIES, 1978
Reproduit avec l’aimable autorisation de Lewis Baltz
The Altered Landscape Collection, Nevada Museum of Art, Reno.
31. Parlant de désastres causés par l’humain, tel Salton Sea en Californie (une erreur d’ingé-
nieurs qui, voulant empêcher une région d’être inondée par les crues de la rivière Colo-
rado, en inondèrent une autre, formant ainsi le plus grand lac de Californie), Smithson
affirme : « so that here we have an example of a kind of domino effect where one mistake
begets another mistake, yet these mistakes are all curiously exciting to me on a certain
kind of level – I don’t feel them depressing » (Flam, 1996 : 305).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 86 11/12/08 15:04:13
chapitre 2 • appropriations 87
Park City que Baltz crée de 1978 à 1981, examine une mutation
similaire, en 102 photographies. L’échelonnement du travail sur qua-
tre ans permet à son auteur d’enregistrer toutes les étapes de la trans-
formation d’un ancien village minier en un village à vocation récréa-
tive où le ski sera la principale activité. Année après année, les ruines,
les saletés, les monceaux de détritus laissés par la mine font place à
des constructions neuves, à un village de résidences secondaires,
autre phénomène tributaire de la mobilité américaine, mobilité
sociale tout aussi bien que physique.
Construite dans les montagnes, à une heure de route de Salt
Lake City en Utah, Park City est à la fois une banlieue éloignée de Salt
Lake City et un lieu où les résidants de la côte ouest peuvent trouver
de la neige pour skier, occasion rare dans la région. La petite munici-
palité est un autre de ces endroits où, à la vie rude des mineurs, suc-
cède grâce à l’électrification, une vie de banlieue climatisée. Un type
d’opération financière en remplace un autre :
Recycled from the boom and bust cycle of rapacious extraction to the
boom and bust of the recreational cycle, the new Park City has swap-
ped the insecurities of speculation in precious metals for the econo-
mic confidences of snow, no more predictable than the weather and
just about as reliable (Baltz et Blaisdell, 1980 : 230).
Au sujet de l’ensemble de son travail des années 1970 et 1980,
Baltz (1988) se déclare intéressé par une certaine « architecture of
entropy » plutôt que par le paysage mais, selon Michèle Chomette
(1988), il faut « considérer ce travail comme une enquête sur la notion
même de paysage contemporain à travers l’étude des artefacts et de
ses mutations alternées du vide au plein suivant les ressacs d’une civi-
lisation édificatrice ». Poursuivant sur la simultanéité temporelle
entre le land art et les premières œuvres de Baltz, Chomette (1988)
remarque que le travail de ce dernier est « un manifeste esthétique
exemplaire, où la création photographique avec une terminologie
minimale, un refus total du spectaculaire, du séduisant, de l’anecdote
et de toute mise en scène démontre […] l’importance du concept et
du langage visuel du photographe face au réel le plus banal, le plus
dépourvu de caractère et de beauté ».
Cette absence de spectaculaire, cette mise en vue du banal, est
précisément ce qui oppose, en termes de réception, la photographie
artistique et le land art. C’est aussi ce qui rend ce dernier apte à deve-
nir un nouvel art du paysage même si paradoxalement ce n’est, comme
il a été démontré, qu’à travers ses documents. Car, à une époque où
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 87 11/12/08 15:04:13
88 Le paysage façonné
le tourisme est l’activité de loisir la plus prisée en même temps que
l’industrie en voie de devenir la plus importante mondialement, il
faut du spectaculaire. Il faut aussi des lieux où l’on pourrait vouloir se
rendre, même si on reste assis dans son fauteuil et que l’on ne voyage
qu’en imagination. Bref, il faut du séduisant, ce que la photographie
de lieux dévastés ne peut offrir. Pour passer agréablement ses vacan-
ces, l’on n’aurait pas idée d’aller explorer des tas de détritus dans les
ruines d’une ancienne mine32.
2.9 LEWIS BALTZ, QUATRE ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE PARK CITY
COMPOSÉE DE 102 PHOTOGRAPHIES, 1978-1981
Reproduit avec l’aimable autorisation de Lewis Baltz
Coll. The Metropolitan Museum of Art, New York.
Certes, une fois les travaux complétés (ceux de Baltz comme
ceux de la construction du village), l’on se rendra à Park City en vil-
légiature, mais à la vue d’images bien différentes… celles des pros-
pectus de voyagistes ou d’agences immobilières. Dans
��������������������
l’Ouest en pro-
cessus de (sub)urbanisation,
32. À moins d’être l’un des « voyageurs des interstices » décrits par Urbain (1993 : 219-228).
« Ce voyageur est aussi attentif et peut-être même surtout séduit par la découverte ou la
redécouverte des micro-déserts : campagnes abandonnées, réseaux ignorés, exotismes
oubliés » (1993 : 222).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 88 11/12/08 15:04:15
chapitre 2 • appropriations 89
[a] single glance from almost any balcony of any motel anywhere in
the urbanising West will provide identical information. Park City is one
place that anybody can know intimately and completely without ever
visiting. This is another way of saying that the place and everything in
it are in the conditions of photographs (Baltz et Blaisdell, 1980 : 22933).
Telle que décrite par Gus Blaisdell, la condition photographi-
que (« photographic condition ») est un état par lequel un endroit peut
être « connu lorsque l’on en regarde les images » (Baltz et Blaisdell,
1980 : 229). Et quand on connaît ajouterai-je, se rendre sur les lieux
c’est simplement re-connaître. Les Suns Tunnels de Nancy Holt propo-
sent un bel exemple de cette condition photographique puisque
cette œuvre semble contenir d’emblée son aspect photographique.
La photographie de paysage est trop familière, trop intégrée à la
vie de tous les jours, bref trop semblable, pour succéder à la peinture
comme art du paysage, et ce, bien que photographie et peinture par-
tagent les conventions qui ont vu naître le paysage, cadre, point de
vue et liaison. Cela parce que, « du fait qu’il n’est guère de photogra-
phie qui ne paraisse faisable ou même toujours déjà faite à l’état vir-
tuel – puisqu’il suffit d’une simple pression sur un déclic pour libérer
l’aptitude impersonnelle qui définit l’appareil – on veut que la photo
graphie trouve sa justification dans l’objet photographié » (Bourdieu,
1965 : 114). Le monde entier (à peu de choses près) est donc toujours
déjà en condition photographique, il est une série de vues qui n’atten-
dent que d’être enregistrées. Dès lors et puisque l’on ne dissocie
« aucunement l’image de l’objet et l’objet de l’image » (Bourdieu,
1965 : 129), l’on amassera des photos de lieux, de paysages lointains ou
grandioses (du stéréogramme à la carte postale aux prospectus tou-
ristiques), mais l’on ne collectionnera pas nécessairement de la photo-
graphie. Car la photographie, dit Bernard Lamarche-Vadel, « n’a nul
besoin de destinataires, chacun y est à son tour sujet et objet, impli-
qué avant même qu’elle ne s’applique, dans une figure du monde
inséparable désormais de son image. Dispositif technico-optique
normatif du monde, la photographie n’a nul besoin de destinataires
particuliers et d’une certaine manière elle ne peut en avoir, dans la
mesure où ces destinataires éventuels sont rassemblés et inclus par
avance dans une image du monde qui n’a pas d’autre motif que son existence
et sa répétition » (1993 : 19-2034).
33. Je souligne.
34. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 89 11/12/08 15:04:15
90 Le paysage façonné
La photographie artistique, encore plus que de destinataires,
manque de destinations possibles et ne peut donc remporter l’adhé-
sion. Des paysages de Baltz, on ne peut dire que l’objet enregistré par
la vue serait susceptible d’inciter au déplacement. Quant au land art,
il présente les qualités nécessaires pour accéder au rang d’art du pay-
sage : son aspect conquête de territoires hostiles et lointains, par
lequel on a pu l’apparenter à l’ouverture de la frontière et à la domi-
nation du wilderness, redoublé dans (et par) d’incroyables images de
paysages imposants, le rend suffisamment spectaculaire pour tenir
lieu de destination où l’on voudrait se rendre. Et ses documents sont des
images photographiques qui fonctionnent en transparence, comme
des vues enregistrées, des doubles d’un original toujours disponible à la
condition que l’on aille l’admirer in situ.
La sacralisation des sites du land art ainsi que celle de leurs re-
productions mécaniques viendront bien après les années 1960 alors
qu’étaient élaborées les grandes œuvres de land art du désert. Mais
lorsque cela arrive, et peut-être pour mieux consacrer le caractère
artistique d’une certaine photographie, les images des photographes
spécialistes du « paysage altéré » tels Lewis Baltz, feront l’objet de rap-
prochements avec le land art :
Although most earthwork photographs were intentionally understated
descriptive records – certainly a far cry from the “fine art” printing and
aesthetics of traditional landscape photography – the directness of
record photographs by Smithson and others have clear parallels in the
works in New Topographics and numerous later photographs by such
artists as Lewis Baltz, John Pfahl, Joe Deal, and Sharon Stewart. It
hardly matters if these photographers were inspired by or are making
conscious references to earthworks, because viewers will bring these
associations to the work. It is difficult to look at Sant Khalsa’s
photographs of a dam site, Martin Stupich’s view of the Phelps Dodge
open-pit copper mine, Robert Dawson’s view of a concrete irrigation
canal or Marilyn Bridges’s aerial view of prehistoric markings without
thinking of them as earthworks created by unknown engineer/artists
(Southall, 1999 : 43).
Encore ici, l’image et sa chose se confondent. On voit bien que
même pour des critiques avertis, les photographies qui montrent des
œuvres de land art sont des vues et non pas des reproductions d’œu-
vres d’art. Quant aux relations qui sont évoquées pour, semble-t-il,
légitimer un peu mieux l’art photographique, elles n’ont rien d’iné-
dit. Pour ce qui est du lien land art et préhistoire, Lucy R. Lippard s’y
penche dès 1977 (Lippard, 1977 : 136-150 ; Lippard, 1983), les artistes
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 90 11/12/08 15:04:15
chapitre 2 • appropriations 91
eux-mêmes s’étant très tôt intéressés aux « œuvres monumentales »
préhistoriques (Morris, 1975 : 26-39). Robert Smithson, quant à lui,
tente à partir de 1972 de s’approprier, littéralement, certains sites
(post)industriels, des puits de mines à ciel ouvert tout particulière-
ment, et propose d’en faire des œuvres de land art, bien avant que les
observateurs de la photographie contemporaine ne commencent à
faire des comparaisons entre territoires dévastés par l’industrie et
earthworks.
À son intérêt pour l’entropie, évident depuis 1967, Smithson
ajoute au début des années 1970 une propension envers le marquage
de sites à très grande échelle, deux dispositions qu’il conjuguera de
façon très personnelle. En 1971, Smithson est l’un des artistes invités
à participer à l’événement Sonsbeek 71, une grande exposition de
sculpture extérieure. Il crée alors une œuvre monumentale, qu’il
construit dans une carrière près de la petite municipalité d’Emmen
aux Pays-Bas. C’est l’artiste lui-même qui réclame pour son œuvre un
lieu inutilisé de type industriel, parce qu’à son avis le paysage euro-
péen est déjà très cultivé. Ce sera une révélation pour lui : « recycler
des carrières, des zones minières désaffectées et toutes ces choses, en
termes d’art. Travailler dans des terrains miniers qui ne sont plus
utilisés, des lieux abandonnés. C’est la chose qui m’intéresse. Sonsbeek
a pointé une autre direction, qui s’éloigne du musée centralisé, vers
quelque chose de plus social, de moins esthétique » (Flam, 1996 : 297).
À Emmen, Smithson fabrique Broken Circle/Spiral Hill, usant de la ma-
tière qui est sur place. Dans l’étang qui s’est formé au fond de la car-
rière il construit une jetée semi-circulaire (Broken Circle) et tout à côté,
une colline spiralée (Spiral Hill).
L’œuvre est si bien appréciée par les résidants d’Emmen qu’ils
demandent aux autorités locales qu’elle soit conservée, qu’elle
devienne permanente. Ce qui encourage Smithson à concevoir
d’autres projets de même type que Broken Circle/Spiral Hill qui, selon
lui, allie avec succès art et land reclamation (Flam, 1996 : 165).
L’artiste décide donc de convaincre les dirigeants de diverses
grandes industries états-uniennes d’inscrire des œuvres d’art, les
siennes, dans le processus de réhabilitation des terrains endommagés
par leurs opérations. À cet effet, il envoie en 1972 et en 1973 une
cinquantaine de propositions à diverses entreprises (Hobbs,
1981 : 242), dont Hannah Coal Company, Kennecott Copper
Corporation, Anaconda Mineral Company, U. S. Steel, Union Carbide
et Peabody Coal. Il obtient, pour ce faire, l’appui d’un industriel,
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 91 11/12/08 15:04:16
92 Le paysage façonné
imothy Collins, président de Collins Securities et ancien président
T
de United Mining Corporation. Collins est également membre actif
du Conseil des amis du Whitney Museum. Il aide Smithson à fabri-
quer une sorte de prospectus que ce dernier fait parvenir aux indus-
tries choisies et il lui fait même une lettre de présentation.
Les propositions de land reclamation de Smithson sont en appa-
rence conformes à son attitude devant le désordre et la destruction
causés par l’action humaine :
Rather than attempting to create images of paradise – an impossible
task – corporations could reclaim large portions of land by creating
grazing land or recreation areas for skiing and boating and leave the
tailings ponds, steep walled water impoundments, and deep pits to
Earth artists who would make them focal points in which people could
reflect about devastation – in much the same way that they contemplate
natural forces in the Grand Canyon (Hobbs, 1981: 21635).
On ne peut que constater que ces projets auraient donné lieu à
une forme de tourisme très achevée, alliant contemplation et activités
récréatives sportives… Mais, malgré tous ses efforts et l’aide de Collins,
aucune des compagnies sollicitées ne donne suite aux offres de Smith-
son, sauf la Mineral Engineering Company de Creede au Colorado,
dont Timothy Collins est un important actionnaire. Par ailleurs, com-
me la compagnie a besoin de nouvelles structures et que le projet
suggéré par Smithson n’augmente pas les coûts de beaucoup, l’idée
retient l’attention de ses dirigeants. Smithson propose à l’entreprise
Tailings Pond, une intervention qui tient compte de la vocation indus-
trielle du lieu tout en étant évolutive. L’œuvre est conçue à partir des
rejets de la mine qui, en s’accumulant au fil des ans, à mesure que le
minerai est extrait, façonneraient une œuvre toujours changeante
que Smithson décrit ainsi : « vingt-cinq ans, neuf millions de tonnes,
diamètres deux mille pieds (première étape)36 ».
Il faut préciser que ce que Smithson veut faire avec Tailings Pond
c’est simplement donner forme à la matière qui sera, de toutes façons,
rejetée par la mine. Ses intentions sont manifestement plus esthéti-
ques (ou formelles) que sociales. Qui, d’ailleurs, irait contempler
une œuvre d’art sur les terrains d’une mine en opération? L’effet
site/non-site serait donc là de première importance, à la fois pour
que le travail de l’artiste soit (re)connu et pour que l’implication de
35. Je souligne.
36. Cette phrase se trouve sur l’une des esquisses préparatoires de Tailings Pond. Voir Robert
Hobbs, Robert Smithson : A Retrospective View, Ithaca, Herbert F. Johnson Museum of Art,
Cornell University, n. d., p. 89.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 92 11/12/08 15:04:16
chapitre 2 • appropriations 93
la compagnie minière envers l’art et envers l’environnement soit ren-
due publique. Les pressions se font de plus en plus fortes pour que les
entreprises restaurent leurs territoires. L’offre de Smithson pourrait
donc être, pour la corporation, une opportunité d’améliorer à peu
de frais son image.
2.10 ROBERT SMITHSON, TAILINGS POND, 1973
© Estate of Robert Smithson/VAGA (New York)/SODART (Montréal) 2007.
Projet pour la Minerals Engineering Company, Colorado
Toutefois, Tailings Pond ne sera pas non plus réalisé. Smithson
meurt accidentellement en 1973, alors qu’il est en pourparlers avec la
Mineral Engineering Company. Tout juste après une visite à Creede
où on lui annonce un délai dans les travaux, Smithson se rend au
Texas où il commence à construire Amarillo Ramp. L’avion dans lequel
il prend place avec le pilote et un photographe pour vérifier la forme
de l’œuvre s’écrase, les tuant tous les trois. Mais, s’il n’a pu donner
suite à aucune de ces initiatives de land reclamation, l’idée qu’a Smith-
son de transporter le land art en des sites postindustriels dévastés aura
une fortune étonnante. C’est en grande partie parce que Smithson
propose l’art comme « une ressource physique qui agit comme un
médiateur entre l’écologiste et l’industriel » (Flam, 1996 : 379-380)
que ses projets deviendront par la suite dignes d’attention. On lui at-
tribuera rétrospectivement des intentions d’engagement social dont
il ne fait pas nécessairement preuve en 1972 et 1973, bien qu’il lui
arrive quelquefois de parler de « quelque chose de plus social et de
moins esthétique ». Si l’on considère ses déclarations de l’époque, il
est évident que ce qu’il cherche, c’est l’accès à des lieux nouveaux
pour un type d’art, le land art, qui semble avoir atteint ses limites.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 93 11/12/08 15:04:16
94 Le paysage façonné
Cette nécessité d’ouvrir de nouveaux territoires est parfaite-
ment conséquente de la sortie de l’atelier à laquelle on a assisté à la
fin des années 1960. Il faut une fois de plus repousser la frontière –
bien des écologistes voient d’un très mauvais œil les altérations que
les land artists font subir au désert – et trouver d’autres sites où façon-
ner à grande échelle un matériau disponible sur place et en quantité.
C’est ainsi que Smithson, voulant combiner ses recherches artistiques
aux intérêts de grandes compagnies privées puisque celles-ci possè-
dent des territoires qu’il convoite, propose une première traduction
qui transformera le land art. Ce terme de traduction indiquant à la
fois que de nouvelles interprétations sont proposées et que des ensembles sont
déplacés (Latour, 1995 : 284).
I would add that Earth Art as a part of the reclamation process would
give the landscape a higher economic value in terms of real estate.
Waste land is thus converted into something practical and necessary,
as well as becoming good to look at. It would provide the company
with a public image which would go far beyond any defensive adverti-
sing. This is a kind of art that anybody can understand. Also, if I build
an Earth Sculpture in a remote strip mine region, I can make it public,
as I have done before by documenting the work with photographs and
movies, which then will be exhibited in a museum or a gallery or on
television37.
Smithson suggère donc de transporter le land art vers une nou-
velle périphérie, les zones industrielles dévastées (déplacer des
ensembles) et d’en faire un art de réhabilitation du territoire, de
mise en valeur du paysage (proposer de nouvelles interprétations), ce
qui ne correspond aucunement à son attitude habituelle envers l’en-
tropie. Il tente d’ajuster ses intérêts à ceux des industriels : « Le pre-
mier moyen – et le plus simple – de trouver des gens qui vont immé-
diatement adhérer à l’énoncé, investir dans le projet ou acheter le
prototype consiste à forger l’objet de façon qu’il corresponde à leurs
intérêts explicites38. »Pour ce faire, l’artiste use des moyens dont il dis-
pose, jusques et y compris l’idée d’une valeur ajoutée par la retransmis-
sion des œuvres de la périphérie vers le centre, c’est-à-dire l’effet site/non-
site qui permettrait à des compagnies privées d’améliorer leur image.
Robert Smithson attache ainsi le premier maillon d’une chaîne de
transformations le long de laquelle le sens et la forme du land art
37. Lettre de Smithson à W. G. Stockton, Vice-président aux relations publiques de Peabody
Coal, citée par Hobbs (1981 : 220).
38. « Traduction 1: je veux ce que vous voulez. » (Latour, 1995 : 261)
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 94 11/12/08 15:04:16
chapitre 2 • appropriations 95
s eront modulés, puisqu’il fera l’objet d’un certain nombre de média-
tions et aussi, d’autres traductions.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 95 11/12/08 15:04:16
Page laissée blanche intentionnellement
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 96 11/12/08 15:04:17
C H APITRE TROIS
Modulations
Il faut sa matière, son lieu, les gestes qui l’ont fait,
ceux qui l’ont présenté, qui l’on « montré montrer », ceux qui l’ont nommé,
attribué, vendu, acheté, exposé, reproduit, admiré
Hennion, La passion musicale.
Le paysage, compris comme l’interaction du « paradigme pers-
pectif » et du déplacement en reconnaissance, agit sur les travaux des
artistes. Ceux-ci en retour, pour qu’il leur soit possible de fabriquer
des œuvres et d’en assurer la diffusion et la pérennité, doivent
convaincre des individus, s’allier certaines instances.
On peut supposer que les artistes sont des constructeurs de faits
qui, en empruntant ces points de passage obligés que sont le système
perspectif (distance, liaison, point de vue) et la mobilité (déplace-
ment en reconnaissance, conquête, tourisme) puis recrutant d’autres
acteurs puisqu’ils ne peuvent agir seuls, élaborent de nouvelles
formes, le land art (qui conduira ultérieurement à l’énoncé nouvel art
du paysage) et, d’une certaine façon, la photographie de paysage
engagée. Le cas de cette dernière est toutefois différent puisqu’elle
ne peut s’installer, seule, comme un art du paysage, n’offrant pas
de destination possible. Elle sera donc systématiquement recrutée, à
l’inverse du land art qui lui, enrôle parfois des acteurs. La photogra-
phie d’art deviendra un opérateur de transformation, mais de façon
toute planifiée, pré-orchestrée, parce qu’elle sera précisément mise au
travail dans ce but.
Dans le présent chapitre, il s’agit de faire apparaître toutes les
médiations, tous les opérateurs et opérations de traductions qui ren-
dent possible la transformation du land art en un art du paysage dont
la fortune sera considérable. Il est donc nécessaire d’examiner les
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 97 11/12/08 15:04:17
98 Le paysage façonné
actions et les interactions des acteurs et des agents de toutes sortes
qui déterminent ou par lesquels s’élabore un état particulier des
choses, état qui peut être soit transitoire, soit définitif. Les actions
décrites parfois transforment les choses, parfois simplement les trans-
portent, assurant leur existence, leur propagation ou leur durée. Cette
mise en situation des œuvres, qui permet d’examiner les humains qui
contribuent à les déplacer et à en moduler le sens, n’empêchera
toutefois aucunement de continuer à tenir compte des dites œuvres
en tant qu’agents actifs, de les voir comme des opérateurs de transfor-
mation, au même titre que les humains, les institutions, la société
d’une époque donnée1.
Les traductions adviennent par une redistribution des intérêts
et des buts, ce qui se produit quand certains acteurs en recrutent
d’autres. Se créent alors de nouvelles alliances ou bien des contro
verses propres à modifier les objets ou les ensembles. Il y a également
traduction si une chose, un énoncé ou un ensemble est modifié par
la recomposition des intérêts des acteurs (Latour, 1995 : 261-292),
comme il se produit lorsque Smithson veut convaincre les industriels
du bien-fondé de l’usage du land art pour réhabiliter les territoires
affectés par leurs activités. Tous les agents hétérogènes (humains et
non-humains) participent donc, par leurs actions, à l’existence et à la
formulation (même fluctuante) des faits étudiés.
Les acteurs souvent n’ont qu’à tenir leur rôle habituel, ils n’ont
pas nécessairement à performer de façon insolite pour agir comme
des médiateurs. Par exemple, l’activité normale d’un collectionneur
est de collectionner. Mais, comme le raconte Robert Morris, le collec-
tionneur peut aussi fabriquer la carrière d’un artiste « quand un
collectionneur comme Robert Scull peut dire à un autre : « je viens
tout juste d’acheter dix œuvres de Untel ». L’autre collectionneur
réplique : « je ne connais pas Untel, c’est un inconnu [a nobody] ». Et
alors Scull répond : « après que j’aie acheté dix de ses œuvres, c’est
quelqu’un » (Morris, 1979 : 12). Par ailleurs, si certains acteurs s’éloi-
gnent de leurs attitudes traditionnelles, il peut arriver que se créent
de nouvelles formes (de nouveaux ensembles) grâce à ces comporte-
1. À l’opposé du modèle de la sociologie critique (bourdieusienne ou « bourdivine » comme
le dit Hennion) qui met l’œuvre à distance ou la traite en transparence, ne la considérant
que comme l’effet de causes sociales : « l’explication part du social pour y revenir après
avoir traversé de part en part les objets artistiques » (Hennion, 1993a : 227). Car pour
Bourdieu, l’art vaut surtout par « la croyance collective dans la valeur du producteur et de
son produit » et les œuvres ne sont que des « fétiches », des « objets de croyance » (Bourdieu,
1980 : 219-220). Sur l’importance des choses comme agents ou médiateurs actifs, voir
Latour et Hennion (1993 : 7-24).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 98 11/12/08 15:04:17
chapitre 3 • modulations 99
ments inédits. Ce qui sera le cas lorsqu’un marchand d’art investit
dans des œuvres qu’il ne peut pas vraiment revendre. Je tenterai donc
de détailler, des œuvres aux artistes, des lieux et territoires aux insti-
tutions, des acteurs du milieu de l’art aux groupes hors champ, toutes
les mailles de la chaîne qui a pour origine le land art et pour point
d’arrivée un nouvel art du paysage. De même, j’exposerai dans ce cha-
pitre comment la photographie artistique en vient à être instrumen-
talisée au profit de la transformation du paysage en spectacle. Toutes
ces modulations, simultanées ou successives, mèneront à un tout der-
nier glissement, au moment où la construction des faits sera assumée
par un groupe différent et non plus par les artistes. Ce dernier dépla-
cement, qui survient lorsque le land art (l’objet, non ses créateurs)
commence à agir sur d’autres groupes constituant un nouveau champ
– les aménagistes et les théoriciens du paysage –, sera décrit au chapi-
tre quatre.
Il importe de mentionner que la sociologie de la médiation est
fortement inspirée par l’étude de l’histoire de l’art et de l’histoire
sociale de l’art. L’histoire de l’art ne peut pas ne pas tenir compte des
objets, les œuvres d’art. À partir du moment où elle se réconcilie avec
l’histoire sociale qui tendait surtout à rapatrier les causes, elle offre
un modèle (à travers certains auteurs, Alpers, Baxandall et Haskell
particulièrement), « qui, de façon oblique, tout en se plaçant sous
l’autorité morale de l’esthétique, a fourni contre l’esthétique les élé-
ments d’une véritable sociologisation de l’art » (Hennion, 1993a :
842). Cela en s’appliquant à restituer toutes les médiations qui sont
nécessaires à l’existence de l’objet artistique. Ainsi, il faut éviter la
généralisation lorsque l’on s’attache à rendre la chaîne des média-
tions qui ont contribué à fabriquer le fait land art ou l’énoncé nouvel
art du paysage, pour plutôt user d’« un modèle de la particularité
généralisée3 », par lequel on peut remettre en place, tout le long de la
chaîne, chacun des acteurs, chacune des choses pour en comprendre
l’importance : « Par définition […], puisque la construction des faits
est une œuvre collective, tous ceux qui y participent sont nécessai-
res. » (Latour, 1995 : 287)
Les artistes, à la recherche de nouveaux lieux pour l’art, se tour-
nent vers la banlieue, le désert et les zones industrielles à l’abandon.
En conséquence, ils développent des façons de faire adaptées à ces
2. Sur le travail de restitution des médiateurs par l’histoire de l’art, voir également Hennion
(1993a : 158-214).
3. « Il faut la particularité de chaque représentation, non la généralisation de la représenta-
tion. » (Hennion, 1993a : 217)
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 99 11/12/08 15:04:17
100 Le paysage façonné
territoires inédits, dont les moindres ne sont pas la mobilité (des artis-
tes comme des œuvres) et la transmission de la périphérie vers le
centre d’un certain supplément documentaire qui est généralement
photographique ; la photographie devenant elle-même le médium ou
le véhicule par lequel l’œuvre d’art sera dorénavant visitée ou abstraite,
selon les termes de Dennis Oppenheim. Les artistes usent aussi de
techniques originales, par exemple l’excavation et le déplacement de
matériaux à très grande échelle, techniques qui nécessitent des
alliances avec des intervenants particuliers, ouvriers de la construc-
tion tout aussi bien que commanditaires privés.
En plaçant ces travaux et ces attitudes artistiques dans un contex-
te large, il s’agit maintenant d’identifier quelles sont les médiations
déterminantes et de comprendre par quelles traductions, opérées
par quels acteurs, le land art et une certaine photographie artistique
deviennent des « boîtes noires » :
Avec de l’astuce et de la patience, il devrait être possible de faire que
tous contribuent à la diffusion d’une thèse dans le temps et dans
l’espace – thèse qui va devenir une boîte noire couramment utilisée
par tout un chacun. Si ce point est atteint, aucune autre stratégie n’est
nécessaire : les protagonistes deviennent purement et simplement
indispensables (Latour, 1995 : 2904).
Très vite, les land artists (ou leurs œuvres?) arrivent à recruter
certaines institutions et certains individus du milieu artistique, parce
que ces individus le veulent bien (leur intérêt va manifestement en ce
sens) et aussi parce que le courant est très fort : un art à ce point amé-
ricain est relativement incontournable pour les conservateurs et criti-
ques des États-Unis et les conditions sociales sont rassemblées pour
qu’un renouveau artistique qui semble contester les vieilles institutions
soit bien accueilli. Avec l’aide de certains alliés du milieu, les artistes
voudront également agir sur des intervenants hors milieu qui se lais-
seront parfois recruter, processus qui pourra donner lieu à des
controverses, cependant que les œuvres elles-mêmes continueront d’agir,
tout particulièrement eu égard à la notion de paysage.
Observons comment et grâce à quels opérateurs de traductions,
par quelles médiations et quels déplacements le land art aussi bien
que la photographie artistique en viennent à contribuer au façonne-
ment de l’espace postindustriel en spectacle, alors que le land art se
repositionne dans les villes et dans les banlieues, tandis que la photo-
4. Les italiques sont de l’auteur.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 100 11/12/08 15:04:17
chapitre 3 • modulations 101
graphie artistique devient l’un des instruments de la production de
l’espace à plus vaste échelle.
L’ART, EN DÉPLACEMENT
La décennie 1960 est le moment où les artistes sortent des ate-
liers et semblent aussi prendre leurs distances par rapport au marché
de l’art. Ce mouvement, que l’on a pu voir comme une révolte des
artistes, a pourtant été très rapidement soutenu, et suivi, par la criti-
que et les institutions artistiques. L’on peut dire que l’institution s’est
ralliée aux artistes ou bien que ces derniers ont aisément recruté
l’institution, parfois avec l’aide des critiques.
« En 1960, Lawrence Weiner propose, à Mill Valley en Califor-
nie, une « exposition » qui consistait en un cratère exécuté grâce à
des explosifs. » (Lippard, 1973 : 13) À l’exception de quelques « ex-
positions » de ce genre, du début jusqu’au milieu des années 1960,
lorsque les artistes sortent des galeries et des musées, c’est générale-
ment pour montrer leurs oeuvres… sur la pelouse attenante au bâti-
ment. Les artistes états-uniens que l’on associera au land art commen-
cent alors leurs carrières et exposent leurs travaux (qui de la peinture,
qui de la sculpture) dans les institutions et les galeries reconnues,
dont celle de Virginia Dwan où l’on trouve Robert Smithson dès
19665. Si les artistes commencent à travailler avec de la terre et du
sable, à empiler de tels matériaux naturels, c’est à l’intérieur même
des galeries. Mais en 1967, le City Parks Department de New York
organise Sculpture in the Environment, une exposition temporaire de
vingt-neuf sculptures de grand format réparties dans la ville. Smithson
travaille (depuis 1966) avec un groupe d’ingénieurs et d’architectes à
l’aménagement du terrain entourant l’aéroport de Dallas-Fort-Worth,
projet auquel il intéresse Carl Andre, Sol LeWitt et Robert Morris. Il
fait sa première excursion du côté de Passaic. Heizer part réaliser ses
premières œuvres dans le désert, en Californie. Oppenheim exécute
son premier earthwork à flanc de montagne. Claes Oldenberg fabri-
que son Placid Civic Monument à Central Park. L’année suivante, le
mouvement s’accentue, les actions à l’extérieur sont de plus en plus
nombreuses. Les interventions en zones périurbaines et dans les
5. Soulignons que Smithson, qui pratique de façon professionnelle et expose ses œuvres
epuis 1959, opère par la suite un léger réajustement historique en décrétant que ses
d
débuts officiels datent de 1964-1965. Il ira même jusqu’à récupérer et à faire disparaître
une bonne partie de ses travaux antérieurs à 1964 (des tableaux, principalement) (Flam,
1996 : 211et 283).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 101 11/12/08 15:04:18
102 Le paysage façonné
éserts de l’Ouest se multiplient. Virginia Dwan présente l’exposition
d
Earth Works à sa galerie de New York, ce lieu n’étant selon elle qu’un
pis-aller, « en attendant de trouver du terrain convenable pour
construire [des œuvres] » (Boettger, 2002 : 130).
En 1969, alors que Nancy Holt commence à enterrer ses Buried
Poems dans quelques lieux isolés, les institutions muséales déjà s’im-
pliquent dans la présentation d’interventions à l’extérieur de leurs
murs. Le Andrew Dickson White Museum of Art de Cornell Univer-
sity présente Earth Art, qui est composé d’œuvres in situ construites
sur le terrain de l’université, dans la forêt adjacente, dans le ravin qui
la traverse, ou un peu plus loin. Ainsi, le Mirror Displacement (Cayuga
Salt Mine Project) de Smithson comprend une œuvre dans la galerie
même et une autre dans la mine Cayuga Rock Salt Company à quelque
distance de l’Université. Les deux œuvres sont reliées par un sentier
de miroirs (Mirror Trail) qui balise l’itinéraire d’un lieu à l’autre. La
même année, le Museum of Contemporary Art de Chicago organise
Art by Telephone dont le catalogue est un disque (microsillon) sur
lequel sont enregistrées les voix des artistes commandant leurs œuvres
ou les performant. Pour cette exposition Smithson demande, par
téléphone bien entendu, que l’on déverse un plein camion de béton
dans un ravin donnant dans le lac Michigan. L’artiste n’est pas pré-
sent lors de la manœuvre et l’intervention disparaît rapidement, car
les bétonnières de diverses compagnies jettent leur trop-plein dans ce
même ravin à la fin de chaque jour de travail. De cette intervention,
titrée Concrete Pour, il reste une documentation filmique et photogra-
phique.
Le mouvement n’est pas uniquement nord-américain. Des artis-
tes européens prennent part à des événements aux États-Unis, les
Américains montrent leurs travaux en Europe. Gerry Schum diffuse
sur les ondes de la télévision allemande des bandes vidéo montrant
des œuvres de land art d’artistes des deux continents. Smithson réa-
lise son Asphalt Rundown près de Rome, dans une carrière abandon-
née. L’œuvre, commanditée par la galerie L’Attico est un autre déver-
sement, cette fois-ci d’asphalte. La galerie expose dans ses murs la
documentation photographique de l’intervention, ainsi qu’une carte
du site, dessinée par l’artiste.
De jeunes commissaires-critiques ou artistes-commissaires,
Willoughby Sharp, Seth Siegelaub et Lucy R. Lippard entre autres,
ont un rôle de premier plan dans toute cette effervescence qui per-
dure jusqu’au milieu des années 1970. Ils multiplient les textes sur le
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 102 11/12/08 15:04:18
chapitre 3 • modulations 103
travail des artistes, sont membres des mêmes collectifs (la Art Workers
Coalition est fondé en 1969), organisent des symposiums dans toutes
sortes d’endroits et des événements d’art en tous genres, participent
à des street works. Ces jeunes commissaires-critiques sont aussi invités
par des institutions prestigieuses. Sharp est l’un des commissaires de
l’événement Earth Art du Andrew Dickson White Museum of Art.
Avec Liza Bear, il fondera la revue Avalanche en 1970. En 1971 il orga-
nise Pier 18, une série d’interventions éphémères photographiées,
dont la documentation est présentée au Museum of Modern Art de
New York. Seth Siegelaub organise divers événements tels January
5-31, 1969 : « L’exposition consiste dans (les idées communiquées
dans) le catalogue ; la présence physique des œuvres est complémen-
taire au catalogue. » (Lippard, 1973 : 71). Pour Siegelaub, le type d’art
présenté ne dépend pas de son aspect matériel ; le catalogue offre
donc de l’information de première main et non pas des reproduc-
tions. La publication peut ainsi être l’événement lui-même6. July-
August-September, 1969, dont Siegelaub s’occupe également est un
catalogue d’exposition plus conventionnel, montrant les travaux de
onze artistes qui réalisent des œuvres en onze sites différents (dans
sept pays), pendant les trois mois indiqués dans le titre du catalogue.
Smithson y participe à partir du Yucatán où il exécute une série d’œu-
vres éphémères, dont les neufs déplacements de miroirs qui forme-
ront les Incidents of Mirror-Travel in the Yucatán. Cette œuvre est une
sorte de non-site, un autre récit de voyage comprenant des photogra-
phies – toujours à l’Instamatic – et une carte sur laquelle sont indi-
qués les lieux des interventions7. En 1970, Siegelaub dirige un nu-
méro spécial de Studio International, une exposition de magazine. Des
œuvres et des artistes sont choisis par six critiques de pays différents,
eux-même invités par Siegelaub. Lucy R. Lippard est parmi ces der-
niers.
Lippard est une critique d’art engagée. Elle est militante de la
première heure du Art Workers Coalition, organisatrice et partici-
pante de street works, animatrice de symposiums radiophoniques et
ainsi de suite. Cela n’empêche toutefois pas que de grandes institu-
tions l’invitent à mettre sur pied des expositions d’envergure.
6. « For example, a photograph of a painting is different from a painting but a photograph
of a photograph is just a photograph, or the setting of a line of type is just a line of type »
(Lippard, 1973 : 125).
7. « Incidents of Mirror-Travel in the Yucatán » paraît dans Artforum en septembre 1969.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 103 11/12/08 15:04:18
104 Le paysage façonné
En 1969, Lippard organise pour le Seattle Art Museum l’exposi-
tion 557, 087 qui réunit une soixantaine d’artistes dont les œuvres
sont réparties dans le musée, mais aussi dans la ville et ses environs,
dans un périmètre de 50 milles autour de Seattle. Peter Plagens, criti-
que pour Artforum, résume ainsi l’aspect général de l’événement :
« L’exposition démontre un style total, un style si envahissant que cela
donne à croire que Lucy Lippard est en fait, l’artiste, et que son mé-
dium c’est les autres artistes » (1969 : 67). Robert Smithson est parmi
les artistes invités par Lippard. Parce qu’il veut créer une œuvre qui
serait construite par un conservateur (Hobbs, 1981 : 167), c’est plutôt
l’artiste qui demande à la commissaire d’être son intermédiaire. Ainsi
est réalisé 400 Seattle Horizons, selon la commande de Smithson : « 400
clichés carrés d’horizons de Seattle – devraient être vides, quelcon-
ques, vacants, vagues, communs, des vides ordinaires, des plages
dépeuplées et mornes, des champs inhabités, des terrains sans inté-
rêt, des routes moyennes typiques sans maisons, des barrières de
sable, des lacs isolés, des sites distants et intemporels ». Sans oublier
l’essentiel : « Utiliser un Kodak Instamatic 804 » (Cité par Hobbs,
1981 : 168).
Suivant le même principe, l’année suivante, Lucy Lippard orga-
nise 955,000 pour la Vancouver Art Gallery (en collaboration avec
l’University of British Columbia) avec les mêmes artistes, auxquels
trois nouveaux s’ajoutent8. Là aussi, les œuvres sont présentées à l’ex-
térieur tout aussi bien qu’à l’intérieur. Pour 955,000 Smithson exé-
cute un autre déversement, de colle celui-là, Glue Pour.
Ces quelques exemples montrent bien que les institutions et les
critiques d’art sont partie prenante des étonnantes manifestations ar-
tistiques de la fin des années 1960. Entre autres illustrations possibles
de cette évidence, notons qu’en 1969 Lucy Lippard accompagne un
groupe d’artistes jusqu’à Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest,
où Lawrence Wiener réalise An Abridgement of an Abutement to or near
or about the Arctic Circle. Ce déplacement est fait sous les auspices de la
Edmonton Art Gallery d’Alberta dont le directeur, Bill Kirby, se joint
au groupe.
Les expositions de documents dans les institutions muséales se
multiplient également. Dès 1969 le Museum of Modern Art de New
York montre A Report – Two Ocean Projects, réunissant la documenta-
8. Les nombres des titres indiquent les populations des villes où l’événement a lieu. Lippard
organisera aussi 2,972,453 à Buenos Aires en 1970, avec des artistes autres que pour les
deux précédentes manifestations.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 104 11/12/08 15:04:18
chapitre 3 • modulations 105
tion d’interventions marines éphémères à Tobago par Oppenheim et
Peter Hutchinson. Pier 18 suivra en 1971 dans ce même MoMA. En
1970 Evidence on the Flight of Six Fugitives est présenté au Museum of
Contemporary Art de Chicago. C’est une exposition de photogra-
phies de projets de six land artists, De Maria, Heizer, Hutchinson,
Long, Oppenheim et Smithson. Aussi, les artistes exposent des docu-
ments en rapport avec leurs œuvres, photographies, esquisses et ma-
quettes, dans des galeries commerciales où ils seront vendus.
Mais, pour qu’existent les œuvres de land art lointaines, bien
avant que d’en ramener la documentation photographique vers le
centre, il faut faire en sorte qu’elles soient construites. Des interve-
nants bien spécifiques, qui agissent avec les artistes, doivent alors être
recrutés. Élaborer des œuvres monumentales dans le désert est
d’abord un travail de collaboration, pour lequel l’artiste devient une
sorte d’entrepreneur :
The environmental artist is no longer a simple economic entity produ-
cing discrete works that can be neatly sold, with custody transferred to
the buyer. The artist is becoming more like a developer, conceiving
a project, hustling for the financing, securing the site, supervising
the construction and arranging public access when the project is
completed. In addition, provisions must be made to maintain the piece
into the future. Like Hollywood directors, artists are becoming deal
makers (Deitch, 1983 : 86).
S’il faut louer ou acheter des terrains, engager de la main-
d’œuvre et trouver de la machinerie9, il faut d’abord et avant tout
arriver à financer toute cette entreprise. Pendant un temps, quelques
mécènes y pourvoiront.
John Gibson ouvre en 1967 le John Gibson Projects for Commis-
sions où il promeut des œuvres monumentales qui pourraient conve-
nir à des environnements publics ou corporatifs. Il expose et vend des
dessins, des photo-montages, des maquettes de ces œuvres (Christo,
Oppenheim, Hutchinson, etc.) et recueille des fonds pour permettre
la réalisation de certains projets, entre autres ceux de Oppenheim et
Hutchinson à Tobago dont il a été question plus haut. Robert Scull
est un riche homme d’affaires de New York (magnat du taxi), grand
9. À titre d’exemple, voici les collaborations que Nancy Holt énumère et qui ont rendu
ossible la réalisation de ses Sun Tunnels : « 2 engineers, 1 astrophysicist, 1 astronomer,
p
1 surveyor and his assistant, 1 road grader, 2 dump trucks operators, 1 carpenter, 3 ditch
diggers, 1 concrete mixing truck operator, 1 concrete foreman, 10 concrete pipe company
workers, 2 core-drillers, 4 truck drivers, 1 crane operator, 1 rigger, 2 cameramen, 2 sound-
men, 1 helicopter pilot, and 4 photography lab workers » (Holt, 1977 : 34).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 105 11/12/08 15:04:19
106 Le paysage façonné
collectionneur d’art, qui supporte financièrement (et possède ainsi)
des projets de land art, de Heizer et De Maria particulièrement.
Virginia Dwan, riche héritière de compagnies minières et manufactu-
rières du Minnesota et propriétaire de galerie privée, sera celle qui
s’impliquera de la façon la plus soutenue et qui sera la plus proche
des land artists.
En 1965, Dwan ouvre une galerie à New York. Elle fermera celle
dont elle est propriétaire à Los Angeles en 1967. À New York, elle
montre surtout les œuvres des minimalistes et de ceux qui vont deve-
nir les land artists. Elle accompagne également les artistes qu’elle re-
présente dans leurs expéditions en périphérie, où ils vont visiter des
sites industriels à l’abandon ou des zones désertiques, là ou Smithson
fait des prélèvements pour ses non-sites. Avec eux, elle cherche du
terrain pour construire des earthworks et bientôt elle assiste à la fabri-
cation de certains de ces travaux, dans les terres isolées des déserts de
l’Ouest. On la retrouve avec les artistes au New Jersey, au Nevada, en
Utah, et même au Yucatán avec Smithson et Holt : elle est du voyage
pendant lequel Smithson exécute ses Incidents of Mirror-Travel in the
Yucatán.
Dwan fournit des fonds pour le Double Negative de Michael
Heizer en 1968 et plus tard pour son Complex City. Elle débourse éga-
lement pour la Spiral Jetty de Smithson en 1970 et pour la première
version (test site) du Lightning Field de Walter De Maria, en 1974. Les
documents qui accompagnent ces œuvres ou en font partie, tels le
film The Spiral Jetty de Smithson sont bien entendu exposés – et éven-
tuellement vendus – dans sa galerie de New York. L’exposition Earth
Works présentée dans sa galerie en 1968 est en quelque sorte un tra-
vail de collaboration avec les artistes, particulièrement avec Smithson
qui s’implique dans l’organisation de l’événement. « Dwan s’identi-
fiait plus avec les artistes qu’avec les marchands. Ainsi, en présentant
des earthworks, elle opérait plus comme une mécène participante que
comme une marchande détachée » (Boettger, 2002 : 21110). Dwan
finance ainsi, à tout le moins en partie, trois des œuvres les plus no-
toires (et les plus permanentes) de land art en sol états-unien11. Tout
10. Je souligne.
11. Après Dwan, la principale source de financement privée pour les land artists sera la Dia
Foundation. Celle-ci finance en partie le Complex City de Michael Heizer (non encore ter-
miné à ce jour), la version définitive du Lightning Field de Walter De Maria (qu’elle gère
toujours), le Roden Crater de James Turell (non encore complété). Nancy Holt (succession
de Robert Smithson) lui a récemment cédé la Spiral Jetty. Notons également que Stanley
Marsh, un industriel du pétrole, a soutenu en 1973 la construction de l’Amarillo Ramp de
Smithson, qui se trouve sur son ranch au Texas.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 106 11/12/08 15:04:19
chapitre 3 • modulations 107
cela se passe en un laps de temps relativement bref, de 1968 à 1974,
qui correspond à une période d’incroyable effervescence artistique,
très certainement en phase avec les mouvements sociaux, la contre-
culture et l’agitation des années 1960 aux États-Unis :
There was general revolt against oppressive, artificial, previously un-
questioned ways of living. It touched every aspect of personal life:
childbirth, childhood, love, sex, marriage, dress, music, art, sports, lan-
guage, food, housing, religion, literature, death, schools (Zinn,
2003 : 29712).
Quelques années pendant lesquelles se mélangent art minima-
liste, art conceptuel, land art, body art, mail art, process art, street works,
performances et ainsi de suite. Certes, il s’agit là de la haute époque
du supplément documentaire, prescription que partagent toutes ces for-
mes d’art.
Cette bouillonnante activité sera cependant de courte durée.
Arrive « la décennie de la désillusion » (Farber, 1994 : 233). 1973,
l’année de la mort accidentelle de Smithson, est marquée par une
grande récession, par la crise du pétrole, par la défaite du Vietnam et
le retour des soldats, par la corruption politique qui est de plus en
plus apparente. Selon Suzaan Boettger, qui s’appuie en cela sur les
dires de Fredric Jameson, c’est à ce moment particulier que se termi-
nent les sixties (2002 : 238). Le pessimisme et la morosité remplacent
l’optimisme des années 1960. Elles laissent place à une sorte de dé-
pression généralisée : « La décennie d’intense combat avait mené à
une dépression cumulative » (Lippard, 1984 : 310). Dès lors, les mou-
vements de contestation se font moins nombreux et les intellectuels
plus frileux. Le déficit allant en s’accentuant, les gouvernements sont
de moins en moins orientés vers le progrès social. Toujours en 1973,
le collectionneur et mécène Robert Scull vend, réalisant ainsi un
énorme profit, son immense collection d’œuvres d’art, transformant
selon Barbara Rose, la scène artistique en une situation propice au big
business, et cela, aux dépens d’artistes qui sont toujours vivants
(Boettger, 2002 : 235). C’est cette même année que Lucy Lippard
constate que l’art ne s’affranchira pas vraiment de la « tyrannie du
système de consommation », non plus qu’il n’a réussi à véritablement
« sortir dans le monde » pour y être accepté par tous.
12. C’est aussi l’époque des gigantesques manifestations anti-guerre du Vietnam et, selon
David Farber : « By 1968, conservative critics were right, the line separating the antiwar
movement and the counterculture had blurred. Increasingly, young antiwar protesters
were in rebellion against both their government’s policies in Vietnam and their society’s
established values. » (1994 : 220)
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 107 11/12/08 15:04:19
108 Le paysage façonné
For the most part, however, contemporary artists who have ventured
“out there” and found sites and sights to revitalize their art have been
more successful in bringing these awareness back in to the art world
than in bringing art out to the world. For example, when so-called
Conceptual Art emerged around 1968, it was welcomed as a blow at
the “precious object” but none of us took into account that these
Xeroxed texts or random snapshots documenting ideas or activities or
works of art existing elsewhere would be of no interest whatsoever to a
broader public. They were, in fact, smoothly absorbed into the art mar-
ket and are now only slightly less expansive than oils and marbles. The
perversity (and failure) of offering unwanted avant-garde art for the
price of wanted schloks bears out in retrospect art historian Linda
Nochlin’s depressing suggestion that, admirable as the move to get out
of the museums and into the streets may be, it can also be seen as “the
ultimate act of avant-garde hubris” (Lippard, 1984 : 75-76).
Nombre d’acteurs et d’agents non humains contribuent à la
production et à la dissémination du land art au cours de la période
qui s’étend de 1967 à 1974. Des artistes aux critiques, des collectifs
aux institutions, des œuvres à leurs documents, des mécènes à leur
argent, bien des interactions peuvent être identifiées. Ce ne sont ma-
nifestement pas seulement les œuvres et leurs auteurs qui ont fait le
land art : « Le critique qui formule un jugement ne devine pas un
niveau de qualité latent, il le produit, modifiant le sens de l’œuvre
critiquée et s’appuyant lui-même sur une série d’anticipations à
propos de son propre public, de sa carrière, du public de l’œuvre »
(Hennion, 1993a : 142). Et contrairement à ce que la légende veut, le
circuit institutionnel et l’argent des possédants sont des maillons im-
portants de la chaîne par laquelle se constitue l’objet ou la forme land
art. Les institutions, même prestigieuses (musées comme galeries
commerciales et publications spécialisées), contribuent à disséminer
(à transporter) cette nouvelle forme d’art. Il est par ailleurs évident
que, même s’ils ne commandent pas d’œuvres à strictement parler,
s’ils n’influent aucunement sur leur aspect et leur contenu, ce sont
les mécènes et leur argent qui rendent possible l’existence des œuvres
monumentales du désert. Et si cet argent autorise les artistes à satis-
faire leur désir de sortir des sentiers battus, il agit aussi de façon plus
patente : « Ce fut le support de quelques marchands et collection-
neurs qui rendit possible non seulement la création de earthworks par-
ticuliers, mais également l’essor du genre artistique « Earthwork » lui-
même » (Boettger, 2002 : 215).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 108 11/12/08 15:04:19
chapitre 3 • modulations 109
Mais, lorsque cette source se tarit, il faut trouver d’autres formes
de soutien financier. C’est manifestement inspiré par ce modèle de
financement, le mécénat privé, que Robert Smithson élabore ses pro-
jets des années 1972 et 1973.
Après la construction de Broken Circle/Spiral Hill (1971), Smith-
son, qui tient toujours à fabriquer de très grandes œuvres, se heurte
à un certain nombre de problèmes, refus de financement, délais et
reports, annulations, de la part d’institutions artistiques et de com-
manditaires potentiels, privés et publics. C’est alors que cette idée de
se faire médiateur entre les écologistes et les industriels lui vient. Son
intérêt pour l’entropie, conjugué à son penchant pour le marquage
de sites à grande échelle, poussent Smithson à rechercher de nou-
veaux territoires, les zones industrielles à l’abandon semblant toutes
désignées. À ces aspirations personnelles, il faut ajouter la connais-
sance qu’a l’artiste de l’importance de la commandite, celle d’une
essentielle médiation par laquelle l’existence des œuvres monumen-
tales est assurée. Smithson propose donc un type de financement qui
en est dérivé : « L’art, à cette échelle, devrait être soutenu directement
par l’industrie et non pas seulement par la commandite privée »
(Flam, 1996 : 37913). Avec ses projets de land reclamation, Smithson
agira effectivement comme un médiateur. Mais pas exactement le
médiateur qu’il souhaitait être.
Our ecological awareness indicates that industrial production can no
longer remain blind to the visual landscape. The artist, ecologist, and
industrialist must develop in relation to each other, rather than con-
tinue to work and to produce in isolation. The visual values of the
landscape have been traditionally the domain of those concerned with
the arts. Yet, art, ecology, and industry as they exist today are for the
most part abstracted from the physical realities of specific landscapes
or sites. How we view the world has been in the past conditioned by
painting and writing. Today, movies, photography and television con-
dition our perceptions and social behaviour. The ecologist tends to see
the landscape in terms of the past, while most industrialists don’t see
anything at all. The artist must come out of the isolation of galleries
and museums and provide a concrete consciousness for the present as
it really exists, and not simply present abstractions or utopias. The
artist must accept and enter into all of the real problems that confront
the ecologist and industrialist (Flam, 1996 : 379-38014).
L’écologie est ici un prétexte pour faire valoir l’importance du
rôle de l’artiste dans le monde qu’il habite. À travers sa vision, par
13. On se demande quelle peut bien être la différence…
14. L’auteur souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 109 11/12/08 15:04:20
110 Le paysage façonné
ailleurs fort pertinente du paysage, ce que Smithson recherche préci-
sément, ce sont de nouveaux lieux pour construire des œuvres monu-
mentales, pour prolonger une forme artistique qui atteint ses limites
faute de nouvelles collaborations financières. L’artiste opère simple-
ment une traduction dans le but de recruter de nouveaux partenaires
économiques, les industriels, ce qui lui permettrait de continuer à
développer son art. Il serait donc plus juste de voir Smithson comme
artiste médiateur au sens où l’entend Antoine Hennion au sujet du
Rembrandt de Svetlana Alpers, « [les artistes] modifiant par leur
action la définition de l’art et les critères de sa qualification »
(Hennion, 1993b : 32).
En effet, Smithson se pose en artiste-entrepreneur et tente en
1972 et 1973 de créer son propre marché, de façon similaire à ce que
Rembrandt a pu faire au XVIIe siècle. Par la suite, ses écrits et ses pro-
jets de réhabilitation de zones industrielles agiront comme une autre
médiation par laquelle Robert Smithson sera traduit en artiste engagé
et précurseur d’un certain art à caractère public et/ou écologiste.
Une comparaison entre Smithson et un Rembrandt médiateur
peut être établie en suivant la démonstration faite par Svetlana Alpers
dans L’atelier de Rembrandt. La liberté, la peinture et l’argent et la lecture
qu’en fait Antoine Hennion15. Alpers conçoit son Rembrandt entre-
preneur en alliant deux vecteurs principaux, l’art et l’argent16. La tra-
duction qu’opère Smithson à partir du land art s’établit selon les deux
mêmes axes. Car c’est la nature même de la production de l’artiste (la maî-
trise développée dans son atelier dans le cas de Rembrandt, ou les
modes de production spécifiques au land art pour Smithson) qui
permet d’inscrire différemment les œuvres dans le tissu économique, et ainsi
de leur attribuer une valeur particulière qui sera un élément de trans-
formation du marché même. Rembrandt y arrive en spéculant sur ses
propres œuvres, entre autres manœuvres.
C’est Rembrandt qui inventa l’œuvre d’art la plus caractéristique de
notre culture […] un objet qui crée son propre marché et que sa pré-
tention à l’individualité et à une valeur commerciale élevée rend pro-
che des aspects essentiels d’une entreprise de type capitaliste (Alpers,
1991 : 250).
Quant à Smithson, il est celui qui reconnaît le potentiel « socio
économique » du type d’art qu’il pratique. Les earthworks pouvant
15. Sur le Rembrandt de Alpers, outre l’article de Hennion (1993b), voir aussi Hennion
(1993a : 159, 188-189, 208-217).
16. Notons que le titre original de l’ouvrage d’Alpers est Rembrandt’s Enterprise: The Studio and
the Market.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 110 11/12/08 15:04:20
chapitre 3 • modulations 111
s’ajuster parfaitement à l’échelle des sites convoités par Smithson, il
lui suffirait de convaincre les industriels que l’art (le sien) est la
meilleure solution pour redorer leur image publique à peu de frais,
pour qu’ainsi les fonds dont il a besoin soient disponibles. Ce que
Rembrandt a réussi dans un système capitaliste alors en plein déve-
loppement, Smithson le tente pour sa part, au sein d’un régime socio
économique industriel, un système capitaliste qui détruit pour pro-
duire et dont l’artiste essaie de s’allier des intervenants majeurs afin
de s’assurer des conditions nécessaires à la survie de son entreprise
artistique. Smithson imagine une nouvelle forme de commandite
corporative adaptée à son travail. « L’art deviendrait alors une res-
source nécessaire, et non un luxe marginal. […] Ceux qui ont le pou-
voir économique ne devraient pas contrarier des entreprises si néces-
saires. » (Flam, 1996 : 380)
De la pratique même de Smithson ainsi que de ses déclarations
entourant ses projets de land reclamation, peuvent être dégagés certains
facteurs qui, rassemblés, forment le mode de production novateur
pour lequel il tente de créer, en même temps que son art, le « réseau
qui assure son usage, sa transmission et sa vente » (Hennion, 1993a :
213) : les méthodes pratiquées par son groupe, sortie hors de l’atelier
et travail site specific ; la collaboration avec les commanditaires et la
direction d’équipes de travailleurs ; l’intérêt très personnel de Smith-
son pour les sites postindustriels dévastés ; la possibilité de transmis-
sion des œuvres de la périphérie vers le centre, selon son système de
site/non-site. Ainsi, plutôt qu’une réelle disposition envers l’écolo-
gie, les propositions de land reclamation de Smithson démontrent une
volonté de mise en œuvre de ses préoccupations artistiques.
L’argument écologique est utilisé par l’artiste parce qu’il sait
qu’il est incontournable. Car, si son expérience à Emmen avec Broken
Circle/Spiral Hill a été concluante au point de l’amener à concevoir le
land reclamation comme une nouvelle forme artistique, une autre
expérience, celle-là beaucoup moins intéressante, datant du début de
1970, ne peut que lui rappeler qu’il faut compter avec le discours éco-
logiste ; il faut donc l’intégrer, même si cela ne va pas sans contradic-
tions.
Avant de réaliser Broken Circle/Spiral Hill, Smithson ne se préoc-
cupe nullement des dommages que ses travaux pourraient causer à
l’environnement. Bien au contraire. Il n’y a qu’à se rappeler ses dé-
versements d’asphalte, de béton, de colle… Au moment où il est à
Vancouver pour réaliser le dernier de ces déversements, Glue Pour
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 111 11/12/08 15:04:20
112 Le paysage façonné
dans le cadre de l’exposition 955,000 organisée par Lucy Lippard,
Smithson conçoit un autre projet, qui sera au centre d’une contro-
verse écologique. C’est une grande œuvre, Island of Broken Glass, qui
devait être financée par Douglas Christmas de la Ace Gallery de
Venice (Californie) et de Vancouver. Smithson prévoit recouvrir un
îlot, Miami Islet dans le détroit géorgien tout près de Nanaimo en
Colombie-Britannique, de cent tonnes de verre cassé, sur le modèle
de Map of Glass (Atlantis), l’un des Continents hypothétiques réalisés
l’année précédente.
Le verre doit rester sur l’îlot et se dégrader lentement, passant
par divers états, jusqu’à redevenir du sable, état originel du verre,
autre illustration de l’entropie, l’évolution à l’envers. Des journalistes
de deux quotidiens de Vancouver prennent position, l’un contre,
l’autre pour, la mise en place de l’œuvre17. La Society for Pollution
and Environmental Control18 arrête le chargement de verre com-
mandé par Christmas en Californie à la frontière canadienne. Le mi-
nistre canadien des Terres et Forêts, qui avait donné son autorisation
à l’intervention, la retire. Le raisonnement qui fonde cette polémi-
que est que les oiseaux aquatiques ne pourront plus se poser à Miami
Islet. Smithson s’incline ; l’œuvre n’aura pas lieu19. Mais il fera, à la
suite de ces événements, des déclarations incendiaires à l’égard des
écologistes qui ne laissent aucun doute sur ses sentiments à leur
égard. Il affirme, par exemple, que l’écologie est l’envers coupable
de l’économie ou que la croyance dans l’écologie a la fonction d’une
religion bon marché (Flam, 1996 : 19720). Jusqu’à sa mort, il ne cessera
de dénigrer les écologistes. Dans le dernier texte publié de son vivant,
il les accable encore: « Les écologistes d’aujourd’hui, qui ont une
tournure d’esprit métaphysique, voient encore les opérations indus-
trielles comme le travail de Satan. L’image du paradis perdu les laisse
sans une dialectique solide et leur cause la souffrance d’un désespoir
écologique » (Flam, 1996 : 161).
Ce qui n’empêche aucunement Smithson de se proposer comme
médiateur entre les écologistes et les industriels. La controverse, inté-
17. Un caricaturiste allant même jusqu’à dépeindre l’artiste en alcoolique cherchant un
endroit pour recycler ses bouteilles de bière vides (Graziani, 1998 : 10).
18. �����������������������������������������������������������������������������������������
Selon Leider (2001 : 76) : « A Canadian watchdog association determined to protect a bar-
ren rock nosing out of the waters of the Georgia Strait, near Vancouver, from being “pol-
luted” by Smithson’s proposed Island of Broken Glass. »
19. Au sujet de cette controverse, on peut aussi consulter Hobbs (1981 : 185-188).
20. Et : « Smithson saw the attempt to protect the animals on Miami Islet as a kind of Oedipal
complex, “a cheap religion to clear [the environmentalist’s] conscience while he con-
tinued to eat his bloody steak and drive his poisonous car”. » (Graziani, 1998 : 11)
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 112 11/12/08 15:04:20
chapitre 3 • modulations 113
grée, fera donc partie de la traduction qu’il tente d’opérer. En retour,
c’est en grande partie à cause de l’argument écologique que l’on
oubliera l’aspect principalement économique de cette tentative, pour
n’en retenir que l’aspect social, hormis quelques dénonciations :
In essence however, Smithson was not really mediating between eco-
logy and industry, but was simply hiring himself out to decorate an
area of the landscape the mining company had exploited (Auping,
1983 : 97).
L’argument écologique sera plus largement retenu et deviendra
l’une des médiations au départ d’une longue chaîne par laquelle le
land art trouve un usage social – supposant toutefois un avantage
économique pour les artistes – avant de devenir, en partie grâce à ce
glissement vers la notion d’utilité, un art du paysage.
Malgré le peu de succès de ses propositions, Smithson reste un
initiateur en territoire postindustriel, dont la notoriété traversera les
décennies. À tel point que Lucy Lippard soutient, dès 1983, que sa
mort prématurée peut être conçue comme une tragédie, dans la me-
sure où il est le seul artiste de sa « génération esthétique » à s’être
véritablement préoccupé du destin de la Terre. Selon Lippard, Smith-
son était absolument conscient de la responsabilité politique de l’ar-
tiste à cet égard (1983 : 33). Et encore en 2001, Philip Leider déclarera
que n’eût été de cette mort précoce, les propos et les projets de Smith-
son auraient trouvé audience et qu’ainsi le paysage américain, à tout le
moins le paysage artistique aurait été, à long terme, fort différent
(Leider, 2001 : 78).
L’INÉVITABLE ENGAGEMENT
Le John Gibson Projects for Commissions présente en 1969 une
exposition dont la moitié des artistes ont participé à Earth Works chez
Virginia Dwan en 1968. Ces artistes sont Carl Andre, Robert Morris,
Claes Oldenburg, Dennis Oppenheim et Robert Smithson. L’exposi-
tion du John Gibson Projects s’intitule Ecological Art. De Earth Works à
Earth Art, puis Ecological Art et Environmental Art – un simple titre pou-
vant agir comme une médiation21 –, diverses appellations viennent
moduler le sens d’une certaine pratique artistique dont le matériau
est (généralement) la terre et dont les sites sont de vastes zones où il
est possible aux artistes de travailler à une échelle monumentale.
21. À ce sujet, on peut consulter Poinsot (1999 : 133-138 et 197-281).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 113 11/12/08 15:04:21
114 Le paysage façonné
La décennie 1960 est celle de l’éveil populaire aux menaces en-
vironnementales. La plupart des auteurs situent les débuts de cette
prise de conscience en 1962, moment de la parution de l’ouvrage
Silent Spring de Rachel Carson. Si cet essai sur la pollution causée par
les insecticides synthétiques devient effectivement un best-seller et
suscite de larges débats, d’autres facteurs contribuent aussi à l’éveil
de la population états-unienne aux problèmes environnementaux.
Dans les années 1960, le Sierra Club, groupe partisan de la défense
de l’environnement fondé à la fin du XIXe siècle et ayant pour mission
la mise en valeur et la protection des ressources naturelles (« natural
and scenic resources » (Marx, 1972 : 79)) des États-Unis, est de plus en
plus militant. In Wilderness Is the Preservation of the World, le premier
« beau livre » du Club qui se porte à la défense du wilderness paraît en
1963, inaugurant une tradition qui perdure encore. L’année suivan-
te, le Wilderness Act est mis en vigueur par le gouvernement central,
à des fins de protection des territoires sauvages de l’Ouest – l’Est
devra attendre 1974 pour bénéficier de son propre Wilderness Act.
En 1966, le Sierra Club engage une grande bataille contre le gouver-
nement de Lyndon Johnson, le Bureau of Reclamation et le Corps of
Engineers de l’armée américaine, pour empêcher que deux barrages
ne soient construits sur la rivière Colorado, barrages qui inonde-
raient… le Grand Canyon. Cette bataille sera menée à coup de publi-
cité-choc par le Sierra Club22, une campagne qui provoque énormé-
ment de réactions de la part du public. Le Club en sort victorieux.
Non seulement les barrages ne seront pas construits, mais l’opinion
publique ne sera plus jamais la même au regard des dommages causés
à l’environnement naturel par les manipulations des gouvernants :
« Un raz-de-marée transformant le sentiment public envers le monde
naturel advenait, l’un de ces bouleversements qui garantissent que les
choses ne seront plus jamais les mêmes » (Reisner, 1993 : 287).
Plusieurs groupes de défense de l’environnement voient alors le
jour dont les Friends of the Earth, organisation fondée en 1969, que
Smithson proposera quelques années plus tard de rebaptiser les en-
nemis de l’art (The Ennemies of the Art) (Flam, 1996 : 171). Une série
de lois sont passées par le gouvernement et l’Environment Protection
Agency qui s’occupe de les faire respecter est créée en 1970, année de
22. L’un des arguments avancés par le Bureau of Reclamation – organisme parapublic qui
s’occupe principalement d’irrigation des terres agricoles – pour justifier que l’on inonde
le Grand Canyon est que les touristes pourraient mieux en apprécier la beauté s’ils pre-
naient place dans des bateaux à moteur. L’une des publicités du Sierra Club demande
donc : « Should we also flood the Sistine Chapel so tourists can get nearer the ceiling? »
(Reisner, 1993 : 286).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 114 11/12/08 15:04:21
chapitre 3 • modulations 115
la tenue du tout premier Jour de la Terre (Earth Day). Certaines de
ces lois font obligation aux industriels de réhabiliter les zones que
leurs opérations ont détériorées.
Les choses, donc, ne seront plus les mêmes ; il est fort douteux
qu’un artiste puisse encore impunément proposer une « exposition »
qui serait réalisée à coup d’explosifs dans une vallée naturelle : « Dans
la mesure où le paysage et les earthworks sont en interaction, ces der-
niers ne peuvent être écologiquement neutres. Les politiques écolo-
giques sont donc un aspect intrinsèque aux earthworks » (Auping,
1983 : 94). Un art dont les matériaux sont naturels et les sites de pré-
dilection les vastes étendues inhabitées de l’Ouest devrait en effet
laisser transparaître quelques préoccupations environnementales. La
plupart des land artists qui pratiquent dans la deuxième moitié de la
décennie 1960 pourtant n’y songent pas, ou si peu.
Selon Suzaan Boettger, le lien fait entre le land art et le mouve-
ment environnemental est un phénomène médiatique, tributaire de
l’engouement populaire de la fin des années 1960 pour l’écologie. À
ce moment, la presse et les médias électroniques commencent à faire
état des désastres écologiques, à donner la parole aux environnemen-
talistes. Leo Marx observe que la télévision, en couvrant quelques
désastres écologiques « mineurs mais spectaculaires » aux heures de
grande écoute, fait une fois de plus la preuve de son pouvoir et que
c’est bien grâce aux médias de masse que l’écologie devient un sujet
d’intérêt public (Marx, 1972 : 81). Suzaan Boettger affirme que c’est
Grace Glueck qui, la première, dans sa critique de l’exposition Earth
Works présentée à la galerie Virginia Dwan parue dans le New York
Times sous l’intitulé « Moving Mother Earth », présume, motivée par
son propre intérêt pour la défense de l’environnement, que l’ensem-
ble de l’exposition démontre des préoccupations similaires
(Boettger, 2002 : 151). Glueck n’est pas la seule à prêter des inten-
tions de ce type aux artistes de Earth Works. Les journalistes, ceux de
la presse spécialisée comme ceux des journaux à grand tirage,
reprennent à loisir cette interprétation, d’autant que le courant envi-
ronnementaliste a la faveur du public. En cette ère de révolte géné-
rale, de contre-culture, il semble normal d’associer les artistes aux
mouvements de contestation, surtout les land artists qui sont sortis de
leurs ateliers pour aller se perdre dans la nature, tout comme les hip-
pies qui sont alors en plein mouvement de retour à la terre.
À la fin des années 1960, toutefois, Smithson et ses collègues,
appuyés en cela par leurs mécènes, sont encore les conquérants que
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 115 11/12/08 15:04:21
116 Le paysage façonné
l’on a vu partir à la recherche de terres qu’ils peuvent aisément louer
ou acheter et qu’ils pourront modifier par leurs actions. Bien que les
artistes utilisent généralement le matériau brut qui est sur place, leurs
interventions ne sont porteuses d’aucune vision particulière de la na-
ture.
Smithson réfute l’idée que le land art pourrait être associé à un
mouvement de retour à la nature, ajoutant que, pour lui, « le monde
est un musée » et que penser en termes de site et de non-site autorise
à ne plus se référer à la nature (Flam, 1996 : 246). Heizer quant à lui,
déclare que l’on peut le considérer comme un « entrepreneur en
construction » (Gruen, 1977 : 98). Et, en dépit des lois visant la pro-
tection de l’environnement et des sites naturels, le désert où tra-
vaillent les land artists demeure un lieu indifférent, qui n’intéresse
personne, où ils peuvent agir à leur guise. Car le désert est cet « en-
droit commode pour tout ce dont on ne veut pas », où l’on peut
enfouir des déchets toxiques avec l’aval des autorités et où des arme-
ments nucléaires sont régulièrement testés par le gouvernement
central : le Nevada Test Site est en fonction depuis 1951 (Darlington,
1996 : 124-149). Quelques mises en réserve dans les déserts seront
faites par le gouvernement central, mais la plupart de façon relative-
ment tardive par rapport à la promulgation du Wilderness Act de
1964 et du National Environment Policy Act de 1970. Ce qui n’exclut
pas que les œuvres monumentales du land art participent, entre autres
facteurs possibles et à long terme, au renouveau de la perception du
désert, lorsqu’il se transforme en un lieu où l’on peut se rendre pour
admirer des panoramas sublimes.
Les préoccupations sociales des années 1960 et 1970, portées
par la faveur (ou la ferveur) populaire, sont en quelque sorte pla-
quées sur les pratiques des artistes, particulièrement par les journalis-
tes. Certains commissaires et critiques cependant construisent des
argumentations plus subtiles concernant le rôle et l’importance des
œuvres monumentales dans le paysage. John Beardsley organise en
1977 Probing the Earth : Contemporary Land Projects, une exposition qui
rassemble des documents en rapport avec plusieurs des grandes
œuvres du désert, dont certaines ne sont pas encore terminées ou
sont complétées de fraîche date en 1977. Dans le catalogue de l’expo-
sition, pour contrer une interprétation voulant que les œuvres altè-
rent les lieux dans lesquels elles sont construites, il insiste sur l’effet
contraire et propose les earthworks comme des endroits privilégiés
pour l’observation de la nature, des points de vue sur le paysage.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 116 11/12/08 15:04:21
chapitre 3 • modulations 117
It is appropriate that land projects emerged just as this time when
many of us are trying to take stock of the natural environment, to
assess what we have done to it and determine what is left of it. Land
projects become, by this coincidence, part of a more widespread effort
to re-establish our relationship to the natural world. They affirm the
need for this relationship by requiring that we experience work and
site as a single totality. Changes in the landscape produce changes in
the works, enhancing our perception of them ; the works are simulta-
neously the means by which we enter a landscape, observe its charac-
teristics, learn its history, absorb its attendant mythology (Beardsley,
1977 : 27).
Beardsley donne ainsi une nouvelle portée aux earthworks que
d’aucuns trouvent antiécologiques et ouvre la porte à de nouveaux
discours qui seront fréquemment repris. Beardsley lui-même, en
mêlant systématiquement les projets d’artistes, de designers et de
jardinistes, contribuera à une certaine vision fonctionnaliste des land
projects.
Tôt ou tard cependant, ce sont les pratiques elles-mêmes qui
seront infléchies, et non pas seulement l’image que l’on en a ou les
discours qui les entourent. En un premier temps, les artistes doivent
modifier leurs attitudes. Smithson l’apprend à ses dépens en 1970,
avec la controverse que crée Island of Broken Glass et grâce à laquelle
il imaginera la fonction d’artiste-médiateur. Par la suite, avec ses pro-
positions de land reclamation, il fera figure de précurseur d’un certain
mouvement et bien qu’il soit mort avant d’avoir pu exécuter l’un
quelconque de ces plans, ses projets et ses écrits demeurent d’essen-
tiels opérateurs de transformation.
Afin de voir quelles sont les incidences de la traduction opérée
par Smithson, suivons un moment quelques-uns des artistes de sa
« génération esthétique », pour employer l’expression de Lippard.
Après quoi, je m’attarderai sur quelques travaux majeurs de Nancy
Holt, qui persévère jusqu’aux années 1990 dans un certain type de
pratique publique liée à la réhabilitation de lieux particuliers.
Pour comprendre ce que devient le land art (ou une certaine
mouvance à laquelle appartiennent les collègues de Smithson) après
le milieu des années 1970, il faut considérer non seulement les chan-
gements sociopolitiques qui contribueront à infléchir les pratiques
artistiques, mais aussi un autre facteur important, le financement des
arts qui aura un impact sur la production des artistes. Si Smithson a
fait preuve d’intuition en comprenant très tôt que la construction des
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 117 11/12/08 15:04:22
118 Le paysage façonné
earthworks monumentaux devait être soutenue par d’autres bailleurs
de fonds que les mécènes, ce ne sont pas vraiment – ou pas très long-
temps – des capitaux privés qui financeront ce type d’œuvres. Un
glissement va plutôt s’effectuer vers certaines formes d’art public, par
diverses interactions dans lesquelles seront engagés différents grou-
pes, instances et individus.
Un certain nombre de programmes de subvention gouverne-
mentaux visant à soutenir l’implantation d’œuvres monumentales
dans des lieux publics sont mis en place dans les années 1960 et 1970.
Le Art-in-Architecture Program du General Services Administration
(GSA) voit le jour en 1963 sous le nom de Fine Arts in New Buildings
Program23. Il est suspendu en 1966, les fonds étant coupés à cause des
énormes dépenses entraînées par la guerre du Vietnam. Il sera réta-
bli en 1973 sous son appellation définitive de Art-in-Architecture
Program. Ce programme stipule qu’un pourcentage (de 0,5 à 1 %)
des coûts de construction des bâtiments gouvernementaux doit être
réservé pour des réalisations artistiques. Le Art-in-Public-Places
Program du National Endowment for the Arts (NEA, organisme lui-
même fondé en 1965) naît en 1967. Les artistes, qui pouvaient déjà
recevoir du NEA des subventions à titre individuel, peuvent mainte-
nant être invités par des instances locales à créer des œuvres dans le
domaine public. Le Art-in-Public-Places Program est en effet créé
pour contribuer à financer des œuvres d’art public dont l’implanta-
tion est coordonnée localement. Des programmes d’intégration des
arts à l’architecture (percent-for-art programs) sont par ailleurs mis sur
pied par divers états, villes et comtés. Cet intérêt pour le soutien à
l’art public est un effet de l’État-providence peu à peu consolidé par
les gouvernements successifs, dans la société libérale d’après-guerre
aux États-Unis. Cette situation, en quelque sorte dans le prolonge-
ment du New Deal de Roosevelt, trouve son apogée sous l’administra-
tion de John F. Kennedy (et sa « Nouvelle Frontière » qui est « the fron-
tier of the sixties »), puis sous celle de Lyndon Johnson.
Des débats autour de la réhabilitation des sites miniers ont lieu
au Congrès et au Sénat à partir de 1968. Pendant plusieurs années,
des élus tenteront de faire passer des lois qui obligeraient les indus-
tries minières à remettre en état les terrains qu’elles altèrent. Il faut
attendre 1977 pour que finalement soit votée la Loi 98-85 (Surface
23. D’après Harriet Senie, la direction est donnée dès 1962 dans un rapport du President’s Ad
Hoc Committee on Federal Office Space, dans lequel il est recommandé que « where
appropriate, fine art should be incorporated in the designs [of New Federal Buildings]
with emphasis on the work of living American artists » (Senie, 1992 : 218).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 118 11/12/08 15:04:22
chapitre 3 • modulations 119
Mining, Control and Reclamation Act – SMCR). Certains États se sont
tout de même dotés de leurs propres lois quelques années aupara-
vant. La loi fédérale 98-85 représente une nouvelle opportunité – qui
ne sera toutefois appliquée qu’en très peu d’occurrences –, celle que
des œuvres de land reclamation soient financées par le U.S. Bureau of
Mines, par ses équivalents régionaux et parfois même par les compa-
gnies privées elles-mêmes.
L’année même de la mort de Robert Smithson, en 1973, le
Women’s Committee of the Grand Rapids Art Museum de Grand
Rapids au Michigan convie Robert Morris à participer à Sculpture Off
the Pedestal, une exposition extérieure. Peu intéressé à simplement
placer une sculpture dans un espace public, mais intrigué par la pos-
sibilité d’implanter une œuvre dans un lieu récréatif urbain accessi-
ble à un grand nombre de gens (Beardsley, 1977 : 61), Morris propose
son Grand Rapids Project qui sera réalisé en 1974. Il s’agit de deux ram-
pes asphaltées formant un grand « X » à flanc de colline à Belknap
Park. Dans une certaine mesure, l’œuvre réhabilite son site, la colline
étant fortement érodée au moment où Morris décide de l’interven-
tion.
L’œuvre restera la propriété de la municipalité. Elle est financée
par le National Endowment for the Arts (NEA), le Michigan Council
for the Arts, le Women’s Committee du Musée qui organise une levée
de fonds et le Grand Rapids Parks and Recreation Department.
Quelques années plus tard, John Beardsley écrira à propos de cette
œuvre :
The Grand Rapids Project marked the first time that public funds have
been involved in effecting a large-scale environmental work in Amer-
ica. From this date, the National Endowment for the Arts, the General
Services Administration and numerous state, county, and municipal
organizations displayed increasing receptiveness to this sort of art.
This coincided with a growing commitment among artists to the evolv-
ing public purpose of art in the landscape. Smithson’s notion that artists
have not only the capacity but also the social obligation to make bene-
ficial contribution to the use and restoration of the landscape was to
win ever-wider approval as the years passed. And while projects con-
tinued to come into being entirely through private sponsorship, more
and more public patrons were to accept both the aesthetic and utilitarian aims
of recent art in the landscape (Beardsley, 1984 : 29-3024).
Peu de projets d’« art dans le paysage » verront dorénavant le
jour avec l’aide de la seule commandite privée. Lorsqu’il ne s’agit pas
24. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 119 11/12/08 15:04:22
120 Le paysage façonné
uniquement de fonds publics, c’est un montage financier privé-public
qui permet la réalisation de ce type de travaux. Les Sun Tunnels de
Nancy Holt, réalisés entre 1973 et 1976, l’une des dernières œuvres
monumentales sises dans le désert, isolées et difficiles d’accès à être
terminées, sont financés en partie par le NEA et le Creative Public
Service Program de New York. Les fonds privés investis dans l’œuvre
sont ceux que Nancy Holt elle-même engage.
Ce qui ressort de la déclaration de Beardsley concernant le
Grand Rapids Project, outre l’intérêt nouveau démontré par les instan-
ces publiques envers la réalisation d’œuvres d’art dans le paysage,
c’est l’usage (« utilitarian aims ») et la fonction publique (« the evolving
public purpose of art in the landscape ») que l’on attribue, dès la fin des
années 1970, à ce type d’art. En effet, devant l’évidence que l’art
n’échappe pas aux lois du marché et avec les bouleversements so-
ciaux advenus dans les années 1960 et 1970, les artistes, et avec eux les
critiques et divers intervenants du milieu, cherchent pour l’art une
vocation, une fonction sociale. Et celle qu’on lui confère est finale-
ment dans la foulée de ce que Smithson propose en 1972 et 1973. S’il
est exagéré de dire que Smithson croyait vraiment à « l’obligation
sociale » de prendre part « à l’usage et à la restauration du paysage »
(dans la mesure où il cherchait un nouveau marché pour ses propres
œuvres), son idée de réhabilitation par l’art se propage. Mais, ce sera
par l’entremise d’une certaine fonction publique de l’art qui, tout en
intégrant des aspects environnementaux, dont la réhabilitation dans
un sens plus large que celle des seuls territoires industriels dévastés,
se traduit par un souci de rapports directs entre les œuvres d’art – ou
les artistes – et le public25, bientôt inclus dans la catégorie des usagers.
Ces nouveaux rapports que l’on cherche à établir entre artistes et
public seraient apparemment plus démocratiques puisque ce sont les
œuvres d’art qui, se retrouvant dans le domaine public, iraient vers la
population. L’« art dans le paysage », allant à la rencontre du public,
se déplace dès lors vers les zones urbaines et suburbaines. Il s’agira
généralement, dans certaines communautés, de redonner aux usa-
gers l’accès et l’usage de quelques endroits précis, en les réaména-
geant en œuvres d’art dans le but de mettre l’espace au service des
25. La notion de public, on le sait, est fort complexe. Harriet F. Senie, dans son introduction à
Critical Issues in Public Art, remarque: « The general public is now recognized as increas-
ingly diverse and composed of special interest groups whose commitment to self-
determination frequently overshadows their sense of participation in the broader fabric of
society.» (Senie, 1992 : xv). Une distinction s’opère donc entre communauté et public
comme « société large », à moins que le public ne soit simplement défini comme « a mass
of consumers and spectators » (Deutsche, 1996 : 59).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 120 11/12/08 15:04:22
chapitre 3 • modulations 121
populations26. Pour résumer, on pourrait dire que fonction sociale,
souci de l’environnement et retour en zones habitées donnent un
nouveau souffle au land art qui, d’« art dans le paysage », devient un
nouvel art public. L’un des facteurs déterminants de cette transforma-
tion du land art sera l’importance accordée à l’aspect récréatif, aux
loisirs. Du reste, Ron Graziani affirme que, sur le modèle de la créa-
tion des parcs nationaux (les mises en réserve – sauf dans le désert –
sont nombreuses à partir du moment de la mise en vigueur du
Wilderness Act en 1964), Smithson avec ses projets de réhabilitation
de territoires miniers veut fabriquer des « Industrial Parks » dont l’in-
térêt se situerait dans l’intégration de l’aspect « rejets », c’est-à-dire
des déchets miniers, et de l’aspect « plaisir » ou loisir (Graziani,
2004 : 20).
La possibilité de créer des zones récréatives en tirant profit des
modifications topographiques provoquées par l’extraction des miné-
raux est examinée dès 1967 dans le rapport « Surface Mining and
Our Environment » du U.S. Department of Interior, rapport qui pré-
cède l’adoption en 1977 de la Loi 98-85 mentionnée plus haut : « Le
rapport concluait son chapitre « Impact sur l’environnement » avec
l’argument selon lequel l’extraction de surface avait créé des oppor-
tunités de développer des zones récréatives [pittoresques] là où il
n’en existait pas auparavant, suggérant que les étangs et les lacs et
même les terrils eux-mêmes offrent très souvent un agréable change-
ment topographique dans des terrains généralement plats » (Graziani,
2004 : 22). Smithson ne raisonne pas autrement puisqu’il propose
« d’accepter les situations entropiques et d’apprendre, d’une certaine
façon, à incorporer ces choses qui semblent laides » ou lorsqu’il com-
pare Niagara Falls à un gigantesque puits minier à ciel ouvert : « Les
falaises entourant Niagara Falls suggèrent l’excavation et le forage,
mais c’est simplement le travail de la nature » (Flam, 1996 : 307-308).
En concevant des projets de réhabilitation par l’art qui auraient
donné lieu à une forme très achevée de tourisme récréatif/contem-
platif, de même qu’en désignant Central Park comme une « earth
sculpture » et en identifiant Frederick Law Olmsted son concepteur,
comme « America’s First earthwork artist » (Flam, 1996 : 158 et 164),
Smithson participe manifestement de ce que Ron Graziani identifie
comme Park Sensibility (1998 : 17). Et c’est bien à cette « sensibilité »
particulière que John Beardsley en appelle lorsqu’il évoque les « ob-
jectifs esthétiques et utilitaires » d’œuvres comme le Grand Rapids
26. « Objects and practices in space were held to be of “public use” if they are uniformly
beneficial, expressing common values or fulfilling universal needs » (Senie, 1992 : 259).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 121 11/12/08 15:04:23
122 Le paysage façonné
roject de Morris et lorsqu’il décrit d’autres lieux publics réaménagés en
P
aires de loisirs par les artistes. Beardsley voit en Calvert Vaux et Frederick
Law Olmsted « les plus éloquents ancêtres » des artistes qui cherchent
à améliorer l’environnement par des œuvres de land reclamation et
par la création de parcs, affirmant que dès le milieu du XIXe siècle,
Vaux et Olmsted avaient reconnu les bénéfices sociaux qu’engen-
draient les espaces récréatifs extérieurs planifiés, dans les régions
urbaines et rurales (Beardsley, 1984 : 11). C’est grâce à ce type d’argu-
ments, manifestement inspirés des écrits de Smithson, que Beardsley
établit une correspondance directe entre le land art et un certain art
public utile, c’est-à-dire récréatif, rapport qui sera par la suite repris et
propagé par bien des auteurs27. Beardsley, toutefois, n’est pas le
premier à suggérer pareil enchaînement, bien qu’il soit celui dont on
semble retenir les propos.
L’année de la réalisation du Grand Rapids Project est aussi celle
de l’inauguration de l’Artpark de Lewiston (dans l’État de New York,
tout près des chutes du Niagara) et de son programme d’artistes en
résidence. La majorité des artistes de la « génération esthétique » de
Smithson prendront part, entre 1974 et 1977, à ce programme que
Lucy Lippard considère comme une première dans le domaine de
l’interaction artistes-public.
If more artists had the opportunity to work in such close contact with
their audience, this could be the birthplace of a genuinely public art
– neither equestrian statues nor their abstract counterparts but an art
that belongs where it is and to the people there, illuminating the his-
tory and development of the area and becoming an heightened part
of the experience of the place (Lippard, 1974 : 38).
Au Artpark, Nancy Holt présente en 1974 Hydra’s Head, une
œuvre qui, à l’instar des Sun Tunnels, attire l’attention sur des phéno-
mènes naturels, ici la constellation dont elle porte le nom. Hydra’s
Head est faite de cylindres de béton tout comme les locators, mais cette
fois incorporés au sol et remplis d’eau, de façon que la lumière chan-
geante, la lune, les étoiles, les gouttes de pluie et ainsi de suite modi-
fient constamment l’œuvre.
Dennis Oppenheim, Alan Sonfist, Charles Simonds et bientôt
les Harrison (Helen et Newton) dont les débuts artistiques sont plus
tardifs et qui pratiquent un art à vocation écologiste – ils se spéciali-
sent dans la réhabilitation hydrographique et des écosystèmes – pré-
27. Entre autres par Harriet Senie, spécialiste de l’art public, qui reconduit sans la mettre en
question, la thèse de Beardsley. Voir Senie (1992), particulièrement le chapitre 4, p. 140-
171.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 122 11/12/08 15:04:23
chapitre 3 • modulations 123
sentent, entre 1975 et 1977, des œuvres temporaires qui sont exécu-
tées sur ou autour d’« un gigantesque tas de déchets chimiques »
(Lippard, 1983 : 233). Les Harrison (en 1977) et Sonfist (Pool of Virgin
Earth, 1975) tentent, littéralement, de réhabiliter le site, d’en extirper
par leurs interventions les composants chimiques. Quant à Oppen-
heim, il fabrique Identity Stretch (1976), une reproduction géante en
goudron de ses empreintes digitales en partie superposées à celles de
son fils. Quoique Oppenheim n’ait aucune intention de restaurer le
lieu, le goudron utilisé pour l’œuvre agit, selon Lippard, comme un
fertilisant pour la pelouse (!). Le Growth House de Simonds n’est pas
non plus une œuvre de réhabilitation, mais elle est tout de même
fidèle aux convictions de l’artiste : c’est un « travail social » qui « criti-
que le système et suggère des améliorations environnementales »
(Lippard, 1983 : 236).
S’appuyant sur l’éventualité que cette nouvelle expérience
donne lieu à des formes d’art qui seraient réellement écologiques et
publiques, Lippard souhaite que l’Artpark soit davantage qu’une
autre attraction touristique située dans le périmètre de Niagara Falls.
Y ayant observé une véritable possibilité d’interaction entre le public
et les artistes, elle défend désormais une certaine fonction (ou utilité)
sociale de l’art qui lui ferait dépasser le statut d’objet de consomma-
tion. Plutôt que l’« immatérialité et l’impermanence », Lippard sou-
tient, dès 1975, dans une série de conférences et d’articles, puis dans
Overlay, l’importance de « la continuité entre nature, site et commu-
nauté qui est une nécessité pour un art vivant » (Lippard, 1983 : 238).
Elle défend aussi une « fonction communicationnelle de l’art »
(Lippard, 1983 : 5) qui ferait qu’un art vraiment public serait celui
qui ne sépare plus l’art et la vie : « En fait, la meilleure gageure de
l’art, en cette époque où l’expérience publique est sujette à l’emprise
corporatiste et bureaucratique, pourrait se trouver dans l’intimité,
dans l’offre d’oasis, de jardins, d’un chez-soi dans l’immensité et l’im-
personnalité du contexte public » (Lippard, 1981 : 139). Et, suivant
cette logique : « Le parc est probablement la forme d’art public la
plus opérante qui soit, une interface entre la nature et la société »
(Lippard, 1983 : 228). Selon Lippard, le parc répond à deux « besoins »
fondamentaux d’un art « antiformaliste », la nécessité d’une conscien-
ce écologique de la nature et celle d’une audience plus large pour
l’art. Et si elle aussi associe Olmsted aux formes d’art qu’elle suppose
être les plus socialement engagées, c’est en citant Smithson, celui
dont elle fait le premier des « contemporary earth and garden artists »,
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 123 11/12/08 15:04:23
124 Le paysage façonné
auquel succéderont Sonfist et les Harrison entre autres artistes « qui
suivent la même voie que Smithson suivait avant qu’il ne meure, des
artistes qui ne sont pas effrayés par un art qui serait utile » (Lippard,
1981 : 137 et 145).
Tandis que les activités artistiques se poursuivent à l’Artpark de
Lewiston, à la King County Arts Commission qui s’occupe d’intégra-
tion de l’art à l’architecture et à l’environnement dès 1973 dans la
grande région de Seattle (la ville de Seattle possède sa propre Arts
Commission), le coordonnateur des arts visuels suggère en 1977 la
tenue d’un grand symposium de sculpture. Cette proposition se
concrétise en 1979 en Earthworks : Land Reclamation as Sculpture, un
événement majeur qui soulève l’enthousiasme des critiques, si ce
n’est celui du public. Quelques-uns des participants sont de la géné-
ration de Smithson : Dennis Oppenheim, Robert Morris, Lawrence
Hanson et Iain Baxter. Mary Miss et Beverly Pepper participent égale-
ment. Toutes et tous ont en commun d’avoir à leur actif des sited works
ou des œuvres commandées par des organismes publics ou des corpo-
rations. Deux architectes paysagistes font partie du groupe, Herbert
Bayer dont Virginia Dwan avait présenté une photographie du Grass
Mound (1955) dans l’exposition Earth Works et Richard Fleischner
qui, malgré une formation en design, se spécialise dans la création
d’œuvres d’art environnementales. Le but de l’événement selon Jerry
Allen, le coordonnateur qui en a eu l’idée, est de créer un nouvel outil
pour la réhabilitation de terrains altérés (« technologically abused ») en
donnant à des artistes l’opportunité de les refaçonner28.
L’événement comprend deux phases, d’abord la réhabilitation
d’une carrière abandonnée de quatre acres dans la banlieue de
Seattle, dont la réalisation par Robert Morris s’étend de janvier à
novembre 1979 et un « Design Symposium » débutant le 31 juillet,
auquel les sept autres artistes sont invités. On assigne à chacun de ces
artistes un site endommagé, diverses carrières et mines, un aéroport
désaffecté, une zone résidentielle expropriée, pour lequel ils doivent
dresser des plans de restauration en se conformant aux normes éta-
blies par l’État et la municipalité pour ce genre de travaux. Des pro-
jets proposés pour cette deuxième phase, seul celui de Herbert Bayer
sera complété (Mill Creek Canyon Earthwork à Kent, 1981) ; celui de
Fleischner fait l’objet d’une étude de faisabilité mais ne sera pas
construit. La majorité des artistes proposent des parcs publics, avec
28. Earthworks : Land Reclamation as Sculpture, Seattle, Seattle Art Museum/King County Arts
Commission, 1979, p. 5.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 124 11/12/08 15:04:23
chapitre 3 • modulations 125
ou sans éléments bâtis, d’un caractère plus ou moins ludique. Entre
autres exemples, le projet de Iain Baxter, « une sorte de parc, une
expérience familiale29 » comprend des « pistes de jogging agrémen-
tées ici et là de « stations d’exercice » » et d’un « parcours de gymnas-
tique pour fauteuils roulants » (Foote, 1979 : 35). Une exposition des
devis et maquettes des projets clôt le symposium et circule dans treize
musées états-uniens et canadiens jusqu’en 1983.
Le Earthwork at Johnson Pit no 30 de Robert Morris est inauguré
en novembre 1979. Il se trouve dans un endroit relativement isolé,
choisi par Morris à cause de cela et de son « cadre propice à la contem-
plation ». Selon la King County Arts Commission « The Earthwork »,
selon l’appellation qu’on lui donne dans la région, est l’une des piè-
ces majeures de sa collection d’art public, qui est par ailleurs fort bien
garnie, et sa création a redonné au site une vocation active, celle d’un
parc public, bien entendu. Il faut préciser que toute l’œuvre, y com-
pris le paysagement, les sentiers et le banc, a été conçue par l’artiste
lui-même30. Le projet est financé par le King County Department of
Public Works, le U.S. Bureau of Mines (U.S. Department of Interior)
et le National Endowment for the Arts.
3.1 ROBERT MORRIS, EARTHWORK AT JOHNSON PIT NO 30,
1979. KING COUNTY, WASHINGTON
Photographie : Suzanne Paquet, 2002
29. Earthworks : Land Reclamation as Sculpture, Seattle, Seattle Art Museum/King County Arts
Commission, 1979, p. 36.
30. Dépliant du King County Office of Cultural Resources, About the Robert Morris Earthwork at
Johnson Pit no 30, Seattle.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 125 11/12/08 15:04:25
126 Le paysage façonné
Earthwork at Johnson Pit no 30 constitue apparemment la première
occurrence d’engagement d’un artiste aux fins de la production
d’une œuvre d’art identifiée comme une œuvre de land reclamation
(Morris, 1980 : 9931). L’ensemble de l’événement soulève l’enthou-
siasme de certains critiques d’art qui croient que des manifestations
du genre répondent à la demande d’œuvres d’art public qui seraient
autre chose que des « masses d’acier géantes qui s’abattent devant les
banques et les places d’affaires » (Lippard, 1984 : 34), un art qui inté-
resserait vraiment et intégrerait la communauté tout en étant écolo-
gique ; un art qui, tout en procurant une expérience spatiale signifi-
cative, « serait capable d’impliquer au moins une partie de son
audience » (Lippard, 1977 : 84). Ici encore, se dresse le spectre de
Robert Smithson. Nancy Foote, dans un article publié peu de temps
après la fermeture du symposium de Seattle décrit en ces termes la
trajectoire qui, partant du land art, conduit au land reclamation :
So the plans are drawn up ; the project is launched. And Earthworks,
which signed off the 1960s as the most private, inaccessible art activity
imaginable, leave the ‘70s in the form of a major public art scheme.
We have come a long way from Double Negative, but by a route advoca-
ted on numerous occasions by Robert Smithson, whose spirit certainly
pervades the Seattle endeavour (Foote, 1979 : 38).
Robert Morris donne, à l’ouverture du symposium et avant
même que son œuvre ne soit achevée, une allocution qui traite d’art
public. Sa ligne directrice est la question suivante, « Qu’est-ce que de
l’art public ? », et il prend pour point de départ les œuvres monumen-
tales du désert. Des premières œuvres de Smithson, De Maria et
Heizer, privément financées et sises dans des zones isolées du désert,
il explique qu’elles ne pourraient être considérées comme des œuvres
d’art publiques puisque : « Le seul accès public à ces œuvres est photo
graphique » (Morris, 1979 : 11). À ce type de travaux il oppose les in-
terventions, effectuées en zones urbaines plus densément peuplées,
de Nancy Holt et Mary Miss entre autres artistes, qui selon lui sont
plus critiques et certainement plus publiques. Il avoue préférer toute-
fois les « terrains vagues » aux « ennuyeuses places » (numbing plazas)
et aux « absurdes jardins de sculpture » et ajoute, non sans ironie :
« en regard de la présente situation, ici, à Seattle, nous avons une
alternative à l’art comme décor urbain sous la forme de l’art comme
réhabilitation du territoire ». Il termine son allocution en s’interro-
geant sur le rôle de ce type d’art qui recèle le danger d’« effacer la
31. Morris souligne toutefois que certaines propositions ont existé avant Seattle et il renvoie
le lecteur aux écrits de Robert Smithson.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 126 11/12/08 15:04:25
chapitre 3 • modulations 127
culpabilité technologique » à peu de frais en fournissant au public
des travaux artistiques « inspirants et modernes » qui seraient tout à la
fois des « lieux agréables où se tenir » ou, à tout le moins, des parcs
« soignés et sans voyous » (Morris, 1979 : 11).
L’année suivante Morris reprend ce discours, le remanie (subs-
tantiellement) et le publie dans October sous le titre « Notes on Art as/
and Land Reclamation ». Entre-temps, le ton s’est considérablement
durci. D’une ironie qui laissait place à l’interprétation, Morris passe à
une dénonciation ferme de l’industrie (minière, principalement) et
de ses technologies de production, une charge à caractère plus nette-
ment politique et écologiste.
The overwhelming emphasis in the industrialized corporate capitalism
state is on the production and consumption of commodities. This pro-
duction/consumption cycle takes not only more and more natural
resources but ever more energy to transform raw materials into com-
modities (Morris, 1980 : 95).
Si, dans son allocution de 1979, il mettait en question l’art
ublic, il présente ici l’art comme objet de consommation, indiquant
p
que les œuvres site specific semblent répondre au système de produc-
tion/consommation plus en termes de services qu’en termes de pro-
duits. Morris souligne que les premiers travaux in situ, les œuvres
commanditées du désert, ont fait l’objet d’un financement tout à fait
aléatoire et sporadique, alors qu’en 1980 l’horizon s’ouvre sur des
possibilités de financement plus grandes par lesquelles pourrait voir
le jour un ménage à trois entre l’art, le gouvernement et l’industrie :
« la clef qui déverrouille la porte de la banque c’est le land reclama-
tion » (Morris, 1980 : 98). Voilà qui aurait ravi Smithson. Morris sou-
tient également que l’art comme land reclamation ne peut être qu’une
entreprise de relations publiques au profit des intérêts miniers en
particulier et des envahissants schèmes technologie-consommation
en général. Et là où Morris est négatif, Smithson était plutôt positif
lorsqu’il proposait ses projets aux compagnies, parlant de « valeur im-
mobilière ajoutée » et d’« image publique améliorée » par l’art com-
me land reclamation. À Seattle, Morris insistait peu sur les implications
politiques de telles interventions ; dans son article d’October il les met
de l’avant. Sa position est diamétralement opposée à celle des criti-
ques – Beardsley et Foote en particulier – qui font preuve d’un grand
enthousiasme eu égard aux possibles fonctions sociales de telles
œuvres. Pour Morris, fabriquer des œuvres de land reclamation équivaut
plutôt à endosser les « forces destructrices du capitalisme », à racheter
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 127 11/12/08 15:04:25
128 Le paysage façonné
socialement ceux qui ont détérioré le territoire. Il suggère donc de
laisser les sites dévastés par l’industrie en l’état, comme autant de
monuments à la folie du XXe siècle32, toute tentative autre, y compris
la réhabilitation par l’art, ne pouvant être qu’une entreprise de pro-
pagande.
Smithson envisioned the possibility of the artist acting as a “mediator”
between ecological and industrial interests. While it is still conceivable
that art works as land reclamation might achieve ecological approval
and the support of harassed coal industry (and even eager govern-
mental money), the notion of “mediation” loses all meaning in this
situation. Given the known consequences of present industrial energy
resources policies, it would seem that art’s cooperation could only
function to disguise and abet misguided and disastrous policies
(Morris, 1980 : 102).
Peu d’interventions artistiques de réhabilitation de sites indus-
triels à l’abandon seront réalisées par des artistes de la génération de
Smithson après l’épisode de Earthworks : Land Reclamation as Sculpture,
peut-être partiellement à cause des aspects controversés de cette pra-
tique qu’expose Morris, mais surtout parce que les compagnies pri-
vées s’y intéressent peu et ne les financent pas. Michael Heizer, mani-
festement peu sensible à la controverse, est invité à deux reprises à
exécuter de telles œuvres. En 1981, il convainc l’Anaconda Mineral
Company de lui laisser sculpter les résidus de sa mine de Tonopah au
Nevada, un site pour lequel Smithson avait fait une proposition en
1972. Geometric Land Sculpture/Anaconda Project ne sera jamais termi-
né. Pour l’artiste, l’occasion était belle de déplacer de la matière en
grande quantité (car l’on sait que Heizer conçoit ses sculptures en
fonction de leurs propriétés physiques), ici un million de tonnes de
roc sur quatre cents pieds par cinq mille pieds par quatre cents pieds.
Il ne reste du projet d’Anaconda qu’un photo-montage.
Peu de temps après, Heizer commence les travaux de réalisation
d’Effigy Tumuli sur un emplacement qui deviendra Buffalo Rock State
Park, près d’Ottawa en Illinois. Pendant deux ans, de 1983 à 1985, il
y déplace quatre cent soixante mille mètres cubes de terre et ajoute
six mille tonnes de pierre calcaire afin de régénérer un sol devenu
complètement acide et stérile, résultat de l’extraction de la silice opé-
rée par l’Ottawa Silica Corporation pendant quarante ans. Malgré
32. « What, one wonders, could be done for the Kennecott Bingham site, the ultimate site-
specific work of such raging, ambiguous energy, so redolent with formal power and social
threat, that no existing earthwork should even be compared to it? » (Morris, 1980 : 99).
Smithson avait proposé un projet pour cette même mine en 1973.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 128 11/12/08 15:04:25
chapitre 3 • modulations 129
cela, et fidèle à lui-même, Heizer affirme qu’il ne s’intéresse aucune-
ment au land reclamation :
I’m not for hire to go patch up mining sites. The strip-mine aspect of
it is of no interest to me. I don’t support reclamation art sculpture
projects. This is strictly art. I love mining sites. My whole family has
been in the mining business – and still is (Heizer cité par Célant,
1997 : 398).
Modelées à même les rejets miniers laissés sur place – une cer-
taine quantité de ceux-ci est encore visible dans le parc, laissés comme
un témoignage de l’état des lieux qui précède leur refaçonnement
par Heizer – , cinq figures monumentales représentent des animaux
aquatiques géométrisés. Les fonds pour cette intervention sont déga-
gés par l’Illinois Abandoned Mined Lands Reclamation Council, le
terrain est donné par l’Ottawa Silica Corporation et la Fondation de
cette même entreprise paie les honoraires de Heizer.
3.2 MICHAEL HEIZER, EFFIGY TUMULI, 1983-1985. BUFFALO
STATE PARK, OTTAWA, ILLINOIS, PANNEAU DIDACTIQUE
Photographie : Suzanne Paquet, 2000
L’œuvre de Heizer est présentée par les autorités responsables
du parc comme l’une des attractions les plus insolites de l’Illinois et
l’une des plus grandes sculptures de terre jamais construites33. De
même, Klaus Kertess compare Effigy Tumuli au Mount Rushmore du
Dakota du Sud, à même lequel Gutzon Borglum a sculpté, de 1927 à
1941, quatre gigantesques têtes de présidents. Soulignant que Effigy
Tumuli est d’un format encore plus considérable que les sculptures
du Mount Rushmore, Kertess (1986 : 79) affirme que l’œuvre de
33. Dépliant « Buffalo Rock State Park/Effigy Tumuli », Illinois Department of Natural
Resources.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 129 11/12/08 15:04:26
130 Le paysage façonné
eizer parle, elle aussi, de fierté nationale… Voilà qui est typique-
H
ment américain.
PLACES PUBLIQUES
Bien que très peu de sites strictement industriels aient été res-
taurés par des artistes dans les années 1970, la notion de réhabilita-
tion par l’art ne s’épuise pas, au contraire. Elle sera plutôt appliquée
en zones urbaines et suburbaines, en des périmètres habités. Car un
art qui interpelle le public au sens où l’entendent de plus en plus de
critiques et d’artistes engagés ne doit pas se trouver en des lieux trop
isolés. Le parc urbain, le jardin comme le dit Lippard, serait l’empla-
cement privilégié d’un certain travail in situ tout en offrant l’opportu-
nité d’intégrer l’art à la vie de tous les jours.
Artists who in the late ‘60s and ‘70s had been working in remote, often
desolate environment – either on private land with limited access (as
with site specific sculpture) or unpeopled land (Earthworks) – brought
back to the public sphere a notion of site not only easily transmissible
but also highly appropriate (Linker, 1981 : 66-67).
Kate Linker, Nancy Foote, Lucy Lippard, John Beardsley, tous
défendent un art qui a une fonction par laquelle sa validité publique
est assurée. Et cet art, étrangement, s’est développé à partir du land
art. Est-ce parce qu’il s’agit d’interventions dans le paysage ou parce
que quelques-uns des land artists de la première heure reviennent à la
ville assumer le design de parcs urbains que cette association est sug-
gérée par les critiques? Une partie de la réponse se trouve éventuelle-
ment dans le fait que l’art in situ (ou le design) subventionné – qui se
pratique surtout dans les villes – est pour un artiste une façon de
gagner sa vie tout en mettant à contribution une expertise chèrement
acquise dans les plaines désertiques et les lacs salés du sud-ouest, ce
qui est exactement ce que Smithson préconisait pour des lieux plus
périphériques, d’autres territoires. De plus, les critiques, en voulant
démontrer l’évidence d’une continuité du land art vers l’art public,
agiront comme des médiateurs qui modulent le sens de l’« art dans le
paysage ».
Quoi qu’il en soit, les œuvres d’art public environnementales
(au sens où elles transforment l’entièreté du lieu où elles sont réali-
sées), exécutées par des artistes en collaboration avec d’autres profes-
sionnels et des équipes d’ouvriers spécialisés, commandées par des
organismes publics et parapublics et subventionnées par les program-
mes d’intégration des arts – GSA, NEA, villes et États –, commencent
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 130 11/12/08 15:04:27
chapitre 3 • modulations 131
à foisonner aux États-Unis. Ce foisonnement s’inscrit en prolonge-
ment de ce que Harriet Senie identifie comme « public art revival in the
late sixties » (Senie, 1992 : 14 et suiv.). En même temps que les sculptu-
res de plazas se multiplient – le gouvernement tout comme les corpo-
rations privées usant de l’art pour améliorer leur image – s’installe
cette nouvelle forme urbaine d’« art dans le paysage » qui met à profit
les compétences des land artists récemment revenus du désert. Ce
genre d’art donne du travail aux artistes, tout en étant (soi-disant)
source de satisfaction pour les communautés environnantes. De plus,
l’art public environnemental est, dès lors, envisagé comme un facteur
de réhabilitation, non seulement physique, mais aussi économique.
Cette forme inédite de réhabilitation est associée à deux des-
seins formés par les gouvernements municipaux, le (re)développe-
ment urbain et l’augmentation du tourisme, généralement liés. Dans
le régime économique postindustriel qui s’installe dans les années
1970, les usines ferment ou déménagent dans d’autres pays et la
population, plus mobile, s’éloigne vers les banlieues. Certaines zones
des centres-villes se dépeuplent et les terrains vagues se multiplient. Il
faut attirer ou créer de nouvelles industries pour des villes en perte
de vitesse. Lorsque s’amorce la décennie 1980, moment où le touris-
me devient l’industrie mondiale numéro un, la réponse est évidem-
ment toute trouvée : le tourisme sera cette industrie et la gentrification
son assise. À cet égard, Kate Linker donne l’exemple de Seattle, « une
ville reconnue à la fois pour son soutien continu à la culture et pour
ses commandes sculpturales innovatrices », commandes novatrices
dont Earthwork at Johnson Pit no 30 de Robert Morris fait manifeste-
ment partie. Selon Linker, à la suite de l’effondrement de Boeing,
dans les années 1970, jusqu’alors la plus grande industrie de la ville et
un important employeur, les autorités municipales réinvestissent
lourdement dans les arts, pour en faire « une attraction touristique
majeure » (Linker, 1981 : 67). Ce réinvestissement contribue certaine-
ment à revitaliser la ville et ses environs et à attirer de nouveaux
citoyens et de nouveaux occupants corporatifs. Une technoburb infor-
matique se développe dans les environs de Seattle, un centre urbain
devenu prospère dont la périphérie (couverte d’œuvres d’art inté-
grées) s’étend de plus en plus.
Dès le milieu des années 1970, Nancy Holt se spécialise dans
ce type d’art de collaboration à fonction sociale, par lequel sont
réhabilités lieux et territoires, terrains vagues urbains et suburbains
et parfois périurbains, voisinages et milieux de vie. L’observation de
son travail peut contribuer à éclairer le rôle substantiel d’aide au
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 131 11/12/08 15:04:27
132 Le paysage façonné
éveloppement économique que l’on veut bien attribuer à l’art, « en
d
relation au tourisme et au développement urbain » (Linker, 1981 : 6834).
3.3 NANCY HOLT, CATCH BASIN, 1982. ST-JAMES PARK,
TORONTO, ONTARIO
Photographie : Suzanne Paquet, 2002
Ayant travaillé hors des villes pendant un certain temps, après
avoir achevé sa série de locators (Missoula Ranch Locators, View through a
Sand Dune et Sun Tunnels) et après avoir installé Hydra’s Head à l’Art-
park de Lewiston, Nancy Holt est sollicitée pour une série d’œuvres de
commande dont plusieurs se trouvent sur les terrains d’établissements
universitaires. Elle exécute Rock Rings (1977-1978) pour Western
Washington University à Bellingham, Polar Circle (1979) et Star Crossed
(1979-80) à Miami University d’Oxford en Ohio ainsi que Wild Spot au
Wellesley College de Wellesley, Massachussetts. Elle fait également par-
tie du groupe d’artistes qui réalisent des œuvres extérieures pour les
jeux olympiques d’hiver de Lake Placid en 1980, où elle crée 30 Below.
Quelques œuvres en zones urbaines lui sont également commandées,
dont Inside Out (1980) à Washington D.C., A nnual Ring (1980-1981) à
Saginaw au Michigan et Catch Basin à Toronto en 1982. Cette dernière
œuvre, tout en étant cohérente avec les préoccupations habituelles de
Holt, point de vue particulier proposé au visiteur, cadrage d’une cer-
34. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 132 11/12/08 15:04:29
chapitre 3 • modulations 133
taine partie du paysage, rappel des structures environnantes, réhabi-
lite aussi d’une certaine façon son site, aux dires mêmes de l’artiste35.
L’œuvre est fabriquée de telle façon que les eaux de ruissellement
sont dirigées vers son centre et évacuées, alors que l’emplacement
avait auparavant tendance à être mal drainé, posant problème aux
usagers du parc Saint-James, au centre-ville de Toronto.
« Nous intégrons de nouveau la fonction dans l’art », déclarera
plus tard Nancy Holt (McGill, 1986 : 45). De 1979 à 1984 elle travaille
à une œuvre d’art public pour la ville de Rosslyn dans le comté
d’Arlington en Virginie, une banlieue de Washington D. C. Cette
œuvre, Dark Star Park, fera l’objet de nombreux articles dans des
revues d’art aussi bien que des magazines de design, pour une raison
bien particulière : Holt assume à elle seule la tâche de direction des
travaux (« project landscape architect » (LeVeque, 1985 : 80)) pour
l’entièreté du projet de parc, créant d’importants précédents par son
travail d’équipe avec les administrateurs et les commissions de plani-
fication (Leibovitz-Steinman, 1995 : 240). Elle s’implique dans le pro-
gramme architectural, le paysagement, agit comme entrepreneur en
s’assurant des devis d’ingénieurs, du drainage, du bétonnage, etc.
L’on se souviendra que la construction et la mise en place des Sun
Tunnels avait fait appel à des compétences aussi diversifiées de la part
de l’artiste. À ceci près que Dark Star Park est une œuvre publique,
pour laquelle Nancy Holt est sélectionnée par un jury. Selon certains
auteurs, c’est justement parce qu’on lui connaît une singulière habi-
leté pour ce genre de réalisation complexe, étant donnée la nature
site specific de ses travaux précédents, qu’on la choisit (LeVeque, 1985 :
8036). Une autre version veut que Holt ait peu à peu pris le contrôle
de l’aménagement de la place publique sur laquelle devait être érigée
une simple sculpture, l’artiste obtenant, question de mieux intégrer
son œuvre, l’annexion de la place située devant un immeuble privé
adjacent au parc et allant même jusqu’à s’approprier une autre sec-
tion de terrain, un « refuge piétonnier » (traffic island) sous juridic-
tion de l’État de Virginie alors que l’emplacement initial est propriété
de la municipalité (Yau, 1985 : 9737). Ce sont toutes ces démarches,
35. Conversation avec Nancy Holt, Santa Fe, N. M., 6 mai 2002.
36. Et : « Originally, county planners had thought to have the park and sculpture designed
separately. But the artist selection panel, reacting to the extremely small site (about one-
half acre), felt that park and art work needed careful integration, and recommended Holt
as an artist capable of executing a single unified design for both sculpture and open
space » (Beardsley, 1984 : 106).
37. On trouve également cette version dans le feuillet de présentation Dark Star Park, Rosslyn,
Arlington County, Virginia, 1984, n. p.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 133 11/12/08 15:04:29
134 Le paysage façonné
ces négociations et ces changements de programme successifs qui
prennent la plus grande partie du temps d’exécution de l’œuvre. Le
parc lui-même sera aménagé en moins d’une année. Outre sa fonc-
tion de lieu public où l’on peut s’arrêter, Dark Star Park présente les
habituelles préoccupations que je qualifierais de photographiques de
Nancy Holt, jeux sur la perception à travers certains objets et prise de
conscience par l’observateur de son propre point de vue, travail avec
la lumière naturelle et le déplacement des ombres, bref « un parcours
destiné à ouvrir des vues » (Tiberghien, 2001 : 166).
Encore ici, l’œuvre est en quelque sorte un travail de réhabilita-
tion du lieu où elle est construite, une demi-acre laissée pour compte
par divers projets routiers et jonchée de décombres et de ruines, en-
tourée d’asphalte endommagé, de mauvaises herbes géantes, de clô-
tures effondrées, que l’artiste transforme en un « refuge pour les rési-
dents de la communauté » (Leibovitz-Steinman, 1995 : 240). En fait,
Dark Star Park est surtout vu par des automobilistes se trouvant dans
des véhicules en mouvement et donc dans l’impossibilité d’apprécier
les subtilités perspectives qu’offre l’œuvre. Elle est, selon LeVeque,
« avantageusement placée à l’entrée de Rosslyn » sur la route en pro-
venance de Washington et elle marque parfaitement l’entrée (« provi-
des a strong sense of entry ») de cette banlieue (1985 : 81).
3.4 NANCY HOLT, DARK STAR PARK, 1979-1984, ROSSLYN,
ARLINGTON COUNTY, VIRGINIA
Arlington Dept of Parks, Recreation and Cultural Affairs/Nancy Holt
Photographies : Nancy Holt. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
Si Dark Star Park est unanimement célébré pour la démonstra-
tion qu’y fait Nancy Holt de la capacité des artistes à agir comme
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 134 11/12/08 15:04:30
chapitre 3 • modulations 135
professionnels de la planification urbaine et directeurs de chantiers
et aussi parce qu’on y voit une parfaite association de l’art et de la
place publique fonctionnelle, les interprétations diffèrent quant à la
forme d’art public que pratique Nancy Holt.
Miwon Kwon (2002 : 60) classe les différents types d’art public
de la façon suivante : (1) art-in-public-places, catégorie qui correspond
à ces « masses d’acier géantes qui s’abattent devant les banques et les
places d’affaires » décriées par Lucy Lippard et dont la vocation est
d’améliorer les images corporatives et gouvernementales ; (2) art-as-
public-spaces, soit un art « fonctionnel » qui va de la conception de mo-
bilier urbain par des artistes aux espaces entièrement paysagés
(« landscaped environment ») par ceux-ci et au rang desquels, d’après
Kwon, se classe la production de Nancy Holt ; (3) art-in-the-public-
interest, une forme d’art qui engage la collaboration des communau-
tés (avoisinantes, en général), qui se distingue par un certain acti
visme social. Cette dernière catégorie, nommée par Arlene Raven
(1989), est décrite par Suzanne Lacy sous l’appellation « new genre
public art ».
Dark Star Park semble se trouver dans toutes ces catégories à la
fois, suivant les positions des différents critiques qui l’examinent. « La
construction du sens dépend de celui ou de celle qui y procède », dit
d’ailleurs Suzanne Lacy (1995 : 21). Et selon elle, l’élaboration d’une
histoire du new genre public art n’est pas tributaire des matériaux, des
espaces ou des médiums artistiques (ce qui serait le cas d’autres his-
toires de l’art public), mais elle est basée sur des concepts d’audience,
de relations, de communication et d’intentions politiques (Lacy,
1995 : 28). Nancy Holt peut entrer dans cette « histoire » spécifique,
puisqu’elle est devenue une « résidente temporaire » de Rosslyn et
parce qu’elle s’est « immergée dans la toile sociale et politique de la
communauté pour faire du parc une réponse aux besoins de celle-ci »
(Leibovitz-Steinman, 1995 : 240). Le new genre public art peut aussi
réhabiliter et restaurer son site, physiquement et socialement. Mais,
pour ce faire, il faut que la population avoisinante soit directement
impliquée dans le processus créatif, par exemple lorsque l’artiste fait
travailler des jeunes ou engage les graffiteurs du coin à peindre des
murales. Le public doit donc être en mesure de se réapproprier
l’espace et l’artiste le soutient dans cette entreprise ou bien conçoit
des projets à cet effet. Soulignons que le new genre public art n’est pas
forcément commandé par des instances publiques ou financé par des
agences telles le NEA ou le GSA, non plus qu’il en résulte des œuvres
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 135 11/12/08 15:04:30
136 Le paysage façonné
qui seraient nécessairement permanentes. Dans la mesure où il n’y a
pas de financement public en jeu, on peut se demander si cela est
bien de l’art public. Les tenants de l’art-in-the-public-interest affirme-
ront que c’en est, dans la mesure où ce qui est politique est public et
que ce type d’art serait l’art public le plus authentique (Markymovcz,
1992 : 149). Ainsi, il ne s’agit pas de faire œuvre d’art permanente à
partir d’un plan d’aménagement préétabli dont un seul artiste aurait
l’entière responsabilité, de la création à la direction des travaux ;
auquel cas la communauté serait simplement consultée, par exemple
lorsque l’on fait appel à l’un de ces représentants des usagers qui
siège à un comité composé des propriétaire, promoteur, architecte,
artiste, etc., qui ne suggère en général que quelques modifications,
souvent en termes de sécurité. Les tenants du new genre public art
soutiennent que Dark Star Park est devenu un repère (« a landmark »)
adopté avec enthousiasme par les résidents de Rosslyn. Pourtant, ces
derniers n’ont aucunement participé à la réalisation de l’œuvre, et
celle-ci ne présente nul contenu ou nulle intention politique. La
communauté à laquelle Dark Star Park s’adresse est formée, semble
t-il, des gens qui travaillent dans l’édifice à bureaux qui jouxte le parc
et Holt a le contrôle complet du projet.
D’autres histoires, en effet, coexistent avec celle du new genre
public art. Harriet Senie explique que Dark Star Park n’est fréquenté
que par les travailleurs de l’édifice adjacent, qui le traversent et s’y
arrêtent, quoique occasionnellement. Comme je l’ai souligné plus
haut, le parc est plus généralement vu à partir d’automobiles en mou-
vement. Et Senie d’ajouter :
Although the visual experiences Holt describes are available, they are
not particularly encouraged by the site. A driver, for obvious safety
reasons, cannot be an attentive art viewer, and pedestrian use of the
area is limited. Dark Star Park remains a strong, formally interesting
piece, which is actually better experienced through Holt’s photographs than at
the site. In an art park or sculpture garden – a different setting with a
different audience – it would be more successful, because Dark Star
Park is basically more concerned with abstract art issues than it is with
being a useful park (Senie, 1992 : 158-15938).
S’il n’est pas vraiment utile selon Senie, le parc améliore tout de
même l’image de Rosslyn, étant donné sa situation à l’entrée de la ville
et le fait qu’auparavant il n’y avait là que des décombres. L’œuvre de
Holt pourrait ainsi être classée dans la première catégorie de Kwon,
celle de l’art pour places publiques (art-in-public-places) ou pour ces
38. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 136 11/12/08 15:04:30
chapitre 3 • modulations 137
« absurdes jardins de sculpture » que Robert Morris range dans le
même groupe.
Mais Dark Star Park fait – sans conteste – partie de la catégorie
dans laquelle Miwon Kwon place les travaux de Holt, cet art-as-public-
spaces dont Rosalyn Deutsche signale qu’on l’appelle également « new
public art » lorsqu’il commence à émerger, au moment même où Holt
entreprend Dark Star Park39. Ce nouvel art public est caractérisé – et
c’est le cas pour Dark Star Park – par sa permanence, par l’occupation
complète du site proposé à l’artiste, et par une fonction que l’on dit
sociale, mais qui est déterminée à l’avance et qui n’est pas bien polé-
mique : l’embellissement et le loisir. Nancy Holt commence son tra-
vail à Rosslyn en 1979 ; elle est donc l’une des premières à concevoir
ce genre de projet. Mais de telles réalisations seront nombreuses dans
les années 1980, à tel point qu’une sorte d’industrie s’installe :
A large industry consisting of artists, government agencies, art organi-
zations and consultants, all or part of whose livelihood has depended
on the expansion of public art. This industry was powered by the
popular appeal of social cachet art acquired beginning in the ‘60s, and
the aesthetics of the period which pushed sculpture out of the art gal-
lery and into open space (Gibson, 1988 : 32).
Ce type d’art associatif (« collaborative art », autre appellation que
lui donne Rosalyn Deutsche) est doublement utile. Une œuvre envi-
ronnementale sous forme de parc public offre un lieu pour pratiquer
certaines activités récréatives, de la détente dont il est question pour
Dark Star Park jusqu’à certaines occupations ludiques – la découverte
des points de vue possibles à l’intérieur de cette même œuvre pour-
rait en être une – ou sportives. Ce type d’œuvre fait donc partie de ce
que Hariet Senie appelle « urban amenities », expression difficile à tra-
duire qui évoque nécessairement l’idée d’une fonction. Par ailleurs,
les parcs et les aires de loisir aménagés par les artistes représentent
une contribution non négligeable à bien des projets de revitalisation
urbaine. Pour les promoteurs urbains et pour les dirigeants munici-
paux, l’art public, dans les années 1970 et 1980, doit attirer le touris-
me, ainsi que de nouveaux commerces et entreprises, tout en redon-
nant aux citoyens de la ville une certaine fierté. « En effet, l’essor de
l’art public associatif accompagne le redéveloppement urbain prati-
39. « The new public art was defined as art that takes the form of functional objects placed in
urban spaces – plumbing, park benches, picnic tables – or as art that helps design urban
spaces themselves. » (Deutsche, 1996 : 259) Signalons que le plumbing est certainement
une allusion à certaines œuvres de Holt (dont Catch Basin) que H. Senie range plus aima-
blement dans la catégorie des fontaines.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 137 11/12/08 15:04:31
138 Le paysage façonné
quement depuis ses débuts » (Deutsche, 1996 : 66). Et dès la fin des
années 1980, selon Eric Gibson, dans les espaces urbains extérieurs,
ce type d’art supplante rapidement parcs et aménagements paysagers
pour devenir une structure récréative majeure40.
Que ce soit comme l’un des éléments d’un nouveau complexe
habitation-services ou qu’il s’agisse de redonner une vocation à des
bouts d’espace qui ont été laissés pour compte lors de grands projets
de renouvellement des infrastructures, ce qui est le cas pour Dark Star
Park, l’art dans le paysage devient l’un des outils de l’aménagement
du territoire qui tend à homogénéiser l’espace urbain au profit d’une
classe moyenne qui sera attirée par l’apparence de qualité de vie que
donnent les lieux soigneusement re-composés et intégrés par des pro-
fessionnels. Et Dark Star Park, que Nancy Holt a si minutieusement
élaboré pour l’entrée d’une banlieue en Virginie, est certes une réus-
site de réaménagement : « Grâce à elle, alors, le terrain vague urbain
renaîtra sous la forme d’un jardin d’Éden du re-développement »
(Linker, 1981 : 72).
Ainsi reconnue pour ses capacités de mener à bien de grands
projets de réhabilitation en collaboration avec d’autres professionnels,
Holt est conviée en 1984, l’année même de l’achèvement de Dark Star
Park, à restaurer un dépotoir du New Jersey. C’est un site périurbain
qui n’est pas directement en zone habitée. Situé aux Hackensack
Meadowlands à quelque cinq milles de New York, le dépotoir a près de
cent pieds de hauteur et couvre cinquante-sept acres, pour dix mil-
lions de tonnes d’ordures. Projet d’envergure non seulement par ses
dimensions, Sky Mound sert plusieurs buts. Le premier est de l’ordre
de l’intervention écologique : la montagne de détritus est scellée par
une toile plastique faite de bouteilles recyclées et les gaz méthane pro-
duits par la décomposition des déchets sont captés pour fabriquer de
l’électricité. Le site est ensuite terrassé, des végétaux sont plantés et un
étang créé, de façon à attirer la faune et à (re)composer un milieu
naturel. Holt veut aussi faire de Sky Mound un parc – « Aussitôt que j’ai
vu le site, j’ai su que je voulais transformer ce dépotoir en parc/œuvre
d’art » (Marter, 1994 : 31) –, une aire de loisirs complète avec des sen-
tiers et toutes sortes de dispositifs d’observation, ces objets dont elle a
fait pour ainsi dire sa marque de commerce. Le parc doit en effet com-
prendre des structures où s’alignent les solstices et les équinoxes ainsi
que des points d’arrêts (ou des points de vue) particuliers pour obser-
40. ���������������������������������������������������������������������������������������������
« Art is fast replacing the park or landscaping as the chief recreational context in our out-
doors urban spaces » (Gibson, 1988 : 32).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 138 11/12/08 15:04:31
chapitre 3 • modulations 139
ver la lune et certaines constellations. De plus, étant donné sa situa-
tion géographique, des vues – panoramiques – s’ouvrent à partir de
Sky Mound, sur Manhattan, Newark, le Pulasky Skyway, des réseaux
d’autoroutes et de voies de chemin de fer, de vieux ponts tournants
d’acier et « ici et là, des restes délabrés de la Révolution industrielle »
(Marter, 1994 : 31). Une décharge publique réhabilitée (« les dépo-
toirs sont les artéfacts de notre génération », dit Holt (Cembalest,
1991 : 104)) offre des perspectives hautement significatives sur des
paysages distinctifs de l’âge postindustriel, la ville et sa banlieue, les
réseaux de transport routiers et ferroviaires symboles de la mobilité
nord-américaine, et même sur quelques ruines industrielles. En
contrepartie, le site étant adjacent au New Jersey Turnpike, aux voies
ferrées de la compagnie de trains de passagers Amtrack et à l’aéroport
de Newark, les voyageurs en transit peuvent bénéficier de vues particu-
lières sur l’œuvre, « Sky Mound ayant été conçu pour divers points de
vue » (LeVeque, 1988 : 86).
3.5 NANCY HOLT, SKY MOUND, 1984.
HACKENSACK MEADOWLANDS, NEW JERSEY
Maquette par Nancy Holt, 1989 ; Vue aérienne vers l’est montrant l’installation du
revêtement de la décharge, 1990 ; Moon Viewing Area, dessin de Nancy Holt, c. 1985.
Reproduit avec l’autorisation de New Jersey Meadowlands Commission. Dessin et
maquettes de Nancy Holt, courtoisie de New Jersey Meadowlands Commission.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 139 11/12/08 15:04:32
140 Le paysage façonné
Comme pour les Sun Tunnels et autres locators, certains aspects
distinctifs des travaux de Holt, soit la quantité de points de vue possi-
bles et les perspectives et panoramas circonscrits et cadrés sur l’œuvre
et dans l’œuvre, offerts au visiteur et au voyageur, sont présents dans
la conception de Sky Mound. Ces formes et configurations particuliè-
res en font une œuvre en condition photographique, comme la plu-
part de ses autres travaux. Il en va de même pour Dark Star Park, dont
Harriet Senie affirme qu’on l’expérimente plus aisément par ses
photographies qu’en l’arpentant. Sky Mound, toutefois, semble destiné
à demeurer une image. Les travaux y sont arrêtés depuis 1990. En
revanche ce serait, de tous les projets de Nancy Holt, celui qui est le
plus médiatisé : « même s’il ne voit jamais le jour, on en a tant parlé
dans la presse qu’il existe d’une certaine façon » (Holt citée par
Tiberghien, 1996 : 49).
Géré par le Hackensack Meadowlands Development Commis-
sion (HMDC) créé à cet effet, le projet de réhabilitation du dépotoir
devait s’effectuer en deux phases. La première, achevée en 1990,
consistait à placer les capteurs de gaz, à recouvrir les déchets et à
renaturaliser le site. L’intervention de Holt devait ensuite être com-
plétée et c’est cette phase qui reste en suspens. Dès le départ, le projet
est un travail d’équipe qui, en plus de Holt, fait appel à une archi-
tecte paysagiste, à un groupe spécialisé dans le recouvrement du gaz
méthane et à deux astro-archéologues, spécialistes des sites préhisto-
riques et de leurs relations avec les événements astronomiques – car
pour Holt, le site de Sky Mound rappelle les tertres anciens. Pour la
première étape, l’État du New Jersey assume le financement ; pour la
deuxième, une subvention du NEA est assurée. Selon l’artiste, qui a
déclaré forfait après plus de dix ans d’attente, l’inachèvement des
travaux est causé par la mauvaise volonté de certaines instances41.
Quant à la HMDC, voici sa version : « Tous les éléments liés à l’étan-
chéification du dépotoir ont été installés selon le plan. Mais le projet
n’était que partiellement complété. Étant donné la nature active de
la décomposition de la sous-couche de la décharge, le sol s’est rapide-
ment comprimé, empêchant l’installation adéquate des autres élé-
ments42. »
Nancy Holt aura plus de succès avec un autre projet de land
reclamation. Avec Up and Under, exécuté en 1998, l’artiste réhabilite
une carrière abandonnée près de Nokia en Finlande, selon ses préoc-
41. Conversation avec Nancy Holt, Santa Fe, le 6 mai 2002.
42. www.meadowlands.state.nj.us/eip/p-reclamation.html
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 140 11/12/08 15:04:32
chapitre 3 • modulations 141
cupations coutumières : « Chaque expérience visuelle se rattache à la
dynamique de la perception elle-même – le proche et le lointain, le
tout et le détail, l’aérien et le terrestre » (Marter, 1994 : 32). En plus
de sa fonction de restauration du site, l’œuvre a un autre usage, celui
d’amphithéâtre, cet agencement ayant été l’une des conditions de la
commande à remplir par l’artiste.
Avec Sky Mound, Holt est la première artiste à tenter de réhabili-
ter un dépotoir. Par la suite, surtout à partir du début des années
1990, d’autres projets similaires seront tentés. Un appel aux artistes
est lancé par le King County Art Program en 2002 pour réhabiliter un
terrain semblable. Mierle Ukeles travaille dans les années 1990 avec
le New York Department of Sanitation à des programmes de gestion
des déchets et de recyclage. Les Harrison travaillent toujours à la res-
tauration environnementale tandis que l’artiste Viet Ngo fonde sa
propre corporation de traitement des eaux usées, qui offre des
schèmes de paysagement complets. Patricia Johanson rétablit des
écosystèmes en péril. Harriet Feigenbaum aux États-Unis et Herman
Prigann en Europe réhabilitent (parfois) des territoires miniers43.
Plus qu’un art dans le paysage, les héritiers de Smithson pratiquent,
d’une part, un art public étroitement lié au développement urbain
qui les apparente aux architectes paysagistes et, d’autre part, un art à
caractère écologique dont la fonction de réhabilitation est plus im-
portante que l’intérêt pour un vocabulaire formel personnel par
lequel se distinguaient les artistes de la « génération esthétique » de
Smithson44. Ceux-ci, à quelques exceptions près (dont Nancy Holt),
après un bref épisode d’art public impliquant parfois la controverse,
comme c’est le cas pour Earthwork at Johnson Pit no 30 de Morris,
retournent dans les galeries et les musées ou se retirent dans leurs
terres, tel Heizer qui travaille depuis les années 1970 à son gigantes-
que Complex City, œuvre monumentale dissimulée dans sa propriété
du Nevada.
43. Au sujet de ces artistes spécialisés dans la réhabilitation et la restauration, on peut consul-
ter : Robin Cembalest (1991 : 97-105) ; Weilacher (1999) ; Tiberghien (2001 : 173-194).
44. Il semble que le Art-in-Public-Places Program du NEA ait suivi (ou encouragé) ces prati-
ques. Déjà, en 1981 : « The [NEA] projects have grown with aesthetic concerns and social
needs, moving from the original focus – large scale sculpture – toward collaborative
ventures, planning grants, works of an ecological nature and works based in economic re-
development schemes » (Linker, 1981 : 39).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 141 11/12/08 15:04:33
142 Le paysage façonné
LE VILLAGE GLOBAL
Just as shifts in the structural organization of cultural production alter the form of
the art commodity (as service) and the authority of the artist (as primary narrator
or protagonist), values like originality, authenticity, and singularity are also
reworked in site-oriented art – evacuated from the art work and attributed to the site
– reinforcing a general cultural valorization of places as the locus of authentic
experience and coherent sense of historical and personal identity
Miwon Kwon, One Place after Another
Issu du land art isolé dans le désert, subséquemment à quelques
tentatives de restauration de territoires industriels rares mais très pu-
bliques par la couverture médiatique dont elles font l’objet, l’art dans
le paysage est intégré à des schèmes de développement urbains ou à
des plans de restauration périurbains. Le voici devenu service dans un
espace socioéconomique où domine une certaine idée de qualité de
vie, qui est en soi un bien de consommation. En ce qui concerne la
forme d’art dénommée art-as-public-spaces par Miwon Kwon, un parte-
nariat dont l’objectif commun est la revitalisation urbaine s’établit
entre les agences gouvernementales subventionnaires et les entrepri-
ses privées productrices de biens et services, particulièrement des
corporations immobilières. Quoiqu’il ne s’agisse pas directement de
réhabiliter des territoires dévastés par des activités industrielles, ce
type d’alliance artistes/entreprises privées/agences gouvernemen
tales est probablement ce que Robert Morris aurait pu envisager de
pire dans le genre ménage à trois dont le privé et le public profitent.
On l’a vu avec Dark Star Park, la municipalité et les promoteurs immo-
biliers bénéficient à part égales de l’amélioration que représente le
parc/œuvre d’art. La présidente du Conseil d’administration du
Comté d’Arlington explique que Dark Star Park est le produit d’une
alliance créative entre les agences locales et fédérales – le Art-in-Public-
Places Program du NEA et les autorités du comté subventionnent
l’œuvre – et le secteur privé – de nombreuses compagnies fournissent
des fonds, dont J. W. Kaempfer Jr, le promoteur immobilier proprié-
taire de l’immeuble adjacent au parc : « Tout comme le design de
Nancy Holt assemble les constructions urbaines et les motifs naturels,
liant la ville et le ciel, le projet démontre comment le gouvernement,
l’entreprise privée, la philanthropie et les arts peuvent collaborer
pour le meilleur profit de tous45. »
45. Texte de Ellen M. Bozman (Chairman, Arlington County Board), feuillet de présentation
Dark Star Park, 1984, n. p.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 142 11/12/08 15:04:33
chapitre 3 • modulations 143
Tout comme John Beardsley, sur la thèse duquel (Earthworks and
Beyond, tout spécialement) elle s’appuie pour retracer la transforma-
tion du land art en un art public qui ramène la nature en ville, Harriet
Senie reconnaît la part prise par ce type d’art dans le développement
urbain, mais toujours au nom d’une fonction sociale d’embellisse-
ment et de récréation largement considérée, comme s’il était possi-
ble que les espaces ainsi créés soient à l’usage de tous sans exception
aucune. Senie soutient en effet que, de la création de parcs à la sculp-
ture de réhabilitation, l’art public qui s’associe au paysage, ou qui
l’intègre, est nécessairement un art égalitariste, puisque le paysage
plaît à tous. Appréciées dans le contexte large de l’aménagement
urbain, ces œuvres remplissent une fonction fondamentale, celle de
procurer quelques-uns des effets réparateurs de la nature, ajoute-
t-elle (Senie, 1992 : 170).
Or, si la nature est en effet séduisante pour tous, on ne peut tou-
tefois ignorer dans quels buts et pour qui sont aménagés ou restaurés
certains lieux.
La revitalisation urbaine profite en effet généralement très peu
aux populations défavorisées, elle les éloignerait (les exclurait) plutôt.
On connaît bien tous ces exemples, dont SoHo à New York est le plus
célèbre, de quartiers ouvriers où les usines sont désaffectées les unes
après les autres, quartiers bientôt gentrifiés parce que des artistes s’y
installent. Comme ils amènent avec eux une aura branchée, des rési-
dants plus fortunés sont attirés vers ces zones avec la spéculation im-
mobilière qui s’ensuit, délogeant finalement artistes et population
traditionnelle. D’autres exemples sont ces complexes résidentiels
chics créés de toutes pièces, comme Battery Park City (toujours à New
York), où des fonds publics sont investis dans la construction de
parcs/œuvres d’art qui agrémentent des lieux à peine publics46. Selon
Rosalyn Deutsche, les artistes qui se consacrent à ce genre d’art public
intégré, de même que les architectes paysagistes, agissent comme des
technocrates au service des forces dominantes qui planifient la revita-
lisation urbaine au détriment des populations pauvres ou tradition-
nelles.
Instead, absorbing dominant ideology about the city, proponents of
the new public art respond to urban questions by constructing images
of well-managed and beautiful cities. Theirs is a technocratic vision.
Insofar as it discerns a real problem – the loss of people’s attachment
46. « [In the 1980s] “public space” was far less concerned with civic pride than with creating
exclusive spaces conductive to hedonistic leisure consumption » (Aitchison, MacLeod et
Shaw, 2000 : 149).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 143 11/12/08 15:04:33
144 Le paysage façonné
to the city – it reacts by offering solutions that can only perpetuate
alienation: the conviction that needs and pleasures can be gratified by expertly
produced, professionally ‘humanized’ environments (Deutsche, 1996 :
69-7047).
La planification urbaine à grande échelle est symptomatique
d’une volonté proprement postindustrielle de production de l’espa-
ce. Et ce désir de (re)mise en forme s’étend à tout le territoire : on revi-
talise l’urbain et parfois le suburbain, on patrimonialise le rural et
parfois l’industriel, on renaturalise la périphérie et ses ruines indus-
trielles, et ce, selon des opérations de plus en plus largement concer-
tées. À l’égard de ces desseins globalisants, deux facteurs retiennent
ici l’attention, d’abord (brièvement), le phénomène général dans
lequel s’inscrivent les parcs/œuvres d’art élaborés par des artistes
comme Nancy Holt, ensuite le rôle d’un autre genre d’art, la photo-
graphie, dans le refaçonnement du territoire à l’ère postindustrielle.
Le redéploiement de l’espace urbain auquel prend part le nou-
vel art public est, comme l’explique Rosalyn Deutsche, tributaire de la
mondialisation et assure la survie du capitalisme. L’usinage des pro-
duits en dur ayant été repoussé à la périphérie, dans des pays généra-
lement non occidentaux, les grandes villes occidentales se reforment
en métropoles à partir desquelles les entreprises exercent le contrôle
sur de vastes réseaux, intercontinentaux voire mondiaux, de produc-
tion. Dans ces réseaux, les télécommunications et les technologies de
l’information ont évidemment une importance grandissante, tout
comme d’ailleurs les transports terrestres et aériens, formes plus tra-
ditionnelles de mobilité. Soulignons que selon Marshall McLuhan, le
transport aérien n’est pas une forme traditionnelle de mobilité. Il
célèbre plutôt « le principe iconique de la mosaïque de contact et
d’interaction simultanés inhérent à la vitesse implosive de l’avion. Le
même principe d’implosion en mosaïque s’applique, encore davan-
tage, au transport électronique de l’information, sous toutes ses
formes » (1992 : 292). La métropole en vient donc à produire des
services à l’usage de ceux qui y résident et qui contrôlent, approvi-
sionnent et entretiennent les réseaux d’information et de produc-
tion. Pour attirer et retenir ces nouvelles classes de travailleurs, il faut
que l’espace soit aménagé en conséquence, homogénéisé selon l’ima-
ge des « well-managed and beautiful cities », ce dont les instances publi-
ques se chargeront en partie, et dont elles profiteront, car l’améliora-
tion du cadre de vie entraîne forcément l’augmentation des impôts
47. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 144 11/12/08 15:04:33
chapitre 3 • modulations 145
fonciers. Les classes moins favorisées sont alors repoussées hors des
centres, vers des enclaves moins visibles et toutes les grandes villes du
monde, les métropoles, en viennent à se ressembler48. Et « [l]es pro-
fessions telles que l’urbanisme et l’architecture de paysage – et main-
tenant l’art public – se chargent d’imposer cohérence, ordre et ratio-
nalité spatiale » (Deutsche, 1996 : 5).
Quant aux œuvres de réhabilitation périurbaines dont Sky
Mound, l’on peut sans doute les considérer comme des infrastructu-
res destinées au tourisme de proximité, aux « activités de loisir
de courte durée des populations urbaines » (Cazes, Lanquar et
Raynouard, 1993 : 5), parce qu’elles sont situées à la périphérie im-
médiate des villes et qu’elles offrent diverses possibilités récréatives.
Ces travaux sont en quelque sorte conçus comme des parcs à thème,
éducatifs ou ludiques ou les deux conjugués. Si par exemple Sky
Mound existait, l’on pourrait à la fois y comprendre comment est
renaturalisée une décharge publique, y déambuler et y admirer de
vastes panoramas, y observer certains phénomènes célestes. Il était
d’ailleurs prévu d’offrir des tours guidés de Sky Mound lorsque le tra-
vail serait suffisamment avancé (Marter, 1994 : 30-31). Les œuvres
complétées ne fonctionnent pas autrement. Up and Under est un parc
où l’on peut se promener et expérimenter des perspectives particu-
lières, ainsi qu’un amphithéâtre en plein air où ont lieu des specta-
cles. Autres exemples : les sites paysagés de traitement des eaux usées
de Viet Ngo comprennent des sentiers et des centres d’interprétation
pour les visiteurs ; les sculptures de Patricia Johanson proposent des
expériences écologiques tout en étant des espaces de jeux pour les
enfants. L’une des œuvres de Johanson est même classée National
Historic Landmark.
Dans les années 1980, au même titre que les œuvres d’art de
type land reclamation et art-as-public-spaces, une certaine photographie
activiste sera appelée à prendre part au réaménagement de l’espace.
La photographie artistique sera aussi mise au service de projets de
réhabilitation des territoires, mais dans ce cas, à des échelles nationa-
les aussi bien que locales.
L’examen des travaux de Lewis Baltz met en évidence l’idée
selon laquelle les photographes, dans les années 1970, sont des obser-
vateurs attentifs des changements territoriaux et de l’émergence d’un
48. « The culture and ideology fostered in this globalization process relates largely to “lifestyle”
themes and goals and their acquisition ; and they tend to weaken any sense of community
helpful to civic life » (Herman et Chomsky, 2002 : xiv).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 145 11/12/08 15:04:34
146 Le paysage façonné
nouveau paysage de la mobilité. Ils rendent compte de phénomènes
comme l’étalement urbain et l’apparition des technoburbs, la suburba-
nisation du désert, les altérations laissées derrières elles par les trente
glorieuses d’après-guerre. Dans cette entreprise documentaire qui se
généralise, le modèle des missions photographiques – les surveys du
XIXe siècle – sera bientôt réactivé. Les photographes intéressés par la
« nouvelle topographie » postindustrielle opèrent d’abord seuls, par-
tant faire leurs relevés en périphérie et revenant ensuite en exposer
les résultats dans les galeries d’art. En 1976 cependant, Baltz reçoit
une commande photographique de la Corcoran Gallery of Art de
Washington D.C. C’est un projet qui s’inscrit dans le cadre des fêtes
du bicentenaire de l’indépendance des États-Unis et qui a pour but
d’élaborer une représentation photographique de la capitale natio-
nale. D’autres photographes que Baltz participent au projet : Joe
Cameron, Robert Cumming, Roy de Cavara, Lee Friedlander, John
Gossage, Jan Groover et Anthony Hernandez. Outre la demande,
large, de dépeindre Washington en photos, aucune consigne particu-
lière n’est donnée aux artistes ; ils sont libres du choix des motifs. Les
images produites à la suite de cette commande sont exposées à la
Corcoran Gallery et huit petits catalogues sont publiés. Baltz choisit
d’illustrer la banlieue, sous le titre Maryland.
Les promoteurs de cet inventaire photographique proposent
non seulement de fixer une représentation de la capitale et ses envi-
rons à un moment précis, celui du bicentenaire, mais aussi de conser-
ver les images pour plus tard les confronter à ce que le lieu sera de-
venu : il est prévu de réexposer certaines d’entre elles en 2076, année
du tricentenaire. En attendant, les épreuves sont archivées.
Les missions photographiques prennent alors de plus en plus
d’importance. Elles sont commandées par des institutions artistiques
(par exemple pour Maryland), par des agences gouvernementales et
aussi par des groupes engagés, souvent écologistes. Elles sont parfois
autocommandées par les artistes eux-mêmes, comme dans le cas du
Rephotographic Survey Project que le photographe Mark Klett coor-
donne entre 1977 et 1979. Aucune institution ou instance publique
ne commande ce survey, mais le NEA lui accorde des subventions par
le truchement d’un programme qui aura la vie brève : « Heureuse-
ment, à la fin des années 1970, une ancienne tradition de comman-
dite gouvernementale de missions photographiques a revécu briève-
ment grâce à une catégorie de subvention du Visual Arts Program du
NEA » (Klett, 1984 : 1). Au cours du Rephotographic Survey Project,
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 146 11/12/08 15:04:34
chapitre 3 • modulations 147
les artistes participants rephotographient soigneusement les paysages
de l’Ouest qu’avaient saisis, lors de surveys géologiques et géographi-
ques, certains des « maîtres » du XIXe siècle, William Henry Jackson,
Andrew J. Russell, John Hillers, Alexander Gardner et Timothy
O’Sullivan. Les nouvelles images, couplées avec les anciennes,
donnent la mesure des changements qu’a subis le sud-ouest des États-
Unis. Ces transformations sont souvent catastrophiques, mais pas tou-
jours.
3.6 SECOND VIEW. THE REPHOTOGRAPHIC
SURVEY PROJECT. TIMOTHY O’SULLIVAN,
QUARTZ MILL NEAR VIRGINIA CITY NEVADA, 1868 ;
MARK KLETT, SITE OF QUARTZ MILL, 1979
Photographies reproduites avec l’aimable autorisation de Mark Klett.
Mark Klett et les membres de son équipe sont particulièrement
intéressés par les expéditions et la technique des photographes du
XIXe siècle, mais la « tradition de commandite gouvernementale »
que Klett mentionne dans le texte de présentation de Second View : The
Rephotographic Survey Project est plutôt celle qui est établie dans les
années 1930 avec les missions de la Farm Security Administration
(FSA). Ces missions, commandées à l’époque du New Deal, sont finan-
cées par le gouvernement central pour rendre compte des problèmes
et des dommages causés par la Grande Dépression qui suit la débâcle
boursière de 1929, à laquelle s’ajoute le désastre agricole du Dust Bowl
de 1933-1934. Ces missions sont plus orientées vers l’humain que vers
le territoire et c’est pour cela qu’elles contribuent grandement à
ancrer une nouvelle tradition photographique, celle du documen-
taire social, à laquelle sont plus ou moins redevables tous les photo-
graphes engagés, que leurs motifs soient humains ou territoriaux, la
photographie de « paysage économique », par exemple. Cette tradi-
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 147 11/12/08 15:04:35
148 Le paysage façonné
tion, dont Walker Evans qui participe aux entreprises de la FSA pour-
rait revendiquer du moins en partie la « paternité49 », ne s’appuie pas
uniquement sur l’aspect humain du contenu des images, mais aussi
sur le fait que quelques-uns des photographes à l’emploi de la FSA,
tout particulièrement Evans, revendiquent une certaine liberté artis-
tique, la possibilité de faire des choix sans que le chef n’y interfère,
sans que le photographe ne se plie à un objectif de propagande gou-
vernementale. Cette revendication sera source de conflit entre Evans
et son chef de mission, Roy Stryker, qui impose aux photographes des
consignes précises concernant le contenu des images. Il émet réguliè-
rement, à l’endroit de ses photographes, des scénarios détaillés pour
les prises de vue (Tagg, 1988 : 169). Stryker rend également inutilisa-
ble 100 000 des 270 000 négatifs produits pour la FSA, les jugeant peu
adéquats. Par leur envergure – 170 000 négatifs archivés sur les
270 000 réalisés – et aussi parce qu’émerge alors la tradition du docu-
mentaire social, les missions de la FSA sont une référence obligée en
la matière. Côté paysage, les surveys géographiques et géologiques du
XIXe siècle restent un repère essentiel.
En Europe, aussi bien qu’aux États-Unis, chaque fois qu’une
mission photographique s’organise, l’on se réclame de ces deux pré-
cédents, surveys du XIXe siècle et FSA des années 1930. Quant au
Rephotographic Survey Project, il donnera le ton à toute une prati-
que photographique dans laquelle s’investissent de nombreux photo-
graphes de paysage activistes. D’autres projets de re-photographie
sont ainsi mis sur pied par exemple, Stopping Time : A Rephotogra-
phic Survey of Lake Tahoe ou le Portland Grid Project. Bon nombre
de programmes de documentation exhaustive des transformations
des territoires ont aussi cours dans les années 1970 et 1980, plusieurs
d’entre eux dans l’ouest des États-Unis, entre autres le Mono Lake
Project, le Great Central Valley Project, le Water in the West Project et
le Pyramid Lake Project. En France, de grandes missions sont organi-
sées auxquelles sont conviés à participer des photographes étrangers
aussi bien que français. Lewis Baltz prend part en 1986 à la mission de
la DATAR (En France, les années 1980, j’y reviens sous peu) et, à la fin
de la même décennie, à la Mission photographique TransManche
pour le patrimoine photographique de la région Nord-Pas-de-Calais.
Baltz amorcera à cette occasion sa série « Technologies » qui s’éloigne
de la photographie de paysage. La Mission TransManche visant à do-
cumenter toutes les transformations apportées par le creusement du
tunnel ferroviaire sous la Manche (France – Grande Bretagne), Baltz
49. Voir Buffard, (1990 : 53-54). Voir également Amérique. Les années noires (1983) et Maresca
(1996 : 89-118).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 148 11/12/08 15:04:35
chapitre 3 • modulations 149
s’intéressera alors à l’imagerie électronique et aux dispositifs de sur-
veillance, nécessaires à ce type d’infrastructures.
Pour la plupart de ces missions des années 1970 et 1980 qui doi-
vent, semble-t-il, « refléter l’aptitude de la photographie à modeler
l’intérêt public pour l’environnement » (Pool, 1999 : 130), les photo-
graphes s’organisent en groupes ou sont recrutés par des organismes
commanditaires. Mais, ils continuent par ailleurs à travailler seuls.
Tout comme Lewis Baltz, Richard Misrach parcourt les déserts
états-uniens depuis les années 1970 pour y photographier la dévasta-
tion entraînée par la présence humaine. Il y répertorie les dommages
causés par Salton Sea et les altérations qui sont le fait des forces ar-
mées. Misrach milite, parallèlement à son travail artistique, dans des
mouvements antinucléaires et pacifistes. Selon Lucy Lippard, ses
expositions et ses nombreux livres publiés font partie du genre « out
looking about place », au même titre que certains des travaux que les
Harrison exposent en galerie, et s’inscrivent donc dans le cadre du
new genre public art : « Je définirais l’art public comme du travail acces-
sible, de n’importe quel type, pour autant qu’il intéresse, défie, en-
gage et questionne l’audience pour qui ou avec qui il est réalisé, du
travail qui respecte la communauté et l’environnement » (Lippard,
1995 : 121). Qui plus est, Misrach, qui photographie à plusieurs repri-
ses les champs d’essai de bombardement implantés dans les déserts
par l’armée des États-Unis, propose que l’un d’eux, Bravo 20 Bombing
Range, soit transformé en un parc environnemental commémoratif
lorsqu’il ne sera plus en usage.
This proposed national park, on sixty-four square miles of abandoned
bombing range, would serve an educational function and include a
theme park of destruction, a Boardwalk of Bombs, a self-guided
automobile tour along Devastation Drive, and a museum (Leibovitz-
Steinman 1995 : 26450).
Cette parenthèse au sujet du travail de Misrach indique que la
« park sensibility » telle qu’elle est définie par Ron Graziani au sujet des
projets de Robert Smithson agit également sur une certaine photo-
graphie engagée postsmithsonienne, tout comme elle influe sur les
travaux de land reclamation et d’art public à caractère éducatif et ré-
créatif d’autres artistes.
Lewis Baltz partage aussi certaines des préoccupations de Smith-
son. Leur vocabulaire – aussi bien en termes formels que sémantiques
– est tout à fait similaire et tous deux sont intéressés par l’entropie.
Tout comme Smithson, voici Baltz à la marge : « Je me suis toujours
50. Voir également Lippard (1999 : 151-152).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 149 11/12/08 15:04:35
150 Le paysage façonné
intéressé au phénomène marginal, à ces régions qui ne ressortissent
pas tout à fait au paysage, pas tout à fait visibles, la marge quasi obs-
cène qui est tabou » (Grout, 1990 : 27). Ce sont ces mêmes zones mar-
ginales qui fascinaient Smithson, dans le désert tout aussi bien qu’en
banlieue ou en territoires postindustriels. Les sites que Baltz privilé-
gie jusqu’à la fin des années 1980 sont toujours en périphérie, je l’ai
déjà signalé. San Quentin Point et Candlestick Point que Baltz photo-
graphie respectivement de 1981 à 1983 et de 1984 à 1988 sont situés
à la bordure de San Francisco : « Candlestick Point est un endroit
aussi à part que les cimetières, les parcs nationaux, les places publiques – le
ventre mou du sublime, où le ravagé le dispute au composé » (Baltz et
Blaisdell, 198951). Là, toutes sortes de détritus s’accumulent, que Baltz
photographie en les monumentalisant par l’angle de prise de vue
(des plans rapprochés au ras du sol). Smithson, plus tôt, avait ainsi
traité d’autres objets sans intérêt, les « monuments » de Passaic, en les
singularisant par le cadre photographique.
3.7 LEWIS BALTZ, DEUX ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE SAN QUENTIN
POINT COMPOSÉE DE 58 PHOTOGRAPHIES, 1981-1983
Reproduit avec l’aimable autorisation de Lewis Baltz. Coll. particulière.
51. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 150 11/12/08 15:04:36
chapitre 3 • modulations 151
La série San Quentin Point est, Baltz le dit lui-même, « dans une
certaine mesure un hommage à Smithson » (Grout, 1990 : 30) :
Ressorts ou bibelots, tissus pressés dans la terre comme s’ils étaient
repassés, chardons poussant n’importe comment, choses gluantes et
innommables, rendues avec la précision exquise avec laquelle « n’im-
porte quelle poubelle » disait naguère Walter Benjamin « pouvait être
et serait embellie par la photographie » (Baltz et Haworth-Booth, 1986,
n.p.).
Candlestick Point et San Quentin Point sont des terrains vagues
que les communautés voisines utilisent comme décharges publiques
au moment où Baltz les photographie. Ces territoires seront éventuel-
lement transformés, l’un en parc provincial où des activités récréati-
ves sont proposées, l’autre en zone résidentielle. Mais, contrairement
à ce qu’il avait fait avec Park City, Baltz dans ces deux cas, ne s’inté-
resse aucunement au processus de transformation : il se contente
d’enregistrer un état chaotique des lieux. À la même époque, il photo
graphie également de vrais dépotoirs, au Canada (Heartlands Sanitary
Landfills, Victoria, B. C., 1986) et en Norvège (Continuous Fire Polar
Circle, Norway, 1986).
Baltz partage avec Smithson un intérêt pour la composition du
territoire en couches successives déposées là par les différents usages.
En photographiant les diverses strates de matériaux accumulés dans
les dépotoirs, avec ses minutieux relevés de ces décharges publiques
qui sont, selon Nancy Holt, « les artefacts de notre génération »,
l’artiste va un peu plus « en profondeur » dans le terrain, mettant à
découvert « le côté sombre du progrès humain » (Rian, 2001 : 68).
La photographie engagée semble parfois tenir un rôle public
qui dépasse la simple dénonciation. Des photographes militants
comme Richard Misrach veulent en faire, littéralement, un opérateur
de transformation et il est vraisemblable qu’elle agisse en ce sens en
certaines occasions, même si les artistes n’ont pas d’intentions aussi
claires que celles de Misrach. Il n’est toutefois aucunement évident
que les images de Baltz ont eu une quelconque incidence dans la
transformation de Candlestick Point et de San Quentin Point,
quoiqu’il arrive fréquemment que les photographes passent avant
que les sites dévastés ne soient restaurés. On pourrait voir dans ce
phénomène un effet semblable à celui observé au premier chapitre
alors que, disait-on, les photographies de William Henry Jackson
avaient influé sur la décision des autorités gouvernementales de faire
de Yellowstone un parc national. Mais, comme le fait remarquer David
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 151 11/12/08 15:04:37
152 Le paysage façonné
Nye, cette légende a perduré tout bonnement à cause de la croyance,
propre au XIXe siècle, en l’objectivité parfaite des photographies.
Nye affirme que ce sont les rapports du chef de mission Hayden, sim-
plement renforcés par les images, qui ont été décisifs pour cette mise
en réserve (Nye, 2003 : 82). (Et ne l’oublions pas, Yellowstone et
Yosemite, alors qu’ils étaient célébrés pour leur nature sauvage, ont
rapidement été aménagés en parcs à thème naturels). Que l’on attribue
aux photographies un pouvoir de changement n’est pas chose rare.
On dit par exemple des photos de Jacob Riis qu’elles ont contribué
au nettoyage des bas-quartiers de New York à la fin XIXe siècle. Il ne
faut cependant pas négliger le discours ou le contexte qui accompa-
gnent et entourent les images. Riis en effet est reporter de police
lorsqu’il retourne dans les bas-quartiers qu’il connaît déjà puisqu’il a
été un immigrant pauvre, et il le fait en compagnie d’un officier du
Health Board de la Ville. Ses images, tout comme celles de Jackson
précédemment, appuient une volonté préexistante. De même, ce
sont aussi bien les consignes strictes de Stryker – et le fait qu’il dé-
truise 100 000 négatifs –, que les photographies elles-mêmes, qui
contribuent à fabriquer la vision très spécifique de l’Amérique des
années noires qui se dégage de l’ensemble des missions de la FSA. On
connaît l’importance, pour la photographie, de la légende qui vient
après coup la compléter ou en infléchir la lecture52. Le discours
préexistant, le contexte – comme texte qui entoure – peuvent agir de
même. Les probabilités que le travail d’un photographe militant
comme Misrach ait un impact dont on dira qu’il est déterminant sont
évidemment plus grandes. En revanche, il serait inexact d’attribuer à
Lewis Baltz une volonté d’influer sur la vocation des lieux qu’il pho-
tographie. Il répertorie plutôt les zones incertaines, marginales, sus-
pendues entre deux états, laissées pour compte par l’économie de la
mobilité. Mais, de par leur nature même, ce sont des lieux fatalement
destinés à être modifiés.
L’intérêt que portent de nombreux photographes aux territoi-
res en mutation sera éventuellement exploité par des instances publi-
ques qui mettront une fois de plus la photographie au travail, cette
fois dans le cadre de vastes entreprises d’aménagement, dans le but
avoué d’éveiller une certaine conscience territoriale des populations.
Précisément parce qu’elles témoignent d’un état transitoire des lieux,
les images de Baltz, entre autres photographes de la marge, seront
mises au service de projets de refaçonnement du territoire.
52. Voir en particulier Barthes (1982 : 9-24 et 25-42), Krauss (1993 : 74), Benjamin
(1968 : 226).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 152 11/12/08 15:04:37
chapitre 3 • modulations 153
En 1986, Baltz est invité à participer à la grande mission de la
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale
(DATAR), entreprise en France dès 1984. La DATAR est un comité
interministériel qui s’occupe d’aménagement, comme son nom le
dit. Sa vaste commande publique réunit, sur cinq ans, trente-six pho-
tographes français, européens, et Baltz, « l’Américain hanté par la
destruction d’une terre qu’il a connue vierge » (Hers et Letarget,
1989 : 16). L’idée de la mission photographique vient à ses promo-
teurs parce qu’ils veulent « retrouver les voies d’une expérience plus
concrète du paysage » (Hers et Letarget, 1989 : 13), cherchant en
quelque sorte à incarner le territoire abstrait qui est celui de l’aména-
geur, généralement considéré au moyen de cartes et de statistiques,
plutôt que de représentations artistiques.
Les promoteurs de cette mission se réclament d’une certaine
« tradition américaine », celle des surveys du XIXe siècle et de la FSA
des années 1930. Ils s’appuient de façon plutôt large sur cette tradi-
tion, car ils choisissent d’entrée de jeu d’engager des artistes et non
pas des photographes professionnels qui disent-ils, illustrent des pro-
pos qui ne sont pas les leurs, alors que les artistes sont des chercheurs,
aptes à proposer des symboles et des repères : « Le manque social que
nous voulions contribuer à combler, au nom du service public, était
celui de repères, non de descriptions » (Hers et Letarget, 1989 :
1753).
Les années 1980 sont celles où l’on veut agir sur le paysage, l’en-
gagement social se traduisant par l’action et non plus par la seule
dénonciation, on l’a vu avec la mise en pratique de l’art comme land
reclamation et le retour à la ville de l’art dans le paysage. Il semble que
ce soit la décennie pendant laquelle on veut revenir sur les ravages
causés par les trente glorieuses et comprendre, pour mieux les contrô-
ler, les changements qu’implique l’émergence d’une économie post
industrielle qui est signalée par le déclin de l’industrie lourde, l’arri-
vée de technologies nouvelles, le développement d’une industrie des
services et des loisirs. À cet égard et du point de vue des auteurs qui
analysent leurs travaux, le regard posé sur l’environnement par les
photographes est essentiel et peut être un embrayeur pour de possibles
interventions.
Lewis Baltz est dans la post-modernité au sens strict, comme ses espaces
sont ceux de l’ère post-industrielle. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a
plus d’industrie (ou de modernité), mais que la logique dominante
53. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 153 11/12/08 15:04:37
154 Le paysage façonné
n’est plus celle de la conquête et de l’expansion industrielles (ou
modernistes). La dynamique est assurée aujourd’hui (là où elle existe)
par les secteurs dits tertiaires (ou “quaternaires”) : quelques industries
de haute technologie, mais surtout le marché des services, des loisirs
et des images (Durand, 1989 : 635).
Pour la DATAR, Baltz opte pour la documentation du Secteur
80 à Fos-sur-Mer, ville industrielle du sud où l’on a voulu installer un
grand port, jouxtant celui de Marseille, et qui aurait lié les deux villes.
Projet avorté, qui laisse derrière lui des terrains vagues en quantité
dans la zone qui devait être dévolue aux activités portuaires. Le
Secteur 80 est l’un de ces lieux laissés pour compte.
3.8 LEWIS BALTZ, DEUX ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE FOS,
SECTEUR 80 COMPOSÉE DE 21 PHOTOGRAPHIES, 1986
Reproduit avec l’aimable autorisation de Lewis Baltz.
Coll. Fos Action Culture, Fos-sur-Mer
Pour la mission de la DATAR, les photographes choisissent li-
brement les terrains qu’ils photographieront et la manière de le faire,
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas à se plier à des consignes émises par les
chefs de mission, qui les restreindraient à des formats ou à un traite-
ment documentaire ou formel particulier. Au contraire. Les com-
manditaires de la mission souhaitent voir émerger de nouvelles ap-
proches artistiques. Dans les années 1980, il ne s’agit plus d’enregistrer
par la photographie des situations concrètes, tout ayant déjà été re-
présenté et surreprésenté et la télévision se chargeant très bien de
montrer le monde tel qu’il est, selon les chefs de mission François
Hers et Bernard Letarget. Ceux-ci reconnaissent, sans pour autant
nier sa capacité descriptive, que la photographie, au moment où ils
coordonnent la mission, devient un art à part entière54. La liberté
54. « Dans un mouvement que les autres arts plastiques avaient connu avant elle, la photogra-
phie est devenue son propre objet, la nécessité du photographe son seul contenu» (Hers
et Letarget, 1989 : 17).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 154 11/12/08 15:04:38
chapitre 3 • modulations 155
a rtistique que revendiquait Walker Evans lorsqu’il travaillait pour la
FSA est donc ici accordée d’emblée au photographe. Cette marge de
manœuvre artistique n’empêche toutefois pas que l’on fasse usage
des œuvres, ne serait-ce que pour donner une image de ce que les
aménageurs cherchent à maîtriser, le territoire.
On croyait autrefois à la transparence de l’image et les commanditai-
res exigeaient donc des photographes qu’ils produisent des docu-
ments. On croit désormais à la subjectivité révélatrice de l’artiste et
l’on demande donc aux photographes de conduire un projet vérita-
blement artistique. Certes, au bout du compte, il s’agit toujours de
faire usage des œuvres mais cette finalité ne constitue plus une
contrainte formelle préalable. C’est ainsi, me semble-t-il, que l’on est
passé du malentendu pernicieux au paradoxe productif (Buffard,
1990 : 5655).
Deux cent mille négatifs (ou prises de vues) sont produits pour
la DATAR, desquels on tire deux mille épreuves formant des albums
déposés à la Bibliothèque nationale de France. Deux publications et
quelques expositions sont aussi réalisées. À l’origine, le but de cette
grande commande photographique est de fournir une sorte d’état des
lieux de la France des années 1980 et selon Bernard Letarget, son plus
grand mérite est de « réactiver une culture du paysage en France56 ».
En effet, la mission de la DATAR en inspirera bien d’autres dans tout
le pays. Pour la DATAR, il s’agit, en permettant le renouveau d’une
« culture du paysage », de cibler ce qui doit être mis en valeur, mis en
patrimoine, réaménagé, toutes opérations ayant, à terme, des inci-
dences économiques. L’une des retombées majeures de cette entre-
prise est sans doute la création de l’Observatoire photographique du
paysage par le ministère de l’Environnement (bureau du Paysage),
qui accomplit ainsi la volonté de « surveillance » générale du territoi-
re français émise par la DATAR. Car « le paysage tend à devenir un
capital, et qui s’exploite » en termes « de patrimoine, d’aménité,
d’image de la ville, de capital touristique » (Berque, 1989 : 45). Selon
Augustin Berque, la volonté de la DATAR d’établir un état des lieux
marque les débuts d’une « société à paysagement », après l’avènement de
la « société à paysage » de la Renaissance qui a succédé à la « société à
pays » prérenaissante qui elle, ne connaissait pas le paysage (Berque,
1989 : 4857).
55. Je souligne.
56. Letarget cité par Buffard (1990 : 58).
57. Les italiques sont de l’auteur.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 155 11/12/08 15:04:38
156 Le paysage façonné
L’Observatoire photographique du paysage rassemble diverses
instances locales, régionales et nationales s’occupant d’environne-
ment, d’aménagement, d’infrastructures, de politiques agricoles,
autour d’une même préoccupation : « constituer un fonds photogra-
phique qui permette d’analyser les mécanismes de transformation
des espaces et les acteurs qui en sont la cause de façon à orienter fa-
vorablement l’évolution du paysage » (Quesney, Ristelhueber,
Stefulesco, 1994 : 6). Ce fonds photographique est composé de pho-
tographies anciennes et de reprises de ces images, de nouvelles pho-
tographies des mêmes lieux faites selon les mêmes cadrages et exécu-
tées par des artistes-photographes, exactement comme l’ont fait les
collaborateurs du Rephotographic Survey Project. Également, de
nouvelles séquences de (re-)prises de vues sont réalisées, dont les pre-
mières photographies sont effectuées par des artistes desquels des
techniciens prendront la relève après quelques années pour repro-
duire périodiquement les premières prises de vues. Si la mission de la
DATAR n’a pas donné lieu à un inventaire exhaustif du territoire
français, c’est grâce à son exemple que l’Observatoire crée une « or-
ganisation systématique58 » qui, subdivisée en groupes de travail
locaux, permet de couvrir le territoire national dans son entièreté et
de l’analyser en vue de programmes d’aménagement généraux.
L’état des lieux dressé, les photographies sont classées et l’artis-
te photographe se retire. Car, si l’archive est intimement liée à l’his-
toire (de l’usage) de la photographie, l’artiste à l’ère postindustrielle
est devenu un nomade, qui accorde par sa présence ponctuelle, valeur
aux lieux et aux sites où il se trouve. Lewis Baltz, ainsi que d’autres
photographes qui à sa suite se sont rendus à Fos-sur-Mer sur invita-
tion, redonnent certes, et précisément parce qu’ils s’y sont rendus,
une certaine fierté aux habitants de l’endroit59. Baltz, allant à Fos
pour la DATAR, impressionne tant que les autorités municipales
s’empressent d’acquérir l’un des portfolios Fos Secteur 80 et de passer
commande de nouvelles images à d’autres photographes, John Davies,
58. Bernard Letarget en entrevue avec Daniel Quesney, « 1980 – Paysages Photographies –
1990 », Séquences/Paysages no 1, 1997, p. 13.
59. « En dépassant l’étude cartographique, en renonçant au documentaire, il s’agissait par de
nouveaux regards de découvrir d’autres réalités, de mettre à jour les liens tissés au fil des
ans entre le cadre urbain, l’industrie et la nature. Seule la création artistique pouvait, en
toute liberté, assurer cette démarche exploratrice. […] Leur vision personnelle transcen-
de la réalité, pour mieux saisir l’instant dans toute la représentation de son histoire et de
son devenir. » (Bernard Granié, maire de Fos-sur-Mer, préface de l’ouvrage de Baltz,
Davies, Garnell et Basilico, 1997 : 5).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 156 11/12/08 15:04:39
chapitre 3 • modulations 157
Jean-Louis Garnell, Gabriele Basilico, qui avaient également pris part
à la mission de la DATAR.
3.9 LEWIS BALTZ, ÉLÉMENT NO 11 DE LA SÉRIE FOS, SECTEUR
80 COMPOSÉE DE 21 PHOTOGRAPHIES, 1986
Reproduit avec l’aimable autorisation de Lewis Baltz
Coll. Fos Action Culture, Fos-sur-Mer.
Dans un monde où les différences tendent à s’estomper, l’art –
la photographie tout aussi bien que l’art public – contribue à rendre
certains lieux uniques. L’art serait en effet un vecteur de distinction et
d’unicité, offrant d’intéressantes opportunités de créer une identité
régionale ou urbaine originale, opportunités séduisantes en termes
de promotion d’une localité au sein de la nouvelle hiérarchie globale
composée par la nouvelle économie, si l’on en croit Miwon Kwon
(2002 : 54). Une nouvelle distinction est ainsi impartie par les photo-
graphes à la municipalité de Fos-sur-Mer, serait-ce celle d’une sorte
de non- lieu où il n’y a rien à voir et que l’on a eu le courage de mon-
trer60.
Baltz, Davies, Garnell, Basilico, ces artistes-voyageurs – « parcou-
rant le monde à titre d’invités de marque, de touristes, d’aventuriers,
de critiques en résidence ou de pseudo-ethnographes » (Kwon,
1997 : 46) – dont un seul est français, sont des fournisseurs de services
60. Je résume ici le propos de Lamarche-Vadel (1997 : 57-63).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 157 11/12/08 15:04:40
158 Le paysage façonné
bien particuliers. De même que les artistes qui élaborent des parcs/
œuvres d’art, les photographes à qui l’on commande des images sem-
blent conférer une aura d’authenticité et de singularité aux lieux
eux-mêmes. Mais, contrairement aux œuvres d’art public qui restent
visibles puisqu’elles sont permanentes, les photographies issues de
commandes publiques semblent avoir pour destination finale les ar-
chives – et parfois les « coffee-table books », ce qui n’est pas très diffé-
rent.
Les œuvres de Timothy O’Sullivan dorment dans les archives du
gouvernement des États-Unis pendant des années, avant d’en être
retirées et d’acquérir leur statut d’œuvres d’art, de « paysages photo-
graphiques modernistes ». Selon Douglas Crimp, un semblable mou-
vement se répand à partir de la fin des années 1970, alors que des
photographies en tous genres sont extraites des archives et reclassi-
fiées selon « leur valeur nouvellement acquise, la valeur dorénavant
attachée aux « artistes » qui ont fait les photographies61 ». La photo-
graphie, comme les chefs de mission de la DATAR l’ont bien compris,
devient alors son propre objet et peut entrer au musée. Crimp signale
que, pour ce faire, la photographie doit cesser d’être utile à l’inté-
rieur d’autres pratiques discursives, qu’elle ne peut plus servir à des
fins de documentation, d’information, de preuve ou d’illustration.
Néanmoins, suivant les principes des commandes photographiques,
des missions et des observatoires, si la photographie est considérée
comme artistique et mise au travail comme telle, elle doit aussi répon-
dre à des objectifs précis, du simple inventaire à la création de repè-
res pour une société en mal de paysage. Cette situation particulière
correspond très certainement à ce qu’Alain Buffard appelle le « para-
doxe productif » qui consiste, littéralement, à enrôler l’art comme opé-
rateur de transformation. Les artistes restent alors maîtres du conte-
nu de leurs images, mais le contexte, c’est-à-dire les motifs de ceux
qui établissent la commande, n’en détermine pas moins le sens géné-
ral.
The value of the photographic image and its role in the action in which
it participated is not inherent in the content of the image or embed-
ded in the intrinsic or extrinsic elements of form. Rather, it is ancho-
red to the functional context of creation and cannot be teased from
the image itself (Schwartz, 1995 : 51).
61. « What was Egypt will become Beato, or Du Camp, or Frith ; […] ; the American Civil War,
Alexander Gardner and Timothy O’Sullivan ; the cathedrals of France will be Henry Le
Secq » (Crimp, 1995 : 74).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 158 11/12/08 15:04:40
chapitre 3 • modulations 159
Les missions photographiques semblent encore opérer comme
au XIXe siècle : une publication en réunit les produits, éventuelle-
ment pour (dé)montrer autre chose que les photographies elles-
mêmes, soit par exemple la nécessité d’une « expérience plus concrè-
te du paysage » dans le cas de la DATAR ou celle d’« orienter
favorablement » son évolution pour l’Observatoire photographique
du paysage ou encore d’établir sa singularité pour une localité comme
Fos-sur-Mer. De même, un siècle plus tôt, les photographies des s urveys
géologiques et géographiques révélaient les paysages grandioses de
l’Ouest américain et aussi la richesse en matières premières exploita-
bles des territoires. Finalement, et comme au XIXe siècle, les photo-
graphies de commande disparaissent et (re)deviennent parties de
collections d’archives62.
Une double tâche est donc remplie par la photographie artisti-
que de paysage considérée comme service, à l’instar d’un certain art
public (art-as-public-spaces). Elle renforce la singularité des lieux pho-
tographiés, non comme le feraient des cartes postales ou autres vues,
mais par la présence même de l’artiste-photographe qui consent à s’y
rendre. La photographie artistique participe également à l’établisse-
ment de constats auxquels pourront avoir recours les aménageurs et
les appareils d’État – ou ces « appareils spécialisés qui renforcent l’ap-
pareil d’État » (Guillaume, 1990 : 17) – au nombre desquels se range
la DATAR. Les états des lieux ainsi dressés puis réunis en collections
sont autant de médiations à partir desquelles seront enclenchés des
processus de mise en valeur du territoire, de mise en patrimoine, de
capitalisation touristique, bref de gestion globale de l’environne-
ment, dans une société à paysagement. Le redéploiement de l’espace
urbain sert une certaine idée de qualité de vie. Il en va de même pour
la gestion du paysage :
L’action politique des « écolos » proprement dits n’est plus qu’une
facette, parmi bien d’autres, d’une mutation des valeurs : la remise en
cause du quantitatif au nom du qualitatif. Et cela, jusqu’aux échelons
institutionnels les plus élevés ; témoin l’apparition d’un domaine de la
« qualité de la vie » au sein même du gouvernement (Berque,
1989 : 44).
Ce n’est certes pas un hasard si ces volontés généralisées de pla-
nification et d’exploitation du capital paysager coïncident avec l’explo-
sion de l’industrie touristique, à l’échelle mondiale : « Aujourd’hui,
rares sont les pays qui ne possèdent pas un plan national et qui n’ont
62. « We might even argue that archival ambitions and procedures are intrinsic to photographic
practice » (Sekula, 1983 : 194).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 159 11/12/08 15:04:40
160 Le paysage façonné
pas transposé dans le domaine des loisirs et du tourisme l’idée de
planification et d’aménagement » (Cazes, Lanquar et Raynouard,
1993 : 5). Car de vastes entreprises de production de l’espace visent à
faire se déplacer d’un lieu à l’autre les populations, au sein d’un « vil-
lage global » qui n’est pas exactement virtuel. En effet, les citoyens de
ce village sont, et resteront, des touristes, toujours et encore conviés à
faire le voyage.
J’ai ici décrit comment, à l’ère postindustrielle, l’art participe au
façonnement des lieux et territoires. Voyons maintenant à quoi
conduisent toutes ces opérations de production de l’espace et sur-
tout, ce qu’il advient alors du paysage.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 160 11/12/08 15:04:41
C H APITRE Q U ATRE
Apparition ou dissolution
Avant même de préciser quelles sont ces pratiques, il me faut remarquer un trait du
monde contemporain qui s’impose fortement : celui d’un l’élargissement des sphères
d’activité naguère limitées, bien cernées. Le métissage des territoires,
l’absence de frontières entre les domaines sont bien une marque
du contemporain ; le paysage n’échappe pas à cette règle
Cauquelin, L’invention du paysage.
Conséquemment à l’analyse de toutes ces médiations, il reste
encore à préciser quelles seraient les conditions d’apparition du pay-
sage postindustriel, à comprendre comment l’espace produit devient
paysage. Mais d’abord, voyons comment les modulations successives
étudiées au précédent chapitre autorisent la reprise de l’art du pay-
sage, ce land art qui désormais participe à l’élaboration de l’espace
postindustriel, par un autre champ dont les acteurs se donneront le
rôle de constructeurs de faits. Cet autre champ, dorénavant identifié
comme celui du paysage (et qui tend, pour tout ce qui concerne
celui-ci, à prendre la relève du champ de l’art), a pour objectif pre-
mier le façonnement des lieux, ce pourquoi son intérêt va plutôt vers
une pratique dans le territoire que vers sa représentation qui est
pourtant le terme premier du paysage. Certains des acteurs du champ,
ceux qui se consacrent à l’étude ou à la théorie de son objet, cher-
chent toutefois à concilier les deux termes, paysage comme représen-
tation et perception et paysage comme territoire ou milieu.
Les land artists, tout comme les autres intervenants du milieu de
l’art sont, jusqu’au début des années 1980, des acteurs actifs dans la
transformation de l’espace urbain et suburbain. C’est alors que le
land art lui-même, à cause de ce fonctionnement en mode touristique
qui a pu être dégagé au chapitre deux, devient un acteur incontour
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 161 11/12/08 15:04:41
162 Le paysage façonné
nable du champ paysage. Dans les années 1980 malgré (ou grâce à)
une reprise du land art, la construction des faits (ou du fait paysage)
n’est plus l’affaire des artistes.
Toujours en examinant comment le champ paysage s’installe
comme constructeur de faits et de façons à mettre au jour le rôle des
représentations artistiques à cet égard, différentes interventions ou
actions seront décrites : celles auxquelles participe la photographie
commandée pour les missions et observatoires ; celles par lesquelles,
dans une économie postindustrielle, l’on tend à refaçonner les terri-
toires en une série de destinations ou de spectacles, de paysages en
mode touristique propres à attirer le plus grand nombre de visiteurs.
Par la suite, il sera possible de remonter, pour bien en attacher les
maillons, la chaîne des médiations et des traductions afin d’indiquer
de quelle façon le land art comme art du paysage est intégré au spec-
tacle et la photographie artistique mise à son service, bref comment
et par qui ou par quoi finalement s’assemblent tous les éléments exa-
minés dans cet essai.
Le paysage est effectivement un domaine de métissage. S’y ren-
contrent l’architecture de paysage, l’aménagement et l’urbanisme, la
géographie, la philosophie, la sociologie, l’histoire de l’art parfois et,
d’une certaine façon, l’art. La préoccupation première des acteurs de
ce champ semble être de gérer et d’administrer, tout en l’esthétisant,
son objet, c’est-à-dire de « paysager notre environnement » selon les
termes d’Augustin Berque (1995 : 355). Cela étant, le paysage post
industriel, considéré dans son acception étroite de représentation de
sites dévastés par l’activité industrielle, ne peut être recevable en
l’absence d’une « esthétique contemporaine de l’abandon [qui] per-
mettrait de considérer les « ruines de la modernité » autrement qu’un
désastre » (Jeudy, 2001 : 16). Ce paysage de ruines reste marginal,
objet d’une attention pour ainsi dire transitoire en attendant son re-
façonnement, cependant que tout l’espace postindustriel se conçoit
et se développe en mode touristique.
CONDITIONS PHOTOGRAPHIQUES
L’analyse du passage du land art à une forme de pratique paysa-
giste artistique urbaine et périurbaine a démontré que, à cet égard, la
construction des faits se situe du côté des acteurs du milieu de l’art,
artistes, commissaires et critiques. Dans les années 1980 toutefois, le
land art sera repris par d’autres intervenants dont l’action, si elle
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 162 11/12/08 15:04:41
chapitre 4 • apparition ou dissolution 163
odifie éventuellement la saisie des œuvres et, surtout celle du mou-
m
vement land art, n’en assure pas moins la transmission et la pérenni-
té.
Une boîte noire se diffuse dans l’espace et devient durable dans le
temps seulement par l’action continue d’acteurs ; s’il n’y a personne
pour la reprendre, elle s’arrête et tombe en pièces, quel qu’ait été le
nombre de ceux qui l’avaient reprise auparavant et quelle qu’ait été la
durée de sa reprise. Mais, le type, le nombre et la qualification des
gens dans la chaîne vont être modifiés […] Pour résumer, il y a toujours
des gens qui se déplacent avec les objets, mais ce ne sont pas les mêmes tout du
long (Latour, 1995 : 337-3381).
Il arrive que le transport d’une boîte noire, sa reprise d’un champ
professionnel à un autre, autorise le maintien ou une certaine conti-
nuité de l’objet, même si cela suppose quelques modifications – de
sens ou de forme. Au cours de la décennie 1980, un champ en émer-
gence – c’est-à-dire à la recherche d’une identité professionnelle avé-
rée –, celui de l’architecture de paysage, enrôle le land art.
Deux facteurs expliquent l’intérêt des architectes de paysage
pour le land art. D’une part, comme on l’a vu avec les travaux de
Nancy Holt, la création de parcs/œuvres d’art s’approche d’une pra-
tique paysagiste, étant de l’ordre de la commande publique. C’est
aussi généralement un travail de collaboration pour lequel s’associent
artistes et aménagistes, l’un des effets de cette interaction étant la
médiatisation de ces œuvres dans des publications spécialisées en
aménagement. D’autre part, et c’est ce dont j’étudierai maintenant
les tenants et aboutissants, le land art semble apporter une possible
réponse à la nécessité d’un modèle (d’un mode) de pratique qui sin-
gulariserait un champ qui oscille entre l’art et la technocratie, entre
inventivité et fonctionnalité, ne serait-ce qu’à cause de « l’indétermi-
nation de son objet, le paysage » (Dubost, 1983 : 432). On fait habi-
tuellement remonter les origines de la profession d’architecte de pay-
sage à l’art des jardins et à quelques « ancêtres » dont Le Nôtre en
France et Frederick Law Olmsted en Amérique. Toutefois, le proces-
sus de sa professionnalisation ne débute qu’après la Deuxième Guerre
mondiale (Dubost, 1983 : 4332), ce qui ne saurait être un hasard, les
« métiers du cadre de vie » (Dubost, 1983 : 432) (ou de la qualité de
vie) ayant connu un formidable essor corrélativement à l’abondance
des années 1950, puis relativement à l’émergence d’une économie
postindustrielle avec ses besoins de développement urbain, suburbain
1. Les italiques sont de l’auteur.
2. Voir aussi : Corbin (2001 : 166-167) et Brown (1991 : 140).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 163 11/12/08 15:04:41
164 Le paysage façonné
et touristique liés à la mobilité grandissante des industries et des
populations. Et si, à partir des années 1980, l’architecte paysagiste
« met plus qu’auparavant l’accent sur sa compétence artistique »
(Dubost, 1983 : 4333), c’est vraisemblablement parce que, au-delà de
son important lien de filiation à la tradition pluricentenaire de l’art
des jardins, certaines formes plus récentes d’interventions artistiques
dans le paysage peuvent être reprises et utilisées comme des facteurs
de légitimation de sa pratique.
L’enrôlement du land art par le domaine du paysage apparaît
comme une stratégie qui serait de l’ordre de la traduction d’intérêts.
Dans les dernières décennies du XXe siècle, les land artists ont en effet
commodément ouvert la voie au façonnage artistique du paysage, per-
mettant que s’ajoute une étape déterminante dans le mouvement de
va-et-vient qui le caractérise : entre la représentation et le déplace-
ment en reconnaissance, s’immiscerait le (re)façonnement physique.
Il y aurait alors esthétisation des lieux mêmes, les images et la saisie
perceptive n’étant plus les seules façons de faire les paysages. Par
extension, l’esthétisation (ou « l’artialisation » comme le dit Alain
Roger) in situ du paysage justifierait les opérations de paysagement et
autoriserait, beaucoup plus que la nécessité d’une gestion écologique,
à « modeler l’espace tout entier » pour reprendre les mots de Françoise
Dubost (1983 : 441). Modelage dont Alain Roger considère qu’il
serait la tâche réservée des spécialistes du paysage :
Le paysage et l’environnement ont des origines et des histoires diffé-
rentes, qui devraient assurer leur autonomie respective. Le fait que,
depuis près d’un siècle, au nom de la rigueur scientifique, la géogra-
phie et l’écologie aient voulu s’approprier, et comme phagocyter le
paysage, n’enlève rien à l’irréductibilité esthétique de celui-ci, et nous
impose, au contraire, de réfuter cet écolonialisme et cette géophagie,
si l’on me permet ces néologismes, et de contenir l’écologie, comme
la géographie, dans les limites de leur compétence (Roger,
1997 : 131).
Il sera ici permis d’ébaucher un parallèle entre le domaine de
l’architecture de paysage et celui de la photographie, autre discipline
qui, comme on le sait, a aussi longtemps hésité (et hésite encore)
entre fonction et esthétique : « Les virtuoses de la photographie ne
veulent pas seulement légitimer une activité reconnue […], ils ten-
tent aussi, transformant en moyen artistique une technique utilisée à
d’autres fins, de nier la définition sociale des usages et des possibilités
de la photographie » (Chamboredon, 1965 : 222-223). Et de même
3. L’auteure souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 164 11/12/08 15:04:41
chapitre 4 • apparition ou dissolution 165
que la difficulté éprouvée par la photographie à se dégager de son
aspect mécanique pour devenir une pratique qui serait essentielle-
ment artistique s’explique « au moins en partie par la discontinuité et
l’hétérogénéité des opérations qui constituent l’acte photographi-
que » (Chamboredon, 1965 : 225), c’est possiblement parce que la
profession d’architecte de paysage se constitue « au point de rencon-
tre d’une multitude de lignes de force » (Dubost, 1983 : 432) que la
discipline oscille entre fonction et invention. Dans les deux cas, c’est
sa « dimension artistique » qui, prenant le pas sur la technique, per-
mettrait d’assurer l’« indivisible unité » du « métier » (Dubost,
1983 : 437). De plus, côté paysage, en intégrant l’art, le champ peut
opérer une appropriation entière de son objet : le groupe, « par là,
s’institue et se rend visible en se référant à ce dont il dit être le dépo-
sitaire ou le gardien » (Davallon, Micoud, Tardy, 1997 : 203).
C’est ainsi que les praticiens du paysage tendent à occuper – ou
à créer – un champ spécifique qui est traditionnellement un genre
artistique. Il y a là traduction, en ce sens que ce champ en émergence
redistribue les intérêts et les buts selon une stratégie identifiée par
Bruno Latour, par laquelle il devient difficile de distinguer « ceux qui
sont recrutés et ceux qui recrutent », mais de telle façon que « ceux
qui construisent les faits doivent apparaître comme la seule force
motrice derrière le mouvement d’ensemble » (Latour, 1995 : 272-
273). D’où cette notion de paysage comme discipline et champ singu-
lier où l’on n’opère plus de nette différenciation entre art et architec-
ture de paysage, ce qui permet d’intégrer le land art devenu art du
paysage. Beau paradoxe que ce recrutement qui donne à la fois une
nouvelle vie au land art et des parentés artistiques dont peuvent se
réclamer les architectes paysagistes ; n’oublions pas par ailleurs que
Smithson – et Beardsley à sa suite – avait donné un « ancêtre » au land
art en la personne d’Olmsted, ouvrant probablement la porte à cette
appropriation, en quelque sorte circulaire, du land art par le champ
paysage4.
Tout comme la photographie artistique est mise au travail
comme opérateur de transformation dans une société à paysagement,
c’est en recourant dans une certaine mesure au land art comme fac-
teur de légitimation qu’une discipline émergente s’installe en
constructeur du fait paysage, en théorie comme en pratique, assurant
4. « Olmsted’s influence on Robert Smithson is the outstanding exception to this tendency
[influence from fine art to landscape architecture instead of vice-versa]. Perhaps this con-
tributes to Smithson’s popularity with many landscape architects and landscape architec-
ture writers » (Brown, 1991: 138).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 165 11/12/08 15:04:42
166 Le paysage façonné
du coup une vision renouvelée du land art. Et curieusement (mais
est-ce vraiment curieux?) cette double médiation advient par la docu-
mentation des œuvres, c’est-à-dire des photographies, des vues qui, sur
le mode des sites/non-sites, ne requièrent pas forcément que l’on se
rende à destination.
Les œuvres de land reclamation, les parcs/œuvres d’art réalisés
par des artistes et l’aménagement de sites par des architectes de pay-
sage ont en commun l’aspect commande publique, je l’ai souligné.
En grande partie à cause de ce partage du « domaine » public, advient
un brouillage des divisions entre les disciplines, autorisant l’appari-
tion d’un champ de spécialistes qui s’occupent de paysage : c’est
« l’objet paysage [qui] doit fonder leur spécificité » (Dubost,
1983 : 437). Aussi, par la théorisation de cet objet, il arrive que tout ce
qui se rapporte au paysage soit annexé, l’art y compris. La commande
a permis aux sculpteurs d’entrer dans le domaine de l’aménagement
voire de donner le ton à toute une pratique paysagiste par l’exécution
de certains projets à caractère récréatif. John Beardsley encourage
d’ailleurs très tôt cette indifférenciation, non seulement en repre-
nant les propos de Smithson qui donne Olmsted comme l’ancêtre du
land art, mais aussi en répertoriant dans ses ouvrages, dès 1977, des
travaux d’architectes de paysage au même titre que des projets de
land art. Il est utile de préciser que Beardsley est lié depuis le début
des années 1980 à divers départements ou facultés d’architecture de
paysage d’universités états-uniennes. Ailleurs, des historiens de l’art
posent certains paysagistes comme des artistes5, qui eux-mêmes pré-
conisent que l’art du jardin et la pratique paysagiste supplanteront les
autres formes d’art6.
Aujourd’hui, le capitalisme, à l’âge du service et de l’immatérialité, se
saisit de la figure même du « créateur ». Une nouvelle étape est franchie
à travers l’intégration du « créatif » dans l’appareil économique lui-
même. Il s’agit de domestiquer la « créativité » en soi – l’acte de créa-
tion – et l’assigner à une nouvelle place, au cœur de la recherche de
productivité (Nicolas-Lestrat, 1998 : 27-28).
La place importante que tient une certaine forme d’art public
dans le (re)développement urbain et périurbain, alors que l’art est
5. Voir par exemple Stephen Bann sur Bernard Lassus (1990 : 214-230) et Bann (1999 : 233-
243). Notons que Bernard Lassus a fait les beaux-arts avant de devenir architecte de pay-
sage ; Stephen Bann relie d’ailleurs le travail de Lassus au land art. Voir Weilacher
(1999 : 117).
6. « It’s no longer painting and sculpture which make inventions, but garden art» (Lassus cité
par Weilacher,1999 : 117). Voir également Lassus (1999 : 164).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 166 11/12/08 15:04:42
chapitre 4 • apparition ou dissolution 167
mis au service d’un certain capitalisme bureaucratique, a été vérifiée
au chapitre précédent. Que la réciproque s’installe, c’est-à-dire que
les architectes de paysage dont le travail est nécessairement tributaire
de la commande publique7 se posent comme des créateurs au même
titre que les artistes, n’est pas étonnant.
Un phénomène autre que la commande publique contribue
aussi à mon avis au brouillage des distinctions entre les disciplines.
C’est l’accoutumance au tourisme, cette correspondance entre représen-
tation – photographique – et déplacement qui permet de considérer
les œuvres de land art comme autant de destinations dont on ferait
l’expérience par le supplément documentaire, par leurs indicateurs,
qui ont la capacité de transformer les œuvres en paysages. Dans la mesure
où les travaux de land art états-uniens de la fin des années 1960 et du
début des années 1970 sont très peu visités, mais sont devenus très
publics grâce à quelques photographies (toujours les mêmes) large-
ment diffusées, l’on peut se demander s’ils ne partagent pas tous,
avec les Sun Tunnels de Nancy Holt, la condition photographique qui fait
que l’on peut les connaître simplement en voyant leurs photogra-
phies. Dans ce cas, faire le voyage serait inutile8. John Urry affirme en
effet qu’il est de plus en plus courant de vivre l’expérience touristique
en imagination, de voir, de comparer et de revoir les lieux et objets
typiques destinés au regard du touriste par la télévision, le magnéto
scope et Internet : « L’expérience touristique typique consiste, de
toutes façons, à voir des lieux déjà nommés, à travers un cadre, tels que
la fenêtre de l’hôtel, le pare-brise de la voiture ou la fenêtre du car.
Mais maintenant, cela peut aussi être expérimenté chez soi, dans son
propre salon, en pressant un bouton » (Urry, 2002 : 90-919). Si les mé-
diums énumérés par Urry sont électroniques, il n’en reste pas moins
que le comportement de leurs utilisateurs se rapproche étonnam-
ment de celui des collectionneurs de recorded sights du XIXe siècle. Et,
pour des raisons évidentes (j’y reviens plus loin), l’on peut douter
que beaucoup de théoriciens comme de praticiens du domaine pay-
sage, nord-américains ou européens, se soient déplacés jusqu’aux
œuvres de land art. Celui-ci serait donc devenu l’art du paysage par
excellence essentiellement grâce à des photographies qui imposent
cadre, point de vue et liaison, toujours selon le modèle perspectif,
cette vieille machine à fabriquer du paysage.
7. « La profession de paysagiste s’est constituée à partir d’un débouché offert par la com-
mande publique dans les années cinquante. » (Dubost, 1983 : 432)
8. À moins que ces œuvres ne deviennent des destinations très tendance, ce qui risque de se
produire, nous le verrons.
9. L’auteur souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 167 11/12/08 15:04:42
168 Le paysage façonné
C’est bien par la photographie que le land art est devenu un art
du paysage. Je crois que sans cet aspect vue enregistrée d’une destina-
tion où il serait possible de se rendre (et c’est la possibilité qui est
importante, non pas le fait qu’elle soit actualisée, comme l’indiquait
Smithson lorsqu’il parlait de « voies mentales ou physiques »), il en
serait tout autrement. La croyance en l’objectivité parfaite des photo-
graphies semble avoir survécu au XIXe siècle, alors que le médium est
considéré comme reproduisant simplement un point de vue partagé,
porteur d’« une vision distribuée qui transcende la subjectivité indivi-
duelle et partant, l’intérêt individuel » (Snyder, 1994 : 183). Il importe
ici d’opérer la distinction entre les deux types de photographies, l’ar-
tistique à laquelle on ne nie plus son statut d’œuvre issue de la subjec-
tivité d’un artiste, et l’ordinaire (pas seulement dans son acception
populaire, mais aussi comme l’instrument dont se servent techniciens
et aménagistes) maniée par tous, comme un simple outil d’enregis-
trement offrant une preuve de la réalité de son objet. C’est immanqua-
blement du supplément documentaire, qui n’est pas de la photogra-
phie artistique, dont on use lorsqu’il s’agit de traiter du land art
comme d’un art du paysage, cet art qui serait un modèle à suivre
lorsqu’il s’agit de paysager le territoire :
Sous leurs apparences rétrospectives ou ludiques, ces manifestations
post-modernes que sont le néo-vernaculaire ou l’art-paysage révèlent
ainsi l’amorce d’une ère sans précédent : celle d’un outre-pays où
l’homme administre l’environnement comme il joue du paysage, dans
l’accord profondément moral de son sens esthétique avec sa connais-
sance (moderne) du réel physique (Berque, 1995 : 35710).
J’ai précédemment signalé l’association que fait Augustin
Berque entre « l’apparition de l’art-paysage aux États-Unis » et l’émer-
gence du terme « paysagement » dans les travaux publics en France,
deux événements qui seraient selon lui contemporains et forts signi-
ficatifs. Berque accorde, dans son texte sur la mission de la DATAR,
une grande importance à cette idée de « paysagement » (« la société à
paysagement ») qui autoriserait l’aménagement et la gestion de l’en-
tièreté du « capital paysager ». Un art, le land art, qui « se déploie dans
l’espace du paysage grandeur nature », en plus de fournir un canon
qui permet de justifier que l’on (re)modèle le territoire, engendre
d’après Berque « un espace imaginaire, [qui] a néanmoins rompu
toute attache avec les espaces illusoires de la perspective “légitime” » ;
cet apparent abandon de la règle perspective étant l’élément essentiel
qui donne sens à son concept de médiance (Berque, 1990 : 132).
10. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 168 11/12/08 15:04:43
chapitre 4 • apparition ou dissolution 169
Mais, comment soutenir l’évidence de cette rupture si l’on n’a pas
arpenté les œuvres? Et il y a fort à parier que si l’on se rend sur les
lieux, on tentera d’ajuster son propre point de vue à celui que
donnent des images que l’on connaît trop bien, en bon touriste satis-
fait de voir les lieux comme s’ils étaient des photos, des cartes et des
panoramas d’eux-mêmes, pour employer les termes de Dean Mac-
Cannell.
Anne Cauquelin, dans L’invention du paysage, ne nie pas l’impor-
tance des photographies et de l’appareil photo comme « instrument
de l’invention » pour les land artists lorsqu’il s’agit de « réflexion pay-
sagiste ». Dans Le site et le paysage, elle parlera plutôt de « réseaux » :
Car du point où se trouve la pièce, ou œuvre, jusqu’à la galerie ou au
musée qui en héberge l’écho, un système de relais s’est mis en place,
changeant chaque fois de support et transformant ainsi son apparen-
ce, mais aussi son organisation interne, et le rapport que cette trans-
formation induit entre l’œuvre et le public (Cauquelin, 2002 : 154).
S’appuyant sur la notion de site/non-site, Cauquelin signale
l’importance de la relation « médiée » par d’autres objets que les œu-
vres elles-mêmes, ceux que j’identifie comme supplément documen-
taire. Si l’œuvre, aux dires de Cauquelin, se « désincarne » ou « s’expa-
trie » (terme fort bien choisi en référence à une certaine mobilité – ou
transmission – de l’image), c’est en s’insérant dans une « forme » qui
tient à la fois du labyrinthe et du réseau et qui se compose de tous les
supports possibles de l’œuvre, multipliant les points de vue (Cauque-
lin, 2002 : 156-157). Cette forme en réseau me paraît proche de la
diversité des lectures potentielles que propose Craig Owens au sujet
de la Spiral Jetty de Smithson. Mais le texte, la photographie ou le film
qui s’interpose entre l’œuvre et le spectateur – ou par lequel « s’expa-
trie » l’œuvre –, reconduit plutôt le vieux point de vue : la position
« from where I am sitting » de l’« homme typographique » de Marshall
McLuhan ou bien l’œil unique de l’appareil photo qui astreint à se
placer à la jonction des lignes de convergence. Points de vue peut-
être démultipliés, mais toujours chacun selon une perspective légi
time.
À l’instar d’Augustin Berque et sa notion d’« outre-pays », Denis
Cosgrove fonde dans le land art l’espoir qu’il pourrait contribuer à
résoudre l’incessant va-et-vient entre l’image et sa chose implicite au
paysage. Le land art se présenterait en effet comme une solution pour
abolir la distance entre le sujet et l’objet, cette impossibilité de se
poser au centre du paysage tout en l’observant à partir d’un point de
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 169 11/12/08 15:04:43
170 Le paysage façonné
vue détaché – fut-il partagé – que Cosgrove appelle une « contradic-
tion » ou une « ambiguïté duelle » (1998 : 1511), qui « fait partie du
paysage » depuis son invention. Cosgrove propose en exemple les tra-
vaux de Richard Long. « Pénétrant le territoire plutôt que de le voir,
il appelle cela land art plutôt que paysage », écrit-il, ajoutant : « c’est
peut-être un signe d’espoir pour nos futures relations culturelles avec
le territoire » (Cosgrove, 1998 : 270). Cosgrove semble oublier que les
œuvres – les sculptures – de Long sont généralement des photogra-
phies, témoignages d’un marquage (léger) du territoire. Long pénè-
tre effectivement dans le paysage, mais il est le seul à le faire. Le spec-
tateur est encore ici confronté au point de vue de la caméra, c’est une
vue enregistrée qui lui est proposée.
John B. Jackson, pour qui la « contradiction » sujet/objet ou
image et chose n’existe pas puisque pour lui paysage et territoire sont
confondus, voit le land art comme n’importe quelle autre composan-
te du paysage. Ainsi les earthworks de même que tout ce que la nature
et les humains élaborent dans le territoire et dans le temps, seront
tout naturellement assimilés ou absorbés, comme l’un des états suc-
cessifs du paysage.
Not far from Quemado (which is not far from the Arizona line) there
is a field of innumerable lightning rods, geometrically planted in an
expanse of range grass. As an example of contemporary environmental
art, it is a source of infinite curiosity and bewilderment. Some day,
centuries hence, the field of lightning rods will have been forgotten by
tourists and entirely assimilated into the landscape (Jackson,
1997 : 5912).
On ne peut que reconnaître le grand intérêt que portent les
théoriciens du champ paysage au land art. C’est en effet chose rare
que de parcourir un ouvrage contemporain sur le paysage sans y trou-
ver au moins une allusion au land art. Certains auteurs états-uniens
font des rapprochements encore plus étroits entre land art et archi-
tecture de paysage, voulant y voir, à l’instar de Cosgrove et de Berque,
une solution à ce fameux paradoxe qui est intrinsèque au paysage, en
même temps qu’un modèle pour la pratique du paysagisme. Des
œuvres des années 1960 et 1970 seront même citées dans des travaux
d’architectes de paysage. Dans la mesure où le land art est en quelque
sorte enrôlé par l’architecture de paysage, il devient possible de s’en
réclamer. L’objet de la discipline paysage est multiple (ou à tout le
11. Landscape’s dual ambiguity (Cosgrove, 1998 : 15).
12. L’auteur fait bien entendu référence au Lightning Field de Walter De Maria, sans toutefois
le nommer.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 170 11/12/08 15:04:43
chapitre 4 • apparition ou dissolution 171
moins duel) et ses acteurs nombreux, comme il a été précédemment
souligné. Les artistes cependant n’y figurent pas (ou très peu) de
façon active, alors que la recherche d’une spécificité pour le domaine
passe très souvent par l’art. C’est que ce ne sont pas les artistes qui
sont recrutés mais bien les œuvres d’art, des acteurs non humains.
À la manière des photographes qui, pour légitimer leur activité,
veulent nier les habituels usages et définitions de la photographie, il
s’agira parfois pour les architectes de paysage d’évacuer l’aspect fonc-
tionnel des interventions paysagères – la réponse aux besoins d’un
client – au profit de leur caractère artistique. Ceci, curieusement, au
moment même où les artistes « réintègrent la fonction dans l’art »,
comme l’affirme Nancy Holt au sujet de son Dark Star Park. Mais, ce
ne sont généralement pas les parcs/œuvres d’art créés par des land
artists qui sont cités en exemple dans le « discours d’accompagne-
ment13 » qui se constitue peu à peu autour de la profession de paysa-
giste, ce sont surtout les œuvres monumentales et isolées auxquelles
on n’a justement jamais attribué d’utilité particulière, sauf peut-être
comme l’affirmait John Beardsley en 1977, celle de « faire mieux per-
cevoir » le paysage.
Why are there so few manmade landscapes which persuade us to
launch a purposeful excursion or cause us unexpectedly to change an
itinerary? Why are there so few fascinating, new landscapes that we
must see? And why do many of those which are provocative so often
come from the pens of building architects […]? Or from the so-called
Earth Artists who manipulate large-scale earth forms? (Krog,
1983 : 7014).
Steven Krog croit que les architectes de paysage devraient mettre
en valeur l’aspect créatif de leur travail. Il met en doute les aspects
« service » et technique du métier, qu’il décrit comme la réponse à
une commande par « l’adaptation fonctionnelle d’un site aux deman-
des de l’usage humain » (Krog, 1981 : 375), qui devraient être rempla-
cés par un « commentaire sur la société » plus proche de préoccupa-
tions proprement artistiques (Krog, 1983 : 72). Aussi, prenant exemple
sur le champ artistique, celui de l’architecture de paysage devrait,
selon Krog, réintégrer sa propre histoire et élaborer des théories cri-
tiques qui lui seraient spécifiques (Krog, 1981 : 374). Il en appelle à la
structuration d’un champ du « landscape architectural art » avec ses pra-
13. « Ils [les paysagistes] se réfugient enfin dans un discours d’accompagnement qui se fait de plus
en plus savant (et parfois de plus en plus obscur), grâce à des emprunts divers à la philo-
sophie et à la sémiologie » (Dubost, 1983 : 444). Les italiques sont de l’auteure.
14. L’auteur souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 171 11/12/08 15:04:43
172 Le paysage façonné
ticiens, bien sûr, mais aussi ses historiens, ses théoriciens, bref son
discours : « le terme « architecture de paysage » pourrait être réservé
à la manipulation artistique des environnements paysagers au profit
d’expériences humaines » (Krog, 1981 : 375). L’annexion du land art
devient dès lors chose toute naturelle.
Françoise Dubost identifie, au début des années 1980, une
frange de la profession qu’elle nomme « les artistes » et qui veulent se
démarquer des « professionnels » et des « gens de métier » par le
caractère plus distinctement artistique de leurs travaux. Ce sont évi-
demment ces « artistes » qui tiennent à produire un « discours d’ac-
compagnement » pour leur discipline (Dubost, 1983 : 439 et 44415).
Discours qui est effectivement élaboré au cours des années 1980, en
France comme aux États-Unis, en se référant tout particulièrement,
et de diverses manières, au champ de l’art.
Expériences perceptives nouvelles ou commentaire sur la société,
c’est à une recherche de sens, pour l’art des jardins comme pour l’art
du paysage, à laquelle se livrent bien des auteurs et des architectes de
paysage qui brouillent ainsi les distinctions entre art et pratique de
l’aménagement (Stephen Bann, Brenda Brown, Catherine Howett,
Robert Riley, Stephanie Ross, Udo Weilacher, etc.) tout au long des
décennies 1980 et 1990. Robert Riley affirme que si un « travail artis-
tique qui façonne la nature pour donner du sens [sic] est un jardin »
alors les œuvres de land art « sont des jardins » (Riley, 1988 : 144).
Stephanie Ross veut « tracer des affinités » entre les jardins du
XVIIIe siècle et les earthworks du XXe siècle (Ross, 1993 : 158-182).
Pour Steven Krog, comme pour John Beardsley avant lui, c’est la per-
ception particulière que provoquent les travaux site specific des sculp-
teurs des années 1960 et 1970 qui fait leur importance. Il cite James
Turell à cet égard : « media of art are perception16 ». De même, c’est la
relation au paysage, de l’œuvre au site et du spectateur à l’œuvre et au
site, qui retient l’attention de Stephanie Ross : « Des travaux comme
le Roden Crater de Turell, le Double Negative de Heizer […] nous for-
cent à repenser notre place dans le paysage, nos rôles d’agents perce-
vant, appréciant, consommant ou détruisant » (Ross, 1993 : 17817).
C’est de cette manière, d’après Ross, que les œuvres de land art rem-
15. Brenda Brown, aux États-Unis, identifie aussi un groupe de ce genre (1991 : 140).
16. « Turning aside from this diversionary question: « Is it beautiful? », we are free to accept
artist James Turell’s imperative that « media of art are perception ». Small wonder that
Robert Smithson, Carl Andre, Christo, Michael Heizer, Dennis Oppenheim and other
artists turned to the landscape as their forum and/or medium » (Krog, 1981: 72).
17. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 172 11/12/08 15:04:44
chapitre 4 • apparition ou dissolution 173
pliraient la même fonction que les plus beaux jardins du XVIIIe siè-
cle.
On peut cependant se demander comment une œuvre très dif-
ficilement accessible comme le Double Negative (mais dont les photo-
graphies sont grandioses et très publiques) ou une autre, le Roden
Crater, que personne n’a visitée puisqu’elle n’est toujours pas complé-
tée et que l’artiste n’autorise pas qu’on la voit tant qu’elle n’est pas
achevée, pourraient nous « forcer à repenser notre place dans le pay-
sage ». Il s’agirait plutôt de notre position devant une image ou par
rapport au discours qui entoure une œuvre. Car si Craig Owens avait
raison sur une chose, c’est bien sur l’importance du discours, qui fait
office de supplément documentaire au même titre que les photogra-
phies – et conjugué avec elles –, et de même s’interpose entre les
œuvres et le spectateur. Le Double Negative et aussi la Spiral Jetty de
Smithson (autre œuvre inaccessible puisqu’elle reste submergée pen-
dant les décennies 1980 et 1990) sont les travaux les plus largement
évoqués lorsqu’il s’agit d’établir des liens entre architecture de pay-
sage et land art. Signalons-le encore, c’est l’expérience de l’œuvre qui
ferait ressortir ces associations. Et pourtant cette « expérience »,
lorsqu’elle n’est pas « vécue » par les photographies, l’est à travers les
écrits des artistes, particulièrement ceux de Smithson, ou suivant des
« récits » généralement acceptés comme celui de John Beardsley18.
Brenda Brown catégorise une nouvelle vague en architecture de
paysage par l’intérêt que partagent les membres de ce groupe pour
les arts visuels, en particulier pour les earthworks et les travaux site
specific.
It [the influence of fine arts] shows in material and formal vocabulary
and in understanding aesthetic and intellectual conceptions. It also
appears in allusions and quotations within works and in verbal and
written references from designers. Examples and precedent from the
art world, exposure to fine art education and collaborations with “fine
artists” may also affect how landscape architects are presenting them-
selves and their works (Brown, 1991 : 140).
Fait intéressant, Brown ajoute que, alors que les « artistes site-
specific » voulaient sortir l’art des galeries (ce qui n’est bien sûr pas
tout à fait exact), plusieurs des paysagistes de cette « nouvelle vague »
semblent en revanche rechercher la légitimité que confère la gale-
rie.
18. Je reviens à ce récit dans la dernière section du présent chapitre.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 173 11/12/08 15:04:44
174 Le paysage façonné
Tout comme Brenda Brown, Catherine Howett souligne le fait
que les collaborations et les commandes publiques faites aux artistes
ont contribué à rendre poreuses les frontières entre l’art et l’architec-
ture de paysage (1985 : 53). Elle dit ainsi de Smithson qu’il fut le pre-
mier à « faire la propagande » (propagandized) des applications du land
art pour la restauration de paysages dévastés, touchant ainsi le
domaine de l’architecture de paysage. Elle fait toutefois référence
aux déclarations de Smithson concernant l’attachement naïf à la
nature idéale (dont on sait qu’il était loin), pour soulever à nouveau
cette épineuse question que Steven Krog avait auparavant posée : l’ar-
chitecture de paysage est-elle un art? Car Smithson demandait en
1968 dans A Sedimentation of the Mind : Earth Projects : « Pouvons-nous
dire que l’art dégénère à mesure qu’il s’approche du jardinage? »
(Smithson cité par Howett, 1985 : 56). Plutôt que de proposer, à
l’instar de Krog, qu’une partie de la profession délaisse la commande
au profit d’interventions plus purement esthétiques, Howett en ap-
pelle à l’hybridation des disciplines (c’est-à-dire à l’établissement de
rapports créateurs entre les architectes de paysage et les artistes, les
architectes, les théoriciens et les critiques aussi bien qu’avec les scien-
tifiques et les techniciens) pour la réalisation de places publiques
« qui accommoderaient superbement nos besoins individuels et de
membres d’une communauté, tout en exprimant des valeurs parta-
gées, parmi lesquelles notre responsabilité envers les systèmes naturels
devrait être prédominante » (Howett, 1985 : 59). Et c’est en grande
partie la qualité artistique des interventions qui les rendraient signifi-
catives. Outre l’art, lorsqu’elle propose une théorie qui éclairerait la
pratique de l’architecture de paysage, une nouvelle façon de l’envisa-
ger pour évacuer son aspect trop « spectaculaire » (scenic), Howett
(1987) prend pour modèle la sémiologie, donnant ainsi raison à
Françoise Dubost.
Qu’elle se penche sur la nécessité pour la profession de respec-
ter l’environnement, ou celle d’élaborer une théorie qui lui serait
spécifique, ou bien de proposer une mission ou un programme pour
les professionnels du domaine, le land art est toujours cité en exem-
ple par Howett. Et l’on trouve bien souvent dans ses articles des pho-
tographies… du Double Negative ou de la Spiral Jetty.
De nombreux praticiens, de ceux que Brenda Brown range dans
la nouvelle vague de l’architecture de paysage, s’inspirent directe-
ment des œuvres d’art tout en tentant de démontrer que c’est leur
profession qui devrait occuper tout le champ. La célèbre architecte
paysagiste Martha Schwartz emprunte autant aux discours entourant
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 174 11/12/08 15:04:44
chapitre 4 • apparition ou dissolution 175
les œuvres qu’aux œuvres elles-mêmes. Elle affirme par ailleurs que
les architectes de paysage sont « allés plus loin » que les artistes du
land art (Brown, 1991 : 145). Garrett Eckbo, autre praticien reconnu,
déclare quant à lui que l’architecture de paysage est « l’art ultime
parce que le paysage, social aussi bien que physique, est la source
d’inspiration pour tous les autres arts » (Howett, 1985 : 58). Michael
Van Valkenburg se serait inspiré, pour son Ice Vine Garden, d’une
œuvre de Hans Haacke, Spray of Ithaca Falls : Freezing and Thawing on
Rope, présentée dans le cadre de Earth Art à Cornell University en
1969. Gary Dwyer procède par « marquages » comparables à ceux de
Richard Long ou de Dennis Oppenheim. Les exemples sont nom-
breux d’œuvres d’art citées par les architectes paysagistes, souvent des
travaux disparus ou inaccessibles. La Tanner Fountain de Peter Walker
(1980) est l’une de ces réalisations qui empruntent à des œuvres que
l’on classe, de façon parfois inexacte, dans la catégorie du land art.
Selon Catherine Howett (1985 : 54) et aussi Brenda Brown (1991 : 145-
147), cette fontaine tient à la fois de la Steam Piece (1967-1973) de
Robert Morris et de la Stone Field Sculpture (1977) de Carl Andre. Steam
Piece, qui était un jet de vapeur sortant de terre par intermittence,
n’existe plus, alors que la similarité entre la fontaine de Walker et
l’œuvre de Carl Andre se trouve dans l’angle de prise de vue des photo
graphies montrées pour établir ladite similitude.
4.1 PETER WALKER, TANNER FOUNTAIN,
1980. HARVARD UNIVERSITY
Reproduit avec l’autorisation de PWP Landscape Architecture
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 175 11/12/08 15:04:45
176 Le paysage façonné
4.2 CARL ANDRE, STONE FIELD, 1977.
HARTFORD, CONNECTICUT
Greater Hartford Arts Council/Photographie : Paul Conee, 2006
Des photographies des deux œuvres, prises à la verticale, mon-
treraient tout autre chose.
4.3 PETER WALKER, TANNER FOUNTAIN,
1980. HARVARD UNIVERSITY
Reproduit avec l’autorisation de PWP Landscape Architecture
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 176 11/12/08 15:04:48
chapitre 4 • apparition ou dissolution 177
4.4 CARL ANDRE, STONE FIELD, 1977.
HARTFORD, CONNECTICUT
Greater Hartford Arts Council
Apparemment, l’un des principes qui guident le travail de
alker est qu’il doit être « visuellement saisissant » (strickingly visual)
W
(Brown, 1991 : 145). S’il reconnaît l’influence que les earthworks et les
« artistes site specific » peuvent avoir sur ses créations, il affirme que le
paysage est à la fois un espace fonctionnel et de la sculpture, qu’il faut
voir. De même, Brenda Brown assure que, pour les architectes de pay-
sage qu’elle identifie comme faisant partie d’une avant-garde, c’est
lorsque leurs travaux sont « visuellement puissants » qu’ils se rappro-
chent des « beaux-arts ». Cette nécessité d’un impact visuel ne serait-
elle pas déterminée par des photographies de sculptures plutôt que par
les sculptures elles-mêmes? Car, comme on l’a vu, la grande majorité
des œuvres dont il a été question ne peuvent avoir été directement
expérimentées, dans le temps et dans l’espace, la plupart ayant été
des interventions éphémères ou des travaux offrant des possibilités
d’accès très limitées. Comme le disait si bien Robert Morris des
grandes œuvres du désert, le seul accès public à ces œuvres est photogra
phique.
On sait pourtant que, tout comme leurs collègues minimalistes,
les land artists avaient fortement mis l’accent, ne serait-ce que dans
leur discours, sur la prépondérance d’un certain rapport physique à
l’œuvre, une relation qui ne serait pas que visuelle, mais aussi bien
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 177 11/12/08 15:04:49
178 Le paysage façonné
corporelle, engageant le spectateur dans une expérience spatiale et
temporelle. Malgré cela, ou à cause de cela, les earthworks, tout spécia-
lement les œuvres monumentales du désert, sont sacralisés par le
champ paysage comme peuvent l’être les spectacles touristiques (sights),
à travers leurs reproductions mécaniques ; celles-ci pouvant être confon-
dues avec ceux-là, on le sait. D’après MacCannell, le spectacle peut
être aisément dominé par son indicateur lorsqu’on les identifie direc-
tement l’un à l’autre ou lorsque l’indicateur lui-même est reconverti
en spectacle. Indice supplémentaire de cette sacralisation des indica-
teurs/œuvres de land art, leur reprise par les théoriciens de l’archi-
tecture de paysage correspond à la phase ultime de la sacralisation
selon MacCannell, qu’il appelle « social reproduction » et qui se produit
lorsque « des groupes, des villes, des régions se réclament d’attrac-
tions fameuses » (1999 : 124 ; 127 et 45).
Cette sacralisation du supplément documentaire ou des indica-
teurs du land art a ceci de particulier qu’elle reproduit le paradoxe
propre au paysage, cette ambiguïté duelle que les acteurs du champ
voudraient bien (voir se) résoudre. Il n’est pas étonnant que l’ambi-
valence persiste puisque la mise en valeur et l’exploitation du « capi-
tal paysager » ont pour principal but de fabriquer des destinations
aptes à convaincre le voyageur de « planifier une excursion ou de
changer inopinément un itinéraire », pour reprendre les termes de
Steven Krog. Et quoi de plus persuasif à cet égard qu’une vue enregis-
trée dont on sait que l’on pourra, en se rendant sur son site, la parta-
ger puis la reproduire?
Après avoir été sacralisées à travers leurs reproductions mécani-
ques, les œuvres de land art pourront devenir de possibles destina-
tions touristiques, en partie grâce à cette fortune qui leur est assurée
parce que les acteurs d’un autre champ que celui de l’art les transpor-
tent, leur garantissant ainsi une meilleure visibilité ou une plus grande
valeur19. Par ailleurs, le tourisme évoluant vers des formes moins
traditionnelles, de nouvelles destinations se dessinent, hors des
sentiers battus. Des visiteurs des confins, selon l’expression de Jean-
Didier Urbain, iront visiter les œuvres de land art isolées, sortes de
« lieux-limites » à « la fin de l’espace construit, [au] bout du chemin,
là où les sociétés s’interrompent, là où tout cesse brusquement »
(Urbain, 1993 : 170), bref dans le désert.
19. Au sujet des fluctuations de valeur entraînées par les médiations successives opérées par
divers agents, voir Hennion, (1993a : 199-200) : « Des causes contradictoires, hétérogènes,
sans cesse composées et réinterprétées, peuvent néanmoins produire du stable, à condi-
tion d’être aussi mêlées avec les choses. »
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 178 11/12/08 15:04:49
chapitre 4 • apparition ou dissolution 179
Again, a cynic might reply that it is the spectacle aspect of much out-
side site and earthworks which is responsible for their popular appeal.
[…] It has been the fate of much site work to be addressed by the
media for its sensational aspect: art’s answer to Disneyland. Come on
out and risk your life crawling through tunnels and teetering on
ladders ! Or better still, if you’re man enough, I should say person
enough, make a risky pilgrimage to the inaccessible desert wilderness
where, if one can avoid the sidewinders and the cryptic remarks of the
taciturn artist, one can return sunburned, but definitely enriched, or
at least thrilled, and with a stack of Kodachrome slides (Morris,
1979 : 15).
Sur les hauts-plateaux du Nouveau-Mexique, le Lightning Field
de Walter De Maria fait maintenant cabane comble tout au long de la
saison pendant laquelle il est ouvert. Dans le Great Basin Desert de
l’Utah, les Sun Tunnels de Nancy Holt attirent des visiteurs réguliers
et tous les ans, lors du solstice d’été, l’on campe nombreux sur les
lieux pour assister au lever du soleil. Dans certains de ses plans pour
son Roden Crater d’Arizona, James Turell prévoit un centre pour les
visiteurs (visitor’s center) ainsi que de l’hébergement à même le site, ce
qui ferait de cette œuvre monumentale une attraction touristique
comme n’importe quelle autre.
Quant à la Spiral Jetty de Robert Smithson, Lucy Lippard avait eu
à son sujet, dès 1977, cette intuition : « Le monument isolé de Smith-
son durera assez longtemps pour devenir une ruine romantique
(peut-être y aura-t-il même des visites de groupes) » (Lippard, 1977 : 88).
Lorsque Nancy Holt lui a cédé la Spiral Jetty en 1999, la Dia Founda-
tion avait d’abord songé à la restaurer, c’est-à-dire à la rehausser pour
la rendre visible. Mais la Jetty a finalement émergé d’elle-même des
eaux du Great Salt Lake, sous un aspect changé par sa longue immer-
sion. Et grâce à cette réémergence tardive, pas de doute qu’elle soit
en voie de devenir un lieu de contemplation, comme une ruine pitto-
resque ou un paysage se prêtant bien à ce que John Urry appelle le
« regard romantique » (romantic gaze) d’un certain tourisme qui tient,
en évoquant la nécessité d’une relation solitaire, intime et person-
nelle voire « semi-spirituelle », à l’objet contemplé, à se démarquer du
« regard collectif » (collective gaze) du tourisme de masse qui, par oppo-
sition, implique une certaine convivialité (Urry, 2002 : 150). De
même, selon Jean-Didier Urbain, le tourisme « désertique » est « un
tourisme de révélation », qui distingue aussi ses consommateurs de la
masse des autres touristes : « Rien d’étonnant à ce que l’amateur de
déserts se conçoive lui-même comme une sorte de nomade des espa-
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 179 11/12/08 15:04:49
180 Le paysage façonné
ces sacrés, un touriste-cerbère préoccupé par l’expulsion de ces intrus
qu’il nommera “touristes” » (Urbain, 1993 : 178). Et le « regard
romantique » démontre apparemment sans ambiguïté le bon goût de
ceux qui le pratiquent (Urry, 2002 : 4320). Cette nouvelle quête de
révélations paysagères par les œuvres de land art pourrait sans doute
faire figure de réplique contemporaine au Grand Tour, que seule
l’élite pouvait se permettre d’effectuer ; il fallait connaître les grandes
œuvres et avoir les moyens du voyage.
4.5 PUBLICITÉ « SPIRAL JETTY WEEKEND »,
PARUE DANS SCULPTURE, JUILLET/AOÛT 2004
Reproduit avec l’autorisation du Salt Lake Art Center, Salt Lake City
20. Urry en réfère à Pierre Bourdieu quant à la « distinction » à laquelle correspond le
« regard romantique ». Et, dit Bourdieu, « les consommateurs défendent leur rareté par la
rareté des produits qu’ils consomment ou la manière de les consommer » (1980 : 171).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 180 11/12/08 15:04:50
chapitre 4 • apparition ou dissolution 181
La Spiral Jetty est inscrite par le Service des parcs nationaux des
États-Unis sur le site Internet du Golden Spike National Historic Site21
(GSNHS) comme « nearby attraction », parmi les Dinosaur National
Monument, Hill Aerospace Museum, Thiokol Rocket Display et autres
City of Rocks National Reserve22. On peut, par le GSNHS, se procurer
des instructions détaillées pour se rendre à la Jetty, voyage qui est
encore périlleux, certainement un « pèlerinage risqué dans le désert
sauvage » selon les termes de Morris, qui nécessite un véhicule à qua-
tre roues motrices. L’itinéraire suit des chemins de terre non entrete-
nus, et offre par intermittence des vues à l’apparence parfaite de
pittoresque postindustriel que Smithson n’aurait pas renié : « D’autres
surprises adviennent sur le parcours, comme autant d’installations
pittoresques intentionnelles : une roulotte rose et blanche abandon-
née et vandalisée, un tracteur amphibie, un camion pick-up rouillé »
(Collier et Edwards, 2004 : 32). Symboles corrodés de cette mobilité
qui a modelé le territoire américain et à laquelle Smithson s’intéres-
sait tant. De plus, comme Lippard l’avait anticipé, il est possible de
participer à un tour, sorte de voyage organisé jusqu’à la Jetty .
Ailleurs, dans le désert du Mohave, le Double Negative de Michael
Heizer (maintenant propriété du Museum of Contemporary Art de
Los Angeles) « retourne à la terre » comme le constatait déjà Lippard
en 1977 (1977 : 88). Peut-être songera-t-on bientôt, dans une impul-
sion de conservation proche des opérations de mise en patrimoine
dont font l’objet ruines et paysages, à le restaurer et à le rendre plus
accessible, car le chemin qui permet de monter sur la Mormon Mesa
où se trouve l’œuvre est très endommagé. Mormon Mesa, après tout,
n’est qu’à une heure en voiture de Las Vegas…
DESTINATIONS
Une certaine condition photographique transforme les œuvres du
land art en des vues enregistrées de destinations vers lesquelles il suffi-
rait d’aller pour les re-connaître. À l’inverse, la photographie artisti-
que telle qu’elle est pratiquée par Lewis Baltz et ses collègues spécia-
listes du paysage de la marge n’illustre certes pas des endroits où l’on
aimerait se rendre. On pourrait pourtant croire que ces artistes
21. Un monument commémoratif a été élevé en Utah, là où se sont rejoints les tronçons est et
ouest des chemins de fer américains, unifiant complètement le pays en 1869.
22. www.nps.gov/gosp/tour/nearby.html. Un lien vers ce site se trouve sur celui de la Dia
Foundation (www.diacenter.org).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 181 11/12/08 15:04:50
182 Le paysage façonné
photographes contribuent à faire exister le paysage postindustriel dans
tout ce qu’il a de curieux ou de spectaculaire ou même de possible-
ment sublime, à l’exemple de ces déserts où ont opéré les land artists,
ou encore de ces « sites catastrophiques » auxquels s’intéresse un
certain type de touriste23. Les photographies de paysages altérés sont
fréquemment comparées aux documents des œuvres monumentales
du land art. Cela est vraisemblablement dû à la ressemblance – visuelle
à tout le moins – des lieux dans lesquels opèrent photographes et
land artists ou bien à la volonté de rattacher la photographie à cer
taines formes ou traditions artistiques :
The connections between these recent photographs [The Altered Land
scape collection] and earthworks are especially rich. The earthworks of
Robert Smithson, Michael Heizer and numerous other artists, which
where based on an actual physical involvement with the land outside of
the confines of the museum, may have been the most innovative
response to landscape ideas in the second half of this century. The
earthwork artists’ attention to common, otherwise unconsidered
landscapes and the way we mark and modify them provided an impor-
tant model for recent photographers, which was especially under
scored by the artists’ active use of photography to record their remote
construction (Southall, 1999 : 43).
Si, d’une part, cette recherche de similarités entre land art et
photographies de sites dévastés démontre encore que la photogra-
phie porte avec elle la nécessité récurrente de sa légitimation en tant
qu’art, l’on ne peut nier d’autre part que des comparaisons, à tout le
moins formelles, s’établissent aisément entre une photographie do-
cumentant l’intervention d’un land artist et une image photographi-
que montrant des altérations causées par l’industrie. À ceci près que
les land artists altèrent eux-mêmes les sites dans lesquels ils opèrent. Par
ailleurs, l’intérêt pour les sites des œuvres monumentales de land art
augmente au moment où leur pérennité semble assurée par des orga-
nismes comme la Dia Foundation, alors que les sites photographiés
par Baltz et ses collègues sont voués, par leur nature même de lieux
marginaux, à la transformation. Les photographies de ces artistes ont
certes une incidence non négligeable, pas seulement celle (par défaut
ou comme une preuve par le contraire) de recréer une culture du
paysage qui aurait été mise à mal par les bouleversements des trente
glorieuses, mais aussi et du coup, celle d’appeler une certaine nostal-
23. « Ces lieux sont vécus comme d’ultimes confins, spectacles de « bout du monde », paysages
où l’imaginaire déchiffre le début du chaos en un instant panoramique » (Urbain,
1993 : 171).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 182 11/12/08 15:04:51
chapitre 4 • apparition ou dissolution 183
gie qui pourra contribuer à justifier la remise en état du paysage, du
territoire. Commandées ou fabriquées dans cette perspective, mises
au travail à cet effet, ces photographies peuvent être un appel à
l’action, parfois formulé par le photographe lui-même s’il est mili-
tant, mais le plus souvent relayé par des agences gouvernementales.
Est-ce un hasard si nombre d’organismes, la DATAR parmi ceux-ci,
emploient surtout des photographes de la marge ? C’est bien une ma-
nière d’établir à l’avance ce qui sera observé, une façon de constituer,
d’entrée de jeu, la valeur du paysage représenté en regard de la qua-
lité que l’on voudra lui redonner.
Le plus souvent, les valeurs paysagères sont définies par rapport à des
images fixes : cartes postales, peintures, photos et, enfin les films, qui
sont eux-mêmes une succession de photos. Ces valeurs fixes sont liées
à la mémoire, ce sont “des lieux de mémoire”, pour reprendre l’ex-
pression de Pierre Nora (Lassus, 1999 : 158).
Mais, dit Nora lui-même, « [l]es lieux de mémoire naissent et
vivent du sentiment qu’il n’y a pas de mémoire spontanée, qu’il faut
créer des archives » (Nora, 1997 : 22). D’où l’impulsion patrimoniale
qui fera des archives existantes une matière de grande valeur et qui
conduira à fabriquer de nouveaux documents d’archives. Les inventai-
res photographiques, dans le cas des programmes de rephotographie
comme dans celui des observatoires, font appel aux archives, aux
photographies anciennes. À partir de celles-ci, l’on produit de nou-
velles images, les collections qui en résultent finissant elles-mêmes
aux archives, les photographies contemporaines devenant les « lieux
de mémoire » du paysage de la marge. Par ailleurs, ces mêmes images
permettront aux aménagistes d’engager le processus de constitution
matérielle de certains sites et territoires en lieux de mémoire. Car,
toujours selon Nora, « identité, mémoire et patrimoine sont les trois
mots clés de la conscience contemporaine, les trois faces du nouveau
continent Culture » (Nora, 1997 : 4713). À tel point que les paysages
deviennent des objets façonnés par et pour la recherche d’identités
nationales, d’authenticité et de conformité tant à une image régionale,
souvent issue du passé, mais revue et corrigée, qu’à un impératif de
rentabilité dans un cadre mondial.
Le façonnement des paysages est en général une sorte de théma-
tisation de l’espace qui s’effectue à partir d’images et de collections
d’images. Cette mise en thèmes s’opère par division des fonctions des
lieux et par dénomination, ce qui rappelle la première étape de la
sacralisation des spectacles touristiques selon MacCannell : naming
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 183 11/12/08 15:04:51
184 Le paysage façonné
phase. Un beau cas de dénomination serait la montagne Sainte-
Victoire devenue « la montagne de Cézanne », tel qu’il est indiqué sur
les panneaux de signalisation qui bordent les routes qui longent
ladite montagne, devenue elle-même un monument national. De
même, certains ouvrages littéraires et filmiques, voire des émissions
de télévision, provoquent la thématisation des lieux où sont situées
des intrigues fictives. Cannery Row à Monterey (Californie) où John
Steinbeck met en scène l’action du roman éponyme est rapidement
devenue une sorte de parc à thème où l’on chercherait vainement les
vieilles usines et les entrepôts désaffectés décrits par Steinbeck : les
entrepôts, restaurés, sont désormais occupés par des échoppes dans
lesquelles tout est à vendre, sous le label Cannery Row. Beaucoup de
destinations acquièrent de l’intérêt simplement parce qu’on y a tour-
né des séries télévisées et des films. Si vous allez à Tozeur en Tunisie,
ce n’est pas le désert lui-même, pourtant d’une grande beauté, que
l’on vous proposera de voir, mais bien le lieu où certaines scènes de
Star Wars ont été tournées. Il y a aussi ces villages typiques où l’on force
l’aspect pittoresque au profit des visiteurs (et du commerce local) :
In the United States there are scores of museum villages, museum
farms, museum streets and alleys and structures, and as tourism
becomes big business, more and more of them come to the surface.
That the public enjoys them is beyond dispute. The public also enjoys
Disneyland and for much the same reason: a “period” disguised as
American history is dramatized and illustrated in an attractive manner
(Jackson, 1997 : 367).
Grâce à ce processus de thématisation des sites et des territoires,
une nouvelle opération s’ajoute à la constitution des lieux en paysage
– ou à leur mise en paysage – dans les dernières décennies du XXe siè-
cle. Le paysage peut être défini comme la relation entre une repré-
sentation et le déplacement que celle-ci provoque vers le site dépeint,
comme je l’ai précedemment suggéré. Il advient, lorsque le champ
paysage prend en mains le remodelage de l’espace tout entier, qu’une
représentation photographique d’un site en perdition (ce qui serait
le paysage postindustriel pris au sens strict) ou une image ancienne
que l’on compare à un état actuel des lieux, est employée comme
motif pour justifier la transformation du site ou du lieu en question.
Par cette modification, le lieu pourrait (re)devenir un paysage, donc
une forme qui serait susceptible d’être admirée selon des modalités
qui ont fait leurs preuves, celles de la vue qui peut être partagée et
vers laquelle l’on se rend pour l’enregistrer à nouveau. Voici donc
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 184 11/12/08 15:04:51
chapitre 4 • apparition ou dissolution 185
que la formule se présente autrement. Plutôt que représentation
entraînant un déplacement, il faudrait maintenant comprendre le
paysage comme représentation qui autorise le façonnement (ou l’es-
thétisation24) du site représenté, entraînant le déplacement et une
appréciation améliorée. Selon les termes de Dean MacCannell, cela
pourrait donner : indicateur-mise en spectacle-spectacle.
Cette étape intermédiaire, celle du (re)façonnement, qui s’ajou-
te entre la représentation et le déplacement en reconnaissance ou
l’appréciation in situ, permet de recomposer le monde comme un
parc à thème où les identités régionales et nationales se distingue-
raient les unes des autres par leurs paysages typiques, porteurs de sin-
gularité, d’authenticité.
Thus “territory is less central to national self-definition” and more im-
portant are specific places, landscapes and symbols including various kinds
of consumption including food, drink and art. What are central then
are various icons of a nation – icons that are also pivotal to that cultu-
re’s location within the contours of global tourism (Urry,
2002 : 15825).
Urry oppose ici territoire comme portion de pays délimitée et
paysages ou autres attraits distinctifs ou symboliques d’une identité
régionale ou nationale. À mesure que les grandes villes du monde, les
métropoles, tendent à s’uniformiser, il devient nécessaire de conser-
ver, de mettre en évidence ou de créer ces singularités. On sait quelles
fonctions peuvent avoir les artistes dans cette quête de distinctions
régionales. Ce peut être par l’implantation d’œuvres d’art public que
se résout ce besoin de différenciation : une forme de paysagement à
échelle réduite mais qui, par le nombre d’œuvres, peut transformer
une ville en un haut lieu de culture – ce qui serait le cas de Seattle par
exemple. Ce peut être aussi la présence des artistes qui contribue à
distinguer une cité qui, par ailleurs, n’a pas de caractère particulier,
comme on l’a vu avec Fos-sur-Mer. Dans cet espace redéfini selon les
pôles de l’authenticité régionale et du tourisme global, l’art et les ar-
tistes garantissent une valeur ajoutée aux sites. Robert Smithson parlait
déjà de valeur ajoutée comme l’un des avantages de la réhabilitation
par les artistes des territoires endommagés. Plus largement, les amé-
nagistes prenant la suite des artistes, c’est l’esthétisation (ou l’« artia-
24. Nous avons vu plus haut que ce sont en grande partie les land artists qui ouvrent la voie, ou
leurs œuvres qui ont servi de modèles, à cette esthétisation du paysage.
25. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 185 11/12/08 15:04:51
186 Le paysage façonné
lisation ») des sites et des territoires qui assure leur caractère distinctif
et donc leur valeur.
C’est ainsi que l’on élabore, dans les villes et hors des villes, des
paysages porteurs d’identité ou de mémoire, susceptibles d’attirer le
plus grand nombre de visiteurs. Car les touristes collectionnent les
destinations comme au XIXe siècle on collectionnait les stéréo
grammes ; les voyageurs sont des consommateurs de sites comme le
suggère Lucy Lippard (2000 : 122). Il va sans dire que les métropoles
ont un rôle déterminant dans la fabrication des paysages en périphé-
rie, soit parce que les métropolitains développent eux-mêmes la péri-
phérie en y injectant des capitaux, soit que la périphérie n’a d’autre
choix économique que de se constituer en destination – authentique,
typique ou exotique, autre – afin d’attirer les gens de la métropole. Le
développement touristique dans les pays en émergence est principa-
lement assuré par de grandes compagnies états-uniennes ou euro-
péennes et la majeure partie des capitaux retourne dans les métro
poles26. De même, ce sont les habitants des villes qui vont vers les
zones périphériques, campagne, littoral, etc., où le tourisme est un
facteur économique important.
Mais voyons par quels procédés on en arrive à construire des
paysages, à thématiser l’espace, en usant d’images récupérées aux
archives et/ou commandées à des artistes. Voici les formes d’inter-
ventions possibles : la conservation, généralement par désignation ; la
restauration en un état antérieur ; la reconstitution ; le nettoyage et la
remise en fonction. Une autre forme d’intervention serait l’invention
de nouveaux paysages, mais celle-ci ne faisant pas appel à des images
préexistantes, elle ne sera pas examinée.
La conservation ou la protection des lieux s’effectue par leur
mise en réserve, soit l’instauration de parcs nationaux ou le classement
de sites qu’il ne sera plus possible de modifier. C’est ce qu’Alain
Corbin appelle « l’étatisation du paysage » (2001 : 165). L’importance,
à cet égard, des inventaires photographiques du XIXe siècle (geogra-
phical surveys) a déjà été soulignée. Si, pour les États-uniens du
XIXe siècle les mises en réserve favorisaient l’émergence d’une image
forte de la nation, la fin du XXe siècle voit naître la crainte de perte
d’identité et, de là, le besoin d’une mémoire unifiante pour les na-
tions. Les inventaires récents, comme la mission de la DATAR, sont
commandés pour suppléer à ce manque. C’est le même enjeu identi-
taire qui pousse à classer, à désigner, à mettre en patrimoine, bref à
26. À ce sujet, on peut consulter Urry (2002 : 57).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 186 11/12/08 15:04:52
chapitre 4 • apparition ou dissolution 187
« muséifier », comme le dit Henry-Pierre Jeudy (2001 : 165), les paysa-
ges, c’est-à-dire les sites et les territoires. Mais leur préservation est
aussi une « source de profit » et un « instrument de pouvoir » selon
Alain Corbin (2001 : 149). Les profits, on l’aura compris, sont générés
par le tourisme qui est une préoccupation constante eu égard à la
conservation ou à la remise en état des territoires. Le patrimoine
serait en effet de l’histoire transformée en produit de consommation
par des mythologies, des idéologies, des nationalismes, des fiertés
locales ou simplement par la mise en marché (Aitchison, MacLeod et
Shaw, 2000 : 96). Ce qui est tout particulièrement intéressant dans
cette dynamique de conservation, de mise en patrimoine, c’est qu’il
semble s’agir, tout comme pour la production de l’espace dans les
villes et concurremment dans le temps, d’un mouvement typique-
ment postindustriel qui procède des mêmes visées technocratiques.
Car si le désir de préservation n’est pas nouveau, la compulsion du
patrimoine est propre aux années 1980. Bien entendu, l’effondre-
ment des modes de production industriels amène beaucoup de
régions « à se donner en spectacle » (Lippard, 2000 : 6), à défaut
d’autres possibilités économiques. En outre, affirme Henry-Pierre
Jeudy, il y a, à partir des années 1980, une volonté « des politiques » de
gérer la « crise », en offrant aux collectivités l’opportunité de s’appro-
prier leur propre passé et leur identité (2001 : 29). Jeudy parle de la
crise économique du début de la décennie qui s’est soldée par ce que
l’on a nommé à la DATAR, un « territoire en crise » ou un « territoire
de la crise » (de Gaudemar, 1989 : 54) résultant de la désindustrialisa-
tion qui laisse derrière elle des terres dévastées. C’est donc par la
mobilisation des communautés aux fins de sauvegarde de leur « héri-
tage » que s’est construit « l’amour collectif du patrimoine » pour re-
prendre les termes de Jeudy (2001 : 29), un amour qui pousse à inven-
torier – souvent par la photographie –, à sélectionner et à « marquer »
ce qui est bon à être conservé. La conservation du passé et la nostal-
gie qui en découle deviennent alors tout à la fois un « opium » (Aitchi-
son, MacLeod et Shaw, 2000 : 97) et une industrie de remplacement.
Cette mobilisation autour de patrimoines particuliers, orchestrée par
l’État, a donné lieu à des initiatives régionales, par exemple le groupe
Mémoire de la Drome en France ou le Farewell, Promise Land Project
aux États-Unis, et nationales, entre autres, le Conservatoire de
l’Espace Littoral et des Rivages lacustres en France ou le Water in the
West Project aux États-Unis, qui s’appuient très souvent sur des inven-
taires et des séries photographiques produites au moins en partie par
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 187 11/12/08 15:04:52
188 Le paysage façonné
des artistes, pour soutenir leur action. En plus de faire appel à la re-
présentation photographique, la volonté généralisée de conserver les
traces du passé avec la « muséification » de l’espace qui s’ensuit, a
cette caractéristique bien particulière, décrite par Jeudy, de « faire
tableau » en fixant et en cadrant ce qui doit être vu :
Au rythme d’une patrimonialisation générale, l’esthétique n’est pas
un « plus », elle est une finalité essentielle puisqu’elle permet de voir
et de se représenter tout ce qui nous entoure, tout ce dans quoi on vit
comme la configuration d’un paysage. Présentant l’avantage indénia-
ble de donner la forme immédiate du « tableau » à tout acte de
perception, le paysage subsume les différentes conceptions du patri-
moine (Jeudy, 2001 : 123).
Ainsi on usera d’images réalisées pour les observatoires photo-
graphiques afin de fixer doublement certains territoires dans la durée.
Mais, malgré la volonté étatique d’impliquer les communautés loca-
les, cette double mise en paysage porte en elle, tout comme la pro-
duction de l’espace urbain, mais à un autre niveau, un risque
d’exclusion. Le paysage – la forme du tableau comme le suggère
Jeudy – supposant le regard d’un observateur extérieur se posant en
sujet pour lequel ce qui est perçu devient objet, le résidant ne pour-
rait en effet se sentir inclus dans ce tableau soigneusement composé,
ne bénéficiant pas de la distance nécessaire pour l’apprécier.
Les séries de rephotographies – ce qu’en France l’on appelle
des reconductions photographiques – produites par des artistes peu-
vent aussi contribuer à établir des comparaisons entre le passé et le
présent. Les images anciennes, photographies mais aussi cartes posta-
les et tableaux, mesurées à des reprises récentes des mêmes lieux
selon les mêmes cadrages servent « aux aménageurs […] à prévenir
les détériorations mais également à susciter des actions d’améliora-
tion » (Quesney, Ritelhueber et Stefulesco, 1994 : 32). Améliorations
qui parfois correspondent à un retour en arrière vers les paysages
intacts d’avant, à leur restauration. Il ne sera pas alors question d’inter
ventions artistiques de réhabilitation comme celles de Nancy Holt
(Sky Mound et Up and Under) par exemple, mais d’un retour à l’authen-
tique passé. On utilisera les séries photographiques pour déterminer
les éléments du paysage à améliorer, à retrancher ou à ajouter. Mais,
qui peut décider quelle image est la bonne, quel est le paysage typique
ou authentique de telle ou telle région? « Jusqu’à quel point un lieu-
image créé pour des spectateurs venus de l’extérieur correspond-il au
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 188 11/12/08 15:04:52
chapitre 4 • apparition ou dissolution 189
sens du lieu des gens de l’intérieur, si tant est qu’il y ait un consensus
parmi ceux-ci? » (Aitchison, MacLeod et Shaw, 2000 : 153).
À l’extrême de ces actions de restauration serait l’« écologie pro-
fonde » (deep ecology) qui demanderait de revenir à un état « premier »
du territoire, un état préphotographique et même préreprésentation,
l’écologie prenant ainsi le rôle de « garde-nature et donc de garde-
paysage », comme le signale Anne Cauquelin (2000 : 427). Ce retour
en arrière autoriserait éventuellement à éliminer une partie… de
l’humanité, pour laisser toute la place à la nature sauvage qui devien-
drait alors sujet de droit et à part entière28.
Une autre forme de restauration moins extrême, mais tout de
même très curieuse est la reconstitution. C’est une opération qui
s’effectue généralement à partir d’images anciennes, de photogra-
phies ou de tableaux. Alain Corbin fait état d’un « projet ministériel
de conservation de paysages célébrés par des peintres dont la noto-
riété est devenue mondiale ; donc de protection de lieux touristiques à
venir 29 ». Le cas évoqué par Corbin est celui de la vallée de la Loue
dans le Jura à laquelle l’on veut redonner l’apparence qu’elle avait
lorsque Gustave Courbet l’a peinte en 1866. Des ingénieurs ont appa-
remment travaillé à cette reconstitution qui nécessitait la coupe
d’arbres et le rétablissement de certaines cultures… « sans compter
les usines » (Corbin, 2001 : 173). John Urry donne l’exemple de ces
terrasses de roc s’élevant au-dessus du lac Rotomahana en Nouvelle-
Zélande qui, au XIXe siècle, formaient une attraction touristique très
prisée. Ces terrasses ayant été détruites par une éruption volcanique
en 1886, elles sont tout de même restées célèbres grâce aux vues enre-
gistrées de l’époque. Au XXe siècle, l’attraction est finalement recons-
truite, mais pas exactement au même endroit. Selon Urry, cet ensem-
ble de terrasses « thématisées » devrait être d’apparence plus
authentique que l’original, qui est connu seulement par des photo-
graphies (Urry, 2002 : 131), images centenaires qui ont bien entendu
guidé la reconstitution. Voilà certes un beau cas de ce que MacCannell
nomme « staged authenticity » : des attractions dont le visiteur se figure
qu’elles sont authentiques ont été complètement fabriquées à son
intention (1999 : 91). Un phénomène similaire est observable au
Québec où une partie du paysage urbain de la ville de Québec, la
place Royale, a été refaçonnée selon un plan conçu dans les années
27. L’auteure souligne.
28. Sur cette notion de la deep ecology on peut consulter Ferry (1992 : 107-138).
29. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 189 11/12/08 15:04:52
190 Le paysage façonné
1970. On voulait alors reconstruire une certaine vérité historique – et
pour ce faire on a démoli un grand nombre de bâtiments : « ses
auteurs [du plan] se pensaient capables de démontrer par une archi-
tecture de réinvention combien harmonieuse eut été l’histoire pré-
servée d’elle-même » (Le Couedic, 1999 : 73). Représentations par
faites d’un passé qui n’a jamais vraiment existé, certains lieux peuvent
ainsi se présenter comme d’intéressantes expériences thématiques,
ou comme des tableaux dans ou devant lesquels les touristes se sentent
à l’aise, mais qui sont difficilement vivables au jour le jour.
Une autre manière de thématiser les lieux est leur remise en
fonction, qui s’effectue habituellement par un changement de voca-
tion. Ce type d’intervention est le plus souvent associé aux sites indus-
triels désaffectés. L’étude de la suite photographique Park City de
Lewis Baltz permet de voir comment une ville auparavant affectée à
une activité unique, minière dans ce cas, peut être transformée en
une destination dont l’économie repose sur la seule fonction récréo-
touristique. Park City reste une ville corporative, seule l’activité chan-
ge, en un glissement de l’industriel au récréatif symptomatique de
l’âge postindustriel. Un pareil changement de vocation a lieu lorsque
le site de la mine de silice de l’Ottawa Silica Corporation devient un
parc provincial en même temps qu’une attraction inusitée, Michael
Heizer le remodelant en un earthwork monumental. Mais dans ce cas,
comme dans la plupart des œuvres de land reclamation étudiées, le
terrain est radicalement modifié par l’action de l’artiste. Il en va de
même de Park City où aucune trace des activités d’extraction ne sub-
siste ; seules les photographies de Baltz en portent témoignage.
L’engouement pour le patrimoine, sensible dès le début des
années 1980, s’exprime aussi par un intérêt pour les friches indus-
trielles. Certaines sont converties à de nouveaux usages, résidences,
ateliers d’artistes ou centres de production et de diffusion des arts,
d’autres sont mises en exposition comme des témoignages d’une
époque révolue ou d’une certaine vie ouvrière. Cette patrimonialisa-
tion de l’industrie vise, d’après Henry-Pierre Jeudy, à rendre esthé
tiques les relations entre l’humain et la machine, ainsi que le travail
d’usine (Jeudy, 2001 : 28-29) qu’autrement l’on pourrait considérer
rétrospectivement comme astreignant, dangereux, spoliateur. « Une
certaine forme de commémoration », affirme Pierre Sansot, « a le
don de blanchir le passé et de lui ôter toute altérité inquiétante »
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 190 11/12/08 15:04:53
chapitre 4 • apparition ou dissolution 191
(Sansot, 1990 : 26930). Ainsi se résolvent les conflits de travail, l’exploi-
tation du territoire et des ouvriers ; les ruines sont nettoyées et remi-
ses en état, l’usine est « muséifiée », son activité passée est reconsti-
tuée et exhibée. À Lowell Massachusetts où, comme la famille de Jack
Kerouac, beaucoup de Canadiens français se sont exilés pour tra-
vailler dans les factries, existe un parc national consacré à l’industrie,
le premier du genre. Après la fermeture des usines, à la recherche
d’une nouvelle vocation pour la ville exsangue, un groupe de citoyens
propose un partenariat privé-public dans le cadre duquel le Congrès
constituerait les lieux en « une nouvelle sorte de parc national, basé
sur le travail et l’histoire industrielle », ce qui est fait en 1978. C’est
pour ainsi dire toute la municipalité de Lowell qui est ainsi muséifiée.
Le parc comprend des moulins de textile, des maisons d’ouvriers et
5,6 milles de canaux et des bâtiments commerciaux datant du
XIXe siècle31. Ces lieux touristiques où l’activité industrielle est mise
en scène sont des attractions relativement populaires, la mise en ex-
position du travail étant selon MacCannell, une autre « production
culturelle » rassembleuse (1999 : 36). Le labeur des uns est transfor-
mé en spectacle pour les autres. John Urry observe finement, par
ailleurs, que l’implantation de « musées de l’industrie » dans de vieilles
usines a une parfaite valeur métonymique eu égard au développe-
ment de la société postindustrielle (2002 : 117).
Précisons que l’intérêt des friches industrielles préservées dont
il est ici question se situe dans leurs bâtiments et non sur le terrain.
Car si l’on remet les équipements en fonction, l’on a tôt fait, dès
après le passage des photographes de la marge, de camoufler les rava-
ges causés aux paysages environnants. Ces friches conservées ont
toutefois le même rôle que les paysages thématisés : elles sont porteu-
ses d’une certaine fierté identitaire et elles attirent les touristes.
Le paysage postindustriel, ou plutôt le paysage de l’ère post
industrielle, est celui que l’on édifie sur les ruines de l’âge industriel,
parfois en mettant celles-ci en valeur pour les intégrer à une écono-
mie tertiaire, mais le plus souvent en les faisant disparaître. Ce pay-
sage est vraisemblablement la plus artificielle des constructions possi-
bles, obtenue en mettant en scène ou en reconstituant des singularités
et des distinctions identitaires régionales pour le plus grand profit du
voyageur mondialisé, collectionneur de destinations dont il souhaite
bien entendu qu’elles soient tout à fait authentiques. Il y a là une
30. « Some return to their hometowns to find the mines and factories they escaped now glori-
fied as museums » (Lippard, 2000 : 23).
31. www.nps.gov/lowe/index.htm
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 191 11/12/08 15:04:53
192 Le paysage façonné
v olonté de contrôle du territoire, alors qu’un « ensemble de règles à
ne pas transgresser ou d’usages à suivre » (Chabason, 1995 : 269) peu-
vent permettre aux professionnels de créer (par désignation et mise
en patrimoine, restauration ou nouveaux aménagements) des paysa-
ges conformes aux identités régionales (ou à l’idée que l’on s’en fait)
et aux attentes des visiteurs.
The nation may, perhaps, be in the process of re-imaging itself as the
site of one vast open-air museum, its economy dependent on the
manufacture of heritage (Aitchison, MacLeod et Shaw, 2000 : 13732).
Alors que John Urry observe que pratiquement tous les endroits du
globe ont été ou sont en voie d’être transformés en spectacles payants,
consommables et collectionnables (2002 : 149), Denis Cosgrove note que
les paysages « préservés » sont un produit de consommation nationa-
lisé à l’usage des étrangers auxquels ils sont vendus par l’industrie du
voyage (1998 : 269).
Les paysages ainsi (re)façonnés sont des productions culturelles
souvent mises en œuvre par l’État sous forme de campagnes publici-
taires vantant des particularités régionales et nationales, des lieux his-
toriques et autres paysages dignes d’intérêt qui seront ensuite exploi-
tés par une succession d’entrepreneurs et de commerçants. Car les
profits des productions culturelles ne sont pas générés par le proces-
sus de production lui-même mais par les entreprises qui gravitent
autour. Pays développés et moins développés thématisent leur propre
espace et « les figures de l’altérité se gèrent comme des produits de marque »33
(Jeudy, 2001 : 60). Et il est permis de croire que ces opérations seront
bientôt gérées sur une base internationale, l’UNESCO ayant intégré
en 1992 les « paysages culturels » à sa liste de possibles sites du Patri-
moine mondial :
La notion de paysage fait donc, sur le plan international, une entrée en
scène dont le caractère relativement récent ne doit pas faire sous-
estimer l’importance : elle reçoit en effet à la fois une sorte de défini-
tion universelle et une consécration symbolique concentrée sur une
série de lieux prestigieux qui impressionnent fortement un large
public (Thibault, 1999 : 194).
La « société à paysagement » deviendra alors un fait universel, la
surveillance, la défense et l’administration du paysage, tout aussi bien
que son esthétisation, pourront être globalisées.
32. Je souligne.
33. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 192 11/12/08 15:04:53
chapitre 4 • apparition ou dissolution 193
LE SPECTACLE
Remontons brièvement la chaîne déployée dans le présent cha-
pitre, en continuité avec le précédent, et par laquelle j’ai tenté de
« rétablir au cas par cas non pas seulement l’infinie complexité et
l’unicité ultime de chaque fait, mais aussi la façon dont certains se
dégagent peu à peu, se stabilisent, se généralisent34 ».
Au début des années 1970, à un moment où les préoccupations
environnementales se font pressantes, Robert Smithson opère sa fa-
meuse traduction que bien des critiques reprennent et transposent,
ou traduisent à nouveau en fonction « sociale », c’est-à-dire écologique
ou publique, pour un art pourtant caractérisé par sa monumentalité,
les altérations causées aux territoires qu’il s’annexe et par sa réalisa-
tion en des lieux hors des circuits conventionnels de présentation.
Les quelques projets de land reclamation exécutés par des land artists et
largement relayés par les médias35, en corrélation avec les possibilités
accrues de financement public pour l’art en milieu urbain, ensemble
autorisent cette réorientation de l’art dans le paysage vers une voca-
tion (sub)urbaine et récréative à saveur environnementale qui sem-
ble en être un aboutissement logique. J’ai ainsi décrit la tentative de
Lucy Lippard de faire voir le land art, converti en parcs et jardins,
comme une forme d’art engagé. Par ailleurs, John Beardsley s’ap-
puyant manifestement sur les écrits de Smithson, Lippard, Linker et
Foote, élabore quant à lui un récit dans lequel le land art « évolue » en
un art public « socialement utile », c’est-à-dire à fonction récréative. À
mesure que cette forme d’art public (art-as-public-spaces) s’installe, le
land art, l’original, celui des déserts, isolé et monumental, se fixe dans
l’histoire de l’art comme un moment – ou un mouvement – artistique
circonscrit dans le temps et fermé, bref révolu.
Il serait donc juste de dire que le land art disparaît, qu’apparaît
une autre forme qui en est en partie dérivée et que c’est une série de
médiations et de traductions, c’est-à-dire une redistribution des inté-
rêts et des buts, souvent opérées par des critiques et commissaires – et
aussi jusqu’à un certain point par les artistes, ne serait-ce que parce
qu’ils « reviennent » à la ville – qui transforme en suite naturelle des
34. « …quitte à recourir pour cela à la fois à des volontés construites et à des circonstances
aléatoires, à des projets explicites et à des effets pervers, à des propriétés recherchées et à
des caractères apparus » (Hennion, 1993a : 200).
35. « Even in the United States the “publicness” of public images goes well beyond their
specific sites or sponsorship: “publicity” has, in a very real sense, made all art into public
art » (Mitchell, 1990 : 30).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 193 11/12/08 15:04:53
194 Le paysage façonné
choses ce déplacement du land art vers une forme de paysagisme
urbain. À cet égard, l’on peut supposer que le travail effectué par
Holt avec Dark Star Park constitue une médiation d’importance, dans
un modèle de la « particularité généralisée » (Hennion, 1993a : 217) :
Beardsley ira jusqu’à le poser comme l’un des paradigmes possibles
de l’art public36.
Par ce déplacement, qui devient la version généralement accep-
tée, le land art, un art réputé isolé et inaccessible peut être directement
donné à voir, sans la médiation du supplément documentaire, pour-
tant déterminante pour ce type d’art. Néanmoins, si l’on en croit les
auteurs dont les écrits ont été étudiés, le land art (si c’en est encore)
est physiquement ramené de la périphérie vers le centre, où il contribue
à combler le besoin de paysage des populations urbaines et sub
urbaines.
Public sculpture incorporating landscape elements addresses a tradi-
tional and widespread longing for pastoral relief in the urban environ-
ment, accessible to more than an art audience (Senie, 1992 : 16).
Le paysage n’est-il pas en effet ce « produit citadin » (Corboz,
2001 : 224) qui répondit d’abord au désir des élites de s’éloigner pour
contempler le pittoresque et le sublime, et plus tard aux besoins de
nature créés par l’industrialisation? Il suffirait donc, puisque certains
artistes en ont développé la capacité, de transplanter le paysage à la
ville… pour consommation rapide et directement sur place37. Dès le
début des années 1980, supposant la mort du paysage tel que
l’Occident le connaissait jusqu’alors, et c’est bien cette mort ou cette
crise du paysage qui motive la grande mission photographique de la
DATAR, l’on en appelle en effet à des « procédures d’aménagement
et de préservation » des « paysages néo-urbains et périurbains », de
sorte que la campagne soit ramenée à la ville (Dagonnet, Guéry et
Marcel, 1995 : 139).
Facteur de cohésion et d’homogénéisation dans le paysage
urbain dans certains cas, destination possible d’un tourisme de proxi-
mité dans d’autres, le land art ainsi transformé est incorporé au spec-
tacle sous forme de services, qui sont les marchandises au fondement
d’une économie postindustrielle. L’art et les artistes deviennent des
ressources et des agents employés à des fins de « contrôle spectacu-
laire dans l’actuel territoire aménagé » (Debord, 2001 : 170-171) qui
36. Texte de John Beardsley dans le feuillet de présentation de Dark Star Park, 1984, n. p.
37. « L’histoire économique, qui s’est tout entière développée autour de l’opposition ville-
campagne, est parvenue à un stade de succès qui annule à la fois les deux termes »
(Debord, 2001 : 169).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 194 11/12/08 15:04:54
chapitre 4 • apparition ou dissolution 195
est le fait de partenariats public-privé. Dans les années 1960, « le capi-
talisme bureaucratique et planificateur a déjà construit son décor38 » ;
l’art public y ajoute, au cours de la décennie suivante, de nouvelles
formes.
Ainsi, ce ne sont pas que les documents des œuvres du land art qui
auront repris leur place dans le système marchand, mais aussi les
façons de faire des artistes.
Le land art lui-même – ou plutôt ses documents – continuera
cependant d’exercer une grande fascination, comme une destination
lointaine dont on rêve encore. Car les grandes œuvres du désert agis-
sent sur le mode des sites/non-sites de Smithson, ou sur celui du tou-
risme, comme des destinations vers lesquelles l’on est invité à se ren-
dre par des reproductions mécaniques ou des vues (recorded sights).
Que l’on s’y rende ou non ne change rien à l’affaire : la destination
peut être rêvée et le voyageur bien à l’aise dans son fauteuil.
Pendant ce temps, la photographie d’art qui, elle, n’offre pas
vraiment de destination possible, est mise au service d’opérations de
planification et d’aménagement à de vastes échelles, on en use comme
d’un embrayeur du façonnement de nouveaux paysages vers lesquels
on se rendra volontiers puisqu’ils sont fabriqués à cet effet. À cet
égard et toujours selon un modèle de la particularité généralisée, la
mission de la DATAR est une importante médiation, par laquelle on
en arrive au paradoxe productif qui permet d’user de la photographie
artistique. De cette façon, il y a un bref moment d’apparition du paysage
postindustriel au sens strict, paysage qui ne sera que photographique
puisque l’on ne pourra se rendre en reconnaissance vers les lieux
montrés. Tout ce qui serait typiquement postindustriel, des territoires
miniers dévastés aux terrains vagues laissés pour compte par l’exode
des industries et par les déplacements des individus, tout ce qui est
généré par une économie de la mobilité, tout cela est refaçonné.
Seules quelques photographies resteront, qui témoigneront d’un état
transitoire des lieux, d’avant la réhabilitation. Images mélancoliques
qui iront rejoindre aux archives des documents photographiques
d’un autre temps, eux aussi conservés comme des traces de ce qui
n’existe plus, suscitant de même la nostalgie.
38. « Critique de l’urbanisme », Internationale situationiste, no 6, août 1961, p. 9. « Dans le spec-
tacle, image de l’économie régnante, le but n’est rien, le développement est tout », dit
aussi Debord (2001 : 21).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 195 11/12/08 15:04:54
196 Le paysage façonné
Les deux opérations, retour physique de l’art dans le paysage de
la périphérie vers le centre et mise au travail de la photographie artis-
tique favorisent le même but, l’organisation de l’espace en un village
global, divisé en centres (métropoles) et en périphéries. Un village
global qui ne serait pas que virtuellement accompli : l’on circule désormais
énormément d’un endroit à l’autre.
La construction des réseaux autoroutiers, celle des nouvelles infras-
tructures ferroviaires et aériennes, l’équipement systématique des
côtes les plus favorables au tourisme estival et celui des régions monta-
gneuses impropres à l’agriculture et au logement pour accueillir celui
de l’hiver, telles sont les traces les plus visibles d’une activité essentiel-
lement citadine, dont le but consiste à mettre les continents à la disposition de
l’homme des villes (Corboz, 2001 : 21239).
Il est vrai que la majorité des touristes proviennent des zones
urbaines ; ainsi pour ceux qui partent du centre, le reste du monde
n’est plus que « pleasure periphery » (Urry, 2002 : 86). Par la production
de l’espace dans les métropoles ainsi que par l’appropriation des ter-
ritoires périphériques (à la fois conquête et adaptation) grâce à des
opérations de mise en valeur, de mise en patrimoine, de sauvegarde
de la culture à des fins touristiques, se perpétue semble-t-il, l’âge du
« world picture » (ou du « world as a picture »), ce rapport au monde par
lequel le sujet, parfois individuel, parfois collectif, produit tout à la
fois la représentation et la mesure et les règles qui lui permettent de
« tout calculer, planifier et façonner » (Heidegger, 1977 : 135). De
plus, une sorte de compression de l’espace tend à annihiler doublement
la distance, la transmission rapide des images s’ajoutant à la circula-
tion des personnes, pour ramener le lointain à proximité :
The amount of “traffic” along all these [the infrastructures of the
global travel industry] has magnified over this last decade and there is
no evidence that virtual and imaginative travel is replacing corporeal
travel, but there are complex intersections between these different
modes of travel that are increasingly de-differentiated from one
another (Urry, 2002 : 14140).
L’aisance à voyager vers des lieux autrefois perçus comme fort
lointains crée une nouvelle demande pour les images de l’altérité,
tandis qu’on peut les consulter par toutes sortes de moyens. On peut
donc encore (aller) observer l’autre (à partir) d’un point de vue uni-
que et détaché. D’autant que le tourisme, plus qu’une activité de loi-
39. Je souligne.
40. Voir également Heidegger (1977 : 135).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 196 11/12/08 15:04:54
chapitre 4 • apparition ou dissolution 197
sir, devient un « mode de vie », « à tout le moins pour le tiers prospère
du nouvel ordre mondial » (Urry, 2002 : 160).
À partir des réflexions qui précèdent, se dégagent deux axes
principaux le long desquels les phénomènes ici étudiés s’accordent
entre eux.
Le paysage, conçu comme représentation et déplacement en re-
connaissance, influe sur, ou encore est enrôlé par, les land artists qui,
en usant des attributs du voyageur, composent un art qui semble être
une impeccable réplique (sur le mode des sites/non-sites) à ce mou-
vement d’allers et retours entre l’image et sa chose propre au paysage.
C’est vraisemblablement ce qui a pu faire croire que le land art, art-
paysage par excellence, pouvait remplacer la peinture de paysage
(Garaud, 1994). Le mode touristique propre aux sociétés occidentales
postindustrielles permet aux land artists, pour élaborer leurs œuvres,
d’intégrer et de reproduire les positions (les postures) et les compor-
tements du touriste, même si ce n’est pas de façon ouvertement
avouée ou tout à fait consciente. Ce mode particulier autorise égale-
ment une saisie critique des œuvres qui est basée sur des vues enregis-
trées dont on ne met pas en doute la véracité. L’on peut ainsi considé-
rer les sites dépeints comme sont appréciées certaines destinations
connues et re-connues, bref comme des paysages offerts à la décou-
verte. La photographie fait alors office d’embrayeur d’une mise en
mouvement vers l’objet à reconnaître, puisqu’elle a pris le relais de la
peinture pour reconduire la représentation paysagère traditionnelle
– point de vue, cadre et liaison –, sans cependant qu’on ne lui consen-
te aucun caractère artistique. Car « il saute aux yeux que la tâche de
l’artiste ne consiste pas à redoubler un panorama ou le site qui s’offre
à son regard » (Dagonnet, Guéry et Marcel, 1995 : 135).
Le land art, autant sous sa forme première d’intervention mo-
numentale et isolée que sous sa forme « évoluée » d’art public urbain
et périurbain est l’un des facteurs concomitants qui ouvrent la voie à
la phase intermédiaire qui s’immisce entre représentation et déplace-
ment en re-connaissance, le refaçonnement ou l’esthétisation du terri-
toire à grande échelle, au centre comme en périphérie. L’on envisa-
gera ainsi progressivement la possibilité de gérer ou d’administrer
globalement le « capital paysager ». Et s’agissant de capital, il faut voir
à (le) rentabiliser.
The recent period has seen a global public stage emerging upon which
almost all nations have to appear, to compete, to mobilize themselves
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 197 11/12/08 15:04:54
198 Le paysage façonné
as spectacle and to attract large numbers of visitors (Urry,
2002 : 158).
Le paysage ainsi refaçonné se présente comme un cortège de
destinations attrayantes, authentiques (le patrimonial), typiques
(l’identitaire). La photographie, ici artistique, est recrutée tout
comme le land art par le champ paysage, à des fins gestionnaires :
identification des secteurs à conserver, recension des zones à restau-
rer, évaluation et comparaison de leurs aspects passés et présents. Se
forment ainsi des plans d’aménagement dont la photographie est
l’un des instruments ; ces desseins visent bien entendu l’amélioration
du cadre ou de la qualité de vie des populations locales, mais il s’agit
aussi de composer les paysages du loisir et du tourisme. Aucune na-
tion, en effet, ne veut voir lui échapper cette manne qui constitue en
général, dans les pays développés, la solution à la fuite des industries
lourdes ; de même le tourisme est l’industrie que les régions en déve-
loppement ou en difficulté économique veulent voir s’implanter en
priorité.
Le tourisme, on le sait, est omniprésent dans le monde et aussi
dans la relation au monde des Occidentaux, à la fin du XXe siècle.
Peut-être faudrait-il dès lors, et aussi parce que spectacle et tourisme
tendent à s’amalgamer, se demander si ce dernier ne serait pas un
autre paradigme dont je suggère qu’il prendrait la relève, tout en
l’absorbant, du « paradigme perspectif », alors que le monde est peu à
peu transformé en un parc à thème global dans lequel les régions
mettent en scène leur histoire, leur identité, leurs attraits au profit de
populations en déplacement, afin de s’offrir au regard du touriste. Un
regard qui tendrait à devenir une forme d’appréhension du monde
largement partagée.
Some sources suggest that tourism will soon be the largest global
source of employment ; others say it already is. Add that to the sub
category of armchair tourism via print and electronic media, and we’re
on our way to becoming a society of visitors and voyeurs on one hand,
and commodified actors or targets of strangers’ fantasies on the other
(Lippard, 2000 : 4).
On ne saurait trop insister sur le rôle de la photographie comme
véhicule paysager dans la construction de ce possible paradigme touris-
tique. Car, faut-il le rappeler, le tourisme et la photographie s’inven-
tent à peu près au même moment, à une époque d’innovations tech-
niques. Et si, dans une société postindustrielle, les modes de
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 198 11/12/08 15:04:55
chapitre 4 • apparition ou dissolution 199
transmission des images se perfectionnent et se complexifient, il n’en
reste pas moins que celles-ci demeurent intelligibles selon les mêmes
critères, point de vue, distance, cadre et liaison, et qu’elles servent les
mêmes fins. Le sujet, en déplacement, reste souverain.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 199 11/12/08 15:04:55
Page laissée blanche intentionnellement
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 200 11/12/08 15:04:55
CONCLUSION
Today, according to Rosalyn Deutsche, space as a reflection of power relations
(produced by social relations) “is on the political agenda as it never had been before”.
This is true for artists who have been “framing” landfills, shopping malls, parks and
other contexts for many years now. Yet the overall tone is not exuberant. I’ve been
struck by three recent naming phenomena: First, the postmodernist impulse (now at
least a decade old and supremely retroactive in its own right) has spawned a plethora
of exhibitions, articles and books called re-viewing, re-visioning, re-mapping,
re-thinking, re-photographing. Second, the titles of exhibitions about land and
nature are becoming melancholic and even apocalyptic: for instance, Against
Nature, The Demoralized Landscape, The Unmaking of Nature, Lost Illusions, and
Utopia, Post-Utopia. Third, the terms “territory”, “land”, “earth”, “terrain”, and
“mapping” are also ubiquitous in both theory and practice
Lippard, Looking Around: Where We Are, Where We Could Be
Grâce à l’élaboration par les peintres de cette convention que
l’on appelle perspective légitime, une invention qui aura une vaste
portée, au XVe siècle s’ouvre l’ère du paysage, ou l’ère de la « société
à paysage » (Berque, 1989 : 48). Ce moment singulier est celui de la
formation de la relation à l’espace qui sera celle du sujet occidental
moderne, cet homme typographique pour qui le monde se présente
comme un tout unifié, saisi dans la distance, à partir d’un point de
vue fixe.
Au XIXe siècle la photographie, reconduisant ses modalités de
construction de l’espace, ajoute au modèle (ou au paradigme) pers-
pectif la possibilité de transformer le monde en vues reproductibles.
Encore plus que la peinture qui eut en son temps cette « fonction
publicitaire » (Cauquelin, 2000 : 83), les vues enregistrées suscitent
maintes excursions vers les lieux représentés. Et dès avant la fin du
siècle, la photographie et les déplacements de masse sont en voie de
devenir universellement pratiqués. Par l’usage conjugué et de plus
en plus répandu d’innovations techniques comme la photographie et
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 201 11/12/08 15:04:55
202 Le paysage façonné
les moyens de transport rapides, par lesquels l’on peut reproduire et
diffuser largement des motifs de toutes sortes et se déplacer plus vite
sur de plus grandes distances, le milieu du XIXe siècle est « l’un de ces
moments remarquables où le monde semble se redéfinir alors que de
nouveaux modèles de relations s’établissent irrémédiablement »
(Urry, 2002 : 148). Commence alors à s’installer, absorbant le para-
digme perspectif, le tourisme comme formule d’interprétation du
monde, qui deviendra au XXe siècle (en actes ou comme pratique du
armchair travel grâce aux médias analogiques puis électroniques) une
sorte de mode de vie.
Il n’est donc pas étonnant que ce mode touristique qui progres-
sivement s’installe dans les sociétés occidentales s’infiltre également
dans les pratiques des artistes de la fin du XXe siècle, particulière-
ment chez les land artists états-uniens qui sortent alors des lieux tradi-
tionnellement dévolus à l’art, en quête de territoires nouveaux, pro-
duisant du supplément documentaire en relation avec leurs travaux
et proposant ainsi une lecture en forme d’allers et retours pour des
œuvres qui s’appréhendent comme des paysages, des destinations
lointaines. Les artistes photographes quant à eux, ne pouvant se
contenter de faire ce que tous les amateurs font, c’est-à-dire enregis-
trer les vues qui s’offrent à tous parce qu’elles sont déjà mises en réserve1,
deviennent « les ultimes touristes de la tragédie » (Lippard, 2000 : 130),
photographiant les paysages en déréliction, en dissolution.
En examinant quelles médiations, quels déplacements lient
entre eux des éléments qui pouvaient sembler de prime abord étran-
gers les uns aux autres, j’ai voulu montrer que l’art a encore, à la fin
du XXe siècle, dans une société postindustrielle, une incidence
lorsqu’il s’agit de paysage. À moins qu’ils ne se spécialisent dans la
commande publique, ce sont moins les artistes que leurs œuvres, des
photographies artistiques et des documents d’œuvres de land art qui
sont aussi généralement des photographies, qui sont comme indirec-
tement, c’est-à-dire à travers diverses médiations, intégrés au domaine
paysage. C’est donc au sein d’un autre champ que celui de l’art que
ces associations sont possibles, un champ dans lequel c’est le façonne-
ment du territoire, du « capital paysager », qui est de première impor-
tance. Et à la clé de ces relations, il y a cette boîte noire fermée qu’est
le tourisme, devenu comme une réplique du paysage que l’on a ici
décrit comme représentation (le paradigme perspectif assimilé)
1. « The view, or the scenic overlook, is a ready made photograph waiting to be snapped »
(Lippard, 2000 : 139).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 202 11/12/08 15:04:55
conclusion 203
e ntraînant des déplacements en reconnaissance. Le mode touristi-
que semble maintenant traverser tout ce qui se rapporte au paysage.
De toutes les entreprises de fabrication de l’espace, de refaçon-
nement du paysage auxquelles participent ou pour lesquelles sont
sollicités le land art et la photographie, en rapport avec le métissage
disciplinaire postmoderne (postindustriel?) qui rend ces opérations
possibles, certains ont voulu voir émerger une opportunité de sur-
monter l’ambiguïté duelle intrinsèque au paysage et d’ainsi abolir la
distance entre sujet et objet propre à la spécialisation visuelle de la
règle perspective. Une déspécialisation qui ne serait pas très éloignée
du « sensorium unifié » du « champ unitaire global » propre à la « nou-
velle culture électromagnétique » que Marshall McLuhan croyait voir
apparaître dès la fin des années 1960 (1992 : 473 et 65).
Peut-être alors le véritable paysage postindustriel serait-il celui
de la mobilité électronique, cette mobilité qui, McLuhan l’avait supposé,
pourrait prendre le relais de l’automobile comme principe de confi-
guration du territoire. Et, disait-il, les nouvelles technologies (l’auto-
mobile en a été une en son temps) changent le cadre tout autant que
l’image qu’il contient (1992 : 337). C’est en effet tout le territoire
occidental qui a été (re)modelé par l’automobile ; mais son règne,
non plus que celui de la mobilité physique (même à plus grande
vélocité), n’est manifestement pas terminé.
Il est vrai, en revanche, que les métaphores paysagères et carto-
graphiques sont désormais omniprésentes, usuelles, dans ce que l’on
appelle le monde virtuel : « Ne présenteraient-ils [les lieux et les espa-
ces virtuels] pas de valables concordances avec ce que nous appelons
paysages « réels » et cartes valides du territoire? » (Cauquelin,
2002 : 93). Car il s’agit encore, sur la toile comme ailleurs, de (simu-
lation de) déplacements, de mouvements d’un point à l’autre, d’un
point de vue à un autre. Une forme possiblement nouvelle de noma-
disme, qui reprend pourtant des figures et des termes familiers, asso-
ciés à des manières anciennes :
Despite the adoption of architectural terminology in the description
of many new electronic spaces (websites, information environments,
programming infrastructures, construction of home pages, virtual spa-
ces, etc.), the spatial experience on the computer is structured more
as a sequence of movements and passages than as the habitation or
durational occupation of a particular “site”. Hypertext is a prime exam-
ple. The (information) superhighway is a more apt analogy, for the
spatial experience of the highway is one of transit between locations
(despite one’s immobile body behind the wheel) (Kwon, 2002 : 173).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 203 11/12/08 15:04:55
204 Le paysage façonné
Plus qu’architecturale, la terminologie serait paysagère : sites,
environnements, espaces, et même structures et construction, puisque le
paysage est aussi une fabrication (de plus en plus) artificielle.
L’errance, l’expérience du transit compléterait l’analogie.
Par ailleurs, les images qui appellent au déplacement se rencon-
trent et se consultent de plus en plus dans les médias électroniques,
entre la télévision et les images virtuelles de l’ordinateur qui ne sont
très souvent que des photographies numériques (numérisées) élec-
troniquement transmises. Des images qui reproduisent les mêmes
motifs, les mêmes destinations que celles qui sont illustrées dans les
dépliants des voyagistes… Seraient-ce alors les images de ces destina-
tions touristiques, reproduites à l’infini par nombre de médias en tous
genres et circulant sur un mode quasi instantané, qui constitueraient
le paysage postindustriel?
Le paysage a toujours été associé avec les conquêtes, grandes et
petites, à l’appropriation du territoire par les empires comme par les
touristes – parfois des artistes nomades. Capitalisme (ou spectacle),
impérialisme culturel et économique oblige, le monde est toujours
scindé en centres et en périphéries. Et la (con)quête des paysages, le
tourisme, produit encore des déplacements selon cet axe. Peut-être
en est-il de même dans la culture électromagnétique et dans le monde
virtuel?
Electronics, by making information accessible and exchangeable, and
by making the products of information repeatable and cheap, forces
the break of national boundaries. One nation is connected to another,
one nation goes through another. But older structures, economic and
military, retain their power in the organization of electronics. One
nation is connected to another either as dominant or submissive, one
nation goes through another as invader or as parasite (Acconci,
1990: 172).
Pour Lewis Baltz, qui peu à peu délaisse le paysage de la marge
pour, avec la mission TransManche, entreprendre une série sur la
haute technologie (The Power Trilogy), le paysage postindustriel est
précisément celui de la technologie, un paysage de la sécurité, de la
surveillance où tout est sondé, inspecté et annexé, l’extérieur comme
l’intérieur, jusques et y compris le corps humain, « comme si le corps
lui-même était devenu un paysage sous observation » (Rian,
2001 : 102). L’indifférenciation de l’intérieur et de l’extérieur parti-
cipe de la dissolution postmoderne de la figure du sujet et semble
appartenir au modèle informationnel qui émerge à partir du milieu
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 204 11/12/08 15:04:56
conclusion 205
du XXe siècle, un modèle par lequel « une nouvelle individualité est
axée sur l’adaptabilité et sur une étroite dépendance des individus à
l’égard des réseaux médiatiques et commerciaux » (Lafontaine, 2004 : 172).
Le sujet moderne ferait alors place à un individu qui ne serait plus
qu’une médiation, un point de passage dans un flux de relations com-
municationnelles, son identité devenue fluctuante et multiple
(Lafontaine, 2004 : 107).
5.1 LEWIS BALTZ, RONDE DE NUIT, 1992.
DE LA SÉRIE THE POWER TRILOGY
Les originaux sont des cibachromes (épreuves couleurs).
Reproduit avec l’aimable autorisation de Lewis Baltz. Coll.
Centre Régional de la Photographie, Nord-Pas-de-Calais.
Le paysage postindustriel serait-il donc celui de la fluidité com-
municationnelle et identitaire? L’ère postindustrielle est, sans aucun
doute, une ère de multiplicité et d’hétérogénéité. Et à mon avis le
tourisme, comme position et disposition partagées, est exemplaire de
cette mixité, tout autant et peut-être plus que l’information et ses
systèmes. Par le tourisme en effet s’associent et se mélangent, se ras-
semblent et s’assemblent, des modes de communication d’apparition
récente, le virtuel et le cyberespace, et d’autres plus anciens tels les
moyens de transports terrestres et aériens, tout comme se lient et se
2. Je souligne.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 205 11/12/08 15:04:57
206 Le paysage façonné
mêlent la culture et le commerce, l’élitiste et le populaire, le loisir et
des matières plus sérieuses telles l’histoire et la géographie.
C’est ainsi qu’en mode touristique le monde est reformulé en
un espace de circulation où tout est à voir ou à visiter. Pour attirer
l’humanité en mouvement on refaçonne des identités régionales et
nationales, on les offre au regard. Représentation et déplacements
sans cesse se répondent, les lieux à voir et leurs images s’additionnant
et se confondant à l’infini. Le voyageur dans son fauteuil, par l’inter
activité du virtuel, croit se mouvoir réellement, véritablement visiter
des lieux cependant que les « non-lieux », qui sont des endroits de
passage et d’attente, mais aussi des haut lieux de la surveillance élec-
tronique, se multiplient. Ces « non-lieux », gares, aéroports, salles
d’attentes en tous genres, routes et échangeurs mais aussi cabines
d’avions, habitacles d’automobiles, etc. (Augé, 1992 : 100 et suivan-
tes) existent en fonction du transit effectué. Ce sont ceux où l’on attend
et espère le départ, puis ceux où l’on absorbe la distance, avant l’arri-
vée à destination. Les destinations, quant à elles, sont ces territoires en
condition photographique dont les images, toujours connues, en-
combrent et tapissent lieux, non-lieux et espace virtuel.
Cette accumulation, cette fluidité, des images aux territoires, du
virtuel aux « non- lieux » aux lieux n’empêche nullement, bien au
contraire, que ce tout ce spectacle soit mis à la disposition d’un « je »
toujours plus exigeant et toujours mieux mis en scène3, toujours plus
consommateur, un individu auquel l’on fait croire qu’il est unique,
que seul son point de vue est important, « comme si la position du spec-
tateur constituait l’essentiel du spectacle » (Augé, 1992 : 110). Et il me
semble qu’ainsi se compose et se révèle le paysage postindustriel. Le
monde entier, figuré en mode touristique, est transformé en images
parfaites, en destinations façonnées, infiniment et fébrilement collec-
tionnées.
3. « La déconstruction contemporaine du sujet s’accompagne, en effet, d’un individualisme
sans borne et d’un repliement sur soi, avec tout ce que cela suppose de désinvestissement
politique » (Lafontaine, 2004 : 192-193).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 206 11/12/08 15:04:57
POSTFA C E
Note sur un essai de méthode
Pour l’étude du land art, comme pour tout travail de chercheur
par ailleurs, deux dispositions sont possibles : rester au centre (suivre
mentalement les voies) ou aller vers la périphérie (les suivre physi-
quement1). Si « rester au centre », c’est-à-dire demeurer chez soi, en
autant que l’on soit entouré des outils nécessaires, ouvrages savants et
documents, m’apparaît comme la manière la plus judicieuse pour
l’étude de l’art, il m’a été, du moins au début, impossible de m’y
tenir. La photographe que je suis ne pouvait pas ne pas se rendre sur
les lieux. Pour y relever des empreintes bien entendu, mais aussi et
surtout pour y chercher le point de vue.
C’est ainsi que j’avais conçu en amorçant ces recherches, de pra-
tiquer le tourisme comme outil méthodologique plutôt que comme
matière théorique. John B. Jackson n’a-t-il pas affirmé, avec raison,
que l’étude du paysage n’est qu’un temps différent du tourisme2 ? J’ai
donc voulu expérimenter, littéralement, le déplacement entre la
représentation et son objet, supposant que le site pouvait faire office
de source première par rapport à son document. Ont donc été reproduits
les gestes de qui part en reconnaissance, à la découverte de lieux
dépeints, et surtout transformés, par les artistes.
En 2000, en un long voyage formant boucle, nous parcourions
le sud-ouest des États-Unis3. En 2002 l’Arizona, le Nouveau-Mexique,
la Californie et le Nevada étaient de nouveau visités. En 2002 égale-
1. « The rules of this network of signs are discovered as you go along uncertain trails both
mental and physical » (Flam, 1996 : 153). Je souligne.
2. « But as I look back on many summers of such travel I wonder if they were not in fact an
excellent introduction to the different phases of tourism that I have learned to call land-
scape studies » (Jackson, 1980 : 9).
3. Ce pluriel n’est pas un surgissement soudain de l’habituel nous académique. Il signale
simplement que je n’étais pas seule. Ma compagne m’accompagnait (ce qui a tout l’air
d’un pléonasme) au cours des voyages dont il est ici question.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 207 11/12/08 15:04:57
208 Le paysage façonné
ment, nous nous rendions dans quelques zones plus (sub)urbaines à
la recherche de certaines œuvres. Partout le rite touristique, la prise
de photographies, a été respecté.
6.1 ZABRISKIE POINT, DEATH VALLEY, CALIFORNIE
Photographie : Suzanne Paquet, 2002
Ces voyages, recommandés tant par Robert Smithson que par
bien des auteurs qui ont étudié le land art, dont Gilles A. Tiberghien
et Anne-Françoise Penders, auront mené à la conclusion que l’on
peut tout aussi bien… rester chez soi. Serait-ce dire que désormais
l’image photographique, le document seul, suffit? Pas tout à fait.
Peut-être est-ce simplement que les déplacements utiles à ce travail de
recherche auront finalement été plus mentaux que physiques, autre
mouvement acceptable selon Robert Smithson lorsqu’il s’agit d’ap-
préhender les sites. Quoi qu’il en soit, le modèle de la sociologie de la
médiation s’est avéré assurément plus efficace que des allers et retours
en série, pour arriver à saisir convenablement mon objet. (Il faut
avouer que j’avais cru pouvoir conjuguer – bien candidement – les
« déplacements » proposés par Smithson avec ceux que l’on peut
mettre à jour lorsque l’on examine les choses sous l’angle des traduc-
tions ou des médiations successives.)
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 208 11/12/08 15:04:58
postface 209
Il serait tout de même dommage de ne pas offrir un compte
rendu, si succinct soit-il, de ces déplacements entre l’image et sa chose,
entre l’indicateur et son spectacle, entre le supplément documentaire et
l’œuvre, entre le non-site et le site.
Au printemps 2000, sur la Mesa mormone4, nous avons cherché
et n’avons pas trouvé le Double Negative de Michael Heizer. Expérience
légèrement périlleuse et fort frustrante. En revanche, le paysage qui
s’offre à la vue des téméraires qui arrivent à monter sur la mesa « vaut
le voyage » comme on dit chez Michelin.
6.2 VIRGIN RIVER VALLEY
VUE DE LA MORMON MESA, NEVADA
Photographie : Suzanne Paquet, 2000
Nous dirigeant ensuite vers l’Utah, nous ne sommes pas allées
au lieu de la Spiral Jetty de Robert Smithson, sachant qu’elle était à ce
moment-là immergée sous les eaux du Great Salt Lake. Mais nous
nous sommes rendues à Lucin, village plus ou moins fantôme à
quelques milles duquel se trouvent les Sun Tunnels de Nancy Holt.
Les quatre buses de ciment veillent toujours dans la plaine, qui s’ouvre
sur le magistral paysage du Great Basin Desert.
4. Mormon Mesa, que certains auteurs appellent aussi Virgin River Mesa.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 209 11/12/08 15:04:59
210 Le paysage façonné
6.3 LES SUN TUNNELS (1973-1976) DE NANCY HOLT.
GREAT BASIN DESERT, UTAH
Photographie : Suzanne Paquet, 2000
Au retour, un bref arrêt à Ottawa en Illinois a permis d’arpenter
Effigy Tumuli de Michael Heizer. Comme on le sait, il s’agit d’une
œuvre de réhabilitation qui était elle-même en cours de réfection au
printemps 2000. Nous avons trouvé plus réussi le paysage composé par
les quelques haldes laissées en témoignage de l’exploitation du mine-
rai qui eut cours en ce lieu pendant quarante ans.
6.4 TERRILS LAISSÉS EN TÉMOIGNAGE DES ACTIVITÉS
MINIÈRES. BUFFALO STATE PARK, OTTAWA, ILLINOIS
Photographie : Suzanne Paquet, 2000
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 210 11/12/08 15:05:01
postface 211
6.5 EFFIGY TUMULI (1983-1985) DE MICHAEL HEIZER,
EN RÉFECTION. BUFFALO STATE PARK, OTTAWA, ILLINOIS
Photographie : Suzanne Paquet, 2000
En 2002, de retour sur la Mesa mormone sur laquelle il devient
de plus en plus risqué de monter, nous avons finalement trouvé le
Double Negative. L’œuvre s’effrite, tout comme le bord de la mesa elle-
même ; son échelle, qui semble grandiose sur les images de 1969 n’est
aucunement impressionnante. Le paysage qui l’entoure est toujours
aussi magnifique.
6.6 LE DOUBLE NEGATIVE (1969) DE MICHAEL HEIZER.
MORMON MESA, NEVADA
Photographie : Suzanne Paquet, 2000
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 211 11/12/08 15:05:02
212 Le paysage façonné
Poursuivant le périple, aux environs de Flagstaff en Arizona
nous avons (très) mollement cherché l’emplacement du Roden Crater
de James Turrell dont la visite est jusqu’à maintenant interdite puis-
que l’œuvre n’est pas terminée (on nous en promet l’ouverture tous
les ans depuis 2000) et aussi pour cause de « James Turell’s sensitivity
to viewing the masterpiece in an incomplete state5 ».
À Quemado au Nouveau-Mexique, un cowboy nous a pris en
charge pour nous conduire au Lightning Field de Walter de Maria où
nous avons passé un jour et une nuit avec l’œuvre et sa cabane. Étant
donné la saison, pas de foudre sur le Lightning Field. Toutefois, nous y
étions, ce jour de mai, les seules touristes. Malgré l’interdiction de
photographier6, bon nombre d’images ont été faites, personne ne
nous ayant confisqué les (quatre) appareils dont nous étions munies
et personne ne se trouvant sur le site pour nous faire reproche de
cette entorse au règlement.
6.7 LA CABANE, AU LIGHTNING FIELD DE WALTER DE MARIA.
HAUTS PLATEAUX DU NOUVEAU-Mexique
Photographie : Suzanne Paquet, 2002
5. Tiré d’un feuillet remis par le centre d’information touristique de Flagstaff.
6. « Photography of the Lightning Field is NOT permitted. Commissioned, copyrighted slides
are available in Quemado or through the Albuquerque office for $30.00 per set of 8, plus
$2.00 shipping and handling. These photographic images are for personal use only and
their publication is prohibited without the written consent of Dia Center for the Arts »
(Site Internet: www.diacenter.org). Voir également Beardsley (1981 : 35-38).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 212 11/12/08 15:05:03
postface 213
6.8 LE LIGHTNING FIELD (1974-1977) DE WALTER DE MARIA.
HAUTS PLATEAUX DU NOUVEAU-Mexique
Photographie : Suzanne Paquet, 2002
Quelque part entre le Lightning Field et la traversée du désert qui
nous ramenait au Nevada, nous avons pu rencontrer Nancy Holt qui
nous a entretenues de son travail, de celui de Robert Smithson, ainsi
que de sa tâche en tant que « Bob’s estate ».
Il nous est également arrivé de nous rendre, visite plus subur-
baine et moins hasardeuse, jusqu’à Seattle pour arpenter le Johnson
Pit no 30 de Robert Morris, œuvre de land reclamation d’une ancienne
carrière qui elle aussi a fait l’objet (l’œuvre, pas la carrière) d’une
restauration, il y a peu d’années.
6.9 LE JOHNSON PIT NO 30 (1979) DE ROBERT MORRIS.
KING COUNTY, WASHINGTON
Photographie : Suzanne Paquet, 2002
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 213 11/12/08 15:05:05
214 Le paysage façonné
À Seattle même, nous avons eu un entretien avec l’une des res-
ponsables du programme d’art public de la King County Arts Com-
mission et nous avons vu quelques autres œuvres de la collection.
Toujours à la recherche de sources inédites pour mon travail,
nous avions également pris rendez-vous au Seattle Art Museum, ques-
tion de consulter quelques documents d’archives concernant l’événe-
ment Earthworks : Land Reclamation as Sculpture. Nous n’avons malheu-
reusement pu avoir accès aux archives où l’on s’affairait ce jour-là à
contrer… une invasion d’insectes mangeurs de papier.
En France la même année, Fos-sur-Mer a été visité, à la recher-
che du Secteur 80 photographié par Lewis Baltz. Secteur que nous
n’avons évidemment pas trouvé. Nous avons cependant rencontré les
responsables de Fos Action Culture qui nous ont aimablement rensei-
gnées sur leurs collections photographiques, sur leurs archives et sur
Fos même. Nous avons pu y revoir « en vrai » la suite Fos Secteur 80 de
Lewis Balz que nous avions déjà vue quelques jours auparavant chez
Michèle Chomette, à Paris.
En 2002 toujours, j’ai eu l’occasion de photographier le Catch
Basin de Nancy Holt, à Toronto.
*
Tous ces voyages ont certes été profitables à mes recherches, car
ils ont permis d’éprouver l’isolement des œuvres, de les considérer
au regard de leur supplément documentaire, d’évaluer l’importance
du déplacement et des effets de va-et-vient entre l’image et sa chose.
Et bien que j’aie affirmé plus tôt que l’on peut tout aussi bien rester
chez soi, je ne saurais trop insister sur la pertinence de se rendre à
destination. L’étude de l’art ne peut qu’en être enrichie.
Mais c’est un tout dernier voyage, un parcours qui n’avait rien à
voir avec le land art, qui aura été le plus instructif. Une presque année
en Australie, où nous n’étions ni tout à fait résidentes ni tout à fait
touristes, plusieurs mois pendant lesquels très peu de photographies
ont été prises, un séjour qui aura occasionné les réflexions les plus
opportunes au sujet du tourisme comme boîte noire, comme prati-
que à laquelle tous se prêtent sans en remettre en question la valeur
et la nécessité. C’est au cours de ces mois dans les régions les plus
isolées du continent le plus désertique de notre monde (si l’on
excepte les pôles), qu’ont été rassemblées les mailles de la chaîne,
non seulement par un patient travail, mais aussi parce cette situation
physique particulière, être étrangère en un lieu étrange, le comman-
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 214 11/12/08 15:05:05
postface 215
dait. La partie nord de Western Australia est un lieu où la moindre
activité touristique prend des allures de voyage d’exploration. C’est
un espace immense où les nations aborigènes, encore marquées par
l’impact de la colonisation britannique, commencent à s’auto-folkloriser
au profit d’un tourisme d’aventure qui consiste à emprunter des routes
mal entretenues (parfois fermées pendant plusieurs semaines) où
l’on ne trouve de l’eau (qui est rarement potable) que trois mois par
année, pour voir de la nature sauvage, mais aussi pour visiter des cen-
tres d’art aborigène disséminés dans le désert. Dans les communautés
du désert, l’« industrie 7 » de la peinture aborigène est florissante. Une
quantité impressionnante de tableaux est produite annuellement, de
la peinture de paysage de tradition récente, mais dont le marché est
déjà bien établi, possiblement pour cause de culpabilité coloniale des
descendants des sujets de l’empire britannique8.
Le nord de l’Australie Occidentale est aussi un lieu où les locals
(les blancs, pas les aborigènes), sans trop comprendre les implications
politiques de ce discours, vous décriront leur région, les Kimberleys,
comme la dernière frontière.
7. Une Indigenous arts industry selon les mots de Suzette Watkins, catalogue Desert Mob 2003
(2003 : 1).
8. À ce sujet, on peut consulter Paquet (2007).
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 215 11/12/08 15:05:05
216 Le paysage façonné
6.10 PERTH, WESTERN AUSTRALIA
Photographie : Suzanne Paquet, 2003
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 216 11/12/08 15:05:06
BIBLIOGRAPHIE
ACCONCI, Vito (1990) Public Space in a Private Time. Dans W.J.T. Mitchell
(dir.) Art and the Public Sphere. Chicago, University of Chicago Press,
p. 158-176.
ADORNO, Theodor W. (1991) The Culture Industry. Selected Essays on Mass
Culture. Londres, Routledge.
AITCHISON, Cara, MACLEOD, Nicola E. et SHAW, Stephen J. (2000) Leisure
and Tourism Landscapes. Social and Cultural Geographies. Londres, Rout-
ledge.
ALLOWAY, Lawrence (1983) Robert Smithson’s Development. Dans A.
Sonfist (dir.) Art in the Land, A Critical Anthology of Environmental Art.
New York, E.P. Dutton, p. 125-141.
ALLOWAY, Lawrence (1981) Smithson Unresovable Dialectics. Dans
R. Hobbs Robert Smithson: Sculpture. Ithaca, Cornell University Press,
p. 19-30.
ALLOWAY, Lawrence (1976) Site Inspection. Artforum, octobre, p. 49-55.
ALLOWAY, Lawrence (1975) Topics in American Art since 1945. New York,
W.W. Norton & Company.
ALKRICH, Madeleine (1986) Le jugement dernier : une sociologie de la
beauté. L’année sociologique, vol. 36, p. 239-277.
ALPERS, Svetlana (1991) L’atelier de Rembrandt. Paris, Gallimard.
ALPERS, Svetlana (1983) The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth
Century. Chicago, University of Chicago Press.
AMIZLEV, Iris (1999) Land Art: Layers of Memory. The �����������������������������
Use of Prehistoric Refer-
ences in Land Art. Thèse de doctorat, Département d’anthropologie,
Université de Montréal, Québec.
ANDREWS, Malcolm (1999) Landscape and Western Art. New York, Oxford
University Press.
ANDRIEUX, Jean-Yves (1992) Le patrimoine industriel. Paris, Presses universi-
taires de France.
APOSTOPOULOS, Yorghos, LEIVALDI, Sheila et YIANNAKIS, Andrew
(dir.) (2001) The Sociology of Tourism. Theoritical and Empirical Investiga-
tions. Londres, Routledge.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 217 11/12/08 15:05:06
218 Le paysage façonné
ARAGO, François (1839) Le Daguerréotype. Rapport fait à l’Académie des sciences
de Paris le 19 avril 1839. Paris, L’Échoppe, 1987.
AUGÉ, Marc (1997) L’impossible voyage. Le tourisme et ses images. Paris,
Rivages.
AUGÉ, Marc (1992) Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité.
Paris, Seuil.
AUPING, Michael (1983) Earth Art : A Study in Ecological Politics. Dans
A. Sonfist (dir.) Art in the Land, A Critical Anthology of Environmental Art.
New York, E.P. Dutton, pp. 92-104.
BABELON Jean-Pierre et CHASTEL, André (1994) La notion de patrimoine.
Paris, Éditions Liana Lévi.
Baltz, Lewis, Davies, John, Garnell, Jean-Louis et Basilico Gabriele
(1997) Fos, nature d’un lieu. Marseille, Images en manœuvres/Fos Action
Culture.
BALTZ, Lewis et Harworth-Booth, Mark (1989) Candlestick Point. New
York, Aperture.
BALTZ, Lewis (1986) San Quentin Point. New York, Aperture.
BALTZ, Lewis et BLAISDELL, Gus (1980) Park City. Albuquerque, Artspace
Press.
BALTZ, Lewis (1985) Landscape Problems. A review of Edward Weston:
California Landscapes. Aperture, no 98, p. 2-3 et p. 69.
BALTZ, Lewis (1984) KONSUMERTERROR: Late-industrial Alienation.
Aperture, n° 96, p. 4-7 et p. 74.
BANN, Stephen (1999) The Necessity of Invention: Bernard Lassus’s Garden
Landscapes. Dans J. Birksted (dir.) Relating Architecture to Landscape,
Londres, E +FN Spoon, p. 233-243.
BANN, Stephen (1990) From Captain Cook to Neil Armstrong: Colonial
Exploration and the Structure of Landscape. Dans S. Pugh (dir.) Reading
Landscape: Country, City, Capital, Manchester, Manchester University
Press, p. 214-230.
BARTHES, Roland (1982) L’obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris, Seuil.
BARTHES, Roland (1980) La chambre claire. Note sur la photographie. Paris,
Cahier du cinéma/Gallimard/Seuil.
BARTHES, Roland (1957) Mythologies. Paris, Seuil.
BAUDELAIRE, Charles (1961) Salon de 1859. Œuvres Complètes. Paris, La
Pléiade.
BAUDRILLARD, Jean (1986) Amérique. Paris, Grasset.
BEARDSLEY, John (1989) Earthwork Renaissance. Landscape Architecture,
vol. 79, no 5, p. 45-49.
BEARDSLEY, John (1984) Earthworks and Beyond. Contemporary Art in the
Landscape. New York, Abbeville Press.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 218 11/12/08 15:05:07
bibliographie 219
BEARDSLEY, John (1981) Art and Authoritarism: Walter De Maria’s Light-
ning Field. October, no 16, p. 35-38.
BEARDSLEY, John (1981) Personal Sensibilities in Public Places. Artforum,
été, p. 3-45.
BECKER, Howard S. (1988) Les mondes de l’art. Paris, Flammarion.
BENJAMIN, Walter (1983) Essais 1 1922-1934. Paris, Denoël-Gonthier.
BENJAMIN, Walter (1968) Illuminations. Essays and Reflexions. New York,
Shocken Books.
BÉRARD, Serge (1999) Daniel Buren and Robert Smithson : A Comparative Study
Thèse de doctorat, Department of Fine Arts, University of British
Columbia, Vancouver.
BERKSON, Bill (1986) Seattle Sites. Art in America, juillet, p. 68-135.
BERMAN, Marshall (1982) All That Is Solid Melts into Air. New York, Penguin
Books.
BERQUE, Augustin (1995) Les raisons du paysage. De la Chine antique aux envi-
ronnements de synthèse. Paris, Hazan.
BERQUE, Augustin (dir.) (1994) Cinq propositions pour une théorie du paysage.
Seyssel, Champ Vallon.
BERQUE, Augustin (1990) Médiance. De milieux en paysages. Montpellier,
Reclus.
BERQUE, Augustin (1989) Les mille naissances du paysage. Dans Mission
photographique de la DATAR, Paysages photographies. En France les années
1980, Paris, Hazan, p. 21-49.
Beyond Wilderness, Aperture, no 120, été 1990.
BOETTGER, Suzaan (2002) Earthworks. Art and the Landscape of the Sixties.
Berkeley, University of California Press.
BOETTGER, Suzaan (2001) A Found Weekend, 1967: Public Sculpture and
Anti Monuments. Art in America, n° 125, p. 81-85.
BORGES, Jorge Luis (1994) Histoire universelle de l’infamie/Histoire de l’éternité.
Paris, Éditions 10/18.
BORGES, Jorge Luis (1978) Le livre de sable. Paris, Gallimard.
BORGES, Jorge Luis (1974) Fictions, Paris, Gallimard.
BORGES, Jorge Luis (1967) L’aleph. Paris, Gallimard.
BOURDIEU, Pierre (1998) Les règles de l’art. Genèse et structure du champ
littéraire. Paris, Seuil.
BOURDIEU, Pierre (1980) Questions de sociologie. Paris, Minuit.
BOURDIEU, Pierre (dir.) (1965) Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la
photographie. Paris, Minuit.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 219 11/12/08 15:05:07
220 Le paysage façonné
Bowden, Charles (1998) Blind in the Sun. Aperture no 150, hiver, p. 74-76.
BROWN, Brenda (1991) Avant-Gardism and Landscape Architecture.
Landscape Journal, vol. 1, no 10, printemps, p. 134-153.
Buffard, Alain (1990) La commande photographique : du malentendu au
paradoxe. Dans Paysages sur commande, Rennes, Le Triangle, p. 49-58.
CANDAU, Joël (1996) Anthropologie de la mémoire. Paris, Presses universitaires
de France.
CASTLE, Ted (1982) Nancy Holt, Siteseer. Art in America, mars, p. 84-90.
CAUQUELIN, Anne (2002) Le site et le paysage. Paris, Presses universitaires de
France.
CAUQUELIN, Anne (2000 [1989]) L’invention du Paysage. Paris, Presses uni-
versitaires de France.
CAUQUELIN, Anne (1998 [1992]) L’art contemporain. Paris, Presses universi-
taires de France.
CAUQUELIN, Anne (1990) Le paysage n’est pas un lieu. Dans Paysages sur
commande Rennes, Le Triangle, p. 92-96.
CAUSEY, Andrew (1998) Sculpture Since 1945. New York, Oxford University
Press.
CAZES, Georges, LANQUAR, Robert et RAYNOUART, Yves (1993) L’aména-
gement touristique. Paris, Presses universitaires de France.
CELANT, Germano (1997) Michael Heizer. Milan, Fondatione Prada.
CEMBALEST, Robin (1991) The Ecological Art Explosion. Art News, été,
p. 97-105.
Chabason, Lucien (1995) Pour une politique du paysage. Dans A. Roger
(dir.) Théorie du paysage en France (1974-1994). Seyssel, Champ Vallon,
p. 260-272.
CHABASON, Lucien (1992) L’homme sans la nature dans la société indus-
trielle. Dans B., Lassus, Hypothèses pour une troisième nature, actes du sémi-
naire tenu à Paris, au Sénat, les 4 et 5 septembre 1987, Paris, Coracle,
p. 133-139.
Chalumeau, Jean-Luc (1990) Le regard et le langage. Ninety no 1, p. 68-
69.
Chamboredon, Jean-Claude (1965) Art mécanique, art sauvage. Dans
P. Bourdieu (dir.) Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la ���������
photogra-
phie. Paris, Minuit, p. 219-244.
CHARD, Chloe (1999) Pleasure and Guilt on the Grand Tour. Travel Writing and
Imaginative Geography 1600-1830. Manchester, Manchester University
Press.
CLARK, Kenneth (1962) L’art du paysage. Paris, Juillard.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 220 11/12/08 15:05:07
bibliographie 221
CLARKE, Graham (1997) The Photograph. New York, Oxford University
Press.
COLEMAN, A. D. (1998) Depth of Field. Essays on Photography, Mass Media and
Lens Culture. Albuquerque, University of New Mexico Press.
COLES, Alex (2001) Revisiting Robert Smithson in Ohio : Tacita Dean, Sam
Durant And Renee Green. Parachute, no 104, automne, p. 130-137.
COLLIER, Ric et EDWARDS, Jim (2004) Spiral Jetty. The Re-emergence.
Sculpture, vol. 23, no 6, p. 28-33.
CONZEN, Michael P. (dir.) (1990) The Making of the American Landscape.
Boston, Unwin Hyman.
COPLANS, John (1974) Robert Smithson. The ‘Amarillo Ramp’. Artforum,
avril, p. 36-44.
CORBIN, Alain (2001) L’homme dans le paysage. Paris, Textuel.
CORBIN, Alain (1988) Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage (1750-
1840). Paris, Flammarion.
CORBOZ, André (2001) Le Territoire comme palimpseste et autres essais. Paris,
Éditions de l’imprimeur.
COSGROVE, Denis E. (1998) Social Formation and Symbolic Landscape.
Madison, University of Wisconsin Press.
CRIMP, Douglas (1995) On the Museum Ruins. Cambridge, MIT Press.
CROW, Thomas (1996) The Rise of the Sixties. American and European Art in the
Era of Dissent. New York, Harry N. Abrams Inc.
CURTIS, Penelope (1999) Sculpture 1900-1945. New York, Oxford University
Press.
DAGONET, François, Guéry, François et Marcel, Odile (1995) Mort et
résurrection du paysage? Dans A. Roger (dir.) Théorie du paysage en France
(1974-1994). Seyssel, Champ Vallon, p. 133-141.
DAGONET, François (dir.) (1982) Mort du paysage? Philosophie et esthétique
du paysage. Seyssel, Champ Vallon.
DAGRON, Chantal et KACIMI, Mohamed (1992) Naissance du désert. Paris,
Balland.
Daguerre, Louis-Jacques Mandé (1839) Historique et description des procédés
du daguerréotype et du diorama. Paris, Alphonse Giroux et Cie, Éditeurs.
DAMISCH, Hubert (2001) La Dénivelée. À l’épreuve de la photographie. Paris,
Seuil.
DAMISCH, Hubert (1993) L’origine de la perspective. Paris, Flammarion.
DANIELS, Stephen (1993) Fields of Vision. Landscape Imagery and National
Identity in England and the United States. Cambridge, Polity Press.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 221 11/12/08 15:05:07
222 Le paysage façonné
DARLINGTON, David (1996) The Mohave. A portrait of the Definitive American
Desert. New York, Henry Holt and Company.
Davallon, Jean, Micoud André et Tardy Cécile (1997) Vers une évolu-
tion de la notion de patrimoine? Réflexions à propos du patrimoine
rural. Dans D. J. Grange et D. Poulot (dir.) L’esprit des lieux. Le patrimoine
et la cité. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, p. 195-205.
de BEAUVOIR, Simone (1997 [1954]) L’Amérique au jour le jour. Paris, Galli-
mard.
DEBORD, Guy (2001 [1967]) La société du spectacle. Paris, Gallimard.
DEBRAY, Regis (1992) Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident.
Paris, Gallimard.
de Gaudemar, Jean-Paul (1989) Le territoire aux qualités. Dans Mission
photographique de la DATAR, Paysages photographies. En France les années
1980 Paris, Hazan, p. 51-85.
Deitch, Jeffrey (1983) The New Economics of Environmental Art. Dans
A. Sonfist (dir.) Art in the Land, A Critical Anthology of Environmental Art.
New York, E.P. Dutton, p. 85-91.
DEUTSCHE, Rosalyn (1996) Evictions. Art and Spatial Politics. Cambridge,
MIT Press.
DOMON Gérald, BEAUDET, Gérard et JOLY, Martin (dir.) (2000) Évolution
du territoire laurentien. Caractérisation et gestion des paysages. Montréal,
Chaire en paysage et environnement.
DORRIAN, Mark et ROSE, Gillian (2003) Deterritorialisations… ������������
Revisioning-
Landscapes and Politics. New York, Black Dog.
DUBOIS, Philippe (1990) L’acte photographique et autres essais. Paris, Nathan.
DUBOST, Françoise (1983) Les paysagistes et l’invention du paysage. Socio
logie du travail, no 4-83, p. 432-445.
DUBOST, Françoise (1991) La problématique du paysage. État des lieux.
Études rurales, no 121-124, janvier-décembre, p. 219-234.
DURAND, Régis (1990) Le regard pensif. Lieux et objets de la photographie. Paris,
La Différence.
DURAND, Régis (1989) Architecture des virtualités et des disparitions. Dans
Mission photographique de la DATAR, Paysages photographies. En France
les années 1980, Paris, Hazan, p. 635.
FARBER, David (1994) The Age of Great Dreams. America in the 1960s. New
York, Hill an Wang.
FERRY, Luc (1992) Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme. Paris,
Grasset.
FLAM, Jack (dir.) (1996) Robert Smithson. The Collected Writings. Berkeley,
University of California Press.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 222 11/12/08 15:05:08
bibliographie 223
FLOHIC, Catherine (1990) Hilla et Bernd Becher. Ninety no 1, p. 70-71.
FOOTE, Nancy (1980) Situation Esthetics. Impermanent Art and the Seven-
ties Audience. Artforum, p. 22-29.
FOOTE, Nancy (1979) Monument-Sculpture-Earthworks. Artforum, octobre,
p. 33-38.
FOOTE, Nancy (1976) The Anti-Photographers. Artforum, septembre, p. 46-
54.
FOSTER, Hal (1987) Discussions in Contemporary Culture. Seattle, Bay Press/
Dia Art Foundation.
FOUCAULT, Michel (1975) Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris,
Gallimard.
FRANCESCHI, Catherine (1997) Séquences/paysages, 1997, Revue de
l’Observatoire Des paysages. Les carnets du paysage, no 1, printemps,
p. 174-175.
FRIED, Michael (1967) Art and Objecthood. Artforum, juin, p.12-23 (Repris
en français sous le titre Art et objectité, dans C. Harrison et P. WOOD
(dir.) (1992) Art en théorie 1900-1990, Paris, Hazan, p. 896-909.)
GABLIK, Suzy (1988) The Art Job, or How the Avant-Garde Sold Out. Art in
America, avril, p. 9-13.
GARRAUD, Colette (1994) L’idée de nature dans l’art contemporain. Paris,
Flammarion.
GIBSON, Eric (1988) Public Art in America. Is Public Art for the Public?
Sculpture, janvier-février, p. 16-17 et p. 32-33.
GILBERT, James (1986) Another Chance. Postwar America 1945-1985. Belmont,
Wadsworth.
GILBERT-ROLFE, Jeremy (1988) Sculpture as Everything Else, Twenty Years
or So of the Question of Landscape. Arts Magazine no 62, janvier, p. 71-
75.
GOIN, Peter (1988) Ground Zero: Nevada Test Site. Landscape, vol. 30, no 1,
p. 24-29.
GOMBRICH, Ernst (2000 [1960]) Art and Illusion. A Study in Psychology of
PictorialRepresentation. Princeton, Princeton University Press.
GOMBRICH, Ernst (1978) The Renaissance Theory and the Rise of
Landscape. Norm and Form. Studies in the Art of Renaissance. New York,
Haidon, p. 107-121.
GOUDINOUX, Véronique et WEEMANS, Michel (dir.) (2001) Reproductibi-
lité et irreproductibilité de l’œuvre d’art. Bruxelles, La lettre volée.
Graburn, Nelson H. H. (1989) Tourism: The Sacred Journey. Dans V. L.
Smith (dir.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism. Philadelphie,
University of Pennsylvania Press, p. 21-36.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 223 11/12/08 15:05:08
224 Le paysage façonné
GRANGE, Daniel J. et POULOT, Dominique (dir.) (1997) L’esprit des lieux. Le
patrimoine et la cité. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
GRAZIANI, Ron (2004) Robert Smithson and the American Landscape. Cambridge,
Cambridge University Press.
GRAZIANI, Ron (1998) Robert Smithson : An Esthetic Foreman in the
Mining Industry (Part Two). Art Criticism, vol. 13, no 1, p. 5-21.
GRAZIANI, Ron (1994) Esthetic Prospector in the Mining Industry (Part 1 :
the 1960s). Art Criticism, vol. 10, no 1, p. 1-28.
GROUT, Catherine (1990) Lewis Baltz. Règle sans exception. Art Press,
no 178, mars, p. 27-31.
GRUEN, John (1977) Michael Heizer: ‘You Might Say I’m in the Construc-
tion Business’. Artnews, vol. 76, no 10, décembre, p. 96-99.
Guillaume, Marc (1990) Inventions et stratégies du patrimoine. Dans
H.-P. Jeudy (dir.) Patrimoines en folie. Paris, Éditions de la maison des
sciences de l’homme, p. 13-20.
HARGREAVES, George (1983) Post Modernism Looks Beyond Itself. Land-
scape Architecture, juillet-août, p. 59-65.
HARLEY, J. B. (2001) The New Nature of Maps. Essays on the History of Carto
graphy. Baltimore, John Hopkins University.
What is Nature Now, Harvard Design Magazine, hiver-printemps 2000.
Popular Places, Harvard Design Magazine, hiver-printemps, 1998.
HEIDEGGER, Martin (1977) The Age of the World Picture. The Question
Concerning Technology and Other Essays. New York, Harper & Row, p. 115-
154.
HEINICH, Nathalie (2001) La sociologie de l’art. Paris, La Découverte.
HEINICH, Nathalie (1998) Ce que l’art fait à la sociologie. Paris, Minuit.
HENNION, Antoine (1993a) La passion musicale. Une sociologie de la médiation.
Paris, Métailié.
HENNION, Antoine (1993b) L’histoire de l’art : leçons sur la médiation.
Réseaux, no 60, 1993, p. 9-38.
HERMAN, Edward S. et CHOMSKY, Noam (2002) Manufacturing Consent.
The Political Economy of Mass Media. New York, Pantheon.
HERS, François et LETARGET, Bernard (1989) L’expérience du paysage.
Dans Mission photographique de la DATAR, Paysages photographies. En
France les années 1980 Paris, Hazan, p. 13-19.
HICKEY, Dave (1971) Earthscapes, Landworks and Oz. Art in America,
septembre octobre, p. 40-49.
HOBBS, Robert, avec la contribution de Lawrence Alloway, John Coplans,
Lucy R. Lippard (1981) Robert Smithson: Sculpture. Ithaca, Cornell
University Press.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 224 11/12/08 15:05:08
bibliographie 225
HOBBS, Robert (dir.) (1982) Earth Works : Past and Present. numéro théma-
tique de Art Journal, automne.
HOLT, Nancy (1977) Sun Tunnels. Artforum, avril, p. 32-37.
HOLT, Nancy (dir.) (1979) The Writings of Robert Smithson. New York, New
York University Press.
HOWETT, Catherine (1998) Ecological Values in Twentieth-Century Land-
scape Design : A History and Hermeneutics. Landscape Journal, numéro
spécial « Ecorevelatory Design : Nature Constructed/Nature Revealed »,
p. 80-98.
HOWETT, Catherine (1987) Systems, Signs, Sensibilities : Sources for a New-
Landscape Aesthetic. Landscape Journal, vol. 6 no 1, printemps, p.1-12.
HOWETT, Catherine (1985) Landscape Architecture : Making a Place for
Art. Places, vol. 2, no 4, p. 52-60.
INGLIS, Fred (1990) Landscape as Popular Culture. Dans S. Pugh (dir.)
Reading Landscape: Country, City, Capital, Manchester, Manchester
University Press, p. 197-213.
Internationale situationniste 1958-1969 (réimpression des numéros 1 à 12)
(1975) Paris, Édition Champ libre.
JACKLE, John A. (1990) Landscape Redesigned for the Automobile. Dans
M. P. Conzen (dir.) The Making of the American Landscape. Boston, Unwin
Hyman, p. 293-310.
JACKSON, John B. (1997) Landscape in Sight. Looking at America. New Haven,
Yale University Press.
JACKSON, John B. (1980) The Necessity for Ruins and Other Topics. Amherst,
The University of Massachusetts Press.
JÄGER, Jens (2003) Picturing Nations : Landscape Photography and Nation-
al Identity in Britain and Germany in the Mid-Nineteenth Century. Dans
J. M. Schwartz et. J. R. Ryan (dir.) Picturing Place. Photography and the
Geographical Imagination. New York, I. B. Tauris, p. 117-140.
JAMESON, Fredric (1991) Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism.
Durham, Duke University Press.
JEUDY, Henri-Pierre (2001) La machinerie patrimoniale. Paris, Sens & Tonka.
JEUDY, Henri-Pierre (dir.) (1990) Patrimoines en folie. Paris, Éditions de la
maison des sciences de l’homme.
JONES, Caroline A. (1996) Machine in the Studio. Constructing the Postwar
American Artist. Chicago, The University of Chicago Press.
JUSSIM, Estelle et LINDQUIST-COCK, Elisabeth (1985) Landscape as Photo-
graph. New Haven, Yale University Press.
KASTNER, Jeffrey et WALLIS, Brian (dir.) (1998) Land and Environmental
Art. Londres, Phaidon Press.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 225 11/12/08 15:05:08
226 Le paysage façonné
KERTESS, Klauss (1986) Earth Angles. Artforum, février, p. 76-79.
KEPES, Gyorgy (dir.) (1972) Arts of the Environment. New York, Braziller.
KLETT, Mark (dir.) (1984) Second View. The Rephotographic Survey Project.
Albuquerque, University of New Mexico Press.
KRAUSS, Rosalind E. (1997) Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à
Smithson. Paris, Macula.
KRAUSS, Rosalind E. (1993) L’originalité de l’avant-garde et autres mythes moder-
nistes. Paris, Macula.
KRAUSS, Rosalind E. (1990) Le photographique. Pour une théorie des écarts. Paris,
Macula.
KROG, Steven R. (1983) Creative Risk Taking. Landscape Architecture, vol. 73,
no 3, p. 70-76.
KROG, Steven R. (1981) Is it Art ? Landscape Architecture, vol. 71, no 3, p. 373-
376.
KWON, Miwon (2002) One Place after Another. Site-Specific Art and Locational
Identity. Cambridge, MIT Press.
KWON, Miwon (1997) One Place After Another: Notes on Site Specificity.
October no80, printemps, p. 85-110.
LACY, Suzanne (dir.) (1995) Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Seattle,
Bay Press.
LAFONTAINE, Céline (2004) L’empire cybernétique. Des machines à penser à
la pensée machine. Paris, Seuil.
LAMARCHE, Lise (1999) Textes furtifs, Autour de la sculpture (1978-1999).
Montréal, Centre de diffusion 3D.
LAMARCHE-VADEL, Bernard (1997) Délinquances exemplaires. Dans
Baltz, Lewis, Davies, John, Garnell, Jean-Louis et Basilico
Gabriele, Fos, nature d’un lieu. Marseille, Images en manœuvres/Fos
Action Culture, p 57-63.
LAMARCHE-VADEL, Bernard (1993) Lewis Baltz. Paris, La différence.
LANQUAR, Robert (1990) Sociologie du tourisme et des voyages. Paris, Presses
universitaires de France.
LASSUS, Bernard (1999) Autour des valeurs paysagères. Dans P. Poullaouec-
Gonidec, M. Gariépy et B. Lassus (dir.) Le paysage. Territoire d’intentions.
Montréal, L’Harmattan, p. 153-168.
LATOUR, Bruno (1995) La science en action. Introduction à la sociologie des
sciences. Paris, Gallimard.
LATOUR, Bruno et HENNION, Antoine (1993) Objet d’art, objet de scien-
ce. Notes sur les limites de l’anti-fétichisme. Sociologie de l’art, no 6,
p. 7-24.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 226 11/12/08 15:05:09
bibliographie 227
LARSON, Kay (1980) The Expulsion from the Garden : Environmental
Sculpture at the Winter Olympics. Artforum, avril, p. 36-45.
LAVOIE, Vincent (2001) L’instant-monument. Du fait divers à l’humanitaire.
Montréal, Dazibao.
LE COUEDIC, Daniel (1999) Le résistible arrachement au passé. Québec, Nota-
Bene/CEFAN.
Le Daguerréotype par Daguerre, Chevalier, Melloni, Hubert (1987) Paris, Jean-
Michel Place.
Histoire et nature du paysage, Le débat, no 65, mai-août, 1991.
Leibovitz-Steinman, Susan (1995) Directional Signs: A Compendium
of Artists’ Works. Dans S. Lacy (dir.) Mapping the Terrain: New Genre Public
Art. Seattle, Bay Press, p. 193-285.
LEIDER, Philip (2000) Robert Smithson and the American Landscape. Art in
America, janvier, p. 74-78.
LEIDER, Philip (1970) How I Spent my Summer Vacation, or Art and Politics
in Nevada, Berkeley, San Francisco and Utah. Artforum, septembre, p. 40-
49.
LEVEQUE, Terry Ryan (1988) Nancy Holt’s ‘Sky Mound’: Adaptive Techno
logy Creates Celestial Perspectives. Landscape Architecture, vol. 78, no 3,
avril-mai, p. 82-86.
LEVEQUE, Terry Ryan (1985) Nancy Holt’s Dark Star Park, Rosslyn, Virginia.
Landscape Architecture, juillet-août, p. 81-82.
LINKER Kate (1981) Public Sculpture II: Provisions for the Paradise. Art-
forum, été, p.37-42.
LINKER, Kate (1981) Public Sculpture: The Pursuit of Pleasurable and
Profitable Paradise. Artforum, mars, p. 64-73.
LIPPARD, Lucy R. (2000) On the Beaten Track. Tourism, Art and Place. New
York, The New Press.
LIPPARD, Lucy R. (1998) Outside (But Not Necessarily Beyond) the Land
scape. Aperture no 150, hiver, p. 60-61.
LIPPARD, Lucy R. (1997) The Lure of the Local. Senses of Place in a Multicentered-
Society. New York, The New Press.
LIPPARD, Lucy R. (1995) Looking Around: Where We Are, Where We Could
Be. Dans S. Lacy (dir.) Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Seattle,
Bay Press, p. 114-130.
LIPPARD, Lucy R. (1984) Get the Message? A Decade of Art for Social Change.
New York, E. P. Dutton.
LIPPARD, Lucy R. (1983) Overlay. Contemporary Art and the Art of Prehistory.
New York, Pantheon Books.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 227 11/12/08 15:05:09
228 Le paysage façonné
LIPPARD, Lucy R. (1981) Gardens: Some Metaphors for a Public art. Art in
America, novembre, p. 136-150.
LIPPARD, Lucy R. (1977) Art Outdoors, In and Out of the Public Domain.
Studio International, mars-avril, p. 36-44.
LIPPARD, Lucy R. (1974) A Is for Artpark. Art in America, novembre-
décembre, p.37-38.
LIPPARD, Lucy R. (1973) Six Years : The Dematerialization of the Art Object. New
York, Praeger.
LIPPARD, Lucy R. et CHANDLER, John (1968) The Dematerialization of
Art. Art International, vol. 12, n° 2, février, p. 31-36.
LOEFFLER, Jane C. (1992) Landscape as Legend : Carleton E. Watkins in
Kern County California. Landscape Journal, vol. 11, no 1, p. 1-21.
MacCANNELL, Dean (1999) The Tourist. A New Theory of the Leisure Class.
Berkeley, University of California Press.
Markymovicz, Virginia (1990) Through the Back Door: Alternative
Approaches to Public Art. Dans W.J.T. Mitchell (dir.), Art and the Public
Sphere. Chicago, University of Chicago Press, p. 147-157.
MALRAUX, André (1951) Le musée imaginaire. Les voix du silence. Paris,
Nouvelle Revue Française, p. 11-128.
MARESCA, Sylvain (1996) La photographie. Un miroir des sciences sociales.
Montréal, L’Harmattan.
MARTER, Joan (1994) Nature Redux: Recent Reclamation Art. Sculpture,
novembre décembre, p. 30-31.
MARX, Leo (2002) The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal
in America. New York, Oxford University Press.
MARX, Leo (1972) American Institutions and the Ecological Ideal. Dans
G. Kepes (dir.) Arts of the Environment. New York, Braziller, p. 78-97.
MASHECK, Joseph (1971) The Panama Canal and Some Other Works of
Work. Artforum, mai, p. 38-41.
McGILL, Douglas (1986) Sculpture Goes Public. New York Times Magazine,
27 avril, p. 45.
McLUHAN, Marshall (2002 [1962]) The Gutenberg Galaxy. The Making of the
Typographic Man. Toronto, University of Toronto Press.
McLUHAN, Marshall (1992 [1964]) Pour comprendre les médias. Les prolonge-
ments technologiques de l’homme. Montréal, Bibliothèque québécoise.
Mercier, Guy (dir.) (2004) Les territoires de la mondialisation. Québec, Presses
de l’Université Laval.
MESSADIÉ, Gérard (2003) Le Tourisme va mal? Achevons-le ! Paris, Max Milo.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 228 11/12/08 15:05:09
bibliographie 229
MILLER, Henry (1945) The Air Conditioned Nightmare. New York, New Direc-
tions.
MISRACH, Richard (1987) Desert Cantos. Albuquerque, University of New
Mexico Press.
Mission photographique de la DATAR, Paysages photographies. En France les
années 1980 (1989) Paris, Hazan.
Mission photographique de la DATAR, Paysages photographies. Travaux en cours
1985-1989 (1987) Paris, Hazan.
MITCHELL, W.J.T. (dir.) (1994a) Landscape and Power. Chicago, University
of Chicago Press.
MITCHELL, W.J.T. (1994b) Imperial Landscape. Dans Landscape and Power.
Chicago, University of Chicago Press, p. 5-34.
MITCHELL, W.J.T. (dir.) (1990) Art and the Public Sphere. Chicago, University
of Chicago Press.
Moments of Grace in the American Landscape. Aperture, no 150, hiver 1998.
MORGAN, Ann Barclay (1996) Site : Nancy Holt. Sculpture, janvier, p. 14-15.
MORRIS, Robert (1980) Notes on Art as/and Land Reclamation. October
no 12, printemps, p. 87-102.
MORRIS, Robert (1979) Keynote Address. Dans Earthworks: Land Reclamation
as Sculpture, Seattle, Seattle Art Museum/King County Arts Commission,
1979, p. 11-16.
MORRIS, Robert (1975) Aligned with Nazca. Artforum, octobre, p. 26-39.
NAEF, Weston J. et. WOOD, James N. (1975) Era of Exploration. The Rise of
Landscape Photography in the American West 1860-1885. New York, Albright-
Knox Art Gallery/Metropolitan Museum of Art.
NASH, Dennison (1989) Tourism as a Form of Imperialism. Dans V. L. Smith
(dir.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism. Philadelphie, Univer-
sity of Pennsylvania Press, p. 37-52.
NICOLAS-LESTRAT, Pascal (1998) Une sociologie du travail artistique. Artistes et
créativité diffuse. Montréal, L’Harmattan.
NORA, Pierre (dir.) (1997) Les lieux de mémoire. Paris, Gallimard, trois
tomes.
NYE, David E. (2003) Visualizing Eternity: Photographic Constructions of
the Grand Canyon. Dans J. M. Schwartz et. J. R. Ryan (dir.) Picturing
Place. Photography and the Geographical Imagination. New York, I. B. Tauris,
p 74-95.
OSBORNE, Peter D. (2000) Travelling Light. Photography, Travel and Visual-
Culture. New York, Manchester University Press.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 229 11/12/08 15:05:10
230 Le paysage façonné
OWENS, Craig (1992) Beyond Recognition: Representation, Power and Culture.
Berkeley, University of California Press.
PANOFSKY, Erwin (1975) La perspective comme forme symbolique. Paris, Minuit.
PAQUET, Suzanne (2007) Figures et territoires du désert australien : un pay-
sage duel. Cahiers de géographie du Québec, vol. 52, no 142, avril, p. 29-46.
PAYANT, René (1987) Vedute. Pièces détachées sur l’art 1976-1987. Laval, Édi-
tions Trois.
Paysages sur commande (1990) Rennes, Le Triangle.
PENDERS, Anne-Françoise (1999) En chemin, le land art. Bruxelles, La lettre
volée, deux tomes.
PLAGENS, Peter (1969) 557,087. Artforum, novembre, p. 64-67.
POE, Edgar Allan (1840) The Daguerreotype. Dans A. Trachtenberg (dir.)
(1980) Classic Essays on Photography. New Haven, Leete’s Island Books,
p. 37-38.
POINSOT, Jean-Marc (1999) Quand l’œuvre a lieu. L’art exposé et ses récits auto-
risés. Genève, Mamco et Villeurbanne, Institut d’art contemporain & Art
édition.
POLLAN, Michael (1998) Beyond Wilderness and the Lawn, Harvard Design
Magazine, hiver-printemps, p. 70-75.
POMIAN, Krzysztof (1999) Sur l’histoire. Paris, Gallimard.
POOL, Peter E. (dir.) (1999) The Altered Landscape. Reno, University of
Nevada Press.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, GARIÉPY, Michel et LASSUS, Bernard
(dir.) (1999) Le paysage. Territoire d’intentions. Montréal, L’Harmattan.
Raven, Arlene (1989) Art in the Public Interest. New York, Da Capo Press.
REISNER, Mark (1993) Cadillac Desert. The American West and Its Disappearing-
Water. New York, Penguin Books.
Autres sites, nouveaux paysages, Revue d’esthétique, no 39, 2001.
RIAN, Jeff (2001) Lewis Baltz. New York, Phaidon Press.
RILEY, Robert B. (1988) From Sacred Grove to Disney World. The Search for
Landscape Meaning. Landscape Journal, vol. 7 no 2, p. 136-147.
ROGER, Alain (1997) Court Traité du paysage. Paris, Gallimard.
ROGER, Alain (dir.) (1995a) Théorie du paysage en France (1974-1994). Seyssel,
Champ Vallon.
ROGER, Alain (1995b) Histoire d’une passion théorique ou : comment on
devient un Raboliot du paysage. Dans A. Roger (dir.) Théorie du paysage
en France (1974-1994), Seyssel, Champ Vallon, p. 438-451.
ROSS, Stephanie (1993) Gardens, Earthworks and Environmental Art. Dans
S. Kemal, et I. Gaskell (dir.) Landscape, Natural Beauty and the Arts,
Cambridge, Cambridge University Press, p. 158-182.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 230 11/12/08 15:05:10
bibliographie 231
SANSOT, Pierre (1990) Du bon et du moins bon usage de la commémora-
tion. Dans H.-P. Jeudy (dir.) Patrimoines en folie. Paris, Éditions de la mai-
son des sciences de l’homme, p. 283-290.
SASSOON, Joanna (2004) Photographic Materiality in the Age of Digital
Reproduction. Dans E. Edwards et J. Hart (dir.) Photographs, Objects,
Histories. Londres, Routledge, p. 186-202.
SCHAEFFER, Jean-Marie (1987) L’image précaire. Du dispositif photographique.
Paris, Seuil.
SCHAMA, Simon (1996) Landscape and Memory. New York, Vintage Books.
SCHWARTZ, Joan M. et. RYAN, James R. (dir.) (2003) Picturing Place. Photo
graphy and the Geographical Imagination. New York, I. B. Tauris.
SCHWARTZ, Joan M. (1998) Agent of Sight, Site of Agency. The Photograph in the
Geographical Imagination. Thèse de doctorat, Département de géogra-
phie, Queen’s University, Kingston, Ontario.
SCHWARTZ, Joan M. (1996) The Geography Lesson: Photographs and the
Construction of Imaginative Geographies. Journal of Historical Geography,
vol. 22, no1, p. 16-45.
SCHWARTZ, Joan M. (1995)‘We Make Our Tools and Our Tools Make Us’:
Lessons from Photographs for the Practice, Politics, and Poetics of
Diplomatics. Archivaria, no40, automne, p. 40-74.
Schwartzer, Mitchell (1998) Off-World in the Far West. Harvard Design
Magazine, hiver-printemps, p. 60-65.
Shaffer, Diana (1983) Nancy Holt: Spaces for Reflections or Projections.
Dans A. Sonfist (dir.) Art in the Land, A Critical Anthology of Environmental
Art. New York, E.P. Dutton, p. 169-177.
SEDDON, Peter (2000) From Eschatology to Ecology: The Ends of History
and Nature. Dans D. Green et P. Seddon (dir.) History Paintings Reassessed,
Manchester, Manchester University Press, p. 82-96.
SEKULA, Allan (1983) Photography Between Labor and Capital. Dans B. H.
D. Buchloch, et R. Wilke (dir.) Mining Photographs and Other Pictures
1948-1968. Halifax, The Press of Nova Scotia College of Art and Design/
University College of Cape Breton Press, p. 84-109.
SENIE, Harriet F. (1992) Contemporary Public Sculpture. Tradition, Transforma-
tion, and Controversy. New York, Oxford University Press.
SENIE, Harriet F. et Sally WEBSTER (dir.) (1992) Critical Issues in Public Art.
New York, HarpersCollins.
Séquences paysages. Revue de l’Observatoire photographique de paysage (1997) Paris,
Hazan.
SHAPIRO, Gary (1995) Earthwards. Robert Smithson and Art after Babel.
Berkeley, University of California Press.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 231 11/12/08 15:05:10
232 Le paysage façonné
SMITH, Valene L. (dir.) (1989) Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism.
Philadelphie, University of Pennsylvania Press.
Snyder, Joel (1994), Territorial Photography. Dans W.J.T. Mitchell (dir.)
Landscape and Power. Chicago, University of Chicago Press, p. 175-202.
SONFIST, Allan (dir.) (1983) Art in the Land, A Critical Anthology of Environ-
mental Art. New York, E.P. Dutton.
SONTAG, Susan (1979) La photographie. Paris, Seuil.
Southall, Thomas W. (1999) Where We Stand. Dans P. E. Pool (dir.) The
Altered Landscape. Reno, University of Nevada Press, p. 33-49.
TAGG, John (1988) The Burden of Representation. Essays on Photographies and
Histories. Londres, MacMillan.
TAYLOR, John (1994) A Dream of England. Landscape, Photography and the
Tourist’s Imagination. New York, Manchester University Press.
Thibault, Jean-Pierre (1999) Vers une déclaration universelle du paysage ?
Portée et limites d’un texte international récent. Dans P. Poullaouec-
Gonidec, M. Gariépy et B. Lassus (dir.) Le paysage. Territoire d’intentions.
Montréal, L’Harmattan, p. 187-207.
TIBERGHIEN, Gilles A. (2001) Nature, art, paysage. Arles, Actes Sud/École
supérieure du paysage/Centre du paysage.
TIBERGHIEN, Gilles A. (2000) Notes sur la nature, la cabane et quelques autres
choses. Strasbourg, École supérieure des arts décoratifs.
TIBERGHIEN, Gilles A. (1996) Land Art Travelling. Valence, École régionale
des Beaux-arts.
TIBERGHIEN, Gilles A. (1993) Land Art. Paris, Carré.
TILLIM, Sydney (1968) Earthworks and the New Picturesque. Artforum,
décembre, p.42-48.
TISSERON, Serge (1996) Le mystère de la chambre claire. Photographie et incons-
cient. Paris, Flammarion.
TRACHTENBERG, Alan (1989) Reading American Photographs. Images as
History Mathew Brady to Walker Evans. New York, Hill and Wang.
TRACHTENBERG, Alan (dir.) (1980) Classic Essays on Photography. New
Haven, Leete’s Island Books.
Le désert, Traverses , no 19, juin, 1980.
TWAIN, Mark (1913) Roughing It. New York, Harper.
URBAIN, Jean-Didier (1993) L’Idiot du voyage. Histoires de touristes. Paris, Payot
& Rivages.
URRY, John (2002) The Tourist Gaze. Londres, Sage Publications.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 232 11/12/08 15:05:10
bibliographie 233
VIRILIO, Paul (1975) Bunker archéologie. Paris, Centre Georges Pompidou/
Centre de création industrielle.
WEILACHER, Udo (1999) Between Landscape Architecture and Land Art.
Boston, Birkhäuser.
WELLS, Liz (dir.) (2000) Photography: A Critical Introduction. Londres,
Routledge.
WILSON, Alexander (1991) The Culture of Nature. North American Landscape
from Disney to the Exxon Valdez. Toronto, Between The Lines.
YATES, Steven A. (dir.) (1985) The Essential Landscape : The New Mexico
Photographic Survey. Albuquerque, University of New Mexico Press.
YAU, John (1985) Nancy Holt, Dark Star Park. Artforum, avril, p. 97-98.
ZINN, Howard (2003) The Twentieth Century. A People’s History, New York,
HarperCollins.
Catalogues
Baltz, Lewis, Nevada, New York, Castelli Graphics, 1978.
Baltz, Lewis, The New Industrial Parks near Irvine, California, New York, Leo
Castelli, 1974.
Baltz, Lewis (dir.), Contemporary American Photographic Works, Houston,
Museum of Fine Arts, 1977.
Bargellesi-Severi, Guglielmo, Robert Smithson Slideworks, Carlo Frua, 1997.
Beardsley, John, Probing the Earth. Contemporary Land Projects, Washington,
Smithsonian Institution Press, 1977.
Bérard Serge (dir.), Paysage, Montréal, Dazibao, 1987.
Brown-Turell, Julia (dir.), Rule Without Exception: Lewis Baltz, Des Moines, Des
Moines Art Center/University of New Mexico Press, 1990.
Froment, Jean-Louis et Jean-Marc Poinsot, Sculpture/Nature, Bordeaux, CAPC
Centre d’arts plastiques contemporains de Bordeaux, 1978.
Fuchs, Anneli (dir.), Lewis Baltz, Humlebaeck (Danemark), Louisiana
Museum, 1995.
Hobbs, Robert, Robert Smithson : A Retrospective View, Ithaca, Hubert F. Johnson
Museum of Art, Cornell University, n. d.
James, Geoffrey, Asbestos (avec un essai de Richard Rhodes), Toronto, The
Power Plant, 1994.
Jenkins, William (dir.), New Topographics. Photographs
����������������������������������
of a Man-Altered Land-
scape, Rochester, International Museum of Photography, 1975.
Langford, Martha, Sur l’espace, la mémoire et la métaphore : le paysage dans la
reprise photographique, Montréal, Le Mois de la photo à Montréal, 1997.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 233 11/12/08 15:05:11
234 Le paysage façonné
Quesney, Daniel, Véronique Ristelhueber et Caroline Stefulesco (dir.),
L’observatoire photographique du paysage, France, ministère de l’Environne-
ment/Cité des sciences et de l’industrie, 1994.
Slade, Roy et Baltz, Lewis, Maryland. The Nation’s Capital in Photographs,
Washington, Corcoran Gallery of Art, 1976.
Sobieszek, Robert A. (dir.), Robert Smithson : Photo Works, Los Angeles, Los
Angeles County Museum of Art/University of New Mexico Press, 1993.
Tsaï, Eugénie, Robert Smithson, Unearthed, New York, Columbia University
Press, 1991.
Amérique. Les années noires. Farm Security Administration/1935-1942, Paris,
Centre national de la photographie, 1983.
Arni Haraldsson. Projects on Vancouver Architecture and Landscape, North
Vancouver, Presentation House Gallery, 1995.
Bernd und Hilla Becher. Typologien Industrieller. Bauten 1963-75. XIV Bienal
Internacional de São Paulo, 1977.
Citysite Sculpture, Toronto, The Market Gallery, 1982.
Earthworks: Land Reclamation as Sculpture, Seattle, Seattle Art Museum/King
County Arts Commission, 1979.
Les commandes photographiques du groupe Lhoist, Paris, Groupe Lhoist, 2001.
Les quatre saisons du territoire. Le printemps. Belfort, CAC de Belfort Éditeur,
1989.
Regarder la ville, Liège, Centre culturel les Chiroux/Editions Façons de voir,
1997.
Roy Arden, North York, Art Gallery of York University, 1997.
Robert Smithson. Une rétrospective. Le paysage entropique 1960-1973, Marseille,
Musées de Marseille/Réunion des musées nationaux, 1994.
Virginia Dwan. Art minimal-art conceptuel-Earthworks. New York, Les années 60-70,
Paris, Galerie Montaigne, 1991.
Documents
Lewis Baltz, « Architecture of Entropy », texte-communiqué de la galerie
Michèle Chomette, Paris, 1988.
Michèle Chomette, communiqué « La photographie en chantier : Lewis Baltz
1986 1988 », Paris, galerie Michèle Chomette, 1988.
Carte Public Art Map. A Tour of the King County Public Art Collection, King
County, Public Art Program, Office of Cultural Resources, 2001.
CdRom Système de Monitoring Visuel du paysage, Montréal, Chaire en paysage et
environnement de l’Université de Montréal, 2000.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 234 11/12/08 15:05:11
bibliographie 235
Communiqué « Dark Star Park to Be Dedicated on June 1 », Arlington
County,Virginia, Office of the County Manager, 1984.
Dépliant About the Robert Morris Earthwork at Johnson Pit #30, Seattle, King
County Office of Cultural Resources, n. d.
Dépliant Buffalo Rock State Park/Effigy Tumuli, Illinois, Department of Natural
Resources, 1999.
Document PDF Chaire Unesco en paysage et environnement, 2004, www.paysage.
umontreal.ca/pdf/brocure.UNESCO.pdf
Feuillet de présentation Earthworks: Land Reclamation as Sculpture, Seattle,
King County Arts Commission, 1979.
Feuillet de présentation Dark Star Park, Rosslyn, Arlington County, Virginia,
1984.
Paquet paysage infoscan 11-12.indb 235 11/12/08 15:05:11
Vous aimerez peut-être aussi
- Passages et mers arctiques: Géopolitique d’une région en mutationD'EverandPassages et mers arctiques: Géopolitique d’une région en mutationPas encore d'évaluation
- Le Québec en changement: Entre l'exclusion et l'espéranceD'EverandLe Québec en changement: Entre l'exclusion et l'espérancePas encore d'évaluation
- L' Évolution du loisir au Québec: Essai socio-historiqueD'EverandL' Évolution du loisir au Québec: Essai socio-historiquePas encore d'évaluation
- Université Du Québec Montréal: EN Études UL ETDocument163 pagesUniversité Du Québec Montréal: EN Études UL ETshine moonPas encore d'évaluation
- Résurgences de La Tradition Des Icônes Orthodoxes RussesDocument117 pagesRésurgences de La Tradition Des Icônes Orthodoxes Russessaintclairchris4Pas encore d'évaluation
- 1760 Exposer Le Manuscrit LitteraireDocument87 pages1760 Exposer Le Manuscrit LitteraireimbertmylanPas encore d'évaluation
- Sur Nicolas de Staël Muma Lumière Du NordDocument44 pagesSur Nicolas de Staël Muma Lumière Du NordfranciscourregoPas encore d'évaluation
- La Cité coopérative canadienne-française: Saint-Léonard-de-Port-Maurice, 1955-1963D'EverandLa Cité coopérative canadienne-française: Saint-Léonard-de-Port-Maurice, 1955-1963Pas encore d'évaluation
- Les Oiseaux Dans L'écriture Égyptienne AncienneDocument152 pagesLes Oiseaux Dans L'écriture Égyptienne AncienneVincent DonvalPas encore d'évaluation
- 06 CCTP-expotemp-mariage VFDocument11 pages06 CCTP-expotemp-mariage VFthemagician31Pas encore d'évaluation
- 1 Hochstrasser Memoire DEADocument75 pages1 Hochstrasser Memoire DEArymPas encore d'évaluation
- Les Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?D'EverandLes Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?Pas encore d'évaluation
- City Guide 2021 2022Document31 pagesCity Guide 2021 2022nikafePas encore d'évaluation
- Gorrochategui - Linguistisque Et Peuplement en AquitaniaDocument30 pagesGorrochategui - Linguistisque Et Peuplement en AquitaniaFelix GimbrerePas encore d'évaluation
- Etude Archeologique Et Ethnohistorique D'un Site RupestreDocument208 pagesEtude Archeologique Et Ethnohistorique D'un Site RupestreouahidabdouPas encore d'évaluation
- Proche Orient 1876 1945Document109 pagesProche Orient 1876 1945Karim KhelifiPas encore d'évaluation
- Les Régions périphériques: Défi au développement du QuébecD'EverandLes Régions périphériques: Défi au développement du QuébecPas encore d'évaluation
- Exposition Merveilleux Trésor D'oignies: Éclats Du 13e Siècle Au Musée de Cluny Jusqu'au 20 Octobre 2024Document38 pagesExposition Merveilleux Trésor D'oignies: Éclats Du 13e Siècle Au Musée de Cluny Jusqu'au 20 Octobre 2024Jason WhittakerPas encore d'évaluation
- LaporteDocument161 pagesLaportethechnurfPas encore d'évaluation
- SOLOMOS Makis XenakisDocument132 pagesSOLOMOS Makis XenakisCédric Segond-GenovesiPas encore d'évaluation
- LDP 01Document54 pagesLDP 01BobPas encore d'évaluation
- Devisu Memomines 01 Livrable t1 1 Processus PatrimonialisationDocument77 pagesDevisu Memomines 01 Livrable t1 1 Processus PatrimonialisationRofi RofPas encore d'évaluation
- 0712 MiticNadiaDocument166 pages0712 MiticNadiaairb airbPas encore d'évaluation
- Un Nouvel Élargissement Du Corpus Littéraire en Malgache Moderne: Les Traductions Du CoranDocument474 pagesUn Nouvel Élargissement Du Corpus Littéraire en Malgache Moderne: Les Traductions Du CoranEly Jhons Ratsihoarana VELOTONGAPas encore d'évaluation
- Isabelle Duval EstienneDocument282 pagesIsabelle Duval EstienneClaudia FernandezPas encore d'évaluation
- Le de Historia Stirpium de Leonhart Fuchs Histoire D Un Succes Editorial 1542 1560Document110 pagesLe de Historia Stirpium de Leonhart Fuchs Histoire D Un Succes Editorial 1542 1560Julia VillardPas encore d'évaluation
- Mégalithes de Carnac, Du Golfe Du Morbihan Et de La Baie de Quiberon: Dossier de Confirmation Sur La Liste IndicativeDocument184 pagesMégalithes de Carnac, Du Golfe Du Morbihan Et de La Baie de Quiberon: Dossier de Confirmation Sur La Liste IndicativePaysagesDeMégalithes100% (7)
- A Guide To 1000 Foraminifera PDFDocument385 pagesA Guide To 1000 Foraminifera PDFMaria Elena Chavez MarreroPas encore d'évaluation
- CatalogueDocument162 pagesCatalogueRafaela CordeiroPas encore d'évaluation
- La Vallee de La Loire A L Epoque de JeanDocument481 pagesLa Vallee de La Loire A L Epoque de Jeanyahya333Pas encore d'évaluation
- Laurent Gervereau, Ver, Compreender e Analisar Imagens - FrancesDocument17 pagesLaurent Gervereau, Ver, Compreender e Analisar Imagens - FrancesCatarina PiresPas encore d'évaluation
- La transparence en communication: Une clé théorique et pratique pour la réussiteD'EverandLa transparence en communication: Une clé théorique et pratique pour la réussitePas encore d'évaluation
- Carsts de MuntanyaDocument180 pagesCarsts de MuntanyaJosep Manuel VictòriaPas encore d'évaluation
- Théories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardeD'EverandThéories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardePas encore d'évaluation
- D3497Document413 pagesD3497Fanida OumanssourPas encore d'évaluation
- (Publications Scientifiques Du Muséum National D'histoire Naturelle.) Jean-Pierre Debenay-A Guide To 1,000 Foraminifera From Southwestern Pacific - New Caledonia-IRD - MNHN (2012)Document385 pages(Publications Scientifiques Du Muséum National D'histoire Naturelle.) Jean-Pierre Debenay-A Guide To 1,000 Foraminifera From Southwestern Pacific - New Caledonia-IRD - MNHN (2012)Michelle CalistaPas encore d'évaluation
- Patrimoine ModerneDocument39 pagesPatrimoine ModerneAchraf ToumiPas encore d'évaluation
- Rites de La Mort en AlsaceDocument63 pagesRites de La Mort en AlsaceMònica Miró Vinaixa0% (1)
- Cultures TerritorialesDocument252 pagesCultures TerritorialesmallaguerraPas encore d'évaluation
- Les Poids du monde: Évolution des hégémonies planétairesD'EverandLes Poids du monde: Évolution des hégémonies planétairesPas encore d'évaluation
- Exposition Voyage Dans Le CristalDocument46 pagesExposition Voyage Dans Le CristalJason WhittakerPas encore d'évaluation
- 2014-Tali Gai Histoire PDFDocument107 pages2014-Tali Gai Histoire PDFMarina ViannaPas encore d'évaluation
- Catalogue Général Des Cartes, Plans Et Dessins D'architecture, Tome 4Document543 pagesCatalogue Général Des Cartes, Plans Et Dessins D'architecture, Tome 4MarinePas encore d'évaluation
- Temps culture et société: Essai sur le processus de formation du loisir et des sciences du loisir dans les sociétés occidentalesD'EverandTemps culture et société: Essai sur le processus de formation du loisir et des sciences du loisir dans les sociétés occidentalesPas encore d'évaluation
- Modelisation Par Elements Finis Banki PDFDocument162 pagesModelisation Par Elements Finis Banki PDFdjalikadjouPas encore d'évaluation
- GDM Magellan GeographieDocument324 pagesGDM Magellan GeographieStephane100% (3)
- Memoire Iris Momeux Mise en Valeur Ressources MuseesDocument126 pagesMemoire Iris Momeux Mise en Valeur Ressources Museessolange matshoPas encore d'évaluation
- Untitled - Engrenages (PDFDrive)Document144 pagesUntitled - Engrenages (PDFDrive)Yanis KemounPas encore d'évaluation
- Exposition Mysterieux Coffrets Au Musée de ClunyDocument41 pagesExposition Mysterieux Coffrets Au Musée de ClunyJason WhittakerPas encore d'évaluation
- Par Ici A1 Guide D 39 Exploitation PVdagogiqueDocument24 pagesPar Ici A1 Guide D 39 Exploitation PVdagogiquejose torresPas encore d'évaluation
- HDR MS FE DifDocument137 pagesHDR MS FE DifJulianna KeresztesPas encore d'évaluation
- Les Ax Pour Les Compositeur SDocument41 pagesLes Ax Pour Les Compositeur SMiquel JustCardonaPas encore d'évaluation
- Brunet-Rougemont-Rousset, Les Contrats AgrairesDocument41 pagesBrunet-Rougemont-Rousset, Les Contrats AgrairesLaura SoffiantiniPas encore d'évaluation
- L Evolution Des Bibliotheques MusicalesDocument87 pagesL Evolution Des Bibliotheques MusicalesDaniel PerezPas encore d'évaluation
- Module 1 - Élaborer Et Adapter en Continu L'offre de Produits Et de ServicesDocument22 pagesModule 1 - Élaborer Et Adapter en Continu L'offre de Produits Et de ServicesThomas RoyPas encore d'évaluation
- PrezentareDocument34 pagesPrezentareA. C. E.Pas encore d'évaluation
- Tapie: L'arrêt de La Cour de CassationDocument21 pagesTapie: L'arrêt de La Cour de CassationLaurent MAUDUITPas encore d'évaluation
- 02 InitiationDocument13 pages02 InitiationTRAOREPas encore d'évaluation
- PIP Attendes Et Besoin Plan D'action Délai Responsable: ClientDocument1 pagePIP Attendes Et Besoin Plan D'action Délai Responsable: ClientEimad BlyPas encore d'évaluation
- Les Destins de La MasturbationDocument20 pagesLes Destins de La MasturbationBruno KinoshitaPas encore d'évaluation
- Chap 5 Transistor JFET MOSFETDocument15 pagesChap 5 Transistor JFET MOSFETBLYNK STEELPas encore d'évaluation
- Ar Bilan Sci 2021Document1 pageAr Bilan Sci 2021thivoyonPas encore d'évaluation
- Tarea 4 Conversacion Francesa 1 Exercices - Du - Devoir - 4. LewinDocument5 pagesTarea 4 Conversacion Francesa 1 Exercices - Du - Devoir - 4. LewinDilenny APas encore d'évaluation
- Management Des Systemes Dinformation - ExposeDocument13 pagesManagement Des Systemes Dinformation - Exposepascal sohoPas encore d'évaluation
- Bacacier-Pannes ZDocument4 pagesBacacier-Pannes ZM MEHENNIPas encore d'évaluation
- Chap2 GSM PDFDocument55 pagesChap2 GSM PDFNisrine BahriPas encore d'évaluation
- NF DTU 34.1 P2 Mise en Oeuvre Des Fermetures Et StoresDocument21 pagesNF DTU 34.1 P2 Mise en Oeuvre Des Fermetures Et StoresPatrick GARCIAPas encore d'évaluation
- B1 Rédiger Une Lettre de Motivation EnseignantDocument10 pagesB1 Rédiger Une Lettre de Motivation EnseignantRexeyPas encore d'évaluation
- Targum Ou TargoumDocument5 pagesTargum Ou TargoumyeshuaPas encore d'évaluation
- Croquer La Vie À Pleines Dents Exprime L AccordDocument3 pagesCroquer La Vie À Pleines Dents Exprime L AccordylonikaPas encore d'évaluation
- Actionnariat SalariéDocument4 pagesActionnariat SalariéLamyaa ErrayPas encore d'évaluation
- Formation Sur L'évaluation Au Cycle SecondaireDocument3 pagesFormation Sur L'évaluation Au Cycle Secondairemourad oumansourPas encore d'évaluation
- Classification Des LogementsDocument1 pageClassification Des LogementsPaul KoudougouPas encore d'évaluation
- GP Chut Je Lis PDFDocument240 pagesGP Chut Je Lis PDFsherrie_gimenezPas encore d'évaluation
- Chapitre-4 Démographie L1Document9 pagesChapitre-4 Démographie L1Khalil ByPas encore d'évaluation
- Le Message PhotographiqueDocument13 pagesLe Message PhotographiqueericooalPas encore d'évaluation
- Rapport Reconstruction PDFDocument37 pagesRapport Reconstruction PDFsamvipPas encore d'évaluation
- Market SensoDocument10 pagesMarket SensoDaouda MagassoubaPas encore d'évaluation
- 16 M.ncaDocument132 pages16 M.ncaAbdouli Roukaya100% (1)
- Evenements 2Document24 pagesEvenements 2Daniela BunoaicaPas encore d'évaluation
- Emma Et La Perle Blanche PDFDocument25 pagesEmma Et La Perle Blanche PDFMonica M EtchegarayPas encore d'évaluation
- Rapport Hebdomadaire CHECDocument31 pagesRapport Hebdomadaire CHECSoria LouboungouPas encore d'évaluation
- Dossier Steeman Biblio FilmoDocument36 pagesDossier Steeman Biblio FilmoWriterIncPas encore d'évaluation
- 7 Étapes Pour Lancer Sa Marque de VêtementsDocument13 pages7 Étapes Pour Lancer Sa Marque de VêtementsmedhiferrosPas encore d'évaluation