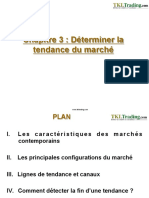Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Deflation en Pratique Charles Rist 1924 Extraits
La Deflation en Pratique Charles Rist 1924 Extraits
Transféré par
rzbc0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues35 pagesTitre original
34275619 La Deflation en Pratique Charles Rist 1924 Extraits
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues35 pagesLa Deflation en Pratique Charles Rist 1924 Extraits
La Deflation en Pratique Charles Rist 1924 Extraits
Transféré par
rzbcDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 35
BIBLIOTHQUE INTERNATIONALE D'CONOMIE POLITIQUE
publie sous la direction d'Alfred Bonnet
LA
DFLATION
EN PRATIQUE
(Angleterre, tsts .. Unis, France, Tchco-Slbvaqule)
PAil
CHARLES RIST
Professeur d'conomie politique l ~ Facult de Droit de Paris
MARCEL GIARD
X.iBRAIltE-DITEUR
16, RUE SOUn.tOT' ET 12, RUE TOULLIER
PARIS (5')
1924,
. -';._
......
AV PROPOS' ',. "
,!. " ,
. , ,:
Nous assistotisdepuis la guerre aU3)expr,i'enes,mone-
taires les plus aries et les. pius instru-ctives "fUele monde
ait jamais ues.
VoulOir y dcourir toute .force la pri fication de telle
ou telle thorie, a priori, serait assi la mthode
-scientifique qu' la' bonne foi. Par contre, contrle des
thories anciennes et adaptatio'rt aux faits noueaux
est pour l'conomiste une tche d'un grand intr3.t. '
L'exprience en conomie politique comme en toute autre
science est le souperain mtre. Obserper les laits, puis 8S-
sayel' de les interprter, en tenant compte de toutes les obser- '
pations srieuses, c'est la seule mthode fconde.
Or, les faits qui se droulent depuis quatre ans en Angle-
tel're, aux Etats- Unis, en France, en T'chco- Sloaquie, ne
paraissent pas confirmer la conception de la dflation
telle que la logique rationnelle la lorme a priori. Le mc,a-
nisTYte par lequel s'accomplit dans un pays troubl par l'in-
flation le montaire, est plus compliqu que
celui qu'on imagine 'd'or4inaire, sans cesser pour cela de
rester conforme ,ce que nous' sapons des lois gnrales ,des
prix. Nous apons essay; dans nos conclusions, d'exposer
ce mcanisme tel est apparu.
De noupelles expriences se poursuient sous nos yeux.
Les .anciennes se continuent, Nous en plus
tard les rsultats aeC ceux que nous exposons ici. Il ne
VI AVANT PROPOS
nous a pas sembl ncessaire d'attendre que tous les pays
lusSent repenus une monnaie saine pour raconter l'his-
toire de ce retour, aprs le fait accompli. Nous croyons plus
profitable, mme au risque d'apoir un jour modifier nos
conclusions, 'd'exposer ds maintenant les rsultats auxquels
les rcentes expriences condui8tmt l' obserpateur sans parti
pris que nous avons essay d
j
tre. S'ils poupaient, t ~ l s
qu'ils sont, servir si peu que ce soit clairer notre .politi-
que montaire et surtout jendre plus nergique et plus
sincre ~ o t r ~ po.litique budgtaire, l'a'mbitii)1i de l'auteur
serait pleinn:ent satisfaite (1).
(1) Quelques-unes des pages qui 'suivent ont paru sous forme d'ar-
ticles dans ie Moniteur des Intrts matriels d 1922 et 1923. Nolis re-
mercions le journal qui avait bien voulu les accueillir dans leur forme
premire, de nous avoir autoris les reproduire ici, trs sensiblement
modifis. ' ,
,'"
\
LA
DF'LATION'
EN PRATIQUE
CHAPITRE PREMIER
Qu'entend-,;>n par Dflatiqn?
Le mot dflation est employ dans des acceptions trs
diverses. Il importe de les prciser pour viter des qui-
voques et mettre quelque clart dans l'expos, qui va
suivre, de politiques diffrentes, catalogues cepen-
dant par l'opinion courante sous une seule et mme ru-_
brique.
i 0 Dans son acception la plus radicale" dflation signi-
fie rduction matrielle des instru,inents de circulation.
L'opration comporte non seulement le retrait, mais la
destruction dfinitive d'une partie du pouvoir d'achat
supplmentaire (dont la cration constitue justement l'in-
flation) avec interdiction' de la remettre en circulation.
Evidemment, ce type de dflation ne peut s'appliquer
qu'au cas o l'inflation a eu lieu par l'mission, soit de
billets de banque cours forc, soit de billets
tous susceptibles d'une destructiou totale.
Quand le pouvoir d'achat a t cr, non sous forme
de billets, mais sous forme en compte cou-
rant, - de simples crdits en banque circulant pr le
Riet i
2 J.A ,DVLATIO!'l EN PRATIQUE
m ~ y e n de chques (et l'on sait que cette mthode a t
largement employe pendant la guerre, aussi bien par
les banques de dpt prives, que par certaines banques
d'mission, comme la Banque d' Angleterre), - la destruc-
tion matrielle de ces crdits (une fois rembourss) ne
peut naturellement avoir lieu. S'il s'agit d'une banque cen-
trale dont le statut est rgl par la loi, on pourrait cepen-
dant concevoir une interdiction d'accorder de nouveaux
crdits aprs le remboursement des premiers. Cette me-
sure correspondrait la destruction des billets de banque
ou des billets d'tat, dans les pays o l'inflation a eu
lieu sous cette dernire forme. En fait, nous ne connais-
sons pas d'exemple d'une mesure semblable. Quant aux
banques de dpts prives, elles sont videmment tou-
jours libres de crer de nouveaux crdits, mme au profit
de l'tat, pour remplacer les crdits rembourss. En
pratique cependant cette libert n'est pas absolue, car
leur scurit repose sur la facilit avec laquelle elles
trouveront auprs d'une instance suprieure (Banque
d'mission, ou Trsor) les 'instruments de payement n_
cessaires en cas de retrait de leurs dpts. Leur facult
de crer des crdits est donc limite par les possibilits
de. cration montaire, soit de la Banque centrale
d'mission, soit du Gouvernement. Ces possibilits fixent
aux banques de dpts prives des limites difficiles ou
mme impossibles franchir.
Le problme de la dflation - au sens radical du mot
- se ramne donc au problme de restreindre la mon-
naie de circulation cre par la Banque centrale ou par
l'tat, monnaie dont l'abondance fixe, en dfinitive, les
limites de cration du, pouvoir d'achat par les autres
banques. Tant que cette monnaie de circ.ulation n'a
pas subi de diminution, les banques de dpts n'ont
QU'E:iTEND'O:'/ l'AR DFLATION? 3
aucun motif de restreindre le chiffre des crdits qu'elles
peuvent accorder mme l'tat, ou aux particuliers d-
sireux de prter l'tat.
20 Ceci nouS conduit au deuxime sens souvent donn
au mot dflation, sens plus modr, si l'on peut ainsi
que le prcdent.. ..
On entend souvent, par dflation, le simple rembourse,-
ment aux banques des moyens de paiements crs par
.elles au profit de l'tat (billets ou crdits) -les banques
restant, d'ailleurs, li bres de les employer nouveau au
:gr des besoins du commerce. Dflation n'est plus alors
synonyme de contraction montaire par destruction de
moyens de paiement. Le mot signifie substitution. de
-moyens de paiement gags sur des ?prations
oeiales, des moyens de paiement gags sur les promesses
.de l'tat, ou encore restitution par l'tat en tapeur du
-commerce et de l'industrie d'instruments de paieme.nt pri-
mitivement crs son seul
A vec cette mthode, le chiffre des instruments
taires, soit sous forme de billets (de banque ou d'tat),
soit sous forme d'inscriptions en compte courant tili-
sables par chques, peut rester inchang, au moins en
prmClpe.
En pratique, videmment, la remise en circulation
billets ou des crdits rembourss pourra se faire attenlre
.plus ou moins longtemps .. Elle dpendra de
.des bsoins de crdit du commerce et de l'industrie.
.s'effectuera plus ou moins vite, suivant que l'on sera en
priode de dpression ou d'essor conomique. Elle
tera cependant toujours possible, tandis qu'elle tait
,exclue dans la conception prcdente de la dflation.
L'effet du remboursement des crdits accords par
les banques l'tat ne sera plus aiors de rdl!ire
r ......
4 LA DFLATION EN PRATIQUE
directement les instruments montaires, mais d'accrotre
la marge de crdit dont disposent les banques au bnfice
des besoins privs. Les banques useront-elles ou non de
cette marge ? C'est une question de fait. Mais si elles
sont amenes en user, cette marge accrue vitera le
risque que l'on courrait sans cela, d'obliger la Banque
d'mission franchir la limite maximum d'mission que
la prudence lmentaire commande, comme nous le ver-
rons, delui assigner en rgime de papier-monnaie.
3
0
Quel que soit le systme adopt -le type radical
ou le type modr - dans les deux cas la prface de la
dflation est le remboursement par l'tat (soit sur le
produit d'emprunts long terme, soit sur lei!! e'xcdents
budgtaires) des s.ommes qui lui ont t avances par'
les banques. Une autre mthode consiste pour les banques
cder au public les titres d'emprunt ou les bons du Tr-
sor qu'elles avaient elles-mmes mis en p'ortefeuille, et
dont elles avaient avanc le prix leur clientle en crant
des crdits. Cette seconde mthode, comme la premire,
ramener la banque le pouvoir' d'achat origi-
naire'ment cr par elle ex nihilo, retour qui s'accomplit
grce des sommes prleves cette fois sur l'pargne
vritable du public, c'est--dire au moyen d'un revenu
efiectif que le public renonce consommer.
Ce remboursement des crdits est opration dis-
tincte de la remise ou de la non-remise ultrieure en cir-
culation des crdits rembourss. Nous appellerons dans
ce qui suit dflation' financire Il ce remboursement. La
dflation financire est ou non accompagne d'une d-
flation montaire, selon qu'en fait elle 'aboutit ou non
une restriction des instruments montaires en circula-
tion, ou des en. banque utilisables par chques.
II importe de distinguer les deux oprations. La dfia-
'"
,"".. ,
PAR DFLA;TION! 5
ti-on financire prcde toujours la' dflation
Mais la seconde n'intervient pas
la premire est ralise. Il peut y avoir. dfl.ation ,
financire sans dflation montaire conscutive. Il
,fit pour cela que les crdits ou les billets rembouI:ss
soient remis ensuite en circulation.
On voit, ds maintenant, quels conflits d'intrts vl)nt .'
natre d'une politique de dflation.
se rsume en une amputation du revenu'
des particuliers, tel qu'il s'est tabli la suite de.l'infla- .
tion. Amputation dfinitive si les crdits rembourss
sont dfinitivement dtruits (dflation radicale) - am-
putation momentane si les banques les remettent en
circulation (dflation modre). Mme dans ce dernier
.cas, les particuliers ne retrouveront qu' titredeprts
-des sommes qu'ils possdaient en pleine proprit avant
de les verser l'tat ou aux banques.
Cette amputation est-elle lgitime? En apparence on
rentre simplement dans l'ordre. La dpens'e d'tat ini-. ,
tiale, cOJ.1trairement la nature des choses, et grce la
-cration montaire en quoi consiste'justement l'inflation,
n'avait exig de personne aucun sacrifice de revenu. 'Le
remboursement, ultrieurement prlev sur la vritable
pargne, constitue tardivement ce sacrifice, et permet de
faire disparatre la monnaie cre qui en tenait lieu.
Mais ce n'est qu'une apparence. Car le remboursement
intervient gnralement quand tout le systme conomi-
que a eu le temps d'tre transform par la hausse .des .
prix, consquence elle-mme de l'inflation originaire. Or,
cette hausse des prix, si elle s'est prolonge, a forc in-,
direct,ement le s!lcrifice de revenu que l'on avait cru,
esquiver l'origine. La dprciation gnrale de la mon-
naie, en rduisant le pouvoir d'achat d'u revenu
6 LA DFLATION PRATIQUE
rduit le revenu rel des particuliers du montant de tous
les biens et services que l'tat, par le papier-monnaie, a
dtourns son profit.
La dflation, en amputant son tour le revenu, n'opre
donc pas une restitutio in integrum, mais ajoute un sa-
crifice nouyeau celui que l'inflation. avait dj con-
somm en sourdine.
Ce nouveau sacrifice, succdant au premier, ne peut se
justifier que de deux manires : soit par des avantages
montaires, - tels que le retour du change national au
pair ou l'obtention d'une marge d'lasticit garantissant
contre une inflation nouvelle; - soit par le dsir de ren-
. dre au revenu des personnes dpouilles par l'inflation
un pouvoir d'achat plus lev. On admet, en effet, que
rparties sur une assez longue priode et frquemment
rptes, les amputations successives de revenu ragissent.
sur le niveau des prix pour l'abaisser. D'o un dplace-
ment du revenu rel inverse de celui qui s'tait effectu
au cours de la priode d'inflation, car l'apprciation de
la monnaie profitera surtout aux bnficiaires de .revenus
fixes, les plus prouvs par la crise prcdente de dpr-
ciation.
Seulement cette baisse des prix met elle-mme toute
l'conomie dans un grave tat de malaise, trs dfavora-
ble la production.
Il arrive un moment o les avantages purement mon-
taires de la dflation, risquent d'tre compenss par ses
inconvnients conomiques.
Au lieu d'employer l'pargne des emprunts ou des ex-
cdents budgtaires rduire le chiffre des instruments
de circulation, c'est--dire dtruire des revenus
naux,ne pas mieux laisser les particuliers
l'employer ? Au lieu de relever, en les
,.
dtruisant, le pouvoir d'achat des billets de banque
prtexte de rembourser l'emprunt forc originairemen,t
ralis par l'mission) - n'est-il pas prfrable de
bourser les souscripteurs des emprunts volontaires, - ce
qui allgerait les finances de l'tat, tout en laissant aux
mains des particuliers le capital rembours, et en facili-
. tant ainsi une reprise de la production, trs favorable
l'apprciation mme de la monnaie?
Telles sont les questions que soulve la dflation, et
c'est dans la balance tablir entre ses avantages mo-
ntaires et ses inconvnients conomiques, que rside
toute la 'difficult.
Celle-ci s'accrot encore si l'exprience dmontre que
les effets montaires eux-mmes, gnralement at-
tendus d'une dflation radicale, ne se produisent pas
toujours, - si l'on constate par exemple que la monnaie
retire d'un ct par l'impt ou l'emprunt, rapparat de
l'autre sous forme de crdits de banque, les particuliers,
pour payer l'impt ou souscrire l'emprunt, tant
obligs de recourir aux avances de leurs banquiers.
C'est ce qui s'est produit, nous le verrons, en
Slovaquie.
Nous nous bornons, pour le moment, signaler la dif-,
ficult, sans l'examiner de prs.
Deux remarques cependant doivent tre faites tout de
suite:
La premire, c'est qu'il n'y a pas de solution a priori
au problme de la dflation. Quoi qu'en disent ou pensent
certains publicistes -les uns toujours disposs dclarer
l'eonomie politique en tat de faillite, les autres trop
enclins donner de simples prfrences person,nelles pour'
des dogmes ternels de la Science ll, -'- il n'y a' pas sur
8 J..\ DFLATlO:-r ElX PRATIQUE
cette question de solution orthodoxe ni de solution hr-
tique. Il s'agit d'un problme pratique, comportant,
comme tous les problmes pratiques, des solutions di-
verses suivant les poques et les circonstances. Les effets
de la quinine sont scientifiquement connus. Mais son
dosage ou mme son emploi varie suivant les personnes
et les maladies. Il en est de mme de la dflation. Tout au
plus pourrait-on noter qu'il existe de la part des hommes
politiques et des hommes d'affaires une tendance sous-
estimer les risques permanents des maladies montaires
et s'exagrer, par contre, - les inconvnients cono-
miques momentans qu'entrane leur gurison. Ce qui
les incline volontiers traiter de dogmatiques les co-
nomistes, plus sensibles qu'eux aux dangers d'une mau-
vaise monnaie, parce qu'ayant gard une mmoire plus
fidle des expriences du pass.
D'ailleurs - et c'est notre deuxime remarque - le
conflit d'intrts signal tout l'heure ne se prsente
que lorsqu'un tat est devenu capable de rembourser sa
dette, c'est--dire quand son budget est en quilibre.
Jusque-l il ne saurait vritablement s'agir pour lui de
dflation, mais seulement d'un arrt plus ou moins com-
plet de l'inflation. Et, par suite, les dangers de la d-
flation peuvent y tre ngligs.
4
0
Jusqu'ici nous avons distingu deux types de d-
flation bass l'un et l'autre sur une dflation
financire pralable.
Or, il en existe un troisime, fort diffrent des prc-
dents. C'est celui dont la crise de 1920 nous a donn le
spectacle. Et c'est lui que l'on vise trs souvent - sur-,
tout en Angleterre et aux tats-Unis - par le mot
dflation .
On entend par l le fait de provoquer par une hausse
PAR OFLATIO:'l? 9
du tattX de l'escompte une baisse des prix et un arrt de
la spculation, quand celle.ci s'est dveloppe au point
de devenir dangereuse. Les tats-Unis ont recouru ce-
mode de dflation, au dbut de 1920, afin de protger
leur talon d'or menac. Les banques d'mission euro-
pennes, en suivant leur exemple, n'ont fait que s'incliner
devant une inluctable ncessit. La dpression conscu-
tive s'est accompagne d'une rduction, cette fois spon-
tane, de la circulation, tenant la baisse gnrale des
prix. Cette dflation spontane s'oppose la dflation
voulue, envisage plus haut.
C'est celle laquelle on assiste la suite de toute grande
priode d'essor conomique. La provoquer est un devoir
pour toute grande d'missi?n consciente de son
rle conomique.
Elle s'oppose essentiellemmt aux types prcdents,
en ce qu'il s'agit ici d'une dflation des crdits privs, et
non d'une dflation des crdits crs au profit de l'tat,
la seule dont il ait t question plus haut. NQUS propo-
sons de l'appeler dflation de crdit pour l'en distinguer.
Ces deux types de dflation ont cependant quelque chose
de commun: ils impliquent l'un et l'autre une rduction
des revenus nominaux des particuliers, la baisse des prix
conscutive la hausse du taux de l'escompte quivalant
une diminution de tous les revenus. la rd uc.
tion rsulte dans un cas de la baisse des prix,dans l'autre
d'un prlvement direct sous forme d'emprunt ou d'impt.
D'ailleurs, la dflation spontane de crdit peut conduire
une dflation lloulue. On peut profiter, en effet, du
retour de la monnaie dans les banques ou au Trsor pour
en supprimer dfinitivement une certaine portion. C'est
la mthode suivie en Angleterre pour la rduction des
Currency- Notes.
-.
10 LA EN PI\ATIQUE
Seulement, dans ce cas, comme prcdemment, 1111
dflation n'est relle que si I;tat: est en soit.
grce des excdents budgtaires, soit grce des em-
prunts long terme, de ne pas remettre en circulation
sous une autre forme la monnaie de papier qui .lui est
spontanment revenue.
Les types de dflation que nous venons de distinguer
_ ne le sont pas toujours nettement, mme par ceux qUJ
sont chargs de formuler la politique montaire des.
grands pays. Il est vrai qu'ils se mlent frquemment
dans la ralit. comme on va le voir, ni leur-
origine, ni leurs effets, ni leur mcanisme ne sont les.
;mmes.
Nous abordons maintenant l'examen des mthodes
pratiques de dflation, telles qu'elles ont t conues
et appliques depuis la fin de la guerre. Nous rsume-
rons, dans un chapitre final, les conclusions qui sem-
blent se dgager de ces expriences.
Nous commenons par la mthode anglaise.
..
CHAPITRE IV
La dflation en Franoe
En France, la politique de dflation n'a jamais t
officiellment dfinie avec la mme prcision qu'en An-
gleterre, ou aux tats-Unis.
Thoriquement ou, si l'on prfre, juridiquement, le
problme se pose dans les termes les plus simples.
L'inflation s'tant effectue sous la forme d'aYancea
successivement consenties par la Banque de France au
gouvernement - avances qui avaient 17.150 mil
lions la fin de la guerre (31 dcembre 1918) et 26 mil- '
liards un an aprs -la dflation doit, semble-t-il, se ra-
liser tout naturellement par l'opration inverse: le rem-
boursement graduel des dites avances par les soins du
gouvernement, jusqu' complet acquittement de la dette.
Mais c'est l une manire toute formelle de poser le
problme. En fait, le lien juridique spcial qui unit la
Banque d'mission l'tat et qui rsulte de la mthode
adopte en France (comme en Allemagne et en Italie) pour
mettre le. a simplement pour cons-
quence que la politique montaire laquelle on s'arrtera
ne pourra se dfinir et se raliser que d'accord avec la
Banque. Des conventions interviendront ncessairement.
Seulement, ces conventions devront tre et seront cer-
LA DFLATION EN FRANCE 6'1
.' lent domines par une conception non troitement
talDen
, 'd'que mais conomique du problme montaire, et
Jun l , .
ar ce large souci de l'intrt gnral qui a toujours
p bd" "f '
caractris la grande anque emlSSlOn ranalse.
Laissant donc de ct l'aspect juridique, nous envisa-
gerons, ici, le seul aspect conomique de la question.
Les principes
Et, d'abord, quel est le but auquel on tend?
En Angleterre, le but nettement affirm, ds l'origine,
par la Commission Cunliffe, a t le retour de la livre
sterling au pair,
En France, le retour du franc au pair - quoiqu' di-
verses reprises la possibilit en ait t formellement r-
serve - est toujours apparu comme un idal trop loin-
tain pour pouvoir ds prsent fournir une directive
pratique, Le but prochain -le seul qu'il soit intressant
de prciser - a toujours t formul par la Banque d'une
manire beaucoup plus circonspecte et moins ambi-
tieuse : il consiste simplement rendre l'mission l'las-
ticit qui lui manque, en substituant la circulation gage
par des bons du Trsor une circulation gage par des
garanties commerciales. A plus d'une reprise la Banque,
dans ses a exprim cette ide, que les
billets rembourss par l'tat ne devaient pas, dans sa
pense, tre sans retour, mais seraient, au con
traire, restitus la circulation au fur et mesure que
les besoins commerciaux l'exigeraient (1). C'est le type
de dflation que nous avons qualifi de dflation mo
(1) La mme ide a t mise par M. Decamps dans
ses nombreuses et intressantes communications sur la politique de
la Banque de France,
ii2
J.A DFLATJO!'I E!'I PRATIQUE
dre, par opposition la dflation radicale, qui con-
s i ~ t e 'dans la rduction dfinitive de la circ.ulation.
Les dclarations du gouverneur de la Banque l'As-
semble gnrale des actionnaires ne'laissent aucun doute-
cet gard,
Si, dans l'assemble du 30 janvier 1919, il se bornait
constater que l'excdent de billets de banque ... pse-
sur les conditions des changes et aggrave la crise des
prix , et concluait simplement la ncessit d'allger
progressivement notre circulation ! dans celle du 27
janvier 1921, il prcisait sa pense. Il s'agissait, di-
sait-il, de rcuprer une certaine marge d'mission,
non pour provoquer une dflation trop rapide que les cir-
constances ne permettraient pas, mais pour l'appliquer,
au contraire, dans toute la mesure nessaire aux besoins
industriels et commerciaux -. Dans l'assemble de jan-
vier 1922, il revenait sur cette ide l'occasion des rem- .
boursements effectus par l'tat en 1921. Il voyait,
d'abord, dans ceux-ci une tape dcisive vers une liqui-
dation progressive des emprunts que les ncessits de la,
guerre ont oblig l'tat faire la circulation , puis il
ajoutait: ils restituent, enfin, notre pouvoir d'mis-
sion l'lasticit ncessaire pour nous permettre de fair
face tous les besoins du crdit commercial et industriel.
Tel tant le but - au moins le but prochain - pour-
suivre, la mthode employer pour le raliser 'a t for-
mule successivement dans les conventions des 14 avril
et 29 dcembre 1920 : elle consiste dans le rembourse-
ment par l'tat d'une somme. de 2 milliards, chaque
anne, de manire ramener successivement la dette
de l'tat 25 milliards le 1
er
janvier 1922, puis 23 mil-
liards le 1
er
janyier 1923, et ainsi de suite, jusqu' com-
plet remboursement. Cette mthode a t inspire visi-
'Ji
]
:
LA EN FJUl\CE
blement de celle qui avait t adopte aprs la guerre
franco-allemande, quand par la loi' du '21 juin 1871,
l'tat prenait de rembourser la Banque
raison de 200 millions par an. C'est ce prcdent que-
M. Ribot rappelait dans son clbre expos des motifs du
budget de 1915, et qui a inspir l'article 3. de la Conven-
vention avec la Banque du 21 septembre 1914, signe
par lui, article depuis par toutes les conven-
tions subsquentes et ainsi conu :cc L'tat s'engage .
rembourser dans le plus court dlai possible les avances.
faites l'tat par la Banque, soit au moyen des res
s{)Urces ordinaires du budget, soit sur les premiers em
prunts, soit sur les autres ressources extraordinaires dont.
il pourra disposer. Les conventions de 1920 n'ont fait
que prciser les modes d'excutin de cet engagement.
gnral, pris vrai dire li une poque o personne ne
souponnait ni la dure, ni le montant formidable des.
avances qu'exigerait la guerre.
A premire vue, on trouvera que la mthode formule
par ces conventions dpasse singulirement le but pour-
suivi, si ce but est simplement. de rendre l'mission de
la Banque l'lasticit ncessaire. d'un passage des
rapports du gouverneur pourraient faire croire effective-
ment une ambition plus vaste: les mots cc rtablir la
situation montaire (Rapport de 1920) ou cc rtablir un-
rgime montaire normal (Rapport de 1919) (1), sem-
(1) Parlant de l'actif de 20 milliards immobiliss constitu par la
dette de l'Etat le rapport .dit : Il faut maintenant s'efforcer de
dgager cet actif dans le plus bref dlai possible. L'excdent de bil-
de banque, qui en est le passif, la contre-partie, pse sur les con-
ditIOns des changes et aggrave la crise des prix. Il importe donc
d'allger progressivement notre circulation. Le remboursement d&
la dette de l'Etat envers la Banque est la condition ncessaire de cet
allgement et l'unique mC!,yen de rtablir un rgime montaire normal.
-64 LA DFLATION E:-I PRATIQUE
blent signifier l'intention de revenir la situation d'avant-
guerre. Mais, nous l'avons dit dj, le devoir de la Banque
.et de l'tat tait de rserver la libert de leur politique
montaire dans l'avenir. Et, d'autre part, il s'agissait
avant tout de barrer la route dfinitivement toute infla-
tion future. Il fallait, contre toute tentative" de cet ordre,
lever une barrire, qu'on ne pouvait construire ni trop
haute ni trop solide, si, comme le disait encore le gou-
verneur, le 27 Janvier 1921, on voulait;qu'il en rsultt
, formelle que l'on peut dsormais, en toute
scurit, contracter en francs, long comme court
terme, parce que la valeur -du franc sera, enfin, rsolu-
ment soustraite l'influence artificielle des besoins de
l'tat )J.
Soustraire rsolument la raleur du franc l'influence
,artificielle des besoins de l'Etat, voil probablement la
formule qui, l'heure actuelle, traduit le plus heureuse-
ment le but prochain de la politique montaire franaise.
C'est une formule de non-inflation, bien plus qu'une for-
mule de dflation. Cependant les conventions conclues
imposent formellement une certaine dflation, au moins
pour le prsent.
La politique montaire franaise, n'est donc pas exempte
.dans ses formules d'un certain flottement. Elle ne dpend
pas d'ailleurs de la Banque seule, mais aussi des pouvoirs
publics. Rien d'tonnant si ce mme flottement se re-
trouve dans l'application.
L' ap plication
On distingue dans les pratiques suivies depuis l'armis-
tice trois phases : .
iODe dcembre 1918 jusqu' dcembre 1920 la circu'
LA DFLATION EN FRANCE
65
-
lation a constamment augment. ,Loin d'assister 'une
dflation, on observe une inflation croissante.
20 En 1921, tout' change. La pirculation diminue.
L'tat fait la Banque ses premiers remboursements.
On pourrait croire un tournant dcisif. Il n'en est rien.
Car quoi tient, en ralit, cette rduction de la circula-
tion ? A l'amlioration de la situation budgtaire? Nulle-
ment. Il s'agit - nous allons le voir - d'une dflation
de crdit semblable celle que nous avons constate en
Angleterre.
30 Aussi voit-on, ds la fin de 1922,ls difficults
rapparatre avec la reprise des affaires. L'tat demande
une nouvelle prorogation. Ses remboursements pour cette
anne sont limits un milliard au lieu des deux prescrits
par les conventions.
Les chiffres correspondant ces trois phases sont nces-
saires rappeler ici.
D'abord, l'augmentation de l'inflation de dcembre
1918 dcembre 1920 :
En dcembre r 918, la oirculation s'levait
le maximum lgal de l'mission lait fix
le maximum des avances l'tal lail arrAt .
la delle du Trsor se mon lait .
millions;
33 ;
21 milliards ;
17 .150 millions (1).
Deux ans aprs, en dcembre 1920, nous trouvons
la circulation . . . . .
son maximum lgal fix . .
le maximum des avances l'tat port .
el la delle effecti ve de l'Elal leve
37.552 millions;
41 milliards ;
27 milliards;
26.600 millions.
(1) Nous ne mentionnons pas les' 3.526 millions emprunts la
Banque pour faire des avances aux gouvernements allis; ils subissent
le taux ordinaire d'escompte et ne sont pas compris dans le montant
utilisable des avances l'tat. l'
Rist
5
66 LA DFLATION EN PRATIQUE
Que s'est-il pasil dans cet intervalle?
Deux ordres diffrents de circonstances expliquent
l'aggravation.
D'une part, au cours de l'anne 1919, l'tat a
demand et obtenu l'lvation, deux reprises, du maxi-
mum de ses avances :. d'abord 24 milliards (13 fvrier
1919), puis 27 milliards (convention du 24 avril 1919).
La premire augmentation fut accorde assez aisment
par la Banque, t ~ n t motive, en partie, par le retrait des
coupures locales mises pendant la guerre dans les rgions
envahies, et par l'introduction du franc en Alsace et en
Lorraine. Mais la deuxime ne fut consentie qu'aprs
un premier refus. Elle ne pouvait s'expliquer, en effet,
que par l'imprvoyante politique financire du ministre
d'alors, M. Klotz. Elle s'accompagna d ~ l'lvation
. 40 milliards du maximum d'mission.
L'anne 1919 pse lourdement, encore aujourd'hui, sur
la situation montaire fran.{aise.
Au cours de l'anne 1920, ce sont les circonstances co-
nomiques gnrales et la crise mondiale qui ont fait
craindre, . un moment, que la marge d'mission de la
Banque ne ft trop troite pour ,rpondre aux besoins
du commerce. Le portefeuille commercial passait de.
1.268 millions le 24 dcembre 1919 3.276 millions au
24 dcembre 1920, et s'levait, un moment, jusqu'
3.660 millions (3 novembre 1920). A la veille des va-
cances parleIl!-entaires, le gouvernement se fit autoriser (1)
lever, par dcret, le cas chant, la limite d'mission
des billets de 40 43 milliards pour les besoins du com-
merce. Le 28 septembre, il fit usage de ce droit en fixant
\ .
la limite 41 milliards. Le maximum, effectivement
(1) Article 74 de la loi de finance du 31 juillet 1920.
t
*
1
Il
1
LA DFLATION EN FRANCK
67
atteint au cours de l'anne, fut celui de 39.645 millions
(le 3 novembre). Incident qui prouvait la ncessit d'une
marge d'mission suffisante, si l'on voulait l'avenir
viter qu'un essor un peu vif des affaires n'aboutt une
inflation supplmentaire.
Avec 1921, la dflation commence, enfin. C'est la
deuxime phase. .
Une srie de remboursements ramnent au 31 d-
cembre 1921 le montant des avanes l'tat 24.600
millions.
Les premiers mois de 1922 voient l'opration se conti-
nuer, et la dette de l'tat, au 16 mars, touche le mini-
mum de 21.200 millions.
En mme temps, la circulation est rdui,te ,en d-
-cembre 1921 36.417 millions, soit de plus d'un milliard
par rapport l'anne prcdente.
Quels ont t les caractres de cette dflation et ses
-consquences? Pourquoi, aprs avoir suscit quelques
.espoirs, a-t-elle t interrompue au mois de dcembre
1922, si bien qu'aujourd'hui les billets en circulation
.atteignent de nouveau 37 milliards et demi?
Nous assistons ici un phnomne tout fait ana-
logue celui que nous avons vu se produire en Angle-
terre et aux tats-Unis.
De mme qu'en Angleterre, la dflation de crdit )
-dclanche en 1920 a provoqu la baisse des prix, le ra-
l&ntissement des affaires' et, par voie de consquence,
,une rduction des besoins d'argent liquide permettant le
reflux des Currency Notes la Banque d'Angleterre et
-au Trsor, - de mme en France, les rserves mon-
taires du public, multiplies par la crise, ont reflu vers
les bons de la Dfense nationale dont l'mission continue
Iournit un placement rmunrateu,r (beaucoup plus rmu-
68 LA DFLATION EN PRATIQUE
nrateur que les comptes courants en banque) pour ses
disponibilits. Le 'rsor, ainsi directement approvisionn
par le public, a pu se passer de la Banque. D'o la rduc-
tion de sop. compte courant, graduellement descendu
jusqu' 21.200 millions, chiffre du 16 mars 1922.
La dflation, loin d'tre une cause; n'a t qu'une con-
squence de la baisse des prix.
Par suite ds 'qu'en 1922 s'est dessine de nouveau
la reprise des affaires, on a vu se produire ce que
des observateurs perspicaces, tels que M. Maroni, dans
ses chroniques des Dbats, annonaient depuis longtemps:
une partie des disponibilits du public a cess d'aller
au Trsor, pour se porter vers des oprations plus fruc-
tueuses (1). Au lieu d'un excdent de souscriptions des
bons de la Dfense sur les remboursements, ces derniers,
dans les six derniers mois de l'anne, ont excd les sous-
criptions de prs de 4 milliards (2).
(1) A plus d'une reprise, M. Maroni a expliqu le mcanisme par
lequel le public rgle en quelque sorte lui-mme la q",antit des billets
en circulation, suivant qu'il demande ou ne demande pas le rembour-
sement des bons de la Dfense. Comme c'est l'tat qui rgle, par sa
politique budgtaire, l'augmentation ou la diminution de3 bons, -
c'est lui, en dernire analyse, qui, rgle la circulation de la Banque elle-
mme. Voici, par exemple, comment s'exprimait, le 16 octobre 1922,
l'minent publiciste:
. Quand le public a besoin de billets, o les prend-on? Autrefois,
c'tait la Banque de France que l'on s'adressait. Les banquiers et les
tablissements de crdit qui dtenaient' les dpts des particuliers
n'avaient d'autre moyen pour faire face des retraits de fonds que de
se faire escompter du papier par la Banque. C'tait par l'augmentation
du portefeuille commercial que se faisait l'accroissement de la circu-
lation. M a ~ s aujoui'd'hui il n'en est plus de mme. Les tablissements de
crdit emploient en Bons de la Dfense la presque totalit des dpts ;
aussi, quand leur client1e leur retire de l'argent, ils se bornent en-
caisser leur chance; une partie des Bons de la Dfense qu'ils ont en
portefeuille, au lieu de les re:Qouveler. Les particuliers qui placent tero-
LA DFLATION EN FRANCE
69
Le contre-coUp de cette situation s'est aussitt fait
sentir dans les rapports de l'tat la Banque. La
dette de l'tat atteignait de nouveau 23.400 millions au
21 dcembre dernier. L'impossibilit de la rduire
23 milliards, comme le commandait.la convention du
29 dcembre 1920, devenait vidente. D'o la nouvelle
convention du 22 dcembre, fixant pour 1923 le maxi-
mum des avances l'tat 24 milliards au lieu de 23,
et limitant ainsi son remboursement un milliard au
lieu de deux .
porairement leurs disponibilits en Bons agissent de mme
ont besoin d'argent liquide. Directement ou indirectement c'est donc
, 'au Trsor que les demandes de billets du aboutissent et le Trsor
ne peut se procurer des billets qu'en yant recours aux avances de la
Banque de France.
En somme, toute augmentation des besoins de la circulation, pro-
voque par des phnomnes tels que l'activit des transactions ou la
hausse des prix, qui dpend elle-mme de la dprciation du change,
entraine fatalement un ralentissement du placement des Bons du Trsor
et, par onsquent, une augmentation du chiffre des avances de la
Banque l'tat. Il ne peut en tre autrement puisque le publie a
constamment la facult de demander au Trsor le remboursement des
Bons arrivs maturit et que c'est la manire la plus commode et la
plus conomique d'obtenir des billets ..... Tant que les dpenses et les
recettes ne s'quilibrent pas, l'tat est donc expos thoriquement au
risque d'avoir payer en billets le montant exact du dficit du bud-
get ...
(2) V. Rapport gnral sur le budget de 1923 par M. Bokanowski
p.136, 'l.t Pierre Gubhard: Le march montaire en 1922 dans La France
conomique en 1922, p. 17-18 (Tnin, dit.). Nous voudrions pouvoir
donner ici la situation des souscriptions aux bons du Trsor au cours
, de l'anne 1923. Cette situation est indispensable pour analyser le
mcanisme de la 'circulation. Malheureusement le rgime de non-
publicit qui s'est install chez nous depuis la guerre dans tous les
qui intressent la vie publique , fleurit galement en ma-
tIre financire. Le ministre des Finances, comme celui des Affaires
trangres, pense avoir accompli tout son devoir quand il a mis les
" Commissions parlementaires au courant faits. C'est, en ralit.
70
LA. DFLATION EN PRATIQUE
La 8ituation budgtaire et la dflation
Telle est l'histoire d'hier.
Elle met dans tout son relief le fait que nous avons
dj not propos de l'Angleterre: le lien troit qui unit
la situation montaire et la situation budgtaire, et l'ac-
tion prpondrante de cette dernire sur le change.
En France comme en Angleterre, il y a eu rduction.
des moyens de paiement en circulation comme cons
quence de la situation conomique: il y a eu dflation .
Mais cette dflation s'est accompagne en Angleterre d'une
amlioration continue du change, alors qu'en France il
n'en a rien t. (Nous renvoyons le lecteur au graphique
reproduit la page 32).
Pourquoi? Parce qu'en Angleterre le rsor, grce
aux excdents budgtaires, non seulement absorbait d-
finitivement les Currency-Notes rapports par le public,
ce qui, nous l'avons dit, est relativement secondaire, mais
surtout consolidait sa dette flottante et diminuait sa
dette globale en cartant ainsi toute chance d'inflation
future.
En France, au contraire, d'un ct la dpression co-
nomique augmentait les disponibilits du public et les
ramenait au rsor, de l'autre, le dficit budgtaire obli-
geait le rsor, non seulement les remettre constam-
ment en circulation, mais augmenter sa dette flottante.
Si, d'un ct, la marche des affaires permettait l'tat
de rembourser la Banque, par contre ses propres em-
un nouveau rgime Les pays de vritable libert
oomme l'Angleterre, n'hsitent pas publier chaque semaine toutes
les donnes indispensables pOUl' apprcier la situation des finances
publiques.
LA DFLATION EN 'FRANCE ';1
b
l
'obligeaient faire au public des emprunts trs
arras ,
, 'eurs au montant de ses r'emboursements.
superl .
La situation est trs nettement represen,tee dans le
tableau o le rapporteur gnral du budget de 1923 a
rsum la situation de la dette flottante aux deux dates
du 31 mai 1921 et du 31 aot 1922.
Bons de la dfense
en circulation .
Avances de la Rao-
que de France.
t.apilal Capital
au 31 Dlai '!Jal au 31 aot '922
Diffrences
62,662,605,000 + 1O,85ci,567,000
26,200.000,000 23,900,000,000 - 2.300,000,000
L'tat rduit bien de 2.300 millions sa dette l'gard
de la Banque. Mais, dans le mme temps, il accrot sa
dette flottante de 10.850 millions (1). Comment, du reste,
autrement, puisqu'en 19211e seul budget gnral
(nous ne parlons pas du budget spcial des rgions lib-
res, dit des dpenses recouvrables ) s'est cltur par
un dficit de 5.415 millions, qui, en 1922, a atteint
5.4'80 millions? Le budget sorti en juillet 1923 des
longues dlibrations des Chambres se prsente avec un .
'quilibre apparent. Mais cet quilibre ne comprend ni
remboursement la Banque ni d'autres dpenses portes
tOrt suivant nous au budget des dpenses recouvrables.
En comparant la situation franaise celle de l'Angle-
terre, nous n'entendons pas dire que la France aurait d
(1) La situation est complique au point de vue comptable du fait
que les remboi.lrsements la Banque figurent hors budget, et que
part les remboursements ont t .oprs pour une grosse' part.
grace au compte d'amortissement constitu la Banque mme. Les
ce compte sont des recettes de l'Etat, de sorte que l'emprunt
n a,pas ete contract directement en vue de rembourser la Banque.
M3.1s le rsultat est le mme que s'il l'avait t.
LA DFLATION EN FRANCE 77
lique une production accrue, laqulle, son tour, im-
Plique que toutes les pargnes disponibles sont orientes
les entreprises industrielles et agricoles.
Or, dans la mesure o l'tat emprunte - et part
une exception que nous allons mentionner - l'pargne
disponible est dtourne par lui des emplois productifs
pour dfrayer les dpenses gnralement improductives
des fonctionnair.es et des rentiers. L'emprunt, en tant
qu'il couvre des dpenses conomiquement improduc-
tives de l'tat, enlve l'pargne son emploi normal,
accrot la proportion du revenu national immdiatement
consomm aux dpens de celui qui servirait sans cela aux
progrs de la production. La supriorit des budgets en
quilibre est de laisser libre pour ces progrs toute
l'pargne disponible. Ils prparent ainsi pour l'avenir
une offre croissante de marchandises' nouvelles, et, par
suite, une apprciation invitable et dans ces conditions
bienfaisante de la monnaie nationale.
Mais, dira-t-on, l'quilibre suppose l'accroissement des
impts. Or, si l'tat s'y dcide, celui-ci (quand le contri-
buable, comme aujollrd'hui, est dj trs charg)' ne
sera-t-il pas, autant que l'emprunt, prlev sur les
sommes mmes destines par le contribuable l'pargne
productive? L'conomie du pays n'en sera-t-elle pas
affecte au mme degr que par l'emprunt?
Soit un dficit de 5 milliards: qu'importe l'conomie
nationale que l'tat le comble par l'emprunt ou l'impt,
si dans les deux hypothses le contribuable en est rduit
prlever ces sur son pargne habituelle et si
dans les deux cas l'tat les dpense improductivement ?
D'abord il restera toujours cette diffrence que l'im-
pt ne grve pas l'avenir. L'emprunt charge les budgets
futurs du poids de l'intrt, menace ainsi quilibre,
']8 LA DFLATION EN PRATIQUE
-et cre, par l, cette inquitude sur l'avenir financier si
dprimante pour le march des changes.
D'autre part, le contribuable prlve en gnral l'impt
sur sa consommation. Pour l'acquitter, ou bien il con-
somme moins, ou bien il travaille I>lus ; mais il cherche
maintenir son pargne au niveau En comblant
le dficit par l'impt, on risque IItoins d'entamer l'pargne
du pays qu'en recourant l'emprunt qui, normalement,
provient de sommes dpassant la consommation cou-
rante.
Dans tous les cas, l'impt est plus pnible au contri-
huable que l'emprunt. Par suite, la pression de l'opinion
dans le sens d'une rduction des dpenses publiques sera
plus forte dans les pays o l'on prfre le premier. Et
c'est encore une raison de supriorit (1).
Ce qui prcde s'applique uniquement aux emprunts
improductif$
(1) Dans une note intressante d'octobre 1922 intitule: R{f9xions
.sur le dficit, MM. Wolf et Bokanowski comparent trs minutieu-
sement les effets conomiques de l'inflation et de l'emprunt. Ils con-
cluent que l'emprunt, mme long terme, constitue lui-mme une
forme d'inflation quoique prfrable l'autre. Nous avons montr
plus haut que l'emprunt sous forme de bons du Trsor constitue effec-
tivement au moins .en puissance une inflation toujours menaante. Par
contre, nous ne voyons pas que . l'emprunt long terme cre un
nouveau pouvoir d'achat. L'effet de l'emprunt d'Etat est de d-
tourner vers la consommation improductive des sommes pargnes
qui sans cela eussent t consacres un accroissement de la production.
L'emprunt modifie au dtriment de cette dernire la rpartition spon-
tane du revenu qui sans lui se serait tablie entre la consommation
et la production; c'est par l qu'il retarde 'le relvement du pouvoir
d'achat du franc. A dire, .dans les pays anglo-saxons les emprunts
de guerre, mme long terme, ont t souvent souscrits par les ban-
ques, non avec leur capital mais par de simples inscriptions en compte
courant au crdit du ,gouvernement, et l'mission de ces emprunts a
t d'une inflation certaine. Mais nous ne croyons pas que
cette mthode ait t employe en France sur une chelle importante,
LA. DFLATION' EN FRANCE .
79
... ' '1 Y a des emprunts productifs. C'est l'exception
lUaiS 1
Ile
noUS faisions allusion tout l'heure, Tels sont,
laque 1
t
'e aU moins (car une autre est affecte des seJ.'-
en par l '.'
, d'l'ntrts et au serVIce des penSIons), les emprunts,
VICes
t
ete
' s en France au bnfice des rgions libres et
con ra .
figurant au budget dit des Il dpenses recouvrables .
Que fait ici l'tat? Il se substitue simplement aux
entrepreneurs privs en qute de capitaux. L'pargne
u'il'attire est cde aux sinistrs pour tre (en majorit)
!ansforme en usines, stocks de matires premires, ma-
chines, etc. Elle sert fortifier la puissance productive
de la nation. Elle n'est pas dtourne au profit de
la consommation. Les consquences fcheuses signales
tout l'heure ne peuvent donc se Loin de
dprcier le franc, de telles dpenses, condition bien
entendu de ne pas tre dtournes de leur but. en pr.
parent au contraire l'apprciation pour un avenir pral'
chain. '
Faisons toutefois une restriction. Ces emprunts, comme
les autres, ne cessent d'alourdir la charge des intrts qui
pse d'un poids croissant sur le budget. Comme les autres,
ils augmentent les chances de dficit pour l'avenir, et,'
par suite, les risques d'inflation auxquelles nous savons
que la spculation sur le change est si sensible.
Diffrences entre 1871-1876 et 1918-1923
En rsum, une interprtation trop simpliste de la
mthode employe ,aprs la guerre de 1870-71 a tromp
sur la porte relle des remboursements la Banque de
France.
Si de 1871 1876 ces remboursements se sont accom-
pagns d'une amlioration rapide du change, ce n'est
80 LA DFLATIO:"i El'! PRATIQUE
pas en raison d'une action quasi mcanique sur la quan-
tit de monnaie en circulation; c'est parce qu'ils tradui-
saient une situation financire chaque anne plus favo-
rable. Ds 1874 on considrait l'quilibre budgtaire
'comme acquis par les seules rentres des impts.
Des remboursements poursuivis, au contraire, comme
ceux de 1921 et 1922, sans politique financire corres-
pondante, ne pouvaient avoir le mme effet. N'oublions
pas qu'en Angleterre le Trsor n'a entrepris sa politique
de dflation qu'aprs s'tre assur que. la dette n'augmen-
terait plus.
Il y a bien d'autres diffrences relever entre la situa-
tion de 1871 et celle d'aujourd'hui. Il n'est pas inutile d'y
consacrer quelques lignes. Les souvenirs de cette po-
que, maintenant lointaine, voilent pour certains esprits
la vue nette des phnomnes d'aujourd'hui.
Le mot mme de dflation appliqu la priode 1871
1876 est singulirement mal choisi, car on ne saurait
parler d'inflation pendant la guerre relativement brve ,
de 1870-71.
Les billets mis alors - (qu'on relise le fameux rapport
de Lon Say) - ont remplac poUl;' la plus grande partie
l'or thsauris ou expdi l'tranger, sans accrotre la
masse des instruments montaires en circulation. L'index
des prix a moins hauss en France qu'en Angleterre,
entre 1871 et 1873!
La guerre finie, on n'a pas assist - en dpit des rem-
boursements de l'tat la Banque - une rduction
correspondante du nombre de billets. Voici les chiffres de
la circulation de 1871 1876 (en millions de francs) :
18l .
182 .
1873 .
2,075
2,400
2,856
18j4 .
1875 .
186.
2,59
6
2,46
1
2,484
U DFLATION ,RANCE
81
La circulation reste suprieure d .1.tOO millions
chiffre maximum de la priode de paix antrieu!e
millions en 1869). .
Pendant ce teIp.ps l'tat a bien remb01!rs 1,OS7 mil
lions sur les 1.425.qu'il avait reus de la Banque. .Maa
comme, au fur et mesure des. r,emboursements de'
l'tat, la Banque' remettait en. circulation des billets
(reprsentant l'or nouveau qui affluait dans ses caisses)
la circulation totale des instruments le est
reste sensiblement la mme. Ce n'est pas Ul;J.e dflation
que nous assistons de 1871 1877 ; c'est la reconstitu-
tion, grce un change fJite refJenu au pair, d'une base
mta.llique une circulation accrue. .
. La France de cette poque a v.u se produire chez elle
ce que nous constatons, non sans envie aujourd'hi, aux
. tats- Unis : une de circulation qui' reste
sans action sur le change parce qu'elle est convertible en
or. Elle a profit des avantages dont
actuellement nos associs : un change peine
pendant la guerre, une balance crditrice,
'. . \;
un rapide rtablissement budgtaire.
Bien diffrentes .sont les circl;lDstances prs,entes avec
une circulation sextuple, une dnivellation prolonge
.des prix, un adapt cette dnivellation, et si
cart du pair qu'on peut douter que la politique finan-
cire la plus sage, accompagne de la balance des comptes
la plus favorable, l'y raDlne jamais. D'o l'loignement
iRdfi'ni de perspective d'un retour spontan de l'or.
Dans ces conditions, les directives de la politique mo-
ntaire ne tre purement' et em-
pruntes la traditiori financire d'il y a cinquante ans.
Un :sremier point est hors de conteste : la ncessit
Rist
6
8Z LA OFLATIO:'l EN .PRATIQUE
pour la Banque de s'assurer toute ventualit une marge
d'inission suffisante, sans avoir dpasser la limite
maximum actuelle.
Qul que soit le systme montaire - papier ou espces
mtalliques - le stock de la monnaie talon doit tre
soustrait aux interventions du pouvoir. Ce principe, faci-
lement applicable dans un systme mtallique o les
mines fixent la production montaire sa limite, et o
l'quivalence de l'or et de la monnaie fiduciaire doit tre
constamment assure, demande une volont persv-
rante pour tre maintenu dans un rgime de papier-mon-
naie inconvertible. D'autre part, il faut que les besoins
commerciaux soient assurs d'une mission fiduciaire
adapte leurs proprs fluctuations. Cette lasticit qui
. ne saurait tre indfinie trouve sa 'limite naturelle dans un
systme mtallique quand l'or commence fuir l'lian-
. ger. Les banques savent qu' ce moment la limite de la
marge de crdit est atteinte. A cette limite naturelle un
systme de papier-monnaie doit substituer la limite
artificielle d'un maximum lgal infranchissable. Pour tre ,
"Sre qu'il ne sera jamais dpass, la Banque. doit main-
tenir l'mission normale assez au-desseus de cette limite,
pour disposer toujours d'une marge importante. Il ne
faut pas que les circonstances conomiques obligent une
fois encore la Banque, comme dans l't 1920, lever
son maximum d'mission.
Ainsi un maximum lgal dfinitif et une marge d'las-
ticit suffisante, voil la double exigence qui domine le
. problme des remboursements de l'tat. La marge ac-
tuelle de 4 milliards parat un peu faible encore pour les
. . ~
ventualits qui peuvent se produire. Son largIssement
6 ou 8 milliards ne parat pas exagre.
On peut concevoir aussi un systme o l'mission aU
LA DFLATION F.:'I FRANCE 83
profit de l'tat fixe .un chitrre
mais o l'misSIOn commercIale pourraIt depasser ce
chiffre dans toute la mesure des besoins commerciaux,
Il
'eu comme nous le pro,posollsci, de un,. e lj:qlite
au , . .'. ,
dfinitive l'ensemble des deux missions,
tale et commerciale. Le premier systme fonctionne,
comme on le verra plus loin, en Le
nouS parat mieux convenir 'la situatio,n prsente
de la France, o les menaces
reuses.
Mais l'obtention d'une marge mme ainsi limite ref\-
tera naturellement illusoire si l'tat par, l'mission con-
tinue de nouveaux bons Trsor, cre constamment
par ailleurs les moyens de l'entamer. La marge d'lasticit,
tant que cette mission se poursuit, n'a qu'une valeur
d'avertissement. L'exigence des remboursements dans
les conditions actuelles est surtout un moyen de n'en
pas laisser prescrire le principe.
'Ainsi l'quilibre b':ldgtaire reste la condition pre-
mire. Tant qu'il n'exIste on ne saurait, vrai dire,
parler de Seulement le problme montaire ne
s'arrte pas l. .
Le jour o, comme on doit j'esprer, l'quilibre budg-
taire sera atteint,et o la marge d'lasticit dont nous
parlions tout l'he
tl
re sera juge suffisante, un problme
,nouveau se posera: - celi que nous' avons appel prc-
demment : le problme du ' rsidu d'inflation.
Quel rsidu d'inflation la France devra-t-ell con-
sentir garder? puisqu'elle devra ,comme l'Amrique,
comme l'Angleterre, se rsigner, bon gr, mai gr, il en '
garder un.
La rponse donner cette question sera influence
,par,une qui n'existait pas en 1871. C'est' une
84
LA DFLATION E:ol PRATIQUE
nouvelle et grave diffrence enire la situation financire
d'aujourd'hui: et celle lgue la France par la guerre
prcdente.
, En 1871, les emprunts de guerre ont t insignifiants.
Le service des deux grands emprunts de libration ~ pu
tre presque aussitt assur par des ressources normales.
De 1869 1872 la dette s'accroit de dix milliards.
En 1918, la France est sortie de la guerre avec une
dette intrieure grossie de cent milliards qui, avec les
emprunts d'aprs-guerre, atteint aujourd'hui 250 mil-
1iards et qui s'aggrandit tous les jours.
-'Or, les finances de l'tat, ne peuvent pas mieux que
'le march montae ~ e passer d'lasticit. Le souci cons-
'tani de tous les gouvernements srieux a toujours t,
aprs les priodes d'emprunts multiplis, d'en rembour.ser
: une partie. C'est la politique suivie actuellement par l'An-
gleterre et les tats-Unis, Si donc, l'hypothse se ralise
enfin d'un budget en quilibre ou mme en plus-value,
"alternative qui se posera devant les pouvoirs publics et
. qui ne se prsentait pas en 1870-71, sera ou de rembourser
les emprunts portant intrt ou de rembourser la dette
contracte en billets de banque.
Entre les deux mthodes, ni l'opinion, ni les pouvoirs
publics n'hsiteront longtemps. La premire, au lieu de
dtruire le produit de l'imp'f"comme le fait la seconde,
restitue au contribuable les billets en vue d'emplois pro-
ductifs ; elle allge, en outre, le budget de tout l'intrt
de la dette rembourse, et diminue ainsi le poids de l'im-
pt futur.
C'st . dans ces termes que se' posera :d'abord le pro-
blme du {( rsidu d'inflation : remboursement la
. .
Banque, oU,remboursement au public.
L'hsitation sera d'autant moins possible que, par une
~
l%
1:
1
LA EN fRANCE 85
. de 'tourne cette mthode provoquera elle-mme le
VOle' ,'. '
retour spontan des billets la Banque et l'largisse- ,
ment de sa marge d'lasticit - bieplus, sremen"t que,
la dflation directe. " , J
Car le rtablissement de l'quilibre budgtaire est, nous,
l'avons vu, le plus sr moyen de relever le cha.nge, et le ,
relvement du change,_ son tour, pl'ov,oquera la baisse'
intrieure des prix. Celle-ci librera des instruments de
circulation qui reflueront spontanment, soit au Trsor,
soit la Banque, entranant comme premire cons-
quence une -baisse du loyer de l'argent. L'experience
tchco-slovaque, dont nous allons parler, comme l'exp"
rience britannique, ont mis ce processu!! en pleine lumire.
A ce moment-l se posera ne fois de plus, mais sous
une autre forme, le problme du rsidu d'inflation.
,
Car le relvement, spontan du franc rendra ncessaire"
enfin de fixer sa limite: poursuivra-t-on le retour l'an-,
cien pair? Le par une dflation montaire?
ou se rsignera-t-on la dvaluation?
L'Angleterre s'est dcide dans le premier sens.
Que devra faire la France ?
Il est trop tt pour le dire encore. Il n'est pas dans les,
habitudes franaises de prciser longtemps l'avancej-.
comme en Angleterre ou aux tats-Unis, les buts et les'
moyens de la politique montaire. A chaque jour suffit
sa peine. L'inflation, chez nous, est menaante encore:
Il suffit, pour le moment, de s'opposer par tous les moyens
son retour possible.
Cependant, il faut l'avouer, les raisons qui ont fait
longtemps redouter 'la dvaluation, perdent de leur force
mesure que s'coulent, sims sensible d
Cours du franc, les mois et les annes. Plus le temps dure,
plus se manifestent les avantages d'u'u prompt retour
86.
LA DFLATIO:-i E:-i PRATIQUE
l'or. Plus s'accrot le nombre des pays revenus une cir-
culation mtallique, plus s'alourdit la charge des em-'
pruntS' conclus en monnaie dprcie, - plus aussi la
dvaluation cesse d'apparatre comme une rvolution,
pour prendre l'aspect rassurant d'une conscration con-
servatrice des faits acco,mplis.
Pour le moment nous n'en sommes pas l.
Qu'on se borne rendre la Banque de France une
certaine marge d'lasticit. Qu'on rtablisse, avant tout,
l'quiliQre' budgtaire en faisant rentrer dans le budget
gnral les pensions et tous les intrts de la d.tte.
tI'oute autre dflation sera parfaitement inutile. L'ac-
croissement spontan de la production, l',amlioration
du change feront hausser le franc bien assez vite pour
'qu'aucune dflation supplmentaire n'apparaisse
comme souhaitable ou efficace. A l'heure o nous cri-
vons, le franc baisse encore. L'orsque, le problme des
rparations enfin rsolu, sa stabilit n'apparatra plus
comme constamment menace par ,les initiatives gn-
falement fcheuses de la politique, l'conomie 'franaise
s'accommodera fort' bien d'un rsidu d'inflation
comme s'en accommodent aujourd'hui l'Amrique et
l'Angleterre.
Vous aimerez peut-être aussi
- VOLATILITY 75 INDEX Sniper EntryDocument22 pagesVOLATILITY 75 INDEX Sniper EntryGuillaume Okegni67% (3)
- Eléments de Corrigé VIVENDIDocument7 pagesEléments de Corrigé VIVENDIhautniveauPas encore d'évaluation
- Ludwig Von Mises - Le Fondement Ultime de La Science ÉconomiqueDocument154 pagesLudwig Von Mises - Le Fondement Ultime de La Science ÉconomiqueGu Si FangPas encore d'évaluation
- Murray Rothbard - Etat, Qu'as-Tu Fait de Notre Monnaie?Document187 pagesMurray Rothbard - Etat, Qu'as-Tu Fait de Notre Monnaie?Gu Si Fang100% (8)
- Money Management - Ajustez La Taille de Vos Trades - Trading - Café Du ForexDocument3 pagesMoney Management - Ajustez La Taille de Vos Trades - Trading - Café Du ForexMaminandrasana Efrano Razafindradany100% (1)
- Banque Libre de L'idée À La Réalité. Le Cas Du Chili, 1860-1898 Par Ignacio BrionesDocument301 pagesBanque Libre de L'idée À La Réalité. Le Cas Du Chili, 1860-1898 Par Ignacio BrionesGu Si FangPas encore d'évaluation
- Artus, Patrick - Etats-Unis Menace Sur La Croissance MondialeDocument99 pagesArtus, Patrick - Etats-Unis Menace Sur La Croissance MondialedoudzoPas encore d'évaluation
- Recherches Sur La Monnaie en Droit PrivéDocument442 pagesRecherches Sur La Monnaie en Droit PrivéGu Si Fang100% (5)
- Yves Guyot - La Démocratie IndividualisteDocument283 pagesYves Guyot - La Démocratie IndividualisteGu Si FangPas encore d'évaluation
- Identité Comptable Krugman-ObstfeldDocument5 pagesIdentité Comptable Krugman-ObstfeldGu Si FangPas encore d'évaluation
- Pages de Jean Escarra Principes de Droit Commercial Vol. 1Document15 pagesPages de Jean Escarra Principes de Droit Commercial Vol. 1Gu Si FangPas encore d'évaluation
- Traité de Droit Civil T. III Les Biens Ch. 2 Théorie de La MonnaieDocument51 pagesTraité de Droit Civil T. III Les Biens Ch. 2 Théorie de La MonnaieGu Si Fang100% (2)
- Jean Carbonnier Sur La MonnaieDocument14 pagesJean Carbonnier Sur La MonnaieGu Si FangPas encore d'évaluation
- Ludwig Von Mises - L'Action HumaineDocument1 037 pagesLudwig Von Mises - L'Action HumaineGu Si Fang100% (1)
- Les SwapsDocument16 pagesLes SwapslahlaliaPas encore d'évaluation
- Les Entreprises Familiales Sont-Elles Inefficaces ? David Sraer David Thesmar Sept.2003Document51 pagesLes Entreprises Familiales Sont-Elles Inefficaces ? David Sraer David Thesmar Sept.2003Familles_en_affairesPas encore d'évaluation
- Anticiper Les MarchéDocument39 pagesAnticiper Les MarchéTime100% (1)
- Gestion ActiveDocument2 pagesGestion ActiveFatima Zahra RamiPas encore d'évaluation
- Order Imbalance Based On The High Frequenly Trading FRDocument72 pagesOrder Imbalance Based On The High Frequenly Trading FRallomPas encore d'évaluation
- FR Les Vagues D'elliott Pour Traders ExpérimentésDocument7 pagesFR Les Vagues D'elliott Pour Traders ExpérimentésHarry DaviPas encore d'évaluation
- Prospectus Capgemini 022 2019 DDocument201 pagesProspectus Capgemini 022 2019 DAbdelPas encore d'évaluation
- Le Dialogue Administrateurs ActionnairDocument84 pagesLe Dialogue Administrateurs ActionnairArnaud DumourierPas encore d'évaluation
- Ni CMTDocument218 pagesNi CMTLuc David100% (1)
- Vernimmen Lettre Numero 100Document12 pagesVernimmen Lettre Numero 100hatemPas encore d'évaluation
- Defaillance Et Creation de Valeur AnalysDocument35 pagesDefaillance Et Creation de Valeur AnalysHoussam houssamPas encore d'évaluation
- Le Marché Des CapitauxDocument26 pagesLe Marché Des CapitauxMustaphaElHamdani100% (1)
- Comprendre Les Indices BoursiersDocument9 pagesComprendre Les Indices BoursiersKouadio Kevin Christophe Junior KOUTOHOUNOUPas encore d'évaluation
- Le Marche Des Matieres Premieres ProtecctedDocument13 pagesLe Marche Des Matieres Premieres ProtecctedAyoub AhrayouPas encore d'évaluation
- L'Analyse Du Marché Monétaire MarocainDocument8 pagesL'Analyse Du Marché Monétaire MarocainBawalidPas encore d'évaluation
- Cours de Trésorerie Au Sein D'un Groupe (2022 - A)Document29 pagesCours de Trésorerie Au Sein D'un Groupe (2022 - A)Aime AmoakonPas encore d'évaluation
- Licence PPIUDDocument1 pageLicence PPIUDDédé KambalaPas encore d'évaluation
- Jérémy Morvan Maître de Conférences en Sciences de Gestion Version 04/20Document50 pagesJérémy Morvan Maître de Conférences en Sciences de Gestion Version 04/20Romaric Judicael YobouetPas encore d'évaluation
- Lynda OuendiDocument298 pagesLynda OuendiKarima TabariPas encore d'évaluation
- TD S2 Fiche 8 2016 2017Document2 pagesTD S2 Fiche 8 2016 2017nada333Pas encore d'évaluation
- Mémoire Yapo (FINAL)Document66 pagesMémoire Yapo (FINAL)AngePas encore d'évaluation
- CAPMDocument21 pagesCAPMChatiri AzizPas encore d'évaluation
- Le PEA - Plan D'épargne en ActionsDocument3 pagesLe PEA - Plan D'épargne en ActionsEKRAPas encore d'évaluation
- BalanceDocument106 pagesBalanceNourhene DhbeibiPas encore d'évaluation
- Société Anonyme (SA)Document3 pagesSociété Anonyme (SA)Slouma AbidiPas encore d'évaluation
- Histoir Et OrigineDocument28 pagesHistoir Et Originemomo271Pas encore d'évaluation