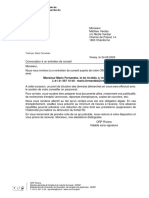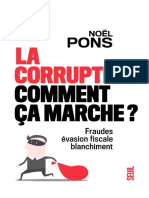Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Sorel Intro Eco Moderne
Sorel Intro Eco Moderne
Transféré par
GregorZaroffCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Sorel Intro Eco Moderne
Sorel Intro Eco Moderne
Transféré par
GregorZaroffDroits d'auteur :
Formats disponibles
Georges SOREL (1847-1922)
Introduction
lconomie moderne
(1903)
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, bnvole,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie
Tremblay, bnvole, professeur de sociologie au Cgep de
Chicoutimi partir de :
Georges SOREL (1847-1922)
Introduction lconomie moderne. (1922)
Une dition lectronique ralise partir du livre Georges Sorel
(1903), Introduction l'conomie moderne. Paris: Librairie des
sciences politiques et sociales Marcel Rivire, 1922, 2e dition revue
et augmente. Collection tudes sur le devenir social, 430 pp. Une
dition ralise grce la prcieuse coopration de Serge D'Agostino,
professeur de sciences conomiques et sociales en France, qui m'a si
gnreusement prt son vieil exemplaire de ce livre.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes
Microsoft Word 2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 13 mai 2003 Chicoutimi, Qubec.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
Table des matires
Avertissement pour la troisime dition
Avant-propos
Premire partie : De l'conomie rurale au droit
I. - Les premires formes de l'conomie considre comme science propre
aux hommes d'tat : proccupations financires, influence des humanistes,
quit naturelle. - Thories ricardiennes tendant la mathmatique ;
circonstances qui leur donnrent naissance. - Efforts contemporains pour passer
une conomie pratique : difficult que prsente l'intelligibilit de la nouvelle
conomie
II. - Grande influence de l'conomie du coton ; dspcialisation ; les ouvriers
sont considrs du point de vue quantitatif. - Physique sociale. - Confiance
absolue dans la rationalit croissante du monde. - Importance de l'agriculture
scientifique. - L'conomie concrte recherche les phnomnes qui prsentent les
diffrences les plus accuses. - Exemple donn par Marx
III: - Changement de point vue des socialistes parlementaires ; causes
politiques de ce changement. - Thories exposes par Jaurs en 1897 et sa
polmique avec Paul Leroy-Beaulieu. - Il dcouvre les paysans en 1900. Recherches de Vandervelde sur la Belgique. - Classification des divers genres
de domaines ; mthodes de Roscher et de Vandervelde ; celui-ci dfigure les
conceptions de Roscher et n'aboutit rien, faute de pntrer ce qu'est le fond de
la vie rurale
IV. - Recherches de Le Play et de Demolins. - Effort tent par de Tourville
pour donner une base la science sociale. - Pourquoi l'tude de la famille
ouvrire est-elle fondamentale ? La psychologie des peuples : tout ce qui est de
nature bourgeoise est superficiel. - Familles rives au travail, - Divers aspects
sous lesquels se prsente l'tude des classes ouvrires. - Sentiment juridique du
peuple ; cas o il est rattach au travail et cas o il est import par des
bourgeois. -Chez les paysans il se manifeste surtout dans les coutumes
successorales
V. - But pratique poursuivi par Le Play - imitation des peuples prospres. Influence saint-simonienne. - Sa manire de diviser l'histoire de France et celle
d'Angleterre. - Les postulants juridiques sur lesquels s'appuie la mthode suivie
par Le Play. - Grande importance qu'il attache la puret des rapports sexuels. Rle de la famille. - Conclusion relative la situation conomique des ouvriers,
dduite des observations de Le Play.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
VI. - Attaques de Le Play contre les juristes. - Le tutiorisme des juristes et
leur dfiance des nouvelles lois. - Reproches injustes qu'on leur adresse propos
de leur travail normal. -L'opportunit et le droit. - L'importance de l'ide
d'opportunit dans la lgislation relative l'agriculture. - Travaux d'amlioration
collective ; servitudes spciales imposes aux forts et aux mines. Remembrement et colonisation intrieur
VII. - La colonisation requiert des formes spciales et les forces productives
ne se crent pas sous le rgime de l'exploitation normale. L'histoire des antiques
monastres bndictins. Grandes analogies que prsente cette histoire avec celle
du capitalisme ; facilit d'avoir de la main-d'uvre ; accumulation primitive ;
technique suprieure ; discipline. - chec de la rgle de saint Columban. Dcadence des socits qui lie s'occupent plus que de la consommation
Deuxime partie : Socialisation dans le milieu
conomique
I. - Collectivisme partiel. - Thories de Proudhon sur les rformes du milieu
conomique. - Distinction de la production et de l'change dam Marx. Contradiction existant entre l'ordre adopt dans les formules et l'ordre historique
des changements. - Opposition entre la production et l'change, au .point de vue
des reformes. - Observations faites par Paul de Bousiers sur les comptoirs de
vente. - Nouveaux programmes socialistes
II. - Thorie proudhonienne de la proprit et influence des gots paysans de
Proudhon. - Thorie de la possession. - Son idal de la proprit, issu en partie
d'ides romaines, et son analogie avec celui de Le Play. - Le fdralisme et son
interprtation. - La proprit n'a pas ralis le mouvement prvu par Proudhon
III. - La coopration comme auxiliaire du capitalisme. - Coopratives d'achat
et de vente. - Analogie de la cooprative et de l'conomat. - Alimentation
administrative. - Rapprochements tablis entre les coopratives et les institutions
dmocratiques. - Doutes sur la manire dont fonctionnement ces socits. Ancien systme de la boulangerie parisienne; assurances contre la hausse des
denres propose par Ch. Guieyesse
IV. - La coopration considre comme un moyen d'entretien des forces de
travail. - Autres institutions ayant le mme but : construction des logements
ouvriers et caisses de secours. -Assurances contre les cas fortuits : les diverses
formes qu'elles revtent. - Importance toujours croissante de l'assurance rurale. Accidents du travail. - La houille comme source universelle de force et la
nationalisation des mines
V. - La partie spirituelle du milieu conomique. - La technologie cesse d'tre
proprit ; le brevet d'invention. - L'apprentissage passe de l'atelier dans les
coles. - Conception dmocratique de l'enseignement populaire. - Discipline des
ateliers. - Comment elle s'est produite ; lgislation napolonienne. - Les
nouvelles conditions techniques et le nouveau rgime des ateliers progressifs
VI. - Classement des institutions qui ont une influence indirecte sur
l'conomie. - Les deux aspects sous lesquels se prsente l'tat. - Les divers rles
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
de l'tat. - La neutralit du milieu conomique. - Confusion frquente entre la
loi du milieu conomique et celles de l'atelier ou de l'tat
VII. - Difficults que prsentent les gestions par les pouvoirs publics. Exprience de l'antismitisme viennois. - Les exploitations but fiscal. Fiscalit du Moyen-Age s'appliquant surtout aux changes. - Ancienne
bureaucratie, sa dcadence et sa prochaine disparition. -Contrle des citoyens
sur les fonctionnaires. - Diffrence des points de vue dmocratiques et
socialistes
Troisime partie : Le systme de l'change
I. - Les transports. - Distinction de la ville et de la campagne. - Diverses
sortes de communications rurales et leurs rapports avec la nature de la proprit.
- Chemins de fer : voyageurs et marchandises. - Les tarifs lgaux et sa
conception mutuelliste. - Influence de la dmocratie plus favorable aux
transports de personnes qu' ceux des marchandises. - Pages
II. - Plaintes des producteurs contre la distribution de crdit. - Enthousiasme
provoqu par les premires banques. - L'usure ancienne et l'glise. - Position
particulire de saint Thomas et ses origines. - La lutte contre l'influence
musulmane. - L'usure juive rend inutile l'usure chrtienne et permet de faire une
thorie sur l'interdiction absolue du prt intrt
III. - Classification des divers genres de crdit d'aprs les srets employes.
- Les srets dlictuelles : clauses pnales, mutilation, excommunication, etc. Anciennes rductions des dettes. - Monts de pit. - Solidarit des caisses
Raiffeissen. - Importance du cautionnement dans l'histoire conomique. - Crdit
hypothcaire. - Relations entre le prt et les systmes de culture. -Anciennes
ides des socialistes sur l'hypothque
IV. - Liquidation des dettes de la terre. - Les anciennes banqueroutes
montaires. - Le bimtallisme et ses raisons. - Les Crdits fonciers. - Les
obligations lots. - L'hypothque maritime et le prt sur les rcoltes
V. - Thories sur le prt intrt. - Le prt assimil la commandite ;
thories de Bastiat et de Proudhon. - Intervention de l'tat. - Assimilation la
location ; thorie des thologiens modernes et de Marx. - Assimilation la
vente ; thorie thomiste. - Explication des contrats titre gratuit. - Classification
des actes juridiques d'aprs l'chelle de la volont
VI. - Les Bourses de commerce. - Obscurits accumules autour des
questions qui se rattachent la spculation. - Traduction des accaparements. Ides des socialistes parlementaires. - Influence, attribue aux Bourses sur la
dpression des prix. - Analogie entre les affaires de Bourse et les oprations des
cartels
VII. - Les entrepts. - Les statistiques. - Les expertises. - Ides de Proudhon
sur la disparition des spculateurs. - L'ancienne, spculation locale ; sa
psychologie ; ses analogies avec l'esprit fodal. - Magasins bl allemands. Silos proposs autrefois par Doyre
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
VIII. - Warrants et leur signification. - Thorie moderne, du prt l'intrt,
dduite de cette pratique. - Les prtendus warrants agricoles
IX. - L'escompte. - La Banque du peuple et les discussions de Proudhon
avec Bastiat. Police de l'escompte. - Taux de l'escompte. trange thorie de P.
Brousse. - Principes actuels de l'administration des grandes banques. - Rsum
du systme de l'change
Observations gnrales
Subordination des idologies un but. - Reprsentation du mobile par la
tension. Inversion de l'ordre historique dans l'idologie. - Mythes
Appendice : L'humanit contre la douleur
I. - Cause physiologique de la douleur. - Anciennes thories qui font de la
douleur un avertissement donn par la nature. - Hypothse sur le rle que
jouerait la douleur comme excitation l'invention.
II. - Asctes asiatiques. - Leurs influences sur les philosophes grecs. Mystiques chrtiens. - Dvotions considres comme moyens de combattre la
douleur
III. - Alcoolisme ; gourmandise et rotisme
IV. - Musique. - Sports. - Travail manuel
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
GEORGES SOREL
Introduction
l'conomie
moderne
Paris : Librairie des sciences politiques et sociales Marcel Rivire, 1922.
Deuxime dition revue et augmente.
Collection : tudes sur le devenir social, n VIII.
Retour la table des matires
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
Introduction lconomie moderne
Avertissement
pour la troisime dition
Octobre 1919
Retour la table des matires
Cette Introduction l'conomie moderne fut publie en 1903 par les soins
d'un Russe pauvre, qui s'tait imagin de pouvoir fonder une maison de srieuses
ditions socialistes ; son entreprise choua, comme l'avaient prvu les gens ayant
l'exprience des affaires de librairie ; sa modeste collection fut disperse. J'ai tout
lieu de penser que les professionnels de l'conomie politique eurent pour mon
livre les sentiments de ddain dont font preuve gnralement les personnages
pourvus de titres officiels, d'idalisme et de hauts faux-cols en prsence des
lucubrations de dbutants tmraires ; mais depuis que j'ai crit les Rflexions
sur la violence, il est devenu bien difficile aux hommes qui veulent passer pour
srieux, de ne pas tudier les thses que je propose ; je crois donc que je suis en
droit de faire appel de jugements rendus jadis la lgre par un public mal
inform, an discernement d'un public mieux inform.
Les conditions si difficiles au milieu desquelles se dbattent les divers tats
europens, donnent une singulire actualit aux questions dont j'ai tent l'analyse.
Les immenses misres matrielles et morales que la guerre rcente a produites
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
partout, ont provoqu ce qu'on pourrait assez correctement appeler une pidmie
d'hystrie communiste. Les peuples affols par quatre annes d'affreux carnages,
croient qu'ils ne pourront trouver la paix, l'ordre national et le bonheur que si le
capitalisme classique est boulevers de fond en comble ; l'industrie est en train
d'tre submerge sous les flots d'interventions plus ou moins tendues de
l'autorit, se mlant d'affaires jadis regardes comme essentiellement prives; des
bourgeois qui s'taient jusqu'ici montrs d'une prudence pusillanime, parlent
maintenant de socialisation sur un ton qui permettrait de supposer que les renversements de l'chelle des anciennes valeurs seraient aussi faciles raliser qu'une
rectification de chemin vicinal.
J'ose esprer que ce livre, inspir de principes proudhonniens, contribuera
faire, comprendre aux gens qui ont des yeux pour voir, qu'il y a plusieurs genres
parfaitement distincts de socialisation ; les politiciens que le hasard du parlementarisme conduit s'occuper de grands problmes conomiques, proposent des
rformes hasardes au gr des inspirations de leur petit gnie ; j'aurais rendu un
srieux service mes contemporains, si je parvenais les amener tudier les
enseignements de Proudhon, assez attentivement pour qu'ils fussent en tat de
mesurer les avantages et les dangers des projets de rforme qui surgissent de tous
les cts.
Les citoyens l'me pure, qui au milieu de nos carnavals chauviniques 1 ont
conserv la facult de penser librement, se demandent, avec anxit si le tohubohu conomique que la dmocratie est en train de nous imposer, ne va pas
entraner un effondrement du droit. Je sais bien que les archimandrites 2 de
l'Entente, les Poincar, les Clemenceau, les Wilson, n'ouvrent jamais la bouche
sans proclamer que la dfaite de l'Allemagne assure le triomphe dfinitif d'une
merveilleuse Justice, compatible cependant avec notre faiblesse, sur la sauvagerie ; mais l'exprience a, maintes fois, montr que les harangueurs professionnels
des foules ont le verbe d'autant plus abondant, plus audacieux et plus bruyant que
leur cervelle est plus vide; il n'est pas ncessaire d'tre un grand philosophe pour
s'apercevoir que les aptres de la Justice ententiste ont sur le droit des ides moins
srieuses que le plus humble greffier de tribunal. La civilisation moderne, que les
bourgeoisies dmocratiques prtendent tre seules capables de sauvegarder,
serait-elle condamne tomber en dliquescence, comme cela tait arriv la
civilisation romaine, mal protge par l'autocratie impriale ?
Les lecteurs des Rflexions sur la violence ne mettent probablement pas en
doute qu'une rvolution proltarienne, surgissant la suite d'pres luttes syndica1
Dans sa Correspondance, Proudhon revient souvent sur la ncessit de lutter contre le chauvinisme qu'il rencontrait mme chez de vieux amis, demeurs sous l'influence des passions
qui avaient agit la France librale pendant la Restauration. Nous tombons toujours dans le
chauvinisme, crit-il, le 27 Octobre 1860 Chaudey ; il faut nous gurir de cette idiotie
nationale . (Correspondance, tome X, p. 184). La plus grande honte de la France, avait-il
mand le 20 Novembre de l'anne prcdente, Boutteville, n'est pas tant la privation de ses
liberts que la platitude avec laquelle son chauvinisme enfourche tous les dadas que lui offre
son gouvernement... Notre cher pays est ignoble. (tome IX, pp. 244-245). Il tait mme all,
pendant la guerre de Crime, jusqu' nommer l'honneur national : du foin pour les nes
(Lettre du 5 Avril 1855 Charles Edmond, qu'il traitait toujours avec une particulire
familiarit ; tome VI, p. 155).
C'est le titre que Dante donne saint Franois d'Assise restaurateur de la vie chrtienne
(Paradisio, IX, vers 99).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
10
listes, serait parfaitement capable d'tre la source d'une civilisation compltement
originale ; les invasions germaniques avaient apport au Ve sicle dans le monde,
qui avait oubli les vertus quiritaires, ces qualits barbares que Vico place au
dbut des ricorsi 1 ; on ne voit pas, d'autre part, comment une renaissance pourrait
se manifester aujourd'hui dans une socit dirige par des rhteurs, des manieurs
d'argent et des politiciens aussi dpourvus d'ides que de grandeur d'me. Nos
bourgeoisies ploutocratiques n'ont pas de hautes ambitions ; elles ne ressentent
pas le besoin d'un sublime qui soit assur d'une gloire ternelle ; elles demandent
seulement durer. La longvit extraordinaire de Byzance qui survcut mille ans
la Rome des Csars, leur semble fournir une exprience trs favorable leurs
dsirs ; l'empire d'Orient put rsister des assauts formidables, parce qu'il possdait des ressources matrielles normes (pour le Moyen Age) ; les capitalistes
croient donc avoir le droit de ne pas dsesprer de l'avenir, tant que le rgime
actuel sera capable de produire des richesses abondantes.
Tous les philosophes disent que l'humanit a besoin de joindre son pain une
nourriture spirituelle ; nos dmocraties, si gorges de biens qu'elles puissent tre,
seraient condamnes mort le jour o elles auraient laiss se dissoudre, leurs
systmes juridiques ; conseilles par des hommes aviss, elles semblent disposes
de faire les plus gros sacrifices financiers pour sauver au moins ce qu'il y a
d'essentiel dans le droit traditionnel. Les doctrines de Proudhon sont fort utiles
connatre pour apprcier cette politique ; il nous a appris que beaucoup de rformes communment nommes socialistes peuvent avoir pour rsultat de rendre
plus prospre l'utilisation de la proprit prive ; les grandes socialisations les
plus probables ne sont peut-tre pas destines blesser mort le droit bourgeois
qui s'est dvelopp sur l'infrastructure de l'exploitation individualiste.
Ces considrations nous aident comprendre pourquoi, dans les rpubliques
qui se sont constitues sur les ruines des Empires centraux, les partis dmocratiques consentent avoir des reprsentants dans des gouvernements forms sous
l'gide de socialistes. Les dmocrates esprent que les ministres bourgeois parviendront sauvegarder ce qui pourrait tre maintenu des systmes juridiques
bourgeois, sans soulever de trop vives protestations ouvrires. Il faudra quelques
annes avant qu'on puisse se faire une ide exacte des consquences qu'a eues une
telle collaboration sur l'esprit socialiste des masses ; il ne sera peut-tre pas audessus des forces de syndicats puissamment organiss d'Allemagne d'empcher le
proltariat d'abandonner totalement sa mission historique, qui est de produire des
conceptions juridiques lui appartenant en propre ; mais il me parat malais
d'empcher les juristes universitaires de corrompre les intuitions proltariennes,
en prtendant leur donner une interprtation savante, sous prtexte de prparer la
jeunesse lettre allemande . se mettre au courant des compromis qui sont journellement conclus entre socialistes et dmocrates.
Il ne semble pas que Marx ait jamais eu un sentiment trs vif du rle que joue
le droit dans le dveloppement des civilisations ; quand il a voulu en 1875 donner
des instructions confidentielles aux rdacteurs du programme de Gotha, il s'est
1
Les romantiques ont peut-tre attribu aux anciens Germains des qualits de race qui se
retrouveraient dans tous les ricorsi. De nos jours on a prtendu nier le ricorso, d aux
invasions; mais entre Fustel de Coulanges et Vico, je n'hsite pas.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
11
bien gard d'expliquer ce que serait la dictature du proltariat 1 qui devrait,
suivant lui, se raliser pour permettre le passage du capitalisme au socialisme ; par
cette formule nigmatique, il entendait, sans doute, que le nouveau monde natrait
en pleine nuit juridique. On ne risque gure de se tromper en donnant de ses
doctrines la paraphrase suivante. La classe ouvrire victorieuse imposera la
bourgeoisie vaincue toutes les obligations qu'elle croira utiles de crer dans son
intrt 2 ; la longue, les familles des anciens matres capitalistes, reconnaissant
l'impuissance des partis de raction, se rsigneront leur sort, comme la noblesse
franaise s'est rsigne aprs le rgne de Napolon; lorsque les souvenirs des
luttes rvolutionnaires ne seront plus que matire d'histoire, il apparatra des
docteurs qui organiseront un systme bien ordonn de droits proltariens.
Personne ne s'avisera de contester le rle historique de la force. Macht geht
vor Recht, disent les Allemands ; cette maxime que l'on traduit vulgairement par :
la force prime le droit , signifie seulement que la force prcde le droit. On a
souvent rpt cette phrase de Marx : La force (die Gewalt) est l'accoucheuse de
toute vieille socit en travail 3 .
Mais toutes les formules de ce genre sont trop abstraites pour pouvoir pleinement satisfaire les esprits qui sont habitus se placer au point de vue du
matrialisme historique. Celte philosophie rclame la dtermination des mcanismes grce auxquels la gense du droit nouveau peut tre assure de se produire
rgulirement.
Cette gense suppose une activit longue, patiente et claire de corps judiciaires qui obtiennent une autorit morale inconteste grce leur savoir, leur
indpendance, leur souci du bien public ; le respect que le peuple accorde ces
dvous serviteurs du droit, se reporte sur la jurisprudence qui nat de leurs
arrts ; c'est sur les rsultats de leur travail, regards par tout le monde comme
uvres de la plus haute raison, que les professeurs oprent pour donner finalement au droit tout fait l'allure d'une science. Le plus difficile problme que pose la
rvolution proltarienne, est celui de savoir comment de telles organisations
judiciaires pourront fonctionner : la Grce, en dpit de la sagesse de ses philosophes, n'a point connu la Justice relle ; notre bourgeoisie dmocratique ne se
soucie, en aucune faon, de la sret du droit.
1
2
Cf. Revue d'conomie politique, Septembre-Octobre 1894, p. 766.
la fin du chapitre X, du troisime livre de La guerre et la paix, Proudhon a tabli un
remarquable paralllisme entre les guerres sociales et les guerres internationales. Nous avons
cit les paroles des auteurs; pour rduire un ennemi opinitre et toujours renaissant, tous les
moyens que fournit la victoire sont licites: la dissolution de l'tat, le partage des territoires,
l'enlvement, des colonies, l'expropriation des citoyens. C'est ainsi que le Tiers-tat en a us
pendant la Rvolution, vis--vis du clerg et de la noblesse ; pourquoi une nation n'en useraitelle pas de mme vis--vis d'une autre nation ? Et pourquoi, sagesse profonde du Journal
des Dbats [qui soutenait les thories des anciens juristes sur les guerres] ! si jamais la guerre
se rallume entre la bourgeoisie et le proltariat et que celui-ci soit le matre, pourquoi le
proltaire n'userait-il pas aussi de la victoire vis--vis du bourgeois. ? Patere legem quant ipse
docuisti, vous dirait-il. Et vous rpondriez en baissant la tte : Tu l'as voulu Dandin. Merito
haec patimur . Les chefs des rands tats capitalistes ont, dans le trait de Versailles, fourni
aux rvolutionnaires de bien redoutables prcdents.
MARX, Capital, tome I, trad. fran. p. 336, col. 1.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
12
Il est possible que Marx n'ait pas aperu les normes incertitudes que prsente
la constitution de la socit qui succdera la rvolution sociale, parce que son
me tait pleine de souvenirs romantiques ; des matres universellement admirs
enseignaient, au temps de la jeunesse, que les populations archaques avaient
possd, un degr minent, la facult de crer le droit ; il a pu supposer que le
proltariat allemand ne serait pas infrieur une tche de ce genre. Si on accepte
cette hypothse, on est amen penser que par l'expression nigmatique de dictature du proltariat , il entendait une manifestation nouvelle de ce Volksgeist
auquel les philosophes du droit historique rapportaient la formation des principes
juridiques. Le monde bourgeois a perdu la vritable vocation lgislative; celle-ci
reparatrait dans le proltariat rvolutionnaire; mais il ne semble point que Marx
ait jamais cherch trop mditer sur cette doctrine qui dpassait un peu trop le
niveau intellectuel des Bebel, des Liebknecht et des autres chefs de la socialdmocratie 1.
Lassalle a voulu combler la lacune que son rival avait laisse dans sa thorie
de la rvolution sociale ; il s'est souvenu que les juristes des assembles de la
Rvolution franaise avaient prtendu ne pas enregistrer les consquences d'une
victoire du Tiers-tat, mais faire triompher la raison longtemps opprime; il a
rv une transformation sociale rvolutionnaire qui, au lieu de se produire dans
une nuit juridique, se manifesterait en pleine lumire du droit. Je ne crois pas que
personne aujourd'hui estime que le Systme des droits acquis (publi en 1861) ait
rsolu les questions que Lassalle y a agites; ce livre me parat avoir surtout d
son prestige son obscurit, qui n'est pas moindre que celle du Capital 2 ; mais
on ne saurait estimer trop haut le service que Lassalle a rendu au proltariat
allemand, en lui faisant accepter l'ide que le socialisme faillirait sa mission s'il
compromettait l'avenir du droit, par une confiance aveugle dans l'excellence des
dcisions que pourraient prendre les hommes affranchis du capitalisme 3. Quand
les Barbares entrrent en contact avec les Romains, ils possdaient des vellits
de droit qui ont eu une influence considrable sur le dveloppement de la civilisation mdivale ; le droit que ralisera te proltariat vainqueur dpendra beaucoup
des tendances actuelles sur lesquelles s'exerce notre pouvoir ; la principale raison
pour laquelle Lassalle possde en Allemagne une autorit plus efficace que celle
de Marx, est probablement l'attachement que les ouvriers de ce pays ressentent
pour les institutions o se manifeste une soif du droit qui est tout leur honneur.
Depuis la Rvolution russe, on peut dire que le Weltgeist, dont Marx semble avoir implicitement fait le moteur de la dictature universelle du proltariat, est sorti des rgions de
l'imagination pour s'affirmer par des faits sociaux facilement observables ; l'avenir juridique
de la nouvelle socit socialiste dpend du bon fonctionnement des soviets; c'est pourquoi
tous les clans de la bourgeoisie, aussi bien les radicaux que les conservateurs, font tant
d'efforts pour empcher le dveloppement des conseils d'ouvriers.
En 1859, Lassalle avait publi un livre sur la Philosophie d'Hraclite l'obscur. La gloire de
l'antique philosophe avait t clbre par Hegel. Lassalle a pu croire qu'il aurait beaucoup
gagner en imitant l'obscurit d'Hraclite.
C'est ainsi qu'Engels a parl avec une incroyable lgret de la formation des nouvelles
murs familiales : les hommes, d'aprs lui, se dicteront eux-mmes leur propre conduite
et creront une opinion publique base sur elle (Origine de la famille, de la proprit prive
et de l'tat, trad. fran., p. 110). Engels parle ici en dilettante.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
13
Rien n'est peut-tre plus propre montrer l'insuffisance de la philosophie
juridique de Marx que le mpris qu'il a toujours affect dprouver pour
Proudhon 1. Celui-ci depuis 1848 jusqu' sa mort n'a jamais cess d'tre proccup
des moyens que l'on pourrait employer pour introduire plus de raison dans les
relations conomiques. Ses projets qui ont tous avort, fournissaient des expressions si claires des principales aspirations de l'conomie moderne que Proudhon
pouvait (dans une lettre du 28 dcembre 1861 Chaudey) se vanter de voir ses
ides tre plus l'ordre du jour que jamais (sur les chemins de fer, la navigation,
la Bourse, le crdit, l'impt) 2 ; dans une lettre du 2 novembre 1862, il crit son
ancien prote : Je suis un des plus grands faiseurs d'ordre, un des progressistes
les plus modrs, un des rformateurs les moins utopistes et les plus pratiques qui
existent 3 - Proudhon dans toutes ces inventions, parat si proccup de sauvegarder le respect du droit qu'on pourrait se demander s'il ne conviendrait pas de
les considrer moins comme des projets de rforme conomique que comme des
petits mythes ayant pour but d'entretenir de forts sentiments juridiques dans l'me
du rvolutionnaire 4.
Durant le Second empire, Proudhon se montra, plus d'une fois, trs inquiet de
la dgnrescence qu'il constatait dans le sentiment juridique populaire ;
notamment, le 26 octobre 1861, il crivait au docteur Clavel : Le gouvernement
du Deux Dcembre a donn un fcheux exemple ; il a inspir aux masses le got
de la dictature, des moyens extra-lgaux et du pouvoir fort. Si cette tendance
n'tait vigoureusement combattue, nous arriverions rapidement ce triste rsultat :
c'est que l'Empire us, puisque tout s'use, le pays, prenant la dmocratie par ses
paroles, par ses admirations et par ses accointances 5, ferait la rvolution, tout la
fois, contre l'empereur et contre nous 6 mais son grand cur l'empchait de
dsesprer du socialisme; quand le Manifeste des soixante lui parut marquer un
2
3
4
5
6
Je crois bien que leur diffrend eut pour origine une lettre que Proudhon avait crite Marx le
17 Mai 1846, lettre dans laquelle notre grand socialiste repoussait l'ide de provoquer des
luttes sanglantes analogues celle de la Rvolution franaise. Telles me semblent tre aussi,
disait-il, les dispositions de la classe ouvrire de France ; nos proltaires ont une si grande soif
de science qu'on serait fort mal accueilli d'eux si on n'avait leur prsenter boire que du
sang. Bref, il serait, mon avis, d'une mauvaise politique pour nous de parler en exterminateurs ; les moyens de rigueur viendront assez ; le peuple n'a besoin pour cela d'aucune
exhortation. (Correspondance, tome II, p. 205). C'est ces paroles de Proudhon que
rpondent les dernires lignes de la Misre de la philosophie, o semblent revivre les horreurs
de 93: la veille de chaque remaniement gnral de la socit, le dernier mot de la science
sociale sera toujours (comme dit George Sand): Le combat ou la mort ; la lutte sanguinaire ou
le nant. C'est ainsi que la question est invinciblement pose. On peut conclure de la qu'au
temps o il allait rdiger le Manifeste communiste. Marx n'avait aucune proccupation
juridique.
Proudhon, op. cit., tome XI, p. 303. - Il dit dans cette lettre que le public ignore gnralement
qu'il est encore plus peut-tre un praticien qu'un homme de thorie .
Proudhon, op. cit., tome XII, p. 220.
Dans la Capacit politique des classes ouvrires, Proudhon regarde les grves, qui semblent si
naturelles en rgime de concurrence anarchique comme un recul par rapport an mutuellisme
du Manifeste des soixante.
Proudhon a souvent reproch la presse dmocratique franaise de vanter une politique de
conqute et d'hgmonie.
PROUDHON, Correspondance, tome XI, p. 258.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
14
rveil du got du droit dans le peuple parisien, il crivit la Capacit politique des
classes ouvrires pour aider ce mouvement.
Lorsqu'on parle du droit chez Proudhon, il faut entendre ce mot dans le sens le
plus technique. Arthur Desjardins, qui fut un magistrat minent de la Cour de
cassation, reconnat chez Proudhon une habituelle lucidit du sens juridique 1 .
J'ai signal, dans un ouvrage rcent, que l'un des caractres les plus remarquables et probablement le moins remarqu de la philosophie de Proudhon est
qu'elle est pleine de rminiscences de droit romain 2.
J'ai ajout la fin du chapitre V de la premire partie de cette troisime dition une note pour appeler l'attention des juristes sur une hypothse qui me semble
destine prendre une place notable dans la philosophie socialiste du droit : le
droit au travail quivaudrait dans la conscience proltarienne ce qu'est le droit
de proprit dans la conscience bourgeoise. J'espre que des hommes plus comptents que moi sauront tirer parti de cette ide.
On s'garerait beaucoup si l'on entreprenait (comme l'a tent Anton Menger)
de construire un systme de droit socialiste. Il faut appliquer ici les observations
que fait Renan sur la dogmatique chrtienne primitive : L'ge des origines, c'est
le chaos, mais un chaos riche de vie ; c'est la glaire fconde 3, o un tre se
prpare exister, monstre encore, mais dou d'un principe d'unit, d'un type assez
fort pour carter les impossibilits, pour se donner les organes essentiels. Que sont
tous les efforts des sicles conscients, si on les compare aux tendances spontanes
de l'ge embryonnaire, ge mystrieux o l'tre en train de se faire se retranche un
appendice inutile, se cre un systme nerveux, se pousse un membre ? C'est ces
moments-l que l'Esprit de Dieu couve son uvre et que le groupe qui travaille
pour l'humanit, peut vraiment dire : Est Deus in nobis, agitante calescimus
illo 4 . Le devoir du socialisme est de tout faire pour faciliter la maturation du
droit.
Le texte de 1903 a t, reproduit avec quelques lgres retouches qui m'ont
paru utiles pour rendre l'expression de ma pense plus exacte ; des notes assez
nombreuses ont t ajoutes. J'avais song faire entrer dans ce volume une tude
sur les revenus, emprunte mes Saggi di critica del marxismo, mais j'ai reconnu
que cet ancien travail ne mritait pas d'tre conserv 5. La loi que Vilfredo Pareto
a dcouverte pour la rpartition des fortunes, ne s'applique pas aux positions trop
modestes; les formules simples qui m'avaient servi pour comparer les revenus des
diverses couches sociales aux revenus totaux, ne donnent, en consquence, que
des rsultats fort sujets caution.
1
2
3
4
5
Arthur Desjardins. P.-J. Proudhon, sa vie, ses uvres, sa doctrine, tome I, p. 194.
G. SOREL. Matriaux d'une thorie du proltariat, p. 407.
En employant l'expression glaire fconde Renan pensait videmment au mystrieux
Urschleim que les philosophes de la nature avaient plac l'origine du monde vivant.
(Edmond PERRIER, La philosophie zoologique avant Darwin, p. 165).
RENAN, Marc-Aurle, p. 544. - Comme cela arrive toujours, c'est au moyen de donnes
fournies par l'histoire humaine que Renan dcrit l'histoire de la cration naturelle.
J'aurais eu corriger les erreurs graves que renferment les applications numriques faites dans
ce travail.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
15
Un appendice a t consacr la psychologie de la douleur qui me semble
emprunter aux circonstances actuelles un singulier caractre d'opportunit. Pendant les horribles temps de la dernire guerre, les chefs de l'Entente ne cessaient
de tenir aux malheureux combattants des discours pleins des plus allchantes
visions d'avenir : prenez patience, disait-on aux soldats; vos souffrances prparent
une re de bonheur universel; quand les mchants Hohenzollern ne tyranniseront
plus l'Europe centrale, des fleuves de lait et de miel couleront pour les dfenseurs
de la Justice ententiste semblables ceux qu'Isral, aprs avoir travers le dsert,
s'attendait trouver dans le pays de Canaan 1. Revenus des champs de carnage,
les proltaires semblent condamns subir un sort semblable celui de Mose qui
mourut sur le mont Nbo, en apercevant la Terre promise, dans laquelle son Dieu
ne l'autorisait pas pntrer. Travaillez, anciens hros de la tranche, devenus
hros de l'atelier, leur enseignent les discoureurs officiels, travaillez avec plus
d'ardeur que jamais, travaillez sans relche, afin de pouvoir rparer les ruines
accumules par les instruments de destruction des armes. ces exhortations
papelardes rpondent des demandes unanimes de vie plus aise, de labeurs moins
crasants, de plaisirs plus accessibles; de toutes les poitrines populaires s'lve
une effrayante protestation contre la permanence de la douleur ; faut-il conclure
de ce que nous voyons, que les pessimistes avaient raison de ne pas croire aux
rves de vie heureuse?
Les problmes relatifs la douleur qui avaient eu seulement de l'intrt pour
les philosophes spculatifs, montent ainsi la premire place dans les tudes
sociales. J'ai donc cru bien faire de complter cette introduction l'conomie
moderne par une esquisse d'une thorie de la douleur 2.
Octobre 1919.
1
2
Nombres. XIII, 28, XIV, 8; Deutronome, XXXII, 20.
J'ai reproduit, avec quelques claircissements nouveaux une prface que j'avais crite en 1905
pour une thse de Georges Castex sur la Douleur physique. Dans les Matriaux d'une thorie
du proltariat (p. 43) je m'tais rfr cet ancien travail.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
16
Introduction lconomie moderne
Avant-propos
Par Georges Sorel
Retour la table des matires
Il y a quelques annes, les socialistes prtendaient, presque tous, s'inspirer de
Marx, et ils affirmaient leur admiration pour ses conceptions rvolutionnaires : ils
disaient qu'un monde nouveau devait incessamment surgir la suite de la lutte
engage entre la classe ouvrire et les classes dirigeantes ; - ils se reprsentaient
l'avenir comme une ralisation des ides juridiques qu'ils voyaient s'laborer dans
le sein du proltariat ; - raisonnant sur ce qui existe sous nos yeux et s'efforant
d'imiter les mthodes employes par les naturalistes, ils croyaient avoir le droit
d'affirmer que les temps de l'utopie taient dfinitivement finis et qu'un socialisme
scientifique (ou matrialiste) allait remplacer les vieilles rvasseries humanitaires.
La discipline marxiste avait t plutt subie qu'accepte ; elle n'avait pas t bien
comprise ; l'impression tant superficielle, le moindre accident devait tout
remettre en question. Une commotion d'un caractre exceptionnel a miett les
classes et a donn des tendances particulires une influence norme 1 ; les anciennes modes de socialisme l'usage des bourgeois sensibles, des artistes et des
dames 2 ont reparu avec leur ancien clat.
1
2
Il s'agissait de l'affaire Dreyfus.
Engels, on 1890, dans la prface une dition du Manifeste communiste, dit qu'en 1848 ses
amis et lui rejetaient le titre de socialistes, parce que les socialistes de ce temps cherchaient un
appui dans les classes cultives; le socialisme tait un mouvement bourgeois. avant ses
entres dans les salons. Cf. Marx, Manifeste communiste, trad. Charles Andler, tome I, pp. 1516. Il se pourrait, que le terme communiste et t adopt par lui parce que les rvolutionnaires allemands rfugis se groupaient en communes de dix vingt membres (op. cit., tome
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
17
Des professeurs de belles-lettres, de riches philanthropes quelque peu niais,
des gens distingus de toute espce ont pris en piti la misre intellectuelle des
marxistes et se sont donn pour mission de civiliser notre barbarie. Il tait vident,
par exemple, qu'il fallait une, certaine dose d'ignorance pour continuer parier de
rvolution sociale, alors que le bon ton tait d'appliquer le mot d'volution en
toute occasion et tout sujet. On avait crit des livres sur l'volution des genres
littraires, pourquoi ne pas en crire sur l'volution des genres conomiques et
politiques ?
Je doute que les grands prneurs de l'volutionnisme social sachent parfaitement de quoi ils veulent parler ; le terme volution ne possde un sens vraiment
prcis que si on l'applique un pass dfinitivement clos et quand on cherche
expliquer ce pass par le prsent 1 ; c'est ce qui a lieu, par exemple, dans le
darwinisme, qui est la formule la plus actuelle de la philosophie volutionniste.
Le darwinisme rduit tout des concurrences et s'inspire des ides de guerre;
c'est seulement aprs la guerre que l'on peut savoir quelle arme tait vraiment
suprieure, et souvent les jugements ports sur les institutions militaires d'un pays,
changent aprs une bataille considrable; ce n'est qu'aprs coup que l'on peut
expliquer les succs d'un grand conqurant ; de mme les naturalistes darwiniens
reconnaissent aux rsultats de la lutte quels taient les mieux arms. J'ai donc le
droit de dire que c'est par le prsent qu'ils interprtent le pass.
Mais nos philosophes sociaux n'entendent pas se borner des recherches de ce
genre ; ils entendent faire des prophties ; leur mthode revient expliquer le
prsent au moyen d'hypothses faites sur l'avenir et ensuite soutenir que ces
hypothses sont justifies par l'explication qu'elles ont fournie. Le moindre
examen montre que l'on peut faire une multitude d'hypothses contradictoires et
cependant capables de satisfaire toutes ce prtendu critrium de vracit ; ainsi
l'volutionnisme social n'est qu'une caricature de la science naturelle.
La thorie rvolutionnaire de l'histoire considre la totalit d'un systme
d'institutions en la ramenant son principe essentiel et elle ne tient compte que
des changements qui se traduisent par une transformation de ce principe. Sans
doute les partisans de cette doctrine ne sont pas assez nafs pour croire que le
centre d'un systme apparat tout d'un coup, par la vertu magique contenue dans le
mot qui sert le nommer. Ils ne croient pas davantage qu'une dclaration des
droits ou mme une lgislation nouvelle oprent infailliblement une transmutation
alchimique de la socit. lis savent que les procds employs par l'humanit pour
se transformer sont varis, complexes et obscurs ; que l'on peut appliquer
l'histoire ce que Liebig disait de la nature : qu'elle ne suit jamais de Noies simples
et qu'elle semble souvent dpourvue de sens commun 2. Les dtails chappent
d'autant plus toute tentative de raisonnement qu'ils s'loignent davantage du
1
2
II, p. 21, p. 40). Ces groupes taient des imitations de la commune jure mdivale, dont
l'histoire a tant enthousiasm nos pres.
Cf. G. SOREL, Illusions du progrs, 3e dition, pp. 239-244.
Rapport par K. VOGT. (Revue scientifique, 1891, 2e semestre, p. 72).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
18
centre ; c'est celui-ci seulement qui se prte des considrations philosophiques
sur le dveloppement.
Les volutionnistes littraires, politiques ou sociaux prtendent procder d'une
manire tout oppose ; ils veulent tablir une liaison entre les diverses poques
historiques en tablissant une continuit entre certains aspects des dtails opratoires. Une pareille science ne peut avoir aucune utilit pour la pratique ; mais elle
a une apparence naturaliste et cette apparence suffit aux gens de lettres.
Rien n'est plus arbitraire que le choix du caractre particulier dont la transformation sera ainsi suivie, tout dans l'histoire ne se prsente pas de manire
pouvoir tre systmatis, mme d'une faon sophistique, dans la dure ; dans bien
des cas il faut se contenter de suivre les changements survenus dans des qualits
secondaires. J'emprunte quelques exemples aux saint-simoniens, parce que peu
d'auteurs modernes ont t aussi ingnieux que ceux-ci pour Inventer ce qu'on
nomme aujourd'hui des volutions. Le droit de transmission de proprit, suivant
eux, a t toujours en se restreignant : le propritaire a d'abord dispos librement,
puis la loi a dsign les hritiers ou l'hritier, enfin elle a partag le bien entre les
hritiers 1, - l'ouvrier moderne est le successeur de l'esclave et du serf, le premier
abandonnant tout le produit de son travail son matre, le second une partie
seulement 2. Tout l'expos de la doctrine saint-simonienne est domin par cette
ide que le monde a subi une srie d'volutions ayant un sens parfaitement dtermin et que le devoir actuel des gens instruits et intelligents serait de prendre la
tte de ces volutions pour qu'elles pussent s'achever d'une manire plus raisonne, plus aise et plus rapide 3.
Le philosophe du droit sera toujours beaucoup plus frapp des oppositions qui
se rvlent entre les centres des systmes successifs que de la continuit plus ou
moins spcieuse que l'on dcouvre la surface. On peut mme se demander si l'on
n'aurait pas le droit de poser en loi peu prs universelle que : la continuit est
d'autant plus complte que les affections sont moins profondes.
Les doctrines des nouveaux socialistes font illusion parce qu'elles sont
prodigieusement obscures ; je ne prendrai qu'un seul exemple et je l'emprunterai
un livre rcent dans lequel Jaurs a essay de donner une philosophie des transformations du droit moderne. L'exemple que je choisis me semble tre d'autant plus
remarquable que la question examine par l'auteur est prodigieusement simple, en
sorte qu'on a peine comprendre comment il a pu accumuler tant d'obscurits
autour de choses si claires.
1
2
3
Charles Andler, Les origines du socialisme d'tat en Allemagne, p. 101.
Charles Andler, Op. cit., p. 108. - Suivant Marx, le proltaire anglais n'est pas sorti du
servage ; c'est un propritaire rural dpossd.
Dans mon dernier ouvrage j'ai dfini avec plus de prcision que je ne l'avais fait antrieurement l'opposition qui existe entre l'tude du pass et la mditation sur l'avenir. Dans la
premire on rencontre des choses acheves, une matire de science, l'histoire, le dterminisme. Dans la seconde, nous nous mettons en prsence de la vie, de l'imagination, de mythes,
de la libert. Ces deux attitudes de l'esprit sont lgitimes; mais il est absurde de mler les deux
genres. (Matriaux d'une thorie du proltariat, p. 24.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
19
Il prtend nous dmontrer que l'histoire philosophique des institutions permet
de concevoir le passage naturel au communisme. Il a lu dans un ouvrage crit par
un de ses amis une phrase qui lui parait avoir une importance capitale et qu'il,
souligne : Loin d'tre immuable, le concept de proprit s'est modifi au cours
des sicles et nul doute qu'il ne se modifie encore l'avenir, qu'il ne suive dans
leur volution les phnomnes conomiques et sociaux . Et il s'crie plein
d'enthousiasme : Voil la grande et large conclusion laquelle aboutit de plus
en plus l'cole historique franaise 1 . mon avis, si cette cole ne fait pas de
dcouvertes plus tonnantes, elle ne brillera pas d'un vif clat; je ne pense pas que
ce soit chose bien extraordinaire que d'affirmer que le concept de proprit se
modifie en raison des conditions historiques!
Quant Jaurs, il se croit en possession d'une philosophie toute nouvelle et il
ajoute immdiatement : Que signifie, en face de ces constatations souveraines
de l'histoire et de cette volution vivante du concept de proprit, la formule
scolastique et enfantine des radicaux ? De mme qu'il s'est modifi, le concept de
proprit se modifiera encore : et il est certain que maintenant c'est dans le sens
d'une complication plus grande, d'une complexit plus riche qu'il va voluer.
Comme tout cela est envelopp d'images impropres ! Depuis l'affaire Dreyfus,
Jaurs affectionne les termes de procdure ; son ami est transform en Cour
d'appel statuant souverainement sur le fait. S'il y a des volutions vivantes 2,
serait-ce donc qu'il y aurait des volutions mortes ? Quand Lon Bourgeois parle
de la proprit individuelle, il n'a aucune prtention suivre les scolastiques, dont
la doctrine n'est pas du lotit, d'ailleurs, celle des rdacteurs de notre Code civil. Enfin que peut bien tre cette riche complexit du concept futur de proprit ?
L'auteur cit par Jaurs avait. crit : La proprit au Moyen ge a nu caractre beaucoup plus complexe, beaucoup moins abstrait, et tranch que de nos
jours. C'est en se reportant cette phrase (cite d'ailleurs par Jaurs), qu'on peut
comprendre ce que veut dire sa prophtie. Nous nous loignerions des concepts
juridiques reus par notre lgislation aprs la Rvolution pour nous inspirer
d'ides mdivales. Je trouve qu'il y a l quelque chose de grave.
Ce n'est pas sans peine, sans rvolutions violentes et sans guerres sanglantes
que l'Europe a pu se dbarrasser de cette complication, de cette complexit et de
cette richesse qu'on signale dans l'idologie du Moyen ge. Pour crer le monde
moderne, il a fallu l'introduction du droit romain et la lgislation napolonienne;
avant de revenir aux manires de penser du Moyen ge, il faudrait y regarder
deux fois et ne pas se payer de mots sonores et pompeux sur la complication, la
complexit et la richesse des concepts. En tout cas, il faudrait nous donner la
signification des grandes rvolutions qui refoulrent la pense ancienne et voir si
cette interprtation ne serait pas susceptible de nous clairer sur la nature de la
rvolution poursuivie actuellement par le socialisme. Si les professeurs de belleslettres et les chefs de la prtendue cole historique franaise n'ont rien nous
1
2
JAURS, tudes socialistes, pp. 157-158.
Le mot, vivant me semble avoir, dans la langue parle par certains socialistes, un sens
mystrieux; je lis en effet dans la Petite Rpublique du 16 mai 1903: Le socialisme
allemand peut tre offert comme un exemple vivant du dveloppement harmonieux et robuste
du proltariat. Je me hte d'ajouter que ce galimatias n'est pas de Jaurs ; mais il pourrait
bien subir parfois l'influence de son journal ; et de toutes les volutions, la plus certaine est,
peut-tre, celle qui entrane tant de jeunes vers le galimatias.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
20
apprendre sur la valeur des transformations passes, je me demande pourquoi ils
prtendent civiliser notre barbarie et rformer nos conceptions socialistes.
Quelques lignes plus bas, Jaurs crit : Pour la premire fois, depuis l'origine de l'histoire, l'homme rclame son droit d'homme, tout son droit. Il rclame
tout ce qui est de l'homme, le droit la vie, le droit au travail, le droit l'entier
dveloppement de ses facults, l'exercice continu de sa volont libre et de sa
raison. Certes, voil un oracle sibyllin qui ne manque pas d'obscurit ; mais au
fond l'auteur revient encore sur la mme ide de rapprochement entre l'idal
socialiste et un idal mdival.
Quoi que Jaurs en puisse dire, ce nest pas la premire fois que de telles
revendications se sont produites depuis l'origine de l'histoire ; moins que
l'auteur ne place cette origine une date singulirement moderne. Il a exist
plusieurs religions caractres universaliste, rationnel et galitaire; le christianisme a notamment prtendu raliser le programme assez nigmatique dont il est
question ici. Ces religions n'ont pu aboutir ou, bien ont fait tout autre chose que ce
qu'espraient leurs premiers disciples ; l'cole historique franaise n'a peut-tre
pas encore eu le temps d'tudier ces questions 1.
travers tout cet encombrement verbal, nous arrivons comprendre que
Jaurs nous convie une nouvelle religion du devoir social, un nouveau
messianisme laque, en un mot une renaissance du vieil utopisme antrieur
1848. Il n'ignore pas que trs nombreux sont les catholiques et les protestants qui
prchent la mme doctrine que lui, dans une langue presque aussi obscure que la
sienne. l'heure actuelle, il existe un grand mouvement humanitaire dans les
classes dirigeantes ; la fameuse doctrine de la solidarit est l'expression de cette
nouvelle tendance. En se plaant sur un terrain singulirement voisin de celui o
se tiennent les bourgeois sensibles, le socialisme modern style ne peut manquer de
rcolter beaucoup d'applaudissements ; il peut mme obtenir des rsultats pratiques d'une certaine valeur; mais avant de rompre avec une tradition qui a t
l'honneur du socialisme contemporain et de revenir aux imitations des caricatures
du christianisme, il faudrait bien se rendre compte de ce que l'on fait et poser les
questions d'une manire intelligible.
Si je me suis arrt si longtemps sur ces pauvrets, c'est que je tenais montrer aux lecteurs que la nouvelle mthode de Jaurs 2 ne doit pas son succs une
supriorit scientifique quelconque ; je sais bien que, plusieurs fois, le rdacteur
en chef de la Petite Rpublique 3 a reproch aux rvolutionnaires de ne pas comprendre les exigences de la science ; mais je suppose que dans le monde frquent
par lui, le mot science a une signification qui lui manque dans la langue franaise.
1
Les ides de nos socialistes savants viennent presque toutes de Saint-Simon; mais celui-ci
avait plus de franchise qu'eux ; il signale l'analogie qui existe entre ses aspirations et l'uvre
du christianisme.
Dans les Rflexions sur ta violence j'ai nomm nouvelle cole un groupe de marxistes qui
taient devenus syndicalistes ; il se proposaient de combattre les illusions de ce que j'appelais
en 1903 la nouvelle mthode de Jaurs.
Il ne s'agit pas ici de Jaurs qui en 1903 n'tait ni directeur, ni rdacteur en chef de son
journal, mais de Grault-Richard qui avait beaucoup plus frquent les chansonniers de
Montmartre qui les savants.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
21
Plus on dmontrera la faiblesse des doctrines des prtendus volutionnistes, plus
aussi on mettra en lumire la puissance des causes conomiques, politiques et
sociales qui ont cr la situation actuelle et engendr le nouveau socialisme. Ces
doctrines sont conditionnes trop troitement par les faits de l'histoire contemporaine pour qu'il soit possible d'en essayer la rfutation ; mais il est clair que leur
succs n'aura qu'un temps.
En attendant que des circonstances favorables rendent aux ides vraiment
socialistes leur ancienne autorit, une double tche s'impose ceux qui ne renient
pas compltement la tradition : chercher pourquoi ce que Jaurs nomme la nouvelle mthode, a pu triompher, et expliquer, suivant des procds marxistes, les
difficults de l'heure prsente ; - dterminer la nature des rformes qui peuvent
rsulter d'une collaboration des partis populaires avec les partis bourgeois. Le
prsent ouvrage est consacr ce deuxime genre d'tudes 1.
Rformer dans la socit bourgeoise, c'est affirmer la proprit prive ; tout
ce livre suppose donc que la proprit prive est un fait indiscut; je ne chercherai
point comment une volution vivante pourrait la transformer en proprit
communiste , car une telle recherche me semble aussi difficile comprendre et
aussi inutile que celle de la pierre philosophale.
Ce sera un des principaux titres de gloire de Proudhon d'avoir dtermin,
mieux qu'on ne l'avait tent jusque-l, le domaine de la proprit et celui du milieu conomique ; je ne crois pas qu'il ait cependant puis la question ; je la
reprends et je montre comment la socialisation du milieu peut donner naissance
une grande quantit de rformes qui ne blessent pas la proprit.
Dans une premire partie, qui sert en quelque sorte d'introduction ces recherches, j'essaye de faire voir que, pour bien comprendre les problmes sociaux
actuels, il faut faire porter l'tude sur l'conomie rurale 2.
on arrive ainsi sur les frontires de la philosophie du droit; pour rsoudre les
difficults que rencontre la pense socialiste contemporaine, il faudrait pntrer
sur ce domaine et voici les trois grands ordres de questions dont l'tude me
semble surtout urgente:
1 Dterminer ce qu'est la dmocratie ; faire voir comment elle s'est mle au
socialisme, ce qu'elle a de commun avec lui et ce qu'elle a d'oppos; fonder cette
recherche sur des considrations purement matrialistes : sur les conditions de
production de la vie matrielle dans les villes (dmocratie) et dans les pures
agglomrations ouvrires, (socialisme)
1
2
Aujourd'hui la question se pose d'une faon encore plus pressante qu'en 1903. Cf.
l'avertissement pour cette troisime dition.
Dans les Illusions du progrs j'ai indiqu quelques sources agronomiques du droit romain (p.
311).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
22
2 Faire une thorie des rvolutions et surtout interprter, en vue de la pratique
socialiste contemporaine, les deux grandes rvolutions dont j'ai parl plus haut et
qui aboutirent l'introduction du droit romain et la lgislation napolonienne ;
3 Donner une forme intelligible aux thses morales, politiques et historiques
des nouveaux utopistes et en fournir une interprtation conforme aux principes
que Marx a conseill d'appliquer la connaissance des idologies.
J'ai runi beaucoup de matriaux sur ces objets ; dans un livre qui va paratre
en Italie et qui traite des transformations subies par les ides sociales modernes,
j'ai t amen aborder plus d'une fois quelques parties des problmes dont je
signale ici l'importance 1. Je voudrais bien trouver assez de loisir pour traiter ces
questions d'une manire mthodique ; je suis persuad que ce serait le meilleur
moyen de prouver, aux gens de bonne foi et d'intelligence, que le marxisme, bien
compris et dvelopp suivant ses principes internes, projette des clarts singulires dans la philosophie du droit.
Ce livre a seulement paru en 1906 sous le titre Insegnamenti sociali della economia
contemporanea.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
Georges SOREL,
Introduction lconomie moderne
Premire partie
De lconomie rurale
au droit
Retour la table des matires
23
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
24
Introduction lconomie moderne :
Premire partie : de lconomie au droit
Chapitre I
Les premires formes de l'conomie considre comme science propre aux hommes
d'tat : proccupations financires, influence des humanistes, quit naturelle. - Thories
ricardiennes tendant la, mathmatique ; circonstances qui leur donnrent naissance. - Efforts
contemporains pour passer une conomie pratique : difficult que prsente l'intelligibilit de
la nouvelle conomie.
Retour la table des matires
Je veux montrer ici combien il est essentiel de prendre pour base des recherches actuelles sur l'conomie les phnomnes que prsente la vie rurale et d'abandonner, par suite, la mthode suivie par presque tous les auteurs socialistes qui
ngligent l'agriculture pour s'occuper des grandes fabriques.
.
Mais je ne crois pas qu'il soit possible d'aborder ce problme difficile sans
examiner tout d'abord quelles ides gnrales nous pouvons nous faire de l'conomie moderne et quels procds il convient d'employer pour tudier les phnomnes que l'on observe dans les campagnes.
Pendant longtemps on a cru que l'conomie politique a surtout pour but de
fournir des conseils aux hommes d'tat, de leur apprendre quelle est la meilleure
mthode suivre pour accrotre la richesse, la puissance et la population du pays
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
25
qu'ils ont gouverner. Jusqu' une poque trs voisine de la ntre, cette conception a survcu au moins partiellement. Michel Chevalier dfinissait la science
conomique la mnagre des tats et lui assignait pour but l'organisation de
la puissance productive de l'homme et de la socit et la rpartition des produits
entre les divers cooprateurs . - Il n'aurait gure parl autrement s'il avait t
question de la gestion d'un grand domaine.
A. 1. - Historiquement, la science conomique est ne de la ncessit o l'on
s'est trouv d'tudier de prs les sources du revenu public et elle a form la base
de la science des finances. Pour que le gouvernement dispost de ressources
abondantes et rgulires, il fallait que la matire imposable ft considrable et
varie ; il fallait donc que toutes les branches de la production nationale fussent
exploites avec fruit. On prouvait aussi le besoin d'avoir une arme solide et on
se proccupait de savoir quels sont les moyens d'entretenir une population saine et
nombreuse 1. On a conserv l'habitude, jusqu' l'heure actuelle, de traiter dans les
mmes ouvrages les questions de production des richesses et de population,
encore que ce soient deux genres de questions tout fait distincts; on ne s'expliquerait pas cette pratique si on ne se reportait la tradition.
De mme on consacre toujours quelques chapitres, dans les mmes livres,
l'emploi que les hommes peuvent faire de leurs biens ; cela est encore fort
singulier ; mais il ne faut pas oublier que jadis cette question de la consommation
tait capitale pour l'homme d'tat. Celui-ci se demandait ce dont la masse a vraiment besoin pour subsister, quelle part il faut permettre l'glise de prlever et ce
que le gouvernement peut rclamer pour lui, sans craindre de tuer la poule aux
ufs d'or : un reste de cette vieille conomie tatiste se retrouve dans les ouvrages
contemporains. Vilfredo Pareto, qui se fait de la science une ide tout fait
moderne, trouve cette tradition fort ridicule et il critique avec raison Paul LeroyBeaulieu qui donne quantit de prceptes bizarres, rappelant les vieilles lois
somptuaires : Il permet un certain luxe et en dfend un autre... Sa science
conomique approuve fort que les hommes procurent des rivires de diamants et
des colliers de perles leur femme ou leur matresse. Ce dernier point reste
cependant indcis. Ce sont l, sans doute, des questions extrmement intressantes ; mais elles nous semblent un peu en dehors du domaine de l'conomie
politique 2.
Notre civilisation moderne a dbut par de terribles besoins d'argent; on ne fut
pas longtemps s'apercevoir que les procds fodaux ne pouvaient suffire pour
la gestion du Trsor des grands princes et qu'il fallait leur procurer des ressources
rgulires. En France, le nouveau rgime commence au XIVe sicle ; on fit appel
aux lumires des hommes de banque et de commerce : Les Italiens, dit Frantz
Funk-Brentano, arrivaient arms de traditions financires, quips de pied en cap
pour la besogne qu'on leur demandait. C'tait une vritable organisation bureau1
On sait que les intrts du recrutement semblent avoir jou un certain rle dans la politique
prussienne relative aux fabriques. Dans les anciens livres sur les fabriques, on fait ressortir
qu'un travail excessif abaisse la taille des conscrits (Marx, Capital, tome I, p. 103, col. 1). Il
faut observer que l'abaissement de la taille lgale n'est pas ncessairement parallle
l'abaissement de la taille moyenne : ainsi en France on a rduit la taille pour prendre plus de
conscrits, encore que leur stature et lgrement augment (Dbats, 13 juillet 1897).
Vilfredo Pareto, Cours d'conomie politique, tome I, p. 19.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
26
cratique qu'ils venaient installer, l'appel d'un roi de France ou d'un comte de
Flandre, en pleine socit fodale 1.
On sait quelle grande influence a exerce sur l'histoire des classes et par suite
sur celle des ides en France, le dveloppement des administrations royales : dans
ces administrations, la-bourgeoisie prit de bonne heure une grande place. Quand
on parle du Tiers-tat, il faut toujours penser, tout d'abord, cette lite, bourgeoise de fonctionnaires et d'avocats qui finit par gouverner presque compltement la France et qui lui a donn une si forte tradition tatiste 2. En mme temps
que ces corps se dveloppaient et que leur fortune suivait le progrs de la richesse
du Trsor, il se formait un courant idologique ayant pour objet la science de
l'conomie ; ce courant ne doit pas tre tudi d'une manire abstraite, mais
rattach troitement aux fonctions de ce Tiers-tat officiel, vou la mission
d'assurer la richesse et la grandeur royales.
A. 2. - ces proccupations d'ordre matriel s'opposrent, aux dbuts de la
Renaissance, celles des humanistes ; ceux-ci vivaient en dehors de la pratique des
affaires et ne connaissaient le Trsor royal que pour y puiser dans leur intrt
personnel - alors que les fonctionnaires royaux s'ingniaient pour trouver des
moyens de combler les vides que ne cessaient d'y pratiquer les gens de la cour :
favoris, bouffons, matresses, artistes et gens de lettres. Ces deux catgories de
personnes ne pouvaient pas considrer l'conomie du mme point de vue et
encore aujourd'hui les groupes qui correspondent celui des humanistes d'autrefois, ont une conception toute particulire de l'conomie et ne songent qu'aux
moyens de bien dpenser l'argent, sans trop se proccuper des moyens de
l'amasser.
Les humanistes lisaient dans les livres grecs que l'tat a pour mission de
raliser - par des efforts raisonns, directs et permanents - la vertu et le bonheur
des citoyens 3 ; ils voyaient que les choses ne se passaient pas de cette manire
autour d'eux et ils estimaient que, les livres n'ayant pu se tromper, il fallait que le
monde se transformt de fond en comble, pour la plus grande gloire des philosophes. Ils crivirent des utopies pour exhaler leur chagrin et exprimer leurs
vux ; quelquefois tout leur semble mauvais dans le monde contemporain et
Morus dcrit une socit idale, en prenant, gnralement, le contre-pied de
l'Angleterre dont il tait le premier magistrat 4.
1
2
3
Frantz Funk-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 569; cf. p. 678. - Il ne semble pas que
l'antiquit ait largement pratiqu cet appel aux hommes spciaux et c'est une des raisons pour
lesquelles il ne se cra pas une littrature quelque peu dveloppe de l'conomie et des
finances.
Cf. G. SOREL, Illusions du progrs, chap. II.
L'tat le plus parfait, dit Aristote, est videmment celui o chaque citoyen peut, grce aux
lois, pratiquer le mieux la vertu et s'assurer le plus du bonheur (Politique, livre IV, chap. II,
3). - Il suffit de quelques instants de rflexions pour trouver bien trange qu'un homme
d'tat puisse mditer la conqute et la domination des peuples voisins... C'est renverser toutes
les lois que de rechercher la puissance par tous les moyens, non pas seulement de justice, mais
d'iniquit (p. 7). Aristote est, comme tout le monde le sait, l'crivain le moins utopiste de
l'antiquit; Platon avait plus d'autorit, que lui la Renaissance ; mais la Cit d'Aristote est
encore terriblement loigne de l'tat, tel que le crait la royaut moderne, tat que les
humanistes, lecteurs de Platon, devaient trouver terriblement barbare.
Vilfredo Pareto, Les systmes socialistes, tome II, pp. 253-255.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
27
Les hommes de la Renaissance taient fort dsorients quand il leur fallait
penser sans avoir recours aux grands auteurs classiques ; les recettes pratiques des
hommes de commerce et d'administration ne pouvaient les intresser parce qu'ils
taient persuads de la ncessit de ramener toutes les actions humaines des
principes aussi gnraux que possible et de subordonner la marche de la socit
aux rgles d'une thique rationaliste.
l'heure actuelle, on tudie l'antiquit un point de vue plus raliste qu'autrefois ; mais l'ducation classique engendre toujours des proccupations fort
voisines de celles de ces utopistes; encore aujourd'hui les professeurs sont ports
admettre que l'conomie politique des conomistes classiques prsente une grave
lacune : elle ne donne pas la formule gnrale suivant laquelle les besognes doivent se partager entre les cooprateurs : quel effort doit donner chacun d'eux ?
quelle rmunration doit-il recevoir ? La libre concurrence abandonne la solution
au hasard ; un tel scandale ne saurait durer ; il faut trouver une rgle satisfaisant
pleinement la raison, imaginer une constitution permettant de raliser les rsultats
rationnels fournis par une vritable science de l'conomie sociale en dpit des
rsistances, ce qui revient supposer l'existence d'une force parfaitement intelligente et sage (que l'on nomme l'tat) charge d'exercer la justice distributive.
Tout cela semble d'autant plus naturel aux idologues qu'ils ne produisent rien et
se croient certains d'avoir, grce leur loquence, une large part dans la distribution des produits. Les conomistes dits thiques ne sont proccups que de
trouver la manire la plus vertueuse de vider le Trsor public : aux gens qui ne
savent pas le grec, le soin de le remplir.
A. 3. - Le dix-huitime sicle a possd une vritable virtuosit dans l'art
d'embrouiller toutes les questions; ce prtendu temps des lumires fut surtout l're
du galimatias. Tout le monde s'occupait de rformer l'tat : on voulait soulager la
misre des pauvres, enrichir le pays et dvelopper la vertu qui seule permet d'atteindre le vrai bonheur. Les charges publiques taient trs lourdes et elles avaient
surtout paru crasantes dans la premire moiti de ce sicle ; les impts taient
donc l'objet de discussions passionnes dans les classes leves de la socit ; les
ressources obtenues d'une manire si dure ne semblaient pas employes d'une
manire parfaitement satisfaisante. Les discussions conomiques sont alors domines par les deux ides d'quitable rpartition des charges et d'quitable distribution des fonctions, auxquelles vient s'ajouter, par voie de consquence, l'ide de
l'quitable constitution des classes. Nous voyons ainsi les conceptions antrieures
sunir dans une sorte de synthse : la science financire prtend devenir morale et
l'utopie des humanistes revt des apparences pratiques. Le fameux article de J.-J.
Rousseau dans l'Encyclopdie sur l'conomie politique est conu d'aprs les
principes de cette synthse : il traite des principes du gouvernement, des rgles
d'une bonne administration, des devoirs des citoyens et de leur ducation, de
l'ingalit des fortunes et beaucoup des impts.
En 1815, Dupont de Nemours, qui tait avec Morellet le dernier reprsentant
de l'cole physiocratique, crivait S.-B. Say pour lui reprocher de trop restreindre la notion de l'conomie politique : Elle est, disait-il, la science du droit
naturel appliqu, comme il doit l'tre, aux nations civilises. Elle est la science
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
28
des constitutions qui apprend et qui apprendra non seulement ce que les gouvernements ne doivent pas faire pour leur propre intrt et pour celui de leurs nations
ou de leurs richesses, mais ce qu'ils ne doivent pas pouvoir faire devant Dieu,
sous peine de mriter la haine et le mpris des hommes, le dtrnement durant
leur vie et le fouet sanglant de l'histoire aprs leur mort. Vous avez cru que notre
manire large de considrer les gouvernements tait la politique et non l'conomie politique. L'conomie est [la science] de la justice claire dans toutes les
relations sociales intrieures et extrieures 1 , Et la fin de sa lettre, il revenait
encore sur la ncessit de ne pas se borner l'tude des richesses : Sortez du
comptoir; promenez-vous dans les campagnes; c'est de toutes les volonts, du
Crateur par rapport notre espce qu'il s'agit. N'emprisonnez pas [votre gnie]
dans les ides et dans la langue des Anglais, peuple sordide qui croit qu'un
homme ne vaut que par l'argent dont il dispose, qui dsigne la chose publique par
le mot : commune richesse (common wealth), comme s'il n'y avait rien de tel que
la morale, la justice, le droit des gens dont le nom n'est pas encore entr dans leur
langue. Ils parlent .de leurs plaines, de leurs montagnes, de leurs rivires, de leurs
ports, de leurs ctes, de leurs contres ; ils n'ont pas encore dit qu'ils eussent une
patrie 2) .
Rien ne peut mieux faire saisir que ce passage l'opposition qui existe entre
l'tat d'esprit des hommes du XVIIIe sicle et celui des conomistes modernes :
trouver l'quit dans l'conomie nationale, voil ce que rclame Dupont de
Nemours ; et il n'est pas inutile d'observer que sur ce point les conomistes allemands de l'cole de Schmoller ne font que rpter de trs vieux enseignements.
Mais il ne faut pas oublier le principe fiscal qui est la base de toutes ces
recherches sur le droit naturel. La plus grande partie de la lettre de Dupont est
consacre raisonner sur les impts ; il critique vivement les droits sur la circulation des boissons, rappelle les anxits que lui causa, au temps de la Constituante,
le projet de maintien des octrois, et expose le plan d'une constitution domaniale
des finances, conue suivant les principes physiocratiques ; il regrette vivement
que la Constituante n'ait pas dclar les dmes rachetables, un tiers aurait pu tre
affect la dotation du clerg et le reste aurait permis de couvrir le dficit. Sa
science est bien dirige vers la rforme fiscale.
B. Un deuxime moment dans l'histoire des doctrines conomiques commence
lorsqu'au lieu de s'occuper des destines de l'tat, on s'efforce de crer une science gnrale des affaires et qu'ainsi on ne raisonne plus sur la socit, mais sur les
individus. Quand le systme est dvelopp, on suppose que tous les hommes sont
des producteurs et des changistes, qui pensent constamment aux moyens de
raliser beaucoup de richesses et d'obtenir sur le march les espces de biens qui
1
Dupont De Nemours. Lettre J.-B. Say, dans la collection Daire : Les physiocrates, p. 397. Cette lettre est crite bord du navire qui conduisait Dupont en Amrique pour un second
exil ; il ne se croyait pas en sret au moment du retour de Napolon; il avait dj d quitter la
France aprs le 18 fructidor. Beaucoup des rflexions contenues dans cette lettre se rapportent
Napolon; il prtend que sa chute tient l'impopularit des impts sur les boissons et que
Louis XVIII vient de tomber parce qu'il n'a pas aboli ces droits (pp. 410-411).
Dupont De Nemours, loc. cit., p. 415.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
29
leur conviennent le mieux. Le commerce est par sa nature minemment international et par suite trs peu proccup des diffrences qui existent entre les diverses
patries ; il ne s'intresse pas aux problmes de justice politique que Dupont de
Nemours regardait comme si importants. Les hommes ne sont que ds porteurs de
marchandises; tout se dissout au contact du march; l'universalit des changes
conduit ne plus envisager que des atomes producteurs-changistes. C'est, en
effet, l'atomisme social que les conomistes dits thiques dnoncent comme tant
le caractre principal de cette doctrine fonde, sur le commerce.
Cette doctrine devait, tout d'abord, atteindre sa perfection dans le pays o le
rle industriel de l'tat tait le moins bienfaisant et o le commerce international
avait pris la plus grande extension. A l'poque o Ricardo commena se faire
une rputation, l'intervention de l'tat dans la circulation fiduciaire avait t
dsastreuse en Angleterre; toutes les vieilles lois sur le travail devenaient caduques ou gnaient le mouvement industriel; nulle part peut-tre l'incapacit des
administrations publiques n'est aussi grande que dans ce pays et leur ineptie
contraste avec l'nergie des hommes d'affaires. Ricardo avait t agent de change
et toutes les questions devaient lui apparatre domines par le concept de valeur
changeable ; cette proccupation tait encore fortifie par la grande importance
que prenaient de son temps les questions relatives au billet de banque. L'conomie
politique fut ds lors inspire par l'ide que tout se ramne, en dernire analyse,
tablir des bilans commerciaux en valeurs qui soient susceptibles d'chapper aux
fluctuations du march montaire. On crut y tre parvenu par la thorie qui
estimait toutes choses en travail ; cette doctrine fut reue avec enthousiasme : la
science semblait enfin possder une base absolue.
L'conomie politique de Ricardo est quantitative, la fois commerciale dans
sa forme et extra-commerciale dans ses principes de valutation.
Des efforts n'ont pas cess d'tre faits pour perfectionner cette conception et
pour raliser une conomie tout fait mathmatique ; on s'est aperu que cela tait
possible et on a vil, alors clairement, que les anciens conomistes avaient souvent
mal pos les problmes : ils ne pouvaient raisonner qu'en employant les formes
arithmtiques simples et les formes logiques correspondantes, ce qui les amenait
simplifier les questions d'une manire exagre. Aujourd'hui, on se rend mieux
compte de ce que l'on peut demander la science conomique abstraite : il s'agit
d'clairer les concepts d'une lumire complte, en montrant comment ils se comportent quand ils fonctionnent d'une manire thorique, c'est--dire sans aucune
complication trangre. Aucune solution pratique ne pourra donc tre demande
l'conomie pure, tandis que l'ancienne conomie se croyait appele instruire les
hommes d'tat et leur dicter des rgles de conduite.
La science dont nous entreprenons l'tude, dit Vilfredo Pareto au dbut de
son cours, est une science naturelle. Comme telle, elle n'a pas donner de
prceptes ; elle tudie les proprits de certaines choses et ensuite rsout des problmes qui consistent se demander : tant donn certains principes, quelles en
seront les consquences 1 ? L'auteur fait observer que la chimie a prouv une
transformation analogue ; longtemps elle a enseign une foule de recettes de
fabrication, tandis que maintenant elle se borne dcrire les proprits chimiques
1
Vilfredo Pareto, Cours, tome I, p. 2.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
30
des corps 1 ; il pense que l'on peut assimiler les problmes conomiques ceux de
la physique ou de la chimie et qu'on peut atteindre la pratique par une srie d'approximations successives 2. Je me fais une ide tout fait diffrente du passage
d'une science abstraite une connaissance de la vie sociale 3.
C. Le passage la pratique ne me semble pas tre une complication des procds employs dans le moment prcdent, mais la ngation mme de ce moment. Il
faut revenir vers la ralit, reprendre l'examen des faits et tablir des classifications qui ne dpendent plus de quelque principe sur la nature des choses, mais du
but atteindre. Tandis que l'conomie pure est indpendante des fins que se
propose chacun et que l'ancienne conomie croyait pouvoir tout subordonner
une fin naturelle qu'elle prtendait connatre, nous sommes placs ici sur un
terrain subjectif et, avant toutes choses, il faut dfinir le but.
L'homme d'tat sera, d'ordinaire, trs peu sensible la dmonstration par
laquelle on lui prouve que le protectionnisme dtruit toujours de la richesse ; s'il
croit que le protectionnisme est le moyen le plus commode pour acclimater l'industrie et l'esprit d'entreprise dans son pays, il n'hsitera point tablir des taxes
douanires. Pour se dcider, il fera une enqute sur les divers pays et verra quelles
sont les mthodes qui ont le mieux russi pour atteindre le but qu'il s'est propos.
Mais encore faut -il que pour faire cet examen, il ne se laisse pas tromper par de
grossires apparences et qu'il ne soit pas dupe de sophismes tenant une
insuffisante intelligence des concepts 4.
On peut comparer, dans une certaine mesure, l'conomiste moderne l'artiste
qui connat la perspective ; il a fallu des sicles pour que les dessinateurs parvinssent comprendre qu'un dessin ne doit pas tre form de parties rassembles
d'une manire quelconque et qu'il y a certaines rgles gomtriques dont il ne faut
pas trop s'carter si l'on veut satisfaire un esprit raisonnable. Les plans gyptiens
devaient paratre fort naturels aux gens du temps ; - j'ai lu quelque part qu'un
peintre russe ayant fait le portrait d'un haut mandarin, celui-ci lui reprocha de ne
pas avoir fait figurer sur le tableau (qui le reprsentait de face) la plume de paon
(insigne de sa dignit), qui lui pendait dans le dos ; - les sculpteurs archaques
1
2
3
Vilfredo Pareto, loc. cit., p. 13.
Vilfredo Pareto, loc. cit., p. 16.
Pour que l'on puisse parler d'approximations successives, il faut admettre que toutes les causes
soient commensurables entre elles; c'est ce qui a lieu dans les problmes astronomiques; on
suppose, dans la mcanique cleste, que la formule newtonienne contient la totalit de la
cause ou tout au moins que, s'il y a des forces perturbatrices, elles sont exprimables par des
formules analogues. On ne saurait, au contraire, imaginer une mthode d'approximations successives pour rsoudre la question de savoir s'il vaut mieux pouser une jeune fille intelligente
et pauvre qu'une riche hritire dpourvue d'esprit.
Il me semble que les protectionnistes ne tomberaient pas dans certaines contradictions
bizarres s'ils avaient rflchi davantage sur l'conomie abstraite. Dans une confrence faite le
25 octobre 1901 devant la Chambre de commerce anglaise de Paris, Edmond Thry a pu
soutenir que le but du protectionnisme est d'amener l'agriculture franaise vendre son bl an
prix de Liverpool ! ce qui aura lieu quand la production se sera encore un peu accrue. Mline
a dclar que jamais on n'avait prsent un tableau aussi complet et aussi saisissant de sa
politique douanire. - Les conomistes thiques raisonnent de la mme manire quand ils
prtendent que la rduction de la journe forcerait les capitalistes occuper plus de monde et
que cependant elle ne rduit pas la productivit journalire de chaque ouvrier.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
31
n'taient pas choqus par l'ide de reproduire la fois sur un bas-relief l'intrieur
et l'extrieur d'un monument; il semble mme que plus d'une de ces erreurs d'architecture figure a ensuite inspir des artistes qui ne comprenaient plus ce qu'on
avait 'voulu faire et qui ont trouv l des combinaisons heureuses de dcoration 1.
C'est probablement cette cause qu'il faut rattacher les dcorations de certaines faades
romanes o l'on a insr des arcatures dans la maonnerie, sans aucune raison d'ordre constructif. - Les reprsentations dfectueuses me semblent avoir jou un rle trs considrable
dans l'histoire de l'art; on s'est demand souvent comment les constructeurs du Moyen ge
ont eu l'ide de faire saillir les arcs doubleaux et diagonaux des votes d'artes alors que les
Romains les engageaient dans la maonnerie gnrale ; c'est qu'ils avaient, sans doute, sous
les yeux, des reprsentations comprenant des votes avec des figures schmatiques des
cintres ; ils ont confondu la charpente et la maonnerie qu'elle avait port temporairement.
Les auteurs qui ont fait driver la vote gothique de l'art du charpentier, ne se seraient donc
pas compltement tromps.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
32
Introduction lconomie moderne :
Premire partie : de lconomie au droit
Chapitre II
Grande influence de l'conomie du coton; dspcialisation; Les ouvriers sont considrs
du point de vue quantitatif. - Physique sociale. - Confiance absolue dans la rationalit croissante du monde. - Importance de l'agriculture scientifique. - L'conomie concrte recherche
les phnomnes qui prsentent les diffrences les plus accuses. - Exemple donn par Marx.
Retour la table des matires
Je propose de nommer conomie concrte la science moderne qui se fonde,
la fois sur l'observation directe des faits et sur la connaissance des thories abstraites qui lui permettent de comprendre l'emploi que l'on peut faire des concepts.
l'origine de ces recherches, il faut se demander sur quelle partie des phnomnes sociaux il faudra faire porter l'investigation. Au dbut du XIXe sicle, on
n'prouvait gure de doute sur ce point ; on pensait qu'il fallait prendre pour base
de la science l'industrie du coton, qui se prsentait comme tant la plus avance,
la plus puissante et la plus capable de progrs. On croyait y remarquer un caractre particulier qui la sparait nettement de toute l'ancienne manufacture : Ure
faisait observer, il y a environ soixante-dix ans, que les fabriques anglaises taient
fondes sur un principe tout diffrent de celui qu'Adam Smith avait dcrit dans
ses tudes sur la division du travail; il opposait ce qu'il appelait le principe
d'galisation , qui n'exige pas un long apprentissage et permet de faire passer
l'ouvrier d'un travail un autre, - l'ancienne routine qui assigne un ouvrier la
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
33
tche de faonner la tte d'une pingle et un autre celle d'en aiguiser la pointe,
travail dont l'uniformit les nerve 1 .
On arriva ainsi penser que, dans l'industrie la plus avance, il devenait
inutile de tenir compte des qualits propres des hommes et qu'on pouvait considrer les travailleurs comme des atomes de qualit moyenne, susceptibles d'tre
seulement distingus par des grandeurs mathmatiques, en sorte que toute l'conomie devnt une science des quantits de travail mises en jeu par les capitalistes.
D'autre part, les affaires prenaient une telle extension que toutes les anciennes
roueries commerciales paraissaient bien archaques 2 ; la multiplicit et l'enchevtrement des oprations devenaient telles que les influences dues aux caractres
individuels tendaient s'effacer; le monde social prenait ainsi l'aspect d'un monde
physique, au milieu duquel il n'tait pas tmraire de concevoir l'existence de lois
aussi certaines que peuvent l'tre des lois naturelles 3. En idalisant la grande
industrie, on aboutissait la notion d'une physique sociale et on pensait que la
science ainsi cre non seulement pouvait clairer la pratique, mais encore devait
s'imposer celle-ci comme une thorie s'impose une application.
On fut ainsi conduit attribuer l'conomie abstraite une valeur exprimentale qu'elle n'a pas et qui a engendr beaucoup d'erreurs. On a cru souvent que les
diffrences constates entre les conclusions de la thorie et les faits devaient
s'attnuer dans l'avenir et que le monde tait appel ressembler, d'une manire
toujours plus parfaite, cette conomie idalise du coton Certains socialistes
tombrent dans cette erreur plus facilement encore que les conomistes, parce
qu'ils ne considraient le mouvement social quu point de vue d'un avenir lointain ; ils devaient donc se croire autoriss ngliger les diffrences que l'on
jugeait n'tre que transitoires ; il leur est arriv, plus d'une fois, de parler de la
ralit avec un profond mpris et de traiter les phnomnes que la science doit saisir, comme des apparences qu'un esprit lev sait carter pour atteindre la ralit
profonde des choses : cette prtendue ralit profonde semblait seule intressante
pour qui s'occupait de penser la socit future.
Cette manire de raisonner constitue une exagration de la philosophie intellectualiste qui a domin une trs grande partie du XIXe sicle et qui est une des
formes les plus graves de la superstition scientifique. On admettait que l'humanit
devait, pour des raisons de logique, se dcider enfin raliser ce que l'esprit
reconnaissait comme tant l'essentiel dans la science.
1
2
3
URE, Philosophie des manufactures, trad. fran., tome I, pp. 31-33. On sait que Marx a
beaucoup utilis cet ouvrage dans le Capital.
Le commerce de dtail contemporain ne connat plus gure que la vente prix fixe ; rien n'est
plus loign des anciennes habitudes, et la transformation a t difficile.
L'exemple le plus connu du grand public est celui que nous offrent les compagnies d'assurance sur la vie, elles peuvent faire des calculs exacts en se servant de tables qui expriment les
survivances moyennes des divers ges : on a pu mme faire entrer beaucoup de rsultats de
ces tables dans des formules mathmatiques remarquablement appropries aux besoins des
actuaires. Marx n'exprimait pas un paradoxe quand il crivait La lgislation de fabrique est
un fruit aussi naturel (d'aprs le texte allemand ncessaire) de la grande industrie que les
chemins de fer, les machines automates et la tlgraphie lectrique (Capital, tome I, p. 208,
col. 1). Il pensait que cette lgislation rsultait d'un ensemble de causes obscures, aussi
inutiles rechercher que les causes du progrs matriel. Les hommes y semblent, le Plus
souvent, noys au milieu des mouvements des choses.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
34
Cette illusion plaisait fort aux conomistes, parce qu'on put croire, durant
assez longtemps, que tous les grands pays allaient adopter le libre-change et
parce qu'on se figurait qu'en Angleterre la rforme douanire avait t faite sous
l'influence des arguments thoriques des freetraders. Les libre-changistes continentaux s'appuyaient sur l'exemple de l'Angleterre et ils remplaaient les raisons
toutes contingentes qui avaient dtermin les hommes d'tat de ce pays, par des
raisons gnrales, capables de justifier l'imitation qu'ils prconisaient. Cette attitude correspondait trop bien aux tendances rationalistes du temps pour que le
sophisme blesst beaucoup de personnes : les progrs du libre-change taient
donc considrs comme une preuve de l'influence croissante de l'conomie abstraite sur la pratique 1. Les socialistes taient parfaitement excusables de croire,
eux aussi, que l'avenir du monde serait caractris par une subordination croissante des rapports sociaux l'abstraction.
La fin du XIXe sicle a t marque par des dcouvertes dont l'importance
technologique, ne le cde pas celle de la machine filer le coton; il n'y a pas de
science qui proccupe davantage l'attention de nos contemporains que la microbiologie ; les anciennes explications de la physiologie ont t, presque toutes,
renouveles et, en mme temps, les procds de culture sont devenus beaucoup
mieux raisonns, tant sous l'influence des dcouvertes de laboratoire que sous
celle des expriences poursuivies avec persvrance par les praticiens 2. L'agriculture cesse d'tre une routine ; elle est rattache troitement la science dont notre
poque est la plus fire; elle a ainsi acquis un prestige qui lui permet d'exercer une
action sur le courant des ides conomiques contemporaines.
On avait cru que le progrs de l'agriculture dpendait de l'emploi de machines ; c'tait l'poque o la mcanique tait la science par excellence de l'industrie.
On ne s'attachait pas beaucoup chercher qu'elles sont les grandes diffrences qui
existent entre les machines agricoles et celles des filatures; on croyait que les
premires taient aux secondes comme des formes imparfaitement dveloppes
encore sont aux formes plus parfaites; cette imperfection n'avait qu'une importance transitoire aux yeux des savants, puisque suivant l'axiome du rationalisme
social l'avenir devait raliser la mme perfection partout. Un peu plus tard, on vit
dans la chimie le grand moteur de la production agricole ; on se figura, encore une
fois, que la culture se modlerait sur les grandes fabriques. Mais aujourd'hui,
quand on parle d'agriculture intensive, il faut penser surtout une industrie biologique et les analogies avec les fabriques deviennent lointaines 3.
1
2
Vilfredo Pareto fait observer qu' l'heure actuelle le libre-change rgne en Angleterre,
parce qu'il est favorable aux intrts de certains entrepreneurs . (Cours, tome II, p. 319.)
Les microbiologistes, en expliquant comment les lgumineuses peuvent vivre en absorbant
l'azote de l'air, ont justifi les opinions que les praticiens avaient mises sur les avantages de
la culture de ces plantes.
Sans vouloir entrer ici dans des dtails que ne comporte pas ce livre, il faut faire observer que
le machinisme agricole est surtout requis par l'agriculture extensive, et cela pour deux raisons
principales : 1 Cette agriculture exile de trs longues marches et il est, par suite, important de
ni fournir des procds perfectionns de parcours (par les faucheuses, moissonneuses, etc.) ;
2 Elle a besoin d'un travail norme concentr sur quelques ours et, si elle ne peut avoir
recours aux gangs ou bandes Se nomades, il faut qu'elle ait des machines.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
35
Il y a entre les principaux procds mcaniques employs dans les fabriques,
entre les diffrents procds chimiques, des analogies assez grandes, au point de
vue des consquences conomiques, pour qu'on ait pu longtemps parler de la
production moderne d'une manire abstraite, sans entrer dans les dtails. Aujourd'hui, la question parait beaucoup plus complexe qu'on ne le croyait autrefois; et
c'est ainsi que la petite industrie persiste dans certains pays avec une force tonnante. Il est vident que la production biologique prsente une extrme varit et
qu'elle chappe toute loi gnrale. Jadis, on avait eu le sentiment de cette
difficult, et c'est pour cela que l'on avait laiss de ct l'agriculture ds que le
progrs des fabriques avait fourni une abondante matire pour les recherches de la
science conomique : c'est dans ce qui se prsentait avec l'allure la plus compltement homogne qu'on avait, tout d'abord, cherch les faits susceptibles de
permettre la construction d'une conomie abstraite.
Pour tudier l'conomie concrte, il y a lieu de procder d'une manire oppose et de se tourner vers ce qui est le plus complexe, vers cette agriculture longtemps nglige : c'est ce qui est plein de varit qu'il fait, demander l'explication
de la ralit. Il serait dangereux, certainement d'affirmer a priori que l'agriculture
contient tout ce dont a besoin l'conomie concrte ; on s'exposerait retomber
ainsi dans l'ancienne erreur sur la parfaite homognit de la production, qui
faisait assimiler tous les phnomnes sociaux ceux que prsente la grande industrie ; mais il faut commencer les recherches par l'agriculture, quitte complter le
tableau en cherchant si la fabrique ne prsente pas quelques diffrences spcifiques.
Cette mthode, qui consiste aller, tout d'abord, ce qui est le plus complexe,
semble contraire aux habitudes scientifiques ; elle serait dangereuse si on n'avait,
d'avance, labor les concepts ; elle est celle que Marx a suivie dans le premier
volume du Capital. Voulant nous donner un tableau complet de la production
capitaliste et noter toutes ses particularits, il transporte le lecteur en Angleterre ;
c'est l que l'industrie moderne avait ralis, la fois, ses merveilles les plus
tonnantes et ses rsultats les plus douloureux ; - l'poque o se passaient les
faits recueillis par Marx, l'Angleterre tait regarde comme un pays monstrueux,
o les moindres accidents prenaient une allure gigantesque. Mais ces monstruosits n'taient que des exagrations de phnomnes qui, dans d'autres rgions,
passaient inaperus cause de leur faiblesse relative ; en s'attachant ces exagrations, il devenait possible de tout montrer, de fournir un tableau vraiment
classique de la production moderne.
Dans la prface, Marx dit qu'il procde comme le physicien qui tudie les
phnomnes lorsqu'ils se prsentent sous la forme la plus accuse . Il estime qu'il
ne faut pas s'arrter cette objection vulgaire que certaines particularits prennent, en Angleterre, un aspect tout particulier et acquirent une importance hors
de proportion avec celle qu'elles ont ailleurs ; il ne s'agit pas du dveloppement
plus ou moins complet des antagonismes sociaux qu'engendrent les lois naturelles
de la production capitaliste, mais de ces lois elles-mmes, des tendances qui se
manifestent et se ralisent avec une ncessit de fer .
Ces remarques s'appliquent trs bien toutes les recherches de l'conomie
concrte ; - le Capital n'est lui-mme, pour une trs grande partie, qu'un essai de
ce genre. Les questions quantitatives sont tout fait secondaires ; ce qu'on veut
atteindre, c'est une connaissance qualitative complte des phnomnes ; pour y
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
36
par-venir, il faut, trs souvent, passer par une investigation de quantits, mais ce
n'est qu'un intermdiaire qui disparatra quand on arrivera aux conclusions ;
celles-ci seront purement qualitatives.
Quand on lit le Capital, il ne faut jamais oublier que c'est un livre d'histoire
philosophique et ne pas le prendre pour un trait d'conomie, illustr par des
exemples fournis par l'histoire. Trop souvent on n'a pas bien compris ce caractre
et on n'a pas saisi la vraie porte de l'uvre de Marx; on s'est, pour cette raison,
beaucoup exagr les dfauts de composition qu'elle prsente 1.
Il me semble que la partie consacre l'conomie abstraite est de beaucoup la moins satisfaisante du Capital ; on peut remarquer, d'ailleurs, que Marx ne la dveloppe que dans la mesure
o elle lui semble ncessaire pour jeter de la clart sur son expos historique. Par suite d'une
erreur trange, cette partie est devenue, pour le plus grand nombre des marxistes, la partie
principale - probablement en raison du prestige que possdent toujours les choses trs
obscures, qui tendent devenir des dogmes.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
37
Introduction lconomie moderne :
Premire partie : de lconomie au droit
Chapitre III
Changement de point de vue des socialistes parlementaires ; causes politiques de ce
changement. -Thories exposes par Jaurs en 1897 et sa polmique avec Paul LeroyBeaulieu. - Il dcouvre les paysans en 1900. - Recherches de Vandervelde sur la Belgique. Classification des divers genres de domaines ; mthodes de Roscher et de Vandervelde ;
celui-ci dfigure les conceptions de Roscher et n'aboutit rien, faute de pntrer ce qu'est le
fond de la vie rurale.
Retour la table des matires
Les socialistes bourgeois ont peine se rendre compte du rle nouveau qui
appartient l'agriculture ; cela tient ce que pendant trs 'longtemps ils ont cru
que, pour raliser leurs projets, ils n'avaient besoin que de conqurir le peuple des
grandes villes; ils aimaient croire que les travailleurs des mtropoles avaient une
sorte de mission historico-conomique et notamment le devoir d'initier les travailleurs ruraux aux mystres de l'humanit intgrale. Les dsillusions rcentes ont
enseign aux chefs du socialisme franais qu'il ne fallait pas tant compter sur les
lecteurs urbains.
Il y a quelques annes, Jaurs cherchait donner une forme philosophique
ses esprances et invoquait une prtendue loi de l'histoire, dont il trouvait la
vrification toutes les poques. Dans les histoires demi-lgendaires des
premires populations iraniennes, s'criait-il dans un discours du 3 juillet 1897
la Chambre des dputs, c'tait autour du forgeron - comme plus tard en
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
38
Angleterre au XIVe et XVe sicles - c'tait autour du forgeron, c'est--dire de
l'artisan qui, au foyer de sa forge, fondait en un seul bloc toutes ces forces paysannes disperses, que ces forces se groupaient ncessairement pour les revendications et le combat. 1 De l il passe Caus Gracchus qui sut intresser les
chevaliers sa politique, - aux Jacques qui essayrent de, donner la main
tienne Marcel ; - la bourgeoisie de 1789 qui mancipait les paysans parce
qu'elle ne pouvait pas s'manciper elle-mme sans briser les chanes qui les
rattachaient les uns et les autres au mme rgime fodal. Enfin il conclut que,
les ouvriers ruraux s'organisant en syndicats comme font les urbains, il y aura
entre ces deux groupes une rencontre durable, une rencontre ternelle, puisque
c'est la souverainet du mme droit, la supriorit de la mme force, la force du
travail, qui sera proclame par l'union des uns et des autres.
Dans ce discours Jaurs attnuait la doctrine ordinaire, puisqu'il ne parlait pas
de la dictature des villes ; mais il n'admettait aucune attnuation la loi de
proltarisation croissante; il se moquait d'un dput qui l'avait interrompu pour lui
faire observer que la petite proprit lui survivrait. Il prtendait s'appuyer sur une
vaste enqute faite par ses amis 2 et sur des constatations faites par Paul LeroyBeaulieu qui aurait dclar qu'il tait ncessaire de faire disparatre la petite
proprit. Cette dernire affirmation donna lieu une polmique trs aigre, au
cours de laquelle Jaurs reprocha son adversaire d'avoir souvent hsit entre
les dogmes de l'conomie politique, les intrts de sa clientle capitaliste et ses
ambitions lectorales 3 . Reprocher Paul Leroy-Beaulieu une superstition
dogmatique, c'tait a-vouer qu'on n'avait jamais lu ses livres ! et de fait Jaurs ne
connaissait les opinions de cet auteur que de seconde main et fort inexactement 4.
Les succs des nationalistes en 1900 et les embarras que lui causait l'opposition des guesdistes, amenrent Jaurs regarder, d'un peu plus prs, ce qui se
passe clans les campagnes et il dcouvrit dans le dpartement qu'il habite depuis
son enfance, des choses qu'il n'avait pas souponnes jusque-l. Marx s'est
tromp quand il a cru que la concentration de la proprit se produirait aussi
1
3
4
Sans doute l'auteur fait allusion ici Wat Tyler, qui fut chef d'insurrection du 7 au 15 juin
1381 et dont le rle parat avoir t assez mdiocre dans la grande rvolte des paysans.
D'ailleurs ce forgeron tait tuilier. (ANDR RVILLE, Le soulvement des travailleurs
d'Angleterre en 1381, p. XLI).
Cette enqute parait n'avoir appris Jaurs que des dtails bien mdiocres de la vie paysanne.
Dans la sance du 19 juin il rvla la Chambre que les fermiers ne laissent leurs valets
de la viande que les os, du beurre que le petit lait, de la volaille que la plume et qu'au sortir
des vignes remues par eux ils ne buvaient que de l'eau. Des courtisons de Jaurs ont os
cependant crire qu'il tait regrettable que Gatti et compos son livre Agricoltura e
socialismo sans avoir en sa disposition une de ces enqutes vastes que le socialisme franais, l'tat d'bauche tout au moins, a mises au service de Jaurs en 1897. (Notes critiques,
25 aot 1900, p. 126). Bien des faits nous permettent de voir que l'cole de Jaurs s'inspire des
plus tristes traditions de bassesse lgus par l'Ancien Rgime et que l'idalisme social est une
assez sale chose !
Petite Rpublique, 11 septembre 1897 ; voir la lettre de Paul Leroy-Beaulieu dans les Dbats
du 26 aot.
Un certain quilibre entre les trois modes de proprit est la condition la plus favorable au
progrs agricole et l'aisance de la population rurale. Voil la thse de Paul Leroy-Beaulieu
(Trait thorique et pratique d'conomie politique, tome II, p. 18). Ce texte est d'une clart
parfaite et les arguties de Jaurs ressemblent trop celles des inquisiteurs ; il dclare qu'en
maintenant ses thses, son adversaire avait reni essentiel de sa pense et s'tait
disqualifi !
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
39
srement et aussi rapidement dans l'ordre agricole que dans l'ordre industriel .
On lui apprit qu'un grand domaine venait d'tre divis et vendu des paysans ; il
vit que le machinisme ne donne pas un avantage marqu la grande proprit....
qu'il respecte le petit propritaire et limine le proltaire proprement dit . (Petite
Rpublique, 9 aot 1900). Ainsi le machinisme agirait ici d'une manire oppose
ce que Jaurs avait cru autrefois tre une ncessit inluctable.
L'anne suivante, les proccupations lectorales devenant plus vives, Jaurs fit
de nouvelles dcouvertes dans son propre dpartement. Les paysans d'un canton
voisin du sien lui apprirent que dans le vignoble la grande proprit tend
diminuer... Il y a environ un [tiers de non-possdants]; mais ce tiers a plutt une
tendance dcrotre. Et encore faut-il ajouter que dans cette catgorie il rangeait
les paysans qui possdent une petite parcelle et doivent aller travailler chez autrui.
Ce tiers est surtout proccup de devenir possdant son tour et cette prtention
n'est pas absolument chimrique (Petite Rpublique, 21 juillet 1901). C'tait
juste le contraire de ce qu'il affirmait en 1897 sur la foi de ses correspondants, et
comme rsultat de sa grande enqute.
Personne n'a song accuser Jaurs d'avoir sacrifi les dogmes du socialisme
ses intrts lectoraux ; mais il est vident qu'il a mieux compris les choses
quand il a eu un intrt pressant les voir comme elles sont, quand il lui a fallu
prendre ni,, contact plus intime avec les paysans, quand il a cherch connatre
leurs aspirations. Alors la question agraire ne lui a plus sembl tre un problme
de statistique, mais une question multiforme et humaine. Dans l'article du 9 aot
1900, il avouait qu'on ne pouvait tirer de conclusions utiles des recensements
gnraux et qu'il fallait procder des tudes de dtail sur le monde rural.
Les dputs socialistes belges avaient devanc leurs confrres franais sur ce
terrain et on cite souvent l'avis de Vandervelde comme faisant autorit en matire
de questions rurales. Je ne crois pas que les conditions dans lesquelles fonctionnent les institutions ouvrires belges soient de nature amener leurs chefs
parfaitement comprendre les problmes agricoles : ils voient surtout dans la
coopration des campagnards un moyen de mieux faire marcher leurs magasins
urbains et il est impossible d'en mconnatre davantage le vrai caractre 1 -
moins qu'ils n'en fassent simplement une boutique lectorale 2. Quoi qu'il en soit,
je vais examiner, d'une manire sommaire, les rsultats auxquels est arriv Vandervelde dans son principal ouvrage : La proprit foncire en Belgique 3.
L'auteur s'est propos de savoir comment les tendues des biens ruraux
s'taient modifies de 1835 jusqu' nos jours ; il a fait relever sur les livres cadastraux les cotes de plus de cent hectares. Il a trouv qu'elles reprsentaient autrefois
392,253 hectares et qu'elles reprsentent aujourd'hui 397,130; l'accroissement est
1
2
G. Sorel, Matriaux d'une thorie du proltariat, pp. 229-230.
C'est ce qui permet de comprendre pourquoi ces farouches libres-penseurs dbitent des
chapelets dans certaines de leurs coopratives socialistes. (Vandervelde, L'exode rural et le
retour aux champs, p. 67). Il s'agit de duper des paysans catholiques.
Je suppose que l'auteur attache, en effet, une importance particulire ce livre, car avant de le
faire diter en France, il lui a donn une grande publicit : le publiant d'abord dans les
Annales de l'Institut des sciences sociales (dirig par le grand industriel Solvay), et ensuite
dans je ne sais combien de revues socialistes.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
40
de 4,877 hectares et cette diffrence est tout fait ngligeable. Ce calcul est trs
contestable parce que la grande proprit belge renferme beaucoup de bois et de
landes, en sorte qu'il faut prendre des cotes bien suprieures 100 hectares pour
avoir une ide exacte de son volution ; si on considre comme minimum 500
hectares, on trouve que la surface de la grande proprit s'est abaisse de 86,931
hectares 82,198. Ainsi se manifeste un rgime de compensation entre les causes
lgales (lois sur l'hritage) qui tendraient morceler les domaines et des causes
historico-conomiques qui tendraient les accrotre.
L'auteur nous montre que l'effet des lois successorales a t compens : par
l'influence des murs des grandes familles parvenant maintenir leurs fortunes
au moyen de la richesse urbaine), - par l'alination des communaux et des forts
domaniales, - par le reboisement de terres jadis dfriches, rapidement puises et
abandonnes bas prix par les moyens possesseurs. Dans les rgions de culture
riche, il est fort rare qu'il se produise une concentration 1.
La partie vraiment intressante de ce livre est ce qui nous est prsent comme
l'accessoire de la partie scientifique, l'histoire de quelques grands domaines ; l'auteur, se proposant de dnoncer aux haines populaires les familles conservatrices, a
recueilli tout ce qu'il a trouv de peu recommandable sur les origines de leur
fortune. Par suite de l'troitesse de ses proccupations de politicien, Vandervelde
n'a pu donner un tableau vraiment complet de la famille belge mais il y a l
cependant quelques renseignements utiles consulter. En gnral, toute statistique
agricole est sans porte, quand elle ne se rattache pas trs troitement une
histoire de la famille.
Vandervelde a tabli aussi de longues comparaisons entre les rsultats fournis
par les enqutes agricoles de 1846, 1880, 1895, pour savoir si le nombre des
grandes exploitations agricoles est en progrs. Les chiffres qu'il emploie ne
mritent pas tous une grande confiance, mais il est essentiel de s'arrter sur le
principe de la classification qu'il adopte. Il faut, dit-il, suivant l'expression de
von Philippowich, se placer au point de vue conomique et non au point de vue
gomtrique 2 ; cela veut dire que les statistiques fondes sur la surface ne
doivent pas servir de base; mais il y a plusieurs manires d'entendre cette formule.
Rau avait propos jadis de classer les cultures en : petite, avec un attelage ;
moyenne, avec deux; grande, avec trois; cette rgle ne permettrait de comparer
que des terres produisant les mmes choses et elle a t faite pour les terres bl.
Le professeur Souchon prend pour base la constitution de l'atelier familial : la
1
Vandervelde, La proprit foncire en Belgique, p. 303. - En France, la statistique dcennale
de 1892 montre que le nombre des exploitations ayant plus de 40 hectares (que notre
administration nomme grandes bien fort) est tomb de 142 139 mille en dix ans et que leur
surface a pass de 22,296 22,493 mille hectares. Ces diffrences rentrent dans les limites des
erreurs d'une statistique. Cette stabilit est d'autant plus remarquable que de 1882 1892 il y a
eu une forte crise dans le pays. Il y a eu des compensations : dans la rgion du nord de la
Loire, la petite et la moyenne culture s'taient tendues; dans les pays vignobles le contraire
s'tait produit parce que beaucoup de propritaires avaient renonce reconstituer leurs vignes
en cpages amricains et avaient vendu leurs terres. (Statistique agricole de la France.
Rsultats gnraux de l'enqute dcennale de 1892, p. 368).
Vandervelde, op cit., p. 277.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
41
grande proprit exige du travail salari ; - la moyenne peut nourrir la famille si
elle n'est pas exceptionnellement nombreuse et si elle travaille tout entire ; - la
petite ne nourrit la famille que si elle reoit un salaire auxiliaire 1. Cette mthode
dfinit la grande proprit par le systme de production, la petite par l'origine des
revenus et la moyenne par un procd mixte ; elle a de plus l'inconvnient de
confondre la petite proprit avec la proprit de la parcelle la plus minime, d'un
jardin attenant une maison ouvrire.
Souchon critique une autre classification adopte par les socialistes franais en
1892 : la grande proprit est afferme ; - la moyenne exige des salaris ; - la
petite est cultive par la famille 2 ; - mais, dans ce systme, on appellera grande
proprit une parcelle que son possesseur ne peut cultiver lui-mme, soit qu'il
habite la ville, soit qu'il ait une profession l'empchant de diriger le travail rural.
Vandervelde commet une erreur au moins aussi singulire en nommant capitaliste
toute proprit qui n'appartient pas celui ou ceux qui la cultivent 3 ; il
multiplie ainsi les capitalistes dans un but lectoral.
C'est au systme de Roscher que Vandervelde donne la prfrence, sans chercher, d'ailleurs, le justifier et sans l'appliquer correctement. La grande proprit
est celle que peut diriger un homme de la classe suprieure, qui y consacre tout
son temps. Dans la moyenne, le chef de famille participe certaines parties du
travail que sa condition sociale et son ducation ne doivent pas lui faire
ddaigner . La petite est cultive par toute la famille qui a recours exceptionnellement des salaris. Enfin, sur la parcelle, la famille ne peut trouver assez de
ressources pour son complet entretien.
Cette classification a t faite pour l'Allemagne o le faire-valoir direct a
encore une importance exceptionnelle ; on ne saurait confondre une exploitation
gre par le propritaire avec une exploitation quelconque, quand on se place sur
le terrain conomique; mais Vandervelde ne se proccupera pas de ce dtail.
L'Allemagne est aussi un pays o la question des rangs joue un grand rle dans la
vie ; en est-il de mme en Belgique? Enfin, dans ce dernier pays se trouvent
beaucoup de domaines qui ne rentrent pas dans le systme de Roscher et qui ont
cependant une grande importance : les forts, les parcs et autres possessions de
luxe 4, trs apprcis dans un pays o existent tant de colossales fortunes
urbaines ; - les terres acquises par les capitalistes en vue de les vendre plus tard
par petits lots 5 quand des chemins de fer amneront un flot de population urbaine
dans la rgion. Les proprits somptuaires et celles qui fonctionnent comme trsors mis en rserve pour l'avenir, forment en Belgique une fraction notable, des
grands domaines.
D'autre part, le lopin de terre se multiplie d'une manire extraordinaire dans ce
pays et Vandervelde distingue cinq espces de possesseurs de lopins : domestiques et journaliers sdentaires ; nomades qui vont faire la moisson en France ;
paysans qui deviennent industriels d'hiver dans les sucreries et les mines ; paysans
travaillant pour des fabricants; urbains prenant tous les jours le chemin de fer pour
1
2
3
4
5
Souchon. La proprit paysanne, p. 10.
Souchon, op. cit., pp. 6-7.
Vandervelde, op. cit., p. 272.
Vandervelde, Op. cit., p. 33, p. 79, etc.
Vandervelde, Op. cit., p. 270.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
42
se rendre de leur maison leur travail 1. Cette classification n'est pas conforme
aux principes de Roscher; pour suivre ses principes il faudrait distinguer : les
parcelles qui exigent l'appui d'une industrie domestique auxiliaire pratique durant
la mauvaise saison; celles qui fournissent la partie principale de l'entretien de la
famille, le surplus tant demand des travaux industriels ou agricoles excuts
plus ou moins loin de la demeure; celles qui ne servent qu' amliorer l'alimentation et dont la culture retombe en grande partie sur les femmes qui, en Belgique,
sont trop souvent transformes en animaux de labour 2.
Dans le systme de Roscher, la production n'est pas considre du dehors ;
elle n'est pas juge par rapport au march; bien que beaucoup de produits soient
destins devenir marchandises, l'auteur allemand peut cependant se placer au
point de vue d'une conomie en nature, parce qu'il se demande comment la
famille organise sa vie sur la terre, au moyen des ressources que celle-ci lui
procure, soit directement, soit indirectement la suite de ventes et d'achats. On
peut dire que le point de vue de Roscher est intrieur 3 ; cependant il ne nglige
pas compltement les relations extrieures ; il s'occupe en effet de savoir comment la famille, considre en bloc, se place dans la socit, quel rang elle occupe
et quelles obligations rsultent de l pour sa manire de vivre.
Non seulement Vandervelde n'a point pris garde tout cela, mais, aprs avoir
expos la classification de Roscher, il la modifie d'une manire profonde, sans
avoir l'air de comprendre ce qu'il fait : On peut, dit-il, considrer comme
grandes exploitations celles qui sont assez tendues pour que l'exploitant ne
participe pas au travail agricole proprement dit et se borne diriger l'entreprise.
Il supprime ainsi deux des lments essentiels de la dfinition de Roscher : que la
culture est dirige par un homme de la classe suprieure et qu'elle peut l'occuper
entirement
ainsi disparat la notion du rang social et en mme temps on oublie que le
propritaire est compltement absorb par sa proprit. Grce ce vritable
contre-sens, il devient possible de revenir une pure classification gomtrique.
Vandervelde applique d'ailleurs la classification par surfaces d'une manire
bizarre ; au lieu de prendre pour chaque rgion agricole les chiffres spciaux qui
correspondent au genre de culture local, il prend des chiffres moyens; la grande
culture sera partout celle qui comprend plus de 50 hectares, alors que, d'aprs les
agronomes du gouvernement, le minimum varierait de 16 60 hectares 4.
1
2
3
Vandervelde, Op. cit., pp. 281-282.
Quan Vandervelde. Op. cit., p. 289 et p. 67.d on distingue l'conomie naturelle et l'conomie
montaire, on distingue, d'une manire plus ou moins inconsciente, et souvent assez
maladroitement, le ct intrieur et le ct, extrieur ; il est vident que la premire de ces
conomies est vue uniquement par l'intrieur et rapporte au centre familial.
Il dit n'adopter les chiffres moyens que sous les plus expresses rserves . (Vandervelde,
Op. cit., p. 279) ; voil un singulier procd scientifique ! - Paul Leroy-Beaulieu estime que
dans les pays pauvres la grande proprit comprend 400 500 hectares, que dans les pays
riches elle a 80 hectares et exceptionnellement 60 (loc. cit., p. 18). Les chiffres belges
paraissent bien faibles.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
43
J'ai insist sur ces dtails pour montrer combien l'habitude de raisonner sur les
questions urbaines empche certains auteurs de se placer sur le terrain qu'il
convient d'adopter pour approfondir les problmes ruraux.
On pourra trouver que j'ai donn un dveloppement excessif la critique d'un
livre de politicien; mais Vandervelde est parvenu faire croire nos universitaires
qu'il est le chef d'une cole de marxisme plus scientifique que celui de Marx. Il
tait donc ncessaire de montrer qu'il tait dpourvu d'ides personnelles : l'tude
de son livre rcent sur L'exode rural et le retour aux champs conduirait aux
mmes conclusions. On se demande pourquoi Vandervelde, reprenant, dans cet
ouvrage, des ides de Le Play sur l'union de l'agriculture et de l'industrie, a cru
devoir ne pas faire connatre la source de ses solutions ! Il suppose, sans doute,
que ses admirateurs sont bien aveugles ou bien peu renseigns.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
44
Introduction lconomie moderne :
Premire partie : de lconomie au droit
Chapitre IV
Recherches de Le Play et de Demolins. - Effort tent par IL de Tourville pour donner une
base la science sociale. -Pourquoi l'tude de la famille ouvrire est-elle fondamentale ? - La
psychologie des peuples : tout ce qui est de nature bourgeoise est superficiel.. - Familles
rives au travail. -Divers aspects sous lesquels se prsente l'tude des classes ouvrires. Sentiment juridique du peuple ; cas o il est rattach au travail et cas oit il est import par des
bourgeois. - Chez les paysans il se manifeste surtout dans les coutumes successorales.
Retour la table des matires
Les auteurs qui ont vraiment compris la nature de l'conomie rurale, ont attach une trs grande importance aux sentiments des producteurs; ils ont soutenu,
souvent, que les conomistes classiques avaient fait des recherches trop superficielles, parce qu'ils avaient nglige cette partie de la science. Le Play, qui tait
cependant un mtallurgiste trs distingue, semble avoir t, au cours de ses
voyages, encore plus frapp par les particularits de la vie ouvrire que par les
conditions techniques des professions; mais il ne faut pas oublier que les deux
tiers des monographies des Ouvriers europens 1 se rapportent l'agriculture et
que, par suite, l'attention de l'auteur devait tre attire sur les questions relatives
l'organisation de la famille et la hirarchie.
Le Play nous apprend, lui-mme, qu'il regardait l'agriculture comme la
premire des professions. Plus que toute autre branche d'activit, elle caractrise
la vie nationale. Au reste, la prminence de l'agriculture sur les autres arts a t si
1
Je citerai souvent ce grand ouvrage en me rfrant la premire dition in-folio.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
45
souvent proclame chez les anciens et les modernes qu'elle peut tre rige en
axiome 1 . Il est manifeste que, le plus souvent, il a crit sur l'industrie sous
l'influence des proccupations qui lui venaient de l'agriculture : par exemple, il a
peut-tre attribu la petite industrie des vertus moralisatrices qu'il avait constates dans la petite proprit ; les conseils qu'il donnait aux chefs des grandes
fabriques taient inspirs par une imitation de ce qui peut se pratiquer assez
facilement sur les grandes exploitations rurales ; etc.
Il me parat ncessaire de discuter de prs un certain nombre de conceptions
de Le Play, parce que les monographies de cet auteur constituent un des plus
remarquables recueils que possde l'conomie concrte, et parce qu'en examinant
ses thories, nous aurons l'occasion de prciser bien des points d'une importance
majeure. Cette tude aura d'autant plus d'intrt pour nous que Le Play, n'ayant
aucune ide du droit, est pass ct des problmes qui nous proccupent ici.
Je laisserai de ct tout ce qu'a produit l'cole qui se rattache le plus troitement Le Play et qui n'a fait que dvelopper la partie purement subjective de son
uvre 2. Aprs sa mort, il se produisit une scission parmi ses disciples : quelquestins d'entre eux, frapps d'admiration pour la minutie des observations contenues
dans les oeuvres de leur matre, crurent qu'ils taient appels renouveler l'tude
des socits, en appliquant plus mthodiquement les principes que Le Play a
suivis d'instinct; ils prtendirent fonder une science sociale, qui leur permettrait
de trouver facilement dans les pays les plus prospres les pratiques les plus recommandables et de les introduire en France. Henri de Tourville 3 a t considr
comme tant le chef de cette cole; mais c'est Edmond Demolins qui la reprsente
aux yeux du grand public.
Cet auteur est loin d'avoir russi constituer des thories vraiment scientifiques ; trs souvent il se borne faire des rapprochements ingnieux, mais superficiels; parfois il semble renverser l'uvre de Le Play et considrer la vie des
familles comme une consquence de l'habitat, rattachant les trois types familiaux
crs par Le Play (patriarcat, famille souche et famille instable) aux steppes, aux
rivages maritimes et aux forts.
1
2
Le Play, La rforme sociale en France, 5e dition, tome II, p. 43. - Cf. tome I, p. 82. - Cf.
Proudhon, De la Justice dans la Rvolution et dans lglise, tome III, p. 133.
Donnat, qui admire beaucoup les monographies de Le Play, dit que les clricaux ont exploit
sa doctrine et fait de lui un Pre de l'glise (La politique exprimentale, p. 346). Quand il
mourut l'vque de Limoges crivit une lettre publique o il disait : Dans les temps actuels
un Pre de lglise n'aurait pas rendu un plus minent service la cause religieuse (De
Curzon, F. Le Play. Sa mthode, sa doctrine, son uvre, son esprit, p. 265). - Cependant Le
Play (au moins l'poque de ses grands travaux) n'tait pas ce qu'on appelle un clrical ; c'est
ainsi qu'il ne montre aucune indulgence pour es congrgations religieuses qu'il avait pu
observer en Italie et en Espagne ; il regardait les instituts monastiques comme condamns
une corruption fatale; c'est aux pays protestants qu'il pense le plus souvent, quand il cherche
des bons exemples. Peu de catholiques oseraient crire franchement, comme lui, que la
rvocation de l'dit de Nantes fut un malheur pour l'glise romaine et que les thologiens
orthodoxes se laissent aller trop facilement des polmiques acerbes contre les protestants. Lorsque le pre Hyacinthe rompit avec la hirarchie, Le Play l'engagea continuer son oeuvre
de moralisation sans se laisser arrter par les cris des ultramontains. (Cf. Sa lettre dans la
Grande revue, 25 dcembre 1913, p. 730). - En vieillissant Le Play a t, comme tous les
chefs d'coles, sous l'influence de ses disciples.
Il est mort le 5 mars 1903; Paul Bureau lui a consacr une notice trs logieuse (L'uvre
d'Henri de Tourville) ; il me semble que ce disciple de Le Play a t, plus remarquable par la
noblesse de son caractre que par ses ides.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
46
Dans un livre retentissant, plein d'observations ingnieuses et d'explications
paradoxales, Edmond Demolins 1 a prtendu expliquer quantit de faits conomiques contemporains par le pass le plus recul : les habitudes des cultivateurs de
jardins marachers dans la valle de la Loire manifesteraient une forte influence
celtique 2 ; dans l'Armagnac, on retrouverait des traditions berbres qu'on doit
expliquer en se rappelant que les Berbres ont habit les dserts de l'Afrique 3 ;
etc.
Entre les mains d'un crivain si ingnieux, la science sociale n'a plus connu de
difficults ; il n'y a pas de phnomne pour lequel il ne puisse construire une
thorie sduisante par son originalit. Edmond Demolins a cru (comme le croit
Jaurs aussi) que la souplesse et la largeur des conceptions constituent une grande
supriorit. Henri Heine se moquait des anciens professeurs allemands qui mettaient leur bonnet de coton sur les trous que prsente le tableau du monde donn
par la philosophie hglienne ; - il y a trop de bonnets de coton dans les grandes
thories sociales d'aujourd'hui. La vraie science sait se borner et avouer son
ignorance; elle ne recherche pas la souplesse des peu prs, mais la rigidit du
vrai. La science, de mme que le droit, ne comportent pas de souplesse.
Henri de Tourville a essay de donner un tableau des recherches faire pour
embrasser tous les lments intressants connatre 4. Il commence par tudier les
moyens d'existence qui comprennent six sujets : le lieu, le travail, la proprit, les
biens mobiliers, le salaire et l'pargne. La proprit foncire est la proprit par
excellence, celle qui est la plus caractristique de tout tat social ; ce dtail trs
important nous montre que l'auteur, tout comme Le Play, pense surtout aux
classes rurales; il ne faut pas oublier ce fait pour comprendre correctement le
systme.
Dans la famille, il considre surtout l'autorit. Qui commande ? Qui obit?
se demande-t-il. Quels rapports personnels a-t-on les uns avec les autres ?
D'aprs cette rgle, on examine la puissance paternelle, l'influence de la femme,
l'ducation des enfants. La hirarchie familiale reoit l'influence des conditions du
lieu et du travail.
C'est dans la famille que se fait la consommation des produits et nous sommes
amens nous occuper des modes d'existence (nourriture, vtement, logement). Il
y a des poques de gne, des phases de l'existence, durant lesquelles la famille
1
2
3
Edmond Demolins, Les Franais d'aujourd'hui. Le mrite trs rel de ce livre est de remplacer l'ancienne division orographique d'un pays (en valles, coteaux, plateaux, etc.) par une
division en cultures principales (p. 266).
Edmond Demolins, Op. cit., p. 242.
Edmond Demolins, Op. cit., pp. 154-155. La coutume de laisser le bien aux filles lui parat
motiver ce rapprochement et indiquer que la race a habit un dsert. Chez les Touaregs, la
rgle de l'hrdit fminine semble fonde sur le dsir de conserver la puret du sang dans les
grandes familles : il est facile de forcer la sur d'un chef pouser un noble ; mais, comment
empcher un chef de bandes pillardes de vouloir transmettre ses richesses et sa puissance
l'enfant qu'il aura eu d'une esclave favorite? (Cours de Flach au Collge de France, 15 mai
1895). Il faut noter que chez les Touaregs, seuls les biens acquis la guerre sont dvolus au
neveu ; les autres sont partags galement entre les enfants. Enfin, tous les Touaregs ne suivent pas cette loi ; le dsert n'a donc rien faire ici.
Science sociale, 1886, 2e semestre, pp. 503-515.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
47
ouvrire se trouve en dficit; le besoin d'une protection se fait alors sentir et on est
amen tudier la famille patronale. Les patron s exercent leur influence sociale
et conomique par le moyen du commerce, de la culture intellectuelle et de la
religion (celle-ci tant considre comme une administration de l'enseignement et
du culte) ; dans les grandes usines, les chefs d'industrie ont sous leur direction des
agents commerciaux, des ingnieurs et des prtres : ce dernier dtail nous ramne
encore aux champs, car il n'y a gure que dans les usines situes la campagne
que l'on trouve ce patronage religieux.
Enfin se forment des groupements d'ordre plus lev : d'abord les rapports de
voisinage o les autorits sociales exercent leur influence, puis la corporation et
enfin les groupements politiques.
Cette nomenclature clbre ne me semble pas avoir exerc une grande
influence sur les amis de Henri de Tourville. Celui-ci n'est point arriv, d'ailleurs,
. justifier l'ordre clans lequel il numre les lments de la science sociale. Il
n'est point mme parvenu expliquer, d'une manire satisfaisante, la raison pour
laquelle il faut partir de l'examen de la famille ouvrire : cependant il attache une
grande importance ce principe dont la dcouverte constituerait une des gloires
de Le Play 1. Il prtend que la vie ouvrire fait connatre toutes les habitudes
essentielles d'un pays, parce qu'elle est la formule la plus lmentaire et la plus
simplifie de l'existence dans une socit ; mais les formes simplifies ne sontelles pas, souvent aussi, les moins propres l'observation, parce que les particularits s'y effacent ? Presque tous les anciens auteurs avaient cru que la
psychologie d'un peuple doit tre tudie dans les classes leves. Il est essentiel
d'approfondir la question et de rechercher si vraiment il faut suivre cette mthode
traditionnelle ou celle de Le Play.
La psychologie, telle qu'elle a t constitue par la pratique de la philosophie
et de la littrature, a pour objet la description de caractres choisis dans les classes
moyennes et suprieures de la socit ; elle est tout extrieure; elle se proccupe
de mettre en vidence les cts pittoresques que prsente la conduite, de faire
ressortir les traits comiques ou tragiques que l'on rencontre dans la vie, de montrer
l'originalit de certains types professionnels. Les habitudes de l'existence riche ou
aise ne marquent pas les hommes de stigmates profonds 2 ; elles peuvent engendrer des ridicules et des gaucheries, un langage particulier, certaines manires
banales de juger ; mais tout cela est sans grand intrt pour l'histoire sociale; ce
sont des dtails presque aussi superficiels que ceux qui se rapportent la mode.
Les explications que donne Le Play dans les Ouvriers europens (p. 21, col 2) ne sont pas trs
claires; son ami de Curzon dit que les familles ouvrires sont choisir, parce qu'elles sont les
plus nombreuses, les plus stables physiquement et moralement; elles constituent partout le
fond, la base mme de la nation (op. cit., pp. 33-35). - Vignes dit que la famille ouvrire
fournit les conditions ordinaires de la rgion (La science sociale d'aprs les principes de Le
Play. tome I, p. 46). - Il semble donc qu'on ait compris que le choix tait fond sur des raisons
statistiques et en quelque sorte physiques.
Probablement parce que pour lutter contre la douleur, ils n'ont pas besoin de mettre en jeu des
puissances d'invention qui pntrent, profondment la volont, ils ont leur disposition des
moyens trs aiss de crer des plaisirs frivoles auxquels ils consacrent toute leur activit.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
48
Quand on a voulu appliquer les procds psychologiques la criminologie, on
n'a abouti qu' dcrire les procds que le criminel emploie pour accomplir son
acte, les ruses qu'il accumule pour dtourner les soupons et les maladresses par
lesquelles il se dnonce. Ces choses sont celles qui intressent au plus haut degr
le journaliste et l'agent de la sret publique ; elles dpendent beaucoup des pratiques professionnelles, des usages de la socit que frquente le dlinquant, des
habitudes qu'il a prises dans la vie courante ; de l vient naturellement l'esprit
l'ide que la criminologie a pour base des distinctions professionnelles. Ces
aspects extrieurs de l'acte ne nous apprennent, en ralit, rien du tout sur le crime
et sont sans intrt pour ceux qui doivent participer au jugement ou discuter les
effets de la peine.
Pour ceux-ci, il faut dbarrasser le crime de tout son appareil pittoresque et le
considrer tout nu, pour y 'voir une manifestation profonde de l'me. Lorsque
nous sommes parvenus voir ainsi les choses, que nous avons pu carter tous les
accidents, 'nous pouvons juger le criminel d'une manire sre, apprcier la vraie
nature de l'acte et lui appliquer sans beaucoup d'hsitation les dterminations du
Code pnal. Au contraire, lorsque les dtails externes occupent la premire place
dans nos proccupations (comme cela a lieu dans les affaires bourgeoises, compliques et romanesques), le juge ne sait plus facilement trouver le droit et le jury
se laisse garer avec une extrme facilit.
On peut dire que la presse est responsable d'un grand nombre de mauvais
verdicts, parce qu'elle est oblige, pour plaire ses lecteurs, d'envelopper l'acte
d'un pais brouillard de dtails pittoresques et d'empcher ainsi l'opinion publique
de voir le crime tel qu'il est ; or un jury qui ne se sent pas soutenu par une solide
opinion rclamant une complte satisfaction, devrait tre dou d'une vertu bien
hroque pour juger sainement. Si l'avocat connat bien son mtier, il s'efforce
d'aggraver le trouble qui existe dans les esprits, en appelant l'attention du jury sur
les accessoires, sur les incidents, sur tout ce qui ne dpend pas directement du
crime. Toute affaire pour laquelle il est possible de prsenter d'abondants claircissements psychologiques, est gagne d'avance pour le criminel. L'exprience des
cours d'assises montre donc que la psychologie courante est incapable de nous
faire pntrer clans le fond de l'me, humaine.
Si tout ce qui se rattache la vie bourgeoise est superficiel et si les professions
librales n'exercent vraiment pas une action bien profonde sur l'homme, il est
vident qu'on doit tendre les observations prcdentes aux ouvriers qui dans les
grandes villes, exercent les mtiers les plus relevs. Nous avons sur ce point le
tmoignage d'un ancien travailleur qui a t ml toute sa vie aux tentatives faites
pour manciper le proltariat ; voici comment, , la fin du Second empire, Corbon
jugeait ses anciens camarades de Paris : Il y a [dans l'ouvrier] une surabondance
de sve et un besoin irrsistible de la dpenser d'une manire quelconque. Mais il
ne la dpensera pas dans l'exercice quotidien de sa profession. La pratique d'un
mtier ordinaire n'a pas assez d'attraits pour absorber toutes les facults d'un esprit
toujours surexcit, et l'ouvrier de Paris ne s'y absorbe gnralement pas 1. Le
1
Corbon, Le secret du peuple de Paris, p. 176. Corbon, mort snateur en 1889, avait t un des
principaux collaborateurs du journal l'Atelier, au temps de Louis-Philippe et par suite un des
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
49
travail quotidien n'est pour notre ouvrier que la corve de chaque jour ; et n'ayant
gnralement point d'amour srieux et durable pour son travail, il n'y consacre que
la moindre partie de sa valeur intellectuelle. 1 - Les solutions qui lui vont le
mieux sont celles qui semblent devoir le dispenser de se proccuper incessamment de ce qu'il considre comme tant le ct infrieur, la corve de la vie.
Corbon attribuait l'insuccs des associations ouvrires formes en 1848 la nature
de l'esprit de l'ouvrier parisien, qui a une secrte conscience de son inaptitude aux
affaires, qui rpugne tout systme qui tendrait, river l'atelier la personne
tout entire 2 .
Il ne semble donc pas que le principe pos par Henri de Tourville soit absolu :
que la vie ouvrire prsente, d'une manire concentre, toutes les habitudes essentielles du pays et que dans son tude on puisse trouver tous les lments sociaux
lis de la manire qui rpond aux besoins dune science sociale. Pour que celle-ci
puisse tre constitue, il faut, en effet, que toutes les activits de la classe considre forment une masse solidement charpente, de telle sorte que l'on puisse
raisonner sur les dterminations des lments les uns par les autres. Nous venons
de voir que non seulement dans les hautes classes les diverses parties de la
psychologie sont dissoutes, mais qu'il en est souvent ainsi dans ce qu'on nomme
parfois les aristocraties du travail manuel. Il faut donc faire un choix entre les
professions.
Henri de Tourville remarque, d'autre part, que toute famille ouvrire n'est pas
bonne pour l'observation ; il faut l'exemple de Le Play, ne s'occuper que de
l'ouvrier prospre. Le Play, domin par des ides morales, prenait l'ouvrier prospre parce qu'il cherchait partout des modles imiter; ses disciples ont compris
qu'il faudrait justifier ce choix, si possible, par des motifs scientifiques 3. Ce type
a t dsign par Denis Poulot sous le nom d'ouvrier vrai 4 ; c'est celui qui travaille rgulirement sans faire la noce ds qu'il a de l'argent dans sa poche. il
1
2
disciples de Buchez, le propagandiste des coopratives de production. Il tait de son mtier
sculpteur sur bois.
Corbon, Op. cit., p. 185.
Corbon, Op. cit., pp. 186-187. Les observations de Cor bon nous permettent de comprendre ce
passage, de l'Avenir de la science, o l'on voit Renan se donner comme idal une organisation
de la vie, dans laquelle le savant pourrait se procurer les ressources ncessaires grce un
travail manuel n'exigeant pas grande attention et considr comme un accessoire auquel on
songerait peine. (Avenir de la science, pp. 395-397. Ce livre a t crit en 1848).
Henri de Tourville dit que dans les sciences naturelles on prend pour tudier l'espce les
exemplaires chez lesquels se manifestent le bien-tre et l'harmonie (Science sociale, 1886 1er
semestre, p. 102).
Le vritable ouvrier est le travailleur qui fait au moins 300 jours de travail par anne, qui ne
fait jamais de dette, qui a toujours une avance, qui aime et respecte sa femme, qui ne s'enivre
jamais, se repose le dimanche et travaille le lundi... Dans le cas d'un travail press ou d'une
rparation, il travaille la nuit et le dimanche aussi consciencieusement que sous la surveillance
de ses chefs. Il ne travaille pas par saccade. (Denis Poulot, Le Sublime, 3e dition, pp. 2912). - Ce type ne convient gure la gnralit des romanciers qui cherchent faire des livres
de grand dbit ; ils prennent pour hros des personnages tout domins par la passion, souvent
fantasques et trop frquemment vicieux. Renan, habitu lire les chefs d'uvre de l'antiquit,
tait fort oppos ces gens de lettres. leur suite on s'amusa d'un monde bas de fripons, de
vauriens dmoraliss, de Vautrin et de Quinola, on se laissa prendre d'un got faux pour le
laid, l'abject . (Feuilles dtaches, p. 297). Le romancier moderne ne travaille pas sur les
mmes matriaux que l'historien ; aussi ne puis-je comprendre que l'on ait parfois nomm
Balzac un matre de la science sociale.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
50
s'agit de l'ouvrier qui est trs srieusement, attach son mtier, tout fait
absorb par lui.
L'ouvrier prospre me parat donc bien moins caractris, au point de vue de
la science conomique, par sa moralit suprieure et par son caractre, de type
sain de l'espce, que par cette, absorption de toute sa personnalit dans le mtier.
L'exprience montre que - pour les socits modernes, tout au moins - cette catgorie de producteurs joue un rle considrable, et souvent prpondrant.
Nous pourrons appliquer surtout la mthode de Henri de Tourville aux populations rurales. Le paysan a toutes sas penses tournes du ct de la production et
on peut dire qu'il est, en quelque sorte, rsorb par la terre qu'il cultive. Comme
je l'ai dit plus haut, Le Play s'tait beaucoup plus occup des gens des champs que
de ceux de la ville ; ses mthodes d'investigation et de raisonnement sont domines par cette ide que l'industrie devrait imiter l'agriculture.
Considrons les cas o l'on peut appliquer avec quelque sret les procds de
l'cole de la science sociale, et o la vie ouvrire concentre vraiment ce qu'il y a
d'essentiel dans un pays. Ce qui sera donn, d'une manire immdiate, ce seront
les monographies de familles prospres. Nous aurons ainsi des descriptions
typiques du mineur du Harz, du tisserand rhnan, du brassier de l'Armagnac, du
blanchisseur de la banlieue de Paris 1, etc. Nous ne tardons pas reconnatre qu'il
faut procder une analyse : toute analyse suppose que l'on cherche superposer
ce qui est mobile quelque chose de fixe, qui constitue une sorte de carcasse; on
est ainsi. conduit faire porter l'tude sur les trois ordres suivants :
1 L'outillage, qui doit tre examin non seulement au point de vue de sa
grandeur, mais surtout au point de vue de ses qualits ; et comme accessoires de
l'outillage : les matires mises en oeuvre et les conditions dans lesquelles s'oprent la circulation des produits et l'change ;
2 Les usages que l'on suit dans le travail, les rglements traditionnels ou
imposs par le chef d'industrie ;
3 Les dispositions lgales qui gouvernent l'acquisition des forces productives : lois sur les partages entre hritiers; lois sur les corporations l o elles
existent encore; lois sur les associations de toutes sortes ; etc.
L'cole de Marx s'est surtout occupe du premier ordre de recherches, qui sont
technologiques ; l'cole de Le Play (en raison de ses proccupations rurales) a
beaucoup crit sur les rformes apporter dans les lois successorales ; mais les
trois parties ne sauraient tre spares dans une conomie concrte complte. On
pourrait se demander si ce tableau s'applique toute sorte de socit ; mais il ne
semble pas douteux qu'il ne soit particulirement appropri notre temps.
Cette analyse permettra d'carter des monographies une masse de dtails dont
on les encombre et qui plaisent par leur pittoresque ; on saura ce qu'il faut chercher mettre en vidence dans la vie ouvrire ; quels sont les sentiments dont il
1
J'emprunte ces titres aux Ouvriers europens de Le Play.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
51
importe de noter les manifestations. Ce qu'il y a de plus essentiel me semble tre
la dtermination de tout ce qui s'attache au point d'honneur du travailleur, c'est-dire : l'attention qu'il porte son travail 1, l'amour qu'il a pour la besogne bien
faite, et le dsir qu'il prouve de devenir une force indpendante, en se crant un
foyer digne. Dans la vie paysanne, nous trouvons ces trois ordres de sentiments
d'une manire si vidente qu'on a pu les considrer parfois comme caractristiques
de l'homme des champs : le rural ne pense qu' sa terre, et est singulirement fier
d'avoir des rcoltes ou des animaux plus beaux que ceux de ses voisins.
Il y a un sicle environ, le point d'honneur n'existait presque pas dans la
grande industrie naissante; la division manufacturire du travail avait transform
l'homme en automate; mais les progrs de la mcanique ont chang tout cela et les
nouvelles machines ne peuvent donner toute leur mesure que dans les pays o le
travailleur ne cesse de s'ingnier pour en tirer le meilleur parti possible. La
supriorit des Amricains sur les Anglais drive, l'heure actuelle en partie, de
ce que les seconds montrent une grande mauvaise volont contre toute nouveaut,
ne cherchent pas tourner les difficults qui se prsentent. Il faut pour l'Anglais,
que la machine russisse du premier coup 2.
La bonne marche des ateliers les plus perfectionns est fonde, aujourd'hui,
sur une active et intelligente collaboration de l'ouvrier qui ne se considre plus
comme un manuvre faisant des gestes fixs d'avance 3 mais comme un producteur s'intressant la parfaite russite de la fabrication. Ainsi il se trouve que
l'industrie la plus avance reproduit des phnomnes analogues ceux que l'on
constate dans l'agriculture des paysans-propritaires. Cette analogie a une trs
grande importance pour le perfectionnement des thories socialistes.
Nous n'avons pas encore puis ce que peut fournir l'tude de la vie ouvrire ;
ni cette description mthodique et fortement lie l'analyse des conditions
abstraites, ni cette analyse ne nous donnent ce qui est vraiment fondamental. La
description monographique ne dpasse pas l'tat de l'me excite par les ncessits de la production; elle nous montre l'homme se manifestant au dehors et en
1
L'attention, voil un grand point dterminer dans toute tude sur le travail ; il semble que ce
soit cause de leur dfaut d'attention que les femmes soient moins avantageuses que les hommes dans des mtiers qui leur seraient appropris (comme la typographie, la stnographie).
Cf. Bulletin de la Socit d'encouragement, 31 aot 1902, p. 320. Il s'agit dans cet article de la
construction des ponts en fer. Un ouvrier amricain fait quelquefois tout seul ce qui exigerait
en Angleterre l'aide de 3 4 auxiliaires (p. 302).
L'ancienne division du travail avait t organise une poque o l'on n'tait pas capable de
construire des machines rapides et prcises. On dcomposait le processus de production en
nombreuses petites manipulations, confies chacune un spcialiste ; celui-ci finissait par
excuter ses mouvements avec la rapidit et la prcision qui correspondent des actes
rflexes, par suite sans les perles de temps que rend ncessaires toute hsitation. L'ducation
du spcialiste avait donc pour effet d'teindre chez celui-ci toute vellit intellectuelle. Un
conomiste anglais avait crit : L'ignorance est la mre de l'industrie, aussi bien que de la
superstition... Aussi pourrait-on dire que la perfection, l'gard des manufactures, consiste
pouvoir se passer de l'esprit, de manire que, sans effort de tte, l'atelier puisse tre considr
comme une machine dont les parties sont des hommes (MARX, Capital, tome I, p. 157, col.
1). Ce genre de production est devenu surann depuis que la mcanique industrielle, claire
par la cinmatique, a pu construire outils plus rapides et plus prcis que ne peuvent tre les
membres du virtuose le plus exerc.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
52
raison de l'organisation extrieure de la vie. L'analyse abstraite de la production
est un travail tout scientifique, qui ne pntre pas dans la vie mme et nous reprsente la socit sous une forme que l'on pourrait nommer anatomique - tandis que
la monographie pourrait tre compare la zoologie, dcrivant les fonctions de
chaque espce, ses murs et son utilisation possible. Il y a videmment autre
chose trouver ; pour connatre fond une socit, il faut la considrer de
l'intrieur, savoir quel aspect elle revt pour l'homme qui rflchit sur les conditions de sa vie. Lorsque le travailleur fait ainsi un retour sur lui-mme pour juger
les relations essentielles de son mode d'existence, le sentiment juridique se
formule ; il est en rapport troit avec la division en classes et trs pntr de
notions traditionnelles.
Il n'y a rien de plus profond dans une conomie sociale que la connaissance de
ce sentiment juridique populaire ; il persiste, avec une force tout fait remarquable, alors que les circonstances qui l'ont fait natre ont disparu ; il finit par
devenir ce qu'il y a de plus caractristique pour l'observateur, et souvent on dit
qu'il est dtermin par la race. Il est clair que cette puissance n'existe pas dans
toutes les classes de la mme manire ; le sentiment juridique est d'autant plus
rigide que la vie de l'homme est plus fortement ramasse autour de son travail :
c'est ainsi que les classes bourgeoises passent, avec une tonnante facilit, d'une
conception politique ou sociale une autre ; elles sont victimes en droit, comme
en littrature ou en musique, de l'inconstance de la mode 1.
On peut se demander si les efforts tents aujourd'hui pour civiliser les classes
ouvrires produiront de bons rsultats; j'ai grand peur qu'on ne les embourgeoise
et j'entends par l qu'on ne diminue la puissance des liens qui rattachent les
travailleurs leur mtier. Il n'est pas douteux que si ce phnomne se produit, il
n'en rsulte une notable diminution dans la valeur effective du sentiment juridique
dans la vie. Il est dsirable, en effet, que l'homme s'assimile si bien les notions du
droit qu'elles deviennent comme des consquences des activits normales de son
existence, qu'elles soient soustraites, en majeure partie, aux caprices de l'imagination, qu'elles soient fortement concentres dans le cercle des proccupations
professionnelles. Or, ce cercle se dissout ds que l'on s'lve aux rgions aristocratiques. L'embourgeoisement de l'ouvrier anglais, qui imite tous les ridicules de
classes suprieures de son pays, a t signal avec raison par Kautsky comme
ayant entran une dcadence intellectuelle et morale de l'lite des ouvriers
anglais , dont se plaignent les crivains bourgeois 2.
On peut affirmer que la dmocratie constitue un danger pour l'avenir du proltariat, ds qu'elle occupe le premier rang dans les proccupations ouvrires ; car la
dmocratie mle les classes et par suite tend faire considrer les ides de mtier
comme tant indignes d'occuper l'homme clair. Corbon n'a peut-tre pas, luimme, vit ce dfaut 3 qui tait, d'ailleurs, gnral dans sa gnration et dont
1
2
3
Le Play note bien ce caractre (Ouvriers europens, p. 21, col 2). Cf. De Curzon (Op. cit., pp.
34-35). - Les paysans, restant soumis la coutume, se trouvent avoir quelquefois une
conscience juridique plus dveloppe que les aristocraties chez lesquelles la proccupation du
droit n'est souvent qu'un caprice. Ainsi l'affaire Dreyfus a montr que la bourgeoisie franaise
a des accs d'ardeur justicire, comme elle a eu des passions romantiques et des engouements
musicaux (pour et contre Wagner, par exemple).
Kautsky, La rvolution sociale, trad. fran. p. 123.
Il parat considrer comme heureux que l'ouvrier parisien soit dvor d'idalisme quelque peu
bourgeois (Corbon, Op. cit.. p. 184).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
53
nous ne comprenons bien l'importance que depuis Marx. Mais ceci demanderait
d'amples dveloppements qui ne peuvent trouver place ici.
Le Play avait t vivement frapp de l'influence des traditions sur le rgime
des exploitations rurales ; pour expliquer la rpartition du sol en grandes et petites
cultures, il faut, disait-il, considrer l'tat des murs et les tendances actuelles
de la race, beaucoup plus que les convenances drivant du climat, du sol, des productions et des mthodes de travail ; 1 au contraire, dans l'industrie les influences techniques sont prpondrantes. Cela revient dire que les coutumes successorales dpendent surtout du sentiment juridique du peuple et que ce sentiment est
trs puissant dans les campagnes. Mais, chose trange, Le Play croyait qu'il serait
facile de changer les coutumes successorales dans les pays o le sentiment juridique populaire est hostile ce changement; nous savons que ses raisons pratiques
n'ont pas vaincu, sur ce point, les thories qui viennent de la Rvolution 2. Cette
illusion est d'autant plus trange chez lui qu'il ne cessait de signaler la force des
coutumes, c'est--dire du droit assimil par le peuple : une nouvelle conception
populaire s'tait forme et il s'obstinait ne pas lui accorder la valeur d'une coutume ; il se figurait qu'il suffirait de donner aux parents la libert testamentaire et de
leur adresser des discours montrant les inconvnients pratiques du morcellement
pour faire natre de nouvelles murs !
L'hritage est li d'une manire si troite aux sentiments juridiques d'un peuple, que l'on a pu considrer parfois les lois successorales comme fournissant un
moyen excellent pour caractriser les diverses socits. En tout cas, c'est presque
toujours sur ,cette question que le droit local livre sa dernire bataille contre les
tendances unificatrices des gouvernements centraliss et quelquefois il la gagne :
c'est ainsi qu'aprs la conqute du Hanovre en 1866, la Prusse imposa son
Landrecht, mais finit, aprs une lutte trs vive, par reconnatre 3 aux gens du pays
la facult de constituer un hritier (anerbenrecht).
1
2
Le Play, Op. cit., p. 169, Col. 2.
Il est curieux que Donnat, qui n'aimait pas les disciples de Le Play et qui tait un rpublicain
trs ferme, ait cru que les ides de Le Play triompheraient sur ce point. La rforme n'est pas
venue, mais elle viendra ; beaucoup la dsirent et l'attendent. (op. cit., p. 335). Le Play a pu
changer l'opinion, de savants et de gens du monde ; il n'a pas eu d'action sur les ides
populaires.
Georges Blondel. tudes sur les populations rurales de l'Allemagne, pp. 195-202.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
54
Introduction lconomie moderne :
Premire partie : de lconomie au droit
Chapitre V
But pratique poursuivi par Le Play : imitation des peuples prospres. - Influence saintsimonienne. - Sa manire de diviser l'histoire de France et celle d'Angleterre. - Les postulats
juridiques sur lesquels s'appuie la mthode suivie de Le Play. - Grande importance qu'il
attache la puret des rapports sexuels. - Rle de la famille. - Conclusion relative la situation conomique des ouvriers, dduite des observations de Le Play.
Retour la table des matires
L'conomie concrte a pour objet la pratique; elle se propose d'amener les
esprits adopter certaines solutions et rclamer certaines rformes. Il y a un
sicle, on ne possdait pas des informations bien tendues et on tait oblig
d'utiliser les faits observs en petit nombre pour illustrer des thories que l'on
prtendait imposer comme rigoureusement dmontres. Lorsque l'on a voulu
introduire le libre-change, il a fallu construire un rgime conomique purement
idal et le prsenter comme un modle digne d'tre imit. Aujourd'hui la situation
est change; il a t fait des expriences sociales dans tous les pays et on peut
apporter un grand nombre de raisons tires de la pratique : dans les discussions
actuelles, on prend pour base ce qui se produit dans un pays dont la prosprit
frappe tout le monde - l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amrique - et on dcrit un des
aspects de la vie de c'es pays-modles. Le talent du publiciste consiste faire
pntrer dans l'esprit du lecteur l'ide que les murs ou les institutions qu'il vante,
jouent un rle prpondrant dans la prosprit de ces pays ; il est vident qu'aucune dmonstration absolue n'est possible sur ce point.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
55
Cette mthode suppose que la prosprit d'un peuple dpend d'une mosaque
de causes distinctes, dissociables et qui peuvent tre transportes d'un pays dans
un autre 1, en emportant avec elles leur vertu cratrice de bonheur ou de richesse.
C'est l une conception parfaitement absurde ; mais elle correspond si parfaitement notre pratique industrielle, que nous avons grand'peine nous en dbarrasser : dans une usine, la grande question n'est-elle pas de se tenir au courant des
moindres progrs qui s'appliquent chez les concurrents ? C'est que dans la
fabrication, phnomne purement physique, toutes choses sont de mme espce ;
il n'y a pas l un centre autour duquel se forme une construction juridique et qui
est comme est l'me de l'tre vivant par rapport la physiologie des organes 2.
Le Play devait tre d'autant plus facilement victime de cette illusion qu'il tait
professeur de mtallurgie et qu'il visitait l'Europe pour connatre les meilleures
mthodes que la pratique et sanctionnes ; il notait tout ce qui devait passer dans
l'enseignement donn aux futurs ingnieurs ; mais en mme temps, il observait les
dtails de la vie ouvrire et, appliquait aux questions sociales la mme mthode
qu' la mtallurgie ; il se demandait quels taient les meilleurs modles imiter en
France. Dans l'introduction de sa Rforme sociale, il a rsum les observations les
plus remarquables qu'il fit durant ses voyages : l'Allemagne fournit d'excellents
modles, surtout en ce qui concerne la religion, le travail, l'enseignement et les
autres dtails de la vie prive... Les tats scandinaves m'ont offert la meilleure
organisation de la famille. Les races tablies dans les hautes montagnes qui
s'tendent au midi de l'Europe ont t pour moi la source des enseignements les
plus prcieux. Ces rgions de la Turquie, de la Grce, de l'Autriche, de la Suisse,
de l'Italie et, de l'Espagne, offrent des modles admirables touchant l'nergie des
croyances, la frugalit des murs, le respect du pouvoir paternel, la fermet de
l'ducation domestique et surtout l'tendue des liberts locales. 3
Il avait trop de bon sens pour croire que tous les beaux exemples peuvent se
transporter en mme temps ; ainsi il semble admettre que le moment n'est peuttre pas encore venu d'imiter les montagnards du midi de l'Europe ; quant aux
peuples slaves, ils fournissent peu d'exemples que l'Europe doive imiter aujourd'hui; mais leurs populations peuvent nous rendre l'intelligence des institutions
sociales du Moyen ge . Il y a donc beaucoup de subjectivisme dans la mthode
de Le Play 4, et il lui est arriv, trop souvent, de ne voir dans le monde que juste
ce qui lui plaisait ; en 1870, il croyait que la France allait se rformer suivant ses
dsirs, et qu'elle entrerait dans une nouvelle priode historique caractrise de la
manire suivante : La prosprit, par l'mulation de tous les chrtiens, sous le
1
2
3
4
Cf. Paul de Rousiers dans la prface qu'il a crite pour le livre de Louis Vigouroux, La
concentration des forces Ouvrires dans l'Amrique du nord, pp. XII-XIII et p. XX.
En 1870, Le Play est oblig de se dfendre contre les prtendus patriotes qui prtendent que la
France n'a rien imiter et qu'elle doit servir de modle l'Europe ; il leur rpond qu'ils
raisonnent comme des Chinois. Il invoque l'autorit de Montesquieu, qui avait attribu les
succs des Romains ce qu'ils ont toujours renonc leurs usages sitt qu'ils en ont trouv
de meilleurs et fait observer que la France est occupe regagner l'avance qu'ont prise sur
elle des rivaux dans la fabrication des armes de guerre (Organisation du travail, 3e dition,
pp. 385-387). Mais il n'aborde jamais la question de principe.
Le Play, La rforme sociale, tome I, pp. 72-73.
Donnat observe trs justement que Le Play choisit fort arbitrairement ce qui lui convient. (La
politique exprimentale, p. 344).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
56
rgime reprsentatif . 1 Tous les promoteurs de rformes sociales sont victimes
d'illusions du mme genre.
Durant sa jeunesse, Le Play avait t extrmement proccup par les ides
saint-simoniennes qu'il ,voyait fort rpandues parmi ses camarades ; ces ides lui
paraissaient fausses ; mais il ne savait tout d'abord comment dmontrer leur
erreur; il pensa qu'il n'y avait pas de meilleur moyen employer dans ce but que
de comparer les institutions rves par les saint-simoniens avec les institutions qui
ralisaient le bonheur chez les peuples europens. J'admis comme rgle, dit-il,
que je devais demander l'exemple du bien aux peuples libres et prospres, chez
lesquels toutes les classes, unies par une solidarit intime, se montrent dvoues
au maintien de la paix publique. 2
Quand on est si proccup de rfuter une doctrine, il est rare qu'il ne reste pas
dans l'esprit beaucoup de souvenirs qui s'y rattachent ; ainsi en fut-il de Le Play,
qui ne me semble avoir jamais compltement oubli les principes saint-simoniens.
On retrouve notamment ce souvenir de jeunesse dans le rle, qu'il attribue aux
autorits sociales ; il voit en elles quelque chose comme un sacerdoce industriel.
Il prenait partout l'avis des chefs d'entreprises, surtout des grands agriculteurs, qui
ont su devenir les chefs moraux des gens qui les entourent. Ces autorits sont la
source vive du bien pour les hommes gars, chez lesquels s'est teinte la notion
de Dieu et de sa loi... C'est auprs de ces hommes d'lite que les peuples souffrants, oublieux de leurs traditions, peuvent revenir l'intelligence des principes
sociaux... Ces autorits sont les plus srs arbitres des intrts moraux. 3
Les vnements de 1848 le frapprent beaucoup, ils se prsentaient comme
les consquences des erreurs et des vices [dont ses amis et lui faisaient] depuis
quinze ans l'inventaire mthodique 4. il jugea qu'il ne pouvait pas se taire plus
longtemps et il publia en 1855 les monographies des Ouvriers europens, avec de
nombreuses observations sur les rformes apporter dans la socit contemporaine ; il se proposait d'expliquer comment la France, en croyant suivre la vole du
progrs, tait, au contraire, sur la voie de la dcadence.
C'est dans ses considrations historiques que l'esprit de la mthode de Le Play
apparat le plus clairement. Il se plaint que les auteurs aient gnralement trait
ces questions sans une vritable proccupation scientifique ; il se propose de
rsumer ce qui lui parat tre le plus essentiel dans les recherches faites par des
esprits minents, qui ont essay d'imiter les savants qui cultivent les sciences
exactes et ont compris que la science historique doit avoir pour but de faire
1
2
3
Le Play, Organisation du travail, p. 134.
Le Play, La rforme sociale, tome I, p. 64.
Le Play, Op. cit., tome III, pp. 421-422. - Dans les Matriaux d'une thorie du proltariat, j'ai
appel plusieurs fois l'attention sur la question de savoir si le rle bienfaisant attribu par Le
Play aux anciennes autorits sociales ne serait pas destin tre jou par les syndicats
ouvriers.
Le Play, op. cit., tome 1, p. 84. Cf. Organisation du travail, p. 134.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
57
connatre les causes qui conduisent les peuples la pratique du bien ou la prosprit, la pratique du mal ou la dcadence 1. Grce aux vritables historiens,
on pourrait ainsi dcouvrir quelles sont les bonnes institutions adopter.
Voici comment, d'aprs ce principe, il divise l'histoire de France : jusqu'au
troisime sicle avant Jsus-Christ, la prosprit des Gaules pastorales et agricoles ; - jusqu' la chute de l'Empire romain, la dcadence des Gaules, sous la
domination des Cits et la centralisation des Romains ; - de 496 1270, la prosprit par l'mulation des deux clergs chrtiens, sculier et rgulier, sous les
institutions fodales ; - de 1270 1589, la dcadence par la corruption des deux
clergs et la monarchie, sous les derniers Valois ; - de 1589 1661, la prosprit
par l'mulation des glises chrtiennes, sous les deux premiers Bourbons ; -
partir du gouvernement personnel de Louis XIV, la dcadence par le scepticisme,
sous la corruption de la monarchie absolue 2 et les violences de la Rvolution.
Dans toute cette histoire, il ne voit que les lments qui correspondent sa proccupation de rforme : la vie agricole, l'esprit religieux, le rgne des autorits
sociales et l'autonomie du gouvernement local ; - il s'agit de prouver que la prosprit du pays est troitement lie avec l'action des principes qui lui sont chers.
L'histoire de l'Angleterre ne prsente pas ce balancement rgulier que Le Play
trouvait dans l'histoire de France ; nous allons voir bientt pour quelle raison. Il la
divise en cinq priodes - jusqu'en 55 avant J.-C., la prosprit des Bretons
indpendants ; - jusqu'en 596, les souffrances de Bretons sous la domination des
Romains et les premires invasions des Saxons ; - jusqu'en 1422, le retour des
Anglais la prosprit aprs la lente fusion des Anglo-Saxons, des Danois et des
Normands ; - de 1422 1783, la continuation de la prosprit sous la hirarchie
du travail et de la vertu, malgr la corruption des classes dirigeantes ; - partir de
1783, l'accroissement de la prosprit par la rforme morale des classes
dirigeantes.
Dans ce tableau, l'auteur veut montrer qu'il y a une force conservatrice de la
proprit qui peut lutter contre la perversion des hautes classes. 3. Il existe, ditil, dans la constitution britannique un pouvoir qui est, la fois, plus sage et plus
stable que les trois principales autorits de son organisme politique, qui a fait
grandir la nation plus rgulirement qu'aucun peuple connu. Ce pouvoir prpondrant dans la constitution sociale de l'Angleterre est la famille anglo-saxonne. 4
C'est pour cette raison qu'aux yeux de Le Play la prosprit ne cessera plus
partir du jour o les coutumes saxonnes se seront implantes en Angleterre, c'est-dire partir de la troisime priode 5. Toute l'histoire de l'Angleterre est donc
destine montrer l'excellence d'une certaine constitution familiale.
1
2
3
4
5
Le Play, Organisation du travail, pp. 52-53.
Le Play attribue une influence dcisive l'influence des hautes classes ; il crit, par
exemple Les dsordres actuels des ouvriers de Paris et de la banlieue proviennent, par une
filiation directe, des dsordres du roi, qui inaugura, en 1661, l're actuelle de corruption. (op.
cit., p. 176). Cela serait peut-tre difficile prouver.
Les propritaires rsistaient la corruption qui, aux mauvaises poques, envahissait la
royaut, la noblesse et le clerg . (Le Play, La constitution d'Angleterre, tome I, p. 83).
Le Play, loc. cit., pp. 99-100.
C'est pourquoi l'Angleterre ne connut point en alternative de prosprit et de dcadence qui
existent en France, d'aprs Le Play.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
58
Le Play procde, dans ses tudes sur ses contemporains, par sa mthode
historique ; il ne veut retenir que ce qui paratra essentiel un historien futur se
plaant au mme point de vue que lui et classant les poques en temps de
prosprit et en temps de dcadence ; tout le reste est frivole et bon amuser les
lecteurs, qui s'intressent beaucoup plus aux catastrophes produites par la pratique
du mal qu'aux faits peu saillants qui se rattachent la pratique du bien. Son
procd est celui de presque tous les gens qui prtendent tirer des conclusions de
l'histoire pour les sciences sociales. Il est trs vraisemblable que Le Play a encore
ici subi l'influence saint-simonienne et a appris de ses anciens camarades l'art de
fermer les yeux sur tout ce qui ne concorde pas avec les grands mouvements
qu'imaginent les philosophes de l'histoire 1.
La mthode de Le Play n'a rien produit ; on peut se demander s'il n'y aurait
pas, cependant, quelque chose tirer de la masse des faits qu'il avait amoncels ;
en procdant cette rvision, il deviendra possible de mieux voir pour quelles
raisons cette cole ne pouvait aboutir qu'au nant.
A. - Ce qui blessait Le Play dans ses voyages, c'tait de trouver les anciennes
relations sociales bouleverses et les hommes abandonns au hasard des circonstances, sans qu'ils eussent quelques moyens de faire valoir leurs plaintes. Il tait,
comme beaucoup d'autres auteurs contemporains, choqu de voir disparatre des
coutumes auxquelles les gnrations antrieures s'taient soumises, et l'ombre
desquelles s'tait coule une existence relativement prospre. Ce mpris pour les
usages consacrs tait odieux Le Play : s'il avait t justifi, sa mthode historique et t vaine ; il est d'ailleurs certain qu'il y avait eu vraiment trop de
maux dans la premire organisation de la grande industrie. Il est digne de remarquer qu'un autre ingnieur, allemand et contemporain de Le Play, fut comme lui
amen chercher les moyens de rformer la socit, aprs avoir constat la misre
dans laquelle vivaient des ouvriers de fabrique 2. Beaucoup de gens de ce temps
taient blesss de voir la vie humaine dpendre de conditions commerciales
pleines de crises, et le monde leur semblait menac de ruine parce que le droit
semblait s'en retirer.
1
Les saint-simoniens divisaient l'histoire en poques critiques et poques organiques qui
alternent; ils voyaient partout de grands mouvements historiques aboutissant leurs doctrines.
Le Play divise l'histoire de la France, depuis 1789 jusqu'en 1869, en priodes de libert et
priodes de contrainte alternant : lutte de l'ancien rgime et des assembles : 1789-1791 ; Terreur : 1791-1794 ; - Convention aprs le 9 thermidor et Directoire : 1794-1799 ; - Consulat
et Empire : 1799-1814 ; - Restauration : 1814-1830 ; - Louis-Philippe: 1830-1848 ; - deuxime Rpublique : 1848-1851 ; - dictature de 1851 et Second empire. (Organisation du travail,
pp. 40-41). La rgularit des alternances exige que la Restauration soit un rgime de libert et
le rgne de Louis-Philippe un rgime de contrainte. Je sais bien qu'il entend par rgime d
libert un rgime o l'ordre est produit par la contrainte morale qui vient de la conscience
individuelle , tandis que dans l'autre rgime il y a contrainte lgale exerce par les
gouvernants et les autorits sociales (op. cit., p. 35) ; il me parat fort difficile de croire que
sous la Restauration la contrainte ait t seulement celle qui vient de la conscience- une police
fonde sur les billets de confession ne pouvait correspondre une foi chrtienne bien vive !
C'est en 1833 que Le Play arrta son programme d'tudes sociales ; c'est en 1845 que Marlo
(Karl Winkelblech) commena rflchir sur l'conomie ; comme Le Play, l'auteur allemand
attache une trs grande importance au christianisme. Mais Marlo n'a pas, comme l'ingnieur
franais, appuy ses thories sur de solides enqutes, en sorte que de ses uvres il ne reste
que du papier noirci.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
59
Les vux de Le Play, comme ceux de beaucoup de ses contemporains, pourraient se rduire ceci : il est dsirable que la conscience juridique du peuple ne
soit pas froisse. Mais il est vident que ce rsultat peut tre atteint de deux
manires : soit que les choses se passent de manire satisfaire un sentiment
juridique exerc - soit que ce sentiment soit peu dvelopp, et que le peuple se
trouve satisfait d'un rgime que d'autres peuples pourraient trouver peu tolrable.
Le Play ne s'arrte gure cette distinction, qui a cependant son importance, car la
vie des populations orientales ne saurait nous convenir, et il le reconnat luimme.
Le Play ne se proccupait nullement du besoin que nos socits modernes
prouvent de tenter toujours du nouveau. L'idal chinois d'un pays bien ordonn
pour toujours nous est devenu peu intelligible : ds que l'on pose la libert de la
recherche, on pose aussi un principe de mouvement qui entranera des souffrances
inluctables. Il faut donc consentir ce que la coutume soit constamment en lutte
avec des besoins nouveaux et que la conscience juridique du peu pie soit froisse
par les courants nouveaux qui engendrent le progrs. Nous avons donc chercher
une formule susceptible de s'appliquer des pays en voie de continuels perfectionnements et dans lesquels les situations soient instables.
Le postulat qui correspond aux aspirations de tous les hommes qui comprennent la valeur des notions morales et leur rle dans le monde, mme industriel 1,
pourrait tre exprim de la manire suivante : il faut que le sentiment juridique se
dveloppe dans le peuple. Peut-on prouver la vrit de ce principe au moyen des
monographies des peuples prospres ? Il me semble que pareille entreprise est
vaine ; on ne saurait davantage prouver que, pour l'individu, une haute ducation
morale est la meilleure condition du bonheur et de la richesse ; il n'a pas manqu
de moralistes pour tenter une pareille dmonstration empirique des lois morales ;
mais peu de gens sont, l'heure actuelle, dupes de cette philosophie de l'intrt
futur bien compris.
B. - On peut demander l'observation de dire qu'elles sont les conditions qui
favorisent le dveloppement du sentiment juridique dans le peuple. Peut-tre Le
Play n'a-t-il pas t toujours heureux dans le choix de ses exemples et aurait-il
obtenu des rsultats beaucoup plus clairs en n'tudiant que les peuples o ce
sentiment juridique a t exceptionnellement exerc. Cependant il est possible de
tirer des conclusions pratiques de ses travaux.
1 J'ai dj appel l'attention sur le caractre sacerdotal qu'il attribue aux
autorits sociales ; mais il y a encore autre chose dire de cet organe qui est
essentiel dans le systme de Le Play; les autorits sociales conservent les rgles
de la coutume, travaillent la maintenir autour d'eux par les conseils donns aux
travailleurs et, aux bonnes poques, elles exercent une influence prpondrante
1
Dans de nombreux crits Gustave de Molinari a insist sur l'utilit de dvelopper les sentiments moraux des ouvriers. mesure que l'industrie se perfectionne et que les entreprises
s'agrandissent, les manquements au devoir causent la socit un dommage croissant et la
rendent de moins en moins capable de soutenir la concurrence des socits au sein desquelles
le sentiment du devoir est plus fort et plus rpandu (Science et religion, p. 51).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
60
dans le gouvernement local. Nous pouvons dire qu'elles servent exprimer le
sentiment juridique du peuple. Qu'il soit trs important qu'il existe ainsi une classe
d'hommes ayant pour fonction de conseiller le droit, de raisonner sur les rgles et
de chercher les adapter aux besoins de l'conomie, c'est ce que personne
n'oserait srieusement contester ; l'histoire romaine pourrait servir illustrer cette
thorie et nous savons qu'en Angleterre et en Amrique les juristes, avocats ou
magistrats, ont toujours, t entours du plus profond respect.
Le Play aurait d arriver poser comme principe fondamental : le respect qui
doit entourer les reprsentants du droit ; mais il ne l'a pas fait, parce qu'il tait
tout proccup (sous l'influence saint-simonienne) des caractres sacerdotaux et
administratifs des autorits sociales et parce qu'il n'a jamais pu se faire une ide
claire du rle de la jurisprudence.
2 La sixime pratique des nations prospres est ainsi formule par Le Play :
respect et protection accords la femme. Nous savons qu'il avait t amen
attacher une trs grande importance cette question la suite de conversations
avec des avocats amricains, qui ne pouvaient se rendre compte des pratiques
franaises 1. Je partage compltement l'opinion de Le Play sur cette question; je
suis persuad que la conscience juridique ne peut tre affine dans les pays o le
respect de la chastet n'est pas fortement entr dans les murs. J'ai crit ailleurs,
au grand tonnement des amis de Jaurs : Nous pouvons affirmer que le monde
ne deviendra plus juste que dans la mesure o il deviendra plus chaste; je ne crois
pas qu'il y ait de vrit plus certaine 2. Il est tout fait curieux que les enqutes
de Le Play l'aient conduit des conclusions si voisines de la pense de Proudhon,
dont il ne semble pas avoir lu grand chose.
Les projets que prconise Le Play ne sont pas trs heureux ; il confond deux
choses bien distinctes : le dlit que commet l'homme en sduisant une fille et
abandonnant l'enfant et la mre sans ressources, - le dommage, rparable en
argent, que subit la femme abandonne 3. Il y a bien moins d'objections faire au
premier systme, qu'au second, qui peut favoriser par trop l'industrie des fausses
ingnues qui pratiquent l'art de se faire sduire par des gens riches et inexpriments ; on ne peut pas dire qu'une rforme ralisant cette fin puisse tre
regarde comme trs favorable au progrs des bonnes murs et au respect d la
femme.
C'est parce qu'il y avait eu beaucoup d'abus autrefois que le Code Napolon
n'a admis la recherche de la paternit que dans le seul cas d'enlvement; il y a l
un acte dlictueux manifeste ; - le Code italien, dans le mme esprit, a ajout le
cas de viol. D'ailleurs, avant la Rvolution, les Parlements se montraient de moins
1
2
Le Play, La rforme sociale, tome I, p. 72. - Organisation du travail, p. 296 et p. 302.
G. Sorel, Matriaux d'une thorie du proltariat, p. 199. - Au congrs fministe de 1900.
Lucien Le Foyer, homme considrable parmi les bourgeois ducateurs du peuple, a soutenu,
avec nergie, qu'il devrait tre permis aux poux de s'accorder par contrat la permission non
seulement d'avoir un domicile spar, mais encore de vivre chacun avec une autre personne .
(Congrs international de la condition et des droits des femmes, p. 244). Cf. ce que l'ai dit
dans les Matriaux, p. 351. Attendons nous voir, quelque jour, des hommes de progrs
demander qu'on ajoute au Code civil un chapitre sur es droits et devoirs des souteneurs et de
leurs marmites.
Le Play, Organisation du travail, p. 306.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
61
en moins disposs accepter les plaintes des filles-mres contre leurs amants; il y
avait longtemps que l'on n'admettait plus comme preuve le serment de la femme
dnonant le pre de l'enfant au moment de l'accouchement.
Le Play se trompe gravement quand il s'lve contre les auteurs du Code pnal
de 1791 qui ne voulurent pas considrer la sduction comme un dlit 1 ; ils ne
firent que consacrer la jurisprudence du Parlement de Paris, qui ne prononait
plus aucune peine pour le stupre que Muyart de Vouglans dfinit : la dfloration
d'une vierge ou l'habitude avec une veuve qui vit honntement et que l'on sduit
sous l'esprance du mariage 2. On accordait seulement la mre de l'argent pour
lever l'enfant et quelquefois une dot ; - mais la dot n'tait pas alloue aux
servantes.
Il faut tre trs sceptique dans l'apprciation des lois ayant pour objet les
murs ; les peines prononces pour l'adultre sont devenues illusoires 3 - Paris
gnralement vingt-cinq francs d'amende ; et on peut se demander si le jour n'est
pas loign o ce dlit disparatra de notre Code. La loi franaise a interdit
l'pouse coupable d'pouser son complice, en cas de divorce prononc pour cause
l'adultre (art. 298 du Code Napolon) ; dans la pratique cette rgle n'a t gure
applique, le jugement de divorce omettant dessein de nommer le complice ;
aujourd'hui on demande l'abolition de cette interdiction 4.
Tout le monde convient que la lgislation est impuissante en ces matires
quand elle n'est pas soutenue nergiquement par l'esprit public. Les ides de Le
Play sont donc manifestement fausses; on aurait beau faire des lois contre les
sducteurs, on ne moraliserait pas la France et on n'y dvelopperait pas le respect
pour la femme. Autre chose est de constater l'importance qu'un tel sentiment a
pour le progrs de la conscience juridique ; autre chose est de donner une recette
pour le produire. Les rgles pnales qui sont adaptes aux murs des pays o la
femme est respecte, n'engendreront pas ces murs dans les pays o elle l'est
peu ; elles seront alors impuissantes ou seront dtournes de leur but.
3 La quatrime et la cinquime pratique ont pour objet la prosprit de la
famille ; ce sont : les habitudes d'pargne assurant la conservation de la famille et
l'tablissement de ses rejetons, - l'union indissoluble entre la famille et son foyer.
Ces deux rgles ont une trs grande importance dans le systme de Le Play ; elles
doivent tre interprtes de la manire suivante :
a) Le respect des traditions nationales se maintient surtout par l'intermdiaire
de la famille ;
1
2
Le Play, Op cit., p. 506.
Muyart De Vouglans. Institutes au droit criminel, p. 485. Le stupre tait puni dans quelques
cas exceptionnels (jeune fille sduite par le valet de son pre on par son professeur de chant
ou par son tuteur). Jusqu'en 1730, le Parlement de Bretagne donnait au sducteur le choix
entre le mariage et la potence.
rapprocher de l'indulgence de plus en plus grande que montrent les tribunaux allemands
dans l'application de l'article 175 du Code pnal (Moll. Les perversions de l'instinct gnital;
trad. fran., p. 300). Cet article punit la pdrastie, qui depuis la Rvolution n'est plus un dlit
chez nous.
Cette rforme a t accomplie par la loi du 15 dcembre 1904.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
62
b) La prosprit matrielle de la famille est un lment prpondrant pour sa
force morale ;
c) La proprit d'un foyer stable joue un grand rle dans la vie de famille.
Ces principes ont des valeurs ingales ; Le Play a t surtout frapp par le
troisime, parce qu'il admirait la constitution des familles hanovriennes 1, et parce
qu'il trouvait l une recette susceptible d'tre traduite immdiatement dans les
lois. Le premier principe n'a pas t formul par lui d'une manire expresse et c'est
pourtant le plus important pour le philosophe : c'est celui qui se relie directement
au fond mme de la conscience juridique du peuple. Les manires d'assurer
l'influence de la famille peuvent varier suivant les civilisations ; mais il ne parait
pas douteux que sans cette influence les traditions juridiques sont sans grande
efficacit. Il est peine besoin d'insister sur cette thorie, que l'histoire romaine
met pleinement en vidence ; cette histoire nous montre encore d'une manire trs
claire, qu'un peuple n'est grand dans le droit que s'il a un profond respect des
traditions.
L encore les recettes de Le Play sont hors de proportion avec le rsultat
atteindre ; il prtend que les anciennes murs se rtabliront d'elles-mmes quand
on donnera aux pres une plus grande libert testamentaire 2 ; il est manifeste,
cependant, que le testament peut tre employ, suivant les circonstances, soit
consolider la famille, soit la ruiner. On lui objectait les captations qui dpouillent les enfants au profit du vice ou de la religion ; il rpondait qu'elle taient
sans danger srieux chez les peuples libres et prospres 3 ; mais il aurait fallu
prouver qu'il en sera de mme chez un peuple que l'on dclare soi-mme corrompu et que l'on veut gurir. Le Play se figurait que le sentiment juridique d'une
nation se forme par le moyen de quelques lois et l'imitation de quelques
hommes 4.
C. - Je groupe maintenant les trois premires pratiques que Le Play recommandait pour assurer la paix sociale : permanence des engagements rciproques
du patron et de l'ouvrier ; entente, complte touchant la fixation des salaires;
alliance des travaux de l'atelier et des industries domestiques, agricoles et manufacturires. Ces trois pratiques se rapportent surtout une vie rurale ou demirurale.
2
3
4
On sait que l'observation des coutumes des familles de la plaine saxonne frapprent beaucoup
Le Play au dbut de ses voyages et exercrent une influence dcisive sur sa pense. - Je me
suis demand si Marx n'avait pas song ces anciennes coutumes quand il a accus le
capitalisme de faire du proltaire un individu sans famille (op. cit., p. 45).
Le Play, Organisation du travail, 35.
Le Play, 45.
Cette rforme serait aussi prompte que celles de Louis XIII et de Georges III si les bons
citoyens qui s'aperoivent du mal se concertaient et se dvouaient pour ramener le rgne du
bien (op. cit., p. 125), et il ajoute en note : Quelques hommes de talent, unis par l'amour de
la vrit, et proccups exclusivement du bien public, suffiraient cette tche . J'ai eu
l'occasion de dire plus haut que la psychologie des hommes des classes suprieures constitue,
d'ordinaire, un ensemble de phnomnes tout fait superficiel.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
63
L permanence des engagements rciproques constitue en faveur de l'ouvrier
une sorte de droit sur les forces productives qui appartiennent au patron ; il y a
comme un dmembrement de la proprit au profit des travailleurs ; Le Play a
signal, lui-mme, cet aspect de la vie ouvrire en disant que les mineurs du Harz
et les sauniers de l'ouest de la France possdent les premiers une sorte d'hypothque lgale, et les uns et les autres un droit au travail sur la proprit 1.
L'entente complte relative au salaire tait conue par Le Play comme un effet
de l'action quasi-sacerdotale des autorits sociales ; elles rglent les tarifs sans
aucun dbat et la satisfaction de leurs ouvriers 2. Mais on peut comprendre les
choses autrement et assimiler la dtermination du salaire un arrangement qui se
produit pour l'usage d'une servitude entre deux propritaires. Il faut noter, en effet
qu'aux yeux de Le Play la forme la plus recommandable du salaire est celle qui
rend la rtribution proportionnelle la quantit de travail fait. L'ouvrier s'lve
ainsi au rang d'entrepreneur en se chargeant, prix fait, d'une subdivision du
travail de l'atelier .
Si l'ouvrier devient entrepreneur, il ne peut plus tre considr comme un
simple subordonn du patron. Au commencement du XIXe sicle, les entrepreneurs de travaux publics taient regards par le gouvernement comme tant des
agents d'un certain ordre de l'administration ; mais aujourd'hui les entrepreneurs
contractent avec l'tat dans les mmes conditions qu'avec les particuliers 3. De
mme l'ide d'autorit sociale finirait la longue, par s'effacer devant celle de
contractant.
La troisime pratique nous ramne, encore plus directement, vers l'ide
paysanne ; il s'agit de mler la vie de salari quelque chose de la vie du petit
propritaire ou du petit artisan. Le Play insiste sur ce que, durant les chmages de
l'atelier patronal, les familles peuvent se procurer quelques rserves par ces
industries domestiques ; ces occupations augmentent la scurit de la famille. Il
trouve trs mauvais le prjug qui, plus d'une fois, fait regarder en Angleterre ce
systme comme contraire la bonne marche des grands ateliers 4.
Ici encore nous ne nous arrterons pas aux formules empiriques de Le Play, et
nous tirerons de ces observations la rgle suivante :
1
2
3
Le Play, Les ouvriers europens, p. 141, col. 2, p. 265, col. 2. Cf. p. 145. - J'indique ici, en
passant, que les coutumes des rgions minires de l'Allemagne et particulirement du Harz
donnent la clef des thories de Fichte. Anton Menger n'a pas vu cette dpendance qui est
cependant frappante. Cf. Anton Menger, Le droit au produit intgral du travail ; trad. fran.,
pp. 50-52 et la description du Harz dans les Ouvriers europens.)
Le Play, Organisation au travail, p. 146.
Il ne reste plus de trace de l'ancienne situation que pour les fournisseurs de l'arme, qui
peuvent tre poursuivis correctionnellement quand ils font manquer le service dont ils sont
chargs . (Art. 430 du Code pnal.)
J'ai vu congdier, dit-il, un excellent ouvrier qui faisait son devoir l'atelier avec une
rgularit exemplaire, mais qui avait commis la faute de crer au logis un petit commerce
d'picerie exploit par sa femme et ses enfants. (Le Play, Op. cit., p. 155. - Cf. La rforme
sociale, tome II, p. 145). - Les patrons anglais n'admettaient pas davantage que les jeunes
commis se livrassent aucune tude trangre leur profession. Ils tiennent mme en
suspicion Liverpool] un commis qui se rcre par des lectures instructives. (p. 164).
Quand on parle de l'hostilit des anciens fabricants anglais contre les organisations syndicales,
il faut largement tenir compte de cette ancienne proccupation de ne permettre aucun
occupation trangre.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
64
La conscience juridique populaire a pour base conomique un ensemble de
conditions mettant l'ouvrier en tat de se juger chef d'entreprise.
Il ne faut pas se dissimuler la trs grande importance d'une formule fonde sur
un si grand nombre d'observations ; mais il ne faudrait pas non plus prtendre
qu'elle rsout compltement le problme de la formation juridique, du peuple. Si
nous n'avions eu connaissance que des socits de paysans et d'artisans, nous
aurions trouv une formule mettant beaucoup plus en vidence la proprit ; et
souvent des auteurs ont, en effet, soutenu que sans proprit prive il n'y a pas de
droit 1. Il serait trs utile de se livrer des recherches sur les effets que produisent
les institutions ouvrires actuelles, au point de vue qui nous occupe ici; je ne crois
pas que l'on ait fait d'tudes srieuses dans ce sens. Quand on aurait dgag une
srie de formules correspondant des rgimes de productions distincts, il y aurait
les grouper en systmes et voir ce qu'il est possible d'en tirer pour clairer les
thories socialistes.
J'objecte cette opinion si rpandue le fait qu'au cours des grves se manifestent souvent des
sentiments juridiques puissants. Ce que je nomme droit au travail quivaut dans la conscience
proltarienne ce qu'est le droit de proprit dans la conscience bourgeoise ; il a pour base
conomique la reconnaissance de la part considrable qui revient la force collective ouvrire
dans le dveloppement industriel (Cf. G. Sorel, op. cit., dernier chapitre). Ds que les
proltaires comprennent la valeur du bon ouvrage, ils collaborent la gense du droit futur (p.
73, pp. 162-161). - Nous voil bien loin du prtendu socialisme juridique expos par Anton
Menger, dans Le droit au produit intgral du travail et dans l'tat socialiste.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
65
Introduction lconomie moderne :
Premire partie : de lconomie au droit
Chapitre VI
Attaques de Le Play contre les juristes. - Le tutiorisme des juristes et leur dfiance des
nouvelles lois. - Reproches injustes qu'on leur adresse propos de leur travail normal. L'opportunit et le droit. - Importance de l'ide d'opportunit dans la lgislation relative
l'agriculture. - Travaux d'amlioration collective ; servitudes spciales imposes aux forts et
aux mines. - Remembrement et colonisation intrieure.
Retour la table des matires
On sait avec quelle animosit Le Play parle des lgistes, auxquels il attribue
une responsabilit norme dans les maux dont souffrait le pays ; il est vrai qu'il
faut faire quelques distinctions, car il emploie ce mot pour dsigner trois catgories bien distinctes.
1 Les anciens conseillers de la couronne aidrent la royaut ruiner les autonomies locales et furent les principaux soutiens de la monarchie absolue. Le Play
flicite Napolon III d'avoir quelquefois chapp l'influence des hauts fonctionnaires de l'tat et des lgistes pour rformer le rgime de contrainte lgale en ce
qui touche les coalitions, la presse et les runions publiques 1.
Le Play. Organisation du travail, p. 127. Dans l'avertissement il dit que l'empereur s'intressa
ses efforts, malgr la rsistance de ses conseillers .
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
66
2 Les avocats, avous et notaires sont trs souvent dnoncs par lui comme
poussant les hritiers contester en justice les dispositions testamentaires conformes aux vieilles coutumes. Il signale la rapacit des hommes d'affaires qui ne
cessent d'augmenter leur fortune au dtriment des propritaires 1.
3 Les thoriciens du droit taient odieux Le Play parce qu'ils sont, avant
tout, des logiciens, ramenant toute solution un principe gnral. L'emploi de la
dduction dans les questions sociales ne lui convenait gure 2 ; il tait persuad
que les lettrs avaient fait beaucoup de mal en prtendant donner a priori des
rgles de rforme sociale en s'appuyant sur la raison pure, guide elle-mme par
la notion de justice ; la rpugnance qu'il prouvait pour toutes ces thories
creuses, le rendait injuste pour les lgistes, qu'il met, presque toujours, sur le
mme rang que les littrateurs 3.
Il ne semble pas que Le Play ait observ que les lgistes ne sont vraiment forts
que dans les cas o ils traduisent sous forme de thses abstraites des sentiments
populaires trs puissants. Il critique fort l'abus que l'on a fait des mots de libert,
de progrs, d'galit et de dmocratie ; ses critiques sont parfois fondes, mais il
ne se doute pas que derrire ces mots fatidiques il y a un vaste ensemble d'aspirations nationales, que tout gouvernement est tenu de respecter 4. Son illusion est
d'autant plus singulire qu'il a remarqu lui-mme que les philosophes rationalistes, quand ils sont embarrasss, font appel aux prjugs et aux passions de leurs
contemporains 5 ; cela est tout naturel puisque leur oeuvre n'est qu'une exposition des sentiments populaires, mise, lorsque cela est possible, sous la forme que
les logiciens sont habitus donner aux expositions scientifiques : la forme ne
doit pas nous tromper; l'essentiel est le fond populaire.
Nous pouvons encore remarquer que, comme la grande masse des anciens
lves de l'cole polytechnique, Le Play n'avait pas l'esprit tourn vers les considrations juridiques ; celles-ci lui paraissaient tre une gne dont l'homme de
science doit s'manciper, On sait que l'cole saint-simonienne n'avait aucune ide
du droit. A. Comte ne parlait que de devoirs.
Il y a dans le raisonnement des juristes quelque chose qui choque beaucoup
les personnes qui n'ont pas rflchi sur les principes de la gense du droit. Chaque
fois que l'on propose une loi nouvelle, on -voit les juristes s'ingnier trouver des
motifs subtils pour en montrer l'inutilit et le danger ; l'exprience ne leur donne
pas toujours raison et les personnes trangres la science juridique finissent par
se demander si toutes ces chicanes ne sont pas de purs jeux scolastiques. Le raisonnement ne peut indiquer quelle sera l'importance d'un danger que l'on aperoit
dans une rforme projete ; le raisonnement peut tout au plus servir prvoir le
1
2
3
4
Le Play, Op. cit., p. 330.
Le Play, La rforme sociale, tome I, p. 90.
Par exemple : loc. cit., p. 79.
Il s'lve beaucoup contre Tocqueville qui regardait le mouvement dmocratique comme
irrsistible (Organisation du travail, p. 368). Il prtend que cet auteur n'a pas justifi les
conclusions de son livre sur la Dmocratie en Amrique. Il est difficile cependant de nier que
Tocqueville avait parfaitement reconnu les forces dominantes actuelles, tandis que Le Play
rvait une restauration utopique des autorits sociales dont il constatait, avec tristesse, la
progressive disparition.
Le Play, La rforme sociale, tome I, p. 90.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
67
fait et le dfinir ; l'exprience seule permet de mesurer les consquences quantitatives. Comme en matire sociale, l'absolu n'existe pas et qu'on devra se contenter de prendre en considration de ce qui arrive le plus souvent, les objections
faites par les logiciens peuvent n'avoir, en pratique qu'une importance secondaire ;
avant que l'exprience n'ait prononc, il n'y a aucun moyen d'tre fix sur ce qu'il
importe surtout de connatre, c'est--dire sur l'effet le, plus ordinaire.
Il faut ajouter aussi qu'une loi dans la pratique, se prsente tout autrement
qu'une loi en projet; la jurisprudence a pour objet de faire disparatre ses oppositions trop saillantes avec le pass, de rduire ses effets paradoxaux, de l'attnuer
parfois mme tel point que ses rdacteurs se plaignent de la mchancet des
tribunaux, qui ne respectent pas leurs intentions 1. Ce travail de la jurisprudence a
pour rsultat, souvent, de rendre moins graves les inconvnients que les juristes
avaient signals durant la priode de la discussion.
D'une manire gnrale, les juristes sont trs opposs aux lois nouvelles,
toutes les fois que celles-ci ne sont pas conformes aux tendances de leur science et
par suite aux sentiments juridiques dont ils sont normalement les interprtes et les
guides. Les bonnes lois devraient, suivant eux, se borner consacrer les opinions
des meilleurs auteurs et fixeraient les dcisions des juges dans le sens tutioriste
(pour parler comme les casuistes) ; les bonnes lois auraient ainsi pour rsultat
d'empcher les carts de tribunaux fantaisistes et de complter les rgles connues
pour faire disparatre des anomalies fcheuses.
Au fond, les juristes, en dpit de leur rputation de logiciens pdants, sont trs
attentifs aux mouvements variables de l'opinion, ds que celle-ci est quelque peu
claire ; ils travaillent les rendre assimilables par la jurisprudence; c'est donc la
partie mobile et sentimentale du droit qui donne, en dernire analyse, la raison
vritable de leur attitude.
Tandis que les propagateurs de rformes ont une confiance infinie dans des
formules lgislatives, les juristes estiment que les textes sont peu de chose et que
la pratique seule importe ; or, la pratique dpend de tant de causes que la lgislation arrive parfois raliser tout autre chose que ce qu'elle cherchait. Ils savent
que l'essentiel dans la lgislation est non pas la rgle, mais l'usage que l'on en fera
de manire satisfaire le sentiment juridique. La logique des lgistes est donc une
savante adaptation de l'appareil rigide des raisonnements un tat mobile.
Il y avait encore entre Le Play et les juristes une opposition d'une autre nature,
sur laquelle il est trs utile d'insister parce qu'elle va nous amener poser l'un des
1
Cela s'est produit surtout depuis que l'on fait beaucoup de lois sociales. Aprs que la Cour de
cassation eut interprt la loi de 1900 sur le travail des femmes autrement que Millerand,
Jaurs et la Petite Rpublique l'avaient dcid, on ne lui mnagea pas les reproches ; on lui fit
observer qu'elle ne respectait pas la pense du rapporteur de la loi et celle du ministre
socialiste. La Petite Rpublique a expliqu, aux ouvriers que le parlement, en rduisant la
dure de la journe du travail, avait eu l'intention de leur conserver le mme salaire et elle a
accus les patrons de s'insurger contre la loi. Les ouvriers, disait-elle le 12 avril 1902,
ignorent le premier mot de leurs droits. Mais o des syndicats existent, o les travailleurs
sont conscients et connaissent le sens exact et la porte de la loi nouvelle, les patrons
capitulent .
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
68
plus graves problmes que l'on rencontre dans l'conomie concrte. Le Play, tant
un homme d'observation, apportait beaucoup de faits pour montrer quil y aurait
avantage adopter une autre manire de conduire le travail en France ; il prtendait que ses preuves taient de nature convaincre les gens srieux, qu'elles
taient du mme genre que celles qui sont juges convaincantes par les hommes
d'affaires pour les dcisions prendre dans les questions d'ordre personnel; en un
mot, il dfendait l'opportunit de certaines pratiques. L'opposition qui existait
entre lui et les juristes tait, dans une certaine mesure, la contradiction qui existe
entre l'opportunit et le droit tout fait.
Il n'entre pas dans mon plan de traiter, sous son aspect philosophique, la question des rapports qui, existent entre l'opportunit et le droit tout fait ; je me borne
rappeler que Iehring a trs souvent insist sur ces rapports, qu'il reprsente
quelquefois comme ceux qui existent entre une matire flottante et un prcipit
qui finit par se durcir. La formation de cette couche profonde a suivi la mme
marche que celle des plus rcentes ; c'est de l'opportunit dpose, consolide par
l'exprience et mise l'abri de toute dispute. 1 Je chercherai montrer seulement
comment, dans les questions rurales, se manifeste la puissance de l'opportunit.
Je crois qu'aucune raison juridique n'est capable d'arrter des lgislateurs
appartenant au monde agricole quand ils sont persuads qu'une loi est capable
d'augmenter la prosprit de la terre. On se trouve donc en prsence d'un singulier
paradoxe : tandis que le propritaire ne cesse de rclamer le respect absolu de ses
droits, le mme homme se montre trs peu soucieux des principes quand l'utilit
d'une mesure lui semble tre certaine pour l'amlioration de l'agriculture. C'est en
partie pour cette raison que Le Play n'a jamais pu dpasser la notion d'opportunit
quand il a raisonn sur la socit et qu'il tait incapable de comprendre les objections que lui faisaient les juristes.
La thorie que je voudrais mettre ici en vidence peut tre formule ainsi : le
domaine propre de l'opportunit est la cration de nouvelles forces productives ; le domaine propre du droit tout fait est la conservation des forces existantes.
Dans le premier cas, il y a mobilit ; dans le second, rigidit 2.
Une diffrence analogue existe dans l'conomie industrielle ; d'ordinaire, les
protectionnistes soutiennent qu'ils ne demandent des droits de douane que pour
permettre de crer des usines neuves exigeant de grands sacrifices; ils promettent
souvent que la situation sera transitoire et que, dans un dlai assez court, on pourra revenir au libre-change : - celui-ci constituerait d'aprs beaucoup de protectionnistes modrs, le rgime normal d'un change quitable; mais l'opportunit
exigerait un sacrifice temporaire.
1
2
Iehring. volution du droit (Zweck lm Recht), trad. franc., p. 291. - Cf. p. 349.
Cette distinction correspond bien une autre distinction que fait Proudhon ; il admettait que
l'tat exerce sa vritable fonction quand il prend l'initiative de grandes crations d'utilit
publique, mais, qu'il sort de son vritable rle, tombe dans l'autocratie, l'immobilisme
quand il veut maintenir sous son administration les services qu'il a cres. (Proudhon, Du
principe fdratif, 1re partie, chap. VIII).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
69
Nos lois rurales prtendent concilier le progrs avec le respect d la proprit ; cette formule signifie simplement : sortir du droit proprement dit pour
faire de l'opportunit, mais en ayant l'air de faire du droit. Je vais donner quelques
exemples pour faire mieux saisir l'importance de l'opportunit dans la pratique
agricole.
Les terres humides ont toujours t considres, en France, comme ne constituant pas une vritable proprit; les souvenirs fodaux exercent ici une action
trs visible comme pour les mines et pour les forts. La loi des 26 dc. 90 - 5 janv.
91, inspire des traditions de l'Ancien Rgime, permettait l'administration
d'entreprendre elle-mme le desschement des marais en dpossdant les propritaires. Ceux-ci devaient tre indemniss, leur choix : soit par une somme
d'argent, soit par la cession de surfaces assainies; le surplus des marais devait tre
vendu des ouvriers capables d'en oprer le dfrichement. Cette loi tait d'une
application peu prs impossible, comme beaucoup de lois faites cette poque
par des hommes qui ne tenaient pas compte des difficults pratiques et notamment
des questions d'argent; l'idalisme rvolutionnaire trouvait facile tout ce qui avait
t pens, exagrant ainsi les illusions des rois, qui voulaient que leurs courtisans
les trompassent sur l'application de leurs ides 1.
En 1807, Montalivet, dans son expos des motifs en faveur de la nouvelle loi
sur les marais, disait qu'on n'avait pas assez respect la proprit dans la
lgislation antrieure et qu'on avait ainsi cr beaucoup de rsistances. Le ministre
observait que l'empereur tenait ce que les propritaires fussent parfaitement
fixs d'avance sur la nature de l'avenir : la possession des marais est trop intimement lie l'intrt gnral, la sant, la vie des hommes et l'accroissement
des produits du territoire pour ne pas tre immdiatement 2 sous l'autorit de
l'administration. En consquences, l'article premier posait ce principe que la
proprit de marais est soumise des rgles particulires et que le gouvernement ordonnera les desschements qu'il jugera utiles 3 ou ncessaires.
Le desschement peut s'oprer de trois manires : 1 par les propritaires qui
s'unissent et prennent l'engagement d'excuter les plans approuvs ; 2 par des
entrepreneurs qui sont rmunrs par la concession d'un droit sur une fraction de
la plus-value rsultant de leurs travaux (cette fraction, fixe par un dcret, est
paye soit au moyen d'annuits, soit au moyen de l'abandon d'une partie des [erres
par les propritaires) ; 3 par des entrepreneurs qui exproprient les propritaires.
Ce troisime mode tait considr comme devant tre tout fait exceptionnel.
1
2
3
On se rappelle le voyage de Catherine en Crime, qui symbolise parfaitement l'idalisme de
ce temps. - En 1849, le comte de Chambord, recevant la visite de deux royalistes franais, fut
trs mcontent d'entendre l'un d'entre eux lui prdire que le prsident se ferait proclamer
empereur : en sortant de chez le prince, l'un des visiteurs dit son ami trop franc : Pourquoi
l'avez-vous contrari ? Il aime tant qu'on lui dise que la France l'attend.
Il aurait fallu dire mdiatement, puisque le projet a pour objet de respecter la proprit; mais
la langue (tes gens de ce temps est souvent incorrecte.
Les constitutions rpublicaines avaient subordonn l'expropriation la ncessit; le Code
Napolon, en 1804, la subordonna l'utilit ; je ne sais pas s'il y a une grande diffrence entre
ces deux rdactions; la langue de la Rvolution franaise mangue de prcision quand elle ne
se rfre pas une terminologie de l'Ancien Rgime. La langue des idalistes ne doit pas tre
confondue avec celle de tout le monde : dans une lettre Andrea Costa (qui lui a valu tant
d'attaques), Jaurs crit que la Triple alliance est le contrepoids ncessaire de l'alliance
franco-russe ; il voulait dire le contrepoids exact.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
70
La ncessit des amliorations agricoles se faisant de plus en plus sentir, les
lois du 21 juin 1865, et du 22 dcembre 1888 ont permis de constituer des
associations syndicales de propritaires intresss certains travaux et d'aider la
majorit imposer ces travaux la minorit. Tout d'abord, on n'avait prvu cette
contrainte que pour la construction de digues contre la mer ou les fleuves, le
curage des cours d'eau, le desschement des marais, l'assainissement des terres
humides et les ouvrages ncessaires aux marais salants. Si les deux tiers des
intresss possdant la moiti de la surface ou la moiti des intresss possdant
les deux tiers de la surface taient consentants, l'administration pouvait contraindre la minorit entrer dans l'association.
En 1888, on a t beaucoup plus loin ; on a admis la facult de coercition pour
l'assainissement et les travaux dits d'utilit publique dans les villes, l'irrigation, le
drainage, l'ouverture de chemins et toutes autres amliorations agricoles
d'intrt collectif 1 ; mais on demande une majorit, plus forte que pour les cas
prvus en 1865. Il faut l'adhsion des trois quarts des intresss, reprsentant
plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impt foncier
affrent aux immeubles, ou des deux tiers des intresss, reprsentant plus des
trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impt foncier
affrent aux immeubles . Les propritaires de la minorit peuvent, par contre
(sauf pour les cas de dfense contre la mer ou les fleuves et le cas de curage), se
faire exproprier.
Aprs la loi de 1865, on justifiait le droit de contrainte admis en faveur de la
majorit en disant que certains travaux ont pour objet de protger les proprits
contre des dommages auxquels elles sont exposes ; les autres n'ont pour objet
que d'accrotre la valeur d'une proprit dj place dans une condition normale ; pour ceux-ci, il n'y aurait pas eu lieu contrainte 2. Cette thorie n'tait
mme pas, exacte en 1865, car elle ne s'appliquait pas bien aux marais salants. Il
faut reconnatre diffrents degrs d'opportunit : l'homme qui refuse de participer
la dfense des terres contre la mer ou les fleuves est un homme dpourvu de tout
jugement, si la trs grande majorit de ses voisins reconnat cette ncessit, d'accord avec l'administration. L'irrigation prsente un caractre d'utilit bien
moins vident, car il est arriv souvent qu'elle a cot plus qu'elle n'a rapport. Il
ne s'agit que d'opportunit ; c'est l'administration qui apprcie souverainement ;
mais elle s'entoure de garanties, d'autant plus srieuses que l'opportunit est plus
contestable 3.
Dans tous les pays du midi de l'Europe, la valeur des terres dpend, dans une
trs large mesure, des facilits de l'irrigation ; il y a des canaux trs anciens et le
droit l'arrosage s'est, en quelque sorte, incorpor la terre; le Code Napolon a
donn aux tribunaux un certain droit d'apprcier l'opportunit dans les procs
relatifs l'emploi que les riverains font de l'eau : de nouveaux riverains peuvent
1
2
3
La rdaction du texte est dfectueuse ; car il rsulte de l'article 3 de la loi que ces travaux
d'amlioration agricole, d'intrt collectif, devront avoir t dclars d'utilit publique, tout
comme les travaux Militaires.
Aucoc, Confrences sur l'administration et le droit administratif, tome II, p. 408. Aucoc a t
prsident de section au Conseil d'tat ; son autorit est trs grande.
Kautsky fait observer qu'au XVIIIe sicle on a souvent en Allemagne fait de grandes
entreprises de travaux d'amlioration du sol, qui ont t fort peu productives. (Politique
agraire du parti socialiste, trad. fran., pp. 137-138).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
71
arroser et nuire aux anciens usagers. Les tribunaux doivent concilier l'intrt de
l'agriculture avec le respect d la proprit ; et, dans tous les cas, les rglements
particuliers et usages locaux doivent tre observs. (art. 645 du Code
Napolon).
Mais l'administration a un pouvoir beaucoup plus tendu pour faire des partages de l'eau d'un territoire ; il lui est arriv, plus d'une fois, de permettre la
construction de nouveaux canaux qui avaient pour effet d'exproprier sans
indemnit les anciens arrosants. La loi du 8 aot 1898 prescrit (art. 9) que les
dcrets rglementaires devront concilier les intrts de l'agriculture et de
l'industrie avec le respect d la proprit et aux droits et usages antrieurement
tablis . On n'a pas trouv de formule plus claire pour dfinir l'opportunit ; on
conoit que c'est l un conseil dont l'administration tient le compte qu'elle juge
convenable.
Rien n'est plus curieux que les efforts que firent les rapporteurs de la loi
forestire de 1827 pour justifier les servitudes qu'elle imposait aux bois particuliers ; devant la Chambre des pairs, on faisait valoir que les bois sont des
objets de premire ncessit et on invoquait des motifs d'ordre public. Si l'on
acceptait assez facilement le droit que la Marine avait, depuis longtemps, de
choisir des arbres propres ses constructions de guerre, il n'en tait pas de mme
du droit que l'administration revendiquait d'interdire les dfrichements. Le gouvernement ne proposait que des mesures temporaires, et, dans son expos, du 29
dcembre 1826, Martignac mettait l'espoir qu'au bout de 25 ans la libert
pourra tre rendue tout entire la proprit . En 1859, cette partie du Code
forestier a t rvise ; la libert n'a pas t rendue tout entire ; mais le contrle
de l'administration a t tellement restreint qu'il ne gne gure (soutien des terres
sur les montagnes, protection contre les eaux des fleuves, maintien des sources,
conservation des dunes, dfense militaire dans la zone frontire et salubrit
publique).
Jusqu'en 1866, il a exist une lgislation tout fait singulire en France sur les
fonderies de mtaux : on ne pouvait tablir un haut-fourneau sans une autorisation ; et le gouvernement s'assurait si une pareille entreprise avait des chances
srieuses de russir, si elle pouvait prosprer sans nuire aux entreprises voisines.
Le gouvernement, qui tait au commencement du XIXe sicle le plus gros consommateur de fer du pays, veillait ce que cette industrie pt marcher d'une
manire rgulire, sans abus de concurrence pouvant dterminer les crises ; de
plus., il donnait aux matres de forge des droits pour se procurer du minerai. Il est
assez singulier qu'il n'ait pas song leur donner aussi des droits sur les forts
voisines 1.
Dans l'expos des motifs de la loi sur les mines, fait le 13 avril 1810, au Corps
lgislatif, Regnault de Saint-Jean-d'Angely disait qu'on avait cherch concilier
les principes de la proprit avec les garanties ncessaires aux exploitations de
1
Le Play estimait que la lgislation napolonienne avait t nuisible aux industriels (op. cit.,
tome II, p. 123) il regrettait de voir les forts souvent spares des fonderies. Dans les
Ouvriers europens (p. 132, col. 2) il avait dit que les exigences des propritaires de bois
avaient entran la dcadence de la mtallurgie du fer en France.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
72
mines. On croyait avoir trouv un juste milieu, conciliant parfaitement les intrts
de l'tat, ceux de l'exploitant et ceux des propritaires du sol. Tandis que le conseiller d'tat soutenait que l'on voulait faire des mines des proprits auxquelles
toutes les dfinitions du Code Napolon puissent s'appliquer , le rapporteur du
Corps lgislatif disait : Les mines n'tant pas et ne pouvant tre considres
comme des proprits ordinaires, doivent tre assujetties des rgles spciales et
soumises une surveillance de l'administration . En fait, l'administration exerce
une action assez tendue et la proprit de la mine peut tre vendue d'autorit au
cas o l'exploitation est restreinte ou suspendue de manire inquiter la sret
publique ou les besoins des consommateurs . Le gouvernement se trouve arm
d'un pouvoir d'apprciation formidable qui rappelle celui dont il jouit envers les
propritaires de marais qui ne veulent pas transformer leurs terrains : c'est
toujours le progrs des forces productives qui est en jeu.
En Allemagne, la considration de l'opportunit a conduit adopter une lgislation destine faciliter le remembrement dans les banlieues parcelles morceles ; cette lgislation semble bien contraire aux ides gnralement reues sur la
proprit ; il faut, toutefois, observer que dans les rgions o la terre est ainsi
morcele l'infini, il n'existe par un fort sentiment d'attachement pour une terre
dtermine ; on est habitu 'vendre et partager la terre comme de vritables
meubles 1 !
Dans ses provinces orientales la Prusse cherche crer une classe de petits
propritaires, en achetant de grands domaines et les vendant par parcelles; en
Pologne elle procde une uvre plus complexe, puisqu'elle essaie d'carter
l'lment polonais de la proprit pour remplacer l'ancienne noblesse par une
paysannerie venant des autres rgions de l'Allemagne.
L'Angleterre a accept le principe de l'expropriation pour la cration de lots de
terre destins aux ouvriers ruraux ; mais, en fait, les propritaires sont gnralement disposs cder l'amiable les surfaces ncessaires. Je cite cette application
des ides d'opportunit pour pouvoir passer aux rgles appliques en Australasie.
Dans ces pays, il existe une population urbaine tout fait exagre et la
grande masse de la terre a t occupe autrefois par de puissants propritaires de
troupeaux. Il y avait un intrt vident pour l'avenir coloniser au moyen des
ouvriers qui encombrent les grandes villes. Les tats ont achet de grands
domaines et les ont partags entre des cultivateurs ; dans l'Australie mridionale
et la Nouvelle-Zlande on a admis l'expropriation en cas de dsaccord. On est all
plus loin encore en crant des colonies par voie administrative ; sur les bords de la
rivire Murray ont t faites d'intressantes organisations de colonisation par le
travail collectif : on y a vu, bien tort, des essais de communisme. Il y a eu de trs
grandes difficults dans la gestion de ces socits d'urbains transforms en
paysans ; il est probable que les meilleurs lments de la population profitaient
des facilits donnes aux acqureurs de lots de ferme et que le gouvernement
1
Le baron S. de la Bouillerie, qui habite le dpartement de la Sarthe, o existent des parcelles
trs rduites, ne croit pas cependant que le paysan franais acceptt facilement le
remembrement suivant le systme allemand (tude sur la petite proprit rurale, p. 79). - Je
reviendrai sur cette question dans la troisime partie, I ; je n'apprcie pas le remembrement
comme le fait Kautsky.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
73
avait faire l'ducation de mdiocres travailleurs pour ses villages de
colonisation 1.
Beaucoup d'Italiens ont pens que leur conomie nationale tait abusivement
greve d'un norme tribut payer pour l'achat des grains, parce que le sol de leur
pays n'tait pas cultiv d'une faon convenable. Le problme de la colonisation
intrieure a pris un tel caractre d'acuit que dans un discours prononc le 12
octobre 1919 Dronero, Giolitti a affirm que l'tat serait fond confisquer les
terres incultes ou mal cultives. Des mesures provisoires ont t prises pour
autoriser les paysans occuper les latifundia sous certaines conditions. Il est
remarquer que Pie VI avait permis aux laboureurs de travailler les domaines de la
campagne romaine dont les propritaires taient trop ngligents ; cette menace de
dpossession temporaire ne parat pas avoir beaucoup mu ceux-ci 2. La
colonisation intrieure est ici plus facilement excutable que dans le plus grand
nombre des autres pays parce qu'en Italie existe un nombreux proltariat rural, qui
a donn des preuves multiples de ses capacits.
1
2
Cf. Louis Vigouroux, L'volution sociale en Australasie.
Abb Sabatier, L'glise et le travail, manuel, pp. 173-176.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
74
Introduction lconomie moderne :
Premire partie : de lconomie au droit
Chapitre VII
La colonisation requiert des formes spciales et les forces productives ne se crent pas
sous le rgime de l'exploitation normale. - L'histoire des antiques monastres bndictins. Grandes analogies que prsente cette histoire avec celle du capitalisme : facilit d'avoir de la
main-d'uvre ; accumulation primitive ; technique suprieure ; discipline. - chec de la rgle
de saint Columban. - Dcadence des socits qui ne s'occupent que de la consommation.
Retour la table des matires
Les procds de colonisation sont extrmement varis : ils reposent tous, en
effet, sur des circonstances psychologiques qui ne prsentent aucune uniformit ;
il s'agit de trouver des moyens d'intresser des hommes entreprendre une uvre
pnible, dont les rsultats dpassent de beaucoup l'tendue des perspectives habituelles de leur pense. On peut comparer ces phnomnes ceux que l'on observe
dans l'atelier capitaliste : les chefs d'industrie habiles s'ingnient trou-ver des
moyens pour forcer l'ouvrier prendre des habitudes nouvelles, capables de
conduire une production d'un ordre plus lev : c'est un monde nouveau qui se
cre grce aux ruses du capitalisme, qui excite l'ouvrier par l'appt de hauts salaires, comme le gouvernement colonisateur attire le colon par le mirage d'une
proprit facile acqurir.
Les procds employs pour fixer le salaire varient beaucoup et aucun d'eux
ne prsente des avantages incontests sur les autres : lis ont t adopts la suite
de ttonnements, pour corriger, au fur et mesure du besoin, des dfauts qui se
manifestaient dans la production : on peut aussi noter dans les diverses histoires
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
75
de colonisation des ttonnements et beaucoup de fautes que l'on s'efforce de
rparer. En Australasie, on a remani, plusieurs reprises, la lgislation agraire,
en vue de la mieux adapter aux besoins que l'exprience seule permettait de reconnatre. Il serait donc absurde, dans un cas comme dans l'autre, de chercher
dgager des principes de droit : je sais que cela a t fait, mais par des auteurs qui
n'entendaient rien soit la marche des ateliers, soit la colonisation,... ni mme
beaucoup au droit 1.
La colonisation constitue dans l'histoire conomique un moment qui n'est pas
rgi par les mmes lois que l'exploitation mthodique du sol ; elle ressemble, dans
une certaine mesure, la cration artificielle des grandes industries au dbut de
l're moderne, alors que l'tat cherchait fabriquer des fabricants 2. Aujourd'hui
il ne viendrait l'ide de personne en Europe de restaurer un pareil rgime, qui a
produit d'heureux effets, mais qui deviendrait dangereux pour le progrs ultrieur
de la production. On peut la rapprocher aussi de l'intervention exceptionnelle de
l'tat dans le desschement des marais : cette intervention, suivant l'esprit de la
lgislation napolonienne, est temporaire ; le but atteindre est de restaurer la
libre proprit aprs une priode transitoire. La mme conception se retrouve dans
la loi de 1810 sur les mines : Napolon entendait limiter la priode des ttonnements prliminaires l'action directe de l'tat : il avait hte de constituer une
proprit minire aussi libre qu'il tait possible.
Il ne faut plus admettre qu'un mme rgime convient la cration et la
conservation des forces productives. Beaucoup d'inventeurs de rformes sociales
ont tir grand parti de cette considration ; si le capitalisme a t ncessaire pour
crer la grande industrie, d'abord sous le contrle de l'tat et ensuite d'une manire peu prs indpendante, il n'est pas vident que la ncessit de son intervention
existe encore dans l'tat actuel. L'conomie leur semble, en quelque sorte libre
et nos inventeurs profitent de cette libert pour la reconstruire suivant les caprices
de leur imagination.
Bien des personnes ont observ dj que dans certaines grandes entreprises on
ne trouve plus les caractres qui taient considrs comme essentiels l'entreprise
capitaliste : c'est ainsi que l'on a souvent soutenu que, - les mines, les chemins de
fer les raffineries de sucre, certaines usines mtallurgiques, tant dirigs d'une
manire administrative, qui rappelle beaucoup les pratiques de l'tat, - le rle du
capitalisme serait fini pour ces affaires, qui seraient mres pour tre transformes
en rgies fiscales. Des philosophes sont persuads que nous ne resterons pas toujours dans cette re fivreuse d'inventions, et que nous entrerons bientt dans une
re calme laquelle conviendra un nouveau systme de gestion 3. Chacun, suivant
1
2
3
C'est ce explique pourquoi tant de personnes ont cru que l'Australasie un pays socialiste; je
m'tais lev contre cette illusion dans un article des Sozialistische Monatshefte. (fvrier
1898) intitul: Ein sozialistischer Staat ? Mes vues viennent d'tre confirmes par un social
dmocrate allemand, Beer ; il a trs bien observ que les lgislateurs de la Nouvelle-Zlande
se proposent de crer une vaste classe moyenne et de raliser le rve qu'avaient form les
puritains de la Nouvelle Angleterre (Mouvement socialiste, 15 dcembre 1902). Louis
Vigouroux ne croit pas non plus qu'il y ait un mouvement socialiste en Australasie et il nous
apprend que c'est aussi l'avis de Ben Tillett qu'il a rencontr dans ce pays. (L'volution sociale
en Australasie, p. 321).
Cf. MARX, Capital, tome I, p. 338, col. 2.
Nous approchons grands pas du moment o l'outillage industriel sera achev ; aujourd'hui
les pays riches en sont pourvus profusion et il est donn dans des limites raisonnables aux
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
76
ses inclinations particulires, prtend prouver que, nous marchons soit au socialisme d'tat, soit la rnovation des familles stables dcrites par Le Play, soit aux
coopratives des types varis.
Les marxistes ne voient pas les choses au mme point de vue, parce qu'ils sont
persuads que le socialisme n'a point pour supposition fondamentale l'arrt ou le
ralentissement du mouvement rvolutionnaire de l'conomie moderne, mais qu'il
doit supplanter le capitalisme quand celui-ci ne peut plus donner ce mouvement
une allure assez rapide.
Il n'existe peut-tre pas dans l'histoire de l'Occident une exprience plus utile
tudier, au point de vue des questions traites ici, que celle des monastres bndictins. Aprs avoir rendu l'Europe des services minents, que tout le monde
reconnat, ces institutions dclinrent rapidement et les paysans n'eurent plus
qu'un dsir, celui de se dbarrasser de la tutelle d'anciens matres devenus inutiles.
Leur grandeur a de nombreux traits communs avec celle, du capitalisme ; et celuici aurait dj peut-tre connu leur dcadence s'il n'avait constamment rajeuni ses
mthodes. Cette histoire est d'autant plus importante faire connatre que l'on a
trs souvent expliqu la prosprit des anciens monastres par des raisons idologiques ; nous allons voir qu'elle s'explique trs bien par des conditions d'ordre
conomique, qui nous permettront d'tablir un paralllisme remarquable entre les
uvres monastiques et le capitalisme moderne.
Nous examinerons d'abord les conditions gnrales dans lesquelles se faisait
la production monastique : les Bndictins craient leur usage un milieu
artificiel privilgi, ayant de grandes analogies avec celui dans lequel s'est dveloppe l'industrie moderne.
Aujourd'hui, nous ne rflchissons pas assez l'avantage norme que procure
la scurit ; le capitalisme a eu grand besoin de cette condition pour pouvoir
tendre ses entreprises. une poque o les gouvernements ne pouvaient donner
la scurit aux citoyens, le prestige religieux des monastres protgeait de petites
colonies pacifiques. Les lgendes sont pleines d'histoires naves sur les animaux
froces qui se laissaient apprivoiser, sur les bandits qui se convertissaient, sur les
nobles pillards que la vengeance cleste amenait se repentir de leurs exactions;
toute cette littrature constitue une preuve indniable de la force merveilleuse
dont disposaient les monastres pour se protger.
Depuis longtemps, les grands propritaires ne trouvaient plus une mainduvre suffisante ; la dcadence de l'Empire romain tint surtout cette cause.
l'origine des temps modernes, le capitalisme a eu beaucoup de mal dplacer les
travailleurs pour les accumuler autour des manufactures ; en Angleterre, cette
accumulation a t favorise par un ensemble de circonstances sur lesquelles
Marx s'est longuement tendu; encore aujourd'hui, on hsite souvent entreprendre certaines oprations dans des pays o la main-d'uvre est rare. Les
monastres attirrent des hommes en masse, parce qu'ils les protgeaient ; il
moins avancs. Nous atteignons pour ainsi dire une priode organique dfinie (Hector
Denis, La dpression conomique et sociale et l'histoire des prix, p. 336). Cela tait crit en
1895.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
77
n'tait pas ais aux anciens matres de reprendre leurs esclaves ou colons fugitifs,
quand ceux-ci taient passs sous l'autorit des instituts ecclsiastiques.
Trouver des capitaux tait jadis un problme fort difficile rsoudre ; pour les
moines, il tait assez simple. Trs rapidement les donations de riches familles leur
prodigurent de grandes quantits de mtaux prcieux ; l'accumulation primitive
tait donc trs aise. D'autre part, les couvents dpensaient peu et la stricte
conomie que les rgles imposaient, rappelle les habitudes parcimonieuses des
capitalistes 1. Pendant longtemps les moines furent en tat de faire des oprations
excellentes pour augmenter leur fortune. Aux XIe et XIIe sicles les moines
taient des banquiers [du Roussillon] comme de bien d'autres provinces... Les
religieux puisaient dans le trsor de leurs glises ; ils livraient leurs encensoirs
d'argent et jusqu'aux rtables prcieux de leurs autels. Ils prtaient sur gages,
achetaient les biens des gens dans la gne ou bien rachetaient les immeubles engags 2 Ainsi nous trouvons ici : une accumulation primitive facile, une pargne
importante et la possibilit de faire fructifier le capital usuraire.
Pntrons maintenant sur le domaine et voyons comment il tait cultiv ; bien
que nous n'ayons pas beaucoup de documents prcis ce sujet, nul doute que les
Bndictins n'aient apport une technique suprieure celles des peuples qu'ils
colonisaient. Montalembert mentionne souvent des importations d'arbres fruitiers
nouveaux et des plantations de grands vergers. Les efforts qui furent tents pour
acclimater la vigne dans des rgions o elle n'est plus cultive aujourd'hui, nous
montrent que les moines taient des horticulteurs singulirement habiles, sachant
profiter de circonstances accidentelles heureuses et ne reculant pas devant des
soins d'une extrme minutie. Il semble bien qu'ils aient vulgaris les mthodes
italiennes d'apiculture.
Parmi les lgendes monastiques, je signale celle de saint Thodulphe, sur
laquelle Montalembert a crit une page si loquente 3 ; pourquoi aurait-on attach
tant d'importance la charrue de cet infatigable travailleur, si l'emploi de cet
instrument n'avait t une innovation importante ? Il est d'autant plus vraisemblable que les Bndictins introduisirent des labours profonds, que leurs tablissements furent trs souvent faits dans des rgions humides que le travail soign de
la terre assainissait rapidement 4.
2
3
4
Dans les trente premires annes du XVIIIe sicle, un fabricant de Manchester qui et offert
ses convives une pinte de vin tranger, se serait expos aux caquets et aux hochements de
tte de tous ses voisins... C'est en 1758, et ceci fait poque, que l'on vit pour la premire fois
un homme engag dans les affaires avoir un quipage lui. Marx cite cette phrase dA
Smith : La parcimonie, et non l'industrie, est la cause immdiate de l'augmentation du
capital. - (MARX, loc. cit., p. 260, col. 2).
Auguste Brutails, tude sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen
ge, p. 73.
Montalembert, Les moines d'occident, tome II, p. 455.
La technique agricole des anciens prsente de trs grandes obscurits ; les auteurs dcrivent
des typs trs multiples de charrues et leurs descriptions sont toujours trop sommaires pour
qu'on puisse srement tenter des reconstitutions : mais il faut noter que Pline nous dit qu'en
Italie huit bufs sont parfois essouffls en tirant la charrue (Histoire naturelle, XVII, 47) ; ce
texte prouve que des labours profonds taient pratiqus de son temps.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
78
La valeur des connaissances techniques des moines se manifeste par l'importance de leurs travaux de desschement. Dans l'histoire de la technologie, il faut
distinguer avec soin l'irrigation et le desschement; la premire de ces pratiques
est, d'ordinaire, beaucoup plus ancienne que la seconde. Jusqu' une poque trs
voisine de la ntre, on considrait avec un respect superstitieux les oeuvres hollandaises : tracer des canaux ayant une trs faible pente, permettant d'couler des
eaux stagnantes, parait la trs grande masse des hommes plus difficile que de
faire aux eaux courantes des lits artificiels, peu prs parallles au lit principal, en
vue d'inonder ou d'arroser les terrains riverains. C'est ainsi que dans le Roussillon
les canaux d'arrosage sont mentionns dans les documents bien avant ceux de
desschement et que dans cette province, si riche en oeuvres hydrauliques anciennes, ce sont les Templiers qui prirent la plus grande part aux assainissements des
marais 1.
L'tude des rgles monastiques, faite au point de 'Vue de la production, nous
amne des rapprochements fconds entre les institutions bndictines et l'atelier
capitaliste. Saint Benot rencontra les difficults contre lesquelles eurent lutter
les premiers crateurs de la grande industrie 2 : les anciens artisans, fiers de leur
long apprentissage, prtendaient conserver leurs habitudes d'indpendance ; ils
travaillaient aux pices et ne voulaient pas se laisser imposer une discipline qu'ils
jugeaient approprie seulement aux ouvriers d'ordre infrieur; ils voulaient sortir
quand il leur plaisait 3 et acclrer ensuite le mtier quand il leur convenait de
rattraper le temps perdu : Ure prtend (non sans quelque apparence de vrit) que
ce genre de travail intermittent engendrait beaucoup d'abus et que les enfants
taient fort malmens par les fileurs de laine rentrant du cabaret.
Ure disait que le grand mrite d'Arkwright avait consist moins dans ses
inventions mcaniques que dans son nergie; il tait parvenu vaincre le naturel
rfractaire des ouvriers habitus expdier l'ouvrage par boutades ; ses
prdcesseurs avaient chou dans cette entreprise 4. Mme aujourd'hui, crit
cet auteur vers 1830, que ce systme est organis dans toute sa perfection, et que
le travail a subi tout l'adoucissement dont il est susceptible, il est presque impossible de trouver parmi les ouvriers, qui ont pass l'ge de pubert, d'utiles
auxiliaires pour le systme automatique. Aprs s'tre efforcs pendant quelque
temps de vaincre leurs habitudes rtives et indolentes, ils renoncent volontairement leur emploi ou sont congdis cause de leur inattention 5. Il parle d'un
patron qui ne voulait plus employer d'ouvriers ayant fait leur apprentissage
rgulier et d'un constructeur qui avait interrompu l'excution d'une nouvelle
3
4
5
Auguste Brutails, op. cit., pp. 3-5. - Peut-tre avaient-ils apport d'Orient l'art de construire
des tunnels d'vacuation destins vider des cuvettes profondes (comme les Romains vidrent
le lac Fucin).
Cf. MARX, loc. cit., pp. 118-119, - p. 159, col. 2. - 183, col. 2. Quelques-uns soutenaient que
sans une grande libert les ouvriers anglais seraient tombs au niveau des Franais qui en cinq
ou six jours ne faisaient pas, disait-on, plus de besogne que les Anglais en quatre; d'autres
reprochaient aux Anglais de ne pas suivre l'exemple des Hollandais qui travaillaient six jours
par semaine (p. 118, col. 2 et p. 419, col. 1).
URE, Philosophie des manufactures, tome I, p. 269.
URE, loc. cit., p. 24.
URE, loc. cit., p. 22.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
79
machine en attendant que le perfectionnement de son outillage lui permt de se
passer des vieilles mthodes de travail 1.
Saint Benot prit des prcautions contre l'indiscipline des ouvriers habiles ;
ils ne pouvaient exercer leur mtier qu'avec la permission de l'abb et en toute
humilit ; et si quelqu'un s'enorgueillissait de son talent et du profit qui pouvait en
rsulter pour la maison, on devait lui faire changer de mtier jusqu' ce qu'il se ft
humili 2.
Il faut que tous deviennent des proltaires : La rgle dnonce la proprit
comme le vice le plus essentiel extirper de la communaut ; les parents
doivent jurer qu'ils ne constitueront pas de pcule leur fils; il est dfendu de
recevoir un prsent sans la permission de l'abb ; l'abb remet chaque moine en
dpt les instruments de travail, sur lesquels personne n'a de droit individuel 3.
On n'a gnralement vu dans cette lgislation qu'un ensemble de rgles asctiques ; mais Montalembert estime que saint Benot a d s'inspirer des souvenirs de
la discipline romaine 4 ; je crois cette hypothse vraisemblable et les expressions
de la rgle semblent, plus d'une fois, la confirmer ; mais j'estime qu'il faut surtout
s'attacher - si l'on veut comprendre l'histoire bndictine - aux questions qui
intressent le travail. Travail et obissance sont les deux colonnes de l'difice
bndictin comme de l'difice capitaliste. Saint Benot a toute la prvoyance d'un
grand patron qui se proccupe d'assurer la prosprit d'une vaste et durable entreprise : la manire de Le Play, il veut combiner les proccupations morales avec
celles de l'intrt bien compris 5.
On apprcie mieux le caractre si fortement pratique de l'uvre bndictine
quand on la compare celle que saint Columban essaya de raliser en Gaule un
demi-sicle environ aprs le fondateur de Mont-Cassin 6. Le clbre Irlandais
choua finalement ; malgr l'extraordinaire prestige qui l'a entour durant son
apostolat et la clbrit de Luxeuil, sa rgle est en dcadence marque cinquante
ans aprs sa mort 7 ; Montalembert attribue ce fait singulier deux causes : le
pape Grgoire-le-Grand avait approuv l'uvre de saint Benot et la papaut la
protgeait; le systme de saint Columban tait beaucoup trop dur, au point de vue
de la nourriture, de la discipline et du gouvernement.
Saint Benot avait dclar, au chapitre 73 de la rgle, qu'il n'avait pas en vue la
vie chrtienne parfaite, mais seulement une trs modeste introduction ce rgime
idal rv par tant d'anciens solitaires; il trouvait qu'il suffisait d'imposer
l'ensemble de ses moines les conditions de vie habituelles des classes laborieuses
1
2
3
4
5
6
7
URE, loc. cit., p. 31.
Montalembert, loc. cit., p. 51 (chap. 57 de la rgle).
Montalembert, loc. cit., pp. 60-68.
Montalembert, loc. cit., p. 58.
Il est remarquer que Ure signalait, l'poque o Le Play allait commencer ses tudes,
l'importance de la moralisation des classes ouvrires et s'levait contre les patrons qui
n'adorent que Mammon. Il est de l'avantage, comme du devoir, de tout chef de fabrique
d'observer l'gard de ses ouvriers le prcepte divin d'aimer son prochain comme soi-mme
(op. cit., tome II, p. 213-215).
Saint Columban nat en 543, quand saint Benot meurt Montalembert note ce fait curieux que
le moine irlandais ne semble pas connatre son prdcesseur (loc. cit., p. 546).
Montallembert, loc. cit., pp. 656-662.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
80
d'Italie 1. Saint Columban veut, au contraire, dompter la nature humaine : la
nourriture est rduite au minimum et on n'en prend qu'une fois par jour; le silence
est perptuel 2 ; on emploie un temps norme psalmodier des offices d'une longueur interminable (75 psaumes dans les grandes ftes); les pnitences sont
froces et vont jusqu' deux cents coups de fouet 3.
Saint Benot tait oppos un gouvernement capricieux ; il avait recommand
de ne rien faire avec excs, de mnager les forces des faibles; il avait prescrit
l'abb de prendre l'avis de son chapitre dans les cas importants et des anciens dans
les moins srieux 4 ; Montalembert trouve dans la rgle bndictine les caractres
de la sagesse romaine, bon sens, douceur, modration . Chez saint Columban,
le pouvoir est rigoureusement despotique ; la rgle tant courte et vague, le despotisme n'tait que plus facile. Je n'ai pas besoin de rappeler combien l'administration capricieuse de certains directeurs d'usines est pernicieuse pour les intrts des
capitalistes.
Il est vident que pour saint Columban les proccupations conomiques
n'avaient qu'une trs faible importance. une poque o les couvents avaient
besoin d'tre forts au point de vue de la production, les ides de saint Benot
devaient l'emporter.
Il ne faudrait pas croire que je veuille soutenir ce paradoxe que la rgle bndictine est, purement et simplement, un rglement rdig par un patron ; je
reconnais, trs bien, que dans cette uvre il y a plusieurs sources et que la notion
d'humilit chrtienne n'en est pas du tout absente ; mais il s'est trouv, par un
heureux concours de circonstances, qu'en voulant faire de bons moines, saint
Benot s'est trouv, grce son esprit pratique, faire de bons travailleurs; et c'est
pour cela que son uvre a t si florissante.
D'aprs ce que j'ai expliqu plus haut, je suis moins dispos que personne
ngliger le ct intrieur ; ici le sentiment religieux absorbe toute la conscience et
prend la place que des sentiments juridiques et moraux doivent occuper chez un
bon travailleur moderne 5. Les abbs habiles devaient s'appliquer cultiver ce
sentiment, de telle sorte que leurs moines en vinssent accepter la discipline
comme une loi naturelle ; cela n'tait pas facile, car les Bndictins formaient une
exception dans la socit de leur temps. - En nous plaant au point de vue conomique, nous voyons mme que cette exception tait plus forte et par suite la
discipline plus difficile maintenir que nous n'aurions pu le souponner tout
d'abord. Le travail rgulier est, aux yeux des populations aussi peu avances que
1
2
3
4
Montalembert observe que le costume est peu prs celui que portaient les esclaves d'aprs
Columelle (loc. cit. p. 67). Le rgime bndictin comportait une ration de vin p. 66); la dure
du travail tait Te neuf heures, dont sept employes au travail manuel et deux la lecture (p.
51). - Sur la rgle de saint Columban, Montalembert, loc. cit., pp. 547-549.
Un silence moins rigoureux existe aussi dans la rgle bndictine ; mais n'est-il pas une
ncessit dans tout grand atelier ?
Deux cents coups de fouet pour avoir parl une femme sans tmoins.
Le Play a souvent signal l'importance pratique de confrences entre le patron et certains
ouvriers. C'est sur cette ide que des comits d'usine furent constitus en Belgique pour aider
les patrons. - Cf. Montalembfrt, loc. cit., p. 51, pp. 55-56, p. 69.
Si dans l'histoire des progrs industriels les monastres bndictins occupent une place
considrable, leur rle parat tre nul dans le dveloppement du droit ; on ne peut pas en dire
autant des ateliers capitalistes qui engendrent non seulement les conditions matrielles, mais
encore les conditions morales du socialisme.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
81
celles du haut Moyen-ge, le pire des esclavages. Ure signalait encore, il y a une
soixantaine d'annes, la rpugnance invincible des paysans anglais pour les
fabriques 1. Les monastres ne purent russir que grce une slection svre ; de
l rsulte la trs grande importance du noviciat dans les ordres religieux; sans
doute les pratiques monastiques exercent une influence sur l'esprit, mais la slection fut si bien ordonne que les couvents ne s'ouvraient (aux poques prospres)
qu'aux hommes prdisposs.
Ces couvents antiques ont de grandes analogies avec beaucoup de nos coopratives contemporaines de production ; celles-ci russissent quand elles ont leur
tte un chef nergique capable d'imposer tous les cooprateurs une discipline
svre et de fermer la porte tous ceux qui ne sont pas aptes suivre la rgle.
Comme les tablissements monastiques, les coopratives ont largement recours
la bourse de gnreux donateurs et quelques personnes pensent qu'elles tendent
trop facilement la main pour pouvoir jouer un rle srieux dans l'ducation du
proltariat 2. De mme que les couvents n'ont pas transform le monde en une
socit parfaitement chrtienne, il serait puril de supposer que les coopratives
puissent changer le monde capitaliste en un monde socialiste.
Lorsque les instituts bndictins eurent accompli leur oeuvre, arriva une
poque de dcadence; quand on n'eut plus besoin de s'imposer la dure discipline
du pass pour vivre et pour prosprer, on se relcha beaucoup. Le rle civilisateur et agricole des moines, dit Alfred Maury, ne cessa que lorsque, enrichis par
les efforts et les travaux de leurs devanciers, ils ne songrent qu' jouir
paisiblement du sol dont ils consommaient les produits 3. Ils cessrent d'tre des
ouvriers groups dans un atelier quasi-capitaliste, ils devinrent des bourgeois
retirs des affaires, ne songeant qu' vivre dans une douce oisivet la campagne ; l'ancien atelier de production perfectionn devint une rsidence pour des
consommateurs bien rents ; on passa de la coopration de production ouverte
seulement aux sujets exceptionnels une coopration de consommation qui
convient tout le monde.
Cette dcadence s'observe sur une chelle trs vaste chez les peuples qui
vivent de rentes et non de production : la prpondrance passe au peuple qui
travaille, alors mme qu'il reste, plus ou moins longtemps, tributaire de celui qui
lui prte des capitaux. Marx a dcrit trs bien ce mouvement dans le premier
volume du Capital. Venise en dcadence prte la Hollande l'argent qu'elle a
gagn jadis par son commerce et sa piraterie. son tour, la Hollande, dchue
vers la fin du XVIIe sicle de sa suprmatie industrielle et commerciale, se vit
contrainte faire valoir des capitaux normes en les prtant l'tranger et de 1701
1776 spcialement l'Angleterre, sa rivale victorieuse 4. l'heure actuelle, on
1
2
3
URE, loc. cit., p. 85 et p. 120.
Cf. ce que dit Marx dans la lettre sur le programme de Gotha (Revue d'conomie politique,
septembre-octobre 1891, p. 765).
Alfred Maury, Les forts de la Gaule, p. 135. Il ajoute que les moines devinrent alors de
grands destructeurs de forts, sans agrandir le domaine agricole. - Edmond Demolins estime
que les trappistes actuels sont peu aptes au travail et qu'ils reprsentent un type arrir de
cultivateurs (Les Franais d'aujourd'hui, p. 285).
MARX, loc. cit., p. 338, col. 1.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
82
se plaint vivement que la France cherche plutt faire des prts l'tranger qu'
entreprendre des affaires.
Cette perversion du capitalisme, qui d'industriel revient ses origines usuraires, a une grande importance dans l'histoire, parce qu'il marque le moment o
l'homme abandonne l'ide pniblement acquise qu'il est producteur pour revenir
l'ide des, sauvages polynsiens qui voient surtout dans l'homme un consommateur, ne travaillant que d'une manire accidentelle.
Ce sera l'honneur du marxisme d'avoir fond toutes ses investigations sociologiques sur la considration de la production et d'avoir ainsi fait comprendre quel
abme spare le socialisme srieux de toutes les caricatures bourgeoises qui
prennent pour base de leurs thories la rpartition des richesses et la consommation. Les philanthropes qui prnent la coopration, ne cessent de rpter qu'il
faut renverser l'ordre tabli par le capitalisme, qu'il faut rendre la consommation
son pouvoir directeur; de pareils sentiments sont naturels chez ces personnes qui,
recevant des rentes, des traitements ou des honoraires, vivent en dehors du
pouvoir productif; elles ont pour idal la vie de l'oisif lettr. Tout autre est l'idal
socialiste.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
Georges SOREL,
Introduction lconomie moderne
Deuxime partie
Socialisation
dans le milieu conomique
Retour la table des matires
83
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
84
Introduction lconomie moderne :
Deuxime partie : socialisation dans le milieu conomique
Chapitre I
Collectivisme partiel. - Thories de Proudhon sur les rformes du milieu conomique. Distinction de la production et de l'change dans Marx. - Contradiction existant entre l'ordre
adopt dans les formules et l'ordre historique des changements. - Opposition entre la
production et l'change au point de vue des rformes. - Observations faites par Paul de
Rousiers sur les comptoirs de vente. - Nouveaux programmes socialistes.
Retour la table des matires
Le socialisme s'est heurt des difficults presque insurmontables tant qu'il a
voulu donner une description des effets que produirait une rvolution unitaire de
la socit; mais depuis quelques annes, il s'est produit une grande transformation
dans les ides et on ne parle plus que d'un collectivisme partiel qu'il devient assez
facile de se reprsenter : la masse des petits et moyens producteurs conservant la
direction de leurs entreprises et les trs grandes fabriques devenant des rgies
administratives au lieu de continuer tre exploites pour le compte d'actionnaires.
C'est surtout la propagande clans les campagnes qui a conduit les thoriciens
modifier leurs anciens points de vue. Kautsky, par exemple, prtend dmontrer
aux paysans allemands qu'ils auront tout gagner se trouver en rapport avec un
tat appliquant le collectivisme partiel : les hypothques seraient nationalises ;
les sucreries et distilleries, qui leur achtent leurs produits, se montreraient moins
rapaces ; les impts tant pays en nature, les paysans n'auraient plus souffrir
des marchands ; des mesures intelligentes seraient prises pour amliorer le sol,
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
85
conserver les forts et amnager les eaux ; un systme perfectionn d'assurances
serait tabli. Les paysans, dit-il, ont bien plus attendre de l'avnement du
socialisme que des rformes qui sont possibles dans la socit actuelle. Le socialisme leur offre la possibilit de participer au progrs social sans tre expropris.
Le socialisme ne se contente pas de ne pas les exproprier ; il les protge efficacement contre l'expropriation qui, dans la socit actuelle, plane constamment sur
leurs ttes 1 .
Ce sont l des solutions empiriques, que lauteur semble n'accepter lui-mme
qu' contre-cur et qu'il ne cherche pas rattacher une doctrine ; il ne faut clone
pas s'tonner si beaucoup de socialistes ne sont pas trs enthousiastes du programme de Kautsky. Il y a dans ce programme une ide gnrale, qu'il est essentiel de
mettre en vidence : ct de la proprit paysanne, qui a toujours t la proprit
par excellence des juristes, il y a des entreprises dont elle dpend troitement et
qu'elle aurait intrt voir passer sous la direction de l'tat.
Il y a une diffrence de, nature entre ce que l'on propose de laisser sous le
rgime de la proprit prive et ce que l'on entend faire administrer par l'tat dans
un but d'intrt gnral. La diffrence ne porte pas seulement sur la grandeur des
entreprises, sur le nombre des employs qu'elles occupent, sur le rgime de la
gestion (devenue anonyme au lieu d'tre particulire). Pour satisfaire l'esprit, il
faudrait trouver une dfinition de ces deux genres ; c'est ce qu'il est possible de
faire en parlant d'une thorie sur laquelle Proudhon est souvent revenu : ce qu'il y
a d'essentiel mettre en opposition, c'est la production et le milieu conomique.
En 1848, Proudhon disait que la proprit ayant t considre comme responsable de la misre contemporaine, on avait cru devoir propager comme
solution une forme de communisme dfendue par L. Blanc et par beaucoup de
rpublicains socialistes, mais qu' son avis le monde ne devait demeurer fidle
la proprit actuelle, ni comme faisait L. Blanc, ou par la base, comme fait la
proprit, il faut l'attaquer par son milieu, agir directement non point sur l'atelier,
le travail, ce qui est toujours agir sur la libert, la chose du monde qui souffre le
moins qu'on y touche, mais sur la circulation et les rapports d'change, de manire
atteindre, indirectement et, par voie d'influence, le travail et l'atelier. En un mot
changer le milieu 2 .
Dans son dernier mmoire sur la proprit, Proudhon exprime des ides fort
analogues celles de 1848. Il propose une srie de mesures qui doivent, d'aprs
lui, assurer le progrs. Parmi les institutions dterminatives de libert et d'galit et dont l'existence, antrieure ou postrieure l'tablissement de la proprit
est de droit, je compte : 1 la sparation des pouvoirs de l'tat ; 2 la dcentralisation ; 3 l'impt ; 4 le rgime des dettes publique, hypothcaire, commanditaire ; 5 les banques de circulation et de crdit ; 6 l'organisation des services
publics, postes, chemins de fer, canaux, ports, routes, entrepts, bourses et marchs, assurances, travaux publics; 7 les associations industrielles et agricoles; 8
1
2
Kautsky, Politique agraire du parti socialiste ; pp. 211-212.
Proudhon, Solution du problme social, pp. 170-172.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
86
le commerce international 1 . Il est clair, d'ailleurs, que ces garanties (comme il
nomme ces institutions) seraient organises conformment aux propositions qu'il
a formules dans ses divers ouvrages ; sans ce sous-entendu sa doctrine n'offrirait
aucun sens. Ainsi pour l'impt, il renvoie au livre prsent au concours de l'tat
de Vaud ; pour les banques, il revient son ide de prt 1 ou 1/2 pour cent. Il
avertit le lecteur qu'il n'entend pas prconiser des associations analogues celles
de 1848, qui avaient pour objet de remplacer l'initiative individuelle par l'action
socitaire ; il trouve absurde de combattre l'individualisme comme l'ennemi de
la libert et de l'galit 2 ; [ce serait] retourner au communisme barbare et au
servage fodal, tuer la fois la socit et les personnes . Par l'association, il
voudrait mettre les petits et moyens entrepreneurs en tat de profiter des dcouvertes modernes. Quant au commerce international, il soutient, une fois de plus,
que le libre-change ne saurait tre accept, s'il n'y a pas galit entre les pays
producteurs.
Ces rformes n'attaquent pas la proprit; elles la garantissent et celle, ci leur
sert de pivot. La proprit existe au milieu de ces crations de la socit, de
mme que l'homme au milieu des crations de la nature; elles ne lui font rien, s'il
ne lui plat pas d'en user; comme aussi, elle y puise de nouvelles forces, des
moyens d'action plus puissants, ds que toutes les proprits se mettent en exercice, chacune commence prouver l'effet de la concurrence 3 .
Ainsi les institutions prconises par Proudhon, en perfectionnant lchange et
la production, constituent une sauvegarde pour le particularisme. Cela paraissait
tre une vritable trahison aux anciens socialistes ; ils s'imaginaient volontiers
qu'ils avaient fait un effort norme d'intelligence pour arriver nier la proprit et
ils regardaient avec piti un philosophe qui, aprs avoir attaqu la proprit, rtrogradait jusqu' s'en constituer le dfenseur ! Cependant l'exprience nous montre
que la ngation de la proprit est la porte de cervelles bien peu solides ; et l'on
a grand tort de donner au socialisme moderne comme prcurseurs les innombrables hrtiques du Moyen ge qui prtendirent supprimer la proprit.
Dans ses premiers crits, Marx ne semble pas avoir song qu'il et autre chose
faire qu' rclamer l'appropriation collective des moyens de production ; plus
tard, il modifia sa formule et la compliqua, sans que l'on sache trs bien quels
mobiles il a obi. Engels nous donne ce sujet quelques renseignements dans la
prface crite en 1895 pour les articles de Marx, runis sans le titre : Lutte des
classes en France, 1848-1850 4 : C'est ici que, pour la premire fois, tait for1
2
Proudhon, Thorie de la proprit, pp. 179-184.
Dans une lettre du 17 mai 1846 Marx, Proudhon, songeant aux ides qu'il devait exposer
deux ans plus tard, disait qu'il se proposait un problme conomique dont la solution
engendrerait ce que vous autres socialistes allemands appelez communaut et ce que je me
bornerai, pour le moment, appeler libert, galit . (Correspondance, tome II, p. 260).
Proudhon, Thorie de la proprit, p. 190. - Proudhon cherche dmontrer, par un calcul
arithmtique, que les garanties ajoutant une mme grandeur aux forces individuelles, les
rapports entre celles-ci tendent devenir moins ingaux (p. 191). On pourrait soutenir aussi
que les forces individuelles sont augmentes proportionnellement et qu'ainsi, leurs diffrences
absolues augmentant, on s'loigne de l'galit. Tous les raisonnements de ce genre ne
prouvent pas grand'chose, l'conomie politique ancienne en a cependant beaucoup abus.
Cette prface clbre manque dans la traduction de l'opuscule de Marx, dite en 1900.
Engels s'y moque des gens sages d'Angleterre, qui ont cru qu'il serait bon de complter la
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
87
mule la phrase [appropriation des moyens de production] par laquelle le
socialisme moderne se distingue nettement, aussi bien de toutes les nuances du
socialisme fodal, bourgeois, petit bourgeois, etc., que de la vague communaut
de biens, du communisme utopique. Lorsque, plus tard, Marx tendit la formule
l'appropriation des moyens d'change, cette extension, qui, d'ailleurs, s'imposait
aprs le Manifeste des communistes, n'tait qu'un corollaire de la proposition
fondamentale.
On ne comprend pas, tout d'abord, pour quelle raison Marx aurait prouv le
besoin de formuler un corollaire d'une proposition principale et de l'noncer sur le
mme plan que cette proposition. Je crois qu'il a, an contraire, voulu considrer la
socialisation des moyens de production et celle de l'change comme deux
moments distincts dans la ralisation du socialisme. Il n'tablit entre eux aucun
lien de dpendance. Il serait absurde de supposer que l'change individuel
subsistt quand la production serait totalement socialise, alors qu'on ne produirait
plus de marchandises ; mais on peut supposer que, la production individuelle
existe encore partiellement, alors que la nation est acheteur universel ; c'est ainsi
que Kautsky admet que les paysans peuvent continuer cultiver leurs betteraves
pour les vendre aux sucreries et distilleries de l'tat. Ce n'est qu' la longue que la
pleine transformation socialiste pourrait s'oprer et que l'conomie deviendrait
vraiment homogne.
En gnral, Marx considre l'ordre historique comme tant oppos l'ordre
idologique. Dans une socit o tout est arrang d'une manire peu prs stable,
on peut dire que le mode de production constitue la base de toute la vie et considrer l'change comme une dpendance de la production ; mais quand on tudie
les changements, les choses se prsentent autrement et c'est la partie la plus basse
qui sera branle, sans doute, la dernire. Nous pouvons signaler quelques exemples de ces interversions dans le Capital.
L'appropriation dpend aussi de la production 1 mais, l'origine des temps
modernes, le capitalisme n'aurait pu se dvelopper s'il ne S'tait rencontr des
conditions historiques qui amenrent un complet bouleversement dans la vie des
paysans. La base de toute cette volution, dit Marx, est l'expropriation des
cultivateurs 2 . - La premire condition de la production capitaliste est que la
proprit du sol soit dj arrache des mains de la masse 3 . - La sparation
radicale du producteur d'avec les moyens de production se reproduit sur une
chelle progressive ds que le systme capitaliste s'est une fois tabli ; mais
comme celle-l forme la base de celui-ci, il ne saurait s'tablir sans elle 4 . Ainsi,
historiquement, c'est la consquence idologique qui est l'antcdent.
On peut faire des observations du mme genre propos des conditions dans
lesquelles se trouve l'change aux commencements du capitalisme ; l'abondance
2
3
4
formule de Marx en ajoutant qu'il fallait attribuer la socit les moyens de rpartition. Le
socialisme philanthropique et bourgeois pense toujours, au premier abord, la rpartition.
Par exemple : Die aus das kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende Aneignungsweise (Das Kapital I, 4e dition, p. 728). La traduction franaise (p. 342, col. 2) est loin de
donner un sens aussi nef que le texte allemand.
Marx, Capital, p. 315, col. 2.
Marx, loc. cit., p. 314, col. 1.
Marx. loc. cit., p. 315, col. 1.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
88
des mtaux prcieux transforma les relations conomiques rsultant des anciens
contrats et des rglements ; le systme des dettes publiques donna l'argent,
jusque-l improductif, une productivit normale; les grandes banques modernes
dvelopprent l'escompte; enfin, ce turent les hommes qui disposaient de grands
moyens d'change qui prirent la tte du mouvement. Ainsi, l'industrie se trou-va
dtermine par une rvolution dans l'change, - alors que le mode d'change peut
tre considr comme une consquence du mode de production dans une conomie toute faite 1.
Nous pouvons signaler dans l'histoire conomique du XIXe sicle des phnomnes au moins aussi remarquables que ceux dont Marx a donn la description
pour l'origine de l're capitaliste.
Le Second empire prsente un caractre qui peut sembler, tout d'abord, paradoxal : d'un ct, le capitalisme industriel a une hardiesse qu'on ne lui connaissait
pas antrieurement ; il se sent assez fort pour tre libre et il aspire la libre
initiative ; - d'autre part, le gouvernement a la prtention d'tre une providence
capable de rsoudre toutes les questions, ce qui semble peu compatible avec un
puissant individualisme industriel. Ce paradoxe est facile expliquer : le Second
empire s'est occup surtout de perfectionner les transports, d'encourager les
institutions de crdit et de donner son appui aux hommes qui avaient conu de
grands plans d'affaires ; il a agi comme une sorte d'exhausteur plutt que comme
un crateur. La troisime Rpublique n'a fait que continuer ses traditions.
On vit par ces pratiques, ai-je crit dans la prface d'un livre de Fernand
Pelloutier, qu'il faut dans la science sociale sparer la production et tout ce qui se
rapporte l'change; jadis on voulait briser l'ordre capitaliste et on n'avait rien
produit; maintenant on se bornait rformer la circulation, la rendre plus conomique pour les entrepreneurs et on obtenait des rsultats inattendus ; - au lieu de
changer l'organisme vivant, on se bornait amliorer l'appareil mcanique dont il
se sert ; - on passait de la transformation par le changement du principe fondamental au perfectionnement empirique de ce qui est tranger au principe, de la
socit 2 .
Ce n'est donc pas une diffrence de degr qu'il faut signaler entre la production et l'change ; il y a une opposition de natures, que se manifeste ds que l'on
aborde la question des rformes. L'exprimentation est beaucoup plus facile sur
l'change que sur la production ; elle peut se poursuivre par ttonnements, par
essais de faible porte et chaque rforme comporte les corrections que l'exprience suggre. L'tat est beaucoup plus apte agir dans le domaine de l'change, qui
est un milieu, une nature inorganique, un arrangement de possibilits offertes aux
activits individuelles, - que dans le domaine de la production.
Kautsky soutient que la socialisation d'une branche de la production est
impossible par vole progressive ; qu'elle exige une transmutation absolue ; qu'elle
1
En gnral, la forme de l'change correspond la forme de production. Changez la dernire,
la premire se trouve change en consquence. Aussi, voyons-nous dans l'histoire de la
socit le mode d'changer les produits se rgler sur le mode de les produire. (MARX,
Misre de la philosophie, 2e dition, pp. 105-106). Cela est vrai quand on considre les phnomnes achevs et qu'on compare ce qu'on peut appeler leurs noyaux; mais cela n'est plus
vrai quand on considre les devenirs et les moyens de passage.
Cf. Fernand Pelloutier, Histoire des Bourses du travail, p. 12.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
89
ressemble la naissance conservant les organes, mais changeant toutes les
fonctions 1. Il affirme la mme chose que moi ; en appelant la production un
organisme vivant, j'ai mis en vidence le rle dcisif du principe intrieur, qui ne
peut tre chang par des additions successives de petits lments venant du
dehors. Dans l'change, au contraire, l'addition est possible, parce qu'il s'agit d'un
appareil mcanique. Dans la production, les parties n'existent que par le tout ;
dans l'change, le tout est une addition mathmatique des parties sparables.
Les phnomnes rcents des cartels et des trusts ont conduit Paul de Rousiers
, mettre en lumire la grande diffrence qui existe entre l'change et la production ; il s'attache longuement montrer que les comptoirs de vente manifestent le
besoin d'une concentration commerciale qui peut exister sans concentration
industrielle ; il oppose mme les deux faits avec une grande force ; mais il ne
semble pas que cette partie de son livre sur les syndicats industriels ait t bien
comprise.
L'exemple du comptoir de Longwy permet de mettre cette distinction en
bonne lumire. Il a t cr pour faciliter l'coulement des fontes de Lorraine, qui,
durant longtemps, furent peu apprcies cause de leur composition phosphoreuse. Ce comptoir arriva grouper onze Socits d'importance souvent assez
mdiocre, possdant vingt-huit hauts-fourneaux, dont le plus grand produisait 180
tonnes par jour. On ne voit point ici de ces grandes ambitions amricaines, des
constructions gigantesques, des capitaines d'industrie cherchant tout runir sous
leur commandement ; les associs veulent vivre sans se gner 2.
Du moment, dit Paul de Rousiers, que la [concentration commerciale] tait
possible, cause de l'uniformit du produit, avantageuse cause de l'conomie [
raliser sur les transports et les frais gnraux de la vente], ncessaire cause de
la mauvaise, rputation des fontes et du grand effort qu'il fallait faire pour les faire
accepter ; du moment que le dilemme se posait entre la concentration commerciale avec chances de grand succs et l'isolement avec la mdiocrit d'autre part, il
y avait gros parier que cette concentration s'oprerait, qu'il se trouverait quelquun pour la raliser. Mais elle aurait pu se raliser par un rachat en masse qui
aurait ajout la concentration industrielle la concentration commerciale... Le
comptoir de Longwy a constitu une sauvegarde pour les industries mtallurgiques, d'abord modestes, qui ont grandi grce lui et dont quelques-unes restent
encore d'importance secondaire... Il a mis leur porte les avantages de la
concentration commerciale et leur a permis d'aborder la lutte contre des concurrents de plus grande taille. Il ne faut pas reprocher an comptoir d'avoir diminu
l'initiative de ses adhrents ; il l'a arme au contraire ; il l'a empche de succomber sous la concentration industrielle 3 .
On croirait lire une illustration dune page de Proudhon.
1
2
3
Kautsky, La rvolution sociale, pp. 27-29.
Paul De Rousiers, Les syndicats industriels de producteurs en France et l'tranger, p. 245.
Paul De Rousiers, Op. cit., pp. 247-249. Cf. p. 270 et p. 284.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
90
Dans les cartels allemands, Paul de Rousiers a relev beaucoup de traits qui
les rapprochent plutt d'institutions destines amliorer l'change que de
transformations de la production; et c'est un des caractres qui les distinguent des
trusts amricains. En Amrique, les ententes industrielles sont presque toujours
domines par un homme puissant qui s'en fait un marchepied. Carnegie avait
tabli des pools successifs pour les rails d'acier avant... de se faire acheter par le
grand trust de l'acier... En Allemagne, les cartels sont sincres, ils ne servent pas
un but cach; ils satisfont pleinement les dsirs modrs de leurs fondateurs 1 ;
ils ne sont point un pur accident dans l'histoire de la concentration industrielle
actuelle, une combinaison phmre imagine par un capitaine d'industrie pour
prparer un trust 2. Et plus loin, Paul de Rousiers observe que si la concentration
industrielle est aujourd'hui forte, la concentration commerciale a atteint un degr
encore plus lev 3.
On peut regretter que l'habile observateur se soit servi d'expressions qui conduisent l'esprit tablir trop d'analogies entre les deux phnomnes qu'il dcrit et
qu'il entend sparer. J'ai pu m'assurer que beaucoup de ses lecteurs n'avaient pas
compris et avaient trouv ses distinctions trop subtiles.
Depuis que l'agriculture occupe une si grande place dans les proccupations
des hommes politiques et qu'il n'est plus possible de la traiter comme un art
arrir, les problmes de socialisation de l'change se posent avec une force nouvelle. Les agrariens demandent que l'tat leur fournisse des transports prix de
revient, du crdit bon march. Ils dnoncent la tyrannie des magnats des Bourses de commerce ; ils s'efforcent de crer des organisations permettant d'atteindre
directement le consommateur sans passer par l'intermdiaire du ngociant. Il se
trouve donc que si les socialistes poursuivaient la socialisation de l'change, sans
inquiter les producteurs, ils trouveraient dans les assembles dlibrantes quantit de gens disposs les aider. Les rformes des transports et du crdit peuvent
se raliser sans rvolution.
Beaucoup de socialistes semblent revenir aujourd'hui vers des conceptions
proudhoniennes ; je suis persuad que ce retour n'a rien de raisonn ; qu'il rsulte
seulement de l'influence de causes gnrales, de proccupations politiques et de ce
grossier empirisme qui pousse tant d'hommes d'tat trouver que les meilleures
rformes sont celles qui se font le plus facilement. Plus ce retour est inconscient,
plus il est intressant pour nous, car il est de nature montrer que la doctrine de
Proudhon a dans la pense populaire des racines plus profondes qu'on ne le croit
d'ordinaire.
Paul Brousse, qui, depuis vingt ans, prconise la transformation de toutes les
industries en rgies administratives (qu'il nomme services publics) et prtend qu'il
n'y a pas d'autre moyen de raliser le communisme, crivait dernirement : Les
services publics que le dveloppement conomique arrache maintenant au gouvernement capitaliste, ne sont pas ceux dont l'tablissement serait le plus urgent pour
l'ouvrier; ce sont les postes, les tlgraphes, les banques, les chemins de fer, le
1
2
3
Paul De Bousiers, op. cit., pp. 156-157.
Paul De Bousiers, op. cit., p. 160.
Paul De Bousiers, op. cit., p. 276.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
91
gaz . Ces services sont ceux qui se rapportent la circulation 1 et au crdit;
l'auteur ne s'apercevait pas de ce caractre spcial et il ajoutait : Patience! que le
parti socialiste fasse la conqute des pouvoirs publics, l'volution continuera; mais
on essaiera de ne point mettre, comme aujourd'hui, la charrue devant les bufs.
(Petite Rpublique, 22 dcembre 1902.) Ainsi Paul Brousse ne comprend rien ce
qu'il voit ; il ne se doute pas que c'est en vertu de lois conomiques que la socialisation pntre si facilement dans l'change ; pour lui, il n'y a l qu'un accident, d sans doute, la perversion capitaliste - que le parti socialiste corrigera, an nom
de la Science, quand il aura la force.
Dans une circulaire adresse aux lecteurs snatoriaux du Gard, Eugne
Fournire disait : Sauf pour les grands services publics de la circulation et du
crdit. c'est surtout des mouvements spontans du monde du travail, de l'association volontaire, de l'initiative individuelle, que [le socialisme] attend ses
solutions capitales. (Petite Rpublique, 30 dcembre 1902).
Il ne serait pas impossible que Fournire (qui tudie en ce moment l'histoire
du socialisme sous la monarchie de juillet) ait eu une rminiscence proudhonienne ; mais il me semble bien plus vraisemblable de penser que sa proclamation a
t commande par la ncessit de parler des vignerons le langage qui leur
convenait. Des cooprateurs ont profit de la circonstance pour fliciter Fournire
d'tre venu eux et d'avoir abandonn ses anciennes prventions contre les coopratives (Association ccoprative, 10 janvier 1903) ; ces bonnes gens n'avaient Nu
dans le programme que les mots associations volontaires et avaient compltement
nglig ce qui est essentiel, ce qui est proudhonien : la distinction faite entre le
milieu o s'opre la production et la production elle-mme.
Je rattache le gaz la circulation parce que la production du gaz n'est vraiment que
l'accessoire de la distribution ; c'est cause des conditions particulires dans lesquelles se fait
celle-ci - en empruntant les voies publiques - que les villes dirigent, directement ou
indirectement, l'industrie gazire.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
92
Introduction lconomie moderne :
Deuxime partie : socialisation dans le milieu conomique
Chapitre II
Thorie proudhonienne de la proprit et influence des gots paysans de Proudhon. Thorie de la possession. - Son idal de la proprit, issu en partie d'ides romaines, et son
analogie avec celui de Le Play. - Le fdralisme et son interprtation. - La proprit n'a pas
ralis le mouvement prvu par Proudhon.
Retour la table des matires
Je consacrerai aux questions qui touchent l'change, toute la troisime partie
de ce livre ; mais ce n'est pas seulement en matire d'change que la transformation du milieu conomique est une condition excellente pour le progrs ; nous
allons examiner ici quels sont les autres cas o la production gagne tre
dbarrasse des entraves que lui apportent des matres qui cherchent commander
le milieu; c'est cette dissolution des volonts particulires, que l'on peut nommer
la socialisation du milieu conomique. Pour bien faire comprendre l'opposition
fondamentale qui existe entre le milieu et la production, je dirai tout d'abord
quelques mots de la thorie proudhonienne de la proprit.
Quand on tudie une thorie de la proprit, il faut toujours se demander quelles taient les tendances esthtiques de l'auteur ; dans ces discussions chacun de
nous apporte, en effet, quelque chose de la partie la plus profonde de son me. Un
homme de la ville, financier ou politicien, savant ou littrateur, ne comprend pas
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
93
la proprit comme un homme de la campagne ; - dans le premier cas la proprit
est surtout reprsente par la maison, c'est--dire par un immeuble qui ressemble
presque un titre de rente ; dans le second, elle voque l'ide de la culture; nous
passons ainsi de la jouissance an travail.
Proudhon n'a jamais t un vrai citadin ; il tait un paysan et son me se
reportait toujours loin de Paris. Dans les crits de son ge mr, il aimait revenir
a ses souvenirs d'enfance et, suivant l'usage gnral, il transportait dans sa
jeunesse les rflexions qu'il avait faites durant toute sa vie. Nous ne pouvons en
effet, chapper une loi de mirage qui nous trompe constamment sur l'origine de
nos ides : quand des sentiments sont trs fortement ancrs dans notre me, nous
nous imaginons qu'ils ont toujours exist, avec cette force et souvent mme nous
croyons qu'ils proviennent de causes hrditaires. C'est dans les souvenirs
d'enfance que les hommes suprieurs trahissent le secret de leur m0e ; ils ne
pourraient analyser leur tat actuel ; mais ils le dcrivent admirablement ds qu'ils
peuvent se ddoubler en crant un pass fictif avec tout ce qui domine leur cur.
Il est assez singulier que dans son livre si tudi sur Proudhon, Arthur Desjardins
n'ait pas vu 1 que les prtendus souvenirs d'enfance sont les penses intimes de
Proudhon, instruit par une longue exprience de la vie et prouvant le besoin de
mettre mi le fond mme de son tre, sous l'influence de fortes motions
actuelles.
Aucun pote bucolique n'a parl de la nature avec plus d'enthousiasme.
Jusqu' douze ans, ma vie, crivait-il vers 1856, s'est passe presque toute aux
champs, occupe tantt de petits travaux rustiques, tantt a garder les vaches...
la ville, je me sentais dpays. L'ouvrier n'a rien du campagnard ; patois part,
il ne parle pas la mme langue, il n'adore pas les mmes dieux... Quel exil pour
moi quand il me fallut suivre les classes du collge, o je ne vivais plus que par le
cerveau, o, entre autres simplicits, on prtendait m'initier la nature que je
quittais, par des narrations et des thmes 2 !
Il ne faut donc pas s'tonner si, au fur et mesure qu'il vieillissait, une ide
plus prcise de la proprit paysanne se formait dans son esprit. Longtemps, il
accusa la lgislation moderne d'avoir ruin la terre ; user des revenus sans aucune
responsabilit lui paraissait tre une monstruosit. Rome avait pri de ce droit
quiritaire de la proprit poursuivi jusque dans ces dernires consquences et
indpendamment de toute possession effective ; aujourd'hui ce mme droit produit la dsertion de la terre et la dsolation sociale. La mtaphysique de la
proprit a dvast le sol franais, dcouronn les montagnes, tari les sources,
chang les rivires en torrents, empierr les valles : le tout avec autorisation du
gouvernement. Elle a rendu l'agriculture odieuse aux paysans, plus odieuse encore
la patrie ; elle pousse la dpopulation... L'homme n'aime plus la terre ; propritaire, il la vend, il la loue, il la divise par actions, il la prostitue, il en trafique,
il en fait l'objet de spculations; cultivateur, il la tourmente, il l'puise, il la
sacrifie son impatiente cupidit; il ne s'y unit jamais 3 .
1
2
Arthur Desjardins, P.J. Proudhon, tome I, pp. 7-11.
Proudhon, De la Justice. etc., tome II, p. 208.
Dans toute la fin de ce chapitre, on sent un souffle virgilien. On sait quelle admiration
Proudhon avait pour Virgile (op. cit., tome III, pp. 354-377).
Proudhon, op. cit., tome II, pp. 202-204.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
94
Je crois que l'on pourrait nommer proprit abstraite ce systme qui se traduit
par une si profonde sparation de l'homme et de la terre ; ce terme correspondrait
bien l'expression de mtaphysique de la proprit que nous avons trouve
chez Proudhon. Pendant longtemps, celui-ci avait cru devoir proposer une
solution qui aurait t comme la contradiction de ce rgime ; il empruntait la
langue latine le mot possession pour indiquer que l'homme ne devrait avoir que la
jouissance de la terre, qu'il devrait en user en bon pre de famille, sans pouvoir la
vendre, ni la partager. L'hrdit s'en suit, non point comme une prrogative,
mais plutt comme une obligation de plus impose au possesseur. On comprend
que le partage du sol tant fait surtout en vue des familles, ce n'est pas parce que
le droit du dtenteur est absolu qu'il transmet la possession ; c'est au contraire
parce que ce droit est restreint que la possession est hrditaire 1 .
La possession a exist beaucoup plus que la proprit ; taient possesseurs, le
censitaire fodal et l'emphytote. Le trs petit nombre est arriv la proprit.
Puis quand la classe propritaire s'est multiplie, tout aussitt la proprit, accable d'impts et de servitudes.... c'est trouve en dessous de l'ancienne possession... Nous voyons une foule de propritaires, grands et petits, fatigus et dus,
faire argent de leur patrimoine et se rfugier, qui dans le trafic, qui dans les
emplois publics, qui dans le salariat . Il lui semble qu'en 1789 on aurait pu se
borner mieux rgler la possession. Le sens commun n'indiquait rien de plus ;
les masses n'eussent pas demand davantage. Il n'en a rien t cependant ; la
dclaration des droits de 1789, en mme temps qu'elle a aboli le vieux rgime
fodal, a affirm la proprit ; et la vente des biens nationaux a t faite en
excution 2.
Rflchissant au rle historique de la proprit et la place qu'elle occupe
dans la philosophie du droit, Proudhon arriva penser que la possession ne
suffisait point. ct de la proprit abstraite et ct des formes si varies de la
possession, on peut concevoir un autre type : c'est celui qui, d'aprs les jurisconsultes romains, aurait exist dans l'ancienne Rome et c'est celui que Le Play
rvait de voir renatre dans la France contemporaine.
Dans le domaine agglomr, sur lequel vit une famille-souche de propritaires-cultivateurs, la proprit se resserre, en quelque sorte, sur elle-mme,
pour acqurir toute sa vertu et se serrer autour de la famille. Cette famille n'est en
contact avec le dehors que pour remplir un double devoir civique : participer aux
dpenses publiques et fournir au pays mie jeunesse saine et nombreuse; ce sont l
les deux seules formes d'migration de ses forces; tout le reste revient la terre :
le principe est bien ici l'intrieur. Je crois que l'on pourrait donner le nom de
proprit concrte ce systme, qui a tout l'aspect d'un organisme vivant domin
par le principe intrieur.
Proudhon, Thorie de la proprit, pp. 88-89. - En 1846, Proudhon disait contre Louis Blanc :
L'hrdit est l'espoir du mnage, le contrefort de la famille, la raison dernire de la
proprit. Sans l'hrdit, la proprit n'est qu'un mot, le rle de la femme devient une
nigme. (Contradiction conomiques, chap. XI, 2).
Proudhon. Thorie de la proprit, pp. 91-92.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
95
Proudhon observait que le rgime de la possession n'avait pas produit les
rsultats que les thoriciens auraient pu attendre de lui ; au Moyen Age, il avait
engendr tyrannie et misre. Il pensait que le progrs des murs permettrait de
raliser la proprit concrte, malgr les excessives difficults que cela prsente ;
c'est que la proprit moderne, constitue en apparence contre toute raison de
droit et tout bon sens, peut tre considre comme le triomphe de la Libert. C'est
la Libert qui l'a faite, non pas, comme il semble au premier abord, contre le droit,
mais par une intelligence suprieure du droit 1. - Ici, nous voyons reparatre
l'idaliste, qui croit qu'une institution doit se produire parce que l'esprit la juge
plus parfaite que celles qui existent. De mme, Le Play croyait qu'il aurait suffi de
donner aux pres de famille la libert testamentaire pour que le rgime ancien des
familles-souches se reconstitut de lui-mme !
C'est bien un idal dont il parle : La proprit n'a pas encore exist dans les
conditions o se place la thorie; aucune nation n'a t la hauteur de cette
institution 2 ; - la plbe romaine se montra incapable de comprendre les devoirs
attachs la proprit foncire 3 ; - on peut se demander si, en 1789, les Franais
taient mrs pour la libert et la proprit 4 ; - la Rvolution a cr une nouvelle
classe de propritaires; elle a cru les intresser a la libert : elle les a intresss
ce que les migrs et les Bourbons ne revinssent pas, voil tout; les propritaires
nouveaux, acqureurs de biens nationaux, ont manqu de caractre et d'esprit
public, disant Napolon 1er : Rgne et gouverne, pourvu que nous
jouissions. 5
La proprit est, toujours allie la libert politique aux yeux de Proudhon;
c'est pourquoi il ne peut admettre qu'elle n'arrivera pas se raliser, - ne voulant
pas dsesprer de la libert. Et puis, sans qu'il l'avoue toujours dune manire
expresse, la proprit concrte doit se produire dans l'avenir parce qu'elle est
l'idal romain, que Rome est la mre du droit et que Proudhon soumet, de plus en
plus, toutes ses esprances historiques ce postulat : le monde doit raliser un tat
social juridique. Il ne faut donc pas s'tonner s'il parle de l'conomie romaine avec
l'enthousiasme qu'elle excitait chez les anciens philosophes du droit, qui prenaient
cette vie (toute mythique, semble-t-il) pour la premire de toutes les ralits. La
maison est ses yeux, comme aux leurs, un vritable tat domestique, gouvern
par un chef digne de commander; la proprit n'est possible que si cette dignit et
cette capacit existent en toute vrit. Proudhon s'imagine le pouvoir absolu du
pater familias peu prs comme le fait Iehring. Rome, o le divorce tait la
prrogative du mari, il s'coula plus de cinq sicles sans qu'il y en et un seul
exemple; je n'ai lu nulle part que, pendant le mme laps de temps, les pres se
soient donn le plaisir de dshriter leurs enfants ou de dvorer en dbauche leur
hritage 6.
Il faut un contrepoids l'tat, mme quand il est constitu de la manire la
plus rationnelle, la plus librale, anim des intentions les plus justes... Louis XIV
niait la proprit absolue; il n'admettait de souverainet que dans l'tat reprsent
1
2
3
4
5
6
Proudhon, op. cit., pp. 143-144.
Proudhon, op. cit., p. 231.
Proudhon. op. cit., p. 120.
Proudhon. op. cit.. p. 175.
Proudhon, op. cit ., pp. 234-235.
Proudhon, Op. cit., p. 112. - Cf. Iehring, Esprit du droit romain, liv. II, chap. 3.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
96
par le roi... Pour que le citoyen soit quelque chose dans l'tat, il ne suffit pas qu'il
soit libre de sa personne ; il faut que sa personnalit s'appuie, comme celle de
l'tat, sur une portion de matire qu'il possde en toute souverainet 1. Cette
condition est remplie par la proprit... tez la proprit le caractre absolutiste
qui la distingue, l'instant elle perd sa force, elle ne pse plus rien; c'est une
mouvance du gouvernement, sans action contre lui 2 .
Dans le rsum de son livre, Proudhon dit encore : La justification de la
proprit, que nous avons vainement demande ses origines, nous la trouvons
dans ses fins : elle est essentiellement politique... C'est pour rompre le faisceau de
la souverainet collective, si exorbitant, si redoutable, que l'on a rig contre lui le
domaine de la proprit, vritable insigne de la souverainet du citoyen... La
proprit allodiale est un dmembrement de la souverainet ; ce titre, elle est
particulirement odieuse au pouvoir et la dmocratie. Elle ne plat point aux
dmocrates, enfivrs d'unit, de centralisation, d'absolutisme. Et il ajoute avec
tristesse : Le peuple est gai quand il voit faire la guerre aux propritaires 3.
Le droit de proprit se rattache ainsi troitement au principe fdratif. Le
citoyen, dit Proudhon, par le pacte fdratif qui lui confre la proprit, runit
deux attributions contradictoires : il doit suivre d'un ct, la loi de son intrt et il
doit veiller, comme membre du corps social, ce que sa proprit ne fasse pas
dtriment la chose publique. En un mot, il est constitu agent de police et voyer
sur lui-mme. Cette double qualit est essentielle la constitution de la libert :
sans elle, tout l'difice social s'croule ; il faut revenir au principe policier et
autoritaire 4.
Il n'est pas vraisemblable que les ides fdralistes de Proudhon se ralisent
de notre temps; ces ides ne semblent, avoir eu de popularit que dans les petites
valles manufacturires 5 ; les ouvriers des grandes villes ne les comprennent pas
facilement. Mais autre chose est la ralisation d'un plan fdratif et autre chose est
le systme des conceptions juridiques auquel il correspondrait parfaitement ; le
gouvernement fdratif peut n'tre qu'un mythe, servant donner un corps
certains principes trs essentiels. Je crois que l'on pourrait ramener la thorie
proudhonienne du fdralisme aux termes suivants :
1
2
3
4
5
Tout gouvernement, toute utopie, toute glise se mfient de la proprit. (Proudhon, Op.
cit., p. 135). - On rduit peu peu la proprit n'tre plus qu'un privilge d'oisif; arrive
l, la proprit est dompte; le propritaire, de guerrier ou baron, s'est fait pquin, il tremble.
Il n'est plus rien. p. 136).
Proudhon, op. cit., pp. 137-138.
Proudhon, op. cit., pp. 225-226. - Cette dernire remarque a une trs grande importance ; pour
ceux qui pensent qu'au fond de l'me humaine sont dposs les principes de toute justice, un
sentiment si instinctif condamne la proprit sans appel ; pour ceux qui se dfient des instincts
et qui croient que la raison domine pniblement et lentement les tendances naturelles, la
proprit est une prcieuse acquisition de la civilisation, qui ne doit tre sacrifie que devant
quelques principes plus levs dans l'ordre de production scientifique.
Proudhon, op. cit., pp. 235-236.
C'est ainsi qu'en France le fdralisme n'a gure d'adhrents socialistes que dans les
montagnes du Jura ; on explique quelquefois ce fait d'une manire idologique par l'influence
que, Bakounine aurait exerce en Suisse il y a trente ans ; mais encore faudrait-il savoir
pourquoi Bakounine a eu cette influence dans les valles du Jura bernois.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
97
1 Responsabilit des administrateurs, placs tout prs de ceux qui ont intrt
contrler leur manire de procder, et trs faible sparation du groupe accidentellement au pouvoir d'avec la masse gouverne 1 ;
2 Possibilit d'exprimenter facilement des solutions pour les problmes,
moraux ou conomiques, soit que cette exprimentation soit poursuivie individuellement, soit qu'elle le soit collectivement ;
3 Ncessit de rgler tous les rapports sociaux par le droit et d'carter, aussi
compltement que possible, l'arbitraire administratif et la domination des partis.
L'hypothse d'un rgime fdraliste parfait constitue un moyen commode pour
se reprsenter mythiquement la ralisation de ce programme de droit public ; mais
celui-ci est indpendant de la reprsentation et il peut atteindre la pratique de
plusieurs manires fort dissemblables. La ralit du fdralisme n'est pas absolument ncessaire pour la ralisation des tendances fdralistes. Cette diffrence
entre un systme idal et tout fait, qui est le modle de ['Ide politique, et le
devenir historique se retrouve, chaque pas, dans les tudes sociales. Bien que la
proprit concrte n'ait jamais exist compltement, elle a jou un rle prpondrant dans l'histoire des institutions, et Proudhon n'est pas loin de la regarder
comme le dieu cach qui gouverne le dveloppement des tats ; elle rgit
positivement l'histoire, crit-il dans sa langue idaliste, quoique absente, et elle
prcipite les nations la reconnatre, les punissant de la trahir. 2
l'heure actuelle, il ne semble pas que la proprit se proccupe du tout du
rle politique que Proudhon lui attribuait ; elle se soucie fort peu de cet avenir
juridique en vue duquel le grand socialiste franais crivait ses thories. Le protectionnisme exerce, ce point de vue, un rle nfaste : le propritaire ne demande aux gouvernements qu'une aide pour accrotre ses revenus ; il raisonne comme
le spculateur et n'a plus de vues d'avenir; les ides de droit et de libert ne sont
pas en honneur en ce moment dans l'Europe; on se montre dispos accepter tout
gouvernement qui donne satisfaction aux besoins du jour et du lendemain. Il
faudrait savoir s'il n'y a pas une relation d'effet cause entre l'affaiblissement du
gnie propritaire et la soumission de plus en plus servile l'arbitraire des
pouvoirs corrompus 3.
Nous avons ici la preuve exprimentale que le monde marche rarement dans le
sens que lui assignent les idalistes et que les plus beaux discours sur la libert et
le droit n'ont pas d'efficacit srieuse sur l'histoire. On pourrait mme se demander s'il ne sont pas d'autant plus nombreux et plus loquents que leur action est
devenue plus nulle. Ce sont des oraisons funbres par lesquelles on clbre la
mort de vertus passes, et non des moyens d'engendrer ces vertus dans l'avenir.
L'histoire de l'cole de Le Play illustre bien cette doctrine relative l'interprtation de l'idalisme. Aprs 1871, les Unions de paix sociale, fondes par ses
1
2
3
Il me soluble que C'est ce rgime que Lnine dsire atteindre dans la Rpublique des soviets.
Proudhon, op. cit., p. 231.
Ces observations de 1903 sont bien plus vraies aujourd'hui qu' cette poque.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
98
amis, s'occuprent avec zle de vulgariser ses recettes ; mais quelques-tins de ses
disciples finirent par s'apercevoir que le monde ne suivait pas du tout la voie qu'il
avait trace. Aux heures de confidence, crit Paul Bureau, Le Play lui-mme,
qui ne cessait de recommander l'exemple de l'Angleterre, ne disait-il pas que ce
pays modle commenait aussi s'engager dans une voie dangereuse et qu'il
fallait se hter de le citer pendant qu'il en tait temps encore ? tait-il donc vrai
que toute l'humanit progressive marcht vers l'abme et que les socits d'avant
garde eussent pour premier devoir d'imiter la plupart des pratiques des peuples
qu'elles avaient distancs ? 1
Le Play avait surtout fait l'oraison funbre du pass, en croyant prparer
l'avenir.
L'esprit actuel de la proprit n'tant pas celui de la concentration des efforts
vers un but intrieur, la diffrence entre la production et le milieu n'apparat plus
avec la mme clart qu'elle apparaissait Proudhon. Raison de plus pour
examiner de plus prs ces diffrences et montrer comment, avec une production
particulariste, il y a intrt dbarrasser le milieu de la domination des matres
particuliers.
Paul Bureau, L'uvre d'Henri de Tourville, p. 15.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
99
Introduction lconomie moderne :
Deuxime partie : socialisation dans le milieu conomique
Chapitre III
La coopration comme auxiliaire du capitalisme. - Coopratives d'achat et de vente. Analogie de la cooprative et de l'conomat. - Alimentation administrative. - Rapprochements
tablis entre les coopratives et les institutions dmocratiques. - Doutes sur la manire dont
fonctionnent ces socits. - Ancien systme de la boulangerie parisienne; assurances contre la
hausse des denres propose par Charles Guieyesse.
Retour la table des matires
Le capitalisme cherche rduire toujours davantage les prix de revient et
l'tat moderne fait les plus grands efforts pour abaisser les frais de transport;
cependant le consommateur ne se trouve pas toujours en position de profiter de
ces avantages et le producteur ne peut dvelopper son industrie dans la mesure
que sembleraient devoir comporter les progrs qu'il a effectus clans la voie du
bon march. Les consommateurs se plaignent d'tre vols par les intermdiaires;
les producteurs font entendre exactement les mmes plaintes; il y a entre eux une
masse qui ne participe en rien aux travaux des inventeurs et qui semble opposer
une rsistance d'autant plus acharne au bon march que les producteurs sont
amens se montrer moins exigeants; cette masse de gens de commerce s'efforce
d'absorber tout le profit venant du progrs, de telle sorte que les producteurs ne
puissent plus retrouver dans le dveloppement des affaires une compensation la
rduction des prix.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
100
Les agriculteurs surtout se plaignent beaucoup des marchands ; la viande
semble donner lieu un nombre absurde de prlvements ; tandis que le paysan
vend en France le pore trs mal, les charcutiers se sont multiplis au fur et
mesure que les bnfices devenaient plus grands, et le consommateur ne profite
pas du bas prix auquel sont vendus les animaux vivants. Dans quelques parties du
commerce de dtail, les grands fabricants sont parvenus rduire presque rien la
part de l'picier; c'est le cas pour le sucre et le ptrole; il y aurait grand avantage
ce qu'un pareil rgime pt se gnraliser, de manire faire disparatre les
particularits qui gnent la circulation. Dans ce but, on a cr les socits dites
coopratives de consommation, qui sont d'excellents auxiliaires du capitalisme,
puisqu'elles permettent celui-ci d'atteindre directement la clientle et de pouvoir
profiter de tout l'accroissement de consommation qui correspond normalement
une rduction de prix.
Les coopratives de consommation jouent un rle fort analogue celui qui est
dvolu ces coopratives paysannes, qui recueillent le lait de leurs adhrents pour
le transformer en beurre ou en fromage et l'expdier dans les grandes villes. Que
la farine soit achete la halle, transforme en pain et distribue, sous cette forme, aux adhrents, ou bien que les produits alimentaires de ceux-ci soient
groups, manipuls et envoys la clientle, c'est exactement la mme chose qui
se passe dans les deux cas : on supprime des rouages inutiles de transmission qui
existaient dans le milieu, pour rendre la circulation plus conomique 1. Il est
d'ailleurs remarquable que les deux espces de socits fonctionnent galement
bien, encore que les laiteries demandent probablement un peu plus de probit dans
leur gestion que les boulangeries coopratives.
On a voulu tablir une grande diffrence entre les coopratives, suivant
qu'elles achtent pour rpartir, ou qu'elles groupent pour vendre ; cette distinction
ayant t faite en Allemagne, a t dclare fondamentale et profonde par nombre
de cooprateurs franais; elle me parat superficielle et niaise.
L'exprience a montr que l'achat n'est pas sans donner lieu autant d'abus
que peut en donner la vente ; des personnes bien informes pensent que les cooprateurs seraient bien inspirs en cessant d'acheter eux-mmes, pour confier les
relations avec les producteurs des professionnels avant des aptitudes spciales
et convenablement pavs. 2
Les vritables diffrences doivent tre tablies de la manire suivante :
1 Les coopratives d'achat ou de consommation peuvent prosprer alors
mme que l'administration en est vicieuse, parce que leurs adhrents consentent
souvent recevoir des marchandises de mauvaise qualit ; c'est ce qui se passe au
Vooruit pour certaines parties du commerce coopratif ; le grant assure que le
principe sauve la mauvaise qualit des produits 3 ;
1
2
3
Pourquoi ne pas donner ces institutions le nom de cooprative de circulation ?
Mouvement socialiste, 15 janvier 1903, p. 108.
Les piceries du Vooruit taient mal tenues lors de l'enqute que fit, en 1897, Victor Muller
(Muse social, dcembre 1897, p. 452, col. 1). Le magasin d'habillement tait encore moins
satisfaisant ; mais il y a le principe , disait Anseele son visiteur (p. 458, col. 1). Dans une
confrence donne le 2 Juin 1903, Paris, Anseele revient sur cette ide et dit qu'il est plus
facile de contenter des cooprateurs que des clients ordinaires qui ont tant d'occasions
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
101
2 Les coopratives de consommation sont les auxiliaires directs du capitalisme, puisqu'elles lui permettent d'atteindre plus directement la clientle, de
raliser le meilleur march et d'exciter ainsi la consommation ; - les laiteries
coopratives profitent plutt du capitalisme qu'elles ne l'aident; elles russissent,
en effet, parce que le capitalisme leur a prpar une clientle dans les agglomrations urbaines, leur a procur des voles rapides de transport et a mis leur
disposition des moyens commodes de paiement distance ;
3 La socit de consommation est surtout urbaine, l'autre est surtout rurale; il
y a peu de cas o l'on ait l'occasion de grouper des produits d'artisans pour les
expdier leur clientle disperse; la premire a pour but immdiat d'amliorer le
sort des familles, la seconde de tirer meilleur parti des forces productives ; on peut
dire que l'une se rapporte aux personnes et l'autre aux choses ; - cette dernire
distinction se retrouve, d'ailleurs, dans presque toutes les affaires dont les types
parfaits se distinguent en types de la ville et en types de la campagne.
Dans le plus grand nombre des cas la notion d'association est presque totalement absente des coopratives de consommation ; les adhrents d'un grand
magasin coopratif sont simplement des clients que l'on retient au moyen d'un
nombre plus ou moins grand de ruses ; l'appel au principe, dont les Belges font un
si grand talage, doit tre donc considr - quand on s'occupe des rsultats comme un systme de rclame ingnieux et puissant.
Beaucoup de marchands ont imagin de donner leurs clients des bons leur
permettant de rentrer en partie dans leur argent au bout de longs dlais et au
moyen de loteries ; quelques autres leur dlivrent des timbres permettant d'acheter
de mentis objets dans des magasins spciaux ; on pourrait multiplier ces exemples
et montrer que le commerce pratique la ristourne cooprative dans beaucoup de
cas. Gand, le Vooruit est concurrenc par la Volksbelang, qui est une entreprise
purement capitaliste, qui reproduit exactement ses procds et qui a plus de
clientle que lui 1. la fin d'une anne ou d'un trimestre les femmes sont heureuses de pouvoir toucher une somme qu'elles n'auraient su conomiser journellement.
La femme es[ le grand moteur de la coopration ; c'est, d'ailleurs, elle qui subit les
inconvnients de la coopration, - tant oblige d'abandonner le magasin voisin,
pour faire de longues courses.
Les adhrents d'une grande cooprative peuvent tre compars encore aux
propritaires qui assurent leurs immeubles une Mutuelle-incendie. Ils se font les
acheteurs fidles d'un grand magasin et celui-ci ayant peu de frais gnraux, par
suite de son gros dbit, peut vendre bon march. C'est cause de cela que Charles
Guieyesse estime que les coopratives devraient se transformer, cesser de se
donner pour des associations d'actionnaires, pour devenir une sorte de services
d'acheter ailleurs (Mouvement socialiste, 15 aot 1903, p. 580). - Aux yeux du parfait thoricien de la coopration le pch irrmissible contre le Saint-Esprit est d'exiger qu'on vous en
donne pour votre argent; pareille prtention mercantile est contraire la solidarit ; si jamais
(es amis du professeur Charles Gide arrivaient au pouvoir, ce pch serait, srement,
considr comme un crime contre l'Union morale.
Muse social, loc. cit., p. 448, col. 2.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
102
publics constitus hors de l'tat et des municipalits ; il voudrait que l'administration pt tre remise des fonctionnaires soumis un contrle exerc par les
intresss ; il croit que ce contrle pourrait tre plus efficace que celui qui existe
aujourd'hui. Il nous apprend, d'ailleurs, qu'en Belgique les questions administratives sont rsolues dans des assembles gnrales o figurent presque seuls les
employs 1.
Un auteur belge, d'ailleurs fort sympathique au Vooruit, conclut ainsi une
tude sur la fdration ouvrire gantoise : Le parti ouvrier a t dirig par
quelques hommes. Son organisation n'est pas du tout celle d'une dmocratie. On
est en prsence d'une arme dont les chefs sont peu nombreux. Qu'arrivera-t-il
quand ceux qui ont la responsabilit du pouvoir disparatront, quand le gouvernement deviendra rpublicain ? Assurment des transformations importantes
devront s'accomplir dans l'esprit des institutions. 2
Les prtendues coopratives belges sont, en fait, des conomats installs par
un parti politique, en vue d'assurer sa puissance sur la population ouvrire du
pays.
On arrive ainsi se demander pont, quelles raisons la cooprative de consommation ne pourrait pas tre remplace par une fourniture d'objets alimentaires
faite par l'administration communale. Gnralement les thoriciens de la
coopration ferment les veux a l'vidence et ne veulent pas voir que les institutions qui leur sont chres, constituent un acheminement vers des services
communaux. Bernstein est de mon avis, car il crit : Je signale un cas o la
cooprative de consommation pourrait tre regarde comme une institution d'une
utilit douteuse ; c'est le cas o elle empcherait le progrs du service public
d'approvisionnement... Pour s'appliquer toits les membres d'une commune,
l'association dmocratique de consommation n'aura besoin que de s'agrandir,
conformment ses tendances naturelles. 3
Il y a une quarantaine d'annes, Paris a failli tre pourvu de boulangeries
municipales ; la suite d'expriences faites par l'administration de l'assistance
publique, Napolon III avait fait tudier un projet dans ce sens par le prfet de la
Seine, Haussmann; celui-ci dtourna finalement l'empereur de cette ide parce
qu'il ne pensait pas qu'une municipalit pt grer convenablement une affaire
commerciale de cette envergure 4. Il me semble que, dans cette affaire, Haussmann se montra un peu timor : la ville de Paris n'aurait pas prouv de difficults
inextricables acheter des bls sur les grands marchs, par vole d'adjudication.
Nous avons aujourd'hui l'exprience de nombreuses coopratives et nous voyons
qu'elles ne sont pas gres par des hommes d'une capacit remarquable, ni d'une
probit extrmement scrupuleuse.
2
3
4
Mouvement socialiste, 15 janvier 1903, p. 102. - Dans la Science sociale, Victor Muller
affirme que le grant du Vooruit a tout le Conseil sa discrtion, en sorte que le contrle des
adhrents est fictif ; d'aprs lui on a cart les cabaretiers du Conseil, parce qu'ils seraient trop
indpendants (aot 1898, pp. 162-167).
Muse social, janvier 1899, p. 41, col. 2.
Mouvement socialiste, 4 septembre 1899, p. 259.
Haussmann, Mmoires, Tome II, p. 363.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
103
Les coopratives sont des champs d'expriences trs intressants ; elles nous
apprennent quels sont les services d'approvisionnement qu'il est possible de
socialiser avec profit et comment cette socialisation peut tre poursuivie. En
Belgique, on ne trouve pas gnralement avantageux de crer des boucheries
coopratives ; les magasins de confections du Vooruit ne donnent pas de brillants
rsultats. Ce sont les objets de grosse vente, qui ne comportent pas de choix et
dont l'acquisition ou la manipulation n'exigent pas d'aptitudes commerciales, qui
conviennent la socialisation ; leur nombre diminue d'autant plus que l'on se
rapproche davantage du type des services communaux. Victor Muller tire de
l'exprience du Vooruit cette conclusion qui me semble trs juste : Le succs du
Vooruit donne la mesure de la valeur de son patron et la question de la capacit du
grant est bien autrement importante que celle de son organisation 1 ; les
services de la grande cooprative gantoise ont d'autant mieux russi qu'ils correspondaient mieux aux aptitudes personnelles d'Anseele. Il me semble, en consquence, que le Vooruit ne fournit pas, comme on l'a cru souvent, un exemple
propre montrer l'extrme valeur socialiste de la coopration; la prosprit d'une
cooprative socialiste devrait pouvoir tre assure sans que le grant et une trs
grande supriorit sur les associs.
Une trs grande cooprative de consommation constitue, en ralit, une commune forme des petites gens qui peuvent acheter leurs denres au comptant.
La question de savoir s'il y a avantage lui laisser une administration compltement autonome, ou bien la fusionner compltement avec la commune
politique, ou bien adopter un systme mixte, est une question d'ordre tout pratique et dpend des circonstances. Le mme problme se prsente pour beaucoup
d'autres intrts collectifs : on peut donner d'excellents arguments en faveur de la
concentration ou en faveur de la dconcentration. Gnralement, l'assistance
publique est confie des commissions dpendant partiellement de la municipalit ; - jusqu' ces derniers temps, en Angleterre, il y avait des conseils scolaires
nomms directement par les intresss; - en Suisse, les usagers de l'Allmend, qui
descendent des anciens occupants de la Marche, ont une administration eux,
distincte de celles de la commune qui comprend aussi les simples rsidants 2 ; dans certains pays les canaux d'arrosage sont municipaux; mais bien plus souvent
ils sont administrs par des syndics que nomment les arrosants, etc.
Nous avons vu que Bernstein considre les coopratives de consommation
comme tant dmocratiques ; il nomme oligarchiques les coopratives de production, qui se caractrisent, en effet, par mie slection remarquable : quand elles
russissent, c'est qu'elles ont limin les non-valeurs et qu'elles ont constitu dans
leur sein un groupe de gens capables qui dirigent patronalement les affaires. Ce
sont de vraies associations de petits entrepreneurs 3.
1
2
3
Science sociale, aot 1898, p. 167.
mile De Laveleye, La proprit et ses formes primitives, p. 279, pp. 303-304, p. 309.
Les philosophes grecs les eussent, sans doute, nommes des aristocraties. On y trouve des
hirarchies bien marques, travers lesquelles des ouvriers peuvent devenir matres. Depuis,
Poulot estimait que la grande question Pour les associations ouvrires est d'liminer les
ouvriers qu'il nommait sublimes ; il cite un rglement vraiment draconien tabli par une
cooprative en vue d'liminer les irrguliers (Le sublime, pp. 345-349).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
104
Les grandes coopratives de consommation ont tous les vices des dmocraties : improbit et incapacit frquentes des administrateurs, - insouciance de la
trs grande masse des adhrents, - formation de partis qui poursuivent avec
impudence leurs fins personnelles. En ce moment on fait les plus srieux efforts
pour constituer une fdration des coopratives parisiennes en vue de rendre les
prvarications des administrateurs plus difficiles; mais ceux-ci rsistent pour des
motifs, dit un rdacteur du Mouvement socialiste, qui sont prsents l'esprit de
tous les lecteurs un peu au courant de la vie des socits parisiennes 1 .
Il est fort difficile d'avoir des renseignements prcis sur l'administration des
coopratives; les gens qui participent an mouvement coopratif, ont sur la valeur
du silence des opinions tout fait clricales; ils sont d'une discrtion incroyable et
veulent viter tout scandale qui pourrait ternir le prestige de la trs sainte coopration ; ils aiment mieux tre vols que de poursuivre les voleurs. J'ai entendu
raconter qu' la suite de graves malversations connues de tout le monde, des
plaintes avaient t dposes contre des administrateurs de coopratives, puis
retires sur le conseil d'avocats - jeunes bourgeois - pleins d'amour pour le peuple.
Il ne faut donc pas s'tonner si tant de chefs des coopratives importantes ont si
mauvaise rputation; dans le Parti ouvrier (journal du parti allemaniste) on
pouvait lire, il y a quelques annes : Les socits coopratives de consommation
sont ronges plus ou moins par cette lpre qui s'appelle le pot de vin. Ce qu'il faut
empcher tout prix, c'est la prise de possession des fonctions par la catgorie des
gens qui font de la coopration pour en vivre. (27 avril 1899).
Durant l'anne 1902, lAssociation cooprative (qui tait l'organe officiel de la
Chambre consultative des associations de production et de l'Union cooprative
des associations franaises de consommation) a parl plusieurs fois des cumeurs
et des apaches de la coopration (5, 12 juillet et 30 aot) ; mais ce journal est
toujours rest dans le vague, suivant les usages des vrais cooprateurs. Nous
savons cependant par lui que l'une des plus grandes coopratives de l'Europe, la
Moissonneuse de Paris, a t, pendant quinze ans, pille par des administrateurs
qui la conduisirent deux doigts de sa perte ; et que la Bellevilloise n'a chapp
que par miracle aux cumeurs : rduite 5,700 adhrents aprs sa rorganisation,
elle a pu distribuer autant qu' l'poque o elle en comptait 7,000. (30 aot 1902).
Durant l'Exposition de 1900, des personnes qui se sont mis en tte de rformer
la coopration et de lui donner un sens suprieur, imaginrent qu'il fallait construire un Palais du travail, destin abriter les uvres des coopratives ouvrires
et leurs congrs. Ce monument fut tabli en dehors des terrains de l'Exposition, et
il tait destin tonner le monde par la nouveaut des procds employs pour le
construire ; on devait dmontrer exprimentalement que les mthodes de travail
capitalistes avaient fait leur temps et que des mthodes socialistes donnaient des
rsultats beaucoup plus conomiques, avec de courtes journes et de hauts
salaires. On employa 440,000 francs ; luvre avait obtenu de trs larges subventions (200,000 francs donns par l'tat, 200,000 francs par la ville de Paris,
20,000 francs par le Conseil gnral de la Seine, le reste provenant de diverses
Bourses et municipalits de province) ; il fallait encore 200,000 francs pour payer
1
Mouvement socialiste, 26 avril 1902, p. 782.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
105
des dettes et autant pour achever. On demanda l'tat l'argent ncessaire ; la
Chambre des dputs vota seulement 300,000 francs et le Snat ajourna sa
dcision parce qu'on ne lui donnait pas de justifications suffisantes. La Chambre
consultative des associations de production, qui renferme des hommes trs capables, offrait de terminer les travaux ; mais comme elle avait considr que les
mthodes des premiers organisateurs devaient conduire un chec fatal, elle
demandait que ces personnes voulussent bien se retirer (Association cooprative,
19 juillet, 2 et 9 aot 1902); - celles-ci ne voulaient pas partir, et elles entendaient
continuer leurs expriences, qui d'aprs les politiciens dont Jaurs est le chef,
'devaient couvrir de gloire le proltariat franais 1.
L'exprience montre que dans les questions qui ne soulvent pas de fortes
passions politiques, les lecteurs montrent la plus grande indiffrence ; c'est ainsi
qu' Paris les juges du tribunal de commerce ne sont nomms que par une infime
minorit ; on ne peut donc s'tonner de voir tant de cooprateurs se dsintresser
des assembles gnrales. D'ailleurs, quel contrle pourraient exercer des assembles gnrales ? La seule chose qui puisse les mouvoir est la fixation de la
ristourne. Quand il y a des polmiques entre administrateurs vincs et administrateurs nouveaux, il est gnralement impossible de rien comprendre aux raisons
donnes de part et d'autre 2.
De prcieux renseignements sur les vices de la coopration se trouvent dans la
Rivisla popolare di politica, lettere e scienze sociali du 15 novembre 1902 ; il
sont dus un crivain socialiste bien connu, Giovanni Lerda. Il nous apprend qu'
Turin un parti socialiste s'tait empar de l'administration de deux grandes
socits : de l'Association ouvrire, par 800 voix sur 7,000 inscrits, et de la Cooprative des chemins de fer, par 250 voix sur 6,000. Les administrateurs nomms
taient tous aux ordres des groupes politiques ; quelques-uns avaient trouv
avantageux de se faire nommer employs de l'association; il existait une sorte de
maonnerie ou de socit secrte d'appui entre compagnons . Tout cela reproduit
les faits bien connus de la vie administrative des villes gouverns par des comits
disciplins, qui imposent leur volont une population indiffrente 3.
On peut dire que la coopration est un mensonge, tout comme la dmocratie;
elle prtend se donner comme une administration des intrts locaux par les
intresss eux-mmes; elle ne ralise pas plus ce programme que la dmocratie ne
parvient nous montrer une volont gnrale conforme la raison, suivant la
thorie de Rousseau. Ce n'est pas dire que les coopratives ne rendent des
1
2
Depuis que ceci a t crit, le Palais du travail, demeur inachev, a t dmoli.
la fin de l'anne 1900, il y eut une polmique trs vive propos des malversations constates dans la grande Cooprative L'Avenir de Plaisance (Paris). Le parti des administrateurs
vincs accusa ses adversaires de livrer l'association la raction (Petite Rpublique, 18
dcembre 1900) - leur principal adversaire tait un guesdiste - et il rclama un jury d'honneur.
- Le comit de contrle, dans une circulaire envoye aux adhrents, accusait les administrateurs d'avoir t des pantins manuvrs par des acteurs cachs dans la coulisse. Le gouvernement occulte est un des dangers habituels de la dmocratie. - (Cf. Coopration des ides, 17
et 24 novembre, 1, 8, 15 et 29 dcembre 1900).
Dans le numro du 15 dcembre se trouve une rplique qui parat laisser debout les assertions
essentielles du critique. Celui-ci nous apprend aussi qu'un mdecin s'est fait inscrire la
socit ouvrire, sans doute avec l'intention de prendre la place d'un confrre non socialiste; il
prvoit que son exemple sera suivi par des camarades avocats; la discipline du parti exige
que l'on favorise les camarades au point de trouver naturel que des administrateurs puissent
tre en mme temps fournisseurs .
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
106
services; les institutions dmocratiques en rendent aussi, malgr leurs vices qui
semblent incorrigibles ; mais il faut regarder les choses comme elles sont, ne pas
se laisser duper par les mots et ne pas attribuer aux formules une 'vertu qu'elles
n'ont pas.
Puisque les grandes socits de consommation ne sont pas l'abri des vices
des corps politiques modernes, il n'y a pas de raison dterminante pour carter a
priori les boulangeries communales ; tout se rduit une question de mesure et je
crois que, dans bien des cas, les services municipaux remplaceront dans l'avenir
les services coopratifs.
La boulangerie nous donne un excellent exemple d'un systme mixte qui a
longtemps fonctionn Paris ; avant 1863, les boulangers possdaient ce que
Haussmann nomme une sorte de charge industrielle privilgie, dont la transmission tait assujettie, comme celle des charges des officiers ministriels,
l'autorisation du pouvoir 1 ; leurs tablissements avaient t dissmins pour la
commodit de la consommation 2 ; ils taient obligs d'avoir des approvisionnements importants; la ville fixait leur prix de vente. C'tait une sorte de concession analogue celle des chemins de fer, avec un contrle trs dur.
Nous trouvons encore dans l'histoire de la boulangerie parisienne une autre
exprience trs instructive. Charles Guieyesse estime, avec une apparence de
raison, que les coopratives tant institues pour l'avantage les salaris, devraient
s'organiser pour mettre ceux-ci l'abri des variations du cours des denres et
constituer par suite une assurance contre le risque de hausse 3 . De 1853
1873, la ville de Paris avait institu un systme de compensation permettant de
subventionner les boulangers en temps de chert pour que le pain ft alors vendu
au-dessous du cours; on prlevait sur eux une taxe pendant les annes favorables.
Cela fut d'un fonctionnement facile tant que la libert de la boulangerie n'exista
pas, mais devint plus difficile aprs. Du 1er septembre 1853 au 16 juin 1856, la
Caisse de la boulangerie, cre par Haussmann, avana 53 millions et demi et put
maintenir le pain 0 fr. 40 le kilo, alors qu'il aurait atteint sans elle 0 fr. 60; il
fallut six ans pour rcuprer ces avances. Aprs 1863, le prix fut limit 0 fr. 50
et durant la petite disette qui dura du 10 novembre 1867 au 31 mai 1868, il fallut
avancer 3,300,000 francs aux boulangers 4.
Il serait probablement assez difficile dans la plupart des cas de procder une
assurance contre la hausse sans l'intervention municipale ; cela serait possible au
Vooruit, parce que la ristourne est trs forte et qu'elle permet, par suite, beaucoup
de combinaisons ; mais presque partout les coopratives doivent suivre les prix du
1
2
3
4
Haussmann, loc. cit., p. 342.
Haussmann fait observer que ce systme tendait augmenter les frais gnraux et accrotre
le prix du pain (loc. cit., p. 361) ; il dit qu'on aurait d concentrer la fabrication du gros pain
de quatre livres et laisser disperse celle du pain de luxe (p. 262); il pense que la ville pourrait
subventionner des manutentions-meuneries tablies par le syndicat des patrons boulangers oit
des socits srieuses dans la priphrie de Paris pour fabriquer le pain d'usage courant (p.
365).
Mouvement socialiste, 15 Janvier 1903, p. 107.
Haussmann, loc. cit., pp. 353-361.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
107
commerce. Il y aurait donc intrt, ce point de vue, faire de la boulangerie un
service public communal.
Lorsqu'une marchandise devient rare, les prix s'lvent dans une rapide proportion, de manire limiter la consommation 1. Si l'on suppose que la plus
grande partie du commerce tombe sous le rgime coopratif comme le supposent
tant de thoriciens, l'assurance contre la hausse aurait pour rsultat de faire
disparatre le moyen qui permet, actuellement, de raliser l'quilibre conomique ;
il faudrait supposer que l'tat tablt un rationnement comme dans une ville
assige. Il est trs peu vraisemblable que la coopration prenne jamais une telle
extension; mais il n'est pas inutile de montrer quel correctif rglementaire est
inclus dans les hypothses que font les fanatiques de la coopration.
Pratiquement, la question ne se poserait probablement que pour le pain, et on
a, en effet, dj demand, tant en France qu'en Allemagne, que l'tat se charget
du commerce des bls. Ces projets n'ont jamais t tudis srieusement ; mais il
semble que les grandes villes d'un pays pourraient appliquer le systme d'Haussmann sans causer de perturbations au march gnral.
Je me suis tendu un peu longuement sur ces questions, parce qu' l'heure
actuelle le charlatanisme coopratif prend une extension inquitante pour le bon
sens.
la fin du XVIIe sicle, Gregory King crut avoir dcouvert une loi fixant les augmentations
que subit le prix du bl en cas de dfaut dans la production.
Dficits en diximes
1.
2.
3.
4.
5.
Augmentation de prix en diximes
3
8
16
28
16
45
28
=3
=8
=
+
+
+
(5
(8
(12
=
=
=
3 + 2)
5 + 3)
8 + 4)
(17
12 + 5)
Les chiffres des augmentations ont t videmment choisis de manire obtenir une rgle
simple de dveloppement mathmatique. Thorold Rogers regarde la loi de King comme
l'expression d'une tendance gnrale des prix : ainsi la grande peste du XIVe sicle avant
enlev (d'aprs son estimation) un cinquime des travailleurs, les salaires doublrent : ce
rsultat est trs voisin de celui que donnerait la loi de King. (Interprtation conomique de
l'histoire, tract. fran., p. 221, p. 224, p. 231). En corrigeant cette prouve, je lis dans l'Officiel
du 17 novembre 1920 une intressante communication faite la veille au Snat par notre
gouvernement : le prix du pain ayant plus que doubl depuis le commencement de l'anne, il
en serait rsult des rductions de consommation ayant atteint Paris 12 et mme 18 pour
cent.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
108
Introduction lconomie moderne :
Deuxime partie : socialisation dans le milieu conomique
Chapitre IV
La coopration considre comme un moyen d'entretien des forces de travail. - Autres
institutions ayant le mme but : construction des logements ouvriers et caisses de secours. Assurances contre les cas fortuits : les diverses formes qu'elles revtent. - Importance toujours
croissante de t'assurance rurale. - Accidents du travail. - La houille comme source universelle
de force et la nationalisation des mines.
Retour la table des matires
A. Si nous cherchons rsumer les recherches faites sur la coopration, nous
voyons qu'il est possible de l'tudier sans tenir compte du ct intrieur, sans se
proccuper du principe coopratif, et qu'on peut la considrer uniquement comme
un procd appartenant un genre qui comprend aussi la municipalisation de
l'alimentation : dans tous les cas, il s'agit de rendre meilleure et plus sre la vie
populaire.
Un important rsultat de l'exprience cooprative est celui-ci : au fur et
mesure que l'opration s'tend et qu'elle prend un caractre plus impersonnel, on
est amen restreindre le nombre d'articles dont le commerce peut tre socialis.
Ce qui appartient en propre ce genre, c'est ce qui correspond la consommation
commune, ce qui s'adresse aux masses populaires habitues une vie frugale et
peu varie. Tandis que le ngociant cherche satisfaire la varit des gots de sa
clientle et va mme au devant d'eux pour les stimuler, en lui offrant toujours des
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
109
choses nouvelles, le commerce coopratif tire son principal avantage de l'uniformit. Au Vooruit, cela est remarquable au point de crever les yeux de l'observateur 1. Les bilans des Wholesale societies qui fabriquent pour les coopratives
anglaises, laissent la mme impression. Elles leur fournissent surtout : en
Angleterre, de la farine, des chaussures, du savon, des confitures, du lard ; en
cosse, de la farine, des chaussures, du tabac, des biscuits, des vtements. La
coopration est donc un commerce d'une nature technique tout fait spciale.
La coopration, tout comme l'conomat patronal, a pour objet la satisfaction
des besoins les plus uniformes de la classe la plus uniforme du pays; on peut dire
qu'elle considre l'homme l'tat abstrait et qu'elle a pour objet de maintenir en
bon tat les forces de travail.
Les socialistes ont t frapps, depuis trs longtemps, de ce caractre de la
coopration et ils ont soutenu souvent que la coopration tourne tout l'avantage
du patronat, comme l'conomat, ayant pour rsultat de lui permettre de payer de
moindre salaires. Le matre pourrait entretenir son outillage humain moins de
frais et gagnerait l'conomie faite sur l'alimentation. Cette thse est fausse dans le
plus grand nombre de cas ; l'conomat lui-mme profite souvent l'ouvrier 2 ; les
patrons ne pensent pas tous, en effet, comme les grands politiques du XVIIe
sicle, que la prosprit d'un pays dpend de l'excessive oppression conomique
des classes ouvrires 3. Les divers moyens que l'on peut employer pour faire que
les travailleurs soient mieux nourris, mieux logs et plus leur aise, sont
considrs aujourd'hui comme tendant tous au progrs de la production, par le
perfectionnement de sa puissance active, de la masse ouvrire.
Ce ne sont pas l, comme on le dit souvent, des choses tout fait nouvelles ;
la convenance de cet arrangement clans les conditions du travail avait t reconnue il y a longtemps; mais autrefois elle donnait lieu une intervention directe de
certains patrons. Cette intervention a t mal comprise par le plus grand nombre
des auteurs qui ont crit sur ces questions ; ils n'ont pas vu que le patron tait l
faute de mieux. Un tat qui poursuit le perfectionnement de l'industrie, peut, en
s'inspirant de l'exprience acquise, s'occuper d'amliorer les conditions de vie de
la classe ouvrire, pour accrotre sa productivit, - comme il amliore les moyens
de transport et encourage les nouvelles branches de production.
Prenant la forme accidentelle pour le fond mme, on mettait en vidence la
volont du patron au lieu de s'attacher 'a tudier des rsultats qui pouvaient tre
obtenus d'une manire toute diffrente. Ce fut l'erreur fondamentale de Le Play,
qui ne considra pas les institutions qu'il rencontra dans les mines allemandes, par
leur ct objectif. Il fut trs frapp de trouver, surtout dans le Harz, une administration cdant les crales prix rduit, assurant des secours et des retraites aux
ouvriers, leur prtant de l'argent pour acheter des maisons. Il aurait voulu que les
1
2
La clientle du Vooruit est homogne et c'est cette cause que l'on doit rapporter l'lment
technique de son succs (Muse social, dcembre 1897, p. 446, col. 1).
Il est souvent fort difficile de distinguer dans la pratique les coopratives et les conomats,
depuis que certaines grandes compagnies (comme celle des chemins de fer de Paris-Lyon
Mditerrane) font grer leurs conomats par des dlgus des intresss.
La surcharge des taxes [n'a pas t] un incident, mais un principe. En Hollande, le grand
patriote de Witt l'a exalt comme le plus propre rendre le salari soumis, frugal,
industrieux . (Marx, Capital. tome I, p. 338, col. 2).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
110
grands patrons imitassent partout ce que faisaient les vieilles rgies allemandes ;
et il prnait sous le nom de patronales des institutions dont la vraie nature est
d'tre impersonnelles.
Depuis quelques annes, les gouvernements s'occupent d'amliorer les logements ouvriers ; en France une loi du 30 novembre 1894 a constitu des comits
officiels chargs d'encourager la construction des logements bon march. Ces
comits seront amens, peu peu, prendre un rle de contrleurs et peut-tre
mme de directeurs. On a modifi assez profondment les lois successorales en
faveur de ce genre d'immeubles ; on peut les maintenir dans l'indivision assez
longtemps aprs la mort du chef de famille ; la loi a permis certains hritiers
d'acheter l'immeuble an prix fix par le comit local, pour diminuer les inconvnients des ventes. On a autoris divers tablissements placs sous le contrle de
l'tat prter aux socits qui construisent des maisons bon march ou mme
en possder eux-mmes. En Angleterre les municipalits ont dpens beaucoup
d'argent pour refaire des quartiers pauvres; mais il n'est pas trs certain qu'elles
aient amlior le sort des travailleurs; il semble que, plus d'une fois, ces travaux
aient profit une classe place un niveau un peu plus lev 1.
Une trs grande quantit de logements ouvriers ont t difis par de puissantes entreprises capitalistes, en vue de faciliter le recrutement de leur personnel ; assez gnralement ces entreprises ne demandent qu' trouver des moyens de
se dbarrasser de leurs immeubles, qu'elles ne peuvent pas facilement surveiller, Il
y aurait lieu de faciliter le passage de ces maisons soit aux ouvriers, soit plutt
des socits qui n'auraient pas subir tous les inconvnients des ventes aprs
dcs. Rien ne s'opposerait mme ce que la commune, dans certains cas, se
charget de l'ensemble des constructions et les livrt ses habitants.
Il semble bien que sous le Second empire la question dun contrle exercer
sur les locations des immeubles ait t discute pour Paris. Le Constitutionnel,
dit Proudhon, aprs une sortie violente contre les propritaires, annona l'intention
d'examiner le droit de l'tat d'intervenir dans la fixation des loyers et une brochure
a paru, il y a six mois, avec le laissez-passer de la police, sous ce titre : Pourquoi
des propritaires Paris? 2
Dans la Capacit politique des classes ouvrires, Proudhon demandait deux
grandes rformes en vue de rduire le prix excessif des loyers parisiens
Voir sur ce point de curieuses observations d'Augustin Filon, qui possde lui-mme des
maisons ouvrires, dans lesquelles il n'y a pas d'ouvriers (Dbats, 27 aot 1902). -
Hambourg, Paul de Rousiers a vu de grands logements municipaux construits au moyen des
legs d'un philanthrope; mais la Ville les emploie surtout y loger ses agents mritants, des
prix de faveur (Hambourg et l'Allemagne contemporaine, p. 262). - La faveur est le grand
danger de telles entreprises municipales; il est bien difficile de refuser aux bons lecteurs un
bon logement et un bon prix.
Proudhon, De la Justice, etc., tome I, p. 329. - La brochure dont il parle, est videmment celle
de Charles Duveyrier. saint-simonien ralli l'Empire (Cf. Georges Weill. L'cole saintsimonienne, p. 251).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
111
1 que la location ft soumise, comme le prt intrt, une loi fixant le taux
maximum des revenus par rapport au capital ; 2 que la plus-value des terrains
btir appartint la ville. Sur ce dernier point, beaucoup de bons esprits sont
disposs adhrer une rforme du droit immobilier urbain. Mais il recommandait de plus la constitution de socits maonniques pour l'achat des terrains, la
construction, l'entretien et la location des maisons, en concurrence avec les
anciens propritaires et dans l'intrt de tous . 1 Il est manifeste, en effet, qu'il
pourrait suffire qu'une proportion notable des immeubles ft loue un prix
modr pour faire baisser le prix gnral des locations. C'est de la mme manire
qu'il concevait Futilit des coopratives de consommation, qui, d'aprs lui,
devaient servir de rgulateurs pour le commerce de dtail . 2
Je ne crois pas que ces deux genres d'institutions, qui ont pour objet de rduire
la matrise des entrepreneurs particuliers sur les travailleurs, puissent tre considrs isolment; on doit les rapprocher de celles qui servent mettre l'ouvrier
l'abri des malheurs provenant des maladies ou de la vieillesse. Suivant Le Play,
c'est le patron qui devrait personnellement intervenir ; mais on peut dire qu'
l'heure actuelle cette manire de voir est gnralement abandonne ; l'opinion se
prononce partout pour que des organisations sociales prennent la place du patron,
dont la volont dpend de trop de conditions subjectives. Dans l'tablissement des
caisses de secours, il ne faut pas nier qu'il n'y ait souvent une influence philanthropique ou un dsir d'amliorer l'assistance ; mais il y a aussi autre chose : on
sent le besoin de rgulariser, en les objectivant, les forces de travail.
Quelques auteurs ont t tellement frapps de cet aspect de la question qu'ils
ont regard cette socialisation comme tant de nature abaisser le caractre des
ouvriers, qui s'habituent n'tre plus que des morceaux d'un mcanisme social,
sans rflchir par eux-mmes sur l'avenir, sans acqurir des qualits de prvoyance et sans tenir compte des rapports humains qui pourraient s'tablir entre
eux et les patrons. Les caisses de secours et de retraites font disparatre tout ce qui
est -vraiment personnel pour ne laisser subsister que des rapports mathmatiques.
On a tort de vouloir nier cela ; mais il s'agit de savoir si cette objectivit n'est pas
une consquence de l'organisation du travail dans la grande industrie. Ce n'est
point pour les artisans que cette socialisation est faite, mais pour les forces de
travail, pour des abstractions d'hommes.
Ces considrations, qu'il me semble, inutile de prolonger davantage, nous
amnent penser que les philanthropes ont fait fausse route quand ils ont discut
ces questions sous l'aspect du devoir social ; la science doit s'efforcer de mettre en
pleine lumire le vrai caractre de ces institutions, en les plaant dans un systme
qui aurait en vue la conservation des forces abstraites de l'industrie moderne. Je
crois que cela est facile faire : nous avons considr ici la production sous le
rapport seulement des hommes qui y participent ; nous avons examin, sous
l'aspect de la socialisation, la consommation, le logement, les maladies et la
vieillesse des ouvriers; il nous faut nous demander maintenant s'il n'y a pas
1
2
Proudhon, Capacit politique des classes ouvrires, p. 110.
Proudhon, op. cit., p. 159.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
112
oprer, dans l'intrt des forces productives, des socialisations ayant de l'analogie
avec celles-ci.
B. - Lorsque l'on tudie l'outillage sous le point de vue de la conservation des
forces abstraites, on n'a plus s'occuper des choses en elles-mmes, de l'emploi
qu'on en fait, de leur aspect technique ; il ne faut examiner que la valeur. La
dperdition de l'outillage, par suite de son usure physique ou de son vieillissement, ne peut pas faire l'objet de notre tude prsente, parce que cette dperdition
dpend trop de la nature des instruments de travail et de la manire de s'en servir.
Quand on examine la destruction par cas fortuit, l'objectivit atteint son plus
grand effet et la perte peut donner lieu des recherches d'ordre mathmatique; on
peut faire intervenir l'ide d'assurance et transformer la perte en un risque. Ce
risque n'est pas indpendant compltement de la nature des choses ; mais il ne
dpend d'elles que par l'intermdiaire du genre; on classera les fabriques en
catgories suivant le danger d'incendie, en partant de statistiques faites par genres,
mais sans s'occuper de ce qu'est la fabrique l'intrieur, au point de vue de la
technique particulire adopte par le chef d'industrie.
Le mot assurance donne lieu certaines confusions qu'il importe de faire
disparatre ici.
1 Dans le sens le plus ancien, on entend par assurance un contrat cr par les
armateurs : le propritaire d'une chose menace de pril de mer passe un spculateur le dommage ventuel moyennant un prix 1). Il y a ici une vritable
abstraction, sparant comme dans les affaires de Bourse le bnfice de la
spculation de celui du ngoce 2. Ici la socialisation n'est pas appele jouer un
rle ; il s'agit de spculations dans lesquelles la particularit est mise en vidence
d'une manire excessive.
2 Dans les assurances sur la vie, l'lment essentiel est l'opration de prts
intrts composs ; ce placement est en partie subjectivis par suite de l'introduction de considrations dge, de sant, de profession, de telle sorte que la dure du
placement dpende de la mort, ou de la survie, d'un individu dtermin une date
prvue par le contrat. Ces oprations comportent cependant des considrations
mathmatiques, parce que les conditions de mort ou de survie de gens valides sont
susceptibles d'tre soumises au calcul des probabilits. Si le contrat est pass entre
deux particuliers, il comporte simplement un jeu, parce qu'il n'y a aucune raison
srieuse pour appliquer le calcul des probabilits ; mais il n'en est pas de mme
quand l'assureur est une compagnie faisant un trs grand nombre d'oprations,
entre lesquelles peuvent s'tablir des moyennes.
cause de, cet aspect mathmatique de l'assurance sur, la vie, on a souvent
pens que l'tat pourrait s'en charger et qu'il lui serait possible d'encaisser les gros
bnfices raliss par les compagnies. La question a donc t examine un
simple point de vue fiscal : si on en a parl comme d'une socialisation, c'est par
1
Les anciens juristes assimilaient l'assurance une vente; en parlant de l'assur, on dit: emere
eventum periculi . (Rotae genuae, dc. 39, no 9 ; d'aprs Dalloz, Rpertoire, tome V, p. 323,
col. 1).
Cf. Proudhon, op. cit., p. 101.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
113
suite d'une, analogie d'ordre purement formel. De mme le monopole du tabac est
une rgie d'intrt fiscal et non une entreprise socialise.
L'assurance sur la vie n'offre qu'un intrt mdiocre au point de vue de la
production ; elle a pour but immdiat d'agir sur les revenus et elle sert surtout
pour les commerants, les fonctionnaires, en gnral pour les urbains. Ce n'est
qu'accidentellement qu'elle peut intresser la production, comme dans le cas o
elle se combine avec des prts hypothcaires 1.
3 L'assurance importante considrer ici est celle qui permet au producteur
de trouver, moyennant une prime annuelle et modre, le moyen de reconstituer
une force productive dtruite par l'incendie ou autre cas fortuit. Dans quelques
dpartements franais, l'assurance contre l'incendie a t organise par l'administration avant la Rvolution, et ce rgime dure encore ; son imitation quelques
caisses d'assurance dpartementales contre les accidents ruraux ont t cres. Je
n'attache pas une trs grande importance, je l'ai dj dit, la question de savoir si
une commune spcialise de ce genre est dirige par les autorits publiques du
lieu ou par des corps spciaux ; ce sont l des dtails administratifs sur lesquels il
y a lieu de beaucoup insister quand il faut faire des applications dans un pays
dtermin; mais ils ne touchent pas la question de la socialisation.
On ne saurait attacher trop d'importance aux progrs de l'assurance rurale. Ces
progrs ont t vraiment extraordinaires la fin du XIXe sicle 2 et ils prouvent
qu'il s'est produit une trs grande transformation dans l'esprit des paysans. En
gnral, le dveloppement de l'assurance constitue un des traits les plus propres
caractriser le passage une conomie suprieure ; l'homme a besoin de beaucoup
de rflexion, pour admettre qu'il a avantage prendre sa part moyenne des accidents pour viter d'tre lui-mme cras, quelque jour, par un cas fortuit. Il faut
qu'il abandonne cet esprit de jeu et d'imprvoyance que l'on trouve si dvelopp
chez les primitifs.
Kautsky ne semble pas avoir compris la haute porte de l'assurance quand il
crit que le groupement des petits propritaires, en vue de parer aux pertes de
btail, est un de ces essais par lesquels l'association tend procurer la petite
exploitation les avantages de la grande [et que cet essai] n'est qu'un succdan
insuffisant de la grande proprit . 3 Il faut qu'un propritaire ait une bien grande
exploitation pour qu'il trouve avantageux d'tre son propre assureur ! Le ct
ducatif et la transformation que l'assurance produit dans l'esprit, au point de vue
juridique, semblent lui avoir totalement chapp.
Ici nous pouvons saisir l'avantage que peut prsenter une administration spare sur les pouvoirs publics ordinaires. Kautsky signale les fraudes que commet1
Notamment dans un projet de Flix Hecht en Allemagne. (Journal des conomistes, mars
1900, pp. 321-336). - La loi franaise sur les maisons bon march a prvu aussi une
combinaison de ce genre, destine faire que les hritiers soient dchargs de toute dette au
cas o leur auteur meurt avant d'avoir acquitt toutes les annuits ncessaires pour payer son
immeuble (Loi du 30 novembre 1894, art. 7).
Les premires compagnies d'assurance contre l'incendie furent cres en France en 1754 et
1786 ; la Mutuelte-Incendie de Paris date de 1816. La premire tentative d'assurance mutuelle
contre la grle est de 1809. - Les assurances sur la vie ont t longtemps regardes comme
illicites en France par beaucoup de juristes.
Kautsky, Politique agraire du parti socialiste, p. 144.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
114
tent les paysans qui assurent le btail des capitalistes; nul doute que l'assurance
par l'tat ne donnt lieu beaucoup d'abus; il y a ici intrt aider et subventionner des groupes locaux, dans lesquels les paysans peuvent exercer une
surveillance les uns sur les autres 1. Les difficults que prsentent les grandes
laiteries fondes par des entrepreneurs, se retrouvent dans beaucoup de questions
rurales 2 ; le paysan ne se fait nul scrupule de voler l'homme de la ville ; - l'tat
est pour lui la ville personnifie et il le vole tant qu'il peut.
L'assurance des rcoltes contre la grle et celle des maisons contre l'incendie
peuvent se faire facilement par l'tat ; il semble mme que, dans le premier cas,
l'tat est seul suffisamment arm, parce que le propritaire se montre d'ordinaire
trop rcalcitrant l'application de l'assurance et on a d se demander s'il ne
conviendrait pas de le forcer s'assurer. Kautsky me parat pencher vers cette
manire de voir.
C'est cette place qu'il faut mettre l'assurance contre les accidents du travail
qui offre surtout de l'intrt quand on la considre en dehors de toute proccupation philanthropique, quand on y voit un moyen imagin pour permettre au chef
d'industrie de se protger contre les procs relatifs aux accidents. Elle produit trois
rsultats trs dignes d'intrt et qui justifient parfaitement l'intervention de la
lgislation :
1 Permettre aux petits patrons de ne pas tre ruins par un cas fortuit les obligeant payer une indemnit hors de proportion avec leurs ressources;
2 Dvelopper l'esprit de prvoyance du peuple en montrant que tout malheur
prvisible peut tre rpar par la vole d'une pargne mathmatique ;
3 Affermir son esprit juridique en lui apprenant que les rparations de
dommages ne dpendent pas de la richesse ou de la pauvret des parties, mais que
le droit est un rapport vraiment objectif.
Il y a un si grand avantage, pour le progrs, ce que l'assurance fonctionne
rgulirement que l'tat a pu souvent juger qu'il tait appel diriger ce service;
cependant bien des personnes pensent qu'il, remplit mieux son rle en contrlant
des caisses gres par les intresss qu'en exerant une rgie directe et complte.
C. Depuis un certain nombre d'annes, on parle beaucoup de la nationalisation
des mines; mais trs souvent on en parle au point de vue fiscal; on met en avant
les normes rentes foncires qui sont contenues dans les dividendes, et on
voudrait que la plus grande partie de ces rentes revnt l'tat. Je ne m'occuperai
pas de la question ce point de vue qui me semble assez secondaire. Depuis la
dernire crise, on se proccupe en Allemagne de ce qu'il faut faire pour assurer le
Cf. Muse social, juin 1898, p. 541, col. 2 et mai 1900, p. 153. col. 2. L'exprience franaise,
comme celle de Belgique, montre qu'il y a avantage organiser de petites mutualits. La
rpartition des subventions de l'tat prsente mme de grandes difficults.
Vandervelde, Essais sur la question agraire en Belgique, p. 187.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
115
pain noir l'industrie 1 et Andr Sayous pense que l'avenir est aux mesures
socialistes.
Quel est donc le rle de la houille dans le monde moderne ? Le Play est probablement l'auteur qui a le plus profondment creus cette question ; dans sa
nomenclature de l'industrie manufacturire, il distinguait : les usines rurales ou
forestires, les usines hydrauliques, les usines vapeur, les fabriques collectives;
c'est au progrs des usines houille qu'il rattachait l'abandon de la coutume. Marx
rappelle que Watt avait montr une perspicacit extraordinaire dans les considrants de son brevet de 1784, puisque dans ce document il donnait sa machine
comme l'agent gnral de la grande industrie . 2
Les transformations prodigieuses des industries chimiques ont donn une
importance de plus en plus grande aux problmes de production de la chaleur
dans des foyers colossaux, - ce qui ne peut tre obtenu que par la houille. Enfin,
tous les transports modernes ne peuvent plus s'effectuer sans une norme et
toujours croissante consommation de combustible minral. Une situation toute
nouvelle s'est donc produite depuis que la chaleur est devenue l'lment capital de
l'industrie.
On ne saurait trop appeler l'attention sur les consquences qui rsultent du rle
de la chaleur dans la production moderne ; les appareils deviennent d'autant plus
conomiques qu'ils sont plus grands et que leur marche est plus intensive, parce
que dans ces conditions les dperditions de chaleur influent moins sur le prix de
revient; cette observation, qui fut faite d'assez bonne heure, a beaucoup contribu
la naissance du dogme de la concentration capitaliste 3.
Il faut aussi rappeler que les usines fondes sur la chaleur peuvent se dtacher
facilement du sol et qu'ainsi elles ne sont plus limites aux conditions que leur
imposait la gographie du pays; il est donc souverainement absurde de prtendre
tablir un rapprochement entre les forces hydrauliques des Alpes transportables
quelques myriamtres par l'lectricit, et la houille qui va partout. Dans un trs
grand nombre de cas, il y a avantage s'loigner des centres miniers pour tirer
parti d'autres circonstances ; les chemins de fer, en abaissant leurs tarifs, favorisent cette indtermination gographique de la production.
Le Play, parlant des circonstances qui ont amen la cration du capitalisme
actuel, dit que des dcouvertes mmorables ont ouvert, dans les mines de
houille, pour les manufactures, des sources indfinies de chaleur et de force
motrice 4. La chaleur est devenue sous forme de houille, une force gnrale et
abstraite, mise la disposition de tout le monde et appartenant au milieu conomique. Quand les industriels eurent acquis cette manire de comprendre les
choses, ils se demandrent de quoi se compose le prix de revient de la houille et
ds lors ils commencrent regarder comme prlevs sur leur production les
1
2
3
4
Andr Sayous, La crise allemande de 1900-1902, p. 364 et p. 368. Les mtaphores jouent un
plus grand rle qu'on ne croit dans les dterminations des hommes; on a us et abus du pain
de l'industrie ; maintenant les torrents des Alpes roulent de la houille blanche.
MARX, loc. cit., p. 161, col. 1.
On a souvent appliqu ce dogme sans se proccuper des raisons qui le justifient dans diverses
circonstances.
Le Play, Organisation du travail, p. 183.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
116
bnfices distribus aux actionnaires des mines. De plus en plus, les houillres
sont assimiles aux chemins de fer, et on voudrait avoir la chaleur prix de
revient comme on voudrait avoir le transport prix de revient.
Dans le pass, le travail des mines paraissait beaucoup plus mystrieux qu'il
ne l'est rellement ; pour extraire la houille, on ne fait rien de plus que ce qui se
fait journellement dans les grands chantiers de travaux publics. Depuis que l'on a
perc les grands tunnels des Alpes et que l'on voit les entrepreneurs de chemins de
fer improviser des ateliers colossaux pour dblayer les tranches profondes, tout
le merveilleux des mines tend s'vanouir. On est amen assimiler les
compagnies non pas des industriels qui produisent ce qu'ils inventent, mais
plutt des tcherons qui prennent forfait le dblai et le transport des minraux.
L'exploitation des grandes mines de houille par l'tat semble d'autant plus
facile oprer que l'ouvrier mineur est, peu prs partout, rest assez voisin du
paysan ; il est habitu faire des tches rgulires ; on n'a pas lui demander
d'exercer son esprit pour tirer toujours meilleur parti d'organes trs dlicats.
Quand je parle d'une exploitation par l'tat, je n'entends pas dire ncessairement
que la houille serait extraite par des ouvriers placs directement sous la surveillance d'agents de l'tat ; il semble que c'est bien le cas de dire avec Proudhon
que l'tat qui semble excuter, par lui-mme, tant de choses, en ralit n'en fait
presque aucune . 1 Il pensait, que la meilleure manire d'exploiter les chemins de
fer serait de constituer des associations charges chacune d'une partie de l'exploitation, comme de son temps il y avait des entrepreneurs de traction 2. L'exprience
ne semble pas avoir t trs favorable ce systme d'entreprises sur les chemins
de fer; mais des coopratives de mineurs pourraient se charger de l'extraction de
la houille dans les domaines appartenant l'tat. C'est ainsi que Proudhon concevait l'exploitation des mines 3.
1
2
3
Proudhon, Des rformes oprer dans l'exploitation des chemins de fer, p. 236.
Proudhon, op. cit., p. 237, pp. 329-330.
Proudhon, Capacit politique des classes ouvrires, p. 160.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
117
Introduction lconomie moderne :
Deuxime partie : socialisation dans le milieu conomique
Chapitre V
La partie spirituelle du milieu conomique. - La technologie cesse d'tre proprit ; le
brevet d'invention. - L'apprentissage passe de l'atelier dans les coles. - Conception
dmocratique de l'enseignement populaire. - Discipline des ateliers. - Comment elle s'est
produite ; lgislation napolonienne. - Les nouvelles conditions techniques et le nouveau
rgime des ateliers progressifs.
Retour la table des matires
Dans ce qui prcde, nous avons considr ce qui est susceptible d'tre
dpersonnalis dans le milieu conomique, en vue de conserver et d'entretenir ce
que j'ai appel les forces abstraites ; nous n'avons pris en considration que des
forces matrielles dont la conservation et l'entretien importent la production,
mais il y a aussi une partie spirituelle de l'conomie dont il ne faut pas se
dsintresser, si l'on veut comprendre quelles sont les vraies conditions du progrs
moderne. On a cru souvent que sur ce point la dmocratie s'identifie avec le
socialisme; cependant il y a quelques remarques utiles a prsenter et peut-tre
mme, cause du contact intime existant entre la dmocratie et le socialisme,
serait-il ncessaire d'approfondir davantage quelques questions qui, tout d'abord,
paraissent trs simples, et qui sont cependant fort obscures.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
118
A. - Nous sommes tout d'abord frapps de ce fait que durant des sicles la
technologie a t l'objet d'une appropriation prive ; on ne pouvait acqurir les
mystres du mtier 1 qu'avec beaucoup de peine. Je ne crois pas qu' l'heure
actuelle cette tradition soit compltement teinte chez les hommes qui n'ont pas
de proprit, c'est--dire chez les ouvriers et chez les littrateurs.
La ville de Paris a cr beaucoup d'coles techniques pour permettre aux
jeunes gens de s'instruire dans les principaux mtiers qui assurent la prosprit de
cette mtropole. Les lves de ces coles qui ont appris travailler par principe et
dont l'instruction scientifique est parfois remarquablement dveloppe, sont trs
mal vus dans les ateliers, parce que les vieux ouvriers ne peuvent comprendre que
l'on ait pu acqurir si facilement ce qu'ils ont eu tant de mal s'approprier; il leur
semble qu'on leur vole quelque chose de leur bien par une concurrence dloyale.
Quant aux gens de lettres, ils croient qu'ils ont sur leurs uvres des droits
d'une espce trs suprieure ceux qu'un propritaire a sur sa maison. Sous le
Second empire il fut fortement question de crer au profit des auteurs, inventeurs
et artistes un monopole perptuel ; Proudhon crivit contre ce projet une brochure
(Les majorats littraires) dans laquelle il s'tonne que la dmocratie ait gnralement approuv ce qu'il regardait comme une cration ultra-fodale 2 . Je crois
que cette attitude est parfaitement naturelle ; la dmocratie, tant essentiellement
urbaine, a pour idal du citoyen l'homme de lettres, l'orateur, le journaliste; elle
devait donc applaudir des mesures qui taient tout l'avantage de ces catgories.
Il y eut une transaction ; la loi du Ili juillet 1866 porta cinquante ans aprs la
mort de l'auteur la dure des droits sur la reproduction de ses oeuvres.
Les droits des inventeurs ont eu un sort bien moins favorable ; Proudhon
signale mme ce fait curieux que certaines personnes au moment o elles rclament la proprit littraire, demandent qu'on supprime le privilge de proprit
industrielle par l'abolition des brevets d'invention 3 . L'inventeur ne jouit d'un
privilge que durant quinze ans et encore est-il dchu s'il omet de payer un terme
des redevances dues l'tat (art. 32 de la loi du 5 juillet 1844); ou s'il introduit en
France des objets fabriqus l'tranger et semblables ceux qu'il a brevets; enfin
il faut mettre le brevet en exploitation en France dans un dlai de deux ans et ne
pas interrompre l'exploitation durant deux ans conscutives, moins de justifier
des causes de son inaction.
Cette diffrence de traitement est assez facile comprendre ; les industriels
n'ont pas un grand intrt ce que des livres ou des gravures puissent tre librement reproduits ; mais ils ont un grand intrt pouvoir appliquer gratuitement
des inventions nouvelles. On comprend donc pourquoi Michel Chevalier pouvait
combattre le privilge des brevets qui lui paraissait contraire aux intrts du
progrs conomique ; nous avons l une remarquable manifestation de l'opposition qui existe entre la production et l'appropriation technologique.
2
3
Marx regarde comme un des faits les plus caractristiques de l'ancienne industrie, l'obligation
impose aux artisans de ne pas divulguer volontairement les secrets du mtier . (Capital,
tome I, p. 210, col. 1).
Proudhon, Les majorats littraires, p. 4.
Proudhon, op. cit., p. 115.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
119
Au commencement du XIXe sicle, quand on a rdig le Code pnal franais,
on considrait la technologie comme fonde sur des secrets appartenant aux
manufacturiers ; aussi l'article 418 a-t-il prononc une peine de trois mois deux
ans de prison contre les directeurs, commis et ouvriers qui communiquent de tels
secrets; pour des raisons politiques la peine est beaucoup plus forte (deux cinq
ans de prison) quand le secret a t communiqu des personnes rsidant
l'tranger 1.
Marx a fort clairement montr quelle grande distance spare la technologie
moderne de la routine traditionnelle dont la thorie restait une nigme mme
pour les initis ; - la technologie est parvenue rduire les configurations de
la vie industrielle, bigarres, strotypes, et sans lien apparent, des applications
varies de la science naturelle, classifies d'aprs leur diffrents buts d'utilit.
Quand ce travail fut un peu avanc, il fut trs facile de crer des coles pour
former les chefs de fabriques 2.
Ds que la technologie devint scientifique, tout le monde admit qu'on ne pouvait s'approprier une telle science ; la loi de 1844 sur les brevets soumet l'inventeur l'obligation de laisser ses dessins et modles la disposition du public. On
n'accorde un monopole temporaire, relatif la manire d'appliquer le principe,
qu' la condition de livrer ce principe tout le monde. Il ne manque pas de gens
ingnieux qui s'emparent de l'ide scientifique nouvelle, pour crer des dispositifs
nouveaux, souvent plus pratiques que ceux de l'inventeur. De trs grosses fortunes
industrielles se sont fondes sur l'emploi et la combinaison de brevets abandonns
par les inventeurs qui n'avaient pu parvenir les appliquer dans les dlais lgaux.
On peut donc dire que la loi sur le, monopole des brevets socialise l'essentiel
de l'invention. Le privilge accord est parfois peine suffisant pour permettre de
rcuprer les frais normes que reprsentent les essais infructueux que l'on a d
poursuivre pendant de longues annes ; d'autres fois aussi il est excessif. La
grande rforme raliser en cette matire serait de rgler les droits de brevet de
manire ce que l'inventeur pt retirer deux ou trois fois la somme qu'il aurait
dclar avoir employe durant ses tudes et qui aurait t juge vraisemblable par
l'Office des brevets.
B. cette question se rattache de trs, prs celle de l'apprentissage ; l'industrie ne comporte pas seulement des appareils, mais aussi des hommes qu'il faut
mettre en tat de bien travailler. Quand la technologie tait la proprit de matres,
il tait naturel que ceux-ci ne transmissent leurs connaissances que moyennant
argent comptant ou services quivalant un paiement. Depuis que l'aspect
1
L'article 298 du Code pnal italien a mi peu. modernise la rgle franaise; mais il a conserv
la diffrence de traitement entre les cas o la divulgation est faite aux nationaux ou des
trangers. Le terme secret de fabrique a disparu ; il a parti trop vieux. La dure de la peine a
t aussi rduite. Ce dlit a une tendance manifeste devenir une forme de l'abus de
confiance.
Marx, loc. cit., p. 210, col. 2 et p. 211. col. 1. Marx ne parat pas avoir observ le rle considrable que jourent les ingnieurs militaires franais dans la cration de la science technologique moderne. Ils s'efforcrent de ramener chaque partie de leur art des principes simples
permettant l'emploi de mathmatiques. L'cole de Monge eut une influence considrable sur
la science des mcanismes, sur ce qu'on nomme aujourd'hui la cinmatique.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
120
scientifique, objectif ou social, est surtout en vidence, l'ancien apprentissage
parat contraire aux conditions de la socit moderne 1 et on se demande pourquoi
il n'est pas remplac par un enseignement donn dans des coles, comme est dj
donn l'enseignement aux futurs ingnieurs.
Ce qui a t fait dans cet esprit est assez mdiocre gnralement et la mise en
pratique de l'apprentissage scolaire se trouve gne par l'influence des ides dmocratiques, toujours plutt portes vers la culture de l'esprit que vers le travail 2.
L'enseignement primaire a t cr pour le boutiquier, le commis et le petit
propritaire, qui ont besoin de savoir faire des comptes et qui doivent lire le
journal pour tre au courant de la politique 3.
L'enseignement secondaire est destin entretenir une classe destine imiter
l'ancien Tiers tat ; il doit former des bourgeois lettrs, familiers avec les bons
auteurs des XVIIe et XVIIIe sicles. Il faut leur donner une teinture d'instruction
humaniste, rappelant celle que donnaient les collges de Jsuites autrefois.
L'exprience montre que les rsultats ne correspondent gure aux esprances que
l'on avait formes ; il ne semble pas que les lves de nos collges ressemblent
aux hommes du Tiers-tat qui existait en 1789, qui a permis la France de
supporter sans grand dommage les orages de la Rvolution et qui a fourni
Napolon le moyen de refaire la France. C'est que l'ducation et l'instruction ne
dterminent pas la conduite des classes ; ce qu'il faut examiner en premier lieu,
c'est la vie de ces classes ; or, rien ne rappelle aujourd'hui la vie du vieux Tierstat, dont le noyau tait constitu des hommes de loi, vivant autour de tribunaux
fort peu semblables ceux d'aujourd'hui.
La dmocratie est jalouse des lves des lyces ; l'instruction classique donne
aux jeunes gens ne les met cependant pas mme de gagner beaucoup d'argent ;
mais elle leur donne du prestige sur les masses; elle en fait des crivains et des
orateurs. Il ne faut donc pas s'tonner si, l'heure actuelle, on voit tant de dmocrates demander la gratuit de l'enseignement secondaire : ils pensent que la
France sera cent fois plus heureuse et plus forte quand elle aura un plus grand
nombre de candidats aux fonctions lectives, capables d'blouir les ouvriers par
leur faconde.
Les coles professionnelles sont beaucoup plutt conues sur les plans de la
dmocratie que sur ceux qui correspondent aux aspirations socialistes; elles ne
sont pas gnralement mises la porte des besoins des ouvriers; on se proccupe
trop d'imiter ce qui se fait dans les coles d'ingnieurs et on donne trop de temps a
la pure culture de l'esprit.
1
D'ailleurs beaucoup de patrons ne veulent plus avoir que le moins possible d'apprentis ; ils
trouvent que ceux-ci font perdre du temps aux ouvriers: ils n'embauchent gure (te jeunes
gens que pour leur confier des besognes simples, abrutissantes et mal payes (Cf. Denis
Poulot, Le sublime, p. 261 et p. 267).
Denis Poulot se plaint vivement que chez nous les familles ayant un peu d'aisance veuillent
viter leurs enfants le travail manuel (op cit., p. 264) et que mme les fils de patrons ne
soient, pas levs en vue de succder leurs pres : ceux-ci veulent que leurs enfants aient
une position librale (p. 273). Il ne s'aperoit pas que ces mauvaises murs sont essentielles
nos dmocraties toutes pleines de prjugs lgus par l'Ancien Rgime.
Cf. G. Sorel, Matriaux d'une thorie du proltariat, pp. 137-138.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
121
Quoi qu'il en soit, il semble trs vraisemblable que d'ici un certain nombre
d'annes l'apprentissage aura presque compltement pass dans les coles ou, tout
au moins, clans des coles annexes des ateliers. Les coles indpendantes des
ateliers ont l'inconvnient de prsenter la technologie sous des formes que l'lve
prend pour dfinitives et quelquefois ces formes sont arrires. Dans l'usine,
l'apprenti assiste aux transformations de la technique, peut apprendre apprcier
la valeur pratique des inventions et se rendre compte des ttonnements travers
lesquels s'effectue le progrs 1. Il faudra peut-tre en venir imposer aux grands
tablissements l'obligation de recevoir un nombre d'apprentis proportionnel leur
importance et d'y organiser des coles-annexes que subventionneraient l'tat et les
villes.
Si l'apprentissage consistait seulement apprendre des gestes et des formules,
il n'y aurait aucune raison pour que l'tat ne pt le diriger convenablement ;
l'enseignement de l'tat est bon quand il s'applique aux choses les plus abstraites ;
mais dans l'apprentissage il y a poursuivre une formation du caractre, qui ne
peut gure tre obtenue que par la frquentation d'hommes de la mme profession,
ayant toutes les qualits de l'ouvrier accompli 2.
C. - Le travail dpend, pour une trs large mesure, des sentiments que les
ouvriers ressentent devant leur besogne ; mais comme ces sentiments ont t, au
cours du dveloppement capitaliste, dvelopps sous l'influence de l'intimidation
patronale, on a pris l'habitude de ne pas les rapporter l'tat moral de celui qui les
prouve, mais aux rapports qui existent entre le matre et le serviteur, ce qu'on
nomme la discipline.
Kautsky parat particulirement embarrass dans l'examen de cette question
capitale ; il se demande comment intresser l'ouvrier son travail ; et il se
contente d'explications dignes des anciens utopistes : le capitalisme a vaincu
l'ancienne paresse de l'homme et quand la journe de travail sera raisonnablement rduite, la masse des ouvriers se livrera, par pure habitude, un travail
rgulier; - la discipline syndicale, qui est assez forte pour arracher l'ouvrier
la fabrique [durant les grves], le sera aussi pour l'y maintenir; - enfin on
devra s'efforcer de faire un plaisir du travail; si le travail devient agrable on s'y
rendra gaiement. 3
Tout cela ne nous instruit pas sur l'tat rel des sentiments; l'exprience des
coopratives de production ne semble pas de nature nous apprendre grand'chose
non plus; on a souvent signal les difficults qu'elles prouvent pour amener leurs
adhrents travailler avec rgularit; un collaborateur de l'Association coop1
2
G. Sorel, Op. cit., pp. 141-142.
Frapp des grands dangers que prsente pour les jeunes gens la frquentation des sublimes.
Denis Poulot est fort oppos l'apprentissage dans les ateliers ; les coles professionnelles
qu'il propose ne devraient pas avoir d'externes afin de compltement soustraire le jeune homme l'influence dltre du milieu (op. cit., p. 267, 1). 276, p. 291). - Les coopratives de
production qui groupent des travailleurs bien slectionns, pourraient rendre le plus srieux
service comme atelier-coles ; les subventions qui leur seraient accordes pour l'apprentissage, les aideraient beaucoup vivre.
Kautsky, La rvolution sociale, pp. 152-155.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
122
rative ayant propos un plan de statuts d'aprs lequel le directeur ne pourra rien
faire sans tre approuv par tous les membres de la collectivit , un cooprateur
pratique rpondait qu' ce compte il n'y en avait pas pour trois mois et il rappelait
le triste sort des Fondeurs de Grenelle, dont la dconfiture entrana celle de la
Banque du crdit au travail ; ils taient seize associs et chacun disait au directeur : J'ai autant de droits que toi. (Association cooprative, 13 dcembre
1902) 1.
Aussi ne faut-il pas s'tonner si, dans un rapport du 15 novembre 1897, le
directeur de l'Office du travail franais signale l'importance d'une forte
discipline ; et il met ce sujet une thorie quelque peu divertissante : Notre
lite ouvrire se convainc peu peu qu'tre libre, ce n'est pas repousser toute
discipline, mais choisir une rgle, et l'ayant adopte, tre assez matre de soi pour
s'y plier ! 2 ce compte le Jsuite serait l'homme le plus libre de la terre
puisqu'il a accept volontairement d'tre trait comme un outil par ses suprieurs!
Il est ncessaire de laisser de ct toutes ces vues subjectives, pour examiner
l'histoire mme de cette discipline, ou plutt de l'tat d'esprit des travailleurs.
Reportons-nous aux rglements minutieux et parfois si rigoureux imposs aux
anciens chefs d'ateliers artisans. L'autorit publique avait jug ncessaire de dterminer, avec une extrme prcision, la manire d'excuter les faons, parce qu'elle
croyait cette discipline ncessaire, tant pour protger les acheteurs contre la fraude
que pour amliorer les conditions gnrales du commerce ; on pensait que la prosprit du pays dpendait beaucoup d'une exacte police de la fabrication. Par
routine, ces pratiques passrent tout d'abord dans les manufactures ; mais elles ne
purent durer parce que les relations anciennes du commerce avec la production se
transformrent compltement ; l'ancienne rglementation avait t faite surtout en
faveur du commerce et il se trouvait que le commerant tait devenu le grand
patron des nouvelles manufactures ; on jugea qu'il avait plus de sagesse que
l'administration pour savoir ce qui convenait son industrie, et on cessa de lui
imposer les entraves que l'on avait jadis imposes aux petits patrons.
Les ouvriers accumuls dans ses ateliers avaient remplac les artisans indpendants ; le manufacturier les avait d'abord groups, puis avait chang leur
manire de travailler et finalement les avait mtamorphoss en pures forces de
travail 3. L'ancienne rglementation de la production devait suivre le mme processus et peu peu devenir une rglementation de l'ouvrier. Puisque la sagesse du
commerant-manufacturier remplaait celle de l'administration, il tait naturel
qu'elle s'appliqut aussi bien lintrieur qu' l'extrieur, qu'elle remplat la
1
D'aprs une publication de l'Office du travail (Les associations professionnelles ouvrires,
tome III, pp. 385-388) ce rcit serait incomplet ; mais les souvenirs du cooprateur Noirot
relatifs au fonctionnement de l'usine sont trop prcis pour pouvoir tre contests; il tait
membre du conseil de surveillance de la banque dont il parl.
Office du travail. Les associations ouvrires de production, p. 9. - Kautsky veut que l'on
maintienne la discipline qui est indispensable et qu'en mme temps le travail soit organis
dmocratiquement, avec une sorte de parlement ayant pour mission de rgler le travail et de
surveiller l'administration bureaucratique. (op. cit., p. 154). Idalisme !!
MARX, loc. cit., p. 147. - Misre de la philosophie, p. 191.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
123
force publique en face des producteurs, comme elle remplaait la prvoyance
administrative, en face des consommateurs.
La police aurait pu intervenir dans la confection de ces rglements, tout au
moins les homologuer et se charger de poursuivre pnalement les contraventions.
Cela n'aurait sans doute pas t trs avantageux pour les ouvriers ; car les ordonnances des prfets de police Paris sont pleines de tracasseries qui nous tonnent
aujourd'hui. Ces ordonnances ne s'immiscent pas dans ce qui se passe l'intrieur
des ateliers et des boutiques ; mais elles imposent aux ouvriers et employs des
servitudes peu en rapport avec la notion de la libert du travail si fortement
proclame par la Rvolution.
Voici quelques exemples qui donneront une ide de cette rglementation : un
garon bouclier qui quitte son patron, ne peut, durant un an, s'embaucher que dans
une boutique spare par quatre boucheries de celle de son ancien matre (17
novembre 1803) ; - pour le garon marchand de vin, il faut quinze boutiques d'intervalle (26 avril 1804) ; - dfense aux propritaires d'employer directement des
ouvriers charpentiers pendant plus de deux jours sans prvenir la prfecture (7
dcembre 1808) ; c'tait rendre presque impossible le travail direct 1.
celte poque, les gens clairs croyaient que la prosprit des manufactures
devait tre un objet constant de proccupations pour l'homme d'tat; aussi l'administration n'hsitait-elle jamais intervenir quand elle voyait les ouvriers troubler
le bon ordre industriel.
On eut cependant sous Napolon quelques doutes sur la sagesse des patrons ;
et ces doutes donnrent lieu la clbre lgislation sur les Conseils de prud'hommes, tablis d'abord Lyon et ensuite gnraliss, au fur et mesure des besoins.
L'empereur commena par faire des rglements pour mettre un terme ce que
les rapports officiels du temps signalent comme des licences coupables, destines
tromper les acheteurs ; ainsi on rtablit des lisires caractristiques des principaux tissus de Lyon. Le conseiller d'tat, Regnault de Saint-Jean-d'Angly, disait
que la loi projete avait pour but de procurer des rgles au commerce, des chanes la mauvaise foi, de l'activit la police, des lumires l'conomie politique,
de la fidlit au fabricant, des garanties au consommateur et de ramener la
loyaut ancienne.
La loi du 18 mars 1806, faite en vue de Lyon, o existait le rgime de la
fabrique collective, ne s'occupe pas de la discipline des ateliers ; elle vise par
contre les soustractions des matires faites par les artisans et les teinturiers (art. 12
et 13). Mais bientt des mesures nouvelles intervinrent ; le dcret du 3 aot 1810
s'occupe de discipline et d'une manire singulirement dure : Tout dlit tendant
troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentis
envers leurs matres, pourront tre punis, par les prud'hommes, d'un emprisonnement qui n'excdera pas trois jours (article 4). Suivant, Dalloz, il ne s'agit, l que
d'une action disciplinaire, qui ne ferait pas obstacle ce qu'une vraie action
criminelle ft intente contre les auteurs de dlits prvus au Code pnal 2 : d'aprs
1
2
Office du travail, Les associations ouvrires professionnelles, Tome I, p. 17, p. 21, p. 24.
Dalloz, Rpertoire, tome XXXVIII, p. 551, col. 2 (article Prud'hommes, 130). La Cour de
cassation a, en effet, le 9 avril 1836, dcid que les prud'hommes pcheurs ne rendent pas de
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
124
ce Rpertoire, le dcret a vis les disputes, le manque de respect, l'insubordination
les paroles grossires; il n'est pas ncessaire qu'il s'agisse d'actes dlictueux, au
sens du Code pnal, pour que les prud'hommes puissent condamner.
Ainsi ct des amendes que le patron peut infliger, l'empereur tablissait
l'emprisonnement : il remettait l'application de cette mesure l'autorit administrative des prud'hommes ; il aurait pu lui donner galement le contrle des amendes. Cette extension de la prud'hommie aurait t conforme aux ides qui avaient
motiv la cration des premiers conseils en 1806 : l'intention de l'empereur tait
videmment d'empcher tout abus qui aurait pu nuire la prosprit de la
fabrique, quelqu'en ft l'auteur.
Depuis quelques annes on a fait beaucoup de projets sur la police des
ateliers ; les auteurs ne se doutent pas toujours qu'ils ne font que dvelopper la
lgislation napolonienne ; ils cherchent l'adapter aux ides gnrales qui ont
cours aujourd'hui sur l'autorit ; on a, de moins en moins, confiance dans la
sagesse des chefs d'industrie; ou trouve qu'on leur a abandonn, trop lgrement,
une autorit qui aurait d tre retenue par l'administration publique ; cette ide
devient, naturellement, plus populaire depuis que le protectionnisme gagne du
terrain, l'tat reprenant leur ancien rle de grand matre des fabriques.
Je ne vois pas que l'on se soit fort proccup, jusqu'ici, de rechercher quelles
sont les transformations que l'industrie a subies depuis un sicle. Les anciennes
ides sur la discipline deviennent surannes ; il ne s'agit plus de savoir comment
on imposera aux ouvriers une volont extrieure 1, mais de savoir comment ils
acquerront la conception de l'usage progressif faire de la machine mise entre
leurs mains. Le passage au socialisme ne peut se comprendre que si la volont du
matre se dissout dans le corps gnral des travailleurs ; alors on ne pourra plus
dire que l'unit du corps collectif [des travailleurs] leur apparat comme l'autorit [du matre], la puissance trangre qui soumet leurs actes son but 2 ; alors
la coopration force sera remplace par la coopration raisonne 3.
Les bases de cette nouvelle manire de produire se trouvent dans la socit
actuelle ; l'industrie la plus perfectionne nous permet de formuler une loi qui, par
son dveloppement normal, conduit l'organisation socialiste : Que tous les
travailleurs aient une gale volont : 1 d'employer leur temps aussi bien que
2
3
vritables jugements, quand ils imposent des amendes pour contravention leurs rglements
faits pour la conservation du bon ordre et la bonne pratique de la pche.
La volont, d'une autorit lue est videmment extrieure : je ne suppose pas qu'il y ait des
thoriciens de la dmocratie assez enrags d'idalisme pour croire que la police municipale
excute leurs volonts.
Marx, loc. cit., p. 144, col. 1.
Marx, loc. cit., p. 31, col. 2. - En prenant pour chaque priode de l'histoire conomique
moderne le type plus accus, on peut se reprsenter ainsi schmatiquement la marche vers le
socialisme : 1 re manufacturire sous la dictature du capitalisme commercial : direction des
usines par des gens ayant des mes de ngriers : ouvriers dresss comme des chiens savants : 2 re de la fabrique, avec prpotence du capitalisme industriel ; direction par des ingnieurs
bien informs ; travailleurs ingnieux, aptes passer d'une besogne a une autre, curieux de
tout progrs : - 3 re socialiste : direction par des techniciens habitus l'ide de l'quivalence des fonctions ; producteurs qui raisonnent leurs oprations, qui veulent faire des
oeuvres parfaites et qui sont pleins du sentiment du droit.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
125
possible ; 2 d'utiliser leurs outils avec toute l'attention dont ils sont susceptibles ;
3 de prendre pour modles les meilleurs d'entre leurs camarades.
Pour bien comprendre cette loi, il faut la considrer dans les cas o elle est
presque ralise, et lui opposer le rgime le plus contraire, c'est--dire le rgime
des ateliers o rgne la plus parfaite routine et o le travail est presque entirement fait la main. Dans tous les cas intermdiaires, les apprciations les plus
diverses peuvent tre formules suivant les circonstances.
L'ancienne production suppose mie addition de tches qui sont comme des
corps durs entre lesquels existent de petits intervalles ; le but poursuivi par le chef
d'atelier est de rendre la journe moins poreuse, comme dit Marx 1 ; l'ouvrier
rsiste cette prtention, parce qu' ses yeux la journe normale comprend un
nombre dtermin d'oprations, fix par l'usage ; il entend se louer seulement pour
ce nombre de Lches lmentaires ; et il lui semble que toute tentative, ayant pour
but de le lui faire dpasser, constitue nue spoliation. Dans les pays o l'esprit
corporatif est rest puissant, l'ouvrier estime que la spoliation est double : d'une
part, on exige de lui plus que l'effort coutumier 2, et de l'autre on rduit le travail
offert la corporation 3. Si l'on introduit quelque progrs dans l'outillage, l'ouvrier
de l'ancienne industrie demande qu'il n'en rsulte pour lui aucune gne et aucun
ennui.
Les dbuts de l'industrie moderne ont t marqus par des luttes trs -vives
entre ouvriers et entrepreneurs ; les seconds cherchant a acclrer la fabrication,
les premiers rsistant par tous les moyens possibles. Proudhon a dcrit, en termes
trs pittoresques, les effets de la rsistance qu'il avait vil natre et dont il ne me
semble pas avoir bien reconnu les causes. Il ne parat voir dans le systme de la
mauvaise mesure qu'une sorte d'affaiblissement de la moralit qui se traduit dans
tous les rapports sociaux ; les vraies causes sont certainement conomiques. C'est,
an resserrement gnral produit par les transformations de prix qu'il faut faire
remonter l'explication des nouvelles murs : l'effort exerc par le patron pour
abaisser le prix du travail, est l'origine de ce mesurage d'une dsesprante exactitude que l'ouvrier lui oppose :
Cette prcision, impossible raliser, tourne au dtriment de celui qui
paye... Les faons se ressentent de ce mauvais vouloir ; le travail est nglig, mal
fait. On fraude en scurit de conscience sur la qualit et l'on s'enhardit de la sorte
frauder sur la quantit ; le dchet et la malfaon sont rejets de l'un sur l'autre ;
tout le monde, avare de son service, fait mauvais poids, mauvaise mesure...
L'homme employ en conscience, c'est--dire la journe ou la semaine, remplit
mal ses heures. L'ouvrier aux pices, pour en faire davantage, nglige l'excution ;
c'est, comme dit le peuple, un massacre. Toute cette malversation aboutit un
1
2
3
Marx, loc. cit., p. 148, col. 2.
C'est parce que l'ouvrier continue raisonner sur les tches coutumires qu'il dsire si souvent
voir s'tendre la juridiction des prud'hommes au rglement des productions normales.
David Schloss a donn, beaucoup d'exemples pour montrer combien les ouvriers anglais sont
convaincus que le travail offert forme une masse sur laquelle tous ont un droit gal : c'est ce
qu'on nomme la thorie du lump of labour ; les trade-unions s'efforcent de limiter le travail de
leurs membres pour qu'il y ait de l'occupation pour tout le monde (Les modes de rmunration
du travail, trad. fran., pp. 77-80).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
126
dficit gnral inaperu d'abord, mais qui se traduit la longue en chert et en
appauvrissement. 1
Pour lutter contre cette tendance gnrale produire le moins possible, les
industriels s'ingnirent inventer des procds de rmunration du travail que
l'on peut considrer comme autant de ruses destines forcer l'ouvrier, comme
malgr lui, fournir une certaine nergie 2 ; ces procds sont trs varis et ne
semblent gure susceptibles d'tre ramens des principes ; ce sont des stratagmes dont la valeur dpend, pour une trs grande partie, de circonstances
locales. Quant prtendre dgager des rgles juridiques de tout cela, c'est une
entreprise qui montre beaucoup de navet chez ceux qui la tentent 3.
Les directeurs des anciens ateliers taient des gens qui cherchaient surtout se
faire craindre ; les patrons les choisissaient plutt en raison de leur nergie et de
leur dvouement qu'en raison de leurs connaissances techniques. C'tait l'poque o l'on voyait une grande usine [de produits chimiques] des environs de Lyon
dirige par un ancien gendarme ; telle autre, dans l'Ouest, par un marinier ; telle
autre, dans le Midi, par un tonnelier. Pendant ce temps, des progrs se ralisaient
l'tranger. La concurrence force les anciens matres du march prter une
attention anxieuse aux travaux de leurs confrres trangers oui de simples
chimistes. 4
Les nouveaux directeurs apportent des habitudes d'esprit que ne souponnaient pas leurs devanciers ; ils se sont forms dans les laboratoires ; pour leurs
recherches thoriques, ils ont eu besoin de l'aide d'ouvriers habiles, intelligents,
dsireux de voir russir les expriences. Dans le laboratoire se ralise, avec toute
sa plnitude, la loi que j'ai nonce plus haut ; pour les nouveaux directeurs,
l'usine tout entire n'est qu'un vaste laboratoire ; les procds sont toujours provisoires et il est essentiel que tout le monde ait l'attention tendue vers les moindres
particularits du travail. L'industrie progressive a pour type idal une combinaison
parfaite de la science et de la, production, - du laboratoire et de l'atelier, - des
qualits de l'inventeur et de l'excutant.
La discipline des routiniers suppose qu'il y ait faire une manuvre suivant
un rglement, qui condense une science toute faite, place au-dessus des intelligences. Le rgime progressif suppose un devenir, dans lequel existe une tension
dpendant de la bonne mesure. On ne peut plus dire qu'il y ait des tches dtermines faire ; l'homme ne produit plus un objet dont le modle est fix par la
tradition ; mais il s'ingnie faire marcher un outillage dont l'utilisation est
susceptible de fournir les rsultats les plus divers. La fabrique livre a l'ouvrier un
organisme impersonnel, qui est comme la condition matrielle toute prte de
son travail 5 ; plus l'outillage devient perfectionn, plus il faut le considrer
1
2
3
4
5
Proudhon, Op. cit., pp. 117-118.
Cf. Charles RIST dans l'introduction la traduction du livre de D. Schloss, p. XLII.
Charles Rist raisonne comme si l'ouvrier tait assimil un contribuable qui, pour se dfendre
contre le fisc, invoque la comparaison avec les taxes payes par les citoyens les plus favoriss.
Que cette assimilation rende compte de beaucoup de rclamations formules dans des grves,
cela prouve simplement que les anciens points de vue persistent toujours et sont trs puissants
chez les ouvriers.
Ernest Sorel, La grande industrie chimique (Soufre, Azote, Phosphore), p. 2.
MARX, loc. cit., p. 167, col. 2.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
127
comme tant l'essentiel de la production. L'homme lutte avec les difficults que
prsente l'emploi des instruments de travail et cherche s'lever jusqu' eux ; et
ds qu'il y est parvenu, tout le onde doit considrer les moyens de travail comme
tant puiss ; il faut alors trouver autre chose ; ouvriers et directeurs ne doivent
avoir d'autres proccupations que de faire dpasser l'atelier la production courante.
Il est certain que l'une des causes de la supriorit incontestable de l'industrie
amricaine est que tous les hommes de valeur sont dans ce pays pntrs de ces
principes ; les patrons peuvent facilement surexciter l'ingniosit de leurs travailleurs en adoptant des modes de rmunration qui leur rendent trs avantageux les
efforts les plus originaux, les plus soutenus et plus puissants. Les modes de
rmunration jouent, videmment, un assez grand rle dans cette question ; mais
il ne semble pas que l'on puisse facilement faire travailler l'amricaine les
ouvriers europens, parce que ceux-ci sont trop pleins de souvenirs corporatifs 1.
Au point de vue de la formation thique du proltariat, le rgime de l'atelier
progressif est trs important : le travailleur se regarde comme tant un mandataire, il fait usage de l'outillage comme s'il en tait propritaire et il se proccupe
d'amliorer l'emploi comme si l'avenir lui appartenait. L'ide d'avenir manquait
totalement dans l'ancienne industrie ; nous retrouvons ainsi quelque chose des
conclusions auxquelles conduisaient les observations de Le Play, quelque chose
de l'esprit du propritaire rural. Qu'y a-t-il de plus essentiel, en effet, dans cet
esprit propritaire, si ce n'est la prminence accorde l'avenir des forces productives sur les considrations relatives au revenu immdiat ?
Ajoutons que les philanthropes qui prtendent faire l'ducation juridique du peuple, raisonnent
en partant de ces souvenirs, en sorte qu'ils sont un obstacle pour le progrs. - Dans la Politique agraire du parti socialiste, Kautsky s'lve avec force contre toute ide de dfendre les
intrts proltariens qui entraveraient l'volution sociale (p. 24) ; c'est pourquoi il ne veut
pas que le parti socialiste prenne la dfense de ceux des intrts ruraux qui lui semblent
contraires au progrs (pp. 26-28).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
128
Introduction lconomie moderne :
Deuxime partie : socialisation dans le milieu conomique
Chapitre VI
Classement des institutions qui ont une influence indirecte sur l'conomie. Les deux
aspects sous lesquels se prsente l'tat. Les divers rles de l'tat. - La neutralit du milieu
conomique. - Confusion frquente entre la loi du milieu conomique et celles de l'atelier ou
de l'tat.
Retour la table des matires
Il faut maintenant chercher nous former des ides gnrales sur le milieu
conomique et bien voir comment il se rattache l'ensemble des institutions du
pays. Nous avons reconnu dans ce milieu trois parties distinctes :
1 Les forces matrielles abstraites, qui constituent comme le grand rservoir
o puise la production et qu'il faut conserver et dvelopper en vue de rendre le
travail plus fcond (les forces humaines de travail, les valeurs menaces pour les
cas fortuits, le moteur universel que reprsente la chaleur contenue en puissance
dans les mines de houille) ;
2 Les forces spirituelles dont l'tude nous montre dans quelles conditions
intellectuelles et morales se trouvent les producteurs ;
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
129
3 Les moyens de transport, de crdit et de vente que je groupe sous la
rubrique de moyens d'change et dont l'examen fera l'objet de la troisime partie
de ce livre.
Nous n'avons jamais pntr sur le terrain propre de la production ; c'est ainsi
qu'en parlant des forces spirituelles, je m'en suis tenu aux conditions gnrales
sans entrer dans l'examen des relations qui peuvent s'tablir entre les patrons et les
ouvriers, propos des prix. Les auteurs catholiques, beaucoup plus proccups
que les socialistes de l'importance des moyens spirituels d'action, ont abondamment crit sur ce sujet ; ils ont recommand la formation de syndicats mixtes ;
d'autres fois ils ont organis des confrries clans l'usine et n'ont pas ml les
ouvriers de divers tablissements. Ces organisations ne sont pas toujours ngligeables ; mais leur rle ne rentre pas dans notre tude ; elles tendent toutes une
meilleure subordination de l'homme, auquel on donne l'illusion que la volont
trangre du matre est conforme sa propre volont. Il s'agit toujours chez ces
auteurs de ce qui se passe dans l'atelier et non des conditions gnrales de la
production, de l'tat dans lequel se trouve la classe ouvrire.
Ces recherches n'puisent pas tout ce que Proudhon avait numr sous le
nom de garanties ; mais il ne semble pas qu'il ait jamais fix ses ides d'une manire parfaitement prcise, ni qu'il ait construit un systme. Dans la Capacit
politique des classes ouvrires, il a donn une nomenclature des fonctions gnrales diffrente de celle qui figure dans la Thorie de la proprit, en sparant les
conomiques d'avec les politiques ; ces deux nomenclatures ne sont pas, d'ailleurs,
limitatives. Il range parmi les fonctions conomiques : l'assistance ; l'assurance ;
le crdit ; les transports ; les entrepts et marchs ; les services de statistique ; les
coopratives ; les compagnies ouvrires entreprenant les travaux publics, l'exploitation des mines et des chemins de fer ; les socits maonniques pour la
construction des maisons bon march ; l'instruction publique ; la rvision de la
proprit et la consolidation du systme allodial ; l'impt.
Pour mettre un peu d'ordre dans l'examen des problmes poss ici par
Proudhon, il faut commencer par reconnatre qu'au contact du milieu purement
conomique se trouvent de vastes domaines qui appartiennent d'une faon plus ou
moins complte, l'activit de l'tat ; celui-ci finit par se faire sentir dans
l'conomie travers diverses mdiations. Nous sommes ainsi amens parler
brivement de quelques-unes des fonctions de l'tat.
1 Proudhon rangeait probablement l'impt parmi les fonctions conomiques,
parce qu'il regardait l'impt comme devant avoir pour principe un change de
services et parce qu'il accordait l'tat, la manire des physiocrates, une dotation immobilire, qui devait tre forme d'environ la moiti de la rente foncire 1.
Aucune thorie vraiment conomique de l'impt n'est possible, parce qu'en fait les
budgets de nos grands pays modernes sont domins par les dpenses que les
guerres anciennes ont occasionnes et par celles que l'on continue faire pour des
guerres ventuelles ; de pareilles dpenses ne peuvent donner lien une notion
d'change de valeurs.
Quand on regarde comment l'impt a fonctionn historiquement, on voit qu'il
manifeste deux aspects radicalement diffrents de l'tat : tantt celui-ci semble
1
Proudhon, Thorie de l'impt, p. 207 et p. 241.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
130
prendre tche de ne pas apparatre comme une volont ; la lgislation fiscale a
pour but de constituer un mcanisme arithmtique qui opre sur les valeurs
visibles et en prlve des fractions sans tenir compte des personnes auxquelles ces
valeurs peu-vent appartenir ; - tantt l'tat se donne comme un matre de morale
qui distribue la rcompense et l'intimidation suivant les mrites de ses disciples.
Dans ce deuxime systme on rpartit l'impt d'aprs les ides que le gouvernement se fait du meilleur emploi des richesses et du droit que chacun peut avoir
s'enrichir ; l'tat apparat trs nettement alors comme tant une institution de
classe.
C'est en Grce que le deuxime systme a t pouss jusqu' ses dernires
limites ; les Cits hellniques fournissent les exemples classiques de l'impt
employ comme moyen de transformation politique ; tandis que dans quelques
rpubliques les dmagogues ou les tyrans proscrivaient les riches pour s'emparer
de leur fortune, Athnes on prfrait dpouiller les riches en douceur pour
amliorer les conditions de vie des pauvres 1.
Il semble que la dmocratie n'ait jamais cess de considrer l'impt ce point
de vue ; chaque instant on propose des impts sur le revenu, sous prtexte de
modifier d'autorit l'assiette des fortunes dans un sens plus quitable. Je suppose
que peu de dputs peuvent penser que l'impt progressif pourrait tre assez
compresseur pour atteindre pleinement un tel but ; mais ils estiment que c'est dj
faire beaucoup que de donner une claire indication aux citoyens : l'tat avertit les
riches qu'il n'estime pas convenable qu'il y ait de trop grandes ingalits dans une
dmocratie et il leur impose des amendes pour leur faire comprendre que leur
fortune ne satisfait pas son idal. C'est exactement pour le mme motif que les
agrariens demandent toujours des impts nouveaux sur les valeurs mobilires ;
l'tat manquerait son devoir social s'il n'avertissait les citoyens que ce ne sont
pas des placements dignes d'loges.
L'impt progressif, alors mme qu'il n'est pas employ comme moyen direct
de spoliation (comme cela eut lieu souvent au Moyen Age), constitue ce qu'on
peut nommer un impt idaliste, puisqu'il est l'expression d'une volont prtendant imposer la socit un certain idal.
2 Dans une deuxime catgorie, je placerai les institutions que l'on peut
nommer intellectuelles et morales ; et tout d'abord il faut parler de la justice, qui
exerce une influence si grande sur l'conomie ; car il importe beaucoup, la
prosprit de la production, que les criminels soient punis, que les intrts privs
soient sauvegards et qu'il y ait des tribunaux indpendants.
L'organisation de certaines cours de justice nous montre comment il est
possible que l'tat parvienne tellement annihiler sa volont que les dbats judiciaires semblent se passer en dehors de lui ; c'est ainsi que tous les thoriciens de
la politique considrent comme un lment essentiel de la vie moderne, la sparation des pouvoirs ; - et cependant les magistrats sont nomms, comme les autres
fonctionnaires, soit par le gouvernement, soit par l'lection. Il est clair que, dans
certains cas, cette sparation des pouvoirs, si savamment organise qu'elle puisse
Paul Guiraud, La main-d'uvre industrielle dans l'ancienne Grce, p. 211.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
131
l'tre, fait dfaut et qu'alors apparat la volont de l'tat : on dit alors qu'il y a une
justice politique ct d'une justice ordinaire 1.
L'assistance et l'instruction publique me paraissent pouvoir tre ranges ici, ait
moins pour une trs grande partie ; elles manifestent galement les deux aspects je
l'tat ; tantt ces services sont dirigs d'une manire objective ; tantt ils sont
dirigs suivant le caprice des hommes politiques, Les Cits antiques avaient
pouss jusqu'aux dernires limites du possible ce dtournement des institutions
intellectuelles et morales, en affectant des sommes normes aux plaisirs populaires, aux ftes nationales, aux oeuvres d'art ; I'tat athnien avait fini par passer du
rgime de la guerre au rgime du spectacle.
3 Les nations ne sont jamais isoles ; l'tat moderne est trs port la
conqute et il ne cesse de chercher des pays neufs annexer sous le prtexte, plus
ou moins vridique, d'accrotre la prosprit conomique de ses producteurs ;
d'autre part, il a continuellement des traits de commerce ngocier avec ses
voisins. Cette politique se mle avec bien d'autres proccupations d'ordre plus
individuel : les vieux instincts de piraterie se retrouvent dans plus d'une guerre
coloniale contemporaine ; dans bien des cas des chefs militaires ambitieux ont
pouss la conqute pour avoir une occasion de s'illustrer ; enfin il y a tout un
monde de fonctionnaires qui demandent toujours voir s'agrandir le champ de
leurs oprations. L'extension de la Russie dans l'extrme Orient serait difficile
comprendre sans ces raisons 2.
Ainsi nous trouvons partout deux formes de l'tat qui se mlent d'une manire
si intime que le plus souvent les thoriciens ne semblent mme pas souponner
qu'il y ait lieu de les distinguer ; ces deux formes ne sont pas deux varits,
susceptibles d'tre distingues par les degrs d'une mme qualit ; il y a entre elles
contradiction absolue. Il ne faut donc pas s'tonner si, dans les discussions qui
s'engagent sur le rle de l'tat, il est si difficile de pouvoir maintenir un peu de
clart ; on peut dmontrer tout ce que l'on veut, suivant que l'on adopte un point
de vue ou l'autre.
a) l'tat idaliste se donne comme la Volont et l'Intelligence incarnes en
quelque sorte, dans des pouvoirs publics ; il est le matre, l'ducateur, le directeur
des volonts et des intelligences particulires ; il apprend aux hommes ce qu'ils
doivent faire et il prtend tre organis de manire ce que ses dcisions renferment toujours le plus de raison possible. C'est cette notion que les philosophes
s'attachent presque toujours et Hegel nous reprsente l'tat comme la ralisation
de l'ide morale ou l'image et la ralisation de la raison ; mais Engels
observe trs justement que cela n'est pas vrai ; en fait, il est en rgle gnrale
l'tat de la classe la plus puissante, de celle qui rgne conomiquement et qui
Suivant Iehring, le Conseil de guerre n'a d'un tribunal que le nom ; en ralit, il fonctionne
comme une autorit administrative. Le Conseil de guerre, c'est l'tat lui-mme. (volution
du droit, p. 263).
En 1878, Gambetta estimait que la France avait besoin de la Tunisie pour donner de belles
situations de fidles serviteurs de la dmocratie (Juliette Adam, Aprs l'abandon de la
revanche. p. 268).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
132
devient ainsi prpondrante au point de vue politique. 1. Cette thorie marxiste
de l'tat n'est pas toujours exacte non plus et il y aurait plusieurs types distinguer ; mais, dans tous les cas, l'tat idaliste manifeste tout autre chose que la
raison objective ; il est l'expression de la domination d'un groupe d'hommes qui
sont parvenus s'emparer de la force concentre et organise. Pour nos tudes
nous n'avons pas besoin d'aller plus loin et d'en connatre la gense.
b) l'tat administratif cherche constituer des mcanismes fonctionnant avec
rgularit et, bien des points de vue, il parat se modeler sur les institutions
conomiques ; il devrait tre plutt serviteur que matre dans la socit ; mais
clans la pratique, il est continuellement dtourn des fins qu'il devrait raliser, par
les dtenteurs de la domination. Tandis que l'tat idaliste est exclusif et tend
mme repousser tout contrle srieux, l'tat administratif accepte le concours de
corporations librement formes ; par exemple il n'y a aucune bonne raison pour
prtendre que l'tat doit seul donner l'instruction ou pour refuser des fondations
charitables le droit d'aider la justice rpressive en hospitalisant et en surveillant
des gens condamns pour lgres fautes ; etc.
c) Dans le milieu conomique nous retrouvons encore une fois l'tat, mais
avec des caractres si singuliers qu'il serait trs utile d'avoir un terme spcial pour
pouvoir le dsigner : ici les corps locaux sont beaucoup plutt appels agir que
les pouvoirs centraux et les associations prennent une si grande importance qu'on
a pu se demander parfois si tout ce champ ne devrait pas leur tre abandonn. Il y
a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas comprendre que les coopratives de consommation et les services communaux d'alimentation sont des
quivalents ; c'est pourquoi je suis entr dans de si grands dtails sur ce sujet.
Nous pouvons dire que l'tat a subi ici une profonde diminution de tte, pour
employer une expression romaine ; il ne ralise plus les fins qu'on lui demande de
raliser, qu' la condition de devenir tout le contraire de ce qu'il tait dans l'tat
idaliste ; il faut qu'il descende sur le mme niveau que des institutions d'initiative
prive, qu'il se mle elles et s'efforce de faire mieux qu'elles. Ce que Kautsky
appelle l'tat civilisateur 2 est une addition des deux formes que nous venons
d'examiner en dernier lieu, combin avec quelques fragments de la premire ; il ne
me semble pas qu'il ait t vraiment au fond des choses ; mon avis il n'a pas
spar les divers aspects de l'tat d'une manire conforme aux principes du matrialisme historique ; il y a toujours chez lui trop d'idalisme.
Le mlange qui existe dans le milieu politico-conomique est indterminable,j'entends par l qu'il serait impossible de donner une loi quelconque pour fixer la
rpartition des fonctions entre les pouvoirs centraux, les communes, les fondations et les associations libres ; il n'y a que des solutions d'espce ; on ne pourrait
mme pas construire un systme embrassant dans une synthse tout ce que renferme d'essentiel ce milieu.
1
2
Engels, Origine de la famille, de la proprit prive et de l'tat, pp. 277-278.
Kautsky, Politique agraire du parti socialiste, pp. 153-157.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
133
On peut encore dire que ce milieu est matrialis, car tout ce qui s'y passe a
pour objet une meilleure utilisation des forces productives du pays et ces forces
productives sont toujours mises en avant quand on veut opposer, d'une manire
claire, le matrialisme de l'conomie l'idalisme des philosophes. Les volonts
sont ici tendues vers une politique de grandeur conomique, de dveloppement
dans la production.
Le milieu parat tre le mieux constitu quand il y a une telle combinaison de
puissances diverses que nulle domination n'y peut apparatre ; l'quilibre est alors
assur et la neutralisation ralise. L'tat ne doit pas intervenir pour poursuivre
un idal, ni pour se crer des profits ; il s'introduit pour faire disparatre des
volonts qui gnaient le mouvement et non point pour substituer sa volont
d'autres. La neutralisation du milieu conomique peut tre compare une suppression de frottement dans une machine.
Les anarchistes n'ont pas t sans observer ces phnomnes de neutralisation
et ils ont tir de leurs observations. - d'ailleurs trs exactes - des conclusions
parfois errones, faute d'avoir pris garde aux distinctions que nous avons faites.
Ils ont t frapps surtout du rle si grand des associations libres et des coopratives de consommation notamment ; ils ont vu que, dans le milieu conomique,
elles quivalaient des communes et ils ont gnralis cette quivalence, se
demandant pourquoi toutes les institutions actuelles ne seraient pas remplaces
par des socits o l'on entre et d'o l'on sort suivant son gr.
Dans la Misre de philosophie, Marx a fait une observation dont la valeur ne
peut tre bien comprise qu'au moyen des explications prcdentes. La socit
tout entire, dit-il, a cela de commun avec l'intrieur d'un atelier qu'elle a aussi sa
division du travail. Si l'on prenait pour modle la division du travail dans l'atelier
moderne, la socit la mieux organise serait celle qui n'aurait qu'un entrepreneur
en chef... On peut poser en rgle gnrale que moins l'autorit prside la
division du travail dans l'intrieur de la socit, plus la division du travail se
dveloppe dans l'intrieur de l'atelier et y est soumise l'autorit d'un seul 1.
Cela est facile comprendre : dans l'atelier l'entrepreneur, oblig de vaincre les
normes rsistances que lui opposait la routine, a eu besoin d'exercer une autorit
absolue au dbut de la grande industrie, et il s'est trouv qu' la mme poque les
industriels ont lutt pour dbarrasser le milieu conomique des puissances qui
gnaient le dveloppement de la production ; ce milieu s'est progressivement
neutralis.
La loi nonce par Marx se trouve donc exacte, mais elle tient la coexistence
de deux causes entre lesquelles on n'aperoit pas de liaison ncessaire pour tous
les temps.
Marx, Misre de la philosophie, pp. 187-188.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
134
Introduction lconomie moderne :
Deuxime partie : socialisation dans le milieu conomique
Chapitre VII
Difficults que prsentent les gestions par les pouvoirs publics. - Exprience de
l'antismitisme viennois. - Les exploitations but fiscal. - Fiscalit du Moyen-Age
s'appliquant surtout aux changes. - Ancienne bureaucratie, sa dcadence et sa prochaine
disparition. - Contrle des citoyens sur les fonctionnaires. - Diffrence des points de vue
dmocratiques et socialistes.
Retour la table des matires
A. - Pour terminer ce sujet, il faut parler des difficults que prsentent les gestions des institutions publiques qui fonctionnent dans le milieu conomique ; ces
difficults tiennent, pour une trs grande partie, la neutralit dont il a t
question plus haut ; les citoyens ne s'intressent pas beaucoup - et surtout d'une
manire suivie - l'administration de corps qui ne touchent pas de trs prs leurs
passions. De temps autre, les habitants honntes de New-York peuvent se
rvolter contre les gens du Tammany-hall ; mais ceux-ci finissent par prendre leur
revanche quand la crise d'indignation est passe. Si la trs grande majorit se
dsintresse de la surveillance des administrations, il y a des hommes hardis et
habiles qui s'organisent pour se partager les profits du pouvoir ; il semble que
toutes les grandes villes doivent tre finalement gouvernes par des politiciens
n'ayant pour industrie que de dpouiller leurs concitoyens.
Cette situation n'est videmment pas nouvelle ; de tout temps, les communes
et les fondations pieuses ont t mises au pillage par ceux qui les administraient ;
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
135
le Moyen ge est tout plein de querelles suscites par les abus de la gestion des
villes riches ; la bourgeoisie se faisant des revenus avec les impts qu'elle percevait sur la masse populaire 1.
Les gestions municipales se lient, de la manire la plus troite, avec l'organisation lectorale que les partis peuvent constituer pour se maintenir au pouvoir ; il
est clair qu'un tribun hardi et peu scrupuleux est capable de tirer un singulier
profit d'une grande extension des services municipaux. Vienne, le fameux
Lueger parat s'tre servi de ces moyens avec une remarquable adresse ; on a
d'abord cru que son sjour l'htel de ville n'tait qu'un accident ; en 1899,
Ellenbogen annonait la dfaite prochaine du Clon viennois 2, il signalait la
corruption des meneurs de l'antismitisme ; mais l'exprience a dmenti les
prvisions optimistes des socialistes, et la puissance de Lueger fut plus grande que
jamais. Aprs les lections de 1900, Otto Pohl expliquait le succs des chrtiens
sociaux en faisant remarquer que ce parti flatte l'esprit populaire jusque dans
ses faiblesses, excelle dans la pratique de l'agitation, dispose de toute la machinerie officielle et ne recule devant aucune illgalit . Vienne, disait-il encore,
contient Un grand nombre d'individus occups dans les entreprises municipales,
qui ne peuvent voter librement 3.
Je sais bien que beaucoup de personnes diront que l'antismitisme n'est qu'une
caricature de la dmocratie et qu'ainsi l'exprience des services municipaux de
Vienne ne prouve rien. C'est l une trs mauvaise dfaite ; en 1900 en prsence
des succs nationalistes de Paris, la Petite Rpublique a cru craser ses adversaires en les traitant de dmagogues ; mais encore faudrait-il savoir s'il y a des
dmocraties sans dmagogues ! L'exprience des municipalits antismites est
d'autant plus intressante tudier qu'ici nous ne risquons pas de confondre
dmocratie et socialisme, comme cela a lieu si souvent dans les discussions ; nous
sommes sur nu pur terrain dmocratique.
Kautsky apprcie la politique antismitique scientifiquement, quand il classe
parmi les dmocrates les petits bourgeois amis de Lueger. La servilit, le besoin
de raction en font des suppts volontaires et mme les dfenseurs les plus fanatiques de la monarchie, de lglise et de la noblesse. [Ces catgories] n'en restent
pas moins dmocratiques ; les formes dmocratiques seules leur permettent
d'exercer une influence politique... On a pu croire au dbut que [cette dmocratie
ractionnaire] ne formait qu'une transition particulire du libralisme la
dmocratie socialiste. Aujourd'hui, chacun peut voir combien cette doctrine est
insoutenable 4 .
Souvent on se demande si, au lieu de grer directement des services publics,
les administrations n'auraient pas plus d'avantage les contrler. Il est probable
qu'un tel systme est beaucoup plus favorable la libert des ouvriers que le
prcdent ; ils ne sont plus obligs de devenir les hommes d'un parti pour pouvoir
conserver leur place. D'autre part, un gouvernement trouvera, d'ordinaire, plus
commode d'adresser des injonctions une compagnie que de prendre lui-mme
1
2
3
4
Par exemple : Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer, pp. 160-161 ; Vanderkindere, Le sicle
des Artevelde, pp. 138-139 ; Frantz Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, pp. 71-72.
Mouvement socialiste, 15 aot 1899, p. 205 et p. 201.
Mouvement socialiste, 15, juillet 1900, pp. 82-83.
Kautsky, La rvolution sociale, p. 68.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
136
les mesures d'excution : cela est trs visible, par exemple, pour les chemins de
fer ; s'ils sont exploits par l'tat, toute rforme de tarifs fera courir les risques de
pertes de revenu, et tout changement dans les rgles de l'exploitation pourra engager la responsabilit pnale des hauts fonctionnaires ; mais s'ils sont exploits par
des compagnies, sous le contrle de l'tat, le ministre pensera que les employs
suprieurs des compagnies trouveront bien moyen de se dbrouiller, qu'ils feront
des conomies sur des chapitres moins ncessaires de leur budget, et qu'ils sauront
imposer tous une discipline en rapport avec les difficults nouvelles. Aussi les
ministres ne sont-ils pas avares de prescriptions.
Dans les pays o la corruption administrative est excessive, les concessions
d'eau, de gaz, de tramways, ont donn lieu aux plus graves prvarications. Beaucoup de personnes raisonnables se demandent si, malgr les abus qui se produisent dans les rgies municipales, ce dernier systme ne vaut pas mieux cependant.
On peut toujours esprer qu'au bout de quelques annes il y aura un scandale
public forant introduire des rformes partielles ; - les vols se comptent seulement par annes avec la rgie, tandis qu'avec les concessions leurs effets se
prolongent sur un demi-sicle. D'autre part, quand la conclusion et l'excution des
contrats municipaux dpendent de pots-de-vin importants remis aux fonctionnaires, les socits srieuses se retirent et les villes ne trouvent plus comme concessionnaires que des aventuriers, qui font mal les travaux, exploitent chrement,
exigent des tarifs exorbitants, et souvent n'ont d'autre but que de se faire racheter
dans des conditions scandaleuses.
Trs frquemment, on vante la municipalisation des transports publics comme
un moyen fiscal excellent ; il arrive parfois que les contrats sont rdigs de telle
manire que la ville n'a payer une indemnit que d'aprs les recettes passes, ce
qui lui permet d'encaisser, comme produit net, toutes les amliorations de trafic.
Le rachat peut tre une excellente affaire quand une ville est en vue de trs rapide
accroissement : le profit est alors certain ; le public se trouve ainsi profiter d'une
rente qui aurait t acquise aux entrepreneurs.
B. - Ici nous touchons l'une des plus graves questions qui puissent se poser
en matire d'administration : convient-il que le revenu net soit vers aux caisses
publiques, ou bien faut-il en faire profiter les clients et exploiter prix de
revient ? Comme les besoins des tats et des villes vont toujours en croissant, la
premire solution a le plus de chances d'tre adopte ; elle correspond d'ailleurs
une, tradition extrmement ancienne ; jadis les oprations d'change taient considres comme une excellente matire imposable. Lorsque ce systme fiscal est
adopt, l'tat fait valoir sa volont comme le ferait un matre ; il ne se neutralise
pas clans le milieu conomique ; il est alors tout fait absurde de parler de
socialisation du milieu conomique. Il y a alors exploitation du milieu par l'tat et
non gestion socialiste.
La situation de l'ancienne socit avait conduit demander beaucoup de ressources l'change ; le numraire tait fort rare et les gouvernements employaient
mille ruses pour pouvoir s'en procurer ; leurs besoins taient alors hors de toute
proportion avec les ressources de la circulation montaire normale. Les villes
taient exploites sans vergogne par les rois, parce que les villes taient des lieux
o le numraire s'accumulait. Un auteur qui a tudi avec beaucoup de sagacit
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
137
les institutions du Roussillon au Moyen-Age, voit dans les emprunts des
rquisitions de numraire ; l'emprunt forc tait de rgle ; le roi Pierre IV donne
aux consuls de Perpignan l'autorisation de svir contre les gens riches qui ne
veulent pas acheter de rentes constitues ; les changeurs doivent porter leur argent
la banque municipale 1 ; quand on est embarrass, celle-ci met du billon en
place d'argent 2.
Dans ce systme fiscal les Juifs jourent un trs grand rle, parce qu'ils taient
accumulateurs de numraire ; le roi se rserve de les taxer sa guise, ils sont les
pourvoyeurs officieux du Trsor. Les princes aviss les mnageaient et les
considraient comme une pice essentielle de leur organisation financire. On
facilite l'tablissement [du Juif] ; on l'aide dans ses affaires ; on le protge dans les
voyages qu'il entreprend pour en traiter. Si les agents administratifs serrent de trop
prs les rglements..., le roi, c'est--dire le fisc, inter-vient en faveur de ces
instruments de production que l'on risque de dtriorer. Le Juif est un immeuble
par destination ; il ne doit pas se dplacer sans autorisation, assimil un article
de commerce qui se fait rare ; et l'occasion on prohibe son exportation conjointement celle du cochon, du bois, du cuir, du poisson frais ou sal 3 .
Les voyageurs ayant toujours de l'argent, sont naturellement des tres corvables, galement viss par les brigands et par les receveurs de pages ; autour des
grandes villes de commerce, chacun veut tirer parti de la richesse des marchands.
Trs souvent l'exagration des redevances constitua une entrave si vidente pour
le commerce que les royauts modernes entrrent en lutte contre les gens qui
profitaient de ces pratiques et s'efforcrent de faire disparatre, par des moyens
plus ou moins arbitraires, les charges imposes sur les routes. Il n'y a pas un trs
grand nombre d'annes que les grandes puissances maritimes ont rachet le page
peru par le Danemark pour l'entre dans la Baltique.
Les octrois constituent une trs remarquable survivance de l'ancienne fiscalit ; en 1860, la Belgique les a supprims dans 78 villes o ils existaient ; l'tat a
abandonn aux communes une partie des revenus qu'il tirait des postes, du caf,
des accises sur les spiritueux et le sucre. L'exprience faite en France rcemment
montre qu'il n'est pas facile de trouver des taxes municipales de remplacement ;
aussi beaucoup de personnes pensent-elles qu'il aurait t convenable de faire
concourir l'tat cette rforme ; celle-ci tait rclame a grands cris par les
viticulteurs qui espraient trouver ainsi un moyen d'couler leurs vins 4 ; il et t
assez naturel que l'ensemble du pays participt ce rachat de pages municipaux ; le gouvernement n'a pas voulu admettre ce principe et n'a pas mme permis
aux communes de percevoir des taxes sur les ventes et hritages d'immeubles 5.
L'opinion gnralement reue, l'heure actuelle, est que toute taxe perue sur la
circulation est trs dommageable pour l'ensemble du pays ; c'est pourquoi le
1
2
3
4
Cette banque (tabula en latin, taula en catalan) parat dater de la fin du mil, sicle.
mile Desplanque, Recherches sur la dette et les emprunts de la ville de Perpignan dans le
Bulletin de la Socit agricole, scientifique et littraire des Pyrenes-Orientales, 1891, p. 297,
p. 301, p. 307, p. 309.
mile Desplanque, Les infmes dans l'ancien droit roussillonnais, p. 36.
Haussmann aurait voulu diminuer l'octroi des vins Paris et il s'appuyait sur l'exemple de
Lyon o la consommation tait double de celle de Paris, cause en partie de la modicit de
l'octroi (Mmoires, tome II, pp. 284-285).
Cela s'est fait Leipzig d'aprs Yves Guyot. (La suppression des octrois, p. 50).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
138
gouvernement aide les dpartements et communes racheter les ponts page ; il
n'y aurait aucune bonne raison pour ne pas appliquer les mmes principes
l'octroi 1.
Nous verrons que Proudhon aurait voulu que les chemins de fer ne fissent pas
payer les frais de premier tablissement ceux qui s'en servent, disant que la
part de l'tat, c'est--dire du pays, dans le produit des chemins de fer ne se traduit
point en recette, mais en remise, c'est--dire en rduction de tarif ; et il ajoute :
Un tat qui, aprs avoir dpens en travaux d'utilit publique 20 ou 30
milliards, voudrait en faire payer la rente aux particuliers, n'aboutirait qu' arrter,
par ses taxes prohibitives, tout commerce et toute industrie 2. Il y a dans ces
paroles une certaine exagration ; mais l'ide semble juste.
C. - Le problme le plus grave que soulve la gestion par l'tat est celui du
contrle que les citoyens peuvent exercer sur les services publics. Le problme n'a
gure t abord jusqu'ici, parce que la dmocratie a impos son dogme de la
souverainet des majorits. Il y aurait lieu cependant de prendre des prcautions
contre les majorits.
La division des pouvoirs peut offrir ici quelques avantages ; on peut, en effet,
esprer qu'un mme parti ne sera point parvenu dominer la fois dans toutes les
lections, surtout si celles-ci ne se font pas simultanment ; on peut donc esprer
que les diverses administrations pourraient se contrler les unes les autres. Cela
est vrai quelquefois ; mais d'autre part, la concentration est bonne quand elle
permet de confier la gestion une bureaucratie assez fortement constitue pour
avoir une certaine indpendance ; - l'indpendance des fonctionnaires a t jusqu'ici la meilleure garantie que l'on ait trouve pour assurer leur probit.
Je regrette de constater que, sur cette question, Kautsky n'a que des ides de
dmagogue ; il reconnat la ncessit d'une bureaucratie, mais il s'empresse de lui
enlever tout ce qui fait sa raison d'tre. Il faut lui retirer, dit-il, tous les caractres qui en font une classe spciale place au-dessus de la masse de la
population. Il faut dpouiller ses membres de leurs privilges, en faire en ralit
des serviteurs du peuple, auquel doit revenir le droit de choisir et de rvoquer au
moins les chefs 3. Une pareille bureaucratie, rforme la mode de Kautsky,
serait une des organisations les plus vicieuses que l'on pt rver, parce qu'elle
servirait opprimer les adversaires du gouvernement, tout en rendant trs peu de
services au public ; d'ailleurs il ne s'agit pas d'une question purement thorique ;
nous avons l'exprience de la France qui peut nous instruire sur l'histoire de la
bureaucratie.
1
2
3
Tout arrt dans la circulation frappe, disait Menier, la production en raison gomtrique, et
il avait raison . (YVES Guyot, L'conomie de l'effort, p. 290).
Proudhon, Des rformes oprer dans l'exploitation des chemins de fer, pp. 243-244. - Cf.
infra, pp. 266-268.
Mouvement socialiste, 15 dcembre 1902, pp. 2263-2264. - Cette citation se trouve au commencement du 3 d'une tude sur l'anticlricalisme et le socialisme qui n'a pas t publie
part.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
139
L'uvre essentielle de l'ancienne monarchie franaise fut la cration d'une
bureaucratie, qui servit de modle tous les pays de l'Europe continentale ; cette
cration fut le rsultat d'une trs longue volution ; on a pu dire qu'elle fut le chefd'uvre de l'esprit des coles de lgistes ; cependant il faut observer que dans
d'autres pays, o les tudes juridiques taient aussi fort en honneur, comme en
Italie, il ne se produisit pas une administration bureaucratique. Les rpubliques
italiennes se sont dbattues durant des sicles dans des convulsions, la recherche
d'un gouvernement rgulier ; elles ont essay un grand nombre de procds
ingnieux pour assurer une bonne administration leurs citoyens ; elles ont
combin les plus tranges divisions de pouvoirs sans arriver crer rien de solide.
Nous avons ainsi une preuve exprimentale de cette loi fondamentale de l'histoire : que les institutions ne se produisent pas quand on en sent le besoin, mais
qu'elles rsultent de causes externes, c'est--dire trangres aux fins que ralisent
ces institutions parvenues leur pleine maturit.
En France, la bureaucratie a pu se dvelopper parce que, depuis le XIIe sicle,
la royaut a t un pouvoir conqurant, exerant une action continue pour dtruire
les puissances locales. Unie l'arme rgulire et la magistrature, l'administration royale conqurait peu peu la France pour le roi ; ainsi, la forte unit que la
guerre introduit dans l'tat, ne se manifestait pas seulement au dehors, mais aussi
au dedans. La bureaucratie fut une sorte de milice civile, qui ne cessa de se
perfectionner et qui reprsentait l'intrt public, dans la limite o l'intrt public
dpendait de la ruine des particularits, mais qui reprsentait aussi le despotisme.
Comme toute organisation associe une conqute, elle cherchait tirer profit de
la guerre laquelle on la faisait participer.
La bureaucratie franaise atteignit sa perfection sous Napolon, qui parvint
lui imposer l'exacte discipline qu'il faisait rgner dans ses armes. L'arme avec
laquelle il triomphait des coalitions europennes avait une cohsion et une discipline que n'avait pas connues celle de l'Ancien Rgime ; le matre y faisait sentir
une unit de direction qui avait jadis manqu aux armes aristocratiques. La
bureaucratie fut rapidement admirable ; la rgularit et l'exactitude dpassrent
tout ce qu'on avait vu jusque-l ; l'avancement y tait dtermin par un examen
attentif des services rendus.
La dcadence de la bureaucratie franaise commena le jour o l'on prtendit
la subordonner aux parlementaires : ceux-ci ne voulaient pas admettre que les
pratiques bureaucratiques, les rgles traditionnelles et la conscience de fonctionnaires indpendants pussent faire obstacle leurs volonts ; tout devait s'incliner
devant la majest de la souverainet nationale, dont ils taient investis titre de
reprsentants du peuple. Les intrts lectoraux se trouvaient continuellement en
lutte avec les dcisions bureaucratiques, et les intrts lectoraux des dputs sont
des choses trs saintes. Que parfois la routine et le formalisme fussent ennuyeux
et mme comique, nul ne songe le nier ; mais cette routine et ce formalisme
taient des conditions de la conservation de l'indpendance.
Rien n'gale la navet des amis de Gambetta qui commencrent par ruiner,
autant qu'il fut en leur pouvoir, la bureaucratie et qui, ensuite, poussrent des gmissements quand ils s'aperurent que l'administration ne marchait plus avec cette
belle rgularit qu'elle avait eue autrefois. Ils s'imaginaient qu'il est possible de
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
140
dmonter et de remonter une vieille machine qui vivait d'antiques traditions. La
bureaucratie qui tait, il y a une quarantaine d'annes, claire, assez impartiale et
honnte, est devenue, pour la trs grande majorit, stupide, servile et amorale
(quand elle n'est pas nettement malhonnte).
Le mouvement de dcomposition ne s'arrte pas ; la dmocratie continue
dmolir ce qui reste de traditions ; il n'y aura plus de bureaucratie - au sens historique du mot - avant que le socialisme triomphe. Il a fallu un assemblage trop
contingent de circonstances pour produire l'ancienne bureaucratie, qu'il n'est pas
possible d'esprer qu'il puisse s'en reconstituer une nouvelle - sur commande.
Il me semble que Vandervelde fait preuve d'un esprit bien utopique lorsqu'il
crit : Partout on rclame ou on ralise une distinction plus ou moins nette entre
la politique et l'administration 1 ; ou encore : En mme temps grandira l'importance des institutions administratives dcentralises et autonomes 2 . Une telle
autonomie est en contradiction absolue avec le principe dmocratique, qui soumet
toutes choses la discrtion des lus. Ce n'est point sur de pareils songes qu'il faut
fonder les vues socialistes relatives l'avenir ; il faut se proccuper des moyens
d'assurer la gestion des services publics sans le secours d'une vritable organisation bureaucratique, solidement hirarchise 3, ayant de l'honneur en raison de
son indpendance mme.
Nous avons vu que le problme se pose exactement de la mme manire dans
les coopratives et dans les corps politiques ; les assembles gnrales ne peuvent
rien contrler ; le principe des majorits n'a de valeur que pour les groupes peu
nombreux dans lesquels les intresss peuvent suivre de prs les oprations de
leur mandataires.
Il y a quelques annes, Saverio Merlino appelait l'attention sur la ncessit
d'organiser un contrle srieux des citoyens sur le pouvoir. Ce qui frappe, disaitil, c'est l'irresponsabilit, surtout des fonctionnaires lectifs. Il faut changer cela et
assurer cette justice dans l'administration, dont on a aujourd'hui une vague
ide 4 . Sans doute, une telle rforme prsente les plus grandes difficults. Il ne
sera pas ais de trouver des tribunaux assez indpendants des partis pour juger les
lus du peuple et donner raison aux citoyens de la minorit contre ceux qui se
targuent d'tre les reprsentants de la majorit 5. Mais il n'y a rien de plus
important qu'une telle rforme. On a souvent fait observer que les Jacobins ont t
les continuateurs de la politique des Bourbons et qu'ils ont pouss les principes de
la tradition royale l'extrme. La royaut n'admettait pas le contrle, parce que
son administration devait combattre les seigneurs fodaux par des moyens
quelquefois assez contestables ; elle ne pouvait donc accepter que sa bureaucratie
1
2
3
4
5
Vandervelde, Le collectivisme et l'volution industrielle, p. 177.
Vandervelde, op. cit., p. 185. L'exprience montre que mme les chaires des Universits ne
sont pas toujours sauvegardes contre les influences des politiciens, mme des hommes d'tat
socialistes.
Marx, dans la circulaire de l'Internationale sur la Commune de Paris, dit que le principe
hirarchique tait abandonner. (La Commune de Paris, trad. franc., p. 40).
Saverio Merlino, Formes et essence du Socialisme. p. 198. Cf. p. 111 et p. 209.
Depuis que l'on a commenc dissoudre les congrgations. la Petite Rpublique a demand.
plusieurs fois, que l'on suspendt l'inamovibilit de la magistrature qui ne lui paraissait pas
assez docile.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
141
ft entrave dans cette guerre qu'elle menait pour le grand profit des matres. La
dmocratie se considre, aussi, comme tant en tat de conflit avec d'autres
forces, constitues (la Raction, lglise, les grandes socits de crdit) et elle
trouve bon d'appliquer les mmes principes que la royaut ; elle ne conoit donc
pas, non plus, le contrle des citoyens.
Nos hommes d'tat sont si persuads que les citoyens doivent rester trangers
toute action de ce genre qu'ils n'ont pu encore consentir admettre que les particuliers puissent se substituer au ministre public pour poursuivre la littrature et
l'art pornographiques ; l'exprience a cependant montr que la rpression actuelle
manque d'nergie et d'esprit de suite ; mais on comprend quelle brche serait faite
dans le vieil difice royal, si les actions populaires pouvaient se multiplier 1.
L'impuissance des citoyens a t surabondamment dmontre par un procs
engag par un contribuable parisien en vue de faire dclarer illgale l'indemnit de
6,000 francs par an que s'allouent les conseillers municipaux de Paris ; aprs des
pripties multiples, le plaideur a gagn son procs ; il a obtenu une dtaxe de
quelques centimes sur ses impts ; mais rien n'a t chang.
Pour qu'il y ait un contrle efficace, il faut que les questions administratives
soient, dans la plus large mesure, places sur le terrain du droit priv, de telle
sorte que tout citoyen puisse obtenir le redressement de tout acte contraire aux
lois, ou blessant les intrts de la localit. C'est par l'organisation des actions
populaires largement ouvertes, que l'on peut esprer rprimer les abus des
administrations : il faut que tout le monde puisse facilement prendre connaissance
des documents dont il a besoin d'avoir communication, en vue d'appuyer ses
rclamations ; il faut qu'il y ait des tribunaux assez indpendants pour pouvoir
prononcer contre les lus du suffrage universel ; il faut aussi que leurs jugements
puissent tre excuts, ce qui n'existe pas en France, mais ce qu'il serait facile
d'obtenir, en accordant aux tribunaux le pouvoir de lancer des injonctions pourvues de fortes sanctions pnales comportant l'emprisonnement.
La diffrence qui existe entre la dmocratie et le socialisme apparat ici d'une
manire particulirement claire. Pour la dmocratie, le fonctionnaire lu doit tre
contrl par le vote des lecteurs ; pour, ceux-ci, la seule question qui se pose est
celle d'apprcier si les tendances gnrales et grossirement apparentes de
l'administration sont conformes aux sentiments qui dominent l'opinion au moment
des lections ; les actes du reprsentant soumis au scrutin sont apprcis d'aprs la
raison d'tat ; il s'agit surtout de savoir s'il a fait bonne besogne comme militant
contre les ennemis du parti, et si sa prsence aux affaires sera favorable aux
progrs du parti. Pour le socialisme, il n'y a pas de sentiments de parti et de raison
d'tat ; le fonctionnaire est un mandataire charg d'une gestion ; il s'agit de savoir
s'il a bien conduit cette gestion et la question ne diffre pas de celles qui peuvent
La loi municipale du 18 juillet 1837 a admis les contribuables plaider eux-mmes dans
l'intrt de la commune, quand le conseil municipal nglige ce soin ; mais il leur faut une
autorisation du conseil de prfecture. Cette mesure a t une garantie donne la grande
proprit au moment o l'on remettait le pouvoir local des corps lus. La loi du 6 avril 1881
a conserv cette rgle.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
142
se dbattre entre un ngociant et son reprsentant. Nous sortons de l'idalisme
pour passer sur le terrain de la production.
Il est remarquer que dans la circulaire de l'Internationale sur la Commune de
Paris, Marx a compar les fonctionnaires aux contrematres des industriels ; il
semble admettre que les employs resteront en place tant qu'ils n'auront pas
dmrit, au lieu d'tre soumis des lections priodiques ; c'est un fait bien
connu que les compagnies, ainsi que les particuliers, quand il s'agit vraiment
d'affaires et de pratique, savent gnralement mettre chacun sa place et que s'il
leur arrive de se tromper, elles ont vite fait de rparer leur erreur 1 ; il pensait
que le suffrage universel pourrait faire facilement ce que font les patrons. Il est
clair que Marx se trompait, et ce qu'il y a de plus trange, c'est qu'il trouvait tout
naturel que, comme les autres serviteurs du public, les juges devaient tre
lectifs, responsables et rvocables 2 . On voit qu'il n'avait pas beaucoup rflchi
aux grandes difficults que prsente la ralisation de son programme d'assimilation des employs aux commis, des fonctions administratives aux fonctions
commerciales 3.
Pour dvelopper cette assimilation, il n'y a pas de meilleur moyen que d'entrer
dans la vole que j'indique, en donnant aux citoyens des moyens d'action judiciaire
contre les fonctionnaires. Il va sans dire que ces rgles seraient analogues celles
qui devraient faciliter aux intresss la possibilit de surveiller les administrateurs
des fondations et des associations libres ; - aujourd'hui la surveillance des administrateurs dans les socits est fort peu efficace et elle aurait grand besoin d'tre
renforce.
1
2
3
Marx, op. cit., p. 40.
MARX, op. cit., p. 39.
Saverio Merlino dit que les ides des socialistes sur l'organisation politique sont encore
vagues et incertaines. (op. cit., p. 199). - Il ne parait pas qu'il ait t, ralis de grands progrs,
ce point de vue, depuis 1903. Lorsque la rvolution de 1918 eut livr l'Allemagne impriale
aux socialistes, qui avaient pour directeurs spirituels des marxistes d'une farouche orthodoxie,
les chefs du proltariat ont t, fort embarrasss. Fort heureusement pour eux, les ides de
Lassalle avaient assez d'autorit sur la masse pour que celle-ci ait, assez facilement, accept le
maintien de trs nombreuses survivances impriales et la coopration de fonctionnaires
rompus aux affaires. Les amis d'bert ont donn ainsi un bel exemple de prudence, qui n'a pas
t d'ordinaire compris par les Franais. Chez nous, rvolution a t trop souvent synonyme
d'improvisation politique et administrative.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
Georges SOREL,
Introduction lconomie moderne
Troisime partie
Le systme de l'change
Retour la table des matires
143
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
144
Introduction lconomie moderne :
Troisime partie : le systme de lchange
Chapitre I
Les transports. - Distinction de la ville et de la campagne. - Diverses sortes de
communications rurales et leurs rapports avec la nature de la proprit. - Chemins de fer :
Voyageurs et marchandises. - Ides de Proudhon sur le transport des marchandises. - Les
tarifs lgaux et sa conception mutuelliste. - Influence de la dmocratie plus favorable aux
transports de personnes qu' ceux des marchandises. - Pages.
Retour la table des matires
Nous mettons part le systme de l'change dans le milieu conomique, parce
que ce systme est extrmement dvelopp et parce qu'il a, depuis longtemps,
donn naissance des institutions de socialisation qu'il faut tudier d'une manire
approfondie. Nous comprenons, dans ce systme : les transports, le crdit, et tout
ce qui accompagne la vente (notamment l'escompte).
Nous commenons cette tude par des considrations sur la circulation matrielle des choses. Il faut, tout d'abord, bien distinguer ce qui est urbain et ce qui
est rural ; nous avons dj en l'occasion d'appeler l'attention sur cette manire de
sparer les faits conomiques en deux classes ; mais ici, la sparation sera beaucoup plus marque et fournira beaucoup de consquences.
la ville, les transports ont surtout pour but de rendre la vie plus commode
chaque citadin, en portant certains produits sa maison, en lui permettant de
gagner rapidement son bureau ou les lieux de plaisir, en facilitant les relations.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
145
Les distributions d'eau, de gaz, d'lectricit rentrent dans la premire catgorie ;
l'emploi de l'eau, du gaz, de l'lectricit pour la production,, est tout fait secondaire la ville ; j'ai dj signal prcdemment que dans ces affaires, la
canalisation joue un si grand rle qu'on doit les traiter comme tant des moyens
de transport. - Les tramways, les omnibus, les chemins de fer mtropolitains, sont
devenus ncessaires pour permettre une population de plus en plus dissmine
de prendre part un travail qui se concentre dans des espaces assez limits ;
d'ordinaire ces communications sont rserves aux voyageurs. - La poste urbaine
et les tlphones se dveloppent sans cesse, et ont peine satisfaire tous les
besoins 1.
la campagne, au contraire, les transports ont surtout pour objet la production ; l'agriculture, l'exploitation des forts et la mtallurgie forment les trois
grands types de l'industrie rurale, et il leur faut des, moyens de transporter trs
bon march des masses normes de matires n'ayant qu'une faible valeur
marchande ; depuis quelques annes, on est oblig d'aborder les grands parcours :
la vulgarisation des engrais chimiques a conduit les cultivateurs faire, venir des
phosphates de trs loin. Parmi les transports petite distance, il ne faut jamais
ngliger les canaux d'arrosage et de desschement, qui ont jou un si grand rle
dans l'histoire des anciennes civilisations ; Marx a pu dire que la distribution des
eaux tait aux Indes une des bases matrielles du pouvoir central (materielle
Grundlage des Staatsmacht) 2.
Quand on examine de combien de manires la proprit peut se trouver en
contact avec les moyens de transport, on est amen faire les distinctions qui
suivent :
a) Il faut considrer, tout d'abord, ce qui est relatif l'exploitation du domaine,
et trois cas essentiels peuvent se prsenter : 1 Si les terres forment des bandes
minces, comme dans les banlieues morceles dcrites par Le Play, il faut adopter
souvent un rgime uniforme de culture, parce qu'il serait impossible de laisser des
chemins d'exploitation entre les troites parcelles ; il n'y a pas de cltures ; aprs
l'enlvement des rcoltes, la vaine pture se pratique. Il n'existe pas de systme o
la proprit soit moins affirme que dans celui-ci. On peut en rapprocher la
culture d'irrigation par inondation gnrale de la campagne, comme elle se faisait
en gypte avant les transformations modernes : tout un canton compris entre des
digues tait livr aux eaux du Nil 3. 2 Si les domaines sont vastes et agglomrs,
1
Il est assez curieux d'observer ici qu' Paris l'administration publique n'a pu satisfaire compltement la population, en sorte que le transport des petits colis et des imprims, soit rest, pour
une trs grande partie, objet d'industrie prive.
Marx, Capital, t. I, p. 221, col. 2. Marx n'a pas malheureusement approfondi cette question, et
il semble mler la production un phnomne qui appartient certainement aux systmes des
transports. Je ne cherche pas ici Marx une querelle scolastique, comme pourraient le
supposer des lecteurs peu attentifs aux thories exposes dans ce livre. Au point de vue qui
nous occupe, en ce moment, il est trs essentiel de bien sparer ce qui a trait des transports,
que la socialisation atteint si facilement, et ce qui a trait la production, dont la socialisation
soulve des problmes d'un tout autre genre.
Avant la conqute franaise de l'Algrie, les Arabes pratiquaient la culture des crales par
inondation, au moyen de canaux larges et peu profonds, partant d'un torrent et portant au loin
l'eau verse par les orages ; l'irrigation tait fort alatoire et durait peu de temps ; cependant
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
146
comme dans les types admirs par Le Play, le propritaire a un accs sur la grande
route, une prise sur une rivire ou sur un canal, une issue pour ses eaux stagnantes
sur un missaire de desschement ; il dispose ses chemins et ses canaux son
gr ; il est compltement indpendant de ses voisins, pourvu que le rseau des
chemins et des canaux publics soit assez dvelopp pour atteindre chaque hritage. 3 Le plus souvent, on observe une situation intermdiaire ; les lois et des
usages locaux rglent les servitudes de passage et d'aqueduc au moyen desquelles
la proprit moyenne arrive la dignit de proprit vraiment autonome, et se
donne une libert gale ce que possde la grande proprit.
J'insiste sur ces dtails, parce que Kautsky me semble avoir mal interprt les
effets du remembrement, qui a pour but de diminuer les inconvnients de la banlieue morcele ; il croit que le remembrement affaiblit le respect de la proprit 1 :
cela est vrai pour le moment transitoire ou on l'opre ; mais ensuite, la proprit
est renforce ; si l'on pouvait, par impossible, arriver pousser la concentration
jusqu'au domaine agglomr, on donnerait la proprit son maximum de force.
Dans la banlieue morcele, il y a une sorte de servitude communiste (assolement
obligatoire, rcolte faite aux poques fixes par l'autorit, vaine pture) ; on passe
de l la servitude particulariste, qui relve le sentiment d'indpendance suivant
le droit.
b) On a fait, au cours du XIXe sicle, les plus grands efforts pour sillonner
tous les pays de voies de communication permettant aux paysans d'aller de leurs
terres aux marchs. Le Second empire a d la plus grande partie de sa popularit
la sollicitude qu'il avait montre pour les chemins vicinaux, il prtendit tre le
gouvernement des paysans et il y avait une grande part de vrit dans cette
prtention. Jadis, on s'tait surtout occup d'assurer les moyens de communication
entre les grandes villes commerantes, ce, qui avait procur de larges bnfices
la bourgeoisie ; dsormais, on portait l'attention sur les moindres hameaux pour
leur permettre de tirer parti de leurs ressources naturelles et de perfectionner la
production.
Les administrateurs de la commune et du dpartement ont surtout pour mission d'assurer la construction et le bon entretien de ces chemins. Le plus grand
obstacle que je voie adopter trie subdivision des dpartements en groupes plus
petits (correspondant mieux aux vieilles circonscriptions de pays) est la difficult
qui en rsulterait pour l'administration des chemins qui seraient trop souvent
coups par les limites des petits districts.
c) L'tat, dans les pays modernes, se manifeste, d'une manire trs clatante,
par les chemins de fer 2 ; c'est pourquoi il est utile d'examiner, avec quelque
dtail, la question des chemins de fer : les notions relatives la socialisation des
transports acquirent, ici, toute leur gnralit.
Quel que soit le mode de transport, le voyage des personnes prsente de grandes analogies avec les communications urbaines ; je ne parle pas seulement des
abonnements qui rendent tant de services dans les banlieues et qui transforment
1
2
les rsultats taient excellents, en gard au systme de culture extensive. Je crois que les
anciens canaux du Roussillon furent destins l'inondation.
Kautsky, Politique agraire du parti socialiste, p. 133.
On peut dire des chemins de fer d'Europe ce que Marx disait des canaux d'irrigation des Indes.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
147
les voies ferres, sur une partie de leur parcours, en prolongement de tramways.
Les trains express ne servent gure qu'aux bourgeois des grandes villes ; le paysan
n'a pas, comme le citadin, des loisirs lui permettant d'aller se promener la montagne et aux bains de mer ; il ne connat gure que le centre voisin o se tiennent
les gros marchs et o sige le tribunal.
Il ne faut pas s'tonner si Proudhon juge les chemins de fer en paysan 1 ; tout
le temps pass en voiture lui semble mal employ ; il voyait dans l'agitation des
populations, usant avec fureur des nouveaux moyens de locomotion, la preuve
que ses contemporains cherchaient moins le travail que le ngoce, c'est--dire
toutes les combinaisons et manipulations qui ont pour but de s'approprier la
meilleure part des produits, en s'en faisant l'entremetteur 2. Il aurait pu ajouter
que cet entranement est en corrlation intime avec l'aspiration des paysans
devenir bourgeois : le travail aux champs, le ngoce la ville.
Tout cela lui semblait fort artificiel ; il se demandait si les chemins de fer
pourraient continuer bien longtemps consommer des quantits normes de
matires qui ne se reproduisent pas dans le sol (fer et houille) ; il pensait que lon
reviendrait peut-tre la vieille navigation, aprs l'avoir perfectionne 3 ; ce systme, qu'il connaissait parfaitement, lui semblait tre excellent. La navigation n'est
pas morte, en effet ; elle est particulirement approprie au transport des marchandises, et surtout de celles qui intressent les trs grandes industries rurales.
Le grand problme conomique moderne, est le transport des marchandises.
Autant, disait Proudhon, il est dans la nature de la circulation voyageuse de
s'apaiser et de se rduire jusqu' ce qu'elle atteigne son minimum normal, autant il
est rationnel, ncessaire que la circulation des produits augmente. 4
Les administrations europennes se soi)[ beaucoup plus occupes cependant
des voyageurs que des produits ; elles n'ont fait que suivre une trs vieille tradition. La Constituante, dsirant perfectionner les institutions de l'Ancien Rgime,
avait dcid que la poste et les messageries rgulires feraient l'objet de services
publics, dfendant aux particuliers d'tablir des services de voitures partant
heures fixes et possdant des relais (26-29 aot 1790, 6-19 janvier et 10 avril
1791) 5 ; la Convention essaya d'organiser la rgie des messageries nationales (30
juillet 1793) qui fut abolie le 9 vendmiaire an VI. Le gouvernement a cependant
toujours conserve un contrle tendu sur les diligences, non seulement au point de
1
2
3
4
5
Proudhon, Des rformes oprer dans l'exp1oitation des chemins de fer, p. 278.
Proudhon, op. cit., p. 277.
Pour prouver qu'il convient de dvelopper certaines institutions, Proudhon semble avoir plus
d'une fois cherch convaincre ses lecteurs qu'elles triompheront la longue de celles qui
masquent au public l'importance des institutions pour lesquelles il se passionne. Cette ide
pourrait bien tre l'origine hglienne : beaucoup des commentateurs de Hegel pensent que
d'aprs son systme la religion devait cder la place la philosophie. Quelle que fut sur ce
point l'opinion authentique de Hegel, il me semble ncessaire de reconnatre la coexistence
possible des divers moments de l'activit humaine ou de la rflexion. Bien que le capitalisme
industriel prenne la premire place dans l'conomie moderne assez tardivement, on ne voit pas
qu'il ait jamais fait disparatre le capitalisme usuraire.
Proudhon, Op. cit., p. 275. Cf. p. 306.
La vitesse en diligence devait tre de 25 30 lieues par jour, en carrosse ; en fourgon de 15
20 lieues par jour. Les tarifs maxima taient fixs 14 centimes par kilomtre en diligence, 9
centimes en carrosse et 4 centimes 1/2 en fourgon. Les colis taient taxs raison de 1 fr. 15
par tonne kilomtrique en diligence et 0 fr. 69 en fourgon et carrosse.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
148
vue de la scurit, mais aussi au point de vue de la commodit du voyage. Le
service des grosses marchandises ne semble avoir t considr comme digne
d'intresser le gouvernement qu'au moment de la construction des chemins de
fer 1 ; mais les tarifs qui furent alors tablis dans les cahiers des charges sont
purement thoriques, n'ayant qu'un rapport trs lointain avec les classifications et
les prix adopts par les compagnies.
Proudhon ne comprenait point, pourquoi l'tat traitait de manires si diffrentes les diverses espces de transports, pourquoi il n'appliquait pas un mme
principe aux voies d'eau et celles de fer ; en 1850, il demanda l'Assemble
lgislative que le gouvernement s'intresst - par une subvention, une garantie
d'intrt et des travaux faits pour amliorer les rivires, - une entreprise de navigation sur la Sane et le Rhne : il proposait une tarification lgale, trs lgrement suprieure celle qu'il esprait, pouvoir raliser. Depuis quelques annes,
l'administration franaise est entre plus directement qu'autrefois en contact avec
la navigation ; quand le mouvement est considrable sur un canal, elle installe un
service de remorquage obligatoire ; elle ne s'occupe plus seulement de la voie,
mais encore de la traction.
Dans son projet de 1850, Proudhon ne demandait pas le monopole pour la
compagnie qu'il reprsentait. Plus tard, dans la Capacit politique des classes
ouvrires, il esquissait le programme du rgime qui lui paraissait le mieux
approprie aux transports : J'ai pratiqu, disait-il, pendant dix ans la navigation
intrieure, et je l'ai vue s'teindre sans qu'elle ait pu parvenir s'organiser Il a fallu
en venir aux concessions par l'tat des chemins de fer, au monopole inhrent ce
mode de transport, la coalition des compagnies, enfin, pour que l'on conut la
possibilit d'un pacte quitable et avantageux tous dans le voiturage. Rien de
plus simple, pourtant, que l'ide de ce pacte . Les entrepreneurs auraient demand aux industriels de leur assurer leur clientle durant un certain temps, et ils
auraient garanti des tarifs et des dlais de transport : L'engagement sera
modifiable, diraient-ils, toutes et quantes fois il se produira une invention ou une
concurrence srieuse pouvant excuter le service meilleur march. Dans ce cas,
nous devrons tre avertis, afin que nous puissions nous mettre en mesure et garder
la prfrence 2. Ce pacte de mutualit aurait servi socialiser le voiturage, en
assurant la fixit, la modration des prix, des conditions gnrales de transport :
ce que l'tat a entrepris de faire au moyen de ses cahiers des charges, aurait pu se
faire librement par des contrats. Mais cela n'a pas eu lieu, et quoi qu'en pense
Proudhon, cette fatalit prouve, que la socialisation des transports ne peut pas
se faire facilement sans l'intervention des administrations publiques.
Nous voyous aussi l un bel exemple de l'influence des solutions produites
empiriquement par l'industrie, sur les thories juridiques. Proudhon affirme, luimme, que sans le rgime des chemins de fer on n'aurait pas pu se rendre compte
de la porte du pacte mutuelliste qui lui semblait propre rsoudre la question des
transports par la libert et l'association. L'idologie est donc dans ce cas, et de
l'aveu du plus grand idaliste du XIXe sicle, le produit d'institutions engendres
1
Proudhon observe que l'industrie avait dj fait un trs grand progrs en organisant le roulage
acclr ; les transports sont alors devenus, ses yeux, une vritable science (op. cit., p. 13). Il
calcule que le prix de revient tait de 16 17 centimes par tonne (p. 161), et montre que les
cahiers des charges des chemins de fer, supposant des tarifs de 14 20 centimes, adoptaient
des chiffres trs voisins de ceux du roulage, (p. 17 et p. 67).
Proudhon, Capacit politique des classes ouvrires, pp. 114-115.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
149
par la simple ncessit de tirer parti d'une technique nouvelle : les chemins de fer
appelaient ncessairement des rglements gnraux sur les transports ; l'esprit
revenant sur les formes antrieures du voiturage, leur donne une thorie inspire
par la pratique de la forme la plus avance.
On comprend facilement pourquoi les grandes compagnies se proccupent
beaucoup plus des voyageurs que des marchandises ; non seulement leurs chefs
sont des bourgeois, dans toutes les acceptions que peut prendre ce moi, mais
encore ils redoutent toujours les criailleries des hommes dont la profession est de
faire marcher l'opinion publique ; l'opinion se fait dans les villes et il ne faut pas
trop conomiser sur les dpenses qui intressent les urbains 1. On est arriv ainsi
transporter parfois les voyageurs nu tarif infrieur il leur prix de revient et
faire payer, par suite, une partie des plaisirs urbains aux producteurs ruraux.
En Amrique, on trouve que pour l'anne 1898, le rapport entre le prix d'un
voyageur et celui d'une tonne de marchandises tait :
Sur l'ensemble des lignes................................ 2.18
New-York Central R-R .................................. 3.1
Pensylvania R-R .......................................... 3.8
Lake Shore and Michigan SouthernR-R.............. 4.1
tandis qu'en France on a en 1899
Sur les six grands rseaux............................... 0.79
Sur le rseau de l'tat .................................... 0.59 2
L'conomiste qui se place au point de vue des progrs de la production, devra
considrer les chemins de fer comme des auxiliaires des trs grandes industries
rurales et dira qu'ils sont d'autant plus utiles qu'ils desservent mieux les intrts de
ces industries, qui ont besoin de trouver des transports trs bon march. On
pourra se faire une ide grossirement approximative de cette utilit, en classant
les voles ferres d'aprs la valeur des coefficients donns ci-dessus ; plus le
chiffre sera fort, plus aussi le service des chemins de fer a des chances d'tre
favorable la mise en valeur des forces productives.
On observe immdiatement que le rseau de l'tat franais se place aprs les
autres rseaux ; cette infriorit s'explique en partie par des raisons locales ; mais
je crois qu'on peut affirmer que les administrations d'tat sont plutt proccupes
des personnes que des marchandises, surtout dans les pays o la dmocratie
exerce une influence notable ; la dmocratie a toujours plac le bien-tre et mme
les plaisirs des citadins au premier rang de ses proccupations. Depuis que la
Suisse a rachet les principales ligues, elle a cherch amliorer le sort du
1
2
Sans compter que les compagnies accordent des quantits de permis aux gens qu'elles
supposent capables d'exercer une influence sur l'opinion.
Revue gnrale des chemins de fer, novembre 1900, pp. 811-812.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
150
personnel ; elle a dvelopp les billets d'aller et retour ; mais les abaissements de
tarifs pour les marchandises ont t renvoys des temps meilleurs 1.
On pourrait dfendre l'exploitation par l'tat en disant que les compagnies ne
sont pas toujours assez stimules favoriser le progrs du trafic ; elles recherchent trop le plus grand revenu net. Il y a une assez longue priode durant laquelle
l'accroissement de ce revenu marche de pair avec l'accroissement de la quantit du
transport 2, mais il arrive un moment o les variations de revenu net deviennent
tellement minimes, qu'il est alors douteux qu'une rduction de prix puisse tre
avantageuse pour la compagnie ; mais ce qui n'est pas douteux, c'est que les
embarras du service augmentent avec une trs grande rapidit, quand il y a un
certain nombre de trains sur une ligne. Je trouve que durant l'exercice 1898-99 sur
le New-York Central R-R, il y a eu accroissement de trafic de 8,5 %, tandis que la
recette correspondante s'accroissait, seulement de 1/8 % 3 ; et cependant sur toutes
les grandes lignes amricaines, on ne cesse de combiner l'exploitation en vue de
faciliter la multiplication du trafic, en rduisant le nombre de trains par suite de
l'emploi de machines et de wagons plus gros 4. Dans de pareilles conditions, une
administration peut hsiter beaucoup avant de poursuivre un bnfice aussi alatoire que celui que l'on peut attendre d'un abaissement de prix, trs favorable
cependant l'industrie nationale.
Mais pour que l'on puisse attendre une action efficace dans ce sens, d'une
administration d'tat, il faut que le gouvernement mette au premier rang de ses
proccupations, la protection des industries rurales ; il est vraisemblable que le
gouvernement prussien peut obtenir des rsultats bien meilleurs que ceux que l'on
pourrait attendre d'autres gouvernements europens, parce qu'il est essentiellement rural.
Il faut ajouter que les bureaucraties n'aiment rien tant que le repos et vitent,
autant que possible, d'engager leur responsabilit. Un ministre des travaux publics
trouve trs faciles les rformes qu'il cherche imposer aux compagnies ; mais il
hsitera souvent longtemps les appliquer, s'il doit porter tout le poids des consquences : dficits des recettes et accroissement du nombre des accidents, rsultant
de l'abaissement des recettes et de la multiplication des trains.
Proudhon a toujours soutenu qu'il faut affranchir les transports du page qui
correspond aux frais de premier tablissement ; les directeurs des compagnies de
chemins de fer ont souvent signal l'anomalie que prsentent, a ce point de vue,
les voies ferres, concurrences par des canaux sur lesquels la batellerie ne, paie
ni le premier tablissement, ni mme l'entretien annuel. Il est probable qu'aucun
pays en Europe ne serait assez riche pour supprimer les pages des chemins de
1
2
3
4
Haguet, Le rachat des chemins de fer suisses et leurs consquences, p. 94.
Souvent on raisonne comme s'il en tait ainsi toujours ; cela n'est vrai que dans certaines
limites et devient faux quand on atteint un haut trafic. (De la Gournerie, tudes conomiques
sur l'exploitation des chemins de fer, p. 127).
Revue gnrale, etc., loc. cit., p. 798.
En accroissant la capacit du wagon, les constructeurs ont rduit le rapport du poids mort au
poids utile, rapport qui, l'origine des chemins de fer, tait exagr.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
151
fer : il faut les considrer comme des impts et examiner quelle est la meilleure
assiette adopter pour cet impt sur la circulation.
Les compagnies ne traitent pas toutes les marchandises de la mme manire
au point de vue du page ; les diffrences de tarifs s'expliquent mai par des
diffrences dans les prix de revient de l'exploitation ; les compagnies descendent
quelquefois des chiffres qui ne comprennent plus que les Frais de transport sans
page 1. Pour les marchandises ayant une grande valeur, une notable majoration
est sans importance ; pour une marchandise bon march, il suffit parfois d'une trs
lgre majoration pour arrter tout le trafic. Ce principe est pratiqu par toutes les
compagnies ; l'tat l'applique la batellerie ; les canaux seraient trs peu utiliss
si ou faisait payer des pages. On peut dire que tous les produits sont placs entre
deux types extrmes : l'un peut supporter des frais levs sans inconvnient et
l'autre ne devrait supporter aucun page ; dans cette dernire classe se rangent
presque tous les produits agricoles, forestiers et mtallurgiques.
Si l'on -veut approfondir davantage ce principe de distinction, il faut revenir
la sparation des villes et des campagnes. Paris le gaz et les tramways sont
fortement imposs au profit de la caisse municipale ; et de plus la Ville doit entrer
en possession d'une partie importante de l'outillage la fin de la concession.
L'tat trouve galement que le service des postes doit lui laisser un notable revenu
net. Il y a donc des transports se rapprochant du type urbain qui peuvent tre, sans
trs grave inconvnient, imposs et qui par suite peuvent devenir des rgies
fiscales. Une rgle toute diffrente devrait tre applique aux transports du type
rural ; ceux-l ne peuvent pas facilement supporter les impts et ils devraient tre
totalement affranchis de page quand il y a moyen de le faire ; en tout cas ils ne
devraient supporter qu'une fraction du page.
La pratique des gouvernements tient compte partiellement de cette diffrence :
aprs la guerre de 1870 on a mis un impt sur les transports de petite vitesse ; le
commerce rclama si vivement que cet impt disparut assez rapidement, mais il
subsiste encore une taxe de 12 % sur les voyageurs ; ayant 1892 cette taxe tait
mme de 23,2 %. En mme temps les compagnies ont d abaisser leurs tarifs de
voyageurs, suivant un engagement qu'elles avaient pris en 1883 ; il est vident
qu'il aurait t bien plus avantageux pour la production que les sacrifices eussent
port sur les prix de transport des engrais et des houilles ; mais l'esprit dmocratique et bourgeois n'et pas t satisfait.
De la Gournerie, op. cit., p. 134.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
152
Introduction lconomie moderne :
Troisime partie : le systme de lchange
Chapitre II
Plaintes de, producteurs contre la distribution du crdit. - Enthousiasme provoqu par les
premires banques. - L'usure ancienne et l'glise. - Position particulire de saint Thomas et
ses origines. - La lutte contre l'influence musulmane. - L'usure juive rend inutile l'usure
chrtienne et permet de faire une thorie sur l'interdiction absolue du prt intrt.
Retour la table des matires
L'histoire du crdit manifeste, d'une manire particulirement saisissante, l'opposition qui existe entre les producteurs et les matres de l'change 1 ; elle montre,
aussi les heureux effets qu'a produits partout la socialisation du crdit se
substituant la particularit des temps anciens.
Les usuriers ont soulev, de tout temps, la rprobation des moralistes parce
qu'ils emploient des procds peu dlicats pour amener leurs victimes signer les
contrats, parce qu'ils abusent, sans piti, de l'ignorance ou de la misre de leurs
emprunteurs pour leur imposer des conditions anormales, parce que le dvelop1
On peut tablir ainsi qu'il suit, une classification des abus commis par le capitalisme usuraire.
1 l'origine l'usure est un prt fait un producteur qui accepte des charges crasantes parce
qu'il s'illusionne sur l'avenir de sa production. L'usurier achte aussi des marchandises un
prix drisoire, quand sa victime, pouss par le besoin d'argent, espre se remettre flot plus
tard. Les majorations du capital dans les socits par actions sont encore des formes de
l'usure. - 2 Lorsque des dtenteurs de richesses sont dcourags, ils cdent souvent leurs
biens dans l'esprance de trouver un bon emploi de leur ralisation, c'est ainsi que les vieilles
familles ruines sont exploites par des bandes noires ; la Bourse, beaucoup de fortunes
s'difient sur les ventes perte que font des spculateurs timides. - 3 Durant les crises, les
valeurs mobilires sont traites comme des marchandises dont un ngociant embarrass se
dbarrasse n'importe quel prix, pour pouvoir viter une faillite imminente.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
153
pement de l'usure ruine la petite production familiale. L'usurier soulve contre lui
les sentiments lmentaires d'quit et il n'est pas loin d'tre assimil un
criminel dans l'opinion publique. Mais pour l'conomiste et l'homme d'tat proccup de l'avenir conomique du pays, l'usurier est aussi un individu dangereux.
Marx observe trs justement que l'usurier s'empare de tout le revenu net, ne
laissant sa victime que ce qui est strictement ncessaire pour vivre ; ds lors plus
moyen d'amliorer la terre ; le capital usuraire paralyse les forces productives au
lieu de les dvelopper et ternise cette situation misrable dans laquelle, contrairement ce qui se passe dans la production capitaliste, la productivit sociale du
travail est incapable de se dvelopper par le travail et aux dpens du travail luimme 1 . Et plus loin : Le capital usuraire exploite, mais ne produit pas comme
le capital [industriel] 2.
Nous devons ajouter que l'usure a pour effet d'appauvrir la campagne aux
dpens des villes et qu'elle montre, sous un des aspects les moins potiques, l'opposition de la ville et de la campagne ; trs souvent l'usurier ne dsire pas acqurir
la terre dont il a ruin le propritaire et prfre rester son crancier hypothcaire,
toucher des rentes sur une population misrable. C'est ce que l'on reproche partout
aux Juifs. Si le riche banquier devient propritaire, peut-tre amliorera-t-il la
culture ; mais s'il reste receveur de rentes, il n'y a aucun espoir fonder sur lui ! Il
ne faut pas s'tonner si Fourier, en raison de sa proccupation d'idylle champtre,
est si fort ennemi des Juifs ; il trouve que le plus honteux des [vices rcents de
la civilisation est] l'admission des Juifs au droit de cit . Il leur reproche de se
livrer exclusivement an trafic, l'usure et aux dpravations mercantiles. Tout
gouvernement qui tient aux bonnes murs, devrait y astreindre les Juifs, les
obliger au travail productif, ne les admettre qu'en proportion d'un centime ; mais
notre sicle philosophe admet inconsidrment des lgions de Juifs, tous parasites,
marchands, usuriers, etc. 3.
Au dbut des temps modernes, la Hollande offrit un spectacle nouveau : Le
capital industriel et commercial, en prenant l'extension, se subordonna le capital
productif d'intrts. De l le bon march de l'intrt et le remarquable panouissement conomique de ce pays. Le monopole de l'ancienne usure, bas sur la misre, y avait disparu de lui-mme . Cette exprience exera une influence dcisive
sur l'esprit europen ; on se proccupa, surtout en Angleterre, de crer des institutions capables de fournir de l'argent bon march aux hommes entreprenants.
Le chef du mouvement, dit Marx, est Josiah Child, le pre de l'organisation des
banques prives en Angleterre... Il dclame contre le monopole des usuriers. Ce
Josiah Child est en mme temps le pre de l'agiotage anglais et l'un des autocrates
de la compagnie des Indes orientales... Dans tous les crits anglais qui furent
1
2
3
MARX, Capital, livre III, 2e partie, trad. fran., pp. 166-167.
MARX, loc. cit., p. 169.
Fourier, Nouveau monde industriel et socitaire, p. 499. - Il dit un peu plus loin : La partie
lucrative du commerce est l'usure. On remarquait en 1800 que les Juifs dans les quatre
dpartements cisrhnans (Mayence, Trves, Cologne, Coblentz) avaient, envahi en dix ans,
par l'usure, On quart des proprits. Il faut que le gouvernement s'empare de cette branche par
l'entremise des fermes fiscales. Il acquerra bientt un tiers des proprits, tout en mnageant
les emprunteurs . Comme cela arrive le plus souvent chez Fourier, cet auteur s'lve de
hautes considrations en embrouillant les ides qu'il rencontre dans des milieux o n'existait
qu'une culture des plus mdiocre, une culture entretenue par des journaux qui ne dpassrent
gure le niveau du Petit Parisien.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
154
publis sur les banques pendant le dernier tiers du XVIIe sicle et au commencement du XVIIIe, on rencontre la mme hostilit que chez Child contre l'usure et la
mme tendance affranchir de son joug le commerce, l'industrie et l'tat 1.
Marx prtend que les saint-simoniens ne firent que reproduire ces thories
anglaises, qui ont pour objet de revendiquer la subordination du capital productif d'intrts et du prt en gnral la production capitaliste . Il dit qu'il y a
concordance mme dans le choix des expressions 2 ; - ce qui montre comment
des situations conomiques analogues peuvent engendrer des identits idologiques 3.
Le crdit, dit Marx, en se dveloppant, ragit, de plus en plus contre l'usure,
non pas dans le sens de la raction des Pres de l'glise, de Luther et des premiers
socialistes, mais en subordonnant le capital productif d'intrts aux conditions et
aux ncessits de la production capitalistes 4 . Ainsi nous trouvons, dans cette,
histoire, la preuve que c'est par le, progrs des institutions conomiques, plutt
que par des mesures coercitives, que l'on peut lutter contre des abus dnoncs
vainement par les moralistes ; l'impuissance de la bonne volont n'apparat nulle
part plus manifeste que dans l'histoire de l'usure. Il est extrmement remarquable
que les Franciscains, si mls la vie populaire, se soient aperus, durant la
seconde moiti du XVe sicle, qu'il n'y avait pas d'autres moyens de supprimer les
usuriers que d'organiser le crdit populaire ; ils crrent, cet effet, les monts-depiti. L'idologie se modifiant au gr des institutions, quand l'utilit des monts-depit fut reconnue, la lgitimit du prt intrt fut bien prs de l'tre galement.
Les raisons qui avaient fait que l'glise avait si longtemps condamn les
usuriers sont assez simples ; elle n'avait pas eu besoin de procder une, analyse
trs approfondie des phnomnes conomiques ; elle avait incorpor dans son
code moral les apprciations que la trs grande masse des hommes moraux
avaient au sujet des usuriers. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de faire intervenir ici
les avantages qu'aurait procurs lglise l'interdiction du prt intrt, tels que
nous les trouvons dcrits dans un fragment emprunt par Marx un livre de J.-G.
Bsch (publi en 1808) et insr par Engels dans le troisime volume du Capital
la fin du XXXVIe chapitre ; lglise aurait tir grand profit de cette lgislation,
sans laquelle elle ne serait jamais devenue riche ; les propritaires obrs avaient
recours aux monastres pour vendre leurs biens rmr et les Juifs ne pouvaient pratiquer l'usure de cette manire, la possession de [telles] garanties ne
pouvant tre dissimule . Je doute que Marx et fait sienne cette explication s'il
1
2
3
Marx, loc. cit., pp. 175-176.
Marx, loc. cit., p. 177.
Marx ne dit pas, en effet, que les saint-simoniens eussent emprunt leurs ides aux crivains
anglais du XVIIIe sicle. La remarque suivante est importante. Tous [les ouvrages de SaintSimon antrieurs au Nouveau christianisme] ne font que glorifier la socit bourgeoise
moderne, compare la socit fodale et exalter les industriels et les banquiers relativement
aux marchaux et aux fabricants de lois de l'poque impriale . Le nouveau christianisme fut,
je crois, inspire en bonne partie par Eugne Rodrigues, qui tait tout plein de philosophie
allemande. - C'est seulement dans ce livre, observe Marx, que Saint-Simon s'est constitu le
dfenseur de la classe ouvrire et s'est assign son mancipation pour but . Le travailleur,
aux yeux des saint-simoniens, demeurs fidles aux premiers enseignements de leur matre est
non pas l'ouvrier, mais le capitaliste industriel on commerant . (loc. cit., p. 178).
Marx, loc. cit., p. 172.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
155
et pu rdiger lui-mme son livre 1 ; il serait assez singulier, en effet, que l'glise
et au XVe sicle rendu des dcisions solennelles pour justifier l'emploi des
rentes constitues, qui ont jou un rle si considrable dans l'conomie de
l'Ancien Rgime (constitution de Martin V, en 1425), si elle avait voulu se rserver le monopole des oprations usuraires.
Je ne conteste pas que l'esprit de beaucoup d'auteurs ecclsiastiques ait pu tre
influenc par des considrations d'ordre conomique se rattachant la vie des
ordres religieux auxquels ils appartenaient. La constitution de 1425 porte que dans
le diocse de Breslau il existe, depuis un temps immmorial, des rentes constitues et que beaucoup de ces rentes appartiennent des corps ecclsiastiques.
D'autre part, c'est au XIIIe sicle que les thories thologiques contraires au prt
se consolident et ce moment il semble que dans pas mal de pays les monastres
fussent dans une situation peu prospre ; en Roussillon les abbayes qui avaient
jadis pratiqu le commerce de l'argent sous toutes les formes, deviennent dbitrices des Juifs 2 ; mais ce sont l, je crois, des considrations secondaires.
En fait, l'usure s'tait toujours pratique, non seulement avec la tolrance des
autorits, mais mme officiellement ; saint Raymond de Peniafort examine la
situation dans laquelle se placent les magistrats des villes de Lombardie qui
prtent intrts 3. Saint Thomas fait observer que les lois humaines sont obliges
de laisser impunis certains faits, cause, de l'imperfection inhrente notre nature
parce qu'une extrme rigueur pourrait avoir des inconvnients au point de vue de
l'utilit gnrale 4 ; plus tard Cajtan, commentant ce texte, dira que les princes
peuvent faire des lois permettant l'usure, comme ils en font pour permettre le
commerce des meretrices 5 (en vue d'viter l'adultre) ; d'aprs saint Thomas les
lois humaines ne dfendent que les actes graves qui ruinent le pacte social comme on dirait aujourd'hui - et elles ne sont pas rdiges pour des socits composes uniquement de gens vertueux 6.
2
3
4
5
Ce fragment est rapprocher d'un autre que l'on trouve la fin du chapitre prcdent et qui est
bien plus trange. Marx dit que le, systme de la monnaie est essentiellement catholique,
celui du ci-dit minemment protestant... C'est la foi qui sauve : la foi en la valeur montaire
considre comme l'me de la marchandise, la foi dans le systme de production et son
ordonnance prdestine, la foi dans les agents de la production personnifiant le capital ayant
le pouvoir d'augmenter par lui-mme sa valeur. Mais de mme que le protestantisme ne
s'mancipe gure des fondements du catholicisme, de mme le systme du crdit ne s'lve
pas au-dessus de la base du systme de la monnaie. Ceci est bien du Marx ; mais cette note
ne se rattache pas au contexte et nous pouvons penser que c'est l une fantaisie, analogue
d'autres fantaisies qu'il a fait disparatre dans la dernire dition du premier volume du
Capital.
Auguste Brutails, tude sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyenge, p. 73.
Summa sancti Raymundi de Peniafort. De usuris et pignoribus. 15. Le commentateur Jean
de Fribourg pense que les magistrats ne sont pas tenus personnellement de restituer les usures
perues par la ville.
Saint Thomas, Secunda secundae, qu. 78, art. 1, ad tertium.
mile Desplanque a fait connatre une curieuse thse, affiche par les Dominicains de
Perpignan en 1608 o il est dit que : aedificare lupanaria est opus pium, sanctum et
meritorium . (Les infmes dans l'ancien droit roussillonnais, p. 99). Il pense que l'ancien
quartier des prostitues tait voisin, Perpignan, de celui des Juifs et qu'il tait conforme aux
ides du temps de juxtaposer l'usure et la dbauche . (op. cit., p. 93).
Saint Thomas, loc. cit., qu. 77, art. 1, ad primum.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
156
Saint Thomas transforme compltement les questions du droit conomique
auquel il touche ; il ne se contente plus de considrations empruntes au bon sens
des consciences dlicates et consolides par quelques textes canoniques ; il veut
faire de la science ; il ne cesse de dire que sa doctrine s'applique au droit, ce qui
est susceptible d'tre revendiqu par voie judiciaire ; il spare avec grand soin ce
qui ce rapporte l'amiti ou la bienfaisance d'avec ce qui se rapporte au droit 1.
En comparant cette partie de son uvre ce qu'crivait son prdcesseur saint
Raymond, on voit qu'il y a une transformation complte accomplie ; il y a un
point de vue nouveau.
Les ides musulmanes ont beaucoup occup saint Thomas ; son chef d'uvre,
le Contra Gentiles, est dirig contre les gens qui prennent pour matres les
philosophes arabes et qui regardent les ennemis du nom chrtien comme les vrais
dpositaires de la sagesse. Le grand scolastique veut dmontrer que la sagesse
catholique est suprieure celle des infidles et il s'efforce d'lever un monument
comparable celui des plus grands docteurs de l'antiquit. Si sur toutes les
questions il apporte des thses plus compltes et plus solides que celles des
musulmans, il pourrait triompher de la tendance l'incrdulit en prouvant qu'il
est absurde d'aller chercher la science ailleurs que dans les coles orthodoxes 2.
On sait que l'usure est svrement condamne par le Coran ; les musulmans
ont aussi sur le commerce des thories qui rappellent beaucoup les cas de conscience des thologiens catholiques. lhering a t frapp de l'analogie d'esprit qui
lui semble exister entre la prohibition de l'usure en droit canonique et l'interdiction de vendre aux enchres dans lesquelles le prix dpasse facilement la vritable
valeur, interdiction que Tornauw a trouve au Caucase 3. D'aprs cet auteur, il est
dfendu : de vendre crdit plus cher qu'au comptant 4, - de dissimuler les dfauts
de la marchandise ou d'eu trop vanter les mrites, - de profiter de la position gne
de l'acheteur ; - il faut que le marchand fasse connatre le bnfice qu'il obtient ; le
dtaillant peut se faire indemniser de tous ses frais, mais il doit indiquer le prix
d'achat. Dans saint Thomas on ne retrouve pas textuellement ces prescriptions,
mais l'esprit est le mme ; le marchand doit faire connatre les dfauts cachs de la
marchandise (singulariter est dicendum vitium ei qui ad emendum accedit) 5; - Il
est, dfendu d'augmenter le prix en raison du besoin qu'a l'acheteur, parce que seul
1
2
4
5
Par exemple : Saint Thomas, loc. cit., qu. 77, art. 1, ad tertium et qu. 78, art. 2. Respondeo et
ad secundum.
Thodore Reinach a montr combien le XIIIe sicle fut roccup de la science des rabbins
(Histoire des Isralites, pp. 138-139, p. 180). Il semble avoir trop rduit la question et n'y
avoir vu qu'une affaire de proslytisme ; je crois que les rabbins taient surtout redouts
comme propagateurs de thories philosophiques empruntes aux Arabes.
Ihering, volution du droit, p. 95. - Tornauw, Le droit musulman expos d'aprs les sources ;
trad. fran., pp. 120-124. Je cite ce livre parce que c'est lui que se lhering. - Cf. dans Khalil
de trs nombreuses rgles contre les oprations ayant un caractre alatoire et usuraire
(Khalil, Code musulman, tract. par Seignette). En gnral on ne doit pas changer le certain
pour l'incertain (art. 76) ; de trs nombreuses prcautions sont prises contre les marchands
d'aliments.
Cependant quelques coles permettent l'escompte. Cf. Saint Thomas : qu. 78, art. 2, ad
septimum.
Saint Thomas, loc. cit., qu. 77, art. 3, ad secundum.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
157
un dommage subi par le vendeur pourrait faire accrotre la valeur 1 ; - le marchand
peut licitement se faire payer sa peine (lucrum expetit non quasi finem sed quasi
stipendium laboris) ; il ne rclamera alors qu'un bnfice modr 2.
Pour bien comprendre la trs forte influence que la concurrence intellectuelle
des musulmans a eue sur saint Thomas, il faut rappeler que les destines des
peuples tiennent, pour une trs grande partie, au sentiment de l'orgueil national :
peut-tre la civilisation antique aurait-elle pri si elle n'avait t soutenue par
l'ide que le Grec est fait pour la libert et le Barbare pour la servitude. Au XIIIe
sicle on traitera les Juifs et les Arabes comme les Grecs ont considr les Barbares et je ne doute pas que cet exclusivisme, qui peut paratre absurde aujourd'hui,
n'ait eu des consquences d'une trs grande utilit autrefois. Mais il fallait pouvoir
soutenir cette prtention la supriorit par des arguments autres que ceux de
l'Inquisition ; saint Thomas a rendu un service inapprciable la culture moderne,
en lui donnant un moyen de se dfendre contre l'invasion d'ides trangres la
tradition grco-latine ; il a cuirass l'Occident en quelque sorte, en lui prouvant
qu'il avait dans Aristote et dans le droit romain les sources d'une raison suprieure. Il veut faire un travail purement scientifique et nous le voyons, propos de
l'usure et du juste prix, s'attacher avec minutie ses sources grco-latines qui sont,
ses yeux, revtues d'un caractre presque surnaturel. C'est l de l'orgueil grec ou
romain, aussi fort que celui que l'on peut constater chez n'importe quel penseur
antique.
Il y a un passage de l Somme qui est particulirement curieux pour montrer
quel degr de respect pour la science (telle qu'il la comprenait) tait parvenu saint
Thomas. Il dclare que la loi humaine ne saurait changer la nature juridique des
choses, nature qui drive de leur contenu conomique : unde in jure civili dicitur
quod res quae usu consumuntur, neque ratione naturali, neque civili recipiunt
usumfructum ; ... Senatus non fecit earum rerum usumfructum, nec enim poteret,
sed quasi-usumfructum constituit, concedens scilicet usuras 3. l'tat peut tre
oblig de ne pas respecter le pur droit, mais celui-ci reste inbranlable comme est
toute vrit scientifique.
Il me parait douteux que ces raisons idologiques, si puissantes qu'elles soient,
eussent suffi pour engendrer une thorie aussi complte et aussi absolue qu'est
celle de saint Thomas ; il faut tenir compte d'un fait trs important qui se produisit
de son temps et qui rendit l'usure chrtienne inutile. A toute poque sur les bords
de la Mditerrane on avait fait, au moyen d'esclaves, des trafics peu estims ; les
Romains avaient beaucoup pratiqu ce systme. On considra les Juifs comme
tant des esclaves 4 ; cette thse sert plusieurs fois saint Raymond ; son com1
2
3
4
Saint Thomas, loc. cit., qu. 77, art. 1, Respondeo.
Saint Thomas, loc. cit. qu. 77, art. 1. Respondeo.
Saint Thomas, loc. cit., qu. 78, art. 1, ad tertium.
Paul Viollet dit que c'est au XIIIe sicle que la thorie de la servitude des Juifs s'panouit
(Prcis de l'histoire du droit franais, p. 305). Cf. Summa sancti Raymundi, p. 33, col. 1 ; p.
34, col. 2 ; 1). 37, col. 2 ; p. 241, col. 2. - Dans une charte de 1237 pour la ville de Vienne,
Frdric II dclare que l'autorit impriale a impos aux Juifs une servitude perptuelle a
priscis temporibus. Quels sont ces temps antiques auxquels l'empereur se rfre ? Je pense
qu'il fait allusion l'obligation de payer une redevance Jupiter Capitolin qui fut pour les
Juifs la consquence de la prise de Jrusalem par Titus (Cf. GAYRAUD, L'antismitisme de
saint Thomas d'Aquin, p. 190. -Le texte que cite l'abb Gayraud pour expliquer la charte de
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
158
mentateur Jean de Fribourg dit que les Juifs ne possdent pas l'autorit paternelle,
que par suite le prince peut leur enlever leurs enfants - et qu'ils n'ont qu'un pcule
au lieu de la proprit.
Il tait naturel d'employer les Juifs pour le commerce de l'argent, dont on ne
pouvait pas se passer ; ils devinrent donc, au moins dans certains pays, usuriers
officiels et rglements ; et on s'est demand si diverses mesures de police ne leur
ont pas t appliques plutt en qualit d'usuriers qu'en qualit de Juifs. C'est
l'ordonnance du 25 fvrier 1241, dit mile Desplanque, qui tend la premire [dans
le Roussillon] rserver aux Juifs le pouvoir de faire les prts usuraires et c'est
deux ans plus tard, en 1243, que les mmes Juifs sont astreints au cantonnement.
On peut se demander s'ils ne furent pas cantonns lgalement, parce qu'ils devenaient infmes du fait de l'exercice de l'usure 1.
Les rglements nouveaux n'empchrent pas les chrtiens de pratiquer
l'usure 2 ; mais il faut soigneusement distinguer - surtout dans un systme mijuridique, mi-moral, comme tait celui de lglise et qui s'occupait plutt des cas
de conscience que de la pratique - ce qui se fait et les combinaisons thoriques
que certains hommes ingnieux construisent en choisissant dans la vie usuelle les
actes qui leur semblent occuper une situation privilgie. Si l'usure peut tre
vite aux chrtiens en se servant des Juifs, les thologiens peuvent, sans manquer aux rgles de la science, dclarer que l'usure serait un dlit clans un tat
vraiment chrtien, voulant faire application des principes trouvs par la raison.
Mais de l la faire, disparatre, il y a un abme.
Il n'est pas sans intrt de signaler que dans les pays berbres le Coran a
apport l'interdiction du prt intrt, mais qu'il n'a pu le faire admettre dans la
pratique 3 ; les marabouts de la Kabylie ne veulent pas reconnatre dans leurs
jugements les obligations d'origine usuraire ; dans quelques villages il y a mme
des peines dictes par les Kanouns (recueils de coutumes) contre les usuriers ;
mais tous les Berbres s'arrangent par se soustraire aux rgles du Coran et ils
savent dissimuler les contrats usuraires sous des formes licites ; enfin les marabouts eux-mmes ne se gnent pas pour prter intrt. Dans quelques tribus le
taux lgal est de 33 % ; le plus souvent il est libre et rarement suprieur 50 %.
L'exemple de la Kabylie est trs instructif, parce qu'il nous montre que dans
les pays conomie prcapitaliste le prt intrt se prsente comme une ncessit aussi imprieuse qu'aujourd'hui, quoique le contraire ait t souvent affirm
par les littrateurs de l'histoire thique. La loi religieuse est impuissante l aussi
contre l'conomie et les reprsentants de cette loi religieuse, eux-mmes, ne la
respectent pas.
1
2
3
1237 n'a aucun rapport avec la question.) - Je pense que la servitude judaque pourrait bien
avoir sa source dans le monde musulman, que l'Europe connaissait bien depuis les Croisades ;
Thodore Reinach dit que la marque distinctive impose aux Juifs en 1215 (Concile de
Latran) semble tre d'origine musulmane. (op. cit., p. 141).
mile Desplanque, Op. cit., pp. 37-38. - Thodore Reinach fait observer que les gouvernements pousseront les Juifs faire l'usure en raison des exigences du dogme, op cit., p. 150).
mile Desplanque. op. cit., pp. 43-44.
Hanoteau et Letourneux, La grande Kabylie, tome II, pp. 494-497.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
159
Introduction lconomie moderne :
Troisime partie : le systme de lchange
Chapitre III
Classification des divers genres de crdit d'aprs les srets employes. - Les srets
dlictuelles : clauses pnales, mutilation, excommunication, etc. - Anciennes rductions des
dettes. - Monts de pit. - Solidarit des caisses Raiffeissen. - Importance du cautionnement
dans l'histoire conomique. - Crdit hypothcaire. - Relations entre le prt et les systmes de
culture. -Anciennes ides des socialistes sur l'hypothque.
Retour la table des matires
Nous distinguerons plusieurs genres de crdit, en prenant pour base les divers
genres de srets offertes ; c'est la seule manire de constituer Une thorie
vraiment objective, pouvant servir clairer l'histoire du droit. Nous ne saurions
nous contenter de la distinction du crdit rel et du crdit personnel, qui est
beaucoup trop vague et trop abstraite. Le crdit commercial se rattache des considrations si particulires qu'il ne pourra tre examin dans cette tude.
A. - Il semble que chez les primitifs on ait gnralement assimil un dlit le
fait de ne pas remplir ses engagements date fixe ; je dis que dans ce systme la
sret est dlictuelle, car on s'excute par la peur d'une peine. Eugne Rvillout a
montr que cette notion eut Une trs grande importance dans l'ancienne gypte et
il croit devoir l'expliquer en disant que dans ce pays toute l'organisation sociale
tait fonde sur la morale et sur l'ide du devoir : tout manquement au devoir doit
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
160
tre puni ; si on trouve parfois la servitude comme consquence d'une dette, c'est,
d'aprs lui, comme punition d'un serment qu'on n'a pas respect 1.
Je crois que cet gyptologue interprte mal ces antiques lgislations ; il trouve
que des contestations, qui nous semblent relever uniquement du droit civil,
conduisent des applications du droit criminel ; ce fait, n'implique pas, du tout, de
hautes conceptions morales, mais plutt une insuffisance de l'esprit juridique.
Chez tous les primitifs les obligations civiles ont beaucoup de peine se sparer
de l'ide de dlit et quelquefois mme il arrive que celui qui succombe dans le
procs n'ait subir que la peine sans indemniser l'autre partie ; ce fait remarquable
existe dans une grande partie de la Kabylie pour les blessures ; la victime ne
reoit pas de ddommagement 2.
En gypte on majorait d'ordinaire la crance de 50 51, quand elle n'tait pas
paye l'chance convenue 3 ; mais quand il s'agissait d'obligations contractes
envers les temples, on n'appliquait pas le droit commun et l'amende pouvait tre
beaucoup plus forte.
l'poque ptolmaque, les usuriers obligrent les dbiteurs promettre des
sacrifices pour le roi ; ils trouvaient ainsi le moyen de porter l'affaire devant des
tribunaux spciaux et de faire condamner la prison leurs victimes 4.
Un passage clbre d'un sermon de saint Ambroise sur Tobie nous apprend
que de son temps les cranciers empchaient souvent de clbrer les funrailles
des dbiteurs, en vue de forcer la famille du dfunt ou ses amis prendre des
engagements envers eux 5. Nous trouvons ici une peine de nature magique,
laquelle on doit rattacher les singuliers contrats mdivaux sanctionns par une
menace d'excommunication ; la clause dite de Nisi a subsist jusqu'au XVIe sicle
et n'a disparu que par l'action des Parlements devant lesquels on put porter ces
affaires par la voie d'appel comme d'abus, en dessaisissant les tribunaux ecclsiastiques.
Le vieux droit romain avait connu une forme singulirement sauvage de la
sret dlictuelle, puisqu'il permettait aux cranciers de tuer le dbiteur et de s'en
partager les morceaux. Iehring pense que jamais cette dissection n'a t pratique
et que la loi avait seulement pour objet d'effrayer les gens solvables, qui mon1
2
3
4
Eugne Rvillout, La crance et le droit commercial dans l'antiquit, p. 113.
Hanoteau et Letourneux, Kabylie, tome III, p. 73.
Eugne Rvillout, op. cit., p. 40, p. 41, p. 115.
Eugne Rvillout, op. cit., p. 88. - Le serment a jou un trs grand rle dans le droit gyptien ;
avant Bocchoris on n'crivait pas les obligations et le dbiteur tait cru sur son serment (p. 37.
p. 49). - Les souverains grecs, foraient leurs fermiers renoncer par serment au droit de se
rfugier dans les temples en cas d'oppression (p. 86 et p. 125). Cet usage du serment rappelle
tout fait des pratiques du Moyen ge.
Esmein, Mlanges d'histoire du droit et de critique, p. 248, p. 256, pp. 261-264 La privation
de spulture existe chez les ngres de la-Cte-d'Or ; au Dahomey, les parents craignent que le
dfunt ne revienne leur jeter des sorts tant qu'il n'a pu trouver le repos. Dans les pays o les
parents. n'ont pas l'habitude de payer, le ngre travaille tant qu'il peut pour pouvoir s'acquitter
avant sa mort et gagner ainsi le droit la spulture. (Cours de Jacques Flach au Collge de
France, 27 mars 1895).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
161
traient de la mauvaise foi 1. Il faudrait alors expliquer la singulire rgle : Si
plus minusve secuerit, sine fraude esto ; pourquoi la loi se proccupe-t-elle ainsi
de la grosseur des morceaux ? Iehring admet qu'au lieu d'en arriver cette extrmit, on se bornait mutiler le dbiteur ; mais videmment la blessure ne devait
pas tre suprieure celle qui, dans les tarifs de compensation, correspondait la
dette et on pouvait se demander si la mutilation ne diminuait pas quelquefois trop
la sret des autres cranciers 2. La loi aurait eu pour objet de rendre l'application
de la mutilation plus pratique et le texte que nous connaissons, aurait exprim la
rgle dans le cas d'une application thorique ; c'est un procd de logique primitive : l'extrme, tout impraticable qu'il soit, comprend les cas moyens.
On sait quelles discussions singulires se sont engages, propos de la
question des mutilations, entre Iehring et plusieurs auteurs allemands. Le premier
a soutenu, avec une grande force, que le jugement rendu par Portia contre Shylock
constitue un dni de justice que rien ne saurait excuser ; il fallait annuler, dit-il, le
contrat ou le faire excuter 3. Le moyen qu'emploie le juge est videmment
misrable ; il rentre dans la catgorie assez nombreuse de ces sentences grotesques rendues par des tribunaux, qui accablent de sarcasmes le plaideur qu'ils
condamnent ; mais je me demande si le comique n'a, pas sa place dans l'histoire
du droit comme le tragique et c'est l ce que Iehring ne me semble pas avoir vu.
Saint Raymond de Peniafort trouve lgitime l'emploi de la peine pcuniaire
non seulement lorsqu'elle est prononce par le juge, mais encore lorsqu'elle est
fixe dans le contrat, pourvu qu'elle soit modre et qu'il n'y ait pas une intention
usuraire ; sa lgitimit est fonde sur la ncessit de faire excuter les contrats 4.
La prison, la mutilation, la menace d'normes amendes, la vente aux enchres
comme esclave, ont t des moyens efficaces pour intimider jadis le dbiteur et sa
famille. De nos jours les srets dlictuelles tendent disparatre ; mais ce qui en
reste nous montre quelle tait jadis leur efficacit : la contrainte par corps a t
supprime en matire commerciale parce qu'elle ne servait gure qu'aux usuriers
pour forcer des familles riches payer des dettes contractes par leurs fils, - dettes
auxquelles on donnait une fausse cause commerciale ; - dans les cercles o l'on
joue, les dettes dites d'honneur sont considres comme tant plus pressantes que
les crances des fournisseurs ; c'est une sret dlictuelle qui fonctionne.
Je crois qu'il faut rattacher aux srets dlictuelles le prt sur gages, tel que le
pratiquent beaucoup d'usuriers ; ceux-ci sont gnralement associs avec les marchands qui achteront le gage au moment de l'chance et cela pour un prix trs
infrieur sa valeur : on peut dire qu'il y a, en fait, une amende consigne
d'avance.
Toutes les fois que la notion de peine intervient (mme dans le droit civil sous
forme d'amendes conventionnelles), on entre plus ou moins sur le terrain rserv
1
2
3
4
Iehring, Esprit du droit romain, tome 1, p. 148.
La difficult d'appliquer exactement le talion pour blessures fait disparatre son emploi chez
les Kabyles (Hanoteau et Letourneux, loc. cit., p. 73 et p. 88.
Iehring, La lutte pour le droit, trad. fran., p. XXIII et suivantes, p. 67 et suivantes.
Summa sancti Raymundi, De usuris, 5.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
162
l'tat ; l'opinion considre qu'il y a un contrle exercer sur les particuliers pour
que les peines conventionnelles soient appliques avec un esprit conforme celui
qui prside aux dcisions des tribunaux rpressifs. Toutes les fois que le sentiment
juridique du peuple est troubl par des applications de clauses pnales qui paraissent indiquer la mchancet, la mauvaise foi ou un certain abus de la force, le
lgislateur est oblig d'intervenir pour que l'me populaire ne soit pas atteinte
dans ses profondeurs.
C'est ainsi que l'on a pu, avec raison, dnoncer le danger de certaines pratiques
des ateliers, o existe une discipline qui blesse les sentiments lmentaires de
justice, si ncessaires entretenir dans les masses. C'est par cette raison que l'on
doit, mon sens, justifier beaucoup de mesures prises jadis contre les usuriers ; la
rduction des dettes par les novae tabulae, qui gne tant Iehring, me semble
devoir tre, en partie tout au moins, rapport cette ncessit de dfendre les
bases sentimentales du droit criminel 1.
Dans les temps modernes on a cherch combattre l'usure au moyen des
monts-de-pit ; la loi franaise leur accorde le monopole des prts sur gage, niais
elle ne supprime pas les agences libres qui, ct des bureaux officiels,
s'installent pour faire des prts supplmentaires sur le dpt du bulletin et qui font
renatre l'usure. Les monts-de-pit ne prtent pas, d'ailleurs, trs bon march et
leurs ventes permettent des bandes organises de brocanteurs d'acqurir les
objets trs bas prix. La cration primitive des Franciscains se trouve ainsi toute
dfigure et Marx a pu dire que les monts-de-pit montrent l'ironie de l'histoire, qui, dans la ralisation, va l'encontre des intentions les plus pieuses 2 .
Marx prend ses exemples en Angleterre o le prt sur gage n'est pas monopolis
comme en France ; mais j'accorde que l'ironie de l'histoire a produit des effets
analogues chez nous. La lacisation de nos monts-de-pit en a fait disparatre ce
qui tait essentiel, c'est--dire l'influence religieuse. Les convictions religieuses
peuvent amener des personnes charitables fournir des capitaux un intrt trs
minime ; mais ce n'est pas l leur rle principal ; l'tat pourrait, lui aussi, tre un
pourvoyeur bienfaisant des monts-de-pit ; leur rle principal consiste agir sur
les emprunteurs. Des socits la fois religieuses et populaires peuvent dvelopper dans les classes malheureuses des sentiments d'honneur qui permettent de
faire fonctionner une sret dlictuelle de nature morale et de rduire d'autant les
srets matrielles qui seules peuvent permettre aux monts-de-pit laques de
fonctionner.
B. - La deuxime sret est la solidarit des gens du pays ; elle prend des
formes trs varies.
1 Il y a une forme de solidarit tout, fait primitive entre les gens d'une
mme commune qui, en temps de calamits publiques, achtent ensemble des
grains pour nourrir les habitants pauvres et pour assurer les semences ; en Algrie
on a d revenir, plusieurs fois, ce systme qui existait normalement autrefois. Ce
1
Il faut aussi tenir compte de la situation spciale des Cits antiques, organismes faits pour la
guerre et dans l'intrieur desquels les considrations relatives au statut des citoyens et une
certaine galit taient capitales.
MARX, Capital, livre III, 2e partie, p. 173.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
163
systme tait jadis la consquence naturelle de la solidarit qui existait entre gens
d'un mme district pour le payement des impts. Pour pouvoir suffire aux charges
fiscales, il fallait bien entretenir la population et maintenir une surface convenable
de sol en culture. Des considrations d'assistance et de sret publique interviennent galement, surtout dans les pays o existe une population vaincue, opprime
et pauvre ; il faut bien l'empcher de se livrer au pillage et pour cela, il faut
l'entretenir. La Commune intervient comme un patron qui aide son client traverser une de ces priodes difficiles que l'cole de Le Play nomme les phases de
l'existence : cette analyse met en lumire le principe de cette intervention
solidariste ; le principe est gouvernemental et extrieur 1.
2 L'opposition la plus absolue ce systme est constitue par beaucoup de
ces associations de crdit populaire qui croient pouvoir se fonder sur ce qu'on
nomme souvent des garanties morales ou d'amiti. Parlez l'homme du peuple,
dit Proudhon, de gage, de caution, d'une double ou triple signature, tout au moins
d'un effet de commerce reprsentant une valeur livre et partant escomptable, il ne
vous comprend plus et prend vos prcautions pour une injure... Il importe que les
ouvriers soient bien convaincus qu'en matire de crdit, plus qu'en aucune autre,
autre chose est la charit et autre chose le droit ; qu'une socit mutuelliste ne doit
pas tre confondue avec une socit de secours ; que les affaires ne sont point
uvres de charit et de philanthropie. Ce n'est que rarement et avec la plus grande
circonspection que les socits ouvrires doivent se permettre le crdit personnel,
peine de dgnrer bientt en fondations charitables, de se voir ruines par le
favoritisme, les billets de complaisance, les garanties morales et de se dshonorer 2. Gnralement ces associations ont t administres d'une manire
absurde, ont fait des prts de sympathie, de sentiment ou de principes et elles ont
mal tourn.
En 1893 a t fonde Paris une banque cooprative des associations de
production, au moyen d'une somme de 500,000 francs donne par un philanthrope, auxquels l'tat ajouta 50,000 francs 3 ; dj le bilan de 1896 signalait deux
affaires de sentiment qui avaient cot plus de 11,000 francs; le bilan de 1901
accuse une perte de 10,000 francs provenant d'une cause analogue et absorbant
ainsi presque tout le bnfice. (Association cooprative, 9 aot 1902); le bilan de
1902 accuse une situation identique: 12,000 francs des bnfices sur l'escompte et
11,000 francs de perte sur avances. (Association ouvrire, 29 aot 1903.) Peuttre ce genre de gestion est-il command par les hauts principes du coopratisme.
2
3
Le Crdit foncier de France ayant ou souvent de la peine se faire payer par des syndicats
d'irrigation, exige que les Communes sur le territoire desquelles se trouvent les canaux
d'arrosage, garantissent l'emprunt qu'il consent Je vois l une sret dlictuelle, car cette
mesure a pour objet de forcer les hommes politiques insister auprs des prfets pour les
amener faire recouvrer les cotisations syndicales qui se recouvrent par l'intermdiaire des
percepteurs, comme des contributions directes. Les hommes politiques demanderaient aux
prfets de ne pas faire recouvrir les taxes syndicales pour se rendre populaires auprs des
arrosants, s'ils ne craignaient de perdre leur popularit en compromettant les Communes.
Proudhon, Capacit politique des classes ouvrires, pp. 120-121.
Office du travail, Les associations ouvrires de production, pp. 121-126. Le don de l'tat s'est
lev 45,000 francs ; il y a eu 90,000 francs d'actions appartenant des socits
coopratives.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
164
3 On se demande souvent comment il se fait que les caisses Raiffeisen aient
si bien russi dans les campagnes, alors qu'elles semblent fondes sur des
principes si peu conformes ceux que Proudhon indique comme essentiels ; on a
maintes fois attribu leur succs leur direction minemment chrtienne. Les
banques Schulze-Delitzich ont souvent sombr, tandis que les caisses Raiffeisen
n'ont jamais fait perdre d'argent 1 ; n'est-ce pas, dit-on, la preuve que les ides
commerciales doivent cder la place aux ides chrtiennes ?
Je ne conteste pas la part de l'influence religieuse ; dans un intrt de puissance, le clerg catholique allemand s'est beaucoup attach dvelopper ces caisses
et il est parvenu entraner les gros paysans, qui auraient, sans son intervention,
bien hsit accepter la responsabilit illimite entre les adhrents 2. Il se peut
aussi que, rciproquement, le clerg impose la discipline aux associs et facilite la
surveillance que les chefs de l'association exercent sur la conduite des associs.
Ce qui doit surtout attirer notre attention, c'est que les caisses Raiffeissen sont
des institutions rurales, destines favoriser la production des monts-de-pit sont
des institutions urbaines, destines faciliter la vie des gens pauvres dans des
moments difficiles) - que les banques Schulze sont des groupements urbains
forms entre gens qui se connaissent peu ou mal et qui pratiquent des affaires
beaucoup moins propres manifester le progrs des forces productives que n'est
la culture. Les amis de Schulze ont cru souvent que la multiplication des affaires
produit une compensation naturelle entre elles ; mais cela n'est pas aussi vrai dans
les villes que dans les campagnes 3.
Le paysan est extrmement mfiant, trs peu dispos se laisser prendre aux
bavardages des idalistes ; il mesure, par une exprience journalire, ce que peut
donner de profit supplmentaire une amlioration dans les instruments de culture
ou dans le btail. Aux champs, le crdit populaire est bien moins vacillant qu' la
ville, bien moins expos se lancer dans des affaires de sentiment , parce qu'il
est bien mieux fond sur le progrs de forces productives connues de tous.
Mais toutes ces conditions ne suffiraient pas encore pour expliquer le succs
de ces caisses ; il faut y ajouter la surveillance exerce par des gens qui se
connaissent les uns sur les autres. Cette surveillance prend assez souvent la forme
d'un cautionnement, donn par deux amis ; Georges Blondel dit que cette mthode
est un moyen de dvelopper entre voisins les liens de la solidarit 4 ; c'est tout
le contraire qu'il faut dire : c'est parce qu'il existe entre voisins des relations propres donner naissance des solidarits juridiques, que les caisses peuvent user
de la garantie qui leur est ainsi offerte et se mettre l'abri de l'un de ces embarras
qui accablent les institutions de crdit populaire.
Le cautionnement a jou un grand rle dans l'histoire du droit ; il a t trs
employ par les Romains et c'est, pour nous, une sre garantie qu'il mrite une
place d'honneur dans le droit : il met en jeu, trs directement, la responsabilit
1
2
3
4
Georges Blondel, tudes sur les populations rurales de l'Allemagne, p. 290.
Ceci semble admis par Vandervelde, Essais sur la question agraire en Belgique, p. 167.
Cf. Georges Blondel, op. cit., pp. 289-291.
Georges Blondel, op. cit., p. 277.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
165
personnelle et carte les obligations qui ne sont pas fondes sur des causes srieuses. Le cautionnement est trs peu philanthropique : que de gens plaideront
avec loquence pour obtenir d'une banque un prt en faveur d'un ami et qui
cependant ne voudraient pas le cautionner ?
Nous n'avons pas faire ici de vagues sentiments de fraternit : le cautionn
soumet ses rsolutions au contrle de gens qui sont placs dans les mmes
conditions que lui, qui sont en tat de juger si son entreprise est conforme aux
rgles de la sagesse commune et qui affirment la fois: qu'ils se chargeraient de la
faire russir si elle leur tait confie et que le cautionn possde la mme capacit
qu'eux.
Voil le contenu psychologique de cet acte juridique : l'affaire est dpersonnalise et elle est prte par suite pour entrer dans le mcanisme d'un crdit
socialis. Avec l'organisation des caisses Raiffeissen, telles qu'elles fonctionnent
en Allemagne, ne comprenant qu'un petit nombre d'adhrents et domines par des
hommes exerant une sorte de patronage, il y a un contrle veill, alors mme
que l'on n'exige pas que des voisins donnent un cautionnement juridique : la
forme ne doit pas nous arrter, quand nous pouvons constater que l'essentiel existe
et nous avons vu que l'essentiel du cautionnement dans ces associations est le
contrle rciproque.
La sret est ici contigu et lie organiquement, en quelque sorte, l'emprunteur ; le rapport qui existe est intime et, par suite, impossible dfinir juridiquement; quand on le regarde par le ct intrieur on ne peut l'analyser et le
dcomposer en parties ; le rapport n'apparat revtu d'une forme juridique qu'aprs
qu'il est tout constitu ; il forme alors un bloc que l'on peut regarder extrieurement et on dit que c'est un cautionnement.
Si l'on essayait de remplacer les caisses Raiffeisen par des corps politiques, on
verrait disparatre toute cette premire partie qui comprend la formation, en
quelque sorte, organique du rapport. Entre la Commune et l'conomie particulariste des citoyens, il ne peut y avoir que des rapports juridiquement dtermins et
par suite extrieurs; ds qu'on prtend
briser l'enveloppe pour faire pntrer l'institution politique jusqu' l'individu,
ou arrive annihiler toute personnalit - puisque toute entreprise serait soumise au
contrle immdiat des chefs locaux, comme dans une association religieuse. Un
pareil systme de crdit, s'il fonctionnait jamais conformment son principe,
supprimerait le droit; mais, en ralit, il fonctionnerait, sans doute, tout autrement
et comme un puissant moyen de dvelopper la corruption et l'esprit du parti, ce
qui ne serait pas favorable non plus au progrs du droit. Le clerg cherche
donner ces caisses une tendance dplorable; car, trop souvent, il ne voit dans le
crdit rural qu'un instrument de domination et un moyen d'annihiler la personnalit par sa prtendue conomie chrtienne.
Le rle de l"tat ne peut commencer que bien loin de l'individu ; il peut aider
les caisses de prt populaire et effectivement il le fait sur une assez large chelle,
en Allemagne ; la Prusse depuis 1895 a fait de grosses avances aux caisses
Raiffeisen, mais celles-ci avaient prouv, par leur histoire, qu'elles constituaient
des organisations assez solides pour pouvoir recevoir le contact de l'tat. La
situation est la mme que pour les monts-de-pit ; l'tat peut les aider beaucoup,
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
166
mais ils ont besoin, pour rendre tous les services qu'on peut attendre d'eux, d'avoir
des auxiliaires libres, capables de dvelopper chez les emprunteurs le sentiment
d'honneur; ici il faut l'action de gens srieux, acceptant la mission de contrler ou
de cautionner leurs co-associs. Ainsi dans les deux cas c'est sur une base
particulariste ayant acquis une grande force que peut s'lever la socialisation du
crdit.
C. - Le crdit le plus parfait et le plus fcond est celui qui a pour sret une
force productive (ou quelque chose d'quivalent) et qui se trouve ralis, d'une
manire particulirement remarquable, dans le crdit hypothcaire moderne. Ce
systme a jou un trs grand rle dans l'laboration de l'ide de productivit de
l'argent ; c'est ce qu'Eugne Rvillout a bien mis en lumire en tudiant le crdit
en Chalde. Dans ce pays fonctionnait ce qu'il appelle l'antichrse babylonienne,
notre ancien mortgage, qui a exist chez un trs grand nombre de primitifs : on
remet au prteur un champ, une maison, un esclave, dont il s'approprie le produit
jusqu'au jour o le dbiteur peut rembourser ; il n'y a aucun compte faire;
quand il rapportera l'argent, il rentrera dans sa maison 1, dit un texte cit par
Eugne Rvillout. De l vint l'ide d'une quivalence absolue entre l'argent et la
force productive et par suite celle de la productivit du capital, considr comme
faisant des petits 2.
Cet auteur suppose que la fixation de l'intrt lgal a eu originairement un
troit rapport avec la fertilit du sol ; c'est ainsi qu'aurait t dtermin le taux de
20 % en Chalde 3 ; Bocchoris aurait admis 30 % pour l'gypte o la terre tait au
moins aussi fertile que dans l'autre pays. En Assyrie il n'y a pas de rgle sur le
prt ; la terre tait moins bonne qu' Babylone et cependant le taux est gnralement plus lev ; 25 100 La thorie de Rvillout me semble douteuse, parce
qu'elle n'explique point pourquoi l'intrt est proportionnel au temps et quelle est
la raison pour laquelle on a adopt une unit de dure plutt qu'une autre 4.
Chez les agriculteurs la dure indivisible est assez naturellement celle de
l'anne; c'est ainsi qu'en gypte l'intrt des crales et en Assyrie tout intrt se
calculent par an ; c'est une indemnit paye la fin de la campagne, agricole. En
Chalde l'unit indivise est le mois ; il est vraisemblable que la productivit du
capital tait fonde sur la location des esclaves ou sur celle de petites boutiques
dans les bazars. L'agriculture a toujours eu beaucoup de peine se faire l'ide
d'une productivit par petites dures (semaines et jours); elle n'a pu s'y accoutumer et la trouver lgitime qu'aprs avoir revtu des formes trs intensives et trs
varies ; quand il y a sur la terre des rcoltes multiples, permettant de vendre
chaque march, le paysan comprend que la dure est divisible par petites priodes
1
2
3
4
Eugne Rvillout, Op. cit., p. 58.
Eugne Rvillout, op. cit., p. 13, pp. 56-58.
Eugne Rvillout, op. cit., pp. 62-64.
Les systmes de mesures ont eu une grande influence sur les dterminations du taux d'intrt :
on demandait une petite unit montaire pour une grande durant une priode regarde comme
indivisible pour des raisons commerciales en Chalde un sekel pour une mine qui vaut 60
sekels par mois ; - en gypte un kati pour un outen qui vaut 10 kalis pour une saison de quatre
mois. L'intrt gyptien pour les crales tait annuel et de 33 1/3 % parce que les mesures se
divisent par trois. (Eugne Rvillout, op. cit., 71-72). - Ces exemples montrent comment le
mcanisme arithmtique a ragi sur la pense.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
167
et la notion de la continuit du temps nat chez lui. La dure conomique est alors
divisible comme le temps mathmatique 1.
Pendant trs longtemps les crivains socialistes ont parl du crdit hypothcaire en termes qui ne sont pas adquats aux conditions de l'conomie moderne ;
ils comparaient le propritaire endett au tenancier du rgime fodal, parce qu'ils
admettaient que le remboursement ne pourrait jamais s'oprer et qu'ainsi les
intrts taient assimilables aux redevances anciennes. Observant une agriculture
obre, trs peu progressive et dcourage, ils reportaient leur esprit aux temps de
l'oppression seigneuriale : les familles paysannes avaient bien juste de quoi
subvenir leurs besoins et elles travaillaient toute l'anne pour arriver produire
un revenu net, soit pour le crancier, soit pour le noble. Aussi voit-on exprimer
frquemment cette opinion que le vritable propritaire n'est pas celui qui semble
l'tre en vertu de ses titres, mais celui qui a hypothque ; cette manire un peu
vieillie de considrer les choses se retrouve encore chez Kautsky; cela n'a rien
d'tonnant si vraiment en Allemagne les propritaires fonciers sont de plus en
plus dans l'impossibilit de tenir leurs engagements , comme il l'affirme 2.
J'ai rappel au commencement du II ce que Marx dt de l'influence de l'usure
qui, par ses exigences, empche le progrs. On reprochait aux cranciers hypothcaires de ne pas avoir pour l'amlioration agricole plus de proccupations que n'en
avaient eu les anciens seigneurs, mangeurs de droits fodaux.
La premire pense qui venait l'esprit tait de librer les paysans par un
moyen imit de celui qui fut employ par la Rvolution et d'carter les cranciers
comme on avait cart les seigneurs ; mais les socialistes voyaient que la dette
foncire s'tait reconstitue dans la France avec une rapidit extraordinaire ; ce
n'tait donc pas le meilleur remde. Il y avait une autre solution : c'tait de remplacer le crancier indiffrent au progrs par un crancier intress au progrs, par
un crancier qui chercherait devenir le propritaire intelligent et humain du
paysan. Il semble bien que ce soit avec cette proccupation que l'on ait dans le
Manifeste communiste propos de nationaliser les hypothques ; c'tait, en effet,
d'aprs Kautsky, un moyen de mettre la proprit foncire sous la dpendance
du gouvernement et de faciliter la transition au rgime socialiste .
Mais il y a peu de classes qui soient, au mme degr que la classe paysanne,
sensibles aux changements qui se produisent dans la situation de la production.
Ds que le cercle de fer de l'ancienne conomie s'est relch, que l'usure n'a plus
t aussi tyrannique et qu'il a t possible de concevoir un progrs dans la culture,
la ncessit d'une rvolution socialiste n'a plus paru aussi vidente. Pareil phnomne s'est manifest dans toutes les branches de la production aprs le dveloppement des chemins de fer; mais il a t plus particulirement vident pour la terre.
C'est en raison de ce grand changement que nous avons, aujourd'hui, tant de peine
Charles Laurent fait observer que dans les traits d'arithmtique on a tort de vouloir dmontrer
la rgle de l'intrt: elle est simplement l'expression d'une convention arbitraire. (Trait du
calcul des probabilits, p. 206). Ce serait un bien grand miracle qu'un pareil arbitraire ; il a
des raisons historiques assez faciles dbrouiller, semble-t-il.
Kautsky, Politique agraire du parti socialiste, p. 34 et p. 36.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
168
comprendre les conceptions lassalliennes et en gnral tout ce qui a t crit
autrefois.
l'ide d'une chane d'airain, reliant toutes choses d'une manire absolue, se
substitue l'ide d'lots, de cellules indpendantes, ayant chacune leur vie propre, et
nageant dans un milieu. Dsormais il ne sera plus question de changer toute
l'organisation sociale pour pouvoir faire aboutir une rforme 1 ; on cherchera
plutt trouver des moyens de liquider une situation malheureuse, en se conformant aux principes du droit. C'est dans ce but que furent crs les Crdits
fonciers.
Cf. Supra, pp. 142-143. - Le Second empire profita beaucoup de cette transformation des
ides; les paysans, qui avaient eu en 1848 de grandes sympathies pour le socialisme, admirrent Napolon III qui donnait souvent satisfaction leurs vux.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
169
Introduction lconomie moderne :
Troisime partie : le systme de lchange
Chapitre IV
Liquidation des dettes de la terre. - Les anciennes banqueroutes montaires. - Le
bimtallisme et ses raisons. - Les Crdits fonciers. - Les obligations lots. L'hypothque
maritime et le prt sur les rcoltes.
Retour la table des matires
Les institutions primitives de Crdit foncier ont eu pour objet de permettre aux
propritaires obrs de s'affranchir des charges trop lourdes qui pesaient sur
eux 1 ; c'est ainsi qu'en Allemagne fut constitue la Landschaft de Silsie en 1770,
pour la libration des biens nobles qui payaient des intrts s'levant jusqu' 15 %.
C'est encore aujourd'hui du ct de la libration de la terre que doivent tre
diriges les considrations des conomistes qui tudient ces institutions. La
Rvolution franaise a brusquement supprim presque toutes les redevances qui
s'taient accumules depuis des sicles ; mais un demi-sicle a suffi pour crer
une nouvelle srie de charges qui ne parurent pas moins crasantes que les
anciennes. Depuis que l'on a tudi scientifiquement la Rvolution, on en est venu
se demander s'il n'aurait pas t plus conomique de racheter les droits fodaux
que de sacrifier tant de vies et tant de forces pour soutenir par les armes le rgime
qui rendit l'abolition dfinitive. Aujourd'hui cette opinion est partage par
beaucoup de savants.
1
Aujourd'hui on emprunte surtout au Crdit foncier pour entreprendre des amliorations.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
170
Je crois que l'on peut rapporter l'origine de ce nouveau jugement au spectacle
que donne l'activit des Crdits fonciers et au dveloppement pris par la pratique
de l'amortissement. Par voie de consquence, on a trouv que la lgislation rvolutionnaire n'avait pas le caractre de justice que jadis tout le monde lui
reconnaissait. On ne juge plus l'abolition des droits fodaux comme on la jugeait
jadis - par suite de la pratique d'un nouveau systme hypothcaire; bel exemple de
la gense de l'idologie ! beau sujet de rflexion pour les partisans du droit
naturel !
Les lgislateurs de la Rvolution ne s'occuprent pas de trouver des moyens
commodes d'amortir les dettes ; ils crurent avoir assez fait en dclarant les rentes
rachetables sans se demander par quels procds les paysans parviendraient
oprer ce rachat en bloc 1. Il semble qu'ils auraient pu dclarer que l'intrt ancien
tait suffisant pour constituer un amortissement en cinquante ans 2 ; une pareille
mesure et t bien peu de chose ct des normes spoliations effectues de ce
temps. Persuads que le partage en nature constituait le meilleur des systmes
successoraux, ils ne se demandrent pas comment le fils qui achte les parts de
ses frres, parviendrait payer sans trop enlever la terre : c'tait un cas, semblet-il, o l'on aurait pu, assez facilement, rendre l'amortissement obligatoire. Ils
avaient une confiance infinie dans le progrs et ne connaissaient pas encore les
mcanismes au moyen desquels on peut raliser, sans loi, ces amortissements 3 :
leur pense ne pouvait devancer l'invention des mcanismes financiers.
Dans le pass l'tat tait intervenu pour modifier le rgime des dettes hypothcaires d'une manire trs indirecte, mais trs effective par l'abaissement du titre
des monnaies. Les rois de France, toujours obrs, pratiqurent un rgime de
banqueroute montaire, grce auquel la livre tournois tomba moins de la
vingtime partie de sa valeur depuis le XIIIe sicle jusqu' la Rvolution. Le
mouvement s'tait ralenti depuis le XVIIe sicle ; cependant, d'aprs Georges
d'Avenel, la livre valait encore plus de 2 francs au commencement, et environ 1
fr. 50 la fin XVIIe sicle 4. Cette question de l'amortissement par la banqueroute
1
Il est curieux, par exemple, que l'on n'ait pas permis un hritier de se librer de sa part de la
rente constitue qui pse sur l'ensemble des domaines ; il faut qu'il paie pour tous les autres et
devienne leur crancier. (Dalloz, Rpertoire, tome XXXIX, p. 89, col. 2).
En 1851, dans l'Ide gnrale de la Rvolution au XIXe sicle, Proudhon propose d'oprer une
liquidation de la proprit foncire, fonde sur le principe Que le fermage constitue un mode
d'acquisition par annuits.
En Allemagne, o la famille est beaucoup plus stable qu'en France, cette question a t
tudie de trs prs par Flix Hecht, qui a fait une active propagande en faveur de combinaisons d'emprunts hypothcaires et d'assurances sur la vie, de manire ce que les dettes
s'teignent par gnration.
J'emprunte au Cours de Vilfredo Pareto (tome I, p. 222) quelques-unes des valeurs de la livre
tournois calcules par Georges d'Avenel ; ces chiffres ne peuvent tre reus qu' titre
d'approximation.
Priodes
1200-1225
1226-1290
1291-1300
1301-1320
Valeurs
21.77
20.00
16.00
13.40
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
171
montaire n'a pas compltement perdu de son importance, puisqu'il y a encore des
bimtallistes.
Les bimtallistes demandent la libert du monnayage de l'argent (avec un
rapport lgal de 15 16 avec l'or) et esprent pouvoir se librer ainsi immdiatement de la moiti de leurs dettes ; ils pensent que, le mouvement de dprciation
continuant, il y aurait une hausse continue des prix qui quivaudrait une rduction nouvelle des crances : - ils demandent une banqueroute violente, analogue
celle que pratiqua la Rvolution, et une banqueroute continue. Au lieu d'accepter
leurs projets, il serait, trs certainement, plus sage de prononcer une rduction de
toutes les dettes la manire antique ou de dcider que, moyennant l'ancien
intrt lgal, toutes les obligations hypothcaires seront amorties en 50 ans. Cette
spoliation serait bien moins dommageable au pays que l'effroyable accroissement
des prix qui rsulterait de l'inflation montaire.
Les raisonnements des agrariens paraissent profondment grossiers beaucoup d'conomistes; mais ils n'auraient pu se maintenir si longtemps s'il n'y avait
au fond de leurs doctrines quelques sophismes fort analogues ceux qui obtiennent du succs parmi nos contemporains. Il convient donc d'examiner quelle est la
porte de leurs thses :
a) On a, maintes fois, clbr l'heureuse rvolution produite par l'apport des
mtaux prcieux rsultant de la conqute de l'Amrique 1 ; on a pu liquider
beaucoup de dettes et on a accumul des capitaux pour l'industrie. Il y a eu une
banqueroute naturelle rsultant du progrs scientifique, en dehors de toute intervention de l'tat ; et cette banqueroute a t l'une des causes de la prosprit
moderne. De nos jours, l'art des mines ayant fait des dcouvertes surprenantes et
pouvant verser sur le march des quantits d'argent incomparablement suprieures
1321-1350
1351-1360
1361-1389
1390-1410
1448-1455
1488-1511
1541-1560
1573-1579
1602-1614
1643-1650
1676-1700
1700-1725
1726
12.25
7.26
8.90
7.53
4.64
3.34
2.88
5.69
2.39
1.82
1.48
1.22
0.95.
En Angleterre depuis 1600 le schilling a conserv son poids et son titre (p. 226). Sous
Edouard VI le titre avait abaiss jusqu' un tiers.
Suivant Thorold Rogers les prix du bl et de la viande, durant les premires annes du XVIe
sicle, taient peu prs ceux des deux sicles prcdents; ils montrent de 1520 1540, mais
lentement, par suite de l'apport des mtaux prcieux; de 1541 1582 il y eut un triplement des
prix, rsultant surtout de l'altration des monnaies; de 1588 1642 les prix doublrent par
l'effet de l'abondance de l'argent (Interprtation conomique de l'histoire, p. 227, Travail et
salaires en Angleterre depuis le XIIIe sicle, trad. fran., p. 310, p. 312-317). Les salaires
prouvaient des augmentations bien moindres que les denres alimentaires.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
172
celles que l'on n'y avait jamais apportes, la banqueroute naturelle reprendrait
son heureux cours, pour le plus grand bien de la production, disent les bimtallistes, si les gouvernements ne venaient s'opposer au mouvement naturel des choses
par la fermeture des htels de monnaie l'argent.
Cette politique montaire, toute diffrente de celle que l'on avait autrefois
pratique, constitue, soutiennent-ils encore, un genre de protectionnisme ; mais
tandis que, d'ordinaire, le protectionnisme a pour objet de favoriser les producteurs, celui-ci est l'avantage des seuls usuriers; y a-t-il politique moins
raisonnable que celle-l ? Les cultivateurs sont accabls par la concurrence des
pays neufs ; il n'y a, l'heure actuelle, qu'un seul fait qui leur soit favorable, c'est
le fait du dveloppement de la mtallurgie de l'argent ; et des conomistes,
ennemis de toute intervention de l'tat, viennent troubler l'ordre naturel !
b) En second lieu, on rpte, sur tous les tons, qu'il faut marcher dans le sens
de l'volution, aller o va l'histoire, orienter l'conomie et la politique dans la
direction qui semble correspondre la meilleure harmonie des intrts. On a
prtendu observer qu'il existe clans le monde moderne une tendance vraiment
merveilleuse qui aurait pour effet de rduire l'ancienne puissance des capitalistes.
Bastiat l'a clbre autrefois avec enthousiasme ; il croyait que l'abaissement du
taux de l'intrt se produit de lui-mme, que la part proportionnelle et la part
absolue du travail augmentent en consquence de la prcdente loi. Personne ne
s'lverait contre une lgislation destine favoriser ce mouvement si heureux du
capitalisme ; pourquoi donc s'opposer aux effets que produirait le bimtallisme
dans le mme sens ? Les propritaires fonciers sont-ils donc moins intressants
que les ouvriers ?
c) Enfin quand, depuis les temps les plus reculs, un principe a reu de nombreuses applications dans tous les pays, on est amen le considrer comme
faisant partie du droit naturel ; or, les lgislateurs se sont toujours occups de
dfendre les dbiteurs contre les cranciers. La conduite suivie par les tats
contemporains semble inexplicable aux agrariens, qui ne sont pas loigns de
l'attribuer l'influence juive.
Les bimtallistes se croient donc victimes d'une grande injustice ; il leur
semble qu'on leur enlve le droit naturel de l'amortissement. Dans leurs plaintes il
y a quelque chose de fond ; il est d'une ncessit absolue pour le progrs que la
dette de la terre s'amortisse et l'tat doit se proccuper de rendre cet amortissement d'autant plus facile que les circonstances conomiques sont moins favorables au progrs du revenu net.
Les agrariens ne vont pas chercher des solutions bien loin; ils sont toujours
disposs avoir recours l'autorit; les questions conomiques leur semblent
faciles rsoudre : il suffit que l'tat veuille bien prendre la peine de dcider et
d'imposer sa volont. Ils raisonnent peu prs comme les idologues : il faut
amortir sans augmenter les charges de la terre ; le bimtallisme permet de le faire
sans qu'il en cote rien aux agriculteurs ; que l'on adopte donc le bimtallisme.
L'esprit des propritaires ruraux est aussi primitif que celui des professeurs;
les uns et les autres ne connaissent que la Bonne volont. On a souvent propos en
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
173
Allemagne de limiter le droit l'endettement ; il est, certain, en effet, qu'une terre
est bien malade quand elle doit employer la moiti de ses revenus pour payer des
intrts. Pour empcher ce mal, il n'y a qu' faire une bonne loi et soumettre les
emprunts au contrle de l'autorit ! Le propritaire sera considr comme un
mineur [c'est une ide fodale] ou comme un lve [c'est une ide de professeur].
Les Crdits fonciers nous montrent comment l'tat peut trs efficacement
intervenir dans l'conomie sans employer sa force coercitive et sans bouleverser
les situations acquises ; il peut crer des institutions qui fonctionnent d'une manire peu prs automatique et qui permettent aux volonts particulires de rsoudre,
elles-mmes, des problmes qui ne comportaient que des solutions violentes et
alatoires par l'intervention directe de l'tat. Les Crdits fonciers montrent la
socialisation du crdit sous sa forme la plus parfaite.
Lorsque la proprit est parfaitement assise, qu'il y a des institutions fortes, si
bien que l'tat, les partis et les intrigues ne comptent pas pour grand chose devant
les rglements, il n'y a aucun inconvnient ce que l'tat se charge lui-mme de
distribuer le crdit. S'il ne peut pas s'tablir entre le Trsor public et les propritaires des rapports juridiques srieux, si le fonctionnement du crdit ne se fait pas
d'une manire vraiment objective, si le milieu conomique se trouve menac
d'tre domin par les politiciens, il vaut mieux que l'tat cherche crer une
institution ayant plus d'indpendance qu'il ne pourrait en avoir lui-mme.
tant donne la situation de la France, la solution qui a t adopte me parat
bien suprieure celle d'une administration d'tat ; notre Crdit foncier, grce
l'existence de ses actionnaires, n'est pas compltement sous la main du gouvernement et les particuliers trouvent en lui un crancier qui les traite, trs peu prs,
tous sur le mme pied. J'ai eu l'occasion d'observer que la Caisse des dpts et
consignations, malgr les prcautions prises pour lui assurer une grande indpendance, est loin d'tre libre des influences des parlementaires.
Le gouvernement franais a accord au Crdit foncier une lgislation hypothcaire de faveur et l'autorisation d'mettre des obligations lots. L'emploi de ce
genre d'obligations mrite de fixer un instant l'attention ; on arrive, en effet, par ce
procd, diriger vers le crdit hypothcaire des sommes que leurs propritaires
seraient disposs employer tout autrement : le crdit hypothcaire ordinaire ne
donne pas, en effet, satisfaction aux gens qui sont fort dsireux d'obtenir des
extra-profits. La recherche de ces profits exceptionnels et alatoires est le grand
moteur du progrs industriel, dans une socit capitaliste ayant atteint un haut
degr de dveloppement. Dans les socits primitives, on obtient de pareils profits
exceptionnels, en faisant l'usure sur les choses qui offrent de grands dangers de
perte et encore en jouant des loteries.
Psychologiquement c'est toujours le mme Sentiment que l'on retrouve, parvenu divers degrs et se modifiant suivant les conditions conomiques. Jamais
un sentiment ne se manifeste uniquement son degr lev; les tats infrieurs
coexistent toujours et l'exprience montre que les classes ouvrires, notamment,
ne parviennent pas vaincre l'effroyable got pour la loterie qui a toujours exist
chez elles : les ouvriers perdent beaucoup aux courses ; la petite bourgeoisie
prend des obligations du Crdit foncier ; - si on ne lui offrait pas des moyens de
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
174
placer son argent en lui donnant le mirage d'extra-profits, elle le confierait, en
entier, aux lanceurs d'affaires vreuses.
J'ai longuement examin le crdit hypothcaire propos de l'agriculture ; il est
clair que c'est en l'appliquant la terre qu'on arrive le mieux en comprendre le
mcanisme. Mais il est vident aussi que les maisons d'habitation - encore qu'elles
ne soient pas des forces productives - peuvent tre traites de la mme manire
que la terre; leurs loyers ont une apparence de fruits recueillis sur un champ et,
ds les temps anciens, on les a assimils, assez facilement, aux immeubles ruraux.
Pour une raison tout fait analogue, on a trait les Communes comme des
immeubles productifs ; an Moyen-ge elles ont cr des rentes constitues et de
nos jours le Crdit foncier de France leur consent des prts trs considrables.
Dans ces deux cas il n'y a que des analogies formelles; la dtermination
conomique des srets est laisse de ct et on n'examine que le mcanisme
financier : les maisons procurent les loyers, alors mme qu'elles servent seulement
l'habitation; les Communes ont des revenus rguliers provenant de l'impt. Dans
les deux cas on a des srets offrant une certaine analogie avec les forces productives ; mais il ne faut pas se dissimuler que l'analogie ne peut se soutenir que
si les conditions conomiques sont favorables; les institutions qui ont beaucoup
prt aux propritaires de maisons, savent quels dboires peuvent les attendre le
jour o la prosprit diminue. Il arrive toujours un moment o le contenu conomique reparat la surface, si paisses soient les enveloppes dont on l'a recouvert : les crises se chargent de dmontrer que tout ce qui engendre des revenus
n'est pas force productive.
Par suite du mcanisme des prts hypothcaires (inscription de la crance et
droit de suite sur l'acqureur) on a souvent considr que l'hypothque ne peut
s'appliquer qu'aux seuls immeubles ; cependant il y avait eu autrefois des hypothques sur navires et elles ont t rorganises en France par les lois du 10
dcembre 1874 et 10 juillet 1885. Le code de commerce italien (art. 485 et
suivants) a constitu un systme analogue au ntre ; mais ses rdacteurs n'ont pas
cru devoir employer le terme hypothque maritime.
On a souvent demand que l'on fournt aux agriculteurs des moyens pour emprunter en donnant comme sret les rcoltes qu'ils ont dans leurs greniers. Une
loi du 18 juillet 1898 a t faite dans ce but; peu de personnes ont voulu admettre
qu'il y et l un crdit hypothcaire 1 ; je pense que leur opinion a t dtermine
par la crainte de voir imposer aux acheteurs l'obligation de consulter le registre
des inscriptions avant de payer; ils pensent que ce serait crer une norme entrave
aux transactions.
Il y a une analogie frappante entre cette sret et l'hypothque maritime; dans
les deux cas, le dbiteur reste dtenteur de la sret et il pourrait la vendre d'une
manire clandestine : pour le navire cette vente ne peut se faire en France, au
dtriment des cranciers; mais rien n'est plus simple que de l'oprer l'tranger.
Une mme peine a t prvue pour les deux cas : les deux lois de 1874 et de 1898
se rfrent aux articles 406 et 408 du Code pnal, qui punissent de deux mois
1
Muse social, octobre 1899, p. 506.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
175
deux ans de prison et d'une amende gale au quart des restitutions et dommagesintrts, le dtenteur d'un gage qui le dtourne au prjudice des cranciers 1.
Si on se place sur le terrain conomique, il semble difficile de contester qu'il
existe une certaine analogie entre les prts sur rcoltes elles prts hypothcaires.
Si le paysan emprunte sur sa rcolte nouvellement engrange, c'est qu'il a de
bonnes raisons pour esprer des prix meilleurs en attendant quelque temps ; il
garde ses produits tant que les cours ne sont pas devenus favorables. La valeur de
la marchandise s'accrot donc (dans l'hypothse qui sert de base la loi) comme
s'il y avait en elle une puissance capable d'agrandir sa place dans l'change.
Quand on considre les rcoltes par le ct extrieur, c'est--dire comme des
moyens de porter une valeur, elles sont parfaitement assimilables une force productive, puisque leur valeur augmente pendant, au moins, un certain temps,
pendant le temps qui correspond un engrangement normal. Cet accroissement
n'est pas toujours trs fort ni trs sr 2 ; c'est ce qui explique, en partie, le peu de
succs de cette loi, que l'agriculture avait rclame grands cris.
L'accroissement de valeur tient aux conditions gnrales du march, comme
les loyers des maisons d'habitation dpendent de la prosprit gnrale. Dans un
cas comme dans l'autre, il n'y a que des productivits apparentes ; on pourrait dire
peut-tre que ces productivits sont commerciales, tandis que celle d'un champ est
industrielle.
Nous aurons revenir plus loin (chap. VIII) sur cette question de l'accroissement des valeurs en magasins.
On peut se demander si le lgislateur franais n'a pas commis une erreur ; en effet, il semble
qu'il aurait t plus logique de se rfrer aux articles 400, 5, et 401, qui punissent tout
dbiteur qui aura dtruit ou dtourn des objets donns par lui titre de gage ; la peine
aurait t d'un an cinq ans de prison et l'amende de 16 500 francs.
C'est l'opinion du professeur Dominique Zolla (Dbats, 2 avril 1894 et 6 mai 1901). Dans
l'autre sens : Congrs de la vente du bl. Versailles, 1900, tome I, p. 12.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
176
Introduction lconomie moderne :
Troisime partie : le systme de lchange
Chapitre V
Thories sur le prt intrt. - Le prt assimil la commandite ; thories de Bastiat et de
Proudhon. - Intervention de l'tat. - Assimilation la location ; thorie des thologiens
modernes et de Marx. - Assimilation la vente ; thorie thomiste. - Explication des contrats
titre gratuit. - Classification des actes juridiques d'aprs l'chelle de la volont.
Retour la table des matires
Je crois qu'il est utile d'examiner maintenant les diffrentes thories juridiques
au moyen desquelles on a cru pouvoir expliquer le prt intrt ; cet examen nous
montrera combien il est difficile, mme aux meilleurs esprits, de raisonner sur des
questions de droit sans avoir une ide, parfaitement claire des phnomnes conomiques correspondants : nous aurons aussi l'occasion d'appeler l'attention sur
certaines vues intressantes de Marx 1.
Les auteurs distinguent rarement les lments juridiques spciaux qui peuvent
entrer dans le contrat de prt et ils cherchent, presque toujours, le ramener exactement tre une commandite, un louage ou une vente.
1
Marx aurait certainement mieux fait de ne pas s'engager dans des discussions qui s'loignaient
de la voie indique par les principes du matrialisme historique. Son exemple est trs propre
montrer avec quelle facilit des esprits suprieurs abandonnent leurs principes quand ils sont
entrans par des illusions sectaires ; c'est surtout pour montrer l'insuffisance des raisonnements de Proudhon. que Marx a voulu discuter les thories juridiques du prt intrt.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
177
A. - D'ordinaire dans les temps modernes on admet implicitement le premier
point de vue. Dans la premire lettre Proudhon sur la lgitimit de l'intrt,
Bastiat crit : Vous me prtez, pour toute l'anne 1849, mille francs en cus ou
un instrument de travail estim mille francs. C'est en 1849 que je recueillerai tous
les avantages que peut procurer cette valeur cre par votre travail et non par le
mien. C'est en 1849 que vous vous priverez, en ma faveur, de ces avantages que
vous pourriez trs lgitimement vous rserver. Suffira-t-il, pour que les services
aient t quivalents et rciproques, qu'au premier de l'an 1850 je vous restitue
intgralement vos cus, votre machine ? 1. Dans la cinquime lettre, il dit : Je
veux bien cder mes droits si tu veux me faire participer pour quelque chose
l'excdent des profits que tu vas faire. Si ce march est librement consenti, qui
osera le dclarer illgitime ?... Plus tard les parties contractantes, pour leur
commodit, ont trait forfait sur cette part 2. Ainsi le prt intrt serait une
commandite.
Si l'on se place sur ce terrain de la socit, la question est trs simple ; saint
Thomas, qui fait une thorie si rigide du prt gratuit, reconnat parfaitement la
lgitimit de la commandite 3 : on peut confier de l'argent un marchand ou un
artisan et lui demander une part de bnfices; mais s'il y a perte, on supporte la
perte, car ou est rest matre de l'argent et la chose prit au compte de son matre.
Non transfert dominium pecuniae suie sed remanet ejus ita quod cum periculo
ipsius mercator de ea negotiatur, vel artifex operatur. On voit que saint Thomas
serre de bien plus prs le problme que Bastiat : il pose la question de la perte, qui
est capitale. Contrairement l'opinion des thologiens modernes, il n'admet pas
que le periculum, sortis puisse constituer un titre pour percevoir une prime dans le
prt intrt ; dans le mutuum, en effet, on n'a plus la proprit de la chose qui
prit; elle est passe au dbiteur. Accepter le periculum sortis comme un titre
justifiant l'usure, ce serait accepter le jeu comme une base d'obligations ; une pareille conception aurait paru monstrueuse tout le monde autrefois. Je n'examine
pas ici comment les choses doivent tre considres quand on se place au point de
vue commercial qui est tout autre que le point de vue civil.
Dans sa rponse la troisime lettre de Bastiat, Proudhon considre le commerce maritime comme ayant donn naissance l'usure. Cette part de bnfices,
par laquelle s'explique la participation du capitaliste ou industriel, qui engage ses
produits ou ses fonds dans le commerce, a reu le nom latin d'interesse, c'est-dire participation, intrt 4. Comme saint Thomas, Proudhon fait remarquer que
le risque est au compte du commanditaire. Il croit que des peuples navigateurs,
l'usure passa chez les autres peuples; l'intrt fut une excellente mesure pour hter
les recouvrements et on finit par croire la productivit du capital. De cet
instrument de police, cette espce de garde du commerce lanc par le crancier
la gorge de son dbiteur, on a voulu faire un principe de justice commutative, une
loi de l'conomie sociale ! 5 Ce que dcrit Proudhon me semble tre l'histoire de
1
2
3
4
5
Proudhon, Mlanges, tome III, pp. 188-189.
Proudhon, loc. cit., p. 275.
Saint Thomas, Secunda secund, qu. 78, art. 2, ad quintum.
Proudhon, loc. cit., p. 234.
Proudhon, loc. cit., p. 236.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
178
la lgitimit du prt : il voit l'importance des mcanismes qui commandent l'idologie ; l'intrt finit par devenir gnral, aprs avoir t une participation et avoir
perdu tout caractre de part dans une commandite 1.
Marx rapporte cette phrase d'un clbre banquier, Gilbart, crite en 1834 ;
C'est un principe vident de justice naturelle que celui qui emprunte de largent
pour en tirer profit, doit cder une partie de ce dernier au prteur 2. C'est ce que
Bastiat rptera peu prs textuellement plus tard ; Marx fait se sujet quelques
rflexions pleines de sagacit. Il est absurde d'invoquer ici la justice naturelle.
Les transactions entre les agents de l production sont justes, parce qu'elles sont
des consquences naturelles des conditions de la production, et leur valeur n'est
pas dtermine par les formes juridiques sous lesquelles elles apparaissent comme
l'expression de la volont commune de ceux qui y participent... Leur teneur est
juste ou injuste, suivant qu'elles sont adquates ou non au systme de production ;
l'esclavage et la tromperie sur la qualit de la marchandise 3 sont galement
injustes dans le systme capitaliste de production.
Il ne faudrait pas, cependant, ngliger l'aspect juridique que revtent les relations sociales ; si l'on assimile le prt la commandite, immdiatement de
nombreuses analogies font irruption dans l'esprit et les rgles appliquer au prt
se trouvent en partie dtermines. Toutes les fois que l'on s'occupe d'association,
il est impossible de ne pas laisser s'introduire des analogies venant du droit public ; on a toujours vu les lgislateurs intervenir pour interdire les contrats
lonins ; les lois annulent les clauses qui feraient tourner la socit en exploitation
des associs les uns par les autres; c'est ainsi que dans le cheptel il nest pas
permis de faire telles conventions 4 que l'on voudrait. On comprend donc que
l'assimilation du prt la commandite conduise le, lgislateur intervenir pour
limiter les exigences des prteurs et imposer, par exemple, des taux maxima
variant suivant les genres d'entreprises.
B. - L'argent a t prt plus souvent autrefois pour des usages domestiques
ou des plaisirs que pour des affaires industrielles ; c'tait encore, la situation en
Angleterre la fin du XVIIe sicle, d'aprs Dudley North, qui ne comptait pas
qu'il y et un dixime d'emprunts faits pour les entreprises 5. Pas moyen d'assi1
2
3
Dans la discussion avec Proudhon, Bastiat ne voulait pas abandonner son ide de l'identit du
prt la commandite et il parle toujours du service rendu. Proudhon, comme saint Thomas,
distingue le mutuum et la socit ; comme lui aussi il rejette une indemnit pour une
prtendue privation qui n'entrane pas de dommage in concreto.
Marx, Capital, livre III, 1re partie, p. 375.
Ceci est remarquer, car Fourier a souvent soutenu tout le contraire ; il regardait la tromperie
comme la base de tout le commerce des civiliss. Ce dtail suffirait pour montrer que Fourier
n'avait aucune vue claire des rapports capitalistes modernes, - quoi qu'en pensent beaucoup de
socialistes allemands et mme Bernstein ! - Ce passage de Marx me parat tre une allusion
Fourier, qu'il classait ainsi parmi les crivains prcapitalistes.
Article 1811 du Code Napolon ; article 1677 du Code civil italien. Il y a une diffrence entre
les deux rdactions propos de la perte ; le Code italien met en principe cette perte au compte
du bailleur (art. 1675) ; le Code Napolon ne la lui attribue en entier que dans le cas de perte
totale (art. 1810). En Italie on dfend de stipuler que le preneur supportera plus de la moiti
des pertes pour cas fortuit; en France on dfend seulement de lui imputer la perte totale pour
cas fortuit sans faute prouve.
MARX, Capital, livre III, 2e partie, p. 186.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
179
miler de pareilles oprations des commandites ; l'analogie conduit bien plutt
dire que largent est lou, comme une maison ou un cheval de luxe.
Contre cette assimilation les anciens canonistes avaient prsent- trois objections 1 : 1 dans le mutuum la proprit passe l'emprunteur, dans la location elle
reste au bailleur ; - 2 l'argent n'prouve aucune usure comme cela a lieu pour une
maison loue ; - 3 l'argent ne produit pas comme un champ. Aujourd'hui les
thologiens semblent assez disposs, au contraire, admettre l'assimilation, parce
qu'ils ne trouvent gure d'autres moyens d'chapper aux thories de saint Thomas
et qu'ils n'osent pas les rejeter ; ils voient dans le prt un louage, parce qu'ils ne
veulent y voir ni une commandite, ni une vente [cette dernire hypothse les
ramenant saint Thomas].
Le P. Antoine, auquel on doit un livre d'conomie sociale gnralement bien
inform, estime qu' l'heure actuelle, le prt n'est plus un mutuum, mais un louage
pour les raisons suivantes, qui me semblent constituer d'assez jolies amusettes
logiques
1 L'argent a une productivit virtuelle gnrale et celui qui prte a le droit de
rclamer, eu bout du temps fix, une compensation pour le bnfice moralement
certain, dont il se trouve priv pendant ce temps ; aujourd'hui l'argent ne reste pas
improductif dans les caisses des capitalistes et il a toujours un emploi lucratif 2 ;
2 L'argent a un pouvoir reprsentatif gnral de toutes les valeurs ; mais il
faut distinguer suivant les poques et chercher quel est l'emploi le plus gnral
que l'on fait des valeurs: jadis il reprsentait des choses dont l'usage n'est pas
distinct de la substance et qui servaient pour les commodits de la vie; maintenant
on emprunte pour les besoins de l'industrie ; l'argent reprsente surtout des choses
dont l'usage est distinct du domaine ; il n'est pas plus contre la justice d'exiger
une compensation pour le service rendu qu'il n'est injuste de rclamer, avec la
restitution de la maison, un prix qui corresponde au loyer 3.
Au Moyen ge on a pu autoriser le prt dans les grandes villes de commerce
qui avaient une conomie analogue la ntre et le dfendre ailleurs. Les doctrines de l'glise n'ont pas chang, dit le P. Antoine, et ses prescriptions se sont
adaptes, avec une merveilleuse prudence, aux conditions concrtes des diffrentes poques 4. Le systme capitaliste est dfectueux et antinaturel 5 ; mais il
faut bien le tolrer provisoirement et avec tout ce qui en dcoule fatalement .
Nous voil vraiment bien avancs il aurait t plus simple et plus scientifique de
1
2
3
4
5
Summa sancti Raymundi, De usuris, 7.
Cette productivit gnrale de l'argent est rattache par Marx au systme des dettes publiques
(Capital, tome I, 337, col. 2). Cela n'est cependant compltement exact que lorsqu'il y a des
Bourses permettant d'acheter et de vendre facilement. - Tornauw nous apprend qu'en droit
musulman le prt peut tre rclam n'importe quel moment par le prteur (Le droit musulman expos d'aprs les sources, p. 138). Ce systme suppose que l'argent n'a pas une
utilisation constante et prvisible ; celui qui en a, le prte gratuitement tant qu'il n'en a pas
besoin.
Charles Antoine, Cours d'conomie sociale, pp. 499-501.
Charles Antoine, op. cit., pp. 506-507.
Tout ce qui n'est pas l'conomie en nature est videmment antinaturel. Quelle belle chose que
l'art de se servir des mots !
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
180
dire l'argent rapportant aujourd'hui des intrts par suite de causes conomiques
diverses, nous ne faisons pas un crime aux chrtiens de participer aux affaires et
de percevoir des intrts comme tout le monde. On aurait ainsi vit beaucoup de
galimatias.
La thorie que Marx donne dans le Capital est obscure ; elle Se rattache aussi
la location, comme on le voit par les passages suivants : Rien n'est modifi
quant la proprit du capital, car il n'y a pas eu change... Le mouvement du
capital prt comprend uniquement la remise de l'argent par le prteur et sa
restitution par l'emprunteur 1 ; - Le prteur ne cesse pas d'tre propritaire [de
l'argent] mme aprs qu'il l'a remis l'emprunteur 2 ; - ce qui est seulement
alin, c'est cette proprit de donner un profit moyen 3 ; et ce profit ne peut
tre obtenu que grce la constitution gnrale de la socit moderne, qui met la
disposition de l'emprunteur du travail salari qui a la vertu de transformer en
capital les lments matriels de la richesse 4.
C. - Le vice de l'usure, suivant saint Thomas, rsulte, de ce que le prteur
vend quelque chose qui n'existe pas ou qu'il n'a pas : Venditur id quod non est...
Si quis seorsum vellet vendere vinum et seorsum vellet vendere usum vini,
venderet eamdem rem bis, vel venderet id quod non est 5 - Pecunia non potest
vendi pro pecunia ampliori quam sit quantitas pecuniae, mutuatae 6. Saint
Thomas ne cherche pas justifier ses principes ; il part d'une rgle de droit romain
qu'il considre comme incontestable : les quatre contrats dits rels (mutuum,
commodat, gage, dpt) ne comportent que des permutations de choses et sont
gratuits : Re non potest obligatio contrahi, nisi quatenus datum sit ; il accepte
ainsi comme incontestable que dans le mutuum la proprit est transmise
l'emprunteur, qui doit rendre ses risques et prils, - systme fort naturel chez le
peuple romain qui possdait des moyens d'action si puissants pour contraindre le
dbiteur. Le mutuum est donc une sorte de vente : A. livre B. une chose dont
celui-ci devient propritaire avec promesse de rendre l'quivalent ; B. rend A.
l'quivalent; sur le livre des entres et sorties de marchandises il y a parfaite
compensation.
Cependant les Romains ne prtaient gure gratuitement ; ils avaient la ressource des pactes adjoints, au moyen desquels ils stipulaient l'obligation de payer
des intrts ; leurs jurisconsultes n'avaient pas tir des principes du droit la thorie
thomiste du prt gratuit. Je ne saurais donc accepter l'opinion d'un savant historien
des institutions qui crit : L'argumentation de saint Thomas et des scolastiques
qu'ils s'imaginaient tre celle d'Aristote, tait celle du droit romain 7. Comment
admettre, en effet, qu'il ait fallu attendre les thologiens du Moyen-ge pour
interprter des doctrines juridiques que les Romains n'auraient pas sa mener leur
terme lgitime ? Une telle hypothse est, tout fait, invraisemblable. L'histoire
1
2
3
4
5
6
7
Marx, Capital, livre III, 1re partie, pp. 383-384.
Marx, loc. cit., p. 389.
Marx, loc. cit., p. 387.
Marx, loc. cit., p. 392.
Saint Thomas, Secunda secundae, qu. 78, art. 1. Respondeo. - Cf. mme article ad quintum.
Saint Thomas, loc. cit., qu. 78, art. 2, ad quartum.
Georges Platon, dans le Devenir social, septembre 1898, p. 748.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
181
nous apprend, au contraire, que dans les cas analogues, il n'y a pas achvement
mais dformation, pas dveloppement, mais interprtation contresens, c'est ce
qui s'est produit ici.
Il y a, en effet, quelque chose de profondment chang ; la thologie du XIIIe
sicle se donne la thse du prt gratuit et elle cherche la justifier par la science ;
mais elle est oblige, cet effet, de torturer la logique et de tirer des principes
romains ce qu'ils ne contiennent pas ; nous avons donc ici un bel exemple de la
sophistique juridique, au moyen de laquelle on peut dmontrer tant de choses,
quand on enlve au droit le contenu conomique qui le soutient.
Dans la pratique romaine les pactes adjoints d'intrts s'incorporaient dans le
contrat de prt ; il tait aussi simple de stipuler la fois pour le capital et pour les
intrts 1 ; de cette amalgamation de deux actes nat l'ide que le pacte adjoint
pourrait bien tre une vente, et c'est de cette hypothse que saint Thomas s'empare : le mcanisme de l'usure va fournir la base de la thorie. Mais que peut vendre
le prteur qui ne soit dj compris dans la vente du principal ? Les objets fongibles ne comportent aucun dmembrement de la proprit ; tout passe en bloc : pas
d'usage, pas d'usufruit, pas de servitude ; donc il ne reste rien pour le pacte
adjoint, moins qu'il n'y ait quelque titre extrinsque.
Que possde encore le prteur qu'il puisse vendre ? Une seule chose : l'indemnit due pour le dommage que peut lui causer le prt (une blessure donne,
chez les Barbares, droit une somme d'argent tarife ; la pnitencerie catholique,
l'imitation des lois barbares, avait introduit ce que l'abb Boudhinon appelle la
pnitence tarife) 2 ; le dommage quivaut un bien qu'on possde lgitimement
et qu'on ne peut tre tenu d'abandonner gratuitement 3. On peut donc demander
une indemnit pour le damnum emergens ; mais un dommage alatoire ne saurait
donner lieu un pacte actuel 4, quia non debet vendere id quod nondum habet et
potest impediri multipliciter ab habendo .
On doit se demander si ces thories scolastiques sur le mutuum ne se rattacheraient pas quelque doctrine gnrale du droit, dpassant ainsi de beaucoup la
porte qu'on est habitu leur accorder. Leur obscurit tiendrait - si cette
hypothse se vrifiait - ce qu'on aurait fait au Moyen Age une application maladroite d'une philosophie juridique incompltement labore.
Nous savons, par les travaux de Iehring, que trs souvent les rgles du droit
romain donnent une expression particulire de principes ayant une haute porte
dans la philosophie du droit. Nous allons examiner s'il ne serait pas possible de
construire un systme juridique englobant le mutuum et la vente et permettant de
1
2
3
Paul Girard, Manuel lmentaire de droit romain, 3e dition, p. 510 (Stipulatio sortis et
usurarum).
Revue d'histoire et de littrature religieuse, novembre-dcembre 1897, p. 497.
Ailleurs saint Thomas dit qu'on ne peut accrotre le prix en raison de la considration des
avantages que l'acheteur retire de son achat : Utilitas quae alteri accreseit non est ex
vendente sed ex conditione ementis; nullus autem debet vendere alteri quod non est suum,
licet possit ei vendere damnum quod patitur (loc. cit., qu. 77, art. 1. Respondeo.)
Saint Thomas, loc. cit., qu. 78, art. 2, ad primum.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
182
comprendre pourquoi le mutuum a t considr comme tant un contrat gratuit.
Nous ferons cette recherche sans nous occuper de l'conomie, mais seulement en
prenant pour base les diffrentes manires d'affirmer sa volont par rapport aux
choses et par rapport aux hommes qui pourraient prtendre des droits: c'est le
ct purement juridique des rapports qui sera pris en considration. Nous serons
amens voir que le mutuum et la vente sont beaucoup plus loigns l'un de
l'autre que ne le pensait saint Thomas.
la base du systme je place trois affirmations pures et simples de l'autorit:
je possde ; - j'use ; - je dirige. Ces trois affirmations apparaissent d'une manire
singulirement forte dans la famille primitive, qui semble se rduire parfois une
affirmation de la puissance absolue du pre sur les gens et sur les choses de sa
maison : le pre est avec ses esclaves un matre, avec ses enfants un roi, avec sa
femme un magistrat rpublicain, d'aprs Aristote 1. Iehring a beaucoup trop
dvelopp l'ide du pouvoir et de la libert dans le droit romain pour qu'il soit
utile d'insister sur cette question; Eugne Rvillout oppose, ce sujet, Rome et
l'gypte, prtendant que ce dernier pays a fond sa constitution sur la morale
tandis que les Romains ont exprim le droit de la force 2.
un tage plus lev, je place trois dclarations par lesquelles l'agent reconnat que son activit est subordonne un contrle futur d'autrui : je possde la
condition de rendre l'quivalent (mutuum); je garde pour rendre (et cela suivant
les trois modes du commodat, du dpt et du gage); - je fais la condition de
rendre compte (mandat). La manire dont ces trois genres d'obligations entrrent
dans le vieux droit romain est encore assez obscure ; je ne m'en occuperai pas ici.
Il y a l des promesses dont la cause reste indtermine ; pour Iehring ce sont des
obligations nes de la bienveillance et il observe qu' chaque contrat onreux peut
s'opposer un contrat titre gratuit 3 ; et en effet rien n'empche de supposer que le
mutuum a eu pour raison le dsir de rendre service un ami; mais la permission
d'y joindre un pacte relatif aux intrts nous montre que la bienveillance n'est pas
ncessairement la cause. Si un pacte d'intrts a pu tre adjoint, c'est qu'il
manquait quelque chose dans l'enchanement, qu'il y a une lacune qui peut tre
comble soit par des considrations d'amiti, soit par la recherche d'un profit.
Je considre donc ces trois formes de contrats comme tant incompltes, leurs
enchanements tant ouverts et appelant un moyen de clture. Les considrations
les plus diverses pourront intervenir pour dterminer cette clture de chane : le
juge sera souvent appel l'oprer lui-mme et il dterminera, par exemple, ce qui
est d pour l'accomplissement du mandat ; le lgislateur fixera le taux des intrts
qui devront courir faute de stipulations contraires. En un mot la gratuit n'est que
dans l'apparence 4 ; elle est synonyme d'insuffisance de dtermination.
1
2
3
4
Aristote, Politique, livre 1, chap. V, 1-2.
Eugne Rvillout, La crance et le droit commercial dans l'antiquit, p. 4. - Il prtend que la
diffrence des points de vue se manifeste clairement dans la procdure suivie pour les
conclusions des actes : Rome celui qui acqurait la chose, dclarait qu'elle tait lui et il
parlait seul; en gypte c'est celui qui s'oblige qui parle seul, pp. 100-103).
Iehring, volution du droit, p. 69.
Iehring observe qu'il faut avoir une conception trs inexacte des procureurs romains pour
croire que c'tait par pure bienveillance qu'ils se soumettaient toutes les peines, et les
difficults de leurs fonctions (op. cit., p. 192).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
183
Viennent enfin les contrats complets, dans lesquels les deux parties mettent en
prsence leurs prestations rciproques et les dterminent d'une manire
quantitative. Le prteur n'aura plus attendre un cadeau de la reconnaissance de
son emprunteur ou une dcision quitable du juge; chacun aura mesur les
avantages et les inconvnients qui peuvent rsulter pour lui de l'opration ; chacun
a statu souverainement sur son propre intrt. La chane tant ferme par la
manifestation claire des volonts des parties, le juge ne saurait rien y ajouter, ni
rien en retrancher d'aprs ses apprciations personnelles. S'il se trouve, par hasard,
qu'il y ait une certaine incertitude dans les dtails, le juge fera disparatre ce
relchement des obligations par une interprtation fonde sur les prsomptions qui
drivent de la bonne foi juridique.
C'est ainsi que se constitue ce que je propose d'appeler l'chelle de la volont;
cette chelle, plus ou moins mal reconnue par les sociologues, a exerc une
grande influence sur les thories relatives l'volution; comme cela arrive trs
souvent, on a pris des schmas idologiques pour des lois historiques. On a pu
dire, par exemple, que le progrs consiste passer de l'autorit la libert ; ou
encore - symbolisant le premier chelon dans la famille et le dernier dans le rgime marchand - passer du systme familial au systme contractuel. On a pu dire
aussi que le progrs consiste passer de la coutume au contrat, parce que la
coutume comblait la lacune que se trouvait au deuxime chelon. On a pu encore
soutenir que la civilisation avait abandonn la bienveillance pour l'intrt, - en
admettant que les contrats incomplets turent fonds primitivement sur la bienveillance. Il serait inutile de multiplier ces exemples.
Les diverses thories du prt intrt que nous avons rencontres, sont bonnes
connatre, pour qui veut se rendre compte des diffrences qui existent entre le
droit naturel et le droit historique. Le premier, Malgr ses prtentions de haute
moralit, ne recherche pas la vrit ; il plaide une cause, voulant faire accepter la
lgitimit d'une pratique, ou la faire condamner, il fait appel des principes
universels auxquels l'exprience devrait se, subordonner. Le prt intrt est
digne de mpris, quand il est le fait spcial des Juifs, esclaves de la chrtient ; il
s'oriente vers le bien quand des Franciscains organisent des monts-de-pit; il
devient tout fait conforme l'ordre thique quand toute l'conomie bourgeoise
en est imprgne. Sophistique et trop souvent galimatias, voil le bilan du droit
naturel.
Le droit historique prend, au contraire, pour donne fondamentale avoue
l'existence d'une institution dont la valeur a t pragmatiquement dmontre ; il se
demande s'il ne conviendrait pas de gnraliser l'application des principes que
l'esprit dcouvre dans cette exprience ; il chemine en s'appuyant toujours sur
l'conomie. Bien que dans la forme, Proudhon ait beaucoup trop suivi la tradition
du droit naturel, sa doctrine devrait tre reprise au nom du droit historique ; il
condamne le prt intrt parce qu'il croit avoir donn le moyen de rduire le
taux de l'escompte un chiffre insignifiant; l'glise, dira-t-il plus tard, proscrit
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
184
le prt intrt quand le monde en a le plus besoin et qu'il n'y a pas possibilit de
prt gratuit, elle l'autorise quand on peut se passer de lui 1.
Proudhon, De la Justice, tome I, p. 320.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
185
Introduction lconomie moderne :
Troisime partie : le systme de lchange
Chapitre VI
Les Bourses de commerce. - Obscurits accumules autour des questions qui se rattachent la spculation. - Tradition des accaparements. - Ides des socialistes parlementaires. Influence attribue aux Bourses sur la dpression des prix. - Analogies entre les affaires de
Bourse et les oprations des cartels.
Retour la table des matires
Il nous faut maintenant parler de la vente, telle qu'on la pratique sur les
marchs modernes. Je n'ai pas l'intention de discuter ici le fonctionnement intime
des Bourses ; cela sortirait de notre sujet ; nous avons tudier, en effet, ce qui se
socialise, c'est--dire ce qui enveloppe les manifestations de la vie particulire.
Cependant quelques rflexions prliminaires ne seront pas inutiles pour bien
montrer la distinction que nous devons tablir entre l'intrieur et l'extrieur du
march.
On est frapp, tout d'abord, d'un fait qui peut sembler paradoxal : c'est que les
hommes d'affaires aient tant de peine exposer, d'une manire claire et bien complte, ce qui a fait l'objet de leur activit ; les crits consacrs aux effets produits
par la spculation offrent beaucoup d'obscurit. Il semble que ces hommes
d'action se trouvent sur une terre inconnue et pleine de prcipices, quand ils
doivent exprimer des ides gnrales. Ce phnomne, si remarquable, s'explique
facilement quand on rflchit qu'il manifeste l'opposition existant entre la nature
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
186
sentimentale et la forte personnalit des spculateurs, d'une part, et la nature
objective de la science, d'autre part; il y a, en effet, entre ces deux manires d'agir
et de penser une barrire infranchissable.
Cette opposition n'est pas une simple curiosit psychologique ; elle doit rester
toujours prsente l'esprit de celui qui veut bien entendre le rle des Bourses.
Cette opposition nous explique comment la Bourse peut se concentrer sur ellemme, rester un pays ferm au dehors, vivre avec des murs si particulires,
tandis que des institutions socialises l'entourent de toutes parts, sans pouvoir
l'touffer.
La langue amricaine nous fournit d'excellents exemples des manifestations
de l'esprit des spculateurs ; les gens que leur mode d'existence loigne de la vie
scientifique, prouvent le besoin de s'exprimer en argot. Ce ne sont pas seulement
les primitifs et les criminels qui parlent argot ; on trouve le mme langage chez
les joueurs, dans la jeunesse dore et dans les cercles des gens d'affaires. L'argot
possde la proprit de ne jamais exprimer des ides gnrales, tandis que la
langue a t faite pour les exprimer ; il voque des souvenirs ayant un ton de
sentiment de nature excitante et des reprsentations en rapport avec les scnes
rputes belles de la vie. Voici quelques expressions amricaines remarquables :
Ring signifie anneau, cercle dans lequel on enferme ses concurrents ; Corner est
le coin, l'impasse, o on les accule; Pool la mare o on les noie 1.
Le public ne peut gure juger l'effet des Bourses que par les tats particuliers
d'me que manifestent les spculateurs; il se rend compte que ce sont des
combatifs, menant contre leurs adversaires une lutte de tous les jours, en vue
d'accrotre indfiniment leurs profits; il est donc port voir en eux des hommes
dangereux qui ne peuvent faire fortune qu' son dtriment 2. Les consommateurs
accusent les Bourses de contribuer leur rendre la vie difficile. Entre les Bourses
et la socit il n'y a pas de communications rgulires de pense; il ne faut donc
pas demander aux gens qui vivent en dehors de ce petit monde, de le juger avec
srnit.
Depuis un temps immmorial les accapareurs sont condamns par l'opinion et,
chose curieuse, cette condamnation ne semble pas moins vive aujourd'hui, sous le
rgime de la libre concurrence, qu'elle ne l'tait sous celui de la coutume 3. Le fait
1
2
Paul De Rousiers, Les syndicats industriels en France et l'tranger, p. 15.
L'anomalie que prsentent les gens de Bourse, suivant l'opinion commune, provoque d'autant
plus de rpulsion que souvent les capitaines de la Bourse n'appartiennent pas la race du pays
o ils oprent. Dans une note trouve parmi les papiers de Proudhon, nous lisons : Quelques
pages accentues sur les Juifs. Une franc-maonnerie travers l'Europe. Une race incapable
de former un tat. ingouvernable par elle-mme, s'entend merveilleusement 5, exploiter les
autres. Son analogue dans les Bohmiens ou Tziganes et les Polonais migrs, les Grecs,
Armniens et tout ce qui vagabonde . (France et Rhin, p. 260). Proudhon tait exaspr en
constatant la place norme que les Juifs occupaient dans l'histoire du capitalisme usuraire
pendant le Second empire.
Dans son commentaire sur la Somme de saint Thomas, Cajtan donne une dfinition remarquable du juste sur lequel on a crit tant de sottises : Justum pretium est illud quod nunc
inveniri potest ab emptoribus, prsupposita communi notitia, et remota omni fraude et
coactione . (loc. cit., qu. 77, art. 1er). Il conclut de l que les gens qui crent des monopoles
et font monter les prix au gr de leurs intrts, sont trs injustes. - Cette dfinition est inspire
par la situation de l'Allemagne au temps de Cajtan. Jansenn nous montre, en effet, que les
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
187
de rendre l'approvisionnement difficile parat aussi criminel aux producteurs qui
manquent de matires premires qu'aux consommateurs qui manquent de subsistances. Dans les luttes contre le, protectionnisme agrarien, les libre-changistes
ont beaucoup us de cette argumentation et dnonc les gens qui voulaient se faire
des rentes en accroissant les prix.
La notion d'accaparement devient de plus en plus vague au fur et mesure que
la spculation s'enferme dans les Bourses et qu'autour de celles-ci s'tendent des
institutions fondes sur la socialisation de l'change. En gnral un dlit n'est
susceptible d'tre bien compris que tout autant que chaque citoyen comprend aussi
qu'il aurait pu commettre l'acte dlictueux ; chacun de nous est constitu juge d'un
crime qui lui est idalement personnel. Pour que les dcisions judiciaires soient
aussi conformes que possible aux apprciations populaires, on a institu le jury ; on a fait valoir en faveur du maintien des conseils de guerre, que les tribunaux
civils ne peuvent se rendre compte de la psychologie militaire et que les citoyens
appels siger comme jurs ne pourraient s'assimiler, comme le fait un officier,
l'tat d'me du soldat criminel ; - de mme ce qui se passe dans les Bourses se
produit dans un monde devenu tranger la masse des citoyens.
Les rgles pnales anciennes taient d'une application relativement facile,
parce que chaque ngociant pouvait comparer les actes des accapareurs ceux
qu'il accomplissait lui-mme dans sa pratique commerciale. Le Code pnal
franais interdit les suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs euxmmes, la runion ou coalition entre les principaux dtenteurs d'une mme
marchandise ou denre tendant ne pas la vendre ou ne la vendre qu' un certain
prix [ayant eu pour rsultat] la hausse ou la baisse du prix au-dessus ou audessous des prix qu'aurait dtermins la concurrence naturelle et libre du
commerce 1 .
On a trouv souvent ces dfinitions bien vagues elles suffisaient autrefois; les
tribunaux, clairs par des experts intelligents et honntes, distinguaient pratiquement les oprations normales et les oprations anormales (qui sont thoriquement
de mme genre). C'est cause de cette unit de genre que la dfinition est vague ;
mais cette unit mme rendait l'apprciation trs sre pour les hommes de
commerce. Ces oprations illicites ressemblent extrieurement aux oprations
ordinaires ; mais elles en diffrent par le ct intrieur et par les rsultats. En fait,
il ne semble pas qu'autrefois les tribunaux aient jamais beaucoup hsit pour svir
contre les coalitions.
Aujourd'hui il en est tout autrement ; quand on signale des coalitions commerciales, les magistrats ne savent gure s'ils doivent les considrer comme
criminelles ou comme licites ; gnralement ils attendent que la coalition ait
produit tous ses rsultats ; si elle a entran des ruines, ils interviennent, parce
grands spculateurs pratiquaient d'normes accaparements contre lesquels des lois nombreuses furent rendues. (L'Allemagne et la Rforme ; trad. fran., tome I, pp. 381-385).
Cet article 449 prvoit aussi les faits faux ou calomnieux sems dans le public, les voies ou
moyens frauduleux ; l'article correspondant du Code italien (art. 289) se borne considrer
ces deux derniers procds si videmment dlictueux. Quelques personnes ont soutenu en
France que la coalition n'est dfendue que s'il s'y mle des moyens frauduleux.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
188
qu'ils sont habitus considrer comme dlictueux chez le failli des actes qui ne
le sont pas chez le ngociant faisant honneur ses affaires 1.
Le public, considrant les Bourses comme un pays tranger, n'a avec elles que
des relations que l'on pourrait nommer diplomatiques. Les conomistes lui ont
prch la doctrine de la non-intervention; ils ont soutenu, que la plus grande
libert commerciale est la vraie garantie du bon march, de la rgularit des
approvisionnements et de la stabilit des prix. Si les choses se passent, peu prs,
comme l'ont dit les conomistes, le public ne s'intresse point ce qui se produit
dans le monde des spculateurs 2 mais il proteste ds que les faits sont en
contradiction avec cet idal ; il se croit tromp et vol par des, trangers qui lui
avaient promis une paix favorable ses intrts; alors il coute volontiers les gens
qui dnoncent la tyrannie des riches.
Lorsque cela se produit, on peut voir combien l'esprit jacobin est encore puissant dans le socialisme ; on pourrait croire alors que, vraiment comme l'affirment
certaines personnes, la pense socialiste n'est qu'une exagration de la passion
jacobine. On sait combien les vieilles lgislations taient dures pour les accapareurs ; la Rvolution avait rendu contre eux des dcrets terribles sous l'impression
de l'effroi que causait la disette; d'aprs le dcret du 26 juillet 1793, la peine de
mort tait encourue par ceux qui drobent la circulation des marchandises de
premire ncessit, sans les mettre en vente journellement et publiquement 3, ou
qui les laissent gter volontairement. Dans toutes les lois de ce temps on retrouve
l'expression de sentiments trs primitifs, c'est--dire de sentiments qui sommeillent ternellement au fond de l'me populaire ; - qu'il survienne une secousse
quelconque, ces sentiments remontent ]a surface et alors on est certain de
trouver le chemin qui mne au cur des masses en faisant appel aux terreurs qui
ont t souveraines aux poques des grands prils de la Rvolution.
Il ne faut donc pas s'tonner si tant de personnes refusent d'abandonner la
lgende du pacte de famine ; Kautsky prtend que le roi de France trouvait dans
la spculation sur les grains une des meilleures sources de ses revenus 4 ; il est
vrai que le livre auquel l'emprunte cette citation, a paru en 1899 et que l'auteur
n'avait peut-tre pas connu les recherches de Biollay (1885) et de Bord (1887) ; mais voici que, tout rcemment, Rouanet dclare que ces recherches ne l'ont pas
convaincu 5 : voil un homme qui doit tre bien difficile convaincre !
1
4
5
L'article 585 du Code de commerce dclare banqueroutier simple tout ngociant failli qui,
s'est livr [des] moyens ruineux pour se procurer des fonds , et l'article 586 permet au
tribunal d'appliquer la mme qualification au failli qui a contract le compte d'autrui, sans
recevoir des valeurs en change, des engagements trop considrables eu gard sa situation .
C'est bien l'imprudence malheureuse qui est punie.
Dans la sance du 15 mars 1901 de la Chambre des dputs, Jules Jaluzot, accus d'avoir
accapar les sucres, rpondait que les oprations faites la Bourse n'avaient pas modifi les
prix facturs aux piciers d'une manire sensible; d'aprs lui, le prix aurait vari de 1 fr. 11
1 fr. 13. Il voulait prouver que les affaires de la Bourse n'intressent pas le public.
Tornauw dit que le droit musulman prescrit aux marchands de mettre en vente au plus tard
dans les 3 jours les marchandises dont les prix augmentent, et au plus tard dans les 40 jours
celles dont les prix baissent (Le droit musulman expos d'aprs les sources, p. 124).
Kautsky, La lutte des classes en France; trad. fran., p. 59.
Revue socialiste, janvier 1903, p. 85.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
189
Ce dput s'est fait une spcialit, dans le groupe socialiste parlementaire, des
questions conomiques et il les traite d'une manire, sinon trs scientifique, du
moins fort originale ; il n'admet pas que les marchandises puissent renchrir en
temps de consommation excessive et voit dans ce qu'on nomme la loi de King 1,
une violation des principes de 89 2 : De pareils faits ne peuvent pas se produire
sans que le parlement, sans que le lgislateur, sans que la puissance publique
intervienne . Tout comme ses anciens amis de la Libre Parole, qui regrettent si
souvent de ne plus le compter dans les rangs de leur arme antismitique 3, il a le
cauchemar de l'accaparement.
La lutte que Rouanet entreprit en 1901 contre Jules Jaluzot, qu'il accusait
d'avoir accapar les sucres, ne me parat pas avoir jet un vif clat sur le
socialisme parlementaire. Jaluzot avait t dnonc par un ngociant qui, ne
pouvant fournir les marchandises qu'il avait vendues, invoquait l'impossibilit
dans laquelle il aurait t mis d'excuter ses marchs par suite d'accaparements ;
Rouanet avait entre les mains toutes les pices de l'instruction ; il trana le
ministre de la justice dans la boue 4, parce qu'il ne le trouvait pas assez zl contre
Jaluzot ; le juge d'instruction fut dnonc, et il semble mme qu'une enqute fut
faite contre lui pour plaire Grault-Richard et Rouanet (Petite Rpublique, 31
dcembre 1901 et 3 janvier 1902) ; - le grand champion de la Justice immanente,
Francis de Pressens, se plaignit que le gouvernement n'et pas fait entendre au
juge des menaces plus nergiques (Aurore, 11 janvier 1902) ; - tait-ce vraiment
la peine d'avoir tant dclam contre les Conseils de guerre qui jugeraient par
ordre, pour en arriver l ? Enfin une ordonnance de non-lieu cltura cette affaire ;
- et Jaluzot n'tait cependant pas des amis du Gouvernement 5.
Si le public est toujours dispos couter les publicistes qui dnoncent les
accapareurs et accuse les Bourses de faire monter les prix, les agriculteurs soutiennent la thse contraire et accusent les Bourses d'agir d'une manire continue
pour produire cet abaissement progressif, auquel on a donn le nom de dpres1
4
5
D'aprs cette loi empirique construite pour le bl au XVIIe sicle, un dficit de un dixime
augmente le prix de trois diximes. Yves Guyot raconte qu'un jour on lui reprocha de
combattre l'abolition de la toi des salaires et de se montrer ainsi l'ennemi des ouvriers ; on
pourrait aussi demander l'abolition de la loi de l'offre et de la demande, qui, d'aprs certains
agrgs de philosophie, est un vieux cheval de retour de l'conomie politique .
Discours du 22 mars 1901. Revue socialiste, avril 1901, p. 483. Les prtendus prix scandaleux
taient ceux de la fonte dont la production se trouvait insuffisante en Europe. Sur les prix de
la fonte cette poque et le vrai rle au comptoir de Longwy (dnonc par Rouanet), voir ce
que dit Paul de Rousiers (op. cit., pp. 221-222, p. 237).
la sance de la Chambre des dputs du 24 mai 1900, Drumont lui rappela qu'ils avaient eu
ensemble des relations si cordiales qu'elles ne peuvent s'oublier jamais. - Je retrouve un article
de la Petite Rpublique du 10 novembre 1897 (intitul : Finissons-en) dans lequel Rouanet
accuse les amis du dport de l'le du Diable de chercher drouter les observateurs
impartiaux par quantit de racontars ; il signale les grandes dpenses qu'ils ont faites et se
demande si les meneurs ne seraient pas des complices.
la sance de la Chambre des dputs du 21 mars 1901, fut lu un article de Rouanet contre
Monis qui gale tout ce que Drumont, a pu crire contre ce collgue de Waldeck-Rousseau.
Henri Turot essaya d'piloguer sur cette ordonnance de non-lieu et se demanda si l'instruction
avait t srieusement mene (Petite Rpublique, 16 mars) ; une rponse premptoire de
Jaluzot est dans le numro du 20. On peut faire bien des hypothses sur les vrais motifs qui
avaient dirig nos illustres justiciards dans cette affaire.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
190
sion. Il est absolument impossible de savoir si une pareille apprciation est
fonde ; elle a t soutenue par un ancien courtier de Liverpool, Charles W.
Smith, qui attribue au march terme les trois quarts de la dpression qui depuis
vingt-cinq ans se serait produite sur les bls. Andr Sayous, aprs avoir fait une
enqute sur place et notamment avoir nou des relations avec Smith, prtend tre
arriv trouver que cinq ou six pour cent seulement de la dpression peuvent
s'expliquer par le march, terme 1. Il semble bien difficile de croire que l'on
puisse attribuer une cause certaine d'aussi faibles diffrences ; d'ailleurs Sayous
ne donne point ses calculs.
Les agrariens semblent tre surtout proccups de ce que les spculateurs ne
se coalisent point pour soutenir les prix; les importateurs, disent-ils, ont perdu
leur ancien intrt la hausse 2. Il rsulterait de l que les Bourses auraient pour
effet de forcer les prix suivre le mouvement gnral d'abaissement qui
caractrise la production moderne. Les producteurs ont pens qu'ils pourraient, en
s'entendant, changer l'orientation des prix et de tous cts on vante les merveilles
qui pourraient rsulter de l'action des syndicats ou cartels.
Il faut observer ici que l'exprience rvle de grandes analogies dans la forme
entre le commerce des Bourses et celui des cartels, et ces analogies mritent d'tre
mises en vidence ; car ainsi nous pourrons mieux comprendre la position juridique du problme ; on sait que les agrariens sont grands admirateurs des syndicats
de production et qu'ils ont enrl des bataillons de juristes pour dnoncer les vices
des Bourses. S'il y a des analogies de formes entre les deux espces d'oprations,
il est difficile d'admettre que les dterminations juridiques puissent tre notablement diffrentes dans les deux cas.
On a souvent reproch aux Bourses d'oprer sur des marchandises abstraites,
dont la ngociation serait contraire la nature des choses 3 : le meunier, habitu
se contenter de ce que lui donnait le, propritaire, est remplac par un acheteur qui
exige imprieusement la conformit un type. Les syndicats agricoles, aprs
avoir beaucoup dclam contre cette manire antinaturelle de procder, ont fini
par reconnatre qu'ils auraient avantage bien nettoyer et bien classer les bls
pour les vendre 4 : comment grouper, en effet, les ventes s'il n'y a pas uniformit
dans les masses offertes aux acheteurs ?
Dans ses excellentes recherches sur les syndicats industriels, Paul de Rousiers
a fait observer que les cartels allemands s'efforcent de rduire le nombre des
types ; ds que le comptoir des poutrelles a t form, on a uniformis les
profils 5. Il arrive souvent que les matires premires ou demi-ouvres se prtent
mieux aux ententes que les matires fabriques, qui offrent trop de varits ; la
fonte, les aciers demi-ouvrs, les tles, les fils de fer, conviennent bien la
1
2
3
4
5
Revue politique et parlementaire, oct. 1899, p. 123.
Revue politique etc., loc. cit., p. 118.
Les tribunaux allemands distinguent les marchandises de Bourse et les Lieferunggeschaefte.
Il a t plusieurs fois question de cela dans les Mmoires soumis au Congrs de la vente du
bl, Versailles (Compte-rendu, tome 1, p. 25, p. 90, p. 93, p. 109).
Paul De Rousiers, op. cit., pp. 260-261.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
191
formation de cartels, mais la quincaillerie, les fourneaux, le fer marchand ne s'y
prtent pas ; les tisseurs allemands n'ont pu s'entendre, tandis qu'il y a un cartel
des fils 1 ; les fabriques de briques rfractaires sont syndiques, mais pour la
qualit la plus commune. En gnral les produits doivent appartenir la catgorie des objets interchangeables, sans personnalit 2 ; - c'est--dire que les cartels
fonctionnent sur des marchandises trs voisines des marchandises de Bourse.
Les cartels allemands se rapprochent encore des Bourses, en ce qu'ils cartent
les petites affaires, qui intressent le moyen et le petit consommateur. Le comptoir
des houilles de Westphalie avait d'abord fix 6.000 tonnes le moindre de ses
marchs et plus tard il consentit descendre 600. En 1896 s'tait form en Italie
un syndicat du fer, qui n'acceptait de traiter qu'avec des maisons de premier ordre,
le mettant l'abri de toute perte 3. Que n'a-t-on pas dit contre les rglements de la
Bourse du commerce de Paris qui n'accepte pas, pour les farines, de filire
infrieure 150 quintaux ?
Enfin il y a un troisime caractre commun remarquable ; les vendeurs cherchent s'assurer contre les baisses futures ; mais les cartels exagrent beaucoup
les pratiques des Bourses, car ils cherchent imposer leurs clients des marchs
portant sur des priodes tellement longues que toute prvision est impossible pour
ceux-ci. La mtallurgie allemande a beaucoup souffert des exigences des mines,
qui la foraient traiter dix-huit mois l'avance 4 ; or, on sait que, dans la
mtallurgie les crises sont particulirement brusques. Le comptoir des fontes de
Longwy se montre beaucoup plus modr que les cartels allemands 5 ; il tablit
des contrats pour 3 et 5 ans, mais il est sous-entendu que si les prix s'abaissent
beaucoup, il suspendra l'excution normale et intercalera un march prix moins
forts. En Allemagne il est arriv que les hauts-fourneaux ont, au contraire, forc
les forges prendre livraison, au grand dommage du march; d'ailleurs dans ce
pays, presque tous les cartels ont abus de la situation quand les mauvais jours
sont venus 6.
Les conomistes thiques reprochent aux Bourses de permettre l'assurance
contre les baisses futures et ils justifient cette critique de la manire la plus bizarre. Le risque qui cre le droit au bnfice disparat, dit un auteur qui a rsum
leurs thses ; en facilitant le partage des risques, le march terme fait manquer le
producteur et le commerant au devoir de les supporter 7. Mais comme toujours,
le droit et le devoir changent trs facilement quand il est de l'intrt des thiques
de les faire changer.
1
2
3
4
5
6
7
Paul De Rousiers, op. cit., pp. 145-147.
Paul De Rousiers, op. cit., p. 258.
Cf. sur ce syndicat un article de Vittorio Racca dans la Riforma sociale (de Turin), 15
dcembre 1899. Ce syndicat obligeait payer dans les huit jours de l'expdition.
Les marchs de coke, livrable en 1900 au prix de 14 marks la tonne, se fusionnrent au
printemps de 1899 avec ceux de 1901. Une quantit double de coke tait offerte au prix de 17
marks. (Andr Sayous, La crise allemande de 1900-1902. Le charbon, le fer, l'acier, p.
109). L'auteur nous dit que cette offre fut impose aux clients ; on leur aurait livr en 1900
de trs mdiocres qualits et plus tard on aurait refus de traiter pour 1901 (p. 101).
Paul de Rousiers, op. cit., pp. 223-228.
Paul de Rousiers, op. cit., p. 230.
Dollans, L'accaparement, p. 76.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
192
Les cartels ne nous apparaissent pas comme des moyens de socialiser
l'change ; ils groupent des volonts sur le march en vue d'exercer un effet bien
dtermin ; ils prtendent que leur action sera comparable celle d'une volont
plaant des barrires sur certaines routes, canalisant le mouvement suivant ses
vues, ayant une politique conomique. Tout cela constitue, tout le contraire de ce
que l'on recherche dans la socialisation du milieu, celle-ci devant faire disparatre
les obstacles et anantir toute matrise sur l'change ; - que cette matrise soit
particulire ou collective, c'est toujours la mme chose. Si on parle quelquefois de
socialisation de la vente, propos des cartels, c'est qu'on est tromp par l'emploi
du mot social qui a tant de sens: de ce que c'est une association qui opre pour
s'emparer de l'change, il n'en rsulte pas qu'il y ait socialisation, pas plus que le
passage d'une industrie une rgie fiscale ne constitue un progrs vers la
socialisation.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
193
Introduction lconomie moderne :
Troisime partie : le systme de lchange
Chapitre VII
Les entrepts. - Les statistiques. - Les expertises. - Ides de Proudhon sur la disparition
des spculateurs. - L'ancienne spculation locale; sa psychologie ; ses analogies avec l'esprit
fodal. - Magasins bl allemands - Silos proposs autrefois par Doyre.
Retour la table des matires
Nous allons tudier ce qui est socialisable tout autour des marchs modernes,
ce qui peut tre organis d'une manire objective, en supprimant les pages que
peuvent percevoir des matres particuliers.
Proudhon avait t extrmement frapp 1 du rle que pourraient remplir prs
des gares notables de chemin de fer, des entrepts destins recevoir les produits
jadis enferms dans les greniers des paysans. Je crois que le commerce trouverait
un immense avantage pou-voir emmagasiner plus conomiquement les produits
dans les gares ; les grandes compagnies ne comprennent peut-tre pas bien, sur ce
point, leur rle, ni mme leur intrt ; quant l'tat, suivant son habitude, il ne
comprend rien. Paul de Rousiers nous apprend qu'en Amrique l'ide de Proudhon
a t applique dans l'Ouest ; l'elevator est l'accompagnement oblig de la gare 2.
1
2
) Proudhon, Des rformes oprer dans l'exploitation des chemins de fer, p. 255.
Paul de Rousiers, La vie amricaine. Ranches, fermes, usines, p. 172.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
194
Du fait de leur passage l'elevator, les grains changent de nature commerciale ; ils appartiennent au stock visible et peuvent tre touchs par la statistique.
l'heure actuelle le service des statistiques n'est pas encore organis d'une manire parfaitement satisfaisante 1 ; en Amrique, on a constat souvent de trs
grosses erreurs; beaucoup d'elevators ne sont pas contrls par les fonctionnaires
publics ; les meilleurs statisticiens se tromprent, parat-il, de 30 % en moins pour
l'anne 1899 et de 21 % en trop pour l'anne 1900. Il est difficile d'expliquer
autrement que par l'insuffisance de renseignements exacts l'extraordinaire
mouvement de hausse qui se produisit en Amrique lorsque le gouvernement
franais crut devoir suspendre en 1898 le droit de douane sur les bls ; ce droit est
de 7 francs par quintal; le prix monta de 14 francs New-York 2.
Dans la Capacit politique des classes ouvrires, Proudhon rclamait un service de statistique, de publicit et d'annonces pour la fixation des prix et la
dtermination des valeurs 3. Ce serait une mesure rentrant. dans la catgorie de
la socialisation de l'change. il est peine besoin d'insister sur l'importance de la
fixation des prix; on sait qu'en Allemagne les producteurs de bl ont eu beaucoup
souffrir de la fermeture de la Bourse de Berlin, parce qu'ils ont cess d'tre fixs
sur les prix et qu'ils ont ainsi t ramens aux pratiques de l'ancien temps.
Un service tout moderne, install pour les besoins des Bourses, est celui des
expertises: la marchandise commence s'avancer sur le chemin de la dtermination de la valeur; le produit devient, par l, quelque chose d'abstrait, capable
d'entrer dans des oprations d'ensemble sans qu'il soit ncessaire que le ngociant
l'examine ; il ressemble un lingot de mtal prcieux poinonn par le reprsentant de l'tat. Proudhon a beaucoup insist sur le rle de l'expertise ce point de
vue ; en 1846 il crivait propos d'un projet de loi sur les marques de fabrique :
Je partage, tout fait, l'ide de Wolowski... Que ce soit une rgie particulire
qui marque au nom de l'tat et garantisse la qualit des marchandises, ou que le
soin de la marque soit abandonn au fabricant ; du moment que la marque doit
donner la composition intrinsque de la marchandise (ce sont les propres termes
de Wolowski) et garantir le consommateur contre toute surprise, elle se rsout
forcment en prix fixe 4.
Suivant son habitude, Proudhon ne tient pas compte de toutes les mdiations 5,
de tous les stades, par lesquels passera le produit avant d'avoir une valeur certaine;
mais il reconnat parfaitement la transformation que subit la marchandise par
1
3
4
5
Congrs de la vente du bl, tome I, pp. 100-101. On a cr Fribourg en Suisse un office de
statistique pour le bl, dans le but de rendre les mmes services que rend Licht pour le sucre
(p. 120). - Depuis que les grands spculateurs amricains se sont occups du cuivre, il est
devenu extrmement difficile d'tre fixe sur la statistique exacte du cuivre, l'amalgamaled
copper ayant pour principe le mystre. (Dbats, 16 mars 1902).
Revue politique et parlementaire, novembre 1900, p. 283. - Le 22 octobre 1897, Mline
dclarait la Chambre des dputs que la campagne mene par l'opposition en vue d'effrayer
la population sur le prix futur du pain, avait eu pour effet de faire monter les prix. Cela est
assez vraisemblable.
Proudhon, Capacit politique des classes ouvrires, p. 159.
Proudhon, Contradictions conomiques, chap. VII, 3.
C'est cette suppression des mdiations qui doit ranger Proudhon parmi les idalistes en dpit
de ses grandes proccupations pragmatistes.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
195
l'expertise; elle cesse d'tre un simple produit pour entrer dans la voie des formes
abstraites; il n'y a pas une tarification gnrale, comme il le dit; mais cette tarification et l'expertise appartiennent au mme ordre de transformations des produits
tendant devenir valeurs sociales.
C'est la pratique des Bourses qui rend seule claire cette thorie qui tait encore
quelque peu obscure dans Proudhon ; il croyait l'expertise impossible, raliser
sous le rgime de la concurrence et ce sont les besoins du grand march capitaliste
qui ont conduit la raliser ! Nul doute, cependant, qu'il n'y ait quelque chose
faire pour arriver une socialisation plus parfaite et donnant plus de garanties aux
producteurs.
Voici comment Proudhon comprenait le rle des entrepts : Relis entre eux
par le rseau circulatoire, en correspondance perptuelle et instantane par le
tlgraphe, ces nouveaux instruments d'change ne forment plus, dans toute la
France, qu'une immense halle, un march unique et permanent, une Bourse
continue o la mercuriale se balance, entoure de toutes les garanties de bonne foi
et de certitude... La spculation disparat. Comment serait-elle possible ? quoi
servirait-elle ?... Le gnie mercantile qu'excitait si vivement autrefois le dfaut ou
l'insuffisance des voies de communication, l'absence de renseignements, la lenteur
des courriers, la pauvret des moyens de transport... va- se rduire un simple
office de bureau, comme le contrle des poids et mesures 1.
Dans cette description, il faut noter que Proudhon nglige tout ce qui est en
dehors de la socialisation ; il ne veut voir que celle-ci et il est ainsi entran,
comme on l'a t si souvent, d'ailleurs, confondre ce qui entoure le march avec
le march lui-mme ; sur celui-ci la spculation n'a pas disparu. Les docks ne
suffiraient pas pour engendrer un nouveau systme de rapports entre producteurs
et consommateurs et pour crer ce qu'il appelait l'galit dans l'change 2.
Ce qui tend disparatre, par suite des mesures de socialisation, c'est la classe
des marchands-usuriers qui existaient autrefois dans tous les gros bourgs o se
tenaient des marchs importants. Par suite d'illusions psychologiques faciles
expliquer, les agrariens ont gnralement attribu tous leurs maux aux grands
spculateurs de la Bourse ; ils croyaient que, ces gens, tant infiniment plus riches
que les marchands du pays, devaient leur faire du mal en proportion de leurs
richesses ; et ils ngligeaient d'examiner le rle des adversaires qu'ils avaient tout
prs d'eux. Ils se sont aperus de la vrit depuis qu'ils ont cr des syndicats pour
la vente en commun et la conservation des crales, syndicats qui rendent inutile
l'intervention de ces petits spculateurs-vampires 3.
Je crois que le rle de ces personnages n'a jamais t apprci sa juste valeur, parce qu'on s'est trop attach considrer le peu de surface de leurs affaires ;
mais leur disparition a une si grande importance dans l'histoire sociale moderne,
que je crois utile de m'arrter un instant sur ce sujet.
1
2
3
Proudhon Des rformes oprer dans l'exploitation des chemins de fer, pp. 256-257.
Proudhon , De la Justice, tome I, pp. 311-314.
Congrs de la vente du bl, p. 89.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
196
Ces spculateurs de village avaient souvent des aptitudes commerciales tout
fait remarquables et j'en ai connu qui faisaient l'admiration de grands ngociants ;
attachs leur localit par des liens de famille ou par le got pour la proprit
rurale, parfois aussi par l'orgueil que leur procurait leur puissance, ils exeraient
leurs facults combiner des ruses diaboliques en vue d'exploiter les paysans.
Leurs victoires leur procuraient autant de satisfaction que peuvent en procurer aux
grands spculateurs amricains les plus belles oprations de Bourse. D'ailleurs les
uns et les autres, malgr l'norme disproportion des oprations, appartiennent au
mme type ; et on doit les rapprocher aussi des anciens chevaliers allemands,
toujours disposs faire des expditions de pillage.
Tous ces gens ne mesurent pas l'importance de leur activit la grandeur des
biens conquis ; c'est une mesure tout intrieure qui leur sert. Ne savons-nous pas
que des pomes piques ont t composs pour clbrer les exploits de hros de
villages ? 1 On ne comprend pas toujours bien ces sentiments parce qu'il semble
que l'orgueil doit dpendre surtout de conditions objectives, de l'admiration que
des multitudes manifestent pour un personnage illustre ; nous nous figurons
comme type d'orgueil celui que pouvait prouver le triomphateur romain ; nous
nous trompons ainsi compltement, car le sentiment fodal n'est pas du tout
classique. La joie que ressentent nos hros de bourgade est fonde sur le grotesque ; ils sont heureux d'avoir humili, ridiculis et dshonor leur adversaire; ils
veulent rire du malheur d'autrui et ne reculent devant aucune ruse pour arriver le
mettre dans une situation burlesque. Aussi ne faut-il pas s'tonner si l'habilet est
plus estime par les barbares que le courage : celui-ci doit tre plus admir dans la
Cit, mais l'habilet procure plus de joies intrieures.
Nous avons eu, dans les temps modernes, Lin exemple tout fait remarquable
de l'me fodale et c'est cause de son caractre fodal que Bismarck a t
souvent si mal compris ; il n'y a que des hommes de ce, type pour pouvoir faire
des plaisanteries macabres semblables celles o il excellait : trouver, par exemple, l'odeur d'oignon brl un village plein de cadavres dvors par les flammes.
Beaucoup de fautes politiques de Bismarck s'expliquent facilement quand on a
bien -compris l'importance du grotesque : il voyait dans la politique un moyen de
s'amuser aux dpens des faibles; il a cr mille incidents pour avoir l'occasion
d'humilier Gladstone et rire de la situation piteuse o se trouvait plac cet homme
grave; il a bless la Russie pour jouir des embarras qui accablaient Gortchacow 2
et il a jou au congrs de Berlin des scnes tout fait amusantes; sa politique
mditerranenne n'est explicable que si l'on tient compte du plaisir qu'il prouvait
provoquer des msaventures l'Italie et lui faire remplir le rle de clown dans
ses combinaisons: attacher sa fortune le pays de Mazzini et de Garibaldi, ne pas
l'aider acqurir un pouce de territoire colonial et provoquer lannexion de Tunis
par la France ; il y avait dans cette grosse farce de quoi bien distraire Bismarck.
Les chants piques bretons se rapportent d'obscurs pisodes locaux. Il en est de mme des
Sagas scandinaves ; elles se rapportent, pour la plupart, des querelles entre des villageois
d'Islande et des Orcades. (Langlois et Seignobos, Introduction aux tudes historiques, p.
154).
Il fit briller Schouwalow. Souvent la nuit, il allait consoler Gortchacow son chevet sur les
concessions qui l'ulcraient... Le 26 Juin Gortchacow malade se fit porter aux dlibrations et
se plaignit sanglotant, des sacrifices faits par ses collgues russes. (Chaples Andler, Le
prince de Bismarck, p. 183).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
197
Ainsi tout est sacrifi, chaque instant, au besoin d'obtenir du grotesque dans
le milieu o l'on volue ; les rsultats comptent pour peu de chose et, par suite,
des hommes de cette trempe n'attachent pas une importance norme l'tendue du
thtre sur lequel ils oprent. Nous comprenons aussi pourquoi ces hommes ne
peuvent jamais s'arrter et ont besoin d'une agitation perptuelle ; si riches que
soient les spculateurs amricains, la vie de chevalier-pillard leur est toujours
ncessaire.
La socialisation de l'change produite par la cration des entrepts, tend
faire disparatre la classe de ces barons de l'usure qui taient embusqus partout
dans les campagnes. Il va sans dire qu'elle ne fait pas disparatre la spculation,
qui se concentre dans les grandes Bourses.
Le gouvernement allemand a aid les socits de propritaires construire des
magasins bl, qui paraissent rendre de srieux services, et qui permettent aux
cultivateurs, grce aux avances qu'on leur fait, de pouvoir attendre les poques o
les prix sont bons. Il ne faut pas confondre ces docks, o le bl se renouvelle
plusieurs fois par an 1, avec les silos que l'on a cherch construire il y a une
quarantaine d'annes pour conserver les grains des annes d'abondance en vue des
annes de disette. Doyre fit, avec l'appui des frres Preire, des expriences qui
montrrent qu'on pouvait russir, en employant des rservoirs mtalliques et en
tuant tous les insectes avec des vapeurs de sulfure de carbone. Ses travaux furent
accueillis avec le plus grand enthousiasme. Michel Chevalier crivait, dans les
Dbats du 30 juillet 1856 : Le problme de l'ensilage conomique et certain
dans ses effets peut tre considr comme rsolu aujourd'hui... C'est un grand
encouragement aux oprations commerciales... C'en est un pour la cration d'tablissements de crdit o les cultivateurs obtiendraient des avances contre le dpt
de leurs rcoltes ; ce serait la fondation du crdit agricole.
Il ne semble pas que l'on ait fait grand'chose pour raliser cette conception ;
les dpenses, cependant, ne semblent pas devoir tre trs grandes d'aprs les
expriences faites; Robert de Pourtals, qui avait immdiatement appliqu les
ides de Doyre, disait que les silos construits chez lui avaient cot 58 francs par
mtre cube de capacit 2 ; ce n'est pas un prix excessif. Mais, aujourd'hui, les pays
producteurs de crales tant beaucoup plus nombreux qu'autrefois, le cultivateur
qui garderait ses grains durant plusieurs annes, ne trouverait plus aussi facilement qu'autrefois les hauts prix capables de compenser ses frais. En tout cas, ces
ensilages pouvant durer longtemps, ne sauraient donner lieu des prts analogues
aux prts commerciaux, comme semblait l'admettre Michel Chevalier. Les
oprations faire ressembleraient plutt celles du crdit foncier.
On nous dit qu' Halle le magasin peut dbiter six fois sa contenance ; en 1898-1899, il a
dbit 280,000 quintaux pour une contenance de 120,000. (Congrs de la vente du bl, pp. 9193). - On s'est fait, semble-t-il, beaucoup d'illusions sur le fonctionnement de ces institutions.
Je vois dans les Dbats du 31 aot 1903, que le magasin de Halle a perdu 80,000 marks en
1901 et 32,000 en 1902.
Doyre, Conservation des grains par l'ensilage, p. 335. Doyre introduisait dans ses silos
quinze grammes de sulfure de carbone par hectolitre de bl, afin de dtruire les insectes (p.
54).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
198
Introduction lconomie moderne :
Troisime partie : le systme de lchange
Chapitre VIII
Warrants et leur signification. - Thorie, moderne du prt intrt dduite de cette
pratique. - Les prtendus warrants agricoles.
Retour la table des matires
Lorsque des marchandises de qualit dtermine sont places dans des
entrepts et que ces entrepts sont les annexes d'un grand march pour lequel ils
tiennent les produits la disposition, les marchandises ont acquis une proprit
qui leur permet de faire un pas de plus sur le chemin de la valeur. Elles possdent
une sorte de valeur virtuelle, que les banquiers, peuvent apprcier d'aprs les
cours, et qui donne lieu une opration trs importante, celle du warrantage.
La loi du 28 mai 1858 a introduit en France une pratique qui existait depuis
longtemps en Angleterre : le magasin gnral dlivre un rcpiss ou weightnote
et un bulletin de gage ou warrant ; le premier document sert transmettre la
proprit par voie d'endossement, et le second permet d'emprunter sur nantissement; le produit ne peut sortir de l'entrept que sur la production simultane des
deux pices. On voit l gnralement un mcanisme commode pour faciliter le
crdit ; mais je crois qu'il y a une interprtation plus complexe en donner.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
199
Dans son projet de Banque d'change, Proudhon ralisait le warrantage de la
manire suivante : La Banque achte 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 du prix de revient,
selon les circonstances et la nature des marchandises de ses socitaires, et les leur
consigne par un acte de dpt privilgi. Jusqu'au terme fix par la lettre de
consignation, le consignataire a la facult de vendre aux meilleures conditions
possibles et n'est tenu que de rembourser la valeur avance par la Banque (Art.
31 et 32). Dans les statuts de la Banque du peuple, le systme est trs lgrement
modifi ; elle achte terme, demi, deux tiers, trois quarts, quatre cinquimes
du prix de revient, les produits de ses clients et les fait dposer soit dans un
entrept, soit dans un magasin qu'elle indiquera. Jusqu'au terme fix par le contrat
de vente, le cdant aura la facult de racheter les marchandises, en remboursant
la Banque la somme avance par elle. (Art. 39 et 40).
Quand Proudhon publiait ces projets les magasins gnraux taient rglements par un dcret et un arrt des 21 et 26 mars 1848, qui ne semblent pas avoir eu,
d'ailleurs, une grande influence dans la pratique. Ces rgles ne prvoyaient que le
rcpiss qui devait servir la fois pour la vente et pour le nantissement ; le
gouvernement provisoire avait surtout en vue de permettre l'industrie de surmonter la crise provoque par les vnements de fvrier, crise que l'on croyait
devoir tre de courte dure.
La vraie signification des warrantages avait t reconnue par Proudhon avec
une parfaite lucidit ; il s'agit d'une vente provisoire 1, faite un capitaliste qui n'a
pas l'intention de prendre livraison de la marchandise et qui compte que son
vendeur - trouvant la mieux placer avant l'expiration du dlai de liquidation - le
dbarrassera du souci d'utiliser le produit acquis. La pratique des Bourses nous
fait paratre toute naturelle cette opration ; nous sommes, en effet, habitus voir
des capitalistes faire de grosses spculations sur des objets qu'ils seraient fort
gns d'avoir quelques jours dans leurs magasins. Les spculateurs raisonnent
uniquement sur les variations de prix; de mme le banquier, qui avance de l'argent
par warrantage, raisonne sur une heureuse transformation des conditions des
marchs permettant l'emprunteur de vendre dans de bonnes conditions. Bien
diffrent de l'usurier, qui espre que son dbiteur ne pourra se librer et lui
abandonnera son gage, le banquier ne dsire que le relvement de la situation de
son dbiteur, de manire, n, pas tre embarrass par le gage.
La valeur du produit est dcompose en deux parties : l'une est considre
comme pratiquement certaine ; elle est un minimum en-dessous duquel ne pourrait pas tomber, moins de cataclysmes imprvisibles, le prix de vente sur le
march 2 ; - l'autre est variable et alatoire. On vend la premire partie un
banquier au moyen du warrant et on cherche acqureur pour le corps de la marchandise, reprsent par le rcpiss. La sparation des deux parties de la valeur
1
Dans les magasins coopratifs monts par les agriculteurs, chaque adhrent reoit une fraction
de la valeur de son bl en le dposant ; j'estime que cette opration constitue une vente
provisoire.
En Amrique on opre un peu autrement qu'en France; les banquiers avancent quelquefois
jusqu' 95 0/0 de la valeur ; mais l'emprunteur doit rapporter, en cas de baisse, immdiatement
les sommes ncessaires pour que l'cart proportionnel reste toujours le mme.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
200
tait purement abstraite et ne pouvait se raliser que par des critures ; la vente du
corps matriel force supprimer toute l'abstraction ; les deux parties se runissent
et l'acqureur, pour pouvoir entrer en possession de l'objet, rembourse au banquier
la partie de valeur acquise provisoirement par lui.
Nous avons l un trs remarquable exemple d'une analyse conomique fonde
sur un mcanisme de comptabilit ; ce n'est pas dans la nature des choses que l'on
pourrait trouver cette dichotomie de la valeur.
L'opration n'est possible que si l'on suppose que le prix augmentera durant la
dure des oprations, autrement il vaudrait mieux vendre tout de suite. Si l'on
suppose que la partie constante soit gale au prix du march au jour du warrantage
et que l'accroissement du prix se fasse d'une manire rgulire, la partie variable
reprsentera l'effet de cette force fictive qui semble oprer dans les marchandises
et que j'ai dj compare une force productive, en parlant des prts sur rcoltes.
Dans cette force fictive se traduit le rsultat final des conjonctures conomiques
travers le temps. Ce n'est pas le produit qui change ; c'est l'ensemble du monde
qui se transforme ; il y a une productivit externe.
Nous arrivons ainsi trouver la thorie clbre de Boehm-Bawerk sur la diffrence qui existe entre les biens prsents et les biens futurs. Jamais cette thorie
n'aurait pu acqurir l'importance qu'elle a acquise de nos jours, si la pratique du
warrantage ne nous avait rendu familire l'ide de la productivit externe, sur
laquelle repose tout le systme des avances sur marchandises. On ne devra donc
plus s'tonner qu'une conception aussi simple que celle de Boehm-Bawerk ait pu
chapper aux anciens auteurs : ils ne pouvaient se former une ide claire de la
productivit du temps, parce qu'ils n'avaient pas sous les yeux des pratiques
capables de la leur montrer.
Joseph Rambaud dit, propos de cette doctrine, que les thologiens scolastiques n'auraient pu l'admettre parce qu' leurs yeux le temps appartient
Dieu 1 ; la diffrence des biens prsents et des biens futurs n'aurait donc pu
justifier le prt intrt. Il me semble que la question est mal pose : il y aurait eu
un cercle vicieux, au Moyen-Age, vouloir fonder la lgitimit de l'usure sur une
idologie conomique de la productivit du temps, car on n'aurait pu fonder cette
idologie que sur l'observation mme de l'usure. Une idologie n'est rien par ellemme ; il faut qu'elle soit explique par des pratiques courantes ; la lgitimit
d'une proposition juridique dpend de l'existence d'une pratique reue.
Nous avons vu que Proudhon prenait pour base des avances le prix de revient
des marchandises ; les rglements de 1848 avaient prescrit une expertise pralable ; la loi de 1858 a fait disparatre cette sujtion qui ne semble pas, en effet,
trs ncessaire, parce que les banquiers seront toujours peu disposes faire des
avances sur des marchandises qui n'auraient pas un coulement certain sur le
march. Un warrant ne peut vraiment circuler comme un effet de commerce que
dans le cas o la ralisation de sa valeur est certaine ; l'existence des Bourses
capables d'absorber toutes les marchandises des magasins gnraux est une
condition essentielle du systme.
1
Joseph Rambaud, Histoire des doctrines conomiques, p. 38.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
201
Il est vident que l'on ne saurait assimiler aux marchandises dposes dans les
magasins gnraux et mises la porte de Bourses de commerce, des produits que
le propritaire garde chez lui, qui n'offrent aucune garantie de qualit, dont la
bonne conservation est alatoire et qui ne pourront se vendre que sur un march
troit. C'est donc bien tort que la loi du 18 juillet 1898 a donn nom de warrants
aux certificats au moyen desquels elle a essay de raliser le crdit agricole : cette
loi n'a pas adopt, d'ailleurs, la dichotomie de la valeur : le propritaire, aprs
avoir remis le bulletin (improprement appel warrant) son prteur, ne peut plus
vendre son produit, dont il devient le gardien. Chose tout fait singulire, le
prtendu warrant est rdig par l'emprunteur et n'offre aucune garantie de sincrit : une pareille opration semble avoir t combine en vue d'viter toute
analogie avec une socialisation du crdit.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
202
Introduction lconomie moderne :
Troisime partie : le systme de lchange
Chapitre IX
L'escompte. - La Banque du peuple et les discussions de Proudhon avec Bastiat. - Police
de l'escompte. - Taux de l'escompte. - trange thorie de P. Brousse. - Principes actuels de
l'administration des grandes banques.
Retour la table des matires
Lorsque la marchandise a t vendue, qu'elle est entre les mains du marchand
qui doit l'offrir la consommation, qu'elle est ainsi sur les frontires de
l'utilisation dfinitive, elle acquiert une valeur in concreto que l'on peut regarder,
dans la pratique ordinaire, comme tant fixe d'une manire assez exacte pour
qu'on parle alors de dtermination sociale. Sans doute il y a encore un peu
d'arbitraire dans cette valeur ; mais les banquiers sont justement des gens dont la
profession est de raisonner sur des hypothses plausibles ; ils entrent de nouveau
en jeu et pratiquent l'escompte. L'escompte est une des oprations sur lesquelles la
socialisation peut s'exercer de la manire la plus remarquable et propos de
laquelle on a dit le plus de sottises.
En 1850, dans sa rponse la sixime lettre de Bastiat, Proudhon crivait :
On appelle valeur faite dans le commerce une lettre de change ayant une cause
relle, revtue des formes lgales, mane d'une source connue et solvable,
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
203
accepte et au besoin endosse par des personnes galement solvables et connues,
offrant ainsi triple, quadruple garantie, et susceptible, par le nombre et la solidit
des cautions, de circuler comme numraire 1. La lettre de change a un dlai de
paiement ; elle ne sera annule par l'change contre de la bonne monnaie que dans
deux ou trois mois ; ceux qui l'acceptent, demandent une commission, parce qu'ils
collaborent maintenir l'hypothse de l'identit de la lettre de change et du
numraire ; l'escompte a un prix sur le march, comme toute opration de banque.
Mais l'exprience a montr qu'il est possible de simplifier cette circulation entrave a chaque pas par des contrles, des critures et des pages : une banque
centrale peut recueillir ces valeurs faites et les remplacer par d'autres valeurs qui
n'exigent aucun contrle, aucune criture et par suite aucun page en cours de
route ; les valeurs signes par des ngociants solvables et payables dans un dlai
plus ou moins long sont remplaces par des billets vue et au porteur souscrits
par une banque centrale.
Ainsi le temps disparat dans les oprations ; aucune thorie n'aurait pu faire
deviner une alchimie conomique aussi merveilleuse ; seul l'empirisme commercial pouvait nous apprendre comment il est possible de ramener l'avenir sur le
plan du prsent. Puisque c'est l'empirisme commercial qui a introduit ce paradoxe
de l'annulation du temps dans l'escompte (comme il a introduit cet autre paradoxe,
de la productivit par le temps dans le warrantage) c'est lui qu'il faut avoir
recours pour savoir sous quelles conditions cette transformation de l'escompte est
possible. Toute thorie serait impuissante pour nous clairer sur ces problmes ;
c'est ce que ne semble pas avoir compris le professeur De Greef qui a consacr
un norme volume 2 la question des banques d'mission et qui croit pouvoir
dmontrer par la science la gratuit de l'escompte: cet auteur pille Proudhon (sans
le nommer d'ailleurs) et il n'a pas toujours bien entendu les thses proudhoniennes.
Dans sa rponse la troisime lettre de Bastiat, Proudhon avait pos le
problme comme il doit l'tre; la question de la lgitimit de l'intrt ne saurait
tre traite d'une manire absolue pour tous les temps et toutes les conditions
conomiques. cette interrogation de ma part : Prouver que la gratuit du crdit
est chose possible, facile, pratique, n'est-ce pas prouver que l'intrt du crdit est
dsormais chose nuisible et illgitime ? Vous rpondez en retournant la phrase :
Prouver que l'intrt est (ou a t) lgitime, juste, utile, bienfaisant, indestructible,
n'est-ce pas prouver que la gratuit du crdit est une chimre ? Vous raisonnez
juste comme les entrepreneurs de roulage l'gard des chemins de fer 3.
Proudhon croyait qu'une rforme de la Banque de France amnerait une vritable rvolution, que l'abaissement de l'escompte au prix de revient ferait
disparatre toutes les rmunrations capitalistes : Les oprations connues sous le
nom de prt, loyer, fermage, etc., se convertiraient en oprations de change et le
1
2
3
Proudhon, Mlanges, tome III, p. 330.
De Greef, Le crdit commercial et la Banque nationale de Belgique.
Proudhon, loc. cit., p. 232.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
204
mouvement des capitaux s'identifierait avec la circulation des produits 1. Ses
ides ont t reprises en Belgique par un richissime industriel, Ernest Solvay, qui
s'est mis en tte de diriger la rvolution sociale 2. Vilfredo Pareto a montr
comment le systme de comptabilisme de Solvay revient une inflation continue
et indfinie de la monnaie, qui entranerait une hausse ininterrompue dans les prix
et une perturbation continuelle dans les rapports sociaux 3. L'exprience a surabondamment dmontr que les procds d'inflation outrance sont surtout
favorables aux agioteurs. En Allemagne les socialistes se sont vigoureusement
opposs au bimtallisme et montr que la situation des classes ouvrires aurait t
empire par ce systme de dtrioration de la monnaie.
Lorsque l'mission des billets se tient dans des limites modestes et que l'or
existe en quantit suffisante pour les affaires internationales, on s'aperoit peine
qu'il y ait inflation ; cependant il est difficile de, croire qu'il ne rsulte pas de cette
inflation un lger trouble dans l'conomie ; mais ce lger trouble est recouvert par
les immenses avantages qui rsultent d'une circulation plus lastique. Les dtenteurs d'or ne peuvent plus exercer une domination aussi grande que par le pass
sur les escomptes ; et ainsi disparaissent des pages onreux ; la production
profite beaucoup de l'institution des grandes banques d'mission.
Les difficults que prsente la thorie des banques se rattachent toutes l'impossibilit de dfinir d'une manire scientifique des conditions qui sont purement
empiriques et de faire passer dans des raisonnements abstraits les hypothses
concrtes sur lesquelles repose l'escompte.
Il n'existe videmment aucun moyen pour savoir si une valeur est socialement
dtermine. Si l'on suppose que seulement des valeurs de ce genre sont prsentes
la banque centrale, il devient difficile de comprendre pourquoi elles Subissent
un escompte, au lieu d'tre acceptes comme quivalant du numraire.
Mais comment sait-on qu'un papier commercial a une telle qualit ? On ne le
sait qu'aprs qu'il a subi la srie des preuves normales pour tre admis l'escompte ; dans la pratique ces preuves se trouvent tre assez svres pour que les
1
Proudhon, loc. cit., p. 69. Ceci est emprunt un projet de dcret destin rformer la Banque
de France, publi par la Voix du peuple, le 9 janvier 1850. Il demande que cette institution
soit remise, aux Chambres de commerce et que l'escompte soit fait de 0,25 1 %. Il considre
que cette rforme constituera le noyau de la rvolution sociale. - Proudhon s'est gravement
tromp en supposant que toutes les rmunrations nonces ici forment un bloc destin,
s'effondrer ds que le taux de l'escompte deviendrait Minime. Il convient, au contraire, de
distinguer plusieurs genres qui peuvent suivre des lois bien diverses. C'est faute d'avoir fait
une analyse de ce genre que tant d'conomistes se sont gars en parlant d'une prtendue loi
qui provoquerait un abaissement indfini des taux de l'intrt. La cration des grandes socits
de crdit a fait changer les conditions dans lesquelles se fait l'escompte en province et les frais
des reports de la Bourse ; mais elle n'a pu, avoir qu'une influence lointaine sur un trs grand
nombre de prts.
Il a fond un Institut des sciences sociales, dans lequel figurrent longtemps trois socialistes
(De Greef, Denis et Vandervelde) chargs de clbrer le gnie de leur bienfaisant patron. De
Greef ne sait comment lui exprimer toute sa reconnaissance pour... les enseignements qu'il a
reus d'un collgue si minent (op. cit., 35). Depuis lors, Solvay a licenci ces courtisans.
Vilfredo Pareto, Systmes socialistes, tome II, pp. 276-282.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
205
pertes soient insignifiantes 1 ; mais encore faut-il que les conditions de la pratique
des grandes banques se trouvent ralises. De Greef s'embrouille dans des cercles
vicieux qui ne peuvent tromper qu'un sociologue.
Proudhon tait proccup des conditions de la sincrit du papier ; dans sa
rponse la cinquime lettre de Bastiat, il dclare que la vente seule donne au
produit sa valeur authentique et que sans le contrle de la vente il est nul et non
avenu 2. Dans son projet de Banque d'change il cherche prendre des prcautions contre le papier qui n'a point pour base une vente srieuse: on doit faire
connatre la nature et la quantit des marchandises ayant motiv la cration de la
valeur prsente l'escompte ; toute fraude ou toute dissimulation commise cet
gard sera poursuivie comme faux (art. 28) : cette menace tait un peu vaine, car
elle n'tait pas conforme aux indications du Code pnal; d'ailleurs l'exprience
semble montrer qu'en matire commerciale les menaces de peines ne sont pas
toujours trs efficaces.
La vente ne suffit point pour que le papier reprsente une valeur socialement
dtermine ; il faut que l'acheteur ait une assez forte situation pour pouvoir couler ses marchandises dans un dlai rapproch. Il est remarquable d'observer
comment Proudhon modifia les conditions de l'escompte dans l'intervalle du 10
mai 1848 au 31 janvier 1849, qui s'coule entre la publication du projet de Banque
d'change et la rdaction des statuts de la Banque du peuple. Il avait d'abord
promis ses adhrents l'escompte illimit toute chance, sur deux signatures,
quand il y a acceptation pralable des produits par un acheteur srieux et il
admettait que l'on escompterait des effets reprsentant des produits prochainement livrables (art. 24, 25, 26). Dans le texte dfinitif il dit que, pour dbuter,
on n'escomptera que les bonnes valeurs du commerce, dans la mesure des
moyens que fournira le capital ralis par la banque (art. 31) ; l'article suivant
promet une extension ultrieure de l'escompte, mais sauf les prcautions
ordinaires prises par les banquiers et fixes par le rglement de la banque .
Les banques d'mission tirent une grande partie de leur scurit de ce qu'elles
vitent d'entrer en relations trop tendues avec le public ; beaucoup d'excellents
esprits pensent qu'elles devraient se borner tre les banques des banquiers 3, de
telle sorte qu'entre elles et les crateurs de papier commercial il existe des hommes d'affaires dont la profession soit d'exercer un contrle srieux sur leur
clientle. On prtend que cela est peu dmocratique ; mais c'est trs pratique.
Nous avons donc l un bel exemple de l'absurdit des thoriciens politiques, qui
veulent transporter dans l'conomie des conceptions qui lui sont totalement
trangres.
Le grand procd par lequel les banques dfendent leurs caisses est l'lvation
du taux de l'escompte ; ce procd donne, en temps de crise, des rsultats gnralement satisfaisants 4 ; mais en temps ordinaire, il est galement trs utile, sur
1
2
3
4
De Greef donne pour la Banque nationale de Belgique 0.012 pour cent (op. cit., p. 403).
Proudhon, loc. cit., p. 288.
Vilfredo Pareto, Cours d'conomie politique, tome I, p. 390.
En corrigeant cette preuve, je lis dans les Dbats du 7 mai 1921 d'importantes remarques de
Vissering, gouverneur de la Banque de Hollande, sur la crise financire actuelle. l'lvation du
taux de l'escompte n'a pas eu l'effet rgulateur qu'en attendaient les banquiers anglo-saxons; il
ne pouvait restreindre les gaspillages des gouvernements; il ne gnait gure les spculateurs
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
206
toutes les places qui ne sont pas trs sres, le taux de l'escompte se maintient haut,
de manire carter les affaires douteuses. Il me semble que l'lvation du taux
de l'escompte est d'autant plus ncessaire que la banque d'mission ressemble
moins une maison prive, qu'elle est davantage sous l'influence du gouvernement et qu'elle a, par suite, un plus grand besoin de se dfendre contre les sollicitations de personnages puissants.
L'erreur de Proudhon me parait donc tout fait grave; sa banque aurait t
rapidement dborde et je ne puis comprendre comment on peut reproduire son
projet aujourd'hui; De Greef propose l'escompte 0,50 p. cent et espre pouvoir le
faire rduire 0,10 p. cent sans distinction de dure 1.
La police de l'escompte forant ainsi raliser des bnfices, on peut leur
attribuer l'un on l'autre de ces deux emplois : ou bien le Trsor public les encaissera, - ou bien l'tat les vendra en bloc, en obtenant d'une socit prive une
remise importante de capitaux. La premire solution est celle qui correspond le
mieux l'esprit moderne, la seconde tait celle des temps passs. Les grandes
banques affubles de titres nationaux, dit Marx, n'taient que des associations de
spculateurs privs s'tablissant ct des gouvernements, et, grce aux privilges
qu'ils en obtenaient, mme de leur prter l'argent du public... Il faut avoir
parcouru les crits des gens de ces temps-l, ceux de Bolingbroke par exemple,
pour comprendre l'effet que produisit sur les contemporains l'apparition soudaine
de cette engeance de bancocrates, financiers, rentiers, courtiers, agents de change,
brasseurs d'affaires et loups-cerviers 2.
Dans les contrats rcents on a combin les deux systmes : les banques ont
rmunrer un capital employ en rentes sur l'tat ou pour lequel l'tat paie un
minime intrt (ou mme pas d'intrt), elles versent aussi au Trsor une partie de
leurs bnfices. Ces dtails administratifs n'ont qu'une importance secondaire ;
mais on s'est demand souvent si on ne pourrait pas supprimer compltement
l'intervention des capitalistes, maintenant que l'tat n'a plus besoin de recourir
des procds dtourns pour se procurer de l'argent.
Il semble que des ides assez singulires aient cours parmi les socialistes
pratiques, rformistes et savants au sujet du capital des banques. Voici, en effet,
ce qu'on pouvait lire dans la Petite Rpublique du 16 fvrier 1903, propos de
l'affaire Humbert, sous la signature de Paul Brousse, qui passe pour un homme
particulirement comptent, en toutes choses, dans son milieu : De cette
opration fiduciaire, Thrse [Humbert] n'a pas eu l'trenne ; la Banque de France
ne fait pas autre chose; elle le fait autrement : elle runit un cautionnement de cent
millions peu prs et elle met cinq millards de papier... On entend bien que je ne
veux pas assimiler les oprations de la Banque de France celles de la sainte
famille. Je ne pose pas pour l'outrancier 3. Mais le principe de l'opration est le
mme : ingalit du gage et de la valeur fiduciaire. Seuls, au dbut, les assignats
eurent un gage suffisant et rel .
1
2
3
qui eurent tant d'occasions de faire des bnfices normes sur les ventes des marchandises et
sur les changes.
De Greef, op. cit., p. 159 et p. 403.
Marx, Capital, tome I, p. 337, col. 2 et p. 338, col. 1.
Non, mais pour l'homme pratique ; on peut voir par cette citation combien serait clair un
gouvernement fes amis de Jaurs !
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
207
La vritable utilit du capital de la Banque est d'avoir des actionnaires
pouvant nommer un conseil d'administration relativement indpendant du gouvernement. Lors des discussions qui eurent lien en Allemagne propos du
renouvellement du contrat avec la Banque de l'Empire, les agrariens auraient
voulu que l'on fit disparatre compltement les actionnaires dont l'autorit est
cependant fort restreinte 1 ; le dput socialiste Schnlank les combattit avec
vigueur : Demander aujourd'hui la cration d'une banque d'tat, disait-il en
rpondant l'antismite Liebermann von Sonnenberg, serait fournir une arme aux
Junkers, faciliter leurs projets de spoliation et contribuer avec eux paralyser les
progrs de la production moderne 2. Les dangers de pareilles influences dsorganisatrices existent un peu partout.
Je trouve tout fait amusantes les rflexions que le discours de Schoenlank
provoque chez De Greef: Les critiques du dput socialiste ne se comprennent
pas ; il avait dgager des intrts empiriques et plus ou moins gostes en
prsence, un plan vritablement organique (!) de circulation et de crdit; il n'a fait
que de la politique opportuniste et trs mauvaise encore, puisque l'occasion lui
tait offerte d'engager les agrariens sur une formule socialiste. Le professeur
belge ne peut comprendre qu'un dput socialiste ait du bon sens et ne se laisse
pas griser par des formules obscures de sociologues, parlant de banques avec la
mme comptence qu'ils parleraient de l'origine du langage.
On a souvent reproch aux grandes banques d'mission d'avoir un gouvernement trop oligarchique ; naturellement ce reproche se trouve dans le livre de De
Greef 3 ; mais l encore le professeur belge a t victime des mots. En France, le
systme qualifi d'oligarchique met l'administration de la Banque entre les mains
d'un petit nombre de chefs de trs grosses maisons parisiennes : ces hommes ont
un bien plus grand intrt ce que l'escompte fonctionne rgulirement et un
taux en rapport avec l'tat des affaires, qu' voir augmenter les dividendes aux
dpens du commerce. L'oligarchie dont on fait un reproche la Banque de France
se trouve tre tout l'avantage du public et constitue un rgime aussi peu bourgeois que possible ; il ralise une socialisation de l'escompte puisqu'il tend faire
rgler l'escompte en vue de la prosprit gnrale de la place.
Marx dit que les premires associations de crdit eurent pour objet de soustraire le commerce maritime et l'tat aux exigences des prteurs. Il convient de
ne pas perdre de vue que les ngociants qui tablirent ces associations, taient les
citoyens les plus importants de leur pays, ayant autant d'intrt soustraire le gouvernement qu'eux-mmes l'usure 4 . C'est justement quelque chose d'analogue
1
2
3
4
On se rappelle les mesures prises autrefois l'instigation de Bismarck contre les avances sur
les fonds russes :
Allemagne a certainement perdu beaucoup d'argent ce moment par suite de cette
politique.
De Greef, op. cit. p. 159.
De Greef, op. cit., p. 379.
Marx, Capital, livre III, 2e partie, p. 174. Il ajoute que les fondateurs de ces institutions
esprrent s'en servir pour assurer leurs dominations. - Le Second empire parat avoir, plus
d'une fois, favoris certaines grandes entreprises de crdit, sous l'influence de l'ide qu'elles
pourraient l'aider tenir le monde rural.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
208
qui existe dans nos grands tats modernes : tant qu'on n'aura pas trouv des
moyens certains d'avoir des assembles lectives produisant la raison et sachant
reconnatre le papier vridique 1, il sera prudent de confier l'escompte rgulateur
exerc par les banques d'mission aux chefs des maisons de banques prives qui
ont le plus grand intrt assurer la bonne marche des affaires gnrales. Les
banques d'mission fonctionneront d'autant mieux qu'elles ressembleront davantage des coopratives de la haute banque.
*
* *
Aprs avoir parcouru tout le systme de lchange, il convient de prsenter
quelques observations qui relvent du gros bon sens commercial, mais dont les
sociologues ne tiennent pas toujours assez compte.
La vente crdit fait apparatre ct de la marchandise, dont l'utilit est
transmise l'acheteur, ce que je propose d'appeler sa valeur potentielle, reprsente par un signe pouvant faire l'objet d'oprations commerciales analogues celles
que l'on fait sur des objets consommables ; le vendeur qui-ne peut plus trafiquer
de la marchandise saisie par l'acheteur, vend le titre de valeur potentielle ou
emprunte sur son dpt. Cette sparation se retrouve dans les diverses spculations qui entrent dans le systme de l'change.
Lorsque, par exemple, on fait venir au Havre du bl d'Amrique, c'est une
valeur potentielle, plutt qu'une utilit, qui voyage, du jugement des hommes de
Bourse. Ds que le destinataire est en possession d'un titre constatant la certitude
de son opration, il peut le faire entrer dans le trafic. Si tout se passe sans accidents, c'est--dire s'il n'y a pas d'avarie en route et si tous les spculateurs
successivement intresss peuvent remplir leurs engagements, l'utilit est dissimule sous la valeur potentielle, jusqu'au moment o la marchandise entre dans le
domaine de la consommation. Mais au moindre accident tout l'difice de la
spculation est branl par l'intrusion de l'utilit qui reparat comme souveraine 2.
Au cours des derniers chapitres, j'ai montr quel chemin compliqu parcourt
la Valeur potentielle, engage dans les marchs modernes pour arriver au prix
dfinitif qu'elle atteint seulement au moment o la marchandise est entre les
mains d'un propritaire pour lequel elle a une utilit de consommation. L'utilit
1
De Greef raisonne comme la science sociologique enseigne par lui l'Universit de
Bruxelles possdait des recettes permettant de rsoudre ces problmes. De telles illusions
peuvent seulement tre acceptes par des admirateurs de Vandervelde.
L'opposition de l'utilit et de la valeur potentielle a rendu trs difficile jusqu'ici l'tablissement
d'une lgislation quitable sur les avaries de chemin de fer. Les ngociants voudraient obtenir
un complet ddommagement de l'utilit perdue, les compagnies cherchent limiter leur
responsabilit ; au temps o l'tat exploitait les messageries en rgie, il y avait un maximum
pour les indemnits dues pour les pertes de bagages ; ce systme a t imit quand on a tabli
les colis postaux; pendant de longues annes les transports effectus sous le rgime des tarifs
spciaux se faisaient peu prs sans garantie. Il semble que le plus sage serait qu'une valeur
potentielle ft dclare par l'expditeur et soumise une taxe d'assurance. Les normes
dficits actuels des chemins de fer donnent un singulier caractre d'actualit cette question
des indemnits.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
209
joue dans ces oprations le rle d'un gnie cach ; le banquier qui fait des avances
sur marchandises ou qui escompte des lettres de change, ne doit pas cesser de se
proccuper de l'utilit ; s'il perd un instant de vue. les besoins de la consommation
et la rapidit avec laquelle celle-ci pourra absorber les objets amens au march, il
s'expose aux plus graves mcomptes. On pourrait dire que les produits s'efforcent
d'entrer progressivement dans le domaine de l'individualisation, qui est celui o le
consommateur apprciera leur vritable utilit, tandis que la valeur potentielle
cherche devenir objective, scientifique et sociale, en s'cartant des apprciations
individuelles, c'est l'utilit qui entrane tout ce mouvement.
Trop souvent les thoriciens de l'change ngligent la force dissimule de
l'utilit et s'garent dans des rveries sur une valeur socialise par leur imagination. Si leurs projets sont partiellement raliss, des crises intenses dsorganisent l'conomie. Tout le systme de l'change repose, en dernire analyse, sur
l'activit de nombreux surveillants de l'utilit. Les partisans des Banques d'tat
voudraient carter ce contrle qui gne leurs plans de grandes oprations ; les
sociologues, qui ne comprennent pas grand chose ces questions, leur viennent
souvent en aide avec leurs sophismes ; le gros bon sens des piciers a jusqu'ici
empch ces personnages de faire tout le mal que pourrait engendrer leur complicit si le gouvernement tait compltement remis aux mains d'Intellectuels.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
210
Georges SOREL,
Introduction lconomie moderne
Observations gnrales
Subordination des sociologies un but. - Reprsentation du mobile par la tension. Inversion de l'ordre historique dam idologie. - Mythes.
Retour la table des matires
Des descriptions du genre de celles que nous venons de faire, ne comportent
point de conclusions ; mais il me semble convenable d'appeler l'attention du
lecteur sur les mthodes que j'ai reues de mes matres et que je m'efforce d'employer d'une manire tous les jours plus correcte ; je chercherai dgager quelques rgles qui pourront tre utiles ceux qui voudraient aborder d'autres problmes conomiques plus compliqus et utiliser l'exprience que j'ai pu acqurir dans
mes recherches. Ces, rflexions n'auraient pas t bien places dans l'avantpropos, parce qu'elles ne peuvent tre parfaitement comprises que de ceux qui se
sont intresss au long travail d'laboration poursuivi au cours de ce livre.
Les questions traites ici comptent parmi les plus simples de celles que l'on
peut se poser en matire sociale ; je les ai tudies pour une poque o le milieu
conomique est trs fortement dpersonnalis ; elles se prtent donc des observations ayant un certain aspect matrialiste et semblent appeler la formation d'une
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
211
sorte de physique sociale. On a cru souvent qu'une connaissance, de ce genre tait
possible ; je pense qu'il n'y a pas d'illusion plus dangereuse que celle-l.
En gnral des mirages de toute sorte agissent sur l'esprit des hommes et tous
les conomistes savent qu'en passant d'un pays un autre il faut s'attendre
trouver des mthodes nouvelles de traiter les affaires; les ides que la tradition
nous a transmises sur le devoir, les conceptions que nous avons au sujet du vrai
bonheur, l'espoir d'un avenir mieux rgl, plus honnte et plus rationnel, toutes
ces forces se traduisent dans l'imagination cratrice des capitalistes. L'industrie est
un art qui comporte des entranements capricieux et qui se droule avec des
allures imprvisibles. Le monde de la production prsente donc des difficults
toutes particulires, tandis que dans le milieu conomique contemporain, il y a
beaucoup de compensations et qu'un apaisement relatif des luttes le fait ressembler une mer n'ayant presque plus de vagues.
Je vais exposer ici trois rgles qui me paraissent fondamentales pour l'tude
scientifique des phnomnes sociaux et dont l'utilit est d'autant plus grande que
l'on aborde des problmes touchant de plus prs la production :
A. - Toutes les classifications, toutes les relations que l'on tablit entre les
phnomnes, les aspects essentiels sous lesquels se prsentent les faits, dpendent
du but pratique poursuivi ; et il est trs prudent de mettre toujours ce but en
vidence.
Il y a un nombre indfini de systmes d'conomie sociale ou de sociologie; les
projets de refonte de la socit ne se comptent plus; les noncs des grandes lois
de l'histoire rempliraient plusieurs tombereaux; et les insuccs de leurs prdcesseurs ne dcouragent pas les fabricants de thories. Ce spectacle a quelque
chose d'effrayant et on a pu se demander s'il n'indiquerait pas une vritable alination mentale chez nos contemporains, toujours aussi empresss poursuivre le
fantme d'une science qui s'loigne d'eux toujours et qui toujours les trompe.
On a souvent essay d'expliquer cette situation en disant que la sociologie est
encore jeune, qu'il faut lui faire crdit et que bien d'autres sciences ont dbut
aussi mal qu'elle ; ce sont l de mauvaises excuses. Les raisonnements gnraux
sur les socits humaines datent de longs sicles et si l'on veut comparer la
sociologie un autre systme de connaissances, il n'y en a pas qui lui soit mieux
comparable que celui des prtendues sciences psychiques ; elles aussi sont fort
anciennes et elles ne cessent de passionner les esprits admirateurs du merveilleux.
Il y a quelques annes Enrico Ferri affirma que la ,sociologie devait devenir
socialiste si elle voulait chapper une sorte de sommeil hypnotique , et ,ne
plus rester, suspendue dans les limbes striles et incolores qui permettent aux
sociologues d'tre, en conomie politique comme en politique, conservateurs ou
radicaux, suivant leur caprice, suivant leurs tendances subjectives . Il expliquait
cet arrt de dveloppement et cette stagnation, en disant que les auteurs reculaient devant les conclusions logiques et radicales que la rvolution scientifique
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
212
moderne devait apporter dans le domaine social ; la science conduit, d'aprs lui,
d'une manire inluctable, au socialisme 1.
Quelques-uns virent dans cette affirmation une gasconnade de sociologue
politicien, cherchant flatter l'amour-propre d'un parti socialiste dans lequel il
venait d'entrer et dont il esprait devenir le chef. Je crois que cette explication est
insuffisante ; il y a, encore l'heure actuelle, des gens attards qui croient la
puissance souveraine, de la science et qui s'imaginent la possibilit de dduire
de propositions scientifiques des programmes pratiques 2 ; Enrico Ferri croyait
trs sincrement que le socialisme se dmontre comme on dmontre les lois de
l'quilibre des fluides, et peut-tre le pense-t-il encore.
Ce qu'il faut la sociologie, c'est qu'elle adopte, ds le dbut, une allure franchement subjective, qu'elle sache ce qu'elle veut faire et qu'elle subordonne ainsi
toutes ses recherches au genre de solution qu'elle veut prconiser. Le socialisme,
offre ce grand avantage qu'il aborde toutes les questions dans un esprit bien dtermin et qu'il sait o il veut aboutir ; - au moins tant que le mouvement ouvrier
exerce sur lui une pression suffisante. Si, depuis quelques annes, le socialisme
semble aller la drive, tout comme la sociologie, c'est qu'il commence oprer
comme celle-ci, qu'il prtend s'lever au-dessus des conditions conomiques et
qu'il devient idaliste.
B. - La connaissance par concepts a t constitue dans l'antiquit pour tudier
les choses immuables, les tres gomtriques, ce qui se conserve et peut toujours
se retrouver; elle semble donc aussi mal adapte que possible aux faits sociaux.
Ceux-ci ne peuvent pas tre facilement compars des corps solides ; on serait
plutt tent de les comparer des nbuleuses, dont la position, les aspects et les
dimensions varient tout instant. Il semble donc qu'il soit possible de dire leur
sujet tout ce que l'on voudra : on les reprsente au moyen de sortes de projections
qui rappellent, par leur grossiret et leur arbitraire, les cartes du Moyen-Age.
L'observateur retient seulement ce qu'il croit tre essentiel ; mais il y a bien des
manires de sparer l'essentiel d'avec l'accidentel ; il en rsulte qu'il n'y a gure de
formule laquelle il ne soit possible d'opposer une formule contraire peu prs
aussi vraisemblable.
Un des matres de la pense contemporaine a maintes fois mis en garde contre
les erreurs qui dcoulent de la philosophie traditionnelle ; il se demande si l'heure
ne serait pas venue d'abandonner la vieille mthode grecque, construite en vue de
la gomtrie, pour chercher atteindre la ralit, le mobile et le continu. Ces
critiques de Bergson trouvent surtout leur application dans la sociologie ; mais
l'esprit n'est pas cependant dsarm devant les difficults qu'il signale; nous
possdons un moyen, la fois trs sr et trs simple, pour venir assez gnralement bout du rel dans les limites de nos besoins 3.
Reportons-nous d'abord aux moyens qui ont t employs, de tout temps, pour
procder une analyse minutieuse, claire et utile des phnomnes sociaux. On les
1
2
3
Enrico Ferri, Socialisme et science sociale, trad. franc., p. 146.
Benedetto Croce, Matrialisme historique et conomie marxiste, trad. fran., p. 159.
La fin de lettre B a t rdige entirement nouveau.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
213
tudie sur ce qu'on peut nommer des projections stylises, arranges avec assez
d'art pour qu'elles donnent l'impression d'tre des ralits auxiliaires, possdant
chacune son principe propre de vie, d'ordre ou de dveloppement. Les hommes
habiles s'efforcent d'envelopper le phnomne social par des systmes d'images
qui ne laissent chapper aucun des caractres dont la connaissance apparat
comme utile pour les recherches qu'ils ont entreprises. Il faut bien se rappeler
qu'aucun ensemble d'images n'a une valeur absolue ; une juxtaposition des projections stylises qui a rendu les plus grands services pour l'examen de certains
problmes, peut se trouver inefficace pour d'autres questions ; il y a beaucoup de
subjectivisme dans la sociologie. Si celle-ci est demeure si souvent strile, c'est
qu'elle a t surtout cultive par des gens dpourvus d'imagination cratrice.
Un des mrites les moins contestables de Marx a t de montrer une extraordinaire dextrit dans l'organisation de ces projections stylises, au moyen
desquelles il a souvent paru avoir puis tout ce qu'offre de varit l'activit
humaine ; ce rsultat n'tait atteint qu'en gard au genre des questions qu'il se
posait ; sa sociologie socialiste est infiniment suprieure aux sociologies construites par les divers pseudo-savants, qui, trop souvent, ont err comme des aveugles
au milieu des faits. L'ordre dans lequel il numre les images doit faire l'objet
d'une srieuse mditation, parce qu'il dpend des ides qu'il se faisait sur les
rapports qui existent entre les divers plans de la connaissance ; Marx l'imitation
de Hegel, tablissait entre eux des genses logiques, dont ses commentateurs ne
semblent pas avoir eu, jusqu'ici, souci ; les marxistes officiels auraient peut-tre
vit bien des illusions s'ils avaient mieux cherch pntrer la pense profonde
de Marx 1.
Les mthodes dont je viens de parler, sont-elles capables de nous conduire
une interprtation de l'incessante mobilit des choses ? On pourrait croire leur
impuissance si on n'avait pas l'exprience sculaire des peintres et des sculpteurs ;
les bons artistes savent trouver des aspects que la stylisation permet de transformer de telle sorte que la tension de l'immobile donne une ide claire de la
mobilit ; cet artifice est si ancien qu'il est surprenant que les sociologues ne se
soient pas aviss de s'en inspirer pour venir bout du rel. L'erreur des gens qui
s'occupent philosophiquement des questions sociales, provient, en bonne partie,
de ce que ces docteurs ne peuvent se rsoudre croire que leur philosophie ait
quelque chose apprendre de l'art. Mais une tude plus approfondie des lois de
l'esprit leur apprendrait que philosophie et art sont deux activits trs voisines
l'une de l'autre.
Cette transformation de la mobilit en tension exige des qualits qu'on rencontre bien plus rarement chez les philosophes que chez les artistes ; et cependant
combien de peintres ou de sculpteurs parviennent seulement produire des
uvres correctes et sans vie ! il faut pour russir, en plus de l'habilit et d'une
parfaite connaissance de la matire, une trs vive sympathie pour le sujet. C'est
pourquoi Marx a t beaucoup plus heureux dans ses exposs du mouvement
rvolutionnaire que dans ses aperus relatifs aux histoires antrieures.
Kautsky est trop tranger toute rflexion philosophique pour souponner l'existence du
mcanisme cach la doctrine de son prtendu matre.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
214
La reprsentation du mobile par la tension de l'immobile russit d'autant
mieux que les changements sont plus rguliers, plus familiers au lecteur, plus
propres lui suggrer l'ide de l'existence d'une loi, ou, comme on dit quelque
fois, mieux rythms. Il faut donc condamner les sociologues qui abandonnent
l'examen des faits actuels pour se lancer dans les hardies considrations sur
l'avenir. Lorsque Bernstein conseillait, il y quelques annes, aux socialistes de
s'occuper du mouvement et non de la fin laquelle aboutirait peut-tre la
rvolution, il disait une chose beaucoup plus philosophique qu'il ne pensait.
C. - Les constructions idologiques sont ncessaires, mais elles sont aussi les
causes les plus frquentes de nos erreurs ; il faut donc rejeter tout ce qui n'est pas
le produit de la rflexion s'exerant sur des institutions, des usages et des rgles
empiriques ayant acquis dans la pratique des formes bien dtermines. Cette proposition mise en lumire par Vico, est une des plus importantes pour le marxiste :
il y a d'abord dans l'histoire, suivant le grand napolitain, une sagesse vulgaire qui
sent les choses et les exprime potiquement, avant que la pense rflchie arrive
les comprendre thoriquement.
A cette rgle se rattache une des lois les plus importantes de notre esprit, qui
est ainsi nonce par Marx dans le Capital: La rflexion -sur les formes de, la
vie sociale, et par consquent leur analyse scientifique, suit une route compltement oppose au mouvement rel 1 ; c'est ce qui se prsente le dernier dans le
inonde, qui explique l'antrieur; ainsi le capital industriel sert interprter le
capital usuraire et le capital commercial qui lui sont bien antrieurs. Marx dit ce
sujet : Nous verrons, dans la suite de nos recherches, que le capital usuraire, et
le capital commercial sont des formes drives (abgeleitete Formen) et alors nous
expliquerons comment elles se prsentent dans l'histoire avant le capital sous sa
forme fondamentale (Grundform) qui dtermine l'organisation conomique de la
socit moderne 2.
Ainsi, donc, le principe qui idologiquement est fondamental, ne peut apparatre que le jour o la socit a pris tout son dveloppement. Les juristes et les
moralistes qui sefforcent de voir dans l'avenir, et de le construire par la pense,
ne peuvent donc aboutir qu' des rveries ; il leur est impossible de formuler le
principe de la socit future et d'en dduire quoi que ce soit pour la pratique; en
effet, ce principe ne pourra tre clairement conu et utilement introduit dans la
logique juridique que le jour o la socit actuelle aura disparu et laiss la place
une organisation nouvelle. Ce qu'on peut esprer trouver, tout au plus, dans le
monde contemporain, ce sont des devenirs partiels, des traces de mouvements
parcellaires; et encore ces observations doivent se borner l'conomie.
L'uvre des idalistes est donc mensonge et duperie ; il est trs regrettable
que les socialistes aient, trop souvent, sembl encourager les utopistes contemporains en parlant avec trop de bienveillance des utopistes anciens. Si Fourier et
1
2
Marx, Capital, tome I, p. 30, col. 1.
Marx, loc. cit., p. 70, col. 1.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
215
Cabet 1 mritent d'tre lus, pourquoi Jaurs et Fournire, ne mriteraient-ils pas,
eux aussi, d'tre compts parmi les investigateurs bienfaisants de l'avenir ?
Il y a une force qui ramne toujours l'esprit vers les voles idalistes ; il faudrait tudier la nature de cette force et chercher si l'idalisme n'aurait pas une
place lgitime dans l'esprit, mais en dehors de l'conomie, et du droit - alors que
nos politiciens idalistes veulent lui faire gouverner l'conomie et le droit 2.
L'exprience montre que l'idaliste peut combiner dans ses projets les dtails
les plus disparates sans choquer le plus grand nombre de ses lecteurs : ceux-ci
croient avoir dans leur cerveau un mcanisme de contrle permettant de savoir si
l'ensemble est ou n'est pas logique; le vrai philosophe de l'histoire ne se servira
pas de cette logique-l!
Les idalistes utilisent la faiblesse qui a conduit tant de fois les rudits se
laisser duper par des faussaires : tous les dtails paraissent convenables et cependant l'uvre n'est qu'une mosaque dsordonne, forme d'emprunts faits des
monuments conservs dans divers muses. Plus une combinaison sociale paratra
brillante par le choix des lments, plus il faudra se dfier d'elle; si les lments
plaisent, c'est qu'ils sont emprunts des lgendes ou des ,circonstances
agrables de la vie prsente; il est par suite tout fait invraisemblable qu'avec de
pareils procds on puisse parvenir des ides justes sur l'avenir: ce n'est pas en
rptant le pass qu'on peut prvoir le futur; le pass est mort pour toujours et
d'autant plus mort, semble-t-il, qu'il a t davantage li aux sentiments qui ont
charm la masse des hommes.
*
* *
Je voudrais, en terminant, appeler l'attention des philosophes sur une question
qui me parat avoir une importance capitale au point de vue des progrs de la philosophie et au point de vue de la bonne propagande du socialisme. Je me demande
Le 18 juillet 1841 Proudhon crit Micaud que le pre Cabet est un homme honnte,
utile au peuple, je dirai mme au gouvernement et qui n'a d'autre dfaut que de manquer de
lumires et de se donner de l'importance . Il pense qu'en prchant la rvolution par les
ides . Cabet a plusieurs fois, dtourn le peuple de l'meute. (Correspondance, tome VI, pp.
305-306). - Sur la vanit enfantine de Cabet, cf. Saint Ren Taillandier (tudes sur la
rvolution en Allemagne, tome II, p. 479).
Les observations faites par Renan dans la Vie de Jsus, peuvent tre utilement consultes ce
point de vue. (Cf. pp. 123-133 ; pp. 293-301 ; pp. 327-333). - Persuad qu'il existe une
contradiction absolue entre l'conomie et le droit d'une part et le domaine lgitime de
l'idalisme d'autre part, Renan a condamn en ces termes les socialismes dont les contemporaines de sa jeunesse avaient t enthousiastes. De nos jours mme, jours troubls o
Jsus n'a pas de plus authentiques continuateurs que ceux qui semblent le rpudier, les rves
d'organisation idale de la socit sont une des branches de cet arbre immense... dont le
royaume de Dieu sera ternellement la tige et la racine... Mais, entaches d'un grossier matrialisme, aspirant l'impossible, c'est--dire fonder l'universelle flicit sur des mesures
politiques et conomiques, les tentatives socialistes de notre temps resteront infcondes jusqu' ce qu'elles prennent pour rgle le vritable esprit de Jsus, je veux dire l'idalisme absolu,
ce principe que, pour possder la terre, il faut y renoncer (pp. 299-300).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
216
s'il est possible de fournir une exposition intelligible du passage des principes
l'action sans employer des mythes 1.
Il ne semble pas que les historiens de la philosophie soient encore parvenus
se faire une ide trs nette du rle, cependant considrable, que les mythes ont
jou dans la pense humaine ; la thorie des mythes platoniciens n'est pas encore
compltement faite ; je me garderai donc d'entrer ici dans une discussion si ardue;
je me bornerai mettre quelques apprciations sur les difficults que rencontre le
socialisme contemporain et qui pourraient peut-tre se rsoudre par une thorie
des mythes sociaux.
On a souvent signal dans le socialisme des thses que les savants hsitent
aujourd'hui beaucoup dfendre et que beaucoup de propagandistes considrent
comme de vritables axiomes l'abri de toute controverse . Il y a quelques
annes, pour clbrer le cinquantenaire du Manifeste communiste, Vandervelde fit
Paris une confrence dans laquelle il signalait comme devenues plus ou moins
caduques les trois propositions suivantes : 1 loi d'airain des salaires, que l'orateur
belge identifie avec celle de la misre croissante ; 2 loi de la concentration
capitaliste ; 3 loi de la corrlation entre la puissance conomique et la politique.
La premire lui paraissait dfinitivement relgue au muse des antiques , - la
seconde n'avoir qu'une application partielle pour le moment, - la troisime tre
dissimule sous des combinaisons politiques 2. Quelques mois plus tard, le dput
hollandais, Van Kol, publiait un article intitul : Arrire les dogmes (Revue
socialiste, octobre 1898), dans lequel il rejetait bien plus de propositions que
Vandervelde 3.
Des discussions sans fin se sont engages sur ces questions et elles ne paraissent pas avoir jet beaucoup de lumire sur les difficults; ce qui me semble
rsulter de l'exprience acquise, c'est que ces fameux dogmes renferment
quelque chose d'essentiel la vie et au progrs du socialisme. Je ne crois mme
pas qu'il soit possible d'abandonner compltement la conception catastrophique.
Je me demande s'il ne faudrait pas traiter comme des mythes les thories que
les savants du socialisme ne veulent plus admettre et que les militants regardent
comme des axiomes l'abri de toute controverse. Il est probable que dj
1
2
Je reproduis ci-aprs le texte de 1903. - Dans les Rflexions sur la violence la thorie des
mythes a pris une forme plus assure.
Revue socialiste, mars 1898, p. 329, pp. 335-340. - D'autre part, dans la Petite Rpublique du
13 juin 1898, un des admirateurs de Vandervelde crivait : Les plus minents thoriciens de
notre parti ont rpondu aux conomistes bourgeois que Jamais le socialisme n'avait proclam
l'existence de la loi d'airain . Cet auteur ajoute que Marx prtendait que la loi d'airain devrait
s'appeler une loi de caoutchouc, ce qui veut dire sans doute qu'elle n'exprime pas toute la
dpression possible de la misre croissante. Il avait donc bien mal compris Vandervelde ;
mais, dans ce monde du socialisme franais de telles bvues n'ont aucune importance.
Suivant van Kol, (Rienzi) la thorie de la valeur doit faire l'objet d'un examen plus rigoureux,
la conception du dveloppement historique de Marx ne convient que pour certaines phases de
la civilisation. De la tactique rvolutionnaire on passe partout la tactique des rformes
progressives, le communisme s'est attnu en collectivisme ; la loi des salaires est une
antiquaille; personne ne soutient plus la doctrine de la misre croissante ; le nationalisme
acquiert de jour en jour plus d'importance; une srieuse lutte internationale ne sera possible
que plus tard; le marxisme cesse d'tre amoral; il reconnat maintenant la valeur des mobiles
psychologiques dans l'volution. (Note ajoute la troisime dition).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
217
Marx n'avait prsent la conception catastrophique que comme un mythe, illustrant d'une manire trs claire la lutte de classe et la rvolution sociale 1.
Si l'on parvenait dmontrer que les mythes sont ncessaires pour exposer,
d'une manire exacte, les conclusions d'une philosophie sociale qui ne veut pas ,se
tromper elle-mme et ne veut pas prendre pour de la science ce qui n'en est pas, on serait amen, sans doute, dmontrer aussi que les thories contestes sont
ncessites par l'action rvolutionnaire moderne ; et il est probable qu'on pourrait
dmontrer, du mme coup, que les constructions savantes, juridiques et pratiques,
prnes l'heure actuelle par des sociologues plus ou moins socialisants, ne sont
que tromperies et fausse science. Il est vident que les inventeurs de systmes de
droit suprieur combattront avec acharnement toute tentative qui serait faite, pour
claircir les problmes qu'ils ont un si grand intrt obscurcir ; ce n'est donc pas
eux que je m'adresse, mais seulement aux personnes qui comprennent les
exigences de la pense dsintresse.
Le moment n'est peut-tre pas loign o il sera reconnu que le vieux socialisme rvolutionnaire est infiniment plus pntr d'esprit philosophique et plus
voisin de la science que ne l'est le socialisme hyper-juridique de nos docteurs en
haute politique rformiste.
Georges Sorel, Matriaux d'une thorie de proltariat, p. 189.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
218
Georges SOREL,
Introduction lconomie moderne
Appendice
Lhumanit contre la douleur
I. Cause physiologique de la douleur. - Anciennes thories qui font de la douleur un
avertissement donn par la nature. - Hypothse sur le rle que jouerait la douleur comme
excitation l'invention.
II. Asctes asiatiques. - Leurs influences sur les philosophes grecs. - Mystiques chrtiens.
-Dvotions considres comme moyens de combattre la douleur.
III. Alcoolisme ; gourmandise et rotisme.
IV. Musique. - Sports. - Travail manuel.
I
Retour la table des matires
Bien que la littrature des sentiments soit considrable, je crois qu'aucun
philosophe n'est parvenu tablir jusqu'ici une thorie gnrale des tats affectifs
qui puisse tre regarde comme pleinement satisfaisante ; cette insuffisance de la
pense de nos matres intellectuels explique la vanit des doctrines que les modernes essayent de substituer aux enseignements jadis donns par les thologiens sur
les puissances profondes, les activits habituelles ou les destines de l'me; seuls
des mtaphysiciens pessimistes ont jet quelque clart sur les problmes essentiels
de notre espce, parce qu'ils ont proclam, comme un axiome, que la douleur est
accroche aux racines de la vie. Malheureusement, la manire dont ils ont parl
du plaisir, blesse un si haut degr les opinions communes que leurs ides ont t
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
219
incapables d'acqurir une autorit directrice dans nos socits occidentales. Je
voudrais montrer ici que l'on peut tablir une psychologie riche en rsultats pratiques, en partant de la considration de la lutte que soutient l'humanit contre la loi
naturelle qui la condamne la douleur.
La psychologie est seulement entre dans une voie scientifique le jour ou
William James fut parvenu faire accepter par les professeurs le renversement de
l'ordre dans lequel on prsentait les moments de la vie affective. Jadis on disait
que sous l'influence d'une perception ou d'une ide, l'me subit une perturbation
qui se traduit matriellement par des altrations de la circulation viscrale et par
des mouvements des membres. Ainsi tout partirait d'un centre; au contraire,
suivant le matre de Harvard, le centre n'aurait qu' considrer un drame priphrique. Les changements corporels qui suivent immdiatement une perception et
la conscience de ces changements, en tant qu'ils se produisent, c'est l'motion...
C'est parce que nous pleurons que nous sommes tristes, parce que nous frappons
que, nous sommes en colre, parce que nous tremblons que nous avons peur 1 .
Quand on se place au nouveau point de vue, on doit regarder comme trs
importante la question de savoir en quoi consistent les phnomnes physiologiques qui correspondent aux sentiments de la douleur. Thodule Ribot tait d'avis
de l'attribuer des modifications chimiques [survenues] dans les tissus et les
nerfs, tout particulirement la production de toxines locales ou gnralises dans
l'organisme. La douleur serait ainsi l'une des manifestations et l'une des formes de
l'auto-intoxication 2 .
Cette hypothse nous conduit trouver tout fait vident qu'entre la douleur
physique et la douleur morale il y ait une identit foncire , alors que, tromps
par la rhtorique des gens de lettres, tant de philosophes avaient cru qu'entre ces
formes de la douleur il y a une diffrence de nature 3 . L'explication chimique est
assez favorable la mtaphysique pessimiste : point de vie, en effet, sans dsorganisation au moins partielle et par suite sans douleur en puissance ; par l'effet
normal des forces que nos activits mettent en jeu, la douleur est toujours prte
jaillir dans la conscience, elle apparat ds que des conditions antagonistes se sont
effaces. Si la douleur drive de l'auto-intoxication, il est vraisemblable qu'elle est
antrieure au plaisir, qui suppose une recherche, soit intelligente, soit instinctive,
des moyens propres faire remonter l'organisme vivant le chemin qui, grce
l'auto-intoxication, conduit, sans arrt de la vie la matire brute; presque tous les
modernes admettent cette antriorit contrairement l'opinion de Descartes,
suivant lequel le plaisir doit tre primitif parce que l'me a d tre mise dans un
corps en bonne sant, c'est--dire en des conditions qui disposent la joie 4.
En prtendant s'en tenir aux donnes de l'exprience, William James se trouva
favoriser la dbile mtaphysique des auteurs, plus ou moins teints de positivisme, qui ont vu dans la psychologie un simple doublet de la physiologie ; mais
le :sens commun admettra bien difficilement que la douleur ait t impose
l'humanit sans qu'elle et jouer un rle bienfaisant dans l'ordre gnral des
choses qui nous intressent ; les mtaphysiciens dignes de ce titre, qui savent que
1
2
3
4
Thodule Ribot, Psychologie des sentiments, pp. 195-196.
Thodule Ribot, op. cit., p. 41.
Thodule Ribot, op. cit., p. 43.
Thodule Ribot, op. cit., p. 81.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
220
leur mission est de rpondre aux interrogations de la sagesse vulgaire, ont, en
consquence, construit des hypothses pour justifier l'existence de la douleur.
Thodule Ribot, qui trop souvent croyait faire de la science en mettant des dchets
de mtaphysique en pillules inoffensives, dit : La douleur (comme tat de
conscience) n'est qu'un signe, un indice, un dnouement intrieur qui rvle
l'individu vivant sa propre dsorganisation 1. Cette formule ne peut rendre aucun
service ; elle est manifestement une rduction d'une thse trs importante propose par des mdecins philosophes.
Suivant Haller, Dieu a donn la douleur l'homme comme une sentinelle
vigilante, charge de lui signaler les dangers qui menacent son corps ; mais il
existe nombre de maladies ingurissables qui voluent jusqu'aux formes les plus
graves sans que la douleur et veill l'attention du sujet sur son tat ; on observe
aussi que la douleur nous trompe assez souvent sur le sige du mal 2. Cette
mtaphysique mdicale se maintient, comme un prjug puissant, parce qu'elle est
lie des superstitions tenaces, fondes sur la croyance que la nature met notre
disposition des moyens de conserver la sant, en passant par-dessus les conditions
de la recherche scientifique. Bien des personnes instruites s'imaginent aujourd'hui
que, durant le sommeil hypnotique, l'homme est capable de voir le fonctionnement des viscres et de dcouvrir des remdes propres obtenir la gurison
Us mtaphysiciens volutionnistes ont dpass les hardiesses des cliniciens
finalistes ; ils ont cru que l'animal trouve dans le plaisir et dans la douleur deux
guides capables de lui apprendre ce qui favorise et ce qui menace son existence ;
ceux-ci auraient t ainsi des facteurs de premier ordre dans la transformation des
espces, qui aboutit, la survivance des pins aptes. Les volutionnistes les plus
logiques ont t jusqu' soutenir que le plaisir et la douleur dpendent de ce qui
est utile ou nuisible pour l'espce ; mais Thodule Ribot, toujours partisan des
solutions moyennes, trouve bien arbitraire une doctrine qui, dpouillant le plaisir
et la douleur des caractres strictement individuels que leur reconnat le sens
commun, prtend les rattacher la vie des espces 3.
Je crois qu'il y a intrt abandonner ces mtaphysiques souvent trop proches
de superstitions, pour une thorie de la douleur qui perfectionne d'antiques donnes du sens commun ; on a mille fois rpt que l'homme fuit la douleur et
recherche le plaisir; je propose de dire que, sous l'aiguillon de la douleur, l'esprit
invente des manires de vivre susceptibles de procurer du plaisir, qui recouvrent
assez la douleur pour que celle-ci semble seulement un incident dont nous
pourrions dbarrasser l'ordre naturel. Quand il s'agit des animaux, l'instinct et
l'ducation prsentent la volont des systmes tout faits qui laissent une bien
faible latitude au libre choix ; chez l'homme, au contraire, la libert est dominante,
celle-ci entrane avec elle des proccupations parfois trs vives, comme cela a lieu
dans tous les essais nouveaux que nous tentons. La perspective du plaisir est
parfois si attrayante que l'homme accepte, pour par-venir au bonheur, les preuves
d'une longue carrire de dangereuses prgrinations 4.
1
2
3
4
Thodule Ribot, op. cit., p. 32.
Thodule Ribot, op. cit., p. 87, p. 90. - Cet auteur, mconnaissant le caractre mtaphysique
de cette thorie, dit que la psychologie doit se contenter de lois embrassant la majorit des cas
et jamais leur totalit (p. 91). La mtaphysique doit proposer seulement des hypothses
pouvant tre utiles.
THODULE RIBOT, op. cit, pp. 88-90.
Comme elle a lieu dans la vie des mystiques.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
221
Les inventions qui nous permettent d'chapper la loi de la douleur, appartiennent des genres trs divers; il rsulte de l que si l'on veut crire sur le plaisir
en gnral, il faut se contenter de l'unification parfois la plus superficielle ; les
dtails dont l'intrt apparat dans les monographies disparaissent dans cette
rduction de la ralit l'abstraction scolastique. Il est donc assez naturel que
Thodule Ribot signale l'exigut de la littrature du plaisir ; mais les douleurs
tant foncirement identiques, la littrature de la douleur est norme; cette diffrence de ces deux littratures aurait d suffire pour avertir les psychologues de
l'absurdit des doctrines qui voient dans le plaisir et la douleur deux moments
d'un mme processus entre lesquels il n'y aurait qu'une diffrence de degr et
non de nature 1.
Je terminerai ces considrations prliminaires par une remarque qui me
semble propre montrer la haute valeur philosophique de la thse propose ici. Si
l'on parvenait suivre jusqu' sa racine la raction dirige par l'homme contre la
douleur, on atteindrait le contact du corps et de l'esprit, qui sur ce point se
dressent l'un contre l'autre 2. Si les mtaphysiciens n'ont su rien dire de vraiment
utile sur cette jonction, c'est qu'ils n'ont pas aperu la porte de la lutte engage
par l'humanit contre la douleur.
II
Retour la table des matires
Avant dexaminer les mthodes les plus communes employes pour nous
affranchir de la douleur, je voudrais parler de procds qui, pour avoir t exceptionnels, n'en ont pas moins eu une grande place dans l'histoire des civilisations.
Depuis des temps extrmement reculs, des asctes orientaux ont ralis des tats
d'extase qui ont frapp de stupeur les populations ; surprises de voir des hommes
qui semblaient levs au-dessus de la loi de la douleur, que tout le monde
ressentait si vivement en des pays riches de souffrances, elles les ont traits
comme des favoris des dieux ; les effroyables mortifications que ces asctes
s'imposaient pour devenir des sages accomplis, ont servi donner une ide
extrmement haute du bonheur procur par la saintet. En entendant ces personnages privilgis raconter leurs rves, les philosophes furent amens penser que
les disciplines asctiques permettent l'me de passer des tnbres de la vie
humaine la lumire cleste ; en s'associant au corps, l'me aurait subi une
1
2
Thodule Ribot, op. cit., p. 57. - Ribot est d'ailleurs fort oppos cette illusion.
La douleur correspondant au sentiment le plus complet que nous ayons de notre corps, on peut
voir en elle une sorte du synthse de psychologies passives. L'invention conscutive la
douleur, est le premier centre spirituel organisateur de la psychologie active.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
222
dchance, tant dsormais condamne la douleur ; mais l'me pourrait se racheter, en s'affranchissant de tous les besoins matriels auxquels sont assujettis les
humains ordinaires. L'effroyable maigreur des asctes fit natre l'ide que l'homme
juste est lger ; de l sont nes de nombreuses lgendes relatives la lvitation de
saints qui se seraient maintenus en l'air, lgendes que le catholicisme a absorbes ;
il est probable que ce prjug n'a pas t tranger l'introduction dans la pratique
criminelle de l'ordalie de l'eau froide dans laquelle l'accus devait surnager pour
tre reconnu innocent.
Les Grecs, habitus emprunter tant de choses au peuples qu'ils traitrent de
Barbares, firent de nombreuses tentatives pour adapter leur civilisation les
merveilles qu'ils entendaient raconter sur les asctes orientaux. Le programme de
Socrate tait probablement de permettre aux Athniens de s'affranchir des charges
de la matire, en employant des procds qui pussent convenir aux murs de la
cit de Minerve ; la lgende de son dmon est une attnuation des lgendes des
prophtes smitiques ; il voulait crer une ducation de la temprance pour des
travailleurs pauvres, trs habiles connaisseurs des uvres d'art et habitus croire
que l'intelligence humaine s'est pleinement manifeste dans les monuments
nationaux, tonnants par l'esprit de modration, de raisonne, ment et par suite
d'ordre conforme au bon sens, dont ont fait preuve leurs auteurs. Xnophon nous
montre son matre comme ayant si bien rgl sa vie suivant les proccupations de
l'esthtique grecque, que la douleur arrive peine l'effleurer ; ses, leons ne
parvenaient malheureusement avoir d'efficacit que, sur des mes d'lite ; il
demeura tranger aux coles, comme un patriarche fabuleux de la sagesse.
Les stociens cherchrent mieux dfendre contre la douleur l'humanit qui de
leur temps semblait condamne des avenirs de plus en plus dsesprants ; ils
renforcrent l'ducation de la temprance en introduisant dans la philosophie grecque beaucoup d'emprunts faits au fanatisme smitique ; mais ils n'osrent pas aller
jusqu' conseiller d'imiter les excs des asctes orientaux qui auraient trop bless
l'esthtique de leurs compatriotes. Le stocisme produisit d'abondantes consolations littraires, mais ne semble pas avoir donn beaucoup de rsultats pratiques.
L'effort le plus considrable qu'ait fait l'antiquit paenne pour s'approprier les
moyens de vaincre la douleur trouvs par l'asctisme oriental, fut celui des noplatoniciens ; il n'est pas du tout certain que ces philosophes aient connu par une
exprience personnelle les tats de mysticisme trs avanc dont on signale la
description dans leurs livres 1 ; il est vraisemblable qu'ils se sont borns donner
des formes littraires propres frapper l'imagination de leurs contemporains des
matriaux que l'Orient leur livrait. Ils ont pu sduire l'empereur Julien, homme
tout plein de rhtorique ; mais leur influence n'a pas t tendue; aussi leurs
biographies nous sont-elles parvenues mles beaucoup de fables.
Dans le christianisme, le mysticisme a pris son plein dveloppement, non seulement en suscitant de nombreux hros de l'asctisme, mais encore en donnant
naissance une abondante littrature de descriptions psychologiques et de
thories. Je ne crois pas que les auteurs qui s'occupent aujourd'hui de ces ques1
Une partie de cette littrature a t connue des docteurs mdivaux de l'occident grce au
pseudo Denis, l'aropagite.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
223
tions, aient remarqu le paralllisme si curieux qu'on peut reconnatre entre la
vole mystique et le dlire chronique volution systmatique ; l'poque des
dgots, des tentations, des obsessions correspond parfaitement la priode o le
malade est en proie au dlire des perscutions; l'union divine remplace le dlire
des grandeurs 1. Un tel rapprochement ne doit pas surprendre celui qui sait quel
point les mystiques ressemblent souvent des nvropathes 2 ; les cliniciens ont
t, plus d'une fois, tents de les comprendre parmi les sujets de l'alination
mentale; les directeurs des congrgations religieuses savent que des candidats
l'union divine arrivent parfois la folie quand leur temprament ne les met pas en
tat de supporter les preuves.
On peut regarder comme des formes de mystique attnue les expriences
religieuses qui jouent un rle considrable dans la lutte contre la douleur. Chez les
protestants, et plus particulirement chez ceux de race anglo-saxonne, on rencontre beaucoup de gens qui partagent leur existence en deux zones bien indpendantes : l'une est consacre aux affaires industrielles et commerciales ; l'autre est
voue la mditation biblique 3 ; tant que cette exprience scripturaire demeure
importante dans les communauts protestantes, celles-ci est un moyen efficace de
combattre la douleur ; la religion remplace pour elles les distractions mondaines si
avidement recherches d'ordinaire par les bourgeois qui sont trs adonns la
poursuite des intrts matriels.
Chez les catholiques, l'exprience scripturaire est remplace par l'exprience
sacramentelle que renferme le culte eucharistique ; cette mystique attnue des
catholiques parait beaucoup plus facile pratiquer que celle des protestants;
lglise offre mme ses fidles des moyens de combattre la douleur qui ont
beaucoup plus de rapports avec les distractions profanes dont il sera question ciaprs, qu'avec la discipline monastique. Les apologistes du clerg catholique
vantent, sans toujours la bien comprendre, l'habile esthtique clricale; ils ont
raison de la regarder comme trs propre carter la douleur qui accable tant
d'mes contemporaines; mais ils n'osent gure analyser les raisons de son succs.
Les illuminations tincelantes des glises, le dcor somptueux, les vtements qui
donnent aux officients un aspect fabuleux ; les gestes, les volutions crmonielles, les dclamations solennelles, la musique ; tout cela donne au culte catholique une remarquable ressemblance avec les merveilles de l'opra. La prsence des
femmes en grande toilette ne constitue pas un des moindres attraits de, ce
spectacle. Si lglise conserve l'emploi des fumes dont les Orientaux avaient fait
un si grand usage comme moyens de produire l'ivresse, c'est qu'elle sait quel
point les parfums peuvent assoupir l'intelligence 4. Les gens fatigus par les
motions d'une vie d'affaires trs nervante trouvent dans le culte catholique un
1
22
3
4
Les deux grandes priodes de la vie mystique se sont particulirement distingues depuis crue
la discipline de l'oraison a t rgularise au XVIIe sicle; elles sont bien divises dans le
Catchisme spirituel du P. Surin, dont Bossuet faisait grand cas.
D'aprs William James, il n'est plus possible de parler avec ddain des mystiques dont la
conduite a t marque de bizarreries nvropathiques (William James, L'exprience religieuse, trad. fran., pp. 6-7.
Renan, Les aptres, p. 286 ; Histoire du peuple d'Isral, tome IV, p. 272.
C'est ce que savent aussi les femmes galantes qui se parfument Pour s'imposer plus facilement
aux hommes, en leur faisant perdre une partie de leur libert de jugement.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
224
srieux soulagement qu'ils ne rencontreraient pas dans le culte protestant 1. Il n'est
donc pas tonnant que le catholicisme se maintienne ou mme progresse dans les
socit& de haut capitalisme 2.
III
Retour la table des matires
Dans un article des Dbats sur Henri-Frdric Amiel, que des philistins lui ont
souvent reproch, Renan a crit en 1884 : Il faut que les masses s'amusent. Pour
ma part, je n'prouve aucun besoin d'amusement extrieur ; mais j'prouve le
besoin de sentir qu'on s'amuse autour de moi ; le jouis de la gaiet des autres. Les
socits de temprance reposent sur d'excellentes intentions, mais sur un malentendu... Au lieu de supprimer l'ivresse pour ceux qui en ont besoin, ne vaudrait-il
pas mieux essayer de la rendre douce, aimable, accompagne des sentiments
moraux ? Il y a tant d'hommes pour lesquels l'heure, de l'ivresse est, aprs l'heure
de l'amour, le moment o ils sont les meilleurs 3 . Modifiant trs lgrement la
formule de Renan, le dirai que, de tous les moyens dont l'humanit dispose pour
surmonter la douleur, l'ivresse alcoolique est celui qui est le plus accessible aux
masses ; ayant observ dans son pays des ivrognes d'une brutalit dgotante,
Renan aurait videmment dsir que ses Bretons ressemblassent aux vignerons
auxquels le vin procure une gaiet bruyante, mais assez souvent tendre; les mdecins savent que le besoin de l'alcool est si fort que beaucoup de dames absorbent
en excs des infusions pharmaceutiques et mme de l'eau de Cologne 4. En
Amrique, le rgime de la temprance lgale semble avoir pour effet la vulgarisation de l'ther, de la cocane et de l'opium parmi les ouvriers mineurs.
2
3
4
Ce mlange de l'exprience sacramentelle (du culte eucharistique) et de distractions du
caractre le plus profane, qui se rencontre dans les dvotions contemporaines, nous permet de
comprendre comment certains auteurs catholiques peuvent, sans scandaliser les fidles, crire
des livres o l'exaltation de la pit se combine avec la lubricit. Ce fait est particulirement
remarquable chez Claudel (Cf. Benedetto Croce, Pagine sparse, 2e srie, pp. 194-195). Renan
a dit : L'humanit est une personne noble et il faut la reprsenter en sa noblesse . (Feuilles
dtaches, p. 237). Claudel n'a jamais, semble-t-il, song respecter cette rgle de
l'esthtique ; son catholicisme et scandalis Bossuet ; mais il est parfaitement conforme aux
murs religieuses actuelles.
Certaines chapelles catholiques anglaises ressemblent tout fait des salons ; cette analogie
m'a frapp en visitant une chapelle de l'avenue Hoche, Paris.
RENAN, Feuilles dtaches, pp. 383-384.
Morel notait dj en 1857 que les tendances l'ivrognerie ne doivent pas tre cherches
exclusivement dans la classe ouvrire, sur 200 observations qu'il avait recueillies, il y avait 52
cas n'appartenant pas aux ouvriers et paysans (Trait des dgnrescences physiques, intellectuelles et morales de l'espce humaine, p. 140).
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
225
Bien que d'assez nombreux officiers anglais et franais aient rapport de
l'Extrme-Orient le got de l'opium, il ne semble pas que nos races occidentales
soient destines subir le flau qui frappe si cruellement les Chinois ; cela est
d'autant plus heureux que suivant Morel, la consommation habituelle de l'opium
serait probablement encore plus funeste aux Europens qu'aux Asiatiques 1 ; la vie
de nos classes riches a t jusqu'ici trop active pour qu'elles se laissent aller un
vice qui convient surtout des classes indolentes.
De l'ivresse nous passons, tout naturellement la gourmandise qui a pris un si
dplorable dveloppement la suite de la dernire guerre ; un phnomne identique s'tait produit aprs la Rvolution franaise ; les gens dont la situation
matrielle s'est subitement et grandement amliore, d'une faon imprvue, tant
pleins d'inquitude sur l'avenir, se livrent, avec furie, aux plaisirs de la gourmandise pour carter la douleur. Fourier dont la principale proccupation fut toujours
de dcouvrir quels taient les instincts les plus bas de ses contemporains, en vue
de fonder sur l'emploi de ces sentiments un grand art social, donna la gourmandise une importance extrme dans l'ordre phalanstrien.
tous les chelons de la civilisation, nous voyons les ftes de la gourmandise
occuper une place d'honneur parmi les activits des classes riches; on dpense des
sommes absurdes pour des dners o les convives sont blouis par des cristaux,
des porcelaines, de l'argenterie de haut prix, des fleurs rares, un clairage propre
faire valoir le luxe des femmes, sont gorgs de plats capables d'veiller le dsir de
l'estomac le plus exigent, abreuvs de vins fins; en Orient, on complte la fte
avec une musique destine exciter les sens, des danses lubriques et des parfums;
chez nous, on se contente de faire asseoir au milieu des hommes des dames dont
la toilette doit susciter les dsirs rotiques. La gourmandise et la lubricit
marchent toujours de pair dans ces ftes.
Il y a encore plus de vrit que ne le croyait Renan dans l'opinion suivante
qu'il a exprime en 1888 dans son examen de conscience philosophique : Il est
surprenant que la science et la philosophie, adoptant le parti frivole des gens du
monde de traiter la cause mystrieuse par excellence comme une simple matire
plaisanteries, n'aient pas fait de l'amour l'objet capital de leurs observations et de
leurs spculations. C'est le fait le plus extraordinaire et le plus suggestif de l'univers. Par une pruderie qui n'a pas de sens dans l'ordre de la rflexion philosophique, on n'en parle pas, o l'on s'en tient quelques niaises platitudes. On ne veut
pas voir qu'on est l devant le nud des choses, devant le plus profond secret du
monde. La crainte des sots ne doit pourtant pas empcher de traiter gravement ce
qui est grave 2 . Renan applique cette thse ce qui, dans l'impulsion vitale, se
rattache la sexualit ; mais il laisse totalement de ct le rle crateur de l'huma1
2
MOREL, op. cit., pp. 407-408.
Renan, op. cit., p. 421. - On est conduit, en approfondissant cette opinion de Renan, penser
que les hommes manifestent dans leur vie sexuelle tout ce qu'il y a de plus essentiel dans leur
psychologie ; si cette loi psycho-rotique a t fort nglige par les psychologues de profession, elle a t presque toujours, prise en srieuse considration par nos romanciers et nos
dramaturges; les uvres que l'on regarde comme les plus fortes, sont celles dans lesquelles le
principal personnage est domin par un amour qui n'appartient pas aux formes trop banales.
C'est pourquoi l'adultre joue un rle si prpondrant dans notre production littraire
moderne.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
226
nit ; celle-ci produit des inventions rotiques qui constituent un moyen d'une
extrme puissance pour vaincre la loi de la douleur.
Dans nos grandes cits les thtres et les concerts tiennent la. place que
lOrient attribuait aux danses lubriques, sans que le monde gagne beaucoup au
change. Nos romans n'obtiendraient pas grand succs s'ils n'taient pas composs
de manire produire une srieuse lvation des dsirs sexuels chez leurs lecteurs ; c'est grce ce phnomne que cette littrature constitue une dfense
contre la douleur; il me semble qu'il y aurait moyen de renouveler la critique en
lui donnant pour but d'examiner si les uvres soumises la discussion russissent
bien produire cet rotisme librateur.
IV
Retour la table des matires
On a toujours considr la musique comme un remde trs efficace pour
calmer les mes accables sous le poids de proccupations, de chagrins ou de mcomptes de la fortune. L'immense popularit obtenue, pendant le Seconde empire,
pour les charges thtrales d'Offenbach tenait, pour une trs grande partie, de ce
que ce genre correspondait parfaitement aux besoins d'une socit trouble par
une conomie enrage de spculation. Il me parat probable que des mlodies
faciles retenir, adaptes des situations bouffonnes et doues d'un rythme
entranant, constitueront longtemps encore le fond de l'art lyrique de notre
bourgeoisie.
Ne disons pas trop de mal du caf-concert qui offre au peuple des distractions
qui valent bien celles du thtre bourgeois ; on doit seulement lui reprocher de
chercher obtenir des succs trop faciles en suscitant des apptits rotiques ; il
n'aurait pas besoin de corser par l'obscnit l'intrt de ses chansons, si celles-ci
avaient une lus franche gaiet. Le monde actuel est condamn la tristesse ; il ne
faut pas lui refuser les moyens qui sont sa disposition pour viter d'tre
submerg par la douleur ; les potes et les musiciens qui travaillent pour donner
quelques instants de plaisirs aux travailleurs, peuvent rendre de trs srieux
services la civilisation en calmant des douleurs qui leur paraissent d'autant plus,
intolrables que l'ducation moderne a aiguis leur sensibilit.
La psychologie de l'amateur de musique ne ressemble nullement celle des
Sens qui frquentent les galeries de tableaux ou de statues ; il ne va pas tant au
thtre pour se procurer quelques instants de satisfaction que pour s'initier
l'excution d'une uvre renomme ; il lui accordera toute son admiration seulement le jour o, ayant tudi fond la partition sur un instrument ou en la
chantant, il pourra assister une reprsentation en se figurant qu'il fait sa partie
dans l'orchestre ou sur la scne. Certains connaisseurs, qui prtendent passer pour
des esprits suprieurs, affectent de regarder comme mdiocres les compositions
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
227
qui entrent facilement dans les rpertoires du peuple ; mais, en fin de compte, le
public impose ces fins dilettantes, le, culte des matres qui ont aid son ducation musicale; c'est ainsi que Verdi fut proclam grand, en dpit de nombreux
savants, pour avoir rempli ses drames lyriques de mlodies passionnes que les
rues italiennes ne tardaient pas rpter. Depuis que l'outillage musical est devenu bon march, le nombre des amateurs-excutants n'a pas cess de s'accrotre ;
des morceaux qui dpassent infiniment le niveau de l'ancienne chanson, se sont
vulgariss ; si la musique est devenue ainsi accessible aux grandes masses
humaines, on ne saurait en dire autant de la peinture et de la sculpture, qui semblent devoir tre toujours rserves une infime minorit.
On pourrait tre tent de conclure de ces observations que les arts plastiques
n'auraient qu'un rle trs minime jouer dans la lutte engage contre la douleur;
cette manire de voir suppose que l'on rserve le nom d'arts plastiques aux choses
qu'enseignent les coles dites des Beaux-Arts; mais nul ne doutant que la
gymnastique grecque ne doive tre range au nombre des arts plastiques de
l'antiquit, il convient de donner ce terme un sens plus tendu que celui dont il
vient d'tre question. Pourquoi les sports lie seraient-ils pas regards comme un
succdan moderne de la gymnastique, qui aurait le droit d'entrer dans le systme
des arts plastiques ? Je sais bien que l'opinion commune est contraire cette
conception.; les prjugs dfavorables aux sports me semblent avoir pour base le
mpris qu'prouvent les gens raisonnables pour les professionnels qui font
admirer leurs muscles aux femmes hystriques; je revendique seulement le titre
d'esthtiques pour les sports qui sont des pratiques de la vie courante, perfectionnes par un srieux entranement. La gymnastique dorienne n'a pas t autre
chose qu'une prparation de la jeunesse aux actes de la guerre, dans les cits o la
guerre occupait toute la vie des hommes libres 1 ; au temps o la noblesse passait
la plus grande partie de son temps cheval, l'quitation tait le premier des arts
sportifs ; aujourd'hui que la bicyclette fournit un moyen de locomotion -si utile
la classe ouvrire, on doit rattacher l'esthtique populaire les courses sur route
auxquelles se livrent, avec tant. d'ardeur, les jeunes travailleurs.
Nos moralistes ont souvent clbr les mrites des sports qui seraient, d'aprs
eux, capables d'loigner les hommes de la dbauche ; comment pourraient-ils
exercer une fonction vicariante, par rapport l'alcoolisme et l'rotisme, s'ils
n'taient pas eux-mmes, des moyens invents pour lutter contre la douleur ? sans
exclure les procds plus grossiers que je viens de mentionner, ils les rendent
moins dsirables.
Nous allons examiner encore une autre extension des sens du terme arts
plastiques qui a une grande importance pour l'tude de la civilisation moderne. On
a tort de rserver le nom de sculpture aux statues des hommes clbres, aux ornements des palais ou aux mdailles ; bien des hommes d'un got fin ont dclar
qu'ils s'intressaient aux moindres ustensiles de la vie commune quand ils y
dcouvraient les marques d'un travail soign, intelligent et original. Une marmite
en cuivre ingnieusement repousse peut avoir exig plus de talent qu'un
pompeux difice lev sur nos places publiques en l'honneur de quelque gloire
nationale. Le seul juge dont la comptence est incontestable en matire esthtique,
1
Cf. TAINE, Philosophie de l'art, tome I, pp. 213-221.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
228
est l'homme qui possde le gnie crateur ; il connat, par son exprience personnelle, combien grande est la valeur de la production plastique dans la lutte
engage par l'humanit contre la douleur ; il prouve, en consquence, une sympathie fraternelle pour l'ouvrier qui a laiss des monuments modestes, mais d'une
interprtation incontestable attestant une victoire remporte sur la loi de la
douleur. Ainsi, le travail manuel, employ pour les besoins de la vie commune, a
le droit d'tre rang dans la mme classe que les sculptures, au point de vue qui
nous occupe ici.
Lorsque la division parcellaire du travail eut rduit l'ouvrier de manufacture
au rle d'une bte, qu'un apprentissage a rendue capable d'effectuer des mouvements rapides et prcis, analogues ceux que nous ralisons aujourd'hui avec nos
mcanismes construits systmatiquement, toute trace de sentiment artistique
disparut. Une norme littrature fut con-sacre par des philanthropes dplorer la
dtresse intellectuelle et morale qui rgnait dans ces tablissements sur lesquels
semblait crite la dsesprante formule de Dante : Lasciate ogni speranza, voi ch'
entrate. Plus de gais refrains, comme dans les anciens ateliers ; un spulchral
silence impos avec une discipline froce ; en entrant dans une manufacture, on
pouvait se demander si les ouvriers n'auraient pas, dans leur rtrogradation bestiale, perdu la parole ! L'alcoolisme et l'rotisme furent les seules ressources qui
restassent ces malheureux pour lutter contre la douleur.
Bien que la technologie actuelle soit dj vieille d'un assez grand nombre
d'annes, on est encore loin d'en avoir bien dgag la loi ; l'tonnement qu'a
produit la mthode de Taylor, a montr que peu de directeurs d'usines avaient
rflchi sur les conditions de l'industrie mcanique; il me parat certain qu'on n'a
pas encore tir des expriences faites par Taylor et ses mules une thorie du
travail. Une chose est dj vidente, c'est que l'ingniosit des ouvriers les mieux
dous, au point de vue de l'imagination, exerce une trs grande influence sur la
production des machines ; l'habilet du bon chef d'atelier consiste faire apprendre mthodiquement aux hommes moins imaginatifs ce qui a t trouv par
l'intuition des plus imaginatifs. Ainsi l'atelier d'usine se trouve ressembler beaucoup un atelier d'artistes dans lequel quelques lves d'lite donnent le ton
l'ensemble.
L'ancienne manufacture ne pouvait avoir rien d'artistique, parce que, fonde
sur une sorte de solidification du processus de production, elle ne laissait aucun
terrain l'imagination. La fabrique moderne peut d'autant mieux se rapprocher de
l'art que sa technologie acquiert davantage de fluidit en raison de ses caractres
progressistes.
Faire que le travail manuel constitue, grce cette marche de la production
vers lart, le moyen par excellence que l'humanit emploiera dsormais pour surmonter la douleur, voil le grand problme pos l'conomie actuelle. Ce rsultat
ne peut tre videmment atteint que si le travail n'entrane qu'une fatigue lgre
susceptible d'tre aisment efface par le repos quotidien 1 ; on est ainsi amen
1
Le sentiment de la fatigue sert avertir l'homme qu'il ne saurait prolonger une occupation
sans compromettre l'harmonie moyenne de ses fonctions. Il me semble qu'on peut se fier,
d'une faon trs sre, aux trois signes suivants pour savoir si la mauvaise fatigue n'est pas
atteinte dans le travail manuel ; lorsque celui-ci est maintenu dans de sages limites, il s'allie
avec le got des jolies chansons, il facilite l'accomplissement des fonctions sexuelles et il
procure un excellent sommeil.
Georges Sorel, Introduction lconomie moderne (1922)
229
regarder comme trs dsirable rtablissement des courtes journes. Je me demande s'il ne conviendrait pas de rendre aux ouvriers le droit de chanter qui leur avait
t enlev par les chefs des manufactures ; le silence de l'ancienne discipline a
quelque chose de bestial, comme je l'a indiqu plus haut; les ateliers de sculptures
sont gnralement fort bruyants 1. Beaucoup de directeurs de grandes entreprises
estiment qu'on a tort de se proccuper de l'esthtique des ateliers ; certainement il
serait bien ridicule de faire travailler les proltaires au milieu d'un luxe bourgeois
(belles broderies, vitraux peints, fleurs ou arbustes, etc.). mais il est trs important
d'inspirer l'ouvrier le sentiment qu'il est un artiste, en lui donnant gouverner
une machine dont la construction rvle clairement qu'elle est elle-mme une
uvre d'art 2 ; on peut dire que l'esthtique de l'outillage est la vritable esthtique
proltarienne.
En faisant jouer au travail manuel, dans les luttes de l'humanit contre la
douleur, le rle que je lui attribue ici, le socialisme renversera l'chelle des valeurs
constitue par la psychologie traditionnelle.
Fin du livre.
1
2
Entre le tapage assourdissant de certains ateliers d'artiste et le silence absolu des manufactures
il y a place pour une intelligente libert.
Souvent des ingnieurs franais, visitant des tablissements germaniques, ont t surpris,
scandaliss ou humilis (suivant leur temprament) en constatant un luxe qui contraste fort
avec la parcimonie que nos chefs d'industrie imposent nos constructeurs ; nos grands
bourgeois regardent les ouvriers comme des sauvages auxquels il serait ridicule de prter des
sentiments esthtiques; ils ont pu lire dans l'vangile que le Christ a recommand de ne pas
jeter des perles devant les pourceaux. - Sur les usines de l'Allegemeine Elektrizitaets
Gezellschaft, et Gaston Raphal, Walther Rathenau, p. 31
Vous aimerez peut-être aussi
- Wiesel, Elie - La Nuit (1958) (2008)Document210 pagesWiesel, Elie - La Nuit (1958) (2008)rebecca.geo1789100% (5)
- Formular CMR InternationalDocument4 pagesFormular CMR InternationalGabriela Lungu100% (1)
- Procédure Risques Et Opportunités 1Document11 pagesProcédure Risques Et Opportunités 1pierre youbi100% (7)
- Alain - Esquisses de L'hommeDocument203 pagesAlain - Esquisses de L'hommeSimon LarivierePas encore d'évaluation
- Arvon, Henri - Les Libertariens AméricainsDocument164 pagesArvon, Henri - Les Libertariens AméricainsOlivier Devoet100% (1)
- Claude Henry Du Bord La Philosophie PDFDocument514 pagesClaude Henry Du Bord La Philosophie PDFSalihabensala100% (1)
- Zhuang Zi - Le Livre de Tschouang-Tseu (Document275 pagesZhuang Zi - Le Livre de Tschouang-Tseu (rebecca.geo1789100% (1)
- Alain (Emile Chartier) - Mars II. Echec de La Force (1939)Document349 pagesAlain (Emile Chartier) - Mars II. Echec de La Force (1939)rebecca.geo1789Pas encore d'évaluation
- Alain (Emile Chartier) - Preliminaire A L'esthetique (1936)Document214 pagesAlain (Emile Chartier) - Preliminaire A L'esthetique (1936)rebecca.geo1789Pas encore d'évaluation
- Sorel, Georges - Introduction A L'economie Moderne (1903)Document229 pagesSorel, Georges - Introduction A L'economie Moderne (1903)rebecca.geo1789Pas encore d'évaluation
- Alain (Emile Chartier) - Abreges Pour Les Aveugles (1942)Document68 pagesAlain (Emile Chartier) - Abreges Pour Les Aveugles (1942)rebecca.geo1789Pas encore d'évaluation
- Alain (Emile Chartier) - Saisons de L'esprit (1935)Document206 pagesAlain (Emile Chartier) - Saisons de L'esprit (1935)rebecca.geo1789100% (1)
- Alain (Emile Chartier) - Systeme Des Beaux Arts (1920)Document210 pagesAlain (Emile Chartier) - Systeme Des Beaux Arts (1920)rebecca.geo1789Pas encore d'évaluation
- Schopenhauer - Les Fondements de La Morale (1894)Document207 pagesSchopenhauer - Les Fondements de La Morale (1894)rebecca.geo1789Pas encore d'évaluation
- MercurialeDocument11 pagesMercurialeMartin MebangaPas encore d'évaluation
- CV Laetitia CoulibalyDocument1 pageCV Laetitia CoulibalyTambe Chalomine AgborPas encore d'évaluation
- Inexistence en Droit Administratif (FR) - JurisPedia, Le Droit PartagéDocument4 pagesInexistence en Droit Administratif (FR) - JurisPedia, Le Droit PartagéFrancisco AlvarezPas encore d'évaluation
- D Eporedirix A Iulius Calenus Du Chef e 2 PDFDocument34 pagesD Eporedirix A Iulius Calenus Du Chef e 2 PDFanaisPas encore d'évaluation
- Après Le Rejet Massif de La Nouvelle Constitution, Le Président Chi... - MediapartDocument4 pagesAprès Le Rejet Massif de La Nouvelle Constitution, Le Président Chi... - MediapartinfoLibrePas encore d'évaluation
- L'assurance Maritime ObligatoireDocument9 pagesL'assurance Maritime ObligatoireBabacar BaPas encore d'évaluation
- Dissert Abcdaire PolitiqueDocument5 pagesDissert Abcdaire PolitiqueMarceloPas encore d'évaluation
- PB Vol 2 rgph4 TG 2010 PDFDocument345 pagesPB Vol 2 rgph4 TG 2010 PDFLm BealhyPas encore d'évaluation
- Luko ContractDocument8 pagesLuko ContractVictoria RandriamanantsoaPas encore d'évaluation
- Social Is MeDocument37 pagesSocial Is MeEmine MoutalyPas encore d'évaluation
- ConvocationDocument1 pageConvocationJahPickney Humble MattheusPas encore d'évaluation
- Lecon1 - Introduction - Generale - HSSTDocument6 pagesLecon1 - Introduction - Generale - HSSTkablanPas encore d'évaluation
- MM-WARA Manuel de Méthodologies 2021Document143 pagesMM-WARA Manuel de Méthodologies 2021Sara Tah LouPas encore d'évaluation
- Contrat Simplifie Distribution Exclusive DéverrouilléDocument6 pagesContrat Simplifie Distribution Exclusive DéverrouilléSAAD WAKKASPas encore d'évaluation
- Acte Uniforme Compar+®Document64 pagesActe Uniforme Compar+®jalik7975Pas encore d'évaluation
- Contrattravail PDFDocument2 pagesContrattravail PDFcoucoutoi009100% (1)
- Fourrey Émile - Curiosités Géométriques - Curiozități Geometrice (1907)Document444 pagesFourrey Émile - Curiosités Géométriques - Curiozități Geometrice (1907)Belko IosifPas encore d'évaluation
- DemandeDocument24 pagesDemandezak ariaPas encore d'évaluation
- Examen Final Seconde La ViolenceDocument4 pagesExamen Final Seconde La Violencemalak jbeilyPas encore d'évaluation
- Avis Des Sommes A Payer: Rubriques Débit Crédit ObservationsDocument2 pagesAvis Des Sommes A Payer: Rubriques Débit Crédit ObservationsoujjaniPas encore d'évaluation
- FO Capacite Autonomie Financiere Travailleurs QualifiesDocument5 pagesFO Capacite Autonomie Financiere Travailleurs QualifiesHaleem OlawalePas encore d'évaluation
- Decrêt 18 AVRIL 1968Document2 pagesDecrêt 18 AVRIL 1968Nader GhrabPas encore d'évaluation
- Formulaire de Renseignements TravailleursDocument6 pagesFormulaire de Renseignements TravailleursPape Ibrahima HANEPas encore d'évaluation
- Noël Pons La Corruption Comment Ça Marche Éditions Du Seuil 2021Document578 pagesNoël Pons La Corruption Comment Ça Marche Éditions Du Seuil 2021Zeineb HajjiPas encore d'évaluation
- Normand Baillargeon-Petit Cours Autodefense Intellectuelle PDFDocument36 pagesNormand Baillargeon-Petit Cours Autodefense Intellectuelle PDFArmelAmorPas encore d'évaluation
- Sous L'orage de Seydou BodianDocument5 pagesSous L'orage de Seydou BodianSATFSCRIB92% (12)
- Droit Des ContratsDocument47 pagesDroit Des ContratsJolie DomiPas encore d'évaluation
- Le Second Empire ColonialDocument4 pagesLe Second Empire ColonialAthéPas encore d'évaluation