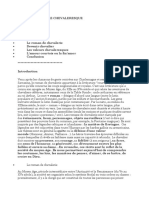Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Chanson
La Chanson
Transféré par
Youcef Ghellab0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues2 pagesTitre original
La chanson
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues2 pagesLa Chanson
La Chanson
Transféré par
Youcef GhellabDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 2
[Introduction
Le titre de cet ouvrage comporte deux particularités, qui
répondent à deux options fondamentales et que nous nous devons
d'expliquer ici : le pluriel de sciences, le singulier de langage.
Nous avons choisi de donner au mot langage le sens restreint
— et banal — de « langue naturelle » : non celui, fort répandu
de IK. •• tours, de « système de signes ». Il ne sera donc question ici
ni ries langues documentaires, ni des différents arts considérés
comme langages, ni de la science prise pour une langue bien ou
mal faite, ni du langage animal, gestuel, etc. Les raisons de cette
restriction sont multiples. D'abord, en quittant le terrain du
verbal, nous aurions été obligés de traiter d'un objet dont les
limites sont difficiles à fixer et qui risque, de par son indétermination
même, de coïncider avec celui de toutes les sciences humaines
et sociales — sinon de toutes les sciences en général. Si tout est
signe dans le comportement humain, la présence d'un « langage »,
en ce sens large, ne permet plus de délimiter un objet de connaissance
parmi d'autres. De surcroît, les institutions sociales, les
structures psychiques, les formes artistiques, les découpages des
sciences n'ont été envisagés comme des systèmes de signes qu'en
un temps récent, et, pour en parler, nous aurions été amenés
souvent à créer une science beaucoup plus qu'à en rendre compte
— ce qui ne correspondait ni à nos buts ni à nos possibilités.
Enfin, une telle extension du mot « langage » aurait impliqué
l'affirmation d'une identité principielle entre les différents systèmes
de signes; nous nous sommes refusés à ériger d'emblée cette
hypothèse au rang de postulat L'étude de ces systèmes pourra
foire l'objet d'autres ouvrages à venir.
8 Introduction
Si lt mot « langage » est donc pris ici en un sens restrictif, le
pluriel de sciences marque, au contraire, notre désir d'ouverture.
Nous n'avons voulu, à aucun moment, séparer l'étude de la langue
de celle de ses productions — entendant par là à la fois sa mise en
fonctionnement (d'où la place accordée à renonciation, aux actes
linguistiques, au langage en situation) et les séquences discursives
qui en résultent, et dont l'organisation n'est (dus directement
régie par le seul mécanisme de la langue (d'où les nombreux
articles consacrés aux questions de littérature : le discours littéraire
étant, de tous, le mieux étudié). Toute tentative d'isoler
l'étude de la langue de celle du discours se révèle, tôt ou tard,
néfaste à l'une et à l'autre. En les rapprochant, nous ne faisons
d'ailleurs que renouer avec une longue tradition, celle de la
philologie, qui ne concevait pas la description d'une langue
sans une description des oeuvres. On trouvera donc représentées
ici, outre la linguistique au sens étroit, la poétique, la rhétorique,
la stylistique, la psycho-, la socio- et la géolinguistique, voire
certaines recherches de sémiotique et de philosophie du langage.
Nous souscrivons par là au credo énoncé naguère par l'un des
maîtres de la linguistique moderne : Linguiste sum : Itnguistid
nihiî a me aiienum puto.
Bien que nous n'intervenions ici comme tenants d'aucune
école, nous avons été amenés, plus souvent qu'il n'est d'usage
dans ce genre d'ouvrages, à prendre une position personnelle,
et même à présenter, ici ou là, des recherches originales, si incomplètes
et provisoires que nous les sachions. Plutôt qu'un bilan
des opinions, dont l'idéal illusoire serait l'impartialité, nous avons
cherché à donner une vue d'ensemble cohérente des problèmes
— ce qui exige toujours le choix d'un point de vue. Indiquons-le
brièvement
Pour étudier les problèmes du langage, nous avons choisi de
les envisager dans une perspective essentiellement sémantique.
Les problèmes de la signification, de ses niveaux, de ses modes
de manifestation sont au centre de tout l'ouvrage. Cette importance
accordée à la signification, entraîne plusieurs conséquences
Vous aimerez peut-être aussi
- Jauss, Théorie de La RéceptionDocument166 pagesJauss, Théorie de La Réceptiondomi5389% (9)
- Journal de Malkuth (Livre)Document78 pagesJournal de Malkuth (Livre)Miguel ChamosaPas encore d'évaluation
- Enseigner Ortho PDFDocument26 pagesEnseigner Ortho PDFYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- Difference Entre Constructivisme Et InterprétativismeDocument3 pagesDifference Entre Constructivisme Et InterprétativismeMarwaneEl-lamrani83% (6)
- Les Differentes Disciplines SportivesDocument2 pagesLes Differentes Disciplines SportivesYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- Béatrice Vicaire - Séminaire de Langue V DéfinitionDocument1 pageBéatrice Vicaire - Séminaire de Langue V DéfinitionYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- La ChansonDocument2 pagesLa ChansonYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- Moyen Âge Tardif: Le Fabliau de RicheutDocument2 pagesMoyen Âge Tardif: Le Fabliau de RicheutYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- New Microsoft Word DocumentDocument2 pagesNew Microsoft Word DocumentYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- Texte D'application: Brunain, La Vache Au PrêtreDocument2 pagesTexte D'application: Brunain, La Vache Au PrêtreYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- L'horizon D'attenteDocument5 pagesL'horizon D'attenteYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- La ChansonDocument1 pageLa ChansonYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- 1ER GuideDocument3 pages1ER GuideYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- Typologie Des Textes NarratifsDocument2 pagesTypologie Des Textes NarratifsYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- Texte Narratif: @sitemagister On Twitter Sitemagister On FacebookDocument4 pagesTexte Narratif: @sitemagister On Twitter Sitemagister On FacebookYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- Hamza MémoireDocument100 pagesHamza MémoireYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- KIOUSDocument44 pagesKIOUSYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- BEL1335Document193 pagesBEL1335Youcef GhellabPas encore d'évaluation
- PUREN Litterature Entre Dire Et FaireDocument18 pagesPUREN Litterature Entre Dire Et FaireYoucef GhellabPas encore d'évaluation
- La Grande ForetDocument3 pagesLa Grande ForetHugo CruzPas encore d'évaluation
- La Grammaire Des Coeurs de Abd Al Karim Al QusayriDocument19 pagesLa Grammaire Des Coeurs de Abd Al Karim Al QusayriachlihiPas encore d'évaluation
- Migne. Patrologia Latina Tomus CXCII.Document699 pagesMigne. Patrologia Latina Tomus CXCII.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Projet Club Fitness DetenteDocument4 pagesProjet Club Fitness DetentefedPas encore d'évaluation
- Sabatier Psychologie Interculturelle Developpement 2014Document26 pagesSabatier Psychologie Interculturelle Developpement 2014Frãncině FränciîaaPas encore d'évaluation
- Los Alemanes en ChileDocument182 pagesLos Alemanes en ChileMarcelo L Leñam BarrilPas encore d'évaluation
- 253Document14 pages253Christophe GarnierPas encore d'évaluation
- Histoire Authentique de La Société ThéosophiqueDocument483 pagesHistoire Authentique de La Société ThéosophiquesantseteshPas encore d'évaluation
- Introduction A La Communaute Islamique Ahmadiyya en IslamDocument8 pagesIntroduction A La Communaute Islamique Ahmadiyya en IslamislamahmadiyyaPas encore d'évaluation
- FrancesDocument2 pagesFrancesIrenePas encore d'évaluation
- Valorisation Des Creations Picturales Contemporaines IvoiriennesDocument122 pagesValorisation Des Creations Picturales Contemporaines IvoiriennesKonan Christian AronouPas encore d'évaluation
- Yuval Noah Harari 21 LeçonsDocument2 pagesYuval Noah Harari 21 LeçonsmosesbantabaPas encore d'évaluation
- Curs 2 Montesquieu - Theorie - ClimatsDocument5 pagesCurs 2 Montesquieu - Theorie - ClimatsAlina MihaelaPas encore d'évaluation
- Le Lien Social Au Defit Du Changement SoDocument18 pagesLe Lien Social Au Defit Du Changement SoRouçadi WafaaPas encore d'évaluation
- Mexique 9Document12 pagesMexique 9Cafe 80sPas encore d'évaluation
- Migne. Démonstrations Évangéliques. 1842. Volume 13.Document670 pagesMigne. Démonstrations Évangéliques. 1842. Volume 13.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- الشريعة الإسلامية وتنازع القوانينDocument14 pagesالشريعة الإسلامية وتنازع القوانينzarroug888Pas encore d'évaluation
- Wafaa KHDocument71 pagesWafaa KHBouchra KelkPas encore d'évaluation
- Livret UEA S3 LLAC 2022-23Document37 pagesLivret UEA S3 LLAC 2022-23Mc TefryPas encore d'évaluation
- Oseki-Dépré Inês, Théories Et Pratiques de La Traduction Littéraire en FranceDocument13 pagesOseki-Dépré Inês, Théories Et Pratiques de La Traduction Littéraire en FranceRadu Toma100% (2)
- Le Parnasse Lart Pour LartDocument3 pagesLe Parnasse Lart Pour LartJean Francois BIAGUIPas encore d'évaluation