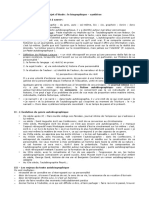Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Maladron 4
Transféré par
Mira0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
31 vues8 pageslitterature
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentlitterature
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
31 vues8 pagesMaladron 4
Transféré par
Miralitterature
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 8
AMOR AMERICA» ou le lieu de l'utopie
(notes sur Maladrôn)
«...sans pouvoir donner mon adhésion à tout ce qu'a dit cet homme (...) je reconnais bien volontiers
qu'il y a dans la république utopienne bien des choses que je souhaiterais voir dans nos cités. Je le
souhaite, plutôt que je ne l'espère» . Thomas More, L'utopie.
Nous nous proposons de montrer dans ces notes les différents traitements de l'utopie dans
Maladrôn, pour tenter de préciser le sens de ce concept foisonnant, d'abord dans le roman, et
ensuite — si ce n'est pas illusoire — dans l'esprit de son auteur : si Maladrôn, à travers le procès de
la conquête, est aussi une quête de l'identité américaine, cette œuvre est par-là même l'expression
d'un désir, et de ceux qu'on prend parfois pour la réalité. Asturias n'a bien entendu pas cette
naïveté, et s'il rêve d'une Amérique différente — métisse, selon ses propres dires — , c'est en
sachant qu'elle n'est pas près d'émerger, précisément, de la réalité historique où elle a été plongée
par la conquête et dans laquelle elle se débat encore aujourd'hui. C'est la justification de l'exergue
ci-dessus1, et particulièrement de sa dernière phrase — qui est aussi, on le sait, la dernière du livre
de Thomas More — , tant il nous semble qu'elle aurait pu être reprise à son compte par Miguel
Angel Asturias.
Si rien, dans Maladrôn, ne rappelle explicitement L'utopie, il est difficile de lire ce roman — comme
d'ailleurs toute œuvre traitant des enjeux spirituels de la conquête, même si c'est, comme ici, par
dérision et de façon détournée — sans avoir présent à l'esprit le texte de Thomas More. Et cela pour
bien des raisons, qui tiennent tant à l'œuvre du chancelier d'Angleterre qu'à l'écho qu'elle a trouvé
dans l'Espagne du XVIe siècle. Thomas More était attentif aux découvertes, et son île d'Utopie est
explicitement située quelque part dans le Nouveau Monde, même si, comme il le dit, il n'a pas
1. Thomas More, L'utopie, traduction de Marie Delcourt, Paris, Garnier-Flammarion, 1991, p. 234.
196 Jean-Marie Saint-Lu
pensé à demander au «très sage» Raphaël Hythlodée, qui lui en révèle l'existence, où elle se trouve
exactement1. Son informateur, «navigateur- philosophe désireux de voir le monde», avait quitté son
Portugal natal pour se joindre aux trois dernières expéditions d'Américo Vespucci. Celui-ci, à sa
demande, le laisse avec quelques compagnons dans un fort — référence directe au premier voyage
de Colomb — d'où, ayant établi avec les indigènes des relations «pacifiques et amicales» (et là,
évidemment, nous sommes déjà loin de la réalité historique), il part, pourvu d'un guide très sûr, pour
le long périple qui lui fera connaître le pays des Utopiens.
Comme on le voit, le rêve et la réalité, la fiction et l'histoire, se séparent presque d'emblée. En ce
sens, le récit d'Hythlodée permet de réunir les diverses acceptions généralement admises
aujourd'hui pour le terme d'utopie2, dans la mesure où il donne comme réel un pays forcément
imaginaire, et aussi parce qu'il «invente» un type de relations entre Indigènes et Européens
(entendons Indiens et Espagnols) démenti par les faits dès le début ou presque de la découverte. A
la frustration de l'histoire, le romancier répond par un désir qui implique la négation de cette dernière
: Asturias et les auteurs modernes de roman historique latino-américains ne font pas autre chose.
L'utopie — le concept comme le livre éponyme — est donc une vision corrigée de l'histoire, mais
aussi, en ce qui concerne la conquête de l'Amérique et sa colonisation-exploitation par les
Européens, de l'abondante historiographie qui la décrit. Si ce qui motive l'invention de More est son
insatisfaction devant les institutions qui régissent l'Angleterre, et plus largement, l'Europe de son
temps, mutatis mutandis c'est le même désir (le mot s'impose vraiment) qui anime Asturias et tous
ceux qui se sont donné pour tâche de «corriger» par leurs fictions l'histoire officielle4. L'écrivain est
donc une sorte de démiurge, vaguement cousin avec le Patriarche de Garcia Marquez dont l'objectif,
plus ambitieux encore était «de corriger les erreurs de Dieu».
1. L'utopie, op. cit., p. 76
2. l£ grand Robert, par exemple, donne à l'article utopie : 1° Vx. Pays imaginaire où un
gouvernement idéal règne sur un peuple heureux. 2° «Plan d'un gouvernement imaginaire, à
l'exemple de la République de Platon». Puis, par ext. Idéal, vue politique ou sociale qui ne tient pas
compte de la réalité et apparaît comme chimérique. — (Dans toute espèce de domaine) Conception
ou projet qui paraît irréalisable.
Il est clair que tous ces sens mettent en jeu, dans des rapports légèrement différents, réalité et
imaginaire, ce qui peut aussi se lire, pour le roman dont nous nous occupons, comme la relation
entre l'histoire et la fiction. Il nous semble que c'est là toute la problématique proposée par
Maladrôn, et d'ailleurs par tout roman historique moderne, et en ce qui nous concerne, par Hijo de
Hombre et La Guerra del fin del mundo.
4. Pour une vue générale sur le roman historique latino-américain, on se reportera avec grand profit
aux articles de Fernando Ainsa, «La invention literaria y îa "reconstruction" histôrica», in America, n°
1 2, p 11-26, et «La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana», in Cuadernos
Americanos, 28, julio-agosto 1991, p. 13-31.
«Amor America» ou le lieu de l' utopie 1 97
Quant à l'impact de la lecture de L'utopie sur de nombreux esprits espagnols du XVIe siècle, il est
bien connu. Nous ne citerons que pour mémoire, et pour sa valeur exemplaire, le cas de Vasco de
Quiroga, dont le propos, en créant ses célèbres hospitales-pueblos de Michoacân, est très
explicitement de concrétiser sur le terrain l'idéal de Thomas More. C'est pour lui le moyen parfait de
retrouver un âge d'or et, tout bonnement, un paradis terrestre impossible à situer dans une Europe
trop vieille et en proie à la plus grande crise de valeurs qu'ait connue l'occident depuis l'époque de la
christianisation :
Porque no en vano, sino con mucha causa y razôn este de acâ se llama Nuevo Mundo, no porque
se hallo de nuevo, sino porque es de gentes y cuasi en todo como rue aquel de la edad primera y
deoro...*
Il n'est guère besoin d'insister sur l'évident eurocentrisme de cette vision d'une Amérique qui
permettrait aux hommes de retrouver cet âge d'or (dans cet Eden que Colomb est persuadé d'avoir
touché lors de son troisième voyage), et qui est d'ailleurs le complément d'une autre vision, escha-
tologique, celle-là, qui fait du continent nouvellement découvert le lieu où le Christ reviendra établir
son royaume : l'Amérique est bien le Nouveau Monde. Mais c'est aussi cet eurocentrisme qui est à
la base du malentendu originel et des malheurs qui en découleront pour les premiers Américains2. Il
y a là en effet toute l'ambiguïté consubstantielle à la conquête : se voulant spirituelle, elle est dès le
début matérielle, et même, selon Asturias dans Maladrôn, matérialiste au dernier degré. En ce sens,
les rêveurs d'âge d'or se transforment vite, plus concrètement, en conquérants de l'or, et ce avec la
meilleure conscience du monde, soutenus qu'ils sont par leur conviction d'appartenir à un peuple
supérieur, puisque leur religion est la seule vraie. On touche ici du doigt la signification de la
«déviance» opérée par Asturias dans son roman, puisque ses héros substituent au Dieu des
chrétiens un petit dieu plus conforme à leurs appétits matériels. C'est une des significations
essentielles de Maladrôn, et nous n'y insisterons pas3. Mais hors du roman, l'enjeu est bien
d'imposer, par différents moyens, des plus doux aux plus radicaux, le Dieu des Espagnols aux
Indiens. Il ne pouvait évidemment pas en être autrement au XVIe siècle, et il n'est pas indifférent, de
ce point de
1. Cité par Silvio Zavala, in Recuerdo de Vasco de Quiroga, Editorial Porrua, Mexico, 1965, p. 59.
2. Voir à ce propos Tzvetan Todorov, La conquête de l'Amérique, Paris, Le Seuil, 1982, intéressant
surtout par la justification de son sous-titre : La question de l'autre, où l'auteur met en relief le poids
de l'eurocentrisme dans l'histoire des relations entre Indiens et Espagnols.
3. Voir pour cet aspect du roman les différents articles contenus dans America, n°12, Histoire et
imaginaire dans le roman hispano-américain contemporain.
198 Jean-Marie Saint-Lu
vue, que ce soit là un des effets reconnus du récit de Raphaël Hythlodée, explicitement exposé par
More au début de L'utopie :
D'autre part, un homme pieux de chez nous, théologien de profession, brûle, et il n'est pas le seul,
du désir d'aller en Utopie. Ce qui l'y pousse n'est pas une vaine curiosité de voir du nouveau ; il
souhaiterait encourager les progrès de notre religion qui se trouve là-bas heureusement implantée.
Comme il désire le faire selon les règles, il a décidé de s'y faire envoyer par le Souverain Pontife et
même à titre d'évêque des Utopiens, sans se laisser arrêter par le scrupule d'avoir à implorer cette
préla- ture. Il estime en effet qu'une ambition est louable si elle est dictée, non par un désir de
prestige ou de profit, mais par l'intérêt de la religion.1
Ce passage est intéressant à plus d'un titre. D'abord, et d'une façon générale, parce qu'il montre
bien la communauté de pensée entre «l'intellectuel» anglais et les évangélisateurs espagnols.
Ensuite, parce qu'il souligne, implicitement, l'eurocentrisme dont nous parlons ; enfin, parce qu'il
exprime le souci d'une orthodoxie qui sera le plus souvent détournée à leur profit par les
conquistadors, dont la bonne conscience sera, là encore, confortée par les tenants de la doctrine de
la juste guerre. Mais même chez les évangélisateurs les plus décidés à comprendre les Indiens et
leur culture — voir Sahagûn, sur ce point — , même chez ceux qui, comme Las Casas, consacrent
leur vie à les défendre, il n'est évidemment jamais question de remettre en cause la supériorité de la
foi chrétienne, qui exclut toute autre croyance, et donc, avec toutes les nuances imaginables,
légitime les moyens mis en œuvre pour convertir les païens de tout ordre. On connaît les arguties
développées par Las Casas, par exemple, lorsqu'il veut établir des différences entre les «infidèles»
d'Afrique ou d'Orient (entendons : les musulmans) et les «gentils» d'Amérique, pour justifier l'emploi
de la force contre les premiers et le condamner contre les seconds2. Quant à Vasco de Quiroga, il
est tout à fait clair :
La pacificaciôn de estos naturales, para los traer y no espantar, habia de ser, a mi ver, no guerra
sino caza. En la cual conviene mas el cebo de buenas obras que no inhumanidades ni rigores de
guerra ni esclavos délia ni de rescate, si quisiéremos una vez
1. Thomas More, op. cit., p. 77. Simone Goyard-Fabre, chargée de cette édition de L'utopie,
commente les termes d'homme pieux dans la note suivante : «La tradition veut que Rowland
Phillips, chanoine de Saint-Paul, ayant lu le livre, ait voulu partir évangéliser les Utopiens». Silvio
Zavala, dans l'ouvrage cité plus haut, glose avec humour ce passage de L'utopie. (Cf. Silvio Zavala,
Letras de Utopia. Carta a don Alfonso Reyes, op. cit. p. 77-83.
2. Cf. Las Casas, Historia de las Indias, Prôlogo.
«Amor America» ou le lieu de l'utopie 199
cazarlos y después de cazados convertirlos, retenerlos y con- servarlos.1
Outre qu'on peut en apprécier la métaphore et la rhétorique, ce passage nous intéresse dans la
mesure où il suffit d'en changer quelques termes pour retrouver exactement l'attitude de Bias
Zenteno et Duero Agudo, les deux plus ardents zélateurs du Mauvais Larron, lorsqu'il s'agit pour eux
de convertir les Indiens à leur culte, en profitant du parallélisme des manifestations de ce dernier
avec celles des adorateurs de Cabracân. C'est bien le mécanisme du détournement de l'esprit, fût-il
hétérodoxe, au profit de l'intérêt bien compris : la réussite d'Asturias est d'avoir su ainsi détourner
tous les principes de la conquête, pour en montrer, en grossissant le trait, l'image réelle. Ce qu'il
condamne par la dérision est bien la prétention espagnole à imposer sa culture, et de s'en servir de
prétexte pour spolier sa conquête. La leçon est claire : l'utopie religieuse accouche d'une imposture.
Même lorsque les intentions sont sincères, elles s'opposent par trop aux réalités humaines et au
désir de lucre pour être réalisables : on sait toutes les difficultés auxquelles s'est heurté Las Casas,
et que l'expérience de Quiroga tourna court. De toute façon, leur œuvre, dans son aspect concret
sinon dans son esprit, ne concernait que des havres de paix dans un monde de fureur : la Verapaz
pour l'un et Michoacan pour l'autre. La tentation est grande de voir en ces deux régions favorisées
des îles, où d'une certaine façon pouvait se concrétiser l'idéal de Thomas More. Leur échec final est
la preuve de l'impossibilité de réaliser l'utopie : celle-ci ne devrait disparaître qu'en perdant la
justification de son nom. Ce «quelque part» apte à transcender le «nulle part» n'est pas encore
découvert.
**
Et pourtant, comme pour conjurer le sort, l'utopie, ce non-lieu, est bien présente dans Maladrôn,
sous diverses formes et à divers degrés. Et d'abord, il existe quelque part au sud du Yucatan, un
triangle magique où vivent certains Espagnols que l'histoire a oubliés parce qu'ils se sont
volontairement séparés des leurs :
y no hablo de los batalladores, sino de los mansos, de los que se quitaron de ruidos de conquistas
para vivir como los indios2
1 . Cité par S. Zavala, op. cit., p. 52.
2. Miguel Angel Asturias, Maladrôn, Madrid, Alianza Editorial, (édition de 1984), p. 169.
200 Jean-Marie SaîNT-Lu
dit la statue de Maladrôn à son créateur. Propos repris de façon très légèrement différente, à la fin
du même chapitre, par le narrateur :
e iba a senalar con el dedo partiendo de Sierra de Minas, por el Noroeste, hacia Yucatan, arriba del
Golfo Dulce, y por el No- reste hacia Puerto Caballos ; pero se detuvo a tomar una filosa lamina de
talco y un renglôn de madera tosca para trazar sobre el mapa el triângulo en que mas hombres
blancos cambiaron el batallar por el vivir en paz.1
Qui sont ces hommes qui ont résolument choisi de couper le cordon ombilical avec la mère patrie en
s'écartant des leurs, et de se laisser subjuguer par leur conquête ? Ils sont en tout cas remarquables
par la transformation radicale qu'ils ont subie en cessant d'être des hommes de guerre pour vivre en
harmonie avec leurs hôtes involontaires. Mais qui sont-ils ? Les deux passages cités ci-dessus ne
sont pas très clairs, pour nous du moins. S'agit-il dans les deux cas du même triangle ? L'hésitation
de Ladrada et son dessin final, ainsi que le mas du syntagme «mas hombres blancos» laissent
penser que c'est bien un autre triangle que trace alors le pirate-sculpteur. Sans pouvoir en décider
vraiment, avançons une hypothèse séduisante, si elle est hasardeuse : lorsqu'on reproduit sur une
carte du Guatemala le triangle dessiné par Maladrôn, on constate qu'on ne passe pas bien loin de la
Vera Paz, l'Utopie lascasienne, et l'on se dit que c'est peut-être là que Ladrada place son propre
triangle. Ce qui est bien certain, en tout cas, c'est que dès 1550, c'est à dire bien avant l'époque où
est censée se dérouler cette aventure (quoique la datation très floue des événements ne permette
pas de s'en faire une idée précise, et Asturias lui-même prétendait que cette histoire se passait en...
1600), les dominicains avaient installé sur les bords du Golfo Dulce le premier village d'une région
qui allait devenir pays de réduction2. Il n'est pas interdit d'imaginer la présence de «civils»
espagnols aux côtés des dominicains. Ce serait là l'une des très rares allusions à l'aspect non
barbare de la conquête, avec la citation des paroles de ce «justo varôn» non nommé de la page
172, dont le discours a un très fort accent lascasien.
Quoi qu'il en soit, les heureux habitants de ce triangle d'or sont à l'opposé du petit groupe dont les
aventures nous occupent : si, pour ces derniers, le Voile del Maladrôn est le lieu d'une utopie
réalisable, il est clair qu'ils ne sont pas pour autant prêts à vivre en situation d'égalité avec les
Indiens, qu'ils ne cherchent, on le sait, qu'à tromper en leur faisant croire que c'est en l'honneur de
Cabracân qu'ils érigent leur petit temple. Et s'ils
1. Ibid. p. 170.
2. Cf. André Saint-Lu, La Vera Paz, esprit évangélique et colonisation, Paris, Institut d'Etudes
hispaniques, 1968, p. 314-315.
«Amor America» ou le lieu de l' utopie 20 1
ont rompu avec l'Espagne, ce n'est certes pas pour adopter les mœurs du Nouveau Monde, mais
pour échapper aux bûchers de l'Inquisition. Là encore, il y a utopie, mais en négatif, et quelle
différence y a-t-il, au fond, dès qu'il s'agit de l'imposer, entre la croix du Christ et celle de Maladron ?
Giïinakil, lui, ne s'y trompera pas. Quant à Antolinares, il comprend un peu tard qu'il a fait le mauvais
choix :
...No hay tiempo. Apercibido estais del peligro con los indios y con Zenteno que os quiere cortar las
manos. Nosotros huiremos hacia el Golfo Dulce. Adios al «Valle del Maladron», donde pudimos ser
felices sin creencias, al modo de los animales.1
Nous voilà, certes, au degré zéro de la spiritualité, mais ce qu'Antolinares exprime ici, c'est
également, au-delà d'un désir fruste d'intégration, un renoncement à toute domination religieuse, et
donc culturelle, et par-là il s'oppose fortement aux autres Espagnols, hommes de guerre ou
zélateurs de Maladron. Contrairement à tous ceux-là, il ne manifeste — très provisoirement™ plus
aucune volonté d'appropriation de l'Amérique, ce qui est l'enjeu de la conquête sous tous ses
aspects. Il est clair aussi qu'Antolinares est comme la plupart des personnages de ce roman qui, à
un moment ou à un autre, subissent la fascination de l'Amérique ; à ce propos, l'on ne peut qu'être
frappé par la fréquence des passages où est décrite la séduction qu'elle exerce sur tout un chacun
par sa beauté, ses richesses et sa magie : les Espagnols sont, au sens propre, envoûtés, et peu à
peu happés par leur conquête, jusqu'à vouloir fusionner avec elle. Nous ne citerons qu'un exemple,
le plus explicite peut-être :
... porque al final de sus vidas y su desesperada bûsqueda de locos, ya eran otros, no los mismos
que llegaron de Espana, otros unos seres que formaban parte de la geografia misteriosa de un pais
construido de los mares al cielo, por manos de ca- taclismos y terremotos, igual que una de esas
pirâmides blan- cas, altfsimas, que en su andar contemplaron perdidos en la selva.2
Ainsi, qu'ils se laissent faire — ceux du fameux triangle — ou pas — Antolinares et tant d'autres — ,
l'Amérique captive et capture ceux qui pensaient la conquérir, et fait d'eux, finalement, presque les
égaux de ces «êtres végétaux» que sont les Indiens. Et surtout, tout du long, une Indienne : Titil-Ic,
bien sûr, et si elle est la seule femme du roman, c'est sans doute parce qu'elle incarne, justement,
cette Amérique objet de tous les dé-
1. Maladron, op. cit., p. 189.
2. Ibid. p. 219.
202 Jean-Marie Saint-Lu
sirs espagnols. Titil-Ic, qu'Angel Rostro a cru posséder, mais dont l'union avec elle est demeurée
stérile. Titil-Ic, qui en revanche a donné un fils à Antolinares, de tous les personnages le moins
accroché à sa patrie (sauf dans son délire final où il redevient, en fait, l'archétype du conquérant
spoliateur pour qui l'Amérique n'est qu'un moyen de devenir Grand, mais en Espagne), et sectateur
point trop zélé, au fond, de Maladron : s'il l'est, c'est surtout par reconnaissance, après qu'il s'est
laissé persuader que c'est au dieu de Zaduc qu'il doit d'avoir recouvré la vue. Cela ne part pas d'un
mauvais sentiment, mais ne témoigne guère d'une conviction bien ancrée. Titil-Ic, enfin, que
recherche désespérément Ladrada, lequel n'aura d'autre choix, quand il s'apercevra de la vanité de
ses efforts pour la retrouver, que celui de regagner la mer du Nord, c'est à dire la mer d'Espagne. Et
la raison de son échec est claire : c'est celle que lui exposent les Halladores qu'il a envoyés à la
recherche de la jeune Indienne et de son fils lorsqu'ils lui disent :
...Pensar en ella sin que la llame tu corazôn, es dentro y dejarle solo lo de fuera, lo fantasma...1
vaciarla por
On le voit, Titil-Ic-Amérique révèle ce que chacun est vraiment, le dévoile, et finalement se dérobe à
tous ceux qui veulent la posséder sans l'aimer : elle est alors, au plein sens du terme, utopie, c'est à
dire terre de nulle part, pays où l'on n'arrive jamais2.
***
C'est d'ailleurs d'un autre lieu magique que sont en quête les héros de Maladron, celui où les deux
océans se rejoignent. Nouvel avatar de l'utopie, mythique cette fois, dont la découverte assurera à
nos aventuriers les privilèges réservés aux grands découvreurs ; c'est donc, encore une fois, un pur
désir de possession qu'ils expriment à travers cette quête (il s'agit bien plus d'une quête que d'une
recherche, comme on le sait). Et la plus belle «trouvaille» d'Asturias est, à notre sens, d'avoir fait de
cette donnée historique — la croyance en une liaison inter-océanique par voie d'eau — la superbe
métaphore récurrente qui irrigue Maladron : c'est à travers elle qu'il développe l'idée directrice et
avouée du roman, à savoir le métissage, en la symbolisant après lui avoir donné comme support
anecdotique la naissance du petit Antolîn Titil-Ic. Cette métaphore nous sert de relais pour passer
de
\. Ibid., p. 230.
2. Pour une étude des significations symboliques de Titil-Ic, voir Marie-Louise Ollé-Bourrillon,
L'image dans Maladron de Miguel Angel Asîurias, Mémoire pour la Maîtrise (inédit), Université de
Toulouse-Le Mirail, 1993.
«Amor America» ou le lieu de l' utopie 203
l'œuvre à son auteur : on sait que cette idée de métissage salvateur n'est pas nouvelle chez
Asturias, puisque c'est une des solutions — bien naïve — qu'il proposait dans sa thèse de
jeunesse1 pour résoudre les problèmes indigènes du Guatemala, avant qu'elle ne sous-tende, sous
la forme de métissage culturel, l'ensemble de son œuvre de fiction. Cette idée n'a pas manqué
d'attirer les critiques, parfois fort virulentes, qui par contre-coup n'ont pas épargné l'œuvre, même si
elles en reconnaissaient la haute valeur littéraire2 Ces critiques, justifiées dans une perspective
sociologique, le sont moins lorsqu'elles touchent à l'univers romanesque, dans la mesure où elles
font fi de la liberté esthétique de tout écrivain, surtout lorsque, comme Asturias, celui-ci n'est pas
dupe de ses propres rêves, du moins de leur aptitude à devenir réalité. Nous renvoyons à ce propos
à la dernière phrase de notre exergue. L'auteur de Maladrôn s'est clairement exprimé sur ce
problème dans la préface de la nouvelle édition de sa thèse :
En mi tesis, entre los medios estudiados para la solution de este angustioso problema de la
regresiôn vital del indigena, pro- ponia, con juvenil entusiasmo, la inmigraciôn. Un fuerte mes- tizaje
a base de sangre nueva. A la fecha, la experiencia ha de- mostrado que si se llevan inmigrantes,
éstos, no solo no se mezclan con el indio, sino muy pronto se convierten en jefes, patrones, amos o
capataces del infeliz nativo.3
Après être revenu ainsi sur la solution préconisée maintenant sentie comme une erreur de jeunesse,
Asturias poursuit en proposant une variante culturelle, comme nous l'avons dit, qui est en quelque
sorte la justification de toute son œuvre romanesque, et c'est pourquoi il nous semble utile de la citer
in extenso :
Si se parte del concepto de que el indio guatemalteco es un ente que en si encierra los elementos
de otra cultura, de su cultura ancestral, propia, que alcanzô pasmoso desarrollo en las artes, los
conocimientos de la naturaleza, etc., no hay que occidenta- lizarlo, sino tratar de despertar en él
esos elementos de su cultura nativa, de su personalidad profunda. En este caso, lo que debe
hacerse, es propocionarle los medios para desarrollarse, ampliar sus formas de vida, y unir la
técnica a su cultura, para
1. Miguel Angel Asturias, El problema social del indio, Guatemala, Sanchez et De Guise, 1923. Le
texte est accessible dans l'édition établie en 1971 par Claude Couffon : Miguel Angel Asturias, El
problema social del indio y otros textos, Institut d'Etudes Hispaniques, Paris.
2. On trouvera une analyse approfondie de la question dans Jean-Michel Barascud, Le romancier
Miguel Angel Asturias et les religions précolombiennes, Thèse pour le Doctorat de Troisième Cycle
(inédite), Université de Toulouse-Le Miraii, 1986.
3. Miguel Angel Asturias, El problema social del indio, op. cit., 2ème éd. 1971, p. 17.
204 Jean-Marie Saint-Lu
que asi, si él quiere, [souligné par nous] mas adelante, se incorpore a la nuestra.1
Notons au passage que les derniers mots montrent à l'évidence qu'Asturias n'a pas la naïveté de se
prendre pour un Indien, et qu'il faut une certaine mauvaise foi pour l'accuser, comme on l'a fait, de
récupérer à des fins esthétiques une culture qui n'était pas la sienne. Pour nous, en tout cas, il doit
être clair que la nature d'une Amérique métisse où les deux héritages, indien et espagnol, seraient
affectés de la même valeur, et qui est l'idée développée dans Maladrôn, est une utopie, élaborée
avec la même lucidité teintée de regret que celle de Thomas More. Ce qui doit être encore plus clair,
c'est que dans ce roman, Asturias applique exactement le précepte énoncé dans le passage de sa
thèse reproduit ci-dessus, à savoir que le devoir des «ladinos» est de donner aux Indiens les
moyens de prendre conscience de la haute valeur de leur culture et de la revendiquer, pour qu'ils
puissent se situer sur un pied d'égalité avec les blancs. On reconnaît là, d'ailleurs, l'une des idées
exprimées au siècle dernier par José Marti, en particulier dans son essai Nuestra America.
Car bien loin de n'être qu'un simple cadre, qu'un décor, l'Amérique est constamment au premier plan
dans Maladrôn, dont on s'accordera à dire qu'il est, dans son ensemble, un chant d'amour à cette
terre indienne si fascinante que même ses spoliateurs en subissent l'envoûtement. Ils auraient pu y
céder et faire de ce paradis perdu (mythe que les Indiens, qui sont des hommes, ont en commun
avec tous les hommes de la terre) le lieu de toutes les utopies européennes, et pourquoi pas celle
de Thomas More, enfin réalisées dans l'harmonie avec le monde indien : l'histoire en a décidé
autrement, et c'est pourquoi le petit Antolincito disparaît dans la forêt matricielle, au tréfonds de
laquelle il attend le jour où ce qu'il symbolise — l'Amérique métisse — pourra vraiment exister. Cette
Amérique dont Maladrôn fait une virtualité : «Todo esta lleno de comienzos».
La dernière phrase du texte de More est empreinte d'un pessimisme lucide. Laissons à un autre
humaniste, André Gide, le soin de redonner quelque chance à l'utopie :
Comme si tout grand progrès de l'humanité n'était pas dû à de l'utopie réalisée ! Comme si la réalité
de demain ne devait pas être faite de l'utopie d'hier et d'aujourd'hui...2
Jean-Marie SAINT-LU
\.lbid.
2. André Gide, Les Nouvelles Nourritures, III, III.
Vous aimerez peut-être aussi
- LES STRUCTURES SYMBOLIQUES DE Hijo Del MundoDocument9 pagesLES STRUCTURES SYMBOLIQUES DE Hijo Del MundoMiraPas encore d'évaluation
- Maladrôn 3Document5 pagesMaladrôn 3MiraPas encore d'évaluation
- Mémoire Et Culture Dans La Révolution NicaraguayenneDocument6 pagesMémoire Et Culture Dans La Révolution NicaraguayenneMiraPas encore d'évaluation
- MALADRÔNDocument8 pagesMALADRÔNMiraPas encore d'évaluation
- Maladrôn 2Document9 pagesMaladrôn 2MiraPas encore d'évaluation
- Mala HoraDocument21 pagesMala HoraMiraPas encore d'évaluation
- Les Mondes Imaginaires de BorgesDocument9 pagesLes Mondes Imaginaires de BorgesMiraPas encore d'évaluation
- La Guerra Del Fin Del Mundo Une EntrepriseDocument6 pagesLa Guerra Del Fin Del Mundo Une EntrepriseMiraPas encore d'évaluation
- FILTRES ET PRISMES Fin de Mundo 2Document9 pagesFILTRES ET PRISMES Fin de Mundo 2MiraPas encore d'évaluation
- La Revanche Des Ames en PeineDocument11 pagesLa Revanche Des Ames en PeineMiraPas encore d'évaluation
- La Guerra Del Fin Del Mundo Une EntrepriseDocument6 pagesLa Guerra Del Fin Del Mundo Une EntrepriseMiraPas encore d'évaluation
- La Guerra Del Fin Del Mundo Une EntrepriseDocument6 pagesLa Guerra Del Fin Del Mundo Une EntrepriseMiraPas encore d'évaluation
- La Représentation Du Paysage Dans Ladera EsteDocument15 pagesLa Représentation Du Paysage Dans Ladera EsteMiraPas encore d'évaluation
- La Construction Du Personnage HistoriqueDocument9 pagesLa Construction Du Personnage HistoriqueMiraPas encore d'évaluation
- La Guerra Del Fin Del Mundo Une EntrepriseDocument6 pagesLa Guerra Del Fin Del Mundo Une EntrepriseMiraPas encore d'évaluation
- Imaginaire Et Histoire Dans MaladronDocument5 pagesImaginaire Et Histoire Dans MaladronMiraPas encore d'évaluation
- Gaucho Et LittératureDocument12 pagesGaucho Et LittératureMiraPas encore d'évaluation
- FILTRES ET PRISMES Fin de Mundo 2Document9 pagesFILTRES ET PRISMES Fin de Mundo 2MiraPas encore d'évaluation
- Fin Del MundoDocument11 pagesFin Del MundoMiraPas encore d'évaluation
- Carav 0008-0152 1967 Num 8 1 1161Document38 pagesCarav 0008-0152 1967 Num 8 1 1161MiraPas encore d'évaluation
- Espace Et Histoire Dans Maladrôn de Miguel Angel AsturiasDocument7 pagesEspace Et Histoire Dans Maladrôn de Miguel Angel AsturiasMiraPas encore d'évaluation
- Deux Modalites Du Traitement de LDocument22 pagesDeux Modalites Du Traitement de LMiraPas encore d'évaluation
- Figement, Défigement Et Traduction. Problématique Théoriquedefigement.s.mejriDocument11 pagesFigement, Défigement Et Traduction. Problématique Théoriquedefigement.s.mejriAlicja CyganiewiczPas encore d'évaluation
- Le Management Et L'islamDocument2 pagesLe Management Et L'islamsakhoibPas encore d'évaluation
- Cause Et Conséquence (Tableau) PDFDocument2 pagesCause Et Conséquence (Tableau) PDFJuan Pablo100% (2)
- L'Industrie Culturelle - Theodor AdornoDocument2 pagesL'Industrie Culturelle - Theodor Adornoelsa.vitonPas encore d'évaluation
- 20 Dissertations - Le Monde Des Passions PDFDocument22 pages20 Dissertations - Le Monde Des Passions PDFJack NixonPas encore d'évaluation
- Effi CA CiteDocument14 pagesEffi CA CiteAyoub SadikiPas encore d'évaluation
- Certificat de Sciences Criminologiques PDFDocument3 pagesCertificat de Sciences Criminologiques PDFgabriel pereiraPas encore d'évaluation
- Le TravailDocument2 pagesLe Travaillisa_bodinierPas encore d'évaluation
- Chap 6 MondialisationDocument5 pagesChap 6 Mondialisationapi-25900879Pas encore d'évaluation
- Travail de Candidature FABER Nathalie 3Document175 pagesTravail de Candidature FABER Nathalie 3Nikola bs07Pas encore d'évaluation
- Le Mouvement ModerneDocument7 pagesLe Mouvement ModerneNick Boris OuizanPas encore d'évaluation
- Histoire LittéraireDocument476 pagesHistoire Littérairefilolog100% (10)
- 14 Nov 2018 Ma FamilleDocument6 pages14 Nov 2018 Ma FamilleOlteanu NicoletaPas encore d'évaluation
- Ingenierie de La Formation Training DesiDocument101 pagesIngenierie de La Formation Training DesiHamid BouleghabPas encore d'évaluation
- Bilans Et Evaluation Bonjour Et BienvenueDocument30 pagesBilans Et Evaluation Bonjour Et Bienvenuesolitude100% (1)
- Synthèse AutobiographieDocument2 pagesSynthèse AutobiographieionikaPas encore d'évaluation
- Néologismes Et AnglecismesDocument3 pagesNéologismes Et AnglecismesYoussef El GarouaouiPas encore d'évaluation
- La Vie Entre Soi Les Moines Taoistes Aujourd Hui en ChineDocument4 pagesLa Vie Entre Soi Les Moines Taoistes Aujourd Hui en ChineTiffany BrooksPas encore d'évaluation
- AïguiDocument3 pagesAïguiahikar1Pas encore d'évaluation
- Article: La Tradition AfricaineDocument6 pagesArticle: La Tradition AfricainePasteur Vivi KodjoPas encore d'évaluation
- Viergeet NeutrinoDocument207 pagesViergeet NeutrinoIsabelle Stengers100% (1)