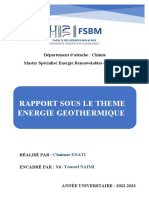0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
187 vues16 pagesGéothermie : Types et Fonctionnement
Ce document décrit les différents types de géothermie, y compris la géothermie profonde, moyenne et basse énergie. Il explique le principe de fonctionnement de la production d'électricité à partir de la géothermie ainsi que les techniques d'exploitation.
Transféré par
Younes KebCopyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
187 vues16 pagesGéothermie : Types et Fonctionnement
Ce document décrit les différents types de géothermie, y compris la géothermie profonde, moyenne et basse énergie. Il explique le principe de fonctionnement de la production d'électricité à partir de la géothermie ainsi que les techniques d'exploitation.
Transféré par
Younes KebCopyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd