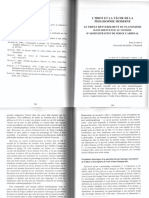Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Lundimatin CLICHÉS DU VIRUS
Transféré par
josé macedoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lundimatin CLICHÉS DU VIRUS
Transféré par
josé macedoDroits d'auteur :
Formats disponibles
lundimatin
CLICHÉS DU VIRUS,
SOUSTRACTION DES
IMAGES
« Comment nous différencier des zombies au dehors, si nous
sommes entrés dans un devenir-zombie au dedans ? »
paru dans lundimatin#242 (11-mai-254), le 12 mai 2020
« « Le langage est un virus venu de l’espace. »
— William Burroughs, Nova Express
»
De quoi nous souviendrons-nous de cette période de pandémie et
de confinement mondial ? Quelles images s’emmagasineront dans
notre mémoire, en marge des discours, des informations et des
journaux de bord qui tiennent le registre d’un quotidien que nous
oublierons bientôt ?
Nous disposons bien de l’une des toutes premières photographies du
virus actuel. Mais que voit-on dans cette image ? Quelques petites
tâches rouges orangées accrochées à des « cils de cellules » bleu fluo
sur un fond gris [1]. Plutôt qu’à une réalité en laquelle nous pourrions
croire, la netteté luminescente de ce cliché saisi au microscope
électronique, nous renvoie à un imaginaire plastique de peinture
abstraite ou d’effets spéciaux de science-fiction.
Il pourrait s’agir d’une image subliminale qu’on aurait
extraite du final halluciné de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley
Kubrick (1968) ou bien de la plongée psychédélique dans l’explosion
atomique de Twin Peaks : the Return de David Lynch (2017). À moins
que ce contraste chromatique (orange, bleu) ne nous renvoie à un
dispositif militaire d’imagerie thermique et au film Ni le ciel, ni la terre
de Clément Cogitore (2015), où disparaissent la guerre, les militaires et
la foi dans les images ?
De fait, les virus se soustraient au visible. Leur système de
reproduction parasitaire fait qu’ils ne figurent en biologie sur aucun
arbre de classification. On débat même de leur appartenance au
monde vivant. Ils opèrent donc sous l’image, de manière
rhizomatique, par détournement des informations génétiques des
cellules qui les accueillent, de manière à leur commander de
nouveaux exemplaires, invisiblement altérés. D’où l’inquiétante
étrangeté dont ils sont porteurs et notre oscillation entre incrédulité et
paranoïa, rire idiot et rire mauvais. Gilles Deleuze et Félix Guattari
concluaient : « Nous faisons rhizome avec nos virus, ou plutôt nos
virus nous font faire rhizome avec d’autres bêtes [2]. »
Qu’est-ce alors qu’un cliché ? Deleuze, seul, en proposait une
description virale : « Ce sont ces images flottantes, ces clichés
anonymes, qui circulent dans le monde extérieur, mais aussi qui
pénètrent chacun et constituent son monde intérieur, si bien que
chacun ne possède en soi que des clichés psychiques par lesquels il
pense et il sent, se pense et se sent, étant lui-même un cliché parmi
les autres dans le monde qui l’entoure. Clichés physiques, optiques et
sonores, et clichés psychiques se nourrissent mutuellement [3]. »
TAXINOMIE DES IMAGES VIRALES
Une fois rappelée cette furtivité, constitutive des virus, on nous
rétorquera que nous ne manquons pas d’images d’actualité. Nous
sommes après tout à l’âge de l’information mass-médiatique, des
réseaux sociaux et d’une surproduction des images. Mais quelles sont
ces images ? Nous comptons d’abord les gros plans sur des visages :
des visages anonymes de gens qui se filment ou se selfisent chez eux,
des visages de stars et de journalistes confinés, sans maquillage et
sans éclairage pour les embellir. S’il est des images ordinaires dont
nous comblons aujourd’hui le manque, des marchandises dont nous
craignons plus que tout la pénurie en les surproduisant, ce sont celles
du visage de nos semblables.
Parmi ces gros plans, quelques visages plus singularisés
semblent incarner le moment : celui de Li Wenliang, ce médecin
lanceur d’alerte de Wuhan, avant et après son infection ; le visage au
look de gourou du Dr. Didier Raoult ; celui fatigué du premier ministre
anglais Boris Johnson à l’hôpital. Avec de tels personnages types : du
martyr, de l’outsider et du gros-jean comme devant, on hésite entre la
fable de La Fontaine et la comédie de caractères à la Molière. Ironie du
sort ou Raison de l’Histoire, Li Wenliang n’était pas virologue mais
ophtalmologue, chargé de traiter les maladies de l’œil.
Viennent ensuite les images formulaires, médiatiques et
officielles, les plans moyens et les plans rapprochés : des gens sans ou
avec masques dans la rue, des représentants anonymes de l’État qui
symbolisent leur fonction (soignants, policiers, pompiers, militaires,
etc.), le cortège des officiels négligents et des officiels diligents,
discourant sur des estrades, devant les baches vert kaki de l’hôpital
militaire de Mulhouse ou, plus classique, les grands dirigeants à leur
bureau : Macron à l’Élysée, Merkel avec une fenêtre donnant sur le
Bundestag, Trump dans le bureau ovale, la reine d’Angletterre à
Buckingham Palace.
Concluons cette taxinomie par les plans d’ensemble sur les
foules et les décors : il y eut d’abord les gens insouciants dans les
parcs puis les gens soucieux qui se ruent au supermarché, les rayons
pleins et vides, les champs plein de légumes mais vides de
saisonniers pour les récolter, des gens ou des banderoles à la fenêtre
ou au balcon de leurs immeubles, des rues de quartiers populaires
encore trop remplies et des rues vides de Paris, où circulent ces drones
policiers qui ordonnent de rentrer chez soi.
Une dernière image marquante, qui fut parmi les premières,
elle aussi filmée par un drone, semblait répondre par anticipation à
tous ces décors vides. C’était celle des pelleteuses de Wuhan qui ont,
littéralement et picturalement, fait sortir de terre un hôpital en dix
jours à peine. François Cheng, auteur d’un ouvrage sur la peinture
chinoise [4], ne renierait peut-être pas cette mise en scène du pouvoir,
ce paysage pittoresque du vide et du plein, de ces petites tâches
bariolées, orange, jaune, cyan, qui s’agitent sur un fond de terre ocre
marron. Quoi de mieux pour répondre à l’image microscopique du
virus, sinon l’image macroscopique d’un drone [5], planant sur une
fourmilière de machines ?
Territoire, sécurité, population, titrait l’un des cours de
Michel Foucault, les trois enfin contrôlés par le dispositif technique et
optique de la chasse à l’homme qui entend faire le vide : le drone
comme complément du microscope [6]. Tandis que disparaissent et
s’anonymisent les visages derrière les masques, se développent les
systèmes de « reconnaissance faciale », notamment en Chine [7] mais
également en France. Sous prétexte de répondre à l’attentat du
14 juillet 2016, un dispositif a été expérimenté à Nice pour le carnaval
de février 2019. La technologie était proposée par la société
israélienne, AnyVision, accusée de participer à la surveillance des
territoires palestiniens [8].
CAPSULES DE SUCRE
Sur Instagram, un hashtag (#covidartmuseum) regroupe des images à
prétention artistique. Elles ont toutes pour thème ou motif le virus et
le confinement. Nous pouvons les classer de la manière suivante.
Premièrement, nous comptons un majorité d’images relevant d’un
néo-pop art. Presque toutes représentent, soit la symbolisation
traditionnelle des virus : sphère et petites ventouses ; soit les trois
objets symboliques de la pandémie : le gant en latex, transparent ou
opaque, le rouleau de papier toilette et, enfin, le masque, parfois
remplacé par la combinaison intégrale. L’imagerie aseptisée d’un
pseudo art contemporain entre ici en adéquation avec l’imaginaire
clinique du moment.
Deuxièmement, cet attribut iconographique dominant
qu’est le masque sert à détourner des peintures emblématiques de
l’histoire de l’art, principalement des portraits : Mona Lisa avec
masque, Jeune fille à la perle avec masque, Bachus du Caravage avec
masque [9]. On attend encore le détournement, plus politique, du
tableau Le Balcon de Manet. Viennent pour finir des images qui
confondent l’art conceptuel et la publicité en proposant mille
variantes du mot d’ordre « Stay Home ». Nous reviennent alors ces
mots de Baudelaire : toutes ces images cherchent à se déguiser, à
s’envelopper « comme une médecine désagréable dans des capsules
de sucre [10] ».
L’ennui avec la plupart de ces images, c’est qu’elles sont
comme ces tableaux qui nous laissent indifférents dans les musées.
Nous regardons le cartel avant de regarder la toile pour vérifier que ce
qui est montré là, correspond bien à ce qui est écrit ici. C’est dire que
toutes ces images, médiatiques comme prétendument artistiques, ne
sont guère que des illustrations. Ce qui importe, c’est de reconnaître la
légende et la petite morale – des images périphériques, sous régime
langagier, qui nous tiennent lieu de réalité dans une croissance de
l’irréel. Nous baignons depuis longtemps dans l’ère des memes, des
images sous-titrées qui privilégient le message au travail du médium.
Ce ne sont donc pas des images, tout juste des métaphores,
de la rhétorique et des informations, un trop-plein viral
d’informations, car il est bien connu que « les gens manquent
(toujours et seulement) d’information ». Dans la mode actuelle de
désintox des fake-news, où les grands journaux s’inventent ministère
de la vérité [11], le gouvernement a, lui aussi, proposé un espace dédié
agrégeant les rubriques journalistiques de fact-checking, avant de le
retirer sous la pression de Syndicat national des journalistes
(SNJ) [12].
RHÉTORIQUE DU FAIT DIVERS
Interviewé durant le confinement, Jean-Luc Godard rappelait que le
« virus est une communication, il a besoin d’aller chez un autre,
comme certains oiseaux, pour y rentrer. Et donc, quand on envoie un
message sur un réseau, on a besoin de l’autre pour entrer chez
lui [13] . » Peut-être était-il difficile d’entendre quelqu’un d’aussi rétif à
la communication. L’idée et l’image étaient pourtant simples : le virus
actuel est aussi celui de l’information et de la « langue », que Godard
distingue du « langage », ce « mélange d’images et de paroles » dont le
cinéma se montre parfois capable grâce à sa technique.
L’actuelle pandémie opère comme un gigantesque fait
divers sur lequel toutes et tous nous pouvons communiquer. Pierre
Bourdieu avait cette formule : les faits divers font diversion. Ils ne
présentent jamais que des faits « omnibus », de nature à intéresser tout
le monde, sans choquer finalement personne, car ils sont, au fond,
sans enjeu, même s’il s’agit d’une question de vie ou de mort. Le fait
divers ne véhicule que des idées reçues, c’est-à-dire « des idées reçues
par tout le monde, banales, convenues, communes » mais aussi,
ajoutait Bourdieu, « des idées qui, quand vous les recevez, sont déjà
reçues, en sorte que le problème de la réception ne se pose pas [14] . »
Les images majoritaires dont nous disposons ne sont que
des clichés, recouverts par des légendes qui prescrivent ce qu’il y a à
voir, en montrant, écrivait Pierre Bourdieu, « ce qu’il faut montrer, mais
de telle manière qu’on ne le montre pas ou qu’on le rend insignifiant ».
En régime médiatique, concluait-il, « paradoxalement, le monde de
l’image est dominé par les mots [15] ». Si cette langue audiovisuelle
empêche de voir, c’est d’abord parce qu’elle contraint à la
reconnaissance d’étiquettes, posées sur les images, quand ces images
ne sont pas déjà des étiquettes insignifiantes, et quand ce ne sont pas
les mots qui dominent, ce seront les scénarios et leur texte
préfabriqué.
Dans une récente interview vidéo, Edwy Plenel évoquait le
travail de documentation journalistique comme recomposition d’un
« puzzle » d’informations, parfois déjà disponibles mais fragmentaires,
pour « former une image » qui fasse sens – ce que ne produit
évidemment pas le journalisme présentiste [16]. Qu’advient-il d’un
monde saturé d’informations, langagières ou iconographiques, mais
en manque d’images et de sens ? L’âge des mass-medias et des
réseaux sociaux nous a fait confondre images et informations :
images dont on se souvient parce qu’elles impressionnent notre
mémoire ; informations partielles que l’on enregistre et que l’on
diffuse pour mieux les oublier.
Comme la météo, notre bulletin journalier du virus est le
fait omnibus par excellence. Il fabrique un « problème de société » de
telle manière qu’il reste sans conséquence politique [17], sinon la
solution univoque et opportune que le pouvoir en place entend lui
apporter. Il est donc tout aussi logique que nous applaudissions toutes
et tous, tous les soirs à vingt heures, heure de cérémonial médiatique
s’il en est. Mais tout comme il était souhaitable de questionner Qui est
Charlie ? [18] après le 11 janvier 2015, il sera utile de s’interroger plus
tard : qu’applaudissions-nous ? Pourquoi battions-nous des mains
comme si, coûte que coûte, il fallait continuer d’émettre un
communiqué auquel tout le monde participe et que tout le monde peut
comprendre ?
LA GUERRE COMME SEUL IMAGINAIRE
À la place de véritables images, nous assistons donc à une inflation de
la langue, au déploiement d’un « arsenal » d’« éléments de langage »
qui sont autant de « gestes barrières » pour éviter de voir. Aux noms
presque littéraires des maladies infectieuses (peste, choléra, syphilis,
jusqu’au cancer et Ebola) a été préféré un nom de code : « SARS-CoV-
2 », simplifié en « Covid-19 » ou « coronavirus ». Rien n’entre dans ce
libellé, pas de rêverie onomastique, pas d’anthropomorphisme,
impossible de le psychologiser. En lui, la langue clinique se confond
avec la langue informatique et la langue administrative.
On comprend alors qu’à cet intitulé de formulaire
bureaucratique, la réponse de l’État soit, elle aussi, de produire des
artefacts dignes d’un roman de Kafka : l’« attestation de déplacement
dérogatoire » et la « distanciation sociale » qui renverse, au profit du
pouvoir, le principe brechtien de prise de distance avec la réalité, pour
la rendre insolite, étrange, et susciter la prise de conscience politique
du spectateur [19].
La souveraineté de la langue et de l’écriture autorisées se
déploie donc dans les consignes sanitaires, les déclarations officielles
des gouvernements et le fétichisme actuel pour les courbes, les cartes
de la contagion, leur code couleur d’école élémentaire, et la litanie
journalière du décompte des morts. Il y a bien des tribunes, des
articles qui se multiplient, çà et là. Mais, comme nous-mêmes, ils
peinent à analyser quoi que ce soit, sinon du virtuel : du virtuel passé
(ce qu’il aurait fallu faire), du virtuel présent (ce qu’il faudrait faire) ou
du virtuel futur (ce qu’il faudra faire).
À cette rhétorique de la simulation, du falloir, du besoin, du
défaut et du manque, répond celle massive de la guerre, classique
dans le vocabulaire médical depuis la fin du xixe siècle. « Nous
sommes en guerre » psalmodiait Macron, nous y sommes parce qu’il
faut bien combler le vide et découper en « séquences » le temps de ce
virus qui dure patiemment. Il faut bien produire du storytelling pour
occuper le temps de cerveau disponible des citoyens, leur faire jouer
un scénario préfabriqué et continuer à faire nation sous l’égide de
l’État.
Celui-ci trahit au passage la pauvreté de son imaginaire : sa
manière d’envisager ultimement son pouvoir comme bio-nécro-
pouvoir militaire et sa relation avec les citoyens comme ennemis de
l’intérieur ou bons citoyens-travailleurs. Le préfet de Paris faisait la
« corrélation très simple » entre les personnes hospitalisées en
réanimation et ceux qui n’avaient pas respecté le confinement [20]. Il
n’y a pas de « dérapage » de la part du Préfet mais une droite ligne,
rhétorique et idéologique, qui le relie à l’anaphore du Président.
Car si « nous sommes en guerre », il y a logiquement des
alliés et des ennemis à qui l’on peut continuer de dire : « nous ne
sommes pas dans le même camp » – propos précédant l’épidémie du
même préfet à l’adresse d’une manifestante gilet jaune –, plus encore
lorsqu’il s’agit des « territoires perdus de la République », une
expression aux accents néo-colonialistes désignant les quartiers
populaires et récemment reprise par un syndicat policier, déjà prêt au
changement de régime et à la guerre de reconquête [21].
Sans surprise, la métaphore militaire, appliquée à une
épidémie, a vocation à justifier le pouvoir autoritaire, sa répression, sa
violence et ses dispositifs de surveillance, elle a vocation à légitimer
les réformes néo-libérales qui-doivent-se-poursuivre, même si, pour
cela, elles devront travestir des mesures d’inspiration socialiste pour
la relance économique [22]. Susan Sontag concluait ainsi son ouvrage,
La maladie comme métaphore : « À propos de cette métaphore, la
militaire, je dirais, pour paraphraser Lucrèce : Que les faiseurs de
guerre la gardent [23] . »
SPECTATOR IN FABULA
Venu d’ailleurs, le virus s’est désormais intégré à la société française
et à ses clichés. Il n’est plus une maladie de l’autre-que-soi, animal ou
étranger, il est devenu une maladie de l’entre-soi et du chez-soi. Il
passe donc sous nos images, se propage selon le principe du
snatching, à travers des porteurs sains, sans symptômes apparents
qui les distingueraient. Le virus est une altérité qui s’assimile au
semblable et passe finalement inaperçue. En anglais, la réponse
médicale à ce problème s’appelle le screening [24], synonyme de la
projection d’un film. Deleuze, toujours, écrivait que ce « n’est pas nous
qui faisons du cinéma, c’est le monde qui nous apparaît comme un
mauvais film [25] . » Nombreux sont celles et ceux qui l’auront noté, le
mauvais film actuel que nous nous projettons est un remake du très
bon Dawn of the Dead (1978) de George Romero.
Notre anti-modèle du virus, rhizomatique et
cinématographique, est donc celui du zombie, couplé à celui du body
snatcher, ces plantes venues d’outre-espace qui prennent apparence
humaine dans Invasion of the body snatchers de Don Siegel (1956).
Confinés comme les personnages du film, notre seul imaginaire
semble devoir être celui régressif du supermarché et de la société de
consommation, médiatisés par l’économie numérique
dématérialisée [26]. Comment nous différencier des zombies au
dehors, si nous sommes entrés dans un devenir-zombie au dedans ?
Deleuze ajoutait : « on se demande ce qui maintient un ensemble dans
ce monde sans totalité ni enchaînement. La réponse est simple : ce qui
fait l’ensemble, ce sont les clichés, et rien d’autre [27]. »
Godard complétait un peu plus tard dans son interview :
« Ça me dépasse… Ou quel est l’envers du mot dépasser ? Ça me
soustrait. » Pas d’image juste, ni juste des images, seulement une
soustraction des images qui nous soustrait à la réalité et à nous-
mêmes. L’une des seules véritables images du virus, celle de sacs
mortuaires noirs, entassés dans une pièce, était une fake-news : le
montage d’une séquence montrant des morts emballés à Guayaquil en
Équateur, entrecoupée du décor extérieur d’un hôpital new-
yorkais [28].
Du virus, il n’existe donc pour le moment que des images
soustraites, minoritaires et fragmentaires : celles des hospitaliers
habillés de sacs poubelles, celles des cercueils de la morgue de Rungis,
celles de morts couchés par terre dans les rues de Wuhan, celles des
prisonniers mutins en Italie, celles des contrôles policiers « musclés »
qui se poursuivent en France, des quartiers populaires, jusqu’aux
manifestations éparses du 1er mai.
Peut-être les images viendront-elles plus tard ? Tandis
qu’est envisagé un renforcement de notre société de contrôle par le
« traçage numérique » des malades [29], il se dit actuellement que nos
officiels passent beaucoup par l’oral, qu’ils restreignent les traces
numériques de leur communication dans la crainte de futurs
procès [30]. Ces procès feront-ils image, radicaliseront-ils le rapport de
l’image à la réalité, ressusciteront-ils image et évènement, quand on
sait que le procès est un haut-lieu de mise en scène de la langue et de
dépolitisation des conflits ?
BE KIND REWIND
Socialement, les virus n’intègrent donc pas nos catégories ; ils se
calquent sur elles et ils font apparaître ces lunettes à travers
lesquelles nous voyons le monde. Si une image parvient à se dresser
après coup, peut-être s’agira-t-il d’un reflet dans le miroir du virus ?
Peut-être s’agira-t-il d’un flasback qui rembobine le film ? Au début de
l’actuelle épidémie, nous pouvions encore nous rattacher à un
imaginaire exotique de la maladie, venue d’abord d’un étranger,
animal et sauvage (chauve-souris, pangolins et autre gremlins), puis
de l’étranger (chinois). Spécisme, puis xénophobie. Nous pouvions
encore croire à une conception séculaire de notre civilisation
européenne, censée être immunisée contre ces pandémies barbares.
Nous pouvions encore croire que de telles calamités n’arrivent qu’aux
autres, n’ont lieu qu’ailleurs, dans les pays d’Afrique ou d’Asie.
Spoiler alert : Quand la calamité partira ou retournera là-
bas, nous lui redeviendrons probablement indifférents, car nous
croirons qu’elle fut, pour nous, productrice d’Histoire (du meilleur
comme du pire), tandis que là-bas elle serait censée s’intégrer à un
cycle qui en fait un aspect de la nature [31]. Spécisme, xénophobie puis
néo-colonialisme. Mais n’avançons pas trop vite et reprenons le fil de
notre retour en arrière. Tandis que la menace ne faisait que se
rapprocher, nous pouvions encore croire aux conspirations (l’accident
dans le laboratoire de virologie de Wuhan et un scénario à la Resident
Evil). Il était encore possible de pointer d’imaginaires agents
infectieux (notre population franco-asiatique). Il était encore possible
de mener l’enquête pour remonter aux origines d’un mythique
« patient zéro » (militaire, agent secret, hôtesse de l’air,
évangélistes ? [32]).
Depuis que le virus s’est intégré à la société française, le
seul réflexe xénophobique profond qui nous reste est la basse logique
du délateur, celle du nanti bon citoyen qui pointe les quartiers
populaires désobéissants pour inviter la police à les discipliner ou
celle du corbeau qui envoie ses lettres anonymes aux soignants pour
les inviter à s’ostraciser. On pense alors au film emblématique de la
France de Vichy : Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot (1943) et au rap
éponyme des Svinkels. Spécisme, racisme, néo-colonialisme puis
classisme et endophobie.
Le virus qui nous assaille est aussi bien le virus de
l’information, de l’économie numérique néo-capitaliste, des sociétés et
des technologies de contrôle, de la privatisation néo-libérale de la
santé, etc. En manque d’images, nous souviendrons-nous de tout
cela ? Pour l’instant, de cette période de pandémie et de confinement,
restent et resteront ces images majoritaires, ces clichés dignes des
manuels scolaires (du futur) : des images anonymes de visages
masqués et des images omniscientes de drones qui filment les rues
pour les évider et y répéter en bons policiers : « Circulez, y’a rien à
voir ». Faites circuler les images majoritaires, faites circuler, avec et
sur elles, l’information virale, il n’y a rien à voir, sinon les clichés d’un
mauvais film de zombies et de corps snatchés, filmés par des drones.
S’agira-t-il aussi des images de nos luttes futures ? Wait and see.
Léo Pinguet
[1] Image diffusée sur le compte Twitter de l’Inserm, 24 mars 2020.
[2] Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 17-18.
[3] Gilles Deleuze, L’Image-mouvement, Paris, Minuit, 1983, p. 281-282.
[4] François Cheng, Vide et plein : le langage pictural chinois, Paris, Seuil, 1991.
[5] Grégoire Chamayou, Théorie du drone, Paris, La Fabrique, 2013.
[6] Michel Foucault, Territoire, sécurité, population : cours au Collège de France, 1977-
1978, Paris, Seuil, 2004.
[7] Yann Moulier-Boutang & Monique Selim, « Leçons virales de Chine », Multitudes,
n° 78, 2020/1, p. 9-19.
[8] LDH Nice, « La reconnaissance faciale, ce sont les hommes du xixe siècle qui en
parlent le mieux », Technopolice, 15 novembre 2019.
[9] Le Getty Museum, situé à Los Angeles, a proposé dernièrement un exercice similaire
(#GettyMuseumChallenge) : recréer chez soi une œuvre d’art célèbre avec des objets du
quotidien.
[10] Charles Baudelaire, Salon de 1859 in Critique d’art, Paris, Gallimard, 1976, p. 274.
[11] Frédéric Lordon, « Macron décodeur-en-chef », La pompe à phynance, 8 janvier
2018 ; « Charlot ministre de la vérité », La pompe à phynance, 22 février 2017.
[12] « Le gouvernement supprime sa page controversée « désinfox coronavirus », Le
Monde, 5 mai 2020.
[13] Jacques Morice, « Jean-Luc Godard, superstar des réseaux sociaux le temps d’un
live sur Instagram », Télérama, 8 avril 2020.
[14] Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Paris, Raisons d’Agir, 1996, p. 30 (nous soulignons).
[15] Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Paris, Raisons d’Agir, 1996, p. 18-19.
[16] Edwy Plenel, « Masques, le fiasco d’État ? », Brut, 14 avril 2020.
[17] Eric Hazan, LQR La propagande du quotidien, Paris, Raisons d’Agir, 2006, p. 14 :
« Auparavant [avant les années 1960], on parlait plutôt de « question » (la question
d’Orient, la question sociale…). La substitution n’était évidemment pas neutre. À une
question, les réponses possibles sont souvent multiples et contradictoires alors qu’un
problème, surtout posé en termes chiffrés, n’admet en général qu’une solution et une
seule. »
[18] Emmanuel Todd, Qui est Charlie ? Sociologie d’une crise religieuse, Paris, Seuil, 2015.
[19] Giorgio Agamben, « Distanciation sociale », Lundi matin, 13 avril 2020.
[20] Nicolas Chapuis, « Le préfet de police Didier Lallement contraint de s’excuser après
un dérapage sur les malades du Covid-19 », Le Monde, 3 avril 2020.
[21] Anaïs Condomines, « Non, cette vidéo partagée par un syndicat de policiers n’a pas
été tournée pendant le confinement », Libération, 26 mars 2020 ; Emmnuel Brenner
(dir.), Les Territoires perdus de la République, Paris, Mille et une nuits, 2002.
[22] David Harvey, « Covid-19 : où va le capitalisme ? Une analyse marxiste »,
Contretemps, 7 avril 2020.
[23] Susan Sontag, La Maladie comme métaphore. Le sida et ses métaphores [1977-1988],
trad. Marie-France de Paloméa & Brice Matthieussent, Paris, Christian Bourgois, 1989-
2009, p. 232.
[24] La traduction française de ce terme est « dépistage ».
[25] Gilles Deleuze, L’Image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 223.
[26] Razming Keucheyan, Les Besoins artificiels : comment sortir du consumérisme,
Paris, La Découverte, 2019.
[27] Gilles Deleuze, L’Image-mouvement, op. cit., p. 281.
[28] Fabien Leboucq, « Cette vidéo d’un homme marchant sur des sacs mortuaires a-t-
elle été filmée dans un hôpital new-yorkais ? », Libération, 4 avril 2020.
[29]
Félix Tréguer, « Le solutionnisme technologique restreint complètement nos
imaginaires politiques », Lundi matin, 20 avril 2020.
[30] Nous n’avons pas pu retracer la source exacte de cette rumeur sinon qu’il s’agit des
propos d’un intervenant sur LCI dans une émission présentée par Olivier Galzi autour
du 11 avril 2020.
[31] Nous paraphrasons Susan Sontag, La maladie comme métaphore, op. cit., p. 176.
[32] Raphaëlle Bacqué & Ariane Chemin, « Coronavirus : militaire, agent secret ou
hôtesse de l’air ? La France sur la piste de son « patient zéro », Le Monde, 10 avril 2020
(les auteures sont spécialistes du genre).
Vous aimerez peut-être aussi
- BOISSIÈRE, Anne. Le Mouvement Expressif Dansé Erwin Straus, Walter BenjaminDocument33 pagesBOISSIÈRE, Anne. Le Mouvement Expressif Dansé Erwin Straus, Walter Benjaminjosé macedoPas encore d'évaluation
- Modernités de Bouvard Et Pécuchet, Borges, QueneauDocument10 pagesModernités de Bouvard Et Pécuchet, Borges, Queneaujosé macedoPas encore d'évaluation
- Le Bonheur Au Xviiie Siècle - Il y A Un Demi-Siècle Michel Delon Presses Universitaires de RennesDocument7 pagesLe Bonheur Au Xviiie Siècle - Il y A Un Demi-Siècle Michel Delon Presses Universitaires de Rennesjosé macedoPas encore d'évaluation
- Michael Fried Et Jacques Neefs Intensités Esthétiques Flaubert Et Quelques-Uns de Ses ContemporainsDocument13 pagesMichael Fried Et Jacques Neefs Intensités Esthétiques Flaubert Et Quelques-Uns de Ses Contemporainsjosé macedoPas encore d'évaluation
- Le Bonheur Au Xviiie Siècle - Qu'écrire Sur Le Bonheur Au Xviiie Siècle Après Robert Mauzi - Presses Universitaires de RennesDocument21 pagesLe Bonheur Au Xviiie Siècle - Qu'écrire Sur Le Bonheur Au Xviiie Siècle Après Robert Mauzi - Presses Universitaires de Rennesjosé macedoPas encore d'évaluation
- Bergson Ou L'humanité Créatrice - Ouverture - CNRS ÉditionsDocument8 pagesBergson Ou L'humanité Créatrice - Ouverture - CNRS Éditionsjosé macedoPas encore d'évaluation
- Mayotte Bollack Momen Mutatum (La Déviation Et Le Plaisir, Lucrèce, II, 184-293)Document52 pagesMayotte Bollack Momen Mutatum (La Déviation Et Le Plaisir, Lucrèce, II, 184-293)josé macedoPas encore d'évaluation
- L Idiot Et La Tache de La Philosophie MoDocument16 pagesL Idiot Et La Tache de La Philosophie Mojosé macedoPas encore d'évaluation
- Sven Lindqvist, Une Histoire Du Bombardement ResenhaDocument3 pagesSven Lindqvist, Une Histoire Du Bombardement Resenhajosé macedoPas encore d'évaluation
- ENJEUX PRAGMATIQUES ET SÉMIOTIQUES DE L'ÉTUDE DES ÉMOTICÔNES Pierre HaltéDocument26 pagesENJEUX PRAGMATIQUES ET SÉMIOTIQUES DE L'ÉTUDE DES ÉMOTICÔNES Pierre Haltéjosé macedoPas encore d'évaluation
- De La Scene de Crime A La Scene de ProceDocument17 pagesDe La Scene de Crime A La Scene de Procejosé macedoPas encore d'évaluation
- Johann Chapoutot Panique Écologique Et Quête Nazi de L'espace Vital Sont Légitimement ComparablesDocument4 pagesJohann Chapoutot Panique Écologique Et Quête Nazi de L'espace Vital Sont Légitimement Comparablesjosé macedoPas encore d'évaluation
- Gaïa N'est-Elle Qu'un Thermostat Sur La Lecture de James Lovelock Par Bruno Latour Paul-Antoine MiquelDocument18 pagesGaïa N'est-Elle Qu'un Thermostat Sur La Lecture de James Lovelock Par Bruno Latour Paul-Antoine Miqueljosé macedoPas encore d'évaluation
- Agnes Giard Des Hommes Et Des Femmes SeDocument4 pagesAgnes Giard Des Hommes Et Des Femmes Sejosé macedoPas encore d'évaluation
- LHommeAMangeLaTerre DPDocument7 pagesLHommeAMangeLaTerre DPjosé macedoPas encore d'évaluation
- Les Robots Sexuels Entre Fantasme Et ReaDocument8 pagesLes Robots Sexuels Entre Fantasme Et Reajosé macedoPas encore d'évaluation
- D'un Renouvellement de La Manière de Philosopher Entretien Avec Didier Debaise Et Pierre MontebelloDocument4 pagesD'un Renouvellement de La Manière de Philosopher Entretien Avec Didier Debaise Et Pierre Montebellojosé macedoPas encore d'évaluation
- Jean-Clet MartinDocument2 pagesJean-Clet Martinjosé macedoPas encore d'évaluation
- La Mauvaise Saison Game of Thrones, Ou La Guerre Des Images Potte-BonnevilleDocument13 pagesLa Mauvaise Saison Game of Thrones, Ou La Guerre Des Images Potte-Bonnevillejosé macedoPas encore d'évaluation
- La Vraie Mise en Garde de La Shoah Timothy SnyderDocument4 pagesLa Vraie Mise en Garde de La Shoah Timothy Snyderjosé macedoPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Marielle Macé Ma Colère Veut Aller Vers Plus D'amour de La Vie, de La Vie CollectiveDocument11 pagesEntretien Avec Marielle Macé Ma Colère Veut Aller Vers Plus D'amour de La Vie, de La Vie Collectivejosé macedoPas encore d'évaluation
- Marielle Macé, Raphaël Baroni La Lecture, Les Formes Et La Vie EntretienDocument17 pagesMarielle Macé, Raphaël Baroni La Lecture, Les Formes Et La Vie Entretienjosé macedoPas encore d'évaluation
- JP10 ADL Intro - PDFDocument7 pagesJP10 ADL Intro - PDFjosé macedoPas encore d'évaluation
- Pouvoirs de La Fiction Sur Une Scène de Game of ThronesDocument7 pagesPouvoirs de La Fiction Sur Une Scène de Game of Thronesjosé macedoPas encore d'évaluation
- Xavier Guchet Médecine Personnalisée Versus Médecine de La PersonneDocument14 pagesXavier Guchet Médecine Personnalisée Versus Médecine de La Personnejosé macedoPas encore d'évaluation
- Jean-Hugues Barthélémy Et Vincent Bontems Philosophie - de - La - Nature - Et - ArtefactDocument11 pagesJean-Hugues Barthélémy Et Vincent Bontems Philosophie - de - La - Nature - Et - Artefactjosé macedoPas encore d'évaluation
- Xavier Guchet Objet Versus Artefact. Pour Une Philosophie Des Techniques Orientée-ObjetDocument35 pagesXavier Guchet Objet Versus Artefact. Pour Une Philosophie Des Techniques Orientée-Objetjosé macedoPas encore d'évaluation
- Anne FAGOT-LARGEAULT ONTOLOGIE DU DEVENIR I 1 LE DEVENIR IMPENSABLE UN PROBLEME AUSSI VIEUX QUE LA PHILOSOPHIEDocument2 pagesAnne FAGOT-LARGEAULT ONTOLOGIE DU DEVENIR I 1 LE DEVENIR IMPENSABLE UN PROBLEME AUSSI VIEUX QUE LA PHILOSOPHIEjosé macedoPas encore d'évaluation
- Xavier Guchet Les Sens de L Évolution TechniqueDocument22 pagesXavier Guchet Les Sens de L Évolution Techniquejosé macedoPas encore d'évaluation
- Arnaud François L'influence Du Bergsonisme Sur La Philosophie Japonaise Les Cas de Nishida Et KukiDocument17 pagesArnaud François L'influence Du Bergsonisme Sur La Philosophie Japonaise Les Cas de Nishida Et Kukijosé macedoPas encore d'évaluation
- Pierre Bourdieu - Le Champ Scientifique PDFDocument21 pagesPierre Bourdieu - Le Champ Scientifique PDFFábio Ramos Barbosa FilhoPas encore d'évaluation
- Vigour La Comparaison Dans Les Sciences SocialesDocument14 pagesVigour La Comparaison Dans Les Sciences SocialesMounir MezzPas encore d'évaluation
- BOURDIEU Et WACQUANT (1992) Ficha. RéponsesDocument5 pagesBOURDIEU Et WACQUANT (1992) Ficha. RéponsesAndrés AntillanoPas encore d'évaluation
- Eliséo Véron, Martine Levasseur Ethnographie de Lexposition Lespace, Le Corps Et Le Sens PDFDocument179 pagesEliséo Véron, Martine Levasseur Ethnographie de Lexposition Lespace, Le Corps Et Le Sens PDFVinicius Noronha100% (1)
- UntitledDocument41 pagesUntitledPaula DiegoPas encore d'évaluation
- Sartre PolygrapheDocument51 pagesSartre PolygrapheEliana CaladoPas encore d'évaluation
- Sociologie Du DroitDocument3 pagesSociologie Du DroitAGBEMADI100% (1)
- Fiche 1 - Comment Analyser La Structure Sociale - Les Analyses Théoriques Des ClassesDocument11 pagesFiche 1 - Comment Analyser La Structure Sociale - Les Analyses Théoriques Des ClassesMme et Mr Lafon100% (1)
- Bloch HDRDocument123 pagesBloch HDRAhlem AchourPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Le Droit Dans La Régulation Sociale Cairn - InfoDocument30 pagesChapitre 1 - Le Droit Dans La Régulation Sociale Cairn - Infojeanbulalu0303Pas encore d'évaluation
- OCPPC-Mutations - Politiques - Comparées - Au - Maghreb - 7ans - Après - Le - Printemps - Arabe-2018 (Web)Document316 pagesOCPPC-Mutations - Politiques - Comparées - Au - Maghreb - 7ans - Après - Le - Printemps - Arabe-2018 (Web)Post FatumPas encore d'évaluation
- Boltanski - Les Cités Et Les Mondes de Luc Boltanski PDFDocument28 pagesBoltanski - Les Cités Et Les Mondes de Luc Boltanski PDFmiquelfm82Pas encore d'évaluation
- Apprendre À AimerDocument6 pagesApprendre À Aimermitul KamalPas encore d'évaluation
- Chapitre 4-Comment Expliquer La Mobilite Sociale-Activit SDocument7 pagesChapitre 4-Comment Expliquer La Mobilite Sociale-Activit SRafanomezantsoaPas encore d'évaluation
- Bourdieu Et Art ContemporainDocument5 pagesBourdieu Et Art ContemporainGKF1789Pas encore d'évaluation
- Cours de Sociologie Rurale IPR IFRADocument34 pagesCours de Sociologie Rurale IPR IFRAoumar baba92% (25)
- Bourdieu, de Saint-Martin - Le PatronatDocument86 pagesBourdieu, de Saint-Martin - Le PatronatEdy-Claude Okalla BanaPas encore d'évaluation
- Cours Complets de Sciences PolDocument101 pagesCours Complets de Sciences PolMCPas encore d'évaluation
- Theme 1 PDFDocument19 pagesTheme 1 PDFEsther NaomiPas encore d'évaluation
- CM Paradigmes SociologiquesDocument17 pagesCM Paradigmes SociologiquesKing IñigoPas encore d'évaluation
- La+Langue+Francaise+ +Un+Usage+Genré+ +Ophelie+WattierDocument92 pagesLa+Langue+Francaise+ +Un+Usage+Genré+ +Ophelie+WattierCarlacplPas encore d'évaluation
- DEZALAY, Les Courtiers de L'internationalDocument33 pagesDEZALAY, Les Courtiers de L'internationalLuan BrumPas encore d'évaluation
- Thèse de DoctoratDocument351 pagesThèse de DoctoratSaïd MendassiPas encore d'évaluation
- Muriel Darmon Classes PréparatoiresDocument3 pagesMuriel Darmon Classes PréparatoiresEsther wanying176Pas encore d'évaluation
- Article Arss 0335-5322 2002 Num 141 1 2813Document5 pagesArticle Arss 0335-5322 2002 Num 141 1 2813bercer7787Pas encore d'évaluation
- BourdieuDocument16 pagesBourdieuMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Le Langage Et La Langue Chez Pierre BourdieuDocument5 pagesLe Langage Et La Langue Chez Pierre BourdieuSimon MarsanPas encore d'évaluation
- Neutralité Axiologique, Science Et EngagementDocument6 pagesNeutralité Axiologique, Science Et Engagementel fatehy boujemaaPas encore d'évaluation
- UPL7695956174861787556 Classe de Premiere Chapitre 6Document72 pagesUPL7695956174861787556 Classe de Premiere Chapitre 6berenger BGXPas encore d'évaluation
- La Sociologie de La FamilleDocument32 pagesLa Sociologie de La Familleel bakkali OmarPas encore d'évaluation