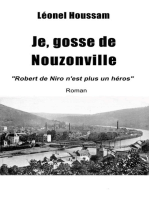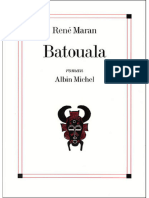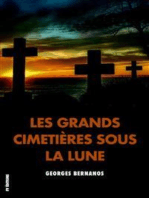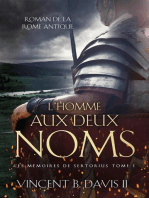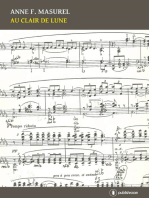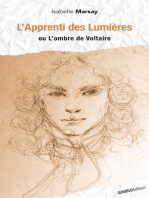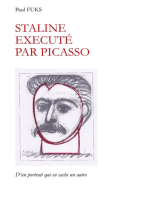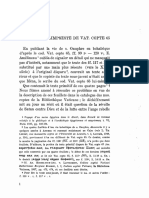Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Winston Churchill
Transféré par
La Marseillaise0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
9 vues4 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
9 vues4 pagesWinston Churchill
Transféré par
La MarseillaiseDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
«Winston, sommes-nous toujours à la tête du
monde ?»
Par WINSTON CHURCHILL ancien Premier ministre du Royaume-Uni (1874-1965)
C’était un après-midi brumeux de novembre 1947, et je peignais à Chartwell, dans l’atelier du
cottage en bas de la colline. Quelqu’un m’avait envoyé un portrait de mon père peint pour un des
clubs conservateurs de Belfast au moment de sa visite dans l’Ulster lors de la crise du Home Rule
de 1886. La toile était méchamment déchirée et, bien que j’hésite toujours à peindre des visages, je
décidai d’essayer d’en faire une copie. Mon chevalet était éclairé par une lampe puissante
reproduisant la lumière naturelle, ce qui est indispensable pour peindre à l’intérieur pendant l’hiver
britannique. A sa droite se trouvait le portrait dont je faisais la copie, et derrière moi un grand miroir
permettait d’examiner le portrait à l’envers. J’avais dû peindre pendant une heure et demie et j’étais
profondément concentré sur mon sujet. Je dessinais le visage de mon père en regardant le portrait et
en me tournant souvent sur la droite pour vérifier mes progrès dans le miroir. J’étais très absorbé par
mon travail et mon esprit était libre de toute autre pensée que celle de ce visage aimé et respecté que
je voyais tantôt sur la toile, tantôt sur le portrait, tantôt dans le miroir.
Je venais d’essayer de rendre le mouvement de sa moustache quand j’eus soudain un sentiment
étrange. Je me retournai avec ma palette à la main et là, assis dans mon fauteuil en cuir rouge, se
trouvait mon père. Il ressemblait tout à fait à l’homme que j’avais vu à sa grande époque, à celui
dont j’avais lu tant de récits pendant son année de gloire. Il était petit et mince, avec la grande
moustache que je venais de peindre, et son air intelligent, séduisant et vif. Ses yeux cillaient et
brillaient. Il était manifestement de très bonne humeur, occupé à remplir son porte-cigarettes en
ambre avec un petit bout de coton avant d’y mettre sa cigarette. Ceci était destiné à arrêter la
nicotine, dont on pensait alors qu’elle pouvait avoir des effets néfastes. Il correspondait si
exactement aux souvenirs les plus charmants que j’avais de lui que j’avais du mal à en croire mes
yeux. Je n’avais pas peur, mais je pensais que je devais rester là où je me trouvais sans m’approcher
plus.
Papa ! dis-je.
- Que fais-tu, Winston ?
- J’essayais de copier votre portrait, celui qui a été fait quand vous êtes allé dans l’Ulster en 1886.
- Je ne l’aurais jamais cru, dit-il.
- Je fais cela seulement pour mon plaisir, répondis-je.
- Bien sûr, tu ne pourrais jamais gagner ta vie de cette façon.
Il y eut une pause.
- Dis-moi, reprit-il, quelle année sommes-nous ?
- 1947.
- De l’ère chrétienne, j’imagine ?
- Oui, c’est encore ainsi que l’on compte.
- Je ne me souviens de rien après 1894. J’ai été très perturbé cette année-là… Donc plus de
cinquante ans ont passé. Beaucoup de choses ont dû se produire.
- Beaucoup, Papa.
- Raconte-moi.
(...)
- La guerre ? dit-il, en se redressant avec un air stupéfait. La guerre, dis-tu ? Il y a donc eu une
guerre ?
- Nous n’avons eu que cela depuis que la démocratie s’est installée.
- Tu veux dire de vraies guerres, pas seulement des expéditions aux frontières ? Des guerres où des
dizaines de milliers d’hommes perdent la vie ?
- Oui, Papa. C’est ce qui s’est produit sans interruption. Des guerres et l’attente d’autres guerres
depuis que vous êtes mort.
- Raconte-moi.
- Il y a d’abord eu la guerre des Boers.
- Ah ! J’aurais arrêté celle-là. Je n’ai jamais été d’accord avec la formule «Vengez Majuba». Il ne
faut jamais prendre de revanche sur rien, surtout si l’on a le pouvoir de le faire. Je me suis toujours
méfié de Joe.
- Vous voulez dire monsieur Chamberlain ?
- Oui. Il n’y a qu’un seul Joe, ou en tout cas un seul dont j’ai entendu parler. Un radical devenu
chauvin est quelqu’un de dangereux. Mais que s’est-il passé dans la guerre des Boers ?
- Nous avons conquis le Transvaal et l’Etat libre d’Orange.
- L’Angleterre n’aurait jamais dû faire cela. S’attaquer à deux républiques indépendantes a dû
diminuer notre position dans le monde. Cela a sûrement remué toutes sortes de choses. Je suis sûr
que les Boers se sont bien battus. Quand j’ai été là-bas, j’en ai vu un grand nombre. Des hommes de
la nature, avec des fusils, et à cheval. On a dû avoir besoin de beaucoup de soldats. Combien ?
Quarante mille ?
- Non. Plus de deux cent cinquante mille.
- Dieu du Ciel ! Quelle effroyable dépense pour le Trésor !
- Les impôts ont augmenté.
Il était visiblement troublé. Je l’ai donc rassuré en lui disant qu’ils avaient fini par baisser.
- Quel général a battu les Boers ? demanda-t-il.
- Lord Roberts, répondis-je.
- J’ai toujours cru en lui. Je l’avais nommé commandant en chef en Inde quand j’étais ministre.
C’était l’année où j’ai annexé la Birmanie. L’endroit était complètement anarchique. Ils se
contentaient de se massacrer. Nous avons dû intervenir, et très vite il y eut un gouvernement civilisé
sous le contrôle de la Chambre des Communes. (...)
- Mais dis m’en un peu plus sur ces guerres.
- Ce furent des guerres entre nations, causées par des démagogues et des tyrans.
- On les a gagnées ?
- Oui, on a gagné toutes nos guerres. Nos ennemis ont tous été battus. On les a même obligés à se
rendre de façon inconditionnelle.
- On ne doit faire cela à personne. Les grands peuples oublient les souffrances, mais pas les
humiliations.
- Cela s’est passé ainsi, Papa.
- Où nous sommes-nous retrouvés après tout cela ? Sommes-nous toujours à la tête du monde,
comme du temps de la reine Victoria ?
- Non, le monde est devenu beaucoup plus grand autour de nous.
- Quelle est donc la plus grande puissance aujourd’hui ?
- Les Etats-Unis.
- Cela ne me dérange pas. Tu es toi-même à moitié américain. Ta mère était la plus belle femme que
la terre ait portée. Les Jerome étaient une famille américaine d’excellente origine.
- J’ai toujours travaillé à maintenir l’amitié avec les Etats-Unis et d’ailleurs avec l’ensemble du
monde anglophone.
- Le monde anglophone, répéta-t-il, tu veux dire le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et tous
ces pays-là ?
- Oui, tous ces pays.
- Sont-ils toujours loyaux ?
- Ce sont nos frères.
- Et l’Inde, est-ce que cela va bien de ce côté ? Et la Birmanie ?
- Hélas ! On les a perdues.
Il poussa une sorte de gémissement.
(...)
- Ces guerres, celles qui ont suivi la guerre des Boers, qu’est-il arrivé aux grands Etats européens ?
Le danger vient-il toujours de la Russie ?
- Nous sommes tous très inquiets à son sujet.
- On l’a toujours été de nos jours, et du temps de Dizzy avant moi. Y a-t-il toujours un tsar ?
- Oui, mais ce n’est pas un Romanoff. C’est une autre famille. Il est beaucoup plus puissant, et
beaucoup plus despotique.
- Et l’Allemagne ? Et la France ?
- Elles sont toutes deux brisées. Leur seul espoir est de se relever ensemble.
- Je me souviens, dit-il, de t’avoir emmené place de la Concorde quand tu avais seulement 9 ans, et
tu m’as posé une question sur le monument de Strasbourg. Tu voulais savoir pourquoi il était
couvert de fleurs et de crêpe noir. Je t’ai parlé des provinces perdues de la France. Quel drapeau
flotte sur Strasbourg maintenant ?
- Le drapeau tricolore.
- Ils ont donc gagné. Ils ont eu leur revanche. Ce dut être un grand triomphe pour eux.
- Ils l’ont payé de leur sang, dis-je.
- Des guerres comme celles-là ont dû coûter un million de vies. Elles ont dû être aussi sanglantes
que la guerre civile américaine.
- Papa, dis-je, dans chacune d’elles près de trente millions d’hommes furent tués sur le champ de
bataille. Pendant la dernière guerre sept millions ont été assassinés de sang-froid, surtout par les
Allemands. Ils ont construit pour des êtres humains des abattoirs comme ceux que l’on trouve à
Chicago. L’Europe est une ruine. Un grand nombre de ses villes ont été réduites en pièces par les
bombes. Dix capitales en Europe orientale sont entre les mains des Russes. Elles sont communistes
maintenant. Vous savez, Karl Marx et tout cela. Il se pourrait qu’une guerre encore pire se prépare.
Une guerre de l’Est contre l’Ouest. Une guerre de la civilisation libérale contre les hordes
mongoles. Le monde de la reine Victoria avec son ordre et son équilibre est bien fini. Mais après
avoir traversé tout cela, nous ne sommes pas désespérés.
Il semblait interdit, et tripota sa boîte d’allumettes pendant environ une minute. Puis il dit :
- Winston, tu m’as dit des choses terribles. Je n’aurais jamais cru que de telles horreurs puissent se
produire. Je suis heureux de ne pas avoir vécu pour les voir. A t’écouter me raconter ces histoires
effrayantes, tu donnes l’impression de très bien les connaître. Je n’aurais jamais pensé que tu
évoluerais aussi bien. Bien sûr, tu es trop vieux maintenant pour y songer, mais quand je t’écoute
parler, je me demande vraiment pourquoi tu n’as pas fait de politique. Tu aurais pu être d’une aide
précieuse. Tu aurais même pu te faire un nom. Il m’adressa un sourire bienveillant. Puis il prit
l’allumette pour allumer sa cigarette et il la frotta contre la boîte. Il y eut un petit éclair. Il
s’évanouit. Le fauteuil était vide. L’illusion avait pris fin. Je passai à nouveau mon pinceau sur la
palette, et repris mon travail pour finir la moustache. Mais la scène avait été si vive que je me sentis
trop fatigué pour continuer. Mon cigare s’était éteint, et la cendre était tombée sur toutes les
couleurs.
Traduit de l’anglais par Thérèse Delpech
Vous aimerez peut-être aussi
- Séquence 2023 Corpus-Misère Littérature D-IdéesDocument4 pagesSéquence 2023 Corpus-Misère Littérature D-IdéeslyblancPas encore d'évaluation
- L'Empire Invisible PDFDocument274 pagesL'Empire Invisible PDFkouadio yao ArmandPas encore d'évaluation
- J’ai (peut-être) tué Hitler: Ou « l’effet papillon » après la chute d’une briqueD'EverandJ’ai (peut-être) tué Hitler: Ou « l’effet papillon » après la chute d’une briquePas encore d'évaluation
- Charles Mingus - Moins Qu'Un Chien AutobiographieDocument285 pagesCharles Mingus - Moins Qu'Un Chien Autobiographiealaouet100% (1)
- Textes Littéraires (HDA)Document28 pagesTextes Littéraires (HDA)mariePas encore d'évaluation
- Je, gosse de Nouzonville: Robert de Niro n'est plus un hérosD'EverandJe, gosse de Nouzonville: Robert de Niro n'est plus un hérosPas encore d'évaluation
- Batouala - Rene MaranDocument243 pagesBatouala - Rene MaranPape Sarr100% (6)
- Batouala - Rene MaranDocument243 pagesBatouala - Rene MaranSalif OUEDRAOGOPas encore d'évaluation
- Batouala 1 IMAGEDocument70 pagesBatouala 1 IMAGEcharlesstyven090Pas encore d'évaluation
- L'autre Goering: L'histoire extraordinaire du frère d'Hermann GoeringD'EverandL'autre Goering: L'histoire extraordinaire du frère d'Hermann GoeringPas encore d'évaluation
- Extraits de Marcelle TinayreDocument12 pagesExtraits de Marcelle TinayreLaurent AlibertPas encore d'évaluation
- Six Mois, Six Jours - Karine TuilDocument160 pagesSix Mois, Six Jours - Karine TuilDenise EmbonPas encore d'évaluation
- Lettre A Un PaysanDocument61 pagesLettre A Un PaysanTech K developpementPas encore d'évaluation
- FRB340325101 Ag1 091 PDFDocument4 pagesFRB340325101 Ag1 091 PDFOccitanica Médiathèque Numérique OccitanePas encore d'évaluation
- 6.allais - Deux Et Deux Font CinqDocument227 pages6.allais - Deux Et Deux Font CinqdelportesanthonyPas encore d'évaluation
- 1 - Le Bracelet de VermeilDocument170 pages1 - Le Bracelet de VermeilMARTINE FrancoisPas encore d'évaluation
- PDF Bertolt Brecht Grand-PeurDocument74 pagesPDF Bertolt Brecht Grand-Peurludovica rubinoPas encore d'évaluation
- Jean-Marie M'a Tuer (François Brigneau)Document330 pagesJean-Marie M'a Tuer (François Brigneau)SchtroumpfduroiPas encore d'évaluation
- L'homme aux deux noms: Les mémoires de Sertorius Tome 1D'EverandL'homme aux deux noms: Les mémoires de Sertorius Tome 1Pas encore d'évaluation
- Monologue Will HuntingDocument3 pagesMonologue Will Huntingpeter.parker.thanosPas encore d'évaluation
- Vdocuments - MX Au Nom de Tous Les MiensDocument1 472 pagesVdocuments - MX Au Nom de Tous Les MiensALEXANDROAIE DANPas encore d'évaluation
- Thomas Sankara, L'espoir Assassiné-Valère D. Somé PDFDocument303 pagesThomas Sankara, L'espoir Assassiné-Valère D. Somé PDFmanga100% (2)
- Céline VoyageDocument3 pagesCéline VoyageGordosKatalinPas encore d'évaluation
- A Fresnes Au Temps de Robert Brasillach BrigneauDocument92 pagesA Fresnes Au Temps de Robert Brasillach BrigneauBibliothequeNatio100% (1)
- Drieu La Rochelle - Mesure de La FranceDocument189 pagesDrieu La Rochelle - Mesure de La FranceroberthenPas encore d'évaluation
- Notre Jack (Michael Morpurgo) (Z-Library)Document67 pagesNotre Jack (Michael Morpurgo) (Z-Library)Lulu PralinePas encore d'évaluation
- Résumé Détaillé de 1984 de George OrwellDocument1 pageRésumé Détaillé de 1984 de George OrwellREPas encore d'évaluation
- Jean D'Ormesson - Je Dirai Malgré Tout Que Cette Vie Fut Belle 1001ebooks - ClubDocument432 pagesJean D'Ormesson - Je Dirai Malgré Tout Que Cette Vie Fut Belle 1001ebooks - ClubAmirouche AMALOUPas encore d'évaluation
- EXTRAIT a Louest Rien de NouveauDocument13 pagesEXTRAIT a Louest Rien de Nouveauismailelatbani66Pas encore d'évaluation
- Verite n4Document16 pagesVerite n4bidon50100% (1)
- Desobeir VlaminckDocument28 pagesDesobeir VlaminckLu LarPas encore d'évaluation
- Staline exécuté par Picasso: D'un portrait qui en cache un autre.D'EverandStaline exécuté par Picasso: D'un portrait qui en cache un autre.Pas encore d'évaluation
- Pour Une Parcelle de GloireDocument50 pagesPour Une Parcelle de GloireViệt Nam cổ sự quánPas encore d'évaluation
- Mémoire d'un fils unique: Mes sentiments de jeunesse sur la vie, la guerre, et l'amour entre 1939 et 1969D'EverandMémoire d'un fils unique: Mes sentiments de jeunesse sur la vie, la guerre, et l'amour entre 1939 et 1969Pas encore d'évaluation
- 10. Le Problème Final Author Arthur Conan DoyleDocument37 pages10. Le Problème Final Author Arthur Conan DoyleEdson BredaPas encore d'évaluation
- Pages Arrachées À Nicolas Bouvier - 2Document12 pagesPages Arrachées À Nicolas Bouvier - 2La MarseillaisePas encore d'évaluation
- 30 Enros D'amende Pour Un Casse Toi Pov ConDocument1 page30 Enros D'amende Pour Un Casse Toi Pov ConLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Olivier BesancenotDocument1 pageOlivier BesancenotLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Mai 68 Un Récit JournalistiqueDocument4 pagesMai 68 Un Récit JournalistiqueLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- L'argotDocument1 pageL'argotLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Fargo Ou True DetectiveDocument3 pagesFargo Ou True DetectiveLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- À Quoi Ça Sert?Document2 pagesÀ Quoi Ça Sert?La MarseillaisePas encore d'évaluation
- BB Je Danse Donc Je SuisDocument1 pageBB Je Danse Donc Je SuisLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Où Sont Passés Les Méchants ChinoisDocument3 pagesOù Sont Passés Les Méchants ChinoisLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Touaregs MaliDocument1 pageTouaregs MaliLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Embouteillage de 100 KM en ChineDocument1 pageEmbouteillage de 100 KM en ChineLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Attention VampiresDocument5 pagesAttention VampiresLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- La Photo ParfaiteDocument3 pagesLa Photo ParfaiteLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- FlorilegeDocument1 pageFlorilegeLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Les Particularités Des FrançaisDocument5 pagesLes Particularités Des FrançaisLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Nous Ne Serons Plus Jamais Déconnectés - RécitsDocument4 pagesNous Ne Serons Plus Jamais Déconnectés - RécitsLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Accords Du Participe Passé WikiDocument7 pagesAccords Du Participe Passé WikiLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Honduras - La Cité CachéeDocument3 pagesHonduras - La Cité CachéeLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Davos 2023 French Full ReportDocument61 pagesDavos 2023 French Full ReportKathia Cancino RojasPas encore d'évaluation
- Ciné Dans Le LotDocument1 pageCiné Dans Le LotLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Les Argentins Poursuivis Par La CriseDocument3 pagesLes Argentins Poursuivis Par La CriseLa MarseillaisePas encore d'évaluation
- Qui A Inventé L'aiguille CreuseDocument4 pagesQui A Inventé L'aiguille CreusejewelgoodremPas encore d'évaluation
- Les Maladies de Dépérissement Des AgrumesDocument48 pagesLes Maladies de Dépérissement Des AgrumesMichelAndriamahazonoroRaherimanantsoaPas encore d'évaluation
- Regarder Le Tresor Du Petit Nicolas Entier VFDocument4 pagesRegarder Le Tresor Du Petit Nicolas Entier VFxzcvxzPas encore d'évaluation
- Rapport Cable TechDocument17 pagesRapport Cable TechMallouki Med100% (1)
- Robe Salopette CatherineDocument57 pagesRobe Salopette CatherineAude EPIARD100% (1)
- Pied Au PlancherDocument2 pagesPied Au PlancherKenza BenmokhtarPas encore d'évaluation
- TD PalettisationDocument12 pagesTD PalettisationZine eddine Hadj mokhnachrPas encore d'évaluation
- Les Courants LitterairesDocument2 pagesLes Courants LitterairesAna-Maria RoșuPas encore d'évaluation
- ANALYSE D'UNE Démarche de Cartographie Du RisqueDocument174 pagesANALYSE D'UNE Démarche de Cartographie Du RisqueSouad TouchliftPas encore d'évaluation
- Syl M2 Inf-DcDocument28 pagesSyl M2 Inf-DcChihebeddine AmmarPas encore d'évaluation
- Bac - Les Meilleures Citations Pour Gagner Des Points en Français - SAMABACDocument4 pagesBac - Les Meilleures Citations Pour Gagner Des Points en Français - SAMABACbeavoguipaulbarre047Pas encore d'évaluation
- Mécanique Des RochesDocument41 pagesMécanique Des RochesIssam ZougariPas encore d'évaluation
- Anelise TalbourdeauDocument9 pagesAnelise TalbourdeauDennis AlexanderPas encore d'évaluation
- Chapitre5 DHCPDocument17 pagesChapitre5 DHCPjeanPas encore d'évaluation
- Comptabilité Des CliniquesDocument47 pagesComptabilité Des CliniquesAnonymous kAVA6ALXNPas encore d'évaluation
- TABLEAU EDEN ROCK - XLSX 2 VILLADocument20 pagesTABLEAU EDEN ROCK - XLSX 2 VILLARebs RebsPas encore d'évaluation
- Chimie GeneraleDocument5 pagesChimie Generaletcheva jokhanan TiambiPas encore d'évaluation
- Etude Typologique de L'expression de L'espaceDocument41 pagesEtude Typologique de L'expression de L'espacevj03ePas encore d'évaluation
- Lantschoot, Arnold Van. Un Texte Palimpseste de Vat. Copte 65, Muséon 60 (1947), 261-268Document8 pagesLantschoot, Arnold Van. Un Texte Palimpseste de Vat. Copte 65, Muséon 60 (1947), 261-268yadatanPas encore d'évaluation
- 2-La Hierarchie AngéliqueDocument6 pages2-La Hierarchie Angéliquemichel fayettetchibinda100% (2)
- Wayser2009 2Document25 pagesWayser2009 2ALEXANDRE F VOLTAPas encore d'évaluation
- Niveaux Langue Registres Exercices PDFDocument4 pagesNiveaux Langue Registres Exercices PDFSadek Kadda Wahid0% (1)
- Yadh Ben AchourDocument26 pagesYadh Ben AchourIsmail SadaouiPas encore d'évaluation
- TEXTE N°1: La Jeune AcrobateDocument5 pagesTEXTE N°1: La Jeune Acrobatelouaslama0106Pas encore d'évaluation
- EchographieDocument10 pagesEchographieImaa Ha NnePas encore d'évaluation
- Corro Philo Valesse 1iere - PDFDocument114 pagesCorro Philo Valesse 1iere - PDFnayoussayacoubou17Pas encore d'évaluation
- Met S 23 Sy PDocument4 pagesMet S 23 Sy Pkhocine100% (1)
- Gestion Du Temps KaufDocument44 pagesGestion Du Temps KaufHodaPas encore d'évaluation
- Manuel D'utilisation Gamme Murale Ar5000 1.1 Samsung 2014Document57 pagesManuel D'utilisation Gamme Murale Ar5000 1.1 Samsung 2014ddrumeaPas encore d'évaluation
- SubnettingDocument19 pagesSubnettingtunisianouPas encore d'évaluation