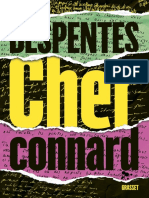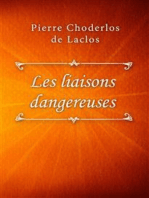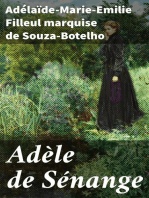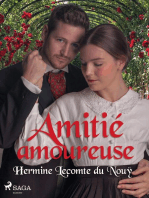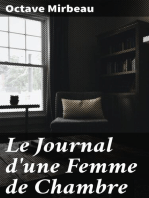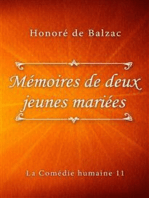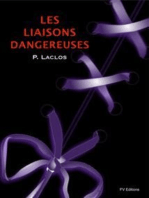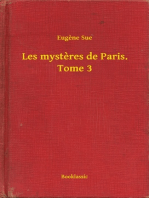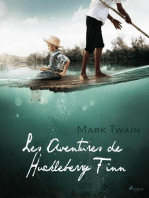Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
LL 4 5 6
Transféré par
massimarwan098Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
LL 4 5 6
Transféré par
massimarwan098Droits d'auteur :
Formats disponibles
Texte 4
— Mon ami, si j’étais madame la duchesse telle ou telle, si j’avais deux cent mille livres de rente, que je
fusse votre maîtresse et que j’eusse un autre amant que vous, vous auriez le droit de me demander pourquoi
je vous trompe ; mais je suis mademoiselle Marguerite Gautier, j’ai quarante mille francs de dettes, pas un
sou de fortune, et je dépense cent mille francs par an, votre question devient oiseuse et ma réponse inutile.
— C’est juste, dis-je en laissant tomber ma tête sur les genoux de Marguerite, mais moi, je vous aime
comme un fou.
— Eh bien, mon ami, il fallait m’aimer un peu moins ou me comprendre un peu mieux. Votre lettre m’a fait
beaucoup de peine. Si j’avais été libre, d’abord je n’aurais pas reçu le comte avant-hier, ou, l’ayant reçu, je
serais venue vous demander le pardon que vous me demandiez tout à l’heure, et je n’aurais pas à l’avenir
d’autre amant que vous. J’ai cru un moment que je pourrais me donner ce bonheur-là pendant six mois ;
vous ne l’avez pas voulu ; vous teniez à connaître les moyens, eh ! Mon Dieu, les moyens étaient bien
faciles à deviner. C’était un sacrifice plus grand que vous ne croyez que je faisais en les employant. J’aurais
pu vous dire : j’ai besoin de vingt mille francs ; vous étiez amoureux de moi, vous les eussiez trouvés, au
risque de me les reprocher plus tard ; j’ai mieux aimé ne rien vous devoir ; vous n’avez pas compris cette
délicatesse, car c’en est une. Nous autres, quand nous avons encore un peu de cœur, nous donnons aux mots
et aux choses une extension et un développement inconnus aux autres femmes ; je vous répète donc que de
la part de Marguerite Gautier le moyen qu’elle trouvait de payer ses dettes sans vous demander l’argent
nécessaire pour cela, était une délicatesse dont vous devriez profiter sans rien dire. Si vous ne m’aviez
connue qu’aujourd’hui, vous seriez trop heureux de ce que je vous promettrais, et vous ne me demanderiez
pas ce que j’ai fait avant-hier. Nous sommes quelquefois forcées d’acheter une satisfaction pour notre âme
aux dépens de notre corps, et nous souffrons bien davantage quand, après, cette satisfaction nous échappe.
Dumas fils, La Dame aux Camélias, (1848).
Texte 5
- Je vous demande pardon, messieurs, dit Nana en écartant le rideau, mais j’ai été surprise...
Tous se tournèrent. Elle ne s’était pas couverte du tout, elle venait simplement de boutonner un petit corsage
de percale, qui lui cachait à demi la gorge. Lorsque ces messieurs l’avaient mise en fuite, elle se déshabillait
à peine, ôtant vivement son costume de Poissarde. Par-derrière, son pantalon laissait passer encore un bout
de sa chemise. Et les bras nus, les épaules nues, la pointe des seins à l’air, dans son adorable jeunesse de
blonde grasse, elle tenait toujours le rideau d’une main, comme pour le tirer de nouveau, au moindre
effarouchement.
- Oui, j’ai été surprise, jamais je n’oserai.... balbutiait-elle, en jouant la confusion, avec des tons roses sur le
cou et des sourires embarrassés.
- Allez donc, puisqu’on vous trouve très bien ! Cria Bordenave.
Elle risqua encore des mines hésitantes d’ingénue, se remuant comme chatouillée, répétant :
- Son Altesse me fait trop d’honneur... Je prie Son Altesse de m’excuser, si je la reçois ainsi...
- C’est moi qui suis importun, dit le prince ; mais je n’ai pu, madame, résister au désir de vous
complimenter...
Alors, tranquillement, pour aller à la toilette, elle passa en pantalon au milieu de ces messieurs, qui
s’écartèrent. Elle avait les hanches très fortes, le pantalon ballonnait, pendant que, la poitrine en avant, elle
saluait encore avec son fin sourire. Tout d’un coup, elle parut reconnaître le comte Muffat, et elle lui tendit
la main, en amie. Puis, elle le gronda de n’être pas venu à son souper. Son Altesse daignait plaisanter
Muffat, qui bégayait, frissonnant d’avoir tenu une seconde, dans sa main brûlante, cette petite main, fraîche
des eaux de toilette. Le comte avait fortement dîné chez le prince, grand mangeur et beau buveur. Tous deux
étaient même un peu gris.
Zola, Nana, (1880).
Texte 6
Un soir, comme ça, à propos de rien, elle m’a offert cinquante dollars. Je l’ai regardée d’abord. J’osais pas.
Je pensais à ce que ma mère aurait dit dans un cas semblable. Et puis je me suis réfléchi que ma mère, la
pauvre, ne m’en avait jamais offert autant. Pour’ faire plaisir à Molly, tout de suite, j’ai été acheté avec ses
dollars un beau complet beige pastel (four pièce suit) comme c’était la mode au printemps de cette année-là.
Jamais on ne m’avait vu arriver aussi pimpant au bobinard. La patronne fit marcher son gros phono, rien que
pour m’apprendre à danser.
Après ça nous allâmes au cinéma avec Molly pour étrenner mon complet neuf. Elle me
demandait en route si j’étais pas jaloux, parce que le complet me donnait l’air triste, et l’envie
aussi de ne plus retourner à l’usine. Un complet neuf, ça vous bouleverse les idées. Elle10
l’embrassait mon complet à petits baisers passionnés, quand les gens ne nous regardaient pas. J’essayais de
penser à autre chose.
Cette Molly, tout de même quelle femme ! Quelle généreuse ! Quelle carnation ! Quelle
plénitude de jeunesse ! Un festin de désirs. Et je redevenais inquiet. Maquereau ?...que je me
pensais.
- N’allez donc plus chez Ford ! Qu’elle me décourageait au surplus Molly. Cherchez-vous
plutôt un petit emploi dans un bureau... Comme traducteur par exemple, c’est votre genre... Les
livres ça vous plaît...
Elle me conseillait ainsi bien gentiment, elle voulait que je soye heureux. Pour la première
fois un être humains intéressait à moi, du dedans si l’ose le dire, à mon égoïsme, se mettait à ma20
place à moi et pas seulement me jugeait de la sienne, comme tous les autres.
Ah ! Si je l’avais rencontrée plus tôt, Molly, quand il était encore temps de prendre une route
au lieu d’une autre ! Avant de perdre mon enthousiasme sur cette garce de Musyne et sur cette
petite fiente de Lola ! Mais il était trop tard pour me refaire une jeunesse. J’y croyais plus ! On
devient rapidement vieux et de façon irrémédiable encore. On s’en aperçoit à la manière qu’on a
prise d’aimer son malheur malgré soi.
Céline, Voyage au bout de la nuit, (1932).
Vous aimerez peut-être aussi
- Ebook Mercedes Ron A Contre-Sens - T1Document211 pagesEbook Mercedes Ron A Contre-Sens - T1kmy.fac100% (6)
- L-Enfant-De-Noe-Pdf LIBRO LECTURA PDFDocument84 pagesL-Enfant-De-Noe-Pdf LIBRO LECTURA PDFevarrr80% (5)
- Virginie Despentes - Cher ConnardDocument220 pagesVirginie Despentes - Cher ConnardAmine Amire100% (2)
- Cours Complet Pour L'enseignement Du (... ) Montgeroult Hélène bpt6k9741747r PDFDocument300 pagesCours Complet Pour L'enseignement Du (... ) Montgeroult Hélène bpt6k9741747r PDFStan FlorinPas encore d'évaluation
- Textes Complémentaires Manon LescautDocument7 pagesTextes Complémentaires Manon LescautjsfeirPas encore d'évaluation
- Adèle de SénangeD'EverandAdèle de SénangePas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2024-01-05 À 11.10.04Document302 pagesCapture D'écran . 2024-01-05 À 11.10.04qmbgfrwhkmPas encore d'évaluation
- Dites-leur que je suis mort: Roman historiqueD'EverandDites-leur que je suis mort: Roman historiquePas encore d'évaluation
- Feuillet JournalDocument263 pagesFeuillet Journalcecileyimker2Pas encore d'évaluation
- Histoire de Mlle Brion dite Comtesse de Launay (1754): Introduction, Essai bibliographique par Guillaume ApollinaireD'EverandHistoire de Mlle Brion dite Comtesse de Launay (1754): Introduction, Essai bibliographique par Guillaume ApollinairePas encore d'évaluation
- Monsieur Quincampoix: Réincarné en chien, quand l’épouse devient maîtresseD'EverandMonsieur Quincampoix: Réincarné en chien, quand l’épouse devient maîtressePas encore d'évaluation
- Balzac 12 Memoires de Deux Jeunes Mariees - GrandDocument242 pagesBalzac 12 Memoires de Deux Jeunes Mariees - GrandcdroopyPas encore d'évaluation
- OCTAVE MIRBEAU-Le Journal Dune Femme de Chambre - (Atramenta - Net)Document333 pagesOCTAVE MIRBEAU-Le Journal Dune Femme de Chambre - (Atramenta - Net)AminataPas encore d'évaluation
- Histoire de Mlle Brion dite Comtesse de Launay (1754): Introduction, Essai bibliographique par Guillaume ApollinaireD'EverandHistoire de Mlle Brion dite Comtesse de Launay (1754): Introduction, Essai bibliographique par Guillaume ApollinairePas encore d'évaluation
- Corpus - Les Liaisons Dangereuses - Extraits Des Lettres-1Document10 pagesCorpus - Les Liaisons Dangereuses - Extraits Des Lettres-1anasghedira02062007Pas encore d'évaluation
- La comédie humaine, volume II Scènes de la vie privée tome IID'EverandLa comédie humaine, volume II Scènes de la vie privée tome IIPas encore d'évaluation
- Les liaisons dangereuses (Illustré)D'EverandLes liaisons dangereuses (Illustré)Évaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Lettre IVDocument2 pagesLettre IVabalde0506Pas encore d'évaluation
- La Comédie Humaine - Etudes de Moeurs: Livre Premier - Tome IID'EverandLa Comédie Humaine - Etudes de Moeurs: Livre Premier - Tome IIPas encore d'évaluation
- Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome septième - deuxième partieD'EverandMémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome septième - deuxième partiePas encore d'évaluation
- Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome cinquième - première partieD'EverandMémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome cinquième - première partiePas encore d'évaluation
- Ma conversion; ou le libertin de qualitéD'EverandMa conversion; ou le libertin de qualitéPas encore d'évaluation
- Le Canapé couleur de feu, par M. de ***D'EverandLe Canapé couleur de feu, par M. de ***Pas encore d'évaluation
- Recapitulatif Sequence 1 LE ROMAN 2023-2024Document5 pagesRecapitulatif Sequence 1 LE ROMAN 2023-2024habis.stephaniePas encore d'évaluation
- Dom Juan Ou Le Festin deDocument67 pagesDom Juan Ou Le Festin de• Domino •Pas encore d'évaluation
- Nodier Le Nouveau Faust Et La Nouvelle MargueriteDocument15 pagesNodier Le Nouveau Faust Et La Nouvelle MargueriteNatalia SoleckaPas encore d'évaluation
- Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome troisième - première partieD'EverandMémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même: Tome troisième - première partiePas encore d'évaluation
- Sous La Revolution Francaise - Dominique JolyDocument102 pagesSous La Revolution Francaise - Dominique Jolyوصفات و شهيوات رائعة أمة اللهPas encore d'évaluation
- Conan - Un Amour Vrai-531Document87 pagesConan - Un Amour Vrai-531Shochitl RangelPas encore d'évaluation
- Louison Musset LTDocument37 pagesLouison Musset LTAmélie DuboisPas encore d'évaluation
- Else Lasker-Schüler Chez MaupassantDocument4 pagesElse Lasker-Schüler Chez MaupassantTorsten SchwankePas encore d'évaluation
- Blind Summit Version Corrigee 0Document217 pagesBlind Summit Version Corrigee 0Dylane TanohPas encore d'évaluation
- Je Suis Une Femme Très Soumise - RomyDocument82 pagesJe Suis Une Femme Très Soumise - Romyahmed50% (4)
- Isekai Dakimakura Arc 3 Le Vrai Monastere de Moroa Texte IntegralDocument387 pagesIsekai Dakimakura Arc 3 Le Vrai Monastere de Moroa Texte IntegralSofia SennPas encore d'évaluation
- Descriptif 2023Document18 pagesDescriptif 2023NCECPas encore d'évaluation
- Lange Du Crepuscule Version Finale MargeDocument395 pagesLange Du Crepuscule Version Finale Margemudiboelikya26Pas encore d'évaluation
- Full Ati RN Med Surg Exam 2020 Latest Questions and Answers PDF Docx Full Chapter ChapterDocument36 pagesFull Ati RN Med Surg Exam 2020 Latest Questions and Answers PDF Docx Full Chapter Chapterzoonwinkfoxyj8100% (22)
- Eho Holdenx PDFDocument5 pagesEho Holdenx PDFFrancis DuprèPas encore d'évaluation
- Textes ORAL 1ère B-Avril 2023 PDFDocument11 pagesTextes ORAL 1ère B-Avril 2023 PDFZainab KhanPas encore d'évaluation
- Paul Gaugin - Avant Et AprèsDocument320 pagesPaul Gaugin - Avant Et AprèslouiscoraxPas encore d'évaluation
- Les Prénoms Épicènes FrenchPDFDocument59 pagesLes Prénoms Épicènes FrenchPDFEnzo LesagePas encore d'évaluation
- Lyndamine Ou L'optimisme Des Pays ChaudsDocument97 pagesLyndamine Ou L'optimisme Des Pays ChaudssiteconPas encore d'évaluation
- CV 2022102813354569Document1 pageCV 2022102813354569Oussama OussamaPas encore d'évaluation
- Wurfel Bingo Scoresheet GreenDocument2 pagesWurfel Bingo Scoresheet GreenSébastien PorcelPas encore d'évaluation
- Les Plaies de La MainDocument33 pagesLes Plaies de La MainurgencemainnicePas encore d'évaluation
- Gardons-Nous Des IdolesDocument10 pagesGardons-Nous Des IdolesCryspus AssoukaviPas encore d'évaluation
- CO Chroniques Oubliees Fantasy 11 11Document1 pageCO Chroniques Oubliees Fantasy 11 11jeaneoPas encore d'évaluation
- Rimbaud, l' Émancipation Par La PoésieDocument3 pagesRimbaud, l' Émancipation Par La Poésieslimiahmed544Pas encore d'évaluation
- Bac Blanc N°1 - TDDocument2 pagesBac Blanc N°1 - TDnjikiPas encore d'évaluation
- Gestion PériméeDocument20 pagesGestion Périméedos saphirPas encore d'évaluation
- Ex Co Transfo Bac 2008 SC E5Document4 pagesEx Co Transfo Bac 2008 SC E5Bourama DjirePas encore d'évaluation
- Cours 4 - Risque ChimiqueDocument80 pagesCours 4 - Risque Chimiquemoussa mrzgPas encore d'évaluation
- TISSOT Constitution Des Organismes Vol2num 1936Document140 pagesTISSOT Constitution Des Organismes Vol2num 1936Ernesto SalvatorePas encore d'évaluation
- Claude Frere. Couvertures Paris MatchDocument9 pagesClaude Frere. Couvertures Paris MatchDavid CastroPas encore d'évaluation
- Le Premier Point Est Sa Visite Dans La Campagne ÉgyptienneDocument3 pagesLe Premier Point Est Sa Visite Dans La Campagne ÉgyptienneGuela GLPas encore d'évaluation
- Cas CliniqueDocument7 pagesCas Cliniquezara100% (1)
- Fiche SynthèseDocument4 pagesFiche SynthèseHedwige LouisePas encore d'évaluation
- Commuttant Cycliques PDFDocument3 pagesCommuttant Cycliques PDFAymen DanounPas encore d'évaluation
- Alice's Adventures in Wonderland de Traduction en Retraduction - La Scène Énonciative Mise À NuDocument9 pagesAlice's Adventures in Wonderland de Traduction en Retraduction - La Scène Énonciative Mise À Nuiranqajar2021Pas encore d'évaluation
- Journal Sur L'identité, Les Relations PDFDocument44 pagesJournal Sur L'identité, Les Relations PDFMoustapha SarrPas encore d'évaluation
- 496-Article Text-1860-1-10-20200827Document20 pages496-Article Text-1860-1-10-20200827Ell IlhamPas encore d'évaluation
- Camille Flammarion - Astronomie Populaire (1880)Document871 pagesCamille Flammarion - Astronomie Populaire (1880)Vlad Gheorghita100% (1)
- Bracelet Brésilien (Lot de 8) - Promesse de CoupleDocument1 pageBracelet Brésilien (Lot de 8) - Promesse de CoupleamzilePas encore d'évaluation
- 612b2668d2004devoir de Maths Niveau 4eme College Moderne de BouDocument2 pages612b2668d2004devoir de Maths Niveau 4eme College Moderne de BouUrdin TOUMBAMONGO KHOTATPas encore d'évaluation
- Les Cent Mensonges de VincentDocument11 pagesLes Cent Mensonges de VincentPainted HenPas encore d'évaluation
- تخصص الترجمة المتخصّصةDocument9 pagesتخصص الترجمة المتخصّصةMarouene OuldbabaaliPas encore d'évaluation
- V1 Routes BidirectionnellesDocument96 pagesV1 Routes BidirectionnellesDavide LeviPas encore d'évaluation
- Approche Du Fonctionnement Cognitif Chez L'Enfant SurdouéDocument60 pagesApproche Du Fonctionnement Cognitif Chez L'Enfant SurdouéCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Support Challenge 1Document141 pagesSupport Challenge 1nomenarakotovaooPas encore d'évaluation
- Exam SMP1 Alg1SN Mars 2021Document1 pageExam SMP1 Alg1SN Mars 2021Mohamed AskoukPas encore d'évaluation
- Massacres BamilekeDocument13 pagesMassacres BamilekeAlain Web-creatorPas encore d'évaluation