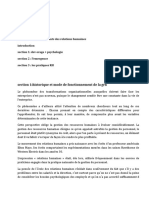Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Analyse Conjoncture 2 Semestre 2010
Analyse Conjoncture 2 Semestre 2010
Transféré par
Allache AbderrahmanCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Analyse Conjoncture 2 Semestre 2010
Analyse Conjoncture 2 Semestre 2010
Transféré par
Allache AbderrahmanDroits d'auteur :
Formats disponibles
DGITM/DAM/MFC Analyse de la conjoncture dans le secteur maritime
Lisa SUTTO
Janvier 2011 1
ANALYSE DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE:
LE TRANSPORT MARITIME
2
me
SEMESTRE 2010
1. CONTEXTE GLOBAL ................................................................................................................. 2
1.1 SITUATION CONOMIQUE GLOBALE ...................................................................................... 2
1.2 SITUATION CONOMIQUE EUROPENNE ET FRANAISE......................................................... 3
1.3 SITUATION CONOMIQUE GLOBALE DU SECTEUR MARITIME.................................................. 4
2. ELEMENTS DE CONJONCTURE PAR SECTEUR DE TRANSPORT.......................... 7
2.1 TRANSPORT DE CONTENEURS................................................................................................ 7
La situation conomique de CMA-CGM.............................................................................................. 9
2.2 TRANSPORT DE VRACS SECS ................................................................................................. 10
Le secteur du transport de vracs secs en France....................................................................................... 12
2.3 TRANSPORT PTROLIER ET DE GAZ ..................................................................................... 12
Le secteur du transport de vracs liquides en France ................................................................................. 13
2.4 TRANSPORT ROULIER ET DE PASSAGERS A COURTE DISTANCE.............................................. 14
La desserte maritime de la Corse ........................................................................................................ 15
La desserte maritime transmanche ...................................................................................................... 16
2.5 AUTOROUTES DE LA MER..................................................................................................... 17
3. CONCLUSIONS.......................................................................................................................... 18
2
1. CONTEXTE GLOBAL
1.1 Situation conomique globale
Globalement, 2010 a t l'anne de la reprise conomique mondiale. Sur lensemble de lanne,
cette reprise sest cependant montre trs variable selon les rgions et les trimestres.
Tout dabord, des taux de reprise non uniformes ont mis en lumire une conomie mondiale
trois vitesses. Les pays mergents ont tir la croissance mondiale, alors quaux Etats-Unis le PIB a
progress de 2,6 % sur l'anne, cest--dire plus que deux fois moins que la moyenne des pays
mergents (7%). Mais cest dans la zone euro que la croissance globale a t particulirement faible,
avec un taux moyen de 1,6 %. Seule l' Allemagne sest distingu par une croissance soutenue, alors que
la Grce et lIrlande sont restes en rcession et la croissance espagnole a t nulle.
En outre, ces volutions nont pas t constantes au fil de lanne, en dterminant un contexte
conomique instable et incertain. Au cours du 1
er
semestre les indicateurs conjoncturels ont tmoign
dun dynamisme conomique au-dessus de la moyenne, alors que le dernier semestre sest caractris
par une inflexion de la croissance. Or, si les signes du ralentissement de la croissance mondiale peuvent
sinterprter comme la fin du rebond conscutif la rcession, il en reste nanmoins que ce
ralentissement affiche un caractre durable. Le rapport de fin 2010 de lUNCTAD Situation et
perspectives de lconomie mondiale est moins optimiste que son dition prcdente et il indique une
croissance plus faible pour 2011 (3,1%) et 2012 (3,5%), notamment pour les pays dvelopps
(respectivement, 1,9% et 2,3%). Selon les prvisions, ce sont toujours les pays en dveloppement qui
tireront la croissance mondiale, mais avec moins de vigueur par rapport au pass (6% en moyenne par
rapport 7% en 2010). En effet, les premiers signes de ralentissement des conomies mergentes ont
t observs sur les derniers mois de 2010, lorsque, en raison dun durcissement des politiques
conomiques et dune baisse des dbouchs extrieurs, lactivit en Chine et dans les pays dAsie
mergente a t moins dynamique.
Le graphique ci-dessus rsume ces tendances globales et illustre les trois scnarios de prvision
de la croissance conomique mondiale raliss par lUNCTAD sur la priode 2011-2012.
Fig. 1 Croissance de lconomie mondiale 2004-2012 (taux annuels-PIB)
Source : UNCTAD, 2010
3
Aprs le creux de dbut 2009, le commerce mondial a rcuper la situation davant la crise.
Toutefois, si la reprise a concern toute la priode 2009-2010, on constate que llan des premiers mois
sest tari en fin de priode. En outre, cette croissance a t ingale selon les rgions.
Fig. 2 Volume du commerce mondial 2005-2010
Source : UNCTAD, 2010
En effet, si le volume des exportations des principales conomies mergentes (Brsil, Chine,
Inde) est redevenu des niveaux pre-crise, pour les exportations des pays dvelopps la reprise na
pas t complte et elle est toujours infrieure de 8% par rapport aux niveaux prcdents la crise. Ces
exportations sont tires par la forte croissance des importations des pays mergents. Or, la question qui
se pose est de savoir jusqu quand ces conomies seront le moteur de la croissance des changes
mondiaux, vu que les prvisions de croissance sont galement la baisse pour ces pays et que, surtout,
ces derniers (notamment la Chine) cherchent de plus en plus rorienter la croissance de la demande
vers leur production interne.
1.2 Situation conomique europenne et franaise
La situation conomique est particulirement instable lchelle europenne, o en raison des
problmes de la dette publique de nombreux tats les mesures de soutien de la croissance sont
censes sattnuer. Les politiques budgtaires devraient devenir globalement moins expansives au fur et
mesure que les pays mettront progressivement en uvre des politiques de consolidation fiscale. Selon
lINSEE, cette volution viendrait se coupler lattnuation de limpulsion manant des conomies
mergentes et lamenuisement dans les pays avancs du mouvement de reconstitution des stocks,
qui a fortement contribu la reprise ces derniers mois.
Au cours du 2
me
semestre 2010, la croissance en zone euro a ralenti. Selon les dernires
prvisions de lINSEE, lhorizon de mi-2011, la zone euro dans son ensemble conserverait une
croissance modre. La dynamique de la demande intrieure ne suffira probablement pas compenser
le ralentissement de la demande adresse la zone euro et limpact des mesures de consolidation
budgtaire. Le mme phnomne est observable en France, o la demande trangre ralentit et les
effets favorables de la dprciation de leuro au 1
er
trimestre 2010 tendent dsormais sestomper. En
France, la faible progression de lactivit (0,4%) a t soutenue par la demande intrieure, ce qui a
permis jusqu' prsent de compenser l'affaiblissement progressif du soutien des exports la croissance.
4
1.3 Situation conomique globale du secteur maritime
Globalement, les dernires tendances macroconomiques mesures et les prvisions dvolution
en 2011 pour les changes mondiaux indiquent un possible ralentissement de la reprise du transport
maritime, qui traverse depuis le dbut de 2010 une phase de consolidation de son activit aprs un an et
demi de rcession. 2010 a marqu pour ce secteur le retour son niveau dactivit prcdent la crise.
Selon le courtier Clarkson, le volume de lactivit maritime mondiale devrait atteindre 8,3 Mds T
(+6%), ce qui correspond +100 Mln T par rapport lactivit de 2008. Ces volutions cachent
nanmoins des diffrences importantes entre les diffrents secteurs dactivit du shipping et selon les
priodes de lanne.
Le graphique suivant illustre les volutions des indices daffrtement des diffrentes catgories de
navires et permet de constater une tendance la baisse du taux daffrtement des porte-conteneurs et
des vraquiers, mais une relative amlioration en fin danne pour les navires ptroliers. Ces volutions
ne sont pas sans relation la situation de surcapacit de la flotte que les stratgies de rduction des units
et dannulation des commandes mises en place pendant la crise nont pas t en mesure de contenir
compltement. De proportions variables dun secteur lautre, la surcapacit concerne de manire
particulirement forte le transport conteneuris, mme si aucun secteur nest pargn.
Fig. 3 Indices daffrtement des navires
Source : Le Marin (laboration des donnes AXS Marine et Hambourg Shipbrokers Association)
Quant aux taux de fret, qui rendent compte de la demande du transport maritime, malgr des
volutions variables selon les secteurs dactivits, ils affichent tous une tendance la baisse. La
surcapacit tend, en effet, effacer les effets positifs sur les taux de fret du retour de la demande. Les
volutions de chaque secteur dactivit seront dtailles dans la deuxime partie de ce rapport, mais on
peut dores et dj remarquer que la crise de la demande de 2009 qui a affect les diffrents segments
du transport maritime aurait t moins forte et moins longue, si les compagnies ne se trouvaient pas
dans une situation de surcapacit, avec des carnets de commandes importants pour les mois venir. Les
mois pendant la crise de 2009 se sont accompagns d'une rception continue de nouveaux navires en
surplus et toutes les stratgies dadaptation mises en place par les armateurs (dmolition, dsarmement,
slow steaming, annulation et report de commandes) nont pas t suffisantes rduire compltement
cette surcapacit. Par consquent, lensemble du secteur du shipping sera lavenir plus vulnrable face
aux volutions de la demande.
Ces volutions s'inscrivent en outre dans un contexte de hausse des cots, en particulier en ce qui
concerne les soutes. En effet, leur cours est presque parfaitement corrl avec le cours de ptrole et ce
dernier est en augmentation continue. En deux ans il a augment de +120% (figure 4). Les prvisions
sont galement la hausse. Selon les dernires chiffres de lEIA (Energy Information Agency, Etats-
Unis) ces augmentations seront particulirement fortes dans les prochaines annes (figure 5).
5
Fig. 4 Evolutions du prix du ptrole brut en dollar
Fig. 5 Prvision des volutions du prix du barile de ptrole selon lEIA
Source : Energy Information Agency
Sagissant des tonnes transportes, en France, aprs un recul en 2009, on a pu observer en 2010
une remonte graduelle des tonnages au kilomtre. Toutefois, lindice synthtique de lconomie
maritime labor par le bureau dtudes Price Waterhouse Coopers
1
(figure 6) permet de constater que
la reprise a t faible, alors que la plupart des secteurs dactivits de lconomie maritime ont connu une
baisse gnralise sur les derniers mois. Cette lgre reprise est mettre au crdit du march des
transports conteneuriss.
1
Le premier indice Price Waterhouse Coopers (PwC) a t cre en 2009 et prsent Brest loccasion des 5
me
Assises
de lconomie maritime. Il prend comme base lanne 2008 (base 100 au 31 dcembre 2008) et compare lvolution de
plusieurs paramtres : le Baltic Dry Index, le trafic de passagers dans les 17 principaux ports mtropolitains, le trafic total
des marchandises dans les 7 GPM + Calais, le taux d'affrtement conteneuris, les immatriculations nautiques, le carnet de
commande construction navale, le prix de l'acier et les ventes des navires de pche
6
En particulier, les indicateurs Price Waterhouse Coopers montrent que le trafic total de
marchandises des 7 Grands Ports Maritimes franais est toujours en baisse. Il avait recul de 12% en
2009, sans pargner les deux principaux ports, Marseille (-13%) et Le Havre (-8,5%), avec un impact
particulirement lourd Dunkerque, 3
me
port de commerce en tonnage, qui a accus une chute record
de 22% explicable par la baisse de lactivit sidrurgique (avec Acelor Mittal) et larrt de la raffinerie
Total. En 2010, les dynamiques des trafics ont t trs variables, en raison notamment des situations
diffrentes dun secteur dactivit lautre. Ainsi, si la reprise de 2010 du port de Marseille, qui a connu
une progression de 7% sur les 3 premiers trimestres de lanne, est essentiellement due aux vracs grce
la reprise de lactivit sidrurgique atone en 2009 et aux trafics de marchandises diverses, la baisse
des trafics constate au Havre sexplique par la conjugaison des baisses du trafic de ptrole brut (- 8 %)
et du charbon (- 7 %). Toutefois, la contraction du trafic global au Havre ne doit pas masquer la
progression de 8 % du trafic d'EVP sur les 9 premiers mois de 2010, consquence notamment des
crations de nouvelles lignes maritimes avec les tats-Unis, lAsie et lIrlande. La baisse des trafics a
galement concern le port de Bordeaux, cause du recul des produits ptroliers raffins et des trafics
conteneurs, et le port de Dunkerque, consquence directe de la disparition du trafic de ptrole brut et
de leffondrement des produits ptroliers raffins. Les ports de Nantes Saint-Nazaire, de Rouen et de
La Rochelle ont connu une progression positive. Globalement, le trafic de lensemble des GPM franais
a progress moins rapidement que dans les autres ports europens, notamment par rapport aux ports
du range Nord (Anvers, Gand, Hambourg, Rotterdam et Zeebrugge). Ainsi, si le trafic de ces derniers
est pass sur une anne mobile de 12% au 1
er
trimestre 2010 (compar au 1
er
trimestre 2009) +2% au
3
me
trimestre 2010 (compar au 3
me
trimestre 2009), le trafic des GPM est pass de 10 % 4 % sur
la mme priode. Avec un moindre cart, la progression a t meilleure aussi pour les ports de la
Mditerrane (Barcelone, Carthagne, Gnes et Valence), passs de - 12 % - 4 %.
Fig. 6 Indice de lconomie maritime
Nota : Brest 2009 = dcembre 2009
Toulon 2010 = dcembre 2010
7
2. ELEMENTS DE CONJONCTURE PAR SECTEUR DE TRANSPORT
2.1 Transport de conteneurs
Contexte global et concurrence
Le transport conteneuris, dont le repli tait dj amorc depuis lt 2008, a t le premier
secteur du shipping avoir subi limpact de la crise, dont la porte a t globalement moindre que sur le
march du transport de vracs secs. Par rapport ce dernier, la baisse des trafics a t quasi continue
jusquau second semestre 2009. La reprise a t plus lente et tardive, mais globalement plus stable. En
2010, le secteur du conteneur est parmi les diffrents secteurs dactivit du shipping celui qui a
montr les signes dune reprise la plus solide.
Au niveau mondial, selon le cabinet de consultants spcialis en lignes rgulires Alphaliner, le
volume de manutention portuaire de conteneurs devrait croitre en 2010 de +11,6% (545 M d'evp),
aprs un recul 8,6% en 2009, en rattrapant le niveau dactivit de 2008. Toutefois, la forte croissance
enregistre au premier semestre 2010 (+18.6%) fait place une plus modre au second (+6%). En
Europe, la reprise a t tire par les imports d'Asie (+20%), avec une forte croissance au printemps et
un pick estival suivi d'un tassement lautomne. La dprciation de lEuro au cours du 1
er
semestre
2010 a permis une reprise des exportations europennes, notamment vers les Etats-Unis (+14%).
Nanmoins, la rapprciation de lEuro par rapport aux autres grandes devises internationales a pes
sur la reprise conomique de lUE, notamment sur ses exportations.
L'indice gnral des taux de fret conteneuriss de Shanghai (SCFI)
2
montre que la demande de
transport faiblit en seconde partie danne sur presque toutes les dessertes et en particulier les grandes
destinations Est-Ouest. Depuis son plus haut en juillet, le SCFI a perdu -29% et la chute a t
ininterrompue pendant les cinq derniers mois. Depuis septembre, la demande de transport maritime au
dpart de la Chine a recul sur presque toutes les destinations et particulirement sur les grandes routes
Est-Ouest en raison du ralentissement de la consommation dans les conomies amricaine et
europenne. En mme temps, la demande de transport au dpart de la Chine est cense baisser en
raison de la nouvelle politique chinoise qui tend une croissance en faveur des consommateurs chinois
plus qu' une croissance conomique fonde sur l'export. Or, les compagnies maritimes avaient anticip
pour le second semestre 2010 des hausses de trafics au dpart de Chine, qui ne se sont pas rvles
fondes. De nouvelles capacits en porte-conteneurs sont aussi arrives sur le march et cette nouvelle
situation dexcs doffre par rapport une demande stagnante a ainsi t lorigine dune nouvelle
baisse des tarifs de fret.
Le secteur du conteneur a connu une forte augmentation de capacit. En 2010, les vingt premiers
armateurs mondiaux de ligne rgulire ont augment leur capacit de 14%. Selon les derniers chiffres
publis par Alphaliner, entre le 1
er
janvier et le 31 dcembre, l'offre de transport mise sur le march par
ces compagnies a augment d'1,16 million d'Evp, passant de 10,8 M Evp 12,3 M Evp. Ce faisant, ces
compagnies ont consolid leur position hgmonique sur le march de la ligne rgulire puisqu'elles
sont passes de 79% en 2009 83% en 2010 de la capacit conteneurise dans le monde. Mais elles ont
aussi aliment une situation de surcapacit pesant sur le secteur dans son ensemble, qui au final rend
plus prcaire la reprise conomique et plus incertaines les volutions dans les mois venir pour les
oprateurs de ce march. Cette vulnrabilit est interprter lgard des prvisions de surcapacit
2
L'indice gnral des taux de fret conteneuriss de Shanghai (SCFI) est publi en version beta depuis mars 2009 et en
version officielle depuis le 15 octobre 2010 par le le Shangai Shipping Exchange (SSE). Il sagit dun indice des taux de fret
conteneuriss pratiqus sur 15 routes principales, qui couvrent les destinations suivantes : Europe, Mditerrane, rive est et
ouest des Etats Unis, Golfe Persique, Australie et Nouvelle Zelande, Afrique occidentale, Sud Afrique, Japon occidental et
oriental, SudEst asiatique, Core, Taiwan et Hong Kong. Le taux de Shanghai inclut certaines surcharges tarifaires maritimes
(BAF/FAF - EBS/EBA - CAF/YAS - PSS - WRS - PCS - SCS/SCF/PTF/PCC), mais pas les THC.
8
concernant la flotte porte-conteneurs dans les annes prochaines illustres dans le graphique suivant
(figure 7). Les projections ralises par le courtier BRS montrent plusieurs hypothses dvolution du
rapport entre loffre et la demande de transport en fonction de diffrentes hypothses de croissance de
cette dernire. On constate, sur ce graphique, quun retour lquilibre entre loffre et la demande nest
pas vident dans les annes venir. En 2013, seule une croissance de 15% par an permettrait datteindre
lquilibre. Dans le cas dune augmentation annuelle de 10%, cet quilibre ne serait atteint quen 2014.
Nimporte quel autre taux de croissance infrieur 10% ne permettrait pas le retour lquilibre.
Fig. 7 Surcapacit de la flotte de porte-conteneurs de 2009 2014 en fonction de la croissance des changes
Source : MLTC/BRS - Alphaliner
Parmi les sept premires compagnies maritimes au monde, en termes de parts de march, seul
APM-MAERSK a vu sa position dcliner. Le leader danois, qui dtenait 18,5% de ces parts en est
14,5% aujourd'hui. Pour sa part, MSC, qui conserve la 2
me
place, a vu ses parts de march passer de
8,2% 12,6% au cours de la mme priode tandis que, CMA CGM, la 3
me
place, les a vues grimper
de 4,9% 8,2%. En termes relatifs, la compagnie plus dynamique a t CSAV, qui a augment sa flotte
de 74% en douze mois. Les trois leaders du secteur sont suivis par Evergreen, Hapag-Lloyd, APL,
CSAV, le chinois COSCO puis le coren Hanjin.
Fig. 8 volution des capacits des 20 premires compagnies mondiales entre 2009 et 2010
Source : Alphaliner
9
Ces volutions ne sont pas sans relation avec une autre tendance qui caractrise lvolution du
secteur du transport conteneuris depuis son origine, cest--dire la tendance continue laccroissement
de la taille des navires. Avec 76 porte-conteneurs gants (dont 49 > 10 000 EVP) devant tre livrs au
cours du 1
er
semestre 2011 contre 61 en 2010 (Alphaliner), le gigantisme devient une caractristique
structurante de la flotte porte-conteneurs. Selon les prvisions, ces nouvelles capacits permettront de
crer 4 5 nouveaux services reliant lAsie lEurope et den ouvrir cinq sur le transpacifique. CMA-
CGM devrait recevoir le plus grand nombre de Very Large Container Ship/VCLS (9), suivi par MSC
(14 units dune capacit comprise entre 12 500 et 14 000 EVP) et MAERSK (9 navires de 13 000
EVP). Larmateur chinois CSCL devrait recevoir ses six premiers navires de 14 000 EVP, auxquels
sajouteront 2 units supplmentaires en 2012.
La dernire partie de 2010 a t concerne par une hausse importante des prix des carburants. A
plus longterme, le dveloppement du secteur est frein par lincertitude concernant les volutions des
soutes. Laugmentation constante des vitesses qui a caractrise le dveloppement du secteur a t
remise en question avec le doublement du prix du carburant partir du 2
me
trimestre 2008. Les
incertitudes quant aux volutions futures des prix du ptrole conduit les oprateurs mettre en place
des stratgies prenant de plus en plus en compte une augmentation durable des prix. Ainsi, la stratgie
de rduction des vitesses, de suppression descales et daugmentation du nombre de navires que lon
avait observe au cours de la crise de 2009 semble se transformer dune mesure conjoncturelle en une
modalit de fonctionnement plus durable. De cette manire, les oprateurs anticipent non seulement les
volutions dtermines par la diminution des ressources disponibles, mais galement la mise en place de
mesures dinternalisation des externalits environnementales de plus en plus contraignantes pour le
secteur maritime.
La situation conomique de CMA-CGM
Le groupe CMA-CGM se confirme au 1
er
rang franais et au 3
me
rang mondial pour le transport
conteneuris. Aprs la priode de crise de 2009, o la compagnie a enregistr une baisse de 30% de son
chiffre d'affaires et une perte de 500 M, les premiers mois de 2010 ont marqu une amlioration de la
situation conomico-financire du groupe. La dette a recul et les trafics ont recommenc crotre,
permettant ainsi au groupe de bnficier des effets cumuls de la reprise des changes mondiaux et des
mesures de rationalisation mises en place partir de 2009.
La stratgie de CMA-CGM pour faire face la crise a repos sur des multiples mesures. Le plan
dconomies a prvu la fois une rationalisation des flottes, des services et des cots oprationnels. Au
total, 30 services sur 200 ont t supprims et la vitesse d'exploitation des navires a t rduite au
maximum, en passant la super eco speed (12 15 nuds) l o c'tait possible. Dans une optique
de partage du risque, CMA-CGM a sign des accords de partenariat avec diffrentes compagnies
maritimes ainsi qu'avec les oprateurs de terminaux afin de tenir compte des baisses de volumes.
Paralllement, la compagnie a mis en place un programme de restructuration financire. Fin
2010, aprs deux ans de ngociations
3
, l'armement franais a vu l'entre d'un nouvel actionnaire dans
son capital, le groupe turc Yildirim
4
qui, le 26 novembre 2010, a pris 20% du capital de CMA-CGM et
s'est engag investir 500 Mln $ sous la forme d'une souscription d'Obligations Remboursables en
Actions (ORA) d'une dure de 5 ans. Le fondateur et prsident de la compagnie, M. Jacques SAADE, a
pu conserver 80% de sa compagnie et, mme si les ngociations se poursuivent avec le FSI (le Fond
Stratgique dInvestissement de l'tat) qui pourrait investir selon certaines sources jusqu' 150 Mln, le
3
Pour mmoire, CMA-CGM sest retrouve dans une situation de manque de liquidit lie aux nombreuses commandes
au moment de lclatement de la crise qui a conduit se partenaires financiers ne plus lui consentir de prt. Les banques ont
alors pos une condition au sauvetage de sa trsorerie. Lentreprise aurait d ouvrir son capital et rformer sa gouvernance.
Les ngociations ont t conduites sous lgide de lEtat. Plusieurs candidatures ont t dposes et examines. Parmi elles,
celle de Louis Dreyfus Armateurs, du groupe Bollor et de plusieurs fonds (Colony Capital, Qatari Holdings).
4
Acteur prsent dans des industries telles que lextraction et le transport de produits miniers, la construction navale ou
encore la gestion de terminaux portuaires.
10
fonds souverain franais ne devrait pas prendre, en cas d'accord, plus de 6% du capital de CMA CGM.
Au niveau de la flotte, 2010 sest caractris par une nouvelle tendance la hausse. Lanne 2009
avait t marque par une rduction des units exploites, puisque l'armement n'avait pas renouvel
l'affrtement d'une partie des navires arrivant en fin de charte. La flotte tait ainsi passe de 395 navires
(dont 98 en proprit) en 2008 352 navires (dont 85 en proprit) au 31 dcembre 2009. Cette
tendance sest renverse en 2010 et la flotte de la compagnie a dpass son record historique. En
octobre, CMA-CGM alignait 401 navires (dont 98 en proprit). De cette manire, la compagnie a
renforc sa position sur les marchs du transport conteneuris, avec une augmentation considrable de
sa part de march (en termes de capacit), qui est passe de 4,9% 8,2% de la flotte mondiale. Sa
politique d'investissements sest concentre sur des navires de grande taille et en proprit. La
compagnie est donc dans une nouvelle phase d'essor, venant mme talonner de plus en plus prs le
groupe suisse Mediterranean Shipping Company (MSC). Au total, en 2010, le groupe aura pris livraison
de 15 navires, dont 4 sous pavillon franais (RIF), et il prvoit d'en recevoir 9 en 2011. Les prvisions
dentre en flotte pour la compagnie varient dans la presse spcialise et ladministration ne dispose pas
dinformations sur ce point. Ainsi, il est difficile d'avoir une ide prcise de la stratgie court terme
envisage par larmateur. Par ailleurs, l'inscription dune partie de ces nouvelles units sous RIF
demeure hypothtique, la majorit des derniers navires neufs reus par l'armateur ayant, au mieux,
transit par le pavillon franais via le RIF avant d'tre placs sous pavillon tiers conscutivement une
procdure de gel de francisation. A l'heure actuelle, 21 navires sont effectivement immatriculs sous
RIF, totalisant 1,72 millions d'UMS soit 31% du tonnage total des navires inscrits sous RIF. Ce nombre
est peu prs stable depuis la mise en uvre de ce registre en 2006. Selon les dclarations de son
prsident, lavenir, la compagnie sorientera de plus en plus vers la Chine pour la construction des
futures navires CMA-CGM, devenue dsormais plus comptitive par rapport la Core.
Laugmentation des units exploits rentre dans la stratgie de rduction des cots dexploitation
par le biais dune rduction des vitesses. Cette stratgie est largement pratique par le groupe sur les
routes Asie-Europe, o comme la expliqu J. SAADE lors de son intervention aux 6
me
assises de
lconomie de la mer Toulon CMA-CGM est passe dune exploitation 8 navires pour une vitesse
de 22 nuds une exploitation 11 navires/18 nuds. CMA-CGM cherche ainsi, comme beaucoup
doprateurs, anticiper les cots dune augmentation des prix des soutes cense tre importante en
fonction des volutions des disponibilits des ressources et des politiques environnementales. En mme
temps, laugmentation des capacits rend la compagnie plus vulnrable face un ventuel nouveau
retournement du march lavenir. Et sur ce point, les analystes de Axs-Alphaliner estiment que les
signes de ralentissement risquent davoir une dure suprieure aux prvisions des armateurs et qu'aucun
des principaux facteurs de la reprise de lhiver dernier n'est pas d'actualit aujourdhui : les transporteurs
n'ont procd qu' de modestes rductions de capacits depuis le dbut de la saison hivernale, certains continuant mme
d'en ajouter malgr des taux de remplissage plus faibles. Deuximement, la reconstitution des stocks semble avoir atteint
son sommet
5
.
2.2 Transport de vracs secs
Le secteur du vrac est celui qui a enregistr la rupture la plus brutale avec des baisses dactivit de
15 20% entre les mois de novembre 2008 et de fvrier 2009. Il sagit galement du secteur qui a connu
les volutions les plus surprenantes et rapides. Les consquences de la crise sur lindustrie minire
chinoise ainsi que leffet massif cr par le plan de relance gouvernemental ont provoqu une
augmentation sans prcdents des importations chinoises de minerai de fer ds le 2
me
semestre 2009.
Le transport maritime de vracs secs en a largement bnfici permettant au march de se redresser
rapidement et de manire totalement inattendue. Toutefois, sa reprise a t brve et fragile, comme le
montrent les volutions des taux de fret, qui ont recommenc chuter partir de lt 2010 (figure 9).
Pourautant, aprs le creux estival, la production sidrurgique mondiale a nanmoins retrouv en
5
LAntenne, 09/12/2010
11
septembre son niveau de production davant crise, tire cette fois-ci par les pays occidentaux.
Malgr cette reprise, les prix du transport maritime de vracs secs se sont replis partir de fin
octobre. A la fin de lanne, ils sont tombs leur plus bas niveau depuis six mois. Aprs avoir
commenc l'anne autour des 3.000 points puis tre mont jusqu' 4.202 points en mai, port par une
vague d'optimisme et par la reprise conomique, le Baltic Dry Index (Bdi) s'est effondr au dbut de
l't, chutant jusqu' 1.700 points avant d'osciller au cours du deuxime semestre au gr des inquitudes
du march (figure 9). Si la chute des dernires semaines de lanne peut sexpliquer par linactivit
caractristique de la fin de lanne, les analystes observent une trange dconnexion entre l'envole des cours
des matires premires qui flambent, et l'indice Bdi, au plus bas depuis plus de cinq mois alors que la demande de fret
s'effrite et que de nouveaux navires engorgent le march (Edward Meir, analyste de la socit financire MF
Global). Sur ce point, il est important de souligner qu'il s'agit d'une donne nouvelle pour l'ensemble
des transports de vrac, y compris de ptrole brut.
Fig. 9 volution du Baltic Dry Index au cours du 2
me
semestre 2010
Globalement, le march sest confirm trs volatil et troitement li aux arbitrages de la Chine
concernant lvolution des cours mondiaux du minerai de fer. Aprs deux ans de croissance des flux de
minerai (+10% en 2010 et +8% en 2009), les prvisions sont au ralentissement pour 2011. La World
Steel Association annonce +5,3% pour lanne prochaine, en sachant quen Chine, qui capte les deux
tiers des changes de minerai de fer, la progression de cette anne sera moins forte que par le pass
(+5%) en raison du ralentissement du secteur sidrurgique chinois depuis mai 2010.
Le retour global de la croissance sur tous les secteurs (minerai, consommation agroalimentaire,
charbon sidrurgique, charbon thermique) a pos nouveau le problme de la congestion portuaire.
Avec le retour des trafics, la chaine logistique du transport de minerais a recommenc souffrir de
l'encombrement des ports. L'essentiel du problme rside dans la volont des gouvernements d'investir
massivement dans des ports dimensionns pour recevoir des capesizes sans tre certains du retour sur
investissement. En effet, avec la congestion portuaire en Australie, en Indonsie et en Amrique du
Sud, le march chinois du charbon et des minerais pourrait se retourner vers l'Amrique du Nord. Le
Canada et les tats-Unis ne connaissent pas encore d'engorgement de leurs terminaux vraquiers et
disposent de ressources pour rpondre en partie la demande chinoise. Dans une telle situation, une
partie de la flotte reste immobilise, dautant plus que dans le contexte actuel de baisse des frets
certains propritaires prfrent lester leurs navires (sans charger de marchandise) plutt que d'accepter les prix actuels du
march, ce qui prfigure une poursuite de la dprime pour les premires semaines de 2011 selon Fearnleys.
Concernant la flotte, la croissance des livraisons entame au 1
er
semestre sest confirme au
second. Les livraisons ont atteint un nouveau record au cours du 3
me
trimestre 2010. En ce qui
concerne les capesizes, le carnet de commandes reprsente encore 65% des capacits de la flotte en
12
service et, selon BRS, lon peut sattendre un rythme de livraison encore trs soutenu pour lanne
2011. Il reprsente lquivalent de 49% des capacits de la flotte actuellement en service pour les
Panamax, alors que la flotte des Handysize est la seule qui malgr de prvisions de livraisons
importantes possde un levier dadjustement de loffre la demande en fonction des opportunits de
dmolition lies lge de la flotte (800 navires gs de plus de 25 ans). Globalement, il est vident que,
dans un contexte de prvisions la baisse de la demande, cette augmentation de loffre constitue une
menace pour lquilibre conomique du secteur.
Le secteur du transport de vracs secs en France
Parmi les principaux oprateurs du secteur en France, on retrouve la socit Staf-Saget, filiale du
groupe BOURBON, et Cetragpa, filiale du groupe LDA.
Aprs avoir dcid de vendre sa flotte de vraquiers en juin 2010, en octobre BOURBON a
annonc vouloir cesser son activit d'oprateur de transport de vrac (16 units). Une lettre d'intention a
t signe en ce sens. Dans le cadre de cette cession, BOURBON ne conserverait en proprit que le
cimentier Endeavor, dj exclu de la cession des 16 vraquiers de la compagnie au groupe amricain
Genco Shipping and Trading. L'Endeavor, mis en service en juin 2009 et affrt sur un contrat long
terme par Lafarge, restera exploit par BOURBON dans le cadre d'un contrat de services avec
l'acqureur. En se dsengageant de l'activit vrac, le groupe souhaite se concentrer uniquement sur le
secteur des services l'offshore. Selon le groupe, la cession de l'activit d'oprateur de vrac Jean-Louis
Bottaro et sa famille (qui fonda Staf-Saget en 1968 et en fut dirigeant jusqu'en 2008) devrait dgager
une plus-value d'environ 10 millions d'euros.
Quant au groupe LDA, lactivit historique de transport en vrac reste son activit principale.
LDA a fond sa stratgie sur le triple dveloppement du secteur du transport en vrac, sur les services
maritimes pour lindustrie (pose de cbles sous-marins avec Alcatel-Lucent, recherche sismique,
transport de gros lments industriels, notamment Airbus) et les liaisons transmanche (via LD Lines).
Les services offshores et de logistique-transbordement compltent les activits proposes par LDA, qui
sest galement lanc via sa filiale GLD Atlantique, dans un service dautoroute de la mer entre Nantes-
Saint-Nazare et Gijon. Recement, LDA a dclar plusieurs reprises son intention de dvelopper
lactivit vrac et de relancer les investissements dans ce secteur. Il compte acqurir de nouveaux
vraquiers pour sa filiale Cetragpa. Les discussions sont en cours avec plusieurs chantiers concernant des
commandes de grosses units d'environ 180.000 tonnes du type Capesize, mais aussi des navires de plus
petite taille, LDA travaillant aussi avec des Handisize (environ 40.000 tonnes), notamment en Asie du
sud-est. Ainsi, l'armateur pourrait reconstituer sa flotte d'avant 2008, lorsquil disposait d'une quinzaine
de vraquiers en proprit. Aujourdhui, Cetragpa arme seulement trois navires avec ses propres
quipages, dont deux vraquiers sous pavillon franais. Lensemble des vraquiers contrls par la
compagnie est, pour sa part, d'une vingtaine d'units. Le dernier navire affrt entr en flotte est le Lake
Deer (28.000 tpl), lanc en dcembre 2010. La mise en service d'un Capesize de 180.000 tonnes, le Lake
D, est prvue en mai 2011. Ce vraquier, construit au Japon, sera affrt pour 12 ans.
2.3 Transport ptrolier et de gaz
Les transports ptroliers ont rsist quelques temps aprs le dclenchement de la crise financire,
mais lajustement progressif des quotas de production de lOPEP la nouvelle donne de lconomie
relle mondiale a port un coup fatal au march en tout dbut danne 2009. Aprs un recul de 55%
en 2009, le transport maritme de ptrole brut a retrouv en 2010 son niveau prcdent la crise, avec une
croissance de +4,6% sur lanne. Les mmes tendances ont caractris le secteur du transport de
produits raffins, qui ont galement rcuper leur niveau de 2008.
Cela est le rsultat de la reprise de la croissance, partir du 3
me
trimestre 2010, de la production
ptrolire et de la demande de ptrole. Du ct de loffre, cette tendance sxplique par laugmentation
13
de la production des pays OPEP et la stabilit de la production des pays non-OPEP. Du ct de la
demande, la hausse est surtout tire par les pays non-OECD, notamment par la Chine, alors que pour
les pays de lOCDE le bilan est trs variable. Si lAmerique du Nord et lAsie du Nord ont retrouv une
(faible) croissance, en lEurope la dcroissance de la consommation continue.
Les tarifs du fret ptrolier ont recul partir de lt 2010 (figure 10). La remont des taux en fin
danne a t brve et conjoncturelle (essentiellement lie la vague de froid en Europe et Amerique du
Nord) et les tarifs ptroliers ont repris leur chute les premires semaines de 2011. Ces tendances sont
en relation avec la situation de surcapacit endmique qui caractrise le secteur, notamment sur le
march des Very Large Crude Carriers (VLCC)
6
, en chute libre depuis plusieurs mois. Aprs un recul de
4% sur le premier semestre, le taux des VLCC a encore baiss de 32 K$/j au 2
me
trimestre 5 K$/j au
troisime.
Fig. 10 volution du Baltic Dirty Tanker (---) et du Baltic Clean Tanker Index (---) au cours du 2
me
semestre 2010
Le secteur du transport de vrac liquide comprend galement le secteur du transport de gaz
naturel liqufi (GNL), en progression exponentielle depuis le dbut des annes 2000 (mme sil na pas
t pargn non plus par la rcession en 2009). Ce secteur est en constante volution en ce qui
concerne les capacits de production, les capacits portuaires (adaptation des terminaux) et les capacits
de transport maritime (construction de navires GNL). Aprs un recul de 5% en 2009, en 2010 la
croissance des changes de LNG a t de 13%. Toutes les rgions mondiales sont concernes par ces
volutions et lEurope connat les volutions les plus importantes (+28%).
Le secteur du transport de vracs liquides en France
Les compagnies leaders en France dans le secteur ptrolier sont Sea-Tankers, Socatra et Euronav.
Sea-Tankers est une socit de transport de produits ptroliers fonde en 2007. Elle regroupe les
activits de Fouquet Sacop et Ptromarine et aligne une flotte spcialise dans le transport de produits
raffins. Cette compagnie a t cre par le logisticien belge Sea-Invest. La flotte de Sea Tankers est
exploite en Europe, en Afrique et dans les Carabes. Elle compte 29 navires dont 17 sous pavillon
franais. Les chances de fin d'obligation de pavillon en dcoulant s'chelonnent de 2010 2015.
Euronav est un armateur, un oprateur et un grant de navires intgrs verticalement. Outre sa
6
Les Very Large Crude Carriers (en franais : trs grand ptrolier transporteur de brut ) sont une classe de ptroliers
gants dont le port en lourd est compris entre 150 000 tonnes (fin de la taille Suezmax) et 320 000 tonnes (dbut de la taille
ULCC, Ultra Large Crude Carrier).
14
flotte de ptroliers, Euronav offre galement un ventail complet de services maritimes. Euronav opre
sa flotte sur le march spot ainsi qu'au travers de contrats d'affrtements fixes. Lexploitation
commerciale de la majeure partie des VLCC et d'Euronav est confie Tankers International. La
majeure partie de sa flotte de Suezmax est frte long terme. Euronav est galement capable de
fournir et d'oprer des navires FSO (Floating, Storage and Offloading) au travers de conversions ou de
btiments neufs. La flotte est gre au dpart de trois filiales : Euronav Ship Management SA et
Euronav SAS, deux compagnies franaises ayant leur sige social Nantes (France), et Euronav Ship
Management (Hellas) Ltd., ayant son bureau principale au Pire, Grce.
Aujourdhui, le secteur du transport ptrolier est celui plus problmatique du point de vue de la
flotte franaise. En effet, le principal risque pour larmement national rsulte de lvolution des
capacits de raffinage sur le territoire franais, qui pourrait entraner la sortie du pavillon de plusieurs
VLCC, avec une rduction importante de la flotte marchande sous pavillon national en termes de
tonnage. Actuellement, en effet, lapplication de la loi de 1992 prvoit que tout propritaire dune unit
de raffinage de ptrole brut installe en France doit disposer dune capacit de transport maritime sous
pavillon franais proportionnelle aux quantits de ptrole brut entrant dans cette usine. Or, la crise
financire a fortement impact les compagnies ptrolires et la rentabilit du secteur du raffinage sest
effondre. Au niveau mondial, le double effet dune augmentation des capacits de production des
raffineries et de la relocalisation dans les pays producteurs a conduit une situation excdentaire
consquente et durable. Cest ainsi que lactivit de raffinage diminue en France, avec un impact lourd
sur le secteur du transport de ptrole brut et sur larmement national. Le secteur est galement
concern par larrive chance dans les annes venir de lobligation de pavillon pour les navires
achets par le biais de GIE fiscaux.
Le secteur du transport de GNL est un secteur porteur, qui traverse cependant en France une
priode difficile. Gazocan est la compagnie leader du march. Elle est dtenue 80% par GDF-Suez et
elle exploite 4 mthaniers sous pavillons franais. La compagnie a connu des pertes en 2008, mais elle a
t de nouveau rentable en 2009. Son actionnaire principal, GDF Suez, a pour sa part dgag un
rsultat net de 4,5 milliards d'euros en 2009. Malgr ces rsultats positifs, la direction de lentreprise a
prsent un plan de restructuration en avril 2010 prvoyant le dsarmement du navire Le Tellier
(dernier mthanier au 1
er
registre depuis la sortie de flotte du Descartes) et la suppression des 60 postes
d'excution lis l'exploitation de sa flotte sous pavillon franais.
2.4 Transport roulier et de passagers a courte distance
Le secteur des navires rouliers est prpondrant en Europe, o le march ouvert a favoris son
dveloppement. En revanche, il a pratiquement disparu des routes intercontinentales face la
concurrence du conteneur. Ce secteur a t lourdement touch par la crise. En effet, les nouvelles
units commandes entre 2007 et 2008 pour rpondre au vieillessement de la flotte, sont arrives sur le
march en mme temps que la crise, en faisant chuter les taux daffrtement. Ainsi, en 2009, la stratgie
a t de rationaliser et de rorganiser le dpoloiement des flottes, avec par consquence la fermeture
dun certain nombre de routes et de services. Ce contexte a galement nui au dveloppement des
autoroutes de la mer, dont plusieurs projets ont t abandonns ou reports par les armateurs. Le
march des navires rouliers est plutt fragile, ce qui explique la forte tendance au regroupement des
oprateurs et lmergence de hub portuaires, dans une optique de rationalisation des cots, tant en ce
qui concerne lexploitation des pur frteurs ro-ro ddis aux flux industriels et aux remorques routires
non-accompagnes quen ce qui concerne les navires mixtes ro-pax.
En France mtropolitaine, cest le secteur du transport passagers qui prsente la plus haute
importance du point de vue conomique, de lemploi et de lamnagement du territoire. Or, ce march
dcrot depuis plusieurs annes sur tous les segments, face la concurrence du mode arien bas cot
et du lien fixe sur le trafic transmanche. Il subsiste de manire significative dans seulement deux
crneaux importants : les traverses courtes et les croisires. En France, donc, les deux marchs les plus
importants sont celui de la desserte maritime de la Corse et celui de la desserte transmanche. Par
15
ailleurs, sur ces deux segments le nombre de compagnies exploitant des navires battant pavillon tiers
(LD-lines sur le transmanche, Corsica Ferries sur la Corse et, depuis le 1
er
avril 2010, Moby Lines)
s'accrot. La crise conomique des derniers mois a aggrav ces tendances en acclrant la rduction de
la demande. Par consquent, les principales compagnies franaises oprant dans ce secteur avec des
navires sous 1
er
registre mtropolitain, la SNCM sur la desserte de la Corse et Brittany Ferries et
SeaFrabce sur la desserte transmanche, traversent une priode de bouleversement conomique, qui
pourrait avoir un lourd impact sur lemploi national de marins.
La desserte maritime de la Corse
a) volution des trafics sur les liaisons Corse-Continent
La desserte de la Corse compte 24 liaisons maritimes, (France et Italie) assures par 6
compagnies. La SNCM (Socit Nationale maritime Corse Mditerrane) et Corsica Ferries assurent
90% du trafic. Cette dernire est devenue l'acteur principal du march en 2002 et dtient dsormais
63% du trafic passagers (chiffres 2010). Le reste du march se partage entre la SNCM (27%), la CMN
(6%) et, depuis avril, Moby Lines (4%).
Les trafics sur la Corse sont en nette progression depuis plusieurs annes. La progression du
nombre de passagers transports s'est poursuivie en 2009, avec 7,3 millions de passagers (maritime +
arien) contre 6,9 millions en 2008. Concernant le transport de fret, mme si ce dernier s'effectue
principalement au dpart de Marseille, toutefois, CFF a russi capter en 10 ans plus de 20% des trafics
fret partir de Toulon au dtriment des compagnies dlgataires.
La saison estivale 2010 a t la hauteur des volutions passes. La progression globale de 8%
cache une progression de 20% de Corsica Ferries, qui avait mis en ligne un navire supplmentaire par
rapport 2010 (accroissement de son offre de places de 20%). Moby-ligne a fait galement de bons
rsultats, conformes ses prvisions pour cette 1re anne (plus de 30 000 passagers depuis le 1er
avril). Par contre, la SNCM continue de chuter (entre -7 et -13%), particulirement sur Marseille (Le
Corse et le Liamone II ont t dploys sur Nice). Les taux de remplissage ont t maintenus grce
une diminution de l'offre sur la DSP (-108 traverses).
b) Le march de la desserte maritime de la Corse : situation conomique et dpense publique
Le march maritime corse se caractrise par une surcapacit de l'offre par rapport la demande.
L'arrive, en 2010, d'un nouveau navire de CFF et d'un nouvel oprateur ont encore aggrav cette
situation. Aujourd'hui, les 4 compagnies prsentes offrent prs de 7 millions de places face une
demande d'environ 3 millions de passagers.
L'augmentation de l'offre a conduit une baisse gnralise des prix, avec une rpercussion sur
les conditions d'exploitation des compagnies assurant le service public. Cette augmentation concerne
galement le fret, qui bnficie Toulon d'un moindre cot de la manutention et de liaisons plus
courtes avec la Corse.
L'accroissement des trafics fret et passagers Toulon fragilise les compagnies dlgataires, ce qui
conduit une augmentation du montant des compensations financires verses par la CTC. En outre, le
cot associ au dispositif d'aide sociale a cru avec les trafics au fil des annes, en passant ainsi de 7,5
M en 2002 21,5 en 2009. A partir de 2010, celui-ci a t plafonn 16 M.
c) La situation conomique de la SNCM
La SNCM exploite 10 navires (4 cargos mixtes, 5 ferries, 1 NGV). En trois ans, l'effectif de la
compagnie est pass de 2 140 salaris (dont 1477 navigants) 1 853 (dont 1307 navigants mi-2010).
La situation financire de la compagnie continue de se dgrader en relation avec les volutions de trafic.
Le chiffre d'affaires de 2009 (196,7 M) tait en baisse de 10,3% par rapport 2008. Perte
d'exploitation de 6,6 M en 2009, le rsultat net a t positif (17,7 M) uniquement en raison de la
cession des participations de la SNCM dans la CMN. En 2010, la SNCM confronte une
augmentation massive de loffre concurrente continue de perdre des parts de march. La forte
16
progression de la frquentation de l'le en 2010 (8% selon l'OTC) a bnfici pour l'essentiel ses
concurrents. Pour la saison estivale, qui reprsente 65% du chiffre d'affaires passagers, ses
performances se situent -9,5 % en passagers et -13,5% en CA par rapport 2009.
Dans un contexte social toujours fragile, sa situation commerciale et financire s'est aggrave au
1
er
semestre 2010. En mars 2010, la compagnie prvoyait 10 M de perte. Ces prvisions ont t revues
en juillet la hausse (-20 M). Courant lautomne, la presse faisait tat dune perte de -25 M. L'anne
sera probablement sauve par des rsultats exceptionnels (vente CMN, sige, Monte Cinto etc.)
La desserte maritime transmanche
L'offre de transport transmanche rpond une demande fret et passagers et repose sur plusieurs
modes (maritime, ferroviaire et transport combin) en concurrence sur les diffrents segments de la
demande. Depuis plus de 15 ans, le transport maritime doit faire face la concurrence du tunnel sous la
Manche. Au cours de 2010, les trafics du tunnel ont repris leur croissance, alors que le trafic maritime a
travers une priode difficile. Au-del de la concurrence modale, les compagnies maritimes oprant sur
ce secteur ont subi des frquents ajustements de march lis aux volutions de la situation conomique
britannique. Ainsi, si la rcession des conomies britannique et irlandaise en 2010 a contribu bloquer
le march, le retour la croissance nest pas prvu pour 2011. Le Royaume-Uni connat une situation
budgtaire trs dgrad (dficit 11,3 % du PIB en 2009 et autour de 11 % en 2010 et 2011 selon la
Commission europenne). Avec un retournement du secteur immobilier et des consommations en
baisse (remont du taux dpargne, pertes de pouvoir dachat, ralentissent des salaires et inflation
leve), lconomie britannique est rentre partir de fin 2010 dans une phase de ralentissement. A cela
sajoutera, pour 2011, un choc sur la consommation li la hausse de la TVA, la pression de
lassainissement des finances publiques et au ralentissement de lconomie mondiale. Cela explique
pourquoi, alors que la reprise du fret est avre en Baltique et en mer du Nord, les volumes
destination de la Grande-Bretagne et de lIrlande sont en berne. Tous les oprateurs prsents sur les
liaisons transmanche subissent les impacts de la mauvaise situation conomique britannique : SeaFrance
est en phase de redressement judiciaire, P&O Ferries de licenciements, LD Lines a supprim la ligne
Douvres-Boulonge et Brittany Ferries connat des rsultats contrasts selon les services.
a) La situation de Sea France
SeaFrance, filiale de la SNCF, assure une liaison Calais-Douvres sur laquelle elle met en ligne
quatre navires battant pavillon franais (dont un frteur) assurant 30 rotations quotidiennes. Sa flotte
alignait sept navires jusquen 2007. En 2009, elle a t rduite quatre units.
Les graves difficults financires ont conduit la compagnie recourir un plan social qui a t
lorigine dun mouvement important de grve. Aprs une nouvelle grve portant sur les conditions
darmement des navires pendant le week-end de Pques 2010 (qui a provoqu une perte de 2 M), le
Conseil de surveillance a dcid, pour viter la cessation de paiement et la liquidation, de saisir le
Tribunal de commerce de Paris qui a plac l'entreprise en procdure de sauvegarde le 16 avril 2010. A
lissue de cet pisode, la direction a propos dbut juin 2010 un plan de restructuration (le nouvel plan
industriel, NPI) prvoyant 725 suppressions de poste (soit prs de 45% de l'effectif, 243 de plus que
dans l'accord de mdiation et 75 de plus que les 650 prvus dans le 1er plan propos par l'entreprise)
sans entraner, ce jour (novembre 2010), de ractions des syndicats ou des salaris qui semblent
rsigns afin d'viter la liquidation judiciaire. A l'issue des dparts enregistrs ces derniers mois,
l'effectif de SeaFrance est aujourd'hui infrieur 1300 salaris (Ils taient prs de 1600 en 2009).
L'effectif final sera de 853 ETP.
Avec ce plan, la direction espre un retour une marge d'exploitation positive l'horizon 2013-
2014. Le soutien de la SNCF (actionnaire unique de SeaFrance), qui assure la trsorerie de l'entreprise,
dpend de la bonne excution de ce plan et de la conclusion d'accords d'organisation avec les salaris.
La SNCF pourrait alors, sous rserve de l'accord de la Commission (au titre des aides d'tat) refinancer
l'entreprise hauteur de 170 M (SeaFrance estime ses besoins 190 M).
b) La situation de Brittany Ferries
17
Brittany-ferries exploite 8 lignes rgulires fret et passagers. Elle dessert lAngleterre et lIrlande
partir de la France ainsi que lEspagne partir de lAngleterre. Larmement arme une flotte compose
de 8 navires dont 6 transbordeurs de grande capacit (proprits du groupe). Fin 2009, Brittany-ferries
employait 2.403 personnes (ETP en effectif moyen entre la baisse et la haute saison) dont 1.615
navigants, ce qui en fait le premier employeur de marins franais.
Britanny Ferries est confront une trs forte concurrence renforce sur la Manche et redoute
l'activit d'armateurs comme Louis Dreyfus Armateurs (Le Havre Southampton sous pavillon
britannique), qui renforce ses liaisons sur le Transmanche et Transmanche Ferries (Dieppe
Newhaven) et peroit des subventions (via une DSP) du Conseil gnral de Seine Maritime au titre d'un
service public Transmanche.
2.5 Autoroutes de la mer
De janvier 2005 mars 2009, date de sa suspension, LDA et le groupe italien Grimaldi ont assur
conjointement un service maritime de fret Ro-Ro et de passagers entre les ports de Toulon et de
Civitavecchia selon le concept d autoroutes de mer . Les pertes enregistres sur cette ligne n'ont pas
permis la poursuite de son exploitation.
Le 16 septembre 2010, LDA a ouvert l'autoroute de la mer entre Nantes-Saint-Nazaire et Gijon,
en Espagne. Aprs une longue phase administrative, la ligne a fait l'objet d'un trait conclu en mars
2009 par la France et l'Espagne, ratifi par les parlements franais et espagnol. Le navire Norman
Bridge effectue dsormais 3 allers-retours par semaine. Il est exploit par GLD Atlantique, socit cre
par LDA et Grimaldi, mais au sein de laquelle le groupe italien, dont le fondateur est dcd en
septembre 2010, sest finalement retir.
18
3. CONCLUSIONS
Globalement, les dernires tendances macroconomiques mesures et les prvisions dvolution
en 2011 des changes mondiaux indiquent un possible ralentissement de la reprise du transport
maritime, qui traverse depuis le dbut de 2010 une phase de consolidation de son activit aprs un an et
demi de rcession. 2010 a marqu pour ce secteur le retour son niveau dactivit d'avant la crise.
Cependant, les taux de croissance plutt levs du 1
er
semestre ont fait place une croissance plus
modre au second. Les politiques d'austrit en Europe et aux tats-Unis et les politiques
conomiques asiatiques sont susceptibles de produire une baisse des changes mondiaux l'avenir, avec
par consquent un impact ngatif sur tous les secteurs du transport maritime. Sur ce march, les
prvisions de la demande demeurent la hausse. Nanmoins, les tarifs du fret ptrolier reculent de
manire ininterrompue depuis lt en relation avec la grave situation de surcapacit qui affecte le
secteur, notamment sur le march des VLCC.
Aprs les importantes livraisons des mois passs et des carnets de commande toujours
importants, le problme de surcapacit affecte aujourd'hui tous les secteurs d'activit du shipping. Ainsi,
dans un contexte conomique o les prix du transport maritime auront du mal se redresser, les
armateurs devront faire face des cots croissants, notamment en ce qui concerne le cot des soutes.
Tir par les volutions de la demande de ptrole, ce dernier sera galement impact l'avenir par la mise
en place d'une politique de rduction des missions de CO2 spcifique pour le transport maritime. La
mise en place des dispositions de l'Annexe 6 de la Convention Marpol concernant le teneur en soufre
des carburants a dj contribu renchrir le mode maritime sur certains segments (SECA Mer du
Nord et Baltique). Plusieurs tudes dmontrent, en outre, que le passage la teneur 0,1% l'chance
2015 dans ces mmes secteurs va significativement renchrir ce mode de transport et risque donc
dentrainer un report modal de la mer vers la route.
Concernant la flotte franaise, les prvisions d'volution ne sont pas trs optimistes. La
conjugaison de plusieurs facteurs risque de porter un coup svre la flotte de commerce sous pavillon
national. Parmi ces facteurs, il faut rappeler : les sorties de GIE fiscal, la concurrence exacerbe entre
compagnies et registres, la baisse de la capacit de raffinage en France (rduisant l'obligation de
transports d'hydrocarbures sous pavillon national, avec par consquent une sortie potentielle de gros
ptroliers de type VLCC) et le risque de retour des navires sous gestion des socits mres (Bromstrm
repris par Maersk, Fouquet Sacop et Petromarine reprises par Seainvest).
Vous aimerez peut-être aussi
- La ConteneurisationDocument70 pagesLa ConteneurisationAllache Abderrahman100% (2)
- Les Droits Et Les Obligations Du Transitaire en DouaneDocument6 pagesLes Droits Et Les Obligations Du Transitaire en DouaneAllache AbderrahmanPas encore d'évaluation
- 6 Approvisionnement Experience SolthisDocument58 pages6 Approvisionnement Experience SolthisAllache AbderrahmanPas encore d'évaluation
- Les Couts Induits Par Les StocksDocument11 pagesLes Couts Induits Par Les StocksAllache AbderrahmanPas encore d'évaluation
- ABC Et WilsonDocument18 pagesABC Et WilsonAllache Abderrahman100% (1)
- StocksDocument5 pagesStocksAllache AbderrahmanPas encore d'évaluation
- Gestion de Stock SETTATDocument15 pagesGestion de Stock SETTATMarouane BelhatPas encore d'évaluation
- Performance de L'entrepôtDocument16 pagesPerformance de L'entrepôtSébastien Bonnaire100% (3)
- Armateurs Du Maroc Par Najib CHERFAOUIDocument5 pagesArmateurs Du Maroc Par Najib CHERFAOUIZakaria Smart100% (1)
- Cours 1 LogistiqueDocument73 pagesCours 1 LogistiqueAllache Abderrahman67% (3)
- Grande Distribution Au MarocDocument2 pagesGrande Distribution Au MarocAllache Abderrahman75% (4)
- Accès Au Dossier MédicalDocument1 pageAccès Au Dossier MédicalAllache AbderrahmanPas encore d'évaluation
- Gestion Cours 3 PDFDocument5 pagesGestion Cours 3 PDFbenslamasouheilPas encore d'évaluation
- La Garantie Bancaire À Première Demande Dans Le Cadre Des Marchés PublicsDocument20 pagesLa Garantie Bancaire À Première Demande Dans Le Cadre Des Marchés PublicsRacem GassaraPas encore d'évaluation
- Blanchiment Des Capitaux Diagnostic Et Perspectives Pour Le Cas MarocainDocument81 pagesBlanchiment Des Capitaux Diagnostic Et Perspectives Pour Le Cas MarocainLahlou Hamza50% (2)
- BARTSITS PONOMARENKO BYSTRYAKOV CURBATOV VIDAL Et All La Russie Et La France Dans L'espace Mondial de L'ensegnement SuperieurDocument209 pagesBARTSITS PONOMARENKO BYSTRYAKOV CURBATOV VIDAL Et All La Russie Et La France Dans L'espace Mondial de L'ensegnement SuperieurAll KPas encore d'évaluation
- Leçon 2 LES FLUX.Document5 pagesLeçon 2 LES FLUX.ningsa ikouyou EfremPas encore d'évaluation
- Patrocle PETRIDISDocument21 pagesPatrocle PETRIDISbeverly DOUNIAMA ALLOMEAPas encore d'évaluation
- Section 2:: Le Diagnostic ExterneDocument67 pagesSection 2:: Le Diagnostic ExterneABBES Nour-ElHoudaPas encore d'évaluation
- Yello StartUp Dossier 10 Conseils - 3Document3 pagesYello StartUp Dossier 10 Conseils - 3decoPas encore d'évaluation
- Evaluation D'un Projet D'investissementDocument116 pagesEvaluation D'un Projet D'investissementMouhssine IrkmanePas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Etat Des Soldes de GestionDocument34 pagesChapitre 3 Etat Des Soldes de GestionFarhati oumaimaPas encore d'évaluation
- NORMES IFRS Et Normes MarocainesDocument64 pagesNORMES IFRS Et Normes MarocainesHicham AHPas encore d'évaluation
- Plan:: ProblématiqueDocument7 pagesPlan:: ProblématiqueAbd Elkarim Aït AmarPas encore d'évaluation
- Service Incompris - Pour Le Retour Du Client by Jean-Paul GUEDJDocument197 pagesService Incompris - Pour Le Retour Du Client by Jean-Paul GUEDJJEUNEENIMAPas encore d'évaluation
- 4 Partie-1 Focus-1Document35 pages4 Partie-1 Focus-1filgoud67Pas encore d'évaluation
- Expose 2022Document6 pagesExpose 2022hanae MouhssinePas encore d'évaluation
- Cours Micro J BerrebehDocument76 pagesCours Micro J BerrebehSimo Simo67% (3)
- Gestion de ProductionDocument64 pagesGestion de ProductionHamid NimklalPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument22 pages1 PBBATTAHIPas encore d'évaluation
- QCM GRH Fayssal Merraoui - CopieDocument3 pagesQCM GRH Fayssal Merraoui - CopieHaytam Elghaoui100% (2)
- Rapport de Stage AmonDocument26 pagesRapport de Stage AmonHugues Cédric KouadioPas encore d'évaluation
- Étude Qualitative Sur Les Jeunes Neet Au MarocDocument180 pagesÉtude Qualitative Sur Les Jeunes Neet Au Marocrima bouzianePas encore d'évaluation
- La Regionalisation Avancee PDFDocument4 pagesLa Regionalisation Avancee PDFRéda TsouliPas encore d'évaluation
- Définition de La Masse MonétaireDocument3 pagesDéfinition de La Masse MonétaireYoussef ElmPas encore d'évaluation
- Valeur de Pip Par LotDocument10 pagesValeur de Pip Par LotMahé Franck Marcel GuéiPas encore d'évaluation
- Comptabilité NationaleDocument14 pagesComptabilité NationaleTesoro HonPas encore d'évaluation
- Le Rapport D'oxfam Sur Les InégalitésDocument160 pagesLe Rapport D'oxfam Sur Les Inégalitésmidilibre34Pas encore d'évaluation
- Ias 17Document7 pagesIas 17alecharpentierPas encore d'évaluation
- Marchandising Et Gestion Des RayonsDocument25 pagesMarchandising Et Gestion Des Rayonsarsene ananiPas encore d'évaluation
- Transport Et LogistiqueDocument32 pagesTransport Et LogistiqueMariem AzzabiPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Le Calcul Des Charges IncorporablesDocument4 pagesChapitre 2 Le Calcul Des Charges IncorporablescharlottePas encore d'évaluation