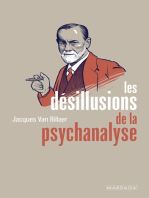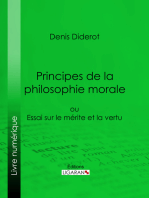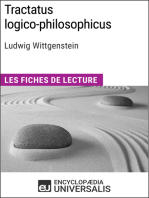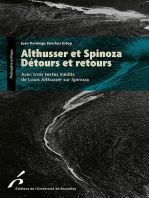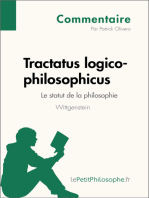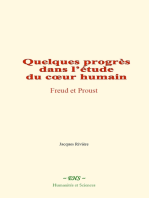Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Hegel, La Mort Et Le Sacrifice
Hegel, La Mort Et Le Sacrifice
Transféré par
Colman HoganTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Hegel, La Mort Et Le Sacrifice
Hegel, La Mort Et Le Sacrifice
Transféré par
Colman HoganDroits d'auteur :
Formats disponibles
GEORGES BA T A I L L E
uvres
compltes
XI I
Articles 2
1950-1961
G A L L I M A R D
Hegel,
la mort et lesacrifice*
Deucalion 1
L'animal meurt. Mais l a mort de l'animal est le
devenir de la conscience.
I. LA MORT
La ngativit de l'homme.
Dans les Confrences de 1805-1806, au moment de la pleine
maturit de sa pense, lpoque o il crivait la Phnom
nologie de l'esprit, Hegel exprimait ainsi le caractre noir de
lhumanit :
Lhomme est cette nuit, ce Nant vide, qui contient tout
dans sa simplicit indivise: une richesse dun nombre infini
de reprsentations, dimages, dont aucune ne lui vient pr
cisment lesprit, ou (encore), qui ne sont pas (l) en tant
que rellement prsentes. Cest la nuit, lintriorit ou
lintimit de la Nature qui existe ici : (le) Moi-personnel pur.
Dans des reprsentations fantasmagoriques il fait nuit tout
autour : ici surgit alors brusquement une tte ensanglante;
l, une autre apparition blanche ; et elles disparaissent tout
aussi brusquement. Cest cette nuit quon aperoit si lon
regarde un homme dans les yeux : on plonge alors ses regards
* Extrait dune tude sur la pense, fondamentalement hglienne dAlexandre
Koive. Cette pense veut tre, dans la mesure o cest possible, la pense de Hegel
telle quun esprit actuel, sachant ce que Hegel na pas su (connaissant, par exemple,
les vnements depuis 1917 et, tout aussi bien, la philosophie de Heidegger), pourrait
la contenir et la dvelopper. Loriginalit et le courage, il faut le dire, dAlexandre
Kojve est davoir aperu limpossibilit daller plus loin, la ncessit, en consquence,
de renoncer faire une philosophie originale, et par l, le recommencement inter
minable qui est laveu de la vanit de la pense.
en une nuit qui devient terrible; cest la nuit du monde qui
se prsente alors nous *.
Bien entendu, ce beau texte , o sexprime le romantisme
de Hegel ne doit pas tre entendu au sens vague. Si Hegel
fut romantique, ce fut peut-tre dune manire fondamentale
(il fut de toute faon romantique pour commencer dans sa
jeunesse , alors quil tait banalement rvolutionnaire), mais
il ne vit pas alors dans le romantisme la mthode par laquelle
un esprit ddaigneux croit subordonner le monde rel lar
bitraire de ses rves. Alexandre Kojve, en les citant, dit de
ces lignes quelles expriment l ide centrale et dernire de
la philosophie hglienne , savoir : lide que le fonde
ment et la source de la ralit objective (Wirklichkeit) et de
lexistence empirique (Dasein) humaines sont le Nant qui se
manifeste en tant quAction ngative ou cratrice, libre et
consciente delle-mme .
Pour donner accs au monde dconcertant de Hegel, j ai
cru devoir en marquer par une vue sensible la fois les
violents contrastes et lunit dernire.
Pour Kojve, la philosophie dialectique ou anthropo
logique de Hegel est en dernire analyse une philosophie de la
mort (ou ce qui est la mme chose : de lathisme) ** .
Mais si lhomme est la mort qui vit une vie humaine *** ,
cette ngativit de lhomme, donne dans la mort du fait
quessentiellement la mort de lhomme est volontaire (dri
vant de risques assums sans ncessit, sans raisons biolo
giques), nen est pas moins le principe de laction. Pour Hegel,
en effet, lAction est Ngativit, et la Ngativit, Action. Dun
ct lhomme niant la Nature en y introduisant comme un
envers, lanomalie dun Moi personnel pur est prsent
dans le sein de cette Nature comme une nuit dans la lumire,
comme une intimit dans lextriorit de ces choses qui sont
en soi comme une fantasmagorie o il nest rien qui se
compose sinon pour se dfaire, qui apparaisse sinon pour
disparatre, rien qui ne soit, sans trve, absorb dans le nan
tissement du temps et nen tire la beaut du rve. Mais voici
laspect complmentaire: cette ngation de la Nature nest
pas seulement donne dans la conscience, o apparat (mais
cest pour disparatre) ce qui est en soi ; cette ngation sex
* Cit par Kojve, IntroductionlalecturedeHegel, p. 573.
** Op. cit., p. 537.
*** Op. cit., p. 548.
triorise et, sextriorisant, change rellement (en soi) la ralit
de la Nature. Lhomme travaille et combat : il transforme le
donn ou la nature : il cre en la dtruisant, le monde, un
monde qui ntait pas. Il y a dun ct posie : la destruction,
surgie et se diluant, dune tte ensanglante ; de lautre Action :
le travail, la lutte. Dun ct, le Nant pur , o lhomme
ne diffre du Nant que pour un certain temps * . De lautre
un Monde historique, o la Ngativit de lhomme, ce Nant
qui le ronge au-dedans, cre lensemble du rel concret ( la
fois objet et sujet, monde rel chang ou non, homme qui
pense et change le monde).
La philosophie de Hegel est une philosophie de la mort ou de
l'athisme **.
Cest le caractre essentiel et nouveau de la philosophie
hglienne de dcrire la totalit de ce qui est. Et en cons
quence, en mme temps quelle rend compte de tout ce qui
apparat nos yeux, de rendre compte solidairement de la
pense et du langage qui expriment et rvlent cette
apparition.
Selon moi, dit Hegel, tout dpend de ce quon exprime
et comprenne le Vrai non pas (seulement) comme substance,
mais tout autant comme sujet ***.
En dautres termes, la connaissance de la Nature est incom
plte, elle nenvisage, et ne peut envisager que des entits
abstraites, isoles dun tout, dune totalit indissoluble, qui
est seule concrte. La connaissance doit tre en mme temps
anthropologique : en plus des bases ontologiques de la ra
lit naturelle, crit Kojve, elle doit chercher celles de la
ralit humaine, qui est seule capable de se rvler elle-mme
par le Discours **** . Bien entendu, cette anthropologie
* Op. cit., p. 573. ,
** bans ce paragraphe, et le paragraphe suivant, je reprends sous une autre forme
ce que dit Alexandre Kojve. Mais non seulement sous une autre forme; j ai essen
tiellement dvelopper la seconde partie de cette phrase, difficile, au premier abord,
comprendre dans son caractre concret: L tre ou le nantissement du Sujet
est lanantissement temporalisant de ltre, qui doit tre avantdtre ananti : ltre
du Sujet a donc ncessairement un commencement. Et tant nantissement (tem
porel) du nant dans ltre, tant nant qui nantit (en tant que Temps), le Sujet"
est essentiellement ngation de soi-mme : il a donc ncessairement une fin. En
particulier, iai suivi pour cela (comme je lai dj fait dans le paragraphe prcdent)
la partie de YIntroductionlalecturedeHegel qui rpond aux parties 2 et 3 de la prsente
tude, savoir : Appendice II, Lide de la mort dans la philosophie de Hegel, p. 527-
573. ^
*** Phnomnologiedelesprit, Prface, Traduction de Jean Hyppolite, t. I, p. 17, 1.
1-4.
**** Op. cit., p. 528.
nenvisage pas lHomme la manire des sciences modernes,
mais comme un mouvement quil est impossible disoler au
sein de la totalit. En un sens, cest plutt une thologie, o
lhomme aurait pris la place de Dieu.
Mais pour Hegel, la ralit humaine quil dcrit au sein, et
au centre, de la totalit est trs diffrente de celle de la
philosophie grecque. Son anthropologie est celle de la tra
dition judo-chrtienne, qui souligne dans lHomme la libert,
l'historicit, et l'individualit. De mme que lhomme judo-
chrtien, lhomme hglien est un tre spirituel (cest--dire
dialectique). Cependant, pour le monde judo-chrtien, la
spiritualit ne se ralise et ne se manifeste pleinement que
dans lau-del, et lEsprit proprement dit, lEsprit vraiment
objectivement rel , cest Dieu : un tre infini et ternel .
Daprs Hegel, ltre spirituel ou dialectique est nces
sairement temporel et fini . Ceci veut dire que la mort seule
assure lexistence dun tre spirituel ou dialectique au sens
hglien. Si lanimal qui constitue ltre naturel de lhomme
ne mourait pas, qui plus est, sil navait pas la mort en lui
comme la source de son angoisse, dautant plus forte quil la
cherche, la dsire et parfois se la donne volontairement, il
ny aurait nr homme ni libert, ni histoire ni individu. Autre
ment dit, sil se complat dans ce qui nanmoins lui fait peur,
sil est ltre, identique lui-mme, qui met ltre (identique)
lui-mme en jeu, lhomme est alors un Homme en vrit : il
se spare de lanimal. Il nest plus dsormais, comme une
pierre, un donn immuable, il porte en lui la Ngativit) et la
force, la violence de la ngativit le jettent dans le mouvement
incessant de lhistoire, qui le change, et qui seul ralise
travers le temps la totalit du rel concret. Lhistoire seule a
le pouvoir dachever ce qui est, de lachever dans le drou
lement du temps. Ainsi lide dun Dieu ternel et immuable
nest-elle, dans cette vue, quun achvement provisoire, qui
survit en attendant mieux. Seule lhistoire acheve et lesprit
du Sage (de Hegel), dans lequel lhistoire rvla, puis acheva
de rvler, le plein dveloppement de ltre et la totalit de
son devenir occupe une situation souveraine, que Dieu noc
cupe que provisoirement, comme rgent.
Aspect tragi-comique de la divinit de l'homme.
Cette manire de voir peut tre bon droit tenue pour
comique. Hegel dailleurs nen parla pas explicitement. Les
textes o elle saffirma implicitement sont ambigus, et leur
extrme difficult acheva de les drober au grand jour. Kojve
lui-mme observe la prudence. Il en parle sans lourdeur,
vitant den prciser les consquences. Pour exprimer comme
il convient la situation dans laquelle Hegel se fourra, sans
doute involontairement, il faudrait le ton, ou du moins, sous
une forme contenue, lhorreur de la tragdie. Mais les choses
auraient bientt une allure comique.
Quoi quil en soit, en passer par la mort manque si bien
la figure divine quun mythe situ dans la tradition associa la
mort, et langoisse de la mort, au Dieu ternel et unique, de
la sphre judo-chrtienne. La mort de Jsus participe de la
comdie dans la mesure o lon ne saurait sans arbitraire
introduire loubli de sa divinit ternelle qui lui appartient
dans la conscience dun Dieu tout-puissant et infini. Le
mythe chrtien, exactement, devana le savoir absolu de
Hegel en fondant sur le fait que rien de divin (au sens pr
chrtien de sacr) nest possible qui ne soit fini. Mais la cons
cience vague o le mythe (chrtien) de la mort de Dieu se
forma, malgr tout, diffrait de celle de Hegel : pour gauchir
dans le sens de la totalit une figure de Dieu qui limitait
linfini, il fut possible dintroduire, en contradiction dun fon
dement, un mouvement vers le fini.
Hegel put et il lui fallut composer la somme (la Totalit)
des mouvements qui se produisirent dans lhistoire. Mais lhu
mour, semble-t-il, est incompatible avec le travail, et lappli
cation que les choses demandent. J e reviendrai sur ce propos,
je nai fait, linstant, que brouiller les cartes... Il est difficile
de passer dune humanit quhumilia la grandeur divine
celle... du Sage divinis, souverain et gonflant sa grandeur
partir de la vanit humaine.
Un texte capital.
Dans ce qui prcde, une seule exigence se dgage de faon
prcise : il ne peut y avoir authentiquement de Sagesse (de
Savoir absolu, ni gnralement rien dapprochant) que le Sage
ne slve, si j ose dire, hauteur de mort, quelque angoisse
quil en ait.
Un passage de la prface de la Phnomnologie de l'esprit *
exprime avec force la ncessit dune telle attitude. Nul doute
* Trad. Hyppolite, t. I, p. 29, cit par Kojve, p. 538-539.
que ce texte admirable, ds labord, nait une importance
capitale , non seulement pour lintelligence de Hegel, mais
en tous sens.
...La mort, crit Hegel, si nous voulons nommer ainsi
cette irralit est ce quil y a de plus terrible et maintenir
luvre de la mort est ce qui demande la plus grande force.
La beaut impuissante hait lentendement, parce quil lexige
delle; ce dont elle nest pas capable. Or, la vie de lEsprit
nest pas la vie qui seffarouche devant la mort, et se prserve
de la destruction, mais celle qui supporte la mort et se conserve
en elle. Lesprit nobtient sa vrit quen se trouvant soi-mme
dans le dchirement absolu. Il nest pas cette puissance (pro
digieuse) en tant le Positif qui se dtourne du Ngatif, comme
lorsque nous disons de quelque chose : ceci nest rien ou (ceci
est) faux et, layant (ainsi) liquid, passons de l quelque
chose dautre ; non, lEsprit nest cette puissance que dans la
mesure o il contemple le Ngatif bien en face (et) sjourne
prs de lui. Ce sjour-prolong est la force magique qui trans
pose le ngatif dans ltre-donn.
La ngation humaine de la nature et de l'tre naturel de l'homme.
En principe, j aurais d commencer plus haut le passage
cit. J ai voulu ne pas alourdir ce texte en donnant les lignes
nigmatiques qui les prcdent. Mais j indiquerai le sens
des quelques lignes omises en reprenant linterprtation de
Kojve, sans laquelle la suite, en dpit dune apparence rela
tivement claire, pourrait nous rester ferme.
Pour Hegel, il est en mme temps fondamental et tout
fait digne dtonnement que lentendement de lhomme (cest-
-dire le langage, le discours) ait eu la force (il sagit dune
puissance incomparable) de sparer de la Totalit ses lments
constitutifs. Ces lments (cet arbre, cet oiseau, cette pierre)
sont en effet insparables du tout. Ils sont lis entre eux par
des liaisons spatiales et temporelles, voire matrielles, qui sont
indissolubles . Leur sparation implique la Ngativit humaine
lgard de la Nature, dont j ai parl sans en faire ressortir
une consquence dcisive. Cet homme niant la nature, en
effet, ne pourrait daucune faon exister en dehors delle. Il
nest pas seulement un homme niant la Nature, il est dabord
un animal, cest--dire la chose mme quil nie : il ne peut
donc nier la Nature sans se nier lui-mme. Le caractre de
totalit de lhomme est donn dans lexpression bizarre de
Kojve : cette totalit est dabord Nature (tre naturel), cest
lanimal anthropophore (La Nature, lanimal indissoluble
ment li lensemble de la Nature, et qui supporte lHomme).
Ainsi la Ngativit humaine, le dsir efficace que lHomme a
de nier la Nature en la dtruisant en la rduisant ses
propres fins : il en fait par exemple un outil et loutil sera le
modle de lobjet isol de la Nature ne peut sarrter devant
lui-mme : en tant quil est Nature, lHomme sexpose lui-
mme sa propre Ngativit. Nier la Nature, cest nier lani
mal qui sert de support la Ngativit de lHomme. Sans
doute nest-ce pas lentendement brisant lunit de la Nature
qui veut quil y ait mort dhomme, mais lAction sparatrice
de lentendement implique lnergie monstrueuse de la pen
se, du pur Moi abstrait , qui soppose essentiellement la
fusion, au caractre insparable des lments - constitutifs
de lensemble qui, avec fermet, en maintient la sparation.
Cest la position comme telle de ltre spar de lhomme,
cest son isolement dans la Nature, et, en consquence, son
isolement au milieu de ses semblables, qui le condamnent
disparatre dune manire dfinitive. Lanimal ne niant rien,
perdu sans sy opposer dans lanimalit globale, comme lani
malit est elle-mme perdue dans la Nature (et dans la totalit
de ce qui est) ne disparat pas vraiment... Sans doute* la mouche
individuelle meurt, mais ces mouches-ci sont les mmes que
lan dernier. Celles de lan dernier seraient mortes?... Cela se
peut, mais rien na disparu. Les mouches demeurent, gales
elles-mmes comme le sont les vagues de la mer. Cest
apparemment forc : un biologiste spare cette mouche-ci du
tourbillon, un trait de pinceau y suffit. Mais il la spare pour
lui, il ne la spare pas pour les mouches. Pour se sparer des
autres, il faudrait la mouche la force monstrueuse de
lentendement : alors elle se nommerait, faisant ce quopre
gnralement lentendement par le langage, qui fonde seul
la sparation des lments, et la fondant se fonde sur elle,
lintrieur dun monde form dentits spares et nommes.
Mais dans ce jeu lanimal humain trouve la mort : il trouve
prcisment la mort humaine, la seule qui effraie, qui glace,
mais neffraie et ne glace que lhomme absorb dans la cons
cience de sa disparition future, en tant qutre spar, et
irremplaable; la seule vritable mort, qui suppose la spa
ration et, par le discours qui spare, la conscience dtre
spar.
La beaut impuissante hait l'entendement.
Jusquici le texte de Hegel prsente une vrit simple et
commune, - mais nonce dune manire philosophique, qui
plus est, proprement sibylline. Dans le passage cit de la
Prface, Hegel au contraire affirme, et dcrit, un moment
personnel de violence. Hegel, cest--dire le Sage, auquel un
Savoir absolu confre la satisfaction dfinitive. Ce nest pas
une violence dchane. Ce que Hegel dchane nest pas la
violence de la Nature, cest lnergie ou la violence de lEn
tendement, la Ngativit de lEntendement, sopposant la
beaut pure du rve, qui ne peut agir, qui est impuissante.
En effet, la beaut du rve est du ct du monde o rien
nest encore spar de ce qui lentoure, o chaque lment,
linverse des objets abstraits de lEntendement, est donn
concrtement, dans lespace et le temps. Mais la beaut ne
peut agir. Elle peut tre et se conserver. Agissant, elle ne
serait plus, car lAction dtruirait dabord ce quelle est : la
beaut, qui ne cherche rien, qui est, qui refuse de se dranger,
mais que drange la force de lEntendement. La beaut na
dailleurs pas le pouvoir de rpondre la requte de lEnten
dement, qui lui demande de soutenir en la maintenant luvre
de la mort humaine. Elle en est incapable, en ce sens qu
soutenir cette uvre, elle serait engage dans lAction. La
beaut est souveraine, elle est une fin, ou elle nest pas : cest
pourquoi elle nest pas susceptible dagir, elle est dans son
principe mme impuissante et ne peut cder la ngation
active de lEntendement qui change le monde et devient lui-
mme autre chose que ce quil est *.
Cette beaut sans conscience delle-mme ne peut donc vrai
ment, mais non pour la mme raison que la vie qui recule
dhorreur devant la mort et veut se prserver de lanantis
sement , supporter la mort et se conserver en elle. Cette
* Ici mon interprtation diffre un peu de celle de Kojve (p. 146). Kojve dit
simplement que la beaut impuissante est incapable de se plier aux exigences de
lEntendement. Lesthte, le romantique, le mysticjue fuient lide de la mort et parlent
du Nant lui-mme comme de quelque chose qui est. En particulier, il dfinit ainsi
le mystique admirablement. Mais la mme ambigut se retrouve chez le philosophe
(chez Hegel, chez Heidegger), au moins pour finir. En vrit, Kojve me semble avoir
le tort de ne pas envisager, au-del du mysticisme classique, un mysticisme conscient ,
ayant conscience de faire un tre du Nant, dfinissant, qui plus est, cette impasse
comme celle dune Ngativit qui naurait plus de champ dAction ( la fin de lhistoire).
Le mystique athe, conscient desoi, conscient de devoir mourir et de disparatre, livrait,
comme Hegel le dit videmment delui-mme, dans le dchirement absolu ; mais, pour
lui, il ne sagit que dune priode : lencontre de Hegel, il nen sortirait pas, contem
plant le Ngatif bien en face , mais ne pouvant jamais le transposer en Etre, refusant
de le faire et se maintenant dans lambigut.
beaut qui nagit pas souffre du moins de sentir se briser en
morceaux la Totalit de ce qui est (du rel-concret), qui est
profondment indissoluble. Elle voudrait elle-mme demeu
rer le signe dun accord du rel avec lui-mme. Elle ne peut
devenir cette Ngativit consciente, veille dans le dchi
rement, ce regard lucide, absorb dans le Ngatif. Cette der
nire attitude suppose, avant elle, la lutte violente ou labo
rieuse de lHomme contre la Nature, dont elle est
laboutissement. Cest la lutte historique o lHomme se
constitua comme Sujet ou comme Moi abstrait de l En
tendement , comme tre spar et nomm.
Cest dire, prcise Kojve, que la pense et le discours
rvlateur du rel naissent de lAction ngative qui ralise le
Nant en anantissant ltre : ltre donn de lHomme (dans
la Lutte) et ltre donn de la Nature (par le Travail qui
rsulte dailleurs du contact rel avec la mort dans la Lutte).
Cest donc dire que ltre humain lui-mme nest autre chose
que cette Action : il est la mort qui vit une vie humaine *.
J insiste sur la connexion continuelle dun aspect abyssal et
dun aspect coriace, terre terre, de cette philosophie, la
seule qui eut la prtention dtre complte. Les possibilits
divergentes des figures humaines opposes sy affrontent et
sy assemblent, la figure du mourant et celle de lhomme fier
qui se dtourne de la mort, la figure du seigneur et celle de
lhomme riv au travail, la figure du rvolutionnaire et celle
du sceptique, dont lintrt goste borne le dsir. Cette phi
losophie nest pas seulement une philosophie de la mort. Cen
est une aussi de la lutte de classes et du travail.
Mais dans les limites de cette tude, je nai pas lintention
denvisager lautre versant, je voudrais rapprocher cette doc
trine hglienne de la mort de ce que nous savons du sacri
fice .
I I . LE SA CRI FI CE
Le sacrifice, dune part, et, de Vautre, le regard de Hegel absorb
dans la mort et le sacrifice.
J e ne parlerai pas de linterprtation du sacrifice donne
par Hegel dans le chapitre de la Phnomnologie consacr la
* Kojve, p. 548.
Religion *. Elle a sans doute un sens dans le dveloppement
du chapitre, mais elle loigne de lessentiel, et elle a, selon
moi, du point de vue de la thorie du sacrifice, un intrt
moindre que la reprsentation implicite dans le texte de la
Prface que je continue de commenter.
Du sacrifice, je puis dire essentiellement, sur le plan de la
philosophie de Hegel, quen un sens, lHomme a rvl et
fond la vrit humaine en sacrifiant : dans le sacrifice, il
dtruisit lanimal ** en lui-mme, ne laissant subsister, de lui-
mme et de lanimal, que la vrit non corporelle que dcrit
Hegel, qui, de lhomme, fait selon lexpression de Heidegger
un tre pour la mort (Sein zum Tode), ou selon lexpression
de Kojve lui-mme la mort qui vit une vie humaine .
En vrit, le problme de Hegel est donn dans laction du
sacrifice. Dans le sacrifice, la mort, dune part, frappe essen
tiellement ltre corporel; et cest, dautre part, dans le sacri
fice, quexactement, la mort vit une vie humaine. Mme il
faudrait dire que le sacrifice est prcisment la rponse
lexigence de Hegel, dont je reprendrai la formule :
LEsprit nobtient sa vrit quen se trouvant soi-mme
dans le dchirement absolu. Il nest pas cette puissance (pro
digieuse) en tant le Positif qui se dtourne du Ngatif... non,
lEsprit nest cette puissance que dans la mesure o il contemple
le Ngatif bien en face (et) sjourne prs de lui...
Si lon tient compte du fait que linstitution du sacrifice est
pratiquement universelle, il est clair que la Ngativit, incar
ne dans la mort de lhomme, non seulement nest pas la
construction arbitraire de Hegel, mais quelle a jou dans
lesprit des hommes les plus simples, sans accords analogues
ceux que rglent une fois pour toutes les crmonies dune
glise nanmoins dune manire univoque. Il est frappant
de voir quune Ngativit commune a maintenu travers la
terre un paralllisme troit dans le dveloppement dinsti
tutions assez stables, ayant la mme forme et les mmes effets.
* Phnomnologie, chap. VIII : La Religion, B. : La Religion esthtique, a) Luvre
dart abstraite (t. II, p. 235-236). Dans ces deux pages, Hegel fait bien tat de la
disparition de l'essenceobjective, mais sans en dvelopper la porte. Dans la seconde
page, Hegel se cantonne dans de$ considrations propres la religion esthtique
(la religion des Grecs).
** Toutefois, bien que le sacrifice de lanimal apparaisse antrieur celui de lhomme,
rien ne prouve que le choix de lanimal signifie le dsir inconscient de sopposer
lanimal en tant que tel, cest seulement ltre corporel, ltre donn, que lhomme
soppose. Il soppose dailleurs aussi bien la plante.
Quil vive ou quil meure, l'homme ne peut connatre immdiatement
la mort
J e parlerai plus loin de diffrences profondes entre lhomme
du sacrifice, oprant dans lignorance (linconscience) des
tenants et aboutissants de ce quil fait, et le Sage (Hegel) se
rendant aux implications dun Savoir absolu ses propres
yeux.
Malgr ces diffrences, il sagit toujours de manifester le
Ngatif (et toujours, sous une forme concrte, cest--dire au
sein de la Totalit, dont les lments constitutifs sont ins
parables). La manifestation privilgie de la Ngativit est la
mort, mais la mort en vrit ne rvle rien. Cest en principe
son tre naturel, animal, dont la mort rvle lHomme lui-
mme, mais la rvlation na jamais lieu. Car une fois mort,
ltre animal qui le supporte, ltre humain lui-mme a cess
dtre. Pour que lhomme la fin se rvle lui-mme il
devrait mourir, mais il lui faudrait le faire en vivant en se
regardant cesser dtre. En dautres termes, la mort elle-
mme devrait devenir conscience (de soi), au moment mme
o elle anantit ltre conscient. Cest en un sens ce qui a lieu
(qui est du moins sur le point davoir lieu, ou qui a lieu dune
manire fugitive, insaisissable), au moyen dun subterfuge.
Dans le sacrifice, le sacrifiant sidentifie lanimal frapp de
mort. Ainsi meurt-il en se voyant mourir, et mme en quelque
sorte, par sa propre volont, de cur avec larme du sacrifice.
Mais cest une comdie!
Ce serait du moins une comdie si quelque autre mthode
existait qui rvlt au vivant l'envahissement de la mort : cet
achvement de ltre fini, quaccomplit seul et peut seul
accomplir sa Ngativit, qui le tue, le finit et dfinitivement
le supprime. Pour Hegel, la satisfaction ne peut avoir lieu, le
dsir ne peut tre apais que dans la conscience de la mort.
La satisfaction serait en effet contraire ce que dsigne la
mort, si elle supposait lexception de la mort, si ltre satisfait
nayant pas conscience, et pleinement, de ce quil est dune
manire constitutive, cest--dire mortel, sil devait plus tard
tre chass de la satisfaction par la mort. Cest pourquoi la
conscience quil a de soi doit rflchir (reflter) ce mouvement
de ngativit qui le cre, qui justement fait un homme de lui
pour la raison quun jour il le. tuera.
Sa propre ngativit le tuera, mais pour lui, dsormais, rien
ne sera plus : sa mort est cratrice, mais si la conscience d
la mort de la merveilleuse magie de la mort ne le touche
pas avant quil meure, il en sera pour lui, de son vivant, comme
si la mort ne devait pas latteindre, et cette mort venir ne
pourra lui donner un caractre humain. Ainsi faudrait-il,
tout prix, que lhomme vive au moment o il meurt vraiment,
ou quil vive avec limpression de mourir vraiment.
La connaissance de la mort ne peut se passer d'un subterfuge : le
spectacle.
Cette difficult annonce la ncessit du spectacle, ou gn
ralement de la reprsentation, sans la rptition desquels nous
pourrions, vis--vis de la mort, demeurer trangers, ignorants,
comme apparemment le sont les btes. Rien nest moins ani
mal en effet que la fiction, plus ou moins loigne du rel,
de la mort.
LHomme ne vit pas seulement de pain mais des comdies
par lesquelles il se trompe volontairement. Dans lHomme,
cest lanimal, cest ltre naturel qui mange. Mais lHomme
assiste au culte et au spectacle. Ou encore, il peut lire : alors
la littrature prolonge en lui, dans la mesure o elle est
souveraine, authentique, la magie obsdante des spectacles,
tragiques ou comiques.
Il sagit, du moins dans la tragdie*, de nous identifier
quelque personnage qui meurt, et de croire mourir alors que
nous sommes en vie. Au surplus, limagination pure et simple
suffit, mais elle a le mme sens que les subterfuges classiques,
les spectacles ou les livres, auxquels la multitude recourt.
Accord et dsaccord des conduites naves et de la raction lucide de
Hegel.
En la rapprochant du sacrifice et par l du thme premier
de la reprsentation (de lart, des ftes, des spectacles), j ai voulu
montrer que la raction de Hegel est la conduite humaine
fondamentale. Ce nest pas une fantaisie, une conduite trange,
cest par excellence lexpression que la tradition rptait
linfini. Ce nest pas Hegel isolment, cest lhumanit entire
qui partout et toujours a voulu, par un dtour, saisir ce que
la mort en mme temps lui donnait et lui drobait.
Entre Hegel et lhomme du sacrifice subsiste nanmoins
une diffrence profonde. Hegel sveilla dune manire
* J e parle plus loin de la comdie.
consciente la reprsentation quil se donna du Ngatif : il le
situait, lucidement, en un point dfini du discours cohrent
par lequel il se rvlait lui-mme. Cette Totalit incluant le
discours qui la rvle. Tandis que lhomme du sacrifice, auquel
manqua une connaissance discursive de ce quil faisait, nen
eut que la connaissance sensible, cest--dire obscure,
rduite lmotion inintelligible. Il est vrai que Hegel lui-
mme, au-del du discours, et malgr lui (dans un dchi
rement absolu) reut mme plus violemment le choc de la
mort. Plus violemment surtout, pour la raison que lample
mouvement du discours en tendait la porte sans borne,
cest--dire dans le cadre de la Totalit du rel. Pour Hegel,
sans nul doute, le fait quil demeurait vivant tait simplement
aggravant. Tandis que lhomme du sacrifice maintient sa vie
essentiellement. Il la maintient non seulement dans le sens
o la vie est ncessaire la reprsentation de la mort, mais
il entendait l'enrichir. Mais prendre la chose de haut, lmoi
sensible et voulu dans le sacrifice avait plus dintrt que la
sensibilit involontaire de Hegel. Lmoi dont je parle est connu,
il est dfinissable, et cest lhorreur sacre : lexprience la
fois la plus angoissante et la plus riche, qui ne se limite pas
delle-mme au dchirement, qui souvre au contraire, ainsi
quun rideau de thtre, sur un au-del de ce monde-ci, o
le jour qui slve transfigure toutes choses et en dtruit le
sens born. :
En effet, si lattitude de Hegel oppose la navet du sacri
fice la conscience savante, et lordonnance sans fin dune pen
se discursive, cette conscience, cette ordonnance ont encore
un point obscur : on ne pourrait dire que Hegel mconnut le
moment du sacrifice : ce moment est inclus, impliqu
dans tout le mouvement de la Phnomnologie o cest la
Ngativit de la mort, en tant que lhomme lassume, qui fait
un homme de lanimal humain. Mais nayant pas vu que le
sacrifice lui seul tmoignait de tout le mouvement de la
mort lexprience finale et propre au Sage dcrite dans
* Peut-tre faute dune exprience religieuse catholique. J imagine le catholicisme
plus proche de lexprience paenne. J entends dune exprience religieuse universelle
dont la Rforme sloigne. Peut-tre seule une profonde pit catholique peut avoir
introduit le sentiment intime sans lequel la phnomnologie du sacrifice serait impos
sible. Les connaissances modernes, bien plus tendues que celle du temps de Hegel,
ont assurment contribu la solution de cette nigme fondamentale (pourquoi, sans
raison plausible, Yhumanita-t-ellegnralement sacrifi ?), mais je crois srieusement
quune description phnomnologique correcte ne pourrait que sappuyer au moins
sur une priodecatholique.
la Prface de la Phnomnologie fut dabord initiale et univer
selle, il ne sut pas dans quelle mesure il avait raison, avec
quelle exactitude il dcrivit le mouvement intime de la Nga
tivit; il na pas clairement spar la mort du sentiment de
tristesse auquel lexprience nave oppose une sorte de plate
forme tournante des motions.
La tristesse de la mort et le plaisir.
Le caractre univoque de la mort pour Hegel inspire jus
tement Kojve le commentaire suivant, qui sapplique tou
jours au passage de la Prface* : Certes lide de la mort
naugmente pas le bien-tre de lHomme; elle ne le rend pas
heureux et ne lui procure aucun plaisir. Kojve sest demand
de quelle manire la satisfaction rsulte dun sjour auprs
du Ngatif, dun tte--tte avec la mort, il a cru devoir,
honntement, rejeter la satisfaction vulgaire. Le fait que Hegel
lui-mme dit ce propos de lEsprit quil nobtient sa vrit
quen se trouvant soi-mme dans le dchirement absolu va
de pair, en principe, avec la Ngation de Kojve. En cons
quence, il serait mme superflu dinsister... Kojve dit sim
plement que lide de la mort est seule pouvoir satisfaire
(1) orgueil de lhomme ... En effet, le dsir dtre reconnu ,
que Hegel place lorigine des luttes historiques, pourrait
sexprimer dans une attitude intrpide, propre faire valoir
un caractre. Ce nest, dit Kojve, quen tant ou en se
sentant tre mortel ou fini, cest--dire en existant et se sen
tant exister dans un univers sans au-del ou sans Dieu que
lHomme peut affirmer et faire reconnatre sa libert, son
historicit et son individualit unique au monde . Mais si
Kojve carte la satisfaction vulgaire, le bonheur, il carte
maintenant le dchirement absolu dont parle Hegel : en
effet, un tel dchirement saccorde mal avec le dsir dtre
reconnu.
La satisfaction et le dchirement concident cependant sur
Mais de toute faon, Hegel, hostile Ytresans faire, ce qui estsimplement, et
nest pas Action, sintresserait davantage la mort militaire; cest travers elle quil
aperut le thme du sacrifice (mais il emploie le mot lui-mme dans un sens moral) :
La condition-de-soldat, dit-il, dans ses Confrencesde 1805-1806, et la guerre sont le
sacrifice objectivement rel du Moi-personnel, le danger de mort pour le particulier,
cette contemplation de sa Ngativit abstraite immdiate... (uvres, XX, p. 261-
262, cit par Kojve, p. 558.) Le sacrifice religieux nen a pas moins, du point de vue
mme de Hegel, une signification essentielle.
* Kojve, p. 549. Les mots souligns le sont par lauteur.
un point, mais ils sy accordent avec le plaisir. Cette conci
dence a lieu dans le sacrifice ; sentend gnralement de la
forme nave de la vie, de toute existence dans le temps prsent,
manifestant ce que lHomme est : ce quil signifie de neuf dans
le monde aprs tre devenu l'Homme, et la condition davoir
satisfait ses besoins animaux .
De toute faon, le plaisir, au moins le plaisir des sens, est
tel qu son sujet, laffirmation de Kojve pourrait difficile
ment tre maintenue : lide de la mort contribue, dune
certaine manire et dans certains cas, multiplier le plaisir
des sens. J e crois mme que, sous forme de souillure, le monde
(ou plutt limagerie gnrale) de la mort est la base de
lrotisme. Le sentiment du pch se lie dans la conscience
claire lide de la mort, et de la mme faon le sentiment du
pch se lie au plaisir *. Il nest pas en effet de plaisir humain
sans une situation irrgulire, sans la rupture dun interdit,
dont, actuellement, le plus simple en mme temps le plus
fort est celui de la nudit.
Au surplus, la possession fut associe, en son temps, limage
du sacrifice: ctait un sacrifice dont la femme tait la vic
time... Cette association de la posie antique est pleine de
sens : elle se rapporte un tat prcis de la sensibilit o
llment sacrificiel, le sentiment dhorreur sacre se lia mme,
ltat faible, au plaisir dulcor; o, dautre part, le got
du sacrifice et lmotion quil dgageait navaient rien qui
semblt contraire la jouissance.
Il faut dire aussi que le sacrifice tait, comme la tragdie,
llment dune fte : il annonait une joie dltre, aveugle,
et tout le danger de cette joie, mais cest justement le principe
de la joie humaine : elle excde et menace de mort celui quelle
entrane dans son mouvement.
Langoisse gaie, la gaiet angoisse.
lassociation de la mort au plaisir, qui nest pas donne,
du moins nest pas immdiatement donne dans la cons
cience, soppose videmment la tristesse de la mort, toujours
larrire-plan de la conscience. En principe, consciemment,
lhumanit recule dhorreur devant la mort. Dans leur
principe, les effets destructeurs de la Ngativit ont la Nature
* Cest du moins possible, et sil sagit des interdits les plus communs, cest banal.
pour objet. Mais si la Ngativit de lHomme le porte au-
devant du danger, sil fait de lui-mme, du moins de lani
mal, de ltre naturel quil est, lobjet de sa ngation des
tructrice, la condition banale en est linconscience o il est
de la cause et des effets de ses mouvements. Or, ce fut
essentiel pour Hegel de prendre conscience de la Ngativit
comme telle, den saisir lhorreur, en lespce lhorreur de
la mort, en soutenant et en regardant luvre de la mort
bien en face.
Hegel, de cette manire, soppose moins ceux qui
reculent , qu ceux qui disent : ce nest rien . Il semble
sloigner le plus de ceux qui ragissent gaiement.
J insiste, voulant faire ressortir, le plus clairement possible,
aprs leur similitude, lopposition de lattitude nave celle
de la Sagesse absolue de Hegel. J e ne suis pas sr, en effet,
que des deux lattitude la moins absolue soit la plus nave.
J e citerai un exemple paradoxal de raction gaie devant
luvre de la mort.
La coutume irlandaise et galloise du wake est peu connue,
mais on lobservait encore la fin du sicle dernier. Cest le
sujet de la dernire uvre de Joyce *, Finnegans Wake, c'est
la veille funbre de Finnegan (mais la lecture de ce roman
clbre est au moins malaise). Dans le pays de Galles, on
disposait le cercueil ouvert, debout, la place dhonneur de
la maison. Le mort tait vtu de ses plus beaux habits, coiff
de son haut-de-forme. Sa famille invitait tous ses amis, qui
honoraient dautant plus celui qui les avait quitts quils dan
saient plus longtemps et buvaient plus sec sa sant. Il sagit
de la mort dun autre, mais en de tels cas, la mort de lautre
est toujours limage de sa propre mort. Nul ne pourrait se
rjouir ainsi qu une condition; le mort, qui est un autre,
tant cens daccord, le mort que sera le buveur son tour
naura pas dautre sens que le premier.
Cette raction paradoxale pourrait rpondre au souhait
de nier l'existence de la mort. Souhait logique? J e crois quil
nen est rien. Au Mexique, de nos jours, il est commun
denvisager la mort sur le mme plan que lamusement : on
y voit, dans les ftes, des pantins-squelettes, des sucreries-
squelettes, des manges de chevaux-squelettes, mais cette
* Sur le sujet de ce livre obscur, voir E. Jolas, lucidationdumonomythedeJames Joyce
(Critique, juillet 1948, p. 579-595).
coutume se lie un intense culte des morts, une obsession
visible de la mort*.
Il ne sagit pas, si j envisage la mort gaiement, de dire
mon tour, en me dtournant de ce qui effraie : ce nest rien
ou cest faux . Au contraire, la gaiet, lie luvre de la
mort, me donne de langoisse, elle est accentue par mon
angoisse et elle exaspre cette angoisse en contrepartie : fina
lement langoisse gaie, la gaiet angoisse me donnent en un
chaud-froid l absolu dchirement o cest ma joie qui achve
de me dchirer, mais o labattement suivrait la joie si je
ntais pas dchir jusquau bout, sans mesure.
J e voudrais rendre sensible une opposition prcise : dun
ct lattitude de Hegel est moins entire que celle de lhu
manit nave, mais ceci na de sens que si lon voit, rcipro
quement, lattitude nave impuissante se maintenir sans faux-
fuyant.
Le discours donne des fins utiles au sacrifice aprs coup .
J ai li le sens du sacrifice la conduite de lHomme une
fois ses besoins danimal satisfaits : lHomme diffre de ltre
naturel quil est aussi: le geste du sacrifice est ce quil est
humainement, et le spectacle du sacrifice rend alors son huma
nit manifeste. Libr du besoin animal, lhomme est sou
verain : il fait ce qui lui plat, son bon plaisir. Il peut faire
enfin dans ces conditions un geste rigoureusement autonome.
Tant quil devait satisfaire des besoins animaux, il lui fallait
agir en vue dune fin (il devait sassurer des aliments, se pro
tger du froid). Cela suppose une servitude, une suite dactes
subordonns au rsultat final : la satisfaction naturelle, ani
male, sans laquelle lHomme proprement dit, lHomme sou
verain, ne pourrait subsister. Mais lintelligence, la pense dis
cursive de lHomme se sont dveloppes en fonction du travail
servile. Seule la parole sacre, potique, limite au plan de la
beaut impuissante, gardait le pouvoir de manifester la pleine
souverainet. Le sacrifice nest donc une manire dtre sou
veraine, autonome, que dans la mesure o le discours significatif
ne linforme pas. Dans la mesure o le discours linforme, ce
qui est souverain est donn en termes de servitude. En effet,
ce qui est souverain, par dfinition ne sert pas. Mais le simple
discours doit rpondre la question que pose la pense dis-
* Cela ressortait du documentaire quEisenstein avait tir de son travail pour un
long film : Tonnerresur leMexique. Lessentiel portait sur les bizarreries dont je parle.
cursive touchant le sens que chaque chose doit avoir sur le
plan de lutilit. En principe, elle est l pour servir telle ou
telle fin. Ainsi la simple manifestation du lien de lHomme
lanantissement, la pure rvlation de lHomme lui-mme
(au moment o la mort fixe son attention) passe de la sou
verainet au primat des fins serviles. Le mythe, associ au
rite, eut dabord la beaut impuissante de la posie, mais le
discours autour du sacrifice glissa linterprtation vulgaire,
intresse. partir deffets navement imagins sur le plan
de la posie, comme lapaisement dun dieu, ou la puret des
tres, le discours significatif donna comme fin de lopration
labondance de la pluie ou le bonheur de la cit. Le gros
ouvrage de Frazer, qui voque les formes de souverainets
les plus impuissantes et, selon lapparence, les moins propices
au bonheur, tend ramener gnralement le sens de lacte
rituel aux mmes fins que le travail des champs, faire du
sacrifice un rite agraire. Aujourdhui, cette thse du Rameau
d'or est sans crdit, mais elle parut sense dans la mesure o
les peuples mmes qui sacrifirent inscrivirent le sacrifice
souverain dans le cadre dun langage de laboureurs. En effet,
dune manire trs arbitraire, qui jamais ne justifia le crdit
dune raison rigoureuse, ces peuples essayrent, et durent
sefforcer de soumettre le sacrifice aux lois de laction, aux
quelles ils taient eux-mmes soumis, ou sefforaient de se
soumettre.
Impuissance du sage parvenir la souverainet partir du
discours.
Ainsi la souverainet du sacrifice nest pas absolue non plus.
Elle ne lest pas dans la mesure o linstitution maintient dans
un monde de lactivit efficace une forme dont le sens est
dtre au contraire souveraine. Un glissement ne peut man
quer de se produire, au profit de la servitude.
Si lattitude du Sage (de Hegel) nest pas souveraine de son
ct, les choses se passent du moins dans le sens contraire :
Hegel ne sloigna pas et sil ne put trouver la souverainet
authentique, il en approcha le plus quil pouvait. Ce qui len
spara serait mme insensible, si nous ne pouvions entrevoir
une image plus riche travers ces altrations de sens, qui
atteignent le sacrifice et, de ltat de fin lont rduit celui
de simple moyen. Ce qui, du ct du Sage, est la cl dune
moindre rigueur, est le fait, non que le discours engage sa
souverainet dans un cadre qui ne peut lui convenir et latro
phie, mais prcisment le fait contraire : la souverainet dans
lattitude de Hegel procde dun mouvement que le discours
rvle et qui, dans lesprit du Sage, nest jamais spar de sa
rvlation. Elle ne peut donc tre pleinement souveraine : le
Sage en effet ne peut manquer de la subordonner la fin
dune Sagesse supposant lachvement du discours. La Sagesse
seule sera la pleine autonomie, la souverainet de ltre... Elle
le serait du moins si nous pouvions trouver la souverainet en
la cherchant : en effet, si je la cherche, je fais le projet dtre
souverainement : mais le projet dtre souverainement
suppose un tre servile! Ce qui assure nanmoins la souve
rainet du moment dcrit, est le dchirement absolu dont
parle Hegel, la rupture, pour un temps, du discours. Mais
cette rupture ellermme nest pas souveraine. Cest en un sens
un accident dans lascension. Bien que lune et lautre sou
verainets, la nave et la sage, soient celles de la mort, outre
la diffrence dun dclin la naissance (de la lente altration
la manifestation imparfaite), elles diffrent encore en ce
point prcis : du ct de Hegel, il sagit justement dun acci
dent. Ce nest pas un hasard, une malchance, qui seraient
dpourvus de sens. Le dchirement est plein de sens au
contraire. (LEsprit nobtient sa vrit, dit Hegel (mais cest
moi qui souligne), quen se trouvant soi-mme dans le dchi
rement absolu.) Mais ce sens est malheureux. Cest ce qui
borna et appauvrit la rvlation que le Sage tira dun sjour
aux lieux o rgne la mort. Il accueillit la souverainet comme
un poids, quil lcha...
J aurais lintention de minimiser lattitude de Hegel? Mais
cest le contraire qui est vrai! J ai voulu montrer lincompa
rable porte de sa dmarche. J e ne devais pas cette fin voiler
la part bien faible (et mme invitable) de lchec.
mon sens, cest plutt lexceptionnelle sret de cette
dmarche qui ressort de mes rapprochements. Sil choua,
lon ne peut dire que ce fut le rsultat dune erreur. Le sens
de lchec lui-mme diffre de celui de lerreur qui la causa :
lerreur seule est peut-tre fortuite. Cest gnralement,
comme dun mouvement authentique et lourd de sens, quil
faut parler de l chec de Hegel.
En fait, lhomme est toujours la poursuite dune souve
rainet authentique. Cette souverainet, selon lapparence, il
leut en un sens initialement, mais sans nul doute, ce ne
pouvait alors tre de manire consciente, si bien quen un sens
il ne leut pas, elle lui chappait. Nous verrons quil poursuivit
de plusieurs faons ce qui se drobait toujours lui. Lessentiel
tant quon ne peut latteindre consciemment et le chercher,
car la recherche lloigne. Mais je puis croire que jamais rien
ne nous est donn, sinon de cette manire quivoque.
Vous aimerez peut-être aussi
- Georges Bataille-Litterature Et Le Mal-Gallimard (1990)Document218 pagesGeorges Bataille-Litterature Et Le Mal-Gallimard (1990)nalpas100% (10)
- Georges Bataille - L'Amour D'un Être MortelDocument21 pagesGeorges Bataille - L'Amour D'un Être Mortelyeatshsu100% (2)
- Georges Bataille Oeuvres Completes Tome II Ecrits Posthumes 1922 1940 PDFDocument463 pagesGeorges Bataille Oeuvres Completes Tome II Ecrits Posthumes 1922 1940 PDFMarceloPas encore d'évaluation
- Le Vocabulaire de Merleau-PontyDocument64 pagesLe Vocabulaire de Merleau-Pontyegonschiele9100% (4)
- Levinas - Autrement Qu'être Ou Au-Delà L'essenceDocument286 pagesLevinas - Autrement Qu'être Ou Au-Delà L'essencenorega000100% (10)
- Éthique de Spinoza: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÉthique de Spinoza: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Blanchot L'Ecriture Du DesastreDocument217 pagesBlanchot L'Ecriture Du DesastreBogdan Cucu67% (6)
- Les Mots Et Les Choses - FoucaultDocument322 pagesLes Mots Et Les Choses - FoucaultIgor Arréstegui92% (13)
- Merleau Ponty SignesDocument343 pagesMerleau Ponty SignesPawel Gajdek100% (6)
- Franck Fischbach - La Production Des Hommes Marx Avec Spinoza (2014, Vrin) PDFDocument174 pagesFranck Fischbach - La Production Des Hommes Marx Avec Spinoza (2014, Vrin) PDFEser KömürcüPas encore d'évaluation
- Marion, Cours Sur Heidegger, Être Et TempsDocument22 pagesMarion, Cours Sur Heidegger, Être Et TempsGros Caca Liquide100% (1)
- L'Imaginaire. SartreDocument65 pagesL'Imaginaire. SartreSemiotista0118100% (6)
- Jean-Luc Nancy - Être Singulier Pluriel-Galilée (1996)Document119 pagesJean-Luc Nancy - Être Singulier Pluriel-Galilée (1996)Jeyson Ramirez89% (9)
- Deleuze - L Empirisme Transcendental - Anne SauvargnaguesDocument446 pagesDeleuze - L Empirisme Transcendental - Anne SauvargnaguesRemy Sarcthreeoneone100% (2)
- Derrida, J. PositionsDocument67 pagesDerrida, J. PositionsJohann HoffmannPas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze, Félix Guattari - Kafka. Pour Une Littérature MineureDocument79 pagesGilles Deleuze, Félix Guattari - Kafka. Pour Une Littérature Mineurebowsurf100% (3)
- Le Bruit Du Sensible by Jocelyn Benoist (Benoist, Jocelyn)Document173 pagesLe Bruit Du Sensible by Jocelyn Benoist (Benoist, Jocelyn)Mathieu Trachman100% (1)
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- Jacques Derrida - Voyous. Deux Essais Sur La Raison-Galilée (2003)Document222 pagesJacques Derrida - Voyous. Deux Essais Sur La Raison-Galilée (2003)Fabián EspejelPas encore d'évaluation
- Deleuze - Qu'est-Ce Que L'acte de CréationDocument13 pagesDeleuze - Qu'est-Ce Que L'acte de CréationprofaudaPas encore d'évaluation
- L'espèce Humaine - Robert AntelmeDocument445 pagesL'espèce Humaine - Robert AntelmeFabien Louis Vazquez100% (6)
- Le Théâtre et son double: Nouvelle édition augmentée d'une biographie d'Antonin Artaud (texte intégral)D'EverandLe Théâtre et son double: Nouvelle édition augmentée d'une biographie d'Antonin Artaud (texte intégral)Pas encore d'évaluation
- Interprétation de La Deuxième Considération Intempestive de Nietzsche by Martin HeideggerDocument214 pagesInterprétation de La Deuxième Considération Intempestive de Nietzsche by Martin HeideggerJairo RochaPas encore d'évaluation
- Merleau Ponty. Origine de La VeritéDocument14 pagesMerleau Ponty. Origine de La VeritéAysegul BaranPas encore d'évaluation
- Schopenhauer (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandSchopenhauer (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Jeanluc Nancy Le Sens Du MondeDocument254 pagesJeanluc Nancy Le Sens Du MondeTimothée Banel100% (1)
- RANCIÈRE, Jacques. La Mésentente PDFDocument195 pagesRANCIÈRE, Jacques. La Mésentente PDFandrade.mariana50% (2)
- Être et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÊtre et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Éthique de Spinoza - L'origine et la nature des sentiments (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandÉthique de Spinoza - L'origine et la nature des sentiments (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Fondements de la métaphysique des moeurs de Kant - Le règne des fins (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandFondements de la métaphysique des moeurs de Kant - Le règne des fins (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Jules Vuillemin Lheritage Kantien Et La Revolution Copernicienne Fichte Cohen HeideggerDocument313 pagesJules Vuillemin Lheritage Kantien Et La Revolution Copernicienne Fichte Cohen Heideggerquatenus2100% (1)
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Paul Ricoeur-La Mémoire, L'histoire, L'oubli-Editions Du Seuil (2000)Document699 pagesPaul Ricoeur-La Mémoire, L'histoire, L'oubli-Editions Du Seuil (2000)hombrehistorico100% (12)
- Derrida Schibboleth Pour Paul CelanDocument121 pagesDerrida Schibboleth Pour Paul CelanFabien Louis Vazquez100% (2)
- Spinoza Philosophie PratiqueDocument175 pagesSpinoza Philosophie PratiqueElhassan andoufiPas encore d'évaluation
- La Philosophie Critique de KantDocument56 pagesLa Philosophie Critique de Kantzbsyahoo100% (1)
- Montaigne (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandMontaigne (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandTractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Fin de partie de Samuel Beckett (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandFin de partie de Samuel Beckett (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Althusser et Spinoza : Détours et retours: Avec trois textes inédits de Louis Althusser sur SpinozaD'EverandAlthusser et Spinoza : Détours et retours: Avec trois textes inédits de Louis Althusser sur SpinozaPas encore d'évaluation
- Zazie dans le métro de Raymond Queneau (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandZazie dans le métro de Raymond Queneau (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Beckett, L'innommableDocument216 pagesBeckett, L'innommableClaudio Duarte100% (3)
- Martin Heidegger - Question III - Lettre Sur L'humanisme - 1946 - Ed. GallimardDocument66 pagesMartin Heidegger - Question III - Lettre Sur L'humanisme - 1946 - Ed. GallimardIlksen Mavituna100% (2)
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Georges Bataille - Oeuvres Completes - Tome 2Document231 pagesGeorges Bataille - Oeuvres Completes - Tome 2Fabien Louis VazquezPas encore d'évaluation
- Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein - Le statut de la philosophie (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandTractatus logico-philosophicus de Wittgenstein - Le statut de la philosophie (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Kierkegaard (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandKierkegaard (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Balibar Identité Et Conscience de Soi Dans L'essai de LockeDocument23 pagesBalibar Identité Et Conscience de Soi Dans L'essai de LockeNicolas Caballero100% (1)
- Vernant, J-P - Mythe Et Religion en Grece AncienneDocument62 pagesVernant, J-P - Mythe Et Religion en Grece AncienneLoredana ManciniPas encore d'évaluation
- Le Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandLe Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- TOSEL, André. Kant RévolutionnaireDocument127 pagesTOSEL, André. Kant RévolutionnaireVítor VieiraPas encore d'évaluation
- Recherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandRecherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Méditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Jacques Derrida 1967, "De L'économie Restreinte À L'économie Générale. Un Hegelianisme Sans Réserve. "Document40 pagesJacques Derrida 1967, "De L'économie Restreinte À L'économie Générale. Un Hegelianisme Sans Réserve. "Arnaud JammetPas encore d'évaluation
- Jean-Luc Nancy - Kiarostami Abbas The Evidence of FilmDocument178 pagesJean-Luc Nancy - Kiarostami Abbas The Evidence of Filmwoody_yipPas encore d'évaluation
- L'Abjection Et Les Formes MisérablesDocument3 pagesL'Abjection Et Les Formes MisérablesFabien Louis VazquezPas encore d'évaluation
- L'Abjection Et Les Formes MisérablesDocument3 pagesL'Abjection Et Les Formes MisérablesFabien Louis VazquezPas encore d'évaluation
- La Pratique de La Joie Devant La Mort (1939)Document7 pagesLa Pratique de La Joie Devant La Mort (1939)Fabien Louis VazquezPas encore d'évaluation
- Quelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustD'EverandQuelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustPas encore d'évaluation
- Mauthausen 302Document40 pagesMauthausen 302Fabien Louis VazquezPas encore d'évaluation
- FRANÇOISE PROUST-L'Histoire À Contretemps. Le Temps Historique Chez Walter Benjamin-ÉDITIONS DU CERF (1994)Document282 pagesFRANÇOISE PROUST-L'Histoire À Contretemps. Le Temps Historique Chez Walter Benjamin-ÉDITIONS DU CERF (1994)Fabien Louis Vazquez100% (1)
- Le Rire de Michel Foucault Michel de CerteauDocument9 pagesLe Rire de Michel Foucault Michel de CerteauFabien Louis VazquezPas encore d'évaluation
- Georges Bataille - Oeuvres Completes - Tome 2Document231 pagesGeorges Bataille - Oeuvres Completes - Tome 2Anonymous oXPBY5xPas encore d'évaluation
- Georges Bataille - Oeuvres Completes - Tome 2Document231 pagesGeorges Bataille - Oeuvres Completes - Tome 2Anonymous oXPBY5xPas encore d'évaluation
- L'esthétique de HegelDocument2 pagesL'esthétique de HegelFabien Louis VazquezPas encore d'évaluation
- Les Cours D'esthétique de HegelDocument6 pagesLes Cours D'esthétique de HegelFabien Louis VazquezPas encore d'évaluation