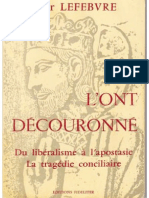Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
S13 L'objet
S13 L'objet
Transféré par
Gianfranco Cattaneo RodriguezDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- Jacques Lacan L'etourditDocument30 pagesJacques Lacan L'etourditTacteon100% (3)
- Jacques Lacan Autres EcritsDocument616 pagesJacques Lacan Autres Ecritsmancol100% (1)
- RADIOPHONIEDocument33 pagesRADIOPHONIEmariosadePas encore d'évaluation
- La Tradition Pythagoricienne - André CharpentierDocument239 pagesLa Tradition Pythagoricienne - André CharpentierGuillaume DenomPas encore d'évaluation
- Guénon René - Le Symbolisme de La Croix PDFDocument103 pagesGuénon René - Le Symbolisme de La Croix PDFBelhamissi100% (2)
- Giorgio Agamben, Joël Gayraud Lusage Des Corps Homo Sacer, IV, 2Document395 pagesGiorgio Agamben, Joël Gayraud Lusage Des Corps Homo Sacer, IV, 2John O'sheaPas encore d'évaluation
- S15 L'acteDocument357 pagesS15 L'acteGianfranco Cattaneo RodriguezPas encore d'évaluation
- Sous, Jean Louis - L'equivoque-Interpretative PDFDocument158 pagesSous, Jean Louis - L'equivoque-Interpretative PDFGianfranco Cattaneo RodriguezPas encore d'évaluation
- D. Lefebvre - Ils L Ont Découronné - Du Libéralisme À L Apostasie, La Tragédie ConciliaireDocument176 pagesD. Lefebvre - Ils L Ont Découronné - Du Libéralisme À L Apostasie, La Tragédie ConciliaireTradição Católica no BrasilPas encore d'évaluation
- Canevas de Production ÉcriteDocument2 pagesCanevas de Production ÉcriteaminemustaphaPas encore d'évaluation
- Lexique de PhenomenologieDocument22 pagesLexique de PhenomenologieYann MangournyPas encore d'évaluation
- Langage, Langue Et ParoleDocument8 pagesLangage, Langue Et ParoleludusludusPas encore d'évaluation
- Analyse de Discours IntegDocument20 pagesAnalyse de Discours Integbasma sounniPas encore d'évaluation
- Seminaire Doctoral de Renforcement Des Capacites MethodologiquesDocument74 pagesSeminaire Doctoral de Renforcement Des Capacites MethodologiquesHermesPas encore d'évaluation
- Instrumenter La Lecture Critique Multimédia (Thomas Bottini, 2010, Thèse)Document369 pagesInstrumenter La Lecture Critique Multimédia (Thomas Bottini, 2010, Thèse)Thomas Amleth BottiniPas encore d'évaluation
- Claude Payan - L'harmonie Du CoupleDocument7 pagesClaude Payan - L'harmonie Du CoupleLudovic Bourgeois100% (3)
- Paradoxe Sur Le GraphisteDocument21 pagesParadoxe Sur Le GraphisteChef PelletPas encore d'évaluation
- MANIGLIER, Patrice. de Mauss À Claude Lévi-Strauss Cinquante Ans Après. Pour Une Ontologie MaoriDocument15 pagesMANIGLIER, Patrice. de Mauss À Claude Lévi-Strauss Cinquante Ans Après. Pour Une Ontologie MaoriSonia LourençoPas encore d'évaluation
- Institutions Et Evolution Politiques de KASAR MARADI PDFDocument257 pagesInstitutions Et Evolution Politiques de KASAR MARADI PDFCentre d'Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale (CELHTO)100% (3)
- Fascicule Philosophie TleDocument71 pagesFascicule Philosophie Tlejb863259Pas encore d'évaluation
- Spe Humanites Litterature Philo 2022 Centres Etranger 2 Corrige OfficielDocument9 pagesSpe Humanites Litterature Philo 2022 Centres Etranger 2 Corrige OfficielSALOUPas encore d'évaluation
- Charles Lancelin Les Cinq Dernieres Vies AnterieuresDocument96 pagesCharles Lancelin Les Cinq Dernieres Vies AnterieuresFranck GfPlow100% (2)
- L'énaction Comme Expérience VécueDocument8 pagesL'énaction Comme Expérience VécueDavid Alcantara MirandaPas encore d'évaluation
- Dissertation PhiloDocument6 pagesDissertation PhiloEdwina SekkoPas encore d'évaluation
- Cours Capes Notions 1 (Cohen-Halimi) - Seances 1 A 6 (Notes Marouan)Document44 pagesCours Capes Notions 1 (Cohen-Halimi) - Seances 1 A 6 (Notes Marouan)fezkfhaefcqjsPas encore d'évaluation
- Penser MangerDocument447 pagesPenser MangerShengyun Violet WangPas encore d'évaluation
- Joseph Moreau - Approche de Hegel-2Document37 pagesJoseph Moreau - Approche de Hegel-2duckbanny100% (1)
- Méthode DissertationDocument3 pagesMéthode Dissertation2pmmjqc7qcPas encore d'évaluation
- L'idéalism Est-Il Spiritualiste?Document20 pagesL'idéalism Est-Il Spiritualiste?dhaPas encore d'évaluation
- Perreau - 2019 - Bourdieu Et La PhénoménologieDocument300 pagesPerreau - 2019 - Bourdieu Et La PhénoménologieDino MurthyPas encore d'évaluation
- 1970 LECOURT, Dominique. Sur L'archeologie Du SavoirDocument24 pages1970 LECOURT, Dominique. Sur L'archeologie Du SavoirJefferson VossPas encore d'évaluation
- Rapport 2016Document96 pagesRapport 2016ijoihjPas encore d'évaluation
- Jean-Luc Nancy, L'Autre Portrait 2014Document125 pagesJean-Luc Nancy, L'Autre Portrait 2014IleanaPradillaCeron100% (2)
S13 L'objet
S13 L'objet
Transféré par
Gianfranco Cattaneo RodriguezTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
S13 L'objet
S13 L'objet
Transféré par
Gianfranco Cattaneo RodriguezDroits d'auteur :
Formats disponibles
LACAN
Lobjet
1965-1966
2
Ce document de travail a pour sources principales :
- Lobjet de la psychanalyse, sur le site E.L.P. ( stnotypie au format image)
- Lobjet, la numrisation faite sur la base de la stnotypie E.L.P. (rue C.B.),
sur le (superbe) site de Pascal GAONACH : Gaogoa.
- Lobjet, version critique de Michel ROUSSAN (dition broche disponible chez lauteur).
Les rfrences bibliographiques privilgient les ditions les plus rcentes.
Les schmas sont refaits.
N.B. : Ce qui sinscrit entre crochets droits [ ] nest pas de Jacques LACAN
3
TABLE DES SANCES
LEON 1 01 Dcembre 1965
LEON 2 08 Dcembre 1965
LEON 3 15 Dcembre 1965
LEON 4 22 Dcembre 1965Sminaire ferm
LEON 5 05 Janvier 1966
LEON 6 12 Janvier 1966
LEON 7 19 Janvier 1966
LEON 8 26 Janvier 1966 Sminaire ferm
LEON 9 02 Fvrier 1966
LEON 10 09 Fvrier 1966
LEON 11 23 Fvrier 1966 Sminaire ferm
LEON 12 23 Mars 1966
LEON 13 30 Mars 1966 Sminaire ferm
LEON 14 20 Avril 1966
LEON 15 27 Avril 1966 Sminaire ferm
LEON 16 04 Mai 1966
LEON 17 11 Mai 1966
LEON 18 18 Mai 1966
LEON 19 25 Mai 1966 Sminaire ferm
LEON 20 01 Juin 1966
LEON 21 08 Juin 1966
LEON 22 15 Juin 1966
LEON 23 22 Juin 1966 Sminaire ferm
VELZQUEZ : Les Mnines
: Las Hilanderas
BALTHUS : La rue
MAGRITTE
RIVIERA : Alameda
PASCAL : Lettre FERMAT
FREUD : Clivage du moi
LACAN : Hiatus irrationnalis
4
0l Dcembre l965 Table des sances
Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur de
l'cole Normale Suprieure qui avez bien voulu, dans
cette enceinte de l'cole o je ne suis qu'un hte,
me faire l'honneur de votre prsence aujourd'hui.
Le statut du sujet dans la psychanalyse, dirons-nous
que l'anne dernire nous l'ayons fond ?
Nous avons abouti tablir une structure qui rende
compte de l'tat de la refente, de Spaltung o le
psychanalyste le repre dans sa praxis.
La psychanalyse repre cette refente de faon en
quelque sorte quotidienne qui est admise la base,
puisque la seule reconnaissance de l'inconscient
suffit la motiver, et aussi bien qui le submerge,
si je puis dire, de sa constante manifestation.
Mais pour savoir ce qu'il en est de sa praxis ou
seulement pouvoir la diriger de faon conforme ce
qui lui est accessible, il ne suffit pas que cette
division soit pour lui un fait empirique, ni mme que
le fait empirique ait pris forme de paradoxe, il faut
une certaine rduction, parfois longue accomplir,
mais toujours dcisive la naissance d'une science.
Rduction qui constitue proprement son objet et o
l'pistmologie qui s'efforce la dfinir en chaque
cas, ou en tous, est loin d'avoir - nos yeux au
moins - rempli sa tche.
Car je ne sache pas qu'elle ait pleinement rendu
compte par ce moyen, de la dfinition de l'objet, de
cette mutation dcisive qui, par la voie de la
physique, a fond La Science, au sens moderne, ds
lors pris pour sens absolu : position que justifie un
changement de style radical dans le tempo de son
progrs, la forme galopante de son immixtion dans
notre monde, les ractions en chane qui
caractrisent ce qu'on peut appeler les expansions de
son nergtique.
5
A tout cela, nous parat tre radicale une
modification dans notre position de sujet au double
sens : qu'elle y est inaugurale et que la science la
renforce toujours plus.
KOYR ici est notre guide et l'on sait qu'il est
encore mconnu.
Donc, je n'ai pas franchi l'instant le pas
concernant la cration comme science, de la
psychanalyse. Mais on a pu remarquer que j'ai pris
pour fil conducteur, l'anne dernire, un certain
moment du sujet que je tiens pour tre le corrlat
essentiel de la Science : un moment historiquement
dfini dont peut-tre nous avons savoir qu'il est
strictement rptable dans l'exprience, celui que
Descartes inaugure et qui s'appelle le cogito.
Ce corrlat qui, comme moment, est le dfil d'un
rejet de tout savoir, prtend laisser au sujet un
certain amarrage dans l'tre, dont nous tenons qu'il
constitue le sujet de la science, dans sa dfinition,
ce terme prendre au sens de porte troite. Ce fil
ne nous a pas guid en vain, puisqu'il nous a men,
formuler en fin d'anne notre division exprimente
du sujet comme division entre le savoir et la vrit,
l'accompagnant d'un modle topologique, la bande de
MBIUS, qui fait entendre que ce n'est pas d'une
distinction d'origine que doit provenir la division
ou ces deux termes viennent se conjoindre.
Qui relira - aux lumires que peut apporter la
technique de la lecture, mon enseignement sur FREUD -
cet article o FREUD nous lgue le terme de Spaltung
1
sur quoi la mort lui fait lcher la plume [S. Freud, Le clivage du moi
dans le processus de dfense ], et remontera aux articles sur le
ftichisme de l927
2
[S. Freud, Le ftichisme] et sur la perte de la
ralit de l924
3
, celui-l apprciera s'il n'appert
pas que ce qui motive chez FREUD un remaniement
doctrinal qu'il accentue dans le sens d'une topique,
c'est un souci d'laborer une dimension que l'on peut
dire proprement structurale puisque c'est la relation
1 S. Freud, Le clivage du moi dans le processus de dfense (1938, G.W XVII), Rsultats, ides, problmes II(1921-38), Paris,
PUF, 1998.
2 S. Freud, Le ftichisme (1927, G.W XIV), La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969.
3 S. Freud, La perte de la ralit dans la nvrose et dans la psychose ( 1924, G.W XIII), Nvrose, psychose et perversion, Paris,
PUF, 1999.
6
entre ces termes et sa reprise dialectique dans
l'exprience, qui seule donne appui son progrs.
Loin de supposer aucune entification
4
d'appareil, pour
tout dire que l'IchSpaltung, refente du moi, sur quoi
s'abat sa main c'est bien le sujet qu'elle nous
pointe comme terme laborer.
Le principe de ralit, ds lors, perd toute
l'ambigut dont il reste marqu si l'ont y inclut la
ralit psychique. Ce principe n'a pas d'autre
fonction dfinissable que de conduire au sujet de la
science.
Et il suffit d'y penser pour qu'aussitt prennent
leur champ ces rflexions qu'on s'interdit comme trop
videntes, par exemple qu'il est impensable que la
psychanalyse comme pratique, que l'inconscient
- celui de FREUD - comme dcouverte, aient pris leur
place avec la naissance, au sicle qu'on a appel le
sicle du gnie, le XVII
e
, de la science prendre au
sens absolu, au sens l'instant indiqu, sens qui
n'efface pas sans doute ce qui s'est institu sous ce
mme nom auparavant, mais qui, plutt qu'il n'y
trouve son archasme, en tire le fil lui d'une
faon qui montre mieux sa diffrence de tout autre.
Une chose est sre, si le sujet est bien l au niveau
de cette diffrence, toute rfrence humaniste y
devient superflue, car c'est elle qu'il coupe
court.
Nous ne visons pas, ce disant de la psychanalyse et
la dcouverte de FREUD, cet accident, que ce soit
parce que ses patients sont venus lui au nom de la
science et du prestige qu'elle confre la fin du
XIX
e
sicle ses servants, mme de grade infrieur,
que FREUD a russi fonder la psychanalyse en
dcouvrant l'inconscient.
Nous disons que contrairement ce qui se brode d'une
prtendue rupture de FREUD avec le scientisme de son
temps que c'est ce scientisme mme, si on veut bien
le dsigner dans son allgeance aux idaux d'un
BRCKE, eux-mme transmis du pacte o un HELMHOLTZ et
un DU BOIS-REYMOND s'tait vous faire rentrer la
4 enter : greffer
7
physiologie et les fonctions de la pense considres
comme y incluses dans les termes mathmatiquement
dtermins de la thermodynamique parvenue son
presque achvement de leur temps, qui a conduit FREUD
- comme ses crits nous le dmontrent - ouvrir la
voie qui porte jamais son nom.
Nous disons que cette voie ne s'est jamais dtache
des idaux de ce scientismes, puisqu'on l'appelle
ainsi, et que la marque qu'elle en porte n'est pas
contingente mais lui reste essentielle.
Que c'est de cette marque qu'elle conserve son
crdit, malgr les dviations auxquelles elle a
prt, et ceci en tant que FREUD s'est oppos ces
dviations et toujours avec une sret sans retard et
une rigueur inflexible.
Tmoin sa rupture avec son adepte le plus prestigieux
- Jung nommment - ds qu'il a gliss dans quelque
chose dont la fonction ne peut tre dfinie autrement
que de tenter d'y restaurer un sujet dou de
profondeurs, ce dernier terme au pluriel, ce qui veut
dire un sujet compos d'un rapport au savoir, rapport
dit archtypique, qui ne ft pas rduit celui que
lui permet la science moderne - l'exclusion de tout
autre - lequel n'est rien que le rapport que nous
avons dfini l'anne dernire comme ponctuel et
vanouissant, ce rapport au savoir qui de son moment
historiquement inaugural garde le nom de cogito.
C'est cette origine indubitable - patente dans tout
le travail freudien - la leon que FREUD nous
laisse comme chef d'cole, que l'on doit que le
marxisme soit sans porte, et je ne sache pas
qu'aucun marxiste y ait montr quelque insistance
mettre en cause sa pense - la pense de FREUD - au
nom d'appartenances historiques de freud.
Nous voulons dire nommment la socit de la double
monarchie pour les bornes judasantes o FREUD reste
confin dans ses aversions spirituelles, lordre
capitaliste qui conditionne son agnosticisme
politique
8
qui d'entre vous nous crira un essai digne de
LAMENNAIS
5
[Essai sur l'indiffrence en matire de religion] sur l'indiffrence
en matire de politique
j'ajouterai : l'thique bourgeoise pour laquelle
la dignit de sa vie vient nous inspirer un respect
qui fait fonction d'inhibition ce que son uvre ait
- autrement que dans le malentendu et la confusion -
ralis le point de concours des seuls hommes de la
vrit qui nous restent, l'agitateur rvolutionnaire,
l'crivain qui de son style marque la langue (je sais
qui je pense) et cette pense rnovant l'tre dont
nous avons le prcurseur.
On sent ma hte d'merger de tant de prcautions
prises reporter les psychanalystes leur
certitudes les moins discutables.
Il me faut pourtant y repasser encore fut-ce au prix
de quelques lourdeurs.
Dire que le sujet sur quoi nous oprons en
psychanalyse ne peut tre que le sujet de la science
peut passer pour paradoxe. C'est pourtant l que doit
tre prise une dmarcation, faute de quoi tout se
mle et commence une malhonntet qu'on appelle
ailleurs objective : mais c'est manque d'audace et
manque d'avoir repr l'objet qui foire.
De notre position de sujet, nous sommes toujours
responsables : qu'on appelle cela o l'on veut du
terrorisme.
J'ai le droit de sourire car ce n'est pas dans un
milieu o la doctrine est ouvertement matire
tractations que je craindrais d'offusquer personne en
formulant ce que je pense : que l'erreur de bonne foi
est de toute la plus impardonnable.
La position du psychanalyste ne laisse pas
d'chappatoire puisqu'elle exclut la tendresse de la
belle me. Si c'est encore un paradoxe que de le
dire, c'est peut-tre aussi bien le mme.
Quoiqu'il en soit je pose que toute tentative, voire
tentation o la thorie courante ne cesse d'tre
relapse, d'incarner plus avant le sujet est errance,
toujours fconde en erreur, et comme telle fautive :
5 Robert Flicit de Lamennais, Essai sur l'indiffrence en matire de religion, Paris, Tournachon-Molin, 1817-1823.
9
ainsi de l'incarner dans l'homme lequel y revient
l'enfant.
Car cet homme y sera le primitif, ce qui faussera
tout du processus primaire, de mme que l'enfant y
jouera le sous-dvelopp ce qui masquera la vrit de
ce qui se passe, lors de l'enfance d'originel.
Bref ce que Claude LVI-STRAUSS
6
a dnonc comme
l'illusion archaque est invitable dans la
psychanalyse si lon ne sy tient pas ferme en
thorie sur le principe que nous avons l'instant
nonc : qu'un seul sujet y est reu comme tel, celui
qui peut la faire scientifique.
C'est dire assez que nous tenons que la psychanalyse
ne dmontre ici nul privilge.
Il n'y a pas de science de l'homme, ce qu'il faut
entendre du mme ton qu' il n'y a pas de petites
conomies . Il n'y a pas de science de l'homme parce
que l'homme de la science n'existe pas, mais
seulement son sujet. On sait ma rpugnance de
toujours pour l'appellation de sciences humaines qui
me semble tre l'appel mme de la servitude.
C'est aussi bien que le terme est faux, la
psychologie mise part qui a dcouvert les moyens de
se survivre dans les offices qu'elle offre la
technocratie, voire comme conclut - d'un humour
vraiment swiftien - un article sensationnel de
Monsieur le Professeur CANGUILHEM
7
, dont je ne sais pas
s'il est ici, voire dans une glissade de toboggan du
panthon la prfecture de police.
Aussi bien est-ce au niveau de la slection du
crateur de la science, du recrutement de la
recherche et de son entretien, que la psychologie
rencontrera l'cueil de son emploi.
Pour toute les sciences de cette classe on verra
facilement qu'elles ne font pas une anthropologie.
6 Claude LVI-STRAUSS, Les structures lmentaires de la parent, Paris-La Haye, Mouton, 1947. Walter De Gruyter Inc.2002
7 Georges CANGUILHEM, "Qu'est-ce que la psychologie ?", confrence du 18 dcembre 1956, Cahiers pour l'analyse, 1966,
n 1-2.
10
Qu'on examine LEVY-BRUHL ou PIAGET, leurs concepts,
mentalit dite prlogique, pense ou discours
prtendument gocentrique, n'ont de rfrences qu'
la mentalit suppose, la pense prsume, au
discours effectif du sujet de la science, nous ne
disons pas de l'homme de la science. De sorte que
trop peuvent s'apercevoir que les bornes : mentales,
certainement, la faiblesse de pense : prsumable, le
discours effectif : un peu coton de l'homme de
science (ce qui n'est pas du tout la mme chose)
viennent lester leurs constructions non dpourvues
sans doute d'objectivit mais qui n'intressent la
science que pour autant qu'elle n'apporte rien sur le
magicien, par exemple, et peu sur la magie, si
quelque chose sur leurs traces - encore ces traces
sont-elles de l'un ou de l'autre puisque ce n'est pas
LEVY-BRUHL qui les a traces - alors que le bilan
dans l'autre cas est plus svre : il ne nous apporte
rien sur l'enfant, peu sur son dveloppement,
puisqu'il y manque l'essentiel et de la logique qu'il
dmontre - j'entends l'enfant de PIAGET - dans sa
rponse des noncs dont la srie constitue
l'preuve, rien d'autre que celle qui a prsid
leur nonciation aux fins d'preuve, c'est--dire,
celle de l'homme de science ou le logicien, je ne le
nie pas, garde son prix.
Dans les sciences autrement valables - mme si leurs
titres est revoir - nous constatons que de
s'interdire l'illusion archaque, que nous pouvons
gnraliser dans le terme de psychologisation du
sujet, n'en entrave nullement la fcondit. La
thorie des jeux - mieux dite stratgie - en est
l'exemple o l'on profite du caractre entirement
calculable d'un sujet strictement rduit la formule
d'une matrice de combinaison signifiantes.
Le cas de la linguistique est plus subtil,
puisqu'elle doit intgrer la diffrence de l'nonc
lnonciation, ce qui est bien l'incidence cette fois
du sujet qui parle en tant que tel (et non pas du
sujet de la science).
11
C'est pourquoi elle va se centrer sur autre chose,
savoir la batterie du signifiant dont il s'agit
d'assurer la prvalence sur ces effets de
signification. C'est bien aussi de ce ct
qu'apparaissent les antinomies, doser selon
l'extrmisme de la position adopte dans la
constitution de cet objet. Ce qu'on peut dire c'est
qu'on va trs loin dans l'laboration des effets de
langages puisqu'on peut y construire une potique qui
ne doit rien la rfrence l'esprit du pote, non
plus qu' son incarnation. C'est du ct de la
logique qu'apparaissent les indices de rfraction
divers de la thorie linguistique par rapport au
sujet de la science. Ils sont diffrents pour le
lexique, pour le morphme syntaxique et pour la
syntaxe de la phrase. D'o les diffrences thoriques
entre un JAKOBSON, un HJEMSLEV et un CHOMSKY. C'est
la logique qui fait ici office d'ombilic du sujet, et
la logique en tant qu'elle n'est nullement logique,
lie aux contingences d'une grammaire. Il faut
littralement que la formalisation de la grammaire
contourne cette logique pour s'tablir avec succs,
mais le mouvement de ce contour est inscrit dans cet
tablissement.
Nous indiquerons plus tard comment se situe la
logique moderne (troisime exemple). Elle est
incontestablement la consquence strictement
dtermine d'une tentative - comme on l'a vu l'anne
dernire - de suturer le sujet de la science, et le
dernier thorme de GDEL montre qu'elle y choue,
ce qui veut dire que le sujet en question reste le
corrlat de la science, mais un corrlat antinomique
puisque la science s'avre dfinie par la non-issue
de l'effort pour le suturer.
Qu'on saisisse l la marque ne pas manquer du
structuralisme.
Il introduit dans toute science humaine qu'il
conquiert, un mode trs spcial du sujet, celui pour
lequel nous ne trouvons pas d'indice autre que
topologique, mettons le signe gnrateur de la bande
de MBIUS que nous appelons le huit intrieur.
12
Le sujet est, si l'on peut dire, en exclusion interne
son objet. L'allgeance que l'uvre de Claude
LVI-STRAUSS, manifeste, un tel structuralisme ne
sera ici porte au compte de notre thse qu' nous
contenter pour l'instant de la priphrie. Nanmoins
il est clair que l'auteur met d'autant mieux en
valeur la porte de la classification naturelle que
le sauvage introduit dans le monde, spcialement pour
une connaissance de la faune et de la flore, dont il
souligne qu'elle nous dpasse, qu'il peut arguer
- Claude LVI-STRAUSS, l'auteur - d'une certaine
rcupration qui s'annonce dans la chimie d'une
physique des qualits sapides et odorantes, autrement
dit, d'une corrlation des valeurs perceptives une
architecture de molcule laquelle nous sommes
parvenus par l'analyse combinatoire, autrement dit
par la mathmatique du signifiant, comme en toute
science jusqu'ici.
Le savoir et donc bien, ici, spar du sujet selon la
ligne correcte qui ne fait nulle hypothse sur
l'insuffisance de son dveloppement, laquelle au
reste, on serait bien en peine de dmontrer.
Il y a plus : Claude LVI-STRAUSS, quand aprs avoir
extrait la combinatoire latente dans
Les structures lmentaires de la parent, il nous tmoigne
que tel informateur - pour emprunter le terme des
ethnologues - est tout fait capable d'en tracer
lui-mme le graphe lvi-straussien.
Que nous dit-il ? Sinon qu'il extrait l, aussi bien
le sujet de la combinatoire en question : celui qui
sur son graphe n'a pas d'autre existence que la
dnotation ego.
dmontrer la puissance de l'appareil qui constitue
le mythme pour analyser les transformations
mythognes qui cette tape paraissent s'instituer
dans une synchronie qui se simplifie de leurs
rversibilits, Claude LVI-STRAUSS ne prtend pas
nous livrer la nature du mythant.
Il sait seulement ici que son informateur - s'il est
capable d'crire Le cru et le cuit, au gnie prs, qui y
met sa marque - ne peut aussi le faire sans laisser
au vestiaire, c'est dire au Muse de l'Homme, la
13
fois un certain nombre d'instruments opratoires,
autrement dit rituels, qui consacrent son existence
de sujet en tant que mythant, et qu'avec ce dpt
soit rejet hors du champ de la structure ce que dans
une autre grammaire on appellerait son assentiment
(la Grammaire de l'assentiment du cardinal NEWMAN
8
-
a n'est pas sans force, cet crit, quoique forg
d'excrables fins et j'aurai peut-tre en faire
nouveau mention).
L'objet de la mythognie n'est donc li nul
dveloppement, non plus qu'arrt du sujet
responsable. Ce n'est pas ce sujet l qu'il se
relate mais au sujet de la science, et le relev s'en
fera d'autant plus correctement que l'informateur
lui-mme sera plus proche d'y rduire sa prsence
celle du sujet de la science.
Je crois seulement que Claude LVI-STRAUSS fera des
rserves sur l'introduction dans le recueil des
documents, d'un questionnement inspir de la
psychanalyse, d'une collecte suivie (des rves par
exemple) avec tout ce qu'il va entretenir de
relations transfrentielles.
Pourquoi, si je lui affirme que notre praxis, loin
d'altrer le sujet de la science - duquel seulement
il peut et veut connatre - n'apporte en droit nulle
intervention qui ne tende ce que le sujet se
ralise de faon satisfaisante et prcisment dans le
champ qui l'intresse ?
Est-ce donc dire qu'un sujet non satur, mais
calculable, ferait l'objet subsumant - selon les
formes de l'pistmologie classique - le corps des
sciences qu'on appellerait conjecturales, ce que
moi-mme j'ai oppos au terme de science humaine ?
Je le crois d'autant moins indiqu que ce sujet fait
partie de conjoncture qui fait la science dans son
ensemble.
L'opposition des sciences exactes aux sciences
conjecturales ne peut plus se soutenir partir du
moment o la conjecture est susceptible d'un calcul
exact (probabilit par exemple) et o l'exactitude ne
8 John Henry Newman, Grammaire de l'assentiment, Paris, Descle de Brouwer, 1986.
14
se fonde que dans un formalisme sparant axiomes et
lois de groupement de symboles.
Nous ne saurions pourtant nous contenter de constater
qu'un formalisme russit plus o moins quand il
s'agit au dernier terme d'en motiver l'apprt qui n'a
pas surgi par miracle, mais qui se renouvelle suivant
des crises si efficaces depuis qu'un certain droit
fil me semble y avoir t pris.
Rptons qu'il y a quelque chose dans le statut de
l'objet de la science qui ne nous parat pas lucid
depuis que la science est ne, et rappelons que, si
certes poser maintenant la question de l'objet de la
psychanalyse c'est reprendre la question que nous
avons introduite partir de notre venue cette
tribune, de la position de la psychanalyse dans ou
hors de la science, nous avons indiqu aussi que
cette question ne saurait tre rsolue sans que, sans
doute, s'y modifie la question de l'objet dans la
science comme telle.
L'objet de la psychanalyse - j'annonce la couleur et
vous la voyez venir avec lui - puisqu'il n'est autre
que ce que j'ai dj avanc de la fonction quy joue
l'objet(a). Le savoir sur l'objet(a) serait-il alors
la science de la psychanalyse ?
C'est trs prcisment la formule qu'il s'agit
d'viter, puisque cet objet(a) est insrer, nous le
savons dj, dans la division du sujet par o se
structure trs spcialement - c'est de l
qu'aujourd'hui nous sommes repartis - le champ
psychanalytique.
Et c'est pourquoi il tait important de promouvoir
d'abord, et comme un fait distinguer de la question
de savoir si la psychanalyse est une science - si son
champ est scientifique - ce fait prcisment que sa
praxis n'implique d'autre sujet que celui de la
science. Il faut rduire ce degr, ce que vous me
permettrez d'induire par une image comme l'ouverture
du sujet dans la psychanalyse, pour saisir ce qu'il y
reoit de la vrit.
Cette dmarche, on le sent, comporte cette sinuosit
que vous me voyez devoir suivre, et qui tient de
l'apprivoisement.
15
Cet objet(a) n'est pas tranquille, ou plutt faut-il
dire, se pourrait-il qu'il ne vous laisse pas
tranquille ? Et le moins, ceux qui avec lui ont le
plus faire : les psychanalystes qui seraient alors
ceux que d'une faon lective j'essaierai de fixer
par mon discours.
C'est vrai ! Le point o je vous ai donn aujourd'hui
rendez-vous pour tre celui o je vous ai laisss
l'an pass : celui de la division du sujet entre
vrit et savoir est pour eux un point familier,
c'est celui o FREUD
9
les convie sous l'appel :
wo es war soll, Ich werden
que je retraduis une fois de plus, l'accentuer
encore ici :
l o c'tait, l comme sujet dois-je advenir .
Or ce point, je leur en montre l'tranget le
prendre revers, ce qui consiste ici, plutt les
ramener son front. Comment ce qui tait
m'attendre depuis toujours d'un tre obscur,
viendrait-il se totaliser d'un trait qui ne se tire
qu' le diviser plus nettement de ce que j'en peux
savoir ?
Ce n'est pas seulement dans la thorie que se pose la
question de la double inscription, pour avoir
provoqu la perplexit o mes lves LAPLANCHE et
LECLAIRE
10
, auraient pu lire dans leur propre
scission dans l'abord du problme, sa solution.
Elle n'est pas en tout cas du type gestaltiste ni
chercher dans l'assiette o la tte de Napolon
s'inscrit dans l'arbre. Elle est tout simplement dans
le fait que l'inscription ne mord pas du mme ct du
parchemin, venant de la planche imprimer de la
vrit, ou du savoir.
9 S. Freud, Nouvelles confrences d'introduction la psychanalyse, (1932, G.W. XV), Paris, Gallimard, Coll. Connaissance de
linconscient, 1984.
10 Laplanche et Leclaire, "L'inconscient : Une tude psychanalytique", VI
e
colloque de Bonneval, 1960, paru dans l'inconscient,
Paris, Descle de Brouwer, 1966.
16
Que ces inscriptions se mlent tait simplement
rsoudre dans la topologie : une surface o l'endroit
et l'envers sont en tat de se rejoindre partout
tait port de main.
C'est bien plus loin pourtant, qu'en un schme
intuitif - c'est, si je puis dire, d'enserrer
l'analyse dans son tre - que cette topologie peut le
saisir. C'est pourquoi s'il la dplace ailleurs, ce
qui ne peut tre qu'en un morcellement de puzzle qui
ncessite en tout cas d'tre ramen cette base.
Pourquoi il n'est pas vain de redire qu' l'preuve
d'crire je pense donc je suis , cela se lit : que
la pense ne fonde l'tre qu' se nouer dans la
parole o toute opration touche l'essence du
langage.
Si cogito sum nous est quelque part - par
HEIDEGGER
11
- fourni ses fins, il faut en remarquer
qu'il algbrise la phrase et nous sommes en droit
d'en faire relief son reste : cogito ergo , o
apparat que rien ne se parle qu' s'appuyer sur la
cause.[tre et temps , trad. Emmanuel Martineau, Hors commerce.]
Or cette cause c'est ce que recouvre le
Soll Ich, le dois-je de la formule freudienne,
qui d'en renverser le sens, fait jaillir le paradoxe
d'un impratif qui me presse d'assumer ma propre
causalit. Je ne suis pas pourtant, cause de moi, et
ce, non pas d'tre la crature ! Du Crateur, il en
est tout autant. je vous renvoie l-dessus
AUGUSTIN
12
et son De Trinitate, au prologue.
La cause de soi spinozienne peut emprunter le nom de
Dieu. Elle est Autre Chose. Mais laissons cela ces
deux mots que nous ne ferons jouer qu' pingler
qu'elle est aussi Chose autre que le Tout et que ce
Dieu d'tre autre ainsi, n'est pas pour autant le
Dieu du panthisme.
Il faut saisir dans cet ego que DESCARTES accentue de
la superfluit de sa fonction dans certains de ses
textes latins (sujet d'exgse que je laisse ceux qui,
ici, peuvent s'y consacrer en spcialistes).
11 M. Heidegger, L' tre et le temps (I
re
partie), Paris, Gallimard, 1964 (trad. Bhms & Waelhens); tre et temps (complet),
Paris, Gallimard, 1986 (trad. Vezin, Lauxerois, Rols) ; Etre et temps , trad. Emmanuel Martineau, Hors commerce.
12 Saint AUGUSTIN, De Trinitate, Paris, Vrin ,2000.
17
Le point dans cet ego est trouver o il reste tre
ce qu'il se donne pour tre, dpendant du Dieu de la
religion. Curieuse chute de l'ergo : l'ego est
solidaire de ce Dieu.
Singulirement DESCARTES suit la dmarche de le
prserver du Dieu trompeur, en quoi c'est son
partenaire qui gagne puisqu'il le prserve au point
de le pousser au privilge exorbitant de ne garantir
les vrits ternelles qu' en tre le crateur.
Cette communaut de sort entre l'ego et Dieu, ici
masque, est la mme que profre de faon dchirante
le contemporain de DESCARTES, Angelus SILESIUS en ses
adjurations mystiques, et qui leur impose - ses
adjurations - la forme distique.
On se souviendrait avec avantage parmi ceux qui me
suivent, de l'appui que j'ai pris sur ces
jaculations, celles du Plerin chrubinique
13
, les
rependre dans la trace mme de l'introduction au
narcissisme que je poursuivais alors, selon son mode,
l'anne de mon commentaire
14
sur le Prsident
SCHREBER.
Cest qu'on peut boiter en ce joint - c'est le pas de
la beaut - mais il faut y boiter juste. Et d'abord
se dire que les deux cts ne s'y embotent pas.
C'est pourquoi je me permettrai de dlaisser un
moment ce point, pour repartir d'une audace qui fut
la mienne et que je ne rpterai qu' la rappeler.
Car ce serait la rpter deux fois : bis repetita,
pourrait-elle tre dite, au sens juste ou ce terme ne
veut pas dire la simple rptition.
Il s'agit de La Chose freudienne
15
, discours dont le
texte est celui d'un discours second, d'tre de la
fois o je l'avais rpt. Prononc pour la premire
fois - puisse cette insistance vous faire sentir en
sa trivialit le contre-pied temporel qu'engendre la
rptition - prononc la premire fois, il le ft
pour une Vienne o mon biographe reprera ma premire
rencontre avec ce qu'il faut bien appeler le fond le
plus bas du monde psychanalytique. Spcialement avec
13 Anglus Silesius, Le Plerin chrubinique, Michalon 2007.
14 J. Lacan, Le sminaire, Livre III, Les Psychoses (1955-56), Paris, Seuil, 1981.
15 J. Lacan, Ecrits, Seuil, Paris,1966, p.401. ou T1, Seuil, Coll. Points n5 p.398
18
un personnage dont le niveau de culture et de
responsabilit rpondait celui qu'on exige d'un
garde du corps, mais peu m'importait, je parlais en
l'air, ayant voulu que ce ft pour le centenaire de
la naissance de FREUD que ma voix se ft entendre en
hommage. Ceci non pour en marquer la place d'un lieu
dsert, mais cette autre que cerne maintenant mon
discours.
Que la voie ouverte par FREUD n'ait pas d'autre sens
que celui que je reprends : l'inconscient est
langage, ce qui en est maintenant acquis l'tait dj
pour moi, on le sait.
Ainsi dans un mouvement, peut-tre joueur se faire
cho du dfi de SAINT-JUST haussant au ciel de
l'enchsser d'un public d'assemble, l'aveu de n'tre
rien de plus que ce qui va la poussire, dit-il
et qui vous parle me vint-il l'inspiration
qu' voir dans la voie de FREUD s'animer trangement
une figure allgorique et frissonner d'une peau neuve
la nudit dont s'habille celle qui sort du puit,
j'allais lui prter voix. C'est une prosopope
16
, je
vous l'pargne, elle culmine dans ces mots :
Moi, la Vrit, je parle
et la prosopope reprend. Pensez la chose
innommable, qui de pouvoir prononcer ces mots, irait
l'tre du langage, pour les entendre comme ils
doivent tre prononcs : dans l'horreur.
Mais ce dvoilement chacun y met ce qu'il y peut
mettre. Mettons son crdit le dramatique assourdi
- quoique pas moins drisoire pour autant - du tempo
sur quoi se termine ce texte, que vous trouverez dans
le numro ad hoc, premier de l'anne l956 de
l'volution Psychiatrique, sous le titre
La Chose freudienne.
Je ne crois pas que ce soit cette horreur prouve
que j'ai d l'accueil plutt frais que fit mon
auditoire l'mission rpte de ce discours,
laquelle ce texte reproduit.
16 RHT. Figure par laquelle l'orateur ou l'crivain fait parler et agir un tre inanim, un animal, une personne absente ou morte.
19
S'il voulut bien en raliser la valeur, son gr
oblative, sa surdit s'y avra particulire. Ce n'est
pas que la chose (la Chose qui est dans le titre)
l'ai choqu cet auditoire, pas autant que tels de nos
compagnons de barre l'poque, j'entends de barre
sur un radeau, o par leur truchement j'ai patiemment
concubin dix ans durant pour la pitance narcissique
de mes compagnons de naufrage avec la comprhension
jaspersienne et le personnalisme la manque, avec
toute les peines du monde nous pargner tous
d'tre peints au coaltar de l' me--me libral.
La Chose, ce mot n'est pas joli , m'a-t-on dit
textuellement ! Est-ce qu'il ne nous la gche pas
tout simplement cette aventure des fins du fin de
l'unit de la psychologie o bien entendu on ne songe
pas chosifier : fi ! qui se fier ?
Nous nous croyons l'avant-garde du progrs,
camarade ?
On ne se voit pas comme on est, et encore moins
s'aborder sous les masques philosophiques. Mais
laissons
Pour mesurer le malentendu l ou il importe, au
niveau de mon auditoire d'alors, je prendrai un
propos qui s'y fit jour peu prs ce moment, et
quon pourrait trouver touchant de l'enthousiasme
qu'il suppose :
Pourquoi - colporta quelqu'un, et ce terme court encore
- pourquoi ne dit-il pas le vrai sur le vrai ? .
Cela prouve combien vains taient tout ensemble mon
apologue et sa prosopope.
Prter ma voix supporter ces mots intolrables :
Moi la vrit je parle passe l'allgorie. Cela
veut dire tout simplement tout ce qu'il y a dire de
la vrit, de la seule - savoir ce que je rpte
pourtant depuis longtemps - : qu'il n'y a pas de
mta-langage (affirmation faite pour situer tout le
logico-positivisme), que nul langage ne saurait dire
le vrai sur le vrai puisque la vrit se fonde de ce
qu'elle parle et qu'elle n'a pas d'autre moyen pour
ce faire.
20
C'est mme pourquoi, l'inconscient - qui le dit le
vrai sur le vrai - est structur comme un langage et
pourquoi moi, quand j'enseigne cela, je dis le vrai
sur FREUD qui a su laisser sous le nom d'inconscient
la vrit parler.
Ce manque du vrai sur le vrai qui ncessite toutes
les chutes que constitue le mta-langage dans ce
qu'il a de faux-semblants et de logique, c'est la
proprement la place de l'Urverdrngung, du
refoulement originaire attirant lui tous les
autres, sans compter d'autres effets de rhtorique
pour lesquels pour lesquels reconnatre nous ne
disposons que du sujet de la science.
C'est bien pour a que pour en venir bout, nous
employons d'autres moyens. Mais il y est crucial que
ces moyens ne sachent pas largir ce sujet.
Leur bnfice touche sans doute ce qui lui est
cach.
Mais il n'y a pas d'autre vrai sur le vrai couvrir
ce point vif que des noms propres, celui de FREUD ou
bien le mien, ou alors ces berquinades de nourrice
dont on ravale un tmoignage dsormais ineffaable :
savoir une vrit dont il est du sort de tous de
refuser lhorrible si pas plutt de l'craser quand
il est irrefusable - c'est dire quand on est
psychanalyste - sous cette meule de moulin dont j'ai
pris l'occasion la mtaphore, pour rappeler d'une
autre bouche que les pierres quand il faut, savent
crier aussi.
Peut-tre m'y verrait-on justifier de n'avoir pas
trouve touchante la question me concernant :
Pourquoi ne dit-il pas ? venant de quelqu'un,
dont son emploi faire les bureaux d'une agence de
vrit, rendait la navet douteuse, et ds lors
d'avoir renonc aux offices qu'il remplissait dans la
mienne d'agence, laquelle n'a pas besoin de chantres
y rver de sacristie
Faut-il dire que nous avons connatre d'autres
savoirs que celui de la science, quand nous avons
traiter de la pulsion pistmologique ?
Et revenir encore sur ce dont il s'agit : c'est
d'admettre qu'il nous faille renoncer dans la
21
psychanalyse ce qu' chaque vrit rponde son
savoir ? Cela est le point de rupture par o nous
dpendons de l'avnement de la science. Nous n'avons
plus pour les conjoindre, que ce sujet de la science.
Encore nous le permet-il, et j'entre plus avant dans
son comment, laissant ma Chose s'expliquer toute
seule avec le noumne, ce qui me semble tre bientt
fait : puisqu'une vrit qui parle a peu de chose en
commun avec un noumne qui - de mmoire de raison
pure - la ferme.
Ce rappel n'est pas sans pertinence puisque le mdium
qui va nous servir sur ce point - vous m'avez vu
l'amener tout l'heure - c'est la cause, la cause
non pas catgorique de la logique, mais en causant
tout l'effet.
La vrit comme cause, allez-vous, psychanalystes,
refuser d'en assumer la question, quand c'est de l
que s'est leve votre carrire ?
S'il est des praticiens pour qui la vrit comme
telle est suppose agir, n'est-ce pas vous ?
N'en doutez pas ! En tout cas, c'est parce que ce
point est voil dans la science, que vous gardez
cette place tonnement prserve dans ce qui fait
office d'espoir en cette conscience vagabonde
accompagne en collectif des rvolutions de la
pense.
Que LNINE ait crit : La thorie de MARX est toute
puissante parce qu'elle est vraie
17
, il laisse vide
l'normit de la question qu'ouvre sa parole :
pourquoi - supposer muette la vrit du
matrialisme sous ses deux faces qui n'en sont
qu'une : dialectique et histoire - pourquoi d'en
faire la thorie accrotrait-il sa puissance ?
Rpondre par la conscience proltarienne et par
l'action du politique marxiste ne nous parat pas
suffisant.
17 Lnine, Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme. Cet article fut crit l'occasion du 30 anniversaire de la mort
de K. Marx, il sera publi dans le n3 de la revue thorique bolchvique "Prosvchtchni" ("L'Education").
La doctrine de Marx est toute-puissante, parce qu'elle est juste. Elle est harmonieuse et complte ; elle donne aux hommes une
conception cohrente du monde, inconciliable avec toute superstition, avec toute raction, avec toute dfense de l'oppression
bourgeoise. Elle est le successeur lgitime de tout ce que l'humanit a cr de meilleur au XIX sicle : la philosophie allemande,
l'conomie politique anglaise et le socialisme franais. C'est ces trois sources, ces trois parties constitutives du marxisme, que
nous nous arrterons brivement.
22
Du moins la sparation de pouvoirs s'y annonce-t-elle
de la vrit comme cause au savoir pris en exercice.
Une science conomique inspire du Capital ne conduit
pas ncessairement en user comme pouvoir de
rvolution, et l'histoire semble exiger d'autre
secours encore qu'une dialectique prdicative. Outre
ce point singulier que je ne dvelopperai pas
aujourd'hui, c'est que la science s'y l'on y regarde
de prs, n'a pas de mmoire. Elle oublie les
pripties dont elle est ne quand elle est
constitue, autrement dit une dimension de la vrit
que la psychanalyse met l hautement en exercice.
Il me faut prciser : on sait que la thorie physique
ou mathmatique aprs chaque crise qui se rsout dans
la forme ou le terme employ de thorie gnralise
ne saurait nullement tre pris pour vouloir dire
simplement un passage au gnral, on sait qu'elle
conserve souvent son rang ce qu'elle gnralise de
sa structure prcdente. Ce n'est donc pas cela que
nous disons, ni visons. C'est le drame, le drame
subjectif que cote chacune de ces crises. Ce drame
est le drame du savant, il a ses victimes dont rien
ne dit que leur destin s'inscrit dans le mythe de
l'Oedipe. En tout cas c'est une question pas trs
tudie. R.J. MAYER
18
, CANTOR
je ne vais pas dresser un palmars de ces drames
allant parfois la folie - o des noms de vivants
viendraient bientt s'y inscrire - o je considre
que le drame de ce qui se passe dans la psychanalyse
est exemplaire. Je pose qu'il ne saurait ici
s'inclure lui-mme, ce drame, dans l'Oedipe sauf le
mettre en cause.
Vous voyez le programme qui, ici, se dessine, il
n'est pas prt d'tre couvert, je le vois mme plutt
bloqu.
Je m'y engage avec prudence et, pour aujourd'hui,
vous prie de vous reconnatre dans les lumires
rflchies d'un tel abord. C'est dire que nous
18 Julius Robert von Mayer (1814, 1878) est un mdecin et physicien allemand. Il formula en 1845 le premier principe de la
thermodynamique. Ses travaux lui valurent la mdaille Copley en 1871.
23
allons les porter sur d'autres champ que le
psychanalytique se rclamer de la vrit.
Magie et religion les deux positions de cet ordre qui
se distinguent de la science au point qu'on a pu les
situer par rapport la science comme fausse ou
moindre science pour la magie, comme outrepassant ses
limites, voire en conflit de vrit avec la science
pour la seconde. Il faut le dire pour le sujet de la
science, l'une et l'autre ne sont qu'ombres, mais non
pour le sujet souffrant auquel nous avons faire.
Ah, va-t-on dire ici : il y vient, qu'est-ce ce que
c'est ce sujet souffrant sinon celui dont nous tirons
nos privilges et quels droits vous donnent ici vos
intellectualisations ?
Je partirai, pour rpondre de ce que je rencontre,
d'un philosophe
19
couronn rcemment de tous les
honneurs facultaires, il crit :
La vrit de la douleur est la douleur elle-mme .
Ce propos que je laisse aujourd'hui au domaine qu'il
explore, j'y reviendrai pour dire comment la
phnomnologie est prtexte la contre-vrit, et le
statut de celle-ci.
Je ne m'en empare que pour vous poser la question
vous, analystes : oui ou non, ce que vous faites
a-t-il le sens d'affirmer que la vrit de la
souffrance nvrotique c'est d'avoir la vrit comme
cause ?
Je propose maintenant :
Sur la magie, je pars de cette vue qui ne laisse pas
de flou sur mon obdience scientifique mais qui se
contente d'une dfinition structuraliste. Elle
suppose le signifiant rpondant comme tel au
signifiant : le signifiant dans la nature est appel
par le signifiant de l'incantation, il est mobilis
mtaphoriquement. La chose en tant qu'elle parle
rpond nos objurgations, c'est pourquoi cet ordre
de classification naturelle que j'ai invoqu des
tudes de Claude LVI-STRAUSS laisse dans sa
dfinition structurale entrevoir le pont de
19 Michel Henry, L'essence de la manifestation, Paris, PUF, 1963.
24
correspondance par lequel l'opration efficace est
concevable sous le mme mode o elle a t conue.
C'est pourtant l une rduction qui y nglige le
sujet. Chacun sait que la mise en tat du sujet, du
sujet chamanisant, y est essentielle. Observons que
le chaman, disons en chair et en os, fait partie de
la nature et que le sujet corrlatif de l'opration a
se recouper dans ce support corporel. C'est ce mode
de recoupement qui est exclu du sujet de la science.
Seuls ses corrlatifs structuraux dans l'opration
lui sont reprables mais exactement.
C'est bien sous le mode de signifiant qu'apparat ce
qui est mobiliser dans la nature : tonnerre et
pluie, mtores et miracles.
Tout est ici ordonner selon les relations
antinomiques o se structure le langage.
L'effort de la demande, ds lors, y est interroger
par nous, dans l'ide d'prouver si l'on y retrouve
la relation dfinie par notre propre graphe avec le
dsir.
Par cette voie seulement plus loin dcrire d'un
abord qui ne soit pas d'un recours grossier
l'analogie le psychanalyste peut se qualifier d'une
comptence dire son mot sur la magie.
La remarque qu'elle soit toujours magie sexuelle a,
ici son prix mais ne suffit pas l'y autoriser.
Je conclus sur deux points retenir dans votre
coute : La magie c'est la vrit comme cause sous
son aspect de cause efficiente.
Le savoir s'y caractrise non pas seulement de rester
voil pour le sujet de la science, mais de se
dissimuler comme tel tant dans la tradition
opratoire que dans son acte. C'est une condition de
la magie. Il ne s'agit sur ce que je vais dire
maintenant de la religion que d'indiquer le mme
abord structural. Et aussi sommairement, c'est dans
l'opposition de traits de structure que cette
esquisse prendra fondement. Peut-on esprer que la
religion prenne dans la science un statut un peu plus
franc ?
Car depuis quelque temps, il est d'tranges
philosophes de la science y donner de leurs
25
rapports la dfinition la plus molle, foncirement
les tenir pour se dployant dans le mme monde o la
religion, ds lors, a la position enveloppante.
Pour nous, sur ce point dlicat, o certains
entendraient nous prmunir de la neutralit
analytique, nous faisons prvaloir ce principe : que
d'tre ami de tout le monde ne suffit pas prserver
la place d'o l'on a oprer.
Dans la religion la mise en jeu prcdente - celle de
la vrit comme cause - par le sujet (le sujet
religieux s'entend) est prise dans une opration
compltement diffrente. L'analyse partir du sujet
de la science conduit ncessairement y faire
apparatre les mcanismes que nous connaissons de la
nvrose obsessionnelle. FREUD les a aperus dans une
fulgurance qui leur donne une porte dpassant toute
critique traditionnelle. Prtendre y calibrer la
religion ne saurait tre inadquat.
Si l'on ne peut partir de remarque comme celle-ci :
que la fonction que joue la rvlation se traduit
comme une dngation de la vrit comme cause,
savoir qu'elle dnie ce qui fonde le sujet s'y
tenir pour partie prenante, alors il y a peu de
chance donner ce qu'on appelle l'histoire des
religions des limites quelconques, c'est--dire
quelque rigueur.
Disons que le religieux laisse Dieu la charge de la
cause mais qu'il coupe l son propre accs la
vrit, aussi est-il amen remettre Dieu la cause
de son dsir, ce qui est proprement l'objet du
sacrifice. Sa demande est soumise au dsir suppos
d'un Dieu qu'il faut ds lors sduire : le jeu de
l'amour entre par l.
Le religieux installe ainsi la vrit en un statut de
culpabilit, il en rsulte une mfiance l'endroit
du savoir d'autant plus sensible chez les pres de
l'glise ds qu'ils se dmontrent plus dominants en
matire de raison.
La vrit y est renvoye des fins qu'on appelle
eschatologiques, c'est--dire qu'elle n'apparat que
26
comme cause finale, au sens o elle est rapporte
un jugement de fin du monde, d'o le relent
obscurantiste qui s'en reporte sur tout usage
scientifique de la finalit.
J'ai marqu au passage combien nous avons apprendre
sur la structure de la relation du sujet la vrit
comme cause, dans la littrature des Pres, voire
dans les premires dcisions conciliaires.
Le rationalisme qui organise la pense thologique
n'est nullement, comme la platitude se l'imagine,
affaire de fantaisie.
S'il y a fantasme c'est au sens le plus rigoureux
d'institution d'un rel qui couvre la vrit.
Il ne nous semble pas du tout inaccessible un
traitement scientifique que la vrit chrtienne ait
d en passer, ait d en passer, par l'intenable de la
formulation d'un Dieu : Trois et UN. La puissance
ecclsiale s'accommode ici fort bien d'un certain
dcouragement de la pense. Avant d'accentuer les
impasses d'un tel mystre, c'est la ncessit de son
articulation qui pour la pense est salubre et
laquelle elle doit se mesurer.
Les questions doivent tre prises au niveau o le
dogme achoppe en hrsie, et la question du Filique
20
ne peut me paratre du tout trangre pour pouvoir
tre traite en termes topologiques.
L'apprhension structurale doit y tre premire et
permet seule une apprciation exacte de la fonction
des images. Le De Trinitate ici a tous les caractres
d'un ouvrage de thorie et il peut tre pris par nous
comme un modle. S'il nen tait pas ainsi je
conseillerais mes lves d'aller s'exposer
- distrayons-nous - la rencontre d'une tapisserie
du XVIme sicle qu'ils verront s'imposer leur
regard ds leur entre au Mobilier National
21
o elle
les attend dploye pour encore un mois o deux.
Les trois personnes reprsentes dans une identit de
forme absolue s'entretenir entre elles avec une
20 En 589, le concile de Tolde III ajoute au symbole de Nice la clause du filioque :
Credo in Spiritum Sanctum qui ex patre filioque procedit ( Je crois en l'Esprit-Saint qui procde du Pre et du Fils ) qui
exprime la doctrine selon laquelle le Saint-Esprit procde du Pre et du Fils.
21 La cration du monde, montre l'exposition Le XVI
e
sicle europen, Tapisseries, Paris Mobilier National, d'octobre 1965
janvier 1966.
27
aisance parfaite aux rives fraches de la Cration
sont tout simplement angoissantes.
Et ce que recle une machine aussi bien faite quand
elle se trouve affronter le couple d'ADAM et d'Eve en
la fleur de son pch est bien de nature tre
propose en exercice une imagination de la relation
humaine qui ne dpasse pas en pratique la dualit.
Mais que mes auditeurs s'arment d'abord d'AUGUSTIN
Ainsi sembl-je n'avoir dfini que des
caractristiques des religions de la tradition juive.
Sans doute sont-elles faites pour nous en dmontrer
l'intrt et je ne me console pas d'avoir du renoncer
rapporter l'tude de la Bible la fonction
du Nom du Pre
22
.
Il reste que la cl est d'une dfinition de la
relation du sujet la vrit. Je crois pouvoir dire
que c'est dans la mesure o Claude LVI-STRAUSS
conoit le bouddhisme comme une religion du sujet
gnralis, c'est--dire comme comportant une
diaphragmatisation de la vrit comme cause,
indfiniment variable, qu'il flatte cette utopie de
la voir s'accorder avec le rgne universel du
marxisme. Peut-tre est-ce l faire trop peu de cas
des exigences du sujet de la science et trop
confiance l'mergence dans la thorie d'une
doctrine de la transcendance de la matire.
Pour ce qui est de la science, ce n'est pas
aujourd'hui que je puis dire ce qui me parat de la
structure de ses relations la vrit comme cause,
puisque notre progrs cette anne doit y contribuer.
Je l'aborderai par la remarque trange que la
fcondit prodigieuse de notre science est
interroger dans sa relation cet aspect dont la
science se soutiendrait : que la vrit comme cause
elle nen voudrait rien savoir.
On reconnat la formule de la Verwerfung (forclusion)
laquelle viendrait ici s'adjoindre en une srie
ferme la Verdrngung (refoulement), la
22 Lacan, Les Noms du Pre . 20 novembre 1963, Paris, Seuil, 2005.( seule sance du sminaire interrompu.)
28
Verneinung (dngation), dont vous avez reconnu - je
pense - au passage la fonction dans la magie et la
religion.
Sans doute ce que nous avons dit des relations de la
Verwerfung avec la psychose, spcialement comme
Verwerfung du nom du pre vient-il l, en apparence,
s'opposer cette tentative du reprage structural.
Pourtant si l'on s'aperoit qu'une paranoa russie
apparatrait aussi bien tre la clture de la science
si c'tait la psychanalyse qui tait appele
reprsenter cette fonction, si d'autre part on
reconnat que la psychanalyse est essentiellement ce
qui introduit ce qui rintroduit dans la
considration scientifique le Nom-du-Pre, l on
n'est pas plus avanc en apparence puisqu'on retrouve
la mme impasse semble-t-il, mais on a le sentiment
que de cette impasse mme on progresse et qu'on peut
voir se dnouer quelque part le chiasme qui semble y
faire obstacle.
Peut-tre le point actuel o en est le drame de la
naissance de la psychanalyse, et la ruse qui s'y
cache se jouer de la ruse consciente, sont-ils ici
prendre en considration car ce n'est pas moi qui
ait introduit la forme de la paranoa russie.
Certes, me faudra-t-il indiquer que l'incidence de la
vrit comme cause dans la science est reconnatre
sous l'aspect de la cause formelle.
Mais ce sera pour clairer que la psychanalyse - par
contre - en accentue l'aspect de cause matrielle.
Telle est proprement son originalit dans la science.
Cette cause matrielle est proprement la forme
d'incidence du signifiant que j'y dfinis.
Par la psychanalyse, le signifiant se dfinit comme
agissant d'abord comme spar de sa signification.
C'est la figure, le caractre littral que dessine la
configuration copulatoire quand, surgissant hors des
limites de la maturation biologique du sujet, elle
s'imprime, sans pouvoir tre le signe s'articuler
effectivement de la prsence du partenaire sexuel,
c'est--dire son signe biologique(qu'on se souvienne
29
de nos formules diffrenciant le signifiant et le
signe
23
).
C'est assez dire au passage que dans la psychanalyse
l'histoire est une autre dimension que celle du
dveloppement, et que c'est une aberration que
d'essayer de l'y rsoudre : l'histoire ne se poursuit
qu'en contre-temps du dveloppement. Point, dont
l'histoire comme science a peut-tre faire son
profit si elle veut chapper l'emprise toujours
prsente d'une conception providentielle de son
cours.
Bref nous retrouvons ici le sujet du signifiant tel
que nous lavons articul lanne dernire. Vhicul
Par le signifiant dans son rapport l'autre
signifiant, il est distinguer svrement, tant de
l'individu biologique que de toute volution
psychologique subsumable comme sujet de la
comprhension.
C'est - dit en terme minimaux - la fonction que
j'accorde au langage dans la thorie.
Elle me semble comparable avec un matrialisme
historique qui laisse l un vide.
Peut-tre la thorie de l'objet(a) y trouvera-t-elle
sa place aussi bien.
Cette thorie de l'objet(a) est ncessaire, nous le
verrons, une intgration correcte de la fonction de
la cause, au regard du sujet du savoir et de la
vrit.
Vous avez pu reconnatre au passage dans les quatre
modes de sa rfraction qui viennent ici d'tre
recenss, le mme nombre et une analogie d'pinglage
nominale qui sont retrouver dans la Physique
d'ARISTOTE. Ce n'est pas par hasard puisque cette
physique ne manque pas d'tre marque d'un logicisme
qui garde encore la saveur et la sapience d'un
grammatisme originel.
sinterroge-t-il.
Nous restera-t-il valable que la cause soit pour nous
exactement autant se polymriser ?
23 crits p.875
30
Cette exploration n'a pas pour seul but de vous
donner l'avantage d'une prise lgante sur les cadres
qui chappent en eux-mme votre juridiction -
entendez : magie, religion, voir science - mais
plutt pour vous rappeler qu'en tant que sujet de la
science psychanalytique, c'est la sollicitation de
chacun de ces modes de la relation la vrit comme
cause, que vous avez rsister.
Mais ce n'est pas dans le sens ou vous l'entendez
d'abord.
La magie n'est pour nous tentation qu' ce que vous
fassiez de ses caractres la projection sur le sujet
quoi vous avez affaire pour le psychologiser,
c'est--dire le mconnatre.
La prtendue pense magique - qui est toujours celle
de l'autre - n'est pas un stigmate dont vous puissiez
pingler l'autre. Elle est aussi valable chez votre
prochain qu'en vous-mme, dans les limites les plus
communes : elle est au principe de la moindre
transmission d'ordre.
Pour tout dire le recours la pense magique
n'explique rien, ce qu'il s'agit d'expliquer c'est
son efficience.
Pour la religion, elle doit bien plutt nous servir
de modle ne pas suivre dans l'institution d'une
hirarchie sociale o se conserve la tradition d'un
certain rapport la vrit comme cause.
La simulation de l'glise catholique qui se reproduit
chaque fois que la relation la vrit comme cause
vient au social, est particulirement grotesque dans
une certaine Internationale psychanalytique la
condition qu'elle impose la communication.
Ai-je besoin en effet de dire que dans la science -
l'oppos de la magie et de la religion - le savoir se
communique ?
Mais il faut insister que ce n'est pas seulement
parce que c'est l'usage, mais que la forme logique
donne ce savoir inclut le mode de la communication
comme suturant le sujet qu'il implique.
Tel est le problme premier que soulve la
communication en psychanalyse : le premier obstacle
31
sa valeur scientifique est que la relation la
vrit comme cause sous ses aspects matriels est
rest nglige dans le cercle de son travail.
Conclurai-je rejoindre le point d'o je suis parti
aujourd'hui : Division du sujet ?
Ce point est un nud.
Rappelons o FREUD l'ouvre : sur ce manque du pnis
de la mre o se rvle au sujet la nature du
phallus.
Le sujet se divise ici - nous dit FREUD - l'endroit
de la ralit, voyant la fois s'y ouvrir le gouffre
contre lequel il se rempardera d'une phobie, et
d'autre part le recouvrant de cette surface o il
rigera le ftiche, c'est--dire l'existence du pnis
comme maintenue, quoique dplace.
D'un ct extrayant le (pas de) du (pas de pnis),
mettre entre parenthse, pour le transfrer au (pas
de savoir) qui est le pas-hsitation de la nvrose.
De l'autre, reconnaissons l'efficace du sujet, dans
ce gnomon qu'il rige, lui dsigner toute heure
le point de vrit.
Rvlant du phallus lui-mme qu'il n'est rien d'autre
que ce point de manque qu'il indique dans le sujet.
Cet index est aussi celui qui nous pointe le chemin
o nous voulons aller cette anne, c'est--dire, l
o vous-mme reculez d'tre en ce manque - comme
psychanalystes - suscits.
Table des sances
32
08 Dcembre l965 Table des sances
La dernire fois, vous avez entendu de moi une sorte
de leon qui ne ressemblait pas aux autres parce que,
il se trouve qu'elle tait entirement crite.
Elle tait entirement crite aux fins d'tre donne au
plus vite une sorte d'impression quon appelle
ronotypie et que vous puissiez l'avoir comme repre,
eu gard mon enseignement.
Certains en ont mis un certain regret, disons une
dception. La chose vaut qu'on s'y arrte.
Pour y mettre un peu d'humour. Je dirai que la faon
dont cette dception s'exprimait tait quelque chose
autour de ceci (je force un peu) : on prfrait cette
sorte de bagarre, parat-il, que reprsente dassister
jose peine le dire - la naissance de ma pense.
Vous pensez si ma pense nat quand je suis l, en
train de me colleter avec quelque chose qui est loin
d'tre tout fait a.
Comme tout le monde, c'est avec ma parole, bien sr,
que je m'explique. a prouve - bien entendu - qu'elle
s'est forme ailleurs.
Dailleurs, vous avez peut-tre pu entendre que mon
cogito moi - ce qui ne veut pas dire dailleurs qu'il
est en quoi que ce soit en contradiction avec celui de
Descartes - ce serait plutt : je pense, donc je
cesse d'tre . Alors, comme je ne cesse pas d'tre,
comme vous le voyez bien, a prouve que ma pense,
j'ai moins de raison que d'autres d'y croire.
Nanmoins il est bien certain que c'est a que nous
avons affaire. Cest ce qui ne rend pas les rapports
plus faciles avec ceux qui elle s'adresse tout
spcialement, c'est dire les psychanalystes. Et le
fait que les remarques de tout l'heure me soient
venues - je le rpte, avec une pointe d'humour - tout
spcialement de leur ct, prouve bien, ce qui se
confirme, que c'est aussi de leur ct qu'on prfre
ce que j'appellerai le ct numro de cette
exhibition. a ne facilite pas les rapports.
33
C'est bien aussi de ce point de vue qu'il faut entendre
le fait que j'ai cru plusieurs reprises, dans mon
dernier expos devoir faire allusion ce qui constitue
un certain temps de mes rapports avec les
psychanalystes, et par exemple que j'aie parl de ce
que j'appelle la Chose freudienne ou tel ou tel autre
point analogue.
Il ne s'agit pas l de ce que j'ai pu entendre
qualifier de vains rappels d'un pass, ce qui est bien
curieux pour des analystes, puisque aussi bien ce
pass fait proprement parler partie d'une histoire,
au titre que jai essay la dernire fois de prciser
ce qu'il en est pour nous de l'histoire, ce que nous y
apportons de contribution essentielle en montrant ce
qu'il en est de la fracture, du traumatisme, de
quelque chose qui se spcifie dans les temps du
signifiant, et que ce serait vraiment tout fait
mconnatre la fonction que je donne la parole - et
telle que je l'ai, la dernire fois tout spcialement,
affirme - si je ne tentais pas, de quelque faon,
d'inclure dans ce que j'en enseigne, ce que
j'enregistre et constate des effets de la mienne, et
tout spcialement concernant ce qu'il en advient de
ceux qui elle s'adresse.
C'est pour cela que, dans toute la mesure o nous nous
avanons cette anne autour d'un point radical, il ne
peut se faire que ceci n'aboutisse pas mettre en
relief quelque chose qui doit donner la cl du
passage, ou non, de mon enseignement l o il doit
porter. Il doit y avoir quelque rapport troit entre
ce que nous pourrons appeler ses phases ou ses
difficults mmes - pour appeler les choses par leur
nom - et ce que prcisment jai pu dire et avancer
concernant le sujet, pour autant qu'il se divise entre
vrit et savoir. La dernire fois je n'ai pas
pourtant - intitul ce discours : courtois dbat
entre vrit et savoir . J'ai parl du sujet de la
science et non pas du savoir. C'est bien l que gt
quelque chose, dont j'ai dit aussi qu'il y a quelque
chose qui boite, autrement dit, qui ne s'abouche pas
d'une faon tout fait adquate ni aise.
34
C'est bien pour a dailleurs que cette leon, cet
expos, a pour vritable titre :
le sujet de la science, mais comme il doit tre mis en
vente, la loi d'un objet vendable, c'est que
l'tiquette couvre ce que j'appelle la marchandise, et
comme il s'agit videmment lintrieur, de la science
dune part et de la vrit, condition que vous
mettiez le (et) dans la parenthse qu'il mrite,
savoir que cest un terme qui na pas du tout un sens
univoque, quil peut bien, aussi bien, inclure la
dissymtrie, loddit dont je parlais tout lheure,
La science (et) la vrit sera le titre de cet expos,
ou bien si vous voulez : La science, la vrit.
Ce qu'il y a dans cet expos est aussi important par
ce que cela laisse en blanc que par ce que cela
contient.
Dans l'numration des diverses phases, des divers
temps, de la vrit comme cause, vous verrez que si
sont produites les phases dites causes efficientes et
causes finales, j'ai laiss dans le discret suspens de
ce qui va alors tre bien appel : dbat entre
psychanalyse et science le jeu des rapports des
causes matrielle et formelle. C'est de ceci que nous
allons avoir aujourd'hui nous approcher.
Dans ce qui s'obtient comme effet de ce que
j'enseigne, dans la pratique de ceux qui le reoivent,
je puis constater une certaine tendance, un certain
versant, qui est celui, curieuse consquence de la
forme singulirement stricte que je tente de donner au
terme de sujet, et qui aboutit une singulire laxit,
proprement celle qu'on pourrait qualifier au dehors et
selon l'usage ordinaire de ce terme, de subjectivisme.
Cest savoir que chacun tour de rle, et aussi bien
suivant je ne sais quel up-to-date - il peut tre la
mode, par exemple dtre un petit peu la trane sur
la mode aurait user comme repre dans la position
qu'il prend dans l'activit analytique successivement
de l'tre et de l'avoir, du dsir et de la demande -
je ne les dis pas dans l'ordre o je les ai sortis
voire alors, au dernier terme, le savoir et la
vrit.
35
Voil une des formes d'chappatoire - si je puis
dire : j'espre qu'elle n'est que mythique,
approximative, que je ne dsigne l et pointe quune
tendance - voil bien une des formes d'chappatoire
les plus radicales ce que je peux tenter d'obtenir
puisque, quel sens aurait-elle cette formulation que
je donne, de la fonction du sujet comme coupure -
laissant peut-tre une certaine indtermination, dans
son choix l'origine, mais ds lors que faite,
absolument dterminante - s'il ne s'agissait pas,
prcisment, d'obtenir une certaine accommodation de la
position de l'analyste cette coupure fondamentale qui
s'appelle le sujet ?
Ici, (ici seulement) comme identique cette coupure,
la position de l'analyste est rigoureuse.
Bien sr, elle n'est pas tenable !
Ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, c'est Freud,
qui nen doutait pas. C'est bien pour a que pour tenir
leur place, les analystes ne la tiennent pas.
A ceci, il n'y a pas proprement parler remdier,
mais il y a le savoir, ce qui peut tre une faon de
le contourner. Ici se dcle la diffrence qu'il y a
entre la Wirklichkeit, savoir la ralisation
possible de mes relations avec le psychanalyste pour
autant quil me laisse la place o je suis et o
j'essaie de serrer un certain type de formules, et la
realitt qui est au-del en tant que comme impossible,
elle est ce qui dtermine notre commun chec.
Cest en quoi tout chec n'est pas
comme on l'a enseign et comme on continue le
croire, savoir au niveau le plus rampant de la
pense analytique
tout chec n'est pas forcment un signe ngatif.
L'chec peut tre prcisment le signe de fracture o
se marque le rapport le plus troit avec la ralit.
Ceci motive et justifie - je vais rapidement le dire
en deux mots - ce pourquoi il me faut la moiti de ces
mercredis, les fermer. Qu'est-ce que a veut dire ?
Et pourquoi ai-je pris cette anne le parti de faire
moi-mme le choix des personnes qui seront invites
y participer ?
36
C'est pour cette raison trs simple : qu'au niveau de
l'tude de cette Wirklichkeit il y a un ct dessin,
un cot change direct, un ct de balle passe ,
de la parole, qui ne peut se raliser que dans
certaines conditions de choix, de dosage entre les
diffrents types de participants : ceux qui ont, de ma
parole, faire un usage analytique et ceux qui me
dmontrent qu'on peut trs bien la suivre dans toute
sa cohrence et sa rigueur jusquo elle va.
Que comme de bien entendu - il faut s'y attendre - si
la praxis analytique mrite ce nom de praxis elle
s'insre dans une structure qui vaut, mme au dehors
de sa pratique actuelle. Il faut donc que stablisse
une possibilit d'changes au niveau de quoi, par
exemple, puissent tre tudis ces termes qui fraient,
qui facilitent ce niveau de connaissance commune,
l'usage de certains termes essentiels pour cette
partie de notre praxis qui s'appelle thorie et, par
exemple que quelque chose je ne dis pas je n'ai
aucune ide prconue qui puisse tre mise l l'ordre
du jour qui par exemple nous montre ce qu'ont dj pu
approcher de notre vrit les Stociens, par exemple,
qui se trouvent d'une part nous apporter au niveau de
la logique des rfrences essentielles qui ont cet
intrt pour nous d'tre branche commune pour l'usage
le plus moderne qui est fait de la logique d'une part,
et d'autre part - ce qui va apparatre dans mes leons
cette anne et qui n'est pas une nouveaut pour
l'analyste ceci prs que ce nest point ainsi quil
le formule -ce qui est impliqu de corporel de cette
logique.Car il ne suffit pas de se souvenir que nous
parlons dans l'analyse, d'image du corps. Image quoi ?
Image flottante, baudruche, ballon, qu'on attrape ou
qu'on nattrape pas. Justement l'image du corps ne
fonctionne analytiquement que de faon partielle,
cest dire implique, dcoupe, dans la coupure
logique. Alors a peut tre intressant de savoir que
pour les stociens, Dieu,[], l'me humaine, et aussi
bien tout dans le monde, y compris les dterminations
de qualit - tout, part quelques points d'exception
dont il ne sera pas sans intrt de relever la carte
- tout tait corporel.
37
Voil des logiciens pour qui tout est corps. Je ne
dis pas que ce soit une tude laquelle on ne
pourrait pas en prfrer quelque autre meilleure, on
pourrait aussi tudier pourquoi ARISTOTE a tout
fait loup la question de la cause matrielle,
pourquoi la matire, en fin de compte, chez lui,
n'est pas cause du tout puisqu'elle est un lment
purement passif.
On peut prendre les choses o on veut, si on a une
praxis comme la ntre on doit toujours retomber sur
les points vifs. Seulement ce choix, alors, ne peut
se faire qu'en commun, puisque c'est un choix trs
spcial et je ne peux pas laisser se rpandre ce
qui ne manquerait pas darriver avec le got des
tiquettes - que je vous prche une psychanalyse
stocienne. Nous tcherons donc de mettre au point
ces choses dun choix commun pour un travail
efficace. Je crois que le meilleur systme est quun
travail en sorte, qui puisse tre communiqu
l'ensemble, lensemble de ceux qui ,ici, me feront
lhonneur, je lespre, de poursuivre leur assiduit
aux deux premiers mercredis.
Ces remarques tant closes - qui dailleurs ne sont
pas sans intrt pour les points qui les ont fait
merger dans mon discours : ce rappel dune certaine
question sur la cause ou sur ce qu'il faut entendre
par la matire - je reprends encore ceci : c'est que
si mon enseignement a un sens, s'il est cohrent avec
le structuralisme qu'il met en valeur, s'il a pu se
poursuivre et s'difier d'an en an, il me semble
qu'il est assez normal de considrer qu'il a trouv
faveur dans ceci, que la formulation structuraliste
pour se fonder - rappelez-vous, ceux qui le peuvent,
mon premier graphe chafaud pendant toute une anne,
patiemment, rappelez vous ce premier graphe, ce
rapport en rseau des fonctions dterminantes de la
structure du langage et du champ de la parole
24
.
24 J. Lacan, Ecrits, p237, Op. cit. ; Les formations de l'inconscient (1957-58), Paris, Seuil, 1998.
38
Si cette structure en rseau, par exemple, a un
avantage, c'est prcisment d'appartenir(au premier
mot monde prs, mais je lemploie vite pour me
faire entendre) un monde topologique, ce qui veut
dire : o les connexions ne se perdent pas, parce que
le fond est dformable, souple, lastique - ce n'est
pas nouveau a, mme les gens rebelles ont trs bien
compris de quoi il s'agissait - de sorte que c'est ce
qui permet que l'difice ne s'croule pas, ne se
dchire pas, en raison des modifications des
proportions de la mtrique de l'ensemble.
Quand j'apporte de nouveaux termes, et que ,comme
tout lheure je lvoquais, aprs l'tre et
l'avoir, je parle du dsir et de la demande, il
s'agit d'apercevoir o la structure les branche - ces
quatre termes - l'un sur l'autre. Il ne me semble pas
que ce soit proprement parler impossible.
Il y a l sur la droite, le rappel de quatre de ces
rseaux structuraux. Dabord sous votre nez :
Le trou qui dsigne ce dont je vais parler
aujourd'hui.
Puis vous avez le graphe, le graphe de deux tages et
la fonction de la parole pour autant que sy
diffrencie lnonciation de l'nonc.
39
A droite de celui-ci, quelque chose comme un lambeau
carr
un champ, o ceux pas tellement rares qui me lisent
(encore que je n'en apprenne jamais rien) ont pu le
relever au dbut d'un article qui s'appelle
Dune question prliminaire tout traitement possible de la
psychose
25
Il est vraiment trs frappant que depuis le temps -
il y a dj quatre ans, que j'ai inscrit au tableau
pour mon auditoire psychanalytique, prcisment
l'anne de mon sminaire sur l'identification
26
,
le schma topologique de ce quon appelle le plan
projectif, de ce que j'ai introduit sous le terme de
cross-cap en ce moment de mon enseignement - quil ne
soit jamais venu l'ide de personne de s'apercevoir
que la bande de MBIUS en tant (nous allons y revenir
tout lheure) qu'elle est dcoupable dans ce plan
projectif avec un reste (nous dirons lequel) que la
bande de MBIUS est l inscrite qui vous attendait
depuis longtemps, il faut le dire(mais enfin on ne
saurait reprocher quiconque de ne lavoir pas
devin), nanmoins les lettres que j'avais inscrites,
M-i-m-I, ce n'est pas pour le plaisir de faire mimi,
que je les ai mises l.
Elles pouvaient peut-tre faire souponner quelque
chose, savoir cette fonction d'application que je
donne la bande de MBIUS pour vous faire saisir ce
qu'il en est de la coupure constituante de la
fonction du sujet.
25 crits, p 531 ou T2 p 9.
26 Sance du 23-05-62
40
Il y a, tout en bas, je vous le signale en passant
pour ceux que a chantera de le relever aujourdhui,
un nouveau petit graphe que je vous donne comme objet
de rflexion qui est proprement parler utile pour
saisir les rapports de ce que j'ai appel - et
continue de faire fonctionner - comme le signifiant,
avec ce qui nous sera tout spcialement utile de
considrer cette anne, son fonctionnement dans ce
qui est non pas seulement le langage, dont je vous ai
dit qu'il n'y a pas de mtalangage : ce qui implique
ds lors que ce qui bien entendu se prsente comme
tel : la logique, - qu'est-ce la logique, sinon
justement une tentative de mtalangage ? - que la
logique nen est quune chute, et quelle ne se
conoit, prend, et recle, qu la considrer comme
telle.
Cest pourquoi dans ce schma den bas :
- vous avez la pointe de gauche - quelque chose que
j'ai crit phon. ou phonme - l'lment
proprement phonmatique du signifiant.
- Il est form par quelque chose qui apparat aux
deux ples, infrieur et suprieur, comme symbole
indicatif, que je puis avancer maintenant, puisque
l'anne dernire j'ai pu vous montrer ce qu'il en est
dans sa fonction centrale, de ce terme d'indication.
Le type en est le shifter.
41
Ce qui est essentiellement indiqu, cest toujours
plus ou moins le trou du sujet, du sujet de
lnonciation
27
.
- Au bord infrieur, le symbole mais peut-tre le
terme va-t-il vous surprendre, et c'est prcisment
que je ne peux l'introduire dans toute sa crudit
qu' ce point de llaboration, parce qualors il ne
domine pas tout, il nemporte pas tout - le symbole
imitatif.
- Voil ce qui concourt dans le phonme, et le
phonme vous renvoie au ple de la combinaison
logique qui est saisir au bout de la ligne
horizontale sur la droite.
La relation de ce rsultat logique avec les index et
les termes lexicaux dont je puis, partir de l,
fort bien admettre quils admettent des lments
d'imitation, leur relation cest toute laffaire de
la logique en tant qu'une logique est constitutive de
la science. Cela ne change rien au fait quil n'y a
pas de mtalangage.
Le petit schma den haut est pour vous rappeler qu
lentre dun article qui sappelle : La lettre vole
vous avez, un certain nombre de concatnations
concernant la chane signifiante
28
, qui peut-tre
sclaireront un peu plus
mais dont je peux pas dire que, jusqu prsent
elles aient eu une grande vertu dillumination
qui sclaireront un petit peu plus de ce dans quoi
nous allons avancer tout lheure.
27 Sminaire Problmes cruciaux03-03, 05-05.
28 crits, p 48-50 ou T1 p 48-50 ; sminaire Le moi 26-04.
42
Et alors ? Il s'agit de partir du sujet, du sujet de
la science tel que nous avons cru pouvoir le pointer
en cette exprience de DESCARTES, signe d'un point
d'vanouissement, mais aussi bien dans l'effort
logique de FREGE par o il nous dsigne o le UN doit
surgir, si nous voulons en donner le fondement
purement logique, c'est--dire proprement au niveau
de l'objet zro
29
. Ces deux rappels de l'anne
dernire ne suffisent-ils pas rendre tonnant et
significatif de l'coute que je rencontre, que tel -
et des meilleurs - se soit montr lui-mme surpris de
l'accent que j'ai mis, lors de mon dernier expos,
sur le sujet de la science.
Ce ne sont pas l remarques vaines, tudier ce
qu'il en est de certaines surdits, momentanes
d'ailleurs, justement parce que freudiens, nous ne
nous satisfaisons absolument pas du terme de
scotomisation, savoir que pour nous, le trou - et
pour les meilleures raisons - ne peut pas tre dans
la perception.
Cest proprement parler une connerie sur laquelle,
Dailleurs, on a difi beaucoup : toute la
psychiatrie anglaise, pendant plusieurs annes, n'a
parl que d'hallucinations ngatives.
Que cest autrement structur et quil suffit pour
cela de lire l'article que FREUD a fait tout
expressment pour le montrer, et qui sappelle
Fetichismus, en quoi consiste la Spaltung, la
division de la ralit, elle-mme, dans le sujet, dit
pervers l'occasion. C'est bien pour a qu'il est
intressant de pointer de telles remarques, de tels
accidents, en tant que j'ai le bonheur aprs tout
a ne paraissait pas un bonheur mon cher et
dfunt ami, Maurice MERLEAU-PONTY, qui bien
plutt alla penser que je recueillais - laprs-
midi mme du jour o javais alors Sainte-Anne
alors mexprimer - que je recueillais les
dsarrois divers de mes propres auditeurs
jy vois au contraire, pour eux comme pour moi
beaucoup davantages.
29 Sminaire Problmes cruciaux 20-01, 03-03.
G. FREGE (1848-1896), les fondements de l'arithmtique. Paris, Seuil, 1970, Coll. Lordre philosophique.
43
Alors, repartons maintenant du trou.
Le trou, il y a longtemps trs longtemps que je lui
donne, quant au fonctionnement de l'ordre symbolique
la fonction essentielle. Ai-je besoin rappeler, un
certain meeting, congrs, attroupement, comme vous
voudrez qui se passait Royaumont, et o ayant fait
un rapport sur La direction de la cure
30
, et tout ce qui
sensuit les principes de son pouvoir
je ne leur ai parl parce quil fallait bien
changer de disque puisque le discours tait dj
imprim - je ne leur ai parl, la stupfaction d'un
journaliste qui est entr l on ne sait par quelle
porte, je ne leur ai parl que du pot de moutarde, en
partant de ce fait d'exprience qui stait une fois
de plus confirm au djeuner, que le pot de moutarde
est toujours vide. Il n'y a pas d'exemple quon ouvre
un pot de moutarde et quon trouve de la moutarde
dedans. Ce pot de moutarde c'est la cration
symbolique par excellence et tout le monde le sait
depuis longtemps. S'il n'y avait pas d'tre qui parle
il y aurait peut-tre des creux dans le monde, des
flaques, des dpressions, des choses qui retiennent,
il n'y aurait pas de vase.
On aurait tort de croire que ce soit pour rien que a
fasse partie pour nous des premiers reliefs - et
essentiels trouver - de la civilisation. Les
cramiques, puis les vases en bronze, la quantit
prodigieuse de ces choses que nous trouvons !
Et qu'il ne reste que a, a devrait quand mme nous
tirer l'oreille et bien d'autre chose encore ! Enfin,
il ne suffit pas de tirer l'oreille pour la faire
entendre, il faut croire.
videmment, il y avait d'autres choses avant, le
premier gisement historique - a porte un joli nom en
danois
31
mais je suis incapable de le prononcer
cest un amas de dtritus, alors, l nous avons
lobjet(a)!
30 crits, p585 ; ou T.2 p.62
31 Kjkkenmdding : Amas coquiller rsultant gnralement de la consommation de mollusques sur une longue priode (et qui
sont associs divers objets et parfois du charbon de bois) par des populations msolithiques et nolithiques, de la Baltique, de
l'cosse, de France, du Portugal, d'Amrique du Sud, etc.
44
Et le vase nest pas un objet(a). a a servi depuis
trs longtemps exprimer quelque chose.
Quoi ? Est-ce que c'est une leon de thologie ? Vous
savez, Dieu le grand ouvrier : de mme - nous dit-
on au catchisme - qu'il faut un potier pour faire un
pot, de mme . Que n'en avons-nous mieux profit !
Car a ne dit pas du tout ce dont a cherche nous
convaincre.
a nous dit quoi ? Deus creavit mundum et la suite
ex nihilo.
Qu'est-ce que a veut dire ? a veut dire que le vase
il le fait autour du trou, que ce qui est essentiel,
c'est le trou.
Et parce que c'est essentiel que ce soit le trou,
l'nonc juif que Dieu a fait le monde de rien, est
proprement parler
KOYR
32
le pensait, lenseignait et la crit
ce qui a fray la voie l'objet de la science.
On est emptr, on reste coll toutes les qualits,
quelles qu'elles soient, depuis la force,
l'impulsion, la couleur, tout ce que vous voudrez
jusqu la perception, bref au morceau de craie
auquel la progniture socratique reste colle comme
les mouches sur du papier mouche depuis deux mille
ans, savoir LAGNEAU et aussi bien ALAIN, l,
spculer sur lapparence.
Alors cette apparence ?
Eh bien, il faut que nous arrivions voir comment
elle est aussi la ralit.
C'est avec a que la philosophie et la science, lune
par rapport lautre, ont pris de solides tangentes.
Alors ?
Je pense tre en mesure de vous le dire tout de
suite. Le bout de craie devient objet de science
partir du moment - et ds le moment - o vous partez
de ce point, qui consiste le considrer comme
manquant. C'est ce que je vais essayer de faire
sentir tout de suite.
32 A. Koyr, Du monde clos l'univers infini, Paris, Gallimard, Coll. Tel, 1988.
45
Mais ds maintenant, je ne veux pas perdre l'occasion
d'agrafer au passage ce que signifie la cause
matrielle. Si vous tes philosophe, ARISTOTE vous
dirait que la matire, cest la moutarde, c'est
dire ce qui remplit le vide [ ARISTOTE, Physique, II, 3, 194b; Mtaphysique, , 2.].
ARISTOTE qui tait pourtant si bien orient dans sa
conception de l'espace est fort loin de cette tendue
terriblement glissante qui est le vritable problme,
toujours reposer, dans notre progrs dans les
sciences mathmatico-physiques. Il avait trs bien vu
que le lieu, voil ce qui permettait de donner, de
l'espace une conception qui ne s'pandrait pas
indfiniment, qui ne nous mettrait pas la question
de ce faux infini. Seulement voil, aprs tre si
bien parti que d'avoir dfini le lieu comme le
dernier contenant :
le dernier tant celui qui est non mu, eh bien
voil
parce qu'il tait grec et quil n'avait pas lu la
bible
il n'a pas pu admettre qu'il y ait un vide sparant
les objets, alors il a rempli le pot de moutarde,
c'est cause de a qu'on y est rest pendant un
certain nombre de sicles ! Est-ce dire que la
cause matrielle c'est le pot, cration
incontestablement divine comme toute cration de la
parole, et quoi se rduit strictement ce qui est
dit dans le texte de la gense ?
Mais non !
Et c'est l, la remarque que je voulais pointer en
passant.
Des pots, nous en trouvons des tas, je vous lai dit
tout lheure, et dans les tombes, partout o rgne
ce qu'on appelle les cultures primitives. Eh bien,
des desseins tout fait prcis, savoir que les
collectionneurs futurs ne puissent pas les donner
comme pots de fleurs leur petite amie, seule fin
que ces pots se conservent, les gens qui les dposent
dans les spultures y font un trou au centre, ce qui
vous prouve que c'est bien du ct du trou qu'il faut
chercher la cause matrielle.
46
Voil quelque chose qui cause quelque chose, un trou
dans le vase : voil le modle.
Si vous prenez le sommet de l'laboration
scientifique qui en est, en mme temps la cl de
vote et la cheville essentielle, vous obtenez quoi ?
Vous obtenez ce qu'on appelle l'nergtique.
L'nergtique n'est pas ce que croit un auteur qui
l'oppose, comme un complment ma thorie
structurale de la psychanalyse. Il s'imagine que
l'nergtique, sans doute, c'est ce qui pousse, voil
la culture des philosophes !
L'nergtique, si vous vous reportez, par exemple,
quelqu'un d'aussi autoris quand mme que FEYNMAN
dont je nai pas attendu quil ait le prix NOBEL - je
vous prie de le croire - pour louvrir, dans un
trait en deux volumes qui sappelle
Lectures on physics
33
et qui pour ceux qui ont le temps,
enfin, je ne saurai leur recommander une meilleure
lecture car cest un cours en deux ans, absolument
exhaustif. Il est tout fait possible de couvrir
tout le champ de la physique, son niveau le plus
lev en un certain nombre de leons qui, finalement
ne psent pas plus d'un kilogramme et demi.
Dans le troisime chapitre, ou le quatrime, je ne
sais pas, il met le lecteur ou l'auditeur, je ne sais
pas, au parfum de ce qu'est l'nergtique. Ce n'est
pas moi donc, qui ai invent a pour servir mes
thses. Je me suis souvenu que j'avais lu a quand
jai eu le volume, cest dire il y a un an et demi
(prire de consulter le premier paragraphe du
chapitre 4 : conservation of energy ).
Quest ce quil trouve de mieux pour en donner l'ide
des auditeurs supposs vierges de ce quil en est
de la physique, puisque jusque l, ils n'ont reu
d'enseignement que d'incomptents.
Il suppose un petit morveux, quil appelle Denis the
menace, Denis le danger public. On lui donne 28
petits blocs, mais comme cest une brute ,ils sont en
platine, indestructibles, inscables, indformables.
33 Richard Phillips Feynman, Robert B. Leighton & Matthew Sands, The Feynman Lectures on physics, Addison-Wesley, 1963,
2 vol., Le cours de physique de Feynman, Paris, Dunod, 1999, "Mcanique", t.1 et t.2.
47
Il sagit de savoir ce que va faire la maman chaque
fois que - discrte comme il convient, c'est--dire
pas amricaine - elle rentre dans la chambre du bb
et que tantt elle ne trouve que vingt-trois blocs,
tantt vingt-deux.
Il est clair que ces blocs se retrouveront toujours,
soit sur le sol du jardin (parce quils auront pass
par la fentre), soit dans une diffrence de poids
que lon pourra constater dune boite (que bien
entendu on n'ouvrira pas), soit parce que l'eau de la
baignoire aura lgrement mont, mais comme l'eau de
la baignoire est trop sale pour quon en voit le
fond, c'est par cette lgre lvation de niveau
qu'on saura o sont passs les blocs.
Je ne vous lis pas tout le passage, le temps me
manque, il est sublime.
L'auteur pointe qu'on retrouvera toujours le mme
nombre constant de blocs l'aide d'une srie
d'oprations qui consisteront additionner un
certain nombre d'lments, par exemple, la hauteur de
l'eau divise par la largeur de la baignoire,
additionner cette division curieuse quelque chose
dautre qui sera par exemple, le nombre total de
blocs restants - vous suivez jespre, personne ne
grimace c'est--dire faire cette chose, je vous
le dis en passant, qui est incluse dans la moindre
formule scientifique qui est, que non seulement on
additionne, mais qu'on soustrait, qu'on divise, qu'on
opre de toutes les faons avec quoi ? Avec des
nombres grce quoi on additionne faute de quoi il
ny aurait pas de science possible - on additionne
communment des torchons avec des serviettes, des
poires avec des poireaux, nest ce pas ?
Or qu'est-ce qu'on apprend aux enfants quand ils
commencent dentrer, - jespre quil nen est plus
ainsi maintenant, mais je nen suis pas assur
justement pour leur expliquer les choses, on leur dit
le contraire, savoir quon ne les additionne pas,
les torchons avec les serviettes, ni les poires avec
les poireaux moyennant quoi, naturellement, ils sont
dfinitivement barrs aux mathmatiques.
48
Revenons notre FEYNMAN, cette parenthse ne peut
que vous garer. FEYNMAN conclut , voil l'exemple,
un chiffre va toujours sortir constant : 28 blocs.
Eh bien, dit-il, l'nergtique, c'est a. Seulement
il n'y a pas de blocs, ceci veut dire que ce chiffre
constant qui assure le principe fondamental de la
conservation de l'nergie - je dis non seulement
fondamental, mais dont le seul frmissement la
base, suffit mettre tout physicien dans la panique
absolue - ce principe doit tre conserv tout prix,
donc il le sera forcment puisquil le sera tout
prix, c'est la condition mme de la pense
scientifique.
Mais qu'est-ce que a veut dire que la constante,
quon retrouve toujours le mme chiffre ?
Car tout est l. Il ne s'agit que d'un chiffre. a
veut dire que quelque chose qui manque comme tel - il
n'y a pas de blocs - est retrouver ailleurs dans un
autre mode de manque. L'objet scientifique est
passage, rponse, mtabolisme (mtonymie si vous
voulez, mais attention), de l'objet comme manque.
Et partir de l, beaucoup de choses s'clairent.
Nous nous reportons ce que lanne dernire nous
avons pu mettre en vidence de la fonction du UN.
Est-ce qu'il ne vous apparat pas que le premier
surgissement du UN concernant l'objet, c'est celui de
l'homme des cavernes - pour vous faire plaisir si
vous vous plaisez encore ces sortes dimages - qui
rentre chez lui o il y a un petit peu de provisions
ou beaucoup, pourquoi pas, et qui dit :
il en manque un ,c'est a l'origine du trait
unaire, un trou.
Bien sr on peut pousser les choses plus loin, et
mme nous ny manquerons pas. Remarquez que ceci
prouve que notre homme des cavernes est dj au
dernier point des mathmatiques, il connat la
thorie des ensembles, il connote : il en manque un,
et sa collection est dj faite.
Le vritable point intressant c'est videmment le UN
qui dnote, l il faut le rfrant, et les stociens
nous serviront.Il est vident que la dnotation l,
est quoi ?
49
Sa parole, c'est dire la vrit qui nous ouvre,
elle, sur le trou, savoir : pourquoi UN ?
Car cet UN, ce qu'il dsigne c'est toujours l'objet
comme manquant.
Et ou serait donc la fcondit de ce quon nous dit,
tre la caractristique de l'objet de la science,
quil peut toujours tre quantifi. Est-ce que c'est
seulement que, par un parti-pris qui serait
vritablement incroyable, que nous choisissons de
toutes les qualits de l'objet seulement celle-ci :
la grandeur, quoi ensuite nous appliquerions la
mesure, dont on se demande ds lors d'o elle nous
vient.
Du ciel bien entendu.
Chacun sait que le nombre, c'tait tout du moins
ainsi que KRONEKER s'exprimait si mon souvenir est
bon :
le nombre entier est un cadeau de Dieu
34
.
Les mathmaticiens peuvent se permettre des opinions
aussi humoristiques.
Mais la question n'est pas l, c'est justement de
rester coll cette notion
que la quantit c'est une proprit de l'objet et
qu'on la mesure
quon perd le fil, qu'on perd le secret de ce qui
constitue l'objet scientifique.
Ce qui se mesure l'aune de quelque chose (qui est
toujours quelque chose d'autre) dans les dimensions
- et elles peuvent tre multiples - de l'objet comme
manque. Et la chose est si peu sensible que ce dont
nous aurons nous apercevoir, cest que la vritable
exprience qu'on fait dans l'occasion est celle-ci :
savoir que le nombre en soi, nest pas du tout un appareil de
mesure, et la preuve en a t donne au lendemain mme des
inspirations pythagoriciennes : on a vu que le nombre ne
pouvait pas mesurer ce quil permet lui-mme de construire,
savoir quil nest mme pas foutu de donner un nombre, un
nombre qui daucune faon nexprime dune faon commensurable,
la diagonale du carr qui n'existerait pas sans le nombre.
34 Lopold Kronecker : " Dieu a cr les nombres entiers, tout le reste est fabriqu par l'homme "
50
Je n'voque ceci ici que par ce que cela a
d'intressant que si le nombre pour nous, est
concevoir comme fonction du manque, ceci - cette
simple remarque que jai faite propos de la
diagonale incommensurable - nous indique quelle
richesse nous est offerte partir de l.
Car le nombre nous fournit, si je puis dire,
plusieurs registres de manque. Je prcise pour ceux
qui ne se sont pas spcialement intresss cette
question : un nombre dit irrationnel, qui est
pourtant, au moins depuis DEDEKIND
35
considrer
comme un nombre rel, n'est pas un nombre qui
consiste en quelque chose qui peut s'approcher
indfiniment, il n'est plongeable dans la srie des
nombres rels, prcisment qu' faire intervenir une
fonction, dont ce nest pas un hasard quon la
appel la coupure.
a n'a rien faire avec un but qui se recule comme
quand vous crivez : 0,33333 qui est un nombre, lui,
parfaitement commensurable : cest un tiers de 1. Pour
la diagonale on sait depuis les Grecs pourquoi elle est
strictement incom-mensurable, savoir que pas un de
ses chiffres n'est prvisible jusqu' la fin des fins.
Ceci n'a d'intrt que de vous faire envisager que,
peut-tre, les nombres nous fourniront quelque chose
de trs utile pour structurer ce dont il s'agit pour
nous, savoir la fonction du manque.
Nous voici donc devant la position suivante : le sujet
ne peut fonctionner qu' le dfinir comme coupure,
l'objet comme un manque. Je parle de l'objet de la
science, autrement dit : un trou. Les choses allant si
loin que je pense vous avoir fait sentir que seul le
trou, en fin de compte, peut passer pour ceci qui,
effectivement nous importe, c'est--dire la fonction de
cause matrielle. Voici les termes entre lesquels nous
avons serrer un certain nud.
35 Richard Dedekind, "Les nombres, que sont-ils et quoi servent-ils?", in Et Dieu cra les nombres
Les plus grands textes de mathmatiques comments par Stephen Hawking , Dunod, 2006.
51
Puisque je nai pu, aujourd'hui avancer mon propos
aussi loin que je l'esprais, en consquence du fait
que les choses n'taient point crites, et puisque
aussi bien je ne peux pas esprer, en huit jours,
faire ma discrtion le choix ncessaire, je ferai ce
troisime mercredi de ce mois, par exception, le mme
sminaire ouvert o vous tes donc tous convis.
Pour ponctuer, pointer, ce dont il va s'agir, je ferai
l'opposition : quel rapport concevoir de l'objet(a) de
la psychanalyse avec cet objet de la science, tel que
je viens d'essayer de vous le prsentifier ?
Il ne suffit pas de parler du trou, alors que pourtant,
bien sr, il me semble, au moins pour les plus vifs que
la solution doit dj vous apparatre pointe cest
le cas de le dire - notre horizon. La fonction du
manque
je n'ai pas dit l'ide, faites attention ! Cette
ide, nous savons comment elle a attrap PLATON
par la cheville et qu'il ne s'en est point dptr
la fonction du manque, nous la voyons surgir, subir
la fuite ncessaire par la chute de l'objet a et c'est
ce que ces dessins - que jai amens aujourd'hui, que
je ramnerai la prochaine fois - sont faits pour vous
faire toucher du doigt.
Quelle structure est ncessaire pour qu'une coupure
dtermine le champ, d'une part du sujet tel qu'il est
ncessit comme sujet de la science, et d'autre part,
le trou o s'origine un certain mode d'objet, le seul
retenir, celui qui s'appelle objet de la science ?
Et comme telle peut tre cette sorte de cause sur
laquelle jai laiss la dernire fois le point
d'interrogation, est-elle, comme il apparat,
seulement la forme des lois ?
Ou bien, o s'accroche-t-elle cette face manifestement
matrialiste par laquelle peut tre justement dsigne
la science. C'est bien en ce nud de la fonction du
manque que gt et qu'est recel ici le point tournant
de ce qui est en question. Et qu'allons-nous avoir en
ce point qui est un point de bance ?
Nous l'avons vu l'anne dernire propos de la gense
fregenne du nombre l. C'est pour sauver la vrit
qu'il faut que a fonctionne.
52
Sauver la vrit ce qui veut dire : ne rien vouloir en
savoir. Il y a une autre position qui est de jouir de
la vrit. Eh bien a, c'est la pulsion
pistmologique, le savoir comme jouissance avec
l'opacit quil entrane dans l'abord scientifique de
l'objet, voil l'autre terme de l'antinomie, c'est
entre ces deux termes que nous avons saisir ce qu'il
en est du sujet de la science, c'est l que je compte
le reprendre pour vous emmener plus loin. Entendez
bien, pour parler de cette fonction radicale, je n'ai
rien fait encore surgir de ce qu'il en est de
l'objet(a), mais vous devez bien sentir que le mme
schma, justement, que je n'ai pas l reproduit, le
schma des deux cercles au temps o je vous ai dpeint
la fonction de l'alination comme telle, rappelez vous
lexemple :
la bourse ou la vie, la libert ou la mort ?
je vous ai expliqu que le schma de l'alination c'est
cela : un choix qui n'en est pas un, en ce sens quon y
perd toujours quelque chose, ou bien le tout.
Vous jouissez de la vrit mais qui jouit, puisque vous
n'en savez rien ? Ou bien, vous avez non pas le savoir
mais la science et cet objet d'intersection qui est
lobjet(a) vous chappe. L est le trou, vous avez ce
savoir amput.
Tel est le point sur lequel je marrterai aujourdhui.
Table des sances
53
15 Dcembre l965
Table des sances
Les figures, les coupures ne vous sont pas mnages
aujourd'hui. Pour tre strict mme, j'ai pris soin de
mettre au tableau en haut et gauche, celle qui
correspond au rappel que j'ai fait la dernire fois
de ce que j'avais donn la fin de ma premire anne
ici comme schma de l'alination.
Disons que l'alination consiste en ce choix, qui
n'en est pas un, et qui nous force - des deux termes
- accepter ou la disparition des deux ou un seul
mutil .
Jouir de la vrit disais-je, voil qui est la vise
vritable de la pulsion pistmophilique en quoi fuit
et s'vanouit, la fois tout savoir et la vrit
elle-mme. Sauver la vrit, et pour ceci, ne rien
vouloir en savoir, voil ce qui est la position
fondamentale de la science et c'est pourquoi elle est
science, c'est dire savoir, au milieu duquel
s'tale le trou du manque, de l'objet(a) - ici marqu
par appui sur une convention eulrienne - comme
reprsentant le champ d'intersection de la vrit et
du savoir.
Il est clair qu' ces cercles d'EULER, j'ai lev
plus d'une objection sur le plan de leur utilisation
strictement logique, et qu'aussi bien leur usage,
ici, est en quelque sorte mtaphorique. Ce sont des
prcautions prendre.
N'allez pas penser que je pense qu'il y ait un champ
de la vrit et un champ du savoir.
54
Le terme champ a un sens prcis que nous aurons
peut-tre l'occasion de retoucher aujourd'hui.
Donc cet usage des cercles eulriens est prendre
avec rserve.
Je le note parce que, la diffrence de cette
rserve que je viens de faire, vous allez me voir
aujourd'hui, prendre appui sur certaines -
dire certaines formes ce nest pas dire ce que
c'est, coupures c'est plus prs, signifiants c'est
ce dont il s'agit, critures pourquoi pas ?
Donc - j'avance - Donc je vous prie de remarquer que
leur porte dcisive est prendre en un bien autre
sens qu'un sens de signification comme ce que
reprsente le cercle - au sens eulrien ici - qui en
somme est destin nous montrer comment s'inclut une
certaine conceptualisation extensive et comprhensive
dans ce que je vous montre au centre de ces figures
que j'ai apportes pour vous aujourd'hui. savoir
quelque chose qui a t trac par un moine bouddhiste
qui s'appelle du nom que j'ai mis l au tableau, dans
sa phontisation Japonaise, puisque Japonais il
tait : JIOUN SONJA
36
.[Cf. article biog. P.21, note 1]
JIOUN SONJA - comme un de mes fidles amis, qui est
ici aujourd'hui, a eu la bont de me l'apprendre -
JIOUN SONJA a vcu de l714 l804. Entr dans les
ordres (si j'ose dire) Bouddhistes l5 ans, vous
voyez qu'il y est rest jusqu' un ge avanc.
Son uvre est considrable et je ne vous dirai pas
les fondations originales qui portent encore sa
marque. Vous donner une ide de son activit, sera
vous voquer, par exemple, qu'un manuel d'tude
sanscrite actuellement considr comme fondamental
est de sa source, sinon tout entier de sa main et
qu'il n'a pas moins de mille volumes. C'est dire que
ce n'tait pas un homme fainant.
36 Lacan voque trs probablement ici un moine japonais de la secte Shingon (littralement La parole vraie), nomm
communment Jiun Sonia (litt : le vnrable Jiun), et Onk de son nom posthume, qui vcut de 1715 (ou 1718, date
incertaine) 1804, fonda son propre courant dans l'cole Shingon, et consacra une importante partie de sa vie l'tude
du sanscrit. Parmi ses Oeuvres sont particulirement clbres mille volumes intituls Rgles de l'tude du sanscrit. Jiun
n'tait pas un moine zen, mais il avait tudi la mditation auprs d'un matre. Il avait tudi les principales doctrines du
bouddhisme. Le texte que cite Lacan (dont la prsente version est assez probable) est crit en chinois, ce qui n'est pas
tonnant de la part d'un moine qui devait lire les stra dans leur traduction chinoise. Enfin les reprsentations d'un cercle
l'encre noire accompagnes d'un pome ou d'un commentaire taient frquentes dans la tradition bouddhiste chinoise
et japonaise. Nous remercions M. Pierre Nakimovitch, Docteur en tudes extrme-orientales, agrg de philosophie et
spcialiste de Dgen, pour les prcisions qu'il a bien voulu apporter concernant Jiun ainsi que le texte cit par Lacan.
55
Mais ce que vous voyez ici est typiquement la trace
de ce quelque chose qui, dirai-je, se fait en quelque
point sommet d'une mditation et n'est pas sans
rapport - au moins de semblance - avec ce qui
s'obtient de certains de ces exercices, ou plutt de
ces rencontres qui s'chelonnent sur le chemin de ce
qu'on appelle le ZEN.
J'aurais scrupule avancer ce nom mme ici, savoir
devant un auditoire, une partie duquel est pour moi
trop peu sre quant la faon dont je peux tre
entendu, pour que, avancer sans aucune prcaution une
rfrence quelque chose - qui n'est certes pas un
secret, qui trane les rues et dont on entend parler
partout : le ZEN - ne reprsente pas quelque chose
qui peut aller jusqu' l'abus de confiance.
vrai dire, je ne saurais trop vous conseiller de
vous mfier de toutes les sottises qui s'empilent
sous ce registre. Mais aprs tout pas plus que sur la
psychanalyse elle-mme .
Je suis forc tout de mme de dire que ceci :
trac d'un coup de pinceau - dont sans doute, il
n'est pas sr que nous puissions apprcier la vigueur
particulire, qui est pourtant pour un il exerc,
assez frappante - ce coup de pinceau, c'est lui qui
va m'importer, c'est sur lui que je vais fixer votre
attention pour supporter ce que j'ai aujourd'hui
avancer dans le chemin que nous avons ouvert.
Il n'est pas douteux qu'il est l dans la position
propre qui est celle qui est celle que je dfinis
pour tre celle du signifiant.
56
Qu'il reprsente le sujet, et pour un autre
signifiant, ceci tant assez assur par le contenu de
l'criture qui, ici, s'aligne et se lit comme
l'criture chinoise qu'elle est :
[Soit en simplifi et en pinyin]
j sn
rn qin
zh nin
di
Ceci est crit en caractre chinois, je vous le
prononcerai, non pas en Japonais mais en Chinois :
San qian nian dai, ji ren zhi ce qui veut dire :
dans trois mille ans, combien d'hommes sauront ? .
Sauront quoi ?
Sauront qui a fait ce cercle.
Qui tait cet homme dont j'ai cru devoir, d'abord,
vous indiquer l'empan entre le plus extrme, le plus
pyramidal de la science et un mode d'exercice dont
nous ne pouvons pas ne pas tenir compte ici comme
fonds de ce qu'il nous laisse ici dcrire ?
Dans trois mille ans, combien d'hommes sauront
ce qu'il y a au niveau de ce cercle trac ?
Je me suis permis, dans ma propre calligraphie, de
rpondre :
57
[Soit en simplifi et en pinyin : ]
rn sn
zh qin
y nin
qin
Dans trois mille ans, bien avant, les hommes
sauront .
San qian nian qian, ren zhi ye
Bien avant trois mille ans, et aprs tout, a peut
commencer aujourd'hui, les hommes sauront, ils se
souviendront peut-tre que le sens de cette trace
mrite de s'inscrire ainsi.
Malgr la diffrence apparente, c'est topologiquement
la mme chose.
Supposez que ceci soit rond, que ce que j'ai appel
cercle soit un disque. Ce qu'ici j'ai trac de ma
main, est aussi un disque bien que sous la forme de
deux lobes dont l'un recouvre l'autre, la surface est
d'un seul tenant, elle est limite par un bord qui,
par dformation continue peut se dvelopper de faon
ce que l'un des bords recouvre l'autre
l'homomorphie topologique est vidente. Que signifie
alors que je l'ai trace d'une faon diffrente et
que ce soit l-dessus que j'aie maintenant attirer
votre attention ?
58
Un trac que j'ai appel un cercle et non pas un
disque, laisse en suspens la question de ce qu'il
limite. Pour voir les choses l o elles sont
traces : sur un plan, ce qu'il limite c'est peut-
tre ce qui tait dedans, c'est peut-tre aussi ce
qui est au dehors.
la vrit, c'est l qu'il nous faut considrer ce
qu'il peut y avoir d'originel dans la fonction de
l'crit. Quittons un instant ce que nous avons ici
sous les yeux et que je propose plutt assurment
un experimentum mentis - un exercice de l'esprit -
qu' une adhsion intuitive.
Car si je vous emmne dans le champ de la topologie,
c'est pour vous introduire une sorte
d'assouplissement (mentis) d'un exercice mental,
concernant des figures qui ne sont pas, sans doute,
sans pouvoir tre apprhende de quelque faon,
intuitivement, mais dont il vous suffira d'essayer
- au moins pour ce qui est des moins prvenus - de me
suivre pour, disons, les effets que j'essaierai de
vous y dcentrer par le trac de certaines coupures.
Vous verrez tout de suite que vous aurez assez de
peine pour ces choses excessivement simples qui sont
l, stageant votre usage dans ce que je vous ai
pour aujourd'hui prpar, pour que vous vous
aperceviez que ce n'est sans doute pas pour rien que
ces constructions
qui s'appellent - je les dj toutes introduites
et j'en ai dj mme assez us et abus, mais non
sans que j'ai aujourd'hui besoin de rassembler ce
qui les regarde - ces figures appeles :
bouteille de KLEIN, plan projectif, tore
se trouvent par rapport ce qui est la structure
des coordonnes habituelles de notre intuition, dans
une position si droutante, qu'il faut vraiment s'y
exercer, s'y appliquer, pour s'y retrouver aisment .
C'est en ceci je m'excuse - auprs de ce que je
peux avoir dans mon auditoire de mathmaticiens - de
devoir expliquer les choses par des oppositions, en
quelque sorte, massives et qui laissent chapper une
part de la rigueur de ce qui serait la prsentation
actuelle de ce qu'il en est, par exemple de ce
59
chapitre o apparaissent ces figures, dans un livre
moderne de topologie.
Mais aprs tout je n'ai pas non plus trop m'en
excuser, car si ces difficults qu'on qualifie de
difficults intuitives concernent le champ de la
topologie ont t, en quelque sorte, radicalement
limines de l'expos proprement parler
mathmatique de ces choses. Si elles n'y psent mme
pas un instant, vu les formules combinatoires trs
assures dans leurs prmisses, dans leurs axiomes
originels, dans leurs lois qui sont avances, il n'en
reste pas moins que quelque chose garde sa valeur
dans la difficult mme qu'ont prsent ces choses
tre dcantes, finir par trouver leur statut
logico-mathmatique et que c'est trop ais de s'en
dbarrasser en disant qu'il y avait l des restes
d'impurets intuitionnistes, que tout serait dans le
fait - par exemple - qu'on s'est laiss trop
longtemps encombrer par une vue en quelque sorte lie
l'exprience d'un espace trois dimensions, qu'il
fallait en arriver pouvoir le penser,
le construire, partir de ces donnes de
l'exprience en variant, en chafaudant, en difiant
une combinatoire gnralise. On se contente, de
cette critique et de cette rfrence, mais je pense
qu'on manque l quelque chose.
Si le nombre ngatif
pour nous en tenir une des apories historiques
vraiment, maintenant pour nous qui nous
paraissent le plus grossirement lmentaires
qui est-ce qui se tourmente propos de l'existence
du nombre ngatif ?
Et cette tranquillit o nous sommes propos du
nombre ngatif
outre d'ailleurs qu'elle ne recouvre rien de bon,
elle est tout de mme nanmoins bien utile pour
ce qui est de ne pas se poser de questions
inutiles
cette tranquillit l'gard du nombre ngatif ne
date pas de plus d'un sicle.
60
Je parlais encore tout rcemment avec un
mathmaticien, fort rudit, qui connat admirablement
son histoire des mathmaticiens : encore du temps de
Descartes le nombre ngatif - cette grandeur
au-dessous du zro - a les tourmente. Ils ne sont
pas tranquilles. Les nombres, a crot, a dcrot
aussi. Et quand a dpasse la limite en dessous, le
fond du fond, o est-ce que a va ? Aprs tout, c'est
assez lgitime, s'ils prenaient les choses en ces
termes, qu'ils en soient tourments.
Je n'voque cet exemple simple vous pensez bien
qu'il me serait facile d'en voquer d'autres : le
nombre irrationnel, le nombre qu'on appelle
imaginaire, la fameuse racine de l (-1).
L encore, les mathmaticiens oublient un petit peu
aisment ce que ce nombre imaginaire a t pendant
des sicles, cinq ou six sicles environ. Vous savez
qu'il est apparu propos d'une racine en dehors du
champ du concevable de la trs simple quation du
second degr. Depuis ce temps-l, jusqu'au dbut du
XIX
e
sicle (a en fait quelques uns) le nombre
imaginaire on ne savait qu'en faire - qu'en faire
conceptuellement - et si maintenant les choses sont
assures, partir du fondement du nombre complexe
(extension des ensembles numriques auxquels on a
fini par donner son statut) il n'en reste pas moins
qu'il est assez ais aux mathmaticiens - et trop
ais ! - de ne pas remarquer que, bien entendu, le
terme d'imaginaire lui reste attach, mais que c'est
un nombre aussi bon qu'un autre : que cette notion
que je viens de faire intervenir d'ensemble numrique
suffit la couvrir, et qu'il n'est pas plus
imaginaire qu'un autre.
Eh bien, c'est sur ce point que j'avancerai une
objection. Car il me semble que pour tout ce qui a
constitu ainsi point darrt, point de scansion dans
la progressive matrise des conqutes de certaines
structures que j'ai voques l'instant sous le
terme d'ensembles numriques, l'obstacle - l'obstacle
n'est pas mettre sous le registre de l'intuition -
de ce voile, de cette fermeture, qui rsulterait de
61
ce que ne peut tre visualis quelque support de ce
dont il s'agit dans la combinatoire.
Je tiens au contraire que nous sommes ports
quelque chose de plus primitif qui n'est rien d'autre
que ce que nous essayons de saisir comme la
structure, comme la constitution, de par le
signifiant, du sujet. C'est en tant que ces diverses
formes de l'expression numrique se trouvent
reproduire divers temps de scansion, je dis
reproduire temporellement et nous ne sommes mme pas
srs que c'est du mme tour qu'il s'agit dans cette
reproduction : il faut y aller voir. En d'autres
termes, il y a peut-tre des formes structurales de
ce manque constitutif du sujet qui diffrent les unes
des autres, et que peut-tre, ce n'est pas le mme
manque qui s'exprime dans ce nombre ngatif
propos duquel on peut bien dire que,
l'introduction par KANT
37
de ce nombre dans le
champ de la philosophie est vraiment - quand on y
retourne - du caractre le plus navrant.
Peut-tre est-ce un grand mrite que KANT ait
tent cette introduction. Le rsultat est un
incroyable pataugeage
donc, ce n'est pas le mme moment du manque
structural du sujet, peut-tre, qui se supporte
- je ne dis pas l se symbolise : ici le symbole est
identique ce qu'il cause - c'est dire le manque
du sujet.
J'y reviendrai.
Il y a introduire au niveau du manque, la dimension
subjective du manque, or je suis tonn que personne
n'ait regard dans l'article de FREUD sur le
ftichisme
38
[S. Freud, Le ftichisme I, II] l'usage du verbe vermessen
dont on peut voir que, dans ses trois emplois dans
cet article il dsigne le manque au sens subjectif du
sens o le sujet manque son affaire.
37 E. Kant, Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur ngative (1763), Paris, Vrin, 2000.
38 S. Freud, Le ftichisme, (G.W. XIV, p.313, 314, 316), op. cit., p.135, 137.
62
Nous voici donc ports, sur cette fonction du manque
au sens o elle est lie ce quelque chose
d'originel qui, s'appelant la coupure, se situe en un
point o c'est l'crit qui dtermine le champ du
langage.
Si j'ai pris soin, j'entends, d'crire :
Fonction et champ de la parole et du langage, c'est que
fonction se rapporte parole et champ langage.
Un champ a a une dfinition mathmatique tout fait
prcise.
La question a t pose dans la premire partie d'un
article
paru, je crois, cette semaine, en tout cas c'est
cette semaine que j'en ai reu la livraison
par quelqu'un
39
qui est trs proche de certains de
mes auditeurs et qui introduit avec une vivacit, un
mordant, une verdeur qui lui donne vraiment une
porte inaugurale, cette question de la fonction de
l'criture dans le langage. Il pointe d'une faon Je
dois dire, dfinitive, irrfutable, que faire de
l'criture un instrument, de ce qui serait, vivrait,
dans la parole, est absolument mconnatre sa
vritable fonction.
Qu'il faille la reconnatre ailleurs, est structural
au langage mme dune chose que j'ai assez indiqu
moi-mme - et ne serait-ce que dans la prvalence
donne la fonction du trait unaire au niveau de
l'identification - pour que je n'aie pas, la-dessus,
souligner mon accord.
Ceux qui ont assist mes anciens sminaires
40
-
s'ils se souviennent encore de quelque chose de ce
que j'y ai dit - pourront se souvenir de la valeur
donne ceci : quelque chose d'en apparence aussi
caduc et ininterprtable que la trouvaille faite par
Sir FLINDERS PETRIE
41
sur les tessons pr-dynastiques,
39 J. Derrida, L'criture avant la lettre, Critique, dc. 1965-janv. 1966
40 Cf. sminaire L'identification, la fin de la sance du 20-12.
41 Sir FLINDERS PETRIE, The formation of the alphabet, London, Macmillan, 1912.
63
savoir loin antrieurs la fondation de l'alphabet
phnicien, prcisment des signes de cet alphabet
prtendus phontiques qui taient l bien videmment
comme marque de fabrique.
Et j'ai l-dessus accentu ceci - qu'il nous faut au
moins admettre, mme quand il s'agirait prtendument
d'criture phontique - que les signes sont venus de
quelque part, certainement pas du besoin de signaler,
de coder des phonmes. Alors que chacun sait que mme
dans une criture phontique, ils ne codent rien du
tout.
Par contre, ils expriment remarquablement la relation
fondamentale que nous mettons au centre de
l'opposition phonmatique en tant qu'elle se
distingue de l'opposition phontique.
Ce sont l choses grossires, je dirai tout fait en
retard, au regard de la prcision avec laquelle la
question est pose dans l'article que je vous ai dit.
C'est toujours bien dangereux d'ailleurs d'indiquer
des rfrences : il faut savoir qui. Bien sr ceux
qui liront ceci y verront mises en question certaines
oppositions telles que celle du signifi et du
signifiant - a va jusque l - et y verront peut-tre
discordance l o il n'y en a aucune.
D'autre part, qui sait, a les incitera lire tel
article avant ou aprs, il y a toujours quelque chose
de bien dlicat dans cette rfrence toujours
fondamentale qu'un signifiant renvoie un autre
signifiant.
crire et publier ce n'est pas la mme chose.
Que j'crive, mme quand je parle n'est pas douteux.
Alors pourquoi ne publiez-vous pas plus ?
Justement cause de ce que je viens de dire. On
publie quelque part.
La conjonction fortuite, inattendue, de ce quelque
chose qui est l'crit - et qui a ainsi d'troits
rapports avec l'objet(a) - donne toute conjonction
non concerte d'crit, l'aspect de la poubelle.
Croyez-moi, l'heure matinale o il m'arrive de
rentrer chez moi, j'ai une grande exprience de la
poubelle et de ceux qui la frquentent.
64
Rien de plus fascinant que ces tres nocturnes qui y
chopent je ne sais quoi dont il est impossible de
comprendre l'utilit. Je me suis longuement demand
pourquoi un ustensile aussi essentiel avait si
aisment gard le nom d'un prfet, auquel on avait
dj donn un nom de rue ce qui aurait bien suffi
sa clbration. Je crois que si le mot poubelle est
venu si exactement se colloquer avec cet ustensile,
c'est justement cause de sa parent avec la
poubellication.
Pour revenir nos Chinois vous savez
je ne sais pas si c'est vrai mais c'est difiant
qu'on n'y met jamais la poubelle un papier sur
lequel a t trac un caractre. Des gens pieux
vieillards dit-on parce qu'ils n'ont rien d'autre
faire, les collectent pour les brler sur un petit
autel ad hoc. C'est vrai.
Si non e vero, e bello !
Il est tout fait essentiel de dlimiter cette sorte
de trappe d'extriorit que j'essaie de dfinir au
regard de la fonction de la poubelle dans ses
rapports avec l'crit. Ceci n'implique pas
l'exclusion de toute hirarchie. Disons que parmi les
revues dont nous sommes dots il y a des poubelles
plus ou moins distingues.
Mais bien prendre les choses je n'ai pas vu
d'avantages sensibles sur les poubelles de la rue de
Lille, par rapport celles de quartier plus
circonvoisins.
Donc, reprenons notre trou.
Chacun sait qu'un exercice ZEN, a a tout de mme
quelque rapport - encore qu'on ne sache pas bien ce
que a veut dire - avec la ralisation subjective
d'un vide. Et nous ne forons rien en admettant que
quiconque - le contemplateur moyen - verra cette
figure, se dira qu'il y a quelque chose comme une
sorte de moment sommet - qui doit avoir rapport avec
le vide mental - qu'il s'agit d'obtenir et qui serait
obtenu - ce moment singulier, brusquerie succdant
65
l'attente - qui se ralise parfois par un mot, une
phrase, une jaculation, voire une grossiret, un
pied de nez, un coup de pied au cul
Il est bien certain que ces sortes de pantalonnades
ou clowneries n'ont de sens qu'au regard d'une longue
prparation subjective.
Mais encore. Au point o nous en sommes venus, si
vide il y a, si le cercle est considrer - pour
nous - comme dfinissant sa valeur trouante, si, y
trouvant faveur figurer ce que nous avons approch
- par toutes sortes de convergence - de ce qu'il en
est de l'objet(a), que l'objet(a) soit li, en tant
que chute, l'mergence, la structuration, du
sujet comme division, c'est l ce qui reprsente, je
dois dire, le point de la mise en question :
qu'est-ce qu'il en est du sujet dans notre champ ?
Est-ce que ce trou, cette chute, cette [ptse]
pour employer ici un terme stocien dont il me
semble que la difficult - certes tout fait
insoluble quil fait aux commentateurs pour tre
affront avec le seul [catgorma] et ceci
propos d'un [lecton] autre terme mystrieux
traduisons-le sous toutes rserves et de la faon
la plus grossire (certainement inexacte) par
signification, signification incomplte - en
d'autres termes : fragment de pense. L'une de
ces possibilits de fragment de pense , c'est
la [doxa], l [eudokein].
Et les commentateurs, bien sr, tenus par
l'incohrence du systme, ne loupent pas tellement le
rapport en le traduisant par sujet, sujet logique.
Comme il s'agit de logique ce niveau de la doctrine
stocienne, ils n'ont pas tort.
Mais que nous puissions y reconnatre la trace
cette articulation de quelque chose qui chot avec la
constitution du sujet, voil ce dont je crois nous
aurions tort de ne pas nous sentir conforts.
alors, allons-nous, de ce trou, nous contenter ?
Un trou dans le rel, voil le sujet. Un peu facile.
Nous sommes encore l, au niveau de la mtaphore .
Nous trouverions l pourtant - nous y arrter un
66
instant - une indication prcieuse, notamment quelque
chose de tout fait indiqu par notre exprience,
qui pourrait s'appeler l'inversion de la fonction du
cercle eulrien : nous serions encore dans le champ
de l'opration de l'attribution, nous rejoindrions l
le chemin ncessaire ce que FREUD dfinit comme la
Bejahung, d'abord et seule rendant concevable la
Verneinung.
Il y a la Bejahung, et la Bejahung est un jugement
d'attribution. Elle ne prjuge pas de l'existence,
elle ne dit pas le vrai sur le vrai.
Elle donne le dpart du vrai savoir quelque chose
qui se dveloppera : [ poios ], telle la
qualification, la quiddit, ce qui n'est d'ailleurs
pas tout fait pareil.
Nous en avons un exemple dans l'exprience
psychanalytique - il est premier pour notre objet
d'aujourd'hui - c'est le phallus.
Le phallus un certain niveau de l'exprience - qui
est proprement parler celle qui est analyse dans
le cas du Petit Hans - le phallus est l'attribut de ce
que FREUD appelle les tres anims.
Laissons de ct, si nous n'avons pas une dsignation
meilleure.
Mais observez que si ceci est vrai, ce qui veut dire
que tout ce qui se dveloppe dans le registre de
l'animisme aura eu pour dpart un attribut qui ne
fonctionne qu' tre plac au centre, structurer le
champ l'extrieur et commencer tre fcond
partir du moment o il tombe, c'est dire o il ne
peut plus tre vrai que le phallus est l'attribut de
tous les tres anims .
Je le rpte. Si j'ai avanc ce schma, je ne l'ai
fait qu'entre parenthses. Soit dit en passant, si
mon discours se droule de la parenthse, du suspens
et de sa clture, puis de sa reprise, trs souvent
embarrasse, reconnaissez-y une fois de plus la
structure de l'criture.
67
Est-ce donc l serait-ce donc l, un de ces rappels
sommaires o se limiterait l'exhaustion que nous
tentons de faire ?
Assurment pas !
Car il ne s'agit pas, pour nous, de savoir - au point
o nous portons la question - comment le signifiant
peinturlure le rel ! Qu'on puisse colorier n'importe
quelle carte sur un plan avec quatre couleurs, et que
a suffise, encore que ce thorme soit cette date,
comme toujours, vrifi, encore indmontr - ce n'est
pas ce qui nous intresse aujourd'hui. Il ne s'agit
pas du signifiant comme trou dans le rel. Il s'agit
du signifiant comme dterminant la division du sujet.
Qu'est-ce qui peut nous en donner la structure ?
Aucun vide, aucune chute de l'objet(a), aucune
angoisse primordiale n'est susceptible d'en rendre
compte et je vais essayer de vous le faire sentir par
des considrations topologiques.
Si je procde ainsi, c'est parce qu'il y a un fait
tout fait frappant, c'est que de mmoire de
griffonneur - et Dieu sait que a date, mme si on
croit que l'criture est une invention rcente - il
n'y a pas d'exemple que tout ce qui est de l'ordre du
sujet, et du savoir du mme coup, ne puisse toujours
s'inscrire sur une feuille de papier. Je considre
que c'est l un fait d'exprience plus fondamental
que celui que nous avons, que nous aurions, que nous
croyons avoir, des trois dimensions. Car nous avons
appris - ces trois dimensions - les faire vaciller
un petit peu. Il suffit qu'elles vacillent un petit
peu pour qu'elles vacillent beaucoup au lieu que,
peut-tre, on crive toujours sur une feuille de
papier et qu'on n'ait pas besoin de la remplacer par
des cubes : a, n'a pas encore vacill.
Il doit donc y avoir l quelque chose, dont je ne
suis pas en train de dire qu'il faille en conclure
que le rel n'est que de deux dimensions.
Je pense assurment que les fondements de
l'esthtique transcendantale sont reprendre, que la
mise en jeu - ne serait-ce qu' titre probatoire -
d'une topologie deux dimensions pour ce qui
68
concerne le sujet, aurait en tout cas dj, cet
avantage rassurant
si nous continuons croire, dur comme fer, nos
trois dimensions dans lesquelles en effet nous
avons bien des raisons de leur marquer de
l'attachement ces trois dimensions, parce que
c'est l que nous respirons
a aurait au moins l'avantage rassurant de nous
expliquer en quoi, ce qui concerne le sujet est de la
catgorie de l'impossible. Et que tout ce qui nous
parvient - par lui - du rel, s'inscrit d'abord au
registre de l'impossible, de l'impossible ralis. Le
rel dans lequel se taille le patron de la coupure
subjective, c'est ce rel que nous connaissons bien
parce que nous le retrouvons, l'envers en quelque
sorte, de notre langage chaque fois que nous voulons
vraiment serrer ce qu'il en est du rel : le rel
c'est toujours l'impossible.
Reprenons donc notre feuille de papier. Notre feuille
de papier, nous ne savons pas ce que c'est. Nous
savons ce que c'est que la coupure et que - cette
coupure - celui qui l'a trace, est suspendu son
effet.
Dans trois mille ans, combien d'hommes sauront ?
Il faudrait savoir quelle condition doit remplir une
feuille de papier, ce qu'on appelle en topologie une
surface, l o nous avons fait les trous, pour que ce
trou soit une cause, savoir ait chang quelque
chose.
Observez que pour ce que nous essayons de saisir de
ce qu'il en est du trou, nous n'allons pas nous
mettre en supposer un autre.
Celui-l nous suffit.
Si ce trou a eu pour effet de faire tomber une chute
- un lambeau, bon - il faut que ce qui reste ne soit
pas la mme chose, parce que si c'est la mme chose,
c'est exactement ce qu'on appelle un trou ou un coup
d'pe dans l'eau .
Eh bien, si nous nous fions au support intuitif le
plus accessible, le plus familier, le plus
69
fondamental - et dont il ne s'agit d'ailleurs pas de
dprcier bien sr, ni l'intrt historique, ni
l'importance relle - savoir une sphre
je demande ici pardon aux mathmaticiens : c'est
l'intuition qu'ici je fais appel, puisque nous
n'avons qu'une surface dans laquelle on tranche
et que je n'ai pas faire appel quelque chose
qui est plong, justement dans l'espace trois
dimensions
savoir [] ce que je veux simplement dire en vous
demandant d'voquer une sphre, c'est de penser que
ce qui reste autour du cercle n'a pas d'autre bord.
Vous ne pouvez intuitionner a dans l'tat actuel des
choses que sous la forme d'une sphre, une sphre
avec un trou. Si vous rflchissez ce que c'est
qu'une sphre avec un trou, c'est exactement la mme
chose que le couvercle que vous venez de faire
tomber. La sphre a la mme structure.
La chute dont il s'agit dans ce trac fondamental n'a
pas d'autre effet que de faire resurgir la mme
place ce qui vient d'tre ablationn. a ne nous
permet en aucun cas de concevoir quelque chose qui ,
au regard du sujet qui nous intresse, soit
structural.
Comme il faut bien que j'avance, je ne ferai qu'une
allusion rapide au fait que M. BROUWER, personnage
considrable dans le dveloppement moderne des
mathmatiques, a dmontr ce thorme topologiquement
qui, topologiquement, est le seul nous donner le
vrai fondement de la notion de centre, une homologie
70
topologique : deux figures, quelles qu'elles soient,
en tant que pourvues d'un bord, peuvent tre, par
dformation de ce bord, dmontres homomorphiques.
En d'autres termes vous prenez un carr, c'est
topologiquement la mme chose que ce cercle, car vous
n'avez qu' souffler, si je puis m'exprimer ainsi,
l'intrieur du carr, il se gonflera en cercle.
Et inversement, vous donnez des coups de marteau sur
le cercle, sur ce cercle deux dimensions, vous
donnez un coup de marteau deux dimensions galement
et il fera un carr. Il est dmontr que cette
transformation, de quelque faon qu'elle soit faite,
laisse au moins un point fixe, ou - chose plus
astucieuse et moins facile voir immdiatement,
encore que dj la premire chose ne soit pas si
facile - ou un nombre impair de points fixes. Je ne
m'tendrai pas l-dessus. Je veux simplement vous
dire qu' ce niveau de structure de la surface, la
structure est, si l'on peut dire, concentrique, mme
si c'est par l'extrieur que nous passons. Je veux
dire intuitivement, pour percevoir ce qui se rejoint,
au niveau de ce bord, il s'agit d'une structure
concentrique .
Il y a trs longtemps que j'ai dit - je suis encore
plus port le dire, mais je ne le dirai pas
pourtant - que PASCAL tait un trs mauvais
mtaphysicien. Ce monde des deux infinis, ce morceau
littraire qui nous casse les pieds depuis quasi
notre naissance, me parait tre la chose la plus
dsute qui se puisse imaginer.
Cet autre topos anti-aristotlicien o le centre est
partout, et la circonfrence nulle part, me parat
bien tre la chose la plus ct qui soit, si ce
n'est que j'en ferai aisment sortir toute la thorie
de l'angoisse de PASCAL .
Je le ferai d'autant plus aisment qu' la vrit je
crois [] si j'en crois des remarques stylistiques
qui m'ont t apportes par ce grand lecteur en
matire de mathmatiques qui m'a pri de me rfrer
au texte de DESARGUES, lequel tait un autrement
grand styliste que PASCAL, pour s'apercevoir, ce que
nous savons trs fermement par ailleurs, de
71
l'importance que les rfrences de DESARGUES
pouvaient avoir pour PASCAL, ce qui changerait tout
le sens de son uvre.
Quoi qu'il en soit, il est clair que sur cette
structure concentrique, sphrique, si le cercle peut
tre partout, assurment le centre n'est nulle part.
Autrement dit, il saute aux yeux de n'importe qui,
qu'il n'y a pas de centre la surface d'une sphre.
L est l'incohrence de l'intuition pascalienne.
Et maintenant, le problme se pose de savoir s'il ne
peut pas y avoir - pour nous expliquer en termes, non
pas d'images, mais peut-tre d'ides, et qui vous
donnent l'ide d'o je vous guide - si l'extrieur
de ce que j'ai appel le cercle, trs
intentionnellement, et pas circonfrence, le cercle
veut dire ce que vous appelez ordinairement en
gomtrie circonfrence, ce qu'on appelle d'habitude
cercle, je l'appellerai disque ou lambeau, comme tout
l'heure.
Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait au dehors pour
structurer le sujet, autrement dit, pour que la
coupure d'o rsulte la chute de l'objet(a), fasse
apparatre - sur quelque chose qui tait tout fait
ferm jusque l et o donc, rien ne pouvait
apparatre - pour faire apparatre, en ce que nous
exigeons de la constitution du sujet, le sujet comme
fondamentalement divis ?
Ceci est facile faire apparatre car il suffit que
vous regardiez la faon dont est dispos ce cercle
dans la faon dont je l'ai retrac, pour vous
apercevoir que si ce trac vous le concevez vide,
comme je vous ai appris lire vide celui-ci, il
devient trs simplement - et cela saute aux yeux :
je pense tout de mme vous avoir assez parl
jusqu'ici de la bande de MBIUS pour que vous la
reconnaissiez - il est la monture, l'armature, ce qui
vous permet de voir soutenu et immdiatement
intuitionnable une bande de MBIUS.
Vous la voyez ici :
72
Joignez, si je puis dire, d'une trace chacun de ses
bords. Vous la voyez se renverser et venir se coudre
au niveau de son envers ce qui tait d'abord son
endroit, la bande de MBIUS a de nombreuses
proprits. Il y en a une majeure, capitale, que je
vous ai suffisamment je pense, reprsente dans les
annes prcdentes - jusqu'avec une paire de ciseaux,
ici, moi-mme je vous l'ai dmontre savoir
qu'une bande de MBIUS, a n'a aucune surface.
Que c'est un pur bord. Non seulement il n'y a qu'un
bord, cette surface de la bande de MBIUS mais si
je la refends par le milieu, il n'y a plus de bande
de MBIUS, car c'est mon trait de coupure, c'est la
proprit de la division qui institue la bande de
MBIUS. Vous pouvez retirer de la bande de MBIUS,
autant de petits morceaux que vous voudrez, il y aura
toujours une bande de MBIUS tant qu'il restera
quelque chose de la bande, mais a ne sera toujours
pas la bande que vous tiendrez. La bande de MBIUS,
c'est une surface telle que la coupure qui est trace
en son milieu, soit elle, la bande de MBIUS.
La bande de MBIUS dans son essence , c'est la
coupure mme. Voil en quoi la bande de MBIUS peut
tre pour nous le support structural de la
constitution du sujet comme divisible.
Je vais ici avancer quelque chose dont je vous
signale, au niveau topologique strict l'inexactitude,
nanmoins, ce n'est pas cela qui sera pour nous
gner, car, que je sois pris entre vous expliquer
quelque chose d'une faon inexacte ou ne pas vous
l'expliquer du tout, voil un de ces exemples
tangibles de ces impasses subjectives qui sont
prcisment ce sur quoi nous nous fondons.
73
Donc - j'avance - vous ayant suffisamment avertis,
qu'en stricte doctrine topologique ceci est inexact,
vous pouvez remarquer que ma bande de MBIUS
je parle de celle qui se dessine sur la monture de
cet objet(a) :
cette monture, je vous l'ai dit, c'est exactement un
lambeau sphrique qui ne se distingue en rien de ce
que je vous ai dmontr tout l'heure propos du
trou de JIOUN SONJA.
Pour qu'il puisse servir de monture une bande de
MBIUS, c'est bien que la bande de MBIUS change
radicalement sa nature de lambeau ou de portioncule
en se soudant lui. Ce dont il s'agit, c'est d'un
texte, tissu, cohrence, d'une toffe, de quelque
chose de tel que, y tant passe la trace d'une
certaine coupure, deux lments distincts,
htrognes apparaissent, dont l'un est une bande de
MBIUS et dont l'autre est ce lambeau quivalent
tout autre sphrique :
Cette bande de MBIUS, fomentez la par l'imagination,
elle viendra en cette ligne ncessairement, si la
chose est plonge dans trois dimensions - c'est l
74
qu'est mon inexactitude - mais c'est une inexactitude
qui ne suffit pas carter le problme de ce fait
que quelque chose qui est indiqu dans les trois
dimensions par un re-croisement, un recoupement qui
donne finalement, la figure totale de ce qu'on
appelle communment une sphre coiffe d'un chapeau
crois ou cross-cap, qui donne ce qui est ici dessin
en rouge :
savoir ce que vous pouvez imaginer, toujours d'une
faon bien sr inexacte, et plong dans la troisime
dimension, comme ayant - dans le bas, et au niveau de
cette base, de cette chiasmatique, de ce re-
croisement comme ayant cette coupe :
75
Toute coupure qui passe au niveau de ce qui,
schmatiquement est reprsent comme cette trace de
re-croisement, toute coupure ferme qui passe par ce
re-croisement est quelque chose qui dissipe, si je
puis dire, instantanment toute la structure du
crosscap (chapeau crois, ou encore plan projectif).
la diffrence d'une sphre qui ne quitte pas sa
structure fondamentale, concentrique, propos de
n'importe quelle coupure ou bord ferm que vous
pouvez dcrire sur sa surface. Ici la coupure
introduit un changement essentiel savoir
l'apparition d'une bande de MBIUS et d'autre part,
ce lambeau ou portioncule :
Et pourtant, ce que je viens de vous dire, c'est que
le trait - ici dessin en noir [ a ] :
76
qui est un trait simple, un bord ferm, du mme type
que celui du dessin de JIOUN SONJA - l'a rduite,
vous aije dit, toute entire cette portioncule.
Alors, o est la devinette ?
Je pense que vous vous souvenez encore de ce que je
vous ai dit tout l'heure, savoir que la coupure
elle-mme est une bande de MBIUS.
Comme vous pouvez le voir ce second trac que j'ai
fait sur la mme figure, ct [ b ], figure qui se
schmatise dans quelque chose, baudruche o j'essaie
de vous faire intuitonner ce qu'il en est du plan
projectif si vous cartez les bords, si je puis dire,
qui rsultent de la coupure ici trace en noir, vous
obtenez une bance qui est faite comme une bande de
MBIUS.
La coupure elle-mme a la structure de la surface
appele bande de MBIUS. Ici vous la voyez figure
par un double trait de ciseaux, que vous pourriez
galement faire et o vous dcouperiez effectivement
la figure totale du plan projectif en chapeau crois
comme je l'ai appel, en deux parts : une bande de
MBIUS d'une part [ a ]
ici elle est cense tre dcoupe elle toute
seule
et un reste [ b ] d'autre part, qui est ce qui joue la
mme fonction du trou dans sa forme primitive,
savoir du trou qu'on obtient sur une surface
sphrique.
Ceci est fondamental considrer et il faut que vous
en voyiez une autre figure sous la forme schmatise
et plus proprement topologique qui est celle-ci dont
j'ai inscrit le complment sur ce tableau o je pense
que vous le voyez :
77
2
me
trou : moebien
Alors que la faon dont se suture le premier trou -
le trou sphrique :
1
er
trou : sphrique
celui que j'ai appel concentrique - la topologie
nous rvle que rien n'est moins concentrique que
cette forme de centre attenant la fonction du
premier lambeau
78
Car pour fermer le trou sur la sphre, une simple
coupure est bonne qui rapproche les deux morceaux,
la faon simplement dont une couturire vous fera
n'importe quelle reprise.
La coupure instaure, si vous prenez la chose en sens
inverse, par la bande de MBIUS cela implique un
ordre, et c'est rellement l qu'est notre troisime
dimension, ce qui nous justifie, tout l'heure en
avoir introduit une troisime, fausse, pour vous
faire sentir le poids de ces figures.
Cette dimension d'ordre
autrement dit, reprsentant une certaine assise
temporelle
implique que, pour raliser ce trou
le trou second dont je suis en train de vous
expliquer les proprits topologiques
un ordre est ncessaire qui est un ordre
diamtral.
Diamtral c'est dire apparemment spatial, fond
selon le trait mdian qui vous donne le support
figur o proprement se lit que cette sorte de
coupure est justement celle que nous attendions,
c'est dire qui ne se ralise qu' devoir du mme
coup se diviser.
Autrement dit, si c'est non pas d'une faon intuitive
et visuelle mais d'une faon mentale que vous essayez
de raliser ce dont il s'agit, partir du moment o
vous pensez que le a, le point a sur ce cercle est
identique au point a diamtralement oppos
ce qui est la dfinition mme de ce qui fut
introduit dans un tout autre contexte, dans la
gomtrie mtrique, par DESARGUES, autrement dit,
le plan projectif, et Dieu sait que DESARGUES en
l'crivant, lui-mme a soulign ce qu'avait de
paradoxal, d'ahurissant, d'affolant enfin, une
telle conception, ce qui prouve bien que les
mathmaticiens sont fort capables de concevoir
eux-mmes les points de transgression, de
franchissement qui sont les leurs propos de
l'instauration de telle ou telle catgorie
structurale.
t
d
o
p
le a
dire
comme
faire
le mo
Nous
sujet
nces
struc
je n
plus
Sache
struc
boute
montr
ensem
vous
nous
propr
D'aut
struc
premi
nous
boute
42 Gira
Desargues
S'ils l
toujour
leur di
disent,
spcial
les mur
on s'in
passion
a et le
si ce
e le tr
e qu'
ouvemen
trouvo
t en ta
ssairem
cture m
'ai, bi
loin l
ez seul
ctures
eille d
r, ell
mble de
le ver
en dd
rits.
tre par
cture.
ires c
servir
eille d
ard Desargues (
Lyonnois), Pari
l'oubli
rs leur
isant q
, ce qu
lement
rs de L
nsultai
nnantes
e a sont
n'est q
rou, la
diviser
nt, si l
ons donc
ant que
ment se
mme.
ien ente
le point
lement q
topolog
de KLEIN
le est
e deux b
rrez, ce
duision
rt le to
Nous po
concerna
r ces de
de KLEIN
(1591-1661). Cf.
is, 8 avril 1619.
aient d
s confr
qu'on ne
i arriv
ce qui
yon se
t pro
. Beau
t le m
que, m
conjon
r le tr
l'on pe
c l le
dterm
prsen
endu, p
t o je
qu'en n
giques
N en ta
faite,
bandes
eci ne
s, par
ore qui
ouvons
ant le
eux aut
N et du
f. L'abcs de Mo
Cf. ses uvres s
d'aille
rres p
e compr
ve ch
est ar
sont c
opos de
temps
me []
me si
nction
rou, qu
eut dir
e modl
min pa
nter co
pas pu
e dsir
nous r
qui so
ant que
compos
de MB
suffit
simple
i est e
part
S conce
tres st
u tore
onsieur d'Esper
sur Gallica t.1 et
eurs, i
pour le
rend rie
haque co
rriv
couvert
e chose
: merve
qu'est
nous co
des bor
veni
e, de s
e de ce
r une c
mme div
aujourd
ais vou
frant
nt resp
, je vo
e de l
IUS
pas du
additi
ncore u
ir de c
evoir
ructure
pour t
rnon, perc par
t t.2
l y aur
leur r
en ce
oup, et
DESARG
s de li
s, vous
eilleus
t-ce qu
onsidr
rds ne
ir y pa
sa conj
e qu'il
coupure
vis da
d'hui p
us fair
deux
pective
ous l'a
la cout
u tout
ion ses
une aut
ces df
quoi
es de l
tablir
un de ses amis
rait
rappele
e qu'il
t
GUES
42
ibells
s le vo
se poq
ue a ve
rons cec
saurait
asser da
onction
l en est
e. Il do
ans la
pousser
re arriv
x autre
ement la
ai dj
ture
ce qu
s
tre
finition
peuvent
la
des
s, sign L.S.D.L
79
r en
s
o
o
yez,
que!
eut
ci
t se
ans
n.
t du
oit
ver.
s
a
ue
ns
t
L.( Le Sieur
80
relations fondamentales qui nous permettront de
situer
avec une rigueur qui n'est jamais obtenue
jusqu'ici avec le langage ordinaire, pour autant
que le langage ordinaire aboutit une
ontification du sujet qui est le vritable nud
et cl du problme. Chaque fois que nous parlons
de quelque chose qui s'appelle le sujet, nous en
faisons un UN. Or ce qu'il s'agit de
concevoir,c'est justement ceci, c'est que le nom
du sujet est ceci : il manque l'UN pour le
dsigner. Qu'est-ce qui le remplace?
Qu'est-ce qui vient faire fonction de cet UN?
Assurment plusieurs choses. Mais si on ne voit
pas que plusieurs choses trs diffrentes :
l'objet(a) d'un ct par exemple, le nom propre
de l'autre remplissent la mme fonction, il est
bien clair qu'on ne peut rien comprendre ni
leur distinction - car quand on s'aperoit qu'ils
remplissent la mme fonction on croit que c'est
la mme chose - ni au fait mme qu'ils
remplissent la mme fonction.
il s'agit de savoir o se situe, o s'articule ce S,
ce sujet divis en tant que tel. Le tore dune part,
figure si exemplaire que dj dans l'anne de mon
sminaire sur l'Identification [ 1961-62 ]
o, sauf les oreilles fraches que j'avais cette
anne-l, personne n'coutait ce que j'tais en
train de dire : on avait d'autres soucis
dans mon sminaire sur l'Identification, j'ai montr
la valeur exemplaire que pouvait avoir le tore pour
lier d'une faon structuralement dogmatisable la
fonction de la demande et celle du dsir proprement
parler au niveau de la dcouverte freudienne,
savoir du nvros et de l'inconscient. Vous en verrez
le fonctionnement exemplaire.
Ce qui peut s'en structurer du sujet est tout entier
li structuralement la possibilit de la
transformation, du passage, de la structure du tore
celle de la bande de MBIUS, non pas la vraie du
sujet :
81
mais la bande de MBIUS en tant que divise,
en tant qu'une fois coupe par le milieu elle n'est
plus une bande de MBIUS, elle est une chose qui a
deux faces, un endroit et un envers, qui s'enroule
sur soi-mme d'une drle de faon, mais qui, comme je
vous ai apport aujourd'hui le modle :
pour que vous le voyez d'une faon sensible, devient
applicable sur ceci qu'on appelle couramment un
anneau et qui est un tore.
Cette connexion structurale permet d'articuler d'une
faon particulirement claire et vidente certaines
relations qui doivent tre fondamentales pour la
dfinition des rapports du sujet de la demande et du
dsir.
De mme au niveau de la bouteille de KLEIN seulement
pourra se dfinir le rapport originel tel qu'il
s'instaure partir du moment o dans le langage
entrent en fonction la parole et la dimension de la
vrit. La conjonction non symtrique du sujet et du
lieu de l'Autre est ce que nous pourrons, grce la
bouteille de KLEIN, illustrer.
82
Sur ces indications simples, je vous laisse en vous
donnant rendez-vous au premier mercredi de janvier.
Pour le quatrime mercredi de ce mois, je prie
instamment quiconque dans cette assemble, qui soit
d'une faon quelle qu'elle soit intress la
progression de ce que j'essaie ici de faire avancer,
de bien vouloir, - quel que soit le sort que je
rserverai la feuille d'information qu'il aura
remplie, c'est--dire que je l'invite ou non au
quatrime mercredi - considrer que ce n'est pas en
raison de ses mrites ou de ses dmrites qu'il est
ou non invit.
Ils sont ou non invits pour des raisons qui sont les
mmes que celle que PLATON
43
dfinit la fonction de
politique, c'est--dire qui n'a rien faire avec la
politique mais de celle qui est bien plutt
considrer comme celle du tapissier.
S'il me faut quelques fils d'une couleur et d'autres
fils d'une autre couleur pour faire ce jour-l une
certaine trame, laissez-moi choisir mes fils [ Sic ].
Que je fasse a cette anne titre d'exprience,
chacun des quatrimes mercredis, est une chose que
l'ensemble de mes auditeurs et d'autant plus qu'ils
me sont plus fidles, et d'autant plus qu'ils peuvent
tre vraiment intresss par ce que je dis, doivent
en quelque sorte laisser ma discrtion.
Vous me laisserez donc, pour le prochain quatrime
mercredi, inviter qui il me semblera bon pour que le
sujet, le sujet donn de discussion, de dialogue, qui
fonctionnera ce jour-l se fasse dans les conditions
les meilleures, c'est--dire avec des interlocuteurs
par moi expressment choisis. Ceux qui ne feront pas
partie - ce mercredi-l - de ceux-l, n'ont nullement
s'en formaliser.
Table des sances
43 PLATON : La Politique,279c .
83
22 Dcembre l965 Table des sances
GREEN CONT MELMAN
[Le dbut de la sance manque]
Andr GREEN [notes en fin dexpos ]
Parler de l'objet de la psychanalyse soulve
immdiatement une question. Elle conduit
s'interroger pour savoir si l'on va traiter de
l'objet de la psychanalyse au sens o l'on parle de
l'objet d'une science ce que vise la dmarche de la
science en sa progression ou si l'on va parler du
statut de l'objet tel que le conoit la psychanalyse.
La surprise serait ici de montrer que ces deux sens
sont troitement lis et interdpendants.
LITTR fait remarquer qu'au mot sujet l'Acadmie dit
: les corps naturels sont le sujet de la physique.
Et au mot objet, elle dit encore : les corps naturels
sont l'objet de la physique. Loin de nous d'y reprer
un redoublement contradictoire ou trop facilement
rductible. Nous ne nous joindrons pas non plus -
brandissant cet exemple - au chur de tous ceux qui
dnoncent dans la sparation du sujet et de l'objet
la cause de toutes les impasses thoriques dont la
pense traditionnelle se rend responsable.
Rencontrer au dpart le sort li du sujet et de
l'objet n'est ni affirmer leur confusion, ni leur
indpendance. C'est supputer que nous allons avoir
faire face aux confrontations de l'identit et de la
diffrence, de la conjonction et de la disjonction,
de la suture et de la coupure. Nous aurons alors
nous demander si l'objet de la psychanalyse je
parle maintenant de ce quoi elle vise peut se
suffire de cette limitation couple laquelle
beaucoup de disciplines contemporaines, parmi les
plus avances, se confinent.
I - L'objet de Jacques Lacan. Rappel cursif
84
Examiner le rle de l'objet(a) dans la thorie de
Jacques Lacan sera, pour nous, faire d'une pierre
deux coups. Cela nous mnera c'est du moins notre
projet en prciser le contenu dans le cadre
conceptuel qui lui est propre, d'une part, et d'autre
part marquer les limites de l'accord de cette
pense et sans doute de toute la pense
psychanalytique avec le structuralisme moderne.
A - Le (a), mdiation du sujet l'Autre
Le (a) (je ne dis pas encore l'objet(a)) est prsent
ds le plus ancien graphe de Lacan
2
o celui-ci part
de la thorisation propose dans le Stade du miroir
(1936-1949).
(a) peut se comprendre alors dans sa relation (a')
(qui aura les plus troits rapports avec le futur
i(a), c'est--dire l'image spculaire) comme lment
de l'indispensable mdiation qui unit le sujet
l'Autre. Il est clair que cette situation du stade du
miroir qu'il est moins important de dater comme
stade que de dsigner comme situation structurante
ne peut se comprendre que si l'on prcise que ce
n'est pas ici la psychologie qui est en cause
(qu'il s'agisse de Preyer ou de Wallon) mais la
psychanalyse. La psychanalyse qui donne l'enfant
issu de sa mre une signification qui pse sur tout
son dveloppement : savoir qu'il est le substitut
du pnis dont la mre est prive et qui n'accde
85
son statut de sujet que de prendre sa place l o il
manque la mre dont il dpend. Ce substitut est le
lieu et lien d'change entre la mre et le pre qui,
pour avoir le pnis, ne peut pour autant le crer
(puisqu'il l'a).
La relation (a)i(a) va doubler la relation que
nous venons de dcrire.
B - Le (a), mdiation du sujet l'idal du Moi
Vient ensuite le quadrangle dit schma R
3
.
Ici encore s'oppose le couple des tensions entre le
systme des dsirs (i M) et le systme des
identifications (m I). Le (a) s'inscrit sur la ligne
(i M) qui, partie du sujet S vers l'objet primordial
M (la Mre) se constitue travers les figures de
l'autre imaginaire. Par contre le (a') s'inscrit sur
la ligne qui va du sujet l'Idal du Moi travers
les formes spculaires du moi. On voit comment le
quadrangle drive du Z [ schma L ] dont il joint les points
qui, dans le premier graphe, ne sont atteints que par
un parcours dtourn. On pourrait ici relever que
dans le champ de l'imaginaire les deux directions du
sujet vont soit vers l'objet, soit vers l'idal. On
sait que dans la pense freudienne cette orientation
est troitement dpendante du narcissisme.
On notera alors que l'Autre, venu au lieu du Nom du
Pre, situ dans le seul champ du symbolique, au ple
oppos au sujet ici identique au phallus, ne
s'atteint que par les deux voies que nous venons de
86
dcrire plus haut, objectale ou narcissique, mais
jamais de faon directe.
Le champ du rel est compris dans la tension des deux
couples (mI) x (iM) dont nous avons prcis la
signification. Mais c'est au seul champ du symbolique
qu'apparat le troisime terme, indispensable la
structuration du processus
4
.
C - Le (a), objet du dsir
En effet, Lacan postule l'existence d'un Moi idal
comme forme d'identification prcoce du moi
certains objets qui jouent la fois comme objet
d'amour et objet d'identification, mais en tant
qu'ils sont arrachs, dcoups, prlevs sur une
srie qui fait apparatre le manque. Moi qui parle,
je t'identifie l'objet qui te manque toi-mme,
dit Lacan. La relation entre (a) et A est donc ainsi
plus clairement montre. Si A n'atteint sa pleine
signification qu' se soutenir du Nom du Pre qui
n'est, faut-il le prciser, ni un nom ni un Dieu, il
passe, nous l'avons vu, par le dfil maternel et ne
s'atteint que lorsque la coupure entre le sujet et
l'objet maternel le spare irrmdiablement dudit
objet. Ou encore lorsque se rvlera le manque dont
est affect l'objet primordial, dans l'exprience de
la castration. La srie des castrations postule par
FREUD : sevrage, dressage sphinctrien, castration
proprement dite, rend cette exprience dans sa
rptition, signifiante et structurante, dans sa
rcurrence.
L'objet (a) sera donc ce qui de ces expriences, va
choir, comme dit Lacan, de sa position
d' exposant au champ de l'Autre
5
, mais pour
atteindre ce statut d'objet du dsir. Le tribut
pay cette accession est d'exclure le sujet
dsirant, dire, nommer, l'objet du dsir.
D'avoir t situ au champ de l'Autre permet
maintenant de concevoir la fonction de mdiation
qu'un tel objet joue moins entre le sujet et l'Autre,
que dans leur rapport ; mon dsir entre dans l'Autre
o il est attendu de toute ternit sous la forme de
87
l'objet que je suis, en tant qu'il m'exile de ma
subjectivit en rsumant tous les signifiants quoi
cette subjectivit est attache
6
.
Nous savons que le fantasme permet l'tablissement de
cette formule de rapport, en tant qu'il y rvle le
sujet en effaant sa trace. Le fantasme comme
structure constitutive du sujet, o celui-ci
s'imprime en creux, par lequel la fascination opre,
ouvre sur la relation de l'objet(a) avec le Moi
idal.
D - Le (a) ftiche
Cette formulation indique tout ce qui spare la
thorisation de Lacan de celle des autres auteurs.
Disons schmatiquement qu'alors que ceux-ci vont
surtout marquer l'aspect positif des qualits de
l'objet, Lacan valorise l'approche ngative. Un
exemple clair nous le montre. Devant l'image de la
mre phallique, les auteurs post-freudiens diront
qu'elle est terrifiante parce que phallique. Parce
que le phallus peut tre instrument de malfaisance,
arme destructrice, etc.
FREUD disait que la sidration produite par la tte
de Mduse oprait parce que les reptiles qui lui
tenaient lieu de chevelure venaient nier, autant de
fois qu'il y avait de serpents, la castration qui par
ce renversement se rappelait de faon multiplie
celui qui la voulait, annuler.
Lacan suivra plus volontiers cette dernire voie.
Le cas du ftichisme sur lequel il reviendra
longuement sera l'apologue de ce mode rflexif.
L'objet du ftiche sera le tmoin, le voile du sexe
chtr du manque au champ de l'Autre.
E - Le (a) objet du manque, cause du dsir
propos de son sminaire sur le Banquet
7
nous
apparat avec une force particulire la structure
mtonymique et mtaphorique de l'objet(a) dans le
reprage que fait Jacques Lacan dans le texte de
88
Platon de la position particulire des agalmata, dans
le discours d'Alcibiade o celui-ci dpeint Socrate :
Il est tout pareil des silnes qu'on voit plants dans des
ateliers de sculpture et que les artistes reprsentent tenant
un pipeau ou une flte, les entrouvre-t-on par le milieu, on
voit qu' l'intrieur ils contiennent des figurines de
dieux .
Nous avons affaire la fois au fragment de corps,
la partie du corps et sa symbolisation, et ceci est
prendre la lettre, sous la forme de la figurine
divine.
C'est justement en tant que cet objet (a) va surgir
comme objet du manque qu'il va se dployer sur un
double registre qui sera la fois la rvlation du
manque de l'Autre et la fois le manque tel qu'il
apparat dans le processus de signification.
Ce qui manque l'Autre, c'est ce qu'il n'est pas
donn de concevoir. Le (- ) qui s'introduit ici sous
la forme de ce qui n'apparat pas c'est le Rien qui
n'est pas figurable sous lequel s'ordonne la
rencontre avec la castration comme impensable, dont
l'hiatus est combl avec le processus de
significantisation, par le mirage du savoir. Je cite
encore :
(a) symbolise ce qui, dans la sphre du signifiant comme
perdu, se perd la significantisation. Ce qui rsiste cette
perte est le sujet dsign. Ds qu'entre en jeu le processus
du savoir, ds que a se sait, il y a quelque chose de
perdu .
C'est cette apparition sous la forme de l'objet du
manque qui spcifie ce autour de quoi va tourner
notre expos, savoir la nature non spcularisable
du (a). Tout se passe comme si le sujet barr prend
fonction de i(a) comme s'exprime Lacan ou encore
comme si, court-circuitant l'impossible
spcularisation du manque, le sujet s'identifie ainsi
au savoir, venant en lieu et place de la perte qui en
suscite la promotion, recouvrant cette perte jusqu'
l'oubli de son existence.
89
partir de cette apparition du manque, va jouer la
fonction de reste issue du dsir de l'Autre, fonction
de reste qui se manifeste comme rsidu lch par la
barre, qui affecte le grand Autre et dont l'homologue
dans le sujet l'intresse au savoir. L encore Lacan
fait une distinction d'ordre logique o la
nullification ne supprime pas l'avoir, ce qui
justement fait apparatre le reste.
Fonction de reste, c'est ce qui est sauv de la
menace qui pse sur le sujet : le dsir se
construit sur le chemin d'une question : n'tre .
L'objet (a) est la cause du dsir.
F - Le (a), produit d'un travail
On peut penser, bien que Lacan ne le dise pas
expressment, que la dimension progression-rgression
peut constituer un plan corrlatif ceux de la
conjonction-disjonction et de la suture-coupure.
Les dveloppements engendrs sur le plan du savoir
seront prendre dans leur perspective ngative,
renvoyant au plan de mconnaissance o ils se sont
organiss dans la dmarche du processus de
significantisation qui tend sans relche annuler
ou nullifier la perte de l'objet ce qui s'est
signifi autour de cette perte, par les traces
laisses de ce travail, dont l'objet (a) sera le
repre le plus sr, l'index de la vrit point vers
le sujet. FREUD insiste, dans ses uvres terminales
sur la vrit historique laquelle vise la
construction de l'analyste. Le canal de la
demande constitue le fil conducteur de cet accs la
vrit. Sa fonction n'est pas seulement de servir de
guide, mais de former le dessin mme de cet
itinraire des chemins de la vrit.
Ce rappel o nous n'avons voulu garder que le minimum
indispensable au dveloppement qui va suivre va nous
permettre de poser quelques problmes.
a) tant donn la relation de l'objet (a) la
reprsentation, il convient de se demander quels sont
90
les rapports de celle-ci avec la chane signifiante.
Le manque reprsent a-t-il quelque relation avec la
parole comme concatnation ?
b) Faut-il accorder en se tournant vers FREUD le
statut de signifiant au seul Vorstellung-reprsentanz ?
Qu'en est-il de l'affect ?
c) N'y a-t-il pas dans l'uvre de FREUD un point
quant la reprsentation qui n'a pas trouv d'cho
chez Lacan : la distinction entre diffrents types de
reprsentations (de mots et de choses par exemple),
qui pourrait conduire diffrencier encore
davantage, pour souligner le caractre original de la
concatnation freudienne.
d) Si le savoir est ce qui vient au lieu de la
vrit, aprs la perte de l'objet, n'y a-t-il pas
lieu de relier l'un l'autre par les traces de cette
perte et la tentative de leur effacement ?
Ce sont ces questions qui permettront de considrer
l'objet(a) moins comme support de l'objet partiel que
comme parcours d'une main traante, inscription,
lettre, a.
II - La suture du signifiant, sa reprsentation et
l'objet (a)
J'en viens ce qui va constituer un autre axe de mon
expos, savoir la relation du (a) avec la coupure
et la suture, et je me rfrerai l'expos de J.A.
MILLER concernant la thorisation, partir de
l'ouvrage de FREGE , de la logique du signifiant
8
.
Ceci pour bien situer la position du nombre zro dans
la mesure o elle va avoir une incidence sur le
destin du (a).
En vertu du principe selon lequel, pour que la vrit
soit sauve, chaque chose est identique soi et zro
est le nombre assign au concept non identique
91
soi , il n'y a pas d'objet qui tombe sous ce
concept. Mais, dit MILLER parlant de FREGE :
il a t ncessaire, afin que ft exclue toute rfrence
au rel, d'voquer, au niveau du concept, un objet non-
identique soi rejet ensuite de la dimension de la
vrit. Le 0 qui s'inscrit la place du nombre consomme
l'exclusion de cet objet. Quant cette place, dessine
par la subsomption, o l'objet manque, rien n'y saurait
tre crit, et s'il y faut tracer un 0, ce n'est que pour
y figurer un blanc, rendre visible le manque .
Il y a donc ici d'une part l'vocation et l'exclusion
de l'objet non-identique soi, et d'autre part ce
blanc, ce trou, la place de l'objet subsum.
La notion d'unit est donne par le concept de
l'identit, concept de l'objet subsum. Mais sa place
de un, non plus en tant qu'unit mais en tant que
nombre un, reste problmatique quant sa place de
premier, quant sa primordialit, si j'ose ainsi
m'exprimer.
Le nombre zro, fait remarquer MILLER, il n'est pas
lgitime de le compter pour rien, et la logique
voudrait alors que l'on confre ce nombre zro le
rle de premier objet.
La consquence en est l'identit au concept du nombre
zro qui subsume l'objet nombre zro en tant qu'il
est un objet. La primordialit, en somme, ne peut
s'instaurer sous le signe de l'unit, mais du nombre
partir duquel le un est possible, le nombre zro.
Ainsi un double registre recouvre un fonctionnement
qu'il faut dplier pour comprendre l'ambigut du
nombre zro en tant qu'il inclut :
- le registre du concept de non-identique soi
- le registre de l'objet, matrice de l'un, objet
permettant l'assignation du nombre un.
Alors se dcouvre la double opration :
92
- l'vocation et l'lision du non-identique soi,
avec un blanc au niveau de l'objet subsum permettant
le nombre zro
- l'introduction du zro comme nombre, c'est--dire
comme nom signifiant et comme objet.
Cette situation a surtout un intrt pour nous en
tant qu'elle spcifie la structure de la
concatnation. Non seulement le sujet s'exclut de la
scne et de la chane signifiante du fait mme qu'il
la constitue comme sujet dans sa structure de
concatnation, mais le premier de ces objets joue
la fois comme concept et comme objet, non reprsent
mais dnomm objet unaire et concept sur la
non-identit soi, concept de menace pour la vrit,
et ceci d'autant plus qu'il est hors-jeu ou hors-je.
Ce concept de menace pour la vrit est pour nous
concept issu de la rencontre avec la vrit, en tant
qu'il dissocie non seulement la vrit de sa
manifestation (identit soi) mais y dsigne sa
place, par le blanc ou la trace qui la ngative.
Il est insuffisant de n'y voir (c'est le cas de le
dire) qu'un simple rapport d'absence. Il faut encore
que soit ici cern son rapport de manque la vrit.
L'intrt pris par nous cette confrontation avec
FREGE lu par MILLER est de lier le sujet au
signifiant. Le sujet s'identifie la rptition qui
prside chacune des oprations par lesquelles la
concatnation se noue, dans la prise de chaque
fragment par celui qui le prcde et celui qui lui
succde : dans le mme temps et dans le mme
mouvement, le sujet se voit autant de fois rejet
hors de la scne et de la chane , qui ainsi se
constitue.
Or, si l'opration l'exclut chaque tape, la
nullification ne supprime pas l'avoir qui subsiste
pour nous, condition de savoir la reconnatre sous
la forme du (a).
L'effet de concatnation rejoint la dfinition par
Lacan du signifiant :
93
le signifiant est ce qui reprsente un sujet pour
un autre signifiant .
S'claire ainsi ce qu'il est des rapports du sujet et
de l'objet(a), dans leurs relations de suture et de
coupure :
Si la suite des nombres, mtonymie du zro commence par sa
mtaphore - dit MILLER - si le 0, nombre de la suite, comme
nombre n'est que le tenant-lieu suturant de l'absence (du zro
absolu) qui se vhicule dessous la chane suivant le mouvement
alternatif d'une reprsentation et d'une exclusion, qu'est-ce
qui fait obstacle, reconnatre dans le rapport restitu du
zro la suite des nombres, l'articulation la plus
lmentaire du rapport qu'avec la chane signifiante
entretient le sujet ? .
Je laisse ici la question du rapport du sujet au
grand Autre par l'effet du zro
9
, mais vais
m'employer soulever deux problmes, ceux de la
suture et celui de la reprsentation.
A) Le problme de la suture
LECLAIRE s'est lev l contre cette suturation
infre par MILLER.
La question demeure : y a-t-il ou n'y a-t-il pas
suture ? Ce qui dsigne la position du psychanalyste
l'endroit de la vrit ne serait-il pas justement
ce privilge de n'avoir pas suturer ? Comment nier
qu'il n'y ait suture s'il y a concatnation ?
J'en voudrais pour preuve cet argument de FREUD trop
souvent oubli sur les consquences de la castration.
Si celle-ci est possible, si la menace vient
excution, elle ne prive pas seulement le sujet du
plaisir masturbatoire, mais elle a, comme implication
hautement redoute, l'impossibilit dsormais
dfinitive pour le sujet chtr de l'union avec la
mre. Qu'on voie ici la castration comme
l'effondrement de tout le systme signifiant par la
rupture de toute possibilit de concatnation,
explique que FREUD la compare un dsastre dont les
dgts sont incommensurables.
94
En tous cas le pnis joue ici le rle de mdiateur de
la coupure et de la suture.
Comment cela peut-il se suturer ? Jacques-Alain
MILLER, je viens de le dire, a montr l'ascension du
nombre zro, sa transgression de la barre sous forme
du un, son vanouissement lors du passage de n n'
qui est (n + 1). Mais on n'a pas tort non plus de
faire valoir que la logique d'un
concept inconscient a des exigences qui sont
internes sa formation.
Citons ici FREUD (avec LECLAIRE) : Faeces ,
enfant , pnis forment ainsi une unit, un
concept inconscient (sit venia verbo). Le concept
nommment d'une petite chose qui peut se sparer
de son propre corps (par. VII).
une opposition du type binaire, celle que la
linguistique nous offre - celle de la phonologie o
les rapports sont toujours poss en termes de couples
antagonistes et celle qu'on met la base de toute
information - on substitue ici un processus
opratoire trois termes (n, +, n') avec
vanouissement d'un terme sitt qu'il s'est
manifest. Nous trouvons l une sorte de paradigme
qui peut nous donner la voie de ce que pourrait tre
le dcoupage du signifi.
En effet les linguistes se montrent extrmement
embarrasss lorsqu'il s'agit du dcoupage du signifi
alors que le dcoupage du signifiant ne prsente pour
eux aucune espce de difficult semble-t-il. Si par
exemple j'en crois MARTINET, je lis :
Quant smantique, s'il a acquis le sens qui nous
intresse, il n'en est pas moins driv d'une racine qui
voque non point une ralit psychique mais bien le processus
de signification qui implique la combinaison du signifiant et
du signifi // un sme en tout cas, ne saurait tre autre
chose qu'une unit double face
10
.
L'embarras nat ici de ce que toute rfrence directe
au signifi ruinerait la dmarche structuraliste,
puisque son accession par la voie du signifiant cre
95
le dtour ncessaire une apprhension indirecte,
relative et corrlative.
En outre, et surtout, le reprage des traits
pertinents nous laisse ici dans la perplexit.
En dfinitive, ce qui manque ici de support
consistant est la structure du corps. Car l'assurance
de tenir pour fermes les traits pertinents en
phonologie ne repose-t-elle pas en dfinitive sur le
fonctionnement de l'appareil vocal ? Sans doute est-
il sous commande nerveuse, ce qui explique la
fascination des linguistes pour la cyberntique.
Le psychanalyste est ici le seul se mettre
l'coute du sens, son niveau, c'est--dire
considrer, en respectant la mme exigence de
rfrence indirecte, que le dcoupage passera au
niveau du signifi, et que c'est ce dcoupage mme
qui impliquera un dcoupage du signifiant qui rend
intelligible le signifi. Ici se repre l'ambigut
qu'il faudra bien lever, entre la conception
linguistique du signifiant et sa formulation
psychanalytique telle que Lacan le conoit. Mais
s'agit-il du mme ?
Vous avez sans doute reconnu dans cette unit
double face la thorisation de la bande de MBIUS de
Lacan
11
. Mais ne peut-on pas considrer que le
dcoupage du signifi, dans cette srie mtonymique
des diffrents objets partiels est reprsent par le
phallus, justement, en tant qu'il vient apparatre,
sous la forme du (- ) dans ses diffrents objets
partiels, dont la succession diachronique vous est
connue : objet oral, objet anal, objet phallique,
(etc.), ces termes ne reprsentant que leur reprage
quant aux zones rognes, laissant la place des
formes plus complexes.
Ceci pourrait concilier un choix entre un systme
binaire strict qui nous renvoie des options telles
qu'elles ne nous laissent pas de mdiation tierce, et
un autre systme o la causalit est dveloppe en
rseau, un systme de type rticulaire, qui fait
disparatre tout fonctionnement de type
oppositionnel. Finalement il parat bien que la forme
minima de cette structure rticulaire est la
96
structure triangulaire ou le tiers est vanouissant.
C'est, je crois, l'opration claire par le
commentaire de MILLER.
Ceci peut nous voquer les diverses formes de
relations auxquelles nous avons affaire dans l'dipe
o une opposition, celle de la diffrence des sexes,
en tant qu'elle est supporte par le phallus est en
fait insre dans un systme triangulaire et ne
s'apprhende jamais que par des relations deux
deux, o le phallus constitue l'talon des changes,
sa cause.
SAUSSURE a eu le mrite de placer au principe de la
langue comme systme, la valeur, esquissant cet
endroit la comparaison avec l'conomie politique.
Mais pour l'avoir ainsi dgage, il n'est gure all
plus loin et ne s'est pas pos la question de ce qui
a valeur pour le sujet parlant. Ainsi la suture
s'accomplit ici en laissant se profiler la valeur, en
cause, sans rien nous dire d'elle.
C'est ici que nous rencontrons la fonction de la
cause dveloppe par Jacques Lacan. Si, avec FREGE ,
l'identit soi a permis le passage de la chose
l'objet, ne pouvons-nous pas penser que ce que nous
venons de montrer peut fonctionner comme relation de
l'objet la cause ? On peut conclure que l'objet est
la relation signifiante qui peut relier les deux
termes de la chose et de la cause. Nous aurions ici
peut-tre un de ces exemples dont parle cet article
aujourd'hui contest de FREUD sur le sens
antithtique des mots primitifs puisque nous savons
que chose et cause ont une racine commune, la
mdiation se trouvant ici passer par l'objet.
En somme, nous assisterions au passage de
l'indtermin l'tat de ce qui est ou opre,
de ce qui est en fait ce qui est de l'ordre
de la raison, du sujet, ou du motif par
l'intermdiaire de l'objet en tant que sa dfinition
est : ce qui se prsente la vue ou affecte les
sens
l2
.
B) Le problme de la reprsentation
97
Ici se pose alors notre deuxime problme, savoir
celui de la reprsentation. Il m'avait sembl que
MILLER avait fait peu de place toutes les
rfrences la reprsentation dont FREGE use.
Cependant il a conserv, dans le passage cit plus
haut, la notion d'un mouvement alternatif d'une
reprsentation et d'une exclusion. La fonction de
rassemblement, de subsomption, est solidaire de la
notion d'un pouvoir qui met ensemble, et qui, au prix
d'une coupure (celle du pouvoir de rassemblement la
chose prsente), reprsente. C'est la coupure qui
permet la reprsentation. Or ici le nombre zro
figure comme objet sous lequel ne tombe aucune
reprsentation. C'est par l'opration mme de la
coupure qu'advient, s'accomplit le sujet, je dirai
sur le dos , aux dpens de l'objet. Comme si l'on
pouvait dire : qu'importe la coupure (du sujet)
puisque reste la suture (de l'objet(a). C'est ce que
ralise, pour ainsi dire, le sacrifice de l'objet par
le dsir. Qu'importe la perte de l'objet si le dsir
lui survit et lui perdure. Quelque chose aussi qui
serait de l'ordre de : l'objet est mort, vive le
dsir (de l'Autre). La demande devient ce qui assure
la rsurrection renouvele du dsir au cas o il
viendrait lui-mme manquer, elle se formule
travers l'objet(a).
La demande que ne soutient aucune cause, cause dont
l'effet est le trou, par lequel le reste se
confondrait avec la demande, n'est-ce pas ainsi que
le fou le bouffon : Polonius voit le fou Hamlet
amoureux de sa fille et incertain vengeur du Pre
mort qui fera prir un autre pre, celui de l'objet
de son dsir (Polonius) la suite d'une tragique
mprise :
That I have found
the very cause of Hamlet's lunacy
I will be brief. Your noble son is mad
Mad call I it ; for to define true madness
What is't but to be nothing else but mad .
Et plus loin :
98
That we find out the cause of this effect,
Or rather say, the cause of this defect,
For this effect defective comes by cause
Thus it remains, and the remainder thus
Perpend .
III - La relation (a) i(a) et le problme de la
reprsentation et de la spcularisation
Lacan insiste avec force sur le fait que l'objet(a)
n'est pas spcularisable, le recours l'image
spculaire n'est ni l'image de l'objet ni celle de la
reprsentation, elle est, dit Lacan dans son
sminaire sur l'Identification (1962) un autre objet
qui n'est pas le mme. Il est pris dans le cadre
d'une relation o est en jeu la dialectique
narcissique dont la limite est le phallus qui y opre
sous la forme du manque.
Or, nous venons de voir l'objet non figurable que
reprsente le nombre zro.
Qu'en est-il chez FREUD ? considrer le problme
uniquement sous l'angle de la dialectique
narcissique, on court-circuite mon avis le problme
de la reprsentation qui renvoie l'objet de la
pulsion. FREUD le dsigne comme minemment
substituable et interchangeable, ce qui pourrait
peut-tre apparatre comme un ddommagement
l'impossibilit de la fuite devant les stimuli
internes, procdure intermdiaire, dirais-je, entre
l'change restreint et l'change gnralis.
Il faut qu' cet change participe comme terme
chang un objet de pulsion, ce n'est donc pas
n'importe quel objet qui fait l'affaire dans la
substitution.
Deux problmes ici se prsentent devant nous. Le
premier est celui de la distinction entre le
reprsentant de la pulsion et l'affect, le second est
celui de la distribution diffrentielle du mode de
reprsentation.
A - Le problme de la distinction entre le
reprsentant de la pulsion et l'affect.
99
La distinction entre le reprsentant et l'affect est
conjecturale dans l'uvre de Freud, on le sait.
Souvent la pulsion y est confondue avec le
reprsentant et vice versa. Mais la fin de son
uvre, nous savons qu'une distinction de plus en plus
marque est tablie o c'est ce que je propose de
prendre en considration l'affect prend statut de
signifiant. La preuve en est que, depuis 1924,
l'emploi de la Verleugnung qu'on a propos de
traduire par dni est de plus en plus spcifi.
Ce qui va trouver sa formulation la plus prcise dans
l'article sur le ftichisme (1927) auquel Lacan se
rfre si frquemment, l'article sur le clivage du
Moi (1938) et enfin le chapitre VIII de l'Abrg de
psychanalyse (1939). La thse de FREUD devient alors
que la perception tomberait sous le coup de la
Verleugnung, alors que l'affect tomberait sous le
coup de la Verdrngung.
La possibilit dans l'alternative acceptation-refus
d'un fonctionnement global ou portant seulement sur
un des termes (perception et affect) est la condition
de la suture diffrencie de certaines organisations
conflictuelles.
C'est l, c'est partir de cette distinction que
FREUD voit ce clivage du moi : lEntzweiung que
valorise Lacan. Or si FREUD cre un terme quivalent
au refoulement, le dni, qui a mme valeur
smantique, il faut probablement en conclure que, si
seul un signifiant peut subir ce destin, c'est que
l'affect entre dans cette mme catgorie
l3
.
Je pense mme que la dfinition du signifiant
gagnerait peut-tre tre complte la lumire de
ce qui prcde : le signifiant serait alors ce qui,
sous peine de s'vanouir, doit pour subsister entrer
dans un systme de transformations o il reprsente
un sujet pour un autre signifiant tombant sous le
coup de la barre du refoulement ou du dni qui le
contraint la chute de son statut d'tre dans son
rapport avec la vrit, chute par laquelle il accde
ou il advient au rang de signifiant dans sa
rsurrection.
100
Il y aurait un certain intrt souligner la
corrlation de ces deux modes de signification,
chacun englobant les deux mcanismes. On ne voit dans
l'affect que la dcharge, alors qu'il est FREUD le
dit pour l'angoisse signal (signifiant pour nous),
on ne voit dans le reprsentant que le signifiant,
alors qu'il est (dans la thorie freudienne)
engendrement d'un certain mode de production, donc de
dcharge (engendr par l'impossibilit de celle-ci).
Dans Le Moi et le a FREUD reprend la question dj
voque, non sans difficult dans son article sur
l'Inconscient, de la diffrence entre le reprsentant
et l'affect. Ce qui qualifie l'affect est qu'il ne
peut entrer dans aucune combinatoire. Il est refoul,
mais sa spcificit en tant que signifiant est d'tre
exprim directement, de ne pas passer par les liens
de connexion du prconscient.
Dans son sminaire sur L'Angoisse, Lacan a lucid et
dmontr ce qui dclenche l'angoisse, la faon dont
a opre quand il y a de l'angoisse. Mais je me
demande s'il a bien rendu compte de ce qu'est
l'angoisse au sens du statut qu'elle a dans la
thorie. Je crois qu'il y a intrt considrer
l'affect comme une forme smantique originale ct
des smantides primaires
14
que sont les reprsentants,
celui-ci fonctionnerait dans une position seconde qui
lui permettrait d'acqurir le statut de smantide
secondaire d'une nature diffrente de celle du
reprsentant et redoublant lEntzweiung dans cette
diffrence.
Il y aurait l redoublement de la non-identit soi
par cette disparit des deux registres du signifiant.
Contrairement l'opinion reue, il est trs curieux
de voir que FREUD fait du langage ce qui transforme
les processus internes en perception, et non pas,
comme on pourrait le penser, ce qui s'arrache du plan
perceptif, et qui appartiendrait l'ordre de la
pense.
Avec l'affect nous sommes en prsence d'un effet
d'effacement de la trace perue restitue sous forme
de dcharge.
101
Qu'en est-il du reprsentant ? Les considrations de
terminologie ne sont pas ici inutiles. Cela n'est pas
pour rien qu'on a longtemps discut pour savoir s'il
fallait appeler le Vorstellung reprsentanz le
reprsentant reprsentatif, le reprsentant de la
reprsentation, le tenant-lieu de reprsentation. Il
entre dans la combinatoire, nous le savons. C'est ici
que commence l'ambigut. Il n'y entre pas titre
d'unit homogne identique soi. La clairvoyance de
FREUD dans son domaine a t de faire ds le dpart
cette distinction exclusive, prsente dans vos
mmoires, entre la perception et le souvenir.
Souvenons-nous du rle qu'il fait jouer la
rminiscence en tant qu'elle serait, si l'on peut
dire, le souvenir au lieu de l'Autre, mais qui garde
par-devers elle la trace non sans perdre sa qualit
de souvenir si elle vient se vivre dans
l'actualit.
B - Le problme de la distribution diffrentielle du
mode de reprsentation.
Un autre type de diffrenciation nous intresse ici,
celui des reprsentations de mots et des
reprsentations de choses, distinction qui n'est pas
contingente. Je ne rappelle ceci, qui est dj connu,
que pour avancer que : s'il y a une thorie du
signifiant chez FREUD, elle ne peut viter de passer
par le peru. Ceci est sensible dans l'organisation
du discours.
Dans le rcit de l'analys, l'laboration secondaire
du rve, le fantasme actuel ou ressuscit, l'image,
en sont les tmoignages renouvels dans le texte de
nos sances. La question est de savoir si tout cela
est vraiment de l'ordre du peru.
Ce reprsentant de la reprsentation montre qu'on ne
peut ramener son statut celui de la perception.
Notons une fois de plus qu'il n'est jamais question
de prsentation mais de reprsentation.
Le peru ne reprsente que le point de fascination,
l'effort de centration de la spcularisation comme
dirait Lacan.
102
Ce qui permet de fonctionner comme zro est de
l'ordre du sujet, mais ce qui va monter et prendre la
place du un est ici l'objet(a), condition qu'on le
considre dans cette distribution diffrentielle, o
la non-identit soi se manifeste dans cette
disparit.
Le point de vue conomique s'illustre ici de ne pas
seulement tre en cause lorsqu'il s'agit de
l'valuation quantitative des processus, mais de
pouvoir tre identifi dans cette distribution
diffrentielle. C'est l'effet de barrage qui pse sur
le discours qui contraint non seulement la
combinatoire, mais encore aux changements de
registre, de matriau et de modes de reprsentation
du signifiant. Ces mutations ont pour objet
d'accentuer la non-identit soi non seulement dans
la rsurgence du signifiant mais dans ses
mtamorphoses mtonymiques. La mtaphore s'infiltre
jusque dans l'enchanement mtonymique. Ce n'est pas
pour rien que FREUD oppose deux systmes : ce qui
fonctionne au niveau de l'un est l'identit des
perceptions et dans lautre lidentit des penses.
C'est en tant que tous les deux ont un rapport la
vrit qu'ils relvent de nos concepts. Mais le point
de trouble et de fascination vient de ce que la
perception puisse se donner comme champ d'identit
alors que l'identit y opre selon un registre qui
n'est pas celui du peru.
Cette identit, c'est ce qui abolit la diffrence
comme soutenue par le manque et qui trouve se
matrialiser dans le peru, de la mme faon que
l'identit des penses dans l'ordre du penser ne
vient tre oprante qu'aprs la perte de l'objet.
Lacan ne me parat pas avoir eu tout fait raison
d'avoir svrement critiqu les travaux portant sur
l'hallucination ngative. Tout au plus peut-on
dplorer leurs repres imprcis.
L'hallucination ngative, si elle est cette ascension
du zro en tant qu'elle ne relve absolument pas de
la reprsentation, serait de l'ordre du reprsentant
de la reprsentation.
103
Sa valeur est de donner un support la notion
d'aphanisis dont on sait qu'elle a jou un rle si
important chez Lacan aprs Jones.
Il faut aussi se souvenir de l'alternative releve
par Lacan dans les travaux de Jones sur la sexualit
fminine, dont la porte est probablement plus vaste
: ou l'objet, ou le dsir. L'hallucination ngative
donnerait ainsi le modle d'une structure subjective,
en tant qu'elle implique le deuil de l'objet et
l'avnement d'un sujet ngativ rendu ainsi apte au
dsir. Ne peut-on rappeler ici que les premiers modes
de la reprsentation du sujet le premier i(a) est
justement le produit d'une reprsentation homologue
de l'hallucination ngative : la main ngative de
l'artiste apparue dans le contour de la peinture qui
en dlimite la forme. On voit alors comment vient se
placer le fantasme, puisque c'est la fonction que
Lacan lui assigne de rendre le plaisir apte au dsir.
Ici donc apparat une forme d'mergence d'un sujet
qui chapperait l'anantissement de la puissance
signifiante dans l'aphanisis, puisque l'hallucination
ngative arrive se produire mais comme manque
spcularis. Elle me parat tre le rapport inaugural
de l'identification narcissique au sens de FREUD
conue comme rapport au deuil de l'objet primordial.
Elle est le point de rencontre de la coupure et de la
suture.
Il devient clair que ce procs est le mme qui fonde
le dsir comme dsir de l'Autre, puisque le deuil
s'est interpos dans la relation du sujet l'Autre
et du sujet l'objet.
Si le (a) joue entre toutes ces formes (on peut dire
qu'il se joue de la fascination du peru en
parcourant ces registres), c'est bien parce qu'il
est, non comme peru, mais comme parcours du sujet,
circuit du discours. J'en donnerai un exemple pris
dans Othello. Dans Othello, c'est le mouchoir qui peut
apparatre comme (a).
En fait, c'est l que nous sommes tmoins de l'effort
de fascination du peru, la vrit est que ce n'est
pas tant le mouchoir qui importe que le circuit qu'il
104
fait de la magicienne qui l'a donn la mre
d'Othello ou du pre celle-ci (les deux versions
sont dans Othello) jusqu' aboutir sur le lit de
Bianca, la putain, pour finalement rvler Othello
son dsir, ma mre est une putain . Ce qu'il faut
dmontrer l'aide du savoir, car Othello cherche
comme tout jaloux l'aveu plus que la vrit.
N'est-ce pas alors ainsi qu'il convient d'entendre
son soliloque, lors de l'entre dans la chambre
nuptiale o il va donner la mort Desdmone, pour
faire de sa nuit de noces une nuit de deuil.
It is the cause, it is the cause my soul
Let me not name it to you, you chaste stars.
It is the cause .
(Acte V, scne 2, 1-3).
La fonction de la cause est ici ordonnatrice de la
perception, indubitable, du mouchoir de sa mre entre
les mains de la putain.
FREUD souligne dans l'Abrg de Psychanalyse que nous
vivons dans l'espoir que nos instruments de
perception de la ralit s'affinant, nous pourrions
finalement accder la certitude du monde sensible.
En fait il accentue une fois de plus l'affirmation
que la ralit est inconnaissable et que nous ne
pouvons nous permettre que la dduction du vrai
partir des connexions et des interdpendances
existant entre les divers ordres du peru.
Ceci est videmment affirmer la prminence du
symbolique, si besoin en est.
Mais son originalit fut d'introduire au niveau du
peru un ordre, une organisation, qui permette de
sortir du dilemme de l'apparence et de la ralit,
pour lui substituer celui de l'idal (Idealfunktion)
et de la vrit, ce couple fonctionnant aussi bien
dans l'ordre du peru que du pens.
La confusion rpte plus d'une fois entre le symbole
et le symbolique doit nous rendre attentifs ne pas
prendre l'un pour l'autre.
Qu'advient-il alors de l'objet(a) ?
105
Celui-ci existe comme structure de transformation o
l'objet du dsir procde une nouvelle mutation et
o c'est le dsir qui devient objet. Par quelle
opration le recoupement travers la non-identit
soi de ces formes numres s'accomplit-il ?
Je crois qu'on peut les saisir selon les deux grands
axes de la synchronie et de la diachronie en prenant
pour rfrence la thorisation de FREUD.
1) Dans l'axe de la synchronie, nous avons une srie
forme par les penses en tant qu'il s'agit des
penses de l'inconscient (et o il faut distinguer
entre les reprsentations de mots et les
reprsentations de choses), les affects (comme
signifiants secondaires) et deux autres catgories
qui me paraissent devoir entrer en considration pour
autant que nous les observons dans la situation
analytique et non hors d'elle. Je pense aux tats du
corps propre dpersonnalisation ou hypocondrie,
etc. et toutes les manifestations qui relvent de
ce que les auteurs anglais appellent les parapraxies
comme expression du registre de l'acte (l'acting-in
et non l'acting-out).
2) Mais nous pouvons reprer galement une autre
srie sur l'axe de la diachronie qui est l'axe de la
succession des objets oral, anal, phallique, etc.
Je me demande si l'objet scopique et l'objet auditif
que Lacan fait entrer dans ce registre gagnent tre
inclus dans cette srie et s'ils ne font pas plutt
partie de ce registre de transmission entre la
synchronie et la diachronie que l'on peut reprer
dans le discours sous les formes diverses du rve et
de son laboration secondaire, du phantasme, du
souvenir, de la rminiscence, bref de toutes ces
voies qui font fonctionner la synchronie et la
diachronie.
C'est sur ce prlvement que s'opre la cration de
l'objet(a) o le dsir devient objet et rend compte
des positions subjectives.
106
Cette non-identit soi que le blanc figure est lie
pour moi au processus d'effacement de la trace. C'est
cela qui contraint ce systme la transformation.
IV - Identit et non-identit soi : la pulsion de
mort
Le signifiant rvle le sujet mais en effaant sa
trace, dit Lacan. C'est l, je crois, que se situe le
divorce avec toute la pense structuraliste
non-psychanalytique : dans l'opposition visible-
invisible, dans l'opposition peru-savoir, nous
mettons en jeu l'ordre de la vrit, mais en tant que
cette vrit passe toujours par le problme de
l'effacement de la trace. FREUD dit dans Mose et le
monothisme(1938) :
Dans ses consquences, la distorsion d'un texte
ressemble un meurtre, la difficult n'est pas d'en
perptrer l'acte mais de se dbarrasser des traces .
Or, c'est ce processus qui, partir des traces,
permet de remonter leur cause que nous trouvons le
processus mme de la paternit. Dans Mose et le
monothisme, toujours, reprenant une remarque dj
mise au moment de l'Homme aux Rats, il rappelle que la
maternit est rvle par les sens tandis que la
paternit est une conjecture base sur des dductions
et des hypothses. Le fait de donner ainsi le pas au
processus cogitatif sur la perception sensorielle
fut lourd de consquences pour l'humanit .
Je fais ici remarquer que si FREUD a tabli un lien
trs troit entre le phallus et la castration, entre
la curiosit sexuelle et la procration, il me parat
curieux qu'il n'ait jamais de faon explicite mis en
relation le rle du phallus dans la procration, dans
le dsir d'enfant chez l'enfant ou dans la curiosit
sexuelle.
Ce qui au niveau du sujet fonctionne comme cause
(dans la recherche de la vrit en tant qu'elle est
question des origines, rapport au gniteur)
fonctionne comme Loi au niveau socio-anthropologique.
107
Ici aussi la combinatoire n'entre en action que sous
la contrainte de la rgle.
la prohibition de l'inceste, interdiction au vu et
au su de tous qui retranche la mre et les surs du
choix pour dsigner d'autres objets leur place,
s'adjoint le rituel funraire qui tablit la prsence
de l'absent, du Pre mort. Double processus,
remarquons-le, de coupure et de suture. Parmi les
vivants, coupure de la mre et suture par ses
substituts, parmi les morts suture de la disparition
du Pre par le rituel ou le totem qui lui est
consacr, coupure de lui par l'au-del inaccessible
o il se tient dsormais.
Nous avons l un exemple frappant de la coupure entre
LVI-STRAUSS et FREUD, qui s'illustre dans une
rencontre inattendue.
propos du masque
15
LVI-STRAUSS insiste sur la
fonction la fois ngative (de dissimulation) et
positive (d'accession un autre monde). Mais il
parat s'agir pour lui d'une homologie, d'une
correspondance telle que dans cette ralit biface
rien n'est d'aucune faon perdu en route. On pourrait
poser la question : qu'est-ce qui contraint la
dissimulation, qu'est-ce qui force cette structure
sur un double plan ?
LVI-STRAUSS parle d'un masque (Hamshamtss) des
Indiens KWAKIUTL, fait de plusieurs volets articuls
qui permettent de dvoiler, de dmasquer (sic) la
face humaine d'un dieu cach sous la forme extrieure
du corbeau.
108
Nous tombons d'accord avec lui pour conclure qu'on
masque non pour suggrer, mais finalement pour
dvoiler , or ce masque dploy fait apparatre la
face humaine, dans ce qu'on pourrait prendre pour le
fond de la gueule du corbeau.
Il ne faut pas beaucoup forcer les faits pour dire
que la figure ici prsente fait apparatre les
quatre demi moitis du bec (2 suprieures et 2
infrieures) comme les 4 membres d'un personnage dont
le tronc est reprsent par la face du dieu.
L'analogie entre cette reprsentation et celle dont
FREUD fait tat dans un texte extrmement court il
s'agit des Parallles mythologiques une
reprsentation obsessionnelle est frappante. Il y
dcrit une reprsentation obsdante qui vient hanter
le patient sous la dnomination de Vater Arsch, et o
est imagin un personnage constitu par un tronc et
la partie infrieure de celui-ci, ses quatre membres,
et o manquent les organes gnitaux et la tte, la
face tant dessine sur le ventre
l6
. FREUD de
conclure au lien entre le Vater Arsch, le Cul du
Pre , et le patriarche, ce sujet portant bien
entendu une vnration toute filiale l'auteur de
ses jours, comme tout obsessionnel. Il me semble que
ce que manque LVI-STRAUSS c'est ce sacrifice de la
tte et des organes gnitaux que reprsente le masque
KWAKIUTL, qui dborde le rapport du montr au cach,
mais rvle un rapport du dvoil l'effac, au
barr, au manque. La cause du dsir est ici.
La mtonymie est pointe par FREUD dans la
reprsentation du corps substitutive au manque d'une
de ses parties, les gnitoires. Tout ceci prend sa
valeur de nous ouvrir l'intrt pris par FREUD,
la fin de sa vie, Mose, non pas seulement en
raison de sa qualit de Juif, mais aussi parce que le
monothisme y apparat troitement li
l'interdiction de l'idoltrie et l'effacement total
de tout signe de la prsence de Dieu autrement que
sous la forme des Noms du pre (Yahve, Elohim,
109
Adona)). Notons encore ici le redoublement de la
non-identit soi.
Le travail de la pulsion de mort qui toujours uvre
dans le silence se repre dans cette rduction le
mot est prendre dans toutes ses dimensions qui
s'efforce de toujours atteindre ce point d'absence
par o le sujet rejoint sa dpendance l'Autre,
s'identifier lui-mme son propre effacement.
La mutation du signifiant, son piphanie sous ses
formes polymorphes et distribues, indique le sursaut
qu'il entend opposer comme dans le rve cet
anantissement et son effort par lequel il perdure
profondment travesti et modifi, comme tmoin.
Faut-il voir encore ici un trait marquant du judasme
dans le silence qu'il fait de la vie dans l'au-del ?
Les deux faits sont peut-tre lis. Mais pour
comprendre la logique de l'effacement de la trace,
peut-tre faut-il recourir d'autres catgories
temporo-spatiales que celles que nous connaissons.
Peut-tre faut-il y trouver ici les structures d'un
temps et d'un espace que seuls les prsocratiques ont
pu nous rvler, directement ou travers les
analyses de VERNANT et BEAUFRET, tous deux d'une
faon trs diffrente, mais o notre surprise est de
constater que ce temps et cet espace, ces lieux et
cette mmoire au sens des Grecs, la cure analytique
nous en fournit l'accs privilgi.
Le (a) se rvle sous les structures de la
nosographie comme organisation pi-smantique et sous
les modes du discours de l'analys, de sa part
smantophore. Les analystes ont l le passage d'une
porte troite. L'approche d'une technique
psychanalytique structurale me parat devoir tre
base sur la diffrenciation des reprsentants et de
l'affect et sur la distribution diffrentielle des
reprsentants. On est extrmement frapp la lecture
des travaux de technique psychanalytique de constater
la carence totale sur tout ce qui concerne les modes
de discours de l'analys. Nous connaissons pourtant
tous les difficults considrables des cures qui ne
se conforment pas au modle tabli par FREUD de
110
l'association libre. Ce qui y manque le plus souvent
est cette distribution diffrentielle des modes de
reprsentation qui tmoigne de la non-identit soi
du signifiant condition ncessaire de l'analyse. Je
ne signale ce point que comme champ de recherches
possibles sans pouvoir m'y arrter davantage.
La difficult essentielle de l'investigation
psychanalytique vient de ce qu'elle est un discours
contraint : il ne s'agit plus seulement de
communiquer, mais de tout dire de la part de
l'analys. Du ct de l'analyste, elle est une parole
courante verba volant que celui-ci ne peut comme
le linguiste ou l'ethnologue enfermer dans sa bote.
L'analyste court aprs la parole de l'analys. Si la
pulsion de mort infiltre la parole de l'analys, dans
le silence vers lequel elle le pousse toujours, c'est
une parole vivante que l'analyste a faire :
vivante par son refus d'tre rduite au silence,
vivante par son caractre rfractaire tout
embaumement o le texte enfin conditionn se prte
tous les traitements auxquels les hommes du savoir le
soumettent.
Nous saurons au juste ce qu'est le (a) lorsque nous
aurons parcouru le champ des positions subjectives.
Nous aurons alors une vision qui sera correspondante
de celle du philosophe qui pense l'histoire et la
culture travers les modes de dcouverte du
mouvement des ides, de l'art, de la science de son
temps, mais comme un milieu polymorphe, htrogne o
s'illustrent diverses formes d'alination. Qu'on ne
s'y trompe pas cependant. Le psychanalyste, ici,
n'est pas dispos abandonner sa priorit
quiconque dans l'examen de ces faits. Quitte tre
tax d'imprialisme, il restera toujours en arrt
devant cette affirmation de FREUD que les religions
de l'humanit en reprsentent les systmes
obsessionnels, tout comme les diverses philosophies
en reprsentent les systmes paranoaques. Les uns et
les autres sont valoriss en tant qu'ils permettent
au sujet de se sentir meilleur, dit FREUD, pour avoir
ainsi chapp au dsir et russi y installer autre
111
chose sa place. Et nous aurions ici, dans l'ordre
des projections du fonctionnement de la psych,
les premiers lments d'une conception ou d'une
thorie mimtique du fonctionnement du sujet. La
psychanalyse n'a pas encore puis les ressources de
la mimesis.
Il est insuffisant d'attribuer au psychanalyste une
fonction de dmystification qui permette de conserver
un cogito purg et purifi.
C'est en fait parce que FREUD part de ce qui est
scorie, dchet, faux-pas, qu'il dcouvre la structure
du sujet comme rapport la vrit. Celle-ci est
peut-tre moins proche de l'image de Promthe chass
pour avoir drob le feu que de celle de Philoctte
abandonn des siens sur une le dserte cause de sa
puante blessure.
Retour 22 Dc
Notes
(1) Publi dans les Cahiers pour l'Analyse n3,
mai-juin 1966.
(2) Ce graphe, dit "schma L", est reproduit dans l'Introduction au "Sminaire sur la lettre vole", La psychanalyse,
vol.II, p.9
(3) Ce graphe est introduit dans D'une question prliminaire tout traitement possible d'une
psychose , La Psychanalyse, vol.II, p.22. Cf. infra p. 18.
(4)Il n'est pas inutile de faire ici deux remarques :
a/ dans les travaux psychanalytiques franais, se dveloppe beaucoup la notion de relation d'objet
(Bouvet) importe des auteurs anglo-saxons (M. Klein surtout, aprs Abraham). Lacan s'y oppose
en soulignant l'absence de toute rfrence aux lments de mdiation dans ces conceptions. Surtout
ce qui revient peut-tre au mme il condamnera cette optique en tant qu'elle dbouche
sur une opposition Rel-Imaginaire, en crasant le Symbolique.
b/ L'opposition moi idal Idal du Moi (Nunberg-Lagache) sert de plate-forme des dveloppements thoriques
de Lacan insrs dans la perspective du rapport l'Autre.
(5) "Remarques sur le rapport de D. Lagache", La Psychanalyse, vol.VI, p. 145.
(6) Sminaire sur L'Angoisse (1963) non publi. Je paraphrase Lacan, ne pouvant le citer.
(7) Sminaire sur "Le Banquet" (1960), non publi.
(8) Texte de cet expos paru dans le n 1 des Cahiers pour l'Analyse, sous le titre : "La suture".
(9) Je voudrais avant d'avancer dans mon propos ouvrir une parenthse sur une certaine vacillation de la pense
freudienne ce sujet qui a branl le jugement de son commentateur Strachey dans la Standard Edition (vol. XXII,
p.65). Elle concerne l'expression "der Trger des Ich-ideals" traduit par : le vhicule de l'Idal du Moi, comme
112
fonction du Sur-Moi. Ce terme de vhicule donne penser. Loin qu'il faille y voir une image de support mcanique,
mais au contraire y relever en l'occurrence un des quelques indices qui nous autorisent parler d'une conception du
sujet de l'inconscient comme Entzweiung. La fonction de l'Idal "Idal-funktion" s'y rvle fondamentale, dpassant
et de loin le rang d'une fonction, mais devant se rattacher ce que FREUD nomme plus heureusement : "Les
Grandes Institutions" qui marquent une instance, ici le Moi pour ce qu'il y fait fonctionner sous le nom d'preuve de la
ralit.
(Complment mtapsychologique la doctrine des rves). L'ide de ces Grandes Institutions me parat propre qualifier cette
"fonction de l'Idal".
(10) A. Martinet, La linguistique synchronique, p.25.
(11) Cette thorisation est mene au cours du prsent sminaire de J. Lacan.
(12) Les termes entre guillemets sont ceux utiliss par Littr aux articles chose, cause et objet.
(13) Je voudrais signaler que j'avais attir l'attention sur ce point ds ma critique du rapport de LAPLANCHE et
LECLAIRE parue dans les Temps Modernes en 1962. Mais il est clair qu'il s'agit l de deux types de signifiants
diffrents, c'est--dire que nous devons garder l'affect sa spcificit comme dcharge face au reprsentant comme
production, production en tant qu'elle est entre dans un systme de transformation combinatoire.
(14) Ces termes sont emprunts au vocabulaire de la biologie molculaire.
(15) "Entretiens avec Jean Pouillon", L'il, n 62, fvrier 1960.
(16) Ceci voque les ttes jambes et les grylles gothiques [formes grotesques, caricatures mdivales graves dans la
pierre] sur lesquelles G. Lascault a attir mon attention. Cf. Jurgis Baltrusatis :
Le Moyen-Age fantastique (chap. I).
Retour 22 Dc.
113
LACAN
Je remercie trs vivement GREEN de cet admirable
expos qu'il vient de nous faire sur sa position
l'endroit de ce que j'ai, comme il l'a rappel,
patiemment amen, construit, produit et que je n'ai
pas fini de produire concernant l'objet(a).
Il a vraiment trs remarquablement montr toutes les
connexions que cette notion comporte. Je dirai mme
qu'il a laiss encore en marge quelque chose qu'il
aurait pu pousser plus loin - je le sais - et
nommment quant l'organisation des divers types de
cure et ce qui la constitue proprement parler :
la fonction de l'objet(a) quant la cure.
Je le remercie d'avoir fait cette clarification qui
est bien plus qu'un rsum, qui est une vritable
animation, un rappel excellent des diffrentes
tapes, je le rpte, dans lesquelles on peut
prciser, l-dessus ma recherche ou mes trouvailles.
Je ne lui rpondrai pas maintenant parce que nous
avons un programme. Je pense qu'il voudra bien
collaborer de la faon la plus troite avec ce qui
vient d'tre recueilli pour que le texte de ce qu'il
a donn aujourd'hui, et qui fait date, et qui peut
nous servir de rfrence ce qui sera dvelopp et
je l'espre, complt ou accru cette anne, je pense
que c'est une excellente base de travail pour ceux
qui feront spcialement partie de ce sminaire ferm.
Merci beaucoup GREEN. Vous avez rempli votre heure
avec une exactitude que je ne saurais trop
complimenter.
Alors, je dorme la parole CONT qui va vous
proposer certain expos de ce qu'il en est des
articles de STEIN qui vont tre aujourd'hui
interrogs.
Nanmoins, je profite de l'intervalle pour vous faire
part de ceci : d'un cercle d'tude et de travail qui
s'appelle le cercle d'pistmologie et qui appartient
cette cole dont nous sommes les htes ici, ce
cercle d'pistmologie s'est constitu au cours du
114
cartel : thorie du discours de l'cole freudienne et
il va publier des Cahiers pour l'analyse.
Le titre mme de ces cahiers ne se commente pas plus.
Mais je vous en donne quand mme la direction et
l'ouverture, la possibilit d'accueil. Ces cahiers
seront mis votre disposition bien sr ici
l'entre du sminaire mais l'cole Normale d'une
faon permanente et galement la Sorbonne dans un
endroit qu'on vous dsignera ultrieurement. J'ai
donn ces cahiers - qui m'apparaissent anims de
l'esprit le plus fcond et ceci depuis longtemps, je
veux dire que le cercle qui va les diter me parait
mriter toute notre attention, tous - j'ai donn ma
premire confrence de cette anne qui, comme vous
l'avez constat tait crite, pour qu'elle soit
publie dans le premier numro.
Il y aura d'autres choses. Vous verrez alors.
115
CONT
Je vais parler de deux articles
44
de STEIN en laissant
de ct le troisime
45
plus rcent, sa confrence sur
le Jugement des psychanalystes qui m'a paru poser des
problmes un niveau diffrent.
Donc, ici deux articles qui se font suite et qui sont
consacrs simultanment fournir un certain reprage
de la situation analytique et laborer une thorie
du poids de la parole de l'analyste en sance.
Le premier article accentue surtout la rfrence au
narcissisme primaire, le second introduisant
l'opposition du narcissisme au masochisme est
essentiel la conception du transfert. Je vais tout
d'abord donner un compte-rendu rapide - trop rapide
srement - de ce qui m'a paru constituer la
contribution thorique essentielle de ce travail. On
me pardonnera, j'espre de passer peut-tre un peu
vite sur certaines articulations et surtout de priver
ces crits de leur rfrence des cas cliniques
prcis qui leur donnent toute leur valeur de
rflexion sur une exprience psychanalytique.
STEIN voudra bien tout au moins me reprendre pour le
cas o j'aurai trahi ou mal traduit sa pense.
Je donnerai ensuite un certain, nombre de remarques
critiques qui n'ont pas d'autre but que de tenter de
saisir dans l'laboration originale qui est la sienne
les points de divergence avec l'enseignement de LACAN
et par l, d'ouvrir un dbat.
Le premier article est donc :
La situation analytique remarques sur la rgression
vers le narcissisme primaire dans la sance et le
poids de la parole de l'analyste .
Il a paru dans la Revue franaise de psychanalyse,
l964 : n 2.
Le propos de STEIN vise lucider le mode d'action
de l'interprtation mais, je le cite ici :
44 Conrad Stein, (1) La situation analytique : remarques sur la rgression vers le narcissisme primaire dans la sance et le poids
de la parole de l'analyste, Revue Franaise de Psychanalyse, mars-avril 1964, t. XXVIII, n 2.
(2) Transfert et contre-transfert ou le masochisme dans l'conomie de la situation analytique, Revue Franaise de
Psychanalyse, mai-juin 1966, t. XXX, n 3.
45 Conrad Stein (3) Le jugement du psychanalyste, Interprtation, Montral, janvier-mars 1968, vol. 2, n 1, p. 15-31.
116
pour pouvoir aborder utilement la question, il faut
se demander auparavant en quoi rside le pouvoir, de
la parole au cours de la sance quel que soit le
choix du contenu de l'interprtation, ce qui dbouche
sur le problme du pouvoir de la parole en gnral .
Ce problme, STEIN va l'aborder partir de certains
moments privilgis de l'analyse. Telle est en effet
la consquence de la rgle fondamentale : pri de se
mettre dans un tat d'attention flottante, le patient
coute en dedans et parle dans un seul et mme
mouvement. La perception et l'mission de sa parole
sont confondues. Il ne parle pas, a parle .
L'analyste de son ct, en tat lui aussi,
d'attention flottante coute le a parle . Il
n'coute pas en personne, a coute mais la parole
et l'coute ne font pas deux .
Le patient et l'analyste tendent tre tous les
deux en un en lequel est contenu tout.
La situation analytique, idalement ralise,
ressemblerait tout fait au sommeil et le discours
qui s'y ferait entendre serait un rve . Ce qui est
en Jeu dans la situation analytique est donc bien une
rgression topique comportant l'abolition des
limites entre le monde extrieur et le monde
intrieur aussi bien du ct du patient que de
l'analyste . Cette rgression topique est une
rgression vers le narcissisme primaire s'exprimant
dans une certaine manire de bien-tre qui
mriterait - nous dit STEIN - d'tre appel le
sentiment d'expansion narcissique ou encore dans
l'illusion d'avoir l'objet du dsir . C'est ce
qu'il dit propos d'un exemple clinique ou dans le
syndrome de batitude accompagnant le dbut de
certaines analyses.
Or, de tels moments de l'analyse manquent rarement
de susciter en sance l'vocation du pass .
La rgression topique dans la situation analytique
est proprement parler la condition de la rgression
temporelle et c'est dans la rgression topique
que s'actualise un conflit paraissant rptitif du
pass .
117
Je cite encore : ce qui se passe l'occasion de
cette actualisation est analogue ce qui se produit
lorsqu'au moment du rveil, le rveur formule le
texte de son rve .
Ici le patient sort de son tat de libre association
[]pour adresser la parole l'analyste. a ne parle
plus. Il parle [en premire personne], il rflchit
sur lui-mme et corrlativement s'adresse
l'analyste comme l'objet de son discours.
C'est en ce point prcis - nous dit encore STEIN -
qu'merge l'agressivit, car l'agressivit, comme
nous dit Freud, nat avec l'objet . la suite de
l'article enrichit cette articulation d'un certain
nombre de prcisions. Il peut en particulier y avoir
au cours de la cure, dfense contre la rgression
narcissique, en tant qu'elle peut favoriser la
rapparition de conflits inconscients et d'angoisse.
Au parler facile, caractristique de l'tat
d'attention flottante ou au silence de style
fusionnel, s'oppose ainsi le parler sans discontinuer
ou le silence vigile qui exprime toujours la dfense
contre la rgression narcissique, la parole de
l'analyste tant en pareil cas souhaite comme
protection contre la rgression mais en mme temps,
redoute en tant qu'elle prive le patient d'une
satisfaction substitutive de l'expansion
narcissique , savoir de l'exercice de la toute
puissance.
La double incidence de la parole de l'analyste se
trouve ainsi repre. Prononce en personne, elle
rompt l'expansion narcissique alors que, se faisant
entendre comme participant du a parle, elle favorise
cette rgression. L'intonation ou le choix du moment
de parler peuvent rendre compte de l'un ou l'autre de
ces effets qui sont en fait habituellement prsents
simultanment mais en proportion variable.
J'ai signal que le premier article introduisait donc
une position de l'analys qui, par rapport au
narcissisme a valeur d'une situation de compromis.
Craignant la rgression, le patient tente de rduire
l'analyste au silence, d'chapper la fluctuation,
en s'en faisant l'ordonnateur, d'en conserver la
118
matrise et par l une jouissance substitutive de la
rgression narcissique.
Le deuxime article labore cette position en
opposant, cette fois, au narcissisme le masochisme du
patient dans la cure. Il s'agit d'une confrence
intitule : Transfert et Contre-transfert ou le
masochisme dans l'conomie de la situation analytique
prononce en Octobre l964 et que je remercie STEIN
d'avoir bien voulu mettre notre disposition.
L'expansion narcissique au cours de la sance est
toujours menace par l'ventualit de l'intervention
de l'analyste en tant que celle-ci implique deux
personnes spares, donc une coupure entre le patient
et ce qui n'est pas lui, une faille par o
s'introduit un pouvoir htrogne c'est--dire
quelque chose qui est mettre en rapport avec le
principe de ralit. Or, ce niveau se ralise une
fausse liaison constitutive du transfert.
Dans la situation analytique se produit un phnomne de
confusion, de coalescence entre la reprsentation de
l'intervention de l'analyste et la reconnaissance de la
ralit du fait qu'il peut parler .
L'analyste apparat comme l'origine de la ralit de
l'existence, comme l'origine du pouvoir dfaillant.
Le psychanalyste apparat comme frustrant le patient
de son plaisir de par sa propre volont alors qu'il
n'est point matre de la frustration que le patient
prouve dans sa coupure d'avec ce qui n'est point
lui. Ce phnomne - nous dit STEIN - nous est connu
sous le non de transfert. L'intervention de
l'analyste passe ds lors pour un abus de pouvoir :
Le transfert a pour corrlatif le masochisme . Mais, en
confrant son analyste un tel pouvoir absolu, le
sujet vise en fait se rendre matre de ce mme
pouvoir qui manque son accomplissement narcissique.
Se prsentant comme bouffon, il fait du psychanalyste
son roi. Il va souffrir pour le plaisir c'est--dire
tenter de nier la ralit de l'existence tout en la
reconnaissant puisque l'accomplissement narcissique
est diffr. Plus fondamentalement encore, il vise
119
manquer au psychanalyste, entretenir indfiniment
son dsir en ne le satisfaisant point . Il s'agit
pour lui d'tre l'objet manquant, objet dont la
compltude figure en somme l'accomplissement du
narcissisme qui ne saurait tre . Par cette
ralisation substitutive il simule la possibilit
que la frustration puisse ne plus tre .
Ceci nous fait alors accder au pas suivant qui est
la reconnaissance de la vise sadique implique dans
le masochisme du sujet, savoir l'appel au contre-
transfert car le psychanalyste qui subit le lot
commun de ne pouvoir chapper la frustration, peut
la limite se laisser tromper et se croire en effet
matre de la frustration. Restant frustr dans la
ralit de son existence, il serait ds lors tent
d'attribuer le non accomplissement de son propre
narcissisme l'unique manquement de son patient
ainsi devenu l'objet qui lui manque.
C'est ainsi que le transfert s'tablit dans la vise
illusoire de la restauration d'un accomplissement
narcissique suppos perdu, sous le signe de
l'incertitude. L terminaison de l'analyse,
l'inverse, implique l'accs un certain ordre de
certitude dans l'existence ou de savoir dans la
frustration.
partir de ce trs bref rsum des deux travaux de
STEIN, je vais proposer un certain nombre de
remarques critiques qui vont s'ordonner en trois
groupes. Le premier groupe concerne le premier
article surtout et l'opposition ou l'alternance
introduite par STEIN et destine rendre compte ce
niveau du dynamisme de la cure. Je rappelle qu'il
situe d'une part, la rgle de libre association qui
tend induire chez le patient un mouvement de
rgression vers le narcissisme primaire caractris
comme fusion avec l'analyste et d'autre part, la
rgression topique vers le narcissisme conditionne
une rgression temporelle savoir la r-mergence
des conflits anciens ou la rptition des conflits en
quoi consiste proprement parler le transfert.
120
La compulsion de rptition apparat comme la
ngation de la compulsion la rgression topique o
je cite encore une autre formule toute l'analyse
est dans cette opposition .
Voici ce propos toutes les questions que j'aimerais
poser concernant la situation fusionnelle. Je
rappelle deux formules, il y a un unique a
parlant et coutant, ou encore le patient et
l'analyste tendent tre tous deux en UN, en lequel
est contenu tout.
Eh bien, les moments o semblent se confondre la
perception et l'mission de la parole dans une
immdiatet o s'abolirait tout cran et tout
intermdiaire, s'ils voquent effectivement certaines
situations cliniques, semblent assez exceptionnels
dans l'ensemble et posent donc d'emble le problme
de leur signification dans la cure et tout
particulirement par rapport au transfert.
Certes c'est bien l ce que STEIN labore dans son
travail mais au niveau, pour ainsi dire, d'une
exprience clinique globale, nous serions tents de
lui demander ce qui l'a conduit choisir de
privilgier des situations relativement rares pour en
faire l'un des repres fondamentaux de la cure, ou
encore - pour rester ce niveau clinique - nous
aimerions peut-tre savoir s'il tendrait rapporter
de tels faits une structure nvrotique dtermine
par exemple, ou bien comment il les situerait par
rapport l'ensemble de la cure et par rapport ses
diffrents temps.
Dans un registre maintenant plus thorique le
problme se poserait de savoir comment STEIN conoit
la rgression topique dans la cure et dans quelle
mesure elle lui parat impliquer une situation de
style fusionnel alors qu'elle paratrait avoir
premire vue rapport avec quelque chose qui serait au
contraire de l'ordre d'un dvoilement du grand Autre
pour se rfrer ici l'enseignement de LACAN.
Ou encore, y at-il lieu de faire converger l'tat de
libre association et l'activit du rve d'une part,
la r-mergence du conflit et le rcit du rve conu
comme rflexion sur le rve d'autre part.
121
Nous savons par exemple qu'un doute portant sur un
des lments du rve, au moment de son rcit, nonc
dans le rcit, doit tre considr comme faisant
partie du texte du rve et que le sujet reste
impliqu dans le texte du rve prcisment.
Paralllement, propos de l'unique a parlant et
coutant, nous lui demandons ce qu'il en est de
l'analyste dans les moments narcissiques de la cure.
Son mode d'tre
est-il rapprocher de l'activit du rve ? Autrement
dit, est-il lui aussi soumis la rgression topique
ou s'agit-il plutt d'un fantasme de fusion de
l'analys ? A propos maintenant du narcissisme
primaire, il est prsent essentiellement comme une
situation limite rfre une identification
primaire fusionnelle ou un tat de satisfaction
hallucinatoire du dsir supposant une situation rgie
par le principe de plaisir.
Une note qui fait rfrence NACHT met la fusion en
rapport avec la mise en suspens de la parole
sparatrice et parat impliquer rfrence un tat
antverbal ou prverbal. Certes, il nous est soulign
que la rgression en sance n'atteint jamais tout
fait le narcissisme primaire bien entendu, il y a
seulement mouvement vers. Cependant, un certain
nombre de passages du texte paraissent proposer le
narcissisme comme quelque chose qui serait un pas
primordial ou un premier temps du dveloppement.
Le deuxime article, par contre, introduit un autre
aspect. Le patient, pour figurer l'accomplissement du
narcissisme impossible est conduit tenter de se
poser comme l'objet manquant, la limite l'objet
comblant de son analyste. Il semble ainsi viser la
restauration du narcissisme de l'autre et ce
narcissisme se prsenterait alors comme le mythe ou
le fantasme de la compltude du dsir de l'Autre.
Nous nous tions demands lequel de cas deux aspects
semblait STEIN le plus dcisif, le plus essentiel
ou encore comment il les articulait entre eux. Depuis
lors STEIN, dans sa confrence sur le jugement du
psychanalyste a apport sur ce sujet un certain
122
nombre d'articulations prcises et je pense que c'est
dans cette direction qu'il serait conduit nous
rpondre. Je maintiens cependant cette interrogation
dans la mesure o le problme restait pos au niveau
de ces deux premiers articles.
A propos maintenant du deuxime article, plus
spcialement, j'aimerais interroger le texte de STEIN
sur les rapports de ces repres thoriques avec
certaines catgories lacaniennes, notamment le grand
Autre, le petit autre et l'objet(a).
Je dois dire ce propos que c'est la catgorie de
l'autre imaginaire qui me paratrait le plus souvent
primer au point que son travail m'a paru tendre,
diffrents moments prsenter la situation
analytique comme une situation duelle par exemple
lorsqu'il met l'accent sur la dialectique de la
frustration dans l'analyse.
De mme, dans le premier article, il nous est dit
qu'au moment de la ractualisation du conflit,
l'agressivit naissant avec l'objet, le patient sort
de la fusion pour s'adresser en personne l'analyste
lui aussi re-personnalis comme objet de son
discours. N'est-ce point l situer l'analyste
essentiellement comme l'autre imaginaire de la
rivalit agressive ? Certes STEIN introduit aussi le
grand Autre qui se trouve galement, certainement
impliqu par ce que je viens de dire, ou galement
lorsque l'analyste se trouve dsign comme matre de
la frustration ou source du pouvoir htrogne mais
il m'a paru nanmoins difficile de diffrencier dans
son texte le grand Autre de l'autre de la relation
imaginaire.
Enfin, STEIN introduit quelque chose qui semblerait
proche de la catgorie de l'objet(a) en particulier
dans le deuxime article : l'analys tentant de se
situer comme l'objet manquant de son analyste. Sans
vouloir reprendre ici l'apport de LACAN concernant
l'objet(a) et l'articulation du dsir sadique et du
dsir masochiste, je fais la remarque que STEIN
parat ce moment s'engager dans une description de
la situation analytique en terme de dsir.
123
Nous retrouvons alors la question : comment articule-
til ce niveau avec celui du narcissisme ? En
particulier avons-nous situer l'objet(a) comme ce
dont la possession, la limite, serait restauration
de la compltude perdue ? Ou encore, si le
narcissisme est synonyme de la disparition des
limites entre le moi et le non-moi, est-il vraiment
rapprocher de ce qui peut se conduire au cours de la
cure de l'ordre d'une vocation fantasmatique de
l'objet qui ne paraissait impliquer une structure
articule plutt qu'une in-distinction fusionnelle.
Enfin, troisime groupe de remarques, je voudrais
pour terminer reprendre les choses au niveau de ce
qui fait l'axe du travail de STEIN et lui donne toute
sa valeur pour nous, savoir la mise en place du
reprage du choix de la parole de l'analyste comme
tel, ou encore du pouvoir de la parole.
Ce qui semble d'abord devoir tre remarqu c'est que
STEIN parait amen devoir orienter sa recherche par
rapport une srie de positions deux termes. par
exemple l'alternance rgression narcissique
r-mergence des conflits ou bien l'opposition
narcissisme/masochisme, ceci recouvrant les dualits
freudiennes principe de plaisir/principe de ralit,
processus primaire/processus secondaire. S'agitil l
d'un modle conceptuel que nous devrions considrer
comme ncessairement impliqu comme cadrage de la
situation analytique ?
STEIN voit, bien-sr, le terme de ses propos : c'est
en somme une interrogation sur l'impression que son
texte donne, qui est ax finalement essentiellement
sur l'opposition rel/imaginaire en faisant passer au
deuxime plan la dimension propre du symbolique.
Certes mon impression tient probablement au fait que
STEIN, dans ce texte n'expose qu'un des niveaux de
son articulation mais ce niveau-mme, la question
mritait peut tre cependant d'tre pose.
Par exemple, dans le premier article, la parole de
l'analyste prend son poids de ce qu'elle va dans le
sens de la rgression ou introduit au contraire une
rupture restituant alors la dualit des personnes.
124
La parole est l pour renforcer l'unit ou souligner
la dualit. Cette dernire ventualit parat plus
essentielle puisque STEIN soutient son point de vue
en situant la parole comme ce qui intervient pour
rompre le narcissisme en sparant le moi de ses
objets. La parole est coupure. Elle est cette coupure
qui introduit la double polarit sujet/objet.
J'avoue ici ne pas trs bien savoir s'il y a lieu
d'introduire essentiellement la parole comme coupure
engendrant une dualit et ne pas saisir non plus
exactement comment cette prsentation s'accorde avec
ce qui est dit des moments narcissiques de la cure o
le sujet coute en dedans et parle dans un seul et
mme mouvement, o a parle, la parole semblant
pouser le flux psychique sans faille ni coupure.
Dans le deuxime article, la parole s'oppose au
narcissisme comme le principe de ralit au principe
de plaisir : elle est ce qui oblige le patient
constater qu'il y a ralit, de son impossibilit de
son accomplissement narcissique.
Il y a l aussi une dualit sous la parole supporte
et impose au sujet. La parole est situe du ct du
rel reprsent par l'analyste comme matre de la
frustration.
Ceci serait-il mettre au compte de l'erreur
transfrentielle ? Il me semble cependant que
l'articulation de la parole et du rel comme tel
gagnerait tre prcise.
C'est la mme question qui se poserait enfin propos
de la fin de la cure comme savoir sur la frustration.
Ce n'est pas l'analyste, nous dit STEIN, qui frustre
le sujet de sa toute-puissance, mais la frustration
est la ralit mme de l'existence .
Le psychanalyste aurait-il alors jouer les
reprsentants de la ralit dans le but d'y ramener
ses patients ? Je force ici le texte et c'est
seulement dans le but d'interroger STEIN sur le rle
dcisif qu'il accorde la frustration.
Il me semble que la catgorie plus radicale du manque
peut se rvler plus maniable aux diffrents niveaux
de la structure en permettant par exemple de situer
la castration par rapport la frustration et
125
d'articuler plus prcisment le symbolique par
rapport au rel et l'imaginaire.
Je clos ici ces remarques qui visaient seulement
introduire une discussion.
Retour 22 Dc.
LACAN
Sans m'attarder tout ce que j'ai fait dire CONT,
je crois que - m'adressant STEIN - il ne peut que
reconnatre qu'il y a l l'expos le plus strict, le
plus exact, le plus articul, le plus honnte et
j'ajouterai, le plus sympathique qu'on puisse donner
de ce que nous connaissons actuellement de sa pense,
dans un effort qui n'a pas manqu de le frapper pour
autant qu'incontestablement ce sont des avenues, si
je puis dire, qui nous ont dj servi au moins pour
une grande part et qu'il tait mme votre fin de les
intgrer, de mettre l'accent sur ce en quoi, mon
Dieu, elles vous servent et rendent compte dune
authentique exprience.
Ce n'est pas maintenant que moi - je vais mettre en
valeur tout ce qui m'apparat dans la position qui
est la vtre, garder la marque d'une sorte de
retenue, de tension, de freinage lie d'autres
catgories qui sont celles, je dois dire, plus
courantes dans la thorie commune qui est donne
actuellement de l'exprience analytique et dont les
deux termes sont trs bien marqus aux deux ples
dans ce que vous avez expos, d'une part la notion,
si discutable et dont ce n'est pas pour rien que je
ne l'ai pas discute jusqu' prsent savoir celle
du narcissisme primaire. J'ai considr que, au point
de mon laboration, elle n'tait jusqu' prsent,
pour personne de ceux qui me suivent au moins,
abordable. Vous verrez que
avec les dernires notations topologiques que je
vous ai donnes, il va paratre tout fait clair
que la diffrence de ce que j'ai assen comme
articulation avec ce qui est jusqu'ici reu dans
126
cet ordre et montr en mme temps, ce qui est
toujours ncessaire, comment la confusion a pu se
produire
que c'est l un noeud, qu'avant de l'aborder, on en
approche, ce n'est pas maintenant que je vais le
marquer. Peut-tre mme pas aujourd'hui du tout,
quoique, que je peux peut-tre la fin de la sance
en donner une indication.
D'autre part, le centrage tout fait articul et
prcis que vous donnez du schma de la psychanalyse
comme restant sur la frustration puisque - dites-vous
- c'est autour de la frustration que se situe et
mme, comme vous le dites, que c'est l ce qu'on
appelle proprement parler le transfert, savoir
que l'analyste est - au dpart - le reprsentant pour
le sujet du pouvoir, de la toute-puissance, qui
s'exerce sur lui sous la forme de la frustration et
que - la fin - la terminaison aboutira ce savoir
sur le fait que la frustration est l'essence divine
de l'existence. Je pense que, l aussi, ce que j'ai
fait et amen consiste proprement dire qu'il n'y a
pas que cet axe et que, en tout cas, la dfinition
que vous donnez la page 3 ou 4 de l'article sur
transfert et contre-transfert, que ce qu'il en est,
quand vous dites que ceci est proprement parler le
transfert, c'est trs prcisment pour dire le
contraire que j'ai introduit le transfert par cette
formule-cl, pour obtenir ce point de fixation mental
la direction que j'indique, c'est savoir que le
transfert est essentiellement fond en ceci que -
pour celui qui entre dans l'analyse - l'analyste est
le sujet suppos savoir. Ce qui est strictement d'un
autre ordre, comme vous le voyez, ce que je
dveloppe actuellement. C'est cette distinction de la
demande et du transfert qui reste au dpart, dans
l'analyse autour de cette Entzweiung de la situation
analytique ellemme par quoi tout peut s'ordonner
d'une faon correcte c'est--dire d'une faon qui
fasse, en quelque sorte, aboutir l'analyse un
terme, une terminaison proprement parler, qui est
d'une nature essentiellement diffrente de ce savoir
sur la frustration.
127
Ceci n'est pas la fin de l'analyse. Je dis cela pour
axer en quelque sorte, je ne dis pas qu'avec a je
clos le dbat, au contraire, je l'ouvre, je montre
que les lignes de fuite sont compltement diffrentes
de ce que j'appellerai, en abrg votre systmatique
qui aprs tout que je n'ai pas de raison de
considrer comme close.
Peuttre que vous la rouvrirez. C'est votre
systmatique conue, ferme, avec ce que nous avons
actuellement, qui prsente dj un certain corps. Je
regrette assurment que CONT , dans un dessein que
lon peut dire de rigueur, voyant qu'il n'arrivait
pas tout fait voir le virage, la transformation,
qui se produit dans votre troisime article, qui
contient galement des choses, mes yeux,
extrmement discutables, nommment l'accent que vous
mettez sur la communication. Il s'agit videmment
toujours du sens qu'a la parole de l'analyste.
Je souligne d'ailleurs, au point o nous en sommes de
l'avancement des choses, que je ne considre pas que
nous allons liquider tout ce dbat aujourd'hui.
Le quatrime mercredi de Janvier nous permettra de
donner
Au point o nous en sommes du temps, estce que vous
verriez dj, vous, des choses qui vous paratraient
bonnes dire ou voulez-vous par exemple laisser
MELMAN - qui a aussi quelque chose dire - MELMAN
avancer ce qu'il a apport ?
STEIN : Je crois qu'il vaut mieux que je laisse
d'abord parler les autres.
LACAN : Mais oui, parce qu'aprs tout, mme si
aujourd'hui vous n'avez pas tout votre temps de
rponse, nous sommes rduits un nombre limit
justement pour a, pour que nous considrions pour
que 'enregistrement de ce qui a t reu puisse d'ici
l mrir. D'autres peut-tre voudront intervenir. Je
donne la parole MELMAN.
STEIN : Je voudrais quand mme, avant que MELMAN ne
parle, dire combien j'ai apprci l'expos de CONT .
128
MELMAN
Je reprendrai les choses au point mme o CONT les
a fait partir. Du fait de ces travaux de STEIN, on
peut penser qu'ils mritent une attention d'autant
plus sympathique et soucieuse, qu'ils semblent
constituer une sorte de rflexion sur une thorie
gnrale de la cure psychanalytique, et que STEIN
fait carrment partir sa rflexion du pouvoir de la
parole de l'analyste, ce qui - dit STEIN - dbouche
sur le problme du pouvoir de la parole en gnral et
qui culmine la fin de ce premier article paru dans
la Revue Franaise de psychanalyse, Mars-Avril l964, dans
cette formule :
considrer le contenu des paroles prononces, ne suffit
jamais rendre compte du changement produit par la parole en
celui qui l'entend. Envisager, comme je l'ai fait ici,
contrairement la coutume, le discours analytique ,autrement
que du strict point de vue du contenu des paroles prononces
,ce parat tre un pas la suite duquel l'intelligence du dit
contenu se trouvera fonde sur celle du pouvoir de la parole.
Car, c'est bien en apparence sur l'intelligence du contenu que
se fonde pour l'essentiel l'action consciente du psychanalyste
dans le progrs de la cure .
Le petit point que l'on pourrait remarquer c'est que,
passer du pouvoir de la parole de l'analyste au
pouvoir de la parole en gnral constitue un
franchissement, constitue un pas, bien entendu, mes
yeux tout fait souhaitable, mais qui implique bien,
nanmoins, que nous avons affaire dans l'analyse au
langage. Et cette deuxime proposition, qu'il s'agit
de considrer le contenu des paroles prononces
parat une illustration si saisissante de ce qu'elle
veut dire, que l'on pourrait aller chercher sa
valeur, son poids, non seulement au niveau de son
contenu mais galement de son contenant ,pour y
remarquer par exemple que, au niveau de son
contenant, il manque certains termes qui sont ceux,
tout simples - que je me permets de rintroduire ici
pour la clart de ce que je veux dire - qui sont les
129
termes, bien entendu, de signifiant et de signifi,
et dont je pense que leur introduction, met mieux sur
les rails ce que STEIN veut dire. En effet, que dit
l'auteur ? Je reprends ici un petit point dvelopp
par CONT. C'est que la parole dans la cure aurait
deux faces : l'une, celle du patient qui est ordonne
pour l'association libre et qui oriente
irrsistiblement le patient dans la rgression vers
une expansion narcissique - narcissisme primaire - et
dont le bien-tre extrme, ultime, hypothtique, est
li au sentiment de fusion avec l'analyste, la dite
fusion pouvant figurer la retrouvaille avec l'objet
perdu, mythique, premier, du dsir.
L'autre face de la parole est celle de l'analyste
dont celui-ci dispose et dont il peut se servir, soit
pour favoriser cette rgression vers cette expansion
narcissique de type primaire, soit introduire une
invitable coupure, celle de la ralit dont, tort,
le patient, le ferait agent. On ne peut que marquer
dj ici la position assez particulire accorde par
STEIN la parole de l'analyste et qui, semble-t-il
s'claire encore mieux dans ce dernier travail fait
tout rcemment aux lundis de Pierra AULAGNIER
Sainte Anne, dernier travail qui porte pour titre
Le Jugement du psychanalyste et o l'auteur dit
ceci :
la parole exceptionnelle du psychanalyste qui vient combler
l'attente du patient est effectivement reue avec plaisir.
Elle neutralise une tension dans un sentiment d'adquation et
de soulagement mme si tout de suite aprs, elle doit susciter
la colre, l'opposition ou la dngation. De l sa comparaison
frquente une substance, nourriture, sperme, ou enfant qui
viendrait remplir le ventre du patient quitte parfois ce
qu'il en ait la nause.
Quayant reu une interprtation vers la fin de la sance, une
patiente rponde : vous m'avez fait plaisir, je voudrais
partir l-dessus, qu' la sance suivante elle voque : le
plaisir que j'ai quand vous me parlez, le ct inattendu de
vos paroles et pourtant, c'est comme un miracle mais cette
comparaison ne me plat pas car dans le miracle - ajoute la
patiente - il y a quelque chose de passif et que la patiente a
du mal expliciter son et pourtant qui se rfre la peur
que le plaisir ne dure pas et son impression de ne pas
130
pouvoir saisir tout ce que son psychanalyste lui dit. Et cela
se termine ainsi ! Et l'on ne sera pas surpris de voir dans la
suite, qu'elle avait reu l'interprtation comme un enfant que
son psychanalyste lui aurait donn : satisfaction coupable .
Et il me semble que c'est au niveau d'une formulation
ici devenue tout fait claire que se prcise mieux
sans doute ce que voulait dire STEIN quand il disait
que le contenu n'puisait pas la parole de
l'analyste. Et, en effet, ce contenu tel qu'il est
appel loi, semble voquer nul signifi qui
appellerait par l-mme quelque articulation
signifiante mais semble essentiellement voquer la
place d'o la parole de l'analyste prendrait cette
brillance si singulire. Je ne crois pas forcer ici
la pense de STEIN en citant par exemple cette
phrase, toujours dans ce dernier travail lorsqu'il
dit que : la parole du psychanalyste est toujours
attendue comme la rptition d'une parole dj prononce
J'aurai tendance bien entendu dire : comme
l'vocation d'une place dj l de toujours .
Je continue STEIN :
parole mythique, parole fondatrice qui l'tablit la fois
(qui tablit le patient la fois) car ces deux effets sont
insparables en tant qu'objets du dsir de l'Autre et en tant
que sujet d'une faute originelle .
Et il me semble que, toujours en accordant ces
lments leur place qui, nos yeux parait trs
importante dans le travail de STEIN et dans les
effets qu'il fournit, je dirai que, supposer que la
parole de l'analyste s'exerce cette place dont
j'essayais tout l'heure d'voquer la brillance si
particulire, suppose bien entendu que l'analyste
accepte ou entrine, pose, tout simplement que sa
parole vienne de ce lieu, et il me semble que tout un
certain nombre d'articulations prsentes dans le
texte pourraient ventuellement s'ordonner autour de
cette position suppose de la parole de l'analyste
dans la cure.
Par exemple, lorsqu'il est dit que par ses libres
associations l'analys dans le parfait
131
accomplissement de son don (c'est une citation)
cherche raliser sa parole vers cette mme place
qui est celle vise de l'analyste, on peut penser
donc que, si par ce don, l'analys cherche
rejoindre ici ce qui peut lui sembler la place o la
parole de l'analyste , il est susceptible
ventuellement d'inscrire, disons un vcu, pour
simplifier un terme de fusion mythique voire mme
dans quelque chose qui peut, ce moment-l prendre
le terme de cette extension narcissique si
particulire susceptible d'aboutir ces effets
extrmes c'est--dire celui d'une fusion avec
l'analyste.
J'ai un petit peu l-dessus J'ai l'impression que je
n'ai pas dit cela tout fait clairement mais ce que
je veux dire c'est qu' partir du reprage de cette
place on peut se demander si effectivement, partir
de ce moment-l, le mouvement de l'analys dans la
cure n'est pas une tentative de rejoindre un lieu
partir duquel effectivement une fusion mythique peut,
de toujours, tre suppose et peut-tre videmment,
dans ce mouvement situer quelque chose qui est ce
bien-tre ineffable inscrit sous le terme de
l'expansion narcissique primaire.
On pourrait galement se demander si, situer la chose
ainsi - je veux dire la parole de l'analyste cette
place - ne vient pas, cette parole qui peut, soit
combler cette rgression narcissique, soit introduire
la coupure, si voir les choses ainsi ne vient pas
rappeler cette bivalence courante et frquente qui
rappelle une spculation frquente qui a sans doute
sa valeur sur le bon et sur le mauvais objet. On
pourrait se demander si galement situer les choses
ainsi n'est pas quelque chose qui permette de
comprendre - car mes yeux, je dois dire, a a paru
comme assez surprenant - le fait que si le sujet
vient manquer la rgle fondamentale dans la cure,
il puisse immdiatement se sentir coupable de
masturbation. On peut donc dire que l aussi, en
situant les choses ainsi, o coupable de quelque
satisfaction auto-rotique originelle.
132
On pourrait donc se demander si le refus du patient
lorsqu'il vient manquer la rgle fondamentale, de
perdre quelque chose, en obissant cette rgle
impose par l'analyse, si ce refus du patient n'est
pas quelque chose qui prend ce caractre
ventuellement auto-rotique ou masturbateur parce
qu'il pourrait signifier la crainte ou le refus de se
perdre, lui, le patient, en quelque objet prciser
qui serait, lui, dtenu prcisment au pouvoir et aux
mains de l'analyste. Que, par exemple, dans le
dialogue de la cure puissent intervenir des lments
qui fassent intervenir le corps, le somatique, au
niveau d'un malaise que la parole de l'analyste
serait susceptible de lever. Il faut que je cite l
encore ces quelques phrases qui me paraissent tout
fait claires et tout fait intressantes dans le
propos, dans le texte de STEIN.
Il dit par exemple ceci :
levant l'incertitude, cette parole de l'analyste supprime du
mme coup le malaise. Mais cette incertitude, le patient
l'avait dj partiellement leve en traduisant son malaise en
une affection plus ou moins dtermine de son corps, phnomne
trs voisin de celui de la complaisance somatique que FREUD
tudie propos de l'hystrie de Dora.
lincertain malaise dans l'attente de la parole du
psychanalyste, le patient avait substitu une souffrance qui
impliquait la reprsentation assez prcise de la substance ou
de l'agent physique ncessaire sa suppression. Cela lui
permettait au moins de savoir de quoi il manquait. Il lui
avait suffi de prendre modle sur une souffrance autrefois
ressentie en raison de l'action de facteurs naturels et ainsi
s'explique le fait que la parole de l'analyste puisse agir
comme si elle tait une substance ou un agent physique .
J'aurai tendance, d'ailleurs STEIN dit ailleurs,
n'est-ce pas parfaitement que cette parole de
l'analyste est galement la mme qui, enfin c'est
encore beaucoup mieux imag lorsque par exemple STEIN
la compare la nourriture :
cette parole qui a pour effet d'entraner une modification
corporelle tout comme la nourriture calme la faim, ou comme
les rayons du soleil suppriment la sensation du froid.
133
J'ai dj signal - dit STEIN - que la parole pouvait
l'occasion faire disparatre une rage de dents ou un mal de
tte. Il n'est pas rare non plus qu'elle calme une sensation
de frais ou qu'elle rchauffe. Une telle identit deffets
pourrait donner penser qu'elle est le substitut d'une
substance ou l'agent d'une action physique ou qu'elle est
dune mme nature .
Enfin, J'aurai tendance voir galement dans cette
position, dans cette place particulire accorde la
parole de l'analyste quelque chose qui ferait que
peut-tre, la dmarche logique de l'auteur se trouve
engage dans un systme parfaitement binaire - CONT
a dit duel tout l'heure - un systme binaire
soutenu par un modle fondamental et que j'aurai
tendance voir comme ceci, non pas quelque chose qui
serait comme a, par exemple sous la formule tre
ou ne pas tre mais quelque chose qui serait peut-
tre plutt tre ceci ou tre cela . Enfin, je ne
demandai aussi si ce n'est pas partir de cette
place, de ce lieu accord la parole de l'analyste
que se trouve forcment pos le problme de la fin de
la cure, dans cette situation close ou effectivement
comme le fait STEIN ils ne peuvent tre inscrits ils
ne peuvent tre traduits qu'en termes d'artifices
techniques.
Je dois dire que, bien entendu, STEIN ne va pas, dans
ses propos, dans les textes que nous avons tudi ne
va pas au del de cette introduction, mais en tout
cas, c'est nanmoins ainsi, je veux dire en termes
d'artifices techniques, que cette fin de cure est
voque et effectivement, bien sr, on peut se
demander comment dans cette situation duelle,
relativement immobile et situant en ce lieu la parole
de l'analyste les choses pourraient tre tellement
diffrentes.
Enfin, pour terminer, l'auteur pose, bien entendu, le
problme de la vrit.
Comment, dit STEIN, l'analyste pourrait-il faire de sa
parole la garantie de vrit alors que le patient dans le
transfert lui attribue un pouvoir qu'il n'a pas?
134
Ce qui dbouche, bien entendu sur des formules qui
font de l'analyste un trompeur, tout simplement lui-
mme tromp. Et je dirais que c'est pour sa part
effectivement ce que je serais amen ventuellement
situer. Je veux dire dans une telle articulation bien
qu'aprs tout, je vois mal effectivement comment il
pourrait, l, en tre autrement si l'analyste n'tait
amen peut-tre, n'tait conduit aliner autre
chose la place du leurre.
STEIN ajoute encore :
il n'y aurait pas de psychanalyse si le psychanalyste
prtendait se poser tout instant en fidle serviteur de la
vrit .
Je relis bien cette phrase :
il n'y aurait pas de psychanalyse si le psychanalyste
prtendait tout instant se poser on fidle serviteur de la
vrit .
Je dois dire que, pour ma part, je ne suis pas du
tout d'accord, bien entendu, avec cette conclusion,
que je pense, bien au contraire - je termine de faon
abrupte et un petit peu rapide que l'analyse a au
contraire ce rapport fondamental la vrit et que,
si le psychanalyste ne pouvait effectivement en tre
constamment le garant, on risquerait de se retrouver
dans ces positions de leurre, dans ces positions de
trompeur tromp avec les consquences que cela peut
avoir sur le droulement de la cure que j'ai essay
peut-tre de manire un petit peu difficile ou pas
toujours trs claire de retracer dans ton propos.
Retour 22 Dc.
135
LACAN
II est deux heures deux. Je vous demande encore deux
minutes. Je ne pense pas que STEIN rpondra
aujourd'hui. Le temps manque tout fait et je pense
que les choses doivent tre reprises.
Une part, une part seulement de la difficult du
texte de MELMAN vient certainement de ceci que cet
article sur le Jugement psychanalytique de STEIN n'a
pas t suffisamment prsent. Je pense qu'il
n'chappe pas STEIN lui-mme ceci - que je vais
clairer tout de suite - qu'en somme MELMAN s'est
livr une lecture d'un article essentiellement
fond sur la fonction de prdication de l'analyste.
C'est en quelque sorte, pour autant que cette
prdication, dites-vous, est attendue que vous notez,
au niveau de quatre ressorts quels sont ses effets.
Pour expliquer ces effets mmes, MELMAN suppose de
votre part une apprhension plus centrale de cette
fonction de la parole de l'analyste. En somme il l'a
lu - il ose le lire - au-del de ce que vous osez
vous-mme voir. Chacun a tout de mme pu suivre cette
place qu'il dsigne et c'est une interrogation. Ce
n'est pas une prise de position. C'est bien pour a
qu'il n'a pas nommment dsigne, prcisment en fin
de compte, la place de l'objet(a). Vous l'avez senti
tout au long de l'expos de MELMAN et ceci encore
pose des problmes, puisque, aussi bien ce serait de
nature rformer toute la chane de votre
conception, sinon la ntre, enfin la ntre depuis l0
ans, du rapport du patient la parole de l'analyste
qui n'irait presque rien de moins qu' tre une
position constitue non pas du tout l, il ne s'agit
pas du masochisme, nous avons laiss compltement de
ct aujourd'hui notre conception du masochisme parce
qu'elle pose trop de problmes. Mais une conception
en quelque sorte hypochondriaque de la fonction de la
parole de l'analyste. Naturellement, tout aboutit, il
l'a fait admirablement aboutir cette difficult que
vous avez soulev : l'analyste doit-il tre le fidle
serviteur de la vrit.
136
C'est ce que j'ai apport rcemment en disant qu'il
n'y a pas de vrai sur le vrai, est-ce que ce n'est
pas l ce qui vous permettrait de corriger ce qu'a,
en quelque sorte, de simple approximation, cette
notion, bien sr, que le psychanalyste ne peut pas
tre le fidle serviteur de la vrit pour la raison
qu'il ne s'agit pas de la servir. En d'autres termes,
on ne peut pas la servir. Elle se sert toute seule.
Si l'analyste a une position dfinir, c'est bien
ailleurs que dans celle d'une Bejahung qui n'est en
effet, jamais que la rptition d'une Bejahung
primitive, C'est bien plutt justement que ce qui a
t introduit lors dun dbat interne notre cole
quoi GREEN qui en avait eu quelque cho, faisait
allusion tout l'heure.
Si justement l'analyste est dans une certaine
position, c'est bien plutt dans celle qui n'est pas
encore du tout, je dirais - on en a parl - pas
encore lucid - c'est la Verleugnung prcisment.
Je vous donne a comme dernire suggestion. Si vous
voulez c'est partir de l que nous pourrons
reprendre le quatrime mercredi de Janvier ce dbat
donc simplement ouvert. Je pense que tout de mme,
s'il s'agit de STEIN, vous en avez eu aujourd'hui
pour votre faim.
Inutile d'ajouter que ce qui est amorc [] et que je
pose comme une dernire question : est-ce qu'il n'y a
pas une profonde confusion dans cette espce de
valeur prvalente, de valeur toujours de point
d'aspiration, qu'a la pulsion orale dans toutes nos
thorisations de l'analyse, est-ce que a ne vient
pas d'une mconnaissance fondamentale de ce que peut
avoir d'orientant, de directeur dans un tel point de
fuite, le fait qu'on oublie que la demande se
prononce - quelle qu'elle soit - avec la bouche.
Table des sances
137
05 Janvier l966 Table des sances
Je vous souhaite une bonne anne, vux affectueux,
vux aprs tout, qui dans ma bouche, prend sa porte
de pouvoir, au moins sur un point si rduit soit-il
de votre intrt, y apporter moi-mme quelque chose.
Nous allons poursuivre ce que nous avons dire cette
anne de l'objet(a). Si vous me le permettez la
faveur de cette coupure et de ces vux, d'y mettre
l'accent sur une certaine solennit
46
- c'est le cas
de le dire nous dirons que cet objet(a), objet de
dchet, vous en avez eu dj assez d'approches pour
sentir la pertinence de ce terme, objet, dans une
certaine perspective et dans un certain sens rejet,
oui. Ne dirons-nous pas de lui que - comme il est
prdit - pierre de rebut il doit devenir la pierre
d'angle ?
Il est prsent partout dans la pratique de l'analyse,
encore, en fin de compte peuton dire que personne ne
sait le voir. Ceci n'est pas surprenant s'il a la
situation des proprits que nous lui donnons :
l'articulation que nous allons essayer - une fois de
plus - de faire avancer aujourd'hui.
Que personne ne sache le voir, est li, nous l'avons
dj indiqu, la structure mme de ce monde en tant
qu'il parait tre coextensif au monde de la vision.
Illusion fondamentale que depuis le dpart de notre
discours nous nous attachons branler, rfuter en
fin de compte.
Mais que personne ne sache le voir - au sens ou
sache c'est puisse le voir - n'excuse pas que
personne encore n'ait su le concevoir, quand, comme
je l'ai dit, son aperception est constante dans la
pratique de l'analyse, tant et si bien - tant et
tellement - qu'aprs tout, l'on en parle, de cet
objet dit prgnital dont on se gargarise pour
essayer, autour, de typifier cette apprhension
injuste, imparfaite, d'une ralit dont la prise,
46 jeu de mot sur solen ?
138
dont la forme serait lie au seul effet d'une
maturation dont assurment les piliers sont fermes
dans l'analyse, savoir le lien qu'il y a entre
cette maturation et quelque chose qu'il faut bien
appeler par son nom : une vrit.
Cette vrit, c'est que cette maturation est lie au
sexe. Encore tout ceci dtil paratre noy dans une
confusion du sexe et d'une certaine morale sexuelle -
qui sans doute n'est pas sans tre intimement lie au
sexe puisque la morale en sort - qui, faute d'une
dlination suffisante, fait de cet objet prgnital
la fonction d'un mythe o tout se perd, o
l'essentiel de ce qu'il peut et doit nous apporter
quant la fonction plus radicale de la structure du
sujet tel qu'il sort de l'analyse est qu'il abolit
jamais une certaine conception de la connaissance.
On en parle donc beaucoup
et non pas seulement au sens qui, je l'ai dit est
bien excusable savoir le voir , car nous
verrons quelles sont les conditions pour qu'une
chose soit vue et sans savoir mme le sens de ce
qu'on en dit, en quoi, puisque cette position, ne
pas savoir ce qu'on dit est proprement ce qui
doit tre tourn dans l'analyse, ce qui doit tre
forc dans l'analyse, ce qui fait que l'analyse
ouvre un nouveau chemin au progrs du savoir
on peut dire que l'analyste fait dfaut sa mission
en ne progressant pas justement l o est le point
vif o doit s'attacher son effort. Je suis venu de
loin pour accrocher ce point central et l'une des
utilits de l'emploi de cet algbre - qui fait que
cet objet je l'pingle de cette lettre (a) - une des
fonctions de cet emploi de la notation algbrique
c'est qu'il est permis d'en suivre le fil, comme un
fil d'or depuis les premiers pas de cette dmarche
qu'est mon discours et que m'attachant d'abord
accrocher le point vif, le point de partage de ce que
c'est que l'analyse et de ce qui ne l'est pas, ayant
commenc par le stade du miroir et la fonction du
narcissisme, si ds l'abord j'ai appel i(a) cette
image alinante, autour de quoi se fonde cette
mconnaissance fondamentale qui s'appelle le moi.
139
Je ne l'ai pas appel i(S) par exemple, l'image du
self ce qui aurait aussi bien suffi, a n'en aurait
t qu'une image.
Ce qu'il y avait dmontrer (que ce n'tait
qu'imaginaire) tait dj suffisamment indiqu.
J'ai appel a ds le dpart i(a), ce qui est en
somme de faon superflue - redoubler l'indication
qu'il y a dans l'identification de l'alination
fondamentale. Nous nous me-connaissons d'tre moi.
(a) est dans la parenthse, au cur de cette
notation, si bien que dj, c'est l qu'est indiqu
qu'il y a quelque chose d'autre, le (a) prcisment
au cur de cette capture et qui est sa vritable
raison.
Il y a donc une double erreur, erreur du mirage de
l'identification et mconnaissance de ce qu'il y a au
cur de ce mirage, qui le soutient rellement.
Je l'indique aujourd'hui pour la premire fois, je
crois, vous allez le voir revenir aujourd'hui dans la
suite de ce discours :(a)
repre, simple indication, je le dis, je n'en
donne pas ici la raison, et vous allez la voir
surgir
: (a) est de l'ordre du rel.
J'ai eu, lors de mon sminaire ferm, la satisfaction
de voir - par quelqu'un - rassembler jusqu' la date
de ce jour, couvrir, dirais-je, peu prs tout le
champ de ce que j'ai articul sur le (a), et poser
les questions que ce rassemblement laisse ouvertes.
J'indique au passage pour tout ceux dont je ne puis,
pour des raisons, pour des raisons de rapport de
masse - de rapport entre la quantit et la qualit
comme on dit ailleurs, du fait que la qualit change
d'un auditoire qu'il soit trop ample et trop touffu -
je m'excuse auprs de ceux que je ne convoque pas
ces travaux dont j'espre qu'ils prendront le ton
d'un change, d'un travail d'quipe.
Celui dont je parle - d M. Andr GREEN -
assurment n'a pas encore amorc le dialogue, si ce
n'est avec moi puisqu'il s'agissait de dire ce que
j'avais dit jusqu'ici de l'objet(a) pour
m'interroger
140
et la pertinence ici suffit pour m'imposer
d'avance l'adquation, sans a quoi bon
s'interroger
la pertinence des questions est de celles auxquelles
j'espre pouvoir cette anne donner satisfaction.
Aussi bien, que tout ceux qui n'assistent pas ces
sminaires sachent qu'ici la solution est simple au
problme de la communication.
Il suffit que cette sorte de petit rapport soit
diffus pour qu'aussi bien il serve tous pour
reprer ce que je pourrais y insrer de rponses par
la suite.
Dans d'autres cas o le dialogue sera de dbat,
d'articulations permettant d'tre rsumes en un
protocole, de mme - ce sera simplement une question
de dlai - ce qui restera de ce qui peut tre
articul comme linament, rseau, obtenu de cette
discussion sera communiqu de mme.
Il ne s'agit donc nullement dans le sminaire dit
ferm d'sotrisme, de quelque chose qui ne soit pas
la disposition de tous.
Je suis donc parti aujourd'hui de ces deux termes,
rappels dans le discours auquel je fais allusion,
savoir que c'est ds l'origine, de mon sillon
critique dans l'articulation de l'analyse, que nous
voyons pointer, apparatre, ce qui aboutit maintenant
l'articulation de l'objet(a), le moi, fonction de
mconnaissance.
Il importe de voir jusqu'o stend, par rapport ce
qui s'est appel, avant FREUD - prenons Janet comme
repre - la fonction du rel, l'important est de
souligner cette tare constitutive du moi.
Contrairement ce qu'on affirme, le moi dans FREUD
n'est pas la fonction du rel, mme s'il joue un rle
dans l'affirmation du principe de ralit, ce qui
n'est pas du tout la mme chose.
Le moi est l'appareil de la perception-conscience :
Wahrnehmung-Bewusstsein.
Or, si depuis toujours le problme de la connaissance
tourne et vire autour de la critique de la
perception, est-ce que de notre place - d'analyste,
141
prcisment - nous ne pouvons pas entrevoir ceci, qui
se trahit dans le discours philosophique lui-mme -
car toujours en fin de compte, dans le discours
tranent les cls de ce qu'il rfute - et le discours
insens des analystes sur l'objet prgnital nous
laisse aussi saillir, de-ci de-l les articulations
qui permettraient de le situer correctement.
C'est bien l ce que nous devons prvoir de quelque
chose d'clatant, qu'il devrait tre depuis longtemps
de notre patrimoine d'avoir mis la disposition de
tous.
Qui ne sait combien est courte l'intelligence de
l'homme et au premier plan ceux-la qui, justement
guids par le progrs du contexte scientifique, se
sont mis tudier l'intelligence l o elle doit
tre prise : au niveau des animaux.
Que nous sommes dj rcompenss quand nous savons
dterminer le niveau d'intelligence par la conduite
du dtour !
Je vous le demande, pour ce qui est de
l'intelligence, o est le degr de plus que l'homme
atteint ?
Il y a un degr de plus.
Il y a ce qu'on trouve au niveau de la premire
articulation thalessiene (de THALS
47
), savoir que,
de quelque chose, une mesure se dtermine par rapport
autre chose d'tre - cette autre chose - dans la
mme proportion qu'une troisime une quatrime.
Et c'est l strictement la limite de l'intelligence
humaine, car c'est l seulement ce qu'elle saisit
avec ses mains.
47 Diogne Larce, dans Vies, Doctrines et sentences des philosophes illustres, vol. 1, prcise que Hironyme dit qu'il mesura les
pyramides d'gypte en calculant le rapport entre leur ombre et celle de notre corps. L'anecdote rapporte que le Pharaon Amasis
aurait mis ses connaissances l'preuve en lui disant que personne n'tait en mesure de savoir quelle tait la hauteur de la Grande
Pyramide. (Plutarque, Le Banquet des Sept Sages, 2 :
Ainsi, vous, Thals, le roi d'Egypte vous admire beaucoup, et, entre autres choses, il a t, au-del de ce qu'on peut
dire, ravi de la manire dont vous avez mesur la pyramide sans le moindre embarras et sans avoir eu besoin d'aucun
instrument. Aprs avoir dress votre bton l'extrmit de l'ombre que projetait la pyramide, vous construistes deux
triangles par la tangence d'un rayon, et vous dmontrtes qu'il y avait la mme proportion entre la hauteur du bton et
la hauteur de la pyramide qu'entre la longueur des deux ombres. )
Il partit simplement du principe qu' un certain moment de la journe, l'ombre de tout objet devient gale sa hauteur. Il ne lui
restait qu' dterminer le moment exact. Il devait galement pour cela tenir compte de ce que les rayons du soleil devaient tre
perpendiculaires avec l'un de ses cts, ce qui ne se produisait que deux fois par anne (21 novembre et le 20 janvier).
142
Tout le reste de ce que nous plaons dans ce domaine
de l'intelligence et nommment ce qui a abouti
notre science est l'effet de ce rapport, de cette
prise dans quelque chose que j'appelle le signifiant,
dont la porte, dont la fonction, dont la
combinaison, dpasse dans ses rsultats, ce que le
sujet qui la manie peut en prvoir.
Car contrairement ce qu'on dit, ce n'est pas
l'exprience qui fait progresser le savoir, ce sont
les impasses o le sujet est mis d'tre dtermin par
la mchoire - dirais-je - du signifiant.
Si la proportion, la mesure, nous la saisissons, au
point de croire - et sans doute juste titre - que
cette notion de mesurer c'est l'homme mme : l'homme
s'est fait, dit le prsocratique
48
, le monde est fait
la mesure de l'homme. Bien sr puisque l'homme
c'est dj la mesure et ce n'est que a.
Le signifiant - j'ai essay de l'articuler pour vous
lors de ces dernires leons - ce n'est pas la
mesure : c'est prcisment ce quelque chose qui,
entrer dans le rel, y introduit lors de la mesure ce
que certains ont appel - et appellent encore -
l'infini actuel
49
.
Mais reprenons.
Que signifie ce que je veux dire quand je rpte
aprs l'avoir tellement dit, que ce qui fausse la
perception - si je puis dire - c'est la conscience.
quoi peut tenir cette trange falsification ?
48 Protagoras : Lhomme est la mesure de toute chose
49 Selon Hippocrate de Chios dit Ibicrate le gomtre , lve de Sophrotatos, les philosophes grecs ont toujours fait
clairement le distinguo entre linfini potentiel accept par Aristote essentiellement lusage des mathmaticiens - l apeiron , plus
exactement traduit par lillimit - et linfini actuel, par exemple l'ensemble des entiers naturels en tant que totalit acheve, quil
refuse de considrer.
- L'infini potentiel fut conu dj dans la Grce antique. On considre que l'on se dirige vers l'infini sans jamais l'atteindre. L'infini
est peru comme une potentialit. Remarquons que mme potentiels, les trs grands nombres peuvent tre difficiles concevoir.
Ainsi les suites de Goodstein sont des suites dfinies trs simplement qui donnent lieu des nombres qui dpassent
l'entendement, bien qu'ils soient encore considrablement plus petits que ceux engendrs par le castor affair.
- L'infini actuel est une conception plus contemporaine. la Renaissance, la perspective cavalire et par la suite la gomtrie
projective introduisirent des points de fuite l'infini perceptibles sur des tableaux ou des dessins. Cela amena les penseurs
imaginer l'infini comme atteignable ou comme ayant une ralit proche, ils considrrent l'infini comme une qualit intrinsque
de ce que ils tudiaient, l'infini tant peru comme une ralit, ou bien plus souvent, car reprsentant Dieu, donc inatteignable ,
immontrable , le cacher par un artifice graphique (btiment dans l'axe du point de fuite central). [ Wikipedia ]
143
Si, de toujours, j'ai attach tant d'importance la
saisir dans le registre psychologique, au niveau du
stade du miroir, c'est que c'est le chercher sa
place, mais cette place va loin. Le miroir ne se
dfinit, n'existe que de cette surface qui divise -
pour le renouveler - un espace trois dimensions,
espace que nous tenons pour rel et qui l'est sans
doute.
Je n'ai pas ici le contester. Je me dplace comme
vous et n'ai pas le moindre petit pied l'trier du
voyage taoste, chevauchant quelque dragon travers
les mondes. Mais Justement, qu'est-ce dire ?
Sinon que l'image spculaire n'aurait cette valeur
d'erreur et de mconnaissance si dj une symtrie,
qu'on appelle bilatrale, par un plan sagittal ne
caractrisait en tout cas l'tre qui y est intress.
On a une droite et une gauche qui ne sont videmment
pas semblables mais qui font office de semblables :
en gros deux oreilles, deux yeux, une mche sans
doute de travers mais en tout cas, on peut faire la
raie au milieu, on a deux jambes On a des organes
par paires - pour un grand nombre dentre eux, pas
dans tous - et quand on y regarde de plus prs,
savoir quand on ouvre : l'intrieur c'est un tant
soi peu tordu, mais a ne se voit pas au dehors.
L'homme, tout comme une libellule a l'air symtrique.
C'est un accident de cette espce - accident
d'apparence comme disent les philosophes - que
quelque chose est d, tout d'abord cette capture
dite du stade du miroir.
Est-ce qu'il n'y a pas - c'est la question qu'ici
nous pouvons nous poser - une raison plus profonde,
de ce qui parat un accident, au fait de cette
capture ? C'est l, bien sr, qu'une vue un peu plus
pntrante, attentive des formes pourrait nous mettre
sur la trace, car d'abord tous les tres vivants ne
sont pas marqus de cette symtrie bilatrale.
En plus, nous non plus car il suffit de nous ouvrir
le ventre pour s'en apercevoir.
En plus, il nous est arriv de nous intresser aux
formes en cours, l'embryologie et l, plus nous
avanons
plus nous remarquons que ce que j'appelais
144
tout l'heure, que je dsignais du terme de torsion
ou encore de disparit ou encore je voudrais me
servir du mot anglais, si excellent - oddit, domine
toujours dans ce qui constitue la transformation,
le passage d'un stade l'autre.
Dans l'anne o j'ai trac au tableau, les premires
utilisations de ces formes - auxquelles je vais venir
maintenant - en topologie et o j'essayais d'inscrire
pour l'dification de mes auditeurs et leur indiquer
ce qu'il y avait en tirer de rsonance, comme
analogie pour les introduire ce qu'il faut enfin
maintenant que je leur montre pour tre proprement la
structure de la ralit et non pas seulement la
figure
50
.
Combien de fois ceux-ci n'ont-ils pas t frapps -
quand pour eux cette baudruche de quelque tore et de
quelque crosscap, je la montrai ventre - de voir,
en quelque sorte surgir au tableau une figure qui
aurait pu passer au premier coup d'il pour une coupe
de cerveau par exemple avec des formes involues si
frappantes jusque dans la macroscopie, ou au
contraire une tape de l'embryon ?
Aprs tout, ouvrez un livre d'embryologie, le premier
venu, voyez les choses au niveau o un oeuf - dj
un stade assez avanc de division - nous prsente ce
qu'on appelle la ligne primitive, et puis ce petit
point qui s'appelle le noeud de HENSEN, enfin, c'est
quand mme assez frappant que a ressemble tout
fait exactement ce que je vous ai maintes fois
dessin sous le nom abrg d'un chapeau crois, d'un
cross-cap.
50 Sminaire lIdentification, 07-03.
145
Je ne vais pas, mme un instant glisser dans cette
philosophie de la nature. Ce n'est pas de cela qu'il
s'agit, de toute faon, nous ne pouvons trouver l
qu'un indice de quelque chose qui indique que, peut-
tre dans les formes de la vie il y a comme une
espce d'obligation de simulation de quelque
structure plus fondamentale.
Mais ce que ceci simplement nous indique et qui doit
tre retenu, c'est qu'il n'est pas lgitime de
rduire le corps - au sens propre de ce terme
savoir ce que nous sommes, et rien d'autre, nous
sommes des corps - de rduire les dimensions du corps
celle de ce qu'au dernier terme de la rflexion
philosophique, DESCARTES a appel l'tendue
51
.
[R. Descartes, Les principes de la philosophie, Mditation seconde]
Cette tendue, dans la thorie de la connaissance,
elle est l depuis toujours. Elle est l depuis
ARISTOTE. Elle est l au dpart de la pense qu'on
appelle du nom - j'ai horreur de ces foutaises
occidentale.
C'est celle d'un espace mtrique trois dimensions,
homogne et au dpart ce que ceci implique c'est :
une sphre sans limite, sans doute, mais constitue
quand mme par une sphre.
Je vais tout l'heure, j'espre, pouvoir prciser ce
que veut dire cette apprhension correcte d'un espace
trois dimensions, homogne, et comment il
s'identifie la sphre, toujours limite mme si elle
peut toujours s'tendre.
51 R. Descartes, Les principes de la philosophie, in uvres, Lettres, Paris, Gallimard, Pliade, 1953, p.571.
Cf. aussi Mditation seconde, op. cit.
146
C'est autour de cette apprhension de l'tendue que
la pense du rel - celle de l'tant comme dit
HEIDEGGER - s'est organise. Cette sphre tait le
suprme et le dernier tant : le moteur immobile.
Rien n'est chang avec l'espace cartsien : cette
tendue est simplement pousse par lui ses
dernires consquences, savoir que lui appartient
de droit tout ce qui est corps et connaissance du
corps. Et c'est pourquoi la Physique des passions de
l'me est manque chez DESCARTES
52
[DESCARTES, Les passions de lme]
parce que, nulle passion ne peut tre l'affect de
l'tendue.
Sans doute, y a-t-il l quelque chose de trs
sduisant depuis toujours. Nous allons le voir,
la structure de cet espace sphrique, c'est l
l'origine de cette fonction du miroir mis au principe
de la relation de connaissance.
Celui qui est au centre de la sphre, se voit
monstrueusement reflt dans ses parois : microcosme
rpondant au macrocosme. Ainsi la conception de la
connaissance comme adquation de ce point central
mystrieux qu'est le sujet, cette priphrie de
l'objet, estelle une fois pour toutes instaure
comme une immense tromperie au sens du problme.
Descartes ne s'est pas assez mfi du dieu malin : il
pense pouvoir l'apprivoiser au niveau du je pense,
c'est au niveau de l'tendue qu'il y succombe.
Mais aussi bien, cette tromperie n'estelle pas
forcment une tromperie. C'est aussi bien une limite,
une limite impose par Dieu prcisment. En tout cas,
dans la Gense, peu prs dans le cinquime verset
- je n'ai pas eu le temps de le vrifier avant de
venir du berchit bara helom, il y a un terme qui
est l, clatant depuis le fond des ges et qui, bien
sr, n'a pas chapp aux commentaires rabbiniques.
C'est celui que Saint Jrme a traduit par
firmamentum ce qui n'est pas si mal : l'enfermement
du monde.
Cela au-del de quoi Dieu a dit :
tu ne passeras pas .
52 DESCARTES, Les passions de lme, in uvres, Lettres, Paris, Gallimard, Pliade, 1953, p.695.
147
Car n'oubliez pas que jusqu' une poque rcente, la
vote cleste c'tait ce qu'il y avait de plus ferm.
a n'a pas chang. Ce n'est pas du tout parce qu'on
conoit qu'on peut voguer toujours plus loin qu'elle
est moins ferme. Il s'agit d'une limite autre dans
la pense de celui qui articula a en caractres
hbraques : raka. Raka spare les eaux
suprieures des eaux infrieures. Il tait entendu,
pour les eaux suprieures que l'accs tait
interdit
53
.
a n'est pas que nous nous baladions dans l'espace
avec, - point que, incidemment j'apprcie, je ne
rduis pas nant que nous nous baladions dans
l'espace avec de charmants satellites qui est
l'important, c'est qu' l'aide de ce quelque chose
qui est le signifiant et sa combinatoire, nous soyons
en possession de possibilits qui sont celles qui
vont au-del de cet espace mtrique.
C'est du jour o nous sommes capables de concevoir
comme possible - je ne dis pas comme rel - des
mondes six, sept, huit - autant que vous voudrez -
dimensions que nous avons crev raka, le firmament.
Et ne croyez pas que ce soient des blagues, enfin des
choses dans lesquelles on peut faire ce qu'on veut
sous prtexte que c'est irrel. On croit, comme a,
qu'on peut extrapoler. On a tudi la sphre
quatre, puis cinq, puis six dimensions. Alors on
se dit c'est bien. On dcouvre une petite loi comme
a qui a l'air de suivre. Alors on pense que la
complexit va aller toujours s'ajoutant en quelque
sorte elle-mme et qu'on peut traiter a comme on
traiterait une srie. Pas du tout ! Arrivs aux sept
dimensions - Dieu sait pourquoi, c'est le cas de le
dire : lui seul sans doute encore actuellement, car
les mathmaticiens ne le savent pas - il y a un os.
la sphre sept dimensions fait des difficults
incroyables
54
. [Cf. article John W. MILNOR]
53 Gense Dieu dit : que le firmament se fasse au milieu des eaux et qu'il spare les eaux d'avec les eaux. Et cela se fit. Dieu fit
donc le firmament et spara les eaux qui sont au-dessous du firmament, d'avec les eaux qui taient au-dessus. Et Dieu nomma le
firmament ciel. Et Dieu vit que cette oeuvre tait bonne. Et le soir arriva, et au matin se fit le second jour.
54 Cf. Sminaire Problmes cruciaux 10-03 ;
Cf. John W. MILNOR, mdaille FIELDS 1962 ; Sommes de varits diffrentiables et structures diffrentiables des sphres.
Bulletin de la Socit Mathmatique de France, 1959, p. 439-444.
148
Ce ne sont pas des choses auxquelles nous aurons
l'espace de nous arrter ici. Mais c'est pour vous
signaler, en retour, en retrait, le sens de ce que je
dis quand je dis : le rel c'est l'impossible .
a veut prcisment dire ce qui reste d'affirm dans
le firmamentum, ce qui fait que spculant de la faon
la plus valable, la plus relle car votre sphre
sept dimensions elle est relle , elle vous rsiste,
elle ne fait pas ce que vous voulez, vous
mathmaticiens.
De mme qu'aux premiers pas de PYTHAGORE, le
nombre
qu'il n'avait pas la navet de croire un produit
de l'esprit humain
lui a fait difficult simplement faire la chose
minimale, commencer par s'en servir pour mesurer
quelque chose, faire un carr. Tout de suite le
nombre surgit dans son premier effet irrationnel, en
quoi c'est a qui dmontre quil est rel : c'est
l'impossible, c'est qu'on n'en fait pas ce qu'on
veut. J'ai tir autant d'enseignement de cette
premire exprience que de celle de la sphre sept
dimensions qui n'est l que pour vous amuser et pas
pour faire plante .
Alors, la question est de savoir comment nous pouvons
rendre compte de ceci
qui est depuis toujours la porte de la main,
de quelque chose qui est tout de mme aussi dans
le rel, mais qui n'est pas du tout comme le
dpeint la thorie de la connaissance savoir
ce point central, ce point de convergence, ce
point de runion, de fusion, d'harmonie, dont on
se demanderait alors pourquoi tant de pripties,
d'avatars, de vicissitudes depuis le temps qu'il
serait l, recueillir le macrocosme : ce sujet
dont la premire chose que nous voyons (et on n'a
pas pour a attendu FREUD) c'est qu'il est - o
qu'il aille, o qu'il fasse acte de sujet - de
lui-mme divis
comment a peut s'inscrire dans un monde topologie
sphrique.
149
Notre seule faveur c'est d'tre au moment o peut-
tre - d'avoir crev raka, firmamentum, avant tout
dans les spculations des mathmaticiens - nous
pouvons donner l'espace, l'tendue du rel, une
autre structure que celle de la sphre trois
dimensions.
Bien sr, il ft un temps o je vous fis faire, dans
un certain rapport - de Rome - les premiers pas qui
consistent bien marquer la diffrence
de ce moi, qui se croit moi, ce qu'il exige de
nous, fascins par ce point secret
d'vanouissement qui est le vrai point de
perspective au-del de l'image spculaire qui
fascine celui qui, l, se reconnat, se regarde
la diffrence qu'il y a entre cela et le je de
la parole et du discours, de la parole pleine, comme
ai-je dit, celle qui s'engage dans ce vu que j'ose
peine rpter sans rire, Je suis ta femme
55
ou
bien ton homme ou bien ton lve .
Pour moi, Je n'ai jamais fait allusion cette
dimension que sous la forme du tu, comme bien entendu
toute personne qui n'est pas absolument insense.
Que cette sorte de message, qu'on ne le reoive
jamais que de l'Autre et sous une forme inverse,
c'est ce sur quoi j'ai insist tout d'abord.
Au niveau de mon sminaire sur le Prsident SCHREBER
j'ai longuement - propos de ce que j'ai appel le
pouvoir de performation, de l'affirmation consacrante
- longuement balanc autour de : tu es celui qui me
suivra(s) qui, bienfait des dieux en franais,
bnficie de l'amphibologie de la deuxime et de la
troisime personne du futur, on ne sait pas s'il faut
crire vras ou vra
56
.
a, on peut le dire, mais quant celui qui dit :
Je suis celui qui te suivrait . Pauvre imbcile !
Jusqu'o est-ce que tu me suivras ? Jusqu'au point o
tu perdras ma trace ou celui o tu auras envie de me
donner un grand coup de tabuses ! sur la tte.
La lgret de cette parole fondatrice est de celle
dont les humains font usage pour tenter d'exister.
55 Cf. Sminaires : Les Formations 08-01; Les Psychoses, 30-11, 07-12.
56 Cf. Sminaire : Les Formations 08-01.
150
C'est quelque chose dont nous ne pouvons commencer
parler avec quelque srieux que parce que nous savons
que ce Je nonant, c'est lui qui est vraiment
divis, savoir que dans tout discours, le Je qui
nonce, le Je qui parle, va au-del de ce qui est
dit. La parole dite pleine - premier lment de mon
initiation - n'est ici que figure drisoire de ceci :
c'est qu'audel de tout ce qui s'articule, quelque
chose parle que nous avons restaur dans ses droits
de vrit.
Moi, la vrit je parle dans votre discours
trbuchant, dans vos engagements titubants et qui ne
voient pas plus loin que le bout de votre nez.
le sujet, le je : celui-l ne sait pas du tout
qui il est.
Le sujet du je parle , parle quelque part en un
lieu que j'ai appel le lieu de l'autre et l est ce
qui, jamais nous oblige de rendre compte d'une
figure, structure qui soit autre que punctiforme et
qui organise l'articulation du sujet.
C'est cela qui nous amne considrer d'aussi prs
que possible ce qui doit tre repris de cette trace,
de cette coupure, de ce quelque chose que notre
prsence dans le monde introduit comme un sillon,
comme un graphisme, comme une criture, au sens o
elle est plus originelle que tout ce qui va sortir,
au sens o une criture existe dj avant de servir
l'criture de la parole.
C'est l que, pour prendre notre saut, nous reculons
d'un pas. Nous n'esprons pas crever raka dans les
trois dimensions. Peut-tre nous contenter de deux,
ces deux qui nous servent toujours, aprs tout, et
puisque depuis le temps que nous nous battons avec ce
problme de ce que a veut dire qu'il y ait au monde
des tres qui se croient pensants.
Que ce soit sur du parchemin, de l'toffe ou du
papier cabinet que nous l'crivions, qu'est-ce que
c'est, qu'estce que a veut dire qu'il y ait au
monde des tres qui se croient pensants ?
Alors, nous allons prendre une fonction dj
illustre par un titre donn l'un de ses recueils
par un des esprits curieux de ce temps.
151
Raymond QUENEAU - pour le nommer - a appel un de ses
volumes Bords
57
.
Puisqu'il s'agit de frontire, puisqu'il s'agit de
limites - et a ne veut rien dire autre chose, bord,
c'est : limite ou frontire - essayons de saisir la
frontire comme ce qui est vraiment l'essence de
notre affaire.
Au niveau des deux dimensions, une feuille de papier,
voil la forme la plus simple du bord.
C'est celle dont on se sert depuis toujours, mais
laquelle on n'a jamais, jusqu'avant un certain Henri
POINCAR, fait une vritable attention. Dj un nomm
POPILIUS et bien d'autres encore
Et si on fait a : _________ est-ce que c'est un
bord ? Justement pas !
Mais a ne veut pas dire que a n'ait pas de bord.
a :
ce trait, a a deux bords ou plus exactement, par
convention, nous appellerons son bord les deux points
qui le lient.
C'est prcisment dans la mesure o ce que vous voyez
l :
57 R. QUENEAU , Bords : mathmaticiens, prcurseurs, encyclopdistes, Paris, Hermann, 1963, Redition 1978.
152
qui s'appelle aussi une coupure ferme na pas de
bord, justement, qu'elle est un bord, un bord entre
ce qui est l [ a ] et ce qui est l [ b ].
Ce qui est l [ a ], puisque nous nous sommes limits aux
deux dimensions, nous allons l'appeler ce que a est,
nous allons l'appeler un trou.
Un trou dans quoi ?
Dans une surface deux dimensions.
Nous allons voir ce qu'il advient d'une surface
deux dimensions qui
partir de ce que nous avons dit tout l'heure,
et qui est l depuis toujours
est une sphre
je n'ai pas dit un globe : une sphre
ce qu'il rsulte dans la surface de l'instauration
de ce trou.
Pour le voir, ce trou [ x ] :
tant lui - stable, ds le dpart de l'exprience,
faisons-en d'autres [ y ]. Il est facile de s'apercevoir
que ces autres trous
153
sur lesquels nous nous donnons la libert du
mouvement, la libert d'exprimenter, ce qui va
rsulter de ce qu'il y a un trou pour les autres
trous
tous les autres trous peuvent se rduire tre ce
point-sujet dont je parlais tout l'heure. Tous !
1 2 3
Car supposez que je fasse ceci [ 1 - 2 ], c'est la mme
chose. Si grande que soit la sphre, ce trou [Y] je
peux l'largir infiniment pour qu'il aille au ple
oppos se rduire un simple point [ 3 ].
Ceci veut dire que sur une surface dtermine par ce
bord que nous appelons le bord d'un disque, que
cette surface est une sphre en ralit
tout ces trous que nous pouvons pratiquer sont
infiniment rductibles un point, et en plus ils
sont tous concentriques, je veux dire que mme
celui-l [ a : y ] que je fais en dehors de la premire
coupure, en apparence, il peut, par translation
rgulire, tre amen la position de celuici [ b : x ].
Il suffit pour a de passer par ce que j'ai appel
tout l'heure le ple oppos de la sphre [ c ].
a b c
154
Et pourtant, quelque chose est chang depuis que nous
avons fait deux trous. C'est qu' partir de
maintenant
si nous continuons faire des trous
supposez que nous en fassions un comme a ici :
c'est un trou rductible, rductible un point.
Mais si nous en faisons un concentrique au premier
trou et concentrique galement au second l :
ce trou-l, n'a aucune chance d'vasion qui lui
permette de se rduire un point.
Il est irrductible, qu'on le rtrcisse ou qu'on
l'largisse, il rencontrera la limite du bord
constitu par deux trous.
Je le rpte : je dis bord, au singulier, pour dire
que, une tape suivante de l'exprience dans la
sphre, j'ai dfini deux trous et c'est a que
j'appelle le bord. Ce qui veut dire quoi ?
C'est qu'une surface qui est ici dessine,
155
qu'il vous est facile de reconnatre mme si a vous
semble puisqu'on peut l'appeler un disque trou,
voire quelque chose comme un jade chinois, vous pouvez
voir qu'elle est exactement quivalente ici ce
qu'on appelle un cylindre.
Avec le cylindre, nous entrons dj dans une toute
autre espce surfacielle car je vous prsente ici ma
sphre deux trous. Je vous ai dit tout l'heure
que c'tait tout fait quivalent que ces trous
aient l'air ou n'aient pas l'air de se concentriser,
si je puis dire, l'un l'autre, cest exactement le
mme tabac.
D'ailleurs vous le voyez, cette espce d'estomac que
j'ai dessin l :
est un cylindre, il suffit que j'en abouche autant,
savoir un cylindre deux trous, aux deux trous
prcdents (b), ce qui en fait quatre, et il suffit
que je les couse pour faire sortir la figure qui
s'appelle tout simplement dans le langage des
demoiselles, un anneau :
156
quil faut bien entendu conserver en image comme
tant creux, pour voir de quelle sorte de surface il
s'agit.
Depuis longtemps, je me suis servi de ce tore pour
articuler bien des choses et vous en retrouvez la
trace dans la dernire phase du rapport de Rome
58
.
Ce tore, lui tout seul - et je dirai presque :
intuitivement - introduit quelque chose d'essentiel,
nous permettre de sortir de l'image sphrique de
l'espace et de l'tendue. Car, bien sr, nous ne nous
imaginons pas que nous ayons dessin l le vrai tore
trois dimensions. Ce tore, deux dimensions lui,
assurment est un bord, savoir que dans la mesure
o nous avons supprim les bords du cylindre, c'est
un sans bord, et comme surface il devient bord de
quelque chose qui est son intrieur et son extrieur.
Mais c'est une figure simple et qui ne doit nous
donner l'ide que, analogique de ce qu'il peut
advenir de l'espace - de l'espace sphrique - si nous
le supposons dans son ampleur, dans son paisseur
d'espace, dirais-je - pour me faire entendre d'un
auditoire pas forcment rompu l'usage des formules
mathmatiques - qu'il soit, sur lui-mme, tordu,
d'une faon torique.
Quoi qu'il en soit, le prendre, ce qui nous suffit,
comme modle au niveau des deux dimensions, nous nous
apercevons qu'ici, il y a -concernant ce que nous
pouvons dessiner de bord une dimension, de coupure
- une diffrence d'espce de la nature la plus
claire, entre les cercles qui peuvent se rduire
n'tre qu'un point
58 crits p.321, ou t.1 p.319 .
et ce
boucl
exemp
mme,
appel
Ceux-
Je vo
que
exemp
la de
Il su
conve
quand
deman
l'int
qu'es
elle
Voici
De qu
figur
ici
Vous
une t
59 Du 21
eux qui
ls, en
ple tra
, ici (
llerons
-l son
ous mon
j'en re
l'anne
le tor
plaire
emande
uffit p
ention
d je se
nde doi
trieur
st le t
mme
i peu
uelque
re comm
:
pouvez
telle b
1-03 au 11-04.
i vont
ntravs
ac comm
(c), de
s, si vo
nt irrd
ntrerai
eprendr
e du s
re nous
figur
au dsi
pour cel
dont vo
erai rev
it la
r (l'int
tore) et
e sans
u prs l
faon q
me ceci
z alors
boucle
se trou
, du fa
me ceci
le bou
ous vou
ductibl
ai ceci
minaire
donne
rer le
ir.
la de d
ous ver
venu de
fois b
trieur
t venir
s'tre
la figu
que vou
, le vi
facile
:
uver, e
ait d'
i (b) t
ucler,
ulez, s
les.
i que j
e sur L
un mod
nud,
dclare
rrez la
es figu
boucler
r d'ann
r se re
crois
ure que
us la d
ide cen
ement c
n quelq
tre un
out le
dans ce
on pai
'ai dj
L'Identif
dle par
le lien
r - con
motiva
res sui
sa bou
eau, de
-boucle
e.
vous o
dpouill
tral de
onstate
que sor
cercle
long d
e que n
isseur
j arti
fication
rticuli
n qui e
nventio
ation p
ivantes
ucle au
e cet a
er sur
obtenez
liez, c
e l'ann
er qu'
rte
e, par
du tore
nous
d'annea
icul
n
59
irement
existe d
on, mai
profonde
s - que
utour de
anneau
z.
c'est un
neau ta
dessin
157
ou
au.
t
de
s
e
la
e
ne
ant
ner
158
vous tes dans l'obligation de faire au moins deux
boucles, je dirai, sur le vide intrieur de l'anneau,
et pour que ces boucles se rejoignent, de faire un
tour autour de l'autre vide, c'est--dire 2 D au
moins plus un d ou inversement 2 d plus un grand D.
Autrement dit, un dsir suppose toujours au moins
deux demandes et une demande suppose toujours au
moins deux dsirs. C'est l ce que j'ai articul dans
un temps et que je reprendrai. Je ne le rappelle ici
que pour pointer l'lment sur lequel nous allons
pouvoir revenir d'une faon qui te cette figure
son opacit.
Il est important d'aller plus loin avant que je vous
quitte. C'est savoir, vous montrer, ce qui
constitue proprement parler la dcouverte de cette
topologie, qui est absolument essentielle pour nous
permettre - nous - de concevoir le lien qui existe
entre ce sillon du sujet et tout ce que nous pouvons
y accrocher d'opratoire et nommment le mirage que
constitue ceci, qui est rest au fond du culot
de la psychanalyse cossue comme un reste de la
vieille thorie de la connaissance et rien d'autre :
l'ide de la fusion autorotique, de la primordiale
unit suppose de l'tre pensant puisque de penser,
il s'agit dans l'inconscient, avec celle qui le
porte
comme s'il n'tait pas suffisant que
l'embryologie nous montre que c'est de l'uf lui-
mme que surgissent ces enveloppes qui ne font
159
qu'un, qui sont contigus avec les tissus de
l'embryon, qui sont faits de la mme matire
originelle comme si depuis les premiers tracs de
FREUD, ceux l mme dont il semble que nous
n'ayons jamais pu les dpasser, il n'tait pas
vident au niveau de l'Homme aux loups
60
, (rappelez
vous, l'homme aux loups qui tait n coiff),
est-ce que ceci n'a pas une importance capitale
dans la structure tellement spciale du sujet,
que ce fait qu'il trane - mais jusqu'aprs les
pas franchis, les derniers pas de l'analyse de
FREUD - cette sorte de dbris qui serait
l'enveloppe, cette obnubilation, ce voile, ce
quelque chose, dont il se sent comme spar de la
ralit.
Est-ce que tout ne porte pas la trace que dans la
situation primitive de l'tre, ce dont il s'agit
c'est bien de son enfermement, de son
enveloppement, de sa fermeture l'intrieur de
lui-mme, mme s'il se trouve, par rapport un
autre organisme dans une position que les
physiologistes n'ont absolument pas mconnue, qui
n'est pas de symbiose mais de parasitisme ?
que ce dont il s'agit dans la prtendue fusion
primitive, c'est au contraire ce quelque chose qui
est pour le sujet un idal toujours cherch, de la
rcupration de ce qui constituait sa fermeture,
non pas son ouverture, primitive.
C'est une premire tape de la confusion mais ce
n'est pas dire, bien sr que nous devions nous en
arrter l et croire comme LEIBNIZ la monade car en
effet, si ce complment nous demeure toujours
chercher comme une rparation jamais atteinte - ce
dont nous avons effectivement dans la clinique les
traces - il reste nanmoins que le sujet est ouvert
et que ce qu'il s'agit de trouver, c'est prcisment
une limite, un bord, un bord tel qu'il n'en soit pas
un, c'est--dire un bord qui nous permette sur sa
surface de tracer quelque chose, qui soit constitu
en bord, mais qui soi-mme ne soit pas un bord.
60 S. Freud, Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1954, 4
me
d. 1970.
160
Vous pouvez vous l'avez vu dj se retracer, la
figure en huit invers sur le tore. Elle coupe le
tore et l'ouvre d'une certaine faon tordue mais qui
le laisse en un seul morceau. Et ce tore reconstitu
est un bord : il y a un intrieur et un extrieur.
Nous pouvons donc tirer modle et enseignement d'une
certaine fonction de bord, qui s'inscrit sur quelque
chose qui est un bord. Nous avons besoin d'une
fonction de bord dterminant des effets analogues
ceux que j'ai dcrits sur la surface, d'une
diffrence, d'une diffrenciation, entre les bords
qui pourront tre tracs par la suite. Nous avons
besoin de cela sur quelque chose qui ne soit pas le
vrai bord, savoir qui ne dtermine ni intrieur ni
extrieur.
C'est prcisment ce que nous donne la figure que
j'ai appele tout l'heure[] sur une feuille, cette
sorte de bonnet crois ou cross-cap.
Cette figure, je dirais, est trop en avant par
rapport ce que nous avons dire. Ce que je veux
aujourd'hui souligner avant de vous quitter c'est
ceci, c'est que, une des deux surfaces qui se
produisent quand - sur cette surface, faussement
ferme, faussement ouverte, c'est ce que j'ai appel
le cross-cap - nous traons le mme bord en huit
invers que j'ai dcrit tout l'heure.
Nous obtenons deux surfaces, mais deux surfaces qui
l sont distinctes l'une de l'autre : savoir l'une
est un disque, l'autre est une bande de MBIUS .
161
Or, ce que ceci va nous permettre d'obtenir c'est
ensuite - des bords d'une structure diffrente.
Tout bord qui sera trac sur la bande de MBIUS
donnera des qualits absolument distinctes de ceux
qui sont tracs sur le disque, je vous dirai
lesquelles la prochaine fois.
Et pourtant ce disque se trouve le corrlatif
irrductible
ds lors que nous avons affaire au monde du rel
trois dimensions, au monde marqu de ce signe
de l'impossible au regard de nos structures
topologiques
ce disque occupe une fonction dterminante
l'endroit de ce qui est le plus original : la bande
de MBIUS.
Qu'est-ce que reprsente dans cette figuration la
bande de MBIUS ?
C'est ce que nous pourrons illustrer la prochaine
fois en montrant ce qu'elle est, c'est dire pure et
simple coupure, c'est dire support ncessaire ce
que nous ayons une structuration exacte de la
fonction du sujet, du sujet en tant que cette
puissance osculatrice
61
, cette prise du signifiant sur
lui-mme qui fait le sujet ncessairement divis et
qui ncessite que tout recoupement l'intrieur de
lui-mme ne fasse rien d'autre, mme pouss son plus
extrme, que reproduire de plus en plus cache, sa
propre structure.
Mais l'existence est dtermine par sa fonction dans
la troisime dimension ou plus exactement dans le
rel o elle existe. Le disque, je vous le
dmontrerai, se trouve en position de traverser
ncessairement - lui comme rel - cette figure qui
est celle de la bande de MBIUS en tant qu'elle nous
rend possible le sujet.
Cette traverse de la bande sans endroit ni envers
nous permet de donner une figuration suffisante du
61 oscultatrice : se dit de lignes, plans, surfaces, se touchant dune faon particulire.
162
sujet comme divis. Cette traverse, c'est
prcisment la division du sujet lui-mme.
Au centre, au cur du sujet, il y a ce point qui
n'est pas un point, qui n'est pas sans laisser un
objet central.
Soulignez ce pas sans, qui est le mme que celui dont
je me suis servi pour la gense de l'angoisse.
Cet objet, sa fonction par rapport au monde des
objets, nous la dsignerons la prochaine fois. Elle a
un nom. Elle s'appelle la valeur. Rien dans le monde
des objets ne pourrait tre retenu comme valeur s'il
n'y avait point ce quelque chose de plus originel qui
est un certain objet qui s'appelle l'objet(a) et dont
la valeur a un nom : valeur de vrit.
Table des sances
163
l2 Janvier l966 Table des sances
Je veux saluer la parution des Cahiers pour
l'analyse. l'intention des auditeurs de l'cole
Normale Suprieure : je ne puis dire assez, combien
je les remercie de cette collaboration, de cette
prsence qui est pour moi un grand soutien.
Contrairement ce que j'ai pu entendre, fusse l'tat
d'cho, pour avoir t mis trs proche de moi, je
veux dire parmi ceux qui sont mes lves,
la thorie
la thorie telle que je la fais ici, telle que je
la construis
la thorie ne saurait aucunement tre mise au rang du
mythe.
La thorie, pour autant qu'elle est thorie
scientifique se prtend et se prouve n'tre pas un mythe.
Elle se prtend, dans la bouche de celui qui parle et
qui l'nonce selon le registre qu'on ne saurait que
rintgrer dans toute thorie, de la parole, de la
dimension - au-del de l'nonc - de l'nonciation.
C'est pourquoi l'origine de la thorie il n'est pas
vain de savoir au nom de qui l'on parle. Il n'est pas
accident que je parle au nom de FREUD et que d'autres
aient parler au nom de celui qui porte mon nom.
Quand je dnonce, par exemple, comme non vrit,
dnoncer au nom d'une certaine phnomnologie qu'il n'y
a pas d'autre vrit de la souffrance que la souffrance
elle-mme, je dis : ceci est une non-vrit tant qu'on
n'a pas prouv que ce qui s'est dit au nom de FREUD -
que la vrit de la souffrance n'est pas la souffrance
elle-mme - est controuv
62
.
Ceci dit la naissance de la science ne reste pas
ternellement suspendue au nom de celui qui l'instaure parce
62 invent de toute pice, mensonger.
164
que la science ne se prtend pas seulement n'tre pas de
la structure du mythe, elle se prouve ne l'tre pas.
Elle se prouve en ceci qu'elle se dmontre tre d'une
autre structure et c'est ce que signifie
l'investigation topologique qui est celle que je
poursuis ici, que je reprends aujourd'hui de la
dernire fois o je l'ai arrte sur la structure du
tore en tant que construit par la jonction o les deux
trous sur la surface dite topologiquement sphre
que je pense que vous ne confondez pas avec la baudruche
des enfants, encore qu'elle ait, bien entendu, les plus
grands rapports avec elle, qu'elle soit ou non
gonfle : mme rduite dans votre poche l'tat d'un
petit mouchoir, c'est toujours une sphre.
J'ai termin, avec quelque hte sans doute, limit par la
coupure - celle du temps - qui gouverne, et pour tous
les sujets, nos rapports. J'en suis rest la coupure
sur la surface du tore, d'un bord, d'un bord ferm,
celui qui y instaure la rptition minimale. Un tour ne
suffit pas nous livrer l'essence de la structure du
tore : un tour fait rapparatre la bance des deux
trous sur lesquels elle est construite, restitue,
avec ces deux trous l'ouverture de ce que nous avons
dfini d'abord comme la bande cylindrique,
165
savoir ce qui
je pense n'avoir pas y revenir aujourd'hui et
que tout ceux qui sont l taient l la dernire
fois, pour les autres, mon Dieu, tant pis, qu'ils
s'informent
j'ai dit que deux trous, quels qu'ils soient sur la
sphre sont toujours concentriques mme s'ils
apparaissent, une premire vue, tre ce qu'on
appelle extrieurs.
Ils sont toujours concentriques et crent ceci que je
dessine ici qui s'appelle la bande, que nous
appellerons par convention ici pour nous en servir,
la bande cylindrique.
Topologiquement, que ce soit, je vous l'ai dit la
dernire fois, un jade plat et perfor
tout a parce que c'est une figure sous laquelle
cette bande peut apparatre et apparat
effectivement et non sans raison dans l'art ou
dans ce qu'on appelle l'art
ce peut donc tre la fois cette forme plate
perfore au centre ou un cylindre, topologiquement
c'est quivalent.
Un tour, donc sur le tore :
coupure, ainsi faite [ 1 ] par exemple, ou aussi bien
ainsi faite [ 2 ], a simplement pour effet de le renvoyer
166
la structure de la bande cylindrique et n'en rvle
nullement, disons, la proprit.
II en faut deux.
Bien commode pour supporter - pour nous - la
ncessit de la rptition, pour ce que va
reprsenter le tore, mais alors, pour que cette
coupure se ferme, il faut que s'y ajoute, disons, le
tour fait autour du second trou
puisque, ce qui dfinit la structure du tore, Je
veux dire intuitivement. je suis moi-mme gn de
devoir poursuivre ce discours en des termes qui
font appel votre il, votre intuition de ce
que c'est, cet anneau creux, le tore.
Mais profitons de ce support de l'intuition et
aprs tout, il rpond au fondement da la
structure
pour que la coupure se ferme en ayant fait deux
tours autour du trou, si vous voulez appelons-la
circulaire, il est ncessaire qu'elle fasse aussi,
cette coupure , un tour autour du trou appelons le,
le nom n'est peut-tre pas le meilleur, mais qu'ici
il fasse pour vous, image, figure, du trou central :
Conventionnellement, nous allons reprsenter je dis
reprsenter au nom du terme de reprsentant.
Si ce reprsentant mrite d'tre appel
reprsentation, nous le verrons aprs.
167
Reprsentant a l'avantage de dire ici tenant lieu,
ce qui veut dire que rien n'est tranch sur le sujet
de la fonction de reprsentation et qu'aussi bien,
peut-tre, ce qui, ici, se dfinit, se dcoupe,
s'affirme comme coupure peut bien, jusqu' nouvel
ordre, tre pris la lettre d'tre rellement ce
dont il s'agit. C'est pourquoi le terme reprsentant
pour l'instant nous suffit.
Voil, donc ce qui va se produire chaque fois que la
rptition de ce tour - que par convention nous
allons assimiler au tour de la demande - deux D ne
saurait aller sans que, pour que la courbe soit
ferme, aussi le tour soit fait du trou central.
2 D ne va pas sans d ou si vous faites la coupure
autrement, ce qui est aussi concevable, je pense
il faut que je fasse les choses un peu plus
rigoureusement pour que je ne sois pas tout
fait
ce qui est aussi concevable, un D (une demande) pour
que la coupure soit ferme implique deux tours autour
du trou central que nous appellerons l'quivalent de
deux d.
La demande et le dsir c'est ce
qu'au cours de notre construction ds longtemps
prpare et quand nous avons introduit au plus
prs de l'exprience analytique les termes
Fonction et champ de la parole et du langage
63
63 crits, p 237, ou t. 1 p. 235.
168
ce quoi nous avons donn la part qui est
l'essentiel de l'exprience analytique, non pas
seulement son truchement, son instrument, son moyen,
mais assurment, il faut tenir compte qu'il n'y a
pas, au dernier terme, d'autre support de
l'exprience analytique que cette parole et ce
langage. Dire - si je puis dire - que sa substance
est parole et langage, c'est l la donne sur
laquelle nous avons difi cette premire
restauration du sens de FREUD. Mais bien sr, ceci
n'est pas l - pour nous - tout dire. Ce que
finalement la topologie du tore vient supporter
c'est - en nous imageant, en nous permettant
d'intuitionner - cette divergence qui se produit de
l'nonc de la demande la structure qui la divise et
qui s'appelle le dsir. C'est une faon pour nous de
supporter ce que nous donne une exprience dont les
prsupposs subjectifs sont approfondir.
L'exprience psychanalytique cette tape de
structure que nous faisons ici supporter par le tore
et qui est, disais-je, le premier temps que j'ai
donn ma reconstruction de l'exprience freudienne,
en un sens, Fonction et champ de la parole et du langage,
c'est l'assurer sur le fondement du pur symbolique.
Et si le tore ne suffit pas pour rendre compte de la
dialectique de la psychanalyse ellemme, si aprs
tout sur le tore nous pouvons nous croire obligs
tourner ternellement dans ce cycle des deux termes :
l'un ddoubl l'autre masqu de la demande et du
dsir, s'il faut que nous en fassions quelque chose,
si je puis dire de cette coupure, et s'il faut que
nous voyons o elle nous mne
savoir comment de ce cercle, de ce bord, qui,
selon la formule propre tout bord est un sans
bord, c'est--dire, tournera toujours et sans fin
sur lui-mme
qu'est-ce qu'on peut reconstruire avec l'utilisation
de coupure de ce bord ?
Un instant, arrtons-nous donc, avant de le quitter.
Avec cette structure
vous m'avez vu hsiter parce que j'allais dire
cette forme et en effet, pour autant que nous
169
allons la quitter pour passer une autre
structure, elle se dtache comme une forme au
moment o elle tombe
arrtons nous-y un instant pour envisager comment
mme il a t possible que nous retienne, que nous
retienne ncessairement, car ce n'est pas vain dtour
mais passage oblig dans notre construction de la
thorie si nous avons d repartir de Fonction et champ
de la parole et du langage comme du point initial : ce
pur symbolique s'inscrit dans les conditions qui font
que c'est le nvros et je dirai, le nvros moderne
mode de manifestation du sujet non pas
mythiquement mais historiquement dat, entr dans
la ralit de l'histoire, srement une certaine
date, mme si elle n'est pas datable, nous
n'allons pas nous garer sur ce qu'tait les
obsessionnels au temps des stociens.
Faute de documents, nous serons prudents en
faire ventuellement quelque reconstruction
structuralement modifie. Ce n'est pas cela qui
nous importe
car ce nvros moderne [] il n'est pas sans
corrlation avec l'mergence de quelque chose, d'un
dplacement du mode de la raison dans l'apprhension
de la certitude qui est ce que nous avons cherch
cerner autour du moment historique du cogito
cartsien.
Ce moment est insparable aussi de cette autre
mergence qui s'appelle la fondation de la science et
du mme coup, l'intrusion de la science dans ce
domaine qu'elle bouleverse, qu'elle force, dirais-je,
qui est un domaine qui a un nom parfaitement
articulable qui s'appelle celui du rapport la
vrit. Les limites, les liens aux entournures, si je
puis dire, de la fonction du sujet en tant qu'elle
est ainsi introduite dans ce rapport la vrit, ont
un statut que j'ai essay seulement d'esquisser pour
vous autant qu' notre propos il est utile, car sans
lui il est impossible de concevoir ni l'existence
comme telle ni la structure du nvros moderne qui,
mme qu'il ne le sache pas est coextensif de cette
prsence du sujet de la science.
170
Outre que pour autant que son statut clinique et
thrapeutique lui est donn par la psychanalyse, si
paradoxal que cela VOUS paraisse j'affirme qu'il
n'existe, si singulier que cela vous paraisse, il
n'existe je dirais, complt que de l'instance de la
clinique et de la thrapeutique psychanalytique.
A quoi vous allez lgitimement - puisque j'ai dit
complt - dire que la praxis psychanalytique, est
littralement le complment du symptme.
Et pourquoi pas ?
Puisque aussi bien c'est de la tension d'une certaine
perspective et d'une certaine faon d'interroger la
souffrance nvrotique, que effectivement se complte
-et dans la cure - la symptomatologie.
FREUD l'a soulign et juste titre. Le fait qu'elle
puisse galement se complter ailleurs, savoir mme
avant que FREUD ait complt son exprience
il y avait eu certaine manire pour le nvros de
complter ses symptmes avec Monsieur Janet
ne va pas contre. Il s'agit justement de savoir ce
que nous pouvons retenir de la structure janetienne
pour la constitution du nvros comme tel.
Mais aprs tout - je vous le dis tout de suite, ne
vacillez pas pour autant - cette espce, je ne dirai
pas d'idalisme mais de relativisme du malade son
mdecin, vous ferez bien de ne pas vous y prcipiter
parce que ce n'est pas du tout a que je dis, malgr
que ce soit a qui ait t entendu parce que, un
petit peu prmaturment, j'ai introduit cette
fonction de la clinique psychanalytique aux runions
de mon cole et o j'ai, bien entendu, instantanment
recueilli cette interprtation de la complmentation
du nvros par le clinicien et qu' la vrit,
j'esprais mieux de ceux qui m'entendent.
C'est peut-tre aussi pour moi un peu excessif que
d'en attendre tant puisque aussi bien j'ai t forc,
titre d'expos, de passer par ce terme de
complter, dont vous verrez comment il pourra tre
corrig quand justement j'aurai pu progresser d'une
autre structure. C'est une complmentation, peut-
tre, mais qui n'est pas d'ordre homogne.
171
C'est ce que va nous livrer la structure suivante,
j'entends que je vais ici rintroduire la bande de
MBIUS. Quoi qu'il en soit, marquons bien dj, ce
qu'il y a l de disparit fondamentale. C'est dj ce
qui est sensible, inscrit, vivant et qui a fait
l'immense retentissement de la psychanalyse mme sous
les formes imbciles o elle s'est d'abord prsente.
Quand j'ai dit que l'entre du mode du sujet
qu'instaure la science bouleverse et force le domaine
du rapport la vrit, observez que dans la parole
donne - dans la psychanalyse - au nvros comme tel,
ce qu'il reprsente, pour employer mon terme de tout
l'heure, c'est sans doute quelque chose qui
appelle, qui se manifeste au premier plan comme
demande de savoir et en tant que cette demande
s'adressait la science.
Mais ce qui s'est introduit avec la psychanalyse
dcidment du ct de celui qui s'autorise et se
supporte d'tre ici sujet de la science
qu'il sache ou non en quoi, pour autant il
s'engage comme responsabilit, il faut bien le
dire, il n'a pas l'air toujours de le savoir,
quoi qu'il s'en targue
mais ce qui est original c'est que la parole est
donne celui que j'ai appel le nvros comme
reprsentant de la vrit. Le nvros, pour que la
psychanalyse s'instaure et ait - ce que nous
appellerons au sens large o j'emploie ce terme - un
sens, c'est - et ce n'est rien d'autre - que la
vrit qui parle, ce que j'ai appel la vrit quand
je l'ai fait dire - parlant en son nom :
moi la vrit je parle .
64
C'est l ce sur quoi il nous est demand de nous
arrter et au plus prs, car celui que nous coutons
la reprsente. Telle est la dimension nouvelle, son
originalit tient dans cette disparit que ce crdit
absolument insens qui est fait une manifestation de
parole et de langage, se fait dans la science en tant
64 crits, p 409 ; ou t.1 p 406.
172
prcisment que la science, dans ce dplacement
fondamental qui l'instaure comme telle, l'exclut pour
le sujet de la science dont il ne s'agit que de
suturer les bances, les ouvertures, les trous par
o, comme tel, va entrer en jeu ce domaine ambigu,
insaisissable, bien repr depuis toujours pour tre
le domaine de la tromperie qui est celui o, comme
telle, la vrit parle.
C'est cette jonction, cet abouchement trange
qu'il s'agit de donner son statut. Je le rpte -
sans doute, j'ai eu trop l'occasion de m'apercevoir
combien il est ncessaire pour se faire entendre
d'insister - la vrit comme telle est incite, est
convoque, non plus tre prise comme dans
l'mergence du statut de la science, comme
problmatique, mais venir - si je puis dire -
plaider sa cause elle-mme la barre, elle-mme
poser le problme de son nigme dans le domaine de la
science.
Ce rapport la vrit ne saurait tre lud. Ce
n'est pas pour rien que nous avons une logique qu'on
appelle moderne, logique dite propositionnelle,
bauche
on peut mme dire et croire autant qu'il faut
aussi faire crdit tellement nous avons peu de
documents
bauche, disje, par les Stociens.
Elle repose, cette logique dont vous auriez tort de
minimiser l'importance de manifestation, car si mme
tardive, dans la construction de la science, ceci a
occup dans nos proccupations prsentes cette place
extraordinaire qui n'en fait pas moins que rvler
une problmatique qui sans doute rsolue dans les
premiers temps de la science en marche ne nous
rejoint pas par hasard au rendez-vous o nous la
trouvons maintenant.
Sans pouvoir mme en dire quoi que ce soit qui
rappelle ceux qui savent la complexit, la richesse
et les dchirements, les antinomies, qu'elle
instaure, je rappellerai simplement comme point de
rfrence ce quoi, si je puis dire elle rduit la
173
fonction de la vrit. Cette [althia] cette figure
ambigu de ce qui ne saurait rvler sans occulter
cette dont un HEIDEGGER nous rappelle
dans la pense qui est la ntre la fonction
inaugurale et nous rappelle y retourner. Je
dois dire non sans une trange maladresse de
philosophe car au point o nous en sommes, j'ose
dire que nous, psychanalystes, nous avons plus
en dire, oui, plus a en dire,
que ce que HEIDEGGER
dit de la Wahrheit mme barre dans son rapport
au Wesen
65
.
laissons cela de ct un instant et disons qu'
l' (c'est pour cela que je l'ai rintroduite)
depuis les Stociens, s'oppose l' [alths] - le vrai
- au neutre - attribut.Qu'est-ce que peut vouloir
dire l' dtach de l' ?
Naturellement, ce n'est tout de mme pas moi qui ai
introduit pour la premire fois cette question.
Disons que toute la logique, la logique
propositionnelle, moderne, que vous pouvez voir - en
ouvrant n'importe quel manuel, qu'on l'appelle
symbolique ou non, vous verrez se constituer le jeu
de ce qu'on appelle l'opration logique, conjonction
par exemple, disjonction, implication, implication
rciproque, exclusion
nulle part vous n'y trouverez, je vous le dis en
passant, la fonction logique pourtant que j'ai
introduite l'anne dernire - l'anne avant
dernire
66
- sous le nom de l'alination.
J'y reviendrai
ces oprations se fondent, se dfinissent d'une
faon qu'on appelle purement formelle partir de la
possibilit de qualifier un nonc d'alths, vrai ou
faux, en d'autres termes de lui donner une valeur de
vrit. La logique la plus commune, celle la vrit
qui dure depuis toujours, et qui a peut-tre quelque
titre faire durer, c'est une logique bivalente.
Un nonc est ou vrai ou faux. Il y a de fortes
raisons de prsumer que cette faon de prendre les
65 M. Heidegger, De l'essence de la vrit (Vom Wesen der Wahrheit, 1943), Questions I, Paris, Gallimard, Coll. Tel, 1990.
66 Sminaire Les Quatre concepts du 27-04 au 17-06.
174
choses est tout fait insuffisante comme d'ailleurs,
il faut le reconnatre, les logiciens modernes s'en
sont aperu d'o leur tentative d'difier une logique
multivalente. Ben c'est pas commode vous savez ! Et
d'ailleurs, je dirai, provisoirement, a ne nous
intresse pas. L'intressant est de savoir simplement
qu'on construit une logique sur le fondement bivalent
alths, vrai ou pas, et que lon peut construire
quelque chose qui ne se limite pas du tout la
tautologie : le vrai est vrai, le faux est faux, qui
peut s'tendre sur des pages et des pages et qui -
bien sr - tout en prenant fortement rfrence la
tautologie, n'en construit pas moins quelque chose o
l'on gagne du terrain. C'est exactement le mme
problme que ce qui est on peut dire, la
mathmatique est une tautologie - d'un certain point
de vue de logicien mais il n'en reste pas moins que
c'est une conqute, un difice justement fcond et
dont les fates, les apoges, les dveloppements,
appelez-a comme vous voudrez, sont tout fait
substantiels, existants, au regard des prmisses, on
a effectivement construit quelque chose, on a gagn
un savoir.
Le rapport la vrit est, en d'autres termes, ici
sutur par la pure et simple rfrence la valeur.
Qu'on en demande plus quand on demande ce que c'est
que d'tre vrai bien sr, la pense dite positiviste
ou no-positiviste ira l au recours la
rfrence
mais ce recours la rfrence en tant que ce
serait l'exprience ou quoi que ce soit de
l'ordre d'une objectalit exprientielle
sera toujours insuffisant, comme il est facile de le
dmontrer chaque fois que cette voie est prise .
Car on ne saurait, avec cette seule rfrence,
expliquer ni le ressort, ni les parties, ni le
dveloppement, ni les crises de toute la construction
scientifique.
Il nous faut nous rappeler pour avoir seulement une
saine logique, nous pouvons compltement liminer le
simple rapport l'tre, au sens aristotlicien,
lequel dit que le vrai est de dire de ce qui est,
175
qu'il est, et est n'est pas l qui existe ,
que le faux est de dire que ce qui est n'est pas,
qu'il n'est pas qu'il est
67
.
On tente une issue pour chapper cette rfrence
l'tre, alors l il y a l'issue russellienne, celle
l'vnement qui est tout autre chose que l'objet.
La gageure est tenue par RUSSEL
68
dont la seule
rfrence vnementielle - savoir du recoupement
spatio-temporel - est quelque chose que nous pouvons
appeler une rencontre et ds lors, on dfinira le
vrai comme la probabilit d'un vnement certain, le
faux comme la probabilit d'un vnement impossible.
Il ny a qu'une faiblesse cette thorie, ce
registre, c'est qu'il y a
et c'est ici que nous nous remettons en jeu, nous
autres analyste - une sorte de rencontre qui est
celle dont je vous ai parl la premire anne o
j'ai parl ici, tout de suite aprs la rptition
c'est prcisment la rencontre avec la vrit
69
.
Impossible donc d'liminer cette dimension que je
dcris comme celle du lieu de l'Autre o tout ce qui
s'articule comme parole, se pose comme vrai mme et y
compris le mensonge. La dimension du mensonge,
contrairement celle de la feinte, tant justement
d'avoir le pouvoir de s'affirmer comme vrit. Dans
la dimension de la vrit, c'est--dire la totalit
de ce qui entre dans notre champ comme fait
symbolique, la vrit avant d'tre vraie ou fausse
selon des critres qui - je vous l'ai indiqu -
ne sont pas simples dfinir puisque, toujours,
ils font entrer d'un ct, la question de l'tre,
et de l'autre, celui de la rencontre justement
avec ce qui est en question : avec la vrit.
La vrit entre en jeu, restaure et s'articule
comme primitive fiction autour de quoi va avoir
surgir un certain ordre de coordonnes dont il
s'agit pour ne pas oublier la structure
67 ARISTOTE, Mtaphysique.
68 B. Russell, La philosophie de l'atomisme logique, Ecrits de logique philosophique, Paris, PUF, 1989, Coll. Epimthe 5 Les
propositions gnrales et l'existence p.388 sq.
69 Sminaire Les Quatre concepts 04-02 (rptition) et 12-02 (tukh).
176
avant que quoi que ce soit puisse se poursuivre
valablement de sa dialectique, c'est cela qui est en
question.
C'est ici que devient fascinant ce qui se poursuit
comme uvre, comme treinte, comme trame, sur ce
point que j'ai appel le point d'abouchement de la
vrit et du savoir.
Si l'anne dernire nous avons ici, fait si long, si
grand tat des thses de FREGE
70
c'est qu'il tente une
solution
- une parmi les autres, mais celle-l spcialement
rvlatrice pour nous d'aller dans un sens radical-
lorsque nous avons vu ou entrevu (grce certains de
ceux qui veulent bien ici me rpondre) ce que nous
avons vu, c'est qu'au niveau de la conception du
concept, tout est tir du ct o ce qui va avoir
prendre valeur, ou non, de vrit est marqu d'une
certaine sollicitation, rduction, limitation qui est
proprement celle du fait qu'il a pu en tirer la
thorie du nombre qui est la sienne et que si l'on y
regarde de prs, le concept fregien est entirement
centr sur ce quoi peut tre donn un nom propre.
En quoi pour nous, avec la critique que nous en avons
faite l'anne dernire ici - je demande pardon ceux
qui n'y taient pas participants - en quoi se rvle
le caractre spcifiquement subjectif (au sens de la
structure que nous-mmes donnons au terme de sujet)
de ce qui, pour un FREGE, en tant que logicien de la
science, est ce qui caractrise comme tel l'objet de
la science. Je sais qu'ici je ne fais qu'approcher un
point qui demanderait dveloppement. Si dveloppement
il y a ce ne peut tre que sur question, si question
il peut y avoir l-dessus a pourra tre fait mon
sminaire ferm.
Mais j'en ai indiqu assez pour rejoindre ce sur quoi
j'ai termin la dernire fois, savoir qu'il y a
problme autour de cette fonction fregeienne
71
prcisment de la Bedeutungswert qui est
Wahrheitswert et que cette valeur de vrit, s'il y a
problme, c'est l, peut-tre, que vous verrez en
70 Sminaire Problmes cruciaux 27-01, 24-02, O2-06.
71 G. Frege, Sens et dnotation. Ecrits logiques et philosophiques, Paris, Seuil, Coll. Points,1994 n296, p.102.
177
fait que nous pouvons apporter quelque chose qui en
donne, qui en dsigne, d'une faon rnove par notre
exprience, le vritable secret, il est de l'ordre de
l'objet(a).
C'est au niveau de l'objet(a) en tant qu'objet qui
choit dans l'apprhension du savoir, que nous sommes,
comme hommes de la science, rejoints, par la question
de la vrit. Ceci est cach parce que l'objet(a) ne
se voit mme pas dans la suture du sujet telle
qu'elle est difie dans la logique moderne et que
c'est proprement ce que notre exprience nous force
d'y restaurer l o la thorie prcisment, non
seulement se prtend mais se prouve tre suprieure
au mythe et que c'est seulement partir de l que
peut tre donn son statut - un statut dont on rende
compte et non pas seulement qu'on constate - comme le
fait d'tre divis, son statut au sujet prcisment,
dont le sens ne saurait chapper cette division.
C'est ici que s'introduit la structure du plan
projectif pour autant que la surface en est autre et
nous permet de rpondre autrement de ce qui se
dcoupe comme objet et comme sujet.
Cette bande de MBIUS, je vous l'ai dj montre au
cours des annes qui sont passes, et dj j'ai donn
les indications qui vous mettent sur la voie de son
utilisation pour nous dans la structure.
La bande de MBIUS, je l'ai dj une fois construite
devant vous, vous savez comment a se fait. On prend
une bande du type de celles que j'appelle bande
cylindrique et la retournant d'un demi tour, on la
colle elle-mme, on fait ainsi cette bande de
MBIUS qui n'a qu'une surface, qui n'a pas d'endroit
et d'envers. Et dj, la premire fois que je l'ai
introduite
72
j'ai fait allusion ceci : comment cette
surface peut-elle tre - comme on dit d'un habit - la
doublure, comment peut-elle ou non tre double ?
Eh bien, observez ici quelque chose d'essentiel la
structure de la sphre
cette structure de la sphre sur laquelle vit
toute la pense, au moins de celle qui est
72 Sminaire Problmes cruciaux 09-12.
178
mergente jusqu' l'entre en jeu de la science,
autrement dit la pense cosmologique qui, bien
entendu, continue de faire valoir ses droits mme
dans la science auprs de ceux qui ne savent pas
ce qu'ils disent. Il ne suffit pas d'avoir en
matire sociale des prtentions rvolutionnaires
pour chapper certaines impasses concernant
prcisment ce qui est pourtant la racine de
l'entre en jeu d'une rvolution quelconque,
savoir le sujet. Mais je n'voquerai pas ici un
dialogue - que peut-tre j'ai dj voqu - avec
un de mes confrres sovitiques. J'ai pu
m'apercevoir et confirmer depuis par une
information qui je vous prie de le croire est
abondante que dans l'Union des Rpubliques
Socialistes, on est encore aristotlicien, c'est-
-dire que la cosmologie n'en est pas diffrente,
c'est--dire que le monde est une sphre
que la sphre peut se doubler l'intrieur d'une
autre sphre et ainsi de suite, en manire de pelures
d'oignons.
Tout rapport du sujet l'objet est le rapport d'une
de ces petites sphres une sphre qui l'entoure et
la ncessit d'une dernire sphre - encore qu'elle
ne soit pas formule - est tout de mme l implicite
dans tout le mode de penser la ralit .
Or quoi qu'on en pense, c'est l quelque chose qui
peut bien se peindre en couleurs qu'on appelle
ridiculement - j'ai encore, il n'y a pas longtemps,
entendu employer le terme - de raliste, pour
dsigner le mythe, comme on disait, de la ralit. En
effet, c'est bien d'une ralit mythique qu'il s'agit
mais appeler a raliste a quelque chose
d'hallucinant comme l'histoire de la philosophie nous
commande d'appeler raliste toute autre chose.
C'est une affaire de querelle des universaux.
Quant savoir si FREUD tombait ou non dans le
travers de prendre la ralit pour la dernire ou
l'avant-dernire ou l'une quelconque de ces pelures,
savoir pour croire qu'il y a un monde dont la
dernire sphre, si l'on peut dire, soit immobile,
179
qu'elle soit motrice ou non, je pense que c'est l
avancer quelque chose de tout fait abusif car s'il
en tait ainsi, FREUD n'aurait pas oppos le principe
du plaisir et le principe de ralit. Mais c'est
encore un fait dont personne n'est arriv jusqu'
prsent prendre conscience des consquences,
savoir de ce que cela suppose quant la structure.
Je rpte qu'on voit combien est solidaire la fois
de l'idalisme et d'un certain faux ralisme
qui est le ralisme, je ne dirai pas de ce qu'on
appelle le sens commun car le sens commun est
insondable, du sens des gens prcisment qui se
croient tre un moi, un moi qui connat et qui
font une thorie de la connaissance
c'est que tant que la structure est faite de ces
sphres qui s'enveloppent l'une l'autre, quel que
soit l'ordre dans lequel elles s'tagent, nous nous
trouvons justement devant cette figure : entre nous
(sphre subjective) et toute sphre, il y aura
toujours une certaine quantit de sphres
intermdiaires : ide, ide d'ide, reprsentation,
reprsentation de reprsentation,
ide de reprsentation et qu'au-del mme da la
dernire sphre - disons que c'est la sphre du
phnomne - nous pouvons peut-tre admettre
l'existence d'une chose en soi, c'est--dire d'un
au-del de la dernire sphre. C'est autour de cela
qu'on tourne depuis toujours et c'est l'impasse de la
thorie de la connaissance.
La diffrence entre cette structure - la structure de
la sphre - et celle de la bande de MBIUS que je
vous prsente, est que si nous nous mettons faire
la doublure de cette bande de MBIUS qui est celle-l
que je tiens l dans la main droite
180
quand nous aurons fait un tour - c'est ce que je vous
ai dit quand je vous l'ai prsente - nous serons de
l'autre ct de la bande. Il semblerait donc qu'il
faille la traverser comme je vous l'ai dit la
premire fois pour lui faire sa doublure mais c'est
condition de vouloir lui faire une doublure comme la
doublure de ce manteau ou la doublure de la sphre de
tout l'heure, une doublure qui se forme en un tour
mais si vous en faites deux vous l'enveloppez
compltement savoir que vous n'avez plus besoin
d'en faire d'autre : la bande de MBIUS est
compltement double avec cet lment qui, en plus,
lui est enchan.
Concatnation, terme essentiel donner sa valeur non
pas mtaphorique mais concrte la chane
signifiante, seulement, ce qui la double, cette bande
de MBIUS, c'est une surface qui n'a pas du tout les
mmes proprits.
C'est une surface qui, si je la dfais - je crois que
nous n'avons pour l'instant plus rien en faire : je
la dfais - cette bande de MBIUS qui tait boucle
avec elle, a pour proprit de pouvoir , si je puis
dire, se doublant elle-mme, accolant une de ses
faces, appelons-la la face bleue pour ne pas dire
l'endroit et l'envers : elle n'a pas d'endroit ni
d'envers, elle a un endroit et un envers une fois
qu'on a choisi - la face bleue est colle elle-mme
et la face rouge puisque je vous le rpte, elle a un
endroit, et un envers, est toute entire dans ce qui
se voit l'extrieur. Voil donc quelque chose, une
surface qui a pour proprit, la bande de MBIUS
primitive dans laquelle ces deuxl ont t faites
c'est une bande de MBIUS que vous prenez,
construisez de faon ordinaire en la retournant
ainsi
si vous dcoupez, d'une faon quidistante
[coupure non mdiane] un bord, si vous y faites une coupure,
vous aurez deux tours, vous les dcouperez au centre,
d'une autre surface de MBIUS, celle que je vous ai
montr tout l'heure, et la priphrie, une bande,
une bande qui, elle, n'est pas une bande de MBIUS,
c'est une bande avec deux faces ce n'est pas une
181
bande cylindrique car, vous le voyez, elle a quand
mme une forme et une forme un petit peu bizarre,
cette forme, je vous la montre, elle est trs simple
trouver, elle fait ici deux tours et dans ce cas-
l, il en pend un.
Bon ! Faites la vrification. Cette bande est une
bande applicable la surface du tore. Voil, je vous
l'envoie pour que vous la regardiez.
Alors, qu'est-ce que nous avons ?
Nous avons une bande de MBIUS qui est telle que
subissant une coupure, une coupure typique, d'une
faon rgulire quidistante son bord, on aboutisse
quelque chose qui est la bande de MBIUS (qui reste
toujours), quelque chose qui l'enveloppe compltement
en faisant un double tour.
Ce quelque chose n'est pas une bande de MBIUS, c'est
quelque chose qui enveloppe la bande de MBIUS, d'o
ce quelque chose est issu dans la mesure o cette
bande rsulte d'une division de la bande de MBIUS.
Cette bande, en tant qu' la fois enchane la
bande de MBIUS mais tout en en tant isole, elle
est applicable sur le tore.
Cette bande, c'est ce qui pour nous, structuralement
s'applique le mieux ce que je vous dfinis pour
tre le sujet, en tant que le sujet est barr.
Le sujet en tant qu'il est, d'une part quelque chose
qui s'enveloppe soi-mme ou encore ce quelque chose
qui peut suffire se manifester dans ce simple
redoublement car nul besoin, mme que la bande de
MBIUS reste isole au centre et enchane cette
bande qui est, comme vous l'avez vu de cette bande
simplement la faire se redoubler, je peux refaire la
structure d'une bande de MBIUS.
182
Ceci va nous servir d'appui pour dfinir la fonction
du sujet. Quelque, chose qui aura cette proprit
essentielle dfinir la conjonction de l'identit et
de la diffrence. Voil ce qui nous parat le plus
appropri supporter pour nous structuralement la
fonction du sujet.
Vous ny verrez des dtails, des finesses qu' mesure
que je poursuivrai, c'est savoir de ce que vous y
pourrez voir d'une faon plus intime ce rapport de la
fonction du sujet celle du signifiant.
Et la distance qui spare dans un cas et dans l'autre
ce rapport la conjonction de l'identit et de la
diffrence. Et maintenant, je vous indique si la
bande de MBIUS est elle-mme l'effet d'une coupure
dans un autre mode de surface
que pour vous faciliter les choses je n'ai pas
introduite autrement et que j'ai appel tout
l'heure le plan projectif
c'est au prix d'y laisser le rsidu d'une chute,
elle, discale, que je prends pour support de l'objet
(a) en tant que c'est de sa chute que dpend
l'avnement de la bande de MBIUS et que sa
rintgration le modifie dans sa nature de chute
discale c'est--dire le rend sans endroit ni envers
et c'est l que nous retrouvons la dfinition de
l'objet(a) comme non spculaire.
C'est en tant que, vous le voyez, il se resuture, il
se recolloque sa place par rapport au sujet dans la
bande de MBIUS, qu'il a pour proprit de devenir ce
quelque chose d'autre dont les lois sont radicalement
diffrentes de celles de n'importe quel trou fait sur
la sphre, qui aussi bien dfinit sujet ou objet.
C'est un objet tout fait spcial.
Et hier soir
je regrette que la personne qui a introduit ce
terme soit actuellement partie, vue l'heure
on nous a parl de retournement.
Aucun emploi d'un terme tel que celui-l ne saurait
tre tenu pour lgitime sauf tre proprement gch
s'il ne ressortit pas cette rfrence structurale.
183
C'est savoir que sont d'une porte toute diffrente
selon les structures, ce qui peut se qualifier de
retournement .
quoi bon ai-je martel depuis des annes la
diffrence du rel, de l'imaginaire, du symbolique
dont vous voyez maintenant incarn
je pense que vous le sentez
que tout l'heure, dans ces successives sphres,
vous avez bien vu comment l, l'imaginaire trouve sa
place, l'imaginaire c'est toujours la sphre
intermdiaire entre une sphre et l'autre.
L'imaginaire n'a-t-il que ce sens ou peut-il en avoir
un autre ? Comment parler d'une faon univoque du
retournement, comment le faire sentir ?
Un gant
prenons la plus vieille faon de prsenter les
choses, elle est dj dans KANT
73
un gant retourn et un gant dans le miroir, ce nest
pas la mme chose. Un gant retourn c'est dans le
rel, un gant dans le miroir, c'est dans l'imaginaire
pour autant que vous prenez l'image du gant dans le
miroir pour l'image du gant qui est dedans.
A partir de l, vous pouvez bien voir, pour nos
formes, celles que je peux vous dessiner au tableau,
il en est de mme, parce qu'elles ont un endroit et un
envers et parce qu'elles ont un axe de symtrie .
Mais pour le plan projectif et pour la bande de
MBIUS, qui n'ont pas d'endroit ni d'envers ni de
plan de symtrie, quoi qu'ils se divisent en deux, ce
que vous aurez dans le miroir est srieusement
questionner. Quant ce que vous avez dans le rel,
essayez toujours de retourner une bande de MBIUS,
vous la retournerez tant que vous voudrez, elle aura,
toujours la mme torsion car en effet cette bande de
MBIUS a une torsion qui lui est propre et c'est ce
titre qu'on peut croire qu'elle est spculaire car
elle tourne ou droite ou gauche.
C'est justement en quoi je ne dis pas que la bande de
MBIUS n'est pas spculaire, nous dfinirons le
73 E. Kant, Prolgomnes toute mtaphysique future, Paris, Vrin, 2
me
d. corr. et augm. 2000, 13.
184
statut de sa spcularit propre, nous verrons que
cela nous mnera certaines consquences.
Ce qui est important, c'est cette fausse
complmentarit qui fait que nous avons d'une part,
une bande de MBIUS qui pour nous, est support et
structure du sujet en tant que nous la divisions, si
nous la divisons par le milieu nous n'aurons plus ce
rsidu de la bande de MBIUS enchan que je vous ai
montr tout l'heure, mais nous l'aurons encore sous
la forme prcisment de cette coupure et qu'importe,
l'essentiel sera obtenu, savoir la bande que nous
appellerons torique applicable sur le tore et qui est
capable de restituer, en s'appliquant sur elle-mme
la bande de MBIUS.
Ceci, pour nous structure le sujet.
Quelque chose se conjoint cet S, que nous appelons
(a), qui est (a) non spculaire, en tant qu'il se
ressoude, en tant qu'il est considr comme support
de ce S du sujet. D'autre part, en tant chu, il perd
tout privilge et littralement laisse le sujet seul,
sans le recours de ce support, ce support est oubli
et disparu. C'est l que j'ai voulu vous mener
aujourd'hui. Je m'excuse de n'avoir pas pu pousser
plus loin cet expos mais j'ai pens depuis longtemps
qu' ne pas mcher littralement les pas je risquais
de prter la rechute toujours dans la pense
psycho-cosmologique qui est prcisment celle
laquelle notre exprience va mettre un terme.
Table des sances
185
l9 Janvier l966 Table des sances
Thrse PARISOT LACAN
Aujourd'hui va tre employ une sorte d'preuve
dont je voudrais vous dire d'abord le dessein.
C'est d'abord une espce d'chantillon de mthode.
On va vous parler
pas moi, la personne que j'en ai charg
on va vous parler d'un clairage apport sur un
point particulier de la Divine Comdie [I, II, III] de DANTE par
quelqu'un qui, manifestement, y a t guid par les
suggestions qu'il a reues de la connaissance de mon
stade du miroir. Bien sr, ce n'est pas a qui lui a
donn la connaissance de DANTE.
Monsieur DRAGONETTI, auteur de l'article dont on va
vous rendre compte est un minent romaniste dont la
connaissance trs ample de DANTE est justement ce qui
donne la valeur au reprage qu'il a fait de la
fonction du miroir, dans un style tel que cela lui
permette d'apporter sur la conscience, sa fonction
fondamentale, des notations, on peut dire, tout
fait sans rapport avec ce qui circule de son temps.
C'est cela qu'on va vous prsenter.
Quel en est l'intrt ? C'est d'indiquer le sens dans
lequel pourrait tre fait cet chantillonnage de
structure qui permettrait de donner un ordre, un
ordre autre que reposant sur des prconceptions
d'volution linaire, d'volution historique, ou plus
exactement de cette introduction dans l'histoire de
cette notion d'volution qui la fausse compltement.
186
Bref, c'est l une espce de premier modle - modle
emprunt ce qui se produit effectivement dans la
ralit, mais qui est en quelque sorte confin des
travaux de spcialistes - un modle, si l'on peut
dire - si vous voulez - de mthode historique telle
qu'elle pourrait tre guide par des considrations
structuralistes qui ici nous guident, en tant
qu'elles seraient employes avec les rfrences
psychanalytiques. Ce sera une occasion de les
rappeler. Cela me mettra, du mme coup, en posture de
vous rappeler certains acquis de mon enseignement
antrieur, pour autant que j'aurai les remettre
trs prochainement en communication avec ce que je
continue de vous dvelopper des structures
topologiques fondamentales, pour autant qu'elles sont
pour nous des structures guides.
Je vous parlerai d'autre chose dont je vous laisse la
surprise mais dont je vous indique ds maintenant que
tout en tant une analyse structurale d'un autre
point du donn de l'acquis culturel - vous verrez
tout l'heure ce que c'est que j'ai choisi -
quelque sicles de distance de DANTE, je me trouverai
amen ici un de ces points tournants
d'introduction, de mise en vidence, de saillie d'une
donne structurale qui nous sera - spcialement pour
nous psychanalystes - de la plus grande utilit,
comme fondement, pour essayer d'ordonner ce qui se
dit de compltement confus, parce que collab ,
parce qu'cras, si l'on peut dire, par les
diffrents plans que a invoque, au sujet du
masochisme.
Alors, je donne la parole Madame le Docteur PARISOT
qui va vous rendre compte de cet article sur un point
particulier de la Divine Comdie, savoir cette
prsence de la spcularit, de ce que DANTE en pense.
187
Thrse PARISOT
Le travail de DRAGONETTI est un travail qu'il a
publi dans la Revue des tudes Italiennes n l02,
Septembre l965. Il a donn pour titre son travail :
DANTE et Narcisse ou les faux monnayeurs de l'image.
Dans Divine Comdie il y a deux allusions, et deux
seulement, au mythe de Narcisse. La premire en enfer
o le nom de Narcisse est mentionn, la deuxime au
paradis qui est trait seulement sous la forme d'une
priphrase. Le propos de Roger DRAGONETTI c'est, par
le biais du commentaire de ces deux passages,
d'avancer que la substance de ce mythe est sans cesse
prsente dans la Divine Comdie et qu'elle fut le
monstre intime de DANTE.
- La premire allusion, celle de L'Enfer, on la trouve
dans le Chant XXX, cette allusion elle-mme est le
vers l28. Elle figure au cours de l'pisode des faux
monnayeurs. L'pisode le voici : DANTE aperoit un
hydropique au ventre prominent et aux membres
disproportionns, c'est Matre ADAM. L'image
obsdante des ruisseaux du Casentin ne fait
qu'augmenter la soif qui le dvore. Accoles lui,
deux ombres : l'une c'est la femme de PUTIPHAR,
l'autre c'est SINON le Grec de Troie.
Matre ADAM et SINON changent des coups dans une
rixe provoque par le premier, qui a trait le Grec
de fourbe. Le texte le voil, traduit naturellement :
Et que te chtie - dit le Grec - la soif qui te crevasse
la langue ainsi que l'eau pourrie qui fait que ton ventre
te fait une clture devant les yeux.
A quoi le faux monnayeur rpond :
comme d'habitude ta bouche ne se dmantibule que pour
son mal, car si j'ai soif et si l'humeur me farcit, tu as
la fivre et la tte te fait mal, et pour lcher le miroir
de Narcisse, il ne te faudrait pas de longues paroles
d'invitation.
188
Premier point : le miroir de Narcisse. Ce miroir de
Narcisse, on ne peut pas le prendre pour une simple
mtaphore pour dsigner l'eau frache. Ce n'est pas
l'eau frache dsigne en termes plus beaux.
D'ailleurs ce serait tout fait contraire l'ide
que DANTE a de la posie. C'est donc l une
mtaphore, mais c'est la mtamorphose de cette eau,
la mtamorphose de cette eau en miroir de Narcisse.
DANTE ne parle donc pas seulement de l'eau mais d'une
surface rflchissante comme durcie qui renvoie
l'image d'un Narcisse pris de son ombre. Ainsi l'eau
frache est effectivement cette eau, mais une eau
transmue en miroir, une eau change en image de
l'eau. A partir de quoi la riposte de Matre ADAM
prend son sens. On peut traduire comme a : ta fivre
te donne tellement soif que tu ne te ferais pas
beaucoup prier pour lcher une image de l'eau.
Le deuxime point c'est le sens allgorique qui
concorde avec la lecture littrale de ces vers. Il
faut donc chercher le sens symbolique de la faute de
Matre ADAM et le sens symbolique de cette difformit
qu'est l'hydropisie.
Matre ADAM c'est donc un faux monnayeur mais dont la
faute apparat d'une singulire gravit tant donn
l'endroit o il est dans l'Enfer.
Ce qu'il a fait : l'instigation des Comtes de
Romena il a fabriqu des florins. Ces florins taient
bons de poids, mais leur alliage ils comportaient un
alliage. Le florin tait en principe une monnaie d'or
pur. Ceux-l ne sont pas en or pur. Ils comportent
trois carats de mtal.
Avant d'approfondir le sens de cette faute, il
convient de la situer dans ce qu'on peut appeler
l'ordonnance morale de l'Enfer qui est expose - dans
le Chant XI - expose par la bouche de VIRGILE. Il
est dit que la fraude, d'une part prsuppose la
malice et d'autre part, il est dit que la fraude est
le mal propre l'homme.
189
Le premier point : la fraude, la falsification
prsuppose la malice. La malice se manifeste dans le
choix dlibr du mal que l'on poursuit.
Elle falsifie le principe lui-mme qui fonde toute
vertu sur le bien, en se dissimulant sous l'apparence
d'un bien. Elle atteint Dieu dans ce qu'il y a de
plus proche de son essence, savoir la raison. Si la
raison rend l'homme semblable Dieu c'est aussi par
elle que cette similitude, dans l'analyse, s'adultre
en son reflet, celui d'un Autre absolu, une semblance
de l'absolu.
La raison, captive de sa propre image du bien,
sduite son reflet, se rend semblable son reflet
en se choisissant comme telle, sens absolu de
mtamorphose. Et ce sens, qui attire en son creux
l'tre de toute chose, en tire un double ressemblant
o rien jamais ne se prsente, ne se drobe sous la
semblance d'un absolu. C'est donc par sa latence que
la malice est redoutable, et le propre de la malice
c'est qu'elle n'apparat jamais. Ce n'est pas une
interprtation, c'est dans le texte a. En fait c'est
dans le Chant XI.
La deuxime chose qui est dite dans ce Chant c'est
que la fraude est le mal propre l'homme. C'est
VIRGILE qui l'exprime dans un raccourci tout fait
saisissant, en un seul vers, le vers 52 de ce chant
XI :
la fraude dont toute conscience sent le remords.
En d'autres termes, toute conscience comme telle est
mordue par la fraude. Il y a chez tout homme quelque
chose de fondamentalement fauss dont la conscience
porte les marques. Il s'agirait de la faute premire,
la faute premire c'est la sparation, c'est la
morsure. Et dans la faute de toute conscience, dans
le remords, il y a ce mor de la morsure. Et c'est
la morsure d'ADAM qui a provoqu cette sparation,
cette brisure, cette brisure de la raison.
Donc toute conscience est toujours dj en rupture,
entame qu'elle est par la falsification originelle.
190
Le faux monnayeur s'appelle ADAM. Naturellement le
nom de ce personnage rappelle celui du premier homme
et prcdant le texte que j'ai lu au dbut - le texte
de l'allusion Narcisse - tous les thmes de la
faute originelle sont prsents.
Maintenant, en tenant compte de ce rapprochement
symbolique et dans le mme registre
d'interprtations, on va voir en quel sens la fausse
monnaie est une image de la faute originelle.
Ce florin, je vous l'ai dit, tait un florin d'or
pur, la nature restant toujours cette poque, la
rfrence. Ce florin d'or pur se reconnat comme
monnaie pure au nom et l'effigie, nom et effigie
qui sont signes de vrit. Mais ce pouvoir de
signifier appartient naturellement celui qui a
autorit pour authentifier le signe, c'est dire le
prince. Le prince se rend coupable s'il corrompt le
signe. Le florin d'or est marqu l'effigie de
Jean-Baptiste. Cette effigie comme signe est donc le
rappel d'un ordre divin sauvegarder. Lorsque la
monnaie est falsifie, le rapport authentique du
signe et de la matire est dtruit. Le symbole,
perverti en fiction, cre une image d'intgrit sous
laquelle s'imbriquent tous les abus de la fraude.
La fraude falsifie donc la vrit de la monnaie et du
mme coup elle falsifie la monnaie de la vrit. La
monnaie de la vrit c'est une chose sainte. Elle
adultre donc l'ordre divin : elle adultre le
rapport Dieu, le rapport la source qui fonde
l'ordre naturel des valeurs.
Quant au sens symbolique maintenant, de la difformit
de Matre ADAM, on peut toujours, dans le mme
registre la prouver. La chose publique, de tout temps
a t compare un corps - le corps social, qu'on
emploie mme maintenant - et les effets que provoque
sur ce corps le gonflement dmesur des richesses
abusives du prince conduit des images de
difformit. Le prince est un membre de ce corps. Il
devient une sorte de monstre, dmesurment gonfl,
gonfl au dtriment du reste du corps, c'est dire
de la communaut. Il en rsulte une disproportion
monstrueuse de cette communaut.
191
Et la difformit de Matre ADAM, cette hydropisie,
une hydropisie telle qu'il a un norme corps, une
norme panse. Cette panse remonte devant ses yeux,
donc elle fait un cran devant ses yeux, elle
l'aveugle - cette panse est pleine d'une eau qui est
stagnante des richesses du prince. Stagnante, elle se
corrompt. Stagnante, elle ne peut plus circuler dans
le reste du corps de Matre ADAM et elle entrane
donc cette scheresse de la bouche o les lvres sont
figes. Elle entrane cette soif constante et
galement, cette maigreur des membres infrieurs qui
ne peuvent plus soutenir matre ADAM,[] cette norme
panse aveugle.
En tenant compte de ces remarques, on peut se
demander ce que reprsente Matre ADAM, que
reprsente Sinon et que reprsente cette rixe, c'est
dire quel est le rapport entre Matre ADAM et SINON
qui se termine par cette merveilleuse allusion.
Tout d'abord Matre ADAM .
La scne se droule donc dans la perspective de la
malice latente d'o est sorti l'art frauduleux du
premier homme. Ce mal, propre l'homme,
l'hydropisie, donc, le symbolise. C'est une maladie
de l'eau, une perversion de l'homme la source et
c'est une maladie pesante qui immobilise dans une
position grotesque ADAM . L est la marque de son
impuissance radicale. L'image des ruisseaux du
Casentin. Le Casentin est un lieu proche de Romena et
Romena est le lieu de la faute. C'est l qu'ADAM a
falsifi sa monnaie. Cette image de cette source
anantie dans son reflet tourmentent ADAM, et le fait
est que, pourtant, il est prt sacrifier cette
image pour voir ses instigateurs. Il est prt
sacrifier ce reflet pour voir le prince, c'est dire
celui qui est cause de sa destruction spirituelle,
c'est dire la malice elle-mme. Et le dsir de la
vue de la malice n'a d'gal que l'impuissance
radicale d'ADAM voir cette ombre puisqu'il ne peut
pas se mouvoir.
192
Si on rappelle que le propre de la malice est sa
latence, on comprend bien que ce qu'ADAM poursuit
- le principe du mal, prfrable la source qui
dsaltre - se drobe, et que ce n'est rien d'autre
que le refus d'tre, donc la drobade radicale.
Et Matre ADAM le porte en lui. Il le porte en lui
comme un vide gonfl en rve d'absolu. Et ce que son
dsir poursuit, ce n'est rien d'autre, en fin de
compte, que Matre ADAM lui-mme, au regard duquel
chappe pour toujours le principe du mal comme
l'Autre de l'absolu.
En sacrifiant la monnaie - chose sainte - la faute a
donc provoqu la perversion du signe, mtamorphos en
fiction le symbole, souill la source de justice,
falsifi le lien d'amour entre les hommes tel qu'il
est voulu par Dieu. Il y a donc eu un choix. Mais ce
choix nanmoins, c'est quand mme l'amour mais un
autre amour. C'est celui que l'homme reporte
entirement sur soi par le dtour d'une image, image
qui feint l'amour pour autrui. C'est une doublure de
l'absolu - qui manque - par un absolu fictif.
Voil pour Matre ADAM.
Maintenant qu'en est-il de SINON ?
En falsifiant l'indicateur du principe divin, Matre
ADAM engage toute la communaut dans une aventure de
l'tre et de l'apparence. C'est ce qui ressort des
paroles de Sinon. SINON dit ceci :
et si je parlais faussement, eh bien toi, tu faussas la
frappe et je suis ici pour un seul crime, et toi pour plus
de crimes qu'aucun autre, ft-il dmon.
SINON entre en scne alors que la monnaie, parole de
vrit est dj falsifie. C'est du produit de Matre
ADAM qu'il va faire usage : dans la falsification de
la parole de vrit. SINON, lui, il n'y est pour
rien. Il entre en jeu au niveau des effets de l'acte
de Matre ADAM. La parole pervertie a entran une
falsification illimite du langage et c'est du
langage que Sinon abuse.
193
Le crime de SINON c'est de s'tre donn pour un
dserteur du camp grec et d'avoir dcid les Troyens
faire entrer le cheval de bois dans leur ville. En
principe c'est a. Ce qui le prsente donc comme un
fourbe et un fourbe par tactique. Mais son crime est
double. C'est la fourberie par tactique, mais il est
galement impliqu - l'instar du crime de Judas -
comme parjure dans un dlit de notorit universelle.
Il est le simulateur qui feint d'tre ce qu'il n'est
pas et un parjure parce que le langage dont il abuse,
est une offense envers les dieux.
Le rapport, maintenant entre Matre ADAM et SINON.
SINON occupe une position trs particulire dans
cette scne. Il est accol d'une manire trs troite
l'hydropique et il semble mme faire corps avec
lui. Matre ADAM ne peut l'apercevoir et Matre ADAM
ignore mme l'origine d'un tel voisinage. Tout se
passe comme si, une fois mise en circulation, la
fausse parole - tout comme la fausse monnaie -
ressemble tellement l'authentique que la vraie
devient mconnaissable et invisible. Le signe, qui
porte garant, efface dans sa lgalit apparente les
traces de son origine suspecte, tant et si bien que
le faux monnayeur lui-mme, n'est pas capable
d'identifier les produits de son artifice.
Et la rixe clate au moment o Sinon s'entend
prsent par Matre ADAM sous le qualificatif de
fourbe. Matre ADAM dit :
le fourbe, SINON le Grec de Troie.
Il s'entend, donc, d'une part, dnonc aux yeux du
monde, et d'autre part, il s'entend dnonc dans
l'attitude de sa latence. Et dans l'altercation au
rythme extraordinairement rapide, tour tour les
deux simulateurs se placent en posture d'accus et
d'accusateur, ne reconnaissant nullement, dans la
malice de l'autre leur propre simulation, et mme
jouant le jeu de la vrit. Le mot vrit revient par
trois fois dans la bouche d'ADAM.
194
Tout ceci semble symboliser deux phases du mouvement
d'auto-fascination de la conscience frauduleuse.
D'une part Matre ADAM, bien que riv une image
d'eau, image qui n'a pas pour lui de pouvoir autonome
puisqu'il prfre ce reflet la vision du principe
du mal, et d'autre part Sinon, que le principe du mal
ne peut intresser puisqu'il ne se sent pas
responsable de cette perversion. Lui, SINON, il n'a
donc rien prfrer une image d'eau.
La source, anantie dans le langage qu'il a feint,
fait si bien recette sur cette fiction qu'elle
acquiert un pouvoir autonome pour Sinon.
Pour Sinon la vraie source est devenue cette eau en
image dont la conscience qui rve est capable de
s'abreuver. D'o la rflexion de Matre ADAM SINON
que pour lcher le miroir de Narcisse, il ne faudrait
pas pour t'y inviter beaucoup de paroles.
SINON reprsente dans le mouvement de la fraude, le
point culminant, la perversion radicale o la malice
enferme le falsificateur dans son image devenue pour
lui la vrit mme. Image de rien. On peut
probablement dire que c'est l'absolu de cette image
que le pervers est fix.
Ce qu'il en est de DANTE dans cette histoire, DANTE
le raconte lui-mme. Il est fascin par le spectacle
de l'altercation : il est fascin par les images de
l'enfer. Et pour rompre l'adhsion de son regard
l'erreur, il faut l'intervention de la voix de
VIRGILE. VIRGILE dit : or donc, prends garde !
De ces images DANTE a se dtourner.Ne pas prendre
ces images pour la ralit, et apprendre se
dtourner tel est le sens que VIRGILE donne au chemin
que DANTE parcourt avec lui : prendre garde ce
danger de capture, c'est veiller la vrit.
DANTE en effet s'veille mais il lui faudra plus
qu'une mise en garde pour s'veiller vraiment.
195
Voil le texte dans la traduction de Madame
ESPINASSE-MONGENET
74
.
C'est DANTE qui parle :
- Je me tournais vers lui plein d'une telle honte
- qu'elle vit encore en ma mmoire
- Et pareil celui qui rve son dommage,
- et rvant, souhaite rver
- si bien qu'il dsire ardemment ce qui est, comme si cela
n'tait point
- tel je me fis, ne pouvant pas parler,
- car j'eusse souhait m'excuser et je m'excusais
- en vrit, tout en ne croyant point le faire. [XXX, 134]
La voix de VIRGILE amne DANTE la vrit, et ce,
dans la honte. Mais cet veil est bref. N la
vrit dans la honte, DANTE s'arrte. Il s'arrte
pour rflchir la honte en voulant l'exprimer.
En voulant parler pour s'excuser, DANTE cesse de voir
la ralit qui parle par elle-mme dans le silence de
la honte. Et son dsir d'expression fait qu'il
mconnat cette vrit mme au moment o elle
s'accomplit. Il tombe nouveau dans la rflexion
brise qu'il assimile un sommeil. Cette comparaison
fixe, en quelque sorte, l'impuissance radicale de la
raison jamais retrouver par elle-mme la vrit.
DANTE le dormeur, dsire ce qui est comme si cela
n'tait pas. Le fait rel, savoir la vrit parlant
par elle-mme travers la honte, est transmue en
irrel, l'impossibilit de parler. La ralit est
prise pour l'irrel. VIRGILE intervient toute
vitesse ce moment-l et il dit :
Moins de honte efface un manquement plus grave,
[]que ne l'a t le tien. C'est pourquoi, de toute
tristesse, allge-toi. [XXX, 142]
74 Dante, La Divine Comdie : L'Enfer, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1922, traduction nouvelle et notes de Louise
Espinasse-Mongenet, prface de Charles Maurras.
196
De tristesse il s'agit. Et l, VIRGILE met l'accent
sur ce qui, par del la honte, pse sur DANTE, un
rsidu de pesanteur, un rsidu de mauvais dsir.
Cette dernire intervention semble avoir plus que la
valeur de mise en garde de la premire. On pourrait
peut-tre la dire, l'assimiler une intervention.
En tout cas, il en apparat que la conscience
originellement mordue est incapable - livre elle
mme - de ragir contre le mauvais dsir, la basse
envie. DANTE clt ce chant XXX par ces paroles de
VIRGILE. Il pose VIRGILE en quelque sorte comme
mmoire de prsence. VIRGILE dit :
Et dis toi bien, que je suis toujours ton ct : s'il
arrive encore que le hasard te mne en quelque lieu o se
trouvent des gens en semblable litige, vouloir our de
telles choses est une basse envie.
Peut-tre peut-on rapprocher la place qu'occupe
VIRGILE de celle de l'analyste ?
- La deuxime allusion au mythe de Narcisse est
celle-ci dans Paradis, au Chant III.
La scne se passe dans le ciel de la lune.
Batrice vient de dtruire l'opinion errone de DANTE
sur les tache lunaires. DANTE se dispose, ce
moment-l confesser son redressement et sa nouvelle
conviction. Voil ce que DANTE dit :
Et moi, pour confesser que corrig et persuad je l'tais
bien, autant que me le permit ma rvrence, je levais haut la
tte afin de mieux parler.
Mais une vision appart, qui retint elle mon attention si
troitement par son aspect que, de ma confession, je ne me
souvins plus.
Tel d'un cristal transparent et limpide ou de la surface des
eaux pures et tranquilles non assez profondes pour que les
fonds en soient obscurcis nous reviennent les traits de notre
visage si affadis qu'une perle sur un fond blanc n'arrive
point brlante nos prunelles, telles, je vis plusieurs
figures prtes parler, ce qui fut cause que je courus
l'erreur contraire celle qui fit natre l'amour entre
l'homme et la fontaine.
197
Aussitt, dans l'instant que je m'aperus de leur prsence,
estimant que c'tait l le reflet de visages vus en miroir,
pour voir qui ils appartenaient je tournais mes yeux en
arrire.
Mais je ne vis rien.
Et je les reportais devant moi droit aux yeux de mon doux
guide qui, souriant, avait une flamme en son saint regard.
DANTE se disposait confesser son redressement, mais
cependant il n'a pas parl. Le geste de porter le
visage en avant change d'intention devant une vision
qui s'impose avec tant de force que DANTE en oublie
sa confession. DANTE aperoit plusieurs visages qui,
comme lui, sont prts parler. Croyant apercevoir
des images de miroir, il tourne la tte en arrire
pour voir de qui elles proviennent et ne voyant rien,
il reporte les yeux en avant, droit dans le regard de
Batrice.
Dans le Chant II qui prcde, Batrice avait donc
expliqu DANTE ce que c'tait que les tches
lunaires et elle avait dit DANTE que ce qui, sur la
lune, lui apparat comme ombre se rvle en vrit
tre aussi lumire, mais lumire qui se diffrencie
de la partie proprement lumineuse de la lune par un
degr de rceptivit, ou plutt de transparence - je
crois que le terme de transparence convient mieux -
un degr de transparence moindre. Alors, ombre,
comprise comme lumire et toujours prsente comme
lumire apparaissant sur un fond lumineux, ce fond
tant la mesure qui rend sensible leur diffrence, et
possible leur apparition.
Les ombres, les mes du paradis, sont - bien entendu
- comprises aussi comme lumire, et c'est la
lumire divine qu'elles s'allument et laissent passer
les rayons sans les arrter. DANTE symboliserait Dieu
par un miroir o se refltent les mes du paradis.
Enfin c'est la conviction de DRAGONETTI.
Non pas par un miroir tam mais un miroir dont le
fond demeure entirement lumire. Les ombres, les
images transparentes apparaissent dans le royaume de
la lumire et l, la rflexion est considre de
manire diffrente de la rflexion terrestre.
198
La rflexion est conue comme action de rayonnement
direct de la lumire divine travers la transparence
des corps clestes et non pas comme rflexion des
rayons produite par des corps dont l'opacit fait
cran cette lumire.
DANTE prcise bien que la surface plus ou moins
spculaire sur laquelle apparat sa vision est
semblable celle d'un cristal ou celle d'eaux dont
le fond n'est pas obscur, dont le fond n'est pas
drob. Fond obscur et fond drob, c'est le tain du
miroir de Narcisse. Ici le fond est lumire. Ce n'est
mme pas qu'il n'y a pas de fond. Le fond est quelque
chose, et il est lumire. Il ne s'agit donc pas de
miroir sur le modle terrestre : il s'agit de
transparence pure, de miroir
75
sur le mode cleste.
De plus, il y a deux sortes d'images qui sont
apparues : il y a les figures prtes parler et il y
a les figures mires. Et ces images jouent l'une dans
l'autre de manire donner l'impression que les
figures mires - les visages des spectateurs - se
mlent aux visages prts parler.
DANTE se retourne pour rompre le sortilge du miroir
et il rvle du mme coup, dit DRAGONETTI, quel
degr il est conscient de l'erreur qui pervertit
pareil rapport aux images. DANTE a port sur la
vision un regard captif de son reflet, et tel, qu'il
a chang la transparence en spectacle.
Ce que DANTE dnoncerait comme :
l'erreur contraire celle qui enflamma d'amour l'homme
pour la fontaine
c'est dans le refus de la raison sur elle-mme
d'avoir fait disparatre la ralit dans une image.
A l'appel de la vision, DANTE rpond par le
redressement spontan du regard en direction des yeux
de Batrice. Pour DRAGONETTI, Batrice serait la
vrit rvle qui dtourne DANTE de la fascination
d'une raison trop rassure sur sa droiture.
75 Cf. D.R. DUFOUR, LACAN et le miroir sophianique de BOEHME, Cahiers de lUnebvue,1998, E.P.E.L.
199
Et au regard de DANTE sur la transparence - le
devenir transparent de ce regard lui-mme -
DRAGONETTI dit que voir serait intrioriser la raison
dans la foi. Le danger qui guette DANTE est que sa
raison face la transparence, soit tente de la
reprsenter au lieu de s'y prsenter.
La raison qui veut rduire la foi une image de la
rflexion terrestre ne mriterait plus alors ce nom
parce que non seulement elle transforme son objet qui
est essentiellement lumire en ombre, mais que coupe
de la vraie lumire, cette raison qui devrait tre
transparente, dvient alors ellemme ombre projete
sur les choses. En cela, je pense que DRAGONETTI voit
un DANTE dont le monstre s'incline sous le mythe de
Narcisse.
Mais cette interprtation de DRAGONETTI peut-tre
peut-on ajouter ceci que, au sein de la transparence
du paradis nulle possibilit d'tre partie prenante.
Remettre Dieu la cause de son dsir est la seule
voie possible. Peut-tre estce l le fantasme de
DANTE, la transparence de son regard face la
lumire de Dieu.
Enfin au Paradis, il y a Dieu. Tout est lumire et la
lumire vient de Dieu. La lumire c'est le regard de
Dieu. Et, entre Dieu et DANTE, il y a Batrice,
Batrice qui n'est pas Dieu, qui n'est pas non plus,
je crois, la vrit rvle de DRAGONETTI mais
Batrice qui porte la marque de Dieu.
Puis il y a, toujours entre Dieu et DANTE la vision
de DANTE sur laquelle il a coll des figures mires.
C'est de ces figures mires quil a rompu le
sortilge en se retournant, ce n'est pas de la vision
elle-mme : la vision elle-mme prexistait ces
figures mires.
Cette vision, ce n'est pas la vision de n'importe
quoi, c'est la vision d'mes qui par contrainte
manqurent leurs voeux de chastet. C'est la vision
de cratures de Dieu.
Puis il y a DANTE.
Or, au Paradis la rflexion est conue comme action
de rayonnement directe de la lumire divine travers
la transparence des corps clestes.
200
En face de Dieu, dans le champ du regard de Dieu, la
seule prsence qui ne soit pas transparente, c'est
DANTE, peut-tre la terre, un fond obscur. Alors,
plutt que du narcissisme de DANTE, ne s'agirait-il
pas galement du narcissisme de Dieu ?
LACAN
Vous avez eu un compte-rendu trs fidle de cet
article de DRAGONETTI. Pour ceux qui - peut-tre - se
seraient perdus travers la fidlit mme des
dtours que suit cette occasion DRAGONETTI, je vais
essayer de reprendre, une fois de plus, et rsumer ce
dont il s'agit. En mme temps que, comme je l'ai
annonc, je montrerai l'intrt qu'a pour nous une
pareille rfrence.
Notre dpart de cette anne a t de rendre cohrent
ce que nous avons noncer de la fonction de
l'objet(a) dans la position de la psychanalyse en
tant qu'elle s'origine de la science et de la science
dans son rapport trs particulier la vrit. La
science tant entendue comme la science moderne, ne
au XVII
e
sicle, au sicle qu'on a appel, en raison
de cette mutation de la position du savoir, le sicle
du gnie. Vous verrez que nous allons venir tout
l'heure une des autres faces de cette apparition de
la position scientifique en tant qu'elle a t
minemment incarne par un autre que Descartes. Vous
verrez tout l'heure lequel si vous ne le devinez
dj.
Il y a donc l une transformation profonde de quelque
chose qui n'est pas ternel, qui rpond un autre
champ, un autre intervalle de l'histoire, savoir
le rapport antrieur l'origine de la science, ce
qui s'inscrit sous la forme - que je ne qualifierai
pas de plus gnrale et que j'ai qualifie
d'antrieure - des rapports du savoir et de la
vrit. Ces rapports du savoir et de la vrit c'est
toute la tradition que nous allons appeler, pour une
plus grands commodit, philosophique.
201
C'est dans ce cadre topologique que se situe la
position d'un DANTE.
N'allons pas trop vite. Je ne dis pas que DANTE soit
un philosophe
encore que son rapport la philosophie soit tel
qu'il ait pu tre suivi, isol, dans tout un
ouvrage par exemple de Monsieur Etienne GILSON
qui a pour titre prcisment :
DANTE et la philosophie et qui tient sa promesse en
nous montrant l'instance, scandant la vie et
l'uvre de DANTE
notre topologie, ici, au sens o je l'entends, o je
la manie, o je vous y introduis, n'a pas d'autre
fonction que de permettre de reprer ces
transformations des rapports du savoir et de la
vrit. Si DANTE est ici choisi par nous aujourd'hui,
pour vous tre prsent, l'intrieur de sa cration
potique la plus minente, celle de La divine comdie
c'est pour une raison qui nous le dtermine en deux
temps (si l'on peut dire) ce choix :
Premirement, il y introduit la prsence de la
construction religieuse chrtienne et la thse
latente, disons, dans ce choix, est celle-ci : qu'
l'origine de la tradition religieuse chrtienne, il y
a cette introduction dans le champ des rapports du
savoir et de la vrit dun certain Dieu
auquel nous arriverons tout l'heure pour le
dfinir dans son origine - dans son origine juive
- en tant que sa prsence est le point de
cristallisation de cette mue fondamentale pour
nous, inaugurale, qui est celle mme de
l'introduction de la science.
Je dis - je l'ai dj suffisamment indiqu - je le
rpte ici avec plus de force et je vais le motiver
tout l'heure, l'introduction de ce dieu des Juifs
est le point pivot qui
quoique rest pendant des sicles en quelque
sorte enrob dans un certain maintien
philosophique du rapport de la vrit et du
savoir
202
finit par merger, par venir au jour, par la
consquence surprenante que la position de la science
s'instaure du travail mme que cette fonction du Dieu
des Juifs a instaur l'intrieur de ces rapports du
savoir et de la vrit.
[Deuximement] Ceci ne suffirait pas nous faire choisir
DANTE puisque aussi bien, tout thologien de l're
mdivale et pu nous servir de mme d'exemple pour
situer ce qu'il en est dans la tradition
philosophique des rapports du savoir et de la vrit.
DANTE est en outre un pote, et je vais essayer de
vous dire comment c'est en tant que pote, qu'il
manifeste d'une faon non seulement minente mais
choisie, l'mergence, le point analytique o, dans ce
qu'il nonce, se manifeste plus qu'il n'en sait, et
o il tmoigne d'une certaine faon - que je vais
maintenant situer, je veux dire donner les raisons
pour lesquelles il peut en tmoigner - o il tmoigne
d'une faon en quelque sorte anticipe pour nous, de
la prsence dans ces rapports du savoir et de la
vrit, de ce qui, proprement cette anne, est par
moi promu comme la fonction de l'objet(a). C'est
l'intrt en effet de ces deux passages en tant
qu'ils sont choisis, signals par les critiques chez
DRAGONETTI, qu'ils sont signals par la prsence du
miroir qui nous permet, nous d'y reprer la
dsignation manifeste et comme telle de l'objet(a)
qui a nom ici : le regard.
Reprenons.
DANTE, bien entendu, loin d'chapper, tombe tout
fait vous en savez - mme si vous ne l'avez presque
jamais ouvert - vous en savez assez sur Divine Comdie,
pour savoir que cette uvre sinscrit dans ce que
j'appelle le module cosmologique, cosmologie de l'au-
del - ce n'en est pas moins une cosmologie - et qui
emprunte ses cadres la cosmologie tablie, disons
partir des premiers philosophes grecs, porte son
premier modelage par ARISTOTE et transmise comme une
forme, comme un cadre, la pense des physiciens du
temps.
203
Le systme Ptolmaque par exemple, tout limit qu'il
soit l'observation du fonctionnement du monde rel,
tel qu'il se prsente, c'est dire pour rendre
compte des rapports du mouvement des astres et
l'instituer comme cohrent avec l'existence de ce
monde qui est celui du monde terrestre
qui s'ordonne, vous le savez, en fonction de
cette topologie de la sphre, d'une srie de
sphres s'incluant les unes les autres, qui sont
les diverses sphres plantaires avant d'arriver
la sphre suprieure, les toiles fixes. Il
s'agit de rendre compte de leur fonctionnement
tel est le dpart de la physique antique et c'est
l-dessus que nous pouvons - en somme, qualifier
d'introduction une science comme telle dans la
connaissance humaine - c'est l-dessus que nous
pouvons qualifier les Anciens comme ayant fait les
premiers pas historiquement recevables,
transmissibles, et qui ont servi de premire matire
la rvolution qui a t appele la rvolution
copernicienne (introduction elle-mme, de celle,
toute diffrente de la rvolution newtonienne).
Ce monde cosmologique qui inclut aussi des
coordinations des diverses parties de l'enseignement
disons, de l'universitas ,c'est l le point de
rfrence fondamental, le cadre dans lequel s'est
dvelopp ce qui a t enseignement jusqu' une
certaine date. La cosmologie donc avec ses
coordonnes, (psychologie, thologie, voire
ontologie) c'est dans ce cadre que se situe la pense
de DANTE.
Qu'est-elle, sinon de nous prsenter un premier
clivage de la vrit et du savoir ?
Et c'est bien en effet ainsi que toute la pense
mdivale
qui loin d'tre une pense ngligeable, en
quelque sorte rejeter, quelque radicale que je
vous prsente la coupure instaure par la
naissance de la science moderne
204
est pour nous clairant de cette topologie dont il
faut que nous tenions compte dans la situation qui se
rinstaure du fait de la question pose par
l'exprience analytique, cette thmatique
d'opposition entre la vrit et le savoir est
inscrite pendant tout le dveloppement de la pense
mdivale, dans ce qu'on a appel la doctrine de la
double vrit.
Nul penseur, nul enseignant de cette poque n'a
chapp la question de la double vrit. C'est le
vritable fondement de ce clivage qui devait tre
fait ncessairement par les enseigneurs de cette
poque entre le champ de la raison et celui de la
rvlation.
Ce n'est pas autre chose que ceci :
- qu'il y a un champ prtendu du savoir constructif,
dans l'idal : dductivement, concernant la structure
du monde,
- et puis autre chose que nous ne connaissons que de
source surnaturelle et de par la parole de cet Autre
qu'est Dieu.
Cette distinction est si fondamentale dans la
structure de tout ce qui s'est nonc cette poque
que nous devons rendre hommage l'minente
rationalit de la pense de ceux que j'appelle ses
enseigneurs pour ne pas les appeler de ce nom
dprci : les scholastiques.
Admirons la fermet de la raison de ces gens qui -
soi-disant pris dans les suggestions qui ne sont plus
pour nous qu'obscurantistes, qui nous viennent de la
religion, ne les ont empch de maintenir les droits
de la stricte raison.
Ai-je besoin de rappeler que Saint THOMAS - si mon
souvenir est bon, encore aprs - je n'en suis pas
sr, mais peu importe - en rfrence (c'est l le
point de rfrence pour nous) la condamnation de
l277 manant de la Sorbonne, de l'vque TEMPIER, qui
le condamne, prcisment d'avoir soutenu aux dires
des autorits ecclsiastiques, plus loin qu'il ne
convient la conscience chrtienne, la distinction
205
de ces deux domaines, se trouve assimil dans la mme
condamnation aux averrostes et l'enseignement par
exemple d'un SIGER de BRABANT, dont pourtant il se
distinguait par toutes sortes de modalits.
Nanmoins ceci n'a pas empch Saint THOMAS d'crire
ceci dont vous connaissez au moins le titre :
De ternitate mundi contra murmurantes
76
C'est dire contre ce qui dj devait provoquer sa
condamnation, savoir : de maintenir que du point de
vue de la stricte raison le monde devait tre
ternel, et que seule la rvlation nous indique
qu'il n'en est rien.
Cette distinction de la vrit et du savoir n'est-
elle pas ici pour nous rappeler que dj toute
l'organisation du savoir, du savoir en tant que
support par ce corps , qui jusqu' l'inauguration
de la position de la science moderne s'impose comme
celui qui peut tre dit du savoir - savoir le
corps cosmologique, thologique, psychologique,
ontologique - que ce corps se pose comme ce mode
d'approche ambigu qui est en mme temps foncier
loignement de ce qu'il en est de la vrit. Je dirai
presque que le savoir, pendant des sicles est
poursuivi comme dfense contre la vrit.
La vrit
si vous voulez, pour vous le faire sentir
tant ici reprer, registrer, comme la question
sur le rapport le plus essentiel au sujet, savoir
son rapport la naissance et la mort en tant que
tout ce qui est de lui est dans leur intervalle.
Ceci est la question de la vrit au sens o je
dfinis, la vrit comme celle qui dit :
Moi la vrit je parle
77
.
C'est de ceci, c'est de nos fins dernires que la
vrit a nous dire quelque chose.
76 Thomas DAquin, De ternitate mundi contra murmurantes, Opuscules, 1270. Sur L'ternit du Monde, les erreurs des
philosophes, in Thomas d'Aquin et la Controverse sur l'ternit du monde, Garnier Flammarion, 2004.
77 crits, p 409 ; ou t.1 p 406.
206
Observez qu'ici l'nonc du terme mme d'intervalle
et la mtaphore, mme potique, du sombre bord est l
pour nous rappeler le terme mme - topologique,
proprement parler - celui que je dsigne comme la
fonction du bord. Tout se passe comme si - pour
prendre notre rfrence, qui n'est pas une mtaphore
- dans l'opposition de la logique moderne entre
l'ensemble ouvert et l'ensemble ferm, le savoir
pendant des sicles n'avait gard (et aussi : bien
gard) la trace de choisir uniquement la part de
l'ensemble ouvert.
Vous savez ce que c'est qu'un ensemble ferm : c'est
ce qui est conu comme unissant l'ensemble ouvert
avec sa limite, en tant que topologiquement elle en
est distingue.
Limite, frontire, bord, tels sont les termes dont il
s'agit. La part de la vrit c'est celle de notre
limite entre la naissance et la mort - limite en tant
que sujet - et tout ce qui est du savoir c'est
l'ensemble ouvert qui est compris dans l'intervalle.
C'est en ceci que le pote (quoi qu'il en ait et mme
s'il ne le sait pas) rintroduit - ds lors que ce
qu'il sait et manipule c'est la structure du langage
et non pas simplement la parole - l rintroduit
(quoi qu'il en ait) cette topologie du bord et
l'articulation de la structure.
C'est ce par quoi DANTE, ici, va au-del de ce qu'il
emprunte la structure du savoir de son temps, et
justement dans la mesure de cette ambigut,
introduite du fait qu'il projette les formes
cosmologiques du savoir de son temps dans le champ de
ce que j'appelle les fins dernires.
C'est d'avoir fait de la cosmologie de son temps, ce
qu'il entend chanter : l'au-del du savoir, le champ
propre de la vrit, qu'il vient faire saillir en
deux points
dans le choix par un commentateur quun
commentateur - sans doute guid, clair d'tre
situ dans l'poque moderne - nous permet de
reprer en deux points
(l'un de l'enfer l'autre du paradis),
207
des constellations que je qualifierai de typiques,
qui sont proprement celles :
- du rapport qui lie la parole en tant que se situant
au champ de l'Autre comme support de la vrit
- et l'mergence ncessaire des coordonnes de
l'objet(a)que, au mme point - point dont on ne vous
a pas tout l'heure signal assez prcisment la
profondeur - au mme point le plus profond de l'enfer
se trouve conjoints celui qui a fait de la parole le
support d'une tromperie [SINON] et celui qui a fait la
fausse monnaie [ADAM].
Quelle trange conjonction, quelle ncessit
singulire pour lesquelles il nous faut invoquer la
double vue potique, c'est que DANTE assurment, dans
la seule lecture de ce pome marqu de tant
d'trangets, nous impose l'ide qu'il sait ce qu'il
dit, si trange que nous paraissent tout instant
ces excs au regard de notre sens commun.
Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard, que
sont conjoints pour dialoguer - dans cette sorte de
singulire treinte - celui qui fondamentalement a
menti
et non pas de n'importe quelle faon, n'a pas
simplement menti, n'a pas simplement fraud, on
vous l'a dit tout l'heure, mais a fraud en
trompant la confiance de l'autre
cette conjonction du mensonge comme atteinte la
foi avec le fait de la rfrence de ce quelque chose
- qui est non pas vrit mais valeur de vrit -
cette chose dont il est si ncessaire d'introduire la
rfrence quand il s'agit de la vrit que, quand
HEIDEGGER nous propose le vom Wesen der Wahrheit,
c'est de la pice de monnaie que lui aussi parle
78
.
Qu'est-ce que veut dire une pice de monnaie fausse ?
Est-ce que la fausse pice de monnaie n'est pas aussi
quelque chose qui est. Elle est ce qu'elle est. Elle
n'est pas fausse. Elle n'est fausse qu'au regard de
cette fonction qui conjoint la vrit la valeur.
78 HEIDEGGER, De lessence de la vrit,Op. cit., p 161-194 .
208
C'est bien pourquoi ce dont il s'agit autour de
l'objet(a) c'est cette fonction de la valeur de
vrit.
C'est ici qu'il est frappant, singulier, de voir que
DANTE - dans cette dispute de charretier qui
s'tablit entre les deux damns - fait surgir de la
bouche de l'un - prcisment du faux monnayeur,
s'adressant au tratre - qu'il serait encore bien
content sil pouvait accder cette forme de
mconnaissance qui serait de lcher le miroir de
Narcisse, c'est dire de se croire au moins tre
lui-mme, alors que ce dont il s'agit c'est
prcisment, comme en vous l'a articul fort bien
tout l'heure, que jusqu' cette essence de lui-mme
qui est d'tre menteur, il l'a perdue, et qu'il ne
peut plus retrouver aucune forme de son tre, qu'
dsirer passionnment retrouver en face de lui, celui
qui l'a entran dans son foncier mensonge.
De mme, arrivant au paradis, ce que DANTE appelle
l'erreur contraire celle de Narcisse c'est,
s'apprhendant quelque chose qui se prsente pour
lui comme un apparatre, de ne pas pouvoir faire
autrement que de se retourner pour voir de quoi ce
qu'il voit est l'image.
Ainsi lui-mme, DANTE, nous livre que ceci qui se
produit la limite o il entre dans le champ de
Dieu, nous propose des objets qui sont proprement
parler ce que je dsigne comme des objets(a). Dans le
champ de Dieu, en tant que c'est de lui qu'manent
les substances, rien de ce qui est objet ne se
prsente comme opacification relative (en quelque
sorte) d'un pur regard, une transparence sur fond de
transparence, et que cette apparition ne peut tre
reconnaissable pour la pense de la rflexion - comme
on dit - qu' chercher, se retournant derrire soi,
o peut bien tre l'original.
209
Il m'est arriv dans un temps d'crire ces phrases :
Quand l'homme cherchant le vide de la
pense s'avana dans la lueur sans ombre de
l'espace imaginaire en s'abstenant mme
d'attendre ce qui va en surgir, un miroir
sans clat lui montre une surface o ne se
reflte rien.
79
Le pige de cette phrase qui conclut l'un des
chapitres du Discours sur la causalit psychique
c'est que cela a l'air de vous dire qu'il n'y a pas
d'image, alors que cela veut dire que l'image ne
reflte rien, dsignant l dj ceci que le texte de
DANTE accentue et qui est proprement ce dont je vous
dis que le (a) n'est pas spculaire.
En effet, quand il apparat sur le fond transparent
de l'tre, c'est justement la fois d'apparatre
comme une image et une image de rien.
C'est ce que DANTE accentue dans cette seconde
apparition, de la rfrence du miroir, savoir que
l o il croit qu'il y a en fonction du miroir, ce
n'est que pour s'apercevoir que quand le (a)
apparat, s'il y a miroir, il n'y a rien qui s'y
mire.
Telles sont les structures que la construction
potique de DANTE met au jour, et s'il le peut c'est
parce qu'il est pote et que, tant pote, ce qu'il
rejoint, ce n'est pas tant notre science que ce que
nous sommes en train de construire pour l'instant, et
que j'appelle la thorie.
Le privilge de cette construction potique par
rapport la thorie
la thorie psychanalytique si vous voulez, pour
nous la thorie tout court
tient ceci d'une relation privilgie qui est
construite, travers une certaine forme d'ascse du
sujet l'Autre. Cette structure privilgie, je l'ai
dfinie l'anne o j'ai fait mon sminaire sur
l'thique.
79 crits p.188, ou t.1 p.187
210
C'est celle de l'amour courtois en tant que nous
pouvons y reprer d'une faon minente les termes
(I) : idal du moi,
(a) : l'objet(a), i(a) : image du (a) le fondement du
moi, et S.Cette structure privilgie
je ne puis ici, que renvoyer mon sminaire sur
l'thique ceux qui y ont assist
est lie ce quelque chose qui est l'amour courtois
et qui est tellement important pour nous, pour
rvler les structures de la sublimation.
Le centre de la vie de DANTE et de son uvre c'est,
comme le souligne fortement une tte aussi rassise
que Monsieur Etienne GILSON
80
, son choix de Batrice
et l'existence, l'existence relle de la personne
dsigne dans son uvre sous ce nom. C'est dans la
mesure o DANTE
comme la seule suite de son uvre le dsigne et
s'en origine dans la Vita Nuova
81
[ DANTE, La vie nouvelle ]
est un pote li la technique de l'amour courtois
qu'il trouve, qu'il structure ce lieu lu o se
dsigne un certain rapport l'Autre comme tel,
suspendu cette limite du champ de la jouissance que
j'ai appel la limite de la brillance ou de la
beaut.
C'est en tant que la jouissance - je ne dis pas le
plaisir - est soustraite au champ de l'amour courtois
qu'une certaine configuration s'instaure o est
permis un certain quilibre de la vrit et du
savoir. C'est proprement ce qu'on a appel, sachant
ce qu'on faisait, le gai savoir.
Et dans mille termes de ce champ ainsi dfini - o
les rudits se perdent faute de pouvoir y apporter la
moindre orientation philosophique - l nous trouvons
mille termes qui nous dsignent les rfrences
topologiques. Un terme trs minent par exemple
celui-ci, qui est employ pour rfrer la fonction
de l'Autre et de l'Autre aim, que la femme choisie
est celle [] ce qui nous parat paradoxal, mais
cest dans Guillaume IX d'Aquitaine : le bon voisin.
80 Dante et Batrice, Paris, VRIN, 2000.
81 DANTE, La vie nouvelle (vita nuova 1292-93), Paris, Gallimard Folio bilingue, 1999.
211
Ce Bon Voisin, pour moi - si j'avais le temps je
pourrai y insister - est l aussi proche que possible
de ce qui, dans la thorie mathmatique la plus
moderne s'appelle la fonction du voisinage : ce point
absolument fondamental instaurer, cette dimension
que j'ai introduite tout l'heure de l'ensemble
ouvert et de l'ensemble ferm.
Dans le dveloppement que j'aurai poursuivre sur le
sujet de la structure, celle que je ramnerai - aprs
l'avoir introduite l'anne dernire sous la forme
qu'elle a pour l'instant, c'est un fait, a s'appelle
comme a, c'est la bouteille de KLEIN - permettra de
structurer d'une faon dcisive, ce que j'entends ici
par ce rapport du sujet l'Autre.
C'est en tant que DANTE, pote courtois le rejoint,
qu'il peut faire les rencontres que je viens
maintenant, je pense il est trop tard en tout cas,
pour savoir si je l'ai atteint cette anne - dans la
suite vous me le prouverez - j'ai suffisamment repr
ce dont il s'agit.
Nous arrivons l'heure de deux heures et par
consquent, ce que je n'ai pas pu faire autrement,
tout l'heure que de vous annoncer - et ce dont je
me rjouis maintenant de ne vous avoir pas dit plus :
comme cela vous n'aurez pas trop le sentiment d'tre
frustrs - ce dont je voulais parler comme second
temps aujourd'hui, je n'ai pas le temps de le faire.
Je le ferai donc mon prochain sminaire et ce
titre, les gens qui sont invits au troisime
sminaire, seront donc invits cette foisci, du mme
coup au quatrime sminaire.
Table des sances
212
26 Janvier l966 Table des sances
STEIN CONT MELMAN AUDOUARD
LACAN
Mes chers amis, la question est de l'existence et du
fonctionnement de ce sminaire ferm.
Ce qui m'a dcid le faire, c'est que j'entends que
s'y produise ce qu'on appelle plus ou moins
proprement un dialogue. Ce terme est vague et on en
abuse beaucoup. Le dialogue tel qu'il peut se
produire dans le cadre que j'essaie de fonder de ce
sminaire ferm n'a rien de privilgi au regard de
tout dialogue.
Tout rcemment par exemple quelqu'un est venu me
demander quelque chose, ce quelque chose tait en soi
quelque chose de si exorbitant et impossible
accorder que je n'ai mme pas cru un instant que
c'tait a qu'on me demandait. Le rsultat c'est que,
concdant quelque chose que je pouvais tout fait
accorder, la personne qui tait en face de moi a t
convaincue que je lui accordais ce qui tait selon
son dsir et qui, je vous le rpte, tait tellement
hors des limites de la possibilit que je ne pouvais
mme pas penser que c'tait a qu'on me demandait.
Tel est l'exemple, facile rapprocher d'une foule de
vos expriences de ce que c'est qu'un dialogue. Il
est vident que tout dialogue repose sur un foncier
malentendu. Ce n'est tout de mme pas une raison pour
qu'on ne le provoque pas ne serait-ce que pour en
faire ensuite le bilan et en dmontrer le mcanisme.
J'ai assur, je pense la transition.
La dernire fois, vous avez entendu un travail fort
srieux et fort honnte qui a fort plu, la suite de
213
quoi j'ai fait des dveloppements trop brefs sans
doute au regard de tout ce que j'aurais pu apporter
sur ce sujet norme, qui revient en somme dire ce
qu'est la fonction du dsir dans La Divine Comdie.
Cette comdie, divine ou pas, je ne la recommencerai
pas aujourd'hui. Je veux qu'aujourd'hui la sance
soit remplie par les rponses, si courtes soient-
elles, que pourra voquer chez chacun de vous ce que
vous allez entendre.
Vous allez entendre quelque chose certainement de
trs soign. Tous ceux qui sont ici taient, je
pense, dj le dernier mercredi de Dcembre, ce
sminaire. Vous avez entendu un expos trs
remarquable de GREEN sur ce qui est actuellement issu
de ma dfinition de l'objet(a). Ce travail paratra,
et partir de sa parution, c'est--dire des textes
que vous pourrez tous avoir en main, sera repris un
des futures sminaires ferms. C'est du travail de
GREEN que je parle. D'autre part, vous avez eu une
prsentation de mon lve CONT, un certain nombre de
questions poses par mon lve MELMAN. Ces trois
travaux qui ont t trs prpars, ont suffi
remplir le quatrime mercredi auquel je fais
allusion, celui du mois de Dcembre.
Il est dans la ligne des choses - et de ce fait
promis - que vous entendiez aujourd'hui une rponse
de STEIN.
J'ai appris hier soir de lui - avec plaisir - qu'il
me demandait de parler plus d'une demi-heure - qu'il
parle tout le temps qu'il voudra une seule
condition : de manire laisser la moiti de la
sance pour les rponses qui, j'espre, se
manifesteront.
Je m'excuse donc auprs de lui si je m'engage comme
je le fais ne pas prendre la parole moi-mme
aujourd'hui.
Puisqu'il s'avre pour certains que c'est la prsence
mme de cette parole qui les met dans une position
ne pas vouloir - je rsume, c'est bien plus complexe
214
- s'exposer je ne sais quelle comparaison dont la
rfrence, une occasion semblable, me parat
absolument la limite de l'analysable, n'est-ce pas.
J'obtiendrai, ou je n'obtiendrai pas - mais il ne
s'agit pas, pour moi du tout, de la valeur du travail
que j'ai fait pour vous ici - j'obtiendrai donc ou je
n'obtiendrai pas qu'on intervienne. Je vous prie donc
maintenant de prter votre attention ce que va nous
dire STEIN qui je passe immdiatement la parole.
STEIN
Je prendrai pour point de dpart de mes rponses les
remarques trs prcises et trs pertinentes que CONT
a faites la dernire fois et du mme coup, je serai
amen rpondre un certain nombre de questions de
MELMAN pour ensuite relever un problme qui concerne
tout particulirement l'expos de MELMAN.
Je crois qu'au centre de la proccupation de CONT ,
propos des deux articles de moi qu'il a analyse se
trouvait cette notion de situation fusionnelle. C'est
sur ce que CONT relve ainsi qu'il insiste au
dpart et il cite deux phrases de moi, deux phrases
qui figurent dans le premier article.
L'une : il y a un unique a parlant et coutant
et la deuxime : le patient et l'analyste tendent
tre tous deux en un, en lequel est tout .
partir de l CONT note que de tels tats sont
rares. Il est ainsi conduit me demander :
l) si je rapporte ces tats une structure
nvrotique dtermine.
2) comment je situe ces tats par rapport
l'ensemble de la cure.
Arrtons-nous donc cette premire question de
CONT. La rponse que j'espre pouvoir vous fournir
215
servira dans une grande mesure de cl pour toutes les
autres questions et pour toutes les autres objections
qui m'ont t faites. Ma rponse pourrait tre la
suivante : il est vrai que je rapporte ces tats
une structure dtermine, une structure nvrotique
dtermine, mais cette structure dtermine concerne
tous les patients, l'ensemble de tous les patients
capables de transfert. Je dirai encore : Oui, je
rapporte tous ces tats une structure commune qui
dfinit cette catgorie, et que j'essaierai
d'lucider un peu tout l'heure. Je rpondrai non
s'il fallait prendre structure , structure
nvrotique au-sens strict du terme, c'est dire ce
qui distingue une forme de nvrose d'une autre.
Je ne pense pas que ces tats ne se rencontrent que
dans l'une des formes de nvroses que l'on peut
distinguer.
Quant l'ensemble de la cure, je dois dire que la
question est un peu plus difficile tant donn que
dans ces travaux - travaux que j'ai donns jusqu'
maintenant - l'ensemble de la cure n'est pas encore
pris en considration en ce qui diffrencie dans ses
phases successives. Ce n'est pas de a que j'ai
trait pour l'instant. Par contre il s'agit bien de
choses, de phnomnes qui se rencontrent d'un bout
l'autre de la cure, c'est dire que dans ce premier
stade, j'ai pris en considration quelque chose qui
est commun, qui concerne non pas la cure mais qui
concerne la sance analytique - quelle qu'elle soit -
c'est dire que j'essaie pour mon usage personnel -
en premier lieu d'ailleurs - de trouver des repres
qui soient valables pour la premire sance aussi
bien que pour la dernire dune cure.
Les rponses que je viens de donner ainsi CONT
sont en contradiction avec la notion que je
privilgie selon CONT , d'tats rares.
Je pourrais objecter cela : ou bien peu importe que
ces tats soient rares s'ils sont exemplaires.
Je pourrais aussi objecter cela :
Moi je les rencontre trs frquemment.
216
Vous ne manquerez pas de trouver que l'une ou l'autre
rponse serait trop subjective pour servir de base
une discussion. Ce caractre subjectif de ma rponse
serait encore accru si je vous rappelais qu'il s'agit
l d'tats limites qui ne sauraient tre raliss.
Ce qu'on peut percevoir cest que ce sont seulement
des tats qui peuvent - c'est ce que j'ai fait - tre
dcrits comme tendant plus ou moins vers cette limite.
Pour abandonner ce registre par trop subjectif, nous
devons considrer que les cas limites en question ne
sauraient tre raliss et sont, par dfinition mme,
imaginaires.
Nous sommes donc amens dfinir cet tat
imaginaire, ce qui revient plus prcisment dfinir
le sens de la proposition : a parle .
C'est propos de la dfinition du sens de cette
proposition que je vais tre amen vous exposer un
argument qui est peuttre un peu nouveau mais qui
devrait vous servir de cl pour les principales
questions qui ont t souleves. Je suis donc oblig
de vous demander une attention particulirement
soutenue pendant quelques instants, puisque je suis
oblig de vous noncer un certain nombre de
propositions sous une forme assez aride.
Il s'agit donc d'lucider le sens de la proposition:
a parle . Nommons prdication toute proposition
qui dsigne un sujet par le moyen de son prdicat. Ce
sujet, appelons-le sujet du prdicat. Quant celui
qui est l'origine ou celui qui est l'agent de la
prdication, celui qui, rellement, prononce les
paroles et qui n'est pas habituellement reprsent
par un terme de la proposition, celui qui pourrait
faire prcder la proposition d'un Je dis ,
appelonsle sujet prdicant. S'il n'est pas
grammatical, c'est un sujet suppos. Vous noterez
qu'il est ncessairement toujours la premire
personne.
Maintenant, convenons que dans toute proposition, le
sujet du prdicat est le terme qui dsigne un patient
dtermin une fois pour toutes.
Dans la situation analytique, il s'agit de celui que
l'on appelle habituellement le patient, et si l'on
217
voulait examiner avec cette mthode le contenu d'un
dialogue quelconque, celui dont vous parlait LACAN
tout l'heure, eh bien, le patient pourrait tre
choisi arbitrairement mais il devrait rester toujours
le mme. Le patient doit rester toujours le mme,
qu'il soit parl de lui, qu'il soit parl lui ou
qu'il parle lui-mme.
Je vous donne un exemple pour bien prciser les
choses. Le patient - disons dans la situation
analytique puisque en fait, ce n'est que cellel que
nous aurons en vue aujourd'hui et que je n'irai pas
jusqu' l'extrapolation qui concerne tout dialogue -
le patient dit son psychanalyste :
vous ne rpondez pas mon attente .
Le sujet du prdicat, contrairement aux apparences,
est contenu dans mon . Ce qui veut dire que cette
phrase, pour clairer les choses, pourrait tre
transpose : J'attends en vain votre rponse .
L le sujet du prdicat serait bien Je : Je
(prdicat) attends votre rponse.
A ceci, vous objecterez que les deux phrases n'ont
pas le mme sens. Je vous rpondrai que cela nous
montre qu'il n'est pas indiffrent que le sujet du
prdicat y figure d'une manire ou d'une autre.
Notre proposition nous : a parle en la sance
est une prdication au deuxime degr. Ne l'oublions
pas. Nous n'avons pas tudier spcialement cette
prdication au deuxime degr, mais nous avons bien
savoir que lorsque nous parlons, nous parlons de
paroles qui se disent dans la sance. Il faut
distinguer ce que nous en disons, des paroles qui se
sont dites. Je ne veux rien dire d'autre. a parle en
la sance, c'est notre discours sur la parole qui,
dans la sance tait prononc. Nous avons donc nous
demander : qui parlait ? qui parle ?
De toute vidence, dans le cas considr, a parle en
la sance. C'tait, c'est le patient qui parle.
Cependant, nous disons bien : a parle et non pas
il parle pourquoi ?
Parce quil ne parle pas, il ne parle pas son
psychanalyste dans le cas imaginaire que nous avons
considrer.
218
Pour bien clairer les choses, envisageons d'abord le
cas o il parlerait son psychanalyste, le cas, la
limite, de loin le plus habituel. Dans le cas o il
parle son psychanalyste, sa parole pourrait tre
prcde d'un : Je dis . ce qui implique que l'on
doit tre deux dans l'coute :
je parlant et coutant qui dsigne le patient, du
mme ordre- en tant qu'il est je - que le je de
l'autre, le psychanalyste coutant.
Pouvons-nous considrer un autre cas, o c'est le
patient qui parle dont nous pouvons dire :
il parle .Le patient peut prononcer des paroles
qu'il suppose adresses lui-mme par son double ou
par un tiers, par exemple par son psychanalyste.
Cette supposition qui est la sienne, c'est que sa
parole pourrait tre encore prcde d'un Je dis ,
je semblable au je de celui dont la parole est
suppose. Tel n'est toujours pas le cas imaginaire
que nous considrons.
Faisons d'abord quelques remarques ayant trait cet
ordre formel qui est celui du : il parle et que
nous envisageons pour l'instant.
Premire remarque : Je, sujet prdicant, est toujours
du mme ordre qu'un autre Je, sujet prdicant,
Deuxime remarque : Lorsque c'est le patient qui
parle, le sujet prdicant est par dfinition le mme
que le sujet du prdicat: je dis.
Troisime remarque : Lorsque le sujet prdicant est
le mme que le sujet du prdicat, ce dernier est
toujours la premire personne. Parlant de moi-mme,
je ne peux pas me dsigner autrement que par je. Pour
parler de soi, on dit Je. Mais, dans le deuxime cas
que nous avons considr, pour faire parler un autre
de soi, on dit son psychanalyste, vous me direz
bien que.. ; pour faire parler un autre que soi, on
ne dit pas je, on dit moi : vous me dites .
A propos de cette forme rflchie de la premire
personne : moi , nous devons noter - c'est trs
important - qu'elle implique la rfrence une
219
prdication la deuxime personne vous me dites .
Me contient le sujet du prdicat. Il n'en reste pas
moins que la rfrence implique la deuxime
personne est celle du tu : vous me dites tu .
Il y a donc dans la forme rflchie de la premire
personne, moi, un certain degr de contamination du
je, premire personne proprement parler par une
rfrence la deuxime personne : tu.
Si je vous fais remarquer ce degr de contamination
du je dans cette forme rflchie c'est parce qu'il
nous amne aisment par transition au moi imaginaire
que nous avons considrer o il n'y a plus
contamination du je par la rfrence un tu
- je et tu dsignant toujours le mme sujet, le
sujet du prdicat - mais o il y a confusion des
deux.
Qu'en est-il donc du cas imaginaire que nous devons
maintenant considrer, celui propos duquel notre
commentaire est : a parle ? Eh bien, nous avons
vu que dans l'ordre formel o l'on peut dire :
il parle , il dsigne je sujet prdicant qui
soppose toujours un autre je, sujet prdicant.
L'ordre imaginaire est celui du a parle . a,
dsigne, comme metteur de la parole une personne
unique, il y a toujours deux je, il n'y a qu'un a :
une personne unique et une personne innomine au sens
qu'elle ne se nomme pas. D'ailleurs, lorsque nous
disons : il parle nous nous rfrons celui qui
dit je, et lorsque nous disons : a parle nous
n'avons pas de nom pour dsigner ce qui est
l'origine de la parole prononce, nous n'avons pas de
nom pour dsigner le sujet prdicant pour la bonne
raison que ce sujet prdicant perd, l, son statut de
sujet.
Le cas imaginaire est prcisment celui o,
contrairement la loi - que je vous ai prsente
sous forme de remarque tout l'heure - o
contrairement la loi, le sujet du prdicat est la
deuxime personne, alors que le sujet prdicant est
le mme que le sujet du prdicat. Autrement dit, o
la premire et la deuxime personne ne font qu'une.
220
Exemple : Comment peuten donner l'exemple d'un cas
imaginaire. On ne peut le faire que d'une manire
trs approximative videment, exemple : le patient
parlant par la bouche de son psychanalyste. J'entends
bien, non pas au sens figur de la formule parler par
la bouche de quelquun d'autre, mais le patient
parlant par la bouche de son psychanalyste, disons
rellement, puisqu'il n'y a rien d'aussi rel - au
sens o il s'agit de la ralit psychique - que
l'imaginaire. Le patient parlant par la bouche de son
psychanalyste c'est quelque chose, si on prend le
terme dans son sens propre et non pas figur,
videmment d'impossible dans tout domaine autre que
celui de la ralit psychique, que FREUD assigna la
ralit psychique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans
ce cas imaginaire ? Dans sa prdication, il se
dsignerait lui-mme comme le sujet la deuxime
personne se disant tu. Si une telle parole tait
prcde d'un je dis , cela donnerait, je et tu
tant le mme, : Je dis tu es Je .
Or, il ne peut pas dire tu es je , c'est pourquoi
nous disons : a dit tu es Je . La personne
imaginaire qui est la fois premire et deuxime,
nous la dsignons dans notre discours sur son
discours comme tant a. a est une personne
imaginaire. a parle et le discours qui se fait
entendre, semblable une prdication, n'en a pas le
statut en raison du caractre ubiquitaire du sujet
qui s'y dsigne(je vous ai dit tout l'heure qu'il
n'avait pas le statut d'un sujet).
Maintenant, il est peut-tre bon de noter que nous
avons distingu deux registres de la parole : le
registre formel du il parle et le registre
imaginaire du a parle . Nous devons ajouter que
ces registres admettent des subdivisions, des
subdivisions trs nombreuses mais cela n'est pas
notre propos d'aujourd'hui d'examiner toutes les
subdivisions possibles de ces registres, ce qui
serait d'ailleurs un propos fort intressant faire.
Je voudrais simplement mentionner trois registres qui
constituent des subdivisions du registre formel il
parle , trois registres parce qu'ils nous seront
221
d'une utilit immdiate. Ces registres-l sont
d'ailleurs les plus simples :
l) Celui de la dsignation du sujet du prdicat la
deuxime personne. La parole dans ce cas est
videmment le fait de l'autre, celui qui dit tu. Ce
registre est, dans une approximation trs grossire,
dans une toute premire approximation, celui qui est
privilgie dans l'interprtation du psychanalyste
qui dit son patient tu.
2) Dsignation du sujet du prdicat la premire
personne rflchie, registre que nous avons dj
rencontr comme exemple. L c'est bien le patient qui
parle de lui-mme se dsignant au moyen du propos
suppos de son psychanalyste qui constitue le
prdicat. Ce registre de la dsignation de sujet la
premire personne rflchie - celui du prdicat - est
celui de l'interprtation suppose du psychanalyste,
c'est la registre, qui d'une manire encore trs
approximative, est d'une manire privilgie, celui
du transfert.
Maintenant, me direz vous, il existe quand mme un
registre extrmement simple et dont nous avons dj
parl tout l'heure, et dont il faut bien tenir
compte, c'est celui de la dsignation du sujet du
prdicat l premire personne, dans le cas de la
psychanalyse, celui o le patient parle disant Je.
Qu'en est-il de ce registre-l ? Eh bien, je vous
demande un instant. nous y reviendrons tout
l'heure. Car je vous propose de prciser tout cela en
rpondant un certain nombre de questions de CONT .
Je prsentais, dit CONT , la parole comme
introduisant une coupure. Je prsentais encore la
parole, dit-il, comme puisant le flux psychique sans
faille ni coupure. L'expression est de CONT . Il y a
l un paradoxe apparent qui amne CONT poser la
question, mais son avis, qu'est-ce qui est
primordial?
Voici ma rponse : la fonction primordiale de la
prdication me parait rsider dans le registre que
222
j'ai dsign tout l'heure comme tant celui de la
dsignation du sujet du prdicat la deuxime
personne, registre qui, d'une manire privilgie
serait celui de l'interprtation du psychanalyste.
Je vous signale que tout ceci, bien entend, demande
tre beaucoup plus fouill que je ne l'ai fait dans
ce premier projet. Voil donc ce qui est primordial.
J'ajouterai que la fonction de cette prdication a
quelque rapport, et je dirais mme, un rapport trs
intime ce que nous pouvons dsigner comme tant la
fonction paternelle, qu'elle est constitutive de
l'appareil de l'me, comme l'appelle FREUD ou
appareil psychique, dans sa dimension topique aussi
bien que dans sa structure, c'est dire dans sa
rfrence ces trois personnes no-grammaticales qui
constituent ce qu'on appelle d'un terme propre, la
deuxime topique freudienne, par consquent
constitutive du registre imaginaire dont nous disons
a parle . Autrement dit constitutive de ce que,
dans le langage habituel on appelle le a , tout
aussi bien que constitutive du moi et du surmoi.
Ajoutons maintenant que dans ce registre imaginaire,
a parle, la fonction de prdication de la parole est
en quelque sorte aline. Notons maintenant qu'il y a
incompatibilit entre a parle et la prdication,
que vis vis du registre narcissique : a parle ,
la prdication a
- ou bien un effet de coupure restituant le patient
dans l'un des modes de registre o il parle,
- ou bien n'a pas d'effet du tout. Dans ce casl,
cette fonction de prdication, cette prdication est
en quelque sorte forclose, pour reprendre le terme de
LACAN dans l'exercice de sa fonction et je pense que
cette manire de voir les choses doit se recouvrir
assez exactement avec ce que LACAN appelle la
forclusion du nom du pre.
Autrement dit, lorsque a parle et que, en quelque
sorte les choses sont fixes dans ce registre, que la
prdication reste sans effet, nous devons considrer
qu'il n'y a pas de transfert, qu'il n'y a pas de
transfert simplement au sens o l'intervention de la
prdication, de la prdication qui dsigne le sujet
223
du prdicat la deuxime personne ne rompt nullement
le a parle et ne fait pas accder le patient -
en particulier - au registre de la dsignation du
sujet la premire personne rflchie.
C'est dire que dans ce cas de forclusion nous avons
affaire, en pratique des patients pour qui
l'interprtation ne reprsente rien en tant que telle
et qui n'accdent pas au registre o ils se dsignent
eux-mmes au moyen de l'interprtation suppose du
psychanalyste. Voil la forclusion, voil ce qui est
de forclusion du nom du pre comme dit LACAN, et
voil trs prcisment la dfinition de la nvrose
narcissique telle que l'a distingue FREUD. Vous
savez je fais ici une incidente destine montrer
que tout cela a aussi un intrt pour la
psychanalyse. Vous savez je fais ici une incidente
destine montrer que tout cela a aussi un intrt
pour la psychanalyse - vous savez que depuis que les
psychanalystes ont commenc s'occuper de gens qui
taient fous, s'occuper d'alins, ils ont not que
ces gensl prouvaient vis vis d'eux des
sentiments trs vifs, ce qui leur a fait croire que
la folie n'excluait pas la possibilit du transfert.
Eh bien, c'est une erreur. Si on veut maintenir le
cadre des nvroses narcissiques, ce qui me parait
ncessaire, il faut prendre le transfert dans un sens
plus restrictif que celui du sentiment attach
quelqu'un, dans un sens strict - qui est celui que je
vous propose par exemple, car il y a beaucoup
d'autres formulations possibles - comme tant par
exemple cette capacit de se dsigner au moyen de
l'interprtation suppose du psychanalyste. Eh bien
la folie - dans la mesure o le patient est fou car
on n'est jamais entirement fou, et c'est pour a
qu'on peut quand mme traiter les fous - dans la
mesure o le patient est fou, cette possibilit
n'existe pas en raison de la forclusion dont il vient
d'tre question.
Or, toujours dans cette incidente - puisque l je ne
rponds plus aux questions de CONT - il faut noter,
quil faut en revenir ce registre dont je ne vous
224
ai rien dit tout l'heure, registre de la
dsignation du sujet la premire personne, le
patient parlant de lui-mme et disant je.
Eh bien, cet autre extrme, pourrait-on dire, la
fonction de prdication de la parole est, non pas
aline, comme dans le registre imaginaire du a
parle, mais elle est prtendument entirement
assume. Ce registre pourrait tre dfini comme tant
celui du narcissisme secondaire. Vis vis de ce
registre, la prdication ou bien, est remise en
question en son effet ou bien elle reste sans effet.
L encore, il peut y avoir forclusion de cette
fonction - que LACAN dsigne comme essentielle - du
nom du pre. L encore il n'y a pas de transfert
possible, il n'y a pas de transfert possible dans la
mesure o les choses sont vraiment ainsi. Nous avons
affaire ici, en pratique, non pas des fous, mais
bien au contraire, des gens qui sont parfaitement
sains d'esprit ou apparemment sains d'esprit, ces
patients sains d'esprit qui ne font pas l'analyse,
qui paraissent en quelque sorte irrductibles et dont
on dit - dans un langage qui me parat assez
inappropri et assez flou, d'autant plus que la
terminologie est multiple - qu'ils prsentent des
dfenses narcissiques rigides ou des dfenses de
caractre irrductibles, ou tout ce qu'on voudra.
Donc ceci, c'tait une incidente, une indication trs
sommaire pour vous montrer que mes formulations un
peu arides - je ne pense pas qu'il soit ncessaire de
voir les choses comme je les vois et je ne pense pas
qu'il soit ncessaire de s'intresser ce genre de
formulations - mais pour vous dire que dans la mesure
o on s'y intresse, cela ne veut pas dire qu'on ne
s'occupe pas de psychanalyse.
Autre question de CONT : dans l'unique a parlant et
coutant, le psychanalyste est-il lui aussi soumis
la rgression, la rgression topique.
Ou bien s'agit-il plutt d'un fantasme de fusion de
l'analys? Eh bien je crois que ce qui prcde permet
de formuler la rponse trs simplement, et implique
dj la rponse. Dans toute la mesure o nous avons
225
justement pos cette convention que le patient
restait toujours le mme, la convention dtermine
prouve que lorsque nous parlons les paroles qui se
font entendre au cours de l'analyse, nous ne pouvons
pas tout d'un coup prendre le psychanalyste pour
patient mais on peut raisonner ainsi, l'unique a
parlant et coutant dsigne bien videmment le
fantasme du patient, fantasme que trahit, au point de
vue phnomnologique, un certain affect, une certaine
manire d'tre, temporaire, alatoire, que j'ai
dsigne comme tant l'expansion narcissique.
Il ne sagit pas du tout que l'on retienne cette
terminologie qui n'a pas une importance fondamentale.
Ce qui est important c'est de souligner le caractre
irrductiblement inconscient du fantasme du patient
en nonant - plutt que de parler d'expansion
narcissique puisque nous faisons la thorie - en
l'nonant, ce fantasme, de la manire suivante :
a dit tu es Je . Vous remarquerez que
tu es Je , cette formule n'est pas spcularisable
et qu'il n'y qu'un a, ce qui rpond, je crois
suffisamment la question de CONT .
Autre question, CONT dit que pour moi le
narcissisme primaire parat - il ne l'assure pas -
parat comme un pas primordial, comme un pas ant
verbal ou prverbal du dveloppement. Par ailleurs
le patient se posant comme l'objet manquant son
psychanalyste, parait dans son travail viser la
restauration du narcissisme de l'autre.
Cette restauration du narcissisme de l'autre se
prsenterait comme le mythe ou le fantasme de la
compltude du dsir de l'autre. Alors CONT se
demande : quel est l'aspect dcisif et comment les
deux aspects s'articulent-il entre eux ?
Eh bien ma rponse sur le premier point : je crois
que j'ai suffisamment rpondu pour ne pas avoir
donner des prcisions sur le fait qu'il est bien
vident que je ne puis considrer le narcissisme
primaire comme quelque chose d'ant-verbal ou de pr-
verbal, cest ce que j'ai essay de vous montrer tout
l'heure.
226
Pour le deuxime point : je dirai CONT que je
crois qu'il faut distinguer le fantasme narcissique
o le mythe narcissique. Dhhhu moins on peut les
distinguer. Le fantasme narcissique c'est le fantasme
du patient : il est inconscient. Le mythe narcissique
- voil une notion, peuttre un peu plus nouvelle
que CONT introduit ainsi - le mythe narcissique,
lui, n'est pas inconscient mais conscient ou pr
conscient, susceptible de devenir conscient, ce mythe
narcissique est celui selon lequel l'autre pourrait
accomplir ou combler son dsir. Le mythe narcissique
serait par exemple le mythe du psychanalyste
ordonnateur du destin, le mythe du psychanalyste
rig dans une fonction qui est proprement parler
celle d'une idole.
CONT et MELMAN, par ailleurs, ont voulu
s'interroger sur le rapport des repres fournis par
mes deux premiers textes avec un certain nombre des
principales catgories lacaniennes. Ils se sont alors
trouvs gns de ce que le narcissisme primaire
dcrit en premire approximation comme un tat-limite
de fusion, pouvait apparatre dans un aspect, en
quelque sorte, amorphe. Peut-tre les prcisions que
leurs remarques m'ont amen formuler quant la
signification de la proposition a parle , peut-
tre ces remarques, ces cls que j'ai essay de
fournir en une premire approximation contribueron-t-
elles mieux poser les lments d'une telle
confrontation.
Cependant, il reste, ne l'oublions pas que mon
premier article introductif conserve et conservera un
caractre plus descriptif que thorique proprement
parler, et que le deuxime article que CONT a
rsum vise situer la parole du patient dans un
plan dfini par deux axes de coordonnes, celui
imaginaire o a parle et celui formel o il
parle, dsignant la premire personne par le moyen de
l'attribution de son objet.
La progression asymptotique vers le premier de ces
axes je l'ai appel mouvement de rgression topique,
et la progression asymptotique vers le second de ces
axes je l'ai appel mouvement du refoulement.
227
Ceci Justifie pleinement l'impression de CONT et de
MELMAN qu'il s'agit l - comme ils disent - d'un
cadrage de la situation analytique en rfrence
l'opposition, je ne dirais pas tellement de deux
termes, comme ils disent, mais plutt de deux axes.
CONT a trs bien senti par ailleurs que dans toute
la mesure o un tel reprage conduisait voquer la
relation sado-masochiste dans le transfert comme je
le fais dans le deuxime article, un troisime terme
s'y trouvait dj ncessairement impliqu, troisime
terme qui sera introduit dans le troisime de ces
articles que MELMAN a comment, celui de la fonction
de prdication de la parole du psychanalyste. Mais il
reste qu'en ce troisime article le travail est loin
d'tre achev. C'est bien cet inachvement qui rend
la confrontation en quelque sorte bancale.
La question de la situation de la castration par
rapport la frustration, sur laquelle s'achve le
commentaire de CONT , sera aborde corrlativement
celle de la constitution de l'idal du moi en tant
qu'hritier du narcissisme primaire. Cela, je ne l'ai
pas encore fait, mais c'est seulement alors que je
pourrai parler de l'volution et de la terminaison de
la cure. A propos de la terminaison de la cure, il
est peut-tre maintenant inutile que je dise - comme
le pensent peut-tre CONT et MELMAN - que je dise
si je puis la subordonner quelque artifice dit
technique. Je crois avoir voqu - sinon rpondu -
toutes les questions et remarques de CONT et un
grand nombre de celles de MELMAN. Pour CONT, il ne
reste que la question du rve pour laquelle la
rponse serait d'ailleurs un exercice trs instructif
mais je n'ai pas le temps. Mais il y a une sorte de
reste en ce qui concerne MELMAN, je dois lui rpondre
sparment sur ce qui parait faire entre lui et moi -
ce qui a paru faire, tout au moins l'autre jour,
entre lui et moi - le principal malentendu. Voici de
quoi il s'agit.
Comment, dit MELMAN, l'analyste pourrait-il faire de
sa parole la garantie de vrit alors que le patient,
dans le transfert, lui attribue un pouvoir qu'il n'a
pas. C'est ce que dit MELMAN me faisant parler : ce
228
qu'il me fait dire. Or je n'ai rien dit qui puisse
prter une telle paraphrase. J'ai crit - et ici
MELMAN me cite correctement et mme deux reprises -
dans un article qui, au demeurant, ne traite pas de
la parole prononc par le psychanalyste, c'est peut-
tre un artifice de faire un article laissant pour
plus tard la question de la parole effectivement
prononce par le psychanalyste, mais cet artifice a
t le mien. J'ai crit dans cet article :
il n'y aurait pas de psychanalyse si le psychanalyste
prtendait tout instant se poser en fidle serviteur de
la vrit .
Voil ce que j'ai crit et dans un contexte qui ne
laisse - je crois - aucun doute sur le sens de cette
phrase. Pour tre encore plus explicite, replaons le
terme serviteur, si vous voulez, par le terme
champion. Champion de la vrit. Qu'il ne s'en fasse
pas le champion tout instant ne signifie point
qu'il ne serve point ce que, tt ou tard, cette
vrit clate. D'une manire gnrale, cela signifie
donc qu'il se tait et qu'il n'empche pas le patient
de parler. Il ne s'oppose pas au dveloppement du
transfert en lequel le patient fait de lui un
trompeur tromp, cela n'implique point - tout au
contraire - qu'il accepte ou qu'il entrine cette
position lorsqu' son tour il vient parler, c'est-
-dire interprter.
La place d'o le psychanalyste parle n'est pas la
mme que celle d'o, dans le transfert, il est
suppos parler. C'est essentiel.
Une remarque un peu incidente quand mme, n'est-ce
pas ? A ce propos MELMAN parle de la place d'o la
parole de l'analyste prendrait cette brillance si
singulire. C'est une trs belle expression.
Mais lorsqu'on parle de ce problme de la place de
l'analyste, de la place occupe par l'analyste, de la
place o l'analyste parle, je crois qu'il y a
souvent, dans le dialogue, une certaine confusion
entre un problme de droit et un problme de fait. Je
229
ne pense pas que nous soyons l en premier lieu pour
dire de quelle place le psychanalyste doit parler,
pour que sa parole prenne cette brillance si
singulire, mais je crois que nous sommes l pour
examiner en premier lieu, de quelle place il s'avre
que le psychanalyste parle. Je soutiendrai cette
considration d'une remarque qui peut paratre peut-
tre un peu mchante, mais MELMAN m'accordera bien
que la parole de tels de ses collgues analystes,
pour l'intelligence de qui il n'a pas la plus grande
estime - je ne mentionne personne, c'est un exemple -
dont il considre que cet analyste ne comprend pas
grand chose l'analyse et ce qu'il fait, il
m'accordera que mme dans ce cas, pour peu qu'il soit
en situation d'analyste avec son patient, il arrive
bien de temps autre que sa parole prenne cette
brillance.
En fait, peut-tre pas pour nous qui pourrions avoir
le compte-rendu de l'analyse, mais pour son patient.
Il ne s'agit donc pas tellement de la question de
droit mais de la question de fait.
MELMAN note que la parole, considre indpendamment
de son contenu qu'il m'accorde, semble voquer
essentiellement la place d'o la parole de l'analyste
prendrait, dit-il, cette brillance si singulire. Il
s'agit, dis-je, bien de la question de la place de
celui qui prononce la parole, autrement dit du statut
du sujet prdicant. Celui qui pronona
l'interprtation dsigne le patient comme sujet du
prdicat la deuxime personne. Il n'a pas le mme
statut que celui qui, suppos parler dans le
transfert est suppos dsigner le patient la
deuxime personne, alors qu'il est en fait dsign
par luimme la premire, dans sa forme rflchie :
moi. Le psychanalyste ainsi suppos parler, occupe la
place du sujet du mythe de l'accomplissement
narcissique.
Il est suppos l'origine de toute chose. Le
psychanalyste donnant l'interprtation occupe la
place d'un sujet lui-mme dsign son tour la
deuxime personne par un autre. Au contraire de celui
qui est suppos l'origine de toute chose, il est
230
marqu par sa place dans la succession de la
gnalogie. Je serais trs bref pour terminer, mais
il me reste rpondre la suggestion que M. LACAN
nous a faite l'issue de la dernire runion, de la
runion o il a t question de ces textes.
Il nous a suggr de reprendre aujourd'hui notre
dbat partir de l'ide suivante : si l'analyste est
dans une certaine position, ce ne peut tre que celle
de la Verneinung et non celle d'une Bejahung.
Bejahung, c'est en franais, tout simplement
l'affirmation. Or, chacun sait que la prdication
peut prendre une forme affirmative ou ngative, la
catgorie de la prdication ne saurait donc tre ni
celle de l'affirmation ni celle de la ngation. Voil
qui rcuse, je crois, l'argument de Monsieur LACAN
selon lequel je situerais ,moi, le psychanalyste dans
une position d'affirmation, de Bejahung.
Et pour tenter de situer ce que j'ai tent de
formuler aujourd'hui dans l'optique de la suggestion
de Monsieur LACAN, je dirai en traits brefs, ceci. La
parole du psychanalyste dsignant le sujet la
deuxime personne est incompatible avec
l'imaginaire tu es Je du narcissisme, je vous le
rappelle. Lorsque la parole du psychanalyste est
entendue, elle ne peut tre reue que comme une
coupure, que comme la coupure constitutive du dsir,
que comme un dni de narcissisme, rptition du
premier dni mythique o le fantasme tu es Je
s'tait constitu dans l'alination de la fonction de
prdication ou fonction de dni ,car c'est une seule
et mme chose ici de la parole. O selon les termes
de FREUD, cette parole ne peut tre reue que comme
un dni de toute puissance infantile, premire
formulation de FREUD, ou disons, comme un dni de
toute puissance narcissique, pour s'en rfrer la
formulation ultrieure de FREUD. Dni qui est par
consquent corrlatif du refoulement.
Ce dni de toute puissance est au mieux illustr par
la parole suivante, par la parole : du fait de
votre souhait , parole que le psychanalyste ajoute
au texte du rve de son patient : Il ne savait pas
qu'il tait mort suscitant ainsi la dngation du
231
patient : tel n'est point mon souhait . Voil ce
que je voulais vous dire.
Retour 26 Janv
LACAN
STEIN, Je vous remercie beaucoup de ce que vous avez
bien voulu apporter comme rassemblement de prcisions
sur ce que vous nous avez prsent d'ailleurs comme
n'tant que les trois premiers temps de quelque chose
qui est votre projet et qui, assurment doit en
comporter au moins un autre, n'est-ce pas?
Il faut donc que je vous remercie de deux choses,
d'abord d'avoir russi en sortir cette premire
partie, deuximement d'avoir bien voulu nous les
situer dans l'ensemble de votre dessein. Je ne vais
pas - comme je l'ai annonc tout l'heure,
conformment ce que j'ai annonc - je
n'interviendrais pas aujourd'hui ni sur le fond ni
sur les dtails de l'articulation que vous nous avez
apporte, comptant sur les personnes qui
vous ont entendu dans l'assistance pour apporter de
premires remarques.
Je ne puis dire qu'une chose c'est que je me
flicite, au-del de ce qui a t la motivation
immdiate pour laquelle j'ai voulu que certains de
ces articles, dans l'ensemble et prcisment propos
du premier, la discussion ft porte ici dans le
cadre de notre sminaire. Assurment, dans ce que
vous avez nonc un certain malentendu a t dissip
concernant l'essence de ce que vous vouliez dire.
Il reste nanmoins que ceci ne veut pas dire que je
puisse tre d'accord sur l'ensemble de votre
situation du problme puisque c'est de cela qu'il
s'agit. Mais c'est assurment une chose assez
profondment armature pour que cela nous dsigne
232
trs bien le niveau o se placent certains problmes
essentiels. Je pense que - car les limites que vous
impliquez du dveloppement de cette situation
analytique peuvent tre dpasses - que c'est ici
justement, l , une base, un point d'appui qui peut
m'tre excessivement prcieux pour reprer en quoi ce
que j'articule cette anne me permet de critiquer
cette position. Je le ferai assurment d'autant plus
- et d'autant plus aisment, et d'une faon d'autant
plus pertinente pour tous - que vous verrez o en
sont tels ou tels de mes auditeurs par rapport
l'audition que cette prsentation d'aujourd'hui
impose.
Nanmoins, je ne peux pas, ds maintenant ne pas
faire une rectification. Elle est importante. Je suis
vraiment tout fait dsol que le texte que je vous
ai communiqu o particulirement MELMAN avait
apport ses corrections, ait laiss passer dans la
dernire page ce qui n'tait de ma part, mme pas un
jalon, une corde lance de votre ct. J'ai parl le
temps de deux pages et demie. Il y a en effet crit
dans ce texte le mot dont peut-tre l'incorrection
aurait d vous veiller, le mot Verneunung qui
n'existe pas. Vous avez traduit Verneinung et j'avais
dit Verleugnung. De sorte que ceci met un peu en
porte faux - sans du tout d'ailleurs en diminuer
l'intrt - ce que vous m'avez, moi, directement
rpondu en terminant.
STEIN
Je suis beaucoup plus d'accord avec Verleugnung.
LACAN
Alors, je demande d'abord, ce qui est naturel, ceux
qui il a t rpondu, savoir nommment CONT et
MELMAN s'ils veulent bien maintenant prendre la
233
parole. CONT , vous avez pris des notes. Est-ce que
vous voulez vous rserver un temps de rflexion ou
est-ce que vous pouvez ds maintenant aborder ce que
vous avez dire ? Ne parlez pas de votre place,
venez ici. Alors puisqu'il est possible que les
choses se passent assez bien mon gr pour que tout
l'heure le dpart se fasse par chelon comme il
arrive, savoir que quelques-uns soient limits par
l'heure et s'en aillent, je tiens vous en annoncer
c'est une des raisons pour lesquelles tout
l'heure je me rjouissais qu'ait pris dans
l'ensemble de mon sminaire cette anne, cette
place qui a t prise par un discours tel que
celui que nous venons d'entendre.
En effet, peut-tre n'en saisissezvous pas ds
maintenant le rapport mais je crois qu'il n'y a
pas de meilleur texte
qui nous permette de relancer certaines des
affirmations que j'entends discuter, de ce
que nous a annonc STEIN
que celui-ci, ce texte, celui que je vous avais
annonc la dernire fois, avant que Madame
PARISOT vous parle de l'article de DRAGONETTI sur
DANTE. Je ne peux, bien sr, aucunement
aujourd'hui commenter la fonction que j'entends
lui rserver.
Mais aprs tout, pour ne pas l'aborder dans un effet
de surprise et que quiconque sa venue ait tomber
de son haut, je vous annonce toutes fins utiles,
c'est--dire pour que vous en rafrachissiez votre
connaissance, voire mme que vous vous rapportiez aux
commentaires nombreux et essentiels qu'il a
provoqus, ce texte d'o je partirai la prochaine
fois, que je prendrai comme relais de la suite
topologique qui, cette anne, vous apprend situer
la fonction de l'objet(a), n'est autre que Le pari de
PASCAL.
Ceux qui veulent - comme il convient - entendre ce
qui se dit cette anne, ont donc huit jours au moins,
pour se rfrer aux diffrentes ditions qui en ont
t donnes.
234
J'insiste - la plupart d'entre vous, j'espre, le
savent - sur le fait qu'il y en a eu, depuis la
premire dition, celle des Messieurs de PortRoyal,
une srie de textes qui sont diffrents, je veux dire
qui se rapprochent plus ou moins, qui tendent se
rapprocher de plus en plus des deux petites feuilles
de papier crites d'une faon incroyablement
grafouille, des deux petites feuilles de papier
recto-verso sur lesquelles ce qu'on a publi sur ce
registre du pari de PASCAL se trouve nous avoir t
laiss. Donc je ne vous donne pas toute une
bibliographie, moins qu' la fin quelqu'un me le
demande. Vous savez aussi que nombreux sont les
philosophes qui se sont attachs en dmontrer la
valeur et les incidences. L aussi ceux qui peuvent
avoir me demander quelque chose, sur les articles
les plus gros auxquels il convient qu'ils se
rfrent, pourront venir l'occasion me le demander
moi-mme moins qu'un temps me soit laiss qui me
permette de les indiquer.
CONT
J'ai l'intention de me limiter trs peu de choses,
et essentiellement de remercier STEIN de ce qu'il
nous a apport aujourd'hui qui, en effet, ma paru en
grande partie nouveau par rapport ce que j'avais lu
et qui nous permet de situer les choses dans une
autre perspective.
Dj, certainement, le troisime article sur le
jugement du psychanalyste, avec l'introduction de la
fonction de prdication aurait certainement pu
permettre de mieux comprendre son premier article et
en tout cas, ce qu'il a dit ce matin qui est plus
prcis, plus dvelopp, laisse la plupart de mes
remarques sans objet.
Je dois dire que les difficults qui se trouvaient
souleves sont rsolues ce niveaul, le problme
cest de les reporter un autre niveau de
discussion.
235
Je reste tout de mme un tout petit peu sur ma faim
sur un certain nombre de points notamment sur les
rapports entre le registre du narcissisme et le
registre du dsir par consquent la dimension de
l'objet(a).Je ne vois pas encore trs bien comment
STEIN articule tous les registres.
Deuxime point : le deuxime article, celui sur le
masochisme dans la cure insistait sur la rfrence
la parole prononce par le psychanalyste comme
relle, ceci s'opposant la dimension de
l'imaginaire et je voulais demander STEIN ce
propos s'il ne tend pas, dans ce texte, situer le
transfert - faire basculer le transfert - un petit
peu trop du ct de la demande et est-ce qu'il n'y
aurait pas l une partialit de sa part au niveau de
cette prsentation.
En fait, je crois que le dbat doit maintenant se
porter, en effet, sur la fonction de la prdication,
et c'est l une rfrence laquelle je suis peu
prpar pour intervenir. Je me rserverai une plus
mre rflexion ce sujet. Et je me demande
simplement premire coute, premire audition, si
on a situer la prdication, cette premire parole
fondatrice originelle comme une prdication fondant
le sujet c'est--dire attribuant au sujet un
prdicat, le sujet devient tel, il est ceci ou cela,
ou si la prdication ne serait pas rapporter plutt
un jugement port sur des objets, ce qui pourrait
ventuellement dvelopper ce point.
Et propos de ce troisime article sur le Jugement
du psychanalyste, il y a l aussi quelque chose que
pour l'instant je saisis mal dans la pense de STEIN
o justement l'articulation du niveau du dsir est
celui de la loi ou encore de l'interdiction, c'est--
dire le moment o STEIN passe du manque et par
exemple l'analys tentant de se poser comme objet
manquant l'analyste - o il passe donc de ce
niveau, celui du manquement, o il s'agit l du
manquement une loi et o il s'agit donc de
l'interdiction, savoir l'articulation trs prcise
que fait STEIN entre le premier jugement fondateur,
236
en tant qu'il tablit le sujet d'une part comme objet
du dsir et d'autre part comme sujet d'une faute
passe. Il y a l une articulation que je n'ai pas
bien saisie, mais sans doute faute d'y avoir
rflchi. C'est tout ce que je voulais dire pour
aujourd'hui.
MELMAN
Il me semble que l'un des grands mrites de ton
expos est en tout cas de l'avoir rendu peut-tre
tes auditeurs beaucoup plus clair que nous n'avons
essay de le faire avec CONT . Quelles sont tes
positions et ton avis sur la cure, ce qui bien sr
permet d'engager une discussion peut-tre plus
aisment.
Ce que je voudrais tout de mme te dire c'est que
J'ai lu tes textes avec beaucoup d'intrt et
certainement d'autant plus grand que comme j'avais
essay de le dire la dernire fois, tout ce qui peut
se prsenter comme un effort de thorisation gnrale
cest dire de ce qui se passe dans l'analyse, ne
peut que bien entendu qu'veiller toute notre
attention, tout notre intrt et toute notre
sympathie, bien sr.
Ceci dit, J'ai eu l'impression et le sentiment, en
lisant justement ces trois textes - les trois
derniers textes rcents - qu'il tait possible
d'articuler les divers termes que tu avances, et qui
sont ceux d'expansion narcissique primaire tu nous
as dit aujourd'hui, qu'aprs tout, ce terme tu n'y
tenais pas trop, tu l'abandonnerais volontiers - je
veux bien.
STEIN
Je prcise qu'il ne s'agit pas l que ce terme ne
se rfre pas, un concept thorique. C'est pour a
237
que j'ai dit que je le considre comme descriptif
donc comme d'une importance effectivement secondaire
LACAN
C'est une prcision trs importante tant donn le
caractre gnralement essentiellement thorique
qu'on donne au terme de narcissisme primaire.
MELMAN
Essentiellement thorique et trs difficile situer,
je veux dire lintrieur de ton texte. Je veux dire
qu'on a parfois l'impression je veux dire que, par
exemple, quand tu situes le narcissisme primaire - ou
tout au moins le but du narcissisme primaire - comme
la retrouvaille de cet objet mythique perdu, il est
bien certain que tu t'engages l dans une certaine
voie, un certain mode d'approche de ce terme. Mais ce
que je voulais te dire c'est que j'ai regroup en
quelque sorte, tes diverses propositions et tes
divers termes autour de quelque chose qui me semble
tre une position. Cette position est celle qui
ferait de la parole de l'analyste un objet(a). C'est
autour de cela que j'ai essay de te parler et c'est
galement, je dis bien autour de cela, qu'il me
semble que les divers moments de tes textes semblent
trs bien s'articuler. Lorsque tu dis que la parole
de l'analyste est susceptible de prendre ce que
j'appelais dailleurs de manire un peu force,
enfin - de prendre cette brillance si singulire. Je
n'en doute bien sr absolument pas, la question
essentielle me paraissant bien plutt celle de la
position de l'analyste l'gard de sa propre parole
et en tant qu'elle est susceptible de figurer pour le
patient cet objet particulier, cet objet singulier.
Pour reprendre les choses peut-tre un petit peu par
le commencement, ce qui m'a sembl, je dois dire,
coincer, en quelque sorte les dveloppements de ces
textes, en quelque sorte les rduire constamment ce
jeu duel entre le patient et l'analyste, ou les
choses comme cela, oscillent de l'un l'autre dans
238
un mouvement o, comme tu le dis trs clairement :
on se demande comment a peut finir . Car enfin tu
le dis quand mme trs clairement, tu poses en tout
cas la question de faon trs claire et tu as une
certaine franchise, il me semble que la rfrence
l'Autre, j'entends ici bien entendu le grand Autre,
le dfaut de rfrences que tu fais ici au grand
Autre est le point o justement les choses viennent
dans le texte s'agglutiner, se colmater et on finit
par se demander comment elles peuvent se dnouer.
Par exemple, j'aurais tendance interprter ce que
tu dfinis sous le terme de situation fusionnelle par
lequel tu as commenc ton propos, je veux dire la
ralisation de cet unique a parlant et coutant que
CONT a relev d'ailleurs comme un phnomne bien
sr possible mais rare, j'aurais bien sr tendance
essayer de l'voquer dans cette dimension qui serait,
peut-tre ventuellement celle o le patient pourrait
avoir le sentiment que sa parole risquerait de
rejoindre un discours, le discours de l'Autre, o
toute sparation partir de ce moment l, o toute
rupture, o tout hiatus, o toute distance se
trouverait abolie.
Je me demande aussi, si d'introduire cette rfrence
ne permettrait pas de situer mesure en tout cas, je
t'en demande pardon s'ils n'ont pas t en t'coutant
l forcment toujours suffisamment attentifs, mais ce
que tu introduis au sujet de cette distinction des
diverses personnes au sujet du tu et du il
qui sont des catgories grammaticales qui, bien sr,
sont essentielles mais dont je dois dire, je me
demande chaque fois en t'coutant comment tu les
utilises. Je veux dire est-ce que tu les prends,
estce que tu les relves telles quelles dans le
sujet de ton patient, je veux dire, est-ce que quand
le patient dit je, par exemple, partir de l est-ce
que tu le fais rentrer dans l'une des trois
catgories que tu as isoles : dsignation du sujet
du prdicat la deuxime personne ou la premire
personne rflchie ou bien encore, dsignation du
sujet du prdicat la seconde personne, n'est-ce
239
pas ? Autrement dit, tout ce que tu introduis l dans
un effort de distinction et d'analyse, du Je, du tu,
et du il, je me demande s'il peut mme, je dirais
tre situ en dehors de cette rfrence ce lieu
tiers d'o le sujet reoit sa parole lui en tant
que sujet. Pour ce qui est de cette petite pointe,
comme cela, que tu avances concernant la vrit, la
question de la vrit, permets-moi de te citer.
Lorsque tu dis ceci, dans ce texte sur le masochisme
le psychanalyste est appele intervenir, il est
appel de deux cts la fois. Dans le transfert le
patient l'appelle en un lieu o il n'est pas. Il le situe
au lieu suppos du pouvoir, du fait duquel il prouve la
frustration, c'est--dire ce pouvoir de ralit que
l'analyste dtiendrait et dont il pourrait faire usage
son gr pour interrompre l'expansion narcissique du
patient . Au nom de la vrit, il serait appel se
prononcer sur le transfert, l'analyste, dnoncer
l'illusion du patient. Rpondant au premier appel d'un
lieu o il n'est pas, il tromperait le patient en
acceptant de lui servir de leurre et de s'arroger un
pouvoir qui n'est pas le sien. Au nom de la vrit, il
devrait s'abstenir de rpondre l'appel du patient et
intervenir pour se rcuser. Mais, dans l'coute de
l'analyste, l'appel du patient est constant. Tolrer le
transfert c'est dj tromper puisque c'est l'coute qui le
suscite. L'analyste devrait donc intervenir constamment
pour dnoncer le faux au nom du vrai et ne point entendre
l'appel la tromperie. Son efficacit alors serait celle
du prdicateur et non plus celle du psychanalyste.
Et c'est l que tu ajoutes :
il n'y aurait pas de psychanalyse si le psychanalyste
prtendait se poser tout instant en fidle serviteur de
la vrit.
Je crois que c'est certain. Je crois que tu as
parfaitement raison.
Mais je ne vois pas comment dans cette articulation
l que tu avances, tu mnages - ce qui parait
nanmoins essentiel pour tout dveloppement possible
240
de la cure, moins qu'elle ne devienne... je ne
saurais pas trop exactement comment la situer
moins que tu ne laisses une place pour, nanmoins
dans ce mouvement, permettre l'existence de sa
dimension qui serait celle de la vrit.
Retour 26 Janv
STEIN
L je te rponds tout de suite. C'est que, il n'en
est pas trait ce point-l. Quant au terme
prdicateur, dans ce texte il est bien vident que
les dveloppements ultrieurs vont n'amener le
supprimer. Jusque-l je l'avais simplement pris dans
le sens de celui qui fait des sermons. Donc pour
qu'il n'y ait pas de confusion, il sera supprim l.
C'est vident
MELMAN
Bon. Entendu comme cela. Je reprendrai peut-tre
galement, peut-tre mon compte, peut-tre en tout
dernier lieu ce que tu dis l'gard du sujet
prdicant qui tient une place importante dans tes
derniers dveloppements qui je crois mrite une
grande rflexion. Cest l, la fonction
ventuellement prdicante que tu assignerais
l'analyste.
LACAN
Bon. STEIN a videmment - je m'en suis aperu
seulement aprs coup, j'tais sous le charme de sa
parole - STEIN a sensiblement dpass son temps, ce
qui ne nous laisse pas suffisamment de temps pour la
discussion que j'aurai attendue aujourd'hui.
Maintenant, il y a place pour encore une personne.
Est-ce que vous voulez intervenir GREEN ?
GREEN
241
Moi, Je veux bien mais je ne veux pas priver les
autres d'intervenir.
LACAN
Estce que MAJOR voudrait intervenir ? Vous avez
quelque chose dire MAJOR ? Il faut que vous
partiez. Bon. Alors AUDOUARD.
Xavier AUDOUARD
Il me semble que cette sorte d'univers grammatical o
STEIN nous a situ tout l'heure laisse tout
moment se constituer comme un reste, et c'est
sensible dans divers aspects de ses propos, par
exemple lorsqu'il dit que mme si le psychanalyste a
une activit contestable, ou qu'il occupe une
position contestable notre regard, il reste
cependant qu'il y a une certaine brillance dans ses
propos. Que mme si le psychanalyste n'est pas
dtenteur de la vrit, il reste cependant qu'il en
est le serviteur fidle. Que s'il est vrai que la
prdication est toujours ou positive ou ngative, il
reste cependant que le champ propre de la prdication
tombe hors du positif comme du ngatif. Et ce n'est
pas peut-tre pour rien que justement verneinung ici
a t entendu la place de Verleugnung.
Car Verleugnung justement introduisait la dimension
du mensonge qui est autre chose que la dngation.
Dans cet univers grammatical o STEIN m'a paru situer
les rapports de l'analyste avec l'analys, il y a
comme une sorte de fidlit qui apparat tout
moment, o l'effort de spcularisation qui se ferait
par exemple entre le Je et le tu, entre la premire
personne se rflchissant o le tu venant l
rflchir la premire personne, il y a dans cet effet
de spcularisation, o STEIN essaie d'introduire le
rapport de l'analys avec l'analyste, il y a comme du
non spcularisable qui apparat tout instant.
En somme on pourrait dire que cet univers logique
d'une rflexion du tu sur le Je ou je sur lui-mme
n'est peut-tre pas tout fait ngligeable dans une
242
orientation d'une dialectique et que, mme si on
introduisait dans une orientation plus dialectique,
encore resteraitil que dans cette dialectique on ne
trouverait gure de fond ou de vrit qui la fonde.
C'est en liaison par exemple avec ce que MADAMe
PARISOT nous a dit l'autre jour qu'on pourrait mettre
tout ceci, savoir qu'aprs tout le spcularis
n'est pas le spcularisable.
Loin d'tre le spcularisable il est peut-tre
simplement ce qui fait croire qu'il y a un
spcularisable et que le spculaire en tant que tel
est toujours travers par un reste qui tomba hors du
champ de la rflexion. En somme qu'il y ait une sorte
d'abme entre le sujet prdisant et le sujet du
prdicat cela nous indique qu'il y a l entre eux
deux, comme un monde, comme un vide, comme un quelque
chose qui les loigne, non certes sans pouvoir les
dialectiser mais sans permettre aucun moment que
cela vise tu es Je , sans que se constitue comme
autre chose, comme un forage qui n'appartient ni
la logique ni la grammaire, mais ce forage
particulier du dsir. La prdication ne me parat pas
tre au dpart un acte logique comme l'enfant dit que
le chien fait miaou et le chat wouh - comme
le disait LACAN - il ne s'agit pas d'une prdication
qui appartient l'ordre de la logique mais l'ordre
de ce forage particulier qu'est le dsir.
Enfin, c'est simplement pour indiquer dans quelle
voie on pourrait mon sens introduire une critique
d'une interprtation, peut-tre mon sens, trop
satisfaisante parce que trop grammairienne .
Retour 26 Janv
LACAN - GREEN, dites un mot.
GREEN
Je m'excuse. J'aurais besoin du tableau. Je
m'efforcerai d'tre aussi bref que possible.
Je pense que je voudrais juste dire quelques mots
concernant la formule de LACAN : Moi la vrit Je
parle avec ce que vient de dire STEIN.
243
Alors, si nous crivons :
nous trouvons une phrase qui est en fait articule
selon deux axes :
l'axe Moi-Je et l'axe la vrit-parle .
Je pense que tout a a un rapport avec ce que nous a
dit STEIN des rapports entre le je ,le moi et la
parole. AUDOUARD vient de faire remarquer que STEIN
construit une quivalence des diffrents pronoms
entre le Je, le tu et ventuellement le il. De mme
que le sujet ne peut pas dire : je dis que tu es
Je , du fait mme que le je dis que tu es Je est
remplac par a dit que tu es je , de ce fait mme
je crois que c'est cette quivalence entre les
diffrents pronoms qui me parat fausser les choses.
Pourquoi ? Parce que, si ce moment-l, en connotant
sous forme d'index, a dit que tu es Je , on peut
dire en quelque sorte que dans l'nonciation mme,
dans la succession de l'nonciation, partir du
moment o le tu parvient au je, le je s'en trouve
pour ainsi dire transform et n'est plus le mme Je
qu'au dpart et il est ramen au tu primitif. Je
crois que ce point est trs essentiel pour concevoir
qu'il y a l quelque chose, qui est une circularit
close et que la seule faon de sortir de la
circularit, la seule faon que a ne constitue pas
un systme qui tourne en rond, est en effet de
concevoir qu'il existe une diffrence entre le tu et
le Je, cette diffrence tant celle du grand Autre et
celle du grand Autre barr en tant que justement ce
qui libre la barre, c'est un reste.
Il faut qu'il y ait un reste et pour qu'il y ait un
reste il faut qu'il n'y ait pas d'quivalence entre
les diffrentes valeurs pronominales.
244
Sur quoi tombons-nous l ? Nous tombons justement sur
le terme, justement dont je parlais en premier : la
vrit c'est--dire que STEIN a parl du moi, qu'il a
parl du Je, qu'il a parl de la parole, mais
justement la question, reste pendante en ce qui
concerne la vrit. L'analyste est-il ou non le
fidle serviteur de la vrit ?
Eh bien je crois que c'est l qu'il nous faut quand
mme revenir, la formule propose par LACAN comme
spcifiant le transfert, savoir que le transfert
s'adresse un sujet suppos savoir, suppos savoir
quoi ? C'est toute la question. Qu'est-ce qu'il sait
le psychanalyste ? Eh bien ? Quest-ce quil sait?
Je pense que tout le malentendu de la cure, toute sa
Verleugnung c'est qu'il est cens savoir tout, sauf
la vrit, et que c'est dans la mesure o ce
malentendu existe au dpart, que la cure peut se
poursuivre pour arriver finalement une situation o
videmment, il est bien entendu que le sujet suppos
savoir n'est plus du ct de l'analyste, et que ce
dont il est question, c'est bien une vrit qui ne
peut tre que celle du sujet. Je crois que nous
trouvons une problmatique tout fait identique
celle que j'ai essay d'analyser en ce qui concerne
l'oracle chez les Grecs.
LACAN
J'essaierai de donner des formules encore plus
prcises mais celle-ci me parait vraiment massive et
tout fait fondamentale. Est-ce que vous voulez,
STEIN, rpondre tout de suite, ou bien comme il est
concevable, car je vous annonce dj que je ferai en
Fvrier trois sminaires : deux sminaires ouverts et
je ferai encore un sminaire ferm.
Le quatrime je serai, en principe, parti aux U.S.A.
Il est tout fait concevable que le quatrime
sminaire se passe poursuivre une discussion si
bien engage.
Ce qui vous laisse tout loisir d'attendre pour
rpondre aux interventions d'aujourd'hui la prochaine
245
fois, moins que vous ne vouliez tout de suite
placer quelques mots.
STEIN
Je ne pense pas qu'il me soit facile de faire une
introduction substantielle la prochaine fois sur la
base des remarques qui ont t faites aujourd'hui car
a ne mnerait rien.
LACAN
Non, mais la prochaine fois il peut s'inscrire auprs
de vous - ce serait plus simple - un certain nombre
de personnes qui, ayant laiss mrir ce qu'ils ont
entendu aujourd'hui se proposeraient venir discuter
avec vous le quatrime Mercredi.
STEIN
Oui, mais je ne pourrais pas m'avancer encore
beaucoup plus sur...
LACAN
Non, il ne s'agit pas de a. Il s'agit ou bien que
vous disiez un mot auquel vous teniez beaucoup...
STEIN
Si! Il y a un mot que je voudrais dire. C'est le
suivant. Dans toute cette discussion, et cela n'est
pas fait pour nous tonner, on en arrive toujours
la tentation de rduire ce reste dont parlait
AUDOUARD et que reprenait GREEN.
Dans l'argument de GREEN, que je ne veux pas
reprendre dans son ensemble parce qu'il est trs
important, intressant, je voudrais quand mme
simplement lui faire remarquer que, en me prtant le
propos d'tablir une quivalence entre les diffrents
pronoms, il rduit justement ce que je laissais en
quelque sorte comme reste, car je n'ai pas dsign
l'quivalence entre les diffrents pronoms mais,
246
justement, une confusion entre les diffrents pronoms
dans le registre imaginaire, ce qui est tout fait
diffrent.
Et ceci m'amne, pour tre trs bref, AUDOUARD qui,
mon avis, a admirablement dfini quelque chose qui
se rapporte, qui est dans ce que je vous ai dit
aujourd'hui, que le non-spcularisable apparat
tout instant dans l'effort de spcularisation, dans
la tentative de spcularisation, ceci est certain et
ceci pourrait mme rsumer ce que j'ai dit
aujourd'hui.
Mais alors je ne vois pas pourquoi Audouard en tire
argument pour dire que ma grammaticalisation n'est
pas satisfaisante dans la mesure o elle rduit ce
reste non-spcularisable, puisque justement, pour
reprendre les excellents termes d'Audouard, cela
pourrait tre encore formul autrement.
Mais qu'est-ce qui est apparu dans ma dmarche comme
tant le reste, si ce n'est justement ce registre
imaginaire ? C'est--dire qu'il est bien vrai qu'il
n'y a pas discours spcularis qui ne se rfre, qui
ne comporte un reste ou, dans les termes o j'ai pos
les choses, qui ne se rapporte un registre
imaginaire.
LACAN
Une des choses les plus saillantes et un point cl de
votre expos d'aujourd'hui, c'est quand vous dites
que ce a parle , savoir ce que j'appellerais la
surface topologique unique du sujet et de l'Autre qui
est bien l implique, cette surface topologique est
de l'ordre imaginaire.
La cl de tout est l et c'est l je crois qu'est
votre erreur de formulation. Nous pouvons aujourd'hui
laisser les choses ici suspendues.
Petite anecdote : je ne suis pas du tout oppos
cette grammaticalisation qui me parat un point
d'appui, si on sait s'en servir, un instrument tout
fait excellent.
Je voudrais quand mme, comme a, pour le plaisir de
l'histoire, rappeler qu' un certain congrs
247
d'Amsterdam qui, si je crois bien, se situe en 1950
non, le premier Congrs d'Amsterdam c'est en ?
GREEN
En 1948.
LACAN
en 1948, j'ai fait le discours que j'avais prpar
ce moment-l. Nous n'en tions pas encore au
commencement d'un enseignement quelconque de ma part,
qui tait, qui tournait autour, non pas seulement de
n'importe quelle grammaticalisation mais trs
prcisment celle des pronoms personnels, discours au
cours duquel j'ai d crever les interprtes car j'ai
t forc de dire en dix minutes ce que j'avais
prpar pour vingt, Madame Anna FREUD ayant cru
devoir dpasser largement son temps d'intervention
Table des sances
248
02 Fvrier l966 Table des sances
Je me soucie de savoir si ceux des psychanalystes
qui j'ai enseign quelque chose transmettront
proprement ce que j'ai dit. C'est l le sens de
l'preuve que constituent les sances consacres un
sminaire auquel je ne puis pas admettre autant de
monde, pour la raison que cette assistance mme
serait un obstacle cette vrification.
S'il est vrai que l'aspiration primaire du sujet
psychologique est de prsenter au dsir de l'Autre
cet objet fallacieux qu'est son image de soi, nous ne
saurions prendre de prcautions trop rigoureuses pour
ne jamais
sous une forme quelconque, voir dans ce qui
s'appelle la cure psychanalytique qui est une
exprience proprement transcendante au regard de
ce qui s'est exprim jusqu'alors dans l'ordre de
l'thique
nous ne saurions jamais prendre trop de prcautions
pour dfinir les voies par o cette formule du
rapport du sujet au dsir de l'autre que, je viens de
donner d'abord et qui n'a jamais t, dans aucune
doctrine philosophique dpasse, soit effectivement
dpasse, franchie d'une faon radicale.
C'est pourquoi, faute de pouvoir tre au quatrime
mercredi o se poursuivront les dbats qui se sont
instaurs depuis les deux mercredi derniers sur le
sujet des formulations de Monsieur STEIN ici prsent
au premier rang de cette assemble, je l'interrogerai
pour que la balle en soit reprise sur ce qu'il entend
par ce prtendu masochisme imput au patient dans la
mesure o il se soumet une rgle svre.
Pourquoi si vite aller que de dfinir masochisme
ceci, aprs tout dont nous pourrions n'avoir rien
dire au dpart, si ce n'est qu'il en veut. C'est tout
ce que nous pouvons en dire : Il en veut !
Formule non pas vague mais minimale du dsir.
249
Tout dsir alors serait-il d'tre dsir et en
lui-mme masochiste. Assurment si la question vaut
d'tre pose, elle vaut aussi de n'tre pas tranches
trop tt, surtout si nous nous souvenons de la
formule que j'ai donne, en parlant du dsir et de
son interprtation qu'en un certain sens - vues
les conditions de l'exprience psychanalytique - le
dsir, c'est son interprtation.
S'exposer cette situation qui est vraiment
fondamentale que toute demande ne peut qu'tre due
c'est l sans doute, ce que le patient a affronter
et ce qu'il ne saurait au dpart prvoir et au reste
quel masochisme dans ce cas s'offrir la
dception, comme l'a formul fort bien quelqu'un
d'autre de mes interlocuteurs
82
. L'analyste est en
effet le sujet suppos savoir, suppos savoir tout
sauf ce qu'il en est de la vrit du patient. Et bien
plus qu'une situation s'tablissant sur les donnes
dont je vous indique ici la pointe, est-ce que le
patient qui s'offre l'exprience analytique ne nous
dit pas :
c'est vous qui subirez, si vous me demandez la vrit, cette
loi que toute demande ne peut qu'tre due. Vous ne jouirez
pas de ma vrit et c'est pour cela que je vous suppose
savoir. C'est parce que c'est cela qui vous oblige tre
tromp. La pulsion pistmologique, c'est la vrit qui
s'offre comme jouissance et qui sait, par l mme tre
dfendue car, qui pourrait jouir de la vrit ?
Pulsion donc, plutt mythique, laissez-moi accoler
ces deux termes en un seul mot et recevez
- psychanalystes - l'investiture de ce qui vous est
ici impos, l'adjectif en un seul mot :
la plutomythique . Ce que le patient fait de nous
c'est qu'il nous fait dchoir de la position de
pyrrhonien
83
.
Vous voudrez en savoir plus :
82 GREEN ; cf. supra la fin de sance du 26-01.
83 Cf. Marcel CONCHE, Phyrron ou lapparence, PUF, 1994, Coll. Perspectives critiques.
250
J'veille votre dsir le plus rflchi,
c'est--dire le plus mconnaissable. Le prdicat dont vous
m'affecterez, c'est votre chute vous, si vous qualifiez,
vous vous qualifiez, je triomphe .
Sans doute y a-t-il l, comme STEIN l'a peru, la
pointe et la naissance d'une culpabilit chez le
patient. Mais vous, si vous vous acceptez comme juge,
vous voil rejet comme sujet, ds lors dans
l'ambigut d'avoir se juger. Le glissement
harmonique de la langue, ce sujet qui a se juger,
reconnaissez-en l une de ces formes dont chaque
langue, sa faon, nous offre l'indication. Sans
doute, ici, du mme coup est l'avertissement de
n'aller pas, de n'avoir pas aller trop loin car,
dit le patient :
bien sr vous me rendriez masochiste c'est--dire amoureux
de votre angoisse que vous prenez pour une jouissance. Je suis
devenu l'Autre pour vous et si vous n'y prenez garde, vous ne
pouvez plus que jouer tout de travers. Car il suffit que je
m'identifie vous pour que vous voyez bien que ce n'est pas
de moi que vous jouirez. La muscade est passe et qu' prendre
votre ralit (Wirklichkeit), ce que j'efface jusqu' la trace
dans le rel (Realitt), c'est justement ce que j'ai choisi en
vous pour sanctionner cet effacement .
Ainsi l'ide d'un tre subsistant et saisissable,
fondant les relations de sujet sujet est proprement
le terrain savonn de piges sur lequel au dpart,
une thorie insuffisante s'engage irrmdiablement.
Et c'est pour cela qu'il est pour nous si souhaitable
d'laborer la structure qui nous permette de
concevoir d'une faon radicale, comment est possible
le progrs de celui qui s'offre dans la position de
sujet suppos savoir et qui doit pourtant,
initialement et de faon pyrrhonienne renoncer tout
accs la vrit. [ou mallon], pas plus ceci que
cela, cette formule nodale est celle o s'exprime la
position du pyrrhonien ou du sceptique, PYRRHON tant
le chef de file d'une de ces sectes philosophiques
que j'ai encore appeles l'occasion coles pour
251
bien rappeler qu'autre chose tait la pratique de la
philosophie dans un certain contexte, celui o
s'achevait un certain ordre socialement dfini du
monde antique.
Songez ce qu'tait la discipline de ceux qui
s'imposaient, prcisment dans l'introduction de tout
prdicat, dans quelque question que ce ft sur la
vrit, non pas seulement de repousser par un
ni-ni les membres d'une alternative mais de
toujours se dfendre contre l'introduction mme de la
disjonction, celle-la plus apparemment s'imposant, le
refus prcisment de franchir la barre de son
tablissement et de rejeter tout ensemble les deux
membres de la disjonction.
La position donc fondamentale d'un sujet comme
s'imposant son propre arrt au seuil de la vrit est
ici quelque chose qui mriterait sans doute plus
longue explication, retour sur ces textes, sans doute
pars, insuffisants, pleins de problmes mais dont
pourtant la lecture d'un SEXTUS EMPIRICUS
84
peut nous
donner toute l'ampleur, celle qui ne se touche pas
simplement en lire dans quelque manuel le rsum ,
mais suivre au dtour d'un texte qu'il faut
effeuiller page par page le style, le poids,
la ralit du jeu qui y tait engag.
Ce n'est point pour rien qu'ici j'avance cette
rfrence que je donne comme vise aux plus studieux,
fusse leur indiquer d'y trouver dans l'excellent
ouvrage de Victor BROCHARD
85
Les sceptiques grecs
le complment, la situation, le fruit d'une
mditation relle dans un esprit moderne.
Ce n'est point par hasard que je le mets ici au seuil
de ce que j'ai annonc aujourd'hui comme devant tre
mon sujet qui, sans doute ne doit pas tre pour rien
dans l'norme assistance que je recueille, c'est
savoir, le pari de PASCAL.
le pari de PASCAL, j'espre qu'il n'est nul d'entre
vous qui avant aujourd'hui n'en ait eu quelque vent.
84 Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, Paris, Seuil, Coll. Points essais, 1997 (bilingue).
85 Victor Brochard, Les sceptiques grecs, Paris, VRIN, 1923 ; ou Les sceptiques grecs, Gallica, pdf
252
Je ne doute pas que le pari de PASCAL ne soit quelque
chose - j'entends comme objet culturel - d'infiniment
plus diffus qu'on ne le suppose et si l'on
s'merveille qu'il y ait eu quelques textes de
philosophes aprs tout si je devais ici vous en
donner la bibliographie, j'arriverais mon dieu, assez
vite l'puiser, quand j'aurais atteint une
cinquantaine de rfrences du ct de ceux qui
crivent, et qui jugent bon de nous faire part de
leur pense, j'en aurais vu le bout, et tout ce qui a
t dit, je regrette d'avoir noncer une formule si
dprimante
je le regrette d'autant plus que ceci intresse,
si je puis dire, la rputation d'une corporation
dite philosophique
tout ceci ne va pas bien loin.
Je ne serai pas, pourtant, sans vous recommander tel
article, qui se recommande par le procd excellent
d'un dpart au niveau, je ne dirai pas, du texte mais
de l'crit de ce petit papier - ou plutt de ces deux
petits papiers couverts recto et verso - qui est ce
que PASCAL nous a laiss de ce qu'on pourrait appeler
son griffonnage, et qui partant de l, car c'est bien
ncessaire de n'y point voir quelque chose qui aurait
t achev notre adresse mais qui pourtant - et
peut-tre d'autant plus - mrite d'tre retenu comme
nous donnant en quelque sorte, une sorte de substitut
ou de substance relle concernant cette singulire
ralit incorporelle qui est proprement celle dont
j'essaie, avec les ressources d'une topologie
lmentaire, de faire valoir pour vous ce que nous
pouvons en tirer au niveau de nos articulations.
ce titre, l'article de Monsieur Henri GOUHIER
paru dans une revue italienne et dont aprs tout,
j'aimerais vous laisser ici l'indication, revue
italienne qui est celle publie sous le titre de
Archivio di filosofia, n3, l962 organe de l'institut
des tudes philosophiques Di studi filosofici Rome
l'article de Monsieur Henri GOUHIER : Le pari de
PASCAL mrite, si vous pouvez vous procurer le tome
de cette revue, votre attention.[ Henri Gouhier, Le Pari de PASCAL]
253
C'est, comme vous le voyez, un des derniers parus.
Dans le pass il y en a eu bien d'autres depuis les
tonnements de VOLTAIRE
86
, les prcisions de
CONDORCET, les divagations de LAPLACE, le scandale de
Victor COUSIN
87
[Des penses de Pascal]
sur lequel ici je ne m'tendrai pas, n'ayant pas
le temps de vous dire quelle fut la vritable
fonction de ce qu'on appelle l'clectisme [ Cf.09-02 ]
plus rcemment les remarques de mrite qui ont t
donnes par le bon LACHELIER
88
[ Du fondement de l'induction] qui,
assurment, peuvent se lire. Je n'en dirai pas autant
de quelque chose dont je vous donnerai un chantillon
tout l'heure, l'article de DUGAS et RIQUIER dans la
Revue philosophique de l900.
Depuis les choses ont t reprises au niveau de ce
que nous appellerons le pari considr au niveau du
plan de l'Autre. Doit-on parier ?
Parier, comme PASCAL nous l'indique, si tant est que
c'est de cela qu'il s'agisse, ce qu'aurait de certain
le bien de notre vie conue son niveau le plus
ordinaire, pour l'incertitude d'une promesse dont
l'articulation de PASCAL semble toute entire
oriente nous montrer le sans mesure au regard de
ce que nous abandonnerions, introduction dit-on, pour
nous : invite au pari de la croyance, assurment
discernez ds maintenant ce qui se propose dans
l'avance de quelque chose, aprs tout, qui n'est pas
si loin de la conscience la plus commune, cette vague
angoisse de l'au-del qui n'est point forcment un
au-del de la mort, ne faut-il pas qu'elle existe
pour se supporter dans toutes sortes de rfrences
qui, pour les plus exigeants, prennent forme dans ces
espoirs auxquels on se consacre et qui ne sont, dans
cette perspective, au regard de la religion, que
quelque chose que pour le moins nous qualifierons
d'analogique, dans un chapitre court et substantiel,
l'auteur du Dieu cach
89
, Monsieur GOLDMAN ne semble
86 Voltaire, XXV
e
lettre, in Lettres philosophiques, d. F. Deloffre, Paris, Gallimard, Coll. Folio Classiques 1986.
87 Victor COUSIN, Des penses de Pascal. Rapport l'Acadmie Franaise sur la ncessit dune nouvelle dition de cet
ouvrage. Paris, Librairie philosophique de Ladrange, 1846.
88 Jules Lachelier, Du fondement de l'induction , Paris, Alcan, 1898.
89 Lucien Goldman, Le Dieu cach : les penses de PASCAL, Gallimard, Coll. Tel, 1976.
254
pas, pour lui, du tout rpugner faire du pari de
PASCAL le prlude la foi que le marxiste engage
dans l'avnement du proltariat.
Je serais loin de rduire cette porte
dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est
un tant soi peu trop apologtique
la porte d'un chapitre dont la valeur de discussion
est assurment enrichissante, assez sans doute pour
que nous puissions mettre cette part de l'entreprise
au dessus du bricolage.
Mais il me semble que nulle part personne ne s'est
avanc dans ce texte du pari de ce point de vue :
que ce n'est pas un on qu'il s'agit de
convaincre, que ce pari est le pari de PASCAL
lui-mme, d'un Je , d'un sujet qui nous rvle sa
structure, structure parfaitement contrlable et
contrler, non pas de tel ou tel incident qui le
confirme dans le contexte biographique, les gestes de
PASCAL dans une vie dont on a raison de manifester
les pas extrmement complexes, les gestes tels qu'ils
s'achvent dans l'approche de la mort, dans tel ou
tel voeu qui peut nous paratre exorbitant : celui
d'tre men aux incurables pour y achever son
existence, ce serait bien vite les pingler que d'y
relever la thmatique masochiste.
Si un sujet, si une pense qui sait si admirablement
distinguer - vous allez le voir - dans la formulation
stricte de positions essentielles, nous livre en
quelque sorte sa structure, c'est l quelque chose
qui, pour nous, n'a tre reli qu'aux autres points
o, aussi, la structure du sujet en tant que telle
est par lui - dans une certaine position radicale
manifeste - et si nous avons l'honneur de voir
s'affirmer, sans qu'au reste rien ne dise qu'il y et
l un quelconque message car aprs tout, ces petits
papiers, nous les avons, presque aprs sa mort,
la mort n'est peut-tre pas la limite d'aucun au-
del, elle est srement une des limites les plus
faciles utiliser quand il s'agit de faire les
poches. On a fait les poches PASCAL. La chose est
faite, profitons-en. Profitons-en, s'il y a quelque
255
chose qui puisse pour nous nous permettre d'articuler
un des plus singuliers projets, une forme
d'entreprise les plus exceptionnelles qui nous ait
jamais t donne et qui peut passer pour tre la
plus banale comme vous allez le voir.
Infini, rien
90
commencetil, ininterprtable.
notre me est jete dans le corps o elle tourne.
Nombre, temps, dimension, elle raisonne l-dessus et
appelle cela nature, ncessit et ne peut croire autre
chose .
Rappel des puissances de l'imaginaire .
L'unit jointe l'infini ne l'augmente de rien non plus
qu'un pied une mesure infinie. Le fini s'anantit en
prsence de l'infini et devient un pur nant. Ainsi notre
esprit devant Dieu, ainsi notre justice devant la justice
divine. Il n'y a pas si grande disproportion entre notre
justice et celle de Dieu qu'entre l'unit et l'infini.
Je ne rsiste pas au plaisir de ne pas couper ce qui
suit
Il faut que la justice de Dieu soit norme comme sa
misricorde. Or, la justice envers les rprouvs est moins
norme et doit moins choquer que la misricorde envers les
lus. Nous connaissons qu'il y a un infini et ignorons sa
nature. Comme nous savons qu'il est faux que les nombres
soient finis, donc il est vrai qu'il y a un infini en nombre.
Mais nous ne savons pas ce qu'il est : il est faux qu'il soit
pair, il est faux qu'il soit impair car en ajoutant l'unit,
il ne change point de nature. Cependant, c'est un nombre et
tout nombre est pair ou impair. Il est vrai que cela s'entend
de tout nombre fini. Ainsi on peut bien connatre qu'il y a un
Dieu sans savoir ce qu'il est.
Telle est l'introduction dveloppe dans la suite. Je
vous prierai, partir de l, de vous reporter au
texte dont le dpart est proprement que PASCAL,
penseur, et penseur - si vous le voulez - religieux,
intgr la pense que, rprouvs comme lus sont
90 PASCAL, uvres compltes, Paris, Pliade, 1954.
256
entirement la merci de la grce divine, n'en pose
pas moins pourtant comme dmarche inaugurale, que
Dieu, d'aucune sorte de faon et jusque dans son
tre, ne saurait tre connu.
Il pointe mme proprement parler qu'on ne saurait,
de par le pouvoir de la raison savoir s'il existe.
L'important, je vais - j'espre - vous le montrer, et
aprs tout, je ne pense pas l apporter, pour aucun
d'entre vous, quelque chose de si surprenant, vous
avez assez entendu parler, quoique suspendus dans le
vague des problmes de l'existence, pour que vous ne
soyez pas surpris si j'indique - si j'indique en
passant, faute de pouvoir plus aujourd'hui m'y
arrter - que l'important n'est point tant dans ce
suspens - en tant qu'il est radical - que la division
qu'il introduit entre l'tre et l'existence.
Le il existe qui fit tellement de difficults
la pense aristotlicienne pour autant qu'aprs tout
l'tre pos se suffit, il existe parce qu'il est tre
et pourtant, l'intrusion de la rvlation religieuse,
celle du judasme pose
je parle, parmi les philosophes partir
d'AVICENNE
la question de savoir comment caser ce suspens de
l'existence en tant qu'il est ncessaire pour une
pense religieuse d'en remettre Dieu la dcision.
Cette impossibilit de caser d'une faon
catgorisable la fonction de l'existence au regard de
l'tre ft-elle la mme qui ira rejaillir en
question sur Dieu lui-mme, nous garder sur cette
question de savoir s'il suffit de dire de Dieu qu'il
est l'tre suprme.
N'en doutez pas !
Pour PASCAL la question est tranche.
Un autre petit papier cousu, lui, plus profondment
que dans une poche, sous une doublure, non pas Dieu
des philosophes mais Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
257
Jacob
91
, nous montre le pas franchi et qu'il ne s'agit
point de l'tre suprme.
Ds lors, dblayez, dcrassez ces questions
prliminaires qui rendront assurment prcaires
toutes rfrences un donn comme constituant
suffisamment de par soi-mme une certitude.
Quand Messieurs DUGAS et RIQUIER, la fin de leur
article - lisez-le, je ne prtends pas le faire juger
tout entier l'chantillon que je vous en donne -
s'interrogent :
Et maintenant que penser d'une exprience qui se prsente
ainsi : pour entrer dans l'tat d'me du croyant, vous
dpouillerez votre nature, vous ferez table rase de vos
instincts, de vos sentiments, de vos conceptions du bonheur.
ne considrer le pari qu'au point de vue logique, le refus,
de parier pour
On appelle a dans l'argument
je ne vous l'ai pas lu assez loin pour que vous
soyez ce point de vocabulaire
prendre croix. a veut dire pair ou impair, croix ou
pile, il ne s'agit pas de la croix chrtienne.
Mais si nous nous mettons en face des conditions relles du
pari, nous devons dire qu'il y aurait au contraire folie
prendre croix car la foi n'est pas telle que PASCAL
quelquefois la prsente. Elle ne se superpose pas simplement
la raison, elle n'a pas pour effet de reculer les bornes de
notre esprit sans entraver son dveloppement naturel et de lui
donner ainsi accs dans un monde qui lui serait naturellement
ferm. En ralit elle exige l'abdication de notre raison,
l'immolation de nos sentiments. Cet anantissement de notre
91 Cf. PASCAL, Mmorial : DIEU d'Abraham, DIEU d'Isaac, DIEU de Jacob
non des philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix.
DIEU de Jsus-Christ.
Deum meum et Deum vestrum.
Ton DIEU sera mon Dieu.
Oubli du monde et de tout, hormis DIEU.
Il ne se trouve que par les voies enseignes dans l'vangile.
Grandeur de l'me humaine.
Pre juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu.
Joie, joie, joie, pleurs de joie.
Je m'en suis spar:
Dereliquerunt me fontem aquae vivae.
Mon Dieu, me quitterez-vous ?
Que je n'en sois pas spar ternellement.
258
personnalit n'est-il pas le plus grand danger que nous
puissions, humainement courir.
PASCAL, nanmoins, voit ce danger d'un il indiffrent.
Qu'avez-vous perdre ? nous dit-il, tout rempli de ses ides
thologiques - nous voil dans la psychologie - il n'entre pas
dans l'esprit de l'homme purement homme et son discours
s'adresse exclusivement celui qui admet dj, sinon le pch
originel et la dchance de l'homme, du moins la faiblesse de
la raison, la vanit du bonheur terrestre et toute cette
philosophie pessimiste que lui-mme a tir du dogme chrtien -
mais tout esprit qui n'a que la raison pour guide et qui croit
la dignit naturelle de l'homme et la possibilit du
bonheur ne peut manquer de considrer l'argumentation du pari
la fois comme une monstruosit logique et une normit
morale. La duret d'un pareil jugement trouverait au besoin sa
justification ou son excuse dans la remarque clbre de PASCAL
sur la diffrence entre les hommes ou l'originalit des
esprits .
Je vous passe quelques lignes pour arriver jusqu'
cette absolution indulgente :
sa sincrit est vidente, sa franchise absolue et
quelle que soit l'immoralit de ses thses et la faiblesse de
ses raisonnements, on continue respecter son caractre et
admirer son gnie .
Voil qui est envoy.
Poupoule passez-moi mes pantoufles, je lui ai rgl
son compte !
Nanmoins j'aimerais que, faisant appel tout ceci,
qui aprs tout, donne une note qui n'est proprement
parler jamais tout fait absente, au moins comme
tat de ceux qui ont pouss le plus loin l'analyse du
pari de PASCAL, auxquels je ne voudrais pas - faute
de craindre de l'oublier ensuite - manquer de joindre
ceux que je vous ai cits tout l'heure, le
chapitre consacr par Monsieur SOURIAU au pari de
PASCAL dans son livre : L'ombre de Dieu
92
.
L aussi vous y verrez des aperus tout fait
suggestifs et valables dans notre perspective au
92 Etienne Souriau, L'ombre de Dieu, Paris, PUF, Bibliothque de philosophie contemporaine 1955, p. 47-87.
259
regard de la faon dont il convient de manier ce
tmoignage.
Un pari. On a dit sur ce pari beaucoup de choses et
en particulier qu'il n'en tait pas un.
Nous allons voir tout l'heure ce que c'est qu'un
pari. Ce qui fait peur, au dpart, c'est l'enjeu et
la faon dont PASCAL en parle.[ p.1213 ]
Examinons donc ce point et disons : Dieu est ou il n'est
pas . Mais de quel ct pencherons-nous. La raison n'y peut
rien dterminer. Il y a un chaos infini. Tout nous spare. Il
se joue un jeu - attention cette phrase - l'extrmit
de cette distance infinie o il arrivera croix ou pile .
Jamais cette distance infinie, savoir ce qu'elle
veut dire n'a t vraiment pris en considration.
Que gagerezvous ? Par raison vous ne pouvez faire ni l'un
ni l'autre. Par raison vous ne pouvez dfendre nulle des
deux .
C'est PASCAL qui parle.
Ne blmez donc pas de fausset ceux qui ont pris un choix
car vous n'en savez rien.
- Non rpond l'interlocuteur qui est PASCAL
lui-mme aussi mais je les blmerai d'avoir fait, non ce
choix, mais un choix car encore que celui qui prend croix et
l'autre, soient en pareille faute, ils sont tous deux en
faute. Le juste est de ne point parier .
- Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire. Vous
tes embarqus. Lequel prendrez-vous donc, voyons, puisqu'il
faut choisir. Voyons ce qui vous intresse le moins. Vous avez
deux choses perdre (personne ne semble s'tre aperu qu'il
s'agit purement et simplement de les perdre) le vrai et le
bien, deux choses engager : votre raison et votre volont,
votre connaissance et votre batitude.
Quand on engage quelque chose, dans un jeu, dans un
jeu qui se mne deux, il y a deux mises : votre
raison et votre volont est la premire.
Votre connaissance et votre batitude est la seconde
qui n'est point mise par le mme partenaire.
260
Plus tard on discutera sur ce qui est en jeu,
savoir :
gagez donc qu'il est, sans hsiter puisqu'il y a pareil
hasard de gain, et de perte, si vous n'aviez qu' gagner deux
vies pour une, vous pourriez encore gagner . [ p.1214 ]
A la suite de quoi, il nous est promis, en une
formule dont il importe de ne pas mconnatre le
texte, une infinit de vie d'abord, ce qui dplace,
bien sr, les conditions de lenjeu, ce ne sont point
deux vies au lieu d'une, une vie de chaque ct qui
sont mises dans le jeu, mais une vie d'une part et
d'autre part, ce que PASCAL appelle d'abord :
une infinit de vie , puis ensuite :
une infinit de vie infiniment heureuse .
C'est ce que nous aurons reprendre dans un instant
quand nous tudierons ce que signifie un tel pari.
Mais d'abord je voudrais interroger sur ceci qui n'a
point t retenu, c'est savoir ce que veut dire
engager sa vie et comment elle est mise dans le
jeu. Nous voyons PASCAL y faire allusion plusieurs
tapes de son raisonnement :
- Premirement qu'elle ne peut pas ne pas y tre
engage.
- Deuximement la faon dont il conviendra de la
juger si, au terme, le pari est perdu.
Je rponds - dit PASCAL - perdue votre vie , et ici
il articule, mais la perdant vous ne perdez rien.
Singularit de ce rien.
D'abord il s'agit d'une vie, au moins pour un temps,
dans le cas moyen, ce choix n'est point fait au lit
de mort, encore que ceci ne soit point impensable,
une vie que vous aurez vcue.
Cette vie, elle est voque d'autres moments comme
comportant plus d'un plaisir, plaisirs qu'il qualifie
d'empests sans doute mais qui n'en sont pas moins
l, pourvus d'un certain poids puisqu'ils feront
obstacle ce que de ce raisonnement, celui auquel il
s'adresse sente la porte convaincante.
L'ambigut donc de cette vie entre ceci qu'elle est
le cur de la rsistance du sujet s'engager dans le
261
pari et que, d'autre part, au regard de ce dont il
s'agit dans le pari, elle est un rien, ceci est
proprement ce qui doit tre par nous retenu pour nous
faire nous interroger sur ce qui distingue ce rien.
Ce rien a tout de mme cette proprit qu'il est
l'enjeu dont nous allons voir tout de suite ce dont
il s'agit concernant un pari, cette remarque est
justement le quelque chose qui va nous permettre de
donner sa vritable place dans la structure ce
prtendu rien de l'enjeu.
Et si, quand franchissant le terme du discours ,
entre guillemets, pour les y mettre comme Messieurs
DUGAS et RIQUIER - de PASCAL, PASCAL celui qui
vient consentir se soumettre aux rgles du pari
dit pourtant, vous ne pourrez croire que les effets
de mon pari s'identifient ma croyance.
La rponse de PASCAL : Abtissez-vous
93
, celle qui
faisait l'horreur de Monsieur Victor COUSIN, le
premier l'avoir extraite avec l'crit du scandale
des papiers directs auxquels il avait directement
accs, de PASCAL - cet abtissez-vous est
pourtant assez clair.
Cet abtissez-vous est exactement ce que nous
pouvons dsigner par le renoncement aux piges et aux
enveloppes, l'habillement du narcissisme, savoir,
au dpouillement de cette image, la seule que
justement n'ont pas les btes, savoir l'image de
soi.
Ce qui tombe, ce qui choit, au but propos d'une
certaine ascse, d'un certain dpouillement, c'est
proprement ce qui relie dans sa situation dans
l'tre, au niveau de ce qui s'en affirme comme
je suis au champ de l'Autre, de ce qui dans le
sujet relve de la mconnaissance de soi. Est-ce
dire, si nous devions prendre pour gal au nant le
rien qui reste, comment pourrait-il alors jouer son
rle d'enjeu.
Ce rien, est-ce que - j'introduis ici la question -
nous ne pouvons pas l'identifier cet objet toujours
fuyant, toujours drob, ce qui est aprs tout,
93 p.1215-16 : Suivez la manire par o ils ont commenc : c'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau b-
nite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement mme cela vous fera croire et vous abtira.
262
espoir ou dsespoir, l'essence de notre dsir, cet
objet innommable, insaisissable, inarticulable
et pourtant que le pari de PASCAL va nous permettre
d'affirmer selon la formule que PLATON emploie dans Le
Phdon
94
concernant ce qu'il en est de l'tre comme
quelque chose quoi correspond un discours
invincible.
Le(a) comme cause du dsir et valeur qui le
dtermine, voil ce dont il s'agit dans l'enjeu
pascalien. Qu'est-ce qui nous permet de le confirmer?
Assurment, je viens de le dire, le fait qu'il est
engag comme enjeu dans le pari. Pour ceci, il
convient de dbrouiller les obscurits qui concernent
ce que c'est qu'un pari. Un pari c'est un acte auquel
beaucoup se livrent. J'ai dit c'est un acte : il n'y
a pas en effet de pari sans quelque chose qui emporte
la dcision. Cette dcision est remise une cause
que j'appellerai la cause idale et qui s'appelle le
hasard.
Aussi bien, faisons trs attention d'viter ici
l'ambigut qui consisterait insrer le pari de
PASCAL dans les termes de la moderne thorie - non
encore ne cette poque - de la probabilit.
La probabilit est ce que le dveloppement de notre
science rencontre au dernier terme d'une certaine
veine d'investigation du rel.
Et pour manifester la permanence de la prsence de
cette ambigut dont j'voquai seulement tout
l'heure le profil concernant le rapport l'tre, je
94 Le Time ! Platon, Time, 29b, Site Remacle, : Dans ces conditions, il est aussi absolument ncessaire que ce monde-ci soit
limage de quelque chose. Or en toute matire, il est de la plus haute importance de commencer par le commencement naturel.
En consquence, propos de limage et de son modle, il faut faire les distinctions suivantes : les paroles ont une parent naturelle
avec les choses quelles expriment. Expriment-elles ce qui est stable, fixe et visible laide de lintelligence, elles sont stables et
fixes, et, autant quil est possible et quil appartient des paroles dtre irrfutables et invincibles, elles ne doivent rien laisser
dsirer cet gard. Expriment-elles au contraire ce qui a t copi sur ce modle et qui nest quune image, elles sont
vraisemblables et proportionnes leur objet, car ce que ltre est au devenir, la vrit lest la croyance. Si donc, Socrate, il se
rencontre maint dtail en mainte question touchant les dieux et la gense du monde, o nous soyons incapables de fournir des
explications absolument et parfaitement cohrentes et exactes, nen sois pas tonn ; mais si nous en fournissons qui ne le cdent
aucune autre en vraisemblance, il faudra nous en contenter, en nous rappelant que moi qui parle et vous qui jugez, nous ne
sommes que des hommes et que sur un tel sujet il convient daccepter le mythe vraisemblable, sans rien chercher au-del.
( ) .
263
ne puis ici que rappeler comment - comme dirait
PASCAL - se marquent les diffrences des esprits ,
ce qui n'est point une remarque psychologique mais
une rfrence la structure du sujet.
La rpugnance marque - par exemple dans une lettre
Max BORN - d'EINSTEIN
95
pour cette dernire ralit
qui ne serait qu'un joueur de ds, l'attachement
foncier et proclam de la part d'un esprit qui y
engageait la plus haute autorit scientifique de son
temps, pour la supposition dun tre - malin sans
doute mais qui ne trompe pas - savoir, une certaine
forme, encore parfaitement subsistante au centre
d'une pense scientifique d'un tre divin, voil qui
mrite d'tre rappel au seuil de ce en quoi nous
allons nous engager et qui est proprement - ceci ne
peut tre dfini qu'au moment de ce seuil, de ce pas,
de ce franchissement radical de PASCAL, savoir - le
terme strictement oppos d'un hasard dfini.
Car qu'est-ce que le hasard ?
Le hasard se rattache essentiellement, la
conception du rel en tant qu'impossible, ai-je dit
- impossible quoi complterai-je aujourd'hui -
impossible interroger, impossible interroger
parce qu'il rpond au hasard .
Qu'est-ce dire de cette forme du rel ?
Nous pouvons considrer, ne serait-ce que pour un
instant et pour situer le sens de ce que nous
articulons comme le mur, la limite le point auquel
nous essayons, au dernier terme par l'exploration de
la science de finir par rejoindre, le point ou il n'y
a plus rien en tirer quune rponse au hasard.
La science n'est point acheve, mais la progressive
monte d'une pense qu'on appelle trs improprement
indterministe pour autant que le niveau du rel que
nous interrogeons nous y oblige, peut nous permettre
au moins de suggrer cette perspective o
s'inscrirait le savoir scientifique, s'il est
95 Albert Einstein, dans une lettre Max Born du 04.12.1926 : La mcanique quantique force le respect. Mais une voix
intrieure me dit que ce nest pas encore le nec plus ultra. La thorie nous apporte beaucoup de chose, mais elle nous
rapproche peine du secret du Vieux. De toute faon, je suis convaincu que lui, au moins, ne joue pas au ds .
Albert Einstein, Max Born, Correspondance 1916-1955 , Paris, Seuil, 1972.
264
prcisment ce que je vous dis, c'est-dire
renonciation au connatre du mme coup l'tre,
n'est-ce point dans la mesure o ce dont il s'agit
c'est de construire sous forme des instruments
scientifiques ce qui - au cours de cette vise de
rejoindre au rel, le point de hasard - nous a t
command comme instrument qui soit capable de la
rejoindre.
Qu'est-ce qu'un d sinon un instrument fait pour
faire surgir le pur hasard. Dans l'investigation, du
rel, tous nos instruments peuvent n'tre conus que
comme l'chafaudage grce quoi, pntrer plus
avant nous arrivons jusqu'au terme de l'absolu
hasard.
Je ne dis point que je tranche en cette matire. Sans
doute, ils ne pourraient tre suffisamment articuls
qu' entrer, d'une faon bien plus prcise, dans les
laborations que notre treinte avec la physique nous
contraignent de donner au principe de la probabilit.
Mais nous sommes l un niveau beaucoup plus
lmentaire. Est-ce que, avant que naisse cette
thorie de la probabilit qui assure ce registre,
si je puis dire, son srieux scientifique, nous ne
devons pas nous interroger sur ce que signifie la
premire spculation sur le hasard indispensable
toujours mettre en exergue de toute spculation sur
la probabilit. Ouvrez n'importe quel livre - il y en
a de bons, il y en a de mauvais
il y en a un bon, que je vous cite au passage,
Le hasard de Monsieur Emile BOREL
96
, simplement du
fait qu'il vous ramasse au passage une srie
d'objections, de questions absurdes, rien de plus
intressant pour nous que les stultiti questiones
97
Vous y verrez que, pour ceux qui commencent donner
corps, donner forme cette question sur le hasard,
quand j'ai dit tout l'heure donner corps et
voquant cette dification de notre science, il me
vient en cho la formule qui avait en quelque sorte,
prenant des notes, jailli de ma plume : que dans le
96 uvres d Emile Borel, Ed. du CNRS, 1998.
97 questions absurdes, insenses
265
reprage sur ce mur de hasard, notre science, dans
ses instruments, donnerait corps la vrit.
Mais qu'est-ce qui hante quiconque taquine, au niveau
le plus accessible et le plus lmentaire, ce jeu du
hasard. Les singes dactylographes au bout de combien
de temps auront-ils crit avec leur machine un vers
d'Homre ? Quelle est la chance qu'un enfant qui ne
connat pas l'alphabet ne range d'emble dans le bon
ordre les lettres ? Quelle chance y atil qu'un
pome sorte de suites de coups de ds ?
Ces questions sont absurdes.
Toutes ces ventualits, il n'y a aucune objection
ce qu'elles se ralisent du premier coup.
Simplement que nous y pensions quand nous
introduisons cette fonction du hasard prouve ce que
signifie pour nous la vise de cette cause.
Elle vise la fois ce rel dont il ny a rien
attendre
ce qu'un pote en l929 crivait dans une petite
revue introuvable :
le mal aveugle et sourd, le dieu priv de sens
98
et en mme temps, elle en attend de se manifester
comme un sujet.
Mais aprs tout, o en venons-nous ?
Mme si les enjeux sont gaux
ce qui est toujours ce dont on part pour
commencer d'apprcier ce qui est en jeu dans un
jeu de hasard
que les chances, comme on dit, ou encore l'esprance
mathmatique, terme trs impropre, soient gales un
demi, ici commence qu'il vaille la peine d'tre jou.
Et pourtant, il est bien clair que si la chance n'est
qu'un demi, vous ne ferez, partie mise gale, que
rcuprer la vtre, ce qui ne veut rien dire.
C'est donc qu'il y a dans le risque quelque chose
d'autre qui est engag.
Ce qui est engag, ce qui est l'horizon subjectif
de la passion du joueur est ceci que au terme de
l'acte, car il faut qu'il y ait acte et acte de
98 J. Lacan, Hiatus irrationalis (6 aot 1929), Le Phare de Neuilly, 1933, n 314. Rdit en 1977 dans le numro 121 du
Magazine littraire
266
dcision, au terme de ceci dont il faut d'abord qu'un
certain cadre signifiant ait dfini les conditions -
je ne l'ai pas encore abord jusqu'ici parce que
c'est l que nous allons entrer ensuite - une rponse
pure, donne l'quivalent de ce qui en effet est
toujours engag comme rien, puisque la mise est mise
l pour tre perdue, qu'elle incarne pour tout dire
ce que j'appelle l'objet perdu pour le sujet dans
tout engagement dans le signifiant et qu'au-del une
autre chane suppose tre signifiante et d'un autre
ordre de sujet, livre quelque chose qui ne comporte
pas d'objet perdu et de ce fait dans la squence
russie nous le rend.
Tel est le principe pur de la passion du joueur.
Le joueur se rfre - dans un certain au-del qui est
celui que dfinit le cadre du jeu - se rfre un
mode de rapport autre du sujet au signifiant, qui ne
comporte pas la perte du (a). C'est pourquoi il est
capable s'il est joueur, et pourquoi le dprcier si
vous ne l'tes pas, vous n'avez aucun doute, sur
les tmoignages les plus importants de la littrature
qu'il y a l un mode existentiel et que si vous ne
l'tes pas, c'est peut-tre simplement de ne pas vous
apercevoir jusqu' quel point vous aussi l'tes, ce
que j'espre bientt vous montrer, comme fait PASCAL
qui vous dit que vous tes, que vous le vouliez ou
non, engags.
Ici il faut nous arrter un instant sur la faon
dont, avant le pari, PASCAL a proprement essay de
donner substance si je puis dire, cette rfrence -
qui peut vous paratre hardie - que je vous donne de
la prsence de l'objet qui se retrouve dans la
squence hasardeuse. Je vous expliquerai, sans doute
pas aujourd'hui mais la prochaine fois (vu que
l'heure me limitera), pourquoi, PASCAL dans le pari,
n'voque pas qu'un jeu - et spcialement celui-l, et
spcialement celui-l pour, disons vite il est tard,
un jansniste - se joue en plusieurs coups.
Mais une chose - l'poque mme o il commenait
d'crire Les Penses et o personne ne peut savoir s'il
avait dj crit les petits papiers du pari - une
chose a t par lui, travaille dont il tait trs
267
fier. Elle est essentielle rappeler parce que, dans
la triade qui est de sa propre plume et qui rsume
les trois temps du pari
dont je n'aurai donc aujourd'hui parcouru que
deux, rservant pour la prochaine fois le
troisime, pyrrhonien - nul accs la
vrit,gomtre, gomtrie du hasard
c'est en ces termes que PASCAL s'adresse la
socit mathmatique parisienne devant laquelle il
prsente certains des rsultats de son triangle
arithmtique.
Il appelle lui-mme stupfiante cette capture, ce
licol par lui pass de la gomtrie au hasard. Il
dialogue longuement avec FERMAT, esprit sans doute
minent mais que sa position dans la magistrature de
Toulouse, sans doute, disons distrayait de la stricte
fermet ncessaire aux spculations mathmatiques.
Car ils ne sont point d'accord sur ce qu'on appellera
- vous verrez ce que c'est dans la suite - la valeur
des parties, c'est que justement, trop prmaturment,
FERMAT entend les traiter au nom de la probabilit,
c'est--dire de la srie des coups, arrangs selon la
suite des rsultats combinatoires entre ce qu'ils
donnent, disons avec PASCAL : croix ou pile .
PASCAL a un tout autre procd.
C'est ce qui s'appelle dans PASCAL la rgle des
parties. Je vais essayer de la mettre tout de suite
la porte de votre main. Je vous conseille nanmoins
de vous mettre trs srieusement la lecture
dans l'dition BOUTROUX, GAZIER, BRUNSCHVICG
99
au livre III du volume III
la lecture de ce qu'il en est non seulement de la
rgle des partis, mais du triangle mathmatique.
Parce que vous verrez, ce momentl, que a ne se
livre pas tout de suite, encore que encore que c'est
- comme je vais vous le dire - pour la premire fois
que PASCAL le prsente FERMAT ou Monsieur
99 PASCAL, uvres, Lon. Brunschvicg, P. Boutroux, F. Grazier, 11 vol., Paris, Hachette, Collection les Grands Ecrivains de
la France, 1908-1914.
268
DE CARCAVI, je ne me souviens pas.
Une partie se joue en deux coups. Ceci suppose que
les mises sont l. Nous disons provisoirement
qu'elles sont gales. On joue un coup. je gagne. Mon
partenaire dsire arrter l la partie. Je souligne
cette scansion qui est abrge dans PASCAL. Il parle
tout de suite d'un commun accord. Or, nous le
reverrons, ce commun accord mrite d'tre interrog.
Je suis d'accord. Quest-ce que nous allons faire,
puisque personne n'a gagn, si le hasard dont il
s'agit c'est par exemple que deux fois la picette
sorte de suite croix , sur lequel j'aurais pari,
simple supposition. Je n'ai pas gagn, et pourtant
PASCAL dit
et affermit dans un dveloppement qui donne
l'articulation dont il va s'agir tout son poids
car il en rsulte une thorie mathmatique dont
les dveloppements sont trs amples et c'est
cette ampleur que je vous priais tout l'heure,
en attendant de me rentendre la semaine
prochaine, de vous reporter.
PASCAL dit :
Ainsi doit raisonner le gagnant pour donner son accord.
Il doit dire : j'ai gagn une partie .
Ceci n'est rien auprs du pari puisque le pari c'est
que j'en ai gagn deux et pourtant cela vaut quelque
chose car si nous jouons la seconde maintenant ou
bien je gagne le tout, l'enjeu, ou bien si c'est vous
qui gagnez nous sommes au mme point qu'au dpart,
c'est--dire que si nous nous sparons , je rpte,
d'un commun accord chacun reprend sa mise.
Donc pour consentir
moi qui suis gagnant maintenant l'interruption du
jeu, il y a ceux qui partent et ce qui le font
repartir :
Parturi cognoscant partitura jusque, ou bien, j'ai
reprendre ma mise ou bien je gagne le tout.
Je vous le demande comme lgitime de prendre la
moiti de votre mise. C'est de l que PASCAL part
pour donner son sens ce que signifie un jeu de
269
hasard. Ce qui n'est pas mis en valeur c'est que si
c'tait moi le gagnant qui interrompe, mon
adversaire serait tout fait en droit de dire :
pardon, vous n'avez pas gagn, et donc, vous n'avez
rien demander sur ma mise !
La substance, l'incarnation que donne PASCAL de la
valeur de l'acte mme du jeu, spar de la squence
de la partie, voil o se dsigne que ce que PASCAL
voit dans le jeu, ce sont prcisment un de ces
objets qui ne sont rien et qui peuvent quand mme
s'valuer en fonction de la valeur de la mise car
comme il l'articule fort bien - cet objet
dfinissable en toute justesse et toute justice dans
la rgle des partis, c'est l'avoir sur l'argent de
l'autre, dit-il.
Il est deux heures et ces choses dans lesquelles je
m'avance dont vous verrez qu'au dernier terme, nulle
part l o je vous ai dit les choses aujourd'hui,
n'est le pari, puisque le pari est - dans le pari de
PASCAL - sur l'existence de l'Autre. Que ce pari
tienne pour sres les deux lignes spares par une
barre : Dieu existe/Dieu n'existe pas, savoir que,
non pas comme on l'a dit, le pari de PASCAL reste
suspendu parce que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas
de pari puisqu'il n'y a ni Autre, ni mise.
Bien loin de l, la structure qu'avance le pari de
PASCAL, c'est la possibilit, non seulement
fondamentale mais je dirai essentielle, structurale,
ubiquiste dans toute structure du sujet que le champ
par rapport auquel, s'instaure la revendication du
(a), de l'objet du dsir, c'est le champ de l'Autre
en tant que divis au regard de l'tre mme, c'est ce
qui est dans mon graphe comme S, signifiant du A
barr : ( ) A .
Table des sances
270
09 Fvrier l966 Table des sances
Comme il arrive que je donne au dbut d'une de mes
leons quelques rfrences de ce qui, dans la sphre
de mon enseignement, se passe ailleurs, j'voquerai
aujourd'hui, au dpart, quelque chose dont la
pertinence - bien sr entire - n'apparatra qu'
ceux ayant assist une sance d'hier soir de notre
cole freudienne, mais qui pourtant, pour tous les
autres, reprsentera une introduction la mise au
point - au sens photographique du terme - que va
constituer mon discours d'aujourd'hui, par o,
j'achverai, je l'espre, ce que j'ai dire du pari
de PASCAL quant ce qu'il conditionne d'essentiel du
rapport engag dans la psychanalyse.
C'est d'o je partirai donc comme un prambule qui
est en mme temps parenthse, c'est d'une remarque
trs abrge, forcment, concernant ce fantasme qu'on
appelle, et qui est en question sous le nom de
masochisme fminin.
Qu'on m'entende ! J'nonce que le masochisme fminin
est, au dernier terme, le profil de la jouissance
rserve qui entrerait dans le monde de l'Autre, en
tant que cet Autre serait l'Autre fminin, c'est--
dire : la Vrit.
Or la femme - la femme si l'on peut en parler, la
femme qu'on essayait hier soir de mettre en suspens
dans une typique essence qui serait celle de la
fminit - entreprise fragile - la femme
disons pour autant que comme FREUD le dveloppe
et l'nonce, un dpart distinct de l'homme dans
ce jeu qui s'engage, o il s'agit de son dsir
la femme n'est pas plus dans ce monde que l'homme.
Sans doute, il arrive qu'elle le lui reprsente sous
la forme de l'objet(a), mais il faut le dire, c'est
ce qu'elle se refuse nergiquement tre, puisque
son but est d'tre i(a) comme tout tre humain, que
la femme est narcissique comme tout tre humain, et
271
que c'est dans cette distance, cette dchirure qui
s'installe, de ce qu'elle veut tre, ce qu'on met
en elle que s'instaure cette dimension, qui se
prsente dans le rapport de l'amour comme tromperie.
Ajoutons que ce narcissisme, c'est l'impasse, la
grande impasse de l'amour dit courtois : qu' la
mettre en la position du (I) de l'idal du moi au
champ de l'Autre - point de repre o peut
s'organiser ce statut de l'amour - ce narcissisme, on
ne peut que l'exalter, c'est--dire accentuer la
diffrence.
Dans ces quelques termes se repre l'impasse qu'il y
a essayer de dfinir, comme une fonction qui
s'isolerait, la fminit.
Rien, ici, donc ne se repre qu'en ce terme, il est
un ple fminin du rapport, du rapport la chose et
que fminin est ce terme de la vrit. Le fminin est
radicalement trompeur sous toutes les formes o il se
prsente. Ceci nous servira de dpart pour reprer
les trois distances o peut s'accommoder le champ de
cette recherche, que toujours l'ambition des
philosophes a signal comme recherche de la vrit.
Le danger qu'assume l'analyste en prenant la place de
guide sur ce chemin estil celui que le mythe
d'ACTEON signale comme l'impossibilit de surprendre
la mouvance o se dessine notre destin comme celui
que commandent les trois Parques :
CLOTHO, LACHESIS, ATROPOS, forme trinitaire du Dieu
foncier, archaque, ancestral, celui dont nous spare
l'autre rvlation, dont nous aurons tout l'heure
reprendre le repre, travers Le Pari de PASCAL qui
accommode sur la fonction du pre, ce qui nous
contient dans une interdiction dtermine l'endroit
de la Jouissance dernire.
Dj, l'nonc inaugural de la pense de FREUD nous
signale l'importance de sa suspension, de la
suspension de toute sa pense autour de cet interdit
du pre dont nous verrons apparatre, tout l'heure,
sous une autre forme, la formule.
Si, dans les annes qui ont prcd, c'est sur le
cogito cartsien que je vous ai appris vous
arrter
272
pour vous reprsenter comment se dessine la
schize, l'Entzweiung, la division radicale o se
constitue le sujet, reconnatre dans la formule
du Je pense lui-mme, que le point o se
saisit la rupture de l'tre du Je pense ne
s'affirme que d'un point de doute
c'est pour approcher, d'une faon plus sre, cette
formulation plus pure, que la mme fonction du sujet
- cette fois radicalement en fonction du dsir - que
nous donne Le Pari de PASCAL que jai ouvert
les Penses.
Car assurment, ce qui dj dans le cogito cartsien
suffit fonder l'tre du sujet
en tant que le signifiant le dtermine comme ne
se saisissant qu'au point o, autour de
l'affirmation du Je pense , il s'est rduit
ce point de doute tel quil n'a plus aucun sens
sinon qu' ouvrir les guillemets de la conclusion
qui lui donne toute sa substance le donc je
suis comme contenu de la pense sans pour
autant qu'il rejette dans une rtroposition le
je suis d'tre de ce Je pense , je suis
celui qui pense : donc je suis .
0r si nous retrouvons la voie de FREUD, considrer
qu'en ce doute est toute la substance de l'objet
central qui divise ainsi l'tre du je pense
lui-mme, cest pour autant que dans ce doute FREUD,
dans sa praxis, nous fait reconnatre le point
d'mergence de cette faille du sujet qui le divise et
qui s'appelle linconscient.
Le point de suture, le point de fermeture inaperu
dans le je pense donc je suis , c'est l que nous
avons reconstruire toute la part lide de ce qui
s'ouvre, que nous rouvrons de cette bance et qui ne
peut
sous toute forme du discours qui est le discours
humain
apparatre que sous la forme du trbuchement, de
l'interfrence, de l'achoppement dans ce discours qui
se veut cohrent.
273
Pourtant, ce qu'il y a qui fonde ce discours n'est
par l point saisi : discours du dsir, nous dit-on,
mais quy a-t-il qui fasse que nous puissions dire,
que ce par quoi nous pouvons y suppler c'est le
tenant lieu de reprsentation. Vous entendez bien que
c'est ici indiquer la place o fonctionne ce qui
soutient comme divis tout ce qui se ralise du sujet
dans le discours, que c'est l la place o nous avons
chercher la fonction de l'objet(a).
Le doute de DESCARTES est encore en ce passage d'une
opration de balance, dubio dubito , c'est
l'habitude, je m'emploie faire osciller ces
plateaux de la balance. C'est autour d'une mise
l'preuve du savoir au regard de la vrit de ce
quil en est ou n'en est pas du vrai savoir.
Bien sr HEIDEGGER
100
a belle part reprsenter qu'est
abandonn le fond - irrmdiablement refoul
de l'Althia, l'Urverdrngung. Si ce n'est pas ainsi
qu'il la nomme, c'est ainsi que nous pouvons
l'identifier.
Mais ce rappel est fragile de ne reprsenter qu'un
retour une mouvance sans issue, conformment au
terme qui est employ l'origine de la pense
grecque c'est de l (tos) qu'il s'agit, de
l'Echt de l'authentique.
DESCARTES installe en mme temps qu'il rvle, son
insu, la division du sujet autour de l'opration de
mise l'preuve - opration ngative, impossible -
de reconnatre comment penchent les plateaux autour
du vrai savoir. Il n'en retire que la certitude de
l'preuve opre et que c'est dans ce doute du sujet
que s'insre la certitude. Pour reprendre et faire un
pas de plus, il faudra qu'il ramne l'argument
antique par o ce qui imprime dans l'ordre de nos
penses, l'ide de perfection, se doit de garantir le
chemin de notre recherche.
100 Martin HEIDEGGER, De l'essence de la vrit, in Questions I, op. cit., p. 181.
274
Assurment, on peut pointer et dessiner, dj ici, la
distance qu'il y a de prise, au regard de l'argument
ontologique dont vous reconnaissez pourtant, ici, la
forme, et qui pour avoir eu son prix dans
l'exploration du champ de l'tre ne mrite plus, pour
nous, d'tre ressaisi que sous cette forme qui y
apparatra certaine, qui sa rflexion aura assez
montr que l'ide de perfection ne s'bauche et ne se
forme que sur le modle de la comptition, de la bte
de concours, et que sa substance n'est pas autre que
celle dont le porc peut rver quant l'obsit de
son chtreur. Je n'aime pas le vain blasphme et l'on
doit savoir que ce que je vise ainsi, ce n'est certes
pas la vise de certains, d'un certain dvoiement
concernant l'interrogation sur l'tre divin, mais
celle o un certain dtail philosophique s'obstine
rester enlis.
Si bien qu'il faut remarquer que la dmarche de
DESCARTES tire l'pingle du jeu du sujet, au regard
du Dieu suppos trompeur, et qu' se retourner vers
l'autre Dieu pour lui rendre la charge entire, son
arbitraire, de fonder les vrits ternelles, la
question - elle est importante pour nous - est de
savoir si dans ce jeu - puisque dj l'pingle est
retire du jeu - c'est bien le sujet qui doute et que
mme le Dieu trompeur ne saurait lui retirer ce
privilge, celui, mme parfait, vers lequel il se
retourne n'est pas alors - et je le dis, fort de ce
que DESCARTES a pens avant moi - n'est pas, ds
lors, un Dieu tromp.
Ce point sensible est important pour nous et dans
notre recherche, pour autant que c'est au pige de la
forme idale - comme en quelque sorte prforme,
ante-pose au chemin o nous avons guider la
recherche du sujet - que proprement l'idal de
perfection a se tromper.
Ce dont il y a faire concernant l'acte du mdecin,
dit proprement Platon, c'est cette image, qu'il a,
lui le mdecin, dans l'me.
275
N'est ce pas dire l'importance exacte qu'il y a, la
reprsentation que nous avons faire, nous faire
de la nature de l'enjeu quand il s'agit de l'ordre de
rapport la vrit seule accessible et dfinie par
les conditions o nous engageons l'exprience qui se
limite celles o le sujet est form, et est dans la
dpendance du signifiant comme tel.
Voil ce qu'apure la structure du Pari de PASCAL.
Quelque part, en un de ses points nombreux o se
prfigure, dans ces dialogues de PLATON - qui sont
bien loin, bien sr, de nous livrer une doctrine, en
quelque sorte unilatrale, rapport de tout ce qui
est, tout ce qui est ide, cet tos dont je
parlais tout l'heure, qui en donnerait l'essence de
tout ce qui, dans l'tre, subsiste bien loin de l
tout instant - nous trouverons des rfrences faites
pour nous orienter et nommment celle-ci :
qu'entre l'tre ternel qui n'existe pas, et ce qui
nat et meurt mais qui n'est pas, le signe, la pierre
de touche, doit nous tre donn en ceci, que si le
premier subsiste il doit se supporter d'un discours
invincible. C'est bien encore ce que nous cherchons,
ceci prs, que ce discours est celui qui doit nous
permettre de reconnatre, dans ce champ qui est le
ntre - d'une existence cerne entre la naissance et
la mort - ce que ce discours l peut tenir qui soit
de cet ordre invincible
101
.
Et c'est ici que nous introduit le discours de
PASCAL. Nul tonnement qu'il ne parte de cette
rfrence l'au-del, de la vie et de la mort, mais
ce n'est pas, je ne dirai pas comme il semble, mais
bel et bien, comme tout un chacun s'en aperoit et
s'en scandalise. Tous ces messieurs de l'idologie
spiritualiste ici se redressent et font la petite
bouche, comment parler de ce qui est d'une si haute
dignit, en termes de ces joueurs qui sont la lie de
notre socit. Au temps de Victor COUSIN seuls les
bourgeois ont le droit de se livrer l'agio.
101 Cf. note 94 sur le Time, fin de la sance 02-02-66
276
Et ceux auxquels sera donne dans la socit la
charge de penser ce qui se passe, ceux qui
pourraient avertir le peuple de ce dont il s'agit
effectivement dans ce qu'on appelle la marque du
progrs, sont pris de rentrer dans cet ordre de
dcence, auquel j'ai voulu donner tout l'heure sous
une forme scandaleuse, son enseigne norme : celle du
porc chtr, autrement dit de rester dans les limites
de dcence de la pense qu'on appelle l'clectisme.
N'avez-vous remarqu que dans ce pari concernant
l'au-del, PASCAL ne nous parle pas - jamais personne
n'a vu a - de la vie ternelle. Il parle d'une
infinit de vies infiniment heureuses. a fait
toujours des vies a ! Et en fin de compte, les
appeler ainsi, il leur garde leur horizon de vie, et
la preuve c'est qu'il commence par dire : Est-ce que
vous ne parieriez pas seulement pour qu'il y en ait
une autre ?
Celui que j'ai appel tout l'heure, je veux dire la
dernire fois, le bon LACHELIER ,eh bien il est bien
gentil : il s'arrte l. Il dit quand mme, qui est-ce
qui parierait pour avoir seulement une seconde vie ?
Retrouvez le passage, je l'ai cherch frntiquement
tout l'heure, vous le retrouverez aisment
102
.
C'est que je ne lui reproche pas ce manque
d'imagination, mais n'est-il pas vrai, simplement,
qu' couvrir son petit bonhomme de chemin d'plucheur
des chances en jeu dans le Pari, il nous invite, nous,
nous poser vraiment la question.
Qu'est-ce qui se passe, effectivement
et cela ne vaudrait-il pas la peine d'engager un
pari seulement avec quelques chances
quant cette vie entre la naissance et la mort,
cette vie qui est la ntre, d'en avoir peut-tre une
seconde ?
102 PASCAL, Penses, d. Havet, 1851, Paris, p.148.
277
Laissons-nous laissons-nous arrter un instant
autour de ce jeu, peut-tre un peu plus arms que
d'autres pour saisir ce qu'apporterait d'irrductible
diffrence, de franchissement, que nous puissions
penser ainsi. Car il faut que ces deux vies soient,
chacune, entre la naissance et la mort, mais il
faudrait aussi que ce soit le mme sujet. Tout ce
qu'on aura jou prcisment dans la premire, nous
savons que nous le pourrons jouer autrement dans la
seconde. Mais nous ne saurons toujours pas, pour
autant quel est l'enjeu.
Cet objet inconnu qui nous divise entre le savoir et
la vrit, comment ne pas esprer que la seconde vie
nous donnera vue sur la premire, que pour un sujet
le signifiant ne sera pas ce qui reprsente le sujet
- l'infini - pour un autre signifiant, mais pour
l'autre sujet que nous serons aussi ?
Comment, cet autre sujet, ne pas en esprer le
privilge, qu'il soit la vrit du premier ? Dans
d'autres termes, ne voyons-nous pas ici dans cette
imagination - phantasme du phantasme - s'claircir ce
qui sous le nom de phantasme joue, au secret de cette
vie qui est bien telle que nous n'en avons qu'une et
que jusqu' la fin l'enjeu peut nous tre cach.
Cette supposition implicite aux Parques - telle que
nous le lisons, si nous le lisons la chandelle de
l'irrflexion o se suspend tout notre sort - cette
supposition, qu'aprs la mort nous en aurons le fin
mot - savoir que la vrit sera patente si oui ou
non ,il y aura l pour la tenir le Dieu de la
promesse - qui est-ce qui ne peut pas voir que cette
supposition implicite toute l'affaire, c'est elle
qui la met vritablement en suspend.
Pourquoi aprs la mort, si quelque chose y perdure,
n'errerions-nous pas encore dans la mme perplexit ?
Le jeu pascalien concernant cette infinit de vie,
multiplie par l'infinit d'un bonheur qui doit bien
avoir quelque rapport avec ce qui se drobe la
ntre, ne peut qu'avoir un autre sens, qui n'a rien
faire avec la rtribution de nos efforts aveugles, et
c'est bien pour a qu'il est cohrent que l'homme
dont la foi tait toute entire suspendue ce
278
quelque chose dont nous ne savons mme plus parler -
qui s'appelle la grce - est dans une position
cohrente quand il droule sa pense concernant
l'enjeu, l'enjeu qui est celui du bonheur, savoir
de tout ce qui cause le prissable et l'chou de
notre dsir, que cet enjeu du bonheur est de nature
rechercher sur le fond du pari.
Cet objet(a) que nous avons vu surgir dans cet au-
del imaginable - dj de faon toute proxime
seulement imaginer une vie seconde - ce n'est pas
quelque chose que la pense religieuse n'ait pas dj
sond.
Ceci s'appelle la communion des saints. Nul de ceux
qui vivent l'intrieur d'une communaut de foi qui
a quelque rapport avec ce fondement du bonheur, n'est
sans tre intress ce que, quelque part, ce
bonheur soit conquis par d'autres, de nous ignors.
Cette conception est cohrente de ce que chacune de
nos vies - nous autres du commun - n'est rien d'autre
que le rve suspendu au mrite de quelque inconnu, et
que ce qui s'exprime traditionnellement dans ce thme
exploit par tout un thtre qui va plus loin dans la
dignit que vous ne pouvez le sonder d'abord, si vous
pensez que le thtre, de SHAKESPEARE lui-mme en
relve, celui dont le thme est que la vie est un
songe.
Au regard de cette perspective, le Pari de PASCAL
signifie le rveil. L'troitesse mme du rapport
l'autre concerne cette doctrine de la prdestination
et de la grce dont - ds mon Rapport de Rome -
j'indiquais qu'au lieu de mille autres occupations
futiles, les psychanalystes y tournent leurs regards.
Tel est dj, l dessin, le point d'impact o nous
pouvons
ainsi qu' la fin d'un article intitul
Remarques
103
sur un certain discours auquel je
vous prie de vous reporter
marquer le point o, d'ores et dj je dsirais vous
diriger, au regard de la fonction de ce pari.
103 crits p.647 ou t.2 p.124 .
279
Car maintenant nous pouvons voir ce que signifie ce
Pari, unique en ceci que l'enjeu y est l'existence du
partenaire. Si PASCAL peut mettre en balance ce
quelque chose qui n'est point le tout, mais
l'infini
qui s'ouvre, seulement savoir le reconnatre en
ce point o nous avons appris l'anne dernire
dsigner substantiellement la fonction du manque
savoir le nombre o l'indfini n'est que le
masque du vritable infini qui s'y dissimule et
qui est justement celui ouvert par la dimension
du manque
le mettre en balance avec ce qui se dsigne dans
le champ du sujet comme objet cause du dsir, qui se
signale de n'tre rien apparemment, et de cette
confrontation mme du balancement port au-del, au
niveau du champ de l'Autre
de ce champ o pour nous se dessine toute la mise
en forme signifiante laquelle PASCAL nous dit :
vous ne pouvez pas chapper, vous tes embarqus,
dj. c'est ce que le signifiant supporte, tout
ce que nous apprhendons comme sujet, nous sommes
dans le pari et c'est celui qui il
appartiendra - comme il fut donn PASCAL - d'en
reconnatre les formes les plus pures, les plus
voisines de cette fonction du manque
c'est l autour de cette oscillation frappant
l'Autre et le mettant entre cette question
que j'ai dj formule - et que je me permets de
rappeler parce que certains ici s'en souviennent
cette question du rien peut-tre ? [J. Lacan, L'identification, sances des 21-
03 et 28-03.] et ce message du peut-tre rien, que les
rponses viennent :
- la premire : pas srement rien ,
- la seconde
pour autant que l'enjeu pour un PASCAL est
justement celui de ce rien, fond dans l'effet
sur nous du dsir
: srement pas rien .
280
Je veux clairer bien la topologie de ce qu'ici je
dsigne. J'ai trouv
il y avait bien d'autres voies pour la faire
jaillir, mais j'aimerais prendre la voie neutre
un logicien de la grammaire, tant pis.
Il y a d'excellentes choses, parmi d'autres plus
mdiocres, dans un livre de Willard Van Orman QUINE
qui s'appelle : Word and Object
104
.
Vous y trouverez
au chapitre IV les caprices de la rfrence,
d. Franaise. vagaries of reference,
intraduisible : flottement ?
quelques remarques.
Elles partent de ceci - qui est la position
frgienne, laquelle nos exercices de l'anne
dernire
105
nous ont accoutums, concernant la
diffrence de ce qui est Sinn et de ce qui est
Bedeutung :
- de ce qui fait sens,d'o je vous ai montr l'avis,
dans l'exemple : Green colourless idea's
- et de ce qui concerne le rfrent.
Au moment o cette parenthse que constitue le Pari
de PASCAL dans la suite de ma topologie, au moment
o, vous ayant prsent, dans le cross-cap, la
surface o nous pouvons discerner se conjoindre les
deux lments du phantasme
ceux qui ne fonctionnent qu' partir du moment o
la coupure fait que l'un de ces lments :
l'objet(a), se trouve en position d'tre la cause
d'une invisible, insaisissable, indiscernable
division de l'autre, le sujet
la question est par nous supporte dans ce modle du
pari - de concevoir, non pas ce qu'est ce phantasme,
mais comment nous pouvons nous le reprsenter. Il est
bien clair que dans son immanence il est inabordable
et qu'il s'agit d'expliquer pourquoi l'analyse permet
de nous faire tomber dans la main le petit(a) dont il
s'agit.
104 Williard van Orman Quine, Word and Object, Cambridge, MIT Press Ltd, 1960. Le mot et la chose, Paris, Flammarion,
Nouvelle bibliothque scientifique, 1992.
105 Sminaire Problmes cruciaux02-12.
281
C'est pour autant, quune autre forme
celle que je n'ai point encore ramene cette
anne, celle topologiquement, contingentement, si
je puis dire de la bouteille de KLEIN
nous le livre.
La fonction de l'Autre dans cet Erscheinung possible
qui ne saurait tre reprsentation de l'objet(a),
voil ce que les dernires explications - sur
lesquelles sans doute s'arrtera mon discours
d'aujourd'hui - vont essayer d'clairer.
Allons tout de suite ce dont il s'agit, savoir la
croyance. Quand je vous ai parl tout l'heure de
cette seconde vie, il pourrait apparatre cette
rflexion : talement, disjonction du fantasme,
est-ce que vous ne vous tes point fait incidemment
la rflexion que ce serait l, donner notre
existence ce jeu aux entournures qui permettrait de
relcher un peu son srieux ?
Il n'y a qu'un malheur, c'est que cette seconde
Vie
qui n'existe pas et que j'ai essay un instant,
l'intrieur du srieux du Pari de PASCAL, de faire
pour vous vivre
eh bien nous y croyons. Nous ne parions pas, mais
justement si vous y regardez de prs, vous verrez que
vous vivez comme si vous y croyez, a s'appelle
cette doublure qui fait les dlices des
psychologues et qui s'appelle l'occasion le
niveau d'aspiration - rien ne s'entend aussi bien
que les psychologues pour donner statut toutes
les immondices dont notre sort est perverti
a s'appelle notre vie idale - celle prcisment
que nous passons notre temps rver mollement.
Monsieur Willard Van Orman QUINE saisit - avec
quelque astuce propos d'un petit exemple que je ne
vois pas du tout pourquoi je changerais - ce qu'il
arrive dans ce qu'on appelle les fonctions
propositionnelles qui ont pour modle ceci,
(je laisse les noms) : Tom croit que Cicron a
dnonc Catilina.
282
La chose prend son intrt, c'est qu'en raison d'une
information errone Tom croit que
celui que, dans les tragdies du XVI
e
sicle, on
aurait aussi bien dsign par ce nom francis -
non pas Tullius mais Tulle - savoir pour nous
qui, bien entendu, sommes des rudits c'est le
mme Cicron
Tom croit que Tulle est vraiment incapable d'avoir
fait une chose pareille.
Ds lors qu'en est-il de la rfrence du signifiant
Cicron quant l'nonc :
Tom croit que Cicron a dnonc Catilina
s'il maintient que Tulle il ne sait pas qu'il est
le mme n'en a rien fait ? C'est autour de cette
suspension qu'un grammairien apporte des prcisions
fort intressantes sur la faon dont il convient de
mesurer l'aune de la logique telle ou telle forme
de grammaire.
Car il devient intressant de remarquer que si dans
la mme forme vous substituez, la nomination, une
forme indfinie - ceci paratrait donc devoir
opacifier encore plus la rfrence, bien au
contraire, la refrencial opacity - savoir
l'opacit qu'introduit la fonction propositionnelle :
Tom croit - c'est ici qu'il ne saurait s'agir de
dire que la rfrence devient vague partir du
moment o vous dites que Tom croit que quelqu'un a
dnonc Catilina. Assurment on peut aller plus loin
et s'apercevoir que ce n'est pas la mme chose de
croire que quelqu'un a dnonc Catilina, ou de dire
que quelqu'un existe dont Tom croit qu'il a dnonc
Catilina. Mais vous voyez que nous commenons
entrer l dans un systme de double porte qui peut-
tre nous entranerait un peu loin.
Mais pour vous ramener la question de l'existence
de Dieu, ceci vous fera saisir la diffrence qu'il y
a entre dire : il croit que Dieu existe , surtout
si nous le trouvions dans le texte de quelqu'un qui
nous dirait qu'on peut penser la nature de Dieu.
283
Or prcisment PASCAL nous dit qu'elle est
proprement parler non seulement inconnaissable mais
impensable et donc qu'il y a un monde entre croire
que Dieu existe en ce que, contrairement ce que
pensent les reprsentants de l'argument ontologique
il n'y a aucun rfrent de Dieu et que, par contre,
dire concernant l'indtermin que devient Dieu dans
je parie que Dieu existe , c'est dire tout autre
chose parce que ceci implique au-dessous de la
barre : Dieu n'existe pas.
En d'autres termes, dire : je parie que Dieu existe
ou (il faut ajouter le ou ) c'est introduire ce
rfrent dans lequel se constitue l'Autre, le grand
Autre, comme marqu de la barre qui le rduit cette
alternative de l'existence ou pas, et rien d'autre.
Or c'est bien ce qui est reconnaissable dans le
message originel, par o apparat, dans l'Histoire,
celui qui change la fois les rapports de l'homme
la vrit et de l'homme son destin, s'il est vrai
- comme on peut dire que je vous le serine depuis
quelques temps
que l'avnement de la Science
de la Science avec un grand S, et, comme je ne
suis pas seul le penser : ce que KOYR a si
puissamment articul
cet avnement de la Science serait inconcevable sans
le message du Dieu des Juifs. Message parfaitement
lisible en ceci : vu que, quand celui encore mal
dptr de ses fonctions de mage en communication
avec la Vrit
car ils furent en communication avec la vrit -
il n'y a pas besoin de se rgaler des dix plaies
de l'Egypte pour le savoir, si vous aviez les
yeux ouverts, vous verriez que la moindre de ces
poteries qui sont inexplicablement pour nous le
legs des ges antiques, respire la magie, c'est
bien pour cela que les ntres ne leur ressemblent
pas.
Si je mets tellement au premier plan certains
menus apologues comme ceux du pot de moutarde, ce
n'est pas pour le simple plaisir de parodier les
histoires du potier.
284
Mais quand Mose demande au messager dans le Buisson
Ardent de lui rvler ce nom secret qui doit agir
dans le champ de la vrit, il ne lui rpond que
ceci : Ey asher ey ce qui comme vous le savez -
du moins pour ceux qui m'entendent depuis quelques
temps - n'est pas sans poser des difficults de
traduction, dont assurment la plus mauvaise pour
tre formellement accentue dans le sens de
l'ontologie serait : je suis celui qui suis .
Asher n'a jamais rien voulu dire de pareil, asher
c'est le ce que , et si vous voulez le traduire en
grec c'est le .
106
Je suis ce que je suis , ce qui veut dire :
tu n'en sauras rien quant ma vrit.
Entre ce Je suis prpos et celui qui est
venir, l'opacit, la raie subsiste de ce ce que
qui reste, comme tel, irrmdiablement ferm .
Je raye sur le grand A cette barre(A), ce en quoi
c'est l, l'ouverture que nous venons frapper pour
qu'en choit ce qui, ds lors, dans le pari de PASCAL,
ne se conoit pas comme rien de reprsentable, mais
comme le rel vu par transparence au regard de cette
brume subjective de ce qui se profile de fumeux et
d'incohrent, de rve sur le champ de l'Autre, dans
ce qui nous sollicite au rveil, savoir de ce
petit(a). C'est vrai qu'il est rel et non
reprsent, qu'il est l saisissable en quelque sorte
par transparence, selon que nous-mmes avons su
organiser plus ou moins dans la rigueur signifiante
le champ de l'Autre.
Ce petit(a) que nous connaissons bien, j'aurai vous
expliquer - et seulement maintenant - son rapport au
surmoi. C'est quand il est au-del de la paroi
d'ombre reprsente par cet Autre suspendu autour de
la pure interrogation sur son existence, que le
rveil c'est l ce qui permet de le faire choir, non
plus post-pos mais ante-pos par rapport ce champ
106 Exode, 3, 14 : A la question de Mose : Que leur dirai-je, s'ils me demandent quel est son Nom ? La rponse de Dieu est :
Le verbe hbreu "tre" est conjugu au mode inaccompli (quivalent au futur) ; mot mot "je serai qui serai". Dieu dit Mose:
Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu rpondras aux enfants d'Isral: Celui qui s'appelle je suis m'a envoy vers
vous.
285
opaque du rve et de la croyance et que le rapport de
l'analyste au regard de cet Autre - dont la
dfinition la fin de l'anne dernire, je vous l'ai
dj donne - c'est l que la position de l'analyste
est dfinir. Le partenaire, le rpondant, celui
partir de quoi s'inaugure la possibilit de l'entre
dans le monde, d'un ordre d'hommes qui ne soient
point soumis l'ternel leurre des fausses captures
de l'tre, mais qui dpend de la ralisation de ceci,
que cet Autre
que ce partenaire, celui qui n'est pas celui dont
nous tenons la place mais avec lequel nous avons
engager la partie trois avec l'analys et
mme avec un quatrime
que cet Autre sait qu'il n'est rien.
Table des sances
286
23 fvrier 1966 Table des sances
Irne PERRIER-ROUBLEF STEIN MELMAN OURY Ginette MICHAUD
Irne PERRIER-ROUBLEF
LACAN nous a demand d'assurer aujourd'hui son
sminaire. Nous allons reprendre la discussion sur
les trois articles de STEIN que vous connaissez.
Mais auparavant, je voudrais introduire un dbat
centr sur les notions de transfert et de nvrose de
transfert pour tenter de restituer ces lments dans
le cadre de la confrence de STEIN sur le transfert
et le contretransfert. Cet expos, venant aprs
celui de STEIN serait en meilleure place avant, tout
au moins en sa premire partie.
Cette premire partie comporte en effet un survol de
la notion de transfert chez FREUD et d'autres
psychanalystes alors que STEIN approfondit cette
notion dans la cure elle-mme. Comme soutien, de la
cure et en mme temps comme obstacle, STEIN introduit
le masochisme qui s'tale sur le divan et dont il
s'agit de reconnatre l'conomie (du masochiste, pas
du divan) et le narcissisme qui s'panouit la
faveur de la rgression topique dans la situation
psychanalytique.
la deuxime partie de nos exposs introduit ce que
LACAN nous enseigne concernant l'objet(a) qui nous
permettra de dpasser l'obstacle du complexe de
castration auquel FREUD s'est heurt dans ses
psychanalyses interminables, ou mieux, infinies.
Dans ce dbat sur les notions de transfert et de
nvrose de transfert, la question qui se pose est
celle-ci : Peut-on prononcer indiffremment ces deux
termes ?
287
Pour aborder ce thme, il m'a paru judicieux de citer
un article de LACAN pris dans
La direction de la cure et le principe de son pouvoir
107
.
LACAN y disait en substance propos du transfert :
Est-ce le mme effet qui attache le patient
l'analyste, qui plus tard le fera s'installer dans la
trame de satisfaction qu'on qualifie de nvrose de
transfert o il faut bien voir une impasse de
l'analyse, entendons que l'analyse s'avre
impuissante rsoudre, aboutissant un point mort ?
Est-ce le mme effet encore qui donne l'analyse au
second stade, la dynamique qui lui est propre et que
symbolise la scansion triadique : frustration,
agression, rgression o l'on motive son procs ?
Est-ce le mme effet enfin par quoi l'analyste vient,
en son tout ou par partie, occuper les fantasmes du
patient ? Voil sur quoi l'on peut s'tonner - dit
LACAN - que la lumire ne soit pas faite. La raison
en a t donne par Ida MACALPINE
108
: c'est qu'
chaque tape de la mise en question du transfert,
l'urgence du dbat sur les divergences techniques n'a
jamais laiss place une tentative systmatique d'en
concevoir la notion (de ce transfert) autrement que
par ses effets .
Force nous est donc de faire tat des pratiques o le
transfert est voqu dans les travaux actuels.
Dans la technique que LACAN qualifie de corrective,
le transfert est apprci pour autant qu'il permet de
saisir, dans une conduite actuelle du patient, ce
qu'on conoit comme un pattern
109
inactuel, occasion de
reflter l'introduction dans la ralit d'une
exigence qui la dforme et qui ne saurait, comme
telle, y recevoir de rponse
110
.
Cette tendance est oriente par la crance faite la
notion du moi inconscient autrement dit un facteur
de synthse organisant les dfenses du sujet contre
ses propres tendances par une srie de mcanismes
dont Anna FREUD a dress l'inventaire.
107 crits p.585 ou t.2 p.62
108 Ida Macalpine, L'volution du transfert, Revue Franaise de Psychanalyse, 1972, vol.36, n3.
109 modle
110 La Psychanalyse d'aujourd'hui(la P.d.a), dir. S. Nacht, prf. E. Jones, J . Lebovici , M . Bouvet , R . Diatkine , J . A. Favreau ,
A . Doumic . Paris, PUF, 1956.
288
LACAN pense que cette thorie est insuffisante pour
n'avoir pu spcifier, dans la gense, l'ordre
d'apparition et la hirarchie de ces mcanismes et
leur coordination aux tapes du dveloppement
instinctuel.
Car il ne sert rien, d'ordonner le traitement de la
surface la profondeur si la notion de leurs
rapports est obscurcie. Le transfert n'est pas
seulement li la dynamique de l'cart entre la
ralit et les symptmes comme tels. Il joue dans le
traitement un rle positif et c'est mme en quoi
ABRAHAM en vient formuler que la capacit de
transfert tant la capacit d'aimer, elle permettait
de mesurer la capacit d'adquation au rel, du
malade
111
. C'est bien cette vue d'ABRAHAM qui fait le
fond de la conception que LACAN qualifie de
saturative du traitement en soulignant la confusion
qui s'est accumule auteur de la notion de transfert.
En ce qui concerne la nvrose de transfert, la
confusion est encore plus grande et chez FREUD lui-
mme ce n'est pas trs clair. A consulter certains
travaux, il semble qu'on puisse dgager deux notions
assez communment admises :
- le transfert qui s'inscrit invitablement dans la
situation analytique, est un facteur d'efficience du
traitement.
- la nvrose de transfert en revanche, implique le
franchissement d'un seuil au-del duquel le monde du
malade se referme sur la personne de l'analyste.
Une rsistance massive s'installe alors qui sera
difficile entamer.
Entre le transfert et la nvrose de transfert, il y a
ainsi
et ce sont les termes de NACHT
112
111 crits p.604-605, t.2 p.81.
112 S. Nacht, La prsence du psychanalyste, Paris, PUF, 1994.
289
franchissement d'un seuil. Au-del de ce seuil, il y
a prolifration, organisation, utilisation titre
dfensif par le nvros de la relation
psychanalytique, laquelle n'tant plus un moyen,
devient un but en soi.
S'agitil l d'un processus inhrent la structure
cre par la mthodologie freudienne ?
Il ne le semble pas et nous en savons assez pour
pouvoir affirmer d'emble que, lorsqu'une nvrose de
transfert s'installe ainsi, l'analyste y est pour
quelque chose.
Autrement dit, cette nvrose de transfert, pourquoi
survient-elle ? Quelle en sont la cause, le sens et
la fonction ? Finalement, comment l'viter ?
Revenons-en d'abord aux textes classiques sur le
transfert. Parmi les auteurs qui se sont proccups
de ce problme, FREUD d'abord et beaucoup d'autres
ensuite, jugent que le transfert et la nvrose de
transfert ne font que reproduire, en les transposant,
la nvrose infantile et les relations que l'enfant a
eues avec son entourage. C'est le transfert d'mois
et d'affects de FREUD. Dans son article
Remmoration, rptition et laboration FREUD
113
crit:
le malade rpte tout ce qui, man des sources du refoul,
imprgne dj toute sa personnalit : ses inhibitions, ses
attitudes inadquates, ses traits de caractre pathologiques.
Il rpte galement pendant le traitement tous ses symptmes
et, en mettant en vidence cette compulsion rpter, nous
n'avons dcouvert aucun fait nouveau mais acquis seulement une
conception plus cohrente de l'tat des choses. Nous
constatons clairement que l'tat morbide de l'analys ne
saurait cesser ds le dbut du traitement et que nous devons
traiter sa maladie non comme un vnement du pass mais comme
une forme actuellement agissante. C'est fragment par fragment
que cet tat morbide est apport dans le champ d'action du
traitement et, tandis que le malade le ressent comme quelque
chose de rel ou d'actuel, notre tche nous consiste
rapporter ce que nous voyons au pass .
Plus tard dans les confrences donnes en 1916 :
Introduction la psychanalyse, FREUD
114
insiste sur la
113 S. Freud, (1914, G.W.X) ,Remmoration, rptition et laboration, La technique psychanalytique, Paris, PUF, 1999.
114 S. Freud, (G.W XI), Introduction la psychanalyse, : Le transfert, Paris, Payot, 1922
290
fait qu'il serait draisonnable de penser que la
nvrose du malade en traitement a cess d'tre un
processus actif : elle a seulement modifi son point
d'impact. C'est dans la relation transfrentielle
qu'elle porte tout son poids, c'est pourquoi nous
voyons souvent le malade abandonner les symptmes de
sa nvrose.
Celle-ci s'exprime dsormais sous une autre forme,
grce au transfert, qui reprsente donc une rdition
camoufle de son ancienne nvrose.
L'avantage est que celle-ci pourra beaucoup mieux
tre saisie sur le vif et lucide, puisque le
thrapeute en reprsente cette fois le centre.
On peut dire qu'on a alors, non plus affaire la
maladie antrieure du patient mais une nvrose
nouvellement forme qui remplace la premire.
FREUD ajoute :
Surmonter cette nouvelle nvrose artificielle c'est
supprimer la maladie engendre par le traitement. Ces deux
rsultats vont de pair, et quand ils sont obtenus, notre
tche thrapeutique est termine [P.422]
Il exprime ainsi clairement que la fin de la cure et
sa russite dpendent de la possibilit de rsoudre
la nvrose de transfert. Nous savons que c'est sur
cela qu'il a but dans Analyses finies et infinies
115
.
Dans la nvrose de transfert, l'analyste en est-il le
centre ? Autrement dit, comme LACAN se pose la
question, possde-t-il cet objet qui focalise le
transfert de l'autre et au-del de son avoir,
qu'est-il lui-mme ?
C'est trs tt dans l'histoire de l'analyse que la
question de l'tre de l'analyste apparat. Que ce
soit par celui qui a t le plus tourment par le
problme de l'action psychanalytique n'est pas pour
nous surprendre.
115 S. Freud, (G.W XVI), L'analyse avec fin et l'analyse sans fin, Paris, PUF, 1985.
291
On peut dire en effet que l'article de FERENCZI
116
Introjection et transfert datant de 1909 , est ici
inaugural et qu'il anticipe de loin, sur tous les
thmes ultrieurement dvelopps. Le transfert
groupe, pour FERENCZI, les phnomnes concernant
l'introjection de la personne du mdecin dans
l'conomie subjective. Il ne s'agit plus ici de cette
personne comme support d'une compulsion rptitive,
d'une conduite inadapte ou comme figure d'un
fantasme. Il s'agit de son absorption dans l'conomie
du sujet, par tout ce qu'il reprsente lui-mme
de problmatique incarne.
La question est de savoir comment lui-mme s'incarne
dans la problmatique projete sur lui. Si l'on en
revient FREUD
117
, Au-del du principe du Plaisir
chapitre III, et la diffrence qu'il fait entre
rpter et se souvenir, on se rappellera que le
psychanalyste doit s'efforcer de limiter le champ de
la nvrose de transfert en forant le plus possible
dans le souvenir et le moins possible dans la
rptition.
Ce qui est souhaitable, nous dit FREUD , c'est que le
malade conserve une certaine marge de supriorit,
grce laquelle la ralit de ce qu'il reproduit
sera reconnue comme un reflet, comme l'apparition
dans le miroir, d'un pass oubli.
Lorsqu'on russit dans cette tche, on finit par
obtenir la conviction du malade et les consquences
thrapeutiques qui s'ensuivent.
Tout cela dfinit le transfert et son maniement et
non la nvrose de transfert en tant que c'est ce qui
est viter aux dires mmes de FREUD . Lui-mme ne
l'vita pas s'il est vrai que dans Analyses finies et
infinies, il se croit possesseur de ce quelque chose
que vise l'analyse dans son dsir.
Pour aller plus loin, il faut voquer ce que LACAN
enseigne concernant l'objet(a).
116 S. Ferenczi, Transfert et introjection (1909), uvres compltes, Paris, Payot, 1990.
117 S. Freud, (1920, G.W XIII), Essais de psychanalyse, "Au-del du principe de plaisir, Paris, Payot, 2006.
292
Car dans la dialectique de l'rasts et de l'romenos
ou bien cet objet se situe dans une problmatique
incarne et c'est l le contre-transfert, ou bien, il
se situe entre l'analys et l'analyste.
C'est la comprhension de ce cap qui peut aider,
plutt que de se poser la question la fin d'une
sance : qu'est-ce que a veut dire dans le
transfert, qu'est-ce que le patient veut me dire
moi, l'analyste ?
Car si l'analyste est un moi cela suffit dterminer
cette sorte de relation duelle qui ne peut tre
qu'une relation situe dans le registre de
l'identification l'analyste ou son dsir.
la nvrose de transfert dans ce qu'elle a
d'encombrant, dans son poids, plus on analyse le
transfert, plus elle s'tablit, et cela faute de
savoir comment formuler autrement le transfert.
Comment en effet, peut-on le formuler autrement ?
L'lment de rptition va de soi. Mais cet lment
historique ne suffit pas. Il y intervient un lment
structural.
Certains lments dans la structure, viennent jouer
un rle de pivot. Si on ne conoit pas le mode de
comprhension de diffrents points du transfert, si
on ne fait pas entrer en jeu les points pivots dans
la faon dont il convient d'aborder l'analyse dans la
relation entre l'analys et l'analyste, on aura beau
analyser le transfert, en ne fera que stabiliser ce
certain type de relation structurale. Une image
alinante est cl dans la nvrose. On constituera une
no-nvrose : la nvrose de transfert.
Il faut tenir compte, non seulement de la structure
de la nvrose, mais du fait qu'elle est intresse
dans la relation complte qui se produit dans la
relation psychanalytique .
Dans Au-del du principe du plaisir, chapitre VII, l'image
idale de la relation de transfert qui se veut la
plus rduite possible, est une image dpasse. Elle
va vers la structure.
La cause de la nvrose de transfert, c'est le mode
sur lequel on analyse le transfert.
293
Il faudrait articuler une formule prcise du rapport
l'image spculaire i(a) dans l'algbre lacanienne,
une correcte analyse du transfert, n'est pas de se
demander tout instant, qu'est-ce que le patient
a voulu me dire ?
Il faut analyser ce que le patient apprhende du
dsir de l'autre propos de l'objet(a), reprer le
degr d'mergence de l'objet(a) chaque sance,
autour de quoi peut se faire l'analyse du transfert,
prendre le moi de l'analyste comme mesure de la
ralit suffit pour qu'une nvrose ne puisse se loger
que l. Tout dpend donc de la faon dont l'analyste
pense la situation.
Rappelons les grandes lignes de la thorie lacanienne
pour situer cet objet (a) du nvros.
D'une part tout l'investissement narcissique ne passe
pas par l'image spculaire. Il y a un reste :
le phallus (- ). Dans l'image relle du corps
libidinalis, le phallus apparat :
- en moins,
- en blanc,
- il n'est pas reprsent,
- il est mme coup de l'image spculaire.
D'autre part le sujet barr par rapport l'Autre,
dpendant de l'Autre, est marqu du signifiant dans
le champ de l'autre, mais il y a un reste, un rsidu
qui chappe aux statuts de l'image spculaire.
Cet objet (n'importe lequel), c'est (a), l'objet de
l'angoisse. L'angoisse se constitue quand un
mcanisme fait apparatre quelque chose la place
naturelle de (- ) celle qu'occupe l'objet(a).
Il n'y a pas d'image du manque : si quelque chose
apparat l, le manque vient manquer. S'il ne
manque pas, l'angoisse apparat. Ce qui peut donc
venir se signaler cette place (- ) c'est
l'angoisse et c'est l'angoisse de castration dans son
rapport l'Autre.
294
Le dernier terme o FREUD est arriv c'est l'angoisse
de castration.
Pour LACAN, ce n'est pas elle qui constitue l'impasse
dernire du nvros : c'est la forme de la
castration. C'est de faire de sa castration ce qui
manque l'Autre, c'est d'en faire la garantie de
cette fonction de l'Autre, cet Autre qui ce drobe
dans le renvoi indfini des significations. Le sujet
ne peut s'accrocher cet univers des significations
que par la jouissance. Celle-ci, il ne peut l'assurer
qu'au moyen d'un signifiant qui manque forcment.
C'est l'appoint cette place manquante que le sujet
est appel faire par signe que nous appelons la
castration.
Vouer sa castration cette garantie de l'Autre,
c'est devant quoi le nvros s'arrte. C'est elle qui
l'amne l'analyse. Et c'est l'angoisse qui va nous
permettre de l'tudier. Le nvros, pour se dfendre
contre l'angoisse, pour la recouvrir, se sert de son
fantasme, qu'il organise.
C'est l'objet(a) qui fonctionne dans son fantasme :
mais c'est un (a) postiche et c'est dans cette mesure
qu'il se dfend contre l'angoisse.
C'est aussi l'appt avec lequel il tient l'Autre,
on peut citer l'exemple de BREUER qui s'est laiss
prendre cet appt en analysant Anna 0.
FREUD, lui, ne s'est pas laiss prendre. Il s'est
servi de sa propre angoisse devant son dsir, pour
reconnatre que ce qu'il s'agissait de faire c'tait
de comprendre quoi tout cela servait et d'admettre
qu'Anna 0. le visait, lui. C'est bien ceci que l'on
doit d'tre entr par le fantasme dans l'analyse et
dans son usage rationnel du transfert.
Et c'est ce qui va nous permettre de voir que ce qui
fonctionne chez le nvros, ce niveau (a) de
l'objet, c'est quelque chose qui fait qu'il a pu
faire le transfert du (a) dans l'Autre, ce qu'il faut
lui apprendre donner, au nvros, c'est rien, et
c'est justement son angoisse.
295
Je vais maintenant essayer de rappeler certaines
parties de l'article de STEIN sur Transfert et
contre-transfert, en m'excusant d'avance de n'avoir
pas eu le temps de prendre connaissance de ses deux
autres articles ainsi que des rponses qu'il a faites
MELMAN et CONT .
Lorsque STEIN introduit, dans l'attente de
l'intervention de l'analyste, la coupure entre le
patient et l'analyste, entre le monde intrieur et le
monde extrieur, coupure par o s'introduit un
pouvoir htrogne, il semble qu'il y ait alors en
prsence deux tres : le sujet et l'objet, l'analyste
et la patient. Cette attente est ressentie comme
dplaisir.
L'analyste semble frustrer le patient du plaisir
qu'il prouve dans sa tendance l'expansion
narcissique. Et c'est la frustration que le patient
prouve dans cette coupure, c'est ce phnomne qui
est le transfert. (Ceci d'aprs l'article de STEIN).
la patient dote l'analyste, d'un pouvoir qui n'est
pas le sien. Il semble premire vue, comme l'a dit
CONT, que cette dialectique de la frustration ramne
la situation analytique une relation duelle entre
sujet et objet.
Pour ma part - c'est peut-tre aussi d'ailleurs
impliqu dans le texte de STEIN, bien qu'il ne l'ait
pas explicit - je pense que le transfert est soutenu
par la rgle analytique et non par la relation la
personne de l'analyste qui justement, par son action,
est dpossd de sa personne. A l'arrire-plan de
cette dialectique, se profile le troisime joueur, le
grand Autre lacanien. L'analyste se trouve pris dans
un ddoublement constitutif de la situation. Et ce
ddoublement n'a rien voir avec une relation
duelle. Il y a l une contradiction qui cre
l'ambigut. Si on l'oublie, c'est que ce joueur, ce
troisime joueur, est bien l'analyste pour l'autre,
et que pour l'analyste, c'est l'autre qui lui dicte
ses coups. Il semble qu'on retrouve ici la vise
sadique dont parle STEIN :
296
Que l'analyste peut se laisser tromper dans le transfert
et prendre la place laquelle le patient le situe, c'est-
-dire comme origine du pouvoir de la frustration.
C'est sur cette frustration que porte sa deuxime
remarque. A mon avis, la frustration dans l'analyse
n'a pas pour source le dplaisir caus par l'attente
de l'intervention, attente qui introduirait une
coupure.
Au contraire, elle natrait sur un horizon de non
rponse toutes les demandes que le patient formule,
y compris celle qu'il ne formule pas. C'est par
l'intermdiaire de la demande que tout le pass
s'entrouvre jusqu'au fin-fond de la premire enfance.
Et c'est parce que je me tais que je frustre mon
patient. C'est par cette voie seulement que la
rgression analytique est possible. L'abstinence de
l'analyste qui se refuse gratifier la demande, la
spare du champ du dsir ; et le transfert est un
discours o le sujet tend se raliser au-del de la
demande et par rapport elle.
Pourtant il me semble que dans cet article de STEIN,
tout laisse penser que lorsqu'il dit frustration,
c'est de castration qu'il s'agit et alors tout
collerait trs bien, comme nous allons le voir.
STEIN situe la fin de l'analyse par l'accs au savoir
sur la frustration. Pour FREUD , les frontires de
l'analyse s'arrtent au complexe de castration qui
garde sa signification prvalente c'est--dire :
l) que l'homme peut avoir le phallus sur le fond de
ne l'avoir pas,
2) que la femme n'a pas le phallus sur le fond de ce
qu'elle la.
Et si FREUD a marqu le caractre l'infini de
certaines analyses, c'est qu'il n'a pas vu que la
solution du problme de la castration n'est pas
autour du dilemme de l'avoir ou pas car ce n'est que
lorsque le sujet s'aperoit qu'il ne l'est pas qu'il
peut normaliser cette position naturelle de combien
il ne l'a pas.
297
Pour revenir l'article de STEIN, si le progrs du
patient tend vers l'interminable, dans ce balancement
entre le progrs apparent dans le monde et l'exigence
du statu quo dans la position du masochisme, mettant
le transfert sous le signe de l'incertitude, peut-
tre pourrait-on voir l une manifestation
justement de la nvrose de transfert aboutissant un
point mort. Cette incertitude inhrente l'analyse
est, comme l'a si bien dit STEIN, celle que FREUD
voit dans la crainte de perdre, ou l'envie d'avoir un
attribut sans prix. Nous retombons l dans les
analyses infinies de FREUD faute d'avoir diffrenci
les plans de l'tre et de l'avoir.
C'est bien d'ailleurs ce que dit STEIN sans
l'expliciter :
la crainte de perdre ou l'envie d'avoir se retourne dans
le transfert en la position de l'tre pour l'analyste :
tre son plaisir ou sa croix.
298
STEIN
Je vais essayer d'tre trs bref au moins dans un
premier temps. Je reviendrai sur certains points si
a parait ncessaire. a m'a videmment beaucoup
intress, beaucoup, beaucoup. Et je vous remercie
beaucoup.
Je prends les points dans l'ordre o je les ai nots
trs rapidement. En ce qui concerne la remarque de
Mme MACALPINE qui dit qu'il n'y a pas de conception
de la notion de transfert en dehors de ses effets,
pour elle c'est une constatation de fait et non un
jugement de ce qui devrait tre. Elle a raison de
dire cela. Mais elle ne sait pas pourquoi il en est
ainsi. Et je crois que si on voulait savoir pourquoi
il en est ainsi, il faudrait noter une chose qui me
parat trs vidente, c'est la suivante : Vous savez
que FREUD a dcouvert le transfert en mme temps que
la rsistance, ds le dbut de la mise en uvre de sa
technique, de sa cure cathartique. Le transfert y
apparaissait comme un accident, une complication de
l'analyse qu'il a vite reconnu inluctable. Par la
suite, FREUD a chang d'avis et aujourd'hui, on nous
apprend dans tous les organismes d'enseignement du
monde que la cure psychanalytique consiste en premier
lieu analyser le transfert. C'est possible. C'est
non seulement possible, c'est mme vrai. Je crois, -
je ne peux pas dvelopper la chose ici - c'est une
ide qui, mon sens, mriterait d'tre fouille. Je
crois que si les choses en sont encore aujourd'hui au
point o elles en sont, c'est que malgr cette
affirmation que l'analyse, c'est l'analyse du
transfert, la pese de cette conception initiale
selon laquelle le transfert est une complication de
la cure, cette pese continue s'exercer sur nous,
c'est--dire que, dans une certaine mesure les
psychanalystes - quoi qu'ils disent le contraire -
continuent considrer le transfert comme une
complication, comme un accident de la cure.
299
Maintenant, pour la question de la diffrence entre
le transfert et la nvrose de transfert, qui n'est
pas trs claire dans FREUD, je dois dire que je n'en
suis pas partisan, en tout cas, pas dans la
formulation que vous avez cite - qui, je crois est
de NACHT - celle du seuil.
Il est vident que si le transfert peut tre le
moteur de l'analyse, qu'il ne peut pas y apparatre
comme un obstacle quasi irrductible : il n'y a pas
l franchissement d'un seuil, dans le sens d'une
question de quantit. Vous avez prsent a, si j'ai
bien compris - je n'avais pas cette citation prsente
l'esprit - comme s'il s'agissait d'une question de
quantit de transfert : il est vident que ce n'est
pas une question quantitative mais une question de
structure du transfert. Mais je ne crois pas qu'on
puisse distinguer le transfert et la nvrose de
transfert qui sont une seule et mme chose, ce qu'on
peut distinguer, ce sont des modalits, des modalits
du transfert, des modalits dans sa structure pour
employer le terme que vous avez emprunt LACAN,
dans votre deuxime partie.
Quand vous avez dit qu'il fallait concevoir le
transfert dans sa dimension historique et aussi dans
sa dimension structurelle ce n'est pas un terme de
FREUD . C'est bien de LACAN. Et moi, je suis tout
fait d'accord avec cette distinction. Je vais mme
peut-tre plus loin que LACAN et c'est votre
vocation de l'article de FERENCZI qui me l'a fait
penser : je crois moi, que toute la technique de la
retrouvaille du pass, de la reconstruction du pass
travers les rminiscences - car la rminiscence est
quelque chose d'actuel et pas quelque chose de pass
- que toute cette technique de retrouvaille est un
moyen de l'analyse et rien d'autre et qu'il est l'un
des moyen qu'il est bon d'employer dans certaines
conjonctures, qu'il n'est pas bon d'employer dans
d'autres conjonctures.
Ce que le patient apprhende du dsir de l'autre
propos de l'objet(a) et la question de la castration
comme garantie de la fonction de l'Autre :
300
je crois que ce sont ceux-l les thmes lacaniens qui
m'ont inspirs pour ce deuxime article. S'il y en a,
ce sont ceux-l, sans aucun doute, quoique je
n'emploie pas l'algbre de LACAN parce que, pour une
raison ou pour une autre, je ne suis pas sensible
l'avantage de ce type de formulation. J'ai peut-tre
tort. Mais enfin, c'est bien l que se trouve ma
source d'inspiration Lacanienne. Il est important de
le noter. Bien sr, on ne peut pas dvelopper la
question maintenant.
Alors, dans les remarques que vous faites concernant
mon article, la coupure o s'introduit un pouvoir
htrogne, cette coupure qui spare, je ne dis pas
deux tres en prsence, mais je dis deux personnes,
pour une raison trs prcise que vous ne pouvez pas
connatre. C'est parce que j'ai donn par ailleurs
une dfinition trs prcise de la notion de personne.
L, je ne veux pas non plus me lancer l-dedans. Il
est vident que je suis oblig de rcuser votre
remarque concernant - comme je l'ai dj fait
propos de la remarque similaire de CONT -
concernant la notion d'une relation duelle entre
sujet et objet. les raisons en sont multiples, mais
d'abord je vous fais remarquer que mme dans la
description que je donne dans ce texte qui est loin
de constituer l'uvre acheve puisque ceux d'entre
vous qui ont assist au sminaire de Piera AULAGNIER
ont entendu un chapitre supplmentaire que j'ai
intitul Le jugement du psychanalyste et que celui-l
n'est pas encore le dernier. Mais mme dans ce texte,
vous remarquerez une chose, c'est que s'il y a des
personnes en prsence, il y en a au moins trois
puisqu'il y a celle du patient et du psychanalyste
dans la coupure, et il y a celle, mythique, qu'on
pourrait dcrire comme le tout est en un et un est
en tout , c'est--dire cette personne o le
psychanalyste et le patient ne sont prsents ni l'un
ni l'autre en tant que sujet, dans la mesure o la
rgression topique, au cours de la situation
analytique s'accomplit d'une manire dont on peut
dire - c'est ce que j'ai dvelopp propos des
argumentations de CONT et de MELMAN - que a parle,
301
le patient parle, le psychanalyste parle. Ils sont
deux et dans l'autre conjoncture qui n'est jamais
parfaitement accomplie, de mme que la conjoncture de
la sparation n'est jamais parfaitement accomplie,
non plus, a parle.
Donc vous avez dj au moins trois personnes. Je ne
veux pas dire qu'on ne peut dcrire que ces trois
personnes-l. A un autre stade du dveloppement,
trois personnes apparaissent dans une formulation
diffrente mais il est bien certain qu'il ne peut pas
y en avoir deux et je crois mme que dans la
conversation ou dans l 'change de paroles le plus
banal, on ne peut pas considrer qu'il y a - comme le
veut une thorie trs en vogue aujourd'hui - qu'il y
a change d'information, une sorte d'insufflation,
d'information entre deux interlocuteurs.
Une telle chose n'existe pas. L'information dont
s'occupe la thorie de l'information - si elle est
vraie - ce sont des ondes sonores et c'est une
question de physique et de physiologie crbrales, a
passe par l'oreille et a va dans le lobe temporal.
a n'est pas a qui nous occupe. Pour que ces
phnomnes physiques soient signifiants, il faut bien
autre chose que cette thorie de la communication
d'une information entre deux personnes et il faut
bien qu'il y ait quelque part la rfrence une
troisime. a non plus je ne peux pas le dvelopper.
Donc, il n'est pas question de relation duelle.
Que le transfert est soutenu par la relation
analytique : J'ai not a. Je ne sais pas si c'est
vous qui le dites ou vous me citez ?
Irne ROUBLEF
Je vous cite.
STEIN
Bon. Nous sommes tout fait d'accord en tout cas.
Mais je crois - l aussi, je ne peux pas dvelopper
la chose - qu'il faudrait donner sa pleine dimension
ce terme soutenu
302
je croyais que vous le disiez dans votre
objection, je n'ai pas mon texte parfaitement en
mmoire.
Non, je crois que c'est votre objection. Mais il
faut voir que le transfert est soutenu par la
relation analytique ou quelque chose comme a.
Enfin, peu importe puisque nous sommes d'accord
soutenu, il faut donner le plein sens ce terme car
je suis de plus en plus persuad - je ne peux pas
vous le dvelopper, je ne pourrais mme pas trs bien
parce que c'est une ide rcente - mais je ne crois
pas qu'on puisse considrer que la situation
analytique cre le transfert. Je crois que la
situation analytique est une rvlatrice du
transfert.
- X dans la salle : Mme Perrier a dit : la rgle
STEIN
J'ai marqu relation. Bon, vous avez raison, et moi
j'ai marqu autre chose probablement parce que
j'avais envie d'en parler. Je continue quand mme son
argument pour en revenir trs vite la rgle. Donc
je pense qu'elle ne cre pas le transfert, je pense
qu'elle le rvle et qu'elle nous permet d'en prendre
connaissance. Mais je crois que le transfert est
justement ce facteur anthropologique universel d'o
manque toute thorie de la communication conue comme
un change d'informations. L non plus, je ne peux
pas dvelopper a.
Quant la question, du transfert soutenu par la
rgle, analytique, c'est--dire la mise en valeur de
l'importance de la rgle analytique, je ne veux pas
intervenir l-dessus maintenant mais prcisment le
premier paragraphe du chapitre que j'ai expos au
sminaire de Piera AULAGNIER et de CLAVREUL y est
consacr. Alors, ce serait un peu long. Ce que j'ai
montr l : j'ai d'abord rappel une chose qui est
d'exprience, je crois, assez courante, c'est qu'il
est parfaitement inutile de formuler ce que nous
303
avons l'habitude de formuler comme tant la rgle
fondamentale, c'est--dire qu'il n'est pas du tout
ncessaire de dire au patient qu'il faut qu'il dise
tout ce qui lui viendra par la tte, etc.
C'est parfaitement inutile mais ce que j'ai essay de
dgager c'est que, mme si on ne la disait pas, la
pese de la rgle restait la mme. Il y avait au
moins quelque chose qui tait impos d'une manire
unilatrale, c'tait par exemple, l'horaire des
sances, c'est--dire que, malgr tout, mme si le
psychanalyste ne formule aucune rgle et vous dit je
vous recevrai trois ou quatre ou cinq fois par
semaine, tel jour, telle heure, venez, couchez-vous
sur le divan et qu'il ne lui dit rien de plus, cela
suffit pour exercer une pese tout fait analogue
celle de la rgle formule.
J'ai aussi fait remarquer ce propos que ce qui est
quand mme trs important, c'est que, il y a au moins
une intervention du psychanalyste chaque sance,
intervention qui peut tre attendue, qui est celle
qui marque la fin de la sance. On n'y chappe pas.
Donc penser que le psychanalyste n'est pas intervenu
parce qu'il n'a rien dit ce jour-l, a n'est pas
tout fait juste. Il est vident que d'tre
intervenu pour dire quelque chose ou d'tre intervenu
pour avoir marqu la fin de la sance ce n'est pas
pareil, mais c'est quand mme une intervention. la
preuve en est qu'il est des patients qui s'en vont
d'eux mme avant la fin de la sance parce qu'ils ne
supportent pas que la fin de la sance soit indique
par le psychanalyste. Je ne crois pas qu'il y ait
beaucoup de patients qui le fassent de manire
constante, toutes les sances, mais dans la
pratique de chaque analyste, a arrive de temps
autre.
la question de l'analyste tromp qui serait
l'origine du pouvoir, je crois que nous sommes tout
fait d'accord l-dessus.
La frustration, me dites-vous, est au contraire sur
un horizon de non rponse. Je veux bien. la
demande. Oui, bien sr.
304
Lorsque je parle de l'attente de l'intervention du
psychanalyste, c'est que cet horizon, je suis tout
fait d'accord pour vous dire que la frustration est
sur un horizon de non-rponse la demande. Mais cet
horizon de quoi est-il fait ?
Si ce s'est de cette attente de l'intervention
du psychanalyste. Je ne crois pas que ce soit l des
arguments contradictoires mais je crois, quant moi,
qu'il est ncessaire parce que c'est cela qui
soutient le transfert dans une dfinition stricte, de
mettre l'accent sur cet horizon de non-rponse, sur
l'attente de l'intervention du psychanalyste, c'est-
-dire sur son intervention imagine ou suppute.
C'est a qui fait d'ailleurs une bonne partie du
discours du patient pendant la sance :
Vous allez me dire que et J'imagine
que,toujours ,vous, vous, vous.
Avec certains patients, jamais. Quand a n'a jamais
lieu, vous savez quel type de rsistance nous avons
affaire. Nous avons affaire au type de rsistance que
BLOUVET a appel la rsistance au transfert. Alors
que la rsistance qui est analysable est plutt la
rsistance du transfert, c'est--dire par le
transfert.
Non, je ne pense pas du tout que ce soit
contradictoire, mais je crois qu'il faut mettre
l'accent sur ce qui vient meubler cet horizon de non
rponse qui est la supputation de l'intervention
attendue. Et puis, ce qui se passe toujours, qui est
important considrer, c'est la non conformit de
l'intervention lorsqu'elle se produit enfin avec ce
qui tait attendu.
Dernier point : vous dites que, l o je parle de
frustration, il faudrait parler de castration.
L-dessus, je ne peux pas vous donner une rponse
absolument ferme et dfinitive parce qu'il est
possible que vous ayez raison et que, pour moi, ce
problme n'est pas encore tout fait tranch.
305
Cependant, je crois qu'en un premier temps, il est
ncessaire de mettre l'accent sur la notion de
frustration, comme je le fais dans cet articlel,
parce que la frustration, qu'est ce que c'est ?
En franais, la frustration, c'est la suppression la
privation de quelque chose quoi on a droit, la
diffrence de la privation. Frustrer quelqu'un, c'est
lui enlever quelque chose quoi il a droit.
Or, de quel droit s'agit-il ? si ce n'est du droit
imaginaire de la toute puissance narcissique.
Autrement dit, le droit dont il est question ici est
loin d'tre un droit au sens juridique, bien sr, il
ne s'agit pas de frustration d'un droit au sens du
code, il s'agit au contraire de frustration au sens
de ce que le patient dans son narcissisme veut poser
comme un droit, et qui est son dsir. Donc, Je crois
qu'il faut, ce niveau-l parler de frustration. La
frustration, comme le dit LACAN, est d'ordre
imaginaire. Or, le droit narcissique, le droit du
dsir tre accompli, si on peut parler de droit
puisque c'est le contraire du droit, au sens du code,
est bien d'ordre imaginaire. D'ailleurs, c'est a qui
soutient le fantasme. Quant la castration comme le
dit LACAN, il faut considrer qu'elle reste d'ordre
symbolique. Et alors, justement, nous arrivons l,
propos de cette fin de l'analyse, qui est en un sens
- comme je l'ai dit, a ne rsout pas la question -
qui est en un sens savoir sur la frustration, mais
savoir sur la frustration dans quoi ? Justement dans
le fait d'assumer la castration au sens symbolique,
c'est--dire dans le sens de la constitution de
l'idal du moi. Et lorsque FREUD dit que l'idal du
moi est l'hritier du narcissisme primaire, et bien,
dans cet hritage, nous avons justement le passage du
registre imaginaire de la frustration, car on
n'assume pas une frustration, la frustration on s'en
plaint, il n'est pas concevable qu'il en soit
autrement, donc dans cet hritage nous avons le
passage du registre imaginaire de la frustration, au
registre symbolique de la castration avec
constitution de l'idal du moi, constitution de
l'idal du moi dont il faudra justement tudier la
306
place par rapport celle o le patient dans son
sentiment de frustration, met l'analyste en tant
qu'origine du pouvoir.
L'idal du moi La fin de l'analyse n'est pas comme on
l'a dit souvent dans une identification au
psychanalyste.
C'est une notion qui est absolument insoutenable mais
en un sens on peut dire que la fin de l'analyse est
dans l'identification l'idal du moi. L'idal du
moi dont on sait, dans la mesure o le savoir sur la
frustration nous indique que cet idal du moi est
une autre place que celle o est la psychanalyste.
Ecoutez, j'ai dj parl beaucoup plus longtemps que
je ne le voulais.
Irne ROUBLEF
Je ne voudrais pas non plus prolonger le dbat mais
simplement vous rpondre deux ou trois petites
Choses.
D'abord sur Ida MACALPINE, tout fait d'accord.
Sur la diffrence que vous faites entre transfert et
nvrose de transfert ou plutt que vous ne faites
pas, je crois en effet qu'il n'est pas du tout
question d'une diffrence quantitative. C'est
videmment une diffrence de structure et que la
nvrose de transfert, si on avait bien compris ce que
je voulais dire, c'tait justement l'impasse
laquelle on arrive dans une analyse o on ne peut pas
aller au-del de ce quoi on se heurte dans le
complexe de castration quand on le place sur le plan
de l'tre, de l'tre au lieu de l'avoir.
Pour FERENCZI, tout fait d'accord sur ce que vous
avez dit. Je suis aussi d'accord quand vous dites
que, sans parler de signifiant, d'objet(a), de grand
Autre, etc. que vous n'aimez pas l'algbre lacanienne
mais que vous vous en servez.
Je suis tout fait d'accord avec vous puisque je le
dis moi-mme dans une remarque que je vous fais
lorsque je vous parle de relation duelle avec il
semble ai-je dit qu'il y aurait deux tres en
prsence, donc le mot tre, je veux bien l'enlever :
307
le sujet et l'objet, l'analyste et l'analys, c'est
vous qui le dites. J'ai dit que, moi, il m'apparat,
sans que vous l'ayez explicit, que ce ne soit pas
a, et qu'en effet l'arrire-plan se profile le
troisime joueur qui est le grand Autre. Je l'ai
dit pour vous.
Maintenant, je voudrais dire un mot sur ce qu'on
appelle la relation duelle. a ne veut pas du tout
dire qu'il y a un monsieur et un monsieur ou un
monsieur et une madame qui sont l, face face et
puis c'est tout. Parce que, comme vous l'avez dit, il
faudrait alors tre dans une le dserte, ne pas
parler pour qu'il y ait une relation duelle. Il est
bien entendu que ce qu'on appelle une relation duelle
dans l'enseignement lacanien, ce n'est pas du tout
qu'il n'y a pas d'autre terme, il y en a forcment un
troisime, mais que a se place dans la dialectique
de l'enfant et de la mre. Ce qui ne veut pas dire
que le pre n'apparat pas. Il apparat forcment
puisqu'il a conu l'enfant.
STEIN
Je ne comprends pas trs bien. Si a se place dans
une dialectique de l'enfant et de la mre o le pre
apparat, quelle autre dialectique peut-on
concevoir ?
Irne ROUBLEF
Le pre n'y apparat pas de la mme faon que
lorsqu'on aborde l'Oedipe. Je sais bien que pour vous
l'Oedipe existe d'emble. Mais ce ne sont pas les
notions que nous avons de la chose, et pour nous
l'Oedipe a commence partir d'un certain moment du
dveloppement, trs tt d'ailleurs, beaucoup plus tt
que pour les analystes classiques, mais enfin ce
qu'on appelle la relation trois, si vous voulez,
qui ne soit pas relation duelle, c'est lorsque le nom
du pre apparat dans la relation entre la mre et
l'enfant. Le nom du pre, je ne vous dis pas que le
pre n'a pas donn son sperme.
308
STEIN
ce moment-l, c'est une relation trois ?
Irne ROUBLEF
Oui, partir du nom du pre et partir du moment o
la dsir de l'enfant est renvoy vers le dsir du
pre par l'intermdiaire de la mre. Enfin, Je crois
qu'on pourra discuter trs longtemps l-dessus.
STEIN
L je pourrai quand mme vous rpondre publiquement
ce que je vous ai dit au tlphone hier, c'est que je
crois que ce que vous dcrivez l, c'est bien le fait
le plus originaire et le plus fondamental qui puisse
exister, qu'on ne peut rien concevoir avant. Parce
que, lorsque vous dites que dans une relation duelle,
c'est une relation entre l'enfant et la mre o le
pre apparat, comment apparat-il ?
Irne ROUBLEF
Non je n'ai pas dit a. J'ai dit bien sr que le pre
a figur puisqu'il a fait l'enfant avec la mre. Mais
il n'apparat pas dans la relation, dans cette
premire relation de la mre et de l'enfant, dans la
relation du nourrisson.
STEIN
Moi, Je ne crois pas l'existence d'une telle chose.
Irne ROUBLEF
Il faudra qu'on reprenne ce dbat, ce serait vraiment
trop long. Maintenant, au sujet de la frustration :
vous dites que l'attente de l'intervention de
l'analyste et la non-rponse, c'est la mme chose. Je
crois que ce n'est quand mme pas tout fait la mme
chose.
309
STEIN
Je dis que la non-rponse est la condition de cette
attente.
Irne ROUBLEF
Ce n'est pas tout fait a que vous dites dans votre
article lorsque vous parlez de ce que cette attente
de l 'intervention de l'analyste provoque
l'introduction d'un pouvoir htrogne qui provoque
la coupure. Je ne crois pas enfin, peut-tre
pourrait-on dire la mme chose dans la non-rponse.
Je crois que ce qui est important, c'est que la
non-rponse porte sur la demande et qu'on a
l'impression que, dans ce que vous dcrivez dans
votre texte, a porte sur le dsir. Et c'est pour a
que je dis que ce n'est pas de la frustration qu'il
s'agit mais que c'est de la castration et que, au
fond, vous dites la mme chose que ce que nous disons
seulement vous l'appelez autrement. D'ailleurs vous
n'avez qu' voir la fin de votre texte. Vous dites
exactement, mot pour mot, ce que LACAN disait : que
lorsque FREUD n'arrive pas terminer une analyse
c'est parce qu'il se croit possesseur d'un objet trs
prcieux. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet trs
prcieux sinon le phallus.
STEIN
Oui, mais reprenons cela. Quand vous dites : non-
rponse, l'horizon de non-rponse, vous vous mettez,
bien sr, disons, la place du patient, pour le
dire. Il n'y a pas de non-rponse en dehors de
l'vocation d' une rponse.
Irne ROUBLEF - Bien sr.
STEIN
Le patient dira : il ne me rpond pas.
310
MELMAN
Qui il ?
STEIN
a c'est une autre question. La non-rponse est un
jugement ngatif fait sur l'existence d'une rponse,
donc il faut que cette rponse soit prsente
l'esprit en tant que possibilit, donc je ne crois
pas que ce soit tellement diffrent.
Irne ROUBLEF
Je crois qu'il faudra revoir tout cela puisque, on
n'a peut-tre pas beaucoup de temps. Justement, je
voulais donner la parole MELMAN et CONT .
Charles MELMAN
Oui, sur cette question, sur cette phrase :
la frustration, survient sur un horizon de non-rponse
la demande ,
et sur cette discussion qu'a introduite Irne, de
savoir si le terme de frustration est ici exact, est
ici bien employ ou bien si ce serait le terme de
castration qui serait sa place. Il me semble que
c'est prcisment l'une des questions fondamentales
qui se dgagent, qui se posent la lecture de ton
texte, et o je dois dire que pour ma part j'aurais
tendance - pas seulement peut-tre pour des raisons
de commodit de lecture ou de facilit - j'aurais
tendance regretter que finalement l'algbre
Lacanienne ne soit pas ici, aprs tout, utilise.
Parce que, aprs tout, horizon de non rponse la
demande , c'est en tout cas dans cette dimension que
j'aurai tendance voir ce qui est l'installation
trs prcisment du transfert, c'est--dire que,
horizon de non-rponse la demande , la demande
exerce en tant que formule et en tant que justement
311
se trouve l cet interlocuteur si singulier qui lui
donne sa vraie dimension, cette demande, c'est--
dire celle d'tre vraiment enfin entendue, et
entendue non pas par quelque rponse qui viendrait
immdiatement soi-disant la gratifier mais en fait
constituer ce fonds, disons-le, si traumatisant de
mconnaissance qui fait partie de nos relations
habituelles, conventionnelles, normales, mais enfin
cette installation de la demande dans son vrai
registre, c'est--dire celui de la non-rponse pour
que prcisment, cette dimension du dsir sur lequel
la demande vient s'installer puisse tre entendue, il
me semble que seule, donc, la non-rponse, en tant
que prcisment, en tant que non-rponse, en tant que
gratifiante, il me semble qu'elle vient couvrir, ici,
justement, la dimension du transfert.
Bien sr, je crois que dans la cure, le patient est
amen bien sr nous prter toutes les rponses,
enfin, nous engager dans ce dialogue que tu voquais
si bien tout l'heure, c'est--dire nous prter
comme a toutes les rponses que nous pourrions lui
faire, tous les sentiments qu'il pourrait nous
supposer.
Ceci dit, je crois que, si nous nous livrions
appelons a un passage l'acte, c'est--dire lui
dire, aprs tout, lui rpondre, sa demande,
n'est-ce pas, je crois que nous exercerions ce
moment-l un effet proprement traumatisant et de
dsarroi qui, enfin peut-tre parfaitement
perceptible, enfin - peru ou not - dans telle ou
telle circonstance ou telle au telle observation.
Ce qui fait que si - aprs tout, je dis bien aprs
tout - si on se sert de l'algbre lacanienne, et que
l'on se pose la question de savoir o se situe
l'absence de rponse finalement tout compte fait,
toute sance faite o se situe l'absence fondamentale
de rponse la demande et, par l mme, le
dgagement de cette dimension du dsir, autrement
dit, je pense que si on fait intervenir ici le grand
Autre, la position respective des divers partenaires
312
dans la cure se trouve, mon sens, beaucoup mieux
prcise. Et cette position respective des
partenaires dans la cure
tout l'heure STEIN en voquait trois ce qui
semble en tout cas, certainement un minimum
je pense qu'elle se trouverait en tout cas galement
mieux prcise par cette petite notation, il me
semble, trs fine, trs prcise que tu fais propos
de l'analyste, de l'intervention implicite de
l'analyste en dbut et en fin de sance. Autrement
dit, que mme si aprs tout, l'analyste se tait, du
seul fait qu'il fixe l'heure de la sance et du seul
fait qu'il est amen un moment donn dire :
restons-en l, la sance est termine, il est amen
implicitement intervenir. Je crois que c'est en fait
une question. Je dois dire que a ne me parat pas,
aprs tout, si simple que a, car je pense qu'il y a
une technique de la cure, par exemple, o justement
le problme se pose de savoir si l'analyste, en
fixant l'heure de la sance et en marquant sa leve,
intervient ou n'intervient pas. Je dois dire que, il
me semble qu'il y a par exemple une technique de la
cure, supposons comme a la cure, la cure idale,
enfin, o les sances sont lundi, mercredi, vendredi,
telle heure, dure : strictement dtermine - on sait
combien l'inconscient des malades pige admirablement
le temps, et combien les malades, mme sans regarder
leur montre, savent parfaitement le moment o, dans
une sance dont le temps est, comme a, strictement
fix, quel moment va tomber la fin de la sance -
eh bien, je pense que, donc, dans cette technique-l,
avec ces sances heure fixe, jour fixe, je ne suis
pas sr qu'il y ait intervention de l'analyste. je
n'en suis pas sr parce que je me demande si -
justement, puisque j'introduisais la fonction du
grand Autre pour essayer de situer, de partager la
position des partenaires dans la cure - je me demande
s'il n'y a pas en fait une dclaration implicite qui
serait un petit peu diffrente, et qui serait plutt,
peut-tre, la soumission de l'analyste, comme du
patient, une relation, un rapport, au temps, en
tant que, bien, entendu, il fait intervenir toujours
313
une relation au grand Autre, soumission en quelque
sorte, dclaration implicite ou intentionnelle
d'identit entre l'analyste et le patient dans cette
relation au temps, et o la dimension, enfin on ne va
pas s'engager dans une discussion l-dessus mais
enfin je voudrais quand mme dire que, parmi les
divers partenaires qui sont prsents dans la sance,
o la dimension disons d'un quatrime qui serait en
l'occurrence ce mort, comme a, qu'on voque de temps
en temps, se trouve mon sens, certainement
introduite de manire trs prcise.
Bon, je n'ai peut-tre pas rpondu ton souci, tes
questions mais enfin, en vous coutant, voil ce qui
m'tait venu.
Irne ROUBLEF
Je vous remercie de ces remarques et je vais peut-
tre demander CONT s'il veut parler.
Jean OURY
C'est simplement quelques remarques terminologiques
parce que, il me semble que c'est important
d'employer l'algbre Lacanienne ou pas, mais enfin
tout au moins, sur les termes, d'avoir quand mme des
acceptions communes. Par exemple, pour employer les
termes frustration, castration, privation. J'ai
l'impression qu'il y a eu un certain mlange et que
a n'a pas abouti, un claircissement, justement
parce que, de ma place, en tant qu'auditeur, j'ai pas
compris grand chose la discussion qui s'est engage
au sujet de la frustration et de la privation.
Surtout quand STEIN a dit que c'est au niveau de la
castration qu'on peut parler d'idal du moi. Il me
semble bien me souvenir que dans la terminologie
Lacanienne - il faut bien s'en tenir ici une
terminologie, il peut se faire qu'on peut en parler
dans les termes lacaniens - c'est que l'idal du moi,
314
se place davantage au niveau de la privation. Encore
faut-il bien dfinir les termes. Le terme de
frustration est engag par FREUD , enfin FREUD
n'emploie pas le terme de frustration, c'est le terme
de Versagung qui est traduit souvent par LACAN sous
le terme de ddit. Et en effet c'est dans la
dimension, dans le registre, imaginaire que se place
la frustration mais il prcise bien que c'est, il
emploie le terme de dam , de dommage imaginaire
mais de quelque chose de rel. Par exemple, on veut
un exemple clinique, disons, de la frustration, c'est
quand, par exemple, on a dire quelque chose, c'est
peut-tre un peu grossier, admettons qu'on soit dans
la salle, qu'on a envie de dire quelque chose et que,
pour des raisons de sance ou de temps, on ne peut
pas le dire : il semble que a, c'est du registre de
la frustration en ce sens que le dit qu'on a dans la
tte pour le dire, il est vraiment ddi et en mme
temps, il y a une espce d'effet d'clatement mme du
dire, parpillement du dire qui est bien sr, un
dommage imaginaire mais qui peut aller loin, qui peut
donner, crer toute une symptomatologie.
Tandis que dans la castration, c'est un registre
symbolique mais qui porte sur un objet imaginaire.
C'est pourquoi tout l'heure j'ai dit que jai fait
ces remarques, en disant que l'idal du moi, ce n'est
pas au niveau de la privation mais dans un des
premiers schmas, disons, de la mise en place, avant
l'Oedipe, justement dans ce passage justement ou le
pre va intervenir dans cette sorte de coalescence de
l'enfant avec la mre, cette premire bauche de
l'identification, c'est au niveau de la privation que
a se fait. Il faudrait le dvelopper avec beaucoup
d'exemples. Mais je pense qu'on n'a pas la temps et
je n'ai pas les moyens ici.
Maintenant, dans le transfert, il est vident que le
transfert, c'est quand mme au niveau de la demande
que a - il faudrait reparler de la demande trs en
dtail - c'est au niveau de la demande qu'apparat,
en fin de transfert, l'impact de l'idal du moi.
Enfin, a c'est une premire terminologie.
315
Maintenant, une autre remarque. C'est au niveau de la
relation duelle. J'ai l'impression que c'est toujours
un terme trs trs malheureux employer, le terme
duel. Quen effet, comme le remarquait STEIN, il
suffit d'une simple conversation les bases mmes de
la linguistique le dmontrent, que dans toute
communication, il y a toujours un rfrent ou un
contexte, le tout sur la notion, reprise par LACAN,
du grand Autre, ce que les linguistes appelaient
aussi la communaut linguistique, le lieu du code,
etc. Il est certain qu'il n'y a pas simplement deux
protagonistes. Mais il est un fait quil y a quand
mme un moment, disons historique, dans l'volution
de la personnalit, o apparat une triangulation. Et
plutt que de parler du passage un petit peu
fantaisiste de deux trois, ce qui ne veut pas dire
grand chose peut-tre, mais c'est l qu'intervient la
fonction spculaire, c'est au niveau du stade du
miroir, l'importance dans le mtabolisme justement,
de la relation de l'assomption imaginaire par la
fonction, du stade du miroir, c'est autour de a que
va se jouer ensuite la triangulation, mais il faut
bien dire que dj, le stade du miroir n'a de sens
que s'il est pris lui-mme dans un systme
symbolique. Il faut dire que ce qui prcde
l'imaginaire, c'est le symbolique. C'est grce a
que souvent LACAN schmatise le stade du miroir en
dessinant le miroir lui-mme, en mettant que c'est le
grand Autre, le miroir dans lequel se reflte le moi,
dans cette mconnaissance. Il semble l quen effet
il y ait un passage d'un systme, disons indtermin,
spculaire, un systme de triangulation dans lequel
intervient, d'une faon plus spcifique, disons, le
nom du pre ou la loi, etc.
On pourrait dvelopper tout a mais enfin c'est
simplement pour marquer qu'il y a quand mme peut-tre
une terminologie dfinir d'une faon plus prcise
avant de pousser plus loin une discussions. Sans quoi
j'ai l'impression qu'on
316
Irne ROUBLEF
C'est trs juste ce que vous dites que la relation
duelle en effet, il faudrait y faire intervenir
l'image spculaire. Quant ce que vous dites sur la
frustration, il est bien vident que la frustration
est un dam imaginaire portant sur un objet rel, vous
avez oubli que l'agent en tait la mre symbolique,
mais ceci nous ramne toujours ce qu'on ne peut pas
appeler autrement que la relation duelle parce que,
pour le moment on n'a pas d'autre terme pour
l'appeler. Il est bien vident que c'est un terme
tout fait impropre. La relation duelle peut
comporter un trs grand nombre de personnes, de petit
(a) ou de n'importe quelle lettre de l'alphabet.
STEIN
Je vais intercaler un mot, un mot pour dire que quand
on parle de la castration - telle que, je crois,
l'entend LACAN, qui est en cela freudien, il n'y a
pas du tout d'cart, il n'y a aucune opposition de
LACAN FREUD en cette matire - quand on parle de la
castration, il ne faut jamais oublier que pour nous,
le concept de castration est un concept positif,
c'est le concept de l'accession un pouvoir
vritable, et c'est l que se situe sa relation avec
l'idal du moi, c'est un concept positif figur par
l'image ngative d'un manque.
Tout a qui se situe dans la marge entre la
positivit de ce concept et la figuration qui est
celle, ngative, d'un manque, c'est quelque chose
d'essentiel la problmatique de l'analyse. On a
souvent tendance confondre la castration avec ce
que les patients de FREUD lui disaient lorsqu'il en
parle dans Analyse termine et analyse interminable :
de toute faon, tout ce travail que nous avons fait
depuis quelques annes, c'est bien gentil mais moi je
n'aurai pas de pnis (si c'est une femme) ou moi je
suis quand mme toujours expos aux risques de le
317
perdre puisqu'il existe, puisque j'en ai un. Je peux
le perdre (si cest un homme).
Or, justement, a c'est le complexe de castration. Le
complexe de castration et la castration, au sens o
l'entend LACAN, ce n'est pas la mme chose.
Je crois que c'tait quelque chose qu'il fallait
dire. C'est justement l que le malade introduit ce
leurre auquel FREUD s'est peut-tre laiss prendre.
Car en dfinitive, en plaant les choses sur un plan
beaucoup plus terre terre de ce qu'on peut dire au
patient, on est quand mme amen lui montrer - et
c'est l qu'intervient justement la structure du
transfert dont vous parliez en citant LACAN, oppose
son historicit - on peut quand mme tre amen
lui montrer, par exemple, lorsque c'est une dame qui
se plaint de n'avoir pas de pnis, de lui dire que de
toute faon l'analyse ne lui en donne pas un, que ce
dont elle se plaint - de ne pas avoir de pnis - que
son envie du pnis n'est rien d'autre que ce avec
quoi elle essaie de prsenter au psychanalyste un
leurre. Car ce n'est pas vrai qu'elle a envie d'un
pnis. Ce n'est pas vrai dans l'absolu. C'est vrai
dans la mesure o cette envie lui permet de maintenir
le psychanalyste dans la position que j'ai dsigne
comme tant celle du contre-transfert.
Il faudrait dire a d'une manire plus prcise.
Irne ROUBLEF
C'est exactement celle laquelle BREUER s'est laiss
prendre avec Anna 0.
LACAN, dit la mme chose et d'ailleurs l'idal du moi
est en relation avec la castration puisqu'il apparat
chez FREUD dans le dclin du complexe d'Oedipe. Ce
n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit sur la
privation.
STEIN
Ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit sur
la privation Il faut voir justement les origines de
lidal du moi
318
Ginette MICHAUD
Il faut voir justement les origines de l'idal du
moi. C'est trs trs marginal la discussion mais
c'est propos d'une remarque qu'a faite STEIN tout
l'heure sur ce qu'il croit tre du transfert comme
non rvl par l'analyse, enfin, comme rvl par
l'analyse et comme prexistant. Je pense qu'on ne
peut qu'aller dans ce sens l. Le premier est FREUD
qui l'a bien dfini comme a, comme quelque chose qui
est rvl par la situation psychanalytique et qui
prexiste, qui n'est pas repris, qui n'est pas
r-articul en dehors mais qui prexiste la
situation psychanalytique.
On peut dire galement que, partir du moment o il
peut exister un support autre que la situation
analytique - c'est pour a que je trouve que,
effectivement, le terme duel, n'est qu'un lment
partiel, qu'une dfinition partielle de ce dont il
s'agit - que donc partir du moment o il peut
exister une situation, o le mcanisme du transfert
puisse tre repris et articul, on peut peut-tre le
mettre jour et s'en servir de la mme faon qu'on
peut s'en servir en analyse.
Par exemple, si on peut dire, trs sommairement, le
transfert en analyse, enfin, l'analyste est celui sur
qui, enfin qui est le rvlateur du transfert, sur
qui porte le transfert, qui est en mme temps, le
destinataire donc du message et le lecteur du
message, plus ou moins, si par exemple, dans un
organisme, dans une institution de soins o il existe
ces mcanismes, o quelque part, une structure puisse
tre en position de polariser ce mcanisme ou une
autre structure, ou l mme o une personne dans la
position analytique, qui soit l'analyste ou qui soit
le mdecin, puisse se servir de ce phnomne.
Je crois que, on peut ce moment-l reprendre des
mcanismes de transfert qui ne sont pas forcment
superposables au transfert de la situation
319
psychanalytique. C'est pour a que le terme duel
c'est un terme, enfin, on peut situer l'analyse
comme situation duelle partir du moment o elle est
situe en ngatif par rapport un grand Autre,
dfinir, enfin un grand Autre, enfin on peut dire en
terme d'exclusion.
Justement en analyse, enfin, l'analyste n'a pas ni de
rapports avec la famille, ni de rapports avec les
amis, se situe en miroir, par rapport ce qui va
tre projet l. Dans une institution, dans un groupe
thrapeutique, la situation est tout fait
diffrente. Il n'y a pas ce systme d'exclusion et
c'est justement la possibilit de polariser tout ce
qui est ailleurs vcu comme systme d'exclusion et
qui doit tre repris pour tre thrapeutique, pour
que justement, les mcanismes de transfert ne
puissent pas chapper au traitement, la thrapie du
malade globalement. Et pour viter le passage
l'acte, a se transforme en acting out c'est dire
disons en mcanismes qui font sens pour le dsir,
enfin, pour la demande, disons de celui qui est dans
cette situation, et puisse tre repris par ailleurs
sur le plan thrapeutique. Enfin Je crois que l, il
y a quelque chose dvelopper.
Irne ROUBLEF
Merci d'tre intervenue. Est-ce que quelqu'un d'autre
veut prendre la parole ? BEIRNAERT ? Non. Personne
d'autre ? Est-ce que STEIN vous voulez dire quelque
chose ?
STEIN
Ecoutez. Je crois que j'ai beaucoup parl. Merci.
Non.
Irne ROUBLEF
Vous pourriez avoir quelque chose dire en rponse
Ginette MICHAUD ?
320
STEIN
Non, tout ce que je peux lui dire c'est que ce n'est
pas possible de discuter maintenant. Tout ce que je
peux lui dire c'est que cette question m'intresse.
Je ne m'occupe pas du tout d'autre chose que
d'analyses. Mais a se situe - je ne crois pas que a
se superpose - mais a se situe dans la mme
problmatique que quelques mots que j'ai eu
l'occasion de dire propos d'une confrence que
KOECHLIN a faite l' volution psychiatrique sur la
thrapeutique institutionnelle.
Et je crois que c'est une chose qui peut intresser
le psychanalyste, disons en tant que thoricien, mme
s'il n'a pas l'occasion de s'occuper, ou l'intention
de s'occuper lui-mme, d'institutions psychiatriques.
Disons que je pense qu'il y a quelque chose
apprendre dans ce que les gens - qui comme vous s'en
occupent - ont nous dire. a me parat trs
certain. C'est--dire que je ne pense pas que la
thorie du soin des malades en institutions puisse
tre autre que la thorie psychanalytique. Et c'est
ce que vous confirmez tout fait. Donc a m'a
beaucoup intress.
Alors, pour terminer. Je voudrais vous remercier.
Irne ROUBLEF
Je vous remercie aussi, la sance est leve.
Table des sances
321
23 Mars l966 Table des sances
J'aimerais que nous ouvrions la fentre d'ailleurs, car c'est vrai, je m'aperois pour la premire fois,
que c'est irrespirable.
Je vous verrai aprs Jean-Paul.
Bon, ben je ne sais pas dans quelle ampleur a pu tre
diffus ceci que j'avais fait connatre qui de
droit en posture de le transmettre, savoir que ce
sminaire aujourd'hui tait un sminaire ouvert.
Peut-tre le fait que vous ne remplissez pas pour
autant la salle est-il d autant la grve qu' une
insuffisante diffusion.
J'avais en effet, mon Dieu, assez envie de reprendre
contact avec l'ensemble de mon auditoire aprs cette
interruption dont je m'excuse. C'est un manque de ma
part, sans doute. Mais, enfin, il me fallait bien
choisir et faire une fois ce que j'aurai d faire
depuis longtemps, savoir ce voyage aux U.S.A.
Il m'a sembl, et encore tout l'instant, que vous
attendiez - que certains de mes auditeurs
attendaient - que je vous en dise quelque chose.
J'essaierai donc de satisfaire, au moins en partie,
et d'une faon donc improvise, ce dsir.
Avant de le faire, pourtant, je tiendrai mettre en
avant, la bonne surprise, qui n'est pas une entire
surprise, la satisfaction finale que j'ai eue, disons
d'une bonne surprise que j'avais eue dj avant mon
dpart. Pour dire de quoi il s'agit, je vous
montrerai tout de suite ce dernier numro des
Temps Modernes, l'article de M. Michel TORT
118
,
ici prsent, paru en deux parties, qui s'appelle :
De l'interprtation ou la machine hermneutique.
118 De l'interprtation ou la machine hermneutique, Les Temps Modernes, n 237, fv. 1966 et n 238, mars 66 .
322
Je ne vous en ai pas parl avant de vous quitter,
attendant la fin de cet article, dont je puis dire
qu'il m'apporte de grandes satisfactions.
Il me semble convenir que porte le nom de TORT celui
qui y relve si bien le gant de ma raison.
En effet, je dirai que, pour qualifier cet article,
qui est un vritable ouvrage, je pense qu'il est pour
moi d'un grand encouragement de voir de la part de
quelqu'un
dont je ne spcifierai pas encore, enfin, la
qualit comme telle
de la part de quelqu'un, une mise au point, quelque
chose que j'appellerai tout de suite, que je
pointerai d'une faon qui pourrait tre encore mieux
qualifie, mais enfin je ne trouve pas de meilleur
terme que celui de dtournement philosophique,
ou encore, dtournement de pense.
Quelqu'un
119
de mon entourage immdiat, avait cru
devoir mettre au premier plan (ce n'tait pas sans
courage) les lments d'emprunt
pas forcment reconnus comme tels depuis
longtemps par l'auteur
des lments d'emprunt mon enseignement.
quoi il s'tait attir une singulire rponse dont
vous pourrez, tout au moins certains, mesurer
l'inexactitude en lisant un certain numro de Critique.
Le terme de plagiat, qui n'tait pas sous la plume de
mon lve, avait t mis en avant dans cette rponse,
et non mme sans en agiter les arrire-plans
juridiques, assurment ce n'est pas l la question.
Il y a longtemps que j'ai parl de cette question de
plagiat pour souligner qu' mes yeux, il n'y a pas de
proprit intellectuelle.
Nanmoins, aprs avoir t trs longtemps, non
seulement l'assistant assidu mais mme le confident
du dessein particulier de mon enseignement
l'endroit de la psychanalyse, s'en servir
et ceci depuis fort longtemps
s'en servir dans des confrences faites en Amrique
qui avaient du reste un grand succs, puis dans un
119 J.P Valabrega, Comment survivre Freud ?, Critique, n 224, janvier 1966.
323
ouvrage
120
des fins qui sont proprement les fins
contraires celles qui constituent le fondement de
la psychanalyse
mon enseignement tant un enseignement qui,
proprement, prtend rtablir l'enseignement de la
psychanalyse sur ses bases vritables
c'est cela que je qualifiai l'instant de
dtournement de pense. Je puis le faire d'autant
plus que l'article de M. Michel TORT est prcisment
la dmonstration exacte de cette opration
scandaleuse qui reflte d'ailleurs le ton gnral
qui, notre poque, est celui de ce qu'on appelle
plus ou moins vaguement, philosophie.
C'est bien pour cela que j'hsitais qualifier
M. Michel TORT de philosophe, l'opration laquelle
il se livre n'ayant rien de commun avec ce qui est
dans ce domaine et dans ce champ, d'usage.
La distinction ferme, rigoureuse, implacable qu'il
fait entre ce qu'il en est de l'interprtation
psychanalytique et de ce champ vague et mou - que
j'ai dj dsigne comme celui proprement de toutes
les escroqueries de notre poque - qui s'appelle
l'hermneutique, cette distinction une fois fixe,
est vraiment le genre d'opration que je puisse le
plus souhaiter venant de ceux qui m'coutent, et qui
m'coutent de faon approprie, j'entends : en
entendant la porte de ce que je dis.
L'ouvrage de Monsieur Michel TORT cet gard,
reprsente une borne, une borne essentielle sur
laquelle, vraiment on pourra se fonder pour qualifier
ce que j'ai voulu dire concernant ce qu'il en est de
l'interprtation psychanalytique.
En effet, si vous vous reportez ce que j'ai avanc
la fin de mon sminaire de l'anne dernire
concernant la situation cre par l'avnement de
la science, et que cet avnement a t possible
dans la mesure o une position tait prise qui
usait du signifiant, si je puis dire, en lui
refusant toute compromission dans les problmes
de la vrit
120 P. Ricur, De l'interprtation, Paris, Seuil, 1965
324
si l'on pense que par l que cette situation est
cre, par quoi du champ de la vrit, la question
est pose la science, par chacun de ceux qui se
trouvent atteints par cette modification
fondamentale : Qu'en estil de la vrit ?
Que c'est proprement sur ce champ de la vrit
effectivement que la religion rpond, et quest
actuellement inliminable de toute position
philosophique de partir de ce fait : de la
distinction, de l'opposition radicale de la religion
et de la science, qu'il est impossible qu'il est
intenable, comme peut le faire un WHITEHEAD
121
,
d'essayer de rpartir les domaines de la science et
de la religion comme deux domaines distincts d'une
objectivit qui pourrait avoir quoi que ce soit de
commun, que leur diffrence est trs prcisment de
deux abords essentiellement et radicalement
diffrents de la position du sujet.
Que ds lors il s'avre, que si je dis que la
psychanalyse, c'est proprement l'interprtation des
racines signifiantes de ce qui, du destin de l'homme
fait la vrit, il est clair que l'analyse se place
sur le mme terrain que la religion et est absolument
incompatible avec les rponses donnes dans ce champ
par la religion pour la raison propre qu'elle leur
apporte une interprtation diffrente.
La psychanalyse, au regard de la religion est dans
une position essentiellement dmystifiante.
Et l'essence de l'interprtation analytique ne peut,
d'aucune faon, tre mle, quelque niveau que ce
soit, de linterprtation religieuse de ce mme champ
de la vrit.
C'est en ce sens que je dirai que M. Michel TORT
en articulant ceci jusqu'au point o ceci rejette
dans le mme champ dmystifier la presque
totalit de la tradition philosophique,
dialectique hglienne comprise
s'est dmontr en cette occasion, tre, ce que je ne
peux en fin de compte qualifier que d'un mot,
121 Alfred North Whitehead, La science et le monde moderne, d. du Rocher, 1994, Coll. Lesprit et la matire
325
puisqu'il n'y en a pas d'autre ma porte pour
l'instant: un freudien.
Ceux qui mritent d'tre qualifis de ce terme sont
ma connaissance, proprement compter sur les doigts.
Eh bien, aprs avoir rendu, cette justice M. TORT,
l'avoir remerci, lui offrir cette occasion, tout
ce qui pourra lui convenir pour adopter son ouvrage
dans quoi que ce soit qui puisse tre de mon orbe,
comme faon de le republier, d'avoir aussi dsign
l'attention de tous, et pri chacun de s'y reporter,
et je dirai, ligne par ligne, eh bien mon dieu,
j'essaierai de vous dire un peu ce que vous attendez
m'a-t-on dit, savoir mes impressions de ce court
voyage d'Amrique, puisque j'y ai pass vingt-huit
jours.
Aborder, surtout d'une faon, comme a, un peu
impromptue cette exprience, ce n'est peut-tre pas
trs commode. D'abord parce que, il y a l des
consquences pratiques et des projets dont je ne
puis, aprs tout faire tat, qu'aprs en avoir
confr avec mes collaborateurs les plus proches dont
je ne dois la confidence qu' eux. C'est pourtant
bien tout de mme sur ce champ de ce que j'ai pu
rencontrer l-bas de la ralit, disons,
psychiatrique, voire universitaire dans son ensemble,
que vous m'attendez. Peut-tre mme - pourquoi pas? -
mattendez-vous sur mes souvenirs de voyage.
Prendre contact avec ce qui n'est un nouveau monde
aprs tout que pour moi puisque j'ai attendu mon ge
avanc pour y mettre le pied, ceci suggre peut-tre
certains, quelque curiosit, je ne vais srement
pas me mettre jouer devant vous au KEYSERLING
propos de cette rencontre.
Et tout de suite, je dirai que la prudence et le
respect du rel me commandent, aprs une traverse
aussi courte, surtout de m'abstenir de jugements.
Je pense d'ailleurs, foncirement, et pas de cette
date, que le bnfice, a tirer d'un voyage c'est
quon voit au retour, ce qui vous est bien connu,
familier, d'un autre il.
326
C'est l, la vritable dcouverte d'un voyage. Et
c'est en ce sens que ce voyage est une grande
dcouverte car je ne sais pas encore jusqu'ou va
aller le fait que je vois ici les choses d'un autre
il, mais je suis certain qu' cet endroit, ce voyage
ne sera pas sans consquence.
Comment essayer de dire a ? Mon premier sentiment
l-dessus ? Il s'agit dans ce que je vais dire, de
mon exprience. Vous voyez bien comme je le situe.
Il ne s'agit pas d'un jugement sur les Etats-Unis
d'Amrique. Il s'agit de ce que moi, j'y ai vu, et
qui, tout d'un coup, laisse prvoir, tout ce que je
vais par exemple, partir de maintenant, laisser
tomber dans mon discours.
Tendance, indication Pas sr que j'aille aussi loin
que je vais le dire. Le dpart d'un tel effet, je
vais, essayer de le rsumer en une courte phrase. Il
m'a sembl rencontrer un pass, un pass absolu,
compact, un pass couper au couteau, un pass pur,
un pass d'autant plus essentiel qu'il n'a jamais
exist, ni la place o il est, pour l'instant
install, ni l d'o il est cens venir, savoir de
chez nous.
Evidemment, ceci peut venir peut-tre d'un excs de
tourisme. Le fait qu' New York j'ai rencontr des
glises gothiques et mme des cathdrales tous les
coins de rues (je dis tous les coins de rues, il y
a des gens qui y ont t qui peuvent dire que c'est
vrai, on ne l'a pas assez soulign et c'est comme a)
le fait que l'Universit de Chicago laquelle j'ai
cru devoir aboutir - mettant ici un terme la srie
de six confrences que j'ai faites l-bas - j'y
tenais beaucoup parce que, Chicago, est un endroit
qui est lu dans mon histoire. Il s'y est tram des
choses bien intressantes, celles qui devaient tre
en principe destines me retirer dsormais toute
possibilit de parole.
Je n'tais donc pas du tout mcontent d'aller l'y
porter moi-mme.
A Chicago j'ai vu une Universit toute entire - mais
une universit, l-bas, vous savez, c'est trs grand
- toute entire construite en gothique.
327
Une centaine de btiments d'un gothique, je dois
dire, parfait. Je n'ai jamais vu de plus beau
gothique, de plus pur gothique. Je peux dire que
c'est rudement bien fait. Le faux gothique vaut
largement le vrai, je vous l'assure !
Nous savons que les mthodes universitaires dans tous
les pays du monde, restent dates de l'poque
gothique.
La Sorbonne, par exemple, est toujours structure
comme lre de sa naissance qui tait l'poque
gothique. Elle se distinguait dj par une violente,
manifeste, opposition tout ce qui pouvait se crer
de neuf, comme nous le savons propos de cette
condamnation, que je vous ai rappel rcemment
qu'elle a cru devoir porter contre Saint-THOMAS
d'AQUIN ,qui tait un petit audacieux novateur.
Quand je parle de la gothicit de l'universit, je ne
dis pas pour autant qu'elle en soit reste toujours
aux mmes principes, elle a plutt dchu. l'poque
gothique, justement on maintenait trs svrement ce
principe des deux vrits dont je vous parlais tout
l'heure, quand on faisait de la philosophie, c'tait
pas pour dfendre la religion, c'tait pour l'en
sparer. De nos jours, nous avons procd ce mixin
dont, bien entendu, les rsultats s'tendent. Ceci
n'est qu'un rappel de ce que je disais tout
l'heure. En tout cas, il y a une chose certaine,
c'est que la Sorbonne l'poque o elle tait de
bonne gothicit, n'tait pas construite en gothique,
pas tout au moins dans ce gothique parfait de
l'universit de Chicago.
Ceci n'est qu'impressif. Vous avez quand mme le mme
sentiment quand vous voyez entasss dans des muses
ces formidables, inimaginables collections
d'impressionnistes - qui semblent l comme exils,
comme prisonniers, extraits de cette atmosphre, de
cette lumire parisienne de la fin du dernier sicle
o ils sont clos - qui sont visits, dans une sorte
d'usage crmoniel par des hordes de femmes et
d'enfants qui dfilent - je dois dire quelque heure
de la journe, quelque jour de la semaine qu'on
survienne - devant cette sorte d'clat incomparable,
328
dchirant, qu'ils prennent de leur accumulation mme,
comme si c'tait l, en effet, le lieu o devait
chouer le produit, enfin, clatant, d'un art que
nous avons, il faut bien le dire, ici,
particulirement ddaign, je veux dire au moment
o il surgissait et c'est donc une fois de plus notre
pass, l massif, qui se trouve l-bas, je dirais
d'une certaine faon qui a pes, pes trs lourdement
sur quoi que ce soit d'autre qui semblerait aprs
tout, appel natre dans une socit qui existe
depuis assez longtemps pour avoir ses matres propres
de culture.
videmment, il y a des petits bourgeons de temps en
temps. Je ne peux pas vous dissimuler la satisfaction
que j'ai eue voir un appartement tout entier meubl
de menus chantillons, de ces petites pousses comme
a de fivre crative qui s'est intitul elle-mme de
la rubrique du Pop Art. C'tait un type qui avait
fait fortune dans les entreprises de taxi et qui
s'tait trouv tre effectivement un des premiers
financer, c'est--dire donner par ci par l deux
cents dollars ce groupe jusqu'alors dispers de
gens qui s'taient lancs dans un certain registre.
Je ne veux pas vous dcrire ni les principes, ni
l'aspect, ni le style, nienfin ce qui rayonne de ce
Pop Art, ce que je veux dire c'est que ce personnage
qui restait l, a entirement meubl, habill, son
appartement, ses murs couverts, des fruits, des
uvres du Pop Art, m'a fait un long discours, trs
boniment, pour m'expliquer comment il avait peru,
aid, soutenu ce Pop Art.
J'ai trouv a extraordinairement sympathique.
Enfin quelque chose me paraissait dans cet art en
rapport avec la socit qui le soutenait.
Malheureusement quand j'ai - sans aucun sens
particulier du paradoxe, car j'avais prouv cette
exprience un assez vif plaisir - j'en ai fait part
aux gens trs distingus que je rencontrais New
York, j'ai senti une certaine rserve. On me
regardait d'un drle d'il. Je veux dire qu'on se
demandait si je ne poussais pas la plaisanterie un
peu loin car le Pop Art pour l'instant, semble bien
329
- et dj - rentr dans les dessous, et mme ce qui
lui a succd, savoir l'Op Art.
Bref, ce que j'appelais tout l'heure la dominance
du pass, je viens de vous l'illustrer - j'improvise,
je m'excuse, d'tre si long - je viens de vous
l'illustrer dans des champs qui ne sont pas
proprement parler ceux qui nous intresse mais c'est
peut-tre que je ne voudrais pas trop en dire, que je
voudrais pargner ce qu'aprs tout, je ne connais
qu'imparfaitement et forcment par des gens qui eux,
taient plutt aspirants ce que quelque chose
change de ce que nous appellerons le mode
d'enseignement de la psychologie, voire de la
psychologie dans la mdecine, de ce qui tait le
statut, le mode de vie, les habitus du psychiatre.
Aprs tout, c'est extraordinaire - je prends les
termes propres de quelqu'un qui me parlait - c'est
extraordinaire, de la facilit de la vie l-bas pour
un psychiatre, on n'a vraiment pas besoin, me disait-
on, de se donner de la peine pour avoir de la
clientle.
Et partir de l des noms m'ont t cits qui ne
sont pas des moindres, qui sont plutt capables
d'tre ceux auxquels je pourrais pingler des propos
comme ceux-ci :
mon Dieu, pourquoi se poser des questions, et surtout si
peu que ce soit mtaphysiques, alors mon Dieu qu'aprs
tout, tout va si bien, qu'on finit son ouvrage cinq
heures et demi, on boit son whisky, on lit un roman,
habituellement d'espionnage et qu'on se place devant sa
tlvision .
Je ne vois pas pourquoi on reproche ce qui
constitue une classe sociale, d'avoir ses commodits,
simplement c'est nous de nous apercevoir de ce que
cela peut comporter, bien sr, d'inertie,
d'installation.
Eh bien, quelles que soient les apparences, il ne
faut pas croire, pourtant, que sur ce fond, sur ce
fond trs particulier qui est peut-tre, si je puis
dire, l'envers de ces gratte-ciels, de cette
330
verticalit monumentale, qui est d'ailleurs - chose
singulire n'est ce pas - le privilge exclusif des
banques. A ct de a, il y a tout un monde
horizontal qui est prcisment celui habit par les
gens de la classe que j'voquai l'instant, savoir
un monde infini, une mer de petites maisons de deux
tages, parfaitement imites du style anglais, dans
lesquelles vivent - avec, mon Dieu, ce qu'on peut
appeler tous les agrments de l'existence - un
personnel considrable, qui est prcisment celui qui
nous intresse l'occasion, puisque c'est celui au
milieu duquel j'tais appel me dplacer en
prgrin ou en pionnier comme vous voudrez. Dtroit
o j'ai pass, est une ville de 25 km de large sur l8
km de hauteur ce qui, quand on va chercher un bon
restaurant, entrane un temps, malgr tout,
considrable pour la traverser en auto.
Encore que le cur de cette ville soit constitu par
un noeud d'autoroutes. A l'intrieur de ce rseau
d'autoroutes, vous avez les alles dont je vous parle
avec les innombrables petites maisons et toutes
celles o j'ai pntr, bien sr - tant donn la
classe des gens que je voyais -taient fort bien
meubles et plutt encombres d'objets d'art
emprunts aux prgrinations travers le monde qui
sont nombreuses, comme vous savez, des personnages
intresss.
Tel est pour le style et le complment de ce que j'ai
appel tout l'heure cette sorte d'inertie passiste
et d'un pass singulier, je reviens l-dessus, car
cela m'a suggr cette forme de question : il y a une
dimension du pass qui est dfinir comme
essentiellement, radicalement, diffrente de celle
qui nous intresse sous la rubrique de la rptition.
Le pass dans lequel elle n'intervient aucun degr,
et c'est bien un sentiment de cette sorte que j'ai eu
la rencontre de cet extraordinaire pass, c'est que
c'est un pass sans aucune sous-jacence de
rptition.
331
C'est peut-tre ce ct singulier, frappant,
impressionnant je vous l'assure, qui m'a donn, tout
au moins, disons le sentiment, qui est celui, enfin,
d'une pte absolument impossible remuer.
Car ce n'est pas dire pour autant que je n'ai
rencontr la-bas de nombreuses occasions de dialogue.
Et je dirai que sur les six auditoires que j'ai eus
nommment, l'Universit de Columbia, ds mon
arrive, au M.I.T. (Massachusets Institute of
Technology), l'universit de Harvard, (Center
for cognitive studies), l'universit de Dtroit
o j'ai parl devant le collge des professeurs,
aprs une de ces sortes de crmonie qui consiste
en un djeuner que l'on prend dans une salle fort
confortable - qui se distingue par l'absence de
toute boisson vinique dont ce n'est pas le
privilge des Etats-Unis - l'universit Dan
Harbour quelque 55 km de l, qui est une ville
- alors j'ai parl de l'universit de Chicago, le
mot ville tait une mtaphore, pour l'universit
Dan Harbour ce n'en est pas une : la circulation
de quelques 30.000 tudiants qui vivent l dans
une ville quasiment spcialise pour les
recevoir. Et enfin l'universit de Chicago, le
public tant diversement dos selon ces
diffrents endroits, plus de linguistes et de
philosophes, peu de mdecins Columbia mais par
contre un public presque entirement mdical
Chicago, ceci tenant au fait dune partie de
l'universit auxquelles s'tait adress mon ami
Roman JAKOBSON, qui je veux maintenant ici
rendre hommage pour toute l'entreprise dont il a
t la fois l'initiateur et l'organisateur
eh bien, je dois dire que sur ces six auditoires,
j'ai eu, en rponse ce que j'ai cru devoir
articuler (dont je n'aurai peut-tre pas le temps de
vous donner ide) en rponse, les questions, mon
Dieu, les plus pertinentes, les plus intressantes
que j'ai eues avec les professeurs de diverses
spcialits avec lesquels, grce a leur accueil, leur
charmante hospitalit, j'avais ensuite - tout au long
de la journe, ou lors de rencontres, dners et
332
autres festivits - l'occasion de m'expliquer. J'ai
eu le sentiment d'une trs grande ouverture des
choses que j'apportai et qui, leurs oreilles,
taient pourtant, incontestablement, indites. Je
parle ici du milieu universitaire. J'excepte, l
comme partout, ce que nous appellerons le milieu
Highbrow , la haute intelligentsia, localise,
pour moi tout au moins, dans ce que j'ai rencontr
New York.
Car New York mon enseignement est indit - peut-
tre, mais il ne le sera probablement pas toujours -
mais il est loin d'tre inconnu.
Mais comme on vous l'a dit sans doute dj trs
souvent, New York n'est pas l'Amrique. A New York on
sait parfaitement ce qui se passe ici et la petite
place que j'y tiens n'est pas ignore. Mais pour
revenir mes contacts avec l'universit amricaine,
mon sentiment - confirm d'ailleurs par mes
interlocuteurs, qui m'ont dit ce qu'il fallait que
j'en attende et que je n'en attende pas - mon
sentiment est que le champ est trs large des lieux
et des points ou vous pouvez retenir l'attention,
nouer des liens, laborer des contacts qui seront
suivis ,enregistrs, publis. J'ai rapport quelques
chantillons de revues proprement parler
intrieures des universits et que j'ai mme lus en
route avec un trs vif intrt car il y a des
articles excellents, de toutes sortes et de toutes
espces et on peut dire que tout est faire. On peut
dire aussi que rien n'est faire car assurment,
avec autant d'ouverture, d'accueil, voire de succs,
le sentiment - le sentiment au moins actuellement
gnral, je parle parmi mes interlocuteurs: je ne me
permettrai pas d'avoir un sentiment moimme - est
qu'en aucun cas on ne changera rien l'quilibre
actuellement atteint, qui laisse trs suffisamment de
libert chacun aux entournures : une personne qui
entrane avec elle un nombre suffisant de
collaborateurs, n'est certainement pas empche de
travailler, et tout s'installe donc dans une
juxtaposition de coexistence vitale qui semble bien
pour l'instant exclure - mme si l'on aspire un
333
renouvellement de style et spcialement dans ce qui
nous intresse, dans ce qui m'intresse : savoir le
statut de l'enseignement de la psychanalyse - qu'on
n'arrivera rien qui ressemble un renversement de
courant, un reflux, un retour de mare, tout ce
que vous voudrez qui ressemble un changement
fondamental.
Nanmoins entre ce tout faire et ce rien faire,
je crois que mon penchant pour l'instant est
assurment, mon dieu, ne serait-ce qu la faon de
relever un dfi - et puis il y a autre chose dans le
monde que les Etats-Unis d'Amrique du Nord - d'y
faire quand mme au moins quelque chose sous la forme
de publication et c'est l ce que je rserverai quant
mon projet, mes lves plus proches.
Y ajouterais-je, en deux mots, le complment, la
confidence de ceci, que, au cours de ce petit travel
qui n'est presque qu'un petit trip, je me suis
rserv a la fin huit jours, pour mon plaisir
personnel et qu'ayant projet d'abord de le faire
dans l'Ouest amricain, j'ai chang mon projet, ne
pouvant soudain rsister la proximit de pays
pleins de magie - je pense pour certains d
!
entre vous
- qui s'appelle le Mexique, que j'y ai t passer
huit jours. Je ne vous en parlerai pas longuement
maintenant. Je n'y ai pas du tout eu l la vie d'un
missionnaire. J'ai eu celle d'un touriste, il faut
bien le dire, rien de plus. Enfin les choses que j'ai
vues m'ont touch, en deux points.
C'est qu'on ne peut qu'tre trs impressionn de
voir, enfin quoi, quelque chose qui est bien, la
religion antique, puisque tout l'heure nous en
parlions de religion, de ces ttes qui sont toujours
l absolument inchangs, le visage et j'oserai dire
le regard, de ces Indiens, toujours les mmes, que ce
soit ceux qui vous servent pas discrets dans les
couloirs des htels ou qui habitent les cabanes
encore de chaume au bord des routes.
Ces Indiens
334
qui ont la mme figure, exactement, que nous
voyons fige dans le basalte ou le granit, ces
fragments flottants que nous recueillons de leur
art antique
ces Indiens ont l, je ne sais quoi d'un rapport qui
persiste avec la seule prsence sur les monuments de
ce qu'on appelle improprement pictogramme, idogramme
ou autres dsignations impropres de ce que nous
pouvons appeler hiroglyphes, et aussi bien pas
toujours dchiffrs, mais dont la reprise par les
peintres contemporains ou les architectes
car Chicago, il y a sur les murs, d'une
bibliothque ultra-moderne par exemple, les
quatre faades entires dcores de ce que nous
pourrions appeler l'usage d'paves de ces formes
signifiantes
ce qui se vhicule par l me semble quelque chose
d' la fois nigmatique et en mme temps, d'aussi
impressionnant par cette sorte de lien invisible
travers une cassure irrmdiable qui subsiste, entre
les gnrations qui se lvent et celles de ces
tudiants qui peuplent une universit Mexico, je
dirais, la plus norme de toutes celles que j'ai
vues, avec ces signes, ces signes avec quoi quelque
chose est jamais rompu et qui pourtant sont l,
traduisant d'une faon visible, ce que je ne pourrai
appeler, parce que je suis devant cet auditoire,
qu'un rapport conserv avec ce qu'il y a de si
sensible dans tout ce que nous savons de ces cultes
antiques, cette chose quoi n'ont rien compris,
sinon par un effet d'horreur, les premiers
conqurants, et qui n'est autre - que
partout visible, partout prsente, partout
accroche, comme en forme de breloque toutes les
formes de la divinit - qui n'est autre que
l'objet(a).
Nous aurons sans doute (peut-tre) y faire allusion
par la suite et peut-tre aurais-je l'occasion de
vous le donner, titre, enfin, de simple
illustration marginale mais non, sans doute, sans
porte ce que je continuerai de vous en dire.
335
Eh bien, il est inutile au milieu de tout a de vous
signaler ce que je pensais voir s'en esquisser comme
consquence. Je me suis donn un mal norme, au cours
des nombreuses annes de mon enseignement, pour faire
parvenir un milieu qui n'tait pas spcialement
prpar le recevoir, un certain nombre
d'informations plus spcialement concernant le champ
de la linguistique. Vous avez dj senti depuis
longtemps que je peux avoir ldessus de lgres
nostalgies, le rsultat est que, aprs quinze ans de
cet enseignement, j'ai mis, peut-tre un petit peu
avant les autres, ce petit milieu qui tait celui sur
lequel j'oprais, au parfum, au parfum de quelque
chose qui, maintenant, cavale delle-mme partout,
tous les carrefours, tous les coins de rue, voire
sous le nom plus ou moins appropri
quil sera bientt absolument mme, impossible
nettoyer tellement il va tre couvert de ces
diverses incrustations de coquillages qui
revtent les paves
le mot de structuralisme. C'est que c'est plutt l
qu'il va s'agir de procder un trs, trs srieux
nettoyage pour tout de mme dire quel est le ntre de
structuralisme.
Cet effort que j'ai pu faire aussi pour rappeler les
conditions de naissance et l'volution de la science
dans ce que a peut avoir pour nous de dcisif, de
nous concevoir comme dtermins par cela. Il faut
bien le dire, j'ai eu la surprise aux EtatsUnis de
trouver une grande partie de mon programme, de ce qui
est dans mon sminaire, tal sur des murs d'une
dizaine de mtres de long sous forme de petits
diagrammes, sur lesquels d'ailleurs personne ne
jetait les yeux, qui contenaient absolument d'une
faon dcisive, les dates, les points tournants et
parfaitement bien expliqus dans chaque ligne de la
classification des sciences et qui, si je dois le
dire, je dois dire que si c'tais l-bas que j'avais
enseigner, m'eussent pargn bien des peines. Car
en fin de compte, toute ces choses l sont au niveau
du livre de poche.
336
C'est l l'intrt, l'importance de ce que
j'appellerais d'un certain ct, l'vacuation du
pass qui est du mme coup possible si nous en voyons
bien la dimension propre, ce ct d'inertie, on
pourrait en laisser la manipulation aux ouvriers
de la pelle. Il faut bien le dire, ceci n'est du tout
une perspective de despise, de mpris. Ce qui
apparat l-dedans au contraire de plus certain,
c'est ce que a dgage concernant notre propre
essence.
Parce qu' partir du moment o le pass, l'tat de
pur pass, est l-bas existant, local,
sous sa forme parfaite, car, comme je vous le
dmontrai tout l'heure, la peinture de l'universit
de Chicago, il existe plus parfait qu'il n'a exist.
La cration impressionniste est l comme une mouche
prise dans l'ambre, dans une perfection de statue
qu'elle n'a jamais eue ici.
Au regard de ce pass qui est nous en quelque sorte,
dont on nous dlivre, il y a tout un ct de nous-
mmes, qui nous en reste, qui est bien nous tels que
nous sommes actuellement et qui n'en est que le
ratage. Pour le voir port la caricature, c'est
encore Mexico qu'il faut aller et l'htel
Del Prado s'installer devant une fresque qui a la
taille de cette paroi de notre pice ici, qui est de
Diego RIVERA et qui s'appelle :
un rve de dimanche aprs-midi sur l'Alameda.
L'Alameda, c'est la sorte de Tuileries de Mexico et
la figure que nous prenons sur ce panneau - je ne
vais pas vous le dcrire - procurez-vous en des
photographies, elle est bien instructive.
Voil donc ce que je crois que nous pouvons apprendre
en allant aux Etats-Unis et aussi bien sur le sol
entier de cette noble Amrique, c'est la figure de
tout ce qui a t manqu, au pass, c'est la figure
en quelque sorte rtroactive d'une adhrence
quelque chose qui n'a jamais t vcu, et qui, comme
tel, ne peut pas l'tre, sous aucune forme, si l'on
se laisse aller un peu quelque mouvement que ce
soit qui soit celui de l'espoir, d'une vivacit,
d'une cration, assurment.
337
Tout ce qui vous reste d'un pareil contact c'est une
impression vraiment crasante de ce qu'il peut y
avoir de lourd soulever dans notre monde.
De quoi leur ai-je parl ? Il est bien certain que
je ne leur ai pas fait proprement parler un
sminaire. Quoique mon enracinement dans un certain
style n'tant pas si possible rompre d'un seul
coup, c'est ce penchant, cette habitude, voire ce
besoin que j'ai pris d'une certaine faon de crocher
mon audience que je dois, mon tonnement, je dois
dire, de n'avoir pu en aucun cas me rsoudre leur
parler en franais, et chose curieuse, d'tre
vraiment arriv leur parler en anglais.
L'habitude que j'ai de suivre sur vos visages l'effet
assez particulier de cette parole, ne m'a pas sembl
extrmement diffrente de ce que j'prouvai devant
ces auditoires, savoir que leur visage captif,
sinon illumin me donnait bien le sentiment que
quelque chose de cet anglais n'tait pas de telle
nature qu'ils n'en reussent pas l'impression d'un
langage articul.
Voil. Alors je leur ai parl - je vais vous dire a
en deux mots puisqu'on va se quitter dans quelques
instants - j'ai un peu centr les choses, parce qu'il
fallait bien me faire entendre, sur quelque chose qui
m'a paru percutant. Et puis moi, vous comprenez, je
suis dans mon objet(a), pour l'instant, j'essaie de
vous l'amener comme a, en route et de vous le faire
glisser dans un certain nombre de chaussettes, et
d'o il nous doit ressortir de telle ou telle faon.
Nous verrons a, nous reprendrons a la prochaine
fois. Il fallait bien que je retourne aux bases. Et
aprs tout, a m'a permis de les rassembler ces
bases. Non pas, bien sr que je les laisse comme a
aller la drive. Mais enfin pourquoi pas : a m'a
peut-tre permis de prendre le module d'un discours
plus regroup, plus simple aussi, plus percutant,
encore que le coup de marteau ne soit jamais absent
de ce que je vous raconte.
338
Peut-tre qu'aprs tout, j'en ferai un petit recueil
qui ne sera peut-tre pas si mal adapt des
oreilles amricaines puisque c'est des oreilles
amricaines que je l'ai mesur.
Eh bien, j'ai cru devoir partir de quelque chose qui
est tout de mme un trait sensible, un trait facile
faire entendre et qui n'est pas nouveau, bien sr
pour vous, c'est celui de la distinction de la
demande et du dsir.
Evidemment en anglais - je me vantais de m'tre fait
entendre - c'est videmment avec un vocabulaire et
des raffinements syntaxiques plus rduits que j'ai
t amen parler.
Il est tout fait facile de faire entendre des
gens qui vous coutent - quand on leur demande
quelque chose - qu'ils aient se mfier : que ce
n'est pas toujours ce qu'on vous demande qui est
justement ce qu'on dsire que vous donniez. Il suffit
d'avoir un petit peu la moindre exprience, il suffit
d'avoir une petite amie pour que cette vrit soit
immdiatement perceptible et aprs a vous pouvez
entrer dans des considrations structurales.
Oui. Parce qu' partir de ce moment-l, bien sr,
vous pouvez montrer que le dsir doit tre extrait de
la demande, et qu'il y a ce second temps, que la
demande est articule dans l'inconscient. Il suffit
l de faire rfrence aux vrits que je vous ai
rappeles depuis toujours et qui consistent
simplement ouvrir les premiers livres de FREUD.
En fin de compte, il n'est pas impossible, mme
devant un auditoire amricain, d'introduire
l'inscription de la formule qui est au coin, en haut
et droite de mon graphe savoir : S D
339
(S barr dans son rapport la demande) savoir que
c'est prcisment l que s'accroche la division du
sujet.
Ce qui est videmment rintgrer cette division du
sujet au mme plan, au mme niveau o FREUD a
introduit la division de l'inconscient et du
prconscient, supprimer la distance qui spare ce
dbut de son uvre, de ce point qui est son point de
chute, le splitting de ce qu'il appelle l'ego, c'est-
-dire le splitting du sujet pour montrer, par
exemple, cette occasion que la remarque que FREUD
fait, que dans l'inconscient ne fonctionne pas le
principe de contradiction, est une remarque qui n'est
que de premire approche, inadquate en un sens, si
elle va jusqu' impliquer qu'il n'y ait pas de signe
de ngation dans l'inconscient.
Car nous savons tous, et lire les textes de FREUD
lui-mme, que la ngation a - je ne dis pas dans
l'inconscient, a ne voudrait rien dire - mais dans
les formations de l'inconscient, des reprsentants
tout fait reprs et clairs. La prtendue
suspension du principe de non contradiction au niveau
de l'inconscient, c'est simplement cette fondamentale
splitting du sujet.
Il y a quelque chose d'autre que j'ai mis au premier
plan de mes discours et qui suit, comme un grain de
chapelet suit l'autre, cet abord, par la diffrence
de la demande et du dsir, c'est la dsignation du
point - qui est le mme point de rendez-vous d'o je
suis parti tout l'heure, au reste concernant les
rapports du savoir et de la vrit - c'est que ce que
FREUD nous apporte, c'est la dsignation du lieu
d'incidence d'un dsir particulier et qui est le
point par o la sexualit entre en jeu comme
fondamentale dans le domaine qu'il s'agit de dfinir
et que ce point s'appelle : le dsir de savoir.
C'est parce que la sexualit entre en jeu d'abord par
le biais du dsir de savoir que le dsir dont il
s'agit dans la dynamique freudienne est le dsir
sexuel. C'est parce qu'il entre en jeu sous les
espces que - dj, avaient repr et non sans motif
les esprits religieux - c'est parce que la
340
cupido sciendi a t situe l o il fallait par
FREUD que tout est chang dans la dynamique de
l'thique. Que les autres dsirs, le dsir de
jouissance et le dsir de domination s'avrent n'tre
pas du mme niveau.
Que l'un se trouve dans cette position dpendante
d'tre au niveau du narcissisme, que l'autre - dsir
de jouissance - est prcisment l pour nous
manifester ce que j'appellerai la duplicit du dsir.
Car, loin que le dsir soit dsir de jouissance, il
est prcisment la barrire qui vous maintient la
distance plus ou moins justement calcule de ce foyer
brlant, de ce qui est essentiellement viter pour
le sujet pensant, qui s'appelle la jouissance.
Irais-je jusqu' vous dire que j'ai amorc pour eux
ce qui sera le pas suivant de ce que je vais avoir
exposer devant vous.
savoir, tenant compte de ceci dont bien sr je n'ai
pu que parler ds l'abord
savoir du lieu de l'Autre, point de position de
la vrit, comme lieu o est mise en question la
vrit de la demande, comme lieu aussi o
apparat et surgit du mme coup la dimension du
dsir
j'ai pu amorcer ce qui, je viens de vous le dire, va
tre la suite de mon discours et qui, consiste
prciser ceci que le dsir - ce dsir dont d'abord,
je vous ai articul le lieu disant que le dsir c'est
d'abord le dsir de l'Autre - la topologie va nous
apprendre mettre en fonction cette sorte de
retournement qui est proprement celui que j'essaierai
de vous manifester au niveau que je vous montrais,
tels qu'ils sont, tel qu'il est faisable, comme on
retourne un gant, au niveau de la structure du tore,
que si le dsir est reprer, mesurer en fonction
d'une demande de l'Autre, ce que la structure va nous
permettre de voir - la structure qui est la structure
du tore - c'est quil y a un fondement structural
parfaitement
je minimise en disant qu'il est illustr par la
structure du tore, il est soutenu par la
structure du tore, le tore est la substance,
341
l [l'upokemenon] de la structure dont il s'agit
concernant le dsir, le tore peut apparatre,
avec vidence, c'est ce que je vous montrerai
bout de craie la prochaine fois
que s'y inscrit, de la faon la plus claire, le
rapport qu'il y a du soutien d'un dsir, non pas la
demande mais a la demande rpte ou la double
demande. Et le fait que cette figure, qui est
proprement celle que je vous dessine ici,
le retournement de la structure du tore peut
manifester, matrialiser sous vos yeux ce qui s'en
peut obtenir et nous verrons ce que signifie
retournement en fonction de ce qu'il arrive du
retournement quand il s'agit des autres structures
topologiques savoir du cross-cap et de la bouteille
de KLEIN.
Ce retournement tant opr, nous avons deux dsirs
en rapport avec une demande.
342
Cette duplicit du dsir par rapport la demande est
la racine de tout ce qui, dans le champ analytique
s'tend aussi loin que ce qu'on appelle confusment
ambivalence et qui peut seule trouver l sa raison.
C'est ce que la prochaine fois, j'aurais l'occasion
de vous dvelopper d'une faon plus ample. Et vous
voyez d'ores et dj que ce dont il s'agit c'est de
la fonction d'une coupure, que dans ces trois formes
que j'aurais reprendre sous cet angle, c'est la
mme forme de coupure, savoir ce que j'ai appel
l'S ou le S invers qui nous en donne la cl et la
forme, et qu'il y a des fonctions diffrentes.
Bref, pour conclure et dire ce que j'essayais avant
tout de faire passer aux oreilles de mon auditoire
aux Amriques, c'est qu'il est un domaine isolable,
dans le champ appel jusqu'ici psychologique, qui est
le domaine de ce qui est dterminable comme champ du
langage et effet dans ce champ de ce qui est la
parole, que ceci est dfinissable : c'est la fonction
du sujet.
Fonction du sujet qui n'est pas, comme j'ai pu le
voir crit rcemment, fonction d'absence mais
fonction au contraire de la prsence intense de
quelque chose de cach, ce qui est ce qui nous ramne
au fondement freudien de l'inconscient et ce qui est
ce sur quoi je vous quitterai aujourd'hui en vous
donnant rendez-vous pour, le sminaire ouvert de la
semaine prochaine .
Table des sances
343
Diego RIVERA Table des sances
Table des sances
344
30 Mars l966 Table des sances
Je rappelle aux quelques-uns d'entre vous qui n'taient pas l la dernire fois que l'administration
de l'Ecole m'a charg de vous demander de ne pas fumer : de ne pas fumer, cher Alain. C'est une
demande de l'administration de l'Ecole.
Cette dernire fois, donc, Je vous ai parl au
premier abord de ce que je pouvais en donner,
immdiatement de ma visite aux Amriques. C'est l un
sujet qui n'a pas fini, je pense, de porter ses
fruits, ou ses consquences, dans la suite de ce que
j'aurais vous dire. Pour aujourd'hui, nous le
laisserons radicalement de ct. On m'entend au fond?
Pas trs bien. Et que donc - ce sujet - je ne le
reprendrai pas aujourd'hui. Je n'ai pas parl que de
cela la dernire fois et pour ce que j'ai dit
d'autre, je me suis aperu que j'avais mis, disons
certains, dans l'embarras, pour ne pas dire, produit
chez eux quelque scandale. En effet, j'ai touch
deux points : le premier, cause de l'article de
Michel TORT, j'ai dit, j'ai tenu sur le plagiat
quelques propos qui m'ont valu la manifestation d'un
tonnement. Comment - a pu me dire l'un des
meilleurs de mes auditeurs - pouvez-vous faire bon
march, comme vous l'avez nonc, du plagiat ?
rptant, ce que pourtant j'avais dit depuis
longtemps, depuis trs longtemps, depuis toujours -
ceux-l le savent qui me suivent depuis l'origine -
qu'il n'y a pas de proprit des ides. Est-ce que
vous ne semblez pas tenir beaucoup vous-mme, que de
ce qui vous est d, hommage - l'occasion - vous
soit rendu ? Je crois qu'il y a l un point
prciser si, en effet, il est bon qu' chacun, pas
seulement moi, hommage soit rendu de ce qu'il peut
apporter de nouveau dans la circulation de ce qui
s'articule d'un discours cohrent, ceci ne peut
treque du point de vue de l'histoire, et d'une
faon, qui doit y rester limite.
Qui donc songerait, faisant un cours de
mathmatiques, rendre chacun des initiateurs de
345
ce qu'il est amen articuler dans son cours, sa
place et son d. Tout ceci reste assimil, rintgr,
repris, gnralis ou particularis selon les cas, et
d'une faon, aprs tout, qui se passe fort bien de
toute rfrence au premier temps de la mise en
circulation d'une dmonstration ou d'une forme.
C'est pourquoi j'ai entendu, dplacer l'accent sur ce
que j'ai appel, d'une faon plus ou moins propre,
dtournement d'un mouvement de la pense. Ceci est
bien autre chose. Quand un discours, dans ce qu'il a
de conqurant, de rvolutionnaire pour appeler les
choses par leur nom, est en train de se tenir et de
nos jours nous savons ou ces discours se tiennent, en
reprendre les oprations voire mme le matriel pour
l'orienter des fins qui sont proprement celles
d'o, il entend se distinguer, c'est l qu'au moins
serait-il ncessaire de rapporter les lments du
discours l o on les a pris et o ils ont t crs,
orients, une fin parfaitement articule et claire,
et qui est celle qu'on entend desservir.
Si l'analyse est une opration qui se poursuit en
rfrence la science, et en tant que repose d'une
faon entirement oriente par l'existence de cette
science, la question de la vrit, cette
interrogation, est, par l'analyse porte son
maximum, au minimum d'troitesse, prcisment, qui
correspond cette vise, que c'est la science
qu'elle interroge.
Si, sur cette question de la vrit, c'est la
religion qui doit donner la rponse, que ne le dit-on
ouvertement! Mais alors, qu'on ne se targue pas, de
la position du philosophe, qui jusqu' ce jour,
prcisment, n'a jamais vari de s'en distinguer, de
cette rponse religieuse.
Personne n'a encore os faire de FREUD un apologiste
de la religion. Pour quelqu'un, ne pas reconnatre
que c'est moi qui lui ai appris lire FREUD, alors
que cette opration est en cours, pour en dtourner
l'incidence - de cette lecture - sur les sables du
dsarroi de la pense spiritualiste, ceci est
proprement une malhonntet, non pas d'crivain qui
drobe tel ou tel passage du discours d'un confrre,
346
mais de philosophe. C'est, proprement parler, une
trahison philosophique laquelle je ne donnerai pas
cette sorte de grandeur qui serait de rvler ce
qu'il peut y avoir partir d'un certain moment de
malhonntet foncire dans la position philosophique
ellemme si elle ignore combien la psychanalyse la
renouvelle.
Dans ce cas, c'est simplement une malhonntet
dbile, un manque absolu de srieux, un pur dsir de
parade, dont je remercie Monsieur TORT d'avoir
dmontr l'inoprance et le ridicule.
J'ai parl ensuite d'autre chose que j'ai peine
amorce : j'ai parl du retournement introduisant ce
que j'ai vous dire aujourd'hui sur le plan du
topologique, et ma foi, de ce retournement il s'est
trouv que certains se sont sentis un tant soit peu
retourns : cest qu' la vrit, dans un certain
contexte, les mots portent, et que l encore, nous
nous trouvons, bien sr, rapports ce qu'il en est,
non tant de l'usage des ides, mais de l'usage des
mots.
Prendre un mot comme support d'un noeud du discours
n'est assurment pas une opration inoffensive
puisque ce mot a dj pu tre pris dans un autre
discours. C'est un autre niveau de la fonction de
l'homonymie et dans certains cas, il peut en effet,
en porter avec lui, certaines consquences.
Ce retournement que j'ai donc amen au jour, ou
plutt ramen, comme vous allez le voir, propos de
la figure du tore. J'ai cru pouvoir le faire d'une
faon assez rapide croyant qu'au moins dans une
partie de mon auditoire, on se souvenait qu' la fin
de l'anne l962, c'est le sminaire l96l-62, sur
L'Identification, celui o j'ai mis au jour la fonction
fondamentale du trait unaire, de la coupure et o -
introduisant dj la fonction des diffrentes formes
topologiques dont je vais avoir parler aujourd'hui
- propos du tore, le 30 Mai l962 exactement, j'ai
expressment montr comment s'articulait deux champs
qui taient proprement ceux de deux tores, si vous
voulez, pris l'un dans l'autre, telle que cette
347
figure peut le reprsenter, et, comme je l'ai
longuement dtaill, comment il est possible de voir,
dans les roulements de l'un sur l'autre, roulements
dont il est dmontrable qu'il est spculativement
possible - la possibilit - d'un entier dcalque de
tout ce qui peut se dessiner sur l'un, au cours de ce
roulement sur l'autre
avec ce que ceci comporte : c'est que, la coupure
suivante
dont j'ai montr l'importance parce que c'tait
prcisment l ce sur quoi j'ai, pendant cette
anne, longuement insist
que la coupure suivante, que nous avions appris
traduire comme le chemin entourant, si l'on peut
dire, le corps du tore, c'est la demande
348
et comment il est ncessaire qu'une demande [D] qui
se rpte dans cette forme d'quivalence, ne puisse
se former que
je m'exprime dans des termes imags et simples de
faon bien me faire entendre de cet auditoire
qui n'est pas forcment initi aux formes
proprement mathmatiques qui donneraient ceci
sa rigueur
faire, si je puis dire, le tour, de ce trou
central, qui est la proprit topologique essentielle
du tore, celle qui introduit dans son extrieur,
cette nigme de contenir un intrieur par rapport
l'intrieur du tore, ou si vous voulez, d'une faon
plus rigoureuse, de permettre que des circuits ferms
l'intrieur du tore, s'enchanent ou se bouclent
par rapport des circuits ferms qui sont
extrieurs.
Je vous l'illustre, voici, je vais le faire dans une
autre couleur :
voil un circuit ferm l'intrieur [ a ], vous voyez
que c'est un tore. Il est possible de faire un
circuit ferm l'extrieur [ b ] qui soit boucl avec le
circuit ferm intrieur :
Ce qui est strictement impossible dans la formule
topologique qui forme depuis toujours le modle sur
lequel s'articule la pense de l'intrieur et de
l'extrieur, qui est la sphre, quelque circuit ferm
que vous fassiez l'intrieur de la sphre, il ne
sera jamais boucl avec un circuit ferm extrieur.
Cette forme topologique tant reste longtemps la
forme prvalente pour toute conception de la pense,
349
et restant par exemple, immanente l'usage des
cercles d'EULER en logique, c'est prcisment l
l'intrt des nouveauts topologiques que je promeus
devant vous :
le fait de vous montrer de quel usage elles peuvent
tre, pour rsoudre certaines impasses des problmes
qui nous sont, nous poss par la topologie de notre
exprience, et qui trouvent, dans ces nouvelles
formes topologiques, leur support et leur solution.
Que ce retournement soit bien un retournement, ceci
peut se voir aisment, et je le dis tout de suite.
C'est de l'ordre, semble-t-il, de la rcration
mathmatique que de le reprsenter, comme je vais
vous le reprsenter. Nanmoins cela garde tout son
intrt et toute son importance.
Comme je ne pourrais pas l'insrer aisment dans la
suite de mon discours, je vais vous en donner tout de
suite l'image. Considrez simplement ceci comme une
introduction ce qui va vous tre dit d'une faon
plus cohrente et plus dveloppe.
Ce n'est pas simplement d'un autre tore qu'il s'agit
dans celui-ci qui peut servir de dcalque ce qui
est inscrit sur l'autre. Topologiquement, un tore est
quelque chose de tout fait quivalent ce qu'on
appelle en topologie l'insertion sur une sphre d'une
poigne.
Vous voyez bien que par transformation continue comme
on s'exprime dans certains manuels, c'est exactement
la mme chose, un tore ou une poigne, que cette
espce de cloche ferme.
350
A partir de l, il vous sera ais de comprendre la
lgitimit du terme de retournement si nous donnons
ce mot, son sens intuitif, son sens intuitif dont ce
n'est pas pour rien qu'il voque la manipulation, la
manuvre, la main, cette main qui est prsente jusque
dans le terme allemand pour dsigner ce traitement :
Handlung.
La faveur que nous pouvons y trouver est justement
celle, sinon de compltement rduire ce qu'il y a
de prvalence visuelle dans le terme d'intuition,
tout au moins de le faire reculer. Dj les stociens
en avaient senti l'importance et l ncessit
certains d'entre vous savent ce qu'ils faisaient de
la main ouverte, de la main ferme, du poing, voire
justement de ce retournement que la main image.
Ici, c'est proprement parler cette sorte de
retournement qui est li l'usage de la main -
retournement de la peau qui la recouvre, le
retournement du gant pour l'appeler par son nom - que
nous faisons rfrence.
Ce fait qu'un gant droit retourn fasse un gant
gauche, et plus exactement fasse l'image du gant dans
le miroir, pour autant que l'image du gant dans le
miroir c'est le gant de l'espce oppose, voil qui
est le point de dpart de l'intrt que nous portons
ce terme de retournement.
N'oubliez pas que cet exemple intuitif, est
proprement ce qui a ncessit, pour KANT
122
, certains
des amarrages de son esthtique transcendantale.
Je ne m'y arrte pas plus longtemps pour l'instant
mais consultez le chapitre qui, si mon souvenir est
bon, est le chapitre treize des Prolgomnes toute
mtaphysique future
123
.
Vous en verrez limportance qui va s'enraciner plus
loin dans toute la discussion entre Leibniz et Newton
sur la nature de l'espace.
Pour le cas de notre sphre avec la poigne, elle est
uniquement l, surtout sous cette forme, pour vous
rendre sensibles ceci qu'un tore est tout-aussi
retournable qu'un quelconque support d'homologie
122 E. Kant, Critique de la raison pure, Paris, Flammarion, 2006.
123 E. Kant, Prolgomnes toute mtaphysique future, Paris, Vrin, 1968, I
e
partie, 13.
351
sphrique tel que le gant. Car le gant, vous le voyez
bien, n'est pas dissemblable, quant sa topologie,
d'une sphre, il suffit que vous souffliez
assez fort sa baudruche pour le voir se rduire une
forme sphrique.
Le tore est retournable galement. Il suffit en
effet, pour que vous le voyez tout de suite, que
passant par une ouverture quelconque votre main vous
alliez accrocher l'intrieur de la poigne pour voir
ce qui s'y passe. Voici maintenant ma sphre ouverte
pour ma main et retourne.
Ici vous voyez se dessiner, avec deux trous dans la
sphre, ce qui pourrait apparatre tre une poigne
intrieure. Je vais mettre mon doigt, ici,
l'intrieur de cette poigne intrieure. Il vous est
du mme coup immdiatement sensible je pense, qu'
tirer l-dessus, vous voyez se produire, se
reproduire, une poigne extrieure. Il n'y a pas de
poigne intrieure insrable sur une sphre.
Toute poigne est toujours une poigne extrieure.
La seule diffrence avec la premire, celle qui est
ici, sera de se profiler ici dans un axe sagital par
rapport vous, alors qu'elle tait ici transversale,
autrement dit, de mme que les deux tores prcdents,
d'tre l'un par rapport l'autre dans une position
de dplacement d'un quart de tour,non pas d'un demi
tour, comme dans une translation qui tenterait d'en
reproduire l'quivalent, mais d'un quart de tour. Ce
quart de tour est trs important car il est
irrductible toute translation spculaire.
352
Nanmoins, il reste, au niveau du tore, que quelque
chose n'apparat pas aussitt, qui nous dtache des
possibilits particulires qui font que le
retournement, la substitution de l'endroit l'envers
et inversement est quelque chose qui reproduit la
formation spculaire.
On pourrait dire ici qu'on trouve quelque chose qui,
ce quart de tour prs, ferait de l'image retourne
du tore, aprs tout quelque chose qui n'est pas,
rellement, qui n'est pas fondamentalement, diffrent
du point de vue topologique et qui en donne encore,
en quelque faon, un quivalent spculaire.
Je le rpte, c'est par ce dplacement d'un quart de
tour prs, dont nous allons mieux voir - rapprocher
le tore des formes topologiques de sa famille - qu'il
est dj quelque chose qui spare le tore de toute
surface d'homologie sphrique concernant cette
relation l'image spculaire.
Nous allons le voir maintenant plus en dtail.
Mais pour ne pas faire baisser, si je puis dire,
votre attention, m'tendre sur ce qui fait la force
gnrale de ces aspects topologiques qui se
distinguent de la sphre, je vais tout de suite
matrialiser pour vous ce dont il s'agit : il s'agit
du rapport d'un dcalque l'image spculaire, vous
n'avez qu' vous reporter ce que j'ai dj
suffisamment, je pense manipul devant vous, de la
surface ou de la bande de MBIUS, pour vous rappeler
la fois ce que je vous en ai dit, et ce qui en
vient aujourd'hui dans mon explication.
Si la surface de MBIUS se fait de joindre les deux
extrmits d'une bande aprs un demi tour, et sil en
rsulte ce que je vous ai dit en son temps, une
surface unilatre, vous pouvez vous souvenir de ce
que je vous ai dit, ici dans mon cours, il y a dj
deux ans
124
, c'est savoir que pour recouvrir cette
surface, pour en faire l'quivalent et le dcalque il
124 Sminaire Problmes cruciaux 09-12.
353
faudra que vous en fassiez deux fois le tour, c'est-
-dire que, partant d'un point, ou d'une ligne
transversale qui est celle-ci vous arrivez aprs un
tour, tre l'envers du point d'o vous tes
d'abord parti et qu'il faut que vous fassiez un
second tour, pour revenir conjoindre votre dcalque
la ligne dont vous tes parti.
Vous aurez donc un dcalque, une surface colle la
premire, qui aura diverses proprits, dont la
premire d'abord, est d'tre, pour nous, pour parler
rapidement, deux fois plus longue que la premire,
d'autre part d'tre compltement diffrente d'elle,
du point du vue topologique.
Elle n'est ni homomorphe ni homotope, elle n'est
pas homologue, car elle, au lieu de se conjoindre
elle-mme, aprs un demi tour, une demi torsion sur
elle-mme, elle est conjointe elle-mme d'une
torsion complte ce qui aura pour effet de vous la
prsenter de la faon que je peux facilement
reproduire en coupant - j'ai dj maintes fois fait
ce geste - celle-ci par son milieu, savoir quelque
chose qui se prsente comme une double boucle,
laquelle est conjointe d'une faon bien particulire
qui reste prciser, qui n'est pas n'importe
laquelle mais dont je vous ai dj dit, et montr
qu'elle a pour proprit d'tre applicable sur la
surface d'un tore, d'une faon qui reproduit
exactement la double boucle et l'inclusion du trou
central dans cette boucle, qui est exactement
celle-ci.
Cette diffrence qu'il y a, du dcalque radical ce
dont il part, c'est l proprement ce sur quoi repose
cette distinction que je fais qu'en parlant de
l'objet(a) je dis qu'il n'est pas spculaire,
l'objet(a) tant prcisment, de la bande de MBIUS,
vous le savez, ce qui la complte et ce qui est son
support, ce qui ferme la bande de MBIUS pour donner
cette surface complte auxquels sont donns
lgitimement les noms divers du plan projectif
quelquefois ou mieux encore, dans le cas o nous la
reprsentons
354
cette construction que j'ai maintes fois
reprsente devant vous sous cette forme dont
vous savez qu'elle reprsente l'entrecroisement
de ce qui est la surface qui se gonfle ici dans
la partie infrieure [ a ] de cette baudruche,
l'entrecroisement de cette surface avec elle-mme
qui, ici passe derrire [ b ], de mme ici, celle-ci
passe derrire [ c ]
c'est ce qu'on, appelle, le cross-cap, la partie
suprieure
ou plus exactement, quand nous avons, comme dans
cette figure - ampute la partie sphrique
infrieure ou calotte
ceci reprsente ce qu'on appelle le crosscap ou
autrement dit la mitre. L'ensemble de la figure, si
vous voulez, appelons-l - pour a, pour cette forme
reprsente - sphre mitre.
Ce qui donne une actualit singulire, si vous me
permettez un peu de fantaisie, aux reprsentations de
DALI des vques morts sur la plage de Cadaqus.
Quoi de plus beau, semble avoir devin Dali, qu'un
vque statufi, pour reprsenter ce qui nous importe
ici savoir le dsir.
Cette proprit gnrale d'un certain nombre de
fonctions topologiques
de se prsenter, avec une distinction plus ou
moins apparente, dont je pense ici vous avoir
355
fait saisir au niveau de la bande de MBIUS le
caractre s'imposant, alors qu'il peut tre, dans
certaines des autres formes, plus larv
voil ce qui est essentiel, distinguer et qui pour
nous, nous dirige, vers ce que, pour parler
rapidement nous appellerons, si vous voulez, les
formes mentales qui sont celles auxquelles nous
devons accommoder notre exprience, ce qui est l
seulement une approche de la question, laquelle est
celle-ci :
quel est le rapport de cette structure avec le champ
de notre exprience ?
Quelqu'un m'a demand rcemment si
j'entends quelqu'un qui n'est pas de notre
domaine, qui est un mathmaticien fort distingu,
dont j'ai l'honneur d'tre l'ami depuis quelques
temps et que certains ici connaissent, au moins
par la liaison que j'ai commenc d'tablir entre
eux et lui
ce quelqu'un qui n'a pas du tout t inattentif la
sortie du premier cahier du cercle pistmologique
m'a pos certaines questions sur tel ou tel texte de
M. MILNER ou de M. MILLER et s'est inquit,
en quelque sorte, de ce dont il s'agissait, savoir
si c'tait de modles mathmatiques ou mme de
mtaphores. J'ai cru pouvoir lui rpondre que les
choses, dans ma pense allaient plus loin et que les
structures dont il s'agit ont droit dtre
considres comme de l'ordre d'un Upokemenon d'un
support, voire d'une substance de ce qui constitue
notre champ.
Le terme donc de forme mentale comme toujours, est
l d'approche, est inappropri. N'oubliez pas
pourtant que celui qui a introduit de faon minente
cette question de la rvision des formes topologiques
comme fondement de la gomtrie, Henri POINCAR pour
le nommer, et ses publications qui commencent, comme
vous le savez, au compte-rendu de la socit de
Mathmatiques de Palerme, entendez bien qu'il
s'agissait l de quelque chose qui ncessite, chez le
mathmaticien lui-mme, une sorte d'exercice,
d'exercice d'auto-brisure des cadres intuitifs qui
356
lui sont habituels et qu'il admettait que dans ces
rfrences, il y avait la source d'une sorte de
conversion de l'exercice intuitif de l'esprit qu'il
considrait comme non seulement fondamental mais
ncessaire l'inauguration de cette rvision.
Disons maintenant quelles sont les forces dont il
s'agit et quelles sont celles qui vont nous servir.
Elles sont au nombre de quatre, dont brivement,
l'usage de ceux pour qui ces termes ont un sens, je
dirai que le caractre commun est que la
caractristique dite d'EULER-POINCAR, prcisment
que je viens de nommer, y est gale zro [ F A + S = O ].
Je ne vais pas vous dire ce que c'est que cette
caractristique d'EULER-POINCAR, nanmoins, je vais
tout de mme vous en donner une pointe, un aperu,
sans a, quoi bon la nommer. Commenons d'abord par
numrer ces quatre formes qui sont :
- le cylindre
ou le disque trou, ce qui topologiquement est
exactement la mme chose
- le tore,
- la bande de MBIUS
- et la bouteille de KLEIN.
Ces quatre formes topologiques ont cette constante
d'EULER-POINCAR.
Pour vous donner l'ide de la diffrence qu'il y a
entre ces surfaces et celle de la sphre, je vous
rappellerai que la sphre (j'ai mis des ombres pour
la rendre plus mignonne)
357
la sphre et tout ce qui lui est homologue, savoir
par exemple tous les polydres que vous connaissez
qui peuvent s'y inscrire car quelle que soit la
complication de ces polydres, ils sont homologues
une sphre. Si vous faites l'intrieur de la
sphre, par exemple, un ttradre, vous verrez qu'il
n'est pas de nature essentiellement diffrente, il
n'y a qu' souffler dans le ttradre assez fort pour
qu'il devienne sphrique.
Eh bien, l'une des incarnations de cette constante
d'EULER consiste prendre, quand il s'agit du
polydre, le nombre de ses faces(F), le nombre de ses
artes(A), et le nombre de ses sommets(S) et y
colloquer alternativement le signe plus et le signe
moins, par exemple +F - A + S. Je mets ici un signe
moins et ici un signe plus et nous avons pour ce qui
est du ttradre : + 4 -6 + 4.
Vous voyez que ceci donne exactement pour rsultat le
chiffre deux. C'est prcisment parce que, si vous
faites, n'est-ce pas : 4 6 + 4, a fait deux, vous
pouvez vrifier ceci propos de n'importe quel
polydre. Si je vous ai mis le plus simple, c'est
pour ne pas vous fatiguer, si vous prenez un
dodcadre, le rsultat sera le mme.
Mais si vous faites un polydre quelconque qui soit
inscrit dans un tore, vous vrifierez facilement qu'
faire la mme opration, savoir l'addition des
faces avec les sommets, et la soustraction des
artes, vous aurez zro.
Maintenant, quel est l'usage que nous pouvons faire
de ces quatre lments topologiques respectivement le
cylindre, le tore, la bande de MBIUS, et la
bouteille de KLEIN ?
C'est l que nous allons venir maintenant et - vous
parlant de cet usage - il faut d'abord que je mette
l'accent sur certaines des proprits, l'usage
viendra aprs. Impossible de vous en jeter la tte,
si je puis dire, tout de suite la valeur opratoire,
dans telle ou telle de nos rfrences, impossible de
vous en donner la translation, la traduction tout de
358
suite, si d'abord je ne mets pas en valeur ce qui les
distingue l'une de l'autre et ce qui leur donne ces
prcieuses proprits, qui ne sont autres, je vous le
rpte que les proprits mmes de notre champ, que
nous voyons ici en raison du fait que ces figures ne
sont pas quoi que ce soit que vous puissiez
lgitimement traduire par ce par quoi je suis
pourtant forc de vous les reprsenter, savoir par
quelque chose qui s'intuitionne, mais par quelque
chose qui, dans toute sa rigueur, ne s'articule que
de rfrence symbolique, et d'une formulation qui ne
se supporte que de l'usage plus ou moins labor et
combin de ce que j'appellerai des lettres, pour
autant qu'une thorie des ensembles pourrait ici vous
amener ce chapitre particulier de la topologie qui
nous attache dans l'occasion - je pourrais
entirement vous le dvelopper au tableau - sous la
forme d'une srie de formules qui ne se
distingueraient pas votre regard de l'usage commun
des formules algbriques et que a serait videmment
d'un cheminement beaucoup plus sr, pour l'usage que
nous pourrions en faire.
Autrement dit, il importe, concernant ces surfaces,
que vous fassiez la distinction dans votre esprit, de
ce qui est de la surface locale et de la surface
globale.
Il est de la consquence de votre capture par ce qui
s'appelle l'intuition, autrement dit l'imaginaire,
que vous pensiez ces surfaces comme des surfaces
locales c'est--dire, que vous ne puissiez pas
dtacher l'intuition d'une portion quelconque de ces
surfaces de ce qu'implique le fait qu'une surface
locale peut faire partie d'un plan indfini ou d'une
sphre ce qui est quivalent, topologiquement.
Mais toute parcelle d'une surface globale telle
qu'elle est dfinie ici topologiquement, doit se
concevoir comme porteuse essentiellement des
proprits de la surface globale. C'est pourquoi par
exemple, il ne nous intresse absolument pas de
considrer, dans le tore, un de ces petits fragments
par exemple[ a ], que nous appellerons disques dans
l'occasion, en tant qu'il peut se rduire un point.
359
Ceci n'a rien faire topologiquement avec le tore,
car ce qui distingue le tore de la sphre - o la
mme chose se produit comme sur le plan - c'est quil
y a dans le tore des circuits ferms, exactement,
apparemment quivalents celui que nous avons dfini
ici tout d'abord [ d ], et dont vous voyez bien qu'il se
distingue radicalement du premier : premirement en
ceci qu'il ne dcoupe rien la surface du tore, il
l'ouvre simplement, il le transforme en un cylindre,
et d'autre part, qu'il ne peut d'aucune faon, se
rduire un point puisque le trou central du tore
est ce qui arrterait, si je puis dire, son
rtrcissement.
Sur un tore, vous voyez bien qu'il existe deux sortes
de circuits ferms de cette espce, voici l'autre [ D ].
Et vous reconnaissez ici donc, les deux formes de
coupure que dans un premier abord, j'ai demand qu'on
me suive par hypothse en convenant d'attacher l'un
la connotation d'une de ces coupures signifiantes que
nous pourrions considrer comme reprsentant la
demande, cette condition, que nous nous apercevions
de ce que comporte la rptition de ce cycle quand il
ne se ferme pas et comment, pour se fermer, il doit
obligatoirement passer par le circuit de l'autre
espce [ d ], que de ce fait, nous nous apercevons
pouvoir particulirement aisment symboliser ce fait
que pour nous ce que la demande se trouve supporter
par rapport ce que je vous ai appris considrer
comme sa consquence, savoir la dimension du dsir,
360
elle ne saurait le supporter comme tel qu' se
rpter ce qui, du mme coup, nous suggre, quelque
originalit spciale de ce terme de rptition,
savoir qu'il n'est pas, en quelque sorte, une
dimension vaine, qu'en elle-mme, la rptition
dveloppe quelque chose, qu'il y a pour nous tout
intrt illustrer de cette faon.
En effet, pour reprendre POINCAR
125
, c'est lui qui a
introduit la fable, (si l'on peut dire philosophique)
l'ide de ces tres infiniment plats qui
pouvaient subsister sur les surfaces topologiques
qu'il a mises en circulation.
Ces tres infiniment plats ont une valeur, ont une
valeur qui est de nous faire remarquer ceci,
savoir : ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent
pas savoir. Il est clair que, si nous supposons, une
topologie, une structure qui est elle-mme de
surface, habite par des tres infiniment plats, ce
n'est certainement pas pour nous rfrer nous-mmes
ce que vous voyez forcment ici reprsent, savoir
la plonge dans l'espace, des dites formes
topologiques.
Pour ce qui subsiste au niveau de cette structure
topologique, ce que j'appelle - au passage, comme a
et en m'en excusant - le trou central, est absolument
impossible apercevoir.
Par contre, ce qu'il est possible d'apercevoir, c'est
la cohrence des boucles telles que je viens de vous
les dessiner. Il est galement parfaitement possible
l'intrieur mme du systme de s'apercevoir qu'une
espce de boucle que je vais vous reprsenter
maintenant - si vous le voulez, pour conomiser, sur
la mme figure - celle-ci qui conjoint en un seul,
les deux espces de circuit ferm qui pour nous
125 H. Poincar,, La science et l'hypothse, Paris, Flammarion, 1968, 2
e
partie, chap.III, La gomtrie de Riemann:
Imaginons un monde uniquement peupl d'tres dnus d'paisseur ; et supposons que ces animaux infiniment plats soient
tous dans un mme plan et n'en puissent sortir. Admettons de plus que ce monde soit assez loign des autres pour tre soustrait
leur influence. Pendant que nous sommes en train de faire des hypothses, il ne nous en cote pas plus de douer ces tres de
raisonnement et de les croire capables de faire de la gomtrie. Dans ce cas, ils n'attribueront certainement l'espace que deux
dimensions..
361
pour nous qui plongeons dans l'espace parce que
nous sommes, au moins provisoirement assez
infirmes pour y trouver un secours
il se trouve y faire circuit la fois autour de ce
que j'appellerai - pourquoi, puisque nous en sommes
la compromission, nous arrter ? - le trou intrieur
et le trou extrieur.
Cette boucle qui s'appelle - parce que c'est celui
qui l'a dcouverte - un cercle de VILLARCEAU.
Il a dcouvert ceci bien avant qu'on fasse de la
topologie, il l'a dcouvert au milieu de proprits
mtriques sur lesquelles je n'insisterai pas.
Il s'est amus dcouvrir que cette sorte de boucle,
condition de la dterminer par une opration bien
choisie, pouvait tre - dans un tore fait par la
rotation d'un cercle rgulier - que cette boucle
ellemme pouvait tre circulaire. C'est trs facile
de s'en apercevoir. Il suffit de pratiquer sur le
tore une coupe par un plan, bitangent ce qui, en
coupe, se prsente comme a.
Ceci
quelq
VILLA
remar
surfa
srie
Il y
ceux
propr
Bien
toute
se re
Ceci
matr
pour
l'art
comme
comme
J'ai
fonct
radic
micro
prse
psych
tait
que ape
ARCEAU.
rquer q
ace du
es de c
a ceux
qui vo
rit d
n enten
e une s
ecoupen
pour v
riel qu
quelqu
ticulat
e probl
e le fa
insist
tion im
calemen
ocosme-
ent de
hologie
dj un
eru top
Je n'y
que mme
tore, p
ces cerc
x qui vo
ont dan
de recou
ndu vou
srie fa
nt pas
vous mon
ue mette
ue chose
tion coh
lme au
antasme
t dans
maginair
nt l'ide
-macroco
module
e.
ne prem
pologiq
y fais
e un t
peut s'
cles de
ont dan
s le se
uper to
s voyez
aisant
:
ntrer l
ent n
e qui n
hrente
regard
.
le db
re comm
entific
osme, t
la c
mire a
que dan
allusi
tre inf
'aperce
e VILLA
ns ce s
ens con
ous les
z bien
tout l
l'labo
notre p
n'est r
e de ce
d par e
but de
me tan
cation
tout ce
cosmolo
pproche
s cette
on que
iniment
voir qu
ARCEAU.
ens-l
traire
premie
qu'on p
e tour
ration
orte c
ien de
qui se
xemple
mon ens
t ce qu
narciss
qui a
gie com
e, il y
e appro
pour v
t plat,
u'il y
et pui
et qui
ers :
peut en
du tor
possib
ces str
moins
e pose
d'une
seignem
ui supp
sique,
servi
mme l
y avait
oche de
vous fai
dans l
a deux
is il y
i ont po
n faire
re, qui
ble, le
ructure
que
nous
ralit
ment sur
porte
le rapp
jusqu'
la
362
ire
la
a
our
ne
s
r la
port
363
J'ai construit un graphe :
pour vous montrer un autre tat et dans une autre
rfrence la combinatoire symbolique quelque chose
qui est aussi une forme d'identification celle qui
fait le dsir se supporter du fantasme.
Le fantasme, je l'ai symbolis par la formule
S coupure (si vous voulez) de(a) : S a
Qu'est-ce que c'est que ce (a)?
Estce que c'est quelque chose d'quivalent : i(a),
image spculaire, ce dont se supporte, comme FREUD
l'articule expressment, cette srie d'identification
s'enveloppant l'une l'autre, s'additionnant, se
concrtisant la faon des couches d'une perle, au
cours du dveloppement qui s'appelle le moi.
Est-ce que le (a) n'est qu'une autre fonction de
l'imaginaire ?
Quelque chose doit tout de mme vous mettre en
soupon qu'il n'en est rien, si j'avance depuis
toujours que le (a) n'a pas d'image spculaire.
Mais qu'est-il? Pour vous reposer, parce que je pense
qu'aprs tout, tout ceci est bien aride, je vous
dirai qu'une fable, un modle, un apologue m'est venu
l'esprit, prcisment au temps de mes confrences
aux U.S.A. mais que je vous en ai rserv la
primeure. C'est--dire que le mot qui m'est venu
l'esprit pour vous faire saisir o est le problme,
ce mot je ne l'ai pas mis en circulation.
364
Je l'ai d'autant moins mis en circulation que je ne
crois pas qu'il ait de traduction en anglais. Mais
enfin je leur en ai donn quand mme une petite ide.
J'ai employ le terme frame ou framing. Il y a un mot
beaucoup plus beau en franais. C'est un mot qui a
son prix sur la scne du thtre, c'est le mot
praticable.
Aprs tout, peut-tre certains d'entre vous se
souviennent-ils de la faon dont j'ai parl du
fantasme certaines de nos journes provinciales
126
quand j'y ai fait rfrence un jeu, qui n'est point
de hasard, du peintre MAGRITTE qui l'a, dans ses
tableaux, rpt bien souvent, savoir de
reprsenter l'image qui rsulte de la pose, dans le
cadre mme d'une fentre d'un tableau qui reprsente
exactement le paysage qu'il y a derrire.
A ceux-la, mon introduction du praticable n'apportera
rien de nouveau, ceci prs que c'est un petit peu
plus mettre l'accent et le point sur les i.
Quel est le fruit de la prsence du praticable sur la
scne du thtre, sinon une certaine distance,
d'tre pour nous trompe lil, d'introduire une
perspective, un jeu, une capture dont on peut dire
qu'il participe de tout ce qu'il en est dans le
domaine du visuel, de l'ordre de l'illusion et de
l'imaginaire.
Nanmoins, si vous passez derrire le praticable, il
n'y a plus moyen de s'y tromper. Et pourtant le
praticable est toujours l. Il n'est pas imaginaire.
Le bti existe. C'est l trs prcisment ce dont il
s'agit, il faut avoir pouss les choses assez loin et
trs prcisment dans une analyse, pour arriver au
point o nous touchons, dans le fantasme, l'objet(a)
comme le bti. La fonction du fantasme dans
l'conomie du sujet n'en est pas moins de supporter
le dsir de sa fonction illusoire. Il n'est pas
illusoire. C'est par sa fonction illusoire qu'il
soutient le dsir, le dsir se captive de cette
126 J. Lacan, Journes Provinciales d'octobre 1962 sur le fantasme.
365
division du sujet en tant qu'elle est cause par le
bti du fantasme.
Qu'est-ce dire ? Est-ce dire que nous puissions
nous contenter de dire que, comme au thtre, il n'y
a qu' avoir son entre dans les coulisses pour aller
visiter le praticable et en avoir le fin mot ? Il est
bien vident que ce n'est pas de cela qu'il s'agit et
que, comme les tres infiniment plats qui habitent ce
corps, ce n'est pas nous dplacer sur la surface du
tore, que nous aurons jamais l'ide de ce qui est l,
sous forme de trou, et qui selon toute apparence,
doit bien avoir quelque chose faire avec cet
objet(a) puisque c'est de son existence que dpend la
distinction de ces deux boucles : celles [d] qui sont
faites autour de cette torsion externe avec celle [D]
qui les rejoint franchir ce trou.
C'est ici que l'usage des autres surfaces
topologiques dont je vous ai annonc la fonction peut
nous tre de quelque service.
Je n'ai pas besoin, je pense, de longuement prorer
sur ce qui peut se dcrire au niveau du plan
projectif quand il est particulirement ais, et je
l'ai fait maintes fois, de le reprsenter ici par ce
que j'ai appel tout l'heure improprement le cross-
cap, car cet impropre nous permet la remarque - mais
continuons de l'appeler ainsi, je n'aime pas beaucoup
la sphre mitre - et de nous apercevoir qu'une
coupure
qui d'une faon trs frappante a exactement la
mme structure de double boucle que celle qui
nous permet, au niveau du tore, de mettre en
vidence la prsence du trou central, mme aux
tres plats, alors que je vous fais remarquer
quelle est, au niveau de la simple coupure, du
cercle de VILLARCEAU
366
parfaitement indiscernable
que cette double boucle ici a pour effet
je pense l'avoir suffisamment de fois dcrite
devant vous, pour que vous vous en souveniez
de sparer la surface, contrairement ce qui se
passe pour la double boucle quand elle est faite sur
le tore : le tore reste d'un seul tenant.
367
Mais ici nous avons au centre, cette surface de ce
que nous pouvons appeler un faux disque
si vous voulez, mais qui est tout de mme bel et bien
un disque dont vous savons depuis longtemps que je le
prend pour support ou encore armature et enfin cause
de l'illusion du dsir, autrement dit comme
quivalent de l'objet(a).
L'autre partie du cross-cap tant, ceci est trs
facile mettre en vidence, je l'ai fait autrefois,
cette mme poque lointaine, en 62, par des dessins
dont certains se souviennent encore,
extraordinairement raffins mais vraiment dont je
serais ici un peu las de reproduire le dtail, ils
n'avaient qu'un intrt, c'est dans certaines des
transformations qui consistent dplier le repli qui
se trouve l, et aussi bien le rduire ici, on va
s'apercevoir que l'autre partie - appelons-la, la
partie B, et celle-l (a) - que l'autre partie, est
une bande de MBIUS.
368
En cours de dploiement, vous pouvez sur cette figure
faire apparatre toutes les illusions les plus
ravissantes, approchez a de la forme de la conque de
l'oreille, d'une coupe mdiane montrant les
involutions des formes extrieures du cerveau, aussi
bien de n'importe quoi d'autre, savoir une coupe
des enveloppes embryonnaires : ceci n'a qu'une valeur
suggestive et peut-tre pas tout fait sans nous
indiquer que quelque chose de ces formes enroules
sont inscrites partout l'intrieur de l'organisme.
Mais alors, est-ce que nous ne pouvons pas nous poser
la question de savoir si nous ne trouvons pas ici
confirmation de ce que nous cherchions concernant ce
que j'ai appel - approximativement jusqu' prsent -
le trou central du tore, une confirmation de cette
indication qu'au niveau du tore
et la chose aura son importance si nous sommes
amens par exemple symboliser le fonctionnement
en dcalque des deux tores d'une faon telle
qu'ils nous servent reprsenter par exemple une
relation spcifique de la nvrose, celui qui lie
le dsir du sujet la demande de l'autre
cette suggestion que, ici, le trou, savoir quelque
chose d'insaisissable est ce qui reprsente la place
de l'objet(a), est-ce qu' le trouver dans son
support au niveau d'une autre surface comme celle du
cross-cap, nous ne voyons pas l une suggestion qui
peut tre prcieuse du point de vue opratoire.
Quelque chose nous le confirme, savoir ceci :
369
un tore, c'est fait de la couture des deux bords, des
deux trous qui constituent les limites
d'un cylindre ou d'un jade trou, comme vous voudrez.
Car ce n'est pas pour rien que quelque chose comme
les jades trous a se fait depuis longtemps, bien
sr, nous ne savons plus ce que a veut dire mais il
est assez probable que ceux qui se sont donns assez
de mal l'origine pour les faire, savaient que a
pouvait servir quelque chose.
Il n'y a pas tellement que a, de formes troues
naturelles et ce n'est pas pour rien que la gravure
chinoise manifeste nettement dans toutes ses
propositions et ses associations que ses formes de
pierre troue qu'elle nous montre avec surabondance,
sont toujours lies des thmes rotiques, par
parenthse.
Comment est-ce constitu un plan projectif ? La forme
rigoureuse, je vous la donne d'emble, pour vous
montrer quel croisement on la rencontre et comment
on la construit
mais c'est elle qui est la fois la plus
essentielle, je veux dire dans une reprsentation
topologique tout fait couramment reue, valable
et fondamentale
c'est celle-ci : partez d'une figure qui est faite
comme l'autre, vous voyez, des deux cercles qui font
bord dans le cylindre
et id
le po
En d
repr
torda
cette
l'a
obten
On coud
opposs
mme s
obtient u
simple (
cylindre
Eh bi
limit
ce se
Il es
une p
proje
dentifi
oint di
'autres
sente
ant d'u
e flch
autre f
nez une
d 2 cts
s dans le
ens : on
un ruban
(ou un
e tronqu)
ien, ce
tes cir
ens l,
st faci
pareill
ectif [
iez chaq
iamtral
s terme
comme c
un demi
he dans
flche q
e bande
On coud 2
opposs d
sens contr
on obtien
ruban de M
ette op
rculaire
s'acco
ile de v
le topol
b], le
que poi
lement
s, ce q
ceci[a]
tour,
son se
qui est
de MB
2 cts
dans le
raire :
nt un
Mbius.
On
o
m
ob
a
ration
es. Vou
oler ic
voir
logie q
disque
int d'u
oppos
qui dan
, sa
que c'
ens, bi
t dans
BIUS.
n coud les c
opposs entr
eux dans le
mme sens :
btient un tor
n-l, f
us aure
ci, dan
cette
qui est
e centr
n de ce
de l'a
s la ba
voir qu
est en
en sr,
le sens
ts
re
e
on
re.
On cou
oppos
couple
mme
en sens
on obti
bouteil
aites-l
z ce qu
s ce se
coupure
celle
al - en
es cerc
autre.
ande de
ue c'es
venant
, en l'
s oppos
ud les cts
s, un
dans le
sens, l'autre
s contraire :
ient une
lle de Klein
l avec
ui, ici
ens-l.
e mme
du pla
ncore q
cles ave
e MBIUS
st en la
t appliq
accouda
s que v
e
:
n.
On coud l
opposs e
contraires
obtient un
projectif.
b
c deux
i va dan
que dan
an
que a n
370
ec
S se
a
quer
ant
vous
les cts
en sens
s : on
n plan
b
ns
ns
ne
371
saute pas l'intuition, mais quand je vous l'ai
reprsent comme a, vous le voyez tout de suite - le
disque central n'est pas un trou, mais fait partie de
la surface. C'est pourquoi un plan projectif est
dit je ne vous apprends l je ne sais pas, a peut
vous surprendre, mais reportez-vous aux manuels de
topologie, vous y verrez - ce qui est considr comme
fondamental - ceci que le plan projectif est compos
de deux parties savoir d'un disque central et de
quelque chose qui l'entoure qui a la structure d'une
bande de MBIUS que je considre, par cette figure,
comme suffisamment illustr.
A ceci prs, que ce disque central, lui, puisque
c'est un vrai disque, est parfaitement vanouissant
savoir qu'il est galement vrai que le plan
projectif, que ce soit ce que je vous dessine l
maintenant
savoir simplement une surface telle que chacun
de nos points soit identique au point
diamtralement oppos
il n'est pas ncessaire que le disque central
apparaisse : il peut se rduire n'tre rien.
En quoi se dmontre sa proprit minente pour
reprsenter telle dimension de l'objet(a) et trs
spcialement le regard par exemple, dont la proprit
d'objet et de pige, consiste prcisment en ceci
qu'il peut tre totalement lid.
Je ne puis vous quitter sans vous faire remarquer
cette chose que je pense avoir dj suffisamment
avance devant vous pour n'avoir qu' y faire
allusion, c'est que, grce la coupure en huit
invers, la double boucle, le dcoupage du tore,
qui, je vous le rpte, reste d'un seul tenant, est,
fait d'une faon telle qu' condition d'une couture
approprie, vous en faites trs aisment - et il ne
s'agit pas l d'une question matrielle,
manipulatoire, encore qu'elle le soit, elle n'est
point incorporelle - vous pouvez trs facilement,
du tore ainsi ouvert par la double boucle, en y
procdant c'est trs facile, je pense que vous le
concevez puisque je vous dis que la surface de MBIUS
coupe par le milieu vient s'appliquer sur le tore,
372
inversement si la coupure du tore reprsente
prcisment, ce qui en isole cette surface double
boucle - vous en faites trs aisment une bande de
MBIUS. C'est l le lien topologique qui nous donne
l'ide de la transformation possible de ce qui se
passe la surface du tore, en ce qui doit se passer
sur une surface de MBIUS si nous voulons que puisse
en surgir la fonction de l'objet(a). Nanmoins cet
objet(a), restant encore l si fuyant, problmatique,
en tout cas si accessible la disparition, peut-tre
n'est-ce pas l ce qui est suffisant. C'est ce qui
fera qu'une fois de plus je vous laisserai sur un
suspense et vous montrerai comment la bouteille de
KLEIN rsout cette impasse.
Table des sances
373
MAGRITTE
retour 11-05 retour 30-03 Retour 25-05 Table des sances
374
20 Avril l966 Table des sances
Je vais, aprs ces vacances qui nous ont spars
il faut que je vous retrouve un mercredi prfix pour
tre un sminaire ferm, et qui de ce fait vous
rduit un nombre d'lves choisis, que je ne trouve
pas du tout tre une mauvaise faon aujourd'hui de
nous runir, pour les choses que j'aurai vous dire.
En effet contrairement ce qui est le principe de
ces sminaires ferms, savoir que a devrait, a
pourrait en tout cas, tre quelqu'un d'autre que
moi-mme qui d'abord au moins pose la question :
eh bien, ce sera moi qui vous parlerai aujourd'hui,
ne serait-ce que pour compenser, renouer ce qui a t
interrompu par mon mois d'absence au trimestre
dernier, et aussi, je l'espre, pour amorcer pour la
prochaine fois, une collaboration qui donnerait ce
sminaire ferm, la prochaine fois, son caractre
propre de sminaire.
Je vais commencer, puisque aussi bien, ce temps de
vacances m'a report sur les problmes prsents dj
dans mes premiers propos, de mes relations avec mon
audience, eh bien, je me suis dit - puisque c'est
hier soir que j'en ai reu pour la correction - que
j'allais voir l un signe et que j'allais vous faire
d'abord lecture de quelque chose que vous voyez tre
l en placard qui est destin l'annuaire de l'Ecole
des Hautes Etudes. Chaque anne parat, de chacun de
ceux qui collaborent l'enseignement des Hautes
tudes un petit rsum de son cours. Ce rsum n'est
bien entendu pas celui de cette anne, c'est celui de
l'anne dernire, il n'est pas trs en avance, vous
le voyez. Mais enfin, il est encore bien temps
puisque aussi bien, a va me donner l'occasion de
vous en faire part.
Je vous en fais part parce que, comme vous allez le
voir, en le rdigeant, j'ai pens vous. Non pas
vous le lire, je ne pouvais pas savoir que a
viendrait.
375
Mais vous allez le voir, j'ai pens vous. Sans plus
de prambule donc, je commence cette lecture. Il
s'agit de ce qui l'anne dernire s'est appel :
Problmes cruciaux pour la psychanalyse.
Le problme mis au centre, dis-je, dans ce petit
rsum et vous imaginez bien tre un ultra condens,
le problme au centre, tient en ces termes : l'tre
du sujet. Je suppose que je m'adresse des gens qui
ont assist ce sminaire de l'anne dernire.
Termes o nous portait la pointe de nos rfrences
antrieures. Que l'tre du sujet, c'est encore
d'actualit cette anne, que l'tre du sujet soit
refendu, FREUD n'a fait que le redire, sous toutes
les formes, aprs avoir dcouvert que l'inconscient
ne Se traduit qu'en noeud de langage, a donc un tre
de sujet.
C'est de la combinatoire de ces noeuds qu'est
franchie la censure,laquelle n'est pas une mtaphore
de porte sur leur matriel,de ces noeuds du
langage.
Pour ces deux petits paragraphes, encore que, un
rsum n'est pas un objet didactique, tout de mme je
rappelle les trs solides fondements de notre
dpart, qui est justement ceci que l'inconscient a
structure de langage, que la censure ne soit pas une
mtaphore, a veut dire qu'elle coupe dans du
matriel et c'est de l que nous sommes partis avec
FREUD. Je pense l'avoir rsum l en cinq lignes.
D'emble, FREUD - c'est l'usage des gens qui
trouverait trop obscur mon rsum s'il lidait ces
vrits premires - d'emble FREUD affirme, cette
incompltude - que toute conception d'un recs de la
conscience vers l'obscur, le potentiel, voire
l'automatisme est inadquat rendre compte de ses
effets.
Rappel donc que tout ce qui entend faire de
l'inconscient une moindre, une virtuelle, une ant-,
une pr-conscience, n'est pas l'inconscient. Trois
lignes donc encore - ce que je prcise :
376
Voil qui n'est rappel que pour carter toute
philosophie de l'emploi que nous avons fait cette anne -
cette anne dont j'ai rendre compte - du cogito,
lgitime croyons nous, de ce que le cogito ne fonde pas la
conscience mais justement, cette refente du sujet.
Il suffit de l'crire :
je suis pensant donc je suis - je rpte : je suis
pensant donc je suis , c'est a ce que je pense :
i am thinking,therefore i am et de constater que cette
nonciation, obtenue d'une ascse
bien sr elle ne nous tombe pas du ciel elle consiste
d'abord en un amnagement, en un grand balayage de
tout savoir actualis au temps de Descartes - qui
entreprend cette ascse
que cette nonciation refend l'tre, lequel de ces
deux bouts, - je suis pensant : donc je suis la
fin - ne se conjoint qu' manifester quelque torsion
qu'il a subie dans son noeud,(son noeud
l'nonciation).
Causation? retournement? Ngativit ? avec des points
d'interrogation, c'est cette torsion dont il s'agit
de faire la topologie.
Je rappelle ici, dans le suivant paragraphe, sous
quel angle j'ai touch PIAGET et VIGOTSKY qui
dis-je :
du premier au second, illustrent le gain qu'on
ralise repousser toute hypothse psychologique des
rapports du sujet au langage, mme quand c'est de
l'enfant qu'il s'agit. Car cette hypothse n'est que
l'hypothse qu'un tre de savoir prend sur l'tre de
vrit, que l' enfant a incarner partir de la
batterie signifiante que nous lui prsentons, que lui
prsente loyalement, comme tel, VIGOTSKY, et qui fait
la loi de l'exprience.
Mais c'est anticiper sur une structure qu'il faut
saisir dans la synchronie, et d'une rencontre qui ne
soit pas d'occasion. C'est ce que nous fournit cet
embrayage du un sur le zro venu nous du point o
FREGE a du fonder l'arithmtique .
377
Rsum donc en trois lignes, de la fonction qu'a jou
dans cette anne dernire, notre tude du
fonctionnement de l'arithmtique. Le UN numrote la
classe nulle. Rfrence aux confrences de MM. MILLER
et MILNER
127
.
De l, on aperoit que l'tre du sujet est la
suture d'un manque, prcisment du manque qui, se
drobant dans le nombre, le soutient de sa
rcurrence
c'est l'ide sur laquelle est fonde la thorie du
nombre du successeur
mais en ceci ne le supporte que d'tre en fin de
compte, ce qui manque au signifiant pour tre l'UN du
sujet, soit en terme que nous avons appel dans un
autre contexte, le trait unaire : la marque d'une
identification primaire qui fonctionnera comme idal.
Le sujet se ressent d'tre, la fois, effet de la
marque et support de son manque. Quelques rappels de
la formalisation o se retrouve ce rsultat seront
ici, cris-je, de mise.
Aussi court que soit la place qu'on me rserve j'ai
tout de mme la place de rappeler
d'abord notre axiome fondant le signifiant comme
ce qui reprsente un sujet - non pas pour un autre
sujet mais - pour un autre signifiant. Cet axiome
situe le lemme qui vient d'tre racquis dune autre
voie : - ce que nous venons de dire avant -
Le sujet est ce qui rpond la marque par ce dont
elle manque. O se voit que la rversion de la
formule
de celle du signifiant que je viens de donner avant
comme axiome
127 G. Frege, Les fondements de l'arithmtique, op. cit.
Cf. Sminaire Problmes cruciaux... confrences de J.A. Miller le 24-02-65 et J.C. Milner le 02-06-1965.
378
que la rversion de la formule ne s'opre qu'
introduire, un de ses ples (le signifiant) une
ngativit. La boucle se ferme, sans se rduire
tre un cercle, de supposer
Troisime terme, appelez-le comme vous voudrez, aprs
l'axiome et le lemme
que le signifiant s'origine de l'effacement de la
trace. La puissance des mathmatiques, la frnsie de
notre science ne repose sur rien d'autre que sur la
suture du sujet, de la minceur de sa cicatrice
et aprs tout, en parlant de cicatrice, ne croyez pas
que j'emploie un terme qui rpugne un
mathmaticien, c'est un terme de POINCAR, dans son
analysis situs.
ou mieux encore de sa bance. Les apories de la
logique mathmatique tmoignent (thorme de GODEL)
de cette minceur - vous vous rappelez le dbut de la
phrase - et toujours, bien sr, au grand scandale de
la conscience.
On ne s'illusionne pas sur le fait - moi je ne
m'illusionne pas, ni j'espre vous non plus - qu'une
critique ce niveau ne saurait dcaper la plaie
de la bance du sujet partout ailleurs qu'au niveau
o la science la maintient suture, la force du
poignet de l' arithmtique
ne saurait dcaper la plaie des excrments, dont
l'ordre de l'exploitation sociale, qui prend assiette
de cette ouverture du sujet (et donc ne cre pas,
quoi qu'on en pense - fusse dans le marxisme -
l'alination) dont l'ordre donc de l'exploitation
sociale - dis-je - s'emploie recouvrir la dite
plaie avec plus ou moins de conscience.
Il y a beaucoup de choses qui servent a.
Discipline de vrit, nous dirons en gnral mais
Il faut mentionner la tche
379
ajouterai-je, n'ajouterai-je pas servile ? - je ne
l'ai pas mis dans le texte, je l'ai mis titre de
correction d'auteur pour le typo, je ne sais pas
encore si je le laisserai
quici remplit depuis la crise ouverte du sujet,
la philosophie.[servante de plus dun matre E.P.H.E. P.271]
J'ai dit : depuis la crise ouverte du sujet ,je
dsigne une date dans l'histoire de la philosophie,
la philosophie comme on dit, depuis qu'elle est en
rapport avec la science et qu'elle y tient bien mal
son rle.
Il est d'autre part exclu qu'aucune critique
portant sur la socit y supple
cette critique, dont je dis que je ne m'illusionne
pas, pour le pouvoir que nous avons de dcaper la
plaie des excrments, etc.
qu'aucune critique donc - portant sur la socit
y supple - c'est trs important -puisque elle-mme,
cette critique, ne saurait tre qu'une critique
venant de la socit, c'est--dire, quelle qu'elle
soit, implique dans le commerce de cette sorte
de pensement, que nous venons de dire. C'est pourquoi
seule l'analyse de cet objet - le pensement - peut
l'affronter dans son rel qui est d'tre l'objet de
la psychanalyse (Propos pour l'anne actuelle).
Nous ne nous contentons pas pourtant de suspendre, ce
qui serait un aveu de forfait, dans notre abord de
l'tre du sujet, l'excuse d'y retrouver, bien sr,
sa fondation de manque
C'est prcisment l ce pourquoi je vous fais cette
lecture.
Je voudrais jeter, comme une semence, dans ce que
j'appellerai votre attitude fondamentale d'auditeur.
C'est prcisment la dimension qui droute,
n'hsitais-je pas crire, de notre enseignement que
380
de mettre l'preuve cette fondation - de manque -
en tant qu'elle est dans notre audience.
Car comment reculerions-nous voir que ce que nous
exigeons de la structure quant l'tre du sujet, ne
saurait tre laiss hors de cause chez celui qui le
reprsente minemment - dans notre discours mme -
pour le reprsenter d'tre et non de pense tout
comme le cogito tout comme fait le cogito a-t-on
saut - vous voyez, on ne perd jamais son temps -
savoir le psychanalyste ?
C'est bien ce que nous trouvons dans le phnomne,
notable cette anne-l, de l'avance prise par une
autre partie de notre auditoire, nous donner ce
succs, dis-je de confirmer la thorie que nous
tenons pour juste, de la communication dans le
langage.
Ce qui n'est pas toute communication. Mais vous la
connaissez depuis longtemps, cette formule. Il faut
croire que les miennes ne perdent pas tellement
tre rabches puisqu'il faut effectivement que je
les rpte et que je les annonce.
Nous l'exprimons dire que le message n'y est mis
qu'au niveau de celui qui le reoit. Sans doute
faut-il faire place ici, puisque je fais allusion
l'autre partie de mon auditoire, au privilge que
nous tenons du lieu dont nous sommes l'hte. Ceci est
un hommage l'Ecole Normale Suprieure. Mais ne pas
oublier qu'en la rserve qu'inspire ce qui parat de
trop ais certains, dans cet effet de sminaire, la
rsistance qu'elle comporte, cette rserve - et
j'ajoute, qui se justifie. Elle se justifie de ce que
les engagements soient d'tre et non de pense, et
que les deux bords de l'tre du sujet se diversifient
ici de la divergence entre vrit et savoir. La
difficult d'tre du psychanalyste tient ce qu'il
rencontre, comme tre du sujet : savoir le
symptme. Que le symptme, soit tre de vrit, c'est
ce quoi chacun consent, de ce qu'on sache ce que
psychanalyse veut dire, quoi qu'il en soit fait pour
l'embrouiller.
381
Mme chez ceux qui l'embrouillent le plus, je suis
sr que j'obtiendrai le consentement leur jeter
tout de suite la figure ceci : c'est que l'essence
du symptme - notre position dans le symptme - c'est
que c'est un tre de vrit.
Ds lors on voit ce qu'il en cote l'tre de
savoir, de reconnatre les formes heureuses de ce
quoi il ne s'accouple, lui, que sous le signe du
malheur : du malheur de son patient. Que cet tre de
savoir doive se rduire - celui du psychanalyste -
n'tre que le complment du symptme, voil ce qui
fait horreur et ce qu' l'lider, l'tre de savoir en
question fait jouer, vers un ajournement indfini du
statut de la psychanalyse - comme scientifique,
s'entend. C'est pourquoi mme le choc, qu' clore
l'anne sur ce ressort, nous produismes, n'vitt
pas, qu' sa place se rptt le court-circuit.
Et je fais allusion une forme sous laquelle ceci
nous revint et qui est trs importante.
Il nous revint - d'une bonne volont, bien sr,
vidente, et mme qu' se parer de paradoxe (comme
elle faisait), que c'est la faon dont le praticien
le pense, qui fait le symptme.
a a l'air d'tre la suite de ce que j'avanais
avant. Pourtant il y a bien lieu que j'y sursaute,
car
Bien sr, c'est vrai de l'exprience des
psychologues par quoi nous avons introduit le grelot
- report au paragraphe VIGOTSKY, PIAGET - mais c'est
aussi rester comme psychothrapeute
Et a, exactement au niveau de dire a, de dire a
qui, en un certain sens est vrai, mais qui n'est pas
la vrit que nous avons, nous, dire, qui n'est pas
celle laquelle nous nous affrontons, au moment o
j'apporte sur le sujet de la clinique, ceci, savoir
que nous avons, comme analyste, prendre part, dans
le symptme.
382
Donc c'est rester, comme psychothrapeute,
exactement au niveau de ce qui fait que Pierre JANET
n'a jamais pu comprendre pourquoi il n'tait pas
FREUD.
La dive bouteille, conclus-je, c'est la bouteille de
KLEIN. Ne fait pas qui veut, sortir de son goulot ce
qui est dans sa doublure. Car tel est construit le
support de l'tre au sujet.
Voil .Je ne vous ai pas lu ce petit morceau pour
vous donner l'occasion de le connatre, car vous
n'auriez jamais t de toute faon le chercher dans
cet annuaire. Qui lit les annuaires ? Mais pour
Mme X : on pourra avoir ce texte?
Ma chre, faites-en faire quelques tirages part .
Bon. Moi, je le donne l'annuaire. Je n'en fais pas
faire de tirage part. Personne ne le fait. Mais
enfin, en effet, a peut vous tre utile, car c'est
un tout petit texte auquel j'ai donn assez de soin
pour qu'on le considre comme ayant une petite
fonction de gong .
Si je ramorce, je reprends, je renoue, je rappelle,
partir de ce texte pour continuer, voyez-vous, ce
dont je partirai le plus aisment, c'est bien sr,
naturellement, de la fin, a n'en sera que plus
facile pour vous pointer quelque chose auquel on ne
songe pas souvent : c'est l'orgueil qui se cache
derrire la promotion telle quelle se fait
d'ordinaire de tout pas vers le relativisme. Je
propose, j'indique que le problme de l'analyste est
justement son implication dans le symptme qui se
propose devant lui, et l'interroge, lui, tre de
savoir, comme tre de vrit, je dis, en somme que le
drame de l'analyste, c'est que forcment, son tre de
savoir, est inflchi, est impliqu dans cette
confrontation : qu'Oedipe, quoi qu'il fasse, rend la
main au moins pour un temps, la Sphinge puisque
c'est de cela qu'il s'agit. De s'tre manifest, en
fin de compte, suprieur comme tre de savoir, c'est
383
justement a qui fait de lui un hros. Ce que nous ne
sommes pas tout instant.
Aussitt, cette pense saute - et trs facilement -
cette fonction de cette prsence de l'observateur
dans l'observation qui est aussi a que nous indique
le progrs de notre physique, et qui nous donne
l'ide, comme on dit, que nous ne sommes pas rien.
Mais c'est le contraire.
Mme dans la thorie da la relativit physique,
qu'elle soit restreinte ou gnralise : a veut pas
dire du tout que c'est l'observateur qui rgle
l'affaire, a veut dire au contraire que l'affaire
l'a lil, l'observateur.
En d'autres termes, toute thorie relativiste ne
donne aucune espce - comme elle est habituellement
ressentie - aucune espce de regain de force
quelconque l'ide du sujet comme sujet de la
connaissance, l'ide d'une bipolarit qui serait l
complmentaire, que vous les opposiez ou non l'aide
de signes, qui seraient en quelque sorte, rciproques
et d'gale dignit.
Il n'y a absolument rien de pareil.
Tout ce qui s'accentue dans cette perspective, que ce
soit celle du progrs de la science ou celle de notre
exprience a nous, analystes, c'est qu'il nous est
impossible de nous en sortir de cette illusion, sauf
justement - ce que nous appellerons un petit peu plus
que de trs grande prcaution - sauf le remaniement
principiel, structurel, absolument total de la
topologie de la question. Et d'introduire, dans
quelque chose qui ne saurait, d'aucune faon tre
appel une autre faon de connaissance, qui
tournerait la difficult, quelque chose qui n'est
point de l'ordre de la connaissance, quelque chose
qui est de l'ordre du calcul, de la combinatoire,
quelque chose que nous faisons sans doute fonctionner
mais qui ne se livre pas pour autant nous,
l'impulsion d'une faon telle qu'elle nous
permettrait de repartir tout simplement d'un pas plus
leste sur le mme chemin, considr comme largi et
perfectionn.
384
Il y beaucoup de choses dire, l, et en particulier
quelque chose auquel je voudrais tout de mme donner
un peu de soin, aujourd'hui, parce que, c'est la
fois faire face des objections, ma foi, pas trs
efficaces, on peut toujours laisser parler, courir,
en fin de compte, une telle faon que la mienne
d'aborder la psychanalyse aurait quelque chose, comme
on dit, de trop intellectualiste, pourquoi pas
verbale, et puis aussi bien de l'usage qui est fait
l'intrieur de la psychanalyse du fameux pouvoir des
mots. Comme d'habitude, les pouvoirs malfiques, et
celui-l en particulier, le pouvoir du mot, magique
encore, comme on dit, de toute puissance magique,
qu'il s'agisse de la pense ou des mots, tout a
revient au mme, c'est toujours l'autre, bien sr,
qui tombe dedans.
Bien sr, que nous avons faire, toujours, cette
opration de dmythification qui consiste reprendre
des termes qui, traditionnellement ont t saisis
dans certains mots et les remettre en question.
Quand NIETZSCHE
aprs tout, pour l'amener, l, ce c'est pas qu'il
ait fait un travail bien excellent, mais enfin,
c'tait un dbut et a a frapp bien du monde
quand NIETZSCHE s'emploie retrouver la trace ce
qui, dans la tradition philosophique a donn
consistance tel terme qu'il vous plaira, l'me
par exemple, qu'est-ce que nous avons en faire ?
Est-ce bien l la voie ? Quand nous irons dire
mme avec nos moyens qui ne nous permettent
qu'une extrapolation d'une lgance qui dpasse
ce quoi il avait accs
dsigner quelque support de cette me dans l'ombre
du corps, celle qu'a laiss en route le personnage de
Chamisso
128
[Adelbert von Chamisso, l'trange histoire de Peter Schlemihl], que ferons-
nous de plus que d'tre toujours exactement sur la
mme voie d'o est partie toute l'affaire.
Une affaire qui dpasse de beaucoup l'affaire
particulire de la psychologie laquelle nous avons
128 Adelbert von Chamisso, l'trange histoire de Peter Schlemihl (1813), Paris, Flammarion, 2007.
385
affaire, savoir l'apologue, la fable de la caverne
dans PLATON
129
, VIe livre si mon souvenir est bon de
La Politia [Platon, La Rpublique], cette ombre, ce n'est pas une
autre que celle qui joue sur la muraille vers
laquelle les captifs de la caverne ont la tte - dans
toutes sortes d'appareils - ncessairement
maintenue, sans pouvoir se tourner, voir ce qui est
derrire, et de quoi ces ombres sont, sur la
muraille, la projection.
Mais qu'est-ce qu'implique cette fable fondamentale ?
Est-ce qu'il s'agit de savoir si l'on sort, ou si
l'on ne sort pas.
Elle implique ce qui - se reporter au texte - est
dsign comme un feu, le feu qui justement, de
l'clairage projet, produit la fantasmagorie,
autrement dit, le feu de feu, ide centrale, la
source bel et bien figure ailleurs, en d'autres
textes de PLATON par le soleil lui-mme [508a], le point
inaugural ou s'indique l'identique de l'tre du rel
et de l'tre de la connaissance.
Moyennant quoi tout se structure selon cette forme
d'enveloppes s'enveloppant les unes les autres
topologie de la sphre, capable de se redoubler
comme identiques de simplement ce qu'on appelle
en topologie se napper, c'est--dire se recouvrir
comme une doublure
qui s'en va jusqu'au point, terme de l'enveloppe, de
toutes les enveloppes, sur lesquelles on prsente,
pour s'opposer l'identit de deux tres, le contenu
du savoir.
Seulement il y a une remarque qui elle toute seule,
peut mettre - condition simplement d'accepter de
retomber dans les tnbres - ces choses en suspens :
remarquer que si assurment l'ombre s'teint s'il
n'y a plus de soleil, le corps lui est toujours l.
On peut le tter dans les tnbres et recommencer
l'exprience sur un nouveau pied.
Or c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de
savoir quels leurres imaginaires les mots donnent
129 Platon, La Rpublique, 514a, Gallimard, Pliade, 1950, red. 2007.
386
consistance en leur donnant leur cachet. Ce ne sont
pas les leurres qui trompent, ce sont les mots. Mais
c'est justement l leur force. Et c'est ce qu'il
s'agit d'expliquer.
Si l'me
pour reprendre les choses au point vif ou nous
croyons l'affaire nettoye
est une entit qui a quelque consistance, c'est
non pas
disons-nous cette anne, pour autant que nous
tudions l'objet de la psychanalyse
c'est non pas que l'me soit quelque chose qui soit
ni l'ombre du corps, ni son ide, ni sa forme qui
soit, proprement parler ce qui de lui choit :
dchet, chute c'est ce qui, du corps, tombe sous le
couperet de ce quelque chose qui se produit comme
effet du signifiant.
Et c'est dans la mesure ou le signifiant sur ce sujet
incarn porte sa marque, que quelque chose de
corporel, d'effectif, matriel, se produit, qui est
ce qui est en question. Ce nest donc pas sanction
par le langage de quelque mirage imaginaire, qui se
produit, mais effet de langage, qui, de se cacher
sous ces mirages, leur donne tout leur poids.
C'est l ce qui est la nouveaut de l'abord
psychanalytique fond sur ce fait que l'effet de
langage dpasse, parce qu'il la prcde, toute
apprhension subjective qui puisse s'autoriser elle-
mme d'tre apprhension de conscience.
Et toute critique du pouvoir des mots, comme on dit,
qui s'y attaque comme telle - car, aprs tout, ce qui
perdure sous l'tiquette acadmique de psychologie
n'est rien d'autre jamais que cette voix - c'est de
partir du statut verbal, incontestablement, parce que
traditionnel, d'une certaine fonction de l'me, de la
mettre en cause comme manque, et d'interroger
partir de l qu'est-ce qu'il y a de rel l-dedans
qui laisse debout parfaitement le cadre du pouvoir
des mots. Alors que ce qu'il s'agit d'interroger,
c'est qu'est-ce qu'a produit le langage, comme effet
387
inaugural sur lequel repose tout le montage, qui fait
la monture de l'tat de sujet.
Ceci ne s'aborde pas simplement de le regarder en
face. C'est pourquoi le rapport de l'tre de savoir
l'tre de vrit, est fond sur ce qui - pour parler
ici de celui mme qui vous parle - fait justement que
mon discours ne se sustente d'aucun remaniement du
vocabulaire. Si je dis qu'il n'y a pas de
mtalangage, je l'accentue de ceci que je ne tente
pas d'en introduire un, un nouveau, qui sera toujours
soumis ceci d'tre comme tout mtalangage, partie
du langage.
La premire condition de saisie qu'il s'agit bien du
rapport un tre de vrit, c'est que, dans le
discours, elle s'articule comme nigme et je regrette
bien si ceci, dans tous les temps
et FREUD lui-mme qui l'a avou et reconnu
comme tel quand il a crit la Science des rves,
Umschreibung disait-il - enrag de ne pas pouvoir
retrouver le style de ces petits rapports
scientifiques d'avant, Umschreibung, ce qui veut
dire : manirisme.
travers les cas historiques de la crise du sujet,
les explosions littraires et esthtiques en gnral,
de ce qu'on appelle le manirisme correspondant
toujours au remaniement de la question sur l'tre de
vrit.
Oui. Il s'agirait de trouver un court-circuit pour
retrouver notre objet(a) puisque aussi bien une ide
m'en vient. Elle m'a t fournie, refournie il n'y a
pas longtemps par GUILBAUD
130
- avec qui j'ai
d'hebdomadaires entretiens depuis quelque temps - il
m'a rappel que c'tait FRANKEL je crois, qui faisait
ce coup-l ses auditeurs : l, 2, 3, 4, 5, quel est
le plus petit nombre entier qui n'est pas crit sur
le tableau ?
Ben, coutez, allez! Le plus petit nombre entier non
crit sur le tableau.
130 G. TH. GUILBAUD, mathmaticien franais, Institut Poincar, MSH spcialis dans les mathmatiques des sciences
humaines : thorie des jeux, cyberntique (Cf. son Que Sais-je), combinatoire ( Cf. : Pour quon lise Pascal in revue francaise
de recherche operationnelle 6e anne - 3e trimestre 1962 - numro 24 et Leons d' peu prs, C. Bourgois)
388
Vous croyez naturellement qu'on veut vous faire des
tours. Mais ce n'est pas compliqu, c'est le 6. Etes-
vous srs que le zro est un nombre entier, a se
discute [LACAN crit au tableau : le plus petit nombre entier qui n'est pas crit sur le tableau.]
Alors, quel est-il maintenant ?
le plus petit nombre entier qui n'est pas crit sur
le tableau ? Aucun videmment.
Quoi ? Qu'est-ce que vous allez dire ?
Quoi que vous disiez, je vous dirai : il est crit
sur le tableau. a vous la coupe ?
Eh bien, c'est justement de a qu'il est question,
que a vous la coupe. a r-instaure, a vous montre,
a vous rintroduit - puisque c'est de a qu'il
s'agissait - dans la question du langage, fond,
comme vous le voyez sur l'criture, l'objet(a). a
vous la coupe ? Vous n'avez absolument rien pousser
cette occasion, comme voix? Quoi ?
M. X - au tableau : qui n'est pas crit
Oui, c'est trs pertinent, bien sr. On pourrait
partir de l et en faire beaucoup de choses. Bon.
Est-ce que c'est dire, quavec ce a vous la
coupe nous avons l le tout de ce dont il s'agit
concernant la castration ?
Je dis non. Il ne s'agit des choses qu'au niveau de
l'objet(a)
Pour que quelque chose d'crit, tienne en somme,
il vous faut payer votre cot, c'est--dire que
si je ne mets que des choses crites - par
exemple un discours scientifique partir du
dbut de la thorie des ensembles, jusque rien
ne m'arrtera jusqu' la fin, j'puiserai tout le
parcours de la physique moderne - a ne tiendra
de toute faon, que si je l'accompagne d'un
discours qui vous le prsente. Il n'y a aucun
moyen de prsenter le discours - ft-il le plus
formalis que vous supposiez - il n'y a aucun
moyen de prsenter si vous voulez le BOURBAKI,
sans prface ni sans texte. C'est de cela qu'il
s'agit.
389
et donc des rapports du langage qui,
incontestablement, en effet, est coupure et criture,
avec ce qui se prsente comme discours, langage
ordinaire, et qui ncessite ce support de la voix,
ceci prs, bien sr, que vous ne preniez pas la voix
pour simplement la sonorit, ce qui la ferait
dpendre du fait que nous sommes sur une plante o
il y a de l'air qui vhicule du son.
a n'a absolument rien faire avec a.
Quand je pense que nous en sommes encore dans la
phnomnologie de la psychose, nous interroger sur
la texture sensorielle de la voix, alors qu'avec
simplement les six ou huit pages de prlude que j'ai
donnes dans mon article sur Une question prliminaire
tout traitement possible de la psychose
131
, j'ai dsign
l'abord parfaitement prcis sous lequel peut-tre de
nos jours, au point o nous en sommes, on peut
interroger le phnomne de la voix. Il n'y a qu'
prendre, le texte de SCHREBER
132
.
et y voir distingu - comme je l'ai fait - ce que
j'ai appel message de code et code de message, pour
voir qu'il y a l moyen de saisir d'une faon non
abstraite mais parfaitement dj phnomnologis, la
fonction de la voix en tant que telle.
Moyennant quoi, on pourra commencer se dtacher de
cette position invraisemblable qui consiste mettre
en question l'objectivit des voix de l'hallucin.
Vous objectivez l'hallucin. En quoi ses voix
seraient-elles moins objectives, en quoi la voix sous
prtexte qu'elle n'est pas sensorielle, serait-elle
de l'irrel, de l'irrel au nom de quoi ? C'est un
prjug qui date de je ne sais quelle tape
archi-archaque de la critique de la prtendue
connaissance.
Est-ce que la voix est irrelle allons-nous dire -
de ce que nous la soumettions aux conditions de la
communication scientifique, savoir qu'il ne peut
131 crits p.531 ou t.2 p.9.
132 D. P. Schreber, Mmoires d'un nvropathe (1903), Paris, Seuil, Coll. Points, 1985. Cf. sminaire Les formations de
l'inconscient, 29-01 et 21-06.
390
pas la faire reconnatre, cette voix qu'il entend -
et la douleur alors, est-ce qu'il peut la faire
reconnatre ? Et pourtant .
Va-t-on discuter que la douleur soit relle ?
Le statut de la voix est proprement parler encore
faire mais non seulement il est faire, il est
faire entrer dans les catgories mentales du
clinicien dont nous parlions prcisment tout
l'heure qui, trs certainement, mme quand il
russit, je l'ai not dans le mme texte, quelque
chose d'aussi heureux que d'apercevoir les choses qui
se voyaient depuis probablement un bon bout de temps
l'il nu, mais que personne n'avait jamais
releves
savoir qu'il y a de ces phnomnes de voix qui
s'accompagnent de mouvements laryngs et
musculaire autour de l'appareil phonatoire et que
ceci, bien sr a son importance, et n'puise
certainement pas la question, et en tout cas, lui
donne un mode d'abord.
a n'a pas fait avancer pour autant, d'un pas de
plus, le statut de la voix.
Ici, je voudrais quand mme faire remarquer que c'est
une bien grande ingratitude - pour quiconque a un
tout petit peu le sens clair de ce que NIETZSCHE
appelait justement la gnalogie, de la morale ou
d'autre chose - ce serait tout fait une folie de
mconnatre ce que le statut de la science,
prcisment - je parle de la ntre - doit SOCRATE
qui prcisment se rfrait sa voix. Il ne suffit
pas de prtendre en finir avec les voix, se
satisfaire ou croire qu'on a satisfait un phnomne
comme celui-la, au fait que SOCRATE disait,
expressment se rfrer sa voix, pour dire, oh ben
oui, il y avait dans un coin, un truc qui tournait
pas rond. Quand il s'agit de SOCRATE, il me semble
difficile de ne pas saisir la cohrence de l'ensemble
de son appareil, surtout tant donn que cet appareil
tait l pour fonctionner tout le temps ciel
ouvert. Nous pouvons avoir lide, prcisment, qu'en
fait, la question du sujet telle que je la pose, est
parfaitement et totalement ouverte au niveau de
391
SOCRATE quoique nous puissions penser de la faon
dont nous ont t transmis ces entretiens qui taient
la base de son enseignement, arrangs, modifis,
enrichis de quelque faon que nous le supposions par
tel ou tel, et par PLATON spcialement. Il n'en reste
pas moins que leur schma est clair, que la
dcantation est parfaite de l'tre de savoir et de
l'tre de vrit.
Il faut relire tout PLATON avec ce fil conducteur qui
se prend - ceci, que bien sr, je vous ai appris
antrieurement dchiffrer beaucoup plus loin - en
appelant les choses par leur nom et en disant ce dont
il s'agit dans le dsir de savoir, savoir l'agalma.
Mais laissons pour l'instant !
Que ce quoi SOCRATE rpond est ceci : quel est
l'tre de vrit de ce dsir de savoir?
Qu'est-ce qu'il veut dire quand ceci aboutit
prtendument la transcription platonicienne :
occupe-toi de ton me ?
Nous le laisserons pour plus tard. Mais ce n'est pas
pour rien que j'voque ici SOCRATE - que je rappelle
d'ailleurs cette cl : tre de savoir et tre de
vrit.
Je laisserai aussi aujourd'hui de ct une remarque
que je pourrai faire sur cet emploi du terme de cl
alors que je viens de dire tout l'heure que son
enseignement ne comportait pas de mots cl. C'est
peut-tre justement que la proprit des cls en
question, c'est de ne pas avoir de serrure. Et en
effet, toute la question est l.
Je veux simplement faire une remarque qui est celle
que, bien entendu, chacun pourrait lever ici :
Alors, pourquoi SOCRATE n'a-t-il pas dcouvert,
articul l'inconscient ?
La rponse, bien sr, est dj implique dans
l'antrieur de son discours : parce qu'il n'y avait
pas notre science constitue. Si j'ai soulign quel
point la psychanalyse dpend d'un statut assur,
sutur, de l'tre de savoir, je pense que cela
pourrait dj passer pour une rponse suffisante si
justement la question ne se reportait pas simplement
: pourquoi n'y avait-il pas au temps de SOCRATE,
392
titre de dpart, une science ayant le statut de notre
science, celui que j'ai dfini d'une certaine faon,
prcisment la suture du ct de la vrit ?
Je n'irai pas bien loin, tant donn l'heure,
aujourd'hui dans ce sens mais comme c'est sur la voie
de quelque chose qui nous importera beaucoup, pour
nous ramener dans ce dont il s'agit, savoir la
position du psychanalyste, savoir ce que je
voudrais pour la prochaine fois que quelqu'un apporte
ici comme contribution : qu'on prenne un des
meilleurs, un des plus grands, et sur le point d'o
il a apport les choses de plus de relief, je prie
qu'on reprenne ici mon article sur la thorie du
symbolisme qui a t fait en commentaire de l'article
de JONES
133
et puis qu'on y mette en connexion ce qui
est impliqu aussi, simplement indiqu dans mon
article, savoir la faon dont JONES a eu se
dbrouiller avec le problme de la sexualit fminine
pour autant quil intresse le statut de la fonction
phallique.
Qu'on fasse le dpart des incohrences manifestes o
glisse sans cesse son discours, o de la faon dont
c'est le symptme mme auquel il a affaire qui le
rectifie et qui en quelque sorte rintgre et fait
plus que suggrer, impose - en quelque sorte toutes
crites, et contrairement son intention, les
formules mmes, topologiques qui sont les ntres.
Je voudrais que quelqu'un se livrt cette petite
manuvre et ne me fort pas - une fois de plus -
m'y exercer moi-mme.
Quel extraordinaire texte que celui auquel je me suis
attaqu dans cet article dont je parle, cet article
sur le symbolisme. Il consiste en somme, nous dire,
- vous le verrez dans le texte - dire conformment
en fin de compte, aux choses que je suis arriv
dire aprs lui, que ce n'est pas une mtaphore de
dire que le symbolisme est fait comme une mtaphore,
que c'est une vraie mtaphore, que l, la mtaphore
au lieu de s'loigner - comme il s'exprime - du
concret, s'en rapproche toute vole.
133 E. Jones, Thorie du symbolisme (1916) , in Thorie et pratique de la psychanalyse, Paris, Payot, 1997.
Cf. crits, p.697 ou t.2 p.175.
393
Qu'est-ce qu'il y a en fin de compte de plus vrai que
cette direction ? Sinon qu' la fin c'est faux tout
de mme parce que ce n'est pas une mtaphore : c'est
une mtonymie.
Pour le phallus avec la femme et avec ce quil
introduit effectivement d'un relief extraordinaire
concernant le dterminisme, la fonction, le sens mme
de l'homosexualit fminine, on peut dire que tout
est dans le texte sans que l'auteur comprenne ce
qu'il dit. Est-ce qu'il n'y a pas l quelque chose o
s'inscrit prcisment ce rapport au symptme dont je
parle, qui est ncessit, qu'on peut, sur l'autre
face, considrer qu'il n'a pu accder aussi
profondment au sens du symptme qu' en manquer la
thorie?
Ainsi pouvons-nous nous demander ce qui fait que la
science, la science grecque qui savait construire
dj d'admirables automates, n'a pas pris son statut
de science.
C'est qu'il y a une autre voix, qui joue son rle
dans l'interrogation socratique. Je pense que vous
l'voquez avant que je la dsigne : c'est celle qu'il
appelle dposer de temps en temps, d'une faon
assez exemplaire - assez scandaleuse peut-tre, nous
n'en saurons jamais rien, pour les oreilles
contemporaines - c'est la voix de l'esclave.
Comment se fait-il que l'esclave rponde donc
toujours si juste, rponde toujours si bien et aille
droit la vrit, la qualit du nombre irrationnel
qui rpond la diagonale du carr? Est-ce que nous
ne saisissons pas l ce dont il s'agit, qui n'est
justement rien d'autre que le statut du dsir.
Si ni FREUD ni SOCRATE n'ont t - quelque dissolvant
qu'ait t leur produit - n'ont t jusqu' la
critique sociale
car aprs tout, que je sache, SOCRATE n'a pas
introduit le matrialisme historique, qu'il en
ft un petit peu trembler sur leurs bases les
statues des Dieux. Il est tout fait clair que
ce n'tait pas pour rien qu'ALCIBIADE coupait la
queue de son chien, que a n'tait pas pour faire
394
uniquement parler les gens, puisque a ressemble
un tout petit peu trop une certaine affaire de
mutilation des HERMS, qui, elle, a fait quelque
bruit
134
pour qui n'tait pas tout fait sans
relation avec la dialectique sur l'tre de
vrit. Mais a, ce n'est pas de la critique
sociale. Appelons a de l'action directe. C'est
de l'anarchisme, chose qui, comme vous le savez,
n'est plus de nos faons. [Plutarque, Les vies parallles]
SOCRATE n'a pas fait de critique sociale et FREUD
non plus. C'est sans doute parce que l'un et l'autre
avaient l'ide d'o se situait un problme conomique
extraordinairement important, celui des rapports du
dsir et de la jouissance. S'il n'y a pas eu de
science antique, c'est parce qu'il fallait, pour
qu'il y ait de la science, qu'il y ait l'industrie
moderne. Et pour qu'il y ait de l'industrie moderne,
il fallait que les esclaves ne soient pas des
proprits prives. Les proprits prives, on les
mnage, on ne les fait pas aussi vachement travailler
que dans les rgimes de libert. Moyennant quoi, le
problme de la jouissance dans le monde antique,
tait rsolu, et de la faon dont je pense vous voyez
clairement ce qu'elle est : les tres dvolus la
jouissance, la jouissance pure et simple, c'tait
les esclaves, comme tout l'indique d'ailleurs :
au respect - contrairement ce qu'on dit - qu'ils
recueillaient (on ne maltraitait pas un esclave comme
a, surtout que c'tait un capital), au fait qu'il
suffit d'ouvrir TERENCE - sans parler d'autres :
EURIPIDE - pour s'apercevoir que tout ce qu'il y a
de rapport de raffinement, de rapports courtois,
de rapports amoureux, se passe toujours du ct
d'tres qui sont dans la condition servile.
Et que nihil humani a me alienum de TERENCE
135
dsigne
l'esclave, n'a pas d'autre sens.
134 Cf. Plutarque, Les vies parallles, Paris, Belles Lettres, tome III, 1969.
135
Trence, L'Heautontimorroumenos : Le bourreau de soi-mme, Paris, Flammarion, 1993, acte I, sc.1 :
CHREMES : Homo sum, humani nil a me alienum puto.
395
Pourquoi irait-on dire une connerie pareille, sil ne
s'agissait pas de dire :
je vais l o est l'humanit, aux esclaves .
La jouissance du monde antique, c'est l'esclave.
Et ce parc rserv la jouissance, si je puis dire,
c'est cela qui a t le facteur d'inertie qui fait
que la science, ni du mme coup l'tre du sujet n'ont
pu se lever. Sans doute le problme de la jouissance
pour nous se posera en d'autres termes, et
certainement - du fait du capitalisme - dans des
termes un peu plus compliqus. Il n'en reste pas
moins qu' un certain endroit, FREUD
136
l'a point du
doigt, et que nous aurons, propos du Malaise dans la civilisation
repasser par cette route, pour reprendre notre fil.
136 S. Freud, (1929, G.W XIV), Le malaise dans la culture, Paris, PUF, 2004
396
27 Avril l966 Table des sances
Murielle DRAZIEN LACAN
Bon. Inter, comme on dit. Inter en latin, C'est Saint
AUGUSTIN qui commence comme a, une sorte d'nonc
qui a fini par s'roder force de courir :
Inter urinas et faeces nascimur
137
.
C'tait un dlicat.
Cette remarque qui, en elle-mme ne semblerait pas
comporter de consquences infinies, puisque aussi
bien, puisquaussi bien on en est n, de ce prine,
il faut quand mme bien dire que, on court aprs. Il
est certain que si Saint AUGUSTIN avait des raisons
de s'en souvenir, c'tait pour d'autres raisons, pour
d'autres raisons qui nous intressent tous, en ce
sens que ce n'est pas titre de vivant, de corps,
que nous naissons inter urinas et faeces, mais
titre de sujet.
C'est bien pour a, que a ne se limite pas tre un
mauvais souvenir mais tre, quelque chose qui - au
moins pour nous qui sommes l - nous sollicite
prsentement cette anne, de nous intresser vivement
aux objets(a) dont il se trouve, qu'au moins l'un
d'entre eux se trouve en connexion avec ces environs.
Au moins l'un d'entre eux et mme deux, le deuxime,
savoir le pnis, se trouvant occuper, dans cette
dtermination du sujet, une place tout fait
fondamentale.
La faon dont FREUD articule ce nud a introduit une
grande nouveaut quant la nature du sujet. Il est
137 Comme Freud aussi aimait le rappeler
397
particulirement opportun de se le rappeler quand
la ncessite de l'avnement de ce sujet nous la fait
venir d'un tout autre ct, savoir du je pense .
Et vous devez bien sentir que si je prends tellement
de soin de l'articuler partir du je pense ,
c'est bien sr, pour vous ramener au terrain freudien
qui vous permettra de concevoir pourquoi c'est le
sujet que nous saisissons dans sa puret au niveau du
je pense cette connexion troite avec deux
objets(a) si incongrment situs. Il faut dire
d'ailleurs, que nous, qui ne sommes pas de parti-
pris, nous n'avons pas de vise spciale vers
l'humiliation de l'homme, nous nous apercevrons qu'il
y a deux autres objets(a), chose curieuse, rests,
mme dans la thorie freudienne, demi dans l'ombre,
encore qu'ils y jouent leur rle, d'instance active,
savoir, le regard et la voix.
Je pense que la prochaine fois, je reviendrai sur le
regard. J'ai fait deux, et mme trois, clbres
sminaires, comme on dit, dans la premire anne de
mes confrences ici
138
, o j'ai tent pour vous de vous
faire sentir la dimension o s'inscrit cet objet
qu'on appelle le regard.
Certains d'entre vous s'en souviennent srement. Ceux
qui viennent depuis longtemps mon sminaire ne
peuvent pas en avoir laiss passer l'importance. Et
puisque j'aurai l'occasion, je pense, la prochaine
fois d'y mettre tout l'accent, je voudrais ds
aujourd'hui, ceux qui reprsentent le bataillon
sacr de mon assistance, savoir vous autres, de
vous recommander d'ici-l - parce que a rendra
beaucoup plus intelligible les rfrences que j'y
ferai - ce qui est paru dans le trs brillant bouquin
qui vient de sortir, de notre ami Michel FOUCAULT ce
qui est paru dans le premier chapitre de ce livre,
sous le titre : les suivantes, chapitre I du livre de
Michel FOUCAULT
139
intitul - pour ceux qui sont
aujourd'hui durs de l'oreille :
in- ti- tu- l -
Les mots et les choses. C'est un beau titre.
138 Sminaire Les fondements 26-02, 04-03, 11-03.
139 M. Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.
398
De toute faon, ce livre ne vous dcevra pas et en
vous recommandant la lecture du premier chapitre, je
suis, en tout cas bien sr, de ne pas le desservir,
car il suffira que vous ayez lu ce premier chapitre
pour, voracement vous jeter sur tous les autres.
Nanmoins j'aimerais qu'au moins un certain nombre
d'entre vous aient lu ce premier chapitre d'ici la
prochaine fois parce que, il est difficile, de n'y
pas voir inscrit, en une description
extraordinairement lgante, ce qui est prcisment
cette double dimension que, si vous vous souvenez,
j'avais reprsente autrefois par deux triangles
opposs : celui de la vision avec, ici, cet objet
idal qu'on appelle l'il et qui est cens
constituer, le sommet du plan de la vision et ce qui,
dans le sens inverse s'inscrit sous la forme du
regard.
Quand vous aurez lu ce chapitre vous pourrez vous
serez beaucoup plus l'aise pour entendre ce que j'y
donnerais la prochaine fois comme suite.
Autre petite lecture, genre distraction, pour lire
sous la douche, comme on dit, il y a un excellent
petit livre qui vient de paratre sous le titre
Paradoxes de la conscience
140
, rdig par quelqu'un que
nous estimons tous, j'imagine, parce que nous avons
140 Raymond Ruyer, Paradoxes de la conscience et limites de l'automatisme, Paris, Albin Michel, 1966
399
tous ouvert, quelque moment, quelques-uns de ses
livres, nourris de la plus grande rudition
scientifique, qui s'appelle Monsieur RUYER
(on prononce Ruyre parat-il) Raymond RUYER,
professeur la Facult des lettres de Nancy -
Monsieur RUYER qui dans cette retraite provinciale
poursuit depuis de longues annes, un travail
d'laboration extraordinairement important du point
de vue pistmologique, vous donne l une sorte de
recueil d'anecdotes qui - je dirai - a mes yeux une
valeur cathartique tout fait extraordinaire, celle
de rduire en effet ce qu'on peut appeler les
paradoxes de la conscience, la forme d'une sorte
d'Almanach VERMOT, ce qui est tout de mme assez
intressant, je veux dire, les met leur place,
leur place, en somme, de bonnes histoires.
Il semblerait que depuis un bon moment les paradoxes
qui nous attirent doivent tre autre chose que des
paradoxes de la conscience.
Bref, sous cette rubrique, vous verrez rsums toutes
sortes de paradoxes dont certains extrmement
importants, justement en ceci qu'ils ne sont pas des
paradoxes de la conscience mais quand on les rduit
au niveau de la conscience, ils ne signifient plus
rien que des futilits. C'est une lecture extrmement
salubre et il semble qu'une bonne part du programme
de philosophie devrait tre mis dfinitivement hors
du champ de l'enseignement aprs ce livre qui montre
l'exacte porte d'un certain nombre de problmes qui
n'en sont pas.
Que pourrais-je vous recommander encore ? Il y a dans
les deux derniers numros d'Esprit un commentaire par
quelqu'un qu'on m'affirme tre un rvrend pre
dominicain et qui signe Jacques M. POHIER
141
et qui se
consacre l'examen d'un livre auquel on a fait
beaucoup d'allusions ici et auquel Monsieur TORT a
donn sa sanction dfinitive.
Il reste nanmoins que, il y a d'autre point de vue
de l'aborder, et que, le point de vue du religieux,
141 Jacques-M. Pohier, Au nom du Pre..., Esprit, mars et avril 1966.
400
n'est pas du tout ngliger, et je vous prie de lire
cet article.
Vous y verrez la faon dont mon enseignement peut-
tre utilis l'occasion, dans une perspective
religieuse quand on le fait honntement.
Ce sera un heureux contraste avec l'usage, qu'on en a
fait prcisment dans l'autre livre que je ne dsigne
ici que d'une faon indirecte.
Que vous conseiller encore ?
Ben, mon Dieu, je crois que c'est l toutes mes
petites ressources. Tout de mme, vous allez voir
qu'aujourd'hui, nous allons mettre l'ordre du jour
l'examen d'un article de JONES car l'intrt de ces
sminaires ferms c'est de nous livrer des travaux
d'tude et de commentaire pour autant qu'ils peuvent
fournir matriau, rfrence et aussi quelquefois
initiation de mthode notre recherche et cet
article de JONES que nous allons voir, aujourd'hui
qui s'appelle :
Dveloppement prcoce de la sexualit fminine
142
et qui est paru en l927, je vous signale, je vous
signale parce que, JONES a commis deux autres
articles
143
, aussi importants que celui-ci, et que le
second comme ce premier
non pas le troisime mais aprs tout, on peut
s'en passer
ont t traduit
a m'a t rappel, d'une faon qui m'a paru
assez heureuse, car je l'avais compltement
oubli
ont t traduit dans le N7 de La psychanalyse consacr
la sexualit fminine, numros qui ne sont peut-
tre pas puiss, de sorte que, mon Dieu, pour ceux
d'entre vous, qui n'ont pas une trop grande
familiarit avec la langue anglaise, ceci vous
facilitera, rtrospectivement, je pense, pour ceux
qui n'ont pas encore lu le premier article, de bien
saisir ce que nous arriverons dire aujourd'hui sur
142 E. Jones, Dveloppement prcoce de la sexualit fminine, in Thorie et pratique de la psychanalyse, p.399, op. cit
143 Jones, Le stade phallique (1932) p.412 ; La sexualit fminine primitive (1935) p.442, in Thorie et pratique de la
psychanalyse, Op. cit.
401
cet article, et lisant l'autre, d'y trouver l'amorce
de travaux futurs que j'espre :
puisque j'espre que j'obtiendrai autant de bonne
volont pour les prochains sminaires ferms que j'en
ai obtenu pour celui-ci, en m'y prenant d'une faon
un peu court terme qui mrite d'tre souligne ici
pour introduire les personnes qui ont bien voulu, sur
ma demande, s'y dvouer. Vous y trouverez - en outre
- dans ce numro sur la sexualit fminine, sous le
titre de
La fminit en tant que mascarade
144
, qui est exactement la
traduction du titre anglais, un excellent article,
d'une excellente psychanalyste, qui s'appelle Madame
Joan RIVIRE, qui a toujours pris les positions les
plus pertinentes sur tous les sujets de la
psychanalyse et tout fait spcialement, je vous le
dis en passant, sur le sujet de la psychanalyse
d'enfant.
Vous voyez que vous ne manquez pas d'objet de
travail, le plus press tant de lire Michel FOUCAULT
pour la prochaine fois.
Alors, comme je tiens beaucoup cette collaboration,
from the floor, comme on dit, d'un sminaire ferm,
je vais donner la parole tout de suite Mademoiselle
Muriel GRAZIEN qui a bien voulu faire votre usage
une sorte de prsentation, d'introduction de cet
article de JONES qui s'appelle Dveloppement prcoce
ou premier dveloppement, comme il vous conviendra,
de la sexualit fminine. Vous allez voir d'abord de
quoi il retourne et j'espre que j'arriverai vous
montrer l'usage que j'entends en faire.
144 Joan Rivire, La fminit en tant que mascarade, in Fminit mascarade, tudes psychanalytiques runies par M.C. Hamon,
Paris,Seuil, 1994, P.197.
402
Murielle DRAZIEN
[crit au tableau : unseen man, unseeing man]
C'est un terme, unseen man, qui est prsent dans le
texte original de JONES et qui est traduit en
franais trs exactement mais qui, forcment, manque
un petit peu de piquant.
Qu'y a-t-il chez la femme, qui corresponde la crainte
de castration chez l'homme ? Qu'est-ce qui diffrencie le
dveloppement de la femme homosexuelle de celui de la
femme htrosexuelle ? [Op. cit. p.399]
Voil les deux questions qu'Ernest JONES se pose et
que son article Early development of female sexuality paru
dans The International Journal of Psychoanalysis en
l927 vise lucider.
Trs vite, dans le fait de cerner la premire
question, JONES centre le problme autour du concept
de castration et c'est en ce point qu'il s'arrte
pour essayer d'laborer un concept plus concret et
plus satisfaisant au droulement d'un certain fil
conducteur de cet article qui est annonc ds le
premier paragraphe. C'est l que JONES voque des
notions de mystification et de prjugs chez les
auteurs crivant au sujet de la sexualit fminine
que les analystes diminuaient l'importance de
l'organe gnital fminin et avaient donc adopt une
position phallo-centrique, comme il dit propos de
ces questions.
Que ces fils conducteurs soient pour JONES l'occasion
de remettre en question tout le concept de
castration, en faisant jaillir ces points o il est
lui-mme insatisfait de la formulation donne alors
de ce concept, n'empchera pas que JONES s'y prend
403
lui-mme dans ce fil, aux divers moments o il parle
de la ralit biologique comme fondamentale.
Quand il souligne le rle primordial de l'organe
sexuel mle :
the all important part normally played in male
sexuality by the genital organ
quand il parle de la menace partielle que reprsente
la castration :
la castration n'est qu'une menace partielle, si
importante soit-elle, de la perte de capacit l'acte
sexuel et du plaisir sexuel . [p.401]
Quand il fait remarquer que la femme est sous une
dpendance troite l'gard de l'homme en ce qui
concerne sa gratification :
Pour des raisons physiologiques videntes, la femme est
beaucoup plus dpendante l'gard de son partenaire pour
sa gratification que l'homme, l'gard du sien. Vnus a
eu beaucoup plus d'ennui avec Adonis que Pluton n'en a eu
avec Persphone .
Enfin quand il prcise ce qui est pour lui la
condition mme de la sexualit normale,
pour ces deux cas, (en parlant des inversions) la
situation primordialement difficile, c'est l'union, simple
mais fondamentale, entre pnis et vagin. [p.400 ]
Le parti-pris inconscient, comme l'appela Karen
HORNEY, a contribu, nous dit JONES, considrer les
questions touchant la sexualit beaucoup trop du
point de vue masculin et donc jeter dans une
position de mconnu ce qu'il appelle les conflits
fondamentaux :
En essayant de rpondre cette question, c'est--dire
de rendre compte du fait que les femmes souffrent de cette
terreur au moins autant que les hommes, j'en vins la
conclusion que le concept de castration a, par certains
404
cts, entrav notre apprciation des conflits
fondamentaux .
Le concept, incontestablement plus gnral et plus
abstrait auquel JONES aboutit est celui d'aphanisis.
Cet aphanisis sera la disparition totale,
irrvocable, de toute capacit l'acte sexuel ou au
plaisir de cet acte. Ce serait donc la crainte -
dread en anglais, qui est encore plus - la crainte de
cette situation qui est commune aux deux sexes.
A propos d'aphanisis, nous avons pens que ce terme
ne pouvait correspondre, au niveau clinique rien
d'autre que la disparition du dsir tel que nous
l'entendons. A ce moment-l, la crainte d'aphanisis
se traduirait par la crainte de la disparition du
dsir ce qui nous parat l'envers d'une de ces
mdailles : ou bien, dsir de ne pas perdre le dsir,
ou bien dsir de ne pas dsirer.
En tout cas, JONES n'ira pas plus loin dans le
dveloppement de ce concept qu'il applique ces fins
utiles, et nous pouvons supposer qu'il ne suffisait
pas, ni lui-mme, ni une formulation plus
rigoureuse, de ce que reprsente la castration
fminine.
Nous suivons JONES jusqu' la deuxime question
maintenant, qu'il aborde par un aperu du
dveloppement normal de la fille, le stade oral, le
stade anal, l'identification la mre, au stade
bouche-anus-vagin, suivi bientt, comme il dit, par
l'envie du pnis.
En prcisant la distinction : d'envie de pnis, pr
et post oedipienne, ou auto et allorotique, JONES
rappelle la fonction dans la rgression comme dfense
contre une privation ce dernier stade, privation
ne jamais partager un pnis avec son pre dans le
cot, ce qui renverrait la petite fille sa premire
envie de pnis, c'est--dire d'avoir son propre pnis
elle.
C'est ce moment que la fillette doit choisir, point
de bifurcation entre son attachement incestueux au
pre et sa propre fminit. Elle doit renoncer ou
bien son objet ou bien son sexe, souligne JONES.
405
Il lui est impossible de garder les deux. Je crois
que a mrite ce moment-l, de vous lire le
paragraphe o il prcise :
Il n'existe que deux possibilits d'expression de la
libido dans cette situation et ces deux voies, peuvent
tre empruntes l'une et l'autre. La fille doit choisir
grosso modo entre abandonner son attachement rotique au
pre et l'abandon de sa fminit, c'est--dire son
identification anale la mre. Elle doit changer d'objet
ou de dsir. Il lui est impossible de garder les deux.
Elle doit renoncer soit au pre, soit au vagin - y compris
les vagins pr-gnitaux, dans le premier cas - les dsirs
fminins s'panouissent un niveau adulte, c'est--dire :
charme rotique diffus, narcissisme, attitude vaginale
positive envers le cot, culminant dans la grossesse et
laccouchement et sont transfrs des objets plus
accessibles. Dans le second cas, le lien avec le pre, est
conserv, mais cette relation d'objet est transforme en
identification c'est--dire en complexe du pnis. [p.405 ]
Les filles qui renoncent l'objet poursuivent un
dveloppement normal tandis que dans le deuxime cas,
o le sujet abandonne son sexe, le non-abandon de
l'objet se transforme en identification et c'est
celui-ci le cas de l'homosexuelle.
La divergence mentionne, qui, y a-t-il besoin de le
dire, est toujours une question de degr entre celles qui
renoncent leur libido d'objet, le pre et celles qui
renoncent leur libido de sujet, le sexe, se retrouve
dans le champ de l'homosexualit fminine. [p.406 ]
Donc, JONES opre une division l'intrieur du
groupe homosexuel. On peut, y distinguer deux grands
groupes :
Primo : les femmes qui conservent leur intrt pour les
hommes mais qui ont cur de se faire accepter par les
hommes comme tant des leurs. A ce groupe : appartient un
certain type de femmes qui se plaignent sans cesse de
l'injustice du sort de la femme et du mauvais traitement
des hommes leur gard.
Secundo : celles qui n'ont que peu ou pas d'intrt pour
les homes mais dont la libido est centre sur les femmes.
406
L'analyse montre que cet intrt pour les femmes est un
moyen substitutif de jouir de la fminit. Elles utilisent
simplement d'autres femmes comme exhibes leur place.
C'est nous qui soulignons maintenant que par la
premire division que JONES opre, ce sont dans ces
deux sous-groupes d'homosexuelles, toutes des femmes
ayant choisi de garder leur objet, le pre et de
renoncer leur sexe. C'est ici qu'il faut suivre
attentivement l'expos de JONES, pour voir ce qui se
passe :
Il est facile de voir que le premier groupe ainsi
dcrit, recouvre, le mode spcifique des sujets qui
avaient prfr abandonner leur sexe ; tandis que le
deuxime groupe correspond au sujet ayant abandonn
l'objet, le pre, et se substitue lui par
identification.
Alors, je rpte :
tandis que le deuxime groupe correspond au sujet ayant
abandonn l'objet, le pre. Les femmes appartenant au
second groupe s'identifient aussi avec l'objet d'amour
mais cet objet perd alors tout intrt pour elles. Leur
relation d'objet externe l'autre femme est trs
imparfaite car elle ne reprsente ds lors que leur propre
fminit au moyen de l'identification et leur but est d'en
obtenir par substitution la gratification de la part d'un
homme qui leur reste invisible (le pre incorpor en
elle).
Et voil l'homme qui leur reste invisible :
unseen man.
D'aprs ces descriptions, on ne peut que remarquer
que cet intrt pour les femmes, en quelque sorte
fuyant, semble porter sur un attribut sans qu'il y
ait de vritable relation d'objet. Que pourrait-on y
comprendre s'il s'agit l d'une identification
double, d'une part au pre, d'autre part l'amante ?
Nous proposons qu'il s'agit dans cet exemple d'une
opration symbolique.
407
Premirement : que l'amante est le symbole de la
fminit perdue plutt que la fminit laquelle le
sujet aurait renonc.
Deuximement : cet homme qui lui est invisible, the
unseen man, ce qui ne veut pas dire the unseeing man,
le pre ou plutt, ce qui, de lui, voit, ce qui de
lui est seeinq, l'il - symbole dj voqu par JONES
dans sa thorie du symbolisme et prcis par lui en
ce lieu comme phallique - est le vritable objet car
sa prsence est ncessaire, voire indispensable
l'accomplissement du rite destin rendre au pre ce
qu'il n'a pas donn.
Pour vous laisser une image trs saisissante de ce
type de relation, je voudrais vous lire un pisode
qui est vu par le narrateur, Marcel, dans
Du ct de chez Swann, dans un moment o lui, par le
hasard, si on veut, est aussi unseen d'ailleurs,
c'est--dire, il s'est cach, il est cach par les
circonstances et la scne se droule devant lui sans
qu'on sache qu'il est l.
videmment, toute la scne est intressante. Je vous
rapporte simplement quelques lignes :
Dans l'chancrure de son corsage de crpe Mlle Vinteuil
sentit que son amie piquait un baiser. Elle poussa un
petit cri, s'chappa, et elles se poursuivirent en
sautant, faisant voleter leurs larges manches comme des
ailes et gloussant et piaillant comme des oiseaux
amoureux. Puis Mademoiselle Vinteuil finit par tomber sur
le canap, couverte par le corps de son amie. Mais celle-
ci tournait le dos la petite table sur laquelle tait
plac le portrait de l'ancien professeur de piano.
LACAN : qui est son pre
Mademoiselle Vinteuil comprit que son amie ne le verrait
pas si elle n'attirait pas sur lui son attention et elle
lui dit, comme si elle venait seulement de le remarquer :
-oh, ce portrait de mon pre qui nous regarde. Je ne sais
pas qui a pu le mettre l ? J'ai pourtant dit vingt fois
que ce n'tait pas sa place.
408
Je me souviens que c'tait les mots que M. Vinteuil avait
dits mon pre propos du morceau de musique. Ce
portrait leur servait sans doute habituellement pour des
profanations rituelles car son amie lui rpondit par ces
paroles qui devaient faire partie de ses rponses
liturgiques :
- Mais laisse le donc o il est, il n'est plus l pour
nous embter. Crois-tu qu'il pleurnicherait et qu'il
voudrait te mettre ton manteau s'il te voyait l, la
fentre ouverte, le vilain singe.
Mademoiselle Vinteuil rpondit par des paroles de
reproche : Voyons, voyons
et plus loin :
Mais elle ne put rsister l'attrait du plaisir
qu'elle prouverait tre traite avec douceur par une
personne si implacable envers un mort sans dfense ; elle
sauta sur les genoux de son amie et lui tendit chastement
son front baiser comme elle aurait pu faire si elle
avait t sa fille, sentant avec dlices qu'elles allaient
ainsi toutes deux au bout de la cruaut en ravissant M.
Vinteuil, jusque dans le tombeau, sa paternit.
Et plus loin (cest le narrateur qui parle) :
je savais maintenant, pour toutes les souffrances
que pendant sa vie M. Vinteuil avait supportes
cause de sa fille, ce qu'aprs la mort il avait reu
d'elle en salaire.
409
LACAN
Merci Mademoiselle.
Bon. Mademoiselle DRAZIEN, en somme, vous a donn une
introduction, une introduction, ma foi, rapide.
Elle n'est pas et aprs tout, nous n'avons nullement
lui en faire reproche puisque c'est une
introduction. Elle a mis deux choses trs importantes
en relief concernant cet article qui, quoique court,
comporte certains dtours qu'elle a cru devoir
lider, sur, par exemple, l'ide de privation et
celle de frustration qui s'ensuit, les rapports de la
privation la castration, tous termes qui sont pour
nous - ceux tout au moins qui se souviennent de ce
que j'enseigne - d'une assez grande importance.
Mais elle n'a pas mal fait nanmoins puisque pour
vous, qui tes dans la position toujours difficile de
l'auditeur, ce qui est mis en relief ce sont deux
termes : d'une part la notion d'aphanisis et d'autre
part, la faon dont FREUD Non ! dont JONES, dans le
souci qu'il a de chercher ce qu'il en est de la
castration chez la femme, se voit reporter sur
certaines positions qui comportent des rfrences
qu'on peut qualifier, proprement parler, de
rfrences de structure.
Ces rfrences de structure, il est clair, - vous
vous reporterez cet article - qu'il ne sait pas les
organiser. Il ne sait pas les organiser en raison du
mme souci que celui qui guide son article sur le
symbolisme, savoir de pointer d'une faon qui soit
rigoureuse et valable, ce qui constitue les amarres
de la thorie freudienne de l'inconscient.
Le symbolisme a pris de toute une srie de fils qui
se sont dtachs du tronc freudien principal, la
valeur de quelque chose qui permet l'utilisation
symbolique, au sens courant du terme, des lments
mis en valeur par le maniement de l'inconscient.
410
Cette utilisation symbolique, celle qui fait que JUNG
voit dans le serpent le symbole de la libido, par
exemple, c'est quelque chose quoi FREUD s'est
oppos de la faon la plus ferme, en disant que le
serpent est, s'il est le symbole de quelque chose, il
est la reprsentation du phallus.
Moyennant quoi FREUD JONES ! - deux fois que je fais
le lapsus ! - JONES fait de grands efforts pour nous
montrer la mtaphore - puisqu'en fin de compte, c'est
bien cette rfrence linguistique qu'il est oblig
- pour nous montrer la mtaphore se dveloppant dans
deux sens. Dans un sens, de toujours plus grande
lgret de contenu
on ne peut pas se rfrer un autre registre,
encore que ce ne soit pas le terme qu'il emploie
mais il est forc d'en employer tellement
d'autres qui sont toutes qui sont tous du mme
ordre
savoir d'une sorte de rarfaction, de vidage ou
d'abstraction, ou de gnralisation, bref, de respect
dans cette sorte d'ordonnance, de hirarchie
concernant la consistance de l'objet qui est celle
d'une thorie enfin classique de la connaissance.
Que on voit bien que ce dont il s'agit, c'est de
nous montrer que le symbole n'a en aucun cas cette
fonction, que le symbole tout au contraire, est ce
quelque chose qui nous ramne ce qu'il appelle
- dans son langage et comme il peut - les ides
primaires, savoir quelque chose qui se distingue
par un caractre la fois de concret,
de particulier, d'unique, d'intressant, la totalit,
- si on peut dire - et la spcificit de l'individu
dans, sa vie mme, dirons-nous, pour ne pas employer
le terme que, bien entendu il vite, qui n'est autre
que le terme d'tre.
Il est bien clair pourtant que quand il fait
rfrence ces ides primaires, et qu'il y inscrit
justement, des termes concernant ce qui est l'tre,
savoir : la naissance, la mort, les relations avec
les proches par exemple, il dsigne lui-mme quelque
chose qui n'est pas un donn biologique,
411
mais bien au contraire, une articulation qui
transcende, qui transpose, qui transcrit ce donn
biologique, l'intrieur de conditions d'existence
qui ne se situent que dans des relations d'tre.
Toute l'ambigut de l'article sur le symbolisme de
JONES tient l.
Nanmoins, ce qu'il vise - en son effort
principalement pour montrer que ce dont il s'agit
dans le symbolisme - cerne quelque chose qu'il ne
sait pas dsigner mais qu'il cerne tout de mme, en
quelque sorte, du mouvement propre de son lan, de
son exprience lui, concrte, de ce dont il s'agit
dans l'analyse. Il arrive ce rsultat de mettre -
d'une faon tellement unique - en avant des symboles
qui tous sont, diffrents degrs, des symboles du
phallus, qu'il nous force bien nous poser la
question, en fin de compte, de ce que c'est que le
phallus dans l'ordre symbolique.
Il ne nous convainc pas, loin de l, que le phallus
est purement et simplement le pnis, mais il laisse
ouverte la question de la valeur centrale qu'ont un
certain nombre d'entits dont le phallus est celle
qui se prsente avec le maximum d'incarnation,
quoique ne se prsentant que derrire un voile, voile
qu'il n'a pas lev.
C'est pour ceci que je ferai reprendre cet article
par quelqu'un qui l'a prpar pour aujourd'hui mais
qui prfre, en somme de lui-mme, le remettre une
tape ultrieure, c'est--dire disons notre
prochain sminaire ferm. Je reprendrais,
l'occasion, en commentaire, les dtails de cet
article sur la thorie du symbolisme, mais je vous
avertis d'ores et dj qu'il y a un article, de moi,
qui est paru si mon souvenir est bon, dans
La psychanalyse numro six C'est le numro six o c'est
paru ?
SAFOUAN - Cinq !
Cinq sur la thorie du symbolisme chez JONES
145
.
145 crits p.697 ou t.2 p.175
412
Ce que nous faisons aujourd'hui a
par rapport ce que j'aurai dvelopper donc
dans les prochains sminaires sur la fonction de
l'objet(a)
une certaine valeur de je ne dirai pas
d'anticipation mais d'horizon. Car, en fin de compte,
il y a un rapport entre la place de l'objet(a) en
tant qu'elle est fondamentale, qu'elle nous permet,
dans un certain mode de structure qui n'a pas d'autre
nom que celui du fantasme, de comprendre la fonction
dterminante - dterminante la manire d'un support
ou d'une monture ai-je dit - qu'a dans la
dtermination de la refente du sujet, l'objet(a).
Cet objet(a) - comme je vous l'ai indiqu dans mon
discours de tout l'heure, et bien sr ce n'est pas
une nouveaut - se prsente sous, non pas quatre
formes, mais disons quatre versants, en raison de la
faon dont il s'insre sur deux versants d'abord, la
demande et le dsir.
Sur le versant de la demande, ce sont les objets que
nous connaissons sous les espces du sein - au sens
et dans la fonction qu'on lui donne dans la
psychanalyse - et de l'excrment ou encore, comme on
s'exprime, fces.
L'autre versant est celui qu'a la relation du dsir,
c'est donc une fonction d'un degr plus lev
je le fais remarquer en passant, la lecture tout
l'heure du texte franais qu'a faite
Mademoiselle GRAZIEN y rvle une inexactitude :
ce qui tait traduit par le dsir une certaine
place, savoir que lhomosexuelle tait amene
renoncer son dsir pour l'objet, pour ne pas
renoncer son sexe, est inexact, en anglais,
c'est the wish, et du moment que c'est the wish,
ce n'est pas le dsir, c'est le voeu ou la
demande.
Le dsir, nous en avons ici situ la place
topologique suffisamment par rapport la demande
pour que vous conceviez ce que je veux dire quand je
dis, je parle d'un autre versant, propos de la
fonction de deux autres objets (a), savoir du
regard et de la voix.
413
Dans les deux couples se fait une opposition qui, du
sujet l'autre peut se situer ainsi :
-demande de l'Autre : c'est l'objet(a) fces,
-demande l'Autre : cest l'objet(a) sein.
Eh bien, la mme opposition existe - quoiqu'elle ne
puisse que vous paratre encore puisque je ne vous
l'ai pas explique, plus obscure - il y a aussi
quelques formes, non pas l'obscurit n'est pas tant
sur le dsir de l'Autre - que vous sentirez dj
immdiatement support par la voix - que sur le dsir
l'Autre qui reprsente une dimension que j'espre -
propos du regard - pouvoir vous ouvrir.
Mais, au cur de cette fonction de l'objet(a), il est
clair que nous devons trouver ce qui est tout fait
central l'institution, l'instauration de la
fonction du sujet, c'est trs proprement parler, la
fonction que vient occuper la mme place, le
phallus qui, prcisment n'a absolument pas le mme
caractre concernant ce qu'on pourrait appeler comme
une question commune englobant dans sa parenthse
l'ensemble des objets en question. Il n'a pas il
n'entre pas comme organe, puisqu'en fin de compte,
dans tous ces cas - et si matriels que puissent vous
paratre deux d'entre eux - il s'agit bel et bien
dans tous les cas, d'un reprsentant organique.
Assurment, il semble dj moins substantiel, moins
saisissable, au niveau du regard et de la voix mais
a n'est nanmoins pas en raison simplement d'une
sorte de diffrence d'chelle - de diffrence
scalaire comme on dirait - dans le caractre
insaisissable, que nous trouvons ici le phallus. Le
phallus entre, comme tel, dans une certaine fonction
qu'il s'agit maintenant de dfinir et qui,
proprement parler, ne peut se dfinir que dans la
rfrence du signifiant.
La double dimension, qui se rvle ici est - vous le
verrez - quelque chose qui diffrencie le caractre
se drobant, le caractre insaisissable de la
substantialit de l'objet(a) quand il s'agit du
regard et de la voix.
414
Ce caractre se drobant, caractre insaisissable
n'est absolument pas de la mme nature quant ces
deux objets et quant au phallus.
Que se passe-t-il quand quelqu'un comme M. JONES
je le dis, nourri, inspir du style mme le plus
pur de la premire recherche analytique, quand la
valeur de dcouverte qu'avaient les ralits de
l'exprience, ne pouvait encore d'aucune faon,
tre rduite navait pas pu tre peu peu r-
aspir dans une srie de voies, de traces qui
reprsentent proprement parler, par rapport
cette exprience, une rationalisation et qui est
toute celle qui a fait se dvelopper la
psychanalyse dans une voie, qui, quelque titre
mrite d'tre situe dans quelque paralllisme
par rapport la rduction, si l'on peut dire
ducative qu'Anna FREUD a faite de la
psychanalyse au niveau des enfants.
Toute masque que puisse tre telle inflexion de
la psychanalyse au regard de ladulte, nous
pouvons dire que tout ce qui fait intervenir dans
l'tat actuel des choses, et tel que ceci a t
exprim, quelque rfrence que ce soit la
ralit ou encore l'institution d'un moi
meilleur ,moins distendu, plus fort comme on dit,
tout ceci ne consiste qu' avoir fait rentrer les
voies que l'analyse nous a permis d'imaginer,
dans le registre du dveloppement, dans le sens
d'une orthopdie, fondamentalement qui dissipe,
proprement parler, le sens de l'exprience
psychanalytique.
JONES n'en est certes pas l et le fait que ce qu'il
produit devant nous reprsente bien quelque chose qui
tend retrouver des points d'appui dans un certain
nombre de rfrences reues, c'est ceci que
Mlle DRAZIEN a fait allusion en parlant d'un certain
nombre de recours ce qu'on peut appeler un certain
nombre de prjugs scientifiques, primaut par
exemple, de la rfrence biologique, pourquoi
primaut ?
415
Il n'est absolument pas, bien entendu, question de la
ngliger ni mme de ne pas dire qu'en fin de compte,
elle est premire, mais assurment la poser
premirement comme premire, c'est l qu'est toute
l'erreur car ce dont il s'agit, l'occasion, c'est
de la prouver. Or, elle n'est pas prouve.
Elle n'est pas prouve au dpart, au moins quand nous
nous trouvons devant un phnomne aussi paradoxal que
la gnralit du complexe de castration pour autant
que gnralit veut dire aussi incidence dans les
deux sexes, les deux sexes ne se trouvant pas, par
rapport ce quelque chose qui se prsente d'abord et
d'une faon fondamentale, comme destinant la
structure de ce complexe de castration, comporte
quelque chose qui se rapporte une partie et une
partie seulement de l'appareil gnital : dans la
partie - qui vient s'offrir de faon manifeste et
visible et en quelque sorte prgnante, et d'un point
de vue de gestalt - qui est chez l'homme, le pnis.
Non pas privilge mais privilge qui prend une valeur
si l'on peut dire de phanie, de manifestation et o
c'est comme tel, semble-t-il, tout au moins au
premier abord, qu'il s'introduit, avec une valeur
prvalente.
Telle est en d'autres termes la fonction que va
prendre le complexe de castration si nous l'examinons
sous un certain biais. Eh bien, il est excessivement
remarquable que la premire dmarche de JONES, aille
dans le sens d'une subjectivation. Je donne ce mot
le poids qu'il peut prendre ici tant donn ce que
j'nonce de la dfinition du sujet depuis dj
presque deux ans, et depuis beaucoup plus longtemps,
bien sr, pour ceux qui viennent ici depuis plus ou
moins toujours.
Nous ne pouvons pas ne pas voir, si nous sommes dj
un peu rompus cette perspective, la relation qu'a
l'introduction par JONES du terme d'aphanisis,
propos du complexe de castration avec ce que je vous
ai reprsent de l'essence du sujet, savoir ce
fading, ce perptuel mouvement d'occultation derrire
416
le signifiant ou d'mergence intervallaire, qui
dfinit comme tel le sujet dans son fondement, dans
son statut, dans ce qui constitue l'tre du sujet.
Il y a quelque chose de tordu qui permet d'aborder,
d'une faon toute diffrente la relation
tre/non-tre
non pas d'une faon qui, en quelque sorte, s'en
extrait comme si un jugement pouvait quelque part
saisir la relation de l'tre et du non-tre, mais
d'une faon qui y est, en quelque sorte,
profondment implique
nous fait saisir que nous ne saurions d'aucune faon
spculer, raisonner, structurer tout ce qu'il en est
du sujet, sans partir de ceci que, nous-mmes comme
sujet, soyons impliqus dans cette profonde
duplicit, qui est la mme que le cogito cartsien
dgage, en se fixant sur un point de plus en plus
rduit l'idal, jusqu' tre, lui de nant, qui est
le je pense, je pense ne voulant rien dire lui tout
seul, ce qui permet d'carter, de diviser, de
montrer, quelle torsion il faut que nous supposions
que soit, en quelque sorte soumis cette subsistance
du sujet pour qu'il puisse apparatre dans une telle
perspective que l'tre est dissoci entre l'tre
antrieur la pense et l'tre que la pense fait
surgir.
L'tre du je suis de celui qui pense, l'tre qui
est amen l'mergence, du fait que celui qui pense
dit donc je suis .
L'aphanisis de JONES n'est absolument concevable que
dans la dimension d'un tel tre.
Car, comment lui-mme nous l'articule-t-il ?
Quel pourrait tre le recul de quoi que ce soit qui
ne soit pas de l'ordre du sujet par rapport une
crainte de perdre la capacit de (ce qui est dit en
anglais : Capacity) de
le terme sexual enjoyment je sais qu'il est trs
difficile de donner un support qui soit
quivalent notre mot franais jouissance ,
ce qu'il dsigne en anglais.
417
Enjoyment n'a pas les mmes rsonances que
jouissance et il faudrait en quelque sorte le
combiner avec le terme de lust qui serait, peut-
tre un peu meilleur.
Quoi qu'il en soit, cette dimension de la
jouissance
dont je vous ai marqu la dernire fois que nous
allions l'introduire, qu'elle est en quelque
sorte un terme qui pose par lui-mme des
problmes essentiels, que nous ne pouvions
vritablement introduire qu'aprs avoir donn son
statut au je suis du je pense
la jouissance, pour nous, ne peut tre qu'identique
toute prsence de corps, la jouissance ne
s'apprhende, ne se conoit, que de ce qui est corps.
Et d'o jamais ne pourrait-il surgir d'un corps
quelque chose qui serait la crainte de ne plus
jouir ? S'il y a quelque chose que nous indique le
principe du plaisir, c'est que s'il y a une crainte,
c'est une crainte de jouir.
La jouissance tant proprement parler une ouverture
dont ne se voit pas la limite, et dont ne se voit pas
non plus, la dfinition.
De quelque faon qu'il jouisse, bien ou mal, il
n'appartient qu' un corps de jouir ou de ne pas
jouir. C'est tout au moins la dfinition que nous
allons donner de la jouissance. Car pour ce qu'il en
est de la jouissance divine, nous reporterons, si
vous le voulez bien, cette question plus tard !
Non pas qu'elle ne se pose pas. Il nous semble qu'il
y a un dfil qu'il est important de saisir, c'est
ceci : comment peuvent s'tablir les rapports de la
jouissance et du sujet ?
Car le sujet dit je jouis .
Le centre - que je ne dirais pas implicite, parce
qu'aussi bien, il est formul, il est dit en clair
dans FREUD - le centre de la pense analytique, c'est
qu'il n'y a rien qui ait plus de valeur pour le sujet
que l'orgasme. L'orgasme est l'instant o est ralis
un sommet privilgi de bonheur.
418
Ceci mrite rflexion. Car en plus, il n'est pas
moins frappant qu'une pareille affirmation comporte
en quelque sorte par elle-mme une dimension
d'accord. Mme ceux qui font quelque rserve sur le
caractre plus ou moins satisfaisant de l'orgasme
dans les conditions o il nous est donn d'y
atteindre, n'en iront pas pour autant ne pas penser
que si cet orgasme est insuffisant, il n'y en a pas
un plus vrai, plus substantiel. Qu'ils appellent de
quelque nom qu'il s'agisse : union, voie unitive,
fusion, totalit, perte de soi, quoi que vous
voudrez, ce sera toujours de l'orgasme qu'il s'agira.
Est-ce que, il ne nous est pas possible - mme
garder accroch quelque point d'interrogation ce
qui est l pris comme point de dpart - est-ce qu'il
ne nous est pas possible ds maintenant de saisir
ceci : que nous pouvons considrer l'orgasme dans
cette fonction, disons mme provisoire, comme
reprsentant un point de croisement, ou encore un
point dmergence, un point o prcisment la
jouissance, je dirais, fait surface.
Ceci prend pour nous, un sens privilgi de ceci que,
l o elle fait surface, la surface par excellence,
celle que nous avons dfinie, que nous essayons de
saisir, comme structurale, comme celle du sujet. Je
vous indique aussitt les repres que ceci peut
prendre dans, pourquoi pas, ce que nous appellerons
notre systme. Je ne refuse pas le mot systme
conditions que vous appeliez systme la faon dont je
systmatise les choses et qui est prcisment faite
de rfrences topologiques.
Nous pouvons bien considrer la jouissance, celle qui
est dans l'orgasme, comme quelque chose qui
s'inscrira par exemple d'une forme particulire qu'en
prendrait notre tore, si notre tore c'est ce cycle du
dsir qui s'accomplit par la suite des boucles
rptes d'une demande.
419
Il est clair qu'en fonction de certaines dfinitions
de l'orgasme comme point terminal, comme point de
rebroussement comme vous voudrez, ce sera d'un tore
peu prs fait ainsi qu'il s'agira :
mais ici [ J ] il a une valeur punctiforme.
En d'autres termes, toute demande s'y rduit zro,
mais il n'est pas moins clair qu'il blouse le dsir.
C'est la fonction, si l'on peut dire, idale et nave
de l'orgasme.
Pour quiconque essaie de la dfinir partir de
donnes introspectives, c'est dans ce court moment
d'anantissement
moment d'ailleurs punctiforme, fugitif, qui
reprsente la dimension de tout ce qui peut tre
le sujet, dans son dchirement, dans sa division
que ce moment de l'orgasme - j'ai dit :
de l'orgasme - se situe.
Il est clair que c'est au titre de jouissance, dont
pour nous, il ne suffit pas de constater que dans ce
moment d'idal - j'insiste sur idal - il est ralis
dans la conjonction sexuelle, pour que nous disions
qu'il est immanent en la conjonction sexuelle et la
preuve c'est que ce moment d'orgasme est exactement
quivalent dans la masturbation, je dis : en tant
qu'il reprsente ce point terme du sujet.
420
Nous n'en retenons donc, dans cette fonction, que le
caractre de jouissance, et jouissance qui n'est
point encore dfinie ni motive.
Mais ceci nous permettra de comprendre condition de
nous apercevoir de l'analogie qu'il y a entre la
forme de la bouteille de KLEIN, si j'ose dire si
tant est qu'on puisse parler de la forme, mais enfin,
puisque je la dessine, elle a une forme, je la
reprsente sous la forme inverse par rapport ce
que vous voyez d'habitude, dans le dessin que j'ai
appel son ouverture, son cercle de rversion, la
bouteille de KLEIN apparat en haut comme le point de
tout l'heure.
Ce cercle de rversion o je vous ai dj appris
trouver le point nodal de ces ceux versants du sujet
tels qu'ils peuvent se conjoindre de l'affrontement
de la couture de l'tre de savoir l'tre de vrit,
je vous ai aussi dit
146
que c'tait l la place o nous
devons inscrire, prcisment comme conjonction de
l'un l'autre ce que nous appelons le symptme.
Et c'est un des fondements les plus essentiels ne
pas oublier de ce que FREUD a toujours dit de la
fonction du symptme, c'est qu'en lui-mme, le
symptme est jouissance.
146 Cf Sminaire Problmes cruciaux13-01, 20-01, 27-01.
421
Il y a donc d'autres modes d'mergence,
structuralement analogues de la jouissance au niveau
du sujet, que l'orgasme.
Je n'ai pas besoin - ce serait facile mais le temps
m'en empche - de vous rapporter le nombre de fois o
FREUD a mis en valeur l'quivalence de la fonction de
l'orgasme avec celle du symptme. Qu'il ait tort ou
raison est une autre question que de savoir ce qu'il
veut dire en cette occasion, ce que nous, nous
pouvons ldessus en construire.
Alors, il conviendrait peut-tre d'y regarder deux
fois avant de faire quivaloir l'orgasme et la
jouissance sexuelle. Que l'orgasme soit une
manifestation de la jouissance sexuelle chez l'homme
- et singulirement complique - de la fonction qu'il
vient occuper dans le sujet, c'est bien ce quoi
nous avons faire et nous aurions tout fait tort
de collaber, en quelque sorte, comme une seule et
mme ralit, ces trois dimensions.
Car c'est a qui est proprement parler
rintroduire, sous une forme dangereusement masque,
et par-dessus le march, ridicule, les vieilles
implications du mysticisme auxquelles j'ai fait
allusion tout l'heure, dans le domaine d'une
exprience qui ne les ncessitent nullement.
Un pote autrefois
147
, qui a dit post-cotum animal
triste ajoutait (parce que a, on l'oublie toujours)
prater mulierem gallumque, mis part la femme et les
coqs.
Chose curieuse, depuis que ce que j'appelle la
mystique psychanalytique existe, on n'est plus triste
aprs le cot. Je ne sais pas si vous avez jamais
remarqu a mais c'est un fait. Les femmes, bien sr,
dj n'taient pas tristes mais puisque les hommes
l'taient, c'est curieux qu'ils ne le soient plus.
Par contre, quand les femmes ne jouissent pas, elles
deviennent extraordinairement dprimes, alors que
jusque l elles s'en accommodaient extrmement bien.
Voil ce que j'appelle l'introduction de la mystique
psychanalytique.
147 Claude Galien, L'me et ses passions, Belles lettres, 1995. post coitum omne animal triste est , sive gallus et mulier .
422
Personne n'a encore dfinitivement prouv qu'il
faille tout prix qu'une femme ait un orgasme pour
remplir son rle de femme.
Et la preuve c'est qu'on en est encore ergoter sur
ce qu'il est, ce fameux orgasme chez la femme.
Nanmoins, cette mtaphysique pris une telle
valeur, je connais un trs grand nombre de femmes qui
sont malades de ne pas tre sres qu'elles jouissent
vraiment, alors qu'en somme elles ne sont pas si
mcontentes que a de ce qu'elles ont et que, si on
ne leur avait pas dit que c'tait pas a, elles ne
s'en proccuperaient pas.
Ceci ncessite qu'on mette un petit peu les points
sur les i concernant ce qu'il en est de la jouissance
sexuelle. Si on pose d'abord que ce qui nous
intresse au premier plan c'est de savoir ce qu'il en
est au niveau du sujet, c'est une premire faon
d'assainir la question. Mais on pourrait aussi se
poser la question de savoir ce qu'il en est au niveau
de la conjonction sexuelle, parce que l, il est trs
remarquable que c'est un phnomne bien trange que
nous parlons toujours comme si, du seul fait que la
diffrence sexuelle existe chez le vivant avec ce
qu'elle ncessite de conjonction, l'accomplissement
de la conjonction s'accompagnait d'une jouissance en
quelque sorte univoque, et univoque en ce sens que
nous devrions, tout simplement l'extrapoler de ce
que, nous, les humains, ou si vous voulez, les
primates plus particulirement volus, nous en
connaissons de cette jouissance.
Eh bien, je ne vais pas entrer dans ce chapitre
aujourd'hui parce qu'il est trs curieux qu'il ne
soit jamais trait. Enfin c'est un fait qu'il ne
l'est pas. Mais enfin il est tout fait clair que
tout d'abord, il est impossible de dfinir, de
saisir, quelques signes de ce qu'on pourrait appeler
orgasme chez la plupart des femelles dans le domaine
animal.
Pour une ou deux espces o on le peut, qui ne font
justement que montrer qu'on pourrait trouver des
signes s'il y en avait puisque quelquefois on en
trouve, il est tout fait clair que partout ailleurs
423
on n'en trouve pas, en tout cas de signes objectifs
de l'orgasme chez la femelle.
Alors, puisqu'on pourrait en trouver et qu'on n'en
trouve pas, c'est quand mme quelque chose de nature
vous jeter un petit doute sur les modalits de la
jouissance dans la conjonction sexuelle.
Je ne dis pas, je ne vois pas pourquoi j'excepterai
la conjonction sexuelle de la dimension de la
jouissance qui me parat une dimension absolument
coextensive celle du corps.
Mais que ce soit celle de l'orgasme, a ne semble
nullement oblig. C'est peut-tre d'une nature toute
diffrente et la preuve d'ailleurs, c'est justement
l o elle est la plus impressionnante la conjonction
sexuelle, l o elle dure une dizaine de jours, entre
les grenouilles par exemple, qu'on voit bien que ce
dont il s'agit, c'est d'autre chose que de l'orgasme.
C'est quand mme trs important.
Nous sommes ici pleins de mtaphores. La tumescence,
la dtumescence est une de celles qui me paraissent
les plus extravagantes. Il s'agit de manifester dans
la suite des comportements ce qu'on pourrait appeler
par rapport la conjonction un comportement
ascendant ou comportement d'approche, suivi d'un
comportement de rsolution des charges aprs lequel
se produira la sparation.
Au mode de l'existence d'un organe rectile qui est
trs loin d'tre universel, il y a des animaux, je
ne vais pas m'amuser faire ici pour vous de la
biologie mais je vous prie d'ouvrir les gros traits
de zoologie - il y a des animaux qui ralisent la
conjonction sexuelle l'aide d'organe de fixation
parfaitement non tumescibles puisque ce sont purement
et simplement des crochets.
Il parait bien vident que l'orgasme, dans ces cas,
s'il existe, doit prendre, mme chez le mle, une
toute autre apparence dont rien ne dit par exemple,
qu'il serait susceptible de quelque subjectivation.
424
Ces distinctions me paraissent importantes
introduire parce que si JONES, au dpart, en quelque
sorte, s'carte et s'tonne et c'est ainsi qu'il
introduit sa notion de l'aphanisis, le caractre
distinct en somme qu'il y a entre l'ide de la
castration telle qu'elle se substantifie dans
l'exprience, savoir la disparition du pnis et de
quelque chose, qui lui paraisse tout ce qu'il y a de
plus important, savoir une disparition mais qui
n'est pas celle du pnis, qui pour nous ne peut tre
que celle du sujet et qu'il s'imagine pouvoir tre la
crainte de la disparition du dsir, alors que ceci
est en quelque sorte une contradiction dans les
termes, car le dsir prcisment se soutient de la
crainte de se perdre lui-mme, qu'il ne saurait y
avoir d'aphanisis du dsir, il ne saurait y avoir
dans un sujet de reprsentation de cette aphanisis
pour la raison que le dsir en est soutenu.
Le persvrer dans l'tre spinozien est le mme texte
et le mme thme qui dit :
le dsir est l'essence de l'homme
148
.
L'homme persvre dans l'tre comme dsir. Et il ne
saurait s'vader d'aucune faon de ce soutien du
dsir. Il y a prcisment l'ambigut de pouvoir
comporter sa propre retenue et sa propre crainte
d'tre face de dfense en mme temps que
face de suspension vers la jouissance.
Alors est-ce que ne prend pas ici, toute sa valeur,
l'autre bout de l'arc, de la trajectoire qu'accomplit
JONES pour nous - quand, trs fermement et combien
juste titre puisqu'il s'agit d'introduire les choses
au niveau du sujet - il nous met, pour ce qui est de
la femme, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, au cur
de la faon dont peut se prsenter pour elle
l'impasse subjective.
148 Spinoza, Ethique, Editions de lclat, trad Misrahi, 2005. Trad. SAISSET: PROPOSITION XVIII :
Le dsir qui provient de la joie est plus fort, toutes choses gales d'ailleurs, que le dsir qui provient de la tristesse.
DMONSTRATION Le dsir est l'essence mme de l'homme (par la Df. 1 des pass.), c'est--dire (en vertu de la Propos. 7, part.
3) l'effort par lequel l'homme tend persvrer dans son tre. C'est pourquoi le dsir qui provient de la joie est favoris ou
augment par cette passion mme (en vertu de la Df. de la joie, qu'on peut voir dans le Schol. de la Propos. 11, part. 3).
425
Oppos au couple fils-mre, d'o est parti, non sans
raison toute l'exploration analytique, il nous parle
du couple pre-fille. Et que nous dit-il ?
Tout part ici d'une privation. L'inceste pre-fille,
nous savons, quant nous, de toute notre exprience,
qu'il est par ses consquences analytiques - je ne
peux pas les dfinir autrement, disons nvrosantes -
mais le terme n'est pas suffisant puisque a va
jusqu' avoir des consquences psychosantes - il est
infiniment moins dangereux, il l'est mme, dangereux,
au degr zro au regard de l'inceste mre-fils qui a
toujours les consquences ravageantes auxquelles je
fais allusion.
Au niveau du couple pre-fille, la fonction de
l'interdit - telle qu'elle s'exerce dans ses
consquences dialectiques, dans ce qu'on appelle
l'interdit fondamental de l'inceste qui est
l'interdit de la mre - prend une forme simplifie
qui met bien en valeur la fonction privilgie de la
femme au regard de la conjonction sexuelle. Car si la
spcificit d'une certaine sorte de vivant est qu'un
organe la fois rectile et comme tel privilgi
comme support de la jouissance, en soit
l'ambocepteur, eh bien, qu'est-ce que a veut dire ?
C'est que pour elle, il n'y a pas de problme :
faire l'amour, si les choses avaient une valeur
absolue bien sr, est forcment alloplastique, si je
puis dire, implique qu'elle aille celui qui l'a.
Si elle n'avait pas quelques-unes des proprits du
petit bonhomme il n'y aurait aucun problme. Le petit
bonhomme en a d'autres prcisment en ceci qu'il peut
jouir de lui-mme exactement comme un petit singe.
La question serait donc toute simple mais il ne
s'agit pas de a, prcisment parce qu'il y a le
langage et la loi - le pre est interdit - et par
cette voie entre en fonction le problme. 0r qu'est-
ce que nous dit JONES ? Qu'est-ce qu'il nous crie
tue-tte en nous rendant compte de son exprience ?
426
Qu'est-ce qu'il nous dit si ce n'est que l encore,
la femme va garder son avantage, va tre gagnante,
mais il faut voir comment et pour voir comment, il ne
faut pas garder en la tte tous ces prjugs .
Voyons ce qu'il nous dit. Il faut que la femme
choisisse entre son sexe et son objet.
Elle renonce l'objet paternel et elle va garder son
sexe. Il n'existe que deux possibilits d'expression
de la libido dans cette situation et ces deux voies
peuvent tre empruntes l'une et l'autre.
Grosso modo, entre abandonner son attachement
rotique au pre et l'abandon de sa fminit. Elle
doit changer d'objet ou de dsir. Et que va-t-il nous
dire de ce qu'il en est ce niveau, voyons,
dcrivez-nous exactement, Mademoiselle DRAZIEN,
dites-moi exactement la place du paragraphe o il
nous dcrit
Voil :
Dans le premier cas, les dsirs fminins s'panouissent
un niveau adulte, c'est--dire, charme rotique diffus,
il souligne : narcissisme . [p.405]
Qu'est-ce dire ? C'est que JONES
149
, ici, de son
exprience, la premire chose qu'il a mettre en
avant, quant ce qui rsulte du choix que je ne
qualifierai pas de normal mais de lgal - celui qui
renonce l'objet paternel pour conserver son sexe en
somme, c'est de cela qu'il s'agit - eh bien, ceci
veut dire qu'il ne sert rien de renoncer l'objet
pour conserver quelque chose, puisque ce quelque
chose qu'on veut conserver au prix d'une
renonciation, c'est prcisment cela qu'on perd.
Car, qu'est-ce qu'a faire avec l'essence de la
fminit le charme rotique diffus qui consiste dans
le maniement de l'attirail narcissique, sinon trs
prcisment ce que Madame Joan RIVIRE a pingl
comme la fminit au titre de mascarade ?
149 lapsus de J. Lacan : Freud
427
Et ceci doit bien reflter quelque chose, c'est que,
prcisment partir d'un tel choix, la femme a
prendre la place - pour des raisons qu'il s'agit pour
nous de prciser - de l'objet(a).
Dans la perspective paternelle, et patriarcalisante,
la femme, ne d'une cte de l'homme est un objet(a).
Se soumettre la Loi pour conserver son sexe, non
seulement ne lui vite pas de le perdre, mais le
ncessite.
Au contraire - ce n'est pas moi qui le dis, c'est
JONES - dans l'autre cas, conservation de l'objet,
c'est--dire du pre, quel va tre le rsultat. Le
rsultat c'est le choix homosexuel
je le rpte je ne puis faire plus aujourd'hui
que de dire : c'est JONES qui le dit. Et aprs
tout, toute notre exprience derrire, y compris
l'pinglage un petit peu incomplet parce que
lid de toute la prsence de Proust qui lie ce
cas, avec tout le caractre divinatoire qu'a son
intuition et son art mais qu'importe !
c'est dans l'autre cas, savoir pour autant que
l'objet pre est conserv que la femme trouve quoi ?
Ce que dit JONES donc, savoir : sa fminit.
Car dans toute attitude ou fonction homosexuelle, ce
que la femme trouve, la place de l'objet et on dit
que c'est la place de l'objet primordial, c'est sa
fminit.
Et alors, deuxime temps de ce qui se passe
l'intrieur de ce second choix. Ici les termes de
JONES - malgr lui - ne sont pas quivoques. C'est de
l'accentuation de la fonction de ce dont il s'agit,
savoir un certain objet, et cet objet comme perdu,
que le choix va se faire, soit que cet objet devienne
objet de revendication, et que la prtendue
homosexuelle devienne une femme en rivalit avec les
hommes et revendiquant d'avoir comme eux le phallus,
soit que dans le cas de l'amour homosexuel, ce soit
au titre de ne pas l'avoir qu'elle aime, c'est--
dire, de raliser ce qui est en somme le sommet de
l'amour, de donner ce qu'elle n'a pas.
428
De sorte qu'en fin de compte, nous n'aurions, et
aprs tout pourquoi ne pas l'admettre, de jouissance
de la fminit comme telle que de ce dpart
homosexuel qui ne fait simplement qu'illustrer la
fonction mdiatrice que prend ce phallus qui alors
nous permet de dsigner sa place.
Car si ce dont il s'agit quant au statut du sujet
c'est de savoir ce que l'tre perd d'tre, tre
celui qui parle ou qui pense, il s'agit aussi de
savoir ce qui vient prendre la place de cette perte
quand il s'agit de jouir.
Et que l'organe privilgi de la jouissance y soit
employ, quoi de plus naturel, c'est, si j'ose dire,
ce que l'homme a sous la main. Mais alors, les choses
se passent deux degrs. Cet organe, comme tout
organe, on l'emploie une fonction. Loin que la
fonction cre l'organe, il y a un tas d'animaux qui
ont des organes dont ils n'ont certainement pendant
longtemps jamais su que faire, jusqu' ce qu'ils
aient trouv un truc pour l'utiliser. Je vous en
donnerai de nombreux. Naturellement, ce n'est pas des
organes absolument comme le foie ou le cur. Il y en
a un qui a une petite scie dans l'sophage. il faut
se donner tellement de mal pour comprendre ce qu'il
peut en faire qu'on admire que lui ait russi en
faire quelque chose. Ben, c'est pareil. C'est avec ce
pnis qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus
intressant savoir un signifiant, un signifiant de
la perte qui se produit au niveau de la jouissance de
par la fonction de la loi.
Et ce qui est important, a n'est pas sa fonction
comme signifiant. Quand vous aurez regard d'un petit
peu plus prs que la plupart de vous ne le font ce
qu'on appelle dans le langage les morphmes, vous
saurez la fonction qu'il y a ce qu'on appelle le
cas ou la forme non marque. Il pourrait y avoir l
une dsinence ou une flexion qui indiquerait que
c'est le futur, le pass, le substantif, le partitif
150
ou le torsif.
150 Empl. subst. masc. sing. valeur de neutre. Catgorie grammaticale qui exprime la partie oppose au tout.
429
Et que a a un sens qu'il n'y ait justement pas
cette place de marque. L est l'essence de la
fonction de signifiance et si la femme garde,
conserve, port une puissance suprieure ce que lui
donne de n'avoir pas le phallus, c'est justement de
pouvoir faire de cette fonction du phallus le parfait
accomplissement de ce qu'est au cur de la castration
le mot phallus, c'est--dire la castration elle-mme,
de pouvoir en porter la fonction de signifiance en ce
point d'tre non marque.
C'est l-dessus que je terminerai aujourd'hui,
certainement forc d'abrger tant donn l'heure.
Je pense tout au moins, pour ceux qui sont ici et
dont je dsire qu'ils saisissent tout
particulirement o va nous mener la r-mergence de
ce complexe de castration dont plus personne ne parle
car il est assez frappant que dans le dernier article
auquel je vous ai dit de vous reporter ce soit un
pre dominicain, ni analys, ni analyste lui non
plus, qui fasse remarquer que dans un certain livre,
on ne parle absolument pas du complexe de castration.
Ce n'est pas tonnant. Je ne lui ai pas appris ce que
c'tait. Il ne peut pas le savoir.
Mais j'espre qu'avec - je pense - suffisamment de
temps, c'est--dire pas plus que la fin de l'anne,
nous y aurons un peu avanc.
Table des sances
430
04 Mai l966 Table des sances
Il s'agit pour nous de situer notre topologie : de
nous situer, nous analystes, comme agissant en elle.
Dans une runion ferme en un tout petit groupe,
quelqu'un posait rcemment la question, propos de
ce que j'ai dit de cette topologie : qu'elle n'est
pas une mtaphore . Qu'en est-il ? Que signifie de
nous situer comme sujets dans une rfrence qui n'est
pas mtaphorique. Je n'ai pas rpondu : celui qui me
questionnait n'avait pas t prsent au dernier
sminaire ferm et la rponse elliptique que j'aurais
pu donner : nous affronter la jouissance aurait
t une rponse qui n'aurait pas t suffisamment
commente.
tre situ dans ce qui n'est plus la mtaphore du
sujet c'est aller chercher les fondements de sa
position, non point dans aucun effet de
signification, mais dans ce qui rsulte de la
combinatoire elle-mme.
Qu'en est-il exactement du sujet, dans sa position
classique, de ce lieu ncessit par la constitution
du monde objectif ? Observez qu' ce sujet pur - ce
sujet dont les thoriciens de la philosophie ont
pouss jusqu' l'extrme la rfrence unitaire - ce
sujet, dis-je, on n'y croit pas tout fait et pour
cause. On ne peut croire qu' lui - du monde - tout
soit suspendu. Et c'est bien ce en quoi consiste
l'accusation d'idalisme.
C'est ici que la structure visuelle de ce sujet doit
tre explore. Dj, j'ai approch ce que, de
matire, nous apporte notre exprience analytique, au
premier chef : l'cran, l'cran que notre exprience
analytique nous apprend comme tant le principe de
notre doute, ce qui se voit - non pas rvle - mais
cache quelque chose. Cet cran, pourtant, supporte,
pour nous tout ce qui se prsente. Le fondement de la
surface est au principe de tout ce que nous appelons
organisation de la forme, constellation.
431
Ds lors tout s'organise en une superposition de
plans parallles, et s'instaurent les labyrinthes
sans issue de la reprsentation comme telle.
Dans un livre que j'ai conseill la plupart de ceux
qui sont ici
puisque aussi bien, cette assistance n'est pas
beaucoup plus tendue que celle que j'ai eue la
dernire fois
un livre qui s'appelle Les paradoxes de la conscience,
de Monsieur RUYER, vous verrez la consquence de ce
renvoi structural.
Tout ce que nous concevons comme correspondance point
par point de ce qui est d'une surface sur une autre,
s'y image de la reprsentation d'un point dont les
rayons partants traversent ces deux plans parallles
y manifestant dune trace une autre de celle sur un
plan au plan correspondant, une fondamentale
homologie, de sorte que, de quelque faon que nous
manipulions le rapport de l'image l'objet, il en
rsulte qu'il faut bien qu'il y ait quelque part, ce
fameux sujet qui unifie la configuration, la
constellation pour la limiter quelques points
brillants, qui, quelque part l'unifie, ce quelque
chose en quoi elle consiste.
D'o l'importance du sujet. Mais cette fuite dans une
unit mythique o il est facile de voir l'exigence du
pur esprit unificateur, la voie, la voie par laquelle
je vous mne
qui est proprement ce qu'on appelle mthode
aboutit cette topologie qui consiste en cette
remarque :
que ce n'est point rechercher ce qui va
correspondre cette surface au fond de l'il qui
s'appelle la rtine, ou aussi bien toute autre,
quelque point o se forme l'image, qu'il s'agit de se
reporter comme constituant l'lment unificateur.
Bien sr, ceci part de la distinction cartsienne de
l'tendue et de la pense.
432
Cette distinction suppose l'tendue, soit l'espace,
comme homogne en ce sens impensable qu'il est, comme
dit DESCARTES, tout entier concevoir comme partes
extra partes mais ceci prs, qui est voil, dans
cette remarque, c'est qu'il est homogne : que chaque
point est identique tous les autres tout en tant
diffrent, ce qui est proprement ce que veut dire
l'hypothse, savoir que toutes ses parties se
valent.
Or, l'exprience de ce qu'il en est de cette
structure de l'espace
non point quand nous le distinguons de la pense,
de la pense en tant que la supporte uniquement
et fondamentalement la combinatoire signifiante
que cet espace n'en est effectivement point
sparable, qu'il en est, au contraire, intimement
cohrent, qu'il n'y a nul besoin d'une pense de
survol pour la ressaisir en cette cohrence
ncessaire, que la pense ne s'y introduit pas d'y
introduire la mesure, une mesure, en quelque sorte,
applicable, arpenteuse qui loin de l'explorer, le
btit.
J'ai dsign l l'essence de ce qu'il en est du
premier pas de la gomtrie, comme son nom de
gomtrie en vhicule encore la trace, de la
gomtrie grecque euclidienne, entirement fonde
prcisment sur ce thme d'une mesure introduite, o
se cache que ce n'est point la pense qui la
vhicule, mais proprement parler ce que les Grecs
ont eux-mme nomm mesure.
L'homme est la mesure de toute chose [ Protagoras ]
c'est--dire son corps, le pied, le pouce, et la
coude. Or, le progrs de la pense reste intitule
gomtrisante - et sans doute n'est ce pas pour rien
que more geometrico a toujours paru l'idal de toute
dduction de la pense - le progrs, dis-je, de cette
gomtrie nous montre l'mergence d'un autre mode
d'abord, o tendue et combinatoire se nouent d'une
faon troite et qui est proprement parler, la
gomtrie projective.
433
Non point galit, mesure, effet de recouvrement,
mais comme vous vous en souvenez encore, effort
souvent pnible pour fonder les premires dductions
de la gomtrie, rappelez-vous du temps o on vous
faisait passer la muscade d'un retournement sur le
plan : Dieu sait que c'est l opration qui ne
semblait pas implique dans les prmices pour fonder
le statut du triangle isocle.
Dplacement, translation, manipulation, homothtie
mme : tout ce jeu partir duquel se dploie en
ventail la dduction euclidienne, se transforme
proprement parler, dans la gomtrie projective
justement d'introduire de figure figure la fonction
de l'quivalence par transformation.
Singulirement ce progrs se marque historiquement
par la contribution d'artistes proprement parler,
savoir ceux qui se sont intresss la perspective.
La perspective n'est pas l'optique.
Il ne s'agit point, dans la perspective, de
proprits visuelles mais prcisment de cette
correspondance de ce qui s'tablit concernant les
figures qui s'inscrivent dans une surface, celles
qui, dans une autre surface sont produites de cette
seule cohrence tablie de la fonction d'un point
partir duquel les lignes droites conjoignent ce point
aux articulations de la premire figure, se trouvent,
traverser une autre surface, faire apparatre une
autre figure.
Nous retrouvons l, la fonction de l'cran.
Et rien n'est impliqu que d'une figure l'autre
apparaisse une relation de ressemblance ou de
similitude, mais simplement de cohrence que nous
pouvons dfinir entre les deux. L'cran, ici, fait
fonction de ce qui s'interpose entre le sujet et le
monde. Il n'est pas un objet comme un autre. Il s'y
point quelque chose.
434
Avant de dfinir ce qu'il en est de la
reprsentation, l'cran dj nous annonce,
l'horizon, la dimension de ce qui, de la
reprsentation, est le reprsentant.
Avant que le monde devienne reprsentation, son
reprsentant
j'entends le reprsentant de la reprsentation
merge.
Je ne me priverai pas d'voquer ici une premire
fois, fusse pour y revenir, une notion qui, quoique
prhistorique ne saurait d'aucune faon passer pour
archologique en la matire.
L'art parital
celui que nous trouvons prcisment au fond de
ces espaces clos qu'on appelle des cavernes, est-
ce que, dans son mystre, dont le principal est
assurment que nous restons encore dans
l'embarras quant savoir jusqu' quel point ces
lieux taient clairs : ils ne l'taient qu'
l'orifice, jusqu' quel point ces lieux taient
visits : ils semblent l'avoir t rarement, si
nous en faisons foi aux traces que nous pouvons
reprer sous la forme de traces de pas dans des
lieux qui, pourtant, sont favorables en porter
les marques
l'art parital semble nous reporter rien de moins
que ce qui, plus tard, s'nonce dans le mythe
platonicien de la caverne, qui prendrait l bien
d'autres portes en effet que mtaphorique.
Si c'est au sein d'une caverne que PLATON tente de
nous porter pour faire surgir, pour nous,
la dimension du rel, est-ce un hasard si sans doute
ce qui se trouve sur ces parois, o les rcentes
explorations par des mthodes enfin scientifiques
et qui, devant ces figures ne s'essoufflent plus
imaginer l'homme des premiers temps dans je ne
sais quelle anxit de rapporter suffisamment
pour le repas de midi sa bourgeoise, cette
exploration qui, elle, se portant non pas sur
l'interprtation imaginative de ce qu'il peut en
tre du rapport d'une flche et d'un animal
435
surtout quand il apparat que la blessure porte
les traces les plus videntes d'tre une
reprsentation vulvaire
cette mthode
qui a fait entrer en jeu avec Monsieur
LEROY-GOURAN
151
l'appareil d'un fichier soign,
voire l'usage d'une machine lectronique
nous reprsente que ces figures ne sont pas rparties
au hasard et que la frquence constante, univoque des
cerfs l'entre, des bisons au milieu, nous
introduit en quelque sorte directement, encore que M.
LEROY-GOURHAN, et pour cause, n'use pas de ce repre
pourtant bien simple, tel qu'il lui est immdiatement
donn par la porte de mon enseignement, savoir
qu'il n'y a nul besoin que ceux qui participaient
trs videmment, autour de ces peintures encore
pour nous nigmatiques
un culte, que ceux-l n'avaient nul besoin
d'entrer jusqu'au fond de la caverne pour que les
signifiants de l'entre ne les reprsentent pour les
signifiants du fond qui n'avaient point besoin, par
contre, d'tre si frquemment, en dehors des temps
prcis de l'initiation, visit comme tels.
Tout ce qui accompagne ces cortges singuliers,
lignes de points, flches qui apparaissant ici
beaucoup plus directrices du sujet que vectrices de
l'intention alimentaire, tout nous indique qu'une
chane structurale, qu'une rpartition dont l'essence
est proprement parler d'tre signifiante, est ce
quelque chose qui, seul, peut nous donner le guide
d'une pense, la fois forte et prudente, au regard
de ce dont il s'agit.
Fonction de l'cran comme support, comme tel, de la
signifiance voil ce que nous trouvons tout de suite
l'veil de ce quelque chose qui, de l'homme, nous
assure que, quel que ft le ton de voix qu'il y
donna, il tait un tre parlant.
C'est bien ici qu'il s'agit de saisir de plus prs le
rapport de la signifiance la structure visuelle,
laquelle se trouve, de par la force des choses,
151 Andr Leroi-Gouhran, (Paris 1911-1986 Paris) : Anthropologue et ethnologue franais. Le geste et la parole, t.1, Technique
et langage, 1964 ; t.2 La mmoire et les rythmes,2000, Paris, Albin Michel.
436
savoir de par le fait qu'il semble, jusqu' nouvel
ordre que nous n'aurons jamais aucune trace de la
voix de ces premiers hommes, c'est assurment
du style de l'criture que nous trouvons les
premires manifestations chez lui de la parole.
Je n'ai point besoin d'insister sur un fait trs
singulier que mettent on vidence galement ces
reprsentations dont on s'extasie qu'elles soient
naturalistes
comme si nous n'avions pas appris dans notre
analyse du ralisme quel point tout art est
foncirement mtonymique, c'est--dire dsignant
autre chose que ce qu'il nous prsente
ces formes ralistes reprsentent avec une
remarquable constance, cette ligne oscillante qui se
traduit en fait par la forme de cet S allong o je
ne verrai, quant moi, aucun inconvnient voir se
recouper celle de l' S dont je vous dcline le
sujet. Oui, exactement pour la mme raison que quand
Monsieur HOGARTH cherche dsigner ce qu'il en est
de la structure de la beaut, c'est aussi exactement
et nommment cet S qu'il se rfre.
Pour donner corps, bien sr, ces extrapolations,
j'en conviens, qui peuvent vous paratre hardies, il
nous faut maintenant en venir ce que j'ai appel
tout l'heure la structure visuelle de ce monde
topologique, celui sur lequel se fonde toute
instauration du sujet.
J'ai dit que cette structure est antrieure,
logiquement la physiologie de l'il et l'optique
mme, qu'elle est cette structure que les progrs de
la gomtrie nous permettent de formuler comme
donnant, sous une forme exacte, ce qu'il en est - je
souligne exacte - ce qu'il en est du rapport du sujet
l'tendue.
Et certes je suis bien empch par de simples
considrations de dcence de vous donner ici un cours
de gomtrie projective. Il faut donc qu'au moyen de
quelques indications, je suscite en vous le dsir de
vous y reporter, quau moyen de quelques apologues,
je vous en fasse sentir la dimension propre .
La g
combi
surfa
mais
ligne
rsor
nombr
telle
inter
dfin
c
e
deux
l'on
ce po
0r il
c'est
gom
omtri
inatoir
aces su
dont l
es, pla
rbe, et
re de n
es, par
rsectio
nies co
car une
elle co
Si nous
les lig
x ligne
se db
oint ex
l appar
t mme
trie p
ie proje
re, comb
usceptib
le fonde
ans, pou
t la
ncessit
r exempl
on de de
omme se
e dfin
omporte
s croyo
gnes qu
es se co
brouille
xiste.
rat que
le fa
projecti
ective
binatoi
bles de
ement i
ur vous
fin, s'
ts pur
le, que
eux lig
coupan
ition c
des ex
ns que
i ne se
ouperon
era com
e prci
aire ex
ive et
est
ire de
e trac
intuiti
s, voq
'vanou
rement
e le po
gnes, q
nt touj
combina
xceptio
les pa
e coupe
nt touj
mme on p
isment
xister
que c'
proprem
points,
s rigou
f, ce q
quent, s
it derr
combina
int se
que deux
ours
atoire n
ons de
arallle
ent pas
ours en
pourra,
ce poi
qu'on f
est bie
ment pa
, de li
ureux
que poi
se diss
rire u
atoires
dfini
x ligne
ne vaut
l'ordre
es sont
n un po
, mais
int exi
fondera
en l,
arler
ignes, d
ints,
sipe, se
un certa
s qui so
ira comm
es seron
t pas s
e intui
t juste
oint et
il faut
iste et
a la
en quoi
437
de
e
ain
ont
me
nt
i
tif.
ment
t que
que
i
438
consiste l'apport de la perspective, c'est que c'est
prcisment le projeter sur un autre plan qu'on
verra, sur cet autre plan, apparatre d'une faon
dont l'intrt n'est pas qu'il soit l intuitif,
savoir parfaitement visible dans la jonction des deux
lignes sur la ligne d'horizon, mais quil ait
rpondre, selon les lois strictes d'une quivalence
attendue, partir des hypothses purement
combinatoires, je le rpte, qui sont celles qui se
poursuivront dans les termes que deux points, par
exemple, ne dtermineront qu'une seule ligne droite,
et que deux lignes droites ne peuvent se couper en
deux points. Pour vous faire sentir ce qu'il en est
de telles dfinitions, je vous rappelle, qu'il en
rsulte qu' l'encontre des manipulations de la
dmonstration euclidienne, l'admission de ces
principes, qui se rsument en une forme qu'on appelle
principe de dualit, une gomtrie purement
projective, non mtrique, pourra avec assurance,
traduire un thorme acquis en termes de points et de
lignes, en substituant point ligne dans son nonc
et ligne point et en obtenant un nonc
certainement aussi valable que le prcdent.
C'est l ce qui surgit au XVII
e
sicle avec le gnie
de PASCAL
152
, sans aucun doute dj prpar par
l'avnement multiple d'une dimension mentale telle
qu'elle se prsente toujours dans l'histoire du sujet
qui fait, par exemple, que le thorme dit de
BRIANCHON, lequel s'nonce : qu'un hexagone form
par six lignes droites qui sont tangentes une
conique, donc hexagone circonscrit
je pense que vous savez ce que c'est qu'une
conique mais je vous le rappelle : conique c'est
un cne, c'est une hyperbole, c'est une parabole
ce qui veut dire dans l'occasion qu'il s'agit de
certaines de leurs formes telles qu'elles sont
engendres dans l'espace et non pas simplement
152 Thorme de PASCAL dit de l'hexagramme mystique :Pour un hexagone inscrit dans une conique, le thorme de PASCAL
affirme que les points d'intersection des cts opposs de l'hexagone s'ils existent, sont aligns.La droite que forme cet alignement
est appele droite de PASCAL. La figure est appele hexagramme mystique. En gomtrie projective, un des trois points o les
trois points peuvent tre des points l'infini.
Thorme de Brianchon : Les diagonales qui joignent les sommets opposs d'un hexagone sont trois droites concourantes
si et seulement si l'hexagone est circonscrit une conique.
439
sous forme de rvolutions. Un cne se dfinissant
alors, par la forme qui se prsente dans
l'espace, de par l'enveloppement d'une ligne
joignant un point un cercle par exemple et ne
la joignant pas forcment d'un point situ
perpendiculairement son centre.
toutes ces lignes donc prsentent la proprit que,
les trois lignes qui joignent des sommets opposs
ce qui est facile dterminer quelle que soit la
forme de l'hexagone, par un simple comptage
ces trois lignes convergent en un point.
Du seul fait de l'admission des principes de la
gomtrie projective ceci se traduit immdiatement en
ceci qu'un hexagone form par six points qui reposent
sur une conique, qui est alors un hexagone inscrit,
que dans ce cas, les trois points d'intersection des
cts oppose, reposent sur une mme ligne.
Si vous avez cout ces deux noncs, vous voyez
qu'ils se traduisent l'un de l'autre par simple
substitution, sans quivoque, de point ligne et de
ligne point.
Il y a l, dans le procd de la dmonstration, vous
le sentez bien, tout autre chose que ce qui fait
intervenir mensuration, rgle ou compas, et que,
s'agissant de combinatoire, c'est bien de points, de
lignes voire de plans en terme de pur signifiant et
aussi bien de thormes qui peuvent s'crire
seulement avec des lettres, qu'il s'agit.
Or, ceci soi seul, va nous permettre de donner une
toute autre porte ce qu'il en est de la
correspondance d'un objet avec ce que nous
appellerons sa figure.
Ici, nous introduirons l'appareil qui dj nous a
servi comme essentiel confronter cette image
mythique de l'il
qui, quelle qu'elle soit, lude, lide, ce qu'il
en est du rapport de la reprsentation l'objet,
puisque, de quelque faon, la reprsentation y
sera toujours un double de cet objet.
confronter ce que je vous ai d'abord prsent
comme la structure de la vision y opposant celle du
regard. Et ce regard, dans ce premier abord je l'ai
440
mis l o il se saisit, l o il se supporte,
savoir l o il s' est pandu en cette uvre qu'on
appelle un tableau.
Le rapport en quelque sorte originaire du regard la
tache
pour autant mme que le phylum biologique peut
nous le faire apparatre effectivement selon des
organismes extrmement primitifs, sous la forme
de la tache, partir de quoi la sensibilit
localise que reprsente la tache dans son
rapport la lumire, peut nous servir d'image,
d'exemple de ce quelque chose o s'origine le
monde visuel
mais assurment ce n'est l qu'quivoque
volutionniste dont la valeur ne peut prendre, ne
peut s'affirmer comme rfrence que de se rfrer
une structure synchronique parfaitement saisissable.
Qu'en est-il de ce qui s'oppose comme champ de vision
et comme regard au niveau prcisment de cette
topologie ?
Assurment le tableau va continuer d'y jouer un rle,
et ceci n'est point pour nous tonner. Si dj nous
avons admis que quelque chose comme un montage, comme
une monture, comme un appareil, est essentiel ce
que nous visons, pour en avoir, nous, l'exprience,
savoir la structure du fantasme.
Et le tableau dont nous allons parler, puisque c'est
dans ce sens que nous en attendons service et
rendement, c'est bien dans sa monture de chevalet que
nous allons le prendre, ce tableau de quelque chose
qui se tient comme un objet matriel, c'est l ce qui
va nous servir de rfrence pour un certain nombre de
rflexions.
441
I
Dans la gomtrie projective, ce tableau, ce va tre
ce plan dont je parlais tout l'heure sur lequel
la perce de chacune des lignes que nous appellerons,
si vous le voulez, lignes oculaires, pour ne faire
aucune quivoque avec rayon visuel, les lignes qui
joignent le point essentiel au dpart de notre
dmonstration, que nous allons appeler il, et qui
est ce sujet idal de l'identification du sujet
classique de la connaissance - n'oubliez pas par
exemple, dans tous les schmas que j'ai donns, sur
l'identification, que c'est d'un S, point d'il, que
partent les lignes que je trace de ce point dans une
ligne droite - ligne oculaire qui se joint ce qui,
ce que nous dsignerons comme support, point, ligne[ ]
voire mme plan, dans le plansupport [ Q ].
Ces lignes traversent cet autre plan [ P ] et les points,
les lignes o elles le traversent
voire la traverse du plan qui se dterminera par
rapport une de ces lignes, de la contenir par
exemple
442
ces traverses du plan-figure - je distingue donc
plan-support [Q] et plan-figure [P] - cette traverse
de la ligne oculaire, laissant sa trace sur le plan-
figure [], c'est ceci que nous avons affaire dans
ce qu'il en est de la construction de la perspective.
Et c'est elle qui doit nous rvler, matrialiser
pour nous, la topologie d'o il rsulte que quelque
chose se produit dans la construction de la vision
qui n'est autre que ce qui nous donne la base et le
support du fantasme savoir une porte qui n'est
autre que celle que j'appelle la perte de l'objet(a)
et qui n'est autre que le regard, et d'autre part,
une division du sujet.
Que nous apprend en effet la perspective?
La perspective nous apprend que toutes les lignes
oculaires qui sont parallles au plan-support [S-]
vont dterminer sur le plan-figure une ligne qui
n'est autre que la ligne d'horizon.
Cette ligne d'horizon est, vous le savez, le repre
majeur de toute construction perspective.
quoi correspond-elle dans le plan-support?
Elle correspond - si nous maintenons fermes les
principes de la cohrence de cette gomtrie
combinatoire - galement une ligne.
Cette ligne est proprement parler celle que les
Grecs ont manque du fait que - pour des raisons que
nous laisserons aujourd'hui de cot mme si nous
devons un jour les mettre en question - que les Grecs
ne pouvaient que manquer et qui est proprement
parler cette ligne - ligne galement, et de par nos
principes, galement ligne droite - qui se trouve
l'infini sur le plan-support et qu'intuitivement nous
ne pouvons concevoir que comme en reprsentant, si je
puis dire le tout. C'est sur cette ligne que se
trouvent les points o dans le plan-support les
parallles convergent, ce qui se manifeste dans le
plan-figure - vous le savez - de la convergence de
presque toutes les lignes parallles l'horizon.
443
On image ceci, en gnral, et on le voit sous la
plume des meilleurs auteurs, c'est ce que vous savez
bien, quand vous voyez une route qui s'en va vers
l'horizon, elle devient de plus en plus petite, de
plus en plus troite. On n'oublie qu'une chose, le
danger qu'il y a de telles rfrences car tout ce
que nous connaissons comme horizon est un horizon de
notre boule terrestre, c'est--dire, un tout autre
horizon, dtermin par la forme sphrique, comme on
le remarque dailleurs
sans y voir, semble-t-il la moindre contradiction
comme on le remarque quand on nous dit que l'horizon
est la preuve de la rotondit de la terre.
Or, je vous prie de remarquer que mme si nous tions
sur un plan infini, il y aurait toujours, pour
quiconque s'y tiendrait debout, une ligne d'horizon.
Ce qui nous trouble et nous perturbe, dans cette
considration de la ligne d'horizon, c'est d'abord ce
sur quoi je reviendrai tout l'heure, savoir que
nous ne la voyons jamais que dans un tableau.
Nous verrons tout l'heure ce qu'il en est de la
structure du tableau. Comme un tableau est limit, il
ne nous vient mme pas l'esprit que si le tableau
s'tendait infiniment, la ligne d'horizon serait
droite jusqu' l'infini, tellement en cette occasion,
nous nous satisfaisons d'avoir simplement penser
d'une faon grossirement analogique, savoir que
l'horizon qui est l sur le tableau, c'est un horizon
comme notre horizon, dont on peut faire le tour.
Une autre remarque est celle-ci : c'est quun tableau
est un tableau et la perspective une autre chose.
Nous allons voir tout l'heure comment on s'en sert
dans le tableau.
Mais si vous partez des conditions que je vous ai
donnes pour ce qui doit venir se tracer sur le
plan-figure, vous remarquerez ceci, c'est qu'un
tableau fait dans ces conditions qui seraient celles
d'une stricte perspective, aurait pour effet, si vous
supposez par exemple
444
parce qu'il faut bien vous accrocher quelque
chose que vous tes debout sur un plan couvert d'un
quadrillage l'infini, que ce quadrillage vienne
bien entendu, s'arrter (nous verrons tout l'heure
comment) l'horizon.
Et au-dessus de l'horizon ?
Vous allez dire naturellement : le ciel.
Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du
tout !
Au-dessus, ce qu'il y a, l'horizon, derrire vous,
comme je pense que si vous y rflchissez, vous
pourrez immdiatement le saisir, tracer la ligne
qui joint le point que nous avons appel S ce qui
est derrire sur le plan-support [II : a] dont vous
verrez aussitt qu'il va se projeter au-dessus de
l'horizon. [II : a]
II
Faisons qu' cet horizon du plan, projectif vienne du
plan-support, se coudre au mme point d'horizon, les
deux points opposs du plan-support[ III : ch] :
l'un par exemple, qui est tout fait gauche de
445
vous sur la ligne d'horizon du plan-support[c
],
viendra se coudre un autre qui est tout fait
votre droite sur la ligne d'horizon galement du
plan-support[-c
].
Est-ce que vous avez compris ?
Je veux dire Non ?
Recommenons.
III
Vous avez devant vous une surface vous avez devant
vous un quadrillage-plan. Supposons, pour la plus
grande simplicit qu'il soit horizontal et vous, vous
tes vertical. C'est une ligne joignant votre il, -
je vais dire des choses aussi simples que possible -
avec un point quelconque de ce plan-support quadrill
et l'infini qui dtermine sur le plan vertical,
disons, pour vous faire plaisir, qui est celui de la
projection qui va dterminer la correspondance point
par point : tout point d'horizon, c'est--dire
l'infini du plan-support correspond un point sur
l'horizon de votre plan vertical.
446
Rflchissez ce qui se passe. Bien sr, s'agit-il
d'une ligne qui justement, comme j'ai commenc de le
dire, n'a rien faire avec un rayon visuel : c'est
une ligne qui part derrire vous du plan-support et
qui va votre il.
IV
Elle va aboutir sur le plan-figure un point
au-dessus de l'horizon. un point qui correspond
l'horizon du plan-support va correspondre un autre
point venant le toucher par en haut, si je puis dire,
sur la ligne d'horizon, et ce qui est derrire vous,
droite, puisque cela passe et que a se croise au
niveau, du point-il, va venir exactement dans le
sens inverse o ceci se prsenterait si vous vous
retourniez, savoir que ce que vous verriez gauche
si vous vous retourniez vers cet horizon, vous le
verrez s'tre piqu droite au-dessus de la ligne
d'horizon sur le plan projectif, de la projection.
En d'autres termes, que ce qui est une ligne[]
447
que nous ne pouvons pas dfinir comme ronde,
puisqu'elle n'est ronde que de notre apprhension
quotidienne de la rotondit terrestre
que c'est de cette ligne, qui est l'infini sur le
plan-support, que nous verrons les points se nouer,
venant respectivement d'en haut, et d'en bas, et
d'une faon qui, pour l'horizon postrieur,
vient s'accrocher dans un ordre strictement inverse
ce qu'il en est de l'horizon antrieur.
Je peux, bien entendu, dans cette occasion, supposer,
comme le fait PLATON dans sa caverne, ma tte fixe et
dterminant, par consquent, deux moitis dont je
peux parler, concernant le plan-support.
Ce que vous voyez l n'est rien d'autre d'ailleurs,
que l'illustration pure et simple, de ce qu'il en est
quand le plan projectif, je vous le reprsente au
tableau sous la forme d'un cross-cap :
Cest savoir que ce que vous voyez - au lieu d'un
monde sphrique - c'est une certaine bulle qui se
noue d'une certaine faon, se recroisant elle-mme et
qui fait que ce qui s'est prsent d'abord comme un
plan l'infini, vient dans un autre plan - s'tant
divis - se renouer lui-mme au niveau de cette
ligne d'horizon et se renouer d'une faon telle qu'
chacun des points de l'horizon du plan-support, vient
se nouer quoi ? Prcisment ce que la forme que je
448
vous ai dj mise au tableau, du plan projectif,
savoir son point diamtralement oppos. C'est bien
pour cela qu'il se fait que dans une telle projection
c'est le point postrieur droite qui vient se nouer
au point antrieur gauche.
Tel est ce qu'il en est, de la ligne d'horizon, nous
indiquant dj que ce qui fait la cohrence, d'un
monde signifiant structure visuelle, est une
structure d'enveloppe, et nullement d'indfinie
tendue.
Il n'en reste pas moins qu'il n'est point assez de
dire ces choses telles que le viens de vous les
imager, car j'oubliais dans la question le
quadrillage que j'avais mis l uniquement pour votre
commodit, mais qui n'est pas indiffrent, car un
quadrillage tant fait de parallles
il faut dire qu'tant admis en outre ceci que
j'ai fix ma tte, toutes les lignes parallles
de l'espace, comme vous n'avez, je pense aucune
peine l'imaginer
iront rejoindre, en un certain point de fuite
lhorizon : un seul point, savoir que c'est la
direction de toutes les parallles dans une certaine
position donne qui dtermine l'unique point
d'horizon sur lequel dans le plan-figure, elles se
croisent.
Si vous avez ce quadrillage infini dont nous parlons,
ce que vous verrez se conjoindre l'horizon, ce sera
toutes les parallles de tout le quadrillage en un
seul point. Ce qui n'empche pas que ce sera le mme
point o toutes les parallles de tout le quadrillage
postrieur viendront d'en haut, galement, se
conjoindre.
449
Ces remarques qui sont fondamentales pour toute
science de la perspective et qui sont ce dont tout
artiste en mal d'ordonner quoi que ce soit - une
srie de figures sur un tableau, ou aussi bien les
lignes de ce qu'on appelle un monument, qui est la
disposition d'un certain nombre d'objets autour d'un
vide - tiendra compte, et que ce point, sur la ligne
d'horizon dont je parlais tout l'heure propos du
quadrillage est exactement ce qui est appel
couramment - je ne vois pas que j'y apporte l
quoique ce soit de vritablement bien transcendant -
le point de fuite de la perspective.
Ce point de fuite de la perspective est proprement
parler ce qui reprsente dans la figure, l'il qui
regarde. L'il n'a pas tre saisi en dehors de la
figure, il est dans la figure et tous, depuis qu'il y
a une science de la perspective, l'ont reconnu comme
tel et appel comme tel.
Il est appel l'il dans ALBERTI
153
[ Lon Battista Alberti (1404-1472), De Pictura]
il est appel l'il dans VIGNOLA
154
[ Vignola, Le due regole de la perspectiva ]
il est appel l'il dans DRER
155
[Albrecht Drer (1471-1528) Underweysung der Messung]
Mais ce n'est pas tout
car je regrette qu'on m'ait fait perdre du temps
expliquer ce point pourtant vritablement
accessible
ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout du tout car il
y a aussi les choses qui sont entre le tableau et
moi.
Les choses qui sont entre le tableau et moi, elles
peuvent galement, par le mme procd, se
reprsenter sur le plan du tableau, o elles s'en
iront vers des profondeurs que nous pourrons tenir
pour infinies. Rien de ceci ne nous en empche, mais
elles s'arrteront en un point qui correspond quoi?
Au plan parallle au tableau qui passe - je vais
dire, pour vous faciliter les choses - qui passe par
mon il ou par le point S. [V : plan S ]
153 Lon Battista Alberti (1404-1472), De Pictura, 1435, Allia, 2007.
154 Iacopo Barozzi, dit il Vignola (1507-1573), Le Due regole d lia prospettiva. Cf. Les deux rgles de la perspective pratique
de Vignole, Egnatio Danti, Paris, CNRS Editions, 2003.
155 Albrecht Drer (1471-1528) Underweysung der Messung, Nuremberg, 1525. Instruction sur la manire de mesurer, Paris,
Flammarion, Coll. Ecrits dartiste 1995. Cf. aussi Gomtrie, , Paris, Seuil, Coll. Source du savoir, 1995.
450
V
Nous avons l deux traces.
Nous avons la trace de ce par quoi le tableau vient
couper le support [VI : hQ] et l'inverse de la ligne
d'horizon [sQ].
VI
451
En d'autres termes, c'est ce qui, si nous renversions
les rapports :
VII
et nous en avons le droit, constitue comme ligne
d'horizon dans le support [SQ], la ligne infinie dans
la figure [h]. Et puis, il y a la ligne qui reprsente
la section du support par le plan du tableau [hQ].
Ce sont deux lignes.
Il est tard et je vous dirai quelque chose de
beaucoup moins rigoureux en raison du peu de temps
qui me reste, les choses sont plus longues
expliquer qu'il n'apparat d'abord.
Rigoureusement, ceci :
veut dire qu'il y a un autre point d'il [S] qui est
celui qui est constitu par la ligne l'infini [h]
sur le plan de la figure, et son intersection par
452
quelque chose qui y est bien, savoir la ligue [hQ]
par laquelle le plan de la figure coupe le plan-
support.
Ces deux lignes se coupent puisqu'elles sont toutes
les deux dans le plan de la figure. Et qui plus est,
elles se coupent en un seul point car ce point est
bel et bien le mme sur la ligne l'infini.
Pour en rester sur un domaine de l'image, je dirai
que cette distance [] des deux parallles, qui sont
dans le plansupport celles qui sont dtermines par
ma position fixe de regardant et celle qui est
dtermine par l'insertion, la rencontre du tableau
avec le plansupport, cette bance, cette bance
qui, dans le planfigure ne se traduit que par un
point
par un point qui, lui, se drobe totalement car
nous ne pouvons pas le dsigner comme nous
dsignons le point de fuite l'horizon
ce point essentiel toute la configuration, et tout
fait spcialement caractristique - ce point perdu
si vous voulez vous contenter de cette image - qui
tombe dans l'intervalle des deux parallles quant
ce qu'il en est du support : c'est ce point que
j'appelle le point du sujet regardant.
Nous avons donc le point de fuite qui est le point du
sujet en tant que voyant et le point qui choit dans
l'intervalle du sujet et du plan-figure et qui est
celui que j'appelle le point du sujet regardant.
Ceci n'est pas une nouveaut. C'est une nouveaut de
l'introduire ainsi, d'y retrouver la topologie du S
dont il va falloir savoir maintenant o nous situons
le (a) qui dtermine la division de ces deux points.
Je dis de ces deux points en tant qu'ils reprsentent
le sujet dans la figure.
Aller plus loin nous permettra d'instaurer un
appareil, un montage tout fait rigoureux et qui
nous montre, au niveau de ce qu'il en est de la
combinatoire visuelle, ce qu'est le fantasme.
O nous aurons le situer dans cet ensemble, c'est
ce qui se dira par la suite.
453
Mais ds maintenant, pour que vous ne pensiez pas que
je vous emmne l, dans des endroits abyssaux - je ne
fais pas de la psychologie des profondeurs, je suis
en train de faire de la gomtrie, et Dieu sait si
j'ai pris des prcautions, aprs avoir lu tout ce qui
peut bien se rapporter cette histoire de la
perspective, depuis EUCLIDE
156
[ Michel Chasles, Les trois livres des Porismes d'Euclide]
qui l'a si parfaitement loupe dans ses porismes,
jusqu'aux personnes dont j'ai parl tout l'heure et
jusqu'au dernier livre de Michel FOUCAULT qui fait
directement allusion ces choses dans son analyse
des Suivantes , dans le premier chapitre des
Mots et des choses, j'ai essay de vous en donner
quelque chose de tout fait support, c'est le cas de
le dire.
Mais quant ce point parfaitement dfini que je
viens de donner comme le deuxime point reprsentant
le sujet regardant dans la combinatoire projective,
ne croyez pas que c'est moi qui l'ai invent. Mais on
le reprsente autrement, et cet autrement a t dj
appel par d'autres que par moi, l'autre il par
exemple.
Il est exactement bien connu de tous les peintres, ce
point. Car puisque je vous ai dit que ce point, dans
sa rigueur, il choit dans l'intervalle tel que je
l'ai dfini sur le plan-support, pour aller se situer
en un point que vous ne pouvez naturellement pas
pointer mais qui est ncessit par l'quivalence
fondamentale de ce qui est la gomtrie projective et
qui se trouve dans le plan-figure, il a beau tre
l'infini, il s'y trouve.
Ce point comment est-il utilis ?
Il est utilis par tous ceux qui ont fait des
tableaux en se servant de la perspective,
c'est--dire trs exactement depuis MASACCIO et
VAN EYCK sous la forme de ce qu'on appelle l'autre
il, comme je vous le disais tout l'heure. C'est le
point qui sert construire toute perspective plane
en tant qu'elle fuit, en tant qu'elle est prcisment
dans le plan-support.
156 Michel Chasles Les trois livres de Porisme d'Euclide, Jacques Gabay , 2007.
454
Elle se construit trs exactement ainsi dans ALBERTI.
Elle se construit un peu diffremment dans ce qui est
LE PELERIN
157
.[ Jean Plerin Viator (1445-1524), De Artificiali Perspectiva ]
Voici Voici ce dont il s'agit de dcouvrir la
perspective, savoir un quadrillage par exemple dont
la base vient s'appuyer ici, nous avons un repre [ a ] .
157 L. Brion-Guerry, Jean-Plerin Viator, Sa place dans l'histoire de la perspective, Belles Lettres, Coll. Les Classiques, 1982.
455
Si je m'y prte, je veux dire si je veux
simplement faire les choses simples pour votre
comprhension, je me mets au milieu de ce repre du
quadrillage, et une perpendiculaire leve sur la
base de ce quadrillage me donne l'horizon le point
de fuite[ a ].
Je saurais donc, d'ores et dj, que mon quadrillage
va s'arranger comme a, l'aide de mon point de
fuite. [ b ]
Mais qu'est-ce qui va me donner la hauteur o va
venir le quadrillage en perspective ? Quelque chose
qui ncessite que je me serve de mon autre il.
Et ce qu'ont dcouvert les gens, assez tard
puisqu'en fin de compte la premire thorie en est
donne dans ALBERTI, contemporain de ceux que je
viens de vous nommer, MASSACHIO et Van EYCK : eh
bien, je prendrai ici une certaine distance [ ], qui
est exactement ce qui correspond ce que je vous ai
donn tout l'heure, comme cet intervalle de mon
bloc au tableau. Sur cette distance, prenant un point
[ S ] situ la mme hauteur que le point de fuite, je
fais une construction, une construction qui passe
dans ALBERTI par une verticale situe ici [ ].
Je trace ici la diagonale [ ], ici une ligne
horizontale et ici, j'ai la limite laquelle se
terminera mon quadrillage, celui que j'ai voulu voir
en perspective.
J'ai donc toute libert quant la hauteur que je
donnerai ce quadrillage pris en perspective, c'est-
-dire, qu' l'intrieur de mon tableau, je choisis
mon gr la distance o je vais me placer de mon
quadrillage pour qu'il m'apparaisse en perspective et
ceci est tellement vrai, que dans beaucoup de
tableaux classiques, vous avez sous une forme masque
une petite tache, voire quelquefois tout simplement
un il.
L'indication, ici, du point o vous devez vous mme
prendre la distance o vous devez vous mettre du
tableau pour que tout l'effort de perspective soit
pour vous ralis. Vous le voyez, ceci ouvre une
autre dimension qui est celle-ci, celle-ci qui est
exactement la mme qui vous a tonn tout l'heure,
456
quand je vous ai dit qu'au-dessus de l'horizon, il
n'y a pas le ciel. Il y a le ciel parce que vous
foutez au fond sur l'horizon, un portant qui est le
ciel. Le ciel n'est jamais qu'un portant dans la
ralit comme au thtre et de mme, entre vous et le
ciel il y a toute une srie de portants.
Le fait que vous puissiez choisir dans le tableau
votre distance et n'importe quel tableau dans le
tableau, et dj le tableau lui-mme, est une prise
de distance, car vous ne faites pas un tableau de
vous l'orifice de la fentre dans laquelle vous
vous encadrez. Dj vous faites le tableau
l'intrieur de ce cadre. Votre rapport avec ce
tableau et ce qu'il a faire avec la fantasme, cela
nous permettra d'avoir des repres, un chiffre assur
pour tout ce qui, dans la suite, nous permettra de
manifester les rapports de l'objet(a) avec le S, c'est
ce que j'espre - et j'espre un peu plus vite
qu'aujourd'hui - je pourrai vous exposer la prochaine
fois.
Table des sances
MASACCIO
457
Van EYCK
458
11 Mai 1966 Table des sances
Pour ce qui est du savoir, il est difficile de ne pas
tenir compte de l'existence du savant, savant ici
pris seulement comme le support de l'hypothse du
savoir en gnral, sans y mettre forcment la
connotation de scientifique.
La savant sait quelque chose ou bien il ne sait rien,
dans les deux cas, il sait qu'il est un savant.
Cette remarque est seulement faite pour vous pointer
ce problme prpar depuis longtemps et je dirai
mme, prsentifi depuis, non pas seulement que
j'enseigne, depuis que j'ai pouss mes premires
remarques sur ce que nous rappelle de fondamental
l'analyse et qui est centr autour de la fonction du
narcissisme ou du stade du miroir.
Disons, pour aller vite, puisque nous avons commenc
en retard, que le statut du sujet, au sens le plus
large - au sens non encore dbroussaill, non pas au
sens o je suis en train d'essayer d'en serrer pour
vous la structure - ce qu'on appelle le sujet en
gnral veut simplement dire, dans le cas que je
viens de dire : il y a du savoir, donc il y a un
savant.Le fait de savoir qu'on est un savant ne peut
pas ne pas s'intriquer profondment dans la structure
de ce savoir. Pour y aller carrment disons que le
professeur, puisque le professeur a beaucoup faire
avec le savoir pour transmettre le savoir, il faut
charrier une certaine quantit de savoir, qu'il a t
prendre soit dans son exprience, soit dans une
accumulation de savoir faite ailleurs et qui
s'appelle par exemple dans tel ou tel domaine, la
philosophie par exemple, la tradition.
Il est clair que nous ne saurions ngliger que la
prservation du statut particulier de ce
savant
j'ai voqu le professeur mais il y en a bien
d'autres statuts, celui du mdecin par exemple
que la prservation de son statut est de nature
inflchir, incliner ce qui, pour lui, lui paratra,
le statut gnral de son savoir.
459
Le contenu de ce savoir, le progrs de ce savoir, la
pointe de son extension, ne sauraient ne pas tre
influencs par la protection ncessaire de son statut
de sujet savant.
Ceci me semble assez vident si l'on songe que nous
en avons devant nous la matrialisation taxable par
les conscrations sociales de ce statut qui font
qu'un monsieur n'est pas considr comme savant
uniquement dans la mesure o il sait et o il
continue de fonctionner comme savant, les
considrations de rendement viennent l, de loin,
derrire celles du maintien d'un statut permanent
celui qui a accd une fonction savante.
Ceci n'est pas injustifi et dans l'ensemble arrange
tout le monde : tout le monde s'en accommode fort
bien. Chacun a sa place : le savant savante dans
des endroits dsigns et on ne va pas regarder de si
prs si son savantement, partir d'un certain
moment, se rpte, se rouille ou mme devient pur
semblant de savanterie.
Mais comme beaucoup de cristallisations sociales,
nous ne devons pas nous arrter simplement ce
quest la pure exigence sociale, ce qu'on appelle
habituellement les fonctions de groupe et comment un
certain groupe prend un statut plus ou moins
privilgi pour des raisons qui sont en fin de compte
toujours faire remonter quelque origine
historique.
Il y a bien l quelque chose de structural et qui,
comme le structural nous force souvent de le
remarquer, dpasse de beaucoup la simple
interrelation d'utilit. On peut considrer que du
point de vue du rendement, il y aurait avantage
faire le statut du savant moins stable. Mais il faut
croire justement qu'il y a dans les mirages du sujet
et non dans la structure du sujet lui-mme, quelque
chose qui aboutit ces structures stables, qui les
ncessite.
Si la psychanalyse nous force remettre en question
le statut du sujet, c'est sans doute parce qu'elle
aborde ce problme, problme de ce qu'est un sujet,
d'un autre dpart.
460
Si pendant de longues annes, j'ai pu montrer que
l'introduction de cette exprience de l'analyse dans
un champ qui ne saurait se reprer que de conjoindre
une certaine mise en question du savoir au nom de la
vrit, si la scansion de ce champ va se chercher en
un point plus radical, en un point antrieur cette
rencontre, cette rencontre d'une vrit qui se pose
et se propose comme trangre au savoir, nous l'avons
dit, ceci s'introduit du premier biais de demande,
qui d'abord dans une perspective qui se rduit
ensuite, se propose comme plus primitif, comme plus
archaque et qui ncessite d'interroger comment
s'ordonnent, dans leur structure, cette demande avec
quelque chose dont elle discorde et qui s'appelle le
dsir.
C'est ainsi que par ce biais, en quelque sorte, dans
ce clivage structural nous sommes arrivs remettre
en question ce statut du sujet, considrer que loin
que le sujet nous paraisse un point-pivot, une sorte
d'axe autour de quoi tourneraient - quels que soient
les rythmes, la pulsation, que nous accordions ce
qui tourne - autour de quoi tourneraient les
expansions et les retraits du savoir. Nous ne pouvons
considrer le drame qui se joue, qui fonde l'essence
du sujet tel que nous le donne l'exprience
psychanalytique, en introduisant le biais du dsir au
cur mme de la fonction du savoir, nous ne pouvons
le faire sur le fondement de statut de la personne
qui, en fin de compte, est ce qui a domin jusque l
la vue philosophique qui a t prise du rapport de
l'homme ce qu'on appelle le monde sous la forme
d'un certain savoir.
Le sujet nous apparat fondamentalement divis en ce
sens qu' interroger ce sujet, au point, le plus
radical, savoir s'il sait ou non quelque chose -
c'est l le doute cartsien - nous voyons ce qui est
l'essentiel dans cette exprience du cogito, l'tre
de ce sujet, au moment qu'il est interrog, fuir, en
quelque sorte, diverger sous la forme de deux rayons
d'tre qui ne concident que sous une forme illusoire
l'tre qui trouva sa certitude de se manifester
comme tre au sein de cette interrogation.
461
Je pense : pensant je suis , mais je suis ce qui
pense, et penser je suis n'est pas la mme chose
que d'tre ce qui pense. Point non remarqu mais qui
prend tout son poids, toute sa valeur de se recouper,
dans l'exprience analytique, de ceci que celui qui
est ce qui pense, pense d'une faon dont n'est pas
averti celui qui pense : je suis .
C'est l le sujet qu'est charg de reprsenter celui
qui, dirigeant l'exprience analytique, s'appelant le
psychanalyste, voit se reposer - pour lui - ce qu'il
en est de la question du savant.
Le rapport du psychanalyste la question de son
statut reprend ici sous une forme d'une acuit
dcuple celle qui est pose depuis toujours
concernant le statut de celui qui dtient le savoir,
et le problme de la formation du psychanalyste n'est
vraiment rien d'autre que, par une exprience
privilgie, de permettre que vienne au monde, si je
puis dire, des sujets pour qui cette division du
sujet ne soit pas seulement quelque chose qu'ils
savent mais quelque chose en quoi ils pensent.
Il s'agit que viennent au monde quelques-uns qui
sauraient dcouvrir ce qu'ils exprimentent dans
l'exprience analytique, partir de cette position
maintenue que jamais ils ne soient en tat de
mconnatre qu'au moment de savoir, comme analystes,
ils sont dans une position divise .
Rien n'est plus difficile que de maintenir dans une
position d'tre ce qui, assurment pour chacun, s'il
mrite le titre d'analyste, a t quelque moment
dans l'exprience, prouv.
Et voil.
partir du moment o le statut est instaur de celui
qui est suppos savoir dans la perspective
analytique, tous les prestiges de la mconnaissance
spculaire renaissent qui ne peuvent que runifier ce
statut du sujet, savoir, laisser tomber, lider
l'autre partie qui est celle dont pourtant a devrait
tre l'effet de cette exprience unique, ce devrait
tre l'effet sparatif par rapport l'ensemble du
troupeau, que de certains non seulement le sachent
462
mais soient, soient au moment d'aborder toute
exprience de l'ordre de la leur, soient conformes ou
au moins pressentent ce qu'il en est de cette
structure divise.
Ce n'est pas autre chose que le sens de mon
enseignement de rappeler cette exigence quand,
assurment, c'est ailleurs que sont les moyens d'y
introduire mais que, de par une structure, je le
rpte, qui, de beaucoup dpasse son conditionnement
social, quelque chose, quelle que soit l'exprience,
du seul fait du fonctionnement o chacun s'identifie
un certain statut nommable, dans l'occasion celui
d'tre le savant, tend faire rentrer dans l'ordre
l'essentiel de la schize par laquelle seule pourtant
peut s'ouvrir un accs l'exprience qui soit au
niveau propre de cette exprience. C'est en tant que
sujet divis que l'analyste est appel rpondre
la demande de celui qui entre avec lui dans une
exprience de sujet.
C'est pourquoi ce n'est pas pur raffinement
ornement de dtail, peinture d'un secteur
particulier de notre exprience, qui illustrerait
en quelque sorte ce qu'il convient d'ajouter
d'information ce que nous pouvons connatre par
exemple de la pulsion scopique
que, la dernire fois, j'ai t amen dvelopper
devant vous des fonctions de la notion de la
perspective.
C'est dans la mesure, au contraire, o il s'agit pour
vous d'illustrer ce qui peut soutenir de son
appareil, ce autour de quoi il s'agit que la
subjectivit de l'analyste se repre, et se reprant
n'oublie jamais
mme au moment o le second point de fuite, si je
puis dire, de sa pense, tend tre oubli,
lid, laiss de ct, du moins dans la
force de quelque schmes
se voit rappel lui-mme qu'il doit chercher o
fonctionne cet autre point de fuite, au moment mme,
l'endroit mme o il tend formuler quelque vrit
qui de par son expression mme, s'il n'y prend garde,
se trouvera retomber dans les vieux schmes unitaires
463
du sujet de la connaissance et l'incitera, par
exemple, mettre au premier plan, telle ide de
totalit qui est proprement parler ce dont il doit
le plus se mfier dans la synthse de son exprience.
La dernire fois, essayant, pour vous, par des voies
abrges, de prsentifier ce que peut nous apporter
ce que nous enseigne l'exprience de la perspective,
encore que ces voies je les ai choisies aussi
praticables que je l'ai pu, assurment, j'ai eu le
sentiment de n'avoir pas toujours russi
concentrer, sinon toute l'attention, du moins avoir
toujours russi la rcompenser.
Faute peut-tre de quelque schma, et pourtant
c'tait bien ce que j'entendais repousser, reculer
pour viter quelque malentendu. Je vais pourtant
aujourd'hui le faire, le rsumer et dire ce qui, dans
cette exprience de la perspective, pour nous,
proprement parler, peut illustrer ce dont il s'agit,
savoir le rapport de la division du sujet ce qui
spcifie, dans l'exprience analytique, la relation
proprement visuelle au monde, savoir un certain
objet(a).
Cet objet(a) que jusqu'ici et d'une faon approche
et qui n'a d'ailleurs pas tre reprise, j'ai
distingu du champ de la vision comme tant la
fonction du regard, comment ceci peut-il s'organiser
dans l'exprience, l'exprience structurale, pour
autant qu'elle instaure un certain type de pense
dans la gomtrie, pour autant qu'elle est rendue
sensible dans tout le fonctionnement de l'art et
spcialement dans la peinture.
J'ai fait la dernire fois, verbalement, une
construction qu'il est facile de retrouver telle
quelle dans un ouvrage de perspective. Ce n'est pas
de celui-l qu'il s'agit (on me l'a apport
l'instant).C'est l'ouvrage par exemple, ou plutt le
recueil des articles d'Erwin PANOFSKY
158
sur la
perspective.
158 Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique et autres essais, Paris, Minuit, 1976, Coll. Le sens commun.
464
Il y en a une dition en allemand qui est d'ailleurs
o les articles, je le vois, se groupent diffremment
de cette dition italienne.
J'ai rappel que, dans le rapport dit projectif, qui
s'tablit du plan de ce qu'on peut appeler le
tableau, au plan de ce que - pour tre simple
aujourd'hui - nous appellerons le sol perspectif, il
y a des correspondances linaires fondamentales qui
s'tablissent et qui impliquent des lments,
proprement parler non intuitivables, et qui sont
pourtant des lments fondamentaux de ce qu'on peut
appeler l'espace, ou l'tendue projectifs.
Une gomtrie cohrente instaurant une parfaite
rigueur dmonstrative, qui n'a rien de commun avec la
gomtrie mtrique, stablit condition d'admettre
que ce qui se passe dans ce que j'ai appel
aujourd'hui le sol perspectif
pour remplacer un terme (je me suis rendu compte)
plus difficile maintenir dans l'esprit que
celui-l que j'avais employ la dernire fois
la correspondance des lignes traces donc sur le sol
perspectif avec les lignes traables sur le tableau,
implique qu'une ligne l'infini sur le sol
perspectif se traduise par la ligne d'horizon sur le
tableau.
Ceci est le premier pas de toute construction
perspective. Je vais le schmatiser de la faon
suivante :
465
supposez que ce soit ici [Q] le sol perspectif, je
vous laisse de profil le tableau [P], je mets ici ce
dont je n'ai pas encore parl : le point il [S] du
sujet.
J'ai suffisamment indiqu la dernire fois ce dont il
s'agissait pour que vous compreniez maintenant le
sens du trac que je vais faire.
Je vous ai dit - indpendamment de quoi que ce soit
quoi vous ayez vous rfrer dans l'exprience (et
nommment pas l'horizon tel qu'il est effectivement
expriment sur notre boule en tant qu'elle est
ronde) un plan infini suppose que, de ce point d'il,
il soit en [I], posant un plan parallle au sol
perspectif, que vous dterminiez la ligne d'horizon
[h] sur le tableau selon la ligne o ce plan
parallle coupe le plan du tableau.
L'exprience du tableau et de la peinture nous dit
que n'importe quel point de cette ligne d'horizon est
tel que les lignes qui y concourent correspondent
des lignes parallles quelles qu'elles soient, sur le
sol perspectif. Nous pouvons donc choisir n'importe
quel point de cette ligne d'horizon comme centre de
la perspective. C'est ce qui se fait en effet dans
tout tableau soumis aux lois de la perspective. Ce
point est proprement ce qui, dans le tableau,
ne rpond pas seulement, vous le voyez, au sol
mettre en perspective, mais la position du point
qui comme tel dans la figure, reprsente l'il.
C'est en fonction de l'il de celui qui regarde que
l'horizon s'tablit dans un plan-tableau.
A ceci, vous ai-je dit la dernire fois, tous ceux
qui ont tudi la perspective, ajoutent ce qu'ils
appellent l'autre il, savoir l'incidence dans la
perspective de la distance [] de ce point S au plan
du tableau.
Or, aussi bien en fait que dans l'usage qu'on en fait
dans n'importe quel tableau, cette distance est
arbitraire, au choix de celui qui fait le tableau. Je
veux dire qu'elle est au choix l'intrieur du
tableau-mme.
466
Est-ce dire que du point de vue de la structure du
sujet - en tant que le sujet est le sujet du regard,
est le sujet d'un monde vu, c'est ce qui va nous
intresser - est-ce dire que nous pouvons ngliger
cette partie du sujet, qu'elle ne nous apparaisse
qu'en une fonction d'artifice
qu'alors que la ligne d'horizon est structurale,
le fait que le choix de la distance librement est
laiss mon choix, de moi qui regarde, je puisse
dire qu'il n'y a l qu'artifice de l'artiste, que
c'est la distance o je me mets mentalement de
tel ou tel plan, que je choisis dans la
profondeur du tableau
que ceci soit donc en quelque sorte caduc et
secondaire et non pas structural.
Je dis, c'est structural et jamais personne jusqu'ici
ne l'a suffisamment remarqu.
Ce second point, dans la perspective, se dfinit de
la remarque que quelle que soit la distance du sujet
provisoire
du sujet S qui est justement ce que nous avons
mettre en suspens et voir comment il rentre dans
le tableau
que quelle que soit la distance de ce sujet au
tableau, il y a quelque chose qui est simplement
l'entre lui et le tableau, ce qui le spare du
tableau et que ceci n'est pas simplement quelque
chose qui se notera de la valeur mtrique de cette
distance, que cette distance, en elle-mme s'inscrit
quelque part dans la structure et que c'est l que
nous devons trouver, non pas l'autre il comme disent
les auteurs de perspective (entre guillemets)
mais l'autre sujet.
Et ceci se dmontre de la faon dont je l'ai fait la
dernire fois et qui, pour certains n'a pas t
comprise, et qui se fonde sur la remarque que
premirement si nous faisons passer par le point S,
un plan [ S ], parallle non plus cette fois au plan
perspectif mais au tableau [S], il en rsulte deux
choses :
467
d'abord que ceci nous incite remarquer qu'il existe
une ligne [] d'intersection du tableau avec le plan,
sol perspectif dont le nom est connu, qui
s'appelle - si j'en crois le livre de PANOWSKY - qui
s'appelle la ligne fondamentale.
Je ne l'ai pas appele ainsi la dernire fois et
c'est cette ligne-l.
Le plan [ S ] parallle au tableau qui passe par le
point S coupe le plan du sol perspectif en une ligne
[b] parallle la premire .
De la reprsentation de ces deux lignes sur le
tableau -ce que j'appelais la dernire fois le plan-
figure - va se dduire ce que nous appellerons le
second point sujet.
En effet, dans la relation triple : S( point-sujet),
plan-tableau, sol perspectif, nous avons vu qu' la
ligne infinie sur le sol perspectif [q] - l je
pense avoir assez indiqu la dernire fois ce que
468
cette ligne infinie veut dire - la ligne infinie du
sol perspectif correspond la ligne horizon sur le
plan-tableau.
Dans le mme groupe de trois, vous pouvez si vous y
regardez de prs, vous apercevoir que la ligne ici
dfinie - appelons-la ligne (b) - celle de la
parallle la ligne fondamentale a la mme fonction
par rapport la ligne infinie du plan du tableau
[p] que l'horizon dans le plan-tableau a par rapport
la ligne infinie dans le sol perspectif.
Elle est donc reprsente dans la figure par cette
ligne infinie, bien sr dans le tableau, et d'autre
part comme la ligne fondamentale est dj dans le
tableau, l'autre point-sujet [S] - alors que le
premier se dfinissait ainsi : n'importe quel point
dans la ligne d'horizon lautre point-sujet [S]
469
peut s'crire ainsi : le point d'intersection de la
ligne infinie du plan tableau avec la ligne
fondamentale.
Vous voyez l que j'ai reprsent
d'une faon qui n'est que figure, qui est
insuffisante, la ligne infinie par un cercle
puisqu'en somme, pour l'intuition, elle est cette
ligne qui est toujours, de tous les cts l'infini
sur un plan quelconque.
Intuitivement, nous la reprsentons par un cercle
mais elle n'est pas un cercle.
Le prouvent tout son maniement et les correspondances
ligne par ligne, point par point qui constituent
l'essentiel de cette gomtrie projective.
L'apparent double point de rencontre qu'elle a avec
la ligne fondamentale n'est qu'une pure apparence
puisqu'elle est une ligne, une ligne considrer
comme ligne droite comme toutes les autres lignes, et
que deux lignes droites ne sauraient avoir qu'un seul
point d'intersection.
470
Ce ne sont pas l choses que je vous demande
d'admettre au nom d'une construction qui serait
mienne. Je ne peux pas, pour vous, pousser la porte
de la gomtrie projective, et nommment pas pour
ceux qui n'en ont pas encore la pratique.
Mais il est trs simple pour quiconque de s'y
reporter et voir qu'il n'y a rien reprendre dans ce
que j'avance ici, savoir qu'il en rsulte que nous
avons deux point-sujet dans toute structure d'un
monde projectif, ou d'un monde perspectif, deux
point-sujet : l'un [O] qui est un point quelconque
sur la ligne d'horizon, dans le plan de la figure,
l'autre qui est l'intersection d'une autre ligne
parallle la premire, qui s'appelle la ligne
fondamentale[] qui exprime un rapport du plan figure
au sol projectif avec la ligne l'infinie, dans le
plan-figure. [p]
Ceci mrite d'tre point par le chemin o c'est
venu, o nous avons pu l'tablir.
Mais une fois tabli par cette voie
dont vous verrez par la suite qu'elle n'est pas
sans - pour nous - constituer une trace
importante chaque fois que nous aurons reprer
cet autre point-sujet
je pense pour vous dire maintenant que si, dans le
plan-figure, nous traons la ligne d'horizon qui est
parallle cette ligne fondamentale, nous devons en
dduire que la ligne d'horizon coupe cette ligne
infinie exactement au mme point o la coupe la ligne
fondamentale puisque c'est une ligne parallle la
premire.
D'o vous verrez se simplifier beaucoup le rapport de
ces deux points, l'un est un point quelconque sur la
ligne d'horizon, l'autre est le point l'infini en
ceci que le point l'infini n'est pas un point
quelconque, qu'il est un point unique malgr que l,
il ait l'air d'tre deux.
C'est ceci qui sera pour nous
quand il s'agira de mettre en valeur la relation
du sujet dans le fantasme et nommment la
relation du sujet l'objet(a)
471
ceci aura pour nous valeur d'appui et mrite que
vous ayez pass le temps ncessaire, pas plus, pas
plus que dans les dmonstrations de DESCARTES.
Une dmonstration une fois saisie est dmontre,
encore faut-il en tenir la rigueur et les procs.
Ceci est ce qui doit nous servir, nous servir de
rfrence chaque fois que nous avons oprer quant
au fantasme scopique.
Ce sujet divis est soutenu par une monture commune,
l'objet(a) qui, dans ce schma est chercher o ? Il
est chercher en un point o bien entendu il tombe
et s'vanouit, sans a, ce ne serait pas l'objet(a).
L'objet(a) est ici reprsent par ce quelque chose
qui, justement, dans la figure - qu'ici, j'espre
vous en avoir montr avec ce succs, de vous en
rendre quelque chose sensible - l'objet(a) c'est ce
qui supporte ce point S, ce que j'ai ici figur par
la mene de ce plan parallle. Ce qui y est lid et
ce qui, pourtant y est toujours, c'est ce que, sous
plus d'une forme, j'ai dj introduit dans le rapport
structural du sujet au monde : c'est la fentre.
Dans le rapport scopique de ce sujet au point S d'o
part toute la construction, apparat spcifi,
individualis dans ce mur - si je puis m'exprimer
ainsi - que reprsente ce plan parallle en tant
qu'il va dterminer le second point du sujet, dans ce
mur il faut qu'il y ait une ouverture, une fente, une
vue, un regard. C'est cela, prcisment, qui ne
saurait tre vu de la position initiale de la
construction.
472
Nous avons dj vu cette fonction de la fentre,
l'anne dernire
159
nous rendre des services en tant
que surface de ce qui peut s'crire de plus premier
comme fonction de signifiant. Appelons-l du nom
qu'elle mrite, elle est
prcisment dans cette structure ferme - qui est
celle qui nous permettrait de nouer les uns avec
les autres tous ces diffrents plans que nous
venons de tracer et reproduire la structure du
plan projectif sous sa forme purement
topologique, savoir sous l'enveloppe du cross-
cap
elle est ce quelque chose de trou dans cette
structure qui permet prcisment que s'y introduise
l'irruption d'o va dpendre, d'o va dpendre la
production de la division du sujet :
c'est--dire, proprement parler, ce que nous
appelons l'objet(a). C'est en tant que la fentre,
dans le rapport du regard au monde vu, est toujours
ce qui est lid, que nous pouvons nous reprsenter
la fonction de l'objet(a). La fentre, c'est dire
aussi bien la fente des paupires, c'est dire aussi
159 Sminaire Problmes cruciaux : 23-06.
473
bien l'entre de la pupille, c'est dire aussi bien
ce qui constitue cet objet le plus primitif de tout
ce qui est-de la vision : la chambre noire.
Or c'est ceci que j'entends aujourd'hui vous
illustrer, vous illustrer par une uvre dont je vous
ai dit qu'elle avait t mise au premier plan dans
telle production rcente d'un investigateur dont le
type de recherches n'est certainement pas trs
loign de celui dont ici - au nom de l'exprience
psychanalytique - je prends la charge, encore que
nayant pas la mme base ni la mme inspiration, j'ai
nomm Michel FOUCAULT et ce tableau de VELZQUEZ qui
sappelle Les Mnines
160
.
Ce tableau, je vais le faire maintenant(fermez la
fentre) maintenant projeter devant vous pour que
nous y voyons d'une faon sensible ce que permet une
lecture de quelque chose qui n'est nullement en
quelque sorte fait pour rpondre la structure de ce
tableau mme, mais dont vous allez voir ce qu'il nous
permet.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il s'agit l d'un diapositive qui m'a t prte par
le Louvre, que je n'ai pas pu exprimenter avant, et
qui vraiment ne donnera l que le plus faible
support, mais qui pour ceux qui ont vu - soit quelque
photographie de ce tableau dit des Mnines, soit
simplement qui s'en souviennent un peu - nous servira
un peu de repre (vous n'avez pas un petit btonnet,
quelque chose pour que je puisse montrer les choses ?
Ce n'est pas beaucoup, mais enfin c'est mieux que
rien.)Voil. Alors, peut-tre pourriez-vous, vous
voyez quand mme un peu, enfin, le minimum.
Est-ce que, quand on est l-bas dans le fond, on voit
quelque chose ?
Melle X - Aussi bien que devant. Monsieur Milner a
essay.
160 Diego Velzquez, Las Meninas, 1656, Madrid, Prado.
474
Remarquez que ce n'est pas tellement dfavorable,
n'est ce pas Ici, vous avez la figure du peintre.
Vous allez la substituer tout de suite pour que, tout
de mme, on voit qu'il est bien l.
Alors, mettez au point.
X - C'est tout, je ne peux pas davantage.
Oui, remettez la premire.
Le peintre est au milieu de ce qu'il peint.
Et ce qu'il peint, vous le voyez rparti sur cette
toile, d'une faon sur laquelle nous allons revenir.
Ici, ce trait que vous voyez est la limite, le bord
externe, touch de lumire c'est pour a qu'il
merge, de quelque chose qui va de l, trs
exactement jusqu' un point qui se trouve ici - vous
voyez presque toute la hauteur du tableau - et qui
nous reprsente - vous voyez ici un montant de
chevalet - un tableau vu l'envers.
Il est sur cette toile. Il uvre ce tableau et ce
tableau est retourn
Vous avez quoi dire ?
ceci est le plan essentiel d'o nous devons partir,
et qu' mon avis Michel FOUCAULT - que je vous ai
tous pri de lire - dans son trs remarquable texte,
a lud. C'est en effet le point autour de quoi il
importe de faire tourner toute la valeur, toute la
fonction de ce tableau.
Je dirais que ce tableau est effectivement une sorte
de carte retourne
et dont nous ne pouvons pas ne pas tenir compte
qu'il est comme une carte retourne
qu'il prend sa valeur d'tre du module et du modle
des autres cartes.
Cette carte retourne, elle est l vraiment faite
pour vous faire abattre les vtres.
Car en effet, il y a eu - je ne pourrais pas ne pas
en faire mention - discussion, dbat, sur ce qu'il en
est de ce que le peintre - ici VELZQUEZ - est l,
une certaine distance du tableau, de ce tableau en
train de peindre.
475
La faon dont vous rpondrez cette question, dont
vous abattrez vos cartes, est en effet absolument
essentielle l'effet de ce tableau. Ceci implique
cette dimension que ce tableau subjugue. Depuis qu'il
existe, il est la base, le fondement de toutes sortes
de dbats. Cette subjugation a le plus grand rapport
avec ce que j'appelle cette subversion, justement, du
sujet, sur lequel j'ai insist dans toute la premire
partie de mon discours aujourd'hui, et c'est
prcisment de s'y appuyer qu'il prend sa valeur.
En fait, le rapport l'uvre d'art est toujours
marqu de cette subversion. Nous semblons avoir admis
avec le terme de sublimation quelque chose qui, en
somme, n'est rien d'autre. Car si nous avons
suffisamment approfondi le mcanisme de la pulsion
pour voir que ce qui s'y passe, c'est un aller et
retour du sujet au sujet, condition de saisir que
ce retour n'est pas identique l'aller et que,
prcisment, le sujet, conformment la structure de
la bande de MBIUS, s'y boucle lui-mme aprs avoir
accompli ce demi-tour, qui fait que parti de son
endroit, il revient se coudre son envers, en
d'autres termes qu'il faut faire deux tours
pulsionnels pour que quelque chose soit accompli qui
nous permette de saisir ce qu'il en est
authentiquement de la division du sujet.
C'est bien ce que va nous montrer ce tableau dont la
valeur de capture tient au fait qu'il n'est pas
simplement ce quoi nous nous limitons toujours,
prcisment parce que nous ne faisons qu'un tour et
que, peut-tre, en effet, pour la sorte d'artiste
qui nous avons affaire, c'est--dire ceux qui nous
476
consultent, l'uvre d'art est usage interne. Elle
lui sert faire sa propre boucle.
Mais quand il s'agit d'un matre tel que celui
prsent, il est clair que au moins ce qui reste de
toute apprhension avec cette uvre est que celui qui
la regarde y est boucl. Il n'y a pas de spectateur
simplement qui ne fasse autre chose que de passer
devant toute vitesse et rendre ses devoirs au rite
du muse - qui ne soit saisi par la particularit de
cette composition dont tous s'accordent dire que
quelque chose se passe en avant du tableau qui en
fait quelque chose de tout fait spcifique,
savoir - on s'exprime comme on peut - que nous sommes
pris dans son espace.
Et on se casse la tte chercher par quelle astuce
de construction, et de construction perspective ceci
peut se produire. partir de l on va plus loin, on
spcule, sur ce qu'il en est de la fonction de chacun
des personnages et des groupes et l'on ne voit pas
que tout ceci fait une seule et mme question.
On procde gnralement par cette voie qui est en
effet la question qui va rester au cur du problme
et qui est celle laquelle, la fin, j'espre
pouvoir donner la rponse. Qu'est-ce que le peintre
fait ? Qu'est-ce qu'il peint ?
Ce qui implique - et c'est le plus souvent puisqu'il
s'agit de critique d'art - la force sous laquelle se
pose la question : qu'a-t-il voulu faire ? Puisqu'en
somme, bien sr, personne ne prend proprement
parler au srieux la question : que fait-il ? Le
tableau est l : il est fini et nous ne nous
demandons pas ce qu'il peint actuellement. Nous nous
demandons : qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Ou plus
exactement quelle ide veut-il nous donner de ce
qu'il est en train de peindre ? Point o dj se voit
marqu videmment un rapport qui, pour nous, est bien
reconnaissable : ce que nous dsirons et dsirons
savoir c'est trs proprement parler quelque chose,
qui est de l'ordre de ce qu'on appelle dsir de
477
l'Autre, puisque nous disons : qu'est-ce qu'il a
voulu faire ?
C'est certainement la position errone prendre car
nous ne sommes pas en position d'analyser, je ne
dirai pas la peinture, mais un tableau.
Il est certain que ce qu'il a voulu faire, le
peintre, il l'a fait puisque c'est l, devant nos
yeux, et que par consquent, cette question, en
quelque sorte s'annule elle-mme d'tre en de du
point o elle se pose, puisque nous la posons au nom
de ce qu'il a dj fait. En d'autres termes, dans le
retour de boucle dont je parlais tout l'heure - et
c'est en ceci dj que ce tableau nous introduit la
dialectique du sujet - il y a dj un tour de fait et
nous n'avons qu' faire l'autre. Seulement pour a,
il ne faut pas manquer le premier.
La prsence du tableau qui occupe toute cette hauteur
et qui, du fait mme de cette hauteur, nous incite
y reconnatre le tableau lui-mme, qui nous est
prsent par la voie
je le note, en quelque sorte en marge de notre
progrs
qui passe par une autre voie que cette discussion,
pour ceux qui ont avanc cette thse que je me permet
de considrer comme futile
que c'est d'un autre tableau qu'il s'agit, vous
le verrez tout l'heure, nous le discuterons de
plus prs, savoir, le portrait du roi et de la
reine - que vous ne pouvez vas pas voir bien sr,
sur cette figure, bien sr tout fait
insuffisante que je vous ai apporte - ici dans
le fond et comme vous le savez j'espre (dans
l'ensemble) est prsent dans un cadre dont nous
aurons discuter tout l'heure de ce qu'il
signifie, mais dont certains prennent le
tmoignage comme indiquant que le roi et la reine
sont ici en avant du tableau et que c'est eux que
le peintre peint
ceci est, mon avis, rfutable.
Je ne veux pour l'instant que remarquer que c'est sur
ce fond, que je vous dis que la taille de la toile
est dj un argument qu'on peut apporter pour qu'il
478
n'en soit pas ainsi et que cette toile reprsente
soit exactement, reprsente, le tableau que nous
avons l, en tant qu'il est une toile supporte sur
une monture de bois dont nous voyons l, ici,
l'armature et qu'en d'autres termes, nous avons dans
ce tableau la reprsentation de ce tableau comme
ralit.
Je peux bien l pousser cette petite porte qui fait
qu'une fois de plus nous y trouvons le recoupement de
ma formule qui fait l, de l'objet pictural, un
Vorstellungsreprsentanz.
Non pas, du tout, que je dise que le tableau est
reprsentation dont la monture, le support serait le
reprsentant. S'il fonctionne ici pour nous faire
apercevoir ce qu'il y a l de vrit, c'est en ceci,
qu' nous mettre dans le tableau ce qui - chose
curieuse - est l fait pour la premire fois, car il
y a dj eu des choses telles que les miroirs dans le
tableau, mme de nombreux cette poque, mais le
tableau dans le tableau
ce qui n'est pas la scne dans la scne, pas du
tout
c'est quelque chose qui a t fait l, semble-t-il,
pour la premire fois et gure refait depuis, sauf au
niveau du point o je vous l'ai repr savoir dans
MAGRITTE.
Reprsentation, c'est bien en effet ce qu'est cette
figure de la ralit du tableau, mais elle est l
pour bien nous montrer que, au niveau de ralit et
de reprsentation, ce qui est l trac dans le
tableau, et le tableau mutuellement se saturent.
Et que c'est l en quoi il nous est point que
justement ce qui constitue le tableau dans son
essence n'est pas reprsentation, car quel est
l'effet de ce tableau dans le tableau :
Vorstellungreprsentanz.
C'est trs prcisment tout ces personnages
que vous voyez justement en tant qu'ils ne sont
pas du tout des reprsentations mais qu'ils sont
479
en reprsentation - que tous ces personnages -
quels qu'ils soient, dans leurs statuts, tels
qu'ils sont l effectivement dans la ralit,
quoique morts depuis longtemps, mais qu'ils y
sont toujours
sont des personnages qui se soutiennent en
reprsentation et avec une conviction entire, ce qui
veut dire prcisment, que de ce qu'ils reprsentent,
aucun d'entre eux ne se reprsente rien.
Et c'est cela l'effet de ce quelque chose qui
introduit dans l'espace du tableau, les noue, les
cristallise, dans cette position d'tre des
personnages en reprsentation, des personnages de
cour.
partir de l, que VELZQUEZ, le peintre, aille se
mettre au milieu d'eux, prend tout son sens. Mais
bien entendu, il va beaucoup plus loin que cette
simple touche, si l'en peut dire, de relativisme
social. La structure du tableau permet d'aller bien
au-del.
la vrit, pour aller au-del, il aurait fallu
partir d'une question non pas d'une question mais
d'un tout autre mouvement que ce mouvement de la
question dont je vous ai dit qu'elle s'annulait du
seul fait de la prsence de l'uvre elle-mme, mais,
partir de ce qu'impose l'uvre telle que nous la
voyons l, savoir que la mme touche d'enfance qui
nous est suggre par le personnage central , par
cette petite infante
qui est la seconde fille du couple royal :
Philippe IV et Dona Mariana d'Autriche
la petite Dona Margherita, je peux dire cinquante
fois peinte par VELZQUEZ, que nous nous laissions
guider par ce personnage qui vient en quelque sorte
notre devant dans cet espace qui est pour nous le
point d'interrogation et pour tout ceux qui ont vu ce
tableau, qui ont parl de ce tableau, qui ont crit
de ce tableau. Le point d'interrogation qu'il nous
pose, ce sont, pousss par sa bouche, les cris
dirais-je, dont il convient de partir pour pouvoir
480
faire ce que j'appellerai le second tour de ce
tableau
et c'est celui, me semble-t-il qui est manqu dans
l'analyse de l'uvre dont je parlais tout l'heure :
Fais voir ce qu'il y a derrire la toile telle
que nous la voyons l'envers, c'est un fais voir
qui l'appelle et que nous sommes plus ou moins prts
prononcer.
Or, de ce seul fais voir peut surgir ce qui, en
effet, partir de l s'impose, c'est--dire ce que
nous voyons, savoir ces personnages tels que j'ai
pu les qualifier pour tre essentiellement des
personnages en reprsentation. Mais nous ne voyons
pas que cela. Nous voyons la structure du tableau,
son montage perspectif. C'est ici qu'assurment je
peux regretter que nous n'ayons pas ici un support
qui soit suffisant pour vous dmontrer ces traits
dans leur rigueur. Ici, le personnage que vous voyez
s'encadrer dans une porte au fond de lumire est le
point trs prcis o concourent les lignes de la
perspective.
C'est en un point peu prs situ selon les lignes
qu'on trace entre la figure de ce personnage - car il
y a de lgres fluctuations du recoupement qui se
produisent - et son coude que se situe le point de
fuite et ce n'est pas hasard si par ce point de
fuite, c'est prcisment ce personnage et un
personnage qui sort.
Ce personnage n'est pas n'importe lequel.
Il s'appelle aussi VELZQUEZ, Nieto au lieu de
s'appeler Diego-Rodriguez. Ce Nieto est celui qui a
eu quelques voix au vote qui a fait accder VELZQUEZ
la position d'Aposentador du roi, c'est--dire
quelque chose comme chambellan ou grand Marchal.
C'est une sorte, en somme, de personnage qui le
redouble et ce personnage, ici, se dsigne nous de
ce fait par ce que nous ne voyons pas et nous
disons : fais voir - non seulement lui le voit,
de l o il est, mais qu'il l'a - si je puis dire -
trop vu il s'en va.
481
Est-ce qu'il y a meilleur moyen de dsigner cette
pointe quant ce qui s'panouit quant au sujet de la
fonction de l'il que ceci, qui s'exprime par un
vu en quelque sorte dfinitif.
Ds lors, la prsence de VELZQUEZ lui-mme dans
cette position o vous l'avez vu tout l'heure et la
seconde photo n'tant pas meilleure que la premire,
vous n'avez pas pu voir ce que vous pourrez voir sur
de meilleures reproductions et ce dont tmoigneront
mille auteurs qui en ont parl, savoir que ce
personnage qui regarde - on le souligne - vers nous,
spectateurs - Dieu sait si on a pu spculer sur cette
orientation du regard - ce personnage a prcisment
le regard le moins tourn vers l'extrieur qui soit.
Ceci n'est pas une analyse qui me soit personnelle.
Maints auteurs, la grande majorit l'ont remarqu.
L'aspect en quelque sorte, rveur, absent, tourn
vers quelque disegno interno
161
comme s'expriment les gongoristes, je veux dire
toute la thorie du style baroque, maniriste,
conceptiste, tout ce que vous voudrez et dont
GONGORA est l'exemple, est la fleur.
Disegno interno ce quelque chose quoi se rfre
le discours maniriste et qui est proprement ce
que j'appelle, que dans ce discours il n'y a pas
de mtaphore, que la mtaphore y entre comme une
composante relle
cette prsence de VELZQUEZ dans sa toile, sa figure
portant en quelque sorte le signe et le support qu'il
y est l, la fois, comme la composante et comme
161 Libertas artibus restituta : la libert rendue aux arts. Ce mouvement, initi ds le dbut de la Renaissance, a vu progressivement
se construire une thorie des arts visuels fonde sur une promotion de sa dimension intellectuelle . Pour que la peinture pt tre
considre comme un art libral , digne dtre pratique et enseigne par les gens libres , il lui fallait tre arrache du rang des
mtiers et des artisanats, qui supposaient un asservissement au corps et son exercice, et rapproche des disciplines de lesprit.
Cest ainsi que, dans son Trait de peinture posthume (1651), Lonard de Vinci affirme vouloir traiter de la peinture comme une cosa
mentale et non plus seulement comme une activit manuelle. De nombreux auteurs, comme Zuccaro et Bellori, en Italie, ont
prsent la peinture comme un art de lesprit , soumis au disegno interno, au dessein de lartiste (par rapport au designo externo, le
dessin, luvre comme objet extrieur) sa capacit forger en son esprit une image prcise et complte de luvre quil
souhaite raliser, et cela mme avant de lavoir excute.
482
lment d'elle, c'est l le point structural,
reprsent, par o il nous est dsign, ce qu'il peut
en tre, par quelle voie peut se faire, qu'apparaisse
dans la toile mme celui qui la supporte en tant que
sujet regardant.
Eh bien, il est quelque chose de tout fait frappant
et dont la valeur ne peut, mon avis, tre repre
que de ce que je vous ai introduit dans cette
structure topologique.
Deux traits sont mettre en valeur :
ce que ce regard regarde, et dont chacun vous dit
c'est nous, nous les spectateurs .
Pourquoi nous en croire tant ?
Sans doute il nous appelle quelque chose puisque
nous rpondons ainsi que je vous l'ai dit.
Mais ce que ce regard implique, comme aussi bien la
prsence du tableau retourn dans le tableau, comme
aussi bien cet espace qui frappe tout ceux qui
regardent le tableau, comme tant en quelque sorte
unique et singulier, c'est que ce tableau, s'tend
jusqu'aux dimensions de ce que j'ai appel la fentre
et la dsigne comme telle.
Ce fait que, dans un coin du tableau, par le tableau
lui-mme, en quelque sorte retourn sur lui-mme pour
y tre reprsent, soit cr cet espace en avant du
tableau o nous sommes proprement dsigns comme
l'habitant comme tel, cette prsentification de la
fentre dans le regard de celui qui ne s'est pas mis
par hasard, ni n'importe comment la place qu'il
occupe : VELZQUEZ, c'est l le point de capture et
l'action qu'exerce sur nous, spcifique, ce tableau.
cela, il y a un recoupement dans le tableau.
Je ne peux que regretter une fois de plus de devoir
vous renvoyer des images, en gnral, d'ailleurs je
dois dire, dans de nombreux volumes, toujours assez
mauvaises ou trop sombres ou trop claires. Ce tableau
n'est pas facile reproduire mais il est clair que
la distance du peintre au tableau, dans le tableau o
il est reprsent est trs suffisamment accentue
pour nous montrer qu'il n'est justement pas porte
483
de l'atteindre et que l, il y a une intention,
savoir que cette partie du groupe, ce qu'on a appel
ici Las Mninas, Les Mnines :
savoir Doa Margherita avec Doa Maria Agostina de
SARMIENTO qui est genoux devant elle, sont en avant
du peintre, alors que les autres, encore qu'ayant
l'air, d'tre sur un plan analogue, devant, sont
plutt en arrire, et que cette question de ce qu'il
y a de cet espace entre le peintre et le tableau est
non seulement l ce qui nous est prsent, mais qui
se prsentifie nous par cette trace qu'il suffit de
dsigner pour reconnatre qu'ici, une ligne de
traverse marque quelque chose qui n'est pas
simplement division lumineuse, groupement de la
toile, mais vritablement sillage du passage de cette
prsence fantasmatique du peintre en tant qu'il
regarde.
Si je vous dis que c'est quelque part au niveau de la
recoupe de la ligne fondamentale avec le sol
perspectif et en un point l'infini que va le sujet
regard, c'est bien galement de ce point que
VELZQUEZ a fait, sous cette forme fantomale qui
spcifie cet auto-portrait parmi tous les autres,
d'un des traits qui se distingue assurment du style
du peintre. Il vous dirait lui-mme :
Croyez-vous quun auto-portrait, cest de cette
goutte-l, de cette huile-l, de ce pinceau-l, que
je le peindrais ? .
Vous navez qu vous reporter au portrait
d'Innocent X qui est la Galerie PAMPHILJ pour voir
que le style nest pas tout fait le mme.
Ce fantme du sujet regardant et rentr par cette
trace qui est encore l sensible et dont je puis dire
que tous les personnages portent la vibration car,
dans ce tableau, o cest devenu un clich, un lieu
commun, et je lai entendu articuler des bouches, je
dois dire les plus - non seulement autorises mais -
les plus leves dans la hirarchie des crateurs.
Ce tableau dont on nous dit que c'est le tableau des
regards qui se croisent et d'une sorte d'intervision
484
comme si tous les personnages se caractrisaient de
quelque relation avec chacun des autres. Si vous
regardez les choses de prs, vous verrez qu' part le
regard de la Mnine Maria Agostina de SARMIENTO qui
regarde Doa Margherita, aucun autre regard ne fixe
rien. Tous ces regards sont perdus sur quelque point
invisible comme qui dirait : un ange a pass
prcisment le peintre.
L'autre Mnine qui s'appelle Isabel de VELASCO est
l, en quelque sorte, comme interdite, les bras
comme, en quelque sorte, carts de la trace de ce
passage. L'idiote, l, le monstre Mari-BARBOLA, la
naine, regarde ailleurs et non pas du tout, comme on
le dit, de notre ct.
Quant au petit nain, il s'occupe ici faire trs
prcisment, jouer trs prcisment le rle qu'il
est fait pour jouer en tant qu'imitation de petit
garon, il fait l'affreux jojo : il donne un coup de
pied sur le derrire du chien comme pour en quelque
sorte lui dire :
tu roupilles, alors ! T'as pas renifl la souris
qui vient de passer .
Regard, nous dirait-on, si on voulait encore le
soutenir, mais observez que dans un tableau qui
serait un tableau du jeu des regards, il n'y a
pas
en tout cas mme si nous devons retenir ce regard
de l'une des Mnines
deux regards qui s'accrochent, de regards complices,
de regards d'intelligence, de regards de qute.
Doa Margharita, la petite fille, ne regarde pas la
suivante qui la regarde. Tous les regards sont
ailleurs. Et bien entendu, le regard - au fond - de
celui qui s'en va, n'est plus qu'un regard qui veut
dire : Je te quitte , loin qu'il soit point sur
quiconque.
Ds lors que peut vouloir dire ce qu'on amne au
centre da la thorie de ce tableau quand on prtend
que ce qui est l au premier plan, notre place et
Dieu sait si le spectateur peut se dlecter d'un tel
support, d'une telle hypothse, ce sont le roi et la
485
reine qui sont reflts dans ce miroir qui devrait
vous apparatre ici et qui est dans le fond ?
A ceci j'objecterai : la peintre o qu'il se montre
dans ce tableau, o entend-il que nous le mettions ?
Une des hypothses, et une de celles qui ont le plus
sduit parmi celles qui ont t avances, c'est que,
puisque le peintre est l et que c'est ceci qu'il a
peint, c'est qu'il a d, tout cela, le voir dans un
miroir, un miroir qui est notre place.
Et nous voici transforms en miroir.
La chose n'est pas sans sduction ni mme sans
comporter un certain appel l'endroit de tout ce que
je vous voque comme relativit du sujet l'Autre,
ceci prs que - quand vous voudrez - c'est autour
d'une telle exprience que je vous pointerai la
diffrence stricte qu'il y a entre un miroir et la
fentre : deux termes prcisment qui structuralement
n'ont aucun rapport.
Mais tenons-nous en au tableau. Le peintre se serait
peint ayant vu toute la scne des gens autour de lui
dans un miroir.
Je n'y vois qu'une objection : c'est que rien ne nous
indique
des tmoignages de l'histoire,et Dieu sait si ce
sont l des nouvelles que l'histoire se charge de
transmettre
rien ne nous indique que VELZQUEZ fut gaucher.
Or c'est bien ainsi que nous devrions le voir
apparatre si nous prenons au srieux le fait que,
dans une peinture faite soi-disant l'aide d'un
miroir il se reprsente tel qu'il tait bien en
effet, savoir tenant son pinceau de la main droite.
Ceci pourrait vous paratre mince raison. Il n'en
reste pas moins que, s'il en tait ainsi, cette
thorie serait tout fait incompatible avec la
prsence, ici, du roi et de la reine. Ou c'est le
miroir qui est ici ou c'est le roi et la reine. si
c'est le roi et la reine, a ne peut pas tre le
peintre, si le peintre est ailleurs, si le roi et la
reine sont l, a ne peut pas tre le peintre qui est
l. Comme moi je suppose qu'il y tait effectivement.
Vous ne comprenez pas Monsieur CASTORIADIS ?
486
- Non.
Dans l'hypothse que le roi et la reine, reflts l-
bas dans le miroir taient ici pour se faire peindre
par le peintre, comme je viens d'liminer l'hypothse
que le peintre ft l autrement que par l'art de son
pinceau il fallait bien que le peintre ft l.
Et d'ailleurs, l'exigence que le peintre ft l et
non pas de l'autre ct d'un miroir que nous serions
nous-mme, est dans le fait de supposer que
roi et reine sont dans le miroir.
En d'autres termes, la mme place nous ne pouvons
pas mettre deux quelconques des personnages de ce
trio qui sont : un miroir suppos, le roi et la
reine, ou le peintre. Nous sommes toujours forcs,
pour que a tienne d'en mettre deux la fois et ils
ne peuvent pas tre deux la fois.
Si le roi et la reine sont l pour tre reflts dans
le fond dans le miroir
or il est impossible qu'ils soient reprsents
comme tant l dans le miroir, ne serait-ce quen
raison de l'chelle, de la taille o on les voit
dans le miroir o ils ont peu prs la mme
chelle que le personnage qui est en train de
sortir ct d'eux. Alors qu'tant donne la
distance o nous sommes, ils devraient tre
exactement deux fois plus petits. Mais ceci n'est
encore qu'un argument de plus.
Si le roi et la reine sont l dans cette hypothse,
alors, le peintre est ici et nous nous trouvons
devant la position avance par les anecdotiers,
par Madame de MOTTEVILLE
162
par exemple, savoir que
le roi et la reine taient ici et ils seraient
debout, encore plus(!), en train de se faire de
poser et auraient devant eux la range de tous ces
personnages, dont vous pouvez voir quelle serait la
fonction naturelle, si vraiment pendant ce temps-l
VELZQUEZ tait en train de peindre tout autre chose
qu'eux et par dessus le march, quelque chose qu'il
162 Franoise Bertaut de Motteville, (1621-1689), Mmoires, Vol. 1 5, Gallica.
487
ne voit pas puisqu'il voit tous ces personnages dans
une position qui l'entoure.
J'avance, l'oppos de cette impossibilit manifeste
que ce qui est l'essentiel de ce qui est indiqu par
ce tableau c'est cette fonction de la fentre. Que le
fait que la trace soit en quelque sorte marque de ce
par quoi le peintre peut y revenir est vraiment l ce
qui nous montre en quoi c'est l, la place vide. Que
ce soit en symtrie cette place vide
qu'apparaissent ceux, si je puis dire, dont non pas
la regard mais la supposition qu'ils voient tout,
qu'ils sont dans ce miroir exactement comme ils
pourraient tre derrire un grillage ou une vitre
sans tain
et aprs tout, rien la limite ne nous
empcherait de supposer qu'il ne s'agisse de
quelque chose de semblable, savoir de ce qu'on
appelle connect, en connexion avec une grande
pice, un de ces endroits du type endroit pour
pier
qu'ils soient l en effet, que le fait qu'ils voient
tout, soit ce qui soutient ce monde d'tre en
reprsentation, qu'il y ait l quelque chose qui nous
donne en quelque sorte le parallle au
Je pense donc je suis de DESCARTES :
Je peins donc je suis dit VELZQUEZ - et je suis
l qui vous laisse avec ce que j'ai fait pour votre
ternelle interrogation.
Et je suis aussi dans cet
endroit d'o je peux revenir la place que je vous
laisse, qui est vraiment celle o se ralise cet
effet de ce qu'il y ait chute et dsarroi de quelque
chose qui est au cur du sujet.
La multiplicit mme des interprtations, leur(on peut
dire)leur embarras, leur maladresse est l,
suffisamment faite pour le souligner.
Mais l'autre point qu'avons-nous ?
Cette prsence du couple royal jouant exactement le
mme rle que le dieu de DESCARTES savoir que, dans
tout ce que nous voyons, rien ne trompe, cette
seule condition que le Dieu omniprsent, lui, y soit
488
tromp. Et c'est l, la prsence de ces tres que
vous voyez dans cette atmosphre brouille si
singulire du miroir. Si ce miroir est l, en quelque
sorte, l'quivalent de quelque chose qui va
s'vanouir au niveau du sujet qui est l, comme en
pendant de ce petit (a) de la fentre au premier
plan, est-ce que ceci ne mrite pas que nous nous y
arrtions un peu plus ?
Un peintre, une trentaine d'annes plus tard qui
s'appelait Luca GIORDANO, prcisment un maniriste
en peinture - et qui a gard dans l'histoire
l'tiquette de fa presto parce qu'il allait un peu
vite, extraordinairement brillant d'ailleurs - ayant
longuement contempl cette image dont je ne vous ai
pas fait l'histoire quant la dmonstration, a
profr une parole, une de ces paroles, mon Dieu comme
on peut les attendre de quelqu'un qui tait la fois
maniriste et fort intelligent : c'est la thologie
de la peinture a-t-il dit.
Et bien sr, c'est bien ce niveau thologique o le
Dieu de DESCARTES est le support de tout un monde en
train de se transformer par l'intermdiaire du
fantme subjectival, c'est bien par cet intermdiaire
du couple royal qui nous apparat scintillant dans ce
cadre au fond que ce terme prend son sens.
Mais je ne vous quitterai pas sans vous dire, quant
moi ce que me suggre le fait qu'un peintre comme
VELZQUEZ ce qu'il peut avoir de visionnaire.
Car qui parlera son propos de ralisme ?
Qui par exemple propos des Hilanderas osera dire
que c'est l la peinture d'une rudesse populaire ?
Elle l'est sans doute, qui veut simplement terniser
le flash qu'il aurait eu un jour en quittant la
manufacture de tapisseries royales et en voyant les
ouvrires au premier plan faire cadre ce qui se
produit au fond.
Je vous prie simplement de vous reporter cette
peinture sur quelque chose qui vaille plus que ce que
je vous ai montr l, pour voir combien peut-tre
distante de tout ralisme
489
et d'ailleurs, il n'y a pas de peintre raliste,
mais visionnaire, assurment
et mieux regarder ce qui se passe au fond de cette
scne
dans ce miroir o ces personnages nous
apparaissent clignotant et eux assurment
distincts de ce que j'ai appel tout l'heure
fantomal mais vraiment brillants
il m'est venu ceci : qu'en opposition, polairement
cette fentre o le peintre nous encadre et comme en
miroir, il nous fait surgir
ce qui, pour nous, sans doute, ne vient pas
n'importe quelle place, quant ce qui se passe
pour nous des rapports du sujet l'objet(a)
l'cran de tlvision.
INNOCENT X
490
Las Hilanderas retour 25-05 Table des sances
491
l8 Mai l966 Table des sances
GREEN AUDOUARD LACAN
Je voudrais saluer parmi nous la prsence de Michel
FOUCAULT qui me fait le grand honneur de venir ce
sminaire. Quant moi je me rjouis d'avoir moins
me livrer devant lui mes habituels exercices que
d'essayer de lui montrer ce qui fait le but principal
de nos runions c'est--dire un but de formation ce
qui implique plusieurs choses, entre nous, d'abord
que les choses ne doivent pas tre ces choses des
deux bords, du vtre et du mien, et immdiatement
repres au mme niveau sans a, quoi bon ? C'est
une fiction d'enseignement.
C'est bien pour cela que, depuis trois de nos
rencontres, Je suis amen revenir sur le mme plan,
plusieurs reprises, par une sorte d'effort,
d'accommodation rciproque. Je pense que dj, entre
l'avant-dernire fois et la dernire, il s'est
produit un pas et j'espre qu'il s'en fera un autre
aujourd'hui. Pour tout dire, je reviendrai
aujourd'hui encore sur ce support tout fait
admirable que nous ont donn Les Mnines, non pas
qu'elles aient t amenes au premier plan comme
l'objet principal, bien sr - nous ne sommes pas
ici l'Ecole du Louvre - mais parce que, il nous a
sembl que s'y illustraient d'une faon
particulirement remarquable certains faits que
j'avais essay de mettre en vidence et sur lesquels
je reviendrai encore pour quiconque ne m'aura pas
suffisamment suivi. Il s'agit l videmment de choses
peu habituelles.
492
L'emploi ordinaire de l'enseignement, qu'il soit
universitaire ou secondaire, par lequel vous avez t
form, fait que ce qui constitue par exemple la forme
vraiment essentielle de la gomtrie moderne, vous
reste non seulement ignore mais spcialement opaque,
ce dont j'ai pu, bien sr, voir l'effet quand j'ai
essay de vous en amener - par des figures, des
figures trs simples et exemplaires - essay de vous
en amener quelque chose qui en suscitt pour vous la
dimension.
L-dessus Les Mnines se sont prsentes, comme il
arrive souvent - il faut bien s'merveiller, on a
tort de s'merveiller - les choses vous viennent
comme bague au doigt.
On n'est pas seul travailler dans le mme champ.
Ce que Monsieur Michel FOUCAULT avait crit dans son
premier chapitre a t tout de suite remarqu par
certains de mes auditeurs - je dois dire avant moi -
comme devant constituer une sorte de point
d'intersection particulirement pertinent entre deux
champs de recherche.
Et c'est bien en effet ainsi qu'il faut le voir et je
dirai d'autant plus qu'on s'applique relire cet
tonnant premier chapitre, dont j'espre que ceux qui
sont ici se sont aperus qu'il est repris un peu plus
loin dans le livre, au point-cl, au point-tournant
celui o se fait la jonction de ce mode, de ce mode
constitutif, si l'on peut dire des rapports entre les
mots et les choses tel qu'il s'est tabli dans un
champ qui commence la maturation du XVI
me
sicle
pour aboutir ce point particulirement exemplaire
et particulirement bien articul dans son livre qui
est celui de la pense du XVIII
me
.
Au moment d'arriver ce qui fait son but, dans sa
perspective
au point o il nous a amen, la naissance d'une
autre articulation, celle qui nat au XIX
me
sicle, celle qui lui permet dj de nous
introduire la fois la fonction et le caractre
493
profondment ambigu et problmatique de ce qu'on
appelle les sciences humaines
ici Monsieur Michel FOUCAULT s'arrte et reprend son
tableau des Mnines, autour du personnage propos
duquel nous avons laiss la dernire fois nous-mme
suspendu notre discours, savoir, dans le tableau,
la fonction du roi.[ p.318]
Vous verrez que c'est ce qui nous permettra
aujourd'hui - si nous en avons le temps, si les
choses s'tablissent comme je l'espre
d'tablir pour moi la jonction entre ce que je viens
d'amener
en apportant cette prcision que la gomtrie
projective peut nous permettre de mettre dans ce
qu'on peut appeler la subjectivit de la vision
de faire la jonction de ceci, avec ce que j'ai
apport dj ds longtemps sous le thme du
narcissisme du miroir.
Le miroir est prsent dans ce tableau sous une forme
nigmatique, si nigmatique qu'humoristiquement la
dernire fois, j'ai pu terminer en disant qu'aprs
tout, faute de savoir qu'en faire, nous pourrions y
voir ce qui apparat tre - d'une faon surprenante
en effet quelque chose qui ressemble singulirement
notre cran de tlvision. Ceci est videmment un
conceto. Mais vous allez le voir aujourd'hui, si nous
en avons le temps (je le rpte) que ce rapport entre
le tableau et le miroir, ce que l'un et l'autre, non
pas seulement nous illustrent ni ne nous reprsentent
mais vraiment reprsentent comme structure de la
reprsentation, c'est ce que j'espre pouvoir
introduire aujourd'hui.
Mais je ne veux pas le faire sans avoir eu ici
quelques tmoignages des questions qui ont pu se
poser la suite de mes prcdents discours. J'ai
demand GREEN, qui d'ailleurs puisque nous sommes
en sminaire ferm s'tait offert en quelque sorte,
spontanment, m'apporter cette rplique en m'en
apportant en dehors de ce cercle. Je vais donc lui
donner la parole.
494
Je crois qu'AUDOUARD - je ne sais pas s'il est ici -
voudra bien aussi, nous apporter certains lments
d'interrogation et tout de suite aprs, j'essaierai,
en leur rpondant, peut-tre, j'espre, d'amener
Monsieur Michel FOUCAULT me donner quelques
remarques. En tout cas, je ne manquerai certainement
pas de l'interpeller.
Bien. Je vous donne la parole, GREEN. Je suis un peu
fatigu de la voix aujourd'hui. Je ne suis pas sr
que dans cette salle - dont l'acoustique est aussi
mauvaise que la propret, aujourd'hui tout au moins -
je ne suis pas sr que on m'entende trs bien
jusqu'au fond. Si ?
Enfin, c'est le moment de faire une petit mouvement
de foule et de vous rapprocher. Je me sentirai plus
sr.
GREEN
En fait, ce que LACAN m' demand, c'est
essentiellement de lui donner l'occasion de repartir
sur le dveloppement qu'il avait commenc la dernire
fois. Et c'est partir de certaines remarques que je
m'tais faites moi-mme au moment de son commentaire,
que j'avais pris la libert de lui crire.
Ces remarques tenaient essentiellement aux conditions
de projection qui taient trs directement lies au
commentaire de LACAN et sa propre place, occupe
par lui, dans le commentaire, et de ce qu'il n'y
pouvait apercevoir du point o il tait.
Les conditions de cette projection ayant t, comme
vous le savez, dfectueuses, et l'absence d'une
suffisante obscurit ont considrablement dnatures
le tableau, et notamment, certains dtails de ce
tableau sont devenus totalement invisibles. C'tait
en particulier le cas pour ce qui concernait
LACAN
GREEN ce n'est pas une critique
On va le projeter aujourd'hui.
495
Aujourd'hui, a va marcher. Je ne pense pas que c'ait
t l'insuffisante obscurit - encore que l'obscurit
nous soit chre - ce n'est pas de a qu'il s'agit.
Je crois que c'est que la lampe tait - je ne sais
pas pourquoi - mal rgle ou faite pour un autre
emploi.
Bref, mon clich la dernire fois
j'ai maudit l'cole du Louvre, j'ai eu tort et je
suis all m'en excuser
mon clich tait non seulement trs suffisant mais
vous allez le voir, excellent. C'est donc une
question de lampe.
Naturellement, il faut baisser ces rideaux si nous
voulons avoir la projection. Alors, faitesle vite.
Vous serez gentils Voil. Merci.
Alors, vous y allez Gloria. Vous mettez Les Mnines.
GREEN
En fait, ce qui tait effac, en cette occasion,
c'tait le personnage de VELZQUEZ lui-mme, le
peintre et le couple. Aujourd'hui, en peut mieux le
voir, mais la dernire fois, justement, ce qui tait
effac, c'tait le personnage du peintre et ce
couple, ce couple qui tait apparu comme totalement
effac.
Je me suis interrog sur cet effacement et je me suis
demand si, au lieu de le considrer simplement comme
une insuffisance, nous ne pouvions pas considrer que
cet effacement tait lui-mme significatif de quelque
chose comme une de ces productions de l'inconscient,
comme l'acte manqu, comme l'oubli et s'il n'y savait
pas l une cl, une cl qui unit trangement le
peintre et ce couple qui se trouve tre dans la
pnombre, qui parait, du reste, se dsintresser de
la scne et qui parait chuchoter.
Et c'est partir de cette rflexion que je me suis
demand s'il n'y avait pas l quelque chose creuser
propos de cet effacement, et effacement de trace
dans le tableau, o les plans de lumire sont
distingus de faon trs prcise, aussi bien par
496
LACAN que par FOUCAULT avec, notamment le plan de
lumire du fond, de l'autre VELZQUEZ, le VELZQUEZ
du fond, et le plan de lumire qui lui vient de la
fentre.
Ce serait donc dans cet entre-deux, dans cet entre-
deux lumires que, peut-tre, il y aurait l quelque
chose creuser sur la signification de ce tableau.
Maintenant, on pourrait peut-tre rallumer si vous
voulez.
Ceci ce sont donc les remarques que j'avais faites
LACAN par crit, sans du tout penser qu'elles
n'avaient un but diffrent que de relancer sa
rflexion. Et puis, j'ai repris le texte de FOUCAULT,
ce chapitre tellement remarquable, pour y constater
un certain nombre de points de convergence avec ce
que je venais de vous dire, et notamment ce qu'il dit
lui-mme du peintre, il dit :
Sa taille sombre et son visage clair sont mitoyens du
visible et de l'invisible .[p.19]
Par contre, FOUCAULT me parait avoir t trs
silencieux sur le couple dont je viens de parler. Il
fait allusion du reste, il parle de courtisan qui est
l et il ne parle pas du tout du personnage, qui,
ce qu'il parait, semble tre une religieuse, ce
qu'on peut voir. L je dois dire que la reproduction
qui est dans le livre de FOUCAULT ne permet
absolument pas de la voir, alors que la reproduction
que vient d'pingler LACAN ici, permet de penser
qu'il y a de fortes raisons pour que ce soit une
religieuse. Et j'ai retrouv, videmment dans le
texte de FOUCAULT, un certain nombre d'oppositions
systmatiques qui clairent la structure du tableau.
Certaines de ces oppositions ont dj t mises en
lumire et notamment, par exemple, il y a
l'opposition du miroir, le miroir comme support d'une
opposition entre le modle et le spectateur, le
miroir comme opposition au tableau et la toile, et
notamment, en ce qui concerne cette toile, une
formulation de FOUCAULT qui, nous rappelle, je crois,
beaucoup, la barrire du refoulement.
497
Elle empche que soit jamais reprable ni dfinitivement
tabli le rapport des regards . [p.21]
Cette espce d'impossibilit confre la situation
de la toile, son envers de savoir, ce qui y est
inscrit, nous fait penser, nous, qu'il y a l un
rapport tout fait essentiel .
Mais surtout, par rapport aux rflexions de LACAN sur
la perspective, ce qui m'a paru intressant, c'est,
non pas de retrouver d'autres oppositions, il y en a
et j'en oublie bien entendu, mais surtout d'essayer
de comprendre la succession des diffrents plans du
fond vers la surface, justement dans la perspective
de LACAN sur la perspective.
Eh bien, il n'est certes pas indiffrent, je crois,
qu'on puisse y retrouver au moins quatre plans.
Quatre plans qui sont successivement, le plan de
l'autre VELZQUEZ : celui du fond, le plan du couple,
le plan du peintre, et le plan constitu par
l'Infante et ses suivantes, l'idiote, le bouffon et
le chien qui sont tous en avant de VELZQUEZ.
Ils sont en avant de VELZQUEZ et je crois qu'on peut
diviser ce groupe lui-mme en deux sous-groupes : le
groupe constitu par l'Infante o FOUCAULT voit un
des deux centres du tableau, l'autre tant le miroir
- et je crois que ceci est videmment trs important
et l'autre sous-groupe constitu par l'animal et les
monstres, c'est--dire l'idiote et le bouffon
Nicolasito PERCUSATO avec le chien.
Je crois que cette division sur le mode d'arrire en
avant, avec ces deux groupes, pourrait nous faire
penser
et l, peut-tre que je m'avance un peu, mais
c'est uniquement pour donner une matire vos
commentaires et vos critiques
comme quelque chose qui fait de ce tableau, bien sr
un tableau sur la reprsentation, la reprsentation
de la reprsentation classique, comme nous disons,
mais aussi peut-tre de la reprsentation comme
cration et comme, finalement, cette antinomie de la
cration entre - sur la partie gauche - entre cet
498
tre, absolument, qui dans le rapport de l'Infante
ses deux gniteurs qui sont derrire, reprsente la
cration sous sa forme humaine la plus russie, la
plus heureuse, et au contraire dport de l'autre
ct, du ct de la fentre, par opposition la
toile, ces rats de la cration, ces marques de la
castration que peuvent reprsenter l'idiote et le
bouffon.
Si bien qu' ce moment-l, ce couple qui serait dans
la pnombre, aurait une singulire valeur par rapport
l'autre couple reflt dans le miroir, qui est
celui du roi et de la reine.
Cette dualit tant probablement trop porte, ce
moment-l sur le problme de la cration, en tant que
justement c'est ce que VELZQUEZ est en train de
peindre, et o nous trouvons cette dualit,
probablement entre ce qu'il peint et le tableau que
nous regardons.
Je crois que c'est par opposition ces plans et
ces perspectives et probablement le fait que ce n'est
pas un hasard, ce que je ne savais pas, si le
personnage du fond, et FOUCAULT crit propos de ce
personnage du fond, dont je ne savais pas qu'il
s'appelait VELZQUEZ et dont on peut dire qu'il est
l'autre VELZQUEZ, il dit de lui une phrase qui m'a
beaucoup frappe :
Peut-tre va-t-il entrer dans la pice ? Peut-tre se
borne-t-il pier ce qui se passe l'intrieur, content
de surprendre sans tre observ . [p.26]
Eh bien je crois que, justement, ce personnage de par
sa situation, est justement en posture d'observer et
il observe quoi ? Evidemment tout ce qui se droule
devant lui, alors que VELZQUEZ, lui, n'est
absolument pas en mesure d'observer ce couple qui est
dans la pnombre, et ne peut que regarder ce qui est
en avant de lui, c'est--dire ces deux sous-groupes
dont je viens de parler.
Je ne veux pas tre beaucoup plus long pour laisser
la parole LACAN, mais je crois que nous ne pouvons
pas ne pas voir quel point dans tout cela et dans
499
le rapport de la fentre et du tableau dont parle
LACAN, eh bien, je crois que l'effet de fascination
produit par ce tableau - et je crois que c'est a qui
est le plus important pour nous, c'est que ce tableau
produit un effet de fascination - est directement en
rapport avec le fantasme dans lequel nous sommes pris
et peut-tre que, justement, y a-t-il l quelque
rapport avec ces quelques remarques que je faisais
concernant la cration, autrement dit la scne
primitive.
LACAN
Bien. Nous pouvons remercier GREEN la fois de son
intervention et - mon Dieu, a n'a pas l'air trs
aimable ! - de sa brivet. Mais nous avons perdu
beaucoup de temps au dbut de cette sance. Je
demanderais AUDOUARD s'il veut, de faire une
intervention dont je ne doute pas qu'elle doive avoir
les mmes qualits.
Xavier AUDOUARD
Justement, il me semble que dans un sminaire comme
celui-ci, ne doivent pas se borner parler ceux qui
ont compris, les lves brillants, mais que ceux qui
n'ont pas compris, aussi puissent le dire.
Alors, je voudrais dire Monsieur LACAN et
vous-mme, en m'excusant d'avance du caractre un peu
ingrat de cette intervention, que ce que je voudrais
exprimer, c'est surtout ce que je n'ai pas compris
dans la prsentation que Monsieur LACAN nous a faite,
de la topologie que Monsieur LACAN nous a faite, en
partie dans la rencontre du plan-support et du plan-
figure. D'abord, il y a plusieurs manires de ne pas
comprendre. Il y a une manire qui est de sortir du
sminaire en se disant : je n'ai rien compris du
tout. Mon vieux toi, tu as compris quelque chose ?
Moi non plus dit l'autre. Et puis on en reste l.
500
Et puis, il y a l'autre manire que pour une fois
j'ai adopte c'est de me mettre devant une feuille de
papier et essayer de me faire mon petit graphe moi,
mon petit schma moi.
a n'a pas t sans mal. C'tait surtout ce matin
parce que c'est ce matin que Monsieur LACAN m'a
tlphon pour me dire que j'aurais peut-tre quelque
chose dire. Alors je me suis dpch faire
quelque chose, alors c'est vraiment tout fait comme
a, impromptu.
Seulement, je suis bien gn car ce petit graphe
moi. J'aurais bien voulu le mettre quelque part et je
m'aperois que ce serait dtruire l'ordonnancement de
la sance et
LACAN - Le papier est pour a, servez-vous de a.
AUDOUARD
Merci beaucoup. Alors ce que je vais faire, je vais
simplement en vous disant la manire dont je me suis
vu oblig de m'exprimer moi-mme, les choses, je
demanderai Monsieur LACAN de me dire en quoi je me
suis tromp
LACAN - Allez-y mon vieux, allez-y.
nous permettront de mieux voir. Bon. Je vais figurer
par un plan circulaire, ce plan du regard [Pr] dans
lequel mon il est pris, plan du regard dans lequel
mon il est pris, donc que mon il ne peut pas voir.
Ici, il va y avoir la ligne infinie [] qui va
conduire l'horizon[h].
501
Ici [A], il va y avoir la rptition projective de
cette ligne[h] qui ne sera pas seulement la
rptition projective de cette ligne comme s'il
s'agissait d'une gomtrie mtrique, mais qui va tre
la possibilit, pour une gomtrie mtrique que
chacun de ses points, bien sr, parallles cette
ligne [] vienne s'y projeter et constituer une
ligne parallle, mais en ralit, pour mon il situ
ici [O] dans le champ du regard, chacune de ces
lignes [, ] n'est donc plus parallle mais viendra
constituer un point [B], comme ceci, dans la
perspective offerte mon il.
Bon. Il est aussi certain que la ligne infinie [] qui
se trace depuis le champ du regard jusqu' l'horizon,
sera elle-mme, d'une manire ou d'une autre - et
c'est l que peut-tre, ma position est un petit peu
incertaine - d'une manire ou d'une autre projete
sur cette ligne [h] et donc en fin de compte, sur ce
point [B]. Chaque point de cette ligne [] et chaque
point de cette ligne [A] seront en fin de compte
projets sur ce point[B].
Ici j'ai le plan-figure [Pf], c'est--dire ce qui
s'offre moi, ce qui s'offre mon regard lorsque je
regarde : mon champ, mon champ dans lequel le plan
que je ne puis pas voir, moi, c'est--dire le plan-
support - le plan du regard dans lequel mon il est
pris - d'une manire ou d'une autre, va se projeter.
Tant et si bien que, comme Monsieur LACAN nous l'a
souvent fait remarquer, je suis vu autant que je
vois.
502
C'est--dire que les lignes [, ] qui viennent ici
rejoindre le plan du regard ou cette ligne
fondamentale dont nous a parl Monsieur LACAN, ce
plan-figure, seront aussi bien inversables si je puis
dire, comme ceci[, ], par une projection exactement
inverse. Tant et si bien que si je considre que dans
le plan-figure se projette le plan-regard, que le
plan-regard me renvoie quelque chose qui venait du
plan-figure, il y aura chaque point intermdiaire
entre le plan du regard et la ligne infinie - le
point de fuite, le point d'horizon - il y aura
chaque point de cet espace, une diffrence entre la
perspective, si je la considre comme vectorialise
pour ainsi dire comme ceci, ou vectorialise comme
cela, c'est--dire que, par exemple, un arbre qui
aura cette dimension dans ce vecteur.
Il y aura cette dimension dans ce vecteur.
Il y aura donc ici un cart [a], quelque chose de non
vu qui ne vient qu'exprimer que, chaque point de ce
plan [Pr], il y a aussi, un cart de chaque point par
rapport, lui-mme, c'est--dire que cet espace ne
sera pas homogne et que chaque point sera dcal par
rapport lui-mme en un cart non vu, non visible
503
qui cependant vient constituer trangement chacune
des choses que mon il peroit dans le plan
perspectif. Chacune de ces choses, vues dans le plan
perspectif tant renvoye par le plan-figure en tant
que dans ce plan-figure, le plan du regard se
projette. Chacun de ces carts pourra tre appel (a)
et ce (a) est constitutif de l'cart que chaque point
du plan-regard prend par rapport lui-mme.
Une non-homognit absolue de ce plan se dcouvre
ainsi et chaque objet se dcouvre comme pouvant avoir
une certaine distance par rapport lui-mme, une
certaine diffrence par rapport lui-mme.
Et je suis frapp que, dans ce que vient de nous dire
GREEN, si l'on considre en effet cette sorte
d'entrecroisement des clairages du plan, les figures
dont il nous a parl se situent comme
l'intersection pour rejoindre en quelque sorte, pour
rejoindre ce qui se croise ici comme cela.
Et qu'en effet, il y a, peut-on dire aussi, dans
l'clairement des visages par rapport aux corps un
petit quelque chose qui dpasse et qui pourrait - en
manire d'illustration simple, je ne prtends pas
faire plus - qui pourrait nous indiquer cette petite
diffrence justement que prend l'objet par rapport
lui-mme quand on met en regard, c'est le moment de
le dire, le plan du regard et le plan de la figure.
Voil la manire dont je me suis exprim les choses
et je laisse Monsieur LACAN le soin de me dire que
je me suis lourdement tromp ou que j'ai mconnu une
partie de ce qu'il a dit l'autre jour.
LACAN
Je vous remercie beaucoup AUDOUARD.
Voil. C'est vraiment une construction intressante
parce qu'exemplaire. Je peux difficilement croire
qu'il ne s'y soit pas ml pour vous le dsir de
concilier un premier schma que j'avais donn au
moment o je parlais de la pulsion scopique, il y a
504
deux ans
163
avec ce que je viens de vous apporter la
dernire fois et l'avant-dernire.
Ce schma tel que vous le produisez et qui ne
correspond ni l'un ni l'autre de ces deux noncs
de ma part, si toutes sortes de caractristiques dont
la principale est de vouloir figurer, du moins je le
crois, si je ne me trompe pas moi-mme sur ce que
vous avez voulu dire, en somme, une certaine
rciprocit de la reprsentation que vous avez
appel la figure, avec ce qui se produit dans le plan
du regard d'o vous tes parti.
Je pense, c'est bien en effet d'une espce de
reprsentation strictement rciproque qu'il s'agit et
o se marque, si l'on peut dire, le vertige permanent
de l'intersubjectivit.
L-dessus vous introduisez, d'une faon qui
mriterait d'tre critique dans le dtail, je ne
sais quoi que je ne veux pas, dans lequel je ne veux
pas m'appesantir, o il rsulterait quelque chose par
quoi l'objet, c'est bien d'un objet qu'il s'agit
puisque vous avez suppos un petit arbre qui tirerait
en quelque sorte - je vais un peu vite - qui tirerait
tout son relief, de la non-concidence des deux
perspectives qui le saisissent. Ce qui, en effet,
doit tre peu prs soutenable de la faon dont vous
avez pos les choses.
Et d'ailleurs je crois que, la fin, ce n'est pas
pour rien que vous nous prsentez dans le plan du
regard deux points carts l'un de l'autre et qui
viennent l, singulirement, sans que je ne sache si
c'est votre intention, mais d'une faon frappante,
voquer la vision binoculaire. Bref, vous paraissez,
avec ce schma, tre tout fait prisonnier de
quelque chose d'assurment confus, et qui prend son
prestige de recouvrir assez bien ce que s'efforce
d'explorer la physiologie proprement optique.
Or - je vais naturellement trs vite - a vaudrait
la peine d'tre discut, en dtail, avec vous, mais
163 Sminaire Les quatre concepts 04-03 et 11-03.
505
alors je pense que le sminaire d'aujourd'hui ne
pourrait pas tre considr comme restant dans l'axe
de ce que nous avons dire.
Bref il est facile de reprer l les dfauts de votre
construction par rapport ce que j'ai apport, le
fait que vous soyez parti de quelque chose que,
disons, vous appelez le plan du sujet voyant ou le
plan du regard, que vous soyez parti de l est une
erreur tout fait sensible et extrmement
dterminante dans l'embarras que vous a donn la suite
de votre tentative de recouvrir ce que j'ai dit. a
ne me donnera qu'une occasion de l'exprimer une fois
de plus.
Partir de l en disant que ceci[A], dont vous avez
trac la ligne horizontale sans prciser tout de
suite, n'est-ce pas, ce que c'tait
et d'ailleurs ce sur quoi nous restons dans
l'embarras, parce que, cette ligne, ce par quoi
elle est dtermine : elle est dtermine par ce
plan que j'ai appel la premire fois le plan-
support, que j'ai appel plus simplement et pour
faire image, ensuite, le sol n'est-ce pas, le
plan sol
vous ne le prcisez pas, mais par contre supposer
que quoi que ce soit qui est dans ce plan, dans ce
plan du regard, peut aller se projeter ce quelque
chose que vous avez introduit d'abord et qui est la
ligne d'horizon, c'est vraiment manquer l'essentiel
de ce qu'apportait la construction que je vous ai
montre l'autre jour [ Supra 11-05 ] en second temps, aprs
l'avoir d'abord exprime [ Supra 04-05 ] d'une faon, enfin,
qui aurait pu se traduire simplement par des lettres
ou des chiffres au tableau.
Rien de ce qui est dans ce plan du regard, si nous
l'avons dfini comme je l'ai dfini, c'est--dire
comme parallle au plan-figure ou encore au tableau,
n'est-ce pas, rien trs prcisment, ne peut aller
s'y projeter dans le tableau d'une faon qui soit par
vous reprsentable, puisque cela va en effet s'y
projeter, puisque tout s'y projette mais cela va s'y
506
projeter selon, non pas la ligne d'horizon mais la
ligne l'infini du tableau.
Ce point-l [x] :
donc, que je vais faire en rouge pour le distinguer
de vos traits, ce point-l, donc, est le point
l'infini du plan du tableau. Vous y tes ?
Ceci est facile concevoir puisque, si nous
rtablissons les choses comme elles doivent tre,
savoir, je dessine ici
voulez-vous me mettre d'autres feuilles de papier
Gloria s'il vous plat parce que, ce sera vraiment
trop confus
pendant ce temps-l, je vais, tout de mme, essayer de
dire en quoi tout ceci nous intresse, parce que,
aprs tout, pour quelqu'un comme FOUCAULT qui n'a pas
assist nos prcdents entretiens, cela peut
paratre un peu en dehors des limites de l'pure,
c'est le cas de le dire.
Mais enfin a peut m'tre l'occasion, a peut m'tre
l'occasion, de prciser ce dont il s'agit.
Nous sommes des psychanalystes.
quoi avons-nous affaire ?
une pulsion qui s'appelle la pulsion scopique.
Cette pulsion, si la pulsion est une chose construite
comme FREUD nous l'inscrit, et si nous essayons la
suite de ce qu'inscrit FREUD concernant la pulsion,
qui n'est pas un instinct, mais un montage, un
montage entre des ralits de niveau essentiellement
507
htrognes, comme ce qui s'appelle la pousse, le
Drang, quelque chose que nous pouvons inscrire comme
tant l'orifice du corps o ce Drang, si je puis
dire, prend son appui et d'o il tire, d'une faon
qui n'est concevable que d'une faon strictement
topologique, sa constance, cette constance du Drang
ne peut s'laborer qu'en la supposant maner d'une
surface dont le fait qu'elle s'appuie sur un bord
constant, assure finalement, si l'on peut dire, la
constance vectorielle du Drang.
De quelque chose, ensuite, qui est un mouvement
d'aller et de retour : toute pulsion inclut en
quelque sorte en elle-mme, quelque chose qui est,
non pas sa rciproque, mais son retour sur sa base.
Ceci partir de quelque chose que nous ne pouvons
concevoir, la limite, et d'une faon, je dis non
pas mtaphorique mais foncirement inscrite dans
l'existence, savoir un tour, elle fait le tour,
elle contourne quelque chose, et c'est quelque chose
que j'appelle l'objet(a). Ceci est parfaitement
illustr d'une faon constante, dans la pratique
analytique, en ceci que l'objet(a), dans la mesure o
il nous est le plus accessible, o il est
littralement cern par l'exprience analytique, est
d'une part, ce que nous appelons le sein, et nous
l'appelons dans des contextes suffisamment nombreux
pour que son ambigut, son caractre problmatique
saute aux yeux de chacun.
Que le sein soit objet(a), toutes sortes de choses
sont bien faites pour montrer qu'il ne s'agit pas l,
de ce quelque chose de charnel dont il s'agit quand
nous parlons du sein, ce n'est pas simplement ce
quelque chose sur quoi le nez du nourrisson s'crase,
c'est quelque chose qui, pour tre dfini - s'il doit
remplir les fonctions et aussi bien, reprsenter les
possibilits d'quivalence qu'il manifeste dans la
pratique analytique - c'est quelque chose qui doit
tre dfini d'une bien autre faon.
508
Je ne mets pas l'accent ici sur la fonction qui
prsente aussi les mmes problmes que constitue, de
quelque faon que vous l'appeliez, le scybalum, le
dchet, l'excrment, ici nous avons quelque chose qui
est en quelque sorte tout fait clair et cern.
Or, ds que nous passons dans le registre de la
pulsion scopique, qui est prcisment celle que dans
cet article, cet article sur lequel je m'appuie, pas
simplement parce que c'est l'article sacr de FREUD
164
,
parce que c'est un article culmen o vient, pour lui,
s'exprimer justement quelque ncessit, qui est sur
la voie de cette prcision topologique que je
m'efforce de donner.
Si dans cet article, il met particulirement en
valeur cette fonction d'aller et de retour dans la
pulsion scopique, ceci implique que nous essayions de
cerner cet objet(a) qui s'appelle le regard. Donc
c'est de la structure du sujet scopique qu'il s'agit
et non pas du champ de la vision. Tout de suite, nous
voyons l qu'il y a un champ o le sujet est impliqu
d'une faon minente. Car pour nous quand je dis
nous, je vous dis vous et moi, Michel FOUCAULT, qui
nous intressons au rapport des mots et des choses,
car en fin de compte, il ne s'agit que de a dans la
psychanalyse - nous voyons bien tout de suite aussi
que ce sujet scopique intresse minemment la
fonction du signe.
Il s'agit donc de quelque chose qui, d'ores et dj,
introduit une toute autre dimension que la dimension
que nous pourrons qualifier, au sens lmentaire du
mot, de physique, que reprsente, le champ visuel en
soi-mme.
L-dessus, si nous faisons quelque chose dont, je ne
sais pas si vous accepterez l'intitul, vous de me
le dire si nous essayons de faire, sur quelque point
prcis ou par quelque biais, quelque chose qui
s'appelle histoire de la subjectivit, c'est un titre
que vous accepteriez, non pas en sous-titre parce que
je crois qu'il y en a dj un mais en sous-sous-
164 S. Freud, (1915, G. W X), Pulsions et destins des pulsions, in Mtapsychologie, Paris, Gallimard, Coll. Ides, 1968, p.11- 44.
509
titre, n'est-ce pas, et que nous dfinissions soit un
champ, comme vous l'avez fait pour La naissance de la clinique,
ou pour L'histoire de la folie en un champ historique comme dans
votre dernier ouvrage, il est bien clair que la
fonction du signe y apparat ce quelque chose
d'essentiel, cette fonction essentielle que vous vous
donnez dans une telle analyse.
Je n'ai pas le temps, grce ces retards que nous
avons pris, peut-tre de soulever point par point,
dans votre premier chapitre tous les termes, non pas
du tout o j'aurai en quoi que ce soit objecter,
mais bien au contraire qui me paraissent
littralement converger vers la sorte d'analyse que
je fais.
Vous aboutissez la conclusion que ce tableau
serait, en quelque sorte la reprsentation du monde
des reprsentations comme vous considrez que c'est
ce dont le systme, je dirais infini, d'application
rciproque constituerait la caractristique d'un
certain temps de la pense. Vous n'tes pas tout
fait contre ce que je dis l ?
FOUCAULT :
Vous tes d'accord ! Merci.
Parce que a prouve que j'ai bien compris.
Il est certain que rien ne saurait plus nous
instruire de la satisfaction que nous donne son
clat, qu'une telle controverse.
Je ne pense absolument pas vous apporter une
objection en disant qu'en fin de compte, ce n'est
que, en faveur d'une fin didactique - savoir de
poser pour nous les problmes qu'imposerait une
certaine limitation dans le systme - repre qu'il
est, en effet, important qu'une telle saisie de ce
qu'a t, disons, la pense pendant le XVII
me
et le
XVIII
me
sicles, nous soit propose.
Comment procder autrement si nous voulons mme
commencer souponner sous quel biais les problmes,
nous, se proposent ?
510
Rien n'est plus clairant que de voir, de pouvoir
saisir dans quelle - je peux dire le mot -
perspective diffrente ils pouvaient se proposer dans
un autre contexte, ne serait-ce que pour viter les
erreurs de lecture, je dirais mme plus, simplement
pour nous permettre la lecture - quand nous n'y
sommes pas naturellement disposs - d'auteurs comme
ceux dont vous mettez par exemple d'une faon
blouissante, en avant, la facture, comme CUVIER par
exemple.
Je ne parle pas, bien sr, de tout ce que vous avez
apport aussi dans le registre de l'conomie de
l'poque et aussi de sa linguistique.
Je vous pose la question :
Est-ce que vous croyez vous ne croyez pas qu'en fin
de compte, quel que soit le trac, le tmoignage, que
nous pouvons avoir des lignes o s'est assure la
pense d'une poque, il s'est toujours pos l'tre
parlant - quand je dis pos, je veux dire qu'il tait
dedans et que, de ce fait, nous ne pouvons pas ne pas
partir de la pense - que exactement les mmes
problmes, structurs de la mme faon, se posaient
pour eux comme pour nous.
Je veux dire que ce n'est pas l une espce
simplement de prsuppos, en quelque sorte
mtaphysique, et mme pour le dire plus prcisment,
heideggerien, savoir que la question de l'essence
de la vrit s'est toujours pose de la mme faon.
Et que, on s'y est refus d'un certain nombre de
faons diffrentes, c'est toute la diffrence. Mais
tout de mme, nous pouvons toucher du doigt sa
prsence, je dis, non pas simplement comme HEIDEGGER
en remontant l'archi-antiquit grecque mais d'une
faon directe.
Dans la succession de chapitres que vous donnez :
parler, changer, reprsenter - je dois dire
d'ailleurs que, cet gard, les voir rsumer dans la
table des matires, a quelque chose de saisissant -
il me semble que le fait que vous n'y ayez pas fait
figurer le mot compter a quelque chose d'assez
511
remarquable. Et quand je dis compter, bien sr je ne
parle pas seulement d'arithmtique ni de bowling. Je
veux dire que, vous avez vu que en plein cur de la
pense du XVII
me
sicle, quelque chose certainement
qui est rest mconnu et qui mme a t hu - vous
savez aussi bien que moi de qui je vais parler,
savoir celui qui a reu les pommes cuites, qui a
rentr sa petite affaire et qui, nanmoins, est rest
indiqu, comme ayant, pour les meilleurs, brill du
plus vif clat - autrement dit Girard DESARGUES, et
pour marquer quelque chose qui chappe, me semble-t-
il ce que j'appellerais le trait d'inconsistance
des modes rciproques des reprsentations dans les
diffrents champs que vous nous dcrivez pour faire
le bilan du XVII
me
et du XVIII
me
.
En d'autres termes, le tableau de VELZQUEZ n'est pas
la reprsentation de, je dirais, tous les modes de la
reprsentation, il est, selon un terme qui va bien
sr n'tre l que comme un dessert, n'est-ce pas, et
qui est le terme sur quoi j'insiste quand je
l'emprunte FREUD, savoir le reprsentant de la
reprsentation.
Qu'est-ce que a veut dire ?
Nous venons de faire enfin d'avoir un tmoignage
clatant - je m'excuse AUDOUARD - de la difficult
avec laquelle peut passer le spcifique de ce que j'ai
essay d'introduire, par exemple, dans un temps,
intervalle assez court remonter, c'est--dire
depuis deux de nos runions.
Quand il s'agit du champ scopique, le champ scopique,
il y a longtemps qu'il sert dans cette relation
L'essence de la vrit. HEIDEGGER
165
est l pour nous
rappeler, dans cet ouvrage dont je ne conois mme pas
pourquoi il n'a pas t traduit le premier, comme
Wesen, non pas comme Wesen der Wahrheit, mais de la
Lehre
166
de PLATON sur la vrit, ouvrage qui non
seulement n'est pas traduit mais en plus,
165 Martin Heidegger, De lessence de la vrit : approche de l'allgorie de la caverne et du Thtte de Platon, Paris, Gallimard,
Coll. Bibliothque de philosophie, 2001.
166 Doctrine, thorie
512
est introuvable, est l pour nous rappeler combien,
dans le premier enseignement, il est absolument
clair, manifeste - sur ce sujet de la vrit - que
PLATON a fait usage de ce que j'appellerais ce monde
scopique.
Il en a fait un usage, comme d'habitude, beaucoup
plus astucieux et rus qu'on ne peut l'imaginer car,
en fin de compte, tout le matriel y est, comme je
l'ai rappel rcemment : le trou, l'obscurit, la
caverne, cette chose qui est si capitale, savoir
l'entre, ce que je vais appeler tout l'heure la
fentre et puis derrire, le monde que j'appellerais
le monde solaire.
C'est bien l'entire prsence de tout le bataclan qui
permet HEIDEGGER d'en faire l'usage blouissant que
vous au moins Michel FOUCAULT, ici, vous savez
parce que je pense que vous l'avez lu, et comme
cet ouvrage est introuvable il doit y en avoir
peu qui l'aient lu jusquici, ici, mais j'en ai
tout de mme quelque peu parl
c'est--dire de faire dire PLATON beaucoup plus
qu'on ny lit ordinairement, et de montrer, en tout
cas, la valeur fondamentale d'un certain nombre de
mouvements du sujet qui sont trs exactement quelque
chose qui - comme il le souligne - lie la vrit
une certaine formation, une certaine [paideia],
savoir ces mouvements que nous connaissons bien, en
tout cas dont ceux qui suivent mon enseignement
connaissent bien la valeur de signifiant : mouvement
de tour et de retour, mouvement de celui qui se
retourne et qui doit se maintenir dans ce
retournement.
Il n'en reste pas moins que la suite mme des temps
nous montre quelle confusion peut prter un tel
dpart si nous ne savons pas svrement isoler, dans
ce champ du monde scopique, la diffrence des
structures. Et bien sr, c'est aller sommairement
que, par exemple, y faire une opposition, une
opposition d'o je vais partir.
L'apologue, la fable de PLATON - telle qu'elle est
d'habitude reue - n'implique que :
513
- quelque chose qui est un point d'irradiation de la
lumire, un objet qu'il appelle l'objet vritable,
- et quelque chose qui est l'ombre
167
.
Que ce que voient ceux qui sont les prisonniers de la
caverne ne soit qu'ombre, c'est l, d'habitude, tout
ce qui est reu de cet enseignement. J'ai tout
l'heure marqu combien HEIDEGGER arrivait en tirer
plus en montrant ce qui y est en effet.
Nanmoins, cette faon de partir de cette centralit
de la lumire vers quelque chose qui va devenir non
pas simplement la structure qu'elle est - savoir
l'objet et son ombre - mais une sorte de dgrad de
ralit qui va en quelque sorte introduire au cur
mme de tout ce qui apparat - de tout ce qui est
scheinen
168
pour reprendre ce qui est dans le texte de
HEIDEGGER - une sorte de mythologie qui est justement
celle sur laquelle repose l'ide mme de l'Ide, qui
est l'Ide du bien : celle o est, o se trouve
l'intensit mme de la ralit, de la consistance, et
d'o, en quelque sorte, manent toutes les enveloppes
qui ne seront plus en fin de compte qu'enveloppes
167 chez Platon, lIde, lobjet vritable, est distinct de ses occurrences (son ombre)
168 apparatre, sembler, briller
514
d'illusions croissantes, de reprsentations toujours
de reprsentations.
C'est cela d'ailleurs prcisment, si vous me
permettez de vous le rappeler - je ne sais pas, aprs
tout si vous avez tous une bonne mmoire - que le
l9 Janvier j'ai illustr ici, en faisant commenter par
Madame PARISOT, ici prsente, deux textes de DANTE,
les deux seuls o il ait parl du miroir de Narcisse.
Or, ce que nous apporte notre exprience -
l'exprience analytique - est centr sur le phnomne
de l'cran. Loin que le fondement inaugural de ce qui
est la dimension de l'analyse soit quelque chose o,
comme en un point quelconque, la primitivit de la
lumire, de par elle-mme, fait surgir tout ce qui
est tnbres sous la forme de ce qui existe, nous
avons, et d'abord, affaire cette relation
problmatique qui est reprsent par l'cran.
L'cran n'est pas seulement ce qui cache le rel, il
l'est srement, mais en mme temps, il l'indique.
Quelles structures porte ce bti de l'cran d'une
faon qui l'intgre strictement l'existence du
sujet ?
C'est l le point tournant partir duquel nous
avons, si nous voulons rendre compte des moindres
termes qui interviennent dans notre exprience comme
connots du terme scopique, et l bien sr, nous
n'avons pas affaire qu'au souvenir cran, nous avons
affaire ce quelque chose qui s'appelle le fantasme,
nous avons affaire ce terme que FREUD appelle non
pas reprsentation mais reprsentant de la
reprsentation, nous avons affaire plusieurs sries
de termes dont nous avons savoir s'ils sont ou non
synonymes. C'est pour cela que nous nous apercevons
que ce monde scopique dont il s'agit n'est pas
simplement penser dans les termes de la lanterne
magique qu'il est penser dans une structure qui
heureusement nous est fournie.
Elle nous est fournie je dois dire, qu'elle est
prsente quand mme au long des sicles elle est
515
prsente dans toute la mesure o tels et tels l'ont
manque.
Il y a un certain thorme de PAPPUS
169
qui se trouve
d'une faon surprenante tre exactement inscrit dans
les thormes de PASCAL et de BRIANCHON, ceux sur la
rectilinarit de la colinarit des points de
rencontre d'un certain hexagone en tant que cet
hexagone est inscrit dans une conique.
PAPUS en avait trouv un cas particulier qui est trs
exactement celui o cet hexagone n'est pas inscrit
dans ce que nous appelons couramment une conique mais
simplement dans deux droites se croisant, ce qui je
dois dire jusqu' une poque qui tait celle de
KEPLER, on ne s'tait pas aperu que deux lignes qui
se croisent c'est une conique. C'est bien pour a que
PAPPUS n'a pas gnralis son truc.
Mais qu'on puisse faire une srie de ponctuations
qui prouvent qu' chaque poque, cette chose qui
s'appelle dj gomtrie projective n'a pas t
reconnue, c'est dj suffisamment nous assurer
qu'tait prsente un certain mode de relation au monde
scopique dont je vais essayer de dire maintenant - et
dans la hte o nous sommes toujours ici pour
travailler - quels sont les effets structuraux.
Qu'est-ce que nous cherchons ? Si nous voulons rendre
compte de la possibilit d'un rapport, disons, au
rel - je ne dis pas au monde - qui soit tel,
qu'institue s'y manifeste la structure du fantasme,
nous devons, dans ce cas, avoir quelque chose qui
nous connote la prsence de l'objet(a), de l'objet(a)
en tant qu'il est la monture d'un effet.
Non seulement, je n'ai pas dire ce que nous
connaissons bien, nous ne le connaissons pas
justement : nous avons en rendre compte de cet
effet premier, donn, d'o nous partons dans la
psychanalyse, qui est la division du sujet, savoir
que, dans toute la mesure - je sais que vous la
faites bon escient - o vous maintenez la
169 Pappus d'Alexandrie, La collection mathmatique, d. Albert Blanchard, 2000.
516
distinction du cogito et de l'impens, pour nous, il
n'y a pas d'impens.
La nouveaut pour la psychanalyse, c'est que l o
vous dsignez - je parle en un certain point de votre
dveloppement l'impens dans son rapport au cogito,
l o il y a cet impens, a pense, et c'est l le
rapport fondamental, d'ailleurs dont vous sentez fort
bien quelle est la problmatique puisque vous
indiquez ensuite, quand vous parlez de la
psychanalyse que c'est en cela que la psychanalyse,
se trouve radicalement mettre en question tout ce qui
est sciences humaines.
Je ne dforme pas ce que vous dites ? Quoi ?
- FOUCAULT : Vous reformez.
Bien sr. Et en plus, naturellement en plus d'une
faon qui ncessiterait beaucoup plus de
franchissement et d'tapes.
Alors, ce dont il s'agit c'est d'une gomtrie qui
nous permette, non seulement d'tre reprsentation,
dans un plan-figure, de ce qui est dans un plan
support, mais que s'y inscrive ce tiers-terme qui
s'appelle le sujet et qui est ncessaire sa
construction. C'est trs prcisment pourquoi j'ai
fait la construction que je suis forc de reprendre
qui, d'ailleurs, n'a rien d'originale, qui est
souvent emprunte aux livres les plus communs sur
la perspective, condition qu'on les claire par
la gomtrie desarguienne et par tous les
dveloppements qu'elle en a fait depuis, aussi
bien au XIX
me
sicle. Mais justement DESARGUES
est l pour pointer qu'au cur de ce XVII
me
sicle, dj, toute cette Gomtrie qu'il a
parfaitement saisie, cette existence fondamentale
par exemple, d'un principe comme le principe de
dualit, qui ne veut dire essentiellement par
soi-mme que : les objets gomtriques sont
renvoys un jeu d'quivalence symbolique
eh bien, l'aide, simplement, du plus simple usage
des montants de la perspective, nous trouvons ceci :
517
que, pour autant qu'il faille distinguer ce point-
sujet[S], ce plan-figure[P], le plan-support[Q], bien
sr, je suis bien forc de les reprsenter par
quelque chose, entendez que tous s'tendent
l'infini bien sr.
Eh bien, quelque chose est reprable d'une faon
double qui inscrit le sujet dans ce plan-figure qui,
de ce fait, n'est pas simplement enveloppe, illusion
dtache si l'on peut dire, de ce qu'il s'agit de
reprsenter, mais en lui-mme constitue une structure
qui, de la reprsentation est le reprsentant.
Je veux dire que la ligne d'horizon, pour autant
qu'elle est directement dtermine par ce point qu'il
ne faut pas appeler point-il mais point-sujet,
point-sujet, si on peut dire - entre parenthses, je
veux dire sujet ncessaire la construction, et qui
n'est pas le sujet puisque le sujet, il est engag
dans l'aventure de la figure - et qu'il est
ncessaire que l se produise quelque chose qui, la
fois indique qu'il est quelque part en un point
ncessairement mais que son autre point, encore qu'il
soit ncessaire, qu'il soit prsent, soit en quelque
sorte, lid.
518
C'est ce que nous obtenons en remarquant, je le
rappelle, - le temps me manque pour en refaire d'une
faon aussi articule la dmonstration - que si cette
ligne d'horizon est dtermine par simplement une
parallle, un plan parallle qui passe par le point
sujet, plan parallle au plan du sol, ceci, tout le
monde le sait, mais que ce type d'horizon,
d'ailleurs, dans l'tablissement d'une perspective
quelconque implique le choix d'un point[O] sur cette
ligne d'horizon et que - chacun sait a - c'est ce
qu'on appelle le point de fuite et que donc, la
premire prsence du point-sujet dans le plan-figure,
c'est un point quelconque de la ligne d'horizon,
disons, n'importe quel point, je souligne encore, il
doit y en avoir en principe un.
Quand il y en a plusieurs - c'est quand il arrive que
les peintres se permettent la licence - quand il y en
a plusieurs, c'est des fins dtermines. De mme
que, quand nous avons plusieurs Moi Idal ou mois
idaux (l'un et l'autre se disent)c'est certaines
fins. Mais que, il y a, mais a c'est bien sr une
des ncessits de la perspective tout ceux qui sont,
l-dedans, les fondateurs savoir ALBERTI et
PELLERIN(autrement dit VIATOR), mais aussi bien
Albert DRER qui l'appellent l'autre il. Je le
rpte, ceci prte confusion car il ne s'agit en
aucun cas de vision binoculaire, la perspective n'a
rien faire avec ce qu'on voit et le relief,
contrairement ce qu'on s'imagine la perspective
c'est le mode - en un certain temps, en une certaine
poque, comme vous diriez - par lequel le peintre
519
comme sujet se met dans le tableau, exactement comme
les peintres de l'poque improprement appels
primitifs se mettaient dans le tableau comme
donateur. Dans le monde, dont il s'agissait que le
tableau soit le reprsentant, au temps des prtendus
primitifs, le peintre tait sa place dans le
tableau.
Au temps de VELZQUEZ, il a l'air de s'y mettre mais
il n'y a qu' le regarder pour voir, - vous l'avez
fort bien soulign - quel point c'est l'tat
d'absence qu'il y est. Il y est en un certain point
que je dcris prcisment en ceci qu'on touche la
trace du point d'o il vient, de ce point - pour
vous, pour vous seulement, car je l'ai dj assez dit
pour les autres - ce point que je n'ai pas, jusqu'
prsent qualifi, qui est l'autre point de prsence,
l'autre point-sujet dans le champ du tableau, qui est
ce point qui se dtermine, non pas de la faon dont
on vous l'a dit tout l'heure, mais en tenant compte
prcisment de ceci qu'il y a un plan et un seul[S],
parallle au plan du tableau, qui ne saurait
aucunement s'inscrire dans le tableau. Et c'est bien
ce qui fait dj sauter aux yeux quel point est
problmatique la premire prsence du point S sur la
ligne d'horizon sous la forme d'un point quelconque.
Ce point quelconque sous sa forme de point
d'indiffrence est bien justement ce qui est de
520
nature nous surprendre sur ce qu'on pourrait
appeler sa primaut.
Par contre, en tenant compte de ceci, que cette
ligne[b] - que nous dterminons comme la ligne
d'intersection du plan[S] qui passe par le point S
suppos de dpart, d'intersection avec le plan
support - que cette ligne sur le plan-figure a une
traduction[p] qu'il est facile de saisir, parce
qu'il suffit simplement de renverser, ce quil nous a
paru tout naturel d'admettre concernant la relation
de l'horizon[h] avec la ligne infinie[q] sur le plan
support, l dans l'autre disposition :
il apparat tout de suite que ceci[b], si vous
voulez, constitue une ligne d'horizon par rapport
quoi la ligne l'infini du plan-figure[p] jouera la
fonction inverse et que, ds lors, c'est
l'intersection de la ligne fondamentale[], c'est
dire du point o le tableau coupe le plan-support,
l'intersection de cette ligne fondamentale avec cette
521
ligne[b] l'infini, c'est--dire en un point
l'infini que se place le second ple[S] du sujet.
C'est de ce ple que revient VELZQUEZ aprs avoir
fendu sa petite foule et la ligne de scission qui s'y
marque, n'est-ce pas, de son passage, en quelque
sorte de ce qui forme son groupe modle, nous indique
assez que c'est de quelque part, hors du tableau
qu'il vient ici surgir.
Ceci, je le regrette, me fait, prendre les choses du
point le plus thorique et le plus abstrait.
Et l'heure s'avance, je ne pourrai donc pas mener les
choses, aujourdhui, jusqu'au point o je voulais les
mener. Nanmoins la forme mme de ce qui m'a t
apport tout l'heure comme interrogation
ncessitait que je remette ceci au premier plan.
Nanmoins, si quelques-uns d'entre vous peuvent faire
encore le sacrifice de quelques minutes aprs cette
heure de deux heures, je vais tout de mme passer,
c'est dire en prenant les choses au niveau de la
description - je dois dire, fascinante - que vous
avez faite du tableau des Mnines, vous montrer
l'intrt concret que prennent ces considrations
dans le plan de la description mme.
Il est clair que depuis toujours, critiques autant
que spectateurs sont absolument fascins, inquits
par ce tableau. Le jour o quelqu'un - je ne veux pas
vous dire son nom, encore que j'aie l toute la
littrature - a fait la dcouverte que c'tait
formidable ces petits roi et reine qu'on voyait dans
le fond, que c'tait srement l, la cl de
l'affaire, tout le monde l'a acclam : comme c'tait
vraiment formidable, intelligent d'avoir vu a qui
est videmment qui s'tale - on ne pas dire au
premier plan puisque c'est au fond - mais enfin qu'il
est impossible de ne pas voir.
Enfin on a progress de dcouvertes hroques en
autres dcouvertes diversement sensationnelles mais
il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas tout fait
explique, c'est quel point cette chose, si ce
n'tait que a : coucou, le roi et la reine sont
522
dans le tableau , a suffisait faire l'intrt du
truc.
A la lumire, si on peut dire, puisque nous ne
travaillons pas ici dans le plan photopique, nous
n'avons pas affaire la couleur - je la rserve pour
l'anne prochaine, si cette anne prochaine doit
exister - nous travaillons dans le champ scotopique
en effet, dans la pnombre comme ici.
Ce qui est important, intressant, c'est ce qui se
passe entre ce point S - rituel, car il ne sert qu'
la construction - tout ce qui nous importe c'est ce
qu'il y a dans la figure(mais il joue quand mme son
rle) c'est ce qui se passe entre ce point-l - dans
l'intervalle entre lui - et l'cran.
Or, s'il y a quelque chose que ce tableau nous
impose, c'est grce un artifice qui est celui
d'ailleurs dont - je vous en rends hommage - vous
tes parti, savoir que la premire chose que vous
avez dite c'est que dans le tableau il y a un tableau
et je pense que vous ne doutez pas plus que moi que
ce tableau qui est dans le tableau soit le tableau
lui-mme, celui que nous voyons
encore que peut-tre l-dessus, vous prtez
laisser se perptrer cette interprtation que ce
tableau serait le tableau o il fait le portrait
du roi et de la reine. Vous vous rendez compte,
il aurait pris le mme tableau de trois mtres
dix-huit avec la mme monture pour faire le roi
et la reine seulement, ces deux pauvres petits
cons qui sont l au fond
or c'est prcisment de la prsence de ce tableau
qui est la seule reprsentation qui est dans la
tableau, cette reprsentation sature en quelque
sorte, le tableau en tant que ralit.
Mais le tableau est autre chose - puisque je ne vous
le dmontrerai pas aujourd'hui, j'espre que vous
reviendrez dans huit jours - parce que je pense qu'on
peut dire quelque chose sur ce tableau qui aille au
del de cette remarque qui est vraiment inaugurale,
savoir ce que c'est vraiment que ce tableau.
523
J'ai assez soulign la dernire fois les difficults
que reprsentent toutes les interprtations qui en
ont t donnes, mais videmment il faut partir de
l'ide que ce qui nous est cach et dont vous faites
si bien valoir la fonction, de quelque chose qui est
cach, de carte retourne pour vous forcer abattre
les vtres
et Dieu sait si, en effet, les critiques
n'ont pas manqu de les abattre, les leurs de
cartes. Et pour dire une srie de choses
extravagantes, pas tellement d'ailleurs, a a
suffi de les rapprocher pour quand mme aboutir
savoir pourquoi leur extravagance, dont une est
celle par exemple que le peintre peint devant un
miroir qui serait notre place. C'est une
solution lgante, malheureusement, elle va tout
fait contre cette histoire du roi et de la
reine qui sont dans le fond parce qu'alors, il
faudrait aussi qu'eux soient la place du
miroir. Il faut choisir
bref, toutes sortes de difficults se prsentent, si
simplement nous pouvons maintenir que le tableau est
dans le tableau comme reprsentation de l'objet
tabbeau.
Or cette problmatique de la distance entre le point
s et le plan du tableau est proprement parler la
base de l'effet captatif de l'uvre.
C'est pour autant, que ce n'est pas une uvre avec
une perspective habituelle, c'est une espce de
tentative folle
qui, d'ailleurs, n'est pas le privilge de
VELZQUEZ, je connais Dieu merci assez de
peintres et nommment l'un dont je vais vous
faire montrer pour vous donner une petite - comme
a - friandise, la fin de cet expos, dont je
regrette d'tre forc de toujours revenir sur les
mmes plans qui soient trop arides, un peintre
dont je vais, en vous quittant vous montrer ici
une uvre que vous pouvez d'ailleurs aller tous
voir l o elle est expose, montrant que c'est
524
bien le problme du peintre, et ceci, reportez-
vous mes premires dialectiques comme quand
j'ai introduit la pulsion scopique, savoir que
le tableau est un pige regard
qu'il s'agit de piger celui qui est l devant.
Et quelle plus propre faon de le piger que
d'tendre le champ des limites du tableau, de la
perspective, jusqu'au niveau de ce qui est l, au
niveau de ce point S, et que j'appelle proprement
parler ce qui s'vanouit toujours, ce qui est
l'lment de chute. La seule chute dans cette
reprsentation o ce reprsentant de la
reprsentation qu'est le tableau en soi, c'est cet
objet(a) et l'objet(a) c'est ce que nous ne pouvons
jamais saisir et spcialement pas dans le miroir,
pour la raison que c'est la fentre que nous
constituons nous-mme d'ouvrir les yeux simplement.
Tout cet effort du tableau pour attraper ce plan
vanouissant qui est proprement ce que nous venons
apporter, nous tous baguenaudeurs : nous sommes l
dans une exposition croire qu'il ne nous arrive
rien quand nous sommes devant un tableau : nous
sommes pris comme mouche la glue, nous baissons le
regard comme on baisse culotte et pour le peintre, il
s'agit, si je puis dire, de nous faire entrer dans le
tableau.
C'est prcisment parce qu'il y a cet intervalle
entre cette haute toile reprsente de dos et quelque
chose qui est le cadre du tableau en avant que nous
sommes dans ce malaise.
C'est une interprtation proprement structurale et
troitement scopique. Si vous revenez m'entendre la
prochaine fois, je vous dirai pourquoi c'est ainsi
car la vrit je reste ici aujourd'hui strictement
dans les limites de l'analyse de la structure, de la
structure telle que vous l'avez faite, de la
structure de ce qu'on voit sur le tableau.
Vous n'y avez introduit rien du dialogue, si je puis
dire, du dialogue qu'il suggre entre quoi et quoi ?
ne croyez pas que je vais vous refaire, aprs
AUDOUARD, de la rciprocit, savoir que nous
sommes pris, nous, de dialoguer avec VELZQUEZ.
525
J'ai assez dit depuis longtemps que les relations
du sujet l'Autre ne sont pas rciproques pour
que je n'aille pas tomber dans ce pige
aujourd'hui
qui est-ce qui parle en avant ? Qui est-ce qui
interroge ? Qui est-ce qui, plutt, crie et supplie,
et demande VELZQUEZ fais voir ! ?
C'est l le point d'o il faut partir, je vous l'ai
indiqu la dernire fois, pour savoir, en fait,
qui est-ce qui est l dans le tableau ?
Et que cet intervalle[], cet intervalle entre les
deux plans, le plan du tableau et le plan du point S,
que cet intervalle qui coupe le plan-support en deux
parallles et par ce qui, dans le vocabulaire de
DESARGUES s'appelle essieu
car, en plus, histoire de se faire un peu plus
mal voir : un vocabulaire qui n'tait pas comme
celui de tout le monde
[G. DESARGUES, Brouillon project d'une atteinte aux vnemens des rencontres d'un cne avec un plan (1639)]
dans lessieu de laffaire, qu'est-ce qui se passe ?
Certainement pas ce que nous disons aujourd'hui et
que le tableau, soit fait pour nous faire sentir cet
intervalle, c'est ce qui est doublement indiqu dans
notre rapport de happage par ce tableau d'une part et
dans le fait que dans le tableau, VELZQUEZ est
manifestement tellement l pour nous marquer
l'importance de cette distance qu'il n'est pas -
remarquez le, vous avez d le remarquer mais vous ne
526
l'avez pas dit - il n'est pas porte, mme avec son
pinceau allong, de toucher ce tableau.
Naturellement, on dit : il a recul pour mieux voir.
Oui, bien sr. Mais enfin, le fait manifestement
qu'il ne soit pas porte du tableau est l le point
absolument capital.
Bref que les deux points de fuite de ce tableau
soient non pas simplement celui qui fuit, lui aussi
vers une fentre, vers une bance, vers l'extrieur,
pos l comme en parallle la bance antrieure, et
d'autre part VELZQUEZ, dont savoir ce qu'il nous dit
est l le point essentiel. Je le ferai parler pour
terminer
non pas pour terminer parce que je veux, encore
que vous voyez le tableau de BALTHUS, tout de
mme
pour dire les choses dans un langage lacanien,
puisque je parle sa place, pourquoi pas ? Il nous
dit, en rponse fais voir ! :
tu ne me vois pas d'o je te regarde .
C'est une formule, fondamentale expliciter ce qui
nous intresse en toute relation de regard.
Il s'agit de la pulsion scopique et trs prcisment
dans l'exhibitionnisme, comme dans le voyeurisme,
mais nous ne sommes pas l pour voir si dans le
tableau, on se chatouille ni s'il se passe quelque
chose.
Nous sommes l pour voir comment ce tableau nous
inscrit la structure des rapports du regard dans ce
qui s'appelle le fantasme en tant qu'il est
constitutif.
Il y a une grande ambigut sur le mot fantasme.
Fantasme inconscient, bon, a c'est un objet.
D'abord c'est un objet o nous perdons toujours une
des trois pices qu'il y a dedans savoir deux
sujets et un (a). Parce que, ne croyez pas que j'ai
l'illusion que je vais vous apporter le fantasme
527
inconscient comme un objet. Sans a la pulsion du
fantasme renatrait ailleurs. Mais ce qui trouble,
c'est que chaque fois qu'on parle du fantasme
inconscient, on parle aussi implicitement du fantasme
de le voir. C'est--dire que l'espoir, du fait qu'on
court aprs introduit en la matire, beaucoup de
confusion.
Moi pour l'instant, j'essaie de vous donner
proprement parler ce qui s'appelle un bti, et un
bti ce n'est pas une mtaphore parce que le fantasme
inconscient repose sur un bti et c'est ce bti que
je ne dsespre pas, non seulement de le rendre
familier ceux qui m'entendent mais de le leur faire
entrer dans la peau. Tel est mon but, et ceci est un
exercice absolument scabreux, et qui pour certains
parat drisoire, que je poursuis ici, et dont vous
n'entendez que de lointains chos.
Je vais maintenant vous faire passer, grce Gloria,
l'image de Monsieur BALTHUS. Il y a une exposition
BALTHUS pour l'instant. Elle est au Pavillon de
MARSAN
170
, information gratuite. Moyennant une modique
somme, vous pourrez tous aller admirer ce tableau.
Eh bien, c'est un petit devoir que je donne
certains. Je leur donne pour a toutes les vacances.
Voyons. Regardez ce tableau.
S'en tant procur, je l'espre quelques
reproductions, ce n'est pas trs facile.
Je dois celle-ci Madame Henriette GOMEZ, qui se
trouvait
c'tait absolument d'ailleurs pour elle un
tonnement
qui se trouvait l'avoir dans son fichier.
Voil, il y a une lgre diffrence dans le tableau
que vous verrez, voyez-vous, contrairement ce qui
se passe dans VELZQUEZ
parce quil y a videmment des questions
d'poques
ici, dans ce tableau-l, on se chatouille un peu et
cette main, pour la tranquillit du propritaire
actuel a t lgrement regratte par l'auteur.
170 Balthus, exposition du 12 mai au 27 juin 1966, pavillon de Marsan, Muse des Arts Dcoratifs.
528
Je le lui ai remontr hier soir, je dois dire que,
il m'a dit que c'tait quand mme bien mieux compos
comme a. Il regrettait d'avoir fait une concession
qu'il avait cru devoir.
C'tait une espce de contre-concession.
Il avait dit : aprs tout, je fais peut-tre a
pour embter les gens alors pourquoi ne pas le
lcher , mais c'est pas vrai. Il l'avait mis l
parce que a devait tre l Enfin, toutes les autres
choses qui sont l, doivent aussi tre l et en fin
de compte, quand j'ai vu ce tableau - je l'avais vu
dj une fois, autrefois, et je ne m'en souvenais
plus, mais quand je l'ai vu cette fois-ci, dans ce
contexte, vous attribuerez ceci, je ne sais pas
quoi, ma lucidit ou mon dlire, c'est vous
d'en trancher - j'ai dit : voil les Mnines.
Pourquoi est-ce que ce tableau ce sont les Mnines ?
Tel est le petit devoir de vacances, donc, que je
laisserai parmi vous aux meilleurs.
Table des sances
529
25 Mai l966 Table des sances
Je vais commencer, sotto voce, par vous lire
rapidement, quelque chose qui reprsente un bref
compte-rendu qu'on m'a demand, en cette poque de
l'anne, comme il se fait, de mon sminaire. Ce sera
moins long que ce que je vous ai donn dj, de
dvelopp concernant le sminaire de l'anne
dernire, mais comme je sais que cette premire
lecture a rendu service, pour ce qui est du sminaire
de l'anne dernire, je vais entrer en matire
aujourd'hui en vous donnant, en vous rappelant, ce
qui est la situation du sminaire de cette anne.
Ce sminaire qui est, pour nous encore en cours, cris-
je s'est occup, suivant sa ligne de la fonction,
longtemps repre dans l'exprience psychanalytique au
titre de la relation d'objet.
On y professe qu'elle domine, pour le sujet analysable, sa
relation au rel et l'objet oral ou anal y sont promus aux
dpens d'autres dont le statut, pourtant manifeste, y
demeure incertain. C'est que, si les premiers - de ces
objets - reposent directement sur la relation de la
demande, bien propice intervention corrective, les
autres, exigent une thorie plus complexe puisque, n'y
peut tre mconnue une division du sujet, impossible
rduire par les seuls efforts de la bonne intention, tant
la division mme dont se supporte le dsir.
Ces autres objets, nommment, le regard et la voix, - si
nous laissons venir l'objet en jeu dans la castration -
font corps avec cette division du sujet et en
prsentifient dans le champ mme du peru, la partie
lide comme libidinale.
Comme tels, ils font reculer l'apprciation de la pratique
qu'intimide leurs recouvrements ces objets, par la
relation spculaire avec les identifications du moi qu'on
y veut respecter.
Ce rappel suffit motiver que nous ayons insist de
prfrence, cette anne, sur la pulsion scopique et son
objet immanent, le regard.
Nous avons donn la topologie qui permet de rtablir la
prsence du percipiens lui-mme dans le champ o comme
imperu, il est pourtant perceptible, quand il ne l'est
530
mme que trop, dans les effets de la pulsion qui se
manifestent comme exhibition ou voyeurisme.
Cette topologie qui s'inscrit dans la gomtrie projective
et les surfaces de l'analysis situs , n'est pas prendre,
comme il en est des modles optiques chez FREUD, au rang
de mtaphore, mais bien pour reprsenter la structure
elle-mme. Cette topologie rend compte enfin de l'impuret
du perceptum scopique en retrouvant ce que nous avions cru
pouvoir indiquer dans un de nos articles - trs
prcisment celui de la Question prliminaire tout traitement
possible des psychoses - ce que nous avions cru pouvoir
indiquer de la prsence du percipiens irrcusable de la
marque qu'elle porte
l du signifiant, quand elle se montre monnaye dans le
phnomne jamais conu de la voix psychotique.
L'exigence absolue en ces deux points, scopique et
invoquant, d'une thorie du dsir, nous reporte la
rectification des inflchissements de la pratique,
l'autocritique ncessaire de la position de l'analyste,
autocritique qui va au risque attach sa propre
subjectivation, s'il veut rpondre honntement, fusse
seulement la demande .
Je vais aujourd'hui poursuivre sur cet objet
exemplaire, que j'ai choisi depuis trois sminaires
de prendre, pour fixer devant vous les termes dans
lesquels se situe cette problmatique - problmatique
de l'objet(a) et de la division du sujet - pour
autant, comme je viens de le dire, que ce nest pas
sans raison que l'obstacle dont il s'agit, c'est
celui que procure l'identification spculaire, c'est
en raison du rle particulier - la fois par sa
latence et l'intensit de sa prsence - que constitue
l'objet(a) au niveau de cette pulsion.
Voulez-vous nous faire revoir le tableau des Mnines ?
Voici ce tableau. Vous l'avez dj vu la dernire
fois, assez je pense pour avoir eu depuis la
curiosit d'y revenir, ce tableau, vous savez
maintenant, par la thmatique qu'il a fournie,
dans la dialectique des rapports du signe avec les
choses, nommment dans le travail de Michel FOUCAULT,
autour de qui, s'est profre toute mon nonciation
de la dernire fois par les discussions nombreuses
531
qu'il a fournies l'intrieur de ce qu'on peut
appeler la critique d'art, ce tableau, disons, nous
prsente, nous rappelle ce qu'il a t, son propos,
avanc, d'un rapport fondamental qu'il suggre avec
le miroir.
Ce miroir - qui est au fond
et o l'on a voulu voir en quelque sorte et comme
en passant lgrement, l'astuce qui consisterait
y reprsenter ceux qui seraient l devant,
comme modles, savoir le couple royal
ce miroir, d'autre part, est mis en question quand
il s'agit d'expliquer comment le peintre pourrait s'y
situer, et - nous peignant ce que nous avons l,
devant nous - peut, lui, le voir. Le miroir, donc qui
est au fond et le miroir notre niveau.
Voulez-vous rallumer ?
Ceci, miroir et tableau, nous introduit au rappel par
o aujourd'hui je veux entrer dans l'explication, que
j'espre pouvoir faire complte aujourd'hui, complte
et dfinitive, de ce dont il s'agit.
La relation, du tableau au sujet est foncirement
diffrente de celle du miroir.
Que j'aie avanc que dans le tableau, comme champ
peru, peut s'inscrire, la fois, la place de
l'objet(a) et sa relation la division du sujet, que
ceci, je vous laie montr, en introduisant mon
problme, par la mise en avant, de la fonction, dans
le tableau, de la perspective en tant que c'est le
mode o partir d'une certaine date, historiquement
situable, le sujet, nommment le peintre se fait
prsent dans le tableau et pas seulement en tant que
sa position dtermine le point de fuite de la dite
perspective. J'ai dsign le point o est, non pas
comme lont dit les artistes, parlant en tant
qu'artisans, comme l'autre il, ce point qui rgle la
distance laquelle il convient de se placer pour
apprcier, pour recevoir au maximum l'effet de
perspective, mais cet autre point que je vous ai
caractris comme tant, le point l'infini, dans le
plan du tableau.
532
Ceci soi tout seul suffit distinguer dans le
champ scopique la fonction du tableau de celle du
miroir. Ils ont tous les deux, bien sr, quelque
chose en commun, c'est le cadre, mais dans le miroir,
ce que nous voyons c'est ce quelque chose o il n'y a
pas plus de perspective que dans le monde rel ; la
perspective organise, c'est l'entre, dans le champ
du scopique, du sujet lui-mme. Dans le miroir, vous
avez le monde tout bte c'est--dire cet espace o
vous vous reprez, avec les expriences de la vie
commune, en tant qu'elle est domine par un certain
nombre d'intuitions o se conjugue, non seulement le
champ de l'optique, mais o il se conjugue avec la
pratique et le champ de vos propres dplacements.
C'est ce titre, et ce titre d'abord, qu'on peut
dire que le tableau - structur si diffremment et
dans son cadre, dans son cadre qui ne peut tre isol
d'un autre point de rfrence, celui occup par le
point S dominant sa projective - que le tableau n'est
que le reprsentant de la reprsentation. Il est le
reprsentant de ce qu'est la reprsentation dans le
miroir. Il n'est pas de son essence d'tre la
reprsentation. Et ceci, l'art moderne vous
l'illustre : un tableau, une toile, avec une simple
merde dessus, une merde relle, car qu'est-ce d'autre
aprs-tout, qu'une grande tache de couleur ? Et ceci
est manifest, d'une faon, en quelque sorte
provocante, par certains extrmes de la cration
artistique, est un tableau autant qu'est une uvre
d'art, le ready made de DUCHAMP savoir aussi bien
la prsentation, devant vous de quelque porte-manteau
accroch une tringle.
Il est d'une structure diffrente de toute
reprsentation. C'est ce titre que j'insiste sur la
diffrence essentielle que constitue, emprunt
FREUD, ce terme de reprsentant de la reprsentation,
Vorstellungsreprsentanz.
533
C'est que le tableau, de par sa relation, au point S
du systme projectif , manifeste ceci, qui parallle
lui, existe encadrant ce point S lui-mme dans un
plan[S] donc parallle au plan du tableau[P] et que
j'appelle la fentre[f], savoir ce quelque chose
que vous pouvez matrialiser comme un cadre parallle
celui du tableau, en tant qu'il donne sa place ce
point S, qu'il l'encadre.
C'est dans ce cadre o est le point S qu'est, si je
puis dire, le prototype du tableau, celui o
effectivement le S se sustente, non point, rduit
ce point qui nous permet de construire, dans le
tableau, la perspective, mais comme le point o le
sujet lui-mme se sustente dans sa propre division,
autour de cet objet(a) prsent qui est sa monture.
C'est bien en quoi l'idal de la ralisation du sujet
serait de prsentifier ce tableau dans sa fentre et
c'est l'image provocante que produit devant nous un
peintre comme MAGRITTE, quand il vient effectivement
dans un tableau inscrire un tableau dans une fentre.
C'est aussi l'image quoi j'ai recouru pour
expliquer ce qu'il en est de la fonction du
fantasme : l'image qui implique cette contradiction,
si jamais elle tait ralise dans quelque chambre,
534
comme ici, claire d'une seule fentre, que
l'accomplissement parfait de cet idal, plongerait la
salle dans l'obscurit.
C'est bien, en quoi le tableau doit tre produit
quelque part en avant de ce plan [f] o il s'institue
comme place du sujet dans sa division, et que la
question est de savoir ce qu'il advient de ce quelque
chose qui tombe dans l'intervalle, ce que le sujet
carte de lui le tableau.
Ce qu'il advient, ce que l'objet exemplaire autour de
quoi je travaille, ici, devant vous, manifeste, c'est
que le sujet, sous sa forme divise, peut s'inscrire
dans le plan-figure[P], dans le plan, cart du plan
[f] du fantasme o se ralise, l'uvre d'art.
L'artiste, comme aussi bien tout un chacun d'entre
nous, renonce la fentre pour avoir le tableau et
c'est l l'ambigut que je donnais l'autre jour, que
j'indiquais sur la fonction du fantasme. Le fantasme
est le statut de l'tre du sujet et le mot fantasme
implique ce dsir de voir se projeter le fantasme,
cet espace de recul entre deux lignes parallles,
grce quoi - toujours insuffisant mais toujours
dsir, la fois faisable et impossible - le
fantasme peut tre appel apparatre en quelque
faon dans le tableau.
Le tableau, pourtant, n'est pas reprsentation. Une
reprsentation, a se voit. Et comment ce a sa
voit le traduire ?
a se voit , c'est : n'importe qui le voit. Mais
aussi, c'est la forme rflchie : de ce fait, il y a,
immanente dans toute reprsentation, ce se voir .
La reprsentation comme telle, le monde comme
reprsentation et le sujet comme support de ce monde
qui se reprsente, c'est l le sujet transparent
lui-mme de la conception classique et c'est l
justement ce sur quoi il nous est demand - par
l'exprience de la pulsion scopique - ce sur quoi il
nous est demand de revenir.
C'est pourquoi quand j'ai introduit la question de ce
tableau avec le fais voir
mis dans la bouche du personnage - sur lequel
nous allons revenir aujourd'hui - le personnage
535
central de l'infante, Dona Margarita, fille de
Mariana d'Autriche : fais voir
ma rponse a t d'abord celle qu'en ces termes j'ai
fait donner la figure de VELZQUEZ prsente dans le
tableau :
tu ne me vois pas d'o je te regarde .
Qu'est-ce dire l ?
Comme je l'ai dj avanc, la prsence dans le
tableau de ce qui, seulement dans le tableau, est
reprsentation, celle du tableau lui-mme - qui lui,
est l comme reprsentant de la reprsentation - a la
mme fonction dans le tableau qu'un cristal dans une
solution sursature, c'est que, tout ce qui est dans
le tableau se manifeste comme n'tant plus
reprsentation mais reprsentant
de la reprsentation.
Comme il apparat, voir - faut-il que je fasse de
nouveau resurgir l'image ? - que tous les personnages
qui sont l, proprement parler, ne se reprsentent
rien, et justement pas ceci : qu'ils reprsentent.
Ici prend toute sa valeur la figure du chien que vous
voyez droite. Pas plus que lui, aucune des autres
figures ne fait autre chose que d'tre sa
reprsentation, figures de cour qui miment une scne
idale o chacun, est dans sa fonction d'tre en
reprsentation, en le sachant peine. Encore que l
gt l'ambigut qui nous permet de remarquer que,
comme il se voit sur la scne quand on y trane un
animal, le chien aussi, est lui aussi toujours trs
bon comdien.
Tu ne me vois pas d'o je te regarde : puisque
c'est d'une formule frappe de ma faon qu'il s'agit,
je me permettrai de vous faire remarquer que dans mon
style je n'ai point dit : tu ne me vois pas, l,
d'o je te regarde , que le l est lid,
ce l sur lequel la pense moderne a mis tant
d'accent sous la forme du dasein comme si tout tait
rsolu, de la fonction de l'tre ouvert ce qu'il y
ait un tre l.
536
Il n'y a pas de l o VELZQUEZ - si je le fais
parler - invoque dans ce tu ne me vois pas, d'o je
te regarde . A cette place bante, cet intervalle
non marqu, est prcisment ce l, o se produit la
chute de ce qui est en suspens sous le nom de
l'objet(a). Il n'y a point d'autre l, dont il
s'agisse dans le tableau, que cet intervalle que je
vous y ai montr, expressment dessin, entre ce que
je pourrai tracer - mais que vous pouvez, je pense,
imaginer aussi bien que moi - des deux glissires qui
dessineraient le trajet dans ce tableau comme sur une
scne de thtre, du mode par o arrivent ces
portants ou praticables :
- dont le premier est le tableau au premier plan,
dans cette ligne lgrement oblique, que vous voyez
se prolonger facilement, voir seulement de la
figure de ce grand objet sur la gauche,
- et l'autre, trace travers le groupe - je vous ai
appris reconnatre son sillage - qui est celui par
lequel le peintre s'est fait introduire comme un de
ces personnages de fantasmagorie qui se font, dans la
grande machinerie thtrale pour se faire dposer
la bonne distance de ce tableau c'est--dire un peu
trop loin, pour que nous n'ignorions rien de son
intention.
Ces deux glissires parallles, cet intervalle, cet
essieu que constitue cet intervalle pour reprendre ce
terme de la terminologie baroque de Girard DESARGUES,
l - et l seulement - est le Dasein.
C'est pourquoi l'on peut dire que VELZQUEZ le
peintre parce qu'il est un vrai peintre, n'est donc
pas l pour trafiquer de son dasein si je puis dire.
La diffrence entre la bonne et la mauvaise peinture,
entre la bonne et la mauvaise conception du monde,
c'est que, de mme que les mauvais peintres ne font
jamais que leur propre portrait, quelque portrait
qu'ils fassent, et que la mauvaise conception du
monde voit dans le monde le macrocosme du microcosme
que nous serions, VELZQUEZ, mme quand il
s'introduit dans le tableau comme auto-portrait,
537
ne se peint pas dans un miroir, non plus il ne se
fait - d'aucun - bon auto-portrait.
Le tableau, quel qu'il soit, et mme auto-portrait
n'est pas mirage du peintre mais pige regards.
C'est donc la prsence du tableau dans le tableau qui
permet de librer le reste de ce qui est dans le
tableau, de cette fonction de reprsentation.
Et c'est en cela que ce tableau nous saisit et nous
frappe.
Si ce monde qu'a fait surgir VELZQUEZ dans ce
tableau - et nous verrons dans quel projet - si ce
monde est bien ce que je vous dis, il n'y a rien,
d'abusif y reconnatre ce qu'il manifeste et ce
qu'il suffit de dire pour le reconnatre.
Qu'est cette scne trange qui a eu pour les sicles
passs cette fonction problmatique si ce n'est
quelque chose d'quivalent ce que nous connaissons
bien dans la pratique de ce qu'on appelle les jeux de
socit, et qu'est d'autre qu'un jeu, la socit,
savoir le tableau vivant ?
Ces tres qui sont l, sans doute en raison des
ncessits mmes de la peinture, projets devant
nous, qu'est-ce qu'ils font, sinon de nous
reprsenter, exactement, ces sortes de groupes qui se
produisent dans ce jeu du tableau vivant.
Qu'est cette attitude presque gourmet de la petite
princesse, de la suivante agenouille qui lui
prsente cet trange petit pot inutile sur lequel
elle commence de poser la main, ces autres qui ne
savent point o placer ces regards, que l'on
s'obstine nous dire qu'ils seraient l pour
s'entrecroiser quand il est manifeste qu'aucun ne se
rencontre, ces deux personnages dont Monsieur GREEN a
fait l'autre jour quelque tat et dont (ceci soit dit
en passant) il aurait tort de croire que le
personnage fminin soit une religieuse, c'est ce
qu'on appelle une guarda damas, tout le monde le
sait, et mme son nom Dona Marcela de ULLOA.
Et l, qu'est-ce que fait VELZQUEZ, sinon de se
montrer nous, en peintre, et au milieu de quoi ?
De tout ce gynce !
538
Nous reviendrons sur ce qu'il signifie, sur les
questions vraiment tranges qu'on peut se poser
concernant le premier titre qui a t donn ce
tableau, je l'ai vu encore inscrit dans un
dictionnaire qui date de l872 : La famille du roi.
Pourquoi la famille ? Mais laissons ceci pour
l'instant, quand il n'y a manifestement que la petite
infante qui, ici, la reprsente ?
Ce tableau vivant, je dirais, et c'est bien ainsi,
dans ce geste fig qui fait de la vie une nature
morte, que sans doute ces personnages, comme on l'a
dit, se sont effectivement prsents. Et c'est bien
en quoi, tout morts qu'ils soient, ainsi que nous les
voyons , ils se survivent, justement d'tre dans une
position qui, du temps mme de leur vie, n'a jamais
chang.
Et alors, nous allons voir, en effet ce qui, d'abord,
nous suggre cette fonction du miroir. Est-ce que cet
tre, dans cette position de vie fixe, dans cette
mort qui nous la fait, travers les sicles, surgir
comme presque vivante, la faon, de la mouche
gologique prise dans l'ambre, est-ce que, l'avoir
fait passer, pour dire son fais voir , de notre
ct, nous n'voquons pas, son propos, cette mme
image, cette mme fable du saut d'Alice, qui nous
rejoindrait, de plonger, selon un artifice dont la
littrature carollienne - et jusqu' Jean COCTEAU - a
su user et abuser : la traverse du miroir ?
Sans doute !
Dans ce sens, il y a quelque chose traverser, ce
qui, dans le tableau, nous est, en quelque sorte,
conserv fig. Mais dans l'autre ? A savoir de la
voie qui, aprs tout nous semble ouverte et nous
appelle d'entrer, nous, dans ce tableau : il n'y en a
pas.
Car c'est bien la question qui vous est pose par ce
tableau, vous qui - si je puis dire - vous croyez
vivants, de ceci seulement (qui est une fausse
539
croyance) qu'il suffirait d'tre l pour tre au
nombre des vivants.
Et c'est bien l ce qui vous tourmente, ce qui prend
chacun aux tripes, la vue de ce tableau, comme de
tout tableau, en tant qu'il vous appelle entrer
dans ce qu'il est au vrai et qu'il vous prsente
comme tel : ceci que les tres sont non point l
reprsents mais en reprsentation.
Et c'est bien l le fond de ce qui rend pour chacun
si ncessaire de faire surgir cette surface invisible
du miroir dont on sait qu'on ne peut pas la franchir.
Et c'est la vraie raison pourquoi au muse du Prado,
vous avez, lgrement sur la droite et de trois
quart, pour que vous puissiez vous y raccrocher en
cas d'angoisse, savoir un miroir car il faut bien,
pour ceux qui a pourrait donner le vertige, qu'ils
sachent que la tableau n'est qu'un leurre, une
reprsentation.
Car aprs tout, dans cette perspective (c'est le cas
de le dire) quel moment - posez-vous la question! -
vous distinguez-vous des figures du tableau en tant
qu'elles sont l, en naturel, en reprsentation et
sans le savoir ? C'est ainsi qu'en parlant du miroir
propos de ce tableau sans doute on brle, bien sr,
car il n'est pas l seulement parce que vous le
rajoutez : nous allons dire, en effet, jusqu' quel
point le tableau, c'est cela mme, mais pas par le
bout que j'ai cru, l'instant, devoir carter de ces
petites Mnines avec leur temps de Dasein encore
affil.
Mais je ne veux point, ici, faire de l'anecdote - ni
vous raconter de chacune, ce qu'en ce point o elles
sont l saisies, elles ont encore vivre - ceci ne
serait que dtail vous garer et il ne convient
pas, rappelons-le, de confondre le rappel des
pignochages d'observation et d'anamnse avec ce qu'on
appelle la clinique, si on y oublie la structure.
Nous sommes aujourd'hui ici pour, cette structure, la
dessiner. Qu'en est-il donc de cette scne trange o
ce qui vous retient vous-mme de sauter, ce n'est pas
simplement que dans le tableau, il n'y ait pas assez
540
d'espace ? Si le miroir vous retient, ce n'est pas
par sa rsistance ni par sa duret. C'est par la
capture qu'il exerce, en quoi vous vous manifestez
trs infrieurs ce que fait le chien en question -
puisque c'est lui qui est l, prenons-le - et que,
d'ailleurs, ce qu'il nous montre, c'est que du mirage
du miroir, il en fait trs vite le tour, une ou deux
fois : il a bien vu qu'il n'y a rien l derrire.
Et si le tableau est au muse, c'est dire en un
endroit o, si vous faites le mme tour, vous serez
aussi fort rassurs, c'est--dire que vous verrez
qu'il n'y a rien. Il n'en est pas moins vrai que,
tout fait l'oppos du chien, si vous ne
reconnaissez pas ce dont le tableau est le
reprsentant, c'est justement de manquer cette
raction, qu'il a, de vous rappeler qu'au regard de
la ralit, vous tes vous-mme inclus dans une
fonction analogue celle que reprsente le tableau,
c'est--dire pris dans le fantasme. Ds lors,
interrogeons-nous sur le sens de ce tableau : le roi
et la reine au fond, et, semble-t-il, dans un miroir,
telle est, l, l'indication que nous pouvons en
retirer. J'ai dj indiqu la vise du point o nous
devons chercher ce sens. Ce couple royal, sans doute,
a-t-il affaire avec le miroir.
Et nous allons voir quoi.
Si tous ces personnages sont en reprsentation, c'est
l'intrieur d'un certain ordre, de l'ordre
monarchique dont ils reprsentent les figures
majeures. Ici, notre petite Alice, dans sa sphre,
reprsentante, est bien en effet comme l'Alice
carollienne, avec au moins un lment qui - j'en ai
dj employ la mtaphore - se prsente comme des
figures de cartes : ce roi et cette reine [dans Alice] dont
les profrations dchanes se limitent la dcision
coupez-lui la tte .
Et d'ailleurs, pour faire, ici, un rappel de ce sur
quoi j'ai d passer tout l'heure, observez quel
point cette pice n'est pas seulement meuble de ces
personnages, tels que j'espre vous les avoir
clairs, mais aussi d'innombrables autres tableaux :
541
c'est une salle de peinture, et on s'est pris au jeu
d'essayer de lire sur chacune de ces cartes quelle
pouvait bien tre la valeur qu'y avait inscrite le
peintre. L encore, c'est une anecdote o je n'ai
point m'garer, sur le sujet d'Apollon et Marsyas
qui sont au fond, ou bien encore de la dispute
d'Arachn et de Pallas, devant le tissage de cet
enlvement d'Europe que nous retrouvons au fond de la
peinture voisine, ici expose, des Hilanderas.
O sont-ils ce roi et cette reine autour de quoi en
principe se suspend toute la scne, proprement
parler ?
Car il n'y a pas que la scne primitive, la scne
inaugurale, il y a aussi cette transmission de la
fonction scnique qui ne s'arrte nul moment
primordial.
Observons que la reprsentation est faite pour qui,
pour quoi ? Pour leur vision, mais de l o ils sont,
ils ne voient rien, car c'est l qu'il convient de se
souvenir de ce qu'est le tableau : non point une
reprsentation autour de quoi l'on tourne et pour
laquelle on change d'angle. Ces personnages n'ont pas
de dos et le tableau, s'il est l retourn, c'est
pour prcisment que ce qu'il a sur sa face, savoir
ce que nous voyons, nous soit cach.
Ce n'est pas dire qu'il s'offre pour autant au
prince. Cette vision royale, elle, est exactement ce
qui correspond la fonction - quand j'ai essay de
l'articuler explicitement - du grand Autre dans la
relation du narcissisme.
Reportez-vous mon article dit Remarques
171
, sur un
certain discours qui s'tait tenu au Congrs de
Royaumont. Je rappelle pour ceux qui ne s'en
souviennent plus ou d'autres qui ne le connaissent
pas, qu'il s'agissait alors de donner sa valeur, de
restaurer dans notre perspective deux thmatiques
qui nous avaient t produites par un psychologue,
171 crits p.647 ou t.2 p.124.
542
et qui mettait l'accent sur le Moi idal et l'Idal
du moi, fonctions si importantes dans l'conomie de
notre pratique, mais o de voir rentrer la
psychologie indcrottable de ses rfrences
consciencielles dans le champ de l'analyse, nous
voyions de nouveau, produits :
- le premier comme le moi qu'on se croit tre,
- et l'autre comme celui qu'on se veut tre.
Avec toute l'amabilit dont je suis capable quand je
travaille avec quelqu'un, je n'ai fait que cueillir
ce qui, dans cette amorce pouvait me paratre
favorable rappeler ce dont il s'agit, c'est dire
d'une articulation qui rend absolument ncessaire de
maintenir, dans ces fonctions, leur structure avec ce
que cette structure impose du registre de
l'inconscient que j'ai figur par cette image du
point S qui, par rapport un miroir, effectivement
- dont il s'agit de savoir maintenant, quelle est ici
la fonction ambigu - se mettre donc - l'aide de
ce miroir par o je dfinis dans ce schma le champ
de l'Autre - en pouvoir de voir, grce au miroir,
d'un point qui n'est pas celui qu'il occupe ce qu'il
ne pourrait voir autrement, du fait qu'il se tient
dans un certain champ, savoir ce qu'il s'agit de
produire dans ce champ, ce que j'ai reprsent par un
vase retourn sous une planchette et profitant d'une
vieille exprience de physique amusante
172
, prise pour
modle.
172 H. Bouasse, Lexprience du bouquet renvers.
543
Ici, il ne s'agit point de structure, mais comme
chaque fois que nous nous rfrons des modles
optiques, d'une mtaphore bien sr, une mtaphore qui
s'applique, si nous savons que grce un miroir
sphrique une image relle peut tre produite d'un
objet cach sous ce que j'ai appel une
planchette et que, ds lors, si nous avions l un
bouquet de fleurs prt accueillir ce cernage, le
col de ce vase.
Il y a l, un jeu qui est prcisment celui qui
constitue ce petit tour de physique amusante,
condition que, pour le voir, on soit dans un certain
champ scnique qui se dessine partir du miroir
sphrique. Si on ne l'occupe pas, justement, on peut,
se faire transfrer comme vision, dans un certain
point du miroir se trouver l, dans le champ conique
qui vient du miroir sphrique. C'est--dire que c'est
ici qu'on voit le rsultat de l'illusion, savoir
les fleurs entoures de leur petit vase.
Ceci, bien sr, comme modle optique, n'est point la
structure, pas plus que FREUD n'a jamais pens vous
donner la structure de fonctions physiologiques
quelconques, en vous parlant du moi, du surmoi, de
l'idal du moi ou mme du a. Il n'est nulle part
dans le corps, l'image du corps par contre y est.
Et ici le miroir sphrique n'a point d'autre rle
que de reprsenter ce qui, en effet, dans le cortex,
peut tre l'appareil ncessaire, nous donner dans
son fondement, cette image du corps.
Mais il s'agit de bien autre chose dans la relation
spculaire, et ce qui fait pour nous le prix de cette
image dans sa fonction narcissique, c'est ce qu'elle
vient, pour nous, la fois, enserrer et cacher,
de cette fonction du petit (a).
Latente l'image spculaire, il y a la fonction du
regard. Et pourtant, je suis tonn, sans savoir
quoi le rapporter, la distraction j'espre, non pas
au manque de travail, ou simplement au dsir de ne
pas s'embarrasser soi-mme, est-ce qu'il n'y a pas l
quelque problme, au moins soulev, depuis que je
vous ai dit que le (a) n'est pas spculaire.
544
Car, dans ce schma, le bouquet de fleurs vient de
l'autre ct du miroir. Il se reflte dans le miroir,
le bouquet de fleurs ! C'est bien toute la
problmatique de la place de l'objet(a).
qui appartient-il dans ce schma ?
la batterie de ce qui concerne le sujet, ici en
tant qu'il est intress dans la formation de ce moi
idal, ici, incarn dans le vase de l'identification
spculaire o le moi prendra son assiette, ou bien
quelque chose d'autre ?
Bien sr, ce modle n'est point exhaustif. Il y a le
champ de l'Autre, ce champ de l'Autre que vous pouvez
incarner dans le jeu de l'enfant, que vous voyez
s'incarner dans les premires rfrences qu'il fait
aussitt, sa dcouverte de sa propre image dans le
miroir : il se retourne, pour la faire, en quelque
sorte authentifier, celui qui, ce moment-l, le
soutient, le supporte ou est dans son voisinage.
la problmatique de l'objet(a) reste donc toute
entire ce niveau. Je veux dire, celui de ce
schma.
Eh bien, est-ce que j'ai besoin de beaucoup insister
pour vous permettre de reconnatre, dans ce tableau,
sous le pinceau de VELZQUEZ, une image presque
identique celle que je vous ai l, prsente?
Qu'est-ce qui ressemble plus, cette sorte d'objet
secret sous une brillante vture
qui est d'une part, ici reprsent dans le
bouquet de fleurs, voil, cach, pris, enserr,
autour de cette norme robe du vase qui est, la
fois image relle, mais image relle saisie au
virtuel du miroir
et l'habillement de cette petite infante, personnage
clair, personnage central, modle prfr de
VELZQUEZ qui l'a peinte sept ou huit fois - et vous
n'avez qu' aller au Louvre pour la voir peinte la
mme anne. Et Dieu sait si elle est belle et
captivante !
Qu'est-ce que c'est - pour nous analystes - que cet
objet trange de la petite fille que nous connaissons
bien.
545
Sans doute, elle est dj l selon la bonne
tradition, qui veut que la reine d'Espagne n'ait pas
de jambes. Mais est-ce une raison pour nous de
l'ignorer : au centre de ce tableau est l'objet
cach, dont ce n'est pas avoir l'esprit mal tourn de
l'analyste
je ne suis pas ici pour abonder dans une certaine
thmatique facile
mais pour l'appeler par son nom, parce que ce nom
reste valable dans notre registre structural, et qui
s'appelle la fente.
Il y a beaucoup de fentes, dans ce tableau,
semble-t-il, vous pourriez vous mettre les compter
sur les doigts en commenant par Dona Maria Augustina
de SARMIENTO qui est celle qui est genoux,
l'Infante, l'autre qui s'appelle Isabel de VELASCO,
l'idiote l, le monstre Mari-BARBOLA, la dona Marcela
da ULLOA aussi, et puis
je ne sais pas, je ne trouve pas que les autres
personnages soient d'une nature autre qu' tre
des personnages, rester dans un gynce, en
toute scurit pour celles qu'ils gardent
le guarda damas, falot qui est tout fait droite,
et pourquoi pas aussi le cabot qui, tout comdien
qu'il soit, me parait un tre bien tranquille. Il est
bien singulier que VELZQUEZ se soit mis l, au
milieu. Il fallait vraiment le vouloir.
Mais cette anecdote franchie, ce qui est important,
c'est le contraste de ceci, que toute cette scne qui
ne se supporte que d'tre prise dans une vision, et
vue par des personnages dont je viens de vous
souligner que, par position, ils ne voient rien. Tout
le monde leur tourne le dos et ne leur prsente, en
tout cas, que ce qu'il n'y a pas voir.
Or, tout ne se soutient aussi que de la supposition
de leurs regards. Dans cette bance gt proprement
parler une certaine fonction de l'Autre, qui est
justement celle l d'une vision monarchique au moment
o elle se vide.
546
De mme qu' maintes reprises, pour ce qui est de la
conception du Dieu classique, omniprsent,
omniscient, omnivoyant, je vous pose la question :
ce Dieu l peut-il croire en Dieu, ce Dieu-l
sait-il qu'il est Dieu ? , de mme ce qui, ici, dans
la structure mme s'inscrit, c'est cette vision d'un
Autre qui est cet Autre vide, pure vision, pur
reflet, ce qui se voit, la surface, proprement, de
miroir de cet Autre vide, de cet autre complmentaire
du Je pense cartsien, je l'ai soulign, de
l'autre en tant qu'il faut qu'il soit l pour
supporter ce qui n'a pas besoin de lui pour tre
support, savoir la vrit qui est l, dans le
tableau, telle que je viens de vous la dcrire.
Cet Autre vide, ce Dieu d'une thologie abstraite,
pure articulation de mirage, Dieu de la thologie de
FENELON, liant l'existence de Dieu l'existence du
moi, c'est l le point d'inscription, la surface sur
laquelle VELZQUEZ nous reprsente ce qu'il a nous
reprsenter.
Mais comme je vous l'ai dit, pour que ceci tienne, il
reste qu'il faut qu'il y ait aussi le regard.
C'est ceci qui, dans cette thologie est oubli et
cette thologie dure toujours, pour autant que la
philosophie moderne croit qu'il y a eu un pas de fait
avec la formule de NIETZSCHE qui dit que Dieu est
mort.
Et aprs ? a a chang quelque chose ?
Dieu est mort, tout est permis dit le vieil
imbcile, qu'il s'appelle le pre Karamazov ou bien
NIETZSCHE. Nous savons tous que depuis que Dieu est
mort, tout est comme toujours, dans la mme position,
savoir que rien n'est permis, pour la simple raison
que la question, non pas de la vision de Dieu et de
son omniscience, est l ce qui est en cause, mais de
la place et de la fonction du regard.
L, le statut de ce qu'il en est advenu du regard de
Dieu n'est pas volatilis. C'est pour a que j'ai pu
vous parler comme je vous ai parl du pari de PASCAL,
parce que, comme dit PASCAL : nous sommes engags
547
et que les histoires de ce pari, a tient toujours.
Et que nous en sommes toujours jouer la balle
entre notre regard, le regard de Dieu, et quelques
autres menus objets comme celui que nous prsente,
dans ce tableau l'Infante.
Et ceci va me permettre de terminer sur un point
essentiel pour la suite de mon discours. Je m'excuse
pour ceux qui n'ont pas le maniement de ce que j'ai
avanc prcdemment, de l'ordre de ma topologie,
savoir ce menu objet appel le cross-cap ou le plan
projectif, o peut se dcouper, d'un simple tour de
ciseaux la chute de l'objet(a), faisant apparatre
cet S doublement enroul qui constitue le sujet.
Il est clair que dans la bance ralise par cette
chute de l'objet - qui est, en l'occasion, le regard
du peintre - ce qui vient s'inscrire c'est, si je
puis dire, un objet double car il comporte un
ambocepteur. La ncessit de cet ambocepteur - je
vous la dmontrerai quand je reprendrai ma
dmonstration topologique - dans cette occasion,
c'est prcisment l'Autre.
A la place de son objet, le peintre, dans cette
uvre, dans cet objet qu'il produit pour nous, vient
placer quelque chose qui est fait de l'autre, de
cette vision aveugle qui est celle de l'autre, en
tant qu'elle supporte cet autre objet. Cet objet
central : lInfante, la petite fille, la girl, en
tant que phallus qui est ceci, aussi bien, que tout
l'heure, je vous ai dsign comme la fente.
Qu'en est-il de cet objet ? Est-il l'objet du peintre
ou de ce couple royal dont nous savons la
configuration dramatique : le roi veuf, qui pouse sa
nice, tout le monde s'esbaudit : vingt-cinq ans de
diffrence! C'est un trs bon intervalle d'ge !
mais peut-tre pas quand l'poux a environ quarante
ans. Il faut attendre un peu !
Et, entre les deux de ce couple
o nous savons que ce roi impuissant a conserv
le statut de cette monarchie qui, comme son image
mme, n'est plus qu'une ombre et un fantme, et
548
cette femme, jalouse, nous le savons aussi par
les tmoignages contemporains
quand nous voyons que dans ce tableau qu'on appelle
la famille du roi, alors qu'il y en a une autre, qui
a vingt ans de plus, qui s'appelle Marie-Thrse et
qui pousera Louis XIV. Pourquoi est-ce qu'elle n'est
pas l, si c'est la famille du roi ? C'est peut-tre
que la famille a veut dire toute autre chose.
On sait bien qu'tymologiquement famille a vient de
famulus, c'est--dire tous les serviteurs, toute la
maisonne. C'est une maisonne bien centre, ici, sur
quelque chose et sur quelque chose qui est la petite
Infante, l'objet(a) en quoi nous allons ici rester
sur la question dont il est mis en jeu, dans une
perspective de subjectivation aussi dominante que
celle d'un VELZQUEZ dont je ne peux dire qu'une
chose, c'est que je regrette d'abandonner son champ
dans les Mnines cette anne, puisque aussi bien,
vous voyez bien que j'avais envie aussi de vous
parler d'autre chose.
Quand il se produit ce quelque chose - qui n'est,
bien entendu, pas la psychanalyse du roi puisque,
d'abord, ce serait de la fonction du roi qu'il
s'agit, non pas du roi lui-mme - quand vient
apparatre, dans cette prise parfaite, cet objet
central o viennent se conjoindre, comme dans la
description de Michel FOUCAULT, ces deux lignes
croises qui dpartagent le tableau pour, au centre,
nous isoler cette image brillante.
Est-ce que ce n'est pas fait pour que nous,
analystes, qui savons que c'est l le point de
rendez-vous de la fin d'une analyse, nous nous
demandions comment, pour nous se transfre cette
dialectique de l'objet(a)? Si c'est cet objet(a)
qu'est donn le terme et le rendezvous o le sujet
doit se reconnatre. Qui doit le fournir ?
Lui ou nous?
Est-ce que nous n'avons pas autant faire, qu'a
faire VELZQUEZ dans sa construction? Ces deux
points, ces deux lignes qui se croisent, portant dans
l'image mme du tableau ce bti de la monture, les
deux montants qui se croisent.
549
C'est l o je veux laisser suspendu la suite de ce
que j'aurai vous dire, non sans y ajouter ce petit
trait : il est singulier que si je termine sur la
figure de la croix, vous puissiez me dire que
VELZQUEZ la porte, sur cette espce de blouson avec
manches creve, dont vous le voyez revtu.
Eh bien, apprenez-en une que je trouve bien bonne :
VELZQUEZ avait, pour le roi, dmontr la monture de
ce monde qui tient tout entier sur le fantasme. Eh
bien, dans ce qu'il avait peint d'abord, il n'y avait
pas de croix sur sa poitrine, et pour une simple
raison c'est qu'il n'tait pas encore chevalier de
l'ordre de Santiago. Il a t nomm environ un an et
demi plus tard et on ne pouvait la porter que huit
mois aprs.
Et tout a nous mne tout a nous mne en l659.
Il meurt en l660 et la lgende dit qu'aprs sa mort,
c'est le roi lui-mme, qui est venu, par quelque
subtile revanche, peindre sur sa poitrine cette
croix.
Table des sances
550
0l Juin l966 Table des sances
Nous avanons vers la clture de cette anne dont je
m'aperois que, par rapport la plus grande partie
de mes collgues, je la prolonge avec un zle
inhabituel. Il n'est pas coutume de vous solliciter
d'une prsence au-del du dbut de Juin, pourtant on
sait que ma coutume est diffrente et il est probable
que je ne la modifierai pas beaucoup cette anne.
Tout dpend de la place que je donnerai au sminaire
ferm : un ou deux.
Il me reste donc deux fois vous parler, dans la
position d'aujourd'hui, dite du cours ouvert. Ce sera
bien sr, pour essayer de rassembler le sens de ce
que j'ai apport devant vous cet anne sous le titre
de l'objet de la psychanalyse dont vous savez qu'il
n'est point cette sorte d'ouverture vague qui s'offre
simple leture du titre mais qu'il veut dire trs
prcisment ce que j'ai articul dans la structure
comme l'objet(a).
Vous pourrez remarquer aussi que, si l'objet(a) est
bien celui dont il se trouverait prendre dans son
accolade, l'ensemble des objets que les
psychanalystes ont fait fonctionner sous cette
rubrique, j'aurais certainement manqu quelque peu,
mme beaucoup, ma fonction descriptive ou de
collation. Je les ai numres, quelquefois la
file, mais on ne peut pas dire que je me sois
appesanti sur leurs bouquets et puisque l'autre jour
je rappelais leur reprsentation justement sous la
forme d'un bouquet de fleurs, je ne me suis pas tal
sur leur botanique chacune.
J'ai surtout parl d'lments topologiques, et
d'lments topologiques o, en somme, je n'ai pas,
jusqu' prsent, d'une faon explicite, tout fait
point o le mettre cet objet(a). Bien sr, ceux qui
m'coutent bien ont pu plus d'une fois recueillir que
l'objet(a) est structure topologique, celle que je
vous ai image par les figures du tore, du cross-cap,
de la mitre, voire de la bouteille de KLEIN : on peut
l'en dtacher avec une paire de ciseaux.
551
Ils ont pu entendre aussi que c'est l une opration
sur la nature de laquelle on se tromperait tout
fait si on croyait que l'en dtacher avec une paire
de ciseaux sous la forme de quelques rondelles, a
reprsente quoi que ce soit.
L encore, le terme de reprsentant de la
reprsentation conviendrait, car la reprsentation
n'est absolument pas du tout dans cette opration
d'isolation, de dcoupage, et il est facile de
s'apercevoir que ces structures sur lesquelles j'ai
opr pour mettre en valeur l'articulation de cette
opration, ces structures ont, si je puis dire, leur
ressources propres en des points qui, singulirement,
par rapport ce qu'elles reprsentent, justement, ne
peuvent gure se dsigner que par le terme de trou.
Si notre tore est efficace reprsenter quelque
chose, un enroulement rpt, successif
comme du fameux serpent amphisbne
173
qui
reprsente pour les Anciens quelque symbole de la
vie
bref si ce tore a une valeur quelconque c'est
justement parce que c'est cette structure topologique
qui est marque de cette chose centrale qu'il est
bien assurment, bien difficile de cerner quelque
part, puisqu'elle semble simplement n'tre qu'une
partie de son extrieur, mais qui, incontestablement,
qui structure le tore trs diffremment d'une sphre.
Eh bien, l'objet(a) - je le disais tout l'heure,
ceux qui ont prt attention ce que je disais et
qui ont pu, mme incidemment, me le voir
explicitement prononcer - l'objet(a) c'est l, dans
cet espace du trou qu'il est proprement, disons
reprsentable, proprement de ce fait qu'il n'est
aucunement reprsent.
Nous allons voir ces choses tout l'heure se boucler,
savoir pourquoi en somme, nous en venons une
rfrence proprement situe dans ce champ
topologique.
173 Serpent deux ttes de la mythologie.
552
Mais ds maintenant vous pouvez voir qu'il y a
srement quelque cohrence entre le fait qu'au
dernier temps des sminaires qui ont prcd
- y inclus les sminaires ferms - qui se sont passs
tout entier dvelopper propos d'un tableau trs
minent pour permettre de manifester, accentuer en
quelque sorte, par le peintre, la fonction de la
perspective, nous nous sommes trouvs, je dois dire
d'une faon laquelle vous pouvez faire la plus
grande confiance, je veux dire que j'y ai pouss
aussi loin que possible la rigueur avec laquelle peut
s'noncer, dans ce cas du champ scopique, comment se
compose le fantasme, enfin, qu'il est pour nous le
reprsentant de toute reprsentation possible du
sujet.
Vous sentez bien qu'il y a un rapport entre le fait
que j'ai mis tous les feux sur ce champ scopique, sur
l'objet(a) scopique, le regard, en tant, il faut bien
le dire, qu'il n'a jamais t tudi, jamais t
isol, je parle : l o j'ai parler, savoir dans
le champ, psychanalytique, o il est tout de mme
bien trange qu'on ne se soit pas aperu qu'il y
avait l quelque chose isoler autrement que pour
l'voquer dans - et encore, sans le nommer - dans de
grossires analogies. Un auteur au nom un petit peu
rebattu dans l'enseignement analytique, Monsieur
FENICHEL, nous a dmontr les analogies de
l'identification scoptophilique avec la manducation.
Mais analogie n'est pas structure et ce n'est pas
l'intrieur de la scoptophilie, isoler de quel objet
il s'agit et quelle est sa fonction.
Il ya bien d'autres choses encore par o le regard
aurait pu faire son entre. Au point o nous en
sommes, et o au moins une partie d'entre vous ont
pu, la dernire fois, m'entendre, aprs l'avoir situ
ce regard, au centre mme du tableau, cach quelque
part sous les robes de l'Infante, de ce point
envelopp, leur donner, si je puis dire, leur
rayonnement, j'ai fait remarquer qu'il tait l.
553
Par quel office ?
S'il est vrai, comme je l'ai dit que ce que le
peintre nous reprsente c'est l'image qui se produit
dans l'il vide du roi, cet il qui, comme tous les
yeux est fait pour ne point voir, et qui supporte en
effet cette image, telle que nous l'a peinte, c'est
dire non pas dans un miroir mais bel et bien son
image dans le bon sens, l'endroit.
Ici le regard est ailleurs, l, dans l'objet qui est
l'objet (a] par rapport ceux qui, tout au fond, le
couple royal, en posture la fois de ne rien voir et
de voir par leur reflet quelque part au fond de la
scne, l o nous sommes, cet objet(a) - devant ce
miroir, en somme, inexistant de l'Autre - nous avons
pos la question de savoir de qui il est
l'appartenance, de ceux qui le supportent dans cette
vision vide, ou du peintre - ici plac comme sujet
regardant - qui fait surgir la transmutation de
l'uvre d'art ?
Cette ambigut de l'appartenance de l'objet(a),
c'est l ce qui nous permet de le rapporter, de
renouer ce fil prcdent que nous avons laiss
pendant autour de la fonction de l'enjeu en tant que
nous l'avons illustr du pari de PASCAL.
L'objet(a) rejoignant ici sa plus universelle
combinatoire, c'est ce qui est en jeu entre S et A en
tant que aucun d'entre eux ne saurait coexister avec
l'autre, sinon d'tre marqu du signe de la barre,
c'est dire d'tre en position de divis prcisment
de l'incidence de l'objet(a).
L'impasse, l'cartlement o est mise la fonction du
sujet, justement, dans la fonction du pari - ce pari
absurde vraiment crucial pour tous ceux qui se sont
penchs sur son analyse - je rappelle que j'en ai
fait le chapitre d'introduction, l'avance de mon
expos cette anne, sur l'objet(a).
Il s'agit aujourd'hui de placer ce que j'avance
ainsi, de le replacer dans l'conomie de ce que vous
connaissez de ce qui vous sert d'appui dans la
doctrine de FREUD.
554
Car aussi bien, il ne doit pas tre oubli, pour
situer la porte de ce que je vous enseigne, du
procd de mon enseignement, qu'il n'est autre que ce
qu'il s'est dclar tre l'origine et qui lui donne
sa chair et son lien, car autrement on pourrait
s'tonner de tel ou tel dtour de mes cheminements.
Et pour qui reprendra ce que j'nonce depuis
maintenant quelques quinze ans - dans le recueil qui
en a toujours t fait avec soin, sinon avec succs,
et qui permettra au moins d'en garder le rseau
gnral - on verra qu'il n'y a rien qui n'ait t
chaque fois, trs exactement command par ceci, que
ce qui m'est demand est quoi ?
Repenser FREUD.
Voil comme je l'avancerai d'abord, prtant l
toutes sortes d'ambiguts, voire de malentendus,
Rckkehr zu FREUD, retour FREUD ai-je dit d'abord,
un moment o ceci prenait son sens des
manifestations confusionnelles d'un prodigieux
dvoiement dans l'analyse.
Il est d'importance secondaire qu'il apparaisse ou
non que j'y ai, si peu que ce soit obvi.
C'tait moins de cette contingence que je
m'autorisais : l'idal, bien classique toutes
sortes d'idalisations, d'un retour aux sources,
n'est certes pas ce qui me poignait. Repenser, voil
ma mthode. Mais j'aime mieux ce second mot, si,
justement, vous penchant sur lui pour le dvisser
quelque peu, vous vous apercevez que le mot
[mthodos] peut exactement vouloir dire : voie,
reprise par aprs. Le mot [mta], comme toutes les
prpositions grecques - et la vrit comme toutes
les prpositions dans toutes les langues - pour peu
qu'on s'y intresse, est toujours un objet d'tudes
extraordinairement rmunrant.
S'il y a une espce de mots propos duquel on peut
dire que toute espce de prominence donne dans
l'tude linguistique la signification est destine
se perdre dans un labyrinthe inextricable, c'est
bien les prpositions.
555
L'exploration de la richesse et de la diversit de
l'ventail des sons du mot mta, vous pouvez
vous-mme essayer d'en faire l'preuve avec les
dictionnaires et vous verrez que rien n'obvie ce
que de ce mta, je passe ce que proprement
ncessitent les formes structurales que j'ai cette
anne promues devant vous, et nommment en vous
montrant sur la bande de MBIUS qui joue dans
apparemment - dans deux de ces formes, la fonction
d'un rapport tout fait fondamental, exemplaire, la
fonction de support de ce qui est leur structure et
qui est aussi latente la troisime, cette bande de
MBIUS qui nous exemplifie ce que j'appellerai la
ncessit, dans une structure du double tour. Je veux
dire que par un seul tour, vous ne bouclez
qu'apparemment ce qui s'y cerne, ne faisant retour
votre point de dpart qu' cette seule condition d'y
avoir renvers votre orientation - surface non
orientable - ce qui ncessite qu'aprs, si je puis
dire, l'avoir deux fois perdue, vous ne la retrouviez
qu' faire deux tours.
C'est trs exactement le sens que je donnerai ma
mthode au regard de ce qu'a enseign FREUD. S'il y
a, en effet, quelque chose d'trange qui soit le
caractre boucl, ferm, s'achevant, quoique marqu
d'une torsion par quelque chose qui se rejoint dans
ce point, o je l'ai longtemps soulign, choit sa
plume, soit : la Spaltung de l'ego
174
- et qui revient
tout charg du sens accumul au cours d'une longue
exploration, celle de toute sa carrire, vers un
point originel
au sens compltement transform
point originel d'o il partait presque de la notion
compltement diffrente du ddoublement de la
personnalit.
Disons que cette notion, en somme courante, quil a
su compltement transformer par les repres de
l'inconscient, c'est celle-l laquelle la fin,
sous la forme de la division du sujet, il donnait son
sceau dfinitif.
174 S. Freud, (Die Ichspaltung 1940. G.W XVII), Le clivage du moi dans les processus de dfense.
556
Ce que j'ai faire, c'est trs exactement de faire
une seconde fois le mme tour, mais dans une telle
structure, le faire une seconde fois n'a absolument
pas le sens d'un pur et simple redoublement.
Et cette ncessit structurale a quelque chose de
tellement premier qu'il ne nous est permis d'y
accder que par la voie d'un difficile reprage,
quelque chose qui, je dirais, presque ncessite une
sorte de boussole laquelle il me faut bien, de la
faon dont j'ai oprer, parlant des praticiens,
justifier de vous fier la mienne,
trs proprement en tant qu'elle se supporte d'une
combinaison de l'exprience analytique et de la
lecture de FREUD mais dont la trigonomtrie a tout de
mme sa sanction, c'est savoir, disons le mot, si
a colle ou pas.
Tous ceux qui viennent l pour m'entendre peuvent
recouper effectivement, qu'avec une construction qui,
bien des fois, semble s'appareiller d'lments qui
taient FREUD bien trangers, c'est trs
prcisment ces points de rendez-vous importants
que je me trouve le rencontrer et d'une faon
qui claire d'une toute nouvelle perspective les
points sur lesquels il a mis l'accent de la valeur.
J'ai dit tout l'heure qu'il n'tait pas tellement
important, que pendant le temps o je poursuis cette
opration, se manifeste bien clairement quelque chose
du ct de ce qui s'nonce du courant de la
psychanalyse comme un renversement du mouvement.
Il faut bien en tout cas que je me rsigne que ce que
j'enseigne ne porte pas immdiatement ce qu'il est
fait pour engendrer, qu'il se contente d'abord de
rassembler ceux qui y peuvent trouver matire.
Car aussi bien, il est un certain ordre d'oprations
auquel je n'ai pas donner de nom gnral, si ce
n'est qu'il est proprement celui qui s'exemplifie de
ce que je viens de dfinir, savoir l'achvement
d'une structure dont il n'est pas tellement essentiel
qu'il se sanctionne immdiatement par ses effets de
communication.
557
Au grand tonnement de quelqu'un, que j'voque ici
dans le souvenir, j'ai pu noncer que ce que j'avais
dit un jour
devant un auditoire qui n'tait certainement pas
le vtre, devant un auditoire qui n'tait pas non
plus de tellement mauvaise qualit, mais devant
un auditoire fort peu prpar
ce que j'avais pu avancer sous un titre comme :
Dialectique du dsir et subversion du sujet
175
Comment, me disait-on pouvez-vous croire qu'il y ait le
moindre intrt noncer ce que vous noncez devant des
gens aussi peu faits pour l'entendre ? Est-ce que vous
croyez que ceci existe dans une sorte de tiers ou de quart
espace ?
Assurment pas, mais qu'une certaine boucle ait t
effectivement boucle et que quelque chose - si peu
que ce soit - en reste indiqu quelque part, voil
qui suffit parfaitement justifier qu'on se donne la
peine d'en faire l'nonc.
C'est ici que la notion d'intersubjectivit devient
tout fait secondaire : le dessin de la structure
peut attendre, une fois qu'il est l, il se soutient
par lui-mme et la faon - si je puis dire, la
mtaphore m'en vient l extemporane - la faon
d'un pige, d'un trou, d'une fosse. Il attend que
quelque sujet du futur vienne s'y prendre.
Il n'y a donc que peu s'inquiter de ce qu'on peut
appeler la dfaillance d'une certaine communaut
- dans l'occasion la psychanalytique - ou plutt, il
y a reprer ce propos, en quoi cette dfaillance
consiste prcisment, dans la mesure - comme je le
fais quelquefois - o on peut y reprer qu'elle porte
tmoignage en faveur de la structure qu'il y a
dessiner.
Vous me direz : o sont les critres de celui qui
donne la bonne structure ? Mais prcisment, c'est
la structure elle-mme.
175 crits p.793 ou t.2 p.273.
558
Dans le champ o il s'agit du sujet, si la structure
est telle que dans l'esquisse, le projet, que vous
faites d'un champ d'objectivation, il n'est pas
impliqu comme ncessaire que vous deviez trouver la
marque, l'empreinte, la trace sanglante et clate du
sujet lui-mme, si c'est exclus d'avance, si je puis
dire au nom de cette fausse modestie exprimentale
qui, croyant s'autoriser de ce qui a t russi
dans le champ de la science physique, croit
pouvoir se permettre de projeter en ce champ
qu'on appelle psycho-sociologie cette sorte
d'objectivation pleine et de plein droit, au nom
de je ne sais quelle faon de tirer son pingle
du jeu au dpart
l'abri de la fausse modestie exprimentale, nous
dirons qu'il est un critre, un registre de
l'preuve, qui est valable, logiquement, que
j'appellerais de ces termes. Il y a des structures
initiales de la dmarche de la pense dont on ne peut
rien dire de plus qu'elles peuvent ou ne peuvent pas
tre souponnes d'tre vraies. L est le test de la
structure.
Si faussement modeste qu'elle soit, celle qui
s'avance dans son champ - celui que j'ai nomm tout
l'heure - d'une faon qui ne prsente pas en elle la
ncessit de cette dchirure, de cette bance, de
cette plaie, ce qui se retrouvera, c'est le signe,
dans un certain nombre de paradoxes. Et aussi bien le
champ de cette science russie, sans doute, qui est
la ntre - pour autant que, dans tout son champ
physique, elle a russi forclore le sujet - ne peut
donner son fondement, son principe mathmatique qu'
retrouver cette mme bance, sous la forme d'un
certain nombre de paradoxes. En ce point elle
continue pouvoir donc tre souponne d'tre vraie.
Mais toute cette plaie que nous laissons s'tendre,
au nom de ne pas savoir motiver ce que veut dire
qu'elle ne saurait en aucun cas tre suppose d'tre
vraie, voil ce qui laisse le champ libre ce que
j'ai appel cette plaie que vous pouvez pingler
encore du terme de mdico-pdagogique.
559
C'est bien l, la gravit du cas du psychanalyste.
Car c'est toute leur force, et je pense que ce que
les mots que je dis ont assez de poids et de porte
pour que, concernant leur place, vous donniez son
sens ce prestige - ils n'en ont pas d'autre - dans
le champ de la science : qu'ils peuvent bien tre
souponns d'tre les reprsentants d'une
reprsentation qui serait vridique.
C'est bien dans ce registre, et ce qui accroche et ce
qui arrte devant ce qui serait normal, une pure et
simple position de rejet puisque, aussi bien, nous
n'avons pas encore russi donner un statut valable
au matriel qu'ils apportent.
Or c'est bien l, quest le glissement et l'alibi :
qu'une formation rponde une dfinition de la
structure, par quoi elle peut tre souponne d'tre
vraie. Ce qui, puisqu'il n'y a que soupon, ne veut
pas dire suffisance, mais implique un il faut
au-del duquel peut-tre, rien d'adjoint ne peut
dcisivement apporter la suffisance.
Tel est ce signe qui est la dfinition de ce soupon,
et c'est bien l, en effet, notre problmatique
devant ce que nous propose le symptme comme question
de vrit. Chaque fois que nous avons affaire,
diversement camps dans un savoir, cette
interrogation de la vrit, la mme ambigut se
prsente ,que supporte et qu'incarne le terme de
reprsentant de la reprsentation.
Car c'est bien ainsi que depuis toujours, choue sur
le leurre que je vais dire, la critique - par
l'Aufklrung - de la religion.
Ces reprsentants savent fort bien l'erreur en quoi
consiste cette reprsentante de la vrit, de
l'attaquer sur les reprsentations, sur les
reprsentations qu'elle en donne, et ceci, les
reprsentants eux-mme, c'est--dire les personnages
diversement sacraliss, le savent fort bien. Ils
encouragent que les assigeants de la citadelle
discutent sur la vraisemblance de l'arrt du soleil
dans la bataille de Josu ou telle ou telle autre
historiette du texte sacr.
560
La question n'est pas porter dans la structure qui
prtend intresser la question de la vrit sur les
reprsentations, quelles que puissent tre les
reprsentations de cette structure, mais sur les
reprsentants de la reprsentation.
C'est pourquoi ceux-ci aiment mieux que la bataille
se porte sur les thmes, d'autant plus inexpugnables
de la rvlation, qu'on peut les pourfendre aussi
longtemps qu'on voudra, comme ils sont de la matire
mme de la structure, c'est--dire pas de la mme
matrialit que les pes qui les traversent, ils se
porteront encore longtemps fort bien.
Ainsi, inverse est ce que nous pourrons appeler la
trahison des psychanalystes.
C'est que pour tre les reprsentants d'une position
qui peut tre souponne d'tre vraie, ils se croient
en devoir de donner corps par tout autre moyen que
ceux qui devraient dcouler du cernage le plus strict
de leur fonction de reprsentant : ils s'efforcent au
contraire, d'authentifier les reprsentations de
toutes les faons les plus trangres qu'ils puissent
chercher, pour leur donner le sceau du gnralement
reu.
Voici, dans la fin de ce que nous cherchons
construire, les critres de la structure en tant
qu'ils rpondent ces exigences - tant donn ce qui
est abord, savoir la structure du sujet - qu'une
doctrine puisse tre souponne d'tre vraie, ce qui
implique chez ceux qui en sont les reprsentants
quelque chose d'autre que de s'appuyer sur des
critres trangers. Voil ce qui justifie non
seulement la mthode mais les limites selon
lesquelles nous devons aborder certains lments-cl
de cette structure et concernant tel objet(a), celui
par exemple du champ scopique, assurment, nous
imposer cette discipline qui ne va pas sans quelque
puritanisme, de faire peu de cas de la richesse de ce
qui nous est l, offert, car aussi bien, comment ne
pas remarquer quel point de concours est ce regard
autour duquel, dj, FREUD nous a appris, lui, et lui
seul, reprer la fonction, la valeur du signe de
561
l'Unheimlichkeit
176
[ S. Freud, L'inquitante tranget et autres essais] car vous
pourrez remarquer, reprendre son tude, dans les
uvres qu'il apporte en tmoignage de cette
dimension, le rle, la fonction qu'y joue le regard
sous cette forme trange de l'il aveugle parce
qu'arrach, ou quelque attribut que ce soit qui peut
en reprsenter l'quivalent proche : les lunettes par
exemple ou encore l'il de verre, le faux il.
C'est l toute la thmatique d'HOFFMAN
177
, et Dieu sait
si elle est encore plus riche que je ne peux ici
l'voquer. La rfrence aux lixirs du diable est l
votre porte.
Il y a toute une histoire de l'il, c'est le cas de
le dire. Et ceux qui ont ici l'oreille ouverte ce
qui peut tre information larve, savent quoi je
fais allusion en parlant de l'histoire de l'il.
C'est un livre publi anonyme par un des personnages
les plus reprsentatifs d'une certaine inquitude
essentielle notre poque, et qui passe pour un
roman rotique.
L'histoire de l'il
178
est riche de toute une trame bien
faite pour nous rappeler, si l'on peut dire,
l'embotement, l'quivalence, la connexion entre eux,
de tous les objets(a) et leur rapport central avec
l'organe sexuel.
Bien sr, ce n'est pas sans effet que nous pourrions
en rappeler que ce n'est pas en vain que, c'est dans
ce point de la fente palpbrale que se produit le
phnomne du pleur dont on ne peut pas dire que nous
n'ayons pas cette occasion nous interroger sur
son rapport la signification structurelle donne
cette fente. Et comment ne pas voir aussi que ce
n'est pas en vain que l'il ou plutt cette fente
joue le rle, pour nous la fonction, de porte du
sommeil.
En voil beaucoup, et assez pour nous garer.
176 S. Freud, (1919, G.W XII), L'inquitante tranget et autres textes, Paris, Gallimard, Follio, 2003.
177 Ernst Theodor Amadeus Hoffman, Les lixirs du diable, capucin, Paris, Phbus, Coll. Libretto, 2005.
178 G. Bataille, Histoire de l'il, Gallimard, Paris, Coll. Limaginaire, 1993.
562
Trop de richesses ou trop d'anecdotes ne sont faites
que pour nous faire retomber dans l'ornire de je ne
sais quelle rfrence dveloppementale o chercher
une fois de plus les temps spcifiques dans
l'histoire qui - quel que soit l'intrt de ces
repres - ne font que nous dissimuler ce qu'il s'agit
de dfinir, savoir la fonction occupe par ce champ
scopique dans une structure qui est proprement celle
qui intresse le rapport du sujet l'Autre.
Il est bien trange, prcisment qu'alors qu'au cours
de tout ce temps, nous avons promu la fonction de la
communication dans le langage comme tant ce qui,
essentiellement, devait centrer ce qui regardait
l'inconscient
alors que de toutes parts, nous n'avons cess de
rentendre cette objection qui n'en est pas une,
savoir qu'il y a du prverbal, de l'extra-
verbal, de l'antverbal, alors qu'on a fait tat,
disons-nous, du geste, de la mimique, de la
pleur, de toutes les formes vasomotrices,
cnesthsiques ou autres, o soit-disant pourrait
s'exercer je ne sais quelle communication
ineffable, comme si nous l'avions jamais contest
que personne n'ait jamais promu ce qui tait
pourtant le seul point sur lequel il y avait vraiment
quelque chose dire, savoir l'ordre de
communication qui se passe par le regard.
a, en effet, ce n'est pas du langage.
C'est justement ce qui vient l'appui de la porte
de son recentrement, du maniement de l'inconscient
sur ce qui est du langage et de la parole, c'est que
justement, FREUD a inaugur la position analytique en
en excluant le regard.
C'est une vrit premire dont on est tout de mme
bien forc de faire tat car le fait justement qu'on
llide et qu'on loublie, prouve quel point on est
ct de la plaque.
563
Alors, cet objet(a), celui qui est en cause dans le
champ scopique, pourquoi est-ce celui-l que nous
avons mis, en somme, en avant, en pointe et sur
lequel cette anne, nous nous sommes trouvs
focaliser ce qu'on appelle, en cette occasion,
l'attention.
L'objet(a) est l'enjeu de ce qu'il y a de fondateur
pour le sujet dans son rapport l'autre. Notre
question est suspendue sur le sujet de son
appartenance. Regardons de plus prs de quoi il
s'agit, et en partant du plus lmentaire de ce qui
est donn dans l'exprience, propos de ce que les
analystes appellent la relation d'objet.
S'ils ont nettement laiss s'inflchir ce rapport du
sujet l'autre, le rduire au registre de la
demande, prenons-en faveur.
Les deux plus connus de ces objets, les objets-type,
si je puis dire, dans la fonction, l'tat qu'en fait
l'analyse :
- cest l'objet de la demande faite l'Autre, du bon
sein, comme on dit,
- c'est l'objet de la demande qui vient de l'autre,
celui qui donne sa valeur l'objet excrment.
Il est clair que tout ceci nous laisse enferms dans
une relation parfaitement duelle - quand je dis
parfaitement je ne veux y inscrire par l nul accent
de satisfecit, mais de ferm, de parfaitement clos -
et l'on sait ce qu'il en rsulta de rduction de
toute la perspective, aussi bien thorique,
comprhensive, pratique, clinique, psychologique et
mme pdagogique, pour s'enfermer dans ce cycle de la
demande, cohrent de celui de la frustration ou
gratification, frustration ou non frustration.
La restitution, en quelque sorte interne, immanente
la fonction de la demande, de ce qui doit en surgir
comme autre dimension du seul fait que cette demande
s'exprime par le moyen du langage : en tant qu'il
donne au lieu de l'Autre la primaut, permet de
donner un statut suffisant la dimension du dsir.
564
Dans la dimension du dsir vient se manifester le
caractre spcifique de l'objet(a) qui le cause, en
tant que cet objet prend cette valeur absolue, ce
cachet qui fait que ce que nous dcouvrons dans
l'efficience de l'exprience, ce n'est pas
proprement parler de la satisfaction du besoin qu'il
s'agit - ce n'est pas que l'enfant soit rempli, ni
que rempli il s'endorme, qui compte - c'est que
quelque chose qui prend un accent si particulier, un
accent de condition si absolue qu'il vient tre
isol sous ces termes diffremment dnomms qu'on
appelle nipple, bout de sein, bon sein, mauvais sein,
ce n'est pas de sa forme biologique qu'il s'agit,
mais d'une certaine fonction structurale qui,
justement permet de lui trouver l'quivalent qu'on
veut
dans, aussi bien, la ttine, par exemple, le
biberon ou n'importe quel autre objet mcanique,
ou mme le petit coin ou le petit bout de
mouchoir pourvu que ce soit le mouchoir sale de
la mre
donnera, prsentifiera la fonction de cet objet oral
d'une faon qui mrite d'tre spcifie,
structuralement, comme tant l, la cause du dsir.
Cette fonction de condition absolue laquelle est
port un certain objet, qui n'est dfinissable qu'en
terme structural, voil ce sur quoi il importe de
mettre l'accent, pour en donner les caractristiques.
Car, en effet, c'est quelque chose qui est emprunt
au domaine charnel et qui devient l'enjeu d'une
relation que - pour parler tout fait improprement -
on peut appeler inter-subjective.
Mais quel est, de cet objet, l'exact statut ? C'est
prcisment ce que nous sommes en train d'essayer de
dfinir. Pour les deux premiers objets que j'ai
points, ils sont en jeu dans la demande mais
pourtant pas sans qu'ils intressent le dsir de
l'Autre.
565
La valeur prise par l'objet rclam dans la
dialectique autant orale qu'anale joue sur le fait
qu'en le donnant, ou en le refusant, le partenaire,
quel qu'il soit, fait valoir ce qu'il en est de son
dsir, dans son consentement ou son refus.
La dimension du dsir surgit avec l'avnement de cet
objet qui, je le rpte, n'est pas l'objet de la
satisfaction d'un besoin, mais d'un rapport de la
demande du sujet au dsir de l'autre. Il est
l'inauguration de la fonction du dsir et il
introduit, dans cette dimension de la demande - qui
s'origine du besoin - la condition absolue du rapport
au dsir de l'autre.
Voici pourquoi ces deux objets se trouvent prvalents
dans la structure de la nvrose, et pourquoi rester
dans un horizon d'autant plus facilement born que
c'est eux-mmes qui le bornent : quand je dis
horizon, il a un sens depuis que j'ai parl d'une
certaine faon, de l'objet scopique.
Les psychanalystes se contentent si aisment d'une
thorie qui met tout l'accent sur la demande et la
frustration, sans s'apercevoir que c'est une
caractristique spcifique de la nvrose.
Le nvros a ce rapport l'Autre : que sa demande
vise le dsir de l'Autre, que son dsir vise la
demande de l'Autre.
Dans cet entrecroisement qui est li aux proprits
- je l'ai accentu plusieurs fois - de la structure
du tore, gt la limitation de la structure
nvrotique.
D'une autre dimension s'agit-il pour les autres
objets que j'ai dj introduit dans un certain
quatuor peut-tre est-il un cadran - savoir la
voix et le regard.
Il est certainement remarquable que je ne me sois pas
pench cette anne, tant donne la prdilection que
je peux avoir pour le champ des effets de la parole,
sur la voix.
566
Sans doute ai-je pour cela mes raisons, ne serait-ce
que celles que la limitation de temps m'impose peut-
tre, de devoir en prendre quelque peu pour faire
comprendre et promouvoir les choses nouvelles que
j'ai apportes justement sur le champ scopique.
Que pour ce qui est de la voix en tout a, l'objet
soit directement impliqu et immdiatement au niveau
du dsir, c'est ce qui est vident.
Si le dsir du sujet se fonde dans le dsir de
l'Autre, ce dsir comme tel se manifeste au niveau de
la voix. La voix n'est pas seulement l'objet causal
mais l'instrument o se manifeste le dsir de
l'Autre. Ce terme est parfaitement cohrent, et
constituant - si je puis dire - le point sommet par
rapport aux deux sens de la demande : soit l'Autre,
soit venant de l'Autre.
Comment, alors pourrons-nous situer cet objet et ce
champ scopique ?
Est-ce que ce n'est pas l que nous lui voyons - et
comme nous laisser guider par le paralllisme des
termes dsir, demande, de, , - que nous voyons
s'ouvrir cette dimension singulire, dj pour nous
offerte par l'vocation de la fentre - qui, aussi
bien, on l'appelle elle-mme volontiers un regard -
dans cette dimension de dsir l'autre, d'ouverture,
d'aspiration par l'autre, qui est proprement parler
ce dont, ce niveau, il s'agit.
C'est alors que nous pouvons voir pourquoi, il prend,
dans la topologie elle-mme cette fonction privilgie
puisque, en fin de compte, quelque rduction
combinatoire que nous puissions pousser ces formes
topologiques dont je fais devant vous tat en en
faisant image, il semble qu'il y reste quelques
rsidus de ce que, peut-tre faussement on appelle
intuitif, et qui est proprement cet objet(a) que
j'appelle le regard.
567
Je vais, pour terminer, aujourd'hui et comme pour
simplement fournir un point de scansion, voquer -
sous une forme qui aura l'avantage de vous montrer la
polyvalence des recours qu'on a au niveau de la
structure - voquer pour vous une autre forme, aussi
bien topologique, qui viendra recouper le paradigme,
l'exemplification que je vous ai donne de cette,
structure scopique au niveau des Mnines.
Je vais terminer la leon d'aujourd'hui, pour trouver
un point de chute sur ce que je vous ai prsent
comme la bonne plaisanterie du roi collant la croix
de Santiago sur la poitrine du peintre dans le
tableau Les Mnines, que ce soit ou non comme la
lgende le dit, en y mettant lui-mme la main au
pinceau.
Ce petit trait aurait mu, si j'en crois les chos,
dans l'assemble, quelques bonnes mes qui y auraient
vu une secrte allusion ce que j'ai traner moi-
mme !
Que ces bonnes mes se consolent, je ne me sens pas
crucifi ! Et pour une simple raison, c'est que la
croix d'o je partais
celle des deux lignes qui divisent le tableau des
Mnines celle qui va du point d'horizon qui se
perd, passant par la porte,(le personnage qui
sort) jusqu'au premier plan au pied du grand
tableau - reprsentant de la reprsentation - et
l'autre ligne, celle qui part de l'il de
VELZQUEZ pour s'en aller tout fait vers la
gauche, l o elle rejoint son lieu naturel, o
je l'ai situ, savoir la ligne l'infini du
tableau
sont deux lignes qui, tout simplement, et toutes
croises qu'elles paraissent, ne se croisent pas,
pour la bonne raison qu'elles sont dans des plans
diffrents.
C'est
laque
analy
a [A
donc
plan
Eh bi
depui
occup
on pr
entre
[B] -
qu'es
A
On pr
avoir
puisq
il s
que
p
c
je v
appel
model
t bien
elle j'
ystes
A], d'u
deux l
.
ien sac
is trs
ps de
rend po
e ces d
- et qu
st-ce q
A
roduit
r, enfi
que je
'agit
pour vo
ce qui
vous de
lle un
le :
aussi,
ai affa
savoir
une fao
lignes
chez -
s longte
ce qu'o
our axe
deux pr
'on fai
qu'on pr
B
quelque
in, dan
n'enten
- on pr
ous fai
va enc
emande d
diabolo
s'il e
aire da
r que -
on qui
[1,2] qu
- c'est
emps pa
on appe
une tr
cdent
it tour
roduit
e chose
s les m
nds auc
roduit
re comp
ore se
de vous
o, autr
en est
ans mes
- on vo
s'inte
i ne so
t une p
ar les
elle le
roisim
tes - q
ner le
?
C
e - auq
minutes
cun cri
quelqu
prendre
produi
s repr
rement
une, to
rappor
us l'a
rrompt
ont pas
etite t
gens qu
s coniq
me ligne
qui sont
tout c
quel peu
prcd
pour m
e chose
e, parce
ire
senter
dit une
oute la
rts ave
reprs
- nous
dans l
trouvai
ui se s
ques -
e quelc
t donc
comme un
u de mo
dentes,
me dire
e comme
e que D
comme
e surfa
a croix
ec les
sent co
s avons
le mme
ille, fa
sont
que qua
conque
comme
ne toup
onde sem
pens
e de quo
e ceci
Dieu sa
ce qu'o
ace ain
568
omme
e
aite
and
a
pie,
mble
,
oi
[C]
it
on
si
569
ceci prs qu'elle s'en va, bien entendu puisqu'il
s'agit d'une droite, l'infini.
Qu'est-ce que c'est que cette surface ?
a se dmontre. C'est ce qu'on appelle une
hyperbolode de rvolution. Qu'est-ce que a veut
dire une hyperbolode de rvolution? C'est tout
simplement ce qu'on obtient en faisant tourner,
roter , une hyperbole autour d'une ligne qu'on
appelle sa drive.
Une hyperbole donc, c'est ce qui est l, savoir ces
deux lignes [1, 2] que vous voyez l en profil mais que
maintenant j'isole sur un plan.
Qu'est-ce que c'est qu'une hyperbole ? C'est une
ligne dont tous les points ont la proprit de ce
que leur distance deux points qui s'appellent les
foyers a une diffrence constante. Il en rsulte que
la mesure de cette diffrence est exactement donne
par la distance qui spare les deux sommets de cette
courbe : le point o elles s'approchent au maximum
sans parvenir se toucher.
Il est remarquable que, prcisment la surface de
ce qui est obtenu par une telle rvolution on puisse
tracer une srie de lignes droites qui ont pour
proprit de s'en aller l'infini.
J'espre que vous faites un peu attention ce que je
fais car a, c'est Justement la point vif et tout
fait amusant : ce sont toujours deux lignes droites
qui peuvent ainsi se dessiner, si je puis dire,
faisant se dployer autour la surface dfinie, d'une
faon qui, partir de son origine du plan parat en
effet complexe et tre ce qu'on appelle une conique,
nous trouvons donc sur une hyperbole - sur une
hyperbole de rvolution - la mme proprit de lignes
droites qui peuvent indfiniment se prolonger, que
nous trouverions sur un cne qui est une autre forme
de conique de rvolution.
Qu'en rsulte-t-il ? C'est que prcisment chacun des
points de ce qui est sur cette hyperbole, mme quand
elle est dploye dans l'espace par cette rvolution,
a cette proprit d'avoir par rapport chacun des
570
foyers une distance telle que la diffrence des deux
distances soit constante.
Nous voil donc en mesure d'illustrer quelque chose,
qui est reprsent par une sphre qui serait
caractrise, exactement, par le fait d'avoir comme
diamtre la mesure de cette diffrence, que ceci
reprsente quelque chose qui, l'intrieur de cette
surface hyperbolique est juste ce qui vient [penser]
son point d'troitesse maximum.
Tel est, si vous voulez voir une autre reprsentation
des rapports de S et de A, ce qui nous permettrait de
symboliser, d'une autre faon, l'objet(a).
Mais ce qu'il y a d'important, ce n'est pas cette
possibilit de trouver un support structural, c'est
la fonction dans laquelle nous pouvons l'inclure.
Ce sera l'objet de notre prochaine rencontre.
Nul lment ne peut avoir la fonction d'objet(a) s'il
n'est associable d'autres objets dans ce qu'on
appelle une structure de groupe. Vous voyez bien dj
ce qui est possible, car nous avons d'autres
lments. Encore que cette structure de groupe
implique-t-elle qu'on puisse employer un quelconque
de ces objets avec un signe ngatif.
571
Qu'est-ce que ceci veut dire ? Et o cela nous
conduit-il ? C'est ce qui nous permettra - ce que
j'espre faire la prochaine fois - de finir cette
anne avec quelque chose qui achve la dfinition
structurale impliquant la combinatoire de l'objet (a)
et la valeur qu'il peut prendre, comme tel, dans ce
qui est le fondement mme de la dimension proprement
freudienne du dsir et du sujet, savoir la
castration.
Table des sances
572
08 Juin 1966 Table des sances
Ce schma, prenez-le la valeur de ces espces de
bouchon de lige flottant sur une eau plus ou moins
calme qui peuvent vous servir reprer o vous avez
laiss traner un filet. Aussi bien, ni ce schma de
droite, ni ces mots bizarres :
I : hiarien
S : gniaka
R : le trou
mais dont j'espre que dj vous dit quelque chose la
rsonance, n'ont bien sur, une valeur opratoire
stricte. Ce sont des repres, des flotteurs
concernant ce que j'ai vous dire aujourd'hui et o
bien sr j'essaierai de mettre les choses au point
d'arrt que comporte le fait que ceci est mon - pour
cette anne - dernier sminaire ouvert.
Pour conserver la note de gravit que certains ont eu
le bon esprit de percevoir dans certaines des choses
que je disais la dernire fois je vais repartir
partir d'un point analogue qui est, qui m'a t
fourni par un entretien que j'ai eu cette semaine
avec un de mes amis mathmaticien :
Dans la mathmatique
me disait cet excellent ami dont je nomets le
nom que parce qu'aprs tout je ne sais pas si je
suis en droit de publier ces sortes d'ouverture
du cur, elles ne sont pas communes chez les
mathmaticiens, ce sont des gens qui dans
l'ensemble manquent un peu d'lan de ce ct-l,
il n'en est pas de mme chez ce personnage
distingu qui me disait
dans la mathmatique
573
en somme, et peut-tre aprs tout cet aveu lui
tait-il arrach par une certaine faon que
j'avais de le harceler, d'essayer de lui tirer du
nez le maximum de ce que je peux pour ces sortes
de vermicules que je viens ensuite faire se
tortiller devant vous sous la forme de ma
topologie
dans la mathmatique, remarquait-il, on ne dit pas de
quoi on parle - tout est dans ce on ne dit - on le
parle tout simplement, d'o un certain air - disait-il
textuellement - de faire semblant
et c'est ce qu'il appelait
d'un ton, comme a, avec un grain qui n'est pas
usuel dans ces sortes de dialogues
c'est ce qu'il appelait :
ce je ne sais quel air d'hypocrisie qu'il y a dans le
discours mathmatique
je n'oserais, moi-mme, avancer une chose semblable,
si je ne la recueillais de la bouche d'un
mathmaticien lui-mme, qui - il faut dire que c'est
quelqu'un qui - cet endroit, ne manque pas
d'exigence. C'est comme si celui qui nonait, un
certain niveau de reprise, ce discours mathmatique,
se trouvait toujours en posture de cacher quelque
chose. Mais l, mon mathmaticien ne se trouve pas
sans biais, car qu'il soit sur une attente de cette
confidence
qui tient aussi, peut-tre, n'omettons rien
d'aucune des faces de la situation , au filet
qu'il tend vers moi
savoir ce que lui aussi de son ct, dsire
extraire de ce bain, dont je suis cens tre le
dtenteur, il revient quand mme sur ses pieds, sa
position, et ajoute qu'aprs tout ce qu'il cache lui,
mathmaticien c'est strictement ce qu'il doit cacher.
L'astuce du discours rationnel c'est d'arriver le
laisser cacher, ce qu'on ne dit pas concernant
exactement la matire, le sujet de la mathmatique.
574
Ce, en tout cas, dont on parle, on le parle tout
simplement.
Une petite parenthse : il en rsulte que les plus
pais et seulement eux - seulement eux, sachez-le
bien ! - croient que la mathmatique elle parle de
choses qui n'existent pas.
Et si j'annonce que je fais un petit dessin, un petit
crayonnage en marge, c'est un plaisir comme a que je
vous donne, en passant, mais a n'est pas du tout
l'axe de ce que je vais continuer vous dire :
seulement je vais vous faire remarquer par exemple,
que si vous ouvrez le livre de MUSIL, l
dont on vient de faire un trs joli film encore
un peu rat : les dsarrois de l'lve Trless
179
vous vous apercevrez que quand le lycen est un peu
fin, il peut y avoir les plus grands rapports entre
le jour o son matre d'cole patauge lamentablement
pour lui rendre compte de ce qu'il en est des nombres
imaginaires et le fait qu'il se rue comme par hasard
vers ce moment l dans une configuration proprement
perverse de ses rapports avec ses petits camarades.
Tout ceci n'est qu'une annotation marginale.
Je voudrais reprendre et dire la fois la diffrence
et la parent de la position du psychanalyste par
rapport celle du mathmaticien.
En fin de compte, et nous le verrons d'une faon
prcise, un certain niveau, lui non plus ne dit pas
de quoi il parle. Seulement, c'est pour des raisons
un peu diffrentes de celles du mathmaticien.
Vraiment - comme tout le monde le sait - s'il ne dit
pas de quoi il parle, ce n'est pas simplement parce
qu'il n'en sait rien, c'est parce qu'il ne peut pas
le savoir. C'est proprement ce que veut dire qu'il y
a de l'inconscient, de l'inconscient irrductible et
de l'Urverdrngung.
Mais peut-on dire que, la faon dont le fait le
mathmaticien, il le parle, tout simplement ?
179 R. Musil, Les dsarrois de l'lve Trless, Seuil, Paris, Coll. Points, 1995. Film de Volker Schlndorff, N et B, Mars 1966.
575
Il est bien vident, qu'il n'est pas du tout dans la
mme position. D'une certaine faon, quelqu'un le
parle, ce dont il s'agit, seulement c'est celui
qui, il donne la parole, savoir le patient. Il
s'agit de savoir o il est car il n'est pas pour rien
dans cette position o il est, en tant qu'il fait que
le patient parle.
Car quand le patient parle, il parle sa faon
concernant ce dont il y aurait dire : ce dont il
parle et qui ne peut pas tre dit.
La chose curieuse, c'est qu'il faut bien que les
psychanalystes aussi parlent, et qu'il en rsulte,
non pas qu'ils parlent comme fait le mathmaticien,
tout simplement - ce dont on ne dit pas qu'il parle -
mais qu'il en parle ct. Il y a un petit syndrome
que les psychiatres ont trouv depuis trs longtemps,
qui s'appelle le syndrome de GANSER ce parler ct
qui caractrisa le discours da la communaut
analytique, peut-tre cela va nous permettre
d'clairer d'un curieux jour latral ou ambiant, je
n'en sais rien, faudrait voir a de prs, ce qu'il en
est du syndrome de GANSER, qui s'appelle prcisment
a : la rponse ct.
Bref ,le psychanalyste est amen avoir cette sorte
de discours qui retombe sur cette ncessit
fondamentale, bien sr, du discours, savoir qu'il
ait cours.
Et vraiment pour entrer plus loin dans ce sujet,
c'est aux mtaphores de l'usage de la
monnaie
non pas mme la mtaphorique, qu'il faudrait me
dire
180
savoir de la diffrence entre un certain discours
qui a un cours forc, l'intrieur, de ce cercle, et
d'autre part de la faon dont il a, en somme se
faire valoir sur le march des changes des cercles
externes.
C'est quelque chose que j'ai essay d'aborder quand
j'ai crit un article
181
180 Cf. cours lgal, cours forc dune monnaie
181 crits p.323 ou t.1 p.322.
576
que je me suis trouv relire pour des raisons non
tout fait contingentes, puisqu'il s'agit de le
faire reparatre avec tout un recueil
article sur les variantes de la technique, auquel
vous pourrez vous reporter.
La question est tout de mme celle-ci, pratique, pour
vous analystes, elle se formule d'une faon trs
gentille, trs nave : est-ce qu'il est vraiment
ncessaire d'apprendre la topologie pour tre
psychanalyste ?
Car, en fin de compte - et ce n'est pas avec des
bbs que ces dialogues s'changent - c'est cette
sorte de question qu'une certaine impasse aboutit.
Quoique je suis amen trancher parmi des notes
beaucoup plus nuances que j'avais jetes sur ce
thme, mais il faut bien fendre la vague et j'ai
d'autres choses importantes vous dire aujourd'hui,
pour la fendre et rpondre cette question.
Quiconque la pose, est dj en mesure que je lui
donne cette rponse : la topologie c'est pas quelque
chose qu'il doit apprendre en plus
en quelque sorte, comme si la formation du
psychanalyste consistait savoir de quel pot de
couleur on allait se peindre
il n'a pas se poser la question de savoir s'il
doit ou non apprendre quelque chose concernant la
topologie
dans l'tiquette abrge et, je dirai imprcise,
laquelle je dsigne le peu que j'en apporte ici
c'est que la topologie, c'est l'toffe mme dans
laquelle il taille, qu'il le sache ou qu'il ne le
sache pas. Peu importe, qu'il ouvre ou non un bouquin
de topologie, du moment qu'il fait de la
psychanalyse, c'est l'toffe dans laquelle il taille,
dans laquelle il taille le sujet de l'opration
psychanalytique : patron, robe, modle, cest ce qui
peut tre en cause, dans ce qu'il a dcoudre et
recoudre. Si sa topologie est faite en se trompant,
c'est au dpend de son patient.
577
Ce n'est pas d'hier, bien sr, que j'ai essay de
former cette construction, ces rseaux, ces criteaux
indicateurs, ces rseaux orients qui s'appellent
successivement schma L ou schma R, graphe ou, enfin
cette anne, depuis disons quelques annes, l'usage
des surfaces de l'analysis situs. Aprs tout ceux qui
m'ont pu voir travailler apporter ces choses savent
que je les ai construites, certes contre vents et
mares, mais pas uniquement par dsir de dplaire
mon auditoire, ancien et actuel, mais parce que je
n'avais qu' le suivre - ce plan dvelopper - dans
le discours mme de mes patients ou de chacun de
ceux, tout au moins que je peux contrler - qui
viennent ma porte pour faire ce qu'on appelle en
psychanalyse, un contrle [qui] m'apportent toute
crues, toute vives, ces formules mmes, qui sont
l'occasion les miennes : les malades les disent
strictement, rigoureusement, exactement comme elles
sont dites ici !
Cette topologie, si je n'en avais pas eu quelque
chose, dj, comme un petit vent, mais les malades me
l'auraient fait rinventer !
La question est donc claire, laide qu'on peut
prendre de telle ou telle rfrence, ce quelque
chose dont le mathmaticien ne dit pas ce que c'est,
mais qu'il le parle, eh bien, il y a toutes les
chances que a nous dblaie un peu le chemin, que a
nous donne des instruments, o l'occasion
reconnatre ce quoi nous avons affaire, ce que j'ai
pos depuis le dbut du moment o je me suis ml de
parler de la psychanalyse, savoir la fonction du
langage et le champ de la parole
182
.
Et pour ceux qui conservent toujours dans la tte
cette espce d'objection :
oui, mais ce n'est pas tout !
182 crits p.237 ou T.1 p.235.
578
je rpterai une fois de plus - depuis le temps que
je sue le rpter ! - qu'en effet, ce n'est pas
tout, mais que tout ce qui vient notre horizon dans
la psychanalyse, vient par l. Autrement dit, que
pour ce qu'il en est de rester cach, beaucoup plus
loin que cach, sans limite, inconnue, peine
approche en quelques points d'accs,
j'ai dit
ce que nous aussi nous ne disons que trs
rarement, au point mme qu'il vaut mieux ne pas
le dire
j'ai nomm la jouissance.
Nous n'aurions aucune espce d'ide de cette
dimension
de cette profondeur dont on ne peut pas dire
qu'elle s'offre nous puisqu'elle est interdite,
mais qu' tout le moins nous pouvons nommer, la
jouissance
nous n'en aurions aucune espce d'ide, si ce
n'tait la fondation du sujet dans le langage, qui
par voie de rpercussion, en tant qu'il fonde en nous
cet ordre, cette barrire, cette dfense qui
s'appelle le dsir qui, par rpercussion dis-je, ne
nous forait interroger :
contre quoi, nous dfendons-nous ?
Qu'en est-il de cette jouissance ?
Question, bien sr, que ne se pose aucun tre qui ne
soit l'tre parlant !
Qu'est-ce que profile pour vous, le droulement de
cette ligne droite ?
579
Mais, si vous avez quelque chose qui vous reste du
schma : S,I,i(a),A,
vous pouvez voir la disposition fondamentale qui va
du S au champ du grand Autre qui vous dsigne ce que
je vais vous rappeler tout l'heure, savoir que
c'est de ce champ [A] quest retir par le sujet
- comme appartenance - l'objet(a), que quelque chose
est en jeu, plus en de [-], concernant une autre
fonction de l'Autre puisque cet autre, l [J], en
arrire du sujet - lui tout fait cach et aperu
seulement comme en mirage l o il le projette, au
champ de l'Autre [J] la jouissance est placer.
Ceci pour l'orientation gnrale de ce que j'ai
vous dire, aujourd'hui.
En effet, la valeur foncire de l'objet de la
jouissance est de nous montrer par quel engrenage,
car nous n'avons rien d'autre jusqu' prsent :
je mets au dfi quelque philosophie que ce soit de
nous rendre compte prsent du rapport qu'il y a
entre le surgissement du signifiant et ce rapport de
l'tre la jouissance.
Il y en a forcment un. Quel est-il ?
Effectivement, c'est dans le filet de la topologie
subjective que se ramasse quelque chose de ce champ
de la Jouissance.
C'est trs prcisment
la chose en est en suspens en ce point o FREUD
nous la dit, c'est l le sens de ce qu'il dit
dans ce filet subjectif, dans ce qui fait que le
sujet n'est pas immanent mais latent, vanouissant au
rseau du langage. L-dedans est prise la jouissance
en tant qu'elle est jouissance sexuelle.
C'est l l'originalit et l'abrupt, l'accent, de ce
que nous dit FREUD.
580
Mais, pourquoi en est il ainsi ?
Aucune philosophie, dis-je, actuellement ne nous en
rend compte. Et ces misrables avortons de
philosophie que nous tranons derrire nous comme des
habits qui se morcellent ne sont rien d'autre, depuis
le dbut du sicle dernier, qu'une faon de batifoler
plutt que de s'attaquer cette question qui est la
seule, sur la vrit et ce qui s'appelle - et que
FREUD a nomme - l'instinct de mort, le masochisme
primordial de la jouissance, savoir : des
mtaphores, des reflets clairs que projette sur
cette question notre exprience.
Toute la parole philosophique foire et se drobe.
Nous ne savons donc pas ce qu'il en est de cette
prise au filet
dans ce champ redoutable et pourtant dj
annonc, dans tout le fantasme de la tragdie
nous ne savons pas pourquoi, quelque chose vient
notre exprience - d'une faon contingente
peut-tre - avec FREUD qui nous dit :
ce qui se prend au champ de la parole et du langage,
c'est ce qui de la Jouissance a un rapport avec cet
autre mystre
laiss intact, je vous le ferai remarquer, dans
tout le dveloppement de la doctrine analytique
et qui s'appelle la sexualit.
Alors, ce que j'appelle le doigt dans l'engrenage,
c'est qu'il s'agit de bien d'autre chose que de
rendre raison, nous n'en sommes pas matriser le
pourquoi de cette aventure. C'est dj beaucoup que
nous sachions comment on y entre, comment pris par le
petit doigt C'est peut-tre l, faire quelques
rflexions
celles qui s'imposent concernant la topologie de
cette mcanique
quil nous pourra venir quelque lumire sur ces
raisons et ces limites. D'autant plus, comme il doit
bien y avoir quelque temps que toute la mcanique
fonctionne, apercevoir les choses par ce bout, nous
en pourrons peut-tre savoir beaucoup, voir de
quelle faon antrieurement - on s'est oblig ne
pas voir.
581
Alors comment on y entre, c'est, videmment tout le
sens de l'objet(a). Dans ce rapport ce que nous
avons inscrit comme ncessaire du lieu de l'Autre,
dans ce rapport qui s'tablit par la demande et qui
nous y pousse partir du besoin, quelque chose entre
en jeu de trs simple : c'est ce que, de ce champ de
l'Autre, nous trouvons rcuprer notre propre corps
en tant que a y est dj. Que le sein ne soit qu'une
appartenance de ce corps gare au champ de l'Autre
tient ce que nous appellerons provisoirement, de
notre point de vue, une contingence biologique qui
s'appelle simplement tre mammifre.
Nous sommes mammifres mes petits amis, nous n'y
pouvons rien !
Et a a beaucoup d'autres consquences.
C'est, en gnral, accompagn de ce fait : d'avoir
cet appareil bizarre qui s'appelle un pnis et qui
fait que la copulation est soutenue par une certaine
jouissance : a ne casse pas les manivelles, comme on
dit, hein ! enfin c'en est une, une de celles qu'on
a la porte de la main
Je vous fais marrer
Mais c'est le centre de lenseignement analytique !
On a commenc par partir de l :
pas toutouche, ou en va te la couper.
- a t une des premires vrits : on faisait -
comme a, n'est ce pas ? dans la vague - cette
dcouverte formidable qui s'appelait l'Oedipe.
Il faut tout de mme bien voir que c'est ce niveau
de vrit triviale que cet autre petit bateau en
rapport avec le pnis est accroch dans l'norme
affaire de l'dipe. a devrait, tout de mme, nous
porter la rflexion.
Est-ce que tout est l ?
En d'autres termes, nous voil mis sur le cas de ce
qu'il faut penser de la castration .
a a bien rapport avec les deux termes que je viens
de mettre en avant : le cycle court de la jouissance
manuelle chez le mammifre.
582
Ah je n'ai pas perdu mon temps, cette anne, vous
expliquer ce que a peut tre chez les punaises
183
.
a doit tre insondable ! Auprs de cela la vtre
peut toujours aller se rhabiller !
C'est trs important, cette remarque.
- La seconde, en effet, c'est comme beaucoup de
choses - beaucoup de choses pour l'homme - c'est la
porte de la main, pour la raison qu'il n'y a pas
beaucoup d'tres, en dehors de lui, qui ont une main.
Les primates en font couramment toute la journe
l'usage que j'ai voqu tout l'heure et ont, par
consquent, concernant la jouissance des problmes
beaucoup plus simples.
Mais on remarquera que, par exemple, simplement chez
le chien
qui a sur le primate, l'avantage d'entrer dans le
champ de la parole humaine
tout ce qui se rapporte ce frottifrotta prend un
degr de plus de complication. On ne peut qu'admirer
qu'une chose : c'est quel point, les chiens sont
bien levs.
C'est de l qu'il faut partir.
VOUS voyez que, trs vite, nous nous trouvons engags
dans une espce de collusion
qui est bien ce sur quoi se sont prcipites les
personnes chemin court
de collusion entre l'objet(a) de la demande et
quelque chose qui concerne ce qu'on refuse de voir :
l'objet de la Jouissance.
C'est justement que, en rester l, on n'ira pas
loin. On n'ira pas loin parce que, rester ce
niveau de la demande, ce qui []quelle appartenance
du corps.
Je n'ai pas parl de l'autre, savoir de la plus
triviale, celle dont on dit qu'il nous est demand
par l'Autre et moyennant quoi nous lui donnons ce que
nous avons donner avec notre corps, le mettre au
lieu de l'Autre considr comme dpotoir, comme champ
d'pandage, savoir ce que nous appelons pudiquement
183 Cf. sminaire Langoisse, 06-03.
583
les fces, le scybale - [scubalon] ce qu'on
rejette - c'est un mot trs lgant et la vrit,
disons qu'ils ont, en gnral la fonction du dchet
corporel. limiter - comme il tend se faire, dans
un certain horizon analytique - toute la dialectique
des rapports du sujet l'Autre la demande, on
aboutit cette sphre limite la frustration, la
prvalence de l'Autre maternel, tout juste port aux
degrs de complication qu'on appelle le parent
compos. Et on obtient, en effet, quelque chose
d'assez ferm qui n'a vraiment qu'un seul
inconvnient c'est qu'on se demande aprs a pourquoi
il y a eu l'invention de l'Oedipe, alors que
justement cette invention tait originelle, qu'elle
est sortie bille en tte toute arme du cerveau de
FREUD. C'est bien certain que c'est ceci que se
rfre cette dimension du dsir pour autant que FREUD
l'a mise, lui aussi, d'abord, et que c'est seulement
autour d'elle que s'est difi, que s'est dcouvert
le mcanisme de la demande et qu'il n'est aucune
demande, non seulement qui n'voque mais qui,
littralement, ne s'voque que de la formation son
horizon de l'appel du dsir.
Disons que l'Autre
au lieu d'tre ce champ inerte o l'on rcupre
quelque chose, savoir ce sein qui est l'objet
idal, toujours manquant, qu'essaye dans toutes
sortes d'appareillage de reproduire la machinerie
humaine, en fin de compte que ce soit celui qui
fait de la nage sous-marine ou qui s'envole dans
les cosmos , comme on dit maintenant, c'est
toujours d'un petit appareil nourricier avec lui
et formant circuit ferm, qu'il s'aborne, aucun
besoin pour a d'imaginer sa nostalgie de
l'utrus maternel dans lequel, prcisment, son
appareillage tait, cet endroit, singulirement
dficient - je veux dire dans le registre que je
viens d'voquer - et d'une symbiose bien boiteuse
le champ de l'Autre c'est cela qu'il s'agit
d'intresser dans le dsir : le dsir vient
intresser l'Autre. Et c'est l, l'essence diffrente
des deux autres objets(a).
584
C'est pour cela, que cette anne j'ai fait pointer et
mme isoler, le paradigme du premier de ces objets,
savoir le regard, comme reprsentant le moment avanc
de mon expos.
Je ne me suis pas attard aux autres dont nous avons
suffisamment le maniement - encore qu'il y a
revenir l-dessus - mais j'ai parl du regard. Le
regard a ce privilge d'tre ce qui va l'Autre,
comme tel. C'est bien sr, il y a l toute une
phnomnologie laquelle on peut s'attarder, voire
mme on peut s'en rgaler, mais puisque c'est une
fente, quel moment fonctionne-t-il?
Quand il est ouvert ou ferm ? Il y a un rve, dans
la Traumdeutung, l-dessus, qui s'appelle fermer
les yeux .
Consultez-le un petit peu, tout est dj l, il y a
une foule de questions qui se posent, mais, de cette
fonction, du regard, j'ai cart tout pittoresque, je
n'ai pas demand pourquoi c'est partir du moment o
il est aveugle que Tirsias devient voyant
- batifolages qui font la joie ordinaire de notre
singulier milieu - j'ai donn la structure.
Et comment avec le regard, il entre en jeu - toujours
complte - une topologie que j'ai dcrite sur
laquelle on ne peut revenir qui est celle qui
justifie l'existence de l'cran. Dans ce champ de
l'Autre le regard est ce qui introduit l'cran et la
ncessit - qu'un de mes lves, MELMAN, m'a fait,
rcemment la remarque, qu'il est inscrit dans
l'article de FREUD ber Deckerinnerungen sur les
souvenirs crans - la ncessit que le sujet
s'inscrive dans le tableau.
Il n'y est pas dit, bien sr - cette topologie si
essentielle, si fondamentale tout le dveloppement
freudien - qu'elle est aussi importante que celle de
l'Oedipe, cette topologie qui est la vritable assise
et ce qui donne sa consistance cette fonction qu'on
appelle (pourquoi ?) la scne primitive.
Qu'est-ce que c'est, si ce n'est la ncessit de ces
cadres, de ces portants que j'ai essay, cette anne,
d'installer devant vous, pour vous y faire remarquer
585
la condition structurale qui n'est, peut-tre (c'est
cela qui est confirmer) que l'envers, que la
doublure, que le deuxime tour grce quoi
dj complet dans FREUD - mais jusqu'ici complt
par personne - complt parce que pas suivi dans
l'ordre
de son double tour instaure, cot de la loi du
dsir en tant qu'il est le dsir conditionn par
l'Oedipe, cette loi de ce qui lie, par quoi le sujet
est accroch au lieu de l'Autre, rend ncessaire ce
certain ordre construit autour de l'objet du regard.
Ce qui fait que quand cet objet de l'Autre vient se
dresser sur quelque chose que nous appelons comme
vous voudrez : le tableau, la scne ou l'cran
ceci est l'accrochage
juste memparant d'un terme dont je pense vous
savez l'origine d'Andr BRETON
184
que j'appellerai l'Autre, en tant que caractris
par ce peu de ralit qui est toute la substance du
fantasme, mais qui est aussi, peut-tre, toute la
ralit laquelle nous pouvons accder.
Ceci mrite que nous ayons laiss - et, non sans
desseins, pour des ncessits d'expos - plus tard,
cet autre objet, trange en somme de se croiser avec
l'objet du regard, j'ai dit : la voix. Mais en tant
que, lui venir manifestement de l'autre, c'est
nanmoins l'intrieur que nous l'entendons.
Ici la voix, bien sr, ce n'est pas seulement ce
bruit qui se module dans le champ auditif mais ce qui
choit dans cette rtroaction d'un signifiant sur
l'autre, qui est ce que nous avons dfini comme
condition fondamentale de l'apparition du sujet.
Autrement dit, dans toute la mesure o vous entendez
de tout ce que je dis, peu de choses, c'est que vous
tes occups par vos voix, comme tout le monde.
Et maintenant, il s'agit de savoir ce que veut dire,
dans tout ceci, la fonction de la castration.
184 Andr Breton, Introduction au discours sur le peu de ralit, in uvres compltes, volume II, Paris, Gallimard, Pliade,
1992, p.265-80.
586
La castration me semble lie la fonction du dsir
en tant que dans ce champ de l'autre elle est,
littralement, projete un point limite
suffisamment, indiqu dans le mythe par le meurtre et
la mort du pre et d'o dcoule la dimension de la
loi. On oublie trop que dans le mythe ce n'est pas
seulement, la mre que le pre accapare mais toutes
les femmes et qu'aprs l'nonc de la loi de
l'inceste il ne s'agit de rien d'autre que de
signifier que toutes les femmes sont interdites tout
autant que la mre
autrement l'histoire du complexe d'Oedipe a
besoin de tellement de rallonge, savoir que
c'est par transfert que les autres femmes (etc.),
c'est un accident, comme si c'tait un accident !
bref que le mythe d'Oedipe n'aurait, autrement aucun
sens. En d'autres termes, la castration se prsente
- la prendre par ce biais - comme quelque chose qui
nous suggre de nous demander l'objet par quoi le
sujet est intress dans cette dialectique de
l'autre, en tant cette fois qu'elle ne rpond ni la
demande, ni au dsir mais la jouissance, puisque
nous partons d'une question pose par FREUD, de la
jouissance des femmes, premier temps, rptons que la
jouissance, ici, donc, s'ouvre pour la premire fois,
comme question; en tant que le sujet en est barr, ce
que nous avions appel autrefois dans notre discours
sur l'Angoisse [1962-63] : embarrass !
Bien sr tout cela est rest, un tout petit peu, dans
les airs, c'est certainement de beaucoup le meilleur
sminaire que j'ai fait. Ceux qui ont eu le souci de
s'en repatre dans les vacances qui ont suivi,
peuvent en tmoigner. Mais en ce momentl j'avais
tout un premier rang de sous-offs qui prenaient
ardemment ce que j'crivais mais ils pensaient
tellement autre chose qu'on conoit qu'il ne leur
en soit rien rest.
Embarrass il est, le sujet, devant cette jouissance.
Et cette barrire qui l'embarrasse c'est trs
prcisment le dsir lui-mme.
587
C'est pour cela qu'il projette dans l'Autre, dans cet
Autre dont FREUD nous repre le mannequin sous la
forme de ce pre tu, o il est facile de reconnatre
le matre de HEGEL en tant qu'il se substitue au
Matre absolu. Le pre est la place de la mort et
il est suppos avoir t capable de soutenir toute la
jouissance.
C'est vrai dans FREUD, part ceci qu'aussi, dans
FREUD, nous pouvons nous apercevoir que c'est un
mirage.
a n'est pas parce que c'est le dsir du pre qui,
mythiquement, se pose l'origine de la loi grce
quoi ce que nous dsirons a pour meilleure dfinition
ce que nous ne voulons pas, ce n'est pas parce que
les choses sont ainsi, que la jouissance est l,
derrire le support du mythe de l'Oedipe puis ce que
j'ai appel son mannequin, Il apparat, au contraire,
tellement bien que ce n'est l qu'un mirage, que
c'est l aussi, que nous n'avons aucune peine
pointer l'erreur hglienne, je parle de celle qui,
dans la Phnomnologie de l'esprit
185
, attribue au
matre
celui de la lutte mort de pur prestige vous
connaissez la rengaine j'espre
attribue au matre de garder par-devers lui le
privilge de la jouissance, ceci sous le prtexte que
l'esclave pour conserver sa vie y a renonc cette
jouissance.
Je pense dj avoir une fois, il y a quelques
sminaires, point un petit peu la question de ce
cotla. Car o prendre les lois de cette singulire
dialectique? Qu'il suffirait de renoncer la
jouissance pour la perdre ! Mais vous ne connaissez
pas les lois de la jouissance!
C'est probablement le contraire c'est mme srement
le contraire : c'est du ct de l'esclave que reste
la jouissance, et justement parce qu'il y a renonc.
C'est parce que le matre dresse son dsir qu'il
vient, sur les marges de la jouissance, buter.
185 G.W.F. Hegel, Phnomnologie de l'esprit, Paris, Aubier Montaigne, 1998, Coll. Bibliothque Philosophique.
588
Son dsir n'est mme fait que pour cela, pour
renoncer la jouissance et c'est pour cela qu'il a
engag la lutte mort de pure prestige. De sorte que
l'histoire hegelienne est une bonne plaisanterie qui
se justifie assez de ce qu'elle est totalement
incapable d'expliquer quel peut bien tre le ciment
de la socit des matres. Alors que FREUD la donne
comme cela, la solution : elle est tout simplement
homosexuelle.
C'est le dsir - a c'est vrai - de ne pas subir la
castration, moyennant quoi les homosexuels ou plus
exactement les matres sont homosexuels et c'est ce
que FREUD dit. Le dpart de la socit c'est le lien
homosexuel, prcisment dans son rapport
l'interdiction de la Jouissance, la Jouissance de
l'Autre en tant qu'elle est ce dont il s'agit dans la
Jouissance sexuelle savoir de l'Autre fminin.
Voil ce qui, dans le discours de FREUD, est la
partie masque. Il est extraordinaire que toute
masque qu'elle soit, cette vrit s'tale, tout
bout de champ - c'est le cas de le dire - dans son
discours, pour ce qui, en tout cas, vient de notre
exprience, savoir que tout le problme de l'union
sexuelle entre l'homme et la femme
sur laquelle nous avons dvers toutes les
conneries de notre stade prtendu gnital, de
notre fabuleuse oblativit
ce problme qui est vraiment celui sur lequel
l'analyse a jou le rle de l'obscurantisme le plus
furieux et ce problme repose tout entier sur ceci,
c'est la difficult, l'extrme obstacle ce que dans
l'union intersexuelle, l'union de l'homme et de la
femme, le dsir s'accorde.
Autrement dit que la jouissance fminine ce qu'on
sait depuis toujours, depuis OVIDE : lisez le mythe
de TIRESIAS, il y a l vingt vers d'OVIDE que j'ai
mis dans mon premier rapport, celui de Rome, parce
que c'est un point essentiel, et que j'ai essay de
faire repasser depuis, quand on a parl de la
sexualit fminine Amsterdam. a a t du beau !
589
Comment oublier la profonde disparit qu'il y a,
entre la jouissance fminine et la jouissance
masculine ! C'est bien pour cela que dans FREUD on
parle de tout, d'activit, de passivit, de toutes
les polarits que vous voudrez mais jamais de
masculin-fminin, parce que ce n'est pas une
polarit, et que d'ailleurs, comme ce n'est pas une
polarit, c'est tout fait inutile d'essayer de
parler de cette diffrence.
Il y a un seul truchement de cette diffrence : c'est
que dans la jouissance fminine peut entrer comme
objet le dsir de l'homme comme tel. Moyennant quoi
la question du fantasme se pose pour la femme.
Mais comme elle en sait, probablement, un petit bout
de plus que nous, concernant le fait que le fantasme
et le dsir sont prcisment des barrires la
jouissance, ceci ne simplifie pas sa situation.
Il est fcheux que des vrits aussi premires, dans
le champ psychanalytique, puissent prendre un air de
scandale, mais il faut qu'elles soient avances parce
que c'est proprement l, ce qui justifie, le temps
prcis o nous en sommes de notre expos, c'est--
dire
contrairement au fait qui fait que c'est telle ou
telle appartenance du corps, objet chu du corps
dans un certain champ qui organise la demande et
le dsir
quant ce dont il s'agit du rapport du dsir la
jouissance, en tant qu'il intresse le sujet du
sexe oppos, le truchement n'est plus d'un objet, ni
mme d'un objet interdit
de l'interdiction pdantesque, si je puis dire-
qui est tout un registre de la castration
freudienne, a va de l'interdit port sur la main
du petit garon ou de la petite fille jusqu' la
formation que vous recevez l'universit, il
s'agit toujours de nous empcher de voir clair
mais l'autre fonction de la castration qu'on confond
avec la premire est beaucoup plus profonde, c'est ce
par quoi, si un accord est possible
590
un accord, entendez-le la faon dont je peux
essayer de faire un chantillon de couleur, ce
qui reproduira cot de celle-ci quelque chose
qui soit de la mme teinte
c'est grce au fait que cet objet qui est le pnis,
mais que nous sommes forcs de porter cette
fonction d'tre pingl phallus est trait d'une
faon telle que celle qui est la mme que quand on se
livre cet exercice de l'accord.
Ce sont des choses, sur lesquelles, par discipline,
je ne me suis pas tendu cette anne, mais c'est d'un
autre registre que du visuel et du regard.
Avec n'importe quel trio de couleur on peut faire un
petit mlange qui reproduit n'importe quel autre (je
dis n'importe quel et n'importe quel !), sauf ce
qu'on se permette quand a ne marche pas ce qui se
produit sur une assez grande marge de se servir de
se servir d'une des couleurs du trio pour le
soustraire sur l'chantillon de l'autre ct.
En d'autres termes, il y a certaines qualits de
certains objets qu'il faut que nous fassions passer
au signe ngatif.
En d'autres termes, il faut que dans le rapport
homme-femme, l'objet contingent, l'objet caduc de la
jouissance mammifre, soit capable d'tre ngativ,
il faut que l'homme s'aperoive que la jouissance
masturbatoire n'est pas tout, et inversement que la
femme s'ouvre la dimension que cette jouissance l
lui manque.
Je ne dis pas l des choses bien sorcires, mais
c'est l le vritable fondement de la relation
castrative, si nous voulons lui donner un sens
quelconque quant la faon dont elle fonctionne
rellement. Dite, comme je viens de vous la dire, a
finit par tre tourn la lapalissade. C'est dans ce
cas l que vous ne voyez pas o est le problme,
savoir quelle est la nature de ce signe ngatif qu'il
s'agit de porter sur cet objet, le phallus.
591
Ce ne sont pas, bien entendu, l, des choses que
j'essaierai mme d'aborder, dans les dernires
minutes de mon sminaire de cette anne, mais c'est,
prcisment, pour rpondre de telles questions que
celui de l'anne prochaine, si Dieu lui prte faveur,
s'appellera la Logique du fantasme.
Nanmoins, je voudrais, ds maintenant, vous faire
remarquer comme introduction cette logique que la
question de ce qu'il en est du ngatif comme on dit
ou de la ngativit mriterait enfin que nous y
prenions une orientation qui ne soit pas simplement
parcellaire. Et pour non pas la dchiffrer mais la
dfricher, je commencerai, comme j'ai fait depuis
toujours, avec des instruments : la charrue de bois
ouvrant un sillon sommaire, bien entendu, et c'est
celui que je me suis amus
ceci, depuis longtemps, je ne sais mme pas si je
l'ai laiss sortir jamais devant votre auditoire
pointer de ces trois registres qui sont :
I : hiarien, S : gniaka, R : le trou
Le premier, l'Imaginaire - et que j'cris comme a,
d'une petite orthographe chinoise : hiarien - ce que
nous disons tous quand quoi ? Quand dans un champ
nous trouvons le vide. Et si vous croyez que c'est
facile, expliquer a : cette notion de champ et de
vide ! Bien sr, le registre gestaltiste s'offre tout
de suite, seulement la rapidit avec laquelle il se
contamine vers une version symbolique
dans la notion de classe, par exemple, qui prend,
justement, de sa prsence toute sa densit
doit nous rendre extrmement prudent quant au
maniement. Quoiqu'il en soit l'crire de cette
orthographe baroque, qui est celle dont je ne fais
rien qu'une occasion de le mmoriser comme instrument
transitoire, j'ai appel cela : le hiarien , crit
comme vous le voyez l.
- Il y a une chose qui est, en tout cas, bien
tranche et qui n'a rien faire avec le hiarien ,
592
c'est celle, que j'exprime dans la deuxime ligne, et
sous cette forme - dont aprs tout je n'ai pas de
raison de vous refuser l'anecdote - cette forme
emprunte au langage d'un petit garon qui tait trs
intelligent puisque c'tait mon frre.
Il gniakavait , me ditil, conjuguant, ainsi
bizarrement un verbe dont le radical serait gniaka .
Eh bon, un registre du gniaka est absolument
essentiel ! Ceci par quoi, un tat prsent est
suppos driver de quelque chose qui fait, qu'il est
amput de quelle chose. Ceci est la forme la plus
radicale par quoi s'introduit toute une catgorie o
nous aurons, justement, nous orienter quant aux
instaurations proprement symboliques de la ngation.
Car gniaka a va trs loin, a peut tre un manque,
a peut tre aussi un point de dpart : gniaka
prendre un point de dpart, on appelle cela le zro,
lment neutre.
Rien qu' ce gniaka l vous avez ce qu'on appelle
un groupe ablien. Ceci pour vous indiquer dans
quelle voie nous serons amens ordonner nos
rflexions, l'anne prochaine. Mais assurment ce
gniaka n'est pas sans nous indiquer de revenir sur
ce que nous avons dit l'anne dernire
186
quant la
fonction du zro comme suturant l'instance du sujet
et d'articuler le rapport du sujet au dsir et aussi
la castration.
gniaka mettre le signe ngatif sur le pnis et la
fonction phallique s'instaure avec tout l'usage
absolument aveugle que nous savons en faire.
Et puis il y a quelque chose pour quoi il n'y a pas
de mot, ni d'pinglage, au moins dans mon registre,
et ceci pour une bonne raison, c'est que si je le
dnommais, ou que, si je le supposais il aurait
quelque rapport avec cette fonction imaginaire ou
celle de la symbolisation.
Ce troisime terme, celui que depuis dj trois ans
que je suis ici, je vous apprends connatre, par
quelque voie, que je ne saurais dire tre celle
186 Sminaire Problmes cruciaux 09-06.
593
de la palpation, c'est bien plus : j'essaye, je
sollicite, j'appelle de vous que vous vous identifiez
ce qu'on peut y appeler - d'un langage mathmatique
- le facteur tor - t.o.r. - ce qui veut dire : ce
qu'il y a dans le rel
dans ce rel auquel nous avons affaire et qui est
justement ce qu'il y a au-del, au dehors de
cette ncessit qui nous contraint de ne
conjoindre la Jouissance que ce peu de ralit
du fantasme
ce rel tmoigne d'une certaine torsion.
Cette torsion n'est pas l[anank]dont parle FREUD,
car [anank] et [logos], ils sont tous les deux de
l'ordre du symbolique. La seule ncessit
contraignante est celle qu'impose le logos.
Et le rel n'entre au-del, comme il est manifeste
dans l'exprience, que pour - entre ces solutions
ncessaires, car il y en a toujours plusieurs
dsigner celle qui est impossible. Telle est la
fonction du rel et sa torsion. Cette torsion c'est
celle mme que nous essayons de saisir au niveau de
ce qui est notre champ, que j'ai, tout au moins cette
anne, essay de vous apporter le matriel qui vous
permette, pour la suite de ce que nous aurons dire,
de reprer comment se coupe, dans une toffe qui est
commune, le rapport du sujet l'Autre, cet avnement
du sujet dans le signifiant grce quoi se soutient
ce fantasme dans son rapport au rel, grce quoi
l'opacit nous apparat d'une jouissance indfinie.
Table des sances
594
l5 Juin l966 Table des sances
SAFOUAN
LACAN
Nous avons entendu
je dis cela pour ceux qui sont la fois partie
prenante de ce sminaire ferm et qui assistent
aux dbats intituls Communications dans l'Ecole
Freudienne, il y a ici, par exemple,
certainement, une part importante de l'assemble
qui ralise cette runion de caractre
videmment, nous avons entendu une communication
trs, trs bien
187
- d'ailleurs je l'ai marqu - mais
enfin elle est trs, trs bien, placer, si vous me
permettez cette chose qui est prendre avec le grain
de sel, dans ce qui constitue pour moi la
problmatique de ce qu'on appelle communication
- vous avez vu tout l'heure, je n'ai pas achev -
communication scientifique dans la psychanalyse.
a ne doit pas lui tre absolument particulier la
psychanalyse. Il doit y avoir bien d'autres
configurations dans lesquelles le mme effet se
produit. Enfin pour la psychanalyse, appelons a
que a tourne toujours un peu au complot contre le
malade!
Et c'est a qui fausse la chose, enfin, qui fait que
qu'on arrive dire des choses qui dpassent, un peu,
enfin si je puis dire, la stricte pense scientifique
qui pourrait tre celle o on se tiendrait, s'il
s'agissait de vritables runions scientifiques.
Comme nous sommes en fin d'anne, on peut me
permettre un peu d'ouvrir mon cur sur les raisons
que j'ai d'tre rticent ce style en tant qu'il est
le moteur courant du travail analytique, et qui
s'appellent les runions o il y a des communications
qu'on appelle scientifiques, et qui ne le sont pas
tellement que a.
187 De Jean CLAVREUL sur le couple pervers. Cf. J. Clavreul, Le couple pervers, in Le dsir et la perversion, Paris, Seuil,
Coll. Points, 1981.
595
Moyennant quoi, sur le plan d'une notation clinique
de quelque chose de centr autour du couple pervers,
CLAVREUL
dont je dplore l'absence ici car je lui aurais
renouvel mon compliment
nous a fait quelque chose d'excellent. Voila !
Il n'y manque que ceci
qui a t dit finalement dans la discussion mais
que personne n'a entendu parce qu'on ne l'a pas
dit clairement
c'est qu'en somme pour parler tout fait
scientifiquement de la perversion, il faudrait partir
de ceci
qui est tout simplement la base dans FREUD : on a
dit, on a amen timidement ces Trois essais sur la
sexualit
ben c'est que la perversion, elle est normale :
il faut repartir de l une bonne fois !
Alors le problme, le problme de construction
clinique, ce serait de savoir pourquoi il y a des
pervers anormaux.
Pourquoi il y a des pervers anomaux ?
a nous permettrait d'entrer dans toute une
configuration pour une part historique parce que les
choses historiques, elles ne sont pas historiques
uniquement parce qu'il est arriv un accident, elles
sont historiques parce qu'il fallait bien qu'une
certaine forme, une certaine configuration vienne au
jour. Il est bien clair que c'est le mme problme
que celui que notre ami Michel FOUCAULT
qui n'est pas l, lui non plus : il ne s'est pas
cru invit au sminaire ferm, c'est bien
malheureux
notre ami Michel FOUCAULT, en somme, aborde avec des
excellents bouquins comme ceux auxquels nous nous
sommes reports - on m'entend l-bas ? Oui ? Bon -
L'histoire de la folie, ou La naissance de la clinique.
Vous comprendrez pourquoi :
- premirement il y a des pervers normaux,
- deuximement il y a des pervers considrs comme
anormaux.
596
C'est bien le moindre que si, partir du moment o
il y a des pervers anormaux, il y a aussi des gens
pour les considrer comme tels, moins que les
choses soient dans l'ordre inverse, mais il ne faut
rien forcer dans ce genre l.
Quoi qu'il en soit, je regrette l'absence de CLAVREUL
parce que je lui aurais recommand, lui, une
lecture pour cette prochaine confrence qu'il nous
fera, certainement encore plus excellente, en
partant, comme je le lui ai conseill, de ce que j'ai
point, savoir que sa rfrence la meilleure, dans
tout ce qu'il nous a dit
n'oublions pas que sa confrence tait intitule
Le couple pervers. Comme s'il y en avait ! de purs
et simples couples pervers. Justement, c'est tout
le drame. Enfin, laissons.
la remarque qui est celle pingle de Jean GENET,
qu'il y a toujours dans l'exercice de l'acte pervers
un endroit o le pervers tient beaucoup ce que soit
place la marque du faux. Je lui ai conseill de
repartir de l. Je lui conseillerai aujourd'hui une
lecture, une lecture qui est une lecture pour tous,
d'ailleurs, que je vous conseille tous et qui vous
permettra de donner une illustration trs simple, et
trs convaincante ce que je suis en train de vous
dire : qu'il faut partir du fait que la perversion,
c'est normal.
Autrement dit, que dans certaines conditions, a peut
ne pas faire tche du tout.
Moyennant quoi, ce livre
que j'ai pris soin de passer chez le libraire
pour que vous voyez qu'il existe, et je ne me
souvenais plus qu'il avait t imprim au Mercure
de France, tout rcemment d'ailleurs, grce
quoi vous pouvez le voir - qui s'appelle les
Mmoires de l'Abb de Choisy habill en femme
188
-
lisez-le. [Mmoires de l'abb de Choisy]
188 Franois Timolon abb de Choisy (1644-1724), Mmoires de l'abb de Choisy habill en femme, Paris, Ed. : Ombres,
1998, Collection : Petite bibliothque Ombres.
597
moyennant quoi vous verrez d'o est le sain dpart
concernant le registre de la perversion. Vous verrez
quelqu'un de, non seulement tout fait l'aise dans
sa perversion - et ceci de bout en bout - ce qui ne
l'a pas empch d'tre quelqu'un qui a men une
carrire accomplie dans le respect gnral, de
recevoir toutes les marques de la confiance publique
et mme royale, et d'crire avec une parfaite
lgance un compte-rendu de choses qui, de nos jours,
nous mettraient littralement la tte l'envers et
nous pousseraient mme faire des choses aussi
exorbitantes qu'une expertise mdico-lgale.
Sans compter le discrdit qui rejaillirait sur le
haut-clerg pourtant bien connu pour tre
particulirement expert dans ces pratiques, alors que
de nos jours, il se croit forc de dissimuler ces
choses qui ne sont que le signe d'un rapport sain et
normal aux choses fondamentales.
Voil donc la lecture que je vous conseille.
Naturellement, certaines des personnes qui sont
- ou qui ne sont pas - ici y verront la confirmation
que, comme a se dit, je suis un bourgeois d'entre
les deux guerres. Mon Dieu, comme les gens voient
petit ! Je suis un bourgeois d'avant la rvolution
franaise, alors, vous vous rendez compte, comme ils
mavancent. Bien, enfin, la chose, vous en serez
convaincus, aprs cette approbation, cette estampille
: livre lire que je viens de donner ce bouquin.
L dessus, aujourd'hui j'aimerais bien que, puisque,
non seulement c'est un sminaire ferm mais que c'est
l'avant-dernier et que, mon Dieu, dans le dernier il
faudra bien que je me donne l'aspect de donner
certaines choses une clture : j'ai hsit sur ce sur
quoi je clorai. Peut-tre aprs tout que je pourrai
tout de mme mettre un point quelque chose qui a
fait le dbut du sminaire ferm cette anne,
savoir la discussion des articles o notre excellent
ami STEIN a produit ses positions sur le sujet de ce
qu'il appelle la situation analytique, qu'il a bien
voulu limiter aux conditions de dpart,
enfin ce quoi on s'engage en faisant des sances
analytiques.
598
Puis aprs a il a t tout doucement au transfert et
au contre-transfert, il s'agit de s'entendre sur ce
qu'il met sous ces deux rubriques. Et aprs a, il a
parl du jugement du psychanalyste
189
.
Il y a eu un dbat, un dbat auquel je n'ai pas
assist tout, parce que, pour une part, le Docteur
Irne PERRIER-ROUBLEF a bien voulu en tenir la
direction en mon absence. Tout a mriterait
assurment complment, et peut-tre clairage, et
peut-tre un peu plus enfin, un peu plus ferme.
Je veux dire je veux dire que peut-tre, tout
l'heure, nous commencerons un peu d'en parler, si a
marche, eh bien a nous incitera aussi demander
STEIN de venir la prochaine fois, puisque aussi bien,
il ne serait pas non plus tout fait convenable que
cette clture soit faite en dehors de sa prsence.
Enfin, a viendra peut-tre quand mme tout
l'heure, je veux dire l'amorce de a.
Ce que j'aimerais
et ce dont, heureusement, je me suis assur une
petite garantie, que j'aurais au moins quelque
chose pour me rpondre
ce que j'aimerais, c'est que, somme toute, aprs une
anne o je vous ai dit des choses, dont il doit y
avoir dans votre tte un gros rsidu quand mme
j'ai dit des choses, certaines qui taient tout
fait neuves au moins pour une part d'entre vous,
d'autres qui taient vraiment structures pour la
premire fois d'une faon absolument, non
seulement exemplaire mais mme rigoureuse, et
j'ai os ajouter - prenant par l une sorte
d'engagement dfinitive, considrant par
exemple, le schma que je vous ai donn de la
fonction du regard
bon, je ne serais pas mcontent, je ne dplorerais
pas que certains me posent des questions.
Naturellement le bruit se confirme que ce n'est pas
une chose faire, sous prtexte que l'autre jour,
par exemple, j'ai eu l'air de dire Monsieur
AUDOUARD
189 Cf. Supra : sance du 22-12, notes 44 et 45.
599
qui, en somme, est la seule personne qui, sur ce
plan, m'a donn toute satisfaction cette anne,
c'est dire qu'il s'est tout simplement risqu
ce que je demande, c'est dire ce qu'on me
rponde
Monsieur AUDOUARD a fait, c'est vrai, une grosse
erreur, une grosse erreur en collant, dans le schma
de la perspective, l'il de l'artiste dans ce qu'on
peut en somme appeler le plan du tableau, ceci au
moment de fondation de la perspective.
Bon. Il faudrait quand mme bien que vous conceviez
ceci, c'est que, tant donn que chacun est ici avec
son petit narcissisme en poche, c'est--dire l'ide
de ne pas se ridiculiser, il faudrait tout de mme
bien vous dire que ce que Monsieur AUDOUARD a fait,
c'est trs exactement ce que, par rapport
ALBERTI
je vous ai dit qu'il tait dans ce fameux schma
de la perspective, je l'ai dessin au tableau,
enfin, j'ai pris beaucoup de peine - dans ce qu'
ALBERTI a fond, et qu'un nomm VIATOR (c'tait
parce qu'il s'appelait PELLERIN tout simplement
en franais) a repris
eh bien, l'erreur qu'a fait Monsieur AUDOUARD, c'est
exactement l'erreur qu'a fait Albert DRER, c'est
dire que quand on se reporte aux crits d'Albert
DRER
190
[Albrecht Drer, Instruction sur la manire de mesurer], on voit trs
exactement que certaines fautes, un certain
dplacement du schma
qui n'est pas sans retentir d'ailleurs sur ce que
vous voyez d'assez chavirant dans les
perspectives d'Albert DRER quand vous y regardez
de prs
est d, trs exactement une erreur initiale de
cette espce. Vous voyez donc que Monsieur AUDOUARD
n'est pas en mauvaise compagnie.
Ceci, bien sr, je ne peux pas vous le dmontrer
parce que, parce qu'il faudraitenfin c'est trs
facile, je peux vous donner, ceux que a intresse
la bibliographie.
190 Albrecht Drer (1471-1528), Instruction sur la manire de mesurer, op. cit.
600
Il y a quelqu'un qui a trs, trs joliment mis a en
vidence, c'est un amricain qui a fait sur l'art et
la gomtrie quelques petits livres astucieux, dont
un spcialement, concernant ce statut de la
perspective en tant qu'il ressort d'ALBERTI, de
VIATOR et d'Albert DRER.
Et on s'explique tout a trs bien.
0n s'explique tout a trs bien en fonction de ceci
justement, qu'Albert DRER a commenc se poser le
problme de la perspective partir de ce que
j'appellerai, enfin, la dmarche radicalement
oppose, celle qui est issue de la considration du
point lumineux et de la formation de l'ombre, c'est
dire la position antcdente, celle que je vous ai
montre pour tre tout fait antinomique de celle de
la construction de la perspective, qui a des fins
toutes opposes, qui ne sont pas des fins de
constitution du monde clair, mais de constitution
du monde subjectif, si vous me permettez de faire
cette opposition marque, marque et justifie de
tout le discours antrieur.
C'est dans la mesure o ce qui intresse DRER, c'est
l'ombre d'un cube, qu'il n'arrive pas faire la
juste perspective du cube.
Bon, ceci tant dit et Monsieur AUDOUARD tant remis
sa place, c'est dire n'ayant subi que du
prestige, auquel d'autres que nous - et qu'on peut
dire plus grands - ont succomb, j'aimerais bien que
a encourage ceux qui peuvent avoir quelques
questions poser sur ce que j'ai dit et par exemple
sur ce que j'ai dit la dernire fois sur le schma,
qui aboutit vraiment poser de trs, trs grosses
questions.
601
Sur ce schma n'est-ce pas, J est l dans un arrire
et o nous nous trouvons avec le sujet dans cette
position - par rapport au champ de l'Autre - que tout
ce qui concerne son rapport la jouissance doive lui
venir par l'intermdiaire de ce qui est li l'Autre
et qui se prsente bien ainsi comme li une
certaine fonction qui nest pas sans tre le[]
puisque aussi bien, ce que l'appareil illustre par
l'exemple des Mnines, de la structure qui fut
produite par VELZQUEZ nous le dmontre.
Disons que dans l'appareil de la perspective et du
regard nous pouvons concevoir, faire coexister, pas
seulement ce pour quoi coexiste le registre
narcissique
tout mon premier effort d'enseignement a t de
le dcoller de ce qu'il a comme articulation
que non seulement, comment ils peuvent coexister
mais comment au niveau d'un certain objet, le regard,
l'un peut donner la cl de l'autre, et le regard
comme effet du monde symbolique, tre le vritable
ressort, le vritable secret de la capture
narcissique. Donc dans ce rapport du S au A, nous
avons pu tablir la fonction de ce (a) dont j'ai
parl
si vous voulez, avec le privilge pour l'un
d'entre eux, le moins tudi et pourtant le plus
fondamental pour toute articulation de la chose
elle-mme
et puis la correspondance en avant ou si vous
voulez, l'quivalence que le (-J) c'est--dire le
phallus, en tant qu'objet en jeu dans le rapport la
jouissance, en tant qu'il ncessite la conjonction de
l'autre dans la relation sexuelle
602
Ah, ben vous voil STEIN. Venez l. Je dplorais
votre absence
eh bien, ceci videmment pose - me semble offrir -
l'occasion de toutes sortes de questions.
Quand je dis que je refais une seconde fois le tour,
que je redouble la bande de MBIUS freudienne, vous
en voyez, non pas du tout une illustration, mais le
fait mme de ce que je veux dire dans le fait que le
drame de l'dipe - que je crois avoir, pour vous,
suffisamment articul - il a une autre face par
laquelle on pourrait l'articuler de bout en bout, en
faire tout le tour.
Le drame de l'Oedipe, c'est le meurtre du pre et le
fait qu'Oedipe a joui de la mre. On voit aussi que
la chose reste en suspens d'une ternelle
interrogation, concernant la loi et tout ce qui s'en
engendre, de ce fait, que dipe comme je le dis
souvent, n'avait pas le complexe d'Oedipe, savoir
qu'il l'a fait tout tranquillement.
Bien sr, il l'a fait sans le savoir. Mais on peut
clairer le drame d'une autre faon et dire que le
drame d'Oedipe, en tout cas le drame de la tragdie,
et de la faon la plus claire, c'est le drame
engendr par le fait qu'Oedipe est le hros du dsir
de savoir.
Mais que, comme je l'ai dj dit depuis trs
longtemps
mais je le rpte dans ce contexte
j'ai dj dit depuis trs longtemps quel est le
terme de l'dipe
191
: Oedipe, devant la rvlation, sur
l'cran crev, de ce qu'il y a derrire, et avec
je l'ai dit dans ces termes
ses yeux par terre, Oedipe s'arrachant les yeux, ce
qui n'a rien faire avec la vision, ce qui est
proprement donc le symbole de cette chute dans cet
entre-deux
dans cet espace que DESARGUES dsigne du nom
d'essieu et que j'ai identifi - c'est la seule
identification possible - ce que nous appelons
le Dasein
191 Sminaires Lthique, 29-06-60 et LAngoisse, 06-03 et 03-07.
603
l est chu le regard d'Oedipe. Ceci est la fin, la
conclusion et le sens de la tragdie, tout au moins
est-il aussi loisible de traduire cette tragdie dans
cet envers que de la poser dans l'endroit o elle
nous rvle le drame gnrateur de la fondation de la
loi. Les deux choses sont quivalentes pour la raison
mme qui fait que la bande de MBIUS ne se conjoint
elle-mme rellement qu' faire deux tours.
Bon. Eh bien, ceci ayant t amen ne s'accompagnera
plus que d'une remarque, c'est que la considration
de l'objet(a) et de sa fonction, pour autant que
seule cette considration nous amne nous poser les
questions cruciales qui concernent le complexe de
castration, savoir comment surgit le groupe
il faut bien employer un terme mathmatique
qui permet le fonctionnement d'un certain(-)
dont nous nous sommes servi depuis longtemps,
mais d'une faon plus ou moins bien prcise
dans uns structure logique.
Eh bien, c'est l ce qu'introduit de dcisif
l'objet(a), savoir ce par quoi il nous permettra
d'aborder ce terrain proprement parler vierge -
vierge pour un psychanalyste comme a, mis de nos
jours si je puis dire - savoir le complexe de
castration.
Il est tout fait clair qu'on n'en parle jamais que
d'une faon cardinale, en faisant comme si on savait
ce que a veut dire. Evidemment, on a bien un petit
soupon parce que j'en ai un peu parl, de ci, de l.
Mais enfin, tout de mme, pas assez pour que Monsieur
RICUR, par exemple, en fasse entrer la moindre
parcelle dans son bouquin qui a provoqu tant
d'intrt.
Il est mme remarquable qu'il n'y en a pas trace.
C'est donc qu'on n'en parle pas ailleurs
non plus. Il serait bien ncessaire qu'on pt, du
complexe de castration dire quelque chose.
Or, il me semble que la dernire fois, j'ai commenc
de dire quelque chose de trs fermement articul sur
ce point.
604
videmment dans la mesure o nous pouvons au moins
baucher le programme, pour dire que l'anne
prochaine nous parlerons de cette sorte de logique
qui puisse nous permettre de situer ce qui, trs
spcifiquement, ressortit la fonction(-) par
rapport ce premier plan que nous avons assur cette
anne concernant l'objet(a).
Il y a une chose en tout cas certaine, puisque nous
avons parl du mythe d'Oedipe : bien sr que
l'Oedipisme est la pierre angulaire et que, si nous
ne voyons pas que tout dans ce qu'a construit FREUD,
c'est autour de l'Oedipe, nous ne verrons jamais
absolument rien. Seulement, il ne suffit pas encore
qu'on explique l'Oedipe pour que vous sachiez de quoi
parlait FREUD, moins que vous ne sachiez, tant
rompus au vocabulaire que je droule devant vous, que
ce qu'il s'agit d'articuler c'est le fondement du
dsir et que, tant qu'on ne va que jusque l, on n'a
mme pas assur le champ de la sexualit.
Le mythe d'Oedipe ne nous enseigne rien du tout sur
ce que c'est que d'tre homme ou femme. C'est
absolument tal dans FREUD. Comme je l'ai dit la
dernire fois, le fait que jamais il ne promeuve le
couple masculin-fminin, sauf pour dire qu'on ne peut
pas en parler justement, prouve assez cette espce de
limite.
On ne commence poser des questions qui concernent
la sexualit, aussi bien masculine que fminine, qu'
partir du moment o entre en jeu l'organe et la
fonction phallique. Faute de faire ces distinctions,
on est dans l'embrouillamini le plus absolu.
Il faut bien dire que l, il y a quelque chose, qui
joue peut-tre la base, du fait que FREUD n'a pas
fait - pourquoi ne l'aurait-il pas fait lui-mme ? -
son second tour. Pourquoi, est-ce qu'il l'aurait
laiss faire quelqu'un d'autre? On peut aussi se
poser cette question.
C'est l que je suis trs embarrass. L'exprience
m'enseigne - m'enseigne mes dpens - me conseille
de ne procder qu'avec de trs grandes prcautions.
605
la vrit, ce n'est pas tout fait de ma nature,
mais d'autres les prennent pour moi, en somme,
puisque cette trame serre d'vnements qui a abouti
un jour faire que j'interrompe ma premire leon,
un sminaire annonc sous le titre des Noms du Pre[ 20-11-63]
vous direz que, pour des psychanalystes, il est tout
de mme bien naturel de donner un sens aux vnements
et que, quels qu'en soient les dtours contingents,
les chances, et les petits pataqus
qui ont pu faire choir justement, ce jour-l, le
fait que, aprs tout, des gens peut-tre plus
avertis de l'importance de ce que j'avais dire,
ont bien veill ce que je tienne ma parole de
ne pas le dire, en certains cas
c'est bien qu'il y avait l tout de mme quelques
raisons, et qui touchent, qui touchent ce fait
dlicat, prcisment, de la limite o s'est arrte
FREUD.
Si tellement de choses de l'ordre qui aboutissent
ces singuliers rendez-vous - dont on ne peut pas dire
qu'en eux-mmes, ils soient progressifs - c'est bien
quil y a quelque-chose dans FREUD qu'on ne peut pas
supporter. Si je le leur retire, de quoi pourront-ils
se supporter ? Ceux qui se supportent justement, en
somme de ce qu'il y a d'insupportable dans ce quelque
chose dont il faut croire que a faisait dj bien
assez en avant dans un certain sens puisqu'on ne peut
pas aller plus loin.
De sorte qu'en somme, ce n'est qu'avec une faon, une
touche tout fait lgre et, en quelque sorte, comme
une ombre de facteur ngatif, que je ferai remarquer
que nous devons FREUD, tout de mme, le fait que
jusqu' la fin de sa vie, semble-t-il, il lui soit
paru rsider un mystre dans la question suivante,
qu'il exprimait ainsi :
Que veut une femme ?
192
Nous devons a une connasse qui nous l'a rapport
et devant laquelle il avait, comme a, laiss
s'ouvrir sa tirelire ventrale.
192 E. Jones, La vie et l'uvre de Sigmund Freud, Paris, PUF, 3 vol., 2006, Coll. Quadrige Grands textes.
606
Il y a des moments o mme les idoles se dballent.
Il faut dire qu'il faut pour a des spectacles
spcialement horrifiants.
Que veut une femme ?
FREUD, comme s'exprime Jones avait un trait qui ne
peut tout de mme pas manquer de frapper, ce trait
qui ne s'exprime bien, qui ne s'pingle bien, qu'en
la langue anglaise, on appelle a uxorious.
En franais, ce n'est pas trs en usage.
Nous ne sommes peut-tre pas assez uxorieux pour a.
Mais enfin, dans un cas comme dans l'autre, qu'on le
soit ou qu'on ne le soit pas, a n'est jamais que la
spcification d'une position qu'on a sur ce point
se vanter. Ce n'est pas plus heureux de l'tre que de
ne pas l'tre. Il tait uxorieux
193
et pas l'endroit
de n'importe qui. La femme de CESAR - dit-on - ne
saurait tre souponne . a s'emploie beaucoup.
le style, c'est l'homme par exemple - c'est une
citation inexacte mais a ne fait rien - c'est des
choses qui marchent toujours. Places au bon endroit,
a ne souffre pas discussion.
Qu'est-ce que a veut dire? Souponne de quoi?
D'tre une vraie femme, peut-tre ?
La femme de FREUD dont il y a tout parier que
c'tait sa seule femme ne saurait tre l'objet d'un
tel soupon.
Nous en avons, sous la plume de FREUD, enfin, toutes
les traces les plus extraordinaires. L'emploi du
terme sich straben : se hrisser, dans l'analyse du
rve de l'injection d'Irma, est en quelque sorte dans
ce style, cet Umschreibung, ce style tordu, presque
le seul cas o je peux me recommander du sien, o il
nous amne ce vers quoi il veut aller, bien sr sans
le dire, c'est qu'en fin de compte, tout a, une
femme, strabt sich - c'est comme Madame FREUD quoi -
et que c'est tout de mme bien embtant.
193 Uxorieux se disait autrefois dun homme qui se laisse gouverner par son pouse.
607
Oui, voil videmment un point de repre de nature
nous donner le sentiment de savoir o se pose le
problme, o est la question et o nous en sommes, o
sont les barrires en quelque sorte structurales,
inhrentes la structure mme du concept mis en jeu,
qui explique beaucoup de choses, par exemple de de
l'histoire de la psychanalyse depuis du mode sous
lequel s'y sont fait valoir non seulement la fminit
et ses problmes mais les femmes elles-mmes.
Ce qu'on peut appeler les mres dans notre communaut
psychanalytique. Ce sont des drles de mres !
- Irne ROUBLEF : On n'entend pas !
Eh bien, c'est peut-tre mieux !
Alors j'aimerais bien l-dessus, en somme, que
certaines questions soient poses. Puisqu'en somme,
par exemple, la dernire fois, en posant le sujet
devant, si je puis dire, cette surface de rflexion
que constitue la dialectique de l'autre, pour y
reprer dune faon qui ncessite, en somme, l
aussi, un certain ordre de mirage - la place de la
jouissance, je vous ai indiqu bien des choses
nommment, et rgl cette question au passage de ce
que j'ai appel l'erreur de HEGEL : que la jouissance
est dans le matre.
On est tonn : si le matre a quelque chose voir
avec le matre absolu c'est dire la mort, quelle
sacre ide de placer la jouissance du ct du
matre.
Il n'est pas facile de faire fonctionner l'instance
de la mort. Personne n'a encore imagin que ce soit
dans cet tre mythique que la jouissance rside.
L'erreur hegelienne est donc bel et bien une erreur
analysable.
Et l, nous touchons du doigt, dans la structure ici
crite au tableau :
608
inscrite dans ces petites lettres o gt l'essence,
le noeud dramatique qui est proprement celui auquel
nous avons affaire : comment il se fait que ce soit
cette place du A, la place de l'Autre, en tant que
c'est l que se fait l'articulation signifiante, que
se pose pour nous la vise du reprage qui tend la
jouissance, et proprement, la jouissance sexuelle ?
Que le(-), c'est dire l'organe, l'organe
particulier dont je vous ai expliqu quelle est la
contingence, je veux dire qu'il n'est nullement, en
lui-mme, ncessaire l'accomplissement de la
copulation sexuelle, qu'il a pris cette forme
particulire pour des raisons qui, jusqu' ce nous
sachions articuler un tout petit commencement de
quelque chose en matire d'volution des femmes, eh
bien, nous nous contenterons de tenir la chose pour
ce qu'elle est.
Tant qu'on n'aura pas substitu quelques principes
imbciles cette apprhension premire qu'il suffit de
regarder un petit peu le fonctionnement zoologique
des animaux pour savoir que l'instinct ne concerne
que ceci : qu'est-ce que le vivant va bien pouvoir
faire avec un organe ?
Non seulement la fonction ne cre pas l'organe,
a saute aux yeux et comment a pourrait-il mme se
faire, mais il faut normment d'astuce pour donner
un emploi un organe.
Voil exactement ce que nous montre rellement le
fonctionnement des choses quand on y regarde de prs.
L'organisme vivant fait ce qu'il peut de ce qui lui
est donn d'origine, et avec l'organe pnien, eh
bien, on peut sans doute, mais on peut peu.
En tout cas, il est tout fait clair qu'il entre
dans une certaine fonction, dans un rle qui est un
tout petit plus compliqu que celui de baiser, qui
est ce que j'ai appel l'autre jour, pour servir
d'chantillon, pour faire l'accord entre la
jouissance mle et la jouissance femelle.
609
Ceci se plaant tout fait aux dpens de la
jouissance mle non seulement parce que le mle ne
saurait y accder qu' faire choir l'organe pnien au
rang de fonction d'objet mais avec ce signe tout
fait spcial qui est le signe ngatif auquel il
s'agira, pour nous, l'anne prochaine - dans de
savantes recherches logiques - de voir, de prciser,
quelle est exactement la fonction de ce signe (-) par
rapport ceux qui sont en usage
et dont on use, d'ailleurs - je parle dans le
courant, chez la plupart des gens qui sont ici,
par exemple - sans du tout savoir ce qu'on fait,
alors qu'il serai tout fait simple de se
reporter d'excellents petits bouquins de
mathmatiques qui, maintenant, courent les rues,
car tout a maintenant, se vulgarise Dieu merci,
avec l50 ans de retard mais enfin, il n'est
jamais trop tard pour bien faire
mais tout le monde peut s'apercevoir que le signe
moins peut avoir selon les groupes - et fait
intervenir - des sens excessivement diffrents.
Il s'agit de savoir donc, ce qu'il est pour nous.
Mais laissons cela. Prenons-le en bloc ce (-) et
disons et disons que le rapport qu'il s'agit
d'tablir dans l'union sexuelle, une jouissance,
laisse prcisment le pas la jouissance fminine
qui n'aurait point cette importance si elle ne venait
pas prcisment se situer la place que j'ai marque
ici du A, lieu de l'Autre. Ca ne veut pas du tout
dire, bien sr, que la femme y soit plus, d'emble,
que nous hommes, car elle est exactement la mme
place du S, et tous les deux, les pauvres chers
mignons, comme dans le clbre conte de
Longus immortel
194
[ Longus, Les amours pastorales de Daphnis et Chlo ], sont l, avec
dans la main ce joli dessert du (), se regarder,
se demander : qu'est-ce qu'on va bien en faire pour
se mettre d'accord quant la jouissance.
Alors, aprs cela, on fera peut-tre mieux de ne pas
nous parler comme dune donne de la maturation
gnitale, de l'existence du mnage parfait.
194 Longus, Les amours pastorales de Daphnis et Chlo, Actes Sud, Coll Les belles infidles, 1993.
610
Parce que, bien sr, l'oblativit - cette sacre
oblativit dont je finis par ne plus que trs peu
parler, et dont il ne faudrait pas parler
ternellement
il faudrait une bonne fois, un jour, qu'on ferme
cette parenthse
il ne faudrait pas croire non plus, que c'est un
moulin vent : j'ai des lves qui le prennent pour
a, ils se lancent toujours tort et travers
l-dessus, l o elle n'y est pas du tout en plus.
C'est tout de mme certain qu'il faut bien dire que
- il y a des choses qu'il faudrait dire quand mme -
a existe le mari oblatif par exemple. Il y en a qui
sont oblatifs comme on ne peut pas imaginer. a se
rencontre ! a a des origines diverses. Il ne faut
pas jeter le discrdit d'avance l-dessus. a peut
avoir des origines nobles : le masochisme par
exemple. C'est une excellente position. Du point de
vue de la ralisation sexuelle, aprs
je commence avoir de l'exprience, enfin quoi,
oui
trente cinq ans quand mme, a commence bien
faire. Naturellement, j'ai pas vu grand monde, pas
plus que personne. On a si peu de temps. Mais enfin,
quand mme, j'ai jamais vu que chez une femme a
dclenche proprement parler, vous savez : a !
a dclenche de trs, trs curieuses ractions et des
abus qui, du dehors, comme a, du point de vue
moraliste, sont tout fait manifestes,en tous les
cas, une grande insistance de la part de la femme sur
la chanterelle de la castration du mari.
Ce qui ne va pas de soi, ce qui n'est pas impliqu
dans le schma, vous comprenez, quand je parle du
moins phallus(-), l, comme de l'chantillon vibrant
qui doit permettre l'accord, a ne veut pas dire que
la castrations soit rserve l'homme puisque
justement, c'est bien tout l'intrt de la thorie
analytique, c'est qu'on s'aperoive que le concept de
castration joue en tant qu'il porte aussi
sur quelqu'un qui ne l'est pas de nature castr, il
peut mme ne pas l'tre s'il s'agit du pnis.
611
C'est dans cette perspective qu'il conviendrait, par
exemple, de s'interroger sur l'extraordinaire
efficace quant la rvlation sexuelle, car a
existe, cet extraordinaire efficace sur beaucoup de
femmes
pour ne pas dire la femme, a existe la femme, a
existe l-bas au niveau de l'objet(a)
L'extraordinaire valeur donc, pour cette opration,
de ce qu'on appelle des hommes fminins.
Leur succs, ne fait absolument aucun doute.
On sait a depuis toujours et puis a se voit
toujours.
Qu'une femme qui a eu ce genre de mari du type en or,
taill la serpe, enfin, le boucher de la belle
bouchre, rencontre seulement un chanteur voix et
vous m'en direz des nouvelles ! Ce sont de ces faits,
enfin, qui sont gros comme a, d'observation
courante, renouvels tous les jours, qui remplissent
nous analystes, nous pouvons savoir le plaisir
qu'elles ont les femmes avec le chanteur voix !
C'est fantastique comment elles se sont retrouves
l. Je ne vous dis pas qu'elles y restent. Si elles
ny restent pas c'est parce que c'est trop bon.
Tout le problme se repose du rapport du dsir et de
la jouissance mais il faut savoir tout de mme de
quel ct est accessible la jouissance.
Je sens que, j'entre tout doucement, comme a sur le
penchant des - je ne sais pas - des mmoires de
trente ans de psychanalyse. Et puis, c'est la fin de
l'anne, on est quand-mme un peu entre nous : vous
me pardonnez de dire des choses qui sont entre la
banalit et le scandale, mais qui, si on les oublie,
finissent vraiment par tre justement ce qui ouvre la
porte, enfin, au dconnage le plus permanent.
Ce qui est tout de mme - malgr tout, malgr tous
mes efforts - celui qui reste absolument en usage et
dominant dans cette contre comme dans les voisines,
il faut bien le dire.
Bon, pendant que j'y suis sur cette pente, il
faudrait tout de mme Oui tenez, j'ai parl d'en
finir avec de rgler, de ne plus jamais parler de
cette histoire d'oblativit.
612
Il faut bien tout de mme se souvenir - puisque j'ai
parl de contexte - dans quel milieu, quel petit
cirque troit, cette ide a fait mange, savoir,
mettre quelques noms, ce n'est pas moi, quand mme,
de vous les ressortir, n'est-ce pas.
C'est pas sorti d'un mauvais lieu.
Il y avait un nomm Edouard PICHON
195
qui n'avait qu'un
tort, c'tait d'tre maurassien, a c'est
irrmdiable. Il n'est pas le seul. Entre les deux
guerres, il y en avait pas mal. Il a foment a avec
quelques cliniciens, enfin, n'est-ce pas, puisqu'il
s'agit d'entre deux guerres, les rescaps de la
premire, vous savez, c'tait pas brillant.
Et alors, a a t repris.
a a t repris, je ne sais pas pourquoi.
Si ! Mais enfin ce n'est pas moi de vous le dire.
Dans un certain contexte, alors beaucoup plus rcent
et nourri d'une histoire qui n'avait en somme rien
faire avec l'oblativit et qui tait ce mode de
rapport trs spcial qui surgissait d'une certaine
technique analytique dite centre sur la relation
d'objet en tant qu'elle faisait intervenir d'une
certaine faon le fantasme phallique et ce fantasme
phallique spcialement dans la nvrose
obsessionnelle. Voil.
Et alors, l, tout ce qui se jouait autour de ce
fantasme phallique, j'en ai, mon Dieu plusieurs
fois, plusieurs temps de mon sminaire parl assez,
je suis assez revenu pour tout de mme que, dans ses
dtails, dans son usage technique, on en ait tout de
mme bien vu les ressorts, les points de forage, les
points d'abus et je ne peux l vraiment que dire
je ne peux mme pas dire, dire quelque chose qui
rsume tout ce que j'en ai montr dans le dtail mais
simplement qui montre le fond de ma pense, sur ce
qu'il y a l dedans.
195 douard Pichon (1890-1940), Mdecin et psychanalyste franais, est surtout connu pour avoir t, avec R. Laforgue, le
vritable fondateur de la psychanalyse en France. Adepte de Charles Maurras et militant de l'Action franaise, ce catholique
fervent rptera qui veut l'entendre qu'il ne prendra de Monsieur Freud que ce qui s'accorde au got national. Il est lauteur, avec
son oncle J. Damourette, dun ouvrage de grammaire de la langue franaise : Des mots la pense. Sur la controverse LACAN-
PICHON sur loblativit, Cf. Ragoucy C., Loblativit : premires controverses, Psychanalyse 2007/1, N 8, p. 29-41.
613
Il y a quelque chose qui a trouv spcialement faveur
du fait que le glissement gnral qui a fait que
toute la thorie de l'analyse n'a plus pris que la
rfrence de la frustration, je veux dire a tout fait
tourner, non pas autour du double point initial du
transfert et de la demande mais tout simplement de la
demande.
Parce que les effets du transfert, bien sr,
n'taient pas ngligs mais simplement mis entre
parenthses, puisqu'on en attendait, en fin de compte
que a se passe, et que par contre, la demande, avec
spcialement ce fait qu'il se passe des choses sur ce
point et en effet, il s'en passe, il ne se passe pas
du tout ce que vous dites STEIN. Mais enfin, si vous
revenez la prochaine fois, on en parlera.
La position de l'analyste dans la sance, par rapport
son patient, c'est certainement pas d'tre ce ple
drangeant li ce que vous appelez le principe de
ralit. Je crois qu'il faut tout de mme revenir
cette chose qui est vraiment constitutive, c'est que
sa position est d'tre celui, qui ne demande rien.
C'est bien ce qu'il y a de redoutable : comme il ne
demande rien, et qu'on sait d'o le sujet sort,
surtout quand il est nvros, on lui donne ce qu'il
ne demande pas.
Or, ce qu'il y a donner c'est une seule chose et un
seul objet(a). Il y a un seul objet(a) qui est en
rapport avec cette demande spcifie d'tre la
demande de l'Autre, cet objet qu'on trouve lui aussi
dans l essieu , dans l'entre-deux, l o est chu
aussi le regard, les yeux d'Oedipe et les ntres
devant le tableau de VELZQUEZ quand nous n'y voyons
rien : dans ce mme espace, il pleut de la merde.
L'objet de la demande de l'Autre, nous le savons par
la structure et l'histoire, aprs la demande
l'autre : demande du sein, la demande qui vient de
l'autre et qui instaure la discipline et qui est une
tape de la formation du sujet : c'est de faire a,
de faire a en temps et dans les formes.
614
Il pleut de la merde, hein l'expression ne va tout de
mme pas surprendre les psychanalystes qui en savent
un bout l-dessus. a ne parle que de a aprs tout.
Mais enfin, ce n'est pas parce qu'on ne parle que de
a qu'on l'aperoit partout o elle est. Enfin, la
pluie de merde, c'est videmment moins lgant que la
pluie de feu chez DANTE, mais ce n'est pas tellement
loin l'un de l'autre. Et puis il y en a aussi dans
l'Enfer de la merde. Il n'y a qu'une chose que Dante
n'a pas os mettre dans l'Enfer, ni dans le Paradis non
plus, je vous le dirai une autre fois.
C'est quand mme bien frappant.
Et en plus, hein, que nous ayons charrier la
tinette, nous autres analystes, ce n'est quand mme
pas non plus des choses dont on va nous faire des
couronnes : pendant tout un sicle, la bourgeoisie a
considr que cette sorte de charriage, que j'appelle
charriage de tinette, tait exactement ce qu'il y
avait d'ducatif dans le service militaire.
Et c'est pour a qu'elle y a envoy ses enfants.
Il ne faut pas croire que la chose ait normment
chang, simplement maintenant, on l'accompagne de
coups de pieds dans les tibias et de quelques autres
exercices de plat ventre, appliqus sur la recrue, ou
sur celle qu'ensuite on lui confie, par exemple quand
il s'agit d'entreprises coloniales.
C'est une lgre complication dont on s'est
lgitimement, naturellement, alarm, mais la base
c'est a : le charriage de tinette. Je ne vois pas le
mrite spcial qu'introduisent dans cette affaire les
analystes. Tout le monde assure que la merde a le
rapport le plus troit avec toute espce d'ducation.
Jusqu' celle - vous le voyez - de la virilit
puisque, aprs avoir fait a, on sort du rgiment, un
homme ! Ce que je suis en train de dire
il s'agit d'une thorie, et certains savent trs
bien lequel je vise
c'est que si vous relisez attentivement tout ce qui
s'est dit de cette dialectique phallique spcialement
chez l'obsessionnel et du toucher et du pas toucher
et de la prcaution et du rapproch, tout a sent la
merde.
615
Je veux dire que ce dont il s'agit,
c'est d'une castration anale, c'est--dire d'une
certaine fonction qui, en effet intervient au niveau
du rapport de la demande de l'Autre ou de la phase
anale, c'est dire ce premier fonctionnement du
passage d'un ct l'autre de la barre, qui fait que
ce qui est d'un ct avec le signe plus est de
l'autre ct avec le signe moins. On donne ou on ne
donne pas sa merde. Et ainsi on arrive ou on n'arrive
pas l'oblativit. Il en est tout fait ainsi de
tout don et de tout cadeau - comme nous le savons
depuis toujours, parce que FREUD n'a jamais dit autre
chose - il ne s'agit jamais, quand on donne ce qu'on
a, que de donner de la merde. C'est bien pour a que
quand j'ai essay da dfinir pour vous l'amour, en
une espce, comme a, de flash, j'ai dit que l'amour
c'tait donner ce qu'on n'a pas. Naturellement il ne
suffit pas de le rpter pour savoir ce que a veut
dire.
Je me rends compte que je me suis laiss aller, un
peu, sur la pente des confidences. Et que je vais
clore par quelque chose qui ne sera pas mal venu,
n'est ce pas SAFOUAN, la suite de ce que je viens
de dire, pour que vous leur fassiez la petite
communication que vous avez eu la gentillesse, comme
a, de forger tout hasard, bien dans la ligne de ce
que vous apportez. Est-ce qu'un quart d'heure vous
suffit ? Sinon on remet la prochaine fois.
Paul DUQUENNE : On a le temps.
SAFOUAN : a dpend
LACAN : Combien est-ce que vous croyez que vous avez
pour dire ce que vous avez dire?
SAFOUAN : Vingt minutes.
LACAN : Eh bien, partez tout de suite, il sera deux
heures cinq, c'est l'heure o on finit d'habitude.
Je suis incorrigible.
616
SAFOUAN
Le sujet de cette communication c'est :
le ddoublement de lobjet fminin dans la vie
amoureuse de l'obsessionnel.
C'est un sujet que j'ai choisi justement parce que,
il me mne aux mmes questions que Monsieur LACAN a
annonces, comme tant celles dont il va traiter
l'anne prochaine, et amen apprcier l'intrt et
l'importance qui, pour un analyste se rattache ce
que cette question soit traite.
Avant de la soumettre l'examen, je vais vous
prsenter d'abord un matriel, qui est en effet assez
exemplaire pour permettre un reprage ais de la
structure sous-jacente ce ddoublement, mais dont
vous ne manquerez srement pas de voir le caractre
tout fait typique.
un moment donn de son analyse un patient tombe
amoureux et cela s'accompagne de son impuissance sur
la plan sexuel. C'est comme si chaque partie de son
corps tait mise dans un crin, dit-il en parlant de
la personne qu'il aime. D'o j'ai conclu la
prsence d'une intention protectrice vis vis du
corps de l'objet aim, mais tout aussi bien de son
phallus qu'il ne parvient pas mettre en usage et
partant une identification de ces deux termes.
Cela, videmment, appelle beaucoup de prcisions
qui, justement vont se dgager par la suite. En outre
il n'est peut-tre pas sans intrt de souligner ceci
que, le mme objet qui le fascinait n'tait pas sans
lui inspirer, par moment un certain dgot. Par
exemple, en notant un manque d'attache au niveau du
poignet ce qui veut dire aussi qu'il n'tait pas sans
dtailler cet objet, indice que son rapport n'tait
pas tout fait tranger la dimension narcissique.
Je dis en effet parce que c'est lui-mme qui la
qualifiait ainsi.Mais l'important est que,
paralllement cet amour qualifi par lui de
narcissique, il tait aussi li d'une faon qu'il
qualifiait lui - d'anaclitique
196
, une autre jeune
196 Qui rsulte de la privation des soins maternels pendant la premire anne.
617
fille, qui non seulement le mettait, mais lui
demandait expressment de se laisser mettre, dans une
position entirement passive, afin de dverser sur
lui toutes les excitations perverses qui lui
plaisaient.
De sorte que l'ensemble de la situation s'exprimait
pour lui dans ce fantasme, savoir, dit-il, qu'il
vole vers sa bien-aime, le phallus rect et dirig
vers le bas, mais l'autre s'interpose, l'attrape au
vol, le pompe et quand il arrive, c'est flacide.
Et c'est dans ce contexte que le patient a racont
un rve o il a vu son ami que j'appellerai, mettons,
Barot, portant un bas en nylon, et la vue de sa jambe
et d'une partie de sa cuisse ainsi revtue l'a mis
exactement dans le mme tat d'excitation que s'il
s'agissait d'une femme.
Et il se demande : quel est ce bas ?
Ce sur quoi je lui ai rpondu : c'est un crin .
Je laisse de ct, pour le moment, je laisse de ct
les effets ultrieurs de cette interprtation qui lui
a fait retrouver pour un temps sa puissance sexuelle,
mais l'important est que sur le champ, il rpond en
disant qu'il allait se lancer dans des histoires
d'homosexualit mais qu'il s'aperoit que son ami
Barot n'est intress dans l'affaire qu'en raison de
son nom - par exemple : Bas (Barot) - que le noeud de
la question est dans cet crin, et que l, il frle
vraiment la perversion. Qu'est-ce que cet crin et
qu'est-ce qu'il met dedans ? Et s'il ne peut pas
s'empcher de dire oui, aprs tout pourquoi pas,
parce qu'un crin on y met aussi des bijoux, et les
bijoux, c'est de la merde. Ce sur quoi il enchane
sur des rcits de masturbation, anale, dit-il.
Voil pour le matriel.
L'crin, c'est le rideau, le rideau dans la
thmatique de l'au-del du rideau que
Monsieur LACAN a trait dans son sminaire sur la
relation d'objet, c'est dire mme pas i(a), image
relle du corps mais i(a
'
) image virtuelle.
618
Si je me rfre videmment au schma optique paru
dans l'article de Monsieur LACAN sur le numro six de
La Psychanalyse, une chose qui mrite d'tre souligne
d'aprs cet article, c'est le fait que ce n'est pas
l'unique, que la saisie la plus immdiate n'est pas
de l'immdiat, mais du mdiat, et que i(a) n'est
jamais apprhend en dehors de l'artifice analytique.
Je veux dire par l que il n'y aurait mme pas
assomption, il n'y aurait mme pas simple relation
ce qui autrement, serait non seulement, serait une
contingence indicible - parce que la notion de
contingence suppose dj la notion d'un rseau - mais
ce qui serait plutt sr d'tre rejet - savoir
l'image spculaire - sort de cette mdiation de
l'autre, laquelle l'enfant se retourne.
Autrement dit, que c'est d'emble, n'est-ce pas
comme i(a) que l'acte sexuel fonctionnant dans le
champ de l'Autre, que l'image du corps fonctionne et
que tout un procd, qui est vraiment le procd
analytique y mette le sujet en position d'o il peut
voir i(a) rellement.
LACAN
Il ne peut jamais le voir, il est construit dans le
schma et puis il le reste, c'est une construction
i(a).
SAFOUAN
Oui Oui bien sr Justement oui.
Mais le contenu de l'crin pose plus de problmes :
le contenu de l'crin se trouve parfois, n'est-ce
pas, s'avre tre, parfois la merde, parfois le
phallus.
Ce phallus se trouve identifi l'objet aim de
sorte que la question se pose : ou bien il y a erreur
de traduction, quelque part, ou bien une traduction
juste pose le paradoxe de ce genre, ce qui est
probablement le cas, tant donn que tant donn
l'exprience.
619
Alors, pour reprendre cette traduction, cette
quivalence : phallus = objet aim, phallus = fille,
on s'aperoit que je l'ai appuy sur la prsence
d'une intention protectrice. D'o la question se
pose : il le protge de qui ? Srement pas de la
fille honnte mais de l'autre, celle qu'il appelle la
perverse. Cela illumine un fait que jusque-l je
n'avais pas soulign, savoir que toute son angoisse
tait engage effectivement dans ses rapports avec sa
bien-aime, c'est--dire celle qui tait un ple du
dsir, terme dont on peut voir combien il est plus
adquat de parler simplement du narcissisme, comme il
le fait, lui, parce qu'il ne voit que i(a), parce que
rien n'est visible en principe que i(a') : c'est l
que toute son angoisse tait engage - arrivera-t-il?
arrivera-t-il pas - alors que cette angoisse tait
parfaitement absente dans son rapport avec la fille
perverse, quon peut donc appeler dsigner comme
ple de demande, dont on peut voir combien a serait
plus adquat que de parler de relation anaclictique
comme il le dit lui-mme.
Il faut donc examiner de plus prs la description
qu'il donne de son comportement, et de cette
dernire. Il s'en dgage ceci qu'elle se servait de
lui comme d'un phallus mais cela au sens d'un objet
soumis l'exercice de ses caprices et non pas au
sens de l'organe dont il est porteur, parce que c'est
justement ce sens l qui est exclus dans ce rapport.
Son phallus rel, elle le mettait hors circuit et
sans doute s'employa-t-elle avec cette castration,
garantir son dsir. Et sans doute l'exaspration de
ses exercices pervers retombaient-ils
l'impossibilit o elle tait d'intgrer, si je puis
dire, sa condition d'tre rellement un objet(a),
c'est dire un objet changeable.
Car aussi, il serait fort difficile videmment de
citer maintes observations qui mettraient en lumire
cet tat de choses savoir que c'est dans la mesure
mme o un sujet est dans l'impossibilit, si je puis
dire de s'avoir comme objet de jouissance qu'il
pensera l'tre, d'o d'ailleurs le paradoxe d'un tre
dont toute pense serait ncessairement fausse :
620
bien, entendu, on ne sait pas que cela mme est Dieu,
c'est parce qu'on ne le sait pas que la religion
garde toujours, et les formes de la vie religieuse
gardent toujours, leur connexion structurale avec la
culpabilit.
D'ailleurs on peut aussi se demander dans quelle
mesure on ne peut pas dire que l'inconscient est cela,
c'est dire ce savoir faux dont le dire constitue
cependant le vrai et qui ne se situe nulle part sauf
dans cette bance d'un s'avoir en souffrance. Mais
avec toutes ces considrations qui ont l'air
philosophiques, je ne fais qu'anticiper sur la
conclusion clinique de ce travail ou de cette
observation.
Pour revenir donc au patient, il y a un malentendu ou
peut-tre une entente n'est-ce pas, c'est ici qu'il
m'est difficile de trancher. Autant un malentendu -
que je qualifierai de comique, n'tait-ce la gravit
des consquences - va s'installer et marquer son
rapport la fille perverse. C'est un malentendu que
l'on peut tirer au clair. C'est que, mesure que
s'intensifient les tentations qui le mettraient
entirement sa merci, au moment donc o
s'intensifient les tentations en somme lies ce que
i(a
'
) tente dans son mode d'change concider avec
(), ou plus simplement ce qu'il s'aperoive comme
un objet qui, non pas la calme, mais qui calme
quelque chose en elle, il n'aura d'autre recours que
de garantir sa castration elle avec la sienne sans
s'apercevoir que c'est dj chose faite. C'est dire
qu'il ne s'aperoit pas que non seulement cette
castration est la mme de part et d'autre mais dans le
sens que c'est un seul et mme objet qui manque
l'un ou l'autre
qui n'est videmment pas le phallus rel parce
que cela, a ne lui manque pas lui et pour ce
qui la concerne, on peut dire que a ne lui
manque pas parce que c'est justement de cela
qu'elle ne veut pas
mais qui est l'image lie cet organe, savoir le
phallus imaginaire qui ds lors va fonctionner comme
(-) et c'est par ce biais l, qu'on peut dire que la
621
position phallique fait que le sujet soit non pas ni
homme ni femme mais l'un ou l'autre.
Autrement dit, ce dont il s'agit en fin de compte est
ceci, c'est que la neutralisation et la mise hors
circuit, non pas de n'importe quel organe mais de son
phallus va promouvoir la fonction de l'image qui s'y
rattache comme (-). En d'autres termes, en d'autres
mots, plus i(a
'
) tend s'identifier (), plus, le
sujet, lui, tend, non pas, s'identifier mais se
subtiliser, si je puis dire en (-) c'est dire en
un phallus toujours prsent ailleurs.
partir de quoi, on voit, non pas comment il
identifie la fille aime au phallus car ce n'est pas
l une opration qu'il accomplit. Il s'agit plutt
d'une opration o il est pris, mais on voit comment
en s'engageant dans cette voie, il ne voit que
narcissisme, le reste, c'est dire l'identification
de la fille au phallus tant l'effet de ce que la
demande de l'Autre s'voquait dj partir d'un
dsir. Chose curieuse, mais cela me parait mriter
plus d'examen, enfin j'irai plus doucement, on
pourrait dire la rigueur que ce (-) qui se
signifie dans cet nonc :
c'est comme si chaque partie de son corps tait mise
dans un crin
et ce malentendu va rebondir ncessairement en une
maldonne, si je puis dire, qui va marquer son rapport
la fille aime comme une marque d'origine.
La maldonne, ici, ne consiste pas en ce que la fille
aime est le phallus mais au contraire en ce qu'elle
ne l'est pas, ou plus prcisment en ce qu'elle est
(-), garantie de la castration de l'autre. C'est que
dans toute la mesure o la vie rotique du sujet se
place ainsi sous le signe de la dpendance de la
toute puissance de l'autre. Et ici, je traite de la
question, de l'autre question, de l'autre problme
qui se pose, savoir que si son corps tait
identifi la merde, alors cela s'claire, je dis
partir de ceci que dans toute la mesure o la vie
622
rotique du sujet se place sous le signe de la
dpendance de la toute puissance de l'autre, on ne
s'tonnera pas que le mme objet bien aim se trouve
galement identifi aux fces.
La formule qui clarifie cet tat de choses et sur
laquelle je vais conclure est la suivante : plus le
dsir de la mre se leurre dans ce qui va fonctionner
d'emble la vue pour le sujet comme i(a
'
), plus le
sujet non seulement rgresse mais s'aline dans un
objet, prgnital, ici, le scybale, lequel objet ne
fonctionnera cependant que par rfrence la bance
qui dans ce dsir de l'autre, se signifie toujours
comme castration.
Je pense que c'est partir de ceci qu'on peut poser
correctement le problme de la castration oedipienne
normativante - j'entends la castration en tant
qu'elle rgularise justement la position phallique,
laquelle position phallique est strictement
identique, on l'a vu, la castration imaginaire.
C'est partir de cela qu'on peut poser le problme
de la castration oedipienne et on voit que, vraiment
la question de savoir par quel cheminement s'effectue
cette castration symbolique, ne saurait tre rsolu
qu'en tablissant des distinctions jusqu'
maintenant, en tout cas, indites, non formules
concernant la ngation.
retour 15 Juin
LACAN
Bien, merci beaucoup cher SAFOUAN. C'est excellent.
Naturellement comme on dit - comme de tout texte lu -
a vaudrait mieux qu'on le relise.
On verra avec MILNER si on ne pourrait pas colloquer
a dans Les Cahiers comme a toutes les personnes
pourraient en prendre connaissance.
Je vais, quand mme, pour conclure la chose de
SAFOUAN, vous dire quelque chose qui m'est venu
l'esprit, comme on dit, cependant.
623
Vous avez bien entendu que, tout de suite aprs son
double engagement avec ces deux objets si
diffrencis, il a fait ce rve concernant la jambe
de son ami dans un bas, et c'est autour de cela que
tout tourne et toute la phnomnologie de la
castration que, si subtilement, vous a prsente
SAFOUAN. a m'a rappel ce que NAPOLON disait de
TALLEYRAND : un bas rempli de merde.
SAFOUAN - Un bas de soie
Oui. Mais a pose des petits problmes.
La jambe, NAPOLEON en connaissait un bout quant ce
qui concerne ce qui ressortit de l'amour. Il disait
que le mieux qu'on avait faire c'tait de les
prendre son cou, les jambes, j'entends. La seule
victoire en amour, c'est la fuite. Il savait faire
l'amour. On a des preuves.
D'autre part, il est vident que la merde tenait une
trs grande place dans la politique de TALLEYRAND.
Enfin, il avait aussi certains rapports la
toute-puissance. Et que son dsir lait trouv assez
bien y cheminer c'est ce qui ne fait pas de doute.
Il faut donc aussi se mfier de ceci, de l'objet du
dsir de l'autre : qu'est-ce qui nous conduit
penser que c'est de la merde ? Dans le cas de
NAPOLEON, il peut y avoir l un petit problme
concernant TALLEYRAND, qui l'a eu, en fin de compte.
Voil. C'tait simplement un ordre de rflexion que
je voulais vous proposer et qui vient en codicille
ce que je vous ai dit de l'objet(a).
Table des sances
624
22 juin l966 Table des sances
MELMAN LACAN I LACAN II
Bonjour SAFOUAN. Venez, venez prs de moi tout de
suite, la dernire fois il s'est pass ce que vous
avez vu, je me suis laiss encore entraner, j'tais
sur mon lan, j'avais un certain nombre de points en
somme prciser dans ce qui avait t ma dernire
leon de ce qu'on appelle sminaire ouvert. Il y
avait l un hte inattendu, que nous avons invit
venir me voir parce qu'il dirige en Italie une revue
ma foi fort intressante.
Il faudra que je parle avec MILNER.
MILNER o est-il ?
MILNER ? Il est sorti.
Ah oui, parce que je l'ai vu rentrer tout l'heure.
Et alors j'ai voulu quand mme qu'il ait un petit
chantillon du style. Ceci dit, il n'en reste pas
moins que l'appel que j'avais fait au dbut de la
sance, esprant avoir des interventions, disons non
prvues, donc se renouvelle aujourd'hui et si
quelqu'un voulait bien aprs MELMAN, qui a quelque
chose nous dire, qu'il avait d'ailleurs dj prt
la dernire fois et pour lequel je tiens beaucoup
ce qu'il parle tout de suite, et le premier. Si
pendant ce temps quelqu'un mijotait une petite
question - quelqu'un ou plusieurs - eh bien je n'en
serais pas mcontent. Voulez-vous bien venir me
parler mon cher SAFOUAN ? Mettez-vous l, je vais me
mettre l. Cela ne vous gne pas ? Vous ne prfrez
pas. Si vous avez une prfrence, dites le.
Qui est-ce qui me donne du papier ?
Il se trouve que je n'en ai pas.
625
MELMAN
des structures comme celles qui ont t abordes au
cours du sminaire, abordes et mises en place au
cours du sminaire de cette anne, en particulier
celles concernant la relation de l'objet a avec le
champ du scopique, la fonction de l'cran. De telles
structures peuvent difficilement ne pas tre
rencontres en cours du travail psychanalytique et
ceci, par exemple, chez FREUD lui-mme et dans un
moment tout fait culminant justement de son travail
psychanalytique, puisqu'il s'agissait de sa propre
analyse.
C'est ainsi que j'offre votre attention trois
petits textes de FREUD choisis pour leur rencontre -
qui m'a semble particulirement heureuse - avec les
structures donc qui ont t mises en place cette
anne au cours du sminaire. Le texte central sur
lequel j'attire votre attention est celui qui porte
le nom tout fait sympathiquement prnomm de:
Deckerinnerungen, autrement dit de souvenirs-crans.
Deck en allemand ayant tout fait le sens analogue
cran chez nous, c'est--dire non plus ce sens de
couvercle, de ce qui obstrue, de ce qui peut cacher
et en mme temps le sens de ce plan, de ce plafond,
sur lequel l'image peut venir s'inscrire.
Deckerinnerungen : souvenirs-crans, je me permets
de vous le rappeler, c'est un texte qui date de l899,
donc du moment de ce foisonnement, de ce
jaillissement, pour FREUD de son travail
psychanalytique. Il est en plein dans la Science des
rves, il est encore manifestement dans son auto-
analyse, sa correspondance avec FLIESS est encore
tout fait active.
C'est l'poque o il s'intresse aux troubles de la
mmoire et c'est ainsi qu'un peu plus tt que
Deckerinnerungen, en l898, il a publi cet article
tout fait inaugural et tout fait stupfiant
c'est--dire cet article sur le
626
Mcanisme psychique de l'oubli, o, je vous le
rappelle, il aborde cet oubli pour lui, FREUD, du nom
SIGNORELLI, pinglant ce propos les processus
inconscients de la mmoire, du fonctionnement mental
dans une organisation qui est bien exclusivement dans
ce texte, sur l'oubli psychique, sur le mcanisme
psychique de l'oubli, dans une organisation qui est
bien exclusivement celle du signifiant dont vous vous
souvenez de ce schma o l'on voit des phonmes en
train de se balader entre SIGNORELLI, BOTTICELLI,
BOLTRAFIO, TRAFO, Bosnie, Herzgovine, etc. et ce
mouvement de ce processus dans un bain en quelque
sorte naturel qui est nommment situ dans le texte
comme tant celui de la sexualit et de la mort. Le
terme y tant tout fait nomm.
Dans Souvenirs crans les deux ples seront bien
davantage, galement nomms par FREUD, ceux de la
faim et de l'amour. Dans ce texte Souvenirs crans qui
date donc de l899, d'un an plus tard, il s'agit pour
FREUD de montrer que les premiers souvenirs de
l'enfance, les tous premiers, mme banals ou
indiffrents en apparence, constituent en fait un
cran la fois dissimulateur et rvlateur de
souvenirs ou d'vnements qui sont tout fait
fondateurs du sujet et qui sont retrouvables par
l'analyse. Un autre point discut par FREUD dans ce
texte est de savoir si ces souvenirs mettent en scne
une histoire relle, soit au moment o elle est
vcue, soit qu'elle a t ultrieurement rencontre
ou bien s'il s'agit d'un fantasme.
Et c'est ainsi que FREUD va nous raconter ce
souvenir-cran qu'un patient g, dit-il, de trente
huit ans, plutt sympathique et plutt intelligent,
lui aurait lui FREUD racont et les commentateurs
ont trs facilement reconnu ce patient de trente huit
ans, FREUD lui-mme, il s'agit donc d'un souvenir
appartenant FREUD. Et voici donc ce qui est dit,
je l'ai traduit votre attention puisque, je crois,
il me semble que ce texte n'est pas en franais.
627
Donc voici ce que dit ce patient FREUD :
Je dispose d'un assez grand nombre de souvenirs de ma
premire enfance qui peuvent tre dats avec la plus
grande sret. En effet, l'ge de trois ans, j'ai quitt
le modeste lieu de ma naissance pour aller la ville et
comme mes souvenirs concernent seulement ce lieu o je
suis n, ils se rapportent ainsi mes deuxime et
troisime annes. Ce sont surtout de courtes scnes, mais
parfaitement conserves et trs vives dans tous leurs
dtails, dans tous les dtails de leur perception, en
opposition complte avec mes souvenirs de l'ge adulte qui
manquent totalement de cet lment visuel. A partir de ma
troisime anne, mes souvenirs deviennent plus rares et
plus obscurs; il y a des lacunes qui peuvent dpasser plus
d'un an et ce n'est pas avant six ou sept ans que le
courant de mes souvenirs devient continu. Je divise mes
souvenirs d'enfance jusqu'au dpart de cette premire
rsidence en trois groupes; un premier groupe est
constitu de scnes que mes parents m'ont racontes et
rptes et dont je ne sais si ces tableaux souvenirs, -
Erinnerungsbild - sont originels ou reconstruits d'aprs
le rcit mais je remarque qu'il y a aussi des cas o
malgr les nombreuses descriptions de mes parents ne se
forme aucun souvenir tableau. J'attache plus d'importance
au second groupe. Ce sont des scnes dont on n'a pas pu me
parler puisque je n'en ai pas revu les participants :
nurse ou camarades de jeux. Du troisime groupe, je
parlerai plus loin. Pour ce qui est du contenu de ces
scnes et de leur habilitation au souvenir, je dois dire
que sur ce point je ne suis pas sans orientations. Je ne
peux certes pas dire que ces souvenirs concernent les
vnements les plus importants de cette poque que je
jugerais tels aujourd'hui. Je ne sais rien par exemple de
la naissance d'une sur, ma cadette de deux ans et demi,
mon dpart, la vue du train, le long parcours en voiture
qui y conduisait n'ont laiss aucune trace dans ma
mmoire. J'ai not par contre deux incidents mineurs de
voyage dont vous vous souvenez qu'ils sont intervenus dans
l'analyse de ma phobie mais ce qui dt me faire la plus
vive impression fut une blessure au visage o je perdis
beaucoup de sang et qu'un chirurgien dut me recoudre. Je
peux encore en toucher la cicatrice mais je n'ai pas
d'autres souvenirs directs ou indirects concernant cet
incident. Il est vrai peut-tre que je n'avais seulement
que deux ans .
628
titre de curiosit, comme a, on pourrait signaler
que les souvenirs de Casanova dbutent sur une scne
qui se trouve trs voisine, je veux dire sur un
panchement de sang intarissable - et qui dut tre
trait - un panchement de substance, un panchement
de substance vitale.
Aussi je ne m'tonne pas des tableaux et des scnes de
ces deux premiers groupes. Ce sont certainement des
souvenirs marqus par le dplacement o l'essentiel a t
omis. Mais dans certains, ce qui a t omis est reprable,
et dans d'autres, il m'est facile d'aprs certains indices
de le retrouver, rtablissant ainsi la continuit dans ce
puzzle de souvenirs et je vois clairement quels intrts
infantiles ont favoris la conservation de ces souvenirs
dans ma mmoire. Mais ceci pourtant, ne s'applique pas au
troisime groupe de souvenirs, ici il s'agit d'un
matriel, une longue scne et plusieurs petits tableaux
que je ne sais pas par quel bout prendre. La scne me
parat plutt indiffrente et sa fixation
incomprhensible. Permettez-moi de vous la raconter. Je
vois un pr quatre coins, un peu en pente, vert et d'une
verdure bien fournie, dans ce vert de trs nombreuses
fleurs jaunes, manifestement le vulgaire pissenlit .
En allemand Lwenzahn, autrement dit
dents de lion qui en est d'ailleurs la traduction
anglaise.
En haut du pr, une maison de paysan et devant sa porte
se tiennent deux femmes papotant avec animation, la
paysanne couverte d'une coiffe et une nurse, Kinderfrau.
Sur le pr jouent trois enfants, je suis l'un d'eux, j'ai
entre deux et trois ans, les deux autres sont mon cousin,
mon an d'un an, et ma cousine, sa sur, du mme ge que
moi, nous arrachons les fleurs jaunes et dj en tenons
chacun un bouquet dans les mains, la petite fille a la
plus jolie gerbe, nous les gars nous lui tombons dessus
comme d'un commun accord et lui arrachons ses fleurs. Elle
remonte le pr en courant et obtient de la paysanne pour
se consoler un gros morceau de pain noir. A peine voyons-
nous cela que nous jetons les fleurs, nous nous htons
vers la maison et exigeons galement du pain. Nous en
obtenons aussi, la paysanne coupant son pain avec un grand
couteau, ce pain me parat dans le souvenir d'un got si
dlicieux - kstlich - et la scne s'arrte l.
629
Un peu plus loin, FREUD ajoute :
J'ai l'impression gnrale qu'il y a dans cette scne
quelque chose qui ne va pas. Le jaune des fleurs ressort
avec une vividit particulire dans cet ensemble et le
got dlicieux du pain, me semble galement exagr
presque hallucinatoire, et je me souviens ce propos,
dit-il, de tableaux vus dans une exposition humoristique
o certaines parties et naturellement les moins
convenables, comme les rondeurs des dames, au lieu d'tre
peintes se trouvaient en relief.
Voil, donc, le passage crucial, enfin que j'ai
dtach dans ce texte de FREUD sur deux souvenirs
crans. Dans l'analyse laquelle FREUD va se livrer,
il construit quelque chose qui pourrait paratre de
l'ordre du roman familial. Pauvret du pre qui l'a
oblig quitter le vert paradis de son enfance. Ce
qui s'est pass pour lui seize ans quand tudiant
il est revenu sur ce lieu de sa naissance et qu'il a
rencontr l vtue d'une robe jaune, la fille de
voisins qui s'appelait Gisela FLUSS et le coup de
foudre immdiat qu'il en eut, coup de foudre bien
entendu sans aucun lendemain, vocation du bonheur et
de la fortune pour lui FREUD s'il tait rest dans ce
nid de sa province, il l'appelle ainsi, Provinznest
mais aussi tout une autre srie de penses qu'il
oriente vers ce que vers les conseils que son pre
lui a donns, c'est--dire il aurait du couter
l'appel de son pre, pouser sa petite cousine qui
figure dans le rve: Pauline, abandonner ses
abstraites tudes pour de solides affaires
conomiques, financires. En conclusion dit FREUD :
faim et amour, Hunger und Liebe, voil les courants
pulsionnels qui sont alors, dit-il, dans ce souvenir
cran.
Bien sr, nous ne pourrons pas nous engager ici,
maintenant, dans l'analyse tout fait dtaille
qu'exigerait ce texte mais je me contenterai d'en
fixer certains repres, en premier lieu la prsence,
aussi manifeste, aussi saillante, aussi clatante de
l'cran.
630
Prsence de l'cran, si clairement figure dans cette
surface, dans ce pr, ainsi comme une surface
quatre coins, lgrement incline en pente. Cet cran
sur lequel va se construire toute la scne. Je pense
qu'on peut galement y situer, d'une manire qui ne
me parat nullement abusive, l'vocation propos de
ce souvenir d'une dimension particulire, celle de la
perspective. Je ne veux pas dire seulement le fait
qu'il s'agit par exemple d'un paralllogramme
je veux dire enfin d'une surface donc incline,
le fait de cette distribution, de cette maison
qui est l situe en haut, au loin des enfants
qui sont l en bas et ensuite du mouvement qui va
porter les enfants vers cette maison de paysan
mais galement le fait par exemple, si saillant lui-
mme, si surprenant lui-mme que dans ces
associations, eh bien, ces associations vont conduire
FREUD voquer cette exposition de tableaux
humoristiques du Pop'Art dj cette poque, o
certaines parties, au lieu d'tre peintes, se
trouvaient l rapportes en relief, en trois
dimensions. Je pense galement qu'il est ncessaire
dans ce texte si suggestif d'voquer la place de
l'objet(a).
FREUD nous y conduit quasiment, je dirais par la
main, en situant lui-mme, cet aspect anormal de
cette reprsentation, il y a quelques chose qui ne va
pas, il y a l quelque chose qui cloche, c'est quand
mme bizarre et ce propos l qu'est-ce qu'il
situe ?
Eh bien, il situe les fleurs, les pissenlits et le
got, kstlich, dlicieux de ce pain, la saveur
presque hallucinatoire. Pour ma part, j'aurais
tendance voir dans la vividit de ces fleurs jaunes
se dtachant sur ce pr vert, trou lumineux,
rassembles en ce bouquet que porte, nous en revenons
toujours des gerbes de fleurs, ou des bouquets de
fleurs, mais que porte cette petite fille, bouquet
qui va s'vanouir d'ailleurs, dont la valeur va
disparatre, va s'vanouir, au moment mme o les
enfants, o les garons l'atteignent puisqu' ce
moment-l, la petite fille s'intresse autre chose,
631
en tout cas, c'est le moment mme o l'objet, au
moment o il est saisi, vient voir sa valeur
sollicite. Il faut bien sr remarquer que les
Lwenzahn ne peuvent pas tre quelque chose de tout
fait indiffrent dans l'analyse de ce texte
je veux dire l'vocation ici du lion dent, pour
FREUD, en tant que ce texte concerne, tourne
autour de problmes concernant la terre natale,
le lieu, ce qui serait le lieu de la naissance
ne peuvent manquer de nous paratre ici, en tout cas
hautement significatifs et revenir en tout cas en
quelque sorte appuyer notre supposition, notre
proposition, quant leur fonction, quant leur
place ventuelle d'objet(a).
Le pain que coupe la paysanne avec son grand couteau
s'appelle en allemand Laib, c'est une miche de pain,
un terme qui, je ne sais pas, ne m'a pas paru tel-
lement usuel.
Laib a s'crit l-a-i-b alors que Leib le corps
s'crit l-e-i-b, c'est donc en tout cas dans du Laib
qu'avec un grand couteau cette paysanne tranche ce
pain au got si kstlich.
Kstlich - cela veut dire cela vient de kosten, co-
ter, payer, a a un got coteux. Et ce pain, un peu
plus loin portera galement le nom de Landbrot,
autrement dit, ce que je crois nous pouvons trs bien
traduire, ici, par pain de pays, par exemple.
En tout cas, dans cet cran, ce que nous pouvons voir
figurer, c'est bien une sorte de terre natale,
reprsentant de sa reprsentation, lui FREUD,
figure dans le tableau comme il le souligne expres-
sment.
Et la fin du texte FREUD va faire cette remarque
qui m'a parue tout aussi stupfiante, c'est que pour
qu'on puisse vraiment parler de souvenir-cran, comme
a, il faut que le sujet figure dans le tableau,
ainsi, il en fait la condition tout fait expresse,
tout fait ncessaire pour que cela puisse tre
envisag comme tel. FREUD y voit le tmoignage d'une
berarbeitung, une sorte de re-laboration, re-
travail o pour notre part nous serions tent de lire
celui-l mme du fantasme.
632
Je crois en tout cas que ce qu'on ne peut manquer
d'voquer, presque qui se trouve tellement conduire
voquer propos de ce texte, c'est bien le
problme de ce que peut tre pour un sujet, le lieu
de sa naissance, lieu de sa naissance en tant bien
sr qu' la fois et irrmdiablement perdu, chu et en
mme temps constitu, figur mais lui-mme avec cet
cran reprsentant de sa reprsentation o il va
venir, ainsi lui petit FREUD, se trouver livr ses
pulsions qui sont la faim et l'amour.
Dans l'article que j'avais signal prcdemment sur
le Mcanisme psychique de l'oubli et concernant donc
l'oubli du nom de SIGNORELLI, cet article orient,
lui, sur la sexualit et la mort, quand ce phnomne
se produit pour FREUD, il voyage avec cet avocat
berlinois, un compagnon, comme cela, de rencontre, de
voyage, Monsieur FREYHAU. Et puis il veut voquer ce
nom, l'auteur des fresques d'Orvieto, des choses
dernires. Cela ne vient pas, mais il se produit ce
moment-l quelque chose de trs curieux
et quelque chose qui d'ailleurs assez bizarrement
a t laiss tomber dans la
Psychopathologie de la vie quotidienne, lorsque
FREUD y reprend ce mme souvenir
il se produit pour FREUD quelque chose de trs
curieux, c'est qu'il ne se souvient pas du nom de
SIGNORELLI, mais il voit des fresques et avec une
vivacit particulire, de manire tout fait ber
Il voit le peintre tel qu'il s'est figur lui-mme
dans un coin du tableau avec des dtails, avec son
visage particulirement srieux, ses mains croises,
et ct du peintre, ct de SIGNORELLI, il voit
l galement, la reprsentation de celui qui tait
son prdcesseur dans la ralisation de ces fresques,
c'est--dire FRA ANGELICO de Fiesole dont le nom ne
semble en rien ce moment-l lui chapper.
C'est l un phnomne qui, je crois, mrite d'tre
signal et que je voudrais, pour terminer, rapprocher
d'un court texte qui, lui, date de quarante annes
plus tard.
633
C'est en l936, lorsque FREUD crit pour le soixante
dixime anniversaire de Romain ROLLAND ce texte, qui
s'appelle Un trouble de mmoire sur l'Acropole, il en
a alors lui-mme quatre-vingt et il raconte Romain
ROLLAND dans ce texte - enfin sa contribution
l'anniversaire de Romain ROLLAND - et donc de lui
raconter combien au cours d'un voyage sur l'Acropole
avec son frre, il a eu un sentiment trs curieux,
Entfremdungsgefhl, sentiment d'tranget que tout
cela ce n'tait pas rel, que ce qu'il voyait n'tait
pas rel, que c'tait bizarre, c'tait curieux, qu'il
n'en croyait pas ses yeux, qu'il en arrivait mme
se poser la question de l'existence de l'Acropole et
tout ceci l'engage sur l'vocation du problme de la
fausse reconnaissance, du dj vu, du dj racont,
c'est--dire mlant tout fait directement le
sentiment de la reconnaissance la plus immdiate et
la plus intime et la plus sre.
Bref, on pourrait dire, lui et son frre, au sommet
de l'Acropole, FREUD ne se voit pas dans le tableau
et ce qui peut nous paratre ventuellement tout
aussi significatif c'est que tout aussitt, tout
aussi directement se trouve invoqu la prsence et le
regard du pre, ceci sous la forme d'un sentiment de
pit filiale, sentiment de culpabilit, sentiment de
faute chez FREUD et puis enfin cette vocation mi-
humoristique, mais peut-tre aussi mi-tragique qui
est celle de cette parole de NAPOLEON qui dit son
frre joseph, bien sr au moment de son couronnement,
son frre Joseph:
Qu'est-ce qu'aurait dit Monsieur notre pre, s'il avait
pu tre l aujourd'hui ?
Voil. je m'arrterai l-dessus.
634
LACAN
J'ai trouv que ceci, pour n'tre pas de l'indit,
illustrait assez bien comme a rtroactivement, parce
que ce sont des choses dont j'ai parl il y a
longtemps, nommment sur le texte concernant
SIGNORELLI, j'ai fait une communication la Socit
de philosophie. Au temps o je l'ai faite, je ne
pouvais pas mettre en valeur videmment ces lments
structuraux ce moment-l, puisque la thorie n'en
tait point encore faite. Le fait que MELMAN ait bien
voulu se donner la peine de s'apercevoir que cela y
est et de la faon la plus articule est tout fait
de nature confirmer ce que j'ai pu, soit la
dernire, soit l'avant dernire fois, faire remarquer
de ce que veut dire ma reprise de FREUD dans un
cercle redoubl, enfin dans une espce de deuxime
tour qui a ses raisons structurales.
Et vous voyez chaque point du texte de FREUD, nous
y trouvons la possibilit dune espce de commentaire
second qui reprend les mmes lments dans un autre
ordre, dans un autre ordre qui n'est en ralit que
la reproduction du premier mis l'envers. Ce que je
vous ai dit par exemple la dernire fois de la
correspondance au drame de l'Oedipe, de ce drame de
l'aveuglement d'dipe - et de l'aveuglement pourquoi?
Pour avoir voulu trop voir - en est une autre
illustration.
Enfin, je ne peux r-indiquer ou plutt r-voquer
ces choses que d'une faon allusive, je ne vais pas
aujourd'hui reprendre une fois de plus ces mmes
thmes.
Il m'a sembl que ce que MELMAN a l repris
d'une faon trs sensible, parce que cela lui
tait trs actuel et qu'il n'a eu aucune peine
en retrouver les repres principaux
valait de vous tre prsent cette occasion.
Est-ce que quelqu'un peut avoir justement une
remarque complmentaire sur ?
635
VALABREGA
Je vais faire deux petites remarques propos de ce
que vient de nous rappeler Charles MELMAN.
La premire
je prends les choses par la fin
la premire est propos de l'article qu'il nous
rappelle du souvenir sur l'Acropole, c'est une
remarque terminologique, le mot Entfremdung ne peut
pas tre traduit, enfin n'a pas intrt tre
traduit par tranget mais par alination - parce
que, il s'agit l de quelque chose de trs
intressant dans ce texte - c'est unheimlich, qui
correspond plutt l'tranget.
LACAN
C'est incontestable que c'est unheimlich qui
correspond tranget.
VALABREGA
Mais ce qui est intressant, c'est que Entfremdung
c'est
LACAN
Commentez, commentez, cela vaut la peine, commentez,
comment dans ce texte vous l'entendez comme
traduisible par alination.
VALABREGA
C'est--dire que dans ce texte cela introduit quelque
chose qui est tout fait autre que ce qui a t
apport par MELMAN, et on pourrait dire que du point
de vue diagnostic, on a l'impression que c'est tout
fait autre chose, dans le souvenir de l'Acropole que
636
LACAN
Parlez plus fort Bon Dieu ! Parce que c'est tout de
mme c'est trs intressant ce que vous dites et
tout le monde personne n'entend.
VALABREGA
Ce qui n'est pas le cas dans le texte de l886/l889,
c'est encore quelque chose
LACAN
Mais discutez-le ! Comment pouvez-vous soutenir que
le terme d'alination est prsent propos de ce
souvenir de l'Acropole et nommment pour traduire
Entfremdung. Je veux bien que vous le souteniez mais
expliquez pourquoi.
VALABREGA
C'est un concept hglien, l'alination.
LACAN
Un instant, je vous en prie, comment concevez-vous le
concept hglien dans quelque chose qui connote un
trait vcu, que cet Entfremdung.
VALABREGA
Je ne sais comment, il faudrait mme...
LACAN
Que Entfremdung puisse correspondre quelque chose
comme la dpersonnalisation, passe encore, ou le
sentiment du sosie ou quelque chose, que nous c'est
not dans le texte comme une impression, enfin c'est
une notation phnomnologique, l'alination n'est
pas n'a rien faire avec a dans HEGEL puisque vous
invoquez - vous, pas moi - HEGEL.
637
VALABREGA
Je trouve quand mme qu'il n'utilise pas l un autre
mot qui pourrait je ne sais pas quel mot allemand
pourrait tre l pour dsigner la dpersonnalisation,
quelque chose comme a, il se trouve tout de mme que
ce n'est pas a.
LACAN
Comment pouvez-vous soutenir que l'alination qui est
vraiment la structure, enfin la plus immanente et en
mme temps la plus cache, tout ce qui est du vcu
du sujet soit l tout d'un coup mise saillante dans
l'apparence ou bien alors montrant sa pointe d'une
faon quelconque qui puisse permettre de l'pingler
avec ce terme d'Entfremdung et justement propos de
ce que FREUD ressent sur l'Acropole ?
VALABREGA
Oui, attendez, ce n'est pas une raison. Je me demande
pourquoi il emploie ce mot simplement, ce n'est pas
un mot, pas un mot du vocabulaire psychiatrique,
absolument pas.
LACAN
Mais pourquoi le traduisez-vous par alination
alors ? CASTORIADIS.
CASTORIADIS
Du point de vue tymologique, je crois que
VALABREGA a raison par rapport HEGEL; je ne crois
pas que dans le texte de FREUD il s'agit de l'ali-
nation dans ce sens. On dira en allemand sich fremden
de quelqu'un qui serait plutt en zizanie, que la vie
a loign du mnage. C'est le Fremd dans ce texte,
alors il ne faut pas le rapprocher du groupe qui a un
autre caractre; je crois que ce que FREUD veut dire
dans le texte c'est qu'il se sent tranger ce pays,
638
et tranger radicalement. Il ne faut pas lui donner,
je crois, la charge philosophique hglienne de
l'alination qui est autre chose.
LACAN
coutez, cela a une note extraordinairement nette,
n'est-ce pas, il s'agit d'un sentiment que nous
appelons dans la clinique psychiatrique : la
dralisation.
VALABREGA
Pourquoi l'utilise-t-il? C'est a le problme, c'est
un problme terminologique, moi je ne sais pas, je
n'ai pas recherch...
LACAN
Ce n'est pas parce que nous nous trouvons devant un
emploi d'Entfremdung qu'on trouve galement dans
HEGEL que nous allons nous mettre, comme a, sauter
pieds joints et dire que la signification que
FREUD implique dans ce terme d'Entfremdung est une
signification hglienne justement l. Et puis
coutez, ds qu'on parle d'alination, tout de mme,
on sait o on en est, on sait ce qu'on voque, on
sait ce que a intresse. Alors si c'est l
simplement pour ouvrir une question sans le moindre
centimtre qui aille plus loin, je ne demande pas
mieux que cela rebondisse mais je veux que vous vous
en expliquiez.
STEIN
Alors, je pense quand mme que le point soulev par
VALABREGA mrite d'tre fouill.
LACAN
Tout fait d'accord.
639
STEIN
je n'ai pas le texte sous les yeux, mais on peut
remarquer qu'en franais propos du terme
d'alination il y a cette mme difficult, c'est que
l'alination n'voque pas seulement HEGEL et Marx.
Elle voque aussi la folie. Or ce sentiment trange,
appelons-le, si vous le voulez, d'tranget, trouv
sur l'Acropole, a quand mme quelque chose voir
avec le sentiment d'tre fou.
LACAN [ STEIN]
Je vais vous donner la parole, je vous demande pardon
de
GREEN
Deux choses. Une concernant la remarque de VALABREGA,
l'autre l'expos de MELMAN. La premire, je pense que
sans introduire le contexte d'alination, on est
quand mme oblig ici partir de ce terme, de penser
que FREUD veut dire et en dehors du mot dont il est
question par rapport au contexte qu'il vit : ce
n'est pas moi qui suis ici, c'est un autre, ce n'est
pas moi , a, c'est dit en toutes lettres dans le
texte. Alors voici concernant le point soulev par
VALABREGA.
Par rapport ce qu'a dit MELMAN, je voudrais
apporter une petite prcision lorsque tu as dit que
le sujet advient et est constitu par le fait qu'il
va se trouver l devant ce que tu appelais ses
pulsions, la faim et l'amour. Eh bien, je crois que
toute l'ambigut de ce texte c'est de montrer que
FREUD a choisi dans cette alternative et que
justement tout le texte parle de la faim en tant
qu'il va s'agir du dsir et non plus de la faim et
que ceci se rattache directement la parole du pre,
en tant, que le pre lui a dit : cessons avec ces
billeveses, il faut manger .
640
Voil la voie des affaires. C'est pourquoi, j'y
verrai donc quelque chose de beaucoup plus nettement
marqu par rapport au dsir et par rapport justement
ce qui est en jeu dans ce personnage nourricier
avec son grand couteau qui n'intresse plus du tout
la faim et qu'il exclut compltement du champ du
problme.
LACAN
Comment s'appelle-t-il?
CABEN
La traduction des textes le mot Entfremdung est un
mot plus simple en allemand, il se traduit trs bien
par le mot dpaysement, tout le reste n'est que folle
interprtation.
LACAN
Bien sr, dpaysement ou dralisation, c'est
exactement de quoi il s'agit, ce n'est pas du rel.
CABEN
Vous avez dj employ la semaine dernire et le mot
Entfremdung, c'est tre dpays et tymologiquement
aussi.
LACAN
Qu'est-ce que j'ai employ la semaine dernire?
CABEN : Entfremden.
LACAN : Srement pas.
CABEN
Dans le sens o vous l'avez traduit par alination.
641
LACAN : C'est une traduction classique.
CABEN
Oui, mais mon avis, c'est dj une interprtation.
LACAN
N'exagrons pas, l non plus, c'est comme si vous
disiez que Aufhebung est dj une interprtation
parce que, dans HEGEL, cela a le sens de plus
qualitativement lev et que cela peut aussi bien
vouloir dire, je ne sais pas quoi abonnement. Le
caractre simplet et cru d'un usage d'un terme n'a
pour autant aucune prsance sur les autres usages,
n'est-ce pas. J'ai souvent fait remarquer qu'il n'y a
pas de prsance de l'usage propre sur l'usage
figur, pour une simple raison d'abord que cela ne
veut rien dire, cette diffrence, mais le ct usuel,
disons, de Entfremdung ne suffit pas donner une
prvalence dpaysement sur son usage philosophique.
Bon, vous[LECLAIRE]
Oui, vous,[VALABREGA] bien sr, naturellement, si
vous voulez reprendre la parole.
VALABREGA
Autre chose, moi je ne suis pas d'accord avec ce que
vient de dire M. CABEN.
LACAN : Moi non plus.
VALABREGA
On peut toujours ramener le sens de n'importe quel
mot un sens non habituel, et qu'il faut prendre
dans ce sens-l, surtout pas dans FREUD. Ce qui ne
veut pas dire qu'il y a une signification indirecte,
je n'en sais rien. Je pose la question propos de
l'Unheimlich d'une part, dont on a beaucoup glos, et
de l'Entfremdung.
642
LACAN
Ecoutez, ne cherchons pas, nous n'allons pas nous
terniser l-dessus. Il est tout fait clair qu'une
rfrence structurale comme l'alination est jamais
personne n'a prtendu voir l'alination affleurant
sur le plan phnomnologique. Le sentiment
d'alination, si cela concerne justement
l'alination, il n'y a pas de sentiment
d'alination, sans cela a ne serait pas
l'alination. Vous tes d'accord?
Allons LECLAIRE, que vouliez-vous dire?
VALABREGA
Au sujet du mcanisme de l'oubli et de la
substitution, puisque tout cela tourne autour du mot
substitutif et plus gnralement de la substitution,
alors l le rapprochement avec le souvenir-cran est
trs important. Parce que l'analyse, - j'ai pu faire
une analyse pousse une fois que quelque chose du
mcanisme de l'oubli qui pouvait, qui jouait un rle
trs important dans une analyse et qui en particulier
englobait et se situait prcisment aussi l sur les
fleurs, parmi toutes ces choses - alors cette analyse
a montr qu'en dehors de la substitution dfinie par
FREUD, en 98-99, il existe, ceci renvoie des
substitutions qu'on pourrait dire formelles et il
apparat nettement que cela renvoie des
substitutions intrinsques, c'est--dire qu'il y a
d'autres mots derrire les mots ou les noms
particulirement oublis et retrouvs, ou non, par
les mcanismes de substitution. Il y a une
substitution intrinsque qui a substitu ces mots-l,
par exemple les noms des fleurs d'autres. Par
consquent, la substitution ici est vraiment un
cran.
LACAN
Est vraiment?
643
VALABREGA
Un cran. Le rapprochement est ici tout fait
creuser. Le souvenir-cran est le mcanisme de
l'oubli. C'est simplement une remarque que j'mettais
dans le sens de ce que nous avons dit. Voil.
LACAN
Ce sont nanmoins des choses diffrentes, n'est-ce
pas, nous sommes bien d'accord.
VALABREGA
Certes, mais a joue le rle d'cran, c'est
fonctionnellement un cran dans l'exemple auquel je
pense. a veut dire que les noms de substitution
renvoient d'autres noms c'est--dire en
substitution au niveau mme du nom, derrire les noms
substitus.
LACAN
Rpondez MELMAN, ce que vous pensez cela.
MELMAN
Non, ce serait s'engager l galement dans une grande
chose. je pense qu'en tout cas, c'est radicalement
diffrent de ce qui se passe au moment o il oublie
le nom de SIGNORELLI, o se prsente lui dans le
tableau la figure mme du peintre, de faon si
prcise, avec cette vividit particulire, je crois
que c'est tout fait autre chose.
LACAN
Mais oui bien sr. LECLAIRE. Non LECLAIRE !
Je l'avais dit, il y a un moment qu'il doit parler.
644
LECLAIRE
C'est un complment l'analyse du souvenir-cran, un
lment pour complter l'analyse dans la mme ligne,
propos de pissenlits qui joue un rle central
dans ce souvenir-cran. Vers la mme poque, il
s'occupe de l'analyse du rve du Comte de Thun et par
erreur il voque le pissenlit, propos d'une autre
fleur qui est un mucilage ordinaire. Il ne se trompe
pas : le pissenlit dsigne bien l pour lui le
problme de son nursie car si ce mot lui est venu,
de pissenlit, pour dsigner une autre fleur qui tait
le mucilage, c'est en franais qu'elle qui voque
tous les problmes de ces incontinences et
principalement de ces incontinences d'urine. Sur le
jaune et sur la tache jaune qui est au centre et que
tu as bien situe comme tant au centre du souvenir-
cran, je voudrais faire encore cette remarque qui se
rapportait aussi l'auto-analyse de FREUD ou
l'analyse de FREUD.
C'est un autre passage de La Science des rves
- j'ai dj eu l'occasion de le signaler - nous
trouvons quelque chose de plus singulier, qui fait
qu' la fois le nom allemand de Lwenzahn pour
le pissenlit et la couleur jaune se trouvent
rassembls en un seul terme. C'est comme l'histoire
d'un patient d'un collgue qui a longtemps t occup
dans ses rves par la figure d'un petit lion jaune.
Or, ce lion jaune, il ne voit absolument pas ce qu'il
vient faire dans ses rves. Ce collgue en parle
FREUD et ce n'est qu'au moment o il retrouve, dit--
il, ce lion jaune comme ayant t un de ses jouets
favoris, un bibelot de sa mre, qui avait t depuis
rang, que le souvenir du lion jaune ou la prsence
du lion jaune inexplicable dans les rves disparat.
je pense pour une autre raison que ce collgue, au
lion jaune, il en est comme de ce sympathique
collgue, ou de ce sympathique patient dont parle
FREUD, je pense que c'est lui-mme, c'est une
hypothse qui n'a pas encore t vraiment soutenue,
simplement que j'avance pour l'instant pour la raison
suivante. C'est l-dessus que je m'arrterai.
645
C'est qu'immdiatement aprs avoir parl de ce
collgue au lion jaune et de cette petite histoire du
lion jaune, il voque une autre aventure du mme
collgue, qui est un souvenir d'enfance, ce collgue
qui avait t trs impressionn du rcit qu'on lui
faisait de l'exploration de NANSEN au ple, avait eu
cette question curieuse qui avait fait rire son
entourage et ses frres parce qu'il est normal
savoir que cette exploration, ce voyage, Reise, tait
douloureux, a faisait mal. Car ce collgue avait
confondu, tant enfant, avait confondu Reise et
reissen, dchirer. C'est partir de l, et c'est sur
ce point que je me fonde pour avancer l'hypothse que
le collgue au lion jaune, c'est FREUD lui-mme. Car
il semble que si nous nous interrogeons l aussi sur
la phobie des voyages, quelque chose peut nous
apparatre concernant la confusion des voyages et de
reissen, dchirer, d'autant que dans l'uvre
freudienne nous trouverons constamment l'arrire
plan ce fantasme fondamental d'avoir dchirer un
voile, d'avoir dvoiler quelque chose et c'est l-
dessus que je veux terminer, car il me semble que
cette considration n'est pas trangre l'analyse
possible de ce souvenir-cran. Car l encore il
montre au pied de la lettre cette dimension de
l'cran, comme surface, nous avons aussi prendre en
considration ce que tu as fait, ce qui peut tre de
l'ordre de la dchirure, ou de la traverse de
l'cran.
LACAN
Je voudrais que vous prcisiez votre pense. Vous
pensez que ce que vous venez de dire, FREUD le
savait, que le sachant il donne tout le texte
concernant le rve o est situ ce lion jaune? Est-ce
que lui-mme en quelque sorte s'tait repr, si je
puis dire, dans cette fonction du lion jaune?
LECLAIRE
Non.
646
LACAN
Vous ne le pensez pas. C'est important.
LECLAIRE
Je pense qu'il s'est repr explicitement dans la
fonction du dchir lorsqu'il a soutenu son fantasme
de l'inauguration de la plaque commmorant la
dcouverte inaugurale de la Science des rves o il
imagine le jour o cette plaque sera inaugure et o
sur cette plaque est crit que se dvoila FREUD le
secret des rves. Nous pensons que le terme de
dvoilement, de dchirement, d'ouverture est
fondamental chez FREUD. Mais ce que je veux dire,
c'est que dans ce souvenir-cran, du fait mme que
l'on voit comme transperant la surface, la couleur
jaune et liant cette couleur jaune exactement ce
qui vient aprs dans l'analyse du souvenir du lion
jaune, c'est--dire le problme du Reise-reissen. Je
pense qu'est li l'vocation de la couleur jaune et
cette prgnance de la couleur jaune, pour FREUD
disons trs consciemment le problme de enfin au
moment o il dcrit ce souvenir trange, je ne pense
pas du tout que la dimension de la dchirure en tant
que telle ou de la rupture chez FREUD soit explicite,
et je pense qu'au jaune est ncessairement lie cette
dimension de passage travers ou de transgression,
bref ce qui voque propos de la transparence de
LACAN
Je souhaiterais simplement que ceci fut crit par
vous, cher Serge.
LECLAIRE
LACAN : Dj ? a veut dire quoi ?
LECLAIRE : Dans les Cahiers n l ou 2.
647
LACAN
Parfait, oui parce que j'aurais eu certainement
l'occasion d'y revenir, je ne peux pas aujourd'hui,
tant donn le temps qui nous reste, nous engager
plus loin dans ce dbat. Allez.
STEIN
Mais, je voudrais faire une petite remarque
LECLAIRE sur le problme de Reise et reissen. C'est
que le dvoilement et de l'autre [] et que la
dchirure reissen, Riss, soient quivalentes pour
FREUD, c'est une chose qu'il faudrait que tu
tablisses quand mme, je ne dis pas qu'il n'en est
pas ainsi. Cela demande tre tabli. Le dvoilement
n'voque pas forcment la dchirure. Peut-tre aussi
pour FREUD des lments pour abonder dans ton sens
moins qu'il il y a une autre dtermination de
reissen qui est intressante et qui est implique
dans ce que tu as dit, c'est de se rappeler que FREUD
avait demand si ce voyage Reise faisait mal.
Or reissen nest pas seulement la dchirure,
reissen est - au sens figur - est employ en
allemand, non d'une manire trs courante, est la
manire de dsigner une certaine douleur qu'on
prouve, donc reissen est quelque chose dont il a
pu entendre parler autour de lui propos des
douleurs rhumatismales prouves par l'un de ses
parents ou dans une circonstance analogue et ceci
nous donnerait le lien entre le voyage et le danger
pour la sant impliqu dans le voyage, la phobie des
voyages et l'association avec reissen , cest
dire une dchirure dans le corps.
648
LACAN
Eh bien! coutez mes bons amis, ces choses ne seront
pas rsolues, j'ai vu un vif intrt la remarque de
Serge parce que nous aurons probablement l'occasion
de la rutiliser plus tard, concernant en effet la
position de FREUD en tant qu'analyste. Voil il nous
reste une demi-heure, je n'aurais pas voulu, c'tait
du moins mon intention, terminer l'anne sans faire
quelque chose qui participe de deux registres : d'une
part de faire un sort ce qui a occup une part
importante des sminaires ferms, savoir la
discussion des articles de STEIN.
Je ne prtends pas la reprendre. Elle a t faite sur
le pied trs lgitime d'une critique de ce qui pour
chacun de ses interlocuteurs leur semblait
discordant, quant leurs sentiments de ce qui se
faisait dans la sance, de ce qui se passait, de ce
qui venait en premier plan et de ce que STEIN, lui,
entendait y mettre, ce mme premier plan.
Je ne reprendrai pas ces choses qui ont une valeur de
dialogue toujours utile entre psychanalystes.
Nanmoins, il me parat qu'il y a quelque chose que
je suis le seul, en somme, autoris tout au moins,
pouvoir faire dans les formes qui ne soient pas de
censure. Je ne voudrais pas qu'il y ait l d'erreur
assurment. Ceux de mes lves qui sont intervenus,
ont justement vit ce point de vue, savoir :
c'est pas conforme ce que dit LACAN .
Et ce n'est galement pas dans ce sens, au sens d'une
certaine lgalit de la dmarche que je me placerai
pour intervenir de nouveau auprs de STEIN.
Je voudrais ce sujet toucher quelque chose qui
parat important parce qu'vident, parce que trs,
trs gros, et en quelque sorte ouvrant un problme
devant tout le monde et auquel est suspendue toute la
porte de mon enseignement.
649
D'abord le fait de ce qu'on pourrait appeler
l'influence de mes formulations, autrement dit ce
qu'on pourrait appeler encore proprement parler le
langage de LACAN. Il est bien vident que, par
exemple, on ne se sert de l'Autre - et surtout quand
on y met pour plus de sret un grand A - que depuis
que je lui ai fait jouer un certain rle. a date un
texte. Avant que j'en parle, il n'y avait jamais de
ce grand Autre nulle part, et mme en dehors de la
psychanalyse. Maintenant, il y en a un peu beaucoup.
Et Dieu sait le rle qu'on lui fait jouer. C'est l-
dessus certainement que j'ai les remarques - de ce
qui est arriv Sartre - les remarques les plus
importantes faire STEIN.
Et puis il y a autre chose, le problme des rapports
entre ce que je dis et ce que je ne dis pas. L c'est
plus complexe. Il est certain que je ne peux pas
quand j'ai commenc faire mon enseignement -
quelles que soient les raisons pour lesquelles j'ai
t amen cette position difficile - il y avait un
fort travail faire pour obtenir un changement
radical de tout : de point de vue, de langage, de
point de vue sur le langage, de langage sur le point
de vue, ce n'tait pas trs, trs commode. J'ai pris
les choses comme elles me semblaient devoir tre
prises, bille en tte si je puis dire, en abordant la
fonction du langage, ou plus exactement le champ du
langage et la fonction de la parole.
Il a fallu que je martle cela un certain temps, pour
pouvoir donner mes auditeurs enfin le temps de
changer les portants de place, de se reprer par
rapport a.
En d'autres termes, il y a un ordre et il y a des
temps. Je suis en train de faire le recueil de mes
crits, comme on le dit. J'cris peu, j'cris peu
il n'en paratra pas environ je ne sais pas,
probablement, le quart restera de ct, alors on a
fait comme a le calibrage chez l'diteur avec le peu
qui reste. Il y en aura dans les six cent cinquante
pages.
650
Ce qui nous pose un petit problme de librairie. A
cette occasion, je me relis, ce que je ne fais pas
souvent, et la vrit, il m'est apparu que mme
dans mes premiers textes, il ne peut y avoir aucune
ambigut concernant l'usage des notions que j'ai
introduites au moment o je les ai introduites. C'est
ce que les gens qui sont - il y en a quelques uns
parmi mes lves qui me disent quelquefois - c'est ce
que les gens dsignent en disant :
cela y tait dj telle poque. Ah! comme c'est
admirable! . Eh bien non, cela n'y tait pas.
a n'y tait pas. Mais a prouve simplement une
certaine rigueur dans l'nonciation et dans l'nonc
qui fait qu'on ne pouvait gure trouver quelque chose
dans le pass sur lequel, dans la suite, j'aie t
oblig de carrment revenir. Les termes ne sont pas
toujours les meilleurs. Je veux dire que par exemple,
l'usage dans les premiers textes que je fais du mot
intersubjectivit est bien celui qui [] le seul que
je pouvais mettre en usage l'poque pour la simple
raison que je n'avais pas encore tabli le jeu
quatre termes qui sont comme je pense que vous vous
en tes aperus, le grand A, le petit a et les deux S
d'autre part - chacun la moiti d'un S - des deux S
barrs [S]. Parler ce moment-l de
l'intersubjectivit en [] ne pas faire fonctionner
a avant que a ne fonctionne. Il n'en reste pas
moins que ds un article qui est peu prs de la
mme date, puisqu'il a t crit huit mois aprs le
discours de Rome
l'article sur Les variantes de la cure-type
197
que j'ai donn la demande de H. EY et d'une
quipe de psychanalystes une Encyclopdie
mdico-chirurgicale
il y a un certain nombre d'noncs, tout fait
clairs, qui font intervenir cette fonction, cette
fonction complexe d'une faon suffisante pour rendre
tout fait impossible je prierai notre cher ami
STEIN de s'y reporter, c'est dans le dbut du second
chapitre : De la voie du psychanalyste son maintien considr dans sa dviation.
197 crits p.323 ou t.1 p.322.
651
Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de faire la
lecture de ce passage, mais je veux simplement le
prier de s'y reporter lui-mme pour me permettre
aujourd'hui de lui dire, lui
pendant qu'il est l et d'une faon dont je ne
pense pas qu'il puisse un seul instant prendre
ombrage
que dans son texte sur la situation analytique, ce
langage, ce discours concernant l'Autre avec un grand
A est proprement parler ce qu'il utilise de la
faon la plus mconnaissable avec le grand A et
l'autre. Eh bien, l'Autre dont je vous parle, l'Autre
au sens o c'est le lieu de l'Autre, c'est l o
vient s'inscrire la fonction de vrit de la parole
et que la relation de a parle au a coute
dont il fait tat dans son premier crit sur la
situation analytique mais directement enfin extraite,
articule, n'est-ce pas, de ce qu'il peut sous un
certain angle entendre de mon discours.
D'ailleurs, en plus, il y a une note qui le
reconnat, il y a une note qui est intercale entre
deux autres, l'une o il fait tat de l'impulsion
qu'il a reue de spculations de GRUNBERGER sur le
narcissisme, n'est-ce pas, et l'autre o il cite trs
abondamment NACHT propos de la prsence
psychanalytique. Il n'est pas question que je vienne
ici prendre un poids prvalant.
Ce que tout le monde peut bien penser - et sait que
je pense - c'est que les positions de GRUNBERGER sur
le narcissisme sont partiales et errones.
Ce dont d'ailleurs vous prenez vos distances, et que
ce qu'a crit NACHT sur la prsence psychanalytique
est simplement impudent, nest-ce pas.
J'en ai fait tat assez abondamment dans mon rapport
sur La direction de la cure, pour qu'il ne soit pas
ncessaire d'y revenir.
L'important n'est pas l. L'important est ceci : est-
ce que comment peut-il se faire que ce qui, en
somme, est extrait des formules qui peuvent tre
pingles, mises entre guillemets dans mon discours
sur le a parle sur le a coute , comment
652
peut-il venir s'adjoindre, fonctionner, servir
peindre
d'une certaine faon, de couleurs qui peuvent de
ce seul fait faire passer pour tre les miennes
quel usage peut-on faire de ce discours pour en
somme le faire rentrer dans une certaine faon de
concevoir la situation analytique qui est absolument
trangre ce discours ?
Je ne suis pas en train de dbattre, si elle est
fonde, si elle est lgitime, ce qui la justifie ou
ce qui l'infirme.
Je mets simplement en question ce problme de
l'utilisation possible de mon langage pour servir
la conception de la situation analytique qui lui est
radicalement contraire. En effet, cela va loin,
n'est-ce pas, et vous y allez vite, partir du a
parle qui est le sujet du a coute qui est
reprsent ici par l'analyste :
a parle et a coute - criviez-vous page 239 -
en la sance
et puis a a l'air de tenir comme a. Sous prtexte
qu'on dit en sance, le en la sance l'air
d'tre un lieu suffisant. Il est bien clair
d'ailleurs que vous ne vous en tenez pas l et que
vous expliquez pourquoi ce moment-l la sance est
quelque chose qui se gonfle aux limites du monde,
proprement parler, comme vous ne manquez pas de
l'crire en y mettant les points sur les i.
La page 240, par exemple, je lis ceci, aprs un bref
rappel de certaines similarits que ferait FREUD de
la sance allant vers lendormissement
ce qui, entre nous, ne permet pas du tout pour
autant, d'aller jusqu'au point o vos collgues
FAIN et DAVID vont, de faire du discours du sujet
dans la sance, quelque chose d'analogue au rve.
Car le rve, l'endormissement et le sommeil ne
sont pas des tats analogues. Mais passons ce
n'est pas sur le fond que je place la chose
653
je veux simplement vous faire remarquer que cet
appareil psychique
qui abolit les limites entre le monde intrieur et le
monde extrieur, aussi bien du ct du patient que du
ct de l'analyste, qui de ce fait, tendent tre fondus
tous deux en un. En terme plus prcis - crivez-vous
toujours - leurs images tendent l'association par
contigut qui caractrise le processus primaire .
Donc vous posez d'abord que les deux sujets, nest-ce
pas, tendent tre fondus tous deux en un, et
partir de l, la contigut qui est en effet une
relation essentielle de signifiant signifiant
devient la contigut entre les signifiants de l'un
et les signifiants chez l'autre.
N'est-ce pas de mme que dans le rve, le monde entier
est l'intrieur du rveur, en cet UN le monde entier
est contenu - et voici votre raison - car on ne
saurait concevoir la fusion de deux tres finis en un seul
tre fini .
Je rpte cette phrase :
On ne saurait concevoir la fusion de deux tres finis en
un seul tre fini .
D'une certaine faon, une phrase comme celle-ci est
bien de nature nous faire dire cette chose qui est
aussi importante souligner de l'usage du
a parle que je n'ai jamais employ en ce sens.
Je veux dire que a parle , c'est un moment
d'interrogation chez moi.
a parle , c'est comme a que a l'air de se
prsenter, mais c'est tout de mme la question, non
pas a parle qui ? qui est la question qui vous
importe, mais la question qui parle? pour moi est
toujours la question que j'ai accentue. En fait,
dans l'analyse, c'est--dire, dans la thorie
analytique, la formule qui viendrait trs
heureusement se substituer au a parle c'est le
654
a dit n'importe quoi - Je parle : dans ce qui est
crit - et a dit n'importe quoi pour une simple
raison, c'est que a se lit en diagonale.
Si a ne se lisait pas en diagonale, enfin je crois
que quelqu'un serait arrt, ce :
Car on ne saurait concevoir la fusion de deux tres finis en
un seul tre fini .
Car rien n'est plus concevable.
Je vais vous dire pourquoi vous, vous ne le concevez
pas ce moment-l : c'est parce que c'est trs
lgitime pour vous. En effet, vous avez commenc par
poser ce processus, cet appareil psychique, qui
abolit les limites entre le monde intrieur et le
monde extrieur, aussi bien du ct du patient que du
ct de l'analyste.
Qu'est-ce que a veut dire? a veut dire que ce
problme de l'intrieur et de l'extrieur est en
effet quelque chose qui est tout fait au premier
plan de votre proccupation.
Et tout ce que j'ai fait cette anne comme effort
pour vous apporter une topologie, c'est pour vous
rendre compte disons d'une forme qui permet de
concevoir justement ces sortes, si on peut dire,
d'anomalies apprhensibles qui sont les ntres
propos de ces problmes de l'intrieur et de
l'extrieur. Seulement, comme c'est la seule chose
qui justifie votre texte cette date, disons comme
pour vous remarquez qu'il y a
un moment quelconque que vous supposez n'tre
pas basalement celui de la situation analytique
il y a quelque faon quivalente entre cet intrieur
et cet extrieur, il en rsulte que vous
pensez
et l, au nom mme de cette espce d'usage
propdeutique : on demande de faire des choses
vous pensez sphre et c'est vrai qu'en un
certain sens, comme je vous l'ai fait remarquer,
simplement propos du cercle, on peut penser
topologiquement la sphre comme enveloppant ce qui
655
est l'extrieur de mme qu'on peut dire, nest-ce
pas
puisqu'il suffit simplement de placer cette
sphre quelque part, dans un quatrime plan
mme si vous placez un cercle sur la sphre, en fait
vous dlimitez deux zones de la sphre qui sont
galement l'intrieur du cercle. Prenez le globe
terrestre, faites un large X , si vous le faites
l'quateur : o est l'extrieur, o est l'intrieur?
Ils sont quivalents, vous avez compris.
STEIN
LACAN
Justement, mon cher, c'est de a qu'il s'agit.
partir du moment o vous pensez les choses ainsi,
il n'y a pas du tout passage, mais quivalence.
Vous posez l'quivalence de ce qui est l'intrieur
et de ce qui est l'extrieur, et c'est pourquoi
partir de l s'il y en a un autre qui est ici, la
mme quivalence tant pose, ces deux tres finis,
en effet, eux ne peuvent se fondre, premirement que
dans une indiffrenciation totale et deuximement qui
implique linfinitude, c'est--dire l'extension au
monde de leur confusion entre eux.
C'est tout au moins ce que vous crivez.
STEIN
Je vous en supplie, non, je pense que ce dont il est
question l dans mon esprit ce n'est pas de
l'quivalence entre l'intrieur et l'extrieur mais
l'unit qui rsulte de l'abolition de la limite, par
consquent, si on voulait faire une figuration de
sphre
LACAN
En d'autres termes ce que nous avons dit, c'est qu'il
ne subsiste aucune limite. je ne vais pas c'est
vous en effet d'en dcider. Cette absence de toute
656
rfrence par consquent, je ne vois pas comment vous
pouvez la faire subsister avec quoi que ce soit,
enfin, qui soit compatible par exemple avec la
poursuite d'un discours.
l'intrieur d'un tout, cette absence totale de
rfrence, n'est-ce pas, c'est un crdit que je vous
fais, de penser qu'il reste encore quelque part une
structure, un appareil.
STEIN
Je le vois bien comme une situation limite qui ne
saurait tre accomplie autrement que dans la mort.
LACAN
Mais, coutez, la science de la situation analytique
telle que vous l'tablissez, n'est-ce pas une
situation que je ne dirai mme pas pragonique car
pragonique elle signifierait quelque chose
postagonique ?
Postagonique, enfin, une situation d'aprs le trpas ?
Vous ne pouvez pas soutenir une chose pareille, nest-
ce pas, nous ne sommes pas en train ici de chercher
faire railler.
Ce que je voudrais, c'est simplement faire remarquer
que l'accent que j'ai mis ds les premiers temps de
mes noncs sur le caractre absolument dterminant
de l'coute de l'analyste
que je n'ai d'ailleurs pour autant nullement
identifi l'Autre dans cette occasion nest-ce
pas ?
a devrait quand mme vous inspirer une certaine
prudence pour utiliser ce registre des rapports du
a parle au a coute dans une voie qui est
trs particulire et que je veux essayer de dfinir.
De quelque faon que vous dfendiez ce que vous venez
de dire, je vais voir si vous admettez ou non ce que
je vais vous donner comme ce qui me semble tre le
repre o se diffrencie essentiellement une certaine
faon de thoriser la situation analytique qui est la
mienne.
657
Il s'agit en fait d'une question trs importante
puisque c'est toute la question du narcissisme
primaire.
Qu'est-ce que le narcissisme primaire?
je n'irai pas par quatre chemins : le narcissisme
primaire au sens o il est usit chez presque tous
les auteurs dans l'analyse est quelque chose devant
quoi je m'arrte et que je ne peux aucunement
admettre sous la forme o c'est articul.
Et maintenant, nous allons essayer de bien prciser
de quoi il s'agit.
L'ide que sous un biais quelconque, quelque moment
que ce soit, le sujet, comme vous venez de le dire,
vous m'en donnez plus alors que je n'en avais mme
sous la main, n'est-ce pas perdre ses limites ? Et
que vous le souteniez ou non avec la terminologie
emprunte mon abord de ce qui se passe dans le
discours, le langage, dans l'intervention de la
parole, ceci n'y change rien.
Le seul fait que vous admettiez que c'est concevable,
que c'est possible, je veux dire que c'est possible
d'une faon qui nous intresse, c'est--dire dans ce
qui est accessible, il ne s'agit pas de savoir si
c'est possible thoriquement, si a nous intresse en
tant qu'analystes, savoir, si en tant qu'analystes
nous avons tenir compte de a, en d'autres termes,
si l'action, si le champ analytique, si la situation
analytique, comme vous dites, est dans une dimension
compatible avec a. Je dis elle est incompatible car
la situation analytique comme telle entre le sujet
parlant et coutant fait intervenir et maintient une
structure qui est tout fait trangre la
possibilit de quelque faon que vous vouliez la
concevoir de cette perte de toute limite.
La situation analytique est une situation extrmement
structure, tout ce que vous pouvez amener comme
tmoignages de ce qui ressemble chez le sujet, ce
que vous appelez expansion narcissique, ce sont des
notations phnomnologiques et qui ne sont nullement
fondes dans quelque rapport que ce soit, articulable
dans le rel, dans ce qui est l dans la situation.
658
Je vais bien appuyer les choses pour bien voir les
choses, que vous conceviez ce dont il s'agit parce
qu'en fin de compte, c'est du sens mme de mon
enseignement l qu'il s'agit.
Il faut tout de mme - dans quel registre ? - cette
espce de retour. quoi ?
Non pas bien sr ce stade antrieur au sujet, nous
ne voyons jamais personne rgresser comme a l'tat
petit enfant mme d'une faon mtaphorique.
Ce qui permet de s'exprimer ainsi, c'est qu'il existe
des techniques, des ascses dans lesquelles le sujet
essaie, effectivement de reprer une remonte qui
n'est pas une remonte
Qui nest pas une remonte dans le champ temporel
du monde qu'il a parcouru, de son pass, mais une
remonte, si l'on peut dire, ce que
j'appellerai un tat indiffrenci de l'tre
et qu'il y a pour a des techniques, il y a une
sorte, une faon d'articuler, de manipuler le rapport
du sujet sa propre conscience pour qu'il ait le
sentiment d'arriver ainsi dpasser quelque chose
des limites du monde. C'est une rgression qui est, -
je ne veux pas bien sr, je ne prtends pas en faire
dans ces quelques mots la thorie - c'est une
rgression qui est une rgression de l'ordre de
l'tre et qui peut esprer ainsi, si tant est que
c'est vis, tre un fondement pour arriver une
position dans l'tre qui soit plus radicale. C'est la
seule chose qui justifie les normits que nous
trouvons dans nos textes sur ce sujet : c'est cette
espce d'existence en cho, de cette technique de
remonter vers, c'est ce qu'on appelle les tats
multiples ou les tats radicaux de l'tre.
Mais ce que nous cherchons, mon cher, quand mme, il
ne faut tout de mme pas oublier que cela n'a
absolument rien foutre avec a. Je l'ai soulign
c'est caractris par des traits tout fait
manifestes, ncessitant premirement d'abord des
choses pour se lancer dans cette sorte d'ascse.
659
Le premier pas exig en quelque sorte au seuil, c'est
une purification du dsir et qu'ensuite a procde
par quoi ?
Par la voie d'une recherche que j'ai aprs tout
articule en son temps, mme si vous n'avez jamais eu
rapprocher ces deux registres.
Je l'ai fait quelque part dans cette causalit psychique
198
sur laquelle j'ai jaspin devant un auditoire ce
moment-l autrement opaque - qui peut l'tre rest
depuis.
Quand l'homme cherchant le vide de la pense
s'avance dans la lueur sans ombres de l'espace
imaginaire, en s'abstenant mme d'attendre ce qui va
en surgir, un miroir sans clat lui montre une
surface o ne se reflte rien . [crits p.188]
C'est moi qui ait crit cela.
Comme illustration de quelque chose qui concernait
proprement parler la limite du stade du miroir.
Certainement pas comme un chemin, comme un sentier
qui fut celui qui appartient notre exprience de
psychanalyste. Il n'a rien faire avec la situation
analytique, c'est l'indication par ici la sortie vers
d'autres techniques. Et il y a beaucoup de choses
dans cette phrase. C'est une de celle, quand je me
relis, dont je me flicite de la rigueur que j'ai su
y mettre, car il n'y a pas un seul de ces mots qui ne
soit utilisable, y compris ce que je n'aurai pas le
temps de faire aujourd'hui : l'ide que vous vous
faites de ce qu'il y a derrire le mot attendre.
Mais laissons!
Nous, ce qui nous intresse c'est trs prcisment le
dsir et nous restons attachs ce point o ce qui
est mis en question, c'est ce qui rsulte du fonc-
tionnement de la prsence de l'enracinement du sujet
dans le dsir et de ce qui en rsulte. Nous pouvons
le faire articuler une structure qui en rend compte
et dont toute difficult quant sa recherche
198 crits p.151
660
consiste prcisment en ceci, que cette structure
qu'on peut articuler thoriquement n'est proprement
parler pas articulable en tant que cela serait le
dsir qui s'avouerait, qui se dirait. S'il n'y avait
que cette diffrence, il y aurait aucune espce de
problme analytique.
Il y a donc une confusion tout fait radicale
faire intervenir comme lment constituant de cette
situation - qui est toujours et de plus en plus
armature de la dcouverte que vous alliez faire - de
faon dont l'incidence chez un sujet qui est en proie
aux consquences de sa position de dsir que sont
pour nous les symptmes des diffrentes formes de
structures subjectives auxquelles nous avons affaire
et qui sont des structures que nous objectivons.
Ce qui nous diffrencie de n'importe quelle autre
objectivation scientifique, c'est que pour
l'objectiver, nous sommes forcs, nous et notre
dsir, de nous mettre dedans. Cela n'en est pas pour
autant une vise inatteignable de pouvoir objectiver
ce qu'il en est du dsir humain en tant que
psychanalyste, c'est--dire en tant que quelqu'un
ayant lui-mme cette exprience du dsir et la
faisant intervenir dans le jeu mme de
l'investigation. Vous voyez quel point nous sommes
loin de quoique ce soit qui se place dans ce champ,
que vous l'appeliez de rgression ou de n'importe
quoi d'autre, d'expansion, qui noie toutes les arti-
culations, qui proprement parler nous fait passer
dans une vise, dans un champ ouvert qui est
absolument tranger celui que nous avons
parcourir.
C'est dans la manipulation, c'est dans la mise en jeu
de ces ressorts du dsir, en tant que nous les
connaissons, que nous obtenons les rsultats
thrapeutiques et pour ce faire nous n'avons pas
absolument besoin de savoir ce que j'en dis.
En d'autres termes, on peut faire des cures
- valables d'ailleurs - avec les ides les plus
aberrantes sur ce dont il s'agit dans l'analyse. Mais
il y a un autre temps qui est celui-ci: c'est que
pour tre psychanalyste, c'est une autre question,
661
tre un psychanalyste c'est faire une psychanalyse en
sachant ce qu'on fait. Il y a en tout cas un temps o
il devient absolument alors indispensable que ce
reprage soit strict, c'est pour faire un
psychanalyste.
Vous voyez les temps : faire une psychanalyse, tre
un psychanalyste ou faire un psychanalyste ce n'est
pas la mme chose. a a des exigences thoriques qui
sont de niveaux diffrents. Il n'en reste pas moins
que cela ne veut pas dire que les thories sont plus
ou moins vraies, selon le niveau, quil y a un niveau
o la rfrence thorique est valable et un autre o
elle n'a aucune importance. Mais faire tat par
exemple de ces sentiments d'expansion narcissique
comme de quelque chose qui aurait un statut
quelconque de rfrence possible, c'est aller tout
fait l'encontre de ce qui doit pour nous, dans
l'opration pratico-thorique, tre notre vise. Ces
sentiments de fusion, d'union et de deux en un, avec
pour consquence que c'est l'espace entier qui s'y
englobe et qui, Dieu sait pourquoi, devient ce
moment-l, ou reste encore tre la sance, c'est
quelque chose dont nous connaissons bien sous la
plume de FREUD la connotation. Dans la lettre
Romain ROLLAND, il parle du sentiment ocanique
199
.
Dieu sait que s'il y a quelque chose qui rpugne la
pense de FREUD, c'est bien toute rfrence qui
donnerait un accent de valeur quelconque quoique ce
soit qui soit prouv dans cet ordre.
Vous me direz, il se rfre une certaine exprience
organique, c'est prcisment l toute la question,
c'est que cette rfrence organique, elle est
hypothtique, elle n'a nullement rentrer en ligne
de compte dans ce qui est proprement parler la
structure de l'exprience. Elle est un pense-bte,
elle est quelque chose qui est l, on peut s'imaginer
qu'il doit y avoir une ancestralit de ce quelque
chose dont nous nous servons maintenant.
199 S. Freud, Correspondance, 1873-1939, Paris, Gallimard, Collection : Connaissance de l'inconscient 1979, lettre du 20.7.1929.
662
Cela n'a strictement du point de vue qui est le
ntre, savoir de ce qui fonctionne, aucun intrt.
Les sentiments d'expansion narcissique et ce qui s'en
suit et tout ce que vous citez comme tant
quelquefois - trs souvent d'ailleurs - le mouvement,
va, ceci est trs remarquable mais rare ,
ajoutez-vous, n'est-ce pas, ou bien c'est rare mais
exemplaire, vous sentez combien les rfrences que
vous donnez pour donner cette subsistance la
situation analytique comme tant cette place, cette
situation, indiffrenciation, qui vous le dites bien
n'est qu'un des ples de la situation analytique.
C'est vrai, c'est vrai, mais mme la placer comme
ple, vous faussez tout ce que vous pouvez ensuite en
dduire. Je veux dire que vous ne pouvez rien en
tirer qui soit valable, considrant, concernant la
fin et le progrs de la situation analytique. Je
regrette d'avoir aujourd'hui trop peu de temps pour
parler, puisque cela s'est tendu selon mon vu
d'ailleurs. Je reviendrai dans la suite sur ce que,
par exemple, peut constituer votre usage absolument
abusif du terme de masochisme, abusif aprs ce que
j'en ai articul aprs le Kant avec Sade
200
.
Vous devez tout de mme savoir que le masochiste ne
peut aucunement tre dfini, ni souffrir, avoir du
plaisir dans la souffrance, ni souffrir pour le
plaisir. On ne peut articuler le masochiste qu'
faire entrer en jeu les quatre termes que j'ai
apports et que la fonction de l'objet(a) en
particulier y est absolument essentielle. Je crois
que l'important de ce que je vous ai apport cette
anne concernant l'objet(a), permet parfaitement de
vous faire concevoir ce qui peut tre repr la
place anciennement rserve au narcissisme primaire.
C'est de voir ce qu'il y a sous le narcissisme, le
narcissisme du stade du miroir, voil le seul
narcissisme primaire.
200 crits p.765 ou t.2 p.263.
663
Le narcissisme secondaire dans mon vocabulaire, pour
reprer les choses, c'est celui qui survient autour
de la crise du surmoi.
Quant ce narcissisme primaire il y a en effet
quelque chose que nous pouvons trouver dessous, c'est
ce que j'appellerai, si vous voulez, juste pour
aujourd'hui, a m'est venu comme a, en prenant mes
notes ce matin, le narcissisme dvoil.
Je peux dire en effet que sous le narcissisme
primaire, il y a dvoiler la fonction de
l'objet(a), mais rien d'autre qui permette de
conjuguer d'aucune faon le narcissisme primaire au
sens o c'est usit couramment dans la thorie
analytique, et l'auto-rotisme du narcissisme
primaire. De mme que ce sentiment ocanique auquel
je me rfrais tout l'heure, tel qu'il est en usage
chez la plupart des auteurs, n'est rien que ce
quelque chose qui reste confus parce qu'il n'y a rien
en tirer et qu'il ne peut s'articuler que de la
faon dont j'ai pos la question la fin de mon
discours de cette anne,
savoir, ce que je vous ai situ du rapport du sujet
la jouissance en tant que c'est ncessairement du
rapport une question pose au lieu de l'Autre
qu'elle peut par lui tre aborde. Qu'il construise,
qu'il fantasme proprement parler quelque chose la
place de cette jouissance qui sur le schma
que je vous ai donn est proprement parler situer
en arrire du sujet par rapport ce qu'il vise,
c'est--dire sa ralisation en ce lieu de l'Autre en
tant qu'elle passe par la chute de cet objet(a), de
ce point de jonction qui est le sien avec l'Autre.
664
Cette anne tous les lments ont t prpars pour
donner topologiquement le sens le plus prcis ce
rapport de S, de petit a et de grand A.
Que tout ceci soit en quelque sorte command par ce
rapport d'aversion du sujet par rapport la
jouissance
qu'il a littralement conqurir par
l'exploitation de tout ce qui l'en dfend, de
tout ce qui l'en spare
c'est ce que vous faites surgir, en effet, un
moment quand vous parlez de cette angoisse tout d'un
coup intolrable qui l'agite devant l'imminence de
ce qui pourrait, dans ce que vous dites, tre la
place de ce que j'exprime concernant la jouissance.
Mais vous ne justifiez en rien, pourquoi le
surgissement de cette angoisse.
S'il l'a comme a dj, baignant dans l'union
universelle, pourquoi l'angoisse surgirait-elle, Bon
Dieu ?
L'angoisse surgit prcisment de ceci, c'est que la
question sur la jouissance ne lui vient que du dsir
de l'Autre et que ce dsir de l'Autre dans certains
tournants est absolument nigmatique parce qu'il
laisse transparatre toute l'nigme de la jouissance
dont il s'agit. J'ai assez articul de choses l-
dessus pour ne mme pas pouvoir aujourd'hui en faire
- si brivement que ce soit - tat.
Vous devez concevoir qu'il y a quelque chose - si
nous voulons arriver un parler efficace, un
discours rigoureux - qui doit absolument mettre
entre parenthse ce mythe de la fusion primitive qui
tait le vritable point d'attraction, centre de
polarisation pour tout ce qui dans la pratique
analytique se prsente comme ayant une valeur
rductive, une valeur de la rgression.
La cristallisation de l'analyse - dans le rapport
seulement enfant-mre, dans la thmatique de la
frustration, dans le registre de la demande son
origine, dans cette espce de rve de paradis
premier retrouver, n'a absolument rien faire
665
avec quoique ce soit ni dans les vises, ni dans
l'origine, ni dans la pratique de l'analyse.
L-dessus, il y a vraiment une limite trancher
d'avec ce qui pourrait conserver encore quoique ce
soit du mirage tel qu'il fut ce titre
d'utilisation dans la psychanalyse et qui n'a
absolument rien faire avec ce que j'enseigne et ce
que j'essaie pour vous de construire.
Bon, il est trs tard, je regrette que tout ceci
puisse prendre une parole, un air si bcl, mais au
moins, vous aurez eu l-dessus quelques affirmations
tranchantes dont vous ferez ce que vous pourrez.
L'anne prochaine donc, avec la logique du fantasme,
nous aborderons des choses qui nous permettront
aussi bien de justifier comment un certain nombre de
constructions peuvent se perptuer dans l'analyse et
les lier une par une, tel ou tel type d'erreur
dans la conduite analytique.
STEIN
J'aurais bien voulu vous rpondre.
LACAN
Rpondez, rpondez, rpondez il a droit rponse.
Oui, oui, oui, qu'il rponde, parce qu'on a toujours
le droit de rpondre.
STEIN
Partiellement mais de manire trs simple.
Or, je dirai premirement que quand vous me faites
en somme le procs que je fais moi-mme
GRUNBERGER. Je vois bien dans la rgression.
Je crois que vous n'en tenez pas compte, vous
m'opposez ce que j'oppose GRUNBERGER rcemment que
le narcissisme est une instance autonome et le moteur
de la cure. Or comme vous le savez en ce n'est pas
mon point de vue.
666
LACAN
a c'est vrai. je n'ai pas dit que ce fut le moteur.
STEIN
Alors pour moi les coordonnes de la situation
analytique sont celles des deux mouvements du
refoulement et de la rgression, disons plutt de la
rgression que du refoulement, la rgression vient en
premier. Qu'est-ce que a veut dire? je m'en rfre
au premier schma de l'appareil de l'me ou de l'ap-
pareil psychique de FREUD, n'est-ce pas.
Je n'entre pas dans le dtail, nous avons ici :
des perspectives venues du monde extrieur, et nous
avons ici des perceptions endo-psychiques, de [] ou
de conscience. Or dans une note, FREUD nous dit,
qu'on comprend o se droule et o se situe cet autre
schma qui est celui du rve, il faut comprendre que
cet appareil peut s'enrouler sur lui-mme, il donne
donc quelque chose comme ceci.
LACAN
Il a fait la bande de MBIUS, dj?
STEIN
Si on fait donc ce mouvement :
667
il est bien entendu que ces deux flches viennent ici
se superposer :
[A]
donc il y a abolition de ces distinctions qui sont
tout fait centrales travers toute la
mtapsychologie freudienne de la distinction entre
les reprsentations endopsychiques et les
reprsentations venues du monde extrieur. Rgression
topique, pour moi, le mouvement de la rgression
topique est celui qui fait l'abolition de la
distinction entre les reprsentations endopsychiques
et les reprsentations extrieures par l'enroulement
de l'appareil. Le mouvement inverse, l'ouverture de
cet appareil est donc correspondant au mouvement du
refoulement pour des raisons que je ne peux rappeler
maintenant. a a t le premier point.
Alors deuxime point, j'en viens maintenant votre
systme topologique. Cette topologie est faite pour
rendre compatible ce que vous quand vous avez fait
a, cela n'a aucunement la consquence que le sujet
devienne infini ou fondu avec qui que ce soit : il
reste ce qu'il est, UN. Alors je vous prie quand mme
de bien vouloir noter une chose, c'est que je n'ai
jamais dit qu'aucun des deux mouvement ne pouvaient
s'accomplir compltement et que tout le jeu tait
dans l'oscillation entre ces deux tendances. Vous
m'attribuez l'ide que cette fermeture, cette
rgression vers le narcissisme primaire puisse
s'accomplir, or je prcise bien qu'il ne saurait tre
question qu'elle s'accomplisse.
668
LACAN
Vous dites qu'elle est constitue par la situation
analytique.
STEIN - Non.
LACAN
Que la sance part de l, savoir coutez, je vais
vous dire un mot qui nous diffrencie, je vois bien
ce que vous pouvez me dire pour vous dfendre,
que vous avez install par rapport a, forcment,
un autre ple. Si vous n'aviez pas mis d'autre ple,
mais il n'y aurait jamais aucune raison qu'ils
sortent de leur ciel bleu. Moi, ce que je vous dis et
qui nous diffrencie, c'est quelque chose qui peut
s'exprimer de la faon suivante : l'Autre n'est en
aucun cas un lieu de flicit.
STEIN
Je ne crois pas qu'il s'agit de me dfendre mais pour
rpondre, donc vous me prtez malgr tout l'ide,
vous en convenez aussi que je n'ai pas prcis que
cette rgression pourrait s'accomplir mais ce que
l'ordonnance mme de la situation analytique, telle
qu'elle est propose par le psychanalyste induit chez
le patient, c'est justement le mythe du paradis perdu
en tant que mythe justement, tout tourne autour de
l. Moi je ne dis pas qu'on atteint le paradis
pendant la sance d'analyse, mais qu'on se sent,
qu'on se sent appel l'atteindre et que le
mouvement d'angoisse vient justement marquer l'arrt
dans cette affaire. L'avantage
LACAN
Je prends l-dessus position. Je suis radicalement
oppos ce que nous puissions considrer comme sain
de faire fonctionner d'aucune faon dans notre
thorie
669
fortiori dans notre pratique
un mythe quelconque de cet ordre.
Ce n'est pas le paradis qui est perdu.
C'est un certain objet.
STEIN
Il est possible que le paradis perdu soit incarn par
ce certain objet. Le paradis perdu, il en est tout de
mme question tout au long de l'auto-analyse de
FREUD, elle tourne autour de cela d'un bout
l'autre. Je continue : l'inconvnient de cet
enroulement, c'est qu'il aboutit quelque chose qui
est informe, qui n'existe pas.
LACAN
Ce n'est pas vrai du tout, c'est tout ce que je vous
enseigne, ma topologie est tellement prcise que vous
ne pouvez pas y faire une coupure sans que cela ait
des consquences absolument mathmatiques.
Vous ne pouvez pas!
STEIN
N'empche que pour le montrer mathmatiquement, il
faut ce que vous avez introduit, il faut cette mitre,
ce cross-cap. Ceci est une manire plus rationnelle
au point de vue mathmatique de reprsenter les
consquences de cela, je crois.
Non, vous tes d'accord?
LACAN
C'est une manire tout fait rigoureuse.
STEIN
Alors que celle-l [ A ] n'est pas rigoureuse!
670
LACAN
Ce n'est pas une raison pour que vous disiez que
c'est la confusion. La confusion dans le schma, peut
tre et encore, il est trs clair ce schma. C'est
une fente.
STEIN
Attendez, maintenant je vais vous poser une question.
Voil donc ces deux sphres. Je crois qu'il n'existe
en mathmatique aucun systme de transformation qui
permette de faire concider leur surface.
LACAN
ces sphres? Oh! mon cher ami Ne vous avancez pas
l-dessus, parce que l-dessus vous n'en savez pas
lourd. la seule condition d'avoir une quatrime
dimension, vous pouvez retourner la sphre comme un
gant sauf si elle est
STEIN
Sans quatrime, si nous avons deux tres comme ceci,
n'est-ce pas, l je vous pose la question, mais je
suppose que sans passer par aucune quatrime
dimension on ne peut superposer leurs deux surfaces.
LACAN
Si je vous ai appris la bouteille de KLEIN cette
anne, c'est parce qu'une bouteille de KLEIN est
exactement faite vous pourriez aussi la reprsenter
comme a, si vous voulez : une sphre avec deux
cross-cap. Une bouteille de KLEIN quivaut a. Je
n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer encore parce
que c'tait videmment un peu difficile, dj de vous
faire comprendre que c'tait la bouteille de KLEIN,
si tant est que j'y suis arriv!
671
STEIN
En somme la particularit de cette reprsentation
dont je vous parlais, c'est qu'elle n'a pas un
intrieur et un extrieur et qu'il n'y a pas de
reprsentations endopsychiques et de reprsentations
externes. Or vous avez dit une fois - et je pense que
vous continuez le dire - que nous devons
considrer, nous reprsenter l'inconscient comme une
surface infiniment plate.
Cette surface, c'est celle-ci, or je crois c'est que,
moi, j'aurais tendance dire que cette surface est
la surface sur laquelle vient s'inscrire tout ce dont
nous pourrons rendre compte concernant les processus
qui se droulent au cours de l'analyse et que vous ne
tenez aucun compte effectivement des [], vous basant
sur le point de vue mathmatique. Ces mathmaticiens
ne s'intressent pas au volume. Or si vous voulez, ce
que je pense est que sur votre surface, pour moi, ce
que vous dites tre l'inconscient, c'est la surface
sur laquelle j'inscris ce que nous pouvons en dire de
l'inconscient mais je crois que l o nous nous
sparons peut-tre ou provisoirement c'est que, moi,
je fais un sort au volume que ces deux tres
dlimitent, or ces deux tres finis dlimitent deux
volumes intrieurs et l'espace extrieur.
LACAN
Oui c'est comme a, c'est bien ce que je disais.
STEIN
Bon! Cet tre n'est pas fini, au sens o il ne
dlimite pas un volume intrieur et un volume
extrieur. Or, ces deux tres finis, il faut d'abord
les transformer, en ceci, pour pouvoir ensuite les
faire concider.
LACAN
C'est tout fait impossible.
672
C. STEIN
C'est impossible ?
LACAN
C'est impossible, il faut transformer l'un l'autre.
Il faut choisir son modle.
STEIN
C'est ce que je dis.
LACAN
Il faut choisir son modle et ce que vous exprimez
l
STEIN
Quand je dis transformation, ce n'est pas une
transformation mathmatique, il s'agit de changer de
systme de rfrence.
LACAN
Tout fait.
STEIN
Or le systme de rfrence qui est celui de
l'aboutissement du refoulement est celui-ci, et le
systme de rfrence de l'aboutissement de la
rgression topique est celui-l. C'est seulement dans
ce systme de rfrence que nous pouvons faire
concider deux tres et nous voyons bien quand dans
leur concidence ils ne sont pas finis. Et dans le
systme de rfrence o ils sont fixs, ils ne
peuvent pas concider et j'opre avec ces deux
systmes de rfrence comme tant les deux ples.
673
Les deux ples de reprsentation entre lesquels se
droule l'opposition entre le mouvement de la
rgression et le mouvement de refoulement qui est...
LACAN
Je ne sais pas si on a bien entendu ce que vous venez
de dire comme je l'ai entendu moi-mme et nous ne
pouvons pas indfiniment prolonger, vous ne pouvez
pas articuler plus clairement que vous conservez
simultanment deux systmes de rfrences
compltement incompatibles l'un avec l'autre.
STEIN
Absolument.
LACAN
Bon. C'est ce que voulais vous faire dire.
STEIN
Et je crois que c'est cette double conservation qui
nous a introduit dans le registre de l'imaginaire.
Table des sances
674
retour 11-05 retour Isabel de Velasco retour 25-05 retour chien retour pot Table des sances
675
676
Extrait de la lettre de PASCAL Fermat du 29 juillet 1654 Table des sances
Au dix-septime sicle un clbre joueur, le Chevalier de Mr, s'est questionn sur les probabilits relies
au jeu : deux joueurs (disons Primus et Secondus) engagent trente-deux pistoles dans un jeu de pile ou
face ; empochera les soixante-quatre pistoles celui d'entre eux qui, le premier, aura obtenu 3 succs,
conscutifs ou non. Ils jouent une premire manche, et Primus gagne ; ils sont ce moment obligs de se
sparer, la partie ne sera jamais termine. Comment partager quitablement lenjeu entre eux ?
Ce problme fut expos PASCAL par le Chevalier de Mr. PASCAL et un de ses contemporains, Pierre
de Fermat, se sont penchs sur ce problme et lui ont apport une solution loin d'tre vidente l'poque.
Le chevalier de Mr se ruinait au jeu de passe-dix , car il supposait que le total des points obtenus en
lanant trois ds quilibrs peut tre douze avec la mme probabilit qu'il peut tre onze. En ralit, si on
joue avec des ds quilibrs, ces probabilits sont respecti-vement de 0,115 741 et 0,125.
du 29 juillet 1654
Lettre de PASCAL Fermat du 29 juillet 1654.
Monsieur ,
L'impatience me prend aussi bien qu' vous et, quoique je sois encore au lit, je ne puis
m'empcher de vous dire que je reus hier au soir, de la part de M. de CARCAVI, votre lettre sur
les partis, que j'admire si fort que je ne puis vous le dire. Je n'ai pas le loisir de m'tendre, mais, en
un mot, vous avez trouv les deux partis des ds et des parties dans la parfaite justesse : j'en suis
tout satisfait, car je ne doute plus maintenant que je ne sois dans la vrit, aprs la rencontre
admirable o je me trouve avec vous.
J'admire bien davantage la mthode des partis que celle des ds : j'avais vu plusieurs personnes
trouver celle des ds, comme M. le chevalier de MER, qui est celui qui m'a propos ces
questions et aussi M. de ROBERVAL : mais M. de MER n'avait jamais pu trouver la juste
valeur des partis ni de biais pour y arriver, de sorte que je me trouvais seul qui eusse connu cette
proportion.
Votre mthode est trs sre et est celle qui m'est la premire venue la pense dans cette
recherche ; mais, parce que la peine des combinaisons est excessive, j'en ai trouv un abrg et
proprement une autre mthode bien plus courte et plus nette, que je voudrais pouvoir vous dire
ici en peu de mots : car je voudrais dsormais vous ouvrir mon cur, s'il se pouvait, tant j'ai de
joie de voir notre rencontre. Je vois bien que la vrit est la mme Toulouse et Paris.
Voici peu prs comme je fais pour savoir la valeur de chacune des parties, quand deux joueurs
jouent, par exemple, en trois parties, et chacun a mis 32 pistoles au jeu.
Posons que le premier en ait deux et l'autre une ; ils jouent maintenant une partie, dont le sort est
tel que, si le premier la gagne, il gagne tout l'argent qui est au jeu, savoir 64 pistoles ; si l'autre la
gagne, ils sont deux parties deux parties, et par consquent, s'ils veulent se sparer, il faut qu'ils
retirent chacun leur mise, savoir chacun 32 pistoles.
Considrez donc, Monsieur, que si le premier gagne, il lui appartient 64 : s'il perd, il lui appartient
32. Donc s'ils veulent ne point hasarder cette partie et se sparer sans la jouer, le premier doit dire
: "Je suis sr d'avoir 32 pistoles, car la perte mme me les donne ; mais pour les 32 autres, peut-
tre je les aurai, peut-tre vous les aurez, le hasard est gal ; partageons donc ces 32 pistoles par la
677
moiti et me donnez, outre cela, mes 32 qui me sont sres". Il aura donc 48 pistoles et l'autre 16.
Posons maintenant que le premier ait deux parties et l'autre point, et ils commencent jouer une
partie. Le sort de cette partie est tel que, si le premier gagne, il tire tout l'argent, 64 pistoles ; si
l'autre la gagne, les voil revenus au cas prcdent auquel le premier aura deux parties et l'autre
une.
Or, nous avons dj montr qu'en ce cas il appartient celui qui a les deux parties, 48 pistoles :
donc, s'ils veulent ne point jouer cette partie, il doit dire ainsi : "Si je la gagne, je gagnerai tout, qui
est 64 ; si je la perds, il m'appartiendra lgitimement 48 : donc donnez-moi les 48 qui me sont
certaines au cas mme que je perde, et partageons les 16 autres par la moiti, puisqu'il y a autant
de hasard que vous les gagniez comme moi". Ainsi il aura 48 et 8, qui sont 56 pistoles.
Posons enfin que le premier n'ait qu'une partie et l'autre point. Vous voyez, Monsieur, que, s'ils
commencent une partie nouvelle, le sort en est tel que, si le premier la gagne, il aura deux parties
point, et partant, par le cas prcdent, il lui appartient 56 ; s'il la perd, ils sont partie partie
donc il lui appartient 32 pistoles. Donc il doit dire : "Si vous voulez ne la pas jouer, donnez-moi
32 pistoles qui me sont sres, et partageons le reste de 56 par la moiti. De 56 tez 32, reste 24 ;
partagez donc 24 par la moiti, prenez en 12, et moi 12, qui, avec 32, font 44
Or, par ce moyen, vous voyez, par les simples soustractions, que pour la premire partie il
appartient sur l'argent de l'autre 12 pistoles, pour la seconde autres 12, et pour la dernire 8.
Or, pour ne plus faire de mystre, puisque vous voyez aussi bien tout dcouvert, et que je n'en
faisais que pour voir si je ne me trompais pas, la valeur (j'entends la valeur sur l'argent de l'autre
seulement) de la dernire partie de deux est double de la dernire partie de trois et quadruple de la
dernire partie de quatre et octuple de la dernire partie de cinq, etc.
Mais la proportion des premires parties n'est pas si aise trouver : elle est donc ainsi, car je ne
veux rien dguiser, et voici le problme dont je faisais tant de cas, comme en effet il me plat fort
:
Etant donn tel nombre de parties qu'on voudra, trouver la valeur de la premire.
Soit le nombre des parties donn, par exemple, 8. Prenez les huit premiers nombres pairs et les
huit premiers nombres impairs, savoir : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, et 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Multipliez les nombres pairs en cette sorte : le premier par le second, le produit par le troi sime,
le produit par le quatrime, le produit par le cinquime, etc. ; multipliez les nombres impairs de la
mme sorte : le premier par le second, le produit par le troisime, etc.
Le dernier produit des pairs est le dnominateur, et le dernier produit des impairs est le
numrateur de la fraction qui exprime la valeur de la premire partie de huit ; c'est--dire que, si
on joue chacun le nombre de pistoles exprim par le produit des pairs, il en appartiendra sur
l'argent de l'autre le nombre exprim par le produit des impairs.
Ce qui se dmontre, mais avec beaucoup de peine, par les combinaisons telles que vous les avez
imagines, et je n'ai pu le dmontrer par cette autre voie que je viens de vous dire, mais seulement
par celle des combinaisons. Et voici les propositions qui y mnent, qui sont proprement des
propositions arithmtiques touchant les combinaisons, dont j'ai d'assez belles proprits.
Si d'un nombre quelconque de lettres, par exemple, de 8 : A, B, C, D, E, F, G, H, voua en prenez
toutes les combinaisons possibles de 4 lettres, et ensuite toutes les combinaisons possibles de 5
lettres, et puis de 6, de 7 et de 8, etc., et qu'ainsi vous preniez toutes les combinaisons possibles
depuis la multitude, qui est la moiti de la toute, jusqu'au tout : je dis que, si vous joignez
ensemble la moiti de la combinaison de 4 avec chaeune des combinaisons suprieures, la somme
sera le nombre tantime de la progression quaternaire commencer par le binaire, qui est la
moiti de la multitude.
Par exemple, et je vous le dirai en latin, car le franais n'y vaut rien :
678
Si quotlibet litterarum, verbi gratia octo : A, B, C, D, E, F, G, H,
sumantur omnes combinationes quaternarii, quinquenarii, senarii, etc., usque ad octona-rium :
dico, si jungas dimidium combinationis quaternarii, nempe 35 (dimidium 70) cum omnibus
combinationibus quinquenarii, nempe 56, plus omnibus combinationibus senarii, nempe 28, plus
omnibus combinationibus septenarii, nempe 8, plus omnibus combinationibus octo-narii, nempe
1, factum esse quartum numerum progressionis quaternarii cujus origo est a : dico quartum
numerum, quia 4 octonarii dimidium est.
Sunt enim numeri progressionis quaternarii cujus origo est 2, isti :
2, 8, 32, 128, 512, etc., Quorum 2 primus est, 8 secundus, 32 tertius, et 128 quartus, cui 128
aequantur :
+ 35 dimidium combinationis 4 litterarum, + 56 combinationis 5 litterarum, + 28 combinationis
6 litterarum, + 8 combinationis 7 litterarum, + 1 combinationis 8 litterarum.
Voil la premire proposition, qui est purement arithmtique ; l'autre regarde la doctrine des
partis et est telle :
Il faut dire auparavant : si on a une partie de 5, par exemple, et qu'ainsi il en manque 4, le jeu sera
infailliblement dcid en 8, qui est double de 4.
La valeur de la premire partie de 5 sur l'argent de l'autre est la fraction qui a pour numrateur la
moiti de la combinaison de 4 sur 8 (je prends 4 parce qu'il est gal au nombre des parties qui
manque, et 8 parce qu'il est double de 4), et pour dnominateur ce mme numrateur, plus toutes
les combinaisons suprieures.
Ainsi, si j'ai une partie de 5, il m'appartient, sur l'argent de mon joueur, 35/128 ; c'est--dire que,
s'il a mis 128 pistoles, j'en prends 35 et je lui laisse le reste, 93.
Or, cette fraction 35/128 est la mme que celle-l :
105
/
384
laquelle est faite par la multiplication
des pairs pour le dnominateur, et la multiplication des impairs pour le numrateur.
Vous verrez bien sans doute tout cela, si vous vous en donnez tant soit peu la peine ; c'est
pourquoi je trouve inutile de vous en entretenir davantage. Je vous envoie nanmoins une de mes
vieilles Tables. Je n'ai pas le loisir de la copier ; je la referai. Vous y verrez comme toujours que la
valeur de la premire partie est gale celle de la seconde, ce qui se trouve aisment par les
combinaisons.
Vous verrez de mme que les nombres de la premire ligne augmentent toujours ; ceux de la
seconde de mme ; ceux de la troisime de mme.
Mais ensuite ceux de la quatrime diminuent ; ceux de la cinquime, etc. Ce qui est trange.
Je n'ai pas le temps de vous envoyer la dmonstration d'une difficult qui tonnait fort M..., car il
a trs bon esprit, mais il n'est pas gomtre (c'est, comme vous savez, un grand dfaut), et mme
il ne comprend pas qu'une ligne mathmatique soit divisible l'infini et croit fort bien entendre
qu'elle est compose de points en nombre fini, et jamais je n'ai pu l'en tirer. Si vous pouviez le
faire, on le rendrait parfait.
Il me disait donc qu'il avait trouv fausset dans les nombres par cette raison :
Si on entreprend de faire un six avec un d, il y a avantage de l'entreprendre en 4, comme de 671
625.
Si on entreprend de faire Sonnez avec deux ds, il y a dsavantage de l'entreprendre en 24.
Et nanmoins 34 est 36, qui est le nombre des faces des deux ds, comme 4 6, qui est le
nombre des faces d'un d.
Voil quel tait son grand scandale, qui lui faisait dire hautement que les propositions n'taient
pas constantes, et que l'arithmtique se dmentait. Mais vous en verrez bien aisment la raison
par les principes o vous tes.
Je mettrai par ordre tout ce que j'en ai fait, quand j'aurai achev des Traits gomtriques o je
travaille il y a dj quelque temps.
J'en ai fait aussi d'arithmtiques, sur le sujet. Table des sances
679
BALTHUS La rue Table des sances
680
Table des sances
S.Freud [1938]
681
Le clivage du moi dans le processus de dfense Table des sances
(Die Ichspaltung in Abwehrvorgang) Manuscrit inachev, dat janvier 1938. [Source Espaces LACAN]
Pour un moment je me trouve dans cette position intressante de ne pas savoir si ce que je veux
communiquer doit tre considr comme connu depuis longtemps et allant de soi, ou comme
tout fait nouveau et dconcertant. Tel est, je crois, plutt le cas.
Il m'est enfin apparu que le moi juvnile de la personne que l'on apprend connatre des dizaines
d'annes plus tard comme patient analytique s'est comport d'une faon bien curieuse dans des
situations dtermines d'instante pression
(a)
. La condition d'un tel comportement peut s'indiquer
d'une manire gnrale et plutt indtermine en disant qu'il se produit sous l'influence d'un
traumatisme psychique. Je prfre choisir un cas particulier nettement circonscrit, qui ne recouvre
certes pas toutes les possibilits de causation. Supposons donc que le moi de l'enfant se trouve au
service d'une puissante revendication pulsionnelle qu'il est accoutum satisfaire, et que
soudainement il est effray par une exprience qui lui enseigne que la continuation de cette
satisfaction aurait pour consquence un danger rel difficilement supportable. Il doit maintenant
se dcider : ou bien reconnatre le danger rel, s'y plier et renoncer la satisfaction pulsionnelle,
ou bien dnier la ralit, se faire croire qu'il n'y a pas motif de craindre, ceci afin de pouvoir
maintenir la satisfaction. C'est donc un conflit entre la revendication de la pulsion et l'objection
faite par la ralit
(b)
. L'enfant cependant ne fait ni l'un ni l'autre, ou plutt il fait simultanment
l'un et l'autre, l'enfant aurait pu se convaincre ce qui revient au mme. Il rpond au conflit par
deux ractions opposes, toutes deux valables et efficaces d'une part, l'aide de mcanismes
dtermins, il dboute la ralit et ne se laisse rien interdire ; d'autre part, dans le mme temps, il
reconnat le danger de la ralit, assume, sous forme d'un symptme morbide, l'angoisse face
cette ralit et cherche ultrieurement s'en garantir. Il faut reconnatre que c'est l une trs
habile solution de la difficult. Les deux parties en litige ont reu leur lot : la pulsion peut
conserver sa satisfaction ; quant la ralit, le respect d lui a t pay. Toutefois, comme on le
sait, seule la mort est pour rien
(c)
. Le succs a t atteint au prix d'une dchirure dans le moi,
dchirure qui ne gurira jamais plus, mais grandira avec le temps. Les deux ractions au conflit,
ractions opposes, se maintiennent comme noyau d'un clivage du moi. L'ensemble du processus
ne nous parat si trange que parce que nous considrons la synthse des processus du moi
comme allant de soi. Mais l, nous avons manifestement tort. Cette fonction synthtique du moi,
qui est d'une si grande importance, a ses conditions particulires et se trouve soumise toute une
srie de perturbations.
Cela ne pourra que nous aider si, dans cet expos schmatique, j'insre les donnes particulires
d'une histoire de malade. Un petit garon, entre trois et quatre ans, a fait connaissance des
organes gnitaux fminins par sduction de la part d'une petite fille plus ge.
Aprs la rupture de ces relations, il prolonge par un onanisme manuel intense la stimulation
sexuelle ainsi reue, mais il est bientt pris sur le fait par son nergique gouvernante et menac de
la castration dont l'excution, comme de coutume, est dvolue au pre. Les conditions de
provocation d'un effroi terrible sont donnes dans ce cas. La menace de castration elle seule ne
produit pas ncessairement beaucoup d'impression, l'enfant refuse d'y croire, il ne parvient pas
facilement reprsenter qu'une sparation d'avec cette partie du corps tant estime soit possible.
A la vue des organes gnitaux fminins l'enfant aurait pu se convaincre d'une telle possibilit,
mais l'enfant n'en avait pas alors tir cette conclusion parce que sa rpugnance l contre tait trop
grande et qu'il n'existait aucun motif qui l'y contraignit. Au contraire, ce qui commenait
poindre comme malaise fut apais par cette explication : ce qui manque l viendra par la suite,
682
cela - le membre - lui poussera plus tard. Ceux qui ont assez observ des petits garons se
rappelleront probablement avoir entendu de telles dclarations la vue des organes gnitaux de la
petite soeur. Mais il en va autrement quand les deux facteurs se sont conjugus. Alors, la menace
rveille le souvenir de la perception tenue pour inoffensive et trouve en elle la confirmation
redoute. Le garon croit maintenant comprendre pourquoi les organes gnitaux de la petite fille
ne montraient pas de pnis et il n'ose plus mettre en doute qu'il puisse arriver la mme chose
ses propres organes gnitaux. Il doit croire dsormais la ralit du danger de castration.
La consquence habituelle, considre comme normale, de l'effroi de castration est alors que le
petit garon cde la menace, soit immdiatement, soit aprs un assez long combat, par une
obissance totale ou du moins partielle - il ne porte plus la main ses organes gnitaux -,
renonant ainsi totalement ou partiellement la satisfaction de la pulsion. Mais nous nous
attendons bien ce que notre patient ait su s'en tirer autrement. Il s'est cr un substitut au pnis
de la femme, en vain cherch (d) : un ftiche. Ainsi a-t-il dni la ralit, mais sauv son propre
pnis. S'il n'a pas d reconnatre que la femme avait perdu son pnis, la menace qui lui a t faite
a perdu de sa crdibilit, et il n'a pas alors eu besoin non plus de craindre pour son pnis, il a pu
poursuivre tranquillement sa masturbation. Cet acte de notre patient nous impressionne en tant
qu'il constitue une faon de se dtourner de la ralit, processus que nous rserverions volontiers
la psychose. Et il n'en diffre pas beaucoup, mais malgr tout, nous voulons suspendre encore
notre jugement, car, une observation plus attentive, nous dcouvrons une diffrence qui n'est
pas sans importance. Le petit garon n'a pas simplement contredit sa perception, hallucin un
pnis l o l'on ne pouvait en voir, il a uniquement procd un dplacement de valeur, transfr
la signification de pnis une autre partie du corps, processus pour lequel - d'une faon que nous
ne pouvons indiquer ici - le mcanisme de la rgression lui est venu en aide. Ce dplacement n'a
certes concern que le corps de la femme ; pour son propre pnis, rien n'a chang. Cette faon,
que l'on serait tent de qualifier de ruse, de traiter la ralit dcide du comportement pratique du
petit garon. Il poursuit sa masturbation comme si elle ne pouvait mettre son pnis en danger,
mais en mme temps il dveloppe, en pleine contradiction, avec son insouciance ou son courage
apparent, un symptme qui tmoigne qu'il reconnat malgr tout ce danger. On l'a menac que le
pre le chtrerait et, aussitt aprs, simultanment la cration du ftiche apparat chez lui une
angoisse intense du chtiment par le pre, angoisse qui l'occupera longtemps et qu'il ne peut
matriser et surcompenser que par la mobilisation totale de sa masculinit. Cette angoisse
l'endroit du pre, elle non plus, ne souffle mot de la castration. Avec le secours de la rgression
une phase orale, elle apparat comme angoisse d'tre dvor par le pre. Il est impossible de ne
pas songer ici un fragment primitif de la mythologie grecque qui rapporte comment que le vieux
pre-dieu Kronos dvore ses enfants et veut aussi dvorer son plus jeune fils Zeus et comment
Zeus, sauv par la ruse de la mre, mascule plus tard le pre.
Mais, pour en revenir notre cas, ajoutons qu'il produisit encore un autre symptme, certes
mineur, qu'il a conserv jusqu' ce jour : une sensibilit anxieuse de ses deux petits orteils devant
un attouchement, comme si, dans tout ce va-et-vient entre le dni et la reconnaissance, c'tait
quand mme la castration qui avait trouv une expression plus distincte...
a) Bedrngnis.
b) La traduction ne peut rendre ici sensibles toutes les rfrencesjuridiques, du texte : il est fait opposition (Einspruch) une
demande considre comme justifie (Anspruch revendication)
c) Nurder Tod ist umsonst Locution proverbiale en allemand.
d) le terme vermissten associe l'ide de simple absence - qui serait connote par le verbe fehlen - une coloration affective de
manque subjectif.
e) Kniffige : rus, avec les marques pjoratives de malhonntet et de mauvaise foi, de petite astuce qui n'en impose pas.
683
Hiatus irrationnalis Table des sances
201
Hraclite ( Fragments )
Choses que coule en vous la sueur ou la sve,
Formes, que vous naissiez de la forge ou du sang,
Votre torrent nest pas plus dense que mon rve
202
,
Et si je ne vous bats dun dsir incessant,
Je traverse votre eau, je tombe vers la grve
O mattire le poids de mon dmon pensant
203
;
Seul il heurte au sol dur sur quoi ltre slve,
Le mal aveugle et sourd, le dieu priv de sens
204
.
Mais, sitt que tout verbe a pri dans ma gorge,
Choses qui jaillissez
205
du sang ou de la forge,
Nature , je me perds au flux dun lment :
Celui qui couve en moi, le mme vous soulve,
Formes que coule en vous la sueur ou la sve,
Cest le feu qui me fait votre immortel amant.
Melancholiae Tibi Bellae
206
. Hardelot. 6 aot 1929
Sign : J. Lacan
201 Le titre de ce pome dans Le Phare de Neuilly et les autres parutions est : Hiatus irrationnalis.
202 Dans Le Phare de Neuilly, la place de la virgule il y a un point virgule.
203 Dans Le Phare de Neuilly, la place du point virgule, il y a un point.
204 Ce vers est omis dans la version Magazine Littraire, ce qui nen fait plus un sonnet. Dans Le Phare de Neuilly, larticle le est
remplac les deux fois par au.
205 Les versions Le Phare de Neuilly et le Magazine Littraire indiquent que vous naissiez au lieu de qui jaillissez .
206 Seule la version manuscrite F. Alqui comporte cette mention. Les autres indiquent H.P., aot 1929, Jacques Lacan .
Table des sances
Vous aimerez peut-être aussi
- Jacques Lacan L'etourditDocument30 pagesJacques Lacan L'etourditTacteon100% (3)
- Jacques Lacan Autres EcritsDocument616 pagesJacques Lacan Autres Ecritsmancol100% (1)
- RADIOPHONIEDocument33 pagesRADIOPHONIEmariosadePas encore d'évaluation
- La Tradition Pythagoricienne - André CharpentierDocument239 pagesLa Tradition Pythagoricienne - André CharpentierGuillaume DenomPas encore d'évaluation
- Guénon René - Le Symbolisme de La Croix PDFDocument103 pagesGuénon René - Le Symbolisme de La Croix PDFBelhamissi100% (2)
- Giorgio Agamben, Joël Gayraud Lusage Des Corps Homo Sacer, IV, 2Document395 pagesGiorgio Agamben, Joël Gayraud Lusage Des Corps Homo Sacer, IV, 2John O'sheaPas encore d'évaluation
- S15 L'acteDocument357 pagesS15 L'acteGianfranco Cattaneo RodriguezPas encore d'évaluation
- Sous, Jean Louis - L'equivoque-Interpretative PDFDocument158 pagesSous, Jean Louis - L'equivoque-Interpretative PDFGianfranco Cattaneo RodriguezPas encore d'évaluation
- D. Lefebvre - Ils L Ont Découronné - Du Libéralisme À L Apostasie, La Tragédie ConciliaireDocument176 pagesD. Lefebvre - Ils L Ont Découronné - Du Libéralisme À L Apostasie, La Tragédie ConciliaireTradição Católica no BrasilPas encore d'évaluation
- Canevas de Production ÉcriteDocument2 pagesCanevas de Production ÉcriteaminemustaphaPas encore d'évaluation
- Lexique de PhenomenologieDocument22 pagesLexique de PhenomenologieYann MangournyPas encore d'évaluation
- Langage, Langue Et ParoleDocument8 pagesLangage, Langue Et ParoleludusludusPas encore d'évaluation
- Analyse de Discours IntegDocument20 pagesAnalyse de Discours Integbasma sounniPas encore d'évaluation
- Seminaire Doctoral de Renforcement Des Capacites MethodologiquesDocument74 pagesSeminaire Doctoral de Renforcement Des Capacites MethodologiquesHermesPas encore d'évaluation
- Instrumenter La Lecture Critique Multimédia (Thomas Bottini, 2010, Thèse)Document369 pagesInstrumenter La Lecture Critique Multimédia (Thomas Bottini, 2010, Thèse)Thomas Amleth BottiniPas encore d'évaluation
- Claude Payan - L'harmonie Du CoupleDocument7 pagesClaude Payan - L'harmonie Du CoupleLudovic Bourgeois100% (3)
- Paradoxe Sur Le GraphisteDocument21 pagesParadoxe Sur Le GraphisteChef PelletPas encore d'évaluation
- MANIGLIER, Patrice. de Mauss À Claude Lévi-Strauss Cinquante Ans Après. Pour Une Ontologie MaoriDocument15 pagesMANIGLIER, Patrice. de Mauss À Claude Lévi-Strauss Cinquante Ans Après. Pour Une Ontologie MaoriSonia LourençoPas encore d'évaluation
- Institutions Et Evolution Politiques de KASAR MARADI PDFDocument257 pagesInstitutions Et Evolution Politiques de KASAR MARADI PDFCentre d'Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale (CELHTO)100% (3)
- Fascicule Philosophie TleDocument71 pagesFascicule Philosophie Tlejb863259Pas encore d'évaluation
- Spe Humanites Litterature Philo 2022 Centres Etranger 2 Corrige OfficielDocument9 pagesSpe Humanites Litterature Philo 2022 Centres Etranger 2 Corrige OfficielSALOUPas encore d'évaluation
- Charles Lancelin Les Cinq Dernieres Vies AnterieuresDocument96 pagesCharles Lancelin Les Cinq Dernieres Vies AnterieuresFranck GfPlow100% (2)
- L'énaction Comme Expérience VécueDocument8 pagesL'énaction Comme Expérience VécueDavid Alcantara MirandaPas encore d'évaluation
- Dissertation PhiloDocument6 pagesDissertation PhiloEdwina SekkoPas encore d'évaluation
- Cours Capes Notions 1 (Cohen-Halimi) - Seances 1 A 6 (Notes Marouan)Document44 pagesCours Capes Notions 1 (Cohen-Halimi) - Seances 1 A 6 (Notes Marouan)fezkfhaefcqjsPas encore d'évaluation
- Penser MangerDocument447 pagesPenser MangerShengyun Violet WangPas encore d'évaluation
- Joseph Moreau - Approche de Hegel-2Document37 pagesJoseph Moreau - Approche de Hegel-2duckbanny100% (1)
- Méthode DissertationDocument3 pagesMéthode Dissertation2pmmjqc7qcPas encore d'évaluation
- L'idéalism Est-Il Spiritualiste?Document20 pagesL'idéalism Est-Il Spiritualiste?dhaPas encore d'évaluation
- Perreau - 2019 - Bourdieu Et La PhénoménologieDocument300 pagesPerreau - 2019 - Bourdieu Et La PhénoménologieDino MurthyPas encore d'évaluation
- 1970 LECOURT, Dominique. Sur L'archeologie Du SavoirDocument24 pages1970 LECOURT, Dominique. Sur L'archeologie Du SavoirJefferson VossPas encore d'évaluation
- Rapport 2016Document96 pagesRapport 2016ijoihjPas encore d'évaluation
- Jean-Luc Nancy, L'Autre Portrait 2014Document125 pagesJean-Luc Nancy, L'Autre Portrait 2014IleanaPradillaCeron100% (2)