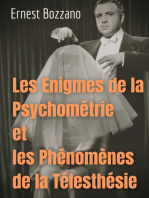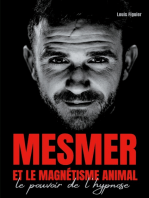Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Steiner - Un Chemin Vers La Connaissance de Soi
Steiner - Un Chemin Vers La Connaissance de Soi
Transféré par
KaDesignCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Steiner - Un Chemin Vers La Connaissance de Soi
Steiner - Un Chemin Vers La Connaissance de Soi
Transféré par
KaDesignDroits d'auteur :
Formats disponibles
Steiner, Rudolf (1861-1925). Un chemin vers la connaissance de soi : huit mditations. 1925.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet 1978 :
*La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
labors ou de fourniture de service.
Cliquer ici pour accder aux tarifs et la licence
2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation particulier. Il s'agit :
*des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss sauf dans le cadre de la copie prive sans
l'autorisation pralable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservs dans les bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signals par la mention Source Gallica.BnF.fr / Bibliothque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de rutilisation.
4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du code la proprit intellectuelle.
5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue par un autre pays, il appartient chaque utilisateur
de vrifier la conformit de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en matire de proprit intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition, contacter reutilisation@bnf.fr.
~t I~f AtCC'A' M~W~
CONNAISSANCE
-)P~
C
Qfi-'t-
'1:
DE-
s '1'
j,,
J L~' Et-,
0
SN CHEMIN
VERS LA
M
't~r~~t c*
"~Rt~~LF~
~~J G~
.TSt
j&i-
.j~
t-<y..f~y< -<"t;t-J .ttK,<,
UN
CHEMIN
VERS
LA
CONNAISSANCE
If~
PRESSES
L~r~J ~
MPMA~
4%.
bM!~S~M~49
RUDOLF
STEINER
PE SOf
HUIT
MDtTATTONS
Traduit
de
ItHemMd
par
ELiSA
PROZOR
DTONS
ALCE
SAUERWEN
D~poMtMre
ganJ
PAMS
!925
7cM<~o<~f~Mn~
INTRODUCTION
(
Le but
que
nous nous
proposons
dans cet
ouvrage
es~
de
communiquer
au lecteur certaines connaissances
ocohes
concernant t'Etre Humain. La forme
que
nous avoaa
adopte
lui
permettra
de
participer personneMemen~ ~j~
lecture,
au
point qu'eUe
lui devienne une sorte
d'entiMt!~
avec tui~mme. Cet entretien
peut
entraner
pour
M !a
mise au
jour
de certaines forces
qui
taient
jusq~~b)~
demeures caches en
lui,
mais
qui
sont
susc~t!
d'tre v~Mes en chacun de nous. La lecture de
e~
dterminera,
en ce
cas,
un travail de !'&me sur
eBe~~&
Et ce travaU
pourra
donner tieu un
vntabk~thjn~
de
t'me,
qui
amenda !e
!ecteur
ta vision
reHe du ttJ )~
s~ntueL
Voi!
pourquoi
nous avons donn
cet e~M)~
ta forme de mditations L'me
peut
se
v~
mditations
!eur
objet
se
communiquera
dte
t lM~~
son recueiMement.
L-S
Nous nous
adressons,
d'une
part,
aux peMMMtj)~
familiarises avec notre littrature et avec te
~M~
<upfa-<enslbte
que
nous
prconisons.
Ceu~
qui
connaissent
h vie
suprarsensible
accorderont
peut-tre
quelque
valeur
t
cet ouvrage
causeducaractre
particulierqu'il
revt
et MMMcausedu
rapport
d!rect
qui
tereliecertaines
expriences
de t'me. D'autre
part,
cettemanirede
prsenter
les
choses
pourraparatre
utileceux
qui
sont
encore
trangers
aux donnesde lascience
spirituelle.
Le
prsentouvragecomplte
ettendmesautrescrits
rehtHs au
domaine
spirituel.
Toutefois,
il
peut
trelu
$paMnMnt<
DeMmeslivres
FA~MopAtc
et La science
occulte,
je
me
<umeCorc
d'exposer
tesfaitstels
qu'ils
se
prsentent
a
teber~teur des
raHts.spIntuettes.
Aussirevtent-Itsune
~nne dMcnptIve.
et leur
ptanm'avalt-lt
t
Impospar
le
!~
mnMdulivre.
~h
c&em&< <~Mla~o~noMMnce J e~Mest
conu
dans
W~tonne
diffrente: 0-ici sont
exposes
les
exp~ences
Mien~ent uneme
engage
d'unecertainemanire
MT
h
we
de
t'Espnt.
Celivre
peut
donctreconsi~
jttp
CMnmelerdt de ces
expriences.
Il nefaut
pas,
perdre
devue
que
ces
expriences
doivent
-~i' chaque
meuneformeindividuelleconforme
jt~ B<
Nousnoussommesefforcsde
prendre
ce
ttk <n
eoMMiratKm,
ensorte
qu'onpeutImaginer
aussi
qw~noua
dcrivonsles
expriences
d'uneme
particulire.
tC~Mtpourquoi
cetouvrageest
intitul Unctonhvenla
A
M.)
Et c'est
prcisment
lce
qui permet
Aot1912. RUDOLF STENER.
d'autresmesd'en
pntrer
lacontenuet d'atteindre
desrsultatssemblables. Dece
fait,
cet
ouvragecomptte
et tend
galement
monlivrel'Initiation..
Nousne
rapportons
ici
que
certaines
expriences
occultes
fondamentales. Nous
renonons,jusqu'
nouvel
ordre/
descommunications demmenatureconcernantd'autres'
domainesdeta
science
spirituelle
.
PREMIERE
MEDITATION
M&MTANT ESSAYE DE SE FORMER UNE REPRSENTATION
EXACTE DU CORPS
PHYSIQUE.
S nous rnchssons
profondment
sur ce
qui
se
passe
~hna notre me, quand, par
l'Intermdiaire des sens et de
i'Mtendement,
elle se consacre aux
phnomnes
du monde
1!)~~
nous ne
pouvons pas
dire
qu'elle peroive
ces
-thfnMnnes
ou
qu'elle
connaisse les
objets qui
l'entourent.
en vrit,
elle
s'ignore
entirement eMe-mme aces
maMenh-I. La lumire du soleil
qui rayonne
dans
l'espace
~t q~e ks objets
rnchissent en mille
couteurs.se ressente
dl~m~me
dans notre me. L'me se
rjouit-elle
~Rine
Acte,
elle
.~t,
durant sa
jouissance, joie eHe"mme~
~~t~M~ h
mesure o etie a conscience du
phnomne.
La
SS~~S~~ ~it
en elle. Une fusion
s'opre
entre !'&me et son
~t~M<!<~ du
monde.
EUe ne se connat
pas
comme un
S~~j~ te rjouit,
qui admire,
qui
se
divertit,
ou
qui
crainte
~th~~ dt~mtme
joie, admiration, ptaisir
ou crainte.
~Be~en
rendait
toujours compte,
elle reconnatrait
~)~tB~!eur
valeur aux moments o elle se dtourne
du
?~t!~)M!~ pour
se considrer eMe-meme. Elle dcouvrirait
danscesinstantsunevied'un
genre
s!
particulier, que
Fon
nesauraitde
prime
abordla
comparer
l'existenceord!"
naire.C'est
lorsque
nous
pntrons
danscettevie
que
se
rveillent,
dansnotre
conscience,
tes
nigmes
de
l'existence;
nigmesqui sont,
en
somme,
lasourcedetouslesautres
problmes
del'univers.Lemondeextrieuret lemonde
intrieursedressentdevant
l'esprit
humain
lorsque,pour
un
tempsplus
oumoins
long,
il s'isoledu mondeexte"
rieuretseretire
dans
lasolitudedesonexistence
person~
nette.
Ceretraitn'est
point
un
phnomnesimplequi,
unefois
accompli,pourrait
tre
reproduit
volont.C'est
bien
plutt
lecorr.-nencement d'un
voyage
versdes mondes
jusqu'alors
inconnus.
Lorsqu'onentreprend
ce
voyage,
chaquepasque
l'onfaitenentraned'autresetenm<hne
temps
les
prpare,
carseulil rend!'me
capable
deles<M~
Il
complir.
Et
chaquepas
nousdaire
davantage
surla
que~
tion
Qu'est-ceque
l'hommeauvraisensdumot? De~
mondess'ouvrent
qui
restentferms
l'observationOM~
nairede la vieet
qui, cependant,peuvent
seulsno<m
dcouvrirlavritconcernantlavieordinaire
etk"m<m~
Sil fautadmettre
que
notre
question
ne
comportepoint
d~
rponseintgrale
et
dfinitive,
celles
que
nous
obtenez
r
au
coursdenotre
plerinage
intrieursont
cet~endant
dk
nahtre
surpasser
toutesles
connaissances
que
les
sec~
eiXtrieurs etl'entendement
qui s'y
rattache
peuvent
nou~
apporter.
Et notremea besoindeces
rponses,
tout~
M
~fkxion
approfondie
sur nous-mmenousen
convainct.
Ce
voyage
intrieurdoitdbuter
par
certainesrflexions
sobres,
froides.Ellesseules
peuvent
fournirun
point
de
dpart
fermela
pntration
ultrieuredansles
rgions
supra-sensibles,
but final de l'me. Biendes
personnes
voudraientviter cette
prparation
et entrer d'emble
dans t'au-det.Maistout tre
sain,
quand
bienmme
une
rpulsionpremire
l'gard
derflexionsdecetordre
t'enauraitd'abord
dtourn,
y
reviendrattoutard.
Car,
quelque
nombreuses
quepuissent
trelesconnaissances
acquisespar
d'autres
voies,
seuleunemthodede
raisonne-
menttelle
que
nousallonsladcrireoffreunterrainsolide
nosrecherches.
Il
peut
survenirdanslaviedel'meunmomentoelle
sedit
Il faut
queje
sachemesoustrairetoutesles
impressionsque
m'offrelemonde
extrieur,
si
je
neveux
pa$
mevoir
contrainteunaveu
d'impuissancequi
me
rendraitlavie
impossible
etmedire
queje
nesuis
qu'un
contre-sensvivant.Tout ce
quejeperois
endehorsde
moi existesans
moi,
existaitsans
moi,
existerasansmoi.
Pourquoi
lescouleurssont-elles
ressentiesen
moi,
ators
que
mes sensations
pourraient
n'tre d'aucune
Importance
Pour
et!es?
Pourquoi
lessubstancesetlesforces- dumonde
4d!6ent~ettes mon
corps?
Il s animeetdevientmon
appa"
renceextrieure.
J e
reconnais
quej'ai
besoindece
corps.
CarM
je
ne
possdaispastes
sens
que
seulit
peut
me
pro-
~urer,je
serais
dpourvue
detoutevieintrieure.Sans
!<
mon
corpsje
serais,
comme
l'origine,vide
detoutcontenu.
C'estmon
corpsqui
medonneune
capacit
etunerichesse
intrieures.
1
Surviennentalorstouteslesrflexions
auxquelles
nul
n'chappe,
sans
risquer
desetrouverun
jour
avecsoi..
mme dans une contradiction
insupportable.
Notre
corps,
du fait mme
qu'il
est
vivant,
est
aujourd'hui
l'expression
delaviedenotreme.C'est
grce
aufonc~
tionnementdeses
organesque
ntreme
s'exprime,
c'est
enlui
qu'elle
manifestesavie. Il n'ensera
pastoujours
-ainsi.Leslmentsconstitutifsdu
corps
seront
rgis
un
jourpar
desloistoutesdiffrentesdeceMes
auxquelles
ils
obissent
aujourd'hui,
o notre
corps
existe
pour nous,
pour
notrevie
psychique.
tt seradterminalors
par
la
lois
quigouvernent
lessubstancesetlesforcesdela
nature,
lois
qui
n'ont riendecommunavec
nous,
avecnotrevie
personnette.
Le
corps, auquel
noussommesredevables
de
notrevie
intrieure,
sera
reprispar
lecourant
universel
dans
lequel
il
perdra
tout
rapport
avecnossentiments
Ceraisonnement
peut
susciterdansnotrevieintrieure
touteslestranses
que
faitnatrela
pense
dela
mort,
sans
ques'y
mtentlesmotions
personnellesqui
lesaccom"
pagnent
d'ordinaire,
et
qui
nuisent la
pondration,
Alasrnitncessaires toutemditation
ayantpour
but
h connaiMance.
nn'est
point
tonnant
que
l'hommedsire
comprendre
ta mortetsavoirsi l'me
possde
unevie
indpendante
de
M
cdtedu
corpsqui
se
dsagrge.
Maissa
position
entace
deces
questions
est
propre,plusque
touteautrechoseau
monde,
troublersavision
objective
etlui faire
accepter
des
rponsesque
sondsirseula
Inspires.
Or,
on.nesaurait
acqurir
deconnaissance
vritablesur
quelquequestion
que
cesoitdudomaine
spirituel,
si onn'est
pasprt
accueilliravecune
parfaitegalit
toute
rponse,qu'elle
soitaffirmativeou
ngative.
Et il suffitde
s'Interroger
avecconscience
pour
se
persuaderqu'on n'accepterait
pas
aveclemmecalmelacertitudedel'extinctiondela
viedel'me
aprs
la mortou celledesasurvie.
Certes,
il
ya
des
personnesqui
croientsincrement
que
ladsin"
~gration
du
corps
entranel'anantissement de
l'meet
qui adaptent
leurviecette
pense.
Il n'enest
pas
moins
vrai qu'aupoint
devuedu
sentiment,
ellesnesontnulte"
ment
impartiales.
Sans
doute,
ellesne se laissent
pas
dominer
par
lesterreursdel'anantissement et eMesne
permettentpas
audsirde
survivred'tounerenelles
ta
vo!xdelaconnaissance. En
cela,leur
esprit
est souvent
doud'une
plusgrandeobjectivitque
celuides
personnes
qui
seleurrentinconsciemment deraisonsalatoiresde
CMure
t'immortatit,
alors
qu'au
fond ellesne sont
guidesquepar
tasoifde
survivre,
qui
consumesecrte
mentleurme.
Cependant
la
prvention
n'est
pas
mo!M
gmndediez
celles
qui
nientl'immortalit. Elleestseut~
mentd'uneautrenature.
Ces
personnes
sef ontune
conception
dnniedece
que
u
signiCe
la
vie,
l'existence.Leur d&utlon
implique
forcmentcertaines
conditions,
conditions
qui
cessent
d'ester
quand
le
corpsdisparait.
Dece
fait,
ellesconcluent
l'extinctionsimtdtanedelaviede
l'me,
etne
s'aper~
oiventpasqu'elles
ontd'abordcrunedfinitiondela
vie
qui
excluait,
priori,
toute
reprsentation
d'uneeaM-'
tence
Indpendante
decelledu
corps
et,
parconsquent,
d'unesurviedel'me.Ces
personnes
neselaissent
pu
influencer
par
leur
sentiment,
maisbien
par
des
ides
dontellessont
incapables
dese
dgager.
Il
existe
encofe
biend'autres
prventions
dansce
domaine;
nousne
pouvons
les
envisager
toutes.
L'ldeque!ecorps,donttesfonctlonsserventtmamtester
laviede
Fam,
seraun
jourlaproie
dumondeextrieur wt
quil
obirades
lois
qui
neconcernent ennonlavie
w
intrieure,
cetteide
voque
devantnousle
phnomne
de la
mort,
sans
qu'il
soit ncessaire
qu'aucunjdsBT,
qu'aucun
Intrt
personnel
semlentnos
considration.
'c.
Nousnetarderons
pas
alors
prouverque
la
pense
delamortn'a
pasd'importance
en
soi,
mais
qu'elleep
<
`
v
acquiert
dutait
qu'elle
clairelavie.
Un
point
devuenouveausefera
jour
l'nigme
de
vienetrouverait-elle pu
sasolution
tbM~sl~cc~rqMrh~wMMMM~
duphnom~e~de
lamortetdesonessence?
0
L'medoitsem6erdudsirdesurvivre
qui
lui est
inhrent,
et des
opinionsque
ce
dsirpeut
lui
iAspi~
concernant la
mort.Pourquoi,en e~et,
lesralitsdumond~
14
Mtaisseralent-ettes
influencer
par
lesmotionsde
!'me?
Celle-ci,
lorsqu'elle
n'coute
que
ses
dsirs,
ne trouve
plus
aucunsenssa
propre
existencesi onla
persuadeque,
pareille
uneflamme
jaillissant
d'un
corps
en
combustion,
ellene
surgit
dessubstancesdeson
corpsquepour
s'-
teindrenouveau.Il se
pourrait,cependant,
que
ceft
vrai,
bien
qu'absurde
en
apparence.
Lorsque
t'mesetourneversla
considrationdu
corps,
elledoitsavoirsebornerauxdonnes
qu'il
lui
prsente.Or,
Hsemble
qu'il
existedans la nature
certaineslois
qui
dterminentles ractionsdessubstanceset desforces
!e<unessurles
autres,
que
ceslois
gouvernent
galement
le
corps
et
qu'elles
le
rintgrentaprs
uncertain
laps
de
temps
danslecircuituniversel delavie.
Considrezcette
pense
soustousses
aspects,
elle
peut
avoirsonutilit
pour
lessciences
naturelles,
maisenface
delaralitelle
apparat
tout fait
insoutenable. Peut-
trevousdirez-vous
que,
seule,
elle
possde
unevidence
scientifique,objective
et
que
toute autreIdeneserait
quecroyancesubjective.
Vous
pouvez
vous
imaginer
cela.
Maisun
jugementimpartial
dtruirace
point
de
vue,
et
c'estlaseulechose
qui compte.
Il
n'Importepas
ici
que
lanature
particulire
denotre
me
impose
certainesncessits notre
pense
seulssont
considrerles
phnomnesque
nous
prsente
le
monde
extrieur
auquel
sont
empruntes
les
substanceset
les
forcesdenotre
corps,
et dans
lequel
ellesse.
dissolvent
aprs
lamort.Cessubstanceset cesforces
obissentalors
deslois
qui
restent
parfaitement
Indiffrentes tout
ce
qui
se
passe
dans
le
corps
humaindurantla
vie.Ceslois
(qui
sontdenature
physico-chimique)
s'exercentsur le
corps
delammemanire
que
surtoutautre
objet
Inanimdela
nature.Onest
oblige
de
penserque
cette
Indiffrence du
monde
l'gard
du
corps
humain,
loin
de commencer
torsdela
mort,
existe
aussidurantlavie.
J amais
laviene
nous
apprendra
le
rapport
exact
qui
relielemondesensible
au
corps
humain
seuleslesrflexionssuivantes
pourront
nousinstruirece
sujet
Mon
corps,qui
estle
support
demes
sens,
lemdia.
leurdes
phnomnesparlesquels
semanifestemon
me~
subitl'actiondumondeextrieur.
J e
connaiscetteaction
lorsqueje
considrece
qui
se
passeaprs
lamort.
J e
sais
qu'untemps
viendrao
je
ne
possderaiplus
unseul
des
moyensd'expression
dont
je dispose
actuellement.
Touteautre
conception
concernantles
rapports
dumonde
sensibleavecle
corps,
estrfute
par
lesfaits.Par
contre,
ta
propositionque
nousvenonsd'noncern'entreenconflit
avecaucunedes
expriencesque
nous
pouvonsfaire,
tantdanslemondeextrieur
que
dansceluidenotreAme.
Nousne
trouvons,
en
effet,
riend'Intolrablela
pense
que
lessubstanceset lesforces
qui
nous
appartiennent
teront le
sige
decertains
phnomnesqui
n'ont
non de
communavecnotre
propre
existence.L'homme
qui
se
Kvreentoute
Impartialit
la
vie,ne
sentmonterdufond
16
dehMnmeaucundsir
provenant
deson
corps
et
qui
luirendrait
pnible
la
pense
dela
dsagrgation
decetul~
aprs
lamort.Cette
perspective
nelui deviendrait Info-
i~bteque
s'HluiMaltse
reprsenter que
les
forcesettes
substances
qui
retournent la natureentranentavec
ettessontrevivantet sentant.Et cette
pense
lui est
intolrableaummetitre
que
touteautre
conceptionqui
nedcoule
pas
naturellement del'observationfidtedu
mondeet deses
phnomnes.
Sonabsurditmmela
feraconstamment rebondircontrelaralit.Par
contre,
Hded'une
participationtoujoursidentique
dumonde
laviedu
corps
nous
apparatpleine
de
sens
;ent'adop~
tant.nous
noussentonsenharmonie
parfaite
avecles
faits,
que
nouslaissonsse rvler librement
nous,
sans
hwr
imposer
nos
conceptions
artHideltes.
Onne
prtepastoujours
assezd'attentionlabelle
harmonie
qui rgne
entrelesentiment
sain,
naturelde
t~ameetla rvlationsde la nature.
Cependant, quel..
que
videnteet
insignifiante qu'ellepuisseparatre~
cette
remarque
claire
beaucoup
la
questionqui
nous
occupe.
L'hommeabiendesraisons
personnettes pour
ne
pas
admettre
que
l'mese
dsagrge
enmme
tempsque
le
corps;
cesraisonsdoiventtrecartes
par
t'observation
Impartiale
et
objective.
Maiscette~dnous
oblige
recon"
natre
que
lemonde
n'a,
danslaviede
Fam,
d'autre
jr6te
que
celui
que
nouslui reconnaissons
aprs
lamort.La
vateurdecette
pense
est dmontre
par
la
ncess!t
2
mmeavec
laquelle
elle
s'Impose
nouset
par
le fait
qu'elle
rsistetoute
objection
donton
pourrait
laofottPe
susceptible. Or,
en
ralit,
ceux
qui
croienttTmmotatItt
commeceux
qui
la nient
pensent
ainsi. Ces denaeM
diront
peut-treque
les lois
qui gouvernent
le
corpa
aprs
la mort dterminent
galement
les
phnomne
propresl'organisme
vivant.Maisilsse
trompent
$Tk
croient
pouvoirs'Imaginer que
cesloiss'exerceraient autf~*
mentsur le
corpslorsqu'il
estle
mdiateur
det'me
que
lorsqu'il
acessdel'tre.
Uneseuleideest
possible
en
soi,
c'est
que
le
comptera
particulier
deforces
qui
semanifesteavecle
corps
ext
aussiIndiffrentsonrlede
support
det'me
que
l'est
cetautre
complexus
deforces
parlequel
le
corps
sedM~
grge.
Cetteindiffrencen'est
pas
lefait de
t'me,
ette
estbien
plutt
lefaitdessubstanceset desforcesdu
corpa.
C'est
par
le
corpsque
t'mesesent
vivre,
maisle
oorpa, M~
vit aveclemonde
extrieur,
en
lui,
par
lui,
etlaTM~h
i'menele dtermine
pasplusque
les
phnomnes
<h~
mondeextrieur. On
esttenud'admettre
quetadrcuMo~
du
sang
dansle
corps
estInSuence
par
lefroidet
par
h
chaleurdu
dehors,
autant
quepar
la
peur
ou
par
la
hont~
qui
ontleur
sige
dansl'ime.
Nousreconnaissonsdoncl'action
que
les loisde h
natureexercentsurnousdansle
rapport
tout
particute~
qui
s'tablitentreelleset
nous,
et
qui s'exprimepair
h
formationdu
corps
humain.Noussentons
que
le
coo~
?
fait
partie
du monde
extrieur,
maisnous
ignorons
ses
rapports
intrieursavec
t'me.La
science
modernenous
~qjlque
partiellement
comment lesloisdu
mondeextrieur
secombinent
pourproduire
cetteentitbiendtermine
que reprsente
le
corps
humain. Elleferasansdoute
d~mportants
progrs
danscette
connaissance,
mais
ceux-ci
ne
pourront
modineren
quoique
cesoitnos
conceptions
concernantles
rapports
det'me
avecle
corps,
ni nous
revoterdans
quelle
mesurelesfonctionsdu
corpsexpriment
laviedel'ame.Grceauxsciences
naturelles,
nousconnais
tronsdemieuxenmieux
les
phnomnesqui prennent
place
dansle
corpspendant
la
vie,
maisces
phnomnes
seront
toujours
deceux
que
l'mesent
extrieurs
elle.
comme
ceux
auxquels
estsoumisle
corpsaprs
lamort.
Notre
corps
doitnous
apparatreau
seindumondeext"
rieur,
commeun
complexus
deforceset d'lments
qui
existeenso!et
quis'explique
de
tui-mmeentant
quepar~
ticipant
aumondeextrieur.Lanature
produit
la
plante,
puis
la
dsagrge.
Ette
gouverne
le
corps
humainet k
<&Mout danssonsein.
Si,
enrichi
par
ces
rnexions,
l'homme
contempleh
MhM,
it
peut
arrivers'oublierlui-mmeettout ce
qui
est en
lui,
et
prouver
son
corps
commeune
portion
du.
monde extrieur.
S'il mditeainsisurles
rapports
deson
threIntimeetBurceuxquiteretienttanature.it
acquiert
~ntm'-meme
laconnaissance dece
que
l'on
peutappeler
sonco~p~N<yue.
DEUXIEMEMEDITATION
LEMDTANT ESSAYE DESEFORMER UNE
REPRSENTATMM
EXACTE DUCORPS LMENTAIRE OU
THRQUE.
La
reprsentationque
tait natredanst'me
le ph-
nomnedelamortest
propreA
la
plonger
dansunecom-
plte
Incertitudeconcernantsa
propre
nature.
Tel serait
le
cas,
siellese
croyait
dans
FImpossIbUlt
derien
oonna~te
d'unautremonde
que
ce
que
lui revient sessensetson
entendement.
Notremeconsidre!e
corpsphysique
dans existence
ordinaire.Ellelevoit
rintgraprs
!amortauseinde h
nature
qui
ne
prend
aucune
part
Ace
qui
constituesa
vie
propre
avantlamort.L'me
peut
savoir
(partap<~
miere
mditation)que
lesmmeslois
rgissent
le
cotfps
physique
avantet
aprs
la
mort, mais
cette
constatmes
nelaconduit
qu'
reconnatre
l'Indpendance
desa~ie
Intrieuredurantl'existence
physique.
L'observation<!u
mondeextrieur
tul
apprend
ce
qui
advienteMUtteAtt
corpsphysique.
UnesemUabieobservation
n'eadstepas~
pour
!avieIntrieure.Dans
notretat
actue!,
toutevision
nousestinterditeau
detdeslimitesdelamort.Tant
que
ao
t'tmeest
incapablede
seformerdes
reprsentations qui
crpassent
le mondedans
lequel
le
corps
sedissout
aprs
la
mort,
ellene
peut,lorsqu'elle
considret'avenir
de
savie
psychique, plonger
son
regardque
danslenant.
Pour
qu'il
en soit
autrement,
il faudrait
que
l'me
puissepercevoir
lemondeextrieur
par
d'autres
moyens
que
ceuxdessenset del'entendement
qui s'y
rattache.
Carceux-ci
dpendent
du
corps
et
disparaissent
avec'lui.
Leursdonnesnenousmneront
jamaisqu'aux
rsultats
<jela
premire
mditation,
qui
sersumentencet aveu
dei'&me
J e
suisliemon
corps.
Celui-ciestsoumis
desloisnaturelleset
j'ai
aveccesloislesmmes
rapports
qu'avec
touteslesautresloisdelanature.Par elles
je
fait
partie
dumondeextrieuret
je
nesauraismieuxme
Mndre
compte
dela
partque
cemonde
prend
monexis"
tence
qu'en
considrant
ce
qu'il
faitdemon
corpsaprs
la
mort.Pourla
vie,
il medonnedessenset unentendement
qui
m'interdisent toutevisionconcernant t'avenirdemavie
psychique.
Cetaveune
peut
avoir
que
deux
consquences:
ou
biennousrefouleronsennous"m6metoutetendance
i unerechercheultrieuretouchantle
problme
det'tme
v
--etnousrenonceronstoutesciencedansce
domaine,
o
Mon,
nousnous
efforcerons,
au
contraire,
d'atteindre
par
v lavidenotremeauxvritsquetemondeextrieurnous
fefuse. Cesefforts
peuvent
avoir
pour
rsultatde fort!"
&er,d'accro!tre
notrevieintrieure.
Dansl'existence
courante,
notrevieintrieure
psychique
2<
etmentaleestdoued'unecertaineintensit.Une
pnale*
nous
occupe
aussisouvent
qu'un
motifextrieuroumt<'
=
rieur
t'voque.
Or,
nous
pouvons
aussichoisirune
pense
et,
sansautremotif
que
notre
volont,
la
reprendre
constam-
ment,l'intensifier,
ennourrirnotre
esprit.
Nous
pouvons
enfaire
frquemment l'objetunique
denotrevie
intrieure,
en
teignantpendant
cesmomentstoutesles
impressions
du dehorset tous les souvenirs
qui
voudraient
surg!~
dansnotre
esprit.
On
peut
fairedecettedvotion
compte,:
exclusive une
pense
ou un
sentiment,
un exefCMe
Intrieur
rgulier.
Pour
qu'une
activitde cettenature
conduisedes
rsultatsrels,
importants,
il faut
qu'eBe
soitsoumisecertaineslois
prouves.
Ces
lois,
la
science'
delavie
spirituelle
a
pourobjet
delesconnatre. Un
grand
nombred'entreelles
sont donnesdans mon
ouvrai
r7n~M<Mn. Parce
procd,
lemditant
arrivea
accroc:
lesforcesdesavieintrieure.Celle-cise
condense,
etb
`
quelque
sorte. Lemditantreconnatles
consquences"
decetravailauxobservations
qu'il
estamen
faMMB~
hMnme,
torsqu'iU'apoursuivi pendant
un
temps$u&M~
ment
long.
Dansta
plupart
des
cas,
une
grandepatie<n~
est ncessaire
pour
obtenir
des
rsultats
probants.
Et~
ron n'est
pasdispos
exercercette
patiencependantdes
annes,
onn'aura
quepeu
dersultats.
Nousne
pouvons
donnerici
qu'un
seul
exemple
dece
qu~v
pourront
trecesrsultats.Ilssontde
nature
tr~s
vane.
v
Cehu
que
nousallons
rapporter
est
propre
favonMf
.a
Mt~pfogrts
Mor lavoiedesmditations
que
nousavons
enMptMeSw
Supposons
qu'unepersonne
sesoit exerce
pendant
toagtemps
Intensincrsavieintrieure. Peut-tren'aura~
~dterien
prouvqui
soit
propre
modinersamanire
devoir concernant !e
monde,lorsqu'unjour
se
produira
kfa!t smvant:
CI
vaMHMdire
querexpnenceque
nous
rapportons
icinese
prsenterapas
exactement delamme
Btamtrechezdeux
pMNnKMnrMa
diffrentes. Maisencher'-
chantse
reprsenter l'une!
deces
expriences,
ons'"
dUresurtoutela
question.)
Unmoment
peut
venir
ourmesesentmtrKWement
Informe. Au
dbut,
c'esten
gnra!
durantlesommeu
~eBe
s'anime
ainsi,
comme
pour
unrve.
Cependant,
tsentaussitt
que
cette
exprience
nesauraittrecom-
tMMM~B<ar~r<hMs<M~iMnaire~iE]tp!M&<MHmt<Bo~nt~aTMHot<ita~
chtedMmondedessenset
de!'entendement,et pourtant
Smsmtrede
sentiretde
percevoir
estcette
queue
n'a
!amam
connue
qu'
t'tat
pleinement
veittetenfacedu
t~MWtjL~9d~anNr.I~me
sesentcontraintese
reprsenter
l~aq~tnMtce
qu't
fait.Etsesert
pour
cela
desconcep"
&Badeiavie
ordmaire,
mais
dtesait,
n'en
pas
douter,
qa'eBetesapptique
des
Mt~d~une toutautrenature
que
CMa:
auxquels
ces
conceptMns
se
rapportent
d'habitude.
EN~ne voitencette
ea~prience qu'unmoyend'expression
paMT
une
expriencequ'ette
n'aencore
jamais
iNteet
taqudte
t'e~stence
ordinMre ne
peutpas
donnerKeu.
Envoiciun
exempte
t'mesesentenvironne
pa~~nc
tempte.
Elleentendle
tonnerre,
elle
peroit
deschh$.
Ellesait
qu'elle
setrouvedansunechambre. Ellesesent
traverse
par
uneforcedontelle
ignorait
l'existence.
Puisles
murssemblent selzarder. L'meest
pousse
se
dire,
eut
dire
une
personnequ'elles'imagine
avoir
auprs
d~eMe
<
Il se
passe
ici unechose
terrible,
l'clair
parcourt
h
jnaison,
il
m'atteint,
je
mesens
foudroye
il medissoo~
Aprsque
sesont
droules
unesriede
reprsentmes
de cet
ordre,
t'merevient
sontatnormal.Ette
retrouve
elle-mme,
aveclesouvenirdece
qu'elle
VMNt
d'prouver.
Si cesouvenirdemeureaussivivantetaM)MMh
.fidle
quepeut
t'tretoutautresouvenir dela
vie,
il
penMt
At'mede
jugerl'expriencequ'ette
vientde
.taire. ES
~alt
alors,
de
faon
immdiate,
qu'elle
n'estredevabte taM~
cundeses
sens,
ni t'entendement ordinairede
t'expno~Kte
~qu'ette
vientdefaire.Carettesent
que
toute
<ta~cnqp~MMa
qu'ettepourrait
en
donner.que
ce
soItette~mmeout~Mt*
trs,
neserait
qu'unmoyen
de
s'exprimer,
desefaire
CM)~
prendre,
mais
que
cette
description
n'aurait
cependant
n<Ht
~ecommunavec
l'objet
mmedeson
exprience.
L'mesatt
donc
qu'elle
n'estredevable decette~d&aucundeses
M~
w
Parlerd'uneactivitcachedessensoudu
cerveau, c'est
Ignorer
lanaturevritablede
t'expnence
dontil est
qoe~
-r
lion;
c'est s~entenir la
descriptionqui
nomen
<a<' `.
donne,
aux
dairs,
au
tonnerre,
auxlzardesdes
nM~~t'
croire
que
t'men'a
prouvquedeschoa
detavIe<BN~
M!re. On
prend
alorsncessairement cette
exprience
po~r
une
vision,
ausensordinairedumot.Onne
peutpas
penaer
autrement. Seulement
onnetient
pascompte
du
&!tque,pour
celui
qui
dcrit,
lesmots
clairs
~tonnerre~,
<
lzardes
nesont
que
des
images
dece
que
sonme
prouv, imagesqui
nedoivent
pas
treconfondues avec
l'exprience
proprement
dite.Il estvrai
queson
mea
bien
rellement cm
percevoir
ces
images,
maiscelles-ci
ne
MprMntaIent
paspour
ellece
qu'est,parexemple,
t'dair
~e peroit
notreoelt. Pour
elle,
lavisiondet'ctairest
paMtBe
unvoile
qui
recouvre
l'expriencevritable;
travers
l'clairellevoitunechosedl~&rente
qu'It
est
MnpOMiMe
deconnatredansle
monde
physique.
Pour
que
t'me
puissejugerl'expriencequ'elle
vient
J e
faire,
il faut
qu'aprs
l'avoirtraverseelle
reprenne,
regard
dumonde
extrieur,
unemaniredevoirtout
faitnormale.
t faut
qu'ellepuissecomparer
cette
exp~
nonce
particulire
avec
cellesc'ullui sont
familires dans
le
mpnde
sensible.
Toute
personne qui,
danslavie
ordinaire,
MHMt
dj
unetendances'abandonner desrveries
de
t<M<
genre.ne
serait
pascapable
defairecette
distinction..
t~tusonpossde
unsens
rassis,
unesaine
comprhension
dej~
raKt,
plus
le
jugement que
l'on
porte
surce
genre
de
~'$J h<M)natM&
estexactet
prcis.
Onne
peut
avoir
conCance
Amses
propresexpriences supra-sensibles
que
lorsqu'on
jbo,
l'gard
dumonde
ordinaire,
d'une
vision
nette
~da!re,
quelorsqu'on
voitleschosestelles
qu'elles
son~
Si, une
foisruniestouteslesconditions
requises,
onest
endroitde
penserqu'on
n'a
pas
t
la.proie
d'unevision
ordinaire,
onsaitalors
que
l'onafaitune
exprience
dans
laquelle
le
corps
n'a
pas
servid'intermdiaire t'observa"
tion.Onaobserv
directement,
sansle
corps,
au
moyen
det'me
intrieurement fortine. Ona
conquis
la
repce"
sentationd'une
exprience
faiteendehorsdu
corps.
Il
peut
treintressant denoter
quepourdistinguer
!arverieoul'illusiondesobservations vritables faitesen
dehorsdu
corps,
onnesauraittablird'autres
rglesqu~
celles
qui s'appliquent
aux
perceptions
sensiblesext"
rieures.H
pourrait
arriver
qu'unepersonne
ait une
puia~
sante
imagination
et
que,parexemple,
l'ideseuled'un~
timonade
puisse
lui
procurer
lammesensation
que
son
absorbtion
effective. Les
contingences
delaviesauraient
bien,malgr
tout,
lui fairediscernert'acte
re!deraete*
Mnaginaire.
Il enestdemmedes
expriences que
ren
faitendehorsdu
corps.
Pour
atteindredanscedomaine~
des
reprsentations empreintes
d'uneabsolue
certitude,&
faut
ypntrer
avecun
esprit
sain,
capable
dediscerna!e~
rapports
intimesdschosesentre
eues,
de
faon
ce
quf
ceMes"ci se
corrigent
les
unes
lesautres.
Une
exprience
commecelle
que
nousvenonsdedcnr~
nousrend
capables
dereconnatre ce
qui
nous
appartient
en
proprepar
d'autres
moyensque
ceuxdenossens
et
de
notre
entendement,
autrement ditdenosinstrume~
corporels.
Non seulementnousconnaissonsdsonnah
autrechose
que
ce
que
nos
organesphysiques
nous
revient
d~
monde,
maisnonsconnaissons autrement. Cefaitaune
Importance capitale.
L'me
qui
est
l'objet
d'unetransfor-
mationIntrieure
reconnat,
de
plus
en
plus,que
siles
pro-
blmesaccablantsdet'existence
netrouvent
point
de
solutiondanslemonde
sensible,
c'est
que
lessens
phy-
siques
etl'entendement
qui s'y
rattachene
sontpasdous
de
pntration
sunisante.Lesmes
qui
setransforment
asaez
pour
vivreconsciemment en dehorsdu
corps
atteignent
de
plusgrandesprofondeurs.
Les
rapports
qu'elles
nousfontdeleurs
expriences
renfermentles
lmentsncessaires ta solutiondes
problmes
de
rame.
Or,
tes
expriences que
l'onfaitendehorsdu
corpssont
trsdKtrentes decelles
que
l'onfaitdansle
corps.
L'me
s'enrendbien
compte
sl~
aprsl'exprienceque
nous
avoM
dcrite, l'tat
deveitteordinaires'tant
rtaMi,
le
soM~enIr lui en demeureassezvif et asseznet
pour
qu~etlepuisse
tenter de
porter
un
jugement
sur cette
taq~nence.
L'mesentson
corpssensibleIsol
do reste
du mondeet lui
appartenant
en
propre.
Il n'enest
pas
de mmede ce
qu'elleperoit
de sol et ensoi en
<hjbors du
corps.
EHesesentnetoutce
<pa\dtepeut
appeler
alorsle mondeextrieur.Les
objets
environ"
1
namtshu
apparaissent
unis
etie,
comme
physiquement
<amainhnestattache. LemondeextfMMr n'estnulte"
t
mentIndinrentau
mondeIntrieurdet'me.
Celle-ci
se j
27
sentau
plus
haut
pointorganiquement
liece
qu'onpeut
appeler
lemondedet'me.Elleen
peroit
l'actionsurson
tre.Il n'existe
point
icidefrontirednnieentrelemonde
intrieuretlemondeextrieur.Les
objetsqui
environnent
t'meen
contemplation
sontMes
elle,
commetesdeux
mainsdu
corpsphysique
sontlieslatte.
Cependant
l'on
peut
considrer une
portion
decemonde
comme appartenant davantage ausol personnel quetereste
de
l'ambiance,
de mme
que
l'on
peutparler
detatte
commed'unmembre
Indpendant parrapport
auxmains
etaux
pieds.
Nousnommons une
portion
dumondeexte-
rieurnotre
corpsphysique.
L'me
qui
vitendehorsdece
corpspeut,
aumme
titre,
considrerunefraction
du
mondenonsensiblecommesa
proprit. Lorsqu'ellepar"
vientdiscerner le
champ
nouveau
qui
s'ouvre
sonexp'
nenceaude!du
monde sensible, ettesent
qu'ellepoMede
un
corpsqueses
sens
physiques
ne
peroivent pas.Oh
peutt'appeter
le
corps
tmentaire ou
thrique.Le
sena
que
lascienceaccordeaumotther
par tequet
<tb
dsigne
untat
plus
subtildela
matire,
n'entre
pas <?
considration ici.
~mnwqu'enmoStantsurtes
rappel
det'honMneavBC
lemondede ta
nature,
nous
avoMohtetHr
('.
une
reprsentation
du
cov~ pA~M
conforme
'&
h ydM
<hs
fmts,
demme
le
plerinage
det'medansles
rgicM
que
t'endcouvre
iorsqu'on
sedtachedu
corpt
MMiH~
nMsconduit
reconnhpe t'eodstence d'un
eo~~no~
&M1C CM
eMO~MC.
M
TROISIEMEMEDITATION
LE MDITANTESSAYEDE SE FORMERDESREPRSENTATIONS
CONCERNANTLACONNAISSANCE CLAIRVOYANTE DUMONDE
LMENTAIRE.
Lemditantconnatunmonde
ignor
dessensetde
l'entendement
ordinaire,lorsqu'ilperoit
sansl'aidedu
corpsphysique,
maisendehorsde
lui,
au
moyen
du
corps
~mentaire.
Sinousvoulions
comparer
cemonde
quelque
choaedefamiliernotre
exprience,
nous
poumonsparler
dumondedes
souvenirs,
des
reprsentations
delammoire.
Demme
que
les
souvenirs,
les
impressions supra-sensIMes
du
corps
lmentaires'lventdu fonddenotre~me.
L'me
qui
sesouvient sait
que
toute
reprsentation
dela
tnmoirese
rapporte
unfaitcoutdumondesensible.
La
reprsentationsupra-sensible comporte
un
rapport
MmUabte.Lesouvenir
qui
s'veilleennousse
distingue
~pMT sa
naturemmedescrations denotrefantaisie. Ilenest
de
mmedela
reprsentation supra~sensIMe.
Elleestissue
detaviede
t'me,
maisellesemanifesteImmdiatement
eoBMne une
exprience
Intrieure
provoque par
uneralit
~tneure.Toute
reprsentation
delamtnoire
voque
un
vnement
pass.
La
reprsentationsupra-sensible
faitd'un
vnement
qui
s'est droulenun
point
quelconque
du
monde
supra-physique,
et un moment
quelconque,
un
vnementIntrieur.Soncaractremmenous
permet
doncdeleconsidrercomme!e
message
d'unmonde
sup&-
rieurnossens.
Nos
progrs
dans
l'expriencespirituelle,poursuivie
selonlamthode
que
nousexaminons
ici,
dpendentdu
plus
oumoins
d'nergieque
nousmettonsfortinerla
viedenotreme.Hse
peutque
nousn'arrivions
percevoir.
dansla
plantequ'un
lmentdistinctdesaforme
physique
et
suprieur
ette.H
se
peut
aussi
que
noustendIoMcette
connaissance
laterreentire.Les
deuxdonnes
appaf"
tiennentaummedomainede
l'expriencesupra-senmbte.
Quandl'homme,qui
a
acquis
lafacultde
percevoir
MMM
1aidedeson
corpsphysique,contemple
une
fleur,HMMl~
outrela
fleur,
unefine
configuration qui
la
pntrecompta
tement.Celle-cise
prsente
lui commeuneentit
dyn~
mque, laquelle
il estconduitattribuerl'dification
d~
la
plante
au
moyen
desforcesetdessubstances
phyM~u~
etlamiseencirculationdessves.Il
peutdire,
en
f~Mmt
usage
d'une
image
utile,
sinontout fait
exacte <!J e
dcouvreun
principe
Intrieurdansla
plante, quiprovoque
lemouvement deses
sves,
commemonme
provoque
te
~nouvement demonbras
qui
sesoulve. Et
je
reconnaM
qu~
=
ce
principe
est
Indpendant
dela
planteque
mesMHM
peroivent.J e
mevoisencore
forcd'admettre
que
ce~
30
principe
existaitavantla
plantephysique.
Il estamen
observerainsila
plantequi
crot,
qui
se
fane,
qui
donne
naissancedes
graines
dontnatrontdenouvelles
plantes.
Lastructure
dynamiquesupra-sensible
du
vgtal
est
particulirement puissantelorsqu'on
considrela
graine.
L'organismephysique
est,
pour
ainsi
dire,
invisiblece
moment
l,
l'organismesupra-sensible,par
contre,
est
complexe.
Hrenfermetousleslmentsdumonde
supra-
physiquequi
travaillent laconstructionet lacroissance
dela
plante.Lorsque
l'observation
porte
surlaterre
entire,
elledcouvre
galement
uneentit
dynamiquequi
exis-
tait, t
n'en
pasdouter,
antrieurement tousleslments
tetrestres
queperoivent
lessens.
Ensuivantcette
mthode,
lemditant
parvient
voquer
toutesles
forces
supra-sensiblesqui
ont
jadis
travaill
l'dincationdelaterre.ttestendroit
d'appeler
la
configu-
rationsubtiledela
plante
oudela
terre,
son
corps
ouson
entit
~A~rt~ue
ou
~men~ure,
exactementcommeil
appellecorpsthrique
oulmentairele
corps
dontil ae
sert lui-mme
pour percevoir
sansl'aidede
l'organisme
physique.
Ds
que
lavision
supra-sensible
commencesedve'
iopper,
ettereconnatcertains
objets
et certains
phno-
mnesdumondedes
sens,
outreleurs
propritsphysiques,
uneessencelmentairedece
genre.
On
parlera
du
corps
thrique
dela
plante
oudelterre. Maiscesformes
lmentairessont loind'treles seules
qui
s'onrent
x
l'observation
suprieure.
On diradu
corps
lmentaire
d'une
plantequ'il
faonne
lessubstanceset les
forcesdu
mondesensibleet
qu'il s'exprime
dansun
corps
physique.
Or,
il
existed'autresentitsdont
l'existenceest
purement
lmentaire,
ellesne semanifestent
pas
dansun
cofpa
physique.
Ainsi,
nonseulement l'observation
supra-sensiMe
complte
laconnaissance
que
nous
possdons
du monde
physique,
maisellenous
rvle,
en
outre,
unmondenou"
veau,
ausein
duquel
les
objets
dumonde
physique
ressens
Mentdes
glaons
flottantdansl'eau.
Quiconque
neverrait
pas
l'eaunesauraitaccorderderalit
qu'
la
glace.
De
mmecelui
qui
secontentedes
objetsque
lui rvlentsea
sensnielemonde
supra-sensible,
dontlemonde
physique
neforme
qu'uneportion,
commeles
glaons
nesont
qu'une
partie
delamuse
liquide
dans
laquelle
ilsflottent.
Or, l'on
s'apercevraque
les
personnes
douesde
pefr
oeptionsupra-sensible
se
servent.pour
dcrireleurs
visions,
d'expressionsempruntes
auxsensations
physiques.
Elles
diront,parexemple,
en
parlant
du
corps
lmentaired'un
tre
appartenant
aumonde
physique,
oudeceluid'unetM
purement
lmentaire,
qu'il.
leur
apparat
commeun
corps
lumineux,
biendlimitet richementcolor.Il met
descouleurs,
il
brille
ouscintilleet il manifestesavieaM
moyen
deces
phnomnes
lumineuxet colors.Ce
que
l'observateurdcrit ainsi
est,
en
ralit,
compltement
invisibleetil a
parfaitement
conscience
quel'image
Imni~
neuseet coloredontil sesertn'a
pasplus
de
mpport
32
aveclaralit
qu'il peroitque
lescaractres
del'criture
dontnousnousservons
pour
noterunfait
quelconque
n'en
ont,
par
exemple,
aveccefait lui-mme.
Cependant
il
n'a
pas
fait
que
traduirearbitrairement
par
des
repr"
sentationssensiblesle
phnomnesupra-sensiblequ'il
a
peru.
Pendant
qu'il
observait ce
phnomne.
il
contemplait
bienrellement une
Imageanalogue
cetted'une
Impres~
sionsensible.Laraisonenest
qu'H
n'tait
pascomplte~
mentaffranchidu
corpsphysique.
Celui-ciresteliau
corps
lmentaireet revt
l'expriencesupra-sensible
d'une
apparence
sensible
c'est
pourquoi
la
descriptionque
donnela
personnequi peroit
untrelmentairerevtle
caractred'une
vision,
ou d'un
assemblage
fantaisiste
~Impressions
sensibles. Sa
description
n'enest
pas
moins
latraductionrellede
l'exprience qu'elle
afaite.Elleabien
rellementvuce
qu'ette
dcnt.Sonerreurneconsiste
pas
dcriresa
vision,
maisla
prendrepour
laralitdont
eNen'est
que
le
signe.
Une
personnequi
n'aurait
jamais
peru
de
couleurs,
unaveug!~n qui acquerrait
ta
visiondumondelmentaireet
qui
voudraitdcrireun
tredece
monde,
nedirait
jamaisqu'il
ressembleun
jet
decouleurs.Il seservirait
d'Imagesqui
lui seraientfaml<
lires. Mais
lorsqu'on
s'adressedes
personnes
douesdela
ifue
physique,
il convientde
faire
usaged'images
visuelles.
Celles-cileur
permettent
dese
reprsenter
lavision
qu'on
veutleur
communiquer.
Et cette
remarque
ne
s'applique
pas
seulementaux communications
qu'un clairvoyant
B
(nousappelonsclairvoyant
l'homme
capable
de
percevo!f
au
moyen
de
son
corpsthrique)
faitl'homme
qui
ne
test
pas,
mais cellesdes
clairvoyants
entreeux.
Le
corpsque
l'homme
possde
danslemonde
physique
revtles
impressions supra-sensibles
deformes
sensibtea,
c'est
pourquoi,
durantlavie
terrestre,
on
peut
utilement
se
servir,
pourexprimer
ces
impressions,
des
imagesphy-
siquesqu'eues
fontnatre.
Il
s'agit
d'veiller danst'&medel'auditeuroudulecteur
un
sentiment
qui
soitdansun
rapportadquat
aveclefait
envisag.
Les
images
sensiblesn'ont d'autrebut
que
de
provoquer
cesentiment. Laformesous
laquelle
ellesse
prsentent
leurinterdittouteralit
possible
danslemonde
physique.
C'est
prcisment
lleurcaractre
distinctif,
caractre
qui
leur
permet
desusciterchezcelui
qui
tes
reoit
des
expriences
Intrieures
qui
n'aurontaucun
rap"
port
aveclemondedessens.
Audbutdela
clairvoyance,
onauradela
peine
~s'a~ran"
dur de
l'expression symbolique.
Mais&mesure
que
cette
facultse
dveloppera,
on
prouvera
lebesoindecrerdea
moyensd'expressionplus
libres.Il sera
toujours
neoe~
saire,
dansce
cas,d'expliquer
d'abordles
signesparticu"
liersdont
c~tsesert.t~~M~rM~h~~ciJ ~~u~eadg~~ata~iMi~uMot
des connaissances
supra-sensibles
et
plus
on
eprouvcf
le besoindese
servir,
pour
les
formuler,
de
moyeM
d'expressionemprunts
lavie
quotidienne.
Les
expriences supra-sensibles peuvent
survenirtout
34
f
A
~ooup
et nous
surprendre.
Ellesnous donnentalors
Fcceasiondenousinstruiresur lemonde
suprieur,
par
notre
expriencepersonnelle,
danslamesureocemonde
nousfait !a
grce!d'illuminer
notrevieintrieure.Mais
unefacult
suprieure
consistesavoirsuscitervolontaire.
ment la
clairvoyance.
En
gnrt,
son
acquisition
n'est
due
qu'
la
poursuitenergique
durenforcement delavie
de l'me.
Cependant,
elle
dpend
aussi
beaucoup
d'un
certaintat
d'espritqu'il
fautsavoiratteindre.Uneatti..
t~decalme,sereine,
vis~vis dumondesensibleestIndis"
pensable.
Cetteattitudeestaussi
loigne
dudsirbrlant
d'acqurir
des
<~na!ssancesnombreuseset
prcises
concernantlemonde
spirituel,que
del'indigence vis~
visde cemonde.
L'avidit
connue a'
pour
effetde
i~aBeb~~<XMa~a~B~unetMi~a~ei~TVMHt4e
surlavisionextra~
C<rporeMe.
L'indiffrencea
pour consquenceque
les
objetssupra-sensibles
semanifestent
bien,
mais
qu'ils
ne
sont
pasperus.
CetteindMrencerevt
parfois
uneforme
ps~culiere II y
ades
personnesqui
dsirent.en
toute
tinf~nt~
attemdfela
ctM~i~q~Mnce.
Maisellessefontune
Me
prconotte
du<anMtefe
que
devrontavoirleurs
exp~
aences
pour qu'eHes
en adn~ent l'authenticit.
Que
SMMennentdes
ptM&aoBnnca
devritable
cLurvo~~Mnce.IIs
~Maeront rapid<tne!MM*s~HiscUMf
lemoindreintrtde
ta
part
deces
peMonnes, parcequ'ils
ne
rpondentpas A
nde
qu'elless'en
taMntfaite.
Loraq~e
h
ciMr~oyanoe
estdueautravaildel'mesur
~He-name.H
vientunmomentoe!!esedit
:~V~<pM;
j'prouve
unesensationtomte<MMvdte.Le
phwameM~
demeure
imprcis,
c'est
~tt
unsentlxnent
vague
deae
plus
setrouverentaceda
monde~ensibte,
de
ne phaviwM
en
ha,
maisaussidene
ptns
'v!vre
<nsoi-mme,
eoeMneo~
tefaitl'tatnonnaLLavieexteneureet ~a.vieint&MQBe
se
confondent,
htSMnnent <enun seMhment
~mM~tf. ju~'
~uators
inconnu,
'eti'amcsait
qae
ceBoniment<M
peot
provenir
ni dumondeextrieur
quepe~oi~eat
se<
~en~
mdes
reprsentations
ordinaires
'qu'its
tontnatreeu
que
lessouvenirs
voquent.
Le mditantsent ensul'teun cment
nourveau,
iasrn
d'unmonde
jusqu'alors
inconnu,
~'insinMer danss~nAat
d'me.Il n'amve
pas
k
de&nir.Hl'prouve,
uM
peot
seiereprse~er.Hest<<n~pariB~entimeat~queaon~tpa
physique
est iohtacte
~1 Fempeche
de TReoonnaSbre h
naturedecetlmentnouveau.Il faut
qut
oeaMNM)Nt
il redooMed'efh<rts
inteieurs, <tu'HpoMfSMve Mm
traMiU.
Aui~outd'uncertain
temps,
il sesentim
rainqueur
deta
rsistancedeson
corps.
L'incrment
physique
de<Ma
InbeHI~enoe
n'tatt
capaMe
decrer
que
des
reprsentations
seTattMhant des
phnomnes
dnmondeMMiMe.Ntait
Mapte
~!e~er
~aaqa'
la
fepraeoMM~, tes
f/~4atM'M
dwtnonde
Mpra-~enaibteqm
cherchentaoct
a<~jjMpe$
d~
M.NdevaatetrefaonBidanscebct.
!i<eneat
<deiTttnnM~)
<MnBne<te i~enfaHt
qui
est entaMcda~ande sensiMa,
maiBdont t'MMtrument intettectnddoXtte
prparapaf
Fexpnence
dece
monde,
avantd'arriverleconcevoir.
Le
clairvoyant
fait,
audbutet un
degrsuprieur,
un
tMva!t
analogue
celuidel'enfantsur l'Instrument de
aon
Intelligence.
n!e
dveloppe
au
moyen
deses
penses
tortISes
et il letransforme
peu
peujusqu'
lerendre
capable
d'tendreau monde
supra-sensible
safacult
de
reprsentation.
CetteactiondeFamsurle
corps
est
pMuvepar
le
clairvoyant.
Son
corps
lui
oppose
d'abord
uneviolente
rsistance,
Hluifaitt'etfetd'un
corpstranger
qu*Hporterait
en
lui.Maisle
corpss'adapteprogressive
menttaviedet'&me.etfinalement,
il n'est
plus
unohs"
fade.Par
contre,
lemonde
supra-sensible
sedcouvre. De
mmeenest-ildet'oNt
que
nousnesentons
pas,
mais
auquel
tMMM
devonsla
perception
dumondedescouleurs. Il faut
quetedairvoyant
ait
acquis
lafacultdene
paspercevoir
son
corps,
avant
que
sonme
puissepercevoir
lemonde
supn~sens!bte.
En
rgt~gnrate
l'homme
qui
est amv
ainsi,par
r<M6ercIce desa
volont,
rendresonme
clairvoyante,
peut toujoursprovoquer
sa
clairvoyance
enconcentrant
sa
pense
sur un
objetqu'I!
sesait
capabled'voquer
avecune
particutitre
intensit.Cetteconcentration fera
<~pt~M~re<Mt(J tIrvo~~H~oe.u<h9but,Il!~e~MNntt~~s<a~pabte
<hdiriger
savision.Tel
objet
outel
phnomnesupra-
aenNbieservteront
lui,
sans
que
sonmeait
t
pr*
pare
lesrecevoiroulesaitrecherchs.
Cependant,
en
poursuivant
sone<fort
Intrieur,
le
clairvoyant
arrivera4
!t
diriger
sa
guise
sonobservation
spirituette.
DeNattas
que
nouscherchoM
rappeler
un souvenir
disparuen
en
voquant
unautre
qui
lui est
apparente
demtM
le
clairvoyant peut
choisir,
pourpoint
de
dpart
de sa
recherche,
tttait
qu'il
estendroitde
supposer
ticeM
qu'il
voudraitatteindre.Enconcentrant toutesa
pense
surlefaitcormuil arrivesouvent
qu'aprs
un
tempstitMS
oumoins
long
il
provoquel'apparition
du
phn~m~ne
cherch.Il fautnoter
cependantque,
d'une
taongn~
rate,
l'attentecahnedumoment
propiceprMntepour
dairvoyant
de
grandsavantages.
Il nedoitrien
brusqu~~
Si telle
exprience laquelle il aspire
nese
prsentepas,it
est
prfrabtequtt y
renonce
mom~tanment,
quitte
chercher
plus
tardunenouvetkoccasion
pourqu'eMe
se
manifeste.
L'apparent
delannaissanhumaineabesoin
demrirlentement
pour
certaines
e~qpriences.
Cehn
q~i
n'a
pas
la
patience
d'attendresamaturitnefera
que
daa
observations
erronnesouinexactes.
r
B
QUATMEME
MEDFTATiON
LE MDITANTCHERCHEA SEFORMERUNEREPRSENTATION
DUGARDIENDUSEUIL
Ln~squer&me
a
acqms
t&tacuhed'observersansl'Intel
~diaite
da son
cotps.physique,
certainesdM6cuk<s
~CMwmt ewf~
~Laaaa~ne~MM~buzMKntatb. Elle
peut
sevoir
~Mt~te
de-
pM<Mte,
~a~~
d'eHe-mca~,
unetoutautte
at!tM<J e
q~epar
t~
pMMML Auparavant,
cite<DONUHMb&Hthk
taKMMMa aaBttUa
<ao<mme andomainefaneur
e!te~
a~tea
w<q~<teNMMat de~
viamtfieMre commec<ma~uant
sa
proprit.
Mais,
prsent<tu'etL&
setrouvee~face
du monde
supra-sensible,
il lui devient
impossible
de
conserverce
point
devue.A
peineperoit-ette
cemonde
suprieurqu'elle
se
rpandpour
ainsidire
en
lui.
Ellene
sesent
pas
isoledelui commedumondeextrieurmate~
net.
En
consquence,
tout ce
qu'eMeappelaitauparavant
aav!eintrieurerevtmaintenantuncaractretrs
spcia!~
trs duSdteaccorderaveclanotiond'intriorit
qui
nous
est tiabitueHe.Nousne
pouvonsplus
dire
alors
J e
pense,je
sens ou
jefaonne
les
pensesqueje
trouve
en moi mais nous noussentons
oNi~a
de &?:
<
Quelque
chose
pense
en
moi,quelque
dtoseveUteea
moides
sentiments,
quelque
chose
faonne
des
penees
et
lesrvlemaconsciencesousuneformedterminiez
Or,
cesentiment
peut
devenirextrmemen
a<'fa)Ha~
supposerque
notre
exprience
dumonde
suprMenaiUc
soitdenaturenousconvaincre'
que
nousn'amenaafM~a
ni une
fantaisie,
ni
uneillusion,
maisuneT~atM,
Nous arrivons nous rendre
compteque
le monde
extrieur
supra-sensible
cherAese
sentir,
se
pM~f e~
nous,
mais
qu'unobstades'oppose
ce
qu'il
weat
vtPaiaMNt
exprimet.
Nous
prouvons
alofs
que
ce
qui
cheMba
s'introduirede lasortedansnotre
me,
c'eft laratM
vritableet
que
seulecett~ratit
pourraitjetet
deta
humresur les
e~nence~ que
noustenions
juaqN~ta
pour
reMea.
Notre
impnaMMon
revtencorelaforme
savante ta
~atitaMpM~enaUe
nou$
panNt
doa~ed'unev~mr tn&~
nMM)Bt
sot~newre
celtede la Wiatit~ordhmM a<mk
eonBoednota
jusqu'
ce
ioor.S
cetmtimpnt<q<td~<B
dMse
d'accabhmt,
cehttent aufait
qne
Dons
~oyonaahot
qnd
est le
prochainpaaqoe
nousavons
tmce;
ne'aa
nc~sentonsle<tbcwr
det'accompttr.
Tout ce
qoe
ao<~
~teiotrteurea~i~utde
nous
ead~emaintenantque
BdMa
iasaMMBscepM<gr~Mus peine
denousrelief etdenoM
aonButef
noo~'mmes~
Et~cependaNt~m~ autreMOtMB<t<t
~0
mtervient,
cetui denotre
Incapacit
entreprendre
la
ttAe
quisTmpoae,
ouceluidenotre
incapacity
russir
si nous
l'entreprenons.
Toutesces
impressions
sersolvent dansla
reprsen~
~ensuivante:
Telle
qu'est
actuellement mon
me,
un
devoirlui incombe. Maiselleest
incapable
de
l'accomplir
parceque
lemonde
aupra-~snMMene t'acceptepa~
telle
qu*dte
e<t.
Ainsi,
r&meenvientsesentiren
opposition
awec
lemonde
supra'~ensiMe,
elleenvientsedire
<~e
nesuis
pasapte
mersoudredanscet
universsup~
neur
et,
cependant,
!ui seul
peut
memontrerlavraie
rtstit,
lui seul
peutm'apprendrequet
estle
rapport
de
ma
personne
aveclavraieralit.
J e
mesuisdoncscind
CMnpttement
delaconnaissance dur<e!
Cesentiment estla
consquence
d'une
exprience
intime
parlaquelle
se
rvle.demieuxenmieux,
nos
propres
yeux,
lavateur/Aritabte
denotreme.Nousnous
Soyons
!mpttqus,detout
notretreetdetoutenotre
vie,
dansune
Mnmense erreur.C'estuneerreur
qui
dMftreradicalement
deserreurs
ordinaires,
carcesdmisesnesont
que
des
eMMMPs
~efM~,
tandis
que
l'immenseerreurdel'meest
me erreurt~cue.Uneerreur
pens&~disparatlorsqu'on
Mtnptaoe
l'idetausse
par
uneidevraie. Maisl'erreur
p<eNe
est devenue
partieintgrante
de
t'n~ ceNe~t est
Mecr.
Et
il est
impossible
de
rectM5er cetteerreuren
changeantsimplement
lecours
de ses
penses.
Cette
41
enreurestune
partie
dela
ralit,
denotre
proprera&.
Unetelle
exprience
a
quelque
chose
qui
annihilel'ttre.
L'mesesent
repoussepar
toutce
qu'elle
dsire.Cette
douleur
qu'onprouve
uncertain
stadedu
plerinagede
Fam
surpasse
de
beaucoup
toutce
que
lemondesensiMe
peut
o~rirdesouffrances. Etc'est
pourquoi
lesforces
que
l'&mes'est
acquisespar
sa
pratique
antrieuredelavie
nesont
pastoujours
lamesuredecette
preuve.
Unefh~
stupCant peut
se
produire.
Une
question
terriMese
pose
o
trouverai-je
lesforces
dontj'ai
besoin
poursupport
iat&chequl
m'est
impose
l?Maist'trene
peut
trouver
~f
cesforces
qu'en
tui-mme.Ettes constituent ce
qu'onpeu
nommer le
courage, l'intrpidit
intrieure.
Pour
progresser,
ds
lors,
sur la voiedu
plerinage
spirituel,
Ilfaut
que
nousnous
voyions
amenercloreen
aouscesforcesd'endurance
psychique,
d'otitdcoulent
un
courage~
une
Intrpidit,
bien
suprieurs
ceux
que
noes~
l,
sitelaviedansle
corpsphysique.Ces
forcesne
peuvent
tsulterquedelavraie
connaissance desoi.C'estseuleoMN
`..
t
ce
degr
del'volutionintrieure
que
nous
constatai
combien
peu
nousavions
connujusqueldenous~m<BM~
Nousnousabandonnions notrevieintrieureauEeu<hi
l'observer
objectivement,
commenousferionsd'une
poo
tiondumonde
extrieur. Maisles
progrsque
nousavcM
accomplis, pour
devenirconscients
!en
dehorsdu
cofps
physique,
nousontannsd'unemaniretoutenouveBe
pour
lasol-connaissance. Nousavons
appris
nous
<9MK
`
nMM~Bous~nme~ d'un
point
devue
spcial,qui nepeMt
eao~er
q)ae~r&oe
l'observationlibredessens. Et te
tentimentd'accabkment
qui
a tdcrit
plus
haut est
j}~
unindicedela
vritablesoi-connaissance. Sesentir
Mnptiqu
dansune
erreur,
ence
qui
concernesesrotations
aveclemonde
extrieur
c'est
apercevoir
lefonddeson
tre
personnet,
tel
qu'il
estreHcment.
()f,
il estdanslanaturedel'hommedesouffrirdeces
tvtations.Lestourmentsdont noussommesalorsla
pfoie
nousrvlent&
quel point
nous
portons
ennousle
dsirtrsnatureldereconM&re unecertainevaleurnotre
personne,
telle
qu'elle
est. Cedsir
peut
nous
paratre
dpourvu
d
beaMt,
maisil
existe
il fautsavoir
regarder
entacecettelaideurde. son
propre
soi.
J usqu'alors,
nous
lierions
cettelaideur
parceque
nousn'avions
jamais
pntr
consciemmentdans les
p~ctondeus
de notre
tre.A
prsent,
nousrecoMMuseons cocAiennous
ainmons~
enBM~mmes.un
tredontlalaideurvientdeservler
ncua.Ce
que
nous
percevonsmaintenant,
c'estla
puis~
$ance
de
ramour~propre.
Etnoussentonsenmme
temp~
que
nouaavonst~s
peu
de
dis~tosihon
nou&
dpouiHbr
decet
amour"propre.
Cesdi&CMtt&sontd~
trs
grandes
ence
qui concerne
!)<&q~alitaquedveloppe
nctremedsnslavieordinaire
et dan~Boa
rapporta
avec00$semMaMes- LavitaMe
MMomMdssance nous
apprend,par eMBOple~ que
nous.
dissimulions
aufonddenotremedela
)atousie,
dela
hatM,
envers
une
personnepourtaqudtenous
ne
pensions
nouMMT
quedes
sentimentsbienveillants.Nous
apprenonsquecette
}atousie~
cette
haine,
qui
neabsent
pas
encoremarniez
ts~
tendrontaemontrerun
jour.
Nousnousrendons
compte
alors
qu'il
seraitvaindenousdire
<<PuiaqM)ejte
reconnatscette
)a!ous!e,
cette
haInCt
je
vais
pouvoM
rtoM~
tefen~mot.Noua
prvoyons
au
contraire; que
nctre
boBne
resotMhon
perdra
toutson
pouvoir
le
jour
osedchaneta
en
nous,
commeuneforcedela
nature,
rinst~octdesa~
ta!re
cctte~ja!ious!ie
ou<ettehaine.Voilde
queHe maM~e
lasM-comaMsance s'veiHe chezlestres
humains,
revtant
pour
chacunwaeforme
parucuhere.
Si ces
expnencea
ae
prMatent
aMmoment t'oncommencevtvrecons~
oemmenthorsdeson
corp&physique,
c'est
que,prcis~
nMsnt ace
moment-t,
!aLsot~ccmnaissance de'nent
rAstte,
m'tant
ph~
trouble
p<Nr
notredsir de lao~ut
t<~ouvar
contonnes
ce
que
nousaimerionstre.
Ces
phnomnes
de sot'<oBna!saance
partieHe
sont
pnibles,
accablants,pour
celui
qui
tes
prouve.
Ma!a<m
nesauMat
acqunrta
taeuttdevivrehorsdeson
corps
nhysiqxae,
saas
passerpar
ces
preuves.
EBes
r~uihBMt
HceasaiMment
de t'athtudetrs
particulireque
ren
dMtalors
adopter
t'gard
de
so~mme.
Maiait estuninstantonousavonsbesoind'une
nerve
payahiqtMB
encon&
plus grande.
C'eat
lorsque
intervient
Mnesoi-connaissance d'oadtfe
gnrt,
dcardre
purement
44
humain.Onseconsidre
alors,soi-mme,
d'un
point
de
vueentirement extrieur sa
propre
ve,
telle
qu'elle
avait
'M
jusqu'
ce
jour.J usqu'prsent,
se
dit-on,
j'aiobserv,
i'a!jug
leschosesetles
phnomnes
decemonde
d'aprs
la loisdemanaturehumaine.
Quej'essaye
uninstant
d'Imaginer queje
soismisdans
l'Impossibilit
delefaire.
J e
cesserais alorsd'tremol-mme.
J e
n'aurais
plus
devie
Intrieure;
je
seraisunnant. C'estainsi
que
doitraison"
ner,
nonseulement l'hommeordinaire
qui
sesatisfait de
sonexistence
quotidienne
et nerflchit
que
rarement
surle
monde,
surla
vie,
maisaussile
savant,
le
philosophe.
Le
propre
dela
pbilosophie
n'est-il
pas
d'observeretde
juger
lemondeselonlamesuredesfacultshumaines?
Or,
cettemanired'observer etde
juger
nesauraitconvenir
aumonde
supra-sensible.
Elleest
pour
ainsidirerfute
par
tu!.
Mais,
du mme
coup,
notre
personnalit
tout
entiresetrouverfute.Lemditantsetourneversson
me
tout~entire,
verssonmot. Cemo<devientune
chose
qu'il
fautabandonner
pourpntrer
danslemonde
sup-
rieur.
OrJ
avantnotreentredansledomaine
spirituel,
nousne
pouvions
nous
empcher
detenirnotremoi
pour
notretre
vritable,
pour
notreessencerelle.Nousnous
disionsC'est
grce
cemot
quejeconois
le
monde
le
perdre,
ceseraitrenoncer montrevritable.L'instinct
le
plusimprieuxpousse
l'meconserver
toujours
son
mol,
sous
peine
de
perdrepied.
Cet
instinct,
dansla
vie
ordinaire,
estabsolument
justifi.
Il doit
disparatre
ds
Qu'onpntre
danslemonde
supra-sensible
exteneur. L$$
trouveleseuil
que
l'medoit
franchir,
etdevantceseuilil
luifaut
abandonner,
nonseulement telleoutelle
possession
prdeuse,
maisencorece
qu'ellecroyait
tre
jusqu'alors
sa
propre
ralit.Elleest
oblige
desed!re <So!s
prte
voirta
plusgrande
ventdevenirta
plusgrande
erreur
audeldeceseuil.
L'me
peut
reculerd'effroi
devant
une
pareille
ead"
gence.
Elle
peut
avoirlesentiment
que
cetacte
implique"
rait un tel
renoncement,
untel anantissement d'elte~-
mme,
qu'elle
s'avoue
impwssante
l'accomplir.
Cetaveu
d'impuissance peut
revtirdesformes
multiples.
Il
peut
arriver
qu'ilprennel'apparence
d'un
instinct,
et
que
nous
mconnaissions soncaractre
vritable,
tout en
pensant
et touten
agissant
sousson
impulsion.
Nous
prouvons
alorsune
profonderpulsion
l'gard
detouteslesventes
supra-sensibles.
Nouslesconsidrons commedes
rveries,
des
fantasmagories.
Cette
rpulsion
nousest
inspire
rellement
par
la
peurque
nousavonsde ces
vrits;
maiscette
peur
sedissimule danslefondle
plus
secretde
l'&me. Nous
imaginons
alors
que
seuleslesconnaissances
acquisespar
lessenset
par
l'intellectnous
permettent
de
vivre.
Et nousvitonsdenous
approcher
du seuil du
monde
spirituel.
Nous
dguisons
notrecrainteennoua
persuadantque
tout ce
qui, soi-disant,
rsideau del
du
seuil,
n'est
qu'unehypothseinjustifiable
au
regard
dela scienceetdelaraison.En
ralit,
si noustenons
ttnttcette~cenoeet cette
raison,
teUes
que
nouste<
conBaiMons,
c'est
qu'elles
sontKesnotre~M.t!
s'agit
ta dMae tarme
trs commune
damooar-~propce.
Mais
tt
amocr-paropre
~st
incomp~tibtea~ec !emonde~tp:a-
s&MtMe*
B
peut
amver<nsm
que
!Ttommenesecontente
pas
de
cet arrtinstinctifdevantleseuil. H
peut
zrm~r
qu'Ii
titbe!~ne
consciemment ~tfMae~a!or$ votte-tce
parcequ'it
a
peur
dece
qu'u
atrouvdevant
tu!.L~n~e<~an~
pMOthnt,
t'homnoe
qui
~'eat
approch
da<euHne
pe~p!M
gnat<B
viterles~&ts
quecette ~ppfoche
cxetcBarlavte
ctdma!rcde
l'~ne,
ni ks
conBquenoes qu'eniraanara pour
ha.
enae
rpandantsur
toutesavie
intneore,
leSB~tMnent
d't<Bpanssance qn'itia ~pMuv.
H
&Mt,
an
contraire,
qu'enpntrant
danale monde
<MpM"seM!Me, t'homne~utaoqQMla
Notice d'abandonnorce
Mntnnent<ht<MO
qui
constitue,
dansia vie
'ordmai~e,
M
if~nteta
piNS
oecoune.B faut
qui! s'adapte
aHB~
ton
toutela~ve~deMnmrettde
jug'er
les~choMaL MaM!<hMt
BMMi
qu~!tiestetoM~oufs capaMe
de
Mhrouvar,
eaiace
~u
nonde~BS~eas, mode
deBentor~t de
iu~erqm
s'occMfdB
aMsc<MJ kMHti. Il doit
apprendre
~n~e
caMoiemeaBOt,
Mmtementent<BmsdeMX
aMndes,
m<metNa~tededem
BttZHArez tout~att dMfentea. Et it~aetea~
paBque
la
t~oessito~ii setrou~~e
d'adopter
uneBouwet!e
iaoan
~e
SH~nr et
d~ju~eftmsae
ia
~uwtesse
de Mnd~rnctMeat
dmotiemoadedesaeM.
Cetteattitudeest extrmement
dimcite
raliser.EHe
exige
une
disciplinenergique,
inlassablement
poursaivte
envuedefortifierlaviedel'me.
Lorsqu'on
subit les
preuvesqui
attendent
Fhomme
devantleseuil desmondes
suprieurs,
on
comprend
quelpoint
il est
salutaire,
pour
laviecourantede
Fam,
de
n'y pouvoir
atteindre.Lesvnements
qui
nousboule-
versentdevantleseuil sontdetellenatuie
que
nousen
venonsnous
reprsenter
unEtre
puissant,
dontmane
uneinterdictionbienfaisante.Cet Etre
protge
l'homme
contretesterreurset les
dangersqu'entrame.~ur
le
aeuN,
t'tLnantissementdumot.
Derrirelemondeextrieur
qui
s'offrenotrevieordi<
naire,
it s'entrouveunautre.Auseuildecetautreunivers
sedresseun svreGardien.Celui-cinous
empche
de
rienconnatredesloisdu monde
supra-sensible.
Car,
m
cruels
quepuissent
trenosdoutesau
sujet
dece
monde,
ilssont
plus
faciles
supporterque
lavisiondece
qu'it
fautabandonner
lorsqu'onypntre.
L'homme,
ausci
longtempsqu'il nes'approchepas
lui..
mmedu
seuil,
reste
protg
contreles
expriencesque
nousvenonsdedcrire.Lesrcits
quepeuvent
faireles
personnesqui
s'ensont
approches,
ou
qui
l'ont
franchi,
nenuisent
pas
cette
protection.
Cesrcits
peuvent,par
contre,
noustrefortutileslorsdenotre
propre
arriveau~
seuil.Il
~estplus
tacite
d'accomplir
unacte
lorsqu'on
a
pu
s'enfaireuneide
pralable, quelorsqu0on
en
ignore
tout..
<?
Cependant, h
sol-connaissance
que
chacundoit
acqurir
par
hn"m<me nes'entrouvenullement modISe.
Certains
clairvoyants. ou
des
personnes
familiarises
avecla
clairvoyance, prtendent qu'H
nefaut
pasparler
de
ceschoses
ceux
qui
nesont
pas
encorersolusencher"
cher
euMn&nes
Faccs. Celan'est
pas
exact.Nousv!voM
a~tueUement une
poque
oleshommesdoivent sefanu"
i~d~MMn~er<leJ tMent~kMav~~tt!~ature<ies
mondes
supra-
-jMNnwHMhHt s'ilaveulent
que-
leursmessoientlahauteur
desncessits
prsentes.
La
divulgation
desconnaissances
V
spirituelles,
ycompris
celles
qui
concernent leGardiendu
Seuil,
estunedestches
qui
incombent notre
poque
et
auprocheavenir.
4
CINQUIEME
MEDITATION
M
MUTANT
ESSAYE DE
SE
FORMER
UNE
REPRESENTAT~
DU
CORPS
ASTRAL".
Nou~som~
moins
~w& du
monde
.upr.-MmiU.
.&
nous
,ntr~u,t
notre
corp~~m~Ir~qu.TuTS
ph~qu~ntn~c.M.~p~
dire
<~nd~t,
pour
~pnn~ k
r.pp~S.~udn~
~n~
monde
~pn~S~
quen~S
<'npn~on,
<~n.,
d.
,ub~M<~
p<
notre
Propre
c~
ton.
monde
phy.~
f.~
.ub~c~S
'~<
corp. m~nd.
Le
chIr~y.nt~S
~mpt.<~d.~n~
.<~n~
<hn,
t.
monde
n<u.
SupP~S
r~<qud~
~7~<~T~
~unitMnn~fort.,tpeutIedMMer,mN<I!h~
P~r~rn~d.n.I.n~nd.d.
~?~
ce~ndeT~po~B
~unp~~d.
rester
j~
P<N
'"P~M.
de
<~p..
k
<~
rSr.
qF~
prsente&
luiavecd'autresfaitsoud'autres
tres,
ce
qui
lui
permettrait
des'orientersurla
signification
desavision.La
perception
dumonde
supra-sensible peut
donctre
limite
celledecertainsdtailset
n'impliquepaspour
leclair-
voyant
la
possibiEt
desemouvoird'un
point
unautre.
Il sesentretenu
par
le
pointparticulierqu'Hperoit.
Or,
il
peut
chercher!acausedecetteHmhation.MMla
dcouvre
qu'en
forti&tntencoresavie
psychiquepar
son
dveloppement
intrieur
jusqu'
ce
qu'il parvienne
an&rancHrdecettelimitation. Il
~wnMt
<toM
que
c'est
diMM<on
meette~nme
querside
h causede
timpcs-
sitntto&H$etMu~aitdesemouvoirdune
perception
Mnemttfe.Il se~nend
compteq~e
lavision
dmmonde
Mpra-~OMiMe
se
J N~n~ue
encoreMyunmitre
point
dela
peMBeption
physiqae.
Tandis
qu*H~ufKt,
par exempte,
daa~Mr
de!Mas
yeuxponr
disoenaer1ensemble des
objets
jM~neh,
i'ore~ae
de
perception
du
corps
tmentonre
peMt
tMsufhMnMent
dwetopp pourperoevoif
tt
<tb~et
patienter,
nMMacvoirAsubaran noNvet
entPMnement,
a!M)t)t
de
p<~uwif
endMoenner <Moatre.Ce
~enfe<ie
<tve~
hppetnentdonne
aM
cbHrvoymt
h aenMthon d'an~eHA
n
e~potne
de
~Mttephon
nne
po<<M)n
<MtefNMne <M
jn~ndeapNfi~et.
comme
<Heeorpa
tmentMe<elovait
t'~ard
de<!ecaondedans<mMdeaonnaeHet
q~'ii
MMe
t'~emeri chacunedeaes
pafticdxnta.
Onett en
A)Mt
deparier
'd'untatdeaomnMB <t d'unAttt
~c ~NNe
dei'6tpedansk monde<!nMnta!te. SedementcesMs
M
T~~dhetT~ant~~<s<x~nmnae(~anBh~~MepjkyBLqaMR;
~ceezate~
MMt
~ongtemp< que
le
corp< ~mentan'e m~ Ae
d~w<
d'aucHne
f*cuihB<te~~e~ceptMMn~!i<jo~t.~kHMt~MNnhNn$!~Mi~
en Mue un
corptetmentMTe.
nMm
c'eu
un
oo<~
endozaoL
Avec !e
renforcenMnt ~e
vie p~ychic~e
reweH coMn~nee.
mws
H n'atteint tout
d'ahoni
qu~ne
partie
oa<p8
mentaire et rame ne ~e
t<a~~tarMM:<~MBe!hB3ZMMQcki<~pat~
aen<nt)!e
que
progyeMivement,
M
{ur et
A n~utRe~e
<'ve<Me
le
cofps etmenta!fe.
Of,
ie monde
sup~~een~Me
ne tu! est
dauam MCOMt
pour ce
trahit. A
supposer
mme
que
!~ne~
d~
~te*
a
discerner un
grand
nombre de
~hoac~,
h vMMa
<de
i~e
de ces choses
n'ina~!que
<MHemeBt
ceHe
dm antte ~b~t.
H
n~t rMsn (huas te WHttMNt
etementMeqNl ~ptnMe
CMB~
mtmtq~ef
t~nne ia
Hbette da
~TM~NT~Mttaat.
CeHe-<a n~
s~~h~ieN~,
et
pour
des
tgMm
de
pt~
r~Tf ~rmhw~
~e par tt~p<n~nHitbB<te6~ExcBCMoe<
d'e~aSoenMat.
Au coura
~ha~~eKtM&n~a~oeB
que
te
iJ <trwci~M)t.a<t
~entMM ee
tMu~e ~Ma~oe
par
un
etcmBnt
th~MMM
'7
en
tuwanM
toreq~'M
ae
<anMiMnae ja~ec
ie .ma~de ~t~
mentaire et qm,
oepe<Mhnt, ae
im~ppwt~
pM J aa
Tecoan~t dwR< un
tre
qui
Mt
de
gutde.~
coa~
~&Mn-'
tMe daM
!e6~Made<
supenew~
qui
<est~~
nM~
I~wHe
pea i peu
J u~~e~caoNMJ ~~OB ewpnMMNe.
A cenMMeMt.~m
wentimantA~~tn~
'~h~w on)
ramedadain~M~~M~w~~ei!~
nMHadte~pwM~MTWMMt
e~nMNtaire <t,<n
n)t!)Mu
~te~e~a~M~~
<
si
1*
cesn&Ms.itne
dcouvrenutte
part
son
semblable.Nous
ne
prtendons pasque
toutes
tesdisciplines qui
ont
pour
hat la
dairvoyance
conduisent cette
effroyable solitude,
tUMl'homme
qui,
consciemment et
par
ses
propresmoyens,
accro!tles
pouvoirs
deson
me,
enfera
l'exprience.
Et,
sTI
estle
discipted'unmatrequitesuit pas
pas
et lui
donne
tesinstructionsncessaires son
dvetoppement,
un
jour
viendra, tt
ou
tard,
mais
invitaMement,
oitsesentira
abandonn
par
lui,
livr
par
lui lasolitudedu
monde
ttmentaire.Hus
tardseulementit reconnatra
que
son
tMJ hr~fut
sage
en
~ssantainsi, jugeantquet'indpen~
danceluitait
indispensable.
L'tme
qui
atteintce
point
deson
plerinage
se
sent,
en
q~etque sorte,
enexildanslemonde
lmentaire.
Mais,
si
sesCMrdces
intrieurst'ontdoued'une
Intrpidit
assez
gnMde,
elle
poursuivra
saroute.Ette
pourra
commencer
t~r surgir,
non
point
autour
d'elle,
mais
enette-m&tne,
un
monde
nouveau
qui
n'estni celuides
sens,
ni lemonde
~mentaire, mais
quivients'ajouter
&cedernier. Cesecond
monde
supra-sensible
lui
parat
d'abordtoutintrieur. Ette
kpo~eenette~mtme,
ellesesentseuleaveclui.
J La<~MaNpaaMMs<M~
suivanteferamieux
comprendre
l'tat
dana
lequel
t'mesetrouvealors.
Supposonsque
noua
aidons
vunMurir
tousles
parentsqui
nouataientcherse~
nous
ne
gardions
d'eux
que
lesouvenir. Nos
parents
nesurvivent
pour
nous
que
dansnos
penses.
C'estdeta
tmtnMman!~
que
s'o<het'mete
secondmonde
spiri"
tuel.Ellele
porteenette
comme
le
souv~ur.maM
eBesatk
qu'ette
n'aaucune
part
saraKt.
Toutefois,
ce
reCetAh
redite
qui
vitseul dansl'meesttui"mme
!n&mm~
plus
re!
que
nelesontlessouvenirs dansle
mondes~*
sible.Cemonde
suprieurpossde
uneexistence
indpeo~
'danteettousseslmentsontunetendanceso~ur
<h
rame,
se
diriger
versunautretieu.L'mesent
WM
unmondeen
elle,
maisellea
t'impresstonquil
cheMt~
se
sparer
d'ette,
que
sescments
vontlafaire
<ch~
Cettetension
peut
s'accrotreau
point
detMbrer ces<tt'
ments,
it semble
que
ceux-cidchirent
quetquedMSe
commeune
enveloppe
derameet
qu'ih
fuient.Et
tl~M
sesent
appauvrie,
alors,
detoutce
qui
s'estdtad~d'eBe.
Or,
elleconstate
que
leschoses
qu'elle
asuaimef ~M
r
sonmonde
intrieur,
aimeravec
dsintressement
powr
elles-mimes et non
parceque
cescho<Ms <ttaent en
~t~M~
se
comportent
d'une
faonparticulire.
Ellesne
s'aTHMeh~
pas
de
rame
;eMes s'en
chappent,
itest
vrai,
maisen
rentn~
nant,
en
quelquesorte,
avecelles.Ettest'attirent
v~t$
lieuorsideleurralit.Unesortedefusion
s'opra
$~~
t'tmeet l'essencevritabledeceschosesdont
e~J ~~
essence ' ces
OIeS.
~ne_
i
possdait, jusqu'alors, qu'uneespce
dereftet.
L'amourdontnous
parlons
Ici doit<tre
prouv
AtM.'v
lemonde
supra-sensible.
Danslemondedessens
ott n~i
peutques'yprparer.
Onle
peut,
en
effet,car,
plus
en
.aimer danslemonde
physique, plus
onconservede
e<
facuttdanslemonde
spirituel.
Voiciun
exempte <b~t!
_ "prl808l,ts.
,~L t__
' t
air
si
les, 11~
il-
th~t~uae rt~~w~ pMMe
tw~ t fti mdMMrcwtt
t~tt~Bt~~
&Mt k met~e
tthyw~M~
et
q~e Mn.
<N~
pcarha w~<atM~M~HMMM<nte.
&~ <w
0)~
aon acMMr
powera.
rMatkr
toMq~~
CM~~p~~tt~rm~u~mMW~~
<~M ~kt NM~
ptnMr ~a~
&)re
<ocMt~oN<Mt<<:tMMr
~t~tt~~a~ <~un~~ ~t
qa~ !x r~aped~
ht vtn&n~wMar~
<Eat~a~j~BtHMHn~ <~ Mt'ah M')~ t<M~
NttNittth~t
tBMtc m t~
<t\d<t) n~tM M~
~Mh~ t~XMd OMt caMMi~ tt thr~ MM~ M~
.;7,ti'
C~m~$'c~t~<~kmM~M~
_j'') ~L
'J t
t
f Ht <
~t<r:tt<6e<M<<tw~i&~itwaHar MM ~a!NHt)hi~~aaMBKtUtt~
~W~$t~
et MH~~ q~taU~ MMntM~
~~Mg~BC t~MM
urn~. D~ t<r nMM~r jpt~~NtqtM~ wn.
attBW' WB
8"le (1 Dam it
au" monde
'~Kg'J L~
~t~
~.jLJ t
<
~Mj~
Ht
$~L ~t t <t
um.
~~tMt n~t~ketq~~M~Mr~atM~c~ee
qui
r~vcIMe.
Si,
aulieude
perdre
conscience danste<oh~
me!l,
nous
restions,
au
contraire,
conscients endkdhoes jt$
notre
corpsphysique,
nousnousreconnatrions
nous-~nAM
dansFtre
qui produit
cetveit.C'estlatroisi~~entM
que
nous
distinguons
d~ notre
tn~aptes
le
corpsphy-
sique
etle
corpstmentaire.Appetons-ta
le
M~<MfM~
et
tM~<h&t~pne<a~FMMar
knMMBB,
ao~eanom~q~raBM
qmsertw~k
ramedo&taMMife
qMe
MM~venons
dcrire.
$
M MDITANT ESSAYE DESEFORMER UNEREPR~NTATON
DU
a
CORPS DUMOI OUCORPS DESPENSES ?.
Le
corps
astral,
plusque
le
corpslmentaire,
donne
ramelesentimentd'existerendehorsdu
corps
sensible.
Le
corps
lmentairelui donnebienlasensationd'avoir
chapp
au
corpsphysique,
maisellecontinue
prouver
te
corps.
Pourle
corps
astral,
au
contraire,
le
corps
sensible
revient,
lui
aussi,
unechoseextrieure.
Lorsque
l'me
pMnd
consciencedeson
corps
lmentaire,
ellesesentse
~Hater
par
contre,
quand
elle
pntre
danslaviedu
corps
trat,
ellea
l'impression
debondirdansune
autreentit,
entitsoumise l'actiond'un monded'tres
spirituels.
L'mesesent tieou
apparente
de
quelque
manire
eestres.Et elle
apprendgraduellement
reconnatreles
apports qu'Us
ont entreeux. La consciencehumaine
~Mt,
partir
de ce
moment,
sonmondes'tendrevers
l'esprit.C'est
ainsi
qu'elleapprend
connatrecertaines
entits
spirituelles quiprsident
lasuccessiondes
poques
deFvotutionhumaineetveillentce
que
lecaractrede
chacunede ces
poques
soitbienrellementdtermin
SIXIEMEMEDITATION
par
destres.Cesontles
Esprits
du
temps
ou
Principauts.
L'me
apprend
encore
distinguer
d'autrestresdont
lavie
psychique
esttelle
que
leurs
penses
sontenmme
temps
desforcesnaturelles. Elleestamenereconnatre
que
lesforcesnaturellesn'existentsouscetteforme
que
pour
lessens
physiques
et
qu'en
ralit,
partout
ouettesse
dploient,s'expriment
les
penses
decertains
tres,
de
mme
que
dansle
geste
d'unemain
s'exprime
uneme
humaine.
Il ne
s'agitpoint
ld'unethorie
qui imaginerait,
der"
rireles
phnomnes naturels,
des entitsdissimuls.
Lorsqu'on
vit consciemment dansson
corpsastral,
on
entreenrelationaveccesentitsd'une
faon
aussi
peu
thorique,
aussiconcrte
que
sontrellesetconcrtesnos
relationsavecnossemblables danslemondedessens.
On
peutdistinguer
une
gradationparmi
lesentitsdans
tedomaine
desquelles
on
pntre
et
parler
d'unmonde
dehirarchies
suprieures.
Lestresdontles
penses
se
manifestent
la
perception
dessenssous
l'aspect
des
forcesnaturettes
peuvent
tre
appels
les
e~W~
d~&r
jonnc.
L'&mene
peut
vivredanscemonde
suprieurqu'
ht
condition
que
sontre
physique
luidevienne aussi
tranger
que
luiest
trangre
une
plante, parexempte, qu'etteperoit
danslemondedessens.Cettemaniredevivreen
dehor~
de ce
que
noussommes
obligs,
danslavie
ordinauxde
considrer commersumant toutnotre
tre,
est
infiniment.
56
pntMe,
ansst
longtempsqu'une
autre
exprience
n'est
pa~
venae
rajouter
cet!e-c!.
Si letracvaH
psychique
int~
neuraepcmsuttnergtquementeta'nmneuneconces~
tmt~ etunrenforcement SM&sants delavie
deF~~me,
t'mtensitdecette sou&anoe
peut
tre
vite~
aMendu
que
laaeconde
caq~nence peut
commenee<r 4se
de~opper
!ent<ment
pendantque
ae
poursuit
t'aodimatationde
rtmedanate
corps
MtraL
Voiden
quoi
consistecetteseconde
preuve
r<me
~ohtoutea<es
qu~t~
toutesses
poasesMona
antneufes
te'wtir
raapect
de
aou~enu~et
dte
pfendt t'tayd
detiMt
ce
qutconsttuait mq)aMMantaon
nm~rectitude
q~
lui
!j~!tentaeaaou~~s
danstB]nMMQ<h~MdM&n<]L!5eMie une
<atp~ti<KMaB<te<BBMh&i*<bux~tiMHad~T~w~n<a~t<NMaa~iez~M&<ftNn
mondeabaohMnent dMfArent
decetmdessens~
etdetavie
dMquet
aontremme
patrtiape.
DscmsM,
aon<B)o~
ptaas
devient:
t'meunechose
tfant&ret
son@tye
jfeLEHepeat tB<oo~aa~h&~ar<~biectn~enaeBt
et
eneHeamrgk
tMM~t:
dece
ques~
fetknMcttttte
q~ettecoBteM~pte
et donteHedi)sak Heat
tTBonB~&nae.l~tsen~,
eHe
ne
parteplusainsi,
elledit
:<je
le
porte
avecnMiconMne
unectM~ttan~re~De
mme
qu'au
coursc~reaMtence
o~KtMa~~t~hBteiae~Mant
mdpendante
deses
sc~veaies.de
m~mete
<
mM~
noMwm~te
<mot~
atqu~s~seatmd~
pendantdn~moi~
anoMar. H
apparent au
mondedes
entMa
aptntueBes.
Orcette
eaqpcience
car Mo
encore,
c'es<t bteod'uae
M
expenence
vcueet nond'une
theone
qu'H$'apt
note
permet
de
pntrer
lanature
~er~taUedeeeqMenoMS
t~ono
pns ]Msq~'a!ot& pour
notre~tnot*. Cen~c~
te
prsente
nouscommeu~tM<Uf
detOMveni~~ptodu~
par
le
<ofp?Mns~He,
te
co~ps
etemeataMeet
tecorp~Mtn~
demme
qMeFtma~qMe
reNj~en~mtnoM' eat
ptMUte
ptaf
eetm~ci~PM
ph~quenou~nencus
<~on<t)MM~ OH~e
cette
MM~l'&meqm
aehnjAdaBtlemonde
t~nhMt
Beaecowtonda~t<ee
qu'etie
VMtd'et~m&n~dM~le
mondeMMibIe~ He<tb!enentende
q~e
cette
coH~pwrwMoa
MM~dkHt~p<a~t~M~Bt~o~n:i~~Btt~<MMM~~e~~M~~e
Mou~ Mum
~hM~pnowMtta
nmroiHr, tetiMude~tcuvemra
q~
comptentceque
noM
pfeaoMtdaM
lemondeaeaame
poMT
no~e~moi~teete~doud'une
phm~afnde
tnd'
t~eBMtttMaB<iH~<aNnatMM~~B~i~HfMB!awMni4t~~t~Bn~o~Maeth&Bt~
$Mt,
en(<cedet'eaMteace~ntwbtede
t'nne~
HB'ett
~~t~B~eiMB<~p&jh~tM~t~e.tJ ~~NM~qpMr~~t<t~~<~v~&~tahte
ant
q~rcfhc<ttMHMMU~<te cet~iKmgepoMt
aetesterteNe-
mme~EtteMtt
q~'oHen'eat p~eeetet~nMMq~'cHene
serait
iMM~s parvenMe
<e
connexe,
si eHene<'e<mt
<M<te
d'abMrddtn~aonMBaeteyeSete pu
un
arModeq~'eMe
~oM~e~neMrette
<Ae~Ne<c~n<MMBBBaM~n
daMImmonde
apintHel~
-0
LetMaude MMvemrs dont est iwattewmoiM<aen
peut
etce
appel
le
OM~t
& HMwou
cof~
dat
penaee~.
Manil fautici tendrelesensdumot
<corp$
Cejaaot
deMgne,ene~,dans
ce
CM~tiout
ce
que
nous
percevons
(0
denous"mme,
et dontnousnedisons
pas que
nousle
sommes,
mais
que
nouslerevtons.
Lorsquegrce
notre
conscience
clairvoyante
noussommes
parvenus
ne
plus
voir
qu'une
sommedesouvenirsdansce
que
nousconsi..
drions
auparavant
commenotretre
lui-mme,
nous
pouvons
avoir
l'exprience
dece
qui
secachederrirele
phnomne
delamort.Carnous
pntrons
alors
jusqu'
t'essencemmed'unmonderel.Dansce
monde,
nous
trouvonsun treen
qui
nousnousreconnaissonsnous"
mmeset
qui conserve,
commedansune
mmoire,
les
expriences
delaviesensible. Ces
expriences
ont
besoin,
pour
se
perptuer,
d'uneentit
qui
les
nxe,
commete
moiordinairefixeles souvenirsdu mondematriel.La
connaissancedu monde
suprasensible
nous rvle
que
t'trehumainasaviedanslemondedesentits
spirituelles
et
que
c.'est
grce
elles
que
seconservetesouvenirde
l'existence
physique.
Ala
question
Que
deviendra
aprs
lamortnotretreacuet?
l'investigateur spirituelrpond
<!ttserace
qui
seconserverade
lui,
envertudesavied'tre
spirituelparmi
d'autrestres
spirituels.
Nous
apprennons
connatrelanaturedecestreset la
notre,
et cetteconnaissanceest le.fait d'une
exprience
Immdiatenoussavons
que
lestres
spirituels,
et
avec
euxnotre
propreme,
possdent
une
existence
en
regard
de
laquelle
notreviematriellen'est
qu'une
manifestation
transitoire.
Grcela
premiremditation,
It est
apparu
notre
61
conscienceordinaire
que
notre
corpsappartient
au
monde
physique
et
que
l'actionrellede ce mondesur nous
servledansla
dissociationdu
corpsqui
suit la
mort.
A
prsent,grce
notre
clairvoyance,
nousdcouvrons
que
lemoi humain
appartient
unmonde
auquel
il est
attach
par
deslienstrsdiffrentsdeceux
qui
soumettent
te
corps
aux
loisdelanature.Cesliens
qui
unissentlemor
auxtres
spirituels
nesont
influencs,
dansleuressencela
plus
profonde,
ni
par
la
naissance,ni par
la
mort,
ilsrevtent
seulementuneforme
particulire
durantlavie
physique.
Les
phnomnes
delaviematriellesont
l'expression
de certains
rapportssuprasensibles.
L'hommetant
par
essenceun tre
suprasensible
et servlantcommetel
l'observation
clairvoyante,
lamortnesaurait
porterpr<
judice
aux
rapports
desmeshumainesentreellesdanst'au"
det. A notre
interrogationinquite,interrogationqui
revtdanslaconscienceordinairelaforme
primitive
sui"
vante
Retrouverai-je aprs
lamortlestres
auxquels
j'tais
attachdurantlavie
physique? l'investigateur
spirituel
vritable,qui
estendroitd'noncerun
jugement
exprimental
surces
matires,
rpondpar
unoui
cat~
gorique.
L'homme
qui
s'exerceaccrotresavie
intrieure
selon
unemthode
que
nousavonssouvent
indique, passera
par
toutesles
expriencesqui
viennentd'tredcrites
et sonmeaurale sentiment
d'atteindre,
dans les
mondes
suprieurs,
sa
propre
ralit
sp!ritue!te.,Cependant
62
cette
expriencepeut
trefavorise
par
le
dvetoppet<Mnt
decertains
sentiments.
Aucoursde
notrevieordinairedanstemondesensIMe
nous
prouvons,
pour
ce
que
nous
appelons
notre
destine,
tanttde la
sympathie,
tanttde
j'antipathie.Pourqui
s'observe
soi-mmeavec
impartiatte,
il ~stinomMe
q~e
cessentimentssontdeceux
qui s'prouvent
~ec le
plus
d~ntens~tc.Le
raisonnement
qui
consistenousdire
que
riendece
qui
arriven'est
inutHe,
qu~~
fut savoir
suppt
ter son
destin,
peut
nousaider&conserveruneattitude
calmeenfacedetouslesvnementsdenotre
vie,
mais
ceriaisonnement
nesuffit
pasnous
donnerune
comprhen"
sionvritabledet'trehum~n.H
peut
tretrsutnela
viedenotre
me,
Tnaisnous
femarquerons
souvent
que
les
sympathies
tesantipathies ainsi tounes,
n'ont
disp~u
quepour
notreconscienceimmdiate
;eSesonttr~outea
autrfondsdenotre
tre,
maisellessemanifesteront
plus
taafdsoit
par
unce<ta!ntat
d'me,
soit
par
dela
fatigue,
ou
par qudqu'autre
sensation
corporelle
anato~ue.
Pour
atteindre
unevntabte
gatite
d~meenfacedu
destin,
iittut aToirrecoins&!amthode
qui
nousa
permis
de
fortifiernotrevieIntrieure.Cettemthodeconaiste
nous
tivrer.d~unefaonf~uKre
et
nerpque~
certames
penses~uce~ainssentiments.
LeTaisonnementnaibou~t
qu'descondusions d'ordretntettectue!et i! ~stInauntsant
pour
nousdonnerrgatit d'~ne~)ue
nous
che<~bons
H
faut
que
noustnfus!ons&nos
penses
une'vie
Intenseet
c
que
nousnousconsacrionsellesd'une
jtaoncompta
durantcertainsmomentsde
concentration,
onouscaf<
tonstoutesles
impressions
dessensettoustesaouvenirsde
lavie.Cetexercice
dveloppe
ennousuntatd'me
par-
ticucer
rgard
denotre
destine
il nous
permet
denous
dlivrerradicalement detoute
sympathieetantipathie
son
~ard
etnousamenconsidrertoutce
qui
nousarrive
avecune
parfaiteobjectivit,
commesi nousobservions
unecascade
qui
tombeduhautd'un
rocheret quire~aiNit
ens'abattant.
ne
s'a~t pas,cependant,
d't~einsensiblenotrede~
tme.Devenirindin'rent toutce
qui
nousarrive
person-
neHement,
cen'estsrement
pas
tresurlabonneVMe
D~vo~ns~nous treinsensiblesau mondeextrieuret aux
choses
qui
nenoustoudMKt
pas
directement ?
Devons-nous
Mefessentir
ni
ioienipeinedecequisepasseaMtourdenous?
Celui
qui
veut
acqurir
taconnaissance
suprasemiMe
ne
doit
pas
chercherdevenirindiHrent la
vie,
maisil
doit
transformerl'intrt
particulierque
aon<inoi
porte
aa
propre
destine.Mest fort
possiMeque,
loincttdaibtM
sa
sensibilit,
cette-transformation
taocroisse,au
000~
tfa!<<e. ConAten
souvent,
aucoufsdelavie
ordtnmre,
l'me
ptk~u~
sur~n destin!EHe
pegtadopter
uneautMattkMde
et
prouverpoursapropMin~rtune
lemmetmtuoent
tt cetui~ci
peut
trevif
que hn imp~Eait
<ceMe
dautrm.
mqm
H
~stplus
facile
d'adopter
ce
pomt
deVMe
lzard
dea
64
vnements deladestine
qu'l'gard
des
facultsdonton
est dou.
Il n'est
pas
facile,
en
effet,
dese
rjouir
autantdutalent
qu'un
autre
possdeque
dufaitdele
possder
soi-mme.
Quand,par
l'exercicedelaconnaissance
de
soi,
on
s'efforce
de
pntrerjusqu'auxprotondeurs
les
plus
cachesdeson
me,
on
y
dcouvrebiendes
joiesgostes
l'idedes
capa-
citsqu'on
sereconnat. Unecommunion
intense,
frquente
<
(mditative)
avecla
pensequ'il
estIndiffrent
bien
des
gards
'au
progrs
delaviehumaine
que
cesoit
un
treouunautre
qui possde
certaines
facults,
peut
nous
fairefairede
grandsprogrs
dans
l'acquisition
ducalme
vritable
que
nousdevonsconserverenfacedeladestine
la
plus
intimedenotretre. Maisce
renforcement dela
viede
l'me,aumoyen
de
pouvoir
dela
pense,
nedo!t
jamais
nous conduire mousser
simplement
la
juste
apprciation
de nos
facults.
il nedoit
que
la
purifier
et
que
nousinciter
agir
enconformitavec
les,facults
dontnoussommesdous.
Et.cecinous
indiquedj
dans
quel
sensdoitse
dvelop-
per
lerenforcement delaviedel'me
par
l'exercicedu
pouvoir
dela
pense.
Grcecet
exercice,
nous
devons
apprendre
connatrece
qui
nous
apparat
comme
un
secondtreaudedansdenous-mmes. Cettreservlera
surtoutnoussi nousrattachonslamditation
d-dessus
quelques
rflexions
qui
nousmontrent
comment
noua
provoquons
nous-mmescertainsvnements
de notre
3
M
destine. Notredestine
d'aujourd'hui
n'est-elle
pas
souvent
lersultatdenosactes
d'hier,
et certainsvnements se
seraient-ils
produits
si nousn'avions
pasagi
d'une
faon
dtermine ?
Or,
danslebutd'tendrenotre
exprience
intrieure,
nous
pouvons
nouslivrerun
examen
rtros"
pectifde
notrevieetrechercher touslesf aits
qui
dmontrent
de
quelle
manirenousavonsnous-mmes
prpar
les
vnements
que
ledestinnousa
apportsplus
tard.Nous
pouvonsessayer
deremonterlecoursdenotreexistence
jusqu'l'ge
os'veilledansl'enfantlaconscience
qui
permetplus
tardl'hommedesesouvenirdesavie.S
nous
joignons
cetexamen
rtrospectif
denotrevieune
attitude
dpourvue
detoute
sympathie
et detouteanti"
pathiegoMtes,
nousnousdironsen
atteignant
cette
poque
denotreenfanceSans douten'est-ce
qu'partir
de cemoment-l
qu'il
m'at
possible
demeconnatre.
nol-mmeet detravaillerconsciemment mavieIn-
~rieure.
Mon
<mol~
cependant,
existait
auparavant. J e
navals
pas
conscience dutravail
qu'il accompHss~It
eh
mol,pourtant
il a
pudvelopper
dansmontrelafar
~J tdeconnatre
quejepossdeaujourd'hui
etfairede
jMMce
queje
suisdevenu?.Aucunraisonnement ne
peut
nousdonnercette
objectivit,
maisl'attitude
spcialeque
Musvenonsdedcrire
l'gard
denotre
propre
destine
wus la
procure.
Nous
apprenons
envisager
lesvnements
~av~c
calme,
nousles
voyons
veniravecdtachement et
nous savons
que
nouslesavonsnous-mmes
provoqus.
66
IjMsque
nouanoussommes rendusmatredecette
attitude,
tes
conditionsdeviedans
lesquelles
nousnaissonsnous.
apparaissent
Besnotremoi~lui"m@meDe
mme,
nousdisons"nous,
quej'ai
travaillmontredurantle
tempsqui
asuivil'veildemaconscience
actuelle, }'yai
travaillaussiavant
qu'elle
ne
naqut.
Ennous
(rayant
ainsiunevoieverslemoi
suprieur que
fecHelemoi ordinairenousreconnaissons
qu'outre
la
raison
qui
nous
oblige
reconnatre
thoriquement
son
existence,
noussommesamens
prouver
reMement e~
nous"m6messonactivit!vivante
etsa
puissance,
et
cons!"
drerlemoiordinairecommesacrature.Sentircett~
activitdu
moi,
c'est commencer
percevoir
l'entit
yw.
spirituelle
deFam.Si cesentiment nenousentrane
pa~
t d'autres
progrs
danslaconnaissance
spintuette,
c'est
que
noust'aurons
nglig
audbut.Il
peut
rester
longtemps
t t'tatdesensation
obscure,
peineperceptible,
ma!s~ s!
nous
poursuivons activement,!nerg!quement
le
travail
qm&
(aitnatreennousce
sentiment,
nous&urons
par percevo!r
lanature
spirituelle
del'me.Hestfacilede
comprendre
queceuxqui
n'ontaucune
exprience
danscedomaine
,t~
croient
que
le
clairvoyant
s'entrane
imaginer
unBaM
suprieurparsimpleauto-suggestion.
Maisle
clairvoyant
ait
que
cette
objection
ne
peutprovenir que
d'un
manque
d'exprience.
Car s'il a
accompli
srieusement tout k
travail
que
nousavons
dcrit,
il a
acquis
aussila
facult
dediscerner
l'imaginaire
durel.Les
preuves
etle
travaH
?
Int&ieur
qu'impliqua
le
plerinage
del'ime
d~veoppnt,
!orsqu'I!s
sontconsciencieusement
poursuivis,
une
pru"
denceextrme
l'gard
de
l'imagination.
L'homme
qui
travaUtedanslebut
dtermindecon"
jMtresontre
spirituel,
son
mo!
suprieur,
donneune
importance
essentIeNe
t'expArIence qui
a<t<
d~cnteBM
d~butdecette
mditation,
et
considrecelle
que
nous
avons
indique
ensuitecommeune
preuve
auxiliairedu
plerinage
de!'<me.
SEPTIEME MEDITATION
!J C
MDITANT ESSAYE DESEREPRSENTER LA
NATURE DES
EXPRIENCES
QUI
SONT FAITES DANS LESMONDES
SUPRIEURS.
Les
expriences que
doitfairel'medsireusede
pne"
trerdanslesmondes
suprasensibles
sont
susceptibles
de
rebuterbiendes
personnes.
Celles-ci
pourront
sedeman~
dkar
quellesconsquences
il
y
aurait
pour
elles
s'aven-
tuferaumilieudetels
phnomnes,
etcomment ellesles
supporteraient
Soust'InNuence dece
sentiment,
ellesse
diront,
sans
doute,
qu'H
vautmieux
pour
ellesdene
pasintervenir,
par
des
moyens artMidels,
d~nsle
dveloppement
de,
leur
tme,
et elles
prfreront
s'abandonneravecconfiance
unedirectiondontelles
n'ont
pas
conscience,
mais
qui
lesconduira
cependant
versunbutdtermin.
Cependant,
cette
opinion
ne sauraitsubsisterdMZ
tdm
qui
se
pntre
d'uneautreIdeetc'est
qu'il
est
dan~
tanaturedel'trehumaindese
dvelopper par
ses
propres
forces,
et
qu'il
serait
coupable
delaisser seStnrcesforces
qui
attendentdanssonmeleur
panouissement.
Les
pou~
voirsncessaires au
dveloppement personnelreposent
v:~
?
danstouteslesmes
humaines,
et
pas
unedecesmesne
peut
restersourdelavoix
qui
rdamel'doslon
dcs
pouvoirs,
ds
qu'il
lui atdonnde
l'entendre, et
d'tre
instruite,
en
quelque
manire,
surlanatureetsurla
porte
desforces
qu'ellepossde.
Aussi,
nul hommenesetaissera-t-lt dtournerdeMO
ascension verslesinondes
suprieurs,
moinsd'avoir
fauss
dsledbutsonattitude
l'gard
des
expriences qu'eSe
Implique.
Les
prcdentes
mditations ontmontren
que!
consistent ces
expriences.Pour
lesdcnreavec
exactitude,
n'yapasd'autremthode.lorsqu'onveutseservIrdeKMt~
~x-d tantforcment
toujoursemprunts
lavieord!"
naire.Carles
preuvesque
l'onsubitsurlavoiedela
connaissance
suprieure
ont
pour
t'&meune
protonde
analogie
aveccertains
sentiments,
tels
que
celui
d'uae
intense
solitude,
ou~etu!deBotterau-dessusd'un
ab&ne,
oud'autresencore: C'estdans
t'prouve
deces
sentiments
ques'engendrent
lesforces
grceauxquelles
nous
progrs"
sonssur lavoiedela connaissance
suprasensible.
Ces:
preuves
sontles
graines
d'onatront
plus
tardlestru&h~
delaconnaIssance.Chacuned'ettestIbreune
forceprotot~
dmentcachedansl'treet
qui
atteint,grce
elle,
son
plus
haut
point
detension.
Quelque
chose faitdatef
lesentiment desolitude
qui
enserrecetteforcecommeune
gaine,
etelle
apparat
danslaviedel'me
poury devemr
unin~rumentdeconnaissance.
M
importe, cependant,
de
remarquer quelorsqu'on suit'
70
lavoie
juste,chaquepreuve
surmonteenfaitimmdia"
tementet ncessairement
surgir
unenouvelle.
Mais,
en
mme
tempsquet'prouve,
la forcede la
supporter
estdonne
pourpeuque
l'onsesouviennedecette
force,
que
l'onrestecalmeet
que
l'ons'accordele
temps
de
reconnatre lanaturede
l'exprience qui
s'offret'me.
Si l'on
prouve
une
souffrance,
mais
que
l'onait en
m6me
temps
lacertitude
qu'il
existedesforces
pour
la
surmonter,
forces
auxquelles
on
peut
faire
appel,
alors
onarrivese
comporter
en
spectateur
vis--vis
d'preuves
qui
eussenttinsurmontables si dtestaient
intervenues
danslecoursordinairedelavie.Voilcomment il sefait
que
des
personnes engages
surlavoiedelaconnaissance
suprasensible
etdontlavieintrieureesten
proie
auftux
etau
reflux
detoutesces
vagues
de
sentiments,
fontpreuve
danslaviematrietted'une
parfaiteg~J it
d'me.Sans
doute,
il est
possibleque
certainsvnements deleurvie
intrieure
ragissent
surleurtatd'me
ordinairensorte.
que
momentanment
ellesne
parviennent pas
s'accorder
avecteur
propre
vieet avecettes'-mmes comme
ellesen
avaientle
pouvoir
avantde
pntrer
danslavoiedeh
connaissance. Maisellestrouverontdansles facults
intrieures
prcdemment acquisespar
leurmelaforce
ncessaireau rtablissement de
l'quilibre.
Il ne
peut
exister,
sur lavoiedelaconnaissance
rgulire,
aucune
circonstance ocet
quilibre
ne
puisse
tretrouv.
Lavoielameilleuresera
toujours
cette
qui
conduitau
.71
monde
suprasensible par
terenforcement oulaconcen~
trationdelaviedel'me
que
l'onobtient
par
lerecueille.
mentintrieuret
par
le
dveloppement
du
pouvoir
dela
pense
etdusentiment.
Maisla
manire
de
penser
etdesentir
propre
aumonde
sensible,
et
qui permet
des'orienterdansce
monde,
ne
convient
pas
au monde
suprasensible.
Pour atteindre
celui-ci,
il fautvivreintensment avecetJ a~Mune
pense
ouun
sentiment,
enconcentrant surcette
pense
ousur
cesentimenttouteslesforcesdel'me.Duranttoutte
tempsque
durela
mditation,
la
pense
oulesentiment
lusdoiventseuls
occuper
laconscience.
Mditons,
parexemple,
une
pensequi
nousa
apport
unecertaine
conviction
sansnous
proccuperpour
le
momentdelavaleur
logiquequ'ellepeutavoir,
revivons-la
incessamment,
de
faon
nousfondre
compltement
avec
die. Il n'est nullementncessaire
que
cette
pense
ait
traitauxchosesdumonde
suprieur,
bien
que
cesder.
mtresse
prtent
mieuxce
genre
demditation.
L'objet
denotremditation
peut
tre
emprunt
une
exprience
ordinaire. Fcondes
sont,
parexemple,
lesrsolutions
que
nousformons
pourl'accomplissement
d'actesd'amouret
qui
nousenflamment desentimentshumanitaires
proton"
dmentsincres.Maiss'il
s'agitprincipalement
del'ac~
quisition
decertaines
connaissances,
alorssont seules
efScacesdes-
reprsentationssymboliquesque
nous
empruntons
la
vie,
lalittrature
occulte,
ou
auxquelles
72
nousnousadonnonssurleconseilde
personnes
comp-
tentesences
matires,
ayantprouv
ettes-mmes t'etS-
cadtdes
moyensqu'elles
nousoffrent.
Cette
mditation,qui
doit devenir
pour
nous une
habitudeetmmeunecondition
vitale,
au
mmetitre
que
la
respirationindispensable
la vie du
corps,
nous
permet
deconcentrer lesforcesdenotre
me
etdelesac.
crotredecefait.Maisnousdevonsarriverce
que,
durant
le
tempsque
nousconsacrons la
mditation,
aucune
-impression physique,
aucunsouvenir mmedeces
Impres"
siensne
pntre
danslaviede
t'me.~Tous
lessouvenirs
ayant
traitdesvnements del'existence
ordinaire,
toute
jde
ettoute
peine
doivent
galement
faire
silence,
a6n
que
notremenesoit
occupeque
duxul
06~~Me
nom&
oco~M
zfy~MenoM~m&ne.
Le
justedveloppement
desforcesdelaconnaissance
suprasensible
doit
dpendreuniquement
dela
mditation,
mditationdontondterminesoi-mme
l'objet
ett~
forme
par
l'exercicedeson
pouvoirpersonnel.
Lasourcedela
mditationn'est
pas
l'essentiel,
t'essentlet est det'avoir
Imposepar
sa
propre
volontsavieintrieureetdene
pas
s'trelaissdterminer
par
des
impulsionsqui
n'"
manent
que
det'meelle-mmeet la
portent
choisir
t'objetddsa
mditation. Cet
objet
n'aurait
quepeu
de
force,
parceque
t'mesesentiraitde
prime
abordenafS-
nitaveclui et
n'aurait,
en
consquence,
aucuneffort
faire.
Or,
c'estdans
r<~or~que
rsidel'lmenteHicace
n
au
dveloppement
des
pouvoirssuprasensibles
delacon"
naissance etnon
point
dansl'tatd'unionavec
l'objet
de
lamditation.
D'autres
moyenspeuvent
conduirela vision
sup~"
sensible.Certaines
personnes,
douesd'une
disposition
naturellela
mditation,
peuvent
atteindred'e!ks"m&nes
untatdeferveurIntrieure
qui
libredansleur<me
certains
pouvoirs
deconnaissance
suprasensible,
Cestatssemanifestent souventd'unemaniresou"
dainechezdes
personnes qui
semblaient ne
pasy
tredes-
tines.
Lavie
supraphysique peut
semanifester souslesformer
les
plus
diverses. Maisonn'arrivetrematredeson
exp"
rience,
commeonestmatredesoidanslavie
ordinaire,
qu'en
suivantlavoiedeconnaissance
que
nousavons
dcriteIci.Touteautreinterventiondu monde
spirituel
danslavie
deTme
s'Impose
comme
par
violenceet
gare
t'tre,
ou
t'expose
toutessortesd'illusionsconcernant
tavaleuret la
signification
rellesdeses
expriences par
rapport
aumonde
suprasensible
vritable.
Rendons-nous bien
compteque
t'mesetransformesur
lavoiedelaconnaissance
suprieure.
Elle
peutn'avoir,
danslavie
ordinaire,
aucunetendance
succomber aux
illusionset
devenir,
cependant,
leur
proie
aussitt
qu'ette
abordetemonde
suprasensible.
Ii se
peut, galement
qu'elle
soitdouel'ordinaired'unsensexactdesraMa
et
qu'elle
sinterdise de
juger
des
chosesoudesvnetnent~
74
d'aprs
ses
penchants personnels. Malgrcela,
il
peut
arriver
qu'elle
nevoiedanslemonde
suprasensible que
ce
que
lui
suggre
sa
personnalit.
N'oublions
pas
la
partque
celle-ci
prend
nos
perceptions.
Nous
voyons
les
objetsqui
l'at-
tirent.Nous
ignorons que
c'estelle
qui dirig
notre
regard
spirituel,
et,
tout
naturellement,
nous
prenons
notrevision
pour
laralit.Il n'existe
qu'un
seul
moyen
denous
pro-
tger
contrece
danger
c'estdenousentraner
par
une
volontsoutenuedesol-connaissance unexamende
plus
en
plus
consciencieux denousmmes. Nousnousrendons
exactement
compte
alorsdelamesuredans
laquelle
notre
Aneest
personnelle
et dusensdans
lequel
semanifeste
sa
personnalit.
Si,
durant notre
mditation,
nous concentrons notre
attention avec
nergie
et sans
mnagements
sur les
points
o notreme
risque
desuccomberses
penchantsperson"
-nels,
nousarrivons
peu
peu
l'endlivrer.
Pouravoirunerettelibertdemouvements dansles
mondes
suprieurs,
il
faut
que
l'meaitreconnucombien
plusgrande
estdanslemonde
spirituel
la
porte
der~
taines
qualits
del'tre
et,
en
particulier,
t
des
qualits
morales. Danslavie
physique
on
distingue
leslois
natu..
rettesetlesloismorales. Cesderniresnesauraientex-
pliquer
lecoursdes
phnomnes
naturels.Une
plante
venimeuse
s'expliquepar
desloisnaturelleset n'encourt
aucune
condamnation
morale.C'esttout'au
plus
si l'on
peutparler
d'unrudiment demoraledanslemonde
animal,
75
bien
qu'a
vrai direcettesorte
d'apprciation
nuise
plutt
l'exactitude
del'observationdanscedomaine.Ence
qui
concernel'valuationdela
vie,
le
jugement
moralne
coma
menceavoirunsens
quelorsqu'ils'applique
aux
rapports
deshommesentreeux. L'homme
qui
parvient
estimer
objectivement
sa
proprepersonnalit
fera
toujoursdpendre
savaleurdu
point
devuemoral.Mais
jamais
unobser"
vateurconsciencieux delaviedanslemonde
physique
ne
rapprochera
lesloisnaturellesdesloismorales.
Ds
que
l'onabordelesmondes
suprieurs,
le
point
de
vue
change.
Pluscesmondessont
spirituels
et
plus
teslois
morales-seconfondentavecce
que
l'on
peut appeler
les
loisnaturellesdecesmondes.Danslavie
ordinaire,
ona
consciencede
s'exprimerImproprementlorsqu'on
dit
d'une mauvaiseaction
qu'elle
brute. On
n'ignorepas
qu'une
brturerelleneressemblerait
pas
lasensation
que
l'oncherche rendre.Cettedistinctionn'existe
pas
pour
lesmondes
suprasensibles.
L,
lahaineet la
jalouse
sontenmme
temps
desforcesdont leseffets
peuvent
tre
appels
les
phnomnes
naturelsde ces mondes.
L'treha ou
jalous
exerceuneactionen
quelque
sorte
dvoranteouannihilantesurcelui
qui
lehaitoule
jatouse
il enrsultecertains
processus
destructifs
qui atteignent
l'tre
spirituel.
L'atnour
produit
danslesmondes
spin"
tuetscommeun
rayonnement
dechateurfcondanteetbien"
faisante.
Ceseffets
peuvent
treobservsmmedansle
corps
76
lmentairedel'homme.
Auseindumonde
sensiblela
main
qui accomplit
unacteimmoralobit
exactement
auxmmesloisnaturelles
que
la main
qui
se livre
uneactionmorale.Par
contre,
certaines
parties
de
t'tre humainlmentairene se
dveloppent pas
en
l'absencedecertaines
qualits
morales. Et le
dveloppe"
ment
imparfait
des
organes
lmentaires est
imputable
certaines
proprits
moralesde
t'tre,
exactement comme
les
phnomnes
naturelsdumondesensible
s'expliquent
par
desloisnaturelles. Maisil fautbiense
garder
decon"
duredelamalformation d'un
organephysique
cellede
sa
contre-partie
lmentaire, Il nefaut
jamais
oublier
que
lesloisdiffrent absolument d'unmondel'autre.Telle
personnepeutpossder
un
organephysique
dfectueux
et
l'organe
lmentaire
correspondant peut
trenonseu"
lement
normal,
mais
parfait
danslamesuremmeo
t'organephysique
est
imparfait.
Ladiffrence
qui
existeentrelesmondes
suprasensible
et lemonde
physique
se
marque
d'une
faon
toute
particulire partout
ointerviennent lesnotionsdebeaut
et delaideur.
L'usagequ'on
faithabituellement deces
termes
perd
toute
signification
ds
qu'on
abordeles
mondes
suprieurs.
H onne
peutappeler
beau,
si on
sesouvientdusensdecemotdanslemonde
matriel,
qu'un
tre
qui parvient
rvlerauxautrestresdeson
mondetoutce
qu'il~roM~e bwn&ne,
demanirece
que
lesautres
puissent
lesentir.- Lafacultdesemanifester
77
toutentieravectoutce
qu'onporte
ensoi et sansnon
dissimuler,
peut
tre
appele
la
beautdanslesmondes
suprieurs.
L'Idedebeaut
s'y
confondabsolument avec
cettedesincrit
absolue,
d'expression
totaledet'tre
Intrieur. Etl'on
peutappeler
laidt'tre
qui
refusede
rvlerson&medansson
aspect
extrieur,qui
renferme
ensoi sa
vie
relleet dissimule
certaines
qualits.
Cet
tresesoustraitson
entouragespirituel.
Lanotionde
laideurrecouvreainsicelledefaussetdans
l'expression
desoi.Danslemonde
spirituel,
mentiret trelaidsont
synonymes,
ensorte
qu'un
trelaidestuntre
menteur.
De
mme,
ce
que
nous
appelons
les
apptits,
lesdsira v
danslemondedes
sens,
ontune
signification
toute
dift"
rentedanslemonde
spirituel.
Lesdsirsnenaissent
pas
danst'me.Les
passions
s'allumentau
contactdes
objets
extrieurs. Untre
qui
sesent
dpouvu
d'unecertaine
qualitque
sanaturesemblerait
impliquer
a tavision
d'unautretre
quipossde
cette
qualit. Qu'Ule
veuIMeou.
non,
cettreest
toujours
devant
!~u.
De
mme,
que
damte
mondesensiblei'H
peroit nature!!ement~out!evIs!Me~d~
mmedanslemonde
suprasensible
l'absenced'une
quaHt
chezuntreentraineconstamment celui-ci dansle
voisina~
det'tre
qui
la
possde,
etcettevisionluidevient uncont!~
nuel
reproche.
Uneforcerelleenrsulte
qui
s'exercesur
Ftreet
qui
veilleenlui ledsir
d'acqurir
cette
qualit
qm
lui
manque.
Cedsirn'ariendecommunavecceux
que
nous
prouvons
danslemonde
physique.
7$
Ces
phnomnes
nenuisentenriennotrelibrearbitre
dansle monde
spirituel.
Nous
pouvons
nous
protger
contrel'tremodle
qui
attirenotre
regard.
Nousnous
teignons
alors
peu
peu
delui.
Cependant,
en nous
en
dtournant,
nousnousexilonsnous-mmesdansdes
rgions
olesconditions deviesont
pluspniblesque
dans
lemonde
auquel
noustionsdestins.
Toutesceschosesdmontrent
que
les
reprsentations
deFamhumainedoivent
changer lorsqu'ellepntre
dans
ledomaine
spirituel.
Onne
peut
dcrireavecexactitude
lemonde
suprieurqu'entransformant,
en
largissant,
9
entondantcertaines
conceptions.
C'est
pourquoi,
lors-
qu'onemploie
sanslesmodifiercertains
concepts
cr?
pour
l'existence
physique,
onn'atteint
qu'
des
descrip-
tionsInexactes. Il estnoter
que,guidspar
notreintui-
tion,
nous
employons parfois,
dansunsens
plus
oumoins
symbolique,
oummedansleursens
propre,
des
expres-
sions
qui
netrouventleur
pleine
valeur
que
dansles
mondes
suprasensibles.
Certaines
personnes
sententrel-
lementlalaideurdu
mensonge. Cependant,compares
la
ralitqui
leur
correspond
danslemonde
spirituel,
ces
expressions
ne
reprsentent malgr
tout
qu'un~
cho.
Cetchoestdaufait
que
touslesmondessontlisentre
eux,
et
que
leurs
rapports
sontobscurment
sentis,
incons-
ciemment
conuspar
l'hommeaumilieudesonexistence
matrielle.
Rappelons-nous
quemensonge
n'implique
nul-
lementlaideurdanslemonde
matriel,
bien
qu'il puisse
7~
nousendonnerlasensationet
que
ceserait
confondre
deuxnotions
que
devouloir
Interprter
lalaideur
par
le
mensonge.
Au
contraire,
lorsqu'ils'agit
des
rglonssupra"
sensibles,
onestendroitdelefaireetle
mensonge, quand
ondvoilelaralit
qu'il
dissimule,
s'imposepar
lalaideur
deson
expression.
Ici encoreil fautse
garder
decertaineserreurs noua:
pouvons
rencontrerdanslemonde
spirituel
tel tre
qui
mrited'tre
appel
mauvaiset
qui
se manifestesous
un
aspec~que
nous
qualifierons
debeausi nous
tuiapptl"
quons
lanotiondebeaut
qui
est
propre
l'existence
sensible.Dansce
cas,
nousn'auronsla visionexacte
de l'treen
questionquelorsque
nousdcouvrirons le
tonddesanature.Alorsnousreconnatrons
que
la
beaut
de
l'apparence
n'tait
qu'unmasquequi
ne
correspondait
pas
l'etre
vritable,
etce
que
noustions
disposs
appder
<beau~selonles
conceptions
delavie
physique,
nousta
~uaMerons
de
laidavecd'autant
plus
de.
conviction
Or,
dsl'instantonousatteindrons ce
point
de
vue,l'tre
<
mauvais
perdrapour
noustout
pouvoir
de
simulerta
<
beaut Nous
l'obligerons
nousdvoiler son
apparence
vritable
qui
ne
peut
tre
qu'uneexpressionImparfaite
desonme.
Ces
phnomnes
dmontrent clairement
quelle
trans"
formationdoiventsubirlesnotionshumaines
lorsqu'on
abordelesmondes
suprasensibles.
M
HUITIEME MEDITATION
LEMDITANT ESSAYE DESEFORMER UNEREPRSENTATION DE
LA SUCCESSION DESVIESTERRESTRES.
Quand
le
plerinage
del'medanslesmondes
spirituels
estsoumiscertaines
rgles,
il ne
peutgure
tre
question
de
dangers.
Lebut
que
se
propose
l'hommeen
poursuivant
ce
plerinage
neserait
pas
atteint,
s'il
y
avaitdansles
instructions
spirituellesqui raccompagnent quoique
ce
soif
qui puisse
trenuisible. Son
objet
constantestbien
=.
plutt
defortifier
l'me,
d'enconcentrer les
forces,
afinde
lui
permettre
de
supporter
les
preuvesqu'elle
doittra~
verseravantd'arriver&voiret
comprendre
d'autres
mondes
que
celuides
sen~
physiques.
Lesmondes
suprieurs
se
distinguent
essentiellement
dumonde
physique
ence
qui
concerneles
rapportsquy
prsentent
entreelleslesfacultsde
voir,
desentiretde-
comprendre. Quand
onnous
parle
d'un
objet
dumonde
des
sens,
d'un
paysage
oud'un
tableau,parexemple,
noua
avonslesentiment trs
justifique
nousnele
comprendrons
rettement
quelorsque
nousl'auronsvu.
On
peut,~arcontre,
arriver
comprendre parfaitement
M
tesmondes
suprasensIbes,
sentirtout ce
quih
eon~
tiennentdeforcesfcondeset
vivifiantes,
en coutant
tes
descriptions qu'en
donnentceux
qui
!es
voient,pouf
peuque
ces
descriptions
soient exactes et
qu'on
lesaccueIBe
dansunespntdeparfaIteImpartIaHt.SeubtesdaIrvoyants
peuvent
avoirdecesmondesunevision
directe,et c~est
toujours
d'eux
que
doit
maner,
endernire
analyse,
tou~e
description.
Maislesconnaissances retadvescesmondes
connaissances
qui
sontncessaires laviede'tme
peuv~it
s'acqurirpar UntetIIgence.
H est tout fait
possIMe
d'arriver,
sanslesobs~rv~r directement
sol~tntme,
t comprendre parfaitement
cesmondesdanstoutce
quih
cot d'essentle!. Touteme
doit,
danscertainescond!~
J Sons,
dsirerlefaire.
Vol!
galement pourquoi
nous
pouvons
trouverdans
tesconnaissances
quenousacqurons
concernant tesmondes
~pMtuds.un
objet
demditation. Puiscette
source!
~itBCa
suprieur
tout~utre
objet,
et nousconduira
p!us
L~af~~aNMdnt~Mit~ut
quenous poursuivons.
&nefaut
pas
craindre
que
lefaitd'avwr
compris
<ees
t~~
avantdeles
contempler
nuiseensuite
t t'acquis!-
Non
dela
perc~tionsuprieure.
Au
contraire,
onatteint.,
beaucoup plus
srement
et
plusrapidement !aclairvoyance
t~squ'on
lafait
prcder partintem~en~e.
Onsecontenter
~~h~XMnprendre,
on
aspirera
percevoir
selon
que
sesera
t; faitjouarensoi
1 dsirde)' L---a.!
elle J h~~
fait
jour
ensoltedsirdel'observation
personnette,
~Mtqu'H
sommelHera encore. L'hommeen
cru!cedsur
M
s*t~veillne
pourra
pas
faireautrement
que
dechercher
Foccasion
d'entreprendre
lui-mmele
plerinage
des
mondes
spirituels.
Quant t'inteltigence
deces
mondes,
unnombred'tres
sanscessecroissant ladsireront. L'ob"
aervationexactedes
tempsprsents dmontre,
en
effet, que
lesAmesentrent
aujourd'hui
dansdesconditionsdevie
tettes
que,
sansla
comprhension
desmondes
suprasen"
sibles;
ellesne
peuvent~ho
s'accommoder lavie.
Quant
l'hommeaatteintle
point
deson
pcierinage
c<
toutce
qu'ilappelait
son
moi son
tre,
dansl'existence
physique,
lui devient
pareil ,un
souvenir
qu'il porterait
eAson
esprit,
etohilsesentvivrelui-mme dansun
moi
suprieur
dsormais
conquis,
alorsil
acquiertgalement
lafacultderemonter lecoursdesavieaudeldesborner
que
lui
assigne
l'existence
terrestre.!
Son
regardspirituet
dcouvreuneautrevie
quiprcda
auseindumonde
spi~
rituel celle
qu'il
vitencemomentsurlaterreet dans
laquelle
il doitchercherlescausesdterminantes decette
dernire. Ses
instincts,
sesfacultssesontlaborsdans-
lemonde
purement spirituel
oil vivaitavant
que
nelu!
fut
octroy
le
oorpsphysiquegr&ceauquel
il a
pnbpt
~ianstemondedessens.L'tre
spirituelqu'il
tait M~
mmedsirait devenir lacraturedouede
sens,
defacutt~
mentales,
decaractres
psychiques qui
s'est
dveloppe
depuis
sanaissance.
?
Neditespas
c Comment
ai~jepu
dsirer,
danslemoo~e
SBirituet,
desfacultsetdesinstincts
qui,prsent,
ne<ne
t~Ment
nuttement ?~
Ce
qui ptat
ramedanssontat
physiquenimportepoint.
Danslemonde
spirituel
ses
Mp!"
rations
mot
dtermines
pardespointsde
vuetrsd!<!t-
rentsde
ce~x
qu'ellepourra
avo!r
plus
tard,
danslemonde
dessens.
D'unmonde
l'autre,
laconnaissance etlavotent
changentrad!cstement
denature.Durantsonexistence
spintuette,t~tme
reconnat
que
sonvolution
gnrak
exige
unevue
physiquequi pourraplus
tardlui
paratre
dplaisante
ou
pnible
c'est
elle,
cependantqui
Fa
vutue.
Car,
danslemonde
spirituel,
ellenese
proccupe pas
de
ce
qui
lui est
agrableousympathique,
elleneconsidre
que
ce
qui
estutile
t*<~Mmou!ssement
desontre.
lenestdemmedeladestinelemditant l'examine
etreconnat
qu'il
t'a
prpare
tui-mme durantlavie
spM"
tuetb,
avectoutce
qu'ettecomporte
de
joies
etde
peines.
tLMB~n~<Bi!atac<ta<<~MMMHt<pNcw~dh~efnin
tebon<'
tteuroulemalheurdesavieterrestre,Ici encorefhonMaa
quineseconna!tquedanstemondedessenspourranepa<s
comprendrequil
ait
provoqu
lui-mme
cortaines
condir
tions.Danslemonde
spirituel,
il taitdoudece
queFon
pourrait
appeler
une
intettigence suprasensibte
qui tui a
command de
supporter
telledestine
pnIUe
oudouiou~
teuse,
parcequ'ettepouvait
seulelef aire
progresserdans
ton
volution. Le
jugement
ordinairedelavieterrestre
$4
est
Incapabled'estimer
dans
quette
mesureune
emtence
jha~avancert'6tresurlavowdel'volutionhumaine.
Delaconnaissance del'tat
spirituelprcdant
lavie
terrestredcou!e!avuedesra!sonsqu!,danscettatsp!ntuet,
ontfait
rechercher uncertaincaractreetuncertaindes"
tin
pour
l'existence sensIMe. Cesraisonsnousconduisent
lavued'uneexistence antrieurevcuedansle
pass.
Cdte~
oa
comport
une
destine,
des
expriences,
ellea
dvelopp
onnouscertaines
qualits.
Durantl'tat
spirituelqui
lui
$
succd,
nousavons
aspir
parfaire
nos
expriences
~restes
incompltes,
dvelopper
nosfacultsdemeures
imparfaites.
L'injusticeque
nousavonscommise
Fgard
d'unautretrenousest
apparue
comme
untrouble
apport
par
nousdansl'ordredumondeet nousavons
prouv
tancessit deretrouver dansunevieterrestrefuture
r@tre
ts.a&n
de
rparer,par
les
rapportsque
nous
tab!!nons
avec
lui,
lemal
que
nousluiavonsfait.
A mesure
que
se
poursuit
le
dveloppement
dpt'&nM,
son
regard
embrasseunnombrecroissant deviesant~
Mures.Elle
acquiert
ainsiuneconnaissance
expnmentah
v
du.
cours
retdelaviedu<moi
suprieur.
Cetteviese
poursuit
traversdesexistencesterrestres
successives~
rparespar
tes
priodespurementspirituelles, qui
ont
an
rapport
dtermmaveclesIncarnations terrestres.
La successiondesviesterrestresdevientainsiunfait
tel d'observation.
(Dans
leseulbut de
prvenir
certains
malentendus
qui
se
reproduisent
sans
cesse,rappelonsu<~
<
fait
que
t'entrouve
plus
exactement
expos
dans
met
autres
ouvrages
laviedet'trehumainnesersume
paE
enunesuccession ternelled'existences terrestres. Cdtes~
se
rptent
uncertainnombrede
fois,
maisellessont
pr~
cdesetsuivies
par
d'autresformesdevietrs
diffrentes
decettes~ci. Cet~isembte
reprsente
unevolutionem~
premte
dela
plusgrandesagesse.)
Lefait
que
l'hommevolue&traversdes
existences
successives
peut
trereconnu
par
laraison
qui
s'apptque
t l'observation delavie
physique.
Dansmes
Kvres,
7'A&
<~M
etLa~CMnce occ~~et dans
plusieursopuscMtes,
j'ai essay
dedonnerdes
preuves
delasuccession desv!es
deTiomme etdes
rapportsqu'elles
ontentre
elles,
en
me
conformant
auxmthodes
scientifiques
deladoctrinevoh~
t!onmste
moderne. J 'ai
voulumontrerdansces
ouvrai
commentune
pense
vraiment
logique,
allant
jusqu'au
boMt
de
tTnvestigation scientifique,
arrivencessairement tran~
fomeT,
ence
qui
concerne
l'homme,
fide
voutionnMte
qu'ontdvetoppe tes temps
modernes,
et
considref
sonentit
vritable, son
individualit
psychique
commeun~
dMsequivotuetraversdesviesphysiquesrptescdtes-~
wttenMnt avecdes
priodes
de
purespiritualit.
Les
preuves
quel'ai
donnesdecette
vritdanames
ouvrages
sont
~dtemment
susceptibles
d'tre
grandement
dveloppes
et perfectionnes.
Mais
je
crois
pouvoirprtendrequ'eBes
p~MMent,
au
point
devuedela
connaissance, et
dansteuf
doBnaine,
estactement lammevaleur
que
ce
que
FoNt
M
appelle
ailleursles
preuvessdentinques.
Tout,
dansla
sciencede
l'esprit,peuts'tayer
surdesemblables
preuves.
Sansdoutecelles-ci sont-ettes
plus
difficilement
acceptes
que
cellesdessciences naturelles. Ellesn'ensont
pas
moins
rigoureuses.
Seulement ellesn'ont
pas
leurbaselefait
nmtnet
qui
fait
accepter
sansdinicuttles
preuves
des
sciencesnaturelles. Maiscettediffrencenemodifieen
rienleurvaleur.Et
quiconque
estenmesurede
comparer
Impartialement
les
preuvesque
donnentlessciencesna-
tureBeset cellesde mmenature
qu'onre
la sdence
1
spirituelle,pourra
seconvaincre
qu'elles
ont la mme
porte.
Aux
descriptions que
t'observateur dumonde
spi~
ritueldonnedelasuccession desviesterrestresviennent
donc
s'ajouter
ces
preuves
et,
t'aidedecesdeux
facteurs,
on
peut,par
la
simple
rflexion,
acqurir
danscedomaine
unecertitude.
Ici,
nousavons
essayd'indiquer
lavoie
qu'il
fautsuivre
r
pouratteindre,
par
detla
comprhension,
lavision
spi-
ritudiedelasuccession desviesterrestres.
APPENDICEA L'EDITIONDE t9t8
Il rsultedes
principesexposs
dansla
deuximede
ces
mditations,
encore
davantage
danslesmditations su!"
vantes,
que
lamthodeintrieuredontil est
traitd~ns
cet
~critexclutabsolument
etrsolument toute
clairvoyance
reposant
sur des
phnomnes
morbidesou
anormaux
<ie
l'organismephysique.
Visionnaires et
mdiumsn'o~t
len
taireaveccettemthodeIntrieure.
t
Les tats
d'Ame
auxquels
ondonnelenom
dedai~
voyance
instinctivesont IsMM
d'uneconstitution!nt~
TMurede
l'hommeauregard
de
laquelle
la
prccpttoo
'sensibleet l'entendement
appuyssur elle reprten~t
im
domaine
trs
suprieur.
Par
cetteperceptionet ~et
entendement
on vit
davantage
dans
1~
monde
<upn~
sensible
et l'on
dpend
moinsdu
corpsque
d<Hmtu
tats
o un
drangement
de
l'organisme
fait
miroiter
levant
ramecertaines
impressions
drivesde
phno~
mtnes
qui
devraienttre utilesau
corps,
mais
ont~t<
pathologiquement
dtournsdeleur vraie
nature.
!b
<
ont ams!conduit
des
reprsentations qui
n'ontleur
baseni dansune
perception
extrieure,
ni dans uneact!~
vite
propre
duvouloir.
t~rmi lesactivitsde
t'me,
prsentes
laconscience
nohnateil
n'y
a
que
la
pensequi puisse
selibrerdela
perception
etconduireuneactivit
indpendante exempte
detoutdsordre
organique.
Cen'est
pas
dansles bas
tatsde
l'me
cen'est
pas
danslestrtondsde
l'orga-
nisme
que
rsidece
que
nous
appelons
Idla
clairvoyance
mais,
aucontraire,
c'estdanslesdomaineslevs
qui
s'ouvrentdevant
la
pense.
Intrieurement Illumine
par
l'meet domine
par
lavolontIndividuelle. C'est
decette
pense,
matressedesol-mme
que
l'mefait
}a!BIr oeque
nous
appelons
clairvoyance
La
pense
Mftdemodlela
perceptionclairvoyante.
Ce
qui
est
dcritdanslesmditations souslaformede
clairvoyance
se
distingue
radicalement
dela
simplepense.
C'estune
activit
qui
conduit
l'homme des
exprience~
d'un
caract~
cosmique
o~
l<t
simplepense
nesaurait
accder,
matslav!e
que
l'me
dveloppe
danscette
clairvoyance
n'est
point
autre
que
celle
qui
lui
appartient
dansh
pense.
Aveclam&medaire~onsclence
que
l'mevit dana
tes
penses,
elledoit vivreaussi dans ces
comemplations
ttces Illuminations.
Lesrelationsdel'meavecces
contemplations aont~
j~~M~B~H~yut
autres
<quMB<piayMl<dIe
aaffaireaux
sunptes
penses.Bienque
tes
dans
l'meentreunecon~
v
teinplationclairvoyante
et laralit
correspondante
re~
semblentaux
rapports
d'un souvenirordinaireavec
l'exprience voque, cependant
il
y
adansla
contempla-
tioncecaractreessentiel
que,pendantqu'ette
est
active,
la
forcedusouvenircessedes'exercerdansrame.
Lorsque
!'onaformdanst'meune
simplen~r&a~
tationonest
toujours
matredela
rappeler,
m&nes!etk
tait
purementImaginaire;
au
contraire,
ce
que
t'ena.
perupar
la
clairvoyance
s'effacedelaconsciencela
minutemmeocessela
perceptionclairvoyante,
moins
qu'
laforcede
percevoir sajoute, par
le
dveloppement
Intrieur,
lafacultde
reproduire
danst'meet volont
lesconditionsncessaires&la
perception, clairvoyante.
On
peut
sesouvenir decesconditions
et,
par
l,
renouv~
lerla
perception,
maisonne
peutpas
sesouvenir !nMn6-
diatement dela
perception
mme.
Quiconque
estanriv
.rneintmitionnc~aaireceschoseatrouvedtns
o~
~meIntuitionncessaireces chosestrouvedans
ceMe
Intuitionun
moyend'prouver
laratitdes
phnomnes
w
qui correspond
la
perceptionclairvoyante.
De
nAnt
qu'on
sesouvientd'unesensationoud'une
eaqpMa~
",maisque,par
le
souvenir,
onneressuscite
pa
le
conteftu;
mais
que, par
le
souvenir,
onneressuscite
pas
lecontienM
delasensationoude
l'exprience
en
question,
de
mjhn~
ce
qui
demeuredela
contemplation dairvoyante
dans
lesowenirn'est
tM~(~b~Bt<~Bla<N?nte~n~jhdic~~e~~a<zne~
On
peut
aussireconnatre
que,pasplusquetapercept!oa
seMlHe,
la
contemplation
n'est une
simple
IBusMM. !1
y
auneralit
qui
lui sertdebaseetles
espritsqu!
sont
90
InsunMamment familiersaveclesloisde la
clairvoyance
et
qui jugent
extrieurement
d'aprs
leurs
prjuges
tom~
tent, !r
cet
gard,
dansuneerreur ilscroient
queles
phnomnes qui
se
produisent
danslaconscience clair-
voyantepeuventreposer
surun
jeu
de
l'Imagination,
ou
suruntissude
reprsentations
manesdes
profondeurs
det'mecommed'obscurssouvenirs. Ceux
qui portent
ces
jugements
nesavent
pasque
laconscience vraiment
~tairvoyante
ne
s'appliquequ'
destatsd'me
quijamais
ne
peuvent
sourdredes
profondeurs
de
l'organisme,
et
dont lecaractreest d'tresoustraits l'actionde la
mmoire.
Uneautre
particularit
dela
clairvoyance
est
qu'elle
se
distingue
detavieintrieurenormale
par
descarac~
tristiquesimportantes.
Danslaconscience
ordinaire,
l'exerciceet raccoutunMmce
jouent
un
grand
r8!e.
Qui"
conquerptefrquemment
une activit
intrieure
acquiertpar
lla
possibilit
des'en
acquitterpl. par-*
fa!tement. Caserait
leprogrs
danslavieet dans
fart ?
Comment l'instruction
serait-ettepossiMe
si cettehabilet
ne
pouvaitpass'acqurirpar exercice?
Il
n'y
a rien
desemMaMe
dansrassimitation
desconnaissances dues
la
ctMn~yance.
Ce!ul
qui
faitune
exprience
dan~tes
mondes
suprieurs
nedevient
paspar RptushaMtepour
laMreunedeuximefois.Au
contraire,
dufait
qu'i!
Fw
raliseune
fois,
elle
s'loigne
de
lui,
ellechercheen
quelque
sorte&!efuir,et
il luifaut
recourir untravail
M
de
Fam
qui
lui
permette
de
disposer
d'unetore
ptut
puissantepour
laseconde
expriencequepour
ta
~pn~
nnre.H
y
adanscetteloiunesourced'ambres
dceptions
pour
lesdbutants.Par desexercicesenectusdansle
sensdecetcriton
arrive,
avecunefacilit
relative,
aux
expriences suprasensibles.
Onse
rjouit
alorsdu
progrs
accompli,
maisl'on
remarquerapidement que
les
exp"
noncesnese
reproduisent pas.
Onsesent l'me
vide,
visvisdu
suprasensible.
Il
importeque
l'onse
j~ntre
delaventsuivantelesmmesefforts
qui
ont
produit
une
premire
foisunrsultatnesuffisent
pas
uneseconde
fols.
il enfautde
plusnergiques,
souventdetoutdl~"
tents.
Il fautae
pntrer
del'ide
que
lesloisdumonde
~up"
rieur
sont,
dansbien
des
cas,
dMrentesdeslois
phy~
slques,
voiremme
compltement
contraires
maisNne
faut
cependant pasen
conclure
que
l'on
acquiertlaeen~
naissance
suprieureuniquement
enfaisanttoutleeon"
tnMredece
que
l'onfait
pouracqurir
la
connaissance
sensible.
il fauttudier
chaque
casIndividuellement
pour
savoircomment vontleschoses.
Un troisimecaractrede
J t'expnencesuprasensible
est
que
lesvisionsnes'clairent devant
la
conaaence<tue
pendantun
espace
de
temps,peineapprciable.
On
~peut
d!r<e
qu'au
moment
oelles
surgissent
elles
sontd~t
parties.
Parsuiteil fautune
prsenced'esprit
et uneaMen~
tien extrmement
rapidespour
lesremarcMer. Enl'absence
tion
1991 ment-
rapidu
pour
les
I'bmbie
?
deces
qualits
onabeauavoirdes
visions,
onn'enUre
aucune
science. Telleesttaraison
pourtaquettel'existence
dumond~suprasensibteestniepartamaioritdestMmmes~
L'eaqpAriencesuprasensibte
est,
en
ralit,
beaucoupplus
rpanduequ'on
ne!ecroit t'ordinaire. Les
rapports
de
t'hommeavec le
mondespitituet
sontun
ph~nomtnegn~M!;
n~aMt!aihMnih~~ktran<forn~er CM
rapports
en
connMMance
par
la
promptitude
deFattenttonestune
facuttdiftiote
acqurur.
Ch
peut t'y prparer
dan$la vie
quot!"
d!emMen ~'accoutumant &
paMerrapidement
t'ac~on
<Kpft<
un<aoMnen
rapide
d'unesituation.Cetu!
qm,
au
coatMM~
daM~ofcoMtanceadelavie
ctwngeconstam-
mentderaotudonet
perd<ontemp<
aed!re <doM~e
ou
nedoM~je pa$?
se
prpare
aussimat
quepoMtUe
robaefvat!on
dumonde
apmtuel.
La
pr&ence
d'eapnt,
quand
eBkeBt
dveloppe
dansla
vie,
se
transporte
dan
tesact!v!t<s
cta!rvioyante&
oelleestde
prenutre
n<cess!t.
S tesiacutt&nAoessAures la
~clairvoyance eadst~eot
dansl'hommenonnatement
il serait
mcapabte d'acco~nptir
sa ttcheterrestre.
Il ne
peuts'dever
ta
<dbMti~~yazMB~
sansse
nuhe, ques'Hdvdoppetes qualits
a~opnes
~n
partant
d'unevieentirement sainedanslaratM
seBaiUe.Cdmqm
croitse
rapprodMr
desmondes
sup<"
riMfsen
s'Alignantdetav!enormate,pardesoria~natits
~MM~gr~wmes
est dansla
pluscomplte
erreur.Ladair"
vcT~Nnee
est,
par
rapport
auxactivittsainesdelacon~
<Ma<WM&e
ordinaire,
danstesm&tnesrotations
que
ceM~
?
conscience
t'gard
destatsdusommeil
qui
M
cawm''
testent
par
lesrves.Etdemme
qu'un
sommeil
matsam
dAArIore
et~M~Ch:tt<Doma~aerMNB!~ornmtt~~h:)m~hBMB<MMBMBM&
dtmr~yance
M!nenesauraitsefondersur uneattitude
r
intrieure
ennemiedelavie
pratique.
PlusThownme ect
<MHMtr<
dans
t'existence
physique,
mieuxil
s'aequitte~cte
sesdevoirs
InteUectuek, sentimentaux,
morauxet
sociaux
et
ptua
aisment aussilesfacuttsdela
clairvoyance
se v
_<Kvetopt~N~ont
entu!.
C'estde
cetteclairvoyance saineque
traitenttesmd!~
talions
qui prcdent.
Tousles
phnomtnea visionnaires,
Mnaginaires
etmorbides sontexclusduchemin
que
nous
Aharivons et
qui
aboutitunevritable
pntration
dana
te monde
suprieur.
OUVRAGES DE
RUDOLF
STEINER
Tn~dmtt en
irmMt
Le
Myatre
Chrtien et ea
Myatrea
antiques. T~dm~
de
i'tHemmd
et
prcde
d'une
Int~duction
par
Edouard
ScHm.
~edMen.~PenMefO'.
L~ SeieMe Occulte.
T~ult
p~J ue.
SAumwnN,
9'
edM~
tt~rJ ~HTtt~C~
'Le
'hri le
A8peet
de
la
Que.don
J IodaIe
d~es
F~ES!E! Option ~Sociale, d~
f
<
<
c"
AM
EDITIONS DE
L'AUBE
~MoM,
CooMMUM Mtelei3
dcembre
t907.
Lee
Guide
SpMtueta de l'Hommeet
de
'Human~.
RMj~
de
t~cheM~ occulte.Mf
rwh~on
hunMme.
Tn~
<h~t<NenMmdpwrJ kJ MS~tMN~TmM.
Aux EDITIONS ALICE SAUBRWNN
L~E~ucadonde
l'Enfant,
au
point
de vuedeh toenee
$p:ntueMe.
Traduit de
rtHemMdpMrE.L.
2*dition.
L'nitiation oulaConnaiaMnce de<Mondes
<up<neMH.
Tmdu~
de
romand
parJ ule<SAUERWnN,
3*dition.
`
Thoaophie.
Traduitder<Hemand
par
EhaPMZOR.
Le Seuil du Monde
Spirituel. AphoMmea.
T~duitde
raMe~
nMndpN'OtCr
CMSHNNT2.
t~ Culture
pratique
de la Penee. Tiraduit deraMen~i r
pMJ uie<
SAumwnN.
La
Phitoeophie
dela
Libert. Tn~uitdel'tUemmd
p~
Ge~
itMNBe CLAMnrM.
Un chemin
vers la Connaisaance de eoi. TeMhat d~
w
r<Memmd t~r Eht P~OMa.
Notre
pre qui
teeaux Cieux"T~duit deFaNern~
EN PRPARATON
pu
Sena de la Vie.
~tt
Vie.
i*eaptit
de Gthe
tfavera Fauat~
et le
co~
dn
Serpent
et du
Lya.
<Bke~tM~
et es
Conception
du Monde.
<~
~025. mp.
de* PreM
Un<MMa<M< de
France,
P<urh.
34.700.
Vous aimerez peut-être aussi
- Un Cours en Miracles 1365pDocument1 365 pagesUn Cours en Miracles 1365pVladimir Georges DONFACK KEUNANGPas encore d'évaluation
- F.jolivet-Castelot - La Vie Et L'ame de La Matiere TexteDocument105 pagesF.jolivet-Castelot - La Vie Et L'ame de La Matiere TexteEric Remy88% (8)
- 4eme Chap1-La Vitesse Et Ses Variations-CorrectionDocument4 pages4eme Chap1-La Vitesse Et Ses Variations-CorrectionMohamadPas encore d'évaluation
- Clair Ressenti PourquoiDocument2 pagesClair Ressenti Pourquoinuit100% (1)
- Valeur Des Valeurs IndienDocument90 pagesValeur Des Valeurs IndienAnonymous UXLUTNfp100% (2)
- Chapitre Manquant Dans La Traduction Française de La Vie Des MaîtresDocument4 pagesChapitre Manquant Dans La Traduction Française de La Vie Des MaîtresribeiroPas encore d'évaluation
- Les Enigmes de la Psychométrie et les Phénomènes de la TélesthésieD'EverandLes Enigmes de la Psychométrie et les Phénomènes de la TélesthésiePas encore d'évaluation
- Reboutement I Et II Lorier 2011Document2 pagesReboutement I Et II Lorier 2011L'araucariaPas encore d'évaluation
- Paul Ranc - La SophrologieDocument14 pagesPaul Ranc - La SophrologieHeclyusPas encore d'évaluation
- Dec 15 11 2023Document46 pagesDec 15 11 2023pringuyPas encore d'évaluation
- Etre Au Devenir 1 Mark HalevyDocument392 pagesEtre Au Devenir 1 Mark Halevydexterite99Pas encore d'évaluation
- PlanDesFrequences 12janvier2012 LuxembourgDocument405 pagesPlanDesFrequences 12janvier2012 Luxembourgmacao100Pas encore d'évaluation
- La Dimension Symbolique Des TICDocument27 pagesLa Dimension Symbolique Des TICAlainzhuPas encore d'évaluation
- Guide Renforcer Son Systeme Immunitaire PDFDocument22 pagesGuide Renforcer Son Systeme Immunitaire PDFIulia Becheriu0% (1)
- Guerir Esprit - Taisen DeshimaruDocument5 pagesGuerir Esprit - Taisen Deshimaruelga74Pas encore d'évaluation
- Unite ImaginationDocument0 pageUnite ImaginationArmando Cypriano PiresPas encore d'évaluation
- Illusions d'Optique-Robert GonsalvesDocument27 pagesIllusions d'Optique-Robert GonsalvesvirgilPas encore d'évaluation
- La Suggestion Mentale - AlliotDocument100 pagesLa Suggestion Mentale - Alliotparetmarco100% (2)
- Module 3 Quiz Professeur de YogaDocument5 pagesModule 3 Quiz Professeur de Yogamoez chabbehPas encore d'évaluation
- Delanne Exteriorisation PenseeDocument36 pagesDelanne Exteriorisation Penseehendrix2112100% (1)
- Etienne GUILLÉ - Le Langage Vibratoire de La Vie VDocument73 pagesEtienne GUILLÉ - Le Langage Vibratoire de La Vie VgabrielPas encore d'évaluation
- Ebook - Faites - de - Votre - Esprit - Un - Ocean PDFDocument87 pagesEbook - Faites - de - Votre - Esprit - Un - Ocean PDFJan GuntherPas encore d'évaluation
- BSG BR66381Document20 pagesBSG BR66381Si DiPas encore d'évaluation
- Le Nombre D or 2Document16 pagesLe Nombre D or 2Arbresha LufajPas encore d'évaluation
- Shri Shankarakcharya - Connaissance Du SoiDocument10 pagesShri Shankarakcharya - Connaissance Du SoiSheepo Dé la VegaPas encore d'évaluation
- Telechargement AnonymeDocument7 pagesTelechargement AnonymealaruePas encore d'évaluation
- L'Importance Des Mots Et Leur InfluenceDocument8 pagesL'Importance Des Mots Et Leur InfluenceFilisorDodoPas encore d'évaluation
- 40 Reponses de Kryeon 55a7564e6c63e PDFDocument50 pages40 Reponses de Kryeon 55a7564e6c63e PDFTIMITE DallaPas encore d'évaluation
- 1 4963345755801649282 PDFDocument27 pages1 4963345755801649282 PDFJuanPas encore d'évaluation
- Les 4 Voies de Communication Avec Son ADN - Laurent Dureau - 5D6DDocument5 pagesLes 4 Voies de Communication Avec Son ADN - Laurent Dureau - 5D6DLes TransformationsPas encore d'évaluation
- Paracelse - Le Livre de La Rénovation Et de La RestaurationDocument7 pagesParacelse - Le Livre de La Rénovation Et de La Restaurationsavoisien88Pas encore d'évaluation
- Les Valeurs PrincipalesDocument8 pagesLes Valeurs Principalesmansouri adelPas encore d'évaluation
- Polycop Respiration Pierre HaabDocument88 pagesPolycop Respiration Pierre HaabGimsStephJunPas encore d'évaluation
- Ernest Bosc, La Doctrine Ésotérique À Travers Les Âges IDocument4 pagesErnest Bosc, La Doctrine Ésotérique À Travers Les Âges IrafelisarnPas encore d'évaluation
- Module 9 Quiz Professeur de YogaDocument6 pagesModule 9 Quiz Professeur de Yogamoez chabbehPas encore d'évaluation
- Comment Attirer Le Grand AmourDocument2 pagesComment Attirer Le Grand AmourRenePas encore d'évaluation
- Kokologie 1Document35 pagesKokologie 1ScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- MudraDocument26 pagesMudramamadousoumare899Pas encore d'évaluation
- 2011 Bio Generateur SFDocument4 pages2011 Bio Generateur SFkategatPas encore d'évaluation
- GlasgowDocument2 pagesGlasgowMahavashtar Amida RoméoPas encore d'évaluation
- Equilibre Bioenergetique 1 Et 2 - HealyDocument7 pagesEquilibre Bioenergetique 1 Et 2 - HealycdPas encore d'évaluation
- Module 6 La Force Du Regard Et Du SouffleDocument35 pagesModule 6 La Force Du Regard Et Du Soufflenathaliebarisele100% (1)
- Conf PR 012013 MGKDocument42 pagesConf PR 012013 MGKPicard TiatsePas encore d'évaluation
- Object If Puissance MemoireDocument58 pagesObject If Puissance MemoireMadalin Daniel LaurentPas encore d'évaluation
- Exploiter Les Lois de La Nature de Issa DemeDocument38 pagesExploiter Les Lois de La Nature de Issa DemeAbdou Karim Gueye100% (1)
- L'antenne de Lecher, Guide Pratique D PDFDocument1 pageL'antenne de Lecher, Guide Pratique D PDFNaima ChaouiPas encore d'évaluation
- Ronsard FranciadeDocument442 pagesRonsard FranciadeBeethoven AlvarezPas encore d'évaluation
- Alexandra David-Neel - Initiations Lamaiques - 1999Document133 pagesAlexandra David-Neel - Initiations Lamaiques - 1999konepartners4479Pas encore d'évaluation
- Miroir D'alchimie - Roger Bacon (... ) Bacon Roger Bpt6k90417Document98 pagesMiroir D'alchimie - Roger Bacon (... ) Bacon Roger Bpt6k90417Nina Elena RaduPas encore d'évaluation
- Pour Libérer L'esprit de L'observateur, Par J. KrishnamurtiDocument6 pagesPour Libérer L'esprit de L'observateur, Par J. KrishnamurtiJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Ibn Arabî - Le Livre Des Chatons Des Sagesses - Tome 2Document312 pagesIbn Arabî - Le Livre Des Chatons Des Sagesses - Tome 2Ahmed KOROMAPas encore d'évaluation
- Pelman Leçon 1 PDFDocument71 pagesPelman Leçon 1 PDFphilosophe662511Pas encore d'évaluation
- Ebook - Devenir - Son - Propre - Therapeute PDFDocument68 pagesEbook - Devenir - Son - Propre - Therapeute PDFJan GuntherPas encore d'évaluation
- Le Calendrier Traditionnel ChinoisDocument5 pagesLe Calendrier Traditionnel Chinoissuperser123465Pas encore d'évaluation
- Pour Combattre La Dilatation D'estomac (... ) Durville Hector Bpt6k97518429Document38 pagesPour Combattre La Dilatation D'estomac (... ) Durville Hector Bpt6k97518429Aya HuascaPas encore d'évaluation
- La Voie de La Dévotion - Swami ParamanandaDocument20 pagesLa Voie de La Dévotion - Swami ParamanandaerutircePas encore d'évaluation
- Corps Causal PowellDocument314 pagesCorps Causal Powellmoisejerry100% (1)
- Mesmer et le magnétisme animal: Le pouvoir de l'hypnoseD'EverandMesmer et le magnétisme animal: Le pouvoir de l'hypnosePas encore d'évaluation
- La Visite de l'Etre en nous-même: Une enquête du Professeur Docteur Zoro Astrien Jr Spécialiste en Kézako-Psycho appliquéeD'EverandLa Visite de l'Etre en nous-même: Une enquête du Professeur Docteur Zoro Astrien Jr Spécialiste en Kézako-Psycho appliquéePas encore d'évaluation
- Fiche1 Distribution Securite ElecDocument6 pagesFiche1 Distribution Securite EleckfawazPas encore d'évaluation
- HumidificationDocument59 pagesHumidificationMedPas encore d'évaluation
- Rivarol 2916Document20 pagesRivarol 2916BibliothequeNatioPas encore d'évaluation
- Les Installations PhotovoltaïquesDocument6 pagesLes Installations PhotovoltaïquesAbed BouadiPas encore d'évaluation
- TP PolymèresDocument9 pagesTP PolymèresTiti Rahim0% (1)
- Energie Eolienne Wikipedia FRDocument44 pagesEnergie Eolienne Wikipedia FRBlondet RomaricPas encore d'évaluation
- BESSENOUCI Mohammed ZakariaDocument130 pagesBESSENOUCI Mohammed Zakariazoom scaipPas encore d'évaluation
- Preuve Ontologique de L'existence de Dieu Chez DescartesDocument10 pagesPreuve Ontologique de L'existence de Dieu Chez DescartesThierrytradePas encore d'évaluation
- Pfe FinDocument28 pagesPfe FinAbdessamad BelabyadPas encore d'évaluation
- Programme Scientifique CongresDocument49 pagesProgramme Scientifique CongresDIBIPas encore d'évaluation
- TD Calorimetrie 2016 LSLLDocument2 pagesTD Calorimetrie 2016 LSLLimaneamira100Pas encore d'évaluation
- Thèse Zebiri FouadDocument131 pagesThèse Zebiri Fouadsarray rawdhaPas encore d'évaluation
- Fiche Exo ch1 Et 2Document3 pagesFiche Exo ch1 Et 2Maxens LE CORVAISIERPas encore d'évaluation
- Kit Pédagogique Sur L'environnement Dans Les Zones AridesDocument76 pagesKit Pédagogique Sur L'environnement Dans Les Zones AridesAmin Bakar50% (2)
- TD Chap III - Turbines À Gaz Et À Vapeur - TextMarkDocument9 pagesTD Chap III - Turbines À Gaz Et À Vapeur - TextMarkait el hadi mohamed messaoud50% (2)
- TD 1Document2 pagesTD 1Fatima zahra KHALOUFIPas encore d'évaluation
- 1.réactions Acido-Basiques Et Couples Acide - Base PDFDocument3 pages1.réactions Acido-Basiques Et Couples Acide - Base PDFkimmikPas encore d'évaluation
- Fiche D'inspectionDocument7 pagesFiche D'inspectionAtipoPas encore d'évaluation
- Grundfos - Manuel D Ing Nierie Pompes SP PDFDocument47 pagesGrundfos - Manuel D Ing Nierie Pompes SP PDFmoummouPas encore d'évaluation
- Droit Du PatrimoineDocument13 pagesDroit Du PatrimoineLadjali HoudaaPas encore d'évaluation
- Evaluation Continue GBMS4 2021 Docx ConvertiDocument7 pagesEvaluation Continue GBMS4 2021 Docx ConvertiMohammed ChaouqiPas encore d'évaluation
- Diderot Et L'art Du DialogueDocument11 pagesDiderot Et L'art Du Dialoguejimi2266Pas encore d'évaluation
- AO PV Bat 8ep Rapport Synthese Rapport PublicDocument29 pagesAO PV Bat 8ep Rapport Synthese Rapport Publicvamshikrishna madaramoniPas encore d'évaluation
- Etiquette Des Essais PDF FreeDocument41 pagesEtiquette Des Essais PDF FreeMawana SubstationPas encore d'évaluation
- 3ème Année CollègeDocument163 pages3ème Année CollègeAbdelhafid Bannis100% (1)
- Hydrogene Combustible Du Futur - Questionnaire-2Document2 pagesHydrogene Combustible Du Futur - Questionnaire-2boussad1Pas encore d'évaluation
- TP HydrologieDocument14 pagesTP HydrologieMerlin NgouaraPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Les Sociétés Face Aux Risques 3Document14 pagesChapitre 1 - Les Sociétés Face Aux Risques 3Éric LambertPas encore d'évaluation
- ch13 Reaction Chimique Echange ProtonDocument5 pagesch13 Reaction Chimique Echange ProtonSophie RosiPas encore d'évaluation