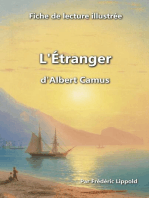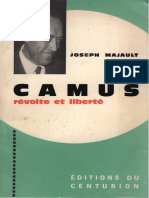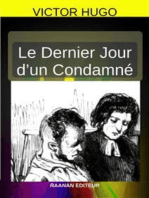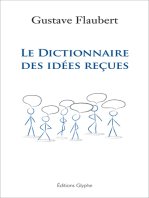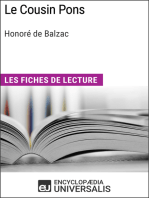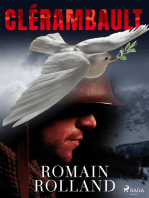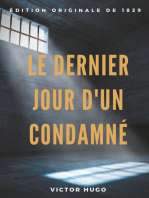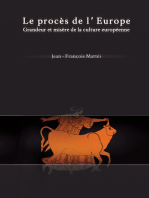Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Reflexions Sur La Guillotine - CAMUS
Reflexions Sur La Guillotine - CAMUS
Transféré par
Daniel David ArangurenCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Reflexions Sur La Guillotine - CAMUS
Reflexions Sur La Guillotine - CAMUS
Transféré par
Daniel David ArangurenDroits d'auteur :
Formats disponibles
Albert CAMUS
philosophe et crivain franais [1913-1960]
(1957)
RFLEXIONS
SUR LA GUILLOTINE
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, bnvole,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Courriel: jean-marie_tremblay@uqac.ca
Site web pdagogique : http://www.uqac.ca/jmt-sociologue/
Dans le cadre de: "Les classiques des sciences sociales"
Une bibliothque numrique fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web: http://classiques.uqac.ca/
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
Politique d'utilisation
de la bibliothque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite,
mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation formelle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales,
Jean-Marie Tremblay, sociologue.
Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent
sans autorisation formelle:
- tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie)
sur un serveur autre que celui des Classiques.
- servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par
tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support,
etc...),
Les fichiers (.html, .doc, .pdf, .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site
Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des Classiques
des sciences sociales, un organisme but non lucratif compos exclusivement de bnvoles.
Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute
rediffusion est galement strictement interdite.
L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisateurs. C'est notre mission.
Jean-Marie Tremblay, sociologue
Fondateur et Prsident-directeur gnral,
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
REMARQUE
Ce livre est du domaine public au Canada parce quune uvre passe
au domaine public 50 ans aprs la mort de lauteur(e).
Cette uvre nest pas dans le domaine public dans les pays o il
faut attendre 70 ans aprs la mort de lauteur(e).
Respectez la loi des droits dauteur de votre pays.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
OEUVRES D'ALBERT CAMUS
Rcits-Nouvelles
L'TRANGER.
LA PESTE.
LA CHUTE
LEXIL ET LE ROYAUME
Thtre
CALIGULA.
LE MALENTENDU.
L'TAT DE SIGE.
LES JUSTES.
Essais
NOCES.
LE MYTHE DE SISYPHE.
LETTRES UN AMI ALLEMAND.
ACTUELLES. CHRONIQUES 1944-1948.
ACTUELLES II, CHRONIQUES 1948-1953
CHRONIQUES ALGRIENNES, 1939-1958 (ACTUELLES III)
L'HOMME RVOLT.
L'T
L'ENVERS ET L'ENDROIT, essais.
DISCOURS DE SUDE
Adaptations et traductions
LES ESPRITS, de Pierre de Larivey.
LA DVOTION LA CROIX, de Pedro Calderon de la Barca.
REQUIEM POUR UN NONNE, de William Faulkner.
LE CHEVEALIER DOLMEDO, de Lope de Vega.
LES POSSDS, daprs le roman de Dostoevski.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay, bnvole, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi et fondateur des
Classiques des sciences sociales, partir de :
Albert CAMUS [1913-1960]
RFLEXIONS SUR LA GUILLOTINE.
Un texte publi dans louvrage dArthur Koestler et Albert Camus,
RFLEXIONS SUR LA PEINE CAPITALE, pp. 119-170. Paris : CalmannLvy, 1957, 286 pp. Collection : Le livre de poche, texte intgral. Pluriel.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Comic Sans, 12 points.
Pour les citations : Comic Sans, 12 points.
Pour les notes de bas de page : Comic Sans, 12 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2008 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format : LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition numrique ralise le 30 mars 2010 Chicoutimi, Ville
de Saguenay, province de Qubec, Canada.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
Albert CAMUS
philosophe et crivain franais [1913-1960]
RFLEXIONS SUR LA GUILLOTINE.
Un texte publi dans louvrage dArthur Koestler et Albert Camus,
RFLEXIONS SUR LA PEINE CAPITALE, pp. 119-170. Paris : CalmannLvy, 1957, 286 pp. Collection : Le livre de poche, texte intgral. Pluriel.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
[121] Peu avant la guerre de 1914, un assassin dont le crime tait
particulirement rvoltant (il avait massacr une famille de fermiers
avec leurs enfants) fut condamn mort en Alger. Il s'agissait d'un
ouvrier agricole qui avait tu dans une sorte de dlire du sang, mais
avait aggrav son cas en volant ses victimes. L'affaire eut un grand
retentissement. On estima gnralement que la dcapitation tait une
peine trop douce pour un pareil monstre. Telle fut, m'a-t-on dit, l'opinion de mon pre que le meurtre des enfants, en particulier, avait indign. L'une des rares choses que je sache de lui, en tout cas, est qu'il
voulut assister l'excution, pour la premire fois de sa vie. Il se leva
dans la nuit pour se rendre sur les lieux du supplice, l'autre bout de
la ville, au milieu d'un grand concours de peuple. Ce qu'il vit, ce matinl, il n'en dit rien personne. Ma mre raconte seulement qu'il rentra
en coup de vent, le visage boulevers, refusa de parler, s'tendit un
moment sur le lit et se mit tout d'un coup vomir. Il venait de dcouvrir la ralit qui se cachait sous les grandes formules dont on la masquait. Au lieu de penser aux enfants massacrs, il ne pouvait plus penser qu' ce corps pantelant qu'on venait de jeter sur une planche pour
lui couper le cou.
Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver
vaincre l'indignation d'un homme simple et droit et pour qu'un chtiment qu'il estimait cent fois mrit n'ait eu finalement d'autre effet
que de lui retourner le cur. Quand la suprme justice donne seulement vomir l'honnte homme qu'elle est cense protger, il parat
difficile de soutenir [122] qu'elle est destine, comme ce devrait tre
sa fonction, apporter plus de paix et d'ordre dans la cit. Il clate
au contraire qu'elle n'est pas moins rvoltante que le crime, et que ce
nouveau meurtre, loin de rparer l'offense faite au corps social, ajoute une nouvelle souillure la premire. Cela est si vrai que personne
n'ose parler directement de cette crmonie. Les fonctionnaires et
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
les journalistes qui ont la charge d'en parler, comme s'ils avaient conscience de ce qu'elle manifeste en mme temps de provocant et de honteux, ont constitu son propos une sorte de langage rituel, rduit
des formules strotypes. Nous lisons ainsi, l'heure du petit djeuner, dans un coin du journal, que le condamn a pay sa dette la
socit , ou qu'il a expi , ou que cinq heures, justice tait faite . Les fonctionnaires traitent du condamn comme de l'intress ou du patient , ou le dsignent par un sigle : le C.A.M. De la peine capitale, on n'crit, si j'ose dire, qu' voix basse. Dans notre socit trs police, nous reconnaissons qu'une maladie est grave ce que
nous n'osons pas en parler directement. Longtemps, dans les familles
bourgeoises, on s'est born dire que la fille ane tait faible de la
poitrine ou que le pre souffrait d'une. grosseur parce qu'on
considrait la tuberculose et le cancer comme des maladies un peu
honteuses. Cela est plus vrai sans doute de la peine de mort, puisque
tout le monde s'vertue n'en parler que par euphmisme. Elle est au
corps politique ce que le cancer est au corps individuel, cette diffrence prs que personne n'a jamais parl de la ncessit du cancer. On
n'hsite pas au contraire prsenter communment la peine de mort
comme une regrettable ncessit, qui lgitime donc que l'on tue, puisque cela est ncessaire, et qu'on n'en parle point, puisque cela est regrettable.
Mon intention est au contraire d'en parler crment. Non par got
du scandale, ni je crois, par une pente malsaine de nature. En tant
qu'crivain, j'ai toujours eu horreur de certaines complaisances ; en
tant [123] qu'homme, je crois que les aspects repoussants de notre
condition, s'ils sont invitables, doivent tre seulement affronts en
silence. Mais lorsque le silence, ou les ruses du langage, contribuent
Maintenir un abus qui doit tre rform ou un malheur qui peut tre
soulag, il n'y a pas d'autre solution que de parler clair et de montrer
l'obscnit qui se cache sous le manteau des mots. La France partage
avec l'Espagne et l'Angleterre le bel honneur d'tre un des derniers
pays, de ce ct du rideau de fer, garder la peine de mort dans son
arsenal de rpression. La survivance de ce rite primitif n'a t rendue
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
possible chez nous que par l'insouciance ou l'ignorance de l'opinion publique qui ragit seulement par les phrases crmonieuses qu'on lui a
inculques. Quand l'imagination dort, les mots se vident de leur sens :
un peuple sourd enregistre distraitement la condamnation d'un homme.
Mais qu'on montre la machine, qu'on fasse toucher le bois et le fer,
entendre le bruit de la tte qui tombe, et l'imagination publique, soudain rveille, rpudiera en mme temps le vocabulaire et le supplice.
Lorsque les nazis procdaient en Pologne des excutions publiques
d'otages, pour viter que ces otages ne crient des paroles de rvolte
et de libert, ils les billonnaient avec un pansement enduit de pltre.
On ne saurait sans impudeur comparer le sort de ces innocentes victimes ceux des criminels condamns. Mais, outre que les criminels ne
sont pas les seuls tre guillotins chez nous, la mthode est la mme.
Nous touffons sous des paroles feutres un supplice dont on ne saurait affirmer la lgitimit avant de l'avoir examin dans sa ralit.
Loin de dire que la peine de mort est d'abord ncessaire et qu'il
convient ensuite de n'en pas parler, il faut parler au contraire de ce
qu'elle est rellement et dire alors si, telle qu'elle est, elle doit tre
considre comme ncessaire.
Je la crois, quant moi, non seulement inutile, mais profondment
nuisible et je dois consigner ici cette conviction, avant d'en venir au
sujet lui-mme. Il ne serait pas honnte de laisser croire que je suis
arriv [124] cette conclusion aprs les semaines d'enqutes et de
recherches que je viens de consacrer cette question. Mais il serait
aussi malhonnte de n'attribuer ma conviction qu' la seule sensiblerie.
Je suis aussi loign que possible, au contraire, de ce mol attendrissement o se complaisent les humanitaires et dans lequel les valeurs et
les responsabilits se confondent, les crimes s'galisent, l'innocence
perd finalement ses droits. Je ne crois pas, contrairement beaucoup
d'illustres contemporains, que l'homme soit, par nature, un animal de
socit. vrai dire, je pense le contraire. Mais je crois, ce qui est
trs diffrent, qu'il ne peut vivre dsormais en dehors de la socit
dont les lois sont ncessaires sa survie physique. Il faut donc que les
responsabilits soient tablies selon une chelle raisonnable et effica-
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
10
ce par la socit elle-mme. Mais la loi trouve sa dernire justification
dans le bien qu'elle fait ou ne fait pas la socit d'un lieu et d'un
temps donns. Pendant des annes, je n'ai pu voir dans la peine de
mort qu'un supplice insupportable l'imagination et un dsordre paresseux que ma raison condamnait. J'tais prt cependant penser
que l'imagination influenait mon jugement. Mais, en vrit, je n'ai rien
trouv pendant ces semaines, qui n'ait renforc ma conviction ou qui
ait modifi mes raisonnements. Au contraire, aux arguments qui
taient dj les miens, d'autres sont venus s'ajouter. Aujourd'hui, je
partage absolument la conviction de Koestler : la peine de mort souille
notre socit et ses partisans ne peuvent la justifier en raison. Sans
reprendre sa dcisive plaidoirie, sans accumuler des faits et des chiffres qui feraient double emploi, et que la prcision de Jean BlochMichel rend inutiles, je dvelopperai seulement les raisonnements qui
prolongent ceux de Koestler et qui, en mme temps qu'eux, militent
pour une abolition immdiate de la peine capitale.
On sait que le grand argument des partisans de la peine de mort
est l'exemplarit du chtiment. On ne [125] coupe pas seulement les
ttes pour punir leurs porteurs, mais pour intimider, par un exemple
effrayant, ceux qui seraient tents de les imiter. La socit ne se venge pas, elle veut seulement prvenir. Elle brandit la tte pour que les
candidats au meurtre y lisent leur avenir et reculent.
Cet argument serait impressionnant si l'on n'tait oblig de constater :
1 Que la socit ne croit pas elle-mme l'exemplarit dont elle
parle ;
2 Qu'il n'est pas prouv que la peine de mort ait fait reculer un
seul meurtrier, dcid l'tre, alors qu'il est vident qu'elle n'a
eu aucun effet, sinon de fascination, sur des milliers de criminels ;
3 Qu'elle constitue, d'autres gards, un exemple repoussant
dont les consquences sont imprvisibles.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
11
La socit, d'abord, ne croit pas ce qu'elle dit. Si elle le croyait
vraiment, elle montrerait les ttes. Elle ferait bnficier les excutions du lancement publicitaire, qu'elle rserve d'ordinaire aux emprunts nationaux ou aux nouvelles marques d'apritifs, On sait, au
contraire, que les excutions, chez nous, n'ont plus lieu en public et se
perptrent dans la cour des prisons devant un nombre restreint de
spcialistes. On sait moins pourquoi et depuis quand. Il s'agit d'une
mesure relativement rcente. La dernire excution publique fut, en
1939, celle de Weidmann, auteur de plusieurs meurtres, que ses exploits avaient mis la mode. Ce matin-l, une grande foule se pressait
Versailles et, parmi elle, un grand nombre de photographes. Entre le
moment o Weidmann fut expos la foule et celui o il fut dcapit,
des photographies purent tre prises. Quelques heures plus tard, Paris-Soir publiait une page d'illustrations sur cet apptissant vnement. Le bon peuple parisien put ainsi se rendre compte que la lgre
machine de prcision dont l'excuteur se servait tait aussi diffrente de l'chafaud historique qu'une Jaguar peut ltre de nos vieilles de
Dion-Bouton. L'administration et le gouvernement, contrairement
toute esprance, prirent [126] trs mal cette excellente publicit et
crirent que la presse avait voulu flatter les instincts sadiques de ses
lecteurs. On dcida donc que les excutions n'auraient plus lieu en public, disposition qui, peu aprs, rendit plus facile le travail des autorits d'occupation.
La logique, en cette affaire, n'tait pas avec le lgislateur., Il fallait au contraire dcerner une dcoration supplmentaire au directeur
de Paris-Soir en l'encourageant mieux faire la prochaine fois. Si l'on
veut que la peine soit exemplaire, en effet, on doit, non seulement multiplier les photographies, mais encore planter la machine sur un chafaud, place 'de la Concorde, deux heures de l'aprs-midi, inviter le
peuple entier et tlviser la crmonie pour les absents. Il faut faire
cela ou cesser de parler d'exemplarit. Comment l'assassinat furtif
qu'on commet la nuit dans une cour de prison peut-il tre exemplaire ?
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
12
Tout au plus sert-il informer priodiquement les citoyens qu'ils
mourront s'il leur arrive de tuer ; avenir qu'on peut promettre aussi
ceux qui ne tuent pas. Pour que la peine soit vraiment exemplaire, il
faut qu'elle soit effrayante. Tuant de La Bouverie, reprsentant du
peuple en 1791, et partisan des excutions publiques, tait plus logique
lorsqu'il dclarait lAssemble nationale : Il faut un spectacle terrible pour contenir le peuple.
Aujourd'hui, point de spectacle, une pnalit connue de tous par
ou-dire, et, de loin en loin, la nouvelle d'une excution, maquille sous
des formules adoucissantes. Comment un criminel futur aurait-il
l'esprit, au moment du crime, une sanction qu'on s'ingnie rendre de
plus en plus abstraite ! Et si l'on dsire vraiment qu'il garde toujours
cette sanction en mmoire, afin qu'elle quilibre d'abord et renverse
ensuite une dcision forcene, ne devrait-on pas chercher graver
profondment cette sanction, et sa terrible ralit, dans toutes les
sensibilits, par tous les moyens de l'image et du langage ?
[127] Au lieu d'voquer vaguement une dette que quelqu'un, le matin mme, a paye la socit, ne serait-il pas d'un plus efficace
exemple de profiter d'une si belle occasion pour rappeler chaque
contribuable le dtail de ce qui l'attend ? Au lieu de dire : Si vous
tuez, vous expierez sur l'chafaud , ne vaudrait-il pas mieux lui dire,
aux fins d'exemple : Si vous tuez, vous serez jet en prison pendant
des mois ou des annes, partag entre un dsespoir impossible et une
terreur renouvele, jusqu' ce qu'un matin, nous nous glissions dans
votre cellule, ayant quitt nos chaussures pour mieux vous surprendre
dans le sommeil qui vous crasera, aprs l'angoisse de la nuit. Nous
nous jetterons sur vous, lierons vos poignets dans votre dos, couperons
aux ciseaux le col de votre chemise et vos cheveux s'il y a lieu. Dans un
souci de perfectionnement, nous ligoterons vos bras au moyen d'une
courroie, afin que vous soyez contraint de vous tenir vot et d'offrir
ainsi une nuque bien dgage. Nous vous porterons ensuite, un aide
vous soutenant chaque bras, vos pieds tranant en arrire travers
les couloirs. Puis, sous un ciel de nuit, l'un des excuteurs vous empoignera enfin par le fond du pantalon et vous jettera horizontalement
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
13
sur une planche, pendant qu'un autre assurera votre tte dans une lunette et qu'un troisime fera tomber, d'une hauteur de deux mtres
vingt, un couperet de soixante kilos qui tranchera votre cou comme un
rasoir.
Pour que l'exemple soit encore meilleur, pour que la terreur qu'il
entrane devienne en chacun de nous une force assez aveugle et assez
puissante pour compenser au bon moment l'irrsistible dsir du meurtre, il faudrait encore aller plus loin. Au lieu de nous vanter, avec la
prtentieuse inconscience qui nous est propre, d'avoir invent ce
moyen rapide et humain 1 de tuer les condamns, il faudrait publier
des milliers [128] d'exemplaires, et faire lire dans les coles et les
facults, les tmoignages et les rapports mdicaux qui dcrivent l'tat
du corps aprs l'excution. On recommandera tout particulirement
l'impression et la diffusion d'une rcente communication l'Acadmie
de Mdecine faite par les docteurs Piedelivre et Fournier. Ces mdecins courageux, appels, dans l'intrt de la science, examiner les
corps des supplicis aprs l'excution, ont estim de leur devoir de
rsumer leurs terribles observations :
Si nous pouvons nous permettre de donner notre avis ce sujet, de
tels spectacles sont affreusement pnibles. Le sang sort des vaisseaux
au rythme des carotides sectionnes puis il se coagule. Les muscles se
contractent et leur fibrillation est stupfiante ; l'intestin ondule et le
coeur a des mouvements irrguliers, incomplets, fascinants. La bouche
se crispe certains moments dans une moue terrible. Il est vrai que,
sur cette tte dcapite, les yeux sont immobiles avec des pupilles
dilates ; ils ne regardent pas heureusement et s'ils n'ont aucun trouble, aucune opalescence cadavrique, ils n'ont plus de mouvements ;
leur transparence est vivante, mais leur fixit est mortelle. Tout cela
peut durer des minutes, des heures mme, chez des sujets sans tares : la mort n'est pas immdiate... Ainsi chaque lment, vital survit
1
Le condamn, selon l'optimiste docteur Guillotin, ne devait rien
sentir. Tout au plus une lgre fracheur dans le cou .
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
14
la dcapitation. Il ne reste, pour le mdecin, que cette impression
d'une horrible exprience, d'une vivisection meurtrire, suivies d'un
enterrement prmatur 2 .
Je doute qu'il se trouve beaucoup de lecteurs pour lire sans blmir
cet pouvantable rapport. On peut donc compter sur son pouvoir
exemplaire et sa capacit d'intimidation. Rien n'empche d'y ajouter
les rapports de tmoins qui authentifient encore les observations des
mdecins. La face supplicie de Charlotte Corday avait rougi, dit-on,
sous le soufflet du bourreau. On ne s'en tonnera pas en coutant des
observateurs plus rcents. Un aide-excuteur, donc peu suspect de
cultiver la romance et la sensiblerie, dcrit [129] ainsi ce qu'il a t
oblig de voir : C'est un forcen en proie une vritable crise de
delirium tremens que nous avons jet sous le couperet. La tte meurt
aussitt. Mais le corps saute littralement dans le panier, tire sur les
cordes. Vingt minutes aprs, au cimetire, il y a encore des frmissements 3 . L'aumnier actuel de la Sant, le R.P. Devoyod, qui ne semble pas oppos la peine de mort, fait dans son livre Les Dlinquants 4
un rcit qui va loin, et qui renouvelle l'histoire du condamn Languille
dont la tte dcapite rpondait l'appel de son nom 5 :
Le matin de l'excution, le condamn tait de trs mchante humeur et il refusa les secours de la religion. Connaissant le fond de son
cur et l'affection qu'il avait pour sa femme dont les sentiments
taient trs chrtiens, nous lui dmes : Allons, par amour pour votre
femme recueillez-vous un instant avant de mourir , et le condamn
accepta. Il se recueillit longuement devant le crucifix, puis il sembla ne
2
3
Justice sans bourreau, no 2, juin 1956.
Publi par Roger Grenier, Les Monstres, Gallimard. Ces dclarations
sont authentiques.
ditions Matot-Braine, Reims.
5 En 1905, dans le Loiret.
4
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
15
plus prter attention notre prsence. Lorsqu'il fut excut, nous
tions peu de distance de lui ; sa tte tomba dans l'auge place devant la guillotine et le corps fut aussitt mis dans le panier ; mais
contrairement l'usage, le panier fut referm avant que la tte y ft
place. L'aide qui portait la tte dut attendre un instant que le panier
soit ouvert de nouveau ; or, pendant ce court espace de temps nous
emes la possibilit de voir les deux, yeux du condamn fixs sur moi
dans un regard de supplication comme pour demander pardon. Instinctivement nous trames un signe de croix pour bnir la tte, alors, ensuite, les paupires clignrent, l'expression des yeux devint douce,
puis le regard, rest expressif, se perdit...
Le lecteur recevra, selon sa foi, l'explication propose par le prtre. Du moins, ces yeux rests expressifs , n'ont besoin d'aucune
interprtation.
[130] Je pourrais apporter d'autres tmoignages aussi hallucinants.
Mais je ne saurais, quant moi, aller plus loin. Aprs tout, je ne professe pas que la peine de mort soit exemplaire et ce supplice m'apparat pour ce qu'il est, une chirurgie grossire pratique dans des
conditions qui lui enlvent tout caractre difiant. La socit, au
contraire, et l'tat, qui en a vu d'autres, peuvent trs bien supporter
ces dtails et, puisqu'ils prchent l'exemple, devraient essayer de les
faire supporter tous, afin que nul n'en ignore, et que la population
jamais terrorise devienne franciscaine dans son entier. Qui espre-ton intimider, autrement, par cet exemple sans cesse drob, par la
menace d'un chtiment prsent comme doux et expditif, et plus
supportable en somme qu'un cancer, par ce supplice couronn des
fleurs de la rhtorique ? Certainement pas ceux qui passent pour honntes (et certains le sont) puisqu'ils dorment cette heure-l, que le
grand exemple ne leur a pas t annonc, qu'ils mangeront leurs tartines l'heure de l'enterrement prmatur, et qu'ils seront informs
de l'oeuvre de justice, si seulement ils lisent les journaux, par un
communiqu doucereux qui fondra comme sucre dans leur mmoire.
Pourtant ces paisibles cratures sont celles qui fournissent le plus
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
16
gros pourcentage des homicides. Beaucoup de ces honntes gens sont
des criminels qui s'ignorent. Selon un magistrat, l'immense majorit
des meurtriers qu'il avait connus ne savaient pas, en se rasant le matin, qu'ils allaient tuer le soir. Pour l'exemple et la scurit, il conviendrait donc, au lieu de la maquiller, de brandir la face nue du supplici
devant tous ceux qui se rasent le matin.
Il n'en est rien. l'tat camoufle les excutions et fait silence sur
ces textes et sur ces tmoignages. Il ne croit donc pas la valeur
exemplaire de la peine, ,sinon par tradition et sans se donner la peine
de rflchir. On tue le criminel parce qu'on l'a fait pendant des sicles et, d'ailleurs, on le tue dans les formes qui ont t fixes la fin
du XVIIIe sicle. Par routine, on reprendra donc les arguments qui
avaient cours il [131] y a des sicles, quitte les contredire par des
mesures que l'volution de la sensibilit publique rend invitables. On
applique une loi sans plus la raisonner et nos condamns meurent par
coeur, au nom d'une thorie laquelle les excuteurs ne croient pas.
S'ils y croyaient, cela se saurait et surtout se verrait. Mais la publicit, outre qu'elle rveille, en effet, des instincts sadiques dont la rpercussion est incalculable et qui finissent un jour par se satisfaire
dans un nouveau meurtre, risque aussi de provoquer rvolte et dgot
dans l'opinion publique. Il deviendrait plus difficile d'excuter la
chane, comme on le voit aujourd'hui chez nous, si ces excutions se
traduisaient en images vivaces dans l'imagination populaire. Tel qui savoure son caf en lisant que justice a t faite le recracherait au
moindre dtail. Et les textes que j'ai cits risqueraient de donner
bonne mine certains professeurs de droit criminel qui, dans l'incapacit vidente de justifier cette peine anachronique, se consolent en
dclarant, avec le sociologue Tarde, qu'il vaut mieux faire mourir sans
faire souffrir que faire souffrir sans faire mourir. C'est pourquoi il
faut approuver la position de Gambetta qui, adversaire de la peine de
mort, vota contre un projet de loi portant suppression de la publicit
des excutions, en dclarant :
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
17
Si vous supprimez l'horreur du spectacle, si vous, excutez dans
l'intrieur des prisons, vous toufferez le sursaut public de rvolte
qui s'est manifest ces dernires annes et vous allez consolider la
peine de mort.
En effet, il faut tuer publiquement ou avouer qu'on ne se sent pas
autoris tuer. Si la socit justifie la peine de mort par la ncessit
de l'exemple, elle doit se justifier elle-mme en rendant la publicit
ncessaire. Elle doit montrer les mains du bourreau, chaque fois, et
obliger les regarder les citoyens trop dlicats en mme temps que
tous ceux qui, de prs ou de loin, ont suscit ce bourreau. Autrement,
elle avoue qu'elle tue sans savoir ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait, ou en
[132] sachant que, loin d'intimider l'opinion, ces crmonies curantes ne peuvent quy rveiller le crime ou la jeter dans le dsarroi. Qui
le ferait mieux sentir qu'un magistrat, parvenu la fin de sa carrire,
M. le conseiller Falco, dont la courageuse confession mrite d'tre
mdite :
... La seule fois de ma carrire o j'ai conclu contre une commutation de peine et pour l'excution de l'inculp, je croyais que, malgr
ma position j'assisterais en toute impassibilit l'excution. L'individu
tait d'ailleurs peu intressant : il avait martyris sa fillette et l'avait
finalement jete dans un puits. Eh bien ! la suite de son excution,
pendant des semaines et mme des mois, mes nuits ont t hantes
par ce souvenir... J'ai comme tout le monde fait la guerre et vu mourir
une jeunesse innocente, mais je puis dire que, devant ce spectacle affreux, je n'ai jamais prouv cette sorte de mauvaise conscience que
j'prouvais devant cette espce d'assassinat administratif qu'on appelle la peine capitale 6 .
Revue Ralits, no 105, octobre 1954.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
18
Mais, aprs tout, pourquoi la socit croirait-elle cet exemple
puisqu'il n'arrte pas le crime et que ses effets, s'ils existent, sont
invisibles ? La peine capitale ne saurait intimider d'abord celui qui ne
sait pas qu'il va tuer, qui s'y dcide en un moment et prpare son acte
dans la fivre ou l'ide fixe, ni celui qui, allant un rendez-vous d'explication, emporte une arme pour effrayer l'infidle ou l'adversaire et
s'en sert, alors qu'il ne le voulait pas, ou ne croyait pas le vouloir. Elle
ne saurait en un mot intimider l'homme jet dans le crime comme on
l'est dans le malheur. Autant dire alors qu'elle est impuissante dans la
majorit des cas. Il est juste de reconnatre qu'elle est, chez nous,
rarement applique dans ces cas-l. Mais ce rarement lui-mme
fait frmir.
Effraie-t-elle du moins cette race de criminels sur qui elle prtend
agir et qui vivent du crime ? Rien [133] n'est moins sr. On peut lire
dans Koestler qu' l'poque o les voleurs la tire taient excuts en
Angleterre, d'autres voleurs exeraient leurs talents dans la foule qui
entourait l'chafaud o l'on pendait leur confrre. Une statistique,
tablie au dbut du sicle en Angleterre, montre que sur 250 pendus,
170 avaient, auparavant, assist personnellement une ou deux excutions capitales. En 1886 encore, sur 167 condamns mort qui avaient
dfil dans la prison de Bristol, 164 avaient assist au moins une
excution. De tels sondages ne peuvent plus tre effectus en France,
cause du secret qui entoure les excutions. Mais ils autorisent penser qu'il devait y avoir autour de mon pre, le jour de l'excution, un
assez grand nombre de futurs criminels qui, eux, n'ont pas vomi. Le
pouvoir d'intimidation s'adresse seulement aux timides qui ne sont pas
vous au crime et flchit devant les irrductibles qu'il s'agissait justement de rduire. On trouvera dans ce volume, et dans les ouvrages
spcialiss, les chiffres et les faits les plus convaincants cet gard.
On ne peut nier pourtant que les hommes craignent la mort. La privation de la vie est certainement la peine suprme et devrait susciter
en eux un effroi dcisif. La peur de la mort, surgie du fond le plus
obscur de l'tre, le dvaste ; l'instinct de vie, quand il est menac,
s'affole et se dbat dans les pires angoisses. Le lgislateur tait donc
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
19
fond penser que sa loi pesait sur un des ressorts les plus mystrieux et les plus puissants de la nature humaine. Mais l loi est toujours plus simple que la nature. Lorsqu'elle s'aventure, pour essayer
d'y rgner, dans les rgions aveugles de l'tre, elle risque plus encore
d'tre impuissante rduire la complexit qu'elle veut ordonner.
Si la peur de la mort, en effet, est une vidence, c'en est une autre
que cette peur, si grande qu'elle soit, n'a jamais suffi dcourager les
passions humaines. Bacon a raison de dire qu'il n'est point de passion si
faible qu'elle ne puisse affronter et matriser la peur [134] de la mort.
La vengeance, l'amour, l'honneur, la douleur, une autre peur, arrivent
en triompher. Ce que l'amour d'un tre ou d'un pays, ce que la folie de
la libert arrivent faire, comment la cupidit, la haine, la jalousie ne,
le feraient-elles pas ? Depuis des sicles, la peine de mort, accompagne souvent de sauvages raffinements, essaie de tenir tte au crime ;
le crime pourtant s'obstine. Pourquoi ? C'est que les instincts qui, dans
l'homme, se combattent, ne sont pas, comme le veut la loi, des forces
constantes en tat d'quilibre. Ce sont des forces variables qui meurent et triomphent tour tour et dont les dsquilibres successifs
nourrissent la vie de l'esprit, comme des oscillations lectriques, suffisamment rapproches, tablissent un courant. Imaginons la srie
d'oscillations, du dsir l'inapptence, de la dcision au renoncement,
par lesquelles nous passons tous dans une seule journe, multiplions
l'infini ces variations et nous aurons une ide de la prolifration psychologique. Ces dsquilibres sont gnralement trop fugitifs pour
permettre une seule force de rgner sur l'tre entier. Mais il arrive
qu'une des forces de l'me se dchane, jusqu' occuper tout le champ
de la conscience ; aucun instinct, ft-ce celui de la vie, ne peut alors
s'opposer la tyrannie de cette force irrversible. Pour que la peine
capitale soit rellement intimidante, il faudrait que la nature humaine
ft diffrente et qu'elle ft aussi stable et sereine que la loi ellemme. Mais elle serait alors nature morte.
Elle ne l'est pas. C'est pourquoi, si surprenant que cela paraisse
qui n'a pas observ ni prouv en lui-mme la complexit humaine, le
meurtrier, la plupart du temps, se sent innocent quand il tue. Tout cri-
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
20
minel s'acquitte avant le jugement. Il s'estime, sinon dans son droit,
du moins excus par les circonstances. Il ne pense pas ni ne prvoit ;
lorsqu'il pense, c'est pour prvoir qu'il sera excus totalement ou partiellement. Comment craindrait-il ce qu'il juge hautement improbable ?
Il craindra la mort aprs le jugement, et non avant le crime. Il faudrait donc que la loi, pour tre [135] intimidante, ne laisse aucune
chance au meurtrier, qu'elle soit d'avance implacable et n'admette en
particulier aucune circonstance attnuante. Qui oserait, chez nous, le
demander ?
Le ferait-on, qu'il faudrait encore compter avec un autre paradoxe
de la nature humaine. L'instinct de vie, s'il est fondamental, ne l'est
pas plus qu'un autre instinct dont ne parlent pas les psychologues
d'cole : l'instinct de mort, qui exige certaines heures la destruction
de soi-mme et des autres. Il est probable que le dsir de tuer concide souvent avec le dsir de mourir soi-mme ou de s'anantir 7 . L'instinct de conservation se trouve ainsi doubl, dans des proportions variables, par l'instinct de destruction. Ce dernier est le seul pouvoir
expliquer entirement les nombreuses perversions qui, de l'alcoolisme
la drogue, mnent la personne sa perte sans qu'elle puisse l'ignorer. L'homme dsire vivre, mais il est vain d'esprer que ce dsir rgnera sur toutes ses actions. Il dsire aussi n'tre rien, il veut l'irrparable, et la mort pour elle-mme. Il arrive ainsi que le criminel ne
dsire pas seulement le crime, mais le malheur qui l'accompagne, mme
et surtout si ce malheur est dmesur. Quand cet trange dsir grandit et rgne, non seulement la perspective d'une mise mort ne saurait arrter le criminel, mais il est probable qu'elle ajoute encore au
vertige o il se perd. On tue alors pour mourir, d'une certaine faon.
Ces singularits suffisent expliquer qu'une peine qui semble calcule. pour effrayer des esprits normaux soit en ralit compltement
dsamorce de la psychologie moyenne. Toutes les statistiques sans
exception, celles qui concernent les pays abolitionnistes comme les
7
On peut lire chaque semaine dans la presse les cas de criminels qui
ont hsit d'abord entre se tuer ou tuer.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
21
autres, montrent qu'il n'y a pas de lien entre l'abolition de la peine de
mort et la criminalit 8 . Cette dernire [136] ne saccrot ni ne dcrot. La guillotine existe, le crime aussi ; entre les deux, il n'y a pas
d'autre lien apparent que celui de la loi. Tout ce que nous pouvons
conclure des chiffres, longuement aligns par les statistiques, est ceci : pendant des sicles, on a puni de mort des crimes autres que le
meurtre et le chtiment suprme, longuement rpt, n'a fait disparatre aucun de ces crimes. Depuis des sicles, on ne punit plus ces
crimes par la mort. Ils n'ont pourtant pas augment en nombre et
quelques-uns ont diminu. De mme, on a puni le meurtre par la peine
capitale pendant des sicles et la race de Can n'a pas disparu pour
autant. Dans les trente-trois nations qui ont supprim la peine de mort
ou n'en font plus usage, le nombre des meurtres, enfin, n'a pas augment. Qui pourrait tirer de l que la peine de mort soit rellement
intimidante ?
Les conservateurs ne peuvent nier ces faits ni ces chiffres. Leur
seule et dernire rponse est significative. Elle explique l'attitude
paradoxale d'une socit qui cache si soigneusement les excutions
qu'elle prtend exemplaires. Rien ne prouve, en effet, disent les
conservateurs, que la peine de mort soit exemplaire ; il est mme certain que des milliers de meurtriers n'en ont pas t intimids. Mais
nous ne pouvons connatre ceux qu'elle a intimids ; rien ne prouve par
consquent qu'elle ne soit pas exemplaire. Ainsi, le plus grand des
chtiments, celui qui entrane la dchance dernire pour le condamn,
et qui octroie le privilge suprme la socit, ne repose sur rien
d'autre que sur une possibilit invrifiable. La mort, elle, ne comporte
ni degrs ni probabilits. Elle fixe toutes choses, la culpabilit comme
le corps, dans une rigidit dfinitive. Elle est cependant administre
chez nous au nom d'une chance et d'une supputation. Quand mme
8
Rapport du Select Committee anglais de 1930 et de la Commission
royale anglaise qui a repris l'tude rcemment : Toutes les statistiques que nous avons examines nous confirment que l'abolition
de la peine de mort n'a pas provoqu une augmentation du nombre
des crimes.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
22
cette supputation serait raisonnable, [137] ne faudrait-il pas une certitude pour autoriser la plus certaine des morts ? Or, le condamn est
coup en deux, moins pour le crime qu'il a commis qu'en vertu de tous
les crimes qui auraient pu ltre et ne l'ont pas t, qui pourront ltre
et ne le seront pas. L'incertitude la plus vaste autorise ici la certitude
la plus implacable.
Je ne suis pas le seul m'tonner d'une si dangereuse contradiction. L'tat lui-mme la condamne et cette mauvaise conscience explique son tour la contradiction de son attitude. Il te toute publicit
ses excutions parce qu'il ne peut affirmer, devant les faits, qu'elles
aient jamais servi intimider les criminels. Il ne peut s'vader du dilemme oh l'a dj enferm Beccaria lorsqu'il crivait : S'il est important de montrer souvent au peuple des preuves du pouvoir, ds lors
les supplices doivent tre frquents ; mais il faudra que les crimes le
soient aussi, ce qui prouvera que la peine de mort ne fait point toute
l'impression qu'elle devrait, d'o il rsulte qu'elle est en mme temps
inutile et ncessaire. Que peut faire l'tat d'une peine inutile et
ncessaire, sinon la cacher sans l'abolir ? Il la conservera donc, un peu
l'cart, non sans embarras, avec l'espoir aveugle qu'un homme au
moins, un jour au moins, se trouvera arrt, par la considration du
chtiment, dans son geste meurtrier, et justifiera, sans que personne
le sache jamais, une loi qui n'a plus pour elle ni la raison ni l'exprience. Pour continuer prtendre que la guillotine est exemplaire, l'tat
est conduit ainsi multiplier des meurtres bien, rels afin d'viter un
meurtre inconnu dont il ne sait et ne saura jamais s'il a une seule
chance d'tre perptr. trange loi, en vrit, qui connat le meurtre
qu'elle entrane et ignorera toujours celui qu'elle empche.
Que restera-t-il alors de ce pouvoir d'exemple, s'il est prouv que
la peine capitale a un autre pouvoir, bien rel celui-l, et qui dgrade
des hommes jusqu' la honte, la folie et le meurtre ?
[138] On peut dj suivre les effets exemplaires de ces crmonies dans l'opinion publique, les manifestations de sadisme qu'elles y
rveillent, l'affreuse gloriole qu'elles suscitent chez certains criminels. Aucune noblesse autour de l'chafaud, mais le dgot, le mpris
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
23
ou la plus basse ds jouissances. Ces effets sont connus. La dcence
elle aussi a command que la guillotine migre de la place de l'Htelde-Ville aux barrires, puis dans les prisons. On est moins renseign
sur les sentiments de ceux dont c'est le mtier d'assister cette
sorte de spectacles. coutons alors ce directeur de prison anglaise qui
avoue un sentiment aigu de honte personnelle et ce chapelain qui
parle d'horreur, de honte et d'humiliation 9 . Imaginons surtout les
sentiments de l'homme qui tue en service command, je veux dire le
bourreau. Que penser de ces fonctionnaires, qui appellent la guillotine
la bcane , le condamn le client ou le colis . Sinon ce qu'en
pense le prtre Bela Just qui assista prs de trente condamns et qui
crit : L'argot des justiciers ne le cde en rien en cynisme et en vulgarit 'celui des dlinquants 10 . Au reste, voici les considrations
d'un de nos aides-excuteurs sur ses dplacements en province :
Quand nous partions en voyage, c'taient de vraies parties de rigolade. nous les taxis, nous les bons restaurants 11 ! Le mme dit,
en vantant l'adresse du bourreau dclencher le couperet : On pouvait se payer le luxe de tirer le client par les cheveux. Le drglement qui s'exprime ici a d'autres aspects encore plus profonds. Les
habits des condamns appartiennent en principe l'excuteur. Deibler
pre les accrochait tous dans une baraque de planches et allait de
temps en temps les regarder. Il y a plus grave. Voici ce que dclare
notre aideexcuteur :
[139] Le nouvel excuteur est un cingl de la guillotine. Il reste
parfois des jours entiers chez lui, assis sur une chaise, tout prt, avec
son chapeau sur la tte, son pardessus, attendre une convocation du
ministre 12 .
Rapport du Select Committee, 1930.
10 Bela Just, La Potence et la croix. Fasquelle.
11 Roger Grenier, Les Monstres, Gallimard.
12 Roger Grenier, Les Monstres, Gallimard.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
24
Oui, voil l'homme dont Joseph de Maistre disait que, pour qu'il
existe, il fallait un dcret particulier de la puissance divine et que sans
lui, l'ordre fait place au chaos, les trnes s'abment et la socit
disparat . Voil l'homme sur lequel la socit se dbarrasse entirement du coupable, puisque le bourreau signe la leve d'crou et qu'on
remet alors un homme libre sa discrtion. Le bel et solennel exemple,
imagin par nos lgislateurs, a du moins un effet certain, qui est de
ravaler ou de dtruire la qualit humaine et la raison chez ceux qui y
collaborent directement. Il s'agit, dira-t-on, de cratures exceptionnelles qui trouvent une vocation dans cette dchance. On le dira
moins quand on saura qu'il y a des centaines de personnes qui s'offrent
pour tre excuteurs gratuitement. Les hommes de notre gnration,
qui ont vcu l'histoire de ces dernires annes, ne s'tonneront pas de
cette information. Ils savent que, derrire les visages les plus paisibles, et les plus familiers, dort l'instinct de torture et de meurtre. Le
chtiment qui prtend intimider un meurtrier inconnu rend certainement leur vocation de tueurs bien d'autres monstres plus certains.
Puisque nous en sommes justifier nos lois les plus cruelles par des
considrations probables, ne doutons pas que, sur ces centaines
d'hommes dont on a dclin les services, l'un, au moins, a d assouvir
autrement les instincts sanglants que la guillotine a rveills en lui.
Si donc l'on veut maintenir la peine de mort, qu'on nous pargne au
moins l'hypocrisie d'une justification par l'exemple. Appelons par son
nom cette peine qui l'on refuse toute publicit, cette intimidation qui
ne s'exerce pas sur les honntes gens, tant qu'ils le [140] sont, qui
fascine ceux qui ont cess de l'tre et qui dgrade ou drgle ceux qui
y prtent la main. Elle est une peine, certainement, un pouvantable
supplice, physique et moral, mais elle n'offre aucun exemple certain,
sinon dmoralisant. Elle sanctionne, mais elle ne prvient rien, quand
elle ne suscite pas l'instinct de meurtre. Elle est comme si elle n'tait,
pas, sauf pour celui qui la subit, dans son me, pendant des mois ou des
annes, dans son corps, pendant l'heure dsespre et violente o on
le coupe en deux, sans supprimer sa vie. Appelons-la par son nom qui,
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
25
dfaut d'autre noblesse, lui rendra celle de la vrit, et reconnaissons-la pour ce qu'elle est essentiellement : une vengeance.
Le chtiment, qui sanctionne sans prvenir, s'appelle en effet la
vengeance. C'est une rponse quasi arithmtique que fait la socit
celui qui enfreint sa loi primordiale. Cette rponse est aussi vieille que
l'homme : elle s'appelle le talion. Qui m'a fait mal doit avoir mal ; qui
m'a crev un il, doit devenir borgne ; qui, a tu enfin doit mourir. Il
s'agit d'un sentiment, et particulirement violent, non d'un principe.
Le talion est de l'ordre de la nature et de l'instinct, il n'est pas de
l'ordre de la loi. La loi, par dfinition, ne peut obir aux mmes rgles
que la nature. Si le meurtre est dans la nature de l'homme, la loi n'est
pas faite pour imiter ou reproduire cette nature. Elle est faite pour la
corriger. Or je talion se borne ratifier et donner force de loi un
pur mouvement de nature. Nous avons tous connu ce mouvement, souvent pour notre honte, et nous connaissons sa puissance : il nous vient
des forts primitives. cet gard, nous autres Franais qui nous indignons, juste titre, de voir le roi du ptrole, en Arabie soudite, prcher la dmocratie internationale et confier un boucher le soin de
dcouper au couteau la main du voleur, nous vivons aussi dans une sorte
de Moyen Age qui n'a mme pas les consolations de la foi. Nous dfinissons [141] encore la justice selon les rgles d'une arithmtique
grossire 13 . Peut-on dire du moins que cette arithmtique est exacte
13 J'ai demand, il y a quelques annes, la grce de six condamns
mort tunisiens, condamns pour le meurtre, dans une meute de
trois gendarmes franais. Les circonstances o s'tait produit ce
meurtre rendaient difficile le partage des responsabilits. Une note de la prsidence de la Rpublique me fit savoir que ma supplique
retenait l'intrt de l'organisme qualifi. Malheureusement, lorsque cette note me fut adresse, j'avais lu, depuis deux semaines,
que la sentence avait t excute. Trois des condamns avaient
t mis mort, les trois autres gracis. Les raisons de gracier les
uns plutt que les autres n'taient pas dterminantes. Mais il fal-
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
26
et que la justice, mme lmentaire, mme limite la vengeance lgale, est sauvegarde par la peine de mort ? Il faut rpondre que non.
Laissons de ct le fait que la loi du talion est inapplicable et qu'il
paratrait aussi excessif de punir l'incendiaire en mettant le feu sa
maison qu'insuffisant de chtier le voleur en prlevant sur son compte
en banque une somme quivalente son vol. Admettons qu'il soit juste
et ncessaire de compenser le meurtre de la victime par la mort du
meurtrier. Mais l'excution capitale n'est pas simplement la mort. Eue
est aussi diffrente, en son essence, de la privation de vie, que le camp
de concentration l'est de la prison. Elle est un meurtre, sans doute, et
qui paie arithmtiquement le meurtre commis. Mais elle ajoute la
mort un rglement, une prmditation publique et connue de la future
victime, une organisation, enfin, qui est par elle-mme une source de
souffrances morales plus terribles que la mort. Il n'y a donc pas quivalence. Beaucoup de lgislations considrent comme plus grave le crime prmdit que le crime de pure violence. Mais qu'est-ce donc que
l'excution capitale, sinon le plus prmdit des meurtres, auquel aucun forfait de criminel, si calcul soit-il, ne peut tre compar ? Pour
qu'il y ait quivalence, il faudrait que [142] la peine de mort chtit un
criminel qui aurait averti sa victime de l'poque o il lui donnerait une
mort horrible et qui, partir de cet instant, l'aurait squestre
merci pendant des mois. Un tel monstre ne se rencontre pas dans le
priv.
L encore, lorsque nos juristes officiels parlent de faire mourir
sans faire souffrir, ils ne savent pas ce dont ils parlent et, surtout, ils
manquent d'imagination. La peur dvastatrice, dgradante, qu'on impose pendant des mois ou des annes 14 au condamn, est une peine plus
lait sans doute procder trois excutions capitales l o il y avait
eu trois victimes.
14 Reemen, condamn mort la Libration, est rest sept cents
jours dans les chanes avant d'tre excut, ce qui est scandaleux.
Les condamns de droit commun attendent en rgle gnrale, de
trois six mois le matin de leur mort. Et il est difficile, si l'on veut
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
27
terrible que la mort, et qui n'a pas t impose la victime. Mme
dans l'pouvante de la violence mortelle qui lui est faite, celle-ci, la
plupart du temps, est prcipite dans la mort sans savoir ce qui lui arrive. Le temps de l'horreur lui est compt avec la vie et l'espoir
d'chapper la folie qui s'abat sur elle ne lui manque probablement
jamais. L'horreur est, au contraire, dtaille au condamn mort. La
torture par l'esprance alterne avec les affres du dsespoir animal.
L'avocat et l'aumnier, par simple humanit, les gardiens, pour que le
condamn reste tranquille, sont unanimes l'assurer qu'il sera graci.
Il y croit de tout son tre et puis il n'y croit plus. Il l'espre le jour, il
en dsespre la nuit 15 . mesure que les semaines passent, l'espoir et
le dsespoir grandissent et deviennent galement insupportables. Selon tous les tmoins, la couleur de la peau change, la peur agit comme
un acide. Savoir qu'on va mourir n'est rien dit un condamn de Fresnes. Ne pas savoir si [143] l'on va vivre, c'est l'pouvante et l'angoisse. Cartouche disait du supplice suprme. Bah ! c'est un mauvais
quart d'heure passer. Mais il s'agit de mois, non de minutes. Longtemps l'avance, le condamn sait qu'il va tre tu et que seule peut
le sauver une grce assez semblable, pour lui, aux dcrets du ciel. Il ne
peut en tout cas intervenir, plaider lui-mme, ou convaincre. Tout se
passe en dehors de lui. Il n'est plus un homme, mais une chose qui attend d'tre manie par les bourreaux. Il est maintenu dans la ncessit absolue, celle de la matire inerte, mais avec une conscience qui est
son principal ennemi.
Quand les fonctionnaires, dont c'est le mtier de tuer cet homme,
l'appellent un colis, ils savent ce qu'ils disent. Ne pouvoir rien contre la
main qui vous dplace, vous garde ou vous rejette, n'est-ce pas, en effet, tre comme un paquet ou une chose, ou mieux, un animal entrav ?
prserver leurs chances de survie, de raccourcir le dlai. le puis
tmoigner, d'ailleurs, que l'examen des recours en grce est fait,
en France, avec un srieux qui n'exclut pas la volont visible de
gracier, dans toute la mesure o la loi et les murs le permettent.
15 Le dimanche n'tant pas jour d'excution, la nuit du samedi est
toujours meilleure dans les quartiers des condamns mort.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
28
Encore l'animal peut-il refuser de manger. Le condamn ne le peut pas.
On le fait bnficier d'un rgime spcial ( Fresnes, rgime no 4 avec
supplments de lait, vin, sucre, confitures, beurre) ; on veille ce qu'il
s'alimente. S'il le faut, on l'y force. L'animal qu'on va tuer doit tre
en pleine forme. La chose ou la bte ont seulement droit ces liberts
dgrades qui s'appellent les caprices. Ils sont trs susceptibles ,
dclare sans ironie un brigadier-chef de Fresnes, parlant des condamns mort. Sans doute, mais comment rejoindre autrement la libert
et cette dignit du vouloir dont l'homme ne peut se passer ? Susceptible ou non, partir du moment o la sentence a t prononce, le
condamn entre dans une machine imperturbable. Il roule un certain
nombre de semaines dans des rouages qui commandent tous ses gestes
et le livrent pour finir aux mains qui le coucheront sur la machine
tuer. Le colis n'est plus soumis aux hasards qui rgnent sur l'tre vivant, mais des lois mcaniques qui lui permettent de prvoir sans
faute le jour de sa dcapitation.
Ce jour achve sa condition d'objet. Pendant les trois quarts
d'heure qui le sparent du supplice, la [144] certitude d'une mort impuissante crase tout ; la bte lie et soumise connat un enfer qui fait
paratre drisoire celui dont on le menace. Les Grecs taient, aprs
tout, plus humains avec leur cigu. Ils laissaient leurs condamns une
relative libert, la possibilit de retarder ou de prcipiter l'heure de
leur propre mort. Ils leur donnaient choisir entre le suicide et l'excution. Nous, pour plus de sret, nous faisons justice nous-mmes.
Mais il ne pourrait y avoir vraiment justice que si le condamn, aprs
avoir fait connatre sa dcision des mois l'avance, tait entr chez
sa victime, l'avait lie solidement, informe qu'elle serait supplicie
dans une heure et avait enfin rempli cette heure dresser l'appareil
de la mort. Quel criminel a jamais rduit sa victime une condition si
dsespre et si impuissante ?
Cela explique sans doute cette trange soumission qui est de rgle
chez les condamns au moment de leur excution. Ces hommes qui
n'ont plus rien perdre pourraient jouer leur va-tout, prfrer mourir
d'une balle au hasard, ou tre guillotins dans une de ces luttes force-
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
29
nes qui obscurcissent toutes les facults. D'une certaine manire, ce
serait mourir librement. Et pourtant, quelques exceptions prs, la
rgle est que le condamn marche la mort passivement, dans une sorte d'accablement morne. C'est l sans doute ce que veulent dire nos
journalistes quand ils crivent que le condamn est mort courageusement. Il faut lire que le condamn n'a pas fait de bruit, n'est pas sorti
de sa condition de colis, et que tout le monde lui en est reconnaissant.
Dans une affaire si dgradante, l'intress fait preuve d'une louable
dcence en permettant que la dgradation ne dure pas trop longtemps.
Mais les compliments et les certificats de courage font partie de la
mystification gnrale qui entoure la peine de mort. Car le condamn
sera souvent d'autant plus dcent quil aura plus peur. Il ne mritera
les loges de notre presse que si sa peur ou son sentiment d'abandon
sont assez grands pour le striliser tout fait. Qu'on [145] m'entende
bien. Certains condamns, politiques ou non, meurent hroquement et
il faut parler d'eux avec l'admiration et le respect qui conviennent.
Mais la majorit d'entre eux ne connaissent d'autre silence que celui
de la peur, d'autre impassibilit que celle de l'effroi, et il me semble
que ce silence pouvant mrite encore un plus grand respect. Lorsque
le prtre Bela Just offre un jeune condamn d'crire aux siens,
quelques instants avant d'tre pendu, et qu'il s'entend rpondre : Je
n'ai pas de courage, mme pour cela , comment un prtre, entendant
cet aveu de faiblesse, ne s'inclinerait-il pas devant ce que l'homme a
de plus misrable et de plus sacr ? Ceux qui ne parlent pas et dont on
sait ce qu'ils ont prouv la petite mare qu'ils laissent la place dont
on les arrache, qui oserait dire qu'ils sont morts lchement ? Et comment faudrait-il qualifier alors ceux qui les ont rduits cette lchet ? Aprs tout, chaque meurtrier, lorsqu'il tue, risque la plus terrible
des morts, tandis que ceux qui le tuent ne risquent rien, sinon de
l'avancement.
Non, ce que l'homme prouve alors est au-del de toute morale. Ni
la vertu, ni le courage, ni l'intelligence, ni mme l'innocence n'ont de
rle jouer ici. La socit est, d'un coup, ramene aux pouvantes
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
30
primitives o plus rien ne peut se juger. Toute quit, comme toute
dignit, ont disparu.
Le sentiment de l'innocence n'immunise pas contre les svices...
J'ai vu mourir courageusement d'authentiques bandits alors que des
innocents allaient la mort en tremblant de tous leurs membres 16 .
Quand le mme homme ajoute que, selon son exprience, les dfaillances atteignent plus volontiers les intellectuels, il ne juge pas que
cette catgorie d'hommes ait moins de courage que d'autres, mais
seulement qu'elle a plus d'imagination. Confront la mort [146] inluctable, l'homme, quelles que soient ses convictions, est ravag de
fond en comble 17 . Le sentiment d'impuissance et de solitude du
condamn ligot, face la coalition publique qui veut sa mort, est lui
seul une punition inimaginable. cet gard aussi, il vaudrait mieux que
l'excution ft publique. Le comdien qui est en chaque homme pourrait alors venir au secours de l'animal pouvant et l'aider faire figure, mme ses propres yeux. Mais la nuit et le secret sont sans recours. Dans ce dsastre, le courage, la force dme, la foi mme risquent d'tre des hasards. En rgle gnrale, l'homme est dtruit par
l'attente de la peine capitale bien avant de mourir. On lui inflige deux
morts, dont la premire est pire que l'autre, alors qu'il n'a tu qu'une
fois. Compare ce supplice, la peine du talion apparat encore comme
une loi de civilisation. Elle n'a jamais prtendu qu'il fallait crever les
deux yeux de celui qui borgne son frre.
16 Bela Just, op. cit.
17 Un grand chirurgien, lui-mme catholique, me confiait aprs exp-
rience qu'il n'avertissait mme pas les croyants, quand ils taient
atteints d'un cancer incurable. Le choc, selon lui, risquait de dvaster jusqu' leur foi.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
31
Cette injustice fondamentale se rpercute, d'ailleurs, sur les parents du supplici. La victime a ses proches dont les souffrances sont
gnralement infinies et qui, la plupart du temps, dsirent tre vengs.
Ils le sont, mais les parents du condamn connaissent alors une extrmit de malheur qui les punit au-del de toute justice. L'attente d'une
mre, ou d'un pre, pendant de longs mois, le parloir, les conversations
fausses dont on meuble les courts instants passs avec le condamn,
les images de l'excution enfin, sont des tortures qui n'ont pas t
imposes aux proches de la victime. Quels que soient les sentiments de
ces derniers, ils ne peuvent dsirer que la vengeance excde de si loin
le crime et qu'elle torture des tres [147] qui partagent, violemment,
leur propre douleur.
Je suis graci, mon pre, crit un condamn mort, je ne ralise
pas tout fait encore le bonheur qui m'choit ; ma grce a t signe
le 30 avril et m'a t signifie mercredi en revenant du parloir. J'ai
aussitt fait prvenir papa et maman qui n'avaient pas encore quitt la
Sant. Imaginez d'ici leur bonheur 18 .
On l'imagine, en effet, mais dans la mesure mme o il est possible
d'imaginer leur incessant malheur jusqu' l'instant de la grce, et le
dsespoir dfinitif de ceux qui reoivent l'autre nouvelle, celle qui
chtie, dans l'iniquit, leur innocence et leur malheur.
Pour en finir avec cette loi du talion, il faut constater que, mme
dans sa forme primitive, elle ne peut jouer qu'entre deux individus
dont l'un est absolument innocent et l'autre absolument coupable. La
victime, certes, est innocente. Mais la socit qui est cense la reprsenter peut-elle prtendre l'innocence ? N'est-elle pas responsable,
18 R.P. Devoyod, op. cit. Impossible aussi de lire, sans en tre boule-
vers, les ptitions de grce prsentes par un pre o une mre
qui, visiblement, ne comprennent pas le chtiment qui les frappe
soudain.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
32
au moins en partie, du crime qu'elle rprime avec tant de svrit ? Ce
thme a souvent t dvelopp et je ne reprendrai pas les arguments
que les esprits les plus divers ont exposs depuis le XVIIIe sicle. On
peut les rsumer d'ailleurs en disant que toute socit a les criminels
qu'elle mrite. Mais s'agissant de la France, il est impossible de ne pas
signaler les circonstances qui devraient rendre nos lgislateurs plus
modestes. Rpondant en 1952 une enqute du Figaro sur la peine de
mort, un colonel affirmait que l'institution des travaux forcs perptuit comme peine suprme reviendrait constituer des conservatoires du crime. Cet officier suprieur semblait ignorer, et je m'en
rjouis pour lui, que nous avons dj nos conservatoires [148] du crime,
qui prsentent avec nos maisons centrales cette diffrence apprciable qu'on peut en sortir toute heure du jour et de la nuit : ce sont
les bistrots et les taudis, gloires de notre Rpublique. Sur ce point, il
est impossible de s'exprimer avec modration.
La statistique value 64 000 les logements surpeupls (de 3 5
personnes par pice) dans la seule ville de Paris. Certes, le bourreau
d'enfants est une crature particulirement ignoble et qui ne suscite
gure la piti. Il est probable aussi (je dis probable) qu'aucun de mes
lecteurs, plac dans les mmes conditions de promiscuit, n'irait jusqu'au meurtre d'enfants. Il n'est donc pas question de diminuer la
culpabilit de certains monstres. Mais ces monstres, dans des logements dcents, n'auraient peut-tre pas eu l'occasion d'aller si loin. Le
moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas seuls coupables et il
parat difficile que le droit de les punir soit donn ceux-l mme qui
subventionnent la betterave plutt que la construction 19 .
Mais l'alcool rend encore plus clatant ce scandale. On sait que la
nation franaise est systmatiquement intoxique par sa majorit parlementaire, pour des raisons gnralement ignobles. Or le taux de responsabilit de l'alcool dans la gense des crimes de sang est hallucinant. Un avocat (matre Guillon) l'a estim 60 p. 100. Pour le docteur
19 La France est le premier des pays consommateurs d'alcool, le quin-
zime des pays constructeurs (1957).
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
33
Lagriffe, ce taux va de 41,7 p. 100 72 p. 100. Une enqute effectue
en 1951, au centre de triage de la prison de Fresnes, chez des
condamns de droit commun, a rvl 29 p. 100 d'alcooliques chroniques et 24 p. 100 de sujets d'ascendance alcoolique. Enfin, 95 p. 100
des bourreaux d'enfants sont des alcooliques. Ce sont l de beaux
chiffres. Nous pouvons mettre en regard un chiffre plus superbe encore : la dclaration d'une maison d'apritifs [149] qui dclarait au
fisc, en 1953, 410 millions de bnfices. La comparaison de ces chiffres autorise informer les actionnaires de ladite maison et les dputs de l'alcool qu'ils ont tu certainement plus d'enfants qu'ils ne pensent. Adversaire de la peine capitale, je suis fort loin de rclamer leur
condamnation mort. Mais, pour commencer, il me parat indispensable
et urgent de les conduire, sous escorte militaire, la prochaine excution d'un bourreau d'enfant et de leur dlivrer la sortie un bulletin
statistique qui comportera les chiffres dont j'ai parl.
Quant l'tat qui sme l'alcool, il ne peut s'tonner de rcolter le
crime 20 . Il ne s'en tonne pas au demeurant, et se borne couper les
ttes o lui-mme a vers tant d'alcool. Il fait justice imperturbablement, et se pose en crancier : sa bonne conscience n'est pas entame.
Tel ce reprsentant en alcools qui, rpondant l'enqute du Figaro,
s'criait : Je sais ce que ferait le plus farouche dfenseur de l'abolition si, ayant une arme sa porte, il se trouvait subitement en prsence d'assassins sur le point de tuer son pre, sa mre, ses enfants
ou son meilleur ami. Alors ! Cet alors semble lui-mme un peu alcoolis. Naturellement, le plus farouche dfenseur de l'abolition tirerait sur ces meurtriers, juste titre, et sans que cela enlve rien
ses raisons de dfendre farouchement l'abolition. Mais s'il avait, de
surcrot, un peu de suite dans les ides et si lesdits assassins sen20 Les partisans de la peine de mort firent grand bruit la fin du si-
cle dernier d'une augmentation de la criminalit, partir de 1880,
qui semblait parallle une diminution d'application de la peine.
Mais c'est en 1880 qu'a t promulgue la loi permettant d'ouvrir
sans autorisation pralable des dbits de boisson. Aprs cela, allez
interprter les statistiques !
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
34
taient un peu trop l'alcool, il irait ensuite s'occuper de ceux dont c'est
la vocation d'intoxiquer les futurs criminels. Il est mme tout fait
surprenant que les parents des victimes de crimes alcooliques n'aient
jamais eu l'ide [150] d'aller solliciter quelques claircissements dans
l'enceinte du Parlement. C'est pourtant le contraire qui se passe et
l'tat, investi de la confiance gnrale, soutenu mme par l'opinion
publique, continue de corriger les assassins, mme et surtout alcooliques, un peu comme il arrive que le souteneur corrige les laborieuses
cratures qui assurent sa matrielle. Mais le souteneur, lui, ne fait pas
de morale. l'tat en fait. Sa jurisprudence, si elle admet que l'brit
constitue parfois une circonstance attnuante, ignore l'alcoolisme
chronique. L'brit n'accompagne pourtant que les crimes de violence, qui ne sont pas punis de mort, tandis que l'alcoolique chronique est
capable aussi de crimes prmdits, qui lui vaudront la mort. l'tat se
rserve donc le droit de punir dans le seul cas o sa responsabilit est
profondment engage.
Est-ce dire que tout alcoolique doit tre dclar irresponsable
par un tat qui se frappera la poitrine jusqu' ce que la nation ne boive
plus que du jus de fruits ? Certainement non. Pas plus que les raisons
tires de l'hrdit ne doivent teindre toute culpabilit. La responsabilit relle d'un dlinquant ne peut tre apprcie avec prcision.
On sait que le calcul est impuissant rendre compte du nombre de nos
ascendants, alcooliques ou non. l'extrmit des temps, il serait 10
puissance 22 fois plus grand que le nombre des habitants actuels de la
terre. Le nombre de dispositions mauvaises ou morbides qu'ils ont pu
nous transmettre est donc incalculable. Nous venons au monde chargs
du poids d'une ncessit infinie. Il faudrait conclure en ce cas une
irresponsabilit gnrale. La logique voudrait que ni chtiment ni rcompense ne fussent jamais prononcs et, du mme coup, toute socit deviendrait impossible. L'instinct de conservation des socits, et
donc des individus, exige au contraire que la responsabilit individuelle
soit postule. Il faut l'accepter, sans rver d'une indulgence absolue
qui conciderait avec la mort de toute socit. Mais le mme raisonnement doit nous amener conclure qu'il n'existe jamais de responsabili-
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
35
t [151] totale ni, par consquent, de chtiment ou de rcompense absolus. Personne ne peut tre rcompens dfinitivement, mme pas les
prix Nobel. Mais personne ne devrait tre chti absolument, s'il est
estim coupable, et, plus forte raison, s'il risque d'tre innocent. La
peine de mort, qui ne satisfait vritablement ni l'exemple ni la justice distributive, usurpe de surcrot un privilge exorbitant, en prtendant punir une culpabilit toujours relative par un chtiment dfinitif et irrparable.
Si la peine capitale, en effet, est d'un exemple douteux et d'une
justice boiteuse, il faut convenir, avec ses dfenseurs, qu'elle est liminatrice. La peine de mort limine dfinitivement le condamn. Cela
seul, vrai dire, devrait exclure, pour ses partisans surtout, la rptition d'arguments hasardeux qui puissent tre, nous venons de le voir,
sans cesse contests. Il est plus loyal de dire qu'elle est dfinitive
parce qu'elle doit l'tre, d'assurer que certains hommes sont irrcuprables en socit, qu'ils constituent un danger permanent pour chaque citoyen et pour l'ordre social et qu'il faut donc, toute affaire cessante, les supprimer. Personne, du moins, ne peut contester l'existence de certains fauves sociaux, dont rien ne semble capable de briser
l'nergie et la brutalit. La peine de mort, certes, ne rsout pas le
problme qu'ils posent. Convenons du moins qu'elle le supprime.
Je reviendrai ces hommes. Mais la peine capitale ne s'applique-telle qu' eux ? Peut-on nous assurer qu'aucun des excuts n'est rcuprable ? Peut-on mme jurer qu'aucun n'est innocent ? Dans les
deux cas, ne doit-on pas avouer que la peine capitale n'est liminatrice
que dans la mesure o elle est irrparable ? Hier, 15 mars 1957, a t
excut en Californie Burton Abbott, condamn mort pour avoir assassin une fillette de quatorze ans. Voil, je crois, le genre de crime
odieux qui classe son auteur parmi les irrcuprables. Bien qu'Abbott
ait toujours protest de son [152] innocence, il fut condamn. Son
excution avait t fixe le 15 mars, 10 heures. 9h 10, un sursis
tait accord pour permettre aux dfenseurs de prsenter un dernier
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
36
recours 21 . 11 heures, l'appel tait rejet. 11h 15, Abbott entrait
dans la chambre gaz. 11h 18, il respirait les premires bouffes de
gaz. 11h 20, le secrtaire de la Commission des grces appelait au
tlphone. La Commission s'tait ravise. On avait cherch le gouverneur qui tait parti en mer, puis on avait appel directement la prison.
On tira Abbott de la chambre gaz. Il tait trop tard. Si seulement le
temps, hier, avait t orageux au-dessus de la Californie, le gouverneur ne serait pas all en mer. Il aurait tlphon deux minutes plus
tt : Abbott, aujourd'hui, serait vivant et verrait peut-tre son innocence prouve. Toute autre peine, mme la plus dure, lui laissait cette
chance. La peine de mort ne lui en laissait aucune.
On estimera que ce fait est exceptionnel. Nos vies le sont aussi et
pourtant, dans l'existence fugitive qui est la ntre, ceci se passe prs
de nous, une dizaine d'heures d'avion. Le malheur d'Abbott n'est pas
tant une exception qu'un fait divers parmi d'autres, une erreur qui
n'est pas isole, si nous en croyons nos journaux (voir l'affaire Deshays, pour ne citer que la plus rcente). Le juriste d'Olivecroix, appliquant, vers 1860, la chance d'erreur judiciaire le calcul des probabilits, a d'ailleurs conclu qu'environ un innocent tait condamn sur
deux cent cinquante-sept cas. La proportion est faible ? Elle est faible
au regard des peines moyennes. Elle est infinie au regard de la peine
capitale. Quand Hugo crit que pour lui la guillotine s'appelle Lesurques 22 , il ne veut pas dire que tous les condamns qu'elle dcapite
sont des Lesurques, mais [153] qu'il suffit d'un Lesurques pour qu'elle
soit jamais dshonore. On comprend que la Belgique ait renonc dfinitivement prononcer la peine de mort aprs une erreur judiciaire
et que l'Angleterre ait pos la question de l'abolition aprs l'affaire
Hayes. On comprend aussi les conclusions de ce procureur gnral qui,
consult sur le recours en grce d'un criminel, trs probablement cou21 Il faut noter que l'usage, dans les prisons amricaines, est de
changer le condamn de cellule la veille de son excution en lui annonant la crmonie qui l'attend.
22 C'est le nom de l'innocent guillotin dans l'affaire du Courrier de
Lyon.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
37
pable, mais dont la victime n'avait pas t retrouve, crivait : La
survie de X... assure l'autorit la possibilit d'examiner utilement
loisir tout nouvel indice qui serait apport ultrieurement de l'existence de sa femme 23 ... l'inverse, l'excution de la peine capitale, en
annulant cette possibilit hypothtique d'examen, donnerait, je le
crains, l'indice le plus menu, une valeur thorique, une force de regret que je crois inopportun de crer. Le got de la justice et de la
vrit s'exprime ici de faon mouvante et il conviendrait de citer
souvent ; dans nos assises, cette force de regret qui rsume si
fermement le pril devant lequel se trouve tout jur. Une fois l'innocent mort, personne ne peut plus rien pour lui, en effet, que le rhabiliter, s'il se trouve encore quelqu'un pour le demander. On lui rend
alors son innocence, qu' vrai dire il n'avait jamais perdue. Mais la perscution dont il a t victime, ses affreuses souffrances, sa mort horrible, sont acquises pour toujours. Il ne reste qu' penser aux innocents de l'avenir, pour que ces supplices leur soient pargns. On l'a
fait en Belgique. Chez nous, les consciences, apparemment, sont tranquilles.
Sans doute se reposent-elles sur l'ide que la justice, elle aussi, a
fait des progrs et marche du mme pas que la science. Quand le savant expert disserte en cour d'assises il semble qu'un prtre ait parl
et le jury, lev dans la religion de la science, opine. Pourtant, des affaires rcentes, dont la principale fut l'affaire Besnard, nous ont donn une bonne ide de ce [154] que pouvait tre une comdie des experts. La culpabilit n'est pas mieux tablie parce qu'elle l'a t dans
une prouvette, mme gradue. Une deuxime prouvette dira le
contraire et l'quation personnelle garde toute son importance dans
ces mathmatiques prilleuses. La proportion des savants vraiment
experts est la mme que celle des juges psychologues, peine plus
forte que celle des jurys srieux et objectifs. Aujourd'hui comme
hier, la chance d'erreur demeure. Demain, une autre expertise dira
23 Le condamn tait accus d'avoir tu sa femme. Mais on n'avait pas
retrouv le corps de cette dernire.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
38
l'innocence d'un Abbott quelconque. Mais Abbott sera mort, scientifiquement lui aussi, et la science qui prtend prouver aussi bien l'innocence que la culpabilit, n'est pas encore parvenue ressusciter ceux
qu'elle tue.
Parmi les coupables eux-mmes, est-on sr aussi de n'avoir jamais
tu que des irrductibles ? Tous ceux qui ont, comme moi, une poque de leur vie, suivi par ncessit les procs d'assises, savent qu'il
entre beaucoup de hasards dans une sentence, ft-elle mortelle. La
tte de l'accus, ses antcdents 'adultre est souvent considr
comme une circonstance aggravante par des jurs dont je n'ai jamais
pu croire qu'ils fussent tous et. toujours fidles), son attitude (qui ne
lui est favorable que si elle est conventionnelle, c'est--dire comdienne, la plupart du temps), son locution mme (les chevaux de retour savent qu'il ne faut ni balbutier ni parler trop bien), les incidents
de l'audience apprcis sentimentalement (et le vrai, hlas, n'est pas
toujours mouvant), autant de hasards qui influent sur la dcision finale du jury. Au moment du verdict de mort, on peut tre assur qu'il a
fallu, pour arriver la plus certaine des peines, un grand concours
d'incertitudes. Quand on sait que le verdict suprme dpend d'une
estimation que fait le jury des circonstances attnuantes, quand on
sait surtout que la rforme de 1832 a donn nos jurys le pouvoir
'd'accorder des circonstances attnuantes indtermines, on imagine
la marge laisse l'humeur momentane des jurs. Ce n'est plus la loi
qui prvoit avec prcision les cas o la mort doit tre donne, mais
[155] le jury qui, aprs coup, l'apprcie, c'est le cas de le dire, au jug.
Comme il n'y a pas deux jurys comparables, celui qui est excut aurait pu ne pas l'tre. Irrcuprable aux yeux des honntes gens de
l'Ille-et-Vilaine, il se serait vu accorder un semblant d'excuse par les
bons citoyens du Var. Malheureusement, le mme couperet tombe dans
les deux dpartements. Et il ne fait pas le dtail.
Les hasards du temps rejoignent ceux de la gographie pour renforcer l'absurdit gnrale. L'ouvrier communiste franais qui vient
d'tre guillotin en Algrie pour avoir dpos une bombe (dcouverte
avant qu'elle n'explose) dans le vestiaire d'une usine, a t condamn
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
39
autant par son acte que par l'air du temps. Dans le climat actuel de
l'Algrie, on a voulu la fois prouver l'opinion arabe que la guillotine
tait faite aussi pour les Franais et donner satisfaction l'opinion
franaise indigne par les crimes du terrorisme. Au mme moment,
pourtant, le ministre qui couvrait l'excution acceptait les voix communistes dans sa circonscription. Si les circonstances avaient t autres, l'inculp s'en tirait peu de frais et risquait seulement un jour,
devenu dput du parti, de boire la mme buvette que le ministre. De
telles penses sont amres et l'on voudrait qu'elles restent vivantes
dans l'esprit de nos gouvernants. Ils doivent savoir que les temps et
les murs changent ; un jour vient o le coupable, trop vite excut,
n'apparat plus si noir. Mais il est trop tard et il ne reste plus qu' se
repentir ou oublier. Bien entendu, on oublie. La socit, cependant,
n'en est pas moins atteinte. Le crime impuni, selon les Grecs, infectait
la cit. Mais l'innocence condamne, ou le crime trop puni, la longue,
ne la souille pas moins. Nous le savons, en France.
Telle est, dira-t-on, la justice des hommes et, malgr ses imperfections, elle vaut mieux que l'arbitraire. Mais cette mlancolique apprciation n'est supportable qu' l'gard des peines ordinaires. Elle
est scandaleuse devant les verdicts de mort. Un ouvrage classique
[156] de droit franais, pour excuser la peine de mort de n'tre pas
susceptible de degrs, crit ainsi : La justice humaine n'a nullement
l'ambition d'assurer cette proportion. Pourquoi ? Parce qu'elle se sait
infirme. Faut-il donc conclure que cette infirmit nous autorise
prononcer un jugement absolu et, qu'incertaine de raliser la justice
pure, la socit doive se prcipiter, par les plus grands risques, la
suprme injustice ? Si la justice se sait infirme, ne conviendrait-il pas
qu'elle se montrt modeste, et, qu'elle laisst autour de ses sentences
une marge suffisante pour que l'erreur ventuelle pt tre rpare 24 ? Cette faiblesse o elle trouve pour elle-mme, de faon per-
24 On s'est flicit d'avoir graci Sillon, qui tua rcemment sa fillette
de quatre ans, pour ne pas la donner sa mre qui voulait divorcer.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
40
manente, une circonstance attnuante, ne devrait-elle pas l'accorder
toujours au criminel lui-mme ? Le jury peut-il dcemment dire : Si
je vous fais mourir par erreur, vous me pardonnerez sur la considration des faiblesses de notre commune nature. Mais je vous condamne
mort sans considration de ces faiblesses ni de cette nature ? Il y a
une solidarit de tous les hommes dans l'erreur et dans l'garement.
Faut-il que cette solidarit joue pour le tribunal et soit te l'accus ? Non, et si la justice a un sens en ce monde, elle ne signifie rien
d'autre que la reconnaissance de cette solidarit ; elle ne peut, dans
son *essence mme, se sparer de la compassion. La compassion, bien
entendu, ne peut tre ici que le sentiment d'une souffrance commune
et non pas une frivole indulgence qui ne tiendrait aucun compte des
souffrances et des droits de la victime. Elle n'exclut pas le chtiment,
mais elle suspend la condamnation ultime. Elle rpugne la mesure dfinitive, irrparable, qui fait injustice l'homme tout entier puisqu'elle ne fait pas sa part la misre de la condition commune.
[157] vrai dire, certains jurys le savent bien qui, souvent, admettent des circonstances attnuantes dans un crime que rien ne peut
attnuer. C'est que la peine de mort leur parat alors excessive et
qu'ils prfrent ne pas assez punir punir trop. L'extrme svrit de
la peine favorise alors le crime au lieu de le sanctionner. Il ne se passe
pas de session d'assises o l'on ne lise dans notre presse qu'un verdict
est incohrent et que, devant les faits, il parat ou insuffisant ou excessif. Mais les jurs ne l'ignorent pas. Simplement, devant l'normit
de la peine capitale, ils prfrent, comme nous le ferions nous-mmes,
passer pour des ahuris plutt que de compromettre leurs nuits venir.
Se sachant infirmes, ils en tirent du moins les consquences qui
conviennent. Et la vraie justice est avec eux, dans la mesure, justement, o la logique ne l'est pas.
Il est pourtant de grands criminels que tous les jurys condamneraient o que ce soit, dans n'importe quel temps. Leurs crimes sont
On dcouvrit, en effet, pendant sa dtention, que Sillon souffrait
d'une tumeur au cerveau qui pouvait expliquer la folie de son acte.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
41
certains et les preuves apportes par l'accusation rejoignent les aveux
de la dfense. Sans doute, ce qu'ils ont d'anormal et de monstrueux
les classe dj dans une rubrique pathologique. Mais les experts psychiatres affirment, dans la plupart des cas, leur responsabilit. Rcemment, Paris, un jeune homme, un peu faible de caractre, mais
doux et affectueux, trs uni aux siens, se trouve, selon ses aveux,
agac par une remarque de son pre sur sa rentre tardive. Le pre
lisait, assis devant la table de la salle manger. Le jeune homme prend
une hache et, par-derrire, frappe son pre de plusieurs coups mortels. Puis il abat, de la mme manire, sa mre qui se trouvait dans la
cuisine. Il se dshabille, cache son pantalon ensanglant dans l'armoire, va rendre visite, sans rien laisser paratre, aux parents de sa fiance, revient ensuite chez lui et avise la police qu'il vient de trouver ses
parents assassins. La police dcouvre aussitt le pantalon ensanglant
et obtient, sans difficults, les aveux tranquilles du parricide. Les
psychiatres conclurent la responsabilit de ce meurtrier [158] par
agacement. Son trange indiffrence, dont il devait donner d'autres
preuves en prison (se flicitant que l'enterrement de ses parents et
t suivi par beaucoup de monde : Ils taient trs aims , disait-il
son avocat) ne peut cependant tre considre comme normale. Mais le
raisonnement tait intact chez lui, apparemment.
Beaucoup de monstres prsentent des visages aussi impntrables. Ils sont limins, sur la seule considration des faits. Apparemment, la nature ou la grandeur de leurs crimes ne permet pas d'imaginer qu'ils puissent se repentir ou s'amender. Il faut seulement viter
qu'ils recommencent et il n'y a pas d'autre solution que de les liminer.
Sur cette frontire, et sur elle seule, la discussion autour de la peine
de mort est lgitime. Dans tous les autres cas, les arguments ,des
conservateurs ne rsistent pas la critique des abolitionnistes. A cette limite, dans l'ignorance o nous sommes, un pari s'installe au
contraire. Aucun fait, aucun raisonnement ne peut dpartager ceux qui
pensent qu'une chance doit toujours tre accorde au dernier des
hommes et ceux qui estiment cette chance illusoire. Mais il est possible peut-tre, sur cette dernire frontire, de dpasser la longue op-
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
42
position entre partisans et adversaires de la peine de mort, en apprciant l'opportunit de cette peine, aujourd'hui, et en Europe. Avec
beaucoup moins de comptence, j'essaierai de rpondre ainsi au voeu
d'un juriste suisse, le professeur Jean Graven, qui crivait en 1952,
dans sa remarquable tude sur le problme de la peine de mort :
... Devant le problme qui se pose derechef notre conscience et
notre raison, nous pensons qu'une solution doit tre recherche non
pas sur les conceptions, les problmes et les arguments du pass, ni
sur les esprances et les promesses thoriques de l'avenir, mais sur
les ides, les donnes, et les ncessits actuelles 25 .
[159] On peut, en effet, disputer ternellement sur les bienfaits
ou les ravages de la peine de mort travers les sicles ou dans le ciel
des ides. Mais elle joue un rle ici et maintenant, et nous avons nous
dfinir ici et maintenant, en face du bourreau moderne. Que signifie la
peine de mort pour les hommes du demi-sicle ?
Pour simplifier, disons que notre civilisation a perdu les seules valeurs qui, d'une certaine manire, peuvent justifier cette peine et
souffre au contraire de maux qui ncessitent sa suppression. Autrement dit, l'abolition de la peine de mort devrait tre demande par les
membres conscients de notre socit, la fois pour des raisons de
logique et de ralisme.
De logique d'abord. Arrter qu'un homme doit tre frapp du chtiment dfinitif revient dcider que cet homme n'a plus aucune
chance de rparer. C'est ici, rptons-le, que les arguments s'affrontent aveuglment et cristallisent dans une opposition strile. Mais justement, nul parmi nous ne. peut trancher sur ce point, car nous tous
25
Revue de Criminologie et de Police technique, Genve, numro spcial, 1952.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
43
sommes juges et parties. De l notre incertitude sur le droit que nous
avons de tuer et l'impuissance o nous sommes nous convaincre mutuellement. Sans innocence absolue, il n'est point de juge suprme. Or,
nous avons tous fait du mal dans notre vie, mme si ce mal, sans tomber sous le coup des lois, allait jusqu'au crime inconnu. Il n'y a pas de
justes, mais seulement des curs plus ou moins pauvres en justice.
Vivre, du moins, nous permet de le savoir et d'ajouter l somme de
nos actions un peu du bien qui compensera, en partie, le mal que nous
avons jet dans le monde. Ce droit de vivre qui concide avec la chance
de rparation est le droit naturel de tout homme, mme le pire. Le
dernier des criminels et le plus intgre des juges s'y retrouvent cte
cte, galement misrables et solidaires. Sans ce droit, la vie morale
est strictement impossible. Nul d'entre nous, en particulier, n'est autoris dsesprer d'un [160] seul homme, sinon aprs sa mort qui
transforme sa vie en destin et permet alors le jugement dfinitif.
Mais prononcer le jugement dfinitif avant la mort, dcrter la clture des comptes quand le crancier est encore vivant, n'appartient
aucun homme. Sur cette limite, au moins, qui juge absolument se
condamne absolument.
Bernard Fallot, de la bande Masuy, au service de la Gestapo, qui fut
condamn mort aprs avoir reconnu les nombreux et terribles crimes
dont il s'tait rendu coupable, et qui mourut avec le plus grand courage, dclarait lui-mme qu'il ne pouvait tre graci. J'ai les mains
trop rouges de sang, disait-il un camarade de prison 26 . L'opinion,
et celle de ses juges, le plaaient certainement parmi les irrcuprables, et j'aurais t tent de l'admettre si je n'avais lu un tmoignage
surprenant. Voici ce que Fallot disait au, mme compagnon, aprs avoir
dclar qu'il voulait mourir courageusement : Veux-tu que je te dise
mon plus profond regret ? Eh bien ! c'est de ne pas avoir connu plus
tt la Bible que j'ai l. Je t'assure que je n'en serais pas l o j'en
suis. Il ne s'agit pas de cder quelque imagerie conventionnelle et
26 Jean Bocognano,
du Fuseau.
Quartier des fauves, prison de Fresnes, ditions
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
44
d'voquer les bons forats de Victor Hugo. Les sicles clairs, comme
on dit, voulaient supprimer la peine de mort sous prtexte que l'homme tait foncirement bon. Naturellement, il ne l'est pas (il est pire ou
meilleur). Aprs vingt ans de notre superbe histoire, nous le savons
bien. Mais c'est parce qu'il ne l'est pas que personne parmi nous ne
peut s'riger en juge absolu, et prononcer l'limination dfinitive du
pire des coupables, puisque nul d'entre nous ne peut prtendre l'innocence absolue. Le jugement capital rompt la seule solidarit humaine
indiscutable, la solidarit contre la mort, et il ne peut tre lgitim
que par une vrit ou un principe qui se place au-dessus des hommes.
[161] En fait, le chtiment suprme a toujours t, travers les
sicles, une peine religieuse. Inflige au nom du roi, reprsentant de
Dieu sur terre, ou par les prtres, ou au nom de la socit considre
comme un corps sacr, ce n'est pas la solidarit humaine qu'elle rompt
alors, mais l'appartenance du coupable la communaut divine, qui peut
seule lui donner la vie. La vie terrestre lui est sans doute retire, mais
la chance de rparation lui est maintenue. Le jugement rel n'est pas
prononc, il le sera dans l'autre monde. Les valeurs religieuses, et particulirement la croyance la vie ternelle, sont donc seules pouvoir
fonder le chtiment suprme puisqu'elles empchent, selon leur logique propre, qu'il soit dfinitif et irrparable. Il n'est alors justifi
que dans la mesure o il n'est pas suprme.
L'glise catholique, par exemple, a toujours admis la ncessit de
la peine de mort. Elle l'a inflige elle-mme, et sans avarice, d'autres
poques. Aujourd'hui encore, elle la justifie et reconnat l'tat le
droit de l'appliquer. Si nuance que soit sa position, on y trouve un
sentiment profond qui a t exprim directement, en 1937, par un
conseiller national suisse de Fribourg, lors d'une discussion, au Conseil
national, sur la peine de mort. Selon M. Grand, le pire des criminels,
devant l'excution menaante, rentre en lui-mme.
Il se repent et sa prparation la mort en est facilite. L'glise a
sauv un de ses membres, elle a accompli sa mission divine. Voil pour-
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
45
quoi elle a constamment admis la peine de mort, non seulement comme
un moyen de lgitime dfense, mais comme un puissant moyen de salut 27 ... Sans vouloir en faire une chose d'glise, la peine de mort peut
revendiquer pour elle son efficacit quasi divine, comme la guerre.
En vertu du mme raisonnement sans doute, on [162] pouvait lire,
sur l'pe du bourreau de Fribourg, la formule Seigneur Jsus, tu es
le Juge . Le bourreau se trouve alors investi d'une fonction sacre. Il
est l'homme qui dtruit le corps pour livrer l'me la sentence divine,
dont nul ne prjuge. On estimera peut-tre que de pareilles formules
tranent avec elles des confusions assez scandaleuses. Et sans doute,
pour qui s'en tient l'enseignement de Jsus, cette belle pe est un
outrage de plus la personne du Christ. On peut comprendre, dans
cette lumire, le mot terrible d'un condamn russe que les bourreaux
du tsar allaient pendre, en 1905, et qui dit fermement au prtre venu
le consoler par l'image du Christ : loignez-vous et ne commettez
pas de sacrilge. L'incroyant ne peut non plus s'empcher de penser
que des hommes qui ont mis au centre de leur foi la bouleversante victime d'une erreur judiciaire devraient se montrer au moins rticents
devant le meurtre lgal. On pourrait aussi rappeler aux croyants que
l'empereur Julien, avant sa conversion, ne voulait pas donner de charges officielles aux chrtiens parce que ceux-ci refusaient systmatiquement de prononcer des condamnations mort ou d'y prter la main.
Pendant cinq sicles, les chrtiens ont donc cru que le strict enseignement moral de leur matre interdisait de tuer. Mais la foi catholique ne se nourrit pas seulement de l'enseignement personnel du Christ.
Elle s'alimente aussi l'Ancien Testament comme saint Paul et aux
Pres. En particulier l'immortalit de l'me, et la rsurrection universelle des corps sont des articles de dogme. Ds .ors, la peine capitale
reste, pour le croyant, un chtiment provisoire qui laisse en suspens la
sentence dfinitive, une disposition ncessaire seulement l'ordre
terrestre, une mesure d'administration qui, loin d'en finir avec le cou27 C'est
moi qui souligne.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
46
pable, peut favoriser au contraire sa rdemption. Je ne dis pas que
tous les croyants pensent ainsi et j'imagine sans peine que des catholiques puissent se tenir plus prs du Christ que de Mose ou de saint
Paul. Je dis seulement que la foi dans l'immortalit de l'me a permis
au catholicisme de poser [163] le problme de la peine capitale en des
termes trs diffrents, et de la justifier.
Mais que signifie cette justification dans la socit o nous vivons
et qui, dans ses institutions comme dans ses murs, est dsacralise ?
Lorsqu'un juge athe, ou sceptique, ou agnostique, inflige la peine de
mort un condamn incroyant, il prononce un chtiment dfinitif qui
ne peut tre rvis. Il se place sur le trne de Dieu. 28 sans en avoir
les pouvoirs, et d'ailleurs sans y croire. Il tue, en somme,. parce que
ses aeux croyaient la vie ternelle. Mais la socit, qu'il prtend
reprsenter, prononce en ralit une pure mesure d'limination, brise
la communaut humaine unie contre la mort, et se pose elle-mme en
valeur absolue puisqu'elle prtend au pouvoir absolu. Sans doute, elle
dlgue un prtre au condamn, par tradition. Le prtre peut esprer
lgitimement que la peur du chtiment aidera la conversion du coupable. Qui acceptera cependant qu'on justifie, par ce calcul, une peine
inflige et reue le plus souvent dans un tout autre esprit ? C'est une
chose que de croire avant d'avoir peur, une autre de trouver la foi
aprs la peur. La conversion par le feu ou le couperet sera toujours
suspecte, et on pouvait croire que l'glise avait renonc triompher
des infidles par la terreur. De toute manire, la socit dsacralise
n'a rien tirer d'une conversion dont elle fait profession de se dsintresser. Elle dicte un chtiment sacr et lui retire en mme temps
ses excuses et son utilit. Elle dlire son propre sujet, elle limine
souverainement les mchants de son sein, comme si elle tait la vertu
mme. Tel un homme honorable qui tuerait son fils dvoy en disant :
Vraiment, je ne savais plus qu'en faire. Elle s'arroge le droit de
slectionner, comme si elle tait la nature elle-mme, et d'ajouter
28 On sait que la dcision du jury est prcde de la formule : De-
vant Dieu et ma conscience...
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
47
d'immenses souffrances l'limination, comme si elle tait un dieu
rdempteur.
[164] Affirmer en tout cas qu'un homme doit tre absolument retranch de la socit parce qu'il est absolument mauvais revient dire
que celle-ci est absolument bonne, ce que personne de sens ne. croira
aujourd'hui. On ne le croira pas et l'on pensera plus facilement le
contraire. Notre socit n'est devenue si mauvaise et si criminelle que
parce qu'elle s'est rige elle-mme en fin dernire et n'a plus rien
respect que sa propre conservation ou sa russite dans l'histoire.
Dsacralise, elle l'est, certes. Mais elle a commenc de se constituer
au XIXe sicle un ersatz de religion, en se proposant elle-mme comme
objet d'adoration. Les doctrines de l'volution et les ides de slection qui les accompagnaient ont rig en but dernier l'avenir de la socit. Les utopies politiques qui se sont greffes sur ces doctrines ont
plac, la fin des temps, un ge d'or qui justifiait d'avance toutes les
entreprises. La socit s'est habitue lgitimer ce qui pouvait servir
son avenir et user par consquent du chtiment suprme de manire
absolue. Ds cet instant, elle a considr comme crime et sacrilge
tout ce qui contrariait son projet et ses dogmes temporels. Autrement
dit, le bourreau, de prtre, est devenu fonctionnaire. Le rsultat est
l, autour de nous. Il est tel que cette socit du demi-sicle qui a
perdu le droit, en bonne logique, de prononcer la peine capitale, devrait, maintenant, la supprimer pour des raisons de ralisme.
Devant le crime, comment se dfinit en effet notre civilisation ? La
rponse est simple : depuis trente ans, les crimes d'tat l'emportent
de loin sur les crimes des individus. Je ne parle mme pas des guerres,
gnrales ou localises, quoique le sang aussi soit un alcool, qui intoxique, la longue, comme le plus chaleureux des vins. Mais le nombre des
individus tus directement par l'tat a pris des proportions astronomiques et passe infiniment celui des meurtres particuliers. Il y a de
moins en moins de condamns de [165] droit commun et de plus en plus
de condamns politiques. La preuve en est que chacun d'entre nous, si
honorable soit-il, peut envisager la possibilit d'tre un jour condamn
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
48
mort, alors que cette ventualit aurait paru bouffonne au dbut du
sicle. La boutade d'Alphonse Karr : Que messieurs les assassins
commencent ! n'a plus aucun sens. Ceux qui font couler le plus de
sang sont les mmes qui croient avoir le droit, la logique et l'histoire
avec eux.
Ce n'est plus tant contre l'individu que notre socit doit donc se
dfendre que contre l'tat. Il se peut que les proportions soient inverses dans trente ans. Mais, pour le moment, la lgitime dfense
doit tre oppose l'tat et lui d'abord. La justice et l'opportunit
la plus raliste commandent que la loi protge l'individu contre un tat
livr aux folies du sectarisme ou de l'orgueil. Que l'tat commence
et abolisse la peine de mort ! devrait tre, aujourd'hui, notre cri de
ralliement.
Les lois sanglantes, a-t-on dit, ensanglantent les murs. Mais il arrive un tat d'ignominie, pour une socit donne o, malgr tous les
dsordres, les murs ne parviennent jamais tre aussi sanglantes
que les lois. La moiti de l'Europe connat cet tat. Nous autres Franais, l'avons connu et risquons de le connatre nouveau. Les excuts
de l'occupation ont entran les excuts de la Libration dont les
amis rvent de revanche. Ailleurs des tats chargs de trop de crimes
se prparent noyer leur culpabilit dans des massacres plus grands
encore. On tue pour une nation ou pour une classe divinises. On tue
pour une socit future, divinise elle aussi. Qui croit tout savoir imagine tout pouvoir. Des idoles temporelles, qui exigent une foi absolue,
prononcent inlassablement des chtiments absolus. Et des religions
sans transcendance tuent en masse des condamns sans esprance.
Comment la socit europenne du demi-sicle survivrait-elle alors,
sans dcider de dfendre les personnes, par tous les moyens, contre
l'oppression tatique ? [166] Interdire la mise mort d'un homme serait proclamer publiquement que la socit et l'tat ne sont pas des
valeurs absolues, dcrter que rien ne les autorise lgifrer dfinitivement, ni produire de l'irrparable. Sans la peine de mort, Gabriel
Pri et Brasillach seraient peut-tre parmi nous. Nous pourrions alors
les juger, selon notre opinion, et dire firement notre jugement, au
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
49
lieu qu'ils nous jugent ; maintenant, et que nous nous taisons. Sans la
peine de mort, le cadavre de Rajk n'empoisonnerait pas la Hongrie,
l'Allemagne moins coupable serait mieux reue de l'Europe, la rvolution russe n'agoniserait pas dans la honte, le sang algrien pserait
moins sur nos consciences. Sans la peine de mort, l'Europe, enfin, ne
serait pas infecte par les cadavres accumuls depuis vingt ans dans
sa terre puise. Sur notre continent, toutes les valeurs sont bouleverses par la peur et la haine, entre les individus comme entre les
nations. La lutte des ides se fait la corde et au couperet. Ce n'est
plus la socit humaine et naturelle qui exerce ses droits de rpression, mais l'idologie qui rgne et exige ses sacrifices humains.
L'exemple que donne toujours l'chafaud, a-t-on pu crire 29 , c'est
que la vie de l'homme cesse d'tre sacre lorsqu'on croit utile de le
tuer. Apparemment, cela devient de plus en plus utile, l'exemple se
propage, la contagion se rpand partout. Avec elle, le dsordre du nihilisme. Il faut donc donner un coup d'arrt spectaculaire et proclamer,
dans les principes et dans les institutions, que la personne humaine est
au-dessus de l'tat. Toute mesure, aussi bien, qui diminuera la pression des forces sociales sur l'individu, aidera dcongestionner une
Europe qui souffre d'un afflux de sang, lui permettra de mieux penser
et de s'acheminer vers la gurison. La maladie de l'Europe est de ne
croire rien et de prtendre tout savoir. Mais elle ne sait pas [167]
tout, il s'en faut, et, en juger par la rvolte et l'esprance o nous
sommes, elle croit quelque chose - elle croit que l'extrme misre de
l'homme, sur une limite mystrieuse, touche son extrme grandeur.
La foi, pour la majorit des Europens, est perdue. Avec elle, les justifications qu'elle apportait dans l'ordre du chtiment. Mais la majorit
des Europens vomissent aussi l'idoltrie d'tat qui a prtendu remplacer la foi. Dsormais mi-chemin, certains et incertains, dcids
ne jamais subir et ne jamais opprimer, nous devrions reconnatre en
mme temps notre espoir et notre ignorance, refuser la loi absolue,
l'institution irrparable. Nous en savons assez pour dire que tel grand
criminel mrite les travaux forcs perptuit. Mais nous n'en savons
29 Francart.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
50
pas assez pour dcrter qu'il soit t son propre avenir, c'est--dire
notre commune chance de rparation. Dans l'Europe unie de demain,
cause de ce que je viens de dire, l'abolition solennelle de la peine de
mort devrait tre le premier article du Code europen que nous esprons tous.
Des idylles humanitaires du XVIIIe sicle aux chafauds sanglants,
la route est droite et les bourreaux d'aujourd'hui, chacun le sait, sont
humanistes. On ne saurait trop, par consquent se mfier de l'idologie humanitaire dans un problme comme celui de la peine de mort. Au
moment de conclure, je voudrais donc rpter que ce ne sont pas des
illusions sur la bont naturelle de la crature, ni la foi dans un ge dor
venir, qui expliquent mon opposition la peine de mort. Au contraire,
l'abolition me parat ncessaire pour des raisons de pessimisme raisonn, de logique et de ralisme. Non que le cur n'ait pas de part
ce que j'ai dit. Pour qui vient de passer des semaines dans la frquentation des textes, des souvenirs, des hommes, qui, de prs ou de loin,
touchent l'chafaud, il ne saurait tre question de sortir de ces
[168] affreux dfils tel qu'on y tait entr. Mais je ne crois pas, pour
autant, il faut le rpter, qu'il n'y ait nulle responsabilit en ce monde
et qu'il faille cder ce penchant moderne qui consiste tout absoudre, la victime et le tueur, dans la mme confusion. Cette confusion
purement sentimentale est faite de lchet plus que de gnrosit et
finit par justifier ce qu'il y a de pire en ce monde. force de bnir, on
bnit aussi le camp d'esclaves, la force lche, les bourreaux organiss,
le cynisme des grands monstres politiques ; on livre enfin ses frres.
Cela se voit autour de nous. Mais justement, dans l'tat actuel du
monde, l'homme du sicle demande des lois et des institutions de
convalescence, qui le brident sans le briser, qui le conduisent sans
l'craser. Lanc dans le dynamisme sans frein de l'histoire, il a besoin
d'une physique et de quelques lois d'quilibre. Il a besoin, pour tout
dire, d'une socit de raison et non de cette anarchie o l'ont plong
son propre orgueil et les pouvoirs dmesurs de l'tat.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
51
J'ai la conviction que l'abolition de la peine de mort nous aiderait
avancer sur le chemin de cette socit. La France pourrait, prenant
cette initiative, proposer de l'tendre aux pays non abolitionnistes de
part et d'autre du rideau de fer. Mais qu'elle donne en tout cas
l'exemple. La peine capitale serait alors remplace par les travaux
forcs, perptuit pour les criminels jugs irrductibles, terme
pour les autres. ceux qui estiment que cette peine est plus dure que
la peine capitale, on rpondra en s'tonnant qu'ils n'aient pas propos,
dans ce cas, de la rserver aux Landru et d'appliquer la peine capitale
aux criminels secondaires. On leur rappellera aussi que les travaux
forcs laissent au condamn la possibilit de choisir la mort, tandis
que la guillotine n'ouvre aucun chemin de retour. ceux qui estiment,
au contraire, que les travaux forcs sont une peine trop faible, on rpondra d'abord qu'ils manquent d'imagination et ensuite que la privation de la libert leur parat un chtiment lger dans la seule mesure
o la socit [169] contemporaine nous a appris mpriser la libert 30 . Que Can ne soit pas tu, mais qu'il conserve aux yeux des hommes un signe de rprobation, voil en tout cas, la leon que nous devons
tirer de l'Ancien Testament, sans parler des vangiles, plutt que de
nous inspirer des exemples cruels de la loi mosaque. Rien n'empche
en tout cas qu'une exprience, limite dans le temps (pour dix ans, par
exemple) soit tente chez nous, si notre Parlement est encore incapable de racheter ses votes sur l'alcool par cette grande mesure de civi-
30 Voir aussi le rapport sur la peine de mort du reprsentant Dupont,
l'Assemble nationale, le 31 mai 1791 : Une humeur cre et brlante le (l'assassin) consume ; ce qu'il redoute le plus, c'est le repos ; c'est un tat qui le laisse avec lui-mme, c'est pour en sortir
qu'il brave continuellement la mort et cherche la donner ; la solitude et sa conscience, voil son vritable supplice. Cela ne nous indique-t-il pas quel genre de punition vous devez lui infliger, quel est
celui auquel il sera sensible ? N'est-ce pas dans la nature de la maladie qu'il faut prendre le remde qui doit la gurir. C'est moi qui
souligne la dernire phrase. Elle fait de ce reprsentant peu connu
un vritable prcurseur de nos psychologies modernes.
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
52
lisation que serait l'abolition dfinitive. Et si vraiment l'opinion publique, et ses reprsentants, ne peuvent renoncer cette loi de paresse
qui se borne liminer ce qu'elle ne sait amender, que, du moins, en
attendant un jour de renaissance et de vrit, nous n'en fassions pas
cet abattoir solennel 31 qui souille notre socit. La peine de mort,
telle qu'elle est applique, et si rarement qu'elle le soit, est une dgotante boucherie, un outrage inflig la personne et au corps de
l'homme. Cette dtroncation, cette tte vivante et dracine, ces
longs jets de sang, datent d'une poque barbare qui croyait impressionner le peuple par des spectacles avilissants. Aujourd'hui o cette
ignoble mort est administre la sauvette, quel est le sens de ce supplice ? La vrit est qu' l'ge nuclaire nous tuons comme l'ge du
peson. Et il n'est pas un homme [170] de sensibilit normale qui, la
seule ide de cette grossire chirurgie, n'en vienne la nause. Si
l'tat franais est incapable de triompher de lui-mme, sur ce point,
et d'apporter l'Europe un des remdes dont elle a besoin, qu'il rforme pour commencer le mode d'administration de la peine capitale.
La science qui sert tant tuer pourrait au moins servir tuer dcemment. Un anesthsique qui ferait passer le condamn du sommeil la
mort, qui resterait sa porte pendant un jour au moins pour qu'il en
use librement, et qui lui serait administr, sous une autre forme, dans
le cas de volont mauvaise ou dfaillante, assurerait l'limination, si
l'on y tient, mais apporterait un peu de dcence l o il n'y a, aujourd'hui, qu'une sordide et obscne exhibition.
J'indique ces compromis dans la mesure o il faut parfois dsesprer de voir la sagesse et la vraie civilisation s'imposer aux responsables de notre avenir. Pour certains hommes, plus nombreux qu'on ne
croit, savoir ce qu'est rellement la peine de mort et ne pouvoir empcher qu'elle s'applique, est physiquement insupportable. leur manire, ils subissent aussi cette peine, et sans aucune justice. Qu'on allge
au moins le poids des sales images qui psent sur eux, la socit n'y
31 Tarde. [Voir les uvres de Gabriel Tarde dans Les Classiques des
sciences sociales. JMT.]
Albert Camus, Rflexions sur la guillotine (1957)
53
perdra rien. Mais cela mme, la fin, sera insuffisant. Ni dans le cur
des individus ni dans les murs des socits, il n'y aura de paix durable tant que la mort ne sera pas mise hors la loi.
Fin du texte
Vous aimerez peut-être aussi
- 1948 - Situations II - Jean-Paul Sartre PDFDocument333 pages1948 - Situations II - Jean-Paul Sartre PDFPiero Eyben75% (4)
- Albert Camus - L'EtrangerDocument2 pagesAlbert Camus - L'Etrangerxavier100% (81)
- Reflexions GuillotineDocument44 pagesReflexions GuillotineFrancine Reinhardt RomanoPas encore d'évaluation
- Camus - L'Envers Et L'EndroitDocument58 pagesCamus - L'Envers Et L'EndroitAlex Jackson0% (1)
- Jankelevitch, Vladimir L'ImprescriptibleDocument44 pagesJankelevitch, Vladimir L'Imprescriptible140871raph100% (3)
- Fiche de lecture illustrée - "L'Étranger", d'Albert CamusD'EverandFiche de lecture illustrée - "L'Étranger", d'Albert CamusPas encore d'évaluation
- Le Dernier Jour d'un condamné de Victor Hugo - Préface de 1832: Commentaire et Analyse de texteD'EverandLe Dernier Jour d'un condamné de Victor Hugo - Préface de 1832: Commentaire et Analyse de textePas encore d'évaluation
- Reflexions GuillotineDocument53 pagesReflexions GuillotineGiovanni Henrique TremeaPas encore d'évaluation
- Réflexions Sur La Guillotine (Albert Camus)Document56 pagesRéflexions Sur La Guillotine (Albert Camus)zaboub mohamedPas encore d'évaluation
- Camus Albert Actuelles IIDocument108 pagesCamus Albert Actuelles IINegru CorneliuPas encore d'évaluation
- Camus Albert Lenvers Et LendroitDocument58 pagesCamus Albert Lenvers Et LendroitD'AGOSTIN100% (1)
- L-Envers Et L-Endroit FRDocument58 pagesL-Envers Et L-Endroit FRInmobiliaria CarandayPas encore d'évaluation
- Albert Camus - Discours de Suede (1957)Document33 pagesAlbert Camus - Discours de Suede (1957)cyrille leandres ngonPas encore d'évaluation
- Létanger de Camus Et LexistentialismeDocument10 pagesLétanger de Camus Et LexistentialismeJIHAN ZAHRAOUIPas encore d'évaluation
- Remarque Sur La Revolte. - Albert Camus, 1945 - @EpubsFRDocument24 pagesRemarque Sur La Revolte. - Albert Camus, 1945 - @EpubsFRNyangaya BaguéwamaPas encore d'évaluation
- Résumé - CamusDocument13 pagesRésumé - CamusNell VuignierPas encore d'évaluation
- Camus Actuelles IIIDocument144 pagesCamus Actuelles IIIAna Fay75% (4)
- Olivier Todd Hak KindaDocument4 pagesOlivier Todd Hak KindanotyousePas encore d'évaluation
- LQ 928Document108 pagesLQ 928Julian P. S.Pas encore d'évaluation
- Critique Fautil Brûler KafkaDocument17 pagesCritique Fautil Brûler KafkarebuPas encore d'évaluation
- Albert Camus - Actuelles IIDocument68 pagesAlbert Camus - Actuelles IIDelignePas encore d'évaluation
- Pierre Michel, "Albert Camus Et Octave Mirbeau"Document68 pagesPierre Michel, "Albert Camus Et Octave Mirbeau"Anonymous 5r2Qv8aonf100% (4)
- Littérature Resume de La ChuteDocument2 pagesLittérature Resume de La Chutelibrexport2476Pas encore d'évaluation
- Camus Actuelles IDocument170 pagesCamus Actuelles Iahmed adenPas encore d'évaluation
- Albert Camus - L'etrangerDocument22 pagesAlbert Camus - L'etrangerAnja IlićPas encore d'évaluation
- De Franck P: (Re) Lire Matin BrunDocument8 pagesDe Franck P: (Re) Lire Matin BrunRomainPas encore d'évaluation
- Séquence 2023 Corpus-Misère Littérature D-IdéesDocument4 pagesSéquence 2023 Corpus-Misère Littérature D-IdéeslyblancPas encore d'évaluation
- Groupement MisereDocument2 pagesGroupement MiserelyblancPas encore d'évaluation
- Joseph Majault - Camus - Révolte Et LibertéDocument168 pagesJoseph Majault - Camus - Révolte Et LibertéMarcelo CordeiroPas encore d'évaluation
- ViewDocument17 pagesViewFina OkomboPas encore d'évaluation
- La Chute d'Albert Camus (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandLa Chute d'Albert Camus (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Knjiž. SeminarskiDocument13 pagesKnjiž. Seminarskimarrina87Pas encore d'évaluation
- Camus Albert Actuelles IDocument170 pagesCamus Albert Actuelles INegru CorneliuPas encore d'évaluation
- Le Premier Homme DAlbert Camus Roman AuDocument18 pagesLe Premier Homme DAlbert Camus Roman AuBianca Lorenza RitaPas encore d'évaluation
- Oeuvres Pré Posthumes - Musil Robert - Z LibraryDocument117 pagesOeuvres Pré Posthumes - Musil Robert - Z LibraryGreg CattaneoPas encore d'évaluation
- FlaubertDocument8 pagesFlaubertBasilaeus GentilhommePas encore d'évaluation
- Lettres Ami AllemandDocument39 pagesLettres Ami AllemandmakiavelliPas encore d'évaluation
- Sartre Présentation Des Temps ModernesDocument8 pagesSartre Présentation Des Temps ModernesUlyses JoycePas encore d'évaluation
- Huis clos de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandHuis clos de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- 《La Case de l'Oncle Tom》(汤姆叔叔的小屋)Document458 pages《La Case de l'Oncle Tom》(汤姆叔叔的小屋)samuel chenPas encore d'évaluation
- Camus Actuelles IIIDocument144 pagesCamus Actuelles IIICallipoPas encore d'évaluation
- Albert-Camus-soleil-et-ombre-by-Grenier-Roger-Grenier-Roger-z-lib.org_Document312 pagesAlbert-Camus-soleil-et-ombre-by-Grenier-Roger-Grenier-Roger-z-lib.org_Almoustapha Amadou Saïdou DjimbaPas encore d'évaluation
- L'absurdeDocument2 pagesL'absurdeyoussef chaat100% (1)
- La Critique Du Libéralisme (Tome 3)Document732 pagesLa Critique Du Libéralisme (Tome 3)IHS_MA100% (2)
- Le Cousin Pons d'Honoré de Balzac: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLe Cousin Pons d'Honoré de Balzac: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Lenfer Cest Les Autres Ou Le ConformismDocument9 pagesLenfer Cest Les Autres Ou Le ConformismRegiane Alves MirandaPas encore d'évaluation
- Mehdi Belhaj Kacem Artaud Et La Theorie Du Complot PDFDocument83 pagesMehdi Belhaj Kacem Artaud Et La Theorie Du Complot PDFOscar Pichardo Isaak100% (1)
- A La Recherche Temps Perdu T 05Document177 pagesA La Recherche Temps Perdu T 0575Pas encore d'évaluation
- PDF of Benjamin Constant 1St Edition Leonard Burnand Full Chapter EbookDocument51 pagesPDF of Benjamin Constant 1St Edition Leonard Burnand Full Chapter Ebookannabelearcella856100% (6)
- Dissertation - EXDocument5 pagesDissertation - EXemma.roques19Pas encore d'évaluation
- Le Dernier Jour d'un condamné: un plaidoyer de Victor Hugo pour l'abolition de la peine de mort (édition originale de 1829)D'EverandLe Dernier Jour d'un condamné: un plaidoyer de Victor Hugo pour l'abolition de la peine de mort (édition originale de 1829)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (207)
- Le Procès de l'Europe: Grandeur et misère de la culture européenneD'EverandLe Procès de l'Europe: Grandeur et misère de la culture européennePas encore d'évaluation
- VPS1 Dossier PedagogiqueDocument20 pagesVPS1 Dossier PedagogiqueFina OkomboPas encore d'évaluation