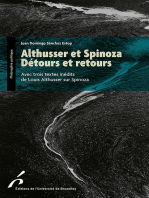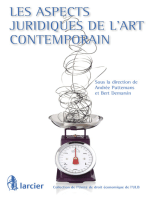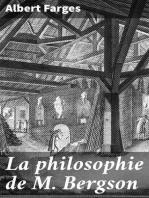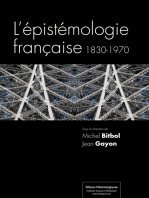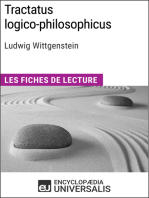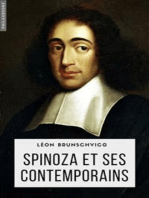Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Sens Et Non Sens
Sens Et Non Sens
Transféré par
Luana NunesCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Sens Et Non Sens
Sens Et Non Sens
Transféré par
Luana NunesDroits d'auteur :
Formats disponibles
Maurice MERLEAU-PONTY [1908-1961]
Philosophe franais, professeur de philosophie
lUniversit de Lyon puis au Collge de France
(1966)
SENS ET NON-SENS
Un document produit en version numrique par Pierre Patenaude, bnvole,
Professeur de franais la retraite et crivain, Chambord, LacSt-Jean.
Courriel: pierre.patenaude@gmail.com
Page web dans Les Classiques des sciences sociales.
Dans le cadre de la bibliothque numrique: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
Politique d'utilisation
de la bibliothque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite,
mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation formelle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales,
Jean-Marie Tremblay, sociologue.
Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent
sans autorisation formelle:
- tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie)
sur un serveur autre que celui des Classiques.
- servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par
tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support,
etc...),
Les fichiers (.html, .doc, .pdf, .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site
Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des Classiques des sciences sociales, un organisme but non lucratif compos exclusivement de bnvoles.
Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute
rediffusion est galement strictement interdite.
L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisateurs. C'est notre mission.
Jean-Marie Tremblay, sociologue
Fondateur et Prsident-directeur gnral,
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
REMARQUE
Ce livre est du domaine public au Canada parce quune uvre passe au domaine public 50 ans aprs la mort de lauteur(e).
Cette uvre nest pas dans le domaine public dans les pays o il
faut attendre 70 ans aprs la mort de lauteur(e).
Respectez la loi des droits dauteur de votre pays.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
Cette dition lectronique a t ralise par Pierre Patenaude, bnvole,
professeur de franais la retraite et crivain,
Courriel : pierre.patenaude@gmail.com
Maurice Merleau-Ponty
SENS ET NON-SENS.
Paris : Les ditions Nagel, 1966, 5e dition, 333 pages. Collection :
Penses.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times New Roman, 14 points.
Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 12 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word
2008 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format : LETTRE US, 8.5 x 11.
dition numrique ralise le 7 dcembre 2014 Chicoutimi,
Ville de Saguenay, Qubec.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
Maurice MERLEAU-PONTY [1908-1961]
Philosophe franais, professeur de philosophie
lUniversit de Lyon puis au Collge de France
SENS ET NON-SENS.
Paris : Les ditions Nagel, 1966, 5e dition, 333 pages. Collection :
Penses.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
PARUS DANS LA MME COLLECTION
BEAUVOIR, Simone de :
L'existentialisme et la sagesse des nations
CROCE, Benedetto :
Contribution ma propre critique
LEFEBVRE, Henri :
Pascal , tomes I et II
LUKACS, Georges :
Brve histoire de la littrature allemande Gthe et son
poque Existentialisme ou marxisme
MARTIN-DESLIAS, Nol :
Un aventurier de l'esprit, Pierre Teilhard de Chardin Le
mythe de la caverne
SANDOR, Paul :
Histoire de la dialectique
SARTRE, Jean Paul :
L'Existentialisme est un humanisme
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
[2]
DU MME AUTEUR
La Structure du Comportement (Presses Universitaires)
Phnomnologie de la Perception (Gallimard)
Humanisme et Terreur (Gallimard)
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
[3]
COLLECTION PENSES
MAURICE MERLEAU-PONTY
SENS ET NON-SENS
Cinquime dition
LES DITIONS NAGEL, PARIS
[4]
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
[5]
Table des matires
PRFACE [7]
I.
OUVRAGES.
Le Doute de Czanne [15]
Le Roman et la Mtaphysique [45]
Un Auteur scandaleux [73]
Le Cinma et la Nouvelle Psychologie [85]
II.
IDES.
L'Existentialisme chez Hegel [109]
La Querelle de l'Existentialisme [123]
Le Mtaphysique dans l'Homme [145]
Autour du Marxisme [173]
Marxisme et Philosophie [221]
III.
POLITIQUES.
La Guerre a eu lieu [245]
Pour la Vrit [271]
Foi et bonne Foi [305]
Le Hros, l'Homme [323]
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
[6]
La Collection Penses a pour but de faire
connatre les diffrents courants de la pense
contemporaine. Les problmes de lhomme et de la
socit se sont modifis depuis cette dernire guerre et l'humanit cherche des solutions travers les
diffrentes doctrines qui lui sont proposes.
Penses donnera le dernier tat des interrogations et des solutions dans les principaux domaines
de la pense et de faction, en se gardant bien, toutefois, de prendre une position doctrinaire.
1966 by Les ditions Nagel, Paris
Imprim en Suisse
Printed in Switzerland
10
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
11
[7]
SENS ET NON-SENS
PRFACE
Retour la table des matires
Depuis le dbut du sicle, beaucoup de grands livres ont exprim
la rvolte de la vie immdiate contre la raison. Ils ont dit, chacun sa
manire, que jamais les arrangements rationnels d'une morale, d'une
politique, ou mme de l'art ne vaudront contre la ferveur de l'instant,
l'clatement d'une vie individuelle, la prmditation de l'inconnu .
Il faut croire que le tte--tte de l'homme avec sa volont singulire n'est pas longtemps tolrable : entre ces rvolts, les uns ont accept sans conditions la discipline du communiste, d'autres celle d'une
religion rvle, les plus fidles leur jeunesse ont fait deux parts
dans leur vie ; comme citoyens, maris, amants ou pres, ils se conduisent selon les rgles d'une raison assez conservatrice. Leur rvolte
s'est localise dans la littrature ou dans la posie, devenues du coup
religion.
Il est bien vrai que la rvolte nue est insincre. Ds que nous voulons quelque chose ou que nous prenons [8] tmoin les autres, c'est-dire ds que nous vivons, nous impliquons que le monde, en principe, est d'accord avec lui-mme, et les autres avec nous. Nous naissons
dans la raison comme dans le langage. Mais il faudrait que la raison
laquelle on arrive ne ft pas celle qu'on avait quitte avec tant
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
12
d'clat. Il faudrait que l'exprience de la draison ne ft pas simplement oublie. Il faudrait former une nouvelle ide de la raison.
En prsence d'un roman, d'un pome, d'une peinture, d'un film valables, nous savons qu'il y a eu contact avec quelque chose, quelque
chose est acquis pour les hommes et l'uvre commence d'mettre un
message ininterrompu... Mais ni pour l'artiste, ni pour le public le
sens de l'uvre n'est formulable autrement que par l'uvre ellemme ; ni la pense qui l'a faite, ni celle qui la reoit n'est tout fait
matresse de soi. On verra par l'exemple de Czanne dans quel risque
s'accomplit l'expression et la communication. C'est comme un pas
dans la brume, dont personne ne peut dire s'il conduit quelque part.
Mme nos mathmatiques ont cess d'tre de longues chanes de raison. Les tres mathmatiques ne se laissent atteindre que par procds obliques, mthodes improvises, aussi opaques qu'un minral inconnu. Il y a, plutt qu'un monde intelligible, des noyaux rayonnants
spars par des pans de nuits. Le monde de la culture est discontinu
comme l'autre, il connat lui aussi de sourdes mutations. Il y a un
temps de la culture, o les uvres d'art et de science s'usent, quoiqu'il
soit plus lent que le temps de l'histoire et du monde physique. Dans
l'uvre d'art ou dans la thorie comme dans la chose sensible, le sens
est insparable du [9] signe. L'expression, donc, n'est jamais acheve.
La plus haute raison voisine avec la draison.
De mme, si nous devons retrouver une morale, il faut que ce soit
au contact des conflits dont l'immoralisme a fait l'exprience. Comme
le montre L'Invite de Simone de Beauvoir, c'est une question de savoir s'il y a pour chaque homme une formule de conduite qui le justifie aux yeux des autres, ou si, au contraire, ils ne sont pas, par position, impardonnables l'un pour l'autre et si, dans cette situation, les
principes moraux ne sont pas une manire de se rassurer et de se dfaire des questions plutt que de se sauver et de les rsoudre. En morale comme en art, il n'y aurait pas de solution pour celui qui veut
d'abord assurer sa marche, rester tout instant juste et matre absolu
de soi-mme. Nous n'aurions d'autre recours que le mouvement spontan qui nous lie aux autres pour le malheur et pour le bonheur, dans
l'gosme et dans la gnrosit.
En politique, enfin, l'exprience de ces trente annes nous oblige
aussi voquer le fond de non-sens sur lequel se profile toute entreprise universelle, et qui la menace d'chec. Pour des gnrations d'in-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
13
tellectuels, la politique marxiste a t l'espoir, parce qu'en elle les
proltaires et par eux les hommes de tous les pays devaient trouver le
moyen de se reconnatre et de se rejoindre. La prhistoire allait finir.
Une parole tait dite qui attendait rponse de cette immense humanit
virtuelle depuis toujours silencieuse. On allait assister cette nouveaut absolue d'un monde o tous les hommes comptent. Mais,
n'ayant abouti qu'en un pays, la politique marxiste a perdu confiance
en sa propre audace, elle a dlaiss ses propres moyens proltariens
[10] et repris ceux de l'histoire classique : hirarchie, obissance, mythes, ingalit, diplomatie, police. Au lendemain de cette guerre, on
pouvait esprer que l'esprit du marxisme allait reparatre, que le
mouvement des masses amricaines allait relayer la rvolution russe.
Cette attente est exprime ici dans plusieurs tudes 1. On sait qu'elle a
t due et que nous voyons prsent face face une Amrique
presque unanime dans la chasse aux rouges , avec les hypocrisies
que la critique marxiste a dvoiles dans la conscience librale, et
une Union sovitique qui tient pour fait accompli la division du monde en deux camps, pour invitable la solution militaire, ne compte sur
aucun rveil de la libert proltarienne, mme et surtout quand elle
aventure les proltariats nationaux dans des missions de sacrifice.
Comme Czanne se demande si ce qui est sorti de ses mains offre
un sens et sera compris, comme un homme de bonne volont, considrant les conflits de sa vie, en vient douter que les vies soient compatibles entre elles, le citoyen d'aujourd'hui n'est pas sr que le monde
humain soit possible.
Mais l'chec n'est pas fatal. Czanne a gagn contre le hasard. Les
hommes peuvent gagner aussi, pourvu qu'ils mesurent le risque et la
tche.
[11]
[12]
Autour du Marxisme. - Pour la Vrit.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
[13]
SENS ET NON-SENS
I
OUVRAGES
Retour la table des matires
[14]
14
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
15
[15]
SENS ET NON-SENS
I. OUVRAGES
Le doute de Czanne
Retour la table des matires
Il lui fallait cent sances de travail pour une nature morte, cent cinquante sances de pose pour un portrait. Ce que nous appelons son
uvre n'tait pour lui que l'essai et l'approche de sa peinture. Il crit
en septembre 1906, g de 67 ans, et un mois avant de mourir : Je
me trouve dans un tel tat de troubles crbraux, dans un trouble si
grand que j'ai craint, un moment, que ma faible raison n'y passt...
Maintenant il me semble que je vais mieux et que je pense plus juste
dans l'orientation de mes tudes. Arriverai-je au but tant cherch et si
longtemps poursuivi ? J'tudie toujours sur nature et il me semble que
je fais de lents progrs. La peinture a t son monde et sa manire
d'exister. Il travaille seul, sans lves, sans admiration de la part de sa
famille, sans encouragement du ct des jurys. Il peint l'aprs-midi du
jour o sa mre est morte. En 1870, il peint l'Estaque pendant que
les [16] gendarmes le recherchent comme rfractaire. Et pourtant il lui
arrive de mettre en doute cette vocation. En vieillissant, il se demande
si la nouveaut de sa peinture ne venait pas d'un trouble de ses yeux,
si toute sa vie n'a pas t fonde sur un accident de son corps. cet
effort et ce doute rpondent les incertitudes ou les sottises des
contemporains. Peinture de vidangeur saoul , disait un critique en
1905. Aujourd'hui, G. Mauclair tire encore argument contre Czanne
de ses aveux d'impuissance. Pendant ce temps, ses tableaux sont r-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
16
pandus dans le monde. Pourquoi tant d'incertitude, tant de labeur, tant
d'checs, et soudain le plus grand succs ?
Zola, qui tait l'ami de Czanne depuis l'enfance, a t le premier
lui trouver du gnie, et le premier parler de lui comme d'un gnie
avort . Un spectateur de la vie de Czanne, comme tait Zola, plus
attentif son caractre qu'au sens de sa peinture, pouvait bien la traiter
comme une manifestation maladive.
Car ds 1852, Aix, au collge Bourbon o il venait d'entrer, Czanne inquitait ses amis par ses colres et ses dpressions. Sept ans
plus tard, dcid devenir peintre, il doute de son talent et n'ose pas
demander son pre, chapelier puis banquier, de l'envoyer Paris.
Les lettres de Zola lui reprochent de l'instabilit, de la faiblesse, de
l'indcision. Il vient Paris, mais crit : Je n'ai fait que changer de
place et l'ennui m'a suivi. Il ne tolre pas la discussion, parce qu'elle
le fatigue et qu'il ne sait jamais donner ses raisons. Le fond de son caractre est anxieux. quarante-deux ans, il pense qu'il mourra jeune
et fait son testament. [17] quarante-six ans, pendant six mois, il est
travers par une passion fougueuse, tourmente, accablante, dont le
dnouement n'est pas connu et dont il ne parlera jamais. cinquante
et un ans, il se retire Aix, pour y trouver la nature qui convient le
mieux son gnie, mais c'est aussi un repli sur le milieu de son enfance, sa mre et sa sur. Quand sa mre mourra, il s'appuiera sur son
fils. C'est effrayant, la vie , disait-il, souvent. La religion, qu'il se
met alors pratiquer, commence pour lui par la peur de la vie et la
peur de la mort. C'est la peur, explique-t-il un ami, je me sens encore pour quatre jours sur la terre ; puis aprs ? Je crois que je survivrai et je ne veux pas risquer de rtir in aeternum. Bien qu'ensuite
elle se soit approfondie, le motif initial de sa religion a t le besoin
de fixer sa vie et de s'en dmettre. Il devient toujours plus timide, mfiant et susceptible. Il vient quelquefois Paris, mais, quand il rencontre des amis, leur fait signe de loin de ne pas l'aborder. En 1903,
quand ses tableaux commencent de se vendre Paris deux fois plus
cher que ceux de Monet, quand des jeunes gens comme Joachim Gasquet et Emile Bernard viennent le voir et l'interroger, il se dtend un
peu. Mais les colres persistent. Un enfant d'Aix l'avait autrefois frapp en passant prs de lui ; depuis lors il ne pouvait plus supporter un
contact. Un jour de sa vieillesse, comme il trbuchait, Emile Bernard
le soutint de la main. Czanne entra dans une grande colre. On l'en-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
17
tendait arpenter son atelier en criant qu'il ne se laisserait pas mettre
le grappin dessus . C'est encore cause du grappin qu'il cartait
de son atelier les femmes qui auraient pu lui servir de modles, [18]
de sa vie les prtres qu'il appelait des poisseux , de sou esprit les
thories d'Emile Bernard quand elles se faisaient trop pressantes.
Cette perte des contacts souples avec les hommes, cette impuissance matriser les situations nouvelles, cette fuite dans les habitudes,
dans un milieu qui ne pose pas de problmes, cette opposition rigide
de la thorie et de la pratique, du grappin et d'une libert de solitaire, tous ces symptmes permettent de parler d'une constitution
morbide, et par exemple, comme on l'a fait pour Greco, d'une schizodie. L'ide d'une peinture sur nature viendrait Czanne de la
mme faiblesse. Son extrme attention la nature, la couleur, le caractre inhumain de sa peinture (il disait qu'on doit peindre un visage
comme un objet), sa dvotion au monde visible ne seraient qu'une fuite du monde humain, l'alination de son humanit.
Ces conjectures ne donnent pas le sens positif de l'uvre, on ne
peut pas en conclure sans plus que sa peinture soit un phnomne de
dcadence, et, comme dit Nietzsche, de vie appauvrie , ou encore
qu'elle n'ait rien apprendre l'homme accompli. C'est probablement
pour avoir fait trop de place la psychologie, leur connaissance personnelle de Czanne, que Zola et Emile Bernard ont cru un chec. Il
reste possible que, l'occasion de ses faiblesses nerveuses, Czanne
ait conu une forme d'art valable pour tous. Laiss lui-mme, il a pu
regarder la nature comme seul un homme sait le faire. Le sens de son
uvre ne peut tre dtermin par sa vie.
On ne le connatrait pas mieux par l'histoire de l'art, [19] c'est-dire en se reportant aux influences (celle des Italiens et de Tintoret,
celle de Delacroix, celle de Courbet et des Impressionnistes), aux
procds de Czanne, ou mme son propre tmoignage sur sa peinture.
Ses premiers tableaux, jusque vers 1870, sont des rves peints, un
Enlvement, un Meurtre. Ils viennent des sentiments et veulent provoquer d'abord les sentiments. Ils sont donc presque toujours peints
par grands traits et donnent la physionomie morale des gestes plutt
que leur aspect visible. C'est aux Impressionnistes, et en particulier
Pissaro, que Czanne doit d'avoir conu ensuite la peinture, non com-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
18
me l'incarnation de scnes imagines, la projection des rves au dehors, mais comme l'tude prcise des apparences, moins comme un
travail d'atelier que comme un travail sur nature, et d'avoir quitt la
facture baroque, qui cherche d'abord rendre le mouvement, pour les
petites touches juxtaposes et les hachures patientes.
Mais il s'est vite spar des Impressionnistes. L'Impressionnisme
voulait rendre dans la peinture la manire mme dont les objets frappent notre vue et attaquent nos sens. Il les reprsentait dans l'atmosphre o nous les donne la perception instantane, sans contours absolus, lis entre eux par la lumire et l'air. Pour rendre cette enveloppe
lumineuse, il fallait exclure les terres, les ocres, les noirs et n'utiliser
que les sept couleurs du prisme. Pour reprsenter la couleur des objets, il ne suffisait pas de reporter sur la toile leur ton local, c'est--dire
la couleur qu'ils prennent quand on les isole de ce qui les entoure, il
fallait tenir compte des phnomnes [20] de contraste qui dans la nature modifient les couleurs locales. De plus, chaque couleur que nous
voyons dans la nature provoque, par une sorte de contrecoup, la vision
de la couleur complmentaire, et ces complmentaires s'exaltent. Pour
obtenir sur le tableau, qui sera vu dans la lumire faible des appartements, l'aspect mme des couleurs sous le soleil, il faut donc y faire
figurer non seulement un vert, s'il s'agit d'herbe, mais encore le rouge
complmentaire qui le fera vibrer. Enfin, le ton local lui-mme est dcompos chez les Impressionnistes. On peut en gnral obtenir chaque
couleur en juxtaposant, au heu de les mlanger, les couleurs composantes, ce qui donne un ton plus vibrant. Il rsultait de ces procds
que la toile, qui n'tait plus comparable la nature point par point,
restituait, par l'action des parties les unes sur les autres, une vrit gnrale de l'impression. Mais la peinture de l'atmosphre et la division
des tons noyaient en mme temps l'objet et en faisaient disparatre la
pesanteur propre. La composition de la palette de Czanne fait prsumer qu'il se donne un autre but : il y a, non pas les sept couleurs du
prisme, mais dix-huit couleurs, six rouges, cinq jaunes, trois bleus,
trois verts, un noir. L'usage des couleurs chaudes et du noir montre
que Czanne veut reprsenter l'objet, le retrouver derrire l'atmosphre. De mme il renonce la division du ton et la remplace par des mlanges gradus, par un droulement de nuances chromatiques sur l'objet, par une modulation colore qui suit la forme et la lumire reue.
La suppression des contours prcis dans certains cas, la priorit de la
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
19
couleur sur le dessin n'auront videmment pas le mme [21] sens chez
Czanne et dans l'impressionnisme. L'objet n'est plus couvert de reflets, perdu dans ses rapports l'air et aux autres objets, il est comme
clair sourdement de l'intrieur, la lumire mane de lui, et il en rsulte une impression de solidit et de matrialit. Czanne ne renonce
d'ailleurs pas faire vibrer les couleurs chaudes, il obtient cette sensation colorante par l'emploi du bleu.
Il faudrait donc dire qu'il a voulu revenir l'objet sans quitter l'esthtique impressionniste, qui prend modle de la nature. Emile Bernard lui rappelait qu'un tableau, pour les classiques, exige circonscription par les contours, composition et distribution des lumires. Czanne rpond : Ils faisaient le tableau et nous tentons un morceau de
nature. Il a dit des matres qu'ils remplaaient la ralit par l'imagination et par l'abstraction qui l'accompagne , et de la nature qu'
il faut se plier ce parfait ouvrage. De lui tout nous vient, par lui,
nous existons, oublions tout le reste . Il dclare avoir voulu faire de
l'impressionnisme quelque chose de solide comme l'art des muses . Sa peinture serait un paradoxe : rechercher la ralit sans quitter la sensation, sans prendre d'autre guide que la nature dans l'impression immdiate, sans cerner les contours, sans encadrer la couleur par
le dessin, sans composer la perspective ni le tableau. C'est l ce que
Bernard appelle le suicide de Czanne : il vise la ralit et s'interdit les
moyens de l'atteindre. L se trouverait la raison de ses difficults et
aussi des dformations que l'on trouve chez lui surtout entre 1870 et
1890. Les assiettes ou les coupes poses de profil sur une table [22]
devraient tre des ellipses, mais les deux sommets de l'ellipse sont
grossis et dilats. La table de travail, dans le portrait de Gustave Geffroy, s'tale dans le bas du tableau contre les lois de la perspective. En
quittant le dessin, Czanne se serait livr au chaos des sensations. Or
les sensations feraient chavirer les objets et suggreraient constamment des illusions, comme elles le font quelquefois, par exemple
l'illusion d'un mouvement des objets quand nous bougeons la tte,
si le jugement ne redressait sans cesse les apparences. Czanne aurait,
dit Bernard, englouti la peinture dans l'ignorance et son esprit dans
les tnbres .
En ralit, on ne peut juger ainsi sa peinture qu'en laissant tomber
la moiti de ce qu'il a dit et qu'en fermant les yeux ce qu'il a peint.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
20
Dans ses dialogues avec Emile Bernard, il est manifeste que Czanne cherche toujours chapper aux alternatives toutes faites qu'on
lui propose, celle des sens ou de l'intelligence, du peintre qui voit
et du peintre qui pense, de la nature et de la composition, du primitivisme et de la tradition. Il faut se faire une optique , dit-il, mais
j'entends par optique une vision logique, c'est--dire sans rien d'absurde . S'agit-il de notre nature ? , demande Bernard. Czanne
rpond : Il s'agit des deux. La nature et l'art ne sont-ils pas
diffrents ? Je voudrais les unir. L'art est une aperception personnelle. Je place cette aperception dans la sensation et je demande
l'intelligence de l'organiser en uvre. Mais mme ces formules font
trop de place aux notions ordinaires de sensibilit ou sensation
et d' intelligence , c'est pourquoi Czanne ne pouvait persuader
[23] et c'est pourquoi il aimait mieux peindre. Au lieu d'appliquer
son uvre des dichotomies, qui d'ailleurs appartiennent plus aux traditions d'cole qu'aux fondateurs, philosophes ou peintres, de ces
traditions, il vaudrait mieux tre docile au sens propre de sa peinture
qui est de les remettre en question. Czanne n'a pas cru devoir choisir
entre la sensation et la pense, comme entre le chaos et l'ordre. Il ne
veut pas sparer les choses fixes qui apparaissent sous notre regard et
leur manire fuyante d'apparatre, il veut peindre la matire en train de
se donner forme, l'ordre naissant par une organisation spontane. Il ne
met pas la coupure entre les sens et 1' intelligence , mais entre
l'ordre spontan des choses perues et l'ordre humain des ides et des
sciences. Nous percevons des choses, nous nous entendons sur elles,
nous sommes ancrs en elles et c'est sur ce socle de nature que
nous construisons des sciences. C'est ce monde primordial que Czanne a voulu peindre, et voil pourquoi ses tableaux donnent l'impression de la nature son origine, tandis que les photographies des mmes paysages suggrent les travaux des hommes, leurs commodits,
leur prsence imminente. Czanne n'a jamais voulu peindre comme
une brute , mais remettre l'intelligence, les ides, les sciences, la
perspective, la tradition, au contact du monde naturel qu'elles sont
destines comprendre, confronter avec la nature, comme il le dit, les
sciences qui sont sorties d'elle . Les recherches de Czanne dans la
perspective dcouvrent par leur fidlit aux phnomnes ce que la
psychologie rcente devait formuler. La perspective vcue, celle de
notre perception, n'est pas la perspective [24] gomtrique ou photographique : dans la perception, les objets proches paraissent plus pe-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
21
tits, les objets loigns plus grands, qu'ils ne le font sur une photographie, comme on le voit au cinma quand un train approche et grandit
beaucoup plus vite qu'un train rel dans les mmes conditions. Dire
qu'un cercle vu obliquement est vu comme une ellipse, c'est substituer
la perception effective le schma de ce que nous devrions voir si
nous tions des appareils photographiques : nous voyons en ralit
une forme qui oscille autour de l'ellipse sans tre une ellipse. Dans un
portrait de Mme Czanne, la frise de la tapisserie, de part et d'autre du
corps, ne fait pas une ligne droite : mais on sait que si une ligne passe
sous une large bande de papier, les deux tronons visibles paraissent
disloqus. La table de Gustave Geffroy s'tale dans le bas du tableau,
mais, quand notre il parcourt une large surface, les images qu'il obtient tour tour sont prises de diffrents points de vue et la surface
totale est gondole. Il est vrai qu'en reportant sur la toile ces dformations, je les fige, j'arrte le mouvement spontan par lequel elles se
tassent les unes sur les autres dans la perception et tendent vers la
perspective gomtrique. C'est aussi ce qui arrive propos des couleurs. Une rose sur un papier gris colore en vert le fond. La peinture
d'cole peint le fond en gris, comptant que le tableau, comme l'objet
rel, produira l'effet de contraste. La peinture impressionniste met du
vert sur le fond, pour obtenir un contraste aussi vif que celui des objets de plein air. Ne fausse-t-elle pas ainsi le rapport des tons ? Elle le
fausserait si elle s'en tenait l. Mais le propre du peintre est de faire
que [25] toutes les autres couleurs du tableau convenablement modifies enlvent au vert pos sur le fond son caractre de couleur relle.
De mme le gnie de Czanne est de faire que les dformations perspectives, par l'arrangement d'ensemble du tableau, cessent d'tre visibles pour elles-mmes quand on le regarde globalement, et contribuent seulement, comme elles le font dans la vision naturelle, donner l'impression d'un ordre naissant, d'un objet en train d'apparatre, en
train de s'agglomrer sous nos yeux. De la mme faon le contour des
objets, conu comme une ligne qui les cerne, n'appartient pas au monde visible, mais la gomtrie. Si l'on marque d'un trait le contour
d'une pomme, on en fait une chose, alors qu'il est la limite idale vers
laquelle les cts de la pomme fuient en profondeur. Ne marquer aucun contour, ce serait enlever aux objets leur identit. En marquer un
seul, ce serait sacrifier la profondeur, c'est--dire la dimensions qui
nous donne la chose, non comme tale devant nous, mais comme
pleine de rserves et comme une ralit inpuisable. C'est pourquoi
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
22
Czanne suivra dans une modulation colore le renflement de l'objet
et marquera en traits bleus plusieurs contours. Le regard renvoy de
l'un l'autre saisit un contour naissant entre eux tous comme il le fait
dans la perception. Il n'y a rien de moins arbitraire que ces clbres
dformations, que d'ailleurs Czanne abandonnera dans sa dernire
priode, partir de 1890, quand il ne remplira plus sa toile de couleurs
et quittera la facture serre des natures mortes.
Le dessin doit donc rsulter de la couleur, si l'on veut que le monde
soit rendu dans son paisseur, car [26] il est une niasse sans lacunes,
un organisme de couleurs, travers lesquelles la fuite de la perspective, les contours, les droites, les courbes s'installent comme des lignes
de force, le cadre d'espace se constitue en vibrant. Le dessin et la
couleur ne sont plus distincts ; au fur et mesure que l'on peint, on
dessine ; plus la couleur s'harmonise, plus le dessin se prcise...
Quand la couleur est sa richesse, la forme est sa plnitude. Czanne ne cherche pas suggrer par la couleur les sensations tactiles
qui donneraient la forme et la profondeur. Dans la perception primordiale, ces distinctions du toucher et de la vue sont inconnues. C'est la
science du corps humain qui nous apprend ensuite distinguer nos
sens. La chose vcue n'est pas retrouve ou construite partir des
donnes des sens, mais s'offre d'emble comme le centre d'o elles
rayonnent. Nous voyons la profondeur, le velout, la mollesse, la duret des objets, Czanne disait mme : leur odeur. Si le peintre veut
exprimer le monde, il faut que l'arrangement des couleurs porte en lui
ce Tout indivisible ; autrement sa peinture sera une allusion aux choses et ne les donnera pas dans l'unit imprieuse, dans la prsence,
dans la plnitude insurpassable qui est pour nous tous la dfinition du
rel. C'est pourquoi chaque touche donne doit satisfaire une infinit
de conditions, c'est pourquoi Czanne mditait quelquefois pendant
une heure avant de la poser, elle doit, comme le dit Bernard contenir
l'air, la lumire, l'objet, le plan, le caractre, le dessin, le style . L'expression de ce qui existe est une tche infinie.
Pas davantage Czanne n'a nglig la physionomie des objets et
des visages, il voulait seulement la saisir [27] quand elle merge de la
couleur. Peindre un visage comme un objet , ce n'est pas le dpouiller de sa pense . J'entends que le peintre l'interprte , dit
Czanne, le peintre n'est pas un imbcile . Mais cette interprtation
ne doit pas tre une pense spare de la vision. Si je peins tous les
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
23
petits bleus et tous les petits marrons, je le fais regarder comme il regarde... Au diable s'ils se doutent comment, en mariant un vert nuanc
un rouge, on attriste une bouche ou on fait sourire une joue. L'esprit se voit et se lit dans les regards, qui ne sont pourtant que des ensembles colors. Les autres esprits ne s'offrent nous qu'incarns, adhrents un visage et des gestes. Il ne sert rien d'opposer ici les
distinctions de l'me et du corps, de la pense et de la vision, puisque
Czanne revient justement l'exprience primordiale d'o ces notions
sont tires et qui nous les donne insparables. Le peintre qui pense et
qui cherche l'expression d'abord manque le mystre, renouvel chaque
fois que nous regardons quelqu'un, de son apparition dans la nature.
Balzac dcrit dans La Peau de Chagrin une nappe blanche comme
une couche de neige frachement tombe et sur laquelle s'levaient
symtriquement les couverts couronns de petits pains blonds .
Toute ma jeunesse, disait Czanne, j'ai voulu peindre a, cette nappe
de neige frache... Je sais maintenant qu'il ne faut vouloir peindre que :
s'levaient symtriquement les couverts, et : de petits pains blonds. Si
je peins couronns , je suis foutu, comprenez-vous ? Et si vraiment
j'quilibre et je nuance mes couverts et mes pains comme sur nature,
soyez srs que les couronnes, la neige et tout le tremblement [28] y
seront.
Nous vivons dans un milieu d'objets construits par les hommes, entre des ustensiles, dans des maisons, des rues, des villes et la plupart
du temps nous ne les voyons qu' travers les actions humaines dont ils
peuvent tre les points d'application. Nous nous habituons penser
que tout cela existe ncessairement et est inbranlable. La peinture de
Czanne met en suspens ces habitudes et rvle le fond de nature inhumaine sur lequel l'homme s'installe. C'est pourquoi ses personnages
sont tranges et comme vus par un tre d'une autre espce. La nature
elle-mme est dpouille des attributs qui la prparent pour des communions animistes : le paysage est sans vent, l'eau du lac d'Annecy
sans mouvement, les objets gels hsitants comme l'origine de la
terre. C'est un monde sans familiarit, o l'on n'est pas bien, qui interdit toute effusion humaine. Si l'on va voir d'autres peintres en quittant
les tableaux de Czanne, une dtente se produit, comme aprs un deuil
les conversations renoues masquent cette nouveaut absolue et rendent leur solidit aux vivants. Mais seul un homme justement est capable de cette vision qui va jusqu'aux racines, en de de l'humanit
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
24
constitue. Tout montre que les animaux ne savent pas regarder, s'enfoncer dans les choses sans en rien attendre que la vrit. En disant
que le peintre des ralits est un singe, Emile Bernard dit donc exactement le contraire de ce qui est vrai, et l'on comprend comment Czanne pouvait reprendre la dfinition classique de l'art : l'homme ajout la nature.
Sa peinture ne nie pas la science et ne nie pas la tradition. A Paris,
Czanne allait chaque jour au Louvre. [29] Il pensait qu'on apprend
peindre, que l'tude gomtrique des plans et des formes est ncessaire. Il se renseignait sur la structure gologique des paysages. Ces relations abstraites devaient oprer dans l'acte du peintre, mais rgles sur
le monde visible. L'anatomie et le dessin sont prsents, quand il pose
une touche, comme les rgles du jeu dans une partie de tennis. Ce qui
motive un geste du peintre, ce ne peut jamais tre la perspective seule
ou la gomtrie seule ou les lois de la dcomposition des couleurs ou
quelque connaissance que ce soit. Pour tous les gestes qui peu peu
font un tableau, il n'y a qu'un seul motif, c'est le paysage dans sa totalit et dans sa plnitude absolue, que justement Czanne appelait
un motif . Il commenait par dcouvrir les assises gologiques.
Puis il ne bougeait plus et regardait, l'il dilat, disait Mme Czanne.
Il germinait avec le paysage. Il s'agissait, toute science oublie, de
ressaisir, au moyen de ces sciences, la constitution du paysage comme
organisme naissant. Il fallait souder les unes aux autres toutes les rues
partielles que le regard prenait, runir ce qui se disperse par la versatilit des yeux, joindre les mains errantes de la nature , dit Gasquet.
Il y a une minute du monde qui passe, il faut la peindre dans sa ralit. La mditation s'achevait tout d'un coup. Je tiens mon motif , disait Czanne, et il expliquait que le paysage doit tre ceintur
ni trop haut ni trop bas, ou encore ramen vivant dans un filet qui ne
laisse rien passer. Alors il attaquait son tableau par tous les cts la
fois, cernait de taches colores le premier trait de fusain, le squelette
gologique. L'image se saturait, se liait, se dessinait, s'quilibrait, tout
la [30] fois venait maturit. Le paysage, disait-il, se pense en moi
et je suis sa conscience. Rien n'est plus loign du naturalisme que
cette science intuitive. L'art n'est ni une imitation, ni d'ailleurs une fabrication suivant les vux de l'instinct ou du bon got. C'est une opration d'expression. Comme la parole nomme, c'est--dire saisit dans
sa nature et place devant nous titre d'objet reconnaissable ce qui ap-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
25
paraissait confusment, le peintre, dit Gasquet, objective , projette , fixe . Comme la parole ne ressemble pas ce qu'elle dsigne,
la peinture n'est pas un trompe-l'il ; Czanne, selon ses propres paroles crit en peintre ce qui n'est pas encore peint et le rend peinture
absolument . Nous oublions les apparences visqueuses, quivoques
et travers elles nous allons droit aux choses qu'elles prsentent. Le
peintre reprend et convertit justement en objet visible ce qui sans lui
reste enferm dans la vie spare de chaque conscience : la vibration
des apparences qui est le berceau des choses. Pour ce peintre-l, une
seule motion est possible : le sentiment d'tranget, un seul lyrisme :
celui de l'existence toujours recommence.
Lonard de Vinci avait pris pour devise la rigueur obstine, tous
les Arts potiques classiques disent que l'uvre est difficile. Les difficults de Czanne, comme celles de Balzac ou de Mallarm, ne
sont pas de mme nature. Balzac imagine, sans doute sur les indications de Delacroix, un peintre qui veut exprimer la vie mme par les
couleurs seules et garde cach son chef-d'uvre. Quand Frenhofer
meurt, ses amis ne trouvent qu'un chaos de couleurs, de lignes insaisissables, une [31] muraille de peinture. Czanne fut mu jusqu'aux
larmes en lisant le Chef-d'uvre inconnu et dclara qu'il tait luimme Frenhofer. L'effort de Balzac, lui aussi obsd par la ralisation , fait comprendre celui de Czanne. Il parle, dans La Peau de
Chagrin, d'une pense exprimer , d'un systme btir , d'une
science expliquer . Il fait dire Louis Lambert, un des gnies
manques de la Comdie Humaine : ... Je marche certaines dcouvertes... ; mais quel nom donner la puissance qui me fie les mains,
me ferme la bouche et m'entrane en sens contraire ma vocation ?
Il ne suffit pas de dire que Balzac s'est propos de comprendre la socit de son temps. Dcrire le type du commis-voyageur, faire une
anatomie des corps enseignants ou mme fonder une sociologie,
ce n'tait pas une tche surhumaine. Une fois nommes les forces visibles, comme l'argent et les passions, et une fois dcrit le fonctionnement manifeste, Balzac se demande quoi va tout cela, quelle en
est la raison d'tre, ce que veut dire par exemple cette Europe dont
tous les efforts tendent je ne sais quel mystre de civilisation , ce
qui maintient intrieurement le monde, et fait pulluler les formes visibles. Pour Frenhofer, le sens de la peinture est le mme : ... Une
main ne tient pas seulement au corps, elle exprime et continue une
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
26
pense qu'il faut saisir et rendre... La vritable lutte est l ! Beaucoup
de peintres triomphent instinctivement sans connatre ce thme de
l'art. Vous dessinez une femme, mais vous ne la voyez pas. L'artiste
est celui qui fixe et rend accessible aux plus humains des hommes
le spectacle dont ils font partie sans le voir.
[32]
Il n'y a donc pas d'art d'agrment. On peut fabriquer des objets qui
font plaisir en liant autrement des ides dj prtes et en prsentant
des formes dj vues. Cette peinture ou cette parole seconde est ce
qu'on entend gnralement par culture. L'artiste selon Balzac ou selon
Czanne ne se contente pas d'tre un animal cultiv, il assume la
culture depuis son dbut et la fonde nouveau, il parle comme le
premier homme a parl et peint comme si l'on n'avait jamais peint.
L'expression ne peut alors pas tre la traduction d'une pense dj
claire, puisque les penses claires sont celles qui ont dj t dites en
nous-mmes ou par les autres. La conception ne peut pas prcder
1' excution . Avant l'expression, il n'y a rien qu'une fivre vague
et seule l'uvre faite et comprise prouvera qu'on devait trouver l
quelque chose plutt que rien. Parce qu'il est revenu pour en prendre
conscience au fonds d'exprience muette et solitaire sur lequel sont
btis la culture et l'change des ides, l'artiste lance son uvre comme
un homme a lanc la premire parole, sans savoir si elle sera autre
chose qu'un cri, si elle pourra se dtacher du flux de vie individuelle
o elle nat et prsenter, soit cette mme vie dans son avenir, soit
aux monades qui coexistent avec elle, soit la communaut ouverte
des monades futures, l'existence indpendante d'un sens identifiable.
Le sens de ce que va dire l'artiste n'est nulle part, ni dans les choses,
qui ne sont pas encore sens, ni en lui-mme, dans sa vie informule. Il
appelle de la raison dj constitue, et dans laquelle s'enferment les
hommes cultivs , une raison qui embrasserait ses propres origines. Comme Bernard voulait [33] le ramener l'intelligence humaine,
Czanne rpond : Je me tourne vers l'intelligence du Pater Omnipotens. Il se tourne en tout cas vers l'ide ou le projet d'un Logos infini. L'incertitude et la solitude de Czanne ne s'expliquent pas, pour
l'essentiel, par sa constitution nerveuse, mais par l'intention de son
uvre. L'hrdit avait pu lui donner des sensations riches, des motions prenantes, un vague sentiment d'angoisse ou de mystre qui dsorganisaient sa vie volontaire et le coupaient des hommes ; mais ces
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
27
dons ne font une uvre que par l'acte d'expression et ne sont pour rien
dans les difficults comme dans les vertus de cet acte. Les difficults
de Czanne sont celles de la premire parole. Il s'est cru impuissant
parce qu'il n'tait pas omnipotent, parce qu'il n'tait pas Dieu et qu'il
voulait pourtant peindre le monde, le convertir entirement en spectacle, faire voir comment il nous touche. Une thorie physique nouvelle
peut se prouver parce que l'ide ou le sens est reli par le calcul des
mesures qui sont d'un domaine dj commun tous les hommes. Un
peintre comme Czanne, un artiste, un philosophe, doivent non seulement crer et exprimer une ide, mais encore rveiller les expriences qui l'enracineront dans les autres consciences. Si l'uvre est russie, elle a le pouvoir trange de s'enseigner elle-mme. En suivant les
indications du tableau ou du livre, en tablissant des recoupements, en
heurtant de ct et d'autre, guids par la clart confuse d'un style, le
lecteur ou le spectateur finissent par retrouver ce qu'on a voulu leur
communiquer. Le peintre n'a pu que construire une image. Il faut attendre que cette image s'anime pour les autres. [34] Alors l'uvre d'art
aura joint ces vies spares, elle n'existera plus seulement en l'une
d'elles comme un rve tenace ou un dlire persistant, ou dans l'espace
comme une toile colorie, elle habitera indivise dans plusieurs esprits,
prsomptivement dans tout esprit possible, comme une acquisition
pour toujours.
Ainsi les hrdits , les influences , les accidents de Czanne, sont le texte que la nature et l'histoire lui ont donn pour sa
part dchiffrer. Elles ne fournissent que le sens littral de son uvre.
Les crations de l'artiste, comme d'ailleurs les dcisions libres de
l'homme, imposent ce donn un sens figur qui n'existait pas avant
elles. S'il nous semble que la vie de Czanne portait en germe son uvre, c'est parce que nous connaissons l'uvre d'abord et que nous
voyons travers elle les circonstances de la vie en les chargeant d'un
sens que nous empruntons l'uvre. Les donnes de Czanne que
nous numrons et dont nous parlons comme de conditions pressantes,
si elles devaient figurer dans le tissu de projets qu'il tait, ne pouvaient
le faire qu'en se proposant lui comme ce qu'il avait vivre et en laissant indtermine la manire de le vivre. Thme oblig au dpart, elles ne sont, replaces dans l'existence qui les embrasse, que le monogramme et l'emblme d'une vie qui s'interprte elle-mme librement.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
28
Mais comprenons bien cette libert. Gardons-nous d'imaginer
quelque force abstraite qui superposerait ses effets aux donnes de
la vie ou qui introduirait des coupures dans le dveloppement. Il est
certain que la vie n'explique pas l'uvre, mais certain aussi qu'elles
[35] communiquent. La vrit est que cette uvre faire exigeait cette vie. Ds son dbut, la vie de Czanne ne trouvait d'quilibre qu'en
s'appuyant l'uvre encore future, elle en tait le projet, et l'uvre s'y
annonait par des signes prmonitoires que nous aurions tort de prendre pour des causes, mais qui font de l'uvre et de la vie une seule
aventure. Il n'y a plus ici de causes ni d'effets, ils se rassemblent dans
la simultanit d'un Czanne ternel qui est la formule la fois de ce
qu'il a voulu tre et de ce qu'il a voulu faire. Il y a un rapport entre la
constitution schizode et l'uvre de Czanne parce que l'uvre rvle
un sens mtaphysique de la maladie, la schizodie comme rduction du monde la totalit des apparences figes et mise en suspens
des valeurs expressives, que la maladie cesse alors d'tre un fait
absurde et un destin pour devenir une possibilit gnrale de l'existence humaine quand elle affronte avec consquence un de ses paradoxes, le phnomne d'expression, et qu'enfin c'est la mme
chose en ce sens-l d'tre Czanne et d'tre schizode. On ne saurait
donc sparer la libert cratrice des comportements les moins dlibrs qui s'indiquaient dj dans les premiers gestes de Czanne enfant
et dans la manire dont les choses le touchaient. Le sens que Czanne
dans ses tableaux donnera aux choses et aux visages se proposait lui
dans le monde mme qui lui apparaissait, Czanne l'a seulement dlivr, ce sont les choses mmes et les visages mmes tels qu'il les voyait
qui demandaient tre peints ainsi, et Czanne a seulement dit ce
qu'ils voulaient dire. Mais alors o est la libert ? Il est vrai, des
conditions d'existence ne peuvent [36] dterminer une conscience que
par le dtour des raisons d'tre et des justifications qu'elle se donne,
nous ne pouvons voir que devant nous et sous l'aspect de fins ce qui
est nous-mmes, de sorte que notre vie a toujours la forme du projet
ou du choix et nous apparat ainsi comme spontane. Mais dire que
nous sommes d'emble la vise d'un avenir, c'est dire aussi que notre
projet est dj arrt avec nos premires manires d'tre, que le choix
est dj fait notre premier souffle. Si rien ne nous contraint du dehors, c'est parce que nous sommes tout notre extrieur. Ce Czanne
ternel que nous voyons surgir d'abord, qui a attir sur l'homme Czanne les vnements et les influences que l'on croit extrieurs lui, et
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
29
qui dessinait tout ce qui lui est advenu, cette attitude envers les
hommes et envers le monde qui n'avait pas t dlibre, libre
l'gard des causes externes, est-elle libre l'gard d'elle-mme ? Le
choix n'est-il pas repouss en de de la vie, et y a-t-il choix l o il
n'y a pas encore un champ de possibles clairement articul, mais un
seul probable et comme une seule tentation ? Si je suis ds ma naissance projet, impossible de distinguer en moi du donn et du cr, impossible donc de dsigner un seul geste qui ne soit qu'hrditaire ou
inn et qui ne soit pas spontan, mais aussi un seul geste qui soit
absolument neuf l'gard de cette manire d'tre au monde qui est
moi depuis le dbut. C'est la mme chose de dire que notre vie est toute construite ou qu'elle est toute donne. S'il y a une libert vraie, ce
ne peut tre qu'au cours de la vie, par le dpassement de notre situation de dpart, et cependant sans que nous cessions d'tre le [37] mme, tel est le problme. Deux choses sont sres propos de la libert : que nous ne sommes jamais dtermins, et que nous ne
changeons jamais, que, rtrospectivement, nous pourrons toujours
trouver dans notre pass l'annonce de ce que nous sommes devenus.
C'est nous de comprendre les deux choses la fois et comment la
libert se fait jour en nous sans rompre nos liens avec le monde.
Il y a toujours des liens, mme et surtout quand nous refusons d'en
convenir. Valry a dcrit d'aprs les tableaux de Vinci un monstre de
libert pure, sans matresses, sans crancier, sans anecdotes, sans
aventures. Aucun rve ne lui masque les choses mmes, aucun sousentendu ne porte ses certitudes et il ne lit pas son destin dans quelque
image favorite comme l'abme de Pascal. Il n'a pas lutt contre les
monstres, il en a compris les ressorts, il les a dsarms par l'attention
et les a rduits la condition de choses connues. Rien de plus libre,
c'est--dire rien de moins humain que ses jugements sur l'amour, sur
la mort. Il nous les donne deviner par quelques fragments dans ses
cahiers. L'amour dans sa fureur (dit-il peu prs), est chose si laide
que la race humaine s'teindrait, la natura si perderebbe, si
ceux qui le font se voyaient. Ce mpris est accus par divers croquis, car le comble du mpris pour certaines choses est enfin de les
examiner loisir. Il dessine donc et l des unions anatomiques,
coupes effroyables mme l'amour 2, il est matre [38] de ses
2
Introduction la mthode de Lonard de Vinci, Varit, p. 185.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
30
moyens, il fait ce qu'il veut, il passe son gr de la connaissance la
vie avec une lgance suprieure. Il n'a rien fait que sachant ce qu'il
faisait et l'opration de l'art comme l'acte de respirer ou de vivre ne
dpasse pas sa connaissance. Il a trouv 1' attitude centrale partir
de laquelle il est galement possible de connatre, d'agir et de crer,
parce que l'action et la vie, devenues des exercices, ne sont pas
contraires au dtachement de la connaissance. Il est une puissance
intellectuelle , il est 1' homme de l'esprit .
Regardons mieux. Pas de rvlation pour Lonard. Pas d'abme
ouvert sa droite, dit Valry. Sans doute. Mais il y a dans Sainte Anne, La Vierge et lEnfant ce manteau de la vierge qui dessine un vautour et s'achve contre le visage de l'Enfant. Il y a ce fragment sur le
vol des oiseaux o Vinci s'interrompt soudain pour suivre un souvenir
d'enfance : Je semble avoir t destin m'occuper tout particulirement du vautour, car un de mes premiers souvenirs d'enfance est
que, comme j'tais encore au berceau, un vautour vint moi, m'ouvrit
la bouche avec sa queue et plusieurs fois me frappa avec cette queue
entre les lvres 3. Ainsi mme cette conscience transparente a son
nigme, vrai souvenir d'enfance ou phantasme de l'ge mr. Elle ne
partait pas de rien, elle ne se nourrissait pas d'elle-mme. Nous voil
engags dans une histoire secrte et dans une fort de symboles. Si
Freud veut dchiffrer l'nigme d'aprs ce qu'on sait sur la signification
du vol [39] des oiseaux, sur les phantasmes de fellatio et leur rapport
au temps de l'allaitement, on protestera sans doute. Mais c'est du
moins un fait que les Egyptiens faisaient du vautour le symbole de la
maternit, parce que, croyaient-ils, tous les vautours sont femelles et
sont fconds par le vent. C'est un fait aussi que les Pres de l'tat se
servaient de cette lgende pour rfuter par l'histoire naturelle ceux qui
ne voulaient pas croire la maternit d'une vierge, et c'est une probabilit que, dans ses lectures infinies, Lonard ait rencontr cette lgende. Il y trouvait le symbole de son propre sort. Il tait le fils naturel
d'un riche notaire qui pousa, l'anne mme de sa naissance, la noble
dona Albiere dont il n'eut pas d'enfant, et recueillit son foyer Lonard, alors g de cinq ans. Ses quatre premires annes, Lonard les
a donc passes avec sa mre, la paysanne abandonne, il a t un enfant sans pre et il a appris le monde dans la seule compagnie de cette
3
Freud. Un souvenir d'enfance de Lonard de Vinci, p. 65.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
31
grande maman malheureuse qui paraissait l'avoir miraculeusement
cr. Si maintenant nous nous rappelons qu'on ne lui connat aucune
matresse et mme aucune passion, qu'il fut accus de sodomie, mais
acquitt, que son journal, muet sur beaucoup d'autres dpenses plus
coteuses, note avec un dtail mticuleux les frais pour l'enterrement
de sa mre, mais aussi les frais de linge et de vtements qu'il fit pour
deux de ses lves, on ne s'avancera pas beaucoup en disant que Lonard n'aima qu'une seule femme, sa mre, et que cet amour ne laissa
place qu' des tendresses platoniques pour les jeunes garons qui l'entouraient. Dans les quatre annes dcisives de son enfance, il avait
nou un attachement [40] fondamental auquel il lui fallut renoncer
quand il fut rappel au foyer de son pre et o il mit toutes ses ressources d'amour et tout son pouvoir d'abandon. Sa soif de vivre, il ne
lui restait plus qu' l'employer dans l'investigation et la connaissance
du monde, et, puisqu'on l'avait dtach, il lui fallait devenir cette puissance intellectuelle, cet homme de l'esprit, cet tranger parmi les
hommes, cet indiffrent, incapable d'indignation, d'amour ou de haine
immdiats, qui laissait inachevs 6es tableaux pour donner son temps
de bizarres expriences, et en qui ses contemporains ont pressenti un
mystre. Tout se passe comme si Lonard n'avait jamais tout fait
mri, comme si toutes les places de son cur avaient t d'avance occupes, comme si l'esprit d'investigation avait t pour lui un moyen
de fuir la vie, comme s'il avait investi dans ses premires annes tout
son pouvoir d'assentiment, et comme s'il tait rest jusqu' la fin fidle
son enfance. Il jouait comme un enfant. Vasari raconte qu' il
confectionna une pte de cire, et, tandis qu'il se promenait, il en formait des animaux trs dlicats, creux et remplis d'air ; soufflait-il dedans, ils volaient ; l'air en sortait-il, ils retombaient terre. Le vigneron du Belvdre ayant trouv un lzard trs curieux, Lonard lui fit
des ailes avec la peau prise d'autres lzards et il les remplit de vifargent, de sorte qu'elles s'agitaient et frmissaient ds que se mouvait
le lzard ; il lui fit aussi, de la mme manire, des yeux, une barbe et
des cornes, il l'apprivoisa, le mit dans une bote et effarouchait, avec
ce [41] lzard, tous ses amis 4. Il laissait ses uvres inacheves,
comme son pre l'avait abandonn. Il ignorait l'autorit, et en matire
de connaissance, ne se fiait qu' la nature et son jugement propre,
comme le font souvent ceux qui n'ont pas t levs dans l'intimida4
Un souvenir d'enfance de Lonard de Vinci, p. 189.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
32
tion et la puissance protectrice du pre. Ainsi mme ce pur pouvoir
d'examen, cette solitude, cette curiosit qui dfinissent l'esprit ne se
sont tablis chez Vinci qu'en rapport avec son histoire. Au comble de
la libert, il est, en cela mme, l'enfant qu'il a t, il n'est dtach d'un
ct que parce qu'il est attach ailleurs. Devenir une conscience pure,
c'est encore une manire de prendre position l'gard du monde et des
autres, et cette manire, Vinci l'a apprise en assumant la situation qui
lui tait faite par sa naissance et par son enfance. Il n'y a pas de conscience qui ne soit porte par son engagement primordial dans la vie et
par le mode de cet engagement.
Ce qu'il peut y avoir d'arbitraire dans les explications de Freud ne
saurait ici discrditer lintuition psychanalytique. Plus d'une fois, le
lecteur est arrt par l'insuffisance des preuves. Pourquoi ceci et non
pas autre chose ? La question semble s'imposer d'autant plus que
Freud donne souvent plusieurs interprtations, chaque symptme, selon lui, tant surdtermin . Enfin il est bien clair qu'une doctrine
qui fait intervenir la sexualit partout ne saurait, selon les rgles de la
logique inductive, en tablir l'efficace nulle part, puisqu'elle se prive
de toute contre-preuve en excluant d'avance [42] tout cas diffrentiel.
C'est ainsi qu'on triomphe de la psychanalyse, mais sur le papier seulement. Car les suggestions du psychanalyste, si elles ne peuvent jamais tre prouves, ne peuvent pas davantage tre limines : comment imputer au hasard les convenances complexes que le psychanalyste dcouvre entre l'enfant et l'adulte ? Comment nier que la psychanalyse nous a appris percevoir, d'un moment l'autre d'une vie, des
chos, des allusions, des reprises, un enchanement que nous ne songerions pas mettre en doute si Freud en avait fait correctement la
thorie ? La psychanalyse n'est pas faite pour nous donner, comme les
sciences de la nature, des rapports ncessaires de cause effet, mais
pour nous indiquer des rapports de motivation qui, par principe, sont
simplement possibles. Ne nous figurons pas le phantasme du vautour
chez Lonard, avec le pass infantile qu'il recouvre, comme une force
qui dtermint son avenir. C'est plutt, comme la parole de l'augure,
un symbole ambigu qui s'applique d'avance plusieurs lignes d'vnements possibles. Plus prcisment : la naissance et le pass dfinissent pour chaque vie des catgories ou des dimensions fondamentales
qui n'imposent aucun acte en particulier, mais qui se lisent ou se retrouvent en tous. Soit que Lonard cde son enfance, soit qu'il veuil-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
33
le la fuir, il ne manquera jamais d'tre ce qu'il a t. Les dcisions
mmes qui nous transforment sont toujours prises l'gard d'une situation de fait, et une situation de fait peut bien tre accepte ou refuse, mais ne peut en tout cas manquer de nous fournir notre lan et
d'tre elle-mme pour nous, comme situation accepter ou refuser , l'incarnation [43] de la valeur que nous lui donnons. Si l'objet
de la psychanalyse est de dcrire cet change entre l'avenir et le pass
et de montrer comment chaque vie rve sur des nigmes dont le sens
final n'est d'avance inscrit nulle part, on n'a pas exiger d'elle la rigueur inductive. La rverie hermneutique du psychanalyste, qui multiplie les communications de nous nous-mmes, prend la sexualit
pour symbole de l'existence et l'existence pour symbole de la sexualit, cherche le sens de l'avenir dans le pass et le sens du pass dans
l'avenir est, mieux qu'une induction rigoureuse, adapte au mouvement circulaire de notre vie, qui appuie son avenir son pass, son
pass son avenir, et o tout symbolise tout. La psychanalyse ne rend
pas impossible la libert, elle nous apprend la concevoir concrtement, comme une reprise cratrice de nous-mmes, aprs coup toujours fidle nous-mmes.
Il est donc vrai la fois que la vie d'un auteur ne nous apprend rien
et que, si nous savions la lire, nous y trouverions tout, puisqu'elle est
ouverte sur l'uvre. Gomme nous observons les mouvements de quelque animal inconnu sans comprendre la loi qui les habite et les gouverne, ainsi les tmoins de Czanne ne devinent pas les transmutations
qu'il fait subir aux vnements et aux expriences, ils sont aveugles
pour sa signification, 'pour cette lueur venue de nulle part qui l'enveloppe par moments. Mais lui-mme n'est jamais au centre de luimme, neuf jours sur dix il ne voit autour de lui que la misre de sa
vie empirique et de ses essais manques, restes d'une fte inconnue.
C'est dans le monde encore, sur une toile, avec des couleurs, qu'il lui
faut [44] raliser sa libert. C'est des autres, de leur assentiment qu'il
doit attendre la preuve de sa valeur. Voil pourquoi il interroge ce tableau qui nat sous sa main, il guette les regards des autres poss sur
sa toile. Voil pourquoi il n'a jamais fini de travailler. Nous ne quittons jamais notre vie. Nous ne voyons jamais l'ide ni la libert face
face.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
34
[45]
SENS ET NON-SENS
I. OUVRAGES
Le roman et
la mtaphysique
Ce qui me surprend, c'est que tu sois touche d'une manire si concrte par une situation mtaphysique.
Mais c'est du concret, dit Franoise, tout le sens de ma
vie se trouve mis en jeu.
Je ne dis pas, dit Pierre. C'est quand mme exceptionnel ce pouvoir que tu as de vivre une ide corps et me.
S. de BEAUVOIR, L'Invite.
I
Retour la table des matires
L'uvre d'un grand romancier est toujours porte par deux ou trois
ides philosophiques. Soit par exemple le Moi et la Libert chez
Stendhal, chez Balzac le mystre de l'histoire comme apparition d'un
sens dans le hasard des vnements, chez Proust l'enveloppement du
pass dans le prsent et la prsence du temps perdu. La fonction du
romancier n'est pas de thmatiser ces ides, elle est de les faire exister
devant nous la manire des choses. Ce n'est pas le rle de Stendhal
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
35
de discourir sur la subjectivit, il lui suffit de [46] la rendre prsente 5.
Mais il est tout de mme surprenant que, lorsqu'ils s'intressent dlibrment aux philosophies, les crivains reconnaissent si mal leurs parents : Stendhal fait l'loge des idologues, Balzac compromet ses
vues sur les relations expressives de l'me et du corps, de l'conomie
et de la civilisation, en les formulant dans le langage du spiritisme.
Proust traduit son intuition du temps tantt dans une philosophie relativiste et sceptique, tantt dans des esprances d'immortalit qui la
dforment galement. Valry dsavoue les philosophes qui voulaient
annexer au moins l'Introduction la Mthode de Lonard de Vinci.
Tout s'est pass longtemps comme s'il existait entre la philosophie et
la littrature, non seulement des diffrences techniques touchant le
mode d'expression, mais encore une diffrence d'objet.
Pourtant, depuis la fin du XIXe sicle, elles nouent des relations de
plus en plus troites. Le premier signe de ce rapprochement est l'apparition de modes d'expression hybrides qui tiennent du journal intime,
du trait de philosophie et du dialogue, et dont l'uvre de Pguy est
un bon exemple. Pourquoi un crivain, dsormais, a-t-il besoin pour
s'exprimer de rfrences philosophiques, [47] politiques et littraires
la fois ? C'est qu'une nouvelle dimension de recherche s'est ouverte.
Tout le monde a une mtaphysique, patente ou latente, ou alors on
n'existe pas 6. Il s'est toujours agi dans les ouvrages de l'esprit, mais
il s'agit dsormais expressment, de fixer une certaine position
l'gard du monde dont la littrature et la philosophie comme la politique ne sont que diffrentes expressions. On n'a pas attendu l'introduction en France de la philosophie existentielle pour dfinir toute vie
comme une mtaphysique latente et toute mtaphysique comme une
explicitation de la vie humaine.
Cela mme atteste la ncessit et l'importance historiques de cette
philosophie. Elle est la prise de conscience d'un mouvement plus
vieux qu'elle dont elle rvle le sens et dont elle acclre la cadence.
5
Comme il le fait dans Le Rouge et le Noir : Moi seul je sais ce que j'aurais
pu faire... pour les autres je ne suis tout au plus qu'un PEUT-TRE . Si,
ce matin, dans le moment o la mort me paraissait si laide, on m'et averti
pour l'excution, l'il du public et t un aiguillon de gloire... Quelques
gens clairvoyants, s'il en est parmi ces provinciaux, eussent pu deviner ma
faiblesse... Mais personne ne l'et vue.
PGUY. Notre Jeunesse.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
36
La mtaphysique classique a pu passer pour une spcialit o la littrature n'avait que faire, parce qu'elle a fonctionn sur un fond de rationalisme incontest et qu'elle tait persuade de pouvoir faire comprendre le monde et la vie humaine par un agencement de concepts. Il
s'agissait moins d'une explicitation que d'une explication de la vie ou
d'une rflexion sur elle. Ce que Platon dit du mme et de lautre s'applique sans doute aux relations du moi et d'autrui, ce que Descartes dit
de Dieu comme identit de l'essence et de l'existence concerne, d'une
certaine manire, l'homme, concerne en tout cas ce fond de la subjectivit o la reconnaissance de Dieu et celle de [48] la pense par ellemme ne se distinguent pas. Ce que Kant dit de la Conscience nous
atteint encore plus directement. Mais enfin, c'est du mme et de
lautre que Platon parle, c'est de Dieu que Descartes finit par parler,
c'est de la conscience que Kant parle, et non pas de cet autre qui existe
en face de moi ni de ce moi que je suis. Malgr les commencements
les plus audacieux (par exemple chez Descartes) les philosophes finissaient toujours par se reprsenter leur propre existence ou bien sur un
thtre transcendant, ou bien comme moment d'une dialectique, ou
bien dans des concepts, comme les primitifs se la reprsentent et la
projettent dans des mythes. Le mtaphysique dans l'homme se superposait une robuste nature humaine que l'on gouvernait selon des recettes prouves et qui n'tait jamais mise en question dans les drames
tout abstraits de la rflexion.
Tout change lorsqu'une philosophie phnomnologique ou existentielle se donne pour tche, non pas d'expliquer le monde ou d'en dcouvrir les conditions de possibilit , mais de formuler une exprience du monde, un contact avec le monde qui prcde toute pense
sur le monde. Dsormais ce qu'il y a de mtaphysique dans l'homme
ne peut plus tre rapport quelque au-del de son tre empirique,
Dieu, la Conscience, c'est dans son tre mme, dans ses
amours, dans ses haines, dans son histoire individuelle ou collective
que l'homme est mtaphysique, et la mtaphysique n'est plus, comme
disait Descartes, l'affaire de quelques heures par mois ; elle est prsente, comme le pensait Pascal, dans le moindre mouvement du cur.
Ds lors la tche de la littrature et celle de la [49] philosophie ne
peuvent plus tre spares. Quand il s'agit de faire parler l'exprience
du monde et de montrer comment la conscience s'chappe dans le
monde, on ne peut plus se flatter de parvenir une transparence par-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
37
faite de l'expression. L'expression philosophique assume les mmes
ambiguts que l'expression littraire, si le monde est fait de telle sorte
qu'il ne puisse tre exprim que dans des histoires et comme montr du doigt. On ne verra plus seulement paratre des modes d'expression hybrides, mais le roman ou le thtre seront de part en part mtaphysiques, mme s'ils n'emploient pas un seul mot du vocabulaire philosophique. D'autre part, une littrature mtaphysique sera ncessairement, dans un certain sens, une littrature amorale. Car il n'y a plus
de nature humaine sur laquelle on puisse se reposer. Dans chacune des
conduites de l'homme, l'invasion du mtaphysique fait exploser ce qui
n'tait qu'une vieille coutume .
Le dveloppement d'une littrature mtaphysique, la fin d'une littrature morale , voil ce que signifie par exemple L'Invite de Simone de Beauvoir. Sur cet exemple examinons de plus prs le phnomne, et puisque les personnages du livre ont soulev, de la part des
critiques littraires, des reproches d'immoralit, voyons s'il n'y a pas
une vraie morale par del la morale dont ils se moquent.
[50]
II
Il y a dans la condition d'tre conscient un perptuel malaise. Au
moment o je perois une chose, j'prouve qu'elle tait dj l avant
moi, au-del de mon champ de vision. Un horizon infini de choses
prendre entoure le petit nombre de celles que je peux prendre pour de
bon. Un cri de locomotive dans la nuit, la salle de thtre vide o je
pntre font apparatre, le temps d'un clair, ces choses de toutes parts
prtes pour la perception, des spectacles donns personne, des tnbres bourres d'tres. Mme les choses qui m'entourent me dpassent
condition que j'interrompe mon commerce habituel avec elles et que
je les retrouve, en de du monde humain ou mme vivant, sous leur
aspect de choses naturelles. Un vieux veston pos sur une chaise dans
le silence d'une maison de campagne, une fois la porte ferme sur les
odeurs du maquis et les cris des oiseaux, si je le prends comme il se
prsente, ce sera dj une nigme. Il est l, aveugle et born, il ne sait
pas qu'il y est, il se contente d'occuper ce morceau d'espace, mais il
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
38
l'occupe comme jamais je ne pourrai occuper aucun lieu. Il ne fait pas
de tous cts comme une conscience, il demeure pesamment ce qu'il
est, il est en soi. Chaque chose n'affirme son tre qu'en me dpossdant du mien, et je sais toujours sourdement qu'il y a au monde autre
chose que moi et mes spectacles. Mais d'ordinaire je ne retiens de ce
savoir que ce qu'il [51] faut pour me rassurer. Je remarque que la chose, aprs tout, a besoin de moi pour exister. Quand je dcouvre un
paysage jusque l cach par une colline, c'est alors seulement qu'il devient pleinement paysage et l'on ne peut pas concevoir ce que serait
une chose sans l'imminence ou la possibilit de mon regard sur elle.
Ce monde qui avait l'air d'tre sans moi, de m'envelopper et de me
dpasser, c'est moi qui le fais tre. Je suis donc une conscience, une
prsence immdiate au monde, et il n'est rien qui puisse prtendre
tre sans tre pris de quelque faon dans le tissu de mon exprience.
Je ne suis pas cette personne, ce visage, cet tre fini, mais un pur tmoin, sans bleu et sans ge, qui peut galer en puissance l'infinit du
monde.
C'est ainsi que l'on surmonte, ou plutt que l'on sublime, l'exprience de l'Autre. Tant qu'il ne s'agit que des choses, nous nous sauvons facilement de la transcendance. Celle d'autrui est plus rsistante.
Car si autrui existe, s'il est lui aussi une conscience, je dois consentir
n'tre pour lui qu'un objet fini, dtermin, visible en un certain lieu du
monde. S'il est conscience, il faut que je cesse de l'tre. Or, comment
pourrais-je oublier cette attestation intime de mon existence, ce
contact de moi avec moi, plus sr qu'aucun tmoignage extrieur et
condition pralable pour tous ? Nous essayons donc de mettre en
sommeil l'inquitante existence d'autrui. Leurs penses, dit Franoise dans L'Invite, a me fait juste comme leurs paroles et leurs visages : des objets qui sont dans mon monde moi. Je demeure le centre du monde. Je suis cet tre agile qui circule travers le monde et
l'anime de part en part. Je ne peux [52] pas srieusement me confondre avec cette apparence que j'offre aux autres. Je n'ai pas de corps.
Franoise sourit : elle n'tait pas belle, mais elle aimait bien sa figure, a lui faisait toujours une surprise agrable quand elle la rencontrait dans un miroir. D'ordinaire, elle ne pensait pas qu'elle en avait
une. Tout ce qui arrive n'est que spectacle pour ce spectateur indestructible, impartial et gnreux, tout n'est que pour elle, non qu'elle
fasse servir les autres et les choses sa satisfaction prive, mais parce
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
39
que, au contraire, elle n'a pas de vie prive et qu'en elle coexistent tous
les autres et le monde entier. Au centre du dancing, impersonnelle et
libre, moi je suis l. Je contemple la fois toutes ces vies, tous ces
visages. Si je me dtournais d'eux ils se dferaient aussitt comme un
paysage dlaiss.
Ce qui fortifie la certitude de Franoise, c'est que, par une chance
extraordinaire, l'amour mme ne lui a pas fait toucher ses limites. Sans
doute Pierre n'est plus pour elle un objet dans son propre monde, un
dcor de sa vie, comme le sont les autres hommes. Mais il n'est pas
davantage un Autre. Franoise et Pierre ont tabli entre eux une telle
sincrit et construit une telle machine de langage qu'ils peuvent demeurer ensemble mme dans ce qu'ils vivent sparment, rester libres
dans leur union : Il n'y avait qu'une vie et au centre un tre dont on
ne pouvait dire ni lui, ni moi, mais seulement nous. Chaque pense,
chaque pisode de la journe tant communiqu et partag, chaque
sentiment aussitt interprt et mis en dialogue, l'tre deux se nourrit
de tout ce qui arrive chacun. Pierre n'est pas pour Franoise un tre
opaque et qui [53] masque tout le reste, il n'est qu'une conduite aussi
claire pour elle que pour lui-mme, en rapport avec un monde qui
n'est pas son monde priv, mais aussi bien celui de Franoise.
vrai dire, il y a ds le dbut des fissures dans cette construction.
Simone de Beauvoir en indique quelques-unes : le livre commence par
un sacrifice de Franoise. Franoise regarda les beaux yeux verts
sous les cils recourbs, la bouche attentive : Si j'avais voulu... Il
n'tait peut-tre pas trop tard. Mais que pouvait-elle vouloir ? La
consolation est commode. Je ne perds rien, se dit Franoise, puisque je
suis mon amour pour Pierre. Elle ne l'est pourtant pas au point de ne
pas voir Gerbert, de ne pas penser un amour avec lui, et de dclarer
aussitt Pierre ces premires penses prives. L'ailleurs et l'autre ne
sont pas supprims, ils ne sont que refouls. Franoise est-elle tout
entire dans l'tre deux qu'ils ont construit ? Ce monde commun que
leurs conversations inlassables recrent et agrandissent chaque jour,
est-ce bien le monde lui-mme, ou bien n'est-ce pas un milieu factice,
et n'ont-ils pas chang les complaisances de la vie intrieure pour
celles de la vie deux ? Chacun se met en question, devant l'autre,
mais devant qui seront-ils ensemble mis en question ? Franoise dclare ingnument que le centre de Paris est toujours o elle est. Cela
fait penser aux enfants qui, eux aussi, n'ont pas de vie intrieure et
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
40
croient toujours tre en plein monde puisqu'ils y projettent jusqu'
leurs rves, mais qui n'en demeurent pas moins en pleine subjectivit,
puisqu'ils ne les distinguent pas des choses vraies. Comme les enfants,
[54] justement, Franoise a toujours un mouvement de recul devant
les choses nouvelles parce qu'elles risquent de bouleverser le milieu
qu'elle s'est construit. Le monde vrai, avec toutes ses asprits, n'admet pas tant de prcaution. Si Franoise et Pierre suscitent autour
d'eux tant d'envies et mme de haines, n'est-ce pas que les autres se
sentent exclus par ce prodige deux ttes, jamais accueillis par eux,
mais toujours trahis par Franoise avec Pierre, par Pierre avec Franoise ? Elisabeth et bientt Xavire se sentent vides de leur substance
et ne reoivent en change que des bienfaits strictement mesurs. Cet
amour de Pierre et de Franoise dans l'ternel, il tient bien sa place
dans le temps. S'il n'est pas menac par les autres amours de Pierre,
c'est condition que Pierre les raconte Franoise, qu'elles deviennent des objets dont on parle, de simples provinces dans leur monde
deux, et que Pierre ne s'y engage jamais pour de bon. Il se trouve que
Pierre souscrit de lui-mme ces conditions : Tu sais bien, dit-il,
que je ne me sens jamais compromis par ce qui se passe en moi.
Pour lui, aimer, c'est vouloir exister et compter pour l'autre. Me faire
aimer d'elle, c'est m'imposer elle, c'est m'introduire dans son monde
et y triompher d'aprs ses propres valeurs... Tu sais bien que c'est le
genre de triomphe dont j'ai un besoin maniaque. Mais les femmes
qu'il aime existent-elles jamais absolument pour lui ? Ses histoires ne sont pas son histoire vraie, qui n'est vcue qu'avec Franoise.
Son besoin d'autres amours, c'est une inquitude de l'autre, le souci de
faire reconnatre sa matrise et une manire brve de vrifier l'universalit de sa vie. Puisque Franoise [55] ne se sent pas libre d'aimer
Gerbert, comment pourrait-elle laisser Pierre libre d'aimer d'autres
femmes ? Quoi qu'elle dise, elle n'aime pas la libert effective de Pierre, elle n'aime pas Pierre aimant pour de bon une autre femme, elle ne
l'aime dans sa libert que s'il s'agit d'une libert d'indiffrence qui ne
s'engage nulle part. Franoise comme Pierre demeure libre d'tre aime, mais non pas d'aimer, ils sont confisqus l'un par l'autre, et c'est
pourquoi Franoise recule devant un amour avec Gerbert, qui la mettrait en jeu, et recherche la tendresse de Xavire, qui, elle le croit du
moins, la confirmera en elle-mme : Ce qui l'enchantait surtout
c'tait d'avoir annex sa vie cette petite existence triste... ; rien ne
donnait jamais Franoise des joies si fortes que cette espce de pos-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
41
session ; les gestes de Xavire, sa figure, sa vie mme avaient besoin
de Franoise pour exister. Comme les peuples de l'Europe sentaient,
sous la politique universaliste de la Convention, l'imprialisme
franais, les autres ne peuvent manquer de se sentir frustrs s'ils ne
sont que des annexes dans le monde de Pierre et de Franoise, et de
deviner sous leur gnrosit une entreprise trs calcule. L'autre n'est
jamais admis entre eux qu'avec circonspection et titre d'invit. Se
contentera-t-il de ce rle ?
La prsence de Xavire rvle brusquement le drame mtaphysique que Pierre et Franoise avaient russi oublier force de gnrosit. Ils ont obtenu, chacun sa faon, l'apparence du bonheur et de la
plnitude par une renonciation gnrale. Moi, dit Xavire, je ne suis
pas ne rsigne. Ils ont cru surmonter la [56] jalousie par la toutepuissance du langage. Quand Xavire est prie son tour de mettre en
paroles sa vie, je n'ai pas une me publique , rpond-elle, et il ne
faut pas s'y tromper : le silence qu'elle rclame, c'est peut-tre celui
des quivoques et des sentiments louches, mais peut-tre aussi celui
o se fait, par del tous les arguments et tous les motifs, l'adhsion
vritable. Cette nuit... dit-elle Pierre, elle eut un rictus presque
douloureux, vous aviez l'air de vivre les choses pour une fois, et pas
seulement de les parler. Xavire remet en question toutes les
conventions par lesquelles Franoise et Pierre avaient cru rendre leur
amour invulnrable. On pourrait exposer le drame de L'Invite en termes psychologiques : Xavire est coquette, Pierre la dsire et Franoise est jalouse. Ce ne serait pas faux. Ce serait seulement superficiel.
Qu'est-ce que la coquetterie, sinon le besoin de valoir pour autrui avec
la peur de s'engager ? Qu'est-ce que le dsir ? On ne dsire pas seulement un corps, on dsire un tre pour l'occuper et rgner sur lui. Le
dsir de Pierre se confond avec la conscience qu'il a de Xavire comme tre prcieux, et son prix vient de ce qu'elle est compltement ce
qu'elle prouve, comme le montrent ses gestes et son visage chaque
moment. Enfin, dire que Franoise est jalouse, ce n'est qu'une manire
de dire que Pierre s'est tourn vers Xavire, que pour une fois il vit un
amour, et qu'aucune communication verbale, aucune fidlit aux
conventions tablies entre Franoise et lui ne peut rintgrer cet
amour l'univers de Franoise. Le drame n'est donc pas psychologique, il est mtaphysique : Franoise a cru pouvoir se lier Pierre en le
laissant libre, ne pas [57] distinguer entre elle-mme et lui, se vouloir
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
42
en le voulant comme chacun veut autrui dans le rgne des fins kantien. L'apparition de Xavire leur rvle non seulement un tre d'o
leurs valeurs sont exclues, mais encore qu'ils sont exclus l'un de l'autre
et chacun de soi-mme. Entre consciences kantiennes, l'accord va toujours de soi ; ils dcouvrent l'inhrence individuelle, le soi hglien
qui poursuit la mort de l'autre.
Les pages o Franoise assiste la ruine de son monde factice sont
peut-tre les plus belles du livre. Elle n'est plus comme par un privilge naturel au cur des choses : il y a un centre du monde d'o elle est
exclue, c'est l'endroit o Pierre et Xavire doivent se retrouver. Avec
les autres les choses reculent hors de ses prises et deviennent les dbris tranges d'un monde dont elle n'a plus la clef. L'avenir cesse
d'tre le prolongement naturel du prsent, le temps se fragmente,
Franoise n'est plus qu'un tre anonyme, sans histoire, une masse de
chair transie. Elle sait maintenant qu'il y a des situations incommunicables et qu'on ne peut comprendre qu'en les occupant. Il y a une pulsation unique qui projetait devant elle un prsent vivant, un avenir, un
monde, qui animait pour elle le langage et cette pulsation a cess.
Faut-il mme dire que Pierre aime Xavire ? Un sentiment, c'est un
nom que l'on donne par convention une srie d'instants, et la vie,
lucidement considre, se rduit ce grouillement d'instants qui n'ont
un sens commun que par hasard. En tout cas, l'amour de Pierre et de
Franoise ne semblait dfier le temps que dans la mesure o il avait
perdu sa ralit. On n'chappe l'miettement du temps que par un
[58] acte de foi qui apparat maintenant Franoise comme une illusion volontaire. Tout amour est une construction verbale, ou tout au
plus une scolastique d'o la vie s'est retire. Il leur a plu de croire
qu'ils n'avaient pas de vie intrieure, qu'ils vivaient vraiment une vie
commune. Mais enfin s'il est vrai que Pierre n'accepte avec personne
de complicit contre Franoise, n'est-il pas au moins en complicit
avec lui-mme, et chaque moment n'est-ce pas partir de sa solitude
o il la juge qu'il se prcipite de nouveau dans l'intermonde qu'ils ont
construit ? Ds lors, Franoise ne peut plus se connatre par le seul
tmoignage intrieur, elle ne peut plus douter d'tre, sous les regards
de ce couple, un vritable objet, et, pour la premire fois, dans leurs
yeux elle se voit de l'extrieur. Qu'est-elle donc ? Une femme de trente ans, une femme faite, qui dj beaucoup de choses sont impossibles irrvocablement, qui, par exemple, ne saura jamais bien danser.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
43
Pour la premire fois elle a le sentiment d'tre son corps, alors qu'elle
se croyait une conscience. Elle a tout sacrifi ce mythe, elle est devenue incapable de tirer d'elle-mme un acte qui ft sien, de vivre
dans l'intimit de ses dsirs, et c'est pourquoi elle a cess d'tre prcieuse Pierre, comme Xavire sait si bien l'tre. Cette puret, ce dsintressement, cette moralit qu'on admirait, elle en vient les har,
parce qu'ils faisaient partie de la mme fiction. Pierre et elle croyaient
avoir dpass l'individualit, elle croyait avoir dpass la jalousie et
l'gosme. Comment savoir ? Quand elle a reconnu pour de bon l'existence d'autrui et accept la figure objective de sa vie qu'elle voit dans
le regard des autres, comment [59] Franoise pourrait-elle tenir pour
indubitable le sentiment qu'elle a d'elle-mme ? quoi reconnatre
une ralit intrieure ? Pierre a-t-il cess de l'aimer ? Ou bien Franoise est-elle jalouse ? Mprise-t-elle vraiment la jalousie ? Le doute
mme qu'elle fait porter sur ce mpris n'est-il pas une construction ?
Une conscience aline ne peut plus se croire elle-mme. Au moment
o tout projet se dfait ainsi et mme la prise du moi sur lui-mme, la
mort, que les projets traversaient jusqu' prsent sans mme la souponner, devient la seule vrit, puisque c'est en elle que se consomme
la pulvrisation du temps et de la vie. Franoise est rejete de la vie.
La maladie qui survient est une sorte de solution provisoire. Dans la
clinique o on l'a transporte, elle ne se pose plus de questions, elle ne
se sent plus abandonne parce qu'elle a rompu avec sa vie. Le centre
du monde est pour le moment dans cette chambre, la grande affaire de
la journe, c'est la temprature, l'examen radioscopique, le premier
repas qu'on va lui donner. Tous les objets ont repris mystrieusement
leur valeur ; cette carafe d'orangeade sur la table, ce mur ripolin sont
intressants par eux-mmes, chaque instant qui passe est plein et se
suffit, et quand ses amis surgissent de Paris, ils mergent du nant
chaque apparition, ils sont intermittents comme des personnages de
thtre. Leurs menues discussions qu'ils apportent auprs de son lit
sont sans ralit auprs de sa solitude qui n'est plus un isolement. Elle
s'est replie de son monde humain o elle souffrait dans le monde naturel o elle trouve une paix glace. Comme on dit si bien, elle a
vraiment fait une maladie. Ou peut-tre la crise qui est en train [60] de
se dnouer n'tait-elle si violente qu' cause de la fatigue et de la maladie qui commenait ? Franoise elle-mme ne le saura jamais. Dcidment, toute vie est ambigu et il n'y a aucun moyen de savoir le
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
44
sens vrai de ce que l'on fait, peut-tre mme n'y a-t-il pas un sens vrai
de nos actions.
De la mme faon, quand Franoise reprend sa place entre Pierre et
Xavire avec des forces neuves, on ne peut pas savoir si les dcisions
auxquelles elle s'arrte contiennent en elles-mmes plus de vrit, ou
si elles expriment seulement le bien-tre et l'optimisme de la gurison.
Pendant sa retraite, Xavire et Pierre se sont rapprochs, ils ont fini
par convenir qu'ils s'aimaient. Cette fois, il ne faut pas cder la souffrance louche. Peut-tre aprs tout Franoise ne s'est-elle sentie abandonne que parce qu'elle se tenait l'cart. Peut-tre pourra-t-elle rejoindre ce couple qui s'est dj form sans elle, peut-tre pourront-ils
tous trois vivre la mme vie, si seulement Franoise prend aussi son
compte l'entreprise du trio. Elle sait dsormais qu'il y a une solitude,
que chacun dcide pour soi, que chacun est condamn des actes
siens, elle a perdu l'illusion de la communication sans obstacles, celle
du bonheur donn et celle de la puret. Mais si justement les obstacles
n'taient venus que de son refus, si le bonheur pouvait tre fait, si la
libert consistait, non pas se retrancher de toutes les inhrences terrestres, mais les dpasser en les acceptant, si Xavire les avait dlivrs de la scolastique o leur amour tait en train de mourir, si elle
se dcidait enfin se jeter en avant de toutes ses forces, au heu de rester sur place, les bras ballants [61] et vides . C'tait tellement simple ; cet amour qui soudain lui gonflait le cur de douceur, il avait
toujours t porte de sa main : il fallait seulement la tendre, cette
main peureuse et avare.
Elle tendra donc la main. Elle russira rester auprs de Pierre
dans sa passion jalouse pour Xavire et jusqu'au moment mme o il
l'pie par un trou de serrure. Et pourtant le trio chouera. Parce que
c'est un trio ? Il est vrai que l'entreprise est trange. Il est essentiel
l'amour d'tre total, puisque celui qui aime aime quelqu'un, et non pas
des qualits, et que l'tre aim veut se sentir justifi dans son existence mme. La prsence d'un tiers, mme et justement s'il est aim lui
aussi, introduit une arrire-pense dans l'amour de chacun pour chaque autre. Le trio n'existerait vraiment que si l'on ne pouvait plus y
distinguer deux couples d'amants et un couple d'amies, si chacun aimait les deux autres du mme cur et en retour attendait d'eux comme
son bien, non seulement l'amour qu'ils lui portent, mais encore l'amour
qu'ils se portent l'un l'autre, si enfin ils vivaient trois au lieu de
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
45
vivre deux deux dans des complicits alternes, avec, de temps
autre, une runion plnire. Cela est impossible, pas beaucoup plus
qu'un couple aprs tout, car dans le couple chacun reste en complicit
avec soi-mme, l'amour que l'on reoit n'est pas le mme amour que
l'on donne. Mme deux, l'unit des vies immdiates n'est pas possible, ce sont les tches, les projets communs qui font le couple. Pas
plus que le trio, le couple humain n'est une ralit naturelle ; l'chec
du trio (comme le succs d'un couple) ne peut pas tre mis au compte
de [62] quelque prdisposition naturelle. Faut-il donc l'attribuer aux
dfauts de Xavire ? Elle est jalouse de Pierre, jalouse de Franoise,
jalouse des gards qu'ils ont pour leurs amis. Elle est perverse et bouscule toute cette diplomatie pour voir ce qui arrivera . Elle est goste, c'est--dire qu'elle ne se quitte jamais elle-mme et ne vit jamais en
autrui : Xavire ne cherchait pas le plaisir d'autrui ; elle s'enchantait
gostement du plaisir de faire plaisir. Elle ne se prte ou ne se donne jamais aucun projet, elle n'accepte pas de travailler pour devenir
comdienne, de traverser Paris pour voir un film, elle ne sacrifie jamais l'immdiat, elle ne sort jamais de l'instant, elle adhre toujours
ce qu'elle prouve. Il y a donc un genre d'intimit auquel elle se drobera toujours ; on vit ct d'elle, on ne vit pas avec elle. Elle demeure fixe sur elle-mme, enferme dans des tats d'me dont on n'est
jamais sr de tenir la vrit, dont il n'y a mme peut-tre aucune vrit. Mais qu'en sait-on ? Sait-on ce que serait Xavire dans une autre
situation ? Ici comme partout le jugement moral ne va pas loin.
L'amour de Franoise pour Pierre russit accepter celui de Pierre
pour Xavire parce qu'il est plus profond et plus ancien. Mais, justement pour la mme raison, Xavire ne peut accepter l'amour de Pierre
et de Franoise. Elle les sent d'accord par-dessus sa tte, ils ont vcu,
avant de la rencontrer, tout un amour deux, plus essentiel que le got
qu'ils ont d'elle. N'est-ce pas justement la torture du trio qui la rend
incapable d'aimer Pierre ou d'aimer Franoise pour de bon ?
Ce n'est pas la faute de Xavire , ni de Franoise, [63] ni de
Pierre, et c'est la faute de chacun. Chacun est totalement responsable,
puisque, s'il avait agi autrement, les autres, leur tour, l'auraient trait
autrement, et chacun peut se sentir innocent puisque la libert des autres tait invisible pour lui et qu'ils lui prsentaient un visage fig
comme le destin. Il est impossible de faire le compte de ce qui revient
chacun dans le drame, d'valuer les responsabilits, de donner une
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
46
version vraie de l'histoire, de mettre en perspective les vnements. Il
n'y a pas de Jugement Dernier. Non seulement nous ne connaissons
pas la vrit du drame, mais encore il n'y en a pas, pas d'envers des
choses o le vrai et le faux, le juste et l'injuste soient dpartags. Nous
sommes mls au monde et aux autres dans une confusion inextricable.
Xavire voit Franoise comme une femme dlaisse, jalouse,
arme d'une aigre patience . De ce jugement qui indigne si fort
Franoise, il n'y a pas un mot qu'elle n'ait elle-mme dit tout bas. Il est
bien vrai qu'elle s'est sentie isole, qu'elle a souhait d'tre aime
comme Xavire l'tait, et qu'elle a, non pas voulu, mais support
l'amour de Pierre pour Xavire. Ceci ne veut pas dire que Xavire ait
raison ; si Franoise avait t dlaisse, Xavire n'aurait pas senti si
bien comme elle comptait pour Pierre, si elle avait t jalouse, elle
n'aurait pas souffert avec lui quand il tait lui-mme jaloux de Xavire, elle aimait Pierre dans sa libert. On pourrait rpondre, il est vrai,
que Franoise cesse d'tre jalouse dans l'exacte mesure o l'amour de
Pierre pour Xavire cesse d'tre heureux. Et ainsi de suite sans fin. La
vrit est que nos actions n'admettent pas un seul motif [64] et une
seule explication, et qu'elles sont, comme Freud le dit avec profondeur, surdtermines . Vous tiez jalouse de moi, dit Xavire
Franoise, parce que Labrousse m'aimait. Vous l'avez dgot de moi
et, pour mieux vous venger, vous m'avez pris Gerbert. Est-ce vrai,
est-ce faux ? O est Franoise ? Est-elle dans ce qu'elle pense d'ellemme ou bien dans ce que Xavire pense d'elle ? Franoise ne s'est
pas propos de faire souffrir Xavire. Elle a enfin cd sa tendresse
pour Gerbert parce qu'elle avait compris que chacun a sa vie et
qu'aprs tant d'annes de renonciation elle voulait vrifier sa propre
existence. Mais le sens de nos actes est-il dans nos intentions ou dans
les effets qu'ils produisent au dehors ? Davantage : ces effets sont-ils
jamais tout fait ignors de nous et ne sont-ils pas voulus eux aussi ?
Cet amour secret pour Gerbert devait apparatre Xavire comme une
vengeance ; cela, Franoise pouvait le deviner, et, en aimant Gerbert,
elle a implicitement accept cette consquence. Faut-il mme dire implicitement ? Rigide comme une consigne. Austre et pure comme
un glaon. Dvoue, ddaigne, bute dans des morales creuses. Et
elle avait dit : Non ! Franoise a voulu briser l'image d'elle-mme
qu'elle avait vue dans les yeux de Xavire. N'est-ce pas, dans son lan-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
47
gage elle, la manire d'exprimer qu'elle a voulu se venger de Xavire ? Ce n'est pas d'un inconscient qu'il faut ici parler. Xavire et l'histoire du trio sont trs expressment l'origine de l'aventure avec Gerbert. Simplement toutes nos actions ont plusieurs sens, en particulier
celui qu'elles offrent aux tmoins extrieurs, et nous les assumons tous
en agissant, puisque [65] les autres sont les coordonnes permanentes
de notre vie. A partir du moment o nous sentons leur existence, nous
nous engageons tre entre autres choses ce qu'ils pensent de nous,
puisque nous leur reconnaissons le pouvoir exorbitant de nous voir.
Franoise sera ce que Xavire pense d'elle, sans recours, tant que Xavire existera. De l le crime qui termine le livre, et qui n'est pas une
solution, puisque Xavire morte ternisera l'image de Franoise qu'elle portait en elle au moment de mourir.
Y avait-il une solution ? On peut imaginer Xavire, repentie ou
malade, appelant auprs d'elle Franoise pour lui faire l'aveu de sa
fourberie. Franoise aurait t bien frivole de s'en aller en paix.
L'exaltation du repentir ou celle des derniers moments ne possdent
aucun privilge. On peut bien avoir le sentiment de conclure sa vie, de
la dominer, et distribuer solennellement les pardons et les maldictions. Rien ne prouve que le converti ou le mourant comprenne autrui
et soi-mme mieux qu'il ne l'a fait auparavant. chaque moment nous
n'avons d'autre ressource que d'agir selon les jugements que nous
avons forms avec toute l'honntet et l'intelligence dont nous sommes capables, comme s'ils taient incontestables. Mais il serait malhonnte et sot de nous sentir jamais acquitts par le jugement d'autrui.
Un moment du temps ne peut effacer l'autre, l'aveu de Xavire ne
pourrait effacer la haine de Xavire, comme le retour de Pierre auprs
de Franoise n'annule pas les moments o il aimait Xavire plus que
tout.
[66]
III
Il n'y a pas d'innocence absolue et, pour la mme raison, pas de
culpabilit absolue. Toute action rpond une situation de fait que
nous n'avons pas entirement choisie et dont, en ce sens, nous ne
sommes pas absolument responsables. Est-ce la faute de Pierre et de
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
48
Franoise s'ils ont tous deux trente ans et Xavire vingt ? Est-ce leur
faute encore si, par leur seule prsence, ils condamnent Elisabeth se
sentir frustre et aline ? Est-ce leur faute s'ils sont ns ? Comment
pourrions-nous jamais nous sentir absolument solidaires d'aucune de
nos actions, mme de celles que nous avons dlibrment choisies,
puisque au moins la ncessit d'un choix nous a t impose du dehors
et qu'on nous a jets au monde sans nous consulter ? La culpabilit
gnrale et originelle dont le sort nous charge en nous faisant natre
dans un certain temps, dans un certain milieu, avec un certain visage,
conditionne et dborde toute culpabilit particulire, et si, quoi que
nous fassions, nous ne pouvons jamais nous sentir justifis, notre
conduite ne devient-elle pas indiffrente ? Le monde est fait de telle
sorte que nos actions changent de sens en sortant de nous et en se dployant au dehors. Franoise peut bien chercher dans ses souvenirs :
les moments qu'elle a passs avec Gerbert dans cette auberge de campagne ne contiennent rien que de rayonnant et de pur. Le mme amour
montre Xavire un visage ignoble. [67] Comme il en est toujours
ainsi, comme c'est pour nous un destin invitable d'tre vus autrement
que nous nous voyons, nous avons bon droit le sentiment que les
accusations qui viennent du dehors ne nous concernent pas tout fait,
la contingence fondamentale de notre vie fait que nous nous sentons
trangers au procs que nous font les autres. Toute conduite sera toujours absurde dans un monde absurde, et nous pourrons toujours en
dcliner la responsabilit puisque, par le centre de nous-mmes,
nous ne sommes pas au monde (Rimbaud).
Il est vrai que nous demeurons libres d'accepter et de refuser la
vie ; en l'acceptant nous assumons les situations de fait, notre
corps, notre visage, nos manires d'tre nous prenons nos responsabilits, nous signons un contrat avec le monde et avec les hommes.
Mais cette libert, qui est la condition de toute moralit, fonde en
mme temps un immoralisme absolu, puisqu'elle reste entire, en moi
comme en autrui, aprs chaque faute, et qu'elle fait de nous des tres
neufs chaque instant. Quelle conduite, quelles relations pourraient
donc tre prfrables pour des liberts que rien ne peut mettre en danger ? Qu'on insiste sur le conditionnement de notre existence ou au
contraire sur notre absolue libert, il n'y a pas de valeur intrinsque et
objective de nos actions, dans le premier cas parce qu'il n'y a pas de
degrs dans l'absurde et qu'aucune conduite ne peut nous sauver du
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
49
gchis, dans le second cas, parce qu'il n'y a pas de degrs dans la libert et qu'aucune conduite ne peut perdre personne.
Le fait est que les personnages de L'Invite sont [68] dpourvus de
sens moral . Ils ne trouvent pas le bien et le mal dans les choses, ils
ne croient pas que la vie humaine ait, par elle-mme, des exigences
dfinies et porte en elle-mme sa rgle comme celle des arbres ou celle des abeilles. Ils prennent le monde (y compris la socit et leur propre corps) comme un ouvrage inachev , selon le mot profond de
Malebranche, ils l'interrogent curieusement, ils le traitent de diverses
faons... Ce qu'on leur reproche, ce n'est pas tant leurs actes : car aprs
tout l'adultre, les perversions, le crime remplissent tous les livres, et
les critiques littraires en ont vu d'autres. La moindre sous-prfecture
connat plus d'un mnage trois. Mais un mnage trois est encore un
mnage. Le moyen d'admettre au contraire que Pierre, Franoise et
Xavire ignorent si compltement la sainte loi naturelle du couple et
(d'ailleurs sans ombre de complicit sexuelle) essaient honntement de
former un trio ? Mme dans les socits les plus strictes, le pcheur
est toujours admis parce qu'il fait partie du systme et que, comme
pcheur, il ne met pas en question les principes. Ce qu'on ne supporte
pas chez Pierre et chez Franoise, c'est un dsaveu aussi ingnu de la
morale, c'est cet air de franchise et de jeunesse, ce manque absolu
d'importance, de vertige et de remords, c'est, en un mot, qu'ils pensent
comme ils agissent et agissent comme ils pensent.
Ces qualits ne s'acquirent-elles que par le scepticisme et voulons-nous dire que l'immoralisme absolu soit le dernier mot d'une philosophie existentielle ? Pas du tout. Il y a un existentialisme de
nuance sceptique qui n'est certainement pas celui de L'Invite. Sous
prtexte [69] que toute opration rationnelle ou linguistique condense
une certaine paisseur d'existence et est obscure pour elle-mme, on
en conclut que rien ne peut tre dit avec certitude. Sous prtexte que
les actes des hommes perdent tout sens si on les dtache de leur
contexte et si on les dcompose en leurs lments matriels, comme les gestes d'un homme que je vois sans l'entendre travers la vitre
d'une cabine tlphonique, on conclut que toute conduite est insense. Il est facile d'ter tout sens au langage et aux actions et de les faire apparatre comme absurdes si on les regarde d'assez loin. C'tait le
procd de Voltaire dans Micromgas. Reste comprendre cette autre
merveille que, dans un monde absurde, le langage et les conduites ont
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
50
un sens pour ceux qui parlent et agissent. L'existentialisme entre les
mains des crivains franais est toujours menac de retomber cette
analyse isolante qui fragmente le temps en instants discontinus,
ramne la vie une collection d'tats de conscience 7.
En ce qui concerne Simone de Beauvoir, elle n'est pas expose ce
reproche. Son livre montre l'existence comprise entre deux limites,
d'un ct l'immdiat ferm sur lui-mme, en de de toute parole et de
tout engagement, c'est Xavire, de l'autre une confiance absolue
dans le langage et dans les dcisions rationnelles, une existence qui se
vide force de se transcender, c'est [70] Franoise au dbut du livre 8.
Entre ce temps morcel et cette ternit qui croit faussement transcender le temps, se trouve l'existence effective, qui se dploie en cycles
de conduite, s'organise la faon d'une mlodie et par ses projets traverse le temps sans le quitter. Sans doute il n'y a pas de solution aux
problmes humains : aucun moyen d'liminer la transcendance du
temps, la sparation des consciences, qui peuvent toujours reparatre
et menacer nos engagements, aucun moyen de vrifier l'authenticit de
ces engagements, qui peuvent toujours, dans un moment de fatigue,
nous apparatre comme des conventions factices. Mais entre ces deux
limites o elle prit, l'existence totale est la dcision par laquelle nous
entrons dans le temps pour y crer notre vie. Tout projet humain est
contradictoire, puisqu'il appelle et repousse la fois sa ralisation. On
ne chercherait jamais rien si ce n'tait pour l'obtenir, et pourtant, si ce
que je recherche aujourd'hui doit tre un jour atteint, c'est--dire dpass, pourquoi le rechercher ? Il faut le rechercher parce que aujourd'hui est aujourd'hui et demain, demain. Je ne peux pas plus regarder
mon prsent du point de vue de l'avenir que la Terre du point de vue
de Sirius 9. Je n'aimerais pas quelqu'un si ce n'tait avec l'espoir d'tre
reconnu de lui, et pourtant cette reconnaissance ne compte que [71] si
elle est toujours libre, c'est--dire jamais acquise. Mais en fait, il y a
l'amour. Entre les moments de mon temps, comme entre mon temps et
celui des autres, et en dpit de la concurrence qui les oppose, il y a
7
8
C'est le reproche que faisait J.-P. Sartre Camus propos de L'tranger.
On sent vivement comme il est regrettable d'crire ce pesant commentaire
en marge d'un roman. Mais le roman a gagn sa cause devant le public et n'a
rien craindre ni esprer de nos commentaires.
Cette ide est dveloppe dans l'essai de Simone de Beauvoir, Pyrrhus et
Cinas (Gallimard).
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
51
une communication, si je veux, si je ne m'y drobe pas par la mauvaise foi, si je suis de bonne volont, si je m'enfonce dans le temps qui
nous spare et nous relie comme le chrtien s'enfonce en Dieu. La
vraie morale ne consiste pas suivre des rgles extrieures ni respecter des valeurs objectives : il n'y a pas de moyens d'tre juste et
d'tre sauv. Mais plutt que la situation insolite des trois personnages
de L'Invite, on ferait bien de remarquer la bonne foi, la fidlit aux
promesses, le respect d'autrui, la gnrosit, le srieux des deux principaux. Car la valeur est l. Elle consiste tre activement ce que
nous sommes par hasard, tablir cette communication avec autrui et
avec nous-mmes dont notre structure temporelle nous offre la chance
et dont notre libert n'est que l'bauche.
[72]
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
52
[73]
SENS ET NON-SENS
I. OUVRAGES
Un auteur scandaleux
Retour la table des matires
Pour ceux qui connaissent Sartre, sa destine littraire offre premire vue un mystre : il n'y a pas d'homme moins provocant et cependant, comme auteur, il fait scandale. Je l'ai connu il y a vingt ans,
un jour que l'Ecole Normale se dchanait contre un de mes camarades
et moi parce que nous avions siffl les chansons traditionnelles, trop
grossires notre gr. Il se glissa entre nos perscuteurs et nous, et,
dans la situation hroque et ridicule o nous nous tions mis, nous
mnagea une sortie sans concessions et sans dommages. Dans le camp
de prisonniers o il a sjourn un an, cet antchrist avait nou des relations cordiales avec un grand nombre de prtres et de jsuites qui le
consultaient comme un homme de sens sur certains points de la thologie mariale. Des confrres en littrature qui n'aiment pas ses ides
l'abordent quelquefois avec l'intention de le mettre en colre, et lui
proposent les thses, croient-ils, les plus contraires aux siennes. Il rflchit, hoche la tte, se dclare d'accord et donne [74] ses interlocuteurs cent bonnes raisons de persvrer dans leur sens. Ce corrupteur
de la jeunesse enseigne ceux qui le consultent sur quelque problme
personnel que leur situation est singulire, que personne ne peut dcider leur place et qu'il leur faut juger selon eux-mmes. Ce gnie de
la publicit prte des manuscrits encore indits des amis qui les perdent ou d'obscurs personnages qui les emportent l'tranger. Il
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
53
conduit de jeunes flatteurs, parce qu'ils ont le temps d'apprendre la
vie, il coute des vieillards ennuyeux, parce que ce sont des vieillards.
On n'a jamais vu ce romancier dmoniaque (Claudel) manquer de
tact envers les pires solliciteurs, pourvu qu'ils soient simples comme
lui. L'enfer, c'est les autres ne veut pas dire : Le ciel, c'est moi.
Si les autres sont l'instrument de notre supplice, c'est parce qu'ils sont
d'abord indispensables notre salut. Nous sommes mls eux de telle faon qu'il nous faut, tant bien que mal, tablir l'ordre dans ce
chaos. Sartre a mis Garcin en enfer, non parce qu'il a t peut-tre lche, mais parce qu'il a fait souffrir sa femme. Cet auteur sans respect
observe scrupuleusement envers les autres la rgle stendhalienne qui
condamne le manque d'gards .
Cette sorte de bont passe dans les personnages de ses romans.
Mathieu, dans Lge de Raison, accepte d'tre mari et pre. Marcelle
n'a qu'un mot dire. S'il ne sduit pas Ivitch, c'est qu'il mprise la crmonie de sduction, paroles contresens des actes, obstination,
moyens obliques, conduite menteuse, c'est finalement parce qu'il
ne se reconnat pas de droits sur elle, qu'il la respecte et la veut libre.
On ne trouvera [75] pas dans les romans de Sartre, sinon ct enfer,
de ces mots-poignards qui enchantent les critiques de Bernstein. On
n'y trouvera pas, sinon titre de satire et chez les personnages sacrifis, le clair-obscur, la complaisance soi, la sensualit. Les personnages favoris de Sartre ont une bonne volont et une propret peu
communes. D'o vient donc que la critique des journaux presque unanime ait parl de boue, d'immoralit, de veulerie ? Il faut que les vertus mmes de ses hros aient quelque chose qui les rend ou invisibles
ou mme odieuses au sens commun. Essayons de dchiffrer l'nigme.
Les griefs qu'on lui fait le plus souvent sont rvlateurs. Ses livres,
dit-on, sont remplis de laideurs. Emile Henriot, qui a bien l'air d'tre
un homme de got, a cit comme horrible l'pisode de L'ge de Raison
o Ivitch boit sottement, se rend malade, et qui se termine par deux
lignes sacrilges, en passe de devenir clbres : Une aigre petite
odeur de vomi s'chappait de sa bouche si pure. Mathieu respira passionnment cette odeur. Le mme auteur ou un autre dnonait
comme intolrable le chapitre du Sursis o sont raconts les dbuts
d'un amour chez deux malades de Berck, avec toutes les humiliations
qui rsultent pour eux de leur tat de malades. Les critiques croient
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
54
avoir tout dit quand ils ont prouv chez Sartre une certaine prdilection pour l'horrible.
La vraie question est de savoir quelle est, dans les ouvrages de Sartre, la fonction et la signification de l'horrible. C'est une habitude,
mais ce n'est peut-tre rien de plus, de dfinir l'art par la beaut de
ses objets. Hegel ne trouvait l que la formule d'un art [76] classique
disparu depuis l'aube du christianisme. L'art romantique, qui apparat
alors, ne reprsente pas l'harmonie de l'esprit et des apparences, qui
fait la beaut du dieu grec, mais au contraire leur dsaccord. L'art
romantique n'aspire plus reproduire la vie dans son tat de srnit
infinie... : il tourne au contraire le dos ce sommet de la beaut, il fait
participer l'intriorit de tout l'accidentel des formations extrieures et
accorde une place illimite aux traits marqus de ce qui est l'antithse
du beau. Le laid ou l'horrible, c'est la discordance fondamentale de
l'intrieur et de l'extrieur. L'esprit paraissant dans les choses est un
scandale parmi elles et inversement les choses dans leur existence nue
sont scandaleuses pour l'esprit. L'art romantique imprime aussi bien
au dehors qu'au dedans un caractre accidentel, tablit entre ces deux
aspects une sparation qui signifie la ngation mme de l'art, et fait
ressortir la ncessit pour la conscience de dcouvrir, pour l'apprhension de la vrit, des formes plus leves que celles fournies par
l'art 10. Si l'intrieur rejoint l'extrieur, ce ne sera pas dans l'harmonie ou dans la beaut, mais par la violence du sublime.
Or, sans hausser le ton et sans chercher le paradoxe, on peut trouver dans la phrase de L'ge de Raison qui choque si fort Emile Henriot comme un petit sublime, sans loquence et sans illusions, qui est,
je crois, une invention de notre temps. Voil longtemps qu'on parle de
l'homme comme ange et bte la fois, mais la [77] plupart des critiques sont moins hardis que Pascal. Ils rpugnent mlanger l'anglique et l'animal dans l'homme. Il leur faut un au-del du dsordre humain, et, s'ils ne le trouvent pas dans la religion, ils le cherchent dans
une religion du beau.
Le grief de laideur ici en rejoint un autre, plus gnral. Quand Sartre a crit que toute uvre d'art exprimait une prise de position
l'gard des problmes de la vie humaine (y compris la vie politique) et
quand dernirement il a cherch retrouver la dcision vitale par la10
Esthtique, traduction Janklevitch, II, p. 254.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
55
quelle Baudelaire s'est donn les thmes de ses souffrances et de sa
posie, on a constat le mme malaise ou la mme colre, cette fois
chez des crivains considrables. Vous nous ramenez la barbarie , disait peu prs Gide. Et ceux qui ne souffrent pas qu'on interroge Flaubert ou Baudelaire sur l'usage qu'ils ont fait de leur vie vont
rptant pour se consoler que Sartre n'est pas artiste.
Si la religion de l'art n'admet pas d'tre mle l' peu prs de la
vie, elle risque de devenir une technique du joli. En art, il n'est pas
de problmes, dit Gide dans une phrase elle-mme trop jolie, dont
l'uvre d'art ne soit une suffisante solution. Sartre moins que personne ne conteste que l'uvre d'art appartienne l'imaginaire, qu'en
ce sens elle transforme la prose de la vie et que l'expression pose des
problmes. Il croit seulement que la vie imaginaire de l'crivain et sa
vie effective forment un ensemble ou encore viennent d'une seule
source : la manire qu'il a choisie de traiter le monde, autrui, la mort et
le temps. Pas d'crivain moins biographique que Sartre, il n'a jamais
livr ses [78] ides que dans des ouvrages, et nous n'avons jusqu'ici de
lui aucun journal intime. Personne donc n'est moins port que lui
expliquer les ides ou les uvres par les circonstances de la vie. Il
s'agit de tout autre chose : de remonter jusqu'au choix indivis qui est
choix simultanment d'une vie et d'un certain genre d'art. Il interroge
l'artiste comme tout autre homme sur sa dcision fondamentale, non
que l'opration de l'art soit rduite aux proportions du langage de tous
les jours, mais inversement parce qu'il croit trouver en tout homme le
moment de l'expression ou de la cration de soi. Tout se passe au niveau de la vie parce que la vie est mtaphysique.
Le malentendu de Sartre et des artistes tient ceci qu'ils ne
mettent pas assez en question l'art et la culture comme domaines spars, qu'ils gardent la nostalgie de l'ordre et de la perfection comme
attributs de l'homme. Aprs la dfaite de 1940, Gide lit et relit, il s'attaque Alexandre, il reprend Hermann et Dorothe, il discute des assonances et de l'emploi des conjonctions, il s'amuse dcouvrir dans
Hugo un hmistiche de Mallarm. Il vit dans le monde de la culture et
de F exquis . On croirait que tous les hommes, et Gide lui-mme,
ne sont au monde que pour rendre possibles les uvres d'art et la
beaut, comme la plante pour pousser ses fleurs. Mais c'est ici Gide
qu'il faut invoquer contre Gide. Qu'une rencontre, un incident se produisent, l'occasion le trouve toujours sensible et attentif et l'humanit
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
56
concrte fait irruption dans le Journal. Alors Gide regrette de n'avoir
pas vu la guerre de plus prs, de n'avoir pas eu plus d'aventure. Alors
le contact est repris avec la vie brute, alors reparat cette admirable
[79] intelligence d'autrui qui, comme passion fondamentale, alterne
dans l'esprit de Gide avec la religion de l'art. Alors l'homme n'est plus
le simple porteur des uvres d'art, son existence nue et fortuite vaut
par elle-mme absolument, et, quand il arrive au problme du fondement dernier, Gide fait la question une rponse qui est peu prs
celle de Sartre. Plus on y rflchit... plus on est pntr de cette vrit vidente : a ne rime rien (Antoine Thibault). Mais quoi diable
souhaitiez-vous que cela rimt ? L'homme est un miracle sans intrt
(Jean Rostand). Mais qu'est-ce au monde qu'il faudrait pour que ce
miracle prt vos yeux de l'importance, pour que vous le jugiez digne
d'intrt ? 11. Par del la srnit de l'uvre d'art, ce qui est intressant, c'est l'existence injustifie de l'homme.
Peut-tre Sartre est-il scandaleux comme Gide l'a t : parce qu'il
met la valeur de l'homme dans son imperfection. Je n'aime pas
l'homme, disait Gide, j'aime ce qui le dvore. La libert de Sartre
dvore l'homme constitu. La matire, le ciel, les moissons, les animaux sont beaux. Les attitudes, le vtement mme de l'homme attestent qu'il ne relve pas de cet ordre. Il est la lettre un dfaut dans le
diamant du monde. Au regard de cet tre qui n'est pas un tre, qui n'a
ni instincts fixes, ni point d'quilibre et de repos, les choses perdent
leur suffisance et leur vidence, et, par un renversement soudain, apparaissent arbitraires et de trop, cependant que lui-mme dans le
monde des [80] choses est aussi de trop. La laideur est la collision de
l'homme en tant qu'il n'est rien ou qu'il est libre et de la nature comme
plnitude et destin.
Si l'humanisme est la religion de l'homme comme espce naturelle
ou la religion de l'homme achev, Sartre en est aujourd'hui aussi loin
que jamais. Rien n'est pur ou absolument vnrable de ce que font les
hommes, pas mme et surtout pas les moments parfaits qu'ils se
mnagent dans la vie ou dans l'art. A la fin de La Nause un air de
musique offrait enfin quelque chose d'incontestable. Mais ce n'est pas
par hasard que Sartre avait choisi Some of these days pour cette lvation finale. Il dclinait ainsi par avance la religion de l'art et ses conso11
Journal, 1939-1942.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
57
lations. L'homme peut dpasser sa contingence dans ce qu'il cre,
mais toute expression, au mme titre que le Grand Art, est un acte de
naissance de l'homme. Le miracle se passe partout et ras de terre,
non dans le ciel privilgi des beaux-arts. Le principe de l'ordre et celui du dsordre sont un seul principe, la contingence des choses et notre libert qui la domine sont faites d'une mme toffe. Quand Sartre,
aujourd'hui, se dit humaniste, ce n'est pas qu'il ait chang d'avis, car ce
qu'il respecte dans l'homme, c'est cette imperfection fondamentale par
laquelle il est et est seul capable de se faire. La sauvagerie de La Nause est toujours l. Simplement, Sartre s'est avis que, dans le moment
mme o il les jugeait durement, les hommes lui tenaient cur.
J'ai beau faire, disait-il un jour devant la gare du Luxembourg bonde, ces bonshommes m'intressent. Il s'est aperu que toute tentative pour vivre l'cart tait hypocrite, parce que nous sommes mystrieusement [81] apparents, que les autres nous voient, qu'ils deviennent ainsi une dimension inalinable de notre vie, qu'ils deviennent
nous-mmes. Les liens du sang ou de l'espce ne seraient rien : chacun
de nous est gnrique en ce qu'il a de plus propre, puisque sa libert
attend la reconnaissance des autres et a besoin d'eux pour devenir ce
qu'elle est. La menace de la guerre et l'exprience de l'occupation ont
fait apparatre la valeur positive qui se cachait sous les sarcasmes de
La Nause. Sartre disait, il y a quinze ans, que la politique est impensable (comme en gnral autrui, c'est--dire une conscience vue du
dehors). Il a dcouvert depuis qu'il faut bien la penser puisque nous la
vivons, et qu'il doit y avoir du valable puisque nous y avons fait l'exprience d'un mal absolu. Il s'agit de faire passer dans les relations des
hommes et de transmuer en histoire cette libert radicale qui est la ngation de lhumanit comme espce donne et l'appel une humanit
qui se cre.
On peut prdire Sartre que ce nouveau langage ne lui conciliera
personne. Du ct chrtien comme du ct marxiste, il semble qu'on
soit press d'oublier ce qu'il y avait d'pre et de sauvage l'origine des
deux traditions. Mathieu, dans L'ge de Raison, peut bien tre de bonne volont et prt sacrifier ses gots propres, cela ne lui sera pas
compt, ce n'est pas l ce qu'on lui demande, on voudrait qu'il le ft au
nom d'une loi naturelle. Il s'tonne d'tre homme, d'tre pre, prt
d'ailleurs accepter les consquences de cette situation. On voudrait
qu'il l'et en rvrence et qu'il en tirt gloire. Dans la dcadence o
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
58
menace de tomber la pense religieuse, toute description un peu violente du [82] paradoxe de l'humanit choque et passe pour diabolique.
Comme si le christianisme avait quelque chose voir avec le ftichisme de la nature, comme s'il n'avait pas dtruit les liens du sang et
de la famille pour crer les liens de l'esprit. Il y a cinquante ans, les
chrtiens trouvaient en face d'eux un rationalisme sommaire au regard
duquel la religion n'tait qu'absurdit pure. Mais les rationalistes de la
vieille cole ne mettaient pas en question les coutumes de l'humanit
constitue, ils se bornaient les fonder sur la raison, leur libert tait
une libert de bonne compagnie. Voil pourquoi, aprs avoir longtemps polmiqu contre eux, les catholiques semblent aujourd'hui les
regretter et rservent leur svrit pour Sartre.
Du ct marxiste, un phnomne analogue se produit. On semble
gnralement plus curieux du XVIIIe sicle que de Hegel ou de Marx.
On parle beaucoup moins de la dialectique que de la science (qui,
transporte en politique, donne Comte et, par lui, Maurras). On rivalise de mfiance envers le sujet, au point mme d'exposer Descartes
sans dire un mot du cogito. Alors que le marxisme est tout entier construit sur l'ide qu'il n'y a pas de destin, que les lois de la sociologie
ne sont valables que dans le cadre d'un certain tat historique de la
socit, qu'il appartient l'homme de reprendre en mains l'appareil
social et de transformer l'histoire subie en histoire voulue, alors qu'il
suppose, en consquence, une vue de l'histoire comme histoire ouverte, de l'homme comme crateur de son sort et devrait se trouver en
sympathie avec toutes les formes de critique radicale, on constate au
contraire, chez la plupart des [83] marxistes, une tonnante timidit.
Leur critique n'est plus une critique qui dpasse et conquiert, c'est une
critique qui met en garde, retient et morigne. La vertu matresse n'en
est plus l'audace, c'est la prudence. On se demande doctement si la
libert de l'artiste est compatible avec la morale et avec le fonctionnement de la socit...
Il est douteux que la morale de Sartre, quand il la publiera, dsarme la critique. Quand mme il fonderait sa manire une objectivit
des valeurs, quand mme il admettrait qu'elles sont offertes par notre
situation en mme temps qu'inventes par nous, on lui reprochera toujours de les soumettre notre reconnaissance et notre assentiment
inconditionns, ce que faisait pourtant, en des temps moins timides,
un philosophe comme Lagneau. Or, il ne cdera rien l-dessus.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
59
Quand on me parle de la libert, disait-il autrefois, c'est comme si
l'on me parlait de moi. Il se confond avec cette transparence ou cette
agilit qui n'est pas du monde et qui rend, comme il l'a crit, la libert
mortelle . Il y a l une intuition que l'on peut dpasser, mais d'o
l'on ne peut revenir et qui dplaira toujours ceux qui veulent dormir.
On raconte qu'un journaliste franais, ayant envoy un critique sovitique une confrence de Sartre rcemment publie, en s'excusant
d'avance de ce qu'il y avait d'arrir, eut la surprise de recevoir en rponse un loge de l'ouvrage. Il y a l, disait peu prs le critique,
une tincelle dont nous avons besoin. Ce Sovitique avait raison.
Mais sera-t-il entendu ? La mme vertu cartsienne de gnrosit qui
rend humaine et rassurante la conduite de Sartre rendra [84] toujours
inquitants ses livres, parce qu'ils en font voir la racine prhumaine.
Les mmes raisons font l'homme conciliant et l'auteur scandaleux.
Il ira donc son chemin, entre l'estime entire des uns et la colre
des autres. Il n'y a pas craindre que l'tincelle s'teigne. Gomme les
journalistes lui attachaient au dos l'tiquette de 1' existentialisme ,
Sartre protesta d'abord. Puis il se dit un jour qu'aprs tout il n'avait pas
le droit de refuser l'tiquette, qui est ce que les autres voient de lui. Il
prit donc bravement le parti de l'existentialisme. Mais ceux qui lui
supposent du dogmatisme le connaissent mal. Mme quand il s'applique aux travaux que le sort lui propose, ce n'est jamais sans sourire.
On peut souhaiter que cette libert se ralise en images littraires plus
lourdes, mais on n'en saurait dire trop de bien, elle est vraiment le sel
de la terre. Il n'y a pas d'apparence que les dormeurs et les valets viennent manquer. Il est bon qu'il y ait, de temps autre, un homme libre.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
60
[85]
SENS ET NON-SENS
I. OUVRAGES
Le cinma et
la nouvelle psychologie
12
Retour la table des matires
La psychologie classique considre notre champ visuel comme une
somme ou une mosaque de sensations dont chacune dpendrait strictement de l'excitation rtinienne locale qui lui correspond. La nouvelle
psychologie fait voir d'abord que, mme considrer nos sensations
les plus simples et les plus immdiates, nous ne pouvons admettre ce
paralllisme entre elles et le phnomne nerveux qui les conditionne.
Notre rtine est bien loin d'tre homogne, en certaines de ses parties
elle est aveugle par exemple pour le bleu ou pour le rouge, et cependant, quand je regarde une surface bleue ou rouge, je n'y vois aucune
zone dcolore. C'est que, ds le niveau de la simple vision des [86]
couleurs, ma perception ne se borne pas enregistrer ce qui lui est
prescrit par les excitations rtiniennes, mais les rorganise de manire
rtablir l'homognit du champ. D'une manire gnrale, nous devons la concevoir, non comme une mosaque, mais comme un systme de configurations. Ce qui est premier et vient d'abord dans notre
perception, ce ne sont pas des lments juxtaposs, mais des ensem12
Confrence faite le 13 mars 1945 l'Institut des Hautes Etudes
Cinmatographiques.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
61
bles. Nous groupons les toiles en constellations comme le faisaient
dj les anciens, et pourtant beaucoup d'autres tracs de la carte cleste sont, a priori, possibles. Si l'on nous prsente la srie :
ab
cd
ef
gh
ij
nous accouplons toujours les points selon la formule a-b, c-d, e-f, etc.,
alors que le groupement b-c, d-e f-g, etc., est en principe galement
probable. Le malade qui contemple la tapisserie de sa chambre la voit
soudain se transformer si le dessin et la figure deviennent fond, pendant que ce qui est vu d'ordinaire comme fond devient figure. L'aspect
du monde pour nous serait boulevers si nous russissions voir
comme choses les intervalles entre les choses, par exemple l'espace
entre les arbres sur le boulevard, et rciproquement comme fond
les choses elles-mmes, les arbres du boulevard. C'est ce qui arrive
dans les devinettes : le lapin ou le chasseur n'taient pas visibles, parce que les lments de ces figures taient disloqus et intgrs d'autres formes : par exemple ce qui sera l'oreille du lapin n'tait encore
que l'intervalle vide entre deux arbres de la fort. Le lapin et le chasseur apparaissent par une [87] nouvelle sgrgation du champ, par une
nouvelle organisation du tout. Le camouflage est l'art de masquer une
forme en introduisant les lignes principales qui la dfinissent dans
d'autres formes plus imprieuses.
Nous pouvons appliquer le mme genre d'analyse aux perceptions
de l'oue. Simplement, il ne s'agira plus maintenant de formes dans
l'espace, mais de formes temporelles. Par exemple, une mlodie est
une figure sonore, elle ne se mle pas aux bruits de fond qui peuvent
l'accompagner, comme le bruit d'un klaxon que l'on entend au loin
pendant un concert. La mlodie n'est pas une somme de notes : chaque
note ne compte que par la fonction qu'elle exerce dans l'ensemble, et
c'est pourquoi la mlodie n'est pas sensiblement change si on la
transpose, c'est--dire si l'on change toutes les notes qui la composent,
en respectant les rapports et la structure de l'ensemble. Par contre un
seul changement dans ces rapports suffit modifier la physionomie
totale de la mlodie. Cette perception de l'ensemble est plus naturelle
et plus primitive que celle des lments isols : dans les expriences
sur le rflexe conditionn o l'on dresse des chiens rpondre par une
scrtion salivaire une lumire ou un son, en associant frquemment cette lumire ou ce son la prsentation d'un morceau de viande,
on constate que le dressage acquis l'gard d'une certaine suite de no-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
62
tes est acquis du mme coup l'gard de toute mlodie de mme
structure. La perception analytique, qui nous donne la valeur absolue
des lments isols, correspond donc une attitude tardive et exceptionnelle, c'est celle du savant qui observe ou du philosophe qui rflchit, la perception des formes, [88] au sens trs gnral de : structure,
ensemble ou configuration, doit tre considre comme notre mode de
perception spontan.
Sur un autre point encore, la psychologie moderne renverse les
prjugs de la physiologie et de la psychologie classiques. C'est un
lieu commun de dire que nous avons cinq sens et, premire vue,
chacun d'eux est comme un monde sans communication avec les autres. La lumire ou les couleurs qui agissent sur l'il n'agissent pas sur
les oreilles ni sur le toucher. Et cependant on sait depuis longtemps
que certains aveugles arrivent se reprsenter les couleurs qu'ils ne
voient pas par le moyen des sons qu'ils entendent. Par exemple un
aveugle disait que le rouge devait tre quelque chose comme un coup
de trompette. Mais on a longtemps pens qu'il s'agissait l de phnomnes exceptionnels. En ralit le phnomne est gnral. Dans l'intoxication par la mescaline, les sons sont rgulirement accompagns
par des taches de couleur dont la nuance, la forme et la hauteur varient
avec le timbre, l'intensit et la hauteur des sons. Mme les sujets normaux parlent de couleurs chaudes, froides, criardes ou dures, de sons
clairs, aigus, clatants, rugueux ou moelleux, de bruits mous, de parfums pntrants. Czanne disait qu'on voit le velout, la duret, la
mollesse, et mme l'odeur des objets. Ma perception n'est donc pas
une somme de donnes visuelles, tactiles, auditives, je perois d'une
manire indivise avec mon tre total, je saisis une structure unique de
la chose, une unique manire d'exister qui parle la fois tous mes
sens.
Naturellement la psychologie classique savait bien [89] qu'il y a
des relations entre les diffrentes parties de mon champ visuel comme
entre les donnes de mes diffrents sens. Mais pour elle cette unit
tait construite, elle la rapportait l'intelligence et la mmoire. Je dis
que je vois des hommes passer dans la rue, crit Descartes dans un
clbre passage des Mditations, mais en ralit que vois-je au juste ?
Je ne vois que des chapeaux et des manteaux, qui pourraient aussi
bien recouvrir des poupes qui ne se remuent que par ressorts, et si je
dis que je vois des hommes, c'est que je saisis par une inspection de
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
63
l'esprit ce que je croyais voir de mes yeux . Je suis persuad que les
objets continuent d'exister quand je ne les vois pas, et par exemple
derrire mon dos. Mais de toute vidence, pour la pense classique,
ces objets invisibles ne subsistent pour moi que parce que mon jugement les maintient prsents. Mme les objets devant moi ne sont pas
proprement vus, mais seulement penss. Ainsi je ne saurais voir un
cube, c'est--dire un solide form de six faces et de douze artes gales, je ne vois jamais qu'une figure perspective dans laquelle les faces
latrales sont dformes et la face dorsale compltement cache. Si je
parle de cubes, c'est que mon esprit redresse ces apparences, restitue
la face cache. Je ne peux voir le cube selon sa dfinition gomtrique, je ne puis que le penser. La perception du mouvement montre
encore mieux quel point l'intelligence intervient dans la prtendue
vision. Au moment o mon train, arrt en gare, se met en marche, il
arrive souvent que je croie voir dmarrer celui qui est arrt ct du
mien. Les donnes sensorielles par elles-mmes sont donc neutres et
capables de recevoir diffrentes [90] interprtations selon l'hypothse
laquelle mon esprit s'arrtera. D'une manire gnrale, la psychologie classique fait donc de la perception un vritable dchiffrage par
l'intelligence des donnes sensibles et comme un commencement de
science. Des signes me sont donns, et il faut que j'en dgage la signification, un texte m'est offert et il faut que je le lise ou l'interprte.
Mme quand elle tient compte de l'unit du champ perceptif, la psychologie classique reste encore fidle la notion de sensation, qui
fournit le point de dpart de l'analyse ; c'est parce qu'elle a d'abord
conu les donnes visuelles comme une mosaque de sensation qu'elle
a besoin de fonder l'unit du champ perceptif sur une opration de l'intelligence. Que nous apporte sur ce point la thorie de la Forme ? En
rejetant rsolument la notion de sensation, elle nous apprend ne plus
distinguer les signes et leur signification, ce qui est senti et ce qui est
jug. Gomment pourrions-nous dfinir exactement la couleur d'un objet sans mentionner la substance dont il est fait, par exemple la couleur bleue de ce tapis sans dire que c'est un bleu laineux ? Czanne
avait pos la question : comment distinguer dans les choses leur couleur et leur dessin ? Il ne saurait tre question de comprendre la perception comme l'imposition d'une certaine signification certains signes sensibles, puisque ces signes ne sauraient tre dcrits dans leur
texture sensible la plus immdiate sans rfrence l'objet qu'ils signifient. Si nous reconnaissons sous un clairage changeant un objet d-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
64
fini par des proprits constantes, ce n'est pas que l'intelligence fasse
entrer en compte la nature de la lumire [91] incidente et en dduise la
couleur relle de l'objet, c'est que la lumire dominante du milieu,
agissant comme clairage, assigne immdiatement l'objet sa vraie
couleur. Si nous regardons deux assiettes ingalement claires, elles
nous paraissent galement blanches et ingalement claires tant que
le faisceau de lumire qui vient de la fentre figure dans notre champ
visuel. Si, au contraire, nous observons les mmes assiettes travers
un cran perc d'un trou, aussitt l'une d'elles nous parat grise et l'autre blanche, et mme si nous savons que ce n'est l qu'un effet d'clairage, aucune analyse intellectuelle des apparences ne nous fera voir la
vraie couleur des deux assiettes. La permanence des couleurs et des
objets n'est donc pas construite par l'intelligence, mais saisie par le
regard en tant qu'il pouse ou adopte l'organisation du champ visuel.
Quand nous allumons la tombe du jour, la lumire lectrique nous
parat d'abord jaune, un moment plus tard elle tend perdre toute couleur dfinie, et corrlativement les objets, qui d'abord taient sensiblement modifis dans leur couleur, reprennent un aspect comparable
celui qu'ils ont pendant la journe. Les objets et l'clairage forment
un systme qui tend vers une certaine constance et vers un certain niveau stable, non par l'opration de l'intelligence, mais par la configuration mme du champ. Quand je perois, je ne pense pas le monde, il
s'organise devant moi. Quand je perois un cube, ce n'est pas que ma
raison redresse les apparences perspectives et pense propos d'elles la
dfinition gomtrique du cube. Loin que je les corrige, je ne remarque pas mme les dformations perspectives, [92] travers ce que je
vois je suis au cube lui-mme dans son vidence. Et de mme les objets derrire mon dos ne me sont pas reprsents par quelque opration de la mmoire ou du jugement, ils me sont prsents, ils comptent
pour moi, comme le fond que je ne vois pas n'en continue pas moins
d'tre prsent sous la figure qui le masque en partie. Mme la perception du mouvement, qui d'abord parat dpendre directement du point
de repre que l'intelligence choisit, n'est son tour qu'un lment dans
l'organisation globale du champ. Car s'il est vrai que mon train et le
train voisin peuvent tour tour m'apparatre en mouvement au moment o l'un d'eux dmarre, il faut remarquer que l'illusion n'est pas
arbitraire et que je ne puis la provoquer volont par le choix tout intellectuel et dsintress d'un point de repre. Si je joue aux cartes
dans mon compartiment, c'est le train voisin qui dmarre. Si, au
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
65
contraire, je cherche des yeux quelqu'un dans le train voisin, c'est
alors le mien qui dmarre. chaque fois nous apparat fixe celui des
deux o nous avons lu domicile et qui est notre milieu du moment.
Le mouvement et le repos se distribuent pour nous dans notre entourage, non pas selon les hypothses qu'il plat notre intelligence de
construire, mais selon la manire dont nous nous fixons dans le monde
et selon la situation que notre corps y assume. Tantt je vois le clocher
immobile dans le ciel et les nuages qui volent au-dessus de lui, tantt au contraire les nuages semblent immobiles et le clocher tombe
travers l'espace, mais ici encore le choix du point fixe n'est pas le fait
de l'intelligence : l'objet que je regarde et o je jette [93] l'ancre m'apparat toujours fixe et je ne puis lui ter cette signification qu'en regardant ailleurs. Je ne la lui donne donc pas non plus par la pense. La
perception n'est pas une sorte de science commenante, et un premier
exercice de l'intelligence, il nous faut retrouver un commerce avec le
monde et une prsence au monde plus vieux que l'intelligence.
Enfin la nouvelle psychologie apporte aussi une conception neuve
de la perception d'autrui. La psychologie classique acceptait sans discussion la distinction de l'observation intrieure ou introspection et de
l'observation extrieure. Les faits psychiques , la colre, la peur
par exemple, ne pouvaient tre directement connus que du dedans
et par celui qui les prouvait. On tenait pour vident que je ne puis, du
dehors, saisir que les signes corporels de la colre ou de la peur, et
que, pour interprter ces signes, je dois recourir la connaissance que
j'ai de la colre ou de la peur en moi-mme et par introspection. Les
psychologues d'aujourd'hui font remarquer que l'introspection, en ralit, ne me donne presque rien. Si j'essaye d'tudier l'amour ou la
haine par la pure observation intrieure, je ne trouve que peu de choses dcrire : quelques angoisses, quelques palpitations de cur, en
somme des troubles banaux qui ne me rvlent pas l'essence de
l'amour ni de la haine. Chaque fois que j'arrive des remarques intressantes, c'est que je ne me suis pas content de concider avec mon
sentiment, c'est que j'ai russi l'tudier comme un comportement,
comme une modification de mes rapports avec autrui et avec le monde, c'est que je suis parvenu le penser comme je pense le comportement [94] d'une autre personne dont je me trouve tre tmoin. En fait
les jeunes enfants comprennent les gestes et les expressions de physionomie bien avant d'tre capables de les reproduire pour leur comp-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
66
te, il faut donc que le sens de ces conduites leur soit pour ainsi dire
adhrent. Il nous faut rejeter ici ce prjug qui fait de l'amour, de la
haine ou de la colre des ralits intrieures accessibles un seul
tmoin, celui qui les prouve. Colre, honte, haine, amour ne sont pas
des faits psychiques cachs au plus profond de la conscience d'autrui,
ce sont des types de comportement ou des styles de conduite visibles
du dehors. Ils sont sur ce visage ou dans ces gestes et non pas cachs
derrire eux. La psychologie n'a commenc de se dvelopper que le
jour o elle a renonc distinguer le corps et l'esprit, o elle a abandonn les deux mthodes corrlatives de l'observation intrieure et de
la psychologie physiologique. On ne nous apprenait rien sur l'motion
tant qu'on se bornait mesurer la vitesse de la respiration ou celle des
battements du cur dans la colre, et on ne nous apprenait rien non
plus sur la colre quand on essayait de rendre la nuance qualitative et
indicible de la colre vcue. Faire la psychologie de la colre, c'est
chercher fixer le sens de la colre, c'est se demander quelle en est la
fonction dans une vie humaine et en quelque sorte quoi elle sert. On
trouve ainsi que l'motion est, comme dit Janet, une raction de dsorganisation qui intervient lorsque nous sommes engags dans une
impasse, plus profondment, on trouve, comme l'a montr Sartre,
que la colre est une conduite magique par laquelle, renonant l'action efficace dans [95] le monde, nous nous donnons dans l'imaginaire
une satisfaction toute symbolique, comme celui qui, dans une conversation, ne pouvant convaincre son interlocuteur, en vient aux injures
qui ne prouvent rien, ou comme celui qui, n'osant pas frapper son ennemi, se contente de lui montrer le poing de loin. Puisque l'motion
n'est pas un fait psychique et interne, mais une variation de nos rapports avec autrui et avec le monde lisible dans notre attitude corporelle, il ne faut pas dire que seuls les signes de la colre ou de l'amour
sont donns au spectateur tranger et qu'autrui est saisi indirectement
et par une interprtation de ces signes, il faut dire qu'autrui m'est donn avec vidence comme comportement. Notre science du comportement va beaucoup plus loin que nous le croyons. Si l'on prsente des
sujets non prvenus la photographie de plusieurs visages, de plusieurs
silhouettes, la reproduction de plusieurs critures et l'enregistrement
de plusieurs voix, et si on leur demande d'assembler un visage, une
silhouette, une voix, une criture, on constate que, d'une manire gnrale, l'assemblage est fait correctement ou qu'en tout cas le nombre
des assortiments corrects l'emporte de beaucoup sur celui des assorti-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
67
ments errons. L'criture de Michel-Ange est attribue Raphal dans
36 cas, mais elle est correctement identifie dans 221 cas. C'est donc
que nous reconnaissons une certaine structure commune la voix, la
physionomie, aux gestes et l'allure de chaque personne, chaque personne n'est rien d'autre pour nous que cette structure ou cette manire
d'tre au monde. On entrevoit comment ces remarques pourraient tre
appliques la psychologie du langage : de [96] mme que le corps et
1' me d'un homme ne sont que deux aspects de sa manire d'tre
au monde, de mme le mot et la pense qu'il dsigne ne doivent pas
tre considrs comme deux termes extrieurs et le mot porte sa signification comme le corps est l'incarnation d'un comportement.
D'une manire gnrale, la nouvelle psychologie nous fait voir
dans l'homme, non pas un entendement qui construit le monde, mais
un tre qui y est jet et qui y est attach comme par un lien naturel.
Par suite elle nous rapprend voir ce monde avec lequel nous sommes en contact par toute la surface de notre tre, tandis que la psychologie classique dlaissait le monde vcu pour celui que l'intelligence
scientifique russit construire.
*
*
Si maintenant nous considrons le film comme un objet percevoir, nous pouvons appliquer la perception du film tout ce qui vient
d'tre dit de la perception en gnral. Et l'on va voir que, de ce point
de vue, la nature et la signification du film s'clairent et que la nouvelle psychologie nous conduit prcisment aux remarques les meilleures
des esthticiens du cinma.
Disons d'abord qu'un film n'est pas une somme d'images mais une
forme temporelle. C'est le moment de rappeler la fameuse exprience
de Poudovkine qui met en vidence l'unit mlodique du film. Poudovkine prit un jour un gros plan de Mosjoukine impassible, et le projeta prcd d'abord d'une assiette de potage, ensuite d'une jeune
femme morte dans son cercueil et enfin d'un enfant jouant avec un
ourson de peluche. On [97] s'aperut d'abord que Mosjoukine avait
l'air de regarder l'assiette, la jeune femme et l'enfant, et ensuite qu'il
regardait l'assiette d'un air pensif, la femme avec douleur, l'enfant
avec un lumineux sourire, et le public fut merveill par la varit de
ses expressions, alors qu'en ralit la mme vue avait servi trois fois et
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
68
qu'elle tait remarquablement inexpressive. Le sens d'une image dpend donc de celles qui la prcdent dans le film, et leur succession
cre une ralit nouvelle qui n'est pas la simple somme des lments
employs. R. Leenhardt ajoutait, dans un excellent article 13, qu'il fallait encore faire intervenir la dure de chaque image : une courte dure
convient au sourire amus, une dure moyenne au visage indiffrent,
une longue dure l'expression douloureuse. De l Leenhardt tirait
cette dfinition du rythme cinmatographique : Un ordre des vues
tel, et, pour chacune de ces vues ou plans , une dure telle que l'ensemble produise l'impression cherche avec le maximum d'effet. Il y
a donc une vritable mtrique cinmatographique dont l'exigence est
trs prcise et trs imprieuse. Voyant un film, essayez-vous deviner l'instant o une image ayant donn son plein, elle va, elle doit finir, tre remplace (que ce soit changement d'angle, de distance ou de
champ). Vous apprendrez connatre ce malaise la poitrine que produit une vue trop longue qui freine le mouvement ou ce dlicieux
acquiescement intime lorsqu'un plan passe exactement... (Leenhardt.) Comme il y a dans le film, outre [98] la slection des vues (ou
plans), de leur ordre et de leur dure, qui constitue le montage, une
slection des scnes ou squences, de leur ordre et de leur dure, qui
constitue le dcoupage, le film apparat comme une forme extrmement complexe l'intrieur de laquelle des actions et des ractions
extrmement nombreuses s'exercent chaque moment, dont les lois
restent dcouvrir et n'ont t jusqu'ici que devines par le flair ou le
tact du metteur en scne qui manie le langage cinmatographique
comme l'homme parlant manie la syntaxe, sans y penser expressment, et sans tre toujours en mesure de formuler les rgles qu'il observe spontanment. Ce que nous venons de dire du film visuel s'applique aussi au film sonore, qui n'est pas une somme de mots ou de
bruits, mais lui aussi une forme. Il y a un rythme du son comme de
l'image. Il y a un montage des bruits et des sons, dont Leenhardt trouvait un exemple dans un vieux film sonore Broadway Melody. Deux
acteurs sont en scne. Du haut des galeries on les entend dclamer.
Puis immdiatement, gros plan, timbre de chuchotement, on peroit
un mot qu'ils changent voix basse... La force expressive de ce
montage consiste en ce qu'il nous fait sentir la coexistence, la simultanit des vies dans le mme monde, les acteurs pour nous et pour eux13
Esprit, anne 1936.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
69
mmes, comme tout l'heure le montage visuel de Poudovkine hait
l'homme et son regard aux spectacles qui l'entourent. Comme le film
visuel n'est pas la simple photographie en mouvement d'un drame, et
comme le choix et l'assemblage des images constituent pour le cinma
un moyen d'expression original, de mme le son au cinma n'est pas la
simple reproduction [99] phonographique des bruits et des paroles,
mais comporte une certaine organisation interne que le crateur du
film doit inventer. Le vritable anctre du son cinmatographique n'est
pas le phonographe, mais le montage radiophonique.
Ce n'est pas tout. Nous venons de considrer l'image et le son tour
tour. Mais en ralit leur assemblage fait encore une fois un tout
nouveau et irrductible aux lments qui entrent dans sa composition.
Un film sonore n'est pas un film muet agrment de sons et de paroles
qui ne seraient destins qu' complter l'illusion cinmatographique.
Le lien du son et de l'image est beaucoup plus troit et l'image est
transforme par le voisinage du son. Nous nous en apercevons bien
la projection d'un film doubl o l'on fait parler des maigres avec des
voix de gras, des jeunes avec des voix de vieux, des grands avec des
voix de minuscules, ce qui est absurde, si, comme nous l'avons dit, la
voix, la silhouette et le caractre forment un tout indcomposable.
Mais l'union du son et de l'image ne se fait pas seulement dans chaque
personnage, elle se fait dans le film entier. Ce n'est pas par hasard qu'
tel moment les personnages se taisent et qu' tel autre moment ils parlent. L'alternance des paroles et du silence est mnage pour le plus
grand effet de l'image. Comme le disait Malraux (Verve, 1940), il y a
trois sortes de dialogues. D'abord le dialogue d'exposition, destin
faire connatre les circonstances de l'action dramatique. Le roman et le
cinma l'vitent d'un commun accord. Ensuite le dialogue de ton qui
nous donne l'accent de chaque personnage, et qui domine, par exemple, chez Proust, dont les personnages [100] se voient trs mal et par
contre se reconnaissent admirablement ds qu'ils commencent parler. La prodigalit ou l'avarice des mots, la plnitude ou le creux des
paroles, leur exactitude ou leur affectation font sentir l'essence d'un
personnage plus srement que beaucoup de descriptions. Il n'y a gure
de dialogue de ton au cinma, la prsence visible de l'acteur avec son
comportement propre ne s'y prte qu'exceptionnellement. Enfin il y a
un dialogue de scne, qui nous prsente le dbat et la confrontation
des personnages, c'est le principal du dialogue au cinma. Or, il est
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
70
loin d'tre constant. Au thtre on parle sans cesse, mais non au cinma. Dans les derniers films, disait Malraux, le metteur en scne passe au dialogue aprs de grandes parties de muet exactement comme
un romancier passe au dialogue aprs de grandes parties de rcit. La
rpartition des silences et du dialogue constitue donc, par del la mtrique visuelle et la mtrique sonore, une mtrique plus complexe qui
superpose ses exigences celles des deux premires. Encore faudraitil, pour tre complet, analyser le rle de la musique l'intrieur de cet
ensemble. Disons seulement qu'elle doit s'y incorporer et non pas s'y
juxtaposer. Elle ne devra donc pas servir boucher les trous sonores,
ni commenter d'une manire tout extrieure les sentiments et les
images, comme il arrive dans tant de films o l'orage de la colre dclenche l'orage des cuivres et o la musique imite laborieusement un
bruit de pas ou la chute d'une pice de monnaie sur le sol. Elle interviendra pour marquer un changement de style du film, par exemple le
passage d'une scne d'action 1' intrieur du [101] personnage,
un rappel de scnes antrieures ou la description d'un paysage ;
d'une manire gnrale elle accompagne et elle contribue raliser,
comme disait Jaubert 14, une rupture d'quilibre sensoriel . Enfin, il
ne faut pas qu'elle soit un autre moyen d'expression juxtapos l'expression visuelle, mais que par des moyens rigoureusement musicaux, rythme, forme, instrumentation, elle recre, sous la matire plastique de l'image, une matire sonore, par une mystrieuse alchimie de correspondances qui devrait tre le fondement mme du
mtier de compositeur de film ; qu'elle nous rende enfin physiquement
sensible le rythme interne de l'image sans pour cela s'efforcer d'en traduire le contenu sentimental, dramatique ou potique (Jaubert). La
parole, au cinma, n'est pas charge d'ajouter des ides aux images, ni
la musique des sentiments. L'ensemble nous dit quelque chose de trs
prcis qui n'est ni une pense, ni un rappel des sentiments de la vie.
Que signifie, que veut donc dire le film ? Chaque film raconte une
histoire, c'est--dire un certain nombre d'vnements qui mettent aux
prises des personnages et qui peuvent tre aussi raconts en prose,
comme ils le sont effectivement dans le scnario d'aprs lequel le film
est fait. Le cinma parlant, avec son dialogue souvent envahissant,
complte notre illusion. On conoit donc souvent le film comme la
14
Esprit, anne 1936.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
71
reprsentation visuelle et sonore, la reproduction aussi fidle que possible d'un [102] drame que la littrature ne pourrait voquer qu'avec
des mots et que le cinma a la bonne fortune de pouvoir photographier. Ce qui entretient l'quivoque, c'est qu'il y a en effet un ralisme
fondamental du cinma : les acteurs doivent jouer naturel, la mise en
scne doit tre aussi vraisemblable que possible car la puissance de
ralit que dgage l'cran, dit Leenhardt, est telle que la moindre stylisation dtonnerait . Mais cela ne veut pas dire que le film soit destin
nous faire voir et entendre ce que nous verrions et entendrions si
nous assistions dans la vie l'histoire qu'il nous raconte, ni d'ailleurs
nous suggrer comme une histoire difiante quelque conception gnrale de la vie. Le problme que nous rencontrons ici, l'esthtique l'a
dj rencontr propos de la posie ou du roman. Il y a toujours, dans
un roman, une ide qui peut se rsumer en quelques mots, un scnario
qui tient en quelques lignes. Il y a toujours dans un pome allusion
des choses ou des ides. Et cependant le roman pur, la posie pure
n'ont pas simplement pour fonction de nous signifier ces faits, ces
ides ou ces choses, car alors le pome pourrait se traduire exactement
en prose et le roman ne perdrait rien tre rsum. Les ides et les
faits ne sont que les matriaux de l'art et l'art du roman consiste dans
le choix de ce que l'on dit et de ce que l'on tait, dans le choix des perspectives (tel chapitre sera crit du point de vue de tel personnage, tel
autre du point de vue d'un autre), dans le tempo variable du rcit ; l'art
de la posie ne consiste pas dcrire didactiquement des choses ou
exposer des ides, mais crer une machine de langage qui, d'une
manire presque infaillible, place [103] le lecteur dans un certain tat
potique. De la mme manire, il y a toujours dans un film une histoire, et souvent une ide (par exemple, dans Ltrange sursis : la mort
n'est terrible que pour qui n'y a pas consenti), mais la fonction du film
n'est pas de nous faire connatre les faits ou l'ide. Kant dit avec profondeur que dans la connaissance l'imagination travaille au profit de
l'entendement, tandis que dans l'art l'entendement travaille au profit de
l'imagination. C'est--dire : l'ide ou les faits prosaques ne sont l que
pour donner au crateur l'occasion de leur chercher des emblmes sensibles et d'en tracer le monogramme visible et sonore. Le sens du film
est incorpor son rythme comme le sens d'un geste est immdiatement lisible dans le geste, et le film ne veut rien dire que lui-mme.
L'ide est ici rendue l'tat naissant, elle merge de la structure temporelle du film, comme dans un tableau de la coexistence de ses par-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
72
ties. C'est le bonheur de l'art de montrer comment quelque chose se
met signifier, non par allusion des ides dj formes et acquises,
mais par l'arrangement temporel ou spatial des lments. Un film signifie comme nous avons vu plus haut qu'une chose signifie : l'un et
l'autre ne parlent pas un entendement spar, mais s'adressent notre pouvoir de dchiffrer tacitement le monde ou les hommes et de
coexister avec eux. Il est vrai que, dans l'ordinaire de la vie, nous perdons de vue cette valeur esthtique de la moindre chose perue. Il est
vrai aussi que jamais dans le rel la forme perue n'est parfaite, il y a
toujours du boug, des bavures et comme un excs de matire. Le
drame cinmatographique a, pour ainsi dire, un grain [104] plus serr
que les drames de la vie relle, il se passe dans un monde plus exact
que le monde rel. Mais enfin c'est par la perception que nous pouvons comprendre la signification du cinma : le film ne se pense pas,
il se peroit.
Voil pourquoi l'expression de l'homme peut tre au cinma si saisissante : le cinma ne nous donne pas, comme le roman l'a fait longtemps, les penses de l'homme, il nous donne sa conduite ou son
comportement, il nous offre directement cette manire spciale d'tre
au monde, de traiter les choses et les autres, qui est pour nous visible
dans les gestes, le regard, la mimique, et qui dfinit avec vidence
chaque personne que nous connaissons. Si le cinma veut nous montrer un personnage qui a le vertige, il ne devra pas essayer de rendre le
paysage intrieur du vertige, comme Daquin dans Premier de Corde
et Malraux dans Sierra de Terruel ont voulu le faire. Nous sentirons
beaucoup mieux le vertige en le voyant de l'extrieur, en contemplant
ce corps dsquilibr qui se tord sur un rocher, ou cette marche vacillante qui tente de s'adapter on ne sait quel bouleversement de l'espace. Pour le cinma comme pour la psychologie moderne, le vertige, le
plaisir, la douleur, l'amour, la haine sont des conduites.
*
*
Cette psychologie et les philosophies contemporaines ont pour
commun caractre de nous prsenter, non pas, comme les philosophies classiques, l'esprit et le monde, chaque conscience et les autres,
mais la conscience jete dans le monde, soumise au regard des autres
et apprenant [105] d'eux ce qu'elle est. Une bonne part de la philosophie phnomnologique ou existentielle consiste s'tonner de cette
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
73
inhrence du moi au monde et du moi autrui, nous dcrire ce paradoxe et cette confusion, faire voir le lien du sujet et du monde, du
sujet et des autres, au lieu de lexpliquer, comme le faisaient les classiques, par quelques recours l'esprit absolu. Or, le cinma est particulirement apte faire paratre l'union de l'esprit et du corps, de l'esprit et du monde et l'expression de l'un dans l'autre. Voil pourquoi il
n'est pas surprenant que le critique puisse, propos d'un film, voquer
la philosophie. Dans un compte rendu du Dfunt rcalcitrant, Astruc
raconte le film en termes sartriens : ce mort qui survit son corps et
est oblig d'en habiter un autre, il demeure le mme pour soi, mais il
est autre pour autrui et ne saurait demeurer en repos jusqu' ce que
l'amour d'une jeune fille le reconnaisse travers sa nouvelle enveloppe et que soit rtablie la concordance du pour soi et du pour autrui.
L-dessus le Canard Enchan se fche et veut renvoyer Astruc ses
recherches philosophiques. La vrit est qu'ils ont tous deux raison :
l'un parce que l'art n'est pas fait pour exposer des ides, et l'autre
parce que la philosophie contemporaine ne consiste pas enchaner
des concepts, mais dcrire le mlange de la conscience avec le monde, son engagement dans un corps, sa coexistence avec les autres, et
que ce sujet-l est cinmatographique par excellence.
Si enfin nous nous demandons pourquoi cette philosophie s'est dveloppe justement l'ge du cinma, nous ne devrons videmment
pas dire que le cinma [106] vient d'elle. Le cinma est d'abord une
invention technique o la philosophie n'est pour rien. Mais nous ne
devrons pas dire davantage que cette philosophie vient du cinma et le
traduit sur le plan des ides. Car on peut mal user du cinma, et l'instrument technique une fois invent doit tre repris par une volont artistique et comme invent une seconde fois, avant que l'on parvienne
faire de vritables films. Si donc la philosophie et le cinma sont d'accord, si la rflexion et le travail technique vont dans le mme sens,
c'est parce que le philosophe et le cinaste ont en commun une certaine manire d'tre, une certaine vue du monde qui est celle d'une gnration. Encore une occasion de vrifier que la pense et les techniques
se correspondent et que, selon le mot de Goethe, ce qui est au dedans est aussi au dehors .
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
[107]
SENS ET NON-SENS
II
IDES
Retour la table des matires
[108]
74
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
75
[109]
SENS ET NON-SENS
II. IDES
Lexistentialisme
chez Hegel
15
Retour la table des matires
Jean Hyppolite, qui s'est fait connatre par sa traduction commente de la Phnomnologie de l'Esprit, a publi depuis une Gense et
structure de la Phnomnologie de l'Esprit, qui fera srement faire un
pas dcisif aux tudes hgliennes en France. Hegel est l'origine de
tout ce qui s'est fait de grand en philosophie depuis un sicle, par
exemple du marxisme, de Nietzsche, de la phnomnologie et de
l'existentialisme allemand, de la psychanalyse ; il inaugure la tentative pour explorer l'irrationnel et l'intgrer une raison largie qui reste la tche de notre sicle. Il est l'inventeur de cette Raison plus comprhensive que l'entendement, [110] qui, capable de respecter la varit et la singularit des psychismes, des civilisations, des mthodes de
pense, et la contingence de l'histoire, ne renonce pas cependant les
dominer pour les conduire leur propre vrit. Mais il se trouve que
les successeurs de Hegel ont insist, plutt que sur ce qu'ils lui devaient, sur ce qu'ils refusaient de son hritage. Si nous ne renonons
pas l'espoir d'une vrit, par del les prises de position divergentes,
15
propos d'une confrence de J. Hyppolite, donne sous ce titre le 16 fvrier
1947 l'Institut d'Etudes germaniques.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
76
et si, avec le sentiment le plus vif de la subjectivit, nous gardons le
vu d'un nouveau classicisme et d'une civilisation organique, il n'y a
pas, dans l'ordre de la culture, de tche plus urgente que de relier
leur origine hglienne les doctrines ingrates qui cherchent l'oublier.
C'est l qu'un langage commun pourra tre trouv pour elles et qu'une
confrontation dcisive pourra se faire. Non que Hegel soit lui-mme la
vrit que nous cherchons (il y a plusieurs Hegel et l'historien le plus
objectif est amen se demander lequel a t le plus loin), mais justement parce que dans cette seule vie et dans cette seule uvre nous
trouvons toutes nos oppositions. On pourrait dire sans paradoxe que
donner une interprtation de Hegel, c'est prendre position sur tous les
problmes philosophiques, politiques et religieux de notre sicle. La
confrence de J. Hyppolite avait l'extrme intrt d'amorcer, en ce qui
concerne l'existentialisme, cette traduction en langage hglien qui
claircirait les discussions de notre temps. Comme il est naturel, l'historien modrait chaque pas le philosophe. Puisque notre objet nous
n'est pas historique, suivons cette confrence, non pas textuellement,
mais librement, pour la discuter quelquefois et la commenter toujours.
[111]
Kierkegaard, qui a le premier employ le mot d'existence dans son
sens moderne, s'est dlibrment oppos Hegel. Le Hegel auquel il
pense, c'est celui de la fin, qui traite l'histoire comme le dveloppement visible d'une logique, qui cherche dans les rapports entre ides
l'explication dernire des vnements et chez qui l'exprience individuelle de la vie est subordonne comme un destin la vie propre des
ides. Ce Hegel de 1827 ne nous offre donc, selon le mot de Kierkegaard, qu'un palais d'ides , o toutes les oppositions de l'histoire
sont surmontes, mais par la pense seulement. Contre lui Kierkegaard a raison de dire que l'individu ne peut pas surmonter par la pense seule les contradictions devant lesquelles il se trouve, qu'il est astreint des dilemmes dont aucun terme n'est satisfaisant. Le Hegel de
la fin a tout compris, sauf sa propre situation historique ; il a tenu
compte de tout, sauf de sa propre existence, et la synthse qu'il nous
offre n'est pas une vraie synthse, justement parce qu'elle affecte
d'ignorer qu'elle est le fait d'un certain individu et d'un certain temps.
L'objection de Kierkegaard, qui, profondment, est d'accord avec
celle de Marx, consiste rappeler le philosophe la conscience de
son inhrence historique ; vous qui jugez le dveloppement du monde
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
77
et le dclarez achev dans l'tat prussien, d'o parlez-vous et comment pouvez-vous feindre de vous placer hors de toute situation ? Le
rappel la subjectivit et l'existence propre du penseur se confond
ici avec le rappel l'histoire.
Mais si le Hegel de 1827 est sujet au reproche d'idalisme, on n'en
peut dire autant du Hegel de 1807. [112] La Phnomnologie de
lEsprit n'est pas une histoire des ides seulement, c'est une histoire de
toutes les manifestations de l'esprit qui rside aussi bien dans les
murs, dans les structures conomiques, dans les institutions juridiques que dans les ouvrages de philosophie. Il s'agit de ressaisir le sens
de l'histoire totale, de dcrire le mouvement interne de la substance
sociale, et non pas d'expliquer par les dbats des philosophes les aventures de l'humanit. Le savoir absolu qui termine l'volution de l'esprit-phnomne, o la conscience s'gale enfin sa vie spontane et
reprend possession de soi, ce n'est peut-tre pas une philosophie, c'est
peut-tre une manire de vivre. La Phnomnologie de l'Esprit, c'est
la philosophie militante, non pas encore triomphante. (Et d'ailleurs,
jusque dans les Principes de la Philosophie du Droit, Hegel a clairement dit que les philosophes ne font pas l'histoire, qu'ils expriment
toujours une situation du monde acquise avant eux.) Le vrai dbat entre Marx et Hegel ne concerne pas le rapport des ides et de l'histoire,
il concerne bien plutt la conception du mouvement historique, qui
s'achve pour le Hegel de 1827 en une socit hirarchise dont le
philosophe seul pense la signification, qui s'achevait peut-tre pour
le Hegel de 1807 dans une vraie rconciliation de l'homme avec
l'homme.
Ce qui est sr en tout cas, c'est que la Phnomnologie de l'Esprit
ne cherche pas faire entrer l'histoire totale dans les cadres d'une logique prtablie, mais revivre chaque doctrine, chaque poque, et se
laisse conduire par leur logique interne avec tant d'impartialit que
tout souci de systme semble oubli. Le philosophe, dit [113] l'Introduction, ne doit pas se substituer aux expriences de l'homme ; il n'a
qu' les recueillir et les dchiffrer telles que l'histoire nous les livre.
On peut parler d'un existentialisme de Hegel en ce sens d'abord qu'il
ne se propose pas d'enchaner des concepts, mais de rvler la logique
immanente de l'exprience humaine dans tous ses secteurs. Il ne s'agit
plus seulement, comme dans la Critique de la Raison Pure thorique,
de savoir quelle condition l'exprience scientifique est possible, mais
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
78
de savoir d'une faon gnrale comment est possible l'exprience morale, esthtique, religieuse, de dcrire la situation fondamentale de
l'homme en face du monde et en face d'autrui et de comprendre les
religions, les morales, les uvres d'art, les systmes conomiques et
juridiques comme autant de manires pour l'homme de fuir les difficults de sa condition ou de leur faire face. Ici l'exprience n'est plus
seulement comme chez Kant notre contact tout contemplatif avec le
monde sensible, le mot reprend la rsonance tragique qu'il a dans le
langage commun quand un homme parle de ce qu'il a vcu. Ce n'est
plus l'exprience de laboratoire, c'est l'preuve de la vie.
Plus prcisment, il y a un existentialisme de Hegel en ce sens que
pour lui, l'homme n'est pas d'emble une conscience qui possde dans
la clart ses propres penses, mais une vie donne elle-mme qui
cherche se comprendre elle-mme. Toute la Phnomnologie de
l'Esprit dcrit cet effort que fait l'homme pour se ressaisir. chaque
ge historique, il part d'une certitude subjective, il agit selon les
indications de cette certitude et il assiste aux consquences surprenantes de sa premire [114] intention, il en dcouvre la vrit objective. Il modifie alors son projet, s'lance nouveau, reconnat encore ce
qu'il y avait d'abstrait dans le nouveau projet, jusqu' ce que la certitude subjective soit enfin gale la vrit objective et qu'il devienne
consciemment ce qu'il tait confusment. Tant que cette extrmit de
l'histoire n'est pas atteinte, et au cas o elle le serait, l'homme,
n'ayant plus de mouvement, serait comme un animal, l'homme se
dfinit, par opposition au caillou qui est-ce quil est, comme le heu
d'une inquitude (Unruhe), comme un effort constant pour se rejoindre et en consquence par le refus de se limiter l'une quelconque de
ses dterminations. La conscience... est donc immdiatement l'acte
d'outrepasser le limit, et, quand ce limit lui appartient, l'acte de s'outrepasser soi-mme... La conscience subit donc cette violence venant
d'elle-mme, violence par laquelle elle se gte toute satisfaction limite. Dans le sentiment de cette violence, l'angoisse peut bien reculer
devant la vrit, aspirer et tendre conserver cela mme dont la perte
menace, mais cette angoisse ne peut s'apaiser : en vain elle veut se
fixer dans une inertie sans pense... 16. Quels que soient les rapports
constatmes de la conscience avec le corps et avec le cerveau, toutes
16
Phnomnologie de lEsprit, Introduction, p. 71, de la traduction Hyppolite.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
79
les dcouvertes de la phrnologie ne peuvent pas faire que la conscience soit un os, car un os est encore une chose ou un tre, et si le
monde n'tait fait que [115] de choses ou d'tres il n'y aurait pas, mme titre d'apparence, ce que nous appelons un homme, c'est--dire
un tre qui n'est pas, qui nie les choses, une existence sans essence.
L'ide est banale aujourd'hui. Elle reprend sa force si on l'applique,
comme fait Hegel, aux rapports de la vie et de la conscience que nous
en prenons. Bien entendu, tout ce que nous disons de la vie concerne
en ralit la conscience de la vie, puisque nous qui en parlons sommes
conscients. Cependant, la conscience ressaisit comme sa propre limite
et sa propre origine ce que pourrait tre la vie avant elle. Ce serait une
force qui se disperse partout o elle agit. Ce serait un meurs et deviens qui ne se saisirait pas mme comme tel. Pour qu'il y ait conscience de la vie, il faut qu'il y ait rupture avec cette dispersion, il faut
qu'elle se totalise et s'aperoive, et cela par principe est impossible la
vie elle-mme. Il faut que vienne au monde une absence d'tre d'o
l'tre sera visible, un nant. De sorte que la conscience de la vie est
radicalement conscience de la mort. Mme les doctrines qui voudront
nous enfermer dans nos particularits raciales ou locales et nous masquer notre humanit ne peuvent le faire, puisque ce sont des doctrines
et des propagandes, que parce qu'elles ont quitt la vie immdiate, que
par un emprunt honteux la conscience de la mort. Ce qu'il faut reprocher aux idologies nazies, ce n'est pas d'avoir rappel l'homme au
tragique, c'est d'avoir utilis le tragique et le vertige de la mort pour
rendre un semblant de force des instincts pr-humains. C'est en
somme d'avoir masqu la conscience de la mort. Avoir conscience de
la mort [116] et penser ou raisonner, c'est tout un, puisqu'on ne pense
qu'en quittant les particularits de la vie, et donc en concevant la mort.
On ne fera pas que l'homme ignore la mort. On ne l'obtiendrait
qu'en le ramenant l'animalit ; encore serait-il un mauvais animal,
s'il gardait conscience, puisque la conscience suppose le pouvoir de
prendre recul l'gard de toute chose donne et de la nier. C'est l'animal qui peut paisiblement se satisfaire de la vie et chercher son salut
dans la reproduction. L'homme ne peut accder l'universel que parce
qu'il existe au lieu de vivre seulement. Il doit payer de ce prix son
humanit. C'est pourquoi l'ide de l'homme sain est un mythe, proche
parent des mythes nazis. L'homme, c'est l'animal malade , disait
Hegel dans un texte ancien de la Realphilosophie publi par Hoff-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
80
meister. La vie n'est pensable que comme offerte une conscience de
la vie qui la nie.
Toute conscience est donc malheureuse, puisqu'elle se sait vie seconde et regrette l'innocence d'o elle se sent issue. La mission historique du judasme a t de dvelopper dans le monde entier cette
conscience de la sparation et, comme Hyppolite le disait pendant la
guerre ses lves, nous sommes tous des juifs dans la mesure o
nous avons le souci de l'universel, o nous ne nous rsignons pas
tre seulement, et o nous voulons exister.
Mais la conscience de la mort n'est pas une impasse et un terme. Il
y a deux mditations de la mort. L'une, pathtique et complaisante, qui
bute sur notre fin et ne cherche en elle que le moyen d'exasprer la
violence, [117] l'autre, sche et rsolue, qui assume la mort, en fait
une conscience plus aigu de la vie. Le jeune Hegel parlait plus volontiers de la mort. Hegel vieilli prfrera parler de la ngativit. Le Hegel de la Phnomnologie juxtapose le vocabulaire logique et le vocabulaire pathtique, et nous fait comprendre la fonction qu'exerce la
conscience de la mort dans l'avnement de l'humanit. La mort est la
ngation de tout tre particulier donn, la conscience de la mort est
synonyme de conscience de l'universel, mais tant qu'on en reste l, il
ne s'agit que d'un universel vide ou abstrait. En fait, nous ne pouvons
concevoir le nant que sur un fond d'tre (ou, comme dit Sartre, sur
fond de monde). Toute notion de la mort qui prtendrait retenir notre
attention est donc menteuse, puisqu'en fait elle utilise subrepticement
notre conscience de l'tre. Pour aller jusqu'au bout de notre conscience
de la mort, il faut donc la transmuer en vie, il faut, comme dit Hegel,
intrioriser la mort. Il faut rendre concret l'universel abstrait qui s'est
d'abord oppos la vie. Il n'y a d'tre que pour un nant, mais il n'y a
de nant qu'au creux de l'tre. Il y a donc dans la conscience de la
mort de quoi la dpasser.
La seule exprience qui me rapproche d'une conscience authentique de la mort, c'est l'exprience d'autrui, puisque sous son regard je
ne suis qu'une chose, comme il n'est qu'un morceau du monde sous
mon propre regard. Chaque conscience poursuit donc la mort de l'autre par qui elle se sent dpossde de son nant constitutif. Mais je ne
me sens menac par autrui que si, dans le moment mme o son regard me rduit en [118] objet, je continue d'prouver ma subjectivit ;
je ne le rduis en esclavage que si, dans le moment mme o je le re-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
81
garde comme un objet, il me reste prsent comme conscience et comme libert. La conscience du conflit n'est possible que par celle d'une
relation rciproque et d'une humanit qui nous est commune. Nous ne
nous nions l'un l'autre qu'en nous reconnaissant l'un l'autre comme
consciences. Cette ngation de toute chose et d'autrui que je suis ne
s'accomplit qu'en se redoublant d'une ngation de moi par autrui. Et de
mme que la conscience de moi-mme comme mort et nant est menteuse et renferme l'affirmation de ma vie et de mon tre, de mme ma
conscience d'autrui comme ennemi renferme l'affirmation d'autrui
comme gal. Si je suis ngation, en suivant jusqu'au bout ce qu'implique cette ngation universelle, je la vois se nier elle-mme et se transformer en coexistence. Je ne puis tre libre seul, conscience seul,
homme seul, et cet autre en qui je voyais d'abord mon rival, il n'est
mon rival que parce qu'il est moi-mme. Je me trouve en autrui, comme je trouve la conscience de la vie dans la conscience de la mort.
Parce que je suis depuis l'origine ce mlange de vie et de mort, de solitude et de communication qui va vers sa rsolution.
Comme la conscience de la mort se dpasse, la matrise, le sadisme
ou la violence se dtruisent. Dans le duel des consciences ou des frres ennemis, si chacun russissait blesser l'autre mort, il n'y aurait
plus rien, il n'y aurait plus mme place pour cette haine d'autrui et cette affirmation de soi qui est le principe de la lutte. Celui qui prend de
la situation humaine la [119] conscience la plus exacte, ce n'est donc
pas le matre, puisqu'il feint d'ignorer le fond d'tre et de communication sur lequel jouent son dsespoir et son orgueil ; c'est l'esclave qui a
vraiment eu peur, qui a renonc vaincre par les armes, et qui seul a
l'exprience de la mort parce qu'il a seul l'amour de la vie. Le matre
veut n'tre que pour soi, mais en fait, il cherche tre reconnu matre
par quelqu'un ; il est donc faible dans sa force ; l'esclave consent
n'tre que pour autrui, mais c'est encore lui qui veut garder sa vie ce
prix ; il y a donc une force dans sa faiblesse. Parce qu'il a mieux
connu que le matre les assises vitales de l'homme, c'est lui qui finalement ralisera la seule matrise possible : non pas aux dpens d'autrui, mais aux dpens de la nature. Plus franchement que le matre, il a
tabli sa vie dans le monde, et c'est justement pourquoi il sait mieux
que le matre ce que signifie la mort : la fluidification de tout ce qui
tait fixe , l'angoisse, il en a vraiment l'exprience. Par lui, l'existence
humaine, qui tait risque et culpabilit, devient histoire, et les dci-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
82
sions successives de l'homme pourront se concentrer en un acte unique par lequel la conscience se rejoint et, comme on voudra dire, Dieu
se fait homme ou l'homme se fait Dieu.
C'est ici que la pense de Hegel quitte son pessimisme initial. La
vrit de la mort et de la lutte, c'est la longue maturation par laquelle
l'histoire surmonte ses contradictions pour raliser dans le rapport vivant des hommes la promesse d'humanit qui paraissait dans la conscience de la mort et dans la lutte avec l'autre. C'est ici aussi, ajoute
Hyppolite, que Hegel cesse d'tre [120] existentialiste. Tandis que
chez Heidegger, nous sommes pour la mort et la conscience de la mort
demeure le fondement de la philosophie comme de la conduite, Hegel
transmue la mort en vie suprieure. Il passe donc de l'individu l'histoire, tandis que les contradictions du Pour Soi et du Pour Autrui sont
pour Sartre sans remde et que chez lui la dialectique est tronque. En
ce sens, on pourrait dire que la Phnomnologie de lEsprit rend possible une philosophie communiste du parti ou une philosophie de
l'tat, plutt qu'une philosophie de l'individu comme celle de l'existentialisme. Il est vrai, ajoute encore Hyppolite, que l'existentialisme
peut tre compris autrement. Cette dernire indication nous parat la
plus juste, car il est remarquer que, mme chez Heidegger, la conscience de la mort n'est pas la vie authentique, la seule attitude qui ne
soit pas menteuse est celle qui assume aussi le fait de notre existence.
La dcision rsolue est l'acceptation de la mort, mais indivisiblement
la dcision de vivre et de reprendre en mains notre existence fortuite.
Quant l'existence d'autrui et l'historicit qui en rsulte, elle n'est
pas nie par Heidegger. On parat oublier que la dernire partie de
Sein und Zeit est consacre la notion d'histoire. On pourrait mme
dire que ce qui manque dans Heidegger, ce n'est pas l'historicit, c'est,
au contraire, l'affirmation de l'individu : il ne parle pas de cette lutte
des consciences et de cette opposition des liberts sans lesquelles la
coexistence tombe l'anonymat et la banalit quotidienne. Il est encore plus certain que les existentialistes franais ne se sont pas attards dans la conscience de la mort. Ma mort n'arrte ma [121] vie
qu'une fois que je suis mort, et pour le regard d'autrui. Mais, pour moi
vivant, ma mort n'est pas ; mon projet la traverse sans rencontrer
d'obstacles. Il n'existe aucune barrire contre laquelle ma transcendance vienne buter en plein lan ; elle meurt d'elle-mme, comme la mer
qui vient battre une plage lisse, et qui s'arrte et ne va pas plus
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
83
loin 17. Je vis donc, non pour mourir, mais jamais, et de la mme
faon, non pour moi seul, mais avec les autres. Plus compltement que
par l'angoisse ou par les contradictions de la condition humaine, ce
qu'on appelle l'existentialisme se dfinirait peut-tre par l'ide d'une
universalit que les hommes affirment ou impliquent du seul fait qu'ils
sont et au moment mme o ils s'opposent, d'une raison immanente
la draison, d'une libert qui devient ce qu'elle est en se donnant des
liens, et dont la moindre perception, le moindre mouvement du cur,
la moindre action sont les tmoignages incontestables.
[122]
17
Simone de Beauvoir. Pyrrhus et Cinas, p. 61.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
84
[123]
SENS ET NON-SENS
II. IDES
La querelle de
lexistentialisme
Retour la table des matires
Voil deux ans que L'tre et le Nant de Jean-Paul Sartre a t publi. Sur ce livre de 700 pages, un grand silence s'est d'abord tabli.
Les critiques tournaient-ils leur plume dans leur encrier ? Respectaient-ils l'union sacre jusqu'en philosophie ? Attendaient-ils qu'une
discussion libre ft de nouveau possible ? Toujours est-il que le silence est maintenant rompu. gauche, les hebdomadaires et les revues
sont assaillis d'articles critiques qu'ils publient ou ne publient pas.
droite les anathmes se multiplient. Les jeunes filles dans les collges
sont mises en garde contre l'existentialisme comme contre le pch du
sicle. La Croix du 3 juin parle d'un danger plus grave que le rationalisme du XVIIIe sicle et le positivisme du XIXe sicle . Il est remarquable que, presque toujours, on remet plus tard la discussion
sur le fond. Les critiques prennent la forme d'avertissements aux fidles, l'ouvrage de Sartre est dsign comme un poison dont [124] il faut
se garder, plutt que comme une philosophie discuter ; on le
condamne sur ses consquences horribles plutt que sur sa fausset
intrinsque. On va au plus press, et le plus press est d'tablir un cordon sanitaire. Ce n'est pas une preuve de force, dans les doctrines tablies, que de se refuser la discussion. S'il est vrai que beaucoup de
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
85
jeunes gens accueillent avec faveur la nouvelle philosophie, il faudrait
pour les convaincre autre chose que ces critiques hargneuses qui ignorent dlibrment la question pose par l'ouvrage de Sartre. Cette
question est celle du rapport entre l'homme et son entourage naturel
ou social. Il y a l-dessus deux vues classiques. L'une consiste traiter
l'homme comme le rsultat des influences physiques, physiologiques
et sociologiques qui le dtermineraient du dehors et feraient de lui une
chose entre les choses. L'autre consiste reconnatre dans l'homme, en
tant qu'il est esprit et construit la reprsentation des causes mmes qui
sont censes agir sur lui, une libert acosmique. D'un ct l'homme est
une partie du monde, de l'autre il est conscience constituante du monde. Aucune de ces deux vues n'est satisfaisante. la premire on opposera toujours aprs Descartes que, si l'homme tait une chose entre
les choses, il ne saurait en connatre aucune, puisqu'il serait, comme
cette chaise ou comme cette table, enferm dans ses limites, prsent
en un certain lieu de l'espace et donc incapable de se les reprsenter
tous. Il faut lui reconnatre une manire d'tre trs particulire, l'tre
intentionnel, qui consiste viser toutes choses et ne demeurer en
aucune. Mais si l'on voulait conclure de l que, par notre fond, nous
sommes esprit [125] absolu, on rendrait incomprhensibles nos attaches corporelles et sociales, notre insertion dans le monde, on renoncerait penser la condition humaine. Le mrite de la philosophie nouvelle est justement de chercher dans la notion d'existence le moyen de
la penser. L'existence au sens moderne, c'est le mouvement par lequel
l'homme est au monde, s'engage dans une situation physique et sociale
qui devient son point de vue sur le monde. Tout engagement est ambigu, puisqu'il est la fois l'affirmation et la restriction d'une libert :
je m'engage rendre ce service, cela veut dire la fois que je pourrais
ne pas le rendre et que je dcide d'exclure cette possibilit. De mme
mon engagement dans la nature et dans l'histoire est la fois une limitation de mes vues sur le monde et ma seule manire d'y accder, de
connatre et de faire quelque chose. Le rapport du sujet et de l'objet
n'est plus ce rapport de connaissance dont parlait l'idalisme classique
et dans lequel l'objet apparat toujours comme construit par le sujet,
mais un rapport d'tre selon lequel paradoxalement le sujet est son
corps, son monde et sa situation, et, en quelque sorte, s'change.
Nous ne disons pas que ce paradoxe de la conscience et de l'action
soit, dans l'Etre et le Nant, entirement lucid. notre sens, le livre
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
86
reste trop exclusivement antithtique : l'antithse de ma vue sur moimme et de la vue d'autrui sur moi, l'antithse du pour soi et de l'en
soi font souvent figure d'alternatives, au lieu d'tre dcrites comme le
lien vivant de l'un des termes l'autre et comme leur communication.
En ce qui concerne le sujet et la libert, il est visible que l'auteur [126]
cherche d'abord les prsenter hors de tout compromis avec les choses, et qu'il se rserve d'tudier ailleurs la ralisation du nant dans
l'tre qui est l'action et qui rend possible la morale. LEtre et le Nant
montre d'abord que le sujet est libert, absence, ngativit, et qu'en ce
sens le nant est. Mais cela veut dire aussi que le sujet n'est que nant,
qu'il a besoin d'tre port dans l'tre, qu'il n'est pensable que sur le
fond du monde, et enfin qu'il se nourrit de l'tre comme les ombres,
dans Homre, se nourrissent du sang des vivants. Nous pouvons donc
attendre, aprs lEtre et le Nant, toutes sortes d'claircissements et de
complments. Mais ce qu'on ne peut nier, c'est que les descriptions de
Sartre posent d'une manire aigu et avec une profondeur nouvelle le
problme central de la philosophie tel qu'il se prsente aprs les acquisitions des derniers sicles. Aprs Descartes, on ne peut nier que
l'existence comme conscience se distingue radicalement de l'existence
comme chose et que le rapport de l'une l'autre soit celui du vide au
plein. Aprs le XIXe sicle et tout ce qu'il nous a appris sur l'historicit
de l'esprit, on ne peut nier que la conscience soit toujours en situation.
C'est nous de comprendre les deux choses la fois. Ni pour un catholique, ni pour un marxiste la solution ne peut consister reprendre
simplement l'une des deux conceptions classiques. C'est impossible en
soi, c'est impossible mme selon la logique interne du christianisme et
du marxisme.
[127]
C'est d'abord l'intuition de l'en soi que les critiques catholiques rejettent. Nous sommes au monde, c'est--dire : nos penses, nos passions, nos inquitudes tournent autour des choses perues. Toute
conscience est conscience de quelque chose, le mouvement vers les
choses nous est essentiel et la conscience cherche en elles comme une
stabilit qui lui manque. Nous nous connaissons partir de nos actions, de l'entourage que nous nous sommes donn, et chacun de nous
est pour lui-mme un inconnu auquel les choses tendent leur miroir. Il
est donc essentiel au sujet d'apercevoir l'objet comme plus vieux que
lui, il se sent apparatre dans un monde qui n'tait pas fait pour lui, qui
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
87
aurait t plus parfait sans lui. Bien entendu cela n'est pas vrai la
rigueur, puisque la rflexion montre que l'tre sans aucun tmoin est
inconcevable. Mais telle est bien notre situation de dpart : nous nous
sentons le corrlatif indispensable d'un tre qui cependant repose en
soi. Telle est la contradiction qui nous lie l'objet. Nous ne pouvons
nous empcher d'envier cette plnitude de la nature, des moissons qui
poussent, des saisons qui se succdent selon leur loi perptuelle. En
regard de cet ordre , l'homme est celui qui n'est jamais achev, et
comme un dfaut dans la paix du monde. Ne rejoint-on pas par l, se
demande M. Gabriel Marcel 18, les conceptions piphnomnistes
pour lesquelles la conscience est lie une adaptation imparfaite ?
Et il parle ailleurs du fond crment matrialiste de la doctrine 19.
Est-ce donc tre matrialiste [128] que de donner tout son sens au mot
d'tre ? Une religion qui affirme l'incarnation de Dieu et la rsurrection des corps peut-elle s'tonner que la conscience, dans tous les sens
du mot, tienne au monde et que l'tre du monde lui apparaisse toujours
comme le type mme de l'tre ?
Les critiques catholiques refusent corrlativement l'intuition du sujet comme nant. Puisqu'elle nous distingue radicalement des choses
et nous arrache au repos qui les dfinit, la libert, pense Sartre, est
exactement un rien, un rien qui est tout. Elle est comme une maldiction et en mme temps la source de toute grandeur humaine. Elle
sera indivisiblement principe du chaos et principe de l'ordre humain.
Si le sujet, pour pouvoir tre sujet, doit se retrancher de l'ordre des
choses, il n'y aura dans l'homme aucun tat de conscience , aucun
sentiment qui ne participe cette libert dvorante et qui soit purement et simplement ce qu'il est, la manire des choses. De l une
analyse des conduites qui les montre toutes ambigus. La mauvaise
foi, l'inauthenticit sont essentielles l'homme parce qu'elles sont inscrites dans la structure intentionnelle de la conscience, la fois prsence soi et prsence aux choses. La volont mme d'tre bon falsifie la bont, puisqu'elle nous tourne vers nous-mmes au moment o il
faudrait nous tourner vers autrui. La dcision mme de respecter autrui ramne l'gosme, puisque c'est encore ma gnrosit qu'autrui
doit d'tre reconnu par moi, et que je m'en sais gr. Donner, c'est
18
19
Gabriel Marcel. Homo viator, p. 249.
Ibid., p. 248.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
88
asservir. Il n'y a donc rien dans l'homme qui soit pur, pas un seul
acte dont nous puissions nous satisfaire et o la [129] belle me ou la
bonne conscience puissent trouver les consolations ou l'assurance
qu'elles aiment. Ces propositions pessimistes comportent une rciproque optimiste : en tant que la libert dsintgre la nature, il n'y a pas
un seul acte humain, pas une seule passion qui n'atteste l'humanit de
l'homme. Pas un seul amour qui soit simple mcanisme corporel, qui
ne prouve, mme et surtout s'il s'attache follement son objet, notre
pouvoir de nous mettre en question, de nous vouer absolument, notre
signification mtaphysique. Le principe du bien et le principe du mal
sont donc un seul principe. La misre de l'homme est visible dans sa
grandeur et sa grandeur dans sa misre. Dans la philosophie de Sartre,
crit un autre critique 20 on a d'abord teint l'esprit . C'est tout le
contraire : on l'a mis partout, parce que nous ne sommes pas esprit et
corps, conscience en face du monde, mais esprit incarn, tre-aumonde.
Au fond, on voit bien ce que voudraient les critiques catholiques.
S'ils rcusent ensemble l'intuition d'un tre inerte et celle d'une agile
libert, c'est qu'ils voudraient que les choses fussent capables de dire
la gloire de Dieu et que l'homme et un destin comme une chose.
Mais ici c'est d'abord Pascal qu'ils se heurtent. Le silence ternel
de ces espaces infinis m'effraye , entendons : il y a quelque chose
d'horrible, de repoussant et d'irrcusable dans ces choses qui sont simplement et ne veulent rien dire. Rien n'arrte la volubilit de notre
esprit , entendons : l'esprit est ce qui ne saurait se reposer [130] nulle
part, en aucune preuve, en aucun destin prtabli, en aucun pharisasme. Avec Pascal, c'est la tradition cartsienne que les catholiques dsavouent, la distinction de la res extenso, de la chose sans esprit, et de
l'existence comme conscience, de l'esprit sans secours naturel. Malebranche parlait d'une premire gloire de Dieu, qui lui vient de la perfection des choses, et distinguait cette gloire de l'architecte de celle que Dieu obtient par le libre sacrifice des hommes, quand ils le reconnaissent, lui rendent le monde, et apportent la Cration comme
un concours indispensable. C'tait distinguer en termes clatants le
Dieu des choses et le Dieu des hommes, c'tait dire que l'ordre humain
commence avec la libert. Dans cette perspective, on aperoit le fond
20
J. MERCIER. Le Ver dans le Fruit, Etudes, fvrier 1945, p. 240.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
89
du dbat : ce n'est pas ici le christianisme et le matrialisme qui se
heurtent, c'est Aristote et Descartes, ou c'est saint Thomas et Pascal.
Les critiques catholiques voudraient qu'une orientation du monde vers
Dieu ft lisible dans les choses, et que l'homme comme les choses ne
ft rien d'autre qu'une nature qui va vers sa perfection. Ils voudraient
mettre de l'esprit dans les choses et faire de l'esprit humain une chose.
M. Gabriel Marcel fait appel au sens commun et une certaine
sagesse sculaire pour localiser dans certains actes privilgis cette
inquitante libert qui pntre partout. Encore notre libert ne consistera-t-elle qu' nous replacer sous une loi qui nous habite dj, accomplir en acte ce que nous sommes en puissance : M. Marcel parle
avec faveur d'une morale naturelle , d'une certaine confiance, la
fois spontane et mtaphysique, dans l'ordre o s'insre notre existence , d'un lien nuptial [131] entre l'homme et la vie , enfin d'une
pit non pas chrtienne, mais prchrtienne ou plus exactement prichrtienne 21. C'est donc bien l'ide, elle-mme prchrtienne,
d'une finalit naturelle de l'homme qui soutient sa critique de L'Etre et
le Nant. De mme chez Mme J. Mercier, c'est l'ide aristotlicienne
d'un Bien identique l'tre qui motive toute la polmique contre le
nant sartrien et le reproche d'avoir dcompos les vertus en y glissant
la libert. Il y a une pit cartsienne et pascalienne, laquelle nous
devons les plus profondes descriptions de l'homme comme monstre
incomprhensible et contradictoire, sans autre nature que les vieilles
coutumes qu'il s'est donnes, comme grand par sa misre et misrable
par sa grandeur. De cette philosophie-l, les critiques catholiques ne
veulent plus. Ils lui prfrent l'ide aristotlicienne d'un homme ordonn sa fin comme la plante la forme de la plante. On demande
de quel ct est le matrialisme . S'il faut tout dire, peut-tre aprs
tout ont-ils raison. Peut-tre le christianisme ne peut-il se maintenir
comme thologie que sur une base thomiste, peut-tre la conception
pascalienne de l'tre comme chose aveugle et de l'esprit comme volubilit ne laisse-t-elle place qu' une action mystique sans aucun contenu dogmatique et qu' une foi qui n'est foi aucun tre, comme celle
de Kierkegaard ; peut-tre finalement la religion du Dieu fait homme
aboutit-elle par une dialectique invitable une anthropologie et non
pas une thologie. [132] Sartre disait que la conscience qui, par le
mouvement constant de l'intentionnalit, tend tre comme une chose
21
Homo viator, pp. 225-226.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
90
sans jamais y parvenir, semblait tmoigner d'une synthse idale entre
elle-mme et l'tre, non que l'intgration ait jamais eu lieu, mais
prcisment au contraire parce qu'elle est toujours indique et toujours
impossible . Absurdit pure, rpond M. Gabriel Marcel : Comment
en effet pourrait-il y avoir dsintgration relle de quelque chose qui
n'aurait jamais t rellement intgr ? . Mais quand, quelques lignes
plus bas, M. Marcel donne sa propre solution, elle consiste dire que
la conscience est amene, en rflchissant sur soi, se regarder ellemme comme dgrade, sans qu'il lui soit d'ailleurs possible de penser
concrtement le monde d'avant la chute 22. Or si, pour M. Marcel
comme pour Sartre, l'intgration originelle est impensable, elle ne
peut tre affirme que par un acte de foi sans contenu notionnel, et les
deux conclusions ne se distinguent en somme que parce que M. Marcel, au lieu de constater la dialectique du pour soi et de l'en soi, la dclare intolrable et veut passer outre par l'action. Encore cette dmarche n'est-elle pas interdite dans la perspective de Sartre, elle pourrait
mme y tre le principe de la morale. Tout ceci ne fait ni une preuve,
ni mme une affirmation de Dieu, mais une affirmation de l'homme.
Si l'on veut retenir le christianisme sur cette pente, c'est le point de
dpart qu'il faut refuser et la notion mme de l'esprit comme ngativit.
[133]
Mais un chrtien peut-il le faire ? Car enfin, mme si la libert,
comme le veulent les thomistes, consiste pour l'homme raliser sa
nature prtablie et sa forme, on est bien oblig d'admettre que cette
ralisation est chez l'homme facultative, qu'elle dpend de lui, et d'introduire ainsi une seconde libert, radicale celle-l, qui consiste dans
le pouvoir absolu de dire oui ou non. Ds lors tout ce qu'on avait pu
faire pour ramener la libert humaine sous une prordination divine se
trouve remis en question. Si je peux dire oui ou non ma destine,
c'est que le Bien n'est pas mon bien sans mon assentiment, qu'il n'y a
pas de valeur en soi, et que, comme le pensait Descartes, la libert de
l'homme est en un sens gale celle de Dieu. Le thomisme l-dessus
est bien loin d'tre la seule tradition chrtienne. Au temps de
lAugustinus, il tait mme quelque peu suspect, et les jsuites maintenaient ferme le pouvoir absolu de choisir en dpit de la prescience
22
Homo viator, p. 254. 132
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
91
divine. La question est de savoir si l'on peut faire la libert sa part et
lui donner quelque chose sans lui donner tout. Nous avons dit plus
haut que L'Etre et le Nant sur ce point nous parat appeler une suite
et qu'on attend de l'auteur une thorie de la passivit. Mais ce qui est
sr, c'est que le livre met cette question en pleine lumire et qu'on ne
peut le dpasser qu'en la comprenant d'abord. Quand la critique catholique ignore le problme, elle se place dlibrment au-dessous du
niveau o elle s'tablissait sans crainte il y a trois sicles, peut-tre
parce qu'on hsitait moins affronter des difficults [134] fondamentales dans un temps o la croyance allait de soi.
*
*
Tandis que les catholiques accusent Sartre de matrialisme, un
marxiste comme H. Lefebvre 23 n'est pas loin de lui reprocher un reste
d'idalisme. C'est dj trop, selon Lefebvre, de s'attarder dcrire
l'tre et fonder l'existence d'autrui. Ces vrits ne sont neuves que
pour une conscience longtemps enferme dans sa solitude. Oubliant
que, selon Engels, la grande question fondamentale de toute philosophie, et spcialement de la philosophie moderne, est celle des rapports de la pense l'tre 24, Lefebvre propose d' admettre immdiatement ce que Sartre redcouvre. En montrant que les problmes
de Sartre ont un sens pour le chrtien, n'avons-nous pas prouv qu'ils
n'en ont aucun pour le marxiste, et, si l'on justifie Sartre devant G.
Marcel, ne le condamne-t-on pas devant Lefebvre ?
Il y a, c'est certain, un marxisme qui se place d'emble, au-del des
problmes de Sartre, c'est celui qui nie absolument l'intrieur, qui traite la conscience comme une partie du monde, un reflet de l'objet, un
sous-produit de l'tre, et enfin, pour parler un langage qui n'a jamais
t marxiste, comme un piphnomne. Il y a, chez les plus grands
crivains marxistes, des formules qui vont dans ce sens. Quand Engels
crit que l'on doit considrer les ides comme les reflets intellectuels
des objets et des mouvements du monde [135] rel 25, quand il demande qu'on rtablisse les vritables relations entre le monde rel et
23
24
25
Existentialisme et Marxisme, Action , 8 juin 1945.
Ludwig Feuerbach, ditions Sociales, 1945, p. 13.
Socialisme utopique et socialisme scientifique. ditions du Parti communiste, 1944,
p. 13.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
92
les ides produites par le cerveau humain, qui, aprs tout, n'est luimme qu'un produit de ce monde rel 26, quand Lnine crit que le
tableau du monde est un tableau qui montre comment la matire se
meut et comment la matire pense 27 ou que le cerveau est l'organe
de la pense 28, on convient qu'il est difficile de jeter un pont entre
ces formules et le cogito cartsien. Mais il faut ajouter que la plupart
des marxistes les tiennent pour insuffisantes. Ils y trouvent bon droit
l'expression d'une philosophie mtaphysique, qui rattache tous les
phnomnes une seule substance, la matire, et non pas celle d'une
philosophie dialectique qui admet ncessairement des relations rciproques entre les diffrents ordres de phnomnes et l'mergence de
relations ou de structures originales sur la base des phnomnes matriels.
Si l'on veut exclure, au nom du marxisme, les problmes et jusqu'
la notion de la subjectivit, ce n'est pas sur ces restes de matrialisme
mtaphysique qu'il faut s'appuyer. En revanche, il y a dans le marxisme une raison beaucoup plus profonde de sortir du sujet et de se placer dans l'objet et dans l'histoire. C'est cette ide que nous n'avons pas
le choix, que nous sommes [136] de part en part historiques, et sans
rserve jets dans le monde, que la rfrence exclusive l'intrieur,
quelles qu'en soient les justifications subjectives, est objectivement
une abstention et une manire d'luder les tches concrtes du dehors,
en un mot que nous sommes engags. Il serait conforme au plus pur
marxisme de dire que toute philosophie est idaliste, puisqu'elle suppose toujours rflexion, c'est--dire rupture avec l'immdiat, mais que
l est la condamnation de la philosophie. Elle est un cas particulier de
l'alination, un moyen de fuir au-del, un refus d'tre, une angoisse
devant la rvolution, une maladie de la conscience bourgeoise. Le philosophe qui prend conscience de lui-mme comme nant et comme
libert donne la formule idologique de son temps, il traduit en
concepts cette phase de l'histoire o l'essence et l'existence de l'homme sont encore disjointes, o l'homme n'est pas lui-mme parce qu'il
est enlis dans les contradictions du capitalisme. L'ide mme d'une
philosophie spculative, qui chercherait saisir une essence ternelle
26
27
28
Ibid.
uvres. Edition russe, t. XIII, p. 288.
Ibid., p. 125.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
93
de l'homme et du monde, atteste chez le philosophe au-dessous des
ides, le refus existentiel de travailler la transformation du monde,
l'angoisse devant la vraie humanit qui se fait par le travail et par la
praxis et qui ne se dfinit pas pour toujours. La seule manire d'obtenir ce que la philosophie veut obtenir, une saisie complte du monde, c'est de nous joindre l'histoire au lieu de la contempler.
Comme le dit Marx dans un texte clbre, la seule manire de raliser
la philosophie est de la dtruire.
L'argument le plus fort du marxisme contre une [137] philosophie
du sujet est donc un argument existentiel . Il revient dire que toute philosophie comme rflexion est inadquate ce qu'elle veut saisir,
l'existence de l'homme, parce qu'elle est dj une certaine manire
d'exister l'cart du monde et de l'histoire. Les philosophes, dit
Marx, n'ont fait qu'interprter le monde de diffrentes manires, mais
il s'agit de le transformer 29. De mme M. Gabriel Marcel reproche
Sartre de s'enfermer dans le cercle infernal de l'tre et du nant. Il
n'y aurait gure de sens, ajoute-t-il, allguer que ce sont les donnes
de fait ou les conditions structurales de notre existence qui l'y contraignent. La seule et authentique transcendance (mieux vaudrait sans
doute dire : le seul et authentique transcendeur) n'est-elle pas l'acte par
lequel, nous dgageant de ces donnes et de ces conditions, nous leur
substituons des donnes et des conditions renouveles ? 30. C'est
donc bien de part et d'autre le mme appel l'action comme moyen de
dpasser les oppositions dialectiques ( ceci prs que Marx ne prtend
pas rejoindre par la praxis terrestre une synthse dj faite dans le ciel
et place cette synthse dans notre avenir au lieu de la mettre hors du
temps). Ici se rejoignent les deux moitis de la postrit hglienne :
Kierkegaard et Marx. Mais le rapprochement mme montre assez que
la praxis marxiste, si elle veut se distinguer d'une action mystique ou
d'un pragmatisme, doit s'clairer elle-mme sur ses fins et sur ses
moyens. C'est bien de nous inviter [138] tre ce que nous sommes,
rejoindre consciemment le mouvement de l'histoire o nous sommes
engags de toutes faons : encore faut-il savoir quel est ce mouvement
de l'histoire, sur qui nous pouvons compter pour l'accomplir avec
nous, encore faut-il savoir que faire. Or, ds qu'on pose ces questions,
29
30
XIe Thse sur Feuerbach.
Homo viator, p. 255.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
94
on invite l'individu comprendre et dcider, on lui remet, en fin de
compte, le gouvernement de sa vie, on convient que l'histoire aura
pour lui le sens qu'il lui aura reconnu. Tout homme, mme marxiste,
est bien oblig de convenir avec Descartes que, si nous connaissons
quelque ralit extrieure, c'est condition de saisir en nous-mmes
cette opration de connaissance, qu'aucun en soi ne nous serait accessible s'il n'tait au mme moment pour nous et qu'enfin le sens que
nous lui trouvons dpend de notre assentiment. Aucun homme ne peut
refuser le cogito et nier la conscience, sous peine de ne plus savoir ce
qu'il dit et de renoncer tout nonc, mme matrialiste. Les crivains
marxistes ont dit souvent et bon droit que le marxisme ne niait pas
les conditions subjectives de l'histoire et qu'il n'est pas un fatalisme,
que les hommes font leur histoire, que les idologies, mme si elles
traduisent une situation conomique et sociale dfinie, psent ensuite
sur l'histoire. Mais c'est dire qu'ils n'liminent pas le sujet comme facteur de l'histoire. ceux que le mot mme de subjectivit fait frmir,
rappelons la fameuse phrase de Marx : Le principal dfaut de tout le
matrialisme pass (...) est que l'objet, la ralit, le monde sensible n'y
sont considrs que sous la forme d'objet ou d'intuition, mais non pas
en tant qu'activit concrte humaine, en tant [139] que pratique, pas
de faon subjective 31.
La subjectivit, M. Lefebvre la vit comme tout le monde, mme s'il
veut l'ignorer. Il doit bien lui arriver pendant quelques heures de ne
plus penser la politique, et d'y revenir ensuite comme un devoir. Si
sa vie a pour lui un sens politique, c'est condition qu'il le lui rende
par des dcisions qui sont siennes. De mme tous les proltaires ne
sont pas communistes. Cela veut dire que nous pouvons nous drober
notre classe et ce que nous sommes. La dialectique de l'tre et du
nant, elle n'a pas lieu seulement dans l'esprit de Sartre, elle a lieu
aussi dans l'esprit de l'ouvrier dcourag qui se retire de la lutte. Qui
oserait exiger qu'aucun condamn ne connaisse l'angoisse de mourir,
mme s'il meurt pour sa classe et travers elle pour l'avenir des hommes ? Ds qu'on introduit l'homme comme sujet de l'histoire, et le
marxisme le fait expressment, ce n'est pas seulement l'homme collectif ou la classe que l'on introduit, mais aussi l'homme individuel,
qui garde le pouvoir de servir ou de trahir sa classe et en ce sens s'y
31
Premire Thse sur Feuerbach.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
95
intgre lui-mme. Marx nous donne une dfinition objective de la
classe par la position effective des individus dans le circuit de la production. Mais il nous dit par ailleurs que la classe ne saurait devenir
un facteur historique et rvolutionnaire dcisif tant que les individus
n'en prennent pas conscience. Il ajoute que cette prise de conscience a
elle-mme ses motifs sociaux et ainsi de suite. La classe comme facteur de l'histoire n'est donc [140] ni un simple fait objectif, ni d'ailleurs une simple valeur arbitrairement choisie par des consciences solitaires, mais comme un fait-valeur, ou une valeur incarne dont il reste laborer la thorie. Aujourd'hui, alors que les rapports de classe
sont plus que jamais masqus par d'autres oppositions, oppositions
nationales de l'Allemand et du Franais, l'un et l'autre uss et privs de
conscience sociale par l'hitlrisme et par le rgime de Vichy, opposition du nouveau monde amricain et du vieux monde occidental, des
pays riches et des pays exsangues, c'est un effort individuel qui est
demand l'ouvrier franais pour rejoindre l'ouvrier italien malgr
l'agression fasciste de 1940, l'ouvrier italien pour rejoindre l'ouvrier
franais, malgr les projets d'annexion du val d'Aoste, l'ouvrier amricain pour rejoindre l'ouvrier franais, parent pauvre, l'ouvrier franais pour rejoindre l'ouvrier amricain, cousin riche, et le rle du sujet
dans la constitution de la classe comme facteur historique est plus que
jamais visible. Il faut analyser rengagement, le moment o les conditions subjectives et les conditions objectives de l'histoire se nouent les
unes sur les autres, le mode d'existence de la classe avant la prise de
conscience, bref le statut du social et le phnomne de la coexistence.
Cette thorie du social, LEtre et le Nant ne nous la donne pas encore. Mais il pose le problme des relations rciproques entre la conscience et le monde social de la manire la plus vigoureuse en refusant
d'admettre une libert sans situation et en faisant du sujet, non pas certes un reflet comme le veut l'piphnomnisme, mais un refletrefltant comme le veut le marxisme.
[141]
Il faut dire plus. Non seulement le marxisme tolre la libert et
l'individu, mais encore, en tant que matrialisme , il charge l'homme d'une responsabilit pour ainsi dire vertigineuse. Hegel, dans la
mesure o il ramenait l'histoire l'histoire de l'esprit, trouvait dans sa
propre conscience, dans la certitude o il tait d'avoir entirement
compris l'histoire et dans la ralisation mme de sa philosophie, l'an-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
96
nonce et la garantie d'une synthse finale. Comment n'aurait-il pas t
optimiste, puisque l'histoire tait le retour soi de la conscience, et
que la ncessit de ce retour, la possibilit de l'homme total et sans
inquitude tait pour lui atteste par la logique interne de l'ide telle
qu'il la vivait en lui-mme ? On peut interprter autrement Hegel, c'est
l le Hegel des manuels, on peut le faire (et selon nous il faut le faire)
beaucoup plus marxiste, on peut fonder sa logique sur la phnomnologie et non pas sa phnomnologie sur sa logique. Mais, qu'elle porte
le nom de Hegel ou celui de Marx, une philosophie qui renonce
l'Esprit absolu comme moteur de l'histoire, qui fait marcher l'histoire
sur ses pieds et qui ne reconnat dans les choses d'autre raison que celle qu'y font paratre leur rencontre et leur action rciproque, cette
philosophie ne saurait affirmer a priori la possibilit de l'homme intgral, postuler une synthse finale, o toutes les contradictions soient
leves, ni en affirmer la ralisation invitable. L'vnement rvolutionnaire reste pour elle contingent, pour elle la date de la rvolution
n'est inscrite nulle part, dans aucun ciel mtaphysique. La dcomposition du capitalisme peut conduire le monde, non pas la rvolution,
mais au [142] chaos, si les hommes ne comprennent pas la situation et
ne veulent pas intervenir, comme un accouchement peut se terminer
par la mort de la mre et de l'enfant si quelqu'un n'est pas l pour aider
la nature. Si la synthse est de droit chez Hegel, elle ne saurait tre
que de fait dans le marxisme. S'il y a un quitisme hglien, il y a ncessairement une inquitude marxiste. Si Hegel peut s'en remettre
aveuglment au cours des choses, parce qu'il reste chez lui un fond de
thologie, la praxis marxiste n'a pas la mme ressource, elle n'a pas
d'autre support que la coexistence des hommes. Elle ne saurait assigner d'avance une fin de l'histoire, ni mme affirmer en thse dogmatique 1' homme total avant que l'vnement soit venu. Si toutes
nos contradictions doivent tre un jour supprimes, nous ne le saurons
que ce jour-l. On admire Engels parlant doctement de la ncessit qui
rsorbe les hasards historiques : d'o sait-il que l'histoire est et sera
rationnelle, puisqu'il n'est plus ni thiste, ni idaliste ? Le propre du
marxisme est de nous inviter faire prvaloir, sans garantie mtaphysique, la logique de l'histoire sur sa contingence. On demandera peuttre pourquoi l'existentialisme tient tant se rapprocher du marxisme.
M. Lefebvre suppose aimablement que c'est pour mieux le manger. La
vrit, plus candide, comme on va voir, est que beaucoup de
lecteurs de Marx se sentent absolument d'accord avec des analyses
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
97
comme celles du XVIII Brumaire par exemple, sans tre satisfaits par
certaines formules thoriques de Marx lui-mme et surtout de ses
commentateurs. Selon eux la dcouverte marxiste de l'existence sociale comme dimension de notre vie la [143] plus intrieure , de la
dynamique des classes comme d'un processus intgral o les dterminations conomiques et culturelles s'entrecroisent et s'entre-signifient
sans fin, non seulement admet, mais encore exige sur le plan thorique
une conception nouvelle de la conscience qui en fonde la fois l'autonomie et la dpendance en la dcrivant comme un nant qui vient au
monde et ne saurait se maintenir dans sa libert sans l'engager chaque instant. Selon eux, c'est cette conception de la conscience que le
marxisme a, sinon formule thoriquement, du moins pratique dans
ses analyses concrtes les plus fortes. Un marxisme vivant devrait
sauver la recherche existentialiste et l'intgrer, au lieu de l'touffer.
[144]
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
98
[145]
SENS ET NON-SENS
II. IDES
Le mtaphysique
dans lhomme
Retour la table des matires
Il ne peut tre question, dans les limites d'un article, de justifier
une conception du monde. Par contre, ce que chacun peut dire brivement, c'est de quelle signification peu peu le mot de mtaphysique
s'est charg pour lui, quoi il l'oppose, quelle intention il l'emploie.
Un compte rendu de ce genre ne suffit pas fonder le concept dont il
ne donne, pour ainsi dire, que la valeur d'emploi. Il est lgitime au
moins comme contribution la sociologie des ides, si la mtaphysique latente qu'il dcouvre dans l'usage du mot est assez rpandue.
Or la mtaphysique, rduite par le kantisme au systme des principes que la raison emploie dans la constitution de la science ou de
l'univers moral, radicalement conteste, dans cette fonction directrice,
par le positivisme, n'a pas cess, cependant, de mener dans la [146]
littrature et dans la posie comme une vie illgale, et les critiques
l'y retrouvent aujourd'hui 32. Dans les sciences mmes elle reparat,
32
Cf. par exemple Etiemble et Y. Gauclre, Rimbaud, p. 234 : La
mtaphysique n'est pas ncessairement l'association factice de noumnes ;
Rimbaud, plus vivement que quiconque, l'a senti ; il a reconstitu une
mtaphysique du concret il a vu les choses en soi, les fleurs en soi .
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
99
non pas pour en limiter le champ ou pour leur opposer des barrires,
mais comme l'inventaire dlibr d'un type d'tre que le scientisme
ignorait et que les sciences ont peu peu appris reconnatre. C'est
cette mtaphysique en acte que nous nous proposons de circonscrire
mieux, et d'abord de faire apparatre l'horizon des sciences de
l'homme.
*
*
Il semble difficile de contester que la psychologie de la forme bouleverse ce qu'on pourrait appeler l'ontologie implicite de la science et
nous oblige rviser notre conception des conditions et des limites
d'un savoir scientifique. Soit l'idal d'une psychologie objective des
animaux. L'ouvrage de Koehler montre indissolublement que nous
avons reconstituer, par del l'univers de notre perception, celui de
l'animal dans ce qu'il a d'original, avec ses connexions irrationnelles , ses court-circuits, ses lacunes, et que, si nous y parvenons,
ce ne peut tre qu' partir de notre exprience humaine de l'animal, en
dcrivant la courbe de sa conduite telle qu'elle nous apparat, avec ses
distinctions qualitatives de fracheur et fatigue , bonne [147]
solution et mauvaise solution , continuit et discontinuit ,
contact optique et connexion mcanique , si bien qu'enfin la
recherche se conclut, non par des lois quantitatives du type stimulusrponse, qui seraient applicables toutes les espces, mais par un tableau de l'laboration que le chimpanz fait subir aux stimuli donns,
de l'univers de comportement du chimpanz tel qu'il se ht dans sa
conduite mthodiquement interprte. L'ouvrage prouve par le fait
qu'une science descriptive est possible et met en vidence ce paradoxe
que, pour devenir vraiment scientifique, la psychologie ne doit pas
rejeter en bloc comme anthropomorphique notre exprience humaine
de l'animal, ni le soumettre aux seules questions que l'exprience physique pose l'atome ou l'acide, qu'il y a d'autres relations vraies que
les relations mesurables et qu'enfin notre notion de l'objectif doit tre
entirement redfinie. Koehler mettait en vidence, comme la condition des rapports stimulus-rponse, une certaine structure de l'univers
animal considr ou un a priori de lespce , et donnait pour tche
la psychologie la description de cet ensemble. Cette conception
s'tendait naturellement la psychopathologie et la psychologie gnrale, qui devaient devenir un inventaire des systmes de conduites
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
100
typiques. Si lIntelligence des singes suprieurs prouve quelque chose, c'est bien qu'on ne saurait parler d'intelligence chez l'animal au
sens o on l'entend chez l'homme. Le livre invitait les psychologues
comprendre les conduites selon leur loi d'organisation interne, au lieu
de chercher en elles le rsultat d'une combinaison de processus simples et universels.
[148]
Il est curieux de constater que ni le livre de Koehler, ni, en gnral,
les recherches de cette cole n'ont t approuvs ou critiqus dans ce
qu'ils apportaient de plus neuf 33. Inintelligence des singes suprieurs
agit sur le lecteur dans le sens d'une anthropologie naturaliste. Il est
moins sensible au contraste de la Gestaltung chez l'homme et chez
l'animal qu'au fait qu'il y a dj une Gestaltung dans la conduite de
l'animal comme chez l'homme, et cette analogie toute formelle prvaut contre les diffrences descriptives les plus manifestes. La psychologie de la forme, au lieu d'entraner une rvision de la mthodologie et de l'idal scientifique qui avaient longtemps masqu la ralit de
33
On s'tonne par exemple que J. Piaget (Psychologie de lIntelligence,
Armand Colin dit., 1947) ne trouve gure dans cette psychologie qu'un
renouveau de l'innisme. En fait, elle a si peu minimis le rle de
l'exprience dans le dveloppement que Koffka (Die Grundlagen der
psyschischen Entwicklung) oppose longuement les catgories du Lernen et
du Reifen et qu'il dcrit dans sa Psychologie (Die Philosophie in ihren
Einzelgebieten, hgg von Dessoir) toute une gense des Gestalten et toute une
srie de formes transitoires, depuis les liaisons syncrtiques de l'enfant
jusqu'au Und-Verbind-ungen de l'adulte. Ce qui en ralit distingue les
Gestaltistes de Piaget, ce n'est pas le rle de l'exprience, gal de part et
d'autre, mais par la manire dont ils comprennent le rapport de l'extrieur et
de l'intrieur, des conditions donnes et de l'laboration biologique et
psychique. Pour les Gestaltistes, l'accumulation de l'exprience ne fait que
rendre possible une restructuration qui rtablira un autre niveau l'quilibre
de l'tre vivant et de son milieu. Dans ses meilleurs passages, c'est bien ainsi
que Piaget, lui aussi, dcrit le dveloppement. Mais, faute peut-tre d'avoir
pris la rigueur ce principe gestaltiste que le tout n'est en aucun cas la
simple somme des parties, il lui arrive de revenir une notion quasi
empiriste de l'exprience : dans la Construction du rel chez l'enfant, il
semble quelquefois que le passage un type suprieur de perception et de
conduite soit simplement expliqu par un enregistrement plus complet et
plus exact de l'exprience, alors que cela mme suppose une rorganisation
du champ perceptif et l'avnement de formes clairement articules.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
101
la forme , ne s'est dveloppe qu'autant qu'elle permettait de ranimer cette mthodologie dfaillante. L'Ecole de Berlin proposait d'une
part de dcrire les formes privilgies de la conduite humaine, d'autre
part de dterminer les conditions qui en commandent l'apparition. Le
retour la description, l'appel aux phnomnes [149] comme une
source lgitime de connaissances psychologiques interdisaient en
principe de traiter la forme comme une ralit moindre ou drive et
de conserver aux processus linaires, aux squences isolables le privilge que leur donne le scientisme. Mais l'Ecole de Berlin a recul devant ces consquences : elle a prfr affirmer, par un pur acte de
foi, que la totalit des phnomnes appartenait l'univers de la
physique, renvoyant seulement une physique et une physiologie
plus avances de nous faire comprendre comment les formes les plus
complexes reposent, en dernire analyse, sur les plus simples. Elle a
tudi de prfrence celles des formes qui, un certain nombre de
conditions externes tant donnes, apparaissent, surtout au laboratoire,
peu prs rgulirement, c'est--dire les fonctions sensorielles anonymes. Elle a voulu tout prix la prcision des formules, quitte dlaisser quelque peu les formes plus complexes qui intressent la personnalit entire, dpendent moins simplement des conditions [150]
extrieures donnes et sont, pour cette raison mme, plus difficiles
dcouvrir, mais plus prcieuses aussi pour la connaissance du comportement humain. La psychologie de la perception est venue relayer
l'ancienne psychophysiologie dans le rle de centre des recherches
psychologiques. En ralit, l'tude des fonctions psychophysiologiques, de la vision (au sens abstrait de vision des couleurs, des distances ou des contours) n'aurait jamais d faire tort celle des comportements plus complexes, qui nous mettent en rapport non seulement
avec des stimuli, mais avec d'autres hommes, avec des situations vitales et sociales. La psychanalyse, elle-mme sauve de ses propres
dogmes, est le prolongement normal d'une psychologie de la forme
consquente. En traitant comme portion centrale de la psychologie ce
qui n'en est que la priphrie, comme si la psychologie des fonctions lmentaires devait nous donner plus tard, par la simple accumulation des recherches spciales, la psychologie du tout, en conservant aux fonctions sensorielles et leurs lois un privilge immrit
parce qu'elles s'accommodent tant bien que mal d'un traitement quantitatif, en concentrant l'effort de la nouvelle psychologie sur le fonctionnel et 1' objectif , alors qu'elle avait cherch aussi retrouver
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
102
tout le descriptif et le phnomnal , le scientisme a retard le
dveloppement d'une science psychologique. Si au contraire nous
voulions dfinir sans prjug le sens philosophique de la psychologie
de la Forme, il faudrait dire qu'en rvlant la structure ou la forme comme un ingrdient irrductible de l'tre, elle remet en question
l'alternative classique de [151] 1' existence comme chose et de
1' existence comme conscience , elle tablit une communication et
comme un mlange de l'objectif et du subjectif, elle conoit d'une manire neuve la connaissance psychologique, qui ne consiste plus dcomposer ces ensembles typiques, mais plutt les pouser et les
comprendre en les revivant.
Il va de soi que l'exemple d'une cole, et d'une cole encore conteste, ne saurait tre probant lui seul. Il deviendrait pourtant significatif si l'on pouvait montrer qu'en gnral les sciences de l'homme
s'orientent chacune leur manire vers la mme rvision des rapports
du subjectif et de l'objectif. Or c'est bien ce que nous constatons en
linguistique. Quand on a voulu tudier la langue suivant des mthodes
rigoureuses, il a fallu d'abord dsavouer des conceptions prscientifiques ou animistes qui reprsentaient chaque langue comme un
organisme ou comme un tre de raison dont l'volution ne ferait que
manifester peu peu l'essence invariable. On s'est donc propos de
traiter la langue comme une chose et de dcouvrir des lois dont l'entrelacement pt expliquer les faits de langue. Mais la langue comme le
comportement s'est drobe au traitement scientiste. Mme en phontique, o pourtant elle semblait devoir trouver un champ d'application
privilgi, la notion de loi est remise en question. On doit renoncer
dtacher la loi des faits, rsorber idalement les faits dans la loi.
La phrase : c + a devient en franais entre le Ve et le VIIIe sicle
ch est l'expression d'un vnement historique qui a eu lieu une fois
pour toutes au mme titre que la phrase : les Bourbons ont rgn [152]
en France de 1589 1791 34. Avec l'idal d'un systme de lois plus
vrai que les faits, c'est la conception mme de la langue comme objet pur qui est remise en cause. Saussure dj estimait qu'on avait t
trop vite dans le dsaveu de l'ancienne grammaire compare. Il y a,
disait-il, certaines images dont on ne peut se passer. Exiger qu'on ne
34
W. VON WARTBURG. Problmes et mthodes de la linguistique, P.U.F.
1947, p. 19.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
103
se serve que de termes rpondant aux ralits du langage, c'est prtendre que ces ralits n'ont plus de mystre pour nous 35. Gomme la
psychologie de la forme revendique l'usage des concepts descriptifs,
emprunts notre exprience humaine, et que ne sauraient remplacer
les concepts fonctionnels, fonds sur la mesure des variations corrlatives, la linguistique de Saussure lgitime, dans l'tude de la langue,
outre la perspective de l'explication causale, qui rattache chaque fait
un fait antrieur et tale donc la langue devant le linguiste comme un
objet de nature, la perspective du sujet parlant qui vit sa langue (et
ventuellement la modifie). Sous le premier rapport, la langue est une
mosaque de faits sans intrieur . Sous le second, au contraire, elle
est une totalit. Un savant aussi rigoureux que Meillet formule ces
progrs de la rflexion linguistique en disant : Les faits linguistiques
sont qualitatifs , et ailleurs chaque langue forme un systme , c'est
dire qu'elle admet un principe d'organisation interne. Dire que les faits
[153] linguistiques sont qualitatifs, c'est encore dire que dans leur
connexion et leur droulement ils ont besoin de la mdiation des
consciences. Cependant on ne peut de l conclure que le lieu ou le milieu de la langue soit la conscience, ni que la langue soit une abstraction et les sujets parlants la seule ralit. Car chaque sujet parlant,
mme quand il modifie la langue, s'prouve astreint de tels modes
d'expression qu'il puisse se faire comprendre des autres. Comme la
psychologie, partage entre la mthode objective et l'introspection,
finit par trouver son quilibre dans l'ide d'une forme du comportement, saisir du dehors comme du dedans, de mme la linguistique
se trouve devant la tche de dpasser l'alternative de la langue comme
chose et de la langue comme production des sujets parlants. Il faut que
la langue soit, autour de chaque sujet parlant, comme un instrument
qui a son inertie propre, ses exigences, ses contraintes, sa logique interne, et nanmoins qu'elle reste toujours ouverte leurs initiatives
(comme d'ailleurs aux apports bruts des invasions, des modes et des
vnements historiques), toujours capable des glissements de sens, des
quivoques, des substitutions fonctionnelles qui donnent cette logique comme une allure titubante. Peut-tre la notion de Gestalt ou de
structure rendrait-elle ici les mmes services qu'en psychologie, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'ensembles qui ne sont pas la pure manifestation d'une conscience rectrice, qui n'ont pas la connaissance ex35
SAUSSURE. Cours de linguistique gnrale, Payot, 1916, p. 19, n. 1.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
104
plicite de leur propre principe et qui, nanmoins, peuvent et doivent
tre lus en allant du tout aux parties. On doit retrouver au centre de
chaque langue des lois [154] d'quilibre, peut-tre mme un thme, un
projet fondamental, ou, comme dit G. Guillaume, un schme sublinguistique qui passe inaperu quand on travaille avec les catgories
du sens commun ou avec celles de l'ancienne grammaire, mais dont la
vie oprante se manifeste quand le linguiste construit les catgories
nouvelles exiges pour la coordination des faits. Il s'agit par exemple
d'une certaine manire de viser le temps, caractristique du grec ou du
latin 36, fixe dans les formes de la conjugaison, qui donc sollicite ds
la naissance chaque membre de la communaut linguistique et n'est
l'uvre d'aucun d'eux, mais qui pourtant n'est pas fatale, reste expose aux influences, la dsutude par lesquelles la langue finalement se transformera en une autre langue. Cet esprit gnral, que tous
constituent par leur vie commune, cette intention dj dpose dans le
systme donn du langage, pr-consciente, puisque le sujet parlant
l'pouse avant de s'en rendre compte et de l'lever au niveau de la
connaissance, et qui cependant ne subsiste qu' condition d'tre reprise
ou assume par les sujets parlants et vit de leur volont d'change,
c'est bien, sur le terrain de la linguistique, l'quivalent de la forme des
psychologues, aussi trangre l'existence objective d'un processus
naturel qu' l'existence mentale d'une ide. Ni chose, ni ide, la langue, comme le psychisme, n'est accessible qu' une mthode de
comprhension qui retrouve dans la multiplicit des faits quelques
intentions ou [155] vises dcisives, les faits profonds et en quelque
sorte secrets sur lesquels repose la construction de la langue 37.
36
37
G. Guillaume. Larchitectonique du temps dans les langues classiques,
Copenhague, 1945.
G. Guillaume. L'architectonique du temps dans les langues classiques,
p. 16. Bien entendu, ce dchiffrement de l'intention fondamentale doit tre
rigoureusement contrl : La mthode longuement mdite qu'on
applique, trs proche de celle qu'on applique actuellement en physique,
pourrait tre dfinie comme une alliance, en toute proportion utile, de
l'observation fine du concret et de la rflexion abstraite, profonde, le dernier
mot appartenant bien entendu la premire, seule qualifie pour dcider en
dernier ressort de la vraie nature des choses, le rle de la rflexion, dans
l'alliance qu'elle contracte avec l'observation, n'tant point de conclure sa
place, mais de la guider, de la rendre plus aigu, plus pntrante, et, pour
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
105
On arriverait peut-tre la mme conclusion en examinant le dveloppement de la sociologie depuis le moment o Durkheim lui a donn ce qu'il croyait tre une mthode scientifique. En fait, considrer
son fameux ouvrage sur les Formes lmentaires de la vie religieuse,
on est tent de dire que, s'il a nergiquement appel l'attention sur
l'tude du social, il l'a peut-tre dpouille de ce qui en fait le plus
grand intrt en conseillant de le traiter comme une chose . On se
rappelle qu'il dfinit nominalement le religieux par le sacr, montre
ensuite que l'exprience du sacr concide avec les moments de plus
grande cohsion de la socit totmique, et conclut qu'au moins dans
ses formes lmentaires, et sans doute aussi dans ses formes suprieures, la vie religieuse n'est que la manire dont la socit prend conscience d'elle-mme. Il n'y a pas [156] lieu de discuter la dfinition du
religieux par le sacr, puisque Durkheim la prsente comme prliminaire et nominale. On pourrait seulement observer qu'elle ne nous fait
pas encore pntrer l'intrieur de la religion, et faire des rserves sur
une mthode plus soucieuse d'assembler des concepts pris en extension que d'en explorer le contenu. L'identification du sacr et du social
justifie ces rserves. Car ou bien elle est trop vidente et laisse la
question entire, ou bien elle est prise comme une explication du religieux par le social, et alors elle nous masque le problme. Que l'exprience religieuse se produise toujours dans une collectivit actuelle ou
virtuelle, qu'elle implique une ide des relations interhumaines et
qu'elle exprime toujours, directement ou non, titre de reflet ou de
contrepartie, les rapports effectifs des hommes dans la civilisation
donne, que toute conception de l'esprit la fois entrane une certaine
conception du rapport entre les consciences et inversement doive
quelque chose l'exprience que nous avons de la communication,
c'est certain, comme il est certain que la littrature, l'art, la science, le
langage sont des faits sociaux au sens de : faits de communication.
Mais, cela reconnu, on n'a encore rien fait pour lucider le phnomne
religieux (littraire ou esthtique, ou linguistique). Quand on remonte
du religieux au social, on ne va pas de l'obscur au clair, on n'explique
pas, on retrouve sous un autre nom la mme obscurit ou le mme
problme ; il restera ressaisir le mode particulier du rapport interhumain et de la communication qui est ralis dans chaque civilisatout dire d'un mot, de lui confrer une puissance que, laisse ses seules
forces, elle n'aurait pas . (Ibid., p. 17.)
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
106
tion. Le recours au lien social ne peut passer pour une [157] explication de la religion ou du sacr que si l'on en fait une substance immuable, une cause bonne tout, une force vague dfinie par sa seule
puissance de coercition, c'est--dire si l'on se rend aveugle pour
l'opration chaque fois originale d'une socit en train d'tablir le systme de significations collectives travers lequel ses membres communiquent. On ne gagne rien fonder le religieux ou le sacr sur le
social, puisqu'on retrouve dans le social les mmes paradoxes, la mme ambivalence, le mme mlange d'union et de rpulsion, de dsir et
de crainte qui se trouvait dj dans le sacr et qui faisait problme.
Durkheim a trait le social comme une ralit extrieure l'individu et
l'a charg d'expliquer tout ce qui se prsente l'individu comme devoir tre. Mais le social ne peut rendre ce service que s'il n'est pas luimme comme une chose, s'il investit l'individu, s'il le sollicite et le
menace la fois, si chaque conscience la fois se trouve et se perd
dans son rapport avec d'autres consciences, enfin si le social est non
pas conscience collective, mais intersubjectivit, rapport vivant et tension entre des individus. La sociologie ne cherchera pas l'explication
du religieux dans le social, ni d'ailleurs du social dans le religieux, elle
les considrera comme deux aspects du lien humain rel et fantastique
tel qu'il a t labor par la civilisation considre et elle tentera d'objectiver la solution que cette civilisation invente dans sa religion
comme dans son conomie ou dans sa politique pour le problme des
relations de l'homme avec la nature et avec l'homme. Si traiter les faits
sociaux comme des choses, c'est en chercher les lments composants
ou rattacher extrieurement [158] l'un l'autre comme sa cause, ce
prcepte fameux n'est pas praticable : la sociologie ne connat pas
d'lments permanents dans les diffrents touts o ils se trouvent intgrs, pas de faits extrieurs les uns aux autres, mais, dans le cas de
chaque socit, une totalit o les phnomnes s'expriment mutuellement et admettent un mme thme fondamental. L'esprit d'une civilisation compose un tout de fonctions ; c'est une intgration diffrente
de l'addition de la totalit des parties 38. Ce mouvement par lequel
les hommes assument et laborent les conditions donnes de leur vie
collective et les couronnent de valeurs et d'institutions originales, si
nous voulons le ressaisir, il nous faut encore une fois rviser notre
ide de la connaissance scientifique et objective : son plus haut
38
M. Mauss. Manuel d'Ethnographie, Payot, 1947, p. 170.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
107
point, la connaissance sociologique, comme la connaissance de quelqu'un, exige que nous reprenions, en nous guidant sur tous les indices
objectifs, l'attitude humaine qui fait l'esprit d'une socit.
Parce qu'il se soucie de l'individuel et reste au contact d'une ralit
inpuisable, l'historien est, par position, mieux prmuni que le sociologue contre le rve d'une connaissance souveraine, capable d'accder
immdiatement tous les temps, et d'une objectivit absolue. Pour
parvenir la conscience de sa tche, il lui a cependant fallu rejeter
d'abord la prtention d'une Histoire Universelle entirement droule
devant l'historien comme elle le serait sous le regard de Dieu. Il lui
faut aussi, ce qui est plus difficile, reconnatre [159] qu'un certain rigorisme ou scientisme en matire d'histoire, loin de nous garantir l'adquation au pass, risque de nous enfermer dans les vues les
plus subjectives. On se rappelle que Seignobos refusait toute mise en
perspective et confinait l'historien dans l'tude, pour chaque vnement, de la constellation singulire qui en avait rendu possible l'apparition. On ne pouvait, selon lui, parmi toutes les conditions, en choisir
quelques-unes qui fussent les principales , ni baucher par l un
commencement d'induction. Elles avaient toutes contribu produire
l'effet, elles en taient toutes causes au mme titre. Il n'y avait pas de
dtails en histoire, pas d'accessoire, donc rien d'essentiel. Suivant cette
mthode, chaque vnement est le rsultat d'une rencontre et d'un hasard. Il nous est interdit d'y trouver un sens intrieur et il n'y a rien
comprendre dans le tumulte insens de l'histoire. Applique par
exemple une rvolution, cette mthode la fait apparatre d'emble
comme illusoire ou absurde. Les hommes qui font une rvolution
croient rsoudre un problme pos dans les choses, il leur semble que
leur volont prolonge une exigence ou rpond une sollicitation de
leur temps. Il n'est, bien entendu, pas sr qu'ils aient raison. Encore ne
pouvons-nous pas postuler qu'ils ont tort. Les chances d'erreur sont
gales qu'on adopte avec Seignobos le point de vue de Sirius et qu'on
refuse toute signification aux vnements quels qu'ils soient, ou
qu'on adopte avec Bossuet le point de vue de Dieu et qu'on les trouve
tous pleins de sens. La rsolution d'ignorer le sens que les hommes ont
eux-mmes donn leur action et de rserver l'enchanement des
faits toute l'efficacit [160] historique, en un mot l'idoltrie de l'objectivit, renferme, selon une profonde remarque de Trotsky, le
jugement le plus audacieux quand il s'agit d'une rvolution, puisqu'elle
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
108
impose a priori l'homme d'action, qui croit une logique de l'histoire et une vrit de ce qu'il fait, les catgories de l'historien objectif , qui n'y croit pas. L'union des paysans et des ouvriers, lors des
vnements de 1917 en Russie, est peut-tre un hasard. Mais une autre
hypothse est possible : le mouvement ouvrier et les revendications
des paysans ont converg vers une rvolution socialiste parce que,
dans un pays qui n'avait pas de bourgeoisie, la phase dmocratique
avec ses rformes librales n'tait pas viable et que les revendications
des paysans ne pouvaient trouver issue qu'en passant au-del. C'est
alors la structure de l'tat tzariste qui expliquerait la rencontre fortuite dont parle l'historien objectif . La vritable objectivit exige
donc qu'on examine, pour leur donner leur juste rle, les composantes
subjectives de l'vnement, l'interprtation qu'en donnaient les
contemporains et les protagonistes. Mais, pour apprcier justement
l'influence de ces vues, il faudra que l'historien les confronte avec les
faits, mesure ventuellement l'cart des unes aux autres, et finalement
prenne l'gard d'une interprtation marxiste des vnements de 1917
une dcision qui est toujours personnelle en quelque mesure, parce
qu'elle ne se fonde que sur du [161] probable 39. La tche de l'histoire
apparat alors dans toute sa difficult : il nous faut rveiller le pass, le
remettre au prsent, reconstituer l'atmosphre de l'poque telle qu'elle
a t vcue par les contemporains, sans lui imposer des catgories ntres, et, cela fait, dterminer de plus si les contemporains ont t
mystifis, qui, d'eux ou de nous, a le mieux vu la vrit du temps.
C'est encore une fois un problme de communication qui se pose.
Comme M. L. Febvre l'a parfaitement montr, propos de l'incroyance au XVIe sicle 40, l'univers mental de Rabelais ne peut pas tre dcrit dans notre langage ni pens l'aide de nos catgories. Beaucoup
de textes empchent de dire qu'il ft croyant au sens que nous donnons ce mot. Mais il serait aussi peu exact de dire qu'il ft incroyant
39
40
Mme dans une perspective marxiste, l'histoire effective ne va jusqu'au bout
de sa logique interne que si les hommes en prennent conscience, la
comprennent dans le sens marxiste et achvent le mouvement bauch dans
les choses. L'historien, mme marxiste, qui crit l'histoire de 1917 ne peut
pas feindre que la rvolution ft fatale, il doit la montrer possible, probable
mme, mais non toute faite. Mme pour lui l'histoire universelle n'est pas
crite d'avance : le socialisme sera, mais quand et par quels chemins ?
L. Febvre. Le problme de l'incroyance au XVIe sicle. La religion de
Rabelais. Paris, Albin Michel, 1943.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
109
au sens que le mot a prix deux, trois ou quatre sicles plus tard. La
religion fait partie de l'quipement ou de l'outillage mental du XVIe
sicle. Mme si elle n'est pas au centre de la vie et de la pense de Rabelais, elle en compose l'horizon, au moins titre de thse implicite et
de ralit tablie. Comprendre Rabelais, ce sera reconstituer [162] cet
entourage de culture qui a t le sien et qui n'est plus le ntre ; ce sera,
travers notre propre situation historique, rejoindre en pense la sienne. Si nous pouvons progresser vers une connaissance adquate du
pass, ce ne sera pas, comme le croyait Seignobos, en nous haussant
au point de vue d'un observateur absolu qui croit dominer tous les
temps et, en cela mme, les ignore, mais au contraire en prouvant
toujours mieux que cette conviction mme a sa date, que l'ide mme
d'un univers de vrit est trompeuse, et en percevant par contraste ce
que le pass a t pour lui-mme. Nous n'atteignons pas l'universel en
quittant notre particularit, mais en faisant d'elle un moyen d'atteindre
les autres, en vertu de cette mystrieuse affinit qui fait que les situations se comprennent entre elles.
*
*
Les sciences de l'homme, dans leur orientation prsente, sont mtaphysiques ou transnaturelles en ce sens qu'elles nous font redcouvrir, avec la structure et la comprhension des structures, une dimension d'tre et un type de connaissance que l'homme oublie dans l'attitude qui lui est naturelle. Il nous est naturel de nous croire en prsence
d'un monde et d'un temps que notre pense survole et dont elle peut
volont considrer chaque partie sans en modifier la nature objective.
La science dans ses commencements reprend et systmatise cette
croyance. Elle sous-entend toujours un observateur absolu en qui se
fasse la sommation des points de vue, et corrlativement un gomtral
de toutes les perspectives. Mais les sciences de l'homme [163] (pour
ne rien dire des autres) ont fait voir que toute connaissance de l'homme par l'homme est invitablement, non pas contemplation pure, mais
reprise par chacun, selon ce qu'il peut, des actes d'autrui, ractivation
partir de signes ambigus d'une exprience qui n'est pas la sienne,
appropriation par lui d'une structure, a priori de l'espce, schme
sublinguistique ou esprit d'une civilisation, dont il ne forme pas un
concept distinct et qu'il restitue comme le pianiste exerc dchiffre
une musique inconnue : sans saisir lui-mme les motifs de chaque
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
110
geste ou de chaque opration, sans pouvoir rveiller tout le savoir sdiment dont il fait usage ce moment. Il n'y a plus ici position d'un
objet, mais communication avec une manire d'tre. L'universalit du
savoir n'est plus garantie en chacun par ce rduit de conscience absolue o le je pense kantien lui-mme, tout h qu'il ft une certaine
perspective spatio-temporelle, s'assurait a priori d'tre identique tout
autre je pense possible. C'est en avant de nous, dans la chose o
nous place notre perception, dans le dialogue o notre exprience
d'autrui nous jette par un mouvement dont nous ne connaissons pas
tous les ressorts, que se trouve le germe d'universalit ou la lumire
naturelle sans lesquels il n'y aurait pas de connaissance. Il y a mtaphysique partir du moment o, cessant de vivre dans l'vidence de
l'objet, qu'il s'agisse de l'objet sensoriel ou de l'objet de science,
nous apercevons indissolublement la subjectivit radicale de toute notre exprience et sa valeur de vrit. Notre exprience est ntre, cela
signifie deux choses : qu'elle n'est pas la mesure de tout tre en soi
imaginable, et [164] qu'elle est cependant coextensive tout tre
dont nous puissions avoir notion. Le fait mtaphysique fondamental
est ce double sens du cogito : je suis sr qu'il y a de l'tre, condition de ne pas chercher une autre sorte d'tre que l'tre-pour-moi.
Quand j'ai conscience de sentir, je n'ai pas d'un ct conscience d'un
tat mien et d'autre part conscience d'une certaine qualit sensible telle
que le rouge ou le bleu : mais le rouge et le bleu ne sont rien d'autre
que mes diffrentes manires de parcourir du regard ce qui s'offre et
de rpondre sa sollicitation. De mme, quand je dis que je vois quelqu'un, c'est que je suis touch de sympathie pour cette conduite laquelle j'assiste et qui happe mes propres intentions en leur fournissant
une ralisation visible. C'est dans notre diffrence mme, dans la singularit de notre exprience que s'atteste l'trange pouvoir qu'elle a de
passer en autrui, de raccomplir les actes d'autrui, et donc que se trouve fonde une vrit laquelle, comme disait Pascal, nous ne pouvons
ni renoncer ni accder pleinement. La mtaphysique est le propos dlibr de dcrire ce paradoxe de la conscience et de la vrit, de
l'change et de la communication, dans lequel la science vit et
qu'elle rencontre sous l'aspect de difficults vaincues ou d'checs
rparer, mais qu'elle ne thmatise pas. partir du moment o j'ai reconnu que mon exprience, justement en tant [165] qu'elle est mien-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
111
ne 41 m'ouvre ce qui n'est pas moi, que je suis sensible au monde et
autrui, tous les tres que la pense objective posait leur distance se
rapprochent singulirement de moi. Ou inversement, je reconnais mon
affinit avec eux, je ne suis rien qu'un pouvoir de leur faire cho, de
les comprendre, de leur rpondre. Ma vie m'apparat absolument individuelle et absolument universelle. Cette reconnaissance d'une vie individuelle qui anime toutes les vies passes et contemporaines et reoit d'elles toute vie, d'une lumire qui jaillit d'elles nous contre
tout espoir, c'est la conscience mtaphysique, son premier degr
tonnement de dcouvrir l'affrontement des contraires, son deuxime degr reconnaissance de leur identit dans la simplicit du faire.
La conscience mtaphysique n'a pas d'autres objets que l'exprience
quotidienne : ce monde, les autres, l'histoire humaine, la vrit, la
culture. Mais, au lieu de les prendre tout faits, comme des consquences sans prmisses et comme s'ils allaient de soi, elle redcouvre leur
tranget fondamentale pour moi et le miracle de leur apparition.
Alors l'histoire de l'humanit n'est plus cet avnement invitable de
l'homme moderne partir de l'homme des cavernes, cette croissance
imprieuse de la morale et de la science dont parlent des manuels scolaires trop humains , ce n'est pas l'histoire empirique et. successive, c'est [166] la conscience du lien secret qui fait que Platon est encore vivant parmi nous.
Ainsi comprise, la mtaphysique est le contraire du systme. Si le
systme est un arrangement de concepts qui rend immdiatement
compatibles et compossibles tous les aspects de l'exprience, il supprime la conscience mtaphysique, en mme temps d'ailleurs que la
moralit. Si par exemple on veut fonder le fait de la rationalit ou de
la communication sur un absolu de la valeur ou de la pense, ou bien
cet absolu ne lve aucune difficult et, tout bien considr, la rationalit et la communication restent fondes sur elles-mmes, ou bien
l'absolu descend pour ainsi dire en elles, mais il renverse alors tous les
moyens humains de vrification et de justification. Qu'il y ait ou non
une pense absolue, et, dans chaque problme pratique, une valuation
absolue, je ne dispose pour juger que d'opinions miennes, qui restent
41
Il y aurait videmment lieu de dcrire prcisment le passage de la foi
perceptive la vrit explicite telle qu'on la rencontre au niveau du langage,
du concept et du monde culturel. Nous comptons le faire dans un travail
consacr l'Origine de la vrit.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
112
capables d'erreur, si svrement que je les discute. L'accord avec moimme et avec autrui reste aussi difficile obtenir, et j'ai beau croire
qu'en droit il est toujours ralisable, je n'ai d'autres raisons d'affirmer
ce principe que l'exprience de certaines concordances, si bien qu'enfin ma croyance l'absolu, dans ce qu'elle a de solide, n'est rien que
mon exprience d'un accord avec moi-mme et avec autrui. Quand il
n'est pas inutile, le recours un fondement absolu dtruit cela mme
qu'il doit fonder. Si en effet je crois pouvoir dans l'vidence rejoindre
le principe absolu de toute pense et de toute valuation, condition d'avoir ma conscience pour moi, j'ai le droit de soustraire mes
jugements au contrle d'autrui ; ils reoivent le caractre du sacr ; en
particulier, [167] dans l'ordre du pratique, je dispose d'un plan de fuite
o se transfigurent mes actions : la souffrance dont je suis cause se
tourne en bonheur, la ruse en raison, et je fais pieusement prir mes
adversaires. Quand donc je place hors de l'exprience progressive le
fondement de la vrit ou de la moralit, ou bien je continue de m'en
tenir aux probabilits qu'elle m'offre, seulement dvalorises par
l'idal d'une connaissance absolue, ou bien je les dguise en certitudes absolues, et alors je lche le vrifiable pour la vrit, c'est--dire
la proie pour l'ombre. J'oscille entre l'incertitude et l'outrecuidance
sans jamais trouver le juste point de la rsolution humaine. Si au
contraire j'ai compris que vrit et valeur ne peuvent tre pour nous
que le rsultat de nos vrifications ou de nos valuations au contact du
monde, devant les autres et dans des situations de connaissance et
d'action donnes, que mme ces notions perdent tout sens hors des
perspectives humaines, alors le monde retrouve son relief, les actes
particuliers de vrification et d'valuation dans lesquels je ressaisis
une exprience disperse reprennent leur importance dcisive, il y a
de l'irrcusable dans la connaissance et dans l'action, du vrai et du
faux, du bien et du mal, justement parce que je ne prtends pas y trouver l'vidence absolue. La conscience mtaphysique et morale meurt
au contact de l'absolu parce qu'elle est elle-mme, par del le monde
plat de la conscience habitue ou endormie, la connexion vivante de
moi avec moi et de moi avec autrui. La mtaphysique n'est pas une
construction de concepts par lesquels nous essaierions de rendre
moins sensibles nos paradoxes ; [168] c'est l'exprience que nous en
faisons dans toutes les situations de l'histoire personnelle et collective,
et des actions qui, les assumant, les transforment en raison. C'est
une interrogation telle qu'on ne conoit pas de rponse qui l'annule,
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
113
mais seulement des actions rsolues qui la reportent plus loin. Ce n'est
pas une connaissance qui viendrait achever l'difice des connaissances ; c'est le savoir lucide de ce qui les menace et la conscience aigu
de leur prix. La contingence de tout ce qui existe et de tout ce qui vaut
n'est pas une petite vrit laquelle il faudrait tant bien que mal faire
place dans quelque repli d'un systme, c'est la condition d'une vue mtaphysique du monde.
Une telle mtaphysique n'est pas conciliable avec le contenu manifeste de la religion et avec la position d'un penseur absolu du monde.
Ces affirmations posent aussitt le problme d'une thodice qui n'a
pas fait un pas depuis Leibnitz, et qui, chez Leibnitz lui-mme, consistait peut-tre, en dernire analyse, voquer l'existence de ce mondeci comme un fait insurpassable qui attire ds l'origine le devenir crateur, et donc rcuser le point de vue d'un Dieu sans monde. Dieu
apparat alors, non pas comme le crateur de ce monde (ce qui entrane aussitt la difficult d'une puissance souveraine et bonne astreinte
incorporer du mal son uvre), mais plutt comme une ide au sens
kantien et restrictif du mot, terme de rfrence d'une rflexion humaine qui, considrant ce monde tel qu'il est, prcipite dans cette ide
ce qu'elle voudrait qui ft. Un Dieu, au contraire, qui ne soit pas seulement pour nous, mais pour soi, la mtaphysique ne peut le chercher
qu'en [169] arrire de la conscience, en de de nos ides, comme la
force anonyme qui soutient chacune de nos penses et de nos expriences 42. ce point, la religion cesse d'tre une construction
conceptuelle, une idologie, et rejoint l'exprience de la vie interhumaine. C'est la nouveaut du christianisme comme religion de la mort
de Dieu de rcuser le Dieu des philosophes et d'annoncer un Dieu qui
assume la condition de l'homme. La religion fait partie de la culture,
42
Toute dtermination qu'on voudrait donner de ce fondement est aussitt
contradictoire, non pas de cette contradiction fconde qui est celle de la
conscience humaine, mais de cette contradiction inerte qui est celle des
concepts inconsistants. J'ai le droit de considrer comme ultimes et vraies
les contradictions de ma vie comme sujet pensant et incarn, fini et capable
de vrit, parce que j'en ai l'exprience et qu'elles se nouent dans la
perception irrcusable d'une chose ou dans l'exprience d'une vrit. Je ne
puis introduire derrire moi comme le fait Husserl (d'ailleurs titre
hypothtique) une transcendance dans l'immanence parce que je ne suis
pas Dieu et ne puis vrifier dans une exprience irrcusable la coexistence
des deux attributs.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
114
non comme dogme, ni mme comme croyance, comme cri. Mais peutelle tre autre chose, du moins avec consquences ? Puisqu'elle enseigne que la faute de l'homme est une heureuse faute, qu'un monde sans
faute serait moins bon, et qu'enfin la cration, qui fait dchoir l'tre de
sa perfection et de sa suffisance originelles, vaut pourtant mieux ou
est un bien, elle est la ngation la plus rsolue de l'infini conu.
Enfin, si entre la mtaphysique conue comme systme et le scientisme se sont livres des batailles retentissantes, entre une mtaphysique qui refuse par principe le systme et une science qui mesure
toujours [170] mieux l'cart de ses formules aux faits qu'elles doivent
exprimer, il y a, comme l'avait vu Bergson 43, bien plus qu'un concordat : une convergence spontane. La prise de conscience philosophique ne rend pas vain l'effort d'objectivation de la science : elle le
poursuit au niveau de l'homme, puisque toute pense est invitablement objectivation ; elle sait seulement qu'ici l'objectivation ne peut
s'emporter elle-mme et nous fait conqurir le rapport plus fondamental de coexistence. Entre la connaissance scientifique et le savoir mtaphysique, qui la remet toujours en prsence de sa [171] tche, il ne
peut y avoir de rivalit. Une science sans philosophie ne saurait pas,
la lettre, de quoi elle parle. Une philosophie sans exploration mtho43
Bergson a montr avec profondeur dans l'Introduction la Mtaphysique
que la science doit tre considre non seulement dans ses formules
acheves, mais encore avec la marge d'indtermination qui les spare du
donn connatre, et que, prise ainsi, elle suppose une accointance avec le
donn encore dterminer. La mtaphysique serait l'exploration dlibre
de ce monde avant l'objet de science auquel la science se rfre. Sur tous ces
points, il nous semble avoir parfaitement dfini l'approche mtaphysique du
monde. Reste savoir s'il est rest fidle cette mthode et ne revient pas au
systme quand il passe des lignes de faits un lan vital ou spirituel dont
elles soient la manifestation ou la trace, et qui ne peut tre aperu que du
point de vue de l'observateur absolu, transformant en repos ternel l'effort et
la tension qu'il avait d'abord dcrits. Si l'intuition nous fait vraiment passer
au-del du monde, c'est que Bergson n'a pas pris pleine conscience de ses
propres prsupposs et de ce simple fait que tout le vcu est vcu sur le fond
du monde. Et si, par contre, on doit finalement comprendre sa philosophie
dans le sens de l'immanence, on peut lui reprocher de n'avoir dcrit le
monde humain que dans ses structures les plus gnrales, par exemple la
dure, l'ouverture l'avenir ; il manque son uvre un tableau de
l'histoire humaine qui donne un contenu ces intuitions qui,
paradoxalement, restent trs gnrales.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
115
dique des phnomnes n'aboutirait qu' des vrits formelles, c'est-dire des erreurs. Faire de la mtaphysique, ce n'est pas entrer dans
un monde de connaissance spar, ni rpter des formules striles telles que celles dont nous nous servons ici, c'est faire l'exprience
pleine des paradoxes qu'elles indiquent, c'est vrifier toujours nouveau le fonctionnement discordant de l'intersubjectivit humaine, c'est
chercher penser jusqu'au bout les mmes phnomnes que la science
investit, en leur restituant seulement leur transcendance et leur tranget originaires. Quand la mthodologie a tabli, semble-t-il, sans
conteste, qu'aucune induction n'est fonde au sens absolu du mot et
que toute rflexion emporte toujours avec soi des pans entiers d'expriences qui concourent tacitement produire nos vidences les plus
pures, il y aurait lieu sans doute de rviser la distinction classique de
l'induction et de la rflexion, et de se demander s'il y a bien l deux
sortes de savoir, s'il n'y a pas plutt un seul savoir diffrents degrs
de navet ou d'explicitation.
Il fallait bien, pour la circonscrire, cerner d'un certain nombre de
ngations cette conception de la mtaphysique. Mais, prise en ellemme, elle est la positivit mme, et l'on ne voit pas de quoi elle pourrait nous priver. La gloire de l'vidence, celle du dialogue et de la
communication russie, la communaut du sort entre les hommes, leur
accord, non pas selon la ressemblance biologique, mais en ce qu'ils
ont de plus propre, [172] tout ce que science et religion peuvent
vivre effectivement se trouve ici recueilli, et arrach aux quivoques
d'une double vie.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
116
[173]
SENS ET NON-SENS
II. IDES
Autour du marxisme
Retour la table des matires
Thierry Maulnier a commenc d'crire sur la politique dans la priode ascendante du fascisme. Il y a beaucoup pens, il en a beaucoup
parl, tantt avec ferveur, tantt avec des rserves. Justement parce
qu'il le prenait au srieux et l'examinait gravement, acceptant ceci,
rejetant cela, nul doute qu'il ait contribu le faire respecter. Comme
il l'crit lui-mme, la sincrit de quelques-uns est un auxiliaire ncessaire des mystifications historiques 44. Cela dit, il faut ajouter aussitt
que notre auteur s'est conduit de telle faon qu'il chappe la polmique et aux procs de tendance et se place dans l'ordre de la philosophie politique, o il y a des opinions vraies et fausses, mais pas d'opinions damnables. Rappelons qu'en mai 1940, laiss seul par le hasard
des circonstances la direction d'un hebdomadaire, Thierry Maulnier
a fait paratre [174] quelques numros rsolument bellicistes qui
lui ont valu deux ans plus tard d'tre dnonc par le mme journal
comme un agent de l'Angleterre. Entre 1940 et 1944, dans les journaux de zone sud auxquels il collaborait, il s'est limit au rle de critique militaire et n'a jamais voulu que l'intrt qu'il avait port au phnomne fasciste pt tre utilis par la propagande des fascismes trangers. Il n'a donc pas seulement fait ses preuves d'indpendance et de
44
Violence et conscience, p. 128.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
117
sincrit, vertus prives, qui ne sont pas dcisives en politique,
il a montr qu'il avait le sens des responsabilits historiques et compris que, dans un pays mme partiellement occup, un crivain, justement s'il s'tait intress au fascisme, ne pouvait plus signer une
chronique politique. C'est ce qui lui donne le droit entier de publier
aujourd'hui ses rflexions et nous toute libert de les discuter sans
arrire-pense.
L'intrt qu'il portait au fascisme tait conditionnel. Le problme
de notre temps consistait pour Thierry Maulnier unir deux forces
jusqu'ici spares : les forces proltariennes qui vont vers une socit
sans classe par la rvolution conomique et sociale, et les forces qui
tendent conserver la nation, forme de civilisation de l'Europe occidentale. Considrant le fascisme ses dbuts, et peut-tre accordant trop de crdit aux dclarations de ses thoriciens, il a cru que
le sens du phnomne tait de raliser cette union. Telle tait, pensaitil, la vrit historique du fascisme, quelle que ft par ailleurs la
conduite des diffrents fascismes existants, qui pouvaient ou non rester fidles leur mission. cet gard, Thierry Maulnier multipliait les
[175] rserves : Le recours l'Action, la Race, au Sang, au Chef
prdestin, la mission suprieure d'un peuple, tout l'attirail suspect
du nationalisme moderne ne sont pas autre chose que les substituts de
l'intelligence dfaillante, l'appel de l'homme aux tnbres pour ressaisir la matrise d'un monde o le savoir est impuissant le guider 45.
Il esprait seulement que des instincts confus, des tendances contradictoires associs des fragments d'anciennes doctrines, des ressentiments parfois grossiers, des intrts parfois sordides 46 porteraient dans l'histoire un vrai fascisme sans perscutions raciales, sans
oppression, sans guerre, et tout entier vou la solution du problme
proltarien dans les limites de la nation. Il fallait donc aider le fascisme prendre conscience de sa vraie destination historique et en quelque sorte le transformer en lui-mme. Il avait fait appel des survivances morales, de vagues revendications, des mythes aussi vagues que ceux de l'hrosme, du devoir, du sacrifice, aux sources les
plus faciles et parfois les plus suspectes de l'exaltation 47. Il fallait
45
46
47
Au-del du nationalisme, p. 19.
Ibid., p. 29.
Ibid., p. 25.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
118
recueillir l'or cach dans cette boue. La question tait de savoir si des
rformes sociales de dtail, le racisme, et l'exaltation de la communaut nationale ne serviraient qu' escamoter le problme social et proltarien, selon les recettes prouves du nationalisme traditionnel, ou si
au contraire on verrait paratre en Allemagne et en Italie un type nouveau [176] de socit. On comprend que Munich, l'occupation de Prague six mois plus tard, la guerre de Pologne et la suite aient clair
dfinitivement Thierry Maulnier sur les rapports du fascisme et de son
essence historique, et qu'il ait sans hsitation refus au fascisme
existant la sympathie qu'il avait tmoign un certain fascisme possible .
L'important est qu'on tire de cette exprience historique tous les
enseignements qu'elle comporte. Nous voulons dire : le fascisme de
Thierry Maulnier tait-il vraiment un fascisme possible ? Est-ce par
hasard ou par un choix imprvisible des individus que le nazisme et le
fascisme ont finalement recouru la guerre et la conqute ? Etait-il
raisonnable d'en attendre la solution des problmes de notre temps ?
Sommes-nous libres de donner un rgime le sens qu'il nous plat d'y
trouver, ou bien n'y a-t-il pas moyen de saisir une logique concrte du
systme qui le conduit ncessairement, ou du moins probablement,
ses dcisions ultimes ? Ds 1938, ne pouvait-on pas reconnatre, entre
les diffrents aspects du fascisme, son aspect novateur et son aspect traditionnel, celui qui devait finalement prvaloir ? Il aurait
seulement fallu quitter la mthode nave de l'intellectualisme et chercher, sous le contenu manifeste du fascisme, son contenu latent.
Thierry Maulnier composait une pure du fascisme en assemblant
quelques ides qui lui plaisent : l'ide d'une rvolution sociale et l'ide
de civilisation nationale. Il s'efforait de montrer que ces ides sont
compatibles. La critique politique ne s'occupe pas d'ides seulement,
elle s'occupe des conduites que ces ides masquent plutt qu'elles
[177] ne les expriment. Mme si, sur le plan des ides, la nation et la
rvolution ne sont pas incompatibles, sur le plan de l'action et dans la
dynamique de l'histoire, un socialisme, s'il est national , cesse
d'tre un socialisme ; les bourgeois de tous les pays ont trs bien compris qu'en ajoutant au socialisme ce prfixe, on en retranche tout ce
qu'il a d'inquitant. Il faut savoir dchiffrer ce langage que les puissances comprennent du premier coup. Disons seulement pour aujourd'hui qu' placer le problme national et le problme proltarien sur le
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
119
mme plan, on corrompt en ralit la conscience socialiste, parce
qu'on la fait dchoir de l'humanisme l'empirisme ou si l'on veut de la
politique ouverte la politique close , qu'elle se trouve ds lors
qualitativement modifie, et que, par une logique vitale contre laquelle les bonnes volonts ne peuvent rien, elle cesse en fait de choisir la
rvolution parce qu'elle cesse de la choisir absolument. Le marxisme a
bien vu cette loi de tout ou rien, et sa critique de l'opportunisme ou de
la social-dmocratie renferme une psychanalyse de la vie politique
qu'il faudra bien un jour dvelopper. Six annes de douleur et de deuil
seraient comme rien pour l'exprience politique si nous continuions
penser que le fascisme aurait pu raliser le socialisme, si nous ne
comprenions pas que, ds l'origine, en reculant devant le problme
proltarien, le fascisme choisissait les solutions (d'ailleurs illusoires) de la guerre et de la conqute, si nous n'avions pas appris relier
politique extrieur et politique intrieure comme deux aspects d'un
choix indivis, si nous n'avions pas appris considrer un rgime ou un
mouvement politique comme [178] un organisme vivant o tout a
rapport avec tout.
On verra que Violence et Conscience ne va pas jusque-l. Les solutions de Thierry Maulnier restent aujourd'hui ce qu'elles taient il y a
sept ans. Il entreprenait l'gard du fascisme une critique de l'intrieur . Les jeunes gens qui lisaient la revue Combat taient de
toute vidence des sympathisants du fascisme et on leur enseignait
dans cette revue critiquer svrement les insuffisances du fascisme
en matire de politique sociale. Comme Thierry Maulnier le dit parfaitement aujourd'hui 48, chaque fascisme a une avant-garde qui remplit son insu la double fonction de rassurer les lments de gauche
rallis au rgime dans l'espoir d'une rvolution sociale et d'inquiter
les lments de droite qui, sans cette menace, tireraient le systme
dans un sens ractionnaire. On ne peut s'empcher de penser qu'en
crivant ces lignes, Thierry Maulnier fait un retour sur lui-mme. C'est
justement sa prtention d'aller la fois au-del du nationalisme et audel du marxisme qui le mettait l'avant-garde de l'idologie fasciste.
Aujourd'hui mme, alors qu'il a depuis longtemps et aussi nettement
que possible retir aux milieux fascistes toute espce de sympathie, sa
position est peine diffrente. Il enseigne que le problme proltarien
48
Violence et conscience, pp. 112 et suivantes.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
120
est le problme des problmes, que le capitalisme doit tre dtruit.
Mais il s'adresse habituellement aux lecteurs du Figaro et de Carrefour, dont on peut dire, sans froisser personne, qu'ils ne sont pas [179]
vous corps et me la rvolution sociale. Quel journal, dans la presse
de cet t, consacre Violence et Conscience deux colonnes en premire page ? L'Epoque. Que retient-elle du livre ? Justement les
conclusions si timides que nous aurons discuter. Les ides de Thierry Maulnier dans un tel milieu ne sauraient encore une fois servir que
de caution morale la politique ractionnaire, et c'est bon droit finalement que Thierry Maulnier reste sociologiquement un critique de
droite.
Tant de lucidit, d'honntet et de vigueur dans la rflexion, une
telle timidit dans le choix d'un public, et dans les conclusions, ces
deux choses ensemble ne s'expliquent chez l'auteur que par quelque
complexe politique. Le problme de Thierry Maulnier, c'est le problme de la droite intellectuelle franaise, et ce problme-l, les
hommes de trente-cinq ans le sentent d'autant mieux que d'une faon
ou de l'autre il a t le leur quelque moment. Vers 1930, l'Action
Franaise a dispos chez les tudiants d'un crdit dont les jeunes gens
d'aujourd'hui ne peuvent se faire une ide et dont il faudrait rechercher
les raisons. Il est passionnant en tout cas de voir Thierry Maulnier rejeter peu peu ce qu'il y avait de sommaire dans ses premires vues,
sans d'ailleurs s'en dbarrasser tout fait, et comment une rflexion
aussi svre tantt est retenue en de du marxisme et tantt touche
ses problmes fondamentaux.
*
*
Il y avait dans le maurrassisme de 1900 une raction [180] saine
contre les illusions kantiennes de la dmocratie. L'optimisme dmocratique admet que, dans un tat o les droits de l'homme sont garantis, aucune libert n'empite plus sur les autres liberts et la coexistence des hommes comme sujets autonomes et raisonnables se trouve
assure. C'est supposer que la violence ne fait dans l'histoire humaine
qu'une apparition pisodique, que les rapports conomiques en particulier tendent de soi raliser la justice et l'harmonie, et enfin que la
structure du monde naturel et humain est rationnelle. Nous savons aujourd'hui que l'galit formelle des droits et la libert politique masquent les rapports de force plutt qu'elles ne les suppriment. Et le pro-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
121
blme politique est alors d'instituer des structures sociales et des rapports rels entre les hommes tels que la libert, l'galit et le droit deviennent effectifs. La faiblesse de la pense dmocratique tient ce
qu'elle est moins une politique qu'une morale, puisqu'elle ne pose aucun problme de structure sociale et considre comme donnes avec
l'humanit les conditions d'exercice de la justice. Contre ce moralisme-l, nous sommes tous rallis au ralisme, si l'on entend par l une
politique qui s'occupe de raliser les conditions d'existence des valeurs
qu'elle a choisies. L'immoralisme maurrassien est d'une autre sorte.
Au lieu de conclure que l'galit et la libert, n'tant pas donnes, sont
faire, il renonce l'galit et la libert. Ayant reconnu que la vue
que nous prenons de l'homme par conscience est abstraite et qu'une
socit n'est pas un assemblage de consciences pures, libres et gales,
mais d'abord un systme d'institutions auxquelles les consciences doivent ce qu'elles [181] peuvent avoir de raison et de libert effectives,
il rcuse dfinitivement le jugement des consciences et fait de la politique une technique de l'ordre o les jugements de valeur n'ont pas de
place. Le maurrassisme est pour une bonne part une critique de l'intrieur au profit de l'extrieur. La justice, la vrit dont les hommes
croient possder la source en tant qu'ils sont des consciences, elles
reposent en ralit sur les tribunaux, sur les livres et les traditions, elles sont donc fragiles comme eux et comme eux menaces par le jugement individuel. L'individu ne vaut et ne pense correctement que
par ses appuis extrieurs et l'essentiel est de les lui conserver. Le politique est celui qui a reconnu le prix des choses existantes et qui les
dfend contre la fantaisie de l'intrieur. Il s'agit de sauver l'homme
historiquement constitu contre la nature qui, en nous et hors de nous,
le menace toujours parce qu'elle est purement transitive. Nous ne devons donc faire aucune confiance au cours des choses, nous devons
vnrer les chances admirables qui ont permis une humanit de
paratre, il n'est pas question d'abandonner aux hritiers un hritage
qu'ils dilapideraient, ni de les consulter sur l'usage qu'il faut en faire. Il
y a ceux qui savent parce qu'ils ont compris l'histoire, et ceux qui follement ne consultent que leur conscience. De l un pathos pessimiste,
cynique et autoritaire dont on trouve des traces dans tous les ouvrages
de Thierry Maulnier. Ainsi quand il disait que la haine et les passions
flambent mieux que la bonne volont ou qu' une bonne partie de la
politique vritable est sans doute de faire servir au bien gnral ce
qu'il est convenu d'appeler les vices des [182] hommes, et d'empcher,
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
122
autant qu'il se peut, de leur nuire ce qu'on appelle leurs vertus 49.
Ainsi quand il voque la puissance efficace de la btise 50. Ainsi
quand il dfinit la libert le bien que revendiquent ceux qui aspirent
la puissance tout le temps qu'ils sont encore faibles 51. Ainsi chaque fois qu'il parle de la dmocratie, et aujourd'hui mme quand il insiste sur les hasards de l'histoire 52. Barrs et Maurras pensaient que le
monde et notre vie sont un tumulte insens, sur lequel paraissent quelques formes fragiles et prcieuses. Le fond de leurs ides est le dsespoir de 1900. Thierry Maulnier doit sa premire formation politique
ce sentiment d'un chaos possible, ce respect de l'homme et ce mpris
des hommes.
Toutefois, ds son livre de 1938, une autre ide parat, qui conduit
ailleurs. Il rejette le progrs ncessaire, mais il rejette galement l'ide
maurrassienne d'une nature humaine immuable qui rduit les problmes politiques ceux d'une immuable sociologie de l'ordre. Il est
absurde de nier que l'homme soit capable de progrs ; il n'est pas
moins absurde de croire que ces progrs le dlivrent (...). Chaque fois
qu'il introduit un lment nouveau dans le systme de relations
connues qu'est une vieille civilisation, l'homme transforme dans des
proportions invaluables ce systme de relations tout entier et peut y
introduire le germe d'une dsorganisation [183] immense ; ainsi certains progrs ont pu tre pays de reculs beaucoup plus grands (...).
Sachons au moins que nous ne crons rien quoi nous ne devions ensuite faire face. cette condition seulement nous pourrons aborder les
problmes poss par le monde moderne sans le ddain stupide, la terreur imbcile et le niais optimisme qui sont les masques de la pense
impuissante 53. Thierry Maulnier introduisait ainsi l'ide d'une dynamique sociale et d'un mouvement de l'histoire. La politique ne pouvait donc plus se limiter aux recettes prouves d'un art de gouverner
et un heureux usage des hasards. Elle exigeait une analyse de la situation prsente, elle reconnaissait un certain sens de l'histoire, dont
elle avait tenir compte sous peine d'tre inefficace. On tait amen
49
50
51
52
53
Au-del du nationalisme, p. 84.
Ibid., p. 23.
Ibid., p. 106.
Violence et conscience, p. 10.
Au-del du nationalisme, pp. 5-16.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
123
distinguer 54 parmi les vnements empiriques ceux qui font faire
l'histoire un pas dont elle ne reviendra pas, parce qu'ils rpondent aux
problmes du temps, et ceux qui ne sont que des aventures parce
qu'ils reposent sur un concours de circonstances auquel ils ne survivront pas. Rien ne garantit que le pouvoir reviendra aux hommes et
aux forces qui sont le mieux capables de dominer les difficults du
moment. Le cours de l'histoire est contingent, ce n'est pas toujours le
meilleur ou le plus vrai qui l'emporte. L'histoire est pleine d'occasions perdues, de richesses gches, d'engagements sur des routes sans
issues 55. Le succs, au moins pour un [184] temps, peut choir aux
idologies les moins rigoureuses. Il y a des doctrines vraies qui, comme disait Pguy, n'obtiennent pas l'inscription historique et inversement des vnements voyants qui ne font pas faire un pas l'histoire.
Mais l'histoire est du moins rationnelle en ceci qu'un mouvement qui
ne russit pas apercevoir sa destination historique et poser les problmes d'o il est n a toutes les chances de dvier, d'avorter, d'tre
effac du cours des choses ou de ne laisser dans la trame de l'histoire
qu'une dchirure phmre 56. Le mouvement qui russit un moment n'est pas toujours le plus vrai ni le plus valable, mais il faut qu'il
le soit s'il doit durer. Si, par exemple, le fascisme ne surmonte l'antagonisme des classes que par l'exaltation phmre du sentiment national et par un nouveau recours la bonne volont des opprims, s'il
continue d'ignorer les problmes au lieu de les rsoudre, il disparatra
faute d'avoir rejoint par sa volont consciente les motifs profonds d'o
il est n et d'avoir assum sa propre vrit. On voyait donc apparatre
l'ide d'une politique qui ne se cre pas ex nihilo dans l'esprit des individus, mais se prpare et s'labore dans l'histoire, et non pas au sens
maurrassien d'une histoire qui se rpte, mais au sens d'une histoire
qui se dpasse et qui prsente aux hommes des situations neuves
dominer. L'histoire comporte des vecteurs, elle a un sens, non que toutes choses s'y disposent en vue d'une fin, mais parce qu'elle expulse
les hommes et les institutions qui ne rpondent [185] pas aux problmes existants, non que tout ce qui arrive mrite d'tre, mais parce que
tout ce qui disparat mritait de disparatre. Or, si l'on admet ainsi la
prsence au cur de l'histoire de certains problmes efficaces, l'analy54
55
56
Ibid., pp. 20-21.
Ibid., p. 21.
Ibid., p. 31.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
124
se de notre prsent ne doit pas s'adresser seulement aux volonts et
aux ides des hommes, elle doit tre totale, elle doit s'attaquer l'arrangement mme des choses et la situation conomique, qui, comme
tout le reste, acquiert dsormais une signification historique. L'ide
d'une logique de l'histoire a pour consquence invitable un certain
matrialisme historique. Par ces deux biais, Thierry Maulnier rencontrait le marxisme. Qu'en pensait-il donc ?
Il lui reprochait d'abord d'avoir sous-estim le rle de l'homme
dans la ralisation de l'histoire. Pour lui, l'histoire, si elle pose des
problmes, n'y apporte de soi aucune solution. La dcomposition du
capitalisme ne porte pas en elle-mme l'avnement du rgime qui le
remplacera. C'est l'homme qu'il appartient de concevoir librement
les institutions qui tireront du chaos un nouvel ordre et qui retiendront
l'histoire au bord du nant. A notre sens, Thierry Maulnier n'tait ici
en dsaccord qu'avec un marxisme superficiel. Comment, en effet,
nier le rle de l'initiative humaine, si la classe n'est efficace qu'en tant
qu'elle a pris conscience d'elle-mme ? Puisque le marxisme a toujours dit que la rvolution n'est pas fatale, pour lui comme pour Thierry Maulnier il n'y a qu'un serai-dterminisme 57 [186] de l'histoire.
Pour le marxisme comme pour Thierry Maulnier, la dtermination
historique des effets par les causes passe par la conscience humaine, et
il en rsulte que les hommes font leur histoire, bien qu'ils ne la fassent
pas dans l'indiffrence et sans motifs. En accordant que la volont politique prend appui sur une situation de fait et prolonge vers leur solution d'avenir des antagonismes donns, Thierry Maulnier a, de son
ct, accord au marxisme tout ce qu'il demande : la dcision humaine, puisqu'elle prend ses motifs dans le cours des choses, apparatra
donc, au moins aprs coup, comme appele par elles, de sorte que
nous ne pourrons jamais, dans l'histoire accomplie, dcouvrir aucune
rupture, aucun hiatus entre les effets et les causes. A cet gard, Violence et Conscience formule avec une nettet parfaite les consquences d'une mthode historique en politique : Ds le moment o il est
bien entendu que l'histoire n'est jamais donne aux hommes comme
une aire vide o ils peuvent construire ce qui leur plat, mais comme
un certain tat de choses produit par des causes antrieures, dont ils ne
peuvent pas faire qu'il ne soit pas, et en considration duquel il leur
57
Au-del du nationalisme, p. 209.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
125
faut bien, bon gr mal gr, rgler leur conduite, la libert qu'elle leur
laisse est seulement la libert de comprendre plus ou moins bien le
monde o ils se trouvent et de se comporter plus ou moins avantageusement dans ce monde. De ce point de vue, si une infinit de reprsentations et de conduites possibles sont contenues dans le fait de la
conscience, il n'y a gure qu'une reprsentation et qu'une conduite
possibles contenues dans le plus haut degr de conscience. C'est dans
le [187] plus haut degr de conscience que l'homme accomplit et dtruit en mme temps la libert qui lui est laisse par l'histoire du fait
mme de sa conscience 58.
En ralit, ds 1938, Thierry Maulnier n'tait plus spar du marxisme que par la manire dont il dcrivait la situation fondamentale de
notre temps. Nous l'avons dit, il y voyait deux faits galement essentiels : d'abord l'apparition dans les socits modernes d'un antagonisme de classe qui dtruit l'unit de la nation, le proltariat se sentant
bon droit tranger dans une patrie o il est admis vendre son travail
sans rester propritaire des produits de son travail, ensuite la rsistance de la nation et, particulirement, des classes moyennes ce processus de dcomposition. Toute analyse du prsent lui paraissait abstraite si elle omettait l'un de ces deux faits ou tentait de le subordonner
l'autre. Il reprochait prcisment au marxisme de ne nous donner
qu'un schma dcharn de l'histoire, parce qu'il rduisait l'histoire
l'histoire conomique, et dformait mme cette dernire en traitant
comme un phnomne de surface la rsistance des classes moyennes
la proltarisation et leur attachement aux valeurs des civilisations nationales. Il est vrai, pensait Thierry Maulnier, que la faon d'tre et de
penser dpend chaque moment des formes de la production, mais
non moins vrai que dans un pays donn, un moment donn, la manire de travailler et de produire dpend des murs, des valeurs reues et de la psychologie du pays considr. La lutte [188] des classes
elle-mme n'a lieu qu' l'intrieur d'une communaut nationale, sur la
base des acquisitions culturelles qui font l'unit de la nation au moment mme o elle se scinde. Nous ne pouvons dduire des changes conomiques, sinon de faon arbitraire et verbale, les changes
sociaux plus complexes, nous devons considrer, au contraire, l'existence d'un milieu social complexe (...) comme la condition vitale de
58
Violence et conscience, p. 139.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
126
tout change conomique, mme le plus primitif. Si considrable que
soit la part de l'change conomique ds l'origine, dans la vie sociale,
aussi considrable que le sont les besoins organiques vitaux et les
moyens de les satisfaire dans la vie de l'individu humain, elle ne
constitue pas plus la structure de la socit que le besoin de manger,
de dormir ou de se vtir ne constitue la structure de la vie individuelle. 59.
Sur ce point encore, la critique de Thierry Maulnier portait beaucoup moins contre le marxisme lui-mme que contre les exposs qu'on
en fait couramment ou contre certaines formules authentiquement
marxistes, mais qui schmatisent la doctrine. On prsente souvent le
marxisme comme une rduction des phnomnes culturels aux phnomnes conomiques ou comme une rduction de l'histoire aux
conflits dintrts. Les marxistes parlent souvent de la bourgeoisie
comme d'une personne conomique , qui agit toujours en vue de
ses intrts et pour qui les ides et les croyances ne sont que des
moyens. Il n'en est pas moins vrai que ces [189] interprtations et ces
formules restent ingales au marxisme et en laissent peut-tre chapper l'intuition centrale. La grandeur du marxisme n'est pas d'avoir trait l'conomie comme la cause principale ou unique de l'histoire, elle
est plutt d'avoir trait l'histoire culturelle et l'histoire conomique
comme deux aspects abstraits d'un unique processus. Le travail, sur
lequel repose l'histoire, n'est pas, dans son sens hglien, la simple
production des richesses, mais, d'une faon plus gnrale, l'activit par
laquelle l'homme projette autour de lui un milieu humain et dpasse
les donnes naturelles de sa vie. L'interprtation marxiste de l'histoire
ne la rduit pas au jeu conscient des intrts, elle admet seulement que
toute idologie, et mme par exemple une morale hroque qui prescrit aux hommes de mettre en jeu leur vie, est solidaire de certaines
situations conomiques qui la portent dans l'existence : la morale des
matres ne cesse d'tre une conception individuelle, ne devient institution et ne reoit l'existence historique que lorsqu'elle s'incarne dans les
relations conomiques du matre et de l'esclave et dans une socit
fonde sur le travail servile. Le matrialisme marxiste consiste admettre que les phnomnes de civilisation, les conceptions du droit
trouvent dans les phnomnes conomiques un ancrage historique,
59
Au-del du nationalisme, p. 64.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
127
par lequel ils chappent la nature transitive des phnomnes intrieurs et se sdimentent au-dehors en Esprit Objectif. La vie conomique n'est pas un ordre spar auquel les autres se rduisent, elle reprsente dans le marxisme l'inertie de la vie humaine, c'est en elle que les
conceptions s'inscrivent et se stabilisent. Plus srement que les livres
ou que [190] les enseignements, les modes du travail transmettent aux
gnrations nouvelles les manires d'tre des prcdentes. Il est vrai
qu' un moment donn, dans une socit donne, la manire de travailler exprime la structure mentale et morale comme le moindre rflexe d'un corps vivant exprime la manire fondamentale d'tre au
monde du sujet total. Mais, en mme temps, la vie conomique est le
porteur historique des structures mentales, comme notre corps maintient les traits fondamentaux de notre conduite par-dessous les variations de nos tats d'me, et c'est pourquoi on connatra plus srement
l'essence d'une socit par l'analyse des relations inter-humaines figes et gnralises dans la vie conomique, que par celle de mouvements d'ides fragiles et fugaces, comme on connat mieux un homme
par sa conduite que par ses penses. Dans le reproche de matrialisme
abstrait que Thierry Maulnier faisait au marxisme, il y avait donc
beaucoup d'injustice. Pas plus que de Man, qu'il nomme et dont il s'est
peut-tre inspir, Thierry Maulnier n'avait alors pris la peine de dgager le marxisme des quivoques mcanistes et utilitaristes auxquelles
peuvent prter certaines de ses formules. La critique de ces formules
laisse intacte la pense principale du marxisme qui est celle d'une incarnation des ides et des valeurs, elle ne nous autorise pas transcender ou dpasser l'analyse conomique, ni laisser tomber le
fil conducteur de la lutte des classes.
Or, c'est bien en fin de compte ce que faisait Thierry Maulnier.
Sous prtexte que, dans chaque vnement singulier, la lutte des classes ne transparat [191] jamais qu' travers les particularits d'un pays
et d'un temps, et qu'en ce sens elle n'est jamais pure, jamais seule en
cause, il faisait comme si certaines ralits historiques chappaient
son influence et traitait, par exemple, la communaut nationale comme un fait aussi essentiel. Il refusait en somme la mise en perspective
parce que les faits historiques comportent, outre leurs conditions conomiques, des conditions morales et psychologiques. Mais la pluralit
des conditions n'interdit pas de traiter l'une d'elles comme condition
principale. C'est ce que font tous les jours les savants. Bien que dans
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
128
la nature tout dpende en quelque mesure de tout et qu'il n'y ait pas de
phnomne isolable la rigueur, nous avons des lois, c'est--dire des
schmas statistiquement vrais qui s'appliquent peu prs au cours de
la nature, parce que, grce une sorte d'amortissement, les phnomnes les plus loigns n'interviennent que d'une manire ngligeable
dans ce que nous observons ici et maintenant. De mme, bien que,
dans les vnements pris un un, les conditions conomiques et les
autres soient mles d'une manire inextricable, on garde le droit de
donner un privilge aux premires dans l'analyse des phnomnes, s'il
est tabli que, considrer un segment d'histoire assez tendu, elles
dessinent plus fidlement le cours des choses. On ne saurait en tout
cas cantonner dans certains secteurs de l'histoire l'analyse conomique, elle pntre partout. La raction des classes moyennes contre la
menace de proltarisation n'est pas un phnomne distinct de la lutte
des classes et ne marque pas un chec de l'analyse marxiste : elle a sa
place dans la [192] dialectique des classes, elle en est une nouvelle
phase et une nouvelle illustration. La nation, que Thierry Maulnier
traite comme un fait irrductible, est, elle-mme, investie par la lutte
des classes, soit que la bourgeoisie invoque l'intrt national et le danger extrieur pour ramener l'obissance les grvistes, soit que le proltariat, comme en 1793, en 1871 ou mme en 1944 reprenne son
compte l'hritage national abandonn par la bourgeoisie. Quand Thierry Maulnier oppose le mouvement proltarien et les exigences du salut
national, le fait proltarien et le fait national, il y a l un trange postulat. Car il peut arriver que le mouvement proltarien soit pour la nation, non pas un danger, mais la condition du salut. Il y a, vrai dire,
deux nations : la nation comme ralit brute, avec son armature bourgeoise existante, celle-l est, sans aucun doute, menace par la lutte
des classes, et la nation comme mode original de vie et de conduite, on ne voit pas bien ce qu'elle aurait craindre d'une rvolution
proltarienne mondiale. On ne peut pas citer le fait national comme un
rsidu inassimilable pour l'analyse marxiste, puisqu'on le voit se ddoubler justement sous l'influence des facteurs historiques qu'elle a
dcouverts. Toute politique qui dclare se fonder sur le fait proltarien
et sur le fait national, comme si le premier n'enveloppait pas le second, sous les apparences flatteuses d'une politique concrte ,
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
129
n'est, en ralit, comme Thierry Maulnier le dit aujourd'hui du fascisme, qu'un essai de diversion 60.
[193]
Avouons seulement que nous sommes mieux prpars reconnatre ces vrits aujourd'hui qu'en 1938. Nous avions alors devant nous
le fascisme en priode d'essor, c'est--dire une fort de baonnettes,
mais aussi une mise en scne sociale et rvolutionnaire , impressionnante au moins pour des intellectuels. lire dans luvre
pendant quatre ans des articles sur l'Europe socialiste et sur l'talon travail, et les confronter avec la ralit de l'Allemagne en guerre,
nous avons appris ce que c'est que la propagande. Sous nos yeux, le
fascisme est devenu d'abord cette arme qui se battait et, enfin, ce
monceau de ferrailles et de ruines o subsistent, tant bien que mal, des
populations uses, sans ide et sans volont politiques. Il nous faut un
effort pour nous rappeler sa mine d'il y a sept ans, pour le distinguer
de la guerre o il s'est englouti, pour lui rendre ses prestiges de socit
nouvelle au-del du marxisme . Par ailleurs, Vichy et le sacrifice
de tant de proltaires franais nous ont montr jusqu' l'vidence que
l'anticommunisme pouvait mener la trahison et la volont rvolutionnaire assumer la nation. Enfin, maintenant que la France a clairement cess d'tre une puissance de premier ordre et que l'existence
nationale nous apparat dans une dpendance si troite l'gard des
imprialismes mondiaux, notre puissance diminue ne nous permet
plus de confronter gravement, comme des faits d'gal poids, le drame
de l'organisation conomique mondiale et le fait national franais, notre humiliation nous dbarrassera peut-tre du provincialisme si frappant dans la politique franaise d'avant-guerre et, particulirement,
dans la politique dAction franaise. [194] Pour avoir, pendant des
annes, attendu notre salut du monde, nous avons peut-tre appris
poser des problmes mondiaux et, pour avoir fait connaissance avec
les infra-structures, nous ne pouvons plus ignorer la matire de l'histoire, comme un malade ne peut plus ignorer son corps.
Ce qui est sr, c'est que, dans son nouveau livre, Thierry Maulnier
rend justice au marxisme comme il ne l'avait jamais fait et propose
une vue de l'histoire qui en retient tout l'essentiel. L'ide de mystification historique semble avoir clair pour lui toute la conception
60
Violence et conscience, p. 93.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
130
marxiste de l'histoire. A un certain degr de dcomposition de la
socit capitaliste, crit-il, le capitalisme ne peut plus trouver de sauvegarde que dans une attitude rsolument anticonservatrice, la caste
capitaliste ne peut plus trouver d'hommes capables de lutter contre la
rvolte proltarienne qu'en dehors de ses propres rangs, la structure
conomique qui comporte la spoliation du travail et la domination de
l'argent ne peut plus compter pour prolonger son lent dprissement
que sur les mythes du dsintressement et de l'hrosme. Il ne s'agit
plus de briser de front l'lan rvolutionnaire anticapitaliste, mais
d'orienter cet lan selon une direction oblique qui attnuera la force du
choc et prservera une partie des institutions existantes 61. Comme
par ailleurs Thierry Maulnier exclut l'interprtation du fascisme comme dguisement autoritaire du grand capitalisme 62, il veut donc
dire que la manuvre [195] est chez presque tous prconsciente. Il
n'est pas sr aprs tout qu' l'exception de quelques matres , aucun
bourgeois ait jamais conu la diversion fasciste sous forme de projet
dlibr. Le mystre de l'histoire est justement que, sans plan prconu, les individus se comportent en tous points comme s'ils avaient
une puissance infinie de prvision, que par exemple le bourgeois
choisit dans tous les domaines, politique, morale, religion, art militaire, avec une sret infaillible, les vues et les valeurs qui en fait
rendront possible le maintien du capitalisme. Complot, prmditation
ou concidence ? se demandait-on au procs Ptain. Ce n'tait probablement rien de tout cela. Mais Ptain, tel que l'avaient form et dfini
cinquante annes en milieu militaire et dix ans en milieu prfasciste,
comme par une sorte de rflexe, adoptait en chaque circonstance, et
par exemple devant le problme de l'armistice, l'attitude qui risquait le
moins de librer les forces rvolutionnaires. La logique de l'histoire
n'opre pas par ides claires et par projets individuels, elle a pour instruments les complexes politiques et les projets anonymes qui donnent
un ensemble d'individus un certain style commun, fasciste ou
proltarien par exemple. Dans la mesure o nous n'avons pas
compris que nos actions, en passant de nous dans les choses, prennent
un certain sens statistique et objectif qui peut tre assez diffrent de
celui que nous leur donnions, nous sommes surpris en face d'elles,
nous ne les reconnaissons pas, nous sommes tromps par le [196]
61
62
Violence et conscience, p. 104.
Ibid., p. 93.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
131
mystrieux pouvoir d'autodtermination 63 dont l'histoire, dit
Thierry Maulnier, semble doue. De l cet air de dormeurs mal veills que l'on voit certains tratres quand l'vnement leur montre
soudain la figure inconnue de leur propre vie. L'histoire n'est faite ni
par les ides seules, ni par des intrts connus pour tels, mais par des
intrts dguiss en ides, par des ides tombes l'tat de soucis et
d'angoisses vagues dans le va-et-vient confus de l'existence. Si le
dterminisme de la Seconde Guerre mondiale ne peut en aucun cas
tre rduit au jeu des causes conomiques et si les causes conomiques de la guerre n'y jouent que dans un enchevtrement et une confusion assez difficilement dchiffrables, il y a toutefois dans ce complexe historique o toutes les forces qui rgissent les socits ont leurs
cheminements, leurs angles d'attaque et leurs interfrences, un systme de dsquilibre dont l'influence parat guider les flux et les reflux
de la grande bataille, peu prs comme les mouvements de l'ocan
sont conduits par une gravitation plantaire. La guerre de 1939 est,
n'en pas douter, dans une considrable mesure, la guerre des peuples
pour la possession des grandes sources de matires premires et pour
la domination par ces sources de matires premires 64. On aperoit
l'ide d'une sorte de dterminisme global ou latral de l'conomie, qui
laisse jouer dans chaque cas singulier les autres sortes de conditions,
quitte les [197] inflchir dans son sens. La discussion du marxisme a
longtemps t conduite comme s'il s'agissait d'assigner la cause de
l'histoire, et comme si chaque vnement devait tre en rapport de
causalit linaire avec un autre vnement dont il s'agissait alors de
savoir s'il est conomique ou idologique , et l'on croyait
triompher du marxisme en montrant qu'il y a des exemples de causalit idologique . Mais il va de soi que l'idologie ne saurait son
tour tre dtache de son contexte conomique. Si l'on refuse comme
abstraite une histoire matrialiste, on doit, pour les mmes raisons,
refuser une histoire idaliste ou spiritualiste. On conclura donc que
chaque vnement comporte des dterminants de tous les ordres, et
certains croient encore, par ce biais, dpasser le marxisme, puisquaucune mise en perspective n'est absolument exclue. Ils ne voient
pas que le marxisme, dans ce qu'il a d'essentiel, est justement cette
ide que rien ne peut tre isol dans le contexte total de l'histoire, avec
63
64
Violence et conscience, p. 46.
Violence et conscience, p. 120.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
132
en plus l'ide que les phnomnes conomiques, raison de leur plus
grande gnralit, contribuent davantage au discours historique. Ils
n'expliquent pas tout ce qui se passe, mais aucun progrs dans l'ordre
de la culture, aucun pas historique n'est possible sans un certain arrangement de l'conomie qui en est comme le schma et le symbole matriel. Prenons garde (...) dit Thierry Maulnier, de ne pas nous laisser entraner trop loin par cette victoire apparente sur le matrialisme . Nous avons seulement chass la production des donnes matrielles de la base , o Marx lavait place pour la rintroduire au
cur de la ralit sociale. [198] Il ne s'agit pas maintenant d'expulser nouveau le travail producteur de ce cur de la ralit sociale
humaine o nous l'avons rencontr, baign tout entier par elle, mais la
baignant tout entire, associ toutes ses formes et toutes ses manifestations par une pntration mutuelle infinie et par une pleine rciprocit. Il ne s'agit pas de rejeter la production des donnes matrielles dans les dpendances de l'histoire, dans les cuisines ou les communs de la socit humaine, comme le font avec pudeur et dgot les
historiens idalistes. La production des donnes matrielles de la vie
n'est pas la base de l'histoire humaine, elle n'en est pas davantage la
servante passive et dshonore, elle se trouve dans cette histoire, solidement tablie en elle, agissant sur elle par de puissantes et continuelles influences, la dterminant et dtermine par elle, pour ainsi dire de
plain-pied. Nous ne pouvons ni l'hypostasier dans un primat en quelque sorte transcendant, ni la rejeter dans les zones honteuses ou ddaignes. Le producteur des donnes matrielles, l'homme qui arrache
au monde la vie de ses semblables, cet homme n'est pas le crateur de
la socit humaine considre dans son tre historique car il est luimme, avec son travail, cr par elle, mais il n'est pas davantage
son esclave : il est l'instrument des puissantes transformations qu'elle
opre sur elle-mme travers la nature qu'elle combat et souvent domine. L'histoire ne sort pas de lui ; elle ne passe pas au-dessus de lui ;
elle passe par lui (...). Il serait vain de nier la part prpondrante prise
dans les activits de la socit humaine par l'effort de lhomo faber
pour assurer la survivance [199] de l'homme dans la nature ; et il va de
soi que cet effort, rayonnant lui-mme de toutes parts dans la totalit
sociale en fonction de laquelle il est produit, dtermine dans une large
mesure les autres formes de l'activit humaine, la production et la
transformation des lois, des moeurs, des croyances, de styles de civilisation, et, en fin de compte, le comportement et le contenu de la cons-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
133
cience. D'o il rsulte que, si la totalit sociale n'est pas dtermine
dans ses superstructures par un substrat conomique qui en serait le
producteur, on peut dire que cette totalit se dtermine elle-mme
principalement par l'intermdiaire des activits au moyen desquelles
elle assure sa survivance et transforme la nature qui l'entoure 65.
Quand on se rappelle les protestations sommaires de La Crise est dans
lhomme contre le machinisme amricain et sovitique, on mesure le
changement. Si l'conomie est dans la socit ce qu'est le cur dans
l'organisme, il ne peut plus tre question de contingenter les progrs
conomiques, il faut guetter, comme disait Balzac, le mystre de la
civilisation dont ils sont peut-tre l'bauche visible.
Il semble que Thierry Maulnier ait renvers ses positions de dpart.
Dans une histoire o tout se tient selon une trange logique, le vrai
politique ne cherchera pas jouer des passions humaines pour parvenir des fins arbitrairement choisies. Jet avec les hommes dans un
drame qui ne va pas forcment au bien, mais qui en tout cas va quelque part, il a compris que le [200] conservatisme est l'utopie, il ne
trouve dans les hommes et dans les choses rien d'insignifiant, il les
interroge et les coute, il ne peut les transformer qu'en eux-mmes. Le
temps du cynisme juvnile est bien pass : Gouverner l'homme par
ses passions, c'est aussi dangereusement les grandir. La flatterie et la
contrainte sont les deux faces du mpris : elles font, certes, de l'homme un bon instrument ; mais faire de l'homme un instrument, l est le
mpris 66. Toutefois on change plus vite de philosophie que de
morale et de morale que de politique. Si, de la philosophie de l'histoire, nous passons aux conclusions pratiques, nous trouverons Thierry
Maulnier en arrire de ses propres ides.
*
*
S'il est vrai que la lutte des classes est un fait essentiel, que l'antagonisme des classes brise les formes culturelles constitues et qu'enfin
de proche en proche la dcomposition conomique du capitalisme corrompt toutes les ides, toutes les valeurs qu'il avait accrdites, il
semble naturel de conclure qu'on ne reviendra une conomie et une
civilisation organiques que par l'expropriation des propritaires et,
65
66
Violence et conscience, pp. 151 et 153.
Violence et conscience, p. 116.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
134
comme disait Lnine, en volant ce qui a t vol . Or Thierry
Maulnier impose au contraire cette reprise de possession par l'homme de sa propre vie une srie de conditions si minutieuses qu'elles
quivalent pratiquement un refus de la rvolution. Il admet bien que
le problme est de [201] supprimer le salariat et de rtablir le lien du
producteur au produit. Cette fraction du travail qui, dans le systme
capitaliste, sert la multiplication du capital, doit tre rmunre, sinon en argent et avec le droit d'employer cet argent l'achat de biens
consommables (car alors disparatrait, avec l'accumulation, la possibilit de nouveaux investissements et d'un dveloppement technique
nouveau), du moins en une monnaie de production qui fasse du
travailleur le co-propritaire des entreprises crer. L-dessus, Thierry Maulnier ajoute : Quant aux dtenteurs des instruments de production actuellement existants, ils se trouveront peut-tre dans ce cas
assez heureux qu'on leur en laisse la proprit, en leur tant le droit de
se servir de cette proprit pour s'approprier gratuitement la plusvalue de travail de ceux qu'ils emploient et s'assurer ainsi le monopole
dans la cration et la proprit de nouvelles richesses 67. Ainsi le
mme auteur qui a dcrit l'occupation de l'tat par la bourgeoisie
peu prs comme le font les marxistes attend la rvolution d'un tat qui
n'aura pas t libr par l'expropriation des propritaires. Comment ne
pas voir que ce sera de deux choses l'une : ou bien les rformes de
Thierry Maulnier supprimeront vraiment le capitalisme, et alors il serait naf de croire que les propritaires des instruments de production
seront assez heureux du hochet qu'on leur laissera. Ou bien leur
pouvoir par quelque biais sera maintenu, et alors ils tolreront la rforme, mais elle ne sera plus qu'une [202] nouvelle mystification.
Concrtement, gui fera la rforme ? Une majorit parlementaire ?
Mais, comme on, verra, il n'est pas sr que Thierry Maulnier accepte
une forme quelconque de dmocratie, et d'ailleurs nous savons bien
de quels moyens disposent les puissances, justement la faveur de la
libert de la presse, pour susciter les mouvements d'opinion et les manifestations qui paralysent une majorit parlementaire. Le problme
proltarien est pos, dit Thierry Maulnier, il y a comptition pour le
rsoudre. Peu nous importe quel sera le vainqueur de la comptition
universelle et que sa main droite tienne l'pe, le sceptre ou le mar-
67
Violence et conscience, p. 173.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
135
teau, mais seulement la pense qui le guidera 68. Et ailleurs : Que
l'on imagine les moyens politiques d'une transformation radicale de la
socit (c'est--dire de l'tat politique) entre les mains d'un homme ou
d'un groupe d'hommes pourvus d'assez d'audace, d'esprit de dcision
et de conscience historique pour supprimer le proltariat en tant que
classe, c'est--dire pour imposer dans la socit une structure conomique o le salariat sera aboli... 69. Voil donc quoi nous aboutissons : le socialisme ralis par les dcrets d'un homme ou d'un groupe
d'hommes clairs ! On croyait Thierry Maulnier acquis cette ide,
peut-tre la moins contestable des ides marxistes, qu'une politique efficace n'est pas celle que conoivent quelques individus leur
table, mais celle qui prolonge le mouvement de l'histoire et que portent les forces historiques ? Qui appuiera les [203] dcisions de nos
rformateurs, sinon ceux qu'elles vont librer, et comment les appuieront-ils, sinon par la grve et l'occupation des usines ? Il faudra donc
leur expliquer qu'ils n'ont pas s'approprier ni mme grer les usines
qu'ils occupent ? Et s'ils prolongent l'occupation ? Qui fera vacuer les
usines, sinon la police, et au profit de qui, sinon des propritaires existants ? Etait-ce la peine de rflchir sur le marxisme et de rejeter d'une
manire premptoire toute espce de rformisme pour aboutir ce
nouveau plan ? Si le socialisme est, non pas une ide d'intellectuel,
mais, comme le disait dj Thierry Maulnier en 1938, ce qui demande natre , la forme d'existence sociale qui se dessine dans
l'alination proltarienne et dans la rvolte contre cette alination, un
socialisme non proltarien est un cercle carr.
Thierry Maulnier a bien pu liminer ses prjugs dans l'ordre philosophique, ils restent efficaces quand on en vient aux problmes
concrets, les seuls, aprs tout, qui comptent en politique, comme l'a
trs bien compris le commentateur de L'poque. ce moment sa pense faiblit et devient banale. Ce n'est plus lui qui parle. Le contrle
ouvrier de la gestion ? Il s'agit l d'une contamination absurde
des programmes de rforme conomique par les principes thoriques
de la dmocratie , c'est--dire par des mthodes qui ont fait la
preuve de leur lenteur paralysante et de leur inefficacit dans l'ordre
68
69
Violence et conscience, p. 58.
Ibid., p. 165.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
136
politique 70. C'est vite dit. [204] Est-il srieux de comparer la dmocratie politique o chacun est appel donner son avis sur des problmes abstraits, et surtout o, entre l'lecteur et les dcisions du lgislatif, s'interposent toute une srie d'influences que Thierry Maulnier
lui-mme a signales, avec la gestion quotidienne de l'entreprise
par les travailleurs, parmi lesquels se trouvent un certain nombre d'ingnieurs et de directeurs aussi comptents que le propritaire de
l'entreprise ou le prsident du conseil d'administration en ce qui
concerne la marche gnrale de l'affaire ? Il suffit d'avoir observ un
atelier au travail, une section au combat, ou un sardinier la pche
pour comprendre que l'autorit technique n'est jamais conteste quand
elle ne sert pas cacher des intrts inavouables. Les hommes ne sont
peut-tre pas bons, mais ils ne sont pas si btes, et quand on pense la
masse des sacrifices qu'ils ont non seulement subis, mais finalement
accepts alors que la ncessit n'en tait pas vidente, on peut se demander s'ils n'en accepteraient pas de plus grands pour la russite
d'une conomie laquelle ils se sentiraient personnellement intresss
et qui serait leur affaire. La question n'est pas de savoir si la rvolution dans son dbut n'entranerait pas de dsordre dans la production,
elle est de savoir quelle solution on peut donner au problme proltarien, hors celle-l. Une politique pour le peuple qui ne se fait pas
par le peuple ne se fait finalement pas du tout, tel est l'a, b, c d'une
politique historique. On se rappelle les rsultats de l'exprience de
Man en Belgique. Adopt en particulier par le Parti Ouvrier Belge, le
plan avait t expos devant des concentrations [205] populaires
qui devaient tre couronnes par une concentration gante
Bruxelles, avec menace de grve gnrale. Deux mthodes taient
possibles : la mthode rformiste ou parlementaire et la mthode rvolutionnaire. Ou bien les travailleurs tous les chelons reprendraient
possession de l'appareil conomique et imposeraient la constitution
d'un gouvernement planiste, on irait alors de la rvolution au pouvoir, ou bien les travailleurs resteraient au travail et des dcisions
lgislatives mrement dlibres raliseraient le plan : on irait alors,
disait de Man, du pouvoir la rvolution. Conformment l'idologie
planiste, de Man choisit la seconde mthode. On sait ce qu'il advint.
Le plan ne fut jamais appliqu. Historiquement il est absurde, si l'on
prend pour fin la libration du proltariat, de chercher atteindre cette
70
Violence et conscience, p. 193.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
137
fin par des moyens non-proltariens, et le choix de tels moyens signifie en clair que l'on renonce la fin prtendue. La fin et les moyens ne
peuvent tre distingus que dans les conceptions de l'intellectuel, et
non sur le terrain de l'histoire. Toute politique qui n'admet pas ce principe reste en de du marxisme sous prtexte de le dpasser .
Qu'on ne cherche pas ici dguiser une politique ractionnaire
sous ce prtexte que la rvolution doit tre dirige. Le problme de la
direction rvolutionnaire existe, mais il se pose une fois qu'on a libr
l'conomie de ses parasites, non avant. Un homme comme Lnine
l'avait, bien entendu, rencontr sur sa route. Il ne pensait pas qu'il y
et de solution spculativement parfaite : on ne peut construire une
politique ni sur l'opinion de la masse seule, ni sur les dcrets du parti
[206] ou de ses chefs. Le secret du lninisme tait dans la communication qu'il russit tablir entre la masse et les chefs, entre le proltariat et sa conscience . Cela suppose des chefs qui ne s'enferment
pas dans un bureau et qui sachent expliquer aux masses ce qu'on leur
propose, cela suppose un dialogue et un change entre les masses qui
indiquent chaque moment l'tat de la rvolution effective et le centre
o s'laborent les conceptions et les perspectives rvolutionnaires.
C'est sans doute ouvrir la porte l'loquence et introduire dans le systme une possibilit de tromperie. Mais il faut bien se dire que, s'il y a
une solution, c'est celle-l. On sent, travers Violence et Conscience,
un second motif conservateur. C'est l'ide que la culture est fragile et
qu'une rvolution proltarienne la dtruirait en mme temps que ses
soutiens capitalistes. Le proltariat, qui n' a pas de patrie parce qu'il
est exclu de sa patrie nominale, est un rsultat de la dcomposition
capitaliste. Comment possderait-il en lui-mme la force d'difier une
nouvelle culture ? C'est sans doute un des points les plus ingnieux,
mais aussi un des plus contestables, de l'interprtation marxiste de la
vie, que cette fusion dans un mouvement dialectique unique des principes de dclin et de dissociation et des principes de renouvellement,
des forces dsagrgeantes et des forces dificatrices de la vie 71. Le
marxisme n'a pas ignor le problme. Il distingue un proltariat vid
de toute substance culturelle, et d'ailleurs aussi de toute nergie
rvolutionnaire, le Lumpenproletariat de [207] Marx, et un proltariat qui reste capable de cration historique et culturelle. L'analyse de
71
Violence et conscience, p. 68.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
138
Marx devrait tre sur ce point prolonge et renouvele : la dcomposition du capitalisme, beaucoup plus avance aujourd'hui qu'il y a un
sicle, et le pourrissement de la rvolution, en particulier sous sa
forme fasciste, ont corrompu, ruin moralement et annul politiquement de larges couches sociales qui auraient t capables d'action rvolutionnaire. Il suffit, pour s'en assurer, de penser aux lments proltariens qui se sont associs, pendant l'occupation, au trafic avec les
Allemands ou qui demeurent, autrement que comme consommateurs,
dans le circuit du march noir. Tout cela rend peut-tre improbable,
pour l'immdiat, la formation d'une conscience rvolutionnaire. Mais
il faut bien comprendre que, dans la mme mesure, la restauration de
la culture est compromise. Car, selon Thierry Maulnier lui-mme, les
phnomnes conomiques tant au cur de la socit, la dcomposition conomique ne laisse pas intact l'hritage culturel. C'est un fait
que, dans la situation o nous sommes, il n'est pas un des termes du
vocabulaire moral qui ne soit devenu quivoque, pas une des valeurs
traditionnelles qui n'ait t contamine. Si un jour on doit pouvoir parler avec faveur du travail, de la famille ou de la patrie, c'est condition que ces valeurs aient t au pralable purifies par la rvolution
des quivoques qu'elles ont servi entretenir. De sorte qu'il ne saurait
tre question de les prserver contre la violence proltarienne, puisque
cette violence peut seule les rendre honorables nouveau. On ne peut
sauver du pass ce qui mrite d'tre sauv qu'en fondant un nouvel
avenir. Dans une socit sans [208] classes, les conditions ngatives
d'une culture renouvele seront runies. L-dessus, Thierry Maulnier
demandera si les conditions positives le seront aussi. C'est ici qu'il
faut choisir. Si l'on voit l'humanit comme le faisait Maurras, c'est-dire comme une russite absolument fortuite due quelques hommes
exceptionnels et quelques circonstances improbables, alors la rvolution apparat ncessairement comme le plus grand risque. Mais
Thierry Maulnier a rejet ce pessimisme de principe. Ce qu'il faudrait
lui opposer, ce n'est pas l'optimisme de principe du XVIIIe sicle, mais
comme un optimisme mthodique. Car aprs tout, si rares que soient
les choses belles et grandes, c'est un fait remarquable qu'elles sont assez gnralement comprises et admires. L'homme pourrait se dfinir
par ce pouvoir qu'il a de concevoir ou en tout cas de respecter ce qu'il
n'est pas et ce qu'il n'a pas. Il suffit de faire vivre ensemble et d'associer une mme tche quelques hommes pour qu'aussitt se dgagent
de leur vie en commun des rgles rudimentaires et un commencement
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
139
de droit. considrer les choses ainsi, on a le sentiment qu'avec des
hommes la ressource est immense. Il faudrait revenir sur cette ide si
rpandue que la raison est rare et l'on pourrait montrer en un sens
qu'elle est partout chez les hommes, qu'ils en sont en quelque sorte
emptrs, et que cette ouverture au possible est justement ce qui fait
leurs instincts beaucoup moins stables que ceux des animaux, comme
Pascal, qui n'tait pas optimiste, l'avait bien vu. Il y a quelque chose
dire en faveur de la lumire naturelle . Les hommes scrtent de la
culture en quelque sorte sans le vouloir. Le monde humain, si [209]
diffrent qu'il soit du monde naturel ou animal, est en quelque sorte
naturel pour lhomme. Dans la philosophie pessimiste de Maurras, on
trouverait bien des traces de l'volutionnisme du XIXe sicle, et si la
diffrence de l'existence humaine et de l'existence animale est radicale, on pourrait sans doute tmoigner un peu moins de dfiance
l'homme. Certes l'enjeu est grave et le risque est grand. Si nous pouvions viter de le courir, il faudrait peut-tre l'viter. Mais si l'alternative est celle du socialisme ou du chaos, l'imprudence est du ct de
ceux qui contribuent aggraver le chaos sous prtexte que la rvolution est un risque. Ramen l'essentiel, le marxisme n'est pas une philosophie optimiste, c'est seulement l'ide qu'une autre histoire est possible, qu'il n'y a pas de destin, que l'existence de l'homme est ouverte,
c'est la tentative rsolue de ce futur dont personne au monde ni hors
du monde ne sait s'il sera ni ce qu'il sera.
*
*
N'y a-t-il donc rien de fond dans les hsitations de Thierry Maulnier en face du marxisme ? Nous pensons au contraire que, dbarrasss de leurs motifs ractionnaires , elles ont une signification profonde, et c'est mme pour dgager dans sa puret ce que nous appellerons le problme marxiste que nous avons formul les critiques qui
prcdent.
On sait que Marx et Lnine ont conu, dans une phase tardive de la
socit socialiste, un dprissement de l'tat comme puissance
contraignante, parce qu'il leur semblait que les contraintes deviennent
superflues [210] dans une socit o il n'y a plus d'oppression ou
d'exploitation, et o la lutte des classes est vraiment abolie. C'tait
supposer que les contradictions de l'individu et de la socit n'ont lieu
que dans une socit capitaliste et que, une fois dtruite cette socit,
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
140
l'homme s'intgrera sans efforts et sans problmes l'existence collective sous toutes ses formes. L-dessus Thierry Maulnier crit : Il y a
une alination qui peut tre abolie parce qu'elle rsulte d'un certain
tat rformable de la socit. Mais il en est une autre irrductible :
l'homme ne pourrait se reconqurir tout entier qu'en cessant de vivre
au contact de ses semblables 72. Le passage serait faible si on le prenait comme un argument contre la rvolution : car mme s'il y a une
alination du Pour Autrui qu'aucune rvolution ne fera cesser, et mme si, une fois retomb l'lan rvolutionnaire, l'individu prouve la loi
comme une contrainte encore, ce n'est pas une raison pour le dtourner de l'acte rvolutionnaire o, pour un temps au moins, il assume
l'existence avec autrui, et qui a chance de rduire au minimum invitable les contraintes de la coexistence. Mais si ce texte ne peut pas
servir justifier une politique ractionnaire, il nous rvle ce qui spare Thierry Maulnier de la plupart des marxistes. C'est qu'il tient pour
dfinitives certaines contradictions de la condition humaine, c'est qu'il
la croit foncirement irrationnelle. Thierry Maulnier ne le dit nulle
part, mais il nous semble que, par-del ses prjugs, la vrit de son
livre est en ceci qu'il a [211] clairement peru dans l'histoire ce que J.
Hyppolite appelle des faits dialectiques , sans pouvoir adhrer
l'ide d'une dialectique unique de l'histoire. Or, il ne s'agit pas ici
d'une critique externe du marxisme, qui pourrait tre rduite par un
examen plus complet de la doctrine. Il s'agit vraiment d'une difficult
interne, qui mrite l'attention des marxistes eux-mmes.
Le marxisme, comme on sait, reconnat que rien n'est absolument
contingent dans l'histoire, que les faits historiques ne naissent pas
d'une somme de circonstances trangres les unes aux autres, qu'ils
forment un systme intelligible et offrent un dveloppement rationnel.
Mais le propre du marxisme, la diffrence des philosophies thologiques ou mme de l'idalisme hglien, est d'admettre que le retour
de l'humanit l'ordre, la synthse finale, ne sont pas ncessaire et
dpendent d'un acte rvolutionnaire dont la fatalit n'est garantie par
aucun dcret divin, par aucune structure mtaphysique du monde. Un
marxiste croit la fois que la rvolution de 1917 en Russie n'tait pas
fatale, que par exemple elle aurait pu chouer faute de chefs capables
de penser la situation et d'orienter les masses, et que la prsence
72
Violence et conscience, p. 87.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
141
mme d'une direction rvolutionnaire remarquable, la faiblesse du
personnel politique bourgeois dans la Russie de 1917 ne sont pas un
hasard et sont lies la situation totale de la Russie en ce moment : au
radicalisme d'un proltariat rcent, form par prlvement de maind'uvre sur les campagnes, et au rgime semi-colonial de la Russie
soumise par le capitalisme tranger une industrialisation rapide. Le
propre du marxisme est donc d'admettre qu'il y a la fois une [212]
logique de l'histoire et une contingence de l'histoire, que rien n'est absolument fortuit, mais aussi que rien n'est absolument ncessaire,
ce que nous exprimions tout l'heure en disant qu'il y a des faits dialectiques. Mais ce caractre tout positif et exprimental du marxisme
pose aussitt un problme. Si l'on admet qu' chaque moment, quelle
que soit la probabilit de l'vnement, il peut toujours avorter, comme
cette offensive du hasard peut se renouveler, il peut se faire finalement
que la logique et l'histoire divorcent et que l'histoire empirique ne ralise jamais ce qui nous parat tre la suite logique de l'histoire. Or, en
perdant le caractre d'un avenir ncessaire, la rvolution ne cesse-telle pas d'tre la dimension fondamentale de l'histoire, et, l'gard de
l'histoire effective, qui aprs tout importe seule, celui qui juge de toutes choses sous l'angle de la lutte des classes n'opre-t-il pas une mise
en perspective arbitraire ? La notion d'une logique de l'histoire
renferme deux ides : d'abord l'ide que les vnements, de quelque
ordre qu'ils soient, en particulier les vnements conomiques, ont une
signification humaine, que sous tous ses aspects l'histoire est une et
compose un seul drame, et ensuite l'ide que les phases de ce drame ne se succdent pas sans ordre, qu'elles vont vers un achvement
et une conclusion. La contingence de l'histoire signifie que mme si
les divers ordres d'vnements forment un seul texte intelligible, ils ne
sont cependant pas rigoureusement fis, qu'il y a du jeu dans le systme, que par exemple le dveloppement conomique peut tre en
avance sur le dveloppement idologique, que la maturit idologique
peut survenir [213] lorsque les conditions objectives ne sont pas encore ou ne sont plus favorables la rvolution, et d'autre part que la
dialectique de l'histoire peut s'enliser ou dvier vers des aventures
sans rsoudre les problmes qu'elle a mis au jour. Si nous quittons rsolument l'ide thologique d'un fond rationnel du monde, la logique
de l'histoire n'est plus qu'une possibilit parmi d'autres. Bien que l'analyse marxiste nous permette mieux qu'aucune autre de comprendre un
trs grand nombre d'vnements, nous ne savons pas si, pour toute la
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
142
dure de notre vie ou mme pour des sicles, l'histoire effective ne va
pas consister en une srie de diversions dont le fascisme a t la premire, dont l'amricanisme ou le bloc occidental pourraient tre d'autres exemples. Bien entendu, l'historien marxiste pourra toujours montrer aprs coup que ces systmes sont autant de rsistances la
lutte des classes, mais on se demande si la politique efficace ne
consisterait pas pour un pays donn tenter de se faire une place, tant
bien que mal, dans ce monde d'accidents tel qu'il est, plutt que d'ordonner toute sa conduite par rapport la lutte des classes, principe
gnral de l'histoire. Il n'y a plus de sens traiter la lutte des classes
comme un fait essentiel, si nous ne sommes pas srs que l'histoire effective reste fidle son essence et que des accidents n'en fassent
pas la trame pour longtemps ou pour toujours. L'histoire ne serait plus
alors un discours suivi dont on pourrait attendre avec assurance
l'achvement et o chaque phrase aurait sa place ncessaire, mais,
comme les paroles d'un homme ivre, elle indiquerait une ide, qui
bientt s'effacerait pour reparatre et disparatre [214] encore, sans
arriver ncessairement l'expression pleine d'elle-mme. Le marxisme ne pourrait plus alors s'noncer que sous la forme de propositions
ngatives : il est impossible ( moins d'une suite continue de hasards
sur lesquels l'homme, comme tre raisonnable, n'a pas compter) que
l'conomie mondiale s'organise et que les contradictions internes en
soient surmontes tant que la proprit socialiste des instruments de la
production ne sera pas tablie partout. Mais nous ne savons ni si une
production socialiste universelle trouverait son quilibre, ni si le cours
des choses, avec tous les accidents qui y contribuent, va vers ce rsultat. Le marxisme demeurerait une politique aussi justifie que les autres, elle serait mme la seule politique universelle et humaine, mais
elle ne pourrait pas se prvaloir d'une harmonie prtablie avec le
cours des choses : le proltariat universel pesant de toutes parts sur
l'appareil capitaliste et le dtruisant pour lui substituer une civilisation
socialiste, ce serait l, non pas un fait, mais un vu, non pas une
force existante sur laquelle on puisse s'appuyer, mais une force
crer, puisque, en fait, les proltariats nationaux sont sduits par les
diversions de l'histoire. On admettra peut-tre plus facilement qu'il
y a l un problme pour le marxisme, si nous le formulons dans les
termes de la politique quotidienne. Les bases de la rvolution proltarienne ont t poses en Russie, en 1917, et nulle part ailleurs jusqu'ici. C'est l un fait auquel on peut sans doute, aprs coup, trouver
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
143
des raisons : ce n'est pas par hasard, dira-t-on, que le pays conomiquement le plus arrir de l'Europe a t le premier faire sa rvolution. Justement parce que la [215] Russie n'avait pas, comme les pays
occidentaux, ralis elle-mme son industrialisation, elle s'offrait aux
capitaux des pays avancs comme un pays semi-colonial et l'implantation brutale des modes de production modernes devait y provoquer une crise qui l'amnerait la rvolution proltarienne sans passer, comme les pays d'Occident, par une longue phase dmocratique et
bourgeoise. On peut mme parler d'une loi de 1' ingalit de dveloppement selon laquelle les phases de l'volution sociale et conomique peuvent tre bouleverses par l'interaction des pays avancs
et des pays arrirs . Mais cette loi n'a t trouve qu'aprs coup, et
de mme que le phnomne russe n'a t qu'aprs coup rintgr la
logique de l'histoire, on ne peut pas exclure pour l'avenir d'autres incidences et d'autres contre-coups qui ne se laissent pas prvoir l'aide
des schmas explicatifs donns. Cela est non seulement possible, mais
encore invitable. Car mme une fois que l'vnement inattendu a t
rang sous une loi nouvelle et reli la dialectique marxiste, il continue par ses consquences, et dans son interaction avec la constellation
mondiale, de brouiller les schmas du marxisme. Les bases du socialisme une fois tablies en Russie, la politique du nouvel tat a t profondment affecte par la double ncessit de raliser une industrialisation qui tait suppose donne dans les schmas marxistes de la rvolution proltarienne et de dfendre le nouvel tat contre une coalition possible des puissances capitalistes. Si le gouvernement de
l'U.R.S.S. a fait intervenir dans son entreprise d'quipement industriel
des mobiles bourgeois , s'il a tabli entre les salaires des diffrences [216] qui sont comparables ou suprieures celles qui existent en
rgime capitaliste, il est sans doute permis d'en trouver la raison dans
ce fait que l'U.R.S.S. ne pouvait appliquer l'idologie socialiste dans
un pays o l'infrastructure du socialisme n'tait pas encore acquise, et
que le problme tait justement pour elle de construire d'abord cette
infrastructure. D'autre part, il est difficile de contester que, si
l'U.R.S.S. n'avait pas offert aux puissances capitalistes l'aspect d'une
rvolution assagie, si elle avait poursuivi au-dehors la politique d'appui aux mouvements proltariens, ou bien la coalition contre l'Allemagne n'aurait pas pu se faire, ou bien les Allemands auraient russi
la dissocier. Aujourd'hui encore, si l'U.R.S.S. ne concluait pas un accord avec Tchang Ka Chek et soutenait ouvertement les communistes
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
144
chinois, la troisime guerre mondiale serait proche. Mais cela revient
reconnatre que la politique de l'U.R.S.S. ne peut plus tre une politique universaliste laquelle les marxistes de tous les pays soient immdiatement accords, que pour un communiste franais, les voies de
la rvolution sont prsent bien diffrentes de celles qui avaient t
prvues par la doctrine, qu'il ne dispose plus, pour juger de chaque
chose en politique et pour savoir que faire en chaque cas, de ce fil
conducteur si simple que Marx avait donn : Proltaires de tous les
pays, unissez-vous. Alors que, pour le marxisme traditionnel, il ne
saurait y avoir de contradiction ni mme de diffrence entre la rvolution et la politique quotidienne, entre la doctrine et la tactique, entre
l'nergie rvolutionnaire et l'efficacit, entre la morale et la politique,
nous sommes rentrs, parce que l'U.R.S.S. [217] tait seule, et que ce
fait imprvisible a bris la rationalit de l'histoire, dans la politique de
ruse, sans tre srs qu'il s'agisse toujours d'une ruse de la raison .
De sorte que l'analyse marxiste, si nous voulons l'appliquer aux vnements qui remplissent notre temps, se perd dans les phnomnes
transversaux, dans les ractions inattendues, court aprs les vnements sans les rejoindre, en tout cas sans les devancer jamais, et qu'un
marxiste lucide, voyant comme le schma de la lutte des classes se
diversifie et se nuance, en vient se demander si, de diversion en diversion, l'histoire sera bien finalement l'histoire de la lutte des classes
et s'il ne rve pas les yeux ouverts.
Cette difficult centrale du marxisme est visible aujourd'hui comme jamais 73. D'une manire gnrale, le marxisme est faible quand on
le confronte avec les vnements concrets pris instant par instant. Cela
ne doit pas nous faire oublier comme il apparat fort quand on l'applique une suite d'vnements un peu tendue. Peut-tre sommes-nous
abuss par l'importance que nous donnons invitablement au prsent
que nous vivons. Si demain, comme il est possible ou mme probable
aprs une guerre, la lutte des classes reparat et s'accuse dans tous les
pays du monde, de nouveau les grandes lignes marxistes de l'histoire
apparatront. Quand [218] Lnine, exil en Suisse, rflchissait sur le
73
C'est elle que Lnine avait en vue dans la Maladie infantile du communisme,
quand il recherchait le critre de validit d'un compromis marxiste avec la
bourgeoisie. Il y aurait lieu de prolonger sur le plan thorique les
conclusions pratiques qu'il adopte. On pourrait tirer de sa perception
marxiste des situations une thorie de la contingence en histoire.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
145
marxisme, quelle apparence y avait-il que, mme dans une seule partie
du monde, il devnt vrai quelques mois plus tard ? Ce qui est sr seulement, c'est que, aprs avoir vu l'histoire multiplier ses diversions,
nous ne pouvons plus affirmer qu'elle n'en inventera pas d'autres jusqu' ce que le monde tombe au chaos, ni, en consquence, compter sur
une force immanente aux choses qui les conduise vers un quilibre
plus probable que le chaos. Nous sommes srs que le monde ne s'organisera pas, ne cessera pas de se dchirer, ne sortira pas des compromis prcaires, ne retrouvera pas des croyances et des valeurs, si les
hommes les moins engags dans les intrts particuliers des imprialismes ne reprennent pas possession de l'appareil conomique. Nous
ne savons ni si cette condition ncessaire sera ralise, ni si elle est
une condition suffisante, ni, en consquence, quelle valeur il faut au
juste reconnatre ces pauses, ces instants de paix que peuvent procurer les compromis capitalistes. nous d'observer le monde pendant
ces annes o il recommence respirer, une fois brise la dalle des
fascismes, une fois dmobilises les consciences. Si la lutte des classes redevient le moteur de l'histoire, si, dcidment, l'alternative se
prcise du socialisme ou du chaos, nous de choisir un socialisme
proltarien, non comme l'assurance du bonheur, nous ne savons pas
si l'homme peut jamais s'intgrer la coexistence, ni si le bonheur de
chaque pays est compossible avec celui des autres, mais comme cet
autre avenir inconnu auquel il faut passer sous peine de mort. Sa vraie
conclusion, qu'il n'a pas crite et qu'il crira peut-tre [219] un jour,
Thierry Maulnier la trouverait dans ce marxisme sans illusions, tout
exprimental et volontaire, auquel il s'est vou son insu quand il a
reconnu la fois la logique et la contingence de l'histoire.
(Aot 1945.)
[220]
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
146
[221]
SENS ET NON-SENS
II. IDES
Marxisme et
philosophie
Etre radical, c'est prendre les choses par la racine. Or,
pour l'homme, la racine est l'homme lui-mme.
Marx (Contribution la critique de la Philosophie du
Droit de Hegel, trad. Molitor, p. 97).
Retour la table des matires
On se ferait une trange ide du marxisme et de ses rapports avec
la philosophie si l'on en jugeait par les crits de certains marxistes
contemporains. Il est visible que pour eux la philosophie est toute verbale, qu'elle n'a aucun contenu, aucune signification, et que, comme
Auguste Comte dans sa premire priode, ils veulent la remplacer par
la science et rduire l'homme la condition d'objet de science. P. Naville crivait que l'conomie politique doit emprunter la mthode des
sciences de la nature, qu'elle tablit les lois de la nature sociale
comme les sciences de la nature tablissent celles de la nature physique. Dans une discussion avec Sartre rcemment publie, il montrait
de la mauvaise humeur l'gard de l'humanisme et prenait bravement
parti pour le naturalisme. R. Garaudy, [222] dans les Lettres Franaises, excute ce tour de force de clbrer Descartes en plusieurs colonnes sans mme mentionner le cogito. Toujours en l'honneur de Des-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
147
cartes, C. Cogniot, au grand amphithtre de la Sorbonne, remet leur
place les philosophes de caf qui croient pouvoir dfinir l'homme,
par opposition aux choses comme non-tre, oubliant que Descartes
est le premier responsable de ces aberrations, comme on peut s'en
convaincre en ouvrant les Mditations 74. C'est le droit strict de chacun d'adopter la philosophie de son got et par exemple le scientisme
et le mcanisme qui ont longtemps tenu lieu de pense aux milieux
radicaux-socialistes. Mais il faut savoir et dire que ce genre d'idologie n'a rien de commun avec le marxisme.
Une conception marxiste de la socit humaine, et en particulier de
la socit conomique, ne peut la soumettre des lois permanentes
comme celles de la physique classique, puisqu'elle la voit en mouvement vers un nouvel arrangement l'intrieur duquel les lois de l'conomie classique ne s'appliqueront plus. Tout l'effort de Marx dans le
Capital tend justement montrer que ces lois fameuses, souvent prsentes comme les traits permanents d'une nature sociale , sont en
ralit les attributs (et les masques) d'une certaine structure sociale , le capitalisme, qui volue lui-mme [223] vers sa destruction. La
notion de structure ou de totalit, pour laquelle P. Naville n'a que mfiance, est une catgorie fondamentale du marxisme. Une conomie
politique marxiste ne peut parler de lois qu' l'intrieur de structures
qualitativement distinctes et qui doivent tre dcrites en termes d'histoire. A priori, le scientisme apparat comme une conception conservatrice, puisqu'il nous ferait prendre pour ternel ce qui n'est que momentan. En fait, dans l'histoire du marxisme, le ftichisme de la
science est toujours apparu du ct o flchissait la conscience rvolutionnaire : le clbre Bernstein adjurait les marxistes de revenir l'objectivit du savant. Comme le remarque Lukacs, le scientisme est un
cas particulier de l'alination ou de l'objectivation (Verdinglichung)
qui prive l'homme de sa ralit humaine et fait qu'il se confond avec
les choses 75.
74
75
Je ne suis point cet assemblage de membres que l'on appelle le corps
humain ; je ne suis point un air dli et pntrant, rpandu dans tous les
membres ; je ne suis point un vent, un souffle, une vapeur, ni rien de tout ce
que je puis feindre et imaginer... (Mditation II.)
C. Lukacs. Geschichte und Klassenbewusstsein, Berlin 1923. Die
Verdinglichung und dos Bewusstsein des Proltariats.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
148
On est d'autant moins fond expliquer la socit humaine dans sa
totalit (simultane ou successive) par l'action combine de lois naturelles permanentes que cette rduction n'est mme plus possible
l'gard de la nature physique. Loin qu'elle puisse elle-mme liminer
la structure, la physique moderne ne conoit ses lois que dans le cadre
d'un certain tat historique de l'univers dont rien ne nous dit qu'il est
dfinitif, et affecte de coefficients empiriques qui sont donns tels
quels et ne peuvent tre dduits. C'est donc, dira Naville, qu'il y a une
dialectique au niveau mme de la nature et qu'en [224] ce sens nature
et socit sont homognes. Or il est bien vrai que Engels a repris
Hegel l'ide aventureuse d'une dialectique de la nature. Mais, outre
que c'est le plus fragile de l'hritage hglien, comment la dialectique
de la nature survivrait-elle l'idalisme ? Si la nature est la nature,
c'est--dire extrieure nous et elle-mme, on ne peut y trouver ni
les relations, ni la qualit qui sont ncessaires pour porter une dialectique. Si elle est dialectique, c'est qu'il s'agit de cette nature perue par
l'homme et insparable de l'action humaine dont Marx parle dans les
Thses sur Feuerbach et dans l'Idologie Allemande. Cette activit,
cette action et ce travail sensibles continuels, cette production sont...
le fondement de tout le monde sensible tel qu'il existe actuellement 76. On trouve, certes, chez Marx, des textes d'humeur positiviste qui traitent certaines idologies comme des absurdits et comptent,
semble-t-il, pour les dissiper sur le grand jour de la science. En
somme, chez ces Allemands, dit par exemple l'Idologie Allemande, il
s'agit toujours de rsoudre l'ineptie existante en quelque autre marotte,
c'est--dire prsupposer que toute cette absurdit a finalement un
sens spcial qu'il faut [225] dcouvrir, tandis qu'il .s'agit simplement d'expliquer ces phrases thoriques par les conditions relles existantes 77. On dirait que Marx se refuse comprendre la religion,
lui reconnatre aucune signification et par consquent rejette le prin76
77
Feuerbach a le tort de ne pas concevoir le monde sensible comme l'activit
sensible totale et vivante des individus qui le constituent (Idologie
allemande, p. 164). Il s'inspire des sciences naturelles. Mais o seraient les
sciences naturelles sans industrie et sans commerce ? Mme ces sciences
naturelles pures ne reoivent en effet leurs buts et leurs matriaux que
par le commerce et l'industrie, par l'activit sensible des hommes (Ibid., p.
163). La science de la nature fait partie du monde culturel et ne doit pas tre
hypostasie puisqu'elle ignore ses propres prmisses humaines.
P. 189.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
149
cipe mme d'une phnomnologie de la religion. Nous voil tout prs
d'un marxisme dcharn qui rduit l'histoire son squelette conomique. La religion ne veut la lettre rien dire, elle est toute en
mots, elle est toute fausse, ce n'est qu'une apparence ou une comdie.
Cependant, ce n'est pas l du Marx, c'est du Voltaire, et Marx a dit par
ailleurs tout le contraire : La religion est la thorie gnrale de ce
monde, son compendium encyclopdique, sa logique sous une forme
populaire, son point d'honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa
sanction morale, son complment solennel, sa raison gnrale de
consolation et de justification. C'est la ralisation fantastique de l'essence humaine, parce que l'essence humaine n'a pas de ralit vritable... La religion est... l'me d'un monde sans cur de mme qu'elle
est l'esprit d'une poque sans esprit 78. Il ne s'agit donc pas de lui
refuser toute signification humaine, mais de la traiter comme l'expression symbolique du drame social et humain. La pense communiste ne
doit pas donner moins que la religion mais plus, savoir la religion
ramene ses sources et sa vrit qui sont les relations concrtes des
hommes entre eux et avec la nature. Il ne s'agit pas de remplacer [226]
la religion d'glise par la religion de laboratoire et de mettre la place
du Saint-Sacrement un cylindre enregistreur, mais de comprendre la
religion comme l'effort fantastique de l'homme pour rejoindre les autres hommes dans un autre monde et de remplacer ce phantasme de
communication par une communication effective dans ce monde-ci.
Dans le temps o il faisait encore reposer l'histoire sur la vie interhumaine et o l'esprit du monde ne s'tait pas encore retir dans l'envers
des choses, le jeune Hegel disait que la lecture des journaux est une
prire du matin raliste . Les hommes en train d'assumer la nature
qu'ils subissent d'abord, de briser les structures donnes de la socit,
et de passer par la praxis au rgne de la libert 79, ou, comme
dit Hegel, l'histoire absolue 80, voil le noyau humain de la
religion et, au sens heideggerien, le contenu mtaphysique du
marxisme. La religion est plus qu'une apparence creuse, c'est un phnomne fond dans les relations interhumaines. Elle ne disparatra
comme religion spare qu'en passant dans ces relations. Il y a un
pseudo-marxisme selon lequel tout est faux sauf la phase finale de
78
79
80
Contribution la critique de la Philosophie du Droit de Hegel, p. 84.
Das Kapital, d. Kautsky, III, 2, p. 355.
Esthtique, trad. Janklvitch, II, p. 261.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
150
l'histoire. Il correspond, sur le plan des ides, ce communisme rudimentaire, envie et dsir de nivellement 81, pour lequel Marx
n'est pas tendre. Le marxisme authentique veut assumer tout l'acquis
en le dpassant, il admet en ce sens que tout est vrai sa place et son
rang dans le systme total [227] de l'histoire, tout a un sens. Ce sens
de l'histoire comme totalit nous est donn non par quelque loi du type
physico-mathmatique, mais par le phnomne central de l'alination.
Dans le mouvement de l'histoire, l'homme, qui s'est alin au profit de
ses ftiches et vid de sa propre substance, reprend possession de luimme et du monde. Il n'y a ni vie conomique, ni marchandise, ni ftichisme de la marchandise, ni rvolte contre ce ftichisme chez les
animaux. Ces phnomnes ne sont possibles que parce que l'homme
n'est pas une chose ou mme un animal, parce qu'il a le privilge de se
rapporter autre chose que soi, parce qu'il n'est pas seulement, mais
existe .
Ce qui accrdite la lgende d'un positivisme marxiste, c'est que
Marx combat sur deux fronts. D'un ct il est contre toutes les formes
de la pense mcaniste. D'un autre ct, il livre bataille contre l'idalisme. L' Esprit mondial de Hegel, ce malin gnie qui conduit les
hommes leur insu et leur fait accomplir ses propres desseins, ou
mme la logique spontane des ides, ce sont pour Marx d'autres ralisations fantastiques de l'essence humaine . Mais cette lutte contre
l'idalisme n'a rien voir avec lobjectivation positiviste de l'homme.
Marx n'accepterait mme pas de parler, comme le fera Durkheim,
d'une conscience collective dont les individus fussent les instruments.
Il faut viter avant tout de fixer de nouveau la socit comme abstraction vis--vis de l'individu. L'individu est ltre [228] social 82.
L'homme est un tre existant pour soi-mme , donc un tre gnrique 83. La socit n'est pas pour lui un accident subi, mais une dimension de son tre. Il n'est pas dans la socit comme un objet est dans
une bote, il l'assume par ce qu'il a de plus intrieur. Voil pourquoi
on peut dire que l'homme produit l'homme lui-mme et l'autre
81
82
83
Marx. conomie politique et Philosophie, trad. Molitor, p. 20.
conomie politique et Philosophie, p. 27.
Ibid., p. 78.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
151
homme 84. De la mme faon que la socit produit elle-mme
l'homme comme homme, elle est produite par lui 85.
Si ce n'est ni une nature sociale donne hors de nous, ni 1'
Esprit du monde , ni le mouvement propre des ides, ni la conscience collective, quel est donc pour Marx le porteur de lhistoire et
le moteur de la dialectique ? C'est l'homme engag dans un certain
mode d'appropriation de la nature o se dessine le mode de ses relations avec autrui, c'est l'intersubjectivit humaine concrte, la communaut successive et simultane des existences en train de se raliser
dans un type de proprit qu'elles subissent et qu'elles transforment,
chacune cre par autrui et le crant. On s'est quelquefois demand
avec raison comment un matrialisme pouvait tre dialectique 86,
comment la matire, si l'on prend le mot la rigueur, pouvait contenir
le principe de productivit et de nouveaut qui s'appelle une dialectique. C'est que dans le marxisme la matire , comme [229] d'ailleurs la conscience , n'est jamais considre part, elle est insre
dans le systme de la coexistence humaine, elle y fonde une situation
commune des individus contemporains et successifs, elle assure la
gnralit de leurs projets et rend possible une ligne de dveloppement et un sens de l'histoire, mais si cette logique de la situation est
mise en train, dveloppe et accomplie, c'est par la productivit humaine sans laquelle le jeu des conditions naturelles donnes ne ferait
paratre ni une conomie ni, plus forte raison, une histoire de l'conomie. Les animaux domestiques, dit Marx, sont mls la vie humaine, mais ils n'en sont que les produits, il n'y participent pas.
L'homme, au contraire, produit des modes de travail et de vie toujours
nouveaux. Il n'y a donc pas d'explication de l'homme partir de l'animal, ni, plus forte raison, de la matire. Il n'y a pas d'origine de
l'homme, ... comme, pour l'homme socialiste, toute la prtendue histoire du monde n'est rien d'autre que la production de l'homme par le
travail humain, donc le devenir de la nature pour l'homme, il a donc la
preuve vidente, irrfutable, de sa naissance de lui-mme, de son origine 87. Si l'homme socialiste peut pressentir un rgne de la libert qui n'est pas encore, et, dans cette perspective, vivre le prsent
84
85
86
87
Ibid., p. 25.
Ibid., p. 26.
SARTRE. Matrialisme et Rvolution, Les Temps Modernes, IX
conomie politique et Philosophie, p. 40.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
152
comme une phase de l'alination capitaliste, c'est qu'il a par devers soi
l'assurance que l'homme est productivit, rapport autre chose que
soi, et non pas chose inerte. Allons-nous donc dfinir [230] l'homme
comme conscience ? Ce serait encore raliser fantastiquement l'essence humaine, car, une fois dfini comme conscience, l'homme se sparera de toutes choses, de son corps et de son existence effective. Il faut
donc le dfinir comme relation des instruments et des objets, et
comme une relation qui ne soit pas de simple pense, mais qui l'engage dans le monde de telle manire qu'il ait une face extrieure, un dehors, qu'il soit objectif en mme temps que subjectif . On y
parviendra en dfinissant l'homme comme tre souffrant ou sensible 88, c'est--dire situ naturellement et socialement, mais aussi
ouvert, actif, et capable d'tablir, sur le terrain mme de sa dpendance, son autonomie. Nous voyons ici que le naturalisme ou l'humanisme ralis diffre de l'idalisme aussi bien que du matrialisme et
est en mme temps la vrit qui les unit tous deux 89. Il s'agit de
comprendre que le bien qui attache l'homme au monde est en mme
temps le moyen de sa libert, et comment l'homme, au contact de la
nature, sans briser la ncessit, mais au contraire en l'utilisant, projette
autour de lui des instruments de sa libration, constitue un monde
culturel dans lequel le comportement naturel de l'homme est devenu
humain... o l'tre humain est devenu son tre naturel, sa nature humaine est devenue sa nature 90. Ce milieu non pas surnaturel, mais
transnaturel, o les hommes refont tous les jours leur propre vie 91,
c'est l'histoire. L'histoire est la [231] vritable histoire naturelle de
l'homme 92. Le marxisme n'est pas une philosophie du sujet, mais
pas davantage une philosophie de l'objet, c'est une philosophie de
l'histoire.
Marx a souvent appel son matrialisme un matrialisme pratique 93. Il voulait dire que la matire intervient dans la vie humaine
comme point d'appui et corps de la praxis. Il n'est pas question d'une
matire nue, extrieure l'homme, et par laquelle le comportement de
88
89
90
91
92
93
Ibid., p. 78.
Ibid., p. 76.
Ibid., pp. 21-22.
Idologie allemande, p. 166.
conomie politique et Philosophie, p. 79.
Par ex., Idologie allemande, p. 160.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
153
l'homme s'expliquerait. Le matrialisme de Marx, c'est l'ide que toutes les formations idologiques d'une socit donne sont synonymes
ou complmentaires d'un certain type de praxis, c'est--dire de la manire dont cette socit a tabli son rapport fondamental avec la nature. C'est l'ide que l'conomie et l'idologie sont lies intrieurement
dans la totalit de l'histoire comme la matire et la forme dans une
uvre d'art ou dans une chose perue. Le sens d'un tableau ou d'un
pome n'est pas dtachable de la matrialit des couleurs et des mots,
il n'est ni cr, ni compris partir de l'ide. On ne comprend la chose
perue qu'aprs l'avoir vue, et aucune analyse, aucun compte rendu
verbal ne peut tenir heu de cette vision. De mme 1' esprit d'une
socit est dj impliqu dans son mode de production, parce que ce
dernier est dj un certain mode de coexistence des hommes dont les
conceptions scientifiques, philosophiques et religieuses sont ou le
simple dveloppement ou la contrepartie fantastique. On comprend
[232] donc qu'il ait t rserv Marx d'introduire la notion de lobjet
humain 94 que la phnomnologie a reprise et dveloppe. Les philosophies classiques ont dissoci cette notion : la rue, le champ, la maison taient pour elles des complexes de couleurs en tous points comparables aux objets de la nature et seulement revtus d'une signification humaine par un jugement secondaire. Marx, en parlant d'objets
humains, veut dire que cette signification est adhrente l'objet tel
qu'il se prsente dans notre exprience. C'tait pousser jusqu' ses
consquences concrtes la conception hglienne d'un espritphnomne ou d'un esprit objectif vhicul par le monde et non pas
retir en soi. L'esprit d'une socit se ralise, se transmet et se peroit
par les objets culturels qu'elle se donne et au milieu desquels elle vit.
Ses catgories pratiques s'y sdimentent, et en retour ils suggrent aux
hommes une manire d'tre et de penser. On comprend ainsi que la
logique puisse tre l'argent de l'esprit 95 ou que le ftichisme de
la marchandise puisse induire tout un mode de pense objective
propre la civilisation bourgeoise. Comme on l'a justement remarqu 96, le rapport de l'idologie et de l'conomie, souvent clbr, reste mystique, prlogique et impensable, tant que l'idologie reste sub94
95
96
conomie politique et Philosophie, p. 30.
Ibid., p. 48.
Raoul LVI. Art moderne et Ralit sociale. Les Temps Modernes, VIII, p.
1499.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
154
jective , tant que l'conomie est conue comme un processus objectif,
tant qu'on ne les fait pas communiquer [233] dans l'existence historique totale, et dans les objets humains qui l'expriment. J. Domarchi a
donc cent fois raison de mettre au compte de Marc cette phnomnologie du monde culturel 97 que Hegel avait bauche dans son analyse
du XVIIIe sicle comme sicle de l'argent et qui serait faire pour chaque civilisation et pour chaque priode. Mais, objecte Naville, pour
Marx, la manifestation, l'aspect phnomnologique de la ralit et
surtout de la ralit idale est justement ce qui doit tre expliqu 98. Ce n'est qu'apparence et la ralit est conomique. Comme si
une phnomnologie ne pouvait pas distinguer des phnomnes
fondants et des phnomnes fonds . Comme si surtout le rapport de l'idologie l'conomie dans le marxisme tait celui de l'apparence la ralit. Les idologies bourgeoises, qui contaminent toute la
socit bourgeoise, y compris son proltariat, ne sont pas des apparences : elles mystifient la socit bourgeoise et se prsentent elle
comme un monde consistant. Elles sont exactement aussi relles
que les structures de l'conomie capitaliste, avec lesquelles elles forment un seul systme. Ces idologies et cette conomie ensemble sont
apparences par rapport l'conomie et la vie socialistes qui se dessinent dj en elles, mais, jusqu' ce que celles-ci soient ralises, les
formes de production et de vie bourgeoises gardent leur poids, leur
efficacit et leur ralit. Lnine le savait bien, lui qui disait que la lutte
des classes durera pendant des [234] annes aprs la rvolution. Le
matrialisme marxiste ne serait rigoureusement dfini et dfendu
contre les retours offensifs du mcanisme que si Marx avait dvelopp
sa thorie de la praxis ou de l'existence sociale comme milieu concret
de l'histoire, gale distance de l'idalisme et du matrialisme mtaphysique. Cela tant, quelle peut donc tre, dans la perspective marxiste, la situation de la philosophie ? C'est une idologie, en d'autres
termes, un aspect abstrait de la vie historique totale et, en tant qu'elle
veut s'autonomiser , c'est encore une fois une ralisation fantastique de l'homme qui joue son rle dans la mystification du monde
bourgeois. Mais plus le domaine que nous sommes en train d'examiner s'loignera de l'conomie et se rapprochera de l'idologie pure
et abstraite, plus nous trouverons qu'il prsente des lments acciden97
98
Revue Internationale, n 2.
Ibid., n 3.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
155
tels dans son volution, plus sa courbe sera trace en zig-zag 99.
Toute tentative pour expliquer massivement une philosophie par les
conditions conomiques est donc insuffisante, il faut en voir le contenu, il faut discuter sur le fond. Il n'est pas exact que la situation conomique soit la cause, soit seule active, et que tous les autres phnomnes ne soient qu'un effet passif 100. La pense causale, ici comme
partout est insuffisante. La conception ordinaire de la cause et de
l'effet en tant que ples strictement opposs est abstraite 101. Une
philosophie, comme un art et comme une posie, [235] est d'un temps,
mais rien n'empche qu' travers ce temps justement elle saisisse des
vrits qui sont un acquis dfinitif, comme l'art grec a trouv le secret
d'un charme ternel (Marx). L'conomie d'un temps suscite une
idologie parce qu'elle est vcue par des hommes qui cherchent se
raliser en elle ; en un sens, cette conomie limite leurs vues, mais en
un autre sens elle est leur surface de contact avec l'tre, leur exprience, et il peut leur arriver, comme il est arriv Marx lui-mme, de ne
pas la subir seulement, mais de la comprendre et par l de la dpasser
virtuellement. La philosophie ne serait fausse qu'en tant qu'elle resterait abstraite, s'enfermerait dans les concepts et dans les tres de raison
et masquerait les relations interhumaines effectives. Mme alors, tout
en les masquant, elle les exprime, et le marxisme n'entend pas se dtourner d'elle, mais la dchiffrer, la traduire, la raliser. C'est...
juste titre qu'en Allemagne le parti politique pratique rclame la ngation de la philosophie. Son tort consiste... s'arrter cette revendication qu'il ne ralise pas et ne peut pas raliser srieusement. Il se figure effectuer cette ngation en tournant le dos la philosophie et en lui
consacrant, mi-voix et le regard ailleurs, quelques phrases banales et
pleines de mauvaise humeur... En un mot : vous ne pouvez supprimer
la philosophie sans la raliser 102. Le Cogito n'est pas faux sinon en
tant qu'il se spare et brise notre inhrence au monde. On ne le supprimera qu'en le ralisant, c'est--dire en [236] montrant qu'il est minemment contenu dans les relations interhumaines. Hegel n'est pas
faux, il est vrai d'un bout l'autre, mais abstrait. Il faut seulement
donner leur nom historique aux combats mythologiques qu'il dcrit
99
Engels Starkenburg, 1894.
Ibid.
Engels Mehring.
102 Marx. Contribution la critique de la Philosophie du Droit de Hegel, p. 93.
100
101
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
156
entre la conscience en soi et la conscience pour soi. La logique de Hegel est, comme on l'a dit, 1' algbre de la rvolution . Le ftichisme de la marchandise est la ralisation historique de cette alination que Hegel dcrit en nigme, et le Capital est, comme on l'a dit
encore, une Phnomnologie de l'Esprit concrte. Ce qu'il faut reprocher au philosophe et au Hegel des dernires annes, c'est de s'imaginer que, par la pense, il peut et peut seul se procurer la vrit de toutes les autres existences, les intgrer, les dpasser et obtenir, du fond
de sa sagesse, la rvlation du sens de l'histoire, que les autres hommes se borneraient subir. Philosopher est une manire d'exister entre
d'autres, et l'on ne peut pas se natter d'puiser, comme dit Marx, dans
l'existence purement philosophique 1' existence religieuse ,
1' existence politique , 1' existence juridique , 1' existence artistique , ni en gnral la vraie existence humaine 103. Mais si le
philosophe le sait, s'il se donne pour tche de suivre les autres expriences et les autres existences dans leur logique immanente au lieu de
se mettre leur place, s'il quitte l'illusion de contempler la totalit de
l'histoire acheve et se sent comme tous les autres hommes pris en elle
et devant un avenir faire, alors la philosophie se [237] ralise en se
supprimant comme philosophie spare. Cette pense concrte, que
Marx appelle critique pour la distinguer de la philosophie spculative,
c'est ce que d'autres proposent sous le nom de philosophie existentielle.
La philosophie existentielle consiste, comme son nom l'indique,
prendre pour thme non seulement la connaissance ou la conscience
entendue comme une activit qui pose en pleine autonomie des objets
immanents et transparents, mais l'existence, c'est--dire une activit
donne elle-mme dans une situation naturelle et historique, et aussi
incapable de s'en abstraire que de s'y rduire. La connaissance se
trouve replace dans la totalit de la praxis humaine et comme leste
par elle. Le sujet n'est plus seulement le sujet pistmologique,
mais le sujet humain qui, par une continuelle dialectique, pense selon
sa situation, forme ses catgories au contact de son exprience et modifie cette situation et cette exprience par le sens qu'il leur trouve. En
particulier ce sujet n'est plus seul, n'est plus la conscience en gnral
ou le pur tre pour soi, il est au milieu d'autres consciences gale103
MARX. conomie politique et Philosophie, p. 84.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
157
ment situes, il est pour autrui et par l subit une objectivation, devient sujet gnrique. Pour la premire fois depuis Hegel, la philosophie militante rflchit, non pas sur la subjectivit, mais sur lintersubjectivit. La subjectivit transcendantale, dit Husserl, est intersubjectivit. L'homme n'apparat plus comme un produit du milieu ou
comme un lgislateur absolu, mais comme un produit-producteur,
comme le lieu o la ncessit peut virer en libert concrte.
[238]
L-dessus, F. Alqui 104 reproche Heidegger d'tre obscur, et, lui
appliquant un procd d'analyse qui dissocie ce que Heidegger veut
unir, met d'un ct la matire de la connaissance, considre comme
irrationnelle, d'un autre ct l'Esprit, fait de Heidegger un irrationaliste, et s'tonne pour finir qu'il veuille faire une philosophie et intgrer
les valeurs de la rflexion, de la science et de la vrit. C'est que Heidegger veut rflchir sur l'irrflchi, c'est que, trs consciemment, il se
propose d'tudier ltre-au-monde toujours prsuppos par la rflexion
et antrieur aux oprations prdicatives, c'est que Heidegger comme
Hegel fait de l'Esprit ou de l'Unit un avenir et un problme, c'est qu'il
veut en tout cas les voir surgir de l'exprience et non pas les supposer
donns. De la mme manire, parlant de Sartre, G. Mounin 105 trouve
dans sa philosophie un matrialisme honteux et un idalisme
honteux . Manire de dire que c'est un essai de philosophie intgrale.
Du matrialisme dialectique, avec autant ou aussi peu de raisons, on
pourrait dire que c'est un matrialisme honteux et une dialectique honteuse . Toute philosophie dialectique hsite toujours dire
son nom puisque, selon Platon, elle ne sacrifie rien et veut toujours
les deux . Ainsi l'effort philosophique pour passer outre aux abstractions est rcus tantt au nom de la matire et tantt au nom de
l'Esprit. Chacun garde sa marotte.
P. Herv, voulant son tour prendre parti dans le dbat, ne retient
de Husserl que ses formules les plus [239] anciennes : la philosophie
des essences, la philosophie comme savoir strict ou absolu, la conscience comme activit transcendantale et constituante. Et il est vrai
que ces formules, Husserl les a maintenues jusqu' la fin. Mais luimme ou son collaborateur E. Fink en introduisaient d'autres : le point
104
105
Revue Internationale, n 3 et n 4.
Cahiers d'Action, n 1.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
158
de dpart comme situation dialectique , la philosophie comme
mditation ou dialogue infinis . Tout l'intrt de sa carrire est en
ceci qu'il ne cessait de remettre en question son exigence de rationalit
absolue, et par exemple de s'interroger sur la possibilit de cette rduction phnomnologique qui l'a rendu clbre. Il apercevait toujours mieux le rsidu que toute philosophie rflexive laisse derrire
elle et ce fait fondamental que nous existons avant de rflchir, de sorte que, prcisment pour obtenir une clart complte sur notre situation, il finissait par assigner au phnomnologue comme tche premire la description de ce monde vcu (Lebenswelt) o les distinctions
cartsiennes ne sont pas encore accomplies. C'est ainsi que, justement
parce qu'il cherchait au dpart une vidence absolue, il en vient fixer
le programme d'une philosophie qui dcrira le sujet jet dans un monde naturel et historique, horizon de toutes ses penses. C'est ainsi que,
parti d'une phnomnologie statique , il aboutit une phnomnologie de la gense et une thorie de l'histoire intentionnelle ,
en d'autres termes une logique de l'histoire. C'est ainsi qu'il contribue plus que personne dcrire la conscience incarne dans un milieu
d'objets humains, dans une tradition linguistique. C'est ainsi qu'aprs
avoir peut-tre, au dbut de sa carrire, fait barrage devant le renouveau [240] hglien , il y contribue prsent. Les philosophes prennent leur temps, il n'y a pas lieu de le leur reprocher. Il faut voir comment Marx traite les jeunes gens qui voulaient trop vite dpasser
Hegel . Exiger qu'un philosophe aille d'emble aux conclusions de
son travail, sous prtexte que l'action est urgente, ce serait oublier que,
comme disait Marx, la courbe des idologies est beaucoup plus complique encore que celle de l'histoire politique. Ce serait sacrifier le
srieux au spectaculaire au nom d'un romantisme politique dont Marx
s'est soigneusement gard. Mais, dira-t-on, l'existentialisme n'est
pas seulement une philosophie, c'est une mode, et une mode n'est pas
srieuse. Certes. Mais, sur ce plan, la rponse est aise. En fait, bien
qu'ils aient pris d'abord un chemin oppos, la phnomnologie et
l'existentialisme ont veill plus d'tudiants aux problmes de l'histoire qu'ils n'en ont endormi dans le quitisme de la conscience transcendantale. On raconte que, dans les dernires annes de sa vie, quand
Husserl voulait aller Belgrade faire les confrences qu'il lui tait interdit de donner en Allemagne, la Gestapo tait charge au dpart de
lire ses manuscrits. Allons-nous notre tour regarder la philosophie
par les lunettes du commissaire de police ? Philosophe Husserl, nous
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
159
vous dclarons suspect d'anti-hglianisme. En consquence, nous
vous plaons en rsidence surveille... P. Naville et P. Herv, pour des
raisons diffrentes, ont autre chose faire que de lire dans le texte un
Husserl non traduit et aux deux tiers indit ? Soit. Mais alors pourquoi
en parler ?
Heureusement, avec ou sans Husserl, la vrit se fait jour chez
ceux qui aiment la philosophie. Quand Herv, [241] laissant l les
phnomnologues, dfinit pour son compte sa position, il le fait dans
des termes fort peu scientistes et passablement phnomnologiques.
Rhabilitation du monde sensible ou peru, la vrit dfinie par cela
que nous percevons ou connaissons, la connaissance comprise non
comme l'opration formelle du Je sur les sensations , mais comme
enveloppement de la forme dans la matire et de la matire dans la
forme, par suite l'univers abstrait de la science et la fatalit du
Logos absolu replacs dans une activit humaine qui prend
connaissance d'elle-mme dans la ralit qu'elle dcouvre au cours de
ses travaux et ne peut compter sur un filet tendu par la Providence
pour la retenir dans ses chutes ventuelles , condamnation, bien entendu, de toute thorie de la conscience-rceptacle soit sous la
forme grossire de la pense scrtion physiologique , soit sous la
forme plus raffine d'un fatum logique et social, telles sont les thses auxquelles Herv aboutit 106 par les voies hglo-marxistes, et que
d'autres ont rejointes partir de la phnomnologie. Quant G. Mounin, dans le mme numro des Cahiers d'Action, demande que l'on
revienne de la conscience au cerveau et soutient que la conscience
rflchit le monde , il croit atteindre l'existentialisme. En ralit,
c'est solidairement le marxisme et la culture philosophique qu'il dsavoue.
[242]
106
Conscience et Connaissance. Cahiers d'Action, n 1, pp. 5 et 6.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
[243]
SENS ET NON-SENS
III
POLITIQUES
Retour la table des matires
[244]
160
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
161
[245]
SENS ET NON-SENS
III. POLITIQUES
La guerre a eu lieu
Retour la table des matires
Les vnements rendaient toujours moins probable le maintien de
la paix. Comment avons-nous pu attendre si longtemps pour nous rsoudre la guerre ? Nous n'arrivons plus comprendre que certains
d'entre nous aient accept Munich comme une occasion d'prouver la
bonne volont allemande. C'est que nous ne nous guidions pas sur les
faits. Nous avions secrtement rsolu d'ignorer la violence et le malheur comme lments de l'histoire, parce que nous vivions dans un
pays trop heureux et trop faible pour les envisager. Nous mfier des
faits, c'tait mme devenu un devoir pour nous. On nous avait appris
que les guerres naissent de malentendus qui peuvent tre dissips et de
hasard qui peuvent tre conjurs force de patience et de courage.
Nous avions autour de nous une vieille cole o des gnrations de
professeurs socialistes s'taient [246] formes. Ils avaient subi la guerre de 1914 et leurs noms taient inscrits par promotions entires sur le
monument aux morts. Mais nous avions appris que les monuments
aux morts sont impies parce qu'ils transforment les victimes en hros.
On nous invitait rvoquer en doute l'histoire dj faite, retrouver le
moment o la guerre de Troie pouvait encore n'avoir pas lieu et o la
libert pouvait encore, d'un seul geste, faire clater les fatalits extrieures. Cette philosophie optimiste, qui rduisait la socit humaine
une somme de consciences toujours prtes pour la paix et le bonheur,
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
162
c'tait en fait la philosophie d'une nation difficilement victorieuse, une
compensation dans l'imaginaire des souvenirs de 1914. Nous savions
que des camps de concentration existaient, que les juifs taient perscuts, mais ces certitudes appartenaient l'univers de la pense. Nous
ne vivions pas encore en prsence de la cruaut et de la mort, nous
n'avions jamais t mis dans l'alternative de les subir ou de les affronter. Au-del de ce jardin si calme o le jet d'eau bruissait depuis toujours et pour toujours, nous avions cet autre jardin qui nous attendait
pour les vacances de 39, la France des voyages pied et des auberges
de la jeunesse, qui allait de soi, pensions-nous, comme la terre ellemme. Nous habitions un certain lieu de paix, d'exprience et de libert, form par une runion de circonstances exceptionnelles, et nous ne
savions pas que ce ft l un sol dfendre, nous pensions que c'tait le
lot naturel des hommes. Mme ceux d'entre nous qui, mieux informs
par leurs voyages, sensibiliss au nazisme par leur naissance ou enfin
dj pourvus d'une philosophie plus [247] exacte, ne sparaient plus
leur sort personnel de l'histoire europenne, mme ceux-l ne savaient
pas quel point ils avaient raison. Nous discutions avec eux en les
raccompagnant, nous faisions valoir des objections : les ds ne sont
pas jets, l'histoire n'est pas crite. Et ils nous rpondaient sur le ton
de la conversation. Habitus depuis notre enfance manier la libert
et vivre une vie personnelle, comment aurions-nous su que c'taient
l des acquisitions difficiles, comment aurions-nous appris engager
notre libert pour la conserver ? Nous tions des consciences nues en
face du monde. Comment aurions-nous su que cet individualisme et
cet universalisme avaient leur place sur la carte ? Ce qui rend pour
nous inconcevable notre paysage de 1939 et le met dfinitivement
hors de nos prises, c'est justement que nous n'en avions pas conscience comme d'un paysage. Nous vivions dans le monde, aussi prs de
Platon que de Heidegger, des Chinois que des Franais (en ralit aussi loin des uns que des autres). Nous ne savions pas que c'tait l vivre
en paix, vivre en France, et dans un certain tat du monde.
Par hasard ou dessein, l'Allemagne nous avait dlgu des reprsentants ambigus. Bremer, lecteur l'Universit de Paris, vnrait les
valeurs de guerre, frquentait Montherlant et, revenu ici en 1940
comme attach culturel, il devait mettre au service de son gouvernement quelques-unes des relations qu'il avait noues avant la guerre.
Mais, en 1938, il disait souvent : Je suis un vieux radical. condi-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
163
tion de parler assez fort, on obtenait de lui des concessions sur les
principaux articles du nazisme. Il s'tait montr surpris et pein, [248]
un jour qu'il parlait des gouvernementaux espagnols en les appelant
avec insistance les rouges , et que nous l'avions pri d'aller porter
ailleurs sa propagande. Je l'ai vu constern quand il lui fallut, en 1938,
quitter la France pour aller faire en Allemagne une priode militaire.
Autant qu'un homme comme lui pt croire quelque chose, il crut sans
doute la propagande europenne de l'Allemagne, ou du moins il
voulut y croire parce qu'elle lui permettait de concilier le plaisir qu'il
avait vivre en France et sa fidlit au gouvernement de son pays. Un
matin de mars 1939, j'entrai dans la chambre d'un autre Allemand de
Paris pour lui apprendre l'occupation de Prague. Il se leva d'un bond,
courut la carte d'Europe (qu'il avait tout de mme fixe au mur) et
dit, avec tout l'accent de la sincrit : Mais c'est fou, c'est impossible ! Navet ? Hypocrisie ? Ce n'tait probablement ni l'un, ni l'autre. Ces garons disaient ce qu'ils pensaient, mais ils ne pensaient rien
de clair et ils maintenaient en eux-mmes l'quivoque pour viter, entre leur humanisme et leur gouvernement, un choix qui leur aurait fait
perdre ou l'estime d'eux-mmes ou celle de leur patrie. Il n'y avait
qu'une solution leurs dbats intrieurs : la victoire allemande. Quand
ils sont revenus Paris en 40, en rgle avec leur pays qu'ils avaient
suivi dans la guerre, ils taient, bien sr, disposs collaborer
avec la France (dans les limites que leur auraient imposes l'tat-major
allemand et la politique nazie) et oublier l'intermde militaire. Avant
1939, leur mollesse les avait fait choisir pour reprsenter l'Allemagne
Paris, elle entrait dans le jeu de la propagande, leur irrsolution entretenait notre [249] inconscience. Aprs 40, leurs bons sentiments
devaient servir aux mmes fins. Ils se sont prts ce jeu dans une
demi-conscience, jusqu'au jour o la mobilisation totale les a jets,
Bremer sur le front russe o il trouva la mort, l'autre sur le front
d'Afrique o il fut, dit-on, grivement brl. C'est ainsi que l'histoire
sollicite et dtourne les individus, c'est ainsi qu' voir les choses de
prs on ne trouve nulle part des coupables et partout des complices,
c'est ainsi que nous avons tous notre part dans l'vnement de 1939.
Entre nos Allemands et nous, il y a seulement cette diffrence qu'ils
avaient eu sous les yeux le nazisme, et nous pas encore. Ils ne pouvaient pas ignorer l'usage que l'on faisait d'eux, nous n'avions pas encore appris ce jeu-l.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
164
*
*
Pendant l'hiver 39-40, notre condition de soldats n'a rien chang
pour l'essentiel nos penses. Nous avions encore le loisir de considrer les autres comme des vies spares, la guerre comme une aventure
personnelle, et cette trange arme se pensait comme une somme d'individus. Mme quand elle s'appliquait avec bonne volont ses tches
guerrires, elle ne s'y sentait pas prise, et tous les critres restaient
ceux du temps de paix. Notre colonel faisait tirer du 155 pour disperser une patrouille allemande autour de nos postes, on dsignait un capitaine pour recueillir les pattes d'paule et les papiers de deux morts
allemands, nous allions songer auprs de ces brancards comme nous
l'aurions fait auprs d'un lit mortuaire. Ce lieutenant allemand qui
avait agonis dans les barbels, une balle dans le ventre, en [250]
criant : Soldats franais, venez chercher un mourant (c'tait la nuit,
devant un poste isol, et l'on avait interdit aux ntres de sortir jusqu'au
jour), nous nous attardions regarder avec compassion sa mince poitrine, peine couverte d'une tunique par quinze degrs de froid, ses
cheveux blond cendr, ses mains fines, comme sa mre ou sa femme
auraient pu le faire.
C'est aprs juin 40 que nous sommes vraiment entrs dans la guerre. Car dsormais les Allemands que nous rencontrions dans la rue,
dans le mtro, au cinma, il ne nous tait plus permis de les traiter
humainement. Si nous l'avions fait, si nous avions voulu distinguer les
nazis et les Allemands, chercher sous le lieutenant l'tudiant, sous le
soldat le paysan ou le proltaire, ils se seraient mpris, ils auraient cru
que nous reconnaissions leur rgime et leur victoire, et c'est alors
qu'ils se seraient sentis vainqueurs. La magnanimit est une vertu de
riche, et il n'est pas difficile de traiter gnreusement des prisonniers
que l'on tient sa merci. Mais c'est nous qui tions les prisonniers. Il
nous fallait rapprendre toutes les conduites puriles dont notre ducation nous avait dbarrasss, juger des gens sur l'habit, rpondre sans
politesse leurs bonnes manires de commande, vivre pendant quatre
ans ct d'eux sans vivre une minute avec eux, nous sentir sous leur
regard des Franais et non pas des hommes. Il y avait dsormais
dans notre univers de personnes cette masse compacte verte ou grise.
Si nous avions mieux regard, nous aurions dj trouv, dans la socit du temps de paix, des matres et des esclaves, et nous aurions pu
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
165
apprendre comment chaque conscience, si [251] libre, souveraine et
irremplaable qu'elle puisse se sentir, se fige et se gnralise sous un
regard tranger, devient un proltaire ou un Franais . Mais aucune servitude n'est plus visible que celle d'un pays occup. Mme
ceux d'entre nous qui n'taient pas inquits et continuaient de peindre, d'crire, ou de composer des pomes, prouvaient, en revenant
leurs travaux, que leur libert de jadis tait porte par celle des autres
et que l'on n'est pas libre seul. S'ils avaient pu autrefois se sentir allgres et matres de leur vie, c'tait encore l un mode de la coexistence,
cela n'tait possible que dans une certaine atmosphre, ils apprenaient
connatre entre chaque conscience et toutes les autres ce milieu gnral o elles communiquent et qui n'avait pas de nom dans leur philosophie d'autrefois.
En mme temps qu'un sujet d'horreur, l'antismitisme allemand
devait tre pour nous un mystre, et, forms comme nous l'tions,
nous devions nous demander chaque jour pendant ces quatre annes :
comment l'antismitisme est-il possible ? Il y avait sans doute un
moyen d'luder la question : on pouvait nier que l'antismitisme ft
vraiment vcu par personne. Les nazis, eux aussi, pardonnaient certains juifs dont ils attendaient quelque service, et le hasard d'une liaison a permis un comdien juif de tenir la scne Paris pendant quatre ans. Peut-tre, aprs tout, n'y avait-il pas un seul antismite ? Peuttre l'antismitisme n'tait-il tout entier qu'un montage de la propagande ? Peut-tre soldats, SS, journalistes obissaient-ils des consignes auxquelles ils ne croyaient pas, et peut-tre enfin les auteurs de
cette propagande n'y croyaient-ils pas davantage ? [252] Dclench
par des meneurs conscients et port par des forces lmentaires confuses, l'antismitisme aurait t une sinistre mystification. Nous le pensions avant 1939, nous ne pouvons plus le croire maintenant, aprs
avoir vu ces autobus pleins d'enfants, place de la Contrescarpe. L'antismitisme n'est pas une machine de guerre monte par quelques Machiavels et servie par l'obissance des autres. Pas plus que le langage
ou la musique, il n'a t cr par quelques-uns. Il s'est conu au creux
de l'histoire. Les meneurs et les forces lmentaires, le cynisme et la
btise, cette conception roublarde et policire de l'histoire est finalement nave : elle prte trop de conscience aux chefs et trop peu aux
masses. Elle ne voit pas de milieu entre l'action volontaire des uns et
l'obissance passive des autres, entre le sujet et l'objet de l'histoire, et
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
166
ce que les Allemands nous ont fait comprendre au contraire, c'est que
les chefs sont mystifis par leurs propres mythes et les troupes demi
complices, que personne ne commande absolument et personne
n'obit absolument. Un antismite ne pourrait pas voir torturer des
juifs s'il les voyait vraiment, s'il percevait cette souffrance et cette
agonie dans une vie individuelle, mais justement, il ne voit pas les
juifs qui souffrent, il est dans le mythe du juif. travers ces tres
concrets, il torture et tue le juif, il se dbat avec ses rves et les coups
atteignent des visages vivants. La passion antismite ne part pas des
individus et ne vise pas les individus.
Nous rencontrions ici la formule marxiste, qui a en tout cas le mrite de nous situer dans le social : L'antismitisme est le socialisme
des imbciles. Une [253] socit dcompose, qui pressent et redoute la rvolution, transfre et apaise sur les juifs une angoisse qui
s'adresse elle-mme. Gela pouvait expliquer l'antismitisme hypocrite des maurrassiens, toujours accompagn de rserves ou d'exceptions,
et timide devant les cas particuliers. Mais le racisme des SS, Drancy,
les enfants spars de leur mre ? Comme toute explication par transfert, celle-ci choue devant la passion pure. Le transfert passionnel
n'est pas une explication dernire, puisqu'il s'agit justement de savoir
ce qui l'a motiv, et pourquoi l'angoisse et le sadisme d'une socit qui
se dcompose se fixent sur les juifs. Nous nous heurtons ici, comme
dans toute passion, un lment de hasard et d'irrationalit pure, sans
lequel la passion serait fonde et ne serait plus une passion. Si cet
homme aime aujourd'hui cette femme, c'est que son histoire passe le
prparait aimer ce caractre, ce visage, mais enfin c'est aussi parce
qu'il l'a rencontre, et cette rencontre met au jour dans sa vie des possibilits qui, sans elle, se seraient assoupies. Une fois tabli, cet amour
fait figure de destine, mais le jour de la premire rencontre il est absolument contingent. Une fixation peut bien tre motive par le pass
de l'individu, mais elle apporte plus qu'elle ne promettait ; une fois
ralise, elle a son poids propre, qui est la force brute du prsent et de
ce qui existe. De mme, on ne peut pas expliquer l'antismitisme jusqu'au bout : on peut en indiquer les motivations le problme social
et le rle que les juifs ont jou jadis dans le dveloppement d'un certain capitalisme, mais elles ne dessinent qu'une histoire possible, et
si, en Allemagne, vers 1930, l'angoisse a [254] remont vers le pass
et choisi de s'assouvir sur les juifs, parce que toute angoisse se dtour-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
167
ne du futur, l'explication rationnelle ne peut pas aller au-del, partir
de ses motifs la passion se cre elle-mme, on ne peut pas la comprendre dans un univers de consciences. L'antismitisme allemand
nous replace devant une vrit que nous ignorions en 1939. Nous pensions qu'il n'y avait pas de juifs, pas d'Allemands, mais seulement des
hommes ou mme des consciences. Il nous semblait qu' chaque moment chacun de nous choisissait dans une libert toujours neuve d'tre
et de faire ce qu'il voulait. Nous n'avions pas compris que, comme
l'acteur se glisse dans un rle qui le dpasse, qui modifie le sens de
chacun de ses gestes, et promne autour de lui ce grand fantme dont
il est l'animateur, mais aussi le captif, chacun de nous dans la
coexistence se prsente aux autres sur un fond d'historicit qu'il n'a
pas choisi, se comporte envers eux en qualit d' aryen , de juif, de
Franais, d'Allemand, que les consciences ont l'trange pouvoir de
s'aliner et de s'absenter d'elles-mmes, qu'elles sont menaces du dehors et tentes du dedans par des haines absurdes et inconcevables au
regard de l'individu, et que, si un jour les hommes doivent tre des
hommes les uns pour les autres, et les rapports des consciences devenir transparents, si l'universalit doit se raliser, ce sera dans
une socit o les traumatismes du pass auront t liquids et o
d'abord les conditions d'une libert effective auront t ralises. Jusque-l, la vie sociale restera ce dialogue et cette bataille de fantmes
o l'on voit soudain couler de vraies larmes et du vrai sang.
[255]
*
*
Or, dans ce combat, il ne nous tait plus permis de rester neutres.
Pour la premire fois, nous tions amens non seulement constater,
mais encore assumer la vie de socit. Avant 39, la police ne nous
concernait pas. Elle existait, mais nous n'aurions jamais song la
faire. Qui d'entre nous aurait prt main-forte pour arrter un voleur,
ou accept de se faire magistrat et de rendre des sentences ? Nous
voulions bien, pour notre compte, n'tre ni criminels, ni voleurs, parce
que nous en avions dcid ainsi. Mais comment notre libert auraitelle eu le droit d'en supprimer une autre, mme si l'assassin avait luimme dispos d'une autre vie ? Nous ne pouvions pas supporter que la
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
168
sanction voult se parer d'un caractre moral et nous la ramenions aux
ncessits de police, dont nous distinguions soigneusement les rgles
morales. C'tait une uvre basse, laquelle, mme si nous y tions
mls, nous ne voulions pas consentir. Je me rappelle ma perplexit
quand j'appris que, sous-lieutenant de rserve, je pouvais tre requis
par la police pour aider une arrestation et devais mme lui offrir mes
services. Il nous a bien fallu changer d'avis : nous avons bien vu qu'il
nous appartenait de juger. S'il avait dpendu de nous d'arrter et de
condamner un dnonciateur, nous n'aurions pas pu laisser d'autres
cette besogne. Avant la guerre, la politique nous paraissait impensable
parce qu'elle est un traitement statistique des hommes et qu'il n'y a pas
de sens, pensions-nous, traiter comme une collection d'objets substituables et par rglements gnraux ces tres singuliers [256] dont chacun est pour soi un monde. Dans la perspective de la conscience, la
politique est impossible. Il y a eu un moment o nous nous sommes
sentis atteints au cur par ces absurdits du dehors.
Nous avons t amens assumer et considrer comme ntres
non seulement nos intentions, le sens que nos actes ont pour nous,
mais encore les consquences de ces actes au dehors, le sens qu'ils
prennent dans un certain contexte historique. Il y a vingt ans, un historien dnonait les responsabilits des Allis dans la guerre de 1914.
Pendant l'occupation, nous avons vu avec stupeur le mme historien
publier, sous le visa de la censure, une brochure o il dnonait les
responsabilits de l'Angleterre l'origine de la guerre de 1939. Il n'a
pas compris que mettre en cause l'Angleterre, Paris, sous l'occupation allemande, c'tait prendre son compte une propagande qu'aucun
pacifiste n'a le droit de servir, puisque c'est celle d'un rgime guerrier.
Au printemps de 1944, les professeurs ont tous reu un texte qu'on
leur proposait de signer et qui adjurait le marchal Ptain d'intervenir
pour arrter la guerre. Il est trop simple de supposer que ceux qui ont
compos ou sign ce texte s'taient mis au service des Allemands et
essayaient d'arrter la guerre avant leur dfaite. Il est rare, au moins
dans le monde des professeurs, que les trahisons se fassent dans cette
clart, et c'est le sort des hommes de ne cder jamais l'intrt seulement, mais en mme temps aux ides. Voici donc comment on imagine un des rdacteurs de ce texte. Pour lui, les passions de la guerre
n'existent pas ; elles ne tiennent un semblant de force que du consentement des hommes aussi libre [257] chaque moment ; il n'y a donc
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
169
pas un monde en guerre, avec, d'un ct, les dmocraties, et, de l'autre, les fascismes, ou encore d'un ct les empires constitus et de l'autre les nations tard venues qui voudraient se constituer un empire (les
premiers fortuitement allis un tat proltarien ) ; il n'y a pas
d'empires, pas de nations, pas de classes, il n'y a rien que des hommes
partout, toujours prts pour la libert et le bonheur, toujours capables
de les obtenir sous quelque rgime que ce soit, condition qu'ils se
reprennent et retrouvent la seule libert qui soit, celle de leur jugement ; un seul mal, donc, qui est la guerre elle-mme, et un seul devoir, qui est de ne pas croire aux victoires du droit et de la civilisation
et de faire cesser la guerre. Ainsi pense ce solitaire cartsien, et il ne
voit pas derrire lui son ombre porte sur l'histoire comme sur un mur,
ce sens, cette figure que prennent ses actions au-dehors, cet Esprit Objectif qui est lui-mme.
Le politique cartsien rpondrait sans doute que, si nous nous tenons pour responsables de nos penses et de nos actions dans leurs
plus lointaines consquences, il ne nous reste plus qu' refuser toute
transaction, comme fait le hros. Or, ajouterait-il, combien de hros
parmi ceux qui se louent aujourd'hui d'avoir rsist ? J'en vois qui
taient fonctionnaires de l'tat, et qui ont continu de recevoir leur
salaire, jurant par crit, puisqu'il le fallait, qu'ils n'taient ni juifs, ni
francs-maons. J'en vois d'autres qui ont accept de demander pour
leurs crits ou pour leur thtre l'autorisation d'une censure qui ne
laissait rien passer qu' dessein. Chacun traait sa faon la frontire
des choses permises. Ne [258] publiez rien, disait l'un. Rien pour les
journaux ni pour les revues, disait l'autre, imprimez vos livres. Je donne ma pice ce thtre s'il est dirig par un homme de bien, je la retire s'il est dirig par un valet du gouvernement, disait un troisime. La
vrit est que chacun a compos avec la ncessit extrieure, sauf
quelques-uns, qui ont donn leur vie. Il fallait ou bien cesser de vivre,
refuser cet air corrompu, ce pain empoisonn, ou bien vivre, c'est-dire se mnager dans le malheur commun un rduit de libert prive,
et c'est ce que la plupart ont fait, mettant seulement leur conscience en
repos par des sacrifices mesurs. Ceci n'acquitte pas les tratres, qui
ont appel ce rgime, l'ont aid au-del de l'indispensable, et se sont
dsigns d'eux-mmes aux sanctions de la loi nouvelle. Mais ceci
nous interdit de les juger au nom d'une morale que personne n'a suivie
jusqu'au bout, et de fonder sur l'exprience de ces quatre annes une
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
170
nouvelle philosophie, puisque nous avons vcu suivant l'ancienne.
Seuls les hros ont vraiment t au dehors ce qu'ils voulaient tre au
dedans, seuls, ils se sont joints et confondus l'histoire, au moment o
elle prenait leur vie, mais ceux qui ont survcu mme aux plus grands
risques n'ont pas consomm ce mariage cruel, personne ne peut parler
de ce silence ni le recommander aux autres. L'hrosme ne se prche
pas, il s'accomplit, et toute prdication serait ici prsomption, puisque
celui qui peut encore parler ne sait pas de quoi il parle.
Ce raisonnement est fort. Mais il va dans notre sens. Il est vrai que
nous ne sommes pas innocents, et que, dans la situation o nous
tions, il n'y avait pas de [259] conduite irrprochable. En restant ici,
nous nous faisions tous complices quelque degr, et il faut dire de la
rsistance ce que les combattants ont souvent dit de la guerre : on n'en
revient qu' condition d'avoir quelque moment limit les risques, et,
en ce sens-l, choisi de sauver sa vie. Ceux qui ont quitt la France
pour poursuivre ailleurs la guerre par les armes ou par la propagande
ne peuvent pas davantage se prvaloir de leur puret, car s'ils chappaient toute compromission directe, c'tait en cdant le terrain pour
un temps, et, en ce sens, ils prenaient comme nous leur part dans les
ravages de l'occupation. Plusieurs de nos camarades se sont pos la
question et ont choisi pour le mieux, mais rien ne peut faire que leur
dcision ait t une vraie solution. En restant on se compromettait, en
partant on se compromettait, personne n'a les mains propres (et c'est
peut-tre pourquoi les Allemands ont trouv Paris le cadavre de
Martel et de quelques autres). Nous avons dsappris la pure morale et appris une sorte d'immoralisme populaire, qui est sain. L'homme moral ne veut pas se salir les mains. C'est qu'il a d'ordinaire assez
de loisir, de talents ou de fortune pour se tenir l'cart des entreprises
qu'il dsapprouve et se prparer une bonne conscience. Le peuple n'a
pas cette libert-l : le mcanicien dans un garage, s'il voulait vivre,
tait bien oblig de rparer les voitures allemandes. Tel de nos camarades s'adressait la librairie Rive Gauche pour avoir les livres de
philosophie allemande dont il avait besoin. Le jour venu, il a pris part
l'insurrection et les Allemands l'ont fusill. Nous sommes dans le
monde, mls lui, compromis avec lui. Ce n'est [260] pas une raison
pour lui cder tout l'extrieur et pour nous confiner dans nos penses,
toujours libres, mme chez l'esclave. Cette division de l'intrieur et de
l'extrieur est abstraite. Nous donnons au monde la fois plus et
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
171
moins. Nous lui donnons moins, car nous pesons sur lui quand le moment est venu, et l'tat (on l'a bien vu avec l'tat vichyssois) n'est rien
sans notre consentement. Nous lui donnons plus, car il veille notre
intrt, c'est en lui que nous vivons, et, vouloir tre libres en marge
du monde, nous ne le sommes pas du tout. Un jugement sans parole
n'est pas accompli, une parole sans rponse possible fait non-sens, ma
libert et celle d'autrui se nouent l'une l'autre travers le monde.
Certes, ceux d'entre nous qui n'taient ni juifs, ni communistes dclars pouvaient, pendant ces quatre annes, se mnager des mditations : on ne leur refusait ni Platon, ni Descartes, ni les rptitions du
Conservatoire, le samedi matin. Nous pouvions recommencer notre
adolescence, revenir nos dieux et nos grands crivains comme
des vices. Nous ne revenions pas pour autant nous-mmes et l'esprit. Nous ne sortions pas pour autant de l'histoire. Nos meilleures
penses, vues de Londres, de New York ou de Moscou, se situaient
dans le monde et portaient un nom, c'taient des rveries de captifs, et
elles en taient modifies jusque dans leur valeur de penses. On ne
dpasse pas l'histoire et le temps, on ne peut que s'y fabriquer une
ternit prive, fictive comme celle du fou qui se croit Dieu. L'esprit
n'est pas dans ces songes moroses, il ne parat qu'au grand jour du dialogue. Mditant sur nos grands hommes, nous n'tions pas plus libres
et pas [261] plus consciences que le juif ou le dport devenu une seule douleur aveugle et sans choix. Il n'y a pas de libert effective sans
quelque puissance. La libert n'est pas en de du monde, mais au
contact avec lui.
*
*
Nous retrouvions l une vrit marxiste. Mais mme le marxisme
tait reprendre, car il risquait de nous confirmer dans nos prjugs
d'avant-guerre. Sous prtexte que l'histoire est l'histoire de la lutte des
classes et que les conflits idologiques n'en sont que la superstructure,
un certain marxisme nous dtache de toutes les situations o le sort
des classes n'est pas immdiatement engag. La guerre de 1939, classe comme guerre imprialiste au moins jusqu' l'intervention de
l'U.R.S.S., n'intressait pas ce genre de marxistes. L'histoire vraie devait recommencer pour eux le jour o la lutte sociale pourrait se manifester nouveau. Le fascisme n'tant, aprs tout, qu'un parent pauvre
du capitalisme, le marxiste n'avait pas prendre parti dans cette que-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
172
relle de famille, et le succs de l'un ou l'autre camp ne lui importait
pas beaucoup. En priode de crise, pensaient certains d'entre nous, le
capitalisme ne peut plus se permettre d'tre libral, il devra partout se
raidir et les mmes ncessits qui ont amen l'existence les fascismes toufferont les liberts dans les prtendues dmocraties. La guerre mondiale n'est qu'une apparence, et ce qui reste vrai sous cette apparence, c'est le sort commun des proltaires de tous les pays et la solidarit profonde de tous les capitalismes travers les contradictions
internes du rgime. Il ne saurait donc tre question, pour les proltariats [262] nationaux, d'assumer en quoi que ce soit les vnements o
ils se trouvent mls, chaque proltaire sous l'uniforme ne peut se sentir que proltaire. Ainsi certains d'entre nous, quand ils apprenaient
quelque chec des Allemands, boudaient leur propre plaisir et affectaient de ne pas se mler la satisfaction gnrale. Quand nous leur
prsentions la situation d'un pays occup comme le type mme des
situations inhumaines, ils s'efforaient de dissoudre ce phnomne
dans le phnomne plus gnral de l'exploitation et de l'oppression
capitalistes. Placs depuis toujours dans le secret de l'histoire, ils
comprenaient la rvolte patriotique mieux qu'elle ne se comprenait
elle-mme, ils lui donnaient l'absolution au nom de la lutte des classes. Et pourtant, quand la libration est venue, ils l'ont appele par son
nom, connue tout le monde.
Ils n'avaient pas besoin, pour le faire, de renoncer au marxisme.
L'exprience de ces quatre annes nous a, en effet, appris mieux
comprendre les relations concrtes de la lutte des classes et de l'idologie. La lutte des classes n'est pas plus vraie que les conflits idologiques, ils ne s'y rduisent pas comme l'apparence la ralit. Marx
l'enseigne lui-mme, les idologies, une fois constitues, ont leur
poids propre, elles entranent l'histoire comme le volant entrane le
moteur. Par suite, une analyse marxiste de l'hitlrisme ne peut pas
consister le classer sommairement comme pisode du capitalisme . Elle met sans doute nu la conjoncture conomique sans laquelle il n'aurait pas exist, mais cette conjoncture est singulire, et,
pour la dfinir entirement, pour rejoindre l'histoire effective, il faut
faire tat de [263] particularits locales, et non seulement de la fonction conomique du nazisme, mais encore de sa fonction humaine. Le
marxiste ne doit pas appliquer mcaniquement le schma capitaltravail, mais penser nouveau chaque vnement qui se prsente pour
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
173
dterminer chaque fois par o passe la ligne sinueuse de l'avenir proltarien. Il n'est pas oblig de considrer l'oppression en pays occup
comme un phnomne de surface, au-dessous duquel la vrit de l'histoire devrait tre cherche. Il n'y a pas deux histoires, l'histoire vraie et
l'histoire empirique. Il n'y en a qu'une, et tout ce qui arrive en fait partie, condition qu'on sache le dchiffrer. L'occupation allemande,
pour un marxiste en milieu franais, n'tait pas un accident de l'histoire, mais un vnement de premire grandeur. La victoire de l'Allemagne et celle des Anglo-Saxons ne sont pas quivalentes du point de
vue de la lutte des classes, parce que les gouvernements anglo-saxons,
si ractionnaires qu'ils soient et veuillent tre, se trouveront freins
dans leur propre pays par leur idologie librale, et que la lutte sociale, redevenir tout de suite manifeste, gagne en intrt pour des
hommes qui n'ont pas cent ans vivre et qui en auraient pass cinquante peut-tre sous l'oppression fasciste. Le marxisme ne supprime
pas les facteurs subjectifs de l'histoire au profit des facteurs objectifs,
il noue les uns aux autres. L'idologie nationale ne peut tre une fois
pour toutes qualifie comme bourgeoise ; il s'agit chaque moment
d'en apprcier la fonction dans la conjoncture historique, o elle peut
tre tantt progressive et tantt ractionnaire. Dans la France de 1940
et maintenant, le sentiment national [264] (nous ne disons pas le
chauvinisme) est rvolutionnaire. Cela ne veut pas dire seulement qu'il
s'oppose en fait aux intrts immdiats du capitalisme franais et que
les marxistes peuvent l'utiliser au profit de leur lutte propre et par une
pieuse ruse. Cela veut dire que la conjoncture historique libre la ralit nationale des hypothques ractionnaires dont elle tait greve et
autorise la conscience proltarienne l'intgrer. On rpondra peut-tre
que, dans une politique marxiste, la nation ne peut jamais tre une fin
mais seulement un moyen, que le patriotisme marxiste ne saurait tre
qu'une tactique, et que, par exemple, l'puration pour un marxiste sert
la rvolution, tandis que pour un patriote, il s'agit au contraire d'intgrer le mouvement des masses la nation. Mais ce langage mme
n'est pas marxiste. Le propre du marxisme est de ne pas distinguer la
fin et les moyens, et il n'y a pas en principe de politique moins hypocrite et moins machiavlique. Il ne s'agit pas de surprendre la bonne
foi des patriotes et de les conduire l o ils ne veulent pas aller. Ce
n'est pas le marxiste, c'est l'histoire qui transforme le sentiment national en volont rvolutionnaire. Il s'agit de faire voir aux patriotes et
les vnements s'en chargent en mme temps que les marxistes
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
174
que, dans un pays affaibli comme la France et pass, par le mouvement de l'histoire, au second rang des grandes puissances, une certaine
indpendance politique et conomique n'est possible que par un jeu de
bascule plein de prils ou dans le cadre d'tats-Unis socialistes qui
n'ont aucune chance de se raliser sans rvolution. Etre marxiste, ce
n'est pas renoncer aux diffrences, tre Franais, [265] Tourangeau
ou Parisien, ce n'est pas renoncer l'individu pour se confondre avec
le proltariat mondial. C'est bien rejoindre l'universel, mais sans quitter ce que nous sommes. Mme dans une perspective marxiste, le proltariat mondial, tant qu'il n'existe qu'objectivement et dans l'analyse
de l'conomiste, n'est pas un facteur rvolutionnaire. Il le devient s'il
se saisit comme proltariat mondial, et cela n'arrivera que par la pese
concordante ou par la rencontre au mme carrefour des proltariats de
fait, tels qu'ils existent dans les diffrents pays, non par un internationalisme asctique o chacun d'eux perdrait ses plus fortes raisons
d'tre marxiste.
*
*
En somme, nous avons appris l'histoire et nous prtendons qu'il ne
faut pas l'oublier. Mais ne sommes-nous pas ici dupes de nos motions ? Si, dans dix ans, nous relisons ces pages et tant d'autres, qu'en
penserons-nous ? Nous ne voulons pas que cette anne 1945 devienne
pour nous une anne entre les annes. Celui qui a perdu un fils ou une
femme aime ne veut pas vivre au-del. Il laisse la maison dans l'tat
o elle tait. Les objets familiers sur la table, les vtements dans l'armoire marquent dans le monde une place vide. Il converse avec l'absent, il ne change rien sa vie, et, chaque jour, ses conduites ressuscitent cette ombre toujours moins dense comme par une sorte d'incantation. Un jour vient pourtant o ces livres, ces vtements changent de
sens : c'taient des livres neufs, ils sont maintenant jaunis, c'taient
des vtements que l'on portait, ils sont maintenant dmods et frips.
Les [266] conserver davantage, ce ne serait pas faire survivre celui qui
est mort, mais au contraire dater plus cruellement sa mort. Il viendra
de mme un moment o nous voudrons garder de nos amis torturs et
fusills, non pas les dernires images, celles de ces quatre annes, et
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
175
de cet t fivreux, mais un souvenir ternel o se mleront les choses
qu'ils ont faites et celles qu'ils auraient pu faire, partis comme ils
l'taient pour la vie. Certes, nous n'en sommes pas l, mais puisqu'il
s'agit ici d'crire et non pas de raconter nos peines, ne devons-nous
pas dpasser nos sentiments pour en trouver la vrit durable ?
La guerre n'tait pas finie que dj tout changeait, et non seulement
par la lgret des hommes, mais par une ncessit intrieure. Dans la
rsistance, l'union tait facile parce que les rapports taient presque
toujours des rapports d'homme homme. En face de l'arme allemande et du gouvernement de Vichy, o, comme dans tous les appareils
d'tat, la gnralit sociale dominait, la rsistance offrait ce phnomne si rare d'une action historique qui ne cessait pas d'tre personnelle.
Les lments psychologiques et moraux de la politique paraissaient ici
presque seuls, et c'est pourquoi on a pu voir dans la rsistance les intellectuels les moins enclins la politique. L'exprience de la rsistance a t pour eux une exprience unique et ils voulaient en garder l'esprit dans la nouvelle politique franaise, parce qu'elle chappait enfin
au fameux dilemme de l'tre et du faire qui est celui de tous les intellectuels devant l'action. De l ce bonheur travers le danger, o nous
avons vu certains de nos camarades, d'ordinaire tourments. [267] Il
est trop clair que cet quilibre de la vie personnelle et de l'action tait
justement li aux conditions de l'action clandestine et ne pouvait lui
survivre. En ce sens, il faut dire que l'exprience de la rsistance, en
faisant croire que la politique est un rapport d'homme homme ou de
conscience conscience, favorise nos illusions de 1939 et masque les
vrits que l'occupation nous enseignait par ailleurs, c'est--dire l'incroyable puissance de l'histoire. Nous voici revenus au temps des institutions, la distance reparait entre les lois et ceux qui elles s'appliquent, de nouveau on lgifre pour X..., de nouveau la bonne volont
des uns prend sa figure de classe, qui la rend mconnaissable pour les
autres. De nouveau, il faut se soucier des consquences de ce que l'on
dit, peser chaque mot selon son sens objectif, sans espoir de convaincre par la seule force du vrai. Nous l'avons fait pendant l'occupation, il
ne fallait pas un geste public qui pt faire le jeu de l'occupant .
Mais entre amis nous avions une libert de critique que nous avons
dj perdue. Allons-nous maintenant soumettre nos paroles et nos gestes cette rgle tout extrieure, qui indignait Pguy, de ne pas faire
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
176
le jeu de la raction , le jeu du communisme ou le jeu du
gouvernement ? Nous avons vu pendant quatre ans la vie personnelle annule. Il n'y a rien l apprendre, et si dcidment la politique est
l'enfer, il n'y a qu' la quitter. Voil pourquoi au lendemain d'une autre
guerre, les fondateurs de la N.R.F. invitaient les auteurs et le public
abandonner les valeurs et les attitudes de la guerre. Ils voulaient dmobiliser les consciences, revenir aux problmes d'esthtique pure, se
dgager de [268] l'histoire...
Assurment, et c'est l que nous voulions en venir, ces cinq annes
ne nous ont pas appris trouver mauvais ce que nous jugions bon, il
reste absurde devant la conscience de cacher une vrit parce qu'elle
nuit au pays, de tuer un homme parce qu'il habite au-del de la rivire,
de traiter autrui comme un moyen. Nous n'avions pas tort, en 1939, de
vouloir la libert, la vrit, le bonheur, des rapports transparents entre
les hommes, et nous ne renonons pas l'humanisme. La guerre et
l'occupation nous ont seulement appris que les valeurs restent nominales, et ne valent pas mme, sans une infrastructure conomique et politique qui les fasse entrer dans l'existence davantage : que les valeurs ne sont rien, dans l'histoire concrte, qu'une autre manire de
dsigner les relations entre les hommes telles qu'elles s'tablissent selon le mode de leur travail, de leurs amours, de leurs espoirs, et, en un
mot, de leur coexistence. Il ne s'agit pas de renoncer nos valeurs de
1939, mais de les accomplir. Il ne s'agit pas d'imiter les tyrans ; et,
dans la mesure o il a fallu le faire, nous leur en voulons justement de
nous y avoir obligs. Pourra-t-on jamais liminer la tyrannie de la vie
politique, est-il vrai que l'tat puisse dprir et les relations politiques
ou sociales des hommes se rsorber jamais dans leurs relations humaines, c'est une question. Mais si nous n'avons pas l'assurance de cet
achvement, nous voyons du moins trs prcisment l'absurdit d'une
tyrannie anachronique comme l'antismitisme et d'un expdient ractionnaire comme le fascisme. C'est assez pour vouloir les dtruire jusque dans leurs racines et [269] pour pousser les choses dans le sens de
la libert effective. Or, cette tche politique n'est incompatible avec
aucune valeur de culture et aucune tche littraire, si culture et littrature se dfinissent, non comme des techniques hors du monde, mais
comme la prise de conscience progressive de nos multiples rapports
avec autrui et avec le monde. Nous n'aurons cacher aucune vrit si
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
177
nous disons toutes les autres. Dans la coexistence des hommes, laquelle ces annes nous ont veills, les morales, les doctrines, les penses et les coutumes, les lois, les travaux, les paroles s'expriment les
uns les autres, tout signifie tout. Il ny a rien hors cette unique fulguration de l'existence.
(Juin 1945.)
[270]
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
178
[271]
SENS ET NON-SENS
III. POLITIQUES
Pour la vrit
Retour la table des matires
Les rpublicains de Stendhal voulaient follement la sincrit contre
les coquins et les fripons qui peuplaient les cours et les antichambres. Les professeurs dreyfusistes de 1900 voulaient la justice
tout prix. Ils disaient : mme si la rvision du procs Dreyfus doit
compromettre l'tat-major de l'Arme et la Dfense nationale, il faut
obtenir la rvision, puisque une France injuste ne serait plus la France
et ne mriterait plus d'tre sauve. Maurras leur opposait bien qu'une
politique ne doit pas se rgler sur le juste et l'injuste tels que nous les
sentons en nous-mmes, mais d'abord sur les conditions d'existence et
l'intrt de la nation, sans laquelle il n'y a pas de civilisation et finalement pas de justice, qu' on a quelquefois vu des tribunaux sans justice, mais jamais de justice sans tribunaux , qu'il fallait donc sauver
l'autorit des tribunaux et laisser Dreyfus l'Ile du Diable au nom
[272] mme de la justice, ni Pguy, ni les Kantiens n'acceptaient
que la France perdt ses raisons d'exister pour conserver l'existence.
sa manire, le mouvement surraliste a repris la mme fonction de
jugement et de scandale, et la Centrale Surraliste se donnait pour tche de signaler toutes les absurdits de la vie relle sans aucun
gard aux consquences. Dans l'entre-deux-guerres, la plupart des intellectuels franais traitaient les questions politiques sous l'angle de la
morale. Pour Gide, pour Alain, pour Andre Viollis, pour le premier
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
179
Aragon, pour Breton, pour Bernanos, la vrit tait te jours bonne
dire, au besoin contre le gouvernement, contre la nation, contre le parti. Quand Malraux redcouvrit qu'en politique l'efficacit est la premire des rgles, ses deux plus beaux livres montrent assez qu'il n'accepta pas sans dbats cette ide. Sans doute mme ne l'accepta-t-il jamais tout fait, puisque son ralisme ne rsista pas l'preuve du
pacte germano-russe. Comme leurs intellectuels, les Franais jugeaient et parlaient franc : l'tonnement des trangers, ils traitaient
Daladier ou Reynaud tantt avec indulgence, tantt avec mpris, mais
en tout cas sans prcaution ni respect.
Nous avons bien chang. Nous avons vu, comme on dit, o cela
mne . A tort ou raison, nous attribuons les malheurs de la France
au cynisme et l'indpendance des Franais. Nous sommes tous des
repentis. On ne nous y reprendra plus. Chacun de nous se sent responsable, charg de patrie ou de parti comme on est charg de famille.
Avant de dire une vrit, nous regardons d'abord aux consquences.
Nous avons gagn [273] en biensance et en srieux, mais force de
mesurer nos paroles et de n'entendre que rponses mesures, nous
prenons l'habitude assez basse des interprtations, des allusions et des
pointes. Si un intellectuel recommande l'esprit de synthse, cela veut
dire, dans le lexique de notre temps, qu'il veut se faire bien voir
des communistes, et, du ct socialiste, on l'observe d'un regard sourcilleux. Il rgne presque partout un ton cafard et insinuant qui est celui
de la Sapinire dans Balzac et de la Congrgation dans Stendhal. Le
jeu se fait par la bande. Les pes sont mouchetes. Les conservateurs
sont socialistes , les rvolutionnaires sont gouvernementaux, chacun rpond ct, de sorte que les discussions sont dialogues de
sourds. Tout le monde est raliste, opportuniste, tacticien, sauf Bernanos, dont les colres trop attendues, comme celles de Raimu, n'impressionnent plus personne. Maurras est en prison, mais le maurrassisme est partout. Nous sommes tous des coquins au sens de Stendhal.
N'avons-nous donc le choix que d'tre ou des cyniques ou des coquins ? Avant de nous rsigner ce dilemme, il faudrait tre sr qu'il
est invitable. Peut-tre l'engagement ne supprime-t-il la libert d'esprit que lorsqu'il est confus et faute d'une pense politique qui soit capable la fois d'accueillir toutes les vrits et de prendre position dans
le rel ? Aucun parti en France ne pense son action, ne dit ouvertement ce qu'il est et ce qu'il fait. Chacun d'eux a son double jeu. Quant
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
180
aux ides, elles ne sont pas formes au contact du prsent et pour le
comprendre, ce sont des lambeaux idologiques hrits du XIXe sicle
et qui couvrent trs mal les faits. Rien [274] d'tonnant si, n'ayant
choisir qu'entre des quivoques, nous nous sentons partout mal l'aise
et si la fidlit un parti devient pnible.
*
*
Deux grands partis marxistes ont eux seuls la majorit en France.
Cela devrait mettre dans notre politique quelque franchise proltarienne. Voyons ce qu'il en est.
Les communistes ont invent le soutien oppositionnel . L'hiver
dernier, ils critiquaient le gouvernement, mais comment auraient-ils
pouss fond la critique, puisqu'ils en faisaient partie ? Ils protestaient
contre la loi lectorale, mais ils avaient commenc par dclarer qu'en
aucun cas leurs ministres ne dmissionneraient. Ils recommandaient le
oui-non, mais leurs ministres restaient membres d'un gouvernement
dont le chef, la radio, recommandait le oui-oui. Ils protestaient
contre l'arrestation des Indochinois de Paris, mais, comme tous les
membres du gouvernement, ils en taient solidairement responsables.
En finir avec les trusts , disaient leurs tracts lectoraux. Comme si
les trusts taient peu prs morts, comme s'il ne s'agissait que de les
achever. En un sens, tous les thmes de l'ancien communisme figurent
dans la politique du P.C. : lutte des classes, anticolonialisme, antimilitarisme. C'est pourquoi Action parvient presque toujours l'envelopper d'un contrepoint marxiste. Mais, s'ils sont toujours l, leur fonction
n'est plus directrice, comme on voit quand Action approuve sans rserves la politique des [275] Trois Grands 107. La fonction des ides
marxistes n'est plus tant de dterminer une politique que de la commenter et de lui fournir laura marxiste. Pour un tmoin ingnu, les
deux choses peuvent se confondre, pour un marxiste de la vieille cole, elles sont aussi distinctes que le chien, animal aboyant, et le chien,
constellation cleste. Mme si, propos de l'affaire de Syrie,
l'U.R.S.S. prend position contre le colonialisme, comme on ne voit
107
D'un point de vue marxiste, la politique des Trois Grands est, bien entendu,
prfrable l'isolement de l'U.R.S.S. et au Bloc occidental. Elle n'en est pas
moins diffrente de la politique extrieure universaliste que l'U.R.S.S. a
dfinie en 1917.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
181
pas qu'elle ait tabli des soviets dans les pays qu'elle occupe, il faut
bien admettre que la libration des peuples coloniss a cess d'tre,
dans la politique de l'U.R.S.S., un principe inconditionnel. Cela ne
veut pas dire, comme on le rpte la lgre, que l'U.R.S.S. est devenue une puissance imprialiste. L'imprialisme aboutit une exploitation des pays arrirs au profit des pays avancs qui vont y
chercher une main-d'uvre peu coteuse, des matires premires, un
march pour leurs produits fabriqus, des possibilits d'investissements et qui, par consquent, ont d'ordinaire intrt maintenir le
pays colonis dans l'tat arrir o ils le trouvent. Or, il est certain
que, pour intgrer son conomie propre celle des pays qui sont sous
son influence, l'U.R.S.S. sera amene y tablir, ouvertement ou non,
un mode de production socialiste, de sorte que l'occupation russe sera
en fait progressiste . Mais ce qui semble sr aussi, c'est que
l'U.R.S.S. [276] ne professe plus l'idologie de son conomie, ou plus
exactement que les thmes rvolutionnaires sont dans l'U.R.S.S. d'aujourd'hui devenus une idologie au sens propre du mot, c'est--dire un
ensemble de justifications a posteriori. Depuis 1917, le marxisme a
une patrie, il s'est incarn dans une certaine partie du monde. partir
de ce moment, les communistes devaient le dfendre la fois dans son
corps et dans son esprit, comme les catholiques d'Espagne devaient
dfendre la fois l'glise visible, ses tabernacles, son clerg, et l'glise invisible qui se btit dans tous les curs et dans les relations des
hommes. Les deux choses ne vont pas toujours ensemble. Action dfend le marxisme dans son corps quand elle soutient la politique des
Trois Grands ; on ne peut certes pas dire qu'au mme moment elle le
dfende dans son esprit, puisqu'il a toujours t hostile la diplomatie
secrte et la grande politique de chancelleries. On verra plus loin
qu' notre sens il aurait t fou, du point de vue marxiste, de sacrifier
l'existence de l'U.R.S.S. aux principes abstraits d'une politique marxiste et que le nouveau cours de la politique sovitique s'explique amplement par la stagnation rvolutionnaire dans le monde et par le danger de mort o l'U.R.S.S. s'est trouve place de ce fait. Mais commenons par reconnatre les changements qui sont intervenus dans la
politique communiste avant de les expliquer et peut-tre de les justifier comme invitables. Il y a un double jeu du P.C, qui consiste en ce
que, tant effectivement proltarien et poursuivant, sur les thmes proltariens classiques, l'agitation quotidienne, il ne souhaite pas la [277]
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
182
rupture avec les gouvernements tablis et, au moment dcisif, fait ce
qu'il faut pour l'viter 108.
Il y a un double jeu du parti socialiste qui consiste en ce que, vivant sous le regard de la bourgeoisie, il continue de se dire marxiste.
Peut-tre vaut-il mieux raisonner sur des vnements dj anciens,
dj clos, et dont, par l mme, la signification est moins contestable.
On se rappelle les tapes de Lon Blum : les thses no-socialistes
favorables la participation ministrielle et l'exercice du pouvoir en
rgime bourgeois l'avaient laiss pouvant . Il les reprend son
compte quelques annes plus tard. Chef d'un parti qui, chaque
congrs annuel, se raffirme marxiste, il accepte de diriger une exprience de Front Populaire qui doit amliorer la condition des travailleurs dans les cadres du capitalisme. Nous avons, au cours de
toute notre propagande, disait-il en mai 36, tir de l'analyse de la crise
conomique la condamnation du rgime social actuel (...). Nous en
avons conclu qu' cette socit, notre effort devait tendre substituer
une socit autre, foncirement diffrente, qui instituerait l'ordre et la
raison l o nous ne voyons que contradiction et chaos (...). Mais, je
veux le dire avec la mme franchise et avec la mme clart, la tche
prsente du gouvernement de Front Populaire (...) [278] cette tche-l
est diffrente ; elle est diffrente en tout cas dans le temps (...). Il n'y a
pas de majorit socialiste, il n'y a pas de majorit proltarienne, il y a
la majorit de Front Populaire (...). Il s'ensuit que nous agissons l'intrieur du rgime actuel, de ce mme rgime dont nous avons dmontr les contradictions et l'iniquit au cours de notre campagne lectorale (...). Il s'agit en somme de savoir s'il est possible, dans le cadre du
rgime actuel, d'assurer un soulagement suffisant aux misres de ceux
qui souffrent 109. Mais si le capitalisme est capable d'amendements,
il n'y a pas lieu de crer une socit nouvelle, et s'il en est incapable, il
n'y a pas lieu d'instituer en toute bonne foi une exprience de Front
108
Cette opinion n'est pas dmentie par la crise qui a prcd la formation du
second gouvernement de Gaulle. La presse ractionnaire a beau prsenter les
communistes comme des ogres, le fait est qu'ils ont accept d'entrer dans un
gouvernement d'union nationale o ils dtiennent avec les socialistes dix
portefeuilles sur vingt-deux, alors que les lections ont donn une majorit
(faible, il est vrai) aux deux partis marxistes.
109 Discours au Congrs du Parti socialiste S.F.I.O., 31 mai 1936, L'Exercice du
Pouvoir, pp. 52-55.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
183
Populaire dans les cadres du capitalisme. Entre les prmisses marxistes et la conclusion rformiste, la contradiction est vidente. Lon
Blum essayait de l'attnuer en prsentant le Front Populaire comme
une phase de transition. Il s'agit, poursuivait-il, de savoir si, par une
action accomplie l'intrieur du rgime actuel, il est possible de prparer dans les esprits et dans les choses, l'avnement invitable du rgime qui reste notre fait et notre but (...). La question que notre exprience pose devant la nation encore plus que devant le parti, c'est de
savoir comment le changement se fera (...), s'il y a une possibilit qu'il
s'excute, je le rpte, paisiblement et amiablement 110. Ainsi le
Front Populaire tait double sens : d'un ct, c'tait un essai loyal
pour [279] tirer du capitalisme tout ce qu'il pouvait encore renfermer
d'ordre et de justice, et ce titre il rclamait le concours de toutes les
bonnes volonts. D'un autre ct, et, comme socialiste, Lon Blum
ne pouvait le voir autrement, c'tait le commencement du socialisme. De l chez Lon Blum deux langages ; il disait en substance aux
chefs d'entreprises et au Snat : Les grves et les occupations d'usines sont illgales, mais elles sont. vous de choisir ; ou bien vous
ferez les concessions ncessaires et l'on rentrera dans la lgalit, ou
bien vous ne les ferez pas, alors c'est vous qui aurez voulu la rvolution. Aux lecteurs proltariens, il disait par contre : Personne ne
peut soutenir que nous soyons en train de sauver la socit bourgeoise,
car la ruine de la socit bourgeoise est en ralit une chose accomplie 111. Les rformes de 1936 taient ambigus ; on les prsentait
aux chefs d'entreprises comme une assurance contre la rvolution, aux
masses comme un commencement de rvolution. Ce double jeu n'tait
honnte ni envers les uns ni envers les autres. Les chefs d'entreprises
ne s'y tromprent pas : on leur offrait contre la rvolution un rempart
peu sr. Ils s'en servirent dans le coup de feu de juin 36 ; ils conurent
mme quelque estime pour un homme d'tat si distingu et qui jouait
si naturellement le jeu lgal, mais ils n'oublirent pas ses menaces voiles, qui taient drisoires, venant d'un homme si dcid ne pas faire
lui-mme la rvolution, et, quand la temprature du pays eut [280]
baiss, on le renvoya sans faons. A l'gard du proltariat, la politique
de Lon Blum n'tait pas plus loyale : dans une perspective marxiste,
un gouvernement composite de transition tait concevable, mais qui se
110
111
Ibid.
Allocution radiodiffuse au pays, 31 dcembre 1936.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
184
serait donn pour tche de dmontrer par le fait l'impossibilit du rformisme, qui, chaque obstacle rencontr, aurait pris appui sur les
masses, au besoin contre le Parlement, et qui n'aurait jou le jeu de la
lgalit bourgeoise que pour en faire voir l'inefficacit. Dans une priode de lutte des classes aigu, un parti proltarien ne peut pas tre
sincre avec tout le monde ; ou bien il est sincre envers le proltariat,
et alors il faut qu'il trompe le capitalisme, ou bien il se conforme aux
engagements pris, aux rgles formelles et universelles de la morale :
alors il trompe le proltariat comme classe. On vante l' objectivit ,
la probit intellectuelle de Lon Blum. On ne voit pas que cette
manire objective , cette habitude de traiter la rvolution comme
un fait dj accompli ou encore venir, et jamais comme un prsent
pont nous soyons chargs, sont des duperies quand il s'agit, non pas
de contempler le monde, mais de le transformer, que le postulat
d'une vrit et d'une morale communes tous est une improbit chez
un homme politique marxiste, puisque le marxisme est une thorie de
la rvolution, qu'il oppose deux mondes, le monde capitaliste et le
monde proltarien, et nous oblige choisir entre eux. Le 31 mai 1936,
Blum disait au parti S.F.I.O. : S'il se trouvait que des rsistances insurmontables nous obligent constater qu'il est impossible d'amender
du dedans la socit actuelle (...), je serais, [281] moi, alors, le premier venir vous le dire 112. Le 31 dcembre de la mme anne,
constatant la persistance des rumeurs paniques , la thsaurisation et
la fuite des capitaux, ce n'est pas ses lecteurs qu'il s'adresse, comme
il l'avait promis, c'est encore une fois aux autres. Ai-je besoin de
rpter une fois de plus que nous ne sommes pas un gouvernement
socialiste ; que nous ne cherchons ni directement, ni insidieusement
appliquer au pouvoir le programme socialiste ; que nous travaillons
avec une entire loyaut dans le cadre des institutions actuelles, de la
socit actuelle, du rgime de proprit actuel (...) 113 Plus un mot
sur la mort invitable du capitalisme, sur la marche vers le socialisme
travers le Front Populaire. Qu'il s'agisse de la non-intervention ou
des questions sociales, les discours de 1936 sont remarquables en ceci
qu'on y trouve toujours un effort pour se justifier devant ladversaire.
C'est devant Mussolini et Hitler, jamais devant les rpublicains espagnols, que Blum veut prouver la loyaut de la France. A l'intrieur, il
112
113
L'Exercice du Pouvoir, p. 55.
Allocution radiodiffuse au pays, 31 dcembre 1936, ibid., p. 348.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
185
est loyal dans le monde parlementaire qu'il a choisi comme membre d'un Parlement bourgeois, mais non dans le monde proltarien
qu'il a choisi comme marxiste. Si maintenant un malin vient dire que
Lon Blum ne croit plus au marxisme, alors ne parlons plus de loyaut. Aprs cela, il est peine ncessaire de relire les dbats du Congrs
socialiste de cet t. L'action de classe respectueuse de l'intrt national, lui-mme compris [282] la manire des conservateurs, c'est bien
dans cet esprit que Blum gouvernait ds 1936. On ne retranche rien du
marxisme, on y ajoute seulement... l'intrt national. De cette innocente retouche, il rsulte que le socialisme n'est plus un avenir inconnu ; il
est dj l, il est partout au pouvoir, nous y touchons, il n'y a pas de
quoi en avoir peur 114. l'gard du P.C. la position parat d'abord claire : si le P.C., dit Le Populaire, avait fait des rserves sur celles des
dcisions des Trois Grands qui rabaissaient la France, nous lui aurions
aussitt propos l'unit. On craint que les socialistes ne soient bien
heureux d'avoir cet argument. Aprs tout, l'unit ouvrire pourrait entraner une transformation du Parti communiste lui-mme, il serait
loisible aux socialistes d'y apporter leurs habitudes de critique et de
discussion. Leur politique gnrale montre assez que, ce qu'ils craignent dans le P.C., ce n'est pas seulement un dvouement trop aveugle
l'U.R.S.S., c'est l'esprit proltarien que le P.C., malgr ses tournants
tactiques, continue de reprsenter. La politique franaise offre parfois
le spectacle d'un quiproquo de comdie : il arrive que le P.C., qui, par
sa composition sociale et par sa propagande, tait l'origine et reste
largement un parti de [283] classe, tende la main aux S.F.I.O. et mme
certains partis bourgeois, tandis que les S.F.I.O. qui, depuis 36,
s'orientent vers une politique d' intrt public , et les partis bourgeois qui nient en principe la lutte des classes feignent de ne pas voir
la main qu'on leur tend et refusent l'occasion qui s'offre de s'assurer la
neutralit du proltariat.
Dans une socit o le mouvement proltarien s'est appel un moment Front National et o l'esprit conservateur se donne l'tiquette
114
Bien que le Parti communiste ait contribu apaiser la classe ouvrire en
1936, comme en tmoigne le fameux mot de Thorez : Il faut savoir
terminer une grve , jamais il n'a sollicit sur ce ton la confiance de ses
adversaires. Ses volte-face ne sont motives que par la discipline ; on sent
que les communistes ne se soumettent pas intrieurement ceux mmes
qu'ils cherchent attirer. C'est en quoi ils gardent le style proltarien.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
186
socialiste , la pense politique et l'analyse des vnements ne peuvent tre que trs confuses, il n'y a plus que des ides mutiles, la position politique de chacun se dfinit moins par un certain nombre de
thses que par son adhsion l'un des deux blocs en prsence. Etre
communiste ou tre socialiste, dans lordre des ides, cela ne signifie
plus rien de dtermin. Nous en sommes parvenus un tat de nominalisme politique dont l'histoire franaise n'offre peut-tre aucun autre
exemple. Bientt, dans ce pays qui se flattait, en croire Thibaudet,
de mettre dans sa politique toute une conception de la vie, les notions
de socialiste et de communiste , pour ne rien dire du M.R.P.,
seront aussi peu dfinissables et communicables que celles de rpublicain et de dmocrate aux tats-Unis. L'hiver dernier, un
garon de caf expliquait les bagarres insurrectionnelles de Bruxelles
par la Cinquime Colonne ; il poursuivait en regrettant les lenteurs de
l'puration ; les gros s'en tirent toujours , disait-il pour finir. Ainsi
s'entrecroisent dans les esprits le motif patriotique et le motif
marxiste . Dans une conversation rcente, l'auteur de ces lignes
disait [284] un interlocuteur radical que le Parti communiste ne
cherchait pas vraiment la rupture et que des industriels plus aviss auraient su saisir cette chance. Un homme de lettres communiste, et
d'ailleurs non sans fortune, qui assistait l'entretien, approuva avec
chaleur, ajoutant que malheureusement il n'tait pas question pour
le moment de reprendre la politique de Lnine.
On pourrait tre tent d'expliquer la dcadence de notre pense politique par celle de notre pays. Nous sommes une puissance de second
ordre. Notre politique et notre pense ne sont plus autonomes, nous ne
les produisons plus de nous-mmes, nos dcisions se bornent choisir
entre deux sphres d'attraction, celle de la Russie et celle des AngloSaxons. La France est maintenant comparable ces tats de l'Amrique centrale et de l'Amrique du Sud o les partis reprsentent autant
d'influences trangres et o l'idologie ne sert qu' couvrir ces influences. Mais cette explication ne va pas loin. La confusion n'est pas
moindre chez les Trois Grands que chez nous. On constate partout la
mme usure et la mme dcomposition des ides. Il n'y a plus de marxisme doctrinal ni de libralisme doctrinal. Les ides marxistes ou les
ides librales peuvent bien tre utilises dans les discours des chefs
d'tats, mais elles ne sont plus que les instruments de l'offensive et de
la dfensive diplomatiques. La Charte de l'Atlantique tait bien ou-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
187
blie quand elle reparut soudain dans un discours de Truman, par ailleurs menaant. Nous employons encore le vocabulaire politique du
XIXe sicle, libralisme, proltariat, et ce vocabulaire exprime
mal les forces politiques effectivement en prsence. La lutte des classes [285] est masque. Le moment de l'histoire o nous sommes est
quivoque, ni le capitalisme ni la rvolution proltarienne ne combattent plus visage dcouvert, parce que le capitalisme est incertain de
son propre avenir et incapable de se projeter en une thorie positive, et
parce que le marxisme, dans le pays o il a triomph, s'il reste inscrit
dans le mode de production et dans la structure conomique, a cess
d'animer une politique proltarienne. Pierre Herv a un jour abord
dans Action le problme du double jeu communiste. La diffrence,
disait-il, entre le double jeu communiste et le double jeu des nouveaux
socialistes est que le premier peut, le second ne peut pas s'avouer
pour ce qu'il est : un communiste reconnatra sans peine que le relvement de la France, la reconstruction, l'puration, la rnovation de
l'arme et du corps judiciaire sont impossibles sans rvolution, parce
que cela est vrai. Le P.C. veut la fois la rvolution et la patrie sans
aucune quivoque, parce que, au tournant de l'histoire o nous sommes, la patrie ne peut revivre sans rvolution. Le communiste n'a donc
rien cacher : son double jeu est fond dans les choses. Au contraire,
le socialisme est une mystification parce qu'il recommande du
bout des lvres le contraire de ce qu'il veut et prpare effectivement.
Herv n'oubliait qu'une chose, c'est que le P.C. n'a pas pu pousser l'insurrection nationale, l'puration et l'incorporation des F.F.I. dans l'arme jusqu' leurs consquences rvolutionnaires, que les ministres
communistes sont demeurs en fonction quand le gouvernement a sabot l'puration et l'amalgame, et qu'au total la politique patriotiquervolutionnaire, y compris l'article [286] sincre de Herv sur
le double jeu, a plutt servi la patrie que la rvolution. Il est parfaitement exact que le marxisme, dans certaines circonstances de temps
et de lieu, peut intgrer le patriotisme. Encore faut-il, pour rester luimme, qu'il en montre chaque pas les implications rvolutionnaires.
Thorez revenant de Moscou, l'hiver dernier, dclarait au contraire que
l'puration a ses limites. La surprise tait visible dans le public du
Vel d'Hiv'. Reste trouver les causes qui expliquent l'ambigut de
notre politique, et les moyens de la dissiper.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
188
C'est bien simple, dira le trotskyste ; la confusion o nous vivons
vient du dcalage toujours plus grand entre la situation objective et la
situation subjective, entre la lutte des classes qui se poursuit en fait,
qui mme est vcue propos de chaque question concrte, et les ides
mises en circulation par les partis, qui ne permettent pas de la penser.
Ds lors le remde n'est-il pas tout prs de nous ? Ne suffit-il pas de
rendre manifeste ce qui est latent, et d'appliquer au prsent les schmas classiques du marxisme pour que les partis se reclassent, que la
vie politique redevienne transparente, que le choix et la fidlit politiques redeviennent faciles ? Le conflit de la morale et du ralisme politique, de la sincrit et de l'engagement d'o nous sommes partis,
n'est-il pas dpass dans une vraie politique marxiste, puisque cette
politique, prolongeant le mouvement effectif de l'histoire, est la fois
ouverte toutes les vrits et capable du maximum d'efficacit ? Le
marxisme n'aime pas parler de morale et il se mfie des valeurs dans
la mesure o elles sont abstraites, o elles contribuent [287] mystifier les hommes en les dtournant de leur vie, de leurs conflits et des
choix ncessaires. Mais enfin l'ide matresse du marxisme n'est pas
de sacrifier les valeurs aux faits, la morale au ralisme, c'est de substituer une moralit effective la moralit verbale qui prcde la rvolution, c'est de faire une socit o la morale soit morale et de dtruire la
morale comme rve hors des choses en la ralisant dans les rapports
effectifs des hommes. Dans la vue marxiste de l'histoire, une morale
est donne par surcrot. Ne suffit-il pas de retrouver l'inspiration marxiste qui animait l'origine le P.S. comme le P.C. pour que tous les
machiavlismes disparaissent, et avec eux les embarras de l'intellectuel scrupuleux ?
Cette solution abstraite et nave oublie que compromis et double
jeu ne sont pas des crations arbitraires des partis, qu'ils expriment sur
le plan politique la situation vitale du monde, qu'aprs des annes
d'quivoque ils ont faonn les esprits, qu'ils ont acquis un certain
poids propre et qu'aucune conversion simplement mentale, aucun effort de connaissance, d'explication et de propagande ne suffira les
rsorber. Dans une large mesure, les hommes sont mystifis par leurs
propres compromis, c'est--dire qu'ils cessent de les sentir comme des
compromis. La lutte des classes, disions-nous, est aujourd'hui masque. Cela ne veut pas dire qu'elle subsiste sans changements telle que
l'ont dfinie les textes marxistes classiques, et voile seulement par les
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
189
mots. Marx pensait que la lutte des classes, tant qu'elle n'est pas consciente d'elle-mme, ne peut parvenir l'issue rvolutionnaire ; il pensait aussi qu'aucune fatalit ne rend invitable [288] la prise de conscience et que le monde, faute d'avoir compris sa propre histoire, pouvait pourrir et se dissoudre dans la barbarie. Peut-tre est-ce justement
ce point que nous en sommes. Le proltariat comme classe est trop
affaibli pour demeurer prsent un facteur autonome de l'histoire. Il
n'y a pas aujourd'hui les proltaires de tous les pays contre le capitalisme de tous les pays, il y a un capitalisme dchir par des contradictions de plus en plus violentes, des proltariats diviss entre eux et
plus ou moins acquis la collaboration de classe, et par ailleurs un
tat production socialise qui rgle ses rapports avec les autres tats
selon les procds de la diplomatie et de la stratgie traditionnelles et
ne cherche pas ouvertement fdrer contre le capitalisme les proltariats disperss. Les facteurs nationaux, gographiques, psychologiques
qui se croisent avec la lutte des classes et brouillent les grandes lignes
marxistes de l'histoire, en un mot, pour parler comme Engels, les hasards historiques n'ont pas t rsorbs par les facteurs considrs
comme essentiels. Nous ne disons pas que ce fait rfute le marxisme,
puisque Marx a lui-mme indiqu le chaos et l'absurde comme une
des issues possibles de l'histoire. Mais il accentue le rle de la contingence en histoire, il interdit d'esprer que l'action marxiste puisse garder la belle rectitude qu'elle a eue certains moments privilgis et
qu'elle aurait encore si elle pouvait s'appuyer sur un mouvement fatal
de l'histoire.
Ni en pratique, ni en thorie, le marxisme le plus rigoureux n'a jamais pu exclure le compromis et avec lui cette sorte de draillement
de l'histoire auquel nous [289] assistons. Ds ses premiers pas, le gouvernement sovitique de 1917 a t oblig de composer avec des situations de fait dans lesquels il lui tait impossible d'viter absolument
l'quivoque et de garder l'histoire qu'il faisait pour son compte un
caractre absolument rationnel. Il se trouvait, aussitt constitu, devant le problme de la paix. L'arme russe bout de forces et saigne
par les oprations de 1914-1917 ne pouvait plus poursuivre la guerre.
Le gouvernement sovitique avait d demander un armistice. Fallait-il
signer la paix ? Si l'on continuait la guerre avec une arme puise, la
rvolution d'Octobre risquait de prir. Si l'on signait la paix avec l'imprialisme allemand, on risquait d'accrditer la lgende, rpandue par
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
190
les gouvernements bourgeois, d'une connivence entre Berlin et la rvolution russe, et de dcevoir les proltariats d'Occident et d'Allemagne. Dans une perspective marxiste, il fallait refuser de choisir entre
l'Allemagne et les Allis et proposer une paix dmocratique aux travailleurs de tous les pays. On l'avait fait, mais cette proposition tait,
comme de juste, reste lettre morte en face de gouvernements bourgeois qui tenaient bien en main leurs proltariats nationaux. On ne
pouvait donc pas dpasser la situation donne, le conflit mondial en
cours, il fallait y prendre position. Le parti tait divis. Lnine tait
d'avis de faire traner en longueur les pourparlers de Brest-Litovsk, et,
en cas d'ultimatum allemand, de signer la paix. Si nous devions prir
pour la victoire de la rvolution allemande, disait-il, nous serions tenus de le faire : la rvolution allemande serait infiniment plus importante que la ntre. Mais quand viendra-t-elle ? On n'en sait rien. Pour
[290] l'instant il n'y a rien de plus important au monde que notre rvolution. Il faut la sauvegarder tout prix. Boukharine et la majorit
du parti refusaient tout accord avec une puissance imprialiste et
taient pour la guerre rvolutionnaire. Trotsky voulait, en cas d'ultimatum allemand, rompre les pourparlers, dclarer la paix tablie de
facto, sans trait, et, en cas d'offensive allemande, signer sous la menace des baonnettes une paix qui, dans ces conditions, ne serait pas
quivoque. C'est cette solution qui prvalut. L'offensive allemande eut
lieu et les dlgus sovitiques durent signer la paix sans la lire, des
conditions beaucoup plus dures que celles qu'ils auraient obtenues en
capitulant plus tt. La solution n'tait pas bonne : les pays baltes
taient perdus pour le gouvernement sovitique, le proltariat mondial
n'avait peut-tre pas compris. La conduite du gouvernement sovitique n'aurait pu tre tout fait rationnelle que si les grves d'Octobre
1917 en Allemagne et en Autriche avaient paralys l'arme allemande
et annonc une seconde rvolution. Lnine avait offert la Raison historique sa chance, mais l'histoire n'avait pas rpondu cette sollicitation. En fait il avait donc fallu pactiser avec l'imprialisme allemand et
librer des troupes allemandes qui pouvaient, sur le front occidental,
emporter la dcision. La conviction la plus profonde concernant le
sens de l'histoire n'a jamais dispens les plus grands marxistes de reconnatre que les voies de l'histoire sont insondables.
Quand l'Arme Rouge se constitua, les comits de soldats des rgiments impriaux firent voler en clats la vieille discipline. Il ne de-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
191
vait plus y avoir que des [291] volontaires, l'autorit militaire devait
tre dcentralise, les officiers ractionnaires devaient tre chasss.
Une fraction du parti voulait dvelopper ce mouvement spontan en
une thorie nouvelle de la guerre : plus de spcialistes , des chefs
lus ; l'arme centralise, pensaient-ils, est l'arme des tats imprialistes, la guerre des tranches est la guerre imprialiste, la rvolution
apporte avec elle le mouvement, la manuvre, la guerre par petits dtachements de toutes armes appuys par les sympathies de la population, enfin le partisanat . Ces ides paraissaient bien dduites :
comment, dans une philosophie marxiste de l'histoire, la rvolution
n'apporterait-elle pas des changements essentiels dans l'organisation
de l'arme et dans l'art militaire, comme partout ? Trotsky, alors charg d'inspecter l'anne, crit cependant : Tout cela tait extrmement
abstrait, et, au fond, c'tait une idalisation de notre faiblesse. L'exprience srieuse de la guerre civile dtruisit bientt ces prjugs .
Mme si l'on pense que la lutte des classes fait l'essentiel de l'histoire
et si l'on est, en consquence, favorable dans chaque problme particulier aux solutions proltariennes, reste savoir si, pour tel pisode
particulier de l'histoire, le processus qui en orientera finalement les
grandes lignes va tre immdiatement dterminant. On pouvait compromettre la rvolution et l'avenir mondial du proltariat en voulant
donner trop tt l'arme une structure rvolutionnaire et proltarienne. Le problme est de reconnatre l'esprit proltarien sous sa figure
du moment. Le chaos des entreprises de partisans, poursuit Trotsky,
tait l'expression mme des dessous ruraux de la rvolution. La lutte
contre le partisanat fut par [292] consquent une bataille pour l'esprit
politique proltarien contre l'lment petit-bourgeois anarchiste qui
tendait le ruiner . Une politique formellement proltarienne peut
tre en fait ractionnaire, l'action marxiste suppose une vue concrte
des circonstances particulires, de leur signification probable, une certaine lecture de l'histoire qui se fait selon le vraisemblable, avec des
risques d'erreur, et ne peut en aucun cas tre mcaniquement dduite
de la thorie. Elle ne doit pas aller toujours et simplement gauche ; le compromis peut tre plus marxiste que le gauchisme .
On a souvent racont travers quelles puisantes discussions s'laborait la ligne du parti dans les premires annes de la Rvolution.
Ainsi la fraction la plus consciente du proltariat, qui tait la rvolution en marche, s'interrogeait sur elle-mme, sur ce qu'elle pouvait
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
192
tre et vouloir au moment prcis de l'histoire o elle se trouvait. Puisqu'il y avait un problme de la ligne, c'est qu'il y avait une quivoque
perptuelle de l'histoire. Lnine, dans la fameuse Maladie infantile du
Communisme, a cherch la thorie de ce cheminement difficile et les
principes d'une ligne juste, entre le gauchisme et l'opportunisme.
Mais n'tait-il pas contradictoire de chercher des critres objectifs qui
permettent de distinguer le compromis marxiste du compromis opportuniste ? Si de tels critres avaient exist, il n'y aurait pas eu besoin de
discussion dans le parti, les dcisions auraient pu en chaque cas tre
dmontres, il n'y aurait plus eu de problme de la ligne. J'ai le droit,
dit Lnine, de remettre un voleur mon argent, si c'est sous menace
de mort et quitte le faire arrter [293] aussitt que je pourrai. Je n'ai
pas le droit de m'associer une bande de voleurs et de tirer profit de
leurs vols. Il est bien clair que ce critre ne permet de trancher que
dans les cas-limites et qu'on passe par transitions insensibles du compromis valable au compromis pourri . Voil pourquoi, comme dit
Lnine, il faut faire travailler son propre cerveau pour se retrouver
dans chaque cas particulier . En d'autres termes : il y a des compromis qui sont dans la ligne vraie, qui reprsentent la vritable intransigeance marxiste ; il y a des intransigeances abstraites et petitbourgeoises qui sont en fait contre-rvolutionnaires ; et pour dcider, hors des cas-limites, il n'y a qu'un ensemble de probabilits. Elles
s'apprcient par un certain flair marxiste ou par une perception marxiste de la situation locale et mondiale qui est de l'ordre du talent ou
du gnie. Mais o s'arrtera-t-on si ce talent vient manquer, et cette
juste apprciation, assez prudente et assez audacieuse, de ce qui est
possible chaque moment ? Des contradictions marxistes ou dialectiques aux compromis opportunistes, la diffrence n'tant pas d'ordre
logique, le glissement est possible. Voil pourquoi, dans le problme
de la paix, Lnine n'a pas voulu imposer sa solution opportuniste
contre celle de Trotsky, bien qu'elle dt coter l'U.R.S.S. les provinces baltes. Le marxiste le plus gnial reconnat dans ses propres dcisions une possibilit d'erreur, de dviation, de chaos. Le moment dcisif est celui o l'homme reprend et prolonge le cours des choses tel
qu'il croit le lire dans l'histoire objective. Et ce moment, en dernire
analyse, il n'a pour se guider qu'une vue [294] sienne des vnements.
L'quivoque qu'il rencontrait dans l'action, le marxisme ne l'a jamais exclue sur le plan de la thorie. Le dveloppement spontan de
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
193
l'histoire objective ne fournit qu'une certaine convergence des faits et
c'est seulement l'histoire pense et voulue par l'homme qui, de cet arrangement donn, fait surgir un sens univoque. Trotsky encore a crit
un jour : Tout le processus historique est le prisme de la rgle juste
vue travers le fortuit. Si nous nous servons du langage de la biologie, on peut dire que la rgle rationnelle de l'histoire se ralise par une
slection naturelle des faits accidentels. C'est sur cette base que se dveloppe l'activit humaine consciente, qui soumet l'accidentel une
slection artificielle. Les faits accidentels, c'est--dire les faits isols,
ceux qui ne sont pas exigs par la situation totale, s'liminent euxmmes de l'histoire, faute de trouver dans le contexte historique des
appuis, des concordances et des complicits, comme les variations
congnitales monstrueuses, selon Darwin, s'liminent d'elles-mmes
faute d'tre compatibles avec la vie gnrale de l'organisme. Mais cette slection ne garantit que la destruction des systmes non viables,
des socits irrationnelles, elle ne garantit pas l'apparition d'une forme
nouvelle viable, qui suppose une slection oriente cette fois par
l'ide. C'est donc la conscience qui met dfinitivement de la raison
dans l'histoire, en reliant dans un sens dtermin la constellation des
faits. Toute entreprise historique a quelque chose d'une aventure,
n'tant jamais garantie par quelque structure absolument rationnelle
des choses ; [295] elle comporte toujours une utilisation des hasards, il
faut toujours ruser avec les choses (et avec les gens) puisqu'il faut en
faire sortir un ordre qui n'tait pas donn avec elles. La possibilit
demeure d'un immense compromis, d'un pourrissement de l'histoire o
la lutte des classes, assez puissante pour dtruire, ne le serait pas assez
pour construire, et o s'effaceraient les lignes matresses de l'histoire
telles que les avait traces le Manifeste Communiste.
Or, selon toute apparence, n'est-ce pas ce point que nous en
sommes ? Quand la Rvolution russe, au lieu de se continuer en Europe par une srie de rvolutions, fut demeure seule en prsence d'un
monde bourgeois, et plus clairement encore quand l'U.R.S.S. fut menace dans son existence par la guerre, il lui fallut composer avec des
gouvernements bourgeois, et elle ne pouvait plus demeurer ouvertement l'animatrice de la lutte des classes travers le monde. Avant
d'tre une thorie, le socialisme dans un seul pays a t une situation de fait dont l'U.R.S.S. avait s'accommoder. Peu importe que le
gouvernement de l'U.R.S.S. ait pu ou non, un moment donn, infl-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
194
chir autrement l'histoire, et que la thorie ait t impose par les faits
ou qu'au contraire elle en ait prcipit le cours. En conduisant autrement le proltariat mondial, la IIIe Internationale aurait peut-tre affaibli de l'intrieur les gouvernements bourgeois. Plus probablement
elle aurait conduit l'U.R.S.S. sa perte en la laissant seule devant
l'agression allemande. Quoi qu'il en soit, la stagnation rvolutionnaire
dans le monde et la tactique des Fronts Populaires ont trop [296]
profondment modifi les proltariats, le recrutement et la formation
thorique des partis communistes, pour que l'on puisse attendre brve chance un renouveau de lutte des classes visage dcouvert, ou
mme proposer aux militants des mots d'ordre rvolutionnaires qu'ils
ne sentiraient pas. Au lieu de deux facteurs clairement circonscrits,
l'histoire de notre temps comporte donc des mixtes, une Union Sovitique oblige de composer avec des tats bourgeois, des partis communistes rallis la politique des Fronts Populaires ou, comme en Italie, arrts dans leur dveloppement proltarien par les incidences de
la grande politique sovitique, des partis bourgeois incapables de
dfinir une politique conomique cohrente, mais, dans les pays affaiblis, conscients de leur impuissance et vaguement acquis un rvolutionnarisme qui peut les conduire des ententes momentanes
avec la gauche. Mme si le marxisme reste vrai en ce sens que le problme des formes de la production clairement pos dpartagerait les
forces rgressives et les forces progressives, comme les unes et les
autres sont trs peu conscientes, la mise en perspective vieux-marxiste
ne fait pas voir dans ce qu'elle a de particulier la physionomie de notre
temps, elle passe par-dessus le dtail des faits, et l'on peut dans cette
mesure accorder l'historien sceptique qu'elle en offre une interprtation abstraite et facultative.
*
*
Si le marxisme, aprs avoir pris le pouvoir en Russie et s'tre fait
accepter par un tiers du peuple franais, semble incapable aujourd'hui
d'expliquer dans son dtail [297] l'histoire que nous vivons, si les facteurs essentiels de l'histoire qu'il avait dgags sont aujourd'hui mls
dans le tissu des vnements des facteurs nationaux ou psychologi-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
195
ques qu'il considrait comme secondaires, et recouverts par eux, n'estce pas la preuve que rien n'est essentiel en histoire, que tout compte
galement, qu'aucune mise en perspective n'a de privilge, et n'est-ce
pas au scepticisme que nous sommes conduits ? La politique ne doitelle pas renoncer se fonder sur une philosophie de l'histoire, et, prenant le monde comme il est, quels que soient nos vux, nos jugements ou nos rves, dfinir ses fins et ses moyens d'aprs ce que les
faits autorisent ? Mais on ne se passe pas de mise en perspective, nous
sommes, que nous le voulions ou non, condamns aux vux, aux jugements de valeur, et mme la philosophie de l'histoire. On ne remarque pas assez que, aprs avoir dmontr l'irrationalit de l'histoire,
le sceptique abandonne brusquement ses scrupules de mthode quand
il en vient aux conclusions pratiques. Il faut bien, pour rgler l'action,
considrer certains faits comme dominants et d'autres comme secondaires. Si raliste qu'elle se veuille et si strictement fonde sur les
faits, une politique sceptique est oblige de traiter au moins implicitement certains faits comme plus importants que d'autres et, dans cette
mesure, elle renferme une philosophie de l'histoire honteuse, vcue
plutt que pense, mais non moins efficace. Par exemple elle raisonnera sur l'avenir de la France en fonction de l'Empire anglais, des
tats-Unis ou de l'U.R.S.S. dfinis une fois pour toutes par des conditions gographiques, des ressources naturelles, des traits psychologiques [298] immuables. Dans le fait, le scepticisme historique est toujours conservateur, quoique, en toute rigueur, il ne puisse rien exclure
de ses prvisions, et pas mme une phase rvolutionnaire de l'histoire.
Sous prtexte d'objectivit, il fige l'avenir, il retranche de l'histoire le
changement et les volonts des hommes. Quand il croit reconnatre
comme des faits la ncessit des lites dans toute socit ou encore la toute-puissance des richesses naturelles et des conditions gographiques, c'est en ralit un pari _ qu'il fait, une prfrence et un vu
qu'il exprime, une responsabilit qu'il prend. Si nous voulons tre
vraiment dociles aux faits et pleinement ralistes, il nous faut rejeter
tous les postulats, toute philosophie a priori de l'histoire, mais en particulier ce postulat du scepticisme que les hommes se conduisent toujours sottement, domins par le pass et par les causes extrieures, ou
mens par quelques habiles, qui les connaissent, des fins ignores
d'eux. Il n'y aurait pas d'histoire si tout avait un sens et si le dveloppement du monde n'tait que la ralisation visible d'un plan rationnel ;
mais il n'y aurait pas davantage d'histoire, ni d'action, ni d'humani-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
196
t, si tout tait absurde, ou si le cours des choses tait domin par
quelques faits massifs et immuables, comme l'Empire anglais, la psychologie du chef ou de la foule , qui ne sont aprs tout que des
produits du pass et n'engagent pas ncessairement notre avenir.
Rcapitulons. Nous ne pouvons plus avoir une politique kantienne,
parce qu'elle ne se soucie pas des consquences, et que, quand on agit,
c'est bien pour [299] produire des consquences au-dehors et non pas
pour faire un geste et soulager sa conscience. Nous ne pouvons pas
avoir une politique sceptique , parce que, malgr l'apparence, elle
choisit ses fins et opre, d'aprs des valeurs inavoues, une slection
dans les faits qu'elle nous propose de reconnatre et sur lesquels elle
nous suggre de nous guider pour dfinir le possible . Nous ne
pouvons plus avoir une politique marxiste proltarienne la manire
classique, parce qu'elle ne mord plus sur les faits. Notre seul recours
est dans une lecture du prsent aussi complte et aussi fidle que possible, qui n'en prjuge pas le sens, qui mme reconnaisse le chaos et le
non-sens l o ils se trouvent, mais qui ne refuse pas de discerner en
lui une direction et une ide, l o elles se manifestent. Soit le rsultat
des lections franaises et en particulier les progrs du Parti Communiste depuis 1936. Il serait absurde de croire qu'il s'agit simplement
d'un progrs du proltariat vers la conscience de classe et vers la rvolution. Mais il est galement impossible de dclarer le fait insignifiant.
On voit ce que dirait ici le sceptique : le P.S. a russi sa manuvre, il
a dup ses lecteurs ; sa tactique patriotique lui a concili des lecteurs autrefois socialistes, et il a jet en pture ses lecteurs proltariens des nationalisations illusoires. Pendant ce temps, les socialistes,
rallis au oui-oui et au Bloc Occidental, ont occup les positions jadis
tenues par les radicaux. En somme rien n'a chang, sauf les noms. Il
ne s'est rien pass dans le pays, le dplacement vers la gauche, ou,
comme disait Thibaudet, le sinistrisme immanent de la politique
franaise n'est qu'une apparence, parce que, tandis que [300] le pays
glisse gauche, les partis glissent droite... C'est une grande erreur de
croire crue le changement de noms puisse aller sans un changement
dans les choses. Il se passe tout de mme quelque chose le jour o un
paysan franais vote communiste pour la premire fois de sa vie : il se
passe quelque chose dans le parti, qui est modifi par son nouveau
recrutement, mais il se passe quelque chose aussi dans le paysan. Et
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
197
c'est l ce que nous aimerions savoir. Qu'est-ce qu'un communiste
franais d'aujourd'hui ? Que pense-t-il de la petite proprit, de la religion, de la morale, de la patrie, de la socit, enfin que veut-il, non
seulement d'une volont dlibre, mais de cette volont tacite qui se
voit dans ses relations familiales, dans sa manire de travailler ou de
se distraire ? Pouvons-nous feindre d'ignorer ces cinq millions de
Franais, probablement des plus rsolus et des plus vivants, qui viennent de voter pour le P.C. ? Et de mme, qu'est-ce qu'un Sovitique
d'aujourd'hui ? Comment voit-il la vie, la mort, l'Occident, l'Allemagne, la famille, la morale, l'amour ? Les armes russes occupent une
partie de l'Europe et quelques journalistes ont tout de mme pntr
dans leur zone, mais quand on nous a dcrit les officiers russes
Prague, les belles manires et les baise-mains, c'tait avec la mauvaise
joie des conservateurs ou avec le zle des convertis, les uns et les autres trop heureux de prouver qu'aprs tout les Sovitiques sont comme
tout le monde. Le fait est que, depuis six ans au moins, nous ne savons
rien de l'U.R.S.S., et la manire dont elle a conduit et gagn sa guerre
prouve que nos renseignements de 1939 ne valaient rien. On voit se
dvelopper en Europe, sous l'influence de [301] l'U.R.S.S., un socialisme d'tat qui vient d'aboutir en Tchcoslovaquie ou en Yougoslavie, et aboutira peut-tre demain en France. Des nationalisations, de
leurs modalits, de leurs incidences probables sur la production, de
leur rendement, nous ne savons peu prs rien. Rien non plus de la
situation relle des tats-Unis ou de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce
qu'un travailliste anglais ? Qu'est-ce que l'administration Truman ?
Quelles sont les tendances des milieux capitalistes aux tats-Unis ?
Comment voient-ils leur avenir ? Quelles perspectives l'ventuelle
crise amricaine peut-elle offrir ? Quelle aide les tats-Unis et
l'U.R.S.S. pourront-ils demain apporter la reconstruction europenne ? On nous somme de choisir entre les tats-Unis et l'U.R.S.S., et
nous choisissons selon que nos prfrences vont la libert ou la
dictature du proltariat, que nous pensons d'abord la reconstruction
ou la lutte des classes, sans nous demander si les tats-Unis, qui ne
sont sortis de la crise que par la guerre et se trouvent menacs d'une
crise peut-tre plus grave que celle de 1929, pourront garantir longtemps une libert relle leurs citoyens, et comme si l'U.R.S.S., profondment transforme depuis vingt ans, pouvait tre simplement dfinie comme la dictature du proltariat, sans nous demander si les
tats-Unis voudront entreprendre la reconstruction europenne et
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
198
comme si l'U.R.S.S. devait tre pour toujours absorbe par les tches
de sa propre reconstruction et incapable d'intervenir dans la ntre. Les
intellectuels franais ne sont pas chargs d'entretenir l'atmosphre dvotieuse et panique, les ferveurs et les [302] terreurs vagues qui donnent la politique franaise un caractre mythique et presque puril,
mais de faire l'inventaire de ce sicle-ci et des formes ambigus qu'il
nous offre. Qu' force d'informations et de faits l'quivoque ne soit
plus subie, mais comprise, alors peut-tre notre vie politique cessera-telle d'tre hante par les fantmes, peut-tre reprendra-t-elle quelque
ralit.
Telle est la tche pour les annes qui viennent. Mais que faire
prsent ? Nous devons ici conclure avec le lecteur des conventions
prcises. Il y a, depuis quinze ans, assez d'auteurs qui dpassent
faussement le marxisme pour que nous prenions soin de nous distinguer d'eux. Pour dpasser une doctrine, il faut d'abord tre parvenu
son niveau et expliquer mieux qu'elle ce qu'elle explique. Si, en face
du marxisme, nous mettons des points d'interrogation, ce n'est pas
pour lui prfrer quelque philosophie conservatrice de l'histoire qui
serait encore bien plus abstraite. Nous ne disons pas que la lutte des
classes ne jouera jamais plus un rle essentiel dans l'histoire mondiale.
Nous n'en savons rien. Les vnements, et par exemple la crise amricaine, peuvent la ramener rapidement au premier plan. Nous disons
seulement que, pour le moment, elle est masque et latente, et qu'une
rvolution proltarienne en France, si elle se produisait, provoquerait
l'intervention des Anglo-Saxons. Mais nous devons prendre garde que
rien, dans notre action, ne contribue freiner le mouvement proltarien s'il renat travers le monde. S'il y a grve, tre pour les grvistes.
S'il y a guerre civile, tre pour le proltariat. Faire ce qui dpend de
nous pour viter [303] un conflit entre les tats-Unis et l'U.R.S.S. En
somme, la politique effective du P. C. Reconstruire avec le proltariat,
il n'y a, pour le moment, rien d'autre faire. Simplement nous ferons
cette politique d'attente sans illusion sur les rsultats qu'on peut en
esprer et sans l'honorer du nom de dialectique. Savons-nous s'il y a
encore une dialectique et si l'histoire finalement sera rationnelle ? Si le
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
199
marxisme reste toujours vrai, nous le retrouverons sur le chemin de la
vrit actuelle et dans l'analyse de notre temps 115
(Novembre 1945.)
[304]
115
la date o ces lignes ont t crites, la pression de l'U.R.S.S. sur la
Yougoslavie, manifeste depuis par la dissidence de Tito, tait moins
imprieuse, ou moins connue en France. Quant aux autres pays de sa sphre
d'influence, elle suivait une ligne optimiste et leur laissait, en apparence,
diront ses adversaires, mais qui niera que le rgime Bns n'tait pas le
rgime Gottwald ? une assez large autonomie. Il tait possible d'imaginer
dans les pays d'Europe occidentale, et ncessaire de hter par une discussion
amicale avec les communistes, la formation de structures sociales libres et
neuves, qui pargneraient l'Europe l'alternative de la dmocratie
populaire et de la politique ractionnaire, du communisme stalinien et de
la croisade antisovitique. Depuis lors, pendant que l'Occident bauchait un
dispositif de guerre, l'U.R.S.S., revenue au pessimisme, l'autorit pure et
la mise en demeure, plaait la gauche non communiste, sous peine d'tre
mystifie, dans la ncessit de dire clairement pourquoi elle n'est pas
communiste et ne saurait en aucun cas jouer le rle de couverture librale du
systme. Cela ne fait pas qu' sa date, et dans le cadre des possibles du
moment, l'attitude ici exprime n'ait t justifie comme celle qui avait
chance de sauver la fois le socialisme et la libert.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
200
[305]
SENS ET NON-SENS
III. POLITIQUES
Foi et bonne foi
Retour la table des matires
Dans la rponse qu'il adressait dernirement au R.P. Danilou 116,
Pierre Herv avait raison. On n'a pas de peine citer, pour en faire
honneur au catholicisme, des textes chrtiens et pontificaux des actes
individuels qui sont en faveur de la libert et vont contre l'intrt des
rgimes tablis. Mais il est encore plus facile de trouver dans la tradition catholique des textes hostiles la libert. Et surtout, le catholicisme, dans l'histoire, n'est pas seulement un certain nombre de textes
ni une somme d'individus, c'est un appareil, une institution ou un
mouvement, qui a sa logique d'ensemble et qui fonctionne, n'en pas
douter, dans un sens ractionnaire, malgr certains textes et malgr les
sentiments des individus, ou mme la faveur de l'quivoque qu'ils
crent. Il tait une fois un jeune catholique que les exigences de sa foi
conduisaient [306] gauche . C'tait au temps o Dollfuss inaugurait le premier gouvernement chrtien-social d'Europe en bombardant
les cits ouvrires de Vienne. Une revue d'inspiration chrtienne avait
adress une protestation au prsident Miklas. Le plus avanc de nos
grands ordres soutenait, disait-on, la protestation. Le jeune homme fut
reu la table de quelques religieux de cet ordre. Au milieu du djeuner, il eut la surprise d'entendre qu'aprs tout le gouvernement Doll116
Action, 14 dcembre 1945.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
201
fuss tait le pouvoir tabli, que, comme gouvernement rgulier, il
avait droit de police, et que, libres de le blmer comme citoyens, les
catholiques, comme catholiques, n'avaient rien lui reprocher. En
vieillissant, le jeune homme n'a jamais oubli ce moment. Il se tourna
vers le Pre qui venait de tenir ce langage, homme gnreux et
hardi, on l'a vu plus tard, et lui dit simplement que ceci justifiait
l'opinion des ouvriers sur les catholiques : dans la question sociale, on
ne peut jamais compter sur eux jusqu'au bout.
Cependant la critique d'Herv est incomplte. Elle replace les sentiments des catholiques dans le contexte du catholicisme comme institution et de la diplomatie pontificale. Elle transporte la discussion du
plan des ides celui des faits. Mais, justement, pour cette raison, elle
ne saurait convaincre le P. Danilou. On le devine, lisant le texte si
dmonstratif d'Herv, et cependant incrdule. Comment sparerait-il
le catholicisme de ce qu'il pense lui-mme, de ce qu'il veut ? Pour luimme, le catholique est avanc ; pour les autres, il est ractionnaire.
Le R.P. Danilou se sent, en politique, libre, juste, audacieux, et il l'est
en effet. Mais nous ne le [307] voyons qu' travers le corps social qu'il
habite, comme nous ne voyons une conscience trangre qu' travers
ce corps physique, toujours le mme, ce pass fig, qui psent si peu
pour elle. Le P. Danilou conviendra que le pass lui donne tort. Mais
il ajoutera qu'il s'agit de rappeler constamment le christianisme luimme, d'y rveiller la faim et la soif de justice. Il plaidera coupable
pour le pass et innocent pour l'avenir. Il en appellera du dehors audedans, du catholicisme historique sa conscience, d'une histoire que
les catholiques d'aujourd'hui n'ont pas faite celle qu'ils veulent dsormais faire. Il aura toujours le droit de penser que, si la religion catholique a t ractionnaire, c'est par un malheureux hasard, et que
tout cela peut changer.
La question ne serait tranche que si l'on clairait les rapports de la
religion elle-mme avec l'esprit conservateur et l'esprit rvolutionnaire. H faut comprendre pourquoi dans l'histoire elle a pris ce visage,
pourquoi le chrtien n'est pas pour les autres ce qu'il est pour luimme. Finalement notre corps tmoigne de ce que nous sommes, le
corps et l'esprit s'expriment l'un l'autre, on ne peut les sparer. On ne
peut critiquer la conduite sociale du catholique sans toucher sa vie
intrieure. On ne peut se contenter de mettre en cause l'infrastructure
politique et sociale du catholicisme. Paralllement la critique des
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
202
infrastructures, il faut une critique qui saisisse le catholicisme dans sa
totalit et le dfinisse globalement comme une certaine prise de position l'gard du monde et des hommes, d'o rsultent la fois des
sentiments gnreux et une conduite conservatrice. l'quivoque du
catholicisme comme phnomne social [308] doit correspondre une
quivoque du catholicisme comme vie spirituelle.
*
*
Le catholicisme croit la fois en un Dieu intrieur et un Dieu extrieur, telle est la formule religieuse de ses contradictions.
Reviens en toi-mme, dit saint Augustin, c'est dans l'homme intrieur qu'habite la vrit. On dcouvre Dieu en se dtournant des
choses. Qu'il soit le modle d'aprs lequel mon esprit a t fait, ou
bien que, en prenant conscience de moi-mme comme esprit, j'aie
l'exprience de Dieu et, pour ainsi dire, je le touche, en tout cas, Dieu
est de mon ct, et non pas du ct du monde. Il est en moi plus
moi-mme que moi , intimior intimo meo, comme dit encore saint
Augustin. Il est absolument cette clart, cette lumire que je suis dans
mes meilleurs moments. Ce qui est vident pour moi ne saurait manquer de l'tre pour lui, puisque c'est justement sur mon exprience intrieure du vrai que je fonde l'affirmation d'une Vrit absolue et d'un
Esprit absolu qui la pense. la seule condition que j'aie tout fait pour
rendre claires mes ides, je servirai toujours Dieu en disant ce que je
pense, puisque Dieu est la vrit. Etre fidle, c'est tre sincre. La Foi
est bonne foi.
Obir Dieu, ce n'est donc pas m'incliner devant une volont
trangre et obscure, c'est faire ce que je veux vraiment, puisqu'il est
plus nous-mmes que nous. Confesser Dieu en paroles n'est rien : La
lettre tue et l'esprit vivifie. Seul a valeur le tmoignage qu'en [309]
nous l'esprit se rend lui-mme. On le trouve chez des hommes qui ne
connaissent pas Dieu sous son nom, mais qui le reconnaissent en esprit et en vrit. Quant aux autres, la force ne peut rien pour les sauver. La force peut imposer des gestes, mais non pas une conviction
intrieure. Nul ne peut tre contraint par la force d'embrasser la foi
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
203
catholique , dit le Droit Canon. La religion ne peut tre attaque ni
dfendue par les armes. Celui qui a frapp par l'pe prira par
l'pe. Elle est ici place dans une dimension d'ternit o elle est
invulnrable. Dieu n'est pas la manire d'une chose, qui a besoin de
temps et d'espace, il est partout et nulle part en particulier. Il n'est pas
moins quand les hommes se dtournent de lui. En ce sens, le pch est
irrel. Si j'agis contre ma conscience, je cesse d'tre esprit, je cesse
d'tre moi-mme, je ne fais rien de positif, le mal n'est que l'absence
du bien. Faire le bien, l'expression n'a plus grand sens, puisque le bien
rside dans l'esprit seul, et finalement en Dieu, qui est ternel. Il y a
toujours, dans l'ide de Dieu, une composante stocienne : si Dieu est,
la perfection est dj ralise en de du monde, elle ne saurait tre
accrue, il n'y a, la lettre, rien faire. Mon royaume n'est pas de ce
monde. Les uvres rsultent par surcrot de la religion. Elles n'augmentent pas la somme du Bien, comme une unit ajoute l'infini ne
l'augmente pas. Peu importe notre sort dans l'au-del puisque, de toute
manire, Dieu est adorable. Reposons-nous en lui. Quitisme. En tout
cas, notre sort ici-bas est indiffrent, nous n'avons qu' le prendre
comme il est, heureux ou malheureux. De toutes [310] faons, nous ne
sommes pas investis dans cette vie. Que votre volont soit faite.
L'homme se dpossde de sa vie. Comme l'enfant vit dans la volont
de ses parents, il vit dans la volont de Dieu. C'est le rgne du Pre,
dit Hegel.
L'Incarnation change tout. Aprs l'Incarnation, Dieu a t dans
l'extrieur. On l'a vu un certain moment, en un certain lieu, il a laiss
derrire lui des souvenirs, des paroles qui se transmettent. Dsormais
le chemin de l'homme Dieu n'est plus la rflexion, mais le commentaire et l'interprtation de ce message ambigu dont l'nergie n'est jamais puise. Le christianisme est en ce sens aux antipodes du spiritualisme . Il remet en question la distinction du corps et de l'esprit, de
l'intrieur et de l'extrieur. Le catholicisme n'aime pas les preuves rflexives de Dieu, il ne leur fait place qu' contrecur. On peut prouver
Dieu partir de l'esprit humain, mais en le prenant comme une partie
de la cration, au mme titre que la terre et les cieux qui racontent la
gloire de Dieu . L'me humaine peut marquer la place de Dieu
l'origine du monde, elle ne peut pas le voir ou le comprendre, elle ne
saurait donc se fixer en lui. Le monde cesse d'tre comme un dfaut
dans le grand diamant ternel. II ne s'agit plus de retrouver, en de du
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
204
monde, la transparence de Dieu, il s'agit d'entrer corps et me dans
une vie nigmatique dont les obscurits ne peuvent tre dissipes,
mais seulement concentres en quelques mystres, o l'homme
contemple l'image agrandie de sa propre condition. Les dogmes de
l'Incarnation, du Pch Originel ne sont pas [311] clairs, mais ils sont
valables, disait Pascal et dit Jacques Rivire, parce qu'ils refltent les
contradictions de l'homme, esprit et corps, noble et misrable. Les paraboles de l'Evangile ne sont pas une manire image de prsenter des
ides pures, mais le seul langage capable de porter les relations de la
vie religieuse, paradoxales comme celles du monde sensible. Les paroles et les gestes sacramentels ne sont pas les simples signes de quelque pense. Gomme les choses sensibles, ils portent eux-mmes leur
sens, insparable de la formule matrielle. Ils n'voquent pas l'ide de
Dieu, ils vhiculent la prsence et l'action de Dieu. Enfin l'me est si
peu sparante du corps qu'elle emportera dans l'ternit un double
rayonnant de son corps temporel.
Hegel dit que l'Incarnation est le gond de l'histoire universelle
et que toute l'histoire ensuite n'a fait qu'en dvelopper les consquences. Et en effet le Dieu-Homme et la Mort de Dieu transforment l'esprit et la religion. Gomme si le Dieu infini ne se suffisait plus, comme
si quelque chose bougeait en lui, comme si le monde et l'homme, au
heu d'tre une inutile dchance de la perfection originaire, devenaient
les moments ncessaires d'une perfection plus grande. Dieu ne peut
plus tre pleinement Dieu et la Cration ne peut s'achever que si
l'homme le reconnat librement et la lui rend dans la Foi. Il se passe
quelque chose, le monde n'est pas vain, il y a quelque chose faire. Or
l'homme ne saurait revenir Dieu s'il ne s'tait spar de lui. Heureuse faute qui a mrit d'avoir un tel Rdempteur. Le paradis perdu
n'est pas regretter. L'homme y vivait [312] comme l'animal sous la
loi naturelle de Dieu. C'est par le pch qu'il acquiert la science du
bien et du mal, qu'il devient conscience et qu'il devient homme. Omnia cooperantur in bonum, etiam peccata. Le pch est rel. Il sert la
gloire de Dieu. Il n'est plus question pour l'homme de se retirer du
monde la manire stocienne, ou de reconqurir la manire socratique la puret et la sincrit par l'exercice de l'intelligence. Sa relation
avec Dieu est ambigu, puisqu'elle ne va pas sans sparation. Kierkegaard pense qu'on ne peut dire je suis chrtien , comme on dit je
suis grand ou je suis petit, puisque tre chrtien, c'est vivre la contra-
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
205
diction du bien et du mal, c'est donc aussi n'tre pas chrtien. N'tant
jamais ni bon absolument, ni absolument mauvais, l'homme ne saurait
tre sincre, puisque la sincrit suppose une nature dfinie sur laquelle on puisse porter une apprciation sans ambigut. Il n'a pas se
contempler, mais se construire ou se dpasser. La foi est des
choses non vues. C'est une adhsion qui dpasse les garanties donnes ; elle exclut donc une sincrit de tous les moments. Le chrtien
ne doit pas renier dans les tnbres ce qu'il a vu dans la lumire . Il
ne rcusera pas son Dieu et son glise, mme s'il ne comprend pas
d'abord leurs dcrets ; il ne doutera pas des sacrements, mme s'il n'en
retire aucun bonheur.
Le paradoxe du christianisme et du catholicisme est qu'ils ne s'en
tiennent jamais soit au Dieu intrieur, soit au Dieu extrieur, et qu'ils
sont toujours entre l'un et l'autre. Il s'agit de se dpasser, il faut perdre sa vie , mais, en la perdant, on la sauve. La foi est confiance,
mais le chrtien sait qui il se confie : scio cui credidi. [313] Le catholicisme ne veut pas tout donner la Foi chrtienne. On n'est pas
catholique, aprs le Syllabus, si l'on doute que Dieu puisse tre prouv
par la raison, et les modernistes ont t condamns quand ils ont voulu
remplacer le Dieu des philosophes et des savants par le Dieu sensible
au cur. Le catholicisme rpugne une philosophie qui ne soit que le
dcalque de l'exprience chrtienne. La raison en est sans doute qu'
la limite cette philosophie serait une philosophie de l'homme plutt
qu'une thologie. Tu es vere Deus absconditus. De ce Dieu cach,
inaccessible la spculation, affirm dans l'obscurit de la Foi, on ne
saurait rien dire, et il apparatrait enfin comme un postulat de la vie
humaine plutt que comme le plus certain des tres. On ne conteste
pas, bien entendu, l'exprience chrtienne et la description qu'en donne Pascal : on la maintient seulement sur le terrain confus de l'existence, dont les essences, la philosophie spculative et le thomisme restent
juges. L'Incarnation n'est pas suivie dans toutes ses consquences. Les
premiers chrtiens, aprs la mort du Christ, se sont sentis dlaisss, ils
ont cherch partout ses traces. Bien des sicles plus tard, les Croiss
se jetteront la recherche d'un spulcre vide. C'est qu'ils adoraient le
Fils dans l'esprit de la religion du Pre. Pis n'avaient pas encore compris que Dieu tait avec eux pour toujours. La Pentecte signifie que
la religion du Pre et la religion du Fils doivent s'accomplir dans la
religion de l'Esprit, que Dieu n'est plus au Ciel, qu'il est dans la socit
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
206
et dans la communication des hommes, partout o des hommes s'assemblent en son nom. Le passage du [314] Christ sur la terre n'est que
le commencement de sa prsence dans le monde, elle se continue par
l'glise. Les chrtiens n'ont pas demeurer fixs sur un pisode historique, si dcisif qu'il ait t. Ils ont vivre le mariage de l'Esprit et de
l'histoire humaine qui a commenc avec l'Incarnation... Le catholicisme arrte et fige ce dveloppement de la religion : la Trinit n'est pas
un mouvement dialectique, les trois Personnes sont coternelles. Le
Pre n'est pas dpass par l'Esprit, la religion du Pre demeure dans la
religion de l'Esprit, la peur de Dieu, la Loi, n'est pas limine par
l'Amour. Dieu n'est pas tout entier avec nous. En arrire de l'Esprit
incarn demeure ce Regard infini devant lequel nous sommes sans
secret, mais aussi sans libert, sans dsir, sans avenir, rduits la
condition de choses visibles. De mme l'tat ne se fond pas dans la
socit des hommes, elle cristallise en marge de l'tat. L'Esprit est
partout, mais il s'incarne en elle d'une manire privilgie. Une seconde fois, les hommes sont alins par ce second regard qui pse sur
eux, et qui a plus d'une fois trouv un bras sculier son service.
Comment s'en tonner ? Il n'est pas seulement tentant, il est urgent de
contraindre les hommes, quand on sait qu'ils perdent leur temps
chercher, pendant que, dans l'envers des choses, une Science infinie a
dj dispos de tout. Ainsi l'amour se change en cruaut, ainsi sera
manque la rconciliation des hommes avec eux-mmes et avec le
monde, ainsi l'Incarnation tourne en souffrance parce qu'elle n'est pas
complte, et le christianisme devient une nouvelle forme de la conscience malheureuse.
[315]
L'ambigut politique du christianisme se comprend. Dans la ligne
de l'Incarnation, il peut tre rvolutionnaire. Mais la religion du Pre
est conservatrice. On peut dire aprs coup que le pch coopre au
bien, que la faute de l'homme est une faute heureuse. Mais on ne peut
le dire au moment de la dcision : ce moment le pch reste dfendu. Adam aurait donc mieux fait de ne pas pcher. La perfection est
derrire nous, non devant nous. Le chrtien a toujours le droit d'accepter le mal existant, et jamais celui d'acheter un progrs par un crime. Il
pourra se rallier une rvolution dj faite, il pourra en absoudre les
crimes, il ne la fera pas. Une rvolution, mme si elle use justement
du pouvoir, reste sditieuse tant qu'elle n'a pas russi. Le catholique,
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
207
comme catholique, n'a pas le sens de l'avenir : il doit attendre que cet
avenir soit pass pour s'y rallier. Heureusement la volont de Dieu
n'est pas toujours claire, et, comme dit Gofontaine dans lOtage, la
seule manire de la connatre est d'essayer d'aller contre elle. Heureusement encore, le catholique, comme citoyen, reste toujours libre
d'adhrer une rvolution. Mais il n'y mettra pas le meilleur de luimme, et, en tant que catholique, il y est indiffrent. Claudel et Jacques Rivire disaient justement que le chrtien gne les pouvoirs tablis, parce qu'il est toujours ailleurs et qu'ils ne sont pas srs de lui.
Mais pour la mme raison, il inquite les rvolutionnaires : ils ne le
sentent jamais tout fait avec eux. Il est un mauvais conservateur et
un rvolutionnaire peu sr. Dans un seul cas, l'glise elle-mme lui
prescrit l'insurrection : c'est le cas d'un pouvoir lgal qui viole [316] la
loi divine. Mais en fait on n'a jamais vu l'tat elle-mme prendre parti
contre un gouvernement lgal pour cette seule raison qu'il tait injuste,
ou prendre position en faveur d'une rvolution pour cette seule raison
qu'elle tait juste. Et, par contre, on l'a vu favoriser des rebelles parce
qu'ils protgeaient ses tabernacles, ses ministres et ses biens. Dieu ne
sera tout fait venu sur la terre que quand l'tat ne se sentira pas plus
de devoirs envers ses ministres qu'envers les autres hommes, envers
ses temples qu'envers les maisons de Guernica. Il y a une rvolte chrtienne, mais elle est localise, elle ne parat que quand l'tat est menace. Dans la mesure o elle rclame pour elle-mme l'audace et l'hrosme de ses fidles et o elle les fait vivre sur deux plans, l'tat est
conservatrice. C'est en somme ce que disait la thorie hglienne et
marxiste de l'alination. C'est ce que dit trs consciemment le christianisme lui-mme : On ne peut pas servir deux matres , on n'aime
pas bien ce qu'on n'aime pas plus que tout. Mais comme en mme
temps les chrtiens croient l'Incarnation, comme elle doit animer
toute leur vie, ils peuvent, au moins pour un temps, venir aussi prs
qu'on voudra des rvolutionnaires, comme on l'a vu par l'exemple de
Bergamin et de plusieurs autres. Ils ont alors, n'en pas douter, cette
sincrit seconde qui consiste dire ce qu'on pense. On ne voit pas
comment ils pourraient avoir cette sincrit premire qui consiste
chasser de soi l'quivoque.
*
* *
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
208
[317]
Allons-nous donc reprendre le mot de Gide : La foi tout court
dispense de la bonne ? Gide lui-mme a dit ce qu'il fallait pour
commenter ce mot : Le bonheur de l'homme n'est pas dans la libert,
mais dans l'acceptation d'un devoir 117. Or, si l'on met la sincrit
avant tout, on ne pourra s'engager nulle part, ni dans une tat, ni dans
un parti, ni dans un amour ou dans une amiti, ni mme dans une tche quelconque. Car l'engagement suppose toujours que l'on affirme
au-del de ce que l'on sait, que l'on croie par ou-dire, que l'on quitte
la rgle de sincrit pour la rgle de responsabilit. L'intellectuel qui
rcuse les siennes sous prtexte que sa fonction est de tout dire se mnage en fait une vie agrable, sous couleur d'obir une vocation. Son
parti est d'tre sans parti et de fournir de bonnes raisons les tides. Qui
n'est pas avec moi est contre moi. L'extra-communisme est anticommunisme. La sincrit mme est menteuse et se tourne en propagande. Ds qu'on fait quelque chose, on se tourne vers le monde, on
cesse de s'interroger, on se dpasse dans ce qu'on fait. La foi, dans
le sens d'une adhsion sans rserves qui n'est jamais motive absolument, intervient ds que nous quittons le domaine des pures ides
gomtriques et que nous avons affaire au monde existant. Chacune
de nos perceptions est foi, en ce sens qu'elle affirme plus que nous ne
savons la rigueur, l'objet tant inpuisable et nos connaissances limites. Descartes disait mme qu'il faut un mouvement de volont pour
croire que [318] deux et deux font quatre. Gomment reprocher au catholique de vivre dans l'quivoque si tout le monde y vit et si la mauvaise foi est l'essence mme de la conscience ?
En ralit, il n'y a pas de dilemme : foi ou bonne foi. Il ne saurait
tre question de sacrifier la bonne foi la foi. Un tel sacrifice n'est
demand que par une foi morte ou sectaire. Hors de toute sincrit, la
foi devient obissance nue ou folie. Pas de mannequins dans le parti ! Que les bouches s'ouvrent ! disait un jour Thorez 118. Les nophytes trop dociles sont les rengats de demain. La sincrit ne suffit
pas dans un tre comme l'homme, qui est chaque instant jet hors de
lui-mme par la connaissance comme par l'action, et qui ne saurait
donc chaque instant fournir de ses motifs une comptabilit exacte.
117
118
Prface Vol de nuit.
ARAGON, Maurice Thorez et la France. Labyrinthe, 15 dcembre 1945.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
209
Quand on est sincre, on n'y pense pas, on n'en fait pas talage. Se
dire sincre implique dj un ddoublement, une rflexion qui vicie la
sincrit dont on se targue et en fait une attitude (...). Faire de la sincrit une valeur est prcisment le propre d'une socit non sincre, qui
se replie sur elle-mme au lieu d'agir sur le monde. 119 La sincrit
n'est pas un but. Mais, exactement pour la mme raison, l'insincrit
ne doit jamais tre un systme, une rgle ou une habitude. L'adhsion,
si elle dpasse les raisons, ne doit jamais tre contre toute raison. La
valeur de l'homme n'est ni [319] dans une sincrit explosive et maniaque, ni dans une foi sans discussion, mais dans la conscience suprieure qui lui permet d'apprcier le moment o il est raisonnable de
faire confiance et le moment o il faut questionner, de joindre en
lui-mme foi et bonne foi, assumant son parti ou son groupe tels qu'ils
sont, les yeux ouverts.
Lnine sous-entendait quelque chose de ce genre avec la formule
du centralisme dmocratique . Il faut qu'il y ait discussion dans le
parti, et cependant il faut qu'il y ait discipline. Il faut que les dcisions
expriment la volont des militants et il faut que les militants se tiennent pour engags par les dcisions du parti, mme si elles sont
contraires leurs vues personnelles. La rvolution est la fois une
ralit qui se prpare dans le cours spontan des choses, et une ide
qui s'labore dans l'esprit des individus les plus conscients. Si, aprs
avoir dfendu devant le parti ce qu'il croit tre vrai, le communiste
n'est pas suivi, c'est que les solutions qu'il propose sont prmatures
ou historiquement fausses, puisque le parti et les masses, qui sont la
rvolution en acte, n'y reconnaissent pas leur vu. Nul asctisme ou
nul fidisme ici, nul parti pris contre l'individu, mais plutt cette ide
que l'action politique n'est pas seulement un exercice de l'intelligence
et suppose un contact effectif avec l'histoire en train de se faire, que
l'adhsion au parti n'est pas un assentiment de l'intelligence seule,
mais l'engagement dans l'histoire effective, contrepoids et rgulateur
de la thorie. Lnine sait parfaitement qu'il y a quelquefois tension
entre l'individu et [320] le parti, entre le jugement et la fidlit. Il pense que ce conflit, qu'il est impossible et qu'il serait malsain d'ignorer,
est dpass par la vie de l'individu dans le parti qui est son parti. Si
l'individu fait crdit au parti contre son opinion propre, c'est parce que
119
P. HERV. La libration trahie, p. 96.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
210
le parti a donn des preuves de sa valeur, parce qu'il est porteur d'une
mission historique, parce qu'il reprsente le proltariat. L'adhsion
n'est jamais sans motifs. Ce qui diffrencie de toute autre la notion
marxiste du parti, ce qui en fait un phnomne culturel neuf et explique sa place dans la littrature et dans la pense modernes, c'est justement cette conception d'un change et d'une communication vitale
entre le jugement individuel et la ralit de l'histoire par l'intermdiaire du parti.
Dans toute formation politique, il y a ncessairement une part de
confiance accorde des dirigeants, voire mme si l'on ne veut pas
l'avouer une part d'orthodoxie. Cette orthodoxie est sans doute relative, raisonne, soumise examen permanent. N'empche qu'il n'est
pas au moyen de n'importe quel citoyen de tout analyser, de tout dcortiquer, de tout juger par soi-mme dans la complexit de la politique mondiale (...) Il faut donc accorder sa confiance sur des faits que
l'on est mme de juger par un examen direct et personnel, et pour le
reste se rallier, ce qui ne signifie nullement se rallier les yeux ferms
et n'exclut pas l'effort de comprhension. Avouons-le, il s'agit ici d'un
parti pris, mais d'un parti pris qui est beaucoup plus prs de l'esprit de
libre examen et de l'honnte objectivit que ne l'est la fausse objectivit des intellectuels hors la loi [321] commune (...) 120 Encore une
fois, il s'agit donc d'un change entre le jugement propre et les dcisions du parti, d'un va-et-vient, d'une vie avec le parti, et non pas d'une
obissance passive. Un parti pris qui n'exclut pas l'examen, une subjectivit qui est objectivit, une confiance qui est vigilance, une foi
qui est bonne foi, une libert qui est engagement, voil Herv en train
de dcrire cette communication des contraires qu'un auteur distrait
mettait dernirement au compte d' une philosophie ractionnaire . Il
faut croire qu'entre ces contraires l'quilibre n'est pas facile tenir,
puisque dans les critiques communistes de l'existentialisme, nombreuses ces derniers temps, on remarquait assurment plus d'ardeur
que de lumires et plus de foi que de bonne foi.
[322]
120
P. HERV. La libration trahie, pp. 32-35.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
211
[323]
SENS ET NON-SENS
III. POLITIQUES
Le hros, lhomme
Retour la table des matires
Il y a, au moins dans la vie littraire, plusieurs signes d'un retour
la paix. Dj le hros s'loigne et, contre les morales hroques ,
s'lvent des protestations qui sont aujourd'hui discrtes, qui demain
seront publiques. Un homme de lettres, combattant de l'autre guerre et
silencieux depuis celle-ci, crit un ami :
Dj scandalis d'entendre Gide fredonner dans les Entretiens
imaginaires, sur musique d'Offenbach, il nous faut des hros, n'en
ft-il plus au monde , je prfrerais quant moi un grain de sagesse,
d'intelligence et de raison. Je me mfie des hros comme Mme Cardinal des femmes, l'ayant t moi-mme, avec ncessit ou sans, dans
mon jeune temps .
Un catholique comme Gabriel Marcel, ayant juger un roman ou
une pice conclusion hroque, sous-entend qu'il y a hrosme et hrosme, et veut bien qu'on dpasse la nature, mais dans les rgles et
par [324] certaines voies seulement. Des crivains artistes revendiquent pour la littrature un domaine spar, l'abri de la politique et
de l'histoire.
Ce genre de dbats est gnant. Comment faire l'loge de l'hrosme
si l'on est un hros ? Et comment le faire si l'on n'en est pas un ? Il
vaudrait mieux savoir au juste ce qu'il y a derrire ce grand mot.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
212
Le culte des hros est de toujours. Mais, tant qu'une civilisation
croit, au-del de ce monde-ci, un autre monde ternel o le bien
l'emporte sur le mal, le grand homme n'est pas seul, il est le ministre
d'une Providence. Le culte du hros ne prend son accent tragique
qu'avec la fin des croyances transcendantes, en tout cas avec l'ide
d'un monde en mouvement. On voit chez Hegel le passage. Pour lui
les individus de l'histoire mondiale sont ceux qui, ns comme tout
le monde une certaine date, sous certaines lois, dans certaines
murs, sont les premiers comprendre que ce systme est sans avenir, et, renonant au bonheur, crent par leur action et leur exemple un
droit et une morale dans lesquels leur temps reconnatra ensuite sa vrit. Ils sont d'abord seuls, puisqu'ils sont contre les coutumes ; ils ont
le pressentiment, mais naturellement ils n'ont pas la science de l'avenir ; ils le sentent dans leurs gots, dans leurs passions et dans leur
tre plutt qu'ils ne le voient clairement devant eux. Ce qu'il y a d'hroque en eux, c'est que, sans preuve absolue et dans la solitude de la
subjectivit, ils accomplissent et conquirent pour les autres ce qui
apparatra ensuite comme le seul avenir possible et le sens mme de
l'histoire ; c'est la jonction [325] inespre de la draison et de la raison. On doit les nommer des hros en tant qu'ils ont puis leurs fins
et leur vocation non seulement dans le cours des vnements tranquille, ordonn, consacr par le systme en vigueur, mais une source
dont le contenu est cach et n'est pas encore parvenu l'existence actuelle, dans l'esprit intrieur, encore souterrain, qui frappe contre le
monde extrieur comme un noyau et le brise parce qu'il n'est pas
l'amande qui convient ce noyau... C'taient des gens qui pensaient et
savaient ce qui est ncessaire et dont le moment est venu, savoir la
vrit de leur temps et de leur monde, pour ainsi dire la race nouvelle
qui existait dj intrieurement... C'est pourquoi les hros d'une poque doivent tre reconnus comme les sages.
Si l'on cesse de croire, non seulement un matre bienfaisant de ce
monde, mais encore un cours raisonnable des choses, alors l'action
du hros est sans aucun appui extrieur : elle ne s'appuie pas sur une
loi divine, ni mme sur un sens visible de l'histoire. Cet hrosme sans
rgle ni contenu, c'est celui du matre nietzschen. Si le hros hglien sacrifiait son propre bonheur et mettait d'abord le chaos dans sa
vie, c'tait pour en sauver l'histoire, et s'il mettait en question l'ordre
tabli, c'tait pour en faire natre un autre. Le matre nietzschen est
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
213
par-del toute chose faite ou faire, il ne veut que la matrise mme,
et puisqu'il refuse de la consacrer aucune tche particulire, elle ne
peut s'affirmer que contre quelque chose ou quelqu'un. La matrise
pure ne peut consister qu' vaincre les autres [326] matres, et le plus
puissant de tous, la mort. Hegel avait dj dcrit cette entreprise et
cette impasse : car toute puissance surmonte, du fait mme qu'elle est
surmonte, cesse d'avoir du prix ; la mort que le hros a traverse, ce
n'tait pas vraiment la mort, puisqu'elle ne l'a pas pris ; les autres qu'il
a rduits l'esclavage ne sont pas des tmoins suffisants de sa puissance, puisqu'il a pu les vaincre. moins qu'il ne vieillisse et ne se
fasse hros honoraire, il cherchera donc toujours d'autres dangers
courir, d'autres hommes soumettre, sr d'avance de n'en pas obtenir
ce qu'il attend, parce qu'il attend l'impossible : une vie qui assume
vraiment la mort et qui s'assure titre dfinitif la libre reconnaissance
d'autrui. Pour Hegel le vrai hros n'tait pas le matre, c'tait l'esclave
qui a prfr la vie, qui travaille et transforme le monde de telle manire qu'enfin il n'y a plus de place pour le matre.
Le hros des contemporains n'est ni celui de Hegel, ni celui de
Nietzsche. Il n'est pas, comme disait Hegel, l'homme d'affaires du
gnie de l'Univers . Il ne croit pas un gnie de l'Univers qui prpare
toutes choses pour son succs et lui indique clairement sa voie. Dans
Pour qui sonne le glas ? Robert Jordan, au moment de risquer sa vie,
se demande honntement s'il le fait pour la socit matrialiste venir.
Une moiti de lui-mme dit alors : Depuis quand as-tu une telle
conception ?... Tu ne l'as jamais eue. Et tu n'as jamais pu l'avoir. Tu
n'es pas un vrai marxiste et tu le sais. Tu crois la Libert, l'galit
et la Fraternit. Tu crois la vie, la libert et la poursuite du
bonheur. Ne te bourre pas le crne avec des excs de dialectique.
[327] C'est bon pour les autres, pas pour toi 121. Il ne s'agit pas, au
moment du risque, de chercher des excuses et des prtextes. La mission est accepte et sera accomplie. Il ne s'agit que des motifs. Or,
quoi qu'il fasse, Robert Jordan ne parvient pas poser la socit future
comme seul motif de son sacrifice. Il ne la veut que comme la garantie
probable, pour lui-mme et pour les autres, de cette libert qu'il exerce
l'instant mme.
121
Pour qui sonne le glas ? p. 199.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
214
Un marxiste comme Kyo, dans La Condition humaine, rencontrait
la question au cur mme du marxisme. Il y a, disait-il, dans le marxisme, la fois une volont et une fatalit : quand donc faut-il suivre
le cours des choses et quand faut-il les forcer ? s'en tenir aux faits,
les communistes chinois sont probablement condamns et c'est le
Kuo-Min-Tang qui va l'emporter. Mais les faits ne sont acquis que
lorsque nous avons renonc les changer : n'est-ce pas le moment
d'apporter aux communistes une aide dcisive et de forcer la main
l'histoire ? Aucune philosophie de l'histoire ne supprime cette hsitation. Car la vie, n'est-ce pas, dans son essence, dans ce qu'elle a de
foncirement angoissant, peut tre dfinie comme la libert de choisir ? Mais le communiste ne renonce, dans une certaine mesure, la
libert du choix, ne se soumet une discipline que parce que celle-ci
est ncessaire l'efficacit de l'action... 122.
Dans une autre conception du monde, le hros de Pilote de Guerre
se pose les mmes questions. La bourgeoisie, [328] dans les gnrations qui nous ont prcds, avait ses absolus : il tait entendu qu'on
excute les ordres, qu'on meurt pour sa patrie. Mais c'est peut-tre que
jamais elle ne s'tait trouve en face du chaos. Quel sens y a-t-il, en
juin 40, excuter une mission sur Arras l'heure o nous ne pouvons
plus rien contre les chars allemands qui s'y rassemblent et o le renseignement ne peut plus mme tre transmis ? Il est plus facile de servir dans une arme forte, dans un moment o l'histoire va clairement
vers une fin. Mais comment l'homme ne penserait-il pas soi et sa
mort quand le monde mme devant lui se disloque et titube ? Comment servir si le service est inutile ?
La devise du hros contemporain n'est cependant pas celle de Barrs ou celle de Montherlant : il ne sert pas pour se faire de la musique , ni pour prouver sa matrise devant la mort, en service inutile . Saint-Exupry se jette dans sa mission parce qu'elle est luimme, la suite de ce qu'il a pens, voulu et dcid, parce qu'il ne serait
plus rien s'il se drobait. mesure qu'il entre dans le danger, il reconquiert son tre. Au-dessus d'Arras, dans le feu de la D.C.A., quand
chaque seconde de survie est aussi miraculeuse qu'une naissance, il se
sent invulnrable parce qu'il est enfin dans les choses, qu'il a quitt
son nant intrieur, et que, s'il meurt, ce sera en plein monde.
122
Roger VAILLAND, Drle de Jeu, p. 163.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
215
Mais peut-tre ne sera-t-il que bless, peut-tre lui faudra-t-il agoniser de longues heures, terre ? Le mme cruel secours lui serait encore offert : tant qu'il vivra, tre et penser comme un vivant, rester
tendu vers les [329] fins qu'il a choisies. Robert Jordan, bless l'intrieur des lignes fascistes, alors qu'il vient d'y faire sauter un pont, doit
se sparer de ses camarades et mme de Maria qu'il aime. Non, guapa, ne pleure pas, dit-il. Ecoute, nous n'irons pas Madrid maintenant,
mais j'irai avec toi partout o tu iras. Tu comprends ?... Tu t'en vas
maintenant, chevreau, mais je reste avec toi. Aussi longtemps qu'il y
aura l'un de nous, il y aura nous deux. Tu comprends ?... Ce que je fais
maintenant, je le fais seul. Je ne pourrais pas le faire bien avec toi. Tu
ne vois pas que c'est comme a ? Quel que soit celui qui reste, il est
les deux. Et, une fois seul : a ne sert rien de penser Maria.
Essaye de croire ce que tu lui as dit. C'est le mieux. Et qui dit que ce
n'est pas vrai ? Pas toi. 123 Pour l'homme encore vivant, il n'y a pas
d'autre ressource mais celle-l souveraine que de garder sa
conduite d'homme vivant. On meurt seul, mais on vit avec les autres,
nous sommes l'image qu'ils se font de nous, l o ils sont nous sommes aussi. Encore une fois et jusqu' la fin, Robert Jordan laisse faire
ce mouvement qui le lie eux, qui le lie aux choses, et qui est au-del
du jugement, puisqu'il tait la condition de tout malheur comme de
tout bonheur. Rest seul, il ne se tuera pas. Si tu attends et les retiens
mme un petit moment, ou si tu descends l'officier, a peut tout changer, une chose bien faite peut... 124. Ce qui permet au hros de se
sacrifier, [330] ce n'est pas, comme chez Nietzsche, la fascination de
la mort, ni, comme chez Hegel, la certitude d'accomplir ce que l'histoire veut, c'est la fidlit au mouvement naturel qui nous jette vers les
choses et les autres. Ce que j'aime, disait Saint-Exupry, ce n'est pas la
mort, c'est la vie.
Le hros des contemporains n'est pas un sceptique, un dilettante, ni
un dcadent. Simplement, il a l'exprience du hasard, du dsordre et
de l'chec, de 36, de la Guerre d'Espagne, de juin 40. Il est dans un
temps o les devoirs et les tches sont obscurs. Il prouve mieux qu'on
ne l'a jamais fait la contingence de l'avenir et la libert de l'homme.
Tout bien considr, rien n'est sr : ni la victoire, encore si lointaine,
123
124
Pour qui sonne le glas ? pp. 300-302.
Pour qui sonne le glas ? p. 305.
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens. (1966)
216
ni les autres, qui ont souvent trahi. Jamais les hommes n'ont mieux
vrifi que le cours des choses est sinueux, qu'il est beaucoup demand l'audace, qu'ils sont seuls au monde et seuls l'un devant l'autre.
Mais quelquefois, dans l'amour, dans l'action, ils s'accordent entre eux
et les vnements rpondent leur volont. Quelquefois, il y a cet
embrasement, cet clair, ce moment de victoire, ou, comme dit la Maria de Hemingway, cette gloria qui efface tout.
Hors les temps de la foi, o l'homme croit trouver dans les choses
le dessin d'une destine toute faite, qui peut viter ces questions et qui
peut donner une autre rponse ? Ou plutt : la foi, dpouille de ses
illusions, n'est-elle pas cela mme, ce mouvement par lequel, nous
joignant aux autres et joignant notre prsent notre pass, nous faisons en sorte que tout ait un sens, [331] nous achevons en une parole
prcise le discours confus du monde ? Les saints du christianisme, les
hros des rvolutions passes n'ont jamais fait autre chose. Simplement ils essayaient de croire que leur combat tait dj gagn dans le
ciel ou dans l'Histoire. Les hommes d'aujourd'hui n'ont pas cette ressource. Le hros des contemporains, ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas
mme Promthe, c'est l'homme.
Fin du texte
Vous aimerez peut-être aussi
- Jean-Luc Nancy, La Communaute DesoeuvreeDocument274 pagesJean-Luc Nancy, La Communaute DesoeuvreeWalterBenjamin88% (8)
- Idees Directrices Pour Une PhenomenologieDocument602 pagesIdees Directrices Pour Une PhenomenologieLaura Hunter96% (24)
- Aventures de La DialectiqueDocument236 pagesAventures de La DialectiquefilosofiacontemporaPas encore d'évaluation
- La Prose Du Monde PDFDocument159 pagesLa Prose Du Monde PDFElaine Cristina Borges100% (3)
- Eloge de La Philosophie - Merleau PontyDocument54 pagesEloge de La Philosophie - Merleau PontyCiceroFilosofia100% (7)
- Derrida, Jacques. La Voix Et Le PhénomèneDocument126 pagesDerrida, Jacques. La Voix Et Le Phénomènejose gaviria100% (12)
- Richir Le Rien Et Son ApparenceDocument194 pagesRichir Le Rien Et Son ApparenceMihaiPas encore d'évaluation
- Baudelaire Sartre Folio Essais English and French Edition PDFDocument97 pagesBaudelaire Sartre Folio Essais English and French Edition PDFHoria AkirohPas encore d'évaluation
- Dictionnaire HeideggerDocument189 pagesDictionnaire HeideggerShih-hong Chuang100% (8)
- Althusser et Spinoza : Détours et retours: Avec trois textes inédits de Louis Althusser sur SpinozaD'EverandAlthusser et Spinoza : Détours et retours: Avec trois textes inédits de Louis Althusser sur SpinozaPas encore d'évaluation
- Derrida, J. L Origine de Geometrie.Document222 pagesDerrida, J. L Origine de Geometrie.Nadine FaurePas encore d'évaluation
- Aspect de La Phenomologie Non SymboliqueDocument9 pagesAspect de La Phenomologie Non SymboliqueJoelle MesnilPas encore d'évaluation
- HUSSERL - La Philosophie Comme Science Rigoureuse PDFDocument96 pagesHUSSERL - La Philosophie Comme Science Rigoureuse PDFRes200180% (5)
- Humanisme Et TerreurDocument168 pagesHumanisme Et Terreurdavid balibal100% (1)
- HyppoliteasdDocument254 pagesHyppoliteasdAli Özdemir100% (1)
- Paul Ricoeur-La Métaphore Vive-Seuil (1975)Document415 pagesPaul Ricoeur-La Métaphore Vive-Seuil (1975)Pablo Pachilla95% (19)
- Le Vocabulaire de Merleau-PontyDocument64 pagesLe Vocabulaire de Merleau-Pontyegonschiele9100% (4)
- Merleau Ponty SignesDocument343 pagesMerleau Ponty SignesPawel Gajdek100% (6)
- Aventures de La DialectiqueDocument237 pagesAventures de La DialectiqueCaptain TrroiePas encore d'évaluation
- Prose Du MondeDocument159 pagesProse Du Mondekantikors100% (1)
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Éthique de Spinoza: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÉthique de Spinoza: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Bachelard, Gaston - La Dialectique de La DuréeDocument146 pagesBachelard, Gaston - La Dialectique de La DuréeDamaskiosPas encore d'évaluation
- Alain Flajoliet La Premiere Philosophie de SartreDocument963 pagesAlain Flajoliet La Premiere Philosophie de Sartrenpite486Pas encore d'évaluation
- Laurent Bove La Strategie Du ConatusDocument169 pagesLaurent Bove La Strategie Du Conatusgdupres66100% (1)
- Jean Beaufret de Lexistentialisme A Heidegger Introduction Aux Philosophies de Lexistence Et Autres Textes Problemes Et Controverses 1986Document178 pagesJean Beaufret de Lexistentialisme A Heidegger Introduction Aux Philosophies de Lexistence Et Autres Textes Problemes Et Controverses 1986Luiza HilgertPas encore d'évaluation
- Essais SchellingDocument566 pagesEssais SchellingLouisPas encore d'évaluation
- La Mathesis Universalis Est Elle L'ontologie Formelle ? (Vincent Gerard)Document38 pagesLa Mathesis Universalis Est Elle L'ontologie Formelle ? (Vincent Gerard)mathesisuniversalisPas encore d'évaluation
- Henri Bergson - Leçons D'esthétique - Leçons de Morale, Psychologie Et Métaphysique - Cours II (1992, Presses Universitaires France)Document493 pagesHenri Bergson - Leçons D'esthétique - Leçons de Morale, Psychologie Et Métaphysique - Cours II (1992, Presses Universitaires France)mes arte100% (1)
- Henri Bergson - Cours Sur La Philosophie Grecque - Cours IV (1998, Presses Universitaires de France)Document284 pagesHenri Bergson - Cours Sur La Philosophie Grecque - Cours IV (1998, Presses Universitaires de France)mes artePas encore d'évaluation
- Marseille Poesie Philo 97Document290 pagesMarseille Poesie Philo 97paragesPas encore d'évaluation
- BARBARAS, R. Sartre - Désir Et LibertéDocument190 pagesBARBARAS, R. Sartre - Désir Et LibertéGiovana Temple100% (2)
- Bachelard. Le Matérialisme Rationnel PDFDocument264 pagesBachelard. Le Matérialisme Rationnel PDFPedro Sosa100% (1)
- Le Problème Moral Dans La (... ) Delbos VictorDocument604 pagesLe Problème Moral Dans La (... ) Delbos VictorFabianaPas encore d'évaluation
- Levinas - Autrement Qu'être Ou Au-Delà L'essenceDocument286 pagesLevinas - Autrement Qu'être Ou Au-Delà L'essencenorega000100% (10)
- DUFRENNE, Mikel - La Notion D'apriori PDFDocument148 pagesDUFRENNE, Mikel - La Notion D'apriori PDFRafaelBastosFerreiraPas encore d'évaluation
- (1982) Tilliette (Ed) L'heritage de Kant PDFDocument254 pages(1982) Tilliette (Ed) L'heritage de Kant PDFLeonardo Ernesto Torres Huechucoy100% (3)
- Phonomenologie de La PerceptionDocument545 pagesPhonomenologie de La Perceptiondavid balibal100% (1)
- AsdfDocument278 pagesAsdfMPas encore d'évaluation
- Jean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Document11 pagesJean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Calac100% (1)
- MACHEREY, Pierre. Introduction A L'ethique de Spinoza 5 - Cinquieme Partie - Les Voies de La LiberationDocument231 pagesMACHEREY, Pierre. Introduction A L'ethique de Spinoza 5 - Cinquieme Partie - Les Voies de La LiberationraveneyesdeadPas encore d'évaluation
- Peter Coulmas, Les Citoyens Du MondeDocument165 pagesPeter Coulmas, Les Citoyens Du MondebentospinozaPas encore d'évaluation
- Méditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandLe Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Être et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÊtre et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandTractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- L'Espoir d'André Malraux (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandL'Espoir d'André Malraux (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Spinoza Lecteur de MarxDocument115 pagesSpinoza Lecteur de MarxddufourtPas encore d'évaluation
- Eloge de La PhilosophieDocument51 pagesEloge de La Philosophiebernierjeremie89Pas encore d'évaluation
- Age Des Foules PDFDocument506 pagesAge Des Foules PDFThiago Fernandes de Amorim100% (2)
- Georges Gusdorf Pensee Occidentale PDFDocument607 pagesGeorges Gusdorf Pensee Occidentale PDFfoucault1100% (1)
- GUSDORF - Georges - Naissance de La Conscience Romantique Au Siecle Des LumieresDocument578 pagesGUSDORF - Georges - Naissance de La Conscience Romantique Au Siecle Des LumieresmlstaffaPas encore d'évaluation
- Esprit Du Socialisme PDFDocument250 pagesEsprit Du Socialisme PDFKenny THELUSMAPas encore d'évaluation
- Panorama Doctrines PhiloDocument174 pagesPanorama Doctrines PhiloLucas MeloPas encore d'évaluation
- Encyclopédie de La MusiqueDocument733 pagesEncyclopédie de La MusiqueDimitris CosmidisPas encore d'évaluation
- Encyclop Died El 09 LaviDocument608 pagesEncyclop Died El 09 LaviDimitris CosmidisPas encore d'évaluation
- J-P DupuyDocument2 pagesJ-P DupuyDimitris CosmidisPas encore d'évaluation
- LA PAROLE PLURIELLE DE MAURICE BLANCHOT Idoia Quintana DomínguezDocument10 pagesLA PAROLE PLURIELLE DE MAURICE BLANCHOT Idoia Quintana DomínguezDimitris CosmidisPas encore d'évaluation